
Pierre Alexis Ponson du Terrail
ROCAMBOLE
LE CLUB
DES VALETS-DE-CŒUR
TOME I
La Patrie – 30 janvier au 5 juin 1858 – 105 épisodes
E. Dentu Les Drames de Paris (3 volumes) 1866
Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » – http://www.ebooksgratuits.com/
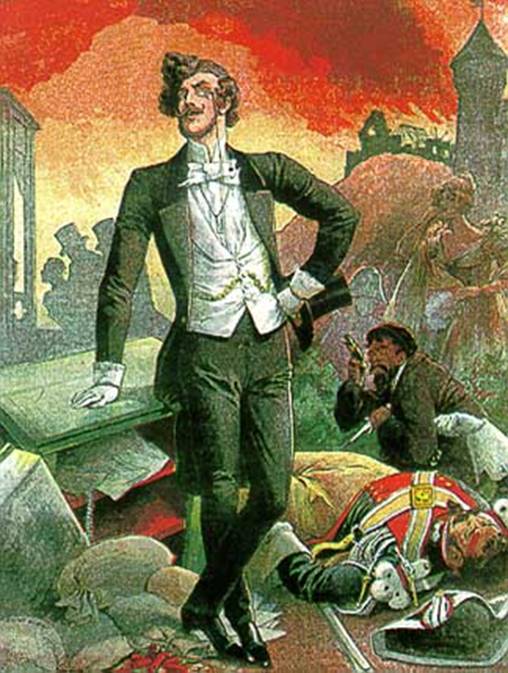
Table des matières
À propos de cette édition électronique
I
Un soir, vers quatre heures, une chaise de poste roulait au grand trot sur une route du Nivernais.
C’était pendant l’automne de l’année 184., c’est-à-dire vers la fin du mois d’octobre. À cette saison, rien n’est splendidement beau comme le centre de la France, et surtout cette partie du Nivernais qui touche au département de l’Yonne et fait partie de l’arrondissement de Clamecy.
Les pâturages passent alors du vert sombre de l’été au vert plus tendre et presque jaune qui annonce les gelées prochaines. Les bois commencent à se dépouiller, et ces grands peupliers mélancoliques qui bordent le canal et la rivière d’Yonne s’inclinent au souffle des premières bises.
Cependant l’air est tiède encore, et le ciel sans nuages ; à peine, au matin, une brume diaphane couvre-t-elle les prés et les marécages pour s’évanouir au lever du soleil ; tandis que, vers le soir, elle redescend lentement du sommet des collines et s’allonge dans les vallées transparentes et dorées par les derniers rayons du couchant.
La chaise de poste dont nous parlons, traversait en ce moment un des sites les plus pittoresques et les plus sauvages de ce beau pays, – une vallée au fond de laquelle couraient en méandres infinis et côte à côte : la rivière, – œuvre de Dieu, – le canal, – œuvre des hommes.
La vallée était encaissée par deux chaînes de collines couvertes de bois, ces bois immenses qui touchent au Morvan ! Çà et là, du milieu des roches moussues et des arbres verts dont l’eau baignait les dernières racines, on voyait surgir un clocher rustique, une église toiturée en ardoises, un village où le chaume dominait la tuile ; parfois une de ces belles ruines féodales respectées par hasard en 1793, et dont l’âpre bande noire ignore encore l’existence. La grande route allongeait son ruban bleuâtre au bord du canal, côtoyant les maisonnettes des éclusiers et passant au bas des villages, presque tous étagés à mi-côte au milieu d’un fouillis de chênes et de vignes, avec une verte ceinture de prés.
Dans la chaise de poste dont la capote était renversée en arrière, un homme et une femme tenaient au milieu d’eux un bel enfant de quatre ans, aux cheveux blonds, à l’œil bleu, qui babillait sans relâche, questionnait son père et sa mère, et s’extasiait sur le bruit des grelots résonnant au collier des quatre vigoureux percherons qui emportaient l’aristocratique attelage. Le père de l’enfant était un homme jeune encore, pouvant avoir trente-sept ou trente-huit ans, grand, brun, les cheveux noirs et les yeux bleus.
Sa figure, un peu sévère, était encore d’une grande beauté, beauté qui devenait presque juvénile, lorsque le bel enfant attachait sur lui ce regard profond et charmant, plein de curiosité naïve et de respectueuse admiration, qui n’appartient qu’à la première jeunesse.
La mère avait vingt-cinq ans peut-être ; elle était blonde, un peu pâle, avec un sourire où le bonheur se révélait par la mélancolie. Elle ressemblait à l’enfant comme la rose épanouie ressemble au bouton naissant.
L’enfant était assis entre eux ; chacun le tenait d’une main ; chacun passait une autre main derrière lui.
Et ces deux mains s’enlaçaient en une affectueuse étreinte.
Ce gage de leur amour semblait avoir prolongé cette lune de miel, si courte d’ordinaire, et qui pour eux paraissait ne devoir point finir.
Or, cet homme et cette femme, dont l’élégant négligé de voyage, les deux laquais assis derrière la chaise et la façon aristocratique de courir la poste trahissaient la haute position sociale, n’étaient autres que le comte et la comtesse de Kergaz revenant d’Italie et se rendant dans leur belle terre de Magny-sur-Yonne, où ils comptaient passer l’arrière-saison, pour ne rentrer à Paris que vers la mi-décembre.
M. le comte Armand de Kergaz avait quitté Paris huit jours après son mariage avec mademoiselle de Balder.
Les enchantements de ce premier amour s’étaient déroulés pour eux au bord de la mer Sicilienne, sous les ombrages d’une villa louée par le comte à Palerme.
Ils y avaient vécu six mois, tout un hiver, la saison du froid noir et du verglas en France, celle des chauds rayons et des brises printanières là-bas.
Puis ils étaient revenus à Paris habiter cet hôtel si vaste et un peu froid de la rue Culture-Sainte-Catherine.
Mais là, le changement d’air et peut-être quelques amers souvenirs avaient agi d’une façon fâcheuse sur la santé de madame de Kergaz.
La frêle jeune femme était tombée malade, assez gravement pour inquiéter ses médecins, qui lui avaient ordonné de retourner en Sicile.
Armand de Kergaz était donc parti, ramenant la jeune mère, car Jeanne était grosse de sept ou huit mois alors, sur cette terre de Sicile où le soleil est si doux pour ceux qui souffrent.
L’influence du climat béni n’avait point tardé à se faire sentir.
Jeanne était promptement revenue à la santé, plus belle, plus jeune que jamais. Son enfant était né à Palerme ; les verts rameaux d’un sycomore avaient ombragé son berceau, le murmure de la vague d’azur resplendissant au soleil avait été la première chanson qu’il eût entendue.
Et comme l’air tiède et parfumé de cette belle contrée était salutaire à ce cher nourrisson, bien que la comtesse se fût rétablie à la fin de la première année, ils s’étaient oubliés à Palerme pendant trois autres années encore.
Cependant, un jour, le mal du pays, ce mal bizarre et si commun en même temps, était venu frapper à leur porte.
Au milieu des pins d’Italie, des lauriers-roses et des sycomores, sur cette terrasse de leur villa qui dominait au loin la mer bleue comme un saphir sans fin, en écoutant cette plainte éternelle et si douce à l’oreille du flot qui roule sans relâche le sable doré de la grève, les deux jeunes époux, que le bonheur avait fait oublieux si longtemps, se souvinrent de notre France. Ils ne songèrent point à Paris d’abord, à cette grande et moderne Babylone où ils avaient aimé et souffert, mais ils se souvinrent de cette belle et poétique contrée nivernaise où M. de Kergaz avait acheté, à son premier retour, une terre seigneuriale, et dans laquelle il s’était reposé quinze jours avant d’aller demander la santé de sa femme aux chaudes haleines du Midi.
Ils songèrent à ce joli castel, perdu sous un massif de grands chênes, entouré d’un parc immense, devant lequel s’étalait une verte prairie ; à ces bois touffus et pleins de vagues murmures, sous les hautes futaies desquels retentissait en automne l’éclatante fanfare des veneurs morvandiaux ; et comme partout où ils étaient ensemble le bonheur était revenu, comme il leur souriait partout sous l’aspect de leur chérubin blanc et rose… ils partirent.
Ils s’embarquèrent pour Naples, traversèrent l’Italie dans toute sa longueur, visitèrent rapidement Rome, Venise et Florence, suivirent la route de la Corniche, et rentrèrent en France par le département du Var, cette Italie en miniature.
Quinze jours après, ils roulaient sur cette grande route du Nivernais où nous venons de les retrouver, et n’étaient plus, vers quatre heures du soir, qu’à cinq ou six lieues du château de Magny.
– Jeanne, ma bien-aimée, murmurait Armand, contemplant sa jeune femme avec amour, tandis que ses doigts jouaient avec la blonde chevelure bouclée du petit Gontran, ne regretterez-vous point notre villa de Palerme, notre chère terre promise, dans ce solitaire et silencieux château où nous allons ?
– Oh ! non, répondit Jeanne ; partout où vous êtes, partout où ma main est dans la vôtre, n’est-ce point la terre promise ?
– Ange, dit tout bas le comte, vous m’avez rendu si heureux, que Dieu me fera tort peut-être de ma part de paradis. En France ou en Italie, vivre avec vous et auprès de vous, c’est mieux que la terre promise, c’est le ciel !
Et le comte pressa dans sa main la main blanche et mignonne de Jeanne ; tandis que, réunis par une commune pensée et un même élan, ils se penchaient tous deux sur le front de l’enfant et y déposaient un double baiser, confondant ainsi leurs chevelures.
– Si vous le voulez, ma chère âme, continua M. de Kergaz, nous passerons tout l’automne à Magny, et ne retournerons à Paris que vers le mois de janvier.
– Ah ! je le veux bien, répondit Jeanne ; ce vilain Paris est si noir, si triste ! On s’y souvient de tant de secousses !
Armand tressaillit.
– Ma pauvre Jeanne, dit-il, je vois un pli se former sur ton front, ton œil s’emplir d’une vague inquiétude… et je te devine…
– Mais non, répondit-elle, vous vous trompez… Mon Armand bien-aimé… le bonheur est-il inquiet ?
Elle lui envoya, en parlant ainsi, son meilleur sourire, ce sourire demi-rêveur qui semblait dire : le calme du cœur, c’est un peu de mélancolie.
– Ah ! c’est que, continua Armand, je me souviens qu’à Palerme, parfois, un nom fatal et maudit errait souvent sur vos lèvres.
– Andréa ! fit Jeanne avec une émotion subite.
– Oui, Andréa. Je crains, me dites-vous, l’infernal génie de cet homme ; notre bonheur doit le poursuivre comme un remords. Mon Dieu ! s’il allait nous apparaître ici…
– Oui, murmura la comtesse, je vous dis cela, en effet, mon Armand ; mais c’est que j’étais folle alors, que j’oubliais combien vous êtes noble et fort, et qu’auprès de vous je puis toujours vivre sans rien redouter.
– Tu as raison, enfant, répliqua M. de Kergaz ému. Je suis fort pour te défendre, fort parce que je t’aime, fort parce que Dieu est avec moi et qu’il m’a fait ton protecteur.
Jeanne attacha sur son mari ce regard plein de confiance de la femme qui a une foi profonde en l’homme dont elle a fait son appui.
– Je sais bien, reprit Armand, que mon frère Andréa est un de ces hommes, heureusement fort rares, qui ont fait de notre société un champ de bataille sur lequel ils brandissent l’étendard du mal ; je sais que son génie infernal a été lent à se décourager ; que la haine qu’il m’a vouée, et qui était si violente déjà, a dû s’accroître de toute la grandeur de sa défaite dans cette lutte où il a osé te disputer à moi. Mais rassure-toi, enfant ; il vient une heure où le démon, las de combattre en vain, se retire pour ne plus reparaître ; et cette heure a sonné depuis longtemps sans doute pour Andréa, car il nous a laissés en paix, renonçant à jamais à poursuivre une inutile vengeance.
Et Armand ajouta, après un silence :
– Le lendemain de notre mariage, ange bien-aimé, j’ai fait remettre, par Léon Rolland, 200 000 francs à ce frère dénaturé, l’engageant, par une lettre, à quitter la France et à passer en Amérique, où il trouverait l’obscurité, l’oubli et peut-être, le repentir… Dieu a-t-il touché cette âme rebelle et coupable ? Je l’ignore. Mais depuis quatre années, cette police infatigable que j’ai organisée à Paris pour faire un peu de bien, et dont j’ai donné en mon absence la direction à notre bon et excellent ami Fernand Rocher, cette police a pu constater que mon frère Andréa avait quitté la France et n’y avait point reparu… Peut-être est-il mort.
– Armand, murmura Jeanne avec douleur, ne faisons point ce vœu impie.
Le comte mit un baiser au front de sa femme.
– Mais, dit-il, pourquoi nous attrister ainsi par des souvenirs déjà lointains, et desquels nous séparent les quatre années de bonheur qui viennent de s’écouler ? Vivons heureux, ma chère âme, les yeux fixés sur notre enfant, et continuons à faire un peu de bien, à soulager ceux qui souffrent.
Armand ajouta en lui-même :
– À punir ceux qui ont attiré sur leur tête de justes châtiments.
Car, à cinq cents lieues de Paris, le comte avait poursuivi sa grande œuvre de réparation sociale, y dépensant les deux tiers de son immense fortune, et associé en cela à Fernand Rocher.
Nous verrons tout à l’heure quel auxiliaire le comte et la comtesse de Kergaz avaient trouvé, pour les seconder, dans la personne de cette Madeleine repentante qui s’était nommée la Baccarat, et qui, à cette heure, n’était plus qu’une humble sœur de charité.
La chaise de poste continuait donc à rouler au grand trot, tandis que M. de Kergaz et sa femme causaient ainsi, lorsque le postillon cria rudement un gare ! fortement accentué qui attira l’attention des jeunes époux et leur fit porter les yeux devant eux.
Un homme, dans une attitude d’immobilité complète, était en travers de la route en cet endroit assez rétréci.
– Gare ! répéta le postillon.
L’homme ne bougea point, bien que les premiers chevaux fussent près de l’atteindre. Alors le postillon, pour éviter un malheur, arrêta brusquement son attelage.
– Cet homme est ivre, sans doute, dit M. de Kergaz…
Et se tournant vers un des deux laquais assis derrière la chaise :
– Germain, dit-il, descends, et range ce pauvre diable de façon qu’il ne lui soit fait aucun mal.
Le laquais obéit, mit pied à terre et s’approcha de l’homme étendu sur la route.
Cet homme, qui était nu-pieds, vêtu de haillons et le visage couvert d’une grande barbe inculte, paraissait évanoui.
– Pauvre homme ! murmura la comtesse émue jusqu’aux larmes… il est peut-être tombé d’inanition…
Et elle mit vivement dans les mains de son mari un flacon de sels qu’elle portait suspendu à son cou, disant en même temps à l’autre laquais :
– Vite ! François, vite ! cherchez dans le coffre, vous trouverez une bouteille de malaga et des aliments.
Armand s’élança à terre et courut au mendiant évanoui.
C’était presque un jeune homme, et son visage amaigri par la souffrance conservait les traces d’une grande beauté. Sa barbe et ses cheveux étaient d’un beau blond doré, et ses pieds nus ensanglantés par les ronces, ses mains brûlées par le hâle étaient cependant d’une exquise délicatesse de formes.
Le comte envisagea cet homme et jeta un cri de stupeur :
– Mon Dieu ! murmura-t-il, quelle étrange ressemblance ! on dirait Andréa…
Madame de Kergaz avait imité son mari ; elle était descendue de voiture, et, comme lui, elle s’était approchée du pauvre mendiant… Comme lui, elle jeta un cri d’étonnement.
– On dirait Andréa !… répéta-t-elle.
Il était pourtant peu vraisemblable que le baronet sir Williams, l’élégant vicomte Andréa, en fût arrivé de chute en chute jusqu’à mendier par les chemins, sans chaussures et presque sans vêtements, puis à tomber mourant d’inanition.
En tout cas, si c’était lui, il avait été rudement éprouvé par les privations de toute nature, à en juger par ce visage hâve, amaigri, où la souffrance avait mis sa fatale empreinte.
Et pourtant, c’étaient bien là ses traits, ses cheveux blonds, sa taille.
Armand lui fit respirer le flacon de sels tandis que les deux laquais le relevaient.
Le mendiant fut long à rouvrir les yeux ; enfin il poussa un soupir, et balbutia quelques mots à peine intelligibles.
– Il faisait chaud… balbutia-t-il… j’avais bien faim… je suis tombé…
En parlant ainsi, le mendiant, que M. de Kergaz et sa femme continuaient à regarder avec une anxieuse curiosité, promenait autour de lui des yeux hagards…
Tout à coup il les fixa sur Armand, manifesta aussitôt une sorte de terreur, essaya de se dégager des mains des laquais qui le soutenaient toujours, et voulut fuir…
Mais il avait les pieds enflés par la fatigue d’une longue route, et il ne put faire un pas…
– Andréa ! s’écria Armand, dans le cœur duquel s’élevait un sentiment de compassion profonde… Andréa, est-ce vous ?
– Andréa ? répéta le mendiant d’une voix égarée, que me parlez-vous d’Andréa ? Il est mort… Je ne le connais pas… Je me nomme Jérôme le mendiant…
Et il parut être pris d’un tremblement convulsif, ses dents se prirent à claquer et à s’entrechoquer, il tenta un suprême effort pour se dégager et s’enfuir.
Mais ses forces le trahirent, l’évanouissement le reprit et il s’affaissa mourant.
– C’est mon frère ! s’écria le comte, qui déjà, à la vue de cet homme réduit à ce honteux et lamentable état, avait oublié tous ses crimes pour ne plus se souvenir que d’une chose, c’est que les mêmes flancs les avaient portés tous les deux.
– C’est votre frère, Armand ! répéta madame de Kergaz que la même pensée et la même compassion animèrent.
Le mendiant, évanoui de nouveau, fut placé dans la chaise de poste et le comte dit au postillon :
– Nous ne sommes plus qu’à trois lieues de Magny ; crève tes chevaux, mais arrive en trois quarts d’heure.
La chaise repartit, rapide comme l’éclair. Elle entrait bientôt dans la grande allée de tilleuls qui conduit au perron du château.
Quelques minutes plus tard, le mendiant rouvrait les yeux ; grâce à des soins empressés, il se trouvait non plus sur la route, mais dans le lit d’une élégante chambre à coucher.
Un homme et une femme étaient anxieusement penchés sur lui, écoutant l’avis d’un médecin qu’on avait envoyé quérir en hâte.
– Cet évanouissement, disait le docteur, a eu pour cause première l’absence trop prolongée d’aliments, corroborée par une longue marche. Les pieds sont enflés. Il a dû faire au moins vingt lieues depuis hier.
– Andréa, murmura M. de Kergaz en se penchant à l’oreille du mendiant, vous êtes ici chez moi… chez votre frère… chez vous.
Andréa, car c’était bien lui, continuait à le regarder avec des yeux hagards, effrayés. On eût dit qu’il croyait faire un rêve étrange, et cherchait à repousser quelque horrible vision.
– Frère… répéta M. de Kergaz d’une voix émue et caressante, frère… est-ce bien vous ?
– Non, non… balbutia-t-il, je suis un mendiant, un vagabond sans feu ni lieu… un homme que la justice divine poursuit, que le remords assiège à toute heure… Je suis un de ces grands coupables qui se condamnent volontairement à parcourir le monde sans relâche, portant avec eux le fardeau de leur iniquité.
M. de Kergaz poussa un cri de joie.
– Ah frère, frère, murmura-t-il, tu t’es donc enfin repenti ?
Il fit un signe à sa jeune femme, qui sortit, emmenant le docteur.
Alors Armand, resté seul au chevet du vicomte Andréa, lui prit affectueusement la main et lui dit :
– Nous avons eu la même mère, et s’il est vrai que le repentir est entré dans ton cœur…
– Notre mère ! interrompit Andréa d’une voix sourde, j’ai été son bourreau…
Et il ajouta avec un accent d’humilité profonde.
– Frère, quand je serai un peu reposé, quand mes pieds désenflés me permettront de continuer ma route, vous me laisserez partir, n’est-ce pas ?… Un morceau de pain, un verre d’eau… Jérôme le mendiant n’a pas besoin d’autre chose…
– Mon Dieu ! murmura M. de Kergaz, dont le noble cœur battait d’émotion, en quelle misère horrible es-tu tombé, pauvre frère ?
– En une misère volontaire, dit le mendiant, courbant humblement le front. Un jour le repentir est venu, et j’ai voulu expier tous mes crimes… Les deux cent mille francs que je tenais de vous, frère, je ne les ai point dissipés. Ils sont déposés à la Banque de New York. Le revenu en est versé dans la caisse des hospices… Moi, je n’ai besoin de rien… Je me suis condamné à m’en aller par le monde, demandant la charité, couchant dans les écuries et les granges… souvent au bord du chemin… Peut-être qu’à la longue, Dieu, que je prie nuit et jour, finira par me pardonner.
– C’est fait ! répondit le comte. Au nom de Dieu, frère, je te pardonne et te dis que l’expiation est suffisante…
Et M. de Kergaz, enlaçant Andréa dans ses bras, ajouta :
– Mon frère bien-aimé, veux-tu vivre sous mon toit, non plus, comme un vagabond, non plus comme un coupable, mais comme mon ami ; mon égal, le fils de ma mère, l’enfant prodigue que ramène le repentir et à qui tous les bras sont ouverts ? Reste, frère ; entre ma femme et mon enfant, tu seras heureux, car tu es pardonné…
II
Deux mois environ après la scène que nous venons de raconter, nous eussions retrouvé à Paris, rue Culture-Sainte-Catherine, le comte Armand de Kergaz et sa jeune femme causant tête à tête dans un cabinet de travail.
On était alors aux premiers jours de janvier. C’était le matin, vers dix heures.
Le givre qui couvrait les arbres du jardin miroitait aux pâles rayons d’un soleil d’hiver ; il faisait froid, et un grand feu flambait dans la cheminée.
Le comte était assis dans un vaste fauteuil, vêtu de sa robe de chambre, les jambes croisées, et tenant à la main des pincettes avec lesquelles il tisonnait, tout en causant. Madame de Kergaz, en négligé du matin, se tenait auprès de son mari et attachait sur lui son calme et mélancolique regard, tandis qu’elle l’écoutait attentivement.
– Ma chère enfant, disait le comte, j’étais déjà bien heureux de votre amour, mais mon bonheur est complet depuis que notre cher frère nous a été rendu par le repentir.
– Oh ! répondit Jeanne, Dieu est grand et bon, mon ami, et il a si bien touché de sa grâce cette âme impie et rebelle, qu’il en a fait l’âme d’un saint.
– Pauvre Andréa, murmura le comte, quelle vie exemplaire !… quel repentir !… Jeanne, ma bien-aimée, il faut que je vous fasse une horrible confidence, et vous verrez combien il est changé.
– Mon Dieu ! qu’est-ce encore ? demanda Jeanne avec inquiétude.
– Vous le savez, Andréa n’a voulu partager que les apparences de notre vie. Assis auprès de nous au salon, il habite une mansarde, sans feu, dans les combles de l’hôtel, sous prétexte de suivre un régime impérieusement ordonné par la faculté. Il s’est réduit aux plus grossiers aliments. Jamais un verre de vin n’effleure ses lèvres.
– Et, interrompit Jeanne, il jeûne tous les jours jusqu’à midi.
– Qu’est-ce que tout cela ? fit le comte, vous ne savez rien encore, ma chère amie.
– Je sais, reprit madame de Kergaz, qu’il a fallu toutes vos instances et les miennes pour l’empêcher d’aller s’enfermer à la Trappe de la Meilleraye. Je sais encore que, tous les matins, il quitte l’hôtel au petit jour, vêtu misérablement, et que, sous l’humble nom d’André Tissot, il se rend rue du Vieux-Colombier, dans une maison de commerce où il tient les écritures, de huit heures du matin à six heures du soir, aux modestes appointements de douze cents francs. Il a voulu, lui qui pourrait puiser dans notre bourse à discrétion, devoir au travail son existence misérable !
– Et c’est pour cela, dit le comte, qu’il m’a forcé d’accepter quatre-vingts francs par mois de pension.
– Un tel repentir, une telle expiation, une vie aussi exemplaire, murmura Jeanne avec admiration, doivent militer aux yeux de Dieu, et sans doute il a été pardonné depuis longtemps.
– Oh ! ce n’est rien encore, mon amie, poursuivit le comte, si vous saviez !…
– Parlez, fit Jeanne émue ; parlez, Armand, Je veux tout savoir…
– Eh bien ! Andréa porte un cilice… tout son corps n’est plus qu’une horrible plaie…
Madame de Kergaz jeta un cri.
– C’est affreux ! dit-elle, affreux… affreux ! Mais comment…
– Vous voulez savoir comment je l’ai appris ?
– Oui, fit la comtesse d’un signe de tête.
– Eh bien ! figurez-vous que, cette nuit, j’ai travaillé fort tard avec Fernand Rocher et Léon Rolland. Il était deux heures du matin lorsqu’ils sont partis. À dîner, j’avais trouvé Andréa fort pâle et il m’avait même avoué qu’il était souffrant. J’avais été inquiet toute la soirée, et l’idée m’est venue de monter chez lui et de voir comment il allait. Vous le savez, ma chère amie, Andréa n’a jamais voulu que les domestiques de l’hôtel pénétrassent chez lui ; il veut faire son lit et balayer sa chambre lui-même, dit-il ; mais, en réalité, c’est que son lit n’a jamais besoin d’être fait. Le malheureux couche par terre sur le carreau glacé, sans autre couverture que sa chemise.
– Mon Dieu ! s’écria la comtesse, et nous sommes en plein mois de janvier !
– Il se tuera… soupira le comte. J’étais monté sur la pointe du pied. Arrivé à la porte, j’ai vu filtrer un rayon de lumière ; j’ai frappé doucement, et il ne m’a point répondu. Alors, comme la porte n’était fermée qu’au loquet, je suis entré. Oh ! l’horrible spectacle !… Andréa était couché sur le sol, à demi nu ; près de lui brûlait sa bougie ; à côté de la bougie était, tout ouvert, un volume de saint Augustin. Le malheureux, brisé de fatigue, s’était endormi en lisant. Alors, j’ai pu voir qu’il avait les reins et les flancs ensanglantés et ceints de cet horrible instrument de discipline qu’on nomme un cilice. J’aurais dû m’en douter, car souvent, lorsqu’un mouvement brusque vient à lui échapper, une pâleur soudaine, indice d’une souffrance aiguë, se répand sur tout son visage.
– Armand, interrompit madame de Kergaz, émue jusqu’aux larmes, il faut tâcher que votre frère renonce à ces macérations exagérées. Vous devriez en parler au curé de Saint-Laurent, qu’il a pris pour confesseur.
Le comte hocha la tête.
– Andréa est inflexible pour lui-même, murmura-t-il, et je crains qu’il ne finisse par succomber à cette pénitence exemplaire. Il est d’une maigreur affreuse, d’une pâleur extrême ; il ne se permet le sommeil que lorsque la fatigue l’emporte sur sa volonté. Ce travail ingrat de douze heures auquel il se livre tous les jours lui devient de plus en plus nuisible. Andréa aurait besoin de grand air et d’une vie active… Je voudrais pouvoir lui faire faire un voyage… Hélas ! il me refuserait, peut-être même nous quitterait-il.
– Oh ! cela ne sera pas ! s’écria Jeanne avec véhémence, il vivra près de nous, ce cher repenti… Tenez, Armand, voulez-vous que je le prenne à part, que je tâche de lui persuader que la justice divine est satisfaite, que l’expiation dépasse la faute ? Oh ! vous verrez, mon bien-aimé Armand, comme je serai éloquente, persuasive ! il faut que je le séduise.
– Tenez, dit le comte, j’ai une idée, une idée excellente pour l’arracher à cette vie de bureau qui le tuera à la longue.
– Vraiment ? fit la comtesse avec joie.
– Vous verrez, ma bien-aimée…
Et M. de Kergaz parut réfléchir.
– Vous le savez, dit-il, en mon absence, Fernand Rocher et Léon Rolland, aidés de sœur Louise, m’ont remplacé de leur mieux et ont soulagé bien des misères… Fernand et sa jeune femme, qui est dame patronnesse de la nouvelle église Saint-Vincent-de-Paul, se sont chargés de soulager adroitement ce qu’on nomme les misères dorées, c’est-à-dire ces humbles employés dont les modiques appointements sont insuffisants pour faire vivre leur nombreuse famille. Léon Rolland et sa belle et vertueuse femme ont eu le département du faubourg Saint-Antoine, ce quartier le plus populeux et presque le plus pauvre de Paris. Léon est à la tête d’un vaste atelier de menuiserie et d’ébénisterie, où il occupe deux cents ouvriers toute l’année. Cerise a ouvert une vaste maison de confection qui emploie toutes les jeunes filles orphelines que le vice réclamerait peut-être si elles étaient abandonnées à elles-mêmes. Enfin, madame Charmet a choisi pour son pieux champ de bataille ce quartier de folie et de perdition où jadis elle brillait sous le nom de Baccarat.
– Je sais tout cela, mon ami, dit la comtesse.
– Les pauvres et les malheureux, reprit M. de Kergaz, n’ont rien perdu à mon absence. Mais ce n’était là qu’une partie de la mission que je me suis imposée qui se trouvait remplie. Si l’œuvre de charité allait son train, l’œuvre de justice chômait…
– Que voulez-vous dire ? interrogea la comtesse.
– Écoutez, Jeanne, écoutez, poursuivit le comte.
« Un soir, une nuit plutôt, il y a bien dix années déjà, deux hommes se rencontrèrent en haut d’un édifice élevé au sommet d’une de ces collines qui dominent Paris. Ces deux hommes se montrèrent mutuellement du doigt la grande ville accroupie sous leurs pieds, et toute frémissante des ivresses convulsives d’une nuit de carnaval.
« L’un de ses hommes s’écria :
« – Voilà un vaste champ de bataille pour celui qui aurait assez d’or à dépenser au service du mal. Voyez-vous cette ville immense ? Eh bien ! il y a là, pour l’homme qui a du temps et de l’or, des femmes à séduire, des hommes à vendre et à acheter, des filous à enrégimenter, des mansardes où le cuivre du travail entre sou à sou à convertir en boudoirs somptueux avec l’or de la paresse. Voilà une grande et belle mission ! »
« Et cet homme riait, en parlant, d’un rire odieux.
« On eût dit Satan lui-même, ou don Juan, préconisant sa vie passée et prêt à la recommencer.
« Or, acheva le comte, cet homme qui parlait de cette façon impie, alors, c’était Andréa ; l’autre, c’était moi !
« Eh bien ! vous savez ce que fut cette lutte entre le bien et le mal, et comment le mal fut vaincu. Mais Andréa n’en était point le seul représentant, et Paris est demeuré la Babylone moderne où le vice coudoie la vertu, où l’infamie et le crime germent comme en une terre féconde… Ah ! que de coupables encore restent à punir ! que de victimes à arracher à leurs bourreaux !
Madame de Kergaz écoutait rêveuse :
– Je vous devine, dit-elle, je crois vous deviner, du moins. Vous voulez donner à Andréa repentant et vertueux le département des expiations et des châtiments mystérieux ?
– Vous avez deviné, chère amie. Peut-être cette intelligence hors ligne, cette volonté puissante, cette audace sans pareille qu’il développait si bien pour la cause du mal, les retrouvera-t-il dans la voie du bien ?
– Je le crois, répondit madame de Kergaz.
Les deux époux furent interrompus par un coup de sonnette qui, de la loge du suisse, correspondait avec l’hôtel et annonçait un visiteur.
– Voici, dit Armand, les notes quotidiennes de ma police. Les hommes que j’emploie à ce métier sont dévoués, intelligents, mais il leur faut un chef.
La porte s’ouvrit, un laquais parut.
Il portait sur un plateau une enveloppe assez volumineuse, que le comte décacheta sur-le-champ.
Cette enveloppe renfermait sept ou huit feuillets d’une écriture menue, sans signature.
M. de Kergaz lut tout bas :
« Les agents secrets de M. le comte sont en ce moment sur la trace d’une mystérieuse et singulière association, qui, depuis environ deux mois, a mis Paris en exploitation… »
– Oh ! oh ! fit Armand, qui continua sa lecture avec une scrupuleuse attention.
« Cette association, poursuivait le correspondant anonyme, paraît avoir des ramifications dans tous les mondes parisiens. Son siège, ses chefs, ses moyens d’exécution, tout est encore pour nous à l’état de mystère. Les résultats seuls commencent à nous êtres connus, et encore n’est-ce que partiellement. Le but de cette agglomération de bandits est de s’approprier par tous les moyens possibles les papiers compromettants pour le repos des familles, et d’exercer, à l’aide de ces papiers, un vaste chantage. Les lettres imprudemment écrites par une femme éprise et qu’on menace de faire tenir au mari, les faux en écriture privée que commettent parfois de jeunes prodigues et qu’une main cachée peut déposer sur le bureau d’un juge d’instruction, rien ne leur échappe.
« Cette association, qui a pris le titre de : le Club des Valets-de-Cœur, s’introduit partout, prend toutes les formes et toutes les attitudes.
« Les agents de M. le comte, achevait le correspondant, travaillent activement ; mais, jusqu’à présent, ils n’ont pu que constater de déplorables résultats sans rien découvrir. »
Armand, tout rêveur, tendit ces mots à sa femme.
– Tenez, dit-il, ce serait à faire croire que le doigt de Dieu intervient. Nous cherchions tout à l’heure un moyen d’occuper les rares facultés de notre cher Andréa, et voici ce que je lis.
Tandis que madame de Kergaz parcourait cette note de la police secrète de son mari, le comte sonna :
– Envoyez-moi Germain, dit-il à son valet.
Germain était le domestique de confiance d’Armand, le seul qui fût dans le secret de la mystérieuse existence d’Andréa.
– Tu vas aller rue du Vieux-Colombier, lui dit M. de Kergaz, et tu me ramèneras mon frère.
Germain partit ; une heure après, le comte et sa femme virent entrer Andréa.
Pour qui avait connu le brillant vicomte Andréa, le don Juan moqueur et impie, ou bien le baronet sir Williams, ce gentleman flegmatique et distingué, le frère de M. de Kergaz, le fils du comte de Felipone, était désormais méconnaissable.
Il était pâle, amaigri. Ses habits affectaient la coupe et la tournure sans prétention des vêtements portés par les ecclésiastiques. Il marchait les yeux baissés, la tête un peu inclinée en avant, et parfois sa démarche trahissait une vive souffrance.
Il osa à peine regarder la comtesse, comme si, à quatre années de distance, le souvenir de son odieuse conduite envers elle et des outrages qu’il avait osé lui faire subir se fût dressé devant lui comme un fantôme vengeur.
Ce fut avec la même hésitation pleine d’humilité qu’il prit et serra la main que lui tendait M. de Kergaz.
– Cher frère, murmura celui-ci.
– Vous m’avez fait demander, Armand ? dit Andréa d’une voix presque tremblante ; je me suis hâté de quitter mon bureau.
– Mon cher Andréa, répondit Armand, je t’ai fait demander parce que j’ai besoin de toi…
L’œil d’Andréa s’illumina d’un rayon de joie.
– Ah ! dit-il, faut-il mourir pour vous ?…
Un sourire vint aux lèvres d’Armand.
– Non, dit-il, il faut vivre d’abord…
– Et vivre raisonnablement, mon frère, ajouta madame de Kergaz, qui prit les deux mains d’Andréa et les pressa avec effusion.
Andréa rougit et voulut retirer ses mains.
– Non, non, murmura-t-il, je ne suis pas digne, madame, de l’intérêt que vous me témoignez…
– Mon frère…
– Laissez, madame, laissez le pauvre pécheur, continua-t-il humblement, tâcher d’apaiser par son expiation la colère divine.
Jeanne leva les yeux au ciel :
– C’est un saint, pensa-t-elle.
– Frère, dit alors M. de Kergaz, tu sais que je me suis imposé une mission ?
– Oh ! dit Andréa, une noble, une sainte mission, mon frère…
– Et j’ai besoin de ton aide pour continuer mon œuvre.
Le vicomte Andréa tressaillit.
– Il y a bien longtemps, dit-il, que je vous aurais demandé de m’associer à vos travaux, Armand, si j’avais été digne de faire le bien. Hélas ! en passant par mes mains souillées, que serait donc la charité ?
– Frère, dit M. de Kergaz, il ne s’agit pas de faire le bien d’une façon vulgaire, il faut punir ou prévenir le mal.
Armand tendit alors la note confidentielle de sa police au vicomte Andréa.
Celui-ci la lut avec attention et parut manifester un profond étonnement.
– Eh bien, frère, reprit M. de Kergaz, l’heure des expiations vulgaires, du repentir humble et caché est passée : il faut redevenir un homme fort, intelligent, habile, un homme aussi audacieux pour servir une noble cause que tu le fus pour faire le mal, un adversaire digne enfin de cette association de bandits que je veux exterminer.
Andréa écoutait avec attention et se taisait. Tout à coup il releva la tête ; un éclair passa dans ses yeux, mornes et sans rayons depuis longtemps.
– Eh bien, dit-il, je serai cet homme !
M. de Kergaz jeta un cri de joie.
– Je serai la main vengeresse, continua le vicomte, qui poursuivra sans relâche les mystérieux ennemis de la société ; cette association, dont vos agents n’ont pu découvrir le lieu de réunion, les statuts, les chefs et les affiliés, je la démasquerai, moi…
Et comme il parlait, une transformation semblait s’opérer chez Andréa.
L’homme humble et courbé jusque-là sous la main du repentir, le pénitent accablé de macérations, se redressa peu à peu : l’œil baissé étincela et retrouva son assurance, et ce ne fut pas sans un vague mouvement d’effroi que madame de Kergaz vit tout à coup reparaître le baronet sir Williams, l’audacieux des anciens jours, le terrible Andréa, si longtemps bandit lui-même.
Mais l’effroi de Jeanne n’eut que la durée d’un éclair. Le baronet n’existait plus, le bandit Andréa était mort ; restait un homme dévoué à son frère, à la société, à Dieu… un soldat de la grande cause de l’humanité.
En ce moment, la porte s’ouvrit ; une femme entra.
Cette femme était vêtue de noir, et sur ses vêtements noirs elle portait la capuche grise des sœurs de charité libres et n’ayant point fait de vœux.
Comme le vicomte, cette femme n’était plus que l’ombre d’elle-même.
Sa beauté seule avait survécu dans ce naufrage pieux où la Baccarat s’était engloutie pour renaître sœur Louise, la noble femme éprouvée par l’amour, la vierge folle devenue la Madeleine repentante.
Baccarat, qu’on nous pardonne de lui conserver ce nom, Baccarat, était demeurée belle, en dépit de ses douleurs, en dépit de son repentir ; belle, malgré le soin qu’elle semblait mettre à dissimuler sous la grossièreté de ses vêtements cette beauté merveilleuse et cette taille de reine qui, jadis, avaient tourné tant de jeunes têtes et causé tant de désespoirs.
Un seul, un dernier reste de coquetterie, hélas ! bien pardonnable, après tout, l’avait empêchée de couper ses cheveux, cette luxuriante chevelure blonde qui l’enveloppait, dénouée, comme un manteau et couvrait ses talons.
Mais elle en dissimulait de son mieux les énormes torsades sous sa coiffe blanche et son capuchon, et elle était si humble et si modeste en sa démarche, que nulle n’aurait osé lui reprocher ce dernier attachement aux choses de ce monde.
À sa vue, Jeanne courut à elle et lui prit les mains :
– Bonjour, chère sœur, dit-elle.
Et Baccarat, l’ange du repentir, fit comme Andréa, elle retira sa main et balbutia.
– Ah ! madame, je ne suis pas digne de baiser le bas de votre robe…
Ce fut alors que M. de Kergaz prit Baccarat et Andréa tous les deux par la main, et leur dit :
– Vous fûtes deux anges déchus ; le repentir vous a relevés tous deux. Unissez-vous pour la cause commune : vous êtes tous deux dignes de combattre sous le même drapeau, ô nobles transfuges du mal…
Baccarat leva alors les yeux sur sir Williams, et elle eut froid au cœur. Il lui semblait qu’une voix secrète lui criait :
– Les monstres de cette nature peuvent-ils donc jamais être touchés par le repentir ? Non, non !
III
Tandis que ces événements se passaient à l’hôtel de Kergaz, une scène d’une tout autre nature avait lieu, quelques heures plus tard, à l’autre extrémité de Paris, c’est-à-dire dans le faubourg Saint-Honoré, à l’angle de la petite rue de Berri.
La nuit était profonde ; un brouillard épais tombait sur Paris, et son intensité était telle, que le service des omnibus et les voitures de place, et jusqu’à la circulation des équipages de maître, avaient dû être suspendus ; les becs de gaz ne parvenaient point à pénétrer l’obscurité de la nuit, et il fallait connaître admirablement son chemin pour ne point égarer dans ce quartier à peu près désert qui portait encore alors la dénomination de faubourg du Roule.
Cependant, au moment où onze heures sonnaient à l’église Saint-Philippe, plusieurs hommes arrivant de différentes directions se glissèrent successivement dans la rue de Berri, s’arrêtèrent tous à l’entrée d’une maison d’apparence plus que modeste, pour ne pas dire suspecte, aux fenêtres de laquelle on n’apercevait aucune clarté, et tous disparurent l’un après l’autre dans les profondeurs d’une allée noire que fermait une porte bâtarde.
Cette allée, qui se prolongeait assez longtemps, aboutissait à la rampe d’un escalier. Cet escalier ne montait pas, comme on aurait pu le croire, aux étages supérieurs de la maison ; il s’enfonçait au contraire dans la terre, et le premier de ces mystérieux visiteurs qui y posa le pied descendit environ cinquante marches dans l’obscurité la plus complète, s’aidant de la rampe et n’avançant qu’à tâtons.
Là, une main le saisit dans l’ombre et l’arrêta.
En même temps une voix assourdie lui dit :
– Où donc allez-vous, et venez-vous me voler mon vin ?
– L’amour est une chose utile, répondit le visiteur nocturne.
– C’est bien, reprit la voix.
Et soudain une porte s’ouvrit, un jet de lumière éclaira l’escalier, et le nouveau venu se trouva sur le seuil d’une salle souterraine dont le bizarre aspect mérite une courte description. C’était, à vrai dire, l’un des compartiments d’une cave, à en juger par la voûte cintrée et une douzaine de futailles rangées le long des murs.
Seulement on avait posé une planche sur les pièces de vin, de façon à en faire un siège improvisé ; puis on avait placé au milieu de la cave une table, sur cette table une lampe à modérateur, et devant elle un fauteuil.
C’était vraisemblablement le fauteuil du président de cette mystérieuse réunion. Auprès de la lampe, sur la table, se trouvait un dossier de paperasses assez volumineux. Mais celui qui les eût examinées avec attention n’aurait pu dire en quels caractères elles étaient écrites.
C’était d’indéchiffrables hiéroglyphes, un assemblage de chiffres arabes et romains et de signes typographiques dont il aurait fallu posséder la clef pour en deviner le sens énigmatique.
L’homme qui veillait à l’entrée de la salle souterraine introduisit ainsi successivement et en faisant la même question, à laquelle il fut invariablement répondu de la même manière, six personnages, qui tous étaient enveloppés dans un large manteau, ce qui leur donnait un aspect uniforme. Puis cela fait, il ferma soigneusement la porte et vint prendre place au bureau du président.
Ce personnage était un tout jeune homme. Avait-il dix-huit ou vingt-deux ans ? C’était ce que personne n’aurait pu dire au juste ; mais il était bien certain qu’il ne dépassait point ce dernier âge.
Cependant la physionomie, malgré cette extrême jeunesse, semblait révéler une haute énergie, une astuce merveilleuse, une audace à toute épreuve et une de ces intelligences d’élite qui se révèlent à de certaines heures par des traits de génie.
Sa mise était celle d’un lion du boulevard, terme alors à la mode, et qui résumait l’homme élégant, riche et inoccupé de cette époque. Il avait la lèvre moqueuse, la démarche assurée ; il portait la tête en arrière d’une certaine façon impertinente, et son regard paraissait dominer moralement les six personnes qu’il venait d’introduire.
Celles-là méritent aussi quelques lignes de silhouette.
Lorsque chacune d’elles se fut débarrassée de son manteau, le président de l’assemblée put constater combien elles étaient différentes d’aspect, de tournure, de vêtements et d’âge.
Le premier entré, et qui s’était assis tout près de la table, était un homme de cinquante ans environ, grand, mince, décoré de plusieurs ordres, portant d’épaisses moustaches teintes en noir avec soin, et une perruque de même couleur qui couvrait son front dégarni par l’âge.
Sa mise était celle d’un homme du monde, ayant conservé dans la vie civile la désinvolture pimpante d’un officier.
Le président lui dit :
– Bonjour, major, vous êtes exact.
Le second des six personnages était un homme de trente ans, portant ses cheveux un peu longs, sa barbe négligée, et ayant une sorte de cachet artistique dans toute sa personne.
– Bonjour, Phidias, dit le président en lui indiquant une place à sa gauche.
Le troisième n’était guère plus âgé que le président.
C’était un de ces petits jeunes gens qui portent un lorgnon d’écaille fiché dans l’œil, une moustache en croc et des manchettes, qu’on voit à toutes les premières représentations dramatiques, dans tous les concerts et dans tous les salons du demi-monde.
Mais comme le président, il avait l’œil vif, le nez droit, signe d’une volonté bien trempée, et la lèvre un peu moqueuse.
– Bonjour, baron, dit le président.
Le quatrième était bien dissemblable de tournure, d’aspect et de costume de ces trois hommes que nous venons de dépeindre.
Ce n’était point un élégant dandy, un jeune homme du monde, courant les comédiennes, fréquentant Tortoni et le café Anglais. C’était un domestique en livrée.
Non point cependant ce valet vulgaire, à l’air niais, qu’un fastueux dentiste ou un marchand de nouveautés affuble d’une casquette galonnée et d’un gilet rouge ; mais le laquais d’autrefois, le Frontin de bonne maison, le valet effronté qui reçoit les confidences de son maître et lui donne parfois des conseils, l’homme enfin entre deux âges, encore vert-galant pour les femmes de chambre, et pouvant, à la rigueur, jouer les oncles de province et les notaires de village.
Le salut que lui adressa le jeune président eut quelque chose de maçonnique et de mystérieux, qui prouvait qu’il était haut placé dans son estime.
Le cinquième avait une physionomie étrange ; c’était presque un vieillard, mais un vieillard robuste, vigoureux, dont les cheveux grisonnants couvraient à profusion le front étroit et fuyant, dont le petit œil gris pétillait d’un feu sombre, et dont les larges épaules, la taille courte et trapue, les fortes mains, trahissaient l’homme habitué à de rudes exercices.
Son visage était couturé de bizarres cicatrices. Avait-il eu la petite vérole, s’était-il brûlé avec le vitriol ou de la poudre, avait-il été défiguré par quelque horrible maladie ?
Mystère.
Toujours est-il que cet homme avait un aspect repoussant et dur, même dans sa toilette, qui était d’une recherche exagérée et de mauvais goût.
Il était vêtu comme pour aller au bal : habit noir, gilet blanc, sur lequel était fastueusement étalée en deux doubles une énorme chaîne de montre, bottes vernies enfermant des pieds énormes qui semblaient se souvenir du sabot, poignets de chemise odieusement rabattus sur les manches de l’habit.
Les mains rouges, calleuses, aux ongles déformés, étaient nues et paraissaient ignorer l’usage du gant.
Enfin le dernier de ces six personnages était, au contraire, ce que l’art et la fantaisie réunis auraient pu rêver de plus idéal.
Était-ce un créole ! Était-ce le produit mystérieux des amours d’un rajah de l’Inde avec une Anglaise aux épaules d’albâtre ? Était-ce quelque fier hidalgo dans les veines de qui coulait le sang des Maures de Grenade ?
Nul n’aurait pu le dire.
Il était grand, brun et presque olivâtre ; ses cheveux crépus avaient, comme sa barbe, qu’il portait courte et très soignée, un reflet bleuâtre d’aile de corbeau.
Ses traits, d’une parfaite régularité, et dont l’ensemble résumait un type de beauté merveilleuse, étaient éclairés par un regard ardent, fascinateur, étrange.
Dans le monde où il vivait, ce personnage, sur lequel nous reviendrons bientôt, et dont nous dirons l’origine transatlantique, avait été surnommé Chérubin le Charmeur.
Quand ces six personnes se furent assises, le président prit place au fauteuil qui lui était réservé, et salua tout le monde comme il avait salué chacun en particulier.
– Messieurs, dit-il, notre association, fondée sous le titre de Club des Valets-de-Cœur, se compose de vingt-quatre membres, la plupart inconnus les uns des autres, ce qui est une garantie de discrétion.
Les six associés, qui ne s’étaient jamais vus, se regardaient avec une mutuelle curiosité.
– Chacun de vous, poursuivit le président, a pu prendre connaissance des statuts du club avant d’entrer parmi nous : vous savez donc que la première des conditions est une obéissance passive au chef mystérieux et inconnu de tous, excepté de moi, et dont je ne suis que l’humble intermédiaire.
Les six membres du club s’inclinèrent.
– C’était donc, continua le président, un ordre du chef qui vous réunit ce soir ici, afin que vous puissiez vous connaître ; car vous allez être obligés de travailler presque en commun. Nous sommes sur la voie d’une opération qui pourrait avoir des résultats fabuleux.
À ces mots, il y eut un vif mouvement de curiosité dans l’assemblée.
– Quels sont les plans du chef ? reprit le président, c’est ce que je ne sais qu’imparfaitement, c’est ce qu’il m’est interdit de vous dire. Mes pouvoirs consistent à vous donner vos instructions…
Alors le président se tourna vers celui des assistants qu’on nommait le major :
– Major, lui dit-il, vous allez beaucoup dans le monde ?
– Beaucoup, répondit le major.
Le président parut consulter ses notes écrites en caractères hiéroglyphiques :
– Allez-vous, dit-il, chez la marquise Van-Hop ?
– Oui, répondit le major.
– Alors, vous êtes invité à son bal de mercredi prochain ?
– Très certainement.
– La marquise n’est-elle point une femme d’à peu près trente ans, créole de l’Amérique espagnole, mariée à un Hollandais ?
Le major fit un signe de tête affirmatif.
– Elle est fort riche, dit-on.
– Six ou sept cent mille livres de rente.
– Elle aime les arts et les artistes ; on dit même qu’elle a eu la fantaisie, depuis un an ou deux, de prendre des leçons de sculpture !
– Je suis son professeur, répondit celui des six associés que le président avait salué du nom de Phidias.
– Très bien. Je m’en doutais.
– Le marquis Van-Hop est un homme de quarante ans, flegmatique et taciturne… On le dit jaloux ?
– Très jaloux, répondit le major. Et cependant il n’a aucune raison de l’être : la marquise est irréprochable.
– Major, dit le président, vous présenterez chez la marquise, mercredi prochain, M. Chérubin que voilà.
Et le président désigna du doigt le sixième personnage, celui dont la beauté était merveilleuse.
Puis il reprit :
– La marquise n’est-elle point fort liée avec une femme de trente-cinq ans environ, veuve depuis deux ans, et qu’on nomme madame Malassis ?
– Je le crois, dit le major. J’ai même rencontré plusieurs fois la veuve chez la marquise aux réceptions intimes.
– Madame Malassis, poursuivit le président en compulsant ses notes, a été, dit-on, du vivant de son époux, à moitié légère.
– Oh ! à moitié… fit le major.
– Mais, disent toujours mes notes, la marquise l’ignore complètement, et elle tient madame Malassis pour la plus honnête des femmes ; d’autant que la veuve est recherchée assidûment par le vieux duc de Château-Mailly, qui la veut épouser, et ne craindra point de l’instituer par testament sa légataire universelle, au détriment de son neveu le comte de Château-Mailly, qui commence à se ruiner…
– Qui achève, plutôt, dit le major.
– Soit, répondit le président.
Alors il se tourna vers le cinquième des associés, celui-là même dont la mise prétentieuse, la figure étrange et brutale, et la stature athlétique faisaient une sorte d’hercule endimanché :
– Madame Malassis, lui dit-il, cherche un homme de confiance qui puisse remplir auprès d’elle les doubles fonctions d’intendant et de maître d’hôtel, une sorte de maître-jacques qu’elle payera le moins cher possible, et qui aura chez elle une besogne d’enfer. Madame Malassis n’est pas riche, mais elle veut représenter. Vous vous rendrez demain chez elle, rue de la Pépinière, 41, et lui direz que vous avez appris indirectement qu’elle cherchait un intendant.
L’homme aux larges épaules s’inclina.
– Quant à vous, poursuivit le jeune président en s’adressant au laquais en livrée, vous avez été chassé hier de chez le vieux duc de Château-Mailly ?
– C’est-à-dire, fit le laquais, que je me suis fait chasser, pour me conformer aux instructions que vous m’aviez données.
– C’est ce que je voulais dire ; mais vous avez oublié de rendre au duc une clef qu’il vous avait confiée.
– La clef du jardin de la maison n° 41, rue de la Pépinière ?
– Précisément.
– En outre, vous devez avoir, bien que vous n’ayez passé que trois mois au service de M. de Château-Mailly, une connaissance parfaite de ses habitudes, de l’emploi de son temps, de ses goûts, de ses manies ?
– Quand je sers un homme, je l’observe tout d’abord.
– Donc vous l’avez observé ?
– Je le sais par cœur.
– Très bien ; on vous demandera des renseignements en temps et lieu. Pour le moment, vous allez passer dès demain chez un serrurier qui est établi rue de Lappe, au coin de la rue du Faubourg-Saint-Antoine ; vous entrerez dans sa boutique, et lui direz simplement : « Te souviens-tu de Nicolo ? » À quoi il vous répondra : « Je l’ai vu guillotiner. »
– Est-ce tout ? demanda le laquais.
– Vous lui présenterez la clef que vous avez gardée…
– Ah ! je comprends…
– Et vous le prierez de vous en faire une pareille. Vous retournerez chez lui le lendemain à la même heure. Il vous remettra les deux clefs, la neuve et la vieille, et vous renverrez cette dernière à M. de Château-Mailly.
– Que ferai-je de l’autre ?
– Vous irez vous promener vers huit heures sur le boulevard des Italiens, et vous attendrez devant les bains Chinois. Vous y rencontrerez monsieur…
Le président désignait du doigt celui des associés qui résumait si parfaitement avec son lorgnon dans l’œil droit et ses favoris taillés en côtelettes le type du lion du boulevard.
Ce dernier fit un geste de surprise.
– Cher associé, dit le président, madame Malassis est encore, à l’heure qu’il est, une fort belle femme, et vous auriez tort de refuser la clef que l’on vous remettra.
Le lion salua sans mot dire.
– Messieurs, acheva le président, comme vous allez tous les six travailler ensemble et à la même heure, il était nécessaire que vous fussiez présentés les uns aux autres. Maintenant, vous vous connaissez et vous pouvez vous séparer. Chacun de vous recevra de minutieuses instructions à domicile.
Et le président leva la séance et congédia les six valets-de-cœur, qui, tous, s’en allèrent l’un après l’autre et disparurent dans l’épais brouillard qui couvrait Paris.
Quand la porte d’entrée de la salle souterraine se fut refermée sur le dernier, le jeune homme qui avait présidé la séance alla pousser de nouveau les verrous ; puis, bien assuré qu’il était seul, il frappa contre une cloison en planches qui séparait ce compartiment de cave d’un autre compartiment, et dit :
– Maître, vous pouvez entrer.
Aussitôt la cloison tourna sur elle-même, faisant l’office d’une porte, et un homme enveloppé dans un grand manteau, pareil à celui que portaient les six valets-de-cœur, apparut, et dit d’une voix railleuse :
– Ma parole d’honneur, tu présides comme un juge, Rocambole.
– N’est-ce pas, capitaine ?
Et Rocambole, car c’était lui que nous retrouvons ainsi métamorphosé, salua avec respect le capitaine, sir Williams, c’est-à-dire le vicomte Andréa, le frère du trop crédule Armand de Kergaz.
– Oui, continua le capitaine, tu présides comme un vrai magistrat, et, l’œil collé à une fente de la cloison, je ne t’ai pas perdu de vue un seul instant… C’est à ne jamais croire que tu as été cet affreux vaurien qui fit tomber la tête innocente du pauvre Nicolo.
– Ah ! capitaine, murmura Rocambole avec humilité, vous savez bien…
– Le fils adoptif de la veuve Fipart, poursuivit le baronet sir Williams, qui vendit la mèche du capitaine au dernier moment pour quelques billets de mille…
Et le baronet accentuait ce reproche sans la moindre aigreur.
– Cependant, répliqua Rocambole avec flegme, vous êtes un esprit trop supérieur pour ne point comprendre et excuser ma conduite d’alors. Alors, voyez-vous, je n’étais qu’un de vos agents subalternes, vous ne m’aviez pas fait mon éducation comme aujourd’hui ; enfin je n’étais point votre fils…
– C’est vrai, drôle…
– Et puis, vous ne saviez pas ce que je deviendrais, et moi j’ignorais ce que vous étiez… un homme fort !
– Heu ! heu ! fit Andréa d’un air modeste.
– Vous veniez de perdre la partie, vous étiez ruiné ; je trouvais mon compte à vous vendre, je vous ai vendu. À ma place vous en eussiez fait autant…
– Parbleu ! dit froidement le baronet.
– Depuis, acheva Rocambole, nous avons fait la paix, en gens qui s’aiment et s’estiment ; vous avez fait de moi un élégant, un homme du monde ; vous m’avez adopté comme votre fils. À New York, où nous avons travaillé, vous m’avez initié à tous les mystères de notre art… Bref, aujourd’hui, c’est, entre nous, à la vie et à la mort ; je suis votre esclave… je me ferais faucher vingt fois pour vous.
– Allons donc ! fit le baronet avec dédain, est-ce qu’on fauche des gens comme nous ?
Et il ajouta, avec ce terrible sourire qui jadis faisait frissonner Armand de Kergaz lui-même :
– Mais, trêve de reconnaissance aujourd’hui, monsieur le vicomte de Cambolh… Eh ! eh ! s’interrompit-il, avoue que je t’ai joliment redressé ton nom.
– Vous êtes un homme de génie, fit Rocambole avec admiration.
– Monsieur le vicomte de Cambolh, avec un h à la fin, cela frise la noblesse historique. Tu es d’origine suédoise, entends-tu bien ?
– Mon père, répliqua gravement le vaurien devenu gentleman, mon père, le général marquis de Cambolh, a quitté la Suède lors de l’avènement de Bernadotte au trône. Il était trop fier pour servir un étranger.
– Parfait ! dit sir Williams ; l’accent est simple, convaincu, le geste est digne. Parfait ! mais en attendant, mon drôle, donne-moi à souper, car le chef des Valets-de-Cœur meurt littéralement de faim.
– Venez, dit Rocambole ; montons chez moi. Vous allez trouver le couvert mis et de quoi vous refaire de vos austérités de la journée. Oh ! le saint homme, ajouta-t-il en riant, que mon pauvre père adoptif !… il vit de haricots et se donne la discipline…
– C’est l’incendie de ma vengeance qui couve ! répondit sir Williams, dont l’œil étincela comme un charbon ardent. Armand de Kergaz n’en est pas quitte avec moi.
IV
Rocambole alla à la porte et l’ouvrit.
– Venez, répéta-t-il en prenant sir Williams par la main et l’entraînant.
Il lui fit gravir sans lumière l’escalier qui conduisait à l’allée noire ; puis, au lieu de suivre cette allée, il posa le pied sur les marches d’un autre escalier.
Celui-là conduisait au premier étage de la maison, qui paraissait, du reste, inhabitée.
En sortant de la cave, Rocambole avait soufflé la lampe ; de telle façon qu’il marchait avec Andréa dans une obscurité complète.
Mais, au premier étage, le président des Valets-de-Cœur s’arrêta, chercha une porte et une serrure à tâtons, introduisit une clef, et aux ténèbres de l’escalier succédèrent presque aussitôt les clartés douteuses d’une lampe à abat-jour, que le capitaine aperçut à l’extrémité d’une sorte de cabinet de toilette encombré de vêtements, de malles et de tous les objets qu’entasse un garçon dans une pièce de débarras.
Rocambole entra. Le capitaine le suivit, et, quand la porte mystérieuse se fut refermée sur eux, ce dernier put remarquer qu’elle était si parfaitement dissimulée par un portemanteau qu’il était impossible, à ceux qui entraient dans le cabinet de toilette par une autre issue, d’en soupçonner même l’existence.
– Vous voyez, mon oncle, dit Rocambole, qu’à présent M. le vicomte de Cambolh n’a plus rien de commun avec cet affreux voisin qui préside les Valets-de-Cœur et se glisse dans une cave par un escalier borgne.
Ce disant, Rocambole se mit à rire et poussa une seconde porte.
Le baronet sir Williams se trouva alors sur le seuil de la chambre à coucher du lion, une chambre coquette, mignonne, respirant un luxe sobre et délicat, tel qu’aurait pu le rêver une femme du monde artistique et galant.
Une épaisse moquette à fleurs d’un rouge pâle, se détachant sur un fond blanc, jonchait le sol ; une étoffe de même couleur servait de rideaux et de portières. Le lit était un bijou de sculpture imitant le vieux chêne ; un meuble de Boule se dressait entre les deux croisées, surmonté d’une petite glace de Venise. Çà et là des tableaux de maître de petite dimension, une panoplie dans le fond du lit, dont les tentures étaient semblables aux rideaux, aux tapis et aux meubles.
Un grand feu flambait dans la cheminée.
– Capitaine, dit Rocambole en avançant à son chef un immense fauteuil confortable, je vais vous faire servir auprès du feu. Nous serons plus à notre aise ici que dans le salon. C’est une canaille d’honnête homme que je vais chasser au premier jour.
– Comme tu voudras, mon fils, répondit le baronet avec une indulgence toute paternelle.
Rocambole passa dans le salon, une fort belle pièce, un peu basse de plafond, comme la chambre à coucher, et gagna une toute petite salle à manger dans laquelle un valet sommeillait sur une banquette, et où était dressée une petite table toute servie.
– Jacques, dit-il en éveillant le laquais, roule cette table dans ma chambre, je souperai au coin du feu… avec mon oncle.
C’était ainsi que Rocambole désignait le baronet.
Le valet obéit et transporta dans la chambre à coucher le souper de son maître, qui consistait en une volaille froide, un pâté, quelques douzaines d’huîtres et deux flacons de vieux vin, d’une couleur jaunâtre merveilleuse. Le baronet, qui, sans doute, ne venait point chez son élève pour la première fois, avait repris, dans son fauteuil, cette attitude pleine d’humilité et de bonhomie craintive qu’il avait chez le comte Armand de Kergaz.
Pour le valet de Rocambole, le baronet sir Williams n’était plus que l’oncle Guillaume, un provincial dévot et riche dont on cultivait l’héritage.
– Tu peux aller te coucher, Jacques, dit Rocambole.
Le valet s’inclina et sortit.
Rocambole ferma la porte, fit glisser la portière sur sa tringle et revint s’asseoir près du feu, de l’autre côté de la table.
Le baronet avait déjà entamé bravement la volaille froide et décoiffé l’un des flacons.
– Nous sommes seuls, mon oncle, dit Rocambole ; nous pouvons causer.
– Et nous causerons, mon fils, car j’ai de longues instructions à te donner. Mais, d’abord, où en sont tes finances ?
– Les miennes ou celles du club ?
– Les tiennes, parbleu !
– Dame ! fit Rocambole avec ingénuité, elles sont basses, mon oncle. J’ai perdu hier cent louis… à mon cercle ; vous me l’aviez conseillé.
– Bien ! très bien ! il faut savoir perdre. C’est semer peu pour récolter beaucoup.
– J’ai trois chevaux à l’écurie, poursuivit Rocambole, un valet de chambre, un garçon. Titine me coûte les yeux de la tête…
– Tu la quitteras. Titine est une femme vulgaire, elle engraisse au moral comme au physique, et j’ai renoncé aux projets que j’avais sur elle. Je te trouverai mieux.
– Tout cela, poursuivit Rocambole, sagement additionné, compose bien un budget de quarante mille livres de rente.
– Comment ! drôle, fit le baronet sans trop d’aigreur, tu dépasses ce chiffre ?
– Pas encore, mais vous pourriez bien, mon oncle, faire quelque chose de plus.
– Soit, si tu travailles en conséquence.
– Dame ! il me semble que je vais assez bien jusqu’ici…
– Peuh ! c’est selon…
Et sir Williams eut un sourire bonhomme, tout en plongeant sa fourchette jusqu’au manche dans le pâté de foie gras.
– Quand vous donneriez un billet de mille de plus…
– Par an ou par mois ?
– Par mois, mon oncle.
– Mon fils, fit gravement le baronet, Dieu m’est témoin que je ne suis pas un de ces ladres qui lésinent en affaires et font des économies de bouts de chandelle…
– Oh ! je le sais bien, dit Rocambole.
– Mais, cependant, j’entends ce que nous appelons le commerce, et j’ai un principe invariable ; à chacun selon ses œuvres.
– Ceci est une maxime évangélique, mon oncle.
– C’est la mienne, fit le baronet qui redevint par son attitude le grand coupable repenti, le saint dont le comte et la comtesse de Kergaz vantaient les vertus. Donc, poursuivit-il, si tu gagnes le billet de mille francs mensuel que tu demandes, je ne vois aucun inconvénient à te l’accorder.
– Vous savez bien, mon oncle, que je ne boude pas à l’ouvrage.
– Ah ! c’est que, dit sir Williams, il ne s’agit plus aujourd’hui d’une besogne vulgaire, de quelques chiffons amoureux à soustraire de droite et de gauche pour les revendre ; nous avons mieux que cela à faire.
– Je m’en doute, mon oncle, car vous m’avez dit que l’affaire était bonne…
– Elle est colossale… gigantesque… répondit froidement le baronet.
– Peut-on savoir ?…
– Certainement, puisque j’ai toute confiance en toi.
– Elle est assez bien placée votre confiance, mon oncle, dit Rocambole avec calme ; je ne suis plus assez bête pour vous trahir ; on ne se brouille pas avec le génie.
– Il est certain, dit le baronet avec son calme habituel, qu’entre gens comme nous, le dévouement, la reconnaissance, l’affection, sont autant de mots vides de sens. De toi à moi, il y a des intérêts. L’amitié vraie n’a pas d’autre loi.
– Vous parlez d’or, mon oncle.
– Si tu trouves mieux que moi, c’est-à-dire un homme plus fort, plus intelligent, qui t’estime autant que je le fais et t’offre plus d’avantages, tu serais un niais de me rester fidèle.
– Je n’ai jamais été niais, dit Rocambole en versant à boire au baronet.
– Mais comme tu ne trouveras pas, je ne vois aucun inconvénient à te confier une partie de mes plans.
– Voyons !
– D’abord, dit sir Williams, procédons par ordre et remontons un peu haut. Comment as-tu trouvé ma petite comédie pour rentrer dans le domicile fraternel ?
– Oh ! parfaite, dit Rocambole avec l’accent d’une sincère admiration. L’évanouissement sur la route était si merveilleusement joué, que si je n’avais été précisément le postillon, vous eussiez été écrasé… La scène de reconnaissance, le repentir, les remords, la vie pénitente, tout cela est très fort, mon oncle.
– N’est-ce pas ? fit sir Williams, satisfait des éloges.
– Seulement, reprit Rocambole, je ne comprends pas que vous ayez la fantaisie de continuer longtemps ce rôle. Ce doit être assez assommant de vivre éternellement au sein de la vertu.
– Peuh ! on s’y fait. Il faut bien, du reste, que je prépare ma petite vengeance, et ils sont sur ma liste.
Et le baronet compta sur ses doigts.
– Il y a d’abord Armand : à tout seigneur tout honneur.
– Vous savez, dit Rocambole, que j’ai à son service un joli coup de couteau.
– Pas encore… Diable ! comme tu y vas… L’enfant hériterait… et puis, Jeanne ne m’aime pas encore, et il faut que Jeanne m’aime.
Le sourire infernal qui passa alors sur les lèvres du baronet eût glacé d’épouvante le comte Armand de Kergaz.
– Après lui, dit sir Williams continuant son énumération, nous avons mademoiselle Baccarat. Oh ! celle-là, le jour où je la tiendrai, elle versera des larmes de feu, et regrettera de s’être évadée de chez Blanche.
– Une belle fille, cependant, observa Rocambole, mais qui a fait une vilaine fin. Si elle avait été gentille, elle avait un bien bel avenir… Une femme comme elle dans vos mains, mon oncle, aurait fait un fier chemin !
– J’en ai une de ce genre à ma dévotion.
– Oh ! oh ! la verrai-je ?
– On vous la donnera si vous êtes sage, répliqua le baronet avec cet accent bonhomme d’un père qui promet un jouet à son fils.
– Ma parole d’honneur, mon oncle ! s’écria Rocambole ému, si la sensibilité n’était pas une bêtise indigne de gens comme nous, je vous baiserais les mains. Vous êtes une crème d’oncle !
– À la mode bretonne, répondit sir Williams en riant. Mais comptons toujours… Après Baccarat, tu penses bien que je n’oublierai pas notre ami Fernand Rocher. Celui-là n’a pas voulu aller au bagne innocent… eh bien, on l’y enverra coupable. Il est trop riche pour devenir voleur, mais on en fera un assassin… Tu le sais, l’amour est une chose utile.
– Et mademoiselle Hermine ? interrogea Rocambole.
– Mon cher, dit le baronet avec un calme terrible, quand j’ai daigné songer à une femme que je n’aimais pas pour en faire la mienne, et que cette femme m’a refusé, elle peut être assurée d’une chose, c’est que je creuse à ses pieds, et peu à peu, un gouffre où elle engloutira son honneur, sa réputation, son repos, et toute sa vie à venir.
– Et de trois ! fit Rocambole.
– Puis, continua le baronet, nous ferons évidemment quelque chose pour cet honnête Léon Rolland, un imbécile qui m’a fait tuer mon pauvre Colar.
– Et Cerise ? demanda le vaurien.
– Entre nous, dit sir Williams, je n’en veux pas à Cerise. Seulement, cette vieille canaille de Beaupréau, pour qui j’ai toujours un faible, en est amoureux comme au premier jour, et je lui ai fait des promesses.
– Est-ce tout ? demanda Rocambole.
– Oui… je crois.
– Mais… Jeanne ?
– Oh ! celle-là, dit sir Williams, je ne la hais pas… je l’aime !
Ce mot, dans la bouche du terrible chef des Valets-de-Cœur, c’était, dans un ténébreux avenir, l’arrêt de mort du comte de Kergaz.
– Mon oncle, dit Rocambole, pourrait-on savoir ce que vous comptez faire à l’endroit de tous ces gens-là ?
– Non, répondit nettement le baronet, et cette question est une niaiserie dans ta bouche. Tu ne sais donc pas, mon fils, que l’homme qui veut se venger doit se taire à lui-même le secret de sa vengeance ? On peut dire à un associé le mot d’une affaire ; l’énigme d’une vengeance, jamais.
– Ainsi, vous continuerez à porter la nuit un cilice inoffensif ?
– Sans doute.
– À vous affubler de cette houppelande, et à coucher, l’hiver, dans une chambre sans feu ?
– Oui.
– À travailler douze heures par jour pour tenir les écritures d’un boutiquier ?
– Non, car mon bien-aimé frère Armand vient de me donner une autre besogne.
– Vous aurait-il fait son intendant ? demanda railleusement Rocambole.
– Mieux que cela, mon fils. Il m’a nommé le chef de sa police.
Rocambole, qui élevait son verre à ses lèvres en ce moment, le reposa brusquement sur la table et partit d’un grand éclat de rire.
– Pas possible ! s’écria-t-il.
– Oui, mon fils, continua le baronet dont l’œil brillait d’une infernale joie, voilà jusqu’à quel point cet homme est fort : il a une police… tu sais, par Satan, quelle police ! une réunion de sourds et d’aveugles. Cette police a mis la main sur le seul document que j’aie cru devoir laisser courir le monde, c’est-à-dire une petite note concernant les Valets-de-Cœur.
– Sangdieu ! fit Rocambole en sautant sur son siège, qu’avez-vous fait là, mon oncle ?
– Une bien belle chose, mon fils… J’ai posé un paratonnerre, car, écoute-moi bien, si bête que soit la police d’un philanthrope, elle peut avoir des hasards, de la chance, laisser couler un avis utile dans l’oreille d’un préfet de police, – enfin devenir embêtante à un moment donné…
– C’est vrai, dit Rocambole, touché de la justesse du raisonnement.
– Or, poursuivit sir Williams, le meilleur moyen de paralyser cette police était de la diriger. J’ai adopté ce moyen. J’ai laissé traîner un document en bon lieu. Ce document parlait des Valets-de-Cœur, de leur association et de leur but. Là s’arrêtaient les détails. Armand, cet homme fort, s’est empressé de me confier la grave mission de découvrir les chefs de la bande, ses moyens d’action, ses statuts.
– Eh bien, demanda le président des Valets-de-Cœur, qu’en ferez-vous ?
– Je démasquerai ces bandits.
– Hein ? fit Rocambole stupéfait.
– C’est-à-dire que tu affilieras quatre ou cinq drôles auxquels nous ne dirons que peu de chose, à qui nous donnerons une besogne insignifiante… puis je les prendrai sur le fait, et la police correctionnelle ou le tribunal mystérieux de mon bien-aimé frère en feront bonne justice. Cela fait, l’association des Valets-de-Cœur n’existera plus. Elle aura été la réunion de quatre ou cinq drôles de bas étage, et la société sera sauvée… grâce à moi. Heu ! qu’en dis-tu ?
– Mon oncle, murmura Rocambole stupéfait d’admiration, vous êtes un homme de génie !
– Il faut bien être quelque chose en ce monde, répondit modestement sir Williams.
– Ah ! çà, reprit Rocambole, tout cela est bel et bon, mais si vous gardez pour vous seul le secret de votre vengeance, je devrais au moins savoir quelque chose de cette fameuse opération que vous qualifiez de gigantesque et pour laquelle vous m’avez fait réunir les six Valets-de-Cœur que vous avez vus ce soir.
– Je vais te dire ce qu’il est indispensable que tu saches.
– Voilà tout.
– Voilà tout, mon fils. Un homme prudent doit garder son dernier mot comme une poire pour la soif.
Le baronet repoussa la table, car il avait achevé son repas, alluma un cigare, se renversa dans son fauteuil, aspira et rendit quelques gorgées de fumée, et dit :
– Tu sais déjà que le marquis Van-Hop est un riche Hollandais qui passe les hivers à Paris. On lui donne cinq ou six cent mille livres de rente ; mais cette fortune est une misère auprès de celle qu’il pourrait avoir s’il n’était pas marié.
– Tiens, dit Rocambole, voilà qui est bizarre.
– Voici comment, continua le baronet. Le marquis Van-Hop avait un oncle ; cet oncle quitta la Haye pauvre comme Job, avec une pacotille sur le dos. Il alla aux Indes, y servit la Compagnie et y fit une fortune fabuleuse. Il a laissé vingt millions à sa fille unique, l’enfant d’une Indienne, une femme qui a tous les instincts du sauvage unis à toute l’éducation d’une fille de nabab retirée à Londres et pensionnée royalement par Sa Majesté britannique.
– Tiens ! interrompit Rocambole, voici qui commence à peu près comme un roman.
– Le roman est l’histoire de la vie, mon fils, répliqua gravement le baronet. Mais je continue. Il y a dix ans, le marquis alla aux Indes voir son oncle ; il y inspira un violent amour à sa cousine, et sa cousine déclara résolument à son père qu’elle n’épouserait jamais un autre homme que lui. Malheureusement le marquis annonçait alors un voyage autour du monde, comme doit le faire tout honnête Hollandais, voué par ses aïeux au culte des missions. Le marquis avait commencé son voyage par les Antilles ; il s’était arrêté à la Havane espagnole, et il y avait vu et aimé sur-le-champ une jeune créole qui se nommait Pepa Alvarez. Le marquis était jeune, il n’était pas encore possédé de la soif de l’or ; il se trouvait assez riche, et au lieu d’épouser sa cousine, il s’en retourna à la Havane, où il fit la señorita Pepa Alvarez marquise Van-Hop.
– Le niais ! murmura Rocambole, peut-on cracher ainsi sur vingt millions !
– Il en avait six…
– C’est une mauvaise raison, mon oncle.
– Soit, je poursuis. Mais le marquis était loin de s’imaginer quel volcan de passion il avait allumé dans le cœur de cette fille du ciel indien. Elle l’aimait, elle l’aimait avec furie, comme les bonzes de son brûlant pays aiment le dieu Siva, et elle eût tordu, éventré elle-même, arraché avec ses ongles le cœur de la Havanaise, lorsqu’elle apprit, au bout de trois ans, pourquoi son beau cousin, qu’elle attendait toujours, ne revenait pas… Il y a huit ans que le marquis est marié, il y en a cinq que l’Indienne rêve une de ces vengeances splendides comme je sais les comprendre…
– Elle hait donc le marquis ?
– Non, elle l’adore plus que jamais.
– Mon Dieu ! fit ingénument Rocambole, il est pourtant facile de se débarrasser d’une rivale, quand on est née dans l’Inde et qu’on a vingt millions.
Sir Williams haussa les épaules.
– Tu es jeune, mon fils, dit-il avec dédain.
Rocambole le regarda.
– Dame ! fit-il, il me semble qu’il y a cinquante manières différentes de rendre un homme veuf. Si l’Indienne me donnait cent mille francs, à moi…
– Elle m’a promis cinq millions, dit froidement le baronet.
Rocambole jeta un cri de stupéfaction.
– Et la marquise vit encore ? dit-il.
– Oui, fit le baronet d’un signe de tête.
– Mais alors elle vous les a promis… il y a… une heure.
– Non, il y a un an.
– Et vous avez… attendu ?
– Mon fils, dit le baronet, la petite conversation que nous avons ensemble me confirme dans une opinion que j’avais déjà sur toi…
– Laquelle, mon oncle ?
– C’est que tu manques de pénétration. Tu as de bonnes dispositions, tu exécutes assez bien un plan, mais…
– Mais ? interrogea Rocambole, qui se mordit les lèvres.
– Tu ne sais pas le concevoir. Au surplus, tu es jeune, cela viendra.
Et le baronet ajouta d’un ton plus doux :
– Comment, étourdi, tu t’imagines que lorsqu’une femme aime éperdument un homme, lequel ne l’aime pas et aime, au contraire, une autre femme, il suffit de faire assassiner ou empoisonner cette dernière pour arriver jusqu’à lui ?…
– C’est juste, mon oncle.
– Mais comprends donc, jeune brute, que le marquis aime sa femme ; que si sa femme mourait, il serait capable de se tuer, ce qui fait que l’Indienne en serait pour ses frais…
– Je comprends cela, mon oncle.
– Par conséquent, mon cher niais, il faut que le jour où la marquise mourra, son mari ait cessé de l’aimer… et cependant il ne faut pas qu’il en aime une autre que l’Indienne.
– Diable ! voilà qui se complique étrangement, il me semble.
– Alors l’Indienne, qui a parfaitement saisi la justesse de ce raisonnement, et qui, cependant, ne veut pas renoncer à son amour, n’a eu d’autre ressource que de se jeter dans mes bras et de m’offrir cinq millions.
– Où l’avez-vous rencontrée ? demanda Rocambole, intrigué.
– À New York, l’année dernière. Oh ! c’est toute une histoire, et je veux bien te la dire.
– Voyons ! interrogea Rocambole.
V
Le baronet alluma un second cigare et reprit :
– C’était quelques jours avant notre départ de New York. Notre voyage n’avait pas manqué de péripéties et d’aventures : nous avions eu des hauts et des bas. La police américaine est bonne fille, mais je ne connais pas de plus mauvais pays que les États-Unis pour y vivre honnêtement. On n’y peut traiter en grand aucune affaire. Bref, je n’emportais guère en Europe qu’une centaine de mille francs, une misère, quand on songe que nous étions depuis trois ans en Amérique.
« Un soir, comme je rentrais à notre hôtel, je vis passer une voiture attelée de quatre chevaux et conduite à la daumont.
« Au fond de cette voiture, j’aperçus une femme de vingt-cinq à trente ans.
« Elle avait une figure étrange et de celles qu’on n’oublie jamais.
« Pour un Européen, c’est-à-dire un homme qui n’est point initié à tous les mystères des croisements de race, cette femme était blanche ; on aurait pu, à son costume, la prendre pour une Parisienne brune. Pour moi, c’était une femme de couleur ; non pas la femme qui a du sang noir dans les veines, mais du sang indien, du sang de la race jaune, qui adore le dieu Siva, et croit au paradis de Vichnou.
« Tous les appétits sauvages, toutes les passions volcaniques de cette race éclose aux feux d’un ciel torride se peignaient sur le visage de cette créature, vêtue à l’européenne comme pour aller à Longchamps, et qu’emportait un landau, produit élégant de l’industrie parisienne.
– Mon oncle, interrompit Rocambole, en prenant à son tour un trabucos sur l’assiette de vieux saxe posée sur la table et l’allumant à la bougie, ce n’est pas que je tienne à vous faire un compliment, mais vous contez à ravir. Je crois lire un feuilleton en vous écoutant.
Le baronet sourit et continua :
– Cette femme et moi nous échangeâmes un regard. Puisque tu fais des comparaisons littéraires, je continuerai ta métaphore, et te dirai qu’il y a souvent tout un poème dans un simple regard échangé. J’eus à peine envisagé l’Indienne que je devinai qu’il y avait tout un drame dans cette existence menée à la daumont ; et, de son côté, elle pressentit, au regard ardent que j’attachai sur elle, que j’étais peut-être l’homme qu’elle cherchait. Elle donna un ordre, obéissant à une sorte d’inspiration soudaine, et la voiture s’arrêta.
« De mon côté, je fus attiré par une sorte de bizarre fascination vers cette voiture, et je la regardai, attachant sur elle cet œil froid, investigateur, que tu me connais et qui pénètre jusqu’au fond de l’âme.
« – Que cherchez-vous ? lui dis-je.
« – Un homme fort, me répondit-elle avec un accent où couvaient des tempêtes de courroux longtemps concentré.
« – Vous êtes une folle d’amour, lui dis-je, et vous avez dans l’âme les brûlantes colères d’une tigresse à qui l’on a enlevé son tigre.
« – Oui, me répondit-elle, je hais à mort.
« – La vengeance coûte cher.
« – J’ai vingt millions, dit-elle froidement.
« Je n’en écoutai pas davantage et je m’élançai à côté d’elle.
« Elle fit un signe. L’équipage repartit au grand trot, et ne s’arrêta qu’à la grille d’une petite villa entourée d’arbres et située hors de la ville.
« Je descendis le premier et lui offris la main. Elle me conduisit dans la pièce la plus reculée de la villa, s’y enferma avec moi, me fit asseoir auprès d’elle sur un lit de repos, et me raconta l’histoire que tu sais.
« – Je ne vous ai jamais vu, me dit-elle, je ne sais ni qui vous êtes, ni de quel pays vous venez ; mais j’ai lu dans vos yeux que vous étiez celui que j’attendais pour me venger.
« – Vous avez raison, répondis-je, je suis le vengeur par excellence. Que voulez-vous faire ?
« – J’aime mon cousin, je veux l’épouser.
« – Pour cela, dis-je, il faut que la marquise meure.
« – Je le sais, et rien ne serait plus facile. J’ai des esclaves qui, sur un mot de moi, iraient poignarder ma rivale. Morte, il l’aimera encore, et je ne veux plus qu’il l’aime.
« – Que donneriez-vous, lui dis-je, à celui qui aplanirait tous ces obstacles, qui supprimerait la marquise et vous ferait aimer de votre cousin ?
« – Tout ce qu’il voudrait !
« – Eh bien, lui dis-je, le jour où vous serez marquise Van-Hop et femme aimée, vous me donnerez cinq millions !
« – Et elle sera morte ?
« – De mort violente.
« – Morte et oubliée ?
« – Morte et exécrée par celui qui l’aura adorée.
« Elle attacha sur moi son brûlant regard qui semblait vouloir lire au fond de ma pensée.
« – Vous dites, fit-elle lentement, qu’elle mourra de mort violente ?
« – Oui.
« – De quelle main ?
« – De la main de son propre époux…
« L’Indienne jeta un cri de joie.
« – Oh ! dit-elle, est-ce possible ?
« – Tout est possible à Paris, quand j’y suis, madame.
« – Mais enfin…
« – Ah ! dis-je, vous voulez savoir ? C’est inutile. Qu’il vous suffise d’apprendre que, dans un an, la marquise sera morte assassinée et maudite par son mari, et que, deux mois après, vous épouserez votre cousin, qui passera le reste de sa vie à vos genoux.
« Elle se leva, alla vers un petit meuble placé dans le fond de la pièce, et l’ouvrit.
« C’était une sorte de secrétaire dans lequel elle prit une plume et du papier, et elle écrivit rapidement.
« – Voici, me dit-elle en me tendant deux lignes, de l’argent pour entrer en campagne.
« Je jetai les yeux sur le papier que je venais de saisir, et je lus :
“Bon pour la somme de cinq cent mille livres de France, payable chez M. Morton, mon banquier à Londres.
“Daï-Natha Van-Hop”
« L’Indienne faisait bien les choses, on pouvait sans crainte se mettre à son service. Puis elle traça un nouveau bon. Celui-là était conçu comme une lettre de change :
“À présentation, je payerai au porteur la somme de cinq millions.
“Daï-Natha, marquise Van-Hop.”
« – Vous mettrez la date, me dit-elle, le jour de mon mariage, car cette pièce n’aura de valeur qu’alors.
« – Madame, lui dis-je, je pars pour Paris, où le marquis Van-Hop passe ses hivers. Ne vous occupez pas de moi, soyez patiente et ayez foi dans mes promesses. Si un jour vous recevez une lettre sans signature, timbrée de Bougival, près de Paris, et dans laquelle on vous dira de venir, accourez… Je laissai l’Indienne, et deux jours après nous étions en pleine mer. »
– Et… demanda Rocambole, avez-vous revu Daï-Natha, mon oncle ?
– Hier, répondit le baronet.
– Elle est à Paris ?
– Depuis deux jours. Elle attend…
Un sourire glissa sur les lèvres de sir Williams, et Rocambole comprit que la marquise Van-Hop était condamnée à mort, au prix de cinq millions cinq cent mille francs. Le baronet buvait du café à petites gorgées et allumait un troisième cigare.
– Mon oncle, interrogea Rocambole, un mot encore s’il vous plaît ?
– Je t’ai dit tout ce que je pouvais te dire pour le moment.
– Soit pour la marquise, car je comprends vaguement le drame terrible que vous préparez en vous mettant à la place du hasard… Mais cette madame Malassis ?
– Ceci, dit le baronet, est un épisode de notre action, de ce drame terrible, comme on dit. En apparence, madame Malassis n’a rien de commun avec la marquise Van Hop ; mais, en réalité, ces deux femmes se tiennent par la main.
– Comment ? fit Rocambole.
– Le marquis Van-Hop est lié avec le duc de Château-Mailly.
– Il est son banquier, n’est ce pas ?
– D’abord. Ensuite, il se trouve flatté, en sa qualité d’étranger, d’avoir pu produire sa femme dans le faubourg Saint-Germain, dont le duc est une des clefs de voûte.
– Mais madame Malassis ?
– Madame Malassis est la maîtresse du duc.
– Je le sais.
– Le duc l’épousera… si on le laisse faire, et il déshéritera ainsi son neveu.
– Le neveu vous intéresse, peut-être ?
– Non, mais il abandonnera cinq cent mille francs sur la succession de son oncle, si son oncle meurt d’apoplexie foudroyante.
– Cinq cent mille francs ne sont pas cinq millions. L’Indienne est plus généreuse.
– C’est incontestable ; mais il y a encore plusieurs raisons pour mener de front ces deux affaires.
– Ah ! fit Rocambole intrigué.
– D’abord, reprit le baronet, le marquis Van-Hop et sa femme ignorent complètement de quelle nature sont les relations de madame Malassis et du vieux duc ; mais ils savent que le duc en est amoureux, et qu’il a l’intention de l’épouser. La marquise aime madame Malassis comme sa sœur, et la croyant la plus honnête des femmes, elle souhaite de tout son cœur voir la veuve épousée par le duc.
« Mais le marquis a une raison de plus, une raison de haine jalouse.
« Le marquis aime sa femme et il est jaloux de son ombre. Le neveu, l’héritier présomptif de M. de Château-Mailly, présenté chez lui, il y a deux ans, a fait la cour à la marquise, et, bien qu’il ait échoué, il s’est fait du mari un ennemi mortel. Le marquis Van-Hop est l’ami du vieux duc le plus acharné à lui conseiller d’épouser madame Malassis.
– Est-ce tout ? demanda froidement Rocambole, car enfin, jusqu’à présent, je ne vois aucune raison capitale, aucun motif sérieux de réunir les deux affaires.
– C’est vrai, à tout prendre. Eh bien ! la véritable cause de mes projets est une raison spécieuse en apparence. Elle se résume en deux mots : deux femmes tombent plus aisément qu’une seule.
« Le jour où madame Malassis aura un amour au cœur, et elle est dans l’âge où les femmes en ont de terribles, elle se laissera aller à une confidence ; le jour où elle aura reçu cette confidence, la marquise se sentira toute troublée, si déjà Chérubin papillonne autour d’elle, et se confiera à son tour à madame Malassis.
– Tout ceci est fort juste, mon oncle ; mais…
– Mais ? fit le baronet en fronçant le sourcil.
– Il y a encore autre chose…
– C’est possible ; seulement c’est le dernier mot de l’affaire, et tu ne le sauras pas…
Et sir Williams se leva avec ce calme glacé de l’homme déterminé à garder son secret.
– Après tout, mon oncle, dit Rocambole résigné à n’en pas apprendre davantage, comme vous êtes la sagesse personnifiée, je vous demande pardon d’avoir été indiscret.
– Je te pardonne, mon fils.
– Et je me bornerai à une dernière question… Oh ! une misère… une question de chiffre ?
– Ah ! ah ! s’agirait-il de la question d’argent ?
– Juste, mon oncle.
– Que veux-tu savoir ?
– Voyons, continua le vaurien, vous m’avez fait votre lieutenant, et je dirige, d’après vos mystérieux conseils, tous les Valets-de-Cœur.
« Eh bien, il a été convenu que dans chaque opération, il y a trois parts : la moitié pour vous, le quart pour moi, l’autre quart pour les Valets.
– Ce qui est dit est dit, mon fils.
– Sera-ce de même dans l’affaire Van-Hop-Malassis ?
– À peu de chose près, c’est-à-dire qu’il y a un million pour toi, un million pour les bonshommes… Tiens ! s’interrompit sir Williams, ma parole d’honneur ! voilà un mot qui est bien trouvé. Si tu veux, nous nous en servirons pour désigner les Valets-de-Cœur.
– Soit. Mais cela ne fait que deux millions, mon oncle.
– C’est que j’en garde trois pour moi.
Et le baronet accentua ces mots avec une intonation nette et précise qui n’admettait pas la réplique.
Aussi Rocambole, dompté, courba-t-il le front sans mot dire.
– Mon bel ami, acheva le baronet, je compte épouser la veuve du comte Armand de Kergaz d’ici à un an ou deux, et je désire lui offrir une corbeille de noce convenable.
En parlant ainsi, le baronet boutonna sa redingote jusqu’au menton.
– Sonne, dit-il, tu vas me faire reconduire.
Il alla à une croisée, l’ouvrit, et plongea son regard dans la nuit.
– Le brouillard est dissipé, dit-il, les voitures roulent : fais atteler ton coupé. Ton cocher me laissera au Palais-Royal.
– Où et quand vous verrai-je ? demanda le président des Valets-de-Cœur.
– Dans trois jours…
Rocambole s’inclina, puis il sonna son groom. – Un groom microscopique, qui dormait sur une banquette de l’antichambre, parut.
– Attelle Leona au coupé, dit-il.
Le groom s’esquiva pour obéir.
Sir Williams s’enveloppa dans son manteau, cacha soigneusement son visage, et tendit la main à son lieutenant.
– Adieu, canaille ! dit-il en souriant.
– Au revoir, mon oncle !
– Tu te brouilleras avec Titine, n’est-ce pas ?
– Dès demain… Mais l’autre ?
– Qui, l’autre ?
– Celle que… enfin… vous savez ?
– Patience ! drôle… Tout vient à point à qui sait attendre.
Et le baronet quitta la chambre à coucher, traversa le salon et gagna l’antichambre, éclairé par Rocambole qui portait un petit candélabre à deux branches.
Il ouvrit lui-même la porte à son chef et le conduisit jusqu’au bas de l’escalier, où le coupé attendait.
On le voit, sir Williams s’en allait par une autre issue que celle qu’il avait prise pour entrer chez son lieutenant.
Rocambole habitait depuis trois mois cet entresol, où l’on arrivait par la porte cochère et le grand escalier d’un vaste hôtel converti en maison à locataires, et dont l’entrée et la façade principale donnaient sur le faubourg.
Les derrières touchaient ainsi à la petite maison borgne de la rue de Berri, et la communication secrète qui reliait l’entresol de l’hôtel et l’escalier en coquille de cette dernière construction était l’œuvre mystérieuse de Rocambole.
Le vaurien ouvrit lui-même la portière, abaissa le marchepied, offrit respectueusement la main au baronet pour l’aider à monter, et celui-ci cria au groom converti en cocher :
– Touche au Palais-Royal !
Des hauteurs du faubourg Saint-Honoré à la place du Palais-Royal, le coupé s’élança avec la rapidité d’une flèche, et déposa, en dix minutes, le baronet devant le Château-d’Eau.
Sir Williams donna dix francs au groom et le renvoya, puis il s’achemina à pied vers la rue de Valois et y entra d’un pas rapide.
– Ah ! ah ! se disait-il, tout en cheminant bien enveloppé dans son manteau, mon Rocambole a d’assez belles dispositions, et je crois que j’en ferai quelque chose ; mais il est curieux, le drôle… Ah ! il voulait savoir le dernier mot de l’énigme. Mais ce dernier mot, c’est ma vengeance car je sais seul les ramifications qui unissent ceux que je hais avec ceux que j’ai intérêt à frapper. Tous ces gens-là m’appartiennent par avance, et je les tiens déjà dans l’immense réseau que j’ourdis jour par jour et heure par heure depuis cinq ans…
Et sir Williams, s’arrêtant tout à coup, sembla prêter l’oreille, à ces bruits confus, à ces rumeurs indécises, à ces murmures inachevés qui s’élèvent, la nuit, de la ville gigantesque, et montant vers le ciel comme l’hymne incohérent, la chanson impie de la Babel moderne, et il se dit :
– Ô Paris ! Paris ! tu es la vraie Babylone, le vrai champ de bataille des intelligences, le vrai temple où le mal a son culte et ses pontifes, et je crois que le souffle de l’archange des ténèbres passe éternellement sur toi comme les brises sur l’infini des mers. Ô tempête immobile, océan de pierre, je veux être, au milieu de tes flots en courroux, cet aigle noir qui insulte à la foudre et dort souriant sur l’orage, sa grande aile étendue ; je veux être le génie du mal, le vautour des mers, de cette mer la plus perfide, et la plus tempétueuse, de celle où s’agitent et déferlent les passions humaines… Ô Armand de Kergaz ! toi que je hais comme les ténèbres exècrent la lumière, tu as été fou le jour où tu m’as défié…
Et le baronet continua sa marche, tourna le Palais-Royal, prit la rue Vivienne, et la descendit jusqu’au boulevard, qu’il traversa à la hauteur du faubourg Montmartre ; puis, suivant cette dernière voie, il gagna les hauteurs du quartier Bréda et s’arrêta à l’entrée de la cité des Martyrs.
Là, avant de sonner à la grille, il regarda attentivement les derniers étages d’une maison située sur la gauche de la Cité, et qui, aujourd’hui, porte le numéro 7. Au cinquième, il aperçut une fenêtre aux vitres de laquelle brillait une faible clarté.
– Bon ! dit-il, la chatte m’attend.
Et il sonna pour éveiller le concierge de la cité, lequel tira le cordon du fond de sa niche, et se contenta de demander le numéro de la maison où allait celui qui rentrait aussi tard, car deux heures du matin sonnaient en ce moment à Notre-Dame-de-Lorette.
Sir Williams souleva le marteau du numéro 7. La porte s’ouvrit, le baronet entra, et comme on ne lui demandait rien, il monta l’escalier de cinq étages, en dépit de l’obscurité. Il frappa à la porte qu’il trouva en face de lui.
– Qui est là ? fit une voix de femme à l’intérieur.
– Celui que vous attendez, répondit sir Williams.
Et le baronet ajouta mentalement :
– Décidément, la future rivale de Baccarat perche un peu haut. Mais elle est à la veille de se laisser choir de son paradis mansardé sur les coussins d’une calèche… Ainsi va le monde !
La porte s’ouvrit, et sir Williams se trouva face à face avec la plus merveilleuse créature qu’un peintre amant de l’idéal ait rêvée jamais pour en faire une Madeleine avant son repentir.
VI
La pièce dans laquelle pénétrait le baronet était d’une petitesse exiguë et d’un ameublement douteux.
C’était, dans toute l’acception du terme, le salon de la pécheresse à ses débuts, c’est-à-dire un luxe misérable de meubles achetés pièce à pièce, de rideaux fanés et venus du Temple, d’étagères, de niaiseries prétentieuses, telles que de faux saxes et des verres de Bohême du prix de vingt-neuf sous.
Un tapis usé couvrait le sol carrelé, une pendule brunie au feu étalait sous globe un sujet mythologique en composition, entre deux candélabres de même métal ; c’était l’opulence de la misère dans toute sa naïve crudité, dans son effronterie la plus complète.
Mais l’impression désagréable qu’on ressentait en entrant dans ce réduit disparaissait tout à coup en présence de la divinité qui occupait cet Olympe de cent sous.
C’était une fille de dix-neuf à vingt ans, petite, frêle, délicate, aux cheveux blonds, aux grands yeux d’un bleu sombre, qui semblaient réfléchir l’azur d’un ciel d’Orient, aux joues creusées d’une charmante fossette, à la taille svelte, souple, onduleuse comme une couleuvre.
Elle avait des pieds et des mains d’enfant, un sourire d’ange, qui tout à coup devenait un sourire de démon, un front large, blanc, légèrement bombé et qui décelait une haute intelligence. Jenny, c’était son nom, était encore ce papillon, larve hier, et qui essaye ses ailes novices ; mais déjà dans son regard, dans son attitude enchanteresse et pleine d’infernales séductions, on devinait quelle envergure avaient les siennes et quel vol puissant elles mesureraient un jour.
À vingt ans, Jenny savait déjà tout ce que doit savoir la femme qui entre dans cette arène meurtrière où l’homme devient l’ennemi ; la ville assiégée, la victime vouée aux dieux infernaux, le Prométhée dont le cœur sera confié à ces vautours aux serres roses, aux lèvres de carmin, aux dents éblouissantes de blancheur, entre lesquelles glisse éternellement le rire impie du scepticisme et de l’insensibilité.
Elle n’avait pas eu le temps d’apprendre, mais elle avait tout deviné, procédant ainsi de l’inconnu au connu.
À seize ans, Jenny était sortie d’une maison d’éducation et s’était trouvée orpheline, en présence d’un vieux tuteur infidèle et dépravé, qui lui avait volé sa fortune et lui offrait sa main et des rhumatismes en échange.
Jenny était sans pain, elle ignorait la vie : elle accepta. À dix-sept ans, Jenny s’aperçut que son mari était aux trois quarts ruiné par de fausses spéculations, et comme dans son pensionnat on lui avait appris le piano avant son catéchisme, qu’on lui avait donné le goût du luxe avant de lui inculquer de sérieux principes, comme enfin il est de certaines natures qui ont les instincts du mal en naissant, et que l’éducation ne saurait corriger, la jeune femme était une de ces natures : elle aimait le mal pour le mal, avec amour, avec art.
Elle haïssait son mari, et comme ce dernier lui avait volé sa fortune, comme il la condamnait à passer sa jeunesse auprès de sa vieillesse maussade et grondeuse, elle médita longtemps, longuement, avec tout le génie d’un forçat qui rêve une évasion, la rupture de son ban conjugal.
Un soir, la jeune femme s’endormit côte à côte de son mari goutteux, tout en rêvant de cette vie dorée, de ce tourbillon de fêtes et de plaisirs où il est facile à une femme jeune, intelligente et belle de se laisser tomber des sommets ardus, des hauteurs escarpées de la vertu.
Le matin, quand le mari s’éveilla, il était seul…
L’oiseau s’était déniché…
À partir de ce moment, Jenny devint franchement pécheresse… Elle n’avait pas de cœur, elle ne ressentait ni remords ni scrupules ; elle avait, en fuyant le toit conjugal, déclaré la guerre à l’ordre social, et elle était partie armée de sa beauté, de son sourire de démon, de sa luxuriante jeunesse et de ses instincts spirituellement pervers.
Elle aurait dû trouver un équipage sur le seuil même de la maison qu’elle abandonnait, un hôtel et des laquais pour la recevoir.
Mais si l’esprit est à la femme, à coup sûr, comme l’a dit le grand poète, la bêtise est à l’homme ; et tant que durera le monde, on verra ces hommes qui se qualifient de viveurs et qui tirent vanité de pouvoir laisser couler des flots d’or aux pieds de femmes perdues, on verra, dis-je, ces hommes passer, le sourire de l’indifférence aux lèvres, auprès de ce qui est réellement jeune et beau, pour aller s’agenouiller devant quelques chiffons, quelques dentelles et un pot de fard, le tout recouvrant une beauté surannée qui cherche les demi-jours.
Jenny était belle, elle avait dix-huit ans alors ; elle ne trouva point d’équipage, elle ne trouva pas d’hôtel ; mais elle alla à pied s’installer dans un petit entresol de la rue Fléchier.
Elle commença par aiguiser ses griffes roses et affiler son sourire sur des employés à mille écus. Au bout d’un an, elle eut jeté le harpon sur un douzième d’agent de change, un fort joli jeune homme, qui la déménagea et lui meubla un appartement de deux mille cinq cents francs de loyer, rue Laffitte, lui donna un coupé bas et un groom.
Malheureusement, Jenny n’eût pas le temps de se lancer. À peine goûta-t-elle quelques heures de la vie élégante ; trois jours après sa morganatique union avec elle, le joli jeune homme eut une querelle, se battit au pistolet, et reçut une balle dans le front qui le tua raide.
Rien n’était payé encore du mobilier, de la voiture et de l’appartement. Le défunt avait un frère, un homme positif et peu galant, qui, en sa qualité d’héritier, mit la jeune femme à la porte.
À partir de ce moment jusqu’au jour où elle rencontra sir Williams, Jenny eut une existence livrée à mille vicissitudes…
Elle fut une de ces femmes dont on dit parfois : « Elle a tout ce qu’il lui faut pour réussir ; mais… elle n’a pas de chance ! »
Côtoyant sans cesse la misère, elle était la proie de ce démon hideux engendré par la galanterie moderne aux abois, qu’on nomme la marchande à la toilette ; perchée à un sixième étage, elle parvenait à redescendre à l’entresol, d’où elle était bientôt expulsée par un propriétaire exigeant.
– Et dire, murmurait-elle souvent en maudissant son mauvais guignon, qu’un jour viendra où j’aurai équipage…
Elle rencontra sir Williams.
Le baronet, nouveau Diogène, cherchait une femme, une femme dont il avait besoin pour l’exécution de ses plans ténébreux. Une heure de conversation, un rapide examen, suffirent à celui-ci pour constater ce qu’on pouvait attendre d’elle.
Le matin du jour où les Valets-de-Cœur s’étaient réunis sous la présidence de Rocambole, Jenny avait reçu le billet suivant :
« Attendez cette nuit, entre une heure et trois heures du matin ; la fortune vous arrivera peut-être sous la forme d’un homme que vous avez rencontré hier.
« Le baronet. »
Et, en effet, le baronet avait été exact au rendez-vous.
– Ma petite, dit-il en s’asseyant auprès du feu où flambaient deux maigres tisons, je te demande pardon de t’avoir fait attendre ainsi.
Jenny le regarda fixement :
– Il y a si longtemps que j’attends quelqu’un ou quelque chose, que… j’ai appris à être patiente.
Le baronet parut enchanté de cette réponse.
– Tu as raison, ma petite, dit-il, qui sait attendre est toujours fort.
Un éclair illumina l’azur des yeux de la jeune femme.
– Ah ! dit-elle, si mon heure vient…
– Elle viendra, sois-en sûre.
Elle plissa ses lèvres et mit à nu ses dents d’une éblouissante blancheur.
– Tenez, fit-elle, vous pouvez me donner des lingots à croquer, elles ne casseront pas.
Sir Williams lorgnait, en véritable connaisseur, ces épaules d’un galbe parfait, cette taille mince, frêle et d’une souplesse merveilleuse, ces pieds d’enfant qu’elle tenait, à moitié accroupie sur un coussin placé devant le feu, dans ses mains mignonnes, garnies de beaux ongles.
Il admirait surtout ce front intelligent et pensif, ce regard profond où se décelait une volonté despotique.
– Ma fille, lui dit-il après un silence, si tu le veux, nous allons causer.
– Soit, je vous écoute.
– Je ne te connaissais pas, il y a huit jours. Je t’ai vue une fois, et cela m’a suffi pour te juger. Tu es une femme très forte.
– Peut-être, fit modestement Jenny.
– Je n’ai pas l’habitude de faire des compliments, continua le baronet, et si je te dis ma façon de penser, c’est que je veux faire avec toi des affaires.
Et sir Williams appuya sur ce mot.
– Je suis prête à tout.
– Aimerais-tu un petit hôtel, rue Moncey ?
– Un hôtel ! fit Jenny éblouie.
– Entre cour et jardin, rue Moncey. C’est feu le baron d’O… qui l’a fait construire, il y a six ou sept ans, pour sa maîtresse, une belle fille, ma foi ! et qu’on appelait la Baccarat…
– J’en ai entendu parler, murmura Jenny avec une secrète admiration. Elle est donc tombée dans la dèche !
– Non, mais dans la vertu, ce qui revient au même, répondit le baronet.
Jenny leva les yeux au ciel d’une façon tragi-comique et s’écria :
– Encore une femme à la mer !
– Donc, reprit le baronet, on pourrait t’avoir le petit hôtel de la rue Moncey.
– Il est à vendre ?
– Non, il est à moi.
– À vous, grand Dieu !
Et Jenny salua ce monsieur à vêtements semi-ecclésiastiques, à large chapeau de quaker, auquel on aurait fait, sur sa mine, l’aumône d’un dîner.
– Je l’ai fait acheter, il y a trois mois, continua le baronet, par mon homme d’affaires, et je ne l’ai pas payé trop cher : cent soixante mille francs tout meublé ; c’est pour rien.
– Et… vous… me… le donneriez ? demanda Jenny, dont la voix tremblait d’émotion.
– Je n’ai pas dit cela précisément… je te le répète, ma petite, je fais des affaires.
Elle frappa du pied avec impatience.
– Voyons, dit-elle, expliquez-vous : qu’attendez-vous de moi ? seriez-vous amoureux ?…
Elle prononça ces derniers mots avec ironie.
Sir Williams répondit par un sourire ; ce sourire illumina si bien son visage, que sa beauté satanique reparut tout entière.
– Eh ! eh ! dit-il, tu ne m’as pas bien regardé : mon cher amour, car, sans cela, tu aurais pu voir qu’on pourrait plus mal tomber…
– Pardon, dit Jenny, mais vous êtes si mal accoutré, qu’on vous donne cinquante ans, et peut-être en avez-vous trente.
– Vingt-neuf, dit le baronet avec calme. Mais il ne s’agit point de moi, petite, et, si je le voulais, tu m’aimerais pour moi-même…
– Sans votre hôtel ?
– Sans mon hôtel.
L’accent de sir Williams était si convaincu et si moqueur à la fois, que Jenny en tressaillit.
– Après cela, dit-elle, vous êtes peut-être un homme hors ligne… Qui sait ?
– Je te parlais donc, reprit le baronet, d’un petit hôtel rue Moncey. Tu pourrais y être installée dès demain ; on te donnerait un coupé bas et trois chevaux.
L’œil de Jenny étincela comme celui d’une bête fauve à qui on promet une proie.
– Ton domestique se composerait d’une femme de chambre, d’un cocher, d’une cuisinière et d’un groom… Si tu es sage, on t’aura un coupon de loge aux Italiens.
Jenny écoutait haletante.
– Ah ! j’oubliais, dit le baronet. On te servira, tous tes frais couverts, mille écus par mois pour ta poche.
– Ah ! çà, mais, s’écria Jenny, vous voulez donc que je devienne folle ?
– Ma petite, répondit gravement sir Williams, il est probable que je compte beaucoup sur toi, puisque je te fais de semblables avances.
– Des avances ! vous spéculez donc ?
– Je joue sur un assez beau capital, ma fille.
– Qu’est-il ?
– C’est un homme qui possède douze millions.
– Douze millions, juste ciel ! murmura Jenny suffoquée. Ah ! si un pareil homme me tombait sous la main…
– Je compte te le donner.
La courtisane eut le vertige.
– Cet homme, poursuivit sir Williams, est marié. Il a une femme qu’il aime passionnément.
– On le détachera de cette affection, dit froidement Jenny.
– Je te le confierai, continua le baronet, qui donna à ce dernier mot si simple une terrible signification.
– Bon ! on vous le rendra comme vous l’aurez désiré.
– Je te donne trois mois, ma petite ; tâche de le ruiner et de le rendre idiot, je ne veux pas autre chose…
– Et les douze millions ?
– Ah ! ceci, c’est une autre affaire ; mais, plus tard nous en causerons… je suis désintéressé, pour le moment.
– Où me présenterez-vous le pigeon ?
– Je ne sais pas encore… nous verrons.
– Peut-on savoir son nom ?
– Mon Dieu, oui ; il se nomme Fernand Rocher, dit le baronet, qui se leva sur ces mots. Adieu… à demain !
– Bonsoir, papa, dit Jenny, toute frémissante, qui prit un flambeau pour l’éclairer.
Sir Williams fit un pas et revint vers elle :
– À propos, dit-il, tu n’a pas d’autre nom que celui de Jenny ? C’est vulgaire, cela ne dit rien.
– Cherchez m’en un autre.
– Il y a beaucoup de tes pareilles, ma fille, qui prennent des noms aristocratiques, c’est bête ! Madame Fontaine, qui se fait de Bellefontaine, n’en a pas moins été blanchisseuse, et madame de Saint-Alphonse, la petite Alphonsine. Personne ne croit à ces titres-là, qui, du reste, ne tirent pas l’œil. Ce qu’il faut, c’est un nom bizarre, original, quelque chose comme le topaze ou l’émeraude… Parbleu ! s’interrompit sir Williams, tu as les yeux d’un bleu sombre admirable, tu te nommeras la Turquoise.
– Joli ! s’écria Jenny.
– Adieu, Turquoise ! dit le baronet. À demain ton installation rue Moncey.
Et sir Williams quitta la rue Neuve-des-Martyrs et se dirigea vers l’hôtel de Kergaz, où il arriva un peu avant le jour. Au moment où il traversait la cour sur la pointe du pied, il vit briller une lumière aux fenêtres du second étage de l’hôtel.
– Tiens ! dit-il, ce pauvre Armand travaille. Ô la crème des philanthropes !
Alors, au lieu de monter furtivement à sa chambre, le baronet, reprenant cette attitude humble et timide qu’il avait toujours en présence de son frère, alla frapper à la porte du cabinet de travail de M. de Kergaz.
– Entrez ! dit Armand surpris.
Le comte avait passé la nuit au travail.
– Comment ! cher Andréa, dit-il en voyant apparaître son frère, vous n’êtes point couché à cette heure ?
– Je rentre à l’instant, mon frère.
– Vous rentrez ?
– Oui, j’ai passé la nuit dans Paris. Ah ! fit-il en souriant, puisque vous m’avez fait le chef de votre police, mon cher frère, il faut bien que je fasse mon devoir.
– Déjà ?
– Déjà. Je suis sur une trace ; à moi les Valets-de-Cœur !
– Comment ! dit M. de Kergaz, vous avez déjà des indices ?
– Chut ! répondit Andréa, ils sont si faibles encore, que je ne veux rien vous dire. Bonsoir, mon frère !
Et il s’en alla comme il était venu, le front baissé, l’œil fixé vers la terre, comme marchent les grands coupables.
– Pauvre frère ! pensa M. de Kergaz, quel repentir !
Le baronet monta dans sa chambrette, située sous les toits, et s’y enferma ; puis il alla s’asseoir devant une table, en ouvrit le tiroir fermé à clef et en tira un volumineux cahier manuscrit qu’il étala devant lui.
Sur la première page du manuscrit, on lisait : Journal de ma seconde vie.
Andréa le repenti, Andréa le saint bardé d’un cilice, écrivait, jour par jour, quelques lignes sur ce registre.
– Voilà pourtant, murmura-t-il avec son infernal sourire, un assez beau monument de patience… Trente lignes chaque jour, trente lignes pour exprimer mon repentir et l’amour secret qui me consume… Ma parole d’honneur ! s’interrompit-il, c’est une assez jolie invention. J’ai eu soin d’écrire en tête de la première page : « Ceci est le livre de ma vie, et personne ne le lira ; j’écris pour moi-même… » Ce qui fait que, un jour, par mégarde, cette clef restera après ce tiroir, ce tiroir entrouvert permettra de voir ce livre ; Armand le lira, et quand il verra une phrase comme celle-ci.
Le baronet ouvrit le cahier et lut :
« 3 Décembre.
« Ah ! que j’ai souffert ce soir !… Comme Jeanne était belle… Jeanne, celle que j’aime dans l’ombre comme l’oiseau de nuit ose humer la lumière, le forçat la liberté. Mon Dieu ! ne me pardonnerez-vous pas un jour, et ne croyez-vous pas que leurs caresses, ces baisers d’époux qu’ils se donnent en ma présence… Ah ! Seigneur, je forgeais moi-même l’instrument de mon supplice, le jour où j’enlevai Jeanne pour me venger ; je l’ai aimée du jour où mon infamie a eu creusé un abîme entre elle et moi… »
– Et cætera ! murmura le baronet en riant de son rire de démon. Le jour où Armand lira cela, il est capable de vouloir se tuer, par pur amour fraternel, afin de me laisser la touchante mission d’épouser sa veuve…
Et sir Williams tailla sa plume pour écrire ses trente lignes quotidiennes, tout en songeant à Fernand Rocher, qu’il allait frapper le premier.
VII
Rue de Buci-Saint-Germain, presque à l’entrée de la rue de Seine, il existait, à l’époque de notre récit, une vieille maison d’apparence semi-seigneuriale, qui avait dû appartenir, un siècle plus tôt, à quelque président à mortier ou à quelque riche procureur au Châtelet.
Ce n’était point une demeure de bourgeois, ce n’était pas un hôtel bâti par la noblesse ; c’était quelque chose d’intermédiaire qui révélait la magistrature, cette branche cadette de l’aristocratie française.
Une cour étroite, ouvrant sur la rue par une porte cochère, précédait le corps de logis, derrière lequel s’étendait un grand jardin mélancolique, dont les pelouses négligées, les arbres mal taillés, annonçaient l’incurie du propriétaire.
Cette maison, qui avait longtemps appartenu à une famille de province, laquelle dédaignait de la mettre en location, avait été vendue, il y avait environ six mois, à une jeune femme vêtue de noir, laquelle avait payé son acquisition comptant et en avait pris possession le jour même, accompagnée de deux domestiques.
Cette dame, qu’on aurait pu croire veuve, à ses habits de deuil et à la tristesse résignée répandue sur son visage, avait pris, dans la rue de Buci, le nom de madame Charmet.
Bien que, à Paris, on s’occupe généralement fort peu de chacun, l’arrivée de madame Charmet dans la rue de Buci y causa une certaine sensation, d’abord parce que, de mémoire de vieillard, la maison qu’elle achetait n’avait été vue habitée ; ensuite, à cause du cachet d’originalité qui semblait distinguer la nouvelle locataire.
Madame Charmet pouvait avoir vingt-six ans. Elle était merveilleusement belle encore, quoique un peu amaigrie, et en dépit de ses vêtements d’une simplicité austère. Pendant les premiers jours qu’elle habita la rue de Buci, son existence parut mystérieuse.
Elle sortait tous les jours, à sept heures du matin, dans une voiture de place, et ne rentrait que vers deux heures. À ce moment-là, on voyait généralement arriver et se succéder chez elle, jusqu’à la nuit, plusieurs graves personnages, tels que des prêtres et des dames âgées.
Un peu plus tard, on apprit que madame Charmet était dame de charité, dame patronnesse de plusieurs œuvres de bienfaisance, et qu’elle était chargée de distribuer aux pauvres les revenus d’une grande fortune.
Puis on sut encore, mais d’une manière fort vague, que cette jeune femme expiait de grandes fautes par une vie ascétique, et qu’elle s’était réfugiée dans les bras de Dieu après avoir souffert de ce terrible mal qu’on nomme l’amour mondain.
Or, cette femme n’était autre que l’héroïne du premier épisode de cette histoire, cette Madeleine qui s’était nommée Baccarat. On s’en souvient, le jour même où Fernand Rocher, cet homme qu’elle avait tant aimé, avait épousé mademoiselle de Beaupréau, Baccarat avait pris l’humble habit des sœurs de charité novices, et elle avait prononcé ces vœux temporaires dont on peut toujours se faire relever.
Pourtant, lorsqu’elle était entrée en religion, sœur Louise avait la conviction qu’elle mourrait sous l’habit monastique.
Elle avait abandonné son petit hôtel de la rue Moncey, envoyé au baron d’O…, son ami, l’acte de propriété de cet hôtel, y joignant les titres de rente, les bijoux de prix et tout ce qu’elle tenait de lui. En vain, le baron, qui l’aimait éperdument, avait-il essayé de la faire renoncer à cette résolution ; il était même allé jusqu’à lui offrir de l’épouser, et de lui donner ainsi les moyens de vivre en honnête femme ; elle s’était montrée inflexible. Force avait donc été à M. d’O… de se résigner à perdre sa maîtresse, et à la voir, elle la lionne fringante de la veille, sous l’humble habit des Sœurs-Grises.
Baccarat était demeurée environ dix-huit mois au couvent, et elle était sur le point de prononcer des vœux plus solennels, lorsqu’un événement imprévu vint l’arrêter.
Un matin, elle reçut un mot ainsi conçu :
« Je me suis battu ce matin au bois de Meudon ; j’ai reçu une balle en pleine poitrine, et le docteur A…, que vous connaissez, affirme que j’ai tout au plus quelques heures à vivre. Ne viendrez-vous pas me serrer une dernière fois la main ? »
Cette lettre était du baron d’O…
Baccarat courut rue Neuve-des-Mathurins. Elle trouva le baron mourant, mais jouissant de la plénitude de son esprit.
– Mon enfant, dit-il à Baccarat qui s’agenouillait en pleurant au chevet de cet homme qui l’avait aimée et perdue, permets-moi de réparer mes torts envers toi et de te demander pardon… Tu étais une fille honnête et pure ; mon amour t’avait conduite au vice, mon amour te permettra de réparer mes fautes et de faire un peu de bien.
Alors, le moribond prit sous son chevet un pli cacheté et le tendit à la jeune femme :
– Voilà, dit-il, mon testament. Je suis le dernier de ma race ; je n’ai que des parents éloignés qui ne portent pas mon nom et sont plus riches que moi : je te laisse toute ma fortune pour que tu en fasses un levier utile au bien, pour que tu en distribues le revenu aux pauvres.
Et le baron appuya ses lèvres sur les belles mains de Baccarat, et mourut.
La pécheresse repentie ne pouvait refuser une semblable fortune, destinée à faire du bien, et sœur Louise comprit qu’elle seule pourrait l’administrer convenablement.
Alors, touchée par la grâce, elle se souvint de sa première existence, de cette vie dorée qui dissimule tant de misères ; elle se prit à songer à ces pauvres vierges folles parmi lesquelles elle avait vécu, victimes d’abord, bourreaux ensuite, créatures primitivement honnêtes que la paresse et le vertige du luxe vont chercher au fond de leur atelier, sous le chaume, dans les conditions les plus humbles, et dont la vie est dès lors condamnée à des vicissitudes sans nombre, à des alternatives d’opulence et de gêne, de joies et de douleurs.
Et celle qui s’était nommée Baccarat comprit qu’elle seule peut-être saurait porter des consolations dans ce monde des pécheresses, et en arracher quelques-unes, les plus jeunes, les moins endurcies, ou celles que l’amour vrai aurait touchées de ses chastes ailes, à ce tourbillon de vie où toutes finissent par disparaître et s’engloutir. Sœur Louise quitta son couvent et devint madame Charmet.
Ce fut à partir de ce moment qu’elle vint habiter la rue de Buci et s’installer dans cette froide et sévère maison où nous allons pénétrer.
Là, tout rappelait les siècles écoulés ; rien ne faisait songer au présent.
Quand on avait traversé la cour, on entrait dans un vestibule un peu sombre, dallé en marbre gris et noir.
Du vestibule on passait dans un vaste salon à boiseries, meublé à la mode de l’Empire, orné de tentures d’un vert foncé, et dont l’aspect triste et froid glaçait le cœur.
À côté de ce salon était une petite pièce dont madame Charmet avait fait son cabinet de travail, son oratoire, la pièce enfin où elle écrivait sa volumineuse correspondance.
Pour qui avait vu le coquet et voluptueux boudoir de la Baccarat, cette pièce donnait la mesure du repentir de la pécheresse.
On eût dit l’austère cellule d’une nonne, tant c’était nu, froid, triste au regard.
Aucun tableau ne se voyait aux murs ; les sièges étaient en jonc canné, la cheminée sans feu ; et, cependant, on était alors au cœur de l’hiver.
Quand une visite arrivait à madame Charmet, elle passait au salon, où il y avait du feu ; quand elle était seule, elle ne bougeait pas du cabinet de travail.
Cependant, au fond de cette dernière pièce, il y avait une porte perdue dans la boiserie, et cette porte cachait un mystère.
Semblable à cette bergère devenue reine et qui avait conservé au fond d’une armoire de fer les vêtements de son premier état, madame Charmet avait voulu conserver un souvenir de ce que fut Baccarat.
Souvent le soir, à l’heure où elle n’attendait plus personne, où la journée de la dame patronnesse était terminée, où ses domestiques – les domestiques des pauvres plutôt – étaient couchées, quand un profond silence régnait dans cette vaste et froide demeure, alors la jeune femme prenait un flambeau, poussait un ressort caché dans la boiserie, et la porte mystérieuse s’ouvrait ; et, comme dans un rêve, celle qui fut Baccarat se trouvait transportée de cet austère cabinet de travail dans une autre pièce qui ressemblait à la première, comme le paradis doit ressembler à l’enfer.
C’était le boudoir ou plutôt la chambre à coucher de Baccarat, telle que nous l’avons décrite dans la première partie de cette histoire, telle qu’elle existait au petit hôtel de la rue Moncey, avec ses tentures gris perle, ses rideaux à lames de velours violet, ses petits tableaux de Meissonnier, et le portrait en pied de la pécheresse, peint en amazone par Lehmann ; avec sa pendule rocaille, son tapis à rosaces, ses sièges moelleux et confortables, ses bahuts en bois de rose, tout ce coquet ameublement au milieu duquel elle avait contemplé toute une nuit son cher Fernand évanoui ; sur la tablette de la cheminée se trouvaient un médaillon et un poignard.
Le médaillon, elle l’avait coupé au cou de Fernand pendant cette nuit au matin de laquelle on était venu le lui enlever comme un voleur de bas étage, et c’était cet objet, on s’en souvient, qui l’avait empêchée de se croire folle.
Ce poignard, c’était celui qu’elle avait appuyé sur la gorge de Fanny, son infidèle femme de chambre, le soir où elle s’évada de la maison de santé.
Baccarat entrait dans ce mystérieux réduit, s’y enfermait soigneusement, allumait les bougies de la cheminée, puis écartait les rideaux du lit ; et les rideaux, en s’ouvrant, laissaient apparaître une grande toile oblongue, représentant Fernand Rocher, couché, enveloppé du grand châle anglais qu’elle avait jeté sur ses épaules dans la rue Saint-Louis, d’où on l’avait transporté évanoui rue Moncey.
Comment possédait-elle ce portrait ?
Elle était allée un soir, sur une simple indication d’une grande et noble misère à soulager, d’une douleur héroïque à consoler, frapper à la porte d’un peintre, un jeune homme de génie qui mourait de faim, en attendant l’heure certaine de la célébrité. Le pauvre artiste était au sixième étage, dans une chambre sans feu, auprès d’un lit au chevet duquel deux cierges projetaient leur lugubre clarté.
Sur ce lit était le cadavre d’une jeune femme, belle encore en dépit du souffle de la mort. Auprès, le malheureux jeune homme, les yeux pleins de larmes, avait dressé son chevalet, et il fixait sur une grande toile ce visage aimé que le fossoyeur allait venir lui prendre pour toujours ; et comme le talent, aux heures solennelles, retrouve ces ailes blanches que Dieu lui fit pour planer au-dessus de l’humanité, l’amant brisé de douleur était devenu un grand peintre tout à coup, et la morte était reproduite sur la toile avec une effrayante et sublime vérité.
Madame Charmet entra et lui dit :
– Ne me demandez pas qui je suis et permettez-moi de pleurer avec vous, de m’agenouiller et de prier, tandis que vous travaillerez.
Elle s’agenouilla et pria, et quand les clartés indécises du matin vinrent rougir les vitres de l’atelier, dont le dernier meuble avait été vendu pour payer le dernier remède de la pauvre trépassée, le peintre avait fini son œuvre… le rayon de génie s’était éteint ; la douleur reprit l’homme et l’homme sanglota…
Alors la jeune femme s’empara de ses deux mains et lui dit :
– Il faut pouvoir aller prier longtemps sur la tombe de ceux que nous avons aimés ; il ne faut pas que celle à qui, dans dix ans, vous eussiez fait un impérissable monument de votre jeune renommée, soit livrée aux horreurs de la fosse commune… J’ai aimé, j’ai souffert, ceux qui ont souffert et aimé sont frères… Mon frère, acceptez ceci de votre sœur…
Et elle lui tendit un reçu de l’administration des cimetières, reçu d’une somme de mille francs pour la concession d’un terrain à perpétuité – et la jeune morte n’alla point à sa dernière demeure dans le corbillard des pauvres, – et un prêtre bénit le cercueil et la première pelletée de terre qu’on jeta sur lui…
Deux jours après, l’homme de génie futur était aux genoux de madame Charmet et lui demandait par quel dévouement il acquitterait jamais sa dette de reconnaissance :
– Écoutez, lui dit-elle, faites pour moi ce que vous avez fait pour vous. Il est un homme en ce monde qui est aussi mort pour moi que celle que vous pleurez est morte pour vous ; cependant, il vit, il est heureux… Cet homme, évanoui, a passé une nuit chez moi, étendu sur mon lit et enveloppé dans un châle que je garde comme une relique ; si je vous le montrais une heure, cela vous suffirait-il pour me le peindre dans l’attitude que je vous décris ?
– Oui, répondit l’artiste, avec cette conviction profonde du talent.
Un soir, deux jours après, au moment où Fernand Rocher sortait de chez lui, une voiture arrêtée se trouva sur son passage ; dans cette voiture étaient le jeune peintre et sa mystérieuse protectrice.
– Le voilà ! dit-elle.
Le peintre l’enveloppa de ce regard clair, profond, intelligent, qui est comme le secret des grands artistes, et répondit :
– Ses traits ne s’effaceront plus de ma mémoire.
Deux mois après, Baccarat se présenta chez le peintre et jeta un cri…
Elle venait d’apercevoir Fernand, – son Fernand bien-aimé et à jamais perdu, couché, recouvert du grand châle écossais, – et l’illusion était si complète, qu’il semblait sortir de la toile et se dessiner en relief sur le fond sombre des draperies.
– Ah ! murmura-t-elle, je le verrai donc toujours !
Le lendemain, le peintre ne vit plus son tableau, mais trouva un petit rouleau de papiers sur sa cheminée.
Ce rouleau renfermait vingt billets de mille francs, et ces deux lignes sans signature :
« Ceux qui aiment les morts sont frères… Adieu ! »
C’était donc pour voir le portrait, pour vivre une heure dans le passé avec ses chers et poignants souvenirs, que l’austère madame Charmet pénétrait chaque soir dans ce mystérieux réduit.
Elle écartait les rideaux qui lui cachaient son Fernand endormi, allumait les bougies et demeurait en contemplation devant son seul et unique amour…
Pourtant, elle rencontrait Fernand quelquefois, soit à l’hôtel de Kergaz, soit chez sa sœur Cerise. Mais là, partout, n’était-ce point pour elle l’heureux époux d’Hermine, l’homme vers qui elle ne levait jamais les yeux ?…
Tandis que sur cette toile, c’était bien celui qu’elle avait aimé, qu’elle aimait encore, dont les lèvres avaient effleuré les siennes.
Souvent la pauvre Madeleine repentie devenait le jouet de l’illusion ; elle oubliait pour se souvenir ; elle se figurait que le passé était un rêve, et que cette toile sans vie c’était bien son Fernand qui dormait, et qu’elle avait peur d’éveiller.
Oh ! le sublime mariage de l’amour que celui qui attardait ainsi cette pauvre femme au milieu de ses chers souvenirs, lui faisant oublier les heures qui passaient rapides, et les fatigues de son austère vie !
Et puis, parfois venait…
Alors les larmes de la pécheresse cessaient de couler, elle s’enfuyait de ce lieu mondain où elle avait retrouvé son cœur, et Baccarat s’effaçait devant la sainte femme vouée à Dieu, et madame Charmet gagnait sa chambre sans feu où elle couchait sur un lit de fer.
Or, un soir, deux jours après l’entrevue de sir Williams avec Jenny, c’est-à-dire un mercredi, et, par conséquent, le jour même où devait avoir lieu le bal de la marquise Van-Hop, la sonnette qui annonçait l’arrivée d’un visiteur vint faire tressaillir madame Charmet, occupée alors à fermer quelques lettres.
Il était environ cinq heures.
Madame Charmet passa dans le grand salon attenant à son cabinet de travail ; en même temps un laquais annonça :
– Madame la marquise Van-Hop.
La pécheresse tressaillit à ce nom, qu’elle n’entendait point pour la première fois.
Elle savait que la marquise était une femme très belle, très riche, d’une vertu inattaquable, et elle éprouva comme un sentiment d’humilité mêlé de remords, la Baccarat, elle allait voir entrer chez elle une femme dont la pureté de mœurs était si justement respectée.
Que venait faire chez la pauvre repentie la brillante et vertueuse marquise Van-Hop ?
Nous allons le dire en peu de mots.
La marquise faisait beaucoup de bien et distribuait des sommes considérables en œuvres de charité.
Madame Van-Hop avait entendu, quelques jours auparavant, un ecclésiastique d’un grand renom de vertu et de piété faire l’éloge de madame Charmet, et entrer dans quelques détails fort intimes sur l’existence de la repentie.
Or, le matin même, une lettre était parvenue à la marquise, et cette lettre lui avait rappelé sur-le-champ madame Charmet.
Voici ce dont il était question.
Une jeune femme qui se disait au bord de l’abîme et n’ayant plus d’autre ressource que le vice, d’autre chance de salut que la mort, s’adressait dans cette lettre à madame Van-Hop et demandait aide et protection.
Cette jeune femme, inconnue de la marquise, habitait à deux pas de chez elle, cité Beaujon.
Elle avait entendu parler de la marquise, elle la savait charitable, elle faisait appel à son cœur.
Madame Van-Hop avait sur-le-champ songé à madame Charmet.
Elle venait chez elle pour la prier de lui servir d’intermédiaire, et elle était munie d’une lettre de cet ecclésiastique dont nous venons de parler.
La grande dame venait prier l’humble pécheresse de se faire la dispensatrice des sommes qu’elle voulait employer à soulager des infortunes qui s’adressaient directement à elle.
Qu’on nous permette de laisser un voile sur la première entrevue de ces deux femmes, que des malheurs communs devaient plus tard réunir.
Nous nous bornerons à dire que c’était le mercredi, jour de la grande soirée dans laquelle Chérubin devait être présenté à la marquise.
Une heure après, la marquise regagnait son hôtel où nous allons la retrouver.
VIII
Quelques heures après la visite de la marquise Van Hop à madame Charmet, un jeune homme en costume de soirée s’arrêta, vers neuf heures du soir environ, dans la rue de la Chaussée-d’Antin, entra dans la maison qui porte le numéro 45, demanda si le major Carden était chez lui, et, sur la réponse affirmative du concierge, monta lentement à l’entresol et sonna.
– Qui annoncerai-je ? demanda le valet de chambre qui vint lui ouvrir.
– M. Chérubin, répondit le jeune homme entrant sur les pas du domestique.
C’était, en effet, celui des Valets-de-Cœur que sa remarquable beauté avait fait surnommer Chérubin, qui se présentait chez le personnage que Rocambole avait, le jour de la séance, désigné sous le nom de major.
Chérubin, car nous lui conservons ce sobriquet, traversa un petit salon, une chambre à coucher de garçon, et pénétra dans une troisième pièce convertie en fumoir.
Là, le major Carden, à demi couché dans un voluptueux fauteuil ganache, les pieds sur les chenets, un puros aux lèvres, attendait sans doute son visiteur, car il était tout habillé et prêt à sortir.
Le major était un homme de cinquante ans, très bien conservé, ayant au plus haut degré la tournure militaire, en dépit de son habit de ville, sur lequel s’étalaient plusieurs décorations étrangères.
Le major, dont le nom annonçait, du reste, l’origine étrangère, avait servi tour à tour en Prusse, en Russie, en Espagne, et en Portugal.
Il habitait Paris depuis environ trois ans, et dépensait annuellement une trentaine de mille francs, gagnait quelques centaines de louis au jeu et était fort répandu dans le monde.
Quant à sa fortune, c’était une de ces énigmes que le monde parisien ne cherche jamais à déchiffrer, et qui lui sont indifférentes.
Le major était-il riche ? était-il pauvre ? Peu importait. Il menait une vie élégante, payait ses fournisseurs, avait une maison convenable et trois chevaux de sang. On ne pouvait, en conscience, lui en demander davantage.
En entendant annoncer M. Chérubin, le major tourna la tête à demi et tendit la main au nouveau venu :
– Bonjour, lui dit-il, vous êtes exact : l’exactitude est la moitié du succès. Asseyez-vous, nous avons le temps de fumer un cigare.
Et le major regarda la pendule placée sur la cheminée.
– La marquise n’aura beaucoup de monde que vers minuit. Nous arriverons à dix heures et demie ; nous la trouverons presque seule. C’est le moment favorable pour votre présentation.
M. Chérubin s’assit dans le voltaire que lui avança le major.
– À propos, reprit celui-ci, comment vous appelez-vous, mon honorable ami, car, enfin, Chérubin est évidemment un nom flatteur, si on songe aux exploits qui vous l’ont valu, mais ce n’est point un nom ?
– Je me nomme Oscar de Verny, répondit le jeune homme.
– Avez-vous servi ?
– Non, major.
– Très bien. Je vous demandais ce dernier détail pour ne point faire de bévue.
Et le major, passant à Chérubin une boîte de cigares, poursuivit :
– Vous avez une de ces physionomies qui sont bien faites pour tourner la tête à une femme.
Chérubin s’inclina.
– Mais, poursuivit le major, en amour, la figure n’est pas l’unique gage du succès. Un homme trop beau a même à lutter contre de certains préjugés vis-à-vis d’une femme intelligente… et la marquise est…
– Très bien, je vous comprends, interrompit Chérubin ; mais ne vous inquiétez pas… Je sais mon métier.
Cette réponse, faite d’un ton un peu sec, ferma la bouche au major, qui se contenta de s’incliner.
– À propos, reprit Chérubin, me permettez-vous une question, major ?
– Faites, monsieur.
– Que pensez-vous de notre association ?
– Mais dame ! j’en pense du bien.
– Ce n’est pas répondre, cela.
– Que voulez-vous donc savoir ?
– Ceci simplement : que risquons-nous dans toute cette affaire ? Car enfin, je ne sais si vous êtes plus renseigné ; mais, quant à moi, je vous avouerai que je vais un peu en aveugle.
– Pardon, fit le major, expliquez-vous, monsieur Chérubin, ou du moins questionnez-moi plus clairement.
– Soit, répondit Chérubin. Comment êtes-vous entré dans cette association.
– Comme vous, par l’intermédiaire de M. le vicomte de Cambolh.
– Et vous ne connaissez pas le chef ?
– Non, répondit le major avec un accent de vérité profonde.
– Et vous ne trouvez pas que nous agissons bien légèrement ?
– En quoi, s’il vous plaît ?
– En ce que nous obéissons à un pouvoir inconnu.
– Qu’importe ! s’il tient ses engagements comme il les a tenus jusqu’ici.
– Mais nous jouons gros jeu…
– Je ne trouve pas… Le métier que nous faisons, mon cher, n’est pas très dangereux ; car il est un de ceux que la police la plus habile constate difficilement. Nous sommes aimables et on nous aime…
Le major sourit et regarda Chérubin :
– Quel mal y a-t-il à cela ? dit-il.
– Aucun, en effet.
– Maintenant, le hasard fait que nos amours ont de funestes conséquences. Nous sommes indiscrets… ou bien étourdis. Eh bien ! S’il arrive une catastrophe, qu’est-ce que cela prouve ? Est-ce là un crime du ressort des tribunaux ?
– Vous avez raison, dit Chérubin.
– Mon Dieu ! acheva le major, je ne sais quel rôle ont à jouer nos associés, mais je trouve que le vôtre est tout à fait sans péril. Personne au monde ne saurait prouver que je ne vous connaissais pas hier. Or, nous nous sommes rencontrés aux bains de mer, aux eaux, ou dans un salon, vous m’avez paru un homme distingué, et, comme tel, j’ai cru pouvoir vous présenter chez la marquise. Maintenant, il arrive que la marquise est belle, et que vous l’aimez, que vous êtes beau et qu’elle vous aime… Qu’y puis-je faire ? En conscience, le marquis lui-même ne saurait m’en vouloir…
– À vous, non, mais à moi ?
– À vous, pas davantage ! Vous n’êtes point ami du marquis ; donc, vous ne le trahissez pas précisément. Le marquis a le droit de vous tuer, mais cela ne regarde nullement la justice ; car, évidemment, le marquis n’est pas un homme à recourir à la police correctionnelle. Vous risquez un duel, voilà tout.
– Alors, dit tranquillement Chérubin, nous pouvons marcher.
Le major sonna :
– Jean, dit-il à son valet de chambre, attelle Éclair à mon tilbury, je conduirai.
Dix minutes après, le major était obéi.
Il acheva de se ganter, passa son pardessus blanc, vêtement alors fort à la mode, et dit à Chérubin :
– Venez, je suis à vos ordres.
Tous deux descendirent dans la cour où attendait le tilbury ; le major prit les rênes, et le cheval s’élança au trot dans la rue de la Chaussée-d’Antin.
Il était alors dix heures et demie.
L’hôtel du marquis Van-Hop était situé à l’extrémité des Champs-Élysées, à l’entrée de l’allée des Veuves.
Quand le tilbury du major en atteignit la porte cochère, quelques coupés de maître, quelques équipages étaient rangés déjà dans la cour.
Cependant il y avait encore peu de monde, et la fête, qui promettait d’être brillante, si l’on s’en rapportait aux préparatifs, était à peine à son début.
Une trentaine de personnes, tout au plus, entouraient la marquise, qui se tenait dans son boudoir, attenant au grand salon du premier étage, tandis que son mari recevait dans cette pièce et donnait la main aux dames à mesure qu’elles arrivaient. Nous avons entrevu la marquise ; qu’on nous permette quelques lignes de silhouette à l’endroit du marquis.
M. Van-Hop était un homme d’environ quarante ans, qui paraissait à peine en avoir trente-cinq.
Il était grand, doué d’un naissant embonpoint, et toute sa personne trahissait un naturel apoplectique…
Blond, le teint légèrement coloré, les yeux bleus, le marquis était fort beau en réalité et résumait admirablement le type de l’homme du Nord.
Son sourire et son regard étaient doux, mais on comprenait que cet homme, bâti en hercule, devait être sujet à de terribles colères, si l’on remarquait ses épais sourcils d’un blond plus fauve et plus foncé que sa barbe et ses cheveux, et qui étaient tellement rapprochés, qu’il suffisait pour les unir d’un simple froncement.
M. Van-Hop était bon, loyal, affectueux même, mais il était jaloux…
Il était horriblement jaloux de sa femme, non point jaloux à la façon de l’homme qui se croit trahi, mais comme l’est celui qui redoute de l’être jamais.
Cette jalousie suffisait à empoisonner la vie calme, heureuse, opulente du riche banquier hollandais ; et cela, d’autant mieux qu’il faisait tous ses efforts pour dissimuler son mal et s’étudier constamment à paraître l’homme le moins jaloux de la terre. Aussi donnait-il des fêtes, conduisait-il sa femme dans le monde, à l’Opéra, aux Italiens, partout !
L’été, le marquis et la marquise Van-Hop se montraient successivement aux eaux de Bade et aux Pyrénées, à Vichy et aux bains de mer.
L’hiver, leurs salons s’ouvraient tous les mercredis à l’aristocratie parisienne des deux rives de la Seine, comme terrain neutre, où la finance et la noblesse se donnaient cordialement la main.
Ce soir-là, le marquis causait, lorsque le major et son protégé arrivèrent, avec un grand vieillard de soixante-dix ans environ, qui, bien certainement, n’en voulait pas paraître cinquante.
C’était le duc de Château-Mailly.
Le duc, ancien général de cavalerie, était de haute taille et avait dû être fort beau jusque dans son âge mûr.
Les succès qui, pour lui, avaient empli le passé, tournaient la tête à sa vieillesse, et il se croyait encore aimé pour lui-même de la meilleure foi du monde.
Aussi teignait-il soigneusement ses cheveux et sa moustache, et portait-il un corset sous son gilet.
Sa mise, d’une recherche excessive, était rehaussée par une brochette de décorations de toutes couleurs passée à son habit.
Le duc et son hôte se promenaient de long en large dans le grand salon, à peu près désert, et arrivaient jusqu’à la porte du boudoir, où la marquise était entourée par les premiers arrivés.
Auprès de la marquise, assise sur le même sofa, on aurait remarqué une femme dont la beauté semblait merveilleuse à distance, et supportait admirablement l’éclat des bougies.
Avait-elle vingt-cinq ans à peine, ou bien touchait-elle aux limites désolées de la quarantième année ?
C’était ce que nul n’aurait pu dire, le soir, au feu des lustres et des candélabres.
Cette femme qui jouait de l’éventail avec la grâce nonchalante de l’Espagnole, et qui avait de délicieuses poses de tête, de charmants sourires et de jolis gestes pleins de mutinerie, était madame Malassis, l’amie intime de la marquise Van-Hop.
Le marquis et le vieux duc arrivaient donc périodiquement jusqu’à la porte du boudoir dont les deux battants étaient ouverts, tournaient sur leurs talons et recommençaient leur promenade. Mais le vieux duc avait le temps, chaque fois, d’échanger avec madame Malassis un imperceptible regard et un demi-sourire de mystérieuse intelligence.
Le major, en entrant, alla droit au marquis.
Celui-ci lui tendit la main d’une façon courtoise et familière qui attestait l’intimité dont le major jouissait à l’hôtel Van-Hop.
– Mon cher marquis, dit-il, me permettez-vous de vous présenter un de mes amis, je dirais volontiers un de mes parents, M. Oscar de Verny ?
Et il démasqua Chérubin.
Chérubin s’inclina, et le marquis Van-Hop, qui s’apprêtait à saluer banalement comme il saluait cent personnes indifférentes ou inconnues chaque soir, se prit à tressaillir soudain.
Chérubin, en effet, justifiait assez bien son surnom pour un mari jaloux comme l’était M. Van-Hop.
Il possédait cette beauté merveilleuse et fatale qui séduit si bien les femmes à l’imagination vive, au caractère romanesque.
Chérubin, redevenu M. Oscar de Verny, résumait fort bien le type de ce jeune viveur un peu lassé déjà, au regard voilé à demi, au front pâli par les veilles, mais qui semble porter ce cachet de fatalité indélébile qui révèle une mission à accomplir.
On pouvait se dire, en le voyant : « Voilà un jeune homme qui s’est imposé le rôle de séducteur et qui le remplit en conscience, sans être arrêté par aucune considération. »
Aussi, à la vue de cet homme, un pressentiment bizarre agita-t-il le cœur du marquis Van-Hop.
Mais déjà le major et Chérubin l’avaient salué et s’éloignaient, pour ne point interrompre son entretien avec M. de Château-Mailly.
Le major pénétra dans le boudoir, toujours suivi de son protégé.
Madame Van-Hop écoutait, en ce moment, une anecdote que racontait madame Malassis, avec un esprit si pétillant, que des sourires approbateurs arquaient les lèvres des auditeurs, tandis que la marquise elle-même manifestait sa gaieté par un franc éclat de rire.
Auprès de la marquise se tenait un grand jeune homme blond, de vingt-sept à vingt-huit ans, dont l’attitude sévère semblait contraster avec le maintien joyeux et de bonne humeur des personnes qui l’entouraient.
Ce jeune homme, fort beau du reste, suivant les lois rigoureuses de la beauté plastique, avait, en outre, un cachet d’exquise distinction dans toute sa personne.
C’était le neveu de M. le duc de Château-Mailly.
Le comte écoutait sans sourire, et sans donner aucune marque d’approbation, le récit de madame Malassis.
Une expression de hauteur dédaigneuse arquait même ses lèvres à demi, tandis que la veuve parlait.
Derrière lui se trouvait un homme dont la physionomie originale et la mise excentrique n’avaient point encore attiré les regards, ce qu’il fallait attribuer à l’intérêt qui s’était attaché au récit de la belle veuve.
Qu’on se figure un homme au visage couleur de brique, aux cheveux roux ardents tombant sur ses épaules, dont les oreilles étaient ornées de boucles d’or, qui portait des diamants à ses doigts et à sa chemise, un habit bleu barbeau, un pantalon nankin et un de ces immenses faux cols britanniques dans lesquels disparaissaient le menton, la bouche et une partie des oreilles. Certes, si ce personnage, aussi bizarre par sa mise qu’étrange par sa physionomie et qui paraissait avoir quarante-cinq ans au moins, à en juger par son embonpoint plutôt que par son visage coloré et qui était presque maigre ; si ce personnage, disons-nous, n’avait eu la précaution de se tenir un peu à l’écart, il eût certainement été un point de mire universel.
Il était inutile de lui assigner une autre patrie que la nébuleuse Albion, et il justifiait pleinement son nom de sir Arthur Collins. Sir Arthur était arrivé le matin même, chez le marquis Van-Hop, muni d’une lettre de recommandation et de crédit en même temps de la maison Fly, Bowr et Cie, le marquis avait compté à sir Arthur les dix mille livres sterling mentionnées dans la lettre de crédit et l’avait invité à son bal. Sir Arthur était arrivé ponctuellement à dix heures, avait causé longuement avec la marquise alors toute seule, puis il s’était modestement effacé, lorsqu’étaient survenus quelques invités.
Or, au moment où madame Malassis terminait son histoire, sir Arthur toucha légèrement du doigt l’épaule du comte.
Celui-ci se retourna et manifesta un vif étonnement à la vue de l’excentrique personnage.
– Pardon, monsieur le comte, dit sir Arthur en très bon français, bien qu’avec un accent britannique très prononcé, pardon, fit-il à voix basse, mais je désirerais vous entretenir un moment.
Le comte fit quelques pas en arrière, et, fort intrigué, suivit l’Anglais dans un coin du salon.
– Monsieur le comte, reprit ce dernier, sans se départir un moment de sa mélopée suffisante et de son grasseyement britannique, vous me voyez pour la première fois, et vous me trouverez peut-être indiscret…
– Nullement, milord, répondit le comte avec courtoisie.
– Oh ! dit l’Anglais, je ne suis pas milord, je suis gentleman simplement ; mais peu importe, je désire, monsieur le comte, vous entretenir d’une personne qui est ici, et qui, sans doute, ne vous est pas indifférente.
Le comte parut étonné.
– Que pensez-vous, continua l’Anglais, de cette dame qui amusait si fort tout le monde tantôt ?
Le comte tressaillit.
– Moi ?… fit-il, absolument rien…
– Lui trouvez-vous de l’esprit ?
– Comme à une parfumeuse retirée.
Un sourire énigmatique passa sur les lèvres de sir Arthur Collins.
– Elle est belle… hasarda-t-il.
– Elle a quarante ans.
– Soit ! Eh bien ?
– Et M. le duc de Château-Mailly, votre oncle…
Cette fois, le comte laissa échapper un geste de surprise, et regarda cet interlocuteur étrange qu’il n’avait jamais vu auparavant, et qui venait précisément lui parler de son oncle et de sa mystérieuse passion.
– Votre oncle, acheva très froidement sir Arthur, est d’un avis diamétralement opposé au vôtre, monsieur le comte. Et la preuve en est…
– Ah ! fit le comte, vous avez une preuve ?
– Oui.
– Et… quelle est-elle ?
– C’est que, avant un mois, madame Malassis, veuve d’un ancien parfumeur, femme de mœurs plus que douteuses, malgré sa pruderie d’emprunt, sera duchesse de Château-Mailly.
Le comte devint livide et se mordit les lèvres.
– Je sais bien, dit sir Arthur, que je ne vous apprends rien, que vous vous attendez même à cet événement depuis longtemps, comme le condamné qui ne peut échapper à l’exécuteur attend en frémissant sa terrible hache…
– Monsieur… fit le comte.
– Pardon, monsieur, poursuivit sir Arthur avec un calme parfait et en s’inclinant de nouveau, veuillez m’écouter sans trop d’impatience, car j’ai peut-être, je dois certainement avoir un mobile bien puissant pour vous parler de cette déplorable affaire ; veuillez m’écouter.
Et l’Anglais s’assit sur un de ces sièges qu’on nomme tourne-dos, invitant du geste le comte à l’imiter.
Puis il reprit, lorsque ce dernier se fut assis à son tour :
– M. le duc de Château-Mailly a une immense fortune dont vous devriez hériter, et qui cependant ira tout entière à madame Malassis, à laquelle il fera une donation universelle par contrat de mariage… Ceci est inévitable.
– Mais monsieur, dit le comte d’une voix sourde, pourquoi vous faire un prophète de malheur et m’annoncer ce que, hélas ! j’ai deviné depuis longtemps ?
– Monsieur le comte, répondit sir Arthur, si je me suis permis de vous faire toucher au doigt le malheur qui vous menace, c’est que… peut-être…
Sir Arthur s’arrêta.
– Peut-être ?… fit le comte anxieux.
Un regard étrange s’échappa des prunelles de l’Anglais :
– C’est que… peut-être…, acheva-t-il lentement, il y a, en ce monde, un seul homme qui puisse empêcher le mariage du duc de Château-Mailly, et vous conserver, à vous, votre héritage.
Le comte étouffa un cri.
– Et… cet homme ?… interrogea-t-il.
– C’est moi, dit sir Arthur Collins.
En ce moment, un laquais jetait aux invités, du seuil du grand salon, le nom de M. et de madame Fernand Rocher, et s’effaçait pour les laisser passer.
IX
Sir Arthur ne sourcilla point, il ne se retourna même pas, et continua à tenir à l’écart le jeune comte de Château-Mailly.
– Vous ! murmura celui-ci, vous !
– Moi, répéta sir Arthur, moi-même !
– Comment… vous pourriez…
– Monsieur, j’ai franchi le détroit, et suis venu tout exprès à Paris. Seulement…
– Ah ! dit le comte, il y a des obstacles, sans doute ?
– Il peut y en avoir de votre part…
– De ma part ? fit le comte de plus en plus étonné.
– Sans doute. Vous pouvez ne pas consentir aux petites conditions.
– Je devine, dit le comte, vous me proposez une affaire…
– Peut-être… Seulement, je commence par dire qu’il ne s’agit point d’argent.
Cette réponse déconcerta fort le jeune comte. Il avait cru deviner, il ne devinait rien.
– Parlez, monsieur, dit-il, expliquez-vous, car je ne vous comprends pas.
Sir Arthur croisa ses jambes avec nonchalance et se pencha à demi vers l’oreille de son interlocuteur :
– Monsieur, dit-il, si on vous demandait un million sur la succession du duc, dans le cas où cette succession vous reviendrait, le donneriez-vous ?
– De grand cœur, monsieur.
– Rassurez-vous, je ne vous le demande pas. Je vous l’ai dit, il ne sera point question d’argent entre nous. Je voulais seulement connaître l’étendue des sacrifices que vous seriez capable de faire pour obtenir le résultat que je vous promets.
Le comte était anxieux et regardait sir Arthur avec un étonnement mêlé d’une âpre curiosité.
En examinant attentivement ce singulier personnage, il éprouva comme une sensation d’effroi. Le regard de l’Anglais était froid et acéré comme une lame d’épée ; son geste sobre avait un cachet de fatalité inouïe, et le comte crut deviner que cet homme devait être terrible sous son enveloppe ridicule.
– Mon cher comte, reprit sir Arthur, sur un ton plus intime, le duc votre oncle est un vieillard amoureux ; de plus, il a une nature apoplectique.
– Que voulez-vous dire ? murmura le jeune homme en pâlissant.
– Je veux dire que M. de Château-Mailly, si son mariage venait à manquer, pourrait bien avoir un coup de sang.
Et sir Arthur accompagna ces mots d’un sourire qui donna le frisson au comte.
– Écoutez, poursuivit-il, le duc est amoureux, et, comme un amoureux septuagénaire qu’il est, il est sourd et aveugle. Madame Malassis a été légère, mais légère en femme prudente et avisée ; il ne reste aucune trace sérieuse du passé. Donc, tout ce que l’on pourrait faire et dire pour perdre madame Malassis à ses yeux serait inutile.
– Je le sais, dit le comte avec l’accent d’une conviction profonde.
– Il faudrait donc une de ces preuves irrécusables, palpables, éclatantes, devant lesquelles le doute s’évanouit forcément, pour faire reculer M. de Château-Mailly. Cette preuve, j’en ai acquis la certitude, n’existe pas… ou plutôt, elle n’existe pas encore.
À ces derniers mots, le comte fit un brusque mouvement.
– Voilà, murmura-t-il, où j’essaye en vain de comprendre…
– Attendez. Je dis que cette preuve n’existe pas encore. Mais je puis la faire exister, moi.
– Vous ! fit le comte stupéfait.
– Moi. Et devant cette preuve, M. de Château-Mailly demeure foudroyé, et celle dont il veut faire sa femme ne sera plus pour lui que la dernière et la plus vile des créatures.
Le comte demeura pensif et hésitant.
– Remarquez, reprit l’Anglais, que votre oncle est septuagénaire, qu’il appartient à cette génération de vieux viveurs qui ont maltraité leur corps à ce point qu’un souffle les peut tuer. Qui vous dit que, après huit jours d’hyménée, madame Malassis ne trouvera point un matin son vieil époux mort à ses côtés ?
– Cela peut arriver, dit le comte.
– Alors vous vous apercevrez que, par un excès de délicatesse, vous avez abrégé la vie de votre oncle, tout en lui laissant le temps de consommer une mésalliance et de vous déshériter.
Le comte réfléchissait et ne répondit pas.
– Voyons, insista sir Arthur, décidez-vous. Je ne puis croire que vous ayez rêvé le bonheur de madame Malassis.
Le comte releva tout à coup la tête et regarda sir Arthur.
– Pardon, dit-il, mais enfin, en admettant que je vous donne carte blanche, puisque vous… ne… voulez… pas… d’argent… et que, cependant, il y a… des conditions, qu’attendez-vous de moi ?
Sir Arthur regarda fixement le jeune comte.
– Monsieur, dit-il, il y a dans le monde une femme qui m’a foulé aux pieds.
Le comte jeta un regard à la dérobée sur sir Arthur, et s’avoua que les cheveux blond filasse de l’insulaire pouvaient, jusqu’à un certain point, justifier les rigueurs dont il se plaignait.
– Cette femme, poursuivit sir Arthur, est jeune, belle, riche, entourée. Elle a tout ce qui peut et doit tourner la tête à un homme comme vous.
– Eh bien ? demanda le comte.
– Eh bien ! si vous voulez me jurer sur l’honneur de votre écusson de vous acharner à la poursuite de cette femme et de faire tout ce qui dépendra de vous pour vous en faire aimer…
– Tiens, dit le comte d’un ton léger, vous avez une singulière façon de vous venger.
– Je suis un Anglais, répondit le gentleman.
Cette réponse était logique et ferma la bouche au comte.
– Le jour où vous serez aimé de la femme dont je vous parle, continua sir Arthur, l’héritage de M. le duc du Château-Mailly vous appartiendra.
– Monsieur, dit gravement le comte, vous m’offrez un moyen de reconquérir mon héritage qu’un homme jeune et fougueux acceptera toujours. Seulement, il faut tout prévoir. La femme dont vous parlez… est…
– La vertu même, dit froidement sir Arthur. Ah ! dame ! je ne vous donne point une besogne facile ; mais quand on veut…
– C’est juste, dit le comte. Mais il est besoin de patience quelquefois… je puis attendre six mois… un an…
– Peu importe ! je suis patient aussi.
– Et si mon oncle se marie d’ici là ?
– Vous êtes un homme d’honneur ?…
– Je le crois.
– Si vous me faites un serment, vous le tiendrez ?
– Je le tiendrai.
– Alors, jurez-moi que, si j’empêche ce mariage, vous serez aussi fidèle à vos engagements envers moi que je l’aurai été envers vous.
– Sur ma parole, dit le comte, je vous le jure ! Mais…
– Ah ! dit sir Arthur, il y a une restriction ?…
– Sans doute.
– Voyons ?
– Il y a le cas où je ne réussirais pas, en dépit de tous mes efforts…
– Si vous faites tous vos efforts, et si ces efforts, combinés avec les miens…
– Ah ! vous m’aiderez ?…
– Sans doute. Et, fit le gentleman avec un sourire, je suis fort. Donc, si, malgré mon aide, vous échouez après avoir dépensé toute votre énergie, et tout votre vouloir, c’est que ma vengeance aura été impossible, et je me résignerai.
– À ce compte-là, j’accepte, et je vous renouvelle mon serment.
Et le comte jura de nouveau.
– Maintenant, dit le gentleman, je n’ai plus qu’un mot à vous dire : souvenez-vous bien qu’un pacte mystérieux et solennel nous lie, mais que le monde entier doit l’ignorer.
– Je serai muet.
– Et vous aurez raison, car la moindre indiscrétion de votre part perdrait tout, en me forçant à quitter Paris et à renoncer à vous suivre.
Le comte s’inclina.
– Maintenant, dit-il à son tour, puis-je vous demander quelle est cette femme ?
– Chut ! répondit sir Arthur ; il est probable que cette nuit, dans un des salons où nous sommes, deux hommes échangeront une provocation à voix basse, mais il est probable aussi que vous en serez le témoin.
– Eh bien ? demanda M. de Château-Mailly.
– Eh bien ! l’un de ces deux hommes sera le mari de cette femme.
– Ah ! fit le comte.
– À partir de ce moment, vous ferez la cour à cette femme, car il est probable que le mari quittera le bal sans elle…
Comme le gentleman prononçait ces derniers mots, onze heures sonnaient à la pendule du boudoir et les préludes d’une valse se faisaient entendre.
– Adieu… dit l’Anglais, nous nous reverrons.
Il se glissa du boudoir dans la salle de jeu, où s’organisaient les tables de whist, tandis que le jeune comte allait valser.
La marquise se levait, elle aussi, et allait prendre le bras de l’un de ces hommes qui se trouvaient auprès d’elle, lorsque le major Carden s’approcha et lui présenta Chérubin, ou plutôt Oscar de Verny.
Il est de bizarres pressentiments de la destinée qui nous assaillent à de certaines heures.
À la vue de ce jeune homme qui avait su prendre une attitude timide et réservée et qui baissait à demi les yeux, la créole havanaise éprouva une sensation extraordinaire.
On eût dit que cet inconnu, qui lui apparaissait si naturellement, cependant, au milieu d’une fête, était comme un agent mystérieux de la fatalité qui entrait dans sa vie.
Elle alla prendre la main d’un homme d’un âge mûr, à qui elle dit tout bas :
– Voulez-vous me faire valser ?
Le major soufflait ces mots à l’oreille de Chérubin :
– Notre chef mystérieux ne s’était point trompé, mon jeune ami, en comptant sur l’effet de votre physionomie. Tenez, la marquise est déjà troublée, et son mari déjà jaloux.
– Vous croyez ? fit Chérubin qui tressaillit.
– Que voulez-vous ? mon cher, poursuivit le major, c’est étrange, inouï, mais cela est vrai, cependant… La marquise passe sa vie au milieu des hommes les plus séduisants du monde ; elle les regarde tous avec une indifférence parfaite, et voici qu’elle pâlit et se trouble à votre vue… Eh bien ! acheva le major, savez-vous pourquoi ?
– Non, demanda Chérubin, et cependant je me suis aperçu bien souvent déjà de cette fascination que j’exerce sur les femmes à première vue.
Pendant que le major et Chérubin échangeaient ces quelques mots, le jeune comte de Château-Mailly promenait son regard sur un groupe de jeunes femmes et cherchait parmi elles une valseuse.
Il aperçut madame Fernand Rocher.
C’était la première fois que Fernand et sa femme venaient aux grands bals de la marquise, qu’ils avaient rencontrée aux eaux de Vichy l’été précédent.
M. de Château-Mailly n’avait jamais vu Hermine.
Il la trouva belle, et, guidé par ce flair merveilleux de l’homme désœuvré qui cherche des bonnes fortunes, il alla l’inviter à valser.
Hermine, on le sait, était grande, svelte et elle valsait à ravir.
Le comte était jeune, et son caractère à demi mélancolique lui faisait adorer la valse allemande qui est la reine des valses.
Pendant vingt minutes il entraîna la jeune femme haletante à son bras, oubliant un peu le bizarre personnage avec lequel il causait naguère, et l’étrange serment qu’il lui avait fait.
Quand le dernier soupir de la valse s’éteignit, le comte un peu grisé, reconduisit Hermine à sa place et la regarda :
– Ma parole d’honneur ! pensa-t-il, elle est charmante et si c’était par hasard, celle qui m’est réservée pour victime, je gagnerais l’héritage de mon oncle sans la moindre répugnance.
Le comte, en songeant ainsi, promena autour de lui un regard investigateur, cherchant des yeux l’excentrique sir Arthur.
Sir Arthur n’était point dans le grand salon.
Il se tenait dans un coin de la salle de jeu, auprès d’une table d’écarté qui demeurait veuve de joueurs.
L’attitude mélancolique du gentleman semblait indiquer le désir qu’il avait de trouver un partner.
Un jeune homme, le lorgnon dans l’œil, la barbe taillée en collier, à la physionomie impertinente et pourtant la tête en arrière, vint à passer.
Ce jeune homme, qui venait pour la première fois chez la marquise Van-Hop, avait été amené par un étranger de distinction. On le nommait M. le vicomte de Cambolh.
Il menait grand train, disait-on, avec de beaux chevaux, et habitait un délicieux entre-sol dans le faubourg Saint-Honoré. Il s’arrêta d’un air indifférent devant la table d’écartés, prit un jeu de cartes et les laissa tomber une à une à gauche et à droite, comme s’il eût été banquier au lansquenet.
Alors sir Arthur s’approcha et le salua avec la roideur habituelle des fils d’Albion.
– Voudriez-vous, monsieur, lui dit-il, faire une partie avec un gentleman qui souhaite fort jouer et ne trouve pas de partners ?…
Le vicomte de Cambolh s’inclina, s’assit, et jeta négligemment cinq louis sur le tapis. L’Anglais salua à son tour, s’assit pareillement, et ouvrit son portefeuille, d’où il tira une bank-note de cinq livres.
La partie commença silencieusement tout d’abord.
La table d’écartés se trouvait en un coin du salon où il y avait encore peu de monde, et où un whist à cinq louis la fiche absorbait la curiosité universelle.
Les deux joueurs d’écartés se trouvaient donc parfaitement isolés, et pouvaient causer à mi-voix sans la moindre crainte d’être entendus.
Alors sir Arthur Collins perdit, comme par enchantement, son accent britannique.
– Ma parole d’honneur ! mon cher Rocambole, dit-il, tu es tout à fait un homme du monde, un gentilhomme de cheval dans l’acception la plus complète.
– Peuh ! fit modestement M. le vicomte de Cambolh, on fait de son mieux… mais vous, capitaine, poursuivit-il avec admiration profonde, le plus bel Anglais que j’aie jamais vu. Votre belle chevelure jaune, votre teint rouge brique et votre faux ventre vous rendent si méconnaissable, que je m’y serais trompé, si je n’avais assisté à votre toilette.
Le baronet sir Williams, car c’était lui, se prit à rire.
– Il est certain, dit-il, que mon frère le philanthrope, qui me reconnut jadis, le jour de mon duel avec Bastien, ne me reconnaîtrait pas aujourd’hui.
– Voyons, reprit Rocambole, quand faut-il commencer ?
– Ah ! dame, répondit sir Williams, attendons une occasion ; tout est prêt, du reste. La Turquoise est prévenue, je l’ai installée dans le petit hôtel de la rue Moncey hier matin, elle sait déjà son rôle par cœur. Et toi ?
– Moi, dit Rocambole, je sais à merveille la botte secrète, et je suis aussi sûr de loger un pouce de fer dans la chair de mon adversaire que je suis certain de l’identité de sir Arthur Collins et de sir Williams.
– Surtout, observa le baronet, souviens-toi bien de la place où il faut toucher. Ne faisons pas de bêtises, nous jouons avec des millions.
– Soyez tranquille, mon oncle.
– On va jouer au lansquenet, reprit sir Williams, c’est certain, le marquis me l’a dit tout à l’heure. Notre ami est joueur, il y viendra… c’est alors qu’il faudra avoir de l’esprit.
– On en aura. Rien n’est plus facile, murmura Rocambole avec une adorable fatuité.
En effet, au moment même, et comme le faux sir Arthur Collins tournait gravement le roi quatre à quatre et empochait les cinq louis de M. le vicomte de Cambolh, on dressa une table de lansquenet, et le marquis Van-Hop vint à l’Anglais et lui dit :
– Êtes-vous des nôtres, my dear ?
– Yes ! répondit sir Arthur en se levant.
Une douzaine de personnes entouraient déjà la table, et parmi elles Fernand Rocher et le jeune comte de Château-Mailly. On tira les places d’abord, puis la main. Un roi tomba devant Rocambole.
Le vicomte salua les pontes, et prit la taille en jetant deux louis sur le tapis.
– Messieurs, dit-il en souriant, je ne passe jamais deux fois. La taille sera hachée, vous verrez. Je suis un vrai jettatore !
M. le vicomte de Cambolh se trompait. Il débuta par un refait d’as.
– Bravo ! dit-on.
– Alors, fit-il négligemment, qui veut de mes quatre louis ? C’est de l’argent sûr.
Les quatre louis furent tenus, le vicomte gagna.
– C’est bien extraordinaire, dit-il.
Et il passa trois fois encore et arriva à soixante louis.
– Bravo ! dit une voix, celle de l’Anglais sir Arthur.
– Valet et valet ! répliqua presque aussitôt le banquier.
Et il dit en souriant :
– Ma parole d’honneur ! cela ne m’est jamais arrivé, et, pour la rareté du fait, je ne veux pas passer la main. Je tiendrai tout ce qu’on voudra. Il y a, messieurs, cent vingt-huit louis au moins, et plus même si vous voulez.
En parlant ainsi, le vicomte tira une jolie bourse à travers les mailles de laquelle on vit blanchir quelques chiffons de la banque et étinceler des pièces d’or, et il la plaça devant lui.
– Banco ! dit une voix à l’extrémité de la table.
Le vicomte leva la tête et regarda.
C’était M. Fernand Rocher qui, son portefeuille à la main venait de tenir le banco.
Alors Rocambole, qui tenait les cartes à la main, les posa froidement sur la table.
– Je passe la main, dit-il.
Et l’accent dont il revêtit ces trois mots fut d’une impertinence si glacée, si dédaigneuse, que le rouge monta au visage de Fernand Rocher.
– Monsieur, cria-t-il, que signifie ?…
– Pardon, monsieur ! dit Rocambole en remettant les cartes à son voisin de droite, qui était précisément le baronet sir Williams, sous les traits couleur brique de sir Arthur Collins, j’use simplement de mon droit, je passe la main.
– Cependant, observa Fernand Rocher se contenant avec peine, il y a dix secondes, vous annonciez que vous ne passeriez pas la main.
– Monsieur, dit tranquillement le vicomte de Cambolh, j’ai réfléchi.
Et il quitta la table de jeu, où cet incident avait jeté un certain émoi.
Mais les joueurs, une fois attablés ne se troublent point pour si peu. D’ailleurs, à tout prendre, Rocambole avait usé de son droit, et ce droit se trouva justifié par l’événement, car la banque passée perdit au premier coup dans les mains de sir Arthur.
– Il a eu du nez ! dirent quelques joueurs. On a des pressentiments.
– Moi, ajouta un autre, je suis fait ainsi, je tiendrai tout ce qu’on voudra avec de certaines personnes, et rien contre telle ou telle figure.
En ce moment, le baronet sir Williams regarda d’un air significatif le jeune comte de Château-Mailly, qui était assis auprès de lui. Le comte tressaillit et comprit que c’était là la provocation dont lui avait parlé le gentleman.
Il se pencha à son oreille et lui dit :
– Quel est ce jeune homme qui vient de passer la main ?
– C’est le vicomte de Cambolh.
– Et l’autre ?
– L’autre, dit sir Arthur bas, c’est M. Fernand Rocher, le mari de cette jeune femme que vous avez fait valser tout à l’heure, comprenez-vous ?
– Oui… murmura le jeune comte, dont le cœur se prit à battre d’une soudaine émotion.
X
Cependant, M. Fernand Rocher avait, à son tour, quitté la table de jeu et avait suivi le comte de Cambolh.
Celui-ci était allé s’asseoir dans un petit salon à peu près désert.
Fernand s’approcha et le salua gravement. Le vicomte lui rendit son salut du bout des doigts.
– Pardon, monsieur, lui dit Fernand, me feriez-vous l’honneur de me donner une explication ?
– Volontiers, monsieur.
Et le vicomte braqua son lorgnon sur son œil gauche et cligna son œil droit.
– Monsieur, reprit Fernand irrité de cette impertinence nouvelle, pourriez-vous m’apprendre en quel lieu vous jouez ordinairement le lansquenet ?
– Dans le monde, monsieur, dit sèchement Rocambole.
– Dans lequel ? demanda Fernand, prenant à son tour un air dédaigneux.
Le vicomte passa son lorgnon de l’œil gauche à l’œil droit et répondit :
– C’est probablement, monsieur, dans celui où j’ai l’honneur de vous rencontrer.
– Monsieur, murmura Fernand exaspéré, je suis étonné en ce cas de m’y trouver moi-même car le monde où l’on vous rencontre ne doit pas être le vrai monde.
– C’est précisément, répondit Rocambole toujours froid et railleur, ce que je me suis dit tout à l’heure en vous entendant me faire banco. Je me connais en physionomies, monsieur, et comme le jeu est pour moi une sorte de bataille, quelque chose comme un duel, j’ai l’habitude, avant de… me battre, d’examiner mes adversaires.
– Ah ! fit Fernand en pâlissant, et…
– Je vous ai regardé, monsieur…
– Eh bien ?
– Eh bien, mais, dit lentement Rocambole, paraît que je n’ai point été satisfait de l’examen, puisque j’ai refusé… le combat.
Et Rocambole se prit à rire au nez de son interlocuteur.
Alors Fernand, hors de lui, saisit le bras du vicomte.
– Votre carte, monsieur ? lui dit-il. Demain à sept heures, au bois de Boulogne.
– Monsieur, répliqua tranquillement Rocambole, je vous ferai observer qu’avant de demander leur carte aux gens, on commence par leur donner la sienne.
– C’est juste, dit Fernand qui lui jeta sa carte au nez.
Rocambole la prit, braqua dessus son lorgnon et lut :
M. Fernand ROCHER,
5, rue d’Isly.
Un sourire plein d’ironie passa alors la bouche de l’élève du baronet sir Williams.
– Mon cher monsieur, dit-il, je suis Suédois, je me nomme le vicomte de Cambolh, et, dans mon pays, les gentilshommes ne se battent jamais avec les bourgeois. Cependant, comme nous sommes en France…
– Assez, monsieur, dit Fernand Rocher. Demain, à sept heures…
– Pardon, monsieur, interrompit froidement le vicomte de Cambolh, je compte trouver, en sortant d’ici à cinq heures du matin, ma chaise de poste, y monter, et prendre la route d’Italie. Si vous avez quelque envie de vous battre, sortons sur-le-champ. Nous trouverons des épées et un terrain à deux cents pas d’ici.
– Soit, répondit Fernand.
– Par exemple, reprit Rocambole, si vous avez une femme ici, vous feriez bien de la prévenir que vous sortez pour quelques heures.
– Pourquoi ?
– Parce que vous ne rentrerez pas… Je compte bien vous tuer.
Fernand haussa les épaules.
– Venez, monsieur, dit-il.
– Monsieur, dit Rocambole en quittant avec lui le petit salon, il est deux heures du matin, et, à moins d’aller à mon cercle ou au vôtre, je crois que nous ferons fort bien de chercher ici des témoins.
– Comme vous voudrez, répondit Fernand.
Or, Fernand, qui venait pour la première fois chez le marquis de Van-Hop, n’y rencontrait précisément aucun de ces amis à peu près intimes à qui on peut demander le service dont il avait besoin en ce moment ; il était donc assez embarrassé, lorsqu’il se trouva face à face avec le major Carden.
La physionomie ouverte et la tournure militaire du major séduisirent Fernand.
Il s’approcha de lui et lui dit :
– Vous avez été militaire, monsieur ?
– Toute ma vie, monsieur.
– Alors, peut-être ne me refuserez-vous pas un léger service ?
– Parlez, monsieur, dit courtoisement le major.
– Monsieur, reprit Fernand, je viens d’être grossièrement insulté. Mon adversaire part demain matin, au point du jour, et il ne consent à me donner satisfaction qu’à la condition que le combat ait lieu tout de suite.
– Vous désirez sans doute que je vous serve de témoin ? demanda le major avec un air de naïveté qui excluait le soupçon qu’il se trouvait là tout exprès, et s’attendait par avance à jouer ce rôle.
– Précisément, monsieur, bien que je n’aie point l’honneur d’être connu de vous.
– Monsieur, répondit le major, je suis un ami du maître de cette maison, et sais ce que valent les gens qu’on y rencontre. Je suis à vos ordres.
Et le major s’inclina.
Tandis que Fernand trouvait un témoin, M. le vicomte de Cambolh cherchait le sien dans la salle de jeu.
Le vicomte, on le devine, n’avait songé à personne autre qu’à sir Arthur Collins. Il s’approcha donc de la table du lansquenet.
Mais l’Anglais n’y était plus, et Rocambole ne le rejoignit que dans la salle du bal, où il causait dans une embrasure de croisée, avec un petit vieillard ventru, que nous allons reconnaître sans doute pour une ancienne connaissance.
Ce petit vieillard, qui portait une jolie perruque blonde, avait les yeux abrités par des conserves bleues, un gilet de nankin, un pantalon noir, un habit bleu boutonné à la Berryer, et une immense cravate blanche dans laquelle sa tête ronde et son visage très coloré disparaissaient à demi.
Propret et silencieux d’ordinaire, on le voyait à peu près partout où il y avait des bals et des fêtes. Il s’asseyait dans un coin, regardait danser toute une nuit sans mot dire, et s’en allait, sur un signe des personnes qui l’avaient accompagné, avec la soumission d’un enfant.
Dans le monde où il allait, ce petit vieillard avait la réputation d’être fou.
Mais sa folie était si douce, si inoffensive, que partout on le recevait avec plaisir. Cette folie, disait-on, provenait d’un chagrin d’amour, et voici quelle était la version qui courait les salons de Paris où on le rencontrait.
Père de famille, occupant une haute position administrative, le petit vieillard avait aperçu il y avait quelques années, une jeune fille dont la remarquable beauté l’avait frappé à ce point, qu’il en était devenu éperdument amoureux.
Cet amour, d’autant plus insensé que la jeune fille, honnête et vertueuse, avait épousé, peu de temps après, un brave ouvrier, l’avait conduit à la folie, et il était persuadé qu’il avait inspiré une si violente passion à la jeune fille, qu’elle en était morte.
Il en était resté pour lui une mélancolie profonde et qui se manifestait de temps à autre par un soupir, mais jamais par une plainte.
Or, ce fou, ce petit vieillard à l’habit bleu, nous l’avons tous connu, c’était M. de Beaupréau.
M. de Beaupréau, que sa femme et sa fille adoptive avaient retrouvé, il y avait un an environ, dans une maison de fous de la province, non loin de son pays natal, à Saint-Rémy.
Qu’on nous permette à ce sujet une digression de quelques lignes et un coup d’œil rétrospectif vers la première partie de cette histoire.
M. de Beaupréau, on s’en souvient, avait été surpris par Léon Rolland dans la maisonnette du parc de Bougival, et l’ouvrier était arrivé juste assez à temps pour sauver sa fiancée et arracher Cerise aux violences du chef de bureau.
Que s’était-il passé alors entre lui et M. de Beaupréau, tandis que M. de Kergaz, sur les indications de Cerise défaillante, volait au secours de Jeanne, qui se débattait aux mains de sir Williams.
Cerise, vaincue par le narcotique, n’avait point tardé à tomber à la renverse, si bien que Léon, effrayé, la crut morte et perdit la tête à ce point, qu’il oublia M. de Beaupréau. Celui-ci retrouva un peu de présence d’esprit et s’esquiva.
À partir de ce moment, on ne l’avait plus revu, et il était probable qu’il avait rejoint sir Williams, qui, lui aussi, disparut pendant cette nuit-là.
Du reste, l’indignation de madame de Beaupréau et d’Hermine était telle, elles avaient un si grand mépris du misérable, qu’elles ne firent aucune démarche pour s’enquérir de ce qu’il était devenu.
Cependant, au bout de trois années, Hermine, à présent madame Fernand Rocher, reçut une lettre de province qui l’étonna profondément.
Cette lettre, datée de Saint-Rémy, en Provence, était signée du directeur de l’hospice des aliénés de cette ville ; elle apprenait à madame Rocher que son père, dont on était parvenu, non sans peine, à constater l’identité, se trouvait au nombre des pensionnaires de l’hospice, et que sa folie, douce et calme, n’était aucunement dangereuse.
Madame de Beaupréau et sa fille, en apprenant l’infortune du misérable, lui pardonnèrent, et montèrent en chaise de poste pour l’aller chercher.
M. de Beaupréau était parfaitement fou, et dans l’impossibilité de dire ce qui lui était arrivé et ce qu’il avait fait depuis trois années.
Alors, la mère et la fille, voyant dans ce châtiment la main de Dieu, rouvrirent leurs bras au vieillard et le ramenèrent à Paris. Dès lors, M. de Beaupréau reprit sa place au foyer de la famille, et se trouva, pour ainsi dire, métamorphosé.
L’homme acariâtre, bilieux, avare, qui tourmenta sa femme pendant quarante années, avait, comme par enchantement, fait place à un vieillard doux, affectueux, au sourire mélancolique.
On n’aurait jamais reconnu en lui le Beaupréau des anciens jours, si parfois le nom de Cerise ne fût venu errer sur ses lèvres.
Ce nom était le seul lien qui semblât l’attacher au passé.
Hermine s’était prise à l’aimer ; Fernand et elle l’emmenaient toujours avec eux dans le monde.
Quelquefois même, si une affaire importante empêchait le jeune mari d’accompagner sa femme, il la confiait sans répugnance à M. de Beaupréau, lequel n’était fou que lorsqu’il parlait de Cerise, et se montrait fort raisonnable en toute autre chose.
Il n’avait qu’une manie, celle de s’habiller parfois comme les infirmiers de la maison de fous.
C’était donc avec M. de Beaupréau que causait l’Anglais sir Arthur Collins, ou, si vous l’aimez mieux, le baronet sir Williams.
– Beau-père, disait le baronet, avouez que vous ne m’auriez jamais reconnu sous ce costume, et avec ma face de Peau-Rouge.
– J’en conviens, répondit de Beaupréau ; mais convenez aussi, mon digne gendre in partibus, que je me suis conduit assez bien depuis que je suis rentré dans ma chère famille.
– D’accord, papa, vous êtes un fou modèle ; vous jouez votre rôle à merveille.
– N’est-ce pas ? fit le Beaupréau avec un mouvement de légitime orgueil. Oh ! comme nous leur avons bien donné le change, hein ?
– L’histoire de Saint-Rémy est parfaite… Ah ! mon cher monsieur de Beaupréau, murmura sir Williams en riant, on voit bien que vous n’avez pas renoncé à Cerise.
– Certes, non, mon gendre.
– Vous avez raison, papa. Il n’y a que les imbéciles qui renoncent à quelque chose, et les mauvais joueurs qui s’arrêtent à la première partie.
– Ah ! fit le vieillard, dont le regard devint brillant derrière ses lunettes bleues, nous avons perdu une belle manche ! Dix minutes de plus, j’enlevais la petite.
– Bah ! fit sir Williams, patience ; aux derniers les bons ! Nous aurons notre revanche, papa.
– Ainsi, murmura de Beaupréau, vous croyez…
– Je crois que si vous êtes gentil, et que vous fassiez tout ce que je vous demande, je parviendrai à vous ménager quelque jour un moment d’entretien avec Cerise, dans quelque solide maison dont son mari ne pourra pas enfoncer les portes.
– Ah ! fit le Beaupréau avec un accent de joie profonde et cruelle.
– My dear, continua le baronet, qui veut la fin veut les moyens. Grâce à mon imagination, vous êtes rentré dans vos pénates, on vous y a reçu à bras ouverts, on vous y traite comme un coq en pâte, et comme tous vous croient fou, personne n’a la moindre défiance de vos actions.
– Eh bien ?
– Eh bien ! voilà une situation dont il faut tirer parti, vertudieu ! et, dès ce soir, je vous nomme mon lieutenant pour une petite opération que j’ai conçue.
– Voyons ? fit de Beaupréau.
– Aimez-vous beaucoup votre gendre ?
– Fernand ? Ah ! le monstre ! murmura l’ex-chef de bureau, si je pouvais l’étrangler !
– Seriez-vous bien aisé qu’il eût… des malheurs ?
– J’en serais ravi.
– Très bien ! Alors, regardez.
Et sir Williams montra à M. de Beaupréau le jeune comte de Château-Mailly assis auprès d’Hermine.
– Un beau garçon, ma foi ! murmura le prétendu fou.
– Il va venir causer avec vous tout à l’heure. Il se nomme le comte de Château-Mailly, et prétendra vous avoir connu beaucoup. Comme vous êtes fou, cela n’a rien d’extraordinaire pour lui. Vous feindrez de le reconnaître, et le présenterez officiellement à votre fille. Demain, je vous donnerai de plus amples instructions.
Et, comme le faux sir Arthur vit venir à lui Rocambole, il laissa M. de Beaupréau dans l’embrasure de la croisée.
– C’est fait, lui dit Rocambole. Notre homme me suit.
– Oh ! yes ! fit le baronet.
Et il suivit à son tour M. le vicomte de Cambolh, qui s’esquivait hors du salon.
En route, sir Williams rencontra le comte de Château-Mailly.
– Vous voyez, lui dit-il tout bas, ce petit monsieur qui a un habit bleu et un gilet de nankin ?
– Oui, dit le comte.
– Eh bien ! c’est le père.
– Allez-vous me présenter ?
– Non, vous vous présenterez fort bien vous-même. Ce bonhomme est fou. Une de ses manies consiste à croire reconnaître tout le monde. Allez à lui, appelez-le par son nom ; il s’appelle M. de Beaupréau et a été chef de division aux affaires étrangères. Dites-lui que vous l’avez beaucoup connu dans le monde, il y a trois ou quatre ans. Il sera ravi, vous appellera son cher ami et vous introduira chez la belle.
– C’est bien, dit le comte ; j’y vais sur-le-champ.
Pendant ce temps, Fernand s’approchait de sa femme et lui disait :
– Ma chère amie, ne m’en veuillez pas, je vais quitter le bal, où vous vous amusez, et vous laisser sous la tutelle de M. de Beaupréau.
– Comment ! dit Hermine d’un ton boudeur, vous partez ?
– Oh ! je serai rentré à l’hôtel dans une heure au plus tard… du moins je l’espère.
– Vous… l’espérez ? fit la jeune femme inquiète. Mon Dieu ! que vous arrive-t-il ?
Fernand se prit à sourire :
– Rassurez-vous, dit-il, j’ai une bonne œuvre à faire… Vous savez que je ne m’appartiens pas toujours.
Ce mensonge coûtait à Fernand Rocher, mais il le dispensait de toute autre explication et lui permettait de quitter le bal sans alarmer sa jeune femme.
Il s’approcha de M. de Beaupréau et lui dit :
– Papa, vous reconduirez Hermine, n’est-ce pas ?
– Oui, fit le petit vieillard d’un signe.
Le vicomte de Cambolh et son témoin étaient déjà sur la première marche du perron, et Fernand se hâta de les rejoindre en compagnie de M. le major Carden.
Ce fut après que Fernand Rocher eut quitté le bal, que le jeune comte de Château-Mailly s’approcha de l’ancien chef de bureau aux affaires étrangères.
– Bonjour, monsieur de Beaupréau, lui dit-il en souriant et d’un ton dégagé.
M. de Beaupréau le regarda, parut un moment étonné, puis se frappa le front :
– Pardonnez-moi, mon cher ami, dit-il, mais j’ai une mémoire déplorable ; j’oublie toujours les noms de mes plus intimes.
– J’en étais jadis, fit le comte en lui prenant familièrement la main et la serrant. Ne reconnaissez-vous pas votre jeune ami d’il y a deux ou trois ans ?
– Oh ! si fait… si fait… Mais… le nom ?
– Le comte de Château-Mailly.
– Parbleu ! s’écria M. de Beaupréau, qui décidément était devenu très bon comédien à l’école de sir Williams, je ne connaissais que vous, mon très cher…
Et il lui serra les deux mains.
Alors M. de Château-Mailly s’efforça de persuader au prétendu fou qu’ils s’étaient rencontrés cent fois et dans tous les mondes, et M. de Beaupréau continua à se montrer empressé, affectueux.
Cette comédie, l’œuvre du génie de sir Williams, se trouva ainsi jouée de la meilleure foi du monde.
– Mais, dit tout à coup M. de Beaupréau, vous avez fait danser ma fille tout à l’heure ?
– Votre fille ? fit ingénûment le comte.
– Sans doute, ma fille, cette dame avec qui vous causiez tantôt, là-bas.
– En vérité ! une femme belle et charmante. C’est votre fille ?
– Oui, madame Fernand Rocher.
– Alors, dit le comte, faites-moi un plaisir, présentez-moi.
– Volontiers, venez.
Et le petit vieillard à lunettes bleues reprit le comte par la main.
Ils se croisèrent avec madame Malassis.
La veuve, après avoir échangé maintes œillades avec le vieux duc de Château-Mailly, s’apprêtait à quitter le bal.
Le duc, qui, sans doute, attendait ce moment avec impatience et se trouvait à l’extrémité opposée du salon, se précipita et voulut fendre la foule pour offrir sa main à la belle veuve ; mais déjà madame Malassis et le jeune comte de Château-Mailly se trouvaient face à face.
La veuve était trop habile pour ne point sourire à celui qu’elle allait bientôt dépouiller de son héritage.
Le comte était trop homme du monde pour ne point saluer et sourire à son tour.
Mais dans son salut et son sourire, il perça comme un dédain ironique et nuancé d’impertinence.
– En vérité, mon cher comte, lui dit la veuve à l’oreille, il me semble que vous vous plaisez fort en la compagnie de ce petit vieux.
– Peut-être, madame.
– A-t-il de l’esprit ?
– Presque autant que vous.
– Ah ! vraiment ! minauda la veuve.
– Parole d’honneur ! il conte à ravir.
– En vérité.
– Et il me narrait tout à l’heure, là-bas, poursuivit le comte d’un ton moqueur, une histoire des plus amusantes.
– Vous me la redirez ?
– Oh ! c’est un peu long…
– Mais encore ?
– Eh bien, c’est l’histoire d’un vieillard plus que sexagénaire qui a la folie de se remarier… d’épouser une intrigante… et de déshériter sa famille à son profit.
Et le comte salua la veuve avec une rare impertinence et passa.
Pendant un moment, madame Malassis demeura pâle et comme suffoquée de tant d’audace.
Mais le vieux duc accourait, empressé, plus amoureux que jamais.
Alors un sourire vint aux lèvres de la veuve.
– À nous deux, mon cher comte ! dit-elle.
XI
Le duc offrit sa main à la veuve et la conduisit jusqu’à sa voiture.
– Ne montez-vous pas ? lui dit-elle de sa voix la plus enchanteresse.
L’amoureux vieillard ne se le fit point répéter ; il s’élança avec une souplesse toute juvénile dans le carrosse et s’assit auprès de la veuve.
– Rue de la Pépinière, 40, dit-il au valet qui releva le marchepied et ferma la portière.
Madame Malassis attendait depuis fort longtemps, c’est-à-dire depuis le moment où le neveu du duc l’avait si impertinemment lorgnée, cette occasion de tête-à-tête avec son vieil adorateur.
– Mon cher duc, lui dit-elle au moment où le carrosse sortait de la cour, il y a réellement trop près de l’allée des Veuves à la rue de la Pépinière.
– Vous trouvez, chère âme ?
– Oui, aujourd’hui, du moins.
Le duc prit la main de la veuve et la baisa galamment.
– Vous êtes charmante, dit-il.
Mais madame Malassis allait droit au but :
– Trêve de compliments, dit-elle.
Et elle ajouta :
– Ordonnez donc à votre cocher de remonter l’avenue des Champs-Élysées, de sortir par la barrière de l’Étoile et d’aller jusqu’à Neuilly. La nuit est tiède, et j’ai une horrible migraine que le grand air dissipera.
– Vos désirs sont des lois, répondit le duc, qui transcrivit au cocher, par l’intermédiaire du valet de pied, les volontés de la veuve.
– Maintenant, reprit madame Malassis, permettez-moi, mon cher duc, de profiter de cette heure d’entretien que nous allons avoir pour vous donner une nouvelle qui vous étonnera peut-être…
– Oh ! oh ! fit le duc, vous m’intriguez.
– Cette nouvelle est celle de mon départ.
Madame Malassis avait articulé ces quelques mots avec un accent naturel et calme qui, cependant, produisit sur M. de Château-Mailly un foudroyant effet, et pendant dix secondes il demeura comme suffoqué et dans l’impossibilité de faire un geste ou de prononcer un mot qui peignît sa douloureuse stupéfaction.
– Oui, mon cher duc, reprit la veuve, je pars… demain matin.
– Vous… partez… murmura enfin M. de Château-Mailly avec l’accent d’un homme privé de sa raison. Pourquoi ? où allez-vous ?
– Je pars pour des raisons à moi connues, et ne puis dire le but de mon voyage.
Et madame Malassis ajouta en souriant :
– Vous voyez, mon pauvre duc, que vous n’êtes pas heureux dans vos questions. Précisément je n’y puis répondre.
– Madame, balbutia le vieillard saisi d’un tremblement nerveux subit et dont la voix s’altéra d’une manière effrayante, voulez-vous me tuer ?
Et il appuya sur ce dernier mot avec une intonation si vraie, que madame Malassis en tressaillit et comprit jusqu’à quel point elle était aimée.
– Moi, vous tuer… mon ami… dit-elle, êtes-vous fou ?
– Oh ! peut-être oui, je ne sais pas ; mais, au nom du ciel, Laure, ne me faites plus de ces atroces plaisanteries.
– Mon cher duc, répondit la veuve, je ne plaisante nullement. Mais je vous vois si étourdi, si stupéfait de la nouvelle de mon départ, que je ne puis avoir la cruauté de vous en cacher le motif.
– Ainsi… vous partez ?…
– Oui, demain matin.
– Et… où allez-vous ?
– Chut ! vous le saurez plus tard…
– Mais enfin… c’est peut-être un voyage de huit jours…
– Non, c’est un voyage d’un an ou deux, et je veux bien vous le dire, je vais en Italie.
M. de Château-Mailly croyait être en proie à un horrible rêve et se sentait défaillir.
– Je pars, poursuivit la veuve, pour me faire oublier un peu… à Paris.
– Vous… faire… oublier ?
– De vous, d’abord, dit-elle froidement.
Et comme le vieillard demeurait frappé de stupeur et ne trouvait plus un mot à répondre, madame Malassis continua :
– Quand une femme est compromise, comme moi, lorsqu’elle a commis une faute, si cette faute parvient au grand jour et demeure irréparable, cette femme n’a plus qu’une chose à faire, c’est de quitter le monde et de fuir… Et c’est ce que je fais, mon cher duc.
– Laure, Laure, balbutia le vieillard, devenu plus tremblant et plus timide qu’un enfant… au nom du ciel, expliquez-vous !
– Comment ! dit-elle avec une véhémence subite, vous ne comprenez pas ? Vous ne comprenez pas qu’il y a eu pour moi un jour fatal et maudit, où je me suis trouvée veuve, isolée, sans appui, considérant le monde à travers ma douleur, et le voyant semblable à une vaste solitude ? Qu’alors je vous ai rencontré, que j’ai eu la faiblesse impardonnable d’accepter d’abord cette amitié que vous m’offriez avec un si noble désintéressement…
La veuve s’arrêta comme dominée par son émotion.
M. de Château-Mailly se précipita sur ses mains et les porta à ses lèvres avec passion.
– Mon Dieu ! reprit-elle, j’ai été faible… j’ai été coupable… vous m’avez fait des promesses auxquelles j’ai eu le tort de croire, en ma naïveté… Hélas ! je paye trop chèrement aujourd’hui les suites d’une heure d’erreur pour ne point prendre un parti.
– Mais… madame… murmura le duc d’une voix entrecoupée, les promesses que je vous ai faites… je les tiendrai…
– Il est trop tard, monsieur, dit-elle d’un ton sec.
– Trop tard !…
– Oui, car tout Paris aujourd’hui… Mon Dieu ! je l’ai bien vu ce soir… chez la marquise… et votre impertinent neveu me l’a bien fait sentir…
– Mon neveu ! exclama le duc avec une colère subite.
– Oui, répondit-elle. Votre neveu m’a laissé entendre, le plus impertinemment du monde, que j’étais… Oh ! non, s’interrompit-elle en fondant en larmes… jamais je n’oserai prononcer ce mot.
– Madame, s’écria le vieux duc, affolé par cette douleur si naturellement jouée que tout le monde s’y fût trompé, mon neveu est un sot à qui j’apprendrai le respect qu’il doit à sa tante la duchesse de Château-Mailly.
Madame Malassis jeta un cri et tomba évanouie dans les bras de son vieil adorateur.
– Touche à l’hôtel ! cria M. de Château-Mailly au cocher.
Le cocher tourna bride, redescendit l’avenue des Champs-Élysées et gagna la place Beauvau, où se trouvait situé l’hôtel de Château-Mailly.
Madame Malassis était encore évanouie, et le vieux duc lui prodiguait inutilement ses soins lorsque le carrosse franchit la grille de l’hôtel.
À l’exception du suisse, du valet de chambre et d’un palefrenier, tous les domestiques étaient couchés à l’hôtel.
Il n’y eut donc que ces trois hommes qui virent M. de Château-Mailly rentrer chez lui avec une femme en robe de bal, évanouie, et qu’il paraissait beaucoup aimer, à en juger par sa figure bouleversée et ses exclamations de douleur.
– Vite, vite, ordonna-t-il, transportez madame dans la chambre de la duchesse… Qu’on appelle un médecin… ou plutôt, non, des sels, du vinaigre !
Le duc étouffait en parlant.
On transporta madame Malassis au premier étage, dans la chambre qu’avait longtemps occupée la feue duchesse de Château-Mailly. Là, le duc, amoureux et hors de lui, prodigua de tels soins à la veuve, l’appela de noms si tendres et d’une voix si brisée, qu’elle se décida à ouvrir les yeux et à promener autour d’elle un regard étonné.
– Ah ! enfin ! murmura le vieillard avec une explosion de joie, enfin, vous m’êtes rendue !
Elle le regarda et jeta un cri :
– Mon Dieu ! dit-elle, où suis-je ? où m’avez-vous conduite ? Mais parlez, monsieur, parlez, expliquez-vous ?
– Vous êtes chez moi, dit le duc.
– Chez vous !
Et elle se dressa épouvantée, et répéta avec l’accent de la folie :
– Chez lui ! je suis chez lui ! Ah ! je suis perdue !
– Vous êtes chez vous, madame, répéta le duc, chez vous et non plus chez moi, car, avant trois semaines, vous serez duchesse de Château-Mailly.
Madame Malassis jeta un nouveau cri, mais elle ne crut point, cette fois, devoir l’accompagner d’une nouvelle syncope.
– Non, non, dit-elle, cela n’est plus possible… Vous m’avez déshonorée.
Et comme il paraissait ne pas comprendre, la future duchesse lui dit avec amertume :
– Vous êtes fou et cruel, monsieur… car vous n’avez pas la prétention, j’imagine, de me ramener ici, en plein jour, au grand soleil, comme votre femme, après m’y avoir furtivement introduite de nuit, en présence de vos domestiques… Ah ! c’est alors, reprit-elle avec une ironie pleine de désespoir et qui acheva de faire perdre la tête au vieux duc, c’est alors que votre neveu aurait le droit de me dire nettement ce qu’il m’a laissé entendre aujourd’hui : « Mon oncle me vole son héritage en épousant sa maîtresse. »
Et madame Malassis, qui avait calculé l’effet subit de ces paroles et leurs conséquences les plus éloignées, se leva avec la dignité d’une reine offensée, s’enveloppa dans sa sortie de bal qu’elle aperçut sur une chaise, et salua le duc de la main :
– Adieu, monsieur… dit-elle, vous m’avez perdue… Je vous pardonne…
Elle fit deux pas et ajouta avec un soupir :
– Parce que je vous aimais… Adieu !…
Et elle sortit, laissant le duc foudroyé et hors d’état de courir après elle et de la retenir.
L’adroite veuve descendit rapidement l’escalier de l’hôtel, passa comme une ombre devant la loge du suisse et se trouva sur la place Beauvau, et par suite, dans le faubourg Saint-Honoré, en moins de cinq minutes.
Une autre que madame Malassis se serait contentée de prendre le duc au mot ; mais elle, elle savait son monde sur le bout du doigt, et n’était pas femme à jouer un rôle à demi. Il y avait environ deux ans que le duc soupirait à ses genoux ; il y avait un an qu’il avait parlé de l’épouser, mais faiblement d’abord et luttant contre force préjugés et force scrupules ; puis d’une façon moins évasive, à mesure que les liens dont la veuve l’enveloppait peu à peu se resserraient et se multipliaient.
Une seule considération arrêtait encore M. de Château-Mailly : l’énormité de la mésalliance…
Madame Malassis avait donc voulu frapper un grand coup, et la scène qui venait d’avoir lieu et que nous avons rapportée en était une preuve.
De la place Beauvau à la rue de la Pépinière, la distance était assez courte pour que la veuve se hasardât à la parcourir à pied, car, à trois heures du matin, dans le faubourg Saint-Honoré, on ne rencontre que fort rarement des voitures de place.
– Dans trois semaines, se dit-elle en s’éloignant d’un pas rapide, dans trois semaines, je serai duchesse de Château-Mailly. Si je ne m’étais pas évanouie, il était capable d’ajourner à trois mois ; si j’étais restée chez lui tout à l’heure j’étais perdue !
Et madame Malassis ajouta, avec un de ces sourires où l’âme d’une femme se révèle tout entière :
– Le duc a une clef du jardin. Dans une heure il sera chez moi.
La maison n° 40 de la rue de la Pépinière, qu’habitait madame Malassis, se composait d’un grand corps de logis donnant sur la rue, une véritable maison à locataires en un mot, et d’un pavillon situé au fond du jardin.
C’était ce pavillon que la veuve avait choisi pour demeure et où elle vivait avec trois domestiques, une cuisinière, une femme de chambre, un intendant, sorte de maître-jacques qu’elle avait depuis le matin seulement.
Ce dernier et la femme de chambre attendaient la veuve.
Bien qu’elle fût venue à pied, comme il faisait une belle nuit d’hiver bien sèche, on aurait pu croire que madame Malassis était rentrée en voiture.
Or, elle arrivait à trois heures du matin, en robe de bal, comme elle était partie. En route, elle avait fait disparaître toute trace de cette émotion passagère, pour ne pas dire simulée, dont le vieux duc avait été la dupe. Par conséquent ses gens ne pouvaient soupçonner aucunement qu’elle venait d’un tout autre lieu que de l’hôtel Van-Hop.
Le pavillon occupé par madame Malassis était grand, spacieux, confortablement meublé, et se composait d’un rez-de-chaussée et d’un premier étage.
Il avait deux portes :
L’une par laquelle on entrait habituellement, qui ouvrait sur un vestibule de marbre gris et noir et faisait face à la maison ;
L’autre, située au bas de l’escalier, donnait sur le jardin, et était masquée à demi par une charmille qui se prolongeait jusqu’au mur et aboutissait à une autre petite porte percée sur la rue Laborde, fort déserte en cet endroit non seulement la nuit, mais à toute heure du jour.
Cette porte était l’entrée particulière de madame Malassis, qui, cependant, ne s’en servait jamais en apparence du moins.
Cependant, cette porte avait deux clefs.
L’une de ces clefs était en la possession de la veuve.
L’autre appartenait à M. le duc de Château-Mailly.
Cette clef ouvrait non seulement la porte du jardin, mais encore celle du pavillon.
Or, très souvent, le soir, vers minuit, quand ce tranquille quartier de la rue Pépinière et des environs devenait désert, deux hommes se glissaient sans bruit dans la rue de Laborde.
L’un introduisait une clef dans la serrure, ouvrait la petite porte du jardin ; l’autre demeurait dans la rue à faire le guet.
Le premier se dirigeait, en suivant la charmille, vers le pavillon, pénétrait à l’intérieur et montait d’un pas juvénile l’escalier qui conduisait au premier étage, c’est-à-dire à l’appartement de madame Malassis.
Presque toujours il en ressortait au bout d’une heure, et retrouvait son compagnon dans la rue.
Ce compagnon, c’était le valet de chambre de M. le duc de Château-Mailly, le même qui s’était fait chasser de la veille au matin, et avait, par mégarde, emporté la clef du jardin.
Madame Malassis trouva en rentrant chez elle son nouveau domestique conversant paisiblement avec sa camériste.
Or, ce maître-jacques n’est autre que l’homme à visage étrange et dur, à stature athlétique, à épaules carrées, dont le regard semblait trahir les passions brutales, et que nous avons vu à la réunion des Valets-de-Cœur, présidée par Rocambole.
Comment cet homme à physionomie repoussante était-il parvenu à plaire à madame Malassis ? Grâce à une simple lettre de recommandation procurée par Rocambole et signée de l’un des noms les plus retentissants du faubourg Saint-Germain.
La marquise de…, recommandait chaudement le sieur Aventure, qui était demeuré dix ans chez elle comme cocher, et n’en sortait que parce qu’il était atteint d’un commencement d’ophtalmie qui ne lui permettait plus de conduire sûrement une voiture.
La prétendue marquise attribuait le visage peu avenant de son protégé à une maladie horrible dont il avait été victime durant sa jeunesse, et qui avait laissé la physionomie d’un bandit au plus honnête homme du monde.
Outre que cette lettre était très chaude, madame Malassis avait été touchée par la modicité des prétentions de maître Aventure, qui ne demandait que six cents francs de gage, la nourriture et le logement.
Donc, elle avait pris Aventure, qui était entré en fonctions le matin même.
D’ailleurs, et en dépit de sa laideur, le gros homme avait bien meilleure façon dans sa livrée bleue à retroussis écarlate que, deux jours auparavant, avec son habit noir, son gilet blanc et ses breloques en chrysocale.
La veuve le congédia en lui disant qu’il pouvait aller se reposer, et elle entra dans sa chambre à coucher où l’attendait un grand feu.
– Vite ! dit-elle à sa camériste en se jetant dans un grand fauteuil et se débarrassant de sa sortie de bal, cherche-moi une malle, des cartons, place tout cela au milieu de la chambre et entasses-y quelques chiffons à la hâte.
– Madame va faire un voyage ? demanda la femme de chambre étonnée de cet ordre.
– Non, mais je feins de partir.
La soubrette était rouée, elle regarda sa maîtresse d’un air fin.
– Madame attend M. le duc ? demanda-t-elle.
– Oui, répondit la veuve. Maintenant, c’est lui qui veut m’épouser…
– Et madame ne veut plus ?
– Justement.
– Alors, dit tranquillement la soubrette, je vais faire mon paquet, car je crois que je coucherai un de ces soirs à l’hôtel de Château-Mailly.
– C’est probable, murmura madame Malassis, qui, on le voit, avait fait sa confidente de sa femme de chambre, justifiant ainsi ce proverbe que « la vertu est de toutes les classes, comme le vice ; que la femme du meilleur monde peut faillir, mais que celle qui se confie à une servante est toujours une femme commune. »
La soubrette exécuta les ordres de sa maîtresse et entassa à la hâte quelques vêtements dans une malle, quelques dentelles dans un carton, et rangea deux chapeaux dans leur boîte.
Et la veuve, qui n’avait pas de secrets pour sa camériste, lui raconta de point en point ce qui s’était passé entre elle et le duc, depuis leur départ de l’hôtel Van-Hop.
La camériste, pour répondre à l’honneur d’une semblable confidence, écouta gravement sa maîtresse jusqu’au bout, et finit par émettre cet avis :
– Je ne me permettrai point de donner un conseil à madame ; mais si madame voulait me permettre une simple observation, j’oserais lui dire qu’il faut que madame ait tout à fait l’air de partir.
– C’est mon intention, ma fille.
– À la place de madame, j’écrirais à M. le duc une belle lettre d’adieu.
– Tiens ! fit madame Malassis, c’est une idée.
– Et j’aurais l’air de la terminer et de vouloir la cacher, lorsque M. le duc arrivera.
– Tu es une fille d’esprit… Va-t’en.
– Madame est trop bonne, répondit la femme de chambre en s’en allant.
Demeurée seule, madame Malassis se mit en devoir de suivre le conseil de sa servante, et, s’asseyant devant un joli pupitre en bois de rose qui supportait tout ce qu’il faut pour écrire, elle prit la plume et commença à tracer quelques lignes.
Mais en ce moment elle tressaillit et prêta l’oreille.
La nuit était silencieuse et l’on entendait les moindres bruits qui résonnaient dans l’espace.
Or, le grincement d’une clef dans une serrure, puis celui des gonds d’une porte étaient venus frapper l’oreille de la veuve.
– Le voici ! pensa-t-elle.
En effet, des pas criaient sur le sable de la charmille ; puis madame Malassis entendit ouvrir une seconde porte, puis des pas résonnèrent dans l’escalier.
Et madame Malassis continua à écrire.
On frappa deux coups à la porte de la chambre.
– Entrez ! dit la veuve.
Elle ne tourna point la tête, elle laissa son regard attaché sur le papier que la plume noircissait.
La porte s’ouvrit, un homme entra et s’arrêta sur le seuil.
Alors, persuadée qu’elle allait voir le visage pâle et bouleversé du vieux duc, la veuve repoussa sa lettre sous un carton et releva lentement la tête.
Mais soudain elle poussa un cri, se leva précipitamment, et recula…
L’homme qui pénétrait chez elle muni d’une clef, cet homme qui franchissait le seuil de sa chambre à coucher à quatre heures du matin, ce n’était point le duc de Château-Mailly.
C’était un inconnu !
XII
Fernand Rocher et le major Carden, son témoin, étaient sortis du bal.
Le faux vicomte et sir Williams les attendaient sur la première marche du perron. Alors Rocambole salua de nouveau son adversaire :
– Veuillez me permettre, monsieur, lui dit-il, une simple proposition. J’ai mon appartement dans le quartier, et dans mon appartement des épées de combat ordinaire. Avez-vous quelque répugnance à vous en servir ? dans ce cas-là, nous ferons lever Devisme ou Lepage.
– C’est inutile, répondit Fernand, nous nous battrons avec vos épées.
– Bien. Ensuite, je trouve le Bois un peu loin.
– Allons où vous voudrez.
– Il y a à quelques pas d’ici un endroit tout à fait désert, entre la rue Courcelles et la rue de Laborde, une sorte de terrain vague où nous serons à merveille.
– Soit, dit encore Fernand.
– Ensuite, monsieur, j’ai là mon phaéton, et comme il est, je crois, parfaitement inutile de mettre des valets dans notre confidence, je vais envoyer mon groom et je serai, si vous le voulez bien, votre cocher jusqu’au lieu du combat.
Fernand s’inclina.
Rocambole ordonna à son groom d’avancer et de ranger son léger équipage au bas du perron.
Puis, tandis que le groom, sautant à bas de son siège, prenait la bride du cheval, le lion invita le major et Fernand à monter derrière, pendant que sir Williams s’asseyait auprès de lui sur le siège de devant.
Alors M. le vicomte de Cambolh rendit la main à son cheval et franchit la grille extérieure de l’hôtel.
Cinq minutes après, il arrivait au faubourg Saint-Honoré, s’arrêtait à sa porte et passait les rênes à sir Arthur Collins.
– Messieurs, dit-il en sautant à bas de son siège, je vous demande dix secondes.
Et Rocambole monta chez lui, y prit deux paires d’épées de combat et redescendit.
– Je suis à vos ordres, dit-il.
L’attelage repartit et ne s’arrêta plus qu’à l’entrée de ces terrains vagues connus sous le nom de plaine Monceau.
Là, les quatre voyageurs mirent pied à terre.
Trois heures et demie sonnaient, dans le lointain, à Saint-Philippe-du-Roule.
La nuit était claire, la lune brillait au ciel ; il faisait un froid sec et vif.
– Nous allons nous battre aussi commodément qu’en plein jour, dit Rocambole à Fernand. Seulement, dépêchons-nous, monsieur, car il fait un froid de loup.
Le major Carden et le faux Anglais s’étaient emparés des épées et les mesuraient gravement.
Les conditions secrètes du vicomte Andréa et de Rocambole étaient que le premier, l’âme, la tête, la pensée incarnée de l’association, demeurerait toujours inconnu.
Or, si le major Carden avait été prévenu par Rocambole que Fernand, provoqué par lui, réclamerait son aide, et que pour provoquer sa demande, il se placerait sur son chemin, il ignorait cependant la cause et le but de ce duel, car Rocambole avait jugé inutile de lui donner la moindre explication ; il ne savait pas davantage ce que pouvait être sir Arthur Collins.
Aussi sir Arthur jouait-il en conscience avec lui son rôle d’Anglais, s’exprimant en un français de fantaisie dont les intonations semblaient intraduisibles pour tout autre gosier qu’un gosier d’outre-Manche.
Le chef des Valets-de-Cœur était donc tout au plus, aux yeux du major Carden, un vulgaire affilié de cette grande association dont il faisait partie lui-même.
Sir Arthur mit même une conscience telle à mesurer les épées, à discuter les conditions du combat, et s’indigna si bien contre l’usage du duel, rappelant qu’il n’existait point en Angleterre, que le major se demanda si, au lieu d’être dans le secret de la comédie sanglante qui allait se jouer, sir Arthur n’était point un Anglais de bonne foi, un convive naïf du marquis Van-Hop, à qui Rocambole avait demandé de lui servir de témoin.
Cependant le faux insulaire eut le temps de s’approcher de Rocambole, qui venait de mettre habit bas, et de lui dire à l’oreille :
– Souviens-toi bien du coup que je t’ai montré, au moins…
– Je le sais par cœur…
– Et pas de bêtises, surtout… ne va pas le tuer.
– Soyez tranquille.
– Monsieur, dit Fernand en s’approchant et prenant son épée des mains de sir Arthur, je suis de votre avis, il fait froid, dépêchons-nous.
Les deux adversaires se placèrent en face l’un de l’autre, sir Arthur mit les épées bout à bout, et prenant son accent le plus guttural :
– Aoh ! dit-il, allez, messieurs !
Fernand était irrité de l’impertinence constante de son adversaire, plus encore peut-être que de l’insulte qui avait été le premier motif du combat.
Aussi n’apportait-il sur le terrain que tout juste assez de sang-froid pour ne point oublier toutes les lois de l’escrime.
Rocambole, au contraire, était aussi calme qu’un chirurgien qui s’apprête à faire une opération, et il sifflotait un air de la Norma en engageant le fer.
Fernand avait reçu l’éducation du jeune homme dont l’entrée dans la vie a eu lieu sous les auspices de la pauvreté ; il avait négligé la salle d’armes pour la salle d’études, le manège pour l’école de droit. La grande fortune que lui avait apportée son mariage l’avait trouvé écuyer novice et tireur médiocre.
À la façon dont il se mit en garde, on eût pu dire de lui qu’il tenait son épée bien plus avec le cœur qu’avec la main.
Rocambole avait mis au service d’une étude patiente une adresse native et une agilité sans égale.
Le fils adoptif de la veuve Fipart, en changeant de pelure, qu’on nous passe le mot, le vaurien devenu lion n’avait rien perdu de ses qualités de jeunesse.
Il possédait toujours ce merveilleux sang-froid qu’il avait déployé le jour où Léon Rolland le tenait sous son genou et lui appuya un couteau sur la poitrine pour le faire parler.
Il était toujours souple, adroit, possédait les mêmes nerfs d’acier, et n’avait point oublié, en apprenant l’escrime, l’art de la savate, qui est la véritable escrime du gamin de Paris.
Rocambole apportait donc sur le terrain son agilité de chat-tigre, unie aux savantes leçons du vicomte Andréa, et servie par sa merveilleuse présence d’esprit. Dès sa première passe, il sut à quoi s’en tenir sur la force de son adversaire, et il n’eût, en réalité, tenu qu’à lui de tuer Fernand à la seconde riposte.
Mais ce n’était là ni ce que voulait sir Williams, ni ce qu’il avait résolu lui-même.
Rocambole avait dit le mot ; il voulait pratiquer une opération chirurgicale, et il savait qu’un pouce de fer dans l’épaule ne tue pas, mais procure un évanouissement subit et blesse assez grièvement pour forcer un homme à garder le lit pendant plusieurs jours.
Fernand, qui avait achevé de perdre sa dernière parcelle de sang-froid en mettant l’épée à la main, s’était précipité sur son adversaire avec impétuosité, moins soucieux de défendre sa propre vie que de tuer Rocambole.
Rocambole, au contraire, semblait être dans une salle d’armes et prendre un plaisir extrême à ce jeu cruel sans danger pour lui.
Les deux témoins placés à distance demeuraient impassibles : le major, en homme habitué à de tels spectacles ; le baronet sir Williams, en amateur passionné, en véritable excentrique enthousiasmé de toutes sortes de luttes, depuis le combat de coqs jusqu’à la boxe anglaise.
Pendant quelques secondes, l’impétuosité pleine de fureur avec laquelle Fernand Rocher chercha vainement le chemin de la poitrine du faux gentilhomme suédois ne permit point à celui-ci d’essayer le coup mystérieux qu’il tenait de la science de son maître. Rocambole se contenta de parer et de rompre, lassant ainsi peu à peu son adversaire, attendant le moment propice.
À mesure qu’il reconnaissait la supériorité du jeu de Rocambole, Fernand, au contraire, achevait d’oublier le peu d’escrime qu’il savait, et bientôt son bras commença à mollir, son attaque fut moins vive, sa riposte plus lente ; il n’avança plus avec la même vigueur.
C’était l’instant qu’attendait Rocambole, et tout à coup rompant avec vivacité, il leva verticalement son arme.
Celle de Fernand ne froissant plus le fer, n’ayant plus ce qu’on nomme le sentiment de l’épée, tâtonna une seconde dans le vide et s’abaissa…
Fernand, frappé d’une irrésolution subite, venait de se découvrir…
Alors, rapide comme la foudre, l’épée de Rocambole siffla comme un reptile, s’allongea par un coup droit, et sa pointe disparut dans l’épaule de Fernand, qui tomba presque sur-le-champ.
– Enfin ! murmura sir Williams, pourvu toutefois qu’il ne l’ait point tué… C’est mieux que sa vie qu’il me faut.
XIII
Le major Carden avait vu tomber Fernand Rocher.
Comme il n’était point dans le secret de sir Arthur Collins ou plutôt du baronet sir Williams ; comme Rocambole ne lui avait fait aucune confidence, il s’imagina que son filleul était mort ou grièvement blessé.
Il voulut donc s’approcher et se pencher sur Fernand.
Mais Rocambole fit un pas vers lui :
– Mon cher major, lui dit-il, faites-moi donc une grâce…
Le major le regarda.
– Enveloppez-vous dans votre manteau, poursuivit Rocambole, et retournez au bal… ou bien rentrez chez vous, vos services nous sont inutiles.
Le major s’inclina.
Il savait, du moins il avait deviné que Fernand était condamné par l’association des Valets-de-Cœur, et il s’était attendu à ce dénouement.
Il boutonna son pardessus, alluma tranquillement son cigare aux lanternes du phaéton, et s’en alla.
Rocambole et sir Arthur Collins demeurèrent penchés sur Fernand.
Fernand était évanoui.
Le sang coulait avec abondance de la blessure, qui était peu profonde, mais assez large, comme toutes celles qui proviennent d’une épée triangulaire.
– Ah çà ! dit sir Arthur, es-tu sûr de ne pas l’avoir tué ?
– Certainement.
Le baronet alla prendre une lanterne, et s’en servit pour examiner attentivement la plaie.
– As-tu la petite boîte que je t’ai envoyée ce matin ?
– Oui, elle est dans le coffre du phaéton.
Rocambole courut au phaéton et revint avec une petite caisse dans laquelle se trouvait du linge, de la charpie et une trousse.
Alors sir Arthur Collins, avec un flegme merveilleux et l’habileté d’un praticien, pansa la blessure et y posa un premier appareil.
– Maintenant, dit-il, il faut transporter notre homme avec précaution pour éviter tout épanchement interne. Il pourrait mourir en route.
Sir Arthur et son compagnon prirent le blessé à bras-le-corps, l’enlevèrent doucement de terre, et le portèrent dans la voiture, l’étendant sur la banquette de derrière, après lui avoir entassé deux coussins sous la tête, afin d’exhausser un peu sa poitrine.
De la plaine Monceau, où avait eu lieu le combat, au lieu où Rocambole et son chef allaient transporter le blessé, la distance n’était pas très considérable.
Cependant il était nécessaire d’éviter toute secousse et tout cahot, si on voulait prévenir un accident.
Sir Arthur monta dans la voiture, soutenant la tête de Fernand toujours évanoui, et dit à Rocambole :
– Convertis-toi en valet de pied et conduis ton cheval à la main et au pas.
Et il ajouta en riant :
– Il est nuit, les rues sont désertes et personne ne te verra. Le vicomte de Cambolh n’aura point à rougir.
Un quart d’heure après, le convoi nocturne s’arrêtait rue Moncey, devant la grille d’un petit hôtel qui nous est bien connu.
Cet hôtel, construit par le baron d’O…, vendu par Baccarat, acheté au moyen d’un prête-nom par sir Williams, était, depuis le matin, habité par Jenny la Turquoise.
Rocambole sonna, la grille s’ouvrit sans bruit, et des pas crièrent sur le sable du jardin.
Jenny, en robe de chambre, la tête enveloppée d’un foulard, arrivait un flambeau à la main.
Un homme, le nez surchargé de lunettes bleues, la tête chauve et le ventre proéminent, la suivait. Cet homme, vêtu d’un habit noir, cravaté de blanc, avait la docte apparence d’un avocat et d’un médecin.
Mais, en réalité, Baccarat eût peut-être reconnu en lui ce faux docteur qu’elle avait trouvé à son chevet quatre années auparavant, après l’arrestation de Fernand Rocher, et qui la conduisit dans une maison de fous.
– Ma petite, dit sir Arthur, qui retrouva sur-le-champ son accent britannique, nous t’amenons le pigeon.
– Ah ! ah ! répondit Turquoise, dont l’œil étincela d’une joie cruelle.
– Tout est-il prêt chez toi ?
– Tout.
Sir Arthur fit un signe au faux cocher, qui se hissa sur le marchepied du phaéton et l’aida à prendre le blessé.
Fernand fut porté dans l’hôtel et placé sur un lit, au rez-de-chaussée, dans la chambre occupée jadis par Baccarat.
Là, sir Arthur redevint chirurgien.
Aidé de Rocambole et de la Turquoise, il déshabilla le blessé, et dit, après avoir lavé et ausculté la blessure :
– Il en a pour huit ou dix jours.
Et se tournant vers Rocambole :
– Sais-tu que si tu eusses pénétré d’un pouce de plus, tu le tuais ?
– Ah ! quel malheur ! murmura naïvement la Turquoise, moi qui veux le croquer.
– Tu le croqueras, ma chérie, dit sir Arthur en caressant de la main le menton velouté comme une pêche de la jolie pervertie.
Turquoise montra ses dents blanches et pointues comme celles d’un rat, en un mutin sourire.
– Sais-tu ton rôle au moins ?
– À merveille, papa !
– Et toi ? dit sir Arthur, se tournant vers le faux docteur.
– Moi, répondit celui-ci, j’ai fait des études consciencieuses depuis un mois, et je suis presque chirurgien. Je soignerai votre blessé comme Esculape lui-même.
Fernand était toujours évanoui.
Turquoise et le faux docteur s’installèrent à son chevet.
– Allons-nous-en, dit sir Arthur à Rocambole, nous n’avons plus rien à faire ici.
Et il ajouta, se penchant à l’oreille de Turquoise :
– Tu m’enverras deux bulletins par jour, n’est-ce pas ?
– Sans doute.
Le baronet prit Rocambole par le bras, l’entraîna hors de la chambre à coucher, et ils gagnèrent le jardin, dans lequel ils avaient laissé le phaéton, le cheval attelé à un arbre. Turquoise, installée du matin seulement, n’avait point encore composé sa maison, et n’avait qu’une femme de chambre qu’elle avait envoyée se coucher par ordre de sir Arthur.
– Mon cher ami, dit alors le baronet en prenant les rênes des mains de Rocambole et s’offrant le plaisir de conduire, veux-tu que nous retournions au bal ?
– Mais, très volontiers, dit Rocambole.
Le baronet tira sa montre.
– Il est quatre heures, dit-il.
– Bah ! on dansera jusqu’à huit.
– Et l’on soupera au petit jour.
Sir Williams, sous les traits de sir Arthur, rentra donc à l’hôtel Van-Hop, où la fête était encore dans toute sa splendeur ; mais personne n’avait remarqué son absence.
Le major n’était pas revenu.
Il était allé souper à la Maison-d’Or, et était rentré paisiblement chez lui.
Sir Arthur se glissa de groupe en groupe jusqu’à une embrasure de croisée, où il s’établit avec Rocambole.
De ce lieu un peu écarté, les deux complices purent tout voir sans attirer l’attention. Ils remarquèrent d’abord le jeune comte de Château-Mailly dansant avec Hermine.
Puis le vieux duc, son oncle, caquetant auprès de madame Malassis.
Enfin, Chérubin le charmeur, le beau Chérubin, qui était parvenu à obtenir une valse de madame Van-Hop, et la faisait tournoyer haletante et tout émue.
– Tiens, dit sir Arthur, se penchant à l’oreille de Rocambole et lui indiquant d’un regard la belle créole, la vois-tu ?
– Oui, elle commence à être charmée.
– Elle me rappelle en ce moment les enfants du roi Charles Ier, qui sourient à la hache sous le tranchant de laquelle devait tomber une heure après la tête de leur père.
– Ah !
– Oui. La marquise valsant avec Chérubin joue avec la hache.
– Jolie comparaison, mon oncle.
– Seulement, cette hache est un poignard…
– Très bien !
– Et ce poignard est pour elle.
– Ce sera Chérubin qui sera le poignard.
Le baronet haussa les épaules.
– Non, dit-il, mais c’est lui qui placera l’arme meurtrière dans la main du marquis, cet honnête homme qui aime sa femme.
Et le baronet eut un sourire à faire frémir Satan lui-même !
XIV
Fernand Rocher s’était évanoui en tombant frappé par Rocambole.
Quand il revint à lui, il n’était plus sur le terrain du combat, et les témoins, son adversaire, les épées, tout avait disparu. Fernand se trouvait couché au fond d’une alcôve où régnait le demi-jour mystérieux d’une lampe placée sur la cheminée voisine.
Cette lampe éclairait confusément les objets environnants, sur lesquels le blessé promena un regard étonné.
Il lui sembla qu’il se trouvait dans une chambre à coucher assez spacieuse, luxueusement décorée et meublée, et dont l’aspect lui était complètement inconnu.
La lampe projetait une clarté mate et douteuse sur les tentures, les meubles, les rideaux, et, à l’aide de cette clarté, l’œil étonné de Fernand en passa une sorte d’inventaire.
Il aperçut d’abord quelques-uns de ces meubles que l’art et la fantaisie réunis font si élégants : dressoirs en bois doré, jardinières de laque, bahuts de Boule, sièges moelleux couverts d’une étoffe de soie d’un gris tendre, tapis à grandes rosaces, dont les couleurs sombres s’harmonisaient avec les tentures des murs, des portes et des croisées.
C’était une chambre à coucher de petite-maîtresse, une chambre comme aurait pu en avoir une, dès le lendemain de ses noces, une duchesse de vingt ans ; car tout était sobre et élégant à la fois, et rien dans cette pièce n’annonçait la femme de situation équivoque. Tout au plus, peut-être, aurait-on pu supposer que la fée de ce logis était, le soir, reine ou simple soubrette de l’autre côté du rideau de la Comédie-Française, tant il y avait de bon goût, de luxe délicat et artistique dans ce joli nid.
Fernand eut beau rassembler ses plus lointains souvenirs, il ne se rappela point avoir jamais franchi le seuil de cette demeure. Et pourtant il s’y trouvait couché, seul, au milieu d’un profond silence.
Un mouvement qu’il fit lui arracha un cri de douleur.
Cette douleur fut pour lui un trait de lumière.
Il se souvint du combat, de son adversaire, des témoins, de l’étrange sensation de froid que lui avait fait éprouver la pointe de l’épée ennemie en pénétrant dans son épaule, et il devina qu’on l’avait transporté quelque part à la hâte.
Quelques gouttes de sang qui jaspaient l’oreiller, et l’appareil qu’il sentit posé sur sa blessure achevaient de rappeler ses souvenirs.
En même temps, le cri qu’il avait poussé donna sans doute l’éveil aux personnes de la maison dans laquelle il se trouvait, car une portière s’écarta près du lit, et un homme vêtu de noir et cravaté de blanc, chauve et un peu obèse, un homme qui portait des besicles et avait une physionomie doctement sérieuse, s’approcha sur la pointe du pied.
Puis, sans dire un mot, le grave personnage s’empara de la main que le blessé laissait pendre hors du lit, et lui tâta le pouls.
– Vous avez une fièvre assez intense, monsieur, lui dit-il, c’est bon signe… Souffrez-vous ?
– Pas précisément, répondit Fernand, qui comprit qu’il avait affaire à un médecin ; seulement, j’ai fait un mouvement assez brusque.
Le docteur découvrit l’épaule du blessé et replaça soigneusement l’appareil, qui était un peu dérangé.
– Il faut vous tenir tranquille, monsieur, dit-il ; le repos est absolument nécessaire.
– Suis-je donc dangereusement blessé, monsieur ? demanda Fernand.
– Dangereusement, non, répondit le docteur, mais assez grièvement, monsieur, pour que je croie devoir vous garder au lit au moins huit jours. Heureusement, nous sommes en hiver, ce qui est toujours préférable à l’été pour les blessures.
– Monsieur, reprit Fernand, me permettrez-vous une question ?
Le docteur fit un signe affirmatif.
– Pourriez-vous me dire si je me trouve dans une maison de santé ?
– Nullement, monsieur.
– Alors, je suis peut-être chez mon témoin… ou chez mon adversaire ?
– Monsieur, dit naïvement le médecin, je ne puis guère vous renseigner à cet égard. J’ai été appelé auprès de vous, il y a environ deux heures ; vous étiez tout vêtu sur ce lit, et le sang coulait assez abondamment de votre blessure… Une femme, une jeune dame d’environ vingt ans…
– Ma femme ! s’exclama Fernand.
– Je ne sais pas ; elle est petite, blonde, fort jolie…
– Ce n’est point Hermine, murmura le blessé, surpris. Chez qui suis-je donc ?
– Je n’en sais absolument rien. J’ai vu cette jeune dame essuyer le sang à mesure qu’il coulait. Elle était assistée de sa femme de chambre.
– Mais, insista Fernand, au comble de la surprise, il n’y avait aucun homme ici ?
– Aucun.
– Et vous ne savez pas le nom de la dame chez qui…
– On l’a appelée devant moi madame seulement, voilà tout ce que je puis vous dire.
– Quel étrange mystère ! pensa le blessé.
Comme il faisait cette réflexion mentale, la portière, que le docteur avait laissé retomber derrière lui, se souleva de nouveau, et Fernand entendit un pas léger glisser sur le tapis ; une femme entra sur la pointe du pied. Cette femme produisit une vive impression sur le blessé.
Le mystère qui semblait environner son étrange aventure d’abord, puis cette prédisposition morale où il se trouvait par suite des émotions qu’il avait éprouvées quelques heures auparavant, enfin la merveilleuse beauté de l’inconnue, contribuèrent puissamment à cette impression.
C’était une charmante et mignonne créature, blonde comme les madones de Raphaël, avec des yeux d’un bleu foncé comme l’azur de la mer, une taille onduleuse et flexible et de petites mains qui semblaient plutôt appartenir à un enfant qu’à une femme.
Une robe de chambre de velours noir et à retroussis bleu faisait valoir la merveilleuse blancheur de ses bras nus et de son cou ; un vague sourire un peu triste, comme on n’en voit qu’aux femmes qui déjà ont entrouvert le livre de la vie à la page de ses amertumes, effleurait ses lèvres.
Elle s’approcha, l’œil inquiet, regarda Fernand et le salua de la main.
– Comment vous trouvez-vous, monsieur ? lui demanda-t-elle.
Sa voix était douce, mélodieusement timbrée, et acheva de séduire le blessé.
Et, comme il entrouvrait la bouche pour remercier, et peut-être pour demander à la belle inconnue par quel étrange concours de circonstances il se trouvait chez elle, elle posa son doigt sur ses lèvres.
– Chut ! monsieur, dit-elle tout haut. Le docteur prétend que vous devez parler le moins possible.
En même temps, elle se dirigea vers un guéridon voisin sur lequel il y avait une tasse remplie de tisane qu’elle prit dans ses mains.
Et comme, alors, le médecin ne pouvait la voir, elle plaça de nouveau son index sur sa bouche, et, cette fois, le blessé comprit qu’elle désirait ne pas être questionnée devant un tiers.
Puis elle revint près du lit et présenta sa potion à Fernand, qui ne cessait d’admirer sa frêle et rayonnante beauté.
– Madame, dit alors le médecin, mes soins sont inutiles pour le moment. La blessure va bien, la fièvre n’a qu’une intensité peu alarmante, je reviendrai dans quelques heures changer l’appareil.
Elle le congédia d’un geste de reine, prit un flambeau pour l’éclairer et sortit avec lui.
Fernand était au comble de la stupeur.
Où était-il ?
Pourquoi sa femme n’avait-elle point été prévenue ?
Il appela.
La femme inconnue revint.
– Madame, lui dit Fernand, bien que vous m’ayez imposé silence, bien que vous prétendiez que ma présence ici doive être pour moi-même un mystère, vous ne me refuserez pas une grâce ?
– Parlez, dit-elle en souriant.
– J’ai une femme, madame, une femme que j’aime… et qui doit être vivement alarmée de mon absence…
– Votre femme est prévenue.
Et la blonde inconnue lui jeta un de ces regards et un de ces sourires qui font naître le trouble au fond du cœur le plus pur.
Puis, elle ajouta :
– Supposez que vous êtes dans le palais d’une fée, – d’une fée qui vous a sauvé la vie, et ne demande, en échange de sa bonne action, qu’une chose…
– Oh ! dites, madame, fit-il avec l’accent de la gratitude.
– Une chose bien simple…
Et elle le regarda, souriant toujours.
– Qu’est-ce donc ? demanda-t-il.
Elle posa un doigt sur ses lèvres.
– Le silence ! dit-elle.
Et elle disparut.
Fernand se retrouva seul, en proie à un étonnement mêlé d’une sorte d’admiration pour la beauté de cette femme.
Pendant quelques minutes, il espéra la voir reparaître, et il éprouva même comme une impatience inexplicable, une sorte d’anxiété dont il lui eût été difficile de se rendre compte. Mais les minutes passèrent, puis une heure s’écoula, et la blonde créature ne vint pas.
Fernand entrait alors dans cette phase fébrile qui suit presque toujours l’évanouissement causé par une blessure.
En effet, grave ou légère, une blessure ne produit pas toujours l’évanouissement ; mais qu’elle obtienne ou non ce résultat, elle est toujours suivie d’un accès de fièvre qui occasionne généralement, quoique à divers degrés, une sorte de délire mental.
Bientôt de bizarres hallucinations s’emparèrent de son esprit, et il perdit absolument conscience de sa situation réelle.
Plusieurs heures s’écoulèrent pour lui dans cet état, et la lampe, qui projetait une clarté douteuse dans la chambre, finit par s’éteindre.
Dans l’obscurité, les hallucinations devinrent plus intenses et plus bizarres encore, et la jeune femme blonde y joua le plus grand rôle.
Chose étrange ! Fernand songeait à la fois à sa femme et à l’inconnue, les confondant parfois toutes deux en une seule créature ; puis il finit par s’imaginer qu’il était mort, qu’il avait été tué, et que le lieu où il se trouvait était déjà l’antichambre d’un autre monde et d’une autre vie.
D’hallucinations en hallucinations, le blessé finit par s’endormir.
Lorsqu’il se réveilla, un rayon de jour filtrait à travers la moire des rideaux et s’ébattait sur le tapis.
Le sommeil avait un peu calmé la fièvre, et la présence d’esprit du blessé lui était revenue.
En même temps, ses souvenirs s’assemblaient un à un, et il pouvait enfin analyser dans tous leurs détails les événements de la veille, c’est-à-dire la provocation inouïe dont il avait été la victime au bal du marquis Van-Hop et ses suites, jusqu’au moment où il était tombé atteint par l’épée de son adversaire.
Là, il y avait forcément pour lui une femme. Qu’étaient devenus son adversaire et les témoins ?
Où l’avait-on transporté ?
Pourquoi sa femme n’était-elle pas près de lui ?
Et quelle était cette ravissante créature qui s’était instituée sa garde-malade ?
C’était là tout autant de questions qu’il lui était impossible de résoudre.
Mais, en dépit de tout, Fernand songeait à sa femme qu’il avait laissée au bal, qui, sans doute, serait rentrée chez elle croyant l’y trouver, et aurait passé la nuit dans une vive inquiétude.
Pourtant il n’osa point appeler, et se résigna à attendre que quelqu’un parût. En effet, peu d’instant après, la porte par où il avait vu disparaître la frêle et blonde inconnue se rouvrit.
Et Fernand sentit une émotion étrange le gagner et faire battre son cœur, et l’image de cette belle et chaste Hermine, qu’il n’avait cessé d’aimer une seconde depuis quatre années que durait son bonheur, eut une lutte à soutenir avec cette autre image de femme que le mystère semblait envelopper.
Sur le seuil de la porte qui venait de s’ouvrir, Fernand apercevait la belle inconnue. Elle vint à lui moitié triste et moitié souriante, et lui dit :
– Le docteur va venir bientôt vous panser. Comment vous sentez-vous ? Souffrez-vous beaucoup ? Avez-vous dormi un peu ?
Elle lui faisait toutes ces questions de sa voix charmante et douce comme une mélodie, et il semblait qu’une affection mystérieuse et puissante dictait chacune de ses paroles.
– Je vais mieux, répondit-il, mais…
– Eh bien ? fit-elle.
– Ma femme… murmura Fernand.
– Chut ! votre femme est prévenue, votre femme est tranquille… que cela vous suffise.
Fernand se sentait en proie à une émotion violente et inexplicable.
Pourtant il ignorait jusqu’au nom de cette femme, et c’était Hermine qu’il aimait.
Elle voulut prendre sa main dans la sienne, pour s’assurer qu’il n’avait pas la fièvre ; mais Fernand s’empara de cette main et y mit un respectueux baiser, – baiser d’un homme reconnaissant.
Elle la retira et rougit un peu.
– Que faites-vous, monsieur ? lui dit-elle.
– Madame, balbutia-t-il, je vous remercie, et tâche de vous témoigner ma gratitude.
– Vous ne m’en devez aucune, répondit-elle simplement.
– Pourtant ?… fit-il d’un ton interrogateur.
– Je vous devine, dit-elle : vous voudriez savoir où vous êtes, comment vous y êtes et qui je suis ?
– En effet…
– Eh bien, répondit-elle, c’est impossible !
– Impossible ?
– Oui ; il est impossible de vous dire non seulement qui je suis, mais encore où vous êtes… Cependant…
– Ah ! fit le blessé avec anxiété.
– Je puis vous apprendre, reprit-elle, que vous vous trouvez à Paris, et qu’on vous a transporté chez moi au moment où vous veniez d’être blessé.
Et, laissant glisser un sourire sur ses lèvres roses, elle ajouta :
– Le reste est un mystère.
Fernand la contemplait avec une muette admiration.
– Votre blessure n’a rien de grave, reprit-elle, mais il vous est cependant formellement interdit de vous lever, de faire aucun mouvement brusque, et il paraît, m’a dit le docteur, que nous serons obligés de vous condamner à une diète sévère.
Et elle continua à sourire, et ajouta :
– Cependant, avant huit jours, paraît-il, vous pourrez être transporté chez vous… chez… votre femme…
Elle se retira sur ce mot, comme si elle eût craint d’en dire davantage.
Le soir, Fernand fut repris par la fièvre et le délire.
La nuit fut mauvaise, remplie de rêves, d’hallucinations, au milieu desquelles sa femme et la blonde inconnue semblaient se tenir par la main.
Le jour le trouva faible, épuisé, les membres atteints d’un tremblement nerveux et les yeux injectés de sang.
Il lui était impossible de fixer un objet, il n’aurait pu lire ou écrire.
La belle garde-malade entra sur la pointe du pied, s’approcha du lit, et s’assura d’un regard rapide et sûr de la situation du blessé.
– Bonjour, lui dit-elle ; vous êtes mieux, beaucoup mieux, et la crise que je redoutais est passée.
– Vous redoutiez une crise ?
– Oui, et j’ai été contrainte de vous faire un mensonge.
– Ah !… lequel ?
– Je vous ai déjà dit que votre femme était prévenue…
Fernand jeta un cri.
– Et… elle ne l’est pas ?
– Non. On lui a simplement écrit qu’une affaire urgente vous éloignait de Paris pour quelques jours. Je redoutais cette crise… elle est passée… nous pouvons… vous pouvez écrire… madame Rocher sera rassurée.
Fernand était atterré.
– Vous savez mon nom ? dit-il.
– Sans doute. Seriez-vous ici sans cela ?
– C’est vrai, murmura-t-il, touché de la justesse de cette réponse. Mais pourquoi n’avoir point écrit à ma femme ?
– Pour ne point l’alarmer. Maintenant, reprit-elle, permettez-moi de vous le répéter ; bien que vous ayez quelque peine, sans doute, à vous servir de votre bras, cependant, je crois que vous pourrez écrire deux lignes, ou, tout au moins, signer celles que j’écrirai.
Et elle courut à un petit pupitre en bois de rose placé sur le bord du lit.
Elle en tira alors une plume, de l’encre, du papier, et lui dit :
– Essayez.
Il prit la plume et essaya de tracer quelques lignes ; mais le mouvement qu’il fit déplaça à moitié l’appareil posé sur sa blessure, et un cri lui échappa.
– J’y vois trouble, dit-il.
– Mon Dieu ! dit la jeune femme, j’ai trop présumé de vos forces… Allons, ce sera moi qui vous servirai de secrétaire.
Et elle s’assit au pied du lit, prit la plume et écrivit :
« Ma chère Hermine, un léger accident qui m’est survenu me force à emprunter, pour vous écrire, le secours d’une main étrangère. Cependant j’aurai la force de signer ma lettre… »
La belle inconnue s’arrêta et regarda Fernand en souriant :
– Ah ! dame, dit-elle, il le faudra bien… malgré la douleur.
Elle reprit la plume et poursuivit tout haut :
« Je viens de courir un grand danger ; heureusement je suis sauvé et vous aime, et avant huit jours je serai auprès de vous.
« Ne vous alarmez pas, ne vous désolez pas ; songez que, à toute heure et partout, je suis à vous et porte votre image gravée au fond de mon cœur.
« Votre Fernand qui vous aime ! »
– Il vaut mieux, dit le joli secrétaire de Fernand en s’interrompant, il vaut beaucoup mieux ne pas entrer dans les détails de cette triste affaire.
Mais, en réalité, la blonde garde-malade n’avait point écrit ces deux dernières phrases, comptant sur l’état de faiblesse et de vertige où était Fernand, et persuadée qu’il ne pourrait lire.
Elle avait écrit au contraire :
« Je me suis battu pour une vétille ; j’ai été un peu blessé. Heureusement la cause de ce duel a une jolie petite main blanche et veut bien me servir de secrétaire.
« Adieu, au revoir ; je vous baise les mains. »
C’était un vrai billet à la Lauzun, un poulet du duc de Richelieu à sa femme.
Elle eut l’audace de lui présenter le papier.
– Je ne puis pas lire, dit-il, mais je pourrai signer.
Et il signa, en effet, d’une main tremblante, mais assez lisiblement pour qu’Hermine ne pût douter de l’authenticité de cette signature.
L’inconnue reprit aussitôt le billet, le plia, le mit sous enveloppe, le cacheta avec le chaton d’une bague qu’elle avait au doigt et, tandis que Fernand admirait naïvement ses mouvements gracieux, ses poses de tête charmantes et les ondulations de sa taille svelte et frêle, elle murmura tout bas en mettant l’adresse :
– Voilà une écriture et un cachet que madame Rocher gravera dans sa mémoire…
Elle s’esquiva légère, souriante, et jeta un adieu au blessé du bout de ses jolis doigts.
Elle allait confier le message à un valet et l’envoyer rue d’Isly.
À dix heures, le docteur revint, pansa Fernand, lui permit de prendre quelques aliments, et se retira sans que son malade eût rien appris de lui.
À partir de ce moment, la jeune femme s’installa au chevet de Fernand, ne laissant pénétrer que sa camériste dans la chambre. Pendant toute la journée, elle charma l’ennui du blessé par mille propos spirituels, par mille anecdotes sur le monde des salons, le théâtre et les arts, effleurant tout avec esprit et savoir, et déployant enfin toutes les grâces, toutes les innocentes coquetteries d’une femme du meilleur monde.
Mais chaque fois que Fernand, qui l’écoutait ravi, voulait l’interroger, lui arracher, en un mot, le secret de son nom et de sa situation, elle fronçait à demi ses beaux sourcils, et lui disait :
– Vraiment ! vous êtes ingrat…
Et comme il baissait les yeux tout confus et balbutiait une excuse, elle ajoutait d’une voix grave, un peu triste même, et dont la mélancolie voilée allait jusqu’au fond de l’âme :
– Croyez, monsieur, que si un mystère vous enveloppe, que s’il m’est aussi impossible de vous dire qui je suis que de vous désigner le lieu où vous êtes, une volonté supérieure à la mienne me contraint à agir…
Et cette réponse faite, le sourire revenait à ses lèvres, et elle détournait la conversation.
Le soir, vers dix heures, elle souhaita une bonne nuit au blessé et disparut.
Fernand rêva d’elle jusqu’au matin ; quand elle revint, il se sentit tout ému, et oublia presque sa femme.
Mais elle lui dit avec un demi-sourire moqueur :
– J’ai des nouvelles de madame Rocher ; elle va bien… Elle a été très inquiète la nuit précédente, mais mon billet l’a rassurée… Elle vous attend dans huit jours…
Ces paroles produisirent un effet bizarre sur Fernand ; il se sentit troublé et baissa les yeux.
Pour la première fois de sa vie, Fernand se demanda s’il était possible qu’on n’aimât point éternellement sa femme.
Et, en s’adressant cette question, il regardait l’inconnue, dont la petite main jouait distraitement avec un gland de sonnette qui pendait au long de la cheminée.
– Mon cher blessé, dit-elle tout à coup en levant la tête, votre garde-malade va vous demander un congé de quelques heures ; je suis obligée de sortir, mais je vous laisserai en tête à tête avec le docteur. En dépit de son air magistral et pédant, c’est un homme de quelque esprit.
Au moment où elle achevait cette définition de l’homme de science, le docteur entra.
La jeune femme envoya un dernier sourire à Fernand et se retira.
– Vite, dit-elle en passant dans une autre pièce où elle trouva sa femme de chambre, viens m’habiller. Je veux voir comment cela me va, une robe de laine, et un bonnet de cent sous…
Alors l’élégante jeune femme, passant dans un cabinet de toilette, y changea rapidement de costume et en ressortit vêtue en humble petite ouvrière des faubourgs : robe noire, petit châle tartan étriqué, bonnet plat dissimulant les boucles luxuriantes de la chevelure, brodequins de prunelle un peu éraillés, gants de tricot aux mains et petit panier au bras.
– J’en tiens un ! murmura-t-elle alors en souriant, à l’autre !
Et elle dit à sa femme de chambre :
– Va me chercher un fiacre.
– On ferait l’aumône à madame, s’écria la soubrette avec une muette admiration pour cette subite métamorphose.
Cinq minutes après, la jeune femme traversait un jardin dépouillé par l’hiver, trouvait à la grille de ce jardin une voiture, y montait et disait au cocher :
– Conduisez-moi place de la Bastille. Vous m’arrêterez au coin du faubourg Saint-Antoine.
Le fiacre partit… Où allait-elle ?
XV
Il est temps de renouer connaissance avec deux personnages du premier épisode de cette histoire.
Nous voulons parler de Cerise et de Léon Rolland.
On s’en souvient, la jolie fleuriste avait épousé l’heureux Léon le jour même où le comte Armand de Kergaz épousait mademoiselle de Balder.
Au moment où l’ouvrier ébéniste sortait de l’église donnant le bras à sa jeune femme, M. de Kergaz s’était approché de lui.
– Mon ami, lui dit-il, je pars à l’instant même, et dans quelques heures je serai fort loin de Paris.
– Allez, monsieur le comte, répondit Rolland ; je comprends que vous vouliez vivre un peu seul avec votre bonheur.
– Mais si je pars, dit le comte, je n’oublie pas que ce bonheur dont vous parlez, c’est à vous et à votre belle et vertueuse jeune femme que je le dois, et je tiens à conserver votre bonne amitié pour mon retour.
– Ah ! monsieur le comte, s’écria Cerise, n’est-ce point un trop grand honneur pour nous ?
– Non, dit Armand, tous les nobles cœurs sont frères.
Et remettant une lettre à Léon :
– Pour vous prouver que je vous considère comme mon ami, je vais vous charger d’une mission… une mission importante, et que je crois digne de vous.
– Ah ! parlez, monsieur le comte, parlez, murmura Léon tout ému.
– Mes instructions sont contenues dans cette lettre, dit-il. Adieu… au revoir plutôt !
Et le comte passa, offrit la main à sa jeune femme, la fit monter dans sa chaise de poste qui attendait tout attelée à la porte de l’église, et l’équipage partit au grand trot, emportant, comme avait dit Léon, le bonheur sur ses coussins de soie.
Alors Léon Rolland brisa la volumineuse enveloppe que lui avait remise le comte.
Elle renfermait deux lettres.
L’une, dont la souscription était de la main de Jeanne, était à l’adresse de Cerise.
L’autre, écrite par le comte, était pour Léon Rolland.
Léon ouvrit la sienne et lut :
« Mon ami,
« Si je me soustrais pour quelques mois à la tâche que je me suis imposée, c’est que j’ai la conviction profonde que je laisse à Paris des cœurs aussi dévoués que le mien à l’œuvre du bien que je poursuis, et que le vôtre est un de ceux qui me seconderont le plus énergiquement. Permettez-moi donc, mon ami, de vous charger d’une mission.
« Il y a à Paris de longs mois d’hiver, pendant lesquels le pain est cher et le bois encore plus, où de nombreuses familles vivent de l’insuffisant salaire de leur chef, salaire que souvent le manque d’argent réduit à néant. Vous avez été ouvrier, vous savez les misères, les douleurs et aussi les vertus de vos frères ; vous êtes donc celui que je choisis de préférence pour soulager ces misères, consoler ces douleurs, encourager ces vertus ignorées.
« Vous étiez ouvrier, je vous fais patron. Allez vous établir au cœur du faubourg Saint-Antoine, ouvrez-y un vaste atelier de menuiserie et d’ébénisterie, et occupez deux cents ouvriers. Donnez de préférence du travail à ceux qui seront pères de famille ; pour vos choix, consultez toujours votre cœur.
« Je joins à ma lettre un bon sur mon banquier de cent mille francs pour vos frais d’installation, et je vous ouvre chez lui un crédit que votre expérience limitera.
« Armand. »
« Ma chère Cerise,
« Armand vient d’écrire à Léon sous mes yeux et m’a donné sa lettre à lire.
« Moi aussi, j’ai une bonne et charitable idée, et puisque Léon est l’exécuteur de celle d’Armand, je veux vous charger de mettre la mienne en pratique.
« Puisque Léon va ouvrir un vaste atelier pour hommes, pourquoi, ma chère Cerise, n’en dirigeriez-vous pas un destiné à des femmes, à de jeunes orphelines que le manque d’ouvrage, les tentations du luxe, les fascinations du vice pourraient éloigner du droit chemin, et qui n’auraient pas le courage de travailler douze ou quinze heures, comme vous l’avez fait longtemps, pour gagner un mince salaire ? Armand met à ma disposition cinquante mille francs et un crédit chez son banquier. Aussi, je vous laisse, en partant, mes pleins pouvoirs, et vous prie de me garder cette amitié dont vous m’avez déjà donné tant de preuves.
« Jeanne. »
Léon et Cerise, après avoir lu ces deux lettres, se regardèrent, et dans ce regard échangé ils se jurèrent d’exécuter les volontés de leurs bienfaiteurs.
Six mois après, au milieu du faubourg Saint-Antoine, les deux ateliers, qui occupaient à eux deux une vaste maison, se trouvaient en pleine activité.
Trois ans plus tard, Léon Rolland était un des fabricants du faubourg Saint-Antoine le plus en vogue et qui occupent le plus d’ouvriers, et Cerise se trouvait à la tête de vastes ateliers de confection où les orphelines et les mères chargées de famille trouvaient toujours de l’ouvrage à un prix plus élevé que partout ailleurs.
Or, précisément le jour même où la belle inconnue avait un moment quitté le chevet de Fernand blessé pour courir, déguisée en ouvrière, sur la place de la Bastille, le maître ébéniste était dans son magasin, vers onze heures du matin environ, occupé avec son contremaître et son caissier, dans une petite pièce convertie en bureau.
Un apprenti, qui rendait au patron quelques légers services domestiques, frappa discrètement à la porte et, sur l’invitation de Léon, pénétra dans le bureau.
– Que veux-tu, Minet ? demanda le maître ouvrier.
– Patron, répondit l’apprenti, à qui ce surnom de Minet avait été donné par ses camarades de l’atelier, précisément à cause de sa jolie figure futée et matoise, et de la légèreté avec laquelle il grimpait aux barreaux des croisées, le long des charpentes, et se laissait couler du haut en bas de l’escalier, à cheval sur la rampe, c’est une jeune fille qui désire vous parler.
Léon crut que sa femme, qui occupait les étages supérieurs de la maison, lui envoyait une de ses ouvrières, et il dit à Minet :
– J’y suis… Fais-la entrer.
Alors le patron vit apparaître sur le seuil cette éblouissante et mignonne créature que nous connaissons déjà, et qui était tout aussi séduisante sous les humbles vêtements d’ouvrières qu’elle l’était, quelques heures auparavant aux yeux de Fernand Rocher, sous la robe de chambre de la femme élégante et riche.
Turquoise était, comme Chérubin le charmeur, douée de cette puissance de fascination qui s’exerce par le regard.
Léon éprouva à sa vue une commotion à peu près semblable à celle qu’avait éprouvée Fernand Rocher, et il baissa involontairement les yeux sous ce regard bleu et profond qu’elle laissa peser sur lui.
Ce rayonnement étrange donnant à ses yeux un pouvoir magnétique assez grand pour jeter à la fois le trouble, et chez un homme oisif, vivant, comme Fernand Rocher, dans un monde opulent et distingué, et chez un pauvre ouvrier, simple de cœur et d’esprit, tel que Léon Rolland.
Léon tressaillit donc involontairement à la vue de la jeune femme, et machinalement il lui indiqua un siège.
– Monsieur… Rolland ? demanda-t-elle de sa voix la plus douce, la plus mélodieusement timbrée.
– C’est moi… mademoiselle…
La jeune femme jeta un regard défiant sur les deux personnes qui se trouvaient dans le bureau.
Léon crut deviner qu’elle n’osait parler devant elles, et d’un signe il les congédia.
– Je vous écoute, mademoiselle, dit-il.
Elle baissait les yeux et paraissait toute tremblante.
– Monsieur… dit-elle enfin, vous avez fait travailler, il y a deux ans, un ouvrier du nom de François Garin…
– Oui, mademoiselle… c’est probable du moins… Je crois me rappeler ce nom-là, dit Léon, qui consulta ses souvenirs. C’était un homme âgé déjà de cinquante-cinq ans environ.
– Oui, fit-elle d’un signe de tête, levant de nouveau sur lui ce regard qui l’avait fait frissonner tout entier.
– Un ouvrier de la province, reprit Léon qui se souvenait tout à fait de l’homme dont on lui parlait ; il était venu à Paris et n’avait pu y trouver de l’ouvrage. Je l’ai occupé environ six mois.
– Précisément, monsieur.
– Puis il est retourné dans son pays, où il avait une fille.
– C’était moi, monsieur, dit la jeune femme d’une voix émue.
– Vous ! fit Léon surpris.
– Je me nomme Eugénie Garin, répondit-elle avec tristesse.
– Et… votre père ? demanda Léon.
– C’est lui qui m’envoie, monsieur.
– Ah ! je devine, dit le brave ouvrier ; il craint sans doute que je ne sois fâché contre lui, vu qu’il m’a quitté un peu brusquement. Mais, ajouta-t-il en souriant, dites-lui que j’ai toujours pour lui du travail… et de l’argent d’avance s’il est gêné.
– Hélas ! murmura la jeune femme, mon père ne travaillera plus, mon cher monsieur…
Elle parut comprimer un gros soupir.
– Il est aveugle, dit-elle.
– Aveugle ! s’écria Léon.
– Depuis six mois, monsieur, répondit-elle en levant sur lui de nouveau son magnifique regard.
– Ah ! je comprends, fit l’ouvrier, et vous avez eu raison, mademoiselle, de songer à moi. Je vous en remercie.
L’inconnue rougit et parut se troubler.
– Vous vous trompez peut-être, monsieur, murmura-t-elle ; nous sommes fiers. C’est du travail que je viens vous demander.
Et comme Léon faisait un geste, elle se hâta d’ajouter :
– Madame Rolland, m’a dit mon père, est une brave et digne femme, qui ne refusera pas de te donner de l’ouvrage…
– Certes, non, dit Léon.
– Malheureusement, reprit-elle en baissant modestement les yeux, je ne pourrai venir travailler à l’atelier et quitter mon père… Non seulement il est aveugle, mais encore il est infirme.
– Qu’à cela ne tienne, dit Léon, Cerise vous donnera de l’ouvrage à emporter.
Et le brave garçon se leva et lui dit :
– Ma femme est sortie en ce moment ; elle est allée chez madame la comtesse de Kergaz ; mais elle ne tardera pas à rentrer. Voulez-vous l’attendre ?
– Oui, monsieur, répondit-elle humblement.
Tout en parlant, Léon jetait un coup d’œil sur les vêtements misérables de la jeune femme ; sur cette propreté qui lui semblait essayer en vain de dissimuler la misère, et il éprouvait déjà pour elle un sentiment qu’il croyait n’être que de la compassion, bien que, en réalité, il fût d’une nature impossible à définir.
– Venez, dit-il, je vais vous conduire là-haut… à l’atelier. Ma femme ne peut tarder à rentrer.
La jeune femme le suivit, toujours humble, toujours modeste, et le visage empreint de tristesse.
– C’est singulier, poursuivit Léon en gravissant l’escalier qui conduisait au premier étage, ce François Garin était un assez triste drôle, à l’atelier, et voici que je suis pris de compassion pour lui.
Et se tournant vers la jeune femme :
– Où demeure votre père ? demanda-t-il.
– À deux pas d’ici, répondit-elle, rue de Charonne, 23.
– Bien, j’irai le voir tout à l’heure. Quand vous êtes venue, j’allais sortir et me rendre précisément dans cette rue, où j’ai un entrepôt de bois.
Et Léon tourna le bouton de la porte d’entrée de son appartement.
Le logement particulier de Léon Rolland se trouvait, comme on le voit, au premier étage, et donnait par une porte sur l’atelier de confections.
Il se composait de quatre petites pièces : une salle à manger, un petit salon, deux chambres à coucher, dont l’une était occupée par les jeunes époux, l’autre par la mère de Léon.
Tout cela était propre, modeste, et respirait l’aisance honnête que procure le travail.
– Maman, dit Léon à sa mère, Cerise est-elle rentrée ?
– Pas encore, répondit la vieille, qui avait conservé son costume de paysanne et ses sabots.
– Tenez, dit Léon, voilà une jeune fille qui va l’attendre ici et que je lui recommande expressément. C’est la fille d’un de mes anciens ouvriers.
Puis, s’adressant à l’inconnue :
– Mademoiselle, dit-il, voulez-vous déjeuner avec nous ? Dans une heure, Cerise sera ici.
– Merci, répondit-elle avec tristesse ; et pardonnez-moi, monsieur, si je ne puis accepter… mais… mon père…
Léon, ému jusqu’aux larmes, pensa que peut-être il n’y avait pas de pain chez le pauvre aveugle, et que cette pensée empêchait sa fille d’accepter cette invitation.
– Soit, dit-il, mais attendez Cerise et attendez… moi ; j’ai une course de quelques minutes à faire, et je serai bientôt de retour.
Et Léon, laissant sa jeune protégée auprès de sa mère, descendit rapidement dans son bureau, mit son paletot et sortit.
Le maître ouvrier gagna la rue de Charonne d’un pas rapide, s’arrêta devant le numéro 23, et jeta au portier le nom de François Garin.
– Au sixième, la troisième porte à gauche dans le couloir, répondit l’autocrate de la loge.
Léon gravit un escalier sale et tortueux, arriva au sixième et frappa à la porte indiquée, dont la clef se trouvait dans la serrure.
– Entrez ! dit une voix chevrotante à l’intérieur.
Léon poussa la porte, et son cœur se serra douloureusement à la vue du réduit dans lequel il pénétrait.
C’était une petite pièce mansardée qui n’avait plus d’autres meubles qu’un lit de sangles, un grabat, une table et deux chaises.
Dans le lit, un vieillard était enveloppé dans une mince couverture, trop légère pour la saison rigoureuse.
Le grabat était sans doute destiné à sa fille. La cheminée était sans feu.
Sur la table, il y avait quelques assiettes fêlées et vides, un morceau de pain, une cruche pleine d’eau.
Dans un coin, une vieille malle en bois, où sans doute étaient serrées les dernières hardes de la misérable famille.
Dans ce vieillard, dont les yeux étaient rouges et sans rayonnement, preuve certaine que sa cécité provenait de son intempérance, Léon reconnut son ancien ouvrier François Garin.
– Qui est là ? demanda l’aveugle d’une voix lamentable.
– C’est moi, répondit Léon, moi, Léon Rolland.
– Ah ! mon cher monsieur, s’écria l’aveugle, est-ce possible ?… Tant d’honneur à un misérable comme moi…
– Votre fille est venue me voir, père Garin…
– Ah ! murmura l’ouvrier, qui parut retenir ses sanglots avec peine, la chère enfant du bon Dieu ! sans elle je serais mort, mon bon monsieur Rolland.
Et le vieillard se dressa à demi sur son lit et raconta avec des sanglots comprimés que sa fille le nourrissait depuis bientôt six mois, travaillant dix-huit heures par jour pour gagner de quinze à vingt sous.
– Hélas ! acheva-t-il, voici la morte saison qui va venir pour les dentellières, et ma fille n’a plus d’ouvrage. Alors j’ai songé à vous, mon bon monsieur Rolland, et j’ai pensé que votre petite dame…
– Vous avez eu raison, mon ami, dit le maître ouvrier. Votre fille est en ce moment à la maison, et ma femme lui donnera de l’ouvrage ; mais en attendant, ne vous fâchez pas, père Garin et permettez-moi de vous prêter un peu d’argent.
L’aveugle cacha sa tête dans ses mains.
– Ah ! murmura-t-il, je n’ai plus la force d’être père quand je songe à ma pauvre enfant…
Et il tendit humblement la main.
Léon y mit deux pièces d’or, et lui dit :
– Je reviendrai vous voir demain. Adieu, père Garin, je vais vous renvoyer votre fille.
Léon Rolland descendit et frappa au carreau de la loge du portier.
Une vieille femme, coiffée d’un madras en forme de turban, lui apparut, et, d’une voix aigre, demanda ce qu’il désirait.
– Montez chez le père Garin, dit Rolland en lui donnant dix francs, un cotret pour lui faire du feu, et portez-lui du bœuf et du bouillon. Ayez soin de lui, je reviendrai.
La portière, qui n’était pas habituée à de semblables munificences, salua jusqu’à terre, et s’empressa d’exécuter les ordres de Rolland, tandis que celui-ci regagnait le faubourg Saint-Antoine et son domicile. Précisément comme il traversait la place de la Bastille, Cerise revenait de l’hôtel de Kergaz, reconnut son mari, pressa le pas et courut à lui.
– Ah ! te voilà ? dit Léon, qui lui offrit aussitôt son bras.
– Oui, mon cher petit homme, répondit Cerise, employant avec son mari cette épithète amicale, fort répandue parmi les ouvriers de Paris.
Cerise était toujours cette vertueuse et jolie fille que nous avons connue autrefois rue du Faubourg-du-Temple, si rieuse et si gaie, et travaillant de si grand cœur en songeant à ses chères amours.
Le mariage l’avait embellie. Ce n’était plus la petite fille de seize ans, c’était la jeune femme de vingt et un ans, dont la taille avait acquis toute son élégance, dont les traits charmants avaient perdu ces légers indices de fatigue qui sont la conséquence de la nubilité, et souvent d’un travail forcé peu soutenu par une nourriture insuffisante chez les femmes du peuple.
Cerise était devenue une femme, une femme jeune et charmante qui faisait l’admiration naïve des habitants du faubourg, dans lequel on ne l’appelait que la belle madame Rolland.
Cerise, enfin, était la plus heureuse des femmes, car elle avait un mari qu’elle aimait et un jeune enfant qu’elle adorait, et le bonheur embellit encore.
– Mon enfant, lui dit Léon, pressons un peu le pas et hâtons-nous de rentrer.
– Pourquoi donc ? est-il déjà l’heure de déjeuner ?
– Ce n’est pas cela, dit Léon en souriant, on t’attend à la maison.
– Ah !… et qui donc ?
– Une pauvre fille sans ouvrage.
Et Léon raconta à sa femme son entrevue avec la fille du père Garin, et sa visite au vieil aveugle.
Ce récit donna des ailes à la bonne Cerise ; elle monta, légère comme une biche, l’escalier de la maison, tant elle avait hâte, la chère femme du bon Dieu, de soulager une misère, et Léon la suivit.
Eugénie Garin, ou du moins celle qui portait ce nom, était assise dans la salle à manger, conservant son attitude modeste et mélancolique.
Elle vit entrer Cerise et Léon Rolland en même temps, et elle devina que la première était celle qu’elle attendait.
Et alors elle leva de nouveau ses yeux sur Léon Rolland, puis elle les reporta sur Cerise…
Ce double regard produisit deux résultats également étranges.
La jeune femme était pauvrement vêtue, elle avait l’apparence de l’honnêteté et de la misère réunies, et cependant, sous le poids de son regard, Cerise tressaillit et se troubla comme si un animal venimeux, un reptile se fût dressé devant elle.
On eût dit qu’elle avait le pressentiment que le malheur venait d’entrer dans sa maison.
En même temps, Léon ressentit également une commotion inconnue qui fouetta son sang dans ses veines.
Aucune de ces impressions n’échappa à la prétendue fille du père Garin :
– Et de deux ! pensa-t-elle.
Puis elle baissa les yeux, ajouta mentalement :
– Avant huit jours, cet homme sera amoureux fou de moi, et cette femme sera jalouse.
XVI
Une heure après, environ, la prétendue fille du père Garin grimpait lentement l’escalier tortueux et sale de la maison qui portait le numéro 23 dans la rue de Charonne, et pénétrait dans le réduit de l’aveugle.
La portière avait ponctuellement obéi à Léon Rolland ; elle avait allumé un feu dans la cheminée, et le vieillard s’était levé et assis au coin de l’âtre ; il achevait tranquillement son repas.
– Eh bien, monsieur l’aveugle, lui dit la jeune femme en entrant et changeant subitement de ton et de manières, avez-vous au moins joué convenablement votre rôle ?
Le père Garin, dont la cécité n’était pas complète et qui y voyait encore suffisamment pour se conduire, essaya de distinguer les traits de la jeune femme, qu’éclairaient en ce moment les reflets rouges du foyer.
– Pardienne ! répondit-il, si vous aviez été là, ma chère dame, vous auriez claqué des mains. J’étais un amour de père, j’ai pleuré, j’ai sangloté, j’ai même dit que vous étiez un ange, à preuve que cet imbécile de patron en était tout chaviré.
Et l’aveugle se mit à rire bruyamment.
– Il m’a laissé quarante francs, le patron ; il m’a envoyé la veuve Fipart la portière, et elle m’a fait du feu.
– Je vois même, dit la jeune femme en souriant et déposant un paquet assez volumineux dans un coin, c’était l’ouvrage que Cerise lui avait donné, je vois que vous avez assez bon appétit, vieux coquin !
– Heu ! heu ! dit le bonhomme, l’appétit va bien, mais la soif va mieux encore… et si c’était un effet de votre bonté, ma belle dame, de me faire seulement donner un peu de vin.
– Non pas, vieil ivrogne ! dit la jeune femme en riant, quand on a bu, on jase, et je ne veux pas que vous fassiez des sottises.
– Faudra donc que je boive de l’eau ? soupira l’ivrogne avec un accent désolé.
– Jusqu’à ce que je vous permette de boire du vin. Ce jour-là, vous pourrez coucher chez le marchand de vin, si vous voulez.
– Sera-ce bientôt ?
– Je ne sais pas, dit-elle d’un ton sec.
Puis elle s’assit près du feu et reprit :
– Voyons, je n’ai pas le temps de rester dans votre taudis infect. Entendons-nous bien. Je vous ai promis dix louis par mois si vous jouez convenablement votre rôle aveugle et malheureux.
– Ça c’est vrai, ma belle dame ; mais je puis me vanter, foi de Garin ! que je suis consciencieux.
– Si vous allez jusqu’au bout, vous aurez mille écus quand la comédie sera terminée.
L’aveugle jeta un cri de joie.
– C’est bien, bonsoir ! Je reviendrai demain matin. M. Rolland ne peut venir ni le matin ni le soir, je le sais pertinemment. Mais s’il venait un soir, car il faut tout prévoir, je suis sortie.
Et elle laissa l’aveugle, descendit et entra chez la portière.
La portière, disons-le tout de suite, n’était autre que la veuve Fipart elle-même, notre ancienne connaissance de Bougival, la veuve illégitime de feu Nicolo, la mère d’adoption enfin du vaurien Rocambole, devenu l’élégant vicomte de Cambolh.
La veuve Fipart, on le devine, n’était portière que par fantaisie et dans l’unique but de se distraire, ce qu’on appelle vulgairement s’entretenir la main.
Dieu merci ! la chère et digne femme avait quelques économies.
D’abord elle avait touché une somme assez ronde pour prix de la trahison de son cher Nicolo, qu’on avait exécuté à la barrière Saint-Jacques, un matin, il y avait environ quatre ans.
Ensuite, elle avait déterré un petit magot caché, à l’insu de Rocambole, dans la cave du cabaret de Bougival.
Puis son fils adoptif, en revenant de l’Amérique, lui avait dit :
– Maman, une femme comme vous, la mère d’un gentleman, ne saurait avoir une existence précaire. Je vais vous faire douze cents francs de rente, et vous pourrez vous retirer à Montmartre ou aux Batignolles, et y vivre comme une bourgeoise qui ne doit rien, ne fait de tort à personne et a de quoi.
– J’aimerais mieux être portière dans une maison bien propre, avait répondu la veuve, nonobstant les douze cents francs.
– Justement, avait répondu Rocambole, le capitaine a acheté une maison rue de Charonne. La place est libre, et voilà votre affaire, avait répondu le fils adoptif.
La veuve Fipart était entrée en fonction le jour même.
– J’ai tant besoin de me distraire ! avait-elle dit à son fils ; car j’ai beau faire, je pleure toujours mon pauvre Nicolo… Chéri, va ! mourir si jeune et innocent !
– Peuh ! il perdait ses dents et devenait chauve…
Telle avait été l’oraison funèbre de Nicolo prononcée par Rocambole.
Or, on le devine, la veuve Fipart était déjà dans le secret de la prétendue fille du père Garin et avait des ordres, car celle-ci entra sans façon chez elle et lui dit :
– J’ai laissé là-haut un gros paquet. Vous le porterez dans la chambre que vous m’avez retenue au coin de la rue de Lappe, et vous me chercherez une ouvrière qui me dépêche cette besogne, hein ?
– Suffit, ma belle dame, dit la portière.
– Bonsoir, à demain !
Et l’inconnue s’en alla, gagna le boulevard à pied, arrêta un fiacre au passage, y monta et dit au cocher :
– Rue Moncey, au coin de la rue Blanche.
Vingt minutes après, la Turquoise, car c’était elle, descendait à la grille de ce petit hôtel qui avait appartenu à Baccarat, que sir Williams avait fait racheter, et dans lequel il avait installé la jeune courtisane pour en faire un des instruments du drame terrible qu’il charpentait pièce à pièce.
La femme de chambre attendait sa maîtresse dans le cabinet de toilette.
– Ôte-moi ces haillons ! dit la Turquoise. Pouah !… S’il n’y avait pas un million au bout.
Elle se déshabilla rapidement et se fit apporter un bain de son.
Après quoi elle se fit habiller comme une femme qui va sortir en toilette de ville et monter en voiture.
– Comment va-t-il ? demanda-t-elle.
– Le docteur est venu, répondit la soubrette, et il l’a pansé. Il a sucé une aile de volaille et bu un doigt de vin de Bordeaux ; je suis entrée deux fois dans sa chambre pour savoir s’il n’avait besoin de rien. Il m’a répondu que non, tout en me demandant si madame tarderait beaucoup à rentrer.
La Turquoise se prit à rire.
– Pauvre cher pigeon !… dit-elle.
– Ah ! fit la soubrette, je crois qu’il est déjà gris… il en est pâle…
– Et… il ne t’a pas questionnée ?
– Non.
– Il ne t’a pas mis deux louis dans la main ?
– Hélas ! non…
– Bon ! fit la jeune femme en souriant, il est loyal… Il respecte le mystère dont je l’enveloppe et n’en sera que plus facile à plumer… Voilà un trou de serrure sur un signe de mon petit doigt.
Et la Turquoise, en robe de soie marron montante, les bras nus et sans chapeau, ses beaux cheveux roulés en torsade, passa de son cabinet de toilette dans la chambre où Fernand Rocher était toujours au lit et l’attendait avec anxiété.
Lorsqu’elle entra, le visage du malade, fort pâle quelques secondes auparavant, s’empourpra tout à coup sous le poids d’une violente et subite émotion.
– Enfin… murmura-t-il, vous voilà !
– Mon Dieu ! dit-elle en souriant et attachant sur lui ce regard qui le troublait jusqu’au fond de l’âme, étiez-vous donc si impatient de me voir ?
Il rougit et se troubla.
– Pardonnez-moi, balbutia-t-il, je suis d’une inconvenance sans nom.
Elle lui sourit encore et se jeta nonchalamment dans un grand fauteuil roulé au pied du lit, arrondissant à demi son bras nu orné d’un mince bracelet, et prenant de l’air le plus simple du monde une délicieuse attitude :
– Mon Dieu ! dit-elle, je comprends un peu cette impatience, et vous êtes tout excusé, car je l’ai éprouvée moi-même.
– Vous ? murmura-t-il, se méprenant sans doute au sens de ses paroles.
– Certainement, dit-elle en souriant. Les malades sont comme les prisonniers. Quand ils sont seuls ils s’ennuient.
– Ah ! madame.
– Chut ! fit-elle en posant un joli doigt sur ses lèvres roses, laissez-moi achever ma théorie.
Et elle reprit en souriant :
– Donc, de même que les prisonniers finissent par attendre avec quelque anxiété l’arrivée quotidienne de leur guichetier, de même les malades se prennent à aimer leur garde ou la seule personne qu’ils voient habituellement.
– Madame… madame… murmura Fernand avec un élan subit, ah ! c’est un tout autre sentiment.
– Je devine, fit-elle en souriant, vous voudriez avoir des nouvelles de madame Rocher ?
Ces mots frappèrent Fernand comme le roulement subit du tambour éveille le soldat endormi.
Il tressaillit, pâlit, balbutia, et songea à Hermine.
Mais déjà les yeux pervers et tentateurs de Turquoise, en dépit de la suave image d’Hermine, avaient jeté le trouble au fond du cœur de Fernand.
Était-ce encore Hermine qu’il aimait ?
À partir de ce moment, Fernand Rocher vécut comme dans un rêve, livré à de rapides alternatives de fièvre et de calme, tantôt appelant sa femme à grands cris, et tantôt l’oubliant pour ne plus voir et entendre que la belle inconnue…
Pourtant, elle continuait à s’environner du plus impénétrable mystère, fronçait ses beaux sourcils si une question indiscrète échappait à Fernand, et lui répondant après avec un sourire plein de tristesse :
– Pourquoi êtes-vous ingrat ? Ne vous ai-je pas dit que mon secret ne m’appartenait pas ?
Et alors Fernand se taisait et se contentait d’admirer l’éblouissante créature.
Cela dura huit jours.
Pendant ces huit jours, la convalescence du blessé marcha rapidement.
Mais, aussi, son cœur eut à subir de cruels assauts. Pourtant jamais femme ne s’était montrée plus naïvement bonne, plus chastement abandonnée que Turquoise, plus réservée sans pruderie qu’elle le fut.
Elle avait des façons qui tenaient à la fois de la duchesse et de la sœur de charité.
Elle soignait Fernand comme on soigne l’homme aimé, idolâtré même, lui souriait comme à un enfant malade, et, cependant, il n’avait jamais osé lui prendre la main.
Elle le quittait peu, pourtant ; chaque jour, vers deux heures, elle sortait et ne rentrait guère qu’à huit.
Mais alors elle s’installait à son chevet, et Fernand oubliait les heures et le monde entier au son de cette voix qui le charmait.
Un matin, comme le soleil entrait à flots dans la chambre par la fenêtre entrouverte et laissant voir les arbres dépouillés d’un grand jardin, le docteur permit à son malade de se lever et de respirer un peu l’air. Ce fut une grande joie pour Fernand, car la belle inconnue lui dit :
– Il fait un très beau temps d’hiver, le soleil est chaud, l’air est tiède. Si vous me promettez de ne pas en abuser, je vais vous permettre deux tours de jardin… Vous vous appuierez sur mon bras.
Fernand la suivit au jardin, lui donnant le bras plutôt qu’il ne s’appuyait sur elle.
On s’en souvient, Fernand Rocher, il y avait quatre ans, avait précisément passé une nuit dans ce petit hôtel de la rue Moncey, et, sans doute, il aurait dû se reconnaître au moins dans le jardin.
Mais il ne faut pas oublier que Baccarat l’y avait d’abord transporté évanoui, que par conséquent il n’avait pu examiner ni même voir l’aspect extérieur du petit hôtel ; qu’ensuite, le lendemain, il en était sorti brusquement, à demi fou, tenu au collet par deux sergents de ville et admonesté par un commissaire de police, et que, dans cet état de prostration, voisin de la démence, il n’avait certes dû remarquer aucune de ces particularités qui font qu’à plusieurs années de distance on reconnaît les lieux où l’on a déjà passé.
D’ailleurs, les arbres avaient grandi, et sir Williams, qui, sans doute, avait prudemment déjà calculé tout cela, avait fait garnir la grille extérieure de hautes plaques de fonte qui interceptaient la vue de la rue.
Donc, Fernand ne vit qu’une chose, c’est que ce jardin ressemblait à tous les jardins, cet hôtel à tous les hôtels, et il lui fut impossible de deviner s’il se trouvait dans le faubourg Saint-Germain ou dans le haut du quartier neuf qui s’étage au flanc de la colline de Montmartre.
D’ailleurs encore, Fernand n’y songeait pas. Semblable à l’oiseau fasciné par le reptile charmeur il ne voyait et n’écoutait que l’adorable créature qui marchait auprès de lui.
Pendant trois jours encore le malade put se lever, se promener une heure ou deux dans le jardin vers midi ; puis, comme la blessure se fermait et commençait à se cicatriser, la belle inconnue lui dit le soir du troisième jour :
– Dans peu vous serez complètement guéri, et je crois que je pourrai vous renvoyer à votre femme.
Fernand tressaillit, et le passé lui apparut…
Il eut le vertige.
– Mon Dieu ! s’écria-t-il, mais j’ai une femme, un enfant… une femme que j’aime, et elle devrait être ici !
La Turquoise s’était absentée un moment. Elle revint et lui prit la main :
– Mon ami, lui dit-elle avec son plus séduisant sourire, je vais vous demander un bien grand service.
– Ah ! dit-il, poussant un cri de joie, je puis donc faire quelque chose pour vous prouver…
– Chut ! murmura-t-elle, pas de grandes phrases ; à quoi bon ? Mais écoutez-moi bien…
Elle se pelotonna dans le fauteuil naguère roulé près du lit, et maintenant avancé devant le foyer depuis que Fernand se levait.
– Écoutez, dit-elle.
– Parlez, je suis prêt.
– Vous le savez, je ne puis vous dire ni mon nom ni celui de la rue où nous sommes…
– Soit, dit-il tristement.
– Donc, reprit-elle, vous allez me donner votre parole d’honneur de m’obéir aveuglément.
– Je vous la donne, madame.
– Aveuglément est bien le mot, dit-elle en souriant, car je vais vous bander les yeux.
Fernand fit un geste de surprise.
– Quand vous aurez les yeux bandés, poursuivit-elle, on vous fera monter en voiture ; mais, auparavant, vous prendrez cette lettre, qui renferme mes instructions, et vous dira ce que j’attends de vous…
– Mon Dieu ! mais c’est un conte des Mille et une Nuits ?
– À peu près.
– Et où me conduira cette voiture.
Elle laissa échapper un frais éclat de rire un peu moqueur.
– La belle question ! dit-elle. Si je voulais vous le dire à présent, il serait réellement inutile de vous bander les yeux…
– C’est vrai, dit-il.
– Donc, vous monterez en voiture. La voiture vous emportera pendant une heure ou deux, puis s’arrêtera, et vous descendrez… Alors vous ôterez votre bandeau et lirez ma lettre, qui vous dira ce que j’attends de vous.
– Et… demanda Fernand, quand faut-il partir ?
– À l’instant.
Alors la Turquoise se plaça devant un petit bureau en bois de rose, prit une plume, écrivit sa lettre et la cacheta.
Puis elle fit mettre à Fernand son pardessus et son manteau, et, ôtant un foulard qu’elle avait à son cou :
– Tenez, dit-elle, vous penserez à moi en l’ayant sur le visage.
Et elle lui banda soigneusement les yeux et le prit par la main :
– Venez ! dit-elle en l’entraînant.
Elle le fit sortir de l’hôtel, traversa le jardin et franchit la grille, devant laquelle une voiture stationnait.
Puis, aidée du cocher, elle le fit monter et ferma la portière :
– Soyez fidèle à votre parole ! dit-elle.
Et la voiture partit, tandis que la Turquoise rentrait chez elle en riant et se disant :
– Voilà un homme qui reviendra ici à genoux et son portefeuille à la main.
La voiture, cependant, roulait avec rapidité sur le pavé ; elle tourna et retourna plusieurs fois sur elle-même, courut environ deux heures et s’arrêta.
Alors le cocher vint ouvrir, et dit :
– C’est ici !
Fernand descendit, et, tandis qu’il ôtait son bandeau, la voiture s’éloigna au grand trot.
Le bandeau enlevé, Fernand regarda autour de lui, s’aperçut qu’il était nuit, que les rues étaient désertes et reconnut le lieu où il se trouvait.
Il était au bas de la rue d’Amsterdam, en face du chemin de fer de l’Ouest.
Courir sous un réverbère et briser l’enveloppe de la lettre fut sa première occupation.
La lettre était courte et ainsi conçue :
« Mon ami,
« Vous êtes à peu près guéri et en état de rentrer chez vous, où votre femme, qui vous aime, vous attend avec impatience.
« Adieu donc, et ne vous battez plus.
« Si quelquefois mon souvenir se présente à votre pensée, dites-vous que la vie est formée d’impénétrables mystères et ne cherchez pas à me revoir…
« D’abord je ne suis pas libre, je ne m’appartiens pas, et vous vous exposeriez aux plus grands dangers…
« Ensuite, songez que vous avez une bonne, belle et charmante femme, que vous aimez et qui vous aime…
« Enfin, n’allez pas être fat, ami, soyez généreux !… car peut-être y aurait-il eu quelque danger pour moi à prolonger mon rôle de garde-malade.
« Adieu, ne m’en voulez pas, et dites-vous que vous avez rêvé.
« Le rêve est ce qu’il y a de meilleur dans la vie. »
Fernand poussa un cri étouffé en achevant de lire cette triste lettre, et il s’appuya défaillant contre le mur :
– Oh ! murmura-t-il, il faudra bien que je la revoie… et, dussé-je bouleverser Paris, je la retrouverai !
XVII
Le lendemain du jour où Fernand Rocher avait été si bizarrement reconduit du petit hôtel de la rue de Moncey par sa mystérieuse inconnue, nous eussions retrouvé sir Williams, vers minuit, attablé en face de Rocambole dans le salon du petit appartement que ce dernier occupait rue du Faubourg-Saint-Honoré, au coin de la rue de Berri.
Le vicomte de fraîche date était enveloppé douillettement dans sa robe de chambre, et fumait, tandis que sir Williams se dédommageait de la faible chère qu’il faisait à l’hôtel de Kergaz, en démolissant un superbe pâté d’anguilles.
– Mon oncle, disait Rocambole, voici trois jours que je ne vous ai vu, et il y a du nouveau…
– C’est probable, mon neveu.
– Tenez, mon oncle, pendant que vous soupez, je vais vous donner communication de nos petites notes.
Et le fils adoptif de la veuve Fipart se leva, alla prendre un volumineux cartable sur un guéridon voisin et l’étala sur ses genoux.
Ce cartable renfermait une liasse de papiers recouverts de signes mystérieux, semblables à ceux que nous avons entrevus sur la table du président, le soir de la réunion des Valets-de-Cœur.
C’était comme le dossier des différents membres de la vaste association.
Chaque Valet-de-Cœur écrivait en caractères vulgaires à Rocambole, qui recopiait la note avec ces caractères de convention et brûlait prudemment l’original.
– Voyons ! dit sir Williams, continuant à souper de fort bon appétit.
– Commençons par le rapport le plus ancien. C’est celui de Chérubin.
– C’est le plus important, dit le baronet.
« Chérubin, lut Rocambole, a fait valser deux fois à son bal la marquise Van-Hop. La marquise a éprouvé quelques embarras, mais elle est demeurée indifférente et froide. Chérubin a risqué un compliment banal qu’on n’a pas entendu, et il a quitté le bal vers trois heures du matin. Le lendemain vers deux heures, comme la marquise descendait l’avenue des Champs-Élysées dans sa calèche, elle a été croisée par un chevalier qui l’a saluée.
« C’était Chérubin.
« Chérubin monte fort bien à cheval et se met à ravir.
« Il a remarqué une légère rougeur qui est montée au front de la belle marquise.
« Le jour suivant, le major Carden a présenté Chérubin chez la comtesse G…, une Anglaise de distinction chez laquelle la marquise va beaucoup et souvent seule.
« Précisément, ce soir-là, le banquier hollandais n’avait point accompagné sa femme, et, lorsqu’elle est entrée, le hasard a voulu que Chérubin fût mélancoliquement appuyé à la cheminée d’un premier salon encore désert.
« Il avait au front un nuage de tristesse du meilleur effet, et il a su pâlir à propos lorsque son regard et celui de la marquise, se sont rencontrés.
« Pourtant il a été strictement poli, et loin de se montrer empressé, il a paru au contraire désireux de se tenir à distance. Il n’a point fait danser la marquise, mais deux fois, celle-ci, en se retournant, a surpris les yeux de Chérubin attachés sur elle… »
– C’est très bien, dit le baronet. Le plus sûr moyen de réussir auprès des femmes et de tout espérer d’elles est de se poser en homme qui cherche à se soustraire à sa destinée fatale. Continue, mon neveu…
Rocambole reprit la lecture de ses notes hiéroglyphiques :
« Chérubin a remarqué un certain trouble chez la marquise. Elle est partie de bonne heure, vers minuit environ.
« Le lendemain, Chérubin s’est promené au Bois, aux Champs-Élysées et dans l’avenue Marly, de deux à quatre heures.
« Le temps était beau, mais il paraît que la marquise n’a point fait sa promenade habituelle. Le jour suivant, il n’a pas été plus heureux.
« La marquise est chez elle le samedi dans la journée.
« Le major Carden lui a fait une visite et l’a trouvée seule.
« La marquise paraissait souffrante ; elle avait les yeux battus.
« Cependant, elle a affecté beaucoup de gaieté et a causé un peu de toutes choses.
« Puis, sans affectation, de la façon la plus naturelle du monde, elle a demandé au major quel était ce jeune homme qu’il lui avait présenté et qu’elle avait revu chez la comtesse G…
« Le major a répondu que c’était M. Oscar de Verny, un parfait gentilhomme, mais triste, mélancolique, en proie, pensait-il, à quelque violent chagrin d’amour.
« Il a vu la marquise tressaillir légèrement, puis détourner la conversation et lui demander des nouvelles de la dernière représentation de l’Opéra… »
– Là s’arrêtent les notes du major et de Chérubin, acheva Rocambole.
– C’est peu, dit le baronet, mais enfin c’est un commencement.
– Ah ! dit Rocambole, les cinq millions de la fille de l’Inde ne seront pas aisés à gagner.
– On y arrivera cependant.
– La marquise est une forteresse de vertu…
– Oui, dit sir Williams ; mais Chérubin, comme la Turquoise, a le regard séduisant, et les femmes les plus sèches de cœur n’y résistent pas toujours. Mais passons à un autre.
Rocambole compulsa de nouveau ses papiers et lut :
« Dossier Malassis. »
– Ceci est la note de Venture, dit-il, et pour un intendant et un homme qui porte la livrée, il n’est pas précisément maladroit.
Et Rocambole lut :
« Madame Malassis est rentrée du bal dans la nuit du mercredi au jeudi.
« Peu d’instant après, elle a entendu des pas et a cru que c’était le vieux duc de Château-Mailly qui pénétrait chez elle à cette heure avancée.
« Mais au lieu du duc, elle a vu entrer M. Arthur Champi, le sixième Valet-de-Cœur.
« Elle a poussé de faibles cris, puis la porte s’est fermée et un profond silence a régné dans sa chambre.
« Que s’est-il passé entre elle et le jeune homme ? C’est ce que personne ne sait. Toujours est-il que, avant le jour, M. Champi est parti et que depuis il n’est pas revenu.
« Mais, chaque jour, madame Malassis sort vers deux heures et ne rentre qu’à quatre.
« Le jeudi matin, vers sept heures, comme il était à peine jour, le duc est venu. Il était horriblement pâle et défait, et l’on voyait au désordre de ses vêtements et de toute sa personne qu’il ne s’était pas couché de la nuit.
« Il est entré par la rue de la Pépinière. Madame était déjà sur pied et la femme de chambre achevait de faire ses malles.
« Madame paraissait fort agitée ; elle est devenue pâle, et n’a pu maîtriser son émotion en voyant entrer le duc.
« Elle craignait déjà de ne le point voir revenir. Cependant, elle a bien joué son rôle, elle a été digne, froide, sévère, elle a su pleurer à propos.
« Le duc s’est jeté à genoux, il a prié, supplié.
« Longtemps inflexible, madame Malassis a fini par céder ; elle a consenti à épouser le duc ; mais à la condition que le mariage se ferait sans pompe, la nuit, et qu’ils partiraient aussitôt pour l’Italie.
« Elle a exigé, en outre, que le duc ne remît pas les pieds chez elle avant la publication du premier ban.
« J’attends des ordres. »
– Voilà, dit sir Williams, une affaire qui va plus grand train que celle de la marquise. Elle va même un peu vite, et il faut trouver un moyen de l’enrayer un peu. La besogne du jeune comte de Château-Mailly n’est pas assez avancée. As-tu des nouvelles de la Fipart ?
– Oui, répondit Rocambole. Maman est venue ce soir vers neuf heures, et je me suis hâté de transcrire son petit rapport.
– Voyons ? interrompit sir Williams.
« La petite dame blonde, lut Rocambole, vient régulièrement tous les jours, vers deux heures, et s’installe chez le père Garin. Elle prend son ouvrage et se met à travailler.
« Léon Rolland vient tous les jours, sous le prétexte de savoir comment va le vieux bonhomme, mais il cause longtemps avec la petite dame.
« Hier, il a parlé de faire transporter le vieux dans une maison de santé.
« Aussitôt qu’il est parti, la petite dame s’en va se déshabiller dans le logement que je lui ai retenu, et m’envoie lui chercher une voiture.
« Depuis deux jours, M. Léon paraît tout soucieux, et sa voix tremble quand il me demande si mademoiselle Eugénie est avec son père.
« Hier, il est venu de meilleure heure. La petite dame n’était point arrivée encore. Je lui ai dit qu’elle était sortie. Il est devenu pâle, mais il est monté tout de même. »
– Voilà l’oiseau englué ! dit sir Williams.
Et il tira de sa poche un petit billet couvert d’une écriture mignonne qui trahissait une plume de femme.
C’était une lettre de Turquoise.
Elle était ainsi conçue.
« Mon cher protecteur,
« Je crois que la pauvre madame Cerise Rolland éprouvera des malheurs d’ici à peu.
« Son imbécile d’époux est décidément toqué. À chaque instant, il est sur le point de tomber à mes genoux, mais la présence de mon prétendu père est un obstacle.
« Faut-il le supprimer et envoyer décidément le bonhomme chez Dubois ?
« Je vous attends demain au rendez-vous convenu, pour savoir ce qu’il reste à faire.
« Votre petite biche aux yeux bleus. »
Sir Williams relut cette lettre. Puis il l’approcha de la bougie et la brûla.
– Ah çà ! mon oncle, dit Rocambole, voulez-vous me permettre une question ?
– Soit, fit sir Williams d’un signe de tête.
– Turquoise va être aimée de Rolland et de Fernand à la fois ?
– Sans doute.
– Pourquoi cette double corvée ? N’aurait-il pas mieux valu trouver deux femmes différentes ? C’eût été plus commode, il me semble…
Sir Williams haussa les épaules.
– Décidément, murmura-t-il, tu es moins fort que je ne pensais.
– Ah ! fit Rocambole froissé du ton dédaigneux de sir Williams.
– Comment ! reprit celui-ci, tu ne prévois donc pas le moment où ces deux hommes seront arrivés au paroxisme de la passion ?
– Eh bien ?
– Eh bien ! mais alors, dit sir Williams dont l’infernal sourire reparut dans sa splendeur fatale, nous arrangerons une petite scène où ils se rencontreront et s’égorgeront comme des garçons bouchers pris de vin.
– Oh ! fameux ! s’écria Rocambole, fameux !
Et il regarda sir Williams avec une admiration naïve.
– Mon oncle, murmura-t-il, le pâtissier[1] finira par abdiquer en votre faveur, car, parole d’honneur ! vous êtes plus roué que lui.
– Merci, répondit sir Williams avec modestie.
Puis il repoussa la table chargée des débris de son souper, prit un cigare sur la cheminée, se rejeta au fond de son vaste fauteuil et s’enveloppa majestueusement dans un magnifique nuage de fumée bleue.
La méditation du baronet, que Rocambole n’osa troubler, du reste, dura environ dix minutes.
Tout à coup il releva la tête :
– Dis donc, fit-il, sais-tu quelle est la meilleure manière d’éprouver le cœur d’une femme ?
– Mais, dit Rocambole, je crois qu’il y en a plusieurs.
– Il en est une infaillible.
– Ah !
– La marquise commence peut-être à aimer Chérubin en secret…
– C’est probable, murmura Rocambole.
– Mais la marquise est vertueuse…
– Hélas !
– Et tant qu’une femme vertueuse n’a point trahi vis-à-vis d’elle-même, par une émotion quelconque, le secret de son cœur, ce cœur est une redoute imprenable.
– Vous avez grandement raison, mon oncle.
– Donc, reprit le baronet, il faut que la marquise s’avoue à elle-même, un jour, qu’elle aime Chérubin…
– Est-ce possible ?
– Tout l’est en ce monde.
– Je vous écoute, mon oncle.
– C’est après-demain jour d’Opéra.
– Oui, on donne les Huguenots.
– La marquise va à l’Opéra assez régulièrement.
– Presque toujours.
– Très bien. Alors, écoute-moi attentivement. Tu iras trouver Chérubin et tu lui diras : « Il est un certain coup d’épée dans le bras qui n’est jamais qu’une égratignure et qui, cependant, produit toujours un certain effet sur les femmes. Il faut que vous receviez ce coup d’épée de ma blanche main, et peut-être la marquise enverra chercher de vos nouvelles dès le lendemain du combat. »
– Diable, fit Rocambole, ceci est encore une assez belle idée, mon oncle.
– Attends donc… Tu enverras donc Chérubin à l’Opéra, et tu lui feras prendre un coupon de la loge voisine de celle de la marquise.
– Parfait !
– Ensuite tu t’arrangeras de façon, pendant que le rideau sera baissé, à lui chercher une querelle polie, courtoise, qui ne puisse s’arranger, et vous parlerez assez haut tous deux pour que la marquise ne puisse perdre un mot de l’entretien, de l’heure du combat, du choix des armes, du numéro de la rue qu’habite Chérubin…
– Très bien ! je comprends.
– En attendant, dit sir Williams, et dès demain matin, Chérubin ira louer un appartement qui se trouve vacant en ce moment rue de la Pépinière, numéro 40.
– De la maison de madame Malassis ?
– Précisément.
– Les fenêtres de cet appartement donnent sur le jardin. On peut les voir de celles de madame Malassis.
– Très bien ! très bien ! murmura Rocambole émerveillé.
– La marquise va quelquefois rendre visite à son amie. Eh bien, je gage que le jour même où la rencontre aura eu lieu, avant qu’il soit midi, la marquise sera chez madame Malassis. Venture nous tiendra au courant. Comment trouves-tu mon idée ?
– Splendide, mon oncle, et je vous jure qu’elle sera merveilleusement exécutée ; mais…
– Ah ! dit sir Williams en fronçant le sourcil, il y a un mais…
– Il y en a partout et toujours.
– Voyons le tien ?
– Si Chérubin n’allait pas vouloir…
– Vouloir quoi ?
– Recevoir le coup d’épée ?…
– Plaît-il ; fit sir Williams, es-tu fou, monsieur le vicomte ?
– Dame ! c’est peu agréable.
– Mon cher, dit froidement le baronet, quand un homme est à nous, il est bien à nous. S’il était nécessaire que maître Chérubin fît au club des Valets-de-Cœur le sacrifice de son nez et de ses deux oreilles, ce qui, j’en conviens, gâterait un peu sa jolie figure, je me chargerais fort tranquillement de l’opération.
– Je n’ai plus rien à objecter, dit Rocambole.
Le baronet se leva et boutonna cette longue redingote noire qui lui donnait la tournure d’un ecclésiastique, prit son chapeau à larges bords, ses gants de tricot, car il n’en portait plus d’autres depuis que, chez lui, le lion avait fait place à l’humble teneur de livres, et il tendit la main à Rocambole.
– Adieu, dit-il, à demain soir.
– Voulez-vous ma voiture ? demanda le vicomte suédois.
– Oui, jusqu’au bas de la rue Blanche.
Et, en effet, sir Williams s’en alla dans le coupé bas de Rocambole, qui s’arrêta, sur son ordre, à l’angle de la rue Blanche et de la rue Saint-Lazare, devant la boutique d’un pharmacien.
Puis il gravit à pied la première de ces deux rues et gagna la rue Moncey.
Sir Williams était un homme prudent ; il avait installé la Turquoise dans le petit hôtel de Baccarat, mais il en était demeuré le mystérieux propriétaire ; et comme il voulait se réserver le droit de pénétrer à toute heure chez la courtisane, il avait conservé une clef de la grille et une clef du corps de logis.
Il entra donc sans sonner, sans faire de bruit, sans éveiller personne, traversa le vestibule, monta lestement au premier étage, et frappa discrètement à la porte de la chambre à coucher, aux fenêtres de laquelle il avait aperçu de la lumière en traversant le jardin.
– Entrez, dit une voix de femme, celle de la blonde Jenny.
La Turquoise allait se mettre au lit, et elle était déjà vêtue de son costume de nuit.
– Ah ! c’est vous, dit-elle en voyant entrer sir Williams. J’avais le pressentiment que vous viendriez ce soir.
– Tu pourrais dire ce matin, il est trois heures.
– Soit. Me permettrez-vous de me coucher ?
– Je n’y vois point d’obstacle.
La Turquoise se glissa comme une anguille sous ses draps, posa sa belle tête et sa forêt de tresses blondes sur l’oreiller, arrondit ses bras nus autour de sa tête et regarda sir Williams.
– Mon cher sultan, dit-elle, je suis à présent votre esclave soumise et suis prête à vous obéir.
– Alors, écoute-moi bien, petite, dit sir Williams d’un ton paternel.
Et il s’assit sur le pied du lit, et il se prit à caresser de sa main la main blanche et mignonne de sa jolie hôtesse.
– Demain, dit-il, tu iras rue de Charonne dans la matinée, tu mettras ton prétendu père dans une voiture, et tu le conduiras à la maison de santé Dubois, dans le faubourg Saint-Denis.
– Ah ! enfin… dit Turquoise, dont l’œil bleu étincela de perversité.
– Le reste te regarde, acheva sir Williams avec flegme.
– Et… Fernand ? demanda-t-elle.
– Oh ! pas encore… pas encore… Diable ! il faut de la patience, ma fille, quand on veut plumer douze millions…
– J’en aurai, murmura la courtisane ; mais je vous jure bien que si Fernand revient ici, il y laissera son dernier louis.
– Et l’honneur de sa femme, ajouta le baronet d’un ton fort calme.
– Amen ! acheva la Turquoise.
XVIII
C’était le surlendemain du jour où sir Williams avait eu avec Rocambole l’entretien que nous venons de rapporter.
Madame la marquise Van-Hop était à sa toilette.
Il était alors sept heures et demie environ.
Le marquis était plongé dans une vaste bergère, dans le boudoir de sa femme, tandis que celle-ci était aux mains de ses caméristes.
Amoureux comme au premier jour de la lune de miel, M. Van-Hop admirait la suave beauté de sa femme, beauté qui se fût fort bien passée de la rivière de diamants qu’elle avait sur ses épaules et des magnifiques branches de corail posées dans ses cheveux noirs. Pourtant la marquise était pâle et souffrante.
Depuis quelques jours, surtout, la créole était en proie à de vagues inquiétudes, à d’insolites tristesses dont elle ne pouvait s’expliquer la cause.
Mais son mari était là, à cette heure ; son mari qu’elle avait tant aimé, qu’elle aimait encore, du moins elle le croyait, et le sourire était revenu à ses lèvres, et c’était avec une chaste coquetterie qu’elle jetait un regard furtif et complaisant dans la psyché placée devant elle.
Le marquis avait bien quarante ans, mais il avait conservé cette mâle beauté un peu froide, un peu taciturne, sans doute, qui est l’apanage des races du Nord.
De haute taille, jouissant déjà d’une sorte d’embonpoint prématuré, le marquis, dont le teint était ordinairement coloré, devenait, par suite d’une émotion violente, extrêmement pâle.
Il était sujet, disait-on, à ce que les peuples septentrionaux appellent la colère blanche. Habituellement calme, doux, bienveillant, il dissimulait sa jalousie, mais souvent sa pâleur livide trahissait ses fureurs concentrées, et sir Williams l’avait parfaitement apprécié lorsqu’il l’avait jugé capable de tuer sa femme le jour où il la reconnaîtrait coupable, ou la croirait telle.
Cependant, M. Van-Hop était un homme du monde, il savait commander à ses passions, dominer ses instincts, et, par conséquent, laisser sa femme entièrement libre de ses actions. Ainsi, ce jour-là, le marquis n’avait vu aucun inconvénient à laisser aller sa femme à l’Opéra sans lui.
Le marquis était joueur d’échecs passionné ; il avait ce soir-là une très belle partie à son cercle, et il ne voulait point y manquer.
– Ma chère amie, avait-il dit à sa femme, j’irai vous prendre à l’Opéra à onze heures, vers la fin du dernier acte.
Et il assistait en causant à la toilette de sa femme, lorsqu’on annonça :
– Monsieur le major Carden !
– Faites entrer au salon, dit la marquise.
– Non, non, dit vivement son mari, vous êtes habillée, ma chère amie, et vous pouvez recevoir le major ici. C’est un vieil ami, qui peut pénétrer partout.
Les cinquante années du major expliquaient parfaitement cette confiance de M. Van-Hop.
Le major entra.
– Ah ! par exemple, dit le marquis, auquel vint sur-le-champ une idée, vous êtes charmant de nous arriver, major.
Le major baisa la main de la marquise et regarda le mari d’un air interrogateur.
– Mon cher major, dit ce dernier, aimez-vous l’Opéra ?
– Beaucoup, marquis.
– Eh bien, madame vous offre une place dans sa loge.
Et le marquis regarda sa femme.
Un léger sourire vint sur les lèvres de la marquise.
– Major, dit-elle, mon mari est un traître, ou plutôt c’est un mari comme il y en a tant, qui préfère un échiquier à sa femme, et qui, pour concilier ses devoirs et ses passions, met sa femme sous la protection de son ami.
Madame Van-Hop regarda son mari et corrigea par un regard charmant la dure amertume de ce petit reproche.
– Allez, ajouta-t-elle, allez jouer, monsieur, mais n’oubliez pas de venir entendre le quatrième acte ; vous savez bien que nous l’aimons.
Dix minutes après, le major montait dans le grand coupé de la marquise et la conduisait à l’Opéra.
C’était un vendredi, le jour de fashion. La salle était pleine.
La marquise était belle à ravir ce soir-là, et fit sensation en entrant dans sa loge.
Les instructions de sir Williams avaient été suivies à la lettre par Rocambole.
Un peu après que la marquise eut pris place sur le devant de sa loge, la loge à côté s’ouvrit et deux jeunes gens y entrèrent.
Le premier était M. Oscar de Verny, dit Chérubin.
Il s’accouda sur le devant et se pencha à demi, de telle façon que la marquise, dont les jumelles étaient précisément dirigées vers la salle, pût l’apercevoir.
Si madame Van-Hop avait vu tout à coup surgir devant elle un péril certain, imminent, impossible à conjurer, peut-être n’eût-elle pas éprouvé une émotion plus violente que celle qui lui serra le cœur au moment où elle aperçut Chérubin.
Mais elle était femme, et toute femme sait dissimuler les angoisses de son âme sous un masque d’indifférence.
Pas un muscle de son beau visage ne tressaillit, et elle se retourna vers la scène sans la moindre affectation.
Mais elle l’avait vu…
Quant au major, comme il ne pouvait, de sa place, apercevoir Chérubin, il conservait une attitude fort calme, et lorgnait la salle en vieil habitué de l’Opéra qui retrouve tout son monde chaque vendredi soir.
Au moment où le rideau se levait, la loge située vis-à-vis de celle de la marquise, et qui était celle d’un étranger de distinction, fut ouverte à M. le vicomte de Cambolh, qui entra le lorgnon dans l’œil, un charmant sourire aux lèvres.
– Tiens, dit le major se penchant vers la marquise, voilà M. de Cambolh.
– En effet, dit la marquise.
– Je crois l’avoir rencontré chez vous…
– Oui, un sculpteur que je vois beaucoup, et qui veut bien me donner quelques leçons de statuaire, l’a présenté chez moi.
La marquise, dont le cœur battait toujours d’une émotion inconnue, était ravie d’échanger quelques mots avec son cavalier dans le seul but de tromper son anxiété.
– Du reste, reprit le major, M. de Cambolh est un homme de bonnes manières, un gentilhomme de la meilleure roche et du meilleur monde.
– C’est un Suédois, m’a-t-on dit ?
– D’origine. Il est né en France. J’ai longtemps servi avec son père. Sa famille a tenu un rang distingué à la cour de Suède.
– Est-il riche ?
– Non, trente ou quarante mille livres de rente au plus ; mais il fera un beau mariage au premier jour. Il est jeune, beau garçon, spirituel… Mais, s’interrompit le major, comme toute médaille a son revers, je vous avouerai que le vicomte a, en échange de grandes qualités, un caractère irascible et querelleur.
– En vérité ! fit la marquise, qui paraissait écouter le major avec attention, alors qu’en réalité sa pensée était ailleurs.
– À ma connaissance, reprit le major, il s’est battu vingt-cinq ou trente fois. Il est très beau tireur, il apporte sur le terrain un sang-froid terrible et souvent il a tué son adversaire.
– Quelle horreur ! murmura la marquise.
Et elle se tourna de nouveau vers la scène et parut écouter le premier acte avec beaucoup d’attention.
Mais, en réalité, elle cherchait à se rendre compte de ces battements de cœur précipités qui l’assaillaient depuis qu’elle avait entrevu Chérubin.
Cependant elle crut remarquer la lorgnette du vicomte de Cambolh dirigée avec une tenace attention sur la loge voisine de la sienne, c’est-à-dire sur celle de M. Oscar de Verny.
Et alors les paroles du major Carden la firent tressaillir.
Ou le vicomte lorgnait Chérubin d’une façon hostile, et la marquise, à cette pensée, sentait son cœur battre plus précipitamment, ou il y avait une femme dans la loge de M. de Verny, laquelle attirait l’impertinente attention de M. de Cambolh.
Et la marquise, en admettant cette hypothèse, éprouva un malaise étrange.
Le premier acte fini, la toile baissa, le vicomte quitta sa loge.
Madame Van-Hop respira… On eût dit qu’elle venait d’échapper à un danger.
Mais, peu après, elle entendit frapper à la porte de la loge voisine ; cette porte s’ouvrit, et elle recueillit ces paroles échangées à mi-voix :
– Monsieur Oscar de Verny ?
– C’est moi, monsieur.
– Monsieur, voudriez-vous m’accorder une minute d’entretien ?
– Volontiers, monsieur.
– Je suis le vicomte de Cambolh.
– Je le sais, monsieur, j’ai eu l’honneur de vous rencontrer chez la marquise Van-Hop, il y a huit jours.
La marquise tressaillit, et elle se prit à écouter avec une âpre curiosité.
– Monsieur, reprit M. de Cambolh avec une courtoisie parfaite, j’ai passé huit jours à chercher votre nom et votre adresse… Tout à l’heure, on vient de me donner votre nom…
– Je puis vous satisfaire, monsieur, sur le dernier point. J’habite un entresol rue de la Pépinière, 40.
À ces mots, madame Van-Hop, qui écoutait toujours, tandis que le major, placé à l’autre bout de la loge, n’entendait pas ou ne paraissait rien entendre, madame Van-Hop tressaillit encore…
– Mais, dit M. de Verny, je suis étonné, monsieur, vous en conviendrez, de la curiosité qui s’est emparée de vous.
– C’est que, probablement, répondit M. de Cambolh, j’avais un motif de vous rencontrer. Au bal, chez la marquise, j’ignorais votre nom… et je tenais à le savoir.
– Monsieur, répliqua M. de Verny avec une pointe d’ironie, seriez-vous chargé de quelque mission… secrète ?
– Nullement, monsieur. Je m’occupe uniquement de mes propres affaires, et si vous voulez bien me le permettre, je m’expliquerai clairement.
– Voyons, monsieur, je vous écoute.
– Monsieur, reprit le vicomte à mi-voix, on a joué au lansquenet chez le marquis Van-Hop.
– Je m’en souviens, monsieur.
– Le jeu était assez animé, n’est-ce pas ? Il y avait des joueurs heureux.
– Très heureux ! fit Oscar avec une pointe d’ironie dans la voix.
– Moi, par exemple, reprit le vicomte, car j’ai gagné une assez belle somme sur main que j’ai passée.
– Je m’en souviens à merveille.
– Cette main passée m’a valu une petite affaire désagréable. On m’a cherché querelle. Bref, j’ai quitté le bal pour aller me battre.
– Ah ! dit M. de Verny avec un accent que la marquise, toujours attentive, prit pour de la surprise.
– Mais j’avais pris toutes mes précautions d’avance et fait mes conditions. Mon adversaire acceptait mes épées, nous allions les prendre chez moi, et, grâce à la vitesse de mon cheval, j’avait calculé que nous aurions le temps d’aller nous battre dans la plaine de Monceau, puis que le vainqueur pourrait revenir et rentrer au bal sans que tout cela eût pris plus d’une heure.
– Vous teniez donc à danser encore ?
– Non, mais à me retrouver avec certaines personnes à qui des sourires malveillants, quelques paroles peu mesurées avaient échappé au moment où je quittais la table de jeu.
La marquise écoutait toujours, et elle était au supplice.
Évidemment, M. de Cambolh venait provoquer Oscar de Verny.
– Ainsi, continua le vicomte, j’ai cru entendre ces paroles au moment où je me retirais : « On n’a jamais vu jouer de cette façon que les gens qui font du lansquenet un métier. »
– Ah ! vous avez entendu cela ?
– Parfaitement.
– Et vous savez qui a prononcé ces paroles ?
– Oui, monsieur, c’est vous…
– Peut-être !
Et madame Van-Hop devina qu’un sourire plein de hauteur dédaigneuse avait dû accompagner ces deux mots.
– Monsieur, dit le vicomte, après l’affaire, quand je suis revenu au bal, je vous ai vainement cherché : vous étiez parti.
– Je pars toujours de bonne heure.
– Ce soir, heureusement, je vous retrouve à l’Opéra, et j’aime à croire que vous ne me refuserez pas une explication… sur ces paroles malencontreuses qui vous sont échappées.
– Monsieur le vicomte, répondit M. de Verny, j’ai un principe invariable…
– Lequel, monsieur ?
– Celui de ne jamais me repentir de mes actions ou de mes paroles en désavouant le passé.
– Ainsi vous ne rétractez rien ?
– Pas même une syllabe.
– Alors, monsieur, il ne me reste plus qu’à vous demander un dernier renseignement. En quel lieu désirez-vous recevoir mes témoins ?
– Je vous le répète, monsieur, j’habite un entresol rue de la Pépinière, 40.
– C’est que, dit le vicomte, il est déjà tard, et je désirerais en terminer dès demain matin.
– La chose est facile.
– Comment cela ?
– J’ai déjà ici un ami, monsieur que voilà, et j’ai aperçu tout à l’heure dans les couloirs le major Carden.
– Il est dans la loge à côté, dit le vicomte, la loge de madame Van-Hop.
– Ah !
– Ah !
Et, dans cette exclamation, la marquise devina une émotion subite, une inexprimable anxiété.
Elle écouta frémissante, et entendit Chérubin qui continuait ainsi :
– Je puis donner rendez-vous au major au café Cardinal, au coin de la rue Richelieu, vers minuit. Il y trouvera monsieur et vos témoins ; puis, demain à huit heures, nous pourrons nous rencontrer au Bois…
– Je dois vous prévenir d’une chose, dit le vicomte de Cambolh.
– Je vous écoute, monsieur.
– Je n’ai jamais compté faire du duel une plaisanterie ridicule ; je me bats sérieusement, et j’aime à croire que nous ne reviendrons pas tous les deux du Bois.
– Je l’espère aussi, monsieur.
La marquise, dont tout le sang affluait à son cœur, entendit de nouveau un bruit de chaises remuées, et comprit que le vicomte se retirait.
Le major profitait de l’entracte pour lorgner la salle, et paraissait ne rien entendre.
Ce que la jeune femme éprouva pendant ce court laps de temps est impossible à décrire.
Par ce qu’elle venait de souffrir, elle comprenait que l’un de ces deux hommes, qui, le lendemain, se disputeraient leur vie avec acharnement, lui inspirait une vive sympathie. Et cette sympathie avait une source mystérieuse, étrange, qu’elle ne pouvait s’expliquer encore.
Car la marquise était une de ces femmes réellement vertueuses, aux yeux desquels la chaîne du devoir paraît forgée d’anneaux indissolubles, et à qui la pensée qu’un autre amour peut remplacer l’amour légitime qui leur fut inspiré ne saurait venir que longtemps après même que cet amour aura clandestinement germé dans leur cœur, comme poussent les racines d’un jeune arbuste sous les racines d’un arbre grand et fort que l’orage renversera au premier jour.
Pendant un moment, la marquise ne chercha point à se rendre compte de ses douloureuses impressions : elle ne vit, ne comprit qu’une chose, c’est que M. de Verny, ce jeune homme si beau et si triste, allait se battre, et sans doute succomberait dans cette lutte meurtrière.
Alors, comme la femme est toujours douée d’un premier mouvement d’énergie et d’opposition, elle songea tout d’abord à empêcher cette rencontre…
Mais comment ? par quel moyen ?
Et puis, était-ce bien à elle de se mêler de la querelle de deux hommes qu’elle connaissait à peine, qui devaient lui être plus qu’indifférents ?
Et la marquise, dont la pâleur était extrême, se prit à réfléchir que dire un mot, laisser échapper un geste, c’était se compromettre à ses propres yeux, s’avouer à elle-même qu’elle aimait Chérubin.
Avouer au major Carden qu’elle avait écouté la conversation de M. de Verny et du vicomte, n’était-ce pas lui dire que Chérubin ne lui était pas indifférent ? Et le major, un homme qui savait la vie, qui avait étudié le cœur humain et les femmes, le major ne devinerait-il point ses angoisses ?
Pendant les dix minutes qui suivirent le départ du vicomte Cambolh, qui avait reparu dans sa loge, madame Van-Hop souffrit le martyre.
Mais ce fut bien autre chose encore lorsqu’elle entendit vibrer de nouveau cette voix enchanteresse et mélancolique de Chérubin, disant au jeune homme qui se trouvait dans sa loge :
– Mon ami, j’ai un aveu à vous faire et un service à vous demander. J’aime une femme, une femme qui ignore mon amour et ne l’apprendra qu’après ma mort. La vie m’est à charge, et j’accepterai le trépas comme un bienfait.
– Quelle folie ! murmura une voix que la marquise n’avait point entendue encore et qu’elle devina être celle du confident de M. de Verny.
– Aussi, continua Chérubin, j’accepte avec une sorte de joie ce combat que je pressens devoir m’être fatal.
– Oscar, vous êtes fou…
– Non, je suis las de la vie, voilà tout, car j’aime sans espoir… et celle que j’aime ignorera mon amour tant que je vivrai.
– Et si vous mourez ?
– Ah ! dit-il avec tristesse, c’est alors, ami, que votre dévouement ne me fera pas défaut, n’est-ce pas ?
– Que dois-je faire ?
– Demain, avant le combat, je vous remettrai une lettre…
Chérubin s’arrêta… La marquise se sentit défaillir.
– Eh bien, cette lettre ? interrogea l’ami.
– Cette lettre sera renfermée dans deux enveloppes : l’enveloppe extérieure sera blanche, l’enveloppe intérieure seule portera le nom du destinataire. Vous allez me jurer que, si je suis tué, vous porterez cette lettre à la petite poste, déchirerez la première enveloppe en fermant les yeux, et jetterez la lettre dans la boîte sans en regarder l’adresse.
– Je vous le jure, répondit l’ami.
– Vous le devinez, ami, murmura Chérubin, cette lettre est pour elle… Au moins, après ma mort, elle saura combien je l’aimais…
La marquise, à ces dernières paroles, se sentit défaillir. Mais en même temps un espoir lui vint.
Espoir insensé et comme les femmes en peuvent seules concevoir.
Chérubin avait songé au major pour son second témoin ; le major était son ami et en même temps l’ami de M. de Cambolh.
Or, Chérubin l’allait venir trouver sans doute, il lui exposerait sa demande, et le major ne pourrait s’empêcher de confier à la marquise ce que, hélas ! elle savait déjà… Et alors elle serait forte, elle saurait être calme, indifférente, avoir un sourire aux lèvres, et après lui avoir ainsi prouvé qu’elle ne s’intéressait pas plus à l’un qu’à l’autre des deux adversaires, elle lui ferait comprendre qu’il serait de son devoir, de son honneur même, à lui vieux soldat et arbitre en bravoure, d’arranger une affaire sans gravité aucune, et qui avait pris naissance dans son salon, à elle, marquise Van-Hop.
Et comme la marquise se promettait déjà de parler très haut en son propre nom, de faire valoir ses craintes de tout scandale, on frappa discrètement à la porte de sa loge…
Et la femme, déjà forte, eut un dernier moment de faiblesse, elle tressaillit et frissonna.
Car elle crut que c’était Chérubin.
XIX
L’attente de la marquise fut trompée. Ce ne fut point Chérubin qu’elle vit apparaître.
Chérubin n’avait point quitté sa loge. Il s’était contenté d’écrire un billet au major en arrachant une feuille de son carnet, et il avait confié son message à une ouvreuse.
La marquise, toujours fort pâle, tourna lentement la tête lorsqu’elle entendit la porte s’ouvrir.
Elle frémissait d’anxiété, croyant voir Chérubin ; elle respira en voyant entrer l’ouvreuse.
Mais elle devina sur-le-champ que c’était lui qui avait écrit le billet.
– Monsieur le major Carden ? demanda la femme.
– C’est moi, répondit le Suédois en prenant le billet.
Puis il dit à madame Van-Hop :
– Vous permettez, marquise ?
– Faites, balbutia-t-elle, s’efforçant de sourire.
Le major ouvrit le billet, le lut avec un grand calme, le froissa et le mit dans sa poche.
Puis il dit à l’ouvreuse :
– Dites au monsieur qui vous a remis ce billet que je serai exact à son rendez-vous.
L’ouvreuse sortit.
Madame Van-Hop avait pris une attitude indifférente et dissimulait l’horrible émotion qu’elle éprouvait sous son plus calme sourire.
– Ah ! major, dit-elle d’un ton léger et un peu railleur, je vous y prends.
Et elle le menaçait de son doigt rose.
– À quoi, marquise ?
– Vous osez recevoir des poulets en plein Opéra, dans ma loge, en ma présence ?
– Ce n’est point un poulet, marquise.
– Oh ! fit-elle, espérant que le major lui avouerait ce qu’elle savait si bien déjà, je vous connais… Mon mari m’a fait des confidences…
– Hélas ! madame, il n’en est rien. Voyez plutôt mes cheveux gris.
Et il ajouta d’un ton confidentiel :
– Je suis, ce soir, d’un souper de garçons…
– Ah ! fit la marquise avec un accent impossible à noter ; car elle comprit sur-le-champ que le major serait discret et ne lui dirait rien de la rencontre du lendemain.
– On m’attend à minuit à la Maison-d’Or, acheva le major.
Madame Van-Hop crut qu’elle allait mourir. Elle ne saurait rien… ou plutôt elle ne devrait pas savoir… et, par conséquent, elle ne pourrait donner un conseil… plaider la cause de l’humanité… demander en son propre nom, et pour le respect dû à sa maison, que cette malheureuse affaire s’arrangeât…
C’était un supplice de damné.
Pendant une heure encore, la marquise espéra que le major finirait par se départir de son mutisme, et elle eut l’atroce courage de caqueter avec lui, de lui sourire, d’effleurer mille sujets de conversation touchant au duel de près ou de loin.
Le major ne parut pas comprendre.
Elle alla jusqu’à lui dire :
– Voilà M. de Cambolh revenu dans sa loge… Où donc était-il allé ?
– Au foyer, sans doute.
– Vraiment ! poursuivit-elle, ce charmant jeune homme est querelleur ?
– Hélas ! oui…
Elle espéra qu’il se laisserait aller à lui dire que, précisément, le vicomte venait encore de se faire une querelle… que lui, major, serait témoin dans cette affaire.
Mais le major fut impassible.
Alors madame Van-Hop sentit qu’elle perdait la tête, et un moment elle eut la pensée de tout avouer au major, et de lui dire qu’elle avait entendu la conversation du vicomte et de M. de Verny.
Mais comme elle hésitait encore et soutenait une dernière lutte avec sa dignité de femme, un homme entra dans sa loge.
Il n’était plus temps ; cet homme, c’était le marquis.
M. Van-Hop était radieux.
Lui, ordinairement froid, un peu triste, sobre de paroles, était souriant et gai…
Il avait gagné la partie d’échecs !
Et comme si, à l’heure où un vague danger menace un mari, un voile descendait sur ses yeux, le marquis, habituellement jaloux et défiant, ne s’aperçut point de l’extrême pâleur et de l’agitation nerveuse de sa femme, qui lui répondait par monosyllabes et avec une sorte d’impatience.
Le marquis écouta le quatrième acte avec ce recueillement profond des vrais dilettantes, et la marquise ne vit et n’entendit qu’une chose…
Ou plutôt, horrible vision ! elle crut voir et entendre deux lames d’épée se croisant et s’entrechoquant.
– Major, dit la marquise avec une voix altérée, tandis que le quatrième acte finissait, n’oubliez pas votre rendez-vous…
– Ah ! dit M. Van-Hop en regardant le major avec un sourire, vous avez un rendez-vous, heureux coquin ?
– Oh ! un souper de garçons…
– Sans femmes ? demanda tout bas le marquis.
– Sans femmes, parole d’honneur !
– Eh bien, allez, dit la marquise.
– J’ai le temps, madame, on se met à table à minuit.
– Bah ! fit-elle avec un sourire contraint, je vous dégage de vos devoirs de chevalier… n’ai-je point mon mari !
Et elle regarda cet homme qu’elle aimait depuis quinze ans, à qui l’unissait une chaîne indissoluble, dont l’amour devait lui servir d’égide.
On eût dit que ce pauvre cœur troublé cherchait à se sentir à lui-même.
Le major se leva et prit congé.
– Ah ! dit-elle en le voyant partir, un mot, mon ami, un seul.
– Je vous écoute, madame.
– Votre souper réunit-il beaucoup de jeunes gens ?
– Quelques-uns.
– Le vicomte en est-il ? Ce vicomte… de… Comment le nommez-vous ? J’oublie toujours ce nom…
Et la sublime femme avait le courage de mentir en demandant un nom qui flamboyait déjà dans sa mémoire, comme le mane, thecel, pharès, sur les murs de la salle où le roi Balthazar donnait son festin.
– Le vicomte de Cambolh, dit le major.
– Ce querelleur…
– Précisément.
– Eh bien, faites-moi une promesse.
– Volontiers.
– Si le vicomte cherche querelle à quelqu’un… C’est si affreux, ce vilain… duel !…
Elle prononçait ces mots avec une indicible émotion, et cependant le marquis ne devina rien.
– S’il cherche querelle à quelqu’un, continua-t-elle, tâchez de vous interposer… n’est-ce pas ?
Et elle avait une voix suppliante qui eût suffi à trahir le secret de son cœur.
Le major se reprit à sourire.
– Soyez tranquille, madame, dit-il ; les soupers de garçons dont je suis se passent tranquillement.
Et s’il s’en alla, laissant la marquise en proie à d’horribles alternatives de terreur et d’espoir.
M. Van-Hop reconduisit sa femme. Ce ne fut qu’à l’hôtel qu’il remarqua sa pâleur et son agitation.
– Qu’avez-vous, ma chère âme ? lui demanda-t-il.
– Rien… un peu de migraine… voilà tout.
– Je vais me retirer, en ce cas, dit-il.
Et il lui baisa la main et rentra dans son appartement.
La marquise renvoya ses femmes, et prétendit qu’elle se déshabillerait elle-même.
La pauvre femme avait besoin de solitude et de silence.
Pour la première fois, depuis huit jours, la marquise avait jeté un regard clair, investigateur au fond de son âme, et elle détournait sa tête épouvantée.
Sa vie calme, chaste et pure, ne se prenait-elle pas tout à coup à subir l’influence néfaste d’un élément nouveau, étranger, jeté brusquement dans sa vie ?
Longtemps courbée sous cette pensée désolante, cherchant à se réfugier, avec l’opiniâtre volonté de ceux qui se noient et ne veulent pas mourir, dans ses pieux souvenirs de jeunesse et d’amour, se cramponnant à l’image, hier adorée, de son mari, et qui, naguère, emplissait et absorbait son cœur tout entier, la marquise demeura plusieurs heures la tête dans ses mains, frissonnante, éperdue, et croyant toujours entendre ce cliquetis d’épées, qui bourdonnait par avance dans sa tête affolée.
De sa chambre à coucher on gagnait une terrasse qui communiquait au jardin par une dizaine de marches s’échappant des deux côtés d’un large perron.
La marquise y descendit.
Elle avait besoin d’air, elle étouffait… Elle se promena longtemps d’un pas inégal, saccadé, la mort au cœur, le cerveau en proie aux premiers symptômes de la folie.
Car ce n’était point seulement le danger terrible qu’allait courir cet homme, vers lequel une force mystérieuse, inconnue, l’attirait, qui la bouleversait ainsi.
Elle était encore en proie aux angoisses de la femme jusque-là pure comme un lis, habituée à porter la tête haute, et qui voit tout à coup un abîme s’entrouvrir sous ses pieds…
Elle l’avait pressenti, deviné, compris aux terreurs folles de son âme… elle aimait M. de Verny, cet homme que le quartier Bréda avait surnommé Chérubin, dans le cœur de qui, la naïve et la sainte, elle croyait avoir allumé une de ces passions terribles qui font prendre la vie en dégoût…
Et cet homme, sans doute, irait au combat, résigné à mourir ; il se ferait tuer, ne pouvant vivre pour elle.
En songeant à cette affreuse alternative, la marquise oubliait tout pour ne songer qu’à lui.
Mais que pouvait-elle ?
Quitterait-elle furtivement son hôtel, pour courir chez le major Carden tout lui avouer ?
Non…
Irait-elle même, au milieu de la nuit, comme une femme perdue, comme une coureuse de rues, chez cet homme qu’elle connaissait à peine, et que cependant elle aimait déjà, pour lui dire : « Je vous défends de vous battre ?… »
C’était impossible, elle n’y songea même pas.
Elle rentra dans sa chambre, s’agenouilla devant un christ d’ivoire appendu au chevet de son lit, et elle se contenta de prier pour celui que le destin était venu placer sur l’honnête chemin de sa vie.
Elle pria longtemps.
Le jour vint.
Un jour sombre et triste, une de ces matinées d’hiver qui semblent ne peser sur Paris qu’à ces heures solennelles et lugubres où les employés de l’octroi voient sortir de la grande ville deux voitures qui se suivent et conduisent au bois de Boulogne deux hommes qui vont jouer leur vie sur le muet échiquier du destin.
Alors, à partir de ce moment et comme huit heures sonnaient à la pendule de son boudoir, la femme, résignée et calmée par la prière, redevint la proie de mortelles angoisses.
Une horrible illusion s’empara d’elle.
La tête dans les mains, les yeux fermés, il lui sembla qu’elle assistait au combat, qu’elle voyait les deux adversaires dépouillés de leurs habits, la chemise au vent, gorge nue, mettre l’épée à la main et croiser, en même temps, le fer et le regard.
Et, chose étrange ! puissance merveilleuse de l’imagination, elle les voyait réellement, elle assistait au combat dans tous ses poignants détails, elle entendait le froissement du fer battant le fer, puis tout à coup l’un des deux champions rompait brusquement, jetait un cri et tombait mortellement atteint. Et celui-là, c’était lui !
Ce mirage de la pensée, qu’on nous passe le mot, avait été si complet, que la marquise avait cru voir et entendre, et que, du fond de sa chambre, rêvant tout éveillée, elle avait entendu le cri du blessé résonner au fond de son cœur…
Et elle s’affaissa sur elle-même, évanouie, brisée, sans avoir eu la force d’appeler du secours.
Madame Van-Hop se couchait fort tard d’ordinaire ; elle se levait, par conséquent, vers onze heures ou midi, et, habituellement, ses femmes de chambre ne pénétraient chez elle qu’à son coup de sonnette.
Ce ne fut donc que vers onze heures que, revenant à elle, la pauvre femme se retrouva étendue de son long sur le parquet et dans un isolement absolu…
Elle avait entendu la cloche de l’hôtel qui prévenait de l’arrivée d’un étranger, et ce bruit l’avait tirée de sa léthargie.
Aussi, se lever, passer la main sur son front, se souvenir, fut pour elle l’histoire d’une seconde.
Elle courut à la croisée de son boudoir, qui donnait sur la cour, et regarda.
N’était-ce point cette lettre fatale qu’elle redoutait… que l’ami inconnu devait mettre à la poste pour la femme aimée ?
Et comme elle se penchait en dehors, avide et frémissante, elle aperçut le chapeau ciré et l’habit à parements écarlates du facteur.
Semblable à la femme de Loth, changée subitement en statue de sel, la marquise demeura immobile, pétrifiée, sans voix, sans haleine…
Quelques minutes passèrent, et ces minutes eurent pour elle la durée de plusieurs siècles…
Enfin, la porte s’ouvrit, un laquais entra, remit la lettre apportée par le facteur.
Et la marquise ouvrit cette lettre, employant à cette action son reste de force et de courage.
Ô bonheur !
Cette lettre n’était pas de lui…
C’était une écriture de femme, l’écriture de madame Malassis.
Et la marquise respira, elle se sentit revenir à la vie, et ses yeux évanouis par les larmes parcoururent avidement cette lettre, comme si, tant il y a de folles pensées dans une tête en proie au mal d’amour, comme si la veuve, qui habitait comme lui le n° 40 de la rue de la Pépinière, allait lui apprendre l’issue de ce combat qui avait dû avoir lieu le matin.
Madame Malassis disait :
« Chère marquise.
« Voici huit grands jours que je ne vous ai pas vue, et je vous appelle comme une âme sœur de mon âme. J’ai eu des ennuis, de vrais chagrins, j’ai besoin de vous ouvrir un peu mon cœur.
« Venez, je vous en prie, car je me suis juré de ne point sortir aujourd’hui.
« Je vous dirai pourquoi.
« Veuve Malassis. »
Cette lettre n’était-elle point pour la marquise comme un prétexte que la Providence indulgente venait lui fournir de savoir l’issue heureuse ou funeste de la rencontre du matin ?
La marquise jeta un cri de joie, et à demi folle de terreur et d’espoir, elle oublia qu’elle était encore en robe de soirée, s’enveloppa dans un grand châle, demanda son coupé et descendit précipitamment.
Le marquis était sorti à cheval le matin, pour une promenade au bois de Boulogne.
– Rue de la Pépinière, 40, dit la marquise au valet de pied en se jetant dans la voiture.
Peu après, la marquise s’arrêtait à la porte de cette maison dont le pavillon du fond était occupé par madame Malassis.
Jamais, en allant voir la veuve, ce qui, du reste, arrivait fort rarement, la marquise n’avait examiné ni l’entrée de la maison, ni l’escalier, ni le concierge.
Elle passait toujours rapidement, traversait le jardin et gagnait le pavillon.
Eh bien, cette fois, elle jeta sur tout cela un regard pénétrant, inquisiteur, qui sembla vouloir interroger les murs et les visages, et leur demander leur secret.
Était-il revenu sain et sauf ?
L’avait-on rapporté mort ou blessé ?
Hélas ! concierge impassible, corridor à peu près désert, maison silencieuse, escalier muet, gardèrent leur secret.
La marquise arriva chez madame Malassis et fut introduite par Venture, ce valet-intendant, au visage repoussant et dur, qui, depuis quelques jours, semblait avoir pris un ascendant mystérieux sur sa nouvelle maîtresse.
Venture, en grande livrée d’apparat, conduisit la marquise au premier étage du pavillon.
La veuve de trente-six ans, la belle madame Malassis, protégée par un demi-jour habilement ménagé par d’épais rideaux, était assise au coin de son feu, pelotonnée au fond d’une moelleuse bergère, dans l’attitude pleine de langueur d’une femme qui a la migraine et des vapeurs.
– Ah ! chère, dit-elle en voyant entrer la marquise, vous êtes bonne et charmante.
Et elle se leva avec une nuance d’infériorité respectueuse et courut à la marquise.
– Mon Dieu ! dit-elle en la regardant, souffririez-vous aussi vous ?… Vos yeux sont abattus… vous êtes pâle… Qu’avez-vous au nom du ciel ?
– Rien, rien, murmura la marquise… J’ai mal dormi… voilà tout.
– Je vous en offre autant, chère belle, soupira la veuve… Ah ! si vous saviez…
La marquise eut un affreux tressaillement ; mais cependant elle eut le courage de ne point interroger.
– Figurez-vous, reprit madame Malassis en entraînant la jeune femme et en la faisant asseoir auprès d’elle sur la bergère, figurez-vous que j’ai tant d’ennuis et de chagrins depuis quelques jours, que je ne dors plus. La nuit dernière, j’ai entendu sonner cinq heures avant d’avoir fermé l’œil… Enfin, je m’étais assoupie depuis quelques heures, lorsque des cris, du bruit, des pas résonnant dans le jardin…
La marquise fut prise d’un tremblement nerveux… et elle attacha sur son interlocutrice un regard effaré…
– Ah ! l’affreux événement, reprit la veuve… C’est épouvantable !…
– Mon Dieu ! balbutia la marquise d’une voix affolée et qui aurait dû étonner la veuve au dernier point, qu’est-il donc arrivé ?
– Un horrible malheur ! répondit madame Malassis, un pauvre jeune homme qui habitait cette maison…
– Eh bien… achevez… demanda la marquise d’une voix mourante.
– Il s’est battu ce matin en duel… au bois de Boulogne… On l’a rapporté presque mort.
La marquise jeta un cri et tomba à la renverse sur le parquet.
Le secret de son cœur venait de lui échapper ; désormais elle avait une confidente.
Madame Malassis courut à une sonnette et l’agita.
Au bruit, la porte s’ouvrit, Venture apparut.
– Ah ! ah ! dit-il en échangeant un regard d’intelligence avec la veuve, je crois que nous tenons la petite dame…
Madame Malassis était-elle donc déjà la complice et l’instrument passif de la redoutable association des Valets-de-Cœur, et l’infernal génie de sir Williams allait-il donc triompher encore ?
C’est ce que nous allons vous dire.
XX
Le vice a d’impénétrables mystères.
Ceux qui ont une fois mis les pieds sur cette pente irrésistible descendent toujours, quoi qu’ils fassent pour remonter.
La femme qui a abandonné une fois l’austère chemin du devoir, cette voie ardue où il est besoin de marcher d’un pied ferme, parvient quelquefois à y rentrer, mais la moindre pierre d’achoppement, le moindre obstacle suffit pour la faire retomber au plus profond du précipice.
Ces quelques réflexions nous étaient nécessaires pour expliquer l’étrange conduite de madame Malassis, et on nous permettra d’esquisser en quelques lignes la biographie de cette femme.
Madame Malassis était, à quinze ans, première demoiselle dans une importante maison de modes de la rue de la Paix.
À seize ans, elle abandonna brusquement cette position pour suivre un vieux débauché veuf, riche, sans enfant, qui remplaça son châle de tartan par un cachemire, et les fleurs de sa coiffure par des branches de corail.
De dix-huit à vingt-trois ans, l’existence de la jeune femme fut livrée à tous les hasards de la vie des pécheresses.
Un adorateur splendide la trouva, un soir, aux prises avec la nécessité la plus âpre, et, prévoyant sans doute que la folle créature ne songerait jamais à l’avenir si l’on n’y songeait pour elle, il lui acheta un fonds de parfumerie sur le boulevard des Italiens.
Là, madame Malassis, qui, par hasard, avait de l’ordre, prit sa situation au sérieux et acquit bientôt cette âpreté au gain, cette économie sévère et bien entendue qui mène les commerçants à la fortune.
Un ancien commis voyageur, un homme qui touchait à la cinquantaine, ne s’effaroucha point du passé un peu leste de la parfumeuse, lui offrit sa main et fut agréé. Comme César Birotteau, le héros immortel de M. de Balzac, M. Malassis était prédestiné aux grandeurs humaines.
Sept ou huit ans lui suffirent pour amasser deux cent mille francs. Il devint adjoint au maire de son arrondissement, membre d’une foule d’institutions philanthropiques, et il produisit dans le monde officiel d’abord, puis dans celui de la finance, et presque dans le faubourg Saint-Honoré, la petite modiste de chez Fanny, l’ancienne femme galante à demi réhabilitée par le mariage. Quand M. Malassis mourut, – et il mourut d’une indigestion à la suite d’un copieux souper fait au Rocher-de-Cancale, – sa femme avait été adoptée par le monde, qui ignorait toute une partie de ses antécédents.
Mais, nous l’avons dit, le vice ne pardonne point… Madame Malassis avait habilement dissimulé ses instincts pervers, et cependant, M. Malassis avait été, disait-on tout bas, bien souvent trahi.
Son mari mort, la veuve rencontra le vieux duc de Château-Mailly.
Elle avait alors trente-cinq ans, l’âge de l’ambition. Elle entrevit un avenir superbe, elle rêva de couvrir et d’éclipser à jamais les fanges de son passé par les perles éclatantes d’une couronne ducale. Pendant deux années, la vieille courtisane prit au sérieux son rôle de femme austère ; elle fut dame patronnesse, elle vit le meilleur monde, se lia intimement avec la marquise Van-Hop, et sut inspirer au vieux duc une irrésistible passion…
On eût pu croire qu’elle avait à jamais reconquis et gravi les sommets ardus de la vertu…
Illusion !
Le jour où elle rencontra ce petit jeune homme au lorgnon d’écaille, aux cheveux bouclés, au minois vulgaire et séduisant, à l’aplomb des fils de famille qui passent, gantés de jaune serin, leur vie sur le boulevard des Italiens, madame Malassis sentit le passé la reprendre dans ses mains crochues et puissantes, et l’abîme se rouvrir sous ses pieds.
Elle était née courtisane, elle devait l’être jusqu’au jour où l’aveugle duc de Château-Mailly la conduirait à l’autel.
La veuve avait trente-six ans, l’âge des passions volcaniques chez la femme ; elle commençait à paraître son âge, on le chuchotait dans le monde à ses oreilles. Le vieux duc ne s’en apercevait point.
Mais le duc était septuagénaire.
Et peut-être que la voix mystérieuse du cœur s’éveillait enfin chez cette femme, dont la vie n’avait été qu’un long calcul.
Elle avait trouvé sur la route, une nuit, un jeune homme de vingt ans, lancé comme une bombe par l’invisible main de sir Williams ; ce jeune homme lui avait parlé le vulgaire et chaleureux langage de la passion, et la femme, qui tant de fois avait cédé, avait été vaincue encore.
Pendant quelques heures, cet esprit fort, calculateur, ce chiffre devenu femme, avait tout oublié… On lui avait parlé d’amour, à elle qui n’entendait plus ce langage sortit de deux lèvres jeunes et fraîches, et elle avait écouté.
Mais la folie a ses heures, rien de plus !
Madame Malassis voulait bien aimer encore, mais elle voulait aussi épouser le duc.
Aussi, à partir de ce jour, divisa-t-elle habilement son temps.
Rentrée chez elle bien avant la nuit, toujours prête à y recevoir M. de Château-Mailly si un caprice jaloux venait à l’y conduire, elle sortait chaque jour, vers deux heures. Où allait-elle ?
En femme prudente, madame Malassis n’avait pas cru devoir mettre sa femme de chambre ni aucun de ses gens dans le secret de son nouvel amour…
Elle sortait de chez elle en voiture, dans un fiacre la plupart du temps, remontait la rue de la Pépinière, prenait la rue Saint-Lazare, qu’elle suivait dans toute sa longueur, entrait dans l’église Notre-Dame-de-Lorette par la grande porte, y séjournait environ dix minutes, et sortait par la rue Fléchier.
Là se perdaient les traces de madame Malassis. Allait-elle soulager une infortune ? Allait-elle à quelque mystérieux rendez-vous ?
Elle entrait dans une maison de la rue Fléchier, passait comme une ombre devant la loge du portier, montait lestement un escalier, son voile baissé… Une porte s’ouvrait et se refermait… c’était tout…
Quelquefois, une heure et même deux s’écoulaient avant qu’elle ressortît. La veuve traversait de nouveau l’église, regagnait son fiacre et rentrait furtivement rue de la Pépinière.
Il y avait huit jours que cela durait, lorsqu’un soir, vers trois heures, au moment où, redescendant de la rue Fléchier, elle s’apprêtait à retraverser la rue, madame Malassis s’arrêta et recula tout à coup, comme si elle avait vu se dresser devant elle un reptile armé d’un triple dard.
Venture se promenait de long en large sur le trottoir, les mains dans ses poches, un charmant sourire aux lèvres, sifflotant un petit air grivois.
Espérant encore n’être point reconnue, la veuve allait passer outre…
Mais Venture se plaça résolument devant elle, et lui dit :
– Bonjour, madame.
Il donna à ce dernier mot cette inflexion respectueuse et particulière aux domestiques parlant à leur maîtresse.
Et comme madame Malassis demeurait stupéfaite et toute bouleversée, il répéta :
– Bonjour, madame.
Toute troublée encore, mais prête à reconquérir son sang-froid, la veuve prit un air sévère et le regardant fixement.
– Que faites-vous ici, maître Venture ? dit-elle.
– Je me promène, madame.
– Je ne vous ai point pris à mon service pour cela.
Le laquais baissa la tête, balbutia quelques mots d’excuse et se tut.
– Cherchez-moi une voiture, dit-elle, et payez-la. Je viens de vider ma bourse chez de pauvres gens qui meurent de faim.
Venture ne se le fit pas répéter ; il se hâta d’obéir, et madame Malassis rentra chez elle en se disant :
– Voilà un homme que je vais me hâter de congédier.
Le soir, en effet, après son dîner, elle sonna, et Venture parut.
La veuve était dans sa chambre à coucher, au coin du feu, toute seule.
Venture salua et se tint debout, sa casquette galonnée à la main.
– Que faisiez-vous ce matin, rue Fléchier ? lui dit-elle d’un ton sec.
– J’attendais madame.
– Vous m’attendiez !… fit-elle en tressaillant.
– J’avais suivi madame depuis la maison…
Un éclair de colère brilla dans les yeux de madame Malassis.
– Et de quel droit ? demanda-t-elle d’une voix irritée.
– J’espionnais madame, répondit-il avec un calme plein de cynisme.
Les lèvres de la veuve blanchirent. Une telle insolence dépassait toutes les bornes.
– Maître Venture, dit madame Malassis, je crois que je vais être obligée de vous faire admettre à Charenton ; car, Dieu me pardonne ! vous devenez fou.
Venture ne répondit point.
Seulement, il remit impudemment sa casquette sur sa tête et s’assit sans façon dans un fauteuil roulé près du feu, vis-à-vis de celui de la veuve.
– Si madame voulait bien causer une minute avec moi, dit-il, elle verrait bien que non seulement je ne suis pas fou, mais que, bien plus, elle a peut-être besoin de moi.
Le regard tranquille, le ton assuré et plein d’arrogance de cet homme, qui, le matin même, était le plus respectueux des valets, bouleversèrent si complètement la veuve, qu’elle s’imagina faire un mauvais rêve.
Cependant, il y avait dans le geste, dans l’attitude, dans le regard de cet homme, une sorte de fascination qui imposa si fort à madame Malassis, qu’elle n’eut ni la force de le chasser d’un signe impérieux de la main, ni de courir à un cordon de sonnette pour appeler sa femme de chambre.
Venture s’assit donc en face d’elle et lui dit :
– Il ne faut jamais se fâcher, madame, avant d’avoir entendu les gens. C’est toujours une chose pénible de casser les vitres sans profit, et la chose devient même parfois dangereuse…
La veuve, stupéfaite, l’écoutait.
– Madame, reprit Venture, veuillez oublier un moment que je porte la livrée et suis à votre service, et écoutez-moi comme on écoute un ami.
Elle fit un geste de répulsion, presque de dégoût.
Il eut un hideux sourire et continua :
– Jouons cartes sur table, madame. Vous allez épouser sous trois semaines, M. le duc de Château-Mailly, un homme fort riche et portant un des plus vieux noms de la noblesse du royaume ; mais il faut si peu de chose pour rompre un mariage ! Quelquefois trois semaines peuvent avoir la durée d’un siècle. Ainsi, par exemple, supposons que M. le duc se soit trouvé comme moi, ce soir, sur le trottoir de la rue Fléchier…
Madame Malassis frissonna et regarda Venture d’un air effaré.
– Ne croyez-vous pas, continua effrontément le laquais, que M. le duc demanderait à réfléchir avant de vous épouser, s’il savait que vous allez chaque jour rue Fléchier, n° 4, que vous montez au premier et sonnez à la porte à droite de l’escalier ? Dispensez-moi de vous dire le reste…
Et Venture regarda insolemment la veuve.
Madame Malassis attacha sur lui des yeux pleins de courroux et de haine.
– Vous êtes un misérable ! dit-elle, et je devine ce que vous voulez…
Alors elle se leva et alla ouvrir le tiroir d’un petit meuble de Boule, dont elle retira un portefeuille.
– Combien vous faut-il ? demanda-t-elle avec dédain.
Venture haussa les épaules.
– Vous allez trop vite en besogne, madame, dit-il ; avant d’acheter, il faut savoir ce qu’on achète. Avant de me demander ce que je veux obtenir pour prix de mon silence, apprenez au moins dans quelle mesure je peux vous desservir, si bon me semble… Chère madame, reprit-il, vous êtes ce qu’on nomme une femme prudente ; c’est-à-dire que vous n’écrivez jamais, et, par conséquent, vous pourriez nier devant le duc, lui affirmer que je mens, que vous ne connaissez point M. Arthur, qu’enfin vous ignorez tout ce que je veux dire.
– Je l’ignore en effet, dit madame Malassis, qui retrouva une sorte d’aplomb et d’indulgence au plus fort de cette situation désespérée.
– Soit, ricana le laquais. Seulement, vous ne me ferez pas l’injure de croire, madame, que je mets mon vin en bouteilles avant sa fermentation, c’est-à-dire que je m’embarque dans une affaire sans avoir pris mes précautions.
– Après ? dit-elle froidement.
– Le duc est amoureux, par conséquent il est aveugle. À la rigueur, il pourrait vous croire innocente et victime d’un odieux laquais, si je ne lui apportais que des indices. Heureusement, j’ai un dossier…
À ce mot de dossier, madame Malassis eut le frisson.
– Madame, reprit Venture, vous n’avez pas toujours eu trente-six ans ; vous avez été jeune, inconsidérée, légère… Vous avez écrit… et beaucoup, et à bien des gens…
Et comme elle le regardait avec terreur, cet homme, qui lui parut être un démon vomi par l’enfer, se prit à lui raconter froidement, année par année, et presque jour par jour, son existence à elle madame Malassis, depuis l’heure où elle était sortie de la maison de modes de la rue de la Paix, jusqu’à celui où elle l’écoutait, l’angoisse au cœur et la sueur au front.
Un avocat général fulminant un réquisitoire contre un criminel, et fouillant sa vie passée jusque dans ses replis les plus obscurs, eût été moins instruit, peut-être, que ne se montra Venture, en racontant sa propre vie à madame Malassis.
Il n’oublia aucun détail, aucune intrigue, corroborant chaque fait d’un nom, d’une date, d’un numéro de rue, relatant chaque lettre tombée, on ne pouvait deviner comment, entre ses mains.
C’était à épouvanter le plus hardi des forçats. Pendant quelques minutes, madame Malassis l’écouta en silence et comme atterrée.
– Vous voyez bien, madame, dit Venture, que je puis bien des choses, et que de moi seul dépend votre mariage avec M. le duc de Château-Mailly.
Elle courba la tête, et deux larmes jaillirent de ses yeux.
– Combien vous faut-il ? murmura-t-elle enfin.
– Ah ! dit-il en souriant, vous n’êtes pas assez riche.
– Je le deviendrai.
– Non, je ne veux pas d’argent.
Et cet homme, que tout à l’heure elle voulait chasser, la dominait alors complètement, arrêta sur elle un regard calme, assuré, dominateur, et reprit :
– Madame, vous auriez tort de croire que vous êtes simplement en mon pouvoir. Je suis tout et ne suis rien à la fois. Vous êtes au pouvoir d’une association immense, puissante, et dont je ne suis que l’humble mandataire.
Et comme elle continuait à le regarder avec terreur :
– Ce n’est pas au prix de quelques chiffons de mille francs que l’association mystérieuse que je représente vous vendra jamais la couronne ducale de Château-Mailly, c’est au prix de vous-même, de votre dévouement, de votre liberté… Voyez, réfléchissez…
Et Venture se leva ; puis il reprit l’attitude humble, respectueuse, servile, d’un domestique prêt à exécuter les ordres de sa maîtresse.
– Quand madame aura réfléchi, dit-il, elle sonnera. Je dois lui dire qu’elle n’a qu’à choisir : ou voir, ce soir même le dossier dont j’ai eu l’honneur de lui parler dans les mains de M. le duc de Château-Mailly, et se résigner, par conséquent, à la rupture de son mariage… ou entrer franchement, résolument les yeux fermés, dans une association qui, après tout, ne désire que son bonheur, en échange de quelques légers services.
Et Venture sortit.
Pendant une heure, madame Malassis demeura courbée sous le poids de ses iniquités passées, se demandant comment un infernal génie avait pu reconstituer ainsi toute sa vie pour s’en faire une arme terrible ; puis elle chercha à deviner ce qu’on attendait, ce qu’on pouvait attendre d’elle…
Et puis, nous l’avons dit déjà, comme elle touchait à l’âge de l’ambition, à cet âge mûr où certaines femmes deviennent impitoyables et se résolvent à fouler le monde sous leurs pieds, si ce peut être une action utile à leur égoïsme, elle sonna et dit à Venture, qui se représenta :
– Parlez… Je suis prête à vous écouter… à vous… obéir…
Et la femme altière baissa la tête et s’humilia devant ce laquais.
Que se passa-t-il alors entre elle et lui ? Nul ne le sait.
Mais, dès le lendemain, le sourire était revenu aux lèvres de la belle veuve, son regard était calme ; elle était sûre, désormais, d’épouser le duc de Château-Mailly, et Venture était redevenu le plus respectueux des intendants.
Chaque jour, madame Malassis sortait comme à l’ordinaire et s’en allait rue Fléchier.
Quelquefois même, son intendant portait à M. Arthur un petit billet ambré, écrit de la belle main de sa maîtresse.
Les choses en étaient là lorsque la marquise Van-Hop, sur une traîtresse indication de madame Malassis, était accourue chez elle, y avait appris vaguement que M. de Verny avait été gravement blessé le matin, et s’était évanouie sous le coup de cette foudroyante nouvelle.
La marquise évanouie, la veuve sonna ; Venture accourut et aida sa maîtresse à porter madame Van-Hop sur un sofa.
Alors madame Malassis lui fit respirer des sels, lui prodigua mille soins, et, au moment où elle rouvrait les yeux, elle congédia Venture, qui s’esquiva sans bruit.
– Ah ! murmura la marquise en promenant autour d’elle un regard étonné, que s’est-il passé, mon Dieu ?
– Rien, chère amie, absolument rien, répondit madame Malassis. Vous vous êtes trouvée mal… une syncope, voilà tout.
Et comme la marquise, horriblement pâle, se souvenait et se sentait étreindre par une angoisse indicible, madame Malassis se hâta d’ajouter :
– Rassurez-vous, du reste, dit-elle, rassurez-vous, ma bonne, ma chère marquise, sa blessure n’est point mortelle… on le sauvera.
Madame Van-Hop jeta un cri… un cri de joie imprudente et folle.
Et puis, tout à coup, elle s’aperçut qu’elle avait livré son secret ; elle devina que déjà une autre âme que la sienne avait deviné les tortures inouïes de son âme ; et la pure et chaste femme, l’innocente victime des trahisons du hasard et de l’infernale malice des hommes, se prit à rougir et à balbutier.
Elle courba le front comme un criminel qui fait l’aveu de son forfait, et, dans un premier élan de douleur, elle murmura :
– Mon Dieu ! mon Dieu ! je suis perdue !
Mais alors aussi madame Malassis, qui sans doute avait prévu ce désespoir, cette honte anticipée de la femme vertueuse qui croit être déjà coupable ; madame Malassis, qui avait étudié consciencieusement ce rôle, s’agenouilla devant elle, prit ses deux mains dans les siennes, la regarda avec une indicible expression d’indulgence et de dévouement, disant :
– Je n’étais que votre amie, voulez-vous que je sois votre sœur ?
La marquise ne répondit pas, mais elle pressa convulsivement les mains de la veuve, et, dans cette étreinte, celle-ci devina que la créole altière, la femme sans reproche et qui pouvait marcher le front levé, avait désormais le cœur troublé. Le gouffre s’était entrouvert.
XXI
L’histoire que nous racontons est multiple.
Elle renferme un grand nombre de personnages et se compose d’événements si divers, que nous sommes obligés de quitter tour à tour chacun de nos héros.
Abandonnons donc un moment la marquise Van-Hop, madame Malassis et les combinaisons machiavéliques de sir Williams, pour revoir une des héroïnes de notre dernier épisode, mademoiselle Hermine de Beaupréau, devenue madame Fernand Rocher.
On s’en souvient, Fernand avait laissé sa femme au bal, sous la garde de son beau-père, M. de Beaupréau, et il était sorti pour aller se battre avec le vicomte de Cambolh.
On sait ce qui lui advint pendant les huit jours qui suivirent.
Quant à madame Rocher, elle était entrée chez elle, rue d’Isly, vers quatre ou cinq heures du matin, persuadée qu’elle avait été devancée par son mari.
Hermine se trompait.
Ses gens lui apprirent que Fernand n’avait point paru à l’hôtel.
Mais, en quittant sa femme, M. Rocher n’avait-il pas dit qu’il était question d’une bonne œuvre ?
Ceci rassura pleinement la jeune femme, et, un peu fatiguée du bal, elle se mit au lit et ne tarda point à s’endormir.
Quand il fit jour chez elle, lorsque sa femme de chambre entra, le lendemain vers midi, Hermine se retrouva seule et pensa d’abord que son mari n’avait point voulu l’éveiller et avait couché dans son appartement particulier.
La femme de chambre, interrogée, répondit que monsieur n’était point rentré.
Hermine se leva en hâte, et, inquiète de cette disparition, elle courut chez son père.
– Mon père, lui dit-elle, Fernand vous a-t-il dit où il allait, hier au soir ?
– Oui, répondit le Beaupréau avec ce sourire bonhomme qui trahissait chez lui un commencement d’idiotisme.
– Où allait-il ?
– Faire une bonne action.
– À Paris ?
– Non, hors de Paris.
Depuis quatre années qu’ils étaient unis, c’était la première fois que Fernand passait la nuit hors du domicile conjugal. C’était étrange.
La journée s’écoula pour madame Rocher dans une inexprimable angoisse.
Le soir vint, Fernand ne parut pas. Alors la jeune femme commença à se livrer aux plus noirs pressentiments.
Et tout à coup elle se souvint…
Elle se souvint que son mari avait quitté ce bal de la marquise en compagnie de deux ou trois hommes, et soudain le mot de duel sembla résonner à ses oreilles :
– Mon Dieu ! dit-elle à sa mère, Fernand s’est battu… on me l’a tué, peut-être… Mon Dieu ! mon Dieu !
Madame de Beaupréau, la sainte femme, l’âme forte, tout en partageant les inquiétudes de sa fille, repoussa d’abord cette pensée que Fernand avait quitté le bal pour aller se battre.
D’abord, Fernand était un homme doux, inoffensif, toujours prêt à s’effacer.
Ensuite, il était peu probable que, chez la marquise Van-Hop, dans le meilleur monde, un homme raisonnable comme l’était Fernand pût avoir une querelle.
Puis, en admettant cette dernière hypothèse, était-ce bien à deux heures du matin que pouvait avoir lieu une rencontre ? Enfin, au cas où cette rencontre aurait eu lieu, Fernand ne serait-il pas revenu mort ou vif chez lui ?
Un homme tué en duel est toujours rapporté à son domicile.
Tout cela était d’une logique rigoureuse, et Hermine fut contrainte de renoncer à cette affreuse idée.
Mais alors, où était Fernand ?
Pourquoi ce mystère ? Pourquoi ne s’être point confié à sa femme ?
Il est si difficile aux Parisiens d’admettre, comme les gens de la province, qu’un homme puisse être séquestré au milieu de Paris, ou jeté à l’eau quand il passe les ponts, et cela en temps de carnaval, lorsque les rues sont encombrées de monde à toute heure de la nuit, que ni madame de Beaupréau ni Hermine n’y songèrent.
Fernand était absent, Fernand ne revenait pas ; mais sauf le cas où il aurait pu être tué en duel, on ne pouvait supposer une minute qu’il était retenu forcément hors de chez lui.
Hermine espéra que son mari reviendrait dans la soirée.
Puis la nuit passa à son tour et fit place au matin, trouvant les deux femmes, la mère et la fille, livrées aux plus douloureuses conjectures.
Alors madame Rocher n’y tint plus.
Elle songea à M. de Kergaz et courut chez lui.
Fernand était comme le lieutenant en philanthropie d’Armand de Kergaz. Il avait été chargé par lui, durant le séjour de ce dernier en Sicile, des missions les plus délicates ; ils avaient comme une bourse commune au service des pauvres.
Hermine pensa que M. de Kergaz devait être dans la confidence de cette affaire, et elle se fit conduire rue Culture-Sainte-Catherine.
Lorsqu’elle y arriva, M. de Kergaz était dans son cabinet avec le vicomte Andréa.
Le frère repenti avait pris, depuis quelques jours, ses nouvelles fonctions à cœur. Il dirigeait avec une habileté sans égale cette police secrète du comte qui avait mission de démasquer et de détruire la redoutable association des Valets-de-Cœur.
Le comte fut quelque peu surpris de voir entrer chez lui, à cette heure matinale, madame Fernand Rocher, dont les yeux battus, la pâleur, semblaient attester la vive anxiété.
Aussi en la voyant paraître sur le seuil du salon, courut-il à elle, manifestant un certain étonnement inquiet.
– Je viens vous demander des nouvelles de mon mari, lui dit Hermine… sur-le-champ.
Le comte fit un geste d’étonnement.
– Comment ! s’écria Hermine… vous ne l’avez pas vu… hier ?… aujourd’hui ?
Le comte hocha la tête.
Alors, toute frémissante, madame Rocher raconta la disparition de Fernand, et M. de Kergaz, stupéfait, l’écouta, la regardant tour à tour, elle et le vicomte Andréa.
– Voilà qui est étrange ! s’écria le vicomte, qui avait modestement baissé les yeux à la vue de la jeune femme, jadis l’objet de sa coupable convoitise.
Et tout à coup il s’écria :
– Mais enfin, un homme ne disparaît pas ainsi dans Paris, madame ; on le retrouvera, c’est impossible autrement.
Et, dans la bouche de celui qui avait été sir Williams, cette espérance était presque une promesse.
– Mon Dieu ! mon Dieu ! murmurait Hermine, il y a trente-six heures de cela… On aura assassiné mon mari !
Armand regardait son frère d’un air interrogateur, et comme lui demandant conseil.
Le vicomte avait l’aspect d’un homme terrassé par une mauvaise nouvelle, et qui cherche cependant un moyen de conjurer l’adversité.
Hermine attachait sur lui un œil suppliant, comme si tous ceux que le baronet sir Williams avait jadis poursuivis de sa haine devaient avoir une confiance illimitée, absolue, aveugle, dans le vicomte Andréa repentant.
– Madame, lui dit-il d’un ton pénétré, je vous jure que, dussé-je remuer le monde et descendre au fond de ses entrailles, je vous retrouverai votre mari.
Et il ajouta, baissant les yeux :
– J’ai tant de crimes à me faire pardonner !…
– Ah ! murmura Hermine touchée, il y a longtemps que vos crimes sont oubliés. Vous êtes un saint… Dieu vous a pardonné !
Au moment où elle achevait, le valet de chambre du comte entra :
– Madame, dit-il à Hermine, votre valet de pied est là, dans le salon, et demande instamment à vous voir.
– Qu’il entre ! dit le comte.
Madame Rocher était sortie de chez elle en coupé bas avec son cocher seulement. Le valet de pied venait donc en hâte, et après elle, de l’hôtel.
Hermine eut un frisson d’espoir.
– C’est Fernand qui l’envoie ! pensa-t-elle.
Le valet entra, une lettre à la main.
– Au moment où madame venait de sortir, dit-il, un commissionnaire du coin de la rue est arrivé porteur de cette lettre. Il m’a recommandé de la remettre à madame sur-le-champ, ajoutant que c’était de monsieur.
Le comte et son frère respirèrent ; Hermine laissa échapper un cri de joie, et s’empara vivement de la lettre.
Il n’était donc pas mort !
Mais en jetant les yeux sur la souscription, elle pâlit.
Ce n’était point son écriture.
Pourtant elle rompit le cachet, déchira l’enveloppe et en retira un petit carré de papier d’où s’échappait un parfum discret, et de bon goût, et que couvrait une écriture déliée, menue, allongée, qui annonçait une main de femme.
Elle tourna le feuillet en tremblant, courut à la signature avant de lire, et reconnut le nom et le paraphe de son mari.
Alors seulement elle respira, et, sans se demander d’abord pourquoi il n’avait point écrit lui-même, puisqu’il avait signé, elle lut cette lettre que la Turquoise avait écrite le matin, tandis que Fernand, fasciné, la regardait avec admiration.
Certes, pour une femme encore adorée la veille, une semblable lettre, venant de l’homme qui passait sa vie à ses genoux, était étrange. Ce ton léger, presque impertinent, cette froideur d’expression, ce sans-gêne qui régnait de la première à la dernière ligne, tout cela était de nature à rendre folle la femme la moins jalouse, la moins habituée à de légitimes respects.
Et pour lui écrire, Fernand s’était servi de la main d’une femme, et il ne disait point à sa femme où il était, n’annonçant son retour que vaguement, comme une chose incertaine et subordonnée à une volonté étrangère.
Hermine n’eut pas la force de prononcer un mot. Elle tendit silencieusement la lettre à Armand, qui la prit et la lut, manifestant à chaque ligne une surprise profonde.
Et, comme elle, frappé de ce mystère inexplicable, il ne trouva pas un mot à dire et transmit la lettre au vicomte Andréa.
Le vicomte la lut, la relut, comme un savant qui déchiffre une inscription hébraïque ou égyptienne, et cherche le sens caché de chaque mot.
Pendant les deux minutes que dura pour lui cet examen, l’œil du comte et celui d’Hermine ne quittèrent point son visage, essayant d’en deviner les impressions rapides et fugitives.
Mais le vicomte demeurait impassible ; on eût dit qu’il hésitait à se prononcer.
Enfin il releva la tête et regarda Hermine.
– Madame, lui dit-il, tranquillisez-vous, votre mari ne court aucun danger, et il vous reviendra, ainsi qu’il vous le dit dans sa lettre. Je suis persuadé même que vous le reverrez avant huit jours.
– Mais… cette lettre ?… cette écriture ?… demanda la jeune femme d’une voix sourde, car déjà l’aiguillon de la jalousie pénétrait dans son cœur.
– Cette lettre a été écrite par une femme, accentua gravement le vicomte.
Hermine chancela et pâlit.
– Mais, cette femme, poursuivit-il, ne sera jamais assez puissante pour éteindre l’amour que votre mari ressent pour vous.
Hermine jeta un cri.
Le comte la soutint défaillante dans ses bras.
– Soyez forte, madame, lui dit-il, il y a un mystère que nous sonderons assurément.
Mais Hermine, hélas ! n’entendait plus la voix du comte. Celle d’Andréa seule semblait encore résonner à ses oreilles, et lui assurer que c’était bien une femme, une femme jalouse de son bonheur, qui avait tracé ces lignes dont chaque lettre était pour elle comme un coup de poignard.
Pourtant elle eut la force de se contenir, de se réfugier dans ses souvenirs d’amour, dans sa dignité de femme, dans la foi qu’elle avait toujours eu en son mari.
– Non, non, dit-elle avec énergie, vous vous trompez, monsieur, cela ne peut être, mon mari m’aime.
– Madame, répondit le vicomte Andréa, je ne puis vous affirmer qu’une chose, c’est que son billet a été écrit par une femme et signé par votre mari. Maintenant, le reste est un mystère, et je ne puis le sonder en deux minutes. Mais tranquillisez-vous, madame, avant peu j’aurai tout éclairci.
Et comme s’il eût obéi à une inspiration soudaine, le vicomte ajouta :
– Connaissez-vous beaucoup de monde chez la marquise Van-Hop ?
– Presque personne, monsieur. Fernand et moi, nous avons connu la marquise aux bains de mer, l’été dernier. Elle nous a présenté chez elle un jeune homme, le comte de Château-Mailly.
– Je connais ce nom-là, interrompit M. de Kergaz.
– Il me l’a même présenté et j’ai dansé avec lui.
– Eh bien ! madame, dit le vicomte, peut-être que M. de Château-Mailly saura comment et avec qui votre mari a quitté le bal ; il nous faut absolument des indices.
– Ah ! dit Hermine, je cours chez mon père ; il ira voir M. de Château-Mailly sur-le-champ.
Et la pauvre femme, tout émue, s’en alla et retourna chez elle au grand trot de ses chevaux, tant elle avait hâte de rencontrer son père et de voir M. de Château-Mailly.
Quand elle fut partie, Andréa regarda son frère :
– Voilà, dit-il, une écriture que je connais.
– Vraiment ! fit le comte stupéfait.
– Ou je me trompe fort, poursuivit Andréa, ou il y a du club des Valets-de-Cœur là-dessous.
Armand tressaillit.
– À de certains moments, poursuivit Andréa, l’homme est doué d’une singulière faculté de divination… Il suffit quelquefois d’un rien, d’un mot, d’un simple indice, d’une ligne d’écriture, pour mettre sur une trace cherchée en vain jusque-là. Fernand a disparu… Fernand écrit de chez une femme et s’en sert comme d’un secrétaire. Eh bien ! souvenez-vous, mon frère, qu’il est aux mains de cette association terrible que nous poursuivons sans pouvoir l’atteindre…
Et le baronet sir Williams, relevant la tête, splendide d’audace et d’impudence, ajouta :
– Donnez-moi huit jours : dans huit jours je vous apprendrai bien des choses. Mais d’ici là, ne me questionnez point, ne m’interrogez pas…
– Soit, dit Armand.
XXII
Pendant ce temps-là, Hermine rentrait chez elle et courait à l’appartement occupé par M. de Beaupréau.
Comme nous l’avons dit, M. de Beaupréau était devenu un petit vieux propret et charmant, de la meilleure humeur du monde, raisonnable en toutes choses, à moins qu’on ne lui parla ou qu’il ne vint à parler de Cerise, la jeune ouvrière morte d’amour pour lui.
Auquel cas, M. de Beaupréau devenait triste, mélancolique, pleurait comme un enfant et perdait complètement la tête.
Tous les matins, il se levait à neuf heures et s’en allait à pieds de la Madeleine au Marais, longeant les boulevards en gagnant la place Royale. Cette promenade le conduisait à l’heure du déjeuner de famille.
M. de Beaupréau était donc sorti, comme à l’ordinaire, lorsque Hermine rentra à l’hôtel.
Elle l’attendit avec anxiété, après avoir montré toutefois la lettre de Fernand à madame de Beaupréau.
La pauvre mère, comme le vicomte Andréa, comme M. de Kergaz, crut deviner une partie de la vérité ; seulement, elle ne comprit pas pourquoi le vicomte tenait à ce que sa fille interrogeât M. de Château-Mailly.
M. de Beaupréau rentra.
– Mon père, lui dit Hermine, Fernand n’est point revenu.
– Ah ! fit-il d’un air indifférent. Eh bien, il reviendra.
Cette réponse dans la bouche d’un homme qui, la veille, partageait l’affliction de sa famille, prouva aux deux femmes que, ce matin-là, il n’avait pas la tête bien solide.
Puis, tout à coup, il ajouta en riant de ce rire à demi hébété qui est un signe certain de folie :
– Je sais où il est.
– Vous le savez ? demanda Hermine avec vivacité.
– Oui, fit-il en clignant de l’œil.
– Mais dites donc, alors ! s’écria-t-elle ; mais parlez.
– Il est chez sa maîtresse, répondit lentement le fou. Il me l’a dit.
Et comme les deux femmes l’écoutaient avec stupeur, il ajouta :
– Mais le pauvre garçon s’abuse, elle ne mourra pas d’amour pour lui, elle. Ces choses-là n’arrivent qu’à moi.
Et il continua à rire, sans paraître remarquer la pâleur, l’émotion, la douleur qui se peignaient sur le visage des deux femmes.
M. de Beaupréau, du moins elles le crurent, avait un de ces rares accès de folie qui ne le prenaient qu’à de longs intervalles, mais qui duraient quelquefois plusieurs heures, car, après avoir ri aux éclats, il se mit tout à coup à pleurer, balbutiant le nom de Cerise et s’accusant de sa mort.
Hermine comprit qu’il ne fallait point compter sur lui ce jour-là pour qu’il allât voir M. de Château-Mailly.
Et déjà elle songeait à écrire un mot à la marquise Van-Hop, et à s’adresser à elle pour avoir quelques éclaircissements, lorsqu’un domestique, entrouvrant la porte, annonça :
– M. le comte de Château-Mailly.
C’était le hasard ou plutôt la Providence qui l’envoyait.
On se rappelle que le comte, au bal de la marquise Van-Hop, d’après les conseils du gentleman aux cheveux rouges, qui dissimulait si bien le redoutable chef des Valets-de-Cœur, s’était fait présenter à Hermine par M. de Beaupréau.
Il lui avait fait une cour respectueuse ; il avait demandé et obtenu la permission de se présenter à l’hôtel de la rue d’Isly, et la jeune femme, que son amour pour son mari absorbait tout entière, n’avait pas cru devoir refuser.
Hermine était trop pure pour se défier d’elle-même. C’est le tort de bien des femmes.
L’arrivée de M. de Château-Mailly n’avait donc rien que de fort naturel.
Il était deux heures, on était au vendredi, le jour où madame Rocher était chez elle l’après-midi ; M. de Château-Mailly ignorait sans doute ou devait ignorer les événements que nous venons de raconter, il usait de la permission qu’on lui avait accordée pour faire une visite.
Le comte était un fort beau et fort élégant cavalier ; ses manières distinguées, sa démarche, son sourire un peu fier trahissaient le grand seigneur.
Mais Hermine ne songeait qu’à son mari, et elle ne vit dans M. de Château-Mailly autre chose qu’un homme qui pouvait venir à son aide et sonder avec elle l’horrible mystère qui semblait envelopper la disparition et l’absence de son mari.
XXIII
M. le comte de Château-Mailly était un de ces hommes qui, élevés avec le siècle, en ont accepté à peu près toutes les idées. Véritable Parisien du boulevard des Italiens, le comte avait été et était encore ce que, dans toute l’acception du terme, on nomme un viveur.
Il était d’une morale indulgente et facile pour les autres et pour lui-même, avait des principes de loyauté bien arrêtés sur certaines choses, et plus que vagues sur beaucoup d’autres.
Aussi, il avait accepté, sans le moindre scrupule, les propositions du gentleman aux cheveux rouges, se disant qu’un niais seul refuserait de reconquérir un héritage perdu, alors qu’il suffisait pour cela de séduire une jeune et fort jolie femme.
Certes sir Williams s’était bien gardé de mettre le comte dans la confidence de ses projets ténébreux, car il était hors de doute que celui-ci n’eût pas voulu faire partie d’une association de bandits ; mais il s’était posé vis-à-vis de lui en amoureux dédaigné, rebuté, et qui met au service de sa vengeance son intelligence et son argent.
Ceci posé, on trouvera donc assez naturel que M. de Château-Mailly eût accepté le rôle qui lui était fait.
Il ne connaissait point M. Fernand Rocher… Hermine était belle.
Ces deux raisons suffisaient à sa conscience élastique pour la mettre tout à fait en repos.
Malgré la rapidité avec laquelle les femmes dissimulent leurs impressions et savent donner un calme menteur à leur visage, l’air bouleversé, l’émotion d’Hermine n’échappèrent pas à M. de Château-Mailly.
Il devina qu’il se passait chez elle et autour d’elle quelque chose d’au moins insolite.
– Monsieur le comte, lui dit la jeune femme après les compliments d’usage, allez-vous beaucoup chez la marquise Van-Hop ?
– Fort souvent, madame.
– Connaissez-vous plusieurs personnes de sa société habituelle ?
– Presque tout le monde.
La jeune femme soupira ; mais elle avait déjà reconquis cette force morale qui donne à son sexe le pouvoir d’interroger sans répondre, de pénétrer le secret des autres sans livrer le sien.
Hermine avait avoué franchement, spontanément, dans la naïveté première de sa douleur, au comte de Kergaz et au vicomte Andréa, l’angoisse inexprimable qu’elle éprouvait.
Elle leur avait ensuite montré ce billet tracé par une main de femme, et qui semblait indiquer qu’une autre possédait celui qu’elle appelait de tous ses vœux et qu’elle avait déjà pleuré comme un mort…
Mais en face de M. de Château-Mailly, c’est-à-dire d’un étranger, Hermine retrouva toute la prudence féminine. Elle essaya de savoir sans rien dire elle-même, et ce ne fut que lorsque le comte eut avoué naïvement qu’il n’avait pas remarqué M. Fernand Rocher au bal, que la jeune femme se laissa aller à une demi-confiance.
– Mon mari, dit-elle, a disparu vers deux heures du matin, m’annonçant qu’il sortait pour le reste de la nuit et rentrerait à l’hôtel de son côté. Je l’ai attendu hier toute la journée, toute la nuit dernière, ce matin… et je ne l’ai point vu encore.
– Madame, répondit le comte, qui avait reçu le matin même un petit billet de son mystérieux complice, billet qui lui donnait de minutieuses instructions, votre mari n’est-il pas grand, brun, avec de petites moustaches noires ?
– Oui, dit Hermine.
– Il peut avoir vingt-huit ou trente ans ?
– C’est bien cela, monsieur.
– Ah ! dit le comte, je l’ai vu sortir de chez la marquise avec le major Carden, un officier suédois.
– Et… demanda Hermine, vous êtes bien sûr qu’ils allaient ensemble ?
– Très sûr.
– Mon Dieu ! reprit-elle, omettant de parler du billet, j’ai peur de quelque duel. S’il avait été blessé !…
– Précisément, répondit le comte, je crois me souvenir vaguement d’une querelle qui a eu lieu à la table de jeu… Mais votre mari s’y trouvait-il mêlé, je l’ignore.
Ces paroles semblaient jeter quelque lumière sur la situation ; mais le billet de Fernand laissait toujours dans l’ombre un coin du tableau.
Et pourtant Hermine eut le courage de n’en point parler et de laisser le comte persuadé qu’elle ignorait absolument ce qu’était devenu son mari, et s’il était mort ou vivant.
– Madame, dit M. de Château-Mailly en se levant, je connais le major Carden, je cours chez lui et saurai bientôt ce qu’est devenu votre mari.
Il lui baisa la main et s’en alla, laissant échapper quelques mots qui eussent signifié, pour une femme plus avancée dans la vie, combien il était heureux de devenir utile.
Hermine attendit le retour du comte, essayant de combattre ses soupçons et les premiers symptômes de la jalousie, ce sentiment qui lui était inconnu la veille, par cette pensée que peut-être Fernand s’était battu, qu’il avait été blessé ; que, transporté dans une maison voisine du lieu du combat pour ne point alarmer sa famille, il s’était servi d’une main étrangère ; qu’après tout, et en admettant qu’une femme eût écrit, cela ne prouvait absolument rien…
Mais le ton leste, impertinent, inouï de cette lettre, qu’elle lut et relut à plusieurs reprises, n’était-il pas là pour attester l’aigreur, la haine sourde d’une rivale ?…
Il est de certaines heures où la femme la plus inexpérimentée, la plus ignorante de la vie, acquiert une merveilleuse lucidité, un art de divination étrange, où elle prévoit l’avenir avec une sagacité sans égale.
Malgré les circonstances mystérieuses qui semblaient avoir enveloppé le départ de son mari et prolongé son absence, Hermine demeurait convaincue d’un fait, d’un fait capital, unique en son genre, et qui paraissait dominer tous les autres : Fernand était chez une femme.
Cette femme était déjà ou allait être sa rivale. Comment ? Elle l’ignorait ; mais elle pressentait ce résultat.
Le comte de Château-Mailly revint.
Une heure à peine s’était écoulée depuis son départ, et pourtant cette heure avait eu, pour la jeune femme, la durée d’un siècle.
Hermine était seule au salon, à demi couchée dans sa bergère, dans l’attitude pleine de langueur de la femme frêle dont les tortures morales brisent la faible organisation physique.
Pour la première fois, depuis qu’elle était heureuse et qu’elle oubliait le monde entier pour ne voir et n’aimer que son mari, Hermine songea à être coquette.
Elle avait besoin du comte. Le comte se montrait empressé, dévoué, lui, inconnu la veille, et les femmes ont un tact exquis pour deviner jusqu’où peuvent aller le zèle et l’abnégation de l’homme, s’il entrevoit le plus faible espoir.
La veille, elle eût reçu M. de Château-Mailly avec cette froideur distinguée, cette politesse pleine d’indifférence qui semble dire catégoriquement :
– Vous êtes pour moi un visiteur, un homme du monde chez une femme du monde, rien de plus.
Aujourd’hui, elle semblait comprendre que cet homme, qui se mettait si spontanément à son service, l’aimait et se dévouerait pour elle, au besoin ; et elle lui tendit la main comme à un ami, lui souriant de ce sourire triste et sérieux qui peint la confiance d’une âme endolorie, et d’un geste lui indiqua un siège près de sa bergère.
– Eh bien ? lui dit-elle.
– Le major Carden est parti ce matin pour Londres, répondit le comte, mais j’ai eu quelques détails par son valet de chambre. Rassurez-vous, madame, votre mari est, Dieu merci, encore de ce monde, et il n’a pas quitté Paris.
– Ah ! fit Hermine qui parut respirer.
– Il paraît, reprit le comte, que, en effet, M. Rocher a eu à voix basse et à mots couverts une querelle avec un Suédois compatriote du major, le vicomte de Cambolh. Le vicomte devait quitter Paris le matin même. Il n’avait pas une minute à perdre. Le major était-il le témoin du vicomte ou celui de votre mari ? c’est ce que son valet de chambre n’a pu me dire… Mais la rencontre a eu lieu presque sur-le-champ, vers trois heures du matin… l’arme choisie était l’épée… Le valet du major ne sait pas où elle a eu lieu, mais il a compris, par quelques mots échappés à son maître, que l’adversaire de M. de Cambolh, car il connaît parfaitement le vicomte, avait été blessé au bras, puis transporté dans une maison voisine.
– Et cette maison ?… demanda Hermine toute tremblante.
– Il ne sait où elle est. Seulement, il paraît que c’est chez une dame, une baronne, croit-il, et qui est très liée avec ces messieurs.
Hermine respira.
Elle commençait à espérer ; elle croyait comprendre que tout cela avait eu lieu sans le consentement de Fernand, évanoui sans doute ; et sans les termes de ce billet qu’elle avait reçu, sans nul doute elle eût été tranquillisée tout à fait.
– Madame, reprit le comte, je ne vois dans tout cela qu’une chose fort naturelle. Votre mari s’est battu, il a été blessé ; ses témoins, et sans doute son adversaire, ne sachant encore quelle pouvait être la gravité de sa blessure, et par égard pour vous, l’auront fait transporter ailleurs que chez lui. Cela arrive souvent en pareil cas. Maintenant, j’ajouterai que le vicomte de Cambolh, à ce que j’ai ouï dire, est très répandu dans le monde galant. Qui vous dit qu’il n’a point fait transporter le blessé chez sa maîtresse ? En dépit de leurs vices, ces créatures ont quelquefois du bon… Elles sont, ordinairement, excellentes gardes-malades.
Chaque parole du comte entrait au cœur de madame Rocher comme un coup de poignard.
L’horrible mystère commençait à s’éclaircir : la lettre de femme s’expliquait.
Une seule chose demeurait incompréhensible : comment Fernand, qui l’aimait, qui l’adorait à genoux, avait-il pu signer un billet conçu en ces termes ?
Alors la femme chaste et pure, à qui le mariage avait laissé toutes ses illusions, toutes ses pudiques naïvetés de jeune fille, essaya de séduire, de fasciner, de gagner à sa cause M. de Château-Mailly.
Certes, le baronet sir Williams eût tressailli d’aise s’il eût pu assister à cette scène, en voyant jusqu’à quel point ses plans ténébreux réussissaient.
Il n’aurait pu rêver mieux pour une première entrevue entre la jeune femme et son séducteur futur.
M. de Château-Mailly avait, du reste, une physionomie ouverte, sympathique, nullement dépourvue de franchise.
Il fut éloquent, passionné ; il parla d’un dévouement inaltérable, ressenti à première vue ; il jura à madame Rocher qu’il lui ramènerait son mari, ou du moins qu’il y emploierait tout son zèle et tous ses efforts : et lorsque l’amour emprunte le langage de l’amitié, il est bien fort.
Au bout d’une heure, M. de Château-Mailly avait si bien gagné la confiance de la jeune femme, qu’elle lui permettait de revenir aussitôt qu’il aurait recueilli le moindre renseignement sur la rencontre de Fernand et de M. de Cambolh, et qu’enfin elle lui montra le fameux billet.
Mais à peine le comte eut-il jeté les yeux sur l’écriture, qu’il parut se troubler, laissa échapper un mouvement de surprise et s’écria :
– Mais je connais cette écriture-là !
– Vous… la… connaissez ? murmura madame Rocher, dont tout le sang afflua à son cœur.
– Oui, dit le comte, mais cependant ce serait si bizarre, si inexplicable !
Et, regardant Hermine avec une compassion subite :
– Pauvre femme ! dit-il.
– Monsieur, monsieur, supplia madame Rocher, si vous savez quelle est cette femme… au nom du Ciel ?
Le comte déboutonna sa redingote, y prit dans la poche de côté un petit portefeuille, dans lequel il chercha une lettre mêlée à d’autres ; puis, ouvrant cette lettre, il la confronta avec celle que madame Rocher tenait à la main.
C’était bien le même papier, le même parfum discret, la même plume délicate, allongée même.
Seulement la seconde lettre était ainsi conçue :
« Mon cher comte,
« Veux-tu venir boire du thé et fumer des cigarettes demain mercredi, chez moi ? Tu y trouveras un lansquenet convenable, ta nouvelle passion qui t’a guéri de ton amour pour moi, cher monstre !
« Je vous embrasse et je vous pardonne. »
Cette lettre, dont le style sentait le quartier Bréda le plus échevelé, était signée d’un nom impossible, comme on n’en entend prononcer que dans le monde interlope des pécheresses. L’auteur de cette invitation cavalière se nommait la Topaze. – c’est-à-dire mademoiselle Charlotte Lupin, vulgairement appelée Carambole.
Le comte mit les deux billets sous les yeux d’Hermine.
Hermine les confronta en pâlissant.
– C’est bien la même écriture, murmura-t-elle avec une sorte d’épouvante.
– Seulement, dit le comte, la mienne a un an de date, et ce qui me paraît extraordinaire, madame, c’est que cette créature était en Italie il y a environ quinze jours. Comment est-elle à Paris, comment votre mari s’est-il servi d’elle pour vous écrire ? Voilà ce que j’éclaircirai à tout prix.
Alors M. de Château-Mailly, qui paraissait ou feignait d’être fort ému, lui prit la main, la porta respectueusement à ses lèvres, et lui dit avec un accent dévoué et sympathique vibrant jusqu’au fond de l’âme :
– Hélas ! madame, je vous crois déjà si malheureuse, que je vous supplie de me regarder comme votre ami ; car, moi seul, je puis vous sauver…
Et il osa fléchir un genou devant elle.
– Laissez-moi, ajouta-t-il, m’incliner devant vous comme on s’incline devant la vertu persécutée par le vice.
Elle l’écoutait avec épouvante, elle ne songea point à lui retirer sa main ; elle ne vit plus en lui qu’un homme qui savait peut-être déjà toute l’étendue de son malheur et que le ciel lui envoyait à ce moment suprême comme un protecteur.
– Madame, continua le comte avec véhémence, avant de vous dire quel danger vous courez, et ce que je puis faire pour le conjurer, pour vous sauver, laissez-moi vous faire une question ?
– Parlez, monsieur, répondit la pauvre femme toute tremblante.
– N’êtes-vous pas mère ?… car tout à l’heure, s’interrompit le comte en montrant une porte du doigt, j’ai entendu, là, une voix d’enfant ?
– J’ai un fils de treize mois, dit-elle, manifestant soudain toutes les saintes alarmes de la mère oubliant qu’elle est femme pour ne plus songer qu’à son enfant…
– Eh bien, au nom de ce fils, reprit le comte avec le chaleureux accent du dévouement, ayez foi en moi comme dans un ami, comme dans un père.
Cet homme qui parlait ainsi était jeune, il avait le front loyal, l’œil ouvert ; il disait si noblement le langage de l’amitié, que la naïve jeune femme le crut et se sentit attirée vers lui.
– J’aurai foi en vous, dit-elle.
Alors le comte éloigna respectueusement son fauteuil, comme si la confiance qu’elle lui accordait eût élevé entre elle et lui une invisible barrière, et il reprit :
– Vous me pardonnerez, madame, si j’ose entrer en votre présence dans les honteux détails de la vie de garçon, détails que ne devrait jamais connaître une femme telle que vous.
Elle se tut, semblant, par son silence, l’inviter à parler.
– La Topaze, reprit M. de Château-Mailly, est une de ces créatures perverses que l’enfer semble vomir, à de longs intervalles heureusement, sous l’enveloppe séductrice des anges. C’est une femme sans cœur, sans pudeur, sans aucun scrupule humain, belle à désespérer, ayant ce regard qui fascine et éblouit, cette voix qui enchante, ce génie machiavélique de la séduction que n’ont jamais possédé les nobles femmes de notre monde. Pendant trois années, madame, j’ai été livré tout vivant aux griffes de ce monstre qui sait paraître un ange ; j’ai failli lui laisser ma vie, mon cœur, mon intelligence, ma fortune entière, dont elle m’a pris la moitié. Pourtant, j’étais ce qu’on appelle un homme déjà éprouvé par la vie, un esprit fort. Eh bien ! pour m’arracher des ongles roses de cette harpie, il a fallu une réunion de mes amis les plus chers, constitués en conseil de famille, un tribunal suprême remplaçant ma propre volonté par la sienne. On m’a pris une nuit, chez moi, on m’a jeté dans une chaise de poste, et deux de mes amis m’ont conduit en Allemagne, au-delà du Rhin, à deux ou trois cents lieues de ce minotaure femelle qui me dévorait tout vivant.
Le comte s’arrêta et regarda madame Rocher. Hermine avait la blancheur mate d’une statue. La vie, chez elle, semblait s’être réfugiée tout entière dans son regard, et elle écoutait avidement, comme un condamné écoute les termes lugubres de son arrêt.
– Il a fallu un an de voyages, de grand air, de dévouement de mes amis, il a fallu toutes les preuves amoncelées des infamies de cette créature pour me guérir. Eh bien, madame, si j’en crois ce billet, si j’en crois cette écriture, voilà dans quelles mains, par je ne sais quel mystérieux enchaînement de circonstances que je ne puis débrouiller encore, votre mari est tombé…
Et comme elle fléchissait, à demi brisée, sous le poids de ces révélations, comme elle voyait distinctement le gouffre entrouvert sous ses pieds, le comte reprit sa main et la pressa avec une respectueuse affection.
– Vous comprenez maintenant, dit-il, pourquoi j’ai exigé de vous un serment… Moi seul peux le sauver, vous sauver, sauver la fortune de votre enfant, qui se fondrait sous les mains prodigues de ce monstre comme un lingot dans un creuset ; mais pour cela, madame, il faut que vous vous laissiez conduire par moi ; il faut que vous m’accordiez une confiance aveugle, que chacune de vos actions soit dictée par moi. À ce prix seul je puis ramener le bonheur dans votre maison.
Deux larmes brûlantes, silencieuses, coulaient le long des joues de la jeune femme.
– Je vous obéirai, dit-elle, je vous obéirai comme à un frère…
– Bien, répondit-il ; alors je vous sauverai. Et il ajouta : À partir de ce jour, madame, je ne puis, je ne dois pas revenir ici. Votre mari doit ignorer que j’y suis venu ; je dois être pour vous un étranger.
– Mon Dieu ! fit-elle avec un effroi subit, ne vous reverrai-je donc pas ?
– Si, répondit le comte ; demain soir, à la brune, sortez à pied de l’hôtel, puis montez dans une voiture de place, et allez aux Champs-Élysées ; je serai au coin de l’avenue Lord-Byron. Et, comme elle paraissait hésiter : Regardez-moi, dit-il en levant sur elle un regard loyal et calme, ai-je l’air sincère ?
– J’irai, répondit-elle, toute rougissante de son hésitation.
Le comte se leva, lui baisa la main et ajouta :
– Ayez foi en moi… je vous sauverai. Adieu…
Il fit deux pas vers la porte, puis revint :
– Pas un mot de tout cela, dit-il, pas même à votre mère ; le succès est à ce prix.
– Je vous le promets, répondit-elle.
Et le séducteur s’en alla, laissant Hermine livrée aux plus noires angoisses, mais déjà pleine de foi et d’espoir en cet homme que sir Williams, le maudit, venait de jeter sur son chemin.
XXIV
M. de Château-Mailly était venu chez madame Rocher en phaéton, conduisant lui-même, et n’ayant qu’un seul domestique, un groom microscopique assis auprès de lui.
Il rassembla les rênes, rendit la main à son cheval et prit le chemin de l’hôtel.
Le jeune comte était quelque peu ému de la scène qu’il venait de jouer avec un véritable talent dramatique. Huit jours auparavant, il eût peut-être rougi d’une semblable conduite. Mais, bah ! le sort en était jeté. Et puis, en amour, se dit-il, tous les moyens sont bons quand ils mènent au succès.
Le comte s’adressait cette petite consolation juste au moment où il tournait l’angle de la rue Laffitte, où il demeurait.
Il avait un coquet appartement situé au premier, duquel dépendait une remise pour deux voitures et une écurie pour cinq chevaux.
Le comte était un homme de goût ; chez lui, chaque meuble, chaque objet, chaque détail de décoration l’attestaient. Il avait su réunir, chose rare, l’opulence du financier à la sobre simplicité du gentilhomme. Les tableaux de chasse et de pêche qui ornaient sa salle à manger, et qui valaient bien six mille écus, un superbe Murillo placé dans le salon, deux Hobbema appendus dans le fumoir, un bronze chinois d’un merveilleux travail, surmontant la pendule de cette dernière pièce, annonçaient ses goûts artistiques ; des tentures sombres ou grises, une chambre à coucher en vieux chêne témoignaient qu’il avait horreur de cette profusion de dorures, de glaces et de clinquant, véritable luxe de café, qu’étalent si complaisamment quelques reines de théâtre et quelques hommes d’un goût douteux.
Le domestique du comte se composait d’un groom, d’origine britannique, d’une vieille cuisinière et d’un noir remplissant auprès de lui les fonctions de valet de chambre, et, par antiphrase, appelé Boule-de-Neige.
Boule-de-Neige, qui se tenait dans la salle à manger, voluptueusement allongé sur une banquette, vint ouvrir à son maître et l’avertit qu’un étranger l’attendait au salon.
– C’est bien, répondit le comte en passant outre, car il s’attendait sans doute à cette visite.
Et il ouvrit la porte du salon.
Un homme était assis devant le feu, planté droit et raide sur une chaise ainsi qu’un automate ; il tenait dans ses mains une canne à pomme d’or, sur laquelle il s’appuyait d’un air mélancolique ; il portait un pantalon collant à carreaux gris et blancs, un gilet de nankin, une redingote brune à col raide ; sa tête, couronnée de cheveux d’un blond roussâtre, était surmontée d’un chapeau droit de forme, à bords imperceptibles. Bref, c’était sir Arthur Collins, en habit de ville, le même que nous avons déjà vu en habit de bal chez le marquis Van-Hop, et qui avait servi de témoin au vicomte de Cambolh dans son duel avec Fernand Rocher. Sir Arthur Collins était un résumé complet de l’Angleterre. On eût dit les trois royaumes incarnés dans un seul homme et passant le détroit d’un seul bloc.
– Ah ! ah ! dit-il en tournant la tête avec la raideur méthodique que ceux de sa race apportent dans tous leurs mouvements, vous voilà, my dear !
– Me voilà, dit le comte. Bonjour, milord.
– Aoh ! dit l’Anglais, j’étais simplement baronet.
Le comte s’assit.
– Eh bien ? demanda sir Arthur, sans se départir une minute de sa prononciation britannique.
– Eh bien, répondit M. de Château-Mailly, j’ai suivi vos instructions de point en point.
– Avez-vous montré la lettre que je vous ai envoyée ?
– Oui ; et j’ai su faire le tableau le moins flatté de la passion imaginaire que j’avais éprouvée pour cette femme, non moins imaginaire, que vous appelez la Topaze.
Et le comte raconta succinctement, et sans omettre un seul fait important, la scène que nous venons de décrire.
Sir Arthur écoutait gravement, donnant de temps à autre de petites marques d’approbation en inclinant la tête de haut en bas ; puis, à mesure que le comte disait les angoisses, les naïves confiances, l’abandon imprudent d’Hermine, une vive satisfaction semblait se peindre sur son visage couleur de brique.
– Aoh ! dit-il enfin, nos affaires vont bon train, mon cher comte.
– Vous croyez ?
– Sans doute. Il y a du vrai dans tout ce que vous avez dit.
– Ah ! la Topaze existe ?
– Certainement, puisqu’elle a écrit.
– Et elle se nomme la Topaze ?
– Non ; mais peu importe.
– D’accord. Cependant j’aime à croire qu’elle est moins dangereuse que ne le fait supposer le portrait que j’ai fait d’elle.
– Vous vous trompez ; vous étiez encore au-dessous de la vérité.
Le comte tressaillit.
– Mais alors, dit-il, c’est une abominable action que nous faisons là !
L’Anglais se prit à sourire et leva sur M. de Château-Mailly ce regard terne, fixe, sans rayons, qui n’appartient qu’aux fils d’outre-Manche.
– Vous plaisantez, dit-il froidement.
– Je plaisante si peu, dit le comte, que je commence à me repentir d’avoir conclu un marché avec vous.
– Voulez-vous le rompre ?
– Dame ! murmura M. de Château-Mailly, je veux bien faire tous mes efforts pour gagner les bonnes grâces d’une femme jeune et charmante, dont je ne connais pas le mari ; mais me rendre complice de la ruine de ce dernier…
L’Anglais haussa les épaules.
– Aoh ! dit-il, vous n’êtes pas dans votre bon sens, monsieur le comte.
– Vous croyez ?
– J’en suis sûr. Car, remarquez bien que ce n’est pas vous qui avez fait tomber M. Rocher aux mains de la femme dont nous parlons, que vous n’avez été pour rien ni dans sa querelle, ni dans le duel, ni dans l’enlèvement du blessé.
– Au fait, dit le comte, cela est assez juste.
– Par conséquent, poursuivit sir Arthur, si M. Fernand Rocher se ruine, cela ne vous regarde pas… Votre seule mission, à vous, – et cette mission, déjà fort agréable par elle-même, me semble assez joliment rétribuée par l’héritage du duc votre oncle, dont vous seriez frustré sans moi, – votre mission consiste à plaire à madame Rocher, voilà tout. Du reste, tranquillisez-vous et apaisez vos scrupules, M. Rocher ne se ruinera pas.
– Vous croyez ? vous me l’affirmez ?
– D’abord il a douze millions…
– Peste ! je ne le croyais point aussi riche, murmura le comte, étourdi d’un pareil chiffre.
– Ensuite, nous verrons.
– Milord, dit froidement le comte, ne seriez-vous pas le diable lui-même, par hasard ?
– Je le voudrais, répondit sir Arthur avec un flegme parfait. Malheureusement je ne suis que son disciple. Puis il ajouta en souriant : – Commencez-vous à me comprendre ?
– À peu près…
– Vous voilà déjà, pour madame Rocher, l’ami, le protecteur, l’homme en qui on a foi. L’espoir que vous lui ramènerez son mari, que vous l’arracherez à cette horrible femme, lui fera faire pour vous toutes les concessions, passer sur toutes les convenances. Elle en agira d’abord avec vous comme avec un frère…
– Mais je ne lui rendrai pas son mari…
– Vous le lui rendrez.
Le comte fit un haut-le-corps.
– Que dites-vous ? murmura-t-il.
– Vous avez rendez-vous avec elle demain soir, n’est-ce pas ?
– Oui, aux Champs-Élysées, à la nuit tombante.
– Eh bien, vous lui donnerez un vague espoir et lui assignerez une autre entrevue pour le surlendemain. Il n’est pas mal d’aiguillonner un peu l’impatience des femmes. Il ne faut pas qu’elle s’habitue à vous voir.
– Très bien. Mais alors que lui dirai-je ?
– Vous lui annoncerez le retour de son mari sous trois jours, sans entrer dans aucun détail, et en exigeant d’elle qu’elle ne fasse aucune allusion ni au billet, ni à la Topaze.
– Et son mari reviendra ?
– Parbleu !
Le comte regarda sir Arthur avec un étonnement profond.
– Mais, en ce cas, dit-il, mes espérances se trouveront ruinées ?
– Au contraire, le jour où M. Fernand Rocher rentrera chez lui, vous aurez fait un pas immense dans le cœur de sa femme.
– Voilà ce que je ne puis comprendre.
– Ah ! j’oubliais de vous dire qu’il rentrera chez lui brusquement, conduit par la Topaze et l’aimant plus que jamais. Il apportera donc à sa femme un regard morne, une humeur sombre, un front morose, tout ce qui caractérise, en un mot, un mari qui aime ailleurs que chez lui.
– Eh bien, qu’arrivera-t-il ?
– Ah ! répondit sir Arthur, vous êtes trop curieux aujourd’hui, mon cher comte. Contentez-vous de suivre à la lettre mes instructions, et, croyez-moi, si vous êtes bien pénétré de l’esprit de votre rôle, avant un mois madame Rocher vous adorera, et, ce qui est plus sérieux, votre oncle, le vieux duc de Château-Mailly, aura renoncé pour jamais à épouser madame Malassis et à vous déshériter.
Sir Arthur Collins se leva à ces mots, remit son chapeau sur sa tête ornée de cheveux rouges, tendit la main au jeune comte et s’en alla, sifflant un air de chasse et marchant de ce pas raide et compassé qui était un de ses avantages physiques les plus caractérisés.
L’Anglais était venu en coupé de remise, comme un simple mortel. Il se fit conduire rue du Faubourg-Saint-Honoré, chez M. le vicomte de Cambolh, où il allait changer de costume et de chevelure, et réintégrer le baronet sir Williams dans la redingote longue et sous le large chapeau du vicomte Andréa, le repenti, le bras droit du comte Armand de Kergaz, le philanthrope, le chef de cette police vertueuse qui avait pour mission de rechercher et d’anéantir la mystérieuse et redoutable confrérie des Valets-de-Cœur.
Les confidences du comte de Château-Mailly avaient laissé la pauvre Hermine livrée à un horrible désespoir. En vain lui avait-il dit d’avoir foi en lui et en l’avenir, en vain lui avait-il promis de lui ramener Fernand : l’infortunée jeune femme ne voyait et ne comprenait qu’une chose à tout cela, c’est que son mari était infidèle, lui qu’elle aimait et qui l’avait tant aimée ; c’est que, à cette heure même où elle se désolait, et, les yeux pleins de larmes, n’apercevait autour d’elle que solitude et isolement, lui, peut-être, avait sa main dans les mains de son odieuse rivale et la regardait en souriant.
Ce qu’elle souffrit pendant la nuit qui suivit, pendant toute la journée du lendemain, nul ne le redira. Et cependant elle demeura fidèle à la promesse qu’elle avait faite au comte, elle n’ouvrit point son âme à sa mère, elle dévora en silence ses larmes et sa douleur, repoussant toutes ses consolations et gardant un affreux mutisme.
En vain M. de Beaupréau, qui paraissait être revenu à la raison depuis une heure ou deux, en vain la pauvre Thérèse se montraient-ils affectueux, empressés autour d’elle, Hermine gardait un silence farouche et semblait ne plus vivre que d’une seule et navrante pensée : Fernand ne l’aimait plus !
La nuit, la journée suivante s’écoulèrent sans qu’aucun événement fût venu apporter une trêve à sa douleur. Elle n’avait plus qu’un but, qu’une préoccupation : revoir M. de Château-Mailly, cet inconnu de la veille, qui avait eu pour elle les chaleureux élans de l’amitié, du dévouement sans bornes, et qu’elle considérait maintenant comme son appui le plus ferme, son ami le plus sûr.
Au moment où la nuit venait, Hermine sortit de chez elle furtivement, comme un prisonnier qui s’évade ; elle gagna la place du Havre à pied, enveloppée dans un grand manteau, le visage couvert d’un voile épais. Là, elle se jeta dans un modeste fiacre, et donna l’ordre au cocher de la conduire à l’angle de l’avenue de Lord-Byron.
C’était une froide soirée d’hiver, brumeuse comme un soir de novembre. Les Champs-Élysées étaient déserts et d’une mortelle tristesse, avec leurs grands arbres dépouillés et leur avenue couverte d’une boue noirâtre. Ce fiacre solitaire qui s’en allait au petit trot de ses deux rosses avait un aspect funèbre qui glaçait le cœur des rares passants attardés dans l’avenue. On eût dit, en le voyant, la voiture du condamné ou le char de l’infortuné ; et nul n’aurait pu supposer que la femme qu’il contenait, cette femme à l’attitude affaissée, aux yeux rougis par les larmes, qui se cachait sous son voile comme ceux qui vont commettre une mauvaise action, était douze fois millionnaire, et que, huit jours auparavant peut-être, elle avait passé là en plein jour, par un bel après-midi de soleil, en calèche à quatre chevaux conduits à la Daumont, sa main dans la main d’un époux jeune et beau, au milieu d’une foule élégante qui disait avec un soupir d’envie : « Voilà le bonheur, l’amour, l’opulence qui passent ! »
Certes il n’y avait jamais eu rendez-vous moins blâmable, plus excusable, que celui auquel cette pauvre femme courait Elle y allait pour son mari, pour son enfant, dans l’espoir d’arracher l’un à l’horrible femme qui le tenait dans ses griffes, de conserver à l’autre une fortune menacée par l’avidité furieuse d’une courtisane ; et cependant Hermine tremblait, durant le trajet, comme cette feuille jaunie que le vent d’automne secoue à la cime des arbres. Une voix secrète semblait lui dire qu’elle courait à un danger plus grand peut-être que celui qu’elle allait conjurer.
Le fiacre s’arrêta à l’endroit désigné.
Hermine, dont le cœur battait avec violence, jeta un regard inquiet dans l’avenue de Lord-Byron, entièrement déserte.
Le comte se faisait attendre ; c’était d’une bonne politique. Pendant un quart d’heure, la malheureuse jeune femme attendit, livrée à une anxiété mortelle. Il ne venait pas…
Enfin, un homme parut à l’extrémité opposée de la rue. Il était à cheval ; il arrivait au grand trot.
– C’est lui ! murmura Hermine avec autant d’émotion que si cet homme eût été l’homme aimé.
C’était, en effet, M. de Château-Mailly.
Il mit respectueusement pied à terre, et, le chapeau à la main, il s’approcha du fiacre.
Hermine était pâle et frissonnante :
– Eh bien ? demanda-t-elle d’une voix étouffée.
– Depuis hier, madame, répondit le comte, j’ai fait un grand pas ; je sais où est votre mari, je sais où est cette abominable créature. Permettez-moi de vous revoir après-demain, car aujourd’hui je ne puis rien vous dire encore, et ayez bon espoir, je vous ramènerai votre époux.
Hermine voulut l’interroger.
– Non, dit-il, n’oubliez pas que vous m’avez promis de m’obéir…
Il lui baisa la main et ajouta :
– C’est après-demain dimanche ; trouvez-vous ici à cinq heures.
Hermine rentra chez elle plus désespérée, plus morne qu’à l’heure où elle était sortie. Elle avait tant espéré de son entrevue avec M. de Château-Mailly !…
Cependant les âmes nobles et résignées s’habituent insensiblement à la douleur, pour peu qu’à l’horizon, dans l’avenir, brille, si petit, si imperceptible qu’il soit, un coin de ciel bleu qu’on nomme l’espérance. Hermine pleurait, Hermine était torturée par le fer rouge de la jalousie ; et déjà pourtant elle avait si bien foi dans les promesses du comte, qu’elle espérait le retour de l’infidèle. Elle passa ces deux jours, qui devaient s’écouler avant qu’elle revît le comte, tout entière à son enfant, se réfugiant dans l’amour maternel comme le navire battu de la tempête se hâte de rentrer au port, se cramponnant à ce berceau comme qui se noie à la corde de sauvetage.
Le dimanche, elle fut exacte au rendez-vous, et cette fois M. de Château-Mailly ne se fit point attendre.
– Réjouissez-vous, madame, dit le comte, votre mari reviendra… Et, comme elle frissonnait de joie et d’émotion tout à la fois, le comte poursuivit : – Mercredi, dans la soirée, vous le verrez rentrer rue d’Isly. Mais, au nom du Ciel, madame, au nom de votre repos, de votre avenir, de votre enfant, au nom du dévouement que j’ai pour vous, obéissez-moi encore.
– Dites, murmura-t-elle, j’obéirai…
– Acceptez l’explication que votre mari vous donnera sur son absence. Croyez-le ou feignez de le croire. Ne prononcez ni le nom de cette femme, ni le mien. Me le jurez-vous ?
– Je vous le jure !
– Merci ! adieu !
Elle rentra chez elle le cœur palpitant d’espoir, ayant déjà pardonné, et résolue à compter les heures et les minutes qui la séparaient encore du moment où, selon la promesse du comte, il devait revenir.
L’histoire de cette attente est un long poème à elle seule. Nous ne la redirons pas et nous franchirons trois jours en trois lignes.
Le mercredi soir, dès huit heures, la pauvre Hermine sentit que sa vie tout entière était suspendue à un seul bruit, celui de la cloche de l’hôtel. Quand arriverait-il ? à quelle heure ? comment ? Elle ne le savait, mais elle croyait à ce que lui avait dit le comte, et chaque fois que la porte de l’hôtel s’ouvrait, elle éprouvait une angoisse inexprimable. Seule dans son boudoir, l’œil fixé sur l’aiguille de la pendule, Hermine vit les heures succéder aux heures. Minuit sonna… Il ne revenait pas !
Alors elle désespéra de nouveau, de nouveau elle sentit le cœur lui manquer, ses yeux s’emplir de larmes, ses jambes se dérober sous elle comme si elle eût été en proie à une lassitude invincible. Et elle crut voir cette femme qui lui avait volé son bonheur et son repos lui apparaître et lui dire en ricanant : « Il ne viendra pas… car je ne le veux pas, et c’est moi qu’il aime. »
Tout à coup, et comme deux heures sonnaient, la cloche de l’hôtel retentit… Hermine sentit résonner ce coup de cloche au fond de son cœur mieux qu’elle ne l’entendit avec ses oreilles.
– Ah ! c’est lui ! c’est lui ! dit-elle.
Elle voulut se lever, elle voulut courir à sa rencontre, se jeter dans ses bras et lui dire : « Enfin, enfin je te revois ! » Mais l’émotion la retint immobile, sans voix, sans haleine… Et elle se laissa retomber brisée et sans forces sur le canapé du boudoir.
XXV
Revenons à Léon Rolland.
Il y avait à peu près huit jours que la Turquoise, sous le nom d’Eugénie Garin, s’était présentée à l’atelier de la rue Saint-Antoine, où, sur la recommandation de son mari, Cerise lui avait donné de l’ouvrage.
Ces huit jours avaient suffi pour amonceler l’orage au-dessus de cette heureuse et paisible famille, que l’amour et le travail réunis avaient protégée jusque-là. Le regard profond et fascinateur de la fausse ouvrière avait suffi pour cela.
On sait quelle révolution elle avait opérée en quelques heures dans le cœur et l’esprit du maître ébéniste, quelle inquiétude vague elle avait jetée dans son âme, quel trouble inexplicable s’était emparé de lui dès la première heure sous les effluves magnétiques de ce regard étrange. Pendant toute cette journée, Léon Rolland ne put se rendre compte du trouble qu’il éprouvait. La nuit suivante fut pour lui presque sans sommeil.
Cependant le sourire heureux et charmant de Cerise et de son enfant, qu’il prit dans ses bras à plusieurs reprises et comme s’il eût voulu s’en faire une égide contre un invisible danger, suffit à le distraire.
La belle Cerise ne s’aperçut point de sa préoccupation.
Il descendit le matin à l’atelier comme de coutume, s’occupa de ses travaux, surveilla ses ouvriers et atteignit l’heure du déjeuner sans trop d’impatience. Il eut même la pensée, un moment, d’envoyer Cerise prendre des nouvelles du père Garin plutôt que d’y aller lui-même, comme il le lui avait promis la veille.
Léon, en cela, voulait obéir à une inspiration soudaine et comme venue d’en haut.
Mais cette bonne pensée, aussitôt venue, fut aussitôt refoulée. Il ne dit rien à Cerise ; il redescendit à l’atelier après son déjeuner, et chercha à y tuer le temps jusqu’à deux heures.
Cerise ne voyait Léon qu’au moment des repas, pendant la semaine. Le dimanche était le seul jour qu’il passât tout entier avec elle. Donc Cerise, en voyant partir son mari, lui avait tendu son front en lui disant : « À ce soir ! » Et, de son côté, elle s’était remise à l’œuvre.
Souvent, dans la journée, les deux époux sortaient chacun de leur côté, et faisaient les courses nécessaires à leurs affaires. Léon allait chez les petits fabricants qui travaillaient pour lui dans ses chantiers de bois, chez ceux de ses ouvriers qui travaillaient en chambre, chez ses clients qu’il servait.
Cerise montait presque chaque jour dans un modeste fiacre, et faisait, de deux à cinq heures, des courses analogues. Elle allait fort souvent chez la comtesse de Kergaz, la consultait en toutes choses et se faisait presque toujours l’intermédiaire des nombreuses charités, des bienfaits de toute sorte que Jeanne répandait autour d’elle.
Par conséquent, les deux époux, qu’une mutuelle confiance unissait, jouissaient vis-à-vis l’un de l’autre d’une liberté complète.
Rarement Cerise interrogeait-elle Léon sur l’emploi de son après-midi ; plus rarement encore Léon demandait-il à Cerise où elle était allée dans la journée, obéissant à leur insu à cette aversion instinctive qu’ont tous gens occupés à parler affaires dans leur intimité.
Les quelques détails qui précèdent nous étaient indispensables pour l’intelligence des événements qui suivirent l’introduction de la Turquoise, comme ouvrière en chambre, dans l’atelier dirigé par Cerise.
Quand deux heures sonnèrent, Léon Rolland, que poussait une force inconnue, et qui obéissait à une attraction mystérieuse, donna quelques ordres à son contremaître, mit son paletot et sortit. Il s’en allait vers la rue de Charonne, comme l’oiseau charmé se traîne en battant de l’aile jusqu’à la gueule béante du reptile. Dans l’escalier de la maison du père Garin, il se sentit pris d’un battement de cœur. Au troisième étage, il rencontra la portière qui balayait.
La veuve Fipart, l’intéressante épouse de Nicolo le guillotiné, salua môssieur Rolland, comme on salue de nos jours les millionnaires.
– Ah ! cher monsieur du bon Dieu, dit-elle, c’est la Providence qui vous a envoyé à ces pauvres gens… à cette bonne demoiselle qui est sage comme une sainte… et malheureuse ! que ça me fendait le cœur, à moi qui ne suis qu’une pauvre mercenaire…
Et d’un ton pénétré, avec une volubilité sans pareille, l’horrible vieille trouva moyen de raconter à Léon une jolie histoire invraisemblable, dont la moralité était que mademoiselle Eugénie Garin passait les nuits et les jours au travail pour nourrir son père.
Léon paya cinq francs l’histoire de la portière et monta lestement au sixième. Son cœur brisait sa poitrine au moment où il frappa à la porte.
– Entrez, dit une voix qui le fit tressaillir des pieds à la tête.
Il poussa la porte et s’arrêta un moment sur le seuil.
Déjà la misérable mansarde semblait avoir revêtu un aspect moins lugubre, grâce aux deux louis qu’il avait laissés la veille, tant il faut peu d’argent pour donner un air d’aisance au dénuement le plus affreux. Le vieillard était toujours dans son lit, mais il était enveloppé dans une belle couverture neuve et des draps bien blancs. Un petit poêle en fonte placé dans la cheminée répandait autour de lui une douce chaleur. Auprès de ce poêle, Eugénie était assise, son ouvrage sur ses genoux et son aiguille à la main.
Léon ne vit qu’elle, et le charme recommença plus terrible, plus puissant que jamais, lorsque l’ouvrière, se levant et arrêtant sur lui son regard magnétique, eut rougi légèrement en lui rendant son salut.
– Papa, dit-elle, c’est M. Rolland.
– Oui… c’est… père Garin, balbutia le maître ouvrier dominé par son émotion.
– Ah ! mon bon monsieur, soyez béni, murmura l’aveugle sur un ton de lamentable reconnaissance. Ah ! patron, vous avez un cœur de prince.
Léon s’assit au chevet du malade, lui demanda comment il allait et parla longtemps sans trop savoir ce qu’il disait ; mais il tressaillait et se sentait l’âme bouleversée chaque fois que la belle Eugénie levait sur lui ses grands yeux bleus… et deux heures s’écoulèrent ainsi et eurent pour lui la durée d’un rêve.
Il s’en alla d’un pas chancelant, comme un homme pris de vin, après avoir pressé silencieusement la main d’Eugénie et lui avoir promis de revenir le lendemain à la même heure.
Ce soir-là, l’ouvrier se montra préoccupé, morose ; et quand Cerise, alarmée de ce brusque changement, l’eut interrogé, il prétendit qu’il était fatigué de ses courses de la journée et éprouvait une violente migraine. C’était la première fois que Léon mentait à sa femme.
Le lendemain, il retourna encore rue de Charonne et trouva, comme la veille, Eugénie travaillant au chevet de son père. Il y retourna le jour suivant, puis l’autre et encore l’autre.
Et cependant l’ouvrière tenait modestement les yeux baissés ; elle avait le maintien décent d’une fille sage, elle parlait peu, rougissait si l’œil ébloui de Léon s’arrêtait sur elle, et, au bout de huit jours, le pauvre ébéniste, sans se l’être avoué à lui-même, était complètement fou d’amour.
Pourtant, et obéissant en cela à cette ruse instinctive du mal qui se cache, il témoignait dans son intérieur une gaieté de mauvais aloi ; il embrassait encore sa femme comme de coutume, mais son cœur ne battait plus de la même émotion. Son sommeil, la nuit, était agité ; parfois, une image le troublait ; une tête de femme apparaissait dans ses rêves ; et ce n’était pas le frais et rose visage de Cerise, avec ses grands yeux si doux, ses beaux cheveux noirs, ses lèvres rouges comme le fruit de juin dont elle portait le nom. C’était ce visage un peu pâle, encadré de fauves cheveux blonds, éclairé par cet œil d’un bleu sombre d’où s’échappait un rayonnement fascinateur ; ce visage pensif et sérieux, comme celui de l’ange déchu qui regrette le ciel et semble se complaire en sa fatale beauté.
Après son souper, Léon prétextait souvent le besoin soit de prendre l’air, soit de descendre dans son bureau pour y mettre au courant sa comptabilité en retard. Il avait besoin de solitude.
Quelquefois il s’enfermait dans son atelier, et là, tout seul, sans témoins, il se prenait à pleurer comme un enfant.
Un jour, il arriva plus tôt que de coutume chez le père Garin. Eugénie était sortie, lui dit l’aveugle.
Léon éprouva comme un frisson d’inquiétude jalouse. Où était-elle ? Il voulut s’en aller, il n’en eut pas la force ; il attendit deux heures.
Enfin Eugénie arriva. Elle avait son panier au bras ; elle était allée, lui dit-elle, faire ses modestes provisions à la halle.
En la voyant entrer, Léon avait rougi et pâli tour à tour ; il s’oublia jusqu’à lui faire des reproches de ce qu’elle laissait son père seul beaucoup trop longtemps.
Eugénie baissa les yeux ; le pauvre ouvrier vit une larme rouler sur sa joue, et il lui demanda pardon et s’en alla la mort au cœur en songeant qu’il lui avait fait de la peine, et s’avouant que ce n’était point l’intérêt qu’il portait à l’aveugle, mais bien un mouvement de jalousie qui avait dicté ses reproches.
Léon commençait à lire distinctement au fond de son âme, et il reculait épouvanté. Car c’était un loyal et brave cœur, après tout, un esprit simple et droit qui avait le respect de la foi jurée, un mari qui prenait au sérieux ses devoirs d’époux et de père. Il avait aimé Cerise, – Cerise l’aimait toujours, – il était devenu son époux, son protecteur, leurs mains s’étaient enlacées pour toujours au-dessus du berceau de leur enfant, et l’honnête homme se disait qu’il lui était à jamais interdit de lever les yeux sur une autre femme que la sienne.
Un soir, seul dans la petite pièce attenant à son atelier et qu’il nommait son bureau, il se répéta tout cela et se jura de dominer son cœur, ses instincts, de fouler aux pieds cette passion insensée, d’aller voir Eugénie une dernière fois, de laisser une poignée de louis sur le lit du père, et d’engager la jeune fille à retourner avec lui dans son pays, où l’air natal, un climat plus doux peut-être pourraient hâter sa guérison.
Léon voulait éloigner Eugénie Garin de Paris ; il se sentait faible, il semblait vaguement comprendre que, si elle restait, il n’aurait pas la force de ne plus la voir.
Il avait quelques économies dont il ne rendait compte à personne, que sa femme lui laissait employer à sa guise et qui passaient presque toutes à soulager des misères cachées. Afin de s’affermir plus encore dans sa résolution, Léon prit un rouleau de mille francs dans son tiroir et le mit dans sa poche. Il avait l’intention de le faire accepter au père Garin, à la condition qu’il retournerait dans son pays.
Quand de l’atelier il remonta dans son logement particulier, le silence et le sommeil y régnaient depuis longtemps, couronnant ainsi une noble journée de labeur.
Dans sa chambre nuptiale, une veilleuse, placée sur la cheminée, répandait autour d’elle une clarté mate et discrète. Auprès du lit se trouvait le berceau de l’enfant, caché par le même rideau que la couche maternelle.
Léon s’arrêta quelques secondes sur le seuil, comme s’il eût éprouvé du remords et de la honte à revenir, lui le cœur troublé de pensées coupables, prendre sa place accoutumée entre ces deux êtres qui auraient dû remplir sa vie : – sa femme, la chaste et belle Cerise, – son enfant, rose et blond comme un petit ange, dont l’âme sans doute retournait au ciel chaque nuit, tandis que son frêle corps reposait auprès de sa mère. Puis, passant la main sur son front comme s’il eût voulu en chasser une pensée qui l’obsédait, une image persécutrice, il s’avança sur la pointe du pied, retenant son haleine, et il écarta doucement les rideaux.
C’était un tableau charmant que celui qu’il eut alors sous les yeux. L’enfant n’était point dans son berceau, sa mère l’avait pris avec elle, elle le tenait dans ses bras, et tous deux dormaient. L’enfant, autour duquel s’arrondissait le beau bras de sa mère, avait les lèvres entrouvertes et souriait dans son sommeil, sans doute à quelque vision céleste, ressouvenir du paradis qui ne s’efface de la mémoire de l’enfance que lorsque la première passion humaine commence à en ternir l’innocence. La mère, plus grave, plus sérieuse, dormait, ses lèvres collées à la blonde chevelure de son chérubin.
Un moment l’ouvrier contempla son bonheur sous cette double apparence, n’osant faire un mouvement ni même respirer. Et l’image fatale, le souvenir fascinateur du démon aux yeux bleus s’effacèrent, et l’heureux père sentit son cœur palpiter alors sur le groupe endormi et voulut prendre l’enfant pour le remettre dans son berceau. Mais malgré les précautions infinies qu’il employait pour le dégager du bras de la jeune femme, ce bras, souple tout à l’heure, se raidit tout à coup, un pli se forma sur le front blanc de Cerise, et la mère, dormant encore, serra son cher nourrisson comme si un danger l’eût menacé.
Puis elle ouvrit les yeux, aperçut son époux. Et alors le pli du front disparut, la lèvre sérieuse dessina un sourire, le bras raidi se détendit, et le père put prendre son enfant et le remettre dans son berceau.
L’image d’Eugénie Garin avait disparu.
* *
*
Le lendemain, Léon descendit à l’atelier, plus gai, plus souriant qu’à l’ordinaire.
Il fut fort occupé durant la matinée, accablé de visites d’affaires, de commandes, d’ouvriers. Puis c’était un samedi, jour de paye, et, dès le matin, Léon avait l’habitude de vérifier la caisse et de faire faire de la monnaie.
Quand il sortit de chez lui, vers deux heures, pour aller rue de Charonne, il était muni du rouleau de mille francs, il avait la ferme résolution de le donner au père Garin et de lui faire promettre de partir. En s’arrêtant à la porte de la maison, il eut bien encore cet étrange battement de cœur qui s’emparait de lui chaque fois qu’il y allait, mais il était résolu, et il monta bravement.
La veuve Fipart n’était point dans sa loge, il ne rencontra personne dans l’escalier et atteignit sans voir âme qui vive la porte de la mansarde.
– Entrez ! répondit la voix de la jeune fille, lorsqu’il eut frappé.
Léon entra et jeta un cri de surprise.
Le lit du vieillard était vide, la jeune fille était seule…
L’ouvrier eut le vertige… Pour la première fois il se trouvait seul avec cette femme qui produisait de si grands ravages dans son âme, et c’était précisément au moment même où il venait la voir pour la dernière fois.
La jeune fille se leva toute rougissante, et comme si elle-même eût redouté ce tête-à-tête.
– Où donc est votre père ? demanda Léon d’une voix tremblante.
Elle baissa les yeux et soupira : – Il est parti depuis ce matin, répondit-elle.
– Parti ! exclama l’ouvrier stupéfait.
– Ah ! monsieur Rolland, murmura Eugénie, qui feignit un embarras profond, nous pardonnerez-vous jamais ?…
– Vous pardonner ! fit-il tout ému, et de quoi donc êtes-vous coupable ?
Et déjà le pauvre Rolland avait oublié quelle résolution héroïque l’amenait. Il contemplait Eugénie, et se demandait ce qu’il pouvait avoir à lui pardonner.
– Monsieur Rolland, reprit-elle d’une voix émue, vous avez été notre bienfaiteur, vous nous avez arrachés à la misère, et quelque chose me dit que c’est bien mal à nous de vous avoir caché…
– Mais… quoi donc ? demanda-t-il de plus en plus étonné.
– Eh bien, reprit-elle, en attachant sur lui son regard d’azur, et d’une voix qui tournait la tête au pauvre Léon chaque fois qu’il l’entendait vibrer, nous pardonnerez-vous si nous avons pu vous faire de la peine ?
Et le serpent tentateur prit la main de ce pauvre homme au cœur plein de trouble, et comme obéissant à un hypocrite élan de reconnaissance.
– Je vous promets, répondit Léon, qui avait le vertige.
Puis, vaincu sans doute par l’habitude, il s’assit auprès d’elle et parut disposé à l’écouter.
– Monsieur Rolland, reprit-elle, nous sommes si malheureux et si pauvres, que c’est peut-être bien mal à nous d’être fiers… et pourtant… mon père l’était… Chaque jour, quand vous étiez parti, le pauvre homme se mettait à pleurer, et, tout en vous bénissant comme un ange du bon Dieu, il maudissait ses infirmités et rougissait de vous tout devoir… autant que j’en rougis moi-même… acheva-t-elle d’une voix entrecoupée.
– Mademoiselle… balbutia Léon.
Car, monsieur Rolland, reprit-elle, je ne m’abuse pas, et mon père non plus. Madame Rolland, votre digne femme, me paye cinq francs ce qui vaut un franc, et vous-même vous ne veniez jamais ici…
– Taisez-vous, mon enfant ! murmura Léon, ému jusqu’aux larmes, votre père n’a-t-il pas été mon ouvrier ?
– Eh bien, poursuivit-elle, le médecin qui soignait mon père lui a dit hier qu’il sera obligé de suivre un traitement des plus longs et des plus coûteux s’il voulait recouvrer la vue ; et comme il devinait bien que nous ne pourrions payer ni le médecin ni les remèdes, il lui a offert de le faire admettre à l’hospice…
– Ah ! s’écria Léon, et il y est allé ?
– Ce matin, Oh ! mon père savait bien, mon bon monsieur Rolland, que si vous appreniez sa résolution, vous vous y opposeriez, que vous lui offririez de l’argent encore… il ne vous a parlé de rien hier, et il est parti, me laissant ici pour vous supplier de nous pardonner.
Et l’ouvrière voulut baiser les mains de Léon et fondit en larmes.
Déjà le pauvre ébéniste avait perdu la tête… Il ne songeait plus à sa femme, à son enfant ; il avait tout oublié en présence de cette femme qui pleurait, et vers laquelle l’entraînait une invincible attraction.
– Quant à moi, reprit-elle, j’irai vous voir ce soir, monsieur Rolland, vous et madame, j’irai la remercier de vos bienfaits, comme je vous remercie du fond d’un cœur reconnaissant et qui n’oubliera jamais…
– Mademoiselle, balbutia Léon, vous me remercierez plus tard… je n’ai encore rien fait pour vous… Attendez…
Elle secoua la tête, un sourire brilla à travers ses larmes.
– Je quitte cette maison demain, dit-elle.
Si la foudre fût tombée sur Léon Rolland, elle l’eût moins anéanti que ces simples mots.
Pourtant, il était venu là bien résolu à faire partir cette femme, dont la présence à Paris menaçait son bonheur, bien décidé à la voir pour la dernière fois. Et, comme elle allait au-devant de ses désirs, qu’elle lui annonçait cette séparation qu’il voulait tout à l’heure, voici qu’il se sentait pris d’une épouvante subite, comme si, avec elle, elle allait emporter son cœur à lui et sa vie tout à la fois.
– Vous… quittez… cette… maison ?… balbutia-t-il comme un homme qui a mal entendu.
– Oui, répondit-elle simplement, j’ai trouvé une place de femme de chambre auprès d’une Anglaise qui voyage… je gagnerai en argent ce que, hélas ! je vais perdre en fierté. Mais que voulez-vous ? acheva-t-elle d’une voix brisée ; comme cela je pourrai aider mon vieux père.
Pendant quelques minutes, Léon garda un silence farouche. Une lutte terrible, suprême, inexorable, s’élevait en son cœur… D’une part, le souvenir de sa femme et de son enfant l’assaillait et venait lui dire : « Le départ de cette femme, c’est ton bonheur, ton repos, le calme de ta vie tout entière… » De l’autre, la vue de cette femme, dont les yeux pleins de larmes n’avaient rien perdu de leur magique et ténébreux pouvoir, le bouleversait… Enfin, le mal l’emporta sur le bien, le vice demeura vainqueur et triompha de la vertu.
– Vous ne partirez pas ! s’écria-t-il.
Elle le regarda avec une sorte de terreur.
– Pourquoi ? pourquoi ?… demanda-t-elle.
– Pourquoi ? répondit-il d’une voix affolée, mais parce que je vous aime.
Et le malheureux tomba aux genoux du démon ; et sans doute qu’à cette heure douloureuse et suprême, l’ange gardien de l’enfant de Léon, se voila le front de ses ailes blanches et remonta tout en pleurs vers le ciel.
Pauvre Cerise ! ! !
XXVI
C’était précisément la veille de ce jour que Fernand Rocher avait été déposé, par la voiture de Turquoise, au bas de la rue d’Amsterdam, en face de l’embarcadère du chemin de fer.
On s’en souvient, Fernand avait arraché son bandeau, puis il s’était approché d’un bec de gaz, et c’était à sa lueur qu’il avait ouvert et lu la lettre de congé de sa belle garde-malade. Il est impossible de rendre la stupeur, le désespoir qui d’abord s’emparèrent de ce pauvre fou, fasciné et gagné à l’enfer par cette femme qui, presque aux mêmes heures, voyait deux hommes ressentir pour elle la plus violente et la plus funeste des passions. Longtemps accablé, anéanti, il demeura affaissé sur lui-même, s’appuyant au mur pour ne pas tomber.
Puis tout à coup, sa prostration fit place à une sorte d’exaltation fébrile.
– Oh ! je la retrouverai ! s’écria-t-il.
Et il se prit à marcher d’un pas saccadé, au hasard, à l’aventure, comme s’il eût voulu retrouver sa propre trace et revenir sur ses pas, pour refaire le chemin qu’il avait déjà parcouru en voiture et les yeux bandés. Mais le hasard le conduisit justement dans la rue d’Isly, située, comme on sait, tout près de la place du Havre, et donnant par un bout dans la rue de ce nom. Quand il se vit à l’entrée de la rue d’Isly, Fernand s’en alla machinalement jusqu’à la porte de son hôtel, et il mit la main sur le bouton de la cloche du suisse. Il se trouvait à sa porte, chez lui, à quelques pas de sa femme et de son enfant, qu’il n’avait pas vus depuis huit jours, qu’il avait oubliés, semblable à Renaud, dans les jardins enchantés d’Armide, et ne se souvenait plus du camp des croisés et de ses compagnons.
Au bruit de la cloche, la porte s’ouvrit.
Fernand entra.
La cour de l’hôtel était silencieuse et déserte.
Fernand leva les yeux et ne vit briller qu’une seule lumière sur toute la façade. Cette lumière partait de l’appartement de sa femme, et scintillait discrètement derrière les rideaux de soie du boudoir.
Alors seulement, cet homme qui rentrait chez lui furtivement, à pied, à une heure indue, comme un voleur s’introduit dans la propriété d’autrui ; cet homme passa la main sur son front, et chercha à rassembler ses souvenirs et à mettre un peu d’ordre dans son cerveau troublé. S’éveillait-il d’un étrange et pénible rêve après quatre années de joie et d’amour, quatre années de ce bonheur extrême que cette lumière discrète, brillant au milieu de la nuit – avait suffi pour lui rappeler ? N’avait-il pas été la proie de quelque hideux cauchemar, et tandis qu’il dormait auprès du berceau de son fils, sous les rideaux de soie d’Hermine, sa blanche compagne, n’avait-il pas entendu en songe qu’il s’était vu couché dans une chambre inconnue, gardé par un démon aux formes enchanteresses et qui avait voulu lui prendre son âme ? Ou bien ces quatre années de félicité, Hermine, sa femme adorée, son enfant blanc et rose, cet hôtel somptueux qui les abritait tous deux de ses lambris dorés et qui était sa maison à lui, son foyer de famille, tout cela n’était-ce point plutôt un long rêve au sortir duquel se retrouvait le malheureux, congédié, presque chassé par sa femme, dont il était fou d’amour.
Et, tout en s’adressant ces questions, toujours vaincu par la force de l’habitude, Fernand continua son chemin, prit une clef dans sa poche, ouvrit la porte vitrée du perron, gagna sans lumière, l’escalier donnant dans l’appartement de sa femme.
Hermine, nous l’avons dit, était demeurée immobile, sans force, sans voix, affaissée sur le sofa du boudoir. Mais lorsqu’elle entendit retentir dans l’antichambre, un peu assourdis par l’épais tapis, ces pas aimés et connus, lorsque la porte du boudoir se fut ouverte sous la main de Fernand, la pauvre femme brisée retrouva son courage, son énergie, l’usage de sa langue, et elle se précipita vers son mari en poussant un cri de joie indicible, et elle lui jeta ses bras autour du cou en lui disant :
– Ah ! te voilà, te voilà donc, enfin !
Cette chaude étreinte, cette voix qui semblait résumer pour lui, en un seul cri, quatre années d’un bonheur sans nuages, achevèrent d’éveiller Fernand et de l’arracher à cette torpeur morale. Il pressa sa femme dans ses bras, retrouva un peu de sa présence d’esprit, et songea alors à lui avouer franchement tout ce qui s’était passé ; comment, en dépit de sa volonté, à son insu, pendant son évanouissement, il avait été transporté dans une maison inconnue, soigné par une femme inconnue, et brusquement chassé par elle…
Mais soit pudeur instinctive et crainte de troubler le cœur de cet ange qui l’accueillait en l’enlaçant dans ses bras, soit que quelque fatale arrière-pensée l’eût dominé tout à coup, cet homme, ému et bouleversé tout à l’heure, qui, quelques minutes auparavant, était dans l’impossibilité de classer ses idées, de rassembler ses souvenirs, cet homme retrouva tout à coup ce sang-froid, cette lucidité d’esprit, ce calme parfait du mari qui s’apprête à offrir à sa femme, non la vérité toute nue, mais la vérité décemment vêtue et parée pour les besoins du moment.
– Ah ! chère Hermine, murmura-t-il, mon Dieu ! que j’ai souffert… et que vous avez dû souffrir !
Et il l’entraîna toute frémissante sur le sofa, et l’assit sur ses genoux, lui mettant un baiser au front ; et l’heureuse femme, palpitante sous ce baiser comme au premier jour de leur union, crut que son mari lui revenait tout entier, corps et âme…
Bien plus, il lui parut impossible qu’il eût pu, même, lui être moralement infidèle une seule minute, et elle allait s’écrier : – Non, M. de Château-Mailly m’a menti.
Lorsque Fernand lui ferma la bouche et lui dit :
– Ah ! vous allez me pardonner, n’est-ce pas ?
Il demandait son pardon. Il était donc coupable ?
Et elle se tut et le regarda.
– Oui, mon cher ange, reprit-il, votre Fernand qui vous aime, votre Fernand en qui vous avez foi, s’est conduit comme un étourdi, comme un enfant. Il a oublié que l’heure des folies de garçon était passée, qu’il avait une femme et un enfant, et il vous a laissée au bal, chère femme aimée, pour un propos en l’air, continua-t-il. Et il était sincère, et en ce moment il oubliait l’inconnue pour ne voir et n’aimer que sa femme. Pour une seule querelle de jeu, une misère, je suis allé me battre, à deux heures du matin…
– Mon Dieu ! mon Dieu ! murmura-t-elle, je le savais… je l’avais deviné… Mais, fit-elle en tremblant et en l’enveloppant d’un regard d’amour, tu as été blessé… légèrement, n’est-ce pas.
Et elle le regardait et semblait chercher en quel endroit de son corps avait pu pénétrer le feu meurtrier.
– Ce n’est rien, dit-il, une égratignure…
Et tandis que le sourire revenait à ses lèvres et illuminait son visage assombri un moment par l’inquiétude, il reprit :
– Une égratignure, pourtant, qui m’a mis au lit pendant huit grands jours, qui m’a procuré un évanouissement, puis le délire… On m’a porté je ne sais où… on vous a écrit je ne sais quoi… Oh ! tout cela est un rêve ? ajouta-t-il en passant la main sur son front.
Et il se leva à ces mots, courut à la porte voisine qui donnait dans la chambre à coucher de sa femme et s’approcha du berceau de son fils.
On eût dit qu’il voulait éviter toute autre explication et se réfugier tout entier dans la tendresse paternelle. Il prit son enfant dans ses bras, le couvrit de baisers ! l’enfant s’éveilla en pleurant.
Et la mère qui entend les pleurs de son fils, ne songe plus à rien, oublie ses propres douleurs, ses fortunes et ses jalousies…
Fernand replaça l’enfant dans son berceau.
Tous deux se penchèrent au-dessus, en le couvrant de baisers. Sir Williams lui-même, s’il eût pu assister à cette scène, aurait douté de sa puissance en voyant le bonheur revenu sous ce toit d’où avait voulu l’expulser violemment son infernal génie. Mais tout à coup Fernand se dégagea brusquement de cette étreinte. Un souvenir s’éveillait dans son cœur, une image maudite et fatale passait devant ses yeux… Il lui avait semblé que ce regard bleu et profond comme l’azur des vastes mers, et qui, comme elles, avait la puissance fascinatrice des gouffres, pesait sur lui de tout son poids. Il pâlit, il frissonna ; un nuage voila son regard, son front s’assombrit tout à coup…
– Hermine, dit-il à sa femme en lui prenant vivement la main, vous allez me faire une promesse…
Elle le regarda avec un douloureux étonnement, tant elle était frappée de ce brusque changement qui s’opérait en lui.
– Parlez !… dit-elle toute tremblante.
– Vous allez me promettre, dit Fernand, de ne jamais me questionner sur ce qui s’est passé durant les huit jours qui viennent de s’écouler.
– Je vous le promets, dit-elle avec soumission.
– Vous ne me demanderez jamais ni où je suis allé, ni quelle personne m’a soigné, n’est-ce pas ?
– Je vous le jure, murmura la pauvre femme, qui comprit cette fois que M. de Château-Mailly ne lui avait point menti.
– Notre bonheur est à ce prix, soupira Fernand qui espéra que le souvenir qui le poursuivait s’effacerait…
* *
*
Le lendemain, à son réveil, Fernand jeta autour de lui le même regard étonné qu’il avait promené sur le somptueux mobilier de la belle inconnue, le jour où il était revenu chez elle de son long évanouissement. Et, de même que là, il avait d’abord cherché à se rendre compte du lieu où il se trouvait, de même, en se retrouvant chez lui, il éprouva un mouvement de surprise et presque de regret. Il avait tant vécu par la tête et le cœur durant ces huit jours, il s’était si bien habitué à la voir, elle, la femme inconnue, assise à son chevet quand il ouvrait les yeux.
De même que, la première fois, il avait soupiré et songé à sa chambre à coucher, où il dormait, la tête sur le même oreiller que sa jeune femme, auprès du berceau de son fils ; de même en se retrouvant dans cette chambre peuplée des souvenirs de quatre années de bonheur, il ne put s’empêcher de songer à son réveil des jours précédents, et tout d’abord ses yeux cherchèrent cette belle garde-malade qui s’avançait auprès de lui, marchant sur la pointe de son petit pied.
La vue de sa femme endormie, la vue du berceau de son enfant lui apprirent que l’inconnue ne pouvait venir.
Et comme l’homme qui veut repousser la tentation, chasser une pensée qui l’obsède, il essaya de se réfugier dans le présent, regardant tour à tour la brune et blanche tête d’Hermine, et cet enfant, unique gage de leur amour. Mais les souvenirs de la veille revenaient.
L’image chassée, repoussée avec énergie, revenait sans cesse, et, pour la première fois depuis quatre années, il sauta hors du lit sans avoir mis un baiser au front d’Hermine.
Hermine dormait… Elle avait passé tant de nuits sans sommeil, livrée aux angoisses de l’attente, aux tortures du désespoir, qu’elle avait fini par céder à la lassitude, par s’endormir auprès de celui qu’elle croyait avoir enfin reconquis.
Fernand se leva sans bruit, furtivement, il sortit sur la pointe du pied. Il avait besoin d’air, de solitude, il espérait que le premier rayon de soleil, la première bouffée de brise matinale ramèneraient chez lui un peu de calme et dissiperaient le souvenir confus des visions de la nuit.
Hermine n’avait point mis ses gens, durant huit jours, dans la confidence de ses alarmes ; pour eux, monsieur était absent, et cela avait dû leur suffire.
Dès le matin, on avait appris par le suisse que monsieur était rentré pendant la nuit.
Fernand descendit donc aux écuries et fit seller son cheval favori, une belle jument du désert, cadeau presque royal du gouverneur général de l’Algérie. Il mit le pied à l’étrier, annonça qu’il reviendrait pour l’heure du déjeuner et s’élança au grand trot dans la rue du Havre.
Il monta jusqu’à la rue Royale, suivit au galop l’avenue des Champs-Élysées, descendit jusqu’au pont de Neuilly, et fit le tour du bois de Boulogne, revenant par Passy et l’avenue de Saint-Cloud.
Cette allure, rapide comme celle d’un cavalier de ballade allemande, était en harmonie avec le trouble de son cœur… Il revint vers onze heures.
Hermine était levée et l’attendait. En s’éveillant et ne le voyant pas, la jeune femme avait jeté un cri d’effroi ; elle avait craint qu’il ne se fût enfui encore, que son odieuse rivale ne le fût venu chercher jusque chez lui ; mais elle s’était rassurée bientôt en apprenant de la bouche de sa femme de chambre que monsieur était sorti à cheval. Fernand n’avait-il pas l’habitude d’aller au bois chaque matin, monté sur Sarah, sa belle cavale du désert ?
Hermine s’était fait habiller avec un goût et un soin merveilleux ; elle avait une fraîche toilette du matin, à fasciner le comte de Château-Mailly, à séduire un homme blasé. Ses souffrances de la veille et des jours précédents avaient, en le pâlissant un peu, apporté à son visage un cachet de distinction suprême.
À sa vue, Fernand oublia une fois encore. Il passa la journée entre sa femme et son enfant, comme s’il eût redouté une seule minute d’isolement.
Le temps était froid, mais beau, très sec ; le soleil se montra radieux vers midi.
Fernand fit atteler l’américaine ; il proposa une promenade à sa femme, et, conduisant lui-même, ils s’en allèrent par les boulevards jusqu’à la place de la Bastille. Là, Fernand tourna l’angle du faubourg Saint-Antoine et gagna la rue Culture-Sainte-Catherine, où Armand de Kergaz avait son hôtel.
Le comte était sorti, mais la comtesse était à l’hôtel. Les deux jeunes époux passèrent une heure avec elle, et revinrent.
Durant ce court trajet, pendant ce laps de temps, Fernand s’était montré gai, souriant…
Hermine espérait, et elle remerciait déjà dans le fond de son âme, M. de Château-Mailly, son invisible protecteur. Mais, le soir, une tristesse mortelle s’empara de Fernand.
Il redevint encore morose, taciturne.
Et Hermine, malgré sa douleur, demeura fidèle à la promesse qu’elle lui avait faite, elle ne le questionna pas ; elle se contenta de lui prodiguer ses soins, ses caresses, ces mille attentions charmantes de la femme dévouée, aimante, et qui veut être aimée…
Trois jours s’écoulèrent. Pendant ces trois jours, ce pauvre malade d’esprit eut des alternatives de joie et de tristesse. Tantôt il se montra affectueux, empressé pour la jeune femme, et prenait son fils sur ses genoux, lui parlant ce langage enfantin, ce délicieux zézaiement des pères ; tantôt, au contraire, il retombait dans sa sombre humeur, ne parlait plus, répondait à peine, repoussait les caresses de sa femme avec une brusque impatience…
Et la pauvre Hermine allait dévorer ses larmes dans la solitude et le silence, et, se jetant à genoux, elle priait Dieu de guérir son Fernand du mal qui semblait le frapper…
Le matin du quatrième jour, Fernand sortit de bonne heure ; comme à l’ordinaire, il fit seller Sarah, et s’en alla faire au Bois sa promenade accoutumée. Mais l’heure du déjeuner sonna, et il ne revint pas. Une légère ondée qui était tombée depuis son départ fit espérer à Hermine qu’il s’était arrêté à Madrid ou à Ermenonville, décidé à y déjeuner.
Mais la soirée passa… Puis le soir vint…
Alors Hermine fut saisie d’épouvante… Fernand ne revenait pas.
Elle l’attendit jusqu’à minuit, elle l’attendit jusqu’au jour ; elle vit entrer un rayon de soleil dans sa chambre… Fernand n’avait pas reparu ; Hermine se sentait mourir. Tout à coup le pas d’un cheval se fit entendre dans la cour.
– C’est lui, pensa-t-elle en se précipitant vers la croisée et l’ouvrant.
C’était bien Sarah, la jument africaine, mais Sarah veuve de son cavalier, et piteusement conduite par la bride, par un commissaire de coin de rue…
Alors, pressentant quelque affreux malheur, éperdue, Hermine descendit et interrogea cet homme. Le commissaire lui répondit qu’une heure auparavant, au rond-point des Champs-Élysées, il avait vu passer une calèche dans laquelle se trouvait une jeune blonde, vêtue d’une robe bleue.
À côté de la calèche, un jeune homme chevauchait sur Sarah.
Il avait mis pied à terre en l’apercevant, lui avait confié le cheval en lui donnant l’ordre de le ramener et il était monté dans la calèche à côté de la jeune dame. C’était là tout ce qu’il savait.
* *
*
À ce récit, Hermine fut prise de vertige ; elle ne douta plus que cette femme blonde ne fût cette créature qui déjà lui avait ravi le cœur de son époux ; elle comprit que Fernand était retombé aux mains du monstre, que le minotaure avait repris sa proie, et, folle de douleur, la tête perdue, sans même songer à l’imprudence de ce qu’elle allait faire, elle demanda ses chevaux, se jeta en robe de chambre dans sa voiture, et cria au cocher : rue Laffitte, 41 !
La belle et vertueuse madame Rocher, en présence de ce nouveau malheur, avait songé à M. de Château-Mailly, et, sans réfléchir que le comte était garçon, que courir chez lui ostensiblement à neuf heures du matin, c’était pour elle se compromettre à jamais, elle alla se confier à cet homme qui seul, du moins elle le croyait, pouvait une fois encore détourner le péril et conjurer l’orage.
Or, au moment où la voiture s’arrêtait à la porte du comte, où Hermine en descendait, un fiacre sortait par la porte cochère, emportant un homme dans lequel les invités de la marquise Van-Hop eussent reconnu sir Arthur Collins. Il vit et reconnut Hermine ; un hideux sourire vint à ses lèvres et illumina son visage couleur de brique.
– Ah ! enfin… murmura-t-il, le comte a décidément du bonheur.
Et le fiacre continua sa course.
XXVII
Que s’était-il donc passé ?
Fernand Rocher était sorti à cheval, comme à l’ordinaire, vers huit heures du matin. La veille, descendant au pas de Sarah la rue du Havre et la rue Tronchet, il s’en allait mélancoliquement, la tête inclinée sur sa poitrine, cherchant, mais en vain, à fuir le souvenir de l’inconnue, et n’y pouvant parvenir. Comme il allait traverser la place de la Madeleine, la cavale africaine, qui était quelque peu ombrageuse, fit tout à coup un écart, se cabra à demi et tourna sur ses deux pieds, effrayée par un bruit de grelots, de claquements de fouet et de roues grinçant sur le pavé. Une chaise de poste arrivait derrière lui au grand trot de ses quatre chevaux, et passa rapide comme l’éclair, tandis qu’il contenait et rassurait la bouillante Sarah.
Mais il avait obéi à un sentiment de curiosité banale, il avait jeté un coup d’œil dans la chaise pour voir quel était le voyageur qui quittait ainsi Paris avec bruit et fracas, et il avait aperçu à demi couchée au fond de la berline, enveloppée de fourrures, et seule, une jeune femme dont la vue lui arracha un cri de surprise, de joie et d’épouvante en même temps : c’était sa belle garde malade !
L’émotion qui s’empara de lui fut alors si forte que, pendant plusieurs minutes, il demeura cloué à la même place, maniant gauchement sa monture et la laissant livrée à tous ses caprices. Puis soudain, et comme dominé par cette mystérieuse attraction que cette femme étrange répandait autour d’elle, il mit l’éperon aux flancs de Sarah, et se lança à la poursuite de la chaise de poste, qui disparaissait en ce moment de l’autre côté du pont de la Concorde. Il voulait la revoir.
La belle voyageuse quittait sans doute Paris pour longtemps, car sa voiture était couverte de malles, et deux domestiques, un valet et une femme de chambre chaudement vêtus, étaient assis derrière.
Elle partait. C’en était assez pour que Fernand ne songeât plus ni à se guérir ni à oublier, pour qu’il n’eût plus qu’une préoccupation, qu’un désir, qu’un but, la rejoindre.
Et le petit hôtel de la rue d’Isly, sa femme, son enfant, sa vie calme et douce, tout ce qu’il avait retrouvé, disparut tout à coup de son souvenir, comme au réveil s’effacent les dernières et fugitives impressions d’un rêve…
Sarah était rapide comme le vent du désert où elle était née, mais la chaise de poste avait de l’avance ; un embarras de voitures, que son cavalier rencontra sur le pont de la Concorde, retarda encore la marche du noble animal. Fernand perdit la chaise de vue. Il fut obligé de se renseigner sur le chemin qu’elle avait pris en quittant le quai, et il arriva à la barrière d’Enfer environ vingt minutes après que la belle voyageuse l’avait franchie.
L’inconnue prenait la route d’Orléans.
Sans plus réfléchir, Fernand lança sa jument au galop, persuadé qu’il aurait bientôt rejoint la chaise de poste. Mais la chaise de poste allait un train d’enfer, le train d’un homme en faillite qui gagne la frontière belge. Ce ne fut que vers Montlhéry, à une demi-lieue de la fameuse tour chantée par Boileau, que le cavalier l’aperçut gravissant une côte au grand trot.
Jusque-là, et depuis le pont de la Concorde, il ne l’avait plus revue.
Fernand, dans l’état d’exaltation où il se trouvait, serait allé au bout du monde. Il ensanglanta les flancs de Sarah, il la fit bondir de douleur, et vingt minutes plus tard il atteignait enfin la chaise de poste, au moment même où elle entrait dans la petite ville d’Étampes et s’arrêtait, pour relayer, à l’hôtel de la Corne-d’Or.
Fernand s’approcha vivement de la portière de la berline et se montra à Turquoise, car c’était bien elle qui courait ainsi la poste.
Elle poussa un petit cri de surprise en le voyant ; puis elle l’enveloppa de son regard profond, arqua ses lèvres en un charmant sourire, et lui dit :
– Comment ! monsieur, vous voilà ?
– Oui, madame… balbutia-t-il, car il ne savait trop réellement que lui dire.
– Par quel hasard ? fit-elle jouant à merveille l’étonnement. Où allez-vous ?
– Je ne sais pas… dit naïvement le pauvre fou.
Elle laissa bruire un éclat de rire moqueur à travers ses dents blanches.
– En vérité, dit-elle, vous ne savez pas où vous allez ?
– Non.
– Mais, au moins, savez-vous d’où vous venez ?
– Je viens de Paris.
– Eh bien, laissez-moi au moins vous apprendre où vous êtes.
– Je ne sais pas, murmura-t-il, la contemplant avec extase.
– Vous êtes à Étampes, à mi-chemin d’Orléans et sur la route du Midi.
Et elle continua à sourire.
– Voyons, dit-elle, comment vous trouvez-vous ? Car il y a plusieurs jours que je vous ai vu, et bien que j’aie eu de vos nouvelles…
– Ah ! s’écria-t-il surpris et charmé, vous avez eu de mes nouvelles…
– Sans doute.
Et le regardant fixement, comme elle seule savait regarder :
– Ne croyez-vous pas, dit-elle, que j’avais un peu à cœur de savoir ce qu’était devenu mon malade ? Je quittais Paris pour longtemps, j’ai voulu partir avec la conviction que vous étiez rétabli.
– Vous… quittez… Paris… pour longtemps ? balbutia-t-il avec un accent effaré.
– Pour un an au moins, répondit-elle en baissant les yeux et avec un certain trouble dans la voix.
– Mais c’est impossible ! murmura-t-il.
– Comment, impossible, puisque me voilà en route ? Je vais à Florence passer le reste de l’hiver.
Elle lui tendit la main par un geste plein de mutinerie et d’abandon.
– Adieu… dit-elle ; souvenez-vous de ma lettre…
Ces derniers mots étaient un congé.
Déjà on attelait des chevaux frais ; quelques secondes encore, et la chaise repartait.
Fernand venait de prendre une résolution soudaine.
– Madame, dit-il vivement, vous ne pouvez partir sur-le-champ… à cette heure…
– Et… fit-elle en fronçant le sourcil, qui m’en empêchera ?
– Moi, dit-il froidement.
– Vous ?
Elle prononça ce mot d’une façon étrange.
– Moi, dit-il, parce que je vous poursuis depuis Paris à franc étrier et qu’il faut que je vous parle !
– Mais… monsieur…
– Madame, dit Fernand avec un calme effrayant, si vous me refusez, je me jette sous les roues de votre chaise de poste.
– Vous êtes fou ! répondit-elle ; mais je ne veux point causer votre mort… Voyons ce que vous avez à me dire.
Elle pencha la tête à la portière, appela son valet de chambre, lui ordonna de renvoyer les chevaux et de demander un appartement à la Corne-d’Or.
– Allons, dit-elle, mettez pied à terre, monsieur le paladin, et offrez-moi la main pour descendre.
Fernand sauta lestement à terre, jeta sa bride à un palefrenier, ouvrit la portière de la chaise et aida la jeune femme à descendre.
– Vous me permettrez, lui dit-elle, puisque je vous ai fait, sans le savoir, venir de Paris tout exprès pour moi, vous me permettrez de vous offrir à déjeuner, n’est-ce pas ? Je repartirai ce soir.
Elle entra à la Corne-d’Or et conduisit Fernand à la chambre qu’on lui avait préparée à la hâte. Alors, se laissant tomber sur une bergère et s’y pelotonnant avec cette grâce féline qui est le privilège des petites femmes :
– Je vous écoute, dit-elle, qu’avez-vous à me dire ?
Fernand n’en savait absolument rien. Il l’avait suivie, attiré par une force inconnue, il ne voulait pas qu’elle partît. C’était là tout ce qu’il lui fallait. Il demeura debout auprès d’elle, silencieux, hésitant, la contemplant avec une muette adoration.
– Mon pauvre monsieur Rocher, dit la Turquoise qui savourait cet embarras plein de souffrance avec la joie cruelle d’une bête fauve, je vous crois plus malade que vous ne le paraissez, et j’ai bien peur que ce coup d’épée que l’on croyait n’être qu’une égratignure…
– Ah ! interrompit Fernand, il m’a frappé là… au cœur.
Et puis, soudain, cet homme qui balbutiait et baissait les yeux sous ce regard de femme armée d’une puissance occulte, cet homme osa la regarder, et devint éloquent. Il osa se mettre à genoux devant elle. Il osa lui prendre la main…
– Madame, murmura-t-il d’une voix lente, grave, pleine d’émotion, plût à Dieu que mon adversaire m’eût atteint mortellement. Je serais mort sans souffrir.
– Allons donc ! fit-elle, est-ce qu’on meurt quand on est jeune, riche, beau, aimé, heureux comme vous !
– Ah ! vous ne savez pas, continua-t-il, ce que j’ai souffert depuis ce jour fatal où vous m’avez chassé de chez vous… Vous ne savez pas quelles tortures sans nom m’ont assailli, à quel désespoir j’ai été livré…
– Peut-être, répondit-elle d’une voix subitement émue.
Et cette femme de vingt ans eut alors une expression, un regard, une attitude, un accent maternel, tant il est vrai que la femme, si jeune qu’elle soit, est toujours plus âgée que l’homme ; elle prit sa main dans ses petites mains, et lui dit :
– Monsieur Rocher, vous êtes un enfant…
Et comme il frissonnait sous ce regard, comme il redevenait véritablement un enfant sous le charme de cette voix douce et triste, sous la pression de ces petites mains imprégnées d’une magnétique chaleur, elle poursuivit :
– Hélas ! je sais ce que vous allez me dire… Je sais déjà cet hymne de l’amour toujours neuf et toujours le même que vous allez me chanter, mon pauvre enfant, et je ne veux pas être coquette, je ne veux pas avoir l’air de tomber de surprise en surprise… Non, vous m’aimez, je le sais et je le vois… Aussi, je ne m’indignerai point, je ne rougirai pas, je ne cacherai point ma tête dans mes mains pour vous dissimuler ma confusion… Je laisse toute cette comédie aux femmes de quarante ans et ne la crois pas digne de moi… Mais je veux que vous m’écoutiez, monsieur, je veux que vous me laissiez vous parler le langage de la raison.
– Je vous aime… balbutia Fernand.
– Au lieu de m’aimer, écoutez-moi, vous ferez mieux.
Et la jeune femme lui laissa prendre une de ses mains qu’il porta à ses lèvres.
– Mon ami, reprit-elle d’un ton moitié sévère et moitié affectueux. Il y a huit jours, je ne songeais pas à quitter Paris.
– Ah ! vous voyez bien, fit-il.
– Il y en a quinze, vous m’étiez inconnu… On vous a transporté chez moi, une nuit, reprit-elle, blessé, évanoui. Était-ce l’effet du hasard ? Frappait-on à ma porte parce que ma porte était le plus près du combat ? Ou bien connaissais-je l’un des hommes qui étaient avec vous ? Permettez-moi de ne pas vous répondre sur ces choses.
– Soit, dit Fernand.
– Je vous ai soigné d’abord avec la sollicitude un peu banale qu’apporte toute femme chargée d’une mission semblable à la mienne, puis…
Elle s’arrêta.
– Eh bien ? fit-il avec anxiété.
– Puis, murmura-t-elle, rougissant un peu, je me suis intéressée à vous.
Il tressaillit.
– Puis, hélas ! continua-t-elle d’une voix qui perdit soudain toute son assurance, j’ai craint de vous aimer…
Fernand jeta un cri de joie et couvrit ses mains de baisers.
Elle lui retira ses mains.
– J’ai songé alors que vous étiez marié, dit-elle brusquement, marié et père…
À son tour, Fernand baissa les yeux et la tête.
– Alors, reprit-elle, j’ai compris que si je venais à vous aimer, mon amour serait un supplice… et c’est pour cela que je vous ai congédié de la façon que vous savez.
– Mais moi aussi je vous aime ! s’écria Fernand qui oublia sa femme en ce moment et ne vit plus que Turquoise.
– Ah ! dit-elle, quand vous saurez… vous ne m’aimerez plus.
– Que saurai-je ?
– Ce que je suis.
– Vous êtes une noble et belle créature, dit-il avec feu.
Elle soupira.
– Tenez, dit-elle, laissez-moi continuer ma route, laissez…
– Non, répondit-il avec l’accent de la passion, non, vous ne partirez pas… Je vous aime !…
Elle eut un triste sourire.
– Avez-vous jamais, reprit-elle, entendu parler de ces femmes légères dont la situation est équivoque dans le monde… et qui, acheva-t-elle en rougissant, n’ont pas de mari ?…
Fernand tressaillit et la regarda.
– Je suis, ou plutôt j’étais, dit-elle avec une noble confusion, une de ces femmes-là, le jour où vous êtes entré chez moi…
– Et… à présent ?
– À présent, hélas ! je suis une pauvre créature touchée par l’amour et qui ne demande plus au monde que le pardon et l’oubli…
Fernand se mit à genoux.
– Mon Dieu ! lui dit-il, je ne veux pas savoir qui vous avez été. Je ne vois, je ne sais qu’une chose, c’est que vous êtes belle, c’est que vous êtes bonne, c’est que sans vous je serais mort, et que je vous aime avec passion, avec délire, avec frénésie.
Turquoise cacha sa tête dans ses mains.
– Mon Dieu ! mon Dieu ! murmura-t-elle en fondant en larmes.
Turquoise pleurait… Donc elle était vaincue… donc elle ne partirait pas…
* *
*
Fernand et Turquoise passèrent le reste de la journée à Étampes, oubliant la terre entière pour ne songer qu’à eux-mêmes.
La blonde complice de sir Williams était réellement une femme forte dans toute l’acception du mot. Elle savait feindre la passion dans ses plus hardis écarts, dans ses détails les plus habiles et les plus minutieux…
Fernand Rocher, au bout de quelques heures, demeura convaincu que cette femme devait s’être aussi complètement réhabilitée par l’amour que Desdémona ou Manon Lescaut ; et, nouveau Desgrieux, il se sentit à tout jamais lié et enchaîné à elle.
Du reste, Turquoise avait si bien calculé et ménagé tous ses effets, qu’elle mit la journée tout entière à se rendre et déploya des merveilles d’éloquence pour prouver à Fernand que précisément parce qu’ils s’aimaient, ils devaient se séparer pour toujours. Si bien que le soir vint et que, déjà, les chevaux étaient à la chaise de poste et piaffaient dans la cour de la Corne-d’Or, que Fernand ne savait encore si elle consentirait à revenir à Paris. Ce ne fut qu’au dernier moment, toute prête à monter en voiture, que, lui tendant la main et le regardant avec égarement, elle lui dit :
– Me jurez-vous que vous m’aimez ?
– Je vous le jure, dit-il.
– M’aimerez-vous longtemps ?
– Toujours.
Il mit dans ce mot l’élan de sa passion.
– Alors, soupira-t-elle, retournons à Paris…
Elle prononça ces mots comme un vaincu raconterait sa défaite. Puis elle s’appuya sur son bras, et ajouta, tandis qu’ils descendaient dans la cour de l’auberge :
– Il ne faut pas songer à ramener votre cheval de pied, qui en prendra soin ?
Certes, Fernand connaissait la valeur de Sarah ; il savait fort bien qu’elle aurait pu, sans peine, aller à Étampes et en revenir sans débrider ; mais pouvait-il refuser ce bonheur de monter dans la berline auprès de la jeune femme ?
– Comme vous voudrez, répondit-il.
Turquoise fit un signe au valet.
Fernand oublia de lui recommander de conduire Sarah rue d’Isly.
Et la chaise partit au grand trot et reprit la route de Paris, qu’elle atteignit en quelques heures et traversa dans le milieu de la nuit.
L’oublieux Fernand ne songea point à l’inquiétude qui devait régner chez lui depuis le matin, au désespoir de sa femme qui l’attendait vainement. Il ne demanda point à sa belle conductrice en quel lieu elle le conduisait.
La chaise descendit la rue Saint-Jacques, traversa la Seine au pont Neuf, près de la rue de la Monnaie, tourna à l’église de Saint-Eustache, remonta la rue et le faubourg Montmartre, et finit par entrer dans le jardin de ce petit hôtel de la rue Moncey que nous connaissons.
* *
*
Le lendemain, comme le premier rayon de soleil glissait à la cime des toits voisins, le valet de pied de Turquoise, qui était parti d’Étampes vers minuit, arriva rue Moncey, monté sur la belle jument arabe. Turquoise, déjà levée, descendit et ordonna au laquais d’aller lui chercher un commissaire médaillé.
– Je vais m’amuser un peu, pensa-t-elle, et donner à ma façon des nouvelles de son mari à la belle madame Rocher.
Et Turquoise eut un mauvais sourire.
Dix minutes après, le valet revint suivi du commissaire.
– Mon ami, dit Turquoise à ce dernier, voulez-vous gagner vingt francs ?
– Oui, madame, répondit le Savoyard, émerveillé de l’aubaine.
– Vous allez conduire ce cheval rue d’Isly, à l’hôtel Rocher.
– C’est facile.
– On vous demandera, continua Turquoise, d’où vous venez et qui vous a remis cette bête. Alors vous répondrez ceci :
« – Je suis commissionnaire aux Champs-Élysées. J’ai vu passer tout à l’heure une calèche bleue dans laquelle était une jeune femme.
« – Un monsieur, qui montait cette bête, trottait à côté de la calèche. En m’apercevant, il m’a fait signe d’approcher, m’a remis son cheval en m’ordonnant de le conduire rue d’Isly, et il est monté dans la calèche, à côté de la dame. »
« Avez-vous compris ?
– Oui, madame, répondit le commissionnaire, qui prit les vingt francs que Turquoise lui tendait, passa la bride de Sarah à son bras et l’emmena.
On sait avec quelle scrupuleuse exactitude le commissionnaire exécuta les ordres de Turquoise, qui, une heure après, disait à Fernand :
– Mon ami, mon valet de pied est de retour ; ne vous inquiétez point de Sarah, il l’a conduite rue d’Isly.
XXVIII
Un soir, madame Charmet rentra chez elle vers cinq heures et descendit de son modeste fiacre, en tenant par la main une jolie petite fille de quatorze à quinze ans.
La vierge folle repentie, la femme qui s’était nommée la Baccarat, avait beaucoup couru toute la journée ; infatigable dans l’accomplissement de son œuvre, la dame de charité arrachait chaque jour une pauvre enfant au vice et la ramenait dans le droit chemin.
Ce jour-là, elle avait sauvé une famille tout entière, ou plutôt trois orphelines, trois sœurs que l’oisiveté et le vice allaient prendre au moment où elle était intervenue comme un pieux agent de la Providence. L’aînée, qui avait vingt ans, avait été placée, en qualité de femme de chambre, dans une famille anglaise ; la seconde, qui en avait dix-sept, était entrée dans un magasin de soieries comme demoiselle interne. Quant à la troisième, qui touchait à sa quinzième année, et qu’un mercier débauché, Géronte au petit pied, Richelieu de boutique, essayait de séduire, Baccarat s’en était chargée provisoirement.
Baccarat conduisit la jeune fille dans ce grand et triste salon, aux boiseries noires, qui était la pièce de réception du petit hôtel de la rue de Buci ; elle s’assit un moment auprès du feu avec elle, et lui dit en la baisant au front :
– Ne t’ennuieras-tu pas trop avec moi, mon enfant ?
– Oh ! non, madame, répondit la petite juive, car elle et ses sœurs étaient de pauvres israélites que Baccarat avait trouvées, grelottant de froid, mourant de faim et prêtes à suivre celui qui les aurait voulu emmener, dans un misérable grenier de la rue de la Verrerie.
Et elle ajouta avec une naïve admiration :
– Vous êtes si belle, madame… et puis si bonne… et c’est si beau, ici !
L’enfant n’avait jamais vu un luxe pareil à celui qui l’environnait, c’est-à-dire que cette maison triste et sombre, ce salon à l’aspect monastique lui apparaissaient comme un palais de roi.
La jeune fille avait quinze ans, mais elle était si petite, si frêle, qu’on lui en eût à peine donné douze. Elle avait ces grands yeux noirs qui brillent d’une lueur profonde et comme inspirée, ce teint d’un brun doré qui semble rappeler les chauds rayons du soleil d’Orient, ces lèvres couleur de carmin, ces dents blanches et ces cheveux plus noirs que l’aile du corbeau, signes caractéristiques de sa race, dont elle paraissait résumer le type le plus pur. Ses pieds et ses mains d’enfant étaient d’une forme admirable, son bras nu, du galbe le plus pur. Elle se nommait Lia, comme la seconde femme de Jacob.
Baccarat s’était sentie entraînée vers ce charmant petit être, et l’austère femme, la pénitente qui avait renoncé aux joies de cette terre pour ne songer qu’à Dieu, Baccarat avait eu, à sa vue, comme une pensée mondaine ; elle avait songé à adopter cette enfant, à la prendre avec elle, à en faire sa compagne…
Puis, elle avait une arrière-pensée, celle de l’instruire dans le dogme catholique et de lui faire abjurer sa religion. Elle avait donc donné à choisir à l’enfant : ou entrer dans un atelier, ou demeurer avec elle, et la petite juive n’avait point hésité ; – elle avait suivi sa bienfaitrice, – elle arrivait avec elle, pour la première fois, dans la maison de la rue de Buci.
Baccarat lui fit chauffer les pieds, lui prit ses petites mains dans les siennes, et la conduisit tout doucement dans la pièce voisine :
– Je vais te montrer ta chambre, mon enfant, c’est là que tu coucheras… tout près de moi.
Elle poussa une porte qui donnait dans le salon, et l’introduisit dans une petite chambrette garnie d’un lit en fer, d’une table, de deux chaises, avec des rideaux blancs au lit et à la croisée.
L’enfant était ravie.
– Je t’apprendrai à lire et à écrire, continua la dame de charité, ensuite je te ferai coudre et broder…
– Tout ce que vous voudrez, ma belle madame, répondit la petite juive ; je ferai tout ce qui vous plaira… Vous avez l’air si bon !
Baccarat allait embrasser l’enfant pour la remercier de cette réponse, lorsqu’elle entendit un coup de cloche dans la cour.
Ordinairement, les quelques personnes qui visitaient madame Charmet, telles que des prêtres, de vieilles dames patronnesses et un des administrateurs des hospices, ne se présentaient jamais passé cinq heures dans la rue de Buci. Ce ne pouvait donc être qu’une visite inaccoutumée, insolite, et ayant un but des plus sérieux ; du moins elle le pensa.
À tout hasard, madame Charmet sonna et remit l’enfant à la vieille servante.
– Va te chauffer à la cuisine, ma petite, dit-elle, tu ne travailleras que demain. Geneviève te conduira tout à l’heure dans un magasin et t’achètera du linge et des vêtements.
Au moment où la jeune fille sortait du salon avec Geneviève par une porte dérobée qui conduisait aux offices, l’unique domestique mâle de la maison introduisit une femme par la grande porte.
Cette femme, c’était Cerise.
Madame Rolland venait rarement voir sa sœur, malgré l’affection qui les unissait. Dans la journée, Baccarat était presque toujours hors de chez elle, et, le soir, Cerise demeurait avec son mari, auquel elle faisait oublier, par ses soins et sa gentillesse, les fatigues de sa rude journée de travail.
Quand les deux sœurs se voyaient, c’était presque toujours chez la cadette. Baccarat avait souvent des jeunes filles à recommander à sa sœur, de pauvres ouvrières sans travail, quelquefois un père de famille dont le salaire était insuffisant, et que Léon prenait dans son atelier. Grande fut donc la surprise de la sœur aînée, en voyant arriver sa cadette chez elle à cette heure crépusculaire ; mais sa surprise se changea subitement en inquiétude lorsqu’elle l’eut envisagée.
Cerise était méconnaissable. Ce n’était plus la fraîche et belle jeune femme dont le visage rayonnait d’un calme bonheur, dont le sourire trahissait les joies multiples de l’épouse aimée et de la mère heureuse et pleine d’un noble orgueil… Cerise était pâle, amaigrie, ses yeux étaient cernés d’un cercle de bistre, ses lèvres avaient une pâleur bleuâtre, son regard était morne, tous ses mouvements semblaient révéler la souffrance… Elle se jeta dans les bras de sa sœur, et lui dit d’une voix brisée :
– Je viens à toi, car je souffre mille tortures depuis huit jours, et n’ose et ne veux me confier qu’à toi…
– Tu souffres ! s’écria Baccarat avec un subit élan de tendresse qui sembla revêtir une nuance maternelle ; tu souffres, ma petite sœur bien-aimée, tu souffres depuis huit jours, et je l’ignorais !
Elle la couvrit de baisers, prenant ses mains dans les siennes, ainsi qu’aurait fait une mère ; puis, l’entraînant vers la cheminée, elle s’assit et la prit sur ses genoux…
– Voyons, lui dit-elle, qu’as-tu ? pourquoi souffres-tu ?
Cerise appuya la main sur son cœur et fondit silencieusement en larmes.
– Mon Dieu ! murmura Baccarat, ton enfant…
– Oh ! il va bien, répondit la jeune femme d’une voix étouffée.
– Ton mari ?…
Cette fois, Cerise se tut, mais ses larmes coulèrent plus abondamment.
– Léon est malade ?… interrogea Baccarat.
– Non… oh ! non…
Et Cerise sanglota.
Baccarat devina vaguement quelque scène d’intérieur, quelque querelle domestique, et la pieuse femme, la pécheresse repentie, qui n’avait plus ni passions, ni colères, sentit tout à coup qu’il restait encore au fond de ses veines quelques gouttes du sang impétueux de la courtisane ; elle eut un cri qui ressembla à un rugissement de la lionne blessée.
– Ah ! dit-elle, si Léon s’était permis de faire la moindre peine à ma petite Cerise, foi de Baccarat ! il ne serait châtié que de ma main.
Et elle eut un regard étincelant comme un éclair et qui rappelait cette femme énergique et hardie qui, un soir, dans la maison de fous, appuya la pointe d’un poignard sur la gorge de Fanny, renversée et captive sous son genou vigoureux.
– Ah ! dit Cerise, il est plus malheureux que coupable… pardonne-lui… il est fou…
Alors, comprimant ses sanglots, essuyant ses larmes, la pauvre jeune femme raconta à sa sœur quel affreux changement s’était opéré dans sa vie depuis quelques jours. Léon ne l’aimait plus. Léon était infidèle et comme en proie à une folie étrange.
Aux heures solennelles, la femme la plus simple, la plus dépourvue d’imagination, puise au fond de son cœur une poésie grandiose et sublime, une éloquence poignante, un art de dire qui emprunte à la douleur une élégance de forme et de langage inusitée. Cerise dépeignit avec une chaleur d’expressions, une poésie simple et touchante, une élévation sublime de pensées, l’histoire de ces quelques jours qui avaient suffi pour changer son bonheur en torture et sa joie en deuil… Elle raconta à sa sœur comment, pris tout à coup de tristesses mortelles, devenu sombre et taciturne, lui toujours souriant et plein de franchise, son mari avait fini par se montrer brusque, chagrin, brutal, par fuir la maison conjugale, négliger le travail, l’atelier, et se faire, au-dehors, une existence mystérieuse et coupable… Depuis huit jours, Léon fuyait son atelier, ses ouvriers, sa femme, pour vivre on ne savait où. À peine s’occupait-il de ses affaires, à peine se montrait-il aux heures des repas. Il avait pris Cerise en aversion, il brusquait sa mère, s’échappait comme un criminel chaque soir, et ne rentrait que bien avant dans la nuit… Sa vie paraissait être un enfer ; la nuit, Cerise l’entendait prononcer un nom de femme dans ses rêves, un nom, hélas ! qui n’était pas le sien.
Elle dit tout cela à sa sœur, entremêlant son récit de ses larmes et lui disant qu’elle voulait mourir.
– Mourir ! s’écria Baccarat, mourir ! toi, mon enfant, toi, belle et vertueuse comme les anges ! Ah ! dussé-je redevenir la femme d’autrefois, dussé-je le suivre pas à pas, jour par jour, heure par heure, jusqu’à ce que j’aie découvert l’indigne créature qui t’a pris ton mari, je te le rendrai !
Et Baccarat pressa de nouveau Cerise sur son cœur, essuya ses larmes avec ses baisers, lui fit mille promesses, lui jurant qu’elle lui rendrait l’affection de son époux, qu’elle le ferait rougir de son odieuse conduite et le ramènerait à ses genoux, repentant et plus épris.
– Tiens, lui dit-elle tout à coup, veux-tu rester avec moi ? Jusque-là veux-tu partager ma vie ? Je t’aimerai tant, moi, petite sœur chérie, que tu ne pleureras plus, que tu seras presque heureuse !…
Et Baccarat lui souriait comme une mère à son fils, cherchant à lui faire reprendre courage.
– Et mon enfant ! s’écria Cerise, chez laquelle l’instinct maternel se réveilla puissant et vivace.
– Eh bien, va chercher ton enfant.
– Oh ! dit-elle, non, car il l’aime encore, lui, il l’embrasse chaque jour… il ne vient plus à la maison que pour lui. Et elle ajouta avec un sentiment de terreur profonde : – Il me tuerait, si j’emportais son enfant…
– Eh bien, va, dit Baccarat, rentre chez toi ; j’irai te voir, ce soir même, à neuf heures.
Baccarat souffrait de voir sa pauvre Cerise brisée et abattue ; mais, au milieu de sa nouvelle et pieuse vie, elle n’avait point oublié les agitations de sa première existence, et elle avait conservé cette connaissance profonde du cœur humain et des passions, si vite et si chèrement acquise par les vierges folles. Elle avait vu bien des femmes abandonnées et trahies, mais elle savait par expérience qu’il n’est chez l’homme qu’un seul amour qui survive à tous les autres, qui ait le magique pouvoir de renaître, comme le phénix, de sa propre cendre, et sur lequel il suffit d’un souffle pour le ranimer plus ardent et plus vivace. Elle savait que si l’homme aime souvent et change souvent d’idole, il ne conserve qu’un seul amour réel et sérieux au fond de son âme, il n’aime qu’une fois. Et Baccarat se souvenait combien Léon avait aimé sa sœur, et d’avance elle était assurée du succès ; elle ne doutait pas un moment qu’elle ne le ramenât pour toujours à sa femme. Ce n’était, à ses yeux, qu’une affaire de temps ; mais il semblait que, ce soir-là, le hasard voulût donner un formel démenti aux convictions de Baccarat.
Tandis que Cerise se levait pour sortir, la cloche de la porte d’entrée se fit entendre de nouveau, et les deux sœurs tressaillirent.
Bientôt après, on annonça :
– Monsieur Andréa !
À ce nom, Baccarat tressaillit et Cerise devint subitement toute pâle.
Jamais, en dépit de son repentir et de la croyance où elle était que le frère d’Armand de Kergaz était devenu un saint homme, Cerise ne se rencontrait avec lui sans éprouver un premier mouvement d’effroi. Elle le vit entrer, et, involontairement, elle fit un pas en arrière. Pourtant le vicomte n’avait plus rien en lui-même du trop célèbre baronet Williams. Il était voûté, vieilli, courbé ; il portait sur son visage les traces indélébiles de la souffrance et peut-être du remords. Le baronet sir Williams n’était plus, hélas ! un objet de terreur, mais bien plutôt un objet de pitié.
– Ma chère dame, dit-il en saluant Cerise humblement, comme saluent ceux qui ont des torts graves à se faire pardonner, et s’adressant à Baccarat, pardonnez-moi de venir aussi tard, mais Armand a tenu à ce que je vous voie ce soir même. J’ai d’importantes choses à vous communiquer.
– Asseyez-vous, monsieur le vicomte, répondit Baccarat, je reconduis ma sœur et suis à vous…
Andréa s’approcha de la cheminée, demeura debout, son chapeau à la main, exposant ses pieds, couverts d’une grossière chaussure, à la flamme du foyer.
Cerise sortit, reconduite par Baccarat.
Elle s’en serait allée un peu calmée, une minute auparavant, ayant au cœur un vague espoir que les consolations et les promesses de Baccarat y avaient allumé ; mais il avait suffi du nom, de la vue, du son de la voix du vicomte Andréa, pour faire naître en son cœur un trouble subit et inexprimable. Elle s’était reprise à trembler, et se sentit froid au cœur au moment où elle franchissait le seuil du salon dont Baccarat ferma la porte sur elle. Soudain, et tandis qu’elles traversaient le vaste et sombre vestibule de la maison, Cerise saisit vivement le bras de sa sœur :
– Ah ! dit-elle, quelle étrange et terrible idée !
– Qu’as-tu ? exclama Baccarat inquiète…
– Oh ! non, c’est impossible !…
– Mais… qu’as-tu ? quelle est cette idée ?
– Non, je suis folle…
Et Baccarat sentit la main de sa sœur frissonner dans la sienne.
– Mais parle donc ! lui dit-elle… parle… quelle est cette idée ?…
– Écoute, murmura Cerise à voix basse, tout à l’heure, là… quand il est entré, cet homme qui nous a fait tant de mal…
– Eh bien ? demanda la sœur.
– Eh bien, il m’a semblé que c’était lui encore… lui qui m’enlevait le cœur de Léon… J’ai ressenti comme un coup sourd dans le cœur.
Baccarat tressaillit.
– Tu as raison, dit-elle, cette idée est inadmissible… et tu es folle…
Puis elle lui mit un dernier baiser sur le front et la renvoya.
Mais cette supposition de Cerise, si folle, si bizarre en apparence, cette pensée que le vicomte Andréa pouvait être le bras mystérieux qui la frappait, avait fait tressaillir Baccarat des pieds à la tête. Pour la seconde fois, un soupçon terrible était revenu à la jeune femme sur le prétendu repentir d’Andréa ; et, pour la seconde fois, elle se demanda si cet homme, foulé aux pieds, humilié, déçu dans tous ses espoirs, dans tous ses rêves, cet homme qui s’était retiré de la lutte avec le sourire superbe que l’ange déchu dut avoir en roulant dans l’abîme, et qui reparaissait tout à coup, au bout de quatre années, courbé sous le fardeau de ses remords, menant une vie ascétique, acceptant le rôle le plus humble ; elle se demanda si cet homme n’était pas un de ces comédiens héroïques et terribles, un de ces protées aux mille formes, qui n’avait accepté une dernière métamorphose que dans un but ténébreux et impitoyable de vengeance. Et pendant quelques secondes, madame Charmet demeura immobile, les bras croisés, le front pensif, dans la solennelle attitude de la méditation.
– Ah ! se dit-elle enfin, sentant se réveiller en elle cet espoir de sourdes intrigues, ce génie des luttes intellectuelles où la ruse des femmes acquiert des proportions grandioses, et qui avait présidé à la première moitié de sa vie, je le saurai ! je fouillerai si bien ce cœur et ce cerveau, j’y ferai si bien pénétrer mon regard et ma pensée, que j’y veux lire, tôt ou tard, comme en un livre ouvert.
Elle rentra au salon.
Le vicomte Andréa était toujours debout devant la cheminée et tournant le dos à la porte.
– Pardonnez-moi, monsieur le vicomte, lui dit Baccarat, je vous ai fait attendre…
Il salua de nouveau, baissant les yeux.
– Je suis à vos ordres, répondit-il.
Elle lui indiqua un siège.
– Je vous en prie, lui dit-elle, veuillez vous asseoir…
Il n’osa pas refuser, et s’assit dans le fauteuil que Baccarat lui indiquait du doigt.
Or, en lui désignant ce siège, l’intelligente femme obéissait à une soudaine inspiration. Il y avait sur la cheminée, à côté d’un grand bloc de marbre noir qui servait de cage à la pendule, une lampe dont les rayons tombèrent d’aplomb sur le visage du vicomte. L’ombre de la pendule se projetait, au contraire, sur l’angle opposé de la cheminée, laissant ainsi Baccarat dans une demi-obscurité. Elle pouvait donc le voir presque sans être vue, l’examiner attentivement, épier les moindres tressaillements, les impressions les plus rapides et les plus passagères de son visage, sans qu’il eût le même avantage sur elle…
Et ces deux intelligences d’élite, nous dirions volontiers ces deux génies du grand drame dont nous sommes l’historien, se trouvèrent alors seuls et face à face, se regardant et s’observant comme s’observaient et se regardaient les gladiateurs antiques avant de croiser le fer meurtrier.
La guerre allait-elle donc surgir de cet examen ?
XXIX
Il y eut comme un moment de silence entre madame Charmet et le vicomte Andréa.
– Monsieur le vicomte, dit enfin Baccarat, avez-vous découvert quelque chose ?
– Relativement aux Valets-de-Cœur ?
– Précisément.
– Je crois tenir un des fils de l’intrigue, répondit-il avec calme, d’une voix nette, bien accentuée, et qui emportait la conviction.
– Ah ! dit Baccarat, voyons ?
– D’abord, poursuivit le vicomte, je dois vous dire que mon sentiment sur cette association est qu’elle se compose d’autant de dames que de valets.
– Vous croyez ?
– La première note de la police d’Armand définissait mal cette mystérieuse institution. L’association des Valets-de-Cœur a pris naissance dans le quartier Bréda, entre quelques femmes bien lancées et quelques Arthur intelligents, – ce qui est rare parmi les Arthur. – D’abord, l’unique but de ce compagnonnage des deux sexes a été le commerce des lettres d’amour – un commerce vieux comme le monde – ce qui prouve que, de tout temps, les femmes ont eu la rage d’écrire, et les hommes, la bêtise de leur répondre.
– C’est vrai, murmura Baccarat, qui jeta malgré elle un regard dans le passé, et se souvint de la lettre que lui avait dictée ce même homme vertueux et repentant à cette heure, et que le Beaupréau avait laissée traîner sur le tapis de son salon.
– Puis, à ce commerce, poursuivit Andréa, l’association a ajouté diverses branches d’industrie. Ainsi, par exemple, un Arthur se fait présenter dans le monde par un mari fourvoyé dans Bréda-street, y fait valoir sa jolie figure, plaît à quelque femme de quarante ans qui le prend au sérieux ; et comme le mari de cette dame soupire précisément à la même heure aux genoux de la lorette de ce même Arthur, voilà un ménage, une famille tout entière qui se trouve à la merci d’un drôle et de sa maîtresse.
– Mais enfin, dit madame Charmet, cette association a un chef ?
– Oui, une femme.
– Quelle est-elle ?
– Écoutez, dit le vicomte d’un air confidentiel, avant d’aller plus loin, laissez-moi vous apprendre un malheur… car c’est pour cela que je viens…
Baccarat tressaillit ; mais son visage était dans l’ombre, et il fut impossible au vicomte de saisir la moindre altération dans ses traits.
– Je veux vous parler, continua-t-il avec une sorte d’émotion, d’un homme que nous devons aimer, vous et moi, car nous avons été bien coupables… envers lui.
Ce fut une maladresse du vicomte de faire précéder de cet exorde la révélation qu’il apportait, car il donna le temps à Baccarat de se tenir sur ses gardes ; et bien qu’elle eût éprouvé un saisissement subit, un serrement de cœur instantané, en devinant qu’il allait être question de Fernand, elle eut la force de se contenir, de se raidir contre tout événement, et sa voix demeura calme.
– Ah ! dit-elle, serait-ce de M. Rocher qu’il s’agit ?
– Hélas !… soupira hypocritement Andréa.
– Mon Dieu ! qu’allez-vous me dire ?… Est-il malade ?… mourant ?… mort ?…
– Il est aux mains de cette association dont nous parlions tout à l’heure.
– C’est impossible, dit Baccarat, M. Rocher aime sa femme…
– Il l’aimait, du moins.
Si forte qu’elle fut, Baccarat eut un éblouissement, une horrible angoisse l’étreignit.
– Écoutez, madame, poursuivit le vicomte d’un ton si naturel, si tristement convaincu, qu’il devait l’avoir étudié longtemps à l’avance, M. Rocher a une maîtresse…
Ces mots furent comme un coup de foudre tombant sur Baccarat, et il s’éleva au fond de son âme quelque chose qui ressemblait à un ouragan, à une tempête qui se déchaîne tout à coup en pleine nuit et soulève précipitamment les flots de la mer, tout à l’heure calmes et unis.
Le cœur humain renferme d’impénétrables mystères : Baccarat, devenue madame Charmet, Baccarat ayant renoncé pour jamais à Fernand, se réveillait tout à coup telle qu’elle était avant sa conversion, pleine de fougue et de passion, jalouse et prête à faire la guerre à une rivale heureuse. Elle s’était inclinée devant la femme légitime, devant l’amour chaste et pur ; elle s’était retirée à l’écart dans l’ombre, comme le pécheur indigne qui n’ose franchir le seuil du temple ; le bonheur de Fernand, son amour pour Hermine semblaient lui défendre d’approcher. Mais voici que, tout à coup, on venait lui dire : Fernand a une maîtresse ! c’est-à-dire : cet homme que vous avez tant aimé, pour lequel vous êtes devenue criminelle, cet homme pour qui vous fussiez morte en souriant, ne vous a dédaignée que pour se donner à quelque femme indigne de lui, quelque chose comme une de vos pareilles d’autrefois… Et le lion dompté rentrait en fureur ; ce cœur, résigné à l’oubli, se reprenait à battre ; Baccarat redevenait jalouse, sinon pour elle, au moins pour Hermine.
– Oui, répéta Andréa, Fernand Rocher a une maîtresse, une fille entretenue qu’on nomme la Turquoise, et, chose singulière ! cette fille habite précisément votre ancien hôtel, rue Moncey.
Cette révélation fut le dernier coup porté au sang-froid de Baccarat. Elle étouffa un cri, elle devint horriblement blême… elle se sentit défaillir.
Le vicomte tenait les yeux baissés, il avait l’attitude d’un homme qui souffre. Et cependant le bourreau tressaillit au dedans de lui d’une joie suprême et cruelle ; au silence que garda tout à coup la pauvre femme, le tourmenteur comprit combien sa vengeance était complète dès la première heure. Le supplice de Baccarat commençait.
Alors le vicomte entra dans les détails les plus minutieux, racontant à sa manière comment, à la suite du coup d’épée reçu à l’issue du bal du marquis Van-Hop, Fernand avait été transporté évanoui chez la maîtresse de son adversaire, la folle passion qui en était résultée, son retour au domicile conjugal, puis son nouveau et brusque départ.
Baccarat l’écouta jusqu’au bout, sans dire un mot, sans faire un geste. Elle avait puisé dans sa douleur une force morale extraordinaire, et quand il eut terminé son récit, elle se leva à demi, comme si elle eût voulu braver la clarté de la lampe et montrer son visage, redevenu calme, impassible, muet, à sir Williams.
Tout autre que ce dernier se fût dit, à l’aspect de cette tranquillité : « Elle ne l’aime plus… peu lui importe ! » Mais lui, l’homme dont le regard fouillait les plus intimes pensées, il se contenta de s’avouer que Baccarat était plus forte qu’il ne l’aurait jamais cru, et sa défiance s’en trouva éveillée.
– Eh bien, dit Baccarat, dont la voix ne se trouva pas plus altérée que son visage, quel rapport cela peut-il avoir avec les Valets-de-Cœur ?
– Vous allez le savoir, madame. Figurez-vous qu’un de mes agents a trouvé le billet que voici, sans signature et décacheté. Ce billet était dans la poche d’une robe pendue à l’étalage d’une marchande à la toilette…
Andréa tendit à madame Charmet le billet, ainsi conçu :
« Ma chère petite, Arthur a négocié tes deux lettres. Sa femme ne peut donner que six mille francs, et encore a-t-elle accroché chez ma tante pas mal de breloques. Mais elle promet de laisser son mari retourner chez toi. Tu te rattraperas de ce côté. J’ai donc mille écus à ta disposition. Le reste appartient à la caisse. »
– Ce billet est sans signature, observa le vicomte, mais voyez-vous dans le coin ce V majuscule, et, auprès, ce cœur tracé d’un coup de plume ?
– Je les vois, dit Baccarat.
– Maintenant, poursuivit-il, regardez cet autre billet qui est exactement de la même écriture.
Et il remit à la jeune femme la lettre écrite par Turquoise à Hermine, et au bas de laquelle Fernand avait écrit son nom.
– Vous le voyez, dit-il, il n’y a pas un doute à avoir, Fernand est tombé dans les mains de cette association. Il est trop riche pour qu’elle puisse le ruiner, mais elle peut tuer sa pauvre femme, qui est au désespoir depuis quelques jours.
Baccarat écoutait pensive, et comme si elle eût prêté à la fois l’oreille à la voix du vicomte et à une voix intérieure qui s’élevait au fond de son âme. Elle avait repris sa place au coin de la cheminée, dans la pénombre projetée par la pendule, et son œil ardent étudiait toujours le visage humble et triste d’Andréa.
– Monsieur le vicomte, dit-elle tout à coup, savez-vous que ce que vous m’apprenez là est d’autant plus effrayant que ma sœur sort d’ici tout en larmes ?
« Oui, reprit-elle, il paraît que, depuis quelques jours, ma pauvre sœur a le même sort que madame Rocher. Son mari, jusqu’ici honnête, laborieux, rangé, plein d’adoration pour elle, se dérange depuis une semaine ou deux… Lui aussi, paraît-il, a une maîtresse…
Et, en parlant ainsi, Baccarat, toujours dans l’ombre, attachait un regard investigateur sur Andréa.
– Il est certain, répondit celui-ci, qu’il y a là une coïncidence extraordinaire.
– Monsieur le vicomte, interrompit brusquement Baccarat, vous me pardonnerez, n’est-ce pas ? mais j’ai eu tout à l’heure un affreux soupçon.
Il la regarda et ne parut pas comprendre.
– Tenez, continua-t-elle, de vous à moi on peut tout se dire ?
– Hélas ! soupira-t-il, nous avons fait partie, l’un et l’autre, des brebis galeuses.
– Puisque vous en convenez, mon aveu me pèsera moins, poursuivit-elle avec tristesse. Je me suis imaginé un moment, en entendant pleurer ma sœur, en écoutant le récit du malheur qui frappe madame Rocher… j’ai cru voir dans ce rapprochement… dans cette coïncidence… quelque chose comme une main invisible armée pour la vengeance.
– Continuez, dit tranquillement Andréa, voyant que Baccarat hésitait.
– Eh bien, – et son œil était rivé au front impassible du vicomte, – eh bien, j’ai cru un moment que vous, touché par le repentir, touché par la grâce divine, vous dont la vie est une longue expiation… vous étiez ce bras armé dans l’ombre, cette main haineuse et vengeresse…
Baccarat s’arrêta.
Le vicomte Andréa gardait le silence, et ses yeux étaient baissés ; cependant son visage exprimait une sorte de joie douloureuse.
– Tenez, dit-il enfin en prenant la main de Baccarat et la portant à ses lèvres, laissez-moi baiser la main qui me châtie… En doutant de mon repentir, vous m’avez fait comprendre que Dieu ne m’avait point pardonné encore.
Et il dédaigna de protester, de s’indigner des soupçons de la jeune femme ; il se contenta de pousser un humble soupir, et ce maintien, cette conduite touchèrent plus Baccarat que des dénégations formelles.
– Pardonnez-moi, lui dit-elle, j’ai été folle et me suis trop souvenue du baronet sir Williams.
Pourtant, quand le soupçon est une fois entré au cœur d’une femme, il est si difficile de l’en extirper, que Baccarat se contenta de douter. Mais une circonstance imprévue, indépendante de la volonté d’Andréa, un de ces événements minimes en apparence et qui, quelquefois, ont la fulgurante puissance de l’éclair, vint presque aussitôt changer ses soupçons en certitude.
– Madame, dit le vicomte, mon frère Armand vous attend ce soir à l’hôtel de Kergaz, y viendrez-vous ?
– Oui, monsieur, à quelle heure ?
– À dix heures, répondit Andréa.
Il se leva, reprit son chapeau et la salua avec son humilité habituelle, cette humilité qui, chez lui, semblait être la livrée éternelle du repentir.
Elle lui tendit la main.
– Vous me pardonnez, n’est-ce pas ?
– Plût au ciel, murmura-t-il avec un sourire triste, que Dieu m’eût pardonné comme je vous pardonne !… Adieu, madame, et priez pour moi, vous qui déjà êtes pardonnée… Les prières du repentir sont les meilleures aux yeux du Christ.
Mais au moment où il allait franchir le seuil du salon, tandis que, la lampe à la main, madame Charmet le reconduisait et ouvrait la porte, la petite juive entra toute joyeuse, en disant : – Ah ! ma belle madame, que je suis heureuse et que je vous aime !… Si vous saviez les belles choses qu’on vient de m’acheter !…
Les yeux du vicomte tombèrent sur l’enfant, sur cette tête charmante au regard voilé un peu sombre, sur ces lèvres qui appelaient le baiser, sur ces joues que colorait le sang oriental, sur ce front large, uni, doré aux chaudes haleines des vents du désert…
Et comme il ne s’attendait point à cette rencontre, comme il est toujours une heure où l’homme le plus sûr et le plus maître de soi s’oublie l’espace d’une seconde, le vicomte s’oublia. Il oublia que l’œil de Baccarat ne le quittait pas, il oublia son rôle de saint homme, de pécheur repenti qui n’aspire plus qu’au ciel, et il laissa tomber un regard de convoitise et d’admiration sur la petite juive. Ce regard, rapide comme l’éclair et éteint aussitôt, fut surpris au passage. Dans la façon dont il avait envisagé l’enfant, il y avait tout à la fois le coup d’œil du maquignon qui juge un cheval, du débauché qui rêve quelque volupté inouïe, et le regard ardent, passionné, de l’ange du mal voyant un ange du ciel et songeant tout d’abord à le corrompre et à le séduire.
Ce fut une révélation pour Baccarat.
Il s’en alla sans deviner qu’il s’était trahi ; mais à peine la porte de la rue s’était-elle refermée sur lui, que la jeune femme ne put contenir plus longtemps l’impassibilité de son visage :
– Ah ! dit-elle, cet homme est un traître ! sir Williams a fait peau neuve, voilà tout ! L’âme est demeurée la même.
– Madame, murmura en même temps la petite juive, quel est ce monsieur ? Ah ! il vient de me regarder comme me regardait ce vieux père qui voulait toujours m’embrasser !
– La vérité sort de la bouche des enfants ! pensa Baccarat.
Pendant quelques minutes, la pauvre femme, dont l’infernal Andréa avait tout à l’heure brisé le cœur, demeura pensive, absorbée et comme fléchissant sous le poids de la douleur ; mais Baccarat était une de ces natures énergiques, faites pour la lutte, et maintenant elle était convaincue que la guerre existait, qu’elle existait sourde, invisible, mais terrible, inexorable, sans pitié pour les vaincus. Elle devinait déjà ce travail colossal et souterrain de sir Williams, cet échafaudage hardi, élevé par lui sur son prétendu repentir, sur cette confiance absolue, universelle qu’il avait su inspirer, et elle comprit qu’elle seule peut-être pourrait lutter contre cet homme une fois vaincu, il est vrai, mais qui apportait à cette seconde guerre les coûteuses leçons d’expérience qu’avait reçues son génie infernal.
– Mon Dieu ! pensa-t-elle, pourvu que M. de Kergaz consente à se laisser dessiller les yeux.
Elle passa dans son cabinet de travail et écrivit un mot au comte :
« Monsieur le comte, disait-elle, je me fie à votre honneur, à votre loyauté, à votre discrétion surtout. Jetez au feu mon billet aussitôt que vous l’aurez lu, et surtout que ni madame de Kergaz, ni M. le vicomte Andréa ne sachent que je vous ai écrit. Vous m’avez donné rendez-vous pour dix heures, recevez-moi à huit. J’entrerai par la petite porte de la rue des Lions-Saint-Paul et gagnerai le petit salon du jardin. J’ai à vous communiquer des choses que vous seul au monde devez savoir.
« J’ai foi en vous.
« Louise Charmet. »
Elle cacheta ce billet, déguisa son écriture en écrivant l’adresse, sonna et envoya chercher un commissionnaire de coin de rue :
– Vous allez vous rendre, lui dit-elle, rue Culture-Sainte-Catherine, à l’hôtel de Kergaz ; vous demanderez à voir M. le comte, à le voir en particulier, et vous lui remettrez ce billet quand vous vous trouverez seul avec lui. Si le comte est absent, vous reviendrez sans laisser le billet.
Le commissionnaire partit et revint une heure après avec un mot du comte :
« Je vous attends, disait Armand. J’étais seul quand on m’a apporté votre lettre, je l’ai brûlée aussitôt. »
Madame Charmet prit, à la hâte, quelque nourriture, recommanda la petite juive à sa vieille servante, et sortit, le visage couvert d’un voile épais, sa taille élégante modestement dissimulée sous l’ampleur d’une grande pelisse noire. Sir Williams, lui-même, ne l’eût pas reconnue.
Vingt minutes après, elle frappait à la porte des jardins de l’hôtel. C’était par là que, souvent passaient les pauvres honteux, les grandes infortunes voilées qui s’adressaient à Armand comme à la Providence elle-même, et qui ne voulaient point rougir devant sa livrée. Un domestique vieux, discret, avait été chargé par M. de Kergaz de veiller chaque soir à cette porte, d’introduire silencieusement ces silencieux visiteurs, et de les faire attendre dans un pavillon situé au fond du jardin. Puis il allait prévenir son maître qui descendait aussitôt.
Baccarat put donc pénétrer dans l’hôtel sans avoir été vue, et demeurer rassurée que le vicomte Andréa ignorerait toujours cette démarche, si Armand lui gardait le secret. Ce petit salon d’attente, destiné aux envoyés de l’infortune, témoignait par sa disposition des exquises délicatesses de ce noble cœur qu’on nommait Armand de Kergaz.
Le pavillon était perdu sous un massif de grands arbres, qui étaient reliés à la porte de la rue des Lions-Saint-Paul par une épaisse charmille.
On entrait par un couloir obscur et qui, le soir, demeurait plongé dans les ténèbres. Le vieux valet prenait le visiteur par la main, le conduisait, lui montrait dans l’éloignement une faible clarté, et lui disait en le quittant : « Allez toujours droit devant vous ; vous rencontrerez un petit salon et vous y attendrez M. le comte. »
Ce salon dans lequel le visiteur pénétrait était à peine éclairé par une lampe à globe dépoli, recouvert lui-même d’un abat-jour.
Si le visiteur était une femme et qu’elle eût un voile aussi épais que Baccarat, le comte lui-même ne pouvait voir son visage. Ce fut donc là qu’entra Baccarat, que le vieux serviteur prit sans doute pour quelque mendiante du monde décent.
Baccarat se laissa tomber sur un siège, ne releva point son voile et attendit. Elle attendit plus de vingt minutes, et ce retard qu’apportait Armand à se rendre au rendez-vous qu’elle lui avait donné commença à lui laisser soupçonner un événement imprévu. Elle craignit même, un moment, quelque fâcheuse intervention de sir Williams. Cependant, Baccarat avait résolument pris son parti ; elle était décidée à s’ouvrir tout entière à M. de Kergaz, à lui parler avec cette éloquence qui entraîne la conviction, à lui arracher le bandeau, son cœur dût-il saigner… En imposant silence à sa propre émotion, essayant de bannir un moment de son âme et de son esprit le souvenir de Fernand, qu’avaient réveillé les cruelles confidences de sir Williams, elle pesa, par avance, chacune de ses paroles, chacun de ses gestes… Elle voulait convaincre le comte, à qui, malheureusement, elle n’apportait aucune preuve matérielle ni morale de l’hypocrisie de son frère.
Enfin un pas léger, rapide, cria sur le sable du jardin, puis se fit entendre dans le couloir, et le comte apparut sur le seuil du petit salon.
La porte fermée, Baccarat releva son voile.
– Bonjour, chère enfant, lui dit le comte en allant vers elle, comment vous trouvez-vous ?
– Bien, monsieur le comte, répondit Baccarat, qui s’aperçut alors, malgré le peu de lumière qui régnait dans la pièce, que M. de Kergaz était fort pâle et visiblement ému.
– Mon Dieu ! lui dit-elle avec effroi, qu’avez-vous donc, monsieur le comte ? Et que vous est-il arrivé ?
– Ah ! murmura le comte d’une voix altérée, je suis encore sous le coup d’une révélation affreuse. Mon frère Andréa…
Il s’arrêta, car la voix lui manquait.
Et Baccarat eut un frisson d’espoir… et elle pensa qu’un événement imprévu avait déjà éclairé le comte et qu’il tenait sir Williams pour un misérable.
XXX
Avant d’aller plus loin, disons ce qui venait de se passer à l’hôtel de Kergaz.
Nous avons peut-être un peu laissé dans l’ombre un de nos principaux personnages très en relief dans la première partie de cette histoire. Nous voulons parler de cette blonde et suave Jeanne de Balder, devenue comtesse de Kergaz. Peut-être pourrions-nous alléguer la meilleure raison qu’on puisse fournir de cette omission volontaire : Jeanne était heureuse, entièrement heureuse, et le bonheur est silencieux, il ne fait bruit, il ne dit mot, il demeure si volontiers dans l’ombre !… Placée entre l’ardent amour de son mari et les joies sans fin de la maternité, Jeanne s’était fait, à l’hôtel de Kergaz, une solitude charmante, dans laquelle elle vivait en dehors du monde.
Deux amies que les infortunes du passé avaient étroitement unies à sa fortune, Cerise et madame Rocher, la venaient voir quelquefois, et lui apportaient, l’une les bruits du monde, l’autre les plaintes touchantes de la classe pauvre, qu’elle se hâtait de faire taire en répandant ses bienfaits parmi elle.
Madame de Kergaz sortait peu ; elle ne quittait que fort rarement son mari. Parfois elle regrettait peut-être ce beau ciel sicilien, témoin de ses premières années de bonheur, mais c’était seulement lorsqu’Armand sortait pour quelque affaire imprévue. Mais Armand de retour, Jeanne ne regrettait et n’enviait plus rien. Une caresse de son fils, un sourire de son époux, n’était-ce pas le meilleur rayon du plus radieux des soleils, même sous la noire atmosphère qui couvre Paris aux jours d’hiver ?
Pourtant, depuis son retour, le noble cœur de Jeanne, déjà si plein, avait senti tressaillir une nouvelle fibre jusque-là muette et qui commençait à s’agiter pour une nouvelle affection. Obéissant à ce penchant naturel aux nobles âmes, et qui les pousse à aimer ce qui souffre, Jeanne avait fini par prendre en pitié ce grand coupable courbé sous le remords, cet homme dont le génie mauvais s’était subitement éteint sous le souffle de Dieu, et qui traînait une vie misérable, accablé sous le fardeau de ses iniquités. Elle avait fini par éprouver une sorte de sollicitude maternelle pour ce vieillard prématuré, devenu plus inoffensif qu’un enfant, et qui faisait une si rude pénitence de ses fautes passées. Chaque jour, en se jetant à genoux, Jeanne demandait à Dieu qu’il rendît le repos au frère bien-aimé de son époux et apaisât ses remords. Souvent elle le traitait avec une affection, une bonté sans égales, l’appelant « mon cher frère », et lui prodiguait mille soins charmants et délicats. Par quels efforts ingénieux, par quelles ruses angéliques n’avait-elle pas cherché à le dissuader de suivre plus longtemps ce régime austère qui délabrait sa santé et le conduisait lentement au tombeau ! Quelquefois, quand elle avait prié, supplié, employé ses arguments les plus éloquents, sa voix la plus câline, Andréa fondait en larmes, baisait humblement le bas de sa robe, et murmurait : – Ah ! vous êtes, madame, une de ces femmes qui font rêver des anges, un de ces anges qui font croire à la miséricorde de Dieu ! Et il refusait obstinément tout adoucissement à sa rude pénitence.
L’hiver était rigoureux. Chaque matin, en s’éveillant, Jeanne voyait miroiter le givre aux branches dépouillées des grands arbres plantés dans le jardin ; elle contemplait avec tristesse la terre gelée, souvent couverte de neige, et elle songeait qu’Andréa couchait sur le carreau froid et nu d’une mansarde située sous les toits, et ne voulait pas même qu’on mît chez lui un petit poêle de fonte.
Un jour, elle eut une merveilleuse idée.
Andréa ne rentrait jamais dans la journée, ou s’il rentrait, jamais il ne remontait à sa chambre. Presque toujours on l’entendait gravir l’escalier vers minuit, et dès six heures du matin les domestiques, qui couchaient au-dessous, l’entendaient aller et venir.
Jeanne prit pour confidente, un jour, sa chère et vieille Gertrude :
– Écoute, lui dit-elle, tu vas aller me chercher un serrurier, tu lui feras ouvrir la chambre de M. Andréa, démonter la serrure, et tu lui donneras vingt francs pour qu’il te fasse une clef dans les deux heures.
– J’y vais, répondit la vieille servante, sans deviner la pensée de sa jeune maîtresse.
Pendant les deux heures que la chambre demeura sans serrure, et tandis qu’on fabriquait la seconde clef, Jeanne fut sur des charbons ardents.
Elle tremblait qu’Andréa ne rentrât et ne s’en aperçût. Mais Andréa ne revint pas.
Lorsqu’elle fut munie d’une seconde clef, Jeanne mit son projet à exécution.
À l’aide de cette clef, la vieille Gertrude alla placer chaque jour, aussitôt qu’Andréa avait quitté l’hôtel, un petit réchaud de fonte, tel qu’on en voit beaucoup en Espagne sous le nom de braseros, et qui, garnis de petites braises de bois, ne laissent après aucune odeur. Ce réchaud, garni de braise ardente, demeurait dans la mansarde toute la journée, une partie de la soirée, et disparaissait vers dix heures, après avoir échauffé l’atmosphère.
Andréa, qui emportait toujours la clef de sa chambre, ne pouvait donc s’apercevoir de rien, pensait Jeanne ; et, en effet, plusieurs jours s’étaient écoulés, et le pauvre pénitent n’avait fait aucune question, aucune observation. Seulement, un jour où, à table, on parlait des rigueurs de la saison, il dit : – Il fait très froid, en effet, mais je m’aperçois que la température s’adoucit un peu la nuit.
Le comte et Jeanne s’étaient regardés à ces mots, avec les yeux pleins de larmes.
Deux jours après, il arriva que Gertrude, qui était sujette à des douleurs, ne put quitter son lit. Alors Jeanne, qui ne voulait pas mettre les autres domestiques de l’hôtel dans sa confidence, se chargea elle-même de porter le brasier chaque matin, et de l’aller reprendre chaque soir.
Un jour, elle laissa tomber une épingle de sa coiffure. Cette épingle longue, à pointe d’acier, avait une tête de corail. Le vicomte Andréa la trouva le soir, en entrant. Un sourire vint à ses lèvres.
– Ah ! ah ! dit-il, je sais maintenant qui apporte du feu chaque jour ici, c’est ma chère belle-sœur… Et il ajouta, tandis que son regard lançait un éclair : – Je crois que je puis, à présent, laisser traîner un peu ce manuscrit, où je relate ma vie jour par jour… et à ma manière…
Et, le lendemain, M. le vicomte Andréa ferma soigneusement sa porte comme à l’ordinaire, et laissa tomber l’épingle révélatrice dans l’escalier… Mais, par un impardonnable oubli, il avait laissé entrouvert le tiroir de sa table, et dans ce tiroir se trouvait le fameux Journal de ma misérable vie. C’était le titre que sir Williams avait donné à ce curieux document, dont nous avons déjà cité quelques passages.
Plusieurs heures après, Jeanne monta.
Elle s’était levée tard. L’enfant avait été malade, l’heure du déjeuner était survenue ; ensuite Andréa était demeuré une partie de la journée avec son frère, dans le cabinet de travail. Ces diverses circonstances avaient été cause que madame de Kergaz n’avait pu porter avant quatre heures de l’après-midi le brasero dans la chambre de son beau-frère.
L’encrier demeuré sur la table attira son attention, puis elle vit le tiroir entrouvert. La plus vertueuse des femmes n’est pas à l’abri de ce défaut qui causa l’expulsion de la race humaine des jardins embaumés du paradis terrestre… elle est curieuse… Jeanne ouvrit le tiroir, malgré un léger battement de cœur qui semblait l’avertir que ce qu’elle faisait était mal. Le tiroir ouvert, elle aperçut le manuscrit ; et comme la curiosité entraîne sur une pente irrésistible, elle tourna la première feuille et lut… Le titre la fit tressaillir ; mais, en même temps, elle eut les yeux rivés à cette écriture mince et serrée, presque illisible, et qui semblait attester que celui qui l’avait tracée avait écrit pour lui seul.
Ce journal paraissait être l’histoire la plus complète de la vie de sir Williams, à partir du jour où M. de Kergaz l’avait surpris aux pieds de Jeanne.
Jamais criminel attiré au tribunal de la pénitence et avouant ses fautes à un prêtre ne s’était accusé avec plus de naïveté et de franchise, jamais homme n’avait, la plume à la main, témoigné un plus profond dégoût, une plus profonde horreur de lui-même.
Après un exorde dans lequel le remords semblait parler éloquemment par la plume de ce grand coupable, Jeanne, frémissante et frappée de stupeur, lut ces quelques phrases :
« Seigneur, je me courbe sous votre verge d’airain, et j’accepte ce dernier supplice que vous m’infligez comme le châtiment de mes forfaits… Ainsi donc, Seigneur, il est bien vrai que, pour élever l’expiation à la hauteur du crime, vous avez allumé dans mon cœur, où le mal paraissait avoir tout détruit et tout desséché, un de ces amours violents et sans espoir qui tuent l’homme dont le corps seul désormais demeure vivant et s’agite. L’âme est morte…
« Ah ! cet amour, mon Dieu ! n’est-ce pas pour moi l’enfer sur la terre, une éternité de tortures en quelques années ?
« Jeanne ! Jeanne ! ange du ciel à qui Dieu a donné le bonheur, vous ne lirez jamais ces lignes, vous ne saurez jamais qu’à l’heure même où vous échappiez pour toujours à sa haine, Andréa sentait alors naître en son âme souillée un amour qui devait l’arracher à sa vie criminelle et le livrer aux tortures sans nom du remords.
« Jeanne, je vous aime ; je vous aime ardemment, saintement, – si ce mot n’est point un blasphème dans ma bouche… et vous l’ignorerez toujours… et mon amour sera mon châtiment.
« Car je me suis condamné à vivre près de vous, à vous voir à toute heure, à entendre votre époux vous donner les plus doux noms.
« Peut-être que Dieu finira par me pardonner, quand il verra ce que je souffre et de quelle pesanteur est le châtiment que je me suis infligé ! »
* *
*
Jeanne lut ces lignes, la sueur au front, l’angoisse au cœur, oubliant tout, le lieu où elle était… l’heure qui passait… Andréa qui pouvait revenir… Elle lut ce manuscrit tout entier, écrit jour par jour et empreint d’un épouvantable esprit de folie…
C’était, qu’on nous passe le mot, l’exaltation de la pénitence. Chaque mot, chaque ligne semblaient avoir été écrits avec le sang du malheureux Andréa. Jamais la passion vraie, émouvante, livrée à toutes les tortures de la désespérance, n’avait parlé un langage plus éloquent, plus terriblement exalté…
Et pendant que la malheureuse jeune femme lisait, le temps s’écoulait, la nuit était venue, et, entraînée par une puissance invincible, un attrait impossible à définir, elle avait allumé au brasier la chandelle de suif dont se servait Andréa, posé cette chandelle auprès du manuscrit et continué sa lecture.
Elle voulait lire jusqu’au bout.
Or, M. de Kergaz, qu’elle avait quitté, le laissant dans sa chambre auprès du petit Armand qui jouait, après avoir reçu le billet par lequel Baccarat lui demandait un entretien seul, M. de Kergaz, disons-nous, commença à s’étonner de cette absence prolongée de sa femme, et il monta à la mansarde d’Andréa. La porte en était demeurée entrebâillée… Armand aperçut Jeanne assise devant la petite table d’Andréa, la tête dans ses mains, absorbée.
Il l’appela ; elle n’entendit point…
Il s’approcha ; elle ne tourna pas la tête…
Alors il la regarda et recula, frappé de stupeur.
Blanche comme une statue de marbre, immobile comme elle, Jeanne, dont la vie tout entière semblait être passée dans le regard, avait les yeux rivés au manuscrit d’Andréa, et deux larmes brûlantes coulaient lentement le long de ses joues.
Armand la prit dans ses bras ; elle tressaillit, leva la tête, puis se dressa tout d’une pièce et jeta un cri :
– Ah ! dit-elle, je crois que je deviens folle !
Et d’une voix étrange, avec des yeux hagards, d’un geste brusque, saccadé, impossible à traduire, elle le fit asseoir à sa place, lui montra le manuscrit, et lui dit : – Tenez… tenez… lisez !
Dominé par cet accent, par la vue de ce visage en pleurs, par ce regard brillant de fièvre, Armand obéit. Il s’assit, il feuilleta le manuscrit, il en lut le titre, les premières pages…
Et, comme Jeanne, il se sentit pris à la gorge par une terrible et cruelle émotion ; son sang se glaça à mesure qu’il lisait.
Et lorsqu’il eut atteint la dernière ligne, un cri sourd, étouffé, se fit jour à travers sa gorge :
– Ah ! le malheureux ! murmura-t-il, le malheureux ! Je comprends à présent la cause première de son repentir !
Le comte repoussa alors le manuscrit dans le tiroir, qu’il ferma, puis il prit sa femme dans ses bras et l’emporta hors de la chambre, dans laquelle le génie du mal triomphait encore.
* *
*
C’était cet événement, cette révélation foudroyante et inattendue qui avait ainsi bouleversé le comte, et le montrait à Baccarat ému et pâle.
– Mon Dieu ! lui avait dit la sœur de Cerise en le voyant dans cet état, qu’avez-vous donc, monsieur le comte, et que vous est-il arrivé ?
Et comme il lui parlait d’un horrible mystère qu’il venait de découvrir, comme elle espérait qu’il avait ouvert les yeux sur Andréa et que Dieu l’avait devancée, elle qui venait démasquer l’hypocrite et le traître, le comte ajouta :
– Mon frère Andréa est un martyr !
– Un martyr ! s’écria Baccarat, qui se leva précipitamment et recula foudroyée par ce mot du comte.
– Un martyr des premiers âges de l’ère chrétienne, répondit Armand, dont les yeux s’emplirent de larmes.
Mais Baccarat était arrivée avec une conviction profonde, inébranlable, une conviction d’autant plus forte qu’elle ne s’appuyait que sur d’horribles pressentiments, et l’on sait que les vérités les plus solides, qui rencontrent les plus fervents adeptes, sont presque toujours celles que l’on ne peut prouver mathématiquement. Elle était venue, décidée à lutter, s’attendant à rencontrer une incrédulité robuste, et elle répondit avec fierté :
– Monsieur le comte, je ne sais pas si votre frère est martyr, mais ce que je sais, ce que je sens, ce dont j’ai une conviction profonde, c’est que son repentir est une comédie ; c’est que, sous l’humble habit du pénitent, sous l’homme armé d’un cilice, le cœur lâche et féroce du baronet sir Williams continue à battre, que sa haine seule a pu le contraindre à jouer si consciencieusement son rôle, et que vous avez chaque jour, à toute heure, sous votre toit, à votre table, auprès de votre femme et de votre enfant, votre plus cruel ennemi…
Le comte regarda Baccarat, puis un sourire vint à ses lèvres :
– Vous êtes folle ! dit-il froidement.
– Ah ! reprit-elle avec exaltation, je savais bien que vous ne me croiriez pas ; mais je vous donnerai des preuves… Je le suivrai pas à pas… Oh ! je finirai bien par le démasquer…
– Eh bien, dit Armand, écoutez-moi, et quand vous m’aurez entendu… quand vous saurez tout…
– Allez ! dit-elle, parlez !… Mais j’ai au fond du cœur une voix qui me parle, et je crois à cette voix !
Armand s’assit : il raconta à Baccarat ce que Jeanne et lui venaient d’apprendre ; il lui récita, pour ainsi dire, ce document laissé par Andréa, éloquent plaidoyer en faveur de son repentir, preuve, à ses yeux, irréfutable, authentique, des remords qui le tourmentaient.
Baccarat l’écouta jusqu’au bout, sans l’interrompre… Et elle comprit que M. de Kergaz croyait désormais en son frère comme on croit en Dieu, et qu’elle ne devait point compter sur son appui pour démasquer Andréa.
– Monsieur le comte, lui dit-elle, vos paroles m’ont convaincue d’une chose, c’est que vous serez aveugle jusqu’au jour où le malheur fondra sur vous. Dieu veuille que je sois assez forte pour vous sauver !
Et comme M. de Kergaz continuait à sourire :
– Vous êtes gentilhomme, monsieur, poursuivit-elle, gentilhomme et homme de bien. Je regarde votre parole comme la plus immuable des lois… Eh bien…
Elle parut hésiter.
– Parlez, mon enfant, dit le vicomte avec bonté.
– Eh bien, dit-elle, voulez-vous me faire un serment ?
– Je vous le promets.
– Alors, jurez-moi que vous me garderez un secret absolu sur ce qui vient de se passer entre nous.
– Je vous le jure.
– Enfin, promettez-moi, monsieur le comte, d’avoir foi en la parole que je vous donne. Je ne toucherai à un cheveu de la tête de votre frère que le jour où j’aurai la preuve, la preuve irrécusable de ce que je viens d’avancer… de ce que vous ne voulez pas croire.
– Je crois à votre parole.
Baccarat se leva, baissa de nouveau son voile et tendit la main à Armand.
– Adieu, monsieur le comte, dit-elle. Le jour où le malheur aura fondu sur votre maison, le jour où vous reconnaîtrez que je disais vrai, je serai là… là pour vous défendre !
* *
*
– Mon Dieu, murmura Baccarat au moment où elle quittait l’hôtel de Kergaz, faites que je sois forte, car je suis seule et isolée de tous ; faites que je puisse les sauver tous !
Et comme si sa prière avait été exaucée sur-le-champ, elle se sentit tout à coup pleine d’énergie et d’audace, et ajouta, avec un mouvement de fierté suprême :
– Quand je me nommais la Baccarat, lorsque j’étais une fille perdue, j’ai déjà triomphé une fois de ce démon ; aujourd’hui, mon Dieu ! que je suis revenue à vous, que je marche sous votre bannière, vous ne m’abandonnerez pas !… À nous deux, sir Williams ! à nous deux, génie du mal !
XXXI
Tandis que Baccarat sortait de chez M. de Kergaz, disposé plus que jamais à croire au repentir sans bornes de son frère Andréa ; tandis qu’elle demandait à Dieu de lui accorder la force nécessaire pour triompher du maudit, sauver tous ces pauvres aveugles et les arracher au sort fatal qui les menaçait, le baronet sir Williams se trouvait chez son ami le vicomte de Cambolh.
Cette fois, le baronet n’était point à table.
Bien enveloppé dans sa longue redingote, coiffé de son chapeau à larges bords, le protecteur du jeune vicomte était assis dans un grand fauteuil, les pieds sur les chenets, un excellent cigare aux lèvres, et il paraissait jouir d’une béatitude complète.
– Mon oncle, disait Rocambole après avoir lâché une bouffée de fumée qui monta en spirale vers les amours bouffis qui supportaient sa pendule rococo, et lancé un jet de salive sur les tritons de cuivre du foyer, mon oncle, vous êtes réellement un homme étonnant !
– Tu trouves, monsieur mon neveu ?
– Le pâtissier n’a pas plus de toupet que vous, il faut en convenir. Non, parole d’honneur ! vous seul avez de ces idées-là !
– De quelles idées veux-tu parler ?
– Dame ! de celle qui vous a fait raconter la moitié de notre plan de bataille à votre philanthrope de frère et à mam’selle Baccarat.
Sir Williams eut un beau sourire, que lui aurait envié l’ange des ténèbres.
– Il est certain, murmura-t-il, que voilà de l’audace d’assez belle qualité.
– Si belle, fit Rocambole avec admiration, que l’épithète d’infernale est pâle et insuffisante pour l’exprimer. Seulement…
– Ah ! dit sir Williams, il y a une restriction ?
– Dame !
– Voyons, parle, j’aime à voir les objections ! D’abord cela peut être utile, puis ça me donne la mesure de tes capacités.
– Alors, mon oncle, puisque vous daignez m’écouter avec bonté, je m’explique.
– Explique-toi.
– D’abord vous avez dit à M. de Kergaz que M. Fernand Rocher vous semblait être dans les mains des Valets-de-Cœur ?
– Oui, certainement.
– Ensuite vous êtes allé plus loin, vous lui avez montré un petit billet que Turquoise a écrit ce matin même sous votre dictée, et qui aurait été trouvé dans la poche d’une vieille robe, sur la table d’une marchande à la toilette ?
– Oui, mon neveu, j’ai osé faire cela.
– Après, vous avez été plus loin : vous êtes allé vous égayer un peu le caractère chez la Baccarat, en lui apprenant que son cher Fernand, l’Arthur de ses rêves, l’homme qu’elle avait généreusement abandonné à sa rivale, s’en était retourné tout seul chez son amie, chez mademoiselle Turquoise ?
– Et je t’assure, interrompit sir Williams, que je me suis même fort amusé, car la chère enfant souffrait un joli petit martyre à réjouir un mandarin chinois, personnage qui, tu le sais, est l’idéal du tourmenteur moderne.
– Puis, continua Rocambole, vous avez fait à Baccarat le même speech qu’à ce vertueux comte de Kergaz ?
– Exactement.
– Eh bien, mon oncle, c’est beau… mais c’est dangereux !
– Tu crois, mon neveu ?
– Dame !
– Voyons ? fit sir Williams du ton complaisant d’un professeur de mathématiques invitant son élève à résoudre une difficulté.
– Je trouve que vous avez agi un peu légèrement, mon oncle.
– J’attends que tu me le prouves.
– D’abord, vous avez dit la vérité… vous avez mis le comte sur une trace qu’il cherchait.
– Après ? demanda sir Williams, d’un ton rempli de dédain.
– Ensuite, vous avez mis forcément Turquoise dans le secret de notre affaire.
– Assez ! dit le baronet. Monsieur mon neveu n’est qu’un sot.
Et sir Williams, relevant la tête, ôta son chapeau, croisa ses jambes, alluma un cigare et prit l’attitude pleine d’ironie d’un maître qui s’est plu à laisser patauger son élève dans les méandres d’un problème qu’il va éclaircir d’un seul mot.
– J’ai dit, poursuivit-il, que vous étiez un sot, et je suis homme à le prouver. Écoute bien, mon beau neveu.
– Voyons ! fit à son tour Rocambole.
– D’abord, je vais répondre à ta seconde objection. L’association des Valets-de-Cœur se compose d’un homme, c’est moi.
Rocambole fit la grimace.
– D’un agent, c’est toi.
– Ah ! je croyais n’avoir pas même droit à ce titre.
– J’aurais dû me douter de ta bêtise, dit froidement le baronet en manière de parenthèse, et confier ce rôle à un autre.
– Merci, mon oncle.
Sir Williams fit un geste d’impatience, et reprit : – L’association se compose donc d’un homme, d’un agent, toi et moi, d’instruments subalternes, les autres, et de moyens… comme qui dirait Turquoise, et ce naïf comte de Château-Mailly, ou madame Malassis, cette veuve intéressante qui aspire à être sa tante par alliance.
– Très bien, mon oncle. Après ?
– Toute association, à commencer par la franc-maçonnerie, et à finir par nous, possède un secret. Ce secret est la propriété du grand-maître chez les francs-maçons, de l’homme chez nous. L’homme en dit la moitié à l’agent, un quart aux instruments, mais il n’a rien à dire aux moyens.
– Vrai ? exclama Rocambole un peu rassuré.
– Parbleu ! imbécile.
– Ainsi… Turquoise… madame Malassis… le comte de Château-Mailly ?…
– Ne savent absolument rien, double brute ! Le comte ne voit dans son rôle que le moyen de venger un galant homme des dédains d’une femme, et d’hériter de son oncle pour récompense. Puis, comme c’est un galant homme, un fils de preux qui tient à sa parole, il se ferait hacher plutôt que de prononcer le nom de sir Arthur Collins ; car il ne m’a jamais vu, moi, vicomte Andréa, le frère bien-aimé du comte Armand de Kergaz.
– Et madame Malassis ? demanda Rocambole, tenace dans ses objections.
– Madame Malassis est une drôlesse de bas étage, fourrée de pruderie, comme une duchesse est fourrée d’hermine. Elle ne connaît de nous tous que Venture, un hercule qui l’étouffera d’une seule main si elle s’avise de résister. Mais elle ne résistera pas, sois tranquille.
– Mais enfin, dit Rocambole, si la Baccarat va chez Turquoise ?
– Elle ira demain, mon neveu, sois-en sûr.
– Et si elle lui parle des Valets-de-Cœur ?
– Turquoise ne saura pas un mot de ce qu’elle veut lui dire.
– Même si elle lui représente le billet que vous lui avez fait écrire ce matin ?
– Oh ! sur ce billet, elle lui racontera une jolie histoire pleine d’imagination, et que je n’ai pas le temps de te redire.
– Mon oncle, dit Rocambole gravement, tout cela est parfait ; seulement, vous m’avez prouvé que vous teniez bel et bien M. de Château-Mailly et sa tante en perspective ; mais Turquoise, comment la tenez-vous ?
– Par son propre intérêt, mon neveu. Fernand Rocher a douze millions ; la maîtresse d’un homme douze fois millionnaire n’a ni cœur, ni entrailles, ni délicatesse, ni scrupules : c’est un chiffre.
– Parfait ! murmura Rocambole, je n’ai plus rien à demander.
– Pardon, fit sir Williams. J’ai commencé par répondre à ta seconde objection, je vais finir par la première.
– Je vous écoute, mon oncle.
– Il est un principe, reprit le baronet après avoir aspiré coup sur coup et silencieusement plusieurs gorgées de fumée bleue, un principe éternel, en ce monde, c’est que les hommes cessent de croire aux vérités qu’on leur affirme. Ce principe trouve son application immédiate en politique, en affaires, en amour.
– Ce raisonnement est très fort, mon oncle, interrompit Rocambole émerveillé.
– J’ai affirmé que ma conviction touchant Fernand Rocher était que les Valets-de-Cœur n’étaient point étrangers à son intrigue avec la Turquoise. Ce pauvre Armand en doute, et Baccarat, demain, sera convaincue du contraire lorsqu’elle sortira de chez Turquoise, dans laquelle elle ne verra désormais qu’une drôlesse vulgaire, qui s’acharne à ruiner un homme fabuleusement riche.
– Mais ne craignez-vous pas l’influence de Baccarat sur Fernand ?
– Au contraire, Baccarat va nous servir sans le vouloir.
– Ah ! par exemple… voilà qui devient incompréhensible pour moi.
– J’en demeure convaincu, tu es décidément fort bête.
Rocambole s’inclina devant cet éloge un peu brutal.
– La première chose que fera Baccarat lorsqu’elle parviendra à mettre la main sur Fernand, ce qui, je te le jure, ne lui sera pas très facile, sera de lui parler de sa femme et de son enfant, dont la fortune, lui dira-t-elle, ira s’engloutir et se fondre sous les doigts avides de Turquoise.
– L’argument aura bien son mérite.
– Oui, mais comme jusqu’à présent Turquoise se montre désintéressée, superbe ; qu’elle ne veut accepter ni un bijou, ni une paire de gants, ni un souper, Fernand haussera les épaules, et trouvera que Baccarat calomnie sa maîtresse. Comprends-tu ?
– Oui, mon oncle.
– Eh bien, reprit sir Williams, puisque tu as compris, tu n’as plus d’objections à faire, n’est-ce pas ?
– Non, mon oncle.
– Tu te trouves suffisamment édifié ?
– Parfaitement, mon oncle.
– Alors, dit le baronet allumant un nouveau cigare, comme le temps a quelque valeur et que c’est le gaspiller que discourir comme nous le faisons, je vais te donner mes ordres… et tu me feras un plaisir.
– Lequel, mon oncle ?
– Celui de t’y conformer au lieu de les discuter ; ce sera plus simple et nous irons plus vite en besogne.
Rocambole courba humblement la tête et devint attentif.
– Dès le matin, reprit sir Williams, tu iras faire une visite au major Carden, et tu lui remettras ce pli. Ce sont les nouvelles instructions du chef.
– J’irai, mon oncle.
Ensuite, tu monteras à cheval, et tu te trouveras vers deux heures au Bois, au pavillon d’Ermenon-ville. Tu feras une toilette du matin fort soignée.
– Je me ficellerai, dit Rocambole.
– Mon cher vicomte, interrompit le baronet, vous avez des expressions triviales dont je vous engage à vous défaire.
– Je ne m’en sers pas dans le monde, répondit impertinemment Rocambole.
– Vous êtes un sot, mon neveu, dit froidement le baronet, car si je n’étais pas du monde, moi devant qui vous parlez, vous n’en auriez jamais été.
– Excusez-moi, capitaine… j’ai voulu rire…
– Je l’espère bien, répondit le baronet avec calme, car, malgré l’affection que j’ai pour vous, je te casserais la tête si tu étais sérieusement insolent avec moi.
Sir Williams accompagna ces paroles d’un de ces regards étincelants qui faisaient trembler Rocambole lui-même.
– Mais, écoute bien, continua-t-il. Le hasard fera que, juste à deux heures, tu te trouveras face à face avec une calèche bleu de ciel… Dans cette calèche tu verras un homme et une femme se souriant et se regardant comme deux tourtereaux qui roucoulent au milieu de la lune de miel.
– Et cet homme et cette femme ?
– Ce sera Turquoise et Fernand.
– Bien, dit le vicomte.
– Alors tu t’approcheras, rangeant ton cheval aux côtés de la calèche, tu salueras poliment M. Fernand Rocher, et tu laisseras tomber un regard de dédain sur la femme.
– Je comprends la situation.
– Monsieur, diras-tu à Fernand, aurais-je l’honneur insigne d’être reconnu de vous ?
– Parbleu ! il est payé pour cela.
– Aussi te répondra-t-il par l’affirmative.
– Alors tu répondras : « La nuit où j’eus l’honneur de me battre avec vous, monsieur, j’eus, à ce qu’il paraît, une inspiration non moins fâcheuse que pleine de générosité. » Et s’il témoigne quelque surprise, tu ajouteras : « Vous étiez blessé, évanoui, vous perdiez votre sang ; il était urgent de vous transporter quelque part sans perdre une minute. Vous transporter chez vous, où votre femme sortant du bal vous aurait trouvé tout sanglant, ne pouvait venir à la pensée de trois hommes de bon sens et de bonne compagnie, nos témoins et moi. Cette créature, et tu désigneras Turquoise du doigt, cette créature, était ma maîtresse, je la croyais bonne et j’avais la faiblesse de l’aimer… Elle avait un hôtel acheté de mes deniers, monsieur, – tu insisteras là-dessus, – un hôtel situé non loin du lieu du combat ; je savais qu’elle m’attendait, car je lui avais promis de lui dire adieu avant de partir, et que, par conséquent, elle et ses gens étaient levés. Nous vous transportâmes chez elle… Permettez-moi, achèveras-tu, de la féliciter des soins qu’elle vous a prodigués, si j’en juge par votre bonne mine, et de vous féliciter vous-même du succès que vous avez eu auprès d’elle, car, en revenant à Paris ce matin même, j’ai appris que vous étiez mon successeur, et que seul désormais vous aviez le droit de monter avec elle dans cette calèche qu’elle tient de moi… »
– Ah ! cette fois, mon oncle, interrompit Rocambole, vous ne trouverez pas ma perspicacité en défaut.
– En vérité ? murmura sir Williams d’un ton railleur.
– Parbleu ! après une scène pareille, Fernand Rocher se croira obligé d’acheter l’hôtel, de payer calèche et chevaux, de forcer Turquoise à me renvoyer les bijoux et les titres de rente que je ne lui ai point donnés.
– Tu ne devines pas tout encore…
« Turquoise quittera l’hôtel et ira se loger dans un entre-sol de quatre cents francs avec une femme de ménage, à un louis par mois… ce qui fait que Fernand, subjugué par cette délicatesse inouïe, achètera sans rien dire un petit hôtel ailleurs qui lui coûtera deux ou trois cent mille francs ; puis il y mettra cinquante mille écus de mobilier, trois ou quatre cents louis de chevaux et de voitures, et y conduira, six semaines après, la noble et vertueuse Turquoise, qui ne demandait, hélas ! qu’une chaumière et le cœur de Fernand.
– Total, additionna Rocambole, un demi-million pour le premier mois.
– Sur lequel on taillera quarante ou cinquante mille francs à la petite, ce qui est bien honnête.
– Incontestablement, mon oncle.
– Mais, reprit sir Williams, revenons à Fernand. Tu peux être certain d’une chose, c’est qu’il te demandera raison. Tu le prieras alors de vouloir bien t’accorder quinze jours ; il ira à la salle d’armes ; Turquoise se lamentera et finira par arranger l’affaire. Quand un homme devient lâche par amour, souviens-toi de ceci, mon neveu, il appartient au diable corps et âme, je veux dire à ton serviteur.
Rocambole fit un geste d’admiration.
– Auprès de vous, dit-il, le diable est un polisson !
– C’est un peu mon avis, fit modestement le baronet, qui se hâta d’ajouter : – Je n’ai pas fini : demain soir, tu te présenteras avenue Gabrielle, 16, aux Champs-Élysées, à la grille d’un petit hôtel tout neuf. Un domestique au teint cuivré viendra s’informer du but de ta visite ; tu lui remettras ta carte, et tu demanderas à être introduit auprès de miss Daï-Natha Van-Hop.
– L’Indienne ?
– Oui, la future marquise.
– Que lui dirais-je ?
– Tu lui remettras cette lettre, dit sir Williams en donnant un second pli cacheté et sans souscription à celui qu’il nommait son neveu. Puis, tu attendras ses ordres. L’Indienne ne parle que l’anglais.
– Et moi je le baragouine.
– C’est plus que suffisant.
– Est-ce tout, enfin ?
– Non, je finis toujours par le commencement, je trouve cela plus simple. Demain matin, avant d’aller chez le major, à sept heures du matin, tu feras atteler ton tilbury et tu iras rue Rochechouart, 41 ; tu trouveras dans cette maison un vieux concierge portant moustache grise, jargonnant un français mélangé d’italien et donnant des leçons d’escrime. Cet homme est le seul à Paris qui connaisse un coup merveilleux venu d’Italie, pratiqué au XVIe siècle, et dont le secret est presque perdu. Ce coup, que moi je n’ai pas le temps de t’enseigner, il te le démontrera à merveille en dix ou quinze leçons.
– Mais, dit Rocambole, ce coup est tout un jeu, alors ?
– Non, ce n’est qu’un coup, un coup unique, de la famille des coups droits ; seulement, il est si difficile à porter, que celui qui le porte mal est un homme mort.
– Et… s’il le porte bien ?
– Alors il frappe mortellement son homme, bien que la mort ne soit jamais instantanée. Le pauvre diable a le temps de se confesser et de faire son testament.
– Ah çà ! demanda Rocambole, encore ce coup-là a un nom ?
– Oui, il se nomme le coup des cent pistoles.
– Pourquoi ?
– Parce que tu commenceras par en donner cinquante avant la première leçon, et que tu compléteras la somme après avoir pris la dernière.
– Je dois donc tuer un homme ?
– Oui.
– Quand cela ?
– Peut-être dans quinze jours, peut-être avant, peut-être plus tard.
– Peut-on savoir son nom ?
– C’est inutile.
– Mais encore ?
– Eh bien ! c’est un homme dont je veux épouser la veuve.
Rocambole tressaillit.
– Bon ! dit-il, je vois que vous êtes un homme complet, mon oncle ; vous avez gardé à chacun son affaire. Et il ajouta, en manière d’oraison funèbre : – Pauvre M. de Kergaz !
Sir Williams quitta son fauteuil, remit son chapeau, ses gants de coton, reprit son attitude pleine d’humilité, et baissa modestement ses yeux naguère remplis d’éclairs.
– Adieu, dit-il, je te verrai dans deux jours. J’ai rendez-vous à dix heures avec Armand et Baccarat.
– Adieu, grand homme ! murmura Rocambole.
Sir Williams s’en alla à pied, descendit le faubourg Saint-Honoré, longea la rue Royale, puis la terrasse du bord de l’eau et ne s’arrêta qu’à l’entrée du Pont-Neuf, sur le parapet duquel il s’appuya.
La nuit était sombre, humide, la bise sifflait ; du lieu où il s’était arrêté, le baronet dominait Paris en amont et en aval de la Seine ; Paris nocturne, à peine éclairé çà et là par ces longues files de réverbères qui essayaient de percer le brouillard, et font, à de certaines heures, ressembler la grande ville à un vaste océan tout parsemé de phares aux lueurs tremblotantes. Alors, comme aux premières pages de cette histoire, cet homme, en qui le génie du mal semblait s’être incarné, mesura la Babylone moderne de son regard plein d’éclairs :
– Ah ! dit-il, je crois décidément, ô Paris, que tu es l’empire du mal, car je suis roi dans tes murs ! Armand de Kergaz, Jeanne, Fernand, Hermine, vous tous qui m’avez vaincu une première fois, vous tous qui me portez des regards de pitié et pressez ma main avec compassion, je vous tiens dans mes serres, comme l’aigle étreint sa proie dans les siennes ! Toi, Fernand, qui m’as volé la femme que je voulais épouser, tu te trouveras dépouillé de tout bien, déshonoré, trahi par ta femme… Vous, Hermine, qui avez dédaigné le baronet sir Williams, vous marcherez la honte au front et la mort au cœur… Toi, Armand de Kergaz, tu mourras ! Toi, Jeanne, tu m’aimeras !
À la même heure, et presque au même instant et dans le même lieu, un fiacre passait, emportant une femme.
Cette femme avait été une pécheresse ; mais Dieu lui avait pardonné, et l’avait rendue forte comme la Madeleine de l’Écriture. Au moment où elle traversait le Pont-Neuf, cette femme, elle aussi, mesura Paris d’un regard inspiré, et s’écria :
– Ô grande ville ! tu renfermes en tes murs un mauvais génie, un démon, qui traîne la mort et le deuil à sa suite… Ce démon, une femme l’a deviné et le suivra pas à pas dans l’ombre, et Dieu veuille que cette femme lui écrase la tête à la veille de son triomphe, comme la Vierge écrasa la tête du serpent !
* *
*
Désormais la lutte allait se concentrer entre cet homme au génie pervers et cette femme que le doigt de Dieu avait marquée au front, lui donnant, comme moyen de racheter ses erreurs passées, la mission de poursuivre sans relâche le vicomte Andréa, sir Williams, sir Arthur Collins, cette redoutable et fatale trinité en un seul homme !
XXXII
Jusqu’à présent, nous n’avons fait pour ainsi dire que poser les fils conducteurs de cette vaste intrigue ourdie par le génie de sir Williams. Maintenant nous allons entrer de plain-pied dans l’action, laissant parfois dans l’ombre ces deux intelligences d’élite, sir Williams et Baccarat, qui sont comme les deux principes ennemis, les deux adversaires soutenant l’un contre l’autre une lutte acharnée. Nous ne nous inquiéterons plus des moyens, nous nous bornerons simplement à raconter les événements.
* *
*
Nous avons laissé M. Fernand Rocher montant dans la calèche de voyage de Turquoise, laquelle criait aux postillons : – Route de Paris !
Deux jours après, nous eussions retrouvé l’époux infidèle, un matin, dans le petit hôtel de la rue Moncey, en tête à tête avec la blonde fille au regard d’azur. Onze heures sonnaient à la pendule.
Turquoise était couchée à l’orientale, un coussin sous sa tête, sur le tapis, auprès d’un divan sur lequel Fernand était gravement étendu. Turquoise lui souriait sans mot dire et semblait le contempler en une muette extase et avec une complaisance emplie d’enthousiasme. Tout à coup elle se souleva à demi, s’appuya sur son coude supporté lui-même par le coussin du divan, et ainsi posée, elle arrêta sur Fernand son regard bleu qui le troublait si profondément.
– Ah ! çà, lui dit-elle, mon cher Fernand, voici quarante-huit heures que nous vivons comme des enfants qui ne se donnent pas la peine de discuter la vie et de l’approfondir…
– La vie, répondit Fernand, la vie c’est le bonheur : je suis heureux… Alors, à quoi bon discuter et approfondir ? Rien ne résiste à l’analyse.
– C’est que, reprit Turquoise avec une gravité triste, le bonheur, au milieu de Paris, a besoin d’être régularisé pour qu’il dure.
Fernand la regarda et parut n’avoir point saisi le sens du mot régularisé.
– Écoute, reprit-elle, les gens qui sont les plus enviés sont incontestablement les gens heureux. Ceux qui sont heureux doivent s’attendre à voir discuter leur bonheur par les jaloux, les oisifs et les méchants.
– C’est vrai, ce que vous dites là, murmura Fernand, saisi de la justesse du raisonnement.
– Donc, mon cher Fernand, le plus sage en cas pareil est de s’attendre à tout, de tout prévoir et de préparer une bonne petite défense, c’est-à-dire de prendre les précautions nécessaires à la conservation de ce bonheur tant envié.
– Avec moi, c’est inutile, je vous aime…
– Bah ! fit-elle en souriant, aujourd’hui n’est pas demain… Aujourd’hui, mon ami, vous êtes dans l’orgueil du triomphe, vous avez à vos pieds une pauvre femme qui vous aime, que vous avez forcée à tout sacrifier, à renoncer à tout, qui n’était, il y a quelques jours, qu’une femme à peu près sans cœur et qui s’est prise à vous aimer éperdument, passionnément, ne voyant plus dans l’univers que vous…
Fernand prit et porta à ses lèvres la petite main de Turquoise.
– Aujourd’hui, reprit-elle, vous êtes tout feu et tout flammes, vous vous battriez avec don Quichotte lui-même, et lui feriez au besoin proclamer, à lui don Quichotte, ma supériorité physique et morale sur sa Dulcinée de Toboso.
Et Turquoise eut un sourire charmant de fine raillerie et d’amour indulgent.
– Mais demain, reprit-elle, ah ! demain…
– Demain comme aujourd’hui, voulut intervenir Fernand.
– Chut ! fit-elle, frappant le parquet du bout de son petit pied… demain, monsieur, vous retrouverez par hasard… le hasard se mêle de tout, surtout des affaires qui concernent les amoureux… vous retrouverez vos amis, vos connaissances, tout autant de gens qui ne comprendront pas ou ne voudront pas que vous soyez heureux…
– Ah ! je compte bien n’écouter personne…
– Les uns diront : « Il a une femme légitime, charmante, adorée… et qui l’adore… »
Fernand tressaillit à ces mots de Turquoise, et la jeune femme, qui jouait en ce moment une partie décisive, attacha sur lui, en parlant ainsi, son regard fascinateur.
– Oui, monsieur, reprit-elle, pressant sa main dans les siennes, vous avez une femme… Hélas ! reprit-elle, c’est triste à dire ! mais pourtant tout finit en ce monde, mon Fernand bien-aimé, surtout l’amour. À moins, ajouta-t-elle en prenant sa tête dans ses deux mains, à moins qu’une pauvre femme comme moi ne se prenne à aimer sérieusement… comme je t’aime !
Et l’œil de Turquoise pénétra jusqu’au fond de l’âme de Fernand, que ce regard bleu avait le don de rendre fou.
– Mais l’amour légitime, comme on dit, reprit Turquoise, cet amour sanctionné par la loi, comment durerait-il toujours ? Donc, mon ami, tu as aimé ta femme, mais il est évident que tu ne l’aimes plus, puisque tu as couru après moi, que tu m’as poursuivie, fait revenir de force à Paris, et que, en fin de compte, te voilà installé ici.
Fernand écoutait… Il écoutait ce langage audacieux et n’osait protester.
Turquoise avait compris que le seul moyen de dompter, de dominer, de garrotter cet homme habitué à vivre avec sa femme, une créature distinguée, charmante, pleine d’une noble et chaste pudeur, était de devenir l’antithèse vivante de cette femme.
Turquoise avait raison. Le secret des faiblesses du cœur humain est tout entier dans les contrastes.
La courtisane continua : – Par conséquent, tu peux être certain d’une chose, c’est que demain le monde entier te lapidera. Personne, entends-tu bien ? ne voudra comprendre que tu négliges une femme charmante à tous égards, pour une femme comme moi.
Et Turquoise caressa son amant du regard et du sourire.
– Aussi, reprit-elle, j’ai déjà tracé notre ligne de conduite à nous deux, mon ami. Tu rentreras chez toi ce soir.
Fernand tressaillit et regarda Turquoise avec une sorte d’épouvante.
– Ce soir, entends-tu, poursuivit-elle, tu inventeras un prétexte sur ton absence de deux jours. Elle te croira ou ne te croira pas, peu importe. Tu reviendras ici chaque jour… à toute heure… Ne seras-tu pas, n’es-tu pas déjà le seigneur et maître ?
– Mais en attendant, mon bien-aimé, reprit-elle, profitons de notre dernière journée d’isolement et de bonheur. Le temps est beau, je vais faire venir une voiture ; nous sortirons après le déjeuner, nous ferons le tour du Bois.
La courtisane se leva à demi, étendit la main vers un cordon de sonnette et ordonna qu’on sortît le déjeuner.
Pendant une heure encore, l’habile sirène acheva d’endoctriner Fernand à demi fou ; elle sut lui faire comprendre et accepter par avance un rôle honteux. Et l’influence de cette femme étrange était telle, il y avait dans son regard, dans son sourire, dans l’inflexion de sa voix, dans le charme tout entier de sa personne une puissance magnétique si entraînante, que Fernand courba la tête et accepta tout.
Hermine était perdue sans retour, puisque son mari consentait à lui mentir.
À une heure, Turquoise et Fernand montèrent en calèche et coururent au Bois. L’équipage de la courtisane descendit la rue d’Amsterdam, traversa la place du Havre, passa devant la rue d’Isly. Là, Fernand ne put se défendre d’une certaine émotion.
– Mon pauvre ami, lui dit Turquoise d’un ton railleur, tu ferais mieux de me laisser te déposer tout de suite à ta porte ; tu m’oublierais au bout de dix minutes, et moi j’essayerais de m’étourdir en songeant que tu es heureux.
Ces derniers mots furent prononcés d’une voix étouffée qui descendit au fond du cœur troublé de Fernand.
– Non, non, murmura-t-il avec impatience, je vous aime…
Et la calèche passa au grand trot, monta l’avenue des Champs-Élysées et gagna le bois de Boulogne, emportant le vampire femelle et sa proie.
Or, c’était précisément le jour fixé par sir Williams pour la rencontre qui devait avoir lieu entre M. le vicomte de Cambolh à cheval et M. Fernand Rocher, dans la calèche de Turquoise, à deux heures, au pavillon d’Ermenonville.
Turquoise avait reçu, le matin, un petit billet de sir Williams, lequel l’avertissait qu’elle reconnaîtrait Rocambole qu’elle n’avait jamais vu, à son cheval alezan brûlé d’abord, et ensuite à une fleur bleue qu’il portait à sa boutonnière.
On le sait, Turquoise n’avait point voulu s’expliquer clairement sur son passé avec Fernand. Tout ce qu’il avait pu savoir, c’est qu’avant de l’aimer, elle était une pécheresse. Soit insouciance de l’homme riche qui ne descendra pas même dans les détails et se contentera d’ouvrir son portefeuille, soit délicatesse exquise de l’amant qui craint de l’humilier, Fernand Rocher n’avait fait encore aucune question.
À deux heures, la calèche bleu de ciel arrivait au pavillon d’Ermenonville. En même temps, Rocambole, qui était à son poste, se montrait dans l’avenue et rapprochait, par de gracieuses courbettes, son cheval de la calèche.
Fernand ne le vit point, il regardait Turquoise, à ses yeux plus belle que jamais.
Mais soudain, il la vit pâlir et tressaillir.
– Mon Dieu ! qu’avez-vous ? dit-il.
– Rien… rien… balbutia Turquoise d’une voix altérée…
En ce moment Fernand leva les yeux et aperçut Rocambole. Le prétendu gentilhomme suédois était à deux pas de la calèche et le saluait, laissant tomber un regard de mépris sur la jeune femme.
Cette brusque apparition déconcerta Fernand et lui fit éprouver une crainte vague.
Rocambole s’approcha, et la scène de provocation eut lieu telle que l’avait prévue et ordonnée sir Williams.
Turquoise, feignant une confusion profonde, avait caché sa tête dans ses mains.
Fernand, pâle, la gorge crispée, écouta le vicomte jusqu’au bout sans prononcer un mot.
– Monsieur le vicomte, dit-il enfin, si j’étais un inconnu, peut-être descendrais-je à des explications qui me semblent, en l’état, complètement oiseuses.
Le vicomte s’inclina.
– Maintenant, monsieur, poursuivit Fernand, veuillez croire que demain, à pareille heure, vous aurez été pleinement désintéressé.
– Oh ! monsieur, fit négligemment Rocambole, vous me permettrez d’être gracieux avec madame ?
– Vous vous trompez, monsieur, répondit Fernand avec hauteur, madame n’accepte rien sans ma permission.
– Non, fit Turquoise, qui jeta un regard de mépris et de haine à Rocambole, regard qui parut du meilleur effet à Fernand et la réhabilita sur-le-champ dans son esprit.
– À présent monsieur, continua le vicomte, vous devez penser que nous sommes gens à nous revoir… une connaissance, si bien commencée…
– Doit avoir des suites, je suis de votre avis, répondit Fernand, dont la voix tremblait de colère. Aussi, monsieur, suis-je tout à fait à vos ordres ; mais toutefois après que madame m’aura permis de dégager sa position vis-à-vis de vous. Ce sera fait demain, et après-demain, j’imagine, je pourrai me mettre à votre disposition.
– Monsieur, répondit le vicomte, vous rencontrez un homme qui est arrivé ce matin et comptait repartir demain soir. Je crois que la situation que vous m’avez faite me donne quelques avantages ?
– Ah ! dit Fernand.
– Celui de me battre à mon heure, par exemple.
– Votre heure sera la mienne.
– Ainsi dans huit jours, à pareille heure, car je serai de retour ce matin, je pourrai vous envoyer mes témoins ?
– Soit ! dit Fernand, dans huit jours.
Le vicomte salua courtoisement la femme qu’il venait d’humilier, piqua son cheval et s’éloigna.
– À l’hôtel ! cria Turquoise au cocher.
La calèche tourna bride et repartit au grand trot, emportant Fernand consterné et ivre de rage, et Turquoise qui cachait toujours sa tête dans ses mains et paraissait souffrir le martyre. Durant le trajet du Bois à la rue Moncey, les deux amants qui tout à l’heure se regardaient en souriant, n’échangèrent pas un seul mot.
Quand la voiture eut franchi la grille du jardin, Turquoise s’élança à terre et entra précipitamment dans l’hôtel, se réfugiant au fond de son boudoir. Fernand la suivit.
La jeune femme se laissa tomber sur le divan où, le matin, Fernand était assis, et fondit en larmes.
Pendant quelques minutes, Fernand, immobile et sombre, l’écouta pleurer sans dire un mot, sans risquer une consolation ; mais enfin son cœur se brisa au bruit de ces sanglots, il se pencha sur Turquoise et lui prit la main :
– Jenny ! murmura-t-il.
Elle parut tressaillir, se dressa comme si cette voix eût été pour elle la trompette du jugement dernier, le regarda avec une expression étrange et s’écria :
– Partez ! partez ! je ne veux plus vous voir…
– Partir ! fit-il avec terreur.
– Oui, dit-elle, car, pour la première fois de ma vie, je viens de m’apercevoir que j’étais une abominable et indigne créature : partez ! car je vous aime… et suis indigne de votre amour… partez… je vous en supplie !
Elle se mit à genoux devant lui, prenant l’attitude d’un condamné qui implore sa grâce.
– Ah ! lui dit-elle, partez, mais ne me maudissez pas… ne me méprisez pas, mon Fernand bien-aimé… vous le seul homme que j’aie aimé… vous qui m’avez fait croire, l’espace de quelques jours, que la femme déchue pouvait se réhabiliter.
Et tandis qu’elle parlait ainsi, Turquoise était belle à désespérer, son regard à demi voilé par les larmes n’avait rien perdu de son pouvoir fascinateur, et elle savait que cet homme, qu’elle suppliait de partir et de l’oublier, resterait et tomberait à ses genoux.
Fernand demeura silencieux longtemps encore, immobile, la regardant et sentant la sueur de l’angoisse perler à son front.
Enfin il reprit sa main :
– Jenny, dit-il, vous avez eu raison, le jour où vous avez cru que l’amour réhabilitait…
Elle hocha tristement la tête, et continua à sangloter.
– Vous avez eu raison, reprit-il, car je ne veux pas savoir le passé, et ne veux songer qu’au présent. Jenny… oubliez… comme j’oublie moi-même… Jenny, je ne sais plus qu’une chose, c’est que je vous aime…
Il la prit dans ses bras, la pressa sur son cœur.
Puis, tout à coup, Jenny se dégagea… Elle ne pleurait plus, elle était froide, résolue, pleine de dignité :
– Mon ami, dit-elle en tendant la main à Fernand, merci de votre générosité ! Vous êtes un noble cœur, et la pauvre déchue ne l’oubliera jamais. Je vous aime, Fernand, je vous aime comme vous aimerait une femme aussi pure que je suis méprisable, et c’est parce que je vous aime que je prends l’immuable résolution de ne pas vous revoir. Partez, mon ami, rentrez chez vous, dans votre famille, auprès de votre femme et de votre enfant… Hélas ! déjà, peut-être, vous ai-je fatalement aliéné la première de ces affections. Adieu… oubliez-moi… et ne me méprisez pas… Si vous saviez…
– Je ne veux rien savoir, répondit Fernand, non moins résolu, je ne veux rien savoir qu’une chose, c’est que vous m’aimez…
– Oh ! oui… fit-elle avec un accent brisé qui semblait monter des profondeurs de son âme.
– Je sais que vous m’aimez, continua-t-il, et je ne vous abandonnerais point.
Et comme elle courbait la tête et qu’une larme brûlante tombait sur la main de Fernand :
– Demain, poursuivit-il, vous renverrez à cet homme tout ce que vous tenez de lui… tout, entendez-vous bien ? voitures, chevaux, bijoux, titres de rente… et jusqu’à l’acte d’acquisition de cet hôtel, dont le prix lui sera remboursé sur-le-champ. Puis, dans huit jours, je le tuerai ! acheva-t-il d’une voix sombre.
Turquoise releva soudain la tête.
Ses larmes cessèrent de couler ; une tristesse pleine de mélancolie se répandit sur son visage et elle regarda Fernand.
– Mon ami, dit-elle, dans ce que vous me proposez, vous ne voyez donc pas une chose ?
– Laquelle ? demanda-t-il.
– C’est que, avec vous je n’aurai fait que changer de condition.
Il tressaillit…
– Ne serai-je pas toujours, poursuivit-elle, ce qu’on nomme une femme entretenue, c’est-à-dire une esclave, un chien, un cheval de luxe, une chose, enfin ?
– Mon Dieu ! mon Dieu ! murmura Fernand, foudroyé par ces paroles – Mais enfin, dit-il, je vous aime, moi, je sais bien ce que vous êtes et ce que vous valez ; à mes yeux, vous ne serez jamais…
– Je le serai aux yeux du monde, répondit-elle lentement ; je le serai à mes propres yeux… et c’est assez !
Puis, comme Fernand, atterré, ne trouvait pas un mot à répondre, elle ajouta :
– Je n’ai rien… et ne puis rien accepter de vous, car vous êtes marié et ne pouvez m’épouser… Adieu… adieu pour toujours !
XXXIII
Turquoise parlait avec véhémence, et chacune de ses paroles, habilement calculée, entrait au cœur de Fernand Rocher comme une pointe de couteau. Cette femme, qui venait d’être si profondément humiliée, avait un certain droit de tenir un pareil langage ; du moins, Fernand le pensa naïvement et demeura foudroyé. Mais lorsqu’il arrive à un homme d’aimer une de ces créatures déchues aussi violemment que notre héros aimait Turquoise, il n’est pour lui ni raisonnement ni logique.
Fernand se mit à genoux et se prit à sangloter comme un enfant.
Alors Turquoise lui murmura à l’oreille :
– Vous ne voulez donc pas me quitter et renoncer à moi ?
– Non, car ce serait mourir.
– Eh bien !…
Elle s’arrêta sur ce mot, et ce mot fut pour Fernand comme ce coin de ciel bleu qui apparaît au naufragé durant la tempête.
– Eh bien ?… fit-il anxieux.
– Eh bien ! reprit-elle, si vous acceptez mes conditions, toutes mes conditions… peut-être… consentirai-je…
– Oh ! parlez, parlez… j’accepterai tout !
– Mon ami, reprit Turquoise d’une voix grave et douce à la fois, avant de me jeter à corps perdu dans le gouffre où vous me voyez plongée, j’ai été une femme honnête ; j’ai été de ce monde qui me repousse aujourd’hui. À seize ans, on m’a fait épouser un vieux mari, un vieillard éhonté qui a perdu ma jeunesse ; il a dissipé une à une mes illusions. Cet homme a dévoré ma dot à peu près entière. Cependant, le jour où j’ai fui de chez lui, j’ai pu emporter un modeste capital, tristes épaves de mon naufrage, dix mille francs.
Turquoise articula ce chiffre du ton orgueilleux d’un millionnaire qui calcule sa fortune.
– Ces dix mille francs, poursuivit-elle, je les possède encore. Ils me rapportent cinq cents francs de rente. Cette somme est à moi, mon ami, bien à moi, et n’a pas une origine honteuse ; j’en ai laissé depuis quatre ans accumuler les revenus, ce qui fait que je possède en outre deux mille francs.
– Eh bien ? demanda Fernand, qui ne comprenait pas.
– Eh bien ! reprit-elle, mais c’est une fortune, cela !
Puis elle lui prit la main, le sourire revint à ses lèvres, elle eut la physionomie mutine d’une petite fille qui dit naïvement ses premières espérances d’amour.
– Comment ! vous ne comprenez pas, mon ami ? Alors, écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de femmes, à Paris, de pauvres ouvrières qui vivent de leur travail et s’estimeraient bien heureuses d’avoir la moitié de ce que je possède. Moi, j’ai été élevée à Saint-Denis ; j’ai appris à broder, à faire de la tapisserie ; je puis gagner trois francs par jour, c’est-à-dire mille francs par an… ce qui, joint à mon revenu, me fera quinze cents francs de rente.
– Ah ! s’écria Fernand, vous, mon enfant, vous vivriez avec quinze cents francs ? Oh ! jamais !
– Et je serai si heureuse encore !… si heureuse de posséder l’amour de mon Fernand bien-aimé ! Mais, acheva-t-elle avec un élan d’enthousiasme, tu ne comprends donc pas que je pourrai t’aimer alors, t’aimer librement ?
Fernand se taisait et baissait la tête.
– Mon bien-aimé, poursuivit Turquoise, ta petite Jenny a une volonté de fer. Ceci est à prendre ou à laisser… ou nous allons nous dire un adieu éternel, et j’entrerai dans un couvent ce soir même.
Fernand frissonna.
– Ou vous m’obéirez, monsieur, et ferez tout ce que voudra Jenny.
– Soit, murmura-t-il vaincu.
– Alors, tu vas être obéissant sur-le-champ, n’est-ce pas ?
– Que faut-il faire ? demanda-t-il, dompté.
– Il faut rentrer chez vous, rue d’Isly.
Le jeune homme tressaillit et songea à Hermine, qui, sans doute, le pleurait déjà comme mort.
– Ensuite, tu reviendras ici demain matin.
– Mais… voulut objecter Fernand.
– Il n’y a pas de mais… je le veux ! dit-elle en frappant le parquet de son joli pied et fronçant ses blonds sourcils.
Et comme il insistait encore, elle eut la persuasive éloquence de la femme dans toute sa puissance séductrice, et il consentit à s’en aller.
– Ah ! enfin ! murmura Turquoise lorsqu’il fut parti. Décidément, je le tiens, et il sera demain en passe d’entamer son magot pour moi. Oh ! les hommes, quels niais !
XXXIV
Hermine, on doit s’en souvenir, en voyant revenir Sarah, la jument favorite de Fernand, couverte de sueur, veuve de son cavalier et conduite par un inconnu qui la ramenait d’Étampes ; Hermine, disons-nous, avait oublié toute retenue pour courir chez le comte de Château-Mailly. Elle ne croyait, elle n’avait foi qu’en lui.
Le comte s’attendait à cette visite, et, au moment où la jeune femme faisait arrêter sa voiture devant la porte cochère, une autre voiture emportait l’Anglais sir Arthur Collins. Sir Arthur avait annoncé au comte la prochaine arrivée de madame Rocher, car il savait déjà que la jument arabe venait de rentrer rue d’Isly.
Le comte, en séducteur qui sait son métier, dressa ses batteries en un clin d’œil. Il sut donner à ses traits un cachet de tristesse et de dignité suprême, fit une toilette d’intérieur d’un négligé minutieux, et se tint dans son fumoir, qui était la plus délicieuse pièce de son entresol.
C’était donc là qu’il attendait, plein de foi dans les paroles de sir Arthur Collins qui venait de sortir, lorsqu’un coup de sonnette parti de l’antichambre arriva jusqu’à lui. Ce coup de sonnette était à la fois timide et précipité, et pour une oreille exercée, il semblait trahir l’agitation nerveuse de la main du visiteur.
– C’est elle ! pensa le comte dont le cœur se prit à battre avec une certaine violence.
Au bruit de cette sonnette, M. de Château-Mailly éprouva un tressaillement qui lui fit comprendre que c’était Hermine qui venait à lui. En effet, le valet de chambre du comte entra presque aussitôt dans le fumoir :
– Qui est-ce ? demanda M. de Château-Mailly d’une voix un peu émue.
– Une dame qui attend au salon et désire voir monsieur.
– La connais-tu ?
– Je ne sais pas.
– Comment, tu ne sais pas ?
– Non, dit le valet, car elle a un voile bien épais sur le visage.
– Fais entrer ici, dit le comte.
La femme voilée entra.
Le comte fut très fort à ce moment-là : il parut ne point deviner quelle était cette femme, et sa physionomie manifesta le plus vif étonnement, sans rien perdre toutefois de sa teinte de mélancolie profonde.
Mais Hermine releva son voile aussitôt que le valet se retira. Alors M. de Château-Mailly jeta un cri.
– Vous ici, madame ! vous ici ! murmura-t-il, jouant la stupeur.
Hermine était horriblement pâle et demeurait immobile.
– Ah ! reprit le comte en s’élançant vers elle et lui prenant la main, pardonnez-moi de vous recevoir ainsi… et dans cette pièce, ajouta-t-il avec un sentiment de courtoisie qui parut très naturel à la jeune femme. Mais j’étais si loin de penser… de soupçonner.
– Monsieur, dit Hermine en se laissant tomber sur un siège, je viens à vous comme à un ami…
– Oh ! merci ! murmura-t-il d’une voix qu’une émotion vraie altéra.
Puis, tout à coup, il parut se repentir de ce mouvement de joie :
– Mais, mon Dieu ! s’écria-t-il, qu’est-il donc arrivé ?
– Il est parti… dit Hermine.
Ces trois mots, en sortant de ses lèvres, résonnèrent lugubres et navrés comme s’ils eussent été le cri suprême chez cette femme…
M. de Château-Mailly, redevenu maître de lui, trouva convenable de jeter un cri de surprise et d’indignation, bien qu’il sût parfaitement déjà tout ce qui s’était passé, et il ne manqua point d’ajouter :
– Mais cela est impossible ! madame… Cela ne se peut… c’est elle qui est partie !
Hermine hocha la tête.
– J’ai exigé son départ, poursuivit M. de Château-Mailly, et elle est aujourd’hui sur la route d’Italie.
Hermine poussa un cri d’angoisse impossible à rendre.
– Mais… alors, balbutia-t-elle, il est parti avec elle ?
Et, chancelante, brisée, près de s’évanouir, elle eut cependant la force de raconter à M. de Château-Mailly comment Sarah, la jument arabe, venait de rentrer à l’hôtel, arrivant d’Étampes, où Fernand l’avait confiée à un messager.
Pendant ce récit, le comte, fidèle au rôle tracé par sir Williams, interrompit plusieurs fois Hermine par des exclamations d’étonnement et de douleur… Puis il se leva tout à coup, et, comme dominé par une inspiration inattendue :
– Madame, dit-il, je vous ai juré d’être votre ami, de vous ramener votre mari, je tiendrai ma promesse… S’il est parti, s’il a quitté Paris avec cette abominable créature, je courrai après lui… je le forcerai à revenir.
Le comte parlait avec chaleur, avec enthousiasme, comme un paladin qui prend l’infortune sous sa protection.
Le regard d’Hermine était suspendu à ses lèvres, et la jeune femme croyait en lui.
– Écoutez, reprit-il, puisque vous êtes venue jusqu’ici, madame, puisque vous avez eu assez de foi en mon honneur, en ma loyauté pour franchir ma porte, vous irez jusqu’au bout, n’est-ce pas ?
Il tremblait en parlant ainsi, et elle le regarda avec une expression d’étonnement qui peignait avec éloquence la pureté de son âme.
Elle ne comprenait pas.
– Vous allez rester ici, n’est-ce pas ? reprit-il, rester ici pendant une heure ou deux jusqu’à ce que je revienne ; car il faut que je sache la vérité sur-le-champ, et je vais courir…
La pauvre femme eut un vague espoir.
– Je resterai, dit-elle avec soumission.
Le comte sonna.
– Baissez votre voile, madame, dit-il vivement ; la femme de César ne saurait être soupçonnée.
Hermine obéit. Le valet de chambre du comte entrebâilla la porte.
– Jean, dit M. de Château-Mailly, je ne suis chez moi pour personne.
Le valet s’inclina.
– Fais atteler mon dog-cart sur-le-champ.
Le valet de chambre parti, M. de Château-Mailly passa dans son cabinet de toilette, qui était attenant au fumoir, et s’habilla rapidement.
Demeurée seule, Hermine avait caché sa tête dans ses mains et s’était prise à fondre en larmes. Le comte n’était séparé d’elle que par une porte entrouverte et une portière baissée ; il entendit ses sanglots déchirants, et, un moment, il fut réellement ému.
Un moment, M. le comte de Château-Mailly, le loyal gentilhomme, se demanda, en écoutant pleurer cette femme, si ce n’était point une chose honteuse et indigne de lui que cette abominable comédie qu’il jouait… Un moment, dominé par cet instinct de droiture qui était en lui, il songea à se jeter aux pieds de madame Rocher, à lui avouer son infamie et à lui demander humblement pardon. Mais, d’abord le comte songea que l’homme qui tombe, dans l’opinion d’une femme, du piédestal chevaleresque sur lequel il était monté, et ose convenir qu’il a menti, est perdu à tout jamais, et à tout jamais digne du mépris de cette femme. Ensuite il se souvint de son pacte avec sir Arthur Collins, ce flegmatique et rouge gentilhomme qui, seul, pouvait empêcher le mariage du vieux duc, son oncle, avec madame Malassis. M. de Château-Mailly irait jusqu’au bout et jouerait son rôle en conscience.
Il ressortit du cabinet de toilette en négligé du matin.
Un certain désordre qui régnait dans l’ensemble de sa mise attestait de sa précipitation à s’habiller. Il était comédien jusqu’au bout.
– Madame, dit-il en prenant de nouveau la main d’Hermine et la baisant avec respect, je ne cours pas, je vole. Avant une heure, je serai de retour.
Et le comte partit.
Ce ne fut que lorsqu’elle eut entendu le bruit des roues de son tilbury, et celui de la porte cochère, se refermant, que madame Rocher, cessant enfin de pleurer, jeta un regard autour d’elle et eut pour ainsi dire conscience de sa situation. Elle était chez un homme ; cet homme n’était ni son père ni son époux, ni son frère ; ce n’était pas même un parent. Cet homme, inconnu huit jours auparavant, était donc déjà bien intimement lié à sa destinée qu’elle se trouvait seule chez lui. Alors seulement Hermine frissonna et eut la pensée de fuir.
Sans doute le comte était un loyal gentilhomme, mais enfin Hermine était femme, et elle comprenait vaguement que cet homme l’aimait. Un moment, à cette pensée, elle oublia pourquoi elle était venue et pour quel motif il l’avait laissée seule ; elle songea à s’en aller précipitamment, et elle eut peur ; mais si elle partait, reverrait-elle jamais Fernand ? Cette dernière pensée domina la pudeur alarmée de la femme. Elle resta.
Il est chez toute femme une sorte de curiosité qui parvient à l’emporter sur les plus sérieuses et les plus pénibles préoccupations. Quand elle fut décidée à rester, Hermine essaya de tromper son impatience en cherchant une distraction quelconque à ses yeux et à ses pensées. D’abord elle examina le lieu où elle se trouvait : ce fumoir élégant et coquet, tendu d’une étoffe orientale aux vives couleurs, et dans lequel une main artiste et intelligente semblait avoir accumulé des chefs-d’œuvre de toute sorte.
C’étaient d’abord les tableaux de maître, tous petits, encadrés en chêne et appartenant à l’école flamande, des Hobvema, un Ruydal, un Téniers ; puis des bronzes enlevés à prix d’or chez l’artiste avant le coulage ; sur un guéridon placé au-dessous d’une glace de Venise, entre les deux croisées, une argile de David ; en face, un buste de marbre blanc. Ce buste, qui attira tout d’abord l’attention de madame Rocher représentait une femme, une femme de théâtre bien connue, et qui avait beaucoup aimé le comte pendant un mois ou deux, le temps le plus long que puisse durer un amour de comédienne.
Dans un coin, à droite de la cheminée, Hermine, qui s’était levée et faisait le tour de la pièce, remarqua un portrait, une blonde tête de seize ans, mutine et souriante. À côté du portrait, un médaillon, une délicieuse miniature représentant également une autre tête de femme, celle-là brune, accentuée, accusant l’origine espagnole, et belle d’une beauté sérieuse et presque fatale… Ces trois têtes, le buste et les deux portraits, impressionnèrent Hermine d’une façon bizarre, révélant chez elle, à son insu, une des singularités les plus curieuses du cœur féminin.
Hermine venait chez le comte, qui lui était indifférent, pour implorer son appui et lui redemander son mari ; bien mieux, elle aimait ce dernier si éperdument, d’une manière si exclusive, que toute autre pensée d’amour ne pouvait trouver place dans son cœur meurtri. Eh bien ! ces trois souvenirs de la vie de garçon du comte lui firent éprouver un mouvement d’impatience, quelque chose qui n’était pas encore de la jalousie, et y ressemblait cependant. Elle trouva inconvenant que le comte l’eût reçue dans cette pièce toute pleine encore de ses souvenirs galants, ne songeant plus, la pauvre femme, que M. de Château-Mailly n’avait pu s’attendre à sa visite, et qu’il avait témoigné le plus vif étonnement à sa vue.
Une heure s’écoula, pendant laquelle madame Rocher, tout en prêtant avec anxiété l’oreille aux moindres bruits, continua à examiner les objets qui l’environnaient. Mais une voiture se fit entendre sous la voûte de la maison, et Hermine, ramenée violemment à ses douloureuses pensées, se laissa retomber sur le siège où elle était tout à l’heure, tremblant de voir entrer M. de Château-Mailly lui disant :
– Il est parti !
C’était le comte, en effet.
Hermine lui jeta un regard qui semblait vouloir lire jusqu’au fond de son âme, et elle n’eut pas la force d’articuler un mot.
– Madame, lui dit-il vivement, votre mari est à Paris.
Elle jeta un cri de joie.
– Il est à Paris, et je vous le rendrai…
– Oh ! tout de suite, n’est-ce pas ? fit-elle avec l’impatience d’un enfant.
– Non, répondit-il, mais demain… Ne me questionnez pas aujourd’hui, je ne puis rien vous dire.
Elle courba le front, et ses larmes coulèrent de nouveau.
Alors M. de Château-Mailly fléchit un genou devant elle.
– Pauvre femme !… dit-il, comme vous l’aimez !…
Et sa voix était sourde, brisée, haletante : elle semblait révéler une souffrance intérieure sans égale ; et cette voix pénétra jusqu’au fond du cœur de la jeune femme et y jeta un trouble mélangé de remords.
– Lui aussi, pensa-t-elle, il m’aime… et je dois le faire souffrir.
– Vous êtes venue ici, madame, reprit le comte, qui parut faire un effort sur lui-même et dominer son émotion ; y venir une première fois était peut-être, aux yeux du monde, une grande imprudence, et pourtant il faudra y venir une fois encore demain soir, à quatre heures… Il le faut.
– Je reviendrai, répondit Hermine avec soumission.
Et, quand elle fut partie, le comte se dit : – Voilà une pauvre femme qui, avant un mois, m’aimera à mourir… Décidément ce damné sir Arthur Collins a une connaissance approfondie du cœur humain.
Et le comte alluma philosophiquement un cigare.
XXXV
Madame Rocher rentra chez elle, en proie à cette douleur morne, sans éclat, qui laisse les yeux rouges et secs.
Sa mère ne la questionna point. Madame de Beaupréau avait compris qu’il est de ces maux de l’âme que les consolations irritent au lieu de les adoucir.
Hermine passa le reste de la journée seule, enfermée dans son boudoir, livrée aux plus amères réflexions sur son bonheur détruit. Muette, immobile auprès du berceau de son enfant, elle vit la nuit s’écouler, se souvenant que c’était également la nuit qu’il était revenu, et espérant qu’il reviendrait encore. Mais la nuit s’écoula, le jour vint, puis la matinée se passa. Fernand n’avait point reparu.
Hermine n’osait point interroger les domestiques ; elle n’osait s’ouvrir à sa mère, car M. de Château-Mailly lui avait recommandé expressément de ne se confier à personne. Elle avait foi en M. de Château-Mailly.
À partir de midi, la pauvre jeune femme compta les heures qui la séparaient encore de celle où elle reverrait le comte. À mesure que cette heure approchait, son cœur se prit à battre d’une émotion inconnue et si bizarre, que Fernand lui semblait étranger.
Au dernier moment, de même qu’elle avait voulu fuir de chez le comte la veille, elle hésita à y aller. Pourtant il le fallait bien, si elle voulait avoir des nouvelles de son mari. À cette dernière pensée elle n’hésita plus. Elle sortit de chez elle furtivement, à pied, monta dans le premier fiacre qu’elle rencontra et se fit conduire rue Laffitte.
Quatre heures sonnaient au moment où elle gravissait l’escalier du n° 41.
La veille, Hermine était venue chez le comte, désespérée, la mort au cœur, sans souci d’elle-même et de sa réputation : elle y revenait aujourd’hui avec un faible espoir, forte des promesses du comte ; et cependant, à cette heure, son cœur battait plus fort, et une voix disait qu’elle était perdue par avance. Elle sonna d’une main tremblante.
Un homme vint lui ouvrir. C’était le comte lui-même. Par un excès de délicatesse que la jeune femme devait apprécier, le comte avait renvoyé ses gens ; il ne voulait point infliger à Hermine le supplice d’avoir à rougir devant les laquais.
Il lui prit la main et la fit entrer.
– Venez, lui dit-il à voix basse. Je suis seul… personne ne vous a vue entrer, personne ne vous verra sortir.
Cette fois il la conduisit au salon et la fit asseoir près du feu, dans un grand fauteuil, s’asseyant lui-même à distance respectueuse.
Pour la femme qui aime, il n’est au monde qu’un seul homme. Hermine aimait Fernand. Donc elle avait à peine regardé M. de Château-Mailly. Eh bien ce jour-là, elle ne put se défendre d’un mouvement de curiosité ; elle lui fit subir ce rapide examen qui suffit à la femme pour juger un homme physiquement et presque moralement, et elle s’avoua que le comte était peut-être digne de l’amour d’une femme autant par la noblesse de son caractère que par sa beauté physique.
– Madame, dit le comte, je puis vous donner, sur la conduite et la situation de votre mari, les plus minutieux détails.
– Parlez, monsieur, murmura-t-elle, je suis prête à tout… j’ai déjà tant souffert, que j’aurai la force de souffrir encore.
– Vous êtes une noble femme, répondit-il, et Dieu vous tiendra compte de votre force d’âme… Mais ayez foi en l’avenir, madame, tout n’est point désespéré encore…
– Que dites-vous, monsieur ? interrogea-t-elle avec une émotion indicible… Croyez-vous qu’il puisse m’aimer encore ?
– Peut-être…
Le comte prononça ce mot avec l’accent du doute, et cet accent alla au cœur d’Hermine.
– Écoutez, reprit M. de Château-Mailly, et soyez forte… J’avais obtenu de cette abominable créature qu’elle quitterait Paris ; elle y avait consenti, et, avant-hier matin, en effet, elle montait en chaise de poste. Mais, que voulez-vous ! le hasard a de singulières et horribles trahisons. Au moment où elle traversait le boulevard à la hauteur de la Madeleine, Turquoise a rencontré M. Rocher faisant sa promenade du matin à cheval. Elle a passé sans lui faire signe d’adieu, sans paraître l’apercevoir, et elle a continue sa route, ordonnant à ses postillons de courir ventre à terre. Mais M. Rocher l’avait vue ; il s’est mis à sa poursuite et a couru après elle jusqu’à Étampes, où il est parvenu à la rejoindre. À Étampes il s’est jeté à ses pieds comme un fou, pleurant, se tordant les mains.
– Ah ! fit Hermine avec un mouvement de dégoût et d’horreur.
– Pauvre femme ! murmura le comte.
Puis il lui prit la main et la baisa comme la veille.
– Ils sont revenus à Paris, dit-il, il est chez elle ; mais elle m’a juré qu’elle ne le garderait pas plus longtemps…
– Vous l’avez donc vue ? demanda Hermine en tremblant.
– Oui, ce matin.
– Et… lui ?
Le comte hocha la tête.
– Vous pensez bien, dit-il, que c’eût été imprudent. Je pouvais, du coup, perdre l’influence presque despotique que le hasard et d’abominables révélations m’ont donnée sur cette femme.
– Ainsi… elle le… renverra ?
– Oui… ce soir même.
Hermine eux un mouvement de joie, et un éclair d’espoir brilla dans ses yeux.
Mais ce ne fut qu’un éclair. Elle baissa la tête, une larme roula sur sa joue, et elle soupira : – Il y retournera, dit-elle, puisqu’il l’aime.
C’était le cas ou jamais, pour M. de Château-Mailly, de tomber aux pieds de madame Rocher, et il ne faillit point à son rôle.
Il se mit à genoux.
– Madame, murmura-t-il de cette voix triste et navrée, qui avait, la veille, si fortement ému Hermine, que puis-je répondre à une pareille question ? sinon que votre mari serait le plus insensé des hommes s’il ne vous aimait.
Et comme elle pleurait silencieusement :
– Je ne sais pas, dit-il, mais il me semble que l’homme assez heureux, assez protégé du ciel pour être aimé d’une femme telle que vous, devrait passer sa vie à genoux, et ne demander à Dieu qu’une chose : prolonger indéfiniment cette vie pour qu’il pût vous en consacrer chaque heure et chaque minute.
Malgré ses douleurs et l’état de prostration dans lequel elle se trouvait, madame Fernand Rocher ne put s’empêcher de frissonner et de rougir en écoutant ces paroles, prononcées d’une voix troublée et tremblante, et elle retira vivement sa main, que le comte pressait dans les siennes.
M. de Château-Mailly comprit qu’il ne devait pas aller plus loin ce jour-là, sous peine de voir s’évanouir la confiance qu’elle avait mise en lui. Il se releva et poursuivit d’un ton plus calme :
– J’ai la conviction, madame, que, tôt ou tard, éclairé par l’infamie de cette femme, honteux de sa conduite, plein de remords, votre mari viendra s’agenouiller devant vous et vous demander son pardon.
– Ah ! s’écria-t-elle avec un mouvement de joie égoïste, si vous pouviez dire vrai, monsieur !
Le comte soupira ; ce soupir brisa le cœur d’Hermine ; elle comprit qu’elle avait fait mal au comte avec ce cri de joie.
– Pardonnez-moi, dit-elle en lui tendant la main, je suis folle…
– Pauvre femme ! répéta-t-il encore avec un accent impossible à noter. Maintenant, continua-t-il, songeons à vous, madame, et, au lieu de nous désoler, cherchons à vous défendre contre l’avenir. Il s’agit de votre enfant.
Ce mot fit tressaillir madame Rocher.
– Je sais que vous possédez une immense fortune, poursuivit le comte, une de ces fortunes qui résistent à tout, même à la dent meurtrière d’une courtisane. Cependant, madame, vous n’avez point le droit de vous laisser appauvrir… ne fût-ce que d’un dixième… il faut songer à votre fils.
Hermine regarda le comte. Sa figure respirait, en ce moment-là, une entière franchise. Le séducteur n’était plus dans son rôle, et, en parlant ainsi, il se laissait aller à la noblesse native de son caractère. D’ailleurs, sir Williams, trop prudent pour livrer son secret, n’avait laissé entrevoir au comte que l’amoureux éconduit, le baronet sir Arthur Collins méditant la défaite de la femme qui lui avait résisté, mais non l’homme altéré de vengeance qui se sert d’un vil instrument, tel qu’une courtisane, pour ruiner une famille tout entière.
Jamais homme ne s’était présenté à une femme sous un jour plus chevaleresque et plus flatteur. Cet homme qui l’aimait, loin de parler de son propre amour, cherchait, au contraire, à lui ramener son époux infidèle et la suppliait de songer à l’avenir de son fils.
M. de Château-Mailly venait, peut-être à son propre insu, de faire vibrer chez madame Rocher la fibre la plus sensible ; il lui avait parlé de son enfant. Aussi la pauvre Hermine ne put-elle réprimer un de ces élans de généreuse gratitude qui n’appartiennent qu’à la femme. Elle tendit spontanément la main à M. de Château-Mailly :
– Vous êtes un noble cœur, lui dit-elle.
– Je le crois, répondit-il, et je vais essayer de vous le prouver…
Il demeura pensif un moment, et reprit :
– Votre mari reviendra aujourd’hui même chez vous. Peut-être allez-vous le trouver en rentrant…
– Mon Dieu, fit-elle, s’il allait savoir…
– Il ne saura rien. Attendez-vous à le voir vous expliquer son absence par une foule de mensonges embarrassés ; feignez de le croire, soyez avec lui d’une grande douceur, ne le brusquez pas… montrez-vous résignée… Le temps est le meilleur des médecins de l’âme… il vous reviendra.
– Mais, dit Hermine d’une voix altérée, il aime cette femme !
– Hélas ! je le sais… cependant…
– Le comte s’arrêta, comme s’il avait voulu peser ses paroles et en mesurer toute la portée.
– Cependant, poursuivit-il, l’amour qui ne repose point sur l’estime ne saurait durer longtemps ; le jour où il reconnaîtra toute l’infamie de cette femme…
– Mais, interrompit vivement madame Rocher, qui lui montrera, qui lui fera toucher du doigt cette infamie ?
– Moi.
Ce seul mot fut articulé si froidement que madame Rocher ne douta point un seul instant de la conviction profonde de M. de Château-Mailly.
– Seulement, ajouta-t-il, pour arriver à ce résultat, il nous faut, à moi du temps, à vous du courage et de la résignation.
– J’en aurai, monsieur, j’en aurai pour mon enfant.
– Adieu, dit-il, ayez foi en moi… Je suis votre ami…
Il prononça ce dernier mot avec effort, comme s’il lui eût déchiré la gorge, et, une fois encore, Hermine tressaillit et se sentit troublée jusqu’au fond du cœur. Elle le devinait et le voyait, M. de Château-Mailly l’aimait.
– Vous reverrai-je bientôt ? demanda-t-il tout bas et en tremblant, tandis qu’il la reconduisait.
– Oui… balbutia-t-elle en rougissant… oui, s’il le faut…
Elle le vit pâlir :
– Oh ! pardonnez-moi, dit-elle, je suis égoïste, je ne pense qu’à moi… et à lui.
– Je n’ai rien à vous pardonner, madame ; si vous avez besoin de moi, si vous pensez que je ne puisse agir seul ou que vous désiriez savoir ce que j’aurai fait, eh bien, écrivez-moi un mot, prévenez-moi… et vous verrez ! Ne suis-je pas un peu votre frère ?
Il lui pressa la main, étouffa un soupir et la conduisit jusqu’au seuil de son appartement.
Madame Rocher rentra chez elle plus émue et plus troublée qu’elle ne l’était la veille, et cependant il lui avait affirmé qu’elle allait revoir son mari.
Pourquoi donc ce trouble et cette émotion auxquels sans doute Fernand était étranger ?
C’est que sir Williams était un profond observateur du cœur humain, un homme qui calculait l’avenir mathématiquement, en prenant pour point de départ la faiblesse de la femme et son désespoir. Hermine aimait son mari ; mais en ne songeant qu’à lui, en n’adorant que lui, elle n’avait pu, cependant, se défendre d’établir un parallèle entre lui et M. de Château-Mailly, entre cet homme à qui elle avait apporté une fortune princière, qu’elle n’avait cessé d’aimer un seul jour, une seule minute, pendant quatre années, à l’innocence de qui elle avait cru quand tous l’accusaient, et qui l’abandonnait lâchement pour une courtisane éhontée, pour une femme sans pudeur, à laquelle il sacrifiait par avance le bonheur de sa maison, le calme de son foyer, peut-être l’avenir de son fils ; et cet autre, qui l’aimait avec assez d’abnégation pour s’effacer complètement et ne songer qu’à elle, cet homme, devenu son mari, son conseil, son protecteur… qui ne demandait rien, qui souffrirait en silence s’il pouvait la voir heureuse.
Et quand une femme reconnaît à un homme une réelle supériorité morale, cet homme est bien près d’être aimé.
Hermine renvoya son fiacre à l’entrée de la rue d’Isly et gagna son hôtel à pied. Le valet de chambre de Fernand, qui se trouvait sur le seuil de la porte, lui dit : – Monsieur est rentré.
Hermine eut un horrible battement de cœur.
Ce n’était pas de la joie… c’était de la terreur.
Il lui semblait à elle, la femme chaste et pure, à elle qui n’avait risqué une démarche compromettante que pour l’amour de lui, que cet homme coupable, indigne désormais de son affection et de son amour, allait lui demander compte de sa conduite et lever sur elle le regard sévère d’un juge.
Il n’en fut rien.
Fernand était au salon, jouant avec son fils, lorsque Hermine y arriva. L’enfant se roulait sur le tapis, en riant. Fernand le contemplait avec cette joie sereine qui trahit l’orgueil de la paternité.
Hermine, qui chancelait à chaque pas, était entrée sur la pointe du pied, pâle, émue, sans voix. La porte était entrouverte, le tapis épais. Fernand tournait le dos, il n’entendit point le pas de sa jeune femme. Hermine s’était arrêtée sur le seuil.
Ce père jouant avec son jeune fils, ce père prodigue revenu au foyer de la famille.
N’était-ce point le repentir personnifié ?
N’était-ce point l’espoir de l’avenir ?
N’était-ce pas le retour du bonheur ?
Elle le crut un moment et, demeurant immobile, elle attendit que Fernand se retournât.
Il se retourna en effet peu après.
– Ah ! dit-il avec surprise, vous voilà ?
Il était souriant et calme. Hermine crut avoir fait un rêve.
– Vous voilà, chère amie ? reprit-il.
Et il fit un pas vers elle.
Hermine jeta un cri de joie, oublia toutes ses tortures en une seconde et se jeta dans ses bras.
– Mon Dieu ! dit Fernand avec calme, qu’avez-vous donc, chère amie ?
– Ah ! je te revois enfin ! murmura-t-elle toute frémissante de bonheur.
Mais Fernand Rocher ne se départit point de son calme :
– Parbleu ! dit-il en souriant, avez-vous donc cru, ma chère amie, que j’allais disparaître de la surface du globe ?
Cette réponse frappa madame Rocher de stupeur. Elle ne trouva pas un mot à répondre et regarda son mari.
Fernand poursuivit :
– Il est vrai que je me suis absenté sans vous prévenir, chère amie, et j’ai eu tort en cela…
Il s’arrêta, un sourire épanouit ses lèvres :
– Mais, acheva-t-il, cela ne m’arrivera plus, je vous le promets.
Madame Rocher se trompa au sens de ces paroles. Elle crut que son mari repentant voulait se soustraire de trop pénibles aveux et se bornait à implorer son indulgence.
– Vrai ? fit-elle avec la joie naïve d’un enfant.
– Sans doute, répondit-il, car vous avez dû être un peu en peine de moi…
Il prononça ces mots froidement, si froidement même, que sa femme éprouva une réaction violente, semblable à celle qui glace tout à coup le sourire sur les lèvres et arrête les élans du cœur comme un ressort qui se brise suspend le mouvement d’une montre.
– En effet, continua-t-il, voici deux escapades pour une… depuis dix jours. Je me suis battu comme un jeune homme qui ne songe qu’à lui et non à ce qu’il peut laisser derrière lui. Et avant-hier je suis parti comme un homme qui reviendra déjeuner, et j’ai fait trente lieues.
Il parlait d’un ton si dégagé, que sa femme l’écoutait avec une sorte de douloureuse stupeur.
– Ah ! dit-elle enfin, vous avez fait trente lieues ?
– Oui… Oh ! une imprudence. Et il ajouta en riant : Les suites d’un pari…
Madame Rocher le regarda et tressaillit profondément. Il était évident que Fernand mentait.
Ah ! s’il avait balbutié, s’il avait essayé de déguiser la vérité avec ce naïf embarras et cette gaucherie d’un homme qui n’y est point habitué et qui s’y voit contraint par la nécessité la plus impérieuse… Mais il mentait froidement, effrontément, comme un laquais ou la soubrette d’une comédienne qui a sa leçon faite… Il mentait avec tout l’aplomb de Turquoise elle-même, qui semblait en ce moment lui souffler une à une chacune de ses paroles.
– Oui, ma chère, un pari… un pari bête et qui a failli coûter la vie à cette pauvre Sarah.
– Ah ! fit Hermine distraite.
– Figurez-vous que j’ai rencontré le vicomte d’A…, vous savez ? une connaissance de la Marche et de Chantilly. Le vicomte montait un cheval anglais qui a couru à Epsom et à Newmarket. Moi, je montais Sarah. Nous nous sommes rencontrés rue Royale. Le vicomte a prétendu que Sarah allait moins vite que son cheval ; moi j’ai soutenu le contraire : de là un pari de vingt-cinq louis. Nous avons pris Étampes pour but et nous sommes partis. Je suis arrivé le premier à Étampes et j’ai failli crever Sarah. Il y a mieux, cette course à franc étrier m’avait tellement brisé que j’ai été forcé de dormir trente heures. J’étais littéralement moulu. Voilà le secret de mon escapade. Que vous en semble ?
– Mais… dit Hermine avec un calme subit qu’elle semblait puiser au fond de sa douleur.
– En effet, ma chère, mais je me repens un peu cependant, car vous auriez pu être en peine de moi.
– Non, dit sèchement madame Rocher, n’avais-je pas de vos nouvelles par l’homme qui a ramené Sarah ?
– Ah ! dit Fernand, qui se troubla un peu, vous l’avez vu ?
– Oui.
– Et il vous a dit…
– Que vous lui aviez confié votre cheval à Étampes.
– Et… rien de plus ?
– Rien de plus.
Hermine avait fait un héroïque effort pour mentir. Mais l’atroce sang-froid de son mari la rendait forte.
Fernand, lui, avait respiré.
– N’importe ! reprit-il, cela est très sot de ma part. J’aurais dû vous prévenir. Ou plutôt, tenez, faisons une chose, ma chère, ce sera plus simple… Convenons entre nous que vous me passerez d’avance ces folies d’hippomane, et ne vous alarmerez pas quand je rentrerai tard… ou même… Il hésita un moment.
– Eh bien ? demanda Hermine.
– Ou même pas du tout, dit-il d’un ton dégagé.
– Comme vous voudrez, répondit madame Rocher, dans le cœur de laquelle quelque chose venait de se briser tout à coup, et dont la voix eut le timbre sec et régulier d’une horloge… comme vous voudrez…
Hermine aimait encore son mari, alors ; mais, hélas !… elle ne l’estimait plus ! Fernand lui avait menti, il s’apprêtait à lui mentir encore.
Or, le jour où l’homme ment à la femme qu’il aime, l’amour de cette femme, si dévoué, si immense qu’il soit, commence à se briser.
Fernand ne regardait plus sa femme, et songeait à Turquoise.
XXXVI
Lorsque Fernand, obéissant enfin à la Turquoise, se fut décidé à quitter le petit hôtel de la rue Moncey, la blonde pécheresse sonna sa femme de chambre :
– Vite ! dit-elle, un fiacre et habille-moi… Léon doit être aux cents coups, voici trois jours qu’il ne m’a vue.
Ce que Turquoise appelait en ce moment l’habiller, c’était revêtir la robe de laine, chausser les souliers lacés et mettre le petit bonnet de la fausse Eugénie Garin, la prétendue fille du pauvre aveugle. Cette toilette se trouva faite en un clin d’œil, et le fiacre arriva peu après.
Turquoise y monta et se fit conduire place de la Bastille. Là elle mit pied à terre, paya son cocher et le renvoya. Puis, un petit panier au bras, elle se dirigea vers la rue de Charonne, de ce pas modeste et pressé de l’honnête ouvrière qui évite tout compliment banal et toute rencontre. Elle ne s’arrêta qu’à la porte de cette maison où avait demeuré le père Garin, et entra dans la loge.
La veuve Fipart était à son poste, en portière bien éduquée et qui sait ses devoirs. À la vue de Turquoise elle se leva avec empressement de son vieux fauteuil d’acajou garni en velours d’Utrecht et placé à portée du carreau et du cordon ; puis elle courut à la rencontre de la jeune femme, et grimaçant son odieux sourire :
– Ah ! dit-elle, vous faites bien d’arriver, mam’selle.
– Pourquoi ?
– Parce qu’il est comme un fou, le mari à la petite Cerise.
– Ah ! ah ! fit Turquoise en riant. Et elle ajouta : – Donnez-moi ma clef, mère Fipart, et venez m’allumer du feu. Il fait un froid de chien aujourd’hui.
La veuve se hâta d’obéir. Elle s’arma d’une clef accrochée à l’un des clous de la loge, prit un cotret sous son bras et monta devant Turquoise avec une légèreté juvénile. Elle s’arrêta au troisième étage, ouvrit une porte et introduisit la blonde fille dans un petit appartement qui pouvait paraître misérable auprès de l’hôtel de la rue Moncey, mais qui, évidemment, était un palais somptueux relativement à l’horrible grenier dans lequel nous avons trouvé le père Garin et sa fille Eugénie recevant la première visite de Léon Rolland. C’était là le nouveau domicile d’Eugénie.
Or, pour expliquer ce changement de logis et les paroles de la veuve Fipart : « Il est comme un fou depuis trois jours, le mari à la petite Cerise, » nous sommes obligé de faire un pas en arrière.
Turquoise, comme on a pu le voir, avait une double vie et un double but.
Sous le nom de Jenny, elle habitait le petit hôtel de la rue Moncey. Sous ce nom encore, elle avait pour mission de se faire aimer de Fernand et de le ruiner.
En même temps, Turquoise, métamorphosée en ouvrière, en fille du père Garin, l’aveugle, habitait la rue de Charonne. Là, elle avait pour but de tourner la tête à Léon Rolland, l’honnête époux de la belle et chaste Cerise.
Nous sommes donc forcé, pour expliquer la double existence et la double action de cet instrument des vengeances de sir Williams, d’entrer dans quelques brèves explications.
Ce fut, si nous avons bonne mémoire, environ trois jours après que Fernand eut été transporté chez elle que Turquoise apparut pour la première fois à Léon Rolland. Pendant cinq jours encore, et bien que le blessé fût toujours chez elle, il fut très facile à la jeune femme de se rendre chaque jour rue de Charonne et de s’y trouver à l’heure où Léon Rolland venait régulièrement voir l’aveugle. Le départ de Fernand de l’hôtel de la rue Moncey, c’est-à-dire la façon mystérieuse dont elle l’éconduisit de chez elle, les yeux bandés, permit à Turquoise de consacrer quatre jours entiers à Léon.
On sait ce qui arriva lorsque l’ébéniste alla rue de Charonne muni d’un billet de mille francs avec l’intention de renvoyer l’aveugle dans son pays. Il était venu, fort de sa résolution, avait trouvé Eugénie seule, Eugénie qui lui annonçait son départ, et le pauvre amoureux avait perdu la tête. Au lieu de consentir au départ de la jeune fille, il était tombé à ses genoux, lui avouant son amour.
C’est à partir de ce moment que nous allons raconter succinctement ce qui s’était passé entre Turquoise et Léon Rolland.
Le maître ouvrier passa plusieurs heures chez la jeune fille, l’accablant de ses protestations de tendresse. Eugénie ne cessa de pleurer, et elle aussi elle avoua à Léon qu’elle l’aimait.
Léon rentra chez lui ce soir-là à demi fou de joie, et il eut, comme Fernand devait l’avoir quelques jours après, le courage de dissimuler et de jouer un rôle.
Mais on n’aime pas deux femmes à la fois. Léon aimait Eugénie Garin ; donc il n’aimait plus Cerise.
Le lendemain, vers huit heures du matin, l’ébéniste courut rue de Charonne.
Il avait passé la nuit à envisager aussi froidement que possible la situation nouvelle que lui faisait son amour, et, dans l’espace de cette nuit, il avait mûri un projet.
Ce ne fut donc pas d’abord à la mansarde du père Garin qu’il monta.
Il entra dans la loge de la veuve Fipart, qui le salua jusqu’à terre.
– Avez-vous quelque chose à louer ici ? lui demanda-t-il aussitôt.
– Oh ! certes oui, mon bon monsieur, répondit-elle en faisant la révérence.
– Qu’avez-vous ?
– Un amour d’appartement au troisième.
– Combien ?
– Deux pièces, une cuisine, un grand cabinet noir.
– Mais, le prix ?
– Trois cents francs.
– Voyons ! dit Léon.
La veuve Fipart s’empressa de montrer le logement.
– Bien, dit Léon, je le loue.
Il donna cent sous de denier à Dieu, et signa sur-le-champ l’engagement de loyer au nom de mademoiselle Eugénie Garin. Quand ce fut fini, Léon monta chez la jeune fille. Eugénie Garin, débarrassée de Fernand depuis la veille au soir, était déjà à l’ouvrage auprès de son petit poêle de fonte. Quand elle vit entrer Léon, elle rougit jusqu’au blanc des yeux, et cacha sa tête dans ses mains pour dissimuler sa confusion. Léon lui prit silencieusement la main ; puis il lui dit en tremblant :
– Me pardonnez-vous ?
Elle ne répondit pas, mais un soupir souleva sa poitrine, et elle pressa silencieusement la main de l’ouvrier.
– Venez avec moi, continua-t-il, venez.
Elle le regarda avec un étonnement simulé.
– Où voulez-vous me conduire ? lui demanda-t-elle.
– Venez.
Il la prit par la main et la fit sortir de l’affreux taudis :
– Je veux vous montrer un logement qui se trouve dans cette maison.
Elle parut ne point comprendre, et le suivit. Il la conduisit au troisième, et la fit entrer.
– Que pensez-vous de ce petit appartement ? lui dit-il.
– Je pense qu’il est occupé par une personne plus riche que moi, dit-elle en souriant d’un sourire triste.
– Vous vous trompez…
Elle le regarda d’un air si naïf que l’homme le plus fort s’y fût trompé.
– Ce logement est à moi, dit Léon.
– À vous ?
– Non, je me trompe, il n’est pas à moi… il est… Vous ne devinez pas ?
– Comment devinerais-je ?
– Il est à vous, Eugénie.
– À moi ! fit-elle en poussant un cri.
Il se remit à genoux.
– Pardonnez-moi, dit-il ; peut-être vous ai-je offensée, mais, que voulez-vous ? cette mansarde de là-haut était si horrible !
Elle cacha sa tête dans ses mains, et fondit en larmes.
– Oh ! fit-elle, quelle humiliation !
Mais le pauvre homme était à genoux, il priait, il suppliait, il parlait au nom de son amour.
Eugénie se laissa vaincre et persuader ; elle consentit à habiter ce logis, à prendre possession de ce joli petit ameublement, que Léon prétendit avoir pris tout entier dans ses ateliers.
– Mon Dieu ! murmura-t-elle, faut-il donc que je vous aime !
* *
*
Ce soir-là commença la vie de désespoir de la pauvre Cerise : Léon aimait Turquoise, Léon ne voyait qu’elle, ne songeait plus qu’à elle… On le vit à peine à son atelier durant quatre jours. Il partait de bonne heure, rentrait bien avant dans la nuit. Si sa jeune femme le questionnait, il répondait avec impatience, presque brutalement. Pendant ces quatre jours, Léon ne vécut plus que pour Eugénie. Ce fut un rêve, dont le réveil devait être terrible.
Le cinquième jour au matin, comme Léon arrivait, vers huit heures, rue de Charonne et s’apprêtait à gravir l’escalier de ce pas alerte et précipité particulier aux amoureux, la veuve Fipart montra sa tête hideuse par le carreau de la loge.
– Hé ! monsieur Rolland ? dit-elle.
Léon se retourna et regarda la vieille.
Elle avait sur les lèvres un sourire moqueur qui fit tressaillir Léon.
– Que voulez-vous ? fit-il.
– Vous remettre la clef.
– Quelle clef ?
– Celle de mam’selle Eugénie.
– Elle est donc sortie ?
– Oui.
– À huit heures du matin ?
– Oh ! bien avant, monsieur ; il était à peine jour quand elle m’a remis sa clef.
– Et… où allait-elle ?
– Je ne sais pas.
Léon monta, saisi d’un funeste pressentiment.
Le petit appartement était propret et rangé comme de coutume, et tout y dénotait la présence récente d’Eugénie.
Sur la table de la salle à manger, Léon aperçut une lettre. Il s’en empara, l’ouvrit, lut, et demeura foudroyé.
La lettre qui venait de lui échapper des mains contenait ces deux lignes :
« Mon ami,
« Des motifs que je ne puis vous révéler m’obligent à me séparer de vous un jour ou deux, mais nous nous reverrons bientôt.
« Je vous aime.
« Eugénie. »
Cette lettre produisit sur Léon l’effet d’un coup de massue. D’abord il crut rêver, et fut obligé de se convaincre qu’il était bien éveillé. Ensuite il fut assailli par une pensée de jalousie. Pensée terrible et soudaine qui fit perler la sueur à son front, battre ses tempes, et figer son sang dans ses veines. Eugénie ne l’abandonnait-elle pas pour suivre quelque heureux rival ?
L’ouvrier se laissa tomber sur un siège, s’accouda à la table, appuya son front dans ses mains et se mit à pleurer comme un enfant.
Une heure après, la veuve Fipart monta. Léon l’accabla de questions sur le départ d’Eugénie. La portière ne savait rien, si ce n’est qu’Eugénie, la veille, était sortie à la brune, n’était rentrée que fort avant dans la nuit, et était partie, le matin, emportant un petit paquet. Le maître ouvrier s’en alla désespéré.
Il revint dans la journée, le soir, le lendemain… Eugénie n’était pas revenue.
Deux jours s’écoulèrent pour Léon dans des angoisses mortelles, et souvent une pensée de suicide l’assaillit.
Mais, dans sa lettre, la jeune fille promettait de revenir, et il espéra. Elle disait que son absence durerait un jour ou deux. Le soir du troisième jour, vers quatre heures, Léon revint.
– Je ne l’ai pas vue, répondit la veuve Fipart. Faut croire, mon bon monsieur Rolland, qu’elle est bien empêchée… car elle vous aime, allez… ça se voit bien.
Il ne voulut point en entendre davantage et s’en alla, des larmes plein les yeux.
Or, il y avait à peine dix minutes qu’il venait de quitter la rue de Charonne, lorsque Eugénie arriva dans cet humble costume qui cachait la Turquoise et lui donnait l’apparence d’une pauvre ouvrière. Turquoise monta donc chez elle, au troisième étage, précédée par la veuve Fipart, qui lui alluma du feu dans la cheminée et mit une bougie sur la table.
Là, elle s’assit fort tranquillement et regarda la veuve Fipart.
– Eh bien ! dit-elle avec cette familiarité qu’ont les femmes du monde galant pour celles qui n’en sont plus, qu’est-il donc arrivé ? Conte-moi cela, ma chère.
– Il est arrivé, répondit la digne veuve de l’infortuné Nicolo, que l’époux à la belle Cerise vient ici dix fois par jour, qu’il se met à pleurer comme un enfant et qu’il croit que vous avez suivi quelque amoureux.
Turquoise se prit à sourire.
– Est ce tout ?
– Dame !
– Quand est-il venu pour la dernière fois ?
– Tout à l’heure. Il vient de partir.
– Bon ! il ne reviendra pas tout de suite, j’imagine, et j’ai le temps d’écrire une lettre.
Puis, se ravisant :
– Dans tous les cas, Fipart, dit-elle, mets-toi à la fenêtre. As-tu de bons yeux ?
– J’y vois la nuit, comme les chats.
– Eh bien, reste là, et si tu le voyais venir, tu me préviendrais, j’aurais le temps de me sauver.
Turquoise prit une plume, du papier, s’assit commodément, parut réfléchir une minute, et écrivit les lignes suivantes, qu’elle eut soin de parsemer de nombreuses fautes d’orthographe, ce qui donne toujours un certain cachet à la lettre d’une femme :
« Mon ami,
« Pardonnez-moi, je vous ai menti.
« Je vous ai menti, mon pauvre Léon, en vous disant que je reviendrais bientôt et que nous nous reverrions.
« J’ai quitté la rue de Charonne avec l’intention de ne plus vous revoir, et je n’y reviens aujourd’hui que pour vous laisser ces lignes, qui sont un éternel adieu. »
– Hum ! interrompit Turquoise, voilà une phrase qui a bien son mérite et qui vaut son pesant d’or. Mon honorable protecteur en serait ravi.
Et elle continua :
« Non, mon ami, nous ne nous reverrons plus, nous ne devons plus nous revoir. Gardons le souvenir du passé comme on garde le souvenir d’un beau rêve.
« Mon ami, le cœur me manque en traçant ces lignes, car je vous aime plus que vous ne m’aimez peut-être… Et c’est parce que je vous aime que je veux être forte et ne penser qu’à vous.
« Si vous aviez été libre, votre amour eût été pour moi le paradis sur la terre… Mais vous êtes marié… vous êtes père… Et j’ai songé que, si pur que fût mon amour, si naïf qu’eût été l’élan de mon cœur qui m’a conduit vers vous, je n’en étais pas moins une créature indigne qui jette le désordre dans un ménage…
« C’est pour cela, mon ami, que je vous dis adieu. Songez que vous avez de graves devoirs à remplir et que quelques jours vous suffiront pour m’oublier…
« Plaise au Ciel que j’aie le même bonheur !
« Adieu encore. Pardonnez-moi… et oubliez-moi…
« Eugénie. »
Turquoise laissa cette lettre tout ouverte sur la table.
Puis elle dit à la Fipart quelques mots à voix basse, redescendit avec elle et s’en alla à pied, comme elle était venue, jusqu’au boulevard, où elle reprit une voiture.
– S’il ne se tue pas avant demain, pensa-t-elle, dans trois mois il mettra la bague d’alliance de sa femme au mont-de-piété pour m’apporter un bouquet. Oh ! les hommes, quelle race méprisable et sotte ! murmura-t-elle.
Une heure après le départ de Turquoise de la rue de Charonne, Léon y revint.
– Eh bien ? demanda-t-il à la veuve Fipart, qui, ses besicles sur son nez, lisait gravement un feuilleton.
– Eh bien ! elle est venue.
Il poussa un cri de joie et voulut s’élancer dans l’escalier. La vieille le retint par le pan de sa redingote.
– Attendez donc, dit-elle, que je vous conte…
– Quoi ? fit Léon avec impatience.
– Des choses qui vous intéresseront peut-être.
– Voyons, et dépêchez-vous.
– Oh ! nous avons le temps, ricana la veuve Fipart, elle n’est pas en haut.
– Ah !
– Elle est sortie.
– Encore !
– Dame ! écoutez donc…
Léon Rolland était redevenu pâle et tremblant tout à coup.
– Il paraît, dit gravement la veuve Fipart, que mam’selle Eugénie en a fait de belles depuis qu’elle est partie…
– Que dites-vous ? que voulez-vous dire ? exclama Léon d’une voix émue.
– Elle a fait fortune, il paraît.
– Elle… a… fait… fortune ?… murmura-t-il avec stupeur.
– C’est probable…
– Mais expliquez-vous donc ! s’écria Léon. Vous me faites mourir.
– Eh bien, elle était vêtue comme une duchesse.
Léon eut le vertige.
– Elle avait des plumes à son chapeau, poursuivit la veuve, à qui Turquoise avait fait la leçon.
– Vous êtes folle ! balbutia Léon.
– Et elle était en équipage.
– Vous rêvez.
– Un coupé à deux chevaux, poursuivit la Fipart, avec un cocher galonné d’or. Et comme elle passait, deux jeunes gens, qui étaient descendus de cheval, ont dit : « Voilà la plus jolie fille entretenue de Paris. »
Léon ne voulut point en entendre davantage ; il monta précipitamment au troisième étage, en dépit de la vieille qui lui disait :
– Monsieur Léon, j’oubliais de vous dire qu’elle n’était pas seule… Il y avait un beau monsieur dans la voiture…
Léon n’entendait plus.
La porte du petit logis était ouverte, le feu brûlait dans la cheminée, la bougie était encore sur la table.
Le cœur de l’ouvrier se prit à battre.
Il espéra un moment que la portière avait menti… Il crut qu’elle était là.
– Eugénie ! Eugénie ! cria-t-il en faisant le tour de l’appartement.
L’appartement était vide.
Il aperçut la lettre demeurée ouverte sur la table, la prit d’une main convulsive et la lut…
La veuve Fipart, qui montait alors l’escalier, entendit tout à coup un grand cri, puis un bruit sourd… Celui de la chute d’un corps sur le parquet. En achevant de lire la lettre d’adieu de Turquoise, le malheureux Léon Rolland était tombé à la renverse et s’était évanoui.
* *
*
Revenons maintenant rue Moncey, où Turquoise s’était hâtée de retourner.
XXXVII
Au moment où Eugénie Garin, ou, si vous le préférez, la Turquoise quittait, vêtue en ouvrière, son petit hôtel pour aller rue de Charonne, un coupé de remise qui montait la rue de Clichy vint s’arrêter devant la grille du jardin.
Une femme en descendit. Cette femme, vêtue de noir et le visage couvert d’un voile épais, mais dont la démarche assez vive trahissait la jeunesse, sonna à la grille sans hésitation et comme si elle allait rentrer chez elle.
Puis, la grille s’étant ouverte, elle traversa rapidement le jardin et alla droit à l’entrée principale de l’hôtel.
– Voilà une dame, dit le valet de chambre de Turquoise, qui entre ici comme chez elle, ma parole d’honneur ! pourtant je ne l’ai pas encore vue.
– Madame Jenny ! demanda la visiteuse en posant le pied sur la première marche du perron.
– C’est ici, madame, répondit le valet, d’un ton leste et presque impertinent.
La visiteuse était vêtue de noir, simplement, comme une honnête femme ; c’en était assez pour exciter l’insolence d’un valet de cette sorte.
– C’est ici, reprit-il, mais elle n’y est pas.
Elle releva son voile, et lui dit avec cet accent d’autorité auquel la livrée ne se trompe jamais et reconnaît ceux qu’elle a coutume de respecter :
– Alors, conduisez-moi au salon, j’attendrai.
Et elle l’écarta d’un geste impérieux, entra dans le vestibule et se dirigea fort tranquillement à droite, vers le salon d’hiver, dont elle ouvrit elle-même la porte sans plus d’hésitation.
Le laquais était stupéfait.
Baccarat, car c’était elle, s’assit sans façon au coin du feu, dans une vaste ganache qui datait de son temps, car sir Williams avait fait acheter l’hôtel tout meublé, et Turquoise n’y avait apporté que son bonnet de nuit et ses espérances. Après quoi elle remit une carte au valet.
– Quand votre maîtresse rentrera, vous lui direz que je l’attends.
Une lampe placée sur la cheminée du salon éclairait le visage de la pécheresse repentie, dont la beauté souveraine acheva de dompter l’effronterie du valet et l’intimida.
– Votre maîtresse est sortie ? demanda Baccarat.
Elle le regardait avec cette fixité qui interdit le mensonge aux subalternes.
– Oui, madame, répondit-il.
– Quand rentrera-t-elle ?
– Pour le dîner, dans une heure.
– C’est bien. Allez.
Et Baccarat congédia le valet d’un geste.
Le valet alla trouver la femme de chambre, à laquelle il confia cette bizarre visite d’une femme qui pénétrait dans l’hôtel ainsi qu’en un pays conquis.
– Je sais qui ce peut être, dit la soubrette.
– Qui donc ? fit le valet curieux.
– Une dame que madame attend à toute heure.
Le valet jeta les yeux sur la carte de Baccarat et lut.
MADAME CHARMET.
– Est-ce cela ? demanda-t-il.
– Je ne sais pas son nom, mais ce doit être elle.
Une heure après, Turquoise rentra.
– Madame, lui dit la soubrette, courant à sa rencontre, il y a au salon une dame qui vous attend.
– Ah ! fit Turquoise, qui tressaillit.
– Voilà sa carte.
– C’est elle ! pensa Turquoise. Viens me déshabiller et me passer une robe.
Et Turquoise, entrant dans le vestibule, se disposait à monter au premier étage et à passer dans son cabinet de toilette ; mais, soudain, elle rebroussa chemin. Elle avait eu une de ces inspirations qui sont comme les éclairs du génie, et Turquoise était presque une femme de génie.
Elle revint donc sur ses pas et entra dans le salon, où Baccarat se trouvait en ce moment aux prises avec les souvenirs du passé.
La pauvre femme, en se retrouvant dans cette maison où elle avait gaspillé les premières années de sa folle vie, dans ce salon où chaque meuble était pour elle comme un jalon qui lui permettait de reconstruire le passé, s’était laissée aller à une rêverie profonde. On n’a point été courtisane impunément ; on ne s’est point nommée impunément la Baccarat, c’est-à-dire la femme élégante et blasée, au sourire d’ange, au cœur d’airain, pour laquelle un homme se brûlait la cervelle, et qui traînait à son char le baron d’O…, le lion parisien par excellence, à une certaine époque. On n’a point été cette femme pour ne s’en souvenir jamais. Dans ce lieu, à cette heure, au milieu du silence, Baccarat avait cru un moment renaître de ses cendres. Elle s’était reportée bien avant dans un passé lointain, se demandant si le passé plus récent n’était pas un rêve…, si son repentir, sa vie austère, sa sombre et froide maison de la rue de Buci, tout cela n’était point la conséquence d’une hallucination… ; si, enfin, elle n’était pas toujours la Baccarat, la folle pécheresse, égrenant sous ses doigts prodigues les cœurs et les fortunes…
Le bruit de la porte, ouverte sous la main de Turquoise, arracha madame Charmet à sa rêverie.
Elle jeta un regard sur son noir costume, s’aperçut bien qu’elle n’avait plus sa robe de chambre en velours grenat à retroussis bleus… et le sentiment de la réalité lui revint. Baccarat était morte…
Madame Charmet, l’austère femme de charité, existait seule.
Elle se retourna pour voir qui entrait.
Turquoise, vêtue en ouvrière, coiffée d’un petit bonnet de lingerie, était sur le seuil.
Baccarat la prit pour une femme de chambre, et lui dit :
– Votre maîtresse est-elle rentrée ?
– Oui, madame, répondit Turquoise en s’avançant et saluant Baccarat.
– Alors, prévenez-la que je l’attends.
– Madame, dit Turquoise en fermant sa porte et continuant à marcher vers Baccarat, veuillez excuser le costume dans lequel vous me voyez et qui vous fait me confondre avec ma femme de chambre sans doute…
Baccarat eut un geste de surprise, et regarda Turquoise attentivement.
– C’est moi qui suis Jenny.
– Vous ?
– Ou la Turquoise, comme on m’appelle…
Baccarat l’enveloppa tout entière de ce regard clair et profond qu’elle possédait, et qui lui permettait de juger son monde au premier coup d’œil.
D’abord, elle avait cru à un piège. Mais quand elle eut rapidement analysé ce visage merveilleusement beau, cette luxuriante chevelure blonde qui s’échappait à profusion du bonnet de lingerie et semblait protester contre cette modeste coiffure ; lorsque son regard eut rencontré ce regard magnétique s’échappant de ces grands yeux d’un bleu sombre ; lorsque enfin elle eut deviné, sous cette robe ample et de couleur brune, la taille svelte, ondoyante de la pécheresse, Baccarat ne douta plus, elle ne put douter davantage.
C’était bien la Turquoise qu’elle avait devant les yeux, la femme qui avait ensorcelé Fernand Rocher ; Fernand, qu’elle avait tant aimé, elle, Baccarat.
– Ah ! dit-elle, c’est vous qu’on nomme Jenny ?
– C’est moi, dit Turquoise avec une douceur et un sourire qui étonnèrent Baccarat.
Baccarat s’attendait à trouver chez Turquoise plus de hauteur et un ton à demi impertinent.
Turquoise ajouta :
– On vient de me remettre votre carte, madame, et, bien que j’aie l’honneur de vous voir pour la première fois… bien que votre nom me soit inconnu, croyez bien que je suis toute à votre service.
– En effet, madame, répondit Baccarat qui se leva et fit, malgré elle, valoir l’élégance de sa taille élevée, tandis que Turquoise pouvait remarquer cette beauté qu’en vain elle cherchait à dissimuler ; en effet, vous ne m’avez jamais vue, et le nom que vous avez lu sur ma carte doit vous être inconnu.
Turquoise s’inclina.
– Mais j’ai jadis porté un autre nom…
– Ah ! dit Turquoise, qui joua si bien la surprise, que Baccarat s’y trompa malgré sa clairvoyance.
– Ce nom, poursuivit-elle a eu même une triste célébrité, hélas !
Turquoise la regardait avec attention, comme on regarde ceux qu’enveloppe un mystère.
– Il y a quelques années, acheva madame Charmet, on me nommait la Baccarat.
Turquoise jeta un cri. Ce cri était un poème tout entier, car il exprimait à la fois l’étonnement, l’admiration, le respect.
Pour Turquoise, la pécheresse à son début, Baccarat devait être quelque chose comme un être supérieur, une femme dont on envie la renommée et la haute situation, le général couvert de gloire que le jeune sous-lieutenant suit des yeux en soupirant.
– Comment ! reprit Turquoise, comment vous, madame, vous êtes Baccarat ?
– Je l’étais, dit-elle en baissant les yeux ; aujourd’hui je me nomme madame Charmet.
– Ah ! continua la jeune femme, laissez-moi vous baiser la main, madame, car je sais ce que vous fûtes et ce que vous valez.
Et Turquoise prit la main de Baccarat, la porta vivement à ses lèvres et continua à la regarder avec une admiration naïve qui s’adressait, on ne pouvait le préciser, soit à la courtisane passée, soit à la femme dont le repentir avait égalé les fautes.
La première hypothèse était la plus admissible, si l’on songeait que Turquoise était ce qu’avait été Baccarat, et si l’on songe surtout que le vice a, comme la vertu, ses fanatiques admirateurs. Mais on pouvait également admettre la seconde, en voyant la robe de toile et le petit bonnet de lingerie dont Turquoise s’était attifée. N’était-elle pas déjà repentie elle-même ?
– Oh ! oui, poursuivit-elle avec feu, levant ses grands yeux sur Baccarat et essayant ainsi sur une femme le pouvoir magique de ce regard devant lequel les hommes s’inclinaient ; oui, madame, je vous connaissais de nom depuis longtemps.
– Ah ! fit Baccarat avec tristesse.
– N’est-ce point là votre maison ? ne suis-je point ici chez vous ? reprit Turquoise, dont la voix s’était faite harmonieuse comme un refrain créole, comme une mélopée des terres bénies du soleil. Et n’est-il pas tout simple que dans cette maison toute pleine de vous encore, au milieu de ces meubles, de ces tableaux, de ces objets d’art, vivants souvenirs de votre goût exquis, j’aie appris quelque chose de votre histoire ?
Baccarat laissait parler Turquoise et l’observait attentivement.
– Oui, continua la jeune pécheresse avec animation, tout ici, madame, m’a parlé de vous ; mais il y a plus, j’ai eu pendant huit jours à mon service Germain.
– Mon cocher ? fit Baccarat.
– Oui, madame.
– Et il vous a parlé de moi ?
– C’est-à-dire, fit Turquoise avec quelque confusion, qu’il a répondu à mes questions ; car j’étais avide de savoir mille détails sur votre vie. Mon Dieu ! s’interrompit Turquoise en rougissant, et sans toutefois abandonner la main de Baccarat qu’elle pressait dans les siennes, si vous ne me promettez pas une indulgence absolue, je n’oserai jamais…
– Parlez, dites-moi tout, mon enfant, fit Baccarat avec bonté.
– Eh bien, murmura Turquoise avec admiration, vous avez vécu dans le monde où je suis, madame, avant de devenir une noble et sainte entre toutes, vous avez eu des chevaux… des voitures… des amants…
Un sourire d’ange vint aux lèvres de Baccarat.
– Dites, mon enfant, fit-elle avec douceur, vous ne m’offenserez pas.
– Vous avez été une lionne enfin, reprit Turquoise, et moi qui débutais, moi qui étais une enfant encore, j’avais déjà tant entendu parler de vous, que j’ai voulu savoir comment vous faisiez… Votre hôtel était à vendre ; je crus en l’achetant hériter de votre gloire… J’aurais voulu qu’on me prît pour vous… c’est pour cela que je gardai Germain.
Baccarat écoutait en souriant ; et la jeune pécheresse jouait si merveilleusement son rôle d’ingénue, elle semblait afficher si simplement cette fanfaronnade du vice, que, plusieurs fois, Baccarat, la clairvoyante et la forte, faillit s’y laisser prendre.
– J’avais un tel respect de tradition pour vous, madame, – et Turquoise pressait toujours la main de Baccarat, – que tout est demeuré ici dans l’ordre où vous l’avez laissé… Votre chambre à coucher seule, que vous aviez démeublée, n’a pu être reconstituée exactement.
– Ah ! dit Baccarat, et, à part ma chambre…
– Tout est comme à la veille de votre départ : le cabinet de toilette, le boudoir, le salon d’été… celui-ci…
– Et, demanda madame Charmet, Germain ne vous a rien dit de ma retraite ?
– Oh ! si fait, madame…
Baccarat tressaillit.
– Que vous a-t-il dit ?
– Il m’a dit qu’un jour, vous qui ruiniez un prince russe en souriant, vous qui vous faisiez gloire de n’avoir pas de cœur, vous pour qui les hommes mouraient en duel ou se suicidaient comme de vrais fanatiques, vous aviez fini par aimer…
– Il vous a dit cela ? murmura Baccarat, dont la voix s’altéra.
– Oh ! mais aimer, continua Turquoise, comme on n’aime qu’une fois, comme nous seules peut-être nous savons aimer un jour, après avoir fait de l’amour un vil métier… Puis il m’a dit encore que pour cet homme, par amour pour lui, vous avez tout quitté, renoncé à tout, disparu du monde.
– Ah ! il vous a dit cela ?…
– Cela ne serait-il point vrai ? demanda naïvement la pécheresse.
– C’est vrai à moitié.
– C’est beau ! fit Turquoise.
– Et… vous a-t-il parlé de… lui ? interrogea Baccarat visiblement émue.
– Oui, fit Turquoise d’un signe de tête.
– Que vous a-t-il dit ?
– Ah ! madame, murmura l’atroce créature, qui savait prendre toutes les formes et tous les masques et jouer tous les rôles avec une égale supériorité, madame… madame, pardonnez-moi… j’ai été folle… car je viens de retourner un couteau dans la plaie de votre cœur…
Et Turquoise, la voix entrecoupée, les yeux pleins de larmes, se jeta aux genoux de Baccarat.
Mais Baccarat, un moment émue, était redevenue maîtresse d’elle-même.
– Eh ! dit-elle avec calme, que dois-je donc vous pardonner, mon enfant ? quel mal m’avez-vous fait, et quelle absurde histoire Germain a-t-il pu vous conter ?
Ces paroles produisirent une incroyable surprise chez Turquoise.
Elle se releva vivement, fit un pas en arrière et regarda Baccarat, jouant la stupeur avec une effrayante vérité :
– Ce n’est donc pas vrai ? s’écria-t-elle.
– Mais quoi ?
– Ce que Germain m’a conté.
– Voyons, ma petite, fit Baccarat tranquillement, que vous a-t-il dit ?
– Mais, madame, vous allez souffrir mille morts, si c’est vrai ?
– Dites toujours.
La voix de Baccarat était nette et brève.
– Eh bien, murmura Turquoise, hésitant à chaque mot, il m’a dit que… cet homme que vous aimiez… cet homme était un voleur !
Baccarat ne sourcilla point.
– Il vous a dit cela… et… vous l’avez cru ?
– Il m’a dit encore qu’on était venu l’arrêter ici… un matin… que vous vous étiez évanouie…
Turquoise s’arrêta.
– Après ? dit Baccarat.
– Que, revenue à vous, vous étiez sortie à demi folle, et que depuis on ne vous avait point revue.
– Est-ce tout ?
– Tout. Seulement, j’ai cru deviner le reste.
– Voyons ? fit Baccarat.
– J’ai pensé que vous aviez dû employer tout votre crédit pour sauver cet homme que… vous aimiez si ardemment…
– Vous avez deviné.
– Ah ! s’écria Turquoise frémissante, mais c’était donc vrai ?
– À moitié, je vous l’ai dit… On a, en effet, arrêté cet homme… mais il était innocent…
Turquoise respira.
– Et vous l’avez sauvé ?
– Oui.
– Et… vous êtes… heureuse ?
– Non, dit Baccarat sourdement, car il ne m’aimait pas… car il en aimait une autre…
– Et… il vous a abandonnée ?
– C’est moi… Mais dites-moi donc, ma petite, Germain ne vous a donc pas appris son nom ?
– Il m’a dit que c’était un grand jeune homme brun et pâle… mais son nom, il l’ignorait.
– En vérité ?
– Oh ! madame, continua Turquoise, il y a huit jours encore, je n’admirais en vous que la femme d’autrefois, la séduisante Baccarat, et je m’efforçais de vous prendre pour modèle et de vous imiter de mon mieux… mais aujourd’hui…
Turquoise soupira et baissa les yeux…
– Aujourd’hui… eh bien ? interrogea Baccarat.
– Aujourd’hui j’admire plus encore la femme aimante que je n’admirais, hier, la femme qui se vantait de n’avoir pas de cœur…
– Et pourquoi cela, ma petite ?
– Pourquoi ?… murmura Turquoise dont la voix s’altéra subitement… Eh bien, parce que, moi aussi, moi, comme vous, j’ai fini par aimer…
Baccarat attachait son clair et terrible regard sur la Turquoise, ce regard qui pénétrait jusqu’au fond du cœur, et dont Turquoise sut, cependant, supporter l’éclat.
– Vraiment ! pauvre enfant, dit-elle, vous aimez ?…
– Oh ! fit Turquoise, portant la main à son cœur.
Et, dans cette exclamation, on eût juré qu’elle avait mis toute son âme.
– Écoutez, madame, poursuivit-elle, je ne sais pas ce qui vous amène chez moi… je ne sais pas ce que vous venez me demander ; mais, au nom du ciel ! donnez-moi une minute, laissez-moi tout vous dire ; car vous seule vous pouvez me comprendre, et… peut-être…
– Peut-être ? fit Baccarat.
– Me donner un conseil.
– Parlez, mon enfant.
– Il y a quinze jours de cela, madame, l’homme qui m’a acheté cet hôtel devait partir le lendemain matin pour Londres. Il m’avait promis de venir dans la nuit me faire ses adieux. Je l’attendais là, où vous êtes, dans ce fauteuil, et quatre heures du matin sonnaient à la pendule… On sonna vivement à la grille, j’entendis des bruits et des pas dans le jardin… Je courus… Le vicomte venait me dire adieu, selon sa promesse, mais il n’était pas seul, il était suivi de deux hommes, et ces deux hommes en portaient un troisième dans leurs bras. Ce troisième était évanoui et perdait son sang. Il s’était battu avec le vicomte et le vicomte le faisait transporter chez moi…
Turquoise s’arrêta, comme si elle eût eu de la peine à comprimer plus longtemps son émotion.
– Continuez, dit Baccarat avec bonté.
Alors Turquoise raconta brièvement, avec l’éloquence du cœur, elle qui n’en avait pas ! la convalescence de Fernand, les huit jours pendant lesquels il était demeuré chez elle ; puis la terreur qu’elle avait éprouvée en songeant qu’elle l’aimait et comment elle l’avait fait reconduire, les yeux bandés, au milieu de la nuit, afin de ne jamais le revoir… Elle eut encore l’audace de dire son départ précipité le lendemain, sa rencontre fortuite avec Fernand, la poursuite exercée par celui-ci ; puis, comment elle avait cédé, comment elle était revenue… Elle alla plus loin encore, elle entra dans la vie privée de Fernand, racontant qu’il avait une femme et un enfant, et que, le jour même, ils avaient rencontré le vicomte de Cambolh au bois… Puis la scène qui s’en était suivie, et enfin sa résolution d’éloigner Fernand à jamais. Quand elle en fut là, elle s’arrêta et regarda Baccarat.
– Eh bien, dit Baccarat avec bonté, qu’allez-vous faire ?
– Voyez ces habits, dit Turquoise. Depuis quelques heures, je rougis de ma vie passée, et je me suis souvenue de vous. La Turquoise est morte, madame, il ne reste plus que Jenny… Jenny, qui vient de louer une chambre de deux cents francs par an et veut y vivre désormais du fruit de son travail.
– Vous ferez cela ? dit Baccarat avec étonnement.
– Oui, répondit-elle ; et s’il m’aime… eh bien, au moins, on ne dira point que j’ai gaspillé sa fortune… je ne veux de lui que son amour…
Et Turquoise se tut et se prit à soupirer.
Mais Baccarat s’était levée tout à coup de son siège ; elle avait, par un brusque mouvement, rejeté en arrière son chapeau recouvert d’un voile, et son chapeau, en tombant sur ses épaules, où il demeura attaché par les brides, laissa échapper les boucles épaisses et ruisselantes de sa chevelure d’or.
En même temps, l’œil de la pécheresse repentie retrouva son éclair d’autrefois, sa bouche s’arqua en un dédaigneux et hautain sourire, et madame Charmet redevint la Baccarat des jours passés, la folle créature qui avait enchaîné la mode à son char, et elle domina Turquoise, en ce moment, de toute la hauteur de sa taille et de toute la supériorité de sa fatale expérience :
– Tu es très forte, ma petite, lui dit-elle d’une voix mordante, ironique, et l’enveloppant de son regard plein d’éclairs ; mais tu oublies un peu trop que je m’appelle Baccarat. À nous deux !
XXXVIII
Cette brusque métamorphose aurait bouleversé, frappé de stupeur toute autre femme que la blonde Jenny, la jeune élève du baronet sir Williams.
Baccarat, en ce moment, était splendide d’audace, de résolution, d’énergie. Il ne lui manquait qu’un poignard à la main pour rappeler cette scène de la maison de fous où elle avait mis Fanny sous ses pieds, la forçant à lui livrer son secret. Mais Jenny était une femme forte, un adversaire digne de Baccarat.
Un moment elles observèrent toutes deux le silence et se regardèrent comme deux tigresses se défiant au combat et qui se mesurent de leurs yeux étincelants.
Jenny s’était redressée calme, souriante, prête à soutenir la lutte :
– Madame, dit-elle enfin, ou vous êtes folle et subissez l’atteinte subite d’un transport au cerveau…
– Je ne suis pas folle, dit Baccarat, va, ma petite.
– Ou l’homme que j’aime, vous l’aimez aussi…
– C’est vrai.
Baccarat prononça droitement ces deux mots, et Jenny comprit à quelle rivale elle avait affaire. Souvent le calme est plus menaçant que la tempête.
À son tour elle se tut et parut attendre que Baccarat exprimât sa volonté :
– Ma petite, dit celle-ci en se rasseyant et prenant une délicieuse et voluptueuse attitude dans son puff, attitude qui rappelait si bien la pécheresse que madame Charmet dut en rougir intérieurement ; ma petite, je t’ai fait l’honneur de t’écouter, tu me feras bien le même plaisir, je suppose ?
– Parlez, madame, dit Turquoise avec soumission.
– Je suis ton ancienne, ma petite, poursuivit Baccarat, et par ce que tu sais de mon passé, tu peux compter que je tiens ma parole.
Turquoise eut la présence d’esprit de frissonner et de manifester une sorte d’effroi subit.
– Écoute, reprit Baccarat, l’homme dont tu viens de parler, l’homme que tu prétends aimer, eh bien, moi aussi je l’aime… je l’aime depuis quatre années ! et c’est pour lui que j’ai changé ma vie.
Jenny eut un geste de surprise mélangé de terreur.
– Tiens, dit Baccarat, je veux bien croire que, toi aussi, tu l’aimes… que tu l’aimes réellement… mais il faut me le prouver…
– Voyez mes habits, dit Turquoise.
– Ceci n’est point une preuve.
Turquoise courut à un meuble, l’ouvrit précipitamment, et s’écria : – Tenez… tenez… venez voir…
Elle retira d’un tiroir un pli volumineux, rompit le cachet, et éparpilla son contenu devant Baccarat.
– Voyez, dit-elle… voilà d’abord l’acte de propriété de cet hôtel, acheté par le vicomte de Cambolh, mon amant, et, à côté de cet acte, une donation sous seing privé de cet hôtel, signée de lui.
– Après ? dit Baccarat.
– Voici, ensuite, une inscription de rente trois pour cent de cent soixante mille francs ; plus une autre de six mille livres de rente sur la ville de Paris.
– Eh bien ? dit Baccarat, qu’est-ce que cela prouve ?
– Voyez l’adresse du pli.
Baccarat examina l’enveloppe et lut :
À Monsieur le vicomte de Cambolh.
– Tu lui renvoyais cela ? dit-elle.
– Oui, répondit Turquoise. Lisez cette lettre annexée au pli.
Baccarat ouvrit la lettre et lut :
« Mon cher vicomte,
« Pardonnez-moi de vous avoir trompé et d’avoir consulté mon cœur et non mes intérêts. Notre rencontre d’aujourd’hui m’a éclairée sur ce que j’avais à faire. Je vous renvoie donc tout ce que je tiens de vous et je quitte votre hôtel, dont vous pouvez reprendre possession à l’instant même. Adieu !
« Jenny. »
– Doutez-vous, maintenant ? dit Turquoise en regardant Baccarat, douterez-vous encore de mon amour pour lui ?
– Oui, dit Baccarat ; mais, pardon, vous allez me laisser ouvrir une parenthèse.
Baccarat retira un carnet de sa poche, et de ce carnet une lettre.
Cette lettre était celle que, la veille au soir, sir Williams, redevenu le vicomte Andréa, lui avait remise comme ayant été trouvée dans la poche d’une vieille robe, chez une marchande à la toilette, lettre qui était séparée de son enveloppe et accusait à un destinataire anonyme, à une femme, sa négociation de quelques poulets amoureux.
– Reconnaissez-vous cette écriture ? dit-elle en tendant la lettre à Turquoise.
– C’est la mienne, dit-elle ; mais comment avez-vous cette lettre ?
– Peu importe !
– J’avoue que c’est moi qui l’ai écrite.
– Quand ?
– Il y a environ six mois.
– À qui ?
– À une fille morte la semaine dernière.
– Son nom ?
– Henriette.
– Henriette tout court ?
– Non, Henriette Fontaine, qui se faisait appeler Henriette de Bellefontaine, autrement dite la Torpille.
– Je l’ai connue, dit Baccarat, qui se souvenait, en effet, d’une pécheresse de ce nom.
Et Turquoise ajouta :
– Que voulez-vous ? à cette époque-là, cette malheureuse était dans la misère, comme moi, comme bien d’autres. Nous avions établi un petit commerce de lettres d’amour… il faut bien vivre. Ce commerce m’avait tirée de la misère, et j’étais à moitié remontée quand j’ai rencontré le vicomte.
Turquoise, en parlant ainsi, avait un accent de franchise qui impressionna vivement Baccarat. Cependant elle ne se tint pas pour battue.
– Qu’est-ce que cela ? dit-elle.
Et elle mit le doigt sur le cœur tracé à la plume qui était au bas de la lettre.
– Ça ? dit Turquoise.
Et la pécheresse eut un sourire moqueur et regarda Baccarat.
– Êtes-vous naïve ! fit-elle d’un ton moqueur. Comment ! vous ne connaissez pas ce signe de notre argot féminin ?
– Non.
– Eh bien, mais… dit Turquoise, c’est pourtant aisé à comprendre.
– Je ne comprends pas.
– Vous souvenez-vous d’Henriette ?
– Oui.
– C’était une grande fille brune de vingt-huit ans… aux traits accentués…
– Après ?
– Eh bien, j’étais son amie de cœur ; elle m’avait lancée. Ce cœur voulait dire que je l’aimais toujours.
Cette explication renversa toutes les suppositions de Baccarat.
– Ou elle est plus forte encore que je ne le supposais, pensa-t-elle, ou elle dit vrai.
Tout autre que Baccarat eût tenté une dernière, une suprême épreuve. Elle eût demandé à Turquoise si elle ne connaissait point sir Williams. Mais Baccarat avait retrouvé sa lumineuse intelligence d’autrefois, et elle avait la prudence du serpent. Prononcer le nom de sir Williams, c’était, dans le cas où Turquoise serait son agent, se trahir elle-même et dire qu’elle se défiait de lui. Dans le cas contraire, c’était inutile.
Turquoise d’ailleurs était une de ces femmes dont le visage ne révèle jamais les angoisses de l’âme ; et sir Williams eût été chez elle en ce moment, que la pécheresse eût manifesté un superbe étonnement en entendant prononcer son nom.
– C’est bien, dit Baccarat, je te demande pardon, ma petite ; ne parlons plus de cette lettre…
Elle remit le billet dans son carnet et le carnet dans sa poche.
– À présent, reprit-elle, revenons à Fernand.
Turquoise parut attendre.
– Si Fernand était pauvre, continua Baccarat, la restitution de ces titres de rente, de cet acte de propriété, et la lettre que tu écris à ton vicomte, prouveraient clair comme le jour que tu l’aimes, et que, pour lui, tu renonces à tout…
– Dame ! fit Turquoise.
– Mais il est riche, il a douze millions, et il te donnera, le jour que tu le voudras, dix fois ce que tu rends aujourd’hui.
– C’est juste, dit Turquoise.
– Donc je ne suis pas convaincue.
– Pourtant, murmura Turquoise, cela est vrai… je l’aime…
Turquoise ouvrit un second tiroir et en tira une lettre.
Cette lettre était adressée à Fernand.
– Lisez, dit-elle, voici encore une autre preuve ; celle-là vous convaincra peut-être…
Baccarat rompit le cachet et lut :
« Mon bien-aimé,
« Si vous avez accepté les conditions que je vous ai faites aujourd’hui, si vous consentez à m’aimer pauvre, venez me voir demain, rue Blanche, 17.
« Jenny. »
Baccarat se leva de nouveau, puis elle montra ses belles mains nerveuses et souples qui cachaient des muscles d’acier sous leurs veines bleues et leur peau diaphane :
– Ma petite, dit-elle, je ne sais pas comment tu as commencé, ce que tu étais avant ton début, si tu es de bonne souche, et si tu as été en pension, ou bien si tu n’es qu’une fille de portier ; mais ce dont je puis te répondre, moi, c’est que j’étais à dix-huit ans une forte fille du peuple, une fille de faubourg, vois-tu, et que je ne craignais point un homme de ta taille…
En parlant ainsi, Baccarat appuya sa main, et sous cette pression, la Turquoise plia comme un roseau sous l’aquilon, et se prit à pâlir.
– Vous voulez me tuer ? dit-elle.
– Peut-être…
Et Baccarat, réunissant ses dures mains, entoura le frêle cou de sa jeune rivale, prête à les convertir en un étau.
– Tiens, dit-elle, si je voulais, avant que tu eusses jeté un seul cri, je t’aurais étranglée.
Turquoise était un peu pâle, mais elle supportait cependant le regard de feu de Baccarat.
– Écoute bien, dit Baccarat, dont la voix brève et saccadée avait un accent métallique, je te donne une minute pour réfléchir… Tu aimes Fernand ?
– Oui, dit Turquoise avec fermeté.
– Moi aussi. Eh bien, choisis : ou tu renonceras à lui sur-le-champ, à l’instant même, ou tu mourras…
– J’ai choisi, répondit Turquoise.
– Tu renonces ?
– Non, je l’aime. Tuez-moi… Mais il m’aime, lui, et il me vengera !
Turquoise avait été héroïque ; mais elle savait bien qu’en invoquant l’amour que Fernand avait pour elle, elle désarmerait Baccarat. En effet, les mains de celle-ci, prêtes à étreindre le cou de sa rivale et à l’étouffer, ces mains se distendirent subitement. Un cri sourd s’échappa de sa poitrine.
– Il l’aime ! pensa-t-elle ; peut-être en mourrait-il, lui !
Cependant elle voulut tenter une dernière épreuve :
– Ma petite, dit-elle, je ne te tuerai pas parce que tu aimes Fernand, mais je te tuerai si tu ne m’obéis pas pendant une heure.
– Que faut-il faire ?
– Sonne et demande ta voiture.
Turquoise sonna :
– Le cheval bai au coupé ! ordonna-t-elle.
Baccarat s’empara des titres de rente, de l’acte de propriété de l’hôtel, et remit ces trois pièces dans leur enveloppe.
Puis elle prit les deux lettres qu’elle avait écrites au vicomte de Cambolh et à Fernand Rocher.
– Que faites-vous ? demanda Turquoise.
Baccarat les jeta dans le feu.
– Je brûle les choses inutiles, dit-elle froidement. Et elle ajouta : – Viens avec moi.
À son tour Baccarat sonna.
– Apportez à madame un chapeau et un manteau, dit-elle à la femme de chambre.
Trois minutes après, les deux pécheresses montaient en voiture.
– Rue de Buci ! cria Baccarat au cocher, et vite !
Le coupé partit avec la rapidité de l’éclair, et franchit en un quart d’heure la distance qui sépare la rue Moncey de la rue de Buci.
Baccarat conduisit Turquoise dans son cabinet, ouvrit son secrétaire et y prit une liasse de billets de banque, de titres de rente et d’actions de chemins de fer, en tout pour une valeur de cent soixante mille francs.
Au moment où elle refermait son secrétaire, la petite juive, sa commensale de la vieille, accourut et lui présenta son front à baiser.
– Bonjour, mon enfant, dit Baccarat avec émotion. Je m’absente deux jours. Tu seras bien sage, n’est-ce pas ?
– Oh ! oui, madame. Je vous le promets, répondit l’enfant.
– Appelle Marguerite.
L’enfant disparut et revint avec la vieille servante.
– Marguerite, dit madame Charmet, je ne rentrerai pas ce soir, ni même demain. Vous aurez soin de cette petite ; vous m’en répondez…
Et Baccarat entraîna Turquoise hors de la maison et la fit monter en voiture.
– Maintenant, dit-elle, allons chez le notaire.
– Chez le notaire !… Pourquoi ?
– Pour lui faire rédiger un acte de vente de ton hôtel.
– Mais il n’est pas à moi !
– Non, il est au vicomte. Mais cela doit être parfaitement indifférent à celui-ci de rentrer en possession de son hôtel ou de son argent, il me semble.
– Mais qui achètera l’hôtel ?
– Moi !
– Vous ! s’exclama Turquoise.
– Ma petite, dit gravement Baccarat, j’ai renoncé au monde et à ma première vie par amour pour Fernand… Tant que j’ai cru qu’il aimait sa femme, sa vraie et légitime femme, je ne me suis point repentie de mon sacrifice ; mais aujourd’hui qu’il aime une de mes pareilles, la force d’abnégation me manque…
– Ainsi… interrogea Turquoise, vous voulez…
– Je veux redevenir la Baccarat… En me retrouvant rue Moncey, j’ai compris que chez nous, pauvres filles déchues, le vice avait de profondes et indestructibles racines. Quand nous sommes une fois descendues au fond du gouffre, en vain remontons-nous à l’orifice, en vain essayons-nous d’en sortir, le gouffre nous fascine et nous reprend tôt ou tard… Tant que tu aimeras Fernand et que Fernand t’aimera, tu feras ce que j’ai fait… Tu essayeras peut-être de redevenir honnête ; mais moi… tu redeviendras la Turquoise, comme je redeviens la Baccarat.
Le coupé s’arrêta sur Neuve-Saint-Augustin, à la porte d’un notaire.
L’étude avait été vendue par Baccarat cent soixante mille francs. Baccarat la rachetait cent soixante.
Le notaire reconduisit les belles pécheresses jusqu’au bas de son magnifique escalier.
– Rue Moncey ! dit Baccarat.
Elles rentrèrent dans le petit hôtel et s’installèrent de nouveau au salon.
– À présent, reprit Baccarat présentant une plume à Turquoise, écris au vicomte, et dis-lui que tu lui envoies ces titres de rente, plus cent soixante mille francs, prix de l’hôtel, que tu viens de revendre à son premier possesseur.
La lettre écrite, Baccarat la mit dans l’enveloppe avec les cent soixante mille francs et les inscriptions, recacheta le tout, sonna et remit le pli au valet avec ordre de le porter sur-le-champ.
Turquoise ne sourcilla point et vit partir sa fortune d’un front calme et d’un regard serein.
– Maintenant, reprit Baccarat, me voici chez moi. Tout est à moi, n’est-ce pas ?
– Tout.
– Chevaux et voiture.
– Sans doute.
– Tu es honnête… parce que tu aimes.
– Ah ça, dit Turquoise, vous allez l’être aussi, j’imagine ?
– Sans doute. Que veux-tu ?
– Vous me laisserez écrire à Fernand ?
– Non.
– Pourquoi ?
– Parce que je veux qu’il vienne te chercher ici demain.
– Et vous lui direz où je suis ?
– Je le lui dirai, parole d’honneur ! Seulement, je veux voir par moi-même s’il t’aime réellement.
– Oh ! dit Turquoise avec assurance, voyez, jugez, vous serez convaincue.
– Tant mieux !
En ce moment, la femme de chambre entrouvrit la porte du salon :
– Madame, dit-elle à Turquoise, le commissaire que vous avez demandé est là.
Un homme vêtu de la traditionnelle veste bleue, portant une grande barbe noire, et dont le front chauve accusait la vieillesse, se montra par la porte entre-bâillée et enveloppa d’un regard.
– Monte avec cet homme, dit Turquoise, et fais-lui prendre la malle qui se trouve dans ma chambre.
La soubrette referma la porte, emmenant le commissaire.
Turquoise se tourna vers Baccarat.
– Cet homme dit-elle, emporte tout ce que je conserve de mon ancienne splendeur, deux robes et un peu de linge. Elle lui tendit la main et remit son chapeau. Adieu… dit-elle.
– Adieu, ma petite ; quand il ne t’aimera plus, nous nous reverrons.
– Nous ne nous reverrons jamais, alors…
– Mais, dit Baccarat, écoute bien un dernier mot. Aussi vrai que je suis là et que j’ai pu t’étrangler tout à l’heure, je te jure que si tu ruines mon Fernand, je me trompe, notre Fernand, je me souviendrai d’un poignard sans gaîne que je dois avoir quelque part, et je lui chercherai un fourreau dans ta poitrine.
Turquoise s’en alla sous le coup de cette menace, et rejoignit le commissaire dans le jardin.
– Ma parole d’honneur ! ma chère, dit celui-ci, voilà une gaillarde qui est forte… J’ai vu le moment où elle t’étranglait.
– Comment ! vous étiez là ?
– Parbleu ! répondit sir Williams, car c’était lui, j’étais caché depuis deux heures dans le cabinet qui se trouve au fond du salon, et j’ai tout vu et tout entendu. Ensuite, ajouta-t-il, j’ai pris le carrick de ton cocher et je vous ai conduites rue de Buci et chez le notaire.
– Vous êtes un homme de génie !
Et Turquoise ajouta :
– Croyez-vous à sa nouvelle conversion ?
– Je ne sais pas, dit sir Williams… Je le saurai demain ; mais si cela est un rôle… Ah diable ! elle est femme à me rouler, surtout si elle sait jamais, ajouta-t-il in petto, que je suis la cheville ouvrière de cette petite comédie.
Et sir Williams dit à Turquoise :
– Ma chère amie, elle t’a promis de te tuer si tu aimais Fernand ; mais je te promets, moi, de te faire bouillir dans l’huile comme une friture de goujons si jamais tu me trahis !
* *
*
Pendant ce temps Baccarat, demeurée seule, tombait à genoux et murmurait d’une voix brisée :
– Ô mon Dieu ! pardonnez-moi… mais il faut bien le sauver… il faut bien les sauver tous !
Baccarat était redevenue madame Charmet.
XXXIX
Revenons à d’autres personnages de notre récit, et changeons de scène un moment, ainsi que cela se pratique au théâtre.
Rocambole, ou plutôt M. le vicomte de Cambolh, comme on l’appelait dans le monde, avait ponctuellement exécuté les ordres de sir Williams.
Il était allé le matin, vers sept heures, chez le concierge du numéro 41 de la rue Rochechouart, et lui avait demandé à apprendre le coup des cent louis.
Le concierge, stupéfait, l’avait salué jusqu’à terre.
– Monsieur est donc un prince ? avait demandé le cerbère au maître d’armes.
– À peu près, mon bonhomme…
– Ou bien veut-il tuer un ambassadeur ?
– C’est possible encore.
Et Rocambole, tirant de sa poche un billet de mille francs, l’avait présenté au professeur d’escrime, disant :
– Je n’aime pas les questions. Montrez-moi le coup et ne cherchez point à savoir qui je suis.
Le concierge s’était incliné ; puis, conduisant le gentleman suédois au sixième étage de la maison, il l’avait fait pénétrer dans une sorte de mansarde disposée en salle d’armes, et lui avait donné la leçon.
De la rue Rochechouart, Rocambole était ensuite allé chez le major Carden ; puis nous l’avons vu, à deux heures, aborder Fernand au bois de Boulogne, et c’est à partir de ce moment que nous allons le suivre.
Le jeune vicomte fit le tour du Bois, revint par l’avenue de Saint-Cloud, rentra dans Paris, et gagna l’avenue Gabrielle, où il s’arrêta à la grille du petit hôtel désigné par sir Williams. Le visiteur était sans doute attendu, car avant qu’il eût sonné et mis pied à terre, un domestique accourut ouvrir la grille à deux battants et s’empara de la bride, que Rocambole lui jeta en lui donnant en même temps sa carte.
Le valet, qui avait le teint cuivré des latitudes indiennes, s’inclina, laissa échapper un premier geste qui signifiait : « Je sais bien qui vous êtes ! » et un second qui l’invitait à le suivre.
L’hôtel de la rue Gabrielle était tout neuf, et sa construction ne remontait pas au-delà de sept à huit mois. À l’extérieur, c’était un édifice qui ressemblait à tous les autres. Il était entre cour et jardin, et possédait des statues de marbre blanc sur la façade creusée de niches.
À l’intérieur, c’était tout différent. Là, Paris disparaissait pour faire place aux mystères de l’Orient voluptueux et fidèle à ses traditions religieuses.
Dans le vestibule, décoré de peintures étranges qui présentaient les trente-trois incarnations de Vichnou, la statue du dieu Siva, sculptée au-dessus d’un bassin dans lequel nageaient de petits poissons rouges.
Au premier étage, où l’on arrivait par un escalier aux repos garnis de fleurs exotiques, Rocambole traversa un long corridor dont les murs étaient couverts d’hiéroglyphes indous. À l’extrémité de ce corridor le valet poussa une porte, et le vicomte se trouva sur le seuil d’un lieu étrange, qui mérite une courte description. Était-ce la réduction d’une pagode ? était-ce l’atrium d’une courtisane antique, ou bien le boudoir de la sultane Schéhérazade, qui racontait les merveilles des Mille et Une Nuits ? Des lampes aux formes bizarres, couvertes d’abat-jour multicolores, projetaient aux quatre coins de la salle une clarté mystérieuse. Les murs étaient tendus d’une étoffe orientale aux couleurs ternes et représentant une fête religieuse des Thaugs, ces étrangleurs terribles des forêts indiennes.
Sur le sol, jonché de tapis, dont l’un était en harmonie avec la tenture des murs, Rocambole aperçut un large coussin d’un rouge écarlate, et sur ce coussin, accroupie à la façon de l’Orient, une créature non moins étrange et non moins bizarre que le lieu où elle se trouvait. C’était une femme au teint brun doré, presque olivâtre, aux cheveux noirs ruisselant en boucles désordonnées sur ses épaules demi nues, aux dents éblouissantes de blancheur, aux yeux d’un vert sombre et relevés par les coins, signe caractéristique des races de l’Indo-Chine. Cette femme, qui pouvait avoir trente ans, était belle de cette beauté mystérieuse qui n’appartient qu’à la race jaune. Elle avait des pieds et des mains d’une admirable petitesse et de forme exquise ; sa taille, dont on pouvait préciser l’élévation, paraissait avoir l’onduleuse souplesse des reptiles.
Le costume de cette femme était celui des épouses des nababs tributaires de l’Angleterre, et consistait en une robe aux couleurs éclatantes, qui permettait d’entrevoir le cou, les bras, les épaules et le bas des jambes, qui étaient entièrement nus. Elle balançait au bout de son pied de petites babouches dorées, à la pointe recourbée comme une carène antique. Enfin, elle avait aux bras et aux chevilles de gros bracelets d’or massif, et portait un collier de perles grosses comme des œufs de pigeon.
À la vue de Rocambole, elle leva la tête par un mouvement plein d’indolence, et attacha sur lui un regard curieux.
Le vicomte lui tendit la lettre de sir Williams.
Elle la prit, jeta les yeux sur la suscription qui était en langue anglaise, et sur-le-champ son œil terne et presque froid jeta des flammes, et elle se leva tout debout comme galvanisée. Toutes les passions volcaniques du sol indien, toutes les ardeurs mystiques des fils de Bouddha venaient d’éclater sur son visage. On eût dit la prêtresse de quelque culte étrange et terrible, inconnu des nations de l’Occident.
* *
*
Que se passa-t-il alors entre la fille des latitudes tropicales et le lion du boulevard parisien ? Ce fut sans doute un mystère. Mais une heure après, le tilbury de M. le vicomte de Cambolh s’arrêta dans la cour de l’hôtel Van-Hop. Le jeune président des Valets-de-cœur jeta les rênes à son groom, monta lestement le perron, donna sa carte à un valet de pied et demanda à voir le marquis sur-le-champ.
– M. le Marquis n’y est pas, répondit le valet, mais madame la marquise est au salon.
– Annoncez-moi, dit Rocambole, qui suivit le laquais.
La créole était seule dans le vaste et somptueux salon de l’hôtel, seule et triste… Quelle révolution s’était opérée dans son cœur ? Quel chagrin, quelle douleur muette avait brisé son âme ?
Peut-être était-ce un mystère encore ? Mais il eût été difficile de reconnaître dans cette femme pâle, aux yeux cernés, au regard morne et sans rayons, la belle et souriante marquise, la séduisante créole qui faisait, huit jours auparavant, les honneurs de son bal avec tant de grâce.
Quand elle entendit prononcer le nom du vicomte sur le seuil du salon, elle se retourna toute frémissante et comme si elle eût été piquée par un de ces dangereux reptiles qui infestent les savanes de son brûlant pays.
Le vicomte entrait souriant, le chapeau sous le bras, comme un homme du monde qui vient faire une simple visite de politesse. Il salua la marquise avec respect et prit le siège qu’elle lui indiqua d’un geste.
Madame Van-Hop était femme du monde avant tout ; elle savait, au besoin, dissimuler ses impressions et se contraindre à ce point de sourire alors qu’elle avait, en réalité, la mort au cœur.
Rocambole lui était odieux. C’était lui qui avait provoqué Chérubin ; lui qui l’avait blessé ; lui qui avait amené pour la marquise cette situation extrême et tendue qui l’avait forcée à s’avouer le véritable état de son cœur. Et cet homme osait se présenter chez elle !… Il y venait, protégé par les lois du monde, par ses devoirs et ses exigences ; il venait faire ce qu’on appelle une visite. Et il fallait bien que la marquise le reçût un sourire aux lèvres, qu’elle lui tendît sa main à baiser, qu’elle causât avec lui de ces mille riens qu’on appelle les bruits du salon, du dernier concert, de la première représentation d’un opéra comique et du discours de réception de tel ou tel académicien.
Rocambole avait acquis si rapidement cette science, à la fois superficielle et profonde, qui constitue le parfait gentleman ; il avait eu dans sir Williams un maître si expérimenté, qu’il était homme à soutenir avec aisance un tête-à-tête d’une heure avec une femme aussi distinguée que la marquise.
Madame Van-Hop, tout à fait maîtresse d’elle-même au bout de quelques minutes, se montra gracieuse, presque enjouée, malgré une récente migraine dont elle prétendait avoir beaucoup souffert. Mais sa pâleur, sa tristesse, le trouble extraordinaire que le nom de Cambolh avait produit tout à coup chez elle n’avaient point échappé au prétendu vicomte.
– Ah ! pensa-t-il en entrant, l’affaire Chérubin a produit des ravages, et voilà une femme qui me porte une haine un peu bien soignée.
Après une heure de conversation insignifiante, madame Van-Hop dit tout à coup à Rocambole :
– Vous désirez peut-être, monsieur le vicomte, voir mon mari ?
– Oui, madame.
– Le marquis est sorti, mais il ne peut tarder à rentrer.
– Si vous vouliez bien me le permettre, madame, je l’attendrais.
– Est-ce pour affaires ? demanda la marquise, présumant que c’était au banquier plus qu’à l’homme du monde que son visiteur en avait.
– Pour affaires très graves, madame, dit Rocambole, répondant à la question de la marquise.
Une cloche se fit entendre, puis le bruit d’une voiture entrant dans la cour.
– Voilà mon mari, dit la marquise. Puis elle ajouta : Le marquis passe rarement chez moi avant le dîner, et il monte dans son appartement. Voulez-vous monsieur, que je vous fasse conduire ?
Rocambole s’inclina.
La marquise sonna, un valet parut, et, sur l’ordre de sa maîtresse, conduisit le jeune vicomte au second étage.
– Ah ! murmura la marquise se retrouvant seule, que veut donc cet homme ? Que vient-il faire ici ? J’ai comme un pressentiment qu’il y vient semblable à un messager de malheur.
Elle devint toute rêveuse, le sourire disparut de ses lèvres, et elle retomba tout à coup dans sa morne tristesse.
* *
*
Cependant Rocambole pénétrait dans le cabinet de travail du marquis Van-Hop.
Le marquis venait de rentrer et s’asseyait au coin de son feu au moment où on lui annonça le vicomte.
Rocambole se présentait pour la seconde fois à l’hôtel, et il était presque inconnu du marquis.
– Monsieur, lui dit Rocambole, qui avait pris l’attitude pensive et la physionomie grave et triste d’homme apportant une mauvaise nouvelle, je viens vous supplier de m’accorder une minute d’entretien.
– Je vous écoute, monsieur, répondit le marquis en lui avançant un fauteuil et en congédiant le valet qui venait d’introduire le jeune vicomte de Cambolh.
– Monsieur le marquis, continua Rocambole en s’asseyant, je suis à peine connu de vous personnellement, bien que j’ose espérer que le nom du général Cambolh, mon père…
– Parfaitement, dit le banquier en saluant avec courtoisie, et croyant, en effet, se souvenir d’un nom identique.
– Je vous ai été présenté, à votre dernier bal, par le baron O’V…, poursuivit Rocambole. Néanmoins, croyez, monsieur le marquis, qu’une circonstance des plus bizarres et des plus imprévues m’oblige seule à vous rappeler ces futiles détails…
– Ils étaient inutiles, monsieur, dit courtoisement le marquis, et votre nom seul…
– Monsieur, interrompit brusquement Rocambole, je viens à vous, chargé de la plus grave et de la plus pénible des missions.
Le marquis eut un geste de surprise.
– Et pour expliquer cette mission, il est nécessaire que je vous raconte en peu de mots une histoire qui vous semblera peut-être bizarre.
– Parlez, monsieur.
– Il y a un an, monsieur, je me trouvais en Amérique, à New York. J’avais vingt-quatre ans ; j’étais ardent, aventureux à la recherche de ce qu’on nomme une bonne fortune.
Le marquis eut un sourire indulgent.
Rocambole reprit :
– Il y avait alors à New York une femme dont la mystérieuse existence, la beauté merveilleuse et les habitudes excentriques excitaient au plus haut degré la curiosité de la fashion américaine. Cette femme, monsieur, portait votre nom, dit froidement Rocambole.
Le marquis poussa une exclamation d’étonnement et regarda son interlocuteur.
– Elle s’appelait miss Daï-Natha Van-Hop.
– Ma cousine ?
– Oui, monsieur.
– La fille du baron Van-Hop, mon oncle mort aux grandes Indes ?
– Précisément.
– Et, dit le marquis, curieux à son tour, elle est à New York ?
– Elle y était.
– Où donc est-elle maintenant ?
– À Paris.
– Venez-vous donc de sa part ?
– Oui, dit Rocambole. Puis regardant le marquis : – Vous m’avez promis, monsieur, d’écouter mon histoire…
– Allez, monsieur, je vous écoute.
– J’étais curieux, parmi les curieux, monsieur, je fis des prodiges pour arriver jusqu’à miss Van-Hop, qui semblait vouloir celer son existence à tous les yeux. Je parvins jusqu’à elle, je lui parlai d’amour, je me prétendis passionnément épris de ses charmes… Elle m’écouta en souriant de ce sourire triste qui ne brille que sur les lèvres des femmes qui ont longtemps souffert et pleuré.
« – On n’aime qu’une fois, me dit-elle, et j’ai aimé… »
À ces paroles, le marquis tressaillit.
Rocambole continua : – Je fus éloquent, monsieur ; j’essayai d’être persuasif, je parlai de l’avenir où luit toujours un rayon d’espérance, du temps qui cicatrise les plus profondes blessures, de la jeunesse qui était en elle et ne pouvait s’ensevelir sous un deuil éternel… Daï-Natha fut incrédule… Incrédule et inflexible ! Mais elle me tendit la main.
« – Voulez-vous être mon ami ? me dit-elle. »
« Je baisai sa main, et lui dis : – « Permettez-moi d’espérer… »
« – Vous espérerez en vain, répondit-elle, mon cœur est mort à l’amour… »
Rocambole s’arrêta et regarda le marquis.
– Pardonnez-moi d’entrer dans ces détails, qui n’ont, en réalité, d’autre but que celui de vous démontrer que Daï-Natha souffrait de quelque chagrin d’amour.
« Elle me pressait de la visiter quelquefois. J’usai, j’abusai même de cette permission, étant devenu réellement amoureux de la belle Indienne.
« Six mois s’écoulèrent.
« Daï-Natha n’était, ne voulait être, ne serait jamais qu’une amie pour moi.
« Une circonstance indépendante de ma volonté, de graves affaires d’intérêt m’obligèrent à quitter New York et à venir à Paris.
« J’arrivai ici l’année dernière ; les plaisirs bruyants de la capitale du monde apportèrent bientôt des distractions à mon amour ; quelques mois suffirent pour me guérir… On est oublieux à mon âge !…
« Mais ce matin, monsieur, une lettre m’est parvenue, une lettre de deux lignes…
« Une lettre signée Daï-Natha et conçue en ces termes :
« Venez, je n’ai plus longtemps à vivre, et je compte sur votre amitié. »
Rocambole tendit en effet un petit billet au marquis Van-Hop.
Ce billet renfermant les deux lignes que nous venons de citer, écrites en anglais, portait bien la signature de miss Van-Hop.
Le marquis la reconnut, poussa un cri et devint tout pâle.
– Au nom du Ciel ! monsieur, murmura-t-il, que venez-vous m’apprendre ? ma cousine est-elle morte ?
– Non, dit Rocambole, pas encore… mais écoutez-moi, je vous en prie…
– Allez ! dit le marquis, dont la voix trahissait de profondes angoisses.
– Monsieur, poursuivit Rocambole, j’ai couru chez miss Van-Hop, que je ne savais pas à Paris hier encore. Je l’ai trouvée dans un petit hôtel de l’avenue Gabrielle, qui rappelait, par ses décorations et ses dispositions intérieures, la maison qu’elle habitait à New York. Daï-Natha était couchée, à la mode orientale, au fond d’un petit boudoir décoré par une pagode indienne. Elle était souriante et calme comme toujours, et paraissait si pleine de vie, que j’ai cru d’abord à une plaisanterie de sa part. Elle m’a tendu la main et m’a dit :
« – Me trouvez-vous en bonne santé ?
« – Oh ! certes, me suis-je écrié, et c’est bien mal à vous…
« – Vous vous trompez, mon ami, je serai morte dans huit jours. »
Rocambole s’arrêta une fois encore.
Le marquis était pâle et la sueur perlait à ses tempes.
Le vicomte reprit :
– Écoutez-moi jusqu’au bout, monsieur. Daï-Natha me fit asseoir auprès d’elle, et prit ma main dans les siennes :
« – Mon ami, me dit-elle, savez-vous pourquoi je n’ai pu répondre à votre amour ? C’est que j’aimais moi-même avec la passion, avec la désespérante ardeur des femmes de mon pays ; c’est que j’aimais depuis quinze ans, car j’en ai trente, les yeux tournés vers l’Europe, où était celui à qui j’avais donné mon cœur à jamais.
« – Et, m’écriai-je, cet homme était donc aveugle et fou, qu’il ne vous aimait pas ?
« – Non, il aimait ailleurs…
« Puis elle s’était reprise à sourire :
« – Savez-vous, m’a-t-elle dit encore, pourquoi je suis venue à Paris ? C’est qu’il y est ; j’y accourais avec un vague espoir, un espoir impie, égoïste… J’espérais qu’il n’était plus aimé, qu’il n’aimait plus… Hélas ! je me suis trompée… Plus que jamais, il aime, plus que jamais il est aimé… Je n’ai donc plus rien à espérer en ce monde.
« – Ah ! me suis-je écrié à mon tour, en lui prenant les deux mains en y imprimant mes lèvres, vous ne mourrez pas, madame, vous êtes si jeune, si belle… vous renoncerez à ces pensées de suicide.
« – Il est trop tard, m’a-t-elle dit en souriant. Ce matin même, j’ai avalé une gorgée de la liqueur que vous voyez miroiter dans ce flacon suspendu à mon cou…
Le marquis jeta un cri.
– Attendez, monsieur, attendez… dit Rocambole, écoutez-moi jusqu’au bout.
« – Cette liqueur, m’a dit Daï-Natha, est un poison de mon pays, un poison lent et sûr, qui ne fait pas souffrir, mais s’infiltre goutte à goutte dans les veines et tue au bout de huit jours. Un seul remède existe contre ce poison, un seul… et ce remède, je ne pourrais pas l’employer, car il n’existe pas en Europe… On ne le trouve que dans mon pays. Ainsi, vous le voyez, mon ami, a achevé Daï-Natha, je suis morte par avance, et tous vos médecins d’Europe ne sauraient me guérir… Mais j’ai voulu vous voir une dernière fois, j’ai voulu vous faire mes adieux éternels. Et puis, a-t-elle ajouté, j’ai voulu vous demander un service.
« – Parlez, madame, ai-je murmuré, les yeux pleins de larmes.
« – Allez, m’a-t-elle dit, chez cet homme que j’ai aimé et pour l’amour de qui je meurs ; allez le supplier de venir me tendre la main. Je voudrais le voir encore une fois. »
Rocambole s’arrêta.
– Après, monsieur, après ? demanda le marquis, plus pâle qu’un mort, et dont la voix passait, entrecoupée par une émotion profonde, à travers ses lèvres frémissantes.
– Eh bien, monsieur, répondit Rocambole avec calme, je crois que je n’ai plus rien à vous dire, car l’homme qu’a aimé Daï-Natha, l’homme qu’elle aime, l’homme pour qui elle meurt… c’est vous !
Le marquis s’était levé ; il écoutait haletant et sans voix, et quand M. le vicomte de Cambolh eut prononcé ce dernier mot, il s’appuya au chambranle de la cheminée pour ne point se laisser tomber à la renverse.
XL
Il y eut entre cet homme qui venait de narrer cette histoire et celui qui l’avait écouté un moment de terrible silence.
Le marquis, d’un tempérament sanguin et apoplectique, était comme foudroyé.
Rocambole le regardait et avait peur. Il avait peur que le marquis n’eût un coup de sang et ne mourût… Et la mort du marquis, c’était la ruine des plus chères espérances des Valets-de-Cœur, c’était la perte des cinq millions promis par Daï-Natha à sir Williams.
Mais, semblable à ce taureau que la lance du toréador a renversé sans l’anéantir à jamais, et qui se relève tout à coup plus fort et plus furieux, le marquis fit un violent effort, secoua son étourdissement, et se redressa calme et énergique comme le sont les hommes du Nord.
– Monsieur, dit-il à Rocambole, Daï-Natha, ma cousine, vous a-t-elle nommé le poison qu’elle avait pris ?
– Oui, monsieur.
– Quel est-il ?
– C’est du fruit du mancenillier réduit à l’état d’extrait et mélangé de feuilles d’upah.
– C’est bien cela ! dit le marquis. Et, ajouta-t-il pensif, Daï-Natha avait raison, il n’y a au monde qu’un seul et unique remède contre ce poison, – un remède qu’on ne trouve qu’aux Indes…
Alors le marquis, cet homme tout à l’heure foudroyé, frappé de stupeur, pour lequel Rocambole avait craint un moment un coup de sang, à qui il était venu dire : « Il y a dans Paris une femme qui vient de s’empoisonner pour vous » cet homme se rassit tranquillement dans son fauteuil et poursuivit avec ce flegme tout hollandais :
– Ce contre-poison, monsieur, est une pierre bleue excessivement rare et qu’on ne trouve que dans le corps d’un reptile appelé le serpent noir. Ce serpent a la tête triangulaire comme la vipère, le dos noir, le ventre d’un jaune d’or éclatant. On ne le rencontre que fort rarement, et encore n’est-ce pas dans les environs de Lahore et de Visapour. Tous les serpents noirs, du reste, ne possèdent point dans leurs entrailles la précieuse pierre bleue ; un sur dix peut-être la renferme dans ses flancs. Une pierre de serpent noir, ajouta M. Van-Hop dont le calme ne se démentait point, se paye aux Indes jusqu’à deux mille livres sterling, et vous comprenez qu’il n’est pas à la portée de tout le monde de pouvoir se la procurer.
À son tour, Rocambole regardait le marquis, et paraissait stupéfait de ce sang-froid qu’il n’avait certainement pas prévu.
Le marquis continua, après avoir pris les pincettes pour arranger le feu, ce qu’il fit avec une habileté merveilleuse :
– Lorsque, soit volontairement, soit par mégarde, une personne est empoisonnée avec le fruit, la feuille ou le jus du mancenillier, il n’est pas d’autre remède que la pierre bleue. On la met dans un verre d’eau, où elle se dissout lentement, lui donnant sa couleur, et on fait avaler ce breuvage à la personne empoisonnée. C’est un moyen sûr, infaillible de paralyser l’action du poison ; mais il faut pour cela que le poison ait eu le temps de s’infiltrer dans toutes les veines et de se mêler à la masse du sang. Il faut donc attendre le sixième ou le septième jour.
– Monsieur, interrompit Rocambole avec une certaine vivacité, permettez-moi de vous manifester tout mon étonnement.
– Pourquoi ? demanda flegmatiquement le marquis.
– Mais, dit Rocambole, parce que je viens vous apprendre que miss Daï-Natha Van-Hop vient de s’empoisonner ; que vous êtes la cause, innocente il est vrai, de ce suicide ; que vous savez aussi bien que moi qu’il n’est qu’un seul remède à son mal, que ce remède est introuvable en Europe, et qu’au lieu de vous désoler et de perdre la tête, vous me racontez fort tranquillement comment on se procure ce remède et comment on l’emploie.
Un sourire vint aux lèvres du marquis.
– Monsieur, répondit-il, un mot fera cesser votre étonnement.
– J’attends ce mot, dit Rocambole.
– Daï-Natha s’est trompée, reprit le marquis, en vous disant que la pierre bleue était introuvable à Paris.
Et le marquis étendit sa main gauche et la montra complaisamment à son interlocuteur. La main du marquis portait au petit doigt une grosse bague, ornée d’une pierre qui ressemblait à s’y méprendre à une turquoise.
– Voilà, dit-il, une pierre bleue, une pierre de serpent noir. Je l’ai rapportée des Indes, il y a douze ans, et je ne m’attendais pas, cependant, à ce que, un jour, elle me servirait à rendre la vie à ma chère Daï-Natha.
Alors le marquis se leva.
– Monsieur, acheva-t-il, voulez-vous me conduire chez ma cousine ?
Rocambole s’inclina.
Le marquis prit un manteau, son chapeau et sa canne, et il descendit suivi de Rocambole, dans la cour, où attendait le tilbury du fringant vicomte.
– Monsieur, reprit alors le marquis, toujours calme, toujours froid, comme un véritable Hollandais, je suis forcé de vous donner quelques explications, car vous pourriez me croire odieux et ingrat, alors que je ne suis que simplement malheureux.
Rocambole se tut et parut attendre les explications du marquis.
Celui-ci continua :
– Il y a environ treize ans, je m’embarquai à la Haye pour faire le tour du monde. Je touchai d’abord à la Havane espagnole, et j’y fus admis dans une famille de planteurs parmi laquelle je vécus plusieurs mois. Cette famille était celle de Pepa Alvarez, une femme que vous connaissez, et qui est devenue la marquise Van-Hop. Je partis de la Havane pour les Indes, aimant Pepa Alvarez et me croyant aimé d’elle, et je lui promis de l’épouser. J’arrivai aux Indes chez mon oncle, le père de Daï-Natha. Daï-Natha s’éprit d’une folle passion pour moi, et elle voulut m’épouser. Hélas ! mon cœur ne m’appartenait plus, ma parole était engagée, et je retournai à la Havane, où j’épousai Pepa. Maintenant, monsieur, foi d’honnête homme, j’ai vécu douze années heureux de l’amour de ma femme, heureux par celui que j’avais pour elle, et persuadé que Daï-Natha m’avait oublié. Jugez de ma stupeur en vous écoutant tout à l’heure.
– Monsieur, répondit Rocambole, vous êtes en effet plus malheureux que coupable, et je vous plains du fond de mon cœur.
Le marquis tressaillit, car les paroles du vicomte avaient l’accent mystérieux d’une lugubre prophétie.
– Je vous plains, reprit Rocambole, car vous êtes la cause innocente de la mort de cette pauvre Daï-Natha.
– Oh ! dit le marquis, elle ne mourra point, je vous le jure.
– Elle mourra.
– Vous oubliez la pierre bleue.
Rocambole hocha la tête.
– Non, dit-il, mais elle ne voudra point en faire usage.
– Je saurai l’y forcer.
– Je ne vois, pour obtenir un pareil résultat, qu’un seul moyen, monsieur.
– Voyons, dit le marquis.
– C’est que vous veniez à l’aimer.
Le marquis eut un sourire triste.
– On n’aime pas deux femmes à la fois dit-il, et…
– Et ?… demanda Rocambole.
– J’aime ma femme, dit gravement le marquis, je l’aime comme au premier jour de notre union… ardemment et saintement, comme elle mérite d’être aimée. Mais je sauverai Daï-Natha… je l’aimerai comme une sœur, ajouta le marquis avec un accent naïf et profondément affectueux qui révélait un noble cœur ayant conservé toute la généreuse chaleur de la jeunesse, en dépit de ce masque de froideur répandu sur ses traits.
Comme il achevait, le tilbury du vicomte entra dans l’avenue Gabrielle et s’arrêta bientôt à la grille du petit hôtel.
L’hôtel de miss Van-Hop avait deux entrées et non point un seul perron au milieu de la façade. Deux pavillons en saillie renfermaient chacun la cage d’un escalier.
Rocambole était entré par celui de gauche deux heures plus tôt ; il avait traversé un vestibule, gravi un escalier, suivi un long couloir et pénétré dans une pièce où tout rappelait l’Extrême-Orient et la religion des ancêtres maternels de Daï-Natha, qui n’avait jamais été chrétienne que de nom, tandis qu’elle croyait fermement aux mystères du culte de Bouddha.
Le valet cuivré qui avait introduit le vicomte par le pavillon de gauche le conduisit, au contraire, le voyant avec le marquis, vers le pavillon de droite.
Là, l’Inde superstitieuse et ses peintures bizarres disparaissaient. Ce n’était plus l’entrée d’une pagode, c’était celle d’un hôtel, d’un ravissant hôtel comme on en voit aux Champs-Élysées et dans les rues neuves du Faubourg Saint-Honoré ; avec un bel escalier jonché de peaux de tigre fixées à chaque marche par une baguette en cuivre doré ; orné de blanches statues à chaque repos, et garni de distance en distance de caisses de fleurs et d’arbustes rares.
Le valet introduisit les visiteurs dans un grand et beau salon dont l’ameublement était une réunion de merveilles, et leur indiquant une des causeuses placées aux deux côtés de la cheminée, il leur dit en anglais fort pur :
– Je vais prévenir miss.
Et il sortit, emportant la carte du marquis.
Quelques minutes après, pendant lesquelles M. Van-Hop, malgré sa douloureuse préoccupation, ne put s’empêcher d’admirer un superbe Murillo appendu au-dessus d’un coffre d’ébène ; quelques minutes après, disons-nous, un froufrou de robe de soie se fit entendre, un pas léger glissa sur le tapis, une portière s’écarta…
Une femme parut. Cette femme, ce n’était plus, et c’était cependant encore Daï-Natha… C’est-à-dire que l’Indienne, la petite-fille des vieux nababs, la superstitieuse enfant de l’Orient, qui avait ses ancêtres maternels dans les bassins de son vestibule sous la forme de petits poissons rouges, avait tout à fait disparu. Elle ne portait plus sa robe orientale aux dessins fantastiques, toute garnie d’amulettes, et ses bracelets d’or, et ses babouches d’un rouge éclatant. Elle était vêtue d’une robe à demi montante, d’une étoffe de soie de couleur mauve ; ses belles mains étaient gantées ; son bras, d’un galbe très pur, dépouillé de tout ornement, sortait à demi nu d’un flot de dentelles. Ses noirs cheveux étaient aplatis sur ses tempes en deux larges bandeaux, et n’avaient pour toute parure qu’une touffe de camélias rouges, coquettement disposés par un habile coiffeur.
La fille de l’Inde s’était métamorphosée en une éblouissante lady, qui n’avait conservé de son affinité avec la race jaune que son teint d’un brun doré, qui pouvait, à la rigueur, la faire prendre pour une Italienne ou une Espagnole. Ainsi vêtue, ainsi parée, la fille des nababs pouvait rivaliser de beauté et d’éclat, de décence et de noble simplicité avec la marquise Van-Hop, sa rivale.
Le marquis demeura un peu ébloui.
Il avait cru retrouver une petite fille à demi sauvage, au visage d’une prêtresse par la passion, à l’expression sinistre d’une prêtresse qui vient de vouer sa vie aux superstitions de sa religion nébuleuse ; et il se trouvait face à face avec une femme pleine de distinction et qui baissait modestement les yeux.
Elle salua ses visiteurs de la main, puis elle s’approcha du marquis :
– Mon cousin, lui dit-elle en anglais, car elle ne parlait que cette langue, je vous remercie de votre empressement.
Elle lui donna sa main à baiser avec l’aisance d’une duchesse du faubourg Saint-Germain, et ajouta :
– Me ferez-vous la grâce de quelques minutes d’entretien et de tête-à-tête ?
Le marquis s’inclina.
– Vous permettez, mon ami, n’est-ce pas ? fit-elle en se tournant vers Rocambole.
Rocambole répondit par un muet salut.
Alors l’Indienne prit le marquis par la main.
– Venez ! lui dit-elle.
Elle lui fit quitter le salon et l’emmena au fond d’un petit boudoir voluptueux et coquet, véritable nid de Parisienne.
Une portière qui retomba derrière eux les sépara pour un moment du reste du monde.
– Mon cousin, dit l’Indienne en le faisant asseoir auprès d’elle, sur un étroit tête-à-tête, je vous remercie ; je vous ai appelé… vous êtes venu.
– Ma cousine…
– Chut ! fit-elle en posant son joli doigt sur ses lèvres, ne m’interrompez pas…
– Je vous écoute, murmura-t-il, commençant à croire, tant elle était souriante et calme, que le vicomte l’avait mystifié, et que rien n’était moins sérieux que l’histoire du poison.
– Mon cher cousin, mon pauvre Hercule, fit-elle avec un peu de tristesse, – le marquis, comme beaucoup de Hollandais, se nommait Hercule, – mon pauvre Hercule, reprit-elle, lorsque vous arrivâtes aux Indes, chez mon père, il y a douze ans, j’étais une enfant, une enfant superstitieuse, ignorante, ne sachant rien de la vie et des orageuses passions du cœur… Vous étiez jeune, vous étiez beau ; mon père m’avait dit souvent que vous deviez être mon mari… je vous aimais…
– Ma cousine…
– Ah ! dit-elle en le menaçant du doigt, vous m’avez promis de ne pas m’interrompre…
Et elle continua :
– Je vous aimai, mon cousin, ne sachant pas que votre cœur était déjà donné, que vous aviez engagé votre parole. Quand vous partîtes, j’espérai votre retour prochain. Je comptai les mois, les jours, les heures… Les heures, les jours, les mois, puis les années passèrent. Vous ne revîntes pas. Puis j’appris la vérité… Oh ! ce jour-là, j’étais encore la sauvage fille des vieux bouddhistes ; alors, ce jour-là, si la mer n’eût été entre nous, je crois que je serais venue poignarder cette femme que vous aimiez !
Un éclair jaillit des yeux de Daï-Natha et fit frémir le marquis.
Mais à cet éclair succéda un sourire.
– Ne craignez rien pour elle, dit-elle, je suis une femme du monde civilisé. Ce qui reste encore en moi de ce sang indien, bouillant comme la lave des volcans, je l’ai tourné contre moi seule… et moi seule en ai été victime… Mais j’ai voulu vous voir, mon cousin, vous voir une dernière fois, pour vous dire que, de ces douze années qui viennent de s’écouler, pas une heure, pas une minute, ni les événements les plus terribles n’ont pu détacher de vous ma pensée. Je vous ai aimé pendant douze ans, vous suivant de ce regard du souvenir, le plus perçant des regards, à travers les mers, au-delà des océans, au milieu de votre vie…
Daï-Natha parlait le langage vrai, sans éclats, sans colère, de la passion profonde et que rien ne saurait éteindre.
Le marquis l’écoutait le cœur serré, et la contemplait avec un douloureux étonnement.
Elle reprit avec plus de calme :
– L’amour que j’avais au cœur, mon ami, ressemble à une de ces maladies qui désespèrent la science et accomplissent lentement leur œuvre de destruction. Il est venu un moment où le vase rempli a débordé, où je me suis inclinée, brisée sous le fardeau… où j’ai eu horreur de la vie… Ce jour-là, mon ami, c’était hier… Ce matin j’ai renoncé à traîner plus longtemps une existence misérable et sans repos…
Elle tira un petit flacon de son sein et le tendit au marquis.
Le marquis, pâlissant, reconnut alors que le flacon contenant une liqueur rougeâtre, ainsi que l’avait dit Rocambole, était à moitié vide.
Elle se prit à sourire :
– J’ai bu, dit-elle, je serai morte dans huit jours.
– Non, s’écria le marquis avec une subite explosion de tendresse, non, tu ne mourras pas, Daï-Natha, mon amie, ma sœur !… Tu ne mourras pas, car, vois…
Et il lui montra sa main.
– Vois cette bague, dit-il. C’est la pierre bleue du serpent noir… le remède infaillible…
Et il prit dans ses mains les mains de Daï-Natha, et poursuivit :
– Nos pères étaient frères, chère Daï-Natha, nos pères s’aimaient… Pourquoi ne nous aimerions-nous pas ?
Elle poussa un cri de joie étrange.
– Pourquoi ne serais-tu pas ma sœur ? acheva le marquis.
Daï-Natha pâlit. Puis elle redevint froide, calme, immobile ; l’éclair de ses yeux s’éteignit.
– Vous êtes fou, dit-elle. Vous venez parler d’affection fraternelle à la femme qui meurt d’amour pour vous !
Ces mots atterrèrent M. Van-Hop.
Alors elle poursuivit, retrouvant sa voix douce et triste :
– Jetez cette pierre, mon ami ; elle ne sauvera point Daï-Natha, parce que Daï-Natha ne veut pas être sauvée…
Le marquis se mit à genoux.
– Au nom du ciel, murmura-t-il, au nom de votre père, et du mien… au nom des liens du sang !…
– Les liens du sang ont parlé en moi, reprit-elle, car je viens de vous instituer, par testament, mon légataire universel, et je vous laisse vingt millions…
– Non, non ! s’écria le marquis, je ne veux point de vos millions… Je veux que vous viviez, chère Daï-Natha.
Daï-Natha se leva, croisa les bras sur sa poitrine et lui dit :
– Me trouvez-vous belle ?
– Comme les anges, répondit-il.
– Aussi belle… qu’elle ?
Et sa voix tremblait, tandis qu’elle prononçait ces mots.
– Oui, dit le marquis.
– Si elle n’existait pas, m’aimeriez-vous ?
– Oh ! passionnément…
L’Indienne eut un sourd rugissement, pareil à celui des tigresses qui peuplent les vastes forêts vierges de sa brûlante patrie.
– Et… si elle mourait ?
À cette question, sa voix trembla plus fort encore.
Mais le marquis secoua la tête :
– On aime quelquefois les morts… murmura-t-il. Je l’aimerais morte…
Daï-Natha laissa jaillir de ses fauves prunelles un regard étincelant.
– Tenez, dit-elle, si je vous demandais un serment, moi qui vais mourir… moi qui meurs pour vous… moi qui vous aime depuis douze ans…
– Un serment ?… s’exclama le marquis.
– Oui, dit-elle, un serment terrible, un serment au prix duquel, peut-être, je consentirais à vivre…
– Ah ! dit-il avec joie, parlez… parlez !… quel que soit ce serment, je le tiendrai.
– Eh bien ! reprit-elle, je vais vous confier un secret qui bouleversera peut-être votre cœur et votre esprit ; me jurez-vous de m’obéir aveuglément jusqu’à l’heure où je vous aurai donné la preuve irrécusable, authentique de ce que j’avance ?
– Sur la cendre de nos pères, je vous le jure, Daï-Natha.
– Eh bien ! reprit-elle, à présent je puis vous faire une question ?
– Faites… dit le marquis.
– Si votre femme n’existait pas, vous m’aimeriez, avez-vous dit.
– Je le répète.
– Si elle était… infidèle ?…
Le marquis poussa un cri :
– Ah ! dit-il, tandis que ses yeux flamboyaient subitement comme les yeux d’un tigre, ne prononcez point un pareil blasphème, Daï-Natha !
– Je ne blasphème point… reprit-elle.
Et elle ajouta avec un calme atroce :
– Vous m’aimerez un jour, Hercule, mon bien-aimé, car Pepa Alvarez, votre femme, a cessé d’être la plus chaste et la plus vertueuse des épouses.
Le marquis ne poussa pas un cri ; mais il se dirigea vers la cheminée, sur laquelle il avait vu un petit poignard malais, à lame tortueuse et empoisonnée. Il prit ce poignard et revint à Daï-Natha, qui l’attendait les bras croisés et le sourire sur les lèvres.
– Tu as eu tort, lui dit-il lentement et avec un calme terrible, tu as eu tort de boire du poison, Daï-Natha, car ce n’est point par le poison que tu vas mourir !
XLI
Celui qui aurait vu le marquis Van-Hop après l’avoir souvent rencontré dans le monde, lui l’homme calme, froid, flegmatique, ne l’aurait certainement pas reconnu. Le marquis était effrayant à voir. D’une pâleur livide, l’œil étincelant, les narines frémissantes, il regardait Daï-Natha comme le reptile charme sa proie.
Daï-Natha était souriante, les bras croisés.
– Tue-moi, parjure, lui dit-elle. Tue-moi avant d’avoir acquis la preuve que je viens de te promettre.
Le marquis se souvint de son serment, et son bras, levé sur l’Indienne, s’abaissa.
– Eh bien ! dit-il avec rage, parle, Daï-Natha, parle et prouve… Si tu as dit vrai, ce ne sera pas toi qui mourras… C’est elle ! Ce n’est pas Pepa Alvarez que j’aimerai au-delà de la tombe… C’est toi que j’aimerai vivante ! c’est toi que j’épouserai !
– Vrai ? dit-elle.
– Oui, mais parle…
Elle ne perdit rien de sa tranquillité et répondit :
– C’est aujourd’hui que j’ai bu le poison, Hercule ; dans huit jours, heure pour heure, je serai morte… toi seul peux me sauver…
– Parle… parle !… s’écria le marquis.
– Écoute-moi donc, dit-elle, puisque tu as juré… écoute-moi…
Il s’assit accablé, car Daï-Natha parlait avec un terrible accent de vérité, et le poignard échappa de sa main.
– Si, dans sept jours, tu n’as pas surpris un homme aux genoux de ta femme, dans un lieu qui n’est point ton hôtel, tu me laisseras mourir.
– Et, demanda le marquis dont la voix couvait des tempêtes, tu me prouveras qu’elle est coupable ?
– Je te le prouverai. Maintenant, souviens-toi de ton serment, car tu m’as juré de m’obéir.
– Je t’obéirai.
– Tu es un homme, poursuivit Daï-Natha ; un homme doit avoir la force de dissimuler ; un homme doit pouvoir, s’il le faut, mettre sur son visage un appareil de glace.
À mesure que Daï-Natha parlait, les traits crispés du marquis reprenaient peu à peu leur sérénité, son œil redevenait morne, et son visage tout entier eut bientôt repris son masque de froideur.
– Rentre chez toi, lui dit Daï-Natha, rentre et attends… Si tu veux que je puisse te livrer les coupables, il faut que les coupables se croient à l’abri de l’impunité.
– Mais, s’écria le marquis, son nom ? dis-moi son nom ?
– Quel nom ?
– Celui de cet homme.
– Non, dit Daï-Natha, pas encore…
– C’est bien, dit froidement le marquis, j’attendrai… Jusqu’au jour indiqué… pas un muscle de mon visage ne tressaillira, mon cœur ne battra pas plus vite… Je continuerai à regarder ma femme avec sérénité, à toucher sa main… à lui sourire… Puis, le jour venu, si tu as dit vrai, je la tuerai… Si tu as menti, c’est toi qui mourras…
– Je ne mourrai pas, dit-elle… Et tu m’aimeras ?
– Je t’aimerai.
– Je serai ta femme ?…
– Oui… sur la cendre de nos pères, je le jure !
– C’est bien, Hercule Van-Hop, dit-elle. Maintenant, adieu… Dans sept jours.
Elle ramassa le poignard qu’il avait laissé tomber et le lui donna.
– Tiens, lui dit-elle, pour l’amour de moi, tue-la donc avec ce jouet… il a été forgé pour elle…
Un atroce sourire, un sourire de tigresse glissa sur les lèvres de l’Indienne. Puis elle prit de nouveau le marquis par la main.
– Tiens, dit-elle, et va-t’en !
Elle ouvrit une porte placée en face de celle par où était entré le marquis, et le poussa dans un corridor où il se sentit saisi par une main d’homme.
– Adieu… lui dit encore Daï-Natha.
Le marquis fut entraîné dans l’obscurité, descendit un petit escalier et se retrouva dans la cour. Là, le valet cuivré qui lui avait servi de guide le salua et disparut.
Le marquis s’en alla à pied, de ce pas chancelant et aviné d’un homme qui voit tout à coup l’avenir et le présent s’écrouler devant lui.
* *
*
Daï-Natha venait de rejoindre au salon le fringant vicomte de Cambolh.
Rocambole, durant son séjour à New York, avait appris assez d’anglais pour pouvoir causer assez facilement.
L’Indienne s’assit auprès de lui et lui dit :
– Il est parti.
– Convaincu ? demanda Rocambole.
– Convaincu et attendant la preuve.
– La preuve, il l’aura, dit froidement le lieutenant de sir Williams.
– En êtes-vous sûr ?
– Oui.
– Il y va de ma vie, dit-elle tranquillement.
– Il y va pour nous de cinq millions.
– Car, reprit-elle, vous ne savez peut-être pas une chose : c’est que, la marquise innocente, je mourrai de toute manière.
– Comment cela ?
– D’abord il me tuera.
– Mais… s’il ne vous tuait pas… Vous n’avez pas pris le poison, j’imagine ?
– Non, dit-elle ; mais je vais le prendre.
– À quoi bon ?
– Parce que la pierre bleue qui sauve ceux qui ont bu du jus de mancenillier tue ceux qui n’en ont pas pris.
– Ah diable ! fit Rocambole.
– Et puis, acheva-t-elle, comme j’ai résolu de mourir s’il ne m’aime pas, si je ne puis devenir sa femme…
– Vous la serez, répondit Rocambole avec certitude.
Alors l’Indienne tira de son sein le flacon, du contenu duquel elle avait répandu à terre une moitié, le porta à ses lèvres et but.
Elle but jusqu’à la dernière goutte.
– Maintenant, dit-elle en reposant froidement le flacon sur une table, il n’y a plus que son amour et la pierre bleue qui puissent me faire vivre…
– Vous vivrez, dit Rocambole, qui avait une foi aveugle dans le génie de sir Williams.
XLII
Baccarat avait pris possession de son hôtel, et son premier soin avait été de congédier les gens de Turquoise, à l’exception de la femme de chambre.
– La maîtresse est très forte, avait-elle pensé, mais, si forte qu’elle soit, elle aura laissé transpirer sans doute quelqu’un de ses secrets, et le secret à demi confié aux subalternes s’achète toujours à prix d’or.
Baccarat se trompait en cela.
Sir Williams avait pris ses précautions, et Turquoise avait eu soin de renvoyer sa femme de chambre la veille, de façon que celle dont héritait Baccarat n’était nullement dans le secret de la pécheresse.
Tout ce qu’elle savait, c’est que Turquoise, la veille, après une scène de larmes et de désespoir, était sortie vêtue en ouvrière.
Baccarat passa une nuit fort agitée.
Ce fut avec une cruelle anxiété qu’elle compta les heures et attendit le lendemain.
À huit heures elle sonna.
– M. Fernand Rocher se présentera ce matin, dit-elle, et demandera sans doute à voir madame. Vous l’introduirez au salon et le prierez d’attendre, sans lui dire que madame n’est pas à l’hôtel.
La femme de chambre s’inclina et sortit.
Baccarat comptait sur la visite matinale de Fernand. Il était évident que, amoureux comme il l’était, Fernand reviendrait de très grand matin chez Turquoise.
Elle ne se trompait point. Au moment où neuf heures sonnaient, Fernand, qui était venu à pied, se présenta à la grille de l’hôtel.
Ce fut la femme de chambre qui vint lui ouvrir. Baccarat n’avait point voulu que les autres domestiques couchassent dans l’hôtel. Ils étaient tous partis la veille au soir.
Fernand fut introduit au salon.
– Madame s’habille et prie monsieur d’attendre, dit la soubrette.
Fernand était pâle et fort ému. Il était rentré chez lui la veille avec l’intention formelle de jeter son bonnet, qu’on nous passe le mot, par-dessus les moulins, et nous l’avons vu mentir effrontément à sa femme.
Hermine avait compris, dès lors, que sa dignité de mère et d’épouse lui ordonnait de se renfermer dans une réserve absolue. Son mari ne l’aimait plus et lui mentait ; l’orgueil natif de la femme, cet orgueil de la vertu, qui ne permet pas de transactions honteuses, lui faisait un devoir de garder désormais le silence et de rendre à son mari toute sa liberté.
Fernand était donc sorti de l’hôtel sans que madame Rocher lui demandât où il allait. Il arrivait chez Turquoise le cœur palpitant, en proie à une vive émotion, et décidé à ne point accepter le sacrifice qu’elle voulait lui faire. Il ne voulait pas que, par amour pour lui, elle se réduisît à une condition obscure et misérable, à une existence pauvre, elle qui avait vécu dans l’opulence. Déjà il avait fait tout un plan de conduite. Il renverrait au vicomte de Cambolh les titres de rente et le prix de l’hôtel ; puis il supplierait Turquoise d’accepter ce même hôtel comme venant de lui.
Tout était, au salon, dans le même ordre que la veille, et rien ne pouvait faire supposer au visiteur matinal qu’il y eût rien de changé dans l’hôtel.
Aussi, lorsqu’il entendit un froufrou de robe de soie dans l’antichambre, fut-il persuadé que c’était Turquoise.
La porte s’ouvrit…
Fernand recula surpris. Ce n’était point Turquoise qui entrait… c’était madame Charmet.
Ou plutôt non, ce n’était plus madame Charmet, l’austère femme vêtue de noir, l’humble dame de charité, consacrant sa vie et sa grande fortune à soulager les malheureux, à arracher au vice de pauvres jeunes filles…
C’était Baccarat, Baccarat rayonnante de jeunesse et de beauté, Baccarat redevenue la lionne des anciens jours, la femme élégante que tout Paris avait vue à Longchamps, menée à la Daumont dans une calèche à quatre chevaux gris pommelé.
Baccarat paraissait rajeunie de quatre années. Elle avait une charmante robe du matin, couleur feuille morte, à demi montante et laissant entrevoir l’albâtre de ses belles épaules. Ses beaux cheveux blonds roulés en torsades étaient ramenés en arrière et dégageaient son front large et intelligent. Un gros bracelet chargeait son bras nu.
– Bonjour, cher, dit-elle à Fernand, d’un ton dégagé et lui tendant la main.
Et son œil noir avait retrouvé le regard séduisant de la Baccarat ; sa lèvre, ce sourire enchanteur pour lequel des hommes avaient joué leur vie.
Fernand demeura muet.
– Eh bien ! dit-elle, vous me refusez la main ?
– Madame… Charmet !… balbutia Fernand avec stupeur.
– Vous vous trompez, mon bel ami, vous vous abusez cruellement, répondit Baccarat, je ne suis plus madame Charmet… Madame Charmet est morte et Baccarat vient de ressusciter.
La jeune femme avança un siège à Fernand.
– Vous êtes charmant, lui dit-elle, de venir me voir. Vous êtes le premier ami qui aura salué ma métamorphose, et il est toujours adroit et spirituel d’être le premier. C’est surtout en amour, mon cher, que l’ancienneté a de la valeur.
– Vous êtes folle ! murmura Fernand.
– Merci du compliment, mon ami. Vous êtes aimable comme un tout jeune homme et mal élevé comme un collégien. C’est à me faire rougir d’avoir eu de l’amitié pour vous. Allez, continuez… si c’est pour cela que vous êtes venu me voir à dix heures du matin…
Fernand était plongé dans un étonnement profond.
– Mon bel ami, poursuivit Baccarat, peut-être ne vous attendiez-vous pas à me trouver ici ?
– Non, dit Fernand, qui retrouva un peu de sang-froid et regarda Baccarat en face, non assurément.
– C’est-à-dire que vous veniez voir Turquoise ?
Fernand tressaillit.
– Peut-être, dit-il.
– Turquoise est partie.
– Que dites-vous ?
– Dame ! mon cher, j’ai racheté mon hôtel ; elle a bien été obligée de s’en aller.
Fernand fit un soubresaut.
– Vous avez… racheté…
– Ah çà, dit Baccarat d’un ton moqueur, d’où sortez-vous donc, très cher ? Ne saviez-vous pas que cet hôtel était à moi ? Oubliez-vous donc que je vous y ai donné l’hospitalité ?
Et elle le regarda d’un air à la fois moqueur et bienveillant.
– Et vous l’avez racheté ?
– Et payé, mon cher, cent soixante mille francs comptant. Ces cent soixante mille francs, Turquoise les a renvoyés sur-le-champ au vicomte de Cambolh.
À ce nom, Fernand eut un frémissement de colère. Cependant il n’était point convaincu encore.
– Voyons, dit-il, qu’est-ce que toute cette plaisanterie ?
– Je ne plaisante pas.
– Ainsi, cet hôtel est à vous ?
– À moi.
– Mais votre maison…
– Celle de la rue de Buci ?
– Oui.
Baccarat eut un sourire équivoque.
– Qui sait ? dit-elle, peut-être l’ai-je vendue à Turquoise.
Et comme Fernand la regardait avec une stupéfaction croissante :
– Mais, dit-elle, je ne veux pas te faire poser, mon cher. Turquoise n’a plus les moyens d’acheter des maisons, et feu madame Charmet possède encore celle de la rue de Buci. Seulement Baccarat, qui est son héritière, va se hâter de la vendre.
– Je rêve !… murmura Fernand.
– Pourquoi ?
– Parce que je ne vous reconnais plus.
Elle l’enveloppa d’un long regard.
– Ingrat ! dit-elle.
– Non, reprit-il, je ne crois pas, je ne puis pas croire que madame Charmet, la femme de cœur et d’esprit, la vertueuse madame Charmet…
– Elle n’est plus, mon cher.
– Quoi ! s’écria-t-il, vous, madame, vous qui depuis quatre ans meniez une vie exemplaire, vous que les malades voyaient à leur chevet, vous recommenceriez cette existence honteuse ?…
Baccarat eut un éclat de rire moqueur qui déconcerta Fernand.
– Mon petit, dit-elle, si vous voulez m’écouter une minute, vous ne jetterez plus les hauts cris. Tenez, je ne vous ferai pas de phrases inutiles, et je vais vous dire une simple histoire.
– Dites… j’écoute.
– Il était une fois une pécheresse, une abominable pécheresse, qui, du fond de son infamie passée, aperçut un coin de ciel bleu, et dans ce lambeau d’azur, une étoile. Cette étoile, c’était l’amour. L’homme qu’elle se prit à aimer était un pauvre diable d’employé qui aimait, lui, une pauvre fille honnête et pure, et dont il voulait faire sa femme.
– Assez ! dit Fernand, je sais de qui vous parlez…
– Attendez donc, cher.
Et Baccarat se pelotonna comme une chatte dans sa chauffeuse.
– Puisque vous savez cette histoire, dit-elle, je vous passerai les détails… et j’arriverai tout de suite à la conclusion.
– Soit, murmura Fernand qui courba le front sous le regard de Baccarat.
– Cette femme devint criminelle par amour ; puis le remords la prit, elle se dévoua : elle sauva l’homme qu’elle aimait, elle aplanit devant lui tous les obstacles, et, en fin de compte, le vit marié et heureux… Alors, comme elle l’aimait toujours, la pécheresse se jeta dans les bras de Dieu, et madame Charmet sortit des cendres de Baccarat.
– Vous le voyez bien, murmura Fernand, vous plaisantiez tout à l’heure, madame, vous êtes toujours madame Charmet, n’est-ce pas ?
– Erreur ! mon cher. L’amour avait fait de la pécheresse une honnête femme ; mais l’honnête femme devait redevenir une pécheresse le jour où son amour se briserait.
Fernand étouffa un cri d’étonnement.
– Dame ! mon cher, reprit Baccarat, le jour où je me suis effacée devant ma rivale, c’est-à-dire devant une jeune fille honnête et pure, dont vous avez fait votre femme, j’ai pris pour de la vertu ce qui n’était qu’un accès de désespoir, et j’ai rompu avec ma première existence. Mais voici qu’une de mes pareilles, une femme qui ne me vaut pas, fit-elle fièrement, une femme de rien…
– Madame, s’écria Fernand avec une irritation subite, vous outragez la femme que j’aime !
Ces mots frappèrent Baccarat au cœur. Elle pâlit, chancela, passa la main sur son front et garda un moment de pénible silence. Mais Fernand ne comprit ni la douleur sublime de cette femme, ni le côté honteux de sa conduite.
– Madame, reprit-il avec froideur, puisque vous êtes chez vous et que Jenny a quitté cette maison, au moins me direz-vous…
Baccarat se redressa hautaine et calme.
– Vous voulez savoir, dit-elle, où est allée madame Jenny ? À Dieu ne plaise, monsieur, que je vous la cache un seul instant. Vous trouverez madame Jenny rue Blanche, 17.
Et, d’un geste plein de dignité, Baccarat congédia Fernand, qui la salua et sortit.
Lorsque Fernand fut parti, la jeune femme ne put retenir ses larmes.
– Mon Dieu ! dit-elle, je voulais le ramener à sa femme, lui parler le langage de la raison, et je n’ai pu étouffer les battements de mon propre cœur… Ô faiblesse humaine !
Et Baccarat soupira profondément.
XLIII
Deux heures après, Baccarat courait rue du Faubourg-Saint-Antoine, et faisait arrêter sa voiture à la porte des ateliers de Léon Rolland.
Elle monta rapidement l’escalier et ne s’arrêta qu’à la porte de Cerise.
Ce fut la jeune femme elle-même qui vint lui ouvrir. Cerise n’était plus que l’ombre d’elle-même. Ses yeux rougis disaient les larmes qu’elle avait versées dans le silence et l’isolement. Elle se jeta dans les bras de sa sœur, sans prendre garde à sa métamorphose mondaine.
– Ah ! viens, lui dit-elle, viens… tu es bonne de venir me voir, car je souffre.
Cerise était seule à cette heure. La mère de Léon était sortie, et ce dernier était sans doute à son atelier.
Cerise entraîna sa sœur au fond de ce petit salon modeste que jadis Léon avait meublé pour elle avec tant de joie et d’amour, et elle la fit asseoir auprès d’elle.
– Mon Dieu ! pauvre petite sœur, murmura Baccarat, comme la voilà changée !
Cerise appuya la main sur son cœur.
– Oh ! dit-elle, ma vie est un enfer !
Baccarat lui prit les mains.
– Espère… murmura-t-elle.
Cerise fondit en larmes et se tut.
– Mais, s’écria Baccarat, cet homme est donc un monstre, qu’il ose te faire souffrir ainsi ?
– Non, répondit Cerise, car il souffre lui-même comme un damné.
– Il souffre, lui ?
– À en mourir.
– Il est fou ?
– Oui, fou de douleur… car cette créature ne l’aime pas.
Et, comme Baccarat paraissait ne point comprendre, Cerise ajouta : – Elle l’a déjà abandonné.
– Elle ?
– Oui, fit Cerise d’un signe.
– Ah ! tant mieux, alors, car, le premier étourdissement passé, il te reviendra. Et Baccarat, pressant les mains de Cerise, ajouta : – Chère enfant, ne sais-tu donc pas que tout passe avec le temps, même l’amour ?
En parlant ainsi, Baccarat oubliait qu’elle aimait toujours, elle, qu’elle aimerait éternellement ; ou plutôt, elle ne croyait point à ces paroles consolatrices avec lesquelles elle essayait d’apaiser la douleur de Cerise.
– Oui, continua-t-elle, tout passe avec le temps, enfant… tout, même l’amour… surtout l’amour… quand il est né du hasard et d’un moment de folie… Elle l’a quitté, dis-tu ?
– Depuis trois jours.
– Tu en es sûre ?
Cerise inclina la tête.
– Alors, espère, ma pauvre petite. L’heure est proche, peut-être, où il te demandera pardon à genoux.
Un sourire navré vint aux lèvres de Cerise.
– Je lui pardonnerai, dit-elle, je lui ai pardonné par avance. Je consentirais de grand cœur à rester malheureuse, même, s’il ne l’était pas ; mais il souffre tant, lui !
Cerise essaya de dominer son émotion.
– Mon Dieu ! si tu savais, fit-elle… Depuis hier soir, il est comme un désespéré… Cette nuit, il a voulu se tuer.
Baccarat eut un geste de surprise.
– Se tuer ! dit-elle.
– Oui, il a passé la nuit à se promener à grands pas, parlant tout seul et se frappant le front et la poitrine. Je feignais de dormir, car il me brusquait depuis quelques jours lorsque j’essayais de l’interroger. Tout à coup il ouvrit la fenêtre ; mais je l’avais deviné. Je poussai un cri, m’élançai et le retins au moment où il allait se précipiter. Il se retourna, me regarda d’un œil hagard et me dit :
« – Pourquoi m’avoir retenu ?
« – Mais, malheureux ! m’écriai-je, ton enfant ? Oublies-tu ton enfant ? »
– Je ne lui parlai pas de moi… je savais bien qu’il ne m’aimait plus.
Cerise, dominée par l’émotion, cacha sa tête dans ses mains, et Baccarat vit jaillir ses larmes à travers ses doigts roses et mignons.
– Le nom de son enfant, reprit-elle enfin, l’a fait tressaillir et hésiter. Il s’est approché du berceau, a regardé l’enfant endormi, l’a baisé au front et s’est pris à pleurer.
« – Je suis un misérable, m’a-t-il dit. Pardonnez-moi, vous qui êtes un ange.
« Et il m’a baisé la main. Puis, comme il faisait un pas vers la porte, j’ai voulu le retenir encore.
« – Où allez-vous ?
« – Laissez-moi sortir, j’ai besoin d’air… j’étouffe.
« – Léon, ai-je eu la force de lui dire, me promets-tu de ne pas te tuer ?
« – Oui, m’a-t-il répondu.
« – Tu me le jures ?
« – Oui.
« – Au nom de notre enfant ?
« – Oui, je te le jure… Mais, laisse-moi… je ne suis pas digne de rester ici. »
Il s’en est allé, et je l’ai entendu descendre l’escalier en sanglotant. Je l’ai attendu le reste de la nuit, il n’est pas revenu. Ce matin, inquiète, hors de moi, j’ai couru à l’atelier… Je l’ai trouvé travaillant. Mais il avait les yeux rouges, il était pâle comme un mort… Il a dû souffrir le martyre. Il est remonté, obéissant à l’habitude, vers onze heures pour déjeuner… Mais il n’avait ni faim ni soif… Il n’a vu que son enfant. Il l’a tenu longtemps dans ses bras, lui parlant, lui souriant ; il ne nous a pas ouvert la bouche, ni à sa mère ni à moi. »
– Mais, demanda Baccarat, comment sais-tu donc, petite sœur, que cette créature l’a quitté ? Te l’a-t-il dit ?
– Oh ! non, jamais il n’a osé m’en parler. Mon Dieu ! s’il m’avait parlé d’elle et que cela eût dû le soulager, je l’aurais écouté.
– Mais, alors, comment as-tu pu savoir… comment sais-tu ?
– Ah ! dit Cerise, j’ai trouvé une lettre, une lettre qu’il avait froissée dans ses doigts, couverte de baisers, et que, dans son agitation, il a laissée tomber ici en s’en allant.
Et Cerise tira de dans son sein un papier plié en quatre, et qu’elle avait placé comme un fer rouge sur sa poitrine, sans doute pour s’habituer à la douleur.
Baccarat s’empara de ce papier, le déplia et voulut le lire.
C’était la lettre écrite par Turquoise, la veille au soir, dans le petit logement de la rue de Charonne, et que Léon Rolland avait trouvée tout ouverte sur la table de la première pièce ; lettre par laquelle Turquoise lui annonçait, en termes obscurs et évasifs, qu’elle ne le reverrait plus.
À peine Baccarat eut-elle jeté les yeux sur l’écriture allongée et menue de cette lettre, qu’elle eut un éblouissement. C’était une vraie lettre de grisette. Mais Baccarat venait de reconnaître cette écriture. La main qui avait tracé ces adieux à Léon Rolland, sur du papier à deux liards la feuille, était celle-là même qui, sur du papier anglais jaune pâle exhalant un discret parfum d’ambre, avait écrit à Henriette de Bellefontaine pour l’avertir de l’heureuse négociation de ses lettres d’amour.
La jeune femme fouilla dans sa poche, en retira ce dernier billet, le confronta avec une religieuse attention, un soin scrupuleux, avec la lettre adressée à Rolland, et murmura : – Ah ! j’ai donc enfin la clef du mystère !
Il se fit dans le cerveau de Baccarat comme une grande lumière, et plus que jamais, elle demeura convaincue de l’infamie d’Andréa et de sa participation à toutes ces horreurs… Il lui était désormais impossible de douter plus longtemps… La femme dont Léon était épris, cette femme pour laquelle il se mourait d’amour et qui certainement ne l’avait momentanément abandonné que pour se l’attacher par le désespoir, le plus indissoluble des liens, n’était-ce pas Turquoise ? Turquoise, cette même femme qui avait ensorcelé Fernand Rocher, et jurait la veille, sur ses grands dieux qu’elle l’aimait à l’adoration, à la folie, à en mourir ?
Baccarat comprit tout. Turquoise avait été plus forte qu’elle ; Turquoise, à demi battue, se retirait emportant le secret de sa défaite. Car il y avait maintenant un secret, un mystère horrible, peut-être, au fond de ce drame dont un rayon inattendu perçait tout à coup les ténèbres.
Baccarat ne pouvait plus admettre la fable de la pauvre pécheresse, cette fable d’amour qu’elle avait récitée avec des larmes et des pauses sentimentales, qu’elle avait su envelopper de circonstances ingénieuses, telles que son désintéressement, son abandon du petit hôtel et des titres de rente, sa mansarde de la rue Blanche et ses humbles habits de grisette.
Cette fable détruite, restait un secret, un mystère. C’est-à-dire que, bien certainement, Turquoise n’était qu’un instrument, l’instrument d’une vengeance. Et si quelqu’un avait à se venger, n’était-ce pas sir Williams ?
Ceci ressortait aussi clairement que le jour pour Baccarat. Seulement, il fallait des preuves ; et ces preuves manquaient sans doute, ou plutôt sir Williams était de taille à les avoir effacées toutes, jusqu’à la dernière.
Cerise n’avait rien compris à l’étonnement, à la terreur, puis à une sorte de joie inspirée, qui tour à tour s’étaient montrés sur le visage de sa sœur.
Elle la contemplait et gardait le silence.
Mais Baccarat était une de ces fortes natures que la tempête courbe sans les pouvoir abattre, et qui se relèvent plus vigoureuses. Son intelligence énergique brillait surtout par sa spontanéité, et d’un coup d’œil elle jugeait froidement toute une situation. Deviner, pressentir plutôt, et prendre un parti de suite, fut pour elle l’affaire de quelques secondes. Cette lettre, brillant comme un éclair dans la nuit, semblait écrite en caractères de feu, et ces caractères assemblés répétaient le nom de sir Williams.
Sir Williams, c’était la lutte… une lutte acharnée et sans merci entre elle et lui, une lutte que l’ombre devait envelopper, qui devait avoir lieu sans témoins, une lutte enfin dans laquelle une simple confidence pouvait être l’arrêt de celui des adversaires qui se serait montré imprudent.
Et Baccarat comprit que ni sa sœur, ni M. de Kergaz, ni Fernand, ni personne enfin ne devait être dans son secret ; qu’elle devait agir seule et silencieusement, car la vraie force, c’est l’isolement et le silence pour de certaines âmes. Aussi elle ne dit rien à Cerise, elle ne lui fit point remarquer l’identité des deux écritures, et elle ne prononça point le nom d’Andréa.
Elle se contenta de prendre sa sœur dans ses bras, de lui mettre un baiser au front et de lui dire : – Écoute bien, petite sœur, et crois à mes paroles ; car, je te le jure, je dis la vérité. Avant quinze jours, Léon aura retrouvé le repos, et il se reprendra à t’aimer.
Cerise eut un cri de joie.
– Mon Dieu ! dirais-tu vrai ? murmura-t-elle frissonnante.
– Je te le jure ; crois-moi et espère.
Et Baccarat ne voulut point s’expliquer ; elle s’en alla, laissant à sa sœur ce mot d’espoir comme un baume versé sur les blessures de son cœur.
Seulement elle emportait la lettre de Turquoise à Léon Rolland.
– Où va madame ? demanda le cocher en baissant le marchepied du coupé devant la belle repentie.
Cette question, faite à la porte même de Léon Rolland, arracha Baccarat à une rêverie profonde qui s’était emparée d’elle dans l’escalier de sa sœur. – Je ne sais pas, répondit-elle. Prenez le boulevard et allez au pas jusqu’à la Madeleine.
Baccarat avait besoin de réfléchir.
Irait-elle chez Turquoise ? Et là, comme jadis, comme la veille, redevenant l’énergique fille du peuple, prendrait-elle dans ses mains nerveuses le cou blanc et frêle de sa rivale, et la menaçant de l’étouffer, tenterait-elle de lui arracher son secret ? Ce parti extrême était dangereux ou du moins prématuré. Sir Williams pouvait se trouver chez Turquoise et venir à son aide. Et puis, si Baccarat voulait déjouer les machiavéliques projets de sir Williams, il était urgent, indispensable, que la défiance du baronet ne fût point éveillée.
La jeune femme renonça donc sur-le-champ à cette première inspiration, qui naturellement s’était tout d’abord présentée à son esprit, et elle comprit que sir Williams était un ennemi qu’il fallait attaquer avec une circonspection extrême et ne frapper qu’à coup sûr.
Le coupé de Baccarat longea lentement les boulevards, et lorsqu’il arriva à la Madeleine, la jeune femme ne s’était encore arrêtée à aucun parti, si ce n’est de temporiser et de rechercher patiemment un bout du fil d’Ariane si nécessaire pour pénétrer sans hésitation dans ce labyrinthe, plus inextricable encore que celui de Crète.
– Allons rue de Buci, se dit-elle. J’ai comme un pressentiment qu’il y est déjà venu ou qu’il y viendra.
Et Baccarat cria au cocher :
– Rue de Buci !
Le coupé monta la rue Royale, gagna la rive gauche de la Seine par la place de la Concorde et le pont du même nom, et, vingt minutes après, il s’arrêtait à la porte de l’austère maison où nous avons déjà introduit le lecteur.
En route, Baccarat était, autant que possible, redevenue madame Charmet. C’est-à-dire qu’elle avait chastement baissé son voile et s’était drapée dans son cachemire de la façon la plus distinguée.
Les habitants de la rue tranquille qui la virent descendre et rentrer chez elle ne reconnurent peut-être pas dans l’élégante jeune femme la dame de charité, vêtue ordinairement de noir ; mais ils durent la prendre pour quelque dame du grand monde venant causer de bonnes œuvres avec madame Charmet.
Les deux domestiques de la dame de charité furent fort étonnés de cette transformation et de ce changement de toilette ; mais elle leur ferma la bouche d’un geste impérieux et froid.
Puis entrant au salon :
– Est-il venu quelqu’un en mon absence ?
– M. le vicomte Andréa, madame, répondit la vieille Marguerite.
– À quelle heure ?
– Il est venu deux fois, d’abord ce matin.
– Et puis ?
– Et puis il y a une heure.
Et Marguerite remit un billet à Baccarat.
Baccarat l’ouvrit et lut :
« Madame,
« J’ai d’importantes révélations à vous faire au sujet des Valets-de-Cœur. Il faut que je vous voie au plus tôt.
« Votre frère en repentir,
« Andréa. »
Baccarat froissa la lettre et la jeta au feu.
– Marguerite, dit-elle, si M. le vicomte revient ce soir, je n’y suis pas.
– Et s’il vient demain ?
– Vous lui rapporterez fidèlement ce que j’ai fait.
Baccarat fit venir son domestique.
– Julien, dit-elle, je compte vendre cette maison, où je ne reviendrai probablement pas de quelques jours.
Les deux serviteurs, qui ne connaissaient que madame Charmet, c’est-à-dire qui ne savaient ni l’un ni l’autre qu’elle s’était nommée la Baccarat, laissèrent échapper une exclamation de surprise.
– J’ai pris certaines dispositions, poursuivit Baccarat ; ces dispositions vous concernent. Tant que cette maison ne sera point vendue, vous resterez ici tous deux ; le jour où elle passera en d’autres mains que les miennes, vous pourrez vous retirez avec six cents livres de rente viagère.
Et Baccarat congédia ses gens d’un ton qui n’admettait ni questions ni répliques, et leur ordonna de lui envoyer la petite juive.
L’enfant accourut et demeura toute surprise de voir Baccarat si élégante et si belle.
– Ah ! chère madame !… La belle robe !… murmura-t-elle avec une naïve admiration ; vous êtes encore plus belle qu’hier.
– Mon enfant, dit Baccarat en prenant la juive sur ses genoux et la baisant au front avec tendresse, conte-moi ce que tu as fait depuis hier.
– Oh ! j’ai été bien triste, allez, dit naïvement l’enfant, bien triste et bien désolée, ma belle madame, d’être comme ça séparée de vous.
– Eh bien, me voilà, es-tu contente ?
– Oh ! oui. Mais vous n’allez pas partir encore, n’est-ce pas ? interrogea l’enfant d’une petite voix câline.
– Si, ma petite.
– Et je vais encore rester seule ?
– Non, je t’emmène.
– Ah ! quel bonheur ! dit la juive, quel bonheur de vous suivre, madame !
Puis un pli se forma sur son front, uni et doré.
– Vous m’emmenez ? dit-elle. Ah ! tant mieux !
– Pourquoi ?
L’enfant laissa lire sur sa physionomie une impression de terreur.
– C’est que, comme ça, dit-elle, je ne verrai plus ce vilain monsieur.
– Quel monsieur ?
– Celui de l’autre jour.
Baccarat tressaillit et se souvint du regard que sir Williams avait jeté à la petite juive.
– Est-ce ce monsieur qui a une longue redingote, un grand chapeau et l’air souffrant ?
– Oui, madame.
– L’aurais-tu revu ?
– Oui, il est venu ce matin… et puis encore ce soir…
– Et… il te fait peur ?
L’enfant répondit par un signe de tête.
Baccarat devint pensive.
– Il a l’air méchant, reprit l’enfant, et il me regarde à me faire frémir…
– Pauvre enfant !
– Je n’ai connu qu’un homme qui me regardait comme ça, continua la juive.
– Quel était cet homme ?
– Un homme qui voulait m’endormir.
Ces paroles étonnèrent madame Charmet au dernier point, et elle regarda l’enfant d’un air interrogateur.
L’enfant reprit : – Maman n’était pas morte, alors. Dans la rue de la Verrerie où nous étions, il y avait au-dessus de nous un monsieur bien laid, qui avait une grande barbe et l’air aussi méchant que celui qui est venu ici. Quand je le rencontrais sur l’escalier, il me regardait si drôlement, que je me sauvais… Ah ! quand j’étais rentrée, mon cœur battait encore de peur. Un jour, ce monsieur vint frapper à notre porte. Ce fut maman qui lui ouvrit…
« – Madame, lui dit-il, je suis un savant et je vous veux du bien… Si vous y consentiez, je pourrais faire gagner à votre fille dix francs par jour…
« Maman devint toute joyeuse ; nous étions si pauvres !
« Alors le monsieur à la longue barbe me désigna du doigt :
« – Ou je me trompe fort, dit-il, ou votre fille est somnambule. »
À ces mots, Baccarat tressaillit.
– Alors, continua l’enfant, il me regarda et vint à moi. Je voulais me sauver, je voulais crier… Mais je ne pus pas faire un pas ni remuer mes lèvres, et je me laissai tomber sur une chaise. Il me mit son doigt sur le front et me dit : « Dormez ! »
– Et tu t’endormis ? demanda Baccarat, intéressée soudain par ce récit.
– Je ne voulais pas dormir… je voulais fuir… mais je ne pus résister… et je ne sais pas ce qui arriva après, car je fermai les yeux et m’endormis en effet. Quand je me réveillai, le monsieur était parti, et ma mère chantait comme dans le temps où mon père vivait et où nous avions de l’argent. Elle m’embrassa et me dit :
« – Tu es somnambule, ma fille.
« Je ne savais pas ce que c’était.
« – C’est-à-dire, reprit ma mère, que tu vois et que tu parles en dormant, et que tu feras ta fortune.
« Et ma mère me montra deux pièces de cent sous que le monsieur lui avait données. »
– Et, demanda Baccarat, il revint ?
– Oui, le lendemain, puis les autres jours, il venait avec des messieurs. Moi je voulais toujours me sauver, tant j’en avais peur ! mais il lui suffisait de me regarder pour me clouer immobile à la place où j’étais, et je fermais les yeux. Il paraît que lorsque je dormais je disais des choses extraordinaires, et ce monsieur que je craignais tant disait qu’il voulait me faire devenir riche… Malheureusement maman mourut quelques jours après, et on nous chassa de la maison parce que nous devions trois termes. Je n’ai pas revu ce monsieur…
Baccarat écoutait, rêveuse et livrée à une méditation profonde.
– Mon Dieu ! murmura-t-elle tout à coup, je me souviens que lorsque j’étais dans le quartier Bréda, j’allais souvent consulter une somnambule pour savoir si j’étais aimée. La somnambule se trompait quelquefois, mais quelquefois elle disait la vérité… Oh ! si cela était… si je pouvais lire au fond du cœur d’Andréa avec les yeux de cette enfant !…
Et l’œil de Baccarat jeta un fauve éclair.
XLIV
– Ainsi, dit Baccarat après un moment de silence, ce monsieur t’endormait ?
– Oui, madame.
– Et tu avais peur ?
– Oh ! bien peur…
– Si je voulais faire comme lui… moi…
L’enfant regarda la jeune femme avec curiosité, et dit naïvement :
– Vous n’êtes pas méchante, vous.
– Non, et je t’aime…
– Vrai ? fit l’enfant.
– Mais enfin, reprit Baccarat, si je voulais t’endormir ?
La petite juive attacha sur sa belle protectrice un regard charmant de naïve confiance :
– Oh ! je n’aurais pas peur, dit-elle.
– Eh bien ! assieds-toi là.
Et Baccarat alla fermer au verrou la porte du salon et abrita la lampe derrière un bahut afin de laisser la jeune fille dans une pénombre.
Puis elle revint à elle et la regarda fixement :
– Dors ! dit-elle, je le veux !
L’œil de Baccarat avait, en ce moment, cette prestigieuse autorité qu’il possédait autrefois. Elle l’attachait sur cette enfant comme elle avait dû le fixer jadis sur ses adorateurs, lorsqu’elle voulait faire des esclaves.
– Oh ! comme vous me regardez !… murmura la juive.
– Dors ! répéta Baccarat.
L’enfant essaya de lutter, de secouer ce regard fascinateur, de rompre le charme, mais elle fut vaincue. Ses yeux se fermèrent au bout de quelques minutes, sa tête se renversa en arrière. Elle dormait.
L’œil de Baccarat brillait d’une sombre joie, et une sorte d’inspiration se répandit sur tout son visage. On eût dit une prêtresse antique sur son trépied, consultant l’avenir dans les exhalaisons du gouffre entrouvert au milieu du temple.
– Dors-tu ? dit-elle enfin.
– Oui, répondit l’enfant sans ouvrir les yeux.
– De quel sommeil ?
– De celui que vous m’avez ordonné.
Ces deux réponses étonnèrent, ou plutôt bouleversèrent Baccarat. Elle osait à peine croire à cette faculté mystérieuse qu’elle évoquait.
– Que vois-tu ? reprit-elle.
L’enfant parut indécise.
– Regarde en moi, dit Baccarat.
La petite somnambule fit un mouvement, puis, faisant un effort, essaya de se lever et retomba sur son siège.
Puis Baccarat la vit appuyer la main sur son front.
– Vous pensez à lui, dit-elle.
– À qui ?
Et Baccarat fit cette question d’une voix haletante.
– À l’homme qui est venu… à celui qui me regarde…
– Après ? reprit Baccarat.
La somnambule se tut.
– Le vois-tu ? cet homme.
– Oui… oui… je le vois.
– Où est-il ?
– Je ne sais pas… je ne vois pas bien… Ah ! attendez… il suit une grande rue… une rue large et qui monte…
Et, involontairement, le doigt de la juive se tourna vers l’ouest.
– Vois-tu une église dans cette rue ? demanda Baccarat.
– Oui, dit l’enfant.
– C’est le faubourg Saint-Honoré, pensa la jeune femme.
Alors Baccarat, d’abord incrédule et dont le doute était vaincu par l’évidence, se pencha sur son sujet avec une sorte d’avidité.
– Où va cet homme ?… suis-le du regard… où va-t-il ?
– Il marche, il marche très vite, dit l’enfant… oh ! très vite… il monte toujours…
– Et puis ?
– Tiens… une voiture…
– Il monte en voiture ?
– Non, il rencontre une voiture.
Et la somnambule sembla concentrer toute son attention sur cette voiture dont elle parlait.
– Oh ! la belle dame ! fit-elle.
– Quelle dame ? demanda Baccarat, qui s’intéressait peu à la dame et à la voiture, et voulait absolument suivre Andréa.
– Je ne l’ai jamais vue, répondit la juive.
– Alors pourquoi la remarques-tu ?
– Parce qu’elle vient ici.
– Ici ! s’exclama Baccarat étonnée.
– Oui, ici.
Et l’enfant, qui avait perdu Andréa de vue, parut ne plus s’occuper que de la dame.
– Elle est bien belle, mais elle est bien triste ! continua-t-elle.
– Elle est triste ?
– Oui.
– Pourquoi ?
L’enfant appuya la main sur son cœur.
– Elle souffre ! dit-elle.
– La connais-tu ?
La juive hocha la tête.
– Je ne l’ai jamais vue, pourtant elle est venue ici.
– Souvent ?
– Non, une fois.
– Et elle vient ?
– Oui… oui… la voiture traverse une grande place, fit la juive lentement et comme si, en effet, elle eût suivi l’équipage des yeux. Elle passe sur un pont… elle court au bord de la rivière…
Baccarat écoutait, haletante.
– Et puis ? et puis ?… interrogea-t-elle.
– Je vois venir la voiture… je la vois…
La juive garda un moment le silence, et Baccarat n’osa l’interroger encore.
Tout à coup un bruit de voiture se fit à l’extérieur. La jeune femme entendit ouvrir la porte de la cour, puis la voiture s’arrêta au bas du perron.
En même temps le vieux serviteur annonça :
– Madame la marquise de Van-Hop !
L’enfant avait dit vrai. La marquise venait des hauteurs du Faubourg Saint-Honoré, et elle était déjà entrée une fois chez Baccarat.
Ces deux circonstances se réunissaient pour accorder une immense puissance au magnétisme. Baccarat en fut bouleversée. Cependant elle eut le temps de dire aux valets :
– Faites attendre une minute ici.
Et, avec une force toute virile, elle prit le fauteuil dans lequel l’enfant dormait, le souleva, l’enleva rapidement, et porta la juive endormie dans la pièce voisine, laissant tomber une portière derrière elle.
Une minute après, la marquise entra au salon et n’y vit personne.
Elle s’assit et attendit.
La marquise portait sur son visage l’empreinte d’une profonde souffrance morale. Il y avait en elle quelque chose d’affaissé, de défaillant qui frappait à première vue. Qu’était-il arrivé ? d’où cette prostration ? C’était ce que Baccarat cherchait sans doute à savoir.
En effet, tandis que la marquise, demeurée seule, jetait autour d’elle un regard distrait, Baccarat, du fond de son cabinet, examinait ce visage merveilleux de beauté, où la douleur venait de frapper son empreinte. À l’aide d’un trou percé dans le mur, Baccarat avait vu entrer la marquise, elle l’avait vue s’asseoir, elle avait surpris ce regard que madame Van-Hop promenait autour d’elle, et dont la distraction ne disait que trop bien que sa pensée était ailleurs. Frappée de cette tristesse que la marquise, se croyant seule, ne cherchait point à dissimuler, Baccarat revint vers la petite juive, qui dormait toujours dans le fauteuil.
Puis, appuyant sa main sur le front de l’enfant : – Regarde ! dit-elle.
– Oh ! c’est elle… je la vois… murmura la petite somnambule tout bas et sans ouvrir les yeux.
– Qui, elle ?
– La femme qui était en voiture, elle est là…
Et la juive, par un mouvement de tête, sembla indiquer le salon.
– Eh bien ! que vois-tu ?
– Elle est triste.
– Sais-tu pourquoi ?
L’enfant remua son bras alourdi, parvint à l’étendre, puis à le replier, appuya sa main sur son cœur et dit :
– Elle souffre là…
– Elle aime, pensa Baccarat.
Et elle reprit :
– Pourrais-tu lire dans son âme ?
L’enfant ne répondit pas d’abord ; mais tout à coup son front se plissa, son visage exprima un effroi subit :
– Ah ! dit-elle, je vois cet homme.
– Quel homme ?
– Celui qui est venu ici, celui qui m’a regardée, celui…
– Andréa ! murmura Baccarat étonnée de cette coïncidence bizarre.
– Je le vois, continua l’enfant, qui parut avoir momentanément perdu de vue la marquise Van-Hop.
– Où est-il ?
– Là-haut, là-haut… dans une maison de la rue… qui monte… avec un jeune homme…
– Que fait-il ?
– Il parle d’elle.
Baccarat comprit ce brusque écart de la double vue qui se manifestait chez la petite somnambule.
Sarah n’abandonnait momentanément la marquise que parce que sir Williams s’occupait d’elle.
Ceci jeta la jeune femme dans une rêverie profonde. Quel rapport pouvait-il avoir entre l’infâme Andréa et la marquise Van-Hop ?
– Ah ! reprit Baccarat interrogeant de nouveau, il parle d’elle ?
– Oui.
Le visage de l’enfant exprimait toujours l’effroi.
– Et… qu’en dit-il ?
– Oh ! je ne sais pas… je ne comprends pas, mais ils veulent la tuer.
Baccarat tressaillit.
– Après, après ? insista-t-elle.
Mais la lucidité de l’enfant s’éteignit.
– Je ne vois plus… murmura-t-elle.
Et sa tête retomba sur son épaule. Baccarat comprit que le magnétisme n’était point, à vrai dire, la science exacte de l’avenir et de la devination, mais seulement une surexcitation des facultés intellectuelles, qui pouvait donner de temps à autre quelques vagues indications. Mais une chose l’avait frappée : c’était ce rapport mystérieux qui semblait, au dire de l’enfant, exister entre la marquise et Andréa.
Baccarat renonça à interroger la petite juive plus longtemps. D’ailleurs elle n’avait encore qu’une foi médiocre dans les révélations de cette double vue qu’elle avait, par hasard, découverte. Et, laissant Sarah endormie, elle passa au salon.
La marquise attendait toujours. Baccarat s’inclina respectueusement devant elle et demeura debout, tandis que la marquise se rasseyait après s’être levée à demi.
Madame Van-Hop, on s’en souvient, était déjà venue une fois chez Baccarat pour une œuvre de charité, une pauvre orpheline à secourir. Elle revenait pour avoir des nouvelles de sa protégée. Depuis qu’un trouble inconnu s’était glissé dans l’âme de la marquise, la pauvre femme essayait de se tromper elle-même par le bruit, le mouvement et mille occupations diverses. Il lui fallait, à tout prix, oublier…
Baccarat devina peut-être la situation exacte du cœur de sa noble visiteuse.
– Madame, lui dit-elle, je me suis acquittée de la mission dont vous m’aviez honorée, à la recommandation de M. l’abbé X… J’ai pris des renseignements sur la jeune fille qui vous a écrit, et ces renseignements étaient excellents.
– Ah ! tant mieux, fit la marquise prêtant aussitôt toute son attention à madame Charmet.
– Cette jeune fille est honnête, poursuivit Baccarat, sa position était des plus désespérées, et je n’ai pas hésité à disposer en sa faveur de la somme que vous aviez mise à ma disposition.
– Bien, madame, répondit la marquise ; mais sera-ce suffisant ?
– Pour le moment, oui. J’ai payé quelques dettes, un loyer arriéré, acheté du linge et des vêtements à la pauvre enfant. Enfin j’ai pu la faire entrer comme lingère dans une maison d’éducation de la rue de Clichy.
– Eh bien, dit madame Van-Hop, puisqu’il en est ainsi, vous devriez l’amener. Je la verrais avec plaisir…
Baccarat tressaillit de joie.
Malgré son peu de confiance dans les révélations de la petite somnambule, elle avait été frappée cependant de ce rapprochement établi par elle entre la marquise et sir Williams. Elle ne devinait pas encore, mais elle pressentait vaguement quelque drame intime dans la vie de la marquise, quelque péril ténébreux dont, sans doute, elle était menacée. Elle devait donc accueillir avec empressement le désir que lui témoignait la marquise de voir la jeune fille qu’elle avait secourue. Elle sentait bien que si, par malheur, sir Williams avait jeté les yeux sur madame Van-Hop et songeait à tenter contre elle quelque infernale entreprise comme lui seul, du reste, en savait concevoir, elle ne pourrait la protéger sûrement qu’à la condition de la revoir et d’avoir accès chez elle. Aussi répondit-elle aussitôt :
– Si vous voulez bien m’indiquer un jour et une heure, madame, je vous présenterai cette pauvre enfant.
La marquise sembla réfléchir à l’emploi de son temps.
– Je suis chez moi le jeudi, répondit-elle, de deux à quatre heures pour tout le monde ; mais venez vers midi, vous me trouverez seule.
– Soit, répondit Baccarat.
– Ou plutôt, tenez, dit vivement la marquise, ne m’avez-vous pas dit que vous l’aviez placée dans une maison, rue de Clichy ?
– Oui.
– Eh bien ! si nous allions la voir ?
Et la marquise se leva.
– Je suis à vos ordres, madame.
Baccarat passa de nouveau dans le cabinet où l’enfant dormait toujours, et lui passant la main sur le front elle l’éveilla. Puis, comme l’enfant ouvrait les yeux, Baccarat appuya un doigt sur ses lèvres pour lui recommander le silence, poussa une porte dérobée et lui dit tout bas :
– Va rejoindre Marguerite.
Madame Charmet prit son chapeau et son grand manteau de couleur sombre qui lui donnait l’apparence d’une religieuse. Puis elle rejoignit la marquise.
Madame Van-Hop était venue en calèche découverte, comme l’avait fort bien dit la petite juive dans son sommeil. Baccarat monta en voiture auprès d’elle, et l’équipage prit au grand trot le chemin de la rue de Clichy, traversant la Seine au pont Neuf, descendant la rue du Roule, celle de la Monnaie, tournant l’église Saint-Eustache et remontant la rue Montmartre.
La marquise ordonna au cocher de longer le boulevard jusqu’à la rue de la Chaussée-d’Antin. Là, le hasard devait servir Baccarat dans ses investigations à propos de madame Van-Hop. À la hauteur de l’Opéra, un cavalier monté sur un très bel étalon limousin croisa la calèche de la marquise et ôta respectueusement son chapeau. À sa vue, madame Van-Hop tressaillit et une pâleur nerveuse se répandit sur son visage ; puis son œil, si doux d’ordinaire, laissa échapper un regard de colère, presque de haine. Ce trouble, ce regard, cette pâleur n’échappèrent point à Baccarat, qui, d’un seul et rapide coup d’œil, enveloppa le cavalier tout entier et de façon à se graver éternellement ses traits dans la mémoire.
– Qui sait ? pensa Baccarat, c’est là peut-être l’homme qui la fait souffrir.
* *
*
Une heure après, la marquise avait vu sa jeune protégée et rentrait chez elle après avoir fait promettre à Baccarat qu’elle irait la voir.
Quant à celle-ci, elle montait dans une voiture de place et retournait rue de Buci.
Précisément au même endroit où la calèche de la marquise avait été croisée par ce cavalier dont la vue l’avait péniblement impressionnée, Baccarat le rencontra de nouveau. Le cavalier ne galopait plus, il allait au pas, fumant son cigare et prenant philosophiquement le grand air.
– Ah ! murmura Baccarat, il faut que je sache qui est cet homme.
Elle frappa doucement au carreau du coupé ; le cocher se retourna, et la jeune femme lui donna l’ordre de suivre à distance le cavalier.
Le cocher tourna bride et obéit.
Le cavalier longea le boulevard jusqu’à la Madeleine, prit la rue Royale, et mit son cheval au petit trot dans le faubourg Saint-Honoré. Baccarat le suivait toujours. Au coin de la rue de Berri, le cavalier s’arrêta ; un valet en livrée accourut, et vint prendre la bride que le cavalier lui jeta en mettant pied à terre. À cent pas de distance, Baccarat avait également fait arrêter son coupé, et, d’un signe, appela un commissionnaire qui se chauffait au soleil, étendu sur son crochet.
Elle lui mit vingt francs dans la main.
– Savez-vous, l’ami, lui dit-elle, quel est ce monsieur qui descend de cheval ?
– Oui, répondit le commissionnaire, c’est M. le vicomte de Cambolh, un monsieur bien riche, qui, paraît-il, s’est battu en duel il y a trois jours. C’est le valet de chambre qui m’a conté ça…
Baccarat était sur la trace de Chérubin ; un mot pouvait l’éclairer sur le péril immense qui menaçait la marquise Van Hop.
XLV
Le lendemain, Baccarat, ressuscitée, se trouvait rue Moncey, complètement installée. Madame Charmet avait entièrement disparu ; restait la folle créature d’autrefois. En quelques heures, et comme par enchantement, elle avait monté sa maison, fait appeler ses anciens fournisseurs et l’architecte qui avait construit le petit hôtel il y avait quelques années.
La petite juive était dans le ravissement. Elle n’avait jamais rêvé de pareilles magnificences et de tels éblouissements. L’hôtel de Baccarat lui semblait être un palais de fée.
Au temps où Baccarat vivait dans un certain monde, elle avait beaucoup d’amies.
Dès le matin de ce jour, elle s’était donc empressée d’écrire à madame de Saint-Alphonse.
Qu’était-ce que madame de Saint-Alphonse ? Une jolie pécheresse, brune comme une Espagnole, aux pieds de laquelle un prince russe sérieux avait mis son cœur et sa fortune. Madame de Saint-Alphonse était née, rue Saint-Lazare, de l’union d’un concierge avec une danseuse de l’Opéra, et avait été baptisée sous le nom d’Alphonsine. Elle s’était octroyé à elle-même, vers sa vingt-troisième année, une particule nobiliaire, et tenait un assez beau train de maison. Une vieille actrice, sa tante, tenait sa maison et l’avait de bonne heure formée aux belles manières. La jolie et mignonne madame de Saint-Alphonse posait assez gentiment et savait faire une révérence comme au Théâtre-Français. Elle donnait des raouts, avait une ravissante paire de chevaux gris pommelé, faisait jouer chez elle un jeu d’enfer, et était devenue célèbre par la passion chevaleresque et folle qu’elle avait su inspirer à Paul Sternay, un grand peintre de l’époque. Paul Sternay s’était brûlé la cervelle à moitié dans un accès de désespoir : c’est-à-dire qu’il s’était défiguré sans se tuer. Ce tragique événement avait achevé de mettre madame de Saint-Alphonse à la mode.
À l’époque où Baccarat, non repentie encore, brillait de tout son éclat, elle s’était liée assez intimement avec madame de Saint-Alphonse, et avait su conquérir un véritable ascendant moral sur elle, bien que cette dernière fût plus âgée qu’elle de trois ou quatre ans.
Or, pour des motifs que nous expliquerons plus tard, madame Charmet, redevenue Baccarat, avait écrit à son ancienne amie la lettre suivante :
« Ma chère brune,
« Les morts vont vite ! mais ils reviennent ! c’est-à-dire qu’on les voit ressusciter parfois.
« Je ne sais pas si tu te souviens encore de Baccarat, ton amie de la rue Moncey, qui maniait si bien le jeu dont elle portait le nom ?
« Eh bien, un beau jour, en pleine gloire, en plein succès, la Baccarat de ton cœur disparut… Personne ne put dire ce qu’elle était devenue. Hôtel, chevaux, garde-robe, bijoux, tout fut vendu… Était-elle morte ? Avait-elle épousé un pacha égyptien ? L’empereur de la Chine lui avait-il fait un sort ?
« S’était-elle enterrée en province avec un petit jeune homme blond et sans le sou ?
« Ou bien avait-elle passé le détroit pour aller épouser un lord écossais ?
« Ce fut un mystère. Ce mystère, ma chère amie, ni toi ni d’autres ne pourrez jamais le sonder.
« Mais la vérité vraie, la voici :
« Hier soir, on a vu revenir Baccarat. Elle s’est installée de nouveau rue Moncey ; on l’a vue arriver aussi jeune, aussi belle, aussi folle que par le passé ; et elle t’attend aujourd’hui, à deux heures précises, pour aller faire un tour au Bois, où elle veut se montrer et retrouver ses amis.
« Sois exacte.
« Feu Baccarat. »
Madame Charmet fondit en larmes.
– Ô mon Dieu ! murmura-t-elle, il faut bien aimer Fernand, il faut bien haïr ce monstre de sir Williams, pour se résigner à un pareil rôle. Mon Dieu ! pardonnez-moi…
* *
*
Une heure après, madame Charmet ne pleurait plus. Baccarat, souriante, plus belle que jamais, lorgnait d’un œil de connaisseur un joli landau bleu de ciel, attelé de deux alezans anglais qui piaffaient dans la cour de son hôtel et rongeaient impatiemment leur frein. Le landau, les chevaux, le cocher, tout cela acheté et retenu le matin, venait d’arriver.
– Madame, ma belle dame, murmurait la petite juive, est-ce que je vais monter dans ce beau carrosse ?
– Pas aujourd’hui, mon enfant, répondit Baccarat, mais demain.
Deux heures sonnaient.
Un coupé bas, traîné par un cheval bai brun, s’arrêta à la grille. Madame de Saint-Alphonse en descendit.
Baccarat courut à sa rencontre et lui dit :
– Renvoie donc ta voiture !
La voiture envoyée, la brune pécheresse regarda sa blonde amie avec stupéfaction.
– Ah çà, ma chère, dit-elle, est-ce toi ? est-ce ton ombre ?
– C’est au choix, dit Baccarat, moi ou mon ombre, comme tu voudras…
Et Baccarat, chez qui la retraite et une vie calme avaient, en dépit de la douleur, développé un léger embonpoint, se cambra et fit valoir la richesse de sa taille élégante et souple, enluminant d’un sourire son beau visage.
– Je rêve… murmurait la Saint-Alphonse ; enfin, d’où sors-tu ?
– Viens assister à ma toilette.
La petite juive la suivait.
– Sarah, mon enfant, dit Baccarat, veux-tu aller jouer au jardin ?
– Oui, madame.
– Qu’est-ce que cette enfant ? demanda madame de Saint-Alphonse, tandis que Sarah s’en allait.
– C’est la suite d’un mystère.
Et Baccarat, poussant un frais éclat de rire, fit entrer son ancienne amie dans son cabinet de toilette. La femme de chambre était sous les armes, attendant sa nouvelle maîtresse. Baccarat la renvoya.
– Tu m’ajusteras bien, j’imagine, dit-elle en riant, toi qui as été femme de chambre ?
– Oui, certes, répondit la Saint-Alphonse, qui ne trouva point l’épigramme de son goût, mais eut l’esprit de sourire.
Alors Baccarat ferma la porte, sur laquelle elle fit glisser une lourde draperie pour intercepter tout bruit extérieur. Puis elle s’habilla en causant, et se servant, sans scrupule, des bons soins de son ancienne amie.
– Ah ! dit-elle de ce ton léger et moqueur qu’elle avait autrefois, tu as cru que Baccarat était morte ?
– Parole d’honneur ! je l’ai cru.
– Eh bien, je ressuscite.
– D’où viens-tu ?
– Des antipodes de Chine.
– Allons donc !
– Je veux dire des environs du Panthéon, ce qui est la même chose.
– Bah !
– Oui, ma chère.
– Tu vivais au quartier Latin ?
– J’y ai vécu quatre ans.
– Et… tu… aimais ?
– Comme une bête.
– Oh femme forte ! ricana la Saint-Alphonse.
– Mais, f… i… ni… c’est fini.
– Tu n’aimes plus ?
– Plutôt la mort !
– Et tu songes à l’avenir ?
– Ma petite, dit Baccarat avec gravité, j’ai soixante mille livres de rente que m’a laissées le baron d’O…
– Crème de baron ! fit Saint-Alphonse avec enthousiasme.
– Le dernier des barons, murmura Baccarat avec un soupir.
– Et… l’autre ?
– Qui, l’autre ?
– M. X… ? dit la brune pécheresse en riant.
– Mort, ma chère.
– Suicidé ?
– Non, il est marié.
– Pauvre fille !
– Aussi, par la dame de pique ! s’écria Baccarat, je ressuscite !
– Sais-tu que, avec tes soixante mille livres de rente, tu peux te faire un paradis ?
– Je le sais.
– Devenir une femme sérieuse ?
– Je le serai.
On frappa discrètement à la porte.
– Entrez ! dit Baccarat.
C’était la femme de chambre.
– Madame, dit-elle, il y a un vieux monsieur qui a un drôle d’air, et qui demande à parler à madame.
Et la camériste tendit une carte.
Baccarat y jeta les yeux et lut : André Tissot, teneur de livres.
C’était le nom que le vicomte Andréa avait pris dans la maison de commerce où il était, quelques jours auparavant, humble commis à quinze cents francs.
– Ah ! pensa Baccarat, je crois que Dieu est pour moi ; et elle dit :
– Faites entrer dans mon boudoir et priez d’attendre.
Le boudoir de Baccarat était séparé du cabinet de toilette par un mur assez épais, et une porte qui fermait hermétiquement. Il était impossible, quand cette porte était close et recouverte d’une double portière, que du boudoir on entendît ce qui se faisait ou se disait dans le cabinet de toilette ; mais Baccarat se souvenait parfaitement qu’en ouvrant un placard pratiqué dans l’épaisseur du mur, et dont le fond était en briques sur champ (qu’on nous passe ce terme de maçonnerie), on pouvait entendre fort distinctement tout ce qui se passait dans le cabinet, fût-on assis à l’extrémité du boudoir. Ce placard était de l’invention de Baccarat. Elle l’avait fait faire, il y avait cinq ans, à l’époque où, fort jalouse du baron d’O… elle se plaisait à surprendre ses causeries intimes avec quelques amis qui, comme lui, l’attendaient au boudoir. M. André Tissot dans cette dernière pièce, Baccarat ouvrit le placard et y chercha un objet de toilette qu’elle ne trouva point. Ensuite elle oublia de le fermer. Puis elle reprit sa conversation légère avec son amie. Elle était bien certaine que le vicomte Andréa n’en perdrait pas un mot.
– Oui, disait-elle, je jette décidément mon froc aux orties, je redeviens Baccarat comme devant.
– Tu as raison, ma chère.
– Si, d’ici à huit jours, je n’ai pas tourné huit ou dix boules, j’y veux perdre mon nom.
– Tu ne le perdras pas, dit froidement la jeune femme.
– En v’là un temps ! continua Baccarat en riant aux éclats, un temps de bois de Boulogne et d’amusements… Si je ne vois pas tout mon monde aujourd’hui, c’est que je n’aurai pas de chance. Et Baccarat ajouta d’un ton plus confidentiel :
– Voyons ! tu vas bien me mettre un peu au courant, n’est-ce pas ?
– Sans doute.
– Que se passe-t-il dans notre monde ? Une femme qui revient du carrefour de l’Odéon ne sait plus rien, en vérité.
– Tu sais que Bellefontaine est morte ?
– Bah ! d’amour ?
– Non, de la poitrine.
Baccarat laissa échapper un grand éclat de rire.
– Arthur Cambray s’est marié…
– Allons donc !
– Et marié en province.
– Bon ! un homme à la mer.
– Georgette a fait une fin.
– Georgette… du Vaudeville ?
– Oui.
– Quelle est cette fin ?
– Elle a épousé Mylord.
– Mylord, dit gravement Baccarat, avait toujours eu la manie des héritages.
Madame de Saint-Alphonse se prit à rire.
– Et puis ? dit Baccarat.
– Mon prince est en Russie.
– Depuis longtemps ?
– Depuis un mois.
– Reviendra-t-il ?
– Pardienne ! ne suis-je pas là ?
– C’est juste, et j’oubliais que tu es un fier aimant.
– Un aimant à remplacer avantageusement la pierre qui tient en équilibre le tombeau de Mahomet.
– Seulement, objecta Baccarat, au lieu d’attirer les gens vers le pôle, tu en fais revenir.
– Bravo !
– Ah çà ! boussole de mon cœur, poursuivit Baccarat, ton prince aurait-il un ami ?
– Veux-tu que je te présente un petit boyard des environs d’Odessa ?
– Nous le rencontrerons au Bois, je suis sûre.
– Mais on t’attend, je crois ?
– Ah ! oui, dit Baccarat, dont la voix sut revêtir une nuance d’émotion.
– Qui cela ?
– Un homme vertueux. Il doit être au salon. Tu vas voir comme je vais poser avec lui. Et Baccarat ajouta :
– Descends au salon et tiens-lui compagnie.
Sans attendre la réponse de madame de Saint-Alphonse, Baccarat ferma le placard.
Le baronet sir Williams, qui n’avait pas perdu un mot de cette conversation, n’entendit plus rien alors.
– Va, dit Baccarat, et envoie-moi la petite que tu as vue.
– Ah ! oui, la petite… Eh bien ?…
– Chut ! je te conterai cela en voiture.
Madame de Saint-Alphonse sortit et, deux minutes après, tandis qu’elle rejoignait le baronet sir Williams au boudoir, Sarah, qu’elle avait prévenue, entrait dans le cabinet de toilette.
Quelques secondes avaient suffi pour faire subir une révolution complète à la physionomie et à l’attitude de Baccarat.
Le sourire impie s’était abaissé vers le sol ; la courtisane avait fait place à madame Charmet. Et madame Charmet était grave, pensive, et elle allait tenter une expérience nouvelle pour arriver à connaître la vérité.
La petite fille entra.
– Assieds-toi là, Sarah, dit-elle.
Et Baccarat la regarda fixement pendant quelques minutes, lui posant sa main sur le front.
– Dors ! dit-elle.
Et l’enfant essaya vainement de lutter contre la puissance du magnétiseur.
Elle ferma les yeux et s’endormit.
– Dors-tu ? interrogea Baccarat.
– Oui, répondit la somnambule.
– Peux-tu voir à travers les murs ?
– Oui, dit l’enfant.
– Regarde alors.
Et Baccarat étendit la main vers le mur qui séparait le cabinet de toilette du boudoir dans lequel Andréa attendait en compagnie de madame de Saint-Alphonse.
– Que vois-tu ? continua-t-elle.
– Oh ! un beau salon, dit l’enfant.
– Comment est-il ?
– Les murs sont bleus… les meubles aussi.
– Et puis ?
L’enfant parut hésiter.
– Tiens, dit-elle, il y a quelqu’un…
– Dans ce salon ?
– Oui.
– Est-ce un homme ?
– Oui, répondit l’enfant, qui obéissait si bien à la pensée secrète de son magnétiseur, qu’elle ne voyait que celui à qui Baccarat songeait, et n’apercevait point madame de Saint-Alphonse.
– Regarde-le bien. Le reconnais-tu ?
– Oh ! oui… c’est lui…
Et Sarah prononça ce mot avec un sentiment de terreur.
– Qui, lui ?
– Le vieux monsieur… celui qui me regarde avec des yeux qui me font peur.
Baccarat prit la carte de M. André Tissot et la mit dans la main de la juive.
– Qu’est-ce que cela ? demanda-t-elle.
–… C’est à lui.
Et l’enfant frissonna.
– Peux-tu lire dans l’âme de cet homme ? Peux-tu savoir ce qu’il pense ?
– Je ne vois pas bien, répondit Sarah, mais il pense de vilaines choses.
– Me hait-il ?
– Oh ! à mort.
– Y a-t-il quelqu’un qu’il haïsse plus encore ?
La somnambule hésita longtemps, s’agita sur son siège.
– Oui… oui… dit-elle tout à coup… Je vois un homme grand… brun.
– Armand, pensa Baccarat.
Et elle ajouta tout haut :
– Pense-t-il à moi ?
– Non.
– À cet homme grand et brun ?
– Non.
– À qui pense-t-il donc ?
– À moi, dit l’enfant, dont un tremblement convulsif parcourait tout le corps.
XLVI
M. le vicomte Andréa était, depuis la veille, dans une grande perplexité. Lui, l’homme de génie qui jugeait les événements et les hommes d’un coup d’œil assuré, éprouvait maintenant comme une sorte d’hésitation.
On eût dit qu’une ombre avait passé tout à coup sur son intelligence. Une chose préoccupait fort, depuis vingt-quatre heures, M. le vicomte Andréa ; cette chose, c’était la brusque métamorphose de Baccarat. Que signifiait-elle ?
Le baronet sir Williams, déguisé la veille en commissaire, après avoir assisté à l’entretien de Turquoise et de Baccarat, après les avoir conduites rue de Buci sous la livrée du cocher, et enfin, après avoir déménagé la malle et l’humble bagage de la première, l’avait accompagnée rue Blanche. Là, il l’avait questionnée sur les moindres gestes et les paroles les plus insignifiantes de Baccarat, soit chez elle, soit chez le notaire.
Mais Baccarat avait merveilleusement joué son rôle ; si merveilleusement, que, malgré sa lucidité d’esprit, le baronet n’avait pu deviner la vérité.
Ce soir-là, il était rentré vers dix heures à l’hôtel de la rue Culture-Sainte-Catherine, montant sans bruit jusqu’à sa mansarde, où il s’était soigneusement enfermé ; puis il avait ouvert la fenêtre qui donnait sur le jardin de l’hôtel : sir Williams avait besoin d’air et de solitude, comme tous les gens qu’absorbe une vaste méditation. Accoudé à la croisée de sa mansarde, la tête nue, le front baigné par l’air glacé d’une nuit d’hiver, le baronet se posa les questions suivantes avec ce sang-froid, cette pénétration d’esprit qui le caractérisaient :
– Baccarat croyait-elle à son repentir ? Baccarat elle-même était-elle réellement repentie, et jouait-elle une comédie pour ramener Fernand à la raison et l’arracher à Turquoise ? Ou bien son revirement subit vers le mal était-il sincère et motivé par la conduite de Fernand Rocher ?
Le baronet répondit aussitôt à la dernière de ces trois questions.
– Il est évident, se dit-il, que la vertu est, comme le vice, une chose qui se pratique d’enthousiasme. Or, Baccarat aimait Fernand, elle l’avait perdu dans l’esprit d’Hermine, et il est arrivé pour elle une chose réellement vulgaire : par amour pour Fernand, qui ne l’aimait pas, elle s’est sacrifiée. L’amour est une grâce de Dieu pour les courtisanes ; Baccarat est devenue repentante et vertueuse par amour.
Ceci, aux yeux de sir Williams, paraissait incontestable.
– Maintenant, reprit-il à part lui, une pécheresse peut-elle devenir tout à fait et à jamais honnête ? Les uns disent OUI… Moi, je dis NON. Tant que Baccarat a vu Fernand heureux et aimant sa femme, elle s’est enveloppée douillettement dans son abnégation, dans son amour résigné ; elle s’est couverte de bure et a mené de bonne foi la petite existence d’anachorète dont j’ai, moi, prudemment habillé mes projets. Seulement, le jour où elle a vu Fernand en aimer une autre, il est fort possible qu’elle ait eu le vertige que le gouffre refermé se soit entrouvert de nouveau… Si cela est, Baccarat n’est point à craindre. Mais il peut se faire encore qu’elle joue un petit rôle… Alors, ou elle me le dira, ou elle me cachera soigneusement la vérité. Dans le premier cas, c’est qu’elle veut arracher son Fernand à Turquoise, et compte sur mon secours. Dans le second, c’est qu’elle se défie de moi ; et alors…
Le baronet ne compléta point sa pensée, il craignait de s’arrêter à cette hypothèse que Baccarat deviendrait son antagoniste.
– La fille est forte, pensa-t-il, et j’aurais pu, sans son sot amour, en faire quelque chose… Si elle est contre moi, j’aurai un terrible adversaire…
Et le baronet continua à rêver, oubliant l’heure qui passait, et les premiers rayons de l’aube le trouvèrent debout, à la même place, l’œil rêveur et fixé sur les grands arbres dépouillés du jardin.
Cette nuit de méditation avait fait surgir, claire, nette, flamboyante, une idée unique dans le cerveau de sir Williams : cette idée, c’était l’arrêt de mort de Baccarat.
– Si elle m’a deviné, se dit-il, elle doit mourir. Si elle croit à mon repentir, son zèle peut me gêner encore… et je dois m’en débarrasser.
Ceci brièvement formulé, sir Williams quitta l’hôtel vers huit heures du matin, et prit un fiacre aux environs de l’hôtel de Ville. Il se rendit rue Buci.
On se souvient que, la veille, il s’était déjà présenté deux fois chez madame Charmet sans parvenir à la rencontrer.
Deux motifs attiraient sir Williams rue de Buci : le désir de pénétrer les secrets de Baccarat d’abord ; ensuite un sentiment dont le baronet ne se rendait pas bien compte encore. Ce sentiment, confus jusque-là, datait de la première visite de sir Williams à madame Charmet, il y avait deux jours.
Sir Williams avait vu la petite juive. Cette tête d’ange où rayonnait comme un reflet lointain de l’Orient, cette beauté enfantine qui rappelait la gazelle du désert, avaient vivement impressionné l’âme de bronze du baronet.
Toute âme, si bien cuirassée qu’elle soit, a son défaut imperceptible par où elle devient vulnérable. Celle de sir Williams, qui paraissait inaccessible à tout sentiment humain, avait cependant éprouvé tout à coup un tressaillement, quelque chose qu’on aurait pu comparer à cette émotion subite et rapide qui s’empare des plus braves, sur le champ de bataille, à l’heure où le canon tonne.
Cette émotion avait livré à Baccarat le secret de sir Williams. Cette attraction mystérieuse que la petite inconnue exerçait sur lui pouvait le perdre.
Neuf heures sonnaient au moment où sir Williams se présenta rue de Buci.
La vieille servante avait sa leçon faite.
– Madame est partie hier soir, dit-elle.
– Où est-elle allée ?
– Je ne sais pas.
– Quand reviendra-t-elle ?
– Je l’ignore.
Et comme sir Williams insistait et lui mettait un louis dans la main :
– Tout ce que je puis vous dire, c’est que madame m’a dit qu’elle allait rue Moncey.
Le baronet l’avait deviné : mais il était nécessaire qu’il l’apprît de la bouche de la servante, pour qu’il osât se présenter au petit hôtel. Sir Williams, aux yeux de Baccarat, ne devait rien savoir de ce qui s’était passé ; sir Williams devait avoir tout appris par hasard. Ce principe admis, il était évident qu’il ne pouvait se présenter rue Moncey avant midi.
De la rue de Buci, le baronet s’en alla donc chez Rocambole. Rocambole était absent, et prenait en ce moment-là sa leçon d’escrime rue Rochechouart.
Mais le baronet passait chez lui pour son oncle, et avait à sa dévotion les gens du vicomte. Il se fit servir un copieux déjeuner, fuma quelques cigares, dégusta une tasse de thé, et attendit patiemment l’heure de sa visite à Baccarat. Puis, vers une heure, il remit sur sa tête son large chapeau à bords un peu gras, boutonna sa longue redingote, laça ses gros souliers, mit ses gants de coton, et s’en alla à pied, toujours absorbé dans sa profonde méditation.
– Il est évident, se disait-il, que je ne puis pas rester plus longtemps dans le doute. Aujourd’hui, je dois savoir à quoi m’en tenir : et quand je le saurai, j’aviserai un moyen convenable et discret de me débarrasser de cette petite Baccarat.
Sir Williams sonna à la grille de la rue Moncey avec l’humilité craintive d’un mendiant.
Il salua profondément le domestique qui vint lui ouvrir ; il s’inclina devant la femme de chambre comme devant une duchesse ; il eut l’air d’admirer, avec la naïve convoitise des pauvres, le brillant équipage de la Baccarat ressuscitée.
Quand la femme de chambre, sur un ordre de sa maîtresse, l’eut conduit au boudoir, il y prit, sur le bord d’une chaise, l’attitude d’un pauvre diable qui entrerait dans un palais pour la première fois.
La femme de chambre partie, sir Williams, demeuré seul, se reprit à méditer.
Mais cet homme était réellement fort et se défiait de tout. Il savait par expérience que si les murs ont souvent des oreilles, ils ont quelquefois des yeux, et il demeura humble, pensif, étonné, quoique seul. Qui sait ? Baccarat avait peut-être l’œil collé à quelque trou imperceptible, dissimulé, dans les plis d’une draperie ou sous le cadre d’un tableau.
Ce fut alors que la pécheresse ouvrit l’armoire, par les profondeurs de laquelle les sons arrivaient clairs et distincts du cabinet de toilette dans le boudoir. Sir Williams put entendre alors cette conversation excentrique et décolletée des deux pécheresses, et tout autre que lui, peut-être, eût été fixé sur-le-champ, tout autre aurait cru à ce retour vers le vice avec l’aveuglement de la conviction. Mais sir Williams ne se trouva point convaincu. Ce pouvait être une comédie jouée à son intention. Cependant ces mots qu’il entendit distinctement : « Va rejoindre mon visiteur au salon, » l’impressionnèrent assez vivement.
Sir Williams connaissait parfaitement la distribution intérieure de l’hôtel, et s’il ignorait cependant la disposition particulière de l’armoire située dans le cabinet de toilette, au moins il savait que le salon était assez éloigné de cette dernière pièce pour qu’aucun phénomène d’acoustique ne s’y pût produire.
Or, si Baccarat le croyait réellement au salon, il était évident encore qu’elle parlait sincèrement.
Ces réflexions jetèrent une certaine perplexité dans l’esprit du baronet.
Ce fut même avec impatience qu’il attendit madame de Saint-Alphonse, ou plutôt la personne qu’il avait entendue parler.
Madame de Saint-Alphonse, à qui Baccarat n’avait fait aucune confidence, descendit fort naturellement au salon, n’y trouva personne et interrogea la femme de chambre. Celle-ci répondit qu’elle avait fait entrer le visiteur dans le boudoir. Elle s’y rendit.
Sir Williams, son binocle à la main, examinait en amateur les peintures du boudoir. Il se leva à demi en la voyant entrer et la salua obséquieusement.
La courtisane lui rendit son salut par une demi-révérence pleine de hauteur, et toisa assez dédaigneusement son piètre costume.
Sir Williams en conclut sur-le-champ, que Baccarat n’avait dû lui faire aucune confidence.
– Madame Baccarat va venir, monsieur, dit la Saint-Alphonse, elle achève de s’habiller.
Sir Williams salua, toujours gauche et embarrassé.
Madame de Saint-Alphonse pensa que M. André Tissot était un vulgaire imbécile, qui ne méritait pas qu’elle se mît en frais de conversation, et elle alla au piano et promena fort négligemment ses doigts sur le clavier pendant vingt minutes.
– Il est bien certain, pensait sir Williams, qu’aux yeux de cette drôlesse je suis un abominable cuistre.
Et il se prit à tambouriner sur le bras de son fauteuil avec ses doigts, tandis que la Saint-Alphonse épuisait son répertoire de lambeaux de polkas et de bribes de valses nouvelles.
Tout à coup la porte s’ouvrit, et Baccarat parut ; elle parut sur le seuil de cette porte qui reliait le boudoir au cabinet de toilette, et s’arrêta stupéfaite en laissant échapper un petit geste de surprise.
Ce fut si bien joué que sir Williams fut dupe de la comédie.
– Ah ! vous voilà, mon cher, dit Baccarat d’un ton léger. Mille pardons de vous avoir fait attendre.
Sir Williams demeura stupéfait de cet aplomb.
Baccarat se pencha sur lui, parut hésiter un moment, puis elle lui dit rapidement :
– Monsieur le vicomte, vous qui avez été un grand coupable, et qui, maintenant, êtes devenu un saint, vous serez indulgent pour moi, n’est-ce pas ?
Le vicomte tressaillit.
– J’aimais Fernand, continua Baccarat à voix basse ; mon amour m’avait convertie, et j’étais revenue au bien. Le jour où j’ai appris qu’il aimait une de mes pareilles, le pied m’a glissé de nouveau… je suis redevenue Baccarat.
Elle lui tendit la main.
– Adieu dit-elle ; un abîme nous sépare désormais. Vous ne me reverrez pas… mais vous me plaindrez, n’est-ce pas ?
Et elle fit un pas et, par un geste, laissa comprendre qu’elle ne voulait entrer dans aucune explication.
Puis, se tournant vers madame de Saint-Alphonse :
– Viens-tu au Bois ? dit-elle.
Andréa, stupéfait, prit son chapeau, se dirigea vers la porte en soupirant : – Dieu ait pitié de vous, mon enfant !
Et il s’en alla presque convaincu de la nouvelle métamorphose de Baccarat.
Le vicomte Andréa parti, Baccarat et sa compagne montèrent en voiture.
Le landau descendit rapidement la rue de Clichy, tandis que sir Williams s’en allait par la rue Blanche et montait chez Turquoise.
On touchait alors aux premiers jours de février, le ciel était sans nuage et l’air était aussi doux qu’à la fin de mars. La place de la Concorde, le Bois, les Champs-Élysées étaient encombrés d’équipages et de cavaliers. Ce qu’on nommait la jeunesse dorée s’y était donné rendez-vous ; tout le Paris élégant allait au Bois ou en revenait.
Il était à peu près trois heures, lorsque le landau monta au petit trot l’avenue des Champs-Élysées.
L’attelage, la voiture, la beauté des deux femmes étalant au soleil leurs merveilleuses toilettes attirèrent bientôt l’attention.
Au rond-point, le landau fut croisé par deux jeunes gens à cheval.
L’un était un Russe, le comte Artoff, celui-là même dont madame de Saint-Alphonse avait parlé à Baccarat. L’autre était le jeune baron de Manerve, un ami de ce pauvre baron d’O… si malheureusement tué en duel trois ans auparavant.
– Dieu me damne ! s’écria le baron de Manerve, si cette blonde enchanteresse n’est pas Baccarat.
Et il arrêta brusquement son cheval qui se cabra à demi.
– Qu’est-ce que Baccarat ? demanda le gentilhomme russe, qui venait d’échanger un rapide salut avec madame de Saint-Alphonse.
Le baron de Manerve regarda son jeune compagnon comme on regarderait, en plein salon du faubourg Saint-Germain, un porteur d’eau qui se ferait annoncer.
– Ah çà, mon cher ami, dit-il, d’où sortez-vous ?
– Mais, dame ! répondit fort naïvement le comte Artoff, je sors de chez moi aujourd’hui, et je suis arrivé de Saint-Pétersbourg il y a six semaines.
– C’est juste, dit le baron en riant. Quel âge avez-vous, au fait ?
– Vingt ans, mon cher baron.
– Vous étiez un enfant, au temps de Baccarat.
– Mais, enfin, qu’est-ce que Baccarat ?
– Tenez, dit le baron, tournons bride et suivons le landau au petit trot et à distance : je vous dirai d’abord l’histoire de cette femme ; puis, si la fantaisie vous en prend, je vous présenterai.
Les deux cavaliers firent volte-face et suivirent le landau qui continuait sa route.
– Mon cher, dit alors le baron de Manerve à son compagnon, avez-vous entendu parler de ce pauvre baron d’O…, tué en duel il y a trois ans ?
– Oui, certes.
– C’était mon ami intime.
– Je le sais.
– Eh bien, le baron avait lancé Baccarat.
– Ah !
– Il l’avait prise rue du Faubourg-Saint-Antoine, à un cinquième étage, et il en avait fait en deux ou trois ans, grâce à la merveilleuse beauté et à la race intelligente dont elle était douée, la femme la plus à la mode du monde interlope. Pendant quatre ou cinq ans, Baccarat a eu les plus beaux chevaux, les plus belles voitures, a porté les toilettes les plus excentriques et les plus riches. C’était une fille d’esprit : les gazetiers allaient chez elle recueillir des mots pour leurs feuilles de théâtre ; ses soupers étaient un champ de bataille ouvert aux discussions de toute nature ; une femme du monde, pendant une absence momentanée de Baccarat, corrompit ses gens pour être admise à visiter en cachette son cabinet de toilette ; un grand pianiste est devenu fou d’amour en la voyant ; X…, le peintre célèbre, s’est brûlé la cervelle après lui avoir écrit.
– Mais elle n’avait donc pas de cœur ?
Le baron haussa les épaules.
– Vous êtes jeune, dit-il.
– C’est possible… murmura le comte Artoff qui se mordit les lèvres.
– Avez-vous lu Balzac ?
– Tout entier.
– Vous souvenez-vous de Fœdora ?
– Fœdora de la Peau de chagrin ?
– Précisément.
– Parbleu ! oui, je m’en souviens…
– Eh bien, Baccarat était, pour la sensibilité, taillée sur le même patron.
– Diable !
– Le seul homme qu’elle ait aimé huit jours, c’était le baron d’O…
– Et elle l’a toléré quatre ans ?
– C’est-à-dire qu’il l’aimait et se cramponnait à elle, aveugle avec discernement, indulgent par principe, et se contentant, par égoïsme, de l’affectueuse estime qu’elle lui témoignait.
– Après ? fit le jeune Russe, qui commençait à être intéressé par ce récit.
– Un jour, Baccarat disparut.
– De Paris ?
– Non, du monde.
– Quelle plaisanterie !
– Je ne plaisante jamais à propos d’un ami défunt, répondit gravement M. de Manerve.
Et il reprit d’un ton moins lugubre :
– Un soir, ce pauvre d’O… vint chez moi. C’était un an avant sa mort.
« – Mon ami, me dit-il, je viens te demander un conseil.
« – Je t’écoute, répondis-je, frappé de sa pâleur, de son visage bouleversé et de l’accent ému de sa voix.
« – Baccarat ne m’aime plus.
« – Bah ! lui dis-je, il y a quatre ans qu’elle a cessé de t’aimer.
« – Je le sais et je m’explique mal.
« – Alors ?
« – Je veux dire qu’elle me dit adieu.
« – Hein ? fis-je stupéfait.
– Il soupira profondément.
« – Je ne puis rien te dire, continua-t-il, car je ne sais moi-même que fort confusément ce qui lui est arrivé ; mais il paraît qu’elle a eu un grand amour au cœur.
« – Tu rêves… Baccarat n’a pas de cœur.
« – Elle en a trouvé un probablement, fit-il avec un triste sourire. Lis plutôt.
– Et il me passa un billet à peu près conçu en ces termes :
“Mon cher d’O…,
“Vous avez été mon bienfaiteur, et je ne veux pas que vous me teniez pour ingrate… Une passion terrible, immense, a broyé mon cœur à ce point qu’il m’a fallu choisir entre la mort et le repentir. Je me repens et j’entre ce soir aux Sœurs-Grises.”
« Suivait une phrase d’adieu et de banales consolations.
– Eh bien ? demanda le jeune Russe.
– Eh bien ! d’O… était désespéré. Il venait me demander un conseil : il voulait se tuer.
« – Mon cher, lui dis-je, il y a trois remèdes contre un désespoir d’amour : le suicide, le temps, les voyages. Va faire un tour en Italie, ou jusqu’en Grèce, en Turquie, reviens par l’Allemagne, et si, à ton retour, tu n’es pas guéri, tu te tueras.
– Le baron suivit mon conseil ; il voyagea un an, revint aussi malade que le jour de son départ, chercha une querelle, la trouva, et se fit tuer.
– Et… Baccarat ?
– Baccarat hérita de lui. Mais qu’était-elle devenue, quel usage fit-elle de la fortune du baron ? Mystère…
– Et on ne l’a jamais revue ?
– Jamais.
– Et vous croyez que cette femme que nous suivons, que j’ai à peine vue, moi, occupé que j’étais à saluer la Saint-Alphonse…
– C’est elle, je le jurerais.
Les deux cavaliers, en causant ainsi, avaient, sans perdre de vue le landau, franchi la barrière, suivi l’avenue de Neuilly, et ils entraient par la porte Maillot dans le Bois.
– Venez, dit le baron de Manerve, pressez votre cheval, nous allons les rejoindre et nous verrons bien.
Au bruit des chevaux trottant derrière la voiture, madame de Saint-Alphonse s’était retournée à demi.
– Tiens, dit-elle à Baccarat, voici mon jeune Russe.
Baccarat se retourna.
Les deux jeunes gens approchaient au galop.
– Pardieu ! s’écria M. de Manerve, c’est bien Baccarat !
– En chair et en os, répondit-elle. Et ma résurrection est un mystère. Chut !
Elle appuya un doigt sur ses lèvres.
– C’est bien, dit le baron, vous me conterez cela plus tard.
Et, montrant le jeune Russe :
– Chère madame de Baccarat, dit-il, permettez-moi de vous présenter mon ami le comte Artoff, un jeune seigneur moscovite qui ignore le nombre de ses villages et passerait sa vie à compter ses paysans sans arriver à l’addition totale, devînt-il centenaire.
Baccarat répondit au salut du boyard avec une aisance de duchesse.
– Je vais mettre deux impossibilités en présence, continua le baron en riant.
– Vraiment ? fit Baccarat.
– Une femme qui revient de l’autre monde.
– C’est vrai.
– Un homme impossible à ruiner.
– Monsieur est une exception, dit froidement Baccarat.
– Une exception qui confirme la règle, ajouta le baron.
– Messieurs, dit Baccarat, je rouvre mes salons mercredi prochain. Permettez-moi de commencer mes invitations par vous.
Les deux jeunes gens s’inclinèrent. Elle leur dit adieu de la main, fit un signe, et le landau repartit.
– Ce soir, dit Baccarat à madame de Saint-Alphonse, tout Paris saura que je suis ressuscitée.
En effet, au bout d’une heure, le landau avait fait le tour du Bois, et Baccarat avait échangé vingt saluts avec la fashion masculine. À cinq heures, le landau rentrait rue Moncey.
– Ma chère, dit Baccarat à son ancienne amie, il est incontestable que le petit Russe ira te voir ce soir. Tu sais ce que tu as à faire.
– Ta confiance m’honore, et j’en serai digne, ma fille.
– Adieu…, reprit-elle en s’élançant lestement au bas du landau. Mon cocher ira te mettre chez toi. Pardonne-moi de ne pas te garder à dîner : je n’ai pas de cuisinière encore et je vais envoyer au restaurant. Mais demain, en revanche, j’irai dîner chez toi et tu me donneras une place dans ta loge, à l’Opéra. Adieu.
Baccarat rentra chez elle, s’enferma dans son boudoir, se jeta à genoux et fondit en larmes. La pauvre comédienne n’était pas en scène, et madame Charmet pleurait du rôle odieux de l’impure Baccarat.
XLVII
Le baron de Manerve et son jeune ami étaient revenus du Bois vers cinq heures et demie, avaient dîné ensemble, puis s’étaient rendus à leur club vers neuf heures.
Le comte Artoff était un peu gris.
– Mon cher baron, disait-il en jetant son cigare dans l’escalier du club, savez-vous que Baccarat est une femme adorable ?
– Parbleu ! à qui le dites-vous ? Et si vous voulez mettre une bride de vos millions sous sa dent…
– Eh bien ?
– Sa dent est pointue, elle a la dureté du diamant, elle vous croquera une douzaine de villages.
– Et… elle m’aimera ?…
– Non, vous êtes trop riche, et puis elle n’a pas de cœur.
– Mais… elle a aimé…
– Raison de plus. Des femmes comme elle n’aiment qu’une fois. Mais elle sera agréable, charmante, et vous fera honneur…
En parlant ainsi, le baron pénétra dans un joli fumoir attenant au grand salon du club. Dans cette pièce, une douzaine de jeunes gens fort à la mode entouraient une table de jeu. Parmi eux se trouvaient deux personnages de notre connaissance : M. Oscar de Verny, M. le vicomte de Cambolh ; c’est-à-dire Chérubin et Rocambole, dont la présence au milieu d’hommes riches, titrés pour la plupart et tous parfaitement honorables, prouvait jusqu’à l’évidence cette légèreté parisienne qui permet quelquefois à deux bandits de se glisser au milieu du meilleur monde, grâce à un nom sonore usurpé, à des manières élégantes et à un semblant de fortune.
Malgré les sommes considérables engagées sur le tapis vert, le jeu était froid ce soir-là. On jouait négligemment, mais on causait avec animation. La nouvelle du jour, l’événement récent qui occupait tout le monde et donnait cours aux commentaires les plus excentriques, c’était la résurrection de Baccarat.
Rocambole lui-même n’y voulait pas croire.
– Messieurs, disait un des joueurs, je vous affirme, sur ma parole, que la femme que nous avons vue aujourd’hui au Bois, c’était bien la Baccarat.
– Elle est morte… dit un incrédule.
– Moi, je l’ai vue, dit un troisième, je l’ai vue, reconnue, saluée, mais…
– Eh bien ?
– Mais je n’y crois pas.
– Ni moi, ajouta un quatrième.
– Messieurs, dit gravement M. le vicomte de Cambolh, je puis vous certifier que Baccarat n’est pas morte.
– Ah ! vous voyez !
– Mais que ce n’est pas elle que vous avez vue au Bois.
– C’est elle.
– Je suis certain du contraire.
– La connaissez-vous ?
– Je ne l’ai jamais vue.
– Alors sur quoi fondez-vous votre conviction ?
– C’est mon secret.
– Messieurs, dit le baron de Manerve entrant, je puis vous certifier, moi, que la conviction du vicomte n’a rien de sérieux.
– Plaît-il ? fit Rocambole.
– J’ai vu Baccarat.
– Vous l’avez vue ?
– Oui.
– Eh bien, nous aussi.
– Je lui ai parlé.
– Diable ! ceci est plus sérieux…
– Oh ! oh ! pensa Rocambole, il y a peut-être du sir Williams là-dessous. Taisons-nous et écoutons. Et il dit négligemment :
– Si vous lui avez parlé, monsieur, c’est différent, je retire mon assertion.
– Et je vous invite à son premier bal de l’hiver, ajouta le baron. On danse chez elle jeudi prochain.
– C’est singulier ! murmura-t-on à la ronde.
– Soit, mais c’est vrai, réel, incontestable.
– Mais d’où vient-elle ?
– On ne sait.
– Est-elle riche ?
– Elle le sera.
– Hein ? fit-on de toutes parts.
– Voilà mon jeune ami, dit le baron en désignant du doigt le comte moscovite, qui se chargera de son avenir.
On salua le jeune Russe.
– Oh ! messieurs, dit-il avec une modestie que ne justifiaient pas ses vingt ans, il n’y a encore rien de décidé là-dessus.
– Tant mieux ! dit une voix.
– Pourquoi, tant mieux ?
Et l’on se retourna vers le nouvel interlocuteur.
C’était M. Oscar de Verny, ou plutôt c’était Chérubin.
– Parbleu ! dit le baron en riant, M. de Verny aurait-il des prétentions ?
– Monsieur, répondit froidement Chérubin, si vous voulez bien me le permettre, je vous ferai ma généalogie avant d’aller plus loin.
– Où voulez-vous en venir ?
– Attendez, vous verrez.
Et Chérubin prit la pose d’un narrateur, au grand étonnement de Rocambole, qui ne s’attendait point à cet incident.
– Voyons la généalogie ? dit-on de toutes parts.
– Messieurs, reprit Chérubin, mon teint, mes yeux, mes cheveux vous disent assez que je ne suis pas d’origine française, en dépit de mon nom.
– Vous êtes Italien ?
– Non, je suis créole.
– Après ?
– Mais créole de l’Amérique du Sud, créole de race espagnole.
– Et… vous descendez ?
– De don Juan.
Chérubin prononça ce nom fameux avec un calme parfait.
Cependant on se prit à rire.
– Vous plaisantez, dit-on.
– Peut-être.
– Pourquoi donc la généalogie ?
– Ah ! voilà, c’est fort simple. Cela veut dire que je fais métier de séduction.
– Bravo !
– Il y a trois femmes, poursuivit Chérubin, dont j’aurais voulu être aimé.
– Quelle est la première ?
– Cléopâtre, reine d’Égypte.
Un fou rire s’empara des joueurs.
– Et la seconde ?
– La belle Impéria.
– Voyons la troisième ?
– Baccarat.
Chérubin était grave au milieu de ces visages qui riaient.
– Savez-vous pourquoi ? reprit-il.
– Voyons !
– Parce qu’elles n’avaient pas de cœur. Or, l’épreuve était impossible sur les deux premières, puisqu’elles ont mis entre elles et moi la poussière des siècles.
– La raison est suffisante.
– Mais puisque la troisième ressuscite, je tenterai l’aventure.
– Et vous réussirez ?
– C’est incontestable.
– Mon cher, dit le baron de Manerve, devenant à son tour aussi grave que Chérubin, vous perdrez votre temps ; Baccarat n’aime que l’or… Oh ! vous pouvez sourire avec orgueil, vous pouvez jeter à votre visage fascinateur un coup d’œil d’admiration, vous pouvez vous remémorer complaisamment, ô don Juan en bottes vernies, le nombre de vos succès, vous ne réussirez pas, parce que là où il n’y a rien, le roi lui-même perd ses droits.
– Je trouverai les miens.
– Monsieur, dit le jeune Russe, froissé de la fatuité pleine d’aplomb de Chérubin et sentant se réveiller en lui le caractère fougueux et irascible de sa race, voulez-vous me permettre un mot ?
– Plusieurs, monsieur le comte.
– Non, un seul.
– Allez, je vous écoute.
– Vous prétendez fasciner Baccarat ?
– Je le prétends, dit Chérubin avec conviction.
– Êtes-vous riche ?
– Non, j’ai à peine trente mille livres de rentes.
– Moi, j’ai une vingtaine de millions, peut-être plus…
– Eh bien ?
– Eh bien, je me suis mis en tête de conquérir Baccarat.
– C’est comme moi.
– Voulez-vous tenir un pari ?
– Mais sans doute.
– Alors, écoutez-moi. Prenez quinze jours. Est-ce suffisant ?
– C’est trop de moitié.
– N’importe ! prenez-les… Si dans quinze jours Baccarat vous aime, je vous donne ici, à pareille heure, en présence de ces messieurs, cinq cent mille francs.
– Parfait, j’accepte.
– Et s’il perd le pari ? demanda-t-on.
– Voici, dit le Russe avec ce terrible sang-froid que déploient, à de certaines heures, les races du Nord… Si M. de Verny perd son pari, si dans quinze jours il n’est pas aimé de Baccarat, comme il n’est pas riche et que je le suis trop pour exiger cinq cent mille francs, je lui brûlerai la cervelle.
Un frisson courut parmi les assistants.
Le jeune Moscovite avait vingt ans, il était presque imberbe et paraissait à peine avoir son âge. Mais il y avait tant de calme dans sa voix, tant d’assurance dans son regard ; on devinait une résolution si bien trempée dans l’âme de ce jeune homme, qui était presque un enfant, que les joueurs comprirent que rien n’était plus sérieux que le pari qu’il proposait.
– Eh bien, monsieur, dit-il à Chérubin, qu’en pensez-vous ?
– Mais, dit Chérubin, la proposition est raide et demande réflexion.
– Réfléchissez…
– Raide et impossible à accepter, observa le baron de Manerve.
– Pourquoi ?
– Mais, dit le baron, parce que nous sommes en France, mon cher comte, c’est-à-dire dans un pays où l’on n’a pas plus le droit de vendre ou de donner sa vie que celui de prendre celle des autres. M. Chérubin aurait beau consentir à vous laisser lui brûler la cervelle, la loi française n’y consentirait certes pas…
– J’ai prévu le cas, dit froidement le comte.
– Vous l’avez prévu ?
– Sans doute, et j’éluderai la loi.
– Comment ?
– D’une façon bien simple.
– Ah !
– Messieurs, reprit le jeune homme, nous sommes tous ici des gens d’honneur, et, par conséquent, incapables de violer une parole donnée.
– Certes ! fit-on à la ronde.
– Donc, si M. de Verny accepte mon pari, voici ce que je compte faire, dans le cas où il se reconnaîtra vaincu.
Un mouvement de curiosité se manifesta dans le fumoir.
– M. de Verny, poursuivit le comte, est un homme d’honneur et incapable de me faire tort de sa vie, si je l’ai loyalement acquise.
– Sans doute, dit Chérubin.
– Par conséquent, s’il perd, il me cherchera querelle, nous nous battrons au pistolet à dix pas, une seule arme chargée, la mienne. Soyez tranquille, monsieur, continua le jeune Russe avec un calme qui épouvanta tous les joueurs ; je tire parfaitement le pistolet ; je vous planterai ma balle entre les deux yeux, et vous tuerai raide sans vous défigurer.
Un silence de mort accueillit ces dernières paroles.
– Si cela arrive, acheva le comte, je compte sur votre discrétion, messieurs.
– Ce pari est impossible ! dit-on enfin aux quatre coins du fumoir.
– Alors, dit le comte, M. de Verny me fera le plaisir de renoncer à ses projets.
– Non pas, dit Chérubin.
– Ou il se battra demain matin ; auquel cas il est probable encore que je le tuerai. Et remarquez, messieurs, qu’il aura ainsi renoncé à la chance de gagner cinq cent mille francs, et qu’il mourra avec la réputation d’un fanfaron.
Ces derniers mots touchèrent en plein l’orgueil de Chérubin.
– Monsieur le comte, dit-il, j’accepte votre pari.
Un murmure d’admiration parcourut l’assemblée.
– C’est une folie ! s’écria-t-on.
– Réfléchissez bien, monsieur, dit une dernière fois le comte.
– C’est tout réfléchi.
– Ainsi, vous acceptez ?
– J’accepte.
– Monsieur le comte, dit Rocambole, M. Oscar de Verny oublie un engagement qu’il a pris. Soyez assez bon pour ne point tenir son acceptation pour sérieuse avant que je lui aie dit quelques mots en particulier.
Cette brusque intervention de Rocambole jeta parmi les joueurs un surcroît d’étonnement.
– Soit, monsieur, dit le comte.
L’élégant vicomte de Cambolh prit par le bras Chérubin stupéfait, et l’entraîna hors du fumoir en disant :
– Excusez-moi, messieurs, je reviens…
Et il conduisit Chérubin à l’extrémité opposée du grand salon alors désert, et le poussa dans une embrasure de croisée…
– Mon cher ami, dit-il alors, vous êtes un sot.
– Vous trouvez ?
– Je devrais dire un niais…
– Ce n’est pas si niais déjà, de jouer sa vie contre cinq cent mille francs, quand on est à peu près sûr…
– On est toujours un sot de risquer ce qui ne vous appartient pas.
– Ma vie n’est pas à moi ?
– Non, dit sèchement Rocambole.
– À qui donc est-elle ?
– À nous.
Et il souligna ce mot.
– Qu’importe !
– C’est-à-dire qu’à moins que le chef ne le permette, dit le vicomte, vous ne tiendrez pas ce pari…
– Et s’il refuse… et que je passe outre ?…
– Ce ne sera pas le comte qui vous tuera, dit Rocambole.
– Et qui donc ?
– Je ne sais pas, mais vous serez mort demain, à pareille heure. Comment ? de quelle main ? avec quelle arme ? je ne sais… Maintenant, voyez.
– J’obéirai, murmura Chérubin, j’attendrais l’ordre du chef.
– Alors, venez.
Rocambole ramena M. de Verny dans le fumoir.
– Monsieur le comte, dit-il au seigneur moscovite, M. de Verny vient de se rendre aux bonnes raisons que je lui ai données…
– Ah ! fit le Russe avec un sourire dédaigneux, il refuse ?
– Non.
– Il accepte, alors ?
– Pas davantage.
– C’est-à-dire qu’il demande à réfléchir ?
– Jusqu’à demain à pareille heure, voilà tout.
– Je le veux bien, dit le comte, mais à une condition.
– Parlez, monsieur.
– C’est que je pourrai, ce soir même, si cela me convient, aller faire ma cour à Baccarat.
– Vous le pouvez.
– Alors, monsieur, dit le comte, à demain.
Il prit le bras de M. de Manerve, salua et sortit.
Quelques minutes après, Rocambole et Chérubin quittèrent également le club et descendirent à pied vers le boulevard.
– Mon cher ami, dit le prétendu vicomte en serrant la main à Chérubin, allez faire un tour au Bois demain.
– À quelle heure ?
– Vers midi.
– Aurez-vous une réponse ?
– Certainement ; d’autant plus que j’aurai peut-être de nouvelles instructions à vous donner concernant la marquise.
– Ah ! dit Chérubin, ce n’est point à propos de celle-là que je voudrais tenir mon pari. J’ai la conviction que la marquise m’aime, mais j’ai bien peur qu’elle ne me l’avoue jamais. Cette femme est un ange !
– C’est pour cela, dit Rocambole, que vous avez été léger en vous mettant une nouvelle affaire sur les bras.
Et il quitta Chérubin le charmeur et regagna à pied son entresol du faubourg Saint-Honoré, où précisément sir Williams l’attendait, les pieds sur les chenets et un cigare aux lèvres.
– Par l’enfer ! mon oncle, s’écria Rocambole en entrant, c’est fort heureux que je vous trouve !
– Tu as besoin de moi ?
– J’ai de grandes nouvelles à vous apprendre.
– Parle, mon neveu.
– D’abord, dit Rocambole avec animation, il paraît que Baccarat a jeté son froc aux orties pour tout de bon ?
– Je le sais. Après ?
– Vous le savez ?
– Je sais tout. Après ?
– Après, maître Chérubin vient de tenir un singulier pari.
– Quel est-il ?
Rocambole raconta fidèlement la scène dont il avait été témoin au club et que nous venons de décrire.
Sir Williams l’écouta sans l’interrompre, puis il parut méditer longtemps.
– Au fait, dit-il, je ne vois aucun inconvénient à ce que Chérubin accepte le pari.
– Aucun ?
– Non, et voici pourquoi. Lorsque tu es arrivé, je rêvais au moyen de me débarrasser de Baccarat qui me gêne. Peut-être ai-je trouvé ce moyen…
Sir Williams jugea inutile de s’expliquer plus clairement, et sous sa dictée Rocambole écrivit à Chérubin :
« Mon cher ami, tenez le pari, on vous le permet. Mais venez néanmoins demain au rendez-vous que je vous ai donné. Il y a urgence. À vous.
« Cambolh. »
– Ma petite Baccarat, murmurait sir Williams à part lui, il faut pourtant que j’aie raison de vous et que je sache à quoi m’en tenir.
XLVIII
Vers dix heures du soir, le même jour, Baccarat était seule rue Moncey ; ou plutôt la petite juive dormait paisiblement sur un divan, dans le boudoir de la pécheresse.
Ni madame de Saint-Alphonse, ni le comte russe, ni M. de Manerve, ni tous les jeunes fous qui, quelques heures auparavant, avaient battu des mains à la rentrée dans le monde de la courtisane célèbre, ne l’eussent reconnue. Baccarat n’était plus Baccarat : ce n’était plus cette fille superbe, au regard hardi, à l’éclat de rire étincelant et moqueur, qui semblait faire métier de tromperie ; ce n’était plus la pécheresse si pleine d’audace, de raillerie, de cynisme.
C’était madame Charmet ; madame Charmet, la pauvre femme courbée sous le poids du remords et du repentir, l’humble pénitente dont les yeux étaient sans cesse tournés vers le ciel, la sœur de charité qui avait passé de longues nuits d’hiver au chevet des malades. Pourtant elle avait encore sa brillante toilette de la journée ; elle n’avait point songé à voiler ses épaules, à dissimuler comme naguère sa belle chevelure, à ensevelir les grâces de sa taille sous les plis larges et raides d’une robe à demi monastique ; mais son œil noyé de larmes, son attitude affaissée, témoignaient assez de sa douleur.
– Mon Dieu ! murmurait-elle, joignant les mains avec ferveur, mon Dieu ! pardonnez-moi et donnez-moi la force de jouer cet horrible rôle jusqu’au bout sans défaillir et sans trembler. Il faut bien que je le sauve, lui !
Un coup de sonnette prévint Baccarat de l’arrivée d’un visiteur. Peu après, en effet, un groom microscopique franchit le seuil du boudoir, tenant à la main une lettre. C’était le groom de madame de Saint-Alphonse.
Madame de Saint-Alphonse écrivait à madame Baccarat :
« Chère amie,
« Vite, mets-toi sous les armes… Le petit Russe vient d’arriver ici ; il est amoureux fou de toi, et son amour est doublé de pas mal de vanité. Il a fait je ne sais quel pari à son club, et je te préviens qu’il va t’assiéger ce soir même et s’introduire chez toi avec effraction et escalade. J’ai prétendu, en sa présence, que tu étais une femme excessivement romanesque, et j’ai soutenu même que tu serais capable des plus grandes folies pour l’homme qui friserait le Code pénal à la seule fin de te plaire.
« Ainsi donc, ma chère, attends-toi à tout.
« Saint-Alphonse. »
Cette lettre, que Baccarat approcha de la bougie et laissa consumer lentement, rendit à la jeune femme toute son énergie :
– Allons ! pensa-t-elle, voici le coup de sonnette du régisseur ; la toile se lève, entrons en scène…
Elle jeta cent sous au groom.
– C’est bien, dit-elle.
Le groom salua et disparut.
Baccarat sonna sa femme de chambre :
– Déshabille-moi, dit-elle.
Cinq minutes suffirent à Baccarat pour remplacer par une toilette de nuit sa fraîche toilette du jour. Elle enveloppa ses cheveux dans un grand foulard bleu, passa une robe de chambre, chaussa de petites mules de satin à talons rouges, et courut s’installer au rez-de-chaussée de son hôtel.
Il y avait là, donnant sur le jardin, un cabinet de travail que le baron d’O… affectionnait. C’était une jolie petite pièce, toute tendue en étoffe orientale, remplie de livres et de journaux et fort simplement meublée de divans et de sièges recouverts d’une étoffe semblable à celle des tentures et des rideaux.
Baccarat renvoya la soubrette et demeura seule, gentiment pelotonnée sur un divan placé près du feu, un livre à la main. Elle avait pensé que si le jeune Russe s’introduisait chez elle, ce serait sans doute à l’aide d’une échelle appliquée contre le mur extérieur et qui lui permettrait de sauter dans le jardin. Or, ce que Baccarat voulait, avant tout, éviter, c’était le bruit, l’esclandre, le scandale. C’était pour cela qu’elle était descendue au rez-de-chaussée, dans cette pièce, dont la fenêtre éclairée attirerait bien certainement tout d’abord l’attention du jeune écervelé.
Ce que Baccarat avait prévu arriva. Elle était dans le cabinet de travail depuis un quart d’heure à peine, lorsqu’un léger bruit se fit dans le jardin, quelque chose qui pouvait être pris pour la chute d’un corps. Puis des pas crièrent sur le sable des allées, puis encore ils s’arrêtèrent auprès de la fenêtre. Alors Baccarat, jusque-là immobile, tourna la tête, crut voir une ombre se dessiner à l’extérieur, et laissa échapper un geste d’effroi qui fut merveilleusement joué.
Deux petits coups furent frappés à la vitre de la croisée.
Baccarat jeta son livre, se leva, alla à la fenêtre et l’ouvrit.
C’était bien le jeune Russe qui frappait.
Baccarat se dispensa de pousser une exclamation de surprise ; elle regarda tort tranquillement le jeune homme, que ce sang-froid, auquel il ne s’attendait pas, déconcertait un peu, et elle lui dit :
– Entrez donc, monsieur le comte, entrez. Puisque vous avez osé escalader mon mur, je ne vois pas pourquoi vous n’iriez point jusqu’au bout, en pénétrant chez moi par la fenêtre…
Et Baccarat fit deux pas en arrière pour permettre au jeune homme d’enjamber l’appui de la croisée.
Le comte rougissait et balbutiait, avec la naïveté de ses vingt ans. Cependant, comme il n’y avait ni irritation ni raillerie dans la voix de la jeune femme, il se décida à sauter dans le cabinet de travail.
Baccarat ferma alors la croisée, tira les rideaux, puis elle indiqua un siège à son nocturne visiteur.
Après quoi elle reprit sa pose nonchalante et gracieuse sur le divan.
– Monsieur le comte, lui dit-elle, je sais quel est le but de votre visite et pourquoi vous vous êtes exposé tout à l’heure aux rigueurs du Code pénal.
– Madame…
– Trêve d’excuses, et veuillez m’écouter. Vous m’avez vue aujourd’hui pour la première fois, on vous a dit ma triste célébrité d’autrefois, mon insensibilité passée en proverbe, et je suis persuadée que ce pauvre Manerve vous aura fait, sur ma retraite de quatre années, quelque romanesque histoire…
– Mais, madame…
– Chut ! monsieur, écoutez-moi.
Le comte fit un geste d’obéissance et se tut.
– Monsieur, poursuivit Baccarat, vous avez vingt ans, n’est-ce pas ?
– Oui, madame.
– L’âge des entreprises chevaleresques et des rêves peuplés d’obstacles.
– Peut-être…
Et le prince russe eut un fier sourire.
– Moi, dit Baccarat, je touche à ma vingt-septième année et j’ai vécu, c’est-à-dire que je suis vieille, très vieille, et que j’ai lu tout entier ce livre désolé de la vie dont vous avez à peine entrouvert les premières pages. Ce triste privilège me donne donc le droit de vous parler avec une certaine autorité, convenez-en.
Le comte s’inclina.
– Or, reprit Baccarat, si j’ignorais hier jusqu’à votre nom, je sais aujourd’hui, ou plutôt je devine toute votre vie et jusqu’à vos plus secrètes pensées.
L’enfant eut un sourire incrédule.
– Écoutez-moi donc, dit-elle, vous en jugerez vous-même. Et elle continua : – Vous avez vingt ans, vous appartenez à une nation chevaleresque, aventureuse et conquérante, qui ne doute de rien. On vous a dit aujourd’hui, en me montrant au doigt : « Voilà une femme qui ne croit à rien, qui n’aime rien, dans les mains de laquelle fondent des fortunes de roi. J’ai vingt ans, je suis fabuleusement riche et je veux être aimé de cette femme. »
« Est-ce vrai, cela ?
Le comte s’inclina :
– C’est vrai, dit-il.
– Monsieur, dit Baccarat, je vous jure que vous vous êtes trompé.
– Oh ! fit le comte.
– Je ne puis pas vous aimer, et je ne veux pas vous ruiner.
Elle prononça ces mots froidement, avec l’accent d’une résolution inébranlable.
– Tenez, dit-elle, regardez-moi bien : je ne souris plus, je n’ai plus l’œil hardi et brillant d’une courtisane… regardez…
Il la regarda et fut frappé de la dignité triste qui régnait sur ce beau visage.
– Pardonnez-moi, balbutia-t-il ; mais je vous aime…
Elle lui jeta un sourire presque maternel.
– Enfant, dit-elle, vous avez vingt ans… À votre âge, il y a encore de nobles cordes au fond du cœur, qui résonnent au simple contact d’une parole généreuse. Regardez-moi bien : je suis une pauvre femme brisée qui joue peut-être un rôle au-dessus de ses forces, une femme qui vaut mieux aujourd’hui que sa célébrité fatale, et qui vous demande loyalement, simplement, à vous gentilhomme, à vous dont l’œil brille d’une noble franchise, à vous encore enfant, d’avoir pitié d’une pauvre femme vieillie au souffle destructeur des passions…
L’accent de Baccarat était ému.
Le comte vit une larme briller dans ses yeux, et ce jeune homme, qui n’était point encore assez éloigné du temps où il posait sa tête blonde sur les genoux de sa mère, ce jeune homme comprit que Baccarat n’était pas ou n’était plus la femme sans cœur, l’abominable créature dont on lui avait parlé, et il devina une douleur immense ensevelie au fond de cette âme, une misère sans nom cachée au milieu de ce luxe éblouissant et coquet dont la pécheresse était environnée.
– Vous avez raison, madame, lui dit-il, de m’appeler enfant. Oui, je suis un enfant, un enfant dont l’audace vous a peut-être fait du mal ; mais si mon repentir…
– Monsieur le comte, dit Baccarat l’interrompant d’un geste plein de dignité, voulez-vous me faire un serment ?
– Oh ! parlez.
– Voulez-vous me jurer sur votre honneur de gentilhomme, sur celui de la noble nation à laquelle vous appartenez, que tout ce qui aura été dit ici, cette nuit, entre nous, sera aussi solennellement enseveli au fond de votre cœur qu’un secret l’est au fond d’une tombe ?
– Je vous le jure, madame, foi de gentilhomme russe ! répondit le comte d’une voix calme, avec un regard éclatant de franchise et de loyauté.
Un moment de silence suivit le serment du jeune Russe.
Baccarat le regardait avec attention, comme si elle eût hésité encore, malgré cette parole solennellement donnée.
– Monsieur, dit-elle enfin, la jeunesse vaut mieux que l’âge mûr ; elle a de généreux instincts, elle conserve pieusement la religion du serment : c’est vous dire que je vais me fier à vous, qui m’étiez inconnu ce matin, de préférence à un homme d’âge mûr, qui serait, pour moi, un ami de dix ans.
– Je vous remercie, madame, répondit le comte avec émotion, votre confiance ne sera point trompée.
– Écoutez, poursuivit Baccarat. Il y a dans ma vie un mystère et un secret. Le mystère est impénétrable… Le secret, je ne puis le divulguer à personne, pas même à vous, ajouta-t-elle avec un sourire, et pourtant quelque chose me dit que vous êtes une noble et loyale nature et que vous deviendrez mon ami.
– Je le suis déjà, madame, répondit le comte avec vivacité.
– Nous verrons, dit Baccarat, car je vais peut-être vous demander un bien grand sacrifice… Et elle ajouta : – Il n’est point question de votre fortune… On a pu vous dire, on vous a dit sûrement, monsieur, que Baccarat avait été une de ces créatures qui n’aiment que l’or, ne tressaillent qu’au bruit qu’il rend, et ont une pierre de touche pour cœur.
– En effet, balbutia le comte un peu embarrassé.
– On vous a dit vrai pour le passé, fit-elle avec humilité. J’ai été cette créature-là. Mais quatre années se sont écoulées, et depuis lors j’ai aimé, j’ai souffert, je me suis repentie… La femme que vous voyez aujourd’hui ne peut plus aimer ni ruiner personne ; et si elle pouvait aimer encore, elle voudrait vivre du travail de ses mains pour purifier son amour. Vous le voyez, je ne vous ruinerai pas.
– Ah ! madame, cessons de descendre à de pareils détails, s’écria le comte, entraîné par un de ces généreux élans que, seule, possède la jeunesse, et dites-moi en quoi et comment je puis vous servir. Ma vie est à vous.
– Dieu me garde d’y toucher ! dit-elle. Je vous demanderai beaucoup moins.
Alors Baccarat se renversa à demi et prit sa pose la plus séduisante.
– Vous vous êtes dit aujourd’hui, quand on m’a montrée à vous : « Voilà une femme à la mode et dont je ferai ma maîtresse. Il m’en coûtera peut-être beaucoup d’argent, mais je suis riche… »
Le comte voulut protester ; elle lui ferma la bouche d’un geste :
– Eh bien, reprit-elle, vos amis et vous, monsieur le comte, vous vous êtes trompés. Je ne puis pas vous aimer, je puis encore moins me laisser aimer par vous. Pourquoi ? C’est mon secret.
– Mais, madame…
– Oh ! je sais ce que vous allez me dire. Un galant homme proteste toujours contre une volonté aussi nettement articulée que la mienne. Mais résignez-vous, mon cher enfant, acheva Baccarat avec un accent presque maternel, je ne puis rien pour vous…
Et, comme il pâlissait, et que son visage trahissait une vive émotion :
– Écoutez ; peut-être allez-vous être raisonnable lorsque vous saurez ce que j’attends de vous. Voulez-vous être sérieusement mon ami ?
– En doutez-vous ?
– M’obéirez-vous, s’il le faut ?
– Je vous obéirai.
– Eh bien, aux yeux du monde, de vos amis, de vos camarades, aux yeux de l’univers, je vous aimerai, et vous serez ici le maître.
Le comte eut un geste de surprise.
Baccarat sourit.
– Hélas ! dit-elle, voilà où est mon secret, ce secret impénétrable que je ne puis confier à personne. Oui, mon ami, je ne puis, je ne veux, je ne dois pas vous aimer ; je dois être désormais une honnête femme, une femme qui n’a plus d’amour que pour Dieu, qui passera ses nuits à pleurer et à prier, et qui, le jour, étalera des toilettes effrontées et un insultant sourire à tous les regards. Pourquoi ? Ne me le demandez pas ; mais croyez que si jamais je dois confier mon secret à quelqu’un, ce sera à vous plutôt qu’à tout autre.
Le comte était frappé de stupeur.
– J’ai votre parole que tout ceci restera enseveli entre nous, continua-t-elle ; par conséquent, je puis vous donner à choisir : être aux yeux du monde votre maîtresse, une créature qui tiendra de vous son luxe, sa position, le présent, l’avenir ; à la porte de qui stationnera ostensiblement votre voiture chaque soir ; de chez laquelle on vous verra sortir le matin…
Le comte croyait rêver, tant les paroles de Baccarat lui semblaient inexplicables.
– Ah ! dit-elle, cela vous semble extraordinaire, sans doute, une femme qui veut être compromise et demeurer vertueuse cependant, lorsqu’il y en a tant d’autres qui, au contraire, cachent leur conduite sous les apparences du devoir… Que voulez-vous ! c’est encore, c’est toujours mon secret.
Le comte Artoff prit la main de Baccarat.
– J’accepte, dit-il, et je vous obéirai aveuglément, car dans votre regard, dans votre voix émue, j’ai deviné une douleur immense. Madame, vous avez eu raison d’avoir confiance en moi, et votre confiance ne sera point trompée. Je ne suis encore qu’un enfant, comme vous me l’avez dit, mais je serai homme au besoin, et je saurai être digne de votre amitié. Et puis, que sais-je ? murmura-t-il tout bas en rougissant, qui sait si un jour…
Elle secoua la tête avec tristesse :
– Pauvre enfant, dit-elle, si j’ai conservé l’apparence de la jeunesse, si je suis encore belle, si j’ai conservé les dehors menteurs de la vie pleine de sève et qui croit à l’avenir, hélas ! mon cœur a cent ans, et je suis vieille, usée, presque morte, et les morts ne peuvent plus aimer. Soyez mon ami, mais ne me demandez rien de plus.
Baccarat prononça ces mots avec une dignité triste et majestueuse à laquelle on ne pouvait se tromper. Cette femme accablée du mépris public apparut au comte comme une noble victime résignée, comme un ange méconnu. Et le comte fléchit un genou devant elle, prit silencieusement sa main et la baisa avec respect.
Alors Baccarat se pencha sur ce jeune front qu’elle effleura de ses lèvres.
– Merci ! murmura-t-elle, vous êtes un vrai gentilhomme, et si j’ai eu jamais un accès d’orgueil subit, c’est en ce moment, car je sens que vous me devinez.
Le comte se releva.
– Maintenant, mon amie, dit-il, regardez-moi comme votre esclave, comme un homme qui se fera tuer sur un signe de vous, et vous obéira, quoi que vous lui puissiez ordonner.
Baccarat lui jeta son mélancolique sourire :
– Attendez-moi une minute ici, dit-elle.
Elle le laissa seul, remonta au premier étage, passa quelques secondes dans son boudoir et revint. Elle tenait un petit papier dans ses doigts.
XLIX
Baccarat présenta le papier au comte Artoff.
– Tenez, dit-elle, voilà un bon de cent mille francs sur mon banquier.
– Pour quoi faire ? demanda le comte surpris.
– Pour couvrir vos frais, répondit-elle simplement.
– Je ne comprends pas…
– C’est facile pourtant.
Le comte la regarda.
– Puisqu’il est convenu, dit-elle, que vous allez, aux yeux du monde, vous ruiner un peu pour moi.
– Mais c’est une plaisanterie ?
– Nullement. Prenez ces cent mille francs d’abord.
– Et puis ?
– Vous m’enverrez tantôt une paire de chevaux que vous achèterez en présence de vos amis. Demain, vous leur demanderez leur avis sur un bracelet, un collier, un colifichet ruineux quelconque, que je porterai triomphalement le soir… Mon Dieu ! si les cent mille francs durent deux mois, ce sera beaucoup.
– Mais, madame, s’écria le comte abasourdi, vous oubliez que je suis votre ami ?…
– Au contraire.
– Que j’ai plusieurs millions de revenus ?…
– Je le sais.
– Et que je ne puis prendre cet argent. Ne sera-ce pas une joie pour moi que ?…
Elle l’arrêta d’un geste.
– Tenez, dit-elle, vous oubliez déjà l’amitié que vous venez de m’offrir. Regardez-moi bien, cher enfant, croyez vous que je sois encore la Baccarat ?
– Oh ! non, certes…
– Alors, si je suis une autre femme, une femme méprisable pour tous et qui veut être estimée de vous, comment voulez-vous que j’accepte de vous une épingle ?
– C’est vrai, dit-il avec une franchise pleine de noblesse : pardonnez-moi…
Et il prit le bon de cent mille francs.
– Vous êtes charmant, lui dit Baccarat, et je veux être aux yeux du monde si bonne, si affectueuse avec vous, que vous serez le plus heureux des hommes, et qu’on dira que vous avez tourné la tête à Baccarat.
Ces mots rappelèrent au jeune Russe son pari d’il y avait quelques heures.
– Mon Dieu ! dit-il, j’ai un aveu à vous faire et un pardon à vous demander.
– Vous êtes pardonné d’avance.
– Tout à l’heure, à mon club, j’ai été fat, j’ai juré que vous seriez bientôt à moi…
– Eh bien, fit-elle avec un sourire résigné, vous savez que je ne vous démentirai pas…
– Oh ! ce n’est pas cela, c’est pis encore.
Le comte raconta alors à Baccarat fort succinctement, mais sans omettre aucun détail, la scène qui avait eu lieu au club entre M. Oscar de Verny, c’est-à-dire Chérubin le charmeur, et lui.
Baccarat l’écouta sans la moindre émotion ; mais soudain elle pâlit lorsqu’il eut prononcé le nom de Chérubin.
– Ciel ! fit-il, remarquant ce trouble subit, le connaissez vous donc cet homme ?
– Je ne l’ai jamais vu…
– Alors, pourquoi pâlir ?…
– Ah ! dit Baccarat d’une voix étouffée, c’est que je commence à croire que c’est la Providence qui vous a amené ici.
L’étonnement du pauvre jeune homme était à son comble.
– Tenez le pari, reprit Baccarat, tenez-le.
– Mais, s’écria le comte Artoff, si je le tiens, je le gagnerai ; car, j’en suis bien certain maintenant, madame, cet homme ne saurait, ne pourrait vous séduire.
Elle eut un sourire superbe.
– Je crois qu’il s’est vanté, dit-elle.
– Mais alors si je tiens le pari… s’il le perd… je le tuerai…
Le comte prononça ces mots avec une certaine émotion.
– Eh bien, répondit Baccarat lentement et d’une voix grave et solennelle comme celle d’un juge prononçant un arrêt de mort, qui vous dit que cet homme n’a point mérité le sort qui l’attend ?
Le comte frissonna malgré lui.
Il y avait dans l’accent, dans le geste, dans toute l’attitude de Baccarat quelque chose de mystérieusement terrible qui donnait à cette femme l’apparence d’une prophétesse inexorable comme la destinée.
* *
*
– À présent, reprit Baccarat d’un ton calme et presque léger, songez qu’il est minuit, mon jeune ami, que cette rue où nous sommes est déserte, et que vous pouvez vous en aller comme vous êtes venu. Adieu, à demain !
Elle lui tendit fraternellement la main, se laissa prendre un baiser sur le front, et reconduisit le jeune comte jusqu’à la grille du jardin, qu’elle ouvrit elle-même.
– Venez déjeuner chez moi demain matin, dit-elle, et venez avec vos chevaux et vos gens, que vous laisserez à ma porte. Adieu !
– Étrange femme, murmura le comte Artoff en s’en allant. Je suis entré chez elle comme un étourdi qui cherche une aventure, j’en sors ami dévoué et prêt à me faire tuer pour elle. L’aimerais-je ?…
Baccarat, le comte parti, remonta dans son boudoir, où la petite juive dormait toujours très profondément.
La jeune femme l’éveilla.
– Chère enfant, lui dit-elle, veux-tu aller te coucher ? es-tu fatiguée ?
– Oh ! non, madame, répondit Sarah, qui ouvrit ses grands yeux de gazelle et les attacha brillants et doux sur sa bienfaitrice ; je ne suis pas fatiguée, je n’ai plus sommeil… je ferai tout ce qui vous plaira…
Baccarat parut hésiter.
– Mon Dieu, pensa-t-elle, cette redoutable faculté, à laquelle j’ose croire à peine, est enveloppée de tant de ténèbres ; il y a tant d’obscurité et de confusion, de contradictions et de réticences dans les réponses de cette enfant, que je n’arriverai jamais, par cet unique moyen, à découvrir la vérité tout entière. L’enfant m’a bien dit déjà que sir Williams me haïssait, qu’il haïssait la marquise, Fernand, Léon, et surtout son frère Armand, mais elle n’a pu trouver le bout du fil qui me guiderait à travers le dédale de fourberies dont cet homme s’environne… Elle m’a bien dit encore qu’il y avait un homme qui tenterait de causer la perte de madame Van-Hop, et je suis parvenue à savoir que cet homme se nommait Chérubin… Mais c’est là tout ce que je sais… Et sir Williams, lui, tient tous les fils de la vaste intrigue, il marche comme au grand jour dans ce labyrinthe de ténèbres ; toutes ses victimes passées ou futures croient en lui… moi seule veille… Mon Dieu ! donnez-moi la force de déjouer ses détestables desseins !… – Il faut pourtant bien, murmura-t-elle, que j’aie le dernier mot de cette horrible énigme, que je sache quel rapport il peut y avoir entre la marquise Van-Hop, un ange, et ce Chérubin, qui est un misérable. Saint-Alphonse m’a dit ce qu’il était, et elle le connaît de longue main. M. de Cambolh s’est battu avec lui, et à la vue de M. de Cambolh la marquise a failli se trouver mal. Oh ! l’horrible mystère que tout cela !
Et Baccarat imposa ses mains sur le front de l’enfant endormie :
– Je veux que tu voies et que tu parles ! ordonna-t-elle d’une voix inspirée.
M. Oscar de Verny, c’est-à-dire Chérubin, regagna son logis de la rue de la Pépinière en quittant Rocambole sur le boulevard.
Il s’en alla à petits pas, fumant son cigare et livré à une profonde méditation. Ce qui venait de se passer au club, du reste, entre le jeune comte russe et lui, était de nature à expliquer cette rêverie.
– Il est évident, murmura-t-il en longeant la rue Saint-Lazare, que je joue gros jeu, et que si la Baccarat ne m’aime point, ce diable de Russe me tuera ; mais il est évident aussi que si on me laisse tenir le pari et que je le gagne, je vais avoir cinq cent mille francs sur la planche, moi qui ne possède plus que des dettes.
Mais cette perspective souriante fut tout à coup assombrie par une autre pensée, fantôme menaçant qui parut se dresser devant lui :
– Si le chef n’allait pas vouloir ? dit-il.
Chérubin jeta son cigare avec un mouvement de colère et étouffa un juron :
– Ma parole d’honneur, se dit-il, je suis entré bien à la légère dans cette association des Valets-de-Cœur ! Il est vrai que j’étais à bout de ressources, mais… enfin… ce n’est pas une raison, si je les sers fidèlement, pour qu’ils m’empêchent de faire mes propres affaires…
En monologuant ainsi, M. Chérubin arriva chez lui, envoya son valet de chambre se coucher, et, au lieu de l’imiter, il ouvrit la croisée de son petit salon, croisée qui donnait sur le jardin et de laquelle on apercevait, à travers les arbres, le pavillon occupé par madame Malassis. Le pavillon était plongé dans l’obscurité, et on ne voyait briller aucune clarté sur sa façade. Ou il était désert, ou ses habitants étaient couchés.
Cependant M. Chérubin demeura à sa fenêtre, en dépit du froid de la nuit, et fredonnant un air d’opéra. Il eut même le soin mystérieux de placer une lampe sur un guéridon, tout auprès de la croisée. C’était sans doute un signal, car presque aussitôt les ténèbres qui enveloppaient le jardin furent traversées par un rayon lumineux qui partit soudain du pavillon, dont une fenêtre s’ouvrit.
Chérubin descendit l’escalier à pas de loup, traversa la cour, le jardin, muet et silencieux comme un fantôme, s’arrêta un moment au pied d’un arbre, puis reprit son chemin vers la porte du pavillon.
On eût dit que Chérubin allait à un rendez-vous d’amour. Il n’en était rien, cependant : M. Chérubin allait parler d’affaires.
La porte du pavillon s’entrouvrit sans bruit, et Chérubin entra. Le vestibule était plongé dans l’obscurité, mais une main saisit celle du jeune homme et l’entraîna doucement. Cette main était douce et mignonne au contact comme une main de femme.
En même temps une voix murmurait à l’oreille de Chérubin :
– Venez… prenez l’escalier… suivez-moi.
Chérubin se laissa guider, prit l’escalier, le gravit jusqu’au premier étage, et se sentit entraîné dans un corridor au bout duquel son mystérieux conducteur poussa une porte… Cette porte, en s’ouvrant, laissa entrevoir, grâce à la lueur tremblante du feu qui achevait de se consumer, la chambre à coucher de madame Malassis. C’était la veuve elle-même qui était venue le chercher à l’entrée du pavillon. Sans doute elle tenait à ce que le plus profond mystère enveloppât son entrevue avec Chérubin, car elle referma prudemment la porte, indiqua à son nocturne visiteur un fauteuil auprès du feu, et jugea inutile d’allumer une bougie sur la cheminée, se trouvant suffisamment éclairée par les reflets du foyer.
– Mon cher monsieur de Verny, dit-elle en s’asseyant elle-même, vous avez commis une grave imprudence.
– Laquelle ?
– Vous êtes sorti trop vite.
– Pourquoi ?
– Parce que, aux yeux de la marquise, vous deviez être fort dangereusement blessé. Sa sympathie pour vous s’accroissait de tout le péril de votre situation.
– Mais, dit Chérubin, sait-elle que je suis sorti ?
– Oui.
– Comment l’a-t-elle su ?
– En venant ici.
– Elle est donc venue ?
– Dans la soirée.
– Voyons, madame, dit Chérubin, parlons clairement. À quelle heure la marquise est-elle venue ?
– À cinq heures.
– Comment a-t-elle su que j’étais sorti ?
– D’une façon bien simple. Quand elle a été là, dans ce fauteuil, j’ai envoyé ma femme de chambre savoir de vos nouvelles chez le concierge.
– Eh bien ?
– Le concierge a répondu que vous étiez sorti avec votre adversaire, M. le vicomte de Cambolh, qui venait tous les jours vous voir depuis votre duel ; que vous alliez beaucoup mieux et paraissiez fort satisfait en descendant l’escalier.
– Diable ! Et la marquise a entendu tout cela ?
– D’un bout à l’autre.
– C’est fâcheux !
– La marquise était fort pâle lorsque ma femme de chambre est entrée : elle paraissait craindre une mauvaise nouvelle ; mais lorsqu’elle a su la vérité, son visage s’est empourpré subitement et j’ai vu glisser sur ses lèvres comme un sourire plein d’ironie. Vous ne sauriez vous figurer, mon cher voisin, ce qu’on perd de terrain dans le cœur d’une femme lorsqu’on se porte bien et qu’on a la mine réjouie.
Chérubin se mordit les lèvres.
– Mais enfin, dit-il, tout cela n’est pas perdu, j’imagine ?
– Hélas ! je n’en sais rien. La marquise est un roc, mon cher voisin, elle est cuirassée de vertu, et si elle n’a point faibli il y a huit jours, il est peu probable…
– Reviendra-t-elle vous voir ?
– Dans sept ou huit jours.
– Comment ! pas avant ?
– Non.
– Mais elle venait tous les jours !
– Oui, grâce à ma feinte indisposition, en apparence ; mais, en réalité, parce qu’elle vous croyait toujours très dangereusement blessé. Aujourd’hui elle s’est trouvée si bien rassurée sur votre compte qu’elle m’a trouvée beaucoup mieux moi-même : « Ma chère amie, m’a-t-elle dit, je vous vois tout à fait rétablie. Vous me permettrez de ne revenir que dans quelques jours. J’ai un arriéré de visites énorme… Toute ma semaine est prise. » J’ai compris, vous le pensez bien, que la marquise voulait vous oublier à tout prix et qu’elle ne reviendrait pas… À présent, que voulez-vous que je fasse ?
– Je ne sais pas, répondit Chérubin. Mais je vous le dirai demain.
– Jetez-moi plutôt un mot à la petite poste. Depuis que vous êtes là je suis sur les épines.
– Pourquoi ?
– Parce que j’ai vu le duc aujourd’hui… qu’il est jaloux… et que j’ai comme un pressentiment qu’il va venir… S’il vous rencontrait, je serais perdue…
– Bien, dit Chérubin, je m’en vais. Demain, vous aurez un mot de moi.
La veuve reconduisit M. Oscar de Verny avec les mêmes précautions minutieuses, et referma soigneusement la porte du pavillon.
Chérubin rentra chez lui et se mit au lit, fort préoccupé. Il se croyait beaucoup plus avancé dans le cœur et l’esprit de madame Van-Hop. Or, il était évident que si, d’après même le dire de madame Malassis, la marquise l’aimait, il s’était fort dépoétisé dans son esprit en faisant tant de bruit pour une égratignure. En effet, Chérubin grièvement blessé, Chérubin mourant, et heureux de mourir tant l’immense amour enseveli au fond de son cœur était sans espoir, devait intéresser beaucoup plus madame Van-Hop que M. de Verny recevant un léger coup d’épée et sortant, au bout de huit jours, le sourire aux lèvres et la mine fleurie. Il comprenait qu’il avait commis une imprudence, mais il s’en consolait bien vite en pensant que M. de Cambolh était son complice. C’était le séduisant vicomte qui l’était venu chercher pour lui faire prendre l’air, et persuadé en cela que la marquise n’en saurait absolument rien. Certes, si Rocambole avait consulté sir Williams, il n’aurait point agi de la sorte ; mais le baronet n’avait point été consulté, et d’ailleurs il avait eu bien d’autres choses à faire qu’à s’occuper de M. Chérubin.
Baccarat lui faisait perdre la tête.
Préoccupé à la fois par son échec moral auprès de la marquise et son singulier pari avec le comte Artoff, M. Oscar de Verny dormit fort mal. Le matin, au petit jour, il fut éveillé par son valet de chambre, qui lui apportait le billet écrit la veille par Rocambole sous la dictée de sir Williams.
Ce billet, on s’en souvient, ordonnait au Valet-de-Cœur de tenir le pari du comte, et de se trouver au rendez-vous convenu du bois de Boulogne. La veille, Chérubin aurait accueilli avec enthousiasme l’autorisation que n’avait pu lui donner Rocambole sans consulter le chef ; mais, à cette heure, il en fut beaucoup moins ravi, et cela pour plusieurs raisons. D’abord il s’éveillait : on sait que les idées d’un homme à jeun sont plus claires et plus nettes que celles de l’homme qui a dîné d’un perdreau truffé et d’un vieux flacon de médoc ; ensuite il ne pouvait se dissimuler que le jeune Russe serait impitoyable et le tuerait comme un chien s’il gagnait son pari, c’est-à-dire si lui, Chérubin, ne parvenait point à se faire aimer de Baccarat. Or, ce qui lui arrivait avec la marquise n’était point tout à fait de nature à encourager M. Chérubin. Cependant, le souvenir de ses nombreuses conquêtes l’eut bientôt réconforté.
Il se leva, s’habilla avec le plus grand calme, fuma deux cigares au coin du feu, dépouilla sa correspondance, lut les journaux du matin, et sortit vers dix heures pour aller déjeuner au café de Paris.
– Tu m’amèneras Ébène à midi, dit-il à son groom.
Ébène était un joli cheval limousin plein de feu, que montait Chérubin depuis qu’il était entré dans l’association des Valets-de-Cœur, association dont les revenus lui permettaient de vivre fort convenablement et d’avoir groom et valet de chambre, en attendant les dividendes certains de l’affaire Van-Hop.
L
Chérubin entra au café de Paris, alors, comme on sait, le restaurant à la mode parmi les jeunes gens riches et oisifs qu’on désignait sous la qualification collective de lions. Il entra la tête haute, la démarche insolente, en homme qui sait sa valeur.
Deux jeunes gens, qui précisément se trouvaient la veille à son club au moment où le comte Artoff avait proposé son étrange pari, déjeunaient dans l’embrasure d’une croisée et le saluèrent de la main. Chérubin alla vers eux.
– Eh bien, dit l’un, la nuit porte conseil, n’est-ce pas ?
– Sans doute.
– Vous avez réfléchi…
– Plaît-il ? demanda Chérubin avec hauteur.
– Je veux parler du pari.
– Eh bien ?
– Eh bien, mais vous étiez gris hier.
– Moi ?
– C’est probable, car sans M. de Cambolh vous teniez le pari.
– Ces Suédois ont du bon et quelque sang-froid, observa le convive de l’interlocuteur de Chérubin.
– Vous êtes dans l’erreur, répondit celui-ci, Cambolh me rappelait un rendez-vous que j’avais ce matin.
– Hein ?
– Je dis, répéta froidement Chérubin qui savait au besoin mentir avec aplomb, je dis que M. de Cambolh m’a rappelé hier que je ne m’appartenais pas, et par conséquent ne pouvais, avant aujourd’hui, accepter les propositions du comte.
– Ah çà, mais vous vous êtes donc battu ce matin ?
– Peut-être…
– Avec qui ?
– Pardon, je n’affirme rien… Je dis peut-être… Or, si je ne conviens pas du fait lui-même, je puis encore moins vous dire…
– C’est juste. Mille pardons de l’indiscrétion.
Chérubin s’inclina.
– Ainsi, ce pari…
– Sera tenu.
– Bah !
– Mais, dit Chérubin avec un sourire superbe, vous me permettrez de vous faire observer que je n’ai pas l’habitude de faire blanc de mon épée.
– Comment ! vous tenez le pari ?
– Certainement.
– Et vous vous ferez aimer de la Baccarat ?
– Incontestablement, ou le comte me tuera. Seulement au lieu de demander quinze jours…
– Vous prendrez un mois ?
– Non, une semaine.
– Bravo ! s’écrièrent les deux jeunes gens avec admiration.
Chérubin les salua, alla s’asseoir à une table voisine et se fit servir à déjeuner.
Quelques minutes après, le baron de Manerve entra, et, sans voir Chérubin, il s’approcha des deux jeunes gens avec lesquels celui-ci venait d’échanger quelques mots.
– Messieurs, leur dit-il, vous étiez hier au club, je crois ?
– Parbleu !
– Alors, vous savez le pari ?
– Sans doute.
– Eh bien, conseillez à M. de Verny de ne pas le tenir.
Chérubin, à qui le baron tournait le dos, entendit ces mots et tressaillit.
– Pourquoi ? demanda-t-on.
– Parce que le comte Artoff est déjà en pied.
– Où ?
– Chez Baccarat.
– Oh ! oh ! déjà !…
– En voulez-vous la preuve ?
Et le baron tira de son carnet à cartes de visite un petit billet plié en quatre et dont le cachet armorié en cire bleue paraissait brisé tout récemment.
– Artoff devait venir déjeuner chez moi ce matin. Voyez ce qu’il m’écrit à dix heures.
Et le baron lut tout haut :
De notre hôtel de la rue de Moncey.
« Mon cher baron,
« L’homme propose, la femme dispose. Cette sentence n’a d’autre but que de vous prouver que Baccarat ne veut pas que j’aille déjeuner chez vous aujourd’hui. La belle folle a ses nerfs, dit-elle, et a besoin de grand air.
« Nous allons croquer un poulet froid et une côtelette au coin du feu, et nous sortirons en voiture tantôt.
« Pardonnez à un homme heureux.
« Comte Artoff. »
Après avoir lu, le baron tendit la lettre à ses deux interlocuteurs.
– Voyez, dit-il, le comte a écrit sur du papier jaune paille marqué d’un B.
– Le chiffre de Baccarat ?
– Précisément.
– Tiens, il y a un post-scriptum.
– Et d’une autre écriture…
– Ah ! fit le baron, c’est une ligne de Baccarat elle-même.
Et le baron lut encore :
« Merci, cher Manerve, de votre cadeau. Votre petit Russe est charmant, et je suis capable de l’aimer, d’autant mieux que je touche à la trentaine, l’âge où les femmes trouvent un cœur quelquefois.
« Baccarat. »
– Ah ! diable ! murmura l’un des jeunes gens, ces derniers mots sont plus que significatifs.
– Vous trouvez ?
– Et Chérubin aura tort de tenir le pari.
– Aussi ne le tiendra-t-il pas, dit le baron.
– Il le tiendra.
– Bah !
– Demandez-le-lui.
Et le jeune homme indiqua du doigt M. Oscar de Verny qui déjeunait fort tranquillement en écoutant cette conversation.
Le baron se retourna.
– Ah ! parbleu ! dit-il, vous étiez là, monsieur de Verny ?
– Oui, baron.
– Et… vous avez entendu ?
– J’ai entendu.
– Eh bien ?
– Eh bien, je trouve le comte un homme très heureux.
Le baron sourit.
– Mon Dieu ! fit dédaigneusement Chérubin, le comte est si riche…
– Il est fort beau…
– Bah ! il est blond, ricana Chérubin.
– Toujours est-il que vous avez bien fait de ne pas tenir le pari.
– C’est ce qui vous trompe, car je le tiens.
– Vous le tenez ?
– Plus que jamais…
– Vous êtes fou…
– C’est fort possible, mais je tiens le pari.
Chérubin jeta un louis au garçon et se leva.
Son cheval était devant la porte, aux mains de son groom.
– Baron, dit Chérubin en saluant les trois membres de son club, savez-vous où je pourrais rencontrer le comte ?
– Mais, répondit M. de Manerve en riant, chez Baccarat.
– J’irai ; ce sera une façon de présentation qui ne manquera point d’originalité. Adieu, messieurs !…
Et Chérubin sortit, sauta lestement en selle et prit au petit trot la route du Bois, où il avait rendez-vous, à Madrid, avec M. le vicomte de Cambolh.
– Voilà un homme mort, dit froidement le baron en le voyant s’éloigner.
– Bah !
– Je vous répète, messieurs, dit M. de Manerve, que Chérubin est un homme mort. Baccarat ne l’aimera point.
– Et vous croyez que, dans ce cas, le comte est homme à le tuer ?
– Je le crois.
Le baron articula ces trois mots avec conviction, et ajouta :
– D’abord, le comte est un jeune homme qui fait peu de cas de la vie humaine ; ensuite, Chérubin l’a froissé dans son orgueil… Je vous le répète, Chérubin est un homme mort.
– Eh bien, répondit l’un des jeunes gens en se versant à boire, resquiescat in pace !
– Amen ! acheva le baron.
* *
*
Peut-être, avant d’aller plus loin, est-il nécessaire de dire en peu de mots ce qu’était ce personnage de notre histoire qui était doué de ce merveilleux pouvoir de séduction, et qu’on nommait Chérubin. L’origine de cet homme était aussi étrange que sa beauté.
Trente années auparavant, une riche et belle Irlandaise, mistress Blackfield, quittait Dublin à bord d’un navire qui se rendait aux Indes. Peut-être y avait-il dans la résolution de mistress Blackfield, qui était veuve depuis un an, quelque motif secret autre que l’humeur vagabonde qui s’empare toujours d’une Anglaise excentrique à un moment donné de sa vie ; peut-être songeait-elle qu’elle avait, au mouillage de Calcutta, un beau cousin, midshipman sur un navire de S. M. britannique, lequel cousin avait vingt-six ans, avait professé un violent amour pour elle à son dernier voyage à Dublin, et deviendrait fou de joie en la voyant arriver veuve, libre et tenant à la main un portefeuille contenant un million de bank-notes et de traites sur les comptoirs de la Compagnie des Indes.
Malheureusement l’intrépide Irlandaise avait fait ses calculs de bonheur d’une façon trop exclusive ; elle n’avait pas voulu admettre les chances adverses d’une si longue course. Un gros temps assaillit le navire à la hauteur du cap de Bonne-Espérance, qu’il ne parvint à doubler qu’en perdant sa mâture et en jetant à la mer une partie de sa cargaison.
Quand le beau temps reparut, une voile se montra à l’horizon. C’était un pirate colombien qui arrivait après la tempête, en véritable oiseau de proie des mers. Le pauvre navire désemparé essaya vainement de fuir. Le pirate était fin voilier ; il aborda le navire le pistolet au poing, s’en empara, jeta l’équipage à la mer, et il allait en faire autant de mistress Blackfield, lorsqu’il s’aperçut qu’elle était jolie, et, comme il était à marier, il la prit pour femme.
Le capitaine colombien était jeune, beau, admirablement pris dans sa taille élégante et moyenne, et la romanesque mistress Blackfield, tout en se repentant amèrement d’avoir quitté sa paisible ville de Dublin, où elle aurait certainement trouvé un époux de son choix bien avant l’expiration de son deuil, la romanesque mistress Blackfield, disons-nous, s’avoua qu’elle aurait pu tomber beaucoup plus mal encore.
En effet, le Colombien était beau en dépit de son teint cuivré, de ses lèvres un peu épaisses et de ses cheveux d’un noir verdâtre, signes caractéristiques de la race indienne. En un mot, c’était un Peau-Rouge assez agréable à l’œil, et qui acheva de séduire la pauvre mistress Blackfield en lui débitant quelques compliments à peu près tournés à l’européenne.
* *
*
Dix ans s’écoulèrent pour mistress Blackfield entre le ciel et l’eau, dans la cabine de cet époux forcé, qui, du reste, était fort sérieusement épris de sa beauté éblouissante.
Un fils était né de cette union de hasard, un petit garçon presque aussi brun que son père, dont l’œil était noir, profond, et respirait un charme étrange ; dont la chevelure d’ébène descendait en boucles capricieuses et touffues sur ses épaules demi-nues.
Le pirate, ayant fait fortune, se décida, un beau jour, à aller vivre honnêtement dans sa patrie et à briguer les honneurs auxquels a droit tout bon colon bien enrichi et possesseur d’une femme blanche. Malheureusement, il était écrit que mistress Blackfield ne jouirait jamais du calme qu’elle n’avait cessé de rêver depuis son fatal départ de Dublin. Ce pirate colombien n’avait plus que quelques centaines de lieues marines à faire pour être à jamais à l’abri des représailles de ces nations d’humeur grondeuse qui courent sus aux écumeurs de mer, lorsqu’une frégate anglaise le découvrit, lui donna la chasse et le prit à l’abordage.
Tout l’équipage du pirate fut jeté par-dessus le bord, on ne fit grâce qu’à mistress Blackfield et à son enfant, qui furent ramenés en Europe.
La pauvre femme s’était prise à aimer son redoutable époux : le pirate mort, la sensible mistress Blackfield s’abandonna à un désespoir sans limites, et elle mourut le jour même où la frégate victorieuse entrait dans la Tamise.
L’enfant du Colombien et de mistress Blackfield avait dix ans alors.
C’était déjà un mousse hardi qui promettait de faire un marin. Il demeura à bord de la frégate, fit avec elle le tour du monde, et relâcha, deux ans après, précisément dans un port de Colombie.
Là, entendant parler l’espagnol corrompu qui avait été sa langue maternelle, le petit Chérubin déserta et passa à bord d’un corsaire de son pays.
De dix à vingt ans, Chérubin fut un jeune loup de mer.
À vingt ans, chose rare, la mer l’ennuya. Il se prit à rêver de l’Europe et de Paris. Il avait combattu vaillamment, il avait eu sa part des prises ; il s’embarqua pour la France avec une centaine de mille francs environ. Chérubin voulait voir du pays.
Sur le navire qui le transportait en Europe, se trouvait un vieillard, un Français, que le souvenir de sa patrie avait poursuivi pendant cinquante années d’exil, et qui, au terme de sa carrière, voulait revoir une dernière fois son berceau. M. de Verny, c’était son nom, était parti cadet de famille avant la Révolution, sans autre avoir qu’une pacotille, et il était allé chercher fortune au Brésil. La fortune lui avait souri ; il revenait riche en France, et espérait y découvrir quelque lointain héritier qui porterait son nom, car presque toute sa famille avait péri sur l’échafaud révolutionnaire.
Chérubin possédait déjà ce charme du regard, cette séduction de l’organe, ce sourire fascinateur, qui agissaient aussi bien sur les hommes que sur les femmes. Il plut à M. de Verny, et se lia avec lui pendant les trois mois que dura la traversée.
Ils vinrent ensemble à Paris ; ils descendirent dans le même hôtel.
Chérubin aida M. de Verny dans ses recherches.
Au bout de quelques mois, le vieux gentilhomme avait la preuve que toute sa famille était éteinte, et qu’il était le dernier de son nom. Il adopta Chérubin, il se fit son mentor, il redevint jeune pour lui.
Trois ans après, c’est-à-dire au moment où il atteignait sa vingt-troisième année, Chérubin se trouva seul au monde par la mort de son père adoptif, et riche de trente à quarante mille livres de rente.
À partir de ce jour, l’enfant de Colombie se fit franchement viveur et Parisien ; il dévora en peu d’années la fortune du vieux gentilhomme, vécut souvent au jour le jour, se fit joueur, duelliste, et s’acquit une véritable célébrité de charmeur, d’homme auquel on ne pouvait résister dans un certain monde.
On sait ce que sir Williams et Rocambole attendaient de lui.
Qu’on nous pardonne ces détails, qui nous paraissaient indispensables pour établir l’authenticité de ce fait, extraordinaire en apparence, que Chérubin avait accepté le pari du jeune comte Artoff.
Chérubin sauta donc en selle, en sortant du café de Paris, et gagna le bois de Boulogne.
Rocambole était déjà au rendez-vous. Le prétendu vicomte suédois était toujours d’une exactitude militaire lorsqu’il s’agissait des affaires de l’association dont il était le second chef.
Les jeunes gens, à cheval tous deux, se rencontrèrent devant Madrid, échangèrent un salut de la main, rangèrent leurs montures côte à côte, et commencèrent à faire le tour du Bois au pas, causant à demi-voix.
– Eh bien, demanda Rocambole à Chérubin, que vous a dit madame Malassis, l’avez-vous vue hier au soir ?
– Oui. La marquise est venue chez elle dans la soirée et a appris que j’étais sorti.
– Ah, diable !
– Madame Malassis prétend que cette sortie prématurée m’a fort compromis.
– Comment cela ?
– En m’ôtant à ses yeux ma physionomie intéressante et romanesque.
– C’est peut-être vrai.
– Entre nous, dit Chérubin, nous avons peut-être gauchement agi, mon cher vicomte.
– En quoi ?
– En ce que vous m’avez fait prendre, pour fléchir la marquise, une voie détournée qui ne me permet d’exercer aucune de mes facultés.
– Je ne comprends pas, dit gravement Rocambole.
– Écoutez : si on m’appelle Chérubin le Charmeur, c’est que probablement j’ai dans la voix, dans le regard, dans l’ensemble de ma personne, quelque chose de fascinateur et de magnétique. Ce quelque chose a d’abord agi sur la marquise.
– C’est vrai.
– Et agi très fortement… plus fortement peut-être que la comédie du duel. Mais en admettant la puissance de ce dernier moyen, il faut convenir que nous en attendions beaucoup mieux. La marquise, dès le lendemain matin, avait couru chez madame Malassis : en apprenant que j’étais blessé, elle s’était évanouie. Elle avait fait une demi-confidence en revenant à elle.
– Il est certain, murmura Rocambole, que je crus un moment qu’avant deux jours elle monterait chez vous pour savoir par elle-même comment vous alliez.
– Eh bien, vous vous êtes trompé comme moi, reprit Chérubin. La marquise est venue tous les jours, il est vrai, chez madame Malassis, mais elle n’a jamais prononcé mon nom ; elle a eu le calme et le sang-froid d’attendre que la veuve lui donnât de mes nouvelles.
– Mon cher, dit brusquement Rocambole, nous avons besoin, cependant, de hâter un dénouement.
– Je ne demande pas mieux.
– À dater d’aujourd’hui, nous n’avons plus que sept jours.
Chérubin tressaillit.
– Passé ce délai, tout est perdu.
– Eh bien, dit Chérubin, ménagez-moi un tête-à-tête avec la marquise.
– Vous l’aurez…
– Quand ?
– Ce soir même, chez madame Malassis.
Rocambole, en parlant ainsi, obéissait comme d’inspiration à sir Williams, lequel avait compris qu’il fallait absolument remettre en présence la marquise et Chérubin. Mais il s’en rapportait à sa propre imagination pour les moyens d’exécution.
– Dois-je écrire à madame Malassis ? demanda Chérubin.
– C’est inutile.
– Alors comment ferons-nous ?
– Ceci me regarde. Seulement, soyez chez vous ce soir, à huit heures.
– À propos, dit Chérubin, vous m’avez écrit ce matin ?
– Oui.
– Et vous m’avez dit dans votre lettre que le chef m’autorisait à tenir le pari du comte ?
– Certainement.
– Je sors du café de Paris, où j’ai déjeuné près de Manerve et de quelques autres de nos amis.
– Eh bien ?
– Eh bien, j’ai dit que je tenais.
– Ma foi ! pensa Rocambole, cela regarde sir Williams, puisqu’il croit qu’on fait très bien plusieurs choses à la fois. Mon avis à moi est que c’est une folie.
Et Rocambole répliqua tout haut :
– Je commence à croire que vous ferez bien de tenir ce pari.
Au moment où le président des Valets-de-Cœur s’exprimait ainsi, une jolie calèche bleue apparut à l’extrémité opposée de l’allée que remontaient les deux cavaliers. Cette calèche, précédée par un piqueur, attelée de quatre chevaux noirs conduits à la Daumont, descendait l’avenue au grand trot.
– Parbleu ! dit Rocambole à Chérubin, je crois que vous n’aurez pas à aller bien loin pour informer le comte Artoff que vous tenez son pari. Le voici.
– Croyez-vous ?
– Du moins ce sont bien sa livrée et ses chevaux ; à moins que la calèche ne soit vide.
Mais la calèche n’était pas vide. Un homme et une femme s’y trouvaient, se regardant et se tenant par la main. C’était Baccarat et le jeune comte.
– Voilà qui tombe à merveille, s’écria Chérubin, et je vais me présenter moi-même à madame Baccarat.
Et Chérubin mit son cheval en travers de l’avenue, faisant signe aux postillons du comte d’arrêter.
LI
Avant d’aller plus loin, retournons à l’hôtel Van-Hop.
Nous avons laissé le marquis sortant de chez sa cousine l’Indienne Daï-Natha, après la foudroyante révélation qu’elle venait de lui faire.
M. Van-Hop était hors de lui, et, pendant une heure, il erra dans les Champs-Élysées, semblable à un homme frappé de folie.
Il était nuit, l’air était froid ; il tombait une pluie fine, menue, qui se dégageait du brouillard et pénétrait jusqu’à la moelle des os. Les Champs-Élysées étaient déserts.
Le marquis se laissa tomber sur un banc, au pied d’un arbre, cacha sa tête dans ses mains et fondit en larmes. Il pleura comme une femme, comme un enfant privé de sa mère et abandonné sur la voie publique. Cet homme riche à millions, heureux naguère et dont la colossale stature semblait résumer le type de la force, s’était senti tout à coup le plus infortuné et le plus délaissé des hommes. Un seul amour avait rempli sa vie… avec cet amour tout croulait autour de lui…
Plusieurs heures s’écoulèrent.
Le marquis ne tint compte ni du temps qui passait, ni de la nuit humide et sombre, ni de la pluie glacée qui fouettait son visage baigné de larmes. La nuit tout entière se fût écoulée peut-être sans qu’il y prît garde, ni une clarté, brillant tout à coup à travers les arbres, et des pas résonnant à une faible distance, ne l’eussent enfin arraché à sa torpeur morale. Cette clarté, dont le rayonnement lointain vint frapper son visage, provenait de la lanterne d’un chiffonnier qui accomplissait sa nocturne besogne en fredonnant un refrain de barrière.
La voix du moderne philosophe était joyeuse, un peu avinée, et fit tressaillir l’infortuné marquis Van-Hop.
– Il est heureux, ce mendiant, pensa-t-il.
Le chiffonnier, guidé par le hasard, se dirigeait sur lui.
– Tiens, dit-il en apercevant enfin le marquis, voilà un bourgeois qui est comme moi, il n’a pas peur de la pluie…
Le marquis examina le chiffonnier. C’était un homme de trente-huit à quarante ans, gros et gras, et dont la physionomie ouverte et souriante décelait une insouciance parfaite. Par une de ces bizarreries inexplicables du hasard, cet homme, vêtu de haillons et exerçant son humble métier, avait une ressemblance avec ce grand seigneur millionnaire, et ce dernier en fut frappé à ce point que, au lieu de se lever et de s’éloigner brusquement, comme il en avait l’intention d’abord, il resta sur son banc.
– Mon bourgeois, dit le chiffonnier en s’approchant, pardon, excusez de l’indiscrétion, mais seriez-vous indisposé, que vous gobez ainsi la pluie ? Dans ce cas, je vous offrirais mes services, soit pour vous reconduire chez vous, soit pour aller vous chercher une voiture.
– Merci, dit le marquis, je ne suis pas indisposé, je prends l’air.
– Hum ! murmura le chiffonnier, foi de Pierre Marin, natif du Petit-Montrouge, vous êtes tout chaviré, mon bourgeois, ni plus ni moins que si vous aviez des peines de cœur.
À ces mots, le marquis tressaillit profondément.
– C’est que je connais ça, moi, poursuivit le chiffonnier, j’en ai eu pas plus tard qu’il y a huit jours.
– Ah ! dit le marquis, regardant attentivement cet homme…
– Oui, continua-t-il, on m’avait dit des bêtises touchant ma femme…
M. Van-Hop sauta sur son banc et sentit un frisson parcourir son corps des pieds à la tête…
Entendait-il réellement une voix humaine ? Un homme s’était-il trouvé dans une situation semblable à la sienne et lui racontait-il son aventure, ou bien était-il le jouet d’une hallucination ?
Mais le chiffonnier continua :
– Oui, mon bourgeois, on m’avait conté des gausses touchant ma femme, et moi qui suis bête, je les avais crues…
Le marquis s’était pris à écouter avec avidité.
– Faut vous dire, poursuivit le Diogène en s’asseyant auprès du marquis avec la familiarité des industriels de son espèce, faut vous dire, mon bourgeois, que j’ai un amour de petite femme depuis douze ans passés, jolie et sage, une perle, quoi ! Je vous demande un peu comme c’est raisonnable d’aller penser qu’au bout de douze ans, une femme cesse de vous aimer et vous fait des traits… Faut être bête, quoi !
Le marquis tressaillit de nouveau. Il lui semblait que cet homme lui racontait sa propre histoire.
– J’ai été bête, moi, poursuivit le complaisant narrateur ; à preuve que j’ai cru la grande Pauline.
– Qu’est-ce que la grande Pauline ? demanda le marquis.
M. Van-Hop était dans un tel état de prostration morale, qu’il avait fini par oublier quelle distance le séparait de son humble interlocuteur.
– La grande Pauline, répondit le chiffonnier, était une femme de rien du tout, qui demeure rue Coquenard, et à qui, paraît-il, j’avais donné dans l’œil, vu que je passe souvent par là.
– Eh bien ?
– V’là que la grande Pauline prétendit, un beau jour, que ma femme avait des intrigues, et elle me conta si bien la chose que je la crus.
– Et… ce n’était pas vrai ? interrompit le marquis, dont la voix tremblait d’émotion.
– Des inventions de pure jalousie, quoi ! répliqua le chiffonnier.
Ces paroles produisirent un singulier bien-être sur M. Van-Hop. Il se prit à respirer.
– Tout ça, observa le chiffonnier, c’étaient des blagues. Mais je n’en ai pas moins pleuré. Oh ! mais pleuré comme un vrai conscrit… J’étais chaviré comme vous, mon bourgeois, et ma pauvre petite femme, voyez-vous, c’était l’innocence même !
– Vous en avez eu la preuve ?
– Pardienne !
Le marquis ne voulut point en entendre davantage. Il se leva, jeta sa bourse au chiffonnier stupéfait et s’en alla précipitamment.
Cet homme venait d’allumer une étincelle d’espérance dans l’horrible nuit de son cœur.
Le marquis rentra chez lui à pied, tête nue. Il portait son chapeau à la main et exposait son front brûlant aux vapeurs humides du brouillard. Combien d’heures avait-il passées sur ce banc, au milieu des Champs-Élysées déserts, sous cet arbre dépouillé par les bises de décembre ? Il ne le sut qu’en franchissant la grille de son hôtel.
– Quelle heure est-il ? demanda-t-il au suisse.
– Minuit, répondit ce dernier.
Le marquis était sorti de chez lui à cinq heures, en compagnie de Rocambole. Il avait passé une heure chez Daï-Natha ; il en était donc resté cinq ou six dans les Champs-Élysées, abîmé dans sa douleur.
Dans le monde où vivait le marquis, les époux jouissent vis-à-vis l’un de l’autre d’une grande indépendance. Si monsieur n’est point rentré à l’heure du dîner, c’est que probablement il dîne à son club ; et madame se met à table. Cette inexactitude était même assez fréquente chez M. Van-Hop. La marquise s’était donc mise à table à six heures et demie, avait dîné seule, passé deux heures au coin de son feu, et, persuadée que son mari était engagé dans quelque importante partie d’échecs, elle s’était retirée chez elle vers dix heures.
Le marquis rentra chez lui comme un homme qui ne sait encore à quel parti s’arrêter. Il s’enferma dans son cabinet, et là, la tête dans ses mains, il médita longtemps.
Les révélations mystérieuses de Daï-Natha le tuaient, et lorsqu’il se souvenait des paroles accusatrices de l’Indienne, il sentait rugir au-dedans de lui-même cette fureur concentrée qui éclate d’autant plus terrible qu’elle a été couvée plus longtemps. Il était pris alors de la tentation d’entrer dans la chambre de sa femme et de la poignarder pendant son sommeil.
Mais alors aussi une voix semblait bruire à son oreille… Cette voix, c’était celle du pauvre chiffonnier, qui avait été jaloux à sa manière, et avait fini par reconnaître qu’on avait calomnié sa femme. Et le marquis s’avouait que Daï-Natha l’aimait, comme on aime sous les tropiques. Et il se disait : Elle a menti !
Mais Daï-Natha avait parlé avec conviction. Elle avait juré de fournir des preuves ; elle avait engagé au marquis le plus précieux des otages, sa propre vie, puisque le marquis seul pouvait la lui conserver.
En présence de telles assertions, le doute était-il permis ?
Mais le marquis se souvint également du serment qu’il avait fait à l’Indienne. Il lui avait juré d’attendre l’heure solennelle et de garder un visage impassible.
Au bout d’une heure d’une lutte acharnée avec lui-même, le marquis demeura victorieux. Le calme reparut sur son visage, son œil en courroux éteignit ses flammes, sa bouche crispée retrouva son sourire :
– J’attendrai, se dit-il. Si Pepa est coupable, je la tuerai. Si Daï-Natha a menti, elle mourra !
Pendant ce temps la marquise dormait. Il y avait huit jours que Chérubin s’était battu avec M. de Cambolh, et, pour faire l’histoire de ces huit jours, il nous faut revenir à ce moment dramatique et solennel où, chez madame Malassis, la marquise, revenant de son évanouissement, s’aperçut que le secret de son cœur lui était échappé, et se prit à fondre en larmes.
– Voulez-vous que je sois votre sœur ? lui avait dit madame Malassis.
Il est une touchante croyance parmi les peuples du Nord. Cette croyance, la voici :
« Chaque âme de femme a une âme, sa sœur jumelle, qui demeure au ciel lorsque celle-ci descend sur la terre et y prend un corps humain. L’âme demeurée au ciel devient un ange et prie Dieu pour sa sœur terrestre.
« Mais le jour où cette dernière prend un époux, l’âme qui restait au ciel descend à son tour sur la terre, et devient l’ange gardien de la pauvre femme qui marchera désormais sur une route semée d’obstacles, de périls et de précipices.
« Invisible, elle ne cessera de guider ses pas chancelants ; sa main puissante empêchera l’épouse de chanceler au bord du gouffre.
« À l’heure où, la tête perdue, la pauvre âme sera sur le point de succomber, l’âme sa sœur lui murmurera à l’oreille un mot de courage et d’espoir. »
Cette poétique fiction sembla prendre une apparence de réalité avec madame Van-Hop, en ce moment suprême.
Sans doute que l’âme sœur de son âme, qui veillait sur elle depuis le jour de son hymen, redoubla de courage et de vigilance à cette heure, car, si troublée, si bouleversée qu’elle fût, madame Van-Hop eut cependant la conscience exacte de sa situation.
Elle devina que si son cœur avait été faible, sa raison devait être forte, et cette énergie morale qui vient au secours des femmes dans les phases difficiles ne lui fit point défaut. Elle comprit qu’un aveu la perdrait ; elle se résolut à ne rien avouer.
Et certes, chez cette femme, qui aimait malgré elle et à laquelle on venait apprendre que l’homme vers qui son cœur se sentait entraîné était blessé, mourant, peut-être mort, le mensonge devenait sublime.
Madame Van-Hop eut le courage de mentir, de se contraindre, de donner à sa physionomie encore épouvantée une expression d’étonnement qui surprit fort madame Malassis.
– Pourquoi seriez-vous ma sœur ? lui demanda-t-elle avec un accent si merveilleux que la veuve en tressaillit.
– Mais, balbutia madame Malassis, votre trouble, votre émotion, votre évanouissement en apprenant que ce pauvre jeune homme… Il était à votre bal, vous le connaissez… J’ai cru que vous auriez foi en mon amitié. Mon Dieu ! nous avons un cœur, nous autres femmes, et il ne dépend pas toujours de nous…
La marquise arrêta madame Malassis d’un geste.
– Ma chère amie, lui dit-elle, veuillez me permettre quelques mots d’explication ; car vous vous méprenez, j’imagine.
Elle dit cela avec un calme sublime, presque avec indifférence, tant chez elle la voix du devoir parlait impérieusement.
La veuve étonnée la regarda.
– Quand vous saurez, dit la marquise, ce qui m’est arrivé hier, vous comprendrez pourquoi je me suis évanouie. C’est horrible !
Et la marquise continua :
– J’étais hier à l’Opéra. Deux jeunes gens étaient dans une loge voisine de la mienne. L’un de ces jeunes gens était M. Oscar de Verny, que le major Carden m’a présenté à mon dernier bal. L’autre m’était inconnu. Un troisième jeune homme, qui m’a également été présenté et qu’on nomme le vicomte de Cambolh a profité d’un entracte pour entrer dans la loge de M. de Verny et le provoquer. J’ai entendu la querelle, la provocation, et M. de Verny dire : « Je demeure rue de la Pépinière, 40. » Le major Carden, qui se trouvait dans ma loge, a reçu un petit billet de M. de Verny qui le priait d’être son témoin. Je suis rentrée chez moi bouleversée de toute cette scène ; j’ai eu mon sommeil plein de coups d’épée, de cris d’agonie ; j’arrive ici, et vous m’apprenez que le duel a eu lieu, que l’un des locataires de cette maison a été gravement blessé. Voyons, ma chère amie, dit la marquise d’un ton presque léger, mettez-vous à ma place… vous eussiez été bouleversée comme moi, comme moi vous n’eussiez pas dormi, comme moi encore vous vous fussiez évanouie…
Elle eut le stoïque courage de sourire.
– Et comme moi, acheva-t-elle, vous n’en eussiez pas conclu que votre cœur, votre repos, votre tranquillité, eussent été atteints dans la personne de ce jeune homme, que j’ai à peine vu, après tout, et qu’on m’a présenté un soir où j’avais cinq cents personnes…
Madame Malassis se mordit les lèvres. Le calme subit de la marquise déroutait tous ses calculs.
Madame Van-Hop se leva à ces mots, son malaise était dissipé ; elle témoigna le désir de prendre l’air et elle laissa madame Malassis assez désappointée. Mais elle revint le lendemain, puis les jours suivants, tantôt sous un prétexte et tantôt sous un autre.
Chaque fois que la pauvre femme entrait dans la rue de la Pépinière, elle se prenait à trembler. Elle s’imaginait qu’elle allait voir une porte tendue de noir. Chaque fois aussi, madame Malassis avait soin de lui donner indirectement des nouvelles de Chérubin. Alors la marquise baissait les yeux, se taisait, essayait de prendre un air indifférent et de dissimuler son trouble.
Mais un soir, vers quatre ou cinq heures, une déception terrible attendait la marquise. Elle était à peine assise auprès de la veuve, dans le salon de cette dernière, que la femme de chambre entra.
– Madame, dit-elle à madame Malassis en lui présentant une carte, on m’a remis cela pour vous.
– Ah ! fit madame Malassis, c’est la carte de ce pauvre blessé.
La marquise sentit battre son cœur.
– Comment va-t-il ? demanda la veuve.
– Oh ! madame, il va très bien…
– Comment, très bien ! Tu l’as vu ?
– Oui, madame.
– Quand ?
– Tout à l’heure.
– Où ?
– Mais, dit naïvement la femme de chambre, je viens de le rencontrer à la porte. Il sortait en fumant son cigare, et il donnait le bras à un jeune homme ; le concierge m’a dit que ce jeune homme était celui avec lequel il s’était battu. Il m’a remis sa carte, acheva la soubrette, en me priant de remercier madame de la bonté qu’elle a eue de faire prendre de ses nouvelles.
Madame Malassis se mordit les lèvres.
Quant à la marquise, elle avait senti quelque chose se briser au fond de son cœur… Évidemment Chérubin avait joué un rôle et visé à se rendre intéressant. Un homme dont un coup d’épée met sérieusement les jours en danger ne sort pas gaiement au bout de huit jours.
Peu d’heures après, madame Van-Hop rentrait chez elle, fort désillusionnée sur M. de Verny.
Le lendemain, madame Malassis l’attendit vainement. Elle ne vint pas davantage le jour suivant.
Ces deux jours, pendant lesquels la marquise n’entendit point prononcer le nom de Chérubin, lui donnèrent de la force et lui firent faire un pas vers sa guérison morale. Elle se crut sauvée. Mais elle avait compté sans l’infernal génie de sir Williams. Sir Williams ne lâchait point ainsi sa proie.
Le troisième jour, c’est-à-dire le lendemain de celui où nous avons vu le marquis Van-Hop rentrer chez lui un peu réconforté par les paroles du chiffonnier, après avoir passé avec son mari plusieurs heures en tête à tête pendant lesquelles le marquis s’était persuadé qu’il avait été, la veille, le jouet d’un horrible cauchemar, tant il trouvait sa femme affectueuse ; vers quatre ou cinq heures, la marquise reçut un billet signé Venture et ainsi conçu :
« Madame la marquise,
« Pardonnez-nous d’oser vous écrire ; mais nous ne savons que devenir, Fanny et moi. Notre chère maîtresse madame Malassis est en danger de mort depuis une heure, et elle prononce à chaque instant votre nom.
« J’ai l’honneur d’être, madame la marquise,
« Votre très humble et très obéissant
« Venture,
« Intendant de madame Malassis. »