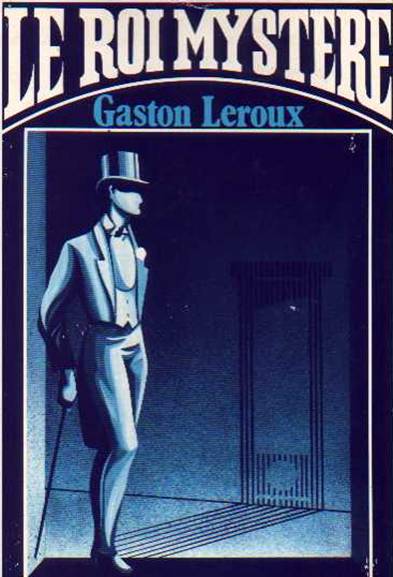
Gaston Leroux
LE ROI MYSTÈRE
Le Matin 24 octobre 1908 au 9 février 1909
Table des matières
PREMIÈRE PARTIE LA PUISSANCE DES TÉNÈBRES
I QUELQUE CHOSE BRILLE DANS LA NUIT
II DEUX GENTILSHOMMES SOUPAIENT
IV OÙ M. LE PROCUREUR IMPÉRIAL COMMENCE À CROIRE À L’EXISTENCE DU ROI MYSTÈRE
VI SUITE DE L’HISTOIRE DE M. PROSPER ET DE M. DENIS
VII UN HOMME QUI ATTEND QU’ON LE TUE
X « TU TE RÉVEILLERAS D’ENTRE LES MORTS »
XI OÙ LE PÈRE SAINT-FRANÇOIS A QUELQUE CHOSE À DIRE AU BOURREAU
XII « MONSIEUR ! JE NE VOUS CONNAIS PAS ! »
DEUXIÈME PARTIE LA PETITE MAISON DE LA RUE DES SAULES
II OÙ APRÈS AVOIR FAIT LE JEU DE TOUT LE MONDE, DIXMER COMMENCE À JOUER LE SIEN
VII OÙ DIXMER COMMENCE À REGRETTER D’AVOIR MONTRÉ SON JEU
VIII LA GRANDE HOSTELLERIE DE LA MAPPEMONDE
X « TU ES LA MARGUERITE DES MARGUERITES ! TU ES LA PERLE DES VALOIS ! »
XI LA PETITE MAISON DE LA RUE DES SAULES
XIV OÙ IL EST PROUVÉ QUE PHILIBERT WAT A BON CŒUR
XVII DE DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS QUI SE PASSÈRENT CE SOIR-LÀ DANS L’ATELIER DE ROBERT PASCAL
XVIII LE SIFFLET DU PROFESSEUR
TROISIÈME PARTIE « TU TE RÉVEILLERAS D’ENTRE LES MORTS »
I UNE FÊTE CHEZ LE COMTE DE TERAMO-GIRGENTI
III IL FAUT RENDRE LES ENFANTS À LEUR PÈRE
IV OÙ IL EST QUESTION DES SUITES D’UN DÉJEUNER DE GARÇON
V SUITE DES SUITES D’UN DÉJEUNER DE GARÇON
VI DANS LEQUEL LE PROFESSEUR S’APERÇOIT QU’ON LUI A COUPÉ LE SIFFLET
VIII LE DÉSESPOIR DU PROFESSEUR
X UNE CONSPIRATION À CENT CINQUANTE MÈTRES SOUS TERRE
XI OÙ NOUS APPRENONS QUE Mlle DESJARDIES N’EST PAS ENCORE AU BOUT DE SES PEINES
XIII M. EUSTACHE GRIMM EST INVITÉ À DÉJEUNER EN VILLE
XV PLAISIR D’AMOUR NE DURE QU’UN INSTANT
XVI TU TE RÉVEILLERAS D’ENTRE LES MORTS
XVII À LA FIN DUQUEL M. MACALLAN SE DÉCLARE DÉGOÛTÉ DE LA VIE ET LE PROUVE
À propos de cette édition électronique
PRÉFACE
UN « FILET » ÉTRANGE QUI DONNE À L’AUTEUR L’OCCASION D’UNE PRÉFACE
Dans la préface qu’il a écrite sur le frontispice de la plus belle histoire du monde, l’auteur des Trois Mousquetaires, notre père à tous, nous raconte comment, compulsant de vieux ouvrages à la Bibliothèque Royale, il tomba sur ces noms singuliers : Athos, Porthos et Aramis, combien son esprit en fut frappé, et de quelle façon il rechercha à qui ils avaient pu appartenir, et comment, l’ayant su, il fut conduit à publier les plus merveilleuses aventures qui soient. Les temps héroïques sont passés, il ne reste plus rien à découvrir dans les bibliothèques et il n’y a plus d’Alexandre Dumas. La seule ressource qui nous reste est le reportage qui ne compulse pas les livres, mais qui est une façon de compulser la vie, la vie contemporaine. Cette occupation – le reportage – me conduisit, moi aussi, à une curieuse découverte, point de départ de recherches qui, pour ne s’être point passées dans les livres, n’en furent pas moins intéressantes. Un jour que, désireux de remonter à l’origine de cette grave affaire politique et judiciaire, toujours restée un peu obscure, qui, dans les dernières années du Second Empire, occupa un moment l’opinion sous ce titre : « Le scandale des chemins de fer ottomans », je feuilletais la collection des plus vieux numéros du journal L’Époque, mon attention fut retenue par un « filet » au-dessus duquel se détachaient, en grosses majuscules, ces deux lettres R. C., suivies d’un énorme point d’interrogation.
Voici, textuellement, ce que je lus : « Si nous étions moins occupés du drame qui se joue en ce moment devant le Corps Législatif, l’opinion publique daignerait peut-être s’étonner du fait unique qui s’est passé ce matin, place de la Roquette. On n’a pas oublié que Desjardies attend à la Grande-Roquette le couteau de M. de Paris. Eh bien ! Nous pouvons affirmer que, la nuit dernière, le couteau est venu. La presse, chose curieuse et sans précédent, n’avait pas été prévenue ; cependant, on procédait au montage de la guillotine vers quatre heures et demie du matin. Dès les premiers rayons de l’aube, le bourreau et ses aides démontaient la sanglante machine sans avoir exécuté personne. Les ordres relatifs à l’exécution avaient-ils été mal donnés ou mal compris ? L’empereur, après avoir rejeté la grâce de Desjardies, l’aurait-il accordée tout à coup et se serait-il, contrairement à tous les usages, entremis pour arrêter le cours suprême de la justice ? Il ne faut pas oublier que Desjardies est la première victime du scandale des chemins de fer ottomans, et, malgré son abominable assassinat, n’est peut-être point le plus coupable. Il y en a d’autres qui ont tué ; cela ne fait point de doute… d’autres que la justice impériale ne découvrira jamais… et qui garderont leur tête sur leurs épaules. En haut lieu, aurait-on eu quelque tardif remords au moment de sacrifier l’une des personnalités en somme les moins compromises dans ce prodigieux tripotage financier ?
» En somme, on ne sait que penser, ni même qu’inventer devant ce fait indéniable : le bourreau qui vient et qui s’en retourne comme il est venu, les mains dans les poches et le panier vide ! Le moins bizarre de l’histoire n’est point la découverte que l’on a faite de deux lettres cabalistiques peintes en rouge sur la grande porte de la prison : R. C. Que signifient ces initiales ? Qui nous le dira ?
» Personne ! Car personne n’a le temps de s’occuper d’autre chose que de la tragi-comédie que l’on est en train de nous monter dans les coulisses du Palais-Bourbon ! »
Très intéressé par ces lignes étranges, je me mis à rechercher dans les autres journaux, à la même date, une trace quelconque d’un événement aussi extraordinaire. Je ne trouvai rien ; mais, à la date du lendemain, je découvris une note de l’agence officielle reproduite par toute la presse : « L’Époque a publié hier un filet relatif à l’exécution de Desjardies. Nous sommes autorisés à lui donner le plus formel démenti. L’exécuteur des hautes œuvres n’a pas eu à se déranger et les bois de justice n’ont pas bougé du hangar où ils sont remisés. On pourrait trouver l’origine d’une aussi invraisemblable histoire dans l’erreur commise par un officier de la préfecture de police qui, ayant compris que l’exécution devait avoir lieu cette nuit-là, a mis inutilement en branle tout le service d’ordre. »
Le même jour, L’Époque faisait amende honorable : « Nous avons été trompés hier par un de nos jeunes rédacteurs dont nous nous sommes, du reste, immédiatement séparés. Un haut fonctionnaire de la préfecture est venu nous donner toutes les explications désirables relatives à l’erreur qui a mis en mouvement tout le service d’ordre ordinaire des exécutions. »
Il arriva que la note de l’agence officielle et la rectification de l’Époque ne parvinrent point à me convaincre. Je leur trouvais une allure louche, inquiétante.
Pour qui connaît un peu les mœurs combatives de la presse, il était permis de s’étonner de la facilité avec laquelle l’Époque endossait le démenti officiel, sans prendre à partie la préfecture de police, qui, cependant, avec son malheureux service d’ordre commandé à tort, était gravement coupable.
Enfin, la parfaite sérénité avec laquelle la presse tout entière enregistrait l’erreur de la préfecture, dans une circonstance pareille, me troubla à un point que je ne saurais dire. Et les deux lettres rouges trouvées sur la porte de la prison : R. C. ? Personne n’en parlait. Personne ne les expliquait. Personne ne les démentait. Pouvait-on croire qu’elles fussent l’œuvre d’un mauvais plaisant ? Je ne le pensais point. Une mauvaise plaisanterie a toujours l’air de vouloir dire quelque chose ; mais que voulait dire : R. C. sur la porte de la prison des condamnés à mort ?
Je flairai là un rare mystère et n’eus de cesse que je n’eusse retrouvé le « jeune rédacteur » si délibérément mis à la porte de l’Époque, ainsi que l’officier de la préfecture qui, prétendait-on, s’était si grossièrement trompé.
Ils vivent encore l’un et l’autre et tous deux furent le point de départ d’une enquête qui dura plusieurs années et au bout de laquelle je vous apporte ce roman, dont on ne pourra justement apprécier les péripéties les plus inquiétantes qu’en se rappelant que certaines figures qui le traversent ne sont point tout à fait inconnues des lecteurs et que certains événements qui s’y mêlent ont déjà eu du retentissement dans le monde.
La réalité s’est montrée, surtout depuis un demi-siècle, si prodigieusement jalouse de la chimère qu’il n’y a plus rien à inventer ici-bas, même pour un romancier.
PREMIÈRE PARTIE – LA PUISSANCE DES TÉNÈBRES
I – QUELQUE CHOSE BRILLE DANS LA NUIT
Est-il rien de plus morne, de plus angoissant, de plus triste, de plus désespéré que ce coin de Paris qui entoure la place de la Roquette ? C’est en vain que sur l’emplacement de la vieille prison, récemment démolie, on s’est empressé d’élever de vastes maisons de rapport, l’aspect général reste lugubre, grâce à cette autre prison de l’autre côté de la place, où l’on a enfermé l’enfance : Prison des jeunes détenus !
À l’époque qui nous occupe, la Grande-Roquette élevait depuis de nombreuses années déjà ses murs nus en face de la Petite. Quand, parfois, la porte de la Petite s’entrouvrait pour laisser sortir quelque adolescent, tout pâle encore d’avoir enseveli là quelques mois précieux de sa jeunesse, la première chose qu’il voyait était la porte de la Grande, sinistre comme si on l’eût dressée sur le seuil de son propre avenir.
L’une et l’autre n’étaient séparées que par quelques pierres, piédestal de l’échafaud. Si le jeune homme détournait les yeux de ce sombre spectacle et si son regard montait vers la gauche, il apercevait une autre porte, la porte d’un cimetière : le Père-Lachaise. Alors il fuyait à droite et descendait hâtivement vers la vie, vers la liberté, vers Paris, par cette partie de la rue de la Roquette qui rejoint la place Voltaire, que l’on appelait alors la place du Prince-Eugène.
C’est précisément à cet endroit que nous allons transporter le lecteur, par une nuit de décembre 186…, exactement le 13 à quatre heures du matin.
Cette voie, si lugubre le jour avec ses maisons basses badigeonnées de rouge sang de bœuf ou de jaune sale, de couleurs ternes et passées, ses boutiques noires où l’enseigne indique en lettres blanches la marchandise mortuaire : « Fleurs et couronnes, perles, fournitures en tous genres », ses « chands de vin » où, sur le zinc, une clientèle débraillée, fournie par le vagabondage spécial, s’empoisonne de compagnie avec des filles en cheveux, cette voie devenait quelquefois gaie la nuit.
C’est qu’alors une populace, venue de tous les bas-fonds de la capitale, remontait vers la place de la Roquette, dans l’espoir d’assister au spectacle toujours alléchant d’une tête qui tombe.
Quelques minutes après quatre heures, alors que tout semblait reposer dans le quartier, de nombreux agents survinrent soudain, dans le plus profond silence. Les chefs s’entretenaient entre eux, et les ordres étaient donnés à voix basse. Presque aussitôt la troupe arriva ; elle n’avait jamais été aussi nombreuse.
L’occupation de la place de la Roquette par la troupe se fit avec le même mystère. De forts pelotons de fantassins, placés au travers de la rue de la Roquette, en haut, du côté du Père-Lachaise, en bas, du côté de la place du Prince-Eugène, ainsi qu’au coin de la prison, de la rue Gerbier, de la rue Merlin et de la rue de la Folie-Regnault, isolaient entièrement le quadrilatère au centre duquel la société se disposait à tuer un homme.
Jamais on n’avait vu un pareil service d’ordre. Une fenêtre, au coin de la rue de la Folie-Regnault et de la rue de la Roquette, à côté d’un établissement de vins dénommé « À la Renaissance du bon coin », s’étant ouverte, un homme, dont il était impossible de voir la figure, non point seulement à cause de l’obscurité, mais encore par suite de la façon dont il tenait les larges bords de son chapeau de feutre noir rabattus sur les yeux, se détacha d’un petit groupe d’officiers, alla sous la fenêtre, dit quelques mots d’une voix sourde et la fenêtre se referma. Cet homme, habillé d’une lourde pèlerine dont le col était relevé haut sur les oreilles, revint au groupe d’officiers et, entraînant l’un d’eux, lui dit :
– Faites mettre la baïonnette au canon, vous devez vous attendre à tout… Dans tous les cas, vous serez averti ; j’ai des agents placés en sentinelles partout… J’en ai plein le Père-Lachaise…
Puis l’homme s’en fut vers les gendarmes à cheval, dont la petite troupe débouchait mystérieusement sur la place par le coin de la rue de la Vacquerie et de la Grande-Roquette, du côté du chemin de ronde, où furent fusillés depuis les otages de la Commune. Il parlementa avec l’officier qui commandait le détachement. Les gendarmes vinrent tout de suite se grouper devant la porte de la prison. L’homme redescendit alors du côté de la place du Prince-Eugène.
Toutefois, la rue de la Roquette restait déserte, uniquement occupée par les agents et les soldats. Mais voilà que, vers cinq heures, plusieurs voitures arrivèrent coup sur coup, et une demi-douzaine de personnages, hommes enveloppés de lourdes pelisses, femmes emmitouflées d’épaisses fourrures, en descendirent.
Ils se dirigeaient, après avoir parlementé quelques secondes avec les agents, vers une porte basse qui s’ouvrait dans la façade lézardée d’une des plus vieilles maisons de la rue. Ils frappaient d’une certaine manière à la porte, qui s’ouvrait et se refermait aussitôt.
Non loin de cette porte, placée pour ne pas être vue et pour tout voir, l’ombre à la pèlerine considérait attentivement les allées et venues des nouveaux arrivants.
Elle était là, immobile depuis plus d’une demi-heure, quand elle s’avança tout à coup vers un homme, une silhouette grande et forte qui descendait d’un fiacre. L’ombre toucha les bords de son chapeau et dit :
– Laissez-moi entrer avec vous, monsieur… Ce sera plus prudent.
– Non, Dixmer… Il vaut mieux que vous restiez dehors… Mais si dans une heure je ne suis pas sorti, envahissez la bicoque.
Et l’homme qui venait de descendre de voiture frappa à la porte deux coups d’abord, trois coups ensuite.
Quand la porte se fut refermée sur lui, il se trouva dans une obscurité profonde. Une voix lui demanda :
– Que voulez-vous ?
– R. C.
Quant à l’ombre qui était restée dehors, elle remonta vers la place de la Roquette. Une petite lueur falote attira son attention du côté de la Grande-Roquette. C’était le couteau du bourreau qui brillait déjà, en haut de son châssis.
II – DEUX GENTILSHOMMES SOUPAIENT
Sur la place, la besogne de M. de Paris et de ses aides avait été faite comme toujours, consciencieusement, méticuleusement, sans hâte. Du reste, l’instrument de justice demande à être traité avec tranquillité, monté, agencé par des mains habiles et sans fièvre, tel un instrument d’horlogerie. Le temps n’est plus où l’on tuait légalement les gens « à la va comme je te pousse ». Le bourreau moderne n’est pas seulement un horloger, c’est encore un architecte. Il a son niveau d’eau et son fil à plomb.
Il est environ cinq heures et demie quand nous retrouvons l’homme à la pèlerine, sans doute un officier de police divisionnaire, qui semblait prendre toutes dispositions dans la crainte d’un événement redoutable, quand nous le retrouvons au coin de la rue de la Roquette, non loin de l’établissement de vins déjà signalé : À la Renaissance du bon coin.
On se rappelle que près de là une fenêtre s’était ouverte, puis refermée sur les injonctions du représentant de la police. Celui-ci est de nouveau sous cette fenêtre qui s’est rouverte. Une silhouette d’homme est apparue là-haut, s’est penchée, a semblé examiner ce qui se passait dans la rue, a fait un signe à la pèlerine, arrêtée sur le trottoir. Puis plus rien à la fenêtre ; mais en bas, une porte s’ouvre que quelqu’un referme soigneusement, quelqu’un qui porte un paquet sous le bras. L’officier de police n’a pas bougé, mais il demande sans tourner la tête :
– C’est toi, Cassecou ?
L’autre, toujours penché sur sa serrure :
– Dixmer ?
– Ne prononce pas mon nom, répond Dixmer, toujours dans la même position. Tu sais où ça va se passer ?
– Au Lapin qui fume.
– Tout est paré ?
– Tout !…
Et l’homme frappa sur son paquet.
– Qui est-ce qui marche ?
– Le Vautour lui-même.
– Parfait. Tu diras au Vautour que tout est prêt pour agir du côté de la rue de la Vacquerie, si c’est nécessaire. J’ai là les cent de Montrouge dans un chantier de bois. Il doit comprendre combien il serait préférable, surtout pour moi qui dirige le service d’ordre, que tout se passe en silence !
– Oh ! le Vautour y compte bien.
– Adieu !
Laissons Dixmer vaquer « consciencieusement » à sa besogne de haute police pour revenir à Cassecou. Celui-ci, son paquet sous le bras, s’était enfoncé dans la nuit de la rue de la Folie-Regnault ; il n’avait pas marché cinq minutes qu’une ombre se détacha d’une encoignure sur le trottoir d’en face, elle s’avança sur Cassecou. Quand elle fut à portée de la vue, elle dit :
– R. C.
Cassecou répondit :
– Panthéon.
L’ombre rejoignit Cassecou qui demanda :
– Tu les as vus passer ?
– Oui, à l’instant… Ils ont dû faire un grand détour, prendre par derrière la Petite-Roquette et revenir sur leurs pas ; ils ont dépassé le Lapin qui fume et remonté le passage de la Folie-Regnault. Ils sont entrés au Lapin qui fume par derrière.
– Le Vautour ?
– Je l’ai vu passer ; il est entré directement, lui, par la rue, avec Patte d’oie.
– Qui y est encore entré ?
– Une douzaine qui doivent être de la « combinaise », mais je ne les ai pas reconnus… peut-être des « titis », peut-être des « lions », pour sûr pas des « chasseurs noirs », je les connais tous, et ils étaient obligés de passer sous la lueur du réverbère.
– C’est bien, retourne à ta place. Si les flics arrivent, t’émeus pas, mais siffle dès que t’en verras. C’est tout, merci.
L’ombre retourna à son poste et Cassecou continua son chemin sur le trottoir. Il n’avait pas fait vingt-cinq mètres qu’il s’arrêtait devant la porte aux vitres illuminées du cabaret du Lapin qui fume. Un lapin rouge, confortablement assis sur ses pattes de derrière et goûtant les délices d’une longue pipe, avait été découpé dans un morceau de zinc qui se balançait sous l’action du vent. La bise était âpre, le froid dur, dans cette nuit de décembre, un de ces froids « noirs » qui précèdent souvent la tombée des neiges. Cassecou entra, nonchalant, la cigarette baveuse aux lèvres, sans curiosité, traînant ses grandes jambes désarticulées jusqu’au comptoir de zinc, ne regardant personne, semblant ne s’intéresser en aucune façon à l’étrange clientèle qui emplissait cette première salle dans laquelle nous aurons l’occasion de revenir. Dans le moment, nous suivrons le coup d’œil lancé par Cassecou à la porte vitrée qui faisait communiquer la salle commune avec une autre petite pièce dans laquelle nous allons entrer.
Là, deux gentilshommes soupaient… En vérité, rien dans leurs manières ne révélait qu’ils dussent descendre d’une haute race, mais la correction de leur tenue, le soin qu’ils avaient pris pour venir souper au Lapin qui fume, d’endosser un vêtement d’une élégance aussi sévère que celle du complet redingote, attestaient hautement qu’ils appartenaient à une classe de la société supérieure à la moyenne.
L’un d’eux était long et maigre, cependant que l’autre paraissait singulièrement trapu. Le maigre avait noué sa serviette blanche sur sa redingote noire, car c’était un homme d’ordre et qui n’aimait point les taches. Il avait conservé son chapeau haute-forme sur sa tête. Il trempa son pain dans la sauce et dit au trapu :
– Faites excuse, monsieur Prosper, mais je croyais qu’il se faisait plus que vous me dites : dans les douze mille au moins, mal an, bon an.
– Oh ! Je ne dis pas !… Dans les bonnes années… mais il n’y a plus de bonnes années… Certainement, autrefois, quand on voyageait, avec ses frais il pouvait même aller jusqu’à dix-huit mille, mais on ne voyage plus guère… Songez qu’il n’y a que six mille de fixe ; le gouvernement n’est pas juste, monsieur Denis, car enfin il faut qu’il représente… Non, non, croyez-moi, le métier est fichu et vous entrez un peu tard dans la carrière… C’est comme nous, qu’est-ce que vous voulez que nous fassions avec nos dix-huit cents francs ? On est obligé de se nourrir, de se loger, de se vêtir… On doit être toujours habillé propre ; du drap noir, ça coûte, sans compter le chapeau haute-forme… Encore un peu de lapin, monsieur Denis ?
– Merci, monsieur Prosper, il est excellent.
– Oh ! c’est une bonne maison. Quand la besogne d’ajustage est terminée, en attendant le jour, c’est toujours ici que je venais souper avec ce pauvre Marquis… On est bien tranquille…
– De quoi donc est-il mort, ce pauvre Marquis ?
– Il s’en est allé de la poitrine. La « dernière » qu’il a faite, il toussait, il toussait ! C’en était impressionnant ; le condamné lui-même, vous savez, pendant que nous lui faisions la toilette, en était tout gêné. Ah ! À propos du condamné, monsieur Denis, n’hésitez pas à le jeter sur la bascule… Quand je vous dirai ; hop ! soulevez-le un peu, et, d’un coup, glissez-le, du même mouvement que moi, jusqu’à la lunette ; moi, je lui tire aussitôt la tête par les cheveux, comme ça… parce qu’ils reculent toujours la tête et quelquefois on peut couper le menton… Pour rabaisser la lunette, ne vous en occupez pas, c’est l’affaire du patron. Il n’a que ça à faire et à appuyer sur le bouton, ça n’est pas sorcier !… Tout le mal est pour nous, comme de juste, et on n’en est pas récompensé… Au fond, on est mal vu… les gens ne vous disent rien… mais on est mal vu…
Ainsi devisant, les deux soupeurs continuaient de savourer le reste du lapin fumant. Ils ne se pressaient point, estimant qu’ils avaient encore vingt bonnes minutes à eux, avant de se lever de table. À cette époque de l’année, le jour se lève très tard et chacun sait que l’exécution légale doit être faite aux premiers rayons de l’aurore.
À un moment, M. Denis, qui songeait malgré lui à son client, demanda :
– Au fond, qu’est-ce qu’il a fait, celui-là ? Je ne me rappelle pas bien son histoire…
M. Prosper répondit :
– Oh ! moi, je ne m’en occupe jamais ! Ça n’a pas d’intérêt pour nous…
– Tout de même, répliqua M. Denis… Tout de même, ça doit être bien « encourageant » quand on sait qu’il est bien coupable.
– Peuh ! C’est l’affaire des jurés… Ce qu’il a fait, ce Desjardies ? Eh bien, mais c’est lui qui a assassiné Lamblin. Vous savez, l’employé du parquet… Ça a fait assez de bruit dans le moment, et puis on s’est occupé d’autre chose… Dites donc, monsieur Denis, vous ne trouvez pas que le garçon nous oublie…
– Mais oui ! Je mangerais bien un morceau de fromage… Ah ! Le voilà !
Le garçon entrait, en effet, empressé, apportant du fromage, des assiettes, remportant la casserole, desservant le couvert… M. Prosper et M. Denis le regardaient curieusement.
– C’est drôle, dit M. Prosper quand il fut parti… Il me semble que tout à l’heure il n’avait pas cette tête-là…
– Il me semble aussi, fit M. Denis. Un silence, et puis M. Prosper :
– On raconte tout de même que ç’a a été un homme très bien, très comme il faut, ce Desjardies. Tant mieux !… Vous savez, il y en a qui ont le cou si sale que ça dégoûte au moment de la toilette… Je crois me rappeler aussi qu’on racontait dans les journaux qu’il avait une fille, une fille très belle qui a voulu se faire entendre en cour d’assises, mais qu’on a mise à la porte, et puis qui a voulu se jeter aux pieds de l’empereur. Elle a tout juste vu le concierge des Tuileries, naturellement… Oui, un tas de chichis, quoi !…
– Qu’est-ce qu’elle voulait ? demande M. Denis.
– Elle prétendait que son père était innocent, naturellement… Mais il a été pris en flagrant délit par le procureur impérial lui-même et le chef du cabinet à la guerre, Régine. Alors…
Alors… la porte qui donnait sur la grande salle du cabaret s’ouvrit et, à leur complet étonnement, M. Prosper et M. Denis virent entrer, en place du garçon, un ouvrier terrassier, qui alla s’asseoir sans dire un mot à côté de la table qu’occupaient les deux hommes en noir.
– Tiens ! fit tout bas M. Prosper, gêné, je m’étonne… le patron m’avait pourtant bien promis que nous serions seuls…
Mais M. Prosper se tut, car son étonnement grandissait : un autre ouvrier entrait et s’asseyait à une table… Il y en avait maintenant à toutes les tables. Le dernier ouvrier entré avait fermé la porte, et tous continuaient à observer le plus impressionnant silence.
III – R. C. ?
Nous avons laissé l’inconnu à qui Dixmer s’était si respectueusement adressé pour lui offrir son concours, derrière la porte d’une vieille maison de la rue de la Roquette. Il n’avait pas plus tôt prononcé ces lettres magiques : R. C. que la lueur subite d’une lanterne sourde perça les ténèbres et éclaira un corridor étroit et bas, aux murs infâmes, aboutissant à un escalier qui descendait. Quand il vit qu’il lui faudrait se glisser dans ce trou, l’homme hésita et mit sa main à sa poche pour y tâter son revolver.
L’individu qui tenait la lanterne devina le mouvement et dit :
– Oh ! monsieur, vous pouvez être tranquille… vous ne courez aucun danger !
Et il descendit le premier ; l’autre suivit. L’escalier était rapide mais court. Ils furent tout de suite sur le sol d’une cave. L’homme à la lanterne, précédant toujours son visiteur, lui fit traverser plusieurs caveaux dont les portes se refermaient automatiquement et silencieusement derrière eux. Ils remontèrent une trentaine de marches ; une porte s’ouvrit. Le mystérieux visiteur se trouva soudain dans une salle étincelante de lumière. Des rires, des cris joyeux accueillirent son arrivée.
– Ce cher procureur ! C’est lui qui nous a fait cette bonne surprise !…
Il regarda ces visages riants, ces femmes couvertes de bijoux, ces hommes en frac qui étaient de ses amis, cette table somptueusement servie, ce salon si clair, si pimpant dans son style Pompadour, tout ce luxe, là où il eût été normal de trouver un bouge, et laissa tomber ces mots :
– Toute la surprise est pour moi.
Puis, sans se préoccuper des convives, il se précipita à une fenêtre, souleva un rideau : la place de la Roquette, lugubrement éclairée de quelques rares réverbères à la flamme vacillante, s’étendait sous ses yeux. Devant la porte de la prison, au centre d’un double cercle formé, le premier par les soldats de la ligne, le second par des gendarmes à cheval, la guillotine dressait ses deux bras sombres. Le procureur impérial laissa tomber le rideau.
Un valet de pied, de la tenue la plus correcte, était derrière lui, le débarrassant de sa pelisse et de son chapeau. Pendant qu’il retirait ses gants, le haut magistrat sourit froidement aux cinq personnes qui se trouvaient en face de lui et dit :
– J’aurais dû m’en douter… c’est une farce… mais elle n’est pas drôle…
L’homme qui parlait ainsi pouvait avoir une cinquantaine d’années. Il était grand, bien découplé, avec les épaules un peu fortes. Tout en lui, du reste, manifestait la force. La tête était puissante avec un port mauvais, un front terrible, magasin d’énergie et de volonté qui semblait prêt à crever ; les cheveux grisonnants en brosse, drus et droits, ajoutaient encore par leur coupe en carré, à l’aspect opiniâtre de cette tête trop énorme, même pour le grand corps qui la portait. Les sourcils étaient touffus, se terminant à la naissance du nez par deux mèches poivre et sel ; ce nez était long, un peu épais du bout. La lèvre supérieure se cachait sous une forte moustache qui avait conservé presque intacte sa couleur châtain foncé ; les pointes en étaient retombantes, à la Vercingétorix, dissimulant le pli inquiétant de la commissure des lèvres, mais la lèvre inférieure, elle, extraordinairement charnue et dépassant la lèvre supérieure, révélait tout, des appétits de tout, formidables. Le menton ras était en harmonie avec le front ; mâchoire de fauve capable de broyer dans la mesure que le front était capable de penser, là-haut. Cette tête n’eût réussi qu’à faire peur si elle n’avait pas eu les plus beaux yeux bleus du monde, de grands yeux clairs d’enfant, qui regardaient bien en face avec sérénité.
Dans l’instant, ils accusaient les personnages présents de s’être rendus coupables, comme on dit au Palais, d’une sinistre plaisanterie, consistant à faire souper le deuxième magistrat de l’empire devant l’échafaud, en aimable compagnie. Celle-ci se composait de trois hommes et de deux femmes. Les trois hommes étaient M. Philibert Wat, banquier et député, et certainement le député le plus influent du régime. Il avait épousé la fille aînée du président du conseil et s’était fait au Corps législatif et dans les ministères une clientèle redoutable. À côté de Philibert Wat se tenaient le portraitiste Raoul Gosselin, une belle figure d’artiste chic, à la mode, monocle dans l’œil, et cependant simple et sympathique, et le directeur gérant de l’Assistance publique, Eustache Grimm, gros homme pacifique et quiet, personnage considérable qui avait la haute main sur tout ce qui touchait en France, publiquement, à la charité et la pitié. Des deux femmes, l’une était grande, belle, blond cendré, de regard enjoué, mais d’allure et de geste tragiques, la comédienne, à cette heure, la plus aimée de la capitale, celle qui venait de triompher dans les Martyrs, à la Porte-Saint-Martin : Marcelle Férand. Tout Paris la savait la grande et fidèle amie de Raoul Gosselin. L’autre femme, créature assez étrange, s’était échappée d’un harem de Tunis et s’appelait « La Mouna ».
Le procureur, Jacques Sinnamari, les écoutait protester contre ses dernières paroles. Tous affirmaient que s’il y avait eu une plaisanterie en tout ceci, ils en étaient, comme lui, les victimes, les victimes du reste nullement à plaindre, car l’hospitalité qui leur était si mystérieusement offerte ne manquait ni de charme, ni de piquant, ni de confortable. Les pyramides de fruits magnifiques qui garnissaient les consoles, le champagne qui rafraîchissait dans des seaux à glacer, le luxe du linge et de l’argenterie marqués aux initiales R. C., tout ce que l’on voyait permettait d’augurer que le mystérieux amphitryon « savait bien faire les choses ». Mais qui était donc celui qui les avait réunis là, dans des conditions telles que, après en avoir été d’abord fort intrigués, après s’en être ensuite amusés, ils commençaient maintenant à en être intimidés ?
– Enfin, mesdames et messieurs, de qui sommes-nous les invités ? s’écria Raoul Gosselin en allumant une cigarette à la flamme d’une bougie… Par quel sortilège sommes-nous réunis ?
Le procureur s’arrêta devant la Mouna qu’il n’avait jamais vue, et que, du reste, personne ne connaissait. Il s’inclina. Elle était assez jolie ; la peau ambrée, de grands yeux noirs, une petite bouche, mais le cou un peu épais ; quelques beaux bijoux. Toilette de voile noir garni de perles, de jais, de paillettes, très tintinnabulante au moindre mouvement. Elle fumait une cigarette d’Orient.
– Madame pourrait peut-être nous renseigner ?
– Sur quoi, monsieur ?
– Mais sur tout… nous ne savons rien…
– Je n’en sais pas plus long que vous, monsieur…
– Serait-il indiscret, madame, de vous demander à qui nous avons l’honneur de parler, car mes amis, pas plus que moi…
– Monsieur, c’est moi qui suis la Mouna ! fit-elle d’un air brusque et entendu, comme si elle n’avait plus rien à ajouter et comme si ces dernières paroles devaient renseigner le genre humain sur sa personnalité.
Tous se mirent à rire pendant que la Mouna les regardait avec étonnement. Et elle raconta comment elle était venue à ce singulier rendez-vous.
– Voilà, disait-elle, c’est bien simple. Je sortais de souper d’un cabaret du boulevard Montmartre dans la nuit d’hier ; j’étais seule, ayant vainement attendu un ami qui m’avait pourtant donné rendez-vous dans cet endroit. Je cherchais ma voiture, que je ne retrouvais plus à la porte du cabaret. Tout à coup, un homme, sortant de je ne sais où, s’est avancé, et, mettant le chapeau à la main, m’a poliment prié de lui permettre de m’offrir son bras. Puis en guise de présentation, l’homme dit un mot… Oh ! pas long… Était-ce un mot ? C’étaient plutôt deux lettres, R. C…
– Ah ! il a dit : R. C. ? demanda Marcelle Férand.
– Oui…
– Très intéressant ! fit la tragédienne. Alors ?…
– Il m’a accompagnée jusqu’à la porte de mon hôtel, rue Taibout… il n’a pas voulu entrer… il m’a seulement donné rendez-vous ici pour cette nuit… J’ai accepté son rendez-vous où je ne croyais pas que nous serions si nombreux. Je lui ai dit que je m’appelais la Mouna et il me dit qu’il s’appelait, lui, vous ne savez pas comment ?… Mystère !
Elle n’avait pas plutôt prononcé ce mot : Mystère que des exclamations partaient des quatre coins du salon :
– Le roi Mystère ! le roi Mystère !…
– Qu’est-ce que je t’avais dit, Raoul ? s’écriait Marcelle Férand. Tu vois bien qu’il existe ! Tu vois bien que c’était lui ! Parbleu ! Il n’y a que lui pour avoir des cartes de visite pareilles !
– Il devrait signer ses cartes R. M., répliqua Gosselin en riant. Pourquoi portent-elles R. C. ?
Et il exhiba, en effet, une carte de visite où étaient inscrites ces deux initiales au-dessus d’une tête de mort sur tibias.
– Ne dit-on pas qu’il habite dans les catacombes ? reprit l’actrice. Alors tout s’expliquerait R. : roi ; C. : catacombes ; le roi Mystère serait le roi des Catacombes !
Tout le monde rit et le peintre se rappela, avec une joie candide, qu’il avait fallu tout de même, huit mois auparavant, une déclaration retentissante du préfet de police pour calmer les imaginations surexcitées du boulevard.
C’est que, dans ce moment-là, les faits les plus monstrueux, les crimes les plus audacieux, les événements restés inexplicables de la vie publique quotidienne avaient été mis avec entrain sur le compte de cet espèce de loup-garou pour grandes personnes qu’avait été, pendant quelques semaines, le roi Mystère ! Mais qui donc avait imaginé, qui avait créé cette royauté ?… Qui ? On ! On, c’est-à-dire tout le monde, c’est-à-dire personne !
– Alors, nous allons le voir ce soir ! s’exclama Marcelle Férand !… Quel bonheur !…
– Ah çà ! Qui peut nous monter ce bateau-là ? s’écria Raoul Gosselin en assurant son monocle d’un geste nerveux. Ce n’est pas drôle du tout !…
– Mais ce n’est pas un « bateau » ! protesta Marcelle.
– Je ne croirai à l’existence de ton roi Mystère que lorsque j’aurai fait son portrait ! déclara le peintre.
La porte venait de s’ouvrir. Un laquais annonçait :
– Monsieur le notaire du roi !… Monsieur le greffier du roi !
IV – OÙ M. LE PROCUREUR IMPÉRIAL COMMENCE À CROIRE À L’EXISTENCE DU ROI MYSTÈRE
Deux hommes firent leur entrée, la tête basse et une serviette de maroquin sous le bras, presque des vieillards tous deux, mais l’un épais et l’autre chétif. Un notaire parisien ne saurait en aucune circonstance être confondu avec un greffier… Quand ils eurent enlevé leur chapeau, leur pardessus et l’écharpe qui leur cachait à moitié le visage, les deux nouveaux personnages furent accueillis par des cris de nature diverse. Le notaire et le greffier montraient un visage si consterné que, quelle que fût la diversité de l’impression, chacun finit par se demander si l’affaire ne devenait pas sérieuse. Me Espérance Mortimard, l’un des premiers et des plus riches notaires de la capitale, dont l’étude, sise quai Voltaire, voyait défiler une exceptionnelle clientèle. Depuis qu’il avait dépassé l’âge de quatorze ans, âge auquel, entre une version latine et un discours français, son père, Me Isidore-Hildebert Mortimard, avait commencé de l’initier aux mystères du papier timbré, nul n’avait vu sourire Espérance. Et, en vérité, quand il apparut en notaire du roi Mystère, cette nuit-là, dans le salon de la maison de la rue de la Roquette, il n’avait jamais moins souri. L’ennui, l’humiliation, et aussi un peu d’effroi, se partageaient l’expression de son visage jaune parcheminé.
À côté de lui, M. Jean-Joseph-Sosthène Bison, greffier de la cour d’assises de la Seine, qui, lui, avait l’habitude de rire, hors de ses fonctions, semblait dans le moment avoir envie de pleurer. Me Mortimard et M. Bison furent moins étonnés de rencontrer en cet endroit M. le procureur impérial que M. le procureur impérial ne fut stupéfait de se trouver face à face avec eux, devenus notaire et greffier du roi !…
– Ah, çà ! s’écria Sinnamari. Qu’est-ce que tout cela veut dire, mon cher Mortimard ? Et vous, que faites-vous ici, monsieur Bison ?
Le notaire répondit :
– Mais, monsieur le procureur impérial, j’ai été appelé ici par un de mes clients.
– Le roi Mystère est votre client ?
– Mais oui, monsieur le procureur impérial.
– Je savais que vous aviez des monarques parmi vos clients, reprit Sinnamari qui n’en pouvait croire ses oreilles.
– Oui, fit Me Mortimard, je m’en flatte : la reine d’Angleterre, le roi de Grèce, le roi d’Illyrie…
– Mais je doute qu’ils soient enchantés d’apprendre que leurs dossiers voisinent avec le dossier du roi Mystère ! répliqua le procureur impérial.
– Je me dois à tous ceux qui viennent requérir l’office de mon ministère, fit le notaire avec onction.
– Et il y a longtemps qu’il est votre client ?
– Le roi Mystère ? Eh bien, mais… depuis un an !…
– Depuis un an ! s’écria Sinnamari. Et vous n’avez pas averti la police, et vous ne m’avez pas averti, moi, votre ami ?
Me Mortimard poussa un soupir que l’on pouvait diversement interpréter, soit qu’on le crût l’expression de l’ennui que lui causait cette sorte d’interrogatoire, soit qu’on imaginât qu’il traduisait le regret que ressentait l’honnête tabellion de n’avoir pu, en effet, avertir la police.
– Vous savez bien, dit Me Mortimard, que nous sommes liés par le secret professionnel…
Et le notaire gémit encore.
– Le secret professionnel ! répartit Sinnamari. Vous me la baillez belle avec votre secret professionnel !… Il n’y a pas de secret professionnel pour les gredins !
Me Mortimard leva à nouveau vers le plafond ses mains qu’il avait grassouillettes, et encore on ne pouvait savoir si ce geste protestait contre l’injure que l’on faisait à l’un de ses clients ou s’il attestait prudemment que lui, Mortimard, était tout prêt à partager l’opinion du procureur impérial.
– Ainsi, il existe ! continuait maintenant le procureur comme s’il ne s’entretenait qu’avec lui-même. Il existe !… Dixmer avait donc raison !… C’est inouï !… À notre époque !…
Et, se retournant vers Me Mortimard :
– Et vous l’avez vu ?
– Comme je vous vois ! soupira le notaire. Le procureur s’exclama encore :
– Eh bien !… M. le préfet de police sera, pour ma foi, bien étonné, mais il ne le sera pas plus que moi !…
Ce disant, Sinnamari se rappelait que quelques mois auparavant, M. le préfet de police, dans sa remarquable déclaration faite à un rédacteur de l’Écho du Boulevard, avait appuyé fort habilement sur ce point faible de l’existence du roi Mystère.
Non seulement personne ne pouvait se vanter de lui avoir parlé, mais encore on ne pouvait dire qui en avait parlé pour la première fois et nul ne pouvait se vanter de l’avoir vu jamais !
Il avait sans doute suffi que l’esprit inventif et loustic d’un chroniqueur en mal de copie eût bâti de toutes pièces la silhouette imaginaire de ce prince de conte de fée pour que l’amour du fantastique qui veille toujours au cœur de la première cité du monde s’en fût emparée avec enthousiasme.
Dans les cerveaux troublés, et il faut bien le dire, amusés, ce prince des ténèbres, dont on plaçait le royaume au fond des catacombes, était devenu maître du bien et du mal.
Oui, le sang répandu et le bienfait anonyme, autant de gestes du roi Mystère ! Une souscription populaire en faveur des victimes du terrible hiver de 186…, où le roi Mystère s’était inscrit pour 100000 francs, avait, comme on peut le penser, donné quelque lustre à la réputation du personnage. C’est même à ce propos que le préfet de police avait jugé bon d’intervenir pour faire cesser une plaisanterie qui menaçait de rendre les services de la préfecture tout à fait ridicules. Il avait, fort sensément, expliqué la souscription par la fantaisie d’un roi de la finance qui tenait à garder l’anonymat. Il avait prié les reporters d’inventer autre chose et de laisser désormais le roi dormir en paix dans ses catacombes…
Sinnamari, maintenant, paraissait furieux. On l’entendait gronder :
– … Et il a son notaire !… Et il a son greffier !… Mais tout cela ne nous dit pas son nom !… Comment s’appelle-t-il ?… Qui est-il ?
Et Sinnamari, retourné vers Mortimard, attendait le nom. Le procureur impérial avait alors cet air hautain, ce ton de commandement, cette voix de menace qui faisaient trembler les accusés et les témoins dans les prétoires. Me Mortimard trembla, lui aussi, mais il ne répondit rien.
– Enfin, vous devez le savoir ! reprit le terrible procureur.
– Il le faut bien… murmura le notaire, pour les contrats…
– Comment ! Il vient chez vous passer des contrats…
Mortimard hocha la tête en signe affirmatif. M. le procureur impérial émit cette opinion qu’il rêvait, mais le notaire ayant alors secoué la tête en signe négatif, Sinnamari dut en conclure qu’il ne rêvait pas.
– Des contrats ! Quels contrats ? demanda le magistrat dont les yeux s’ouvraient énormes. Quel genre de contrats faites-vous pour cette sorte d’individu, Mortimard ? Ils ne doivent par être valables… Vous le savez bien !… Que signifie cette comédie ?
– Ah ! Comment voulez-vous que je consente jamais à faire des contrats qui ne soient pas valables ?… Voyons, monsieur le procureur impérial, vous me connaissez assez… Ces contrats sont valables, du moment qu’ils sont moraux…
– Ah !… ils sont moraux !…
– Entièrement moraux !… C’est même leur principale qualité !…
Sur quoi Me Mortimard ayant poussé un nouveau soupir, M. le procureur impérial estima qu’il ne tirerait rien de plus de l’honorable tabellion, et il se retourna vers le greffier.
Ce fut le tour de M. Joseph Bison, dont les doigts fiévreux tambourinaient le maroquin de sa serviette.
– Et vous ! M. Bison ! Je vous croyais greffier à la cour d’assises de la Seine ?…
– Vous avez raison, monsieur le procureur impérial, répondit M. Bison, levant et abaissant la tête avec rapidité, dans un geste qui disait assez que, lui, Bison, ne se permettrait jamais de contredire M. le procureur impérial…
– Vous ne l’êtes donc plus ?…
– Oh, monsieur le procureur impérial… dans mes moments perdus, je fais des petits extras…
Et Joseph Bison, après avoir relevé soigneusement les deux pans de sa redingote, s’assit, épuisé…
Sinnamari, devant les déclarations des deux hommes de loi, montrait une figure où étaient peints à la fois une si remarquable consternation et un si parfait ahurissement, que les jeunes femmes repartirent à rire.
– Eh bien ! S’il existe, tant mieux ! s’écria Philibert Wat, le gendre du président du conseil qui, jusqu’alors, ne s’était mêlé que fort peu à la conversation. Vous m’en voyez enchanté, et qu’il arrive vite !…
– Vous êtes pressé de le voir ? demanda Sinnamari.
– Je vous crois ! répondit Wat. Il doit me remettre vingt-cinq mille francs que j’ai gagnés cette nuit, au Grand Cercle, au comte de Teramo-Girgenti.
À ce nom, Sinnamari sembla oublier ses préoccupations et allant à Wat :
– Vous connaissez le comte de Teramo-Girgenti ? Il est à Paris ?
– Depuis huit jours…
– C’est que j’ai reçu une lettre du prince de Tolède, président des Cortès, qui me le recommande d’une façon toute particulière.
– Vous le verrez, fit Wat. Il ne s’est encore fait présenter chez personne… Il se met dans ses meubles… et quels meubles !… Vous verrez, on pendra la crémaillère… En attendant, je le pilote…
– Et il connaît le roi Mystère ? Qu’est-ce que vous me racontez là ?
– Mais, mon cher, la pure vérité. Il paraît même qu’ils sont en compte, puisque le roi Mystère règle les dettes du comte de Teramo-Girgenti.
– Ça, c’est trop fort ! s’écria le procureur.
– Il n’y a rien de trop fort pour le comte, répliqua Wat. Vous n’avez jamais rencontré un pareil original… Il dit qu’il ne reconnaît plus Paris et que la ville est bien changée depuis la dernière fois qu’il l’a vue…
– Il y a donc bien longtemps ?
– Un peu… Depuis le jour de l’assassinat de Henri IV.
– Vous plaisantez !
– C’est lui qui plaisante, j’espère…
– C’est peut-être un sorcier ? demanda, les yeux brillants d’espoir, Marcelle Férand.
Et se tapant dans les mains, dans une joie enfantine :
– Quelle chance ! Un roi et un sorcier !
– Voilà Marcelle repartie, fit Raoul Gosselin. Oui madame, un sorcier… Joseph Balsamo… Cagliostro… tout ce que vous voudrez, revenu à Paris, sans doute pour nous amuser…
– Ce n’est pas Balsamo du tout ! expliqua, sceptique, Philibert Wat. Si le comte de Teramo-Girgenti savait qu’on le compare à Balsamo, il quitterait Paris tout de suite. C’est un homme susceptible…
– Vraiment !…
– Vraiment !… Songez donc que Balsamo ne pouvait pas mourir. Il avait un nombre d’années incalculable… Mon ami Teramo-Girgenti, lui, n’a que soixante-dix ans…
– Alors, il n’a pas connu Henri IV ? fit la tragédienne désappointée.
– Il prétend qu’il n’a connu que lui, au contraire ! répondit Wat, si sérieusement qu’il y eut des rires. Ils ont été intimes, seulement, il est mort depuis !…
– Ah !
– Oui, il est même mort plusieurs fois depuis. Il prétend qu’il a trouvé le secret de ressusciter… Vous voyez bien… c’est le contraire de ce qui arrivait à Cagliostro qui, lui, ne pouvait pas mourir… Mon sorcier à moi meurt tout le temps…
À ce moment, une porte s’ouvrit avec fracas et deux laquais poussèrent devant eux un homme qui avait les yeux masqués par un bandeau et la bouche obstruée par un bâillon. Il essayait en vain de se débattre entre les mains qui, respectueusement mais solidement, le maintenaient. Le valet de pied qui avait déjà offert ses services au procureur entra par une autre porte et fit un signe. Les laquais délivrèrent l’homme, qui poussa un cri.
V – LE SERVICE DU ROI
– Régine ! s’écrièrent en même temps Sinnamari, Gosselin et Eustache Grimm, cependant que Philibert Wat faisait entendre un grognement au fond de sa belle barbe d’or ouverte en éventail sur sa poitrine trop plate.
Régine, aussitôt délivré de son bâillon et de son bandeau, avait voulu se ruer sur les deux laquais qui l’avaient « accompagné », mais ceux-ci avaient disparu. Retourné maintenant du côté de ses amis, Régine, suffoqué, finit par dire :
– Comment êtes-vous là ?… Je me croyais victime d’un guet-apens !
– Qui vous dit, fit Sinnamari en s’avançant, qui vous dit que ce n’est pas un guet-apens ?… Nous n’en savons rien !…
L’entrée un peu brutale de Régine avait naturellement fort intrigué ces dames. Elles demandèrent des explications. La vue de ses amis n’avait pas tout à fait calmé la colère du chef de cabinet du ministre de la guerre, et c’est d’une voix méchante qu’il leur raconta sa mésaventure.
Voici, pour lui, comment les choses s’étaient passées : Il était au Théâtre-Français avec sa femme et, durant un entracte, il était allé se promener seul dans le foyer, quand il fut abordé par un homme en habit, insignifiant, très correct, qui lui demanda s’il se souvenait de lui. Cet homme prétendait lui avoir été présenté autrefois par un camarade commun, le colonel Marage. Or, Marage était de retour d’Algérie, de passage à Paris pour vingt-quatre heures, et devait souper justement ce soir-là avec l’inconnu qui se présenta alors comme étant un capitaine Finot. Le souper devait avoir lieu après la sortie du théâtre, à côté même du Théâtre-Français, au Bœuf à l’Anglaise. Marage serait dans une grande joie de revoir son vieux camarade de Saint-Cyr. Car Régine était un ancien soldat. Il avait donné sa démission de colonel pour faire de la politique. Et le capitaine Finot prenait la liberté de l’inviter. Le capitaine avait ajouté qu’il y aurait à ce souper de jolies femmes, ce qui ne gâte rien. Régine désirait beaucoup revoir son ami Marage. Il mit donc, à la fin du spectacle, sa femme dans sa voiture et suivit l’ami de Marage dans la rue étroite et déserte qui sépare le Palais-Royal du restaurant du Bœuf à l’Anglaise. Il n’était pas plus tôt entré dans cette rue que l’ami de Marage et trois autres amis de Marage, sans doute, qui se trouvaient justement là à point, dans une encoignure du Palais, le surprenaient, l’emportaient, l’emballaient dans un coupé qui se trouvait là, lui aussi, comme par hasard. Un ami de Marage monta sur le siège à côté du cocher et les trois autres montèrent avec Régine dans le coupé. C’est dans ces conditions qu’on était allé tous ensemble faire une promenade au Bois qui dura de minuit jusqu’à quatre heures du matin ; lui, très inquiet, ne sachant pas ce que cet enlèvement voulait dire, ses compagnons, très silencieux, ne lui expliquant rien. Au Bois, on lui avait enlevé bandeau et bâillon ; en rentrant à Paris, on les lui avait remis. Enfin, il était enchanté de se retrouver au milieu d’amis, et l’aventure, toujours incompréhensible, se terminait mieux qu’un instant il avait pu le craindre. Mais où se trouvait-il ? Dans quel lieu de plaisir ? Dans quel restaurant à la mode ?…
– Mon cher, dit le Procureur de la République, vous êtes tout simplement place de la Roquette… Vous avez pris un chemin un peu long pour y venir, voilà tout…
– Place de la Roquette ! se récria Régine. Ici, place de la Roquette !…
– Regardez ! fit Sinnamari en soulevant le rideau de la fenêtre…
Régine s’était précipité à la fenêtre.
– Qu’est-ce que c’est que ça ? demanda-t-il d’une voix défaillante.
– Ça, mon cher, c’est la guillotine.
– Qui guillotine-t-on ce matin ?…
– Comment !… Tu as déjà oublié… Desjardies !…
Régine devint plus pâle que la nappe sur laquelle il s’appuya pour ne pas tomber.
– Oh, mais cela te produit de l’effet, la guillotine, mon cher !… Ça n’est pourtant qu’un morceau d’acier et tu es soldat…
– J’aime mieux voir un sabre, dit Régine en essayant de plaisanter et faisant un effort visible pour recouvrer tout son sang-froid.
– La guillotine, c’est notre sabre à nous ! Ne la méprise pas si tu m’aimes ! fit Sinnamari d’un air goguenard, et il frappa sur l’épaule de Régine. Allons, mon vieux camarade ! Pas d’émotion… Si quelqu’un s’est moqué de nous… qu’il se hâte d’en rire… car il n’en rira pas toujours !…
L’homme que Sinnamari appelait « mon vieux camarade », Régine, n’avait pas dû être déplaisant à voir sous l’uniforme.
Svelte, élancé, et cependant la poitrine bombée, à l’allemande, un fin profil, une jolie bouche qu’ornait une moustache restée naturellement blonde, des yeux un peu froids, cyniques, un habituel sourire de sceptique au coin des lèvres ; ç’avait été un bel officier et quelques-unes de ses bonnes fortunes avaient été retentissantes : mais, dans le moment qui nous occupe, le colonel Régine n’était pas très brillant.
Était-ce l’humiliation qu’il venait de subir, un malaise purement physique devant la vision de la guillotine à laquelle il ne s’attendait pas ? Toujours est-il que son émoi était extrême, quoi qu’il fît, d’ailleurs, pour le dissimuler. Il voulut savoir comment ses amis se trouvaient là.
– Pour Marcelle et moi, fit Gosselin, c’est bien simple. Nous soupions à la maison Dorée quand un chasseur est venu nous apporter un petit mot nous invitant à venir resouper ce soir « chez un ami », place de la Roquette. Notre aimable correspondant ajoutait que l’exécution de Desjardies devait avoir lieu cette nuit. J’ai imaginé qu’un camarade, renseigné par la préfecture de police, avait loué un cabinet dans quelque cabaret borgne, payé une fenêtre, que sais-je ?… Enfin, Marcelle a voulu absolument venir… ce mystère l’intriguait… Songez donc qu’on nous disait qu’il faudrait frapper cinq coups sur une porte, prononcer un mot de passe : R. C. ! On marcherait dans les murs, comme dans les drames de 1830… Enfin, on est tragédienne ou on ne l’est pas !… Et puis, Marcelle n’a encore jamais vu d’exécution…
– Et puis, il y avait encore autre chose, fit Marcelle Férand, qui s’était assise devant la cheminée et qui présentait au feu la pointe de ses souliers, autre chose que vous ne dites pas… vieux jaloux… à propos de ces initiales R. C.
– Oui, interrompit Gosselin en riant, figurez-vous que, le soir de la répétition des couturières, l’avant-veille de la première des Martyrs, Marcelle, en remontant dans sa loge, l’a trouvée pleine des plus rares fleurs du monde… des orchidées magnifiques… il y en avait pour une somme fabuleuse… Ces fleurs lui promettaient déjà un triomphe…
– Vous en faisiez un nez !… interrompit la tragédienne.
– Et devant la psyché, sur la table de toilette, on avait déposé un petit bouquet de violettes de deux sous avec une carte de visite… carte de visite étrange que Raoul vous montrait tout à l’heure. Fleurs rares, bouquet de deux sous, carte de visite, on n’a jamais pu savoir comment tout cela était venu…
– Et vous, Grimm, comment êtes-vous ici ? interrogea Sinnamari.
Tous les yeux se tournèrent vers le gros homme qui, jusqu’alors, semblant somnoler, n’avait rien dit.
– Figurez-vous, dit-il, qu’il se passe en ce moment à l’Assistance publique des choses incroyables. Un livre de comptabilité des plus importants a disparu ; à la place qu’il occupait, on a trouvé ces deux lettres à la craie : R. C. ; ce n’est pas tout ! Trois employés supérieurs, auxquels on n’avait jamais rien eu à reprocher, sont venus m’avertir avant-hier qu’ils donnaient leur démission. Je les ai interrogés, ne cachant pas mon étonnement. Ils m’ont répondu : « Nous nous en allons à cause de R. C. ; c’est tout ce que nous pouvons vous dire. » Alors, quand, en ouvrant ma serviette, ce soir, au moment de dîner, j’en vis échapper un mot signé R. C. qui m’invitait à venir assister à l’exécution de Desjardies, je me suis dit : « Voilà une occasion de faire la connaissance avec ce fameux R. C. ne la manquons pas ! » Et je suis venu…
Il ajouta, placide :
– Maintenant, si vous voulez savoir mon opinion, je finis par croire qu’il existe !… Je ne lui reproche qu’une chose : c’est de se faire un peu attendre… J’ai faim, moi !
Et le directeur-gérant de l’Assistance publique jeta sur la table des yeux dévorateurs.
– Qu’il se montre ! Qu’il arrive ! Qu’on le voie ! soupira Marcelle Férand, impatiente.
Le procureur fronça ses épais sourcils et dit :
– Regardez-le bien, mesdames, car sitôt que vous l’aurez vu, il pourrait bien redevenir invisible.
– Il retournera dans son royaume ? demanda l’artiste.
– Non ! répliqua Sinnamari avec un gros rire inquiétant. Dans le mien !…
Dans le même moment, un grand tumulte se fit dans le corridor et, la porte ayant été une fois de plus brusquement poussée, un individu se précipita dans le salon, suivi de deux laquais qui restèrent sur le seuil.
À son allure, à son chapeau de feutre mou, à son ample pèlerine dont le col relevé lui cachait encore les oreilles, on eût pu reconnaître l’homme qui, sur la place de la Roquette, faisait quelques instants auparavant des recommandations aux officiers…
– Dixmer ! s’écria Sinnamari.
L’homme ôta son chapeau et d’une voix haletante :
– Enfin, vous voici, monsieur le procureur impérial… Vous avez bien fait de me donner le mot de passe !… Mais j’ai cru que ces gens-là allaient m’étrangler… Enfin, je vous vois… il faut sortir d’ici !… Vite ! Vite ! Tout de suite… tout le monde… ce rendez-vous est un abominable traquenard… Quand je vous disais qu’il était capable de tout !… Les chauffeurs de la Villette, les lions de Montrouge, les Titis de Pantin, les Ravageurs d’Aubervilliers, je vous dis qu’il commande à tous… qu’il les a tous dans sa main !… Et s’il n’avait que ça !… Enfin, il faut s’attendre à un coup pas ordinaire !… Mes hommes m’ont signalé tous les chefs de bande… Depuis une demi-heure, ils rôdent de la place du Prince-Eugène au Père-Lachaise ! Leurs troupes ne doivent pas être bien loin… Vous savez bien ce que l’on vous a écrit… les menaces que l’on vous a faites…
– Eh bien ? demanda Sinnamari en regardant de toute sa hauteur le divisionnaire de la préfecture de police.
– Quand je pense qu’hier encore, continua Dixmer, on s’est moqué de moi à la préfecture !… Si, au dernier moment, je n’avais pas apporté des preuves indéniables, jamais on ne m’aurait chargé du service d’ordre, et nous serions propres aujourd’hui… on ne sait pas ce dont il est capable !…
– Mais vous, monsieur, vous êtes capable de nous défendre ?…
– Est-ce que je sais ? Je ne suis arrivé jusqu’à vous que parce qu’ils l’ont bien voulu… Cette maison est truquée comme un château de féerie. Ils peuvent à leur gré couper toute communication avec le dehors… J’ai voulu faire envahir la maison par mes hommes… Nous avons pénétré partout avec des lumières… Nous n’avons rien découvert. Nous n’avons vu personne… De la cave au grenier, nous avons cherché votre piste… Inutile !…
– Alors, comment êtes-vous ici ?
– J’ai fait ressortir tout mon monde, je me suis présenté seul à la porte… J’ai fait comme vous… j’ai donné le mot de passe… On s’est emparé de moi dans l’obscurité… on m’a apporté ici… Ah ! de grâce, monsieur le procureur impérial, messieurs, mesdames, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce sera très grave… Vous n’êtes pas là pour rire, croyez-moi… il faut sortir d’ici, tout de suite, s’il en est temps encore !… par les fenêtres, si c’est nécessaire !…
Une voix fit se retourner tout le monde, une voix mâle, ardente, souveraine :
– Non ! Par la porte !… Que l’on jette cet imbécile à la porte !…
Trois laquais s’emparèrent de Dixmer et l’emportèrent comme une plume. L’homme qui avait prononcé la phrase d’expulsion, un être dans toute la force, toute la grâce, toute la splendeur, toute l’aimable majesté de la jeunesse, s’inclinait déjà devant les deux femmes extasiées, qui ne trouvaient pas un mot pour le remercier des fleurs merveilleuses dont ses mains tendues vers elles étaient pleines.
Tous comprirent qu’ils avaient devant eux le roi Mystère ! Le roi des Catacombes !
En même temps, un maître d’hôtel parut et commanda :
– Le service du roi !…
VI – SUITE DE L’HISTOIRE DE M. PROSPER ET DE M. DENIS
Il serait peut-être temps de revenir à M. Prosper et à M. Denis, que nous avons laissés dans la petite salle du Lapin-qui-fume, tout étonnés de se trouver entourés par des ouvriers terrassiers qui, assis aux tables voisines, les contemplaient dans un étrange silence.
Pour comprendre tout ce que cette invasion d’un cabinet particulier retenu par nos deux honorables gentilhommes avait d’insolite, il serait peut-être bon que nous fussions au courant de ce qui s’était passé quelques minutes auparavant dans la première salle du cabaret où était entré Cassecou.
Cassecou, debout devant le comptoir, dégustait son grog, à petits coups, ayant en vain essayé d’engager la conversation avec le patron, qui ne lui répondait que par des grognements.
Sans doute, M. Martin – c’était le nom du propriétaire du Lapin-qui-fume – était-il fort mécontent de la mauvaise tournure que prenaient les affaires « une nuit d’exécution ». L’heure exceptionnellement tardive à laquelle on s’était enfin décidé à monter la machine de mort était certainement la cause de toute la tristesse qui régnait ce matin-là dans une salle où, à l’ordinaire, la nouvelle du transport des « bois de justice » de la rue de la Folie-Regnault à la place de la Roquette apportait tant de gaieté.
À un moment, la porte de la cuisine s’ouvrit et le garçon passa rapidement en portant une casserole d’où s’échappait un fumet fort appétissant de lapin sauté.
Cassecou, dans une petite glace qui se trouvait en face de lui, paraissait moins occupé à contempler les traits inharmonieux de son visage étique qu’à suivre tous les mouvements du garçon.
Celui-ci avait couru à une porte vitrée qui faisait communiquer la pièce principale du cabaret avec la petite salle. Puis, ayant tiré de sa poche une clef, il ouvrit la porte, disparut, revint presque aussitôt sans sa casserole, referma la porte à clef et s’enfuit dans la cuisine.
Il y eut quelques exclamations goguenardes parmi la clientèle, et Cassecou se retourna. Son premier regard se croisa avec celui d’un jeune homme de haute taille, un ouvrier dont le cou de taureau était entouré d’un mouchoir rouge. Mais ce qui frappait tout d’abord dans cet athlète de vingt ans, c’était moins la puissance de sa musculature que l’aspect singulièrement troublant de son profil aigu.
Ce profil était féroce, farouche, formidable ; cela n’était plus un profil d’homme, un nez d’homme, cela était un nez de proie, un bec d’oiseau carnassier ; cette sombre figure de vautour s’éclairait par instants du regard étonnamment pur de deux admirables yeux bleus.
L’homme-vautour, en ce moment à moitié affalé sur un banc, jouait négligemment au « zanzi » avec un camarade dont la figure, incroyablement décharnée, avait des rides si marquées qu’on eût pu les croire dessinées au pinceau.
– À toi, Patte d’oie ! fit-il en passant le cornet et les dés à son partenaire.
Quatre ouvriers terrassiers, taillés en hercules, regardaient cette partie mélancolique.
À deux autres tables, une demi-douzaine de consommateurs fumaient et bavardaient. Ils n’avaient point des mines précisément recommandables, avec leurs casquettes, leurs cheveux plaqués en accroche-cœur, leurs sourires cyniques, mais le Lapin-qui-fume en avait vu fumer bien d’autres.
À la dernière table qui touchait presque la porte vitrée de la petite salle, un client ayant les allures honnêtes d’un petit bourgeois du quartier qui se serait levé de bonne heure pour une circonstance aussi importante que celle d’une exécution, vidait un verre de café noir. Il connaissait le patron, car, lorsque le garçon eut soigneusement refermé la porte vitrée sur ses mystérieux clients, il dit :
– Ah bah, monsieur Martin ! Vous faites des cabinets particuliers, maintenant… mes compliments !
Le petit bourgeois se leva, et avant que m’sieur Martin ait eu le temps de l’empêcher, il était allé à la porte, avait soulevé le rideau de cretonne qui cachait la vitre et regardé dans le cabinet.
– Peste, dit-il, des hommes en redingue et en chapeau haute-forme, s’il vous plaît…
Le patron était déjà derrière l’indiscret, si furieux qu’on eût pu croire qu’il allait le frapper de son poing fermé, mais il se contenta de grogner dans ses dents, cependant que l’honnête petit bourgeois, tout défaillant et soudain pâle, murmurait le doigt tendu vers la vitre :
– Mais… mais, m’sieur Martin… mais ce sont les aides du bourreau !…
Aussitôt, il paya rapidement sa consommation et s’en alla, comme si une telle promiscuité lui avait donné des nausées, poursuivi d’ailleurs par la mauvaise humeur de m’sieur Martin, furieux de ce qu’on eût dévoilé publiquement la qualité exceptionnelle de ses mystérieux clients.
– Eh bien quoi ! Faut bien qu’ils mangent ! dit Cassecou. C’est pas des purs esprits.
Un observateur attentif eût été profondément étonné que, dans cette salle de cabaret, l’annonce du voisinage des aides du bourreau n’eût point provoqué la moindre curiosité, le plus petit signe d’étonnement.
Les clients continuaient de causer avec une nonchalance telle qu’elle en devenait suspecte. Et comme ils avaient tous le même air, « celui de n’en avoir pas », le patron lui-même finit par s’en apercevoir. Mais, dans le même moment, l’homme dont le cou s’entourait d’un mouchoir rouge, et qui avait un profil de vautour, ayant échangé un rapide regard avec Cassecou, frappa brutalement la table de son cornet à dés et s’écria :
– J’ai perdu !… Patron, une bouteille, mais du bon !… Ce que vous avez de meilleur dans votre cave…
– François ! Donne une bouteille de cacheté vert à ces messieurs…
Le garçon expliqua qu’il fallait aller le chercher dans la cave.
– Mais je ne sais pas où il est. C’est toujours vous qui y allez, patron !…
– Possible !… Mais je suis fatigué aujourd’hui, mon garçon !… Allons !… Dégrouille-toi… Au fond, à droite, la troisième case…
Pendant que François ouvrait dans le plancher, à côté même du comptoir, la lourde trappe de la cave, le patron ne cessait de regarder l’homme au mouchoir rouge, son camarade Patte d’oie et les terrassiers qui les entouraient.
Décidément, leur allure a tous ne lui « revenait pas », et, machinalement, il donna un tour de clé au tiroir de sa caisse. Cassecou, lui aussi, lui paraissait inquiétant. Il en était à son troisième grog et il n’avait pas lâché le paquet qu’il portait sous le bras gauche, du geste du tailleur qui s’en va livrer au client « le complet » enveloppé dans la serge professionnelle.
Le garçon était remonté de la cave et disposait des verres sur la table des joueurs de zanzibar. La demi-douzaine de clients qui se trouvait à l’écart, des gars qui n’avaient pas, comme nous l’avons fait remarquer, trop bonne mine, se levèrent pour sortir, mais, arrivés à la porte, ils se ravisèrent, et telle une escouade à l’exercice qui fait soudain demi-tour, ils s’approchèrent du comptoir à l’invitation qui leur était faite par l’un d’entre eux de prendre une dernière tournée. Ils se firent servir sur le zinc debout près du comptoir.
François, derrière eux, avait débouché sa bouteille. Le « cou de taureau » invita alors gracieusement le patron à trinquer avec eux. Celui-ci, qui ne pouvait refuser, s’avança avec circonspection. Il n’aurait pu dire pour quelle raison il ne se trouvait pas à son aise. Une sorte de pressentiment lui soufflait qu’il allait se passer quelque chose.
Il y a des pressentiments qui ne trompent pas. Il trinqua, mais il n’eut point le temps de porter son verre à sa bouche. Il se sentit saisi tout à coup par des mains innombrables, aux bras, aux jambes, à la poitrine. Il voulut crier : il avait un poing dans la bouche ; il mordit. Il put voir que son garçon subissait le même sort que lui. La petite escouade du comptoir s’était d’un seul coup ruée sur eux et les avait réduit au silence, en silence !
Pas un cri, pas un murmure, pas le bruit d’une chaise qui tombe. De la besogne propre. Les terrassiers n’avaient pas eu à bouger. Le Vautour dit :
– Bien travaillé, mes enfants !
Cependant, Patte-d’Oie était allé rejoindre Cassecou. Tous deux se placèrent de chaque côté de la porte qui donnait dans la cuisine, et Cassecou, après avoir consenti à se séparer de son précieux paquet, qu’il déposa sur le comptoir, frappa d’un index autoritaire sur la vitre de cette porte. D’abord, cet appel resta sans réponse, et puis, comme il se répétait, la porte s’ouvrit.
Une grosse mère parut. Des mèches folles s’échappaient de son bonnet et lui tombaient jusque sur les yeux, mais lui laissaient toutefois la vue suffisamment libre pour qu’elle aperçut, rangés côte à côte sur le carreau maculé, serrés de cordes, bâillonnés, saucissonnés, son époux et son serviteur.
L’expression d’horreur et d’éclatante indignation qu’un tel spectacle n’eût pas manqué d’arracher à cette brave dame fut arrêtée, dès l’origine, par les soins empressés de Cassecou et de Patte d’oie. Seuls, les yeux de l’innocente victime avaient conservé le droit de parler, et ils en usaient avec une éloquence qui en disait long sur la terreur de cette pauvre âme.
La porte de la cave était restée ouverte. Ces messieurs, en quelques mouvements harmonieux et rapides comme on en voit faire dans les écoles aux petits enfants qui apprennent à décomposer une gymnastique primaire, s’étaient baissés, avaient soulevé les trois fardeaux, les avaient glissés en douceur dans cet obscur réduit où dormaient d’un sommeil falsifié le « cacheté vert », et, tranquillement, cette mise en cave étant faite, avaient rabaissé la trappe. Aussitôt, on entendit dehors un coup de sifflet dont la stridence prolongée attira l’attention toujours en éveil de Cassecou, dans le moment qu’il s’apprêtait à user de la clef du cabinet particulier, clef dont il avait soulagé la poche du garçon, François.
– Silence ! fit-il. Des flics…
On entendait des pas qui se rapprochaient sur le trottoir. L’homme au cou de taureau, au profil de vautour et au mouchoir rouge, dit, très calme :
– Gardez la porte, les titis. Si un flic entre, si un pante inconnu entre, occupez-vous en ! Vous resterez dans cette salle. À moi, les lions !
Les ouvriers terrassiers l’entourèrent. Mais il dit :
– Non ! Pas tout de suite… Nous avons encore bien cinq minutes… pour rigoler…
Et il demanda :
– Mon tailleur ?
Cassecou se précipita :
– Présent, mon prince !
– Aboule les nippes.
Cassecou s’en fut à son paquet et, méthodiquement, retira les épingles qui fermaient la serge verte. Et il mettait les épingles dans sa bouche, comme un honnête tailleur qui en aurait mangé toute sa vie.
À ce moment, la porte de la rue s’ouvrit, et les titis s’apprêtèrent à « faire un sort » à l’imprudent qui allait en franchir le seuil. Mais ce fut une silhouette féminine qui apparut. Cette femme était nu-tête et brinqueballait un vaste carton à chapeau.
– C’est moi, la modiste ! fit-elle.
– Boulotte ! dit Cassecou. T’es juste à l’heure. On va pouvoir passer dans le cabinet de toilette.
Et il lui ouvrit la porte de la cuisine.
Et maintenant, retournons dans la salle réservée où M. Prosper et M. Denis devaient être si singulièrement troublés dans leur honnête digestion.
Nous avons dit l’arrivée des ouvriers terrassiers, et leur étrange attitude, et leur impressionnant silence, si impressionnant que les deux convives ne purent continuer de manger. Le fromage ne passait pas. M. Prosper regardait M. Denis et M. Denis regardait M. Prosper. Tout à coup, un ouvrier dit tout haut :
– Ça me dégoûte de voir manger des fonctionnaires !
M. Prosper fit discrètement signe à M. Denis ; tous deux se levèrent, assurèrent leurs chapeaux haute-forme sur leurs fronts soucieux et se dirigèrent d’un pas qu’ils essayaient de maintenir majestueux vers la porte de sortie qui donnait directement sur les derrières du passage de la Folie-Regnault.
Cette porte était vitrée. Comme les deux hommes noirs se disposaient à l’ouvrir, ils aperçurent, à travers les carreaux, deux hommes qui les regardaient et qui étaient habillés de noir comme eux, coiffés de chapeaux haute-forme comme eux et qui leur ressemblaient comme deux frères.
M. Prosper et M. Denis crurent d’abord à un effet de glace ; ils furent vite détrompés et n’eurent point de peine à reconnaître leur erreur. Avant qu’ils eussent tenté d’ouvrir la porte, celle-ci s’ouvrit et les deux frères de M. Prosper et de M. Denis s’avancèrent en chair et en os au-devant des aides du bourreau, qui ne purent retenir une sourde exclamation de surprise et d’effroi. M. Prosper se demandait lequel était en vérité M. Prosper : ou de ce grand et puissant garçon tout habillé de noir qu’il avait devant lui ou de lui ? Ah ! C’étaient, ma foi, la même moustache, le même air, la même carrure, la même façon de marcher en traînant la jambe droite, et tout, et tout ! Quant à M. Denis, il eût pu très bien serrer la main de ce grand dégingandé qui lui faisait vis-à-vis en lui demandant des nouvelles de sa propre santé, comme si, oubliant qu’il n’avait pas cessé d’être lui-même, il se rencontrait lui-même !
Cependant, M. Prosper et M. Denis reculèrent. Mais, en même temps qu’ils faisaient, eux, trois pas en arrière, leurs images faisaient, elles, trois pas en avant, et comme ces images arrivaient sous la lumière de la lampe suspendue au plafond et regardaient les aides de bourreau bien en face, les aides du bourreau reconnurent à certaines lignes de la physionomie, au nez par exemple de l’image de M. Prosper, aux tempes de l’image de M. Denis, que ces deux fantômes noirs ne leur ressemblaient pas autant qu’ils l’avaient cru tout d’abord. D’autres auraient pu, plus longtemps, s’y tromper, mais eux étaient bien forcés maintenant de se dire : ces deux reflets de nous-mêmes ne sont pas nous-mêmes !… Et alors, chose extraordinaire, ce phénomène de la ressemblance les épouvanta davantage encore que le phénomène, auquel ils avaient cru, de l’identité ! Ils ne reculèrent plus !… Ils tournèrent le dos à ces deux images muettes et s’enfuirent en appelant à leur secours ! Une terreur folle leur travailla le cerveau, car un sûr instinct les avertissait qu’il allait leur arriver une méchante aventure.
Ils ne s’enfuirent point longtemps. Derrière eux, les ouvriers terrassiers s’étaient levés et les avaient suivis de si près que, sitôt que ces messieurs du bourreau furent retournés ceux-ci leur tombèrent dans les bras.
La force de M. Prosper était respectable et il fallut trois ouvriers terrassiers pour le réduire au silence et à l’immobilité, cependant qu’un seul de ces honnêtes manœuvres suffisait à faire entendre raison à M. Denis.
La raison que faisait M. Denis était alors des plus mélancoliques. Il réfléchissait que le nouvel état où il venait d’entrer et dans lequel il s’était flatté de goûter un repos relatif et, pour le moins, une tranquillité parfaite, ne présentait point dès l’abord tous les avantages qu’il avait imaginés.
Depuis quinze jours, il apprenait par les soins de M. Prosper à faire décemment des nœuds solides, à ficeler les poignets comme il sied et à entourer les jambes ; il avait cru, cette nuit-là, le moment venu de prouver à son professeur que tant d’excellentes leçons n’avaient pas été perdues et c’est lui-même qui était ficelé, noué, entraîné ! Et si bien, ma foi, que, puisqu’il avait une certaine connaissance de cette sorte de travail, il ne pouvait s’empêcher de l’apprécier et de déclarer en son pauvre a parte qu’il n’eût pas mieux fait.
Couchés l’un près de l’autre, chacun sur une table, M. Prosper et M. Denis ne pouvaient correspondre que par leurs regards qui étaient attristés. Leurs yeux se dirent leur inquiétude quand leurs deux corps furent soulevés avec mille précautions.
Que voulait-on faire d’eux ? Quel allait être leur sort ?
Ils virent qu’on soulevait la trappe de la cave et peut-être pensèrent-ils que leur dernière heure était venue, car, sous leurs bâillons, ils soupirèrent. Ils ne furent un peu rassurés que lorsque, étant descendus tout au fond de cette cave, ils aperçurent sur le sol fangeux, à la lueur d’une lanterne brinqueballée par l’un de leurs oppresseurs, ils aperçurent, disons-nous, trois autres corps liés comme eux, mais auquel il ne paraissait point qu’on eût ôté la vie. Et ils remercièrent le ciel que, dans leur malheur, ils eussent, au bout de cette incroyable aventure, trouvé de la compagnie.
Au-dessus d’eux, la trappe venait de se refermer. Il n’y eut plus, autour de M. Prosper et de M. Denis, que de la nuit et du silence. Ils essayèrent de remuer et de se faire entendre de leurs compagnons de captivité, mais c’est tout juste s’ils sortirent de leurs bâillons un inutile vagissement, et les mouvements qu’ils tentèrent ne firent que resserrer les nœuds de leurs liens.
M. Denis était poursuivi par cette idée que la position qu’il occupait sur le sol fangeux de la cave était bien dangereuse pour sa santé, et il redoutait déjà d’attraper quelque mauvais rhume qui, tôt, dégénère en cette vilaine toux, laquelle avait conduit ce pauvre Marquis de l’échafaud dont il vivait, à son lit où il mourut.
On a facilement reconnu le Vautour et Patte d’Oie dans les vêtements dont ils s’étaient affublés pour ressembler le plus possible à M. Prosper et à M. Denis. Avouons qu’ils y avaient réussi.
Mais maintenant, le plus difficile de leur besogne restait à faire. Elle ne les effrayait pas. Le Vautour et Patte d’Oie, que nous apprendrons à mieux connaître, n’avaient peut-être jamais osé un travail aussi audacieux, mais ils en avaient réussi de plus difficile.
Ce n’était cependant point chose banale que de se substituer aux aides du bourreau pour sauver Desjardies.
Le Vautour et Patte-d’Oie sortirent du Lapin-qui-fume par le passage de la Folie-Regnault.
Arrivés dans la rue de la Folie-Regnault, ils trouvèrent la rue barrée par une ligne de fantassins, baïonnettes au canon.
Les soldats semblaient garder une sorte de bâtisse qui avait bien la silhouette la plus bizarre et la plus sinistre du monde. D’abord, elle n’avait pas de fenêtre, elle n’avait pas de porte visible. On y accédait par un large porche qui donnait sur une cour.
Cette bâtisse semblait n’avoir que des murs et un toit. Mais quel toit ! Les choses doivent avoir leur destin, comme les hommes. La destinée de ce toit devait être certainement d’abriter le couteau de la justice ! Il l’annonçait à tous les passants, il le proclamait avec orgueil, il l’attestait hautement.
C’était, en effet un toit très haut, très aigu, taillé en biseau. Comme toit, il était absurde ; comme gardien gigantesque de la guillotine, il était logique. C’est là que le bourreau, entre deux exécutions, rangeait son mobilier.
Or, cette nuit-là, des baïonnettes gardaient ce toit-couteau. Ceci ne s’était jamais fait et le Vautour en marqua quelque étonnement, mais il ne s’attarda pas à demander d’explications et il franchit sans encombre, avec son ami, le cordon de soldats qui avaient reçu la consigne de ne laisser passer personne se dirigeant du côté de la rue de la Roquette, excepté le bourreau et ses aides.
Ils avaient été reconnus tout de suite.
Quand ils furent passés, ils entendirent un sergent qui disait :
– Ce sont les aides du bourreau !…
Et quelques soldats, qui les avaient frôlés, firent entendre des paroles de dégoût.
– Ça va bien, fit le Vautour à Patte-d’Oie.
– Oui, chef ! obtempéra Patte-d’Oie.
– Appelle-moi Prosper… Monsieur Prosper… Moi, je t’appelle Denis…
Patte d’Oie parlait avec un certain respect au Vautour et, à l’entendre, il n’était point difficile de deviner que le Vautour tenait une place prépondérante dans cette formidable organisation à la tête de laquelle se trouvait R. C.
Le Vautour portait son pardessus sur le bras malgré la rigueur de la température. Cependant il semblait se défier de celle-ci, puisqu’il avait le cou et le bas de la figure entourés par un énorme cache-nez de laine noire ; il tenait la tête baissée, de sorte que les bords de son chapeau achevaient de dissimuler sa physionomie. Ce qu’on en pouvait apercevoir ressemblait singulièrement à M. Prosper, et le bourreau devait, selon son plan, forcément s’y tromper, d’autant mieux qu’il était de notoriété publique qu’il était myope comme une taupe ce brave M. Hendrick, exécuteur des hautes œuvres de Sa Majesté. Il avait même demandé la permission, les nuits d’exécution de porter lunettes ; mais l’administration le lui avait interdit, ne pouvant se résoudre à avoir un bourreau à bésicles.
Le Vautour devait s’arranger, du reste, pour ne pas se trouver face à face avec lui… Il avait pour cela bien des chances, car la besogne qui lui était départie, et qu’il avait apprise sur le bout du doigt, s’accomplissait les trois quarts du temps en tournant le dos au bourreau, et en silence.
Cependant, le Vautour et Patte-d’Oie furent tout étonnés, en débouchant place de la Roquette, d’entendre des coups de marteau. Est-ce que l’édification de la guillotine n’était point achevée ?
À cette époque, ce n’était pas, en effet, une petite affaire car la guillotine avait encore un échafaud, où l’on accédait par quelques marches. Seulement, pour la monter, le bourreau disposait d’une équipe exceptionnelle qui a disparu aujourd’hui. Le Vautour dit à Patte-d’Oie :
– Tu vas te mettre en avant, pour tout. C’est toi qui demanderas des explications si c’est nécessaire et qui parleras au bourreau… Il ne sera point étonné d’une faute que tu peux commettre ou de l’ignorance dans laquelle tu te trouveras de certains détails… C’est ta première exécution, ne l’oublie pas… Il t’a vu une fois chez lui, et une autre fois en pleine nuit, tout à l’heure, quand vous avez monté l’échafaud… Allons ! Du courage et du coup d’œil !… Avançons !…
– Entendu, chef !…
– Tu as ton revolver tout prêt ?
– Tout prêt !
– Tu ne t’en serviras, si c’est nécessaire, que sur un regard de moi… Mais j’espère que tout va bien se passer… Et n’oublie pas que le Maître te regarde travailler !…
– Le Maître sera content, fit Patte-d’Oie.
Tous deux traversèrent la place, tournèrent autour du fourgon qui était là, tout près, pénétrèrent dans le cercle de gendarmes, de soldats et de gardiens de la paix. D’un coup d’œil, le Vautour s’assura que le service d’ordre avait été disposé comme Dixmer l’avait fait savoir, presque toutes les forces, soit autour de l’échafaud, soit du côté de la rue de la Roquette, dans sa partie haute et dans sa partie basse…
Une seule barrière, un seul cordon d’une quinzaine d’hommes, barrait, au coin de la prison, la rue de la Vacquerie. Enfin, le cercle armé qui se trouvait autour de l’échafaud s’éclaircissait jusqu’à la porte de la prison. Là, à droite de cette porte, faisant la haie, trois soldats dont les coudes ne se touchaient même pas.
Les coups de marteau retentissaient toujours. L’homme qui les donnait sur l’un des pieds de la machine se releva et fit un signe quand il aperçut ses aides. Le Vautour et Patte-d’Oie allèrent à lui sans hésitation. C’était le bourreau. Il descendit l’escalier de l’échafaud et rejoignit ses aides. Il avait une lourde masse dans une main et un niveau d’eau dans l’autre.
– Ce n’est rien ! dit-il. Elle n’était pas tout à fait d’aplomb. Et vous, Denis, demanda-t-il, macabre, à son nouvel apprenti, vous sentez-vous d’aplomb, vous ?
– Mais oui, monsieur, répondit Patte-d’Oie.
Le bourreau leva la tête et regarda Patte-d’Oie. Les deux compagnons sentirent qu’ils touchaient là à un moment décisif… La nuit était encore épaisse, à peine éclairée de la lueur falote des réverbères.
Après un court silence, le bourreau dit :
– Bah ! Vous verrez !… On s’y fait…
Et puis, il ne dit plus rien ; il jeta sa masse, il déposa le niveau d’eau et consulta sa montre.
– C’est l’heure, dit-il. Entrons.
Le bourreau et ses deux aides se dirigèrent vers la porte de la prison…
VII – UN HOMME QUI ATTEND QU’ON LE TUE
Le plus ordinaire argument de ceux qui se sont donné la mission agréable de travailler à la suppression de la peine de mort est l’inéluctable fatalité de l’erreur humaine.
Il vaut qu’on s’y arrête, non point à cause de sa valeur philosophique qui est à peu près nulle – en effet, il importe peu pour l’exemple qui doit être servi à la foule que le condamné soit coupable ou non, si, étant cru coupable, il est châtié – mais à cause du réel malheur personnel qu’il y a pour un homme qui est un honnête homme à se trouver, sans y avoir été préparé, aux prises avec le bourreau.
Cette considération, malgré sa banalité, est celle qui frappe davantage, car enfin, si on a eu, personnellement, jusqu’alors la chance d’échapper à un aussi exceptionnel événement, comme, après tout, il suffit d’un hasard pour qu’il se présente, on est porté, malgré soi, à imaginer l’horreur d’une telle situation.
Ce n’est point là, évidemment, l’objet d’une cogitation habituelle, mais que la lumière se fasse tout à coup sur un drame que la société avait expliqué à côté, d’où il était résulté qu’un monsieur avait été coupé en deux sans l’avoir mérité, et voilà tous les cerveaux dans le crâne de l’honnête condamné.
Qui de nous n’a pas été dans ce crâne-là ? Qui de nous, en songeant à la possibilité de l’innocence d’un homme que l’on va exécuter, n’a pas imaginé l’abominable et formidable angoisse de l’individu victime de l’erreur de cette brute magnifique et souveraine : la justice humaine !…
C’est dans ce crâne-là que je veux vous conduire. Nous allons pénétrer dans la cellule et dans le cerveau de Desjardies.
La cellule d’abord.
Il y avait à la Roquette trois cellules de condamnés à mort. Elles avaient été agencées spécialement lors de la construction de la prison, en 1834.
Elles étaient placées au rez-de-chaussée, au-dessous de l’infirmerie, ouvrant sur un petit vestibule que fermait une large porte peinte en noir.
Rarement ces chambres étaient occupées toutes trois. Il faut descendre jusqu’en 1885 pour les trouver insuffisantes, car il y eut alors jusqu’à cinq condamnés à mort à la fois, dont deux durent être logés en dehors du quartier.
Il est bon de savoir, pour l’histoire qui nous occupe, que, pendant tout le temps qu’il passait à la Roquette, le condamné à mort avait six gardiens attachés spécialement à sa personne. Ceux-ci en avaient la responsabilité et ne le quittaient qu’entre les mains du bourreau.
Ces gardiens avaient tous les jours deux fois quatre heures de présence auprès du condamné, alternant avec huit heures de repos.
En cellule, le condamné avait toujours deux gardiens auprès de lui, que l’on enfermait avec lui. Hors de la cellule, il était toujours escorté de quatre gardiens. Il sortait de sa cellule pour aller à sa promenade quotidienne, pour assister à la messe.
Ces quatre gardiens se disposaient ainsi : un de chaque côté, un par-devant, un par-derrière. Au mois de décembre 186…, il n’y avait qu’un condamné à mort à la Grande-Roquette, Desjardies. Il occupait la cellule du milieu.
La veille du jour où se déroulèrent les événements que nous avons commencé de narrer dans les précédents chapitres, vers quatre heures du soir, la porte de la cellule de Desjardies s’ouvrit et le gardien-chef, secoueur de clefs, un petit être sec et désagréable, toujours sur le qui-vive, ne songeant qu’à l’exécution parfaite de tous ses devoirs de police, redoutant par-dessus tout une chose horrible : une infraction au règlement. Il entra, suivi de deux gardiens.
– Allons, Desjardies ! dit-il. C’est l’heure de la promenade !…
Desjardies, qui était assis sur sa couchette, sembla sortir d’un rêve très lointain, fit un signe de tête au gardien-chef et se leva.
Desjardies portait le costume de la prison et malgré la veste grise trop large et le pantalon trop court, manifestait dans ses moindres mouvements une aisance élégante qui révélait tout de suite un homme qui avait dû appartenir à ce qu’on est convenu d’appeler la bonne société. Desjardies pouvait avoir cinquante-cinq ans. Comme il était très raisonnable, on lui avait épargné la camisole de force.
Était-ce seulement la terreur de la mort prochaine qui avait creusé les rides de son visage, cerné ses yeux, pâli ses traits ? Était-ce encore le remords de l’acte assassin ?
Était-ce réellement, comme il eût fallu le croire – si on l’avait cru innocent – le sentiment d’horreur et de désespoir qui le déchirait devant l’impossibilité de prouver cette innocence, car le malheureux n’avait cessé de la proclamer ?
Est-ce bien sur lui-même que cet homme pleure ?
Est-ce sur sa propre destinée qu’il recueille son désespoir ?
N’y a-t-il point pour lui quelque chose de plus affreux que son propre supplice ?
On pourrait le penser en entendant le râle qui gonfle sa poitrine quand il se lève de son grabat, en voyant de quel geste rapide et passionné il porte à ses lèvres une image que les geôliers lui ont laissée…
C’est l’heure de la promenade… Il glisse la chère image dans sa poche… Il suit les hommes qui l’attendent… Il est maintenant dans le vestibule.
Des portes que l’on ferme, d’autres que l’on ouvre… Un bruit de clefs, toujours, des verrous… Il se promène, encadré de ces quatre hommes qui le frôlent, qui continuent dehors la prison du dedans… Prison de chair, prison qui se promène avec lui…
Le voilà dans la petite cour du quartier des condamnés à mort… une petite cour carrée, la cour de la Bibliothèque.
Il y a là quelques mètres cubes d’air, assez pour ceux qui vont mourir, mais insuffisants à faire vivre ce tronc de marronnier et ces arbrisseaux qui, même au printemps, n’ont ni fleurs ni parfum… mais on dit au prisonnier : ce sont des lilas… Des lilas… Le mot seul en a déjà l’exquise odeur et évoque le printemps passé à la mémoire du malheureux qui n’en verra jamais plus…
Une galerie voûtée fait le tour de la cour, à la manière des cloîtres… C’est là-dessous que le prisonnier fait sonner ses lourdes galoches, quelque temps qu’il fasse, pendant une demi-heure.
La demi-heure est écoulée. Retour à la cellule. Voilà de nouveau Desjardies renfermé avec ses deux gardiens. Ceux-ci ne lui demandent point s’il veut faire une partie de cartes… Ils savent qu’il ne joue pas, qu’il ne s’intéresse à rien, à rien qu’à cette image qu’il a là, dans la poche extérieure de son paletot et qu’il va reprendre, pour la regarder, encore, encore…
Ah !… ce n’est pas un condamné amusant. Il y en a qui sont divertissants… qui trichent… qui connaissent des tours de cartes… qui racontent des histoires terribles, qui se vantent et qui, lorsqu’ils doivent mourir sur l’échafaud, ont cet orgueil devant leur geôlier de l’avoir mérité dix fois…
Il y en a qui se lamentent, qui ont des regrets, qui voudraient bien avoir le temps de devenir honnête homme ! Mais celui-là reste tout le temps muet, en face du portrait de sa fille…
– Tiens ! fait l’un des gardiens à son camarade en battant le paquet de cartes crasseuses… Tiens ! Regarde-le, le voilà encore avec sa photographie !
De fait, Desjardies s’est approché de la lanterne incrustée dans le mur où brûle, derrière un grillage, un pauvre lumignon, et il a ressorti le portrait. Il tourne le dos à ses gardiens et ceux-ci ne peuvent plus voir la stupéfaction inouïe qui se peint sur les traits du malheureux.
Les yeux agrandis, les doigts tremblants, se maîtrisant pour ne pas laisser paraître le frisson de fièvre qui l’agite, il regarde l’image… Est-ce bien l’image qu’il regarde… Mais non… c’est le dos de la photographie que fixent en ce moment ses yeux fous. Il ne regarde pas le portrait… Il lit… des mots… au crayon… Quels mots !
« Espérez !… On veille sur vous… on vous sauvera… mais ne vous étonnez de rien, quoi qu’il arrive, et surtout refusez d’être accompagné par le prêtre »…
Mots étranges !… Mots impossibles !
« Espérez ! On veille sur vous ! »…
Desjardies, ayant replacé la photographie dans la poche de son veston, répétait ces mots comme quelqu’un qui, en ayant depuis longtemps perdu le sens, se serait efforcé d’en retrouver la signification…
Se pouvait-il, en vérité, que le mot « espoir » eût encore affaire avec lui, Desjardies, au pied de l’échafaud ?
Espérer ! Mais il savait qu’il ne pouvait même pas espérer dans sa grâce ! Il savait que son pourvoi serait rejeté ! Et l’on voulait qu’il espérât !…
Et que voulaient dire ces autres mots plus mystérieux encore : « On veille sur vous ! » Ce on lui apparaissait comme une Providence dérisoire.
N’était-il pas abandonné de tous, excepté de sa fille, qui ne pouvait rien hélas pour le sauver ?… D’où lui venait ce on ? Et que pouvait faire ce on entre le bourreau et lui ? Et puis, pourquoi, dans ces heures sinistres, lui recommandait-on de se priver des suprêmes consolations du prêtre ?
Et puis, comment ces mots étaient-ils venus s’inscrire sur cette carte ? Depuis quand y étaient-ils ?
Il ferma les yeux pour réfléchir, et aussi pour qu’on ne vit pas qu’il y avait en eux une lueur nouvelle. Il dompta l’émotion qui lui chauffait le cœur, il commanda à ses mouvements, il se laissa aller négligemment contre le mur, croisa les bras et, dans la nuit de ses paupières closes, attendit de comprendre… Il se disait :
« Voyons, avant de sortir dans la cour pour la promenade, ces mots étaient-ils déjà sur la carte ?… Ai-je regardé le dos de la carte ?… Il me semble en effet que j’ai vu le dos de la carte… J’ai à chaque instant cette chère image dans la main… Je la tourne, je la retourne… je la caresse… j’aurais eu certainement l’occasion d’apercevoir ces signes… Est-ce bien sûr ?… Et puis, qui m’approche assez pour avoir pu, sans que je m’en sois aperçu, sans éveiller l’attention de personne, prendre cette carte dans ma poche, écrire, remettre la carte ?… Un gardien… il n’y a qu’un gardien qui a pu faire cela !… Lequel ?… »
Desjardies ouvrit les yeux. Les deux gardiens jouaient au piquet et ne le regardaient pas.
Rien, rien ne pouvait faire croire à Desjardies que l’un ou l’autre de ces hommes fût celui qu’il cherchait. Ils avaient été toujours aimables avec lui, mais tout juste comme le permettait le règlement.
Ils lui avaient laissé la liberté de se lever, de se coucher, de s’asseoir, de marcher. Ils lui avaient proposé des parties de cartes, ils lui avaient offert des cigarettes. Tout cela n’était compromettant pour personne, c’étaient là les ordinaires douceurs permises à un condamné à mort.
La société, dans les dernières heures de vie qu’elle accorde à un condamné, s’humanise. Elle n’hésite pas à mettre la main à la poche pour acheter le petit tabac et le pain blanc.
Ma foi, oui ! le condamné à mort a du pain blanc, et même du bouillon et du bœuf, tous les jours. C’est le régime de l’infirmerie.
Cet homme que l’on va tuer est soigné comme un malade. Et cela dure de 40 à 45 jours ! Il y avait quarante-quatre jours exactement que Desjardies était dans sa cellule…
Son regard maintenant faisait le tour de la pièce… Comment ? De quel côté ?… Par où allait lui venir le secours annoncé ?… Par la porte ou par la fenêtre ?… Le plafond s’entrouvrirait-il ?… Le parquet se soulèverait-il ?…
Hélas ! En admettant n’importe quoi, quel serait le résultat d’une pareille tentative ?… Est-ce que ses gardiens n’étaient pas toujours avec lui ? Au moindre mouvement, ils se précipiteraient sur le cordon de la sonnette, pendu là contre le mur… et l’on accourrait à leur secours…
Desjardies regardait encore cette salle si nette, si vide, si sonore qui était sa prison, où rien ne pouvait se cacher… ce parquet lisse, le poêle de faïence, la toute petite armoire où il avait enfermé ses habits à lui, les habits qu’on lui rendrait le matin du supplice, car enfin la société peut être bonne pour le condamné à mort sans pour cela gaspiller… Il y aurait gaspillage, si on tuait l’homme avec les habits de la société…
Il y avait encore, dans cette cellule carrée, très haute de plafond, une table, trois chaises de paille et un lit de sangle. La porte donnait, comme je l’ai dit, sur le vestibule ; la fenêtre, à deux battants, munie de barreaux et d’une trame métallique, placée très haut, donnait sur le premier chemin de ronde, car il y avait deux chemins de ronde à la Roquette. Sous la fenêtre du condamné à mort, dans le premier chemin de ronde, il y avait une sentinelle.
Desjardies secoua la tête, découragé ; il fit quelques pas, se laissa retomber sur sa couchette. La pensée de ces mots sur la photographie de sa fille ne le quittait pas…
Comment ? comment ?… Les gardiens précédents… L’un des quatre gardiens, au moment de la promenade ?… Il s’arrêta un moment à cette idée… Il crut qu’il allait peut-être pouvoir comprendre…
À la promenade, il avait un gardien devant lui, un par-derrière, un de chaque côté. Ceux qui étaient à ses côtés le touchaient presque, marchant du même pas que lui… Le quatrième gardien, par-derrière, avait la liberté de ses mouvements…
Il avait pu glisser sa main dans la poche extérieure de son veston, en tirer la carte, écrire pendant la promenade, presque tranquillement, derrière le dos des trois hommes… L’écriture au crayon était tremblée, inégale. L’homme avait dû écrire en marchant… Cela était possible…
Desjardies se rappela le visage de l’homme, du gardien qui aurait fait cela… une petite face pâlote, des yeux d’albinos, une moustache blond fadasse, quelqu’un qui semblait inexistant, sans personnalité, et quelqu’un qui ne lui avait jamais marqué aucune attention, même simplement curieuse…
Desjardies avait hâte de revoir cette figure insignifiante. Pour cela, il devait attendre au lendemain matin. Car déjà, oui, il reprenait espoir, il se bâtissait un roman d’espoir…
Ah ! maintenant, il croyait pouvoir comprendre comment les choses s’étaient passées ! Mais ce qu’il ne comprenait pas du tout, c’est que quelqu’un tentât une chose pareille pour lui !… Pourquoi ce gardien s’y risquait-il ?… Et qui, qui pouvait entreprendre cette chose formidable : faire évader un condamné à mort ?
Et pourquoi ?… Pour lui… lui, l’assassin Desjardies, qui avait assassiné Lamblin, qui avait été condamné comme tel et si bien cru coupable par tous, sur des preuves d’une si absolue évidence, qu’il s’était un moment demandé s’il n’allait pas, lui aussi, croire à sa propre culpabilité !… Sans sa fille, Gabrielle, certainement sa pensée, en une sombre folie, se fût ruée jusqu’à ce suprême désespoir : s’accuser soi-même, pour que son malheur fût parfait et n’eût plus rien à désirer.
Être un honnête homme, avoir été riche, élevé comme un fils de riche, et avoir été ruiné, ruiné jusqu’à se demander comment on pourra manger demain, et surtout comment on pourra faire manger sa fille, et n’avoir pas, pour cela, désespéré ! N’avoir plus rien que sa vertu, ses dix doigts, son intelligence et l’amour de sa fille, ce n’est pas un malheur : c’est un accident qui n’abat que les imbéciles…
N’avoir désespéré de rien, jamais, dans ses efforts être resté honnête toujours ! Et aboutir à l’échafaud !…
Quand Desjardies, de par le krach de la Caisse de chemins de fer, fut réduit à la mendicité du travail, il mendia. Car on le vit tendre la main à la porte des ministères.
Comme il savait l’anglais, l’allemand et un peu de turc appris dans sa jeunesse à Constantinople, on lui donna une place à Salonique. Une recommandation de Sinnamari, qui se trouvait à cette époque dans les bureaux de la chancellerie, et celle d’un sous-chef de cabinet, qu’il avait connu autrefois à Péra, le firent entrer dans la nouvelle société qui venait de se former des Chemins de fer ottomans, une entreprise immense à lancer.
Il partait comme sous-secrétaire de l’administrateur, et s’installait avec sa fille à Salonique. Six mois plus tard éclatait le scandale ; toute l’histoire de tripotages, de pots-de-vin, de l’achat des consciences et des votes, un flot de corruption qui montait jusque sur les gradins du corps législatif. Son chef, l’administrateur Pleumartin, très compromis, était rappelé, et Desjardies dut revenir en France avec lui…
Desjardies, dans sa belle honnêteté, n’avait rien soupçonné des affaires louches qui se manigançaient autour de lui et, naïvement, s’était fait quelquefois le commissionnaire d’une œuvre qu’il ne croyait point criminelle, demandant et fixant des rendez-vous dans des termes qui lui étaient imposés d’avance…
Dans l’éclat de l’affaire, cette correspondance, d’un intérêt secondaire, passa d’abord inaperçue… Elle n’apparut à l’horizon judiciaire que dans les circonstances tragiques qui conduisaient cet homme à l’échafaud.
Un matin, au Palais de Justice, dans le cabinet du substitut du procureur de la République, où il venait parce qu’on l’avait chargé charitablement de quelques traductions, on avait trouvé Desjardies un couteau, son couteau à la main, venant de frapper mortellement l’employé du parquet, Lamblin, qui avait la garde des dossiers des Chemins de fer ottomans.
Le cadavre de Lamblin était étendu devant le coffre rempli des précieux papiers accusateurs… Une liasse de ces papiers, qui n’avait pas encore été compulsée, semblait s’offrir à la main criminelle de Desjardies… et cette liasse l’accusait de complicité de chantage et de corruption de fonctionnaires !…
L’affaire était si formidablement simple et si directe qu’elle n’entraîna point un immense intérêt. Lamblin, un garçon fort aimé, fort estimé, fut plaint, et Desjardies condamné à mort… Il était innocent.
Quand on songe à la prodigieuse force intelligente de ces choses vagues qui vous entourent sans que vous les soupçonniez, qui vous menacent, qui vous guettent, qui accumulent au-dessus de votre tête le poids formidable des événements sans importance, de ces choses inadmissibles et mystérieuses que les anciens appelaient d’un seul nom : le destin, et auxquelles nous avons donné un autre nom : le hasard, on peut se demander si celui-là n’est point fou qui ose marcher parmi les hommes, le front haut, parce qu’il n’a rien à se reprocher !
Il ne sait point, le malheureux, qu’il a à se reprocher simplement d’avoir, un soir, simplement oublié son couteau sur une table ! Et puis, comme le destin-hasard passe son temps à s’amuser des hommes, donnant à ceux-ci la chance et à ceux-là la déveine, il s’arrangera fort habilement pour placer l’honnête homme « guignard » entre son couteau qu’il a oublié sur une table, un soir, un cadavre tout chaud et un coffre-fort entrouvert dans lequel il y a, justement, la raison d’être du crime qu’il n’a pas commis ! Et l’honnête homme sera condamné à mort !
VIII – LE ROI
Dans le salon dont les fenêtres donnaient sur la place de la Roquette, l’arrivée tant attendue du singulier amphitryon que les uns ne connaissaient que sous les initiales R. C., et que les autres appelaient déjà : le roi des Catacombes, semblait avoir changé en autant de statues tous les personnages présents. Puis, sur un geste de lui, empreint d’une grâce parfaite, sur un mot qui était à la fois une prière et un ordre, les statues étaient revenues à la vie, avaient fait les mouvements nécessaires pour s’asseoir à la place qui leur était indiquée…
Les mains pleines de fleurs qu’il venait de leur offrir et qu’elles avaient reçues sans un mot, sans un geste de remerciement, tant leur émotion avait été forte, les deux femmes s’étaient assises à côté du roi. Il leur parlait, elles l’entendaient, mais ne lui répondaient pas. Il dut en souriant les débarrasser de leur fardeau embaumé. Elles le regardaient.
Enfin, elles le voyaient, le roi Mystère ! Le roi des Catacombes ! C’était ce beau jeune homme si pâle, qui pouvait avoir au plus vingt-huit ans, aux grands yeux noirs à la fois si doux, si profonds, si attirants, si redoutables ! L’ovale de sa figure était parfait. Le front était harmonieux sous la volute légère de sa chevelure châtaine ; une mince moustache blonde ombrageait sa lèvre un peu relevée, dédaigneuse.
Ce qu’un tel visage pouvait offrir de trop charmant, de trop féminin, était immédiatement corrigé par le relief un peu accentué des pommettes, signe de ruse, et par le développement des muscles maxillaires, signe de force.
Il portait l’habit à la française avec l’élégance de jadis. Il avait la culotte de soie, les bas de soie. Un gilet de soie noire s’ouvrait sur une chemise à jabot d’une grande finesse qu’attachait une perle unique du plus grand prix. Il avait des manchettes de dentelle d’où sortaient des mains longues et fines, des mains de femme. Une cravate, une sorte d’écharpe de mousseline faisait plusieurs fois le tour de son cou et achevait de lui donner cet aspect délicieux qu’avaient les élégants d’autrefois… il y a deux cents ans… et cependant, dans ce costume d’un autre âge, il apparaissait jeune… jeune… C’était la jeunesse même, rayonnante de grâce, de force et d’espérance !
Seul, Sinnamari était resté debout, le sourcil mauvais, les yeux fixes, poursuivant de son regard de flammes l’audacieux qui osait jouer un pareil jeu devant lui, le procureur impérial.
– Monsieur le procureur impérial, ayez donc la bonté de vous asseoir, là, en face de moi !… pria le jeune homme.
– Monsieur !… commença Sinnamari.
– Monsieur, je ne vous écouterai que lorsque vous m’aurez fait l’honneur de vous asseoir à ma table…
Sinnamari fit, glacial :
– Mon devoir, monsieur, est de vous faire arrêter sur-le-champ.
– Au dessert, mon cher procureur, au dessert !… Chaque chose en son temps, répliqua R. C. en éclatant de rire. Que diable ! On n’est pas magistrat tout le temps ! Nous causerons d’affaires sérieuses au dessert ! Maintenant, il faut manger, il faut boire, il faut rire ! Nous pleurerons au dessert, je vous le promets.
Et il ajouta sur un tel ton de noblesse, de politesse raffinée que les deux femmes ne purent retenir un murmure d’admiration :
– Monsieur le procureur impérial, ce sont ces dames qui vous en prient.
Sinnamari, toujours debout derrière sa chaise, avait eu un mouvement d’hésitation. Maintenant, Marcelle Férand, Raoul Gosselin, Wat, Eustache Grimm suppliaient le procureur de s’asseoir. Quant à la Mouna, elle n’avait pas la force de parler.
– Auriez-vous peur, monsieur le procureur impérial ? demanda R. C. railleur. En ce cas, je vais donner l’ordre qu’on vous reconduise au milieu de vos agents.
Et R. C. avança la main sur un timbre que l’on avait mis à sa portée. Sinnamari rougit jusqu’à la racine des cheveux.
– Je n’ai peur de rien, monsieur ! Pas même de souper avec vous… Mais je vous préviens que je vous fais arrêter au dessert !
Et il s’assit.
– Encore ! reprit R. C. en riant de tout son cœur. Encore !… Oubliez donc pour un instant, monsieur le procureur impérial, ces vilaines préoccupations policières… elles sont tout au plus dignes d’un Dixmer… Ce pauvre Dixmer !… Vous avez vu dans quel état il était, mesdames !… J’espère qu’il n’a pas réussi à vous effrayer ?
– Oh ! Pas du tout ! s’exclama joyeusement Marcelle Férand. Moi, je suis tout à fait enchantée… j’adore les brigands…
– Et vous, mademoiselle, aimez-vous les brigands ? demanda R. C. à sa voisine de gauche.
Celle-ci répondit :
– Moi, monsieur, je suis la Mouna.
– Mes compliments ! répliqua R. C.
On rit. Le notaire lui-même rit, le greffier lui-même rit, Sinnamari sourit. Seul, Régine ne se dérida point. Il semblait le seul qui ne vît ni n’entendît. Depuis qu’il avait aperçu la guillotine sur la place de la Roquette, il n’avait même pas eu la force de continuer à se plaindre de l’étrange contrainte qu’il avait dû subir.
– Vous paraissez triste, monsieur Régine ?
C’était R. C. qui l’interrogeait.
Régine leva la tête et regarda l’homme qui lui parlait, comme s’il sortait d’un mauvais rêve…
– Moi ?…
Et la tête de Régine était si lugubre qu’on ne put s’empêcher encore d’en rire…
– Mais oui, vous, mon cher convive… Vous ne mangez pas… vous ne parlez pas !… Vous n’êtes pas malade ?…
Régine se recueillit un instant.
– Pourriez-vous m’expliquer, monsieur, finit-il par dire, pourquoi vous m’avez fait si brutalement enlever ?
– Moi ? s’écria R. C. Je vous ai fait enlever ?…
– Mon Dieu, monsieur, j’imagine que tout ceci s’est passé sur vos ordres… Ne suis-je point ici votre prisonnier ?…
– Mon prisonnier ! Que signifie ?… Personne n’est ici mon prisonnier !… Chacun est libre de s’en aller, comme chacun a été libre de venir. J’en appelle à tous mes convives… Mesdames ! Messieurs !
Il y eut un murmure de protestations joyeuses.
Sinnamari lui-même commençait à s’amuser. C’était un artiste dans son genre et il aimait le côté pittoresque des affaires les plus tragiques ; sa perspicacité naturelle, développée par une longue expérience de la magistrature, lui faisait penser que cette histoire pourrait bien ne pas toujours être aussi plaisante, mais cela ne l’empêchait point de se réjouir de la mine déconfite de Régine.
– Monsieur, déclara Régine, j’ai été l’objet d’une brutale agression, j’ai été enfermé pendant quatre heures dans une voiture, j’ai été amené ici avec un bandeau sur les yeux et un bâillon sur la bouche. Cela peut amuser beaucoup mes amis… Quant à moi…
R. C. ne le laissa pas continuer :
– Que me dites-vous là, mon cher hôte ? Mais c’est déplorable !… Mais c’est inexplicable !… Agréez toutes mes excuses… Ce sont là des manières que j’ai sévèrement interdites à mes gens…
Et il frappa deux coups sur un timbre… Un homme entra. C’était un petit vieux bien propre, habillé d’une longue redingote noire usée qui lui pendait jusqu’aux pieds. Il portait lunettes et paraissait fort myope. Il avait sous le bras un énorme livre à couverture verte et à coins de cuivre, comme on en voit dans les casiers de toute comptabilité qui se respecte.
– Ah ! vous voilà, monsieur le chef du contentieux ! dit R. C.
Et, se tournant vers ces dames :
– Vous m’excuserez, mesdames, mais je désirerais immédiatement tirer au clair cette déplorable histoire… Vous avez là le grand-livre ? reprit-il en s’adressant à l’homme qui se tenait à demi incliné, dans une pose pleine de respectueuse attente. Il est au net ? À quelle heure avez-vous transcrit le dernier rapport ?
– À l’instant, maître V. sort d’ici. Toutes les demi-heures, il doit venir rédiger un nouveau rapport sur l’affaire Desjardies et c’est moi-même qui transcris sur le grand-livre tout ce qui concerne personnellement les débiteurs.
– Bien. Lisez-moi le rapport Régine.
Le petit vieil homme glissa son doigt le long des pages du livre en disant entre ses dents :
– R… R… R… Ra… Ra… Ré… Régine… Régine, voilà… Faut-il tout lire ? demanda le chef du contentieux.
– Mais non ! seulement le dernier rapport Régine, répliqua R. C. sans impatience.
L’homme sauta cinq, six, sept grandes pages, ce qui prouvait aux yeux des moins observateurs que les rapports ne manquaient point sur le chef du cabinet du ministre de la guerre ; c’était si manifeste que tous les convives éclatèrent encore de rire, à l’exception toujours de Régine, qui se demandait s’il était réellement éveillé, s’il n’était point la proie de quelque cocasse et effroyable cauchemar… Que pouvait bien signifier ce chef du contentieux, ce grand-livre, où, lui, Régine, figurait comme débiteur ?
L’homme lut :
« Hier soir, j’ai commandé pour cette nuit, à minuit et demi, quatre hommes du deuxième peloton de la première compagnie des chasseurs noirs. Consigne donnée : enlever Régine à sa sortie du Théâtre-Français où il se rendra ce soir avec Mme Régine, soirée d’abonnement. Ne pas inquiéter Mme Régine, qui ne devra s’apercevoir de rien. Ramener Régine en voiture ; l’amener à quatre heures et demie au salon Pompadour. Les quatre hommes, après avoir consulté le dossier Régine chez l’archiviste, ont pris leurs dispositions et la consigne a été strictement exécutée. – N. B. Nécessité d’agir par la force avec Régine, qui ne serait jamais venu de son plein gré au salon Pompadour ; voir à ce propos le dossier, cote 125. »
Le chef du contentieux, ayant lu, se tut.
– C’est bien, monsieur, fit R. C.
Et le petit vieux s’en alla. R. C., tourné vers Régine, dit :
– Mon cher hôte, encore une fois, agréez toutes mes excuses ; je suis persuadé que mes gens ont eu tort ; je vous promets d’examiner dès demain la cote 125 de votre dossier, et, s’il ne m’est pas absolument démontré que, pour avoir le bonheur de vous posséder ici, il fallait employer des mesures aussi regrettables, les coupables seront sévèrement punis. Je leur avais pourtant bien recommandé de n’user de la contrainte par corps qu’à la dernière extrémité… Mais parbleu, ils auront trouvé la force plus facile !… Que ne s’est-on servi de la ruse vis-à-vis de vous comme pour M. le procureur impérial.
– De la ruse ! s’écria Sinnamari. Je suis venu ici de mon plein gré…
– Évidemment… Mais après que votre curiosité eut été éveillée par les rapports de Dixmer… Dixmer, depuis trois jours, n’a découvert de notre organisation, monsieur le procureur impérial, que ce que nous avons bien voulu lui en montrer… suffisamment pour que vous ayez été le magistrat le plus intrigué du monde… Vous êtes curieux et vous êtes brave, monsieur Sinnamari, vous êtes venu…
– Voudriez-vous dire… s’écria Régine.
– Oh ! Monsieur, interrompit immédiatement R. C., je vous sais aussi brave que notre cher procureur, mais vous êtes plus sensible… Et il était à craindre que la vue de la guillotine…
– Je suis aussi sensible que mon ami Régine, fit Marcelle Férand, et je vous avouerai que je vous en veux un peu du dessert que vous nous avez ménagé ! Vous teniez donc bien à nous montrer comment on guillotine un homme…
À ces paroles, R. C. se leva, alla à la fenêtre, souleva le rideau et, montrant à travers les vitres l’ombre sinistre de la machine de mort, dit sur un ton dont on ne saurait rendre la majesté :
– J’ai voulu vous montrer comment on ne guillotine pas un homme, madame !
IX – UN HOMME D’AFFAIRES
Tous les convives furent debout : Sinnamari et Régine poussèrent une sourde exclamation, Eustache Grimm fit : « Il est fou ! » Philibert Wat déclara : « Teramo Girgenti ne m’avait pas annoncé celle-là ! » Raoul Gosselin cria : « Épatant ! » La Mouna battait les mains d’enthousiasme, Marcelle Férand s’écria : « Bravo ! » Elle aurait embrassé R. C., tellement il lui apparaissait brave, beau, sympathique, dans ce milieu mondain de soupeurs, auxquels il annonçait tranquillement qu’il allait arracher un homme au bourreau !
Et cela devant le procureur impérial.
Celui-ci était déjà remis de son émotion. Un pâle sourire crispa ses lèvres mauvaises.
– Pour cela, monsieur, fit-il, il faudrait être plus fort que la mort !
Le roi des Catacombes le regarda longuement.
– C’est vrai ! finit-il par répondre. C’est vrai !… Je suis plus fort que la mort !… Je suis la Vie !…
Sinnamari n’avait pas même tressailli sous ce regard si grave, si grave, qui le fouillait. Il haussa les épaules :
– Mais faites donc comprendre à ces dames, monsieur, que ceci n’est qu’une pauvre plaisanterie… On ne plaisante pas avec l’échafaud. Vous êtes le premier qui osiez en rire devant moi, monsieur !… Puissiez-vous ne vous en repentir jamais !
Et Sinnamari s’avança à son tour jusqu’à la fenêtre. Son geste, lui aussi, montrait la terrible machine.
– Voyez-la, dit-il, elle est prête… Elle l’attend ! Rien ne peut le sauver d’elle. Regardez cette place, ces soldats, ces gendarmes, ce couteau debout sur le seuil de la prison… Dans une heure, quand les premiers rayons du jour viendront éclairer ces deux bras rouges, ces deux bras vengeurs de la société, ces bras de la justice, monsieur, Desjardies aura payé de sa tête la dette qu’il a contractée envers les hommes et envers Dieu !
– Dans une heure, répliqua R. C., dans une heure, la tête de Desjardies sera encore sur ses épaules… Et elle ne tombera que lorsque je le voudrai !
Devant cette phrase formidable, il y eut une rumeur… Le pouvoir que s’arrogeait cet homme extraordinaire de faire tomber une tête à l’heure de sa justice à lui dépassait tout ce que la plus folle imagination, nourrie des contes authentiques du banditisme d’autrefois, pouvait inventer.
Ah ! il y a eu les Fanandels, il y a eu les Chauffeurs, il y a eu Cartouche, maître de Paris, et Mandrin, maître de la province, des chefs admirables de cruauté et d’héroïsme, commandant de véritables armées, ayant dans l’État mille complices – ceci est historique – prenant d’assaut des villes et faisant la police des campagnes… De nos jours, il y a eu des bandes puissantes qui ont terrorisé des départements entiers, et, dans le Nord, une société, avec son organisation et ses chefs, qui était la véritable maîtresse de la frontière. Il y a eu des ligues politiques assez colossales pour être un État dans l’État et pour mettre en balance à un moment donné la fortune de la troisième République.
Oui, dans l’ombre ou dans la lumière, dans le mystère des vagues carrefours où s’élabore le crime ou dans l’éclat et le retentissement de la place publique où surgit la révolte, il y a eu des événements d’une audace surhumaine, conduits par des êtres qui, momentanément, s’étaient mis au-dessus de tout, et dont l’orgueilleuse volonté, l’outrecuidance splendide prétendaient se substituer à la loi, mais jamais un de ces surhommes n’osa dire tranquillement, au commencement d’un souper, à l’un des premiers magistrats du pays, en lui montrant par la fenêtre la silhouette de l’échafaud : « Votre échafaud, il est à moi !… »
Le roi des Catacombes vit la stupeur de tous, laissa retomber le rideau, prit la main des dames et les reconduisit à leurs places, et chacun regagna la table en silence. Régine regardait Sinnamari, lequel, jaloux de se montrer dans ces étranges circonstances aussi maître de lui que R. C. lui-même, affectait un grand sang-froid. Il s’assit et dit :
– Très amusant !…
Tout le monde fut étonné, en reprenant sa place à table, d’apercevoir, tout au bout de cette table, assis sur un haut tabouret, un singulier personnage qui était arrivé là sans qu’on sût comment ni pourquoi.
Il était fort petit, très remuant, faisant beaucoup de gestes inutiles qui pouvaient passer pour des tics, et si bizarrement conformé qu’il ressemblait plutôt à un gnome qu’à un être humain. Sa face, qui était celle d’un vieillard, était toute rose et toute grimaçante, exprimant une ironie à la fois féroce et enfantine.
Marcelle Férand lui adressa la parole et il ne répondit point. On l’entendait mâcher des paroles incompréhensibles dans un jargon étranger. Soudain, il grimpa sur son tabouret et l’on put voir qu’il n’était guère plus haut qu’une botte. Il étendit un bras décharné au-dessus de l’assistance stupéfaite et laissa tomber ces mots, qui furent salués par des rires éclatants :
– All right ! Mister Monte-Cristo, il était de la crotte de bique.
Et il se rassit et se mit à manger.
Cet incident comique, au milieu du drame qui se jouait, fut l’occasion pour Sinnamari d’une nouvelle ironie à l’adresse de son hôte.
– Tout cela, fit le procureur, comme dit très bien monsieur, que je n’ai pas l’honneur de connaître, est du roman-feuilleton. Au fond, il n’y a ici-bas qu’un homme qui croit vraiment en vous, c’est Dixmer !
– Monsieur le procureur impérial, répondit R. C. assez négligemment, si vous aviez cru Dixmer aussi fou que cela, M. le préfet de police ne l’aurait pas, cette nuit, chargé du service d’ordre et on n’aurait pas pris tant de mystérieuses précautions pour l’exécution. Dixmer est un habile et, sans qu’il s’en doute, il nous a déjà causé beaucoup d’ennuis.
– Que nous dites-vous là ? s’exclama ironiquement Sinnamari. Dixmer a été capable de causer des ennuis à Sa Majesté le roi des Catacombes ?
Et il eut un sourire presque insultant.
R. C. fixa Sinnamari et lui dit sur un ton d’une violence qui glaça les convives :
– Ne riez pas ainsi du roi des Catacombes… C’est un hôte généreux, M. le procureur impérial… et qui ne vous veut que du bien…
– Du bien !… Et quel bien peut-il donc me vouloir ?
– Est-il un plus grand bien pour un magistrat que celui d’être arrêté au moment où il va accomplir une épouvantable erreur judiciaire… où il va châtier un innocent ?…
– Une erreur judiciaire !… Desjardies !… Qu’en dites-vous, Régine ?
Sinnamari, tourné vers Régine, le voyait prêt à défaillir… Il n’attendit point que son ami eût recouvré l’usage de la parole…
– Nous l’avons surpris, M. Régine et moi, le couteau à la main, penché sur le corps encore tout chaud de sa victime. Que vous faut-il de plus ? Il n’y a pas d’affaire plus simple au monde… si simple, qu’il m’étonne, monsieur, qu’elle puisse vous intéresser ! Je ne sais qui vous êtes… Mais je le saurai, et il faudra alors vous bien tenir !… Je ne sais ce que vous voulez… mais je le saurai, et alors vous ne pourrez plus rien vouloir !… Les uns vous représentent comme un bandit de droit commun, auquel cas vous m’appartenez ; les autres vous représentent comme une sorte d’apôtre qui s’est donné la mission de rétablir la justice sur la terre, auquel cas vous m’appartenez encore, car il ne saurait y avoir d’autre justice que la mienne… Vous m’appartenez, et je vous aurai !… Mais, en attendant que j’entre en possession de votre mystérieux et intéressant personnage… laissez-moi vous donner un conseil… Occupez-vous aussi peu que possible de l’événement Desjardies. Il est trop tard pour qu’il puisse intéresser votre activité… Desjardies est mort et vous le savez bien !…
R. C. n’écoutait plus Sinnamari. Tantôt penché sur Mouna, tantôt vers Marcelle Férand, il les entretenait des derniers événements parisiens. La Mouna ouvrait les yeux, la bouche, soupirait. La tragédienne s’amusait divinement. Elle croyait faire un rêve dont R. C. était le héros. Elle se plaisait à s’imaginer que toute la puissance réelle, personnifiée par Sinnamari, était enfin tombée sous la domination de la puissance idéale, personnifié par R. C. !
R. C., un bandit de droit commun !… Allons donc ! Il suffisait de le regarder pour être transporté par l’éclat de son courage, de sa franchise, de sa vertu ! Quelle audace brûlait dans ses yeux ! Quelle foi en lui-même !
Elle se disait tout cela, et puis encore que, ma foi, si ce héros fantastique était un peu bandit par-dessus le marché, cela ne déparerait point l’image !… Ah ! le beau bandit-roi qu’elle avait là, à ses côtés !…
Le plus admirable était que cet homme, qu’on n’avait jamais rencontré nulle part, connaissait Tout-Paris mieux qu’elle, avec des anecdotes extraordinaires sur chacun et aussi sur les petits potins de coulisses. Il lui fit mille compliments sur la façon dont elle avait triomphé dans les Martyrs.
– Mais vous n’étiez pas là ! s’exclama-t-elle, heureuse.
– Si, fit-il, je suis à toutes les premières. Je suis allé vous féliciter dans votre loge… Seulement, vous ne m’avez pas reconnu…
La tragédienne croyait bien qu’il se moquait, mais elle n’en était pas bien sûre. Ce fut elle qui revint à l’affaire Desjardies…
– C’est vrai, c’est bien vrai, demanda-t-elle, que vous allez empêcher ce pauvre homme d’être exécuté ?
– Mais oui ! il n’y a rien de plus simple !…
Sinnamari dit :
– Demandez donc à notre hôte, chère madame, qu’il vous explique comment il va s’y prendre. Cela nous fera passer quelques minutes…
Sinnamari regarda sa montre et il se répéta mentalement :
– Que fait donc Dixmer ?… S’il ne revient pas avec ses hommes, moi, je reste. Je ne lâche pas R. C. avant qu’on n’ait mis la main dessus. S’il est nécessaire, je l’arrêterai moi-même…
Et il tâtait son revolver, dans sa poche.
– Mais oui, rien de plus simple ! reprit R. C. Tenez ! En ce moment, les aides de bourreau sont en train de souper au Lapin-qui-Fume…
– Qu’est-ce que c’est que ça, le Lapin-qui-Fume ?
– Un petit cabaret qui, depuis trois heures, est plein de mes hommes… Mes hommes qui ont mission de s’emparer des aides du bourreau !
Sinnamari s’était levé en entendant ces dernières paroles… Il étouffa un juron et courut à la porte.
Mais, là, il se heurta à une véritable barrière humaine, quatre poitrines devant lesquelles il recula.
– Monsieur, s’exclama-t-il, vous m’avez dit tout à l’heure que j’étais libre de sortir…
R. C. répondit, sans tourner la tête :
– Tout à l’heure, je vous ai dit cela, oui, monsieur !… Mais, maintenant, je vous dis qu’il faut rester !…
Sinnamari voulut courir à la fenêtre, prêt à l’ouvrir, à briser les carreaux, à appeler. Deux valets de pied, debout devant la fenêtre, l’empêchèrent d’en approcher. Le procureur impérial était prisonnier du roi des Catacombes !… C’était à ne pas croire !… Sinnamari ne le croyait pas encore ! Il ne put dompter la colère qui bouillonnait en lui ! Il appela Régine et ses amis à son aide, il sortit son revolver…
Tous les convives, à nouveau, s’étaient levés… Seul, R. C. n’avait pas bougé de sa place. Comme par enchantement, le salon s’était soudain rempli de laquais impassibles qui se tenaient immobiles derrière les invités, dans un silence menaçant.
– Bah ! fit Raoul Gosselin. Vous voyez bien, mon cher procureur, qu’il n’y a rien à faire…
R. C. montrait au procureur le siège qu’il avait si brusquement quitté. Sinnamari s’assit, vaincu momentanément, le cœur en tumulte, se disant que cette plaisanterie aurait une fin et « son tour », à lui, viendrait. Chacun fit comme Sinnamari.
Du reste, le service reprenait… On apportait sur un plateau d’argent une lamproie magnifique.
– Mais enfin, demanda Marcelle Férand quand l’émotion causée par cette chaude algarade fut un peu calmée, nous expliquerez-vous pourquoi vous vous intéressez si fort à ce Desjardies ?
– Je croyais, madame, l’avoir déjà fait entendre, répondit R. C.
– Vous avez parlé d’erreur judiciaire ! Desjardies serait donc innocent ?…
– Ma foi, je n’en sais rien !…
– Mais alors, on ne vous comprend plus du tout !…
– Il est possible qu’il soit innocent, répliqua R. C., sa fille prétend qu’il l’est et que si on lui accorde un mois, un pauvre mois encore de la vie de son père, elle apportera la preuve de cette innocence…
– Mais avec votre système, répliqua la tragédienne très intéressée, on ne laisserait jamais la justice suivre son cours et les méchants ne seraient jamais punis…
– Avec le système de votre société, madame, on peut très tranquillement trancher la tête d’un parfait honnête homme… Depuis la condamnation de Desjardies, depuis que son pourvoi a été rejeté, depuis, en un mot, qu’il est à la disposition du bourreau, Mlle Desjardies a découvert un fait nouveau… Oh ! Un fait nouveau qui n’a rien de juridique et qui ne saurait légalement entraver le cours de la justice, mais un fait nouveau qui devrait suffisamment impressionner tout personnage de bonne foi pour faire retarder le supplice. Mlle Desjardies a tenté de se faire entendre… Elle a frappé à votre porte, monsieur le procureur impérial… à celle du chef de l’État… Elles sont restées closes…
– Et alors… elle est venue frapper à la vôtre, qui s’est ouverte ? demanda Marcelle Férand. Mais où est votre porte à vous ?…
– Oui, donnez-nous votre adresse ! s’écria Raoul Gosselin, car, après tout, on ne sait jamais ce qui peut arriver… avec la justice…
– Non, on ne sait jamais, fit R. C. Mlle Desjardies non plus ne savait pas… elle ne savait pas que je suspendrais un jour au-dessus de la tête de son père le couteau du bourreau… Tout arrive…
– Alors Mlle Desjardies était votre cliente ? demanda en tremblant la Mouna, tout étonnée de sa propre audace, effrayée d’entendre le son de sa voix.
– Mais oui, madame, ma cliente…
– Votre cliente ? reprit Marcelle Férand. Qu’est-ce que vous vendez donc, monsieur le roi ?
– Beaucoup de choses, fit R. C. mais j’essaie de vendre surtout un peu de sécurité pour ceux à qui on la refuse…
– Vous êtes la Providence !
– Non !… Je suis une assurance… voilà tout…
– Ah ! très ingénieux !… Une assurance… Mlle Desjardies était assurée chez vous ?…
– Mon Dieu, oui !…
– Et comment s’était-elle assurée ? Nous voulons savoir… racontez-nous tout !
– Tout ! Oh ! c’est court. Mlle Desjardies habitait avec son père dans un hôtel de Montmartre, l’hôtel de la Mappemonde… Leur appartement donnait à côté d’une chambre occupée par un de mes amis… Cet ami leur parla de moi un jour où la conversation roula sur la fatalité de l’existence. Il leur dit qu’il était bien tranquille depuis qu’il avait contracté une assurance dans une compagnie… « Une assurance contre quoi ? » demandèrent-ils. « Une assurance contre tout ! » répliqua mon ami, et il montra sa police d’assurance. M. et Mlle Desjardies rirent beaucoup en voyant cette police, mais comme mon ami disait à Mlle Desjardies qu’une telle assurance, pour elle, ne lui coûterait pas plus de cent sous, elle signa…
– Et elle donna les cent sous ? demanda la Mouna…
– Non ! elle ne donna pas les cent sous… car elle pensait que tout cela n’était qu’un jeu. Le jour même, mon ami la conduisit chez mon notaire, où elle se rendit en riant toujours… mais le lendemain, son père était arrêté, accusé d’assassinat… Heureusement pour elle, mon ami songea à payer l’assurance… sans quoi le contrat n’était pas régulier, je ne le considérais point, moi, comme valable, et je laissais exécuter Desjardies…
– Vraiment pour cent sous !… Je ne vous crois pas, dit Marcelle. Qu’est-ce que vous pouviez bien lui promettre pour cent sous ?…
Le roi des Catacombes offrit des cigarettes d’Orient à ces dames, pendant que ces messieurs allumaient des cigares, et prenant une cigarette lui-même, se disposait à fumer quand il arrêta son geste.
– Me Mortimard, fit-il.
Le notaire sursauta sur sa chaise. Il regarda R. C. les convives, son assiette, puis Sinnamari. Enfin, revenu à lui, il toussa et dit :
– Sire !
– Vous avez apporté le contrat Desjardies ? demanda R. C. qui souriait, avec la tragédienne et la Mouna, de l’ahurissement du respectable tabellion.
– Oui, sire.
– Eh bien, lisez-le nous !
Me Mortimard se leva, alla chercher sa serviette qu’il avait déposée sur une assiette, derrière lui, se rassit, ouvrit le vaste maroquin et en tira une « chemise » d’où il sortit une feuille de papier timbré et lut de ce ton nasillard et indifférent qu’affectent souvent les hommes de loi :
« Entre Mlle Louise Gabrielle Desjardies, demeurant à Paris, Hôtel de la Mappemonde, rue Lepic, et M. Valentin Cousin, demeurant à Paris, 32 bis, rue Linné, agissant au nom et comme représentant de la compagnie d’assurances A. C. S., ayant son siège légal, 32 bis, rue Linné, et son siège réel dans les catacombes de la ville de Paris, constituée suivant acte reçu par Mortimard, notaire à Paris, le 15 janvier 186…
» Et ce, en vertu de la procuration qui lui a été donnée par les membres du conseil d’administration de cette compagnie, aux termes d’un acte reçu par ledit Me Mortimard, notaire à Paris, le 23 février de la même année.
» Il a été convenu ce qui suit :
» M. Valentin Cousin a, par les présentes, déclaré assurer, pour une somme de cinq francs par an, Mlle Gabrielle-Louise Desjardies contre tous les risques injustes de l’existence résultant uniquement de l’intervention des pouvoirs publics.
» La compagnie A. C. S. (Association contre la société) prend à sa charge les risques et périls qui menacent et frappent injustement l’assuré et provenant de toute molestation, outrage, négligence, manque d’exactitude de la société dans l’accomplissement du devoir administratif, non-reconnaissance des droits, atermoiements injustifiés de requêtes valables, atteinte à la liberté morale ou physique de l’individu et, en général, provenant du mauvais fonctionnement de tous les rouages sociaux.
» La Compagnie A. C. S. s’engage à faire cesser dans le délai de deux mois tout préjudice de ce genre dont aurait à souffrir la demoiselle Desjardies, soit par une intervention efficace auprès des pouvoirs publics, soit par le versement d’une somme équivalente autant que possible au dommage causé.
» Toute rectification de préjudices du genre qui a été défini ci-dessus, demande de règlement et notification devra être adressée à Me Mortimard, notaire à Paris, quai Voltaire, qui le fera parvenir à qui de droit.
» Ces requêtes préjudicielles seront examinées dans les douze heures par le tribunal de paix des Catacombes, qui statuera en dernier ressort, soit sur l’action à entreprendre vis-à-vis des pouvoirs publics, soit ensuite sur les résultats pratiques de cette action concernant l’intéressé, soit sur les dommages et intérêts à fixer.
» Les assureurs et assurés s’engagent, en outre, à se conformer aux lois et règlements des Catacombes, relatifs spécialement à la présente assurance, et dont il leur sera fait communication avant la signature du présent engagement.
» Passé par devant Me Mortimard, notaire à Paris, quai Voltaire. Fait et signé double, le … juin 186… Gabrielle Desjardies et, pour la Compagnie A. C. S. Valentin Cousin. »
– Tout cela pour cent sous ! fit la Mouna, et elle dit cela si drôlement que tout le monde éclata de rire.
R. C. lui-même parut s’amuser beaucoup de la réflexion de la Mouna. Cependant, il lui dit :
– Il y en a qui ont payé un million !…
– C’est cher ! fit encore la Mouna. Alors, c’est trop cher. Un million !
– Tout dépend de la fortune. Ça n’est rien pour Teramo-Girgenti.
– Vous pratiquez l’impôt sur le revenu ! observa Raoul Gosselin.
– Et aussi l’impôt forcé ? demanda Marcelle Férand, en souriant à R. C.
– Quelquefois ! répondit R. C. simplement. Mais n’est-ce pas là privilège de roi ?… Voyez-vous, moi, je désire que tout le monde vive, du moins tous ceux qui m’intéressent. Alors, quand j’ai trop de pauvres… je fais dire un mot à mes riches…
– Vous êtes délicieux ! interrompit Marcelle Férand. Vous êtes un bandit tout à fait civilisé, monsieur le roi !… Vous ne me faites pas peur du tout !…
– À moi non plus, gémit amoureusement la Mouna.
– Pourquoi vous ferais-je peur ? Je suis un homme d’affaires, tout simplement. Et je ne demande qu’une chose, c’est à augmenter honnêtement ma clientèle.
Marcelle Férand battit joyeusement des mains.
– Je veux en être !…
– Moi aussi ! dit la Mouna.
Et la tragédienne pria Raoul Gosselin de lui payer une assurance.
– Hum ! fit Gosselin, si Sa Majesté vous demande un million !…
– Non, madame, je ne vous demanderai qu’un peu de votre talent…
– Comment cela ?…
– Je vous demanderai une représentation des Martyrs pour les pauvres des Catacombes !…
– Oh ! parfait ! C’est entendu ! C’est promis ! s’écria l’artiste. Une soirée pour les pauvres des catacombes ! En voilà une histoire qui fera courir tout Paris ! Quand signe-t-on le contrat ?
– Vous pourrez passer demain à mon étude, madame, fit Me Mortimard.
– Non, répliqua R. C., Me Mortimard se dérangera. Nous vous ferons des contrats d’amis à vous, madame, et à Mlle la Mouna et nous les signerons joyeusement chez mon ami le comte de Teramo-Girgenti, le soir de sa pendaison de crémaillère…
» Mais, à propos de ce cher comte, continua R. C. en sortant son portefeuille et en se tournant du côté de Philibert Wat, il faut, monsieur, que je vous règle ce qu’il vous doit, car nous sommes en compte, Teramo et moi !… Et le roi des Catacombes remit au gendre du président du conseil un chèque de vingt-cinq mille francs.
– Chez Johnson ! dit-il. N’est-ce point votre banquier ?
– Parfaitement, répondit Philibert.
– Eh bien ! c’est le mien aussi ! Voyez comme ça se rencontre !
– Cartouche a un banquier ! s’exclama Marcelle Férand.
– Cartouche est mort sur la roue, fit Sinnamari d’une voix sinistre.
– Le Christ est mort sur la croix ! dit R. C. d’une voix grave.
– Singulier rapprochement, monsieur…
– Monsieur le procureur impérial, les bons et les mauvais larrons se donnaient la main au Golgotha.
– Plus de Golgotha… Il n’y a plus de croix, il n’y a plus de Christ, prononça Sinnamari d’un ton de plus en plus froid, mais il y a des gens qui se mettent hors la loi et que la loi punit. Desjardies a commis, en s’armant contre un homme sans défense, un crime moins grand que vous, monsieur, en vous armant contre la loi, et on lui tranche la tête !
– Non ! répliqua R. C. Non !… On ne lui tranche pas la tête…
– Je ne crois pas un mot de votre histoire d’aides du bourreau capturés, monsieur… Et en admettant même qu’elle soit vraie, cela ne saurait retarder le supplice ; le bourreau fera sa besogne tout seul !…
– Mais si Desjardies est innocent ! s’écria Marcelle Férand.
– Mais s’il est coupable ? répondit Sinnamari. Et les juges ont répondu à cette question !
Tout le monde se tourna vers R. C.
– S’il est coupable, je le rendrai à l’échafaud ! fit R. C. Cela vous étonne ? Je ne suis pas un anarchiste. Je suis un bon bourgeois qui fait honnêtement ses affaires… et celles des autres !… Je ne rêve pas de bouleverser la société ! D’en changer la forme de fond en comble !… Je ne rêve même point d’en accélérer la transformation vers un idéal de progrès, sur lequel les philosophes ne sont pas encore parvenus à s’entendre. L’échafaud existe… Tant pis ou tant mieux, cela ne me regarde pas. Ce qui me regarde, c’est qu’il ne serve pas à couper la tête à un de mes clients, si ce client a des chances d’être innocent ! Je l’ai assuré contre toutes les injustices résultant de la mauvaise volonté du pouvoir public se mouvant, normalement, dans un cadre social que je ne me permets pas de discuter ! Ce que je demande à toutes les administrations, quelles qu’elles soient, que ce soit l’administration de la peine de mort ou celle des bureaux de tabac, c’est qu’elles donnent à mes clients le maximum de justice auquel ils ont droit dans l’état actuel de la société ! Est-ce clair ? Desjardies avait droit à ce que l’on entendît sa fille, laquelle prétend avoir découvert un fait nouveau susceptible de modifier l’opinion que l’on s’est faite sur le crime du parquet de la Seine !… On ne l’a pas entendue !…
– Mais l’eût-on entendue, s’écria Sinnamari, l’entendrait-on maintenant que rien ne pourrait arrêter l’œuvre de la justice ! Il est trop tard !… Je voudrais moi-même dire à cette heure au bourreau : « Arrête ! », je ne le pourrais pas, car ma voix resterait sans effet ! Il faut que le panier d’Hendrick soit ouvert ou fermé. C’est la loi !
– La loi, monsieur, répondit le roi des Catacombes, ne s’opposait point à ce que l’on entendît Mlle Desjardies avant qu’il ne fût trop tard… Est-il possible, est-il naturel que vos portes et vos oreilles, messieurs des Pouvoirs publics, soient restées aussi prodigieusement closes aux cris de douleur et de pitié de Mlle Desjardies ? Vos domestiques, vos huissiers, vos laquais n’ont donc point trouvé de mots pour vous toucher avec le désespoir de cette malheureuse qui s’évanouissait dans vos antichambres ?… Qu’avez-vous fait de ces lettres sublimes auxquelles il n’a pas été répondu par le plus humble de vos scribes ?… Vraiment, monsieur le procureur impérial, ne trouvez-vous point cela bizarre, extraordinaire, inexplicable, que Mlle Desjardies, depuis la condamnation de son père, n’ait même point pu causer avec l’avocat de celui-ci ?
– Est-ce bien possible ? s’écria Marcelle Férand.
– N’ayant pu parler à Me Destalot, reprit R. C., dont la voix tremblait d’une généreuse indignation, Mlle Desjardies s’en fut trouver le bâtonnier, qui est encore un de vos amis, monsieur le procureur, et qui répondit qu’il ne pouvait rien pour elle, en l’absence de Me Destalot… Mlle Desjardies tenta de faire paraître une note dans les journaux, mais ceux-ci lui firent entendre que prendre la défense de Desjardies en ce moment, c’était avouer publiquement qu’on avait, comme lui, tripoté dans les chemins de fer ottomans…
– Elle n’avait plus qu’une chose à faire, dit Sinnamari qui s’était levé, elle n’avait plus qu’à s’adresser à vous…
– C’est ce qu’elle a fait…
Sinnamari éclata d’un effroyable rire. Sa main était tendue vers la fenêtre dont le rideau était relevé. Tous les yeux allèrent vers cette fenêtre, virent le trou noir de la place et puis des clartés en face de la porte de la prison, des clartés errantes, des lanternes qui tournaient autour de l’échafaud, déjà moins sombre dans la nuit touchée des premiers rayons du jour… On distinguait alors distinctement les silhouettes se mouvant dans l’espace réservé pour le supplice.
– Voyez ! continuait Sinnamari. Les reconnaissez-vous ?… Ils sont là !… Ils sont à leur poste, les aides du bourreau !… Prêts à faire subir sa peine à Desjardies, sa juste peine… Roi de pacotille !… Et la tête du père tombera avant qu’on ait entendu la fille !…
Sinnamari riait encore, quand R. C. se levant, le front rayonnant et les yeux pleins d’éclairs, s’écria :
– Faites entrer Mlle Desjardies !…
X – « TU TE RÉVEILLERAS D’ENTRE LES MORTS »
Le bourreau et ses aides étaient entrés dans la prison. Aussitôt qu’on avait passé la porte de la Grande-Roquette, on se trouvait sous un vaste portail qui abritait sur la droite le poste militaire. Il y avait là un local qui contenait à l’ordinaire une petite troupe de vingt-deux hommes commandée par un adjudant. À gauche, toujours sur le portail, s’ouvrait une loge pour le gardien-portier. Cette loge traversée, on se trouvait dans la cour d’honneur ou cour d’administration. Cette cour était entourée par les cuisines, à gauche, par des magasins, à droite, et, au fond, par le bâtiment de l’administration.
Toute la prison se composait de trois corps de bâtiments entourés par deux chemins de ronde indépendants. Le plan de cette prison avait été si bien établi que si, dans l’histoire de la Grande-Roquette, on relève quelques tentatives d’évasion, on ne saurait dire qu’une seule, jusqu’au jour qui nous occupe, ait réussi. En tout cas, l’administration n’en avoue pas.
Après avoir traversé la cour d’honneur, on accédait par un perron de quelques marches au guichet du greffe. C’était un vestibule carré d’où l’on pénétrait à droite dans les bureaux du greffe et de la comptabilité, à gauche dans le parloir, et au fond, dans la partie de la prison réservée à la détention proprement dite.
Quand on avait franchi le guichet du greffe, on se trouvait dans la cour centrale, vaste et carrée, occupée dans son milieu par une fontaine surmontée d’un réverbère. Cette cour servait deux fois par jour, à neuf heures et à quatre heures, pour la promenade en commun des détenus. Il ne faut pas confondre cette cour avec la cour des condamnés à mort, dans laquelle nous avons assisté à la promenade de Desjardies.
Entre cette grande cour et la petite cour des condamnés à mort, il y avait encore un poste occupé par une trentaine de soldats, commandés par un adjudant.
Les deux chemins de ronde, indépendants l’un de l’autre, étaient enclos entre des murailles de huit et neuf mètres !
Les hauts bâtiments contenaient, pour six sections, 272 cellules, et, au bout de chaque section cellulaire, il y avait un dortoir commun de vingt lits.
Nous avons établi dans un précédent chapitre de quelle façon les cellules des condamnés à mort étaient isolées de toutes les autres cellules. Nous voudrions maintenant faire comprendre au lecteur le chemin que l’administration de la Roquette faisait suivre aux condamnés à mort conduits à l’échafaud.
Le lugubre cortège, avant 1870, accomplissait un trajet interminable. Ce n’est qu’après 1870 qu’on avait adopté un nouveau trajet, qui ne fut plus modifié jusqu’à la démolition de la prison, et qui fut suivi par le dernier condamné à mort exécuté.
Le condamné à mort sortait du vestibule qui précédait sa cellule par la porte peinte en noir dont j’ai déjà parlé. Cette porte donnait sur un couloir qui passait derrière le corps de garde placé à droite, au fond de la grande cour. Sans que l’on ait jamais su pourquoi, on ne voulait pas faire traverser au condamné cette grande cour. C’est pourquoi on l’astreignait à la lugubre promenade par les dortoirs pour le faire aboutir enfin aux ateliers.
Il traversait ainsi trois ateliers, déserts à cette heure, et retombait dans un couloir. Au bout de ce couloir, il y avait une porte. Cette porte donnait dans l’arrière-greffe ; là, on le livrait aux aides du bourreau pour sa dernière toilette. C’est dans cet arrière-greffe, appelé aussi avant-greffe, que devaient l’attendre le Vautour et Patte d’Oie.
Nous avons dit comment on accédait au greffe par le guichet qui se trouvait au fond de la première cour. Quand le bourreau, le Vautour et Patte d’Oie arrivèrent sous le guichet, un gardien leur en ouvrit la porte. Le bourreau marchait en tête ; ses deux aides, tête baissée, suivaient.
Le bourreau demanda :
– Ces messieurs sont arrivés ?
– Oui, répondit le gardien, ils sont chez M. le directeur.
Sur quoi, le bourreau entra à droite dans le greffe, salua le greffier-chef qui était debout devant son pupitre, sur lequel était le registre d’écrou. Le greffier répondit d’un signe de tête, et Hendrick, sans un mot, alla signer sur le registre l’élargissement de Desjardies. À ce moment, il était déjà censé avoir reçu Desjardies, et c’est lui qui en devenait responsable.
Régulièrement, ou plutôt raisonnablement, il n’eût dû signer qu’au moment où il quittait la prison avec le patient, mais à cette minute suprême on avait jugé que c’était là faire perdre du temps au bourreau, et ainsi ajouter au supplice du condamné.
Le bourreau fit signe au Vautour et à Patte d’Oie qui étaient restés sous le guichet et qui, sournoisement, examinaient les lieux. Ce guichet était fermé par la porte qu’ils venaient de franchir, par la porte en face d’eux qui donnait sur la Détention et par là sur la grande cour. À gauche, ils avaient la porte ouverte du parloir, fermé dans son milieu par une double grille. À droite, la porte de l’arrière-greffe. Le greffe communiquait aussi par une porte sur l’arrière-greffe. Enfin, cet arrière-greffe avait, comme nous l’avons dit, une petite porte qui donnait à droite sur l’intérieur de la prison.
Le Vautour, d’un coup d’œil de maître bandit, avait jugé la situation et l’avait mesurée selon la disposition des locaux ; on n’eût pu deviner, au froncement de ses terribles sourcils, s’il était déjà prêt à accomplir le formidable coup d’audace qu’il préméditait, ou si l’examen des lieux ne lui donnait point à réfléchir sur les difficultés d’une pareille entreprise.
Patte d’Oie semblait, lui, n’avoir d’autre préoccupation que de se mettre devant son compagnon pour qu’il restât dans l’ombre ou pour empêcher qu’on pût trop facilement le dévisager. Du reste, il faisait à peine jour dehors et encore tout à fait nuit dans cette prison. Trois lampes, l’une sous le guichet, l’autre dans le greffe, l’autre dans l’arrière-greffe, répandaient une triste lumière jaune.
L’arrière-greffe, où se tenaient maintenant en silence le bourreau et ses aides, était une petite pièce étroite et longue, éclairée par les fenêtres placées haut, meublée d’un petit bureau noir, d’un poêle, d’un banc et d’un tabouret. C’est sur ce tabouret que s’étaient assis, depuis la construction de la Grande-Roquette, tous les condamnés à mort. Il était au milieu de la pièce, à côté du poêle. Il semblait déjà attendre…
Le poêle n’était jamais allumé qu’aux jours d’exécution. Ce jour-là, on entendait son ronflement et c’était le seul bruit que le Vautour et Patte d’Oie percevaient alors dans tout l’établissement.
Hendrick se promenait de long en large, les mains derrière le dos. Il ne regardait personne ni rien. Si, il regarda sa montre, et, dans le même moment, on entendit un grand bruit de pas et de portes ouvertes et refermées ; c’étaient les autorités qui venaient du dehors et qui se rencontraient dans la cour d’honneur avec les autorités venues du dedans.
Un groupe d’hommes, vêtus de noir sous des pardessus sombres, envahit le greffe. Le directeur de la prison était à leur tête. Il dit un mot au greffier et il se dirigea vers l’arrière-greffe, suivi de tout le groupe. Dans celui-ci, on reconnaissait le préfet de police, le commissaire de police du quartier, le juge d’instruction et derrière survenait l’aumônier. Comme ils traversaient l’arrière-greffe, le Vautour entendit le juge d’instruction qui disait au préfet de police :
– Je ne comprends pas comment M. le procureur impérial, qui devait venir, n’est pas encore arrivé…
Et le préfet de police répondait :
– M. le directeur de la prison a raison. On ne peut attendre plus longtemps.
Tout ce monde disparaissait par la petite porte qui faisait communiquer l’arrière-greffe avec la prison, quand le greffier, pris lui aussi d’une curiosité bien compréhensible, suivit le cortège.
À ce moment, il sembla à Patte d’Oie que la large poitrine du Vautour se soulevait, comme si on l’eût soulagée d’un poids énorme. Mais le Vautour, maintenant, regardait le bourreau, qui s’était arrêté dans sa marche-promenade. Celui-ci tournait le dos au Vautour et à Patte d’Oie. Ils se consultèrent du regard, et il n’était point difficile de deviner ce que ce regard signifiait. S’ils étaient restés seuls avec le bourreau, ils n’auraient pas hésité à sauter dessus. Mais il y avait encore le gardien dans le guichet… Ils l’entendaient remuer ses clefs. D’un geste, le Vautour fit comprendre à Patte d’Oie qu’il fallait être prudent. Et il haussa la tête, traduisant ainsi l’embarras dans lequel Hendrick le mettait en restant dans l’arrière-greffe avec eux.
C’est que le bourreau allait presque toujours avec les magistrats au-devant du condamné, se tenant sur le seuil de la cellule pendant que le directeur de la prison entrait avec le juge d’instruction. Pourquoi n’agissait-il point ainsi aujourd’hui ?
Certes, armés comme ils l’étaient, le Vautour et Patte d’Oie pouvaient tout réussir contre le bourreau et le gardien, surpris d’une pareille attaque. Mais il fallait agir en silence, et ne point compromettre par un scandale inutile une affaire dans laquelle il serait toujours temps d’employer la force ! S’ils employaient la force dans l’intérieur de la prison, cela n’irait point sans éclat, et l’intervention des soldats du poste aurait vite fait de réduire leur tentative à néant.
Le Vautour avait déposé son pardessus sur le banc. Hendrick, fatigué d’être debout, sans doute, était allé au bout du banc et, pour s’asseoir, avait repoussé le pardessus de la main. Quand il vit la main de Hendrick sur son pardessus, le Vautour pâlit.
Transportons-nous maintenant dans la cellule de Desjardies. Nous l’avions laissé, la veille de cette nuit dont nous retraçons les événements si bizarres, sous le coup de l’espérance que lui apportait l’inscription mystérieuse trouvée au dos de la photographie de sa fille. Était-ce bien l’espérance qui le tenait ainsi, anéanti sur cette couchette où il passait, immobile, presque tout le temps qu’on lui laissait à vivre ? N’y avait-il pas surtout de la surprise et de l’effroi dans le sentiment qui l’arrachait un instant à la vision hallucinante du dernier supplice ?
Oui, le premier mouvement de son cœur avait été de s’accrocher à cette folle promesse mystérieuse qui lui arrivait si étrangement au fond de sa prison. Mais, à la réflexion, il avait mesuré toute l’impossibilité d’une tentative quelconque…
À cette heure de la mort où l’on est disposé à croire à tout ce qui peut vous rattacher à la vie, Desjardies se dit : « N’y croyons pas !… Ne croyons plus à rien, qu’à la mort ! » Et il pria… Il pria comme lorsqu’il était enfant… Il pria pour sa fille.
Desjardies était resté religieux, sinon pratiquant, et, depuis qu’il était enfermé dans sa cellule de la Roquette, il avait toujours accueilli le prêtre, qui était venu lui apporter les consolations de son ministère, avec une joie reconnaissante.
Ce prêtre n’était point l’aumônier ordinaire de la prison qui, malade, était momentanément remplacé par un père récollet. C’était un bon vieillard du couvent de la rue de Puteaux, ami de l’aumônier, un ancien médecin qui avait eu beaucoup à souffrir de la vie et qui s’était réfugié dans la paix du couvent, ce vestibule du tombeau.
Desjardies lui avait, à lui aussi, crié son innocence, et il avait eu cette suprême douleur de voir que, lui aussi, croyait, malgré ses cris, à sa culpabilité.
Il ne lui disait point, mais Desjardies sentait bien que la pitié profonde qu’il manifestait pour son sort s’adressait uniquement au grand pécheur qu’il était devant les hommes et devant Dieu ! Alors, Desjardies demanda à se confesser. Le condamné se disait : « Peut-être cet homme va-t-il croire enfin que je ne mens pas à Dieu !… »
Il se confessa donc et le père Saint-François, cette fois, crut en effet à l’innocence de Desjardies. Quand le condamné releva la tête après avoir reçu une absolution donnée d’une voix tremblante, il vit que le père Saint-François pleurait.
Il alla trouver son ami l’aumônier, se pencha sur son lit et lui confia qu’en dehors de la confession dont il ne pouvait violer le secret, il s’était fait une conviction ferme et définitive sur l’innocence de Desjardies et il lui demanda ce qu’il pouvait tenter auprès des hommes pour leur éviter une épouvantable erreur judiciaire.
L’aumônier eut un triste sourire et lui conseilla de faire ce qu’il avait tenté deux ou trois fois lui-même dans des circonstances analogues : voir le garde des sceaux.
Le père Saint-François demanda à l’aumônier quel avait été autrefois le résultat de ses visites au garde des sceaux. On lui avait répondu : « C’est le vieux truc de la confession ; nous le connaissons !… »
– Et alors ? avait encore demandé le père Saint-François.
– Et alors il arriva que je finis par me dire, moi aussi : c’est peut-être le vieux truc de la confession… et qu’il me fut difficile, depuis, malgré l’accent le plus sincère, de croire profondément à ce qui m’était confié… Ma confiance était empoisonnée…
– Si vous aviez entendu cette voix-là, s’écria le père Saint-François, peut-être auriez-vous fait confiance à l’homme qui crie son innocence sans que personne l’entende ! Desjardies est innocent !
– Faites comme s’il l’était, mon père, répliqua l’aumônier.
Et le père Saint-François s’en fut trouver le garde des sceaux qui lui répondit en souriant « que cela devait fatalement lui arriver pour son premier condamné à mort. »
Le père Saint-François comprit qu’il ne lui restait plus qu’à préparer un martyr à la mort. Et il trouva, les jours suivants, le moyen d’apaiser l’angoisse de Desjardies, moins par des considérations sur la vie future que par la promesse qu’il lui fit de s’occuper de sa fille. Et c’est cet homme, en qui il avait mis sa foi dernière, que la mystérieuse inscription lui conseillait d’éloigner !
Qu’allait-il faire ? Devait-il croire réellement à une tentative d’évasion ? Non, c’était impossible ! Aussi, s’il y avait cru, comment s’y serait-il pris pour dire à cet homme, son dernier ami ici-bas et son suprême espoir après sa mort : « Allez-vous-en !… Je ne veux plus vous voir ! » ?
Comme il en était là de ses prières et de ses réflexions, Desjardies entendit du bruit à la porte de sa cellule ; celle-ci s’ouvrit et il vit que le gardien-chef s’effaçait pour laisser passer un personnage. C’était le prêtre… c’était le père Saint-François. Les gardiens suspendirent leur partie de cartes et se levèrent. Desjardies était déjà debout : il allait au père Saint-François qui lui tendait les deux mains et l’attirait sur sa rude poitrine.
Le moine embrassa le condamné et ils se mirent à pleurer tous les deux. Le gardien-chef haussa les épaules, prenant en pitié l’émotion du prêtre, une émotion de novice à ses yeux expérimentés, puis il referma la porte à clef et l’on entendit son pas qui s’éloignait dans la solitude.
Les deux gardiens s’étaient retirés discrètement dans un coin de la cellule. Desjardies, la tête sur la poitrine du prêtre, lui faisait la même question qu’il lui adressait tous les jours, à la même heure.
– Est-ce pour aujourd’hui ?
Et le père Saint-François faisait la même réponse.
– Nous n’en savons rien, mon fils… nous ne pouvons rien en savoir…
Et immédiatement, il le faisait se rasseoir, comme tous les jours, sur la couchette : il prenait une chaise et s’asseyait à son tour, en face de lui, et gardant les mains de l’homme dans les siennes, il le faisait parler de sa fille !…
Desjardies admirait sa fille comme un père et l’aimait comme une mère… Oui, elle avait été sa vie, et c’était très beau à ce prêtre qui avait reçu mission de Dieu et des hommes d’entretenir ce malheureux de sa mort prochaine, de consacrer au contraire ces heures suprêmes à l’entretenir des joies de sa vie passée !…
Tout à coup, il sembla que l’esprit de Desjardies était traversé par une pensée subite ; il fit un brusque mouvement et sa main alla chercher, dans sa poche, la photographie…
– Tenez, mon père, dit-il en tenant l’image, permettez-moi de vous laisser un souvenir de ma reconnaissance… ce portrait qui est l’objet le plus cher qui me reste ici-bas… Gardez-le, en souvenir de moi !…
Mais le moine repoussait la photographie.
– Non Desjardies, répondait-il, non !… Gardez-la jusqu’à la dernière minute… elle vous donnera du courage… Pourquoi vous en séparer maintenant ? Pourquoi vous causer cette peine ?…
– Acceptez-la, je vous en prie, tout de suite, en souvenir de moi ! insista le condamné.
Et, comme sa main pressait étrangement celle du moine, il comprit qu’il devait accepter le cadeau.
Il fit disparaître la photographie sous sa robe de bure. Les gardiens avaient assisté naturellement à ce court épisode qui ne leur avait semblé nullement suspect.
Il n’est point difficile de comprendre à quel mobile obéissait le prisonnier en se séparant de la photographie de sa fille. Desjardies avait soudain réfléchi que c’était le meilleur moyen d’avertir le prêtre qu’il n’eût point à le précéder au moment du supplice. Car enfin, après tout… On lui disait d’espérer… On allait donc tenter quelque chose pour lui… on allait essayer… Et ce n’était point à lui, Desjardies, à apporter des entraves à ceux qui ne désespéraient point de le sauver… Le prêtre lirait certainement l’inscription qui se trouvait sur le dos du portrait et ne serait donc point étonné d’entendre Desjardies, au moment au supplice, refuser son aide… Enfin, Desjardies était persuadé que, quoi qu’il arrivât, le moine ne le trahirait pas…
Le père Saint-François adressa encore quelques paroles d’encouragement à Desjardies et se leva. Un gardien alla tirer le cordon d’une sonnette ; le gardien-chef revint ouvrir la porte. Dans le même moment que le prêtre s’en allait, le dîner du prisonnier arrivait. Il mangea d’assez bon appétit, but un verre de vin et se coucha.
Chose qui ne lui était pas arrivée depuis longtemps, il s’endormit tout de suite. Vers une heure, il s’éveilla en poussant un grand cri… Les deux gardiens vinrent à lui…
Il avait le front en sueur et, la voix tremblante, il dit :
– Ce n’est rien ! Je rêvais !…
Et il regarda les gardiens ; ce n’étaient plus les mêmes. Ce gardien-là, en face de lui, à la tête de sa couchette, il le reconnaît… Voilà les petits yeux d’albinos, la figure falote, la barbiche blonde… C’est le gardien qui marchait derrière lui lors de la dernière promenade dans la cour… le seul homme qui ait pu écrire sur la photographie les mots étranges qu’il y a trouvés…
Desjardies se soulève sur sa couche, s’assied, dévisage cet homme. Qu’y a-t-il dans ces yeux d’albinos ? Répondront-ils à sa muette interrogation ?… Non. Ils se taisent… ils n’expliquent rien, les yeux d’albinos, rien… Et le gardien reste aussi impénétrable que s’il n’avait rien à cacher !
De la voix la plus naturelle du monde, le gardien prie Desjardies de s’étendre de nouveau, de continuer son somme. Desjardies se laisse faire, sans plus dire un mot.
Et les deux autres retournent à leur éternelle partie de cartes… Seulement, l’albinos dit à son compagnon à voix basse :
– Ce n’est pas la première fois que j’entends ce cri-là !… Je l’ai bien reconnu… c’est le cri de la guillotine… Oui, ils ont tous ce cri-là, quand ils font ce rêve-là… Tu comprends, c’est aujourd’hui le quarante-quatrième jour… il doit se sentir près de sa fin… le pauvre bougre !…
Oui, Desjardies se sent près de sa fin… Et il en rêve !… Ah ! ce rêve, il l’a déjà eu, depuis qu’il est entré dans cette cellule, trois fois !… Et cette nuit, il l’aura encore une fois !… Cette nuit, avant que l’on vienne le chercher pour la guillotine, Desjardies sera mort déjà deux fois !…
Car le sommeil de plomb l’a repris… et l’atroce angoisse de l’affreux rêve a encore envahi son crâne douloureux… lui a encore serré la gorge, lui a coupé la gorge… Oui, il a été amené par des hommes noirs qui ne lui disaient pas un mot, on l’a assis sur une chaise, on lui a entravé les poings et les pieds… Il a senti le froid des ciseaux qui lui coupaient les cheveux et le col de sa chemise… Et le bourreau lui a dit : « Marche ! »
Chose incroyable, c’était le bourreau qui lui tendait le christ à embrasser… le christ sur lequel il allait poser ses lèvres blêmes… Et comme il ne pouvait marcher assez vite à cause des cordes… le prêtre… oui, le moine… il reconnaissait bien le moine à sa tête et à ses pieds nus… le moine l’avait emporté et jeté sur la bascule… Et puis… il s’était réveillé, il s’était réveillé d’entre les morts !… Et il s’était trouvé au milieu des vivants…
Comme il y avait des vivants dans la cellule de Desjardies ce matin !… On ne lui a jamais rendu visite en si nombreuse compagnie… Ils sont là, tous, autour de son lit… ils le regardent. Lui aussi les regarde. Et ses cheveux sont debout sur sa tête ! On a beau dire, il est bien plus difficile de mourir quand on est innocent que lorsqu’on est coupable !…
Parmi tous ces hommes noirs, il y en a un qui dit des choses qu’il ne distingue pas très bien… mais dans lesquelles on lui recommande, il croit bien, du courage…
Du courage !… Du courage !… Eh bien !… Il n’en a pas !…
XI – OÙ LE PÈRE SAINT-FRANÇOIS A QUELQUE CHOSE À DIRE AU BOURREAU
Ceux qui sont montés sur l’échafaud au temps de la Révolution, les condamnés politiques qui ont marché au supplice la tête haute et des paroles historiques à la bouche, eurent cette consolation suprême de savoir que leur fin, au bout du compte, si terrible fût-elle, était glorieuse.
Ils avaient l’ostentation sublime de succomber en beauté devant une foule qui pouvait les haïr, mais qui pouvait les admirer. Ce sentiment-là tient un homme tout droit devant le destin.
Mais le misérable qui a été condamné pour le plus vil des crimes et qui est tout seul à se savoir innocent et qui va perdre la vie uniquement parce que quelques événements que nul ne pouvait prévoir l’ont fait descendre de la classe honnête et heureuse à la classe assassine, celui-là n’aura rien pour le soutenir à la minute suprême. Tant d’injustice et surtout tant de malchance le trouvent désemparé, à moins qu’il ne soit un saint.
Un saint divinise l’injuste mort, et quand elle viendra ce pourra être encore du bonheur pour sa foi. Mais un homme qui n’est pas un saint, qui est simplement un homme, ayant droit à la vie comme tous les hommes, et dont le supplice ne servira qu’à déshonorer la mémoire et à jeter au désespoir, à la ruine, à la folie, à la mort, ceux qu’il aime, cet homme-là a le droit de trembler devant l’échafaud.
Un assassin s’est fait à cette idée qu’un jour il pourra être assassiné à son tour, selon la loi du talion, qu’il connaît et qui est inscrite dans le code. Il peut se dire, quand on le jette sur la planche fatale : « J’ai perdu la partie ! » Mais Desjardies, lui, n’avait joué aucune partie. C’était un homme heureux et prudent qui n’était pas joueur.
Il se contentait de vivre selon la règle, en harmonie avec la société, et celle-ci, tout à coup, venait le tuer au nom de la règle. Qu’est-ce que tout cela signifiait ?… Il ne comprenait pas !… Il ne voulait pas comprendre que l’heure de la mort était venue.
Et, à ces hommes noirs qui lui demandaient d’avoir du courage, il répondait : Non !…
Le directeur de la prison était là, debout devant lui, aussi pâle que lui, et lui disait : « Du courage ! Votre grâce a été rejetée ! Du courage ! »
Obstinément, il secouait la tête. Il répondait : « Non ! Non ! Non ! » On n’entendait que ce mot : Non ! Il secouait la tête comme un enfant… Il disait : Non !…
Et puis, il dit encore : « Je suis innocent ! » Et il regarda ces hommes noirs, le directeur de la prison, le préfet de police, le juge d’instruction qui lui demandait s’il avait des révélations à faire. Et il dit :
– Non ! Non ! Non !
Et il tendit les bras comme un naufragé qui espère une main, un appui, un secours, et qui va disparaître et qui crie au secours !
Alors, comme un gardien avait pris son pantalon et son pardessus dans la petite armoire et lui tendait ces vêtements pour qu’il s’en revêtit une dernière fois, il détourna la tête et son regard alla au seuil de sa prison et il vit, là encore, un homme noir qu’il ne connaissait pas et qu’il reconnut cependant tout de suite. C’était le bourreau, et dès qu’il l’eut reconnu, Desjardies fit entendre le cri des naufragés :
– Au secours ! Au secours !…
Assis sur sa couchette, le col nu, la tête effroyable à voir, les yeux désorbités, montrant une physionomie de fou, Desjardies appelait : « Au secours ! »
Et cela était lugubre comme le hululement d’un chien qui sent passer la mort.
Tous ceux qui étaient là, magistrats, fonctionnaires, gardiens, en eurent le frisson. Ils n’avaient jamais entendu quelque chose de pareil : jamais un condamné à mort n’avait appelé ainsi « Au secours ! » contre la société…
Le directeur de la prison, pendant que les gardiens passaient au condamné son pantalon, se pencha vers lui et lui demanda d’une voix tremblante s’il voulait du rhum !
– Du rhum ?… demanda Desjardies, comme s’il ignorait la signification de ce mot… Du rhum ?
Déjà un gardien apportait un verre… Il l’approcha des lèvres de Desjardies, mais Desjardies écarta le verre si brusquement qu’il le fit tomber par terre.
Le directeur de la prison, qui connaissait son affaire, résolut d’aller jusqu’au bout de ce qui lui était permis d’offrir au condamné à mort. Il dit encore :
– Une cigarette, Desjardies ?
Desjardies répéta :
– Une cigarette !…
Alors le préfet fit :
– Non ! Il ne veut rien ! Il faut le laisser tranquille…
Et Desjardies donna raison au préfet en hochant la tête. Deux gardiens avaient déjà mis debout Desjardies. Ils venaient de lui jeter son pardessus par les épaules. Le directeur de la prison se tourna vers le moine qui était resté discrètement dans un coin de la cellule. Il s’étonnait que celui-ci, selon la coutume de l’aumônier, ne fût point déjà intervenu lui épargnant les encouragements dont il ne parvenait pas à trouver nettement la formule.
C’est toujours difficile d’encourager un homme à mourir, et Desjardies paraissait plus difficile que tout autre à encourager.
– Monsieur l’abbé ! dit le directeur.
Mais à la stupéfaction de tous, le père Saint-François répondit à cette invitation :
– Le condamné, monsieur le directeur, refuse les secours de la religion !…
Ces paroles étonnèrent M. le directeur qui connaissait, par les rapports des gardiens, les excellentes et consolantes relations du prisonnier et de son confesseur. Il ne crut point opportun cependant de demander des explications.
Le juge d’instruction, accomplissant son devoir, s’était à son tour penché sur le condamné et lui avait demandé s’il n’avait pas, avant de mourir, quelques aveux à faire. Mais Desjardies n’entendit même point que le juge d’instruction lui parlait. Tout son être vibrait encore de cette phrase prononcée par le moine :
– Le condamné, monsieur le directeur, refuse les secours de la religion !…
Desjardies, à cette voix amie, retrouve un peu de force. Il regarde du côté du prêtre et se rappelle l’inscription de la photographie… Le père Saint-François espérait donc, lui aussi, que quelque intervention allait se produire… Il attachait donc quelque importance à ces mots qui priaient le condamné à mort de ne point se faire précéder du prêtre.
Et, à cette idée qui lui vint tout à coup qu’on allait tenter de le raccrocher à la vie, voilà qu’il reconquit toute sa lucidité, toute sa présence d’esprit, voilà que tous ses sens furent, tout d’un coup, prêts à le servir…
Et c’est d’une voix qui ne tremblait plus qu’il dit, à la stupéfaction de tous :
– Je suis prêt !…
Et il marcha, il marcha…
Le cortège se forma. Le condamné se vit, comme à l’ordinaire, entouré de ses quatre gardiens. Le gardien aux yeux d’albinos et à la barbiche blonde était, cette fois-ci, non point derrière lui, mais devant lui. Le bourreau marchait en tête. Le père Saint-François, obéissant à tout hasard aux ordres de la photographie, ne précédait point le condamné, mais se tenait à côté du gardien qui était au côté gauche de Desjardies… Le directeur de la prison, le préfet de police, tous les autres personnages, le greffier, suivaient.
Toutes les facultés de Desjardies étaient en éveil. Il semblait regarder fixement devant lui : en réalité, son regard épiait chaque individu, les pierres du chemin, les cours, les portes, le moindre recoin d’ombre.
Ah ! Il n’avait pas beaucoup de pas à faire pour aller jusqu’à la guillotine… et il lui semblait qu’il en avait déjà fait trop… Encore quelques pas, quelques seuils à franchir, encore quelques portes, et il serait trop tard… Ainsi on passa la porte noire du vestibule, on traversa un petit corridor…
On arrivait maintenant dans les ateliers… Desjardies regarda, tourna même la tête, embrassa d’un coup d’œil anxieux les salles désertes avec leurs établis, leurs tables… Rien ! rien !… Le cortège, qui paraissait pressé, continuait toujours.
À côté de lui, quelqu’un surveillait plus étroitement toute chose. C’était le prêtre qui se répétait : ne pas précéder le condamné… Et il songea que sa place, devant le condamné, était prise, maintenant, par le bourreau lui-même.
Alors, comme on allait sortir du dernier atelier pour entrer dans le petit couloir qui aboutissait à l’arrière-greffe, le père Saint-François fit deux pas en avant et, mettant la main sur l’épaule du bourreau, attira l’attention de celui-ci. Jamais on ne touchait le bourreau… Hendrick se retourna, stupéfait que quelqu’un eût osé entrer en communication physique avec lui. Il vit le moine et ne s’étonna plus. Le moine n’avait pas l’habitude, le moine ignorait peut-être qu’il fût le bourreau.
– Monsieur ! lui dit le moine. Un mot, s’il vous plaît…
Hendrick fit un mouvement en arrière et cela suffit pour que le cortège des gardiens et du condamné, avançant toujours, se trouvât dans le couloir, alors que le moine, le bourreau et les autres personnages étaient encore dans le dernier atelier.
– Monsieur, dit le moine, un renseignement ! Je crois qu’au dernier moment, Desjardies ne refusera pas les secours de mon ministère… sur la place, je dois marcher devant lui, n’est-ce pas ?… lui cachant autant que possible l’échafaud…
Hendrick n’eut pas le temps de répondre.
Il se produisit alors dans le couloir un fait unique, un fait inimaginable…
Le premier gardien qui précédait Desjardies, et qui était, comme nous l’avons rapporté, l’homme aux yeux d’albinos, était arrivé tout contre la porte de l’arrière-greffe, où on allait procéder à la toilette du condamné à mort.
Cette porte avait été laissée entrouverte à peine par le bourreau qui, au dernier moment, s’était décidé à aller, comme il le faisait quelquefois, au-devant du condamné. Le premier gardien, disons-nous, était arrivé contre cette porte, qui ouvrait à l’intérieur de l’arrière-greffe. Il la poussa un peu et se tournant tout à coup, avec la promptitude de l’éclair, du côté du condamné, il l’attira à lui si brusquement qu’il le jeta, en quelque sorte, plutôt qu’il ne le fit entrer dans l’arrière-greffe…
Le mouvement avait été si inattendu, si rapide que tout le cortège s’arrêta une seconde, ne comprenant pas… Il comprit lorsque la porte de l’arrière-greffe se referma avec précipitation… Il comprit qu’il se passait quelque chose qu’il était impossible d’expliquer…
L’idée d’une évasion dans de pareilles conditions ne pouvait traverser le cerveau de personne… Cependant ! Pourquoi avait-on poussé cette porte ?…
Le gardien-chef et le directeur de la prison étaient déjà contre cette porte, frappant du poing et ordonnant d’ouvrir… Alors, comme on n’ouvrait pas, tout le monde se regarda avec stupeur… Le préfet de police cria. Ils se mirent tous à crier et à frapper contre la porte. Le bourreau appelait son aide : « Prosper ! Prosper !… »
Le gardien-chef avait introduit une clef dans la serrure : mais il y avait, du côté de l’arrière-greffe, des verrous à la porte et la porte ne s’ouvrait pas. Évidemment, les verrous avaient été tirés. Le gardien albinos avait disparu.
Alors tous ces gens, fonctionnaires, gardiens, bourreau rebroussèrent chemin et, criant toujours, revinrent sur leurs pas, se répandirent dans les couloirs, dans la cour, et se précipitèrent, ceux-ci vers la porte de la cour qui donnait sur le guichet du greffe et ceux-là sur la porte qui donnait sur le parloir. Alors ils s’aperçurent qu’ils étaient prisonniers dans leur prison, car aucune de ses portes ne leur livrait passage.
Et il n’y en avait point d’autres ! Les architectes avaient si bien conçu le plan de la Grande-Roquette pour qu’on ne s’évadât pas que les trois portes aboutissant à l’unique guichet de la détention étant condamnées, le directeur de la prison lui-même et ceux qui, affolés, l’entouraient, tentaient en vain de s’évader !
Alors, ils redoublèrent de cris et de coups sur les portes et sur les murs, espérant être entendus du poste qui se trouvait sous le portail. Quant aux soldats et aux gardiens qui se tenaient à l’ordinaire dans le poste situé au fond de la grande cour, à côté de la chapelle-réfectoire et des ateliers, ils avaient rejoint le cortège de suite et ne parvenaient qu’à doubler le tumulte.
Le directeur de la prison passa son mouchoir sur son front en sueur et dit :
– Je suis déshonoré !… Mais tout de même, il ne s’échappera pas… Il ne peut pas s’échapper… Il ne peut pas sortir de la prison sans être arrêté !
Une idée subite lui fit interroger Hendrick qui, au fond, était le seul responsable de l’affaire devant la loi puisqu’il avait signé l’élargissement sur le registre d’écrou…
– Enfin, monsieur, vous êtes sûr de vos aides ?…
– Comme de moi-même, répondit Hendrick, seulement, une autre fois, je ne signerai pas sur le registre d’écrou, d’avance !…
Et il paraissait assez calme, comme s’il était le seul de tous ceux qui étaient là à ne point redouter une disgrâce immédiate qui lui eût fait perdre sa place.
Le préfet de police murmurait :
– C’est Dixmer qui avait raison !
XII – « MONSIEUR ! JE NE VOUS CONNAIS PAS ! »
Au moment où nous avons quitté le Vautour et Patte d’Oie dans l’arrière-greffe, le bourreau allongeait la main sur le pardessus du Vautour, geste qui avait fort impressionné cet aide exceptionnel du bourreau. Cependant, ayant repoussé le pardessus, Hendrick n’y toucha pas autrement et le Vautour en fut rasséréné, mais, en vérité, il est bon de dire que le Vautour n’avait point lieu d’être enchanté de la tournure que prenaient les choses.
S’il avait vu avec joie l’homme du greffe suivre le cortège qui se dirigeait vers la cellule de Desjardies, il avait constaté avec désespoir, pour l’exécution de son plan, que le bourreau restait dans l’arrière-greffe. S’il ne s’en éloignait pas, il allait falloir adopter le second plan prévu, qui était celui de l’emploi de la force et de l’irruption des cent lions de Montrouge au coin de la rue de la Vacquerie, dans le moment que Desjardies, les bras et les jambes liés, apparaîtrait sur la place.
Le Vautour commençait déjà en lui-même de ruminer tous les détails de ce plan-là, renonçant à l’autre qui était le plan de la ruse, quand, à sa plus grande joie, il vit le bourreau se lever et gagner le couloir.
Il le suivit avec précaution, pencha la tête hors de l’arrière-greffe et constata que Hendrick se rendait à la cellule du condamné à mort. Alors, il referma la porte de l’arrière-greffe, porte dont il ne tira pas les verrous.
En ce moment, Patte d’Oie et lui se trouvaient dans la situation qu’ils avaient espérée comme étant la plus propice à leur première entreprise. Tous deux étaient seuls dans l’arrière-greffe, avec, à côté d’eux, sous le guichet, un unique gardien.
Pour bien comprendre ce qui va se passer, il faut se rappeler que l’on accédait à l’arrière-greffe par trois portes : celle qui donnait sur la détention et par où venait de sortir le bourreau, celle qui donnait directement sur le guichet, vestibule de la prison ; enfin, une troisième porte qui donnait sur le greffe lui-même.
Le greffe, lui aussi, communiquant naturellement et directement par une porte sur le guichet.
Le Vautour leva le doigt. Patte d’Oie leva le doigt. Ils se regardèrent, ils sourirent : ils s’étaient compris ; seulement, le sourire de Patte d’Oie pouvait faire sourire, mais le sourire du Vautour faisait peur. Ces deux doigts levés en l’air signifiaient à ne s’y point tromper : Attention, le moment d’agir est venu !
Sous le guichet, ils entendirent le gardien tousser, faire quelques pas, remuer ses clefs. Le Vautour désigna à Patte d’Oie la porte qui donnait de l’arrière-greffe sur le guichet, puis lui-même entra dans le greffe en étouffant le bruit de ses pas.
Patte d’Oie, sur le seuil de la porte désignée, fit signe au gardien. Ce signe priait le gardien de s’approcher. Évidemment, l’aide du bourreau avait une chose importante à dire au gardien. Celui-ci s’avança. Il brinqueballait négligemment au bout de ses doigts les clefs retentissantes. Quand il fut près de Patte d’Oie, il ne s’aperçut point que quelqu’un s’approchait de lui, le plus sournoisement du monde, par-derrière ; c’était le Vautour qui, après être entré dans le greffe, en était sorti par la porte donnant sur le guichet.
Avant que Patte d’Oie ait eu le temps d’expliquer au gardien ce qu’il attendait de lui, le Vautour avait saisi celui-ci à la gorge et l’avait renversé sur lui. Le gardien essaya bien de se débattre, mais la surprise et la force combinées du Vautour et de Patte d’Oie eurent vite raison de sa résistance. De solides cordelettes lui attachaient les pieds et les mains, cependant qu’un linge qu’on lui avait enfoncé assez vigoureusement dans la bouche tout d’abord et que l’on transforma ensuite en bâillon, réduisit au silence cette nouvelle victime de la puissance mystérieuse de R. C.
Les deux faux aides du bourreau transportèrent incontinent le pauvre gardien dans le parloir dont ils refermèrent la porte. Tout ceci, qui demande du temps pour être raconté, en exigeait beaucoup moins pour être accompli.
D’une façon générale, il se passait dix-sept minutes entre le moment où le cortège se mettait en route vers la cellule du condamné à mort et le moment où le couteau tombait. Le Vautour et Patte d’Oie n’avaient pas une minute à perdre.
Le Vautour s’était emparé des clefs du gardien, qui étaient tombées sur les dalles. Il se rendit, aussitôt la petite opération faite, aux portes qui faisaient communiquer le guichet avec la détention, et non content de s’assurer que les verrous étaient tirés, il introduisit dans chaque serrure un petit morceau de fil de fer contourné d’une bizarre façon et qui, certainement n’avait point été travaillé de cette sorte uniquement par distraction d’artiste.
Il revint ensuite dans l’arrière-greffe rejoindre Patte d’Oie, qui était courbé contre la porte donnant sur la détention, l’oreille aux écoutes. Patte d’Oie leva encore le doigt. Le Vautour leva le doigt. Ces deux hommes parlaient peu, mais ils semblaient s’entendre merveilleusement.
Des pas retentissaient dans le corridor, se rapprochaient. Le Vautour se colla contre le mur. Patte d’Oie était de l’autre côté ; la porte allait s’ouvrir sur lui et le cacher. La porte s’ouvrit brusquement.
– Va ! dit seulement le Vautour.
Cette syllabe devait sans doute être le signal qui signifiait que l’on adoptait le plan de ruse, car il ne l’eût pas plutôt entendu que le gardien aux yeux d’albinos qui précédait le cortège agissait comme nous l’avons dit. Il se jetait littéralement avec Desjardies dans l’arrière-greffe dont la porte se refermait sous le poids de Patte d’Oie. Le Vautour tirait les verrous.
Desjardies ne se rendait pas compte de ce qui se passait, et les deux faux aides ne perdirent point leur temps à le lui expliquer ; le Vautour alla à son pardessus replié sur le banc ; il le déplia et sortit de sous ce vêtement, où elle était restée dissimulée, une superbe redingote et un chapeau claque dont il fit jouer le ressort.
– Monsieur va dans le monde ! fit Patte d’Oie, qui se permettait la première plaisanterie de la nuit.
Et il commença de l’habiller, pendant que la porte retentissait de coups furieux.
Sous le porche de la prison qui précédait la cour d’honneur, l’adjudant Beauvisage s’entretenait mélancoliquement avec le sergent Valentin. Il lui disait :
– Ça n’est tout de même pas juste, sergent, pour une fois que nous sommes de garde à la Grande-Roquette et qu’il y a une exécution, que nous ne puissions pas y assister…
– Ça n’est pas juste, répondait le sergent Valentin… Mais êtes-vous bien sûr, mon adjudant, qu’on ne pourra pas risquer un coup d’œil ?
– J’en suis sûr, répondit l’adjudant. Je l’ai demandé au portier. Interrogez-le à votre tour. Il m’a répondu, à moi, qu’aussitôt le cortège passé, on fermait la porte.
Le sergent Valentin haussa les épaules dans un mouvement qui attestait son profond mépris pour une consigne aussi stupide, et il se dirigea vers le gardien-portier, un vieux à barbe blanche, qui se promenait dans la cour comme s’il n’était qu’à demi éveillé et comme s’il s’imposait cette promenade pour s’éveiller tout à fait.
Il y eut un court colloque et le sergent Valentin revint à l’adjudant Beauvisage en haussant de plus en plus les épaules, et en laissant échapper ces deux syllabes qui expliquaient parfaitement le résultat de sa démarche : Macache !…
Sur ce, l’adjudant, le sergent et quelques soldats qui se trouvaient derrière eux tournèrent tous la tête vers le perron du fond de la cour d’honneur par lequel on arrivait au guichet du greffe, car la porte de ce perron venait de s’ouvrir…
– Tiens ! Les voici ! fit l’adjudant.
Mais, au lieu du cortège qu’ils attendaient, ils virent un homme seul descendre le perron, cependant que derrière lui, la porte du guichet se refermait.
– Tiens ! Un aide du bourreau, dit l’adjudant.
Cet homme était Desjardies ; il avait endossé la redingote apportée par le Vautour, le chapeau claque, et ressemblait ainsi tant bien que mal à M. Denis, que nul, du reste, dans la prison, ne connaissait que pour l’avoir vu passer tout à l’heure, au milieu de la nuit, sous la forme fallacieuse de Patte d’Oie.
Desjardies n’aurait pas été plus pâle s’il avait été entouré de toute la force publique qui avait mission de le conduire à l’échafaud. Desjardies descendit les marches, traversa la cour, ne regardant ni à droite ni à gauche, ni même devant lui, passant le nez baissé devant le gardien-portier, devant l’adjudant Beauvisage et devant le sergent Valentin. Il s’arrêta contre la porte, sous la voûte, et attendit. L’adjudant appela le portier, qui continuait à rêver dans la cour. Le portier accourut.
– Vous désirez sortir, monsieur ? demanda le portier.
– Oui ! fit, d’un geste, Desjardies.
Le portier ne s’étonna point que cet homme ne s’exprimât que par geste. Il était habitué à ne jamais entendre la voix des aides du bourreau. C’étaient pour lui des réprouvés qui se rendaient parfaitement compte de la besogne de damnés qu’ils acceptaient et qui n’osaient point souiller les autres hommes, même d’un souffle.
Une porte, une seule, sépare encore Desjardies de la liberté et de la guillotine.
Les clefs remuent, tintinnabulent ; le bruit du pêne énorme qui s’ouvre… la porte… la porte qui grince sur ses gonds, un coin de jour livide qui pénètre sous la voûte, et, dans cet encadrement blême, la guillotine qui attend… le couteau triangulaire suspendu !…
Il ne peut pas parler !… Va-t-il pouvoir marcher ? Ainsi, dans les songes, il arrive que dans les mouvements où la vélocité s’impose, les jambes refusent tout service. C’est l’un des plus ordinaires supplices du cauchemar.
L’extravagant destin de Desjardies l’a jeté depuis quelques semaines, si souvent, et sans transition, du cauchemar à la réalité, qu’il ne saurait plus dire si la guillotine qui est devant lui est celle de ses rêves ou celle de la vie. Que de fois, dans son sommeil hanté, il a voulu fuir cette machine sans y parvenir !… Mais quoi ! Voilà que ses jambes le dirigent… Voilà qu’il va franchir le seuil de la prison…
Et, tout à coup, voilà qu’il entend le portier qui lui dit :
– Mais, monsieur, je ne vous connais pas !
Desjardies, interpellé par le portier, sent son cœur se glacer. Il a la terreur de savoir qu’il ne peut pas répondre. Sa langue, collée à son palais, lui refuse tout service. Incapable d’un geste, incapable d’un mot, il reste là, debout, devant l’homme qui vient de lui entrouvrir cette porte. Il a encore la force de se maintenir, mais il sent bien qu’il est pareil à ces cadavres millénaires, qu’on retrouve dans des attitudes vivantes au cœur des cités enfouies et qui s’écroulent quand on les touche du doigt.
L’homme aux clefs répète :
– Je ne vous connais pas !…
Oh ! Parler… parler !… Pouvoir prononcer cette phrase qui est sur sa langue : « Je suis le nouvel aide du bourreau, Denis, et je vais chercher dans le fourgon des choses dont j’ai besoin… » Mais c’est une phrase tout à fait extraordinaire, et qu’on n’a point tous les jours sur la langue, et qui pèse sur la langue comme un bœuf… « Je suis le nouvel aide du bourreau. »
Desjardies ne peut pas parler !
XIII – MADEMOISELLE DESJARDIES
– Faites entrer Mlle Desjardies ! avait dit le Roi Mystère.
Alors, une porte que l’on ne soupçonnait pas, une porte secrète sembla s’ouvrir toute seule dans le mur. Tous les yeux étaient tournés de ce côté, et il y eut de sourdes exclamations quand, sur le seuil de ce trou noir qui allait on ne sait où, apparut une figure qui venait d’on ne sait où. Cette figure était la statue vivante du désespoir.
Mais jamais peut-être, depuis qu’il y avait des larmes sur la terre, jamais le désespoir n’avait emprunté une figure plus idéalement belle !…
D’une main, elle s’appuyait au mur, car il semblait que sa faiblesse était telle qu’elle allait tomber. La seule volonté de pousser un dernier cri de protestation, de prière et de pitié, pendant qu’il en était temps peut-être encore, car elle ne pouvait concevoir, même en cette dangereuse minute, que le crime allait s’accomplir, car son désespoir ne cessait d’espérer un miracle, cette seule volonté parvenait à la tenir encore debout, droite, haute et frissonnante, dans ses vêtements noirs qui moulaient des formes d’une perfection antique.
Un voile sombre était jeté sur sa lourde chevelure brune et encadrait son visage, d’une pâleur marmoréenne. Son front si harmonieux, malgré la douleur qui le creusait, ses yeux très beaux, malgré les larmes qui les rougissaient, sa bouche d’un dessin gracieux, malgré l’amertume qui tenait ses lèvres closes, fermées sur des sanglots, bouleversèrent l’assistance.
R. C. alla à elle au milieu d’un silence de mort. Il lui tendit la main qu’elle prit et, chancelante, elle se laissa conduire devant Sinnamari.
– Parlez ! fit R. C. Parlez, mademoiselle, si vous en avez la force encore… Dites à M. le procureur impérial ce que vous savez.
L’émotion des assistants semblait portée à son comble. Sinnamari lui-même ne paraissait point se défendre contre un certain sentiment de pitié.
– Monsieur le procureur, fit Mlle Desjardies d’une voix mourante, M. le procureur, mon père est innocent… je vais vous dire… il faut qu’on attende… oui, il faut cela… cela n’est pas possible que l’on ne me donne pas le temps de vous prouver que mon père est innocent !… Si vous m’aviez entendue plus tôt, vous sauriez cela et vous penseriez comme moi… mais vous ne m’avez pas entendue… vous qui pouvez tout, qui êtes le maître… alors, n’est-ce pas ?… on peut encore espérer… oui… on peut encore espérer… j’espère…
Et, disant qu’elle espérait, la jeune fille éclata en un si lugubre sanglot que tous en furent déchirés. Elle continuait, essayant de dominer par instants l’épouvantable angoisse qui l’étouffait… elle continuait… essayant de dire autre chose que des cris, que des lamentations inutiles…
Elle essayait d’exprimer… elle essayait de montrer qu’on avait tort… elle essayait de discuter comme un avocat et cela était, plus que tout, affreusement pitoyable… Par moments, elle s’arrêtait et un silence terrible entourait ces voiles noirs sous lesquels palpitait une douleur surhumaine…
Mais quelles paroles nouvelles vient-elle de prononcer ? Pourquoi ces hommes se rapprochent-ils, plus serrés maintenant, autour de ce désespoir qui se traîne sur le parquet ? Pourquoi ces têtes pâles, ces yeux qui s’interrogent à la dérobée ?
Quel intérêt nouveau soulève donc ainsi la conscience de Sinnamari, de Régine, d’Eustache Grimm et de Philibert Wat lui-même, pendant que Mystère, les bras croisés sur la poitrine, considère d’un œil calme de juge cette transformation subite des physionomies et des caractères et que, derrière lui, s’accrochant aux basques de son habit comme un enfant peureux, le gnome singulier et énigmatique, cessant tout à coup ses surprenantes grimaces, fait entendre des gloussements attendris ?
La voix, sous les voiles noirs, dit :
– Comment ?… Comment ai-je su cela ?… Oh ! par le plus grand hasard… Moi, j’ignorais ce suicide de l’employé de l’Assistance publique. Les journaux en avaient parlé… et puis je ne pouvais pas m’imaginer que cette histoire-là pût être pour quelque chose dans nos malheurs… Un employé de l’Assistance publique se suicide, un employé du parquet est assassiné… ça n’a aucun rapport… du moins on croit que ça n’a aucun rapport… Mais, écoutez-moi… je voudrais, monsieur le procureur, vous raconter tout, tout ce qui m’est arrivé depuis le commencement que j’ai découvert cela… Cela ne sera pas long… Et puis, il faut m’écouter pour sauver mon père, que vous connaissez… Vous savez bien que mon père ne peut pas être un assassin… Et puis, j’ai le temps !… N’est-ce pas… j’ai le temps ?
Quand la malheureuse eut prononcé ces mots : « J’ai le temps ! » un frisson passa dans le cœur de tous, même des plus endurcis, même de ceux qui semblaient maintenant, en écoutant la jeune fille, obéir à une étrange préoccupation…
– J’ai le temps !
La malheureuse ne savait donc point que son père allait être guillotiné… De quel trou obscur et profond, de quel tombeau sortait-elle donc, pour ignorer cela, à dix pas de la guillotine ?… Elle n’avait qu’à tourner la tête ; elle eût, à travers la fenêtre, sous les premiers rayons du jour levant, aperçu l’échafaud…
– J’ai le temps… Monsieur, qui est un ami, me l’a dit ! fit-elle en se retournant vers Mystère. L’exécution n’est pas pour aujourd’hui… Alors, maintenant que je vous ai vu… n’est-ce pas ?… C’est fini !… Il n’y aura plus d’exécution… naturellement !… Mon Dieu ! Qu’est-ce que je vous disais ?… Ah ! oui ! c’était à propos de cet employé de l’Assistance publique…
Mais, encore une fois, avant que Mlle Desjardies ne continuât son récit, ou plutôt sa plainte, on regarda R. C. Décidément, quel était cet homme qui avait éveillé un si formidable espoir dans le cœur de cette enfant ? Qui avait cette audace tranquille d’assumer la responsabilité d’un pareil mensonge ?
R. C. ne semblait point savoir que tous le regardaient… Immobile et les paupières closes, il écoutait la voix parfois enfantine et parfois déchirante de Mlle Desjardies.
– Voilà, continua-t-elle. Dans la maison que j’habite, tout en haut, dans une mansarde, il y a une pauvre femme ! Oh ! il faut aller la voir… Il faut l’interroger… et vite, car elle est bien malade !… Elle s’appelle Mme Didier… Elle m’a raconté que son mari, qui était l’employé de l’Assistance publique dont je vous parle, ne s’est point suicidé comme tout le monde l’a cru ou comme, en haut lieu, on a fait semblant de le croire… Elle affirme qu’on lui a suicidé son mari, comme cela arrive, paraît-il, dans les affaires politiques… Oui, elle m’expliqua cela… On trouve un jour un monsieur pendu à sa fenêtre comme ce Didier ? Eh bien ! Il ne s’est pas pendu !… Il a été étranglé !… C’est un agent encombrant que l’on a fait disparaître… voilà tout… C’est de la politique… Et elle m’a dit que son mari faisait en dessous de la politique et qu’il connaissait beaucoup de choses, et que, la veille de sa mort, cet homme était plein d’espoir et qu’il lui avait dit qu’avant peu ils seraient riches tous deux et pourraient se retirer des affaires… Je n’aurais peut-être pas attaché une grande importance à ce que me racontait cette femme si la date du suicide de son mari ne m’avait tout naturellement frappée ; cela se passait le 3 juin… et c’est le 3 juin que Lamblin était assassiné et que mon père était arrêté…
Ici, la narration plaintive de Mlle Desjardies s’arrêta un instant, et l’on attendait dans le plus angoissant silence, qu’elle reprit. R. C. seul a fait un geste. Il a voulu relever Mlle Desjardies, mais celle-ci l’a repoussé.
– Le 3 juin, monsieur le procureur impérial, est une terrible date ! J’ai feuilleté tout le dossier de mon père… tant que j’ai pu voir son avocat… et ce dossier, je le connais par cœur… par cœur… eh bien ! j’avais relevé dans le dossier, particulièrement, tout ce qui s’était passé le 3 juin ; c’était bien naturel et cela ne devait pas être long, puisque le drame eut lieu entre sept heures et huit heures du matin. Mon père, lui, s’était, en sortant de chez nous – nous habitions à cette époque la rue de Rivoli – rendu directement au Palais. Quant à Lamblin, le dossier relatait que, sorti de chez lui à cinq heures du matin, il était, d’abord allé chez un de ses amis qui habitait place de l’Hôtel-de-Ville. Quel était cet ami ? Sa femme avait déclaré ne point le savoir… Lamblin aurait dit à sa femme, qui s’étonnait de le voir quitter son domicile de si bonne heure, qu’il fallait qu’il fût très tôt, ce matin-là, au Palais, et qu’il devait passer d’abord place de l’Hôtel-de-Ville, chez un ami avec qui il avait rendez-vous… C’était tout et c’était vague, si vague que l’instruction, monsieur le procureur, n’a pu découvrir qui était cet ami de Lamblin, habitant place de l’Hôtel-de-Ville, et que sa femme ne connaissait pas ! Eh bien ! moi, monsieur le procureur, je l’ai découvert… Je sais chez qui, avant de venir se faire assassiner au Palais de Justice, Lamblin est allé ce matin-là… Il est allé chez Didier, que l’on trouvait, un peu plus tard, suicidé, lui aussi !… Ah ! Monsieur le procureur impérial, ne dites pas non ! J’en suis sûre… Vous comprenez… la date du 3 juin… Didier, employé à l’Assistance publique, avenue Victoria… l’ami de Lamblin, habitant à côté, place de l’Hôtel-de-Ville… Une parole imprudente de Mme Didier à moi, m’avouant qu’avant d’habiter à l’hôtel de la Mappemonde… elle avait habité avec son mari la place de l’Hôtel-de-Ville… Je l’ai pressée… je l’ai pressée… elle est faible… elle est malade… je la soignai… alors… alors, comme elle croyait qu’elle allait mourir… elle m’a avoué… Oui, avant que son mari ne se suicidât, il avait reçu la visite de Lamblin… Elle avait vu, ce matin-là, Lamblin… Monsieur le procureur… Mme Didier est très malade… Elle sait des choses terribles… Elle pourrait mourir… Il faut aller l’interroger, tout de suite… tout de suite… Voilà ce que je voulais vous dire… depuis quinze jours !… Mais enfin, je vous ai vu, vous m’avez entendue… Je remercie Dieu !… Et à vous aussi, monsieur, ajouta-t-elle en se tournant vers R. C… à vous aussi… merci !…
Pendant que Mlle Desjardies parlait, Régine et Eustache Grimm s’étaient, petit à petit, reculés, dissimulés derrière Sinnamari. On aurait dit vraiment que ces hommes cherchaient instinctivement un abri derrière le procureur impérial, comme si un danger inattendu était venu les menacer… Et, comme Mlle Desjardies s’avançait maintenant, toujours à genoux, vers le procureur, le suppliant de ne point perdre une minute pour interroger Mme Didier, le procureur recula à son tour, et les autres reculèrent avec lui, et ainsi, il arriva que Mlle Desjardies, qui n’avait pu jusqu’alors apercevoir, à cause de ce groupe qui était autour d’elle, absolument rien de ce qui se passait, soit dans le salon, soit par la fenêtre du salon, sur la place… Il arriva que son regard rencontra la vitre, et que, continuant son chemin à travers la vitre, il erra sur la place et enfin s’arrêta sur la silhouette effroyable d’une chose, qui, depuis quelques nuits, hantait tous ses rêves. Elle reconnut les deux bras menaçants de l’instrument de mort, poussa un cri rauque, se redressa d’un bond, courut à la fenêtre, et hurla :
– La guillotine !…
Et elle s’arracha les cheveux comme une insensée, emplissant le salon de sa clameur sauvage, car, en face de la guillotine, la porte de la prison venait de s’ouvrir et le cortège des hommes noirs apparaissait sur la place !
Rien n’eût pu arrêter l’élan de la malheureuse, qui se ruait sur la fenêtre, si elle n’avait trouvé en face d’elle celui en qui elle semblait, un instant auparavant, avoir mis toute sa confiance.
Cependant que dans la salle tout le monde semblait avoir perdu son sang-froid, que Régine défaillait, qu’Eustache Grimm gémissait, que Philibert Wat, pour ne plus rien voir de ce qui se passait sur la place, s’était tourné du côté du mur, contre lequel il s’appuyait comme un homme ivre ; que Sinnamari, pour cacher l’allégresse infernale qui ravageait soudain son terrible visage, se passait fébrilement un mouchoir sur son front en sueur ; que les deux femmes, l’artiste et la courtisane, jetaient des paroles incohérentes, des cris d’horreur, de désespoir et de pitié ; que Me Mortimard, dans son trouble, ne parvenait pas à ranger ses précieux papiers dans son maroquin notarial, et que M. Bison essayait en vain de retrouver, au bout de sa plume tremblante, la fin de ces phrases étonnantes avec lesquelles un greffier, qu’il soit de correctionnelle ou de cour d’assises, a accoutumé de rapporter les événements judiciaires qui se déroulent sous ses yeux ; pendant, enfin, que chacun traduisait dans un désordre bien compréhensif, selon son propre tempérament et suivant aussi, sans doute, son propre intérêt, l’émotion – joie ou épouvante – qui lui étreignait le cœur, en cette minute atroce où la tête du père allait tomber sous les yeux de la fille, R. C. parvenant seul à dominer une émotion souveraine, fixa le regard éperdu de Mlle Desjardies et lui ordonna de se détourner du spectacle de la place.
Mlle Desjardies reçut le choc de ce regard et recula en murmurant un nom :
– Robert !…
– Oui, Robert !… C’est Robert qui vous commande d’espérer ! fit entendre Mystère d’une voix si douce et si nouvelle que tous ceux qui étaient là en furent étrangement frappés.
– Il n’y a plus d’espoir… Desjardies est mort ! répliqua la voix de Sinnamari, sinistre comme un glas.
Et comme Gabrielle, à cette parole maudite, se laissait aller, sans force, aux bras de Mystère, celui-ci, avant qu’elle ne fermât les yeux, lui montra un homme qui venait d’apparaître sur le seuil d’ombre, sur le seuil de la porte secrète qu’elle avait elle-même franchie tout à l’heure, et lui dit, de sa voix la plus calme :
– Monsieur le procureur impérial a menti, mademoiselle : votre père est vivant !
Et il remit le précieux fardeau, qui lui glissait des mains, aux mains de Desjardies sauvé !
Aussitôt, on entendit un grand fracas qui domina les cris d’enthousiasme des uns et les clameurs de rage des autres ; c’était l’étrange petit personnage, gnome, nain, enfant, vieillard (il y avait des moments où on lui eût donné dix ans par derrière et cent ans par devant), qui dégringolait du haut de son immense tabouret dont il avait tenté à nouveau l’ascension pour mieux voir, et qui accourait avec un grand bruit de bottes vers R. C. dont il secouait la main avec une énergie farouche, cependant que, les yeux brillants, la mine écarlate, il laissait tomber ces deux mots, qui exprimaient évidemment toute la satisfaction qu’il ressentait d’avoir assisté à des événements extraordinaires :
– All right !
Êtes-vous jamais allé rue des Saules ? Et d’abord, la rue des Saules, surtout à l’époque où se déroule ce drame inouï, était-elle une rue ? Si quelques planches pourries, des murs croulants, de sordides enclos bordant un ravin cahoteux forment une rue, oui, cette voie sinistre avait droit au nom de rue, mais à cause de cela seulement, car, en vérité, elle ne possédait en fait de maisons qu’une petite vieille auberge, qui se tenait encore debout par on ne sait quel miracle du temps et de la volonté de son propriétaire, une petite auberge qui s’appelait tout simplement à cette époque l’Auberge du Bagne.
On m’a bien raconté qu’elle avait changé de nom après la guerre et qu’elle s’était appelée Auberge des Assassins, mais je ne saurais certifier en aucune façon qu’il s’agit de la même, d’autant plus qu’on me dit maintenant que cette Auberge des Assassins s’appelle de nos jours – de nos jours actuels – le Lapin agile.
Quand on avait poussé la porte de mon auberge, on se trouvait tout de suite intéressé par la décoration fort artistique et fort sanglante des murs. Les scènes de meurtre, de rixe, de pillage, de vengeance et d’amour faisaient le plus bel ornement des salles basses et sombres, attestant ainsi que l’Auberge du Bagne avait une clientèle éclectique dont les honnêtes gens, même quand ils étaient peintres, n’étaient pas exclus.
Plus d’un rapin, le ventre creux et l’escarcelle vide, s’était assis à ces tables boiteuses et ne s’était acquitté, au dessert, de la savoureuse hospitalité de la mère Fidèle, qu’avec la seule richesse de sa palette, dont le rouge écarlate coulait à flots autour de la truculente agonie des bourgeois…
Il était huit heures du matin – du matin tragique qui s’était levé sur l’évasion de Desjardies – quand un mauvais fiacre, dont la haridelle semblait avoir gravi avec beaucoup de difficulté la Vieille-Rue-des-Moulins et la rue Gabrielle, s’arrêtait sur cette petite place qui, non loin de la rue du Mont-Cenis, descend si rapidement vers Paris.
De cette voiture descendit un personnage que nous n’avons nulle peine à reconnaître, malgré les amples plis de la fourrure dont il entourait sa taille exiguë. Son grand nez blême et ses petits yeux aigus, méchants et railleurs, au-dessous de sa casquette en drap à carreaux, nous ont déjà renseignés sur la personnalité du gnome de la place de la Roquette.
Pour gravir hâtivement la place, il s’appuyait sur un bâton court et fort curieusement épais. Arrivé au haut de la place, il descendit avec non moins de hâte cette funèbre rue des Saules dont je parlais à l’instant.
À cette heure, elle était complètement déserte, et il ne rencontra âme qui vive qu’au terre-plein où se dressait l’auberge qui annonçait à l’hôte de passage, en grosses lettres noires sur son mur jaune : l’« Auberge du Bagne ». Alors, cette sorte d’avorton frappa de son bâton à la porte close. Il appela :
– Mère Fidèle ! Mère Fidèle !
Une fenêtre s’ouvrit au premier et dernier étage de la bicoque et notre petit homme aperçut la tête de la mère Fidèle, une bonne figure réjouie, tout enluminée de bonne humeur, tout ensoleillée d’une tignasse, ou plutôt d’une véritable broussaille d’or que les deux bras relevés de l’hôtesse essayaient en vain de transformer en confortable et décent chignon. C’était là l’ogresse de cette auberge d’assassins « à la manque » et d’artistes « dans la purée ». Sa bonté et son excellent caractère, et aussi la facilité avec laquelle elle oubliait les services qu’elle rendait, l’avait faite populaire dans le monde spécial des poètes sans fortune et des rapins « fauchés ».
Elle était bonne à tous, ne demandait son passeport à personne, et quand quelque « enfant de minuit », grinche ou poisseur, tirelaine, vendangeur, s’asseyait à sa terrasse, qui était, par parenthèse, la plus belle de Paris « pour le panorama » comme elle disait avec orgueil, elle le servait sans dégoût, fût-il accompagné de sa « nénesse ». Ce n’était point la faute de la mère Fidèle si les femmes du monde, à cette époque, n’avaient pas encore pris l’habitude d’aller au café.
– Ah ! C’est vous, monsieur Macallan ! fit la brave femme en apercevant l’avorton. Je descends tout de suite ; un peu de patience ; « le temps de me ratisser la terrasse » et je suis à vous…
Il ne faudrait pas supposer que, par cette dernière expression, l’aimable patronne de l’Auberge du Bagne faisait allusion à ce genre d’exercice de propreté quotidien qui consiste, pour un cabaretier, à nettoyer, balayer, sabler comme il convient cette partie de trottoir qu’il consacre, souvent malgré les arrêtés de police, au besoin exprimé par ses clients de « consommer » en plein air. D’abord, il n’y avait point de trottoir devant cette auberge, et puis, « la terrasse » dont parlait en cet instant la mère Fidèle n’était ni plus ni moins que ce front ambré et un peu « bas de plafond » surmonté de la tignasse désordonnée dans laquelle la brave femme promenait avec acharnement cette sorte de râteau appelé peigne par les coiffeurs qui s’appellent eux-mêmes « merlans ».
M. Macallan – puisque Macallan il y avait – se prit à battre la semelle sur le terrain dur, cependant que les premières neiges tombaient.
Oui, les premiers flocons de l’année, les doux flocons blancs commençaient à tacheter de leur duvet léger tout ce paysage de tristesse et de ruine ; murailles crevées, planches vermoulues, terre en deuil, ciel gris, tout disparut, ou plutôt tout apparut avec un nouveau visage sous la voilette de l’hiver : il y a des vieilles femmes qui deviennent jolies quand elles se cachent à demi sous un tissu transparent.
M. Macallan était sans doute un artiste, car il parut apprécier la transformation des choses sous ce nouvel aspect de l’atmosphère. Il toussa fortement, bruyamment, fit un moulinet avec son bâton et cria tout à coup :
– Petit gigue !
Et il entreprit illico « une petite gigue » qui aurait eu le don de mettre en sueur un squelette. Les pointes de ses pieds, sans talons, touchaient tour à tour la terre avec une telle rapidité, un tel rythme fou, qu’on pouvait les entendre, mais qu’il eût été difficile à l’œil le plus exercé de les suivre dans leur danse insensée. Les épaules de M. Macallan aussi, ses bras, son bâton participaient à cet exercice joyeux.
La mère Fidèle qui venait d’ouvrir sa porte, resta stupéfaite devant une si sublime gesticulation.
Quand M. Macallan s’arrêta, il ne paraissait même point essoufflé et pas une goutte de sueur ne perlait sur le parchemin rugueux de son front dur. Il « tapa » le sol du bout de son bâton brusquement, comme si ce geste était le signal de la fin « du petit gigue », et déclara à la mère Fidèle :
– Aoh ! Je suis bien content !…
Et il entra dans son établissement en lui jetant un :
– Good morning ! Gin and soda, please !…
La mère Fidèle devait être déjà habituée aux excentricités de ce singulier client et aussi à ses goûts, car elle ne s’étonna point de ses façons de faire et trouva immédiatement, derrière son comptoir, le gin et le soda demandés.
Elle les porta dans une salle où l’on parvenait par un petit escalier, salle décorée des peintures les plus surprenantes, ainsi que nous l’avons dit plus haut, salle dans laquelle la suivit M. Macallan. Il s’assit devant une table, ses pieds ballotant et tambourinant le tabouret sur lequel il était parvenu à se percher, et il cria :
– Mère Fidèle ! Une plume et de l’encre !
Quand il eut ce qu’il demandait, il avala une large lampée de son « gin and soda », puis plongea avec frénésie la plume dans l’encrier et se prit à écrire sur une enveloppe l’adresse de lord Aberdeen, en son château d’Inverness, Écosse. Enfin, il commença, en anglais, une lettre qui était empreinte, dès les premiers mots, d’un surprenant enthousiasme, et que nous nous empressons de traduire ainsi :
« Mon bien cher grand ami,
« Je vous écris du fond de l’Auberge du Bagne. Je viens de passer une nuit inoubliable et qui me console de bien des choses ! Une nuit encourageante ; une nuit souveraine. Quelle splendide nuit ! »
M. Macallan en était là de ses adjectifs, quand il fut soudain interrompu dans son écriture par le bruit de la porte qui s’ouvrait doucement.
– Le roi ! s’écria soudain Macallan, en apercevant la silhouette qui se dressait devant lui. Le roi !… Vous êtes le roi !… Vous êtes un vrai roi !… You are a right King ! Votre main !… Félicitation !… Well !…
C’était en effet R. C. qui se trouvait devant Macallan.
Une pèlerine noire l’habillait de la tête aux pieds, et son admirable visage pâle, éclairé par ses yeux profonds et en ce moment étrangement douloureux, était tourné vers son interlocuteur, semblant attendre quelque chose de Macallan, quelque chose d’autre que ses congratulations.
Macallan comprit, car il sourit, et, se décidant tout à coup :
– Come on ! fit-il. Venez !
Et, par une sorte de saut de carpe qui le jeta du tabouret sur le plancher, le gnome se retrouvant debout sur ses courtes jambes et sur son court bâton, courut à la porte. R. C. le suivit en poussant un profond soupir.
Dehors, la neige tombait plus épaisse. La crête des murs en était déjà toute ouatée.
Macallan et R. C. quittèrent l’auberge sans même que la mère Fidèle se fût montrée. Ils gravirent un peu la pente de la rue des Saules et prirent à droite, un sentier qui venait couper cette rue à angle droit.
Des murs croulants, quelques planches défaillantes, des branches mortes au-dessus des lamentables palissades et puis, soudain, un cimetière.
Oui, il y avait là un cimetière dont Paris semblait avoir oublié les morts. Un petit enclos en pente, fermé d’une grille rouillée et qui semblait n’avoir pas été ouverte depuis des années sans nombre. À travers cette grille, on apercevait quelques tombes, des croix fléchissantes, des pierres sépulcrales dont les inscriptions avaient été depuis longtemps mangées par la mousse, lavées par les pluies.
Ce misérable petit cimetière est le cimetière Saint-Vincent. Il paraît que l’on y enterre encore des gens, puisqu’en face de la grille on trouve encore un marchand d’ornements mortuaires.
Macallan et R. C. s’était arrêtés.
– C’est ici ? demanda R. C.
– Ici ! répondit Macallan.
XIV – LE SERMENT
Le roi des Catacombes, en proie à une émotion qu’il essayait en vain de dompter, avait déjà appuyé son front sur la grille, et, à travers les barreaux, fixait anxieusement cet enclos funèbre, tandis que Macallan, revenant un peu sur ses pas, allait sonner à la petite porte qui précédait la grille.
En attendant qu’on vint lui ouvrir, il rejoignit R. C. à la grille et, comme lui, considéra ce maigre champ des morts qui, sous le linceul de la neige, revêtait un aspect plus impressionnant encore. Et Macallan, de sa petite voix de crécelle, de sa petite voix odieuse, fit entendre :
– Ne trouvez-vous point, monseigneur que ceci ressemble beaucoup au cimetière du Chevalier Ténèbre ? Indead ! My dear ! Paul Féval l’a dit : « Le cimetière ne possédait pas une seule tombe dont la pierre pût rester scellée. Il n’y avait, pour les tenir en repos, ni plâtre moderne, ni antique ciment. Minuit soulevait tous ces marbres mobiles !… »
Cette voix, cet accent avec lequel il prononçait ces phrases d’un romantisme macabre eurent sans doute le don de révolter prodigieusement, en un tel moment et en un tel endroit, le roi des Catacombes, car Mystère, qui était, comme nous l’avons dit, appuyé à la grille, tordit littéralement l’une des barres de fer sous l’effort insensé de son poignet irrésistible. Jamais on n’eût pu croire que cette main délicate de femme était susceptible de déployer cette force de Titan.
Et il se retourna.
Sa figure, si pâle à l’ordinaire, était alors plus blanche que la neige qui ensevelissait le cimetière. Il s’avança d’un pas menaçant vers Macallan.
Mais Macallan avait déjà tourné le dos à R. C. et était retourné à la porte, où un homme, coiffé d’un képi, l’attendait. C’était le gardien du cimetière. Il lui dit quelques mots et passa.
R. C. suivait. L’homme au képi referma la porte.
Macallan tourna tout de suite à droite, passa entre une double rangée de tombes abandonnées, remonta un peu la pente du terrain et arriva ainsi vers ce coin de cimetière qui touche au mur et qui, encore aujourd’hui, semble ne point avoir abrité de morts, puisque la terre, où pousse une herbe rare l’été, où s’étend uniformément le givre l’hiver, n’exhibe là ni croix, ni couronne, ni fleurs artificielles. C’est dans ce coin, pourtant, que furent enterrés momentanément, lors de la Commune, les cadavres des généraux Lecomte et Clément-Thomas, que l’on avait traînés jusque-là après la fusillade du petit jardin de la rue des Rosiers.
Que venait faire dans cette partie désertée même des morts du cimetière Saint-Vincent, le gnome Macallan suivi comme une ombre par R. C. ?
Arrivé au haut du monticule, Macallan se tourna vers R. C. et, lui montrant l’angle du mur, lui dit :
– C’est là !…
R. C. s’approcha, vit qu’on avait tracé, au goudron, une croix sur le mur. Il tomba à genoux.
La douleur de R. C., profonde comme le silence, muette comme la tombe, discrète comme la mort, le courbait, immobile, sur cette terre sur laquelle l’être le plus pieux eût marché sans que rien fût venu l’avertir qu’il commettait un sacrilège… Rien, pas même ce renflement du sol qui dénonce au regard le plus distrait qu’on a enfoui quelque chose… ou quelqu’un… rien ne pouvait faire soupçonner qu’il y eût là une dépouille sacrée capable un jour de faire plier les genoux à quelque mystérieux passant.
R. C. ne se relevait point… Les minutes s’écoulaient dans le silence de toutes ces choses mortes et dans la douceur glacée de la neige qui pleurait sur le cimetière toutes ses larmes blanches… R. C. ne soupirait point, ne gémissait point, ne pleurait point, ne priait point, mais quand enfin ses épaules se redressèrent et que sa tête nue, que son front dans la pâle lumière du jour, réapparurent à Macallan, celui-ci ne put supporter l’éclat des deux yeux foudroyants, et il recula en étouffant entre ses dents quelques syllabes incompréhensibles.
L’éclair n’est pas plus aveuglant que le regard de R. C. quand R. C. se retrouve debout sur cette terre dont il possède le secret. C’était de la Douleur qui s’était courbée sur elle, c’est une Fureur sainte qui se relève. Et, en vérité, quand, retourné vers Paris, vers la ville dont on aperçoit, du haut de ce misérable tumulus, les tours, les clochers, les flèches innombrables, les dômes monstrueux, quand, debout au-dessus de la prodigieuse cité qui s’éveille, le roi des Catacombes étend lentement la main dans un geste de divine menace, il apparaît bien comme l’ange redoutable, tranquille et sûr de la Vengeance !
À côté de lui, un démon s’agite, souffle sur sa haine, attise la flamme qui dévore le cœur de R. C. :
– Jure ! fait Macallan. Jure et souviens-toi !
Les lèvres muettes de R. C. doivent prononcer un terrible serment, un serment qu’elles n’osent même pas confier aux morts, car elles remuent sans qu’on les entende…
Macallan lui-même, le gnome Macallan, n’entend pas. Et il veut entendre.
– Plus haut ! implore le gnome, dont toute la physionomie est étrange à voir en ce moment.
Ah ! ce n’est plus là une tête à farce, à blague, à clownerie grotesque. Cette tête-là ne se moque plus de rien ni de personne. Elle rayonne aussi de fureur, comme si le feu qui sort des yeux de R. C. l’avait embrasée… Mais quel aspect ! Quel aspect surprenant a cette tête-là… La fureur qui l’anime semble faite à la fois de joie et de colère… Oui, c’est de la fureur joyeuse… En vérité, à le regarder de bien près, M. Macallan tressaille de joie furibonde…
– Jure !… Jure ! Que je t’entende !… Dis, dis seulement « Je jure ! »
Et le gnome tend l’oreille, et il entend le Roi des Catacombes qui dit :
– Je jure !
Alors, Macallan se frotte les mains à s’en arracher l’épiderme, fait un petit salut bref à R. C., du bout de son bâton, accomplit un rapide demi-tour, et, sans plus s’occuper de R. C. que s’il n’existait pas, se dirige vers la porte du cimetière. Il n’est pas plutôt sorti du champ des morts qu’il ne se retient pas de traduire pour lui tout seul l’extraordinaire et fantastique allégresse furieuse de son âme par le mouvement désordonné de son corps. De son gros et court bâton, il tambourine le sol durci, et puis ses genoux se déclenchent et le revoilà parti pour une gigue insensée qui le conduit à nouveau sur le seuil de la mère Fidèle.
Là, il cesse sa danse à la vue d’un personnage qui semble l’attendre, debout sur les marches de l’Auberge du Bagne.
– Tiens ! Le Vautour ! s’exclame-t-il joyeusement. Très gentil d’être venu !
Et il l’entraîne rapidement dans la salle où tout à l’heure nous l’avons vu commencer sa correspondance. Il le tire par la main… Il lui secoue la main.
– Vautour ! Tu vas me raconter des histoires !… Tu vas me dire tout… tout… tout… je veux tout savoir depuis le commencement… Mystère ne me dit jamais rien, lui !… Jamais !… Pas un mot !… Tu entends, pas un mot !… Il y a des jours où je suis bien malheureux, Vautour !
Et il assied lui-même le Vautour sur la petite chaise et il reste planté devant lui, attendant les histoires de Vautour avec une curiosité extrême.
C’était bien le Vautour qui était devant Macallan, mais encore une fois il avait changé de costume. Il avait quitté son déguisement d’ouvrier terrassier et se présentait, le pardessus ôté, dans un complet veston marron qui semblait devoir habiller à l’ordinaire sa réelle personnalité. La coupe n’en était nullement commune, et, si le Vautour avait eu une autre façon de porter son chapeau melon, il serait peut-être parvenu à tromper ceux qui ne le connaissaient point, sur la classe sociale à laquelle il avait l’honneur d’appartenir. Mais un rien, un « on ne savait quoi » de la forme du chapeau qui le distinguait tout de suite, à première vue, de tous les honnêtes chapeaux melons et aussi, comme nous l’avons dit, la manière que ce chapeau avait d’être porté, suffisaient à rejeter un jeune homme comme le Vautour dans la catégorie des jeunes gens qui ont accoutumé de se faire entretenir par les dames. D’autant plus que, grand, bien découplé, carré d’épaules, tout en lui attestant la bonne santé et la puissance musculaire, il devait leur plaire infiniment, malgré le relief effrayant de son masque tragique.
Macallan avait tiré de la poche de son pantalon un immense canif, dont il ouvrit la lame énorme ; il se mit en mesure de se tailler les ongles, et dit au Vautour :
– Je t’écoute !
Le Vautour parla et raconta à l’avorton, qui semblait y prendre un plaisir d’enfant à qui on raconte des histoires de fées, tous les événements de la nuit et tous les détails de l’évasion de Desjardies. Quand il en fut au moment où le malheureux s’était vu arrêter sur le seuil même de la prison par l’interrogation indiscrète du portier, Macallan soupira, ouvrit des yeux effarés, se réfugia entre les genoux du Vautour, avec des gestes de gamin qui redoute pour le petit chaperon rouge la grande bouche de la mère grand.
Heureusement, Desjardies n’avait pas été dévoré. L’intervention opportune du gardien aux yeux d’albinos, qui surveillait avec le Vautour et Patte d’Oie, du haut du judas du greffe, les mouvements de Desjardies, avait décidé à temps le portier à laisser « le nouvel aide du bourreau, qui avait besoin de se rendre au fourgon ». Dix secondes plus tard, Desjardies se trouvait au milieu de la foule de la rue de la Vacquerie, emporté il ne savait où par il ne savait qui. Descendu dans la cave d’un chantier de bois, il n’en était ressorti que pour se retrouver en face de sa fille. Macallan s’émut à ce récent souvenir, mais il rit bien en apprenant la cruelle et dernière aventure qui était survenue aux véritables aides du bourreau.
L’adjudant Beauvisage, qui avait vu entrer les deux aides du bourreau (les deux faux), avait d’abord marqué quelque étonnement d’en voir ressortir trois (Desjardies, le Vautour et Patte d’Oie), et il n’avait rien moins fallu que la nouvelle intervention du gardien aux yeux d’albinos, connu comme le plus fidèle des gardiens par le portier, pour lui faire comprendre que Patte d’Oie n’était autre que le greffier du juge d’instruction, qui courait au-devant du procureur impérial, pour le mettre au courant des sensationnelles révélations faites à l’instant même par Desjardies, ce qui faisait du reste que l’exécution, en dehors de toutes les règles, avait été retardée.
Or, Patte d’Oie, le Vautour et le gardien aux yeux d’albinos n’étaient pas plutôt hors de la prison que le bruit infernal fait par tous les fonctionnaires enfermés dans la cour de l’administration venait éveiller la curiosité du portier, qui entrait sous le guichet du greffe et découvrait « le pot aux roses ».
Or, la police du Vautour, aidée par cet excellent Dixmer, venait de lui apprendre que, dans ce même moment, les vrais aides du bourreau, les deux vrais Prosper et Denis, auxquels la bande des Titis de Pantin venait de rendre la liberté, s’étaient présentés à la porte de la prison comme des fous. Mais l’adjudant Beauvisage, en apercevant encore des aides du bourreau, déclara qu’il en avait assez !
– Qu’on les arrête ! hurla-t-il.
Et c’est ainsi qu’après avoir été arrêtés une première fois, cette nuit-là par des bandits, M. Denis et M. Prosper le furent une seconde fois par des soldats.
Et en écoutant cela, le gnome Macallan ne se tient pas d’aise. Mais pourquoi maintenant le Vautour se penche-t-il à son oreille ? Quelle nouvelle surprenante lui conte-t-il ? D’abord il y a sur les traits du gnome de l’incrédulité, puis de l’anéantissement, puis, tout à coup, de la rage. Mais une rage tellement insensée et si subitement éclatante que, saisissant à plein poing le couteau dont il se nettoyait les ongles, Macallan en donna un coup formidable à la table, si bien que la lame entra de plus d’un pouce dans le bois et que le manche qu’il avait lâché se mit à vibrer comme une flèche empennée qui vient d’atteindre la cible…
– By Jove ! hurla-t-il. Si ce que tu dis là est vrai, Vautour, tu es mon ami ; mais si tu mens ou si seulement tu t’es trompé, je ne donnerais pas un penny de ta peau ! Qui t’a raconté une chose pareille !
– C’est la Mouna ! répliqua simplement le Vautour.
XV – BENVENUTO CELLINI
Le roi Mystère remontait la Butte par des chemins déserts ; son front semblait encore penché sur cette terre funèbre qui avait entendu son serment, et la vision du petit cimetière habitait encore son regard souverain. Le vent qui vint le fouetter au visage dès qu’il arriva au sommet de son ascension parut le rendre à la réalité. Sa figure si sombre se rasséréna et la pensée terrible qui, les instants précédents, le dominait tout entier, sembla faire place à quelque chose de très doux et de très humain…
D’un pas déterminé, il redescendit la Butte du côté de la rue Gabrielle. Avant d’arriver à la Vieille-Rue-des-Moulins, il s’arrêta devant des terrains vagues. Là, il regarda autour de lui et sauta par-dessus une barrière de planches qui bordait un pauvre champ envahi par des tas d’ordures et des tessons de bouteilles. Soudain, il se trouva arrêté par un vaste bâtiment dont la façade donnait certainement sur la Vieille-Rue-des-Moulins.
Il contourna le bâtiment par derrière et ne s’arrêta que lorsqu’il fut devant une petite porte creusée dans le mur même de sa bâtisse. Il tira une clef de sa poche et ouvrit cette porte. Celle-ci laissa voir un escalier sombre et décrépit.
R. C. ayant encore jeté un regard inquisiteur sur les terrains vagues, certain de n’avoir pas été aperçu, referma la porte et, malgré la quasi-obscurité, gravit l’escalier avec une rapidité telle qu’il n’y avait point de doute qu’il ne connût admirablement l’étrange masure.
Mystère avait certainement franchi la hauteur de trois étages sans rencontrer un seul palier. On pouvait donc en conclure que cet escalier avait été construit jadis pour uniquement desservir l’appartement auquel il allait aboutir. Et, à la vérité, c’était bien là un passage secret qui conduisait à une mansarde meublée le plus pauvrement du monde. Une tenture dissimulait la porte de l’escalier par laquelle entra Mystère. Un lit de fer occupait un coin en face ; à côté, une « commode » contre le mur et, pendue au mur, une misérable glace. Au-dessus du lit, un portrait de femme et, seul de tous les objets qui étaient là, ce portrait semblait avoir de la valeur ; non point que le cadre en fût riche, mais le tableau était certainement d’un maître. La signature de l’artiste en était absente.
Cette tête était merveilleusement jolie, pleine de grâce et de douce noblesse. C’était une blonde aux yeux noirs profonds d’Andalouse ; le nez était un peu busqué, très légèrement, suffisamment pour ajouter à cette physionomie enchanteresse un rien de ce caractère un peu altier que tout homme est heureux de rencontrer chez la femme qu’il aime. Ce portrait avait été peint par un amant.
En entrant, après avoir soigneusement refermé sa porte, R. C. s’en fut à de vastes placards qui tenaient tout un côté de la mansarde, les ouvrit avec des clefs spéciales, y prit quelques vêtements, un béret, une boîte qu’il jeta sur une table de toilette, et immédiatement se mit à l’ouvrage.
D’abord, il ouvrit la boîte et en tira une soyeuse barbe blonde, et, après avoir puisé à nouveau dans le petit coffret, il en tira une perruque qu’il disposa fort artificieusement sur son front, et dont la teinte était, ma foi, tout à fait pareille à la teinte des cheveux du portrait.
C’était même une chose surprenante que la ressemblance en blond de R. C. et du portrait de cette femme. C’étaient les mêmes yeux noirs, les mêmes traits réguliers et fins, le même ovale aristocratique, le même teint de lait. Un frère ne ressemble point davantage à sa sœur, ni un fils à sa mère !…
Mystère n’est plus reconnaissable. Et quand il aura revêtu ces vêtements qu’il a jetés sur son lit, le large pantalon de velours à côtes, le veston brun de velours, qu’il aura noué sur sa chemise molle la cravate « Lavallière », il vous apparaîtra comme le plus Montmartrois des artistes.
Robert Pascal, qui avait son atelier à la Grande-Hôtellerie-de-la-Mappemonde, se qualifiait modestement, bien qu’il fût un peu peintre, beaucoup sculpteur et tout à fait artiste, ouvrier décorateur.
Mais ses amis, qui savaient ce dont il était capable, le nommaient Benvenuto Cellini !
Nous comprendrons sans doute l’enthousiasme parfait que dénote une semblable appellation quand nous aurons poussé, avec R. C., redevenu Robert Pascal, la petite porte qui donnait de sa mansarde dans son atelier.
Cet atelier était une vaste pièce quadrangulaire admirablement éclairée par un immense vitrage qui avait à moitié remplacé la toiture en zinc couvrant autrefois les mansardes.
Dès que l’on avait mis les pieds dans l’atelier de Pascal, on s’apercevait que cet ouvrier décorateur était surtout un orfèvre comme il n’en existe plus guère de nos jours.
Bien peu des objets qui se trouvaient là – il était facile de s’en rendre compte à première vue – avaient connu le moule. Tout cela avait été tordu, travaillé, ciselé par la main de l’ouvrier, et il n’eût pas été imprudent de prétendre que le principal, sinon l’unique procédé de l’ouvrier, était le martelage.
Ainsi, il était impossible de découvrir dans tout l’atelier un seul tour. Robert Pascal prétendait quand on s’en étonnait, que le tour a sur le métal des effets déplorables ; il allonge les pores en les étirant et les relâche ; il rend la matière plus molle et plus flasque, tandis que le martelage met le métal dans la meilleure condition moléculaire possible. Bref, il était complet dans son art, comme l’avaient été Binnelleschi, Lorenzo Ghiberti, Verrocchio, et, plus tard, Francia et Benvenuto Cellini, le plus illustre de tous, dont les locataires de l’Hôtellerie-de-la-Mappemonde lui faisaient dès maintenant partager la gloire.
Robert Pascal, ayant traversé tout l’atelier, tira les verrous d’une porte qui donnait sur le palier ; puis, tout doucement, il tira à lui cette porte, dont le panneau s’ornait d’un des plus beaux médaillons qui se puissent rêver, un véritable bijou en cuivre repoussé représentant Marguerite de Valois, aux plus beaux temps de la gloire amoureuse de la reine de Navarre.
Robert risqua un coup d’œil sur le palier et écouta… Puis il repoussa la porte sans la fermer complètement, retraversa son atelier et, se dirigeant vers une enclume ronde qui était placée près du grand vitrage, il saisit sur une tablette un marteau et une feuille d’argent qui s’y trouvaient déposés.
En vérité, Robert Pascal était bien pressé de travailler, ce matin-là. Il avait déjà appliqué sa feuille d’argent, qui mesurait environ, en long et en large, vingt-cinq centimètres, et dont l’épaisseur ne dépassait guère deux millimètres, sur l’enclume. Il est probable que le dessein de l’artiste était de transformer cette feuille en un vase, car au milieu de cette feuille, se trouvait déjà dessiné le cercle marquant la partie qui devait rester plate et servir d’embase.
Levant son marteau d’une main, maintenant de l’autre la feuille d’argent sur l’enclume, le voilà qui commence son œuvre. Il frappe. Il frappe et il voit la feuille prendre peu à peu la forme sphérique.
Pascal est en train d’emboutir sa pièce, c’est-à-dire de rendre celle-ci concave d’un côté, convexe de l’autre. Et il frappe, il frappe encore…
À un moment, il s’arrête de frapper, il écoute… Et puis il frappe, il frappe trop fort, il frappe maintenant avec rage ; la pauvre feuille d’argent est en lambeaux… Il frappe encore jusqu’au moment où il entend que l’on frappe à la porte ; alors, il jette loin de lui son marteau et court à la porte qu’il ouvre.
Une jeune femme tout en noir est sur le seuil.
– Entrez, mademoiselle… dit Robert Pascal.
Et Gabrielle Desjardies entre…
Ce n’est plus la figure désespérée que nous avons vue apparaître sur le seuil du salon Pompadour de la place de la Roquette. Cette face d’outre-tombe est revenue à la vie, ces joues ont repris de la couleur, ces yeux n’ont plus leur regard d’épouvante.
Gabrielle s’avance vers Robert d’un mouvement si spontané, tout son être gracieux tendu vers lui, les mains en avant cherchant déjà celles du jeune artiste, que l’on devine qu’il y a dans ce mouvement-là une reconnaissance infiniment douce et qui brûle de s’exprimer.
– Oh ! mon ami !… dit-elle.
C’est tout ce qu’elle trouve… C’est du moins tout ce qu’elle dit… Elle s’arrête pleine de confusion, car elle vient de s’apercevoir qu’elle est tout contre, tout contre la poitrine du jeune homme, si près de son cœur qu’elle pourrait l’entendre battre…
Et alors elle recule un peu, si peu qu’un spectateur désintéressé de cette petite scène, après avoir jugé que le premier mouvement qui avait précipité Gabrielle vers Robert était de reconnaissance, n’aurait pas hésité à estimer que le second qui l’en éloignait était d’amour…
Robert Pascal n’était pas moins troublé que la jeune fille : peut-être l’était-il davantage, car enfin, si elle n’avait dit que trois mots, il n’avait pas encore prononcé une parole, lui… Mais ses yeux parlaient pour lui, son regard enveloppait Gabrielle.
Il parvint cependant le premier à rompre le charme de ce trouble délicieux. Il pria la jeune fille de s’asseoir et lui dit, sur un ton qu’il parvint à rendre des plus naturels :
– Eh bien ! Gabrielle, vous avez sans doute de grandes nouvelles à m’apprendre ?…
– Vous savez bien que mon père est sauvé ! s’écria la jeune fille.
– Certes ! Je le sais depuis que vous avez poussé cette porte, répliqua Robert Pascal. Car cela seul, n’est-ce pas, pouvait faire votre regard si brillant, votre physionomie si rayonnante, vos gestes si vivants… Quand je vous ai vue pour la dernière fois, il y a trois jours, Gabrielle, vous sembliez une morte et vous voilà ressuscitée… En faut-il davantage pour m’apprendre que votre père est sauvé ?
– Mon ami ! C’est à vous qu’il doit la vie !… C’est à vous qu’il devra l’honneur…
– À moi ? s’écria le jeune homme, en montrant les marques de la plus sincère stupéfaction. À moi ?…
– Oui, à vous !… Je ne sais ce que vous faisiez pendant ces trois jours d’absence, ces trois longs jours interminables, ces jours de folie où j’attendais ici un mot de vous comme vous me l’aviez ordonné, pendant que mon père attendait l’heure prochaine où il allait marcher à l’échafaud… Je ne sais ce que vous faisiez… mais mon cœur me dit que pas une minute de ces trois jours ne s’est écoulée sans que vous ayez travaillé pour nous, pour lui… pour son salut… pour sa délivrance… pour la réalisation de ce rêve insensé auquel je ne voulais, je ne pouvais pas croire : l’évasion d’un condamné à mort !… Et mon cœur ne me trompe pas !…
– Gabrielle, savez-vous où j’étais pendant ces trois jours-là ?
– Non !
– J’étais à Saint-Valery-sur-Somme !
– À Saint-Valery-sur-Somme !… Et que faisiez-vous à Saint-Valery-sur-Somme ?
– Je chassais le canard sauvage !
– Pourquoi me dites-vous cela, Robert ? Je ne vous crois pas…
– Il faut toujours me croire, Gabrielle, même quand je vous dis que je chasse le canard sauvage… L’hiver, quand je ne travaille pas, c’est ma distraction favorite…
– Je ne puis croire que vous ayez eu le cœur de vous distraire, mon ami, quand vous me saviez plongée ici dans un aussi sombre désespoir…
– Bah ! fit Robert en souriant, ne savais-je pas aussi que la source de ces larmes serait bientôt tarie, et que tant de douleur aurait une fin prochaine ?… Si vous aviez eu confiance en moi, Gabrielle, votre torture aurait cessé bien avant ces trois jours-là… Mais voilà, vous n’aviez pas confiance en moi…
– Vous raillez, Robert, et vous me chagrinez… Eh quoi ! dans ce moment où nous ne devrions plus avoir de secrets l’un pour l’autre, dans ce moment où ma reconnaissance infinie est prête à vous donner ma vie en échange de celle de mon père que vous avez sauvée, vous continuez à jouer ce jeu de l’indifférence, auquel je n’ai jamais cru, vous persistez à prétendre que vous n’êtes pour rien dans les événements providentiels qui se succèdent dans ma triste existence depuis que je vous connais… Vous allez jusqu’à vouloir me faire croire que vous ne vous y intéressiez même pas !…
– Si, Gabrielle, je m’y intéressais, vous le savez bien, puisque c’est moi qui ai parlé de vous à mon tout-puissant ami, et c’est à cet ami seul que doit aller votre reconnaissance… Si vous aviez eu confiance en moi comme j’avais confiance en la toute-puissance de cet ami, les trois jours que vous avez passés ici, dans la solitude, vous auraient paru moins terribles… Eh bien ! Gabrielle, que dites-vous de mon ami ?
– Le roi Mystère ?…
– Oui, le roi Mystère…
– Il faut bien que j’y croie puisque vous me dites que c’est lui qui a sauvé mon père !…
– Vous ne l’avez donc pas vu ?
– Cette nuit ? Oh ! oui, je l’ai vu !… fit Gabrielle d’une voix tremblante…
– Il m’avait fait savoir en effet qu’il vous verrait cette nuit, dit Robert…
– Quand vous a-t-il fait savoir cela ?…
– Mais, dans la lettre, reprit le jeune homme, où il me priait de vous avertir d’avoir à vous trouver cette nuit même, à deux heures, sur le terre-plein de l’Opéra.
– Et vous avez reçu cette lettre à Saint-Valery-sur-Somme ?
– La voici ! fit le jeune homme.
Et il tira de son portefeuille une enveloppe qui portait comme suscription ceci : « Monsieur Robert Pascal, Hôtel de France, Saint-Valery-sur-Somme. »
Le timbre de cette enveloppe avait été oblitéré par le cachet de la poste.
– Lisez ! dit Pascal en tirant la lettre de son enveloppe.
Gabrielle lut :
« Mon cher Robert,
» Vous seriez tout à fait aimable de prévenir Mlle Desjardies d’avoir à se trouver après-demain, jeudi, à deux heures du matin, sur le terre-plein de la place du nouvel Opéra. Sitôt qu’elle sera arrivée, je le saurai et j’irai moi-même la rejoindre et la conduire auprès du procureur impérial. Elle devra prendre le bras de l’homme qui viendra à elle en lui disant simplement : « R. C. » Conseillez-lui bien de ne s’étonner de rien, et de ne poser aucune question. Comment va la chasse ? On signale du côté de Saint-Valery-sur-Somme un grand passage de canards sauvages. Quand nous revenez-vous ?
» Grandes amitiés. Signé : R. C. »
– C’est étrange ! fit Gabrielle, très émue. Alors, l’homme en noir qui m’a pris le bras quand j’arrivais sur le terre-plein de l’Opéra, c’était votre ami !… C’était le roi Mystère !…
– Vous ne l’avez donc pas interrogé ?…
– Non ; vous me l’aviez défendu dans la lettre qui me dictait toute ma conduite… et qui m’a été remise d’une façon si bizarre… Elle ne portait ni date… ni timbre… elle ne portait que votre écriture et elle avait été glissée sous ma porte… et rien ne pouvait me faire croire qu’elle vînt de Saint-Valery-sur-Somme…
Il y eut un silence entre les deux jeunes gens, puis Gabrielle prit les mains de l’artiste et lui dit sur un ton d’adorable prière :
– Ainsi, Robert, vous me jurez que vous n’êtes pour rien dans les événements de cette nuit, que vous ne les connaissez pas, que j’ai été la première à vous apprendre qu’au moment même où on allait le conduire à l’échafaud – car l’affreuse chose devait avoir lieu cette nuit, cette nuit même – mon père a été sauvé par une intervention divine ?… Vous me jurez que je suis la première à vous apprendre tout cela ?…
– Je vous le jure, Gabrielle.
Robert Pascal n’avait pas hésité à dire : « Je vous le jure ! »
– C’est bien, fit Gabrielle un peu triste, c’est bien ; je vous crois… J’aurais désiré que la dette d’immense reconnaissance que j’ai contractée l’eût été surtout vis-à-vis de vous, mon ami ; j’en ferai donc deux parts, dont la meilleure vous est encore réservée, puisque sans vous je n’aurais pas connu ce tout-puissant ami qui fait des miracles pour vous être agréable, et puisque… puisque je vous aime, Robert…
C’était la première fois que Gabrielle prononçait ces trois mots. Le jeune homme comprit que Gabrielle, désormais, lui appartenait et qu’il n’avait qu’à étendre les bras pour qu’elle fût à lui. Chose curieuse, son front, tout à l’heure si rayonnant, se rembrunit. Et c’est d’une voix glacée qu’il laissa tomber ces mots dans le silence cruel qui, tout à coup, les séparait.
– Si mon ami n’avait pu sauver votre père, Gabrielle, m’aimeriez-vous ?
La jeune fille n’hésita pas :
– Je serais morte en vous aimant, Robert.
Robert n’était pas encore satisfait.
– C’est donc mon ami qui vous a sauvé la vie à tous les deux, fit-il, c’est mon ami qu’il faut aimer, Gabrielle !
– J’admire votre ami, répliqua Gabrielle, d’une voix singulière, mais c’est vous que j’aime, Robert !…
– Gabrielle ! Gabrielle ! s’écria Robert, en proie à une étrange exaltation… Je suis jaloux… Je suis terriblement jaloux de mon ami !…
La jeune fille fixa Pascal de ses beaux grands yeux pleins de douleur et d’amour.
– Pour vous, dit-elle, je suis prête à commettre le plus abominable des crimes, celui de l’ingratitude. Je ne penserai même plus à votre ami, votre pensée seule m’occupera le cœur. Je ne veux plus connaître votre ami, de qui cependant dépend toute la sécurité de mon père. Je vous aime, Pascal ; ce n’est pas l’autre que j’aime, c’est vous !
– Que voulez-vous dire ? s’écria l’ouvrier orfèvre. Gabrielle ! Je ne vous comprends pas !…
– Comprenez, Robert, reprit Gabrielle en baissant la voix, comprenez que votre ami a des yeux aussi effrayants que les vôtres sont doux…
– Alors, mon ami ne vous plaît pas, Gabrielle ?
– Comment pourrais-je dire cela d’un homme qui a sauvé mon père ? répondit la jeune fille. Seulement, voyez-vous, c’est un homme…
– C’est un homme ?… demanda avec anxiété et insistance Robert Pascal.
– C’est un homme qui me fait peur ! dit Gabrielle en frissonnant.
Robert Pascal, à ces mots, attira doucement la jeune fille sur sa poitrine haletante. Cette fois, elle n’eut aucun mouvement de recul. Elle se laissa aller en toute confiance et en tout amour sur ce cœur généreux, et ses lèvres ne se dérobèrent point au baiser passionné qui venait enfin de sceller le pacte qui liait désormais leurs âmes et leurs corps…
DEUXIÈME PARTIE – LA PETITE MAISON DE LA RUE DES SAULES
I – LA COLÈRE DE SINNAMARI
La colère de Sinnamari était gigantesque. Cet homme d’une incroyable audace, d’une astuce prodigieuse, d’une faculté d’intrigue telle que pour en retrouver le type il eût fallut puiser dans l’histoire des petites républiques italiennes du seizième siècle, qui eût pu écrire le Traité du prince, si Machiavel avait oublié de le faire ; ce magistrat, dont la tête formidable de forçat en rupture de ban, de « Trompe-la-Mort » qui a réussi à se recaser parmi les vivants, avait dans certains moments des airs de finesse florentine, ce bandit de génie qui devait être né entre Toulon, la ville des bagnes, et Florence, la ville des Médicis, qui ressemblait à Vautrin et qui agissait comme Mazarin, dont il avait l’avarice, cet homme que de honteux et nécessaires services publics rendus à plusieurs ministres – qui savaient où le trouver aux heures de crise politique – et aussi que le crime privé avait conduit à l’une des premières places de la magistrature française, revenait de cette fameuse nuit de la place de la Roquette, beaucoup moins furieux d’avoir été joué, berné, ridiculisé personnellement, que d’avoir vu, de ses propres yeux vu, se dresser au-dessus de la puissance de l’État, une sorte de héros de roman comme en créent les imaginations en délire des plus extraordinaires hommes de lettres, et tel qu’il eût juré, encore la veille, que de pareilles figures ne pouvaient et n’avaient jamais existé en chair et en sang !
Ainsi, il s’était trouvé réellement un homme pour accomplir dans les ténèbres l’œuvre d’intrigue et de force qu’il avait accomplie, lui, au grand jour. Pendant que, lui, Sinnamari, travaillait à l’édifice de sa fortune sur la place publique, il y avait quelqu’un qui avait osé établir la sienne au-dessous du forum, dans l’ombre, dans le secret inquiétant des cavernes, dans les catacombes, dont il se proclamait roi ! Et cette fortune, et cette puissance, et cette royauté n’étaient point un conte ! Il en avait eu, la nuit même, la preuve écrasante !…
Cet homme avait ses troupes, ses soldats, son administration… Cette association n’était pas plus un vain songe que ne l’avaient été tant de ligues, « comornas », « ventes », qui s’étaient plus ou moins, à un moment donné, partagé bénévolement le monde en se donnant tout d’abord pour mission, avant de devenir un véritable instrument politique, de rétablir la justice sur la terre, de frapper le fort et d’élever le faible !…
Et l’un des premiers auxquels elle s’attaquait, c’était lui ! Lui, le procureur impérial, lui devant qui tous les ennemis de l’État tremblaient, et à qui l’État était redevable de tant de choses qu’il pouvait se croire tout permis, qu’il espérait tout oser, et qu’il comptait bien tout réussir !… Et voilà que ce roi de roman-feuilleton, s’attaquant à lui, procureur impérial, en ce qu’il lui volait un de ses condamnés à mort, faisait l’attaque plus personnelle encore en ce qu’ayant à choisir un condamné à sauver, il avait justement choisi qui ? Desjardies !…
Mais, pensant à ceci, dans la voiture qui le conduisait au Palais de Justice, Sinnamari avait un sinistre sourire qui éclairait étrangement sa figure ravagée par son intime fureur. Il estimait à part lui que R. C. s’était surtout attaqué au procureur, et c’était tout à fait inconsciemment qu’il se trouvait avoir touché, beaucoup plus qu’il n’y avait songé certainement, à Sinnamari lui-même ! Est-ce que ce n’était pas le même R. C. qui avait jeté Mlle Desjardies à ses pieds ? Et ceci n’expliquait-il point suffisamment que R. C., qui supposait évidemment Desjardies innocent, n’avait aucune idée du vrai coupable ?
Et Sinnamari souriait.
Oh ! le sourire de Sinnamari !… Le sourire d’un homme qui n’a jamais douté de lui-même, qui se croit plus fort que tous, ceux d’en bas et ceux d’en haut, princes de la terre ou rois des ténèbres ! Maintenant qu’il était sûr que ce roi Mystère n’était point une ombre, comme il allait l’abattre !
Mais ce roi Mystère était fou de l’avoir ainsi laissé partir, lui, Sinnamari, qui avait été en sa possession ! Ah ! le pauvre roi Mystère fou qui avait montré Desjardies délivré et les avait délivrés à leur tour !… Une longue promenade dans les ténèbres dirigée par des laquais armés jusqu’aux dents ; puis la réapparition des convives sur le pavé de Paris, dans une cour de la rue Montgallet !… Et maintenant le voilà, lui, le procureur impérial, dans un fiacre prêté par le roi des Catacombes, roulant vers le Palais de Justice, avec son ami Régine à ses côtés !… Ah ! il fallait agir, et vite !… À cause de cette histoire Desjardies…
Et Sinnamari se tourna vers son compagnon, ce pauvre Régine qui, anéanti sur son coussin, semblait ne pas encore avoir recouvré la pleine possession de lui-même.
– Eh bien ! Régine !… À quoi penses-tu, mon vieux camarade ?…
Régine sursauta.
Il répondit à cette question par un soupir qui renseigna suffisamment le procureur impérial sur la nature des pensées de « son vieux camarade », car Sinnamari répliqua à ce soupir comme il eût répondu à une phrase nettement explicative.
– Tu es fou ! souffla Sinnamari. Que crains-tu ? Tu vieillis, mon cher !… Qui m’a fichu une pareille poule mouillée ?… C’est ce roi d’opérette qui te produit un semblable effet ? C’est ce fameux R. C. qui te « coupe le sifflet » ? Remets-toi, je t’en prie… nous approchons du Palais, et je ne tiens pas à ce que l’on te voie descendre d’un fiacre en ma compagnie, avec cette figure d’enterrement !… Tu te porterais mieux si tu revenais de l’enterrement de Desjardies, hein ?
– Tais-toi !… Tais-toi !
– Qu’importe, après tout, que Desjardies vive, pourvu que Lamblin ne soit pas ressuscité !
– Ah ! Tais-toi ! supplia encore Régine en frissonnant.
– As-tu vu la figure de Philibert Wat, quand la fille de Desjardies nous racontait sa petite histoire ? En voilà un à qui il faudra que je parle « dans le blanc des yeux » avant deux fois quarante-huit heures… S’il s’imagine que la Providence a suffi pour le débarrasser d’un Didier… et d’un Lamblin !…
– Prends garde, Sinnamari !… On pourrait t’entendre…
– Malheur à qui pourrait me comprendre, Régine !
Et Sinnamari leva le poing comme s’il allait frapper, et sa face ardente livra toute la joie mauvaise qui le transportait à l’idée de la bataille… Régine, effrayé, le regardait… il avait la figure d’un assassin héroïque.
– Calme-toi, Sinnamari ! Tu avais cette figure-là le jour où…
– Le jour, acheva Sinnamari en ricanant, où Desjardies a tué Lamblin !… Allons bon ! Voilà que tu vas te trouver mal !… Décidément, il n’y a rien à faire avec toi ! Je ne travaillerai plus qu’avec Eustache Grimm. En voilà un que rien ne trouble ! As-tu vu quel appétit il avait cette nuit ? Il n’a lâché ses gelinottes que lorsque la Desjardies s’est mise à parler de Didier…
– Didier… soupira Régine.
– Dame ! s’exclama le procureur… on a chacun le sien… Il a « son Didier », comme nous avons « notre » Lamblin.
Régine se souleva, et d’une voix rauque :
– Je te défends de parler ainsi. S’il n’avait dépendu que de moi…
– S’il n’avait dépendu que de toi, mon vieux Régine, le gouvernement serait foutu !
» Je les tiens tous ! rugit-il sourdement. Mon crime a été leur salut !
Et se penchant vers son triste compagnon :
– Vois-tu, Régine, tu es un soldat, tu devrais comprendre ces choses-là… Il y a des moments où le général en chef doit faire le coup de feu… Bonaparte au pont d’Arcole !… Allons, debout ! Nous sommes arrivés !
La voiture venait, en effet, de s’arrêter devant la grille du Palais. Sinnamari en descendit vivement et Régine, faisant un violent effort sur lui-même, suivit le procureur.
En montant l’escalier qui conduisait à son cabinet, escalier qu’avait gravi quelques mois plus tôt l’infortuné Desjardies, Sinnamari sentit que la vague inquiétude que les événements de la nuit avaient, quoi qu’il en eût, laissée au fond de lui-même, s’évanouissait tout à fait. Le lieu dans lequel il se mouvait, l’aspect du monument de justice, de force et de châtiment dont il était le maître incontesté, avaient suffi à lui rendre l’entière confiance dont il avait besoin pour aller jusqu’au bout de son destin.
Péniblement, Régine montait derrière lui. S’il avait pu échapper à cette nécessité de pénétrer avec Sinnamari dans ce cabinet maudit !… Et l’idée seule qu’il allait revoir cette table où Lamblin, avant de tomber, s’était désespérément accroché, ce parquet où il avait roulé en exhalant son dernier soupir et sa suprême malédiction, ce coffre-fort qui avait contenu la raison du crime qui s’était accompli devant lui sans qu’il ait eu le temps de faire un geste pour l’empêcher, du crime dont il avait été l’inconscient complice, du crime qui le sauvait lui… et les autres !… Cette idée faisait encore son pas chancelant, et la sueur lui coulait au front, et la peur le tirait par derrière…
La porte qui donnait sur les bureaux du procureur était entrouverte. Un huissier saluait sur le seuil Sinnamari et Régine.
– Mme Demouzin est ici ! fit l’huissier. Elle a demandé M. le procureur impérial. Je l’ai fait attendre dans le cabinet de M. le secrétaire.
– La mère Demouzin ! À cette heure !… bougonna entre ses dents Sinnamari, en faisant passer Régine devant lui… Qu’est-ce qu’elle va encore nous apprendre, cette vieille taupe ?
Et il ferma la porte derrière eux.
Il n’y avait encore, de si bon matin, qu’un huissier dans le vestibule de M. le procureur. L’huissier mettait de l’ordre… et écoutait aux portes.
Il ouvrit la porte par laquelle le procureur et Régine venaient de disparaître. Il constata alors que le secrétariat, sur lequel donnait cette porte, était vide, et que Mme Demouzin devait avoir suivi Régine et le procureur dans l’autre pièce.
L’huissier traversa le secrétariat et alla enfin coller son oreille contre la porte du cabinet du procureur.
Il se redressa bientôt et, résolument, ouvrit cette porte.
Le cabinet était vide.
L’huissier traversa le cabinet et alla coller son oreille contre la porte qui donnait sur le bureau du substitut. Là, il resta plus longtemps, puis enfin, il se redressa :
– Oh ! oh ! siffla-t-il.
Évidemment, l’huissier avait entendu quelque chose qui l’intéressait au plus haut point. Il s’empressa de refaire tout le chemin parcouru, de revenir dans le vestibule, de fermer à clef la porte de ce vestibule qui donnait sur la galerie, puis de prendre un petit corridor qui glissait entre la galerie extérieure et les différentes pièces consacrées au service du procureur. Ainsi arriva-t-il contre la cloison qui le séparait du bureau du substitut.
Là, il s’arrêta, s’agenouilla au-dessus d’une bouche de chaleur qui s’ouvrait moitié dans le bureau du substitut, moitié dans le corridor, et, malgré l’air surchauffé qui risquait de l’asphyxier, se maintint dans cette position difficile pendant plus d’un quart d’heure.
Soudain il se releva, la face rouge, les yeux fous, et bondit jusqu’au vestibule.
Il y arriva juste à temps pour se trouver en présence d’une tête qui émergeait du plancher dans lequel il y avait un trou entouré d’une rampe.
Par cette étroite ouverture, on communique directement encore aujourd’hui avec un escalier à pic tournant sur lui-même et conduisant à la « souricière », prison de passage où l’on enferme nombre de prisonniers qui doivent, dans un délai rapproché, se présenter devant les juges.
Cet escalier pouvait servir soit à faire monter directement de la souricière dans les bureaux du procureur, les prisonniers auxquels on voulait faire subir un interrogatoire, soit au personnel du procureur à se rendre directement des bureaux dans la cour de la Sainte-Chapelle, sans avoir à suivre les couloirs ni les escaliers publics.
La tête s’élevait peu à peu au-dessus du plancher. Quand la tête eut été suivie du buste et des jambes et que tout le corps de Dixmer fut sorti de l’oubliette, Dixmer dit :
– Bonjour, monsieur Cyprien. M. le procureur impérial est dans son bureau ?
– Oui, répondit M. Cyprien en prenant une mine désolée et bonasse, oui, M. le procureur est dans son bureau ! Mais il est de bien bonne heure, monsieur Dixmer, et M. le procureur ne reçoit personne quand il vient à ces heures-là. C’est une consigne générale.
– Il est seul, dans son bureau ?
– Non, monsieur Dixmer, non, il n’est pas seul. Il est avec M. Régine.
– Vous voyez donc bien qu’il reçoit, monsieur Cyprien…
– On ne saurait dire que M. le procureur impérial ait reçu ce matin M. Régine, car il est venu ici avec lui.
Dixmer regarda la figure du larbin, se demandant si celui-ci ne se payait pas sa tête ; mais M. Cyprien avait, plus que jamais, l’aspect doucereux, niais et ennuyé d’un domestique de bonne maison qui entend faire respecter sa consigne sans cependant se fâcher avec celui qu’elle gêne.
– Et M. le procureur est seul avec M. Régine ? demanda Dixmer.
– Non… il y a, avec ces messieurs, une dame…
– Et vous continuez à prétendre, monsieur Cyprien, que M. le procureur ne reçoit pas !…
– La consigne générale, monsieur Dixmer, comportait une exception…
– En faveur de cette dame ?
– Vous l’avez dit, monsieur Dixmer.
– Et pourrait-on savoir le nom de cette personne, que l’on reçoit quand on me laisse à la porte ?
– Mon Dieu, je n’y vois pas d’inconvénient ; c’est Mme Demouzin.
– Je m’en doutais… fit Dixmer entre ses dents… Et vous croyez qu’il en ont encore pour longtemps ?…
– Je n’en sais rien ! Veuillez le croire, monsieur Dixmer…
– Elle vient souvent ici, Mme Demouzin ?
– Je l’ai oublié !…
– Voilà une réponse ridicule, monsieur Cyprien, car je ne vois pas pourquoi vous me cacheriez que Mme Demouzin vient quelquefois chez M. le procureur impérial… C’est une aimable vieille dame qui va voir tout le monde, et que tout le monde va voir. Mme Demouzin est une personne à la mode, dont le salon est fort côté par tous ceux qui ont l’ambition de devenir quelqu’un… ou d’obtenir quelque chose du gouvernement…
» C’est votre métier d’ouvrir les portes, monsieur Cyprien, ouvrez-moi donc celle de M. le procureur, je vous prie !
Mais le bon Cyprien répondit une fois de plus que c’était également son métier de les tenir fermées. Dixmer, énervé, alla aux fenêtres qui donnaient sur le boulevard du Palais.
– Tiens, fit-il, voilà l’équipage de M. le préfet de police qui rentre chez lui !…
Et il regarda sa montre, ne pouvant dissimuler un mouvement d’impatience.
– Avant une demi-heure, se dit-il, le préfet sera ici !… Cette histoire va faire un chambard !…
Alors, il sembla avoir pris une résolution soudaine.
– Parfait ! fit Dixmer… Eh bien ! Puisque vous ne voulez pas m’introduire, je vais me présenter tout seul !
Et Dixmer, s’approchant si près du visage de M. Cyprien, qu’on eût pu croire qu’il allait l’embrasser, lui dit :
– Je crois que le mot de passe aujourd’hui est Panthéon… mon cher Martinet…
M. Cyprien « reçut » le mot de passe avec un sang-froid auquel on ne se fût point attendu de la part d’un homme d’aspect aussi paterne. Il s’effaça devant Dixmer en lui tendant la main :
– Sans rancune, monsieur Dixmer !
Le haut fonctionnaire de la police ne s’étonna point que ce domestique lui tendît ainsi la main.
Il la prit et Cyprien la garda une seconde.
Il est probable que cette main avait répondu à la question que la main de Cyprien avait posée, car l’huissier dit :
– Passez !
Quand il fut à la porte du cabinet du substitut, Dixmer se tint un instant immobile, parut écouter et, tout à coup, ayant frappé, ouvrit cette porte.
Il se trouva en face de Sinnamari qui, debout entre Régine et Mme Demouzin, ces deux derniers assis, gesticulait, frappait son bureau de son poing fermé et déclarait :
– Je ne vous écrirai point une lettre pareille ! Du reste, c’est fini ! Je n’écrirai plus jamais !
Il s’arrêta en voyant apparaître Dixmer sur le seuil de son cabinet.
– Ah ! c’est vous ! s’écria-t-il, très étonné… J’avais ordonné qu’on ne laissât entrer personne !… Mais voilà, et c’est tant mieux, car j’allais vous envoyer chercher… Est-ce que le préfet de police est rentré chez lui ?… J’ai besoin de le voir aussi ! Et le chef de la Sûreté, cet imbécile de Dax ! Je ne veux plus le voir en peinture !… C’est un idiot !… capable tout au plus de commander à la brigade des garnis et d’arrêter les filles au pieu !…
» Avant huit jours, continua-t-il, je l’aurai fait mettre à pied !
– Et par qui le remplacerez-vous ? demanda Mme Demouzin.
– Est-ce que je sais ?… Par le roi des Catacombes !… En attendant, laissez-moi vous prier, madame, de remettre à un autre jour la suite de notre entretien… Nous avons une besogne à faire ici qui n’est pas ordinaire…
Comme Mme Demouzin se levait, Dixmer, à la stupéfaction générale, la pria de s’asseoir.
– Qu’est-ce que ça signifie ? demande Sinnamari, presque suffoqué.
– Cela signifie, monsieur le procureur impérial, répondit Dixmer, que vous allez écrire à Madame la lettre qu’elle vous demande…
II – OÙ APRÈS AVOIR FAIT LE JEU DE TOUT LE MONDE, DIXMER COMMENCE À JOUER LE SIEN
Mme Demouzin était une petite femme toute ratatinée, contrefaite, les lèvres peintes, les sourcils noir de charbon, habillée avec une assez sobre élégance mais portant, sur la fourrure sombre de son manteau, une longue et épaisse chaîne d’or.
Cette vieille femme peu ragoûtante était à la tête de l’un des salons les plus fréquentés de Paris, et passait pour être plus puissante qu’un ministre. Elle se mêlait autant qu’elle le pouvait des affaires des autres, et le bruit courait que cela faisait parfaitement les siennes.
Si Mme Demouzin aimait à s’occuper des affaires des autres, elle ne tenait guère, à moins qu’elle ne vous y invitât, à ce qu’on mît le nez dans les siennes…
Aussi, si le procureur impérial montra de la suffocation, lors de l’intervention si inattendue de Dixmer, Mme Demouzin montra de la hauteur. Ses petits yeux brillants de courroux fixaient Dixmer et sur son chapeau deux plumes, l’une blanche et l’autre bleu pâle, avaient pris résolument le parti de leur maîtresse, recourbées comme des points d’interrogation, semblant demander, avec force agitation et balancement, à l’intrus, les raisons de son intrusion.
Quant à Régine, le lecteur le connaît suffisamment maintenant pour imaginer qu’il ne montrait aucune colère de l’incident, mais qu’il en ressentait certainement de l’inquiétude. Cet ancien soldat était cependant ce que l’on est convenu d’appeler un homme brave, et il l’avait glorieusement prouvé au feu. Sa conduite pendant la guerre d’Italie avait été admirable.
Régine, si audacieux dès qu’il s’agissait de mourir honorablement, devenait lâche dès qu’il se trouvait en face de la nécessité, pour vivre ou pour faire vivre les siens, d’une action déshonorante.
Comment expliquer une pareille nécessité ? Par le jeu ! Le jeu, après en avoir fait un officier aux abois, en faisait à cette heure un tripoteur de profession. Sa débâcle avait commencé avec celle de la Caisse générale des voies ferrées, qui engloutit tant de fortunes ; il avait dû signer alors un nombre considérable de billets à ordre qu’il n’avait jamais pu payer. Depuis, malgré sa haute situation politique, qu’il devait tout entière à Sinnamari, tombé entre les mains des usuriers, usant de tous les moyens pour se procurer de nouvelles ressources, d’abord dupé, puis indélicat, il ne devait pas tarder à devenir le jouet des plus louches intermédiaires. Sur l’intervention même du procureur impérial, qui avait tout intérêt à le savoir entièrement à sa disposition, il alla porter, un beau jour, un papier qui le gênait à l’une des âmes damnées de Sinnamari ; Mme Demouzin s’en chargea et réussit facilement à le négocier. Dès lors, il faisait partie de l’agence Demouzin, et, peu à peu, monta, malgré lui, au premier plan de cette puissante organisation, imaginée par le procureur impérial, dont tous les rouages visibles étaient réunis entre les mains de Philibert Wat, gendre du président du conseil, organisation qui s’était donné pour mission de vendre, à son profit, tout ce qu’un gouvernement doit donner pour rien : places, charges, concessions, honneurs.
Ce matin-là, Mme Demouzin avait des choses d’importance à confier à son cher procureur. On a su depuis qu’il s’agissait de trois affaires que Sinnamari croyait conclues et qui, sans qu’il fût possible d’en trouver la raison, lui échappaient complètement. Depuis quelque temps, en effet, l’association semblait jouer de malheur.
Sinnamari, qui n’était point habitué à trouver d’obstacles, en concevait une rage qui n’osait s’exprimer librement que devant Mme Demouzin et devant Régine.
– Et l’affaire Merlin ? interrogea-t-il en crispant ses poings puissants. Faudra-t-il lui dire aussi adieu à celle-là…
– Pour l’affaire Merlin, ça marche ! avait répondu la Demouzin, mais il me faut une lettre de vous !…
C’est là-dessus que Sinnamari avait déclaré qu’il ne l’écrirait pas et que Dixmer était survenu pour le prier de l’écrire.
– Monsieur le procureur, fit Dixmer, si vous me le permettez, je vais laisser ouvertes toutes grandes les portes qui donnent sur votre cabinet ; il est préférable quand on a des choses intéressantes à se dire, d’avoir affaire à des portes ouvertes qu’à des portes fermées, au moins on est à peu près sûr que l’on n’écoute pas derrière.
– Vous en parlez par expérience, Dixmer !
– Oh ! monsieur le procureur impérial, c’est par pure coïncidence que, me trouvant derrière votre porte au moment où vous entreteniez Mme Demouzin de l’affaire Merlin, j’ai saisi, bien malgré moi, quelques éclats de votre conversation.
– Qu’est-ce que c’est que l’affaire Merlin ? demanda le procureur du ton le plus indifférent ; il faudrait d’abord me le dire, Dixmer.
– C’est une affaire, monsieur le procureur, dans laquelle on essaie de perdre le crédit si honorable de Mme Demouzin et dans laquelle on tente de vous atteindre.
– Expliquez-vous, Dixmer, fit Sinnamari visiblement impatienté.
Dixmer alla jeter un coup d’œil du côté du vestibule, constata que celui-ci était vide et que Cyprien lui-même était allé se faire pendre ailleurs, et, ayant pris le soin, comme il en avait demandé la permission de laisser toutes les portes ouvertes, vint s’asseoir tranquillement sur une chaise que personne ne lui offrait.
– M. Merlin, fit-il, a été présenté, il y a environ trois semaines, à Mme Demouzin. Il se disait un riche industriel du Gard et ne fit point mystère qu’il désirait acheter les houillères de Portes et Sénéchas. Mais cette opération, qu’il estimait excellente, se trouvait retardée par l’entêtement que mettait le gouvernement à exiger de l’acheteur deux millions supplémentaires pour la construction d’un chemin de fer qui relierait ces mines à Alais. M. Merlin estimait que ce chemin de fer, d’intérêt général, ne devait pas être payé de la poche d’un particulier. Et il était tout disposé à montrer quelque reconnaissance aux personnages assez intelligents pour faire triompher une aussi juste cause auprès du gouvernement…
» Tout ceci n’est-il pas exact, Mme Demouzin ? demanda Dixmer.
Mme Demouzin regarda, elle aussi, du côté du vestibule et répondit :
– Allez, monsieur, j’ignore où vous voulez en venir…
– Je veux en venir à ceci, répliqua Dixmer, de plus en plus calme, cependant que les autres commençaient à montrer quelque trouble, je veux en venir à ceci, que M. Merlin vous a offert un premier versement de cinquante mille francs.
– C’est faux ! s’écria Mme Demouzin.
– Il est faux que vous l’ayez accepté, répondit Dixmer, mais il est exact que cet homme vous l’a offert. Vous avez repoussé ses offres, d’abord parce que vous êtes une honnête femme, ensuite parce qu’il exigeait, après avoir promis trois cent mille francs en tout, une lettre dans laquelle M. Sinnamari s’engageait à parler en ami de cette honnête affaire à M. Philibert Wat. Cette lettre devait vous être adressée, madame. Moyennant cette lettre, il versait tout de suite les cinquante mille francs… Vous attendez toujours les cinquante mille francs, madame, parce que lui, il attend toujours la lettre. Est-ce exact ?
Dixmer se tut. Personne ne lui répondit. Alors, il reprit :
– M. le procureur impérial ici présent, à qui, madame, vous avez communiqué les desiderata excessifs de M. Merlin, vous a répondu comme il devait. Il refusait tout engagement, toute promesse, toute signature… M. Sinnamari est un honnête homme. Et cependant, je viens de dire à cet honnête homme : il faut écrire !… Écrire une lettre qui atteste, clair comme le jour, que si Mme Demouzin a pu parfois s’autoriser de ses relations avec M. Sinnamari pour aider des amis dans la peine, M. le procureur impérial, lui, est resté toujours en dehors de ces sortes de… spéculations dangereuses… Voilà ce que j’avais à dire pour que l’un des premiers magistrats de ce pays n’ait point à souffrir des imprudences de madame…
Sinnamari n’avait pas cessé de contempler Dixmer avec une curiosité évidente, mais ironique.
– Qui est ce Merlin ? demanda-t-il. C’est la première fois que j’en entends parler…
– Ce Merlin, monsieur le procureur impérial, répliqua immédiatement Dixmer, n’est point du Gard, comme il le prétend, et il n’est pas industriel… C’est tout simplement un agent qui s’est présenté chez Mme Demouzin avec l’intention d’obtenir la preuve de trafics criminels qui, j’en suis sûr, n’ont jamais existé !
Mme Demouzin s’affaissa légèrement sur sa chaise. Régine gémit. Quant à Sinnamari, le danger évident semblait avoir décuplé tous « ses moyens ».
– Un agent de qui ? demanda-t-il sourdement.
– M. Merlin est tout simplement un agent de R. C., le roi Mystère, le roi des Catacombes !
– Pas possible ! fit négligemment le magistrat. M’en voudrait-il donc personnellement ?
Dixmer fut seul à l’entendre, à le comprendre.
– Oui… dit-il en regardant le procureur jusqu’au fond des yeux.
Alors, il se leva et dit :
– Monsieur le procureur impérial, je désirerais avoir un entretien particulier avec vous.
Sinnamari tendit sa main à Régine et à Mme Demouzin. Tous deux s’en allèrent, parvenant difficilement à calmer leur agitation.
On entendit Cyprien qui leur ouvrait la porte du vestibule et qui la refermait. Puis on n’entendit plus rien.
Le procureur s’avança vers Dixmer :
– Vous jouez gros jeu, dit-il.
– Je le sais, répondit Dixmer sans broncher.
– J’ai peur, continua Sinnamari, peur pour vous !
– Je suis plus fort que vous, monsieur le procureur impérial, moi je n’ai peur pour personne… Ni pour vous, ni pour moi !…
Sinnamari regarda cette figure de fouine, qui avait dû tromper tout le monde… pour de l’argent, pour rien, pour le plaisir…
– Vous êtes un artiste, monsieur Dixmer, prenez garde… les artistes finissent toujours mal…
– Non ! je ne suis pas un artiste. Je ne suis qu’un pauvre fonctionnaire dévoré d’ambition, qui voudrait être quelque chose…
– Quoi donc ?
– Je vous le dirai tout à l’heure…
Sinnamari désigna en face de lui une chaise à Dixmer :
– Asseyez-vous, mon cher Dixmer !… Qu’est-ce que vous avez à me dire ?
Dixmer s’assit, et, sans émotion apparente, répondit :
– Une chose que vous savez déjà !
– Laquelle ?
– Que Desjardies est innocent.
– C’est l’opinion de sa fille ! répliqua le procureur.
– C’est aussi la mienne, répliqua l’agent de police.
Où Dixmer voulait-il donc en venir ?
Malgré sa grande force d’âme, le procureur fut un instant ébranlé, mais il se reprit vite, et, d’une voix nonchalante :
– Serait-il possible, mon cher monsieur Dixmer, que nous ayons commis une erreur judiciaire ?… Vous m’en verriez désolé.
– Oui, fit Dixmer, l’erreur judiciaire a été commise…
– En vérité !… Et qui donc serait le coupable, mon cher monsieur Dixmer ?
– Vous, monsieur le procureur impérial !…
III – DIXMER ABAT SES CARTES
L’officier de police s’était préparé à tout, connaissant la violence et l’impulsivité de Sinnamari. Mais sa stupéfaction fut énorme de voir que celui-ci n’avait jamais été aussi calme.
– Vous avez des preuves ? fit-il simplement, les yeux sur Dixmer.
Dixmer, qui se croyait très fort, assez fort pour oser demander à entrer dans le jeu de Sinnamari en lui faisant peur, commença à sentir son courage l’abandonner.
– Oui, répondit-il, j’ai des preuves, et les voilà…
Il ajouta :
– Je vous le donne…
Il tendait un paquet, un petit paquet de papiers ficelés. Sinnamari déficela l’objet, jeta un coup d’œil sur les lettres, les billets, quelques cartes de visite recouvertes d’une écriture minuscule, presque illisible, son écriture, puis rejeta le tout d’un revers de main du côté de l’officier de police et lui dit :
– Vous êtes un imbécile !
Dixmer regarda le procureur et ne comprit pas que dans une circonstance où il aurait dû, lui, Dixmer, apparaître plutôt redoutable, Sinnamari le traitât avec un pareil mépris.
Sinnamari se chargea de le lui expliquer.
– Ce sont là, dit-il, tous les pauvres papiers avec lesquels Lamblin, qui était encore plus stupide que vous, a essayé de me faire chanter. Voudriez-vous me faire chanter à votre tour ?
– Ça a trop mal réussi à Lamblin, répliqua Dixmer, très décontenancé. Vous savez bien que je viens vous trouver en ami, monsieur le procureur, et je vous en donne la preuve en vous abandonnant tout de suite ce paquet plutôt compromettant.
– Vous pouvez le garder, dit Sinnamari. Ce sont là des autographes qui prouvent que je suis un brave homme, un excellent ami pour mes amis, que je sais les soutenir à l’occasion, comme c’est mon intérêt politique et mon devoir moral !…
– Et votre intérêt pécuniaire, monsieur ! interrompit Dixmer.
– Il me semble que j’entends parler ce pauvre Lamblin… dit le procureur avec un sinistre sourire…
– Voilà encore des papiers qui vous intéressent, répliqua Dixmer en sortant un autre paquet de la poche de sa redingote.
– Ces lettres, dit Sinnamari, en montrant le nouveau paquet qu’il négligea de prendre, doivent être celles avec lesquelles cet autre imbécile de Didier essaya de faire chanter mon ami Eustache Grimm, toujours pour la même raison, parce que celui-ci avait recommandé quelques amis à la bienveillance ministérielle pour des affaires fort honorables. Encore un – je parle de ce pauvre Didier – qui a mal fini…
– Oui, déclara Dixmer, prenant son air le plus sombre, comme Lamblin, il a été assassiné…
– Il s’est suicidé !… sourit le procureur. Vous confondez, monsieur Dixmer.
– Il s’est suicidé comme tant d’intermédiaires dans quelques affaires politiques que je ne vous nommerai pas, d’abord parce que vous les connaissez aussi bien que moi, ensuite parce que j’ai, autant que quiconque, le souci de la tranquillité de l’État.
– Vous vous abusez étrangement sur l’importance de vos petits secrets. Vous allez me permettre de déposer ces deux paquets sur le bureau de mon substitut, avec cette note : « Prière de remettre ces deux paquets à M. Jonard, juge d’instruction dans l’affaire Desjardies, et prière à ce juge d’instruction de demander à M. Dixmer, officier divisionnaire de la préfecture de police, comment il les a eus en sa possession. »
Et Sinnamari écrivit tranquillement cette petite note-là. Dixmer n’en pouvait croire ses yeux. Il se demandait si le procureur n’était pas devenu fou.
– Si M. Jonard me pose une pareille question, fit-il en se levant, je lui dirai la vérité !… Lamblin était mon ami…
– Mes compliments… C’est dangereux, ce que vous dites là, Dixmer… Si vous étiez l’ami de Lamblin, songez donc que vous n’étiez pas loin d’être son complice. Je ne peux plus faire arrêter Lamblin, qui est mort trop vite, mais qui m’empêche de vous faire arrêter, vous ?
– Si on m’arrêtait, monsieur le procureur, je crois qu’on le regretterait… Il me reste encore bien des choses à vous dire…
– Oh ! je suis patient !… constata Sinnamari… je suis très patient !… Asseyez-vous donc, mon cher monsieur Dixmer, et dites-moi ce que vous diriez à M. Jonard, s’il prenait fantaisie à cet excellent M. Jonard de vous interroger…
– Je lui dirais que je voyais Lamblin presque tous les jours… Or, l’avant-veille de sa mort, Lamblin me dit, en me remettant les deux paquets que voici sous enveloppes scellées, qu’il courait les plus grands dangers… qu’un haut personnage lui en voulait à mort… et qu’il craignait qu’il lui arrivât malheur à lui, ainsi qu’à un ami qu’il avait à l’Assistance publique. Si un tel événement survenait, il me laissait entre les mains de quoi le venger, lui, et du même coup, son ami, que je ne connaissais pas… J’ai cru qu’il avait la cervelle un peu détraquée, et il vit bien que je ne le prenais pas au sérieux ; alors il voulut bien me répéter, par écrit, ce qu’il venait de me dire…
– Par écrit ! fit Sinnamari. Voyez-vous cela !… De telle sorte, monsieur Dixmer, que vous avez cet écrit-là… et que, par ma foi, vous en voilà tout fier. Y est-il dit expressément que j’ai promis à Lamblin de l’assassiner ?…
– Plus bas, monsieur le procureur… on pourrait nous entendre… fit Dixmer en jetant un regard du côté des portes…
– Et vous tenez à ce qu’on ne vous entende point, monsieur Dixmer ? Ce sont là des habitudes de basse police… Que me fait, à moi, votre papier ? Il est tel qu’eût pu l’écrire un homme qui se prépare à jouer une partie de chantage qu’il croit redoutable…
– Le surlendemain, Lamblin était mort. En arrivant à la Préfecture, j’appris qu’on venait de le trouver assassiné dans votre cabinet. En même temps, j’apprenais qu’un homme nommé Didier, secrétaire de M. Eustache Grimm, de l’Assistance publique, venait d’être trouvé, chez lui, suicidé. J’avais les deux paquets… et je compris…
– Vous avez compris que votre ami Lamblin était une crapule, qu’il avait voulu me faire chanter comme il a voulu faire chanter Desjardies ! Mais, pauvre cher monsieur Dixmer, sachez donc que le juge d’instruction les attend, ces lettres, que je les lui ai annoncées, que je me suis empressé, dès le début de l’affaire Desjardies, de lui dire ce que je pensais de Lamblin, et comment il avait voulu me faire chanter, moi ! Oui, moi ! Le procureur impérial ! Et pourquoi, mon Dieu ? Pour les démarches et recommandations les plus innocentes du monde ! Et ainsi s’éclairait le drame Desjardies… Lamblin avait l’habitude du chantage, il avait le chantage dans le sang !… Il a voulu tenter avec Desjardies le coup qu’il n’avait pas réussi avec moi… Seulement, si moi, je me moquais des papiers dont me menaçait Lamblin, malheureuses lettres que je lui avais remises pour qu’il les portât à leur adresse et que, commissionnaire infidèle, il avait détournées, Desjardies, lui, ne se moquait nullement de ce que l’on pût découvrir ces papiers prouvant ses tripotages dans les Chemins de fer ottomans… Lamblin en avait la garde… Il a dû demander une somme énorme… Je connais ses prix : cent mille francs au minimum… Desjardies n’avait pas le sou… il a assassiné Lamblin !…
» Comprenez-vous que vous n’avez rien à apprendre à personne ?… Apprenez que le juge d’instruction, dans ses perquisitions chez Lamblin, a cherché tous les papiers que vous m’apportez là et dont je lui avais fait à l’avance la plus complète description… Je lui avais même montré la liste, que Lamblin avait eu la bonté de me faire passer…
Dixmer ne pouvait plus parler… C’était fort ! C’était vraiment très fort !… C’était trop fort !…
– Qu’avez-vous, mon cher Dixmer ?…
Celui-ci passa la main sur le front comme pour s’éclaircir les idées, et puis il dit :
– Seulement, il y a aussi les papiers Didier… et si l’on rapproche les deux paquets de lettres et les deux morts, cela peut faire naître de bien dangereux soupçons…
– M. le juge d’instruction, répondit Sinnamari sans montrer le moindre émoi, recevra les deux paquets avec le même plaisir… car, sur les indications de M. Eustache Grimm, et sur les miennes… il a cherché les papiers Didier comme les papiers Lamblin… sans les trouver, puisqu’ils étaient tous deux dans votre poche…
– Le juge d’instruction savait donc ?…
– Que Lamblin et Didier formaient à eux deux une association de malfaiteurs ? Parfaitement… Dès que M. Grimm m’eut confié à quel genre d’exercice son employé avait la prétention de le soumettre, il reçut de moi l’ordre d’aller se plaindre au commissaire de police… Didier, sans doute très ému de ce que lui avait dit le commissaire de police, et bourrelé de remords, s’est pendu lui-même !… Ne trouvez-vous point, Dixmer, que voilà une mort bien naturelle ! Qu’en dites-vous, mon cher Dixmer ?…
– J’en dis, murmura Dixmer affolé, et risquant un dernier coup, j’en dis que Didier a été étranglé par un nommé Costa-Rica, à qui une lettre anonyme envoyée par vos soins et ceux de M. Eustache Grimm avait fait croire que sa maîtresse…
– Que sa maîtresse le trompait avec Didier… Une lettre anonyme est venue aussi me dénoncer ce Costa-Rica. On l’a fait venir au Palais. Il a apporté un alibi irréfutable en réponse à l’accusation de la lettre, et quant à sa maîtresse, une fille qui se fait appeler La Mouna, je crois, il a été prouvé qu’elle n’a jamais connu Didier…
Dixmer se taisait. Le procureur lui frappa sur l’épaule.
– Ah ! lui dit-il. Où allez-vous donc chercher vos amis et les amis de vos amis, mon cher monsieur Dixmer ?
Dixmer était écrasé. Pourquoi avait-il voulu faire le malin avec Sinnamari ? Maintenant, il comprenait toute l’affaire : Lamblin, se rendant, le matin, au Palais où l’attendaient, pour la négociation définitive du chantage, le procureur et Régine, avait dû nécessairement garder sur lui les papiers les plus importants, les seuls qui comptaient aux yeux de Sinnamari, et dont l’employé du parquet pouvait espérer un bon prix.
Quels pouvaient être ces papiers-là ?… Des papiers qui parlaient d’argent ?… Oui… Ceux-là seuls valaient un crime… Qui demandaient de l’argent ? Non… Jamais Sinnamari n’eût été assez stupide pour écrire ou faire écrire ce genre de papiers-là… Qui en offraient, ou qui rappelaient des offres déjà à demi acceptées ?… Oui… évidemment… c’étaient les seuls que le procureur avait intérêt à conserver pour rester armé en face de certains gros personnages qui oublient facilement les services rendus…
Comment Lamblin s’était-il emparé de ces papiers ?… Le fait est qu’il les avait eus, puisqu’il avait voulu les vendre… et qu’il en était mort !…
Tout cela était clair, maintenant, dans l’esprit de Dixmer, mais ce qui l’était davantage encore, c’était l’inutilité des paperasses qu’il avait apportées.
Sinnamari regardait en silence Dixmer, qui s’était levé et se promenait, les mains derrière le dos, les épaules voûtées, le front soucieux, Dixmer vaincu, stupéfait, anéanti.
– De tout notre entretien, je ne veux retenir que ceci, fit bonassement Sinnamari, c’est que vous êtes venu pour me rendre service…
– C’est vrai, répondit Dixmer, un peu effrayé…
– Vous aviez des papiers que vous croyiez compromettants pour moi, vous me les avez apportés ; en somme, c’est très bien cela !…
– Je suis votre ami, monsieur le procureur, soupira Dixmer.
– Vous aviez appris, je ne sais comment, que M. Merlin était un agent de je ne sais quel escarpe qui se fait appeler le roi Mystère, et aussitôt vous avez pris la peine de venir m’avertir… Voilà qui est assez louable, mon cher monsieur Dixmer…
– Oh ! monsieur le procureur ! Je ne demande qu’à vous rendre service !
– J’en suis sûr… Le malheur pour vous est que le service est mince, attendu que les papiers ne sont pas compromettants du tout. Mais enfin, j’avoue que je serais un ingrat si je ne tenais pas compte de vos bonnes intentions à mon égard, mon cher monsieur Dixmer !
– Ne vous moquez pas de moi, monsieur le procureur, je suis assez malheureux !…
– On le serait à moins ! ricana Sinnamari… Et qu’est-ce que vous espériez, en venant me trouver, poussé par une amitié aussi profonde, monsieur l’agent de police ?
» Vous ne me répondez pas ? continua Sinnamari… Je vais répondre pour vous !… Je connais votre ambition, monsieur Dixmer !… Vous veniez me demander la place de M. Dax ! La place de chef de la Sûreté ! Est-ce vrai ?
– Je la mérite ! fit Dixmer modestement, mais je n’ose plus l’espérer…
– Et en quoi la méritez-vous, monsieur ? Est-ce parce que vous avez laissé échapper Desjardies, cette nuit ?…
– Non ! répliqua l’officier, mais parce que je vous avais averti qu’il s’échapperait !…
– C’est peu !
– C’est beaucoup ! C’est beaucoup que de connaître un des secrets du roi des Catacombes !…
– Si vous connaissez ses secrets, moi je suis plus avancé que vous, depuis cette nuit, car je le connais lui-même !…
– Monsieur le procureur, fit Dixmer d’une voix sourde, je l’ai connu avant vous !…
Sinnamari lui planta son regard dans les yeux et, sans hésitation, lui dit :
– Allons ! Dixmer ! Le moment est bon ! Trahissez !…
Dixmer, en entendant cette parole qui répondait si bien à sa pensée, en resta étourdi… C’est vrai qu’il avait envie de cela et que, depuis un instant, il ne songeait qu’à cela : trahir !… Trahir l’autre tout de suite, malgré les dangers à courir… et peut-être à cause des dangers qu’il courait ! Car, maintenant, après le terrible pas de clerc qu’il venait de commettre, il n’avait plus de salut à espérer du côté de Sinnamari qu’en lui livrant le roi des Catacombes…
À choisir entre les deux, ne valait-il pas mieux prendre parti pour celui qui possédait tout au soleil et qui pouvait tout donner, que pour celui qui promettait tout dans l’ombre et qu’il était si dangereux de servir ?…
Il s’était cru assez fort pour user de tous les deux à son bénéfice, mais il voyait bien que le moment était venu où il lui fallait choisir un maître.
Il s’avança vers Sinnamari.
– Vous êtes mon maître, dit-il. Promettez-moi que je serai chef de la Sûreté, et je vous livrerai la plus effroyable association occulte qui ait jamais commandé à la société et menacé l’État.
– Vous voulez parler du R. C. et de sa bande ?
Dixmer regarda une fois de plus du côté des vastes salles désertes, à sa droite et à sa gauche, et, tout à fait rassuré sur leur isolement à tous deux, il dit, plus bas encore qu’il n’avait parlé durant tout cet entretien :
– Oui, de l’Association du roi des Catacombes, de l’A. C. S. comme ils disent, de l’Assurance contre la société.
– Vous la connaissez bien ? demanda Sinnamari.
– J’en suis ! fit Dixmer, dans un souffle.
– Je m’en doutais, répliqua le procureur, nullement étonné.
– Promettez-vous ?… Songez que je serai votre homme… à vous !… Un homme qui vous admire !… qui vous aime !… qui a appris aujourd’hui à vous connaître et à vous craindre !… On a besoin d’un homme comme moi quand on est un homme comme vous ! Promettez-vous ?…
Dixmer semblait supplier et menacer à la fois… Il jouait sa dernière cartouche… son visage était ruisselant de sueur…
À ce moment, on entendit du bruit dans le vestibule. M. Cyprien se montra.
– C’est M. le préfet de police qui demande à parler à monsieur le procureur impérial, dit l’huissier.
– Faites entrer ! ordonna Sinnamari.
Et, se tournant vers Dixmer qui attendait :
– Monsieur Dixmer, il faut que vous sachiez que le procureur impérial n’a besoin de personne… Voici M. le préfet de police qui vient à nous. Vous allez nous dire ce que vous savez de votre roi Mystère et comment nous pourrons mettre la main dessus, ce qui importe en ce moment par-dessus tout… À la suite de cet entretien, M. le préfet de police et moi, nous déciderons de votre sort !… Ou vous serez le chef de la Sûreté, et vous savez que quand je promets, je tiens !… Ou vous serez déféré à la justice pour avoir voulu faire chanter un magistrat de l’empire !… Ou encore… ou encore je ne donnerais pas deux sous de votre peau !… Bonjour, mon cher préfet !…
Et Sinnamari serra la main du préfet, qui venait de pénétrer dans son cabinet, et qui, pour la raison sans doute qu’il venait d’en laisser échapper un, avait la figure défaite d’un condamné à mort.
IV – L’AMATEUR DE PERROQUETS
Le matin même de ce jour qui vit se dérouler des événements si importants pour notre récit, vers dix heures et demie, un homme qu’à sa belle barbe blonde taillée en éventail, on reconnaissait pour ne pouvoir être autre que Philibert Wat lui-même, remontait l’avenue des Champs-Élysées.
Ceux qui le connaissaient – et qui ne connaissait, à Paris, l’homme d’affaires tout-puissant, le plus élégant des financiers, le gendre du président du conseil ? – pouvaient s’étonner de le voir de si bon matin, par un froid solide, à pied, dans une avenue qu’il ne fréquentait ordinairement qu’à l’heure du Bois, en fringant équipage, car Philibert aimait le luxe, les beaux chevaux, les belles maîtresses, et tout ce qui, d’après lui, rendait la vie supportable dans une ville comme Paris.
Ce matin-là, Philibert paraissait fort soucieux. Les événements de la dernière nuit l’avaient étrangement troublé. Bien qu’il n’eût été mêlé en rien à l’assassinat de Didier non plus qu’à celui de Lamblin, il avait été mis cependant au courant de leur tentative de chantage et il avait partie assez étroitement liée avec Sinnamari et Eustache Grimm pour s’émouvoir de ce qui pouvait leur survenir de désagréable. Or, il ne pouvait rien leur arriver de plus déplaisant que l’évasion de ce Desjardies, dont l’exécution eût si merveilleusement conclu les deux affaires Lamblin et Didier.
Et, à ce propos, Philibert se demandait pour la centième fois qui était ce fantastique roi Mystère qui se mêlait si audacieusement de choses qui ne le regardaient pas ? Qui était cet être extraordinaire dont il venait de mesurer la toute-puissance ? Ce R. C., avec lequel il avait soupé dans des conditions si bizarres et si tragiques ? Le comte de Teramo-Girgenti lui avait dit que c’était un de ses amis. Le comte ne s’était pas moqué de lui ? Il eût été tenté de le croire s’il n’eût senti contre sa poitrine les 25 000 francs perdus par le comte, et qu’il venait de toucher chez le banquier de R. C. ! Tout de même, il allait interroger sérieusement Teramo-Girgenti ! Et Philibert pressa le pas vers l’hôtel que venait d’acheter le comte, au coin de l’avenue des Champs-Élysées et de la rue du Colisée.
Philibert avait déjà dépassé le rond-point et il se préparait à sonner à la grille de l’hôtel quand il vit descendre vers lui, sur le trottoir, un noble vieillard qu’il reconnut immédiatement. Le noble vieillard avait sur son poing un perroquet.
– M. de Teramo-Girgenti ! fit Wat, et il s’avança vivement vers le comte ; mais celui-ci lui montrait déjà l’oiseau.
– Comment le trouvez-vous ? demanda-t-il. Il est superbe ! Vous savez, c’est moi qui l’ai déniché ! C’était un voisin. Je l’entendais, tous les matins, en sortant de chez moi, annoncer aux passants qu’il « avait bien déjeuné ». C’est par le plus grand des hasards qu’en rentrant de ma promenade, je l’ai découvert chez un savetier qui a établi son échoppe dans un sous-sol de la rue du Colisée… Je suis bien content… Le bonhomme me l’a laissé pour quinze louis !… C’est pour rien ! Il y tenait tant ! Comment le trouvez-vous ?
Philibert Wat trouvait que ce perroquet ressemblait à tous les perroquets, et ne parvenait point à comprendre comment un homme qui paraissait aussi sain d’esprit que le comte, avait payé trois cents francs un oiseau aussi vulgaire.
– Rentrons vite, fit Teramo-Girgenti, ou il va attraper froid…
La grille qui donnait accès dans les jardins de l’hôtel du comte s’ouvrit sans que celui-ci eût même touché le bouton de la sonnette.
Wat ne s’étonna pas. Il avait déjà pu constater, depuis le peu de temps qu’il connaissait ce singulier personnage, que le comte de Teramo-Girgenti était servi comme nul prince au monde ne pouvait se vanter de l’être.
Qu’était donc exactement ce comte de Teramo-Girgenti, que le président des Cortès avait recommandé à la bienveillante attention de Sinnamari… ? À l’entendre, il connaissait personnellement la plupart des princes régnants, et se prétendait apparenté avec les plus nobles familles d’Espagne et d’Italie.
À Paris, on ne connaissait pas ce grand seigneur ; le comte prétendait n’y être point venu depuis des siècles, et ce détail avait évidemment suffi pour classer le personnage dans l’esprit de Philibert Wat parmi les fantaisistes. Mais ce fantaisiste avait, depuis les quelques jours qu’il se trouvait à Paris, jeté une fortune par les glaces de son coupé, un coupé traîné par une paire de bais qui valaient bien deux mille louis.
En quarante-huit heures son intendant lui avait acheté cet hôtel et l’avait royalement meublé… Une armée d’ouvriers avaient fait de cet immeuble, bourgeoisement banal, un véritable palais que le comte s’était plu à remplir des bibelots les plus rares.
Plus encore que sa passion pour les bibelots, l’ineffable amour de Teramo pour les perroquets avait stupéfait le banquier. Au moins, en ce qui concernait les bibelots, le comte choisissait, et si bien que n’eût pas mieux fait le plus habile des experts, mais jamais il ne choisissait parmi les perroquets qu’il rencontrait sur son chemin ; il les achetait tous ! Et il ordonnait qu’on les portât immédiatement chez lui quand il ne les rapportait lui-même, comme il venait encore de le faire.
Le gendre du président du conseil avait envoyé des télégrammes à Rome, à Madrid, à Vienne, à Berlin, chez les princes et chez les ministres qui s’étaient portés garants du comte auprès de lui, et de partout il n’avait obtenu que cette explication brève, mais décisive, et conçue presque toujours en ces termes : « Faites ce que vous dira le comte. C’est un gentilhomme, et je m’honore d’être son ami. » Et Philibert Wat avait fini par penser qu’il se trouvait en face de quelque prince du sang qui avait ses raisons pour déguiser sa véritable personnalité.
… Quand ils eurent passé la grille et que celle-ci se fut refermée derrière eux, le concierge, sans mot dire, vint prendre le perroquet sur le poing du comte.
– Et qu’est-ce que vous allez faire de cette bête ? demanda Wat au comte.
– Elle va aller rejoindre les autres dans la cage de la rue de Ponthieu !…
– Et vous tenez réellement à ce perroquet ?
– Beaucoup !
– Vous irez le voir dans sa cage ?
– Jamais !
– Comment ! Jamais !… Et tous les perroquets que vous achetez, alors, mon cher comte ?
– Je ne les revois jamais.
– C’est tout à fait inexplicable.
– Si… je vous expliquerai cela… un autre jour… le jour où nous pendrons la crémaillère, mon cher monsieur Wat !
– Et ce sera bientôt ?
– Je l’espère… dans une quinzaine de jours, peut-être… Cela dépend de mon intendant, qui est le plus méchant intendant que je connaisse… Il est lent ! Il est lent !… Nous devrions être complètement installés depuis longtemps !
Le comte et Wat étaient arrivés au bas du perron de l’hôtel.
– Allons, mon cher Wat, rentrons… J’ai hâte de me reposer, fit Teramo-Girgenti. Voilà trois heures que je marche !…
– Trois heures ! répliqua Philibert… C’est donc un régime ?
– Oui, c’est un régime… À mon âge, il le faut, hélas !
– Oh ! À votre âge…
– Quel âge me donnez-vous ?
– Eh bien ! je vous donne entre soixante et soixante-cinq ans, bien que vous ne les paraissiez pas, mon cher comte…
– J’ai vingt ans ! interrompit Teramo… Vingt ans et trois mois… Pas un jour de plus !…
Et il poussa Philibert Wat dans le vestibule de l’hôtel.
Philibert riait. Quant à Teramo, il ne riait pas ; jamais Philibert ne l’avait vu rire.
Teramo-Girgenti paraissait, en effet, une soixantaine d’années, plutôt un peu plus qu’un peu moins. Les sourcils blancs touffus, la moustache épaisse et toute blanche retombant de chaque côté d’une bouche bien dessinée, mais aux commissures dures, amères, le collier de barbe blanche et toute la chevelure chenue tombant en boucles d’argent sur les oreilles qu’elles cachaient, devaient contribuer beaucoup à vieillir un visage qui, par certains côtés, pouvait paraître jeune encore ; les joues n’étaient point creusées ; un sang généreux devait courir encore sous cet épiderme si pâle. Les traits étaient réguliers.
Teramo-Girgenti ressemblait beaucoup à cette tête de l’apothéose d’Homère, dessinée par Ingres. Seulement, il portait des lunettes d’or, et c’est un ornement qui manquait à Homère. Il était d’une belle taille, les épaules très légèrement voûtées ; tous ses gestes étaient calmes et harmonieux. Sa voix était douce, et il parlait le français avec un léger accent italien qui ne manquait point de saveur.
Wat s’était arrêté soudain au milieu de son rire en percevant une voix, une voix aiguë et désagréable, qu’il avait déjà entendue quelque part, sans qu’il put préciser où…
La voix criait derrière la porte : « Master Bob ! Master Bob ! Je vais vous raconter l’histoire de Mlle Belladone et l’assassinat du Ponte-Rouge ! »
Le comte, dans le moment que Philibert écoutait cette voix, s’était vivement retourné vers lui. Il le fit entrer, ou plutôt il le poussa dans une pièce assez sombre, meublée à la turque. Là, ne lui laissant pas le temps d’admirer les panoplies, les armes rares, les spécimens uniques de yatagans, de fusils aux crosses incrustées d’argent, de cuivre et d’ivoire qui ornaient les murs, il s’excusa de le recevoir dans ce « cabinet de débarras », mais il tenait à ne lui montrer son hôtel que lorsque son intendant aurait rendu celui-ci digne d’un Parisien aussi averti que l’était Philibert Wat !
Sur quoi, il le pria de s’asseoir, insista pour qu’il prît quelques cuillerées de ses confitures parfumées qu’un domestique nègre, qu’il appelait Ali, avait apportées.
Ces confitures de toutes couleurs brillaient comme une fusion de joyaux dans les cases de cristal d’une immense coupe de ce verre que l’on appelle aventurine, et que seuls obtiennent les ouvriers de Venise par des procédés secrets, verre si remarquable par le semis de ses petits cristaux prismatiques, à quatre faces, très brillants et sans nombre ayant l’apparence du cuivre.
Mais Philibert Wat, qui était une bien petite bouche, ne voulut rien prendre et remercia. Le comte s’étendit sur un divan, et, pendant qu’il prenait des mains d’Ali une sorte d’étui de cristal, au fond duquel on apercevait quelques gouttes d’une liqueur opaline :
– Vous avez tort, mon cher ami, dit-il, de ne point goûter à ces confitures qui me viennent de Fez et qui sont un cadeau annuel de mon ami le seigneur Sidi ben Kadour, ministre de la guerre de Sid’na Mohamet-Ali.
– On raconte, interrompit Wat sans s’émouvoir, que ce Sidi ben Kadour est le plus vieil homme de la terre. Aurait-il vraiment cent trente ans ?
– Mon Dieu ! répliqua le comte, la chose est exacte, je crois bien, et ses cent trente ans ne l’empêchent pas d’être plus jeune que moi, qui n’en ai que vingt ! Vingt ans !… C’est incroyable… comme le temps passe… Je suis né, cette fois, en Syrie, mon cher monsieur Wat, le jour même où l’amiral Napier se mit à bombarder Saint-Jean-d’Acre. Je me rappelle très bien ! J’ai dû attendre, dans mon cercueil, pendant douze heures, que toute cette méchante canonnade ait pris fin…
– Comment vous trouviez-vous là le jour de votre naissance ? demanda, sans sourciller, Philibert Wat.
– Mon Dieu, c’est bien simple !… Je m’y étais fait enterrer soixante-quinze ans auparavant ! Vous savez bien, mon cher monsieur Wat, que je me fais enterrer tous les cent ans pour soixante-quinze ans, ce qui me laisse vingt-cinq ans à vivre tous les siècles. J’ai donc encore cinq bonnes années devant moi… Seulement, cette fois, je sens qu’il faut que je me surveille, et surtout que je n’engraisse pas !… Que voulez-vous ? Je ne suis pas un homme éternel !… Aussi, pour atteindre mes vingt-cinq ans, me faut-il souvent prendre des précautions… Dans la saison, mon cher monsieur Wat, je vais aux eaux. Mais, au fond, il n’y a encore que la marche… La marche est souveraine… et aussi cette mixture de perles de Ceylan écrasées dans du baume de Fingal !… Si vous en voulez un peu, permettez-moi de vous en faire servir.
– À combien vous revient la goutte de cette mixture ? interrogea curieusement Wat.
– Oh ! vous attachez quelque importance à ce détail !… Moi, je ne pourrais vous dire… Attendez ! Je vais interroger Ali.
Le domestique nègre s’avança, dit :
– Cinq mille francs la goutte, monseigneur. Puis il salua et sortit.
Philibert sursauta. Le comte le calma.
– Vous savez, mon cher, que vous auriez tort de vous gêner, fit-il… J’ai, aux Indes, trois pêcheries de perles inépuisables et je n’ai pas envie de m’établir bijoutier… Voyons, mon cher Wat, me voyez-vous en bijoutier ?… Une vitrine rue de la Paix… « Maison Teramo-Girgenti… Perles de Ceylan »… Je serais à jamais déshonoré dans ce monde et… je n’oserais plus me représenter dans l’autre !… Sérieusement, que voulez-vous que je fasse de mes perles, si je ne les mange pas ?
Philibert, qui était galant, répondit au comte :
– Si vous ne mangiez pas vos perles, vous pourriez les donner aux dames.
– Oh ! mon cher monsieur ! Les femmes sont si ingrates !… J’en suis bien revenu, allez ! depuis deux mille ans…
– Depuis deux mille ans ! En vérité, vous avez commencé votre régime il y a deux mille ans ?
– À peu près… Mais je dois à la vérité de dire que la mémoire me fait un peu défaut quand je me reporte à cette époque lointaine où je suis né pour la première fois. Et puis, la première fois ne compte pas ! C’était là un accident, un simple accident… Tandis que les autres fois, c’est moi qui ai voulu ma naissance !… Après avoir préparé ma mort !… Les autres fois, j’étais, si j’ose dire, mon propre père… Puisque ma volonté seule me faisait renaître à la lumière du jour, après soixante-quinze années de repos chez les morts !…
Wat considérait avec étonnement Teramo-Girgenti. Ce n’étaient point ses propos bizarres qui l’intriguaient, car il en avait déjà entendu quelques-uns depuis qu’il le fréquentait, mais la précipitation avec laquelle il parlait, le ton dont il disait ces choses, sa voix qui s’élevait à un diapason inaccoutumé… Enfin, le comte s’était levé et marchait bruyamment dans la chambre, lui qui ne faisait jamais de bruit…
À ce moment, la porte s’ouvrit, livrant passage à Ali, et Wat entendit encore cette voix bizarre, ces exclamations tantôt rauques et tantôt aiguës qui le troublaient sans raison… peut-être tout simplement parce qu’il ne se rappelait plus où il avait bien pu entendre ce singulier glapissement.
La voix criait : « By Jove ! Master Bob ! What a fearful sight ! Quel affligeant spectacle ! »
Et Wat surprit un coup d’œil terrible lancé par Teramo-Girgenti à Ali, coupable évidemment d’avoir ouvert la porte au moment où le comte faisait tout son possible pour que son visiteur n’entendît point les extraordinaires clameurs qui retentissaient dans le vestibule.
Après avoir quitté Ali, le regard du comte s’était reporté sur Philibert. Ce coup d’œil avait suffi pour le renseigner : Philibert avait entendu.
Alors, Teramo-Girgenti sembla prendre son parti et, s’adressant à Ali :
– Tu vas dire à M. Macallan que je ne veux pas le recevoir… que je n’ai rien à lui dire… et que je ne veux plus le revoir avant le 15 janvier…
– Et s’il refuse de partir ?
– Tu le mettras à la porte !
Ali sortit.
– Qu’est-ce que je vous disais donc ? reprit aussitôt le comte, pendant que Wat se souvenait soudain du curieux gnome qui avait partagé leur souper, place de la Roquette… Qu’est-ce que je vous disais ?…
… Une tempête de jurons franco-anglais éclatait alors derrière la porte, mais le comte ne semblait point les entendre et reprenait, marchant à grands pas dans cette pièce obscure, apparaissant et disparaissant tour à tour dans la pénombre et dans l’ombre, comme un fantôme tapageur qui bouleverse les meubles :
– Ah, oui ! Je vous disais qu’avec trois heures de marche quotidienne, j’espère atteindre le terme de ma vie, ce siècle-ci !…
Et, là-dessus, le comte jeta par terre le tabouret arabe et tout le magnifique service de Venise, qui se brisa en mille éclats, laissant couler sur le tapis la pâte languissante des confitures de Fez. Philibert ne s’y trompa point. Une attitude aussi inusitée était destinée à couvrir le bruit que faisait derrière la porte cet énigmatique avorton, que le comte avait appelé Macallan.
Le comte se taisait maintenant et le tumulte avait cessé dans le vestibule. Évidemment, Ali avait exécuté la consigne.
Philibert Wat ne voulut point paraître le moins du monde intrigué par l’incident et il dit sur le ton d’une aimable plaisanterie :
– Puisque vous aimez tant la marche, mon cher comte, quand vous êtes mort cela doit bien vous gêner pour suivre votre régime ?…
Teramo-Girgenti s’arrêta, regarda étrangement son interlocuteur, si étrangement que le sourire légèrement narquois du célèbre financier en resta comme figé sur ses lèvres.
– Sachez, monsieur, dit le comte, pour votre gouverne, que rien ne me gêne, mort ou vivant, mais je vous jure que si je ne marche pas quand je suis mort, je marche et je fais marcher les autres quand je suis vivant… si bien et si longtemps, monsieur Philibert Wat, que j’en ai vu se jeter à mes pieds pour que je m’arrête !…
Et il ajouta d’une voix si sombre, si sinistre, si annonciatrice de malheurs et de catastrophes cachés que Philibert Wat en frissonna :
– … Mais je ne m’arrête jamais !
Sans pouvoir s’en expliquer la raison, à cette parole du comte, Philibert eut peur ; et cependant il n’était point pusillanime et c’était un caractère que Philibert Wat. Quelques lignes qui nous feront connaître son histoire ne sont point ici inutiles. Philibert Wat était né à Bordeaux ; il avait vingt et un ans quand son père mourut, le laissant sans ressources. Mais ses projets ambitieux le déterminèrent à se rendre à Paris.
Après avoir essayé sans succès de placer des vins, il s’achemina vers la Bourse, s’occupa de courtage, de circulation d’effets et prit ainsi « ses premiers degrés dans la bohème marronne de la coulisse et de la banque ». Il ne tarda pas à entrer en pleine lumière et à montrer à la fois la souplesse et son imagination, la fertilité de ses ressources et une rare audace d’exécution. Son premier coup de génie fut de fonder un journal : Le chemin de fer, dont il fit un centre de renseignements en matière de voies ferrées et aussi de finance spéculative. Philibert Wat était lancé.
Usant de la grande publicité du Chemin de fer, il fonda une société : la Caisse des actions associées, dont le but était d’acheter des actions dans le moment favorable pour les revendre avec bénéfice. C’est à cette époque qu’il rencontra Sinnamari. Ces deux hommes devaient se comprendre. L’agence Sinnamari fonctionnait déjà dans l’ombre. Sa puissance politique était considérable. Philibert résolut d’unir d’un lien secret la puissance politique et la puissance financière, persuadé que chacune ne pouvait sérieusement exister et durer que par l’autre. En réalité, Philibert Wat ne fit qu’exécuter ce qu’avait décidé Sinnamari, mais comme le procureur impérial laissait volontiers Philibert prendre les plus compromettantes responsabilités, Philibert put facilement s’imaginer, un moment, qu’il était l’un des hommes les plus forts de son temps. Le jour où il épousa la fille du président du conseil, il se crut le plus fort. Il oubliait Sinnamari. Mais Sinnamari, lui, ne l’oubliait pas.
La porte du petit salon turc venait de s’ouvrir, et le domestique noir annonça que la voiture du comte était avancée.
– Vous sortez tout de suite, monsieur ? demanda Wat, assez interloqué par ce qui venait de se passer, et n’osant plus donner à Teramo-Girgenti, sans savoir exactement pourquoi, du « cher comte ! »
– Tout de suite… J’ai rendez-vous au cours de déclamation de Mlle Marcelle Férand…
– Vraiment ! Mais Mlle Marcelle Férand est une de mes bonnes amies à moi, et si je puis vous être utile… Figurez-vous que nous nous sommes rencontrés cette nuit chez… chez le roi Mystère !
– Le roi Mystère ! reprit Teramo en faisant passer devant lui Philibert Wat. Et comment va-t-il, ce cher ami ?
– Est-il vraiment votre « cher ami » ?
Philibert, posant cette question, considérait attentivement le comte qui descendait le perron de l’hôtel en lui faisant un signe d’invitation à monter dans son coupé. Et le comte lui dit :
– Vous savez, moi, je n’ai guère d’amis… D’abord, qui peut se dire sûr d’avoir un ami ?… Socrate, que j’ai eu l’honneur d’enterrer autrefois, lors d’une de mes premières jeunesses, Socrate trouvait que sa maison était toujours trop grande pour qu’elle ne contînt que des amis. Mais enfin, Mystère m’a rendu quelques services, du temps que j’étais son prisonnier dans la campagne de Rome…
– Comment ! Son prisonnier ?…
– Oui, Mystère a commencé par être un grand bandit romain… En Italie, ce sont des choses que l’on voit tous les jours, ou toutes les nuits… un roi des Catacombes… pour peu qu’après dîner on aille prendre le frais du côté du tombeau de Cœcilia Metella, qui est, ma foi, un fort beau tombeau… C’est ce qui m’est arrivé il y a environ huit ans…
– Et, vous ayant fait son prisonnier, mon cher comte, quel service vous a-t-il rendu ?…
– Celui, entre autres, de me faire faire la connaissance du pape…
– Comment cela ?… demanda Philibert en allumant un énorme cigare de la Havane.
– Le pape fut aussi son prisonnier pendant quarante-huit heures… Je crois bien, du reste, que ce fut là le début de la fortune du roi des Catacombes…
Le comte avait fait monter Philibert Wat dans sa voiture.
– Puisque vous êtes un ami de Mlle Marcelle Férand, dit-il, vous allez me rendre le service de me la présenter…
– Mais comment donc !… J’allais vous le proposer…
La voiture s’ébranlait sur le gravier de la grande allée du jardin. Le comte ferma l’une des glaces, qui était restée ouverte, et se jeta dans l’un des coins du coupé.
– Quand je dis que ce fut là le début de sa fortune, je veux dire de sa renommée, de sa situation de bandit, de grand bandit romain. Car R. C., comme on l’appelait déjà là-bas, dans la campagne romaine, était trop gentilhomme pour ne point se contenter de la gloire d’un coup pareil : prendre le pape !… Le pape, pour sortir du repaire de R. C., paya une rançon de trois millions. Deux heures après sa rentrée au Vatican, qui fut du reste aussi mystérieuse que sa sortie forcée, les trois millions lui étaient rendus « pour ses pauvres ».
Philibert Wat avait bien entendu parler des fantastiques histoires des bandits romains, mais il trouvait celle-là d’une force ou d’une exagération… Cependant, quel intérêt le comte eût-il eu à se moquer de lui ? Il racontait toutes ces choses sur un ton si naturel…
– Tout de même, fit Wat, s’il avait enlevé le pape, on l’aurait su…
– On ne l’a pas su, monsieur… Le roi des Catacombes est discret…
– Et comment, si on ne l’a pas su et s’il n’a conservé de l’aventure aucun profit pécuniaire, ce « coup » a-t-il pu être le début de la fortune de « votre » roi ?
– Oh ! on ne l’a pas su dans le public !… Mais tous les chefs de bandes, des Calabres à l’Émilie, l’ont connu… Et de ce jour ils ont reconnu R. C., pour leur chef.
– Et qu’a fait R. C. ?
– R. C., trouvant que l’Italie est trop pauvre pour ses talents, est venu s’installer en France.
– Comment n’en a-t-on pas entendu parler que ces jours-ci ?
– C’est qu’il concevait une affaire qui demandait quelques années à être sérieusement montée.
– Et vous, mon cher comte, peut-on vous demander combien vous avez payé ce « brave » pour reconquérir votre liberté ?…
– Mais, mon cher monsieur Wat, il n’y a là aucune indiscrétion… Cela m’a coûté cinq millions.
– Cinq millions !… qu’il ne vous a pas rendus… Et vous appelez cela vous rendre service !…
– Je vous ai dit qu’il m’avait fait connaître le pape…
– Évidemment… mais on peut connaître le pape pour beaucoup moins cher…
– Quand on est catholique… Mais je ne l’étais pas… Figurez-vous que j’étais resté pythagoricien… Je retardais !…
– Et alors ?…
– Et alors le pape m’a converti… Vous comprenez, nous partagions la même cellule, et il s’ennuyait…
– Charmant ! Tout à fait délicieux ! prononça Philibert du bout de ses longues dents éclatantes. Et, à propos de « votre » ami, vous connaissez son dernier exploit ? Vous savez ce qu’il a fait cette nuit, le roi Mystère ?
Teramo-Girgenti interrompit Wat :
– Oui, je le sais, car « c’est un garçon qui m’intéresse beaucoup ». Mais, mon cher monsieur Wat, n’avez-vous point promis le secret sur cette affaire Desjardies ?
– Non seulement à R. C., mais nous l’avons tous promis aussi au procureur impérial. Je doute cependant qu’on le puisse garder longtemps… Les journaux…
– Les journaux ne diront rien, parce qu’ils ne sauront rien… Le pouvoir d’en haut, avec Sinnamari, le pouvoir d’en bas avec R. C. y veilleront. Tout le monde a intérêt à garder le silence…
– Décidément, pour un nouveau débarqué dans la capitale, vous me paraissez être très au courant de ce qui s’y passe… C’est R. C. qui vous met au courant de ces choses ?
– Oui, c’est R. C. ; je le vois souvent.
– Et vous savez… sans doute… ce que veut R. C. ?
– Comment, ce qu’il veut ?
– Oui… Il ne fait point de doute que R. C. poursuit un but… un but tout à fait personnel, en dehors de toutes les affaires de la fameuse association, de l’A. C. S., comme cela s’appelle, je crois…
– C’est exact…
– J’en étais sûr… Ce n’est point seulement par pur amour de l’humanité qu’il a fait évader Desjardies… Il en veut à quelque chose… à quelqu’un…
– C’est indéniable…
– C’est très intéressant, ajouta d’un air négligent Philibert Wat. Et je n’ose espérer que l’on puisse savoir tout de suite qui est… ce quelqu’un… quelle est cette chose…
– Mon cher, qu’est-ce que ça peut vous faire, puisqu’il ne s’agit point de vous ?
À ce moment, la voiture, qui se dirigeait vers la rue de Berlin, où Marcelle Férand tenait son cours de déclamation, était arrivée au carrefour de la rue du Faubourg-Saint-Honoré.
Un encombrement se produisit alors, qui la força de s’arrêter.
Wat, tout à coup, sursauta. Dans le cadre de la glace, du côté de Teramo-Girgenti, venait d’apparaître, grimaçante et horriblement menaçante, la figure fantasque du gnome américain. Il proférait des choses que l’on n’entendait pas.
Le comte baissa brusquement la glace et adressa de sévères paroles au gnome, dans une langue que Wat ne reconnut pas.
Alors Wat assista à ce spectacle inquiétant d’une figure qui instantanément, cessa de refléter la fureur pour manifester la joie la plus folle. Enfin, la bouche édentée qui râlait un rire infernal, ayant prononcé ces mots : « Cela se peut-il ? » les yeux prirent une expression de tendresse inexprimable et laissèrent couler deux lourdes larmes.
Le comte releva la glace. La voiture reprit sa marche. Le gnome avait disparu.
Philibert Wat se décida à poser à ce moment une question qui le tracassait depuis qu’il avait entendu Teramo-Girgenti nommer M. Macallan…
– Mon cher comte, fit-il avec quelque hésitation, quel est cet homme ?… Je ne le connais pas… Il s’est présenté lui-même cette nuit chez le roi des Catacombes…
– Bah ! répondit l’amateur de perroquets, ne vous occupez pas de ça !… Le roi est le roi et celui-ci est son fou !
V – OÙ LE LECTEUR FAIT CONNAISSANCE DE Mlle LILIANE D’ANJOU, ET OÙ Mlle LILIANE D’ANJOU FAIT LA CONNAISSANCE DU COMTE DE TERAMO-GIRGENTI
Philibert Wat n’insista pas, mais l’étrange apparition de M. Macallan à la glace du coupé devait l’avoir singulièrement ému, car il ne rompit le silence qui régnait dans le coupé depuis ce curieux incident que lorsqu’un nouvel arrêt se produisit au coin du boulevard Malesherbes et de la rue de la Pépinière.
Il était à ce moment exactement onze heures.
Philibert Wat, qui regardait vaguement les passants défilant frileusement sur le trottoir, s’écria tout à coup :
– Tenez ! Vous ne connaissez pas le colonel Régine ? Le voilà ! Il sort de cette maison ; là, en face !
– Qui est Régine ? demanda Teramo-Girgenti, qui paraissait profondément indifférent à l’honneur d’apercevoir cet officier supérieur.
– Vous savez bien ! Je vous en ai déjà parlé ! Un ami à moi ! Quand on est de Paris, mon cher comte, il faut connaître Régine ! J’aurai l’occasion de vous le présenter.
– Ce monsieur qui paraît si triste, et qui promène ces deux petites filles ?
– C’est cela ! C’est l’heure de sortie de ses filles, et quand Régine n’est pas retenu dans les bureaux de la guerre, il ne laisse à personne le soin de les promener.
– Mais ces bébés ont deux ans ! Et ce sont ses filles ?… Mais le père a l’air d’un vieillard !
– C’en est un ! Et c’est ce qui explique sa folle passion pour ces deux rejetons tardifs, deux jumelles délicieuses.
– Je croyais que vous m’aviez dit que ce Régine n’avait eu dans sa vie qu’une passion…
– Le jeu !… Mais depuis deux ans, il en a une autre… ces deux petites filles qui lui sont nées au bout de huit ans de mariage…
– Mme Régine est donc très jeune ?
– Sinon très jeune, beaucoup plus jeune que son mari… c’est une cousine, une proche parente de M. Sinnamari, notre procureur impérial.
– Ah, oui ! J’avais oublié, répondit négligemment Teramo-Girgenti. Vous m’avez déjà raconté tout cela… Mais j’ai une si pauvre mémoire… Régine et votre M. Sinnamari sont de vieux amis, n’est-ce pas ?
– Des copains de collège !… Ils étaient trois à Sainte-Barbe, qui ne se quittaient jamais : Sinnamari, Régine et Eustache Grimm… Ils ne se sont pas lâchés dans la vie…
– Sénèque, M. Philibert Wat, a fait un traité sur l’Amitié, et ça ne lui a pas réussi…
Et Teramo-Girgenti changea de conversation.
Il demanda à Wat des détails sur les cours de déclamation de Mlle Marcelle Férand.
À quoi Wat répliqua en entretenant le comte de la présence de l’actrice à la cérémonie de la place de la Roquette, mais il était à remarquer que, plus Wat s’efforçait d’amener la conversation sur le seul terrain qui l’intéressait, plus le comte réussissait à la transporter ailleurs.
Wat en fut donc pour ses frais.
Le comte expliqua qu’il ne montrait quelque curiosité de ce cours que parce qu’on le lui avait désigné comme pouvant lui fournir les éléments d’une troupe jeune et jolie – et de talent – destinée à jouer couramment les chefs-d’œuvre qu’il aimait, dans une salle de théâtre qu’il faisait aménager pour cet objet dans son propre hôtel.
Comme on arrivait au coin de la rue d’Amsterdam et de la rue Saint-Lazare, après quelques arrêts causés encore par l’encombrement excessif de la voie publique, le comte, qui aimait à ce que son équipage courût à grande allure et qui ne s’était pas encore impatienté, regarda l’heure qu’il était à sa montre ; sur quoi, Philibert Wat, ayant tiré la sienne, déclara qu’il était onze heures et dix minutes ; sur quoi le comte rectifia en affirmant onze heures onze.
En vain, Wat fit-il remarquer à son compagnon que le cours de déclamation se tenait ce jour-là, entre onze heures et midi, on était sûr de ne pas « manquer » Marcelle Férand, à moins cependant que, fatiguée par une nuit d’insomnie, elle n’eût donné congé à ses élèves, le comte s’empara du tuyau acoustique et fit savoir à son cocher, par l’intermédiaire de son valet de pied, « qu’il était pressé ».
Cette formule devait être magique et Philibert pensa qu’elle était capable de produire une certaine impression sur le cocher, car celui-ci, d’un geste large, sans s’occuper en aucune sorte du danger que ce geste pouvait faire courir à son maître, à M. Philibert Wat et à lui-même, et surtout à ceux qui traversaient alors la rue, leva son fouet et cingla ses deux fameux chevaux bais comme un charretier.
Naturellement, il n’en fallut pas davantage pour que malgré la pente ascendante de la rue d’Amsterdam, l’équipage partît comme un obus.
Philibert Wat, épouvanté, se tourna vers le comte.
Celui-ci, comme si de rien n’était, avait paisiblement baissé les deux glaces qui se trouvaient l’une devant l’autre à côté de lui, et puis s’était repris à regarder sa montre.
Wat voulut crier, mais il ne le put pas. Le train était devenu tellement infernal que le malheureux se voyait déjà en charpie… et le comte regardait toujours sa montre…
Chose extraordinaire, fantastique, inouïe, malgré la rapidité vertigineuse de l’équipage, le cocher n’écrasa personne et ne renversa rien du tout dans le parcours de la rue d’Amsterdam jusqu’au coin de la rue de Berlin, mais alors, arrivé là, il renversa quelque chose.
Une forte clameur poussée par les passants et un choc assez rude, qui fut la cause que M. Philibert Wat alla donner douloureusement de son grand nez sur la glace d’en face, qui ne résista pas, firent connaître qu’un accident venait de se produire.
Les chevaux du comte, événement incroyable, s’étaient arrêtés sur le coup. Quant au comte lui-même, bien avant que Wat fût revenu de sa stupeur, il avait sauté, leste comme un jeune homme, hors de sa voiture, et s’était précipité vers le malheureux véhicule que son équipage avait réduit en miettes.
Il s’agissait d’une élégante Victoria dont toute la carrosserie était en morceaux, si bien que devant le résultat d’un pareil choc les passants ne pouvaient que s’étonner du désastre complet de cette voiture, cependant que celle du comte ne semblait nullement avoir souffert.
Heureusement, on n’avait point d’accident de personne à déplorer, comme on dit… Par un phénomène dont on ne pouvait que se féliciter sans toutefois parvenir complètement à se l’expliquer, le cocher de la Victoria avait si habilement sauté de son siège, en entendant (car il ne pouvait le voir encore) l’équipage du comte, qui roulait au travers de la rue d’Amsterdam, avec la rapidité et le bruit du tonnerre, qu’il s’était trouvé sur le trottoir, dans le moment que le dit équipage venait, de son essieu, renverser, briser, anéantir la Victoria.
Disons enfin que le hasard, s’était complu à placer si malheureusement la Victoria au coin de la rue de Berlin et de la rue d’Amsterdam, que tout son arrière, dépassant un peu la rue de Berlin, se présentait comme une véritable cible à un équipage emballé qui aurait remonté la rue d’Amsterdam ; car, encore, la Victoria était stationnaire et venait de débarquer sur le trottoir la plus impressionnante demi-mondaine que Paris connût alors pour son charme à la fois tendre et fatal, Mlle Liliane d’Anjou, qui montrait toute l’apparence de la consternation.
Non que la perte irrémédiable de sa voiture et que le triste état dans lequel se trouvait un superbe demi-sang qui, blessé, se débattait à grand bruit dans l’emmêlement des traits, des harnais et des brancards éclatés, fussent susceptibles de la réduire au désespoir, mais bien évidemment l’idée seule que son aimable personne aurait pu, à quelques secondes près, se trouver mêlée à tout ce cruel et dangereux gâchis, devait augmenter dans des fortes proportions sa naturelle mélancolie.
Elle vit tout à coup que, devant elle, un monsieur fort correctement mis et d’un âge respectable la saluait très bas. Ce personnage exprimait sa honte et ses remords d’un tel accident et ajoutait qu’il était heureux, malgré tout, que l’affaire se bornât à des dégâts matériels, car jamais il ne se fût consolé si, par sa faute, il était arrivé le plus petit malheur à une aussi belle personne.
Liliane laissa dire le vieillard, leva ses adorables épaules que recouvrait une magnifique fourrure de chinchilla, eut une moue légère sous la voilette, comme pour faire entendre à ce monsieur, qui s’exprimait si bien en français, cependant que son accent trahissait une origine italienne, que cette histoire d’accident lui paraissait déjà bien vieille et qu’elle ne s’en occupait plus.
Mais le comte insista pour lui dire qu’elle ne pouvait rester ainsi sans équipage, ni retourner chez elle à pied ; aussi osait-il lui offrir l’hospitalité dans son propre coupé, ou plutôt mettait-il son coupé à la disposition de Liliane.
Teramo-Girgenti, disant ces mots, avait fait un signe et sa voiture était venue se ranger près du trottoir.
Liliane ne put retenir l’expression de son enthousiasme en apercevant les deux bais et tout l’admirable équipage du comte.
– Si vous étiez chic, dit-elle, vous m’en feriez cadeau…
– Je n’osais pas vous l’offrir, mademoiselle, dit Teramo-Girgenti. Cet équipage est à vous. Et je vous donne par-dessus le marché le cocher.
Et il cria : « Cassecou ! Tu appartiens désormais à Madame ! »
Sur le siège le cocher s’inclina et le comte alla, lui-même, ouvrir la portière.
De l’équipage descendit aussitôt Philibert Wat, que le comte avait tout à fait oublié et qui commençait seulement à se remettre d’une si chaude alarme. Le banquier voulut présenter Liliane au comte, mais celui-ci déclara que la chose était déjà faite ; puis ayant aidé la jeune femme à s’installer dans le coupé, il monta auprès d’elle, donna le signal du départ, et laissa, médusé, Philibert Wat sur le trottoir.
– Marcelle Férand va être furieuse ! observa en riant Liliane. Bah ! je prendrai ma leçon une autre fois ! Et où me conduisez-vous ainsi, monsieur… monsieur…
– Le comte de Teramo-Girgenti !…
– Joli nom !
– Jolie femme !
Et le comte regarda Liliane.
VI – VERS LE PASSÉ
Bien que nous n’ayons encore défini la beauté de Mlle Liliane d’Anjou que d’une façon très imprécise, le lecteur n’ignore point cette beauté tout à fait.
En vérité, quand nous avons pénétré d’une façon si mystérieuse dans la chambre de Robert Pascal, nous avons eu l’occasion de décrire par le menu un portrait de femme qui faisait, avec une glace, l’ornement de ces murs austères.
On retrouvait chez Mlle Liliane d’Anjou, d’une façon frappante, le dessin du visage de cette belle personne. Notre demi-mondaine avait encore la même teinte blonde de cheveux et les yeux bruns du portrait, mais ce que le portrait n’avait pas, c’était cette mélancolie, cet air détaché de tout, cet aspect d’égoïsme impertinent et tranquille, ce mépris des autres et peut-être de soi-même, imprimé sur le front de Liliane.
Sa taille était une merveille et sa démarche en était une autre. On avait vu de vieux Parisiens, disons des gens que rien n’étonne, s’éprendre subitement de Liliane après l’avoir rencontrée simplement au Bois, à l’heure des Acacias, mollement étendue sur les coussins de sa voiture, mais d’autres, qui l’avaient vue marcher, en étaient devenus fous.
Elle s’en apercevait à peine. Qu’on l’aimât, qu’on se ruinât, qu’on se tuât pour elle, la chose lui importait peu, et cependant elle était une femme autrement redoutable qu’une femme méchante. Elle était indifférente. Et le sang des amants qui, par deux fois, avait rougi le tapis de ses appartements, l’avait ennuyée comme une incongruité.
Les hommes avec qui le destin lui avait donné affaire l’ennuyaient. Cependant, le comte Teramo-Girgenti, avec qui elle venait de faire connaissance, ne l’ennuyait point. Il avait eu une façon de briser sa voiture et d’en réparer les dégâts qui n’était pas celle de tout le monde. Sa parfaite galanterie, et puis aussi ses cheveux blancs lui plaisaient. Elle aimait les vieillards, avec qui l’on peut causer. Celui-ci avait encore cet avantage sur les autres, qu’il l’intriguait un peu. Les manières du vieux gentilhomme étaient si singulières et… si pleines d’une inquiétante et douce autorité, qu’elle n’avait point résisté au plaisir de se trouver seule avec lui, dans ce coupé.
Pressentiment inexplicable, il lui semblait non point que cet étranger avait quelque chose à lui dire, mais qu’ils avaient, tous deux, quelque chose à se dire. Par exemple, elle ne savait pas quoi ! C’était une simple sensation, mais curieuse en vérité. Le comte la considérait maintenant si sérieusement qu’elle ne put s’empêcher de lui dire avec un de ces sourires vagues qui avaient déjà fait tant de malheureux :
– Mais enfin, monsieur, que me voulez-vous ?
– Rien, répondit Teramo, je ne veux rien, madame, que l’honneur de vous déposer à votre porte…
– Mais, vous ne savez pas où j’habite !…
– Croyez-vous ? fit tranquillement le comte. Quand vous me connaîtrez mieux, madame, vous apprendrez que je sais tout.
– C’est beaucoup de prétention… d’autant plus de prétention que je vous surprends en défaut du premier coup : nous tournons le dos à mon domicile.
– En vérité ?
– Votre cocher nous conduit rue de Moscou et j’habite…
– Dans le quartier des Champs-Élysées… Mais, madame, n’est-il point agréable de prendre quelquefois le chemin des écoliers ? Quand je vous aurai déposée à votre porte, qui me dit que je vous reverrai jamais !… Et je goûte trop le charme de votre conversation…
La voiture se trouvait maintenant au coin de la rue de Moscou et de la rue de Saint-Pétersbourg. Elle s’arrêta.
– Mais nous ne sommes pas arrivés ! s’écria, en riant, Liliane.
– Je sais ce que c’est, fit le comte en ouvrant la portière. Vous permettez, madame ? Dans une minute je suis de retour… le temps de dire un mot à cet homme…
Et le comte descendit.
Liliane le vit qui se dirigeait vers la porte cochère d’une bâtisse toute neuve, et s’entretenait quelques instants avec un bonhomme qui paraissait être le concierge du lieu ; celui-ci disparut et revint aussitôt portant une cage dans laquelle se trouvait un perroquet.
Le comte donna la cage au cocher, et reprit sa place auprès de Liliane.
– Vous avez acheté ce perroquet ? demanda-t-elle, assez étonnée.
– Oui ; mon cocher sait que j’adore les perroquets. Il aura vu celui-ci derrière la fenêtre de la loge, et il a aussitôt arrêté ses chevaux, persuadé que j’aurais grand plaisir à revenir chez moi avec cette adorable petite bête.
– Vous êtes un type ! constata Liliane, qui prit aussitôt son parti des excentricités du comte, car elle en avait vu bien d’autres…
La voiture continuant son chemin, arriva jusqu’à l’angle du boulevard des Batignolles et là, s’arrêta.
– Eh bien ! demanda Liliane, de plus en plus étonnée. Vous allez encore acheter un perroquet ?
– Ce n’est donc pas ici que vous habitez ? dit le comte, en montrant un balcon qui tenait toute la ligne du premier étage d’une maison de belle apparence.
– Vous retardez, monsieur ! répliqua la demi-mondaine. J’habitais, en effet, cet appartement il y a dix-huit mois. On vous a mal renseigné.
– À ce moment, dit Teramo-Girgenti avec ce calme suprême qui appartient seulement aux esprits supérieurs et aux imbéciles, à ce moment, madame, vous faisiez le bonheur de M. de Saint-Roy, avocat général à la Cour de cassation.
Liliane, stupéfaite, regarda le comte et lui dit, hostile :
– Qu’est-ce que ça peut vous faire ?
– À moi ? Rien, chère madame, croyez-le bien, et vous non plus, je l’espère… Je n’ai jeté ce détail dans la conversation que pour vous prouver que je suis peut-être un peu mieux renseigné que vous ne le supposiez.
– Et vous m’avez prouvé que vous êtes plus mal élevé que vous n’en avez l’air.
La voiture était repartie au grand trot. Cette fois, elle avait fait demi-tour et remontait le boulevard de Clichy…
– Mais où va cette voiture ? demanda encore Liliane en marquant soudainement une franche mauvaise humeur.
– Est-ce qu’on sait ?… Quand je ne donne pas d’adresse à mon cocher, ce garçon, dont je vous fais cadeau avec tout l’équipage et que je vous recommande tout particulièrement, imagine que je n’ai que le désir de me promener… Et voilà, il me promène…
– N’importe où ?…
– Est-ce nous conduire n’importe où que de nous arrêter devant cette porte, madame ?…
Comme le comte disait ces mots, la voiture venait stationner devant un hôtel meublé de la rue de Douai.
Liliane reconnut la porte de l’hôtel, et sa méchante humeur devint tout à fait de la colère.
– Ah çà, monsieur, me direz-vous ce que signifie ?…
– Ici, laissa tomber le comte, toujours aussi calme, vous avez fait le bonheur de ce pauvre Bolivar, qui en est mort ! Un brave garçon qui, après s’être emparé d’une petite fortune qu’il avait trouvée dans la caisse de son patron, un banquier de la rue de Clichy, n’a su rendre, quand la justice est venue lui demander des comptes, que le dernier soupir.
Liliane avait déjà une main sur la poignée de la portière, prête à s’élancer, à fuir cette évocation sinistre de son passé, mais le comte saisit cette main délicate ; la voiture repartit à une vitesse nouvelle, et Liliane resta en tête à tête avec le mystérieux vieillard qui, maintenant, l’épouvantait. Elle n’avait plus de colère : elle n’avait plus que de l’effroi.
– Oh ! Monsieur, monsieur ! gémit-elle. Qui donc êtes-vous ?… Que me voulez-vous ?…
L’équipage descendait la butte Montmartre, traversait la place de la Trinité, passait la rue de la Chaussée-d’Antin, arrivait rue de Rivoli… et maintenant traversait la Seine sur le pont Neuf.
Liliane, d’une voix mourante, demandait :
– Où allons-nous ?… Où allons-nous ?…
L’équipage prit la rue Mazarine. Il sembla à Liliane que son cœur allait cesser de battre… Elle étouffait… Elle allait mourir…
– Grâce ! murmura-t-elle.
Mais la voiture s’arrêta encore. Elle se trouvait en face d’une maison infâme… Cette masure, bien connue des étudiants en goguette, avait une ignoble porte rouge, entrouverte sur un corridor obscur.
Liliane claquait des dents : ses ongles roses entraient sauvagement dans la chair exsangue de ses joues ; ses yeux avaient la fixité de la folie…
– Je ne pourrais dire exactement, madame, le jour où vous êtes entrée dans cette maison… mais vous en êtes sortie, il y a trois ans, le 14 de mai, au bras d’un homme qui est aujourd’hui l’amant d’une Tunisienne qui s’appelle la Mouna. L’homme qui vous a ouvert les portes de cette maison s’appelle le comte de Costa-Rica.
Et la voiture repartit.
Liliane n’avait pas eu un gémissement. Elle souffrait à un point où la douleur ne trouve plus ni un cri ni une larme.
Le comte ne la regardait pas. Mais si quelqu’un eût regardé le comte, il eût vu que derrière ses lunettes d’or, celui-ci pleurait.
Combien de temps la voiture roula-t-elle encore à travers Paris ?… Ce n’est ni Teramo-Girgenti, ni Liliane qui l’auraient pu dire…
Un silence affreux régnait dans le coupé, entre ces deux êtres qu’une destinée si étrangement énigmatique avait si singulièrement réunis.
Quand le cocher arrêta à nouveau ses chevaux, l’équipage se trouvait au pied d’un long mur sombre recouvert d’un épais rideau de lierre : on apercevait au-dessus du mur la cime dénudée des arbres et un petit toit pointu, aux tuiles couvertes de neige, qui y était adossé.
Au tournant de la ruelle, on apercevait une petite maisonnette carrée dont le toit était assez drôlement relevé aux quatre coins, à la chinoise.
Le comte avait ouvert la portière et était descendu.
– Venez ! dit-il à sa compagne.
Liliane obéit. Il lui semblait que cet homme qu’elle ne connaissait pas, et qui la connaissait si bien, était son maître depuis longtemps. Elle trouva en elle la force de se lever, de descendre, parce que l’autre l’ordonnait.
Où était-elle ?… Son regard erra, indifférent, autour d’elle… Soudain, elle tressaillit. Elle venait d’apercevoir le petit toit chinois…
– Ce n’est pas possible ! fit-elle. Je deviens folle…
Le comte sortit alors de sa poche une vieille clef rouillée par le temps, et l’introduisit dans la serrure d’une petite porte vermoulue qui s’ouvrait dans le mur. Le lierre était si épais qu’il cachait à moitié cette porte.
Teramo-Girgenti poussa la porte et souleva le lierre.
– Entrez ! dit-il à Liliane.
Liliane s’avança sur le seuil. Mais elle n’eut pas plutôt jeté un regard sur ce qu’il y avait derrière ce mur qu’elle poussa un cri et tomba à genoux…
Magie du souvenir ! Résurrection du passé ! Mémoire ! Après des années et des années que l’on ne compte plus, la nostalgie des temps révolus vous prend quelquefois et vous conduit comme par la main vers la vieille maison chancelante qui a vu vos premiers pas, au pied du mur qui a connu vos premiers jeux, dans une allée déserte du jardin où vous vous rappelez avoir vu marcher votre mère, et alors une angoisse inexprimable, faite de bonheur et d’effroi, gonfle votre poitrine oppressée, vous poussez un soupir et vous dites : c’est là !…
– Ici, jouait mon frère… soupira Liliane.
– Vous avez donc un frère, mademoiselle ! Savez-vous ce qu’il est devenu ?
Pourquoi lui dit-il maintenant : mademoiselle, quand, tout à l’heure, il l’appelait : madame ?
– Non, non, je ne sais pas… Je ne sais rien, gémit-elle… J’avais un père, j’avais une mère, j’avais un frère… Nous vivions heureux !… Mais il doit y avoir longtemps, longtemps… Je ne sais plus… Je ne sais rien, moi…
– Tenez, monsieur, reprend-elle dans ses larmes, tenez… là, là sous ces arbres, notre père nous avait construit, avec quelques planches, une petite maison qui était pour nous tout seuls : mon frère et moi… une petite maison pour jouer… Il n’y avait que nous qui avions le droit d’y aller, et mon frère avait la clef.
Liliane ne s’apercevait pas que son compagnon était presque aussi ému qu’elle… Elle ne s’occupait pas de lui. Elle ne parlait pas pour lui, mais pour elle… Il lui semblait qu’au son de sa voix, ressuscitaient, plus nombreuses, les images, les figures, les heures d’autrefois…
– Allons dans notre demeure, dit-elle, en s’avançant résolument comme si elle eût reconquis d’un coup toutes ses forces, allons dans l’atelier de mon père.
– Que faisait votre père, mademoiselle ?
– Je ne sais pas… mais il avait un atelier avec de jolies tasses dedans…
– Des tasses ?
– Oui, des tasses et des carafes en argent… Je ne sais pas… C’étaient des choses que l’on ne voyait que là… Quelquefois, l’atelier nous faisait peur…
– Comment cela ?
– Oui, mon père allumait du feu dans des fourneaux et on entendait des grands coups de marteau, et mon petit frère disait que papa fabriquait de l’or… Oh ! je me souviens bien, maintenant…
Ils entrèrent dans la maison. Ils s’arrêtèrent un instant dans le corridor.
– Oh ! comme nous avons joué dans le corridor !… Mon petit frère y faisait rouler des billes… Voici l’escalier sur les marches duquel il alignait tous ses soldats de plomb… C’est drôle, monsieur, comme tout cela me revient…
Ils entrèrent dans l’atelier, dans la salle à manger, dans les chambres, partout… et partout elle revécut le passé, comme s’il avait été d’hier. Il semblait que rien n’avait été changé et les meubles familiers occupaient leur place familière. Les ombres de son père, de sa mère, de son frère la suivaient de pièce en pièce et s’entretenaient avec elle. Elle continuait de pleurer doucement… de bonheur… Et elle trouvait maintenant tout naturel que ce jardin, cette maison, cette cour fussent restés ainsi que les lui révélait le souvenir…
Il fallait que ce fût le comte lui-même qui lui fît remarquer combien il était étonnant qu’elle retrouvât tout à sa place, dans la maison, comme si sa mère venait de sortir, comme si son père allait rentrer…
– Oh ! oui, monsieur, fit-elle, c’est bien merveilleux. Vous ne savez pas à qui est cette maison ? Oui, vous le savez, puisque vous m’y avez conduite… Je voudrais l’acheter.
– Elle est à moi, répondit le comte, et je vous la donne.
– Oh ! monsieur, vous êtes bon… Mais qui êtes-vous ?… Qui êtes-vous, pour m’avoir conduite ici ?…
Le comte dit d’une voix altérée :
– Je ne sais pas qui je suis…
– Comment cela ?…
– Savez-vous qui vous êtes, vous ?… demanda le comte tristement. Savez-vous comment vous avez quitté cette maison, ce bonheur, vos parents que vous n’avez jamais revus ?…
– Non ! fit-elle. Je ne sais pas… Je croyais être seule sur la terre à avoir oublié qui je suis…
– Vous ne vous souvenez de rien ?… Ni quand vous êtes partie, ni pourquoi… ni comment, ni rien ?…
– Non ! non !… Rien… Encore maintenant, rien… Je crois que mon père est mort et que ma mère est morte… mais je n’en suis pas sûre… Et puis, j’ai eu la fièvre typhoïde, et il paraît que la fièvre typhoïde est terrible quelquefois pour la mémoire… Mais pourquoi pleurez-vous, monsieur ?… Ah ! pourquoi pleurez-vous ?… Comment se fait-il que mes malheurs vous touchent à ce point que vous ne puissiez retenir vos larmes ? Si vous êtes un parent, dites-le moi !… malgré la honte qui puisse en rejaillir sur vous d’avoir une parente comme moi. Le secret sera bien gardé, allez !… Si vous savez quelque chose, renseignez-moi… Il ne fallait pas me conduire ici si vous ne vouliez rien me dire… Pourquoi pleurez-vous ?
– Je ne suis pour vous qu’un ami… déclara Teramo-Girgenti… un ami inconnu… Il faut avoir confiance en moi… il faut me dire le nom de votre père…
– Mais je ne le sais pas !… Mais je vous jure que je ne le sais pas !… Je sais qu’une vieille femme de Marseille m’a trouvée dans la rue, et je ne sais pas comment je me trouvais à Marseille… Je sais que j’ai eu une fièvre typhoïde dont j’ai failli mourir… c’est tout ce que je sais…
– Vous me le jurez ?
– Je le jure !
Le comte en silence, la conduisit vers cet endroit, sous les tilleuls, où elle s’était souvenue d’une petite maison en bois qu’avait construite le père. Alors, il lui montra la petite maison en bois, qu’elle n’avait pas vue tout d’abord, à cause d’un rideau de lierre qui la masquait.
C’était une pauvre petite cabane dans laquelle on ne pouvait entrer qu’en se courbant.
– Oh ! fit-elle, notre cabane… Entrons !
– Comment ! Notre cabane ?… demanda le comte.
– Pardonnez-moi… Figurez-vous, monsieur, que j’ai eu un moment l’illusion que c’était mon frère qui me conduisait dans cette cabane… Je ne vous regardais pas… et je vous tenais par la main comme autrefois…
Liliane entra, et elle frappa aussitôt des mains avec une joie enfantine !…
– Oh ! sa bêche !… Mon râteau !… C’est avec cette bêche-là qu’il creusait mon petit jardin pour y planter des pieds de violettes que notre mère rapportait du marché…
– Qui, il ?… interrogea le comte, dont la main tremblait à côté de la main de Liliane, sur la petite bêche…
– Mais, mon frère !…
Et, tout à coup :
– Qu’est devenu mon frère, maintenant ?… Mon Dieu ! Il est peut-être mort… Je ne sais même pas comment il s’appelait…
– Comment, mon enfant, demanda le comte, vous ne vous souvenez même pas du nom de votre frère ?…
– Oh ! monsieur… c’est bien naturel, puisque j’ai en vain essayé de me rappeler mon nom à moi…
Teramo-Girgenti se pencha vers Liliane et, tout bas, lui dit :
– Clotilde !…
Ce mot n’avait pas été plutôt prononcé que Liliane poussa un grand cri :
– Robert !…
Et, dans un véritable délire, elle embrassa le comte. Il lui paraissait qu’à ces deux noms qui, si joyeusement jadis, avaient retenti entre ces murs, les arbres allaient reverdir, le printemps fleurir, la vieille maison s’animer, et les morts, ayant brisé, à l’appel de cet écho sacré, la porte du tombeau, reparaître avec les gestes de la vie !…
… Robert !… Clotilde !… Ah ! Comme elle les voyait maintenant, comme elle les entendait, le petit garçon et la petite fille !…
Et c’était lui, cet inconnu qui avait prononcé le mot magique !… Maintenant, elle le suppliait d’en dire davantage… davantage…
– Puisque vous ne pouvez être ni mon père, ni mon frère, finit-elle par dire, après un long silence qui semblait les avoir réunis plus qu’il ne les avait séparés, qui êtes-vous ?… Je ne sortirai pas d’ici sans le savoir…
– Je suis un envoyé de votre frère, dit le comte.
– Il est donc vivant ! s’écria-t-elle… Dieu soit loué !…
– Oui ! il est vivant…
– Conduisez-moi près de lui !
– Un jour… un jour viendra où je vous conduirai près de lui, Liliane…
– Bientôt ?…
– Bientôt.
– Et en attendant, que faut-il faire ?
– Rien, Liliane… rien…
– Où verrai-je mon frère, monsieur ? demanda Liliane, dans une fièvre grandissante.
– Chez moi… chez le comte de Teramo-Girgenti… le soir où, dans son hôtel des Champs-Élysées, il pendra la crémaillère… Ce sera une grande fête, Liliane, ajouta le comte, d’une voix que la jeune femme ne reconnut plus tout à coup… Une grande fête… pour les vivants… et pour les morts !…
VII – OÙ DIXMER COMMENCE À REGRETTER D’AVOIR MONTRÉ SON JEU
Quelques minutes plus tard, le comte et Liliane se retrouvaient dans la petite ruelle, où les attendait l’équipage dont Teramo-Girgenti avait fait don à la demi-mondaine.
Le comte referma la porte, donna la clef de la propriété à Liliane, lui dit que chaque fois qu’elle voudrait revenir en ces lieux elle n’avait qu’à faire connaître son désir à son cocher, enfin qu’il fallait qu’elle gardât son cocher, lequel lui serait aussi dévoué qu’il l’avait été pour lui-même.
Liliane écoutait le comte et semblait ne point l’entendre. Elle obéit comme une automate au geste de Teramo-Girgenti et se retrouva seule dans la voiture avant qu’elle eût eu le temps de s’en étonner.
– Chez Madame ! commanda le comte. Et n’oublie pas, Cassecou, cet après-midi, d’aller porter mon perroquet rue de Ponthieu !
La tête de Liliane se montra à la portière. Elle s’était déjà reprise à sourire au comte.
– Comment dites-vous que s’appelle cet homme ? fit-elle.
– Cassecou, madame…
– Joli nom pour un cocher !
Et elle envoya au vieillard un baiser désespéré…
L’équipage fila comme une flèche.
Le comte resta seul. Il revint, à pied, par ces rues presque désertes du quartier de l’Observatoire.
Au coin du boulevard du Montparnasse, le comte fut rejoint par une voiture de maître qui semblait l’attendre.
Il cria au cocher :
– Au Palais de Justice !
Et il se jeta dans le coupé.
Quand le comte arriva au Palais de Justice et eut gravi l’escalier qui montait chez le procureur, sans avoir eu pour cela le besoin de demander son chemin à quiconque, il fut assez étonné du mouvement insolite qui régnait dans la galerie.
Des gardiens couraient, des gagistes s’interpellaient, des avocats stagiaires, sortant de la correctionnelle, se précipitaient comme des petits fous, retroussant leur robe, et, de la galerie Marchande, survenait une patrouille de gardes.
Le comte arrêta un jeune avocat qui paraissait fort affairé et lui demanda ce qui se passait ; le jeune avocat lui répondit qu’il n’en savait rien et qu’il courait comme tout le monde.
Enfin, un gagiste finit par lui dire que le bruit s’était répandu dans tout le Palais « qu’il y avait encore eu un assassinat dans les bureaux du procureur impérial ».
Et ce gagiste ajouta :
– Depuis l’affaire Desjardies et l’assassinat Lamblin, ils ont tous perdu la tête : ils voient des assassinats partout. Au fond, il n’y a rien eu de grave ; c’est tout simplement le portier de la prison de la Grande-Roquette qui était venu au Palais, mandé par M. le procureur impérial, et qui s’est trouvé mal.
Teramo-Girgenti remercia et continua son chemin. Ce ne fut pas sans peine qu’il parvint à la porte des bureaux du procureur.
Le comte avait l’air de chercher quelqu’un qu’il ne trouvait point, et il finit par demander à un garçon de bureau :
– M. Cyprien n’est point ici ?
– Non ! fit l’autre brusquement… Que lui voulez-vous ?
– J’étais venu hier soir pour voir M. le procureur et votre collègue m’a dit que je serais sûrement reçu aujourd’hui. Il m’a dit que je n’aurais qu’à demander M. Cyprien.
– Il n’est pas là ! fit le garçon de bureau en s’échappant.
Teramo-Girgenti montra une grande patience. Il s’empara d’une chaise et s’assit, et, attentivement, il regarda tout ce qui se passait autour de lui.
Des groupes discutaient autour du trou dont nous avons parlé, trou par lequel un escalier en colimaçon conduisait à la cour de la Sainte-Chapelle et à la Souricière. Teramo-Girgenti continuait à s’étonner de ne point trouver son M. Cyprien.
Tout à coup, les groupes s’écartèrent et il entendit ces mots :
– Voici le docteur Sartine ! Voici le docteur Sartine !
Et il vit arriver en grande hâte un homme en longue redingote noire qui portait sous son bras une trousse. Cet homme avait une figure singulièrement anxieuse, et Teramo-Girgenti pensait que ce n’était point là la figure d’un docteur qui va soulager quelqu’un qui se trouve mal.
Le docteur passa, bousculant tout le monde, et pénétra, par le secrétariat, dans le bureau du procureur.
La porte s’était refermée. On avait mis une garde devant cette porte.
Teramo-Girgenti surprit ensuite ces paroles prononcées, derrière lui, à voix basse, par le garçon auquel il s’était adressé tout à l’heure, et qui s’entretenait maintenant avec un huissier :
– M. le procureur a demandé Cyprien à trois reprises… C’est tout de même drôle qu’il ait disparu comme ça…
– Qu’est-ce que tu en penses ? demandait l’autre.
– Je pense qu’il se passe trop d’affaires louches ici… Je vais tâcher de passer au service du procureur général.
– Et ce pauvre homme ? questionna l’huissier, crois-tu qu’il soit mort ?
– Il en avait bien l’air…
Teramo-Girgenti se leva, fit signe au garçon de bureau, l’entraîna dans un coin, et lui mettant un louis dans la main :
– Vous ne pouvez pas m’annoncer en ce moment à M. le procureur ?
– Oh ! Monsieur, répondit le garçon, en montrant une physionomie bouleversée par le désespoir de ne pouvoir contenter immédiatement les désirs d’un homme assez généreux pour payer de vingt francs l’honneur de parler à un larbin du parquet, si vous vouliez patienter un peu…
Teramo-Girgenti remit un nouveau louis dans cette main mercenaire…
– Je ne patienterai qu’à une condition, mon ami, c’est que vous me racontiez, par le menu, tout ce qui vient de se passer ici…
Et il se rassit.
Alors, l’autre, avec une mine importante et mystérieuse, lui confia que « depuis des heures » M. le procureur impérial, le préfet de police et un officier divisionnaire de la préfecture, nommé Dixmer, étaient en conférence, et que celle-ci avait d’autant intrigué tout le monde qu’on en ignorait le motif, et que, lorsqu’elle avait pris fin, il y avait un quart d’heure, M. le procureur impérial, le préfet de police et M. Dixmer étaient apparus dans l’antichambre, fort agités. Or, pendant que durait cette conférence, était arrivé, de la Roquette, le portier de la prison. Le préfet de police, paraît-il, l’avait fait mander. Et il attendait d’être introduit auprès de lui, quand préfet, procureur, officiers étaient sortis. Le préfet, apercevant le portier, avait dit au bonhomme : « Je vous attends à la préfecture tout à l’heure », puis il avait serré la main du procureur comme quelqu’un qui prend congé. Dixmer avait salué ces messieurs en leur disant : « À ce soir », et il s’était dirigé vers l’escalier en colimaçon qui donne directement du vestibule du procureur sur la cour de la Sainte-Chapelle. Au moment où il posait la main sur la rampe de l’escalier, l’huissier Cyprien était passé brusquement devant lui en disant à Dixmer : « Je ne sais si la porte d’en bas est ouverte : je vais vous l’ouvrir. » Et il disparut dans le trou. Dixmer avait un pied sur la première marche, quand le procureur impérial l’avait retenu un instant pour lui dire quelque chose à l’oreille. Pendant ce temps, l’espace de quelques secondes, le portier de la Roquette passait, lui aussi, devant Dixmer, et descendait l’escalier…
« M. Dixmer venait de descendre à son tour, quand nous entendîmes qu’il criait : il appelait au secours. Je me suis précipité et j’ai aidé comme j’ai pu M. Dixmer à sortir de là un corps qui obstruait l’étroit boyau. Quand nous l’eûmes monté ici, on reconnut le portier de la Roquette ! Respirait-il encore ? Nous ne savions ! Il ne faisait plus aucun mouvement. Le procureur et le préfet de police n’avaient pas eu encore le temps de quitter cette pièce. Personne ne savait plus où donner de la tête, quand M. le procureur a ordonné qu’on transportât le corps dans son cabinet et que l’on allât chercher le médecin du Palais… Et voilà ! Vous en savez autant que nous, monsieur… Maintenant, on dit qu’il est tombé d’une attaque… mais d’une attaque de quoi ?… ajouta l’homme en clignant des yeux… Le plus drôle, c’est que, depuis, on n’a pas revu Cyprien… D’où venait-il, celui-là ?… Personne ici ne le connaissait… »
Pendant que le comte se renseignait ainsi dans le vestibule, le docteur Sartine avait pénétré dans le cabinet du procureur. Il avait trouvé le corps étendu sur le divan de cuir.
Le procureur leva la tête à l’arrivée du docteur.
– Docteur, fit froidement Sinnamari, nous sommes renseignés… C’est une balle qui a tué cet homme…
– Vous êtes sûr que c’est une balle ? s’écria le docteur, en s’avançant vers le corps, dont la poitrine avait été mise à nu. Il n’est pas possible que cette petite blessure… On dirait une piqûre d’épingle…
– Cette blessure, docteur, a été faite avec un pistolet d’enfant, un joujou… et un pistolet qui, paraît-il, fait moins de bruit qu’un pistolet de tir dans une foire… Oui, nous savons maintenant… Du reste, il faudra procéder le plus tôt possible à l’autopsie… mais dans le plus grand mystère. Je compte sur vous, docteur, la justice compte sur vous…
Et il passa dans le cabinet de son substitut, qui était vide. Le préfet et Dixmer le suivaient.
Aussitôt la porte fermée, Dixmer, dont l’agitation grandissait, s’écria sourdement :
– Je vous le dis ! Ils se sont trompés !… C’est moi qui devais mourir !… C’est moi qui devrais être à la place du mort !… Ah ! Vous ne savez pas ce qu’ils sont forts ! Comment ont-ils deviné que je les trahissais ?… Par quel miracle ne suis-je pas mort ?… J’avais le pied sur cet escalier quand ce pauvre homme est venu prendre ma place et se faire tuer à ma place !
– Par qui ?
– Par qui voulez-vous que ce soit, si ce n’est pas ce Cyprien, qui descendait devant nous, qui m’a cru derrière lui, qui s’est retourné et qui a appliqué son joujou sur la poitrine de l’autre ?… Un joujou terrible, car ces hommes n’ont pas les armes de tout le monde !… Cyprien sait que je trahis !… Je suis perdu !… gémit furieusement Dixmer.
Sinnamari interrompit un instant le désespoir de Dixmer.
– Mais enfin, s’écria-t-il, impatienté, en admettant que Cyprien avait été placé comme espion à ma porte par R. C., ce Cyprien serait donc aussi son exécuteur, pour qu’il n’hésite pas une seconde à assassiner un homme qui trahit son maître !…
– Mais tous, monsieur le procureur !… Tous sont ses exécuteurs… Oui, il a comme ça des hommes qui sont prêts à tuer et à se faire tuer pour lui… J’en connais, pour mon compte, trois qui sont prêts à mourir pour lui… et il y en a d’autres… d’autres que l’on ne connaîtra jamais… car au fond je ne sais rien… Ils ne m’ont laissé pénétrer de leur secret que ce qui pouvait leur être utile… Ce chemin par lequel je suis descendu depuis un mois dans les catacombes est perdu pour nous, maintenant qu’ils savent que j’ai trahi !… Ah ! j’étais bien surveillé, allez !… Ils ont une bonne police… Ils se surveillent tous les uns les autres. Ah, prenez garde !… Cet homme peut tout contre vous, et vous ne pouvez rien contre lui, parce qu’il apparaîtra partout et que vous ne le trouverez nulle part !…
– Mais enfin, vous nous avez dit que vous l’aviez vu !… Et moi je l’ai vu !… On peut donc le voir, le toucher, le reconnaître !
– Le reconnaître !… Mais vous lui serrez peut-être la main dix fois par jour, et vous le croyez votre ami, ou l’ami de votre ami… Cet homme a vingt faces, dont ses lieutenants les plus fidèles ne connaissent qu’une, et vous voulez le reconnaître !…
– Et que vous avait-il promis pour que vous fussiez à lui ? demanda le préfet de police.
– De me faire nommer préfet de police ! répondit Dixmer.
Et il ajouta naïvement, dans sa douleur, pendant que le préfet de police le regardait tout interloqué :
– Et il l’aurait fait, monsieur le préfet, je vous le jure !… Il en a fait bien d’autres ! J’étais plus sûr d’être préfet de police avec lui que de devenir chef de la Sûreté avec vous…
– Dixmer, dit rudement Sinnamari, je crois que vous êtes fichu…
– C’est bien mon avis ! obtempéra lamentablement Dixmer.
– Vous êtes fichu… si nous n’atteignons pas ce roi de malheur !… Voyez-vous un moyen ?
– Un moyen de quoi ?
– De devenir chef de la Sûreté !…
Dixmer se tut, et puis il sembla se décider.
– Un moyen de l’atteindre, lui, directement ? dit-il. Maintenant que je suis brûlé, je n’en connais pas… Mais il y a peut-être quelque chose à faire qui le gênerait bien…
– Parlez !
– Ce matin, après l’affaire, reprit l’officier de police, j’ai surpris un bout de conversation entre le Vautour et Patte d’Oie…
– Qu’est-ce que c’est que ça, le Vautour et Patte d’Oie ? demandèrent à la fois le préfet et Sinnamari.
– Ce sont deux de ses principaux lieutenants. Ils s’étonnaient un peu de la formidable besogne de cette nuit… Ils disaient que depuis que l’A. C. S. existait, on n’avait jamais fait une chose approchant de l’évasion de Desjardies…
– Et alors ?
– Et alors, ils pensaient que toute cette affaire pouvait bien n’avoir pas été montée seulement pour les beaux yeux du père…
– Ah ! Ah ! fit Sinnamari, qui commençait à comprendre.
– Le Vautour ajoutait qu’il avait vu quelquefois Mlle Desjardies et qu’elle était bien belle…
– Et qu’est-ce qu’a répondu Patte d’Oie ?
– Il a répondu qu’il voudrait bien être sûr de ça… Alors le Vautour lui a frappé sur l’épaule et lui a dit textuellement : « Eh bien ! ma vieille Patte, moi j’en suis sûr, et la Mouna elle-même me l’a dit : elle a bien vu cette nuit que Mystère était amoureux de la Desjardies, et nous ne sommes que des poires ! »
– Et après ? demanda Sinnamari, très intéressé.
– Oh ! après, je n’ai plus rien entendu, parce que, comme je pouvais être surpris…
– Par qui ?
– Oh ! dans cette maison-là, il faut s’attendre à tout… Par le roi des Catacombes, peut-être… C’était chez un bistrot de la rue Montgallet… on ne sait pas quelle forme peut prendre le roi des Catacombes…
– Vraiment ?…
– Et il arrive toujours quand on s’y attend le moins…
À ce moment, on frappa à la porte, et un huissier annonça que M. le comte de Teramo-Girgenti faisait demander à M. le procureur impérial si celui-ci pouvait le recevoir.
– Le comte de Teramo-Girgenti ! s’écria Sinnamari. C’est le ciel qui nous l’envoie !…
Le préfet et Dixmer firent un mouvement pour se retirer.
– Restez, messieurs ! Je vous en prie… Je vais vous présenter au comte.
Le comte apparut sur le seuil du cabinet.
– Monsieur de Teramo-Girgenti, soyez le bienvenu chez moi, fit Sinnamari, bien que votre arrivée coïncide avec des circonstances particulièrement tragiques…
– En effet, monsieur le procureur impérial, je viens d’apprendre qu’un gardien venait de mourir chez vous d’une attaque d’apoplexie. J’ai vu emporter le corps.
Sinnamari ferma la porte derrière le comte, lui présenta le préfet et Dixmer, le pria de s’asseoir, puis lui demanda des nouvelles de son grand ami don Alvarez de Manovar, président des Cortès d’Espagne.
– Il m’a écrit une longue lettre dans laquelle il m’écrivait tant de merveilles sur vous que j’avais hâte de faire votre connaissance. Mon ami, M. Philibert Wat, le gendre de notre président du conseil, m’a annoncé votre arrivée à Paris. J’en fus d’autant plus joyeux que, je ne vous le cache pas, je suis décidé à vous demander un service, monsieur, un très gros service.
– Je suis vraiment très heureux de pouvoir être utile à un ami de don Alvarez de Manovar, répondit le comte. Le service que vous me demandez, monsieur le procureur impérial, est accordé…
– Peut-être que vous… Voici ce dont il s’agit : nous sommes aux prises, en ce moment (quand je dis « nous », je parle de la justice, de la police française) avec un bandit d’une envergure peu ordinaire, qui nous joue les plus méchants tours du monde… Ainsi, je vais vous confier un secret… L’homme dont vous venez de voir emporter le corps n’est pas mort de mort naturelle… Il vient d’être frappé, ici même, chez moi, par un brigand de sa bande…
– De la bande de qui ? demanda, imperturbable, Teramo-Girgenti.
– De la bande du roi Mystère ! On l’appelle aussi le roi des Catacombes…
– Ah, le roi des Catacombes !… Je connais, fit le comte.
– Justement ! Vous connaissez !… Philibert Wat nous a dit que vous le connaissiez !… Il a même dit, mais en plaisantant, bien entendu, que vous étiez son ami…
– Oh ! interrompit Teramo-Girgenti avec un pâle sourire… Son ami… C’est beaucoup dire…
– J’en étais sûr !…
– Pardon, monsieur le procureur, interrompit Teramo. Mais pourriez-vous me dire pourquoi ce gardien a été frappé par un acolyte de ce monarque ?
– Par erreur, monsieur. Et, puisque vous êtes dans nos secrets, je puis vous dire que le coup était destiné à monsieur…
Et Sinnamari montra Dixmer, qui s’inclina, très pâle…
– Mes félicitations, monsieur, dit le comte, en s’adressant à Dixmer…
Et, retourné vers Sinnamari :
– Mais voilà un pauvre homme qui ne s’attendait pas à mourir !… Voulez-vous faire savoir à sa femme, à ses enfants, s’il en a, enfin à ses parents, que je fais une pension à ses héritiers de dix mille francs. Le capital sera versé ce soir !…
Les trois hommes n’en croyaient pas leurs oreilles.
– Bah ! cela ne fait après tout qu’un capital de trois cent mille francs… et cela ne fera jamais que six millions trois cent mille francs que me coûte le roi des Catacombes…
– Mystère vous doit six millions ?… demanda Sinnamari, très intéressé.
– « Me doit » est une façon de parler… C’est là le chiffre dont j’ai dû payer ma rançon quand j’étais son prisonnier dans les carrières de la campagne romaine… La dernière fois que j’ai revu ce charmant garçon – c’était il y a quelques jours – il me déclara qu’il serait bientôt en mesure de me rembourser mes six millions. Il m’expliqua les rouages amusants d’une société tout à fait étonnante, qu’il appelle l’A. C. S. Si bien, monsieur le procureur, si bien que, non seulement je lui ai dit de garder pour son fonds de commerce les six millions qu’il m’a volés, et qui vont au moins me rapporter, paraît-il, du 20 %, mais que je lui en ai encore remis six autres !…
Et Teramo ajouta : « Voilà comme je suis l’ami du roi des Catacombes. Je ne suis pas son ami du tout ; je suis en affaires avec lui, ce qui n’est pas la même chose. »
Enfin Teramo annonça que s’il lui avait été prouvé que Mystère lui avait menti en lui affirmant qu’il ne faisait plus que des affaires honnêtes, il ne se ferait, lui, Teramo, aucun scrupule de livrer Mystère à la justice, car il n’aimait point qu’on se moquât de lui !
Sur ce, humant avec une distinction suprême un peu de poudre de tabac, il laissa les trois hommes fort intrigués, le préfet affirmant qu’on avait affaire à un faiseur, Sinnamari prétendant que Teramo était un peu fou, Dixmer se demandant, à part lui, s’il ne venait pas de voir, une fois de plus, le roi Mystère…
Au cours de la conversation, le comte avait invité Sinnamari à sa pendaison de crémaillère et le procureur impérial avait accepté avec empressement.
Il était quatre heures de l’après-midi quand Sinnamari quitta le palais. Sa figure ne reflétait plus aucune trace de préoccupation ou d’ennui. Sur le boulevard, il héla un fiacre :
– Cocher, 72 bis avenue d’Iéna, et au trot !
Et, montant dans le fiacre, il murmura, ne pensant plus qu’à sa belle maîtresse :
– Pourvu que Liliane m’ait attendu !…
VIII – LA GRANDE HOSTELLERIE DE LA MAPPEMONDE
Il pouvait être dix heures du matin. C’était un dimanche, quelques jours après les événements que nous venons de raconter. Deux hommes montaient bras dessus bras dessous la pente ardue de la rue des Moulins et se trouvaient non loin de l’endroit où le moulin de la Galette a été construit depuis, rue Lepic.
L’un de ces hommes, que l’on pouvait facilement reconnaître à sa silhouette juvénile et à sa belle barbe blonde en collier, pour notre Robert Pascal, disait à son compagnon, un grand gaillard aux fortes épaules, au torse bombé à l’allemande, à la démarche à la fois nonchalante et orgueilleuse :
– Mon bon Professeur, voici une enveloppe et voici un sifflet…
Le professeur prit l’enveloppe et le sifflet que lui tendait en souriant Robert Pascal et il lui demanda, en courbant sa haute taille et en fronçant un sourcil soucieux :
– Pourriez-vous me dire, mon cher Benvenuto Cellini, quel est ce mystère ?
– Cette enveloppe, fit Robert Pascal, que vous ne déchirerez que demain matin, contient un mot d’ordre. Vous recevrez par la poste une enveloppe pareille tous les jours, car tous les jours il y aura un nouveau mot d’ordre. Sous quelque prétexte que ce soit, dans votre trajet de l’hôtel à l’atelier de Raoul Gosselin, quand vous serez avec Mlle Desjardies, ne vous arrêtez pour parler à quiconque ignorerait ce mot d’ordre. Fût-ce votre meilleur ami, continuez votre chemin.
– Compris ! fit le professeur. Et le sifflet ?
– Si, dans ce trajet, vous vous trouviez aux prises avec une difficulté quelconque, que quelque chose vous semble louche et que vous ayez besoin d’un renfort ou d’un refuge, sifflez !… Renfort et refuge viendront à vous.
– Par la Butte sacrée ! s’exclama le Professeur. Par Montmartre ! Voilà qui est admirable !… Mais je ne peux pas le croire…
– Essayez ! pria Robert Pascal en riant.
– Que je siffle ? fit l’autre, interloqué, en regardant son sifflet. Et si je siffle, renfort et refuge viendront à moi ?
– Sans aucun doute, répliqua Robert Pascal.
– Écoutez ! vous m’avez bien raconté des histoires sur votre roi Mystère, sur votre monarque des catacombes, mais qu’il soit assez puissant pour, au son de ce petit instrument, peupler instantanément cette rue déserte de chevaliers qui seront prêts à se faire tuer pour moi, voilà qui me dépasse !
La langue du Professeur était la plus imagée du monde, et pour les plus petites choses. Il n’avait jamais rien professé du tout que la joie de vivre à Montmartre, parmi les artistes, les bohèmes et les pauvres poètes aux âmes retentissantes. La sienne – d’âme – était un véritable gong que le plus petit souffle ou zéphir, que le plus mince incident faisait résonner bruyamment, magnifiquement.
Le Professeur se promenait dans la vie comme dans un conte de fée. L’enthousiasme latent qui brûlait ses vastes artères rayonnait autour de lui et l’entourait d’une atmosphère d’épopée Montmartoise.
Vers trois heures du matin, quand il sortait du cabaret des Trois-Pintes, et qu’il s’arrêtait un instant sur le seuil des ténèbres, piquées çà et là de la lueur vacillante des réverbères de la Butte sacrée, il fallait l’entendre dire Mons Martyrum, qu’il avait soin de prononcer à la romaine : Mons Martyroum. Et ce brave Professeur était si bon que souvent il se prenait à pleurer en songeant à tout le sang qui avait coulé autrefois dans cet endroit où devait couler un jour tant de bière.
Le Professeur était un ami désintéressé et fidèle. Il habitait depuis que Montmartre le connaissait, autant dire depuis toujours, la Grande Hostellerie de la Mappemonde, où il n’avait jamais payé un terme ni l’un des repas qu’il y prenait tous les jours, le patron s’y étant refusé absolument, à cause de la grande admiration qu’il avait pour son glorieux client.
C’est là qu’il avait connu Robert Pascal, et les allures un peu romantiques du jeune orfèvre l’avaient séduit tout de suite. Tous deux avaient lié une solide amitié d’abord à table d’hôte, où Robert Pascal venait quelquefois prendre ses repas, bien qu’on y fût consciencieusement empoisonné ; ensuite au cabaret des Trois-Pintes, qui était une dépendance de l’hôtel.
De son côté, Robert avait eu l’occasion d’apprécier certaines qualités du Professeur. Ainsi, le Professeur, en dépit d’un bavardage incroyable et tel qu’il eût étonné chez une femme, était l’homme le plus discret du monde. Ainsi, le Professeur, malgré l’apparente familiarité de ses manières, était un véritable sauvage avec les gens qu’il ne comptait point parmi ses amis, et vis-à-vis de ceux-ci, il se montrait toujours plein de tact, ne les provoquant point à des confidences gênantes, et ne leur demandant point, comme on dit encore à Montmartre, la couleur de leurs chaussettes. C’était un homme, bruyant et silencieux, familier et poli ! Le Professeur n’avait point laissé, par exemple, d’apercevoir, comme tout le monde dans l’hôtel, qu’une jolie femme était venue s’installer depuis quelques semaines sur le palier de l’orfèvre. Il avait même rencontré l’orfèvre dans l’escalier, dans le moment qu’il s’entretenait assez vivement avec elle. Et, cependant, pas un instant il ne lui était venu d’interroger son ami sur Mlle Desjardies. Il savait, comme tous les locataires, que la nouvelle venue s’appelait Mlle Derennes, et il se contentait de ce mensonge.
Et lorsque Robert Pascal lui demanda le service d’accompagner tous les jours Mlle Derennes à l’atelier de Raoul Gosselin qui se trouvait rue Cardinet, et où l’artiste faisait le portrait de la jeune fille, il eut encore l’esprit de ne marquer aucun étonnement ni de demander aucune explication. Le Professeur connaissait Raoul Gosselin, et c’est dans son atelier qu’il apprit que Mlle Derennes n’était autre que Mlle Desjardies, la fille du condamné à mort.
Un moment il se dit : « Dans quelle histoire me suis-je fourré ! Par Notre Saint-Père le Pape, ouvre l’œil, Professeur ! » Donc, il l’ouvrit l’œil, mais, le soir, quand son ami Robert lui eut confié les malheurs de Mlle Desjardies et l’innocence de son père, il dut fermer cet œil pour qu’on n’y vît point les larmes dont il était humide. Robert lui avait dit : « Mon vieux Professeur, maintenant que vous connaissez les malheurs de Mlle Derennes, vous allez être dans l’hôtel son chevalier servant. Ceci consistera à l’accompagner une fois par jour chez Raoul Gosselin. Mlle Derennes ne doit point sortir de l’hôtel sans vous, et sa seule promenade sera celle-là. Suivez toujours l’itinéraire que je vous ai tracé. C’est une promenade et, autant que possible, je vous serais reconnaissant de ne point prendre de voiture. »
– Il serait plus simple de suivre les boulevards extérieurs, avait fait observer le Professeur.
– Plus simple, mais plus dangereux.
– Mlle Desjardies court donc des dangers ? avait tout de même osé demander cet excellent homme.
– Elle n’en courra aucun, si vous exécutez le programme.
– Soyez tranquille. Sufficit ! s’était exclamé le Professeur en agitant sa canne comme devant un ennemi imaginaire.
Robert Pascal l’avait remercié : le Professeur lui avait répondu qu’il était capable de se faire « hacher en morceaux » pour un ami qui était un si bel orfèvre. À quoi Robert Pascal avait répondu que le dévouement qu’il lui demandait à la cause de Mlle Desjardies était d’un prix inestimable pour son ami le roi Mystère.
– Le roi Mystère ! souffla le Professeur avec extase, vous êtes un ami du roi Mystère !
Et il était bien près de se moquer un peu du légendaire roi Mystère. Il osa, par bravade, une petite plaisanterie ; mais Robert en parut si cruellement atteint qu’il jura de faire désormais ce que lui demanderait son ami sans s’étonner de rien, et de croire tout ce qu’il lui dirait de son ami Mystère !
Ainsi, plusieurs jours, avait-il conduit Mlle Desjardies chez son peintre, et il n’était arrivé d’incident autre que celui qu’il fallait attendre de la curiosité de la concierge et des locataires.
Enfin, ce jour de dimanche étant venu, comme le Professeur était descendu place Clichy « prendre un petit quelque chose », il avait été rejoint, au moment où il remontait la rue des Moulins, par Robert Pascal qui, après l’avoir chaleureusement remercié de ses bons et loyaux services, l’avait mis en garde plus que jamais contre les aventures de la route.
Le Professeur et Robert Pascal étaient arrivés au coin de la rue des Moulins et de la rue Tholozé. Le Professeur tenait le petit sifflet, le regardait, et ne se décidait point à siffler.
– Mais sifflez donc, tête de mulet, reprit Robert Pascal.
Le Professeur leva les yeux au ciel, attestant les dieux de la folie de son ami.
Et il siffla. Le sifflet rendit un son strident, très particulier, très puissant et très aigu.
Mais comme la rue, qui était déserte avant qu’il ne sifflât, restait encore déserte après qu’il eût sifflé, le Professeur éclata de rire.
– Où donc est le secours ? Où donc est le refuge ? s’écriait-il, joyeux.
Alors, Robert Pascal lui montra sur le seuil de tous les immeubles, à partir de la Grande Hostellerie de la Mappemonde jusqu’au plus loin que le regard pouvait s’étendre, les concierges debout et attentifs.
Le Professeur fut évidemment très étonné d’apercevoir en quelque façon au port d’armes, tant de concierges à la fois, qu’il n’avait pas vus dès l’abord, parce que ceux-ci n’avaient point franchi le seuil de leurs demeures.
– Encore un coup de sifflet, fit Robert Pascal, et toutes ces bonnes gens vont se précipiter vers nous, nous apportant secours et refuge, le secours de leurs bras et le refuge de leurs loges.
– Diable ! s’étonna le Professeur. Voici qui est tout à fait bien trouvé et fort ingénieux !
– Le mérite n’en revient point à mon ami le roi des Catacombes, reprit Robert Pascal, mais à la police russe elle-même, qui a inventé ce moyen de se faire aider dans quelque circonstance qu’elle se trouve et à quelque heure que ce soit. C’est une institution – celle des concierges policiers – au-dessus de tout éloge, car elle permet au pouvoir d’avoir toujours à sa disposition, sans que la tranquillité de la rue en soit troublée, une véritable armée de secours. Mon ami Mystère s’est créé, d’après ce modèle, quelques bataillons de chevaliers du cordon, qui, sur certains points de la capitale qui l’intéressent particulièrement, sont toujours prêts à obéir au coup de sifflet de ses agents et à se jeter sur ses ennemis.
Les concierges, voyant qu’on ne sifflait plus, étaient rentrés dans leurs loges.
– C’est à peine si j’en crois le témoignage de mes yeux, fit le Professeur. Encore une fois, j’avais bien entendu parler du roi des Catacombes, mais par Notre-Dame-de-Lorette, j’avais cru à une blague.
– Je vous le présenterai un jour, cher ami.
Devisant de la sorte, Robert Pascal et le Professeur arrivèrent à la Grande Hostellerie de la Mappemonde.
C’était, sur la rue, un vaste bâtiment sans aucune architecture, aux murs nus et lisses, d’un jaune sale et culotté, regardant au-dehors par de hautes et larges fenêtres que ne reliaient entre elles aucune corniche, aucun agrément de plâtre ou autre.
Un vaste porche, comme on en voit aux anciennes auberges, permettait de pénétrer en voiture dans l’hôtel. Les portes en étaient ouvertes et ce porche était sombre. À droite, une petite porte ouvrait sur la loge du concierge. À gauche, une autre petite porte permettait de descendre par deux marches au grès usé dans la salle du cabaret des Trois-Pintes.
Le cabaret des Trois-Pintes avait également une porte donnant sur la rue. Au-dessus de cette porte particulière au cabaret était suspendue une antique enseigne qui menaçait à chaque instant de choir sur la tête des clients. Mais les clients, qui étaient pour la plupart des artistes, avaient défendu qu’on y touchât. Elle représentait un Alboche, un Bourguignon et un gars normand qui luttaient de jovialité et de boisson, armés chacun d’une pinte, qui de bière, qui de vin, qui de cidre, ce qui signifiait évidemment qu’il y en avait, aux Trois-Pintes, pour tous les goûts.
Quant à l’hostellerie elle-même, elle n’avait point d’enseigne, mais on avait peint en larges lettres noires, sur toute la largeur de son mur sale, à la hauteur du premier étage : « Grande Hostellerie de la Mappemonde », inscription qui, évidemment, en disait plus long que tout, puisqu’elle embrassait l’univers.
Le Professeur et Robert Pascal arrivaient sous le porche quand ils s’entendirent héler par une voix joyeuse ; et ils reconnurent Raoul Gosselin, le peintre, qui se tenait sur la porte de la loge.
– À propos, demanda tout de suite, bas, à son compagnon, le Professeur, est-ce que la mère Héloïse en est, de votre association des concierges ?
– Non, elle n’en est pas, répliqua Robert Pascal.
Et il s’avança vers Gosselin.
– Vous savez qu’il y a une demi-heure que je suis là, fit Gosselin, à vous attendre, mon cher Pascal.
– Eh ! fit le Professeur, n’aviez-vous point pour vous tenir compagnie la mère Héloïse ?
– Elle n’est point là, la sainte femme, répondit Gosselin.
Et le Professeur entra dans la loge.
– Oh ! oh ! fit-il, voilà qui est plus fort que tout… Par les dieux immortels, quel malheur nous menace ?
… Robert Pascal et Gosselin étaient entrés dans la loge derrière le Professeur. Ils la trouvaient comme ils l’avaient toujours connue, pleine à déborder d’objets de piété, de statuettes de la vierge, de saint Joseph et d’enfants Jésus, de chemins de croix et de chapelets pendus en guirlandes au long des murs. Sur le poêle de fonte, un miroton mijotait.
– Étrange ! Étrange ! murmurait le Professeur.
– Mais, quoi ? Que voyez-vous ?
– C’est ce que je ne vois pas qui m’épouvante ! D’abord, je ne vois pas la mère Héloïse, ce qui n’est rien, mais je ne vois pas Salomon, ce qui est bien quelque chose.
– Salomon ! En effet, où est Salomon ? demanda Robert Pascal.
– Où est Salomon ? répéta le peintre… Je ne m’étais pas aperçu de l’absence de Salomon !…
– Rien d’étonnant à cela pour quelqu’un qui n’a pas l’habitude de la maison. Salomon, quoique perroquet, ne parle pas ! fit le Professeur. Son silence ne saurait vous révéler son absence, mais nous autres qui avons coutume de le voir matin et soir sur son perchoir, qui lui demandons notre clef quand la mère Héloïse n’est pas là ; nous autres qui, pour la première fois, voyons la loge sans Salomon, comprenez que les pires pressentiments nous assiègent !
Le Professeur se rejeta sous le porche en criant :
– Où est Salomon ?… Personne n’a vu Salomon ?
À son appel, une demi-douzaine de locataires accoururent et s’émurent ensemble en constatant la disparition de Salomon ! Quelquefois, la mère Héloïse s’absentait, mais Salomon restait toujours pour garder la loge. C’était un concierge modèle que cet oiseau silencieux, connaissant tous les locataires, prêt à répondre d’un coup de bec habile à leur moindre appel, leur tirant le cordon la nuit, leur donnant leur clef le jour. Et, avec cela, d’une discrétion rare chez un concierge, mais unique chez un perroquet. Bref, le roi des pipelets. C’était la sagesse même, et voilà pourquoi les locataires de la Grande Hostellerie de la Mappemonde l’avaient appelé Salomon. Car, de son vrai nom, il s’appelait Jacquot, comme tous les perroquets.
– Salomon ? Où est Salomon ? Avez-vous vu Salomon ?…
Le Professeur prononçait des discours funèbres.
– Pauvre Salomon ! gémissait-il. Est-il vrai que nous t’ayons perdu ? Tu as connu cette vertu que le monde en général et que ces dames en particulier, qui m’entourent, ne connaîtront jamais : la vertu du silence !
Ces dames houspillèrent le malheureux Professeur, prétendant qu’il était plus bavard à lui tout seul qu’elles toutes réunies… Robert Pascal se dégagea tout doucement de la foule et fit signe à Gosselin de le suivre. Or, l’événement amusait le peintre et il dit à l’orfèvre : « Bah ! descendez-moi votre médaillon. Je vous attends ici… C’est trop drôle ! »
L’orfèvre prit le chemin de sa chambre. Dans le même moment, des cris retentirent sous le porche. C’était la mère Héloïse qui rentrait, et elle avait à la main une cage dans laquelle se trouvait Salomon.
Nul ne pouvait se vanter d’avoir vu la mère Héloïse été comme hiver, sans sa platine, sur laquelle elle croisait les mains comme pour la prière ; nul, bien entendu, excepté défunt son mari, qui l’avait connue lorsqu’elle était encore jeune et désirable ; mais puisque le brave homme était défunt, il ne pouvait pas se vanter plus que les vivants. Car cette vieille avait eu un mari, un ancien curé qui avait jeté le froc aux orties, et qui avait enlevé la future concierge de la Mappemonde à son couvent, où elle était sœur tourière. Voilà pour la concierge ; quant au pipelet mâle, je veux dire le perroquet, il ressemblait à la plupart des perroquets et il était d’un vert très ordinaire.
Quand la mère Héloïse fut assise dans sa loge et qu’elle eut replacé Salomon sur son perchoir, elle souffla un peu et consentit à donner des explications. On s’aperçut tout de suite qu’elle était rentrée « l’amour-propre froissé ». Elle ouvrit un journal et, montrant, en première page, un filet écrit en gros caractère, elle déclara : « C’est de là qu’est venu tout le mal ! » Le Professeur lit le filet à haute et vibrante voix : « Toutes les personnes en possession d’un ou de plusieurs perroquets sont priées de passer à l’hôtel du comte de Teramo-Girgenti ; se présenter rue de Ponthieu… Tous les perroquets sont achetés. Les personnes qui auraient un perroquet auquel elles seraient trop attachées pour vouloir s’en défaire, sont également priées de venir rue de Ponthieu. On leur louera leurs perroquets pour une période et pour un prix à débattre. »
Tout le monde comprit que cette annonce avait tenté la vieille Héloïse. Certes, elle eût été incapable de vendre Salomon, mais le louer était une autre affaire.
– Ah ! gémit-elle, je n’aurais pas eu le courage de m’en séparer plus de huit jours !
Oui, oui, cela on le comprenait ; mais, ce qu’on ne comprenait pas, c’était la raison que pouvait avoir un citoyen, fût-il comte de Teramo-Girgenti, à louer tous les perroquets qu’on ne voulait pas vendre.
– Que la Sainte Vierge me pardonne, fit la vieille ; mais vous me direz si je n’ai point raison d’être en colère ! Je vais vous raconter ce qui m’est arrivé. C’est indigne ! Ce matin, ayant lu l’annonce de ce journal et ayant pris ma résolution, je mis Salomon dans sa cage. Il se laissa faire sans rien dire, comme toujours…
La mère Héloïse avait commencé le récit des aventures de Salomon au milieu de l’attention anxieuse de tous ses auditeurs. Aussi n’était-il point étonnant que pas un de ceux-ci ne se fût aperçu de l’arrivée d’un nouveau personnage qui se prit à écouter de toutes ses oreilles, qu’il avait longues et fort décollées. À ce détail, et aussi à certain profil rappelant celui de ce petit mammifère carnassier du genre martre que l’on appelle fouine, profil qui apparaissait encore assez nettement malgré tout l’embroussaillement d’une barbe de sapeur destinée évidemment à déguiser sa véritable personnalité, nos lecteurs reconnaîtront notre vieil ami Dixmer.
IX – LES AVENTURES DE SALOMON
S’étant glissé aussi modestement qu’il avait pu jusqu’au seuil de la loge de la Grande Hostellerie de la Mappemonde, Dixmer écoutait donc le récit de la mère Héloïse.
– J’ai pris l’omnibus place Clichy ; dans l’omnibus Salomon a été le sujet des conversations de tous les voyageurs, et, quand je leur ai eu raconté qu’il m’aidait la nuit à tirer le cordon, on ne me laissa point tranquille jusqu’au moment où je voulus bien me lever pour approcher Salomon du cordon qui sert au conducteur à prévenir le cocher quand l’omnibus doit s’arrêter ou se remettre en route. Donc, Salomon a tiré le cordon à la place du conducteur, et il l’a fait de si bonne grâce, Sainte Vierge, et d’un coup de bec si fort, si net, si autoritaire qu’on ne se lassait pas de l’admirer et qu’on l’a applaudi comme s’il avait été « une personne véritable ». Mais son succès, au lieu de me réjouir, me faisait de la peine, et je n’en éprouvai que plus de chagrin d’avoir à le quitter. Les larmes m’en sont venues aux yeux…
» Des personnes charitables m’ont demandé la cause de mon émotion. Je leur ai dit que j’allais « louer » Salomon pour quelques jours à M. le comte de Teramo-Girgenti, et j’ai montré le journal. L’annonce leur parut si bizarre que trois des voyageurs, dont une femme, ont voulu m’accompagner jusqu’à la rue de Ponthieu. Nous voilà donc tous en cortège autour de Salomon, rue de Ponthieu. Ah ! monseigneur Jésus ! À ce moment-là, le cœur m’a manqué et j’ai failli revenir sans rien plus vouloir savoir. Mais quoi ! L’année n’a pas été bonne, et ça n’est pas pour vous le reprocher, mais les étrennes ont été plutôt maigres. Enfin, je m’ai crié : « Du courage ! » À la porte de l’hôtel, il y avait une vingtaine de personnes qui attendaient avec des cages et des perroquets. On les faisait entrer une à une et elles ressortaient naturellement une à une, mais elles n’avaient plus ni cage, ni perroquet.
» Ça a été mon tour. J’entrai dans une cour sur laquelle s’ouvrait un immense hangar. Un domestique me conduisit dans ce hangar. Ah, mes enfants, quel tintamarre ! Il y avait bien là huit mille perroquets ! peut-être dix mille ! Et ils jacassaient ! Et ils jacassaient ! Toutes les cages étaient alignées par rangées et par étages. Il y avait bien là vingt étages de cages, et entre les rangées et les étages, il y avait des espèces de passerelles et d’échafaudages en planches, qui permettaient aux gens de se promener entre toutes les cages. Il y avait une armée de domestiques. On voyait que les cages étaient tenues proprement et que les oiseaux ne devaient manquer de rien. Mais ce qui m’a étonné le plus de tout, c’est de voir des écrivains, une quantité d’écrivains qui se promenaient entre toutes les cages !
– Des écrivains ? s’écriait-on. Des écrivains chez des perroquets ?…
– Ils allaient y puiser l’inspiration, s’écria le Professeur. L’écrivain, mesdames et messieurs, doit tout au perroquet ! Et il le sait si bien, qu’arrivé au faite des grandeurs, il se déguise en perroquet. Pour peu que vous ayez pénétré, mesdames et messieurs, dans la cage qui est au bout du pont des Arts…
– Et d’abord, mère Héloïse, comment savez-vous que c’étaient des écrivains ?
– Ah ! c’est vous, mon bon monsieur, fit la concierge en se tournant vers un petit homme myope correctement vêtu d’un complet à carreaux et qui portait binocle et qu’on eût pu prendre, lui aussi, pour un écrivain, mais qui, en fait, vendait des olives dans un petit baquet de bois traversé d’une baguette qu’il avait toujours à la main. Vous me demandez comment j’ai su que c’étaient des écrivains. C’est bien simple, je l’ai bien vu, parce qu’ils écrivaient.
– Ils écrivaient ! s’écria encore le Professeur. Ils écrivaient dans un pareil tintamarre. Ils écrivaient au milieu de dix mille perroquets !… Et comment donc écrivaient-ils ?
– Voilà ! expliqua la mère Héloïse, ils se promenaient…
– Comment, ils écrivaient en se promenant ?…
– Oui, ils écrivaient en se promenant au milieu des cages. Ils allaient à petits pas, et, de temps en temps, s’arrêtaient et écrivaient.
– Et sur quoi écrivaient-ils ? demanda un petit homme dont la chevelure opulente déroulait ses anneaux jusque sur ses maigres épaules.
– Ah ! c’est vous, mon bon monsieur Sésostris ! fit encore Héloïse. Eh bien, mais ils écrivaient sur des registres !
– Sur des registres ?
– Sur de gros registres.
– Avec des coins de cuivre ?
– Autant que je m’en souviens, mon doux Jésus, il y avait des coins en cuivre aux gros registres !
– Alors, ma mère, répliqua le Professeur, affectant de donner à dame Héloïse une appellation et un titre dont on avait dû souvent la saluer autrefois quand elle tirait le cordon dans la tour de son couvent, alors, ma mère, ces écrivains n’étaient point des écrivains. On n’a jamais vu des écrivains écrire sur des registres à coins de cuivre. C’étaient des employés comptables.
– Sans doute, fit M. Maïs… Ils comptaient le grain que les autres employés donnaient aux perroquets.
Mais cette discussion secondaire fut interrompue par le chœur des locataires, qui désiraient connaître la suite des aventures de Salomon.
– J’étais « prostrée » devant ce spectacle, reprit dame Héloïse, quand un employé vint me prendre la cage des mains et me conduisit dans un petit tiosque vitré qui se trouvait dans ce hangar. Il y avait là un homme penché sur des écritures. Sans lever le nez, il m’a demandé si j’étais venue pour louer ou vendre mon perroquet. Je lui ai répondu que j’étais venue pour le louer. Il m’a dit : « Combien de jours ? » J’ai répondu : « Huit jours ! » Il m’a dit qu’il ne louait pas à moins d’un mois, qu’il se pourrait du reste qu’on me rendît mon perroquet au bout de huit jours, mais il voulait avoir le droit de le conserver un mois. Je lui ai répondu que ça dépendrait du prix. Il m’a répondu que l’on s’entendrait toujours. Et il m’a demandé mon adresse. Alors, je la lui ai donnée, à cet homme ! Mais il ne l’a pas plutôt connue qu’il a levé sa vilaine face jaune, m’a regardée et a dit : « Ah ! vous êtes la concierge de la Grande Hostellerie de la Mappemonde, rue des Moulins ?… Eh bien ! Vous pouvez vous en retourner avec votre perroquet. Nous n’en voulons pas ! »
Ici dame Héloïse fut prise d’une véritable crise de rage et de malédiction. L’affront que cet homme lui avait fait à elle, et surtout à Salomon, l’avait complètement fait sortir de sa nature dévote. Elle avait expliqué, à cet homme ! avec une colère grandissante, qu’elle croyait bien que l’annonce avait été mise dans le journal exprès pour elle, pour lui faire faire une inutile démarche et lui faire perdre son temps ! Et elle avait exigé qu’on lui payât ses frais d’omnibus, ce à quoi, du reste, l’homme du tiosque vitré avait obtempéré tout de suite.
– Quand je pense, dit-elle, qu’il y avait là peut-être vingt mille perroquets, dont pas un, certainement, ne valait Salomon.
– Attendez, s’écria le Professeur… Attendez, ma mère ! Tout s’explique !
Mais comme il n’expliquait rien, ces dames crurent encore à une plaisanterie, et les murmures prirent des proportions inquiétantes.
– Attendez ! reprit-il. L’inspiration arrive. Par hasard, vous n’auriez point dit à l’homme du tiosque en verre que Salomon ne parlait pas ?
– Je ne le lui ai point dit.
– Il devait le savoir ! Il était certainement renseigné sur ce fait que Salomon ne parle pas ! Son exclamation : « Ah ! c’est vous la concierge de la Mappemonde », nous prouve qu’il le savait. Et comme tous les écrivains n’étaient là, que pour recueillir les propos des perroquets…
Le chœur des locataires applaudit à cette explication :
– Si je ne lui ai point dit que Salomon ne parle pas, c’est que ce n’est pas la vérité ! éclata la mère Héloïse.
– Comment ? Salomon parle donc ?
– Il parle !
– Nous ne l’avons jamais entendu parler, reprit le chœur des locataires.
– Salomon n’a plus parlé depuis la mort de mon pauvre mari.
» Mais avant, continua Héloïse en essuyant une larme, avant, il parlait comme tous les perroquets et même mieux que tous les perroquets. Et il avait la voix de mon mari ! Et il me disait les mots tendres que me disait mon mari au temps de notre jeunesse !… Si bien que mon époux descendu au tombeau et mon perroquet devenu muet de chagrin, c’est comme si j’avais été veuve deux fois !
Comme la mère Héloïse, à ces souvenirs, s’était prise à pleurer pour tout de bon et ne racontait plus rien, le chœur des locataires résolut de respecter sa douleur. Et on commença à faire le vide autour d’elle. Le Professeur s’apprêtait à entraîner Raoul Gosselin au cabaret des Trois-Pintes, quand Robert Pascal s’avança vers eux, un paquet sous le bras.
– Voilà votre affaire, dit-il à Gosselin, seulement laissez-moi demander un bout de ficelle à dame Héloïse, le paquet ne tient pas.
Et il entra dans la loge.
– Ah ! Laissez-le moi regarder encore, demanda Gosselin. C’est un vrai cadeau royal que vous me faites-là !…
– Qu’est-ce que c’est ? interrogea le Professeur.
– Venez, vous allez voir, répliqua Gosselin.
Le Professeur et Gosselin rejoignirent Robert Pascal dans la loge. Gosselin défit le paquet, et un merveilleux médaillon apparut.
– Comment, s’écria le Professeur, comment ? Robert se défait de son médaillon ? Du médaillon de Marguerite de Valois ?
Le Professeur avait à peine achevé cette phrase « du médaillon de Marguerite de Valois » qu’un phénomène inouï se produisit.
Inouï d’abord parce qu’il était naturellement inattendu. Une voix, une voix étrange, lointaine et rauque, une voix d’outre-tombe, sortit du bec entrouvert de Salomon dressé sur son perchoir, une voix qui disait :
« Tu es la Marguerite des Marguerites ! Tu es la perle des Valois ! »
Inouï ensuite, ce phénomène, parce qu’il eut le double effet :
1°De faire s’évanouir la mère Héloïse, après qu’elle eut poussé un cri déchirant ;
2°De faire s’évanouir Robert Pascal qui, lui, n’avait pas poussé de cri du tout.
X – « TU ES LA MARGUERITE DES MARGUERITES ! TU ES LA PERLE DES VALOIS ! »
Je ne sache point qu’il ait jamais existé dans la capitale une Hostellerie comparable à la Grande Hostellerie de la Mappemonde.
Le premier corps de bâtiment, celui qui donnait directement sur la rue des Moulins, était dénommé : « L’Hôpital ». Il figurait sous ce nom sur les livres du père Thiébault, propriétaire et gérant de l’hôtel, qui était aussi le cabaretier des Trois-Pintes et le tenancier de la table d’hôte.
L’hôpital était habité par ces sortes de petites gens, comme disait le père Thiébault, qui font leur ménage eux-mêmes et qui refusent les services des mains mercenaires du garçon de l’hôtel. C’étaient, comme on dit, des ménages en chambre, des « collages » souvent, mais de mœurs irréprochables.
Ces petites gens ne faisaient point de grande dépense dans l’hostellerie, vivaient chez eux, se chamaillaient chez eux, mais payaient régulièrement leur écot à messire Thiébault. Aussi étaient-ils fort méprisés des autres locataires qui formaient la partie la plus importante de la clientèle de cet honnête homme et qui occupaient les deux autres corps de bâtiment. Ils étaient méprisés aussi un peu par le tenancier lui-même.
Le second corps de bâtiment s’appelait « La Littérature » et avait tout le respect de messire Thiébault. La Littérature était en briques, d’une construction plus récente et avait six étages. C’étaient là qu’habitaient les gens épris d’idéal. Le Professeur en occupait la plus belle chambre. Il était entouré de romanciers, poètes, chansonniers, dessinateurs de portraits aux ciseaux, comme son ami Sésostris, ou encore de marchands d’olives comme M. Maïs, tous gens de grand talent.
La Littérature ne payait pas, et il eût été difficile de comprendre l’attitude si conciliante du sieur Thiébault pour cette classe de locataires, s’il ne se fût chargé de vous l’expliquer lui-même en vous montrant avec orgueil la boutonnière de ses clients. Ils ne payaient pas, mais ils étaient tous décorés. Ceux qui ne l’avaient pas été par le gouvernement l’avaient été par eux-mêmes, et ils en avaient agi de la sorte, moins par un sot amour des distinctions que pour ne point déplaire à messire Thiébault, qui n’eût point compris qu’on osât entrer à l’œil dans la Littérature, si l’on n’était pas décoré !
Et cela jetait un lustre ineffable sur sa maison.
Le troisième corps de bâtiment s’appelait le « Conservatoire » et servait uniquement à loger les musiciens.
Il ne faudrait pas croire qu’un partage aussi net des aptitudes et professions s’était fait tout seul. La logique des mœurs, les forces de la nature, les atomes crochus s’en étaient mêlés dans le cours des âges. Au commencement de la Mappemonde, tout était sens dessus dessous et les hommes et les choses vivaient dans un chaos inimaginable.
Artistes, chansonniers, clowns, littérateurs, violonistes se heurtaient sans parvenir à se confondre, et de leurs chocs résultaient des perturbations atmosphériques dont on n’a point perdu le souvenir dans le quartier ; l’air s’emplissait de clameurs ; la mère Héloïse, épouvantée, s’enfuyait sur le trottoir, poursuivie par Salomon ; le sieur Thiébault surgissait sur le seuil des Trois-Pintes, montrant au passage un visage bouleversé par la fureur et une chevelure arrachée par le désespoir.
Mais il faut attribuer surtout le déchaînement des éléments divers de la Mappemonde et finalement leur séparation à ce fait que les atomes musicaux instrumentistes persistaient à se lever à l’heure où les atomes littéraires persistaient à se coucher – en admettant tout d’abord que les atomes se lèvent et se couchent, ce qui était d’ailleurs le cas de nos atomes à nous, puisqu’ils étaient surtout venus habiter l’hôtel de la Mappemonde pour cette importante opération. Les cloisons qui séparaient ces divers éléments étaient minces et tout à fait dans l’impossibilité de permettre à un piano ou à un violon, ou à une contrebasse, ou à une flûte, ou à un piston de saluer l’aurore sans être entendus d’un drame romantique, ou d’une tragédie en cinq actes qui, dans le même moment, lui avait dit au revoir (à l’aurore). Et il n’y a rien de terrible comme une tragédie en cinq actes qui a veillé toute la nuit sur une table de café, qui a dit au revoir à l’aurore et qui est obligée de contempler à nouveau la lumière du jour, tout simplement parce que le trémolo, son voisin, n’a plus sommeil. La musique qui, partout ailleurs, adoucit, paraît-il, les mœurs, les irrita d’une si singulière façon à l’Hostellerie de la Mappemonde que sire Thiébault déclara un jour que tous ceux qui avaient un instrument de musique, quel qu’il fût, iraient s’établir dans le corps de bâtiment du fond. Le Conservatoire était fondé.
Il ne faudrait point croire que tout fut désormais pour le mieux dans la meilleure des « Mappemondes ». Les gammes purent vivre en paix tout au fond de la seconde cour ; mais la Littérature, qui n’est jamais contente, eut souvent encore l’occasion de se plaindre. Isolée entre deux vastes cours, elle eût pu croire qu’elle allait enfin goûter un repos bien gagné ; mais, la rapacité de messire Thiébault pour tout ce qui n’était point littéraire la fit sortir plus d’une fois encore de son lit…
C’est ainsi qu’une espèce de sortilège poussait toutes les fanfares en voyage à l’Hostellerie de la Mappemonde, où après avoir soupé, elles se couchaient fort honnêtement. Le malheur était que le lendemain matin, avant de partir pour une exposition ou pour un concours, elles répétaient dans l’une des cours ! Et comme la Littérature habitait entre les deux !… Vous m’avez compris…
L’été, dès quatre heures du matin, on a vu, on a entendu, dans la cour, des deux cents musiciens, venus du lointain pays des Allobroges, ou descendus des Flandres, ou remontés des Aquitaines pour réveiller le Professeur au son de leurs cuivres inharmoniques !…
La fureur du Professeur contre les musiciens de passage était naturellement partagée par la Littérature tout entière. Celle-ci ne se gênait point pour dire à messire Thiébault : « Messire, si vous étiez un peu moins cupide et si vous aviez un peu plus souci de notre repos, vous refuseriez d’hospitaliser ces bandes cosmopolites ! » À quoi messire Thiébault répondait avec un semblant de bon sens : « Si je n’hospitalise pas des gens qui me payent, je serai obligé de mettre à la porte ceux qui ne me payent pas. » À quoi le Professeur répliquait : « Tout ça, c’est des raisons d’Harpagon ! Si vous étiez un type chic, on se ruinerait ensemble ! »
Mais le père Thiébault ne voulait pas se ruiner, et, comme la Littérature lui coûtait de plus en plus cher, il avait résolu d’ouvrir les portes de sa maison à tout ce qui paierait !
Quand je dis à tout ce qui paierait, c’est comme si je disais bêtes ou gens. Par exemple, il prit pour locataires des phoques qui payaient bien. C’étaient des phoques qui n’avaient point trouvé à se loger à la foire. Il les installa dans la grotte de la cour ! Je dis : il les installa, car, en vérité, il ne les enferma point. Du reste, la grotte n’avait point de porte.
C’était une petite grotte de rien du tout en carton-pâte qui ornait le centre de la seconde cour. Autour de la grotte, il y avait une petite pièce d’eau sans eau et autour de la pièce d’eau une pelouse sans gazon. Sur la pelouse, il y avait quatre manches à balai simulant des arbres, et ainsi s’expliquait le prospectus qu’envoyait le père Thiébault dans les provinces les plus lointaines pour séduire les parents dont la progéniture mûrissait pour la capitale. Ce prospectus s’exprimait ainsi : « Grande Hostellerie de la Mappemonde, recommandée aux jeunes gens de bonne famille. Patron charmant, clientèle choisie, frais ombrages ! »
Quand les phoques surent qu’ils étaient si bien reçus chez le père Thiébault, ils y vinrent d’une façon assez régulière. Un ménage de phoques partait, un autre arrivait. On les voyait se promener tranquillement autour de la grotte ou prendre le frais sur le seuil de leur demeure.
Donc, les phoques ne gênaient personne dans la journée, c’est-à-dire à partir de quatre heures de l’après-midi, qui est, comme on le sait, le commencement de la journée pour la Littérature de Montmartre. Mais le matin ils faisaient autant de bruit que s’ils avaient été locataires du Conservatoire. Et, comme leurs cris gutturaux leur avaient attiré quelques brocs d’eau vengeurs jetés à la volée du haut des fenêtres et que les phoques n’aiment rien tant que l’eau, surtout quand ils en sont privés, ils s’imaginèrent qu’on les récompensait de leurs chants et se mirent à braire davantage. Ainsi en va-t-il des petits musiciens des rues, auxquels on donne deux sous pour qu’ils s’en aillent et qui ne veulent plus partir.
On commençait à s’habituer aux phoques, car il faut bien s’habituer à tout, quand, pendant la foire, un renne vint habiter chez le père Thiébault. Ce fut le comble. Car il fit à lui tout seul avec ses pattes plus de bruit que les phoques avec leurs gueules. Jusqu’à l’heure de sa représentation, on l’enfermait dans une cave, dans laquelle on l’avait fait descendre par un vaste soupirail donnant sur la même cour.
Quand le renne était là-dedans, on fermait la porte, mais alors il ne cessait de taper sur cette porte avec une telle rage de toutes ses pattes, que messire Thiébault ne cessait de demander : « Mais qu’est-ce qu’il a ? Qu’est-ce qu’il a, le renne ? » À quoi le Professeur condescendait à répondre : « Vous voyez bien qu’il regrette la Laponie. » Et il ajoutait : « Et croyez bien, mon cher monsieur Thiébault, que si je pouvais la lui donner !… »
Ce renne s’était montré si insupportable pour la Littérature que celle-ci avait juré de se venger, et elle aurait mis son projet à exécution si, quarante-huit heures avant les événements qui nous occupent, le renne n’avait quitté la « Mappemonde » pour l’Amérique. Seulement, comme leur vengeance était prête, les littérateurs décidèrent qu’elle servirait à quelque chose, et, le matin même de ce jour immuable où nous avons fait connaissance avec dame Héloïse, l’un des deux phoques qui tenaient encore domicile dans la grotte, et qui avait pris l’habitude de se promener dans les corridors, frappant de son museau aux portes, avec l’audace d’un facteur matinal qui ne craint point de réveiller les locataires parce qu’il leur apporte une lettre chargée, l’un des deux phoques avait disparu. Personne n’avait encore eu le temps de s’en apercevoir. Seule, la Littérature « savait ».
Et, maintenant que le lecteur connaît un peu les êtres de la Grande Hostellerie de la Mappemonde, il ne s’étonnera plus que, obligés de subir tant d’animaux bruyants, les locataires eussent, dans le chapitre précédent, montré tant d’intérêt pour un perroquet qui ne parlait pas.
Or, voici que Salomon s’était mis à parler… Et avec quel résultat ! Il lui avait suffi, pour déterminer un double évanouissement, de prononcer une phrase bien banale en apparence, mais qui devait sans doute être redoutable au fond : « Tu es la Marguerite des Marguerites ! Tu es la perle des Valois ! »
Robert Pascal rouvrit les yeux. Il reprit sur-le-champ possession de lui-même et, sur un ton inattendu de commandement, il pria le Professeur et Raoul Gosselin de le laisser seul avec la mère Héloïse évanouie.
– Mon devoir de médecin… commença le Professeur.
– Est d’aller boire à ma santé et de ne rien dire à personne de cet incident, fit Robert Pascal, et il les mit tous deux littéralement à la porte, et referma celle-ci à clef.
Puis, comme il avait tiré de sa poche un étui dans lequel se trouvait un flacon qu’il allait faire respirer à la concierge toujours immobile, il s’aperçut qu’une figure à profil de fouine regardait par les carreaux… Il fit glisser immédiatement le rideau de serge sur sa tringle de cuivre.
– Où donc ai-je vu ce museau-là ? se demanda le jeune homme, et il s’agenouilla auprès du corps de dame Héloïse, cependant qu’il soupirait :
– Enfin, mon Dieu ! Je vais donc savoir !
Le dictame que contenait le flacon de Robert Pascal devait être bien puissant, car son efficacité ne se fit point attendre une minute. À son tour, dame Héloïse ouvrit les yeux ; elle parut fort étonnée de se trouver sur le carreau de sa loge, en compagnie de ce jeune homme à genoux qui lui prodiguait ses soins. Mais elle reconnut l’un de ses meilleurs locataires, lui sourit et lui demanda d’une voix éteinte ce qui lui était arrivé.
– Mme Héloïse, c’est à cause du perroquet.
– Du perroquet ? répéta la concierge en se passant la main sur le front comme si elle faisait un violent effort de mémoire.
– Oui, de Salomon, Salomon a parlé.
– Salomon a parlé ! Oui ! Je me souviens maintenant !…
– Et cela vous a produit un tel effet…
– Dame, mon bon monsieur Pascal, songez donc que je ne l’avais pas entendu depuis des années !… J’ai cru entendre sortir de la tombe la voix de mon pauvre mari ! Salomon l’imitait si bien ! J’aimais beaucoup Prévost…
– Qui était-ce Prévost ?
– C’était mon mari ! Vous êtes trop jeune, monsieur Pascal, vous n’avez pas connu l’histoire de l’abbé Prévost… Ah ! le monde entier en a parlé dans les journaux ! Le meilleur homme de la terre, seulement il n’était pas plus fait pour être abbé que moi sans doute religieuse. Un beau jour, il m’a enlevée parce qu’il m’aimait. Nous avons disparu. On nous a cherchés. Quand on nous a retrouvés, j’étais enceinte, mon pauvre monsieur Pascal. Alors, l’abbé Prévost, qui était un honnête homme, m’a épousée. Malheureusement, notre enfant est mort en naissant. C’est alors que nous avons adopté Jacquot, que ces messieurs ont appelé depuis Salomon. Salomon était aussi attentionné pour moi qu’un fils, et aussi tendre qu’un mari. Il me donnait les mots les plus doux, et comme je m’appelle de mon vrai nom Marguerite…
Mais ici, elle fut encore interrompue par le perroquet : Tu es la Marguerite des Marguerites ! Tu es la perle des Valois !
Dame Héloïse se leva toute droite à cette manifestation nouvelle de la voix d’autrefois. Salomon, debout sur son perchoir, la crête haute, une patte en l’air, l’œil humide, semblait un amant qui ose tout à coup la plus audacieuse des déclarations.
– Ah, tais-toi maintenant ! Tu me fais trop de peine ! gémit dame Héloïse en retombant sur son siège.
Quant à Robert Pascal, la répétition de la phrase fatale ne semblait point, cette fois, l’avoir bouleversé outre mesure. Son esprit était tendu vers un unique objet, et évidemment il avait hâte d’y atteindre.
– Madame, dit-il en donnant à sa voix l’intonation la plus séduisante, quand vous vous êtes mariés, M. Prévost et vous, quel métier avez-vous donc fait pour vivre ?
– Moi monsieur, j’ai toujours travaillé. Au couvent, je faisais de la dentelle : j’ai continué à en faire dans ma nouvelle position. Quant à Prévost, il faisait les devoirs des élèves du collège Louis-le-Grand. Il traduisait leurs versions, leur faisait des vers latins, pour quelques sous, mais à la fin du mois ça faisait encore une jolie somme, car le bruit s’était répandu dans tous les établissements d’éducation qu’il y avait à Montmartre un ancien curé qui faisait les versions latines pour cinq sous et les discours français pour dix sous, et les vers latins à un sou pièce ; nous avons été bientôt débordés de commandes.
– À Montmartre ! répéta sourdement Robert Pascal. Vous habitiez donc déjà Montmartre à cette époque ?
– Oh ! nous sommes venus nous y installer tout de suite et nous n’avons jamais voulu le quitter : nous y sommes venus d’abord parce que, dans notre situation, nous nous disions qu’il n’y aurait qu’à Montmartre qu’on pourrait nous comprendre. Montmartre, monsieur Pascal, a toujours eu des idées libérales.
– Et à quel endroit habitiez-vous, à Montmartre ?…
– Mais tout à côté, monsieur Pascal !… Comme vous voilà défait, grand Dieu !… Tout à côté, derrière la butte… La maison que nous habitions existe toujours. On n’y a pas touché !…
– Dieu soit loué ! soupira Pascal avec une exaltation grandissante. Et la rue ? Est-ce qu’on a touché à la rue ? Quelle rue habitiez-vous ?…
– La rue des Saules, monsieur Pascal, oui, nous habitions dans la rue des Saules une petite maisonnette dont on a fait une auberge depuis, une auberge : l’auberge du Bagne !
– Ah mon Dieu ! s’écria Robert Pascal… L’auberge du Bagne !… Et moi qui ne m’en étais pas douté !… Ah ! Macallan !… Prends garde, car la patience de Mystère a des bornes !…
Et le jeune homme fut soudain pris d’une telle fièvre qu’il dut se lever et marcher à grands pas dans la petite pièce.
– Vous allez tout me dire ! souffla-t-il.
– Tout quoi ? demanda Héloïse.
– Tout ce qui vous est arrivé pendant que vous habitiez dans cette maison.
– Mais il ne nous est rien arrivé du tout. Quoi qu’on en dise, le quartier est fort tranquille. Il ne vaut pas sa méchante réputation et ce n’est pas une raison parce qu’on a appelé cette auberge l’auberge du Bagne, pour croire qu’on assassinait toutes les nuits à notre porte.
– Vous avez une bonne mémoire, madame Prévost ? demanda si sévèrement le jeune homme, que la bonne femme en fut tout de suite un peu inquiète.
– Ma foi oui, monsieur Pascal, pour vous servir.
– Rappelez-vous l’année…
Et le jeune homme se pencha à l’oreille de la vieille ; celle-ci tressaillit.
– Ah ! fit-elle en le fixant singulièrement. En effet je me rappelle cette année-là, et elle ajouta entre ses dents : ça n’a pas été une bonne année.
– Pourquoi ?
– Pour rien !
– Vous souvenez-vous, demanda le jeune homme, de ce qui arriva rue des Saules, au printemps de cette année-là ?
– Au printemps ?
La mère Héloïse baissait de plus en plus la voix et regardait son locataire avec une anxiété nouvelle mêlée d’un certain effroi.
– Je ne sais pas ce que vous voulez dire.
– Je veux vous rafraîchir la mémoire, madame Prévost, répliqua Robert Pascal en se rapprochant encore de la concierge. Il ne passe pas beaucoup de monde rue des Saules, à trois heures du matin, et, quand on est à sa fenêtre, avec son époux, en train de respirer la nuit parfumée des premiers effluves du printemps…
– Oh ! monsieur Pascal, il y a si longtemps… je ne sais plus… je vous jure que je ne sais plus… je suis une vieille femme…
– … qu’il fait clair de lune… qu’une voiture… qu’une voiture, continua le jeune homme sans essayer de calmer l’agitation croissante de dame Héloïse… qu’une voiture monte la rue des Saules… car elle montait, elle venait donc de derrière la butte… une voiture, rue des Saules, une rue qui ne voit jamais de voiture, dame Héloïse !… Quand on est à sa fenêtre à trois heures du matin et qu’on voit venir cette voiture sous le clair de lune, on s’en souvient toute la vie !…
– Toute la vie ! murmura la vieille en secouant la tête.
– Et savez-vous pourquoi on s’en souvient toute la vie ?… On s’en souvient parce qu’on a vu cette voiture s’arrêter devant la porte d’un jardin, une femme en descendre aux bras de deux hommes, une femme si étrangement encapuchonnée qu’on eût pu croire qu’elle était bâillonnée, et s’appuyant sur ses cavaliers servants, de telle sorte qu’on eût pu penser que ceux-ci la portaient, une femme dont l’allure, l’attitude, le silence entre ces deux hommes vous a si profondément impressionnée que vous avez dit tout haut à votre mari : « Oh ! regarde donc, mon ami ! On dirait que cette femme se débat ! » Et vous rappelez-vous ce que votre mari vous a répondu, madame Prévost ?
– Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! pleurait madame Héloïse, en regardant du côté de sa porte avec épouvante.
– Il a répondu : « Mais non, Marguerite ! Tu vois bien qu’elle s’amuse ! » Il est probable que ces propos gênaient ces messieurs dans leurs petites opérations, car ils bousculaient fort leur compagne pour qu’elle entrât plus vite dans le jardin. Quand elle y fut, ils refermèrent la porte, mais pas avant que vous n’ayez encore prononcé une phrase mémorable, dame Héloïse. Voulez-vous vous rappeler la phrase mémorable ? Non ! Eh bien ! je serai votre aide-mémoire. Vous avez dit : « Regarde le cocher ! On dirait le Gros ! » Là-dessus la voiture s’en est allée. On était dans la nuit du 6 au 7 mai.
Le jeune homme, ayant dit cela, s’essuya le front qu’il avait en sueur.
– Si vous êtes si bien renseigné, monsieur Pascal, fit la vieille en tremblant, alors, ne me demandez plus rien !… D’autant plus que je ne pourrais plus rien vous dire, moi !… Je n’en sais pas davantage.
– Si, vous en savez davantage ! fit Robert Pascal impitoyable. Oui, vous savez encore entre autres choses… que cette femme, entrevue, à trois heures du matin, rue des Saules, au moment où elle entrait dans le mystérieux jardin… cette femme, vous ne l’avez jamais revue… Il n’y avait qu’une porte à cette propriété, une seule, la porte qui donnait sur la rue des Saules. Elle s’est ouverte pour laisser entrer cette femme, elle ne s’est jamais rouverte pour la laisser sortir… N’est-ce pas que vous ne l’avez plus revue ?
– Jamais ! laissa passer dans un souffle la pauvre dame Héloïse.
– Et cependant, n’est-ce pas que vous surveilliez cette porte et que la dame de la rue des Saules a hanté vos nuits, madame Prévost ?… Comment en aurait-il été autrement quand on a entendu… ces gémissements funèbres qui ont rempli le jardin un jour d’été, et qui ont duré exactement de midi à midi et demie. Après quoi, tout s’est tu.
Cependant, vous vous étiez précipitée contre la petite porte et vous aviez crié :
» Qui appelle comme ça ?
» Mais vous avez été rejointe immédiatement par votre mari, qui vous a dit, très en colère : « Ne t’occupe donc pas de ces histoires-là ! » Et vous avez dû le suivre, car vous étiez une femme obéissante, madame Prévost !
La dame Héloïse, croyant sans doute avoir affaire au diable, prit un chapelet et commença à murmurer de tremblantes prières.
– On ne venait jamais dans ce jardin que la nuit, reprit l’orfèvre. Pas une fois vous n’avez vu la petite porte s’ouvrir dans le milieu du jour. Une nuit, vous avez encore vu venir, à pied cette fois, une femme accompagnée d’un homme. La femme que vous aviez aperçue la première fois était grande ; celle-ci était petite. Et vous avez dû certainement remarquer que l’homme qui accompagnait cette petite femme ressemblait à s’y méprendre à ce cocher de qui vous aviez dit : « On dirait le Gros. » La petite femme paraissait marcher librement, mais elle avait un bandeau sur les yeux.
» Sans doute, continua Robert Pascal, cette nuit-là, pendant que s’avançait dans la petite rue des Saules ce couple étrange, aviez-vous résolu, plus prudente, de passer inaperçue et regardiez-vous ce qui se passait cachée derrière vos rideaux, car vous n’avez fait aucune réflexion à voix haute.
– Aucune ! Aucune !… Mon Dieu !
– Le malheur est que, tout à coup, dans la nuit, une voix retentit qui disait : « Tu es la Marguerite des Marguerites ! Tu es la perle des Valois ! » Et immédiatement vous avez fait taire cette voix en disant : « Chut ! Jacquot ! »
– Monsieur Pascal, je n’ai jamais, jamais parlé de ces choses à personne et je me ferais plutôt arracher la langue…
Pascal continua :
– Si vous n’avez plus revu la première femme, vous avez revu deux fois la seconde… Et toujours la seconde femme avait son bandeau sur les yeux, soit en entrant soit en sortant. Elle ne restait jamais dans le jardin plus d’une demi-heure, trois quarts d’heure… Seulement, ce n’était plus « le Gros » qui l’accompagnait. La seconde fois, c’était un bel homme, de taille bien prise, carré des épaules, et la troisième c’était un homme mince, aux allures militaires, qui marchait les jambes légèrement arquées, comme un homme de cheval. Remettez-vous, dame Héloïse ; tenez, respirez un peu ce flacon.
La concierge ne se fit point prier. Elle avait besoin de forces. Quand elle fut à nouveau remise, elle fit un grand signe de croix, essaya de se lever comme pour mettre fin à l’entretien.
– Monsieur Pascal, je ne vous laisserai point aller plus loin. Qu’il soit venu une, deux, trois ou vingt dames dans ce jardin, comme me disait mon pauvre Prévost : « Tout ça, c’est des histoires qui ne nous regardent pas » Et permettez-moi de vous le dire, monsieur Pascal, je ne vois point en quoi elles peuvent vous intéresser. La mort a passé par dessus tout cela.
Pascal regarda dame Héloïse. Elle avait peine à se soutenir, et il crut qu’elle allait s’évanouir encore.
– Vous voulez dire, sans doute, que puisque la dame de la rue des Saules n’a pas reparu…
– Je ne m’occupe point, dit-elle, de cette morte-là !
– Ah ! Vous avez donc pensé qu’elle était morte ?… Mais quelle autre mort donc vous occupe ? interrogea le jeune homme haletant.
– Monsieur Pascal ! Les femmes parlent toujours trop… J’ai été un peu bavarde autrefois… à ce moment-là.
– Puisque vous ne saviez rien, comment avez-vous pu bavarder ?
– Eh ! J’ai voulu savoir !… Vous me disiez tout à l’heure que jamais nous n’avions vu la porte du jardin s’ouvrir pendant le jour… Eh bien ! si, c’est arrivé une fois, pour notre malheur… la dernière fois, du reste, que j’aie vu s’ouvrir cette porte maudite. Vous avez bien fermé la loge, monsieur Pascal ? Après tout, je ne vois pas pourquoi je ne vous dirais pas ce que j’ai sur le cœur depuis tant d’années, à vous qui savez tout ! Qu’est-ce que je risque ? Il ne peut rien arriver de pire que ce qui est arrivé…
Et voilà que dame Héloïse, qui avait commencé à ne vouloir rien dire, semblait tout à coup prête à trop parler…
– Dans le jardin, il venait, dit-elle, un quatrième homme… celui que nous appelons le jardinier… mais je crois bien que ce devait être un domestique chargé de nettoyer la petite maison qui se trouvait au fond du jardin et dont nous n’apercevions, quand nous étions à « notre premier », que le toit pointu. Il venait, comme les autres, la nuit et s’en retournait avant le jour. Il portait toujours aux bras des paquets. Nous pensions que c’étaient des provisions. Or, la dernière nuit que nous l’avons vu venir rue des Saules, il traînait derrière lui une petite charrette à bras qui paraissait très lourde et qu’il eut grand-peine à faire entrer dans le jardin. Nous nous demandions ce qui se passait encore cette nuit-là, car depuis plusieurs nuits, malgré l’éloignement du pavillon, nous entendions des cris, des rires… Et puis, la nuit précédente nous avions entendu un tel cri d’horreur que nous avions pensé qu’on assassinait quelqu’un. C’est cette nuit-là que la petite femme est venue pour la dernière fois. Elle était arrivée une heure avant le cri et je pensais, et Prévost pensait que la petite femme avait été tuée. Mais il n’en était rien, car nous l’avons vue repartir avant le jour, le bandeau sur les yeux et toujours accompagnée de « l’officier ».
– Vous l’appeliez « l’officier ? »
– C’est Prévost qui l’appelait comme ça, comme il appelait l’autre, le grand aux épaules carrées, « le substitut ». Oui, à ce qu’il paraît qu’il avait l’air d’un magistrat… C’est même pour cela que Prévost disait : « Un officier, un magistrat, un gros qu’on ne sait pas ce que c’est ! Ne nous mêlons pas de leurs affaires ! » Et il ajoutait en frissonnant : « Ils sont peut-être du gouvernement ! » Aussi, je vous prie de croire que nous faisions les morts ! Mais pas assez !…
– Revenons au jardinier, fit brusquement Pascal.
– Eh bien ! Le jardinier, dans la nuit qui a suivi le cri d’horreur, fit donc entrer dans le jardin sa charrette à bras, qui paraissait chargée très lourdement. Prévost et moi nous veillions, et nous avons été tout étonnés de ne pas le voir ressortir avec cette charrette. La porte ne s’est rouverte que le lendemain, à huit heures. C’était la première fois que nous la voyions s’ouvrir le jour. On l’a poussée d’abord tout doucement. Nous autres, nous étions cachés derrière nos rideaux. La tête du jardinier s’est montrée : il regarda en haut et en bas de la rue et puis, en face, chez nous, et, comme il ne voyait personne, il fit un signe derrière lui. Alors il sortit avec celui que Prévost appelait le substitut…
– Après ! après ! supplia l’ouvrier orfèvre d’une voix altérée… Vous êtes sûre que celui que vous appeliez le substitut est resté dans la maison toute cette nuit-là ?
– Il ne l’avait pas quittée depuis la veille… puisqu’il se montra sur le seuil du jardin, en chair et en os, avec le jardinier. L’apparition n’a pas duré longtemps. Le substitut a descendu la rue et le jardinier l’a remontée… Ils se cachaient la figure autant qu’ils pouvaient, et ils avaient raison, car ils n’étaient pas beaux à voir ! Ils étaient faits comme des voleurs ! Ils avaient de la boue partout, oui, partout… sur les chaussures, sur les vêtements, sur les joues, dans les cheveux ! Oui, de la boue partout… et il n’avait pas plu depuis au moins huit jours, comme me l’a fait remarquer ce pauvre Prévost, qui prétendait encore qu’ils avaient des figures d’enterrement ! Je veux dire des figures qui reviennent d’enterrer quelqu’un !
– Et la charrette, qu’est-elle devenue dans tout ceci ?…
– La charrette, nous ne l’avons plus jamais revue…
– Vous n’avez plus jamais revu rien ni personne ?…
– Ni rien, ni personne, conclut la mère Héloïse. À peu de là, mon pauvre Prévost est mort, emporté du poumon. J’ai quitté la maison de la rue des Saules pour la Mappemonde… De tout cela, je n’ai jamais rien dit à personne. Aujourd’hui encore, de vous en avoir parlé, j’ai peur du jardinier… Oh, mais j’oubliais ; le jardinier, je l’ai pourtant revu. Une seule fois et par hasard : le jour d’une fête, à Enghien où j’étais allée chez un ami de mon pauvre Prévost. Cet ami m’a dit que l’homme était domestique depuis toujours dans une grande famille de la ville. Je l’ai revu, oui, mais lui ne m’a pas vue. Mais d’en reparler, aujourd’hui encore, j’ai peur…
– Le nom du jardinier ?
Héloïse considéra Robert Pascal avec épouvante et secoua la tête :
– Non ! non ! ça, jamais !
– Et celui de son maître ?
– Je l’ai oublié ! J’ai tout oublié !
Le jeune homme conserva un instant le silence, et puis :
– Après tout, vous avez raison ! dit-il. Le silence est d’or !
Et, ouvrant un portefeuille, il en tira un billet de mille francs qu’il remit à la mère Héloïse, de plus en plus stupéfaite, et il ajouta :
– Je ne vous ai rien demandé et vous ne m’avez rien dit.
– Oh ! monsieur, fit-elle, je me tairai bien sans tout cet argent-là !…
– Ce n’est pas à vous que je donne les mille francs, dit Robert Pascal. C’est à Salomon. C’est un bon perroquet, il partagera avec la Marguerite des Marguerites, avec la perle des Valois !
Et le jeune homme, quittant la mère Héloïse, s’éloignait déjà, il revint près de dame Héloïse.
– Encore un mot, fit-il. Confidence pour confidence. Vous savez, ce jardinier dont vous n’avez pas voulu me dire le nom ? Eh bien, il est mort !
– Vous en êtes sûr ? interrogea la vieille.
À ce moment même, on frappa à la porte de la loge. Robert Pascal lui-même ouvrit. Une pauvre femme entra, tenant dans ses bras et traînant derrière elle, accroché à ses jupes, deux enfants en bas âge, pâles et chétifs. Cette femme avait dû être jolie, mais les souffrances et les privations l’avaient certainement vieillie prématurément. Elle s’avança jusqu’à la table qui était au milieu de la loge et y déposa quelques pièces d’argent.
– Voilà l’argent de votre terme, madame Héloïse, dit-elle ; si vous voulez me donner le reçu…
La concierge parut surprise, mais ne dit rien. Elle ramassa l’argent et donna le reçu. Et, comme elle manifestait l’intention de donner une barre de chocolat aux petits, la mère s’y opposa.
– Ils n’ont besoin de rien, dit-elle.
Et elle sortit avec les enfants.
– C’est fier, dit la mère Héloïse. Et cependant, hier, ça n’avait pas encore de quoi payer son terme du huit, et aujourd’hui j’allais être forcée de les mettre à la porte. C’était l’ordre de M. Thiébault. Le patron est terrible pour « l’Hôpital » ! Quand je pense que, aux dernières étrennes, je n’ai pas reçu un sou, vous entendez, pas un sou de la Littérature !… Mais vous disiez donc, mon bon monsieur Pascal, que le jardinier est mort ? Et que vous en étiez sûr ?…
– Si sûr, répliqua très calme l’orfèvre, si sûr, que vous venez de voir sa veuve !
– Mme Didier ! s’écria la concierge.
– Chut ! ordonna Robert Pascal.
Et il sortit.
XI – LA PETITE MAISON DE LA RUE DES SAULES
Il était environ deux heures du matin ; le froid était vif, mais la nuit claire.
La Vieille-Rue-des-Moulins était à peu près déserte. La porte de la grande Hostellerie de la Mappemonde était close. Rares étaient les locataires qui venaient, à cette heure, troubler le sommeil du pipelet Salomon, et lui demander le cordon. Les trois quarts des noctambules de la Mappemonde rentraient chez eux en passant par le cabaret des Trois-Pintes qui, comme nous l’avons déjà dit, communiquait directement avec l’auberge.
Soudain, la grande porte de l’hostellerie s’ouvrit et une ombre se glissa sur le trottoir après avoir repoussé le battant. Elle passa devant les vitres allumées du cabaret, et, à cette lueur projetée, on eût pu reconnaître notre ami Robert Pascal. Cette ombre, qui descendait vers Paris, n’était pas arrivée au tournant de la rue des Moulins, qu’une autre ombre qui venait de sortir, celle-là, des Trois-Pintes, descendit derrière la première, faisant doucement le même chemin.
Robert Pascal se retourna, vit l’ombre, et continua sa marche.
– Je l’espérais bien, pensa-t-il, je suis suivi ! Je vais donc savoir quelle est cette vilaine figure-là ! J’ai bien fait de ne pas prendre par les derrières de l’hôtel.
Arrivé au coin de la rue de l’Abbaye, il hâta son pas. L’ombre, derrière lui, eut une plus vive allure.
Mais quand Robert Pascal, ayant suivi la rue de l’Abbaye absolument déserte, se trouva à l’angle du passage de l’Élysée-des-Beaux-Arts, il avait bien une centaine de pas d’avance sur celui qui le suivait. Il descendit brusquement dans le passage.
C’était une ruelle fort étroite, glissant à pic jusqu’aux boulevards extérieurs. Il y avait là de petites bâtisses qui se décoraient du nom d’hôtels, des taudis où les filles amenaient leurs amants de passage pour les dévaliser plus sûrement, car si l’entôlage est un mot d’hier, l’opération en elle-même est connue depuis la plus haute antiquité.
Robert Pascal était enveloppé dans un épais manteau à pèlerine et coiffé d’un chapeau mou, dont les larges bords rabattus lui cachaient tout à fait le visage. Tout en bas, au coin du boulevard, une femme faisait sentinelle. Précipitant le pas l’ouvrier orfèvre fut bientôt près d’elle.
Il lui jeta tout de suite deux mots qui firent dresser l’oreille à la fille : Filoche et morlingue ! Puis :
– Pour le grand Dab, dit-il, débloque les clairs ! (Pour le roi, ouvre les yeux !)
– Jaspine ! fit la fille, en essayant de dévisager son interlocuteur, qui semblait lui tomber du ciel. J’suis de guette !
– Agriffle le fileur et r’mouche sa musette ! (Empare-toi de l’homme qui me suit et regarde bien sa figure.)
– Défouraille ! (Va-t’en) V’là l’croquant !
Pascal était déjà loin, remontant du côté du boulevard Rochechouart. Son espion, le fileur, comme il l’appelait, arrivait au milieu du passage quand la fille en cheveux, qui avait remonté languissamment ce chemin des amants en faisant entendre un singulier appel des lèvres, l’abordait galamment sous un réverbère. Dans ce sinistre décor, elle parvenait encore à être aguichante. Elle était jeune, la bouche jolie, les cheveux luisant de pommade, relevés en casque, les yeux allongés au khôl, l’air effronté.
– Mon mignon, dit-elle, c’est-y que tu ne reconnaîtrais pas ta Lolotte ? T’as donc l’palpitant en carton ?
Aussitôt, une autre voix derrière l’ombre se fit également entendre, traînarde et déjà un peu rauque, celle-là.
– Eh ben ! En v’là un pante ! V’là qu’tu passes maintenant sans dire bonjour à Belotte ! Crénon, va ! T’en trouveras de plus chenilles su’l’turbin, mon vieux. Tiens ! Reluque-moi un peu ces jacquets-là !
Et, sous le réverbère, elle se retroussa jusqu’aux jarretières. Mais une troisième voix, de rogomme, celle-là, essayait encore d’attendrir l’ombre si subitement et si malencontreusement entourée.
– Jun’homme ! C’est la pauv’ Pâlotte qu’a l’estome dans les godins ! Un peu d’pèse si vous plaît pour une gonzesse qu’a perdu sa doche et qu’a envie de brichtonner.
L’ombre, manifestement furieuse, regarda Lolotte, Pâlotte et Belotte. Elle avait bien essayé de passer, mais les trois filles s’étaient serrées autour d’elle en riant.
– Ben quoi ! disait Lolotte de sa voix angélique, tu ne vas pas me marcher dessus ! Prends garde à tes arpions, mon chéri !
L’ombre, de plus en plus impatientée, eut un tort, un grand tort, celui de toucher à cette exquise enfant qui ne lui voulait que du bien. Elle la bouscula un peu, si peu ! N’importe ! On ne bouscule pas une femme !
Ah, messeigneurs ! Lolotte était très susceptible. Seuls, les imprudents qui se sont trouvés à deux heures du matin dans ces parages savent combien une Lolotte trop polie et à laquelle ils n’ont point répondu sur le même ton de politesse peut marquer d’amour-propre froissé, d’indignation vengeresse, de colère souveraine… Et, pour peu qu’un gentilhomme attardé passe par hasard et qu’il soit bien innocemment, ma foi, attiré par cette altercation, voilà toute une histoire ! Le gentilhomme, naturellement, croit que l’on a manqué de respect à une dame, et, comme il a reçu une excellente éducation, il se porte à son secours ! Comment peut-on mieux secourir une dame qui est offensée à une heure aussi tardive qu’en rappelant au malotru qui l’avait oublié, ce qu’il doit au beau sexe. Il lui doit des excuses d’abord, et sans doute aussi, son porte-monnaie et sa montre, car c’est journellement ainsi que les choses se terminent.
Or, voyez l’événement : comme Lolotte prenait bruyamment le ciel à témoin à la muflerie de l’ombre, une autre ombre surgit, qui venait d’on ne sait où, mais qui était assurément l’ombre d’un gentilhomme, car elle prit tout de suite la défense du sexe outragé.
– Que voulez-vous à madame ? demanda la nouvelle ombre sur un ton qui n’admettait sans doute point de réplique, puisque la première ombre ne répondit rien, mais elle sortit de dessous son manteau son revolver.
Lolotte, Pâlotte et Belotte crièrent ; mais, avant que le revolver ait eu le temps de se mêler à la conversation, un coup de bâton, venu d’on ne sait où, avait fait choir le joujou aux pieds de ce butor qui maltraitait les femmes.
L’inconnu voulut ramasser son arme, mais un pied était déjà dessus, et il se vit entouré d’une demi-douzaine d’individus à figures patibulaires. Il eût voulu crier, il eût été sûrement perdu. Il ne serait pas sorti vivant de leurs mains. Tout à coup, il lui sembla, à la lueur incertaine du réverbère, que quelques-unes de ces ombres ne lui étaient pas inconnues.
– Eh mais ! dit-il. C’est les Titis de Pantruche !
Et il risqua le coup :
– On turbine ce soir pour le grand Dab ! (On travaille ce soir pour le Roi !)
Il y eut une certaine émotion parmi les ombres. La première, qui avait parlé déjà, dit :
– Possible ! Mais tu vas nous dire le mot de passe ou ton compte est bon.
Et celui qui avait pris la défense de Lolotte ramassa le revolver.
L’inconnu eut un mouvement de recul. Mais encore une fois il fut enserré dans une véritable prison vivante. Hommes et femmes le touchaient, le tenaient. Il put croire son affaire réglée, car il n’avait pas le mot d’ordre.
– Si tu as entendu parler du grand Dab, dit encore celui qui paraissait être le chef de ces bandits, tu dois savoir qu’il n’aime pas les roussis ! (les espions).
– Dégomme-le, fit Mlle Lolotte de sa voix angélique, c’est une casserole. Il n’a pas le mot d’ordre et il reconnaît les Titis de Pantruche ! Il est renseigné, le frangin ! Tout de même, avant de le refroidir, reluque-lui la bobinasse !
– La môme a raison ! fit le chef de la bande.
Et il poussa l’inconnu sous la lanterne.
Ce chef était un grand diable, maigre comme Don Quichotte ; il souleva le chapeau de son prisonnier, le regarda sous le nez, et, malgré sa fausse barbe, le reconnut, car, soudain, se retournant, il dit aux autres gentilhommes et à ces dames :
– Campo !
Tous s’éloignèrent sans un murmure, disparurent dans l’ombre, s’enfoncèrent dans la nuit.
Alors, quand ils furent seuls, le grand maigre qui avait pris la défense de Lolotte dit à son prisonnier :
– C’est vous, monsieur Dixmer ?
Et l’autre répondit :
– C’est moi, Patte-d’Oie !…
– Qui filiez-vous ce soir, monsieur Dixmer ?
– Je n’en sais rien ! répliqua l’agent de police, et c’est justement pour le savoir que je le filais.
– D’où venait-il ?
– De la Mappemonde !…
– Ah ! ah ! de la Mappemonde !… Ça doit être un personnage… car il a tous les mots d’ordre, ceux qui font qu’on doit obéir comme au grand Dab lui-même… et vous, monsieur Dixmer, vous n’avez aucun mot de passe, ce qui ne serait rien encore… mais le pire, voyez-vous, c’est que – où que nous vous rencontrions – nous devons vous tuer comme un chien ! Qui, vous êtes affiché dans la Profonde !
– Dans les catacombes ?
– Qui… Vous devez savoir pourquoi… Ah ! vous avez de la veine d’être tombé sur moi ce soir… Vous me devez la vie, monsieur Dixmer, ne l’oubliez pas ! Tenez ! Rentrez votre « soufflant » !
Et Patte-d’Oie rendit à Dixmer son revolver.
– Écoutez ! reprit Patte-d’Oie, il y a des choses qu’on ne peut pas se dire comme ça sous la calotte des cieux… et puis, ici, ça manque de chaises ! Venez donc sans crainte après-demain soir à l’Ange-Gardien ; il n’y aura pas une nombreuse compagnie, mais elle suffira pour ce que nous avons à nous dire…
Et il siffla !
– Lolotte, fit-il, laisse donc passer ce brave homme qui ne veut de mal à personne et qui te fait toutes ses excuses…
Dixmer dit tout bas à son sauveur :
– Merci, Patte-d’Oie !… À titre de revanche !… À après-demain !
Et il poussa un gros soupir en arrivant sur le boulevard. Là, il constata naturellement qu’il devait renoncer à retrouver la trace de Robert Pascal. Il n’avait plus qu’une envie, après une si chaude algarade, celle de s’aller coucher ; ce qu’il fit.
Quand à Robert Pascal, débarrassé de son « fileur », il s’était jeté dans un fiacre et s’était fait conduire derrière la butte. Là, il quittait sa voiture, remontait à pied la pente de la butte et arrivait enfin rue des Saules.
Quand il y parvint, il s’arrêta un instant et regarda attentivement autour de lui. Le silence le plus absolu régnait sur toutes choses, et la lune éclairait un paysage de mort.
Sous les rayons pâles et glacés de l’astre des nuits, les murs d’un jardin à droite, hauts et décrépits, éclataient de blancheur comme le marbre des tombeaux.
Aux yeux du jeune orfèvre, nuls murs au monde ne pouvaient être plus sinistres que ceux-là. Et, cependant, ils n’étaient, comme tant de vieux murs, que de la pierre et de la mousse ! Nulle porte sur la terre ne devait avoir le don de faire battre son cœur désespéré par son seul aspect, comme cette petite porte basse aux planches pourries, aux gonds rouillés !…
Il s’appuya à cette porte pour ne point tomber, car tout son être vacillait autour de cette pensée : « Il y a vingt ans, elle a franchi cette porte, une nuit comme celle-ci, une nuit de lune et de crime, et, pour elle, cette porte ne s’est jamais rouverte. » Et il gémit tout haut : « Elle est encore là ! »
Le son de sa voix, dans la nuit déserte, le rendit à lui-même. Il fit un effort pour reconquérir toute la force morale et physique dont il allait avoir besoin.
– Allons ! À l’œuvre ! murmura-t-il.
Et il entrouvrit son manteau. Il s’y trouvait cachés divers objets qu’il déposa par terre avec précaution. Ceci fait, il longea le mur au pied duquel il se trouvait jusqu’à ce qu’il fût en face de l’auberge du Bagne.
La masure profilait son ombre sur le sentier. Robert Pascal entra dans cette ombre et se retourna. Maintenant, il avait sur sa droite le mur et la petite porte plus bas. Alors, il vit bien qu’il n’y avait plus aucun doute à avoir sur cette petite porte, car, de l’auberge du Bagne on ne voyait, dans tous les murs nus qui formaient à eux seuls la rue des Saules, que cette porte-là.
Plus d’une fois, lors de ses rendez-vous chez la mère Fidèle avec cet être inexplicable qu’était M. Macallan, il s’était demandé et il avait demandé à la patronne des chourineurs quelle pouvait bien être cette sorte de propriété abandonnée où l’on ne voyait jamais entrer personne, et d’où ne venait jamais le moindre bruit. L’hôtesse lui avait répondu que depuis qu’elle s’était installée là, elle avait fait souvent cette question à de vieux habitants du quartier, qui tous avaient hoché la tête, en signe d’ignorance.
Certainement, depuis des années et des années, la propriété non seulement n’avait pas été habitée, mais avait cessé d’être fréquentée. Et jamais alors R. C. ne s’était douté que ce qu’il cherchait depuis si longtemps se trouvait à portée de sa main ! Car l’homme, si puissant soit-il, n’est dans toutes les circonstances de la vie que le jouet du hasard.
Quelle leçon pour R. C., qui n’était point loin de se croire l’homme du destin, que celle qu’il avait reçue dans la modeste loge de dame Héloïse. Il achète tous les perroquets de la terre, et le seul dont il ne veuille point parce qu’il le croit muet, est celui qui détient la clef de sa vengeance. Cette pensée, cependant, n’aurait point réussi à humilier R. C. Bien au contraire, l’événement, à cause de son hasard même, l’avait confirmé dans son orgueil.
De l’endroit où il se trouvait, Robert Pascal examinait toute la longueur du mur qui lui était accessible et cherchait le point propice à son escalade. Il n’avait pas pensé une seconde à pénétrer par la porte. D’abord, il lui eût fallu l’enfoncer, et, avant tout, il tenait à opérer sans bruit. Il ne devait pas oublier qu’à deux pas de là, derrière lui, dormait la mère Fidèle, dans cette même chambre d’où, vingt ans auparavant, le ménage Prévost, dissimulé derrière les rideaux, avait assisté aux allées et venues nocturnes des étranges habitants d’en face.
Le jeune homme considéra une seconde les fenêtres sombres du premier étage, s’approcha à pas de loup du seuil de l’auberge, colla son oreille contre la porte, et, rassuré, se redressa pour la tâche à accomplir.
Non loin de la petite porte, le mur avait conservé une garniture de tuiles formant chapeau. Avec une adresse incomparable et une sûreté de mouvements merveilleuse, Robert jeta au-dessus de ce chapeau de tuiles une courte corde qui se terminait par un crampon de fer à plusieurs crocs.
Agile comme un chat et les pieds au mur, ne se servant de la corde que pour y grimper des mains, Robert s’agrippa à la crête juste au moment où les tuiles cédaient sous l’effort du crampon de fer. Robert à cheval sur la crête du mur, penché du côté de la rue, tira à lui par le truchement d’une ficelle des objets assez lourds qu’il avait dû y attacher avant de s’élancer à l’assaut de la propriété abandonnée.
Quand ces objets furent à sa hauteur, il les jeta de l’autre côté du mur, puis se dressa tout droit. Les ailes de son manteau le faisaient ressembler à un monstrueux oiseau nocturne…
L’oiseau disparut. Robert Pascal était tombé sur un amas pourri de feuilles mortes laissées là par vingt automnes. Il s’appuya au tronc d’un hêtre et regarda. Son émotion était indescriptible. La clarté lunaire faisait apparaître à ses yeux un lieu de rêve, un jardin fantastique. Elle donnait aux arbres des proportions étranges et des attitudes de fantômes. La blême lumière s’accrochait aux troncs droits ou courbes, orgueilleux ou chancelants, qui dressaient désespérément leurs bras ou les laissaient retomber humblement vers la terre. Ceux-ci paraissaient supplier, ceux-là semblaient maudire.
En opposition avec toutes ces clartés inquiétantes, des coins de jardin étaient peuplés d’ombres bizarres aux formes innombrables et entrelacées. Ici c’étaient comme des nœuds de serpents gigantesques qui se livraient une bataille acharnée, noirs sur le fond lumineux du ciel ; là c’étaient de sombres silhouettes penchées l’une sur l’autre et semblant se raconter des histoires qui ne regardent personne, et qu’on ne confie même pas au vent qui passe. Mais il n’y avait pas de vent cette nuit-là. Tout était immobile. Pas un nuage là-haut, pas un autre frisson dans ce jardin, que le frisson de son cœur.
Le plus curieux de ce jardin était l’encombrement extraordinaire de tout, le prodigieux enchevêtrement des branches mortes et des bras vivants. Depuis vingt ans, nul n’avait pénétré là-dedans ; et cela avait poussé en forêt vierge. Les plantes parasites, les plantes rampantes, grimpantes, le lierre, la mousse s’étaient emparés des individus et les avaient liés en un troupeau indissoluble et certainement impénétrable l’été. Mais par l’hiver qui dénude toute chose, par cette nuit de lumière, Robert Pascal saurait certainement retrouver ce qui, autrefois, avait été des chemins.
Et puis, n’aurait-il pas retrouvé les chemins, qu’il s’en serait fait un, qu’il aurait repoussé à poignées la vaine protestation des branches, qu’il aurait écarté de son effort surhumain le tronc des arbres et qu’il serait arrivé ensanglanté, déchiré, au but, à la petite maison qui était, là-bas tout au fond, gardée par le jardin-mystère, la petite maison du crime, la petite maison de la rue des Saules…
Pauvre Robert Pascal, qui se croyait si fort ! Depuis que nous le connaissons, nous l’avons déjà vu pleurer, nous l’avons déjà vu s’évanouir ! R. C. qui a des larmes ! R. C. « qui a une faiblesse ! »
Et maintenant nous allons le voir trembler ! Lui qui, sous les apparences de Teramo-Girgenti, s’est penché si souvent sur l’abîme de la tombe ! Trembler comme un enfant devant l’évocation de la mort !
Quand, à pas lents et difficiles, il eut accompli le chemin qui le séparait de la demeure ; quand, sur une piste traîtresse, il eut vingt fois trébuché comme un homme ivre, qu’il se fut battu avec les branches cinglantes et qu’il eut lutté avec les grands fantômes que sont les arbres sous la lune, il arriva enfin devant un petit perron ; il déposa sur la première marche les objets qu’il avait attachés à sa ceinture, choisit l’un d’eux, qui était une lanterne sourde, et l’alluma.
La façade de la maison était entièrement plongée dans l’ombre. Le jeune homme promena le jet lumineux de sa lanterne sur cette façade. C’était un mur de briques troué au premier étage de trois fenêtres ; au rez-de-chaussée de deux fenêtres et d’une porte. Cette porte donnait naturellement sur le petit perron. Porte et fenêtres étaient hermétiquement closes. Il y avait des volets à toutes les ouvertures. En se penchant sur le perron, qui offrait une assez large cavité, Robert Pascal découvrit des ustensiles de jardinier, une pelle, une bêche, des outils de maçon, une truelle, et même un outil de terrassier, une pioche.
Il gravit les quatre marches du perron et fut devant la porte. Il déposa sa lanterne sur la rampe et, comme il avait pris, encore avant de monter, parmi les objets apportés, une pince-monseigneur, il introduisit immédiatement celle-ci entre la porte et le mur, juste au-dessous de la serrure. La porte s’ouvrait en dedans et s’encastrait dans le mur, le jeune homme put donc user de sa pince très franchement comme d’un levier.
Il ne fallut point déployer une force excessive pour que la pince, à l’intérieur, fît bientôt sauter la gâche, et la porte s’ouvrit. Une odeur, à la fois forte et fade de « renfermé » vint d’abord surprendre désagréablement les narines de Robert Pascal. Il ne voyait rien. Il saisit sa lanterne, et c’est ainsi, une lanterne sourde dans une main et une pince-monseigneur dans l’autre, que le roi des Catacombes pénétra dans la petite maison de la rue des Saules…
R. C. se trouva tout de suite dans un étroit et assez long vestibule qui se terminait par un escalier montant au premier et unique étage. Une petite lucarne, sans volet, garnie de barreaux, donnait, tout au fond, sur cet escalier et laissait entrer un rayon de lune qui découpait un carré clair sur une marche. En dehors de ce petit carré blanc et du disque rouge que la lanterne sourde de Robert Pascal promenait sur les murs et sur le parquet, tout n’était que ténèbres. Trois portes ouvraient sur ce vestibule, deux à gauche, une à droite.
Le visiteur poussa la première porte qui s’offrait à lui à sa gauche. Et il entra dans une petite salle qui, tout d’abord, semblait ne devoir présenter à ses regards avides rien de bien intéressant. Ceci paraissait avoir été un fumoir et était meublé assez simplement de tables et de chaises en bambou. Des fauteuils en osier, un guéridon sur lequel se trouvait encore tout un service de fumeur. Le disque rouge de la lanterne découvrait peu à peu sur les murs tout une décoration de dessins plutôt légers, de femmes en toilette sommaire. Le crayon qui avait dessiné ces « nus » était celui d’un artiste.
Robert Pascal allait quitter cette pièce quand il trébucha dans une chaise longue, ou plutôt dans une corde qui était attachée à une chaise longue. Il vit cela en se baissant et en ramassant la corde. La chaise longue suivit la corde. La corde avait des nœuds bizarres ; l’osier de la chaise longue était arraché par places. On eut dit qu’une main furieuse s’était acharnée contre ce meuble et, malgré le temps écoulé, on voyait parfaitement que ce n’était point l’usage qui l’avait détériorée ainsi, mais quelque rage ou quelque bataille. Et puis, la corde que Robert Pascal avait ramassée et qui était attachée à l’un des pieds de la chaise longue n’était point la seule, le jeune homme en découvrit une autre à l’un des bras de la chaise, et cette corde aussi était restée attachée là par un bout…
Comme la lanterne éclairait le parquet autour de la chaise longue, elle montra des débris d’osier et puis une loque de linge fin. Robert Pascal ramassa cette loque. La lanterne tremblait dans sa main.
Il quitta cette pièce. D’autres débris d’osier et encore un bout de corde qu’il n’avait point vus tout d’abord, et qu’il trouva dans le vestibule, entre la porte du fumoir et celle qui se trouvait en face, semblaient lui indiquer que l’on avait traîné la chaise longue de la pièce fermée par cette porte au fumoir qu’il venait de visiter. Il poussa donc la porte d’en face et voulut aller plus avant, mais il lui fut difficile de faire un pas sans risquer de tomber, tant ses pieds rencontraient d’obstacles. Sa lanterne sourde lui ayant montré, dans cette salle, deux fenêtres, l’une donnant évidemment sur l’ombre de la façade et l’autre donnant à coup sûr du côté du clair de lune, il imagina de se laisser glisser le long des murs et d’atteindre cette seconde fenêtre, qu’il ouvrit et dont il poussa les volets.
À flots blancs, la lumière lunaire entra dans cette pièce plongée dans l’obscurité depuis vingt ans et éclaira un désordre affreux.
Quelle orgie, suivie de quelles scènes de bataille, avait ainsi immobilisé, dans une confusion sans nom, tous ces témoins du passé : cette table où avait été servi un souper aussi dramatique que joyeux, s’il fallait en croire le nombre de flacons qui avaient roulé à terre, les coupes brisées dont les éclats jonchaient encore les tapis, cette nappe qui traînait à demi sur le parquet comme si elle avait été arrachée violemment par les doigts crispés de cette main sanglante, dont la trace semblait fraîchement imprimée. Ces fauteuils, ces chaises renversés. Et la table elle-même avait basculé, une patte rompue.
Une glace, au fond de la pièce, n’était plus qu’une prodigieuse étoile éclatée.
À pas lents et prudents, Robert Pascal fit le tour de ces choses, s’attardant à des détails, se penchant sur un objet imperceptible, restant longtemps courbé sur un pli de la nappe, s’agenouillant sur le tapis, promenant dans les rainures du parquet le jet écarlate de sa lanterne, puis, se relevant, la poitrine haletante, comme anxieux du souffle qui va lui manquer. Le jeune homme s’était donné pour tâche de sonder les abîmes du passé, et parfois cette tâche l’étouffait.
Il sortit de cette salle, tâtant les murs, si troublé, si hésitant qu’on eût pu croire qu’il venait de prendre sa part de cette orgie défunte. Ses lèvres murmurèrent des mots sans suite, et puis, soudain, il parut retrouver une force nouvelle et il commença de gravir l’escalier qui conduisait au premier étage, d’un pas d’automate. Quand son visage apparut dans la lueur du petit carré lunaire, il exprimait, avec un tel relief, tant de force et d’énergie sauvage, la haine, que quiconque l’eût aperçu se fût enfui, épouvanté.
Quand il fut au premier étage, il n’hésita point. Sans doute savait-il que des deux portes qui étaient là, c’était la première, à sa droite, qu’il fallait pousser, car il s’y appuyait avec certitude.
La porte obéit à la pression… La première chose que Robert Pascal vit dans cette pièce fut une fenêtre avec des barreaux, la seconde fut un lit ; cette pièce pouvait être à la fois chambre et prison. La prison, certes, avait été élégante ; elle n’en paraissait que plus lugubre. Rien de plus sinistre que ce lit à baldaquin entouré de lourds rideaux fanés si soigneusement fermés qu’on eût pu croire que la main qui les avait si méticuleusement disposés leur avait donné à garder quelque redoutable secret.
Du reste, dans cette chambre, tout était en ordre. Sur un petit bureau qui s’appuyait au mur, quelques feuilles de papier étaient disposées. Une plume plongeait encore dans un encrier, et la chaise qui se trouvait à côté de ce bureau était placée de façon qu’on pouvait facilement imaginer qu’une personne venait de la quitter après quelque correspondance. Peut-être même eût-on pu imaginer encore que cette correspondance venait d’être interrompue tant ces différents objets : bureau, papier, encrier, plume et chaise, présentaient un arrangement propice à une telle hypothèse. Cependant, le papier sur le bureau était vierge de toute inscription.
Le lit, plus que tout le reste, attirait Robert Pascal : le lit fermé, le lit avec son secret, et il alla vers le lit, et, d’un geste pieux, il en écarta doucement les rideaux.
Le lit n’était point défait. Il était en ordre, comme toute chose dans la chambre. L’oreiller, garni de dentelles, paraissait attendre encore, après tant d’années, la tête qui avait coutume de s’y reposer. La courtepointe de satin était tirée méthodiquement sur les couvertures et les draps.
Robert Pascal, devant ce lit, se laissa glisser à genoux comme nous avons vu Liliane tomber à genoux sur le seuil du petit jardin du quartier de l’Observatoire. La courtepointe si méthodiquement tirée se déplaça, car Robert Pascal avait machinalement, en s’agenouillant, laissé glisser ses mains sur le lit. Robert Pascal voulut remettre la courtepointe en place. C’est alors que ses mains pressèrent sous cette courtepointe quelque chose qui n’était ni de la toile ni de la laine. Il souleva la couverture et découvrit un cahier de papier qu’il porta immédiatement sur le bureau, qu’il présenta à la lueur de sa lanterne, et sur lequel, avec une émotion sainte, il commença de lire, à la première page, ces mots : « Mon pauvre petit Robert, je t’ai conduit aujourd’hui aux Enfants trouvés… » Et ces premières lignes avaient des taches jaunes qui autrefois avaient été des larmes.
XII – L’APPARITION
Parfois un geste brusque, un poing qui se ferme, venaient ponctuer cette muette lecture, parfois le lecteur était obligé de s’interrompre, parce que ses pleurs, avant d’aller rejoindre ces autres pleurs qui avaient laissé leurs traces sur le papier, obstruaient son regard ; parfois aussi, Robert Pascal, incapable de maîtriser le tumulte qui gonflait sa poitrine, se levait, marchait à grands pas et remplissait cette chambre paisible des farouches éclats de sa colère.
Quand il eut terminé sa tragique lecture, Robert Pascal porta le cahier à ses lèvres et il le glissa dans sa poitrine, puis il reprit, comme en un rêve, le chemin parcouru. Il erra dans la maison comme une âme débarrassée du fardeau de son corps. Il ne s’aperçut même pas qu’il laissait, dans cette chambre, la petite lanterne sourde ; il s’en fut sur le palier, il descendit l’escalier, il se promena dans les pièces, doucement, lentement, lamentablement, mais sans hésitation et sans crainte, sans heurt d’aucune sorte, malgré le nombre d’obstacles qui eussent pu l’arrêter.
Ainsi vont les somnambules dans la nuit noire, éclairée seulement par l’éblouissante et surnaturelle clarté intérieure. Et il fut à nouveau sur le seuil, sur le perron, en face des fantômes blancs des arbres immobiles, en face du jardin mystérieux et terrible, et il dit :
– Ma mère ! Si, en ce moment le souffle qui m’émeut et qui caresse mon visage est votre souffle, faites ce miracle pour votre enfant de vous manifester à lui sous une forme que ses pauvres sens ne puissent mettre en doute ! Ah ! si vous êtes là ! dites-le-moi, ma mère !… Voici l’heure !… Je ne suis plus qu’une vengeance en marche et qui va frapper !
Et tout bas, tout bas, il murmura encore :
– Ma mère !… Pour vous venger, il faut que vous soyez là ! Si votre âme est avec moi, montrez-moi votre corps !
Robert Pascal n’avait pas fini de prononcer ces mots, que, du milieu de toute la troupe des fantômes immobiles, arbres séculaires qui dressaient vers les cieux leur geste d’immuable désespoir, un fantôme se détacha. Et c’était bien un corps qui semblait avoir surgi soudain de la terre et qui venait à son appel !
Le jeune homme, épouvanté, recula. Il recula dans le trou noir du vestibule. Il recula devant le fantôme qu’il avait évoqué et que lui envoyait sa mère ! De l’endroit où il se trouvait, il vit le fantôme blanc entrer dans l’ombre noire de la maison, et puis, plus rien. Si, des pas furtifs, qui semblent toucher la terre… Robert Pascal entend les pas du fantôme sur les marches de pierre qu’il ne voit pas. Et, soudain, le voici tout noir, plus noir que l’ombre même du vestibule, plus noir que la nuit. Il est debout sur le seuil.
Soudain, venu de la lucarne de l’escalier, le petit carré de lumière qui a quitté la marche, qui s’est promené sur le mur, et qui continue son chemin de rayon de lune, vient frapper en plein dans le visage du fantôme. Tout l’être de Robert Pascal vibre d’une allégresse divine, « hurle en silence » de joie triomphante, renaît à la vie de la vengeance, car sa mère a répondu ! Le fantôme qui est là ne vient point d’outre-tombe. Il sort du Palais de Justice ! Il s’appelle Sinnamari !
Oui, c’était bien Sinnamari. Qui l’avait amené là, lui qui n’avait pas mis les pieds dans ce lieu depuis vingt ans ? Quelle combinaison inouïe du hasard avait conduit les pas de cet homme pour qu’il se trouvât, par cette nuit anniversaire de son crime, à l’endroit même où le crime avait été commis, en face du fils de la victime ?
Pour un esprit qui avait « travaillé les superstitions » dans les livres de magie comme Robert Pascal, n’y avait-il point là une raison évidente de croire à l’intervention de « l’au-delà » ? En vérité, l’au-delà lui répondait. Il avait demandé à l’inconnu un signe palpable de son droit à la vengeance : pouvait-il en donner de plus tangible que celui-là ? N’était-ce point sa mère elle-même qui lui remettait son bourreau dans les mains ?
Il eut besoin de toute sa force d’âme reconquise pour ne point, sur-le-champ, bondir sur sa proie et la tuer sur le coup ! Mais il se rappela l’affreux martyre de sa mère, le supplice de son père, et il jugea que la vengeance eût été par trop simple s’il n’avait mis en face de tant de douleur, de désespoir, de désastres et de sang que la vie d’un homme ! Il lui fallait autre chose, autre chose, au roi des Catacombes ! Et il attendit, tapi au fond des ténèbres.
Sinnamari était donc arrivé au haut du perron… Cette nuit-là, il avait été étrangement travaillé, non point par le remords, mais par une sorte de pressentiment.
Les événements qui se succédaient depuis quelques semaines l’étonnaient par la persistance avec laquelle ils s’obstinaient à lui être désagréables. Les affaires les mieux conduites lui « claquaient » dans la main. L’association qui avait si longtemps prospéré sous ses ordres et qu’il n’avait cessé d’entourer des plus sûres garanties, avait été tout à coup menacée et il avait fallu avoir recours aux grands moyens, se débarrasser de deux comparses dangereux qui avaient eu la prétention de se faire payer trop cher : Lamblin et Didier. Du moins, en se débarrassant de Didier – par le suicide – avait-il fait coup double et s’était-il débarrassé ou plutôt Eustache Grimm l’avait débarrassé du même coup d’un ancien témoin gênant de ce qu’il appelait « les peccadilles de sa jeunesse », car avant d’appartenir à Eustache Grimm comme homme bon à tout faire, Didier avait appartenu à Sinnamari comme domestique.
N’importe, il est toujours regrettable d’en être réduit, même quand il s’agit là de l’intérêt de l’État, à l’assassinat ! Car il était à remarquer que Sinnamari ne disait jamais « Mes affaires ! » ou « Mon intérêt ! » Comme il avait mis dans ses affaires et dans son intérêt, quelques-uns des plus hauts personnages de l’État, et comme il était aussi à lui tout seul une des plus grandioses expressions de l’État, il disait toujours en parlant de ses crimes : « Les affaires de l’État, l’intérêt de l’État. » Hélas ! Sinnamari n’était point le seul, depuis qu’il y a des États, à penser et à s’exprimer de la sorte. Combien de fois l’action criminelle de la raison d’État a eu pour point de départ le crime de quelque particulier !
Donc, Sinnamari s’inquiétait de son inattendue et persistante « déveine ». L’affaire Desjardies, l’évasion du père de Gabrielle n’était point pour le rassurer. Ce Roi des Catacombes qui prétendait n’avoir d’autre but que de poursuivre dans l’ombre, l’œuvre de justice pour tous, qu’il lui était impossible d’accomplir au soleil, ne lui disait rien qui vaille. Et comme les coups de R. C. l’avaient déjà, lui, tout particulièrement frappé, il avait fini par se demander s’il n’était point, lui, plus particulièrement visé.
Les confidences de Dixmer, en le prévenant que R. C. n’était point précisément bien disposé à son égard, avaient augmenté son émoi. Il n’était point loin de croire que R. C. se révélait un ennemi personnel des plus dangereux. Pourquoi ? Il se le demanda. Il avait navigué sur une telle mer d’infamie qu’il interrogea en vain l’horizon, trop vaste pour qu’il découvrît l’écueil. Soudain, dans le ciel sombre, une lueur fut sur le point de l’éclairer. La foudre de R. C. n’essayait point seulement de l’atteindre, elle frappait autour de lui, elle venait de brûler Régine.
Le jour même, pendant que Sinnamari travaillait dans son bureau, au Palais de Justice, un domestique de Régine avait demandé à le voir sur-le-champ et il l’avait reçu aussitôt.
Cet homme était essoufflé et paraissait en proie à la plus grande consternation. C’est à peine s’il pouvait parler… Il laissait échapper des bouts de phrases :
– Monsieur le procureur !… Les enfants… Les enfants étaient sorties avec monsieur… elles sont perdues !… Madame est folle !… Les enfants perdues à la kermesse des Tuileries. Monsieur est fou !… Il veut se suicider…
Enfin, Sinnamari finit par faire expliquer à cet homme que Régine était allé avec ses deux jumelles à la kermesse des Tuileries, que « Madame », un peu souffrante, ne les avait pas accompagnés. Régine et ses deux petites filles avaient déjeuné au restaurant de la kermesse.
Après le déjeuner ils avaient fait le tour du jardin. À un moment, les petites filles demandèrent à monter sur les chevaux de bois, et Régine les installa lui-même dans une petite voiture.
Les chevaux de bois se mirent en marche. Le père fut accosté par un marchand de programmes et de journaux qui lui annonça une catastrophe, retint son attention une seconde, et lui laissa une feuille dans la main. Quand Régine reporta ses regards sur les chevaux de bois qui ralentissaient leur marche, les petites filles avaient disparu !…
Il les chercha partout ! Il cria, appela, ameuta tout le monde, courut partout. Les petites filles avaient disparu !…
À ce moment, il avait regardé la feuille qu’il tenait machinalement à la main. Il n’y avait que deux lettres écrites sur cette feuille : R ! C ! Et Régine, de plus en plus fou, était rentré chez lui, espérant peut-être retrouver ses fillettes, car on leur avait appris à baragouiner leur adresse, mais elles n’y étaient pas, mais elles ne revinrent pas ! On les avait, bien sûr, volées !…
Alors Régine et sa femme, tout à fait fous, avaient passé le reste de la journée et la nuit à courir par la ville, cependant que tous les commissariats étaient en rumeur.
Pourquoi R. C. avait-il volé les deux enfants de Régine ? Qu’est-ce que Régine et lui, Sinnamari, pouvaient bien avoir de commun avec le vengeur R. C. ? Il remonta le cours de son amitié avec Régine ; il s’en fut jusqu’aux années de la plus folle jeunesse. Tout de même, parmi les crimes de Sinnamari, il y en avait un plus grand que les autres, si grand, que le monstre, qui ne connaissait point le remords, se le rappelait quelquefois avec orgueil !
Qu’une telle mentalité surprenne, effraie, déconcerte, il faut cependant l’admettre. L’univers est une merveilleuse balance entre le bien et le mal. Je crois que si le bien l’emportait, toute la mécanique s’affolerait, perdrait l’équilibre, irait au cataclysme du néant. Il faut donc que, puisqu’il est entendu qu’il y a dans un des plateaux de la balance des vertueux sublimes, nous n’hésitions pas à voir dans l’autre des criminels équivalents. Sinnamari était un criminel sublime.
J’ai été frappé de ce fait que, dans les romans, les bandits voyagent toujours en emportant en croupe le remords. Eh ! le plus souvent, dans la vie, ils ne le connaissent point, et pour peu que l’on fréquente le Palais de Justice, on s’aperçoit que, non seulement ces messieurs ne regrettent rien, mais sont pleins d’ostentation ! Seulement, ils ne sont point tous naturellement procureurs.
Quand la chose arrive une fois dans un siècle, on a vraiment une figure qui compte et qui doit contribuer d’une façon appréciable par son poids dans le plateau du mal. Que le monde donc ne s’en plaigne point, d’abord parce que ça ne lui servirait à rien de gémir, ensuite parce que, en face d’un Sinnamari, la nature doit nécessairement créer trois Saint Vincent de Paul.
De cet examen de conscience auquel s’était livré Sinnamari, l’affaire de la petite maison de la rue des Saules venait donc de sortir. Certes, ç’avait été un crime fameux ! Son plus beau ! Mais, par suite, c’était là une histoire qui ne rayonnait plus que de temps à autre dans sa mémoire ! Qui se souviendrait maintenant de la rue des Saules ? Qui en aurait parlé ? Ni Régine, ni Eustache Grimm à coup sûr. Ni Didier. Surtout Didier, qui était mort ! Alors ?… Alors, l’affaire était bien morte… et la morte était bien enterrée !
Et Sinnamari se souvenait qu’en effet la morte avait été d’autant mieux qu’elle l’avait été « par ses soins ». Une besogne dont il n’avait voulu charger personne !… Ce pauvre Didier lui-même avait en vain offert ses services.
Et il s’était endormi là-dessus.
Soudain, il se réveilla. Sa pendule sonnait deux heures et demie du matin. Il sauta à bas de son lit. Il venait de rêver qu’on lui volait sa morte !
– Décidément, se dit-il, voilà une vieille histoire qui me revient la nuit ! Et qui m’empêche de dormir ! Il faut soigner ça !
Il s’habilla. Ceci était un événement considérable. Sinnamari avait le plus beau sommeil de bête qu’il fût possible de désirer. Il dormait comme une brute et se réveillait comme un ange, la conscience tranquille et le teint pur, la joue fraîche. Il ne rêvait guère. Sa santé physique égalait sa santé morale qui était parfaite. Et voilà qu’il venait de rêver qu’on lui avait volé sa morte !
Il était décidé à aller voir si sa morte était toujours à sa place. Qui donc la lui aurait dérangée ? N’importe ! Il irait ! Il s’étonna d’avoir peut-être pris cette décision dans son sommeil !
Un coup d’œil de hasard au calendrier pendu à la muraille lui avait rappelé une date ! « Tiens ! fit-il, l’anniversaire ! »
Et il pensa que cette date avait été remarquée par lui, la veille, au moment de se mettre au lit, et que de ce puéril détail était sortie toute la tracasserie de cette imagination de morte volée ! Mais cependant, il continuait à s’habiller et il avait hâte d’être là-bas ! Sans savoir exactement pourquoi, sans se l’avouer du moins !… Au fond, après tant d’années de sécurité, il voulait toucher la preuve durable de cette sécurité-là !
Et il marchait à la morte, tout droit, comme si elle lui eût dit de venir ! Quand il se retrouva dans cette rue des Saules, quand il revit la porte de cette petite propriété dont il n’avait jamais voulu se défaire, malgré les offres qui lui furent faites, il s’étonna bien un peu et il trouva que sa démarche était tout à fait indigne de lui, indigne de son caractère, enfantine, ridicule ! Mais quoi ! Il n’était point venu si loin pour reculer. La porte était là et la clef dans sa main. Il ouvrit, la serrure céda à ses efforts et il fut dans le jardin. Il referma soigneusement la porte.
À travers les branches poussées au hasard de l’abandon, il entr’aperçut le pavillon, qui découpait son ombre aiguë sur ce qui avait été autrefois une pelouse, et qui n’était plus maintenant qu’un amas de feuilles, de mousse, et de terre pourrie, desséché par l’hiver.
Bravement, il s’avança. Bravement ? mieux que cela, naturellement ! Il sortit des bosquets, franchit la barrière des buis épineux, dépassa la lisière des grands arbres, glissa sur la terre feutrée de la dépouille de vingt étés et marcha droit, droit au pavillon, droit au palier, droit à la morte.
Quand il eut gravi les marches du perron, il fut soudain agrippé en pleine figure par le rai de lune venu de l’intérieur de la maison, de l’intérieur du vestibule, et alors il s’aperçut que la porte du perron était ouverte.
Il jura comme un charretier. Il n’eut point peur. Jamais. Il arma son revolver et il entra dans le vestibule.
Revolver dans une main et rat de cave allumé dans l’autre, il alla jusqu’au fond du vestibule. Là, il y avait une troisième porte, à gauche, que Robert Pascal avait négligée parce qu’il savait qu’elle donnait sur l’office et qu’il croyait n’y avoir rien à y voir ; d’un coup de pied, Sinnamari enfonça la porte. À ce moment, Robert Pascal, sous l’escalier, avait Sinnamari devant lui et il pouvait l’assommer d’un coup de sa lourde pince, sans que celui-ci pût trouver le temps de placer un soupir. Il n’en fit rien. Il vit Sinnamari entrer dans l’office, déplacer un gros bahut et ouvrir dans la muraille une petite porte qu’on n’y eût pas soupçonnée. Cette ouverture devait donner dans un escalier, car Robert Pascal aperçut Sinnamari dans cette ouverture, d’abord dans toute sa hauteur, puis à mi-corps, puis il n’y eut plus de visible que la tête terrible du procureur dans les lueurs sanglantes du rat de cave.
Quand cette tête eut disparu, Robert Pascal s’élança à son tour. Et, à son tour, il entra dans le trou.
L’escalier, étroit et tournant sur lui-même, ne permettait pas à Robert Pascal d’apercevoir au-dessous de lui le procureur, mais cette disposition même le servait d’autre part, puisqu’elle permettait au jeune homme d’être en quelque sorte sur le dos de Sinnamari sans que celui-ci l’aperçût. Seul, le moindre bruit eût pu trahir la présence de Robert Pascal, mais la prudence et l’habituelle sûreté de son pas le mettaient à l’abri d’une pareille hypothèse.
Il est probable que R. C. avait reçu une éducation physique toute spéciale et que, dans la nécessité où un exceptionnel destin l’avait placé d’être partout sans être vu nulle part, son premier soin avait été d’apprendre, à l’école sans doute des terribles chourineurs, ses compagnons, à remuer en silence. Le seul danger immédiat couru par le jeune homme résultait de la possibilité pour Sinnamari de se raviser ; le procureur pouvait en effet renoncer soudain à cette excursion souterraine, ou bien simplement se retourner et remonter l’escalier, s’il avait oublié quelque chose ! À cette pensée, Robert Pascal serra sa pince avec une sauvage énergie. Face à face, dans cet étroit boyau, les deux hommes eussent dû se livrer une lutte aussi rapide que mortelle.
L’existence de cet escalier avait d’autant plus étonné le roi des Catacombes que rien, du dehors, quand on regardait attentivement le pavillon, ne faisait prévoir que cette bâtisse eût une cave. Pas le moindre soupirail, pas même cette sorte de petite porte basse, par laquelle on a coutume de glisser les fûts…
Le jeune homme était entré depuis quelques secondes dans le boyau et avait descendu une vingtaine de marches, guidé par le reflet rougeâtre du rat de cave tenu par Sinnamari, quand soudain celui-ci s’arrêta. Robert Pascal n’entendait plus ses pas. Il s’arrêta aussi, suspendant son souffle. La lueur, sur le mur en face de lui, restait immobile. Que faisait Sinnamari ? Il ne pouvait le voir, mais il entendait parfaitement sa respiration un peu forte. Écoutait-il ? Avait-il, au-dessus de lui, entendu quelque chose ? Était-ce l’anxiété de ce qu’il allait trouver en bas qui le faisait hésiter, ou la crainte d’un danger venu d’en haut ? Était-ce simplement le pressentiment qu’il savait quelqu’un à ses côtés ?
La minute était tragique. Si Sinnamari ne continuait pas à descendre et s’il n’avait pas, lui Robert, le temps de remonter, il était décidé à assommer le procureur impérial comme, à l’abattoir, un « louche-bem » abat un bœuf.
– Ce serait dommage ! pensait-il avec un effrayant sang-froid.
Il y eut une agitation de la lueur rouge sur le mur. La lumière allait-elle venir ? Ou s’éloigner ? Robert Pascal s’aplatit contre la paroi de pierre et leva sa pince-monseigneur toute droite, au-dessus de sa tête. Mais la lumière disparut ! Oui, soudain, il n’y eut plus de lumière du tout ! Sinnamari avait dû la souffler ! Donc, il avait entendu ! Il savait qu’il y avait quelqu’un là !…
Robert Pascal ne voyait plus rien, n’entendait plus rien ! Le souffle de Sinnamari s’était tu !… Sinnamari n’avait qu’à tirer dans l’escalier, au-dessus de lui, n’importe où ! Robert Pascal était sûr d’être atteint !
– S’il me manque ou s’il ne me tue pas du coup, pensa-t-il, il est mort !
Avec une bravoure sans égale, il n’attendait que la lueur d’un coup de revolver qui pouvait le tuer pour frapper son ennemi !
Et, comme celui-ci ne tira pas, Robert Pascal immédiatement en conclut que Sinnamari n’avait rien entendu du tout ; et, tout valait mieux que cette dangereuse immobilité, le jeune homme avança dans le noir. Il tourna en silence autour de ce froid pilier de pierre qui s’enfonçait dans la terre et, tout à coup, il comprit ce qui venait de se passer.
Il n’eut que le temps de se rejeter dans l’obscurité de l’escalier. Il était arrivé à la dernière marche, et Sinnamari était dans la cave ou plutôt dans une espèce de vaste crypte, assez haute et qui tenait tout l’espace compris entre les fondations du pavillon.
On n’avait point divisé, ainsi qu’on le fait d’ordinaire pour les caves, cet espace en plusieurs caveaux. Il y avait là une unique salle souterraine dont le plafond de plâtre et de ciment, entre des poutrelles de fer, était soutenu çà et là par des piliers de briques. L’air qu’on y respirait était étouffant, pourri, moisi, horrible. Cette salle n’avait d’autre ouverture que celle de l’escalier.
Sinnamari avait dû, examinant la dernière marche, s’arrêter pour regarder la salle, la reconnaître, voir déjà de loin, si rien n’y avait été changé. Ainsi s’expliquait son immobilité de tout à l’heure. Et puis, il s’était avancé dans la crypte. Ainsi se comprenait l’obscurité soudaine dans laquelle avait été plongé l’escalier.
Maintenant, il errait toujours, son rat de cave à la main, entre les piliers. Il se promenait la main haute, dressant son luminaire, la tête basse, regardant la terre. Et il faisait ainsi le tour de la cave, s’arrêtant parfois, s’adossant à un pilier et paraissant réfléchir.
Le plus curieux, c’est que dans cette salle-tombeau, il n’y avait rien. Rien entre les murs, rien entre les piliers. Sinnamari resta bien là cinq minutes, dans le plus profond silence. Puis il eut un ricanement sinistre et il dit tout haut : « Quand on est mort, c’est pour longtemps ! » Cette phrase banale et macabre, dans le mystère de cette espèce de crypte insoupçonnée, prit un accent si lugubre que tout autre que Sinnamari qui l’eût prononcée en eût été effrayé.
Robert comprit alors plus que jamais que l’heure n’était pas encore venue et que quelqu’un le retenait, par-derrière ! Qu’avait-il demandé ? À voir ! Eh bien voilà : l’« au-delà » lui montrait un tombeau ! Et, du fond de son cœur farouche, Robert Pascal remercia l’ombre de sa mère de l’avoir si vite entendu… et d’avoir permis que Sinnamari ne fût point déjà entre ses mains, mort d’une mort trop brève qu’on ne voit pas venir !
Toujours est-il que, une demi-heure plus tard, quelqu’un qui se fût trouvé à la fenêtre de la mère Fidèle, à l’« Auberge des Assassins », eût vu sortir Sinnamari, sain et sauf, de la petite maison de la rue des Saules. Que s’était-il passé au juste entre Sinnamari et Robert Pascal, au fond de cette étrange cave ?
Mais ce qu’il eût été à peu près impossible à quelqu’un qui se fut trouvé à la fenêtre de la mère Fidèle de deviner – même s’il en avait su déjà autant que nous – c’est la raison pour laquelle cinq heures plus tard, à huit heures du matin, Robert Pascal se retrouva à califourchon sur le mur de la petite maison de la rue des Saules, avec une figure de désespoir si effroyable qu’elle eût fait reculer Dante sur le seuil de l’enfer. Il regarda à droite et à gauche, en face, ne vit personne, et R. C. sauta dans la rue.
Or, il y avait quelqu’un à la fenêtre de la mère Fidèle ! Il y avait eu quelqu’un toute la nuit, à cette fenêtre – quand je dis à la fenêtre de la mère Fidèle, je veux dire à l’une des fenêtres de l’auberge tenue par la mère Fidèle. Il ne s’agit que de s’entendre. Le premier étage – le seul – de l’auberge du Bagne était distribué en deux chambres. C’était donc à la fenêtre de l’autre chambre qu’il y avait eu quelqu’un toute la nuit, quelqu’un qui avait veillé et surveillé, qui avait assisté sans mot dire aux allées et venues de Robert Pascal, qui l’avait vu jeter un coup d’œil soupçonneux sur l’auberge et puis se livrer à son escalade ; quelqu’un qui avait vu entrer Sinnamari par la petite porte du mystérieux jardin, qui avait vu sortir le même Sinnamari aussi calme qu’il y était entré, et qui voyait maintenant sortir Robert Pascal, à huit heures du matin, dans cet état désespéré.
Sitôt qu’elle eut aperçu Robert, la personne dont nous parlons abandonnait immédiatement son observatoire pour dégringoler l’escalier de l’auberge avec un grand bruit de bottes et de canne. La canne semblait moins servir à soutenir cette personne qu’à faire du bruit et à frapper plancher et murs à tort et à travers, sans raison apparente, mais avec force.
Robert Pascal se retourna et fut stupéfait de voir soudain apparaître, sur le seuil de l’Auberge du Bagne, un être unique par sa laideur, un individu sans forme sérieuse, une gesticulation plus encore qu’un être humain, un gnome dont l’aspect sembla le remplir de fureur.
– Ah, c’est vous, monsieur Macallan ! dit-il…
Il dit cela… et ses yeux eussent voulu tuer le gnome.
– Oui, c’est moi, M. Macallan ! Moi ! répliqua le gnome, dont l’allégresse, soudain, ne connut plus de bornes.
– Qu’est-ce que vous faites ici à une pareille heure ? demanda Robert Pascal en essayant de se dompter.
Mais l’autre riait et, tout en riant de ses dents de loup, criait :
– Ah ! Tu as le nez fin ! Tu as le nez fin, mon fils !
Et il se moquait maintenant.
Et il répétait :
– Ah ! Tu as le nez fin ! Tu as le nez fin ! I am very sorry ! Je suis bien désolé !
– De quoi ? Vous êtes désolé de quoi ? demanda Robert Pascal, en serrant les poings. Parlez sérieusement, monsieur Macallan, car je vous jure que je ne suis pas d’humeur, ce matin, à baguenauder avec votre seigneurie…
– I am very sorry for the trouble I have given you ! Je suis bien fâché de la peine que je vous ai donnée.
Robert Pascal se troubla alors tout à fait :
– Depuis quand êtes-vous ici, monsieur Macallan ?
– Oh ! Depuis le commencement du monde !… Ah ! que tu es beau, jeune homme ! Un jeune homme beau comme un jeune dieu ! How pleased I am ! Dieu, que je suis content !
– Depuis quand êtes-vous ici, monsieur Macallan ? répéta Robert Pascal, sur un tel ton de menace, cette fois, que M. Macallan recula, effrayé…
– Reviens à toi, R. C. ! fit sérieusement, cette fois, le gnome. Et il prit une voix tendre. Vous savez si je vous aime, mon ami !…
– Répondez ! Depuis quand ?
R. C. s’avançait sur lui, la main levée.
– J’ai passé ici la nuit ! finit par avouer Macallan, en regardant avec anxiété Robert Pascal.
Robert regarda, toute colère tombée, M. Macallan avec un tel air de douloureux reproche que M. Macallan en fut encore tout ému.
– Tout cela, dit solennellement R. C., en passant la main sur le front, aura une fin…
– Possible ! répliqua en souriant Macallan. Et il rebondit sur ses pattes, agitant son gros bâton… Possible ! Ça aura une fin ! Vous avez le nez fin, monsieur, mais on peut avoir le nez fin et une dent creuse !
Et quand il fut dehors, il courut, se sauva, criant par-dessus ses épaules :
– Vous avez une dent creuse, my dear friend ! Et je vous l’arracherai !
Il n’était plus qu’un petit point gesticulatoire en haut de la rue des Saules, qu’on l’entendait répéter encore de sa voix glapissante : « Une dent creuse ! Une dent creuse !… »
XIII – LE VENTRE DE PARIS
L’avenue Victoria, où habite la direction de l’Assistance publique, est une voie moderne, froide et triste, bordée de hautes maisons en pierres de taille, sans aucun style, sans aucune physionomie particulière.
C’est cependant une rue majestueusement bourgeoise, mais rébarbative. On dirait qu’elle a pris ce visage-là exprès pour intimider les pauvres diables, depuis que la charité publique, laïque et obligatoire y a installé sa demeure. Et, de fait, la veuve sans ressources, la mère abandonnée, la vieille qui ne sait pas où elle doit mourir et la fille qui ignore où elle a le droit de mettre son petit au monde, ceux qui ont froid et ceux qui ont faim, et ceux qui n’ont plus rien sur la terre que leur misère sont pris d’un frisson nouveau dès qu’ils pénètrent dans cette voie, au bout de laquelle ils trouveront moins assistance que l’Assistance ! Hélas ! ils n’ont point d’illusion ! Ils savent bien que, venus pour demander un secours, ils s’en retourneront avec un renseignement.
L’Assistance a là un beau bâtiment. Traversons une première cour – sinistre comme une cour de prison ou une cour de lycée – et gravissons deux étages. Un huissier tout noir, à chaîne d’argent, se promène, placé là, semble-t-il, moins pour annoncer les visiteurs que pour les arrêter.
Et cependant ceux qui tentent de se faire annoncer par cet imposant fonctionnaire doivent être eux-mêmes presque des personnages, car, enfin, il faut n’être point dénué d’une certaine audace pour oser avoir l’espérance de pénétrer tout de go chez M. le directeur adjoint, ou même chez le grand maître de l’Assistance publique, puisque le directeur en chef, depuis des années, ne s’occupe plus de rien… de rien que de ses rhumatismes… C’est – pour tout dire – M. Eustache Grimm lui-même !
Dans une première pièce, de vagues ombres attendent sur de vagues fauteuils… L’huissier ne semble même point se rappeler leur présence. Puisque, pour le moment, nous devons faire antichambre, examinons ce bel homme d’huissier, bien grand, bien gros, au ventre gaillard. Avec quelle tranquillité, sérénité, sécurité, il se promène dans cette maison dont il a la garde ! Comme il la sent solide sous ses pas pesants, et éternelle comme la misère du monde !
La paix majestueuse de son esprit et de ses gestes est faite de toute l’angoisse, de toute l’inquiétude, de toute l’incertitude de ceux qui viennent s’asseoir quotidiennement entre ses rideaux verts et qui supplient en tremblant « Monsieur l’huissier » de les annoncer à M. le directeur ou à M. le secrétaire ou à un n’importe qui de l’administration !…
Si le spectacle d’un huissier qui se promène, les mains derrière le dos, à pas pesants, dans les salles d’attente de l’Assistance publique est propre à inspirer une telle philosophie, en somme assez commune, quelle réflexion ce spectacle fera-t-il naître dans l’esprit de celui qui, doué d’une grande finesse des sens et de l’entendement, aura deviné dans cet auguste fonctionnaire un suppôt, disons plutôt un soldat déguisé de notre roi Mystère ? Du coup, cet esprit imaginera que, malgré la tranquille apparence des choses, des catastrophes vengeresses sont prêtes à éclater dans l’administration.
Ainsi, ce gros monsieur enchaîné d’argent qui nous paraissait jouir comme une brute de sa haute situation administrative ! Regardez plutôt attentivement les mains de M. Lambert, et voyez comme elles sont grassouillettes. Je n’ai connu, ma foi, de mains pareilles aux doigts si gentiment boudinés qu’à un M. Cyprien, qui fut un certain temps huissier chez M. le procureur impérial, et qui disparut de son poste dans des circonstances bien étranges.
M. Lambert a, je crois bien, d’autres points de ressemblance avec M. Cyprien, que l’on retrouverait plus facilement sans cette trop belle barbe qui lui descend jusque sur le nombril… Allons ! Allons ! Ce n’est pas possible ! L’Assistance publique a beau soigner ses huissiers, elle ne leur donne pas un ventre pareil en quelques jours ! À moins que celui-ci ne se soit mis un faux ventre pour flatter son maître, le directeur-adjoint de l’Assistance publique, Eustache Grimm, qui, comme chacun le sait, a le plus beau ventre de Paris.
Une porte, là-bas, tout au fond, claque. Un grand dégingandé d’employé à longue redingote noire luisante, porte-plume à l’oreille, registre sous le bras, traverse la salle d’attente, arrive dans le petit cabinet où se trouve M. Lambert, huissier.
L’huissier arrête l’employé et lui tend une petite feuille de papier qu’il a vivement tirée de son gousset.
– Vous savez lire, monsieur Lepage ? Moi, je suis si myope que même avec mes lunettes…
– Tais-toi, Martinet (nous savons que le vrai nom de l’ex-M. Cyprien, aujourd’hui Lambert, est Martinet) ordonne M. Lepage, en jetant un coup d’œil rapide autour de lui… et il lit.
– On t’a remis ça ce matin, à la Profonde ? interrogea Lepage.
– Oui, au rapport !… Il paraît que ça presse, j’ai demandé un mot d’écrit. Depuis mon aventure, je ne marche plus qu’avec des ordres écrits, moi ! Le lieutenant a rigolé.
– Le Vautour ?
– Oui ! il paraît que la mort de ce pauvre concierge a mis R. C. dans un état !
– Euh ! fit Lepage, en se grattant la tempe, qu’il avait singulièrement ridée, marquée, pareille à une patte d’oie. R. C. est un sentimental !
– Un sentimental qui te brûlerait la cervelle sans te donner le temps de recommander ton âme au diable, Patte d’Oie ! Souviens-toi de cela, mon garçon…
– C’est bon ! répliqua en toussotant M. Lepage, Le grand Dab, c’est le grand Dab, quoi ! Tu as lu ?
– Bien sûr !… répondit Lambert en haussant les épaules.
– Eh bien, reprends ton papier, je n’en ai plus besoin, et annonce-moi chez M. le directeur-adjoint.
Lambert reprit le papier et le fit de nouveau disparaître dans sa poche, après y avoir jeté un dernier coup d’œil qui parut l’enchanter. Sur ce papier, on avait écrit cette phrase :
– Faire passer l’ordre à P. O. de commencer à troubler les digestions de M. le Directeur-adjoint.
Au bout de la phrase, il y avait un cachet qui était une tête de mort, et puis ces lettres qui étaient les initiales du Vautour : L. V.
Lambert poussa la porte-tambour, entra chez le directeur et revint, faisant un signe à Lepage ; celui-ci pénétra à son tour chez le directeur, son registre sous le bras.
Eustache Grimm était à son bureau : c’était un très ancien bureau de style Louis-Philippe, si l’on peut dire, qui avait servi à de nombreux directeurs de l’Assistance publique avant d’échoir à Eustache Grimm. Mais le fauteuil qui se trouvait derrière ce bureau, et dans lequel reposait l’admirable sphéricité de M. le Directeur, était quasi tout neuf.
Oui, il avait fallu faire un fauteuil exprès pour les formes de M. le Directeur. Jamais Eustache Grimm n’avait montré un si beau ventre que depuis que la cotisation de MM. les chefs de bureau reconnaissants lui avaient offert ce fauteuil unique. C’était là un trône-fauteuil dans lequel reposait le ventre-roi. Ah ! le ventre de M. le directeur de l’Assistance publique ! Quelle merveille ! Et quel symbole ! C’était le ventre même de l’administration, grassement nourri de pitié, compassion, sensibilité, commisération, et autres succulentes viandes et divines graisses et digestifs, légumes servis à la sauce « soirée de gala », ou à la sauce « tombola », ou à la sauce « vente de charité », ou à la sauce « représentation à bénéfice », ou à la sauce « notaire » qui est faite d’un arrangement savoureux de dons, donations et legs.
Dans le moment, M. Eustache Grimm se contentait pour ses apéritifs d’une vieille bouteille de madère qui lui venait en droite ligne du Funchal, et qui lui avait été envoyée, avec beaucoup d’autres, par la reconnaissance émue d’un bienfaiteur de l’Assistance publique, auquel il avait fait avoir les palmes académiques.
M. le directeur trempait paisiblement un biscuit dans la liqueur dorée qui, il le proclamait, était âgée de cent deux ans et six mois, et, se léchant les babines, il vit venir à lui en souriant M. Lepage, qui lui faisait un grand salut.
– Mon bon Lepage, nous apportez-vous de bonnes nouvelles ? demanda M. le directeur à cet employé fidèle, peut-être moins fidèle cependant qu’il était maigre, si maigre qu’en le voyant à côté du ventre de M. le directeur, on ne savait plus si l’on devait ou s’étonner de l’épaisseur de celui-ci ou se passionner plutôt pour la transparence de celui-là !
– Il y a des nouvelles qui sont bonnes pour les uns et mauvaises pour les autres, répondit sentencieusement M. Lepage.
– Finissons-en ! Que venez-vous me dire, mon ami ?
Et, lâchant son biscuit et son verre, M. Eustache Grimm se croisa les mains sur le ventre. C’était un geste qui lui était depuis longtemps familier, mais maintenant il arrivait à le faire tout juste.
– Monsieur le directeur, pour vous dire d’abord ce qui me tracasse… il se passe ici des choses étonnantes.
– Ah çà ! s’écria le directeur en sursautant sur son fauteuil, ce qui fit osciller le ventre-roi… Ah çà ! Ce ne serait pas encore ce R. C. ?
– Justement ! Je crois bien que c’est lui, monsieur le directeur… J’en suis même sûr, car il s’est arrangé pour que nul n’en ignore !…
– Mais il nous fichait la paix depuis quelques semaines !… Est-ce qu’il va recommencer ?… Ça n’est pas fini, ces plaisanteries-là ?…
– Ça n’en a pas l’air, monsieur le directeur… Vous savez, entre nous, appuya Lepage en lançant à Grimm un coup d’œil que M. le directeur s’efforça de ne point voir… Vous savez avec quel soin je relève nos écritures ?
– Je le sais, mon ami, je le sais, vous êtes un employé précieux…
Lepage ouvrit tout à coup son registre et l’étala sous les yeux d’Eustache Grimm. Celui-ci essaya de se pencher pour mieux voir, mais il fallut que l’employé lui mît le registre sous le nez.
– Vous ne voyez pas là, en marge, ce que j’ai trouvé ce matin dans nos écritures, monsieur le directeur ?
– Ça ?… La note au crayon ?
– Oui, lisez…
Et Eustache Grimm, qui avait son large binocle d’écaille, lut : « Ces comptes sont faux ! R. C. »
– Bah ! fit M. le directeur en relevant la tête et en reposant son binocle… Voilà que ce R. C. se mêle encore de nos écritures, et qu’il prétend que notre comptabilité n’est pas en règle !… Qui est-ce qui a pu écrire cette note-là ?…
– Est-ce qu’on sait ! Moi, je jette ma langue au chien ! On enferme les registres à double tour la veille au soir… Le lendemain matin, on les retrouve avec des signes cabalistiques !
– Qu’est-ce que ça peut vous faire, répliqua tranquillement Eustache Grimm, puisque votre comptabilité est en règle ?…
– Voilà bien le malheur, monsieur le directeur ! C’est que justement ma comptabilité n’est pas en règle !
Eustache Grimm, du coup, se leva :
– Comment ? Elle n’est pas en règle ? Et pourquoi n’est-elle pas en règle ?
– Parce que je l’ai falsifiée !…
– Oh ! fit Grimm en retombant de tout son poids sur le fauteuil qui gémit, lui aussi !
– Oui, ajouta Lepage, très calme, j’avais besoin d’argent.
Il y eut un silence. Lepage attendait M. le directeur qui essayait de reconquérir son sang-froid. Il eût voulu évidemment livrer le mauvais comptable Lepage au bourreau, mais des raisons supérieures semblaient devoir faire remettre à plus tard une exécution aussi sommaire.
– Combien vous faut-il, monsieur Lepage, pour que votre comptabilité soit, le plus tôt possible, en règle ?
– Monsieur le directeur, fit-il, ne prononce jamais de paroles inutiles. Je ferai comme monsieur le directeur… Il faudrait à notre comptabilité cinquante mille francs pour qu’on n’ait rien à lui reprocher…
M. le directeur crut avoir mal entendu.
– Vous dites ?
– Je dis : cinquante mille francs.
– Vous êtes fou, monsieur Lepage.
– J’ai tout mon esprit, monsieur le directeur. Je dois vous dire que j’ai été moi-même étonné de la somme quand, averti par la mystérieuse indication de R. C., je me suis mis à refaire mes comptes. Et mes erreurs ont-elles pu s’oublier jusque-là ? Hélas ! Quand on commence à faire de fausses écritures, monsieur le directeur, on ne saurait dire où elles pourront s’arrêter. Le faux entraîne le faux, le crime engendre le crime ! J’ai dû commencer par une bagatelle… et voilà où nous en sommes !
– Comment ! Où nous en sommes ?…
– Évidemment ! Un autre à ma place se serait brûlé la cervelle ! Voyez quel ennui pour vous, monsieur le directeur !…
– Monsieur Lepage, dit M. Grimm, vous êtes une canaille !
M. Lepage reçut l’insulte sans émoi.
– Heureusement, monsieur le directeur, car voyez ce qui serait arrivé si j’avais été un honnête homme : je me serais brûlé la cervelle, c’est une affaire entendue ! Aussitôt on se serait demandé pourquoi… La justice aurait mis le nez dans mes livres. Les faux seraient apparus. Comme ils sont d’importance, l’opinion publique se serait émue que de telles malversations puissent être commises à l’Assistance publique sans que M. le directeur-adjoint les eût même soupçonnées. Interpellations de M. le préfet de police au conseil municipal, et du ministre de l’intérieur à la Chambre. On nomme des commissions d’enquête. Le scandale éclate. On s’aperçoit que l’affaire Lepage n’est rien à côté de l’affaire…
– Taisez-vous ! Taisez-vous, Lepage !…
– À côté de l’affaire Eustache Grimm…
– Voulez-vous vous taire…
– On arrête M. Eustache Grimm.
– Assez !
– On le conduit en prison.
– Lepage !…
– On le juge !
– Mon petit Lepage !…
– On le condamne à mourir de faim dans un cachot !…
– Grâce !…
M. Lepage s’arrêta. M. Lepage eut pitié de M. le directeur. Celui-ci s’était écroulé dans son trône-fauteuil et il roulait des yeux hagards dans une face livide. Quand il put parler, il dit avec effort :
– C’est bien, monsieur Lepage. Vous aurez vos cinquante mille francs, mais à une seule condition ! D’abord, vous remettez toutes vos écritures en règle. C’est une clause à laquelle je veillerai moi-même ; ensuite, vous me ferez le plaisir de quitter mon service et d’aller vous faire pendre ailleurs…
– Impossible ! s’écria l’employé sur le ton de la plus grande douleur. Impossible !
– Quoi ! qu’est-ce qui est impossible ?
– Je ne peux vous quitter !…
– Pourquoi ?
– Je vous aime trop, monsieur le directeur.
Eustache Grimm prit sur son bureau son binocle à garniture d’écaille, en chaussa son nez et, fixant Lepage d’un regard qui avait, de toute évidence, la prétention de « méduser » l’audacieux et dangereux fonctionnaire :
– Monsieur Lepage, déclara-t-il d’une voix traînante et dolente et qu’il jugeait d’autant plus importante, vous avez voulu occuper ici la place de ce pauvre Didier…
– Je la jugeais enviable, monsieur le directeur…
– Et cependant elle ne lui a guère réussi.
– J’avais tant le désir de lui succéder, monsieur le directeur, je ne vous l’ai pas caché… Et je vous ai dit : « Ne vous faites pas de bile, monsieur le directeur, ce pauvre Didier n’est pas bien dangereux, allez ! Il est amoureux, et il arrive tant de vilaines histoires aux amoureux… »
– C’est bon ! Il est tout à fait inutile de reparler de ces choses qui sont du reste sans importance.
– Pardon ! Pardon ! insista Lepage. C’est vous le premier, monsieur le directeur, qui vous êtes tourmenté sur le sort de ce pauvre Didier… Vous avez été très intéressé alors par ce que je vous disais des amours de Didier, monsieur le directeur, et quand vous eûtes appris qu’il était amoureux d’une jeune femme en possession d’un amant fort jaloux, vous vous êtes mis à le plaindre si sincèrement qu’on eût pu croire qu’il était déjà arrivé malheur !…
– Oh ! interrompit Grimm en soufflant… Vous me disiez donc, monsieur Lepage, qu’il vous faut cinquante mille francs.
– L’amant, continua l’employé sans prendre garde à l’interruption, un nommé Costa-Rica, reçut communication d’une lettre signée Didier dans laquelle Didier donnait rendez-vous à la Mouna, maîtresse de Costa-Rica, chez lui Didier, en l’absence de Mme Didier. Cette preuve de la trahison de sa maîtresse fut envoyée à l’amant de la Mouna par un inconnu qui l’avait enveloppée dans une autre lettre, anonyme, celle-là, naturellement.
– C’était bien inutile ! fit remarquer doucement Eustache Grimm, et je ne vois pas pourquoi vous perdez votre temps, monsieur Lepage, à me raconter ces histoires de l’autre monde !…
– Un peu de patience, monsieur le directeur, et tout à l’heure, j’espère que vous allez me comprendre… L’inconnu, dans cette lettre anonyme, expliquait qu’il avait par hasard surpris ce billet amoureux et qu’il se faisait un devoir de le faire parvenir à la connaissance d’un ami, ajoutant que c’étaient là des services qu’on ne saurait trop se rendre entre amis.
– Je ne saisis pas !… Où voulez-vous donc en venir ?
– Attendez ! Quand il fut en possession de ces deux lettres, l’amant trompé arriva à l’heure fixée pour le rendez-vous chez Didier et sonna. La porte fut ouverte par Didier, qui se trouvait seul chez lui, comme il était nécessaire. Vous lui aviez donné congé ce jour-là, monsieur le directeur. L’amant bondit sur Didier et l’étrangla net ; puis, il le pendit à la fenêtre et s’en alla. L’affaire devenait admirable. Un suicide était bien préférable pour vous à un assassinat !
– Oh ! Lepage !… Silence ! Malheureux !…
– Comment, silence ! C’est maintenant que la chose devient intéressante…
– Pourquoi me forcez-vous à écouter de pareilles choses que je ne dois pas connaître, Lepage !… Qui ne regardent que vous, Lepage !
– Ah ! Vraiment ! Vous croyez qu’elles ne regardent que moi ?… Eh bien ! mon cher directeur, je me charge de vous guérir de cette fâcheuse erreur ! On n’avait pas plutôt constaté le suicide de Didier qu’une lettre anonyme arrivait au parquet affirmant qu’il y avait eu assassinat. Et Costa-Rica était dénoncé comme l’auteur… On interrogea cet homme… On trouva immédiatement les preuves flagrantes de son innocence, un alibi incontestable, on ne l’inquiéta même pas… Heureusement pour vous, monsieur le directeur !
– Comment, heureusement pour moi ! répéta terriblement anxieux, Eustache Grimm… Qu’ai-je à faire dans tout ceci, moi ?…
– Je dis heureusement pour vous, parce que si Costa-Rica avait été convaincu du crime, il n’eût pas hésité à montrer, pour se trouver des circonstances atténuantes, les deux lettres qu’il avait reçues et qui l’avaient conduit, comme par la main, à l’assassinat ! On n’eût pas tardé à découvrir que la lettre de rendez-vous n’avait pas été écrite par Didier, puisque Didier connaissait à peine la Mouna, ne l’ayant vue que de temps à autre, aux courses, le dimanche, aux côtés de Costa-Rica, book-maker du Pavillon à qui Didier confiait parfois d’assez gros paris… mais Didier n’avait jamais été l’amant de la Mouna et ne pouvait lui donner rendez-vous…
– Après ?…
– Après, on eût voulu savoir qui avait intérêt à exciter la jalousie bien connue de Costa-Rica et à s’en faire l’instrument d’un crime… On eût voulu savoir qui avait écrit la fausse lettre Didier…
– On eût peut-être découvert que c’était vous !…
– On n’eût rien découvert du tout pour cette lettre-là ; malheureusement pour vous, il y avait l’autre, la lettre d’avertissement, la lettre anonyme…
– Toujours écrite par vous misérable !
– Oui… toujours écrite par moi… Mais voyez la malheureuse, la triste, la regrettable coïncidence… Écrite par moi sur du papier de votre bureau, monsieur le directeur !
– De mon bureau !
– Oui, vous avez du papier spécial, fait pour vous et qu’on ne trouve que chez vous, monsieur le directeur ! Entendez-moi bien !
– Oh ! je vous entends ! Je vous entends, râla Eustache Grimm, mais que prouve contre moi ce papier que vous m’avez volé ?
– Il ne prouverait pas évidemment grand-chose, reprit Lepage, si, par une autre regrettable coïncidence, la lettre anonyme, mon cher directeur, qui est écrit sur votre papier, n’était également… de votre écriture !
Eustache Grimm d’abord crut qu’il comprenait mal, et on l’entendit souffler bruyamment. Puis la vérité de la terrible situation dut envahir tout à coup son cerveau congestionné, car il se précipita comme un fou sur Lepage, les mains en avant, les doigts crochus… Mais son ventre l’arrêta dans son élan, et, du reste, le bureau était une suffisante barrière entre M. le directeur et M. l’employé. Celui-ci, impassible, continuait :
– Vous comprenez, monsieur le directeur, qu’avec le joli talent dont je dispose, il ne m’est pas plus difficile d’imiter votre écriture que celle de Didier… Que dis-je, imiter ?… faire de votre écriture !… La preuve, la voilà !
Et, prenant sur le bureau du directeur la plume du directeur, il écrivit sur le papier du directeur, avec l’écriture du directeur, ces mots : « M. Lepage est le plus honnête, le plus travailleur, le plus ponctuel des employés. C’est l’employé modèle. Il mérite une gratification. Je la fixe à cinquante mille francs. C’est pour rien ! »
Eustache Grimm regardait son écriture s’allonger sur le papier. Il ouvrait de petits yeux énormes. Rien n’y manquait, ni la boucle affable des fins de mots, ni la barre un peu molle des t, ni la façon d’accentuer, ni rien ! Il n’en fallait pas davantage à un expert pour envoyer un homme à la Guyane ou à l’Abbaye-de-Monte-à-Regret.
– Enfin, soyez heureux, monsieur le directeur, acheva Lepage, que je n’aie pas signé la lettre en question, car il n’y a pas une signature au monde que je possède aussi bien que la vôtre !…
Et il signa, de la signature d’Eustache Grimm.
Eustache Grimm n’en pouvait pas supporter davantage. Il allait certainement rouler sur le parquet quand la porte de son bureau s’ouvrit et l’huissier annonça :
– M. le comte de Teramo-Girgenti !
XIV – OÙ IL EST PROUVÉ QUE PHILIBERT WAT A BON CŒUR
Si, après avoir quitté le boulevard Saint-Germain, vous longez cette partie de la rue Saint-Dominique qui va de la rue de Bellechasse à la rue de Bourgogne, vous ne tardez pas à trouver sur votre droite une guérite décorée aux couleurs nationales et dans laquelle se tient un pioupiou baïonnette au canon. Guérite et pioupiou sont chargés de veiller sur la sécurité d’une vaste cour au fond de laquelle s’élève une bâtisse de pierres de taille, de ce style que l’on pourrait appeler « ministériel ».
Cette bâtisse est la demeure du ministre de la guerre. Quand on pénètre dans les bureaux de l’état-major, on est tout de suite impressionné par l’ombre et le silence des couloirs, par l’odeur un peu fade qui se dégage des murs. Nul bruit de sabre qui traîne, d’éperon qui sonne. Là, quand un officier passe, on s’aperçoit qu’il n’est armé que d’une plume.
Il y a des gens stupides, qui ne peuvent voir un officier dans un bureau sans dire, par exemple, s’il est colonel : « Pourquoi n’est-il pas à la tête de son régiment ? » ou bien, s’il est général : « Voilà un beau général qui ferait bien à la tête de sa division ! » Eh bien ! Et le service intérieur ? Et les comités ? Et les commissions techniques ? Et les commissions d’études ? Et les commissions de perfectionnement ? Il en faut ! Il en faut ! L’armée ne passe pas tout son temps à se battre, heureusement ! Elle mange, et il lui faut des gamelles ; elle s’habille, et il lui faut des vêtements ; elle se couche, et il lui faut des lits, des lits militaires !
Certes ! Là comme partout ailleurs, on y trouve des brebis galeuses, mais je connais, moi, des officiers d’état-major, qui sont l’honneur de l’armée française.
Cependant ce jour-là – le jour où nous pénétrons dans les bureaux de la guerre – ce brigand de Régine était en train de vendre une décoration – car la vente des décorations n’a pas été, comme on pourrait le croire, une invention de la troisième république – et écoutait les doléances de Mme Demouzin.
Écoutait-il vraiment la bonne dame ? La tête dans les mains, les coudes sur son bureau, était-ce là attitude de profonde et silencieuse attention, ou simplement de fatigue et de prostration ? Mme Demouzin agitait, assez perplexe, les plumes en points d’interrogation de son extravagant chapeau, et disait :
– Je sais, mon cher colonel, je sais le malheur qui vous frappe, et soyez persuadé que nulle plus que moi n’y prend part… Ces pauvres petites… elles étaient si mignonnes… Oh ! elles le sont encore, cher colonel. Il n’est point possible que… Enfin… Vous les retrouverez… Le ciel ne voudra pas !… Avec le pouvoir dont vous disposez… avec la police… avec vos amis, vous les retrouverez…
L’ex-colonel, sans lever la tête, arrêta la bonne dame au milieu de ses protestations :
– Vous avez voulu absolument me parler de l’affaire Maupin de la Jeannotière, madame Demouzin ; je vous prie, dites-moi vite… vite où nous en sommes…
Mme Demouzin fut empêchée de dire un seul mot par l’entrée de l’huissier, derrière lequel on apercevait Philibert Wat.
– Ah ! Vous voilà, monsieur Philibert Wat !…
L’huissier disparut ; Régine, toujours affalé à son bureau, ne fit pas un mouvement. La mère Demouzin :
– Je suis bien aise de vous voir ici, car il faut en finir avec l’affaire Maupin de la Jeannotière… Il a remis soixante mille francs au Chemin de fer, m’a-t-il dit… et s’il n’est point décoré…
– Madame Demouzin, interrompit Philibert Wat, vous avez une fâcheuse habitude.
– Laquelle, je vous prie ?
– Celle de confondre les questions. Si M. Maupin de la Jeannotière est un jour décoré, veuillez croire que ce ne sera point parce qu’il a remis soixante mille francs au Chemin de fer, qui ne vend point de cette marchandise-là. Le Chemin de fer vend de la publicité, comme tout honnête journal qui se respecte. M. Maupin de la Jeannotière est libre de la réclame qu’il juge nécessaire à son commerce ! Et pour le prix qu’il lui plaît ! Inventeur d’une ceinture cartouchière qui présente des avantages indéniables pour le chasseur…
– Et pour le soldat, s’écria Mme Demouzin, ne l’oublions pas !
– Justement, et pour le soldat !… Si M. Maupin de la Jeannotière est décoré, il le sera uniquement pour avoir doté l’armée d’une nouvelle ceinture de guerre. Mais encore faut-il que le modèle de cette ceinture cartouchière ait été adopté, ce qui fatalement doit entraîner encore certains frais… C’est cela, madame Demouzin, qu’il faut lui faire comprendre à cet homme… et quand il aura compris, eh bien ! vous viendrez me retrouver…
Et Philibert Wat reconduisit Mme Demouzin jusque dans le corridor avec beaucoup moins de brutalité que ne l’aurait fait un Sinnamari.
Quand il revint, débarrassé de la vieille, il ouvrit ses bras à Régine qui s’y laissa aller en pleurant, et Philibert Wat pleura avec lui… Oui, Philibert Wat pleurait. Les larmes du gendre du président du conseil !
– Rien encore ? demanda Régine.
– Rien ! répondit Philibert Wat.
C’était une chose surprenante que ces deux hommes qui pleuraient comme des enfants. Quelle douleur commune pouvait ainsi les unir, eux dont l’amitié semblait n’être faite que de l’indivision de leurs crimes ?
Le colonel était retombé sur son fauteuil.
– Alice ! Renée ! répétait-il avec un tel accent de désespoir qu’on eût dit qu’en dehors de ces deux noms rien n’attachait plus cet homme à la vie !…
Si poignante que soit la douleur de Régine, celle de Philibert Wat, pour plus retenue, en paraît plus grande encore ! Est-ce là vraiment une douleur d’ami ? Et pourtant c’était ainsi ! Philibert Wat pleurait les enfants disparus de son ami, comme s’il avait été le principal intéressé de cette sinistre aventure ! Philibert Wat avait donc un bon cœur ? Mauvais esprit, bon cœur ! Il y a des crapules qui pleurent si facilement, mon Dieu !
– Je suis allé partout, dit Wat. J’ai mis la France policière sens dessus dessous. Tous les commissaires ne s’occupent que de la disparition d’Alice et de Renée ! Les pauvres petites ! J’ai reçu ce matin un mot d’Eustache Grimm me disant que, de son côté, il avait fait l’impossible… Aux Enfants-Trouvés, rien !…
– Si on ne les retrouve pas, fit Régine, j’en mourrai !
– Et moi aussi, déclara Philibert Wat.
Chose singulière. Philibert Wat paraissait sincère. Chose plus singulière encore, le colonel ne s’étonna point de la sincérité de Philibert Wat. Et, tout à coup, la douleur du colonel se fit furieuse :
– Mais enfin ! Qu’est-ce que je lui ai fait, qu’est-ce qu’il me veut, ce R. C. ? Pourquoi suis-je marqué comme un débiteur sur les livres ? Le roi des Catacombes ! Ah ! Que ne l’ai-je étranglé l’autre nuit !
– Le coup vient-il vraiment de lui ? demanda Wat.
– Comment en douter ? Cette feuille qu’on me laisse entre les mains pendant qu’on me vole les petites… Cette feuille sur laquelle il n’y a que deux initiales, R. C., ne nous renseigne-t-elle point suffisamment ?…
– En ce cas, répliqua lugubrement Philibert Wat, nous n’avons plus qu’un espoir… Et je le mets tout entier dans Teramo-Girgenti !…
– Teramo-Girgenti ! Vous êtes tous à me parler de votre Teramo-Girgenti… Je ne l’ai jamais vu, moi !
– Et moi, je ne l’ai pas revu depuis que j’ai appris la disparition d’Alice et de Renée… Il doit être en voyage… c’est ce qu’on m’a dit à son hôtel ; il doit revenir incessamment… Je passe chez lui dix fois par jour !…
– Et votre Teramo-Girgenti connaît bien ce roi des Catacombes ?
– Il a été autrefois son prisonnier.
– Et comment s’en est-il tiré ?
– Avec cinq millions…
– Ah ! Tout ce que je possède pour ravoir Alice et Renée, si c’est de l’argent qu’il lui faut ! Tout ce que je possède…
– Et moi aussi !
Cette réplique, qui prouvait le désintéressement hors de proportion de Philibert Wat, n’eut point encore le don d’étonner le colonel. Philibert Wat reprit :
– Vous dites : tout ce que je possède ! Vous oubliez donc Régine, que vous ne possédez plus rien…
– C’est vrai ! constata le colonel, stupéfait d’avoir oublié ce détail…
– Et puisque vous ne possédez plus rien, ce n’est donc pas pour avoir de l’argent que R. C. s’est emparé des petites…
– C’est encore vrai !… Mais alors, pourquoi ?… C’est épouvantable !
L’huissier rouvrit la porte du cabinet du colonel, et une femme jeune encore, élégante, distinguée, mais effroyablement pâle sous une voilette épaisse, fit irruption dans la pièce.
– Monsieur Wat ! Avez-vous quelque chose de nouveau ? demanda-t-elle tout de suite, d’une voix rauque, sans même faire un signe au colonel.
– Rien, madame !
C’était la femme du colonel, c’était la cousine de Sinnamari, c’était la mère d’Alice et de Renée…
– Rien ! répéta-t-elle, et Philibert Wat dut la soutenir pour qu’elle ne tombât pas… Mais le comte ?… Vous m’avez dit qu’il devait savoir… Il ne vous a rien dit ?
– Le comte, madame, n’est pas revenu… L’huissier entrait encore.
– Qu’est-ce ? demanda avec une impatience fébrile le colonel… je ne veux plus recevoir personne !
– C’est Eustache Grimm, fit l’huissier.
– Ah ! Eh bien, qu’il entre !…
– Mais, c’est qu’il n’est pas seul…
– Avec qui est-il ?
– Avec M. le comte de Teram… Teramo…
– Teramo-Girgenti ! s’écrièrent-ils tous en se précipitant vers la porte…
Eustache Grimm et Teramo-Girgenti entrèrent. Le directeur de l’Assistance publique paraissait aussi ému que les trois personnages qu’il trouvait réunis dans le cabinet du colonel Régine. Seul, le comte avait ce calme superbe qui ne l’abandonnait dans aucune circonstance de la vie. À peine avait-il eu le temps de s’incliner profondément devant la colonelle, à laquelle Philibert Wat venait de le présenter, que déjà celui-ci le prenait à partie. « Eh quoi ! Quel était un pareil ami qui disparaissait dans le moment qu’on avait le plus besoin de son secours ?… »
Dans le trajet de l’Assistance publique au ministère de la guerre, le directeur-adjoint de l’Assistance publique avait mis Teramo-Girgenti (que Wat lui avait dit être l’ami de R. C.) au courant de l’étrange acharnement avec lequel le ténébreux R. C. s’immisçait dans les comptes de son administration sans qu’il pût en deviner la cause, et il avait entretenu aussi le comte du service que l’on attendait de lui dans l’affaire de l’enlèvement des jumelles. R. C., l’incroyable R. C., se révélait comme leur ennemi commun.
– Oui, notre ennemi ! Et pourquoi ? gémissait Eustache Grimm.
– Notre ennemi à tous ! appuya Philibert Wat.
Le comte leva les yeux sur le premier gendre de France et ne put s’empêcher de marquer quelque étonnement de le voir si pâle et si défait.
– Nous sommes tous au désespoir ici, fit Wat ! Voyez dans quel état nous a mis l’acte infâme de votre ami R. C.
– R. C. n’est point mon ami, protesta Teramo-Girgenti.
– Nous n’avons plus d’espoir qu’en vous ! fit la pauvre mère, qui dévorait du regard le comte impassible. Si ce que notre ami, M. Wat nous a raconté de vous est exact, vous pouvez tout pour nous sauver !… Quant à moi, si mes filles ne me sont pas rendues avant vingt-quatre heures, je me tue… Vous pouvez dire cela de ma part, monsieur, à votre ami R. C. !
» Je vous demande pardon, monsieur, mais je ne puis entendre parler de ce R. C., de ce roi des voleurs, sans devenir folle !… Qu’est-ce que je lui ai fait, moi, à cet homme-là, pour qu’il me prenne mes enfants ? À moi, à moi, la femme du colonel Régine, la cousine du procureur impérial !
Soudain, la malheureuse s’arrêta, le regard vacillant, comme si elle venait d’apercevoir quelque chose qui l’épouvantait.
– Oh ! dit-elle… c’est peut-être à cause de cela !
– Madame, fit le comte, qui n’eut point l’air d’avoir entendu cette dernière exclamation… j’ai eu l’honneur déjà de me présenter chez monsieur votre cousin, pour qui j’avais une lettre de recommandation. N’est-ce point à lui que vous devriez vous adresser ? Il m’a eu l’air d’un fort bon parent !
– On voit bien que vous ne le connaissez pas encore !
Ceci fut dit avec une telle violence que Régine jugea de son devoir d’intervenir :
– Oh ! Lucie !…
– Vous, fit Lucie, sans interrompre sa colère, vous le connaissez !… Vous vous connaissez bien tous les deux !…
– Mon amie, murmura Philibert Wat, la douleur vous égare…
Cette scène fut troublée par l’entrée de l’huissier qui annonçait à Régine que le ministre de la guerre le demandait.
Sitôt qu’il fut sortit, sa femme se précipita sur Teramo, lui prit les mains, les serra avec fièvre :
– Monsieur ! Il faut nous sauver ! Puisque vous connaissez R. C., dites-lui, dites-lui bien que moi, moi, je ne suis pas son ennemie ! Et qu’il n’a pas le droit de se venger sur moi de ce qu’il peut avoir à reprocher aux autres !… Ah ! je m’entends bien et vous m’entendrez et vous me comprendrez !… Mon mari et mon cousin ont des ennemis terribles, terribles ! R. C. doit être un de ceux-là !… Il doit y avoir eu entre eux des choses !… Est-ce qu’on peut savoir avec mon mari, avec mon cousin ?… Mais moi, monsieur, moi, je n’aime pas mon mari et je déteste mon cousin, qui m’a mariée à ce Régine !… Laissez-moi, Wat ! Laissez-moi !
Il est difficile d’interrompre une femme en colère, surtout quand elle dit du mal de son mari, mais quand la fureur de la femme est doublée du désespoir de la mère, alors il n’est point de digue pour un tel flot. Le souci unique de son honneur n’est plus une barrière et le mouvement de sa rage emporte tout. Ainsi, le comte fut-il mis, à son corps défendant, au courant de la situation ménagère de ce pauvre Régine, le plus cyniquement du monde.
Volubile, farouche et très pressée, craignant le retour trop prompt du colonel, la cousine de Sinnamari continuait donc :
– Laissez-moi, Wat, laissez-moi ! (Philibert Wat trouvait que cette femme était en train de se livrer à des confidences inutiles)… Il faut que le comte sache que je n’ai point affaire, moi, dans les vieilles histoires de mon mari et de mon cousin !… L’action abominable de R. C. cache et prouve une vengeance !… Qui veut-il châtier ? Le colonel Régine, évidemment ! Sans quoi, il ne serait pas venu lui prendre mes enfants !… Je dis bien mes enfants pour que vous le lui répétiez, vous entendez, monsieur le comte !… Sa vengeance frappe à côté ! Mes enfants n’ont rien à voir, pas plus que moi, dans ce qui touche au colonel Régine ! La loi me force à habiter sous le même toit et à porter son nom, et c’est ce qui l’a trompé, votre R. C. !… S’il veut savoir qui sa vengeance atteint véritablement, qu’il vienne !… Amenez-le-nous, et qu’il me regarde, moi !… et qu’il le regarde, lui !…
Disant cela, la colonelle s’était retournée, tragique tendant le bras vers Philibert Wat.
Teramo-Girgenti avait compris, maintenant. Une ride plissa son front, et puis la sérénité la plus parfaite reconquit son calme visage, pendant que Philibert Wat se laissait retomber sur une chaise avec un geste de désolation définitive que l’on eût pu traduire par cette phrase : « Le sort en est jeté ! »
Quant à la colonelle, haletante encore de son aveu, elle attendait que Teramo-Girgenti parlât, lui donnât un mot d’espoir, et, comme il ne se pressait pas, elle lui dit :
– Et maintenant, monsieur, que pouvez-vous pour nous ?
Teramo ne répondait toujours pas. Lucie Régine s’exaspéra.
– Il y a une chose que vous pourrez encore lui dire, à votre ami, quoi qu’il arrive, que c’est un lâche ! On ne s’attaque pas à des enfants !
La porte s’ouvrit. C’était Régine qui revenait.
– Eh bien ? demanda-t-il, anxieux. Le comte se tourna vers lui.
– Madame, dit-il, vient de prononcer des paroles si émouvantes que je suis sûr que R. C. lui-même n’y résisterait pas ! Le mieux, voyez-vous, est que je vous présente tous à R. C. Alors, vous vous expliquerez ! Sa conduite dans toute cette affaire apparaît si bassement cruelle que je ne lui vois point d’excuse. Elle est peut-être le résultat d’un malentendu…
– Quel malentendu ? s’écria Régine. Quel malentendu peut-il y avoir entre ce brigand et nous ?…
– N’importe, fit Eustache Grimm, il vaudrait mieux s’expliquer. Je suis de l’avis de M. Teramo-Girgenti. Nous devons le voir. On s’entendra certainement. Nous ferons ce qu’il faudra pour cela !…
– Vous y êtes prêts ? demanda Teramo-Girgenti.
– Ce ne peut être qu’une affaire d’argent, indiqua en sourdine le directeur adjoint de l’Assistance publique. Et puis, enfin, on saura, après, à quoi s’en tenir !
Régine crispa les poings :
– Quand je pense que Sinnamari ne l’a pas encore fait arrêter !
La colonelle :
– Moi ! je veux le voir ! Vous ferez ce que vous voudrez, vous autres, cela m’est parfaitement égal… mais il faut que je le voie…
– Moi aussi ! déclara Régine d’une voix sourde.
– Moi aussi ! fit Eustache Grimm.
– Moi aussi ! souffla Philibert Wat.
Teramo-Girgenti :
– Puisque vous êtes tous d’accord…
– Où peut-on le voir ? interrogea, impatiente, la colonelle.
– Chez moi ! répondit le comte. Écoutez, madame, c’est après-demain que j’offre à mes amis ma première fête dans mon hôtel… une pendaison de crémaillère… R. C., à qui j’ai fait parvenir une invitation, m’a promis d’y venir… C’est une occasion unique…
– Il n’osera jamais !… s’écria Régine.
– Il craindrait d’être arrêté sur-le-champ ! dit Philibert Wat.
– Monsieur, répliqua le comte avec une grande froideur, on n’a jamais arrêté personne sous mon toit…
– Votre domicile n’est pas inviolable ! fit remarquer Eustache Grimm.
– Si, monsieur, il l’est !…
La colonelle dit, très agitée :
– Il n’y a rien d’inviolable pour mon cousin. Sinnamari le fera arrêter chez vous, monsieur, dans vos bras… ce qui, du reste, me serait parfaitement égal si mes enfants m’étaient rendus… Mais ce R. C. n’a pas l’air d’un niais. Il ne viendra point chez vous, monsieur !…
– Je m’y engage ! affirma Teramo-Girgenti. Sur sa parole ! Il n’y a jamais manqué. Il m’a promis de venir ; il viendra !… Et ce n’est ni le procureur impérial ni personne au monde qui pourrait l’en empêcher. Du reste, votre cousin, madame, m’a promis de venir, lui aussi.
– Lui aussi ! s’exclama Régine. Mais sait-il qu’il se trouvera en présence de R. C. ?
– Certainement ! Je lui ai écrit ce matin, lui rappelant mon invitation et le priant de ne point manquer à ma petite fête, qui sera d’autant plus intéressante, ai-je ajouté, que le roi des Catacombes l’honorera de sa présence.
– Il faut y aller ! Il faut tous y aller ! déclara Eustache Grimm. Il se passera là des choses certainement intéressantes.
– Oui, monsieur, obtempéra Teramo. On y fera de la musique et l’on y jouera la comédie.
La colonelle serra les mains du comte.
– Merci, monsieur, fit-elle, j’accepte. Malgré la catastrophe qui me frappe et qui est connue de tout Paris, j’irai à votre fête avec bonheur, puisque, grâce à elle, je reverrai bientôt mes enfants.
– Je l’espère, répondit Teramo-Girgenti en s’inclinant devant Mme Régine pour prendre congé… Je l’espère, car ce R. C… après tout, n’est point aussi dénué de cœur qu’on le prétend, et il trouvera certainement, colonel, que vous avez assez souffert comme père !
Sur cette dernière parole, le comte salua.
XV – LE LION AMOUREUX
Mlle Liliane d’Anjou habitait à Paris un magnifique appartement, sis au premier étage d’un des plus somptueux immeubles de l’avenue d’Iéna.
Liliane d’Anjou avait enchaîné Sinnamari et n’avait même point pour cela, qui était bien le triomphe amoureux le plus vaste qu’une courtisane pût concevoir, daigné sourire. Elle n’avait usé vis-à-vis de ce tout-puissant que de dédain et avec une telle persistance et opiniâtreté qu’il eût été difficile de trouver à Paris homme plus maltraité par sa maîtresse. Et, cependant, peut-être à cause de cela, Sinnamari était fou de Liliane. Cet homme, qui avait mis son ambition au-dessus de tout, eût peut-être été prêt à mettre son amour au-dessus de son ambition si Liliane le lui avait demandé, mais elle ne lui demandait rien ; rien que de l’argent, en échange de quoi elle lui avait promis son corps pour une époque qui restait encore à déterminer.
En vérité, Sinnamari en était là. Personne à Paris n’eût cru une chose pareille, et si les ennemis et surtout les amis de Sinnamari l’avaient su, ils auraient bien ri ; mais ils ne le savaient pas. Liliane avait répondu au terrible procureur qui l’avait suppliée de ne point laisser soupçonner autour d’elle et autour de lui que leur aventure en fût restée à ce point platonique – ce qui l’eût couvert de ridicule – qu’elle ne tenait nullement à lui faire affront et qu’elle était prête à proclamer qu’elle l’adorait, pourvu qu’il lui en demandât la preuve le plus tard possible.
Sinnamari savait qu’on ne comptait plus les amants de Liliane, et son malheur devait en apparaître plus grand. Une telle rigueur ne pouvait s’expliquer que par une certaine répugnance.
Ce jour-là, qui était celui où Teramo-Girgenti était allé au ministère de la guerre, Liliane était étendue dans une bergère de son boudoir, boudoir dans lequel elle n’avait pas encore permis à Sinnamari d’entrer depuis six mois que le procureur subvenait à tous les frais de la demi-mondaine. Mlle Nichette vint annoncer que Sinna demandait à la voir. Sinna était un diminutif charmant de Sinnamari, que ses amis lui donnaient souvent pour le flatter, car « Sinna » en arabe veut dire le Seigneur, le Maître, et que Liliane avait – pure ironie ! – adopté. Sans doute était-elle, ce jour-là, de bonne humeur, car elle sourit à Mlle Nichette et lui dit :
– Faites entrer ici !
Mlle Nichette fit une révérence à sa maîtresse et s’éloigna en murmurant : « Ce qu’il va être heureux, le singe ! »
Le singe, en effet, fut si heureux qu’il dut se faire répéter deux fois l’invitation de Liliane pour y croire. Mais Mlle Nichette le précédait déjà, lui ouvrait les portes, lui faisait traverser la chambre, qu’il n’entrevoyait jamais sans être prêt à défaillir comme un adolescent à ses premiers rendez-vous d’amour, et l’introduisait dans le boudoir. D’abord, il s’arrêta sur le seuil, contemplant Liliane dans un déshabillé, un peignoir léger qui laissait apercevoir presque librement la gorge admirable, et qui dessinait le mouvement de la hanche, la ligne de la jambe, le pied jouant négligemment avec la petite mule rose, agaçante. Nulle part plus que dans ce réduit intime, il ne l’avait vue plus désirable et il ne l’avait plus désirée.
Si Liliane fût restée deux secondes de plus à se polir négligemment les ongles, sans le regarder, il n’eût pu résister à la tentation ; il se serait jeté sur elle comme une bête. La soubrette était partie. Rien ne pouvait plus arrêter son élan… rien que le regard enfin levé de Liliane… Telles les bêtes fauves dans la cage, après avoir sournoisement préparé, dans le dos du dompteur, leur bondissement, reculent parce qu’il s’est retourné, tel Sinnamari prêt maintenant à s’agenouiller devant Liliane.
– Comment allez-vous, mon ami ? demanda Liliane en lui tendant une main qu’il baisa gloutonnement et qu’elle lui retira presque aussitôt, non sans marquer un recul de dégoût qui le fit sourdement gémir.
Car c’était ainsi. Chaque fois que cet homme l’approchait, elle n’était point maîtresse de cacher son instinctive horreur. Et pourquoi ? Elle n’eût pu le dire. Car Sinnamari était beau dans sa monstruosité morale et sa puissance physique. C’était un mâle magnifique que d’autres femmes, avec acharnement, se seraient disputé.
Mais elle, Liliane, pourquoi, elle qui ne pouvait le sentir près d’elle sans un frisson de dégoût, avait-elle permis son approche et lui avait-elle « laissé de l’espoir » ?… Pour l’argent ?… Non ! Il y avait d’autre argent que celui-là !… Pour se venger sur lui qu’elle était sûre de ne pas aimer, de tous ceux qui l’avaient trahie ?… Peut-être !… Pour obéir aux jeux du destin qui avait besoin de la réunion momentanée de ces deux êtres, afin que certaines choses nécessaires fussent accomplies ?… Est-ce qu’on sait ?… Il faudrait voir !…
Sinnamari s’assit sur un coussin aux pieds de Liliane. Ce formidable amoureux était ridicule. Il fut banal dans son trouble, ne trouvant pas ses mots pour la remercier de le recevoir dans un endroit qui, jusqu’à ce jour, lui était resté fermé.
– J’ai quelque chose à vous demander ! fit Liliane, l’interrompant dans son bredouillis.
– Tant mieux ! répondit Sinnamari… C’est accordé !…
– Oh ! répliqua doucement Liliane… Comme vous voilà !… Prenez garde, il ne s’agit pas d’argent…
– Enfin ! ne put s’empêcher d’exclamer le procureur.
– Merci ! répondit Liliane.
– Pardon ! reprit, honteux, Sinnamari.
– Allons ! parlons sérieusement : j’ai fait trois souhaits.
– Trois souhaits ! Vous n’en avez fait que trois, Liliane ? Je regrette qu’ils soient en si petit nombre, du moment où vous m’avez choisi pour les accomplir.
Liliane sourit à ce bel empressement.
– Alors, nous disons… le premier souhait ? demanda l’amoureux en levant le doigt.
– Celui-là n’est pas bien difficile… Il est déjà à moitié accompli, mais je voudrais être sûre qu’il le sera tout à fait…
– Vite de quoi s’agit-il ?
– D’abord, fit la demi-mondaine, d’abord, dites-moi, mon ami, que pensez-vous que je fais en ce moment ?
– Vous vous faites les mains.
– Eh bien ! Voilà où vous vous trompez, j’apprends mon rôle…
– Quel rôle ?
– Celui-ci, indiqua Liliane en lui désignant une petite brochure qui traînait sur sa coiffeuse. C’est Marcelle Ferrand elle-même qui m’a choisie pour ce rôle-là parmi toutes ses élèves… Elle jouera avec moi !
– Oh !… Mes félicitations… avec Marcelle Férand ! Ce sera l’événement de la saison dramatique à Paris… Et où débutez-vous ?
– Justement dans un endroit où je tiens absolument à vous voir, ou plutôt où je tiens à ce que vous me voyiez…
– Je vous en remercie, Liliane… Et où cela ?
– Chez M. le comte de Teramo-Girgenti, après-demain. C’est là mon premier souhait.
– Mais, ma chère amie… c’est un souhait qui ne compte pas, celui-là… Vous savez que je dois y aller… Je suis invité. Je vous l’ai dit moi-même…
– Justement… vous devez y aller… Eh bien ! moi, je veux être sûre que vous irez… Vous comprenez si je tiens à votre opinion, mon ami, celle des autres ne compte pas. Vous me direz si j’ai du talent… Alors, c’est entendu ?
– Entendu !
– Quoi qu’il arrive ?
– Quoi qu’il arrive !…
Les deux pseudo-amants furent interrompus par l’arrivée de Mlle Nichette, qui tenait une lettre à la main.
– Le domestique de monsieur, dit-elle, vient d’apporter une lettre.
– C’est bien ! fit Sinnamari d’un geste qui chassait Mlle Nichette.
Sinnamari ouvrit la lettre et lut, après en avoir demandé la permission à la jeune femme.
– Diable ! dit-il, le front soucieux… Voilà qui change un peu nos projets…
– Lesquels ?
– Mais nos projets pour la soirée du comte. C’est le comte qui m’écrit. Il me rappelle son invitation, et il ajoute : « Surtout ne manquez pas. Le roi des Catacombes m’a promis de venir… »
– Eh bien ! en quoi cela peut-il ?… Au contraire ! Moi je serais enchanté de le voir, ce roi des Catacombes, dont on parle tant !
– C’est que je vais justement vous demander de ne pas aller ce soir-là chez le comte.
– Pourquoi ?
– Parce qu’il y aura du danger à s’y trouver.
– Le danger ne m’effraye pas… Quel danger ?
– Ma chère amie, je vais faire, ce soir-là, arrêter chez le comte le roi des Catacombes, et vous comprendrez qu’il y a bien des chances pour que le dessert soit un peu troublé.
Dans le moment, Liliane fit un geste pour déposer la lime à ongles, et elle dut se pencher un peu, de telle sorte que son bras et son sein sortirent des fanfreluches du peignoir, découvrant leurs formes parfaites, dignes de tous les hommages. Il en tremblait de les voir, et, vainement, sa voix voulait ordonner : « Vous n’irez pas, Liliane, chez le comte, vous n’irez pas ! », le sein et le bras attardés encore au même geste voulaient y aller, eux. Ils disaient si bien en même temps que Liliane : « Nous irons, nous irons ! » que Sinnamari sentait sa force de contradiction lui échapper. Cependant, il voulut tenter un dernier effort et, détournant les yeux de ce spectacle trop attrayant :
– Liliane, dit-il, songez que cette fête pourra se terminer d’une façon terrible. Ce triste sire viendra certainement, il est d’une audace que rien n’arrête, accompagné de quelques-uns de ses sujets et toutes précautions prises ; de mon côté, j’aurai pris les miennes.
– Oh, mais ce sera tout à fait intéressant !
– Trop ! on se battra…
– À la bonne heure ! On va s’amuser…
– Ne riez pas, Liliane, ce sera très sérieux… Il ne faut pas aller chez le comte… Vous savez si je vous aime, Liliane… Il pourrait vous arriver malheur ! Et je ne serais pas là pour veiller sur vous…
– Comment ! Vous n’iriez donc pas non plus, monsieur ? Auriez-vous peur ?
– Je n’ai peur de rien, Liliane, mais faisant arrêter un hôte du comte, je ne puis vraiment accepter l’invitation de celui-ci.
– Quelle délicatesse !… J’en serai donc pour mes débuts…
– Vous débuterez une autre fois…
– C’est bien, mon ami, je n’irai pas, puisque vous ne le voulez pas !… Je n’ai rien à vous refuser, moi !…
– Quels sont vos autres souhaits, Liliane ?
– Cela ne vous regarde plus, mon cher. J’ai eu trop peu de succès avec vous pour le premier, j’attendrai de voir un autre de mes amis pour les lui faire connaître…
– C’est bien, Liliane, dit Sinnamari devenu pâle en entendant cette menace, puis, redevenant rouge en revoyant le bras et le sein nus, c’est bien ! Vous irez chez ce Teramo, et j’irai moi aussi, je vous le jure ; je ferai arrêter le roi des Catacombes devant vous, puisque vous y tenez !… Vous me donnerez la comédie, et moi je vous servirai la tragédie… N’en parlons plus. Le second souhait, Liliane ?
– Allons, vous voilà raisonnable. Si vous saviez comme vous me plaisez ainsi !
Et le bras et le sein rentrèrent dans le peignoir.
– Mon second souhait, mon ami, est celui-ci : je désirerais ce soir aller avec vous à la Porte-Saint-Martin, entendre Marcelle Férand dans les Martyrs.
– Oh ! Cela, c’est gentil ! s’écria Sinnamari en prenant les mains de la jeune femme. Je vais faire retenir tout de suite une baignoire.
– Oh ! c’est déjà fait… La baignoire n° 8, c’est la meilleure. Il est impossible de vous voir de la salle, et puis, avant votre arrivée, je tirerai la grille.
– C’est parfait… On dira : il y a là derrière deux amoureux… Et l’on se trompera, Liliane, ajouta tristement Sinnamari.
Liliane l’écarta. Il poussa un soupir qui la fit rire. Alors, il rit.
– J’ai encore quelque chose à vous demander pour mon second souhait, fit-elle. Après le théâtre, nous irons souper, et après le souper…
– Après le souper ?
Sur ces entrefaites, Mlle Nichette entra encore :
– C’est un monsieur qui s’appelle Dixmer et qui demande à voir monsieur tout de suite.
– Qui est-ce, Dixmer ?
– Un haut fonctionnaire de la police.
– Il est votre ami ?…
– Oui, en ce moment… Cela tombe bien. Permettez-moi d’aller lui dire deux mots…
– Allez, mon ami, et prenez votre temps… Pendant ce temps, j’étudierai mon rôle.
Sinnamari baisa les doigts de Liliane et courut rejoindre Dixmer qui l’attendait dans le petit salon Louis XV. Il fallait que le policier eût vraiment quelque chose d’important à confier au procureur pour qu’il vînt le relancer jusque chez sa maîtresse.
– Eh bien ? demanda Sinnamari. M’apportez-vous de bonnes nouvelles ?
Déjà Sinnamari était redevenu lui-même, avait reconquis toute son intelligence, sa lucidité, sa force.
Dixmer n’avait pas quitté le déguisement que nous lui connaissons depuis son apparition à l’Hôtellerie de la Mappemonde. Du reste, il n’eût point osé se montrer en Dixmer tant qu’il n’avait point réduit le roi des Catacombes. C’était maintenant une question de vie ou de mort entre eux, et il n’avait pas eu besoin de l’assurance que lui en avait fait Patte-d’Oie pour en être persuadé. Pourquoi Patte-d’Oie l’avait-il épargné ? Il ne le savait pas encore, mais il pensait bien qu’il ne dépendait que de lui d’en connaître la raison dès cette nuit même, s’il allait la chercher au rendez-vous que le sergent du roi des Catacombes lui avait fixé au cabaret de l’Ange Gardien. Mais irait-il ? Pourquoi pas ? Si Patte-d’Oie avait eu de mauvais desseins contre lui, il n’avait, l’autre nuit, qu’à le faire exécuter… Tout de même, Dixmer était perplexe… La voix de Sinnamari le tira de cette perplexité.
– Oui, fit-il, j’ai, je crois, de bonnes nouvelles. Vous pourriez bien avoir raison !
– Serait-ce possible ? s’écria Sinnamari… Surtout Dixmer, pas de gaffes ! C’est un coup à nous mettre l’Europe à dos, s’il y a erreur sur la marchandise…
– Écoutez !… Tout ce que vous m’avez dit m’a tellement frappé que j’ai travaillé autour. Moi, je crois que c’est le même !
– Vraiment ? Eh bien, voyez ! Il s’invite lui-même à la petite fête d’après-demain…
Et Sinnamari tendit la lettre qu’il venait de recevoir. Dixmer la lut :
– Oh ! Il a un certain toupet…
– Oui, parce que, que ce soit lui, ou que ce ne soit pas lui, qu’il soit le même ou non, l’autre est pris ! Qu’est-ce que vous avez découvert, Dixmer, qui vous fait croire davantage que Teramo-Girgenti et le roi des Catacombes ne font qu’un ?
– Bien des choses… D’abord, j’ai vu un des sergents du roi des Catacombes, un nommé Cassecou, que je connais bien, sortir de chez lui.
– Tiens ! fit Sinnamari. Il s’appelle comme le cocher de Liliane ! Ensuite ?
– Ensuite, le premier des lieutenants de R. C., celui qu’il a mis à la tête de toute sa « bande noire », car il a sa « bande noire » et sa « bande blanche », le Vautour, est venu deux fois chez Teramo dans la seule journée d’hier. C’est un grand fort garçon, qui est connu dans les milieux des courses sous le nom de Master Bob. J’aurais pu le faire arrêter, si justement sa filature ne nous rapportait davantage que son arrestation.
– Qu’a-t-il fait en sortant de chez Teramo ?
– Il s’est rendu à la Profonde. C’est ainsi que les séides de R. C. appellent leur repaire dans les catacombes. Il y est descendu par l’entrée de la rue Lamartine.
– On peut donc pénétrer chez eux, par là ?…
– Ça ne servirait à rien… Si vous voulez que je vous explique comment ils sont gardés…
– Bon ! Ce sera pour une autre fois… Ah ! si vraiment ce Teramo-Girgenti, c’était lui, R. C. ?…
– Je le crois…
– Malheureux ! Taisez-vous ! Je le fais arrêter tout de suite… Ah ! C’est ce qu’il faudrait !… Vous pensez bien que s’il se découvre d’une façon aussi extraordinaire pour la fête, c’est qu’il a dû préparer pour cette damnée crémaillère un coup dont il se croit sûr… Ce jour-là, il sait où il va, lui… Nous, nous ne savons pas où nous allons !… Quand nous crions : quoi qu’il arrive, il est pris !… nous nous vantons sur les forces dont nous disposons… Elles peuvent être immenses ; elles ne comptent pas si nous ne connaissons pas les siennes. Son astuce seule peut déjouer toutes nos combinaisons… Vous le savez bien vous-même puisque vous en étiez !…
– C’est vrai ! fit mélancoliquement Dixmer.
– Comprenez qu’il faut l’arrêter avant la fête ! Ah ! Si on était sûr que ce fût vraiment le même ! On cueillerait le Teramo et ce serait fini !…
– Ce que je vous ai dit ne vous suffit pas, monsieur le procureur impérial ?
– Non ! Il me faut d’autres preuves en face de toute la paperasserie diplomatique qui me recommande ce singulier comte… Songez, Dixmer, que le comte ne se cache pas du tout d’être en relation avec R. C. qui l’a fait prisonnier autrefois… Cassecou, votre Vautour, peuvent bien n’avoir été auprès de lui que les commissionnaires de R. C. Ah ! C’est dommage ! Comment savoir ?
– Écoutez, dit résolument Dixmer, je le saurai ce soir.
– Comment cela ?…
– Je le demanderai à quelqu’un… à un sergent de R. C., qui me veut, paraît-il, du bien, en ce moment, à un nommé Patte-d’Oie, qui m’a donné rendez-vous dans un bouge de la rue Brisemiche, le cabaret de l’Ange Gardien. C’est là que se réunissent souvent les sergents de R. C. pour faire la bombe avec leurs gigolettes. Je me déguiserai en Titi de Pantruche ce soir et j’irai le rejoindre. Je verrai de quoi il retourne avec Patte-d’Oie, et je cours le risque d’y rencontrer Cassecou qui y vient quelquefois. Je leur tirerai les vers du nez sur ce Teramo. Cassecou, au moins, lui, doit savoir, et ça m’étonnerait bien si Patte-d’Oie… Seulement, je vais avertir la Sûreté et faire faire un sérieux service d’ordre occulte autour de l’Ange Gardien… Je ne tiens pas à me faire assassiner là-dedans, car au fond, je ne connais pas leurs intentions bien exactes à mon égard.
– Faites ! Prenez toutes vos précautions, Dixmer… C’est cela… un sérieux service d’ordre !
– Entendu ! acquiesça Dixmer.
– Et l’autre affaire ? Ça ne marche toujours pas ?…
– Elle ne bouge pas ! Elle suit toujours le même chemin avec son Professeur tous les jours, en plein jour… les mêmes rues… Tous les concierges, soudoyés par R. C., arriveraient au premier appel… au coup de sifflet du Professeur… et puis il y a un mot d’ordre nouveau chaque jour… Le Professeur ne parlera point pendant le trajet à quiconque n’aura pas le mot d’ordre… Il me faudrait le mot d’ordre et le sifflet… Tant que je n’aurai pas cela… rien à faire… Mais je l’aurai peut-être demain ou après-demain…
– Ah ! le plus tôt possible !… Je sens qu’il va nous falloir des armes contre R. C. et le plus tôt possible !… Qu’est-ce que vous espérez ?
– Tout ! Je suis devenu intime avec le Professeur !…
– Vraiment ?
– Oui, les trois pintes du cabaret du même nom nous ont rapprochés… À propos, j’ai découvert, dans cette étrange hôtellerie, un garçon bien curieux à observer, un nommé Robert Pascal ; j’ai failli me faire assassiner par les Titis de Pantruche en le suivant, un soir…
– Qu’a-t-il de curieux, ce garçon, mon cher Dixmer ?
– Il s’évanouit pour rien… Un matin, il s’est évanoui en entendant un perroquet prononcer cette phrase : « Tu es la Marguerite des Marguerites, tu es la perle des Valois ! »
– Tiens ! fit Sinnamari, surpris. Où donc ai-je déjà entendu cette phrase-là, moi !…
XVI – LE TROISIÈME SOUHAIT
Sinnamari, après avoir vainement cherché au fond de sa mémoire endormie dans quelle circonstance, ou à quelle époque, il avait pu entendre cette phrase bizarre : « Tu es la Marguerite des Marguerites, tu es la perle des Valois » et après y avoir renoncé, s’entretint encore quelques instants avec Dixmer sur la conduite prochaine des événements, sur l’empressement qu’il fallait montrer à réussir certaine entreprise d’enlèvement qui apparaissait des plus importantes, sur la nécessité de savoir à quoi s’en tenir exactement sur la qualité du comte Teramo-Girgenti dans les vingt-quatre heures. Quant au plan à suivre pour la pendaison de la crémaillère de Teramo-Girgenti, il ne pourrait en être question qu’après qu’on serait assuré de la personnalité même du comte.
– Allons, mon cher Dixmer, recommanda Sinnamari avant de le congédier, prenez garde, cette nuit.
Dixmer partit et Sinnamari courut au boudoir, où il retrouva Liliane apprenant son rôle.
– Mon ami, fit Liliane en déposant son livre, vous ne m’avez pas demandé quel était mon troisième souhait.
– C’est vrai, avoua le procureur, recevez toutes mes excuses. La faute en est à Dixmer… Et quel est ce troisième souhait ?
– Vous rappelez-vous la promenade que nous fîmes un jour à Montmartre, il y a des mois de cela ?
– Si je me rappelle ?… N’est-ce point dans cette promenade-là que je vous ai suppliée de tout quitter pour moi, Liliane ?
– C’est dans cette promenade-là, en effet. Un soir, il faisait si beau, si doux… Nous étions montés comme deux amoureux sur la butte…
– Comme deux amoureux…
– … Et puis, nous sommes redescendus derrière Paris, par je ne sais plus quelle rue…
– La rue des Saules…
– C’est cela, la rue des Saules… Dieu ! Qu’il faisait doux ! Une brise légère nous apportait le parfum des jardins… Dans ce coin de Paris, on se croirait à la campagne, tous ces arbres par-dessus les murs, toute cette verdure dans les enclos.
– C’est un quartier bien désolé, bien perdu… dangereux même…
– Vous rappelez-vous, Sinna, ce qui s’est passé alors ?…
– Ma foi non, Liliane…
– Comme je vantais le charme de cette thébaïde, et que je m’étonnais qu’elle ne fût plus habitée dans la belle saison, vous avez étendu la main vers ces murs et vous m’avez dit : « Oui, tout cela, mademoiselle, c’est du bonheur perdu… Voici une propriété qui est à moi et où je n’ai pas remis les pieds depuis vingt ans… »
– Je vous ai dit cela, Liliane ? Après tout, c’est bien possible… J’ai, en effet, là-bas un coin de terrain inculte dont je n’ai jamais rien fait… Que voulez-vous que j’aille faire rue des Saules ? demanda avec une curiosité aiguë Sinnamari…
– Rien ! C’est justement pour cela que je n’éprouve aucune gêne à formuler mon troisième souhait : donnez-moi donc cette propriété dont vous ne faites rien !
– Oh ! Voilà une idée bizarre ! s’écria Sinnamari.
– Mais, que vous prend-il, mon ami ? Vous voilà tout pâle !… Est-ce ma proposition qui vous met dans un pareil état ?
– Non, Liliane, non… Mais qui est-ce qui vous a donné cette idée-là ?…
– Personne, je vous jure…
– Personne ?… Vous me l’affirmez ?…
– Je vous l’ai juré…
– Oh ! J’y suis maintenant ! s’exclama le procureur. Et il parut soudain plus troublé.
– Que voulez-vous dire, mon ami ?…
– Rien ! rien !…
Et Sinnamari se passait la main sur le front. Il venait de se souvenir tout à coup d’où était venue la phrase, l’extravagante phrase dont lui avait parlé Dixmer et qui avait été la cause de l’évanouissement de ce jeune homme… Oui, il se rappelait maintenant l’avoir entendue une nuit, et quelle nuit !… Et voilà que cette phrase revenait à ses oreilles… au moment même où Liliane lui demandait de lui faire cadeau de la petite maison de la rue des Saules ! Pouvait-il croire à un simple rapprochement ? Liliane était-elle l’instrument inconscient d’un ennemi inconnu ?… R. C. ?… Pourquoi, mais encore pourquoi ?
– Eh bien ? demanda Liliane.
– Eh bien ! répéta le procureur qui semblait revenir de très loin et qui reprenait peu à peu son sang-froid…
– Mon troisième souhait ? Qu’avez-vous décidé d’en faire ?
– Je ne puis vous donner cette propriété, Liliane, répliqua Sinnamari d’un ton ferme.
– Vraiment ! je le regrette, vous m’auriez fait un très grand plaisir.
Et elle se leva apparemment fâchée, et passa dans sa chambre.
Sinnamari voulut l’y suivre, mais elle lui colla la porte sur le nez et tira le verrou. Alors Sinnamari, n’ayant plus pour le dompter le regard de Liliane, cria à la courtisane, à travers la porte, un tas de choses comme celles-ci par exemple : qu’on ne se moquait pas à ce point d’un homme comme lui ; qu’il en avait assez du rôle ridicule qu’elle lui faisait jouer ; qu’il saurait bien se passer d’elle, et autres balivernes que les femmes sont habituées à entendre, sans frémir du reste.
Quand Liliane revint dans le boudoir, il fut tout étonné de constater que son refus de lui donner la petite maison de la rue des Saules et que les reproches dont il avait accompagné ce refus ne l’avaient point autrement bouleversée. Au contraire, elle n’avait jamais été aussi calme.
– M’expliquerez-vous quelle est cette fantaisie de vouloir cette bicoque ? dit-il.
– M’expliquerez-vous celle que vous avez de me la refuser ? dit-elle.
– C’est un coin de terre qui me vient de ma mère, Liliane, et où j’ai des souvenirs de famille.
– Tant pis !
– Vous n’êtes point trop fâchée ?
– Ma foi non ! Mais c’est à une condition…
– Dites ! Liliane, dites…
Et Sinnamari était tout à fait heureux de la voir abandonner ce qu’il appelait une fantaisie, avec cette facilité ! Il s’était donc trompé ! Il n’y avait eu vraiment dans cette évocation du drame passé que de l’imagination de sa part… Comment, du reste, eût-il pu en être autrement ? Vraiment la présence de Liliane faisait de lui un autre homme. Il poussa un soupir.
– Eh bien ! mon cher Sinna, puisque vous ne pouvez me donner cette petite maison de la rue des Saules, vous m’en offrirez une autre, fit Liliane.
– C’est cela ! Tout ce que vous voudrez…
– Elle sera un peu plus grande, par exemple…
– Un palais, Liliane ! Un palais…
– Vous n’êtes jamais sérieux… Tenez, donnez-moi en place de la petite maison de la rue des Saules, votre grande propriété de Brétigny, et je vous aimerai, Sinna !…
– C’est vrai, Liliane, vous m’aimerez ?… C’est que vous m’avez dit si souvent cela que je n’ose plus y croire… N’importe, Liliane, ma propriété de Brétigny est à vous…
– Merci ! Écrivez !…
– Quoi ?
– Que cette propriété est à moi…
– À qui voulez-vous que je l’écrive ?
– Êtes-vous drôle ! À votre notaire…
– À Me Mortimard ?
– À lui-même.
– Comme vous êtes pressée d’avoir ma propriété, Liliane…
– Regrettez-vous déjà le don que vous m’avez fait ?
– Nullement !… Mais…
– Il n’y a pas de mais ! Écrivez à Me Mortimard de dresser tout de suite l’acte de donation de votre propriété de Brétigny.
– Et vous m’aimerez ?
– Et je vous aimerai…
Il la regarda. Elle avait le plus joli sourire du monde. Il écrivit.
– Je passerai vous prendre au Palais, Sinna… Je vous attendrai à six heures dans mon coupé, au coin de la place Dauphine…
– Pour quoi faire ?
– Mais, pour passer chez Me Mortimard, à qui je vais moi-même porter ce petit mot-là tout de suite.
Et Liliane caressa le nez du procureur de ce bout de lettre, sur lequel il priait le notaire de dresser l’acte de donation…
– Vous ne perdez pas de temps, Liliane…
– Jamais, mon ami, quand je suis avec vous. Puisque vous avez été bien gentil, nous passerons toute la nuit ensemble…
– Toute la nuit… murmura Sinnamari ému et n’osant comprendre.
– Oui, toute la nuit… On fera la noce jusqu’au jour… On ne se couchera pas !
Il avait compris… C’était la première nuit d’amour qu’il passait avec elle. Il fit une drôle de grimace et Liliane s’en amusa.
– Allez-vous-en maintenant, dit-elle, allez, mon bon Sinna… Il faut que je m’habille…
Et elle le chassa doucement. Et il partit.
Quand le procureur fut dans la rue, Mlle Nichette vint retrouver sa maîtresse.
– Il est là ! dit-elle…
– Faites-le entrer !…
Et M. Macallan entra dans le boudoir de Liliane. Celle-ci lui sourit :
– Comment va le comte ? demanda-t-elle.
– Très bien, belle Cécily !
– Il sera content… Tout est arrangé… Tenez, vous lui remettrez ceci…
– La petite maison de la rue des Saules ? interrogea le gnome en exécutant une pirouette galante… All right !
– Hélas ! non…
– Oh ! Liliane ! What is it ? fit le gnome avec mépris.
– Cela a été impossible… Il n’a rien voulu savoir !… Mais j’ai la propriété de Brétigny.
– Très bien, belle Cécily ! Avec cela, Me Mortimard s’arrangera, susurra le gnome rasséréné. Vous êtes une jolie fille, by jove.
Et Macallan prit le papier que lui tendait Liliane.
Liliane fit signe qu’elle ne comprenait pas. Mais elle avait promis au comte de Teramo-Girgenti d’agir sans essayer de comprendre.
– Vous direz aussi au comte que tout est arrangé également pour cette nuit…
– Pour cette nuit ?… interrogea le gnome soudain anxieux… Comment, pour cette nuit… ?
– Le comte ne vous a rien dit de ce que nous devons faire cette nuit, monsieur Macallan ? Alors, fit Liliane en souriant, c’est que ça ne vous regarde pas !…
– En effet ! avoua Macallan, très contrarié… Ça ne me regarde pas… Ce sont des choses qui arrivent… dans les Chevaliers du lansquenet, de M. Xavier de Montépin…
– Vous êtes très ferré sur notre littérature, monsieur Macallan.
– Je connais M. de Montépin par cœur, madame…
Et l’avorton fit une virevolte savante qui lui mit, comme par hasard, le nez sur un coupon de théâtre qui traînait sur une psyché… Il eut le temps de constater que ce coupon donnait droit, ce soir-là même, à la baignoire 8, pour la représentation des Martyrs à la Porte-Saint-Martin, et il se dit à part lui : « Je sais toujours où tu iras après dîner ! » Sur quoi, il salua profondément la demi-mondaine en lui jetant ces mots :
– À bientôt, divine Cécily !…
Quand il fut dehors, M. Macallan jura et dit :
– Il va donc faire quelque chose cette nuit ? Pourquoi ne m’en a-t-il rien dit ? Il se doute donc de quelque chose ? Ah ! c’est un type ! c’est un type !
Restée seule, Liliane se disait :
– Pourquoi le comte a-t-il besoin de cette petite maison de la rue des Saules ? Et pourquoi, n’ayant pu l’obtenir, a-t-il besoin de la propriété de Brétigny ?
Elle sonna Mlle Nichette.
– Habille-moi, Nichette !… Bah ! ajouta-t-elle tout haut, tout cela s’expliquera un jour…
– Madame, fit Nichette, je voudrais demander quelque chose à madame…
– Va, mon enfant…
– Pourquoi le mal-né…
– Tu veux dire sans doute M. Macallan…
– Oui ; pourquoi M. Macallan appelle-t-il madame quelquefois Liliane et quelquefois Cécily ?…
– Ma fille, je le lui ai demandé et il m’a répondu qu’il ne pouvait pas me le dire…
– Il est un peu fou… Mais j’avais pensé que Cécily était le vrai nom de madame…
– Non, mon vrai nom, Nichette, si cela peut te faire plaisir de le savoir, est Clotilde, expliqua Liliane d’une voix subitement grave.
– Clotilde, c’est un joli nom. Pourquoi cet imbécile vous appelle-t-il Cécily ?
XVII – DE DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS QUI SE PASSÈRENT CE SOIR-LÀ DANS L’ATELIER DE ROBERT PASCAL
Le soir de cette journée où nous avons assisté tour à tour à l’émoi d’Eustache Grimm, de Régine et de Sinnamari lui-même, entre dix et onze heures, Robert Pascal travaillait encore dans son atelier de l’hôtel de la Mappemonde. Sous les rayons éclatants de sa lampe, il achevait de buriner l’argent d’une boîte à montre qu’il destinait au nielle ; il avait promis ce bijou à Marcelle Férand pour la récompenser de toute la grâce qu’elle mettait dans les soins dont elle entourait Mlle Desjardies, quand celle-ci se rencontrait avec elle dans l’atelier de Raoul Gosselin.
Robert Pascal semblait prendre à ce travail un plaisir extrême, moins peut-être à cause de la satisfaction d’artiste qu’il devait ressentir en terminant cette jolie chose, qu’à cause de la douce musique qui accompagnait son labeur tardif. Cette douce musique lui venait d’une voix adorée et révélait dans l’ombre la présence d’une jeune personne à qui Robert Pascal avait, depuis quelques semaines, abandonné son cœur.
Gabrielle Desjardies se plaignait délicieusement, mélodieusement pour les oreilles enchantées du pauvre orfèvre, de ne jamais voir celui-ci que la nuit, furtivement, quand tout semblait dormir au fond du « Conservatoire », car la chambre de Mlle Desjardies et l’atelier de Robert Pascal se trouvaient dans cette partie de l’hôtel de la Mappemonde.
Certes, elle aimait la parfaite tranquillité de ces rendez-vous où les jeunes gens échangeaient d’ardents mais encore chastes baisers, en attendant ce qu’ils appelaient tous deux le moment de leur délivrance, c’est-à-dire le moment où l’innocence de Desjardies apparaîtrait éclatante aux yeux de tous, et que seraient en même temps confondus ses ennemis. Mais, quand donc viendrait ce moment-là ?…
Gabrielle avait naturellement demandé des nouvelles de son père, qu’elle n’avait pas le droit de voir, pour leur sécurité à tous les deux, mais qui lui écrivait souvent pour relever son courage. Robert Pascal avait répondu que son ami R. C. avait trouvé ce jour-là à M. Desjardies la plus belle mine du monde, relevée par la certitude où il était qu’il touchait à la fin de leurs maux.
– Et d’où lui est venue cette certitude ? demanda Gabrielle.
– De mon ami.
– De votre ami !… Toujours votre ami !… Comme vous l’aimez Robert, cet ami-là !
– Comme moi-même… Vous devriez l’aimer aussi, Gabrielle. Il a fait beaucoup pour vous… C’est lui qui a tout fait… vous le savez bien…
– Oh ! Robert ! Je ne puis croire que vous n’avez pas été pour quelque chose dans tout ce qu’a fait votre ami. Il y a dans tout ce qui vous entoure, Robert, tant de mystère, que je crois toujours plus que vous ne me dites ou moins…
– Où voyez-vous du mystère en moi, Gabrielle ?…
La jeune fille soupira encore :
– Enfin, dites à votre ami de se presser…
– Vous trouvez donc, Gabrielle, qu’il a perdu du temps !… fit Robert Pascal sur un ton de reproche.
– Je ne dis pas cela, mais c’est une chose si affreuse de ne pouvoir agir quand il y a tant à faire… Je voudrais tant agir… Et me voilà condamnée à rester là… dans cet hôtel… prisonnière… On m’a accordé une promenade par jour… On m’a permis d’aller à l’atelier de Gosselin, comme on permet à un détenu d’aller au préau, pour qu’il prenne un peu d’air !… Et je suis, moi aussi, toujours accompagnée d’un gardien…
» Si je savais au moins où nous en sommes, je serais moins impatiente… Ah ! vous n’êtes donc pas pressé, vous, Robert ?
– Pas pressé !… Pas pressé ! répéta le jeune homme. Pas pressé !… Mais, Gabrielle, si je pouvais d’une minute précipiter le cours des événements qui se préparent dans l’ombre, j’achèterais cette minute de toute la fortune de mon ami le roi Mystère ! Ah ! si vous saviez ce que je suis pressé !… Pressé de partir, loin, loin… si loin !… De n’être plus rien, dans un coin béni de la terre, qu’un homme parmi les autres hommes… qu’un peu d’amour, à vos côtés, Gabrielle !…
Puis il se tut. Robert Pascal, le premier, rompit le silence.
– Je comprends, Gabrielle, votre impatience de voir surgir enfin la preuve de l’innocence de votre père… Soyez heureuse donc, à votre tour… Puisqu’il vous est défendu d’aller au-devant de ces preuves, le moment arrive où elles vont venir à vous…
– Oh ! Robert, fit Gabrielle, est-ce bien possible ?… Quand cela, mon ami ?
– Tout de suite… L’heure est venue, Gabrielle.
La fille de Desjardies fut debout dans une agitation extrême.
– Calmez-vous, mon amie… Vous allez avoir besoin d’un peu de sang-froid pour saisir le premier anneau de la chaîne de l’innocence de votre père… Mais comptez sur moi…
– Sur votre ami… fit Gabrielle, avec un doux reproche dans la voix.
– Oui, sur mon ami… Quand vous tiendrez le premier anneau, toute la chaîne viendra !
– Que faut-il faire ?
– Vous allez descendre chez Mme Didier.
– Chez cette pauvre femme… à cette heure ?… elle est couchée avec toute sa petite famille.
– En êtes-vous sûre ?…
– Si j’en suis sûre ! Avant de venir chez vous, j’ai été lui porter du bouillon pour elle et les petites, qui toussent à vous arracher l’âme…
– Toujours bonne, Gabrielle… Mme Didier n’a rien à vous refuser… N’est-ce pas vous qui avez payé son terme ?
– Avec quel argent, mon ami ?
– Puisqu’elle est couchée, vous la prierez de se lever… C’est nécessaire…
– Elle était si faible… si faible tout à l’heure… Mais puisque vous me dites que c’est nécessaire…
– … Quand elle sera levée, elle s’habillera et puis elle vous suivra…
– Où donc, mon ami ?
– Elle vous suivra là où je vais vous dire d’aller, Gabrielle… Entendez-moi bien… il ne faut pas que cette femme vous quitte d’un pas, d’un seul pas… Du reste, puisqu’elle est faible, vous lui donnerez le bras.
– Bien !… Et où devons-nous aller ?…
– Vous descendrez toutes deux sous le porche de l’hôtel et vous entrerez, par la petite porte qui donne sous ce porche, dans la salle du cabaret des Trois-Pintes.
– Au cabaret des Trois-Pintes ? À cette heure ?… Deux femmes… Oh ! Robert, c’est entendu… c’est entendu… Tout ce que vous ordonnerez, mon ami, sera fait, je vous le jure… Mais que faut-il faire ?…
– Vous irez demander à messire Thiébault qui se trouve sans doute à son comptoir, de vous prêter de la bougie…
– De la bougie ?…
– Oui, de la bougie… Voilà une chose toute naturelle… Vous n’avez plus de bougie chez vous et vous êtes descendue en demander…
– Et si M. Thiébault n’est pas à son comptoir ?…
– Eh bien ! Il y aura une autre personne à qui vous demanderez également de la bougie.
– Et après ?
– Après ?… C’est tout !…
– Comment, c’est tout ?…
– Oh ! Gabrielle, vous verrez que vous trouverez que c’est déjà quelque chose !… Quand vous aurez votre bougie, vous remonterez, vous reconduirez Mme Didier chez elle et puis vous viendrez me retrouver ici, tout de suite.
– Bien, mon ami.
– Allez, Gabrielle… Je vous attends.
– À tout à l’heure, Robert !…
Et, de plus en plus émue, la jeune femme s’enfuit rapidement de l’atelier. Robert Pascal écouta son pas s’éloigner rapidement dans l’escalier, puis dans le corridor… Puis il alla à la porte qui donnait de l’atelier sur sa chambre, ouvrit la porte secrète qui donnait sur l’escalier secret conduisant sur le derrière de l’Hostellerie de la Mappemonde, descendit cet escalier et ouvrit la porte donnant sur le terrain vague.
La nuit était très obscure. On ne voyait pas devant soi à trois pas. Robert Pascal siffla. Aussitôt une ombre se détacha de l’ombre et vint à lui.
– Monte ! fit Pascal à l’ombre.
L’ombre pénétra dans l’étroit escalier. Robert Pascal la suivait. Dans la chambre du jeune homme, l’orfèvre, qui paraissait assez inquiet, demanda :
– Eh bien ?…
– Eh bien !… C’est lui qui est à la tête de tout, maître !… C’est lui, j’en ai la preuve !…
– Fais bien attention à ce que tu dis, Cassecou, gronda Robert Pascal… Il y va de ta tête…
– Sur ma tête, souffla Cassecou en étendant la main, sur ma tête, le Vautour trahit !
– Oh ! fit Robert Pascal, moi qui l’aimais comme un frère… Moi qui l’ai sauvé de Macallan…
– C’est le tort que vous avez eu, maître… Ah ! vous êtes trop bon !…
– Alors, les fuites qui se produisent depuis quelque temps… c’est lui ?…
– Lui ou Patte-d’Oie !… c’est la même chose ; Patte-d’Oie marche pour le Vautour !
Robert Pascal pencha tristement la tête et longtemps réfléchit. Tout à coup, il entendit du bruit dans l’atelier. Il fit signe à Cassecou de rester à sa place et sortit de la chambre, dont il referma soigneusement la porte. Il se trouva en face de Mlle Desjardies.
XVIII – LE SIFFLET DU PROFESSEUR
À l’heure où Robert Pascal et Gabrielle Desjardies, dans l’atelier du « Conservatoire », commençaient à s’entretenir de la façon que nous avons dite plus haut, il y avait grande liesse au cabaret des « Trois-Pintes ». C’était ce jour-là la fête d’une des principales personnalités de la « Littérature ». Il y avait tant de fêtes et de réjouissances à propos de tout et de rien au cabaret des Trois-Pintes, qu’on avait fini par ne plus se préoccuper précisément du personnage qui en était le héros. Une telle solidarité réunissait les membres de la confrérie que la fête de l’un était inévitablement la fête de l’autre, et il n’était point de gentillesses que ces garçons-là ne se fissent en une telle occurrence, pour se prouver leur bonne amitié. Ce soir-là, le Professeur venait de demander à messire Thiébault :
– Messire, quelle heure avez-vous ?
Sans empressement, l’hôtelier, ayant consulté sa montre, car le coucou de l’établissement avait renoncé à marquer l’heure depuis des années, avait répondu :
– Dix heures !
– Dix heures ! avait répété le Professeur. Passez-moi votre toquante que je voie bien qu’elle marque dix heures !…
Et le Professeur s’était, malgré quelques protestations grognonnes, emparé de la montre de messire Thiébault et l’avait déposée sur la table, où il venait de commencer une partie de dames avec le poète Sésostis, cependant que Maïs, le marchand d’olives, marquait les coups avec un sérieux d’arbitre.
– Quel besoin avez-vous de savoir l’heure à ma montre ? questionna, maussade, le sieur Thiébault.
Alors, le professeur, gonflant la voix, avait fait assavoir à la « Littérature » attablée aux Trois-Pintes, que, vu la solennité du jour – il avouait avoir, du reste, oublié laquelle – il louait au sieur Thiébault, pendant deux heures, les deux robinets de sa pompe à bière !
Des clameurs enthousiastes accueillirent cette proclamation, mais le cabaretier, derrière son comptoir, eut une mine si soucieuse que la gaieté générale s’en montra tout de suite inquiète.
Le Professeur crut de son devoir de lui demander des explications.
– Quelle tête faites-vous là, messire Thiébault ? demanda-t-il. Le jour où, pour la première fois, j’ai franchi le seuil de votre modeste demeure, vous m’aviez promis patron charmant.
Le chœur des locataires reprit, énumérant d’une façon retentissante un programme illustre :
– Patron charmant, clientèle choisie, frais ombrages.
Le Professeur voulut continuer son beau discours, mais messire Thiébault, qui, depuis quarante-huit heures, ne décolérait pas, l’interrompit et lui fit entendre que toute sa mauvaise mine venait de ce que la « Littérature » abusait vraiment de ses bontés, buvant toujours et ne payant jamais. Aussi avait-il résolu, lui, Thiébault, de laisser désormais mourir de soif la « Littérature ».
Celle-ci éclata de rire, car elle savait bien que sire Thiébault avait confiance en elle, ne lui accordant un si long crédit que pour le mieux payer « quand la Littérature aurait réussi », ce qui ne pouvait trop tarder. Au fond, l’hôtelier montrait cette méchante humeur, tout simplement parce qu’il n’était pas encore revenu de la surprise qu’il avait éprouvé en retrouvant l’un de ses pensionnaires quasi-mourant de faim au « Mont-de-Piété », ainsi appelait-on, à l’hôtel de la Mappemonde, cette sorte de cave, ou plutôt de sous-sol, dans lequel le père Thiébault emmagasinait les pauvres meubles de ses locataires chassés de l’Hôpital ou du Conservatoire à la suite de quelque fâcheux accident de la mémoire à l’époque du terme.
Nous avons dit que le père Thiébault était aussi féroce pour le Conservatoire et l’Hôpital qu’il était bon pour la Littérature. Ce sous-sol, ce Mont-de-Piété dans lequel on descendait par une trappe qui donnait dans la cour, était une chose fort curieuse à visiter et que le père Thiébault montrait certains jours où il était bien « luné », avec cette espèce d’orgueil qu’on ne voit qu’aux collectionneurs. Il y avait là des trapèzes, des barres fixes, des mannequins, des machines à coudre, des cornets à piston, d’énormes basses et violoncelles, et des clarinettes, tous instruments à cordes ou à vent créés pour l’harmonie, des défroques de clowns, jusqu’à des cravaches de dompteur.
Quand on avait fait le tour du Mont-de-Piété, on était l’ami du père Thiébault, et pour longtemps. Jamais il n’essayait de vendre un objet quelconque de sa collection. Lorsqu’il se trouvait dans la nécessité de saisir le gage d’un locataire insolvable, il ne savait au juste s’il devait se désoler de n’être point payé de sa location ou se réjouir de voir son Mont-de-Piété s’enrichir de quelques pièces nouvelles.
Or, dernièrement, un grand scandale avait éclaté à l’Hostellerie de la Mappemonde. On n’a pas oublié que le père Thiébault avait loué sa grotte à deux phoques qui payaient fort congrûment ; or, un beau matin, on s’aperçut que l’un des phoques avait disparu. On le chercha en vain partout, de la cave au grenier : on demanda de ses nouvelles aux voisins ; on s’adressa même au commissaire de police du quartier, qui fit une enquête. On ne retrouva pas le phoque, qui s’appelait d’un nom pourtant bien connu et populaire : Henri IV.
Le père Thiébault marquait autant de douleur de la disparition d’Henri IV de son hôtellerie qu’une mère abbesse de la fuite d’une nonne. Il se disait déshonoré et s’arrachait ce qui lui restait de cheveux, quand, ayant décidé pour se consoler de faire une visite au Mont-de-piété, il fut accueilli dans le « magasinage » par des gémissements plaintifs. C’était Henri IV, qui se mourait de faim. Et Dieu sait, cependant, ce qu’il avait mangé ! Il avait mangé la plus belle partie de la collection du père Thiébault : violoncelles, clarinettes, mannequins n’étaient plus que des débris informes. Il ne restait plus que quelques fétus de la barre fixe. On ne saura jamais ce qu’un phoque enfermé dans un Mont-de-Piété est capable de faire servir à son déjeuner.
La tragédie qui avait résulté de cette découverte devait vivre longtemps dans les mémoires. Persuadé qu’il était victime d’une basse vengeance de la Littérature, qui se plaignait du manque de sommeil par la faute des locataires phoques, le père Thiébault, outragé comme hôtelier et comme collectionneur, avait résolu de donner congé d’un coup à toute la Littérature. Il l’avait assemblée dans la cour, lui avait craché à la face tout son mépris, et lui avait ordonné de faire ses paquets, déclarant qu’il ne voulait conserver aucun souvenir d’elle.
Mais il est probable que ce mouvement héroïque était le résultat d’une exaltation passagère, car la Littérature s’étant jetée à ses genoux avec des gémissements affreux, le père Thiébault, qui n’était point au fond un méchant homme, lui avait pardonné ; si bien qu’il semblait que, ce soir-là, elle montrait tant de joie et liesse moins pour fêter la fête du jour, que pour se réjouir d’avoir retrouvé le patron charmant qu’elle avait failli perdre !
Tout de même, de l’aventure, Thiébault avait conservé une malheureuse rancune, et nous avons vu de quel front hostile il avait accueilli l’offre du Professeur de lui louer, pendant deux heures, les deux robinets de sa pompe à bière.
La querelle allait sans doute se ranimer, quand un inconnu, un « inaperçu », un pauvre petit bonhomme de rien du tout, qui paraissait quelque chose comme un nain derrière la table où, modestement, il se cachait, se leva, ce qui fit qu’on put à peu près l’apercevoir, et dit d’une voix forte :
– Monsieur le cabaretier, moi, je vous loue pendant toute la nuit votre pompe à bière, et le prix qu’il vous plaira, je paie d’avance, by jove !
Un grand mouvement de sympathie entoura, immédiatement l’être étrange qui avait prononcé ces admirables paroles, et on lui fit une ovation. On lui demanda sans plus tarder comment il s’appelait, chacun, poète, romancier, chansonnier, marchand d’olives, voulant avoir l’honneur de faire sa connaissance. Il répondit qu’il avait nom : M. Macallan, et qu’il était de nationalité américaine. Et comme il exhibait des billets de banque, dont son portefeuille était amplement garni, messire Thiébault se précipita sur sa pompe à bière dont les deux robinets, à partir de cette minute, ne se refermèrent plus.
M. Macallan commença par faire de grands compliments au Professeur, lui disant que sa réputation était immense en Amérique, ce qui ne parut point étonner outre mesure notre pauvre ami, et comme celui-ci lui demandait s’il avait quitté New York exprès pour le voir, M. Macallan lui répondit que ce n’était point là précisément le but de son voyage, mais qu’il avait pris rendez-vous au cabaret des Trois-Pintes avec des amis qui tardaient un peu à arriver. Sur quoi le Professeur se montra curieux de savoir quels pouvaient bien être les amis de M. Macallan qui connaissaient assez Montmartre pour avoir en aussi particulière estime le cabaret des Trois-Pintes. M. Macallan répondit que ses amis à lui étaient aussi les amis du Professeur et qu’ils avaient habité longtemps l’Hostellerie de la Mappemonde.
Ils s’appelaient, l’un, qui était un homme : Master Bob, et l’autre, qui était une femme : la Mouna. Le Professeur, à cet énoncé, poussa de glorieux cris, manifesta une grande joie de revoir la Mouna, joie qui parut partagée par toute l’assistance, mais déclara qu’il n’avait jamais eu une grande sympathie pour Master Bob, auquel il avait toujours trouvé un « air renfermé et sournois ».
– La Mouna est donc toujours avec Master Bob ? demanda-t-il.
– Oh, non ! Depuis longtemps elle a quitté cet homme pour un autre amant, mais ils sont restés très amis.
– Curieux ! fit le Professeur. J’ai connu un temps où Master Bob était si jaloux de la Mouna qu’il n’aurait pas hésité à zigouiller celui qui lui aurait fait de l’œil !
– Qu’est-ce au juste que la Mouna ? demanda M. Macallan.
– Bah, dit le Professeur, une bonne fille qui s’ennuyait dans son harem de Tunis et qui, bravant la surveillance des eunuques, est venue chercher des amants à Paris. Je dis des amants, car c’est le désespoir où elle était d’avoir à se contenter pour toute sa vie d’un seul homme qui lui a fait braver le poignard des assassins et traverser l’Océan !
Le Professeur connaissait comme tout le monde sa géographie, et cependant jamais on ne lui eût fait appeler la Méditerranée d’un autre nom que celui-ci, qui, dans sa bouche, prenait une sonorité magnifique : l’Océan !
– Le malheur, continua-t-il, pour cette pauvre Mouna, est que, aussitôt arrivée à Paris, elle tomba sur un amant plus jaloux même que son époux devant Mahomet, le Master Bob en question, qui mit toutes les entraves possibles au contentement des passions que la charmante Mouna sentait bouillonner en elle. Sans cette sombre brute, certainement la Mouna eût été notre maîtresse à tous, et l’hostellerie de la Mappemonde se fût changée pour elle en un harem où il n’y aurait eu que des hommes, multiple objet de ses convoitises !
– Hélas ! gémit la Littérature.
– Mme la Mouna n’a décidément pas de chance, fit entendre M. Macallan. Elle est maintenant au pouvoir d’un nouveau maître qui semble au moins aussi jaloux que Master Bob.
– Comment s’appelle-t-il ?
– M. Costa-Rica.
– Connais pas !
– J’aurai l’honneur de vous le présenter.
C’est alors que Master Bob entra et, comme il était suivi de la Mouna, des chants d’allégresse firent trembler les poutres des Trois-Pintes. La Mouna embrassa le Professeur, serra la main à tous ces messieurs, et s’intéressa aussitôt à la partie de dames que le Professeur avait interrompue. En vain celui-ci voulut-il s’extasier plus longtemps sur la toilette magnifique de la jeune personne et ses bijoux somptueux, la Mouna le ramena à son jeu, disant qu’elle s’intéressait beaucoup à la partie, et que le jeu de dames, que l’on joue beaucoup dans les harems de Tunisie, lui rappelait toute sa jeunesse.
La tablette à casiers sur laquelle le Professeur et le poète Sésostris débattaient la partie, était moins couverte de jetons que des plus disparates objets destinés à les remplacer. Les jetons naturellement avaient été perdus depuis longtemps. On voyait là des morceaux de sucre, un dé à coudre, des allumettes. Une dame était représentée par un sifflet.
– Chez nous, en Tunisie, nous jouons aux dames, dit la Mouna, avec des crottes de chameau !
XIX – LA MOUNA
La Mouna était un petit être charmant, peu compliqué, instinctif toujours, instrument docile dans les mains de celui qui la tenait, ne connaissant et ne pouvant connaître de l’amour que le désir qu’il inspire ou la terreur qu’il apporte. Elle avait désiré et redouté Master Bob, et, maintenant que ce désir était allé à son second amant, Costa-Rica, elle gardait encore de ses aventures précédentes la peur de cet être mystérieux qui n’avait pas cessé de la dominer, de cet hercule à profil de vautour qui l’avait aimée, lui aussi, jusqu’au crime, et puis, un beau jour, l’avait en quelque sorte donnée à Costa-Rica, à ce Costa-Rica qui s’était révélé tout de suite un maître aussi jaloux, aussi tyrannique que Master Bob, aussi… sanglant… puisqu’il avait tué ce Didier qu’elle connaissait à peine et à qui elle n’avait jamais parlé !
Elle avait fui l’Orient et l’austère devoir des hourris et les tragédies de la jalousie mahométane après avoir lu un bouquin où il était parlé des joies futiles, nombreuses et passagères de Paris en général et de Montmartre en particulier ! Elle avait cru à la liberté, à la joie facile, aux amants innombrables ; elle se sentait capable de toutes les infidélités. Hélas ! Les bras du géant Master Bob s’étaient refermés sur elle plus solidement qu’une porte de prison…
Jamais elle n’avait soupçonné que Master Bob appartenait à une formidable société secrète, qu’il en était l’un des chefs tout-puissants, et qu’il lui faisait faire à elle, naïve, docile et apeurée, une besogne souvent effroyable. Espionne, délatrice, guetteuse, receleuse, indicatrice, préparant inconsciemment et joyeusement les drames les plus noirs, elle obéissait à toutes les fantaisies de Master Bob et accomplissait tous les gestes qu’on lui dictait, croyant le plus souvent jouer un rôle dans une farce de carabin sans importance.
Master Bob, du reste, quand elle le connut, ne paraissait nullement riche et lui fit mener une vie plutôt modeste à l’Hostellerie de la Mappemonde. Quand il cessa de l’aimer, et qu’elle devint la chose de Costa-Rica, sa situation matérielle changea du tout au tout. Elle eut un petit hôtel, rue d’Aumale ; des toilettes, des bijoux, beaucoup d’argent. Où Costa-Rica avait-il tout cet argent qu’il lui donnait ? Elle n’eût pu le dire. Il allait aux courses, où il perdait. C’est tout ce qu’elle savait de Costa-Rica.
Par quel hasard, ce soir-là, la revoyait-on à l’Hostellerie de la Mappemonde, au cabaret des Trois-Pintes ? Était-ce bien un hasard que celui qui réunissait dans cette salle joyeuse, autour du Professeur, Master Bob, M. Macallan et la Mouna ? Et puis, comment expliquer cet intérêt soudain de la demoiselle pour cette partie de dames quasi délaissée par le Professeur et qu’elle faisait reprendre avec une telle hâte ? Le Professeur avait déjà, sur son ordre, repris ses jetons.
Ses jetons ? Nous avons dit quels pauvres jetons étaient là. Un sifflet ! Un sifflet pour figurer une dame. Le Professeur, tout en faisant honneur au houblon mousseux, faisait manœuvrer sa dame, c’est-à-dire son sifflet, au grand préjudice de Sésostris. Le poète allait certainement perdre la partie quand la Mouna, se penchant sur le damier, fit observer au Professeur que sa dame aurait dû prendre un jeton à Sésostris et que, ne l’ayant point fait, elle devait être indubitablement confisquée par le poète. Ce disant, la Mouna étendit ses menottes sur le sifflet et, le retirant du jeu, le plaça à côté de Sésostris. Le Professeur poussa des cris de désespoir et le poète des cris d’allégresse, tandis que la Mouna mettait tranquillement sa main dans la poche de sa petite jaquette.
Ce geste, qui paraissait sans importance, avait réussi cependant, sans que nul ne s’en aperçût, à substituer au sifflet qui représentait la dame, un autre sifflet exactement semblable, mais qui, sans doute, ne devait pas avoir les mêmes propriétés. La Mouna paraissait enchantée de son petit tour de passe-passe et sa gaieté, subitement excessive, aurait pu provoquer de l’étonnement si on l’eût mise sur le compte du plaisir qu’elle avait de voir apparaître sur le seuil du cabaret son amant.
– Costa-Rica, s’écria Master Bob. Vous êtes en retard de cinq minutes, mon ami !… D’où venez-vous ?
– Du « Williams Bar », répliqua Costa-Rica en serrant la main de Master Bob. Et c’est elle qui m’a mis en retard… Elle n’est pas venue, mais elle me revaudra ça !…
– Qui, elle ? demanda la Mouna, curieuse.
– Mon notaire ! répondit Costa-Rica, ironique et énigmatique. Le Vautour daigna sourire, car sans doute comprenait-il l’expression de Costa-Rica. La Mouna, elle, qui ne se fatiguait jamais à comprendre, entreprit à nouveau le Professeur ; elle lui présenta son amant, elle présenta tout le monde. La pompe à bière ne cessait point de couler aux frais de M. Macallan. Le gnome, qui s’était glissé auprès de la Mouna, recevait d’elle, sous la table, le sifflet qu’elle avait dérobé au Professeur…
– Qu’est-ce que nous sommes venus faire ici ? demanda maussadement Costa-Rica.
– Mon chéri ! répondit la Mouna, j’avais tant envie de revoir le lieu où pour la première fois j’ai fait connaissance avec la grande vie de Paris !
Costa-Rica parcourut d’un regard dégoûté le cabaret avec son extravagante décoration, ses pots d’étain, ses plats de faïence, ses hallebardes, ses panoplies branlantes, ses caricatures. Costa-Rica était habitué à un autre luxe. À côté de lui, le Vautour, le profil immobile, les paupières mi-closes, semblait somnoler ou réfléchir, ou… attendre quelque chose. Celui qui l’eût bien observé aurait vu que sous l’apparente indifférence de sa tenue, il tournait incessamment ses yeux du côté de la petite porte qui donnait sur le porche de l’hôtellerie.
La partie de dames continuait sous la direction de la Mouna. Costa-Rica regardait sa maîtresse. Ah ! comme elle le tenait ! Et sans qu’on sût pourquoi, car elle n’était pas excessivement jolie. Il le savait peut-être, lui.
Costa-Rica, regardant sa maîtresse, se taisait. Il pensait. Le malheur est que, chaque fois qu’il commençait maintenant à penser à elle, il finissait par penser à lui, à celui qu’il avait tué à cause d’elle !…
En vain essayait-il de se tromper, de se répéter qu’il n’avait rien à craindre, que son crime resterait à jamais ignoré – n’avait-il pas trouvé un merveilleux alibi ? Non, non, il n’était point tranquille, car toujours, toujours se dressait devant lui une figure… un visage de femme… un pauvre visage souffreteux qui lui était apparu certain jour, à certaine heure… dans un certain escalier… quand il redescendait du crime !…
Oui, au moment où la porte refermée sur le cadavre du suicide, il fuyait… ce visage de femme lui avait barré la route… ces yeux l’avaient fixé comme s’ils devinaient quel geste il venait d’accomplir… Quelle était cette femme ? Il ne savait pas !… Mais ce qu’il savait bien, au fond de lui, c’est que, pour sa sécurité, il valait mieux qu’il ne rencontrât plus jamais ce visage-là…
Il fut tiré de sa songerie par une voix de femme qui demandait à M. Thiébault « de lui céder un bout de bougie ». Costa-Rica leva la tête. Il vit devant le comptoir, lui tournant le dos, deux femmes, l’une grande, élancée, l’autre petite, courbée, grelottante sous un mauvais châle dont elle s’enveloppait honteusement. Le père Thiébault donna la bougie demandée, et les deux femmes se retournèrent. Costa-Rica eut besoin de toute son énergie pour retenir un cri d’angoisse et de terreur, mais il eut un mouvement si brusque que M. Macallan fut bousculé.
– Qu’y a-t-il donc ? demanda M. Macallan, dont les yeux semblaient dévorer Costa-Rica.
Costa-Rica ne répondit pas. Il n’entendit peut-être pas… Il regardait… de tous ses yeux il regardait… Il eût voulu fuir… et il ne le pouvait pas… Et soudain il y eut un cri déchirant, le cri de la petite femme voûtée, de la femme au châle :
– Lui !
Et elle chancela… Mlle Desjardies dut la retenir.
– Qu’avez-vous ? demanda-t-elle anxieuse.
Alors, la femme montra l’homme, d’un geste sauvage…
– Lui ! répétait-elle, celui dont je vous ai parlé… Lui, qui était à ma porte, le jour où mon mari s’est suicidé !… L’inconnu de l’escalier… C’est lui… je vous dis que c’est lui !…
Et Costa-Rica ne pouvait détacher son regard épouvanté de ce visage qui le fixait… qui l’accusait… lui !… Elle !…
La femme au châle ne parla plus… Costa-Rica ne pouvait prononcer un mot, et ils continuaient de se regarder tous les deux avec horreur.
La femme s’approcha. Costa-Rica recula.
– Que me voulez-vous, madame ? interrogea-t-il d’une voix rauque… Je ne vous connais pas.
Le père Thiébault était accouru.
– Qu’est-ce qui se passe ? demandait-on…
– Bah ! répliquaient certains, c’est la folle… la pauvre folle !… Car cette femme, depuis qu’elle habitait l’hôtellerie, avait eu des allures telles, parlant toute seule parfois, chantant et pleurant tour à tour, sans raison, affirmant à tous que son mari ne s’était pas suicidé, mais avait été tué, qu’on avait pensé que son cerveau était dérangé…
Tout à coup la folle cria dans la figure de Costa-Rica, qui essayait en vain de reconquérir son sang-froid :
– Moi, je te connais !… C’est toi qui as assassiné mon mari !…
Il y eut des cris, des rumeurs, une bousculade… « C’est la folle !… C’est la folle !… »
– C’est encore la folle qui a une crise… Son mari s’est suicidé et elle accuse tout le monde de le lui avoir tué… s’écria le père Thiébault.
– Je ne connais point cette femme, je vous jure, murmurait Costa-Rica, pendant qu’on s’empressait autour de l’accusatrice, qui n’était prise au sérieux par personne, bien que l’étrange trouble de l’accusé ne passât point inaperçu… Je ne sais même point comment elle s’appelle…
– Je m’appelle Mme Didier !… Et toi, comment t’appelles-tu, assassin ?
La Mouna s’était dressée, haletante, comprenant soudain le danger…
– Je vous défends d’accuser mon amant, vieille folle ! s’écria-t-elle… C’est un honnête homme !…
La Mouna en eût dit bien davantage si le père Thiébault ne l’avait calmée et si elle n’avait aperçu tout à coup la jeune femme qui se tenait auprès de la femme au châle.
– Oh ! dit-elle entre ses dents, pendant qu’elle se rappelait la nuit de la Roquette, la fille du condamné à mort !… Le roi des Catacombes ne doit pas être loin !… Il fait mauvais pour nous ici…
Et, inquiète, elle se tourna vers Master Bob. Celui-ci, sans la regarder, car ses yeux étaient occupés ailleurs, lui dit d’une voix sourde :
– Va-t-en, maintenant… emmène-le… et tais-toi !
Alors, la Mouna, déclarant avec volubilité qu’elle ne remettrait plus jamais les pieds dans une sale boîte pareille, s’enfuit en poussant devant elle Costa-Rica. Mme Didier glapissait toujours d’une voix qui se mourait : « Assassin ! » Le père Thiébault la poussa sous la voûte, où elle tomba quasi évanouie dans les bras de Mlle Desjardies.
Master Bob, appelé encore le Vautour, offrit ses bons offices pour porter chez elle cette pauvre femme.
– C’est cela, s’écria le père Thiébault, qu’elle aille se coucher.
Et il referma la porte du cabaret, furieux.
XX – TRAQUENARDS
Sitôt qu’elle fut entrée, Robert ferma vivement la porte de l’atelier et accompagna Gabrielle jusqu’à un fauteuil où elle se laissa tomber, vaincue par son émotion trop violente.
Mais Gabrielle se remettait déjà. La jeune fille faisait de louables efforts pour reconquérir tout son sang-froid. Un instant, elle resta l’oreille attentive, écoutant les moindres bruits de l’hôtel.
Elle lui sourit et lui dit qu’il venait de se produire chez messire Thiébault une scène de la plus grande importance pour l’affaire qui les préoccupait. Elle savait l’étroite liaison qui existait entre le crime Lamblin et le crime Didier et toute l’importance qu’il y avait pour son père à ce que le premier crime fût puni, de telle sorte qu’on fût naturellement conduit au véritable auteur du second…
– Gabrielle, fit Robert, tout ce que vous venez de me raconter, je le sais… Je vous l’avais promis : vous tenez le premier maillon…
– L’assassin était là !… Vous aviez raison de dire que les preuves viendraient à nous, puisque l’assassin est venu !… La pauvre femme l’a reconnu tout de suite… « C’est lui ! s’est-elle écriée… c’est l’homme de l’escalier !… » Vous saviez donc qu’il allait venir ?
Robert ne répondit pas. Alors, Gabrielle reprit :
– Mme Didier a été si émue par la vue de l’homme de l’escalier qu’on dut la transporter chez elle… Un individu, que vous connaissez certainement, Robert, pour l’avoir rencontré ici quelquefois, quand il habitait l’hôtel, la souleva dans ses bras et je les suivis tous deux. J’indiquai à cet individu la chambre de Mme Didier. Nous y entrâmes tous trois. Il y avait une faible lumière dans la chambre, je ne reconnus point tout d’abord l’homme qui déposa la pauvre femme sur son lit. Les enfants dormaient. Je me penchai sur Mme Didier et j’eus la satisfaction de constater qu’elle n’était point évanouie, mais par un phénomène dû à l’extrême fatigue et à l’extrême émotion, elle dormait, elle aussi, d’un sommeil presque régulier. Je la couvris avec soin, pour qu’elle n’attrapât point froid et je me disposais à venir vous rejoindre quand je me retrouvai en face de l’homme qui n’avait point quitté la chambre…
– Mais qui était cet homme ? demanda Robert Pascal.
– Je vous ai dit que je ne sais point son nom. Mais son regard m’effraie ! Un regard d’oiseau de proie qui ne vous quitte pas !
– Le Vautour ! murmura-t-il. Le Vautour !
Alors Robert Pascal fit signe à Gabrielle de ne point quitter sa place et, se levant, il entra dans sa chambre. Là, il retrouva Cassecou, qui, patiemment, attendait des ordres.
– Eh bien, dit Cassecou, avez-vous réfléchi, maître ? Me livrez-vous le Vautour ?
– Non, Cassecou, non ! Moi vivant, on ne touchera point à un cheveu du Vautour !…
Il est probable que cette nuit-là Cassecou et Robert Pascal avaient encore quelques petites choses importantes à se dire, car ils ne se quittèrent point tout de suite, et ce n’est que vers onze heures et quart que l’ombre de Cassecou retraversa les terrains vagues qui s’étendaient derrière l’Hostellerie de la Mappemonde. Le sergent de R. C. revint dans la rue des Moulins et la redescendit. Il passa devant le cabaret des Trois-Pintes et colla son visage contre les vitres. Il constata que Master Bob n’était plus là. À une table, le gnome américain écrivait.
– Qu’est-ce qu’il a ? Qu’est-ce qu’il a à écrire toujours comme ça ? se demanda Cassecou. Si quelqu’un peut jamais me dire ce qu’il fiche chez nous, celui-là !… À la place du Dab, ce que je m’en serais déjà débarrassé !…
Et Cassecou reprit sa marche descendante sans se presser. Il aurait été peut-être plus inquiet s’il avait su que son visage collé à la fenêtre des Trois-Pintes avait été aperçu et reconnu par M. Macallan.
Celui-ci, une minute plus tard, était dans la rue.
– Qu’est-ce que Cassecou est venu faire ici ce soir ? se demanda M. Macallan. Il a certainement vu Robert.
La silhouette de Cassecou disparaissait à ce moment à l’angle de la rue des Moulins…
– Je le suivrais bien, fit Macallan tout haut, se parlant à lui-même, mais je n’ai pas le temps.
Il paraissait fort perplexe et très ennuyé d’avoir aperçu la figure de Cassecou dans ces parages.
– Allons, il faut savoir ce qu’ils font à la Porte-Saint-Martin. Pourquoi ne m’a-t-il pas parlé de cela ? C’est étrange… Bizarre !… On ne me roule pas, moi !
Un fiacre passait au coin de la rue de l’Abbaye ; il le héla. Avant de monter dans la voiture, il menaça le cocher de son bâton, lui promettant une raclée magistrale, s’il ne le déposait point dix minutes plus tard à la Porte-Saint-Martin. Le cocher rit et le modeste équipage partit comme le vent, sur la promesse d’un bon pourboire. L’automédon eut cinq sous et injuria l’avorton qui pénétrait déjà dans le théâtre.
On en était au quatrième acte des Martyrs. La pièce en comptait cinq. Macallan était donc arrivé avant le dernier entracte. Il prit un fauteuil de première galerie et immédiatement y grimpa. De là, il pouvait voir sans être vu. Son regard plongeait dans la salle et fit le tour des baignoires. L’une d’elles avait sa grille complètement levée. Il se dit : « Elle est là derrière. »
Sur la scène, le drame du cirque se déroulait. Néron, penché au bord de la loge de pourpre, écoutait avec épouvante la prophétesse, à demi-nue, prête au supplice, qui, debout sur le sable de l’arène, annonçait au maître de l’empire sa fin misérable et prochaine. Au dernier plan, les esclaves commençaient à allumer les chrétiens, torches vivantes, flambeau rayonnant sur le monde romain. Dans la lueur sinistre des flammes dévoratrices, Mlle Marcelle Férand lançait l’imprécation avec un tel enthousiasme de la mort, que la salle tout entière se levait dans une tempête de bravos et de clameurs, dans une ovation sans pareille. Et c’était ainsi tous les soirs. L’œuvre n’avait, au fond, rien que de banal. Mais, la tragédienne faisait passer sur cette œuvre médiocre un souffle tel qu’elle l’avait sacrée chef-d’œuvre aux yeux de tous.
Le rideau tomba. Les spectateurs, debout, transportés, des flammes au cerveau, le faisaient relever dix fois, et le gnome Macallan vit que la grille dorée de la baignoire qu’il fixait d’un regard curieux ne put résister plus longtemps. Elle fut baissée d’un geste fébrile. Macallan s’attendait à ce que ce geste fût celui d’une femme, mais il reconnut aussitôt dans la personne qui avait baissé la grille et qui se penchait hors de la baignoire pour encore applaudir Marcelle Férand, Teramo-Girgenti lui-même. Derrière lui se tenait Liliane d’Anjou et le procureur impérial.
– Oh oh ! dit Macallan, qu’est-ce que tout cela signifie ?
Et il songeait :
– Comment a-t-il fait pour être déjà là ?
Teramo-Girgenti continuait d’applaudir follement, hors de lui. En le voyant si noblement « emballé », le gnome eut une moue suprême de mépris.
– Ah ! tu ne changeras pas ! dit-il à mi-voix, tu ne changeras pas !… Quelle misère !… Regardez-le applaudir… Quelle misère !… Avoir dépensé tant d’argent !…
La salle se vidait. Macallan gagna les couloirs.
– Bah ! fit-il, nous allons toujours tenter l’opération de la dent creuse. Après on verra.
Il descendit, se mêla à la foule et arriva non loin de la porte de la baignoire qui paraissait tant l’occuper. Il était là depuis quelques instants quand cette porte fut poussée et il vit Liliane qui sortait, au bras de Teramo-Girgenti. Celui-ci était habillé comme aux plus grands soirs, en habit, portant au cou, sur la cravate blanche, la croix de commandeur de Sainte-Anne. Ce vieillard paraissait ainsi, malgré son grand âge, de la plus jeune élégance. Macallan se demandait, anxieux, s’il allait suivre le couple ou rester à surveiller les gestes de Sinnamari, quand il vit celui-ci sortir également de la baignoire et suivre Liliane et Teramo, à quelques pas. Soudain, Teramo fit un signe à l’ouvreuse, qui apporta les fourrures, et tous trois descendirent sous le porche. Sinnamari se tenant toujours derrière, sans doute parce qu’il ne voulait point causer ce scandale public de se montrer trop ouvertement avec la courtisane. M. Macallan crut remarquer que Sinnamari était fort préoccupé.
Le procureur s’arrêta un instant au contrôle, et M. Macallan, qui le surveillait de près sans qu’il s’en doutât, l’entendit préciser au chef de contrôle, l’un de ses correspondants sans doute :
– Je souperai à la Maison Dorée. Surtout, qu’ils ne perdent pas une minute.
Macallan en avait entendu sans doute plus qu’il n’espérait en savoir, car il sortit aussitôt et sauta dans un fiacre qui le conduisit devant la Maison Dorée. Ainsi, il put voir arriver Liliane et Teramo-Girgenti dans le coupé de la demi-mondaine ; ils entrèrent dans le vestibule, éblouissant de lumière du restaurant à la mode. Cinq minutes s’écoulèrent, et ce fut le tour de Sinnamari de pénétrer dans le restaurant. Il marchait vite, le nez dans le col de sa fourrure. Il donna, en passant, un ordre bref au portier.
– Je ne sais pas ce qu’il prépare ! Indeed ! faisait tout haut dans son fiacre le gnome. Je donnerais bien un penny que Teramo va se faire jouer par Sinnamari ! Ah ! by jove ! Quelle misère !… Et ce Sinna ! Quel homme ! Le vrai dab, c’est lui !
Et le gnome fut pris d’une rage qu’il traduisit cependant par quelques jurons sonores, interrompus soudain par l’apparition de deux ombres solidement emmitouflées qui entraient dans la lumière du vestibule et qui étaient arrêtées un instant par le portier. Le gnome bondit hors du fiacre.
– Le préfet de police ! Le chef de la Sûreté ! Oh ! oh ! Ça devait finir comme ça avec ce terrible sentimental fellow ! My patience is exhausted. Ma patience est à bout !
Et, haletant, cherchant le parti qu’il devait prendre, il commença par s’arracher une mèche de ses cheveux filasses. Puis il pénétra directement dans le restaurant et grimpa hâtivement un escalier. La porte d’un des cabinets était entrouverte. Il passa devant cette porte, jeta un coup d’œil dans ce cabinet et vit qu’il était occupé par les deux personnages qui avaient eu le don de déchaîner dans sa petite personne un si furieux émoi. Un garçon arrivait. Il lui demanda si le cabinet qui se trouvait à côté de celui où se tenaient le chef de la Sûreté et le préfet de police était libre ; on lui répondit affirmativement ; il y pénétra, disant qu’il attendait quelqu’un et demandant qu’on le laissât seul jusqu’au moment où il sonnerait. La porte fermée, il constata qu’une autre porte, dont les verrous étaient tirés, faisait communiquer le cabinet où il se trouvait avec celui d’à-côté… Il colla son oreille contre cette porte et il montra une mine désillusionnée, car il n’entendit rien. Il se releva en poussant un soupir et, à nouveau, il se tira les cheveux. Mais, tout à coup, un éclat de voix, qu’il reconnut, le fit tressaillir et il courut à la porte de communication. C’était Sinnamari qui venait d’entrer et qui parlait, mais s’il n’arrivait au gnome que des bribes de cette conversation, encore eurent-elles le don de l’exaspérer au plus haut point. Il entendait :
– J’ai juré que je le saurais ce soir… Il faut tenter le coup… Nous ne savons pas ce qui nous attend demain… La fête de Teramo est un traquenard dont nous ignorons tout… Si ce Teramo et le roi ne font qu’un, il y a du bon !…
Mais la voix du préfet de police se faisait entendre :
– C’est impossible ! Impossible que ce soit le même homme… Et si nous nous trompons, les conséquences peuvent être incalculables.
– Je suis bien de votre avis, reprenait Sinnamari, voilà pourquoi je tiens à tenter ce coup-là… Nous verrons bien ce qu’il fera ! Et ce qu’il fera nous renseignera !… Nous saurons du coup à quoi nous en tenir !…
Ici les voix se firent tellement basses que Macallan n’entendit plus rien. On ne saurait exprimer la fureur qui envahit le petit corps de l’avorton quand il entendit Sinnamari émettre cette hypothèse : « Si Teramo et le roi ne font qu’un… »
Puis, la voix du chef de la Sûreté se fit entendre, mécontente :
– Jamais ! C’est une invention de Dixmer !… Je m’en fiche pas mal de ces gens-là et ils peuvent jaboter tout leur soûl… Comprenez donc que Dixmer encore une fois ménage la chèvre et le chou… Vous avez eu beau lui promettre ma place…
– Vous êtes ridicule, mon cher, répliquait Sinnamari.
Et puis encore du silence.
Sinnamari se faisait à nouveau entendre :
– Je suis si bien de votre avis sur Dixmer que, me méfiant de son jeu, je ne dirai rien à son agent qui doit venir nous chercher ici… Sans quoi, j’aurais attendu l’arrivée de cet agent pour vous faire prévenir… Ah ! c’est un coup !… Quand j’ai su que le hasard me mettait au théâtre en face de Teramo et me l’amenait jusque dans ma baignoire, je me suis dit : Il ne faut plus le lâcher, il faut l’emmener coûte que coûte avec nous et tenter le coup !
En entendant ces derniers mots, M. Macallan se releva, tremblant, le front en sueur.
– N. d. D. !… s’écria-t-il, lui qui ne jurait jamais que par le dieu des grecs. Quel coup vont-ils donc tenter ?
Et il sortit du cabinet, dans un tel état de fureur, d’humeur et de terreur qu’il en oublia son bâton…
– Oh ! si je pouvais savoir où il est !…
À tout hasard, il ouvrit deux portes de cabinets particuliers, mais ne réussit qu’à troubler des desserts plus ou moins intéressants. Un garçon le bouscula, lui demanda ce qu’il voulait. Il fit la description de Liliane, et on le conduisit dans le cabinet de Sinna.
– Pourvu, se disait-il, que le procureur ne vienne pas tout de suite !
Quand la porte du cabinet de Sinnamari fut poussée, il aperçut Liliane qui écoutait tranquillement Teramo-Girgenti. Le comte semblait fort galant et allumait une cigarette d’Orient aux lèvres de la jeune femme ; mais, quand il aperçut M. Macallan, il bondit littéralement sur lui et le prit au collet. L’autre balbutiait :
– J’ai voulu te prévenir !… Un traquenard… Sinnamari !… Prends garde !… Ne va pas où tu dois aller !…
Mais Teramo le secouait sans l’écouter.
– Encore toi ! Encore toi !…
– Pour te sauver ! râlait le gnome.
– Oh ! fit Teramo avec un immense soupir… Tu mériterais bien de ne pas voir demain !
Et il le jeta comme un paquet dans le couloir, ordonnant au garçon de reconduire tout de suite ce mendiant sur le trottoir. Trois domestiques arrivèrent au bruit et s’emparèrent de Macallan qui, malgré les coups dont était accompagnée la bousculade, trouva encore le moyen de souffler à Teramo :
– N’y va pas !…
Mais Teramo avait déjà refermé la porte.
Et si le comte n’alla pas cette nuit-là au cabaret de l’Ange Gardien, ce ne fut pas pour suivre le prudent avis du gnome. Sinnamari avait eu l’intention de l’y entraîner, mais trop peu sûr que R. C. et Teramo ne fussent qu’un, il s’était laissé convaincre par le Préfet de Police et le Chef de la Sûreté de ne rien précipiter.
Selon eux, R. C. ne pouvait pas manquer de faire un faux pas, qu’ils guettaient.
Macallan avait rejoint son fiacre. Lui aussi guettait. Il suivit Teramo qui raccompagna Liliane après le souper ; plantant là le procureur impérial qui en parut très dépité.
– Ah, cette dent creuse ! gémit le nain.
TROISIÈME PARTIE – « TU TE RÉVEILLERAS D’ENTRE LES MORTS »
I – UNE FÊTE CHEZ LE COMTE DE TERAMO-GIRGENTI
Ce soir-là, l’avenue des Champs-Élysées, aux alentours du rond-point, était si bien ombrée d’équipages qui se rendaient à l’hôtel du comte de Teramo-Girgenti, que la circulation en fut arrêtée. Les voitures qui descendaient de l’Arc de Triomphe durent, pour gagner la place de la Concorde, prendre des chemins détournés. On n’avait encore vu à la fois si somptueuse et si nombreuse cohue qu’aux grands soirs des Tuileries, et le service d’ordre était débordé de toutes parts. Une foule énorme de curieux, d’oisifs, de badauds, augmentaient encore la confusion.
Quelques échos, parus dans les feuilles boulevardières, avaient suffi à rameuter, devant l’hôtel du Comte, les Parisiens qui aiment tant à badauder. Mais en vérité, bien peu avait été publié.
À ce moment, Paris était surtout intrigué depuis quelques semaines par les histoires que l’on racontait sur un certain R. C., sur une certaine association que les initiés appelaient l’A. C. S. et que commandait un bandit fameux et qu’on avait cru jusqu’alors légendaire : le roi des Catacombes, dont les initiales seules épouvantaient la police.
L’imagination aidant, on avait eu vite fait de créer, pour ce Cartouche nouveau style, un piédestal gigantesque d’où il dominait la ville et l’État. Tout ce que l’on rapportait de lui était fabuleux. On le disait riche à millions et disposant de tous les secrets de l’Empire. Ses hommes étaient partout. Il avait des espions dans tous les ministères. Les fonctionnaires les plus huppés étaient à ses ordres. Enfin, le plus beau était que ce bandit paraissait animé de l’esprit le plus honnête et qu’il avait juré le bien de tous. On citait des exemples de bons citoyens récompensés comme dans les contes de fées et les méchants cruellement punis.
Ce qui avait mis le comble à l’intérêt que l’on portait à cette mystérieuse figure, c’est que, au cours de cet hiver rigoureux, dix soupes populaires avaient été créées dans les plus pauvres quartiers de la capitale et dix asiles de nuits ouverts, sur la porte desquels se lisaient les fameuses initiales R. C. Ce roi des Catacombes était aimé des uns et haï des autres, sans être connu de personne, bien que l’on racontât qu’il fût partout à la fois. Les uns disaient qu’il n’employait que d’honnêtes gens, les autres affirmaient que les pires bandits étaient à sa solde.
La police, qui avait commencé par rire trop bruyamment de toutes ces histoires de brigands, avait fini par ne plus cacher qu’elle était sur la piste de la plus formidable organisation de malfaiteurs qui eût jamais existé.
La préparation de la fête du comte fut ébruitée, dans le public, en même temps que l’on commença à savoir que cet étranger était en affaire avec R. C. Sur quoi les journaux donnaient des détails sur le comte de Teramo-Girgenti.
Les reporters avaient interviewé quelques-uns de ses amis et s’étaient amusés à dépeindre sa figure comme celle d’un Cagliostro fin XIXe siècle. Il était riche comme s’il avait réellement trouvé la pierre philosophale, et il se disait immortel, naturellement. Les reporters, dans leur hâte, n’avaient pas eu le temps d’expliquer au public la différence qu’il y avait entre la résurrection perpétuelle de Teramo-Girgenti et l’immortalité du comte de Saint-Germain. Mais le public en savait assez pour se faufiler, ce soir-là, où on lui avait dit que le Teramo donnait une fête, aux abords de l’hôtel du millionnaire.
Quant à ce que nous appelons le Tout-Paris, qui avait été invité par le comte, et cela depuis plus de quinze jours, quinze jours qui avaient paru bien longs, tant on était déjà intrigué, il était venu en foule, d’autant plus que ce n’était plus un secret pour personne – Philibert Wat avait raconté la chose – que Teramo eût été autrefois le prisonnier du roi des Catacombes et qu’il lui eût payé une rançon de cinq millions. On avait fait des bassesses pour être invité à cette soirée mémorable. Philibert Wat, qui était le grand répartiteur des grâces du comte, avait été assiégé. Les femmes étaient les plus enragées.
Heureusement, les salons du comte étaient vastes et les serres immenses. La cour derrière l’hôtel, dont la porte donnait sur la rue de Ponthieu, avait été elle-même transformée en serre. On lui avait mis un toit de vitrage, on l’avait chauffée et on avait fait pousser là, en quelques heures, les arbres et les fleurs les plus rares et de véritables bosquets.
Tout le fameux aménagement réservé aux perroquets avait disparu.
Il n’y avait plus un seul de ces volatiles criards dans l’hôtel. Sur les ordres du comte, ils avaient tous été rejetés sur le marché qui s’en était trouvé encombré. Pendant vingt-quatre heures, on put avoir à Paris un perroquet pour deux sous.
Quant à l’hôtel lui-même, c’était, à vrai dire, un musée, ou plutôt, ce qui répondra mieux à la vérité, une collection de musées. Musée d’armes, galeries de tableaux, musée d’orfèvreries, tapisserie-musée, musée de céramique, et chaque pièce à elle toute seule était un musée pour l’ameublement.
Les invités, reçus sur le perron par une livrée flamboyante « tout en or » et qui eût pu sembler de mauvais goût de la part de tout autre que de Teramo qui prétendait avoir le pouvoir de transformer en or tout ce qu’il touchait ; les invités, disons-nous, étaient présentés par Philibert Wat au comte, qui se tenait sur le seuil de la galerie des Glaces ; puis ils se répandaient dans le palais en attendant l’heure du dîner, ravis, éblouis, fascinés, enthousiastes.
Ceux qui gardaient quelque sang-froid se demandaient en face de tant de richesses « dont on ignorait l’origine », ce que cela voulait dire.
En connaisseurs à qui « on n’en fait pas accroire », ils palpaient, touchaient, caressaient, scrutaient, et ils étaient au bout du compte obligés d’avouer que ce n’était point là un décor de théâtre. Cependant, il y avait bien un théâtre, mais il était à sa place, comme toutes choses. On disait même que le comte avait sa troupe, à la tête de laquelle se trouvait Marcelle Férand, qui allait jouer, ce soir-là, aux côtés de la belle Liliane d’Anjou, son élève.
Mais toutes ces curiosités, ces enthousiasmes, ces étonnements, ces stupéfactions, après avoir fait le tour de l’hôtel, revenaient dans la galerie des glaces, où se tenait toujours le comte, recevant ses invités, car le plus curieux, dans l’hôtel, c’était encore Teramo-Girgenti lui-même. D’où venait-il ? Où allait-il ? Que voulait-il ? C’était le mystère fait homme.
Ce soir-là, il paraissait radieux. Ses yeux flambaient d’une vie effarante chez un vieillard. Un vieillard, lui ?… C’est à peine si on voulait croire à ses cheveux blancs ! Quel jeune homme eût présenté une taille plus droite, plus noble et plus fière ?… Il se cambrait dans son habit noir comme on se cambre à vingt ans. La souplesse de ses mouvements, la grâce de ses manières, tout était jeune chez cet ancêtre qui prétendait avoir connu Périclès.
Regardez-le s’incliner, dans le moment, devant la colonelle Régine, qui vient d’arriver ; et regardez-le se relever surtout après lui avoir baisé la main et dites-moi qui est le plus vieux, de ce vieillard ou de cet homme qui se tient à ses côtés, et qui est, comme on dit, « dans toute la force de l’âge » ! Ah ! Que Teramo-Girgenti est jeune ce soir ! Et que Philibert Wat est vieux !… On ne le reconnaît plus… Lui qui porte ordinairement si beau et dont les traits affectent dans le monde une si noble indifférence !… Quelle figure ravagée !… Quel désespoir l’a ainsi transformé ?… Et, si quelque douleur cachée le fait souffrir à ce point, pourquoi est-il venu ?… Pourquoi se tient-il aux côtés de ce jeune vieillard joyeux ?
C’est que celui-ci lui a promis, pour ce soir, une réponse… une réponse à une question terrible : « Où sont les deux petites jumelles du colonel Régine ? » Il est là pour la même raison que le colonel Régine et la colonelle elle-même qui s’y trouvent. Le même désespoir est peint sur leurs figures, et personne ne s’en étonne, car on sait quel malheur les a frappés : on a volé les deux petites jumelles du colonel Régine ! Mais tout le monde, tout le monde s’étonne – et c’est dans la galerie des glaces un murmure hostile – que, puisqu’on a volé leurs enfants, les parents, dont le désespoir n’étonne pas, aient trouvé bon de venir à cette fête, de venir à une fête quelconque !…
Pourquoi ? Pourquoi sont-ils là ? Qu’est-ce qu’ils font là ? On leur a promis une réponse. Qui ? Où ?… Cet homme terrible, extraordinaire, l’ami de R. C. !… Teramo-Girgenti… L’ami de R. C. !…
Elle est venue cependant ; elle s’est habillée tout de noir, comme si elle portait déjà le deuil. Elle défaille aux bras du colonel Régine, qui est aussi pâle que sa femme, aussi pâle que Philibert Wat… Comme au milieu de ces trois êtres, images de l’angoisse et de la mort, Teramo apparaît vivant, bien vivant, heureusement et terriblement vivant ! La colonelle essaie de parler, elle ouvre la bouche, des larmes coulent de ses yeux, elle implore, et, auprès d’elle, le colonel, de toute son attitude, de tout son silence, implore… Et Philibert Wat implore…
À tant de douleur, Teramo-Girgenti sourit enfin…
– Madame, dit-il, j’ai fait votre commission… Vous saurez tout à l’heure, madame, pourquoi on vous a volé vos enfants !…
La malheureuse veut des explications, tout de suite… mais le comte lui a déjà échappé et s’avance, les mains tendues, vers deux nouveaux arrivants, cependant que l’huissier clame :
– M. Sinnamari, procureur impérial ! M. Eustache Grimm, directeur de l’Assistance publique !…
Sinnamari, physiquement et moralement, n’était jamais apparu aussi fort. Cet homme dégageait de la puissance. Le moindre de ses gestes, la moindre de ses paroles, son silence même disaient la pleine confiance qu’il avait dans son étoile. Certes, il avait des ennemis, mais ces ennemis surtout lui accordaient un courage qui n’était égalé que par son audace et ses succès. Il sentait que cette soirée était dirigée contre lui, sans qu’il en pût dire les raisons : il ne pouvait même pas soupçonner en quoi elle le menaçait…
N’importe, il était venu ! Et s’il était venu, ce n’était point seulement pour obtempérer au désir de sa maîtresse, Liliane d’Anjou, qui lui avait fait promettre que rien au monde ne pourrait l’empêcher de répondre à l’invitation du comte, ni d’assister à ses débuts d’artiste. C’était aussi par bravade de sort qu’il pressentait momentanément hostile, c’était surtout pour savoir ce qu’il avait au juste à redouter du comte, dont il ignorait plus que jamais la personnalité. Quelque chose, tout au fond de sa conscience, lui criait : « Prends garde ! Prends garde !… »
– À propos, dit-il, mon cher procureur, vous savez que j’ai vu notre roi.
– Quel roi ? demanda Sinnamari.
– Mais le roi Mystère.
– Allons donc, mon cher comte ! Vous n’avez pas bougé d’ici de toute la journée.
– Oh ! oh ! cher ami… Vous me faites donc espionner ?…
Sinnamari se mordit la lèvre.
– Pouvez-vous le penser ? dit-il. Je vous fait garder, voilà tout !…
– Garder ?… interrogea Teramo-Girgenti. Et pourquoi donc me faites-vous garder, s’il vous plaît ?
– Parce que je ne me consolerais point qu’il arrivât malheur à un ami tel que vous.
– Bah ! fit Teramo. Voyez donc, mon cher procureur, comme vous vous trompez… Je ne suis point, en effet, sorti d’ici ; c’est le roi des Catacombes qui est venu chez moi.
Un murmure d’étonnement amusé accueillit ces dernières paroles. Eustache Grimm, qui avait encore grossi depuis que le comte ne l’avait vu et qui éclatait dans son habit, cependant tout neuf, reçut les compliments de Teramo sur une santé si prospère. Le directeur de l’Assistance publique, voyant que l’on parlait de R. C., se risqua à son tour à demander au comte si le roi des Catacombes avait bien voulu lui expliquer certaines anomalies dont il avait déjà parlé à son hôte et qui troublaient sans raison apparente la quiétude de son administration, mais le comte lui répondit en souriant qu’il se trompait certainement sur l’origine de ces anomalies-là, car le Roi lui avait déclaré qu’il ne connaissait pas plus M. Eustache Grimm que M. Sinnamari lui-même.
Le procureur s’était déjà glissé dans les groupes, cherchant quelqu’un qu’il ne voyait pas. Il s’adressa à un valet qui lui indiqua une porte au bout de la galerie des glaces. Il la poussa. Il se trouvait dans un adorable boudoir Pompadour.
– Tiens ! bonjour, Sinna, dit une voix joyeuse.
– Bonjour, Liliane ! Mais je ne me trompe pas !… C’est bien maître Mortimard que je vois échoué dans ce coin, fit le procureur… Que faites-vous ici, maître Mortimard ?…
Et le procureur s’assit, tournant le dos au notaire et dévorant de son regard l’agréable spectacle que Liliane lui offrait, à lui… et au notaire, mais, comme disait la demi-mondaine :
– Un notaire, n’est-ce pas, ce n’est pas un homme !
Liliane, aidée de sa femme de chambre, essayait le travesti qu’elle devait revêtir après le dîner pour jouer son rôle de page amoureux. Elle avait déjà passé son maillot – et c’était cette partie du costume qui intéressait à un point que l’on ne saurait dire le regard concupiscent de l’inflammable Sinna. Jamais il n’avait tant vu les jambes de Liliane, le malheureux ! Et ce maillot qui gantait de soie violette des cuisses admirables, qui moulait toute la jambe fine, longue, nerveuse, le transportait. Il sentait que jamais il n’avait autant désiré cette femme qui, se promettant toujours, ne se donnait jamais… à lui.
Jusque-là, dans ses rêves ardents, il s’était imaginé Liliane nue : il ne savait pas ce qu’un peu de cette nudité, transparaissant sur un maillot de soie, pouvait ajouter à son rêve coutumier. Il se leva un peu pâle et se recula pour ne point se précipiter gloutonnement sur cette jambe qu’avec une innocence et une impudeur égales, Liliane balançait sous le nez de son cher Sinna. L’extrême force touche à l’extrême faiblesse, et le plus vaste orgueil à la plus triste niaiserie. Il y avait des minutes où Sinnamari était niais. Qui l’eût cru ?
Il essayait de se ressaisir, de ne point montrer au notaire le tumulte passionnel qui l’agitait ; il souriait à Liliane comme un gros bêta, mais un coin de conversation, qu’il surprit entre la courtisane et Me Mortimard lui rendit tout à coup le sens de la réalité.
– Alors, tout est en règle, maître Mortimard ? demandait Liliane.
– Mon Dieu, oui, mademoiselle… puisque les signatures sont données, la propriété vous appartient désormais… Il ne me reste plus qu’à remplir le devoir ordinaire de mon état, qui consiste…
– Faites-moi grâce, maître Mortimard !… Je ne connais goutte à tout votre papier timbré, et, du moment que vous me dites que je suis désormais propriétaire…
– Mais, mademoiselle, demanda le notaire, que comptez-vous faire de cette propriété ? Il y a là un pauvre pavillon…
– Je veux avoir « ma folie » en plein cœur de Paris, déclara Liliane.
C’est ici que le procureur intervint.
– De quelle propriété parlez-vous donc ? interrogea-t-il curieux.
– Mais de celle, cher ami, que vous avez la bonté de m’offrir.
– De la maison de campagne de Brétigny ? fit Sinnamari, qui comprenait de moins en moins.
– Eh ! non, de votre petite maison de la rue des Saules !
Le procureur regarda Liliane, le notaire… et comme ils n’avaient point l’air de saisir la raison de sa très apparente stupéfaction.
– Moi ! s’écria-t-il. Moi ? Je vous ai donné ma petite maison de la rue des Saules !
– Évidemment, répliqua le notaire, puisque vous avez signé l’acte de donation.
– Mais c’est impossible ! C’est une erreur de votre part ou une ridicule plaisanterie ! Je n’ai jamais rien signé de pareil !
– Eh bien ! interrompit Liliane, très calme. Heureusement, Me Mortimard, que vous m’avez dit que tout était en règle, sans quoi je vois que monsieur tient tellement à sa propriété que, après me l’avoir donnée, il n’hésiterait pas à me la reprendre… Et ça dit que ça m’aime !
– Allons, allons ! Parlons sérieusement, reprit Sinnamari, qui, de pâle qu’il était tout à l’heure, était redevenu très rouge… Vous m’avez lu l’autre jour, Me Mortimard, un acte de donation par lequel je donnais à mademoiselle ma propriété de Brétigny…
– Pardon ! Pardon !… Celle de la rue des Saules !
– Vous avez lu : « Brétigny » !… Je vous entends encore…
– J’ai lu : « rue des Saules… » Et vous avez signé !…
– Mais enfin ! Dans la lettre que je vous ai écrite, en vous demandant de préparer l’acte de donation, je disais : « Brétigny ».
– Vous disiez : « rue des Saules !… » Du reste, c’est bien simple, la voilà !
Et Me Mortimard fouilla dans son portefeuille, d’où il tira la lettre, objet du litige. Nerveusement, Sinnamari s’en empara et lut :
– Il y a en effet « rue des Saules », fit-il, mais il y a faux, car ceci n’est point de mon écriture.
– Non, répliqua Liliane très tranquillement, c’est la mienne !
– Ah ! Vous voyez bien ! s’écria Sinnamari.
Et il se retourna, furieux, vers Liliane :
– Vous faites des faux, maintenant ? Qu’est-ce que cela signifie ?
– Cela signifie que je voulais cette propriété et que je l’ai !
– Ah ! vous l’avez ! Il va falloir me la rendre !
– Non ! Elle est à moi ! Et elle restera à moi ! À moins, mon beau Sinna, à moins…
Et Liliane entoura, de ses deux beaux bras frais, le cou de Sinnamari, dont la colère s’amollissait déjà…
– À moins que vous ne me traîniez devant vos juges, mon beau procureur…
– Oh ! Liliane ! soupira Sinnamari sous la caresse de sa maîtresse. Qu’est-ce qui vous fait désirer ainsi cette bicoque perdue dans un infâme quartier de Montmartre ?… Parlez-moi sincèrement, Liliane… qu’est-ce qui vous a soufflé ce désir ?…
– Personne !…
– Vous me le jurez ?…
– Je vous le jure !…
– Pourquoi ?
– Pour vous y recevoir, mon maître !… J’ai rêvé que nous aurions là le plus joli coin d’amoureux qui se puisse rêver… Ce n’est point seulement pour moi que je la veux, cette petite maison d’amour… C’est pour vous surtout, mon Sinna… Vous verrez !… Vous verrez !… Je vais en faire une merveille… J’ai des idées déjà pour la décoration… Ce sera charmant… Vous verrez comme nous nous y aimerons, mon beau procureur… Voyez-vous, il ne faut point que nos amours soient comme toutes les amours… Il leur faut un cadre à part… Je vous ai fait attendre longtemps… C’est pour vous aimer davantage… Pensez au jour prochain où, vous ayant fait dire : « Venez, mon maître, tout est prêt pour vous recevoir… », vous viendrez vers celle qui vous attendra !…
Et, disant ces choses, Liliane se faisait câline, si câline, et balançait si joliment sa jambe, sa jambe moulée dans le maillot violet, que Sinnamari, oubliant tout à fait la petite maison de la rue des Saules, ne pensa qu’à la femme… à la femme qui se promettait si tendrement, si amoureusement… L’amour chasse l’image du crime.
– Tout ce que tu voudras, ma chérie… sourit-il, heureux.
La camériste était allée à la porte.
– Dépêchons-nous, madame… La galerie des glaces est vide, ce doit être l’heure du dîner…
Liliane donna congé à Sinnamari et à maître Mortimard, qui rejoignirent Teramo-Girgenti, lequel, suivi d’une véritable cour, arrivait sur le seuil de l’immense salle à manger. Les trois cents invités du dîner étaient arrivés tous « au complet ». Ces trois cents personnages, hommes et femmes, constituaient ce que Paris compte de plus célèbre, de plus à la mode, de plus illustre par l’art, le talent, la richesse, l’habileté, la vertu, la science, le mensonge, le crime et la prostitution. Ce qui n’était qu’au second plan dans la capitale devait arriver après dîner.
Comme Sinnamari et maître Mortimard pénétraient dans la salle à manger, derrière le comte de Teramo-Girgenti qui donnait le bras à Marcelle Férand, ils entendirent Raoul Gosselin qui demandait à son hôte quelques explications sur l’étrange « suisse » qui se tenait debout sur le seuil de la salle. Cet homme était, du reste, l’objet de la curiosité de tous.
C’était un véritable hercule tout habillé de soie rouge ; son profil, qui ressemblait singulièrement à celui d’un oiseau de proie, était à demi masqué par un loup de velours noir derrière lequel flamboyaient des yeux, comme deux escarboucles… Ce géant écarlate s’appuyait sur le pommeau d’une épée monstrueuse à deux tranchants.
Le comte répondit à Raoul Gosselin en passant devant cet homme :
– Mais, monsieur, ce n’est pas mon suisse. Mon suisse à moi est bien plus beau et bien plus grand que cela ! Seulement, il est malade !…
Alors, le roi des Catacombes a eu l’idée, que j’ai trouvée drôle, de me prêter, pour le remplacer, son exécuteur des hautes œuvres !
II – OÙ CERTAINS CONVIVES DU COMTE DE TERAMO-GIRGENTI COMMENCENT À ÊTRE FORT INTÉRESSÉS PAR UNE VIEILLE HISTOIRE
La grande salle à manger de l’hôtel du comte était gothique, et l’effet que produisait sur son seuil la silhouette rouge de ce bourreau masqué était assez impressionnant. Mais, à Paris, on rit de tout, et, ma foi, on rit du bourreau masqué.
Le comte, avant que de prier son monde de prendre place aux trois grandes tables qui garnissaient somptueusement ce magnifique réfectoire, s’amusait encore des histoires qu’il racontait, histoires personnelles et qui n’en étaient que plus curieuses. Elles avaient trait à un vieux bahut devant lequel il passait, à une antique horloge, à un portrait.
Dans cette salle, il y avait une collection d’armoires et de huches et de rouets qui lui rappelaient quelques heures terribles ou joyeuses de ses existences passées. Il disait couramment : « le roi François Ier, mon ami », ou « Agnès Sorel, un soir qu’elle filait, car Agnès Sorel était excellente filandière, me disait… » Si bien, si bien qu’après avoir raillé de ses contes du vieux temps, et surtout la prétention à l’éternité de leur amphytrion, les dames commencèrent d’être troublées par le sérieux de Teramo-Girgenti, qui paraissait ne point s’apercevoir une seconde que l’on pût mettre en doute la succession miraculeuse de ses résurrections.
– Tout est là, disait-il, sans sourire, en se penchant aimablement vers Marcelle Férand, qui lui demandait tout simplement le secret de son éternité. Tout est là : vivre vingt-cinq ans et se reposer soixante-quinze. Et, alors, on peut vivre d’une façon indéfiniment répétée. Vingt-cinq ans, à condition bien entendu qu’on ne fasse pas le fou pendant ces précieuses vingt-cinq années. C’est pourquoi j’ai choisi les environs de la soixantaine humaine pour revivre ces vingt-cinq ans. Les passions sont alors modérées, ou tout au moins il est plus facile de les commander. Elles ne vous brûlent point, ce qui est fort important. Frédéric Hoffmanns l’a dit : « Il meurt plus d’hommes par l’esprit que par le corps ! » Ne jamais oublier que la température animale peut monter de 28 degrés Réaumur à 30° dans un violent accès de colère, et descendre à 27° sous l’empire de la frayeur. Mesdames, vous souriez ; vous avez tort, car jamais on ne vous a parlé plus sérieusement. Il est telles de vos contemporaines qui ne sourient jamais pour se garder des rides ; moi, vous ne me verrez jamais rire réellement, je veux dire avec bruit, avec éclat, pas plus que vous ne me verrez triste, pas plus que vous ne me verrez inquiet, parce que l’exhalaison de l’acide carbonique par les voies respiratoires augmente sous l’influence des impressions exhilarantes, et diminue par la tristesse et l’inquiétude.
J’ai dit tout à l’heure combien les discours baroques de Teramo occupaient les esprits ; dois-je ajouter que si quelqu’un s’en moquait absolument, ou plutôt les ignorait tout à fait, c’était le rabelaisien Eustache Grimm, qui ne s’était vu à pareille mangeaille.
Il fut troublé cependant dans l’acte prodigieux de sa manducation par une voix qui, à côté de lui, disait :
– La loi du jeûne se retrouve dans toutes les religions. Les Phéniciens et les Assyriens avaient leurs jeûnes sacrés. Les brahmanes se nourrissent de l’écorce des arbres qui croissent sur les bords du Gange. Il y avait à Rome des jeûnes institués en l’honneur de Jupiter. Certains jeûnes chez les Lacédémoniens s’étendaient jusqu’aux bestiaux ! Si on ne sait pas jeûner, on est condamné à une mort prochaine. Regardez le comte : il ne mange rien !
Eustache Grimm leva, à ces mots (« Si on ne sait pas jeûner on est voué à une mort prochaine ») un regard éperdu sur celui qui les prononçait. C’était un médecin fort célèbre, du nom de Mackensie, qui s’entretenait avec une pauvre petite figure de rien du tout, pas plus haut que ça sur son siège, et en laquelle nous avons déjà reconnu M. Macallan. M. Macallan avait les yeux fixés sur Eustache Grimm pendant que le docteur Mackensie lui parlait de la sorte, et ainsi le directeur de l’Assistance publique jugea que cette conversation du jeûne était venue du spectacle qu’il donnait d’une évidente goinfrerie, et encore que la phrase relative au décès prématuré des gens qui mangent trop le visait particulièrement.
Il s’essuya les lèvres, clapota de ses lourdes paupières sanguinolentes, se gratta le bout du nez et demanda :
– Pardon, docteur, est-ce que vous croyez réellement qu’il soit impossible de manger beaucoup et vivre vieux ? Il y a des exemples…
– Certes, interrompit le docteur Mackensie, il y a des exemples !… Mais ce sont des exemples de gens qui mangeaient beaucoup et qui restaient maigres !
Eustache Grimm toussa.
– Ainsi, fit-il, après un silence qui, pour lui, fut solennel, ainsi, vous pensez que je mange trop ?
– Je le pense.
– Et que c’est dangereux ?…
– Oui… Plures occidit gula quam gladius.
– La gueule en tua plus que le glaive, traduisit méchamment Macallan.
– Et donc, je puis en mourir ? reprit Eustache Grimm, de plus en plus mélancolique. Mais, quand ? À première vue…
– Eh bien !… Aujourd’hui… demain…
– Diable !…
Et Eustache Grimm se gratta encore le bout du nez et reclapota ses paupières…
– Est-il encore temps de me sauver ? demanda-t-il. Que faut-il faire ?
– Il vous faut manger moins !…
– Vous n’avez pas d’autre régime ?…
– Non !…
– Alors, tant pis, monsieur, tant pis ! s’écria furieusement Eustache Grimm, et, comme un valet passait derrière lui portant un plat, il l’arrêta pour reprendre pour la troisième fois du salmis de perdrix péripatéticienne à la radjah !
Dans le même temps, Mme de Grandmouzin prenait sa voix la plus flûtée pour demander :
– Mais enfin, mon cher comte, quand vous êtes mort, comment faites-vous pour vous ressusciter ?
– Je ne me ressuscite pas, dit le comte. On me ressuscite. Il suffit pour cela que dans certaines conditions données on prononce devant mon cadavre certains mots pour que je revienne à la vie !
– Oh ! Très amusant ! dit Marcelle Férand. Mais quelles conditions ? Quels mots ?
– Ceci est le secret de la mort, madame !…
– Et comment vous ressuscite-t-on si vous ne confiez ce mot à personne ?
– Je le confie à mon héritier… à la personnalité, héritière d’autres personnalités définies, dans mon testament, qui héritera de moi une somme énorme, soixante-quinze ans après ma mort, à condition qu’elle prononcera les mots de ma résurrection devant mon cadavre !
– Admirable recette, répliqua en jouant Marcelle Férand. Mais vos héritiers, tous les soixante-quinze ans, pourraient en abuser et dépeupler un cimetière !…
– Je ne leur en laisse point le temps, madame ; je n’ai point plutôt revu la lumière du jour que je les envoie aux Enfers prendre ma place. Il faut son compte à Caron.
Sinnamari, riant d’un fin rire, intervint :
– Comte ! Vous allez effrayer ces dames. Regardez-les… Elles ne savent plus si elles doivent rire ou pleurer.
– Et vous, mon cher procureur, que faites-vous ?
– Je ris !…
Teramo-Girgenti resta quelques secondes sans répondre à Sinnamari, et puis il dit d’une voix qui retint l’attention déjà si éveillée de tous ceux qui l’entouraient :
– Vous avez tort de rire, monsieur le procureur impérial, et pour que vous ne riiez plus, je m’engage devant vous…
– À ressusciter les morts ? s’écria Sinnamari.
– Un seul ! Un seul cadavre revivant, monsieur le procureur, et ce sera suffisant, je crois, pour que vous ne riiez plus !… répliqua le comte d’une voix tellement lugubre qu’un silence pesant succéda tout à coup à toutes les conversations. Ceux qui n’avaient pas entendu et qui n’étaient pas au courant demandaient à leurs voisins : « Qu’est-ce qu’il y a ? Qu’est-ce qu’il y a ? » et les autres répondaient tout bas : « C’est le comte qui s’engage, devant le procureur impérial, à ressusciter les morts ! »
– Vous avez donc bien envie de me convaincre personnellement de votre pouvoir surnaturel ? demanda Sinnamari, qui ne voyait pas bien où son dangereux hôte voulait en venir.
– Nullement, mon cher procureur, nullement ! Je vais vous faire profiter d’une occasion, simplement… Vous, et ceux de ces messieurs et de ces dames qu’un pareil événement pourrait intéresser…
Immédiatement, tout le monde se proposa pour être de cette exceptionnelle partie d’outre-tombe ; mais le comte, de plus en plus calme et de plus en plus lugubre, déclara qu’il ne pouvait pas dire s’il y aurait place pour tout le monde, attendu qu’il ne savait pas encore où la chose se passerait, et qu’il lui fallait auparavant que de ressusciter le cadavre, trouver le cadavre lui-même !
– Oh ! oh ! fit-on de toutes parts, si on ne sait pas encore où on a enterré Lazare, nous avons le temps d’attendre qu’il sorte du tombeau !
– Pas si longtemps ! répliqua Teramo-Girgenti en faisant taire tous ses contradicteurs d’un geste légèrement impatienté… car je saurai où se trouve ce cadavre dès ce soir même… je l’ai promis au roi Mystère !
– C’est donc un cadavre qui intéresse beaucoup le roi ?
– Beaucoup ! C’est le cadavre de sa mère !
Le comte avait prononcé cette dernière phrase d’une voix où se révélait une si étrange émotion que chacun eut le pressentiment qu’on n’était point venu seulement là pour dîner et qu’on allait certainement assister à quelque événement inattendu. Le dîner, du reste, était déjà fortement avancé. On déserta les deux autres tables pour venir écouter Teramo-Girgenti qui, disait-on, allait faire d’intéressantes révélations sur le roi des Catacombes… Tous les convives, déjà, le lui demandaient, le pressaient. Puisqu’il était si documenté sur le fameux R. C., qu’il leur dise tout de suite son histoire. Elle devait être merveilleuse…
– C’est qu’elle n’est pas précisément gaie, dit le comte.
– Bah ! Cela fera toujours passer un moment, fit négligemment Sinnamari.
– J’espère, mon cher procureur, que vous ne vous ennuyez pas… Ni vous, mon cher monsieur Eustache Grimm… Ni vous, mon cher colonel… Tiens où donc est le colonel Régine ?
Et il se tourna vers un valet :
– Faites donc dire au colonel Régine que je désirerais le voir. On alla chercher le colonel, qui s’était retiré, avec sa femme dans un petit cabinet solitaire et qui vint s’asseoir entre Sinnamari et le directeur de l’Assistance publique, en face du comte. Il était plus pâle que jamais… il faisait pitié à tout le monde… Il avait fini par raconter à ceux qui s’étonnaient de sa présence en ces lieux que Teramo-Girgenti lui avait promis de lui retrouver ses deux enfants…
– Que me veut-on ? demandait-il.
– Ce sont ces dames, dit Teramo, qui veulent que je leur raconte l’histoire du roi des Catacombes…
– Commencez ! Je frappe les trois coups… dit Marcelle Férand…
– Il était une fois… dit Liliane d’Anjou.
Le comte commença, après un sourire ami à Liliane : « Il était une fois, dans les premières années de l’Empire, trois jeunes gens qui s’étaient juré une amitié éternelle… »
À ce début de la narration de Teramo-Girgenti, Sinnamari, Eustache Grimm et le colonel Régine commencèrent de dresser l’oreille, Sinnamari surtout, qui s’était promis de ne s’étonner de rien de ce qui devait arriver de cette soirée et qui, comme nous le verrons, avait pris ses précautions, étant moralement trop averti pour ne point se défier d’une histoire dont le début lui rappelait sa jeunesse et le pacte qui était autrefois intervenu entre Grimm, le colonel et lui. Aussi, dès l’abord affecta-t-il un air assez distrait pendant que ses deux complices, au contraire, écoutaient manifestement le comte avec un très vif intérêt.
– Ils s’étaient juré une amitié éternelle, continuait Teramo. Tinrent-ils leur serment ? Non ! Car il faut vous dire de suite que ces trois jeunes gens étaient incapables d’amitié. Ce sentiment, le plus sacré qui soit, n’avait point de place dans leurs cœurs égoïstes. Il ne pouvait s’agir en la circonstance que d’une convention pratique à s’entraider à travers la vie, dans la bataille quotidienne de l’ambition, des honneurs et de l’argent. À l’âge où d’autres ne songent encore qu’à avoir une maîtresse, ils ne pensaient déjà qu’à devenir riches et puissants. Aucune vertu, mais des vices, des vices tyranniques qu’ils allaient contenter tout de suite. Ils avaient été élevés au même lycée et avaient, dès le plus jeune âge, appris à se connaître. Avant qu’ils ne fussent des hommes, l’association était déjà formée, le pacte était déjà conclu ; ils l’appelaient pacte d’amitié ; ce n’était qu’un pacte d’intérêt, ce ne devait être qu’un traité de brigandage. Ce traité-là, ils le respectèrent si bien qu’au jour où nous sommes, il existe encore.
» L’un de ces jeunes gens entra dans la magistrature, l’autre dans l’armée, le troisième dans l’administration. Pas un instant ils ne se perdirent de vue, s’entraidant, usant de leurs relations communes, abusant du secret surpris par l’un pour se pousser dans la carrière tous les trois, s’encourageant à perdre tout scrupule, se félicitant des pires moyens devant les meilleurs résultats. Le chef de la bande était le magistrat. Au fond, il est probable que les autres n’eussent point existé sans lui. Ils auraient végété dans quelques postes subalternes, commettant d’insignifiantes vilenies et regrettant l’occasion qui ne se serait jamais présentée de faire la fortune qu’ils rêvaient. Mais le magistrat était un être vraiment doué. Tout jeune encore, il était nommé substitut à Paris et il avait déjà, chez le garde des sceaux, une réputation établie d’intelligence et d’audace qui lui firent demander certains services difficiles, dont eurent à pâtir certains hommes politiques devenus, depuis, illustres.
» L’habileté et le cynisme de notre substitut étaient tels que loin de lui nuire dans l’esprit de ces politiciens, lorsque à leur tour ils arrivèrent au pouvoir, ceux-ci s’en souvinrent avec un empressement heureux et ému, qui pourrait étonner si la philosophie des révolutions n’était pas là pour nous faire souvenir qu’il n’y a pas deux façons de gouverner et que les plus bas besoins de la conservation politique forcent les plus honnêtes gens du monde à se servir des plus abominables crapules ! Il n’est pas tous les jours facile de trouver des gens qui se chargent du service de la voirie, par exemple, qui est cependant la première des besognes dans une société bien policée puisqu’elle assure la « tranquillité dans la rue ! » Balayer les perturbateurs, ramasser les ordures révolutionnaires, charger le panier à salade, sans se préoccuper au juste de ce qu’on y met, jeter au cachot d’aisance tout ce qui embarrasse le corps de l’État, c’est là un travail qui demande aussi peu d’odorat que de conscience ! Mais il faut un cœur solide ! Notre substitut avait le nez bouché et un cœur de pierre !
» Grâce à lui, l’association prospérait. Chaque étape franchie sur la route de la fortune par l’un des associés était fêtée joyeusement. Mais il est permis d’affirmer, à ce propos, que rarement fête fut plus gaie que celle que le jeune substitut donna à ses deux camarades à l’occasion de l’enterrement de sa vie de garçon ! D’autant plus joyeux que ce devait être également l’enterrement d’une vie de médiocrité et de modestie pécuniaire qui touchait parfois, vu les goûts du monsieur, à la gêne. Notre magistrat n’était point riche et il allait épouser une dot de deux millions.
» Huit jours avant cet heureux événement, il avait convoqué à Chatou, chez un restaurateur bien parisien, ses deux camarades. Quelques dames de mœurs faciles, devaient être de la partie. Elles ignoraient à qui elles avaient affaire et avaient été envoyées chez le restaurateur par les soins d’une entremetteuse de luxe qui avait la clientèle ordinaire de ces messieurs. Le restaurateur, prévenu, fit entrer tout ce joli monde dans un cabinet particulier, dont les fenêtres donnaient sur le bord de l’eau. Juste au-dessous de la fenêtre, il y avait une terrasse où quelques couples bourgeois déjeunaient à des petites tables.
» Ces dames, qu’on avait fait entrer dans le cabinet, étaient au nombre de quatre. Pourquoi quatre, puisque ces messieurs étaient trois ? Fallait-il expliquer ce chiffre par une erreur de l’entremetteuse ou par le beau zèle d’une marchande de chair humaine qui connaît l’appétit de ses clients ? Toujours est-il que si le mariage de ce cher substitut manqua – car il manqua – ce fut à cause de la « quatrième ». Qui des quatre devint la quatrième ? Celle qui fut laissée pour compte par les trois, naturellement. Voici comment les choses se passèrent et comment un déjeuner qui avait commencé comme une partie de plaisir se termina sur l’un des plus sombres drames que les annales de la justice aient eu jamais à enregistrer.
» Le repas s’était passé fort gaiement, du moins pour six des convives. La délaissée, la moins belle sans doute, se tenait debout devant la croisée refermée, d’où elle apercevait le spectacle familial des groupes bourgeois achevant de déjeuner sur la terrasse. Derrière elle, quelques exclamations, cris étouffés, rires, protestations vite calmées, bruits de baisers, lui apprenaient qu’on ne s’ennuyait pas dans le cabinet particulier, ce qui, du reste, n’était pas pour l’étonner. Elle en avait entendu et vu bien d’autres. Seulement, était-ce ce jour-là le contre-coup de la solitude parfaite dans laquelle on la laissait… Toujours est-il qu’elle ne put retenir un geste d’exaspération énervée en entendant les hâbleries débitées dans son dos par les trois personnages masculins qui se vantaient qu’aucune femme jusqu’à ce jour n’avait pu leur résister.
» – Bah ! fit-elle, sans se détourner. Il y a des femmes que vous n’aurez jamais.
» – Lesquelles ? demandèrent les trois hommes.
» – Les honnêtes femmes !
» – Elles sont plus faciles « à faire » que les autres ! répliqua le magistrat, qui enterrait sa vie de garçon et qui avait bu, ce jour-là, plus qu’il n’avait coutume.
» – Et vous vous mariez ? demanda la demoiselle qui avait appris ce détail pendant le repas et qui se tenait toujours debout devant la fenêtre.
» – Je n’épouse point ma femme pour son honnêteté, répliqua-t-il cyniquement, et je ne suis pas un imbécile, je l’épouse pour ses millions…
» – Je ne connais pas celle qui vous offre des millions pour avoir l’honneur de porter votre nom, monsieur, et je ne connais pas davantage cette jeune femme qui, en face de moi, sur cette terrasse, achève de déjeuner entre son mari et ses deux petits enfants, mais je parierais tout ce que vous voudrez que vous pourriez lui donner les millions de votre femme que vous ne parviendriez point à la détourner de ses devoirs ! Je ne me trompe pas sur la vertu des autres, et cette femme est vertueuse !
» – Voyons le phénomène ! s’écria le substitut en se levant.
» Il repoussa sa compagne qui s’accrochait à lui et courut à la fenêtre. Les amis l’y suivirent.
» – Bigre ! firent-ils ensemble, elle est bien jolie !…
» La jeune femme qu’ils avaient en face d’eux était plus que jolie. Elle avait cette beauté simple des jeunes mères de famille quand elles sont heureuses. On sentait, en effet, on devinait que la beauté de cette femme, le rayonnement de son teint, le charmant éclat de ses regards, la parfaite harmonie de ses gestes, lui venaient pour moitié de l’amour de son mari qui était en face d’elle et du sourire de ses deux bambins qui ne la quittaient pas des yeux. Elle était mise avec un goût irréprochable et sûr que l’on retrouve à tous les degrés de la bourgeoisie féminine à Paris.
» On n’eût pu dire du mari si c’était un artisan ou un artiste. Son costume, sa silhouette, sa façon d’être, tenaient à la fois de l’un et de l’autre. L’aîné des enfants était un petit garçon fort éveillé, qui paraissait plein de malice et d’intelligence, et la petite fille, qui ressemblait étonnamment à sa mère, ouvrait sur le monde des grands yeux étonnés. Homme et enfants étaient groupés autour de la maman, qui leur racontait quelque histoire que l’on n’entendait pas, mais qui les emplissait d’aise.
» – Je parie, déclara avec un gros rire le magistrat, je parie que cette femme est à moi avant huit jours.
» – Et à moi aussi ! s’exclama l’officier.
» – Et à moi aussi ! fit entendre le fonctionnaire.
» – Non ! répliqua le magistrat. Non ! À moi tout seul ! Elle est trop jolie, je la garde !
» – Tu n’es qu’un égoïste, firent les deux autres, elle est à nous aussi bien qu’à toi ! Et tu n’as pas le droit de nous priver d’un morceau pareil !
» – Un morceau de roi !
» – Cette femme n’est à personne, messieurs, qu’à son mari, et elle restera à son mari ! conclut en haussant dédaigneusement les épaules celle des filles qui avait si malheureusement attiré l’attention des convives sur ce ménage bourgeois.
» – Tirons-la au sort ! s’écria l’officier.
» – Je veux bien, répondit le substitut. C’est moi qui gagnerai !
» Le fonctionnaire obtempéra. Et ils tirèrent cette femme au sort, cette femme qu’ils ne connaissaient point et qui continuait à s’entretenir tranquillement, à quelques pas de là, avec son mari et avec ses enfants.
» Ce fut le magistrat qui gagna. Il avait été stipulé que les perdants aideraient le gagnant dans ses projets et qu’ils ne lui refuseraient aucun service destiné à faire tomber cette honnête femme… dans ses bras !…
» Dès lors, le déjeuner de garçon, l’enterrement de la vie de garçon, la ripaille de Chatou et les demoiselles n’intéressèrent plus nos héros. Ils renvoyèrent les filles après les avoir payées, et, très amusés de leur projet, se concertèrent pour en assurer la prompte exécution. Il fallait se presser. Le mariage du magistrat ne devait-il pas avoir lieu dans huit jours ? Et d’abord, ils suivirent cette famille à sa sortie du restaurant, à sa rentrée dans Paris. Le soir à six heures, ils savaient que l’homme était ouvrier orfèvre à domicile, qu’il gagnait très aisément sa vie, que sa femme était sage et honorablement connue dans le quartier, le quartier de l’Observatoire… »
Le comte de Teramo-Girgenti fut interrompu à cet instant de son récit par un cri poussé près de lui : c’était Mlle Liliane d’Anjou qui se trouvait mal…
III – IL FAUT RENDRE LES ENFANTS À LEUR PÈRE
Le comte se pencha sur la jeune femme qui était tombée dans les bras de Raoul Gosselin. Quelle émotion soudaine l’avait ainsi foudroyée ? Quelle brusque lumière, au récit du comte, avait éclaté dans les ténèbres de son souvenir ? Quel mot l’avait peut-être mise enfin à même de comprendre le rôle qu’elle jouait et dont elle n’avait pas jusqu’alors soupçonné la portée, dans cette tragédie montée par Teramo-Girgenti, à qui, depuis la visite à la maison du quartier de l’Observatoire elle avait obéi aveuglement, pour des raisons qu’elle n’était pas encore parvenue à démêler ? Comprenait-elle enfin le jeu de Teramo-Girgenti ?
Le comte, pendant qu’on s’empressait autour d’eux, faisait respirer à Liliane ce flacon de sels qui ne le quittait jamais. Liliane ouvrit les yeux et l’aperçut tout d’abord, si près, si près d’elle que leurs visages se touchèrent presque et qu’il put dire un mot et qu’elle put lui répondre sans que personne ne les entendît. Liliane, maintenant, avait les yeux pleins de larmes, et elle disait, dans un souffle :
– Mon frère !… Oh ! Mon frère !…
Et Teramo lui répondait, remuant à peine les lèvres, et si bas qu’elle le comprit plus qu’elle ne l’entendit :
– Silence !… Pour l’amour de notre mère… Silence, Clotilde !…
Le comte se releva, soutenant Liliane, qui souriait dans ses larmes.
– Ce n’est rien, dit-il. Une faiblesse… la chaleur… Que l’on ouvre les fenêtres !
Chacun s’empressa.
Le récit du comte et l’indisposition subite de Liliane avaient si bien occupé les yeux et les esprits que nul ne semblait avoir prêté la moindre attention à l’étrange attitude de trois des principaux personnages de cette histoire. La figure de Sinnamari, pendant que le comte parlait, était devenue de marbre. Il eût été difficile de dire même si cet homme écoutait et si sa pensée n’était point partie pour quelque rêve lointain qui s’immobilisait hors de ce salon et de tout ce qui pouvait s’y passer. Mais Régine et Eustache Grimm avaient marqué, malgré tout l’effort qu’ils faisaient pour rester impassibles, au fur et à mesure que les événements racontés par le comte se déroulaient, un émoi qui s’était traduit d’abord chez l’un par une pâleur extrême, et chez l’autre par une rougeur excessive.
Ils frissonnèrent tous deux, comme on frissonne sous un vent glacé, quand le nom de Chatou fut prononcé, et que l’aventure du cabinet particulier et les péripéties du pari infâme apparurent comme des images vengeresses dans le récit de Teramo ! Tous les spectres de leur jeunesse, comme ils les croyaient évanouis pour toujours ! Et voilà que cet homme qu’on ne connaissait pas, les leur ramenait ces temps hideux dans le moment qu’ils se croyaient le plus tranquilles !… Où cet homme avait-il appris toute cette histoire morte ?
Cet homme était le diable ! Et ils sentaient que s’ils ne se surmontaient, ils allaient se mettre à claquer des dents et à montrer un tel désarroi que la foule qui les entourait n’aurait plus rien à deviner de la haute personnalité des trois héros de cette horrible histoire. Un coup d’œil jeté sur le procureur leur fit honte de leur attitude et de leur pusillanimité. Ils s’efforcèrent de se mieux tenir sous les coups qui les frappaient… et puis de voir Sinnamari si calme, si étonnamment maître de lui, ils espéraient que l’étrange partie à laquelle Teramo-Girgenti les avait convoqués n’était pas encore entièrement perdue pour eux. D’abord, ils ne savaient pas où le comte voulait en venir, ni le rapport qui pouvait exister entre leurs forfaits passés et l’histoire promise du roi des Catacombes…
Au moment de l’incident Liliane, ils poussèrent un profond soupir et se levèrent. Quand le comte pria qu’on ouvrît les fenêtres, ils furent les premiers à y courir. Et ils ouvrirent les trois fenêtres qui donnaient sur la rue du Colisée ; mais, chose singulière, comme après avoir respiré un peu d’air frais ils se retournaient, ils se trouvèrent en face de Sinnamari qui venait refermer tranquillement la dernière fenêtre du coin de droite, fenêtre devant laquelle il se tenait, assis, immobile et… si « lointain » pendant le récit.
– Laissez-moi donc cette fenêtre-là fermée, dit-il à ses deux amis. Je ne tiens pas à attraper un rhume de cerveau !…
Il les regarda. Il les vit dans un tel état qu’il jura.
– Du sang-froid ! fit-il. Nous en avons besoin.
Non loin de lui, dans un coin, la colonelle Régine, à côté de Philibert Wat, regardait Sinnamari qui parlait si hâtivement et si brusquement au colonel et à Grimm, et ses yeux avaient une affreuse expression de haine pour les trois.
– Non ! s’écria-t-elle, et si haut que Philibert Wat lui pinça le bras jusqu’à la douleur pour la faire taire… Non ! je ne paierai pas, nous ne paierons pas pour eux !
Elle entraîna Wat du côté du comte, et, comme celui-ci venait au-devant d’elle pour lui offrir son bras et la conduire dans le salon à côté où le café et les liqueurs allaient être servis, cependant que de toutes parts les convives réclamaient la suite de l’histoire, la colonelle dit à Teramo d’une voix sourde :
– Mes enfants ! Je veux mes enfants ! C’est vous qui nous les avez volés ! C’est vous qui avez à vous venger de mon mari et de mon cousin ! Et c’est moi que vous tuez !… Vous m’avez pris mes enfants !… Ah ! Comte !… Vengez-vous sur eux, mais rendez-moi mes enfants !…
– Vos petites filles, qui sont adorables, madame, et qui se portent merveilleusement, sont aujourd’hui aussi joyeuses que vous êtes triste !
– Vous les avez vues, monsieur ?… demanda anxieusement la cousine de Sinnamari.
– Moi ! Nullement, madame, mais le roi des Catacombes m’a donné de leurs nouvelles, et si vous voulez connaître la cause de leur grande joie, c’est que mon ami R. C. leur a promis qu’elles reverraient bientôt leur maman…
– Quand ? fit la colonelle, qui se sentait défaillir…
– Bientôt ! Mais n’est-ce pas le colonel qui passe là-bas avec M. Grimm ?
Et le comte fit un signe au colonel et à Grimm.
Ceux-ci s’approchèrent. Philibert Wat, qui n’était jamais loin de la colonelle, se mêla au groupe, et Sinnamari, qui craignait tout de l’audace du comte et tout de la couardise de ses camarades, s’approcha lui aussi.
– J’ai une bonne nouvelle à vous apprendre, colonel, fit le comte à Régine.
Le colonel, si pâle, blêmit encore. Il s’attendait maintenant à quelque catastrophe. Il la sentait venir. Il se disait qu’il ne pouvait plus l’éviter…
– Vous vous souvenez, colonel, que lorsque vous êtes arrivé, j’ai dit à madame qu’elle saurait pourquoi on lui avait volé ses enfants…
– Oui ! pourquoi ? fit la malheureuse en échangeant un rapide et anxieux regard avec Philibert Wat, regard que surprit le comte.
– C’est bien le roi des Catacombes qui s’est rendu coupable de ce « larcin », madame… Il l’a reconnu devant moi… il m’a dit qu’il avait agi aussi cruellement parce qu’il croyait avoir à se venger de votre mari.
– Il croyait ?… interrogea la colonelle, qui ne savait plus si elle devait espérer ou désespérer.
– Se venger de moi ? gémit Régine.
– … Mais, sans doute, s’est-il trompé, et reconnaît-il s’être trompé, puisqu’il a résolu de vous rendre, madame, les enfants qu’il vous a volés…
– Mais quand ? implora la colonelle.
– Demain, madame, à trois heures de l’après-midi, vous pourrez embrasser vos enfants.
– Mon Dieu !…
Et la cousine de Sinnamari se laissa choir sur un fauteuil que lui avançait le comte.
Teramo leva les yeux sur Régine et sur Philibert Wat ; ils étaient radieux. Le morne désespoir qui s’était emparé de ces deux hommes depuis la disparition des deux petites jumelles faisait instantanément place à une allégresse commune qui, visiblement, les suffoquait.
– Ah ! pardon !… encore un mot, madame… j’oubliais !… R. C., le roi des Catacombes, comme on dit, a des manies, des lubies… je ne sais comment qualifier… Toujours est-il qu’il a décidé, m’a-t-il dit, que les enfants ne seraient pas remis directement à leur mère.
– Et à qui donc ? demanda la colonelle, se sentant gagnée par une nouvelle angoisse.
– À leur père ! madame… Oui, à leur père !… Le roi y tient beaucoup.
Et Teramo regardait fixement les deux hommes qu’il avait devant lui, le colonel Régine et Philibert Wat…
– Oh ! mais ceci n’a aucune importance ! s’écria la cousine de Sinnamari.
– C’est ce que je me suis permis de dire au roi, madame, mais il est probable encore qu’il y attache, lui, une importance que nous n’y voyons pas, car il a insisté pour que cette… restitution se fasse entre les mains du père… Et il a ajouté : Dites bien au père d’être chez lui, demain, à trois heures, s’il veut jamais revoir ses enfants ! Je ne les rendrai qu’à lui !
– C’est entendu ! fit la colonelle, qui parut soudain débarrassée d’un grand poids…
– C’est entendu ! répéta Régine.
Le comte brûlait alors, de son regard de flamme, Philibert Wat. Philibert Wat répéta, lui aussi :
– C’est entendu !
– Allons, fit le comte gaiement, voilà une affaire réglée. Teramo, s’il avait pu voir la figure ironique de Sinnamari, n’aurait peut-être pas montré tant de gaieté.
Derrière Régine et Philibert Wat, Sinnamari, qui avait tout entendu, sifflait entre ses lèvres mauvaises :
– L’imbécile !…
Mais, après tout, ce mot pouvait s’adresser à Régine ou à Philibert. Et, le comte l’eût-il entendu, il avait trop de raison de croire à sa propre intelligence et à celle de Sinnamari pour ne pas imaginer que celui-ci eût sur sa personne une opinion aussi sommaire.
C’était l’heure du café, des liqueurs, des cigares… C’était l’heure où les convives, ayant reconquis toute liberté, se répandent dans les serres, dans les galeries, dans les salons, dans les fumoirs… Mais, ce soir-là, chez le comte, par un phénomène dû sans doute à l’exclusive curiosité qu’il y avait de ce personnage fabuleux qu’était Teramo-Girgenti, tous les invités étaient restés dans le salon où le comte se trouvait. Dès l’abord, ils avaient osé réclamer avec insistance la suite de l’histoire commencée au dessert, mais un geste du comte avait fait comprendre qu’il fallait être patient… Chose remarquable, on se pressait autour du comte, mais par une sorte de convention tacite que l’on ne trouve plus réalisée que par l’étiquette qui entoure les souverains, la circonférence humaine qui enfermait Teramo était assez vaste et décrivait à distance une ligne respectueuse.
Ainsi, malgré la foule de courtisans – car, en vérité, si ces gens ne l’étaient pas encore, après ce qu’ils avaient vu chez le comte, ils étaient tout prêts à le devenir – Teramo avait pu, selon son expression, « régler l’affaire des jumelles » sans être autrement gêné par de trop curieuses oreilles.
Ceci fait, s’étant retourné vers cette foule, il daigna demander si quelqu’un s’intéressait encore à cette vieille histoire qu’il avait entrepris de conter. Chacun prétendit avec enthousiasme qu’il brûlait d’en entendre la suite, et un grand silence se fit.
En face du comte, comme tout à l’heure dans la salle, se trouvaient Sinnamari, Régine et Eustache Grimm. Sinnamari eut recours à nouveau à l’impressionnante immobilité de sa figure de marbre ; Eustache Grimm, toujours aussi défait, avait voulu fuir, mais un geste de Sinnamari l’avait cloué à sa place. Quant à Régine, il semblait que tout ce que le comte allait raconter ne l’intéressait plus depuis qu’il était sûr qu’on allait lui rendre ses enfants.
Au-dessus de la foule attentive, sur le seuil du salon, comme tout à l’heure sur le seuil de la salle à manger, se tenait la formidable et écarlate figure de cet étrange suisse porte-glaive, l’exécuteur masqué des hautes œuvres du roi des Catacombes.
Avant de reprendre son récit, le comte dit :
– Ne trouvez-vous pas qu’il fait chaud ?
De fait, on étouffait… Les valets ouvrirent les fenêtres, mais Sinnamari se leva et, tranquillement, comme il avait fait à l’instant d’avant dans l’autre salle, il alla refermer la fenêtre du coin de droite, fenêtre que l’on venait d’ouvrir sur l’ordre de Teramo.
Il revint près de lui.
– Je vous demande pardon, dit-il… mais cette fenêtre ouverte fait courant d’air et je suis assez sensible !
IV – OÙ IL EST QUESTION DES SUITES D’UN DÉJEUNER DE GARÇON
« Étant ainsi renseignés sur la famille qu’ils avaient résolu de déshonorer, par désœuvrement, par vantardise et par obéissance à un bas instinct de luxure et de cruauté, qui se retrouve plus ou moins au fond de toute bête humaine, nos trois jeunes gens, reprit le comte de Teramo-Girgenti, eurent tôt fait de dresser leur plan. Il était aussi simple que machiavélique. Il s’agissait de tâcher à corrompre la femme, qu’on la prît de bonne volonté ou par stratagème, cependant qu’on éloignait le mari. Le substitut, chef de la bande, avait une garçonnière, petite bicoque abandonnée dans une ruelle déserte de la Butte-Montmartre, dont il avait fait à peu de frais « sa folie ». Il n’eut garde d’user de ce domicile compromettant pour sa dernière aventure de garçon. À quelques jours du mariage, il tenait à garder l’incognito, et ce fut le troisième larron, le camarade qui faisait sa carrière dans la haute administration, qui, n’ayant rien à refuser au magistrat, prêta à celui-ci un petit chalet qu’il habitait pendant la bonne saison, sur les bords du lac d’Enghien.
» Justement il venait d’aménager et d’y faire transporter quelques meubles de prix, quelques bibelots de luxe achetés pour rien, lors de la vente d’un illustre collectionneur, grâce à la bienveillance et à la reconnaissance d’un commissaire priseur de ses amis. Ce furent ces bibelots qui, par une association d’idées assez compréhensible, puisque le mari à tromper était ouvrier orfèvre, servirent de prétexte à nos jeunes gens pour entrer en relations immédiates avec le ménage.
» Le fonctionnaire écrivit à l’orfèvre qu’il avait un travail très pressé à lui commander autour de bibelots précieux qu’il venait d’acquérir. Il le priait de faire dès le lendemain le voyage d’Enghien. Nos trois amis se trouvaient le lendemain à Enghien. Si c’était le mari qui venait, le magistrat devait immédiatement prendre le train pour Paris et aller trouver la femme chez elle, mais il se pourrait fort bien que le mari envoyât sa femme à Enghien. C’est ce qui arriva. C’est la femme qui vint. Elle fut introduite par une porte du pavillon pendant que les deux amis du substitut sortaient par une autre.
» Le magistrat et la femme de l’orfèvre étaient seuls dans cette maisonnette abandonnée, au bord du lac. D’abord, la femme ne se douta de rien, car le substitut lui montrait les bibelots dont il avait été question comme s’il en avait été le réel propriétaire, et il ne lui parlait que de l’ouvrage qu’il désirait confier à son mari. Et puis, à propos d’une miniature un peu leste, le magistrat en profita pour faire comprendre à cette femme qu’il n’était pas resté insensible à ses charmes, et qu’il savait apprécier la beauté partout où elle se trouvait, même chez une femme d’orfèvre.
» La malheureuse, stupéfaite, voulut fuir. L’homme la retint malgré elle, lui faisant les offres les plus outrageantes et la pressant si bien que la femme, un moment, n’eut plus qu’une ressource, celle d’ouvrir une fenêtre, d’appeler au secours. Personne ne venait, personne ne l’entendait ; le soir était tombé ; elle se vit au milieu de ce désert, la proie d’un être brutal dont la passion était exaspérée par la résistance acharnée qu’on lui opposait. La fenêtre était ouverte. Elle sauta. Elle sauta dans le noir. Elle pouvait sauter dans le lac et se noyer. Elle tomba sur une pelouse, se releva sans blessure et se mit à courir comme une folle.
» La nuit était opaque, on n’y voyait pas à deux pas devant soi ; il pleuvait à verse. La malheureuse courait… courait… elle ne rencontra personne… elle ne savait plus ce qu’elle faisait… Elle croyait avoir pris le chemin de la gare, elle avait pris la route opposée, celle qui conduisait à Paris. Et puis elle se trompa encore, se perdit dans des terrains vagues… Elle courut ainsi des heures, sous la pluie… Enfin elle arriva à Paris à l’aurore. Et dans quel état ! Elle eut encore la force de donner son adresse à un fiacre maraudeur qui la recueillit, puis elle arriva chez elle. Son mari, d’abord, ne la reconnut pas. On devine dans quelle terrible angoisse l’ouvrier orfèvre avait passé la nuit. Les médecins arrivèrent et diagnostiquèrent une pleurésie.
» Bien que l’avis des médecins fût que l’on ne fatiguât la malade d’aucune question, le mari voulut savoir ce qui était arrivé à sa femme, et celle-ci, dans un moment de lucidité, put le lui apprendre. Il était alors dix heures du soir. L’orfèvre, après avoir fait de méticuleuses recommandations à la garde-malade, sortit. Il prit le train pour Enghien. Il avait un revolver chargé dans sa poche. Il se rendit à la maison du bord de l’eau. Il trouva la porte ouverte. Il entra, et, ne rencontrant personne, il traversa plusieurs pièces, dont les portes étaient également ouvertes. Il arriva au pied d’un escalier. Guidé par une faible lumière, venant d’un bec de gaz qu’on avait laissé brûler à demi, il gravit cet escalier. Arrivé sur le palier, il frappa du poing assez fortement contre une porte, la première qu’il rencontra. Cette porte s’ouvrit. Un homme en chemise, la figure ensommeillée, grelottant de froid et de peur, se présenta.
» – C’est vous qui êtes le propriétaire de cette maison ? demanda l’orfèvre, le plus posément du monde.
» L’autre, qui ne pouvait parler, fit signe que c’était lui. Alors, l’ouvrier sortit son revolver de sa poche et en déchargea sur le propriétaire trois coups en pleine poitrine. Notre fonctionnaire, ainsi frappé, s’affala et l’ouvrier le crut mort. Une porte s’ouvrit au-dessus et un garçon, qui servait de domestique, tantôt au fonctionnaire, tantôt au magistrat, tantôt à l’officier et que chacun de ceux-ci prisait pour son intelligence et son astuce débrouillarde, un nommé Didier, accourut au bruit. Il vit son patron sur le palier, râlant. Le revolver fumait encore dans la main de l’inconnu. Didier voulut fuir.
» – Ne fuyez pas, lui dit l’ouvrier, arrêtez-moi et conduisez-moi chez le commissaire de police. Je viens de tuer cet homme qui a insulté ma femme.
» L’orfèvre fut conduit chez le commissaire de police, qui vint faire immédiatement une enquête. On constata que cette nuit-là même la maisonnette du bord de l’eau avait été dévalisée de ses bibelots de prix ; l’enquête établit que la femme de l’orfèvre était venue en ces lieux la veille et avait pu se rendre compte de la valeur unique des objets et, grâce à cette effroyable coïncidence d’un vol dont on n’a jamais retrouvé les auteurs et d’une légitime vengeance, les magistrats d’abord, le juge ensuite furent persuadés que l’ouvrier orfèvre avait tué le fonctionnaire au moment où celui-ci le surprenait dans sa besogne de rapt.
» Les complices s’étaient enfuis, naturellement, emportant le butin et l’on ne cessa, jusqu’à la dernière minute du procès, de demander à l’orfèvre de livrer leurs noms. La femme, interrogée, malgré son état presque désespéré, déclara que son mari avait voulu la venger d’un attentat dont le fonctionnaire, propriétaire de la villa d’Enghien, s’était, la veille, rendu coupable envers elle.
» Il fut facile de prouver qu’elle mentait puisque ledit propriétaire était absent de sa maison, à l’heure même où elle s’y était présentée, et qu’il fut constaté qu’il avait passé la fin de la journée chez des amis du voisinage. Le domestique, Didier, affirma que cette femme était restée seule, plusieurs heures, dans la maison, en attendant son maître, et qu’elle s’était enfin décidée à partir, lasse de ne le point voir rentrer. Les choses s’arrangèrent si bien que la conviction de tous fut faite. Il y avait un vol accompagné de meurtre. Un homme eût pu, seul, sauver l’accusé, c’était le substitut ; il l’eût pu en perdant sa situation, en renonçant à son mariage. Il garda le silence. La femme, grâce aux soins dévoués qui l’entourèrent ne mourut pas. Le fonctionnaire ne mourut pas ; ses blessures n’étaient point, par un hasard miraculeux, très graves ; le seul qui mourut fut l’ouvrier orfèvre. Il mourut sur l’échafaud ! »
Ces dernières paroles furent prononcées par le comte avec une voix si étrange, que tous les assistants frissonnèrent et qu’il y eut un murmure général d’horreur, comme si le monstrueux forfait judiciaire venait de s’accomplir devant leurs yeux. Liliane d’Anjou, qui était debout derrière le comte, chercha sa main, et l’entendit qui disait :
– Courage !
Un silence effrayant régnait maintenant dans le salon. On attendait… On voulait savoir pour quelle raison formidable Teramo-Girgenti avait tenu à réunir tant de monde autour de ce terrible récit !… On pressentait qu’il allait se passer quelque événement capital pour l’un des personnages qui, peut-être, se trouvait là… Ce drame était ancien ; dans le procès, le nom seul, le nom encore obscur à cette époque d’Eustache Grimm avait été prononcé. Qui donc s’en serait souvenu ? Qui excepté Eustache Grimm lui-même, Régine et Sinnamari ?
Si on avait moins regardé le comte et si on les avait regardés davantage, eux, on eût deviné, peut-être. Mais on ne regardait que le comte.
– Je vous ai dit, reprit-il après ce moment de silence, qu’il semblait avoir occupé à dompter une émotion toute personnelle, je vous ai dit que le mariage du magistrat devait avoir lieu dans la semaine. Il ne se fit pas : un de ces matins-là, on retira de la Seine le cadavre de sa fiancée. Le jeune magistrat avait été le dernier à l’avoir vue vivante, la veille. À ce jour, nulle explication cohérente ne permet de décider s’il y eut crime ou suicide, et pourquoi. Le fiancé, en tout cas, ne fut pas inquiété. Ni chagriné.
» La femme de l’Orfèvre fut assez forte, le jour de l’exécution de son mari, pour se lever, habiller ses enfants et assister avec eux au dénouement de ce tragique imbroglio. Du moins ne purent-ils rien voir, mais ils entendirent le coup de couteau qui retentissait au nom de la justice humaine. Les enfants, depuis des semaines, réclamaient leur père en pleurant.
» Le jour même de l’exécution, la malheureuse qui avait quelques économies, prenait le train à la gare du Nord avec ses petits et débarquait le soir dans un bourg perdu de la Picardie, où elle savait que l’Assistance publique envoyait de nombreux enfants trouvés. On disait que dans cette région les enfants étaient très bien traités. Ils étaient, du reste, considérés comme une source de revenus pour le pays. Elle remit les petits entre les mains d’une brave paysanne à qui elle donna toutes ses économies.
» Elle lui dit :
» – Je reviendrai peut-être après-demain, peut-être dans deux ans ; quoi qu’il arrive, jurez-moi de soigner mes enfants comme une mère, vous en serez récompensée.
» La paysanne songea à la somme qu’on lui laissait. Il y avait là de quoi soigner les deux petits pendant quatre ans. Elle promit. La mère ne revint jamais.
» Elle avait donné, avant de partir, un faux nom. La paysanne interrogea à ce propos le petit garçon, mais celui-ci avait juré à sa mère, avant qu’elle ne partit, qu’il ne dirait jamais son nom. La petite fille était si petite que la paysanne la crut quand elle lui dit qu’elle l’avait oublié ! Comment cette femme s’était-elle aperçu qu’on lui avait donné un faux nom ? Tout simplement à ce que deux initiales laissées par mégarde sur le linge du petit ne correspondaient pas à ce nom-là. Ces initiales étaient : R. C.
V – SUITE DES SUITES D’UN DÉJEUNER DE GARÇON
Une rumeur dans la salle fit entendre au comte que l’on venait de comprendre de quelle sorte se reliait son histoire du roi des Catacombes ; mais la curiosité de tous était telle que le silence se rétablit aussitôt. Quant aux trois personnages qui se trouvaient si particulièrement intéressés au récit de Teramo, nul n’y faisait attention. Il ne venait encore à l’idée de personne que Sinnamari, Régine et Grimm fussent justement ceux-là dont l’infamie était si ouvertement dénoncée. Nul geste, nulle exclamation n’avaient trahi nos trois compères.
La vérité était que deux d’entre eux avaient perdu la force nécessaire à la plus petite manifestation, et que le troisième se demandait dans un silence farouche comment il pourrait bien faire taire instantanément cet homme qui savait tant de choses, qui savait trop de choses… Sinnamari ne fut pas surpris par cette révélation des initiales : R. C., qui apparurent soudain dans cette sombre histoire… Il les attendait depuis que Teramo avait prononcé ce mot : Chatou…
Le comte, maintenant, racontait la suite de l’étrange et formidable aventure d’une voix si singulièrement indifférente qu’on eût pu se demander si la volonté même qu’il avait de marquer une telle indifférence ne trahissait pas plus sûrement une émotion profonde que le trouble le plus évident.
« La mère, dit-il, avait juré de venger son mari. Elle revint à Paris. Elle retrouva facilement la piste de la victime de l’orfèvre, de celui qui avait failli périr sous ses coups. Elle ne reconnut point en lui l’homme qui, une nuit, à Enghien, avait tenté de la violenter, mais le hasard fit que, dans un ami qui venait voir celui-là, à domicile, elle retrouva le monstre cherché, la cause de tant de maux, de ruine, de sang et de désespoir. Elle sut à qui elle avait eu affaire ; elle résolut de le tuer de sa propre main. Elle s’arma d’un couteau dans le dessein « de lui couper la gorge comme on avait fait à son mari ». Ce sont là ses propres expressions consignées dans un rapport fort intéressant et fort passionnant qu’elle écrivit pour qu’il fût plus tard mis sous les yeux de ses enfants, s’il lui arrivait quelque malheur.
» Elle suivait le magistrat depuis quarante-huit heures et n’était point parvenue à le joindre, dans des conditions propices au projet qu’elle méditait, quand un soir elle put sauter dans un fiacre et faire suivre celui qui emportait le substitut. Les deux fiacres s’arrêtèrent devant un cabaret de nuit. Le substitut descendit le premier. La femme était déjà sur ses pas. Elle l’entendit qui demandait si ses amis étaient arrivés dans le cabinet de… Je ne dirai point le nom, un nom propre, paraît-il, bien connu, mais moi je ne le connais pas ; à cette heure, seul R. C. le connaît et il ne m’en a point fait la confidence… Le valet de pied répondit affirmativement, et rapidement l’homme gravit l’escalier. La femme, enveloppée d’un ample vêtement et dissimulant son visage sous une épaisse voilette, monta derrière lui ; on la laissa monter sans rien lui demander. On crut qu’elle était avec cet homme.
» Quand l’homme entra dans le cabinet, elle y entra derrière lui et repoussa la porte derrière elle. Mais aussitôt elle poussa un cri ; elle avait cru se trouver seule dans ce cabinet avec le substitut. Deux personnages s’y trouvaient déjà : vous avez deviné lesquels : c’étaient le fonctionnaire entièrement guéri de ses blessures et l’officier. Ils étaient dans un état d’ébriété avancée et saluèrent l’entrée de leur ami et de cette femme inconnue par des cris insensés. Le magistrat se retourna et fut stupéfait. La femme voulut fuir, mais tous trois la retinrent et ils poussèrent les verrous. Elle se débattait. Le fonctionnaire parvint à lui enlever sa voilette. Alors, ils reculèrent d’un même geste, car ils avaient reconnu la femme de Chatou !
» Celle-ci, profitant de ce mouvement de stupéfaction, avait bondi sur le substitut, brandissant un large poignard dont elle était armée et qu’elle avait jusqu’alors dissimulé sous ses vêtements. Le magistrat parvint à parer le coup dont elle le frappait. La lame, cependant, entailla légèrement le menton. Tous trois furent sur la femme et la désarmèrent. Alors, se produisit une scène effroyable. L’ivresse des uns, la colère de l’autre, le souvenir de leur terreur au cours d’un procès qui pouvait être leur perte à tous, le ressentiment du fonctionnaire qui avait failli mourir sous les coups du mari, la concupiscence du magistrat pour cette femme qui n’avait jamais été aussi belle que dans cette minute, l’endroit où ils se trouvaient, ce cabinet particulier qui ne leur rappelait que des tableaux d’orgie, tout cela concourut en quelques secondes à la perte de la pauvre femme. Ils s’excitaient les uns les autres au crime et le crime fut commis.
» Avec l’aide de ses deux complices, le premier de ces bandits, le chef de cette association monstrueuse, posséda la malheureuse ! On lui avait mis un bâillon sur la bouche, on n’entendit point ses cris. Quand le viol fut consommé, le magistrat se ressaisissant comprit quel danger maintenant était suspendu sur leurs têtes à tous trois, il comprit que le crime ne pouvait pas en rester là !
» Un escalier dérobé conduisait directement sur les derrières du restaurant les couples qui désiraient ne point être vus. On resserra le bâillon sur la bouche de la victime, on remit la voilette par-dessus. La femme ne se défendait même plus. Quand la nuit fut assez avancée et qu’ils se furent assurés que nul ne pourrait rencontrer dans l’escalier dérobé leur étrange cortège, la femme fut littéralement portée dans une voiture qui appartenait au fonctionnaire, et qu’il conduisit lui-même.
» Je vous ai dit que le magistrat possédait une sorte de pied-à-terre dans une des rues les plus désertes de Montmartre, tout en haut de la butte. La femme continuait à ne présenter aucune résistance, mais elle était si faible que, lorsqu’on la fit descendre de voiture, le substitut et l’officier, la prenant chacun sous un bras, comme s’ils l’accompagnaient, devaient la soulever pour qu’elle avançât.
» Elle ne pouvait rien voir, car ils avaient encore pris la précaution d’ajouter un bandeau qu’ils avaient placé sur ses yeux. Seulement, elle pouvait entendre et il est certain que tout le monde ne reposait pas, cette nuit-là, dans la petite ruelle déserte, puisque, dans le moment même qu’on fit descendre la malheureuse, celle-ci perçut une voix de femme qui disait : « Oh ! regarde donc, mon ami, on dirait que cette femme se débat ! » et une voix d’homme qui répondait : « Mais non, Marguerite, tu vois bien qu’ils s’amusent. » Et puis encore la première voix qui disait : « Regarde le cocher, on dirait le Gros ! »
» Une porte, alors, était ouverte et la femme était introduite dans un jardin. La porte était refermée derrière elle. On lui fit traverser le jardin et, après avoir gravi un perron, elle fut dans une salle où elle s’évanouit tout à fait. Quand elle revint à elle, elle était couchée dans un lit et un homme était penché sur elle qui semblait attendre assez anxieusement la minute de son réveil. C’était le magistrat. Il lui dit à peu près ceci : qu’il s’était conduit vis-à-vis d’elle comme un infâme, mais qu’il l’aimait à ce point qu’aucune infamie ne lui coûterait encore pour qu’elle restât sa maîtresse ; qu’elle devait comprendre qu’il n’y avait plus pour lui de salut après ce qu’il avait fait, que dans l’oubli de sa victime et la bonne volonté d’une femme qui, si elle se laissait aimer, n’aurait point par la suite, à le regretter ; avec un cynisme d’une inconscience magnifique, il lui promit de veiller sur elle et sur ses enfants jusqu’à la mort.
» – Jusqu’à quelle mort ? demanda la malheureuse.
» – Jusqu’à la vôtre, madame, répliqua le magistrat.
» Elle avait compris. On lui donnait à choisir entre l’amour et la mort. Chose bizarre, mais qu’il n’est peut-être point si difficile d’expliquer, elle ne rebuta point tout de suite son terrible amant ; et celui-ci, à la suite de cette importante entrevue, pensa qu’à la longue ses affaires finiraient peut-être par s’arranger ! Au fond, la pauvre femme ne songeait qu’à la vengeance et elle ne demandait plus à Dieu qu’une chose, c’est qu’il lui donnât assez de force pour la mener à bien.
» Elle l’a écrit, et j’ai eu, moi, cette confession suprême sous les yeux. Elle voulait avoir la tête du magistrat. Il lui fallait sa tête !… Mais sa tête détachée du tronc ! Elle voulait lui couper la tête et jouer avec ses doigts dans ses cheveux ! Elle était dans un état qui confinait à la folie, et nul ne s’en étonnera, surtout si l’on songe que son exceptionnel état moral coïncidait avec cette situation physique si particulière d’un début de grossesse. Oui, la malheureuse était enceinte… c’est le dernier mot qu’elle a écrit sur ces papiers qui, par un hasard miraculeux, devaient un jour tomber entre les mains de son fils !… « J’étais enceinte !… »
» Que se passe-t-il dans la petite maison de Montmartre ? Quelles orgies ! Quels supplices ! Cette femme eut un geôlier, le domestique d’Enghien, le nommé Didier. Il ne devait plus la quitter. Il observait une rigoureuse consigne. Il ne s’absentait, pour les provisions, que la nuit, lorsque ses maîtres étaient près de sa prisonnière. Elle n’avait, elle, même point le droit de se promener dans le jardin. On redoutait ses cris, ses appels. Les narcotiques, la fatigue, le sommeil factice durent la livrer souvent sans défense à ses bourreaux. Du reste ses projets de vengeance n’avaient point été difficiles à percer et sa pauvre diplomatie n’eut aucun succès.
» Le magistrat vit bientôt qu’il n’avait rien à attendre de cette femme que la mort et il en joua si bien qu’il parvint à n’en prendre que l’amour ! Et il l’aima ! Mon Dieu, oui, il l’aima. Il en eut la passion ! Il était ainsi fait que l’affreuse révolte que dressait en face de lui cet être qui le haïssait de toutes ses forces, excita sa passion ! Il l’aimait à cause de la souffrance qu’il lui donnait. Il l’aimait à cause de sa haine ! Elle fut traitée comme une esclave. Il la fit attacher pour qu’elle fût à lui sans danger pour lui. Une chaise longue fut transformée en lit de supplice… Le sadisme du maître réduisit la malheureuse à n’être plus entre ses mains qu’un objet inerte d’abominable volupté ! Elle n’en mourut point, parce que déjà elle était folle. Les mémoires dont j’ai parlé tout à l’heure le prouvent… Elle n’en mourut point et ne s’en suicida point parce qu’elle se disait encore au fond du chaos de sa pensée délirante : Je le tuerai ! Je le tuerai ! Je lui couperai la tête ! Et je jouerai avec mes doigts dans ses cheveux !
» Un jour, vers midi, un jour d’été, un jour qu’elle avait reconquis quelque lucidité, elle parvint à échapper à la surveillance de Didier et à fuir le pavillon. Elle n’alla pas loin. Le geôlier la rejoignit dans le jardin et la fit rentrer, malgré ses gémissements, dans sa prison. Ce jour-là, elle fut entendue du dehors et elle perçut une voix qui disait dans la rue, derrière la porte du jardin : « Qui appelle comme ça ? » Et une autre voix répondit : « Ne t’occupe donc pas de ces histoires-là ! »
» Toutes ces horreurs qui semblaient avoir eu d’abord pour but de faire mourir de sa belle mort la malheureuse furent dépassées par une horreur plus grande encore, qui consistait maintenant à faire vivre la malheureuse !… Oui, maintenant, il voulait qu’elle vécût !
»… Il voulait qu’elle vécût ! Sans doute, la souffrance de cette lamentable créature était-elle devenue nécessaire à la joie de vivre de ses bourreaux, car l’occasion s’étant présentée d’une mort naturelle et probable pour la victime, notre substitut ne parut point tout d’abord vouloir en profiter, et malgré le danger qu’il courait personnellement en introduisant une étrangère dans une pareille aventure, il amena près de la malheureuse, dans le moment que celle-ci ne put plus lui cacher qu’elle était enceinte, une sage-femme à qui il avait fait donner la forte somme. Cette sage-femme vint deux fois, la nuit. Didier la connaissait, c’était une amie à lui. Elle consentit à se laisser bander les yeux et fut conduite dans la maison de Montmartre avec mille précautions. La seconde fois, quand elle partit, elle emportait un paquet. Dans ce paquet, il y avait un enfant vivant qu’elle déposa, dans la nuit du lendemain, suivant les instructions qu’elle avait reçues, sur le banc devant l’administration des Enfants assistés.
» Après cette complaisance, la sage-femme put se retirer des affaires. Elle avait promis de ne jamais chercher à pénétrer le mystère de la naissance de l’enfant. On s’était arrangé de telle sorte qu’elle ne sût point dans quel lieu de la capitale elle avait été appelée à donner des soins aussi exceptionnels. Toutefois, elle se rappela qu’avant de pénétrer dans un jardin, et se trouvant encore dans la rue, une voix étrange et qui ne pouvait être que celle d’un perroquet, attendu qu’une autre voix lui avait répondu : « Veux-tu te taire, Jacquot ! » lui avait soudain déchiré les oreilles, et cette voix disait : « Tu es la Marguerite des Marguerites ! Tu es la perle des Valois ! »
Ici, Teramo-Girgenti s’arrêta une seconde. Il paraissait ému au delà de toute expression. Derrière ses lunettes d’or, ses yeux fixaient Sinnamari d’une façon qui eût épouvanté celui-ci, si celui-ci, qui avait la tête baissée, et qui semblait réfléchir profondément, avait pu s’en rendre compte. Quant à Régine et à Grimm, on n’eût pu dire s’ils respiraient encore.
« Messieurs ! reprit le comte… messieurs, l’enfant, bien qu’il fût venu au monde bien avant terme, vécut. Mais la mère mourut en lui donnant le jour… Que s’était-il passé entre la première visite de la sage-femme et la seconde ? Il dut se produire un drame inattendu, suite de quelque horrible excès, car c’est tout à fait précipitamment qu’on alla chercher la sage-femme, la seconde fois, et sans qu’elle fût prévenue, et alors que l’on se trouvait encore loin du terme qu’elle avait à peu près fixé pour la délivrance de la mère.
» Toujours est-il que la nuit qui précéda cet événement et la nuit même de l’événement, des clameurs, des cris de joie, des bruits de fête étaient venus, par-delà les murs de la maison, troubler l’ordinaire tranquillité de ce quartier tout à fait abandonné… des cris de joie qui firent place soudain à une épouvantable crise de douleur qui devait être le cri de mort de la mère donnant la vie à son enfant…
– Bah ! fit tout à coup une voix tranquille et profonde… Vos trois petits satyres n’étaient que des enfants à côté de Boris Godounov !
Teramo-Girgenti reçut cette phrase de Sinnamari et il en fut, malgré toute sa présence d’esprit, étourdi, interdit, abasourdi !… Ainsi, à cette évocation tragique de ses crimes, voilà tout ce que ce géant du mal ressentait ! Voilà l’effet produit ! De l’horreur ? Non, de la blague ! Oui, de la blague ! De la blague !… Oui, à cette minute où il espérait l’écraser sous la révélation de ses crimes d’autrefois, si terribles pour sa réputation d’aujourd’hui, Sinnamari blaguait !
– Oh ! Oh ! By Jove ! gémit derrière Teramo une voix chevrotante… Mange-le !… Teramo ! Mange-le… Ou je me tue !
Teramo se retourna, très pâle, et il dit, entre ses lèvres inertes, des mots que seul Macallan entendit :
– Ne te tue pas encore ! Je te jure que je vais le faire trembler.
– Tant mieux ! murmura l’Américain, qui caressait dans sa poche la crosse de son revolver et qui montrait à Teramo une figure affreusement ravagée par le doute et l’angoisse… Tant mieux ! Car je ne survivrais pas à une faillite !
Et Macallan, attendant les événements, s’affaissa sur un tabouret.
L’interruption de Sinnamari avait été couverte de « chut » énergiques… On s’accordait à la trouver déplacée… Du reste, on ne pouvait pas admettre que quelqu’un ou quelque chose vînt, au point culminant où il en était, interrompre le récit du comte.
– Après !… Après !… criait-on.
Le comte s’était déjà retourné vers Sinnamari. Il se leva, et, tranquillement, alla à lui. Sinnamari le vit venir avec une tranquillité au moins apparente. Mais leurs regards à tous deux se croisèrent avec un tel éclat que certains qui les surprirent, comprirent aussitôt qu’un duel à mort venait de s’engager entre ces deux hommes, et osèrent se rappeler aussi que parmi les trois convives de Chatou, il y avait un magistrat.
Le comte s’était donc avancé jusqu’au procureur.
– Monsieur, dit-il, je vois que vous êtes au courant de l’histoire russe, ce qui fait que vous trouvez peut-être la mienne très peu intéressante. Je ne connais que bien vaguement les crimes de la cour de Moscou.
– Mon cher comte, c’est ce que nous appelons en France de la mauvaise littérature !
– Je ne la connais que vaguement, répéta le comte, qui, penché sur son interlocuteur, semblait vouloir le dévorer des yeux, mais le roi des Catacombes sait ce qu’un magistrat a fait souffrir à sa mère ! Il a juré de se venger de telle sorte que si celui qui a commis l’atroce forfait, et ceux qui l’ont aidé, pouvaient soupçonner cette vengeance, ils tomberaient à genoux et demanderaient en grâce qu’on les tuât tout de suite !
– Diable ! gouailla le Procureur. Comme vous y allez, mon cher comte ! Ce sont donc là des gens qui ne tiennent point à la vie !… Et votre roi des Catacombes serait, en vérité, bien bon de leur accorder une grâce pareille ! Êtes-vous bien sûr qu’il serait disposé à la leur faire ?
– Peut-être ! fit d’une voix sourde Teramo. Peut-être… si ceux-là osaient lui dire…
La voix du comte était alors devenue si éclatante que toute l’assistance s’attendait à quelques révélations plus affreuses encore.
– Osaient lui dire ?… répéta curieusement Sinnamari.
– Osaient lui dire ce qui s’est passé entre la première visite que la sage-femme fit à sa mère et la seconde, pour qu’à la seconde la malheureuse apparût à la sage-femme épouvantée avec des cheveux blancs !…
Teramo avait si étrangement, si superbement lancé la phrase « pour que la malheureuse apparut à la sage-femme épouvantée avec des cheveux blancs ! » qu’un frisson d’enthousiasme, alors que tout le monde frémissait d’horreur, secoua cet étrange petit être de Macallan, qui sursauta sur son tabouret, grimpa dessus pour mieux voir Teramo et se prit à gesticuler et à crier :
– Bravo ! Bravo ! It is truly magnificent ! Il est plus beau que le comte de Saint-Germain !
On dut lui mettre la main sur la bouche pour le faire taire et il mordait les doigts qui voulaient être bâillon.
Le comte reprit, semblant tout à coup oublier Sinnamari pour ne s’occuper que de la foule des invités qui l’entouraient :
« J’ai déjà raconté à quelques-uns d’entre vous comment j’ai été amené à faire la connaissance de R. C. et ce qu’un tel événement me coûta. Je ne saurais regretter en vérité l’aventure puisqu’elle m’a permis d’approcher un de ces hommes dont l’existence ne semble possible que dans les romans et qui commande à l’une des plus formidables puissances occultes qui se soient constituées depuis longtemps en marge de la société. Tout ce qu’on a raconté de R. C. est encore au-dessous de la vérité. Je l’ai vu à l’œuvre et son œuvre m’a intéressé, moi que si peu de chose intéresse ici-bas. Je ne vous narrerai point par le détail l’effort superbe qu’il accomplit pendant ces dix dernières années, pour devenir le plus redoutable bandit – dans le sens de chef de bande – des temps modernes et peut-être de l’histoire. Il faut avoir comme moi pénétré dans ces souterrains mystérieux et terribles comme les cercles de l’Enfer du Dante où il a établi les principaux rouages du mécanisme merveilleux qu’il dirige et qui en fait l’un des maîtres du monde. Comment le petit abandonné en est-il arrivé à ressusciter en plein XIXe siècle le pouvoir des Cartouche et des Mandrin ? Qui lui a procuré cette force ? Qui l’a aidé ?
» Certes ! Ayant appris par quelque hasard miraculeux uni par l’indiscrétion de la sage-femme qui avait assisté sa mère à ses derniers moments, de quel supplice il avait à la venger, ayant reconstitué tout le drame qui avait fait de lui le fils d’un guillotiné, il dut sentir bondir en lui une énergie surhumaine et bouillonner dans son cœur l’irrésistible et impétueux désir de rendre coup sur coup à l’injustice des hommes !…
» Mais les rois de l’ombre ont besoin pour vaincre, comme les rois dont la puissance s’étale au soleil, d’argent, de beaucoup d’argent ! Qui lui en a donné ? Qui lui en a donné assez ?… Ses crimes ?… Peut-être !… Qu’importe !… Il n’admet d’autres juges que Dieu et lui ! Et tout semble prouver aujourd’hui que Dieu est avec lui ! Car après avoir satisfait, par son amour des humbles et le secours dont il les a comblés, la haine qu’il a vouée à la société des forts, voilà qu’il touche aujourd’hui au but de toute sa vie, au châtiment terrible de ceux qui firent mourir son père sur l’échafaud, sa mère dans les tourments, et qui livrèrent sa sœur, enfant pure qu’on vola toute jeune à sa protection fraternelle, à la prostitution ! »
Le comte sembla ne pas entendre la plainte douloureuse que, derrière lui, laissait échapper Liliane. Il regardait à nouveau Sinnamari, Régine et Eustache Grimm. Ces deux derniers n’essayaient même plus de dissimuler la terreur qui les avait peu à peu envahis. Ils attendaient… ils attendaient le mot, la phrase, le geste qui allait les condamner, les vouer au supplice promis.
« Oui, continua-t-il, la vengeance de R. C. est prochaine, et j’en sais qui, s’ils ne sont pas devenus subitement fous, doivent trembler ! Si l’A. C. S., la société fondée par R. C., a prospéré, il en est une autre qui jouit d’une pleine faveur ! L’association des trois malfaiteurs a réussi !… Qui étonnerai-je ici en disant que tous les trois sont parvenus aux sources même du pouvoir ?… Les connaissez-vous ?… Certainement !… Les reconnaissez-vous ? Peut-être pas !… Car ils sont si puissants qu’il faut être plus courageux qu’intelligent pour les reconnaître, et j’ai autour de moi la société la plus intelligente de la terre !… »
Un mauvais murmure s’éleva : mais, se dressant soudain au-dessus de la foule, d’un geste de commandement suprême, Teramo ordonna et obtint le silence.
« Silence !… Écoutez-moi bien !… La preuve du crime existe !… Et je ne vous ai réunis ici, tous, que pour venir vous dire, de la part du roi des Catacombes : « Le jour est venu où les hommes vont connaître le crime qu’ils ont commis en faisant tomber la tête de Robert Carel ! La tête du père de R. C. ! »
Ces derniers mots n’étaient pas plutôt prononcés qu’on entendit la lourde chute d’un corps sur le parquet. C’était Eustache Grimm qui venait de perdre connaissance.
– Ce n’est rien ! fit remarquer d’une voix légèrement voilée Sinnamari. C’est encore cet imbécile qui aura trop mangé !
Et il regarda la fenêtre, qu’il avait maintenue fermée.
VI – DANS LEQUEL LE PROFESSEUR S’APERÇOIT QU’ON LUI A COUPÉ LE SIFFLET
Quelques heures avant les événements que nous avons retracés dans les chapitres précédents, le Professeur et Mlle Desjardies se trouvaient sur le seuil de l’Hostellerie de la Mappemonde. Ils se disposaient à sortir. Il était deux heures. Le temps n’était point beau. Comme on dit, il était « menaçant ».
– Allons ! dit-il… et que Dieu nous protège !
Il offrit l’appui de son bras à Gabrielle, et tous deux descendirent la rue Lepic. Ils se rendaient, ainsi que tous les jours, chez le peintre Raoul Gosselin, qui habitait rue de Rome, et, ainsi que tous les jours, ils suivirent la route qui leur avait été tracée. Pendant cette promenade qui leur était devenue fort agréable à tous les deux, à cause même de la conversation qu’ils y entretenaient, ils parlèrent de Robert Pascal comme de coutume, et de cela ils ne se lassaient point, elle parce qu’elle l’aimait et lui parce qu’il trouvait à ce jeune homme un talent indéniable et aussi un air de mystère qui l’intriguait et l’amusait fort.
Pour des raisons de sécurité, nos promeneurs ne descendaient point jusqu’aux boulevards extérieurs, mais remontaient derrière le cimetière Montmartre. La promiscuité de ces tombes et de tous ces marbres mortuaires déposés en pleine vie de la capitale, les invitait quotidiennement à des réflexions auxquelles, ce jour-là comme les autres, ils furent fidèles.
Cependant, il ne faudrait point croire que la parfaite tranquillité avec laquelle jusqu’à ce jour la promenade s’était accomplie, avait endormi la vigilance du Professeur. Tout en tenant ces propos raisonnables – ils parlaient de ces morts qui leur étaient du reste indifférents et du seul vivant qui les intéressât – le Professeur ne manquait point de surveiller le voisinage. Son œil averti faisait rapidement le tour des choses et des gens et, autant que possible, le Professeur évitait les rencontres.
Pour rien au monde il n’eût permis à quiconque de l’aborder ou, tout au moins l’ayant abordé, de le retenir. Il savait qu’il ne devait s’arrêter devant un étranger qui lui adresserait la parole, que si celui-ci donnait d’abord le mot de passe, dont, tous les matins, le Professeur se trouvait muni par les soins de Robert Pascal. Enfin, le Professeur ne se mettait jamais en route sans avoir tâté dans la poche de son gilet le sifflet qui devait être le signal qui les sauverait, sa compagne et lui, si l’occasion se présentait pour eux d’être sauvés.
Le Professeur et Gabrielle devisaient donc. Le Professeur disait :
– La pensée des morts ne m’effraie pas et l’aspect de leurs demeures ne me remplit pas d’épouvante, mais m’incite à goûter davantage le prix de la vie ! N’espérons point de vivre toujours, mademoiselle ; chaque saison est pour nous un avis. Qui sait si les dieux ajouteront à la somme de nos jours le jour de demain ?
– Touchez du bois ! fit Mlle Desjardies, légèrement effrayée par cette philosophie qui s’accommodait si vite de la fin de Tout, pourvu qu’on ait su jouir du commencement.
Et elle frappa elle-même du bout de son index gauche le manche de son parapluie qu’elle tenait de la main droite. Le docteur, non seulement pour lui faire plaisir, mais encore par humilité d’esprit devant le destin qui veille et rôde autour de nous, toucha le bois du parapluie, lui aussi.
Quand ils arrivèrent au coin de l’avenue de Saint-Ouen, il se prit à pleuvoir. Alors Mlle Desjardies ouvrit son parapluie, et quelque temps ainsi ils cheminèrent.
Comme la pluie redoublait, le Professeur dit :
– On fera peut-être bien de prendre un fiacre… Et il ajouta : en voici justement un qui nous attend !
De ce fait, ce fiacre semblait les attendre. Le cocher était sur son siège et la voiture était vide. Enfin, le cocher leur faisait signe qu’il était prêt à charger !…
– Où faut-il vous conduire, bourgeois ?…
Ce n’était plus de la pluie qui tombait, c’était le déluge qui allait noyer la Terre. Le Professeur bénit les dieux qui avaient mis sur sa route cet aimable automédon, fit monter dans le fiacre Mlle Desjardies et expliqua au cocher le chemin qu’il devait prendre.
Le cocher, ruisselant, fit un signe de la tête qui prouvait qu’il avait compris, et le Professeur s’apprêta à rejoindre dans la voiture Mlle Desjardies, mais dans le même moment, il entendit derrière lui une voix qui disait :
– Connaissez-vous la Chanson des Saules ?
Il se retourna précipitamment. Ce qu’il venait d’entendre, c’était le mot de passe. Ce mot venait d’être prononcé par un homme de haute taille enveloppé d’une lourde pèlerine noire, rejetée de telle sorte sur le visage qu’on ne voyait de celui-ci que les yeux. Cette tête, il sembla au Professeur qu’il l’avait déjà vue quelque part, mais il lui eût été impossible de dire où. Le chapeau de feutre aux larges ailes du mystérieux personnage descendait très bas sur le front.
Et la pluie tombait toujours. Le Professeur, étonné d’avoir entendu l’inconnu, s’étonnait maintenant de son silence. Pourquoi l’avait-il abordé, lui avait-il dit le mot de passe et maintenant se taisait-il ? Que lui voulait-il ? C’est ce qu’il lui demanda, un peu impatiemment. Mais aussitôt il entendait un petit bruit derrière lui : il se retourna et vit que la vitre du fiacre venait d’être close automatiquement par un volet de fer. Il voulut s’élancer, mais déjà le cocher avait enveloppé son cheval d’un coup de fouet terrible qui le fit partir comme la foudre.
Tout de même, sans plus s’occuper du personnage qui lui avait crié le mot de passe et qu’il bouscula rudement dans le moment où celui-ci tentait audacieusement de le retenir, le Professeur bondit. Et, en bondissant, il se souvint qu’on lui avait donné un sifflet pour en user dans des circonstances aussi exceptionnelles. Il fouilla dans la poche de son gilet, en tira le sifflet, le porta à ses lèvres, y souffla éperdument, mais n’obtint aucun son. Le sifflet était muet !
Le Professeur, stupéfait de ce phénomène, ne perdit point de temps à en chercher l’explication. La coïncidence de l’arrivée de l’inconnu et du malencontreux mot de passe prononcé, pendant que la voiture où se trouvait Mlle Desjardies s’éloignait au triple galop, le renseignaient suffisamment sur la nature de l’événement qui venait de se produire. On enlevait Mlle Desjardies !… Malgré le vent, malgré la pluie, il courait avec une vélocité dont on n’eût point cru capable un être humain, qui ne dispose que de deux jambes… Malheureusement le cheval avait quatre pattes et augmentait son avance dans des proportions telles que le Professeur commença à désespérer de l’atteindre.
Il appela. Il cria. Nul ne lui répondit. La pluie avait fait le vide dans la rue et laissait le champ libre à l’équipage, qui en profitait. Quelques passants s’étaient réfugiés sous les porches et riaient de cet homme qui courait en hurlant, derrière cette voiture emballée.
Ainsi fut parcourue la rue Legendre jusqu’au pont du chemin de fer, par le pauvre Professeur qui avait perdu son chapeau et qui allait perdre de vue la voiture. Celle-ci avait passé sur le pont et, tournant à droite, enfilait le boulevard Pereire. Elle passa, sans le traverser, devant le pont de la rue Saussure, et le Professeur, qui était loin d’être un sot, en conclut, malgré tout le trouble de sa pensée et le désarroi de ses sens, qu’elle ne gagnait ni Asnières, ni Levallois-Perret, sans quoi elle se serait dirigée directement vers les fortifications. Elle ne semblait point non plus vouloir rentrer dans le centre de Paris, car, négligeant à sa gauche toutes les rues adjacentes, elle filait droit, toujours suivant le boulevard Péreire, toujours suivant la ligne du chemin de fer, vers la porte Maillot.
Le Professeur se trouvait vers le pont du chemin de fer au milieu duquel se dresse la gare des Batignolles ; il n’eut qu’à jeter un coup d’œil sur la gare qui s’étalait à ses pieds pour y voir un train prêt à partir, dans la direction de la porte Maillot. Il se précipita comme une bombe dans la gare, renversa l’employé qui, en haut de l’escalier, voulait l’empêcher de passer sur la voie, prétextant qu’il n’avait point de billet, dégringola l’escalier sur la rampe et arriva juste à temps pour sauter sur le marchepied du fourgon de queue du train qui venait de se mettre en marche.
À la gare de la place Pereire, il voulut monter sur le toit du fourgon, dans la petite cabine du serre-frein, pour voir s’il apercevait toujours la voiture sur le boulevard, car le chemin de fer occupe là un profond fossé.
On le prit pour un fou et, comme il criait qu’il allait à la porte Maillot, qu’il n’avait pas eu le temps de prendre un billet et qu’il agitait sa bourse, un employé, qui le fit entrer dans un wagon de voyageurs, se chargea de le mettre en règle, grâce à sa comptabilité ambulante, avec la compagnie. Le Professeur avait la tête à la portière, pendant ce temps, et criait de temps à autre : « Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! » Et puis il se rasseyait et disait à trois voyageurs épouvantés : « Perdue pour perdue, au moins j’ai encore une chance de la rattraper ! » Et il remettait la tête à la portière, et il recriait : « Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! »
Si bien que, à la porte Maillot, les employés, croyant avoir affaire à un fou dangereux, voulurent s’en emparer. Mais il donna un croc-en-jambe à l’un, un coup de pied dans le tibia d’un autre, un coup de poing dans la figure d’un troisième et passa comme une trombe à travers le quai, l’escalier, la salle d’attente. On courait derrière lui. Les premiers qui arrivèrent sur la place ne l’aperçurent plus. Il était, à ce moment-là, caché dans une encoignure du boulevard Péreire et regardait, le cœur battant, le visage ruisselant de pluie et de sueur, venir à lui le fiacre, son fiacre, qui, ne se croyant plus suivi, avait modéré son allure.
Quand le fiacre passa près de lui, le Professeur n’eut garde de se faire voir au cocher et de se jeter brusquement à la tête du cheval ; il savait trop combien un faux geste, une tentative malheureuse de sa part entraînerait loin de lui avec la rapidité de l’éclair cette voiture, que seule son astuce lui avait fait rejoindre. Celle-ci lui avait trop bien réussi pour qu’il ne continuât point à se montrer plein d’imagination et de prudence ; et, quand le fiacre passa devant lui, il s’installa avec une agilité étonnante sur les ressorts d’arrière, en disant :
– Il ne sera pas dit qu’on se sera payé la figure du Professeur !
Le fiacre arriva ainsi avenue de la Grande-Armée.
Le Professeur se disait :
– S’il passe la grille du Bois, j’ai des chances de faire arrêter l’équipage en appelant à mon aide les gabelous !
Mais c’était là un vain espoir. L’avenue de la Grande-Armée fut traversée dans toute sa longueur et le fiacre s’engagea dans les boulevards qui suivent les fortifications à l’intérieur de Paris. La pluie tombait toujours à verse et le Professeur était passé à l’état d’éponge.
S’il maudissait la pluie, c’est qu’elle rendait plus désert encore ces boulevards peu fréquentés, et que tout espoir d’une intervention extérieure était interdit.
Le boulevard Lannes suivi de bout en bout, la voiture s’engagea, toujours suivant les fortifications, sur le boulevard Suchet. On avait passé la porte de la Muette et l’on se trouvait en face de la porte de Passy. Le Professeur se demandait si on allait longtemps ainsi continuer à faire le tour de Paris, à travers cette persistante inondation. Tout à coup, la voiture, sans ralentir son allure, se dirigea vers la gauche et entra rapidement dans une petite propriété isolée au coin du boulevard Beauséjour. La grille était ouverte et personne heureusement ne se trouvait là pour la refermer, sans quoi le Professeur eut été certainement aperçu. Probable que le concierge se garantissait de la pluie quelque part et le Professeur bénit la pluie.
La voiture décrivant un arc de cercle autour d’une pelouse qui précédait un petit hôtel, prit à droite et pénétra dans la cour de l’hôtel située sur les derrières par une porte qui, elle, se referma aussitôt la voiture passée. Mais, comme cette porte pleine avait été refermée de l’intérieur par un personnage que le Professeur n’avait pas aperçu, celui-ci put croire en toute tranquillité qu’il n’en avait point été vu non plus. Le Professeur, avec la voiture, se trouvait enfermé dans la cour.
– Justes Dieux ! murmurait-il. Quelle aventure ! Que suis-je venu faire dans cette galère ?
La voiture s’était arrêtée près d’un perron et le cocher avait sauté en bas de son siège ; mais avant qu’il ne retombât sur pieds, le Professeur, leste comme un cerf, s’était rejeté derrière la porte d’une obscure remise qui était entrouverte derrière lui. De là il pouvait voir sans être vu. Ce qu’il aperçut tout d’abord l’intéressa au plus haut degré. Il aperçut le cocher qui, en sautant, avait laissé tomber son chapeau, et il reconnut un visage qui avait déjà eu le don de lui inspirer une prudente méfiance.
– Oh ! oh ! se dit-il. La tête de fouine !… Nous savons maintenant pourquoi cet individu fréquentait les Trois-Pintes !… Ah ! Robert Pascal avait raison de me dire de me méfier de cette tête-là, si jamais je la rencontrais sur mon chemin !…
La tête de fouine avait ramassé son chapeau, s’était recoiffée et, tirant un passe-partout de sa poche, ouvrait tranquillement la portière de la voiture.
– Descendez, mademoiselle ! pria-t-il d’une voix ferme, et ne craignez rien ! Il ne vous sera fait aucun mal.
Mlle Desjardies bondit hors de la voiture et voulut crier, mais apercevant tout à coup, derrière le cocher, la figure effarée du Professeur, qui avait mis un doigt sur la bouche, elle se tut…
Le cocher lui montrait maintenant une porte qui venait de s’ouvrir au haut des marches. Elle obéit et pénétra dans l’hôtel en remerciant le ciel de lui avoir réservé le secours inattendu de son compagnon. Elle sentit qu’elle pouvait compter sur son compagnon et sur sa ruse, et elle résolut de garder tout son sang-froid pour l’aider…
Elle entra donc dans l’hôtel et la porte se referma sur elle, mais pas si vite que le Professeur n’entendît son cri désespéré.
L’hôtel n’avait qu’un étage et des mansardes. Les fenêtres du rez-de-chaussée avaient leurs volets fermés. Il n’y avait pas de volets aux fenêtres du premier étage, qui étaient garnies simplement de « jalousies », qu’on ne déroulait qu’en été. Ces volets eussent été, du reste, inutiles, car des propriétés environnantes, on ne pouvait pas apercevoir les fenêtres.
Bientôt, réapparut sur le perron le cocher à la tête de fouine, qui descendait, allait à son cheval, et commençait à le dételer.
L’homme épongea, bouchonna, frictionna la bête comme s’il n’avait pas eu d’autres préoccupations et puis, quand il lui eut jeté une botte de foin dans la mangeoire, retourna au perron, qu’il gravit à nouveau, frappa à la porte qui s’ouvrit et il disparut.
Le jour était tombé prématurément et cette obscurité du ciel devait avoir favorablement servi le Professeur qui s’écrasait dans l’ombre contre la muraille, derrière un insuffisant attirail de harnais. Combien, cependant, durant que l’homme passait à portée de sa main, avait-il eu l’envie de lui sauter à la gorge, de l’étrangler tout net et d’en finir au moins tout de suite avec l’un de ces ennemis ! Mais la raison, la perspicacité et l’inspiration qui sans doute coopéraient au succès de son entreprise le retinrent en lui montrant le danger d’une intervention trop rapide, qui n’aurait d’autre résultat que d’avertir les complices de la tête de fouine, qu’il y avait un étrangleur inconnu dans cette demeure où ils espéraient agir en toute tranquillité.
Un coup d’œil sur les lieux avait déjà renseigné le défenseur de Gabrielle Desjardies sur la façon dont il pourrait subrepticement se rapprocher de celle qui, dans ce moment, ne devait plus compter que sur son intelligente et victorieuse intervention.
Une corniche longeait le premier étage au-dessus des fenêtres, et il ne semblait point impossible, avec un peu d’adresse et d’agilité, d’atteindre cette corniche par le truchement d’une gouttière massive et retenue par des crochets de fer dans l’encoignure du mur de l’hôtel et du mur de la remise. Arrivé sur la corniche, il briserait un carreau et pénétrerait dans l’hôtel.
Justement comme il regardait les vitres du premier étage, celles-ci s’illuminèrent. Un flambeau passa de fenêtre en fenêtre et s’arrêta devant la dernière croisée, celle qui se trouvait près de l’encoignure du mur, à côté de la gouttière. Une ombre vint à cette fenêtre. Quand le Professeur l’aperçut, il ne put retenir une sourde exclamation, car il venait de reconnaître dans cette noire silhouette l’homme au manteau et au chapeau de feutre qui l’avait arrêté au coin de la rue Legendre par le mot de passe : Connaissez-vous la chanson des Saules ? L’homme inconnu dont il avait vu la tête quelque part.
L’homme fit un geste, qui eût pour résultat de décrocher l’embrasse d’un lourd rideau qui retomba sur la croisée, masquant la lumière intérieure.
Le Professeur décida alors d’agir. Son imprudence naturelle, le besoin qui était toujours latent chez lui de se dévouer, et une curiosité excessive qui n’avait d’égale que son inépuisable bavardage, lui dictèrent qu’il avait déjà attendu trop longtemps, et il sauta comme un singe sur la gouttière, qu’il gravit avec des genoux de quinze ans.
Les crochets de fer lui furent d’un secours dont il remercia le ciel, tout en s’excitant au combat.
Et il parvint à poser le pied sur le haut de la fenêtre du rez-de-chaussée.
Quand il fut sur la corniche, le rideau de la fenêtre, mal tiré, lui permit d’apercevoir ce qui se passait dans la chambre.
Il y avait dans cette pièce trois personnages : Mlle Desjardies, l’homme au manteau noir qui lui tournait le dos, et dont il ne put voir le visage, bien qu’il tînt son chapeau à la main, car il ne se retourna point une seule fois de son côté et puis la tête de fouine.
Mlle Desjardies s’était laissée tomber sur un fauteuil, dans une attitude de lassitude et de découragement parfaite, que le Professeur jugea simulés pour mieux tromper « ses persécuteurs ». L’homme au manteau noir parlait, et il n’était point difficile de deviner à ses gestes qu’il devait demander pardon à la belle Gabrielle de la liberté qu’on avait prise de l’amener dans cet hôtel sans lui en avoir préalablement demandé la permission. Mlle Desjardies ne répondait pas. La tête de fouine ne disait pas un mot.
– Si seulement, se disait le Professeur, j’étais sûr qu’ils ne fussent que tous deux dans la maison, je descendrais chercher dans l’écurie un manche à balai, je leur sauterais sur le casaquin et je les ferais passer de vie à trépas avant même qu’ils ne s’en doutent !
Comme si le hasard s’était chargé de le renseigner et de le garder d’une néfaste aventure, l’homme au manteau noir appuya sur un timbre et la porte de la pièce s’ouvrit. Deux hommes et une femme entrèrent. C’étaient évidemment des domestiques et on les montrait certainement à Mlle Desjardies, moins pour lui dire qu’ils étaient à sa disposition que pour la prévenir qu’elle n’avait aucun espoir de s’évader.
La porte entrouverte faisait voir une autre pièce illuminée ; ce devait être la chambre qu’on réservait à Mlle Desjardies, car on y voyait un lit.
À ce moment l’homme au manteau noir fit un geste brusque qui dérangea le rideau de la fenêtre et le Professeur ne vit plus rien, mais il en avait assez vu et il redescendit rapidement dans son écurie, où il resta tapi jusqu’à dix heures du soir, heure à laquelle toutes les lumières étant éteintes et un silence parfait régnant dans l’hôtel, il lui sembla qu’il pouvait avoir quelque chance d’oser mettre ses projets à exécution. La pluie avait cessé et la lune, en éclairant sa haute silhouette, debout sur la corniche, le gênait. Il fallait faire vite. Il parvint, au risque de se rompre le cou, jusqu’à la fenêtre du milieu et frappa trois petits coups. Il pensait bien que la prisonnière ne dormait pas ; en effet, à son appel, la fenêtre s’ouvrit tout doucement.
– Mademoiselle ! dit-il tout bas, si bas qu’elle ne l’avait peut-être pas entendu, mademoiselle !…
Mais elle ne répondit pas.
Alors il enjamba l’appui de la fenêtre et se trouva dans la chambre obscure.
VII – FACE À FACE
Dans le salon de Teramo-Girgenti, le malaise soudain d’Eustache Grimm avait paru assez significatif. La pâleur cadavérique du général Régine n’échappait plus à personne. Et la colère évidente de Sinnamari devant la défaillance de ses anciens complices aurait corroboré tous les soupçons, si les soupçons eussent eu besoin d’être corroborés. Si on n’osait encore former d’hypothèses sur la personnalité du comte, il ne faisait de doute pour aucun des invités que Teramo, pour une raison qui restait obscure, prenait en mains les intérêts de R. C. et d’une façon si énergique qu’il n’eût pas montré plus d’ardeur ni d’animosité s’il se fût agi de lui-même… Il se dressait en face des Trois, comme un ennemi terrible, prêt à porter des coups décisifs. Allait-il vaincre ?
Sinnamari, de toute l’assemblée, apparaissait le moins ému. Il attendait ce nom de Robert Carel… il le voyait venir… et quand il éclata dans le silence angoissant du salon, il le reçut d’un front serein cependant que Régine sentait une sueur froide l’envahir, et que Grimm s’effondrait sur le parquet, l’imbécile !…
Le docteur Mackensie se pencha sur ce corps énorme, ventripotent et flasque, en déclarant qu’une congestion mortelle devait être tôt ou tard l’aboutissement du régime alimentaire du directeur de l’Assistance publique. Il lui arracha son col et sa cravate et constata que cette fois-ci encore, Eustache Grimm « en réchapperait ». Après qu’on lui eût fait respirer des sels, Grimm poussa un soupir, et Teramo-Girgenti, qui semblait très amicalement contrarié de voir l’un de ses convives dans ce pénible état, prononça comme toujours les paroles qu’il fallait pour que le malade revînt tout à fait à lui. Il l’invita à déjeuner pour le lendemain !…
L’effet fut foudroyant. Quelle phrase mieux que celle-ci : « Je vous invite à déjeuner » pouvait ramener Eustache Grimm à la vie ? Dans les plus tristes circonstances, dans les heures les plus moroses, elle était toujours venue, cette phrase, éclaircir son destin… Mais tout à coup il se rappela… il se souvint que celui qui l’invitait ainsi était l’homme qui avait prononcé ce nom : Robert Carel !… Et alors il lui sembla qu’il n’aurait plus jamais faim de sa vie…
Teramo, en faisant cette invitation macabre, avait ri, mais son rire était apparu à tous si diabolique que pas un invité ne se fit l’écho de cette joie lugubre… C’était la deuxième personne qui se trouvait mal chez le comte depuis que le comte avait commencé son récit… et l’on sentait que ce qui s’était passé jusqu’alors n’était rien à côté de ce qui allait se passer peut-être…
– Mon cher comte, fit soudain Sinnamari en allumant un cigare, mon cher comte, je serais tout à fait curieux de savoir où vous voulez en venir. Vous ne me raconteriez point cette histoire inouïe, à moi procureur impérial, si vous n’aviez le dessein de m’y intéresser d’une façon particulière.
– N’en doutez point, répliqua Teramo, un peu désarçonné par tant d’audace.
– Et pourrais-je savoir à quoi je puis vous être utile ?… L’affaire me paraît bien lointaine. Il y a certainement prescription. En vérité, je ne vois pas du tout comment mon intervention…
– Ah ! Vous ne voyez pas, monsieur le procureur impérial ! gronda Teramo, qui avait peine à contenir la fureur léonine qui l’embrasait… Ah ! Vous ne voyez pas… Eh bien, si vous me le permettez, je vais vous faire voir, moi !
Sinnamari fit tomber la cendre de son cigare d’un petit geste négligent et dit :
– Faites !
Et il ajouta :
– Croyez bien que je vous suis tout dévoué. Je vous ai trop d’obligations pour ne point mettre ma personne et mon ministère à votre entière disposition…
Teramo vit, derrière Sinnamari, Liliane qui pleurait… Il lui sembla que ses larmes lui faisaient un bien infini. Il en fut comme rafraîchi et il reconquit tout le sang-froid que l’ironie outrageante du procureur était sur le point de lui faire perdre.
– Je vous ai dit, monsieur le procureur, que la preuve du crime existe.
– En quoi consiste-t-elle ? demanda Sinnamari.
– Dans un cadavre, répliqua le comte.
– Comment, dans un cadavre !… Qu’est-ce qu’une preuve qui consiste dans un cadavre ?
– Je vais vous l’expliquer, monsieur le procureur, car ce soir je suis désolé de constater que, si vous ne voyez que difficilement ce que je veux vous faire voir, vous ne comprenez pas mieux ce que je veux vous faire entendre. Écoutez-moi donc et vous allez suivre toute l’affaire. La malheureuse femme dont je vous ai parlé n’est jamais sortie de la petite maison de Montmartre.
– Vous commencez à m’intéresser…
– Son cadavre s’y trouve encore.
– Parfait !
– C’est là que les misérables l’ont enterré !…
– Tout cela est très bien, mais l’important, mon cher comte, n’est point que l’on sache qu’il y a un cadavre dans une petite maison de Montmartre… L’important est de savoir où se trouve cette petite maison et, si j’ai bien écouté votre récit, je ne vois pas comment on pourrait arriver à se faire même une idée de l’endroit… La victime n’en est jamais sortie, dites-vous, et la sage-femme, la seule personne qui ait été introduite dans cette maison, le fut dans des conditions de mystère telles qu’elle n’a rien vu, puisqu’on l’amenait là les yeux bandés.
– Elle ne voyait pas, interrompit le comte, mais elle entendait.
– Et qu’a-t-elle entendu ?
– Une phrase : Tu es la Marguerite des Marguerites, tu es la perle des Valois !
– Ah ! oui, cette phrase prononcée, vous nous avez dit… par un perroquet.
– C’est cela !… Eh bien, monsieur le procureur, j’ai retrouvé le perroquet.
Ce fut au tour de Sinnamari de comprendre et de s’émouvoir.
– Vous avez retrouvé le perroquet… Alors ?
– Alors, par le perroquet, monsieur le procureur, j’ai retrouvé la maison…
Sinnamari se dit : « Il ment peut-être ! Nous allons bien voir. »
– Très ingénieux, fit-il. Et, ayant retrouvé cette maison, qu’avez-vous fait ?
– J’en ai donné l’adresse au roi des Catacombes…
– Vous voyez bien que vous êtes son ami !
– Il y a des jours…
– Et alors, racontez-nous ce qu’il a fait, votre ami… Il est sans doute aller y chercher le cadavre de sa mère ?
– Oui.
– Est-ce qu’il l’a trouvé ?
– Non !…
Régine et Grimm ne purent retenir un léger soupir de soulagement. Quant à Sinnamari, qui savait par sa récente visite à la cave de la rue des Saules que le cadavre ne pouvait avoir été découvert, il était moins ému.
– C’est dommage ! s’écria-t-il, c’est dommage ! Si nous avions le cadavre, nous pourrions faire quelque chose pour vous ! Mais que voulez-vous que nous fassions sans le cadavre ?
– Ça a été le raisonnement de R. C. ! reprit le comte qui, lui, semblait regagner en sang-froid ce que Sinnamari perdait en énervement… Et il est venu me trouver tantôt pour lui retrouver ce cadavre-là !
– Vous ?
– Moi !
– Et vous le lui retrouverez ?
– Je le lui ai promis…
– Et quand donc le retrouverez-vous ?
– Ce soir !
– Mais où ?
– Ici !
Un mouvement général attesta l’intense curiosité déchaînée par les dernières paroles de Teramo.
– Ah ! Ça !… fit Sinnamari, un peu rassuré… est-ce que vous ne vous moquez pas un peu de nous ?… Vous allez retrouver ce soir ici un cadavre qui est enterré dans une maison de Montmartre ?
– Ne vous ai-je point promis des expériences plus curieuses encore ? reprit Teramo. Qu’est-ce que découvrir un cadavre pour un homme qui a la prétention de le faire revivre ?
– Après l’avoir trouvé, vous ferez revivre ce cadavre ?
– Je le jure !
– Eh bien ! Pour voir… Trouvez-le d’abord, et nous parlerons de la résurrection ensuite ! fit Sinnamari avec un rire qui sonnait faux.
De fait, le comte était si sérieux en disant d’aussi apparentes extravagances que les plus forts, que le plus fort, même Sinnamari, ne pouvaient manquer d’en être impressionnés.
– Attention ! Monsieur le procureur, fit Teramo tout à coup, je commence !…
– À quoi ?
– À retrouver le cadavre… Je ne vous demande qu’une chose, c’est de ne point m’interrompre… quoi que je dise… quoi que je fasse… pas un mot… et je réponds de l’expérience !…
Le comte fit asseoir tout le monde. Seul, il resta debout, dominant l’assemblée, devant Sinnamari, très intrigué, et… un peu inquiet.
– La petite maison où a été enterré le cadavre, commença Teramo, se trouve à mi-flanc de la Butte, dans une ruelle déserte. C’est là qu’un soir, sur mes indications, Robert Carel, le fils du guillotiné, R. C., le roi des Catacombes, pour tout dire, se rendit pour y chercher le cadavre de sa mère. Or, sachez que par hasard, ce même soir, le magistrat assassin qui n’avait point remis les pieds dans cette propriété depuis plus de vingt ans, s’y rendit aussi, poussé sans doute par la secrète intuition que la sécurité dont il avait pleinement joui jusqu’alors se trouvait tout à coup en danger.
» Caché dans un coin de la maison, le fils vit venir à lui le bourreau de sa mère et il pensa que c’était le ciel qui le lui envoyait, non point pour faire naître l’occasion d’une immédiate vengeance, car il est des crimes pour qui la mort seule serait un trop mince châtiment, mais pour l’aider dans sa pieuse recherche… Pour lui montrer l’endroit où les bandits avaient caché la preuve de tous leurs forfaits !…
» Sans la rencontre providentielle de ces deux hommes, cette nuit-là, R. C. ignorerait encore l’existence d’une porte secrète qui le conduisit dans un immense caveau dissimulé dans les fondations mêmes de la maison… L’assassin marchait devant… et il ne se doutait pas, après avoir ouvert la porte, qu’à quelques pas derrière lui, dans les ténèbres de l’étroit escalier, il était suivi par le Vengeur !… L’assassin pénétra dans le caveau et en fit lentement le tour, puis il remonta, précédé maintenant dans l’escalier par R. C., qui avait assisté de loin à cette promenade silencieuse… L’assassin quitta, complètement rassuré, la maison abandonnée qui avait si bien gardé son secret… Pour R. C., il ne faisait plus de doute que le caveau était devenu le tombeau de sa mère !… C’est là qu’il lui fallait chercher !… Ayant surpris le secret de la porte, il n’eut aucune difficulté à retrouver l’escalier qui le reconduisit dans le mystérieux caveau ! Et, tout de suite, il se mit à la besogne ! Armé d’une lanterne et d’une pioche, il refit, le chemin qu’avait accompli, quelques minutes auparavant, l’assassin ! Il s’arrêta là où celui-ci s’était arrêté… Il fit les mêmes pauses, il fit les mêmes pas !… Son regard cependant ne discernait rien qui lui dît : C’est ici plutôt que là ! Arrête-toi et travaille !… Alors, alors… il résolut de tout creuser, de tout remuer… de ne pas laisser sans la retourner une parcelle de cette terre ! Et il donna son premier coup de pioche ! Il travailla toute la nuit… il travailla une partie du jour !…
» Il avait fouillé de ses mains toute la terre de ce caveau maudit !… Et il n’avait rien trouvé ! Et il ne trouva rien !… Un autre se fût enfui de cette inutile maison, mais R. C., quand il s’agit de sa vengeance, espère toujours ! Il vint à moi ! Il se souvint qu’il y avait un homme ici-bas pour qui la vie et la mort n’ont plus aucun secret, et que c’était mon métier à moi de retrouver et de réveiller les morts !…
Et Teramo, brusquement, s’avança vers Sinnamari et lui prit la main…
Sinnamari s’attendait si peu à ce geste qu’il n’essaya même point de retirer sa main de celle de Teramo. Du reste, il ne comprenait pas encore ce que le comte lui voulait… et puis… et puis il lui semblait qu’il fallait que sa main fût dans celle du comte, si bien que l’idée de résister à Teramo ne lui vint même pas.
– C’est vous… vous-même, monsieur le procureur, qui allez me servir de truchement pour cette expérience que vous jugez si délibérément impossible… déclara Teramo en brûlant de ses regards le regard de Sinnamari… C’est par votre entremise que nous allons être immédiatement fixés sur l’endroit où l’on a caché le cadavre !… C’est vous qui allez me servir de médium entre le ciel et la terre !… Cela vous étonne !… Vous êtes comme tant d’autres qui sont des médiums qui s’ignorent… Mais moi je ne me trompe pas et l’on ne me trompe pas !… J’ai découvert en vous un sujet de premier ordre, un instrument merveilleux et très docile… d’autant plus docile que vous êtes plus sceptique… Je ne vous demande que votre main dans la mienne… là… comme cela !… C’est parfait… et maintenant, entrons ensemble dans la petite maison de Montmartre… poussons la porte du jardin… traversons ce jardin… faisons-en le tour… Vous y êtes ?… Regardez-moi !… Regardez-moi !… Regardez-moi donc !… Vous y êtes… dans le jardin ! Bien ! Bien !… Nous n’avons que faire au jardin, n’est-ce pas ?… Nous gravissons le perron… nous traversons le perron… nous traversons le vestibule… nous allons à la porte secrète… nous descendons l’escalier !… Voici le caveau !… Laissez-moi vous conduire, monsieur le procureur… docilement… docilement… ne vous raidissez pas !… Ne vous révoltez pas !… Suivez-moi !… Suivez-moi et arrêtez-moi quand j’irai trop vite… Visitons chacun de ces piliers de brique… il y en a trois à gauche… trois à droite… trois au milieu… marchons tout doucement… tout doucement, vous dis-je !… Eh ! Je vous ai prié de m’arrêter, et c’est vous qui précipitez ma marche… Tout doucement… tout doucement… là !… Celui-ci ?… Est-ce au pied de celui-ci qu’il faut creuser plus avant… plus avant… plus profondément la terre ?… Au nom de Dieu, monsieur Sinnamari !… Au nom de Dieu ! songez au cadavre !… Ne songez qu’au cadavre !… Deuxième pilier… l’autre… l’autre en face… l’autre… trois pas… trois pas encore… l’autre… l’autre… à droite… à gauche… encore !… là… là… là…
Et le comte se tut… On eût entendu voler une mouche. Le comte et le procureur étaient aussi pâles l’un que l’autre, aussi immobiles… Ils paraissaient maintenant deux statues liées par ce geste de la main, un geste de pierre…
– C’est étrange ! murmura-t-il. Étrange… Nous avons fait tous les chemins… Et pourtant le cadavre est bien là… n’est-ce pas ?… Dites-moi… dites-moi avec votre main si le cadavre est bien là… dans ce caveau… Oui ! Oui !… Il est là… dans le caveau… Voyons ! Marchons !… Marchons encore !… la main dans la main, dans le caveau !…
Encore un silence. Et quel silence ! Il semblait que, dans l’immense salon, personne ne respirait plus !… L’angoisse, l’attente du dénouement tragique de cette situation formidable avait pétrifié trois cents personnes !…
… Et puis, tout à coup… le comte laissa tomber la main de Sinnamari ; il leva son front radieux où flambaient tous les feux de la victoire.
– Merci, monsieur le procureur ! s’écria-t-il… Je sais maintenant où est le cadavre !…
VIII – LE DÉSESPOIR DU PROFESSEUR
Personne ne put douter de ce cri de triomphe. Le drame, pour muet qu’il fût, n’échappait à personne, et pendant que la foule des invités resserrait son cercle de Teramo-Girgenti avec des exclamations, des murmures prudents encore, mais qui attestaient l’émotion générale, on vit les Trois se lever, se dresser sous le regard du comte pour répondre à l’accusation terrible qui venait d’être lancée contre eux avec la certitude de la preuve enfin obtenue par un homme qui disposait de moyens qui dépassent les forces humaines. Sinnamari lui-même semblait avoir perdu la libre disposition de ses esprits, et l’on fut tenté de croire un instant que, vaincu par un rare adversaire, il allait prononcer, sous l’ascendant de cette puissance hypnotique qui annihilait en lui toute velléité de défense, les paroles définitives de l’aveu !…
Mais voilà qu’un événement, un tout petit événement se produisit qui changea soudain la face des choses et brisa comme verre la victoire de Teramo.
Nous disons « comme verre ». Et ce fut du verre qui fut brisé en effet, un carreau… La fenêtre que Sinnamari avait si obstinément tenue fermée dans un coin du salon attira subitement tous les regards… car le bruit d’une vitre en éclats, traversée d’un caillou qui vint rouler jusqu’aux pieds du Procureur, se fit entendre dans le silence, qui avait suivi ces mots : « Je sais maintenant où est le cadavre ! » Et pendant que tous les regards étaient encore sur cette vitre éclatée, Sinnamari, transformé, reconquis, Sinnamari, le feu aux pommettes, et le regard fulgurant, penché sur le comte, lui disait entre les dents :
– Pas un mot de plus, comte Teramo-Girgenti, ou vous pourrez annoncer à votre ami que je ferai souffrir à sa fiancée tous les supplices endurés par sa mère… Pas un mot de plus, ou tremblez ! Car Gabrielle Desjardies est en mon pouvoir !…
Si bien que lorsque l’assistance se retourna vers le comte et vers le procureur, elle vit que c’était le procureur qui maintenant menaçait et le comte qui tremblait.
Que s’était-il donc passé en une seconde ? Nul ne pouvait le supposer, mais chacun comprit que le tout-puissant magistrat n’avait point partie perdue et qu’il n’était pas temps encore de le renier !
Appuyé contre la muraille, non loin de l’impassible exécuteur des hautes œuvres de R. C., de l’immobile bourreau rouge toujours appuyé sur son énorme glaive, le pauvre être qu’était M. Macallan semblait agoniser en face de l’attitude nouvelle des deux personnages.
– J’en mourrai ! murmurait-il en appuyant la main sur son cœur… J’en mourrai !… What a fearful sight (Quel spectacle effrayant !)
Quant à Liliane, elle regardait le comte et ne comprenait plus… et tous ceux qui ressentaient une grave sympathie pour le comte : Raoul Gosselin, Marcelle Férand, Philibert Wat lui-même, qui le craignait et cependant n’espérait qu’en lui… ne comprenaient plus…
Tout à coup, il y eut un grand brouhaha. Une voix criait « Le comte de Teramo-Girgenti ! Le comte de Teramo-Girgenti ! » Cette voix venait des pièces lointaines et était accompagnée de tumulte, d’un bruit de bataille… Tout le monde s’était tourné vers la porte grande ouverte par où parvenait ce tintamarre. Et l’on vit arriver comme une trombe un grand corps tout déchiqueté, couvert d’habits en loques, la figure en sang, la bouche hurlante, poursuivi par une nuée de domestiques, de laquais en livrée qui s’accrochaient comme ils pouvaient à ce forcené.
– Teramo-Girgenti !… Le comte de Teramo-Girgenti ! hurlait la bouche.
Le comte, qui semblait avoir peine à se soutenir, trouva la force cependant de s’avancer vers l’homme :
– Me voici ! dit-il… C’est moi !
Alors, l’homme s’écroula aux pieds de Teramo en s’écriant :
– Ils me l’ont volée !… Ils me l’ont volée !…
On n’était pas encore remis d’un pareil événement que, par une porte faisant face à celle qui avait livré passage au Professeur, un autre individu accourait, tout aussi déguenillé tout aussi arraché, « abîmé » que le Professeur, et qui ne paraissait pas moins ému. Aussitôt qu’il l’aperçut, le comte marqua une stupéfaction profonde et lui fit signe de venir à lui.
– Qu’y a-t-il donc, Cassecou ? demanda Teramo qui, voyant le destin se détourner de lui, essayait de retrouver un peu de sa force d’âme pour résister aux coups inattendus qui le frappaient.
Le nouveau venu se pencha à l’oreille du comte :
– Il y a, maître, que la Profonde est en pleine révolte et que le Vautour est sur le point de se faire proclamer roi !…
– Le Vautour ? interrompit le comte en montrant du doigt à Cassecou le bourreau rouge, l’homme au masque et au glaive. Mais il est ici !
– Non maître ! Je viens de le voir à l’instant, entouré des mutins !…
Teramo releva le Professeur, qui se désolait à haute voix, maudissait dans les larmes le sort ennemi, invectivant les dieux infernaux. Et, l’entraînant d’une main, pendant que de l’autre il conduisait Cassecou, il se dirigea vers l’homme rouge, ouvrit la porte contre laquelle il s’appuyait, poussa cet homme dans l’autre pièce déserte, referma la porte sur eux quatre, arracha le masque qui couvrait le visage du porte-glaive, et s’écria :
– Ce n’est pas le Vautour !
Non, ce n’était pas le Vautour ! C’était un homme dont l’allure, la haute taille, le profil masqué lui ressemblaient, mais ce n’était pas le Vautour !
L’homme, du reste, ne paraissait rien comprendre au geste brusque du comte qui l’avait démasqué, et son ahurissement de brute prouvait assez qu’il n’était, dans toute cette affaire, qu’un vulgaire comparse qui ignorait même l’importance du rôle muet qu’on lui avait fait jouer.
Le comte ne s’attarda pas à lui demander des explications. Il se recueillit quelques secondes, les mains sur les yeux, dans une immobilité tragique. Lorsqu’il montra à nouveau ses regards, il était redevenu lui-même, l’homme fort que rien n’atteint, que rien n’étonne et qui ne peut que vaincre…
Il poussa une petite porte qui donnait sur une chambre secrète et ordonna à Cassecou et au Professeur de l’y attendre. Puis il retourna dans les salons, qui étaient légèrement houleux et où l’on s’entretenait avec mille commentaires des dernières scènes qui avaient suivi le récit si intéressant du comte. Sinnamari se donnait le luxe de défendre le comte contre les méchantes langues, lesquelles, croyant faire leur cour au procureur, ne se gênaient presque plus pour traiter Teramo-Girgenti en aventurier. Il affirmait que le comte était son meilleur ami, qu’il lui avait été recommandé par les premiers personnages de l’Europe, qu’il était allié à la plus vieille noblesse espagnole et italienne, mais qu’il manquait un peu de ce parisianisme que ne saurait donner la plus vaste fortune, mais qui s’acquiert très vite pour peu qu’on soit intelligent. Or, Sinnamari ne refusait pas au comte l’intelligence. Dans quelques semaines, Teramo-Girgenti comprendrait lui-même combien il avait montré de mauvais goût en voulant « épater Paris avec des histoires de revenants ».
Ces dernières paroles furent entendues du comte, qui arrivait. Il remercia Sinnamari de vouloir bien excuser les excentricités d’un homme qui revenait de l’autre monde et qui n’avait encore pris qu’un contact insuffisant avec celui-ci. Il paraissait tout à fait désinvolte, et il dit avec un bon rire, un peu confus :
– Eh bien ! Maintenant que je vous ai fait bien peur, nous allons nous amuser…
Il donna des ordres pour que la représentation commençât dans le petit théâtre de l’hôtel, cependant qu’il retournait à la porte de la grande galerie pour recevoir les invités de la soirée, qui commençaient à affluer. Comme la représentation battait son plein et qu’on applaudissait Marcelle Férand et Liliane, il disparut à l’anglaise.
Cinq minutes plus tard, il entrait dans la petite chambre secrète où Cassecou et le Professeur l’attendaient toujours. Seulement, ce n’était plus le comte que ceux-ci virent entrer, c’était le magnifique jeune homme habillé de ce costume noir et de ces dentelles d’un prix inestimable que nous avons vu apparaître dans le salon Pompadour de la place de la Roquette. Une résolution terrible se lisait dans son fier regard. Une épée lui battait au côté et il avait de singuliers pistolets à la ceinture.
– Robert Pascal ! s’écria le Professeur, qui reconnut l’ouvrier orfèvre, malgré la différence de teinte de ses cheveux et qui hésitait à en croire ses yeux.
– Le roi ! fit Cassecou en se levant.
IX – DANS LA « PROFONDE »
Quelques instants plus tard, les trois hommes sortaient de l’hôtel de la rue de Ponthieu. Une voiture les attendait qui les emporta avec une rapidité vertigineuse.
Le Professeur était loin d’être remis de tant d’émotion, et ce n’était certes point la découverte qu’il venait de faire que Robert Pascal et le roi, comme l’avait appelé ce monsieur qui avait, paraît-il nom Cassecou, ne faisaient qu’un, qui pouvait l’aider à ressaisir ses esprits. Il n’avait, dans toute cette histoire où il plongeait comme dans un abîme, pour le guider, que son courage. Heureusement que celui-ci n’était point mince et qu’il ne lui avait jamais, en aucune circonstance de la vie, fait défaut. « Nous verrons bien, se disait-il moralement fort inquiet, nous verrons bien comment tout cela va tourner. »
En vérité, il ne connaissait pas ce jeune homme en tant que roi des Catacombes et autres lieux, mais celui-ci lui avait été jusqu’à ce jour fort sympathique en tant qu’orfèvre. Et ma foi, le Professeur se rappelait qu’il n’avait jamais été trompé par ses sympathies.
La voiture descendait à toute allure les Champs-Élysées. Elle traversa la place de la Concorde, le pont, et s’engagea dans le boulevard Saint-Germain.
Le roi, qui jusqu’alors avait gardé un silence absolu, qu’il avait dû occuper à mûrir le plan de ses rapides opérations, adressa une question au Professeur :
– Professeur, à quelle heure l’enlèvement ?
– Entre deux heures et demie et trois heures.
Le roi se retourna vers Cassecou :
– Le Vautour était absent de la Profonde à cette heure-là ?
– Non. Mais Patte-d’Oie n’était pas là.
– À quelle heure est-il arrivé ?
– À la nuit.
– Et il y est maintenant ?
– Oui. Il a rejoint le Vautour qui, à présent, s’est peut-être proclamé le maître ! répondit Cassecou.
Le roi au Professeur :
– Mlle Desjardies a été enlevée par qui ?
– Par un homme dans la voiture duquel elle était montée pendant que j’étais resté sur le trottoir.
– Le connaissez-vous ?
– Je le crois.
– Son nom ?
– Je l’ignore. Mais je suis à peu près sûr que c’est la tête de fouine dont je vous ai parfois signalé la présence inquiétante au cabaret des Trois-Pintes.
– Par l’enfer ! hurla le roi. Patte-d’Oie !
Et il se précipita sur le tube acoustique qui le faisait communiquer avec le cocher. La voiture stoppa.
– Dites vite ! haleta R. C. Il n’y avait pas d’autre homme à côté de vous au moment de l’enlèvement ?
– Si, un homme qui m’a justement arrêté sur le trottoir au moment utile en me donnant le mot de passe.
– Ah ! fit R. C. en poussant un soupir comme si sa poitrine venait d’être instantanément soulagée d’un poids énorme. Il avait le mot de passe… Et comment était-il fait ?
– Je ne pourrais dire. Son chapeau me cachait sa figure et son manteau enveloppait complètement sa personne. Cependant, je jurerais bien que sa tête ne m’était point inconnue.
– Songez à quelqu’un que vous avez déjà vu ! ordonna le Roi.
– Un inconnu qui rôdait à la Mappemonde, le jour où Salomon retrouva la parole ?
– C’est lui ! s’écria le Professeur…
– Dixmer. Cela ne fait pas de doute ! L’affaire a été menée de main de maître par le Vautour et Patte-d’Oie ! C’est au Vautour qu’il faut aller.
Et il se rejeta sur le tube acoustique. La voiture reprit sa course avec une vitesse telle que le Professeur en fut effrayé, non pour lui, naturellement, mais pour ceux qu’elle pouvait écraser.
Et justement, comme elle tournait au coin de la rue de Rennes, elle fit un saut terrible et rebondit sur quelque chose de mou. On entendit des cris.
– Nous écrasons quelqu’un ! cria le Professeur qui voulait déjà ouvrir la portière.
Mais la main de R. C. lui saisit le poignet. L’équipage n’avait même pas modifié son allure.
– C’est possible ! fit durement le roi. Nous n’avons pas une minute à perdre si nous voulons sauver Mlle Desjardies. Et vous le voulez, n’est-ce pas, mon ami ?
– L’orfèvre est épatant, gronda le Professeur.
– Maintenant, dit le roi, nous avons dix minutes devant nous. Vous pouvez nous conter votre petite histoire, Professeur.
Sa petite histoire !… Voilà comment ce jeune homme, habillé comme un prince de carnaval, qualifiait son aventure. Pour parler avec désinvolture, il fallait que Robert Pascal fût bien sûr de la retrouver, sa Gabrielle ! Au fond, ce sentiment ne pouvait être que réconfortant pour un brave cœur et le Professeur, mettant tout son amour-propre de côté, fit le récit complet de sa « petite histoire ».
Quand il en fut arrivé au point où, nous autres, nous l’avons laissée, c’est-à-dire à ce moment où la fenêtre de la chambre où avait été enfermée Mlle Desjardies venait de s’ouvrir, laissant passage au Professeur qui enjambait l’appui et entrait dans l’appartement, le roi l’arrêta.
– Êtes-vous sûr que c’était Mlle Desjardies qui vous ouvrait ? demanda-t-il.
– J’en étais sûr au moment où j’entrais ; quelques secondes après, je n’étais plus sûr de rien ! Je me suis trouvé dans une nuit noire ; je m’attendais à entendre à mon oreille la voix de Mlle Desjardies, mais rien ! rien ! La nuit et le silence !… Ma foi ! je n’étais pas très fier, bien que j’eusse emporté avec moi une fourche que j’avais trouvée dans l’écurie ; je serrai le manche de ma fourche en disant tout bas : Mademoiselle ! Mademoiselle !… Est-ce vous ?… Répondez-moi !… Où êtes-vous ?… Et rien ne me répondait !… Je n’osais plus bouger… je me disais maintenant : évidemment, ce n’est pas mademoiselle qui a ouvert, sans quoi elle me parlerait… Mais, alors, qui ?… Qui ?… Puisqu’il se tait, ça ne peut être qu’un ennemi ! Donc, attention, Professeur !… Soudain, il me sembla qu’une ombre remuait, se déplaçait et que quelque chose de menaçant tombait sur moi !… Je n’hésitai plus ; je fis un moulinet terrible avec ma fourche et je frappai à tour de bras en disant tout haut cette fois : Gare à la casse !
» Aussitôt un bruit terrible se fit entendre. On eût dit que j’avais mis en miettes un magasin de porcelaine. J’étais hors de moi, car je pensais naturellement que, maintenant, j’étais perdu, et que, ma présence se trouvant signalée d’une façon aussi retentissante, les bandits allaient accourir et me mettre à mon tour en pièces… si bien que je m’imaginai voir en face de moi une porte s’ouvrir et quelqu’un se précipiter. Un second moulinet me délivra de cette seconde imagination et aussitôt un vacarme assourdissant, bien plus terrible que le premier, répondit à mon attaque.
» Je n’eus que le temps de me rejeter en arrière, car mille éclats de verre tombaient en pluie aiguë et tranchante autour de moi. J’avais dû mettre à mal une glace. En me rejetant en arrière, j’enfonçai ma fourche dans le carreau de la fenêtre, qui s’abîma sur le pavé de la cour avec un tintamarre incroyable, de telle sorte, qu’après avoir, à n’en pas douter, averti de ma présence, à l’intérieur de l’hôtel, les personnes auxquelles j’avais tout intérêt à la cacher, je renseignai par surplus celles qui, à l’extérieur, eussent pu encore l’ignorer.
» Le grand malheur en tout cela était surtout que je ne paraissais point avoir réussi à faire part de ma courageuse intervention à celle qui en avait le plus besoin. Je ne pensais plus que ce fût Mlle Desjardies qui m’avait ouvert la fenêtre, et, comme à tout prendre je ne pouvais songer qu’elle fût endormie à ce point de n’être pas réveillée par le travail auquel je m’étais livré avec ma fourche, je fus amené à conclure que Mlle Desjardies ne se trouvait plus dans cette pièce, où j’avais cru qu’elle passerait la nuit. Mais alors, où était-elle ? Et qu’allais-je faire ? Et qu’allais-je devenir ?
» Tout d’abord, les mouvements que j’avais faits m’avaient si peu réussi que je résolus, quelque temps, de rester coi ! Je m’attendais à toutes les catastrophes, et, comme celles-ci ne vinrent point, à tout hasard je m’encourageai à voir clair dans ma bizarre situation et je fis craquer une allumette dont j’étais muni. Il me semblait avoir été tellement trahi par le bruit que je ne craignais plus de l’être par la lumière. Mon allumette éclaira un surprenant chaos de vaisselle en miettes. Les meubles étaient couverts de débris de verre et de glace pilée. Un flambeau était devant moi, que ma fourche avait oublié d’abattre. Je l’allumai. À sa lueur, je vis que le lit était vide, ce qui ne m’étonna point, mais je lus sur une porte une sorte d’écriteau qui, lui, me stupéfia. Savez-vous ce qu’on avait écrit sur cet écriteau ? Non ! Je vous le donne en mille : Donnez-vous la peine d’entrer, Professeur !
» La fureur, la honte d’avoir été ainsi joué, la rage de constater que tant de malheureuse astuce n’avait servi peut-être qu’à précipiter le malheur de cette pauvre jeune fille, me firent ouvrir la porte sans précaution aucune, me ruer dans l’hôtel, traverser les appartements déserts… Je criais !… Je pleurais !… Je l’appelais !… Je les maudissais, eux, les infâmes ravisseurs !… Je les traitais de lâches ! On m’avait roulé !… Le cocher s’était certainement aperçu de ma présence derrière son fiacre et il ne trouva rien de mieux, au lieu de me laisser dehors où j’aurais pu être dangereux, de m’emporter avec lui et de me mettre dedans !… Après quoi, tranquille sur mon compte, les misérables avaient emmené la pauvre mademoiselle.
– Et comment êtes-vous sorti de là ?
– En passant par-dessus les grilles, en m’arrachant mon pantalon, en déguenillant mon pardessus, en laissant un peu partout un peu de mon étoffe, un bout de ma peau ! Ma peau, passe encore !… Mais qu’est-ce que va dire mon tailleur ?… Oh ! pardon !… Voilà que je me remets à la blague… et…
– Vous pouvez !… Vous pouvez !… Mlle Desjardies sera en liberté dans une heure…
– Je ne le crois pas !… interrompit Cassecou d’un air sombre.
– Voilà maintenant que tu doutes de ton roi, mon brave Cassecou !…
La voiture s’arrêta.
– C’est ici ! fit le roi…
Ils descendirent tous trois. Le Professeur regarda autour de lui. Il ne put s’empêcher de frissonner, car l’endroit était particulièrement sinistre.
– Malheur ! fit-il. Si c’est dans ce quartier-là qu’ils l’ont conduite ! Elle ne doit pas être très rassurée, la pauvre !…
Le Professeur, qui avant d’aller porter ses pénates sur la Butte avait longtemps habité au Quartier latin sur les hauteurs de la montagne Sainte-Geneviève, reconnut immédiatement le quartier Mouffetard. On se trouvait dans le coin le plus infâme de cet amas de taudis, habité, si l’on peut dire, par toute une agglomération de chiffonniers et de marchands de bric-à-brac.
La petite ruelle dans laquelle la voiture de R. C. n’aurait pu tourner, tant elle était étroite, était éclairée par une seule lanterne ; heureusement, la lune venait de se montrer dans un ciel débarrassé de nuages et illuminait les maisons décrépites, les baraques en planches, les murs lie-de-vin d’un bistro. Il était difficile de croire qu’il existât au cœur de la capitale une ruelle semblable, aussi infecte, aussi sordide et si prodigieusement « ambiguë ».
Il n’y avait personne d’autre dans cette ruelle que nos trois personnages et le cocher qui se tenait immobile sur son siège sans dire un mot.
– Nous prenons le puits Macallan, maître ? demanda Cassecou.
R. C. fit un signe affirmatif. Alors, Cassecou alla frapper du doigt au volet du bistro. Une porte, immédiatement, s’ouvrit.
– Nous venons tirer de l’eau, fit Cassecou.
Et il entra. R. C. poussa devant lui le Professeur, qui murmurait :
– C’est la première fois que je vois des gens entrer chez un marchand de vin pour lui demander de l’eau !
La porte refermée derrière eux, l’homme qui avait ouvert alluma une lanterne et pénétra dans l’arrière-boutique. Les autres suivirent. De l’arrière-boutique on arriva dans une cour. Au centre de la cour, il y avait un puits.
– Ne vous étonnez de rien, fit R. C. au Professeur. Nous allons descendre dans les Catacombes. Cela ne vous effraie pas ?
– Rien ne m’effraie, répondit le Professeur, et puis j’y suis déjà descendu dans les Catacombes.
– Oui, répliqua le roi, à la porte d’Enfer, comme tous les touristes… Mais dans celles où je vous mène vous ne rencontrerez pas d’Anglais…
– Et nous allons descendre dans les Catacombes par un puits ? questionna le Professeur en hochant la tête.
– Parfaitement !
– Comme dans les Mohicans de Paris ! Rien ne change !
Et le Professeur, bravement, attira à lui la chaîne et paraissait déjà prêt à s’installer sur le seau, ainsi qu’il est raconté dans la terrible histoire de M. Jackal, du toujours vivant Alexandre Dumas père.
– Vous avez tort de dire que rien ne change, répliqua R. C. Tout progresse, au contraire. Ce serait malheureux s’il nous fallait, sous le second Empire, descendre dans les Catacombes comme au temps des Ventes et de cet excellent Salvator !
Ayant dit, il appuya du doigt sur un coin de la margelle, cependant que Cassecou tirait jusqu’au haut de la poulie le seau, à seule fin qu’il ne gênât pas. Alors, le Professeur, non sans stupéfaction, vit monter à l’orifice du puits un ascenseur.
– Donnez-vous la peine d’entrer, Professeur ! fit R. C.
Et le Professeur entra en se disant : « C’est la seconde fois que l’on me prie de me donner la peine d’entrer. Quand donc m’offrira-t-on le plaisir de sortir ? »
Quand ils furent tous trois dans l’ascenseur, celui-ci descendit avec une grande rapidité. La descente n’en dura pas moins plusieurs minutes qui parurent des siècles au glorieux hôte de la Mappemonde.
– Eh quoi ! fit-il tout haut. Nous allons donc au centre de la terre !…
Enfin, l’ascenseur s’arrêta en pleine obscurité. R. C. fit jouer une petite lampe portative. Et le Professeur vit que l’ascenseur se trouvait au centre d’une vaste pièce circulaire, entièrement close. Était-ce là vraiment une pièce ? On eût dit plutôt une crypte, aux murs et à la voûte de granit. Elle ne semblait avoir d’autre ouverture que le trou circulaire de son sommet, qui avait laissé passer l’ascenseur.
R. C. avait pris la tête de l’expédition. Le Professeur le suivait, Cassecou fermait la marche. Sans qu’il pût dire comment cela se fit, le Professeur constata que la muraille avait cédé sous les mains de R. C., que l’on s’enfonçait dans la muraille et que l’on se trouvait maintenant dans un étroit couloir aux murs humides. Un petit ruisselet coulait à leurs pieds.
– Pourvu, se disait le Professeur, qu’on retrouve son chemin ! Je me suis laissé dire que les Catacombes sont dangereuses à cause de la difficulté que l’on a à retrouver son chemin… Au prochain carrefour, je ferai une marque dans la muraille avec mon couteau.
Mais, il ne rencontra pas de carrefour ; s’étant baissé derrière R. C., il se trouva tout à coup, quand il releva la tête, dans un véritable salon ; la pièce était circulaire et à peu près de la même dimension que la précédente, mais, tandis que la première était une véritable caverne, celle-ci était garnie de lambris de tentures d’un luxe rare.
Elle n’avait d’autres meubles qu’un vaste bureau également circulaire, une sorte de table à casiers divisée en six triangles, devant chacun desquels se trouvait un fauteuil.
Le Professeur ouvrait de grands yeux, mais Cassecou en ouvrait de plus grands que lui encore et le Professeur s’en étonna.
– Il n’y a que moi, fit R. C., qui sait que cette pièce existe et où elle existe. C’est la Rotonde du roi ; personne ne peut venir nous y chercher, et si je mourais tout à coup ici, je vous défie d’en pouvoir sortir !…
– C’est gai ! fit le Professeur.
Comme il levait les yeux au plafond, il fut étonné de voir qu’une légère galerie, une sorte de balcon faisait le tour de la pièce, tout en haut. On accédait à cette galerie par un petit escalier de fer. À quoi servait cette galerie ? Voilà ce qu’on n’eût pu dire.
R. C. montra l’escalier au Professeur et à Cassecou et leur dit :
– Montez !…
Ils montèrent tous trois. Le Professeur comprenait de moins en moins. Soudain R. C. ayant éteint sa lampe, un carré de la muraille qui se trouvait en face d’eux, à hauteur de leurs yeux, se déplaça ; une pierre tourna sur elle-même. Tout au fond de la cavité il y avait un mince tissu de fer, une sorte de voile transparent de métal qui leur permettait de voir tout ce qui se trouvait au-delà de ce voile et qui était éclairé, cependant qu’eux-mêmes, plongés dans l’obscurité, restaient invisibles.
Le Professeur regarda et, s’il faut en croire ce qu’il raconta souvent depuis, voici ce qu’il vit, et il n’y a aucune raison pour que le Professeur n’ait point vu ces choses.
Il crut avoir en face de lui les bureaux d’une banque ou de quelque administration d’État. Il y avait là des employés, caissiers, garçons de bureau, comptables, qui écrivaient, étudiaient des dossiers, alignaient des chiffres, grattaient du papier, comptaient des liasses de billets de banque, empilaient de l’or… Là le travail était ardent, fiévreux. Les employés ne se livraient à aucun inutile bavardage et le seul bruit qui montait de cette salle, dont on n’apercevait du reste qu’un coin, était le bruit de l’or, le tintinnabulement des pièces de monnaie.
– Banque et contentieux. Ce sont nos bureaux, cher Professeur. C’est ce que nous appelons la « Section des faussaires »…
– Comment ? La section des faussaires ?… Vous prenez les faussaires pour faire vos comptes et garder vos caisses ! souffla le Professeur, dont le cerveau menaçait d’éclater… Quelle histoire ! Pour sûr, j’en deviendrai fou !… Je crois que vous me conduisez dans un antre où nous allons trouver enchaînée cette pauvre Mlle Desjardies, et, après être descendus à plus de cent mètres sous terre…
– Cent cinquante !…
– Cent cinquante… Je tombe à minuit dans une espèce d’étude de notaire qui est à la fois une banque et où tous les employés sont des faussaires.
– Je vous ai dit de ne plus rien redouter pour Mlle Desjardies ; avant une heure, je vous le répète, elle sera libre…
Le roi avança la tête et son regard sembla faire le tour de la salle, d’où le bruit de l’or continuait à monter en échos agaçants.
– Cassecou ! fit-il… Vois-tu Patte-d’Oie ?…
– Je ne le cherche même pas, répondit Cassecou… Il est avec les autres !… Je vous dis, maître, que vous avez trop de confiance !… Patte-d’Oie n’a pas mis les pieds cette nuit à la section… Le Vautour lui a dit de venir au conseil.
– Le Vautour réunit maintenant mon conseil ? ricana R. C.
– Les ordres partaient pour toutes les sections quand je me suis échappé, voulut reprendre Cassecou… Figurez-vous, maître…
Mais R. C. le fit taire violemment.
– Pas de paroles inutiles, déclara le roi. Si tu n’as pas foi en moi, si tu crois que le Vautour est plus fort que moi, pourquoi me sers-tu ? Le Vautour est un enfant !
… Le Professeur n’écoutait même pas ces propos, incompréhensibles pour lui… Les yeux fixés sur le spectacle d’en bas, il se demandait s’il ne rêvait pas… Certes, il avait entendu parler de bandes fantastiquement organisées, admirablement installées, mais une installation pareille, à cent mètres sous Paris…
Évidemment, la folle imagination du Professeur, excitée par un spectacle aussi inusité, courait la prétentaine… Cependant nous devons à la vérité de dire que le point de départ de ses raisonnements n’était point aussi insensé qu’on eût été tenté de le croire. Des quartiers entiers des catacombes de Paris ont été autrefois habités, du côté de la place d’Enfer, par exemple par la puissante organisation des Talpa, et aux environs du Panthéon, là même où nous avons aujourd’hui conduit le lecteur, par des bandes politiques qui tinrent, après la chute du premier Empire, toute l’Europe monarchique sous la terreur, associations libertaires et bonapartistes très connues sous le nom de « carbonari ».
C’est dans l’ancienne demeure souterraine de ces conspirateurs que R. C. avait élu domicile avec sa bande. Mais bientôt l’extension de ses affaires le força à agrandir ses magasins, si j’ose m’exprimer ainsi, et si quelque carbonaro était revenu en ce monde et redescendu chez lui par le puits de la rue Mouffetard, il eût été bien étonné, d’abord d’y trouver un ascenseur ensuite de voir en quel palais immense, et sans limite appréciable, s’étaient transformées ses primitives salles de conseils secrets que l’Histoire elle-même, du reste, nous présente agréablement aménagées et ne manquant nullement de confortable.
Le Professeur, légèrement abasourdi, en était là de ses réflexions, tandis que R. C. et Cassecou échangeaient soudain quelques propos en une langue complètement inconnue, quand la pierre se referma sur les bureaux du roi des Catacombes. Mais, non loin de là, toujours à la même hauteur, une autre pierre bascula ; un autre carré de lumière apparut et un autre bruit bien connu se fit entendre, plus connu aux oreilles du Professeur, grand amateur de duels, que le bruit de l’or, le bruit des épées qui se froissent.
X – UNE CONSPIRATION À CENT CINQUANTE MÈTRES SOUS TERRE
Lorsque Dante Alighieri descendit aux Enfers sur les pas de Virgile, il trouva la terre creusée jusque dans son centre en dix grandes enceintes, et dans chacune de ces enceintes il n’était point un crime oublié. Ces enceintes étaient concentriques et si bien ordonnées dans leurs divisions que Montesquieu n’en trouva point d’autres pour l’Esprit des lois. Dans cette immense spirale, les cercles allaient en diminuant jusqu’à ce qu’on rencontrât au centre Lucifer lui-même, garrotté et servant de clef à la voûte de ce curieux édifice.
Ainsi, je pourrais comparer, au fond des catacombes, lorsqu’il se trouva dans cette pièce centrale où viennent aboutir les différentes sections de son empire, R. C. au roi des Enfers, avec cette différence toutefois que R. C. avait conservé la liberté de ses mouvements et que les divisions de ses administrations, au lieu d’être concentriques, affectaient chacune la forme d’un triangle dont il occupait le sommet.
Ce qui différenciait encore l’empire de R. C. de l’Enfer du Dante était que le premier n’avait que six divisions, tandis que le second comptait dix cercles ; mais là où la ressemblance de ces deux organisations reprenait étrangement de sa force, c’était dans la distribution des tâches de l’une comparée aux peines de l’autre.
Quand le roi, en quelques mots, se fut expliqué là-dessus, le Professeur ne put retenir le cri de son admiration et il ne s’étonna plus que des faussaires eussent pour unique travail de rédiger d’équitables écritures, que des notaires prévaricateurs dussent passer leur temps à défendre honnêtement les intérêts des clients de l’A. C. S., que des caissiers infidèles et qui avaient, sur la terre, trop étanché, au détriment du prochain, leur soif de richesses, fussent condamnés par ce nouvel ange de ténèbres à voir ruisseler, sans pouvoir s’y désaltérer, le fleuve tintinnabulant de l’or. R. C. avait sauvé tous ces misérables de la prison ou des galères ou de la mort pour les faire venir à sa cause d’abord, et puis, on peut le dire, à la leur, puisqu’ils rachetaient ainsi, et combien équitablement, leurs crimes passés.
Au bout d’un certain temps, quand ils avaient suffisamment expié et servi l’A. C. S., le roi des Catacombes leur rendait une absolue liberté et quelquefois même leur payait une maison de campagne, ce qui, chez Dante, ne se voit que dans la partie du poème affectée au purgatoire. Tout ceci pourrait paraître bien extraordinaire si l’on ne réfléchissait encore une fois que, en fait d’organisation de brigands, le roman ne saurait rien imaginer et que la lecture des faits divers nous dévoile chaque jour les plus extravagantes combinaisons. Au fond, on peut tout avec de l’argent ; avec lui, on est maître du ciel et de la terre, on s’assure toutes les complicités nécessaires à notre dessein, si singulier soit-il ; on triomphe partout. Or, R. C. avait beaucoup d’argent.
Au fur et à mesure que défilaient les différents tableaux de cette revue souterraine, le Professeur se retournait vers R. C. et semblait se demander : « Est-il possible, justes dieux, que ce jeune homme, que je prenais pour un habile ouvrier orfèvre, soit le maître de tout ceci ? » Mais R. C. lui désignait du doigt l’ouverture lumineuse et répétait :
– Regardez ! De tous vos yeux, regardez !
Il vit d’admirables jeunes gens, beaux comme des demi-dieux, qui, dans une salle d’armes rayonnante, se livraient des assauts furieux et finissaient d’apprendre le métier de l’épée, celui qui permet à coup sûr de coucher sur le terrain un adversaire condamné par R. C. Il vit, après la bande blanche, la bande noire ; après celle de l’épée, celle qui assassine avec le couteau. Car l’association contre la société (l’A. C. S.) avait ses crimes nécessaires comme la société elle-même…
Toutes les classes de la société avaient là leurs représentants prêts à servir l’A. C. S., soit avec la loi, soit contre la loi, mais toujours selon un idéal de droit éternel qui avait fait déjà beaucoup d’heureux et beaucoup de cadavres.
Le Professeur sut que la bande blanche n’avait aucun rapport avec la bande noire, et que les différentes sections n’avaient aucun point de contact entre elles et qu’elles ne pouvaient communiquer que par un couloir circulaire, où seuls les chefs de ces sections pouvaient passer, quand R. C. ou son lieutenant dit le Vautour, les faisaient demander. Le Professeur vit la salle des Rapports. C’était la plus immense. C’est dans cette salle des rapports que se tenait la section de l’espionnage. Là, tous les agents d’en haut venaient livrer leurs secrets, qui leur étaient grassement payés et qu’ils avaient dérobés partout où le conseil de l’A. C. S. l’avait jugé nécessaire. L’A. C. S. avait du reste des oreilles partout, et le conseil des Dix, à Venise, ne fut pas mieux servi que le conseil de l’A. C. S. à Paris.
Cette salle était bizarrement disposée en une sorte de multiple labyrinthe en bois dont les allées étaient tracées de telle sorte qu’une cinquantaine de personnes pussent s’y promener sans jamais se rencontrer. Comme à Venise, des boîtes secrètes étaient à la disposition du passant. Enfin, dans un coin de la salle, il y avait les confessionnaux, où ceux qui ne voulaient rien confier au papier venaient se confesser, masqués.
Ce qui étonnait par-dessus tout le Professeur, c’était la vie grouillante de tout cela… « à une heure pareille », disait-il. Il semblait à l’entendre que s’il avait vu toutes ces merveilles à midi, il les eût trouvées naturelles.
– À midi, dans les Catacombes, expliqua le roi, tout dort !
Quand le Professeur eut tout regardé, R. C. lui fit tourner une autre pierre sur ses gonds invisibles.
– Et ici, le voyez-vous ? demanda-t-il.
– C’est lui !… s’exclama le Professeur. C’est lui !
Au milieu d’un groupe de six hommes, le Vautour faisait de grands gestes et commandait le silence sans l’obtenir. Ces six hommes étaient les chefs de section de l’A. C. S. Parmi eux, on reconnaissait parfaitement Patte-d’Oie, dont la voix couvrait celle des autres.
Il criait :
– Il faut en finir tout de suite ! Nous sommes écrasés des pires besognes ! Si tu ne marches pas, Vautour, tu seras écrasé toi aussi. Et nous marcherons avec un autre.
– Demain ! suppliait le Vautour. Demain, tout ce que vous voudrez… Vous pouvez bien attendre vingt-quatre heures !
– Non ! Les sections sont prêtes. Demain, nous serons trahis ! Nous le sommes peut-être déjà ! On n’a pas pu mettre la main sur Cassecou ! Il s’est cavalé !
– Pourquoi demain ? répliqua un autre… N’avais-tu pas promis pour aujourd’hui ?… N’avais-tu pas dit que tu serais prêt aujourd’hui ? Et que tu l’aurais, devant toi, pleurant comme un enfant !
Le Professeur entendit un sourd grondement derrière lui : c’était le roi qui, en entendant ces dernières paroles, rugissait.
Ce débat se passait dans une salle entièrement tendue de rouge… Une table en occupait le milieu, recouverte d’un tapis rouge. Un trône, au fond, s’élevait sur des gradins. Au-dessus du trône il y avait un portrait, celui de R. C., dans un costume de soie noire et de dentelles blanches.
– Mais, fit le Professeur, en qui l’artiste veillait toujours, quelles que fussent les circonstances, c’est un Winterhalter de la première manière…
Déjà Patte-d’Oie s’avançait vers le portrait. Il tendit le bras vers lui et dit :
– Si tu ne proclames pas de suite sa déchéance, s’écria-t-il, moi je la proclamerai, et tant pis pour toi !
– Tant pis pour toi ! répétèrent tous les autres.
– Jures-tu ?
Le Vautour les considéra tous, les vit si décidés, si exaltés que, sans doute, les raisons qui lui faisaient reculer la trahison jusqu’au lendemain furent sacrifiées. À son tour, il s’avança sous le portrait et étendit le bras.
– C’est bien, dit-il, je le jure !
Patte-d’Oie continua :
– Il mourra ?
– Il mourra !
– Prends ce couteau, fit Patte-d’Oie en tendant une lame au Vautour, et, tout de suite, plante-le dans le cœur de cette image ! Alors, nous te croirons ! Et tu seras notre roi !
Le Vautour prit le couteau et, d’un geste énergique, l’enfonça dans le portrait.
Cela aurait pu être risible. Mais il est probable que ce fut terrible, car le Professeur en sursauta comme si, réellement, il venait de voir tuer un homme. Il se retourna vers R. C. Le jeune homme, d’une pâleur de cire, écoutait et regardait, les bras croisés. Patte-d’Oie dit encore :
– C’est bien ! Maintenant, travaillons ! Toutes les issues sont gardées. Nous n’avons rien à craindre. La porte du conseil est gardée. Nous ne risquons qu’une chose : c’est que Cassecou nous ait dénoncés, et encore tout sera pour le mieux. Il accourra plus vite au piège. Un pas dans la « Profonde » et il est notre prisonnier.
– Et il est mort ! firent tous les autres.
Sur un signe de Patte-d’Oie, ils s’assirent autour de la table rouge. Le Vautour voulut s’asseoir à côté d’eux, mais les autres le repoussèrent et, lui désignant le trône :
– Là-bas !… dirent-ils… Là-bas !… C’est ta place !…
Le Vautour gravit les gradins et regarda un instant le portrait de R. C., dans lequel le couteau était fiché à la place du cœur… et puis il se retourna vers ses complices et s’assit.
– Je suis roi ! dit-il.
– Le roi est mort, vive le roi ! crièrent les six chefs.
La clameur emplissait encore la salle rouge que, derrière les conjurés un pan de draperie se soulevait et un homme apparaissait…
– Qui donc a dit que le Roi était mort ! dit-il.
C’était R. C.
XI – OÙ NOUS APPRENONS QUE Mlle DESJARDIES N’EST PAS ENCORE AU BOUT DE SES PEINES
Les six n’avaient pas aperçu tout d’abord le nouvel arrivant. Du reste comme il a été dit au précédent chapitre, aucun de ceux qui étaient là ne pouvait s’imaginer qu’on pût venir les troubler dans leur retraite, et tous ignoraient qu’on pût entrer dans la salle du conseil autrement que par l’unique porte qu’ils connaissaient. Ce n’est qu’en voyant le Vautour, en face d’eux, se lever tout droit, les yeux fixés sur un objet inconnu, qu’ils détournèrent la tête et découvrirent le roi, dans le moment même qu’il prononçait d’une voix singulièrement calme : « Qui donc a dit que le roi était mort ? »
Ils eurent un mouvement de recul, et puis vite ils se ressaisirent. Est-ce que, par un hasard providentiel, celui-ci ne venait pas justement s’offrir à leurs coups ? L’occasion était bonne et ils allaient pouvoir en finir tout de suite avec leur tyran. Un coup d’œil échangé entre eux les confirma dans leur résolution. Ils s’étaient tous compris.
Le roi, sans une marque apparente d’émotion, s’avança vers la table autour de laquelle ils se tenaient maintenant tous debout dans l’attente de l’événement.
Du haut de son observatoire qu’il n’avait pas quitté, car le roi avait disparu sans prévenir le Professeur ni Cassecou, le Professeur regardait la scène. Quand il aperçut tout à coup dans la salle rouge R. C., le Professeur ne put retenir l’expression de son angoisse : « Ils vont l’assassiner ! » C’était aussi l’avis de Cassecou et tous deux regrettèrent qu’il les eût quittés ou qu’il se fût lancé dans une aussi audacieuse entreprise sans leur avoir fait signe. Cassecou ne l’aurait pas laissé s’exposer tout seul et, ma foi, le Professeur, qui cependant n’avait rien à gagner dans une histoire dont il ne connaissait pas le premier mot, l’aurait suivi, pour l’amour de l’art.
– Qu’il est beau ! s’écria le Professeur. Qu’il est brave ! Voilà un roi comme je les aime ! Admirons-le, monsieur Cassecou, pendant qu’il en est temps encore !
– Ah ! Si je savais par où passer pour le rejoindre ! grondait Cassecou en fermant les poings.
Mais il ne le savait pas, et force lui fut de regarder la scène sans s’y mêler… R. C. venait de jeter son épée sur la table.
– Quelle imprudence ! murmura le Professeur.
R. C. venait d’envoyer ses pistolets rejoindre son épée. C’étaient de ces singuliers pistolets à répétition, armés de mystérieux « chargeurs » dont les cartouches, à volonté offensive ou inoffensive, tuaient ou faisaient semblant de tuer. En vérité, l’affaire était simple : certaines cartouches étaient à balle et d’autres en étaient privées.
Ainsi R. C. se trouvait complètement désarmé.
– Notre roi est devenu fou ! gémit le triste Cassecou.
Les six firent un mouvement vers la proie facile qui s’offrait à eux, mais le roi les regarda d’une façon si terrible que pas un n’osa l’affronter, n’osa se ruer sur lui ! Il avait les bras croisés et ses yeux les domptaient. Ils courbèrent la tête en disant : « Nous le frapperons par derrière… ». Car maintenant, négligeant cette racaille, il s’avançait droit au Vautour qui, debout devant le trône sur lequel il avait osé s’asseoir, le voyait venir sans épouvante, sûr de sa force et de son triomphe.
Chose étrange, le regard foudroyant du roi des Catacombes s’était transformé en se posant sur le Vautour… C’était maintenant un regard de douceur et de tristesse, presque un regard ami… Le Vautour en fut à ce point stupéfait que, d’un geste, il retint ses acolytes déjà prêts à se ruer vers l’homme sans défense qui leur tournait le dos. Le Vautour voulait savoir ce que le roi avait à lui dire avec ce regard-là.
R. C. avait gravi les degrés du trône. Et, quand il fut si près du Vautour que celui-ci n’avait qu’à allonger la main pour le tuer, il lui dit :
– Pourquoi donc, Vautour, n’étais-tu pas ce soir à la place que je t’avais fixée ?… Pourquoi as-tu, Vautour, donné ton masque et ton glaive à un autre ? Pourquoi m’as-tu trompé ?
Le Vautour ne répondit pas. Il était étrangement ému par le regard si doux, si doux de l’autre… R. C. répéta :
– Pourquoi m’as-tu trompé ? Ne savais-tu pas que c’était ce soir la nuit de ma vengeance ? Et que j’avais besoin de toi auprès de moi ?
Il y eut un silence, puis le Vautour, baissant la tête, répondit :
– Ta vengeance n’est pas la mienne !… Je ne veux plus servir ta vengeance…
Et, plus bas encore :
– Va-t-en !… Je t’en supplie, va-t-en !… J’ai promis de te tuer… va-t-en !…
– Puisque tu as promis de me tuer, Vautour, pourquoi ne tiens-tu pas ta promesse ?
– Parce que… je ne veux pas, finit par dire le lieutenant de R. C. d’une voix sourde.
– Pourquoi ?
– Je ne sais pas ! Va-t-en ! Va-t-en !…
– Veux-tu que je te dise pourquoi ?… Regarde-moi !… Allons, lève la tête !… Regarde-moi, te dis-je !… Et tu vas savoir pourquoi tu ne peux pas me tuer…
Alors, les six qui attendaient, anxieux et impatients, la fin de cet intime colloque, assistèrent à un spectacle inattendu : le roi prit la tête de Vautour, l’attira à lui et l’embrassa. Mais s’ils virent le baiser, ils n’entendirent pas le mot qui l’accompagnait. Quel pouvait bien être ce mot pour produire instantanément un effet pareil ? Aussi, les six furent-ils stupéfaits et quasi anéantis quand celui qu’ils venaient de prendre pour chef de leur trahison s’avança vers eux et leur dit en leur montrant R. C. :
– Il n’y a d’autre roi ici que celui-là !
Et comme il avait dit cela, le Vautour ! De quelle voix subitement changée, avec quel geste d’enthousiasme et de dévouement, avec des larmes plein les yeux !… Oui, le Vautour, qu’on n’avait jamais vu pleurer, pleurait !
Les six comprirent que le Vautour désertait leur cause et qu’ils étaient perdus ! Ils se précipitèrent sur les deux hommes, sur les deux chefs, qu’ils enveloppaient maintenant dans la même haine et qu’ils allaient sacrifier dans le même crime. Ce fut une ruée sur les marches du trône. Le premier arrivé fut Patte-d’Oie. Mal lui en prit…
… Mal lui en prit, car le Vautour saisissant tout à coup d’un geste brusque le couteau de Patte-d’Oie, qui était resté fiché derrière lui dans le portrait du roi, lui en porta un coup terrible. Patte-d’Oie s’affaissa et rendit illico son âme au diable avec un abominable juron… Sa propre lame lui était entrée dans le cœur, châtiment éminemment moral…
Le roi saisit à la gorge le second qui se présenta et l’étrangla net. Le troisième ayant trébuché sur les marches ne se releva pas, assommé d’un formidable coup par le Vautour.
Il en restait trois. Ils savaient qu’ils n’avaient plus d’autre espoir de vivre, après leur trahison, que celui de tuer… Mais trois contre deux quand ces deux étaient R. C. et le Vautour ! Cependant, ils ne désespérèrent point et se souvinrent tout à coup des armes que le roi avait jetées si imprudemment sur la table. Ils s’en emparèrent. Mais celui qui avait saisi l’épée de R. C. dut en lâcher immédiatement la poignée. Il venait de recevoir dans le bras une secousse affreuse qui lui fit pousser un cri de désespoir. Il crut son bras foudroyé. Quant à ses deux camarades, revenus sur le Vautour et le roi avec les deux pistolets à répétition dont nous avons parlé, ils les déchargèrent sur R. C. presque à bout portant. Mais quelle ne fut pas leur terreur en voyant le roi sourire à cette effroyable décharge ! Ils crurent qu’il était invulnérable.
C’était un bruit, du reste, qui courait depuis longtemps dans la Profonde. Mais jamais ils n’avaient été à même d’en juger aussi bien que dans ce moment-là. Alors, ils sentirent qu’il n’y avait plus à lutter et tombèrent à genoux en demandant grâce comme des enfants. Sur quoi, le roi, toujours aussi calme, ramassa ses pistolets, qu’ils avaient abandonnés, et, froidement, leur brûla la cervelle. Ils n’eurent même point le temps de s’extasier sur l’incohérence d’une arme qui tantôt tue et tantôt ne tue point. Ils roulèrent sur le tapis et ne se relevèrent plus.
Des six, il ne restait plus que celui qui avait osé toucher à l’épée du roi et qui en avait été si cruellement puni. Il se croyait, lui aussi, condamné à mort. Mais il était brave et il attendait.
– Frappe, dit-il à R. C. Je l’ai mérité.
Celui-ci était le chef de la bande blanche, et le roi l’avait eu jusqu’alors en particulière estime. Il lui fit grâce en lui annonçant, du reste, qu’il ne pourrait jamais plus recouvrer l’usage de son bras droit…
– Et maintenant, s’écria le roi en se retournant vers le Vautour, tu vas me dire pourquoi tu voulais attendre jusqu’à demain pour me trahir… Ton temps était donc bien pris, cette nuit, Vautour ?
Le Vautour rougit…
– Vautour, tu m’as pris ma maîtresse… Tu vas me la rendre.
Le lieutenant de R. C. ne répondit pas, et R. C. en parut assez singulièrement étonné…
– Où est Mlle Desjardies, Vautour ?
Cette fois, le roi ne le regardait plus d’un œil tendre. L’autre fit un geste sur lui-même et finit par dire :
– Je n’en sais rien !…
– Il ment ! cria une voix retentissante qui semblait venir du ciel. Le roi, malgré la gravité des circonstances, ne put faire mieux que de sourire en reconnaissant la voix indignée du Professeur.
Le Vautour leva la tête et regarda autour de lui et au-dessus de lui, cherchant à découvrir le personnage qui l’accusait si inopinément de mensonge. Mais il ne vit rien et n’en fut pas plus rassuré. Il considéra R. C. avec une admiration mêlée de réelle terreur.
– Oh ! oui, tu es bien le roi ! fit-il… Mais je te jure que je ne mens pas…
– Il ment !
C’était encore le Professeur qui protestait. Le Vautour frissonna.
– Écoute, fit R. C., tu sais maintenant si je t’aime… Tu sais ce que j’ai fait pour toi. Tu sais ce que je t’ai pardonné. Tu sais ce que j’attends de toi. Tu sais que ma vengeance est la tienne !… Il m’a suffit d’un mot pour t’apprendre tout cela… Eh bien… malgré ce mot-là… tu as vécu, Vautour, si tu ne me dis immédiatement où se trouve Mlle Desjardies…
– Tue-moi, répondit le Vautour, tue-moi, car je ne saurais te le dire, attendu que j’en sais rien…
R. C. devint effroyablement pâle et un tremblement nerveux l’agita… Il fallait, devant une pareille déclaration, et sachant ce qu’il savait, qu’il eût des raisons bien puissantes pour qu’il ne mît point sa menace à exécution.
Il réussit cependant à calmer la colère qui le faisait trembler et, posément, il raconta au Vautour toute l’histoire de l’enlèvement de Mlle Desjardies, jusqu’à l’hôtel dans lequel avait pénétré le Professeur.
– Tout cela est-il vrai ? demanda-t-il.
– Tout cela est vrai, avoua le Vautour.
– Enfin ! soupira R. C., nous y voilà ! Et l’homme qui a prononcé le mot de passe, me diras-tu que ce n’était pas toi ?
– C’était Dixmer. Nous voulions te forcer la main : Gabrielle contre ton pouvoir ! Une assurance, quoi !
– Tu sais pour qui travaille Dixmer ?
– Je croyais qu’il travaillait pour moi !…
– Et maintenant, tu ne le crois plus ? demanda anxieusement R. C.
– Dixmer m’a roulé. Quand Patte-d’Oie est revenu dans l’hôtel où il devait enfermer, pour moi, Mlle Desjardies, Mlle Desjardies ne s’y trouvait plus !…
– Malédiction ! hurla le roi. Et tu ne sais pas davantage où elle se cache ?
– Je te jure que je n’en sais rien et que je ferais tout pour le savoir… tout…
Le roi considéra le Vautour longuement… Il le crut… Il ouvrit ses bras, et les deux hommes s’étreignirent.
– Et maintenant, fit le roi, se dégageant des bras du Vautour, à l’ouvrage ! Car si tu ne sais pas pour qui travaillait Dixmer, je le sais moi ! C’était pour Sinnamari. Et Sinnamari nous rendra Gabrielle.
Ayant dit, il s’assit, prit une feuille de papier et écrivit :
« Monsieur le procureur impérial, je me présenterai demain, à deux heures, à votre cabinet. Vous aurez la bonté d’y faire venir Mlle Desjardies, que j’y viendrai chercher.
« Croyez-moi, monsieur le procureur impérial, votre dévoué serviteur. »
Et il signa :
Robert Carel, Roi des Catacombes
XII – DANS L’ANTRE DU LION
Le lendemain de ce jour mémorable où le comte de Teramo-Girgenti avait inauguré son hôtel de l’avenue des Champs-Élysées, à deux heures de l’après-midi, Sinnamari se trouvait au Palais de Justice, dans son cabinet.
Sur son bureau, le procureur impérial avait, grande ouverte, la lettre qui lui annonçait la visite du roi des Catacombes. Tant d’audace, un si extravagant cynisme eussent pu épouvanter d’autres qui avaient une conscience plus tranquille. Mais c’eût été bien peu connaître cette âme de combat que de la croire émue de ce nouveau et curieux incident. À sa place, quelques-uns eussent pensé que pour user d’une telle menace et l’affronter jusqu’au sein de sa puissance, dans ce palais où tout lui obéissait, il fallait que le fameux bandit fût terriblement armé et sûr de le battre. Or, il ne pouvait venir à l’idée de Sinnamari que quelqu’un fût suffisamment armé contre lui pour vaincre.
Même après les avertissements formidables de la veille, même après cette résurrection d’un crime qu’il croyait inconnu des hommes, le procureur ne doutait point de sa force ni de son triomphe final. Et même, en cette minute où il était averti qu’il allait se trouver face à face avec son pire ennemi, car cette lettre n’eût rien signifié si le projet qu’elle annonçait ne devait pas être suivi d’exécution, alors qu’il s’attendait à voir sa porte s’ouvrir devant le fils de celui qu’il avait fait exécuter comme un vil assassin et de celle qu’il avait traitée comme la dernière des filles… Ce n’était point par l’aléa tragique d’une pareille et si imminente rencontre que son esprit était occupé…
Certes, s’il n’avait pensé qu’au drame prochain, il n’eût point montré ce sourire, ces yeux en fête, cette démarche « avantageuse », cette fièvre heureuse enfin qui ne lui permettait point de se tenir en place… En vérité, Sinnamari, par son exceptionnelle attitude, manifestait ce genre si spécial de « transport », si nous pouvons ainsi nous exprimer, qui habite le cœur des amoureux avant le rendez-vous qui doit combler leurs désirs… ou après la victoire…
Nous pouvons affirmer tout de suite qu’une trop longue expérience des atermoiements décevants auxquels se complaisait Liliane dès qu’il s’agissait de « couronner la flamme » de ce prodigieux magistrat, avait suffisamment instruit celui-ci de ne se réjouir de rien avant que de tenir, pour que nous puissions juger à coup sûr qu’il n’avait tant de joie que pour avoir tenu…
Et c’était ainsi. Il avait tenu, cette nuit même… il avait tenu enfin Liliane… Il l’avait tenue autant qu’amant au monde puisse tenir physiquement sa maîtresse… il l’avait tenue comme une chose à lui, et elle l’avait « retenu », lui, comme une chose à elle.
Et elle lui avait si longuement et si complètement, ma foi, prouvé son amour, qu’il eût été impossible de comprendre rien à quoi que ce fût s’il avait douté de son amour ! Liliane l’aimait !
Tout lui souriait… N’était-il point armé contre R. C. d’une façon inattaquable avec cette Gabrielle Desjardies, que Dixmer avait réussi à mettre en son pouvoir ? Et le fameux crime d’antan, après tout, était-il démontrable autrement que par l’exhibition du cadavre dans sa propriété de la petite rue des Saules !… Or, où était-il, le cadavre ?… Qui pouvait, en dehors de lui, dire où il était ? Le Teramo ?… La scène de suggestion, lorsqu’il s’était emparé de sa main, lui aurait révélé où était le cadavre ?… Allons ! Allons ! Et puis, même si on savait, il faudrait aller le chercher, le cadavre ! Et il était bien décidé à veiller dessus !… Il était décidé à habiter dessus !… À dormir avec !… Est-ce que Liliane, qui avait eu une si étrange et si inquiétante envie de cette petite maison de la rue des Saules, est-ce que Liliane (qu’il ne pouvait soupçonner une seconde de faire cause commune avec son ennemi depuis qu’elle lui avait donné de si indéniables preuves de son attachement) n’avait point cette idée merveilleuse – elle lui en avait parlé cette nuit encore – d’en faire leur nid d’amour ?… Et tout de suite ?…
Dès le soir même, il allait prendre un long congé qu’il avait bien mérité, certes !… Il allait oublier pendant quelques semaines les affaires sérieuses… Il allait s’enfermer avec Liliane dans la petite maison de la rue des Saules !… Et qui oserait alors venir le troubler ?… La morte ?… Quel enfantillage !… Il saurait faire discrètement, lui qui disposait de toute la force publique, veiller sur les vivants qui auraient le mauvais goût de s’égarer du côté de la rue des Saules, et, ceci fait, il répondait du sommeil des morts !…
Et que pouvait la mort devant la vie, la vie de Liliane amoureuse ? Il la voyait encore !… Ah ! comme il la voyait ! Telle qu’elle lui était apparue si inopinément dans son appartement des quais… Oui, chez lui ! Chez lui-même !… Elle avait eu cette audace !… Elle lui avait fait cette surprise ! Il venait de rentrer chez lui après cette abominable soirée… Et, dans son bureau, il réfléchissait aux événements, à la conduite à tenir, quand on avait sonné à sa porte. Sa domestique était couchée. Il était allé ouvrir lui-même. D’abord, il ne distingua pas, et puis il ne put en croire ses oreilles, quand elle avait dit : « C’est moi ! »
Stupéfait, il ne trouva pas une parole. Elle s’avança. Il referma la porte derrière elle. Jamais elle n’était venue chez lui… Il le lui avait du reste défendu… Quand il revint vers elle… elle était déjà dans le bureau… Elle laissait tomber son manteau… Elle lui apparut telle qu’il l’avait tant désirée, dans sa loge, le soir même. Elle n’avait jamais été si belle…
À partir de ce moment, il ne se rappelait plus rien de ce qui avait pu être dit entre lui et elle ! Il ne se souvenait plus que du geste qui lui avait livré cette femme, que de ces bras blancs qui s’étaient refermés si amoureusement sur sa tête. Dans sa chambre à lui, ils s’étaient aimés jusqu’au jour…
Ah ! Comment douterait-il maintenant de la passion de cette femme dont, par instant, il s’était cru détesté ? Comment oserait-il encore se plaindre de ce qu’elle l’eût tant fait attendre après tout ce qu’elle venait de lui accorder ? Quelle nuit !
À ce moment, Sinnamari releva la tête d’un geste orgueilleux. C’est dans ce moment – il était deux heures cinq – que la porte de son cabinet s’ouvrit et que son huissier lui annonça :
– M. Robert Carel !
Rappelé à la terrible réalité de la minute présente, il s’assit à son bureau et sa main alla tâter dans le tiroir le revolver qu’il y avait déposé.
– Faites entrer ! dit-il…
Le roi des Catacombes entra. Il salua, enleva son chapeau de feutre, ouvrit son pardessus et, sous ce vêtement, se montra dans le curieux habit noir sous lequel Sinnamari l’avait vu pour la première fois dans le salon Pompadour de la place de la Roquette. L’homme paraissait désarmé.
Quand ils furent seuls, R. C. prit le premier la parole.
– Je suis en retard de cinq minutes, fit-il… Vous m’excuserez, mais la faute en est à M. Desjardies, que j’ai amené avec moi et qui s’est trouvé mal de joie dans ma voiture quand je lui ai annoncé qu’il allait revoir sa fille…
– M. Desjardies !… s’écria Sinnamari. Desjardies est avec vous ?… Vous l’avez amené avec vous ?…
– Il m’attend en bas, dans ma voiture.
Le procureur regarda le jeune homme… longuement. Tant de confiance en soi-même finissait par le remplir d’admiration. Le silence qui régnait entre ces deux hommes était effrayant. La destinée de chacun d’eux se décidait pendant ce silence-là… Des paroles définitives allaient être échangées après ce silence-là…
– Vous savez ce que vous risquez, en venant me braver ainsi, moi, procureur impérial, dans mon cabinet, au Palais de Justice ?… fit lentement Sinnamari…
– Rien !… Sans quoi je ne serais pas venu… Je ne risque jamais rien !… Vous savez pourquoi je suis venu… Je viens chercher Mlle Desjardies, que vous avez fait enlever… Où est Mlle Desjardies ?
– Là !… répondit Sinnamari.
Et très calme, il montrait la porte qui donnait sur le bureau du substitut…
Robert Carel fit un mouvement vers la porte. Sinnamari étendit la main.
– Un instant, dit-il.
– Je suis pressé, fit remarquer sur le ton du plus insistant mépris le roi des Catacombes.
– Pas plus que moi, répliqua Sinnamari. Et cependant vous n’êtes pas encore arrêté !…
Robert Carel pâlit comme sous une mortelle offense en entendant ce mot : « arrêté ». Il croisa les bras :
– Je suis ici seul, sans armes, devant vous, qui avez l’armée et la police à votre disposition, et un revolver dans le tiroir de votre bureau. Et cependant, je vous jure que vous ne m’arrêterez pas !
– Pourquoi ? demanda Sinnamari se levant.
– Parce que je ne le suis pas déjà !…
Il y eut un nouveau silence. La réplique était terrible pour Sinnamari. Elle lui révélait à lui-même ceci qui était l’absolue vérité : qu’il avait peur de faire arrêter le fils de ses victimes !… Et pour la première fois, il douta de lui-même, car, jusqu’alors, il avait cru qu’il n’avait peur de rien !… Il se rassit, tête basse. Quand il releva le front, il semblait avoir pris une grave résolution.
– Monsieur, dit-il, pas de paroles inutiles entre nous !… Vous savez qu’il me suffit d’un geste pour vous faire arrêter, d’un mot pour perdre Mlle Desjardies qui est derrière cette porte, et cependant que vous ne reverrez jamais, si je le veux !… Eh bien ! je vais vous proposer ceci, moi, procureur impérial : la liberté, la sécurité pour vous, pour Mlle Desjardies et… pour son père, si vous voulez disparaître à jamais…
– D’où ? demanda R. C., avec un sourire que Sinnamari ne vit point, car il en eût été épouvanté.
– De mon chemin !
R. C., entendant ces mots, s’assit au bureau de Sinnamari en face de lui… Et, le regardant dans les yeux, la voix basse et sifflante :
– C’est tout ce que vous avez trouvé. Votre justice a assassiné mon père, vous avez torturé ma mère, ma sœur a été livrée, à cause de vous, à la plus vile prostitution… Et moi ?… Qu’avez-vous fait de moi ?… Quelque chose de formidable et de ridicule, un homme dont on ne peut pas parler sans trembler ou sans rire : le roi des Catacombes !… L’empereur et le paillasse du crime !… Et quand, pour la première fois, nous nous rencontrons face à face, sachant, moi, qui vous êtes, et apprenant enfin, vous, qui je suis, voilà ce que vous trouvez à me dire : « Disparaissez de mon chemin !… » Voilà tout ce que vous me proposez… Un pacte qui me donne à moi la liberté et qui vous donne à vous, au nom du père assassiné, de la mère violée, de la fille flétrie et du fils maudit, le pardon !… L’oubli de vos crimes !… Insensé !…
Et Robert Carel rit, rit effroyablement. Il reprit, farouche :
– Savez-vous pourquoi je suis venu vous trouver aujourd’hui, monsieur le procureur impérial ?…
– Pour chercher Gabrielle Desjardies, que je ne vous donnerai jamais…
– Oui, pour chercher Gabrielle Desjardies, qui va descendre, tout à l’heure, de ce palais, à mon bras… et aussi pour autre chose de très important. Pour vous apprendre ceci : « Monsieur le procureur impérial, je vous ai condamné à mort ! »
– Monsieur ! gronda Sinnamari. J’ai grande envie de vous tuer !…
Et il fouilla dans son tiroir…
– Ici ! railla R. C. Vous auriez tort !… Cela ferait beaucoup de cadavres dans vos bureaux, monsieur le procureur impérial !… On finirait par se douter de quelque chose, et ce nouveau scandale ne serait certainement point du goût de M. le procureur général, qui sera ici dans trois minutes…
R. C. avait tiré sa montre.
– Que voulez-vous dire ? interrogea Sinnamari… Et que vient faire dans tout ceci le procureur général ?
– Mais c’est vous qui l’avez fait demander, monsieur le procureur impérial.
– Moi ?
– Vous-même !… Et d’urgence encore, vous excusant de ne pouvoir aller vous-même chez lui.
– Vous êtes fou !… Je n’ai pas besoin de lui !…
– Vous, non… Mais moi, oui…
– Pour quoi faire ? demanda, inquiet cette fois, Sinnamari.
– Pour lui remettre ceci…
Robert Carel tira alors de la poche de son pardessus un étui dont la vue produisit sur le procureur impérial un effet foudroyant… C’était pour cette boîte de cuivre plate qu’il n’avait pas hésité à commettre un assassinat et à laisser condamner à mort Desjardies, la boîte de cuivre de Didier, dans laquelle se trouvaient tous les documents qui prouvaient son infamie et la preuve du rôle joué par lui dans l’affaire des décorations !… Comment cet étui se trouvait-il dans les mains de son pire ennemi… Voilà ce que, dans le désarroi de son esprit épouvanté, il ne pouvait comprendre. Il le croyait toujours au fond de son coffre-fort, chez lui, à son domicile, dans son cabinet de travail, dans lequel personne ne pénétrait quand il n’était pas là. Non seulement, il avait, lui seul, la clef et le secret de son coffre-fort, mais, lui seul, il avait la clef de son cabinet de travail…
Était-il possible qu’un pareil larcin ait été commis chez lui sans qu’il s’en fût aperçu ?… Voilà aussi ce qu’il se serait refusé à croire si l’étui de cuivre n’avait été là, devant ses yeux !… Quand donc le vol avait-il été commis ?… Il essayait de se rappeler… Depuis quarante-huit heures il n’avait pas ouvert le coffre-fort. Quarante-huit heures auparavant l’étui était encore dans le coffre-fort. Et cependant, depuis deux jours, nul n’avait pénétré chez lui – nul n’était venu chez lui… Personne excepté, cette nuit même Liliane… Or, il ne pouvait même pas soupçonner Liliane, qui ne l’avait pas quitté un instant ! Et puis, comment soupçonner cette femme amoureuse d’une pareille trahison ?
Matériellement, du reste, c’était impossible… La clef du coffre-fort était toujours sur lui… Cependant, il se rappelait qu’il l’avait laissée, la nuit passée, avec ses vêtements, dans le cabinet où se trouvait le coffre-fort… le cabinet adjacent à cette chambre dans laquelle les bras de Liliane l’avaient entraîné. Mais quoi, on ne pouvait entrer dans le cabinet qu’en passant par sa chambre ! Il ne comprenait plus !… Et surtout il ne voulait pas une seconde essayer de comprendre que l’amour et la possession inattendus de Liliane fussent pour quelque chose dans l’incident !… Non ! L’étui avait été volé – sans qu’il sût comment – la veille… Et la preuve de cela, il l’avait. La preuve que l’étui avait été volé avant l’arrivée de Liliane, il la possédait…
… En effet, la lettre du roi des Catacombes lui annonçant qu’il viendrait le lendemain, à deux heures, dans son bureau même, au Palais de Justice, chercher Mlle Desjardies, cette lettre il l’avait trouvée à sa rentrée chez lui en sortant de chez Teramo-Girgenti… avant donc que Liliane ne se présentât à sa porte… Or, il ne pouvait douter qu’au moment même où R. C. lui écrivait cette lettre et osait tenter ouvertement un pareil coup d’audace, R. C. ne fût déjà en possession de l’étui !… C’était l’arme avec laquelle il comptait le faire chanter…
Alors, il respira et il demanda mentalement pardon à Liliane d’avoir pu, un instant, diriger sa pensée du côté d’un si extravagant soupçon…
Maintenant, il pouvait écouter R. C. Eh bien ! qu’est-ce qu’il lui voulait avec son étui, cet étui qu’il avait ouvert et dont il sortait des lettres qu’il connaissait bien ?… Livrer le tout au procureur général, qui allait peut-être, dans l’instant, comme l’autre le lui avait annoncé, pousser sa porte ?
Le procureur général était la bête noire de Sinnamari. La vertu parfaite de ce magistrat suprême, son seul chef, l’excédait. La parfaite simplicité de ses mœurs, sa pauvreté, l’inintelligence voulue qu’il avait des choses de la politique, son mépris de l’intrigue en général et son mépris de Sinnamari en particulier, l’avaient plus d’une fois poussé à de terribles accès de rage secrète contre un personnage qui était si bien l’antithèse du sien ! Il le haïssait de toutes ses forces et, s’il ne le craignait point, du moins il s’avouait que cet homme le gênait. Il le gênait de toute l’estime qu’il traînait derrière lui au Palais. Il le gênait comme une injure, comme un reproche, comme un remords, comme une accusation muette. De voir l’un si blanc, l’autre devait apparaître plus noir. Couramment, il le traitait d’imbécile : c’était un honnête homme.
Sinnamari, se passant la main sur son front en sueur, se leva et alla à R. C.
– Que voulez-vous ? dit-il.
– Mlle Desjardies.
– Et vous me rendrez toutes ces lettres ?
– Oui.
Sinnamari ouvrit la porte qui donnait sur le bureau de son substitut. Il fit un signe.
Mlle Desjardies était sur le seuil. Elle vit R. C., poussa un cri de surprise. Elle le connaissait et ne « le reconnaissait pas ! » Mais R. C. parla avec cette douce voix dont il lui disait son amour, et elle s’écria, délirante :
– Pascal !…
Ils furent dans les bras l’un de l’autre.
– C’est touchant ! fit cyniquement le procureur, mais vous vous embrasserez dehors !… Mes lettres, s’il vous plaît ?
R. C. se dégagea de l’étreinte de Gabrielle tremblante, ne sachant si elle devait se réjouir, craindre ou espérer… Il donna les lettres. Le procureur les regarda, les compta…
– C’est bien, fit-il, elles y sont toutes…
Et il allongea la main vers l’étui… Mais R. C. le mit dans sa poche.
– Non, dit-il. Vous n’aurez pas l’étui !… Je le garde. Il a appartenu à Didier ; si par hasard il vous prenait fantaisie de me faire arrêter dans la cour de Mai, malgré les précautions que, personnellement, j’ai prises, je ne serais pas mécontent d’apprendre à ceux qui l’ignorent comment cet étui est tombé en ma possession.
– Vous êtes vraiment fort ! dit Sinnamari… Mes compliments !…
R. C., ayant à son bras Mlle Desjardies, se disposait à quitter le cabinet du procureur, quand un huissier annonça que le procureur général était dans l’antichambre.
– Qu’est-ce que je vais lui dire ?… murmura Sinnamari.
– Ce que vous voudrez ! répliqua avec un sourire sinistre le roi des Catacombes. Maintenant, nous sommes quittes en ce qui concerne Mlle Desjardies, mais je vous préviens qu’il va falloir recommencer à compter avec Robert Carel !… Comme on dit en Corse : « Garde-toi, je me garde !… » Je vous ai condamné à mort, monsieur le procureur impérial !…
– Ce sera pour bientôt ? demanda avec une effroyable ironie Sinnamari…
– Monsieur, mon père a attendu la mort quarante-quatre jours après le verdict. Je vous préviens que dans quarante-quatre jours, jour pour jour, heure pour heure – il est deux heures et demie – vous me reverrez, monsieur !
– Pour quoi faire ?…
– Pour mourir !…
Sinnamari ne broncha pas sous cette menace, qu’il prit pour une rodomontade, mais, tout de même, il se demanda un instant s’il n’allait pas faire sur-le-champ arrêter R. C. Il recula devant l’effroyable scandale que son ennemi pouvait déchaîner et aussi devant la certitude que R. C. devait avoir pris, comme il le lui avait dit, ses précautions.
Du reste, le procureur général entrait dans son cabinet… et R. C. et Mlle Desjardies s’éloignaient déjà.
Aucun incident ne se produisit. Le roi des Catacombes et sa fiancée purent sortir du Palais sans être inquiétés. Une voiture attendait devant la grande grille de la cour de Mai. R. C. y fit monter Gabrielle et aussitôt on entendit des exclamations et des cris de joie !
– À la gare d’Orléans, commandait R. C. au cocher.
Et il monta à son tour dans la voiture, où il trouva Mlle Desjardies dans les bras de son père…
Les trois voyageurs prirent, à la gare d’Orléans, des billets pour Bordeaux. Mais ils descendirent à Juvisy, et là, abandonnant la ligne d’Orléans pour le P.-L.-M., prirent place dans un train qui les conduisit à Laroche. À Laroche, ils montèrent dans le rapide de Marseille. Dans le moment même où le train allait se mettre en marche, R. C. ne fut pas peu surpris de voir accourir sur le quai M. Macallan, tout essoufflé, et agitant plus que jamais son bâton.
– Et l’étui de Cécily ?… Et l’étui de Cécily ? hurlait-il, du plus loin qu’il reconnut R. C.
Macallan grimpa sur le marchepied et voulut ouvrir la portière du compartiment. R. C. tentait en vain de lui faire lâcher prise.
– Je ne te laisserai pas, by Jove ! Si tu ne me montres pas l’étui de Cécily !… Jure-moi que tu l’as toujours, by Jove !… Montre-le moi ?… Donne-le moi !…
R. C. sortit l’étui de sa poche et le donna à l’avorton, qui paraissait en proie à une crise d’hystérie, tant son exaspération était désordonnée.
Quand il tint l’étui, M. Macallan lâcha la portière du wagon ; le train partit… Resté seul sur le quai, M. Macallan ouvrit l’étui.
– By Jove ! clama-t-il… il est vide !
Et il donna un tel coup de canne sur le bord du quai que le bâton vola en éclats !… Il en considéra les morceaux, mélancolique…
– L’étui ne serait pas vide, soupira-t-il, s’il n’avait pas une dent creuse !…
XIII – M. EUSTACHE GRIMM EST INVITÉ À DÉJEUNER EN VILLE
Le jour même où Robert Pascal se présentait chez le procureur impérial, au Palais de Justice, c’est-à-dire le jour qui suivit la fameuse fête qui inaugurait l’hôtel du comte de Teramo-Girgenti, M. Eustache Grimm se trouvait, vers midi moins un quart, dans un vaste et imposant bureau de l’avenue Victoria en train de déguster assez tristement son troisième verre de Marsala-apéritif, quand notre vieil ami, l’huissier Lambert, se présenta à son regard étonné.
– Que voulez-vous, mon ami ? fit Eustache Grimm.
– Monsieur, répondit Lambert, j’ai pris la liberté de me présenter devant vous pour vous rappeler l’heure du déjeuner…
– L’heure du déjeuner !… mais, mon ami, fit Eustache Grimm, de plus en plus stupéfait, je ne l’ai pas oubliée. Est-ce que je serais, par hasard, en retard ?…
– Vous ne seriez point en retard, monsieur, si vous ne déjeuniez en ville, je prends la liberté de rappeler à monsieur qu’il est midi moins un quart passé…
– Ah ! ah ! vous êtes sûr que je déjeune en ville ?… interrogea d’une voix basse et subitement inquiète le directeur de l’Assistance publique.
… De fait, Eustache Grimm n’avait pas oublié l’invitation de Teramo-Girgenti ; mais il s’était passé dans cette malencontreuse soirée tant d’événements extraordinaires, qu’il espérait que Teramo, lui, ne s’en était plus souvenu ! C’était bien la première fois de sa vie que Grimm Eustache se trouvait dans une disposition d’esprit telle qu’il souhaitait qu’on eût oublié de lui offrir le déjeuner auquel il avait été invité… Mais, en vérité, la fréquentation de ce Teramo ne lui paraissait plus une chose dont il était impossible de se passer. Quand on était comme lui, Eustache Grimm, un des premiers fonctionnaires de l’Empire, on devait regarder à se commettre avec des comtes de pacotille, qui ne sont connus ni d’Ève ni d’Adam, qui se prétendent néanmoins plus vieux que le monde, qui connaissent des rois des Catacombes, qui sont leur ami, qui se font leur champion, et qui, à ce propos, racontent des histoires de revenants !
M. Eustache Grimm aimait assez, après dîner, un peu de musique, le bruit charmeur des violons, un bout de spectacle aimable, quelque récitation, quelque chose enfin qui aidât tranquillement l’acte de digestion, mais en revanche, il ne goûtait guère qu’on lui fît peur soit avec des vers de tragédie clamés par quelque échappé du Conservatoire, soit avec des contes poussés à la manière noire qui n’ont d’autre but que de mettre en vedette ceux qui les rapportent, en faisant frissonner ceux qui les écoutent… Or, Teramo leur avait, au dessert, raconté une histoire… mais une histoire…
– Ah ! çà ! s’exclama Grimm, ah ! çà ! mon ami, qui vous a dit que j’étais invité à déjeuner en ville ?…
– Mais le domestique qui est là, dans l’antichambre.
– Quel domestique ?
– Le domestique du comte de Teramo-Girgenti.
Grimm toussa, se remua… et, difficilement, se leva…
– Répondez au domestique du comte, fit-il, que je suis souffrant ce matin et que je prie le comte de bien vouloir m’excuser…
Lambert sortit. Au bout de quelques instants, Grimm le sonna.
– Eh bien ? demanda-t-il.
– Eh bien, le domestique est parti !
– Sans rien dire ?…
– Sans rien dire.
– Ah ! fit Grimm, rassuré… Et Lepage ? Est-il arrivé, Lepage ?
– Non, monsieur le directeur, non, M. Lepage n’est pas arrivé. Il n’est pas venu à son bureau ce matin…
– Et il n’a rien fait dire ?
– Rien !…
– Il est peut-être malade, fit remarquer Grimm.
– Je ne pense pas, répondit Lambert.
– Pourquoi ne le pensez-vous pas ?
– Parce que s’il était malade, il l’aurait fait dire.
– Alors ?…
– Alors, il est peut-être mort !…
Eustache Grimm, qui n’avait rien tant à redouter qu’un événement qui permît à un nouveau venu de mettre présentement le nez dans les écritures de Lepage, eut un sursaut.
– Taisez-vous ! Lambert, vous êtes stupide…
– Oui, monsieur le directeur.
Et il sortit.
Le lendemain, à la même heure, Lambert rentrait dans le bureau d’Eustache Grimm.
– Monsieur le directeur, faisait-il, c’est encore le domestique.
– Quel domestique ?…
– Le domestique du comte de Teramo-Girgenti.
– Qu’est-ce qu’il veut ?
– Il vient vous chercher pour déjeuner.
Eustache Grimm gronda, jura, bougonna, finit par faire répondre qu’il était encore souffrant.
Mais le surlendemain le domestique revint encore en disant que le comte attendait ce jour-là sans faute M. le directeur de l’Assistance publique pour déjeuner, car il avait les choses les plus importantes à lui dire, relativement à la disparition de l’un de ses employés, un nommé Lepage, et qu’à ce propos il était prêt à lui rendre le plus signalé service.
– Il faut y aller, monsieur le directeur, osa dire l’huissier Lambert, qui prenait souvent des libertés avec son maître. Si vous n’y allez pas, j’irai… Il faut avoir des nouvelles de ce pauvre Lepage, qui n’a pas reparu chez lui depuis quatre jours.
– Eh bien ! fit avec une résolution soudaine Eustache Grimm, viens avec moi ! Tu ne me quitteras que devant la porte du comte et tu ne t’en iras que lorsque je sortirai de chez lui… Comme tu dis, il faut que nous ayons des nouvelles de Lepage… Il n’ajouta pas : « Et puis, j’ai reçu un mot de Sinnamari qui m’ordonne de céder au désir du comte pour savoir ce qu’il me veut ! »
– Va chercher une voiture ! fit-il d’une grosse voix déterminée.
– Inutile, monsieur le directeur… la voiture du comte est là qui nous attend…
Deux minutes plus tard, le directeur de l’Assistance publique et son huissier Lambert, l’un à l’intérieur, l’autre à côté du cocher, prenaient place dans la voiture de Teramo-Girgenti.
Mais contrairement à ce que pensait le directeur de l’A. P., l’équipage ne prit point la direction des Champs-Élysées.
Au coin de la rue de Rivoli, il entra dans la rue des Halles, et se dirigea à grande allure vers la rue Montmartre.
– Bah ! pensa Eustache Grimm. Il est probable que nous déjeunons au cabaret. J’aime mieux ça !… Tout de même, qu’est-ce qu’il peut avoir à me dire sur Lepage ? Ce comte m’épouvante, et si Sinnamari lui-même ne nous avait pas rassurés, Régine et moi, en nous disant qu’il ne peut rien contre nous…
La voiture traversait les grands boulevards sans s’arrêter et se dirigea droit vers le carrefour de la rue de Châteaudun.
– Est-ce que nous déjeunerions à Montmartre ? En voilà une idée ! gémit Eustache Grimm. On ne sait pas manger sur la Butte…
On était maintenant sur les boulevards extérieurs.
– Que je suis bête, s’exclama l’important fonctionnaire, nous allons avenue de Clichy.
Bientôt, la disparition de Lepage d’une part, et, d’autre part, l’histoire du roi des Catacombes racontée d’une façon si dramatique par son ami le comte de Teramo-Girgenti, cédèrent la place dans les préoccupations d’Eustache Grimm à l’unique inquiétude de savoir où il allait déjeuner, car on avait dépassé la place Clichy et, si on avait bien pris ensuite l’avenue de Clichy, on avait dépassé les restaurants connus. Il n’y a plus de restaurants, se disait-il dans ces quartiers-là… De nouveau inquiet sur la sorte de cuisine qui lui était réservée, il voulut interroger le cocher, mais il avait beau souffler dans le tuyau acoustique, le cocher ne répondait pas… la voiture ne s’arrêtait pas…
– Heureusement, fit-il, que j’ai emmené avec moi ce brave Lambert. En voilà une bonne idée ! Car enfin, où allons-nous ?
Et il souffla encore. Et il frappa contre les vitres, et il essaya d’ouvrir les portières sans y parvenir. L’équipage avait pris à droite. On faisait le tour de la Butte. On gravissait la Butte, par derrière…
– Oh ! oh ! gémit Grimm, le cœur serré tout à coup d’une inexprimable angoisse. Que veut dire tout ceci ?…
Et comme on approchait de cette partie de la Butte où se dressait alors l’auberge du Bagne, il advint que les préoccupations gastronomiques d’Eustache Grimm disparurent tout à fait pour céder à leur tour la place au souvenir de cette histoire du roi des Catacombes racontée d’une façon si dramatique par le comte de Teramo-Girgenti…
Sans doute Eustache Grimm songeait-il à cette petite maison de Montmartre où il s’était passé tant de curieuses aventures… Et il en était tout remué. Soudain la voiture stoppa… L’huissier Lambert sauta de son siège et ouvrit la portière, opération que Grimm avait inutilement tentée…
– Nous sommes arrivés, monsieur le directeur, dit Lambert avec un bon sourire…
Grimm descendit. Il faillit s’affaler, épouvanté, en reconnaissant la petite rue des Saules !…
XIV – UNE LECTURE CONSOLANTE
Dans le même moment, la porte du jardin de la petite maison de la rue des Saules s’ouvrait, et un maître d’hôtel d’une correction absolue saluait très bas Eustache Grimm, que ce brave Lambert soutenait pour qu’il ne tombât point, tant il paraissait en proie à la plus violente émotion. Si faible, du reste, paraissait Eustache Grimm que le maître d’hôtel n’hésita pas à venir en aide à l’huissier qui allait succomber sous le poids du directeur de l’Assistance publique. Ainsi, soutenu de droite et de gauche, Eustache Grimm fut conduit, traîné, presque porté jusque dans le jardin. La porte s’était refermée derrière lui.
– Remettez-vous, monsieur le directeur, disait d’une voix sympathique l’huissier Lambert…
Et, tourné vers le maître d’hôtel, il ajouta :
– L’heure du déjeuner de M. le directeur est passée, et il n’est point surprenant qu’il en éprouve quelque incommodité !
– Le déjeuner de M. le directeur est servi ! répliqua le maître d’hôtel. Si M. le directeur veut bien me suivre !…
Mais quoi ! Ces paroles merveilleuses, qui eussent, en toute autre circonstance, donné des jambes à M. le directeur, dans l’instant qu’il lui en manquait le plus, parurent ne point produire d’effet appréciable.
Eustache Grimm laissait tomber un regard éteint sur les lieux où il venait, sans qu’il s’y attendît, de pénétrer de si étrange façon. Il regardait le jardin, les allées, et, en face de lui, la petite maison où l’on accédait par un perron sur le haut duquel un chef cuisinier, dans les atours immaculés de ses importantes fonctions, attendait…
Un gémissement informe sortit de la bouche entrouverte du malheureux.
– Qu’est-ce que dit monsieur le directeur ? demanda le maître d’hôtel avec intérêt.
– Que dites-vous ? interrogea Lambert, anxieusement penché sur son maître, qui s’appuyait, pour ne point tomber, contre le mur.
– Allons-nous-en ! murmura Eustache Grimm en secouant la tête désespérément.
Lambert s’écria :
– M. le directeur dit qu’il a faim !…
Le maître d’hôtel fit un signe au chef, qui accourut, et tous trois, réunissant leurs efforts, parvinrent à pousser Eustache Grimm jusqu’aux marches du perron, qu’il dut gravir, bon gré, mal gré.
De là, on voulut le diriger sur la salle à manger. Mais Eustache Grimm se cramponna :
– Pas par là !… Pas par là !
Il dut cependant obéir à plus fort que lui. Quand il revit la salle à manger, il fit :
– Oh ! Mon Dieu !…
Et ce n’était point un cri d’allégresse, bien que jamais salle à manger ne se fût présentée avec plus d’avantage aux yeux d’un gourmand-gourmet que cette salle à manger-là. La table était royalement servie pour un appétit gigantesque.
Le maître d’hôtel prit la parole.
– M. le comte, fit-il, m’a chargé de l’excuser auprès de monsieur le directeur. Une affaire inattendue de la plus haute importance le force de renoncer au plaisir de déjeuner avec monsieur le directeur ; mais j’ai reçu mission de veiller à ce que monsieur le directeur ne manque de rien, et j’ose espérer que monsieur le directeur sera content…
– Où est Lambert ? demanda en tremblant l’agonisant Eustache Grimm.
– M. Lambert mange à la cuisine… Faut-il l’appeler ?
– Dites-lui que nous allons partir tout de suite… Du moment que le comte n’est pas là, expliqua d’une voix mourante le directeur de l’A. P., je n’ai pas faim…
Ce fut en vain que le maître d’hôtel lui énuméra tous les mets succulents qui avaient été préparés à son intention.
Non ! Décidément il n’avait pas faim ; ni faim, ni soif… Il n’avait qu’un seul désir, celui de s’en aller… Et il redemanda Lambert.
– Monsieur le directeur a tort de mépriser notre cuisine, fit d’un air pincé le maître d’hôtel… Que Monsieur le directeur se rappelle bien ce que je vais lui dire : Monsieur le directeur n’aura plus souvent l’occasion de manger de la cuisine comme celle-là !
Mais Eustache Grimm redemanda Lambert.
– Comme monsieur le directeur voudra !
Lambert apparut. Eustache Grimm prit son bras, fermant autant que possible les yeux, non point comme on eût pu le penser pour ne plus apercevoir toutes ces extraordinaires victuailles qu’il quittait, sans y avoir touché… mais pour ne pas se souvenir… Oui, il lui semblait qu’en fermant les yeux il ne verrait plus cet endroit, où d’aussi horribles choses s’étaient passées, au temps de leur jeunesse… et que, ne le voyant pas, il ne se souviendrait plus ! Hélas ! hélas !… Il voyait encore dans la nuit de ses paupières closes.
– Fuyons ! murmurait-il. Fuyons !…
Maintenant, ils étaient descendus dans le jardin. Lambert le faisait à nouveau traverser à Eustache Grimm. Mais pourquoi ne le dirigeait-il point vers cette petite porte par laquelle ils étaient entrés ? Grimm ne s’aperçut même pas qu’il ne suivait plus le même sentier que tout à l’heure. Il se trouva soudain devant une sorte de masure aux murs de terre épaisse qui servait autrefois de débarras au jardinier. Lambert le poussa dans cette masure et referma la porte derrière eux, une lourde porte de chêne qui ne laissait passer la lumière que par un petit judas grillagé. Il n’y avait pas de fenêtre à cette masure. Le rai de lumière qui passait à travers le judas tombait sur une table de bois grossier et éclairait d’une façon fantastique, avec un relief à la Rembrandt, les quelques objets qui s’y trouvaient. C’étaient un livre, un carnet de chèques, un morceau de pain de ménage et une cruche d’eau.
Eustache Grimm avait ouvert les yeux, sur ce décor de cauchemar… Qu’était-ce que cela ?… Une prison ?… Et si c’était une prison… qu’y faisait-il ?… Il appela d’une voix déchirante, cette fois, car la peur, l’horrible peur, le talonnait et le mordait aux mollets… Il voulait fuir… fuir…
– Lambert !… Lambert !…
– Monsieur, fit Lambert, il ne faut pas crier comme ça, ou il va nous arriver des choses désagréables…
Lambert était près de lui, Lambert lui répondait. Et Grimm reprit :
– Allons-nous en !… Allons-nous en… Mon bon Lambert !
– Monsieur, répliqua Lambert, qui était aussi calme que son maître paraissait affolé… il faut être raisonnable !…
– Raisonnable… Lambert ! Qu’entendez-vous par « raisonnable », mon ami ?
– J’entends qu’il faut nous asseoir, ne point crier, ce qui ne servirait de rien, et essayer de passer le temps aussi agréablement que possible.
– Hein ?
Et Eustache Grimm, renonçant à discuter avec un homme qui semblait avoir perdu le sens commun, roula vers la porte de chêne au judas grillagé et la secoua avec une force que ses derniers accès de faiblesse n’eussent point laissé soupçonner…
– Là, que vous disais-je, monsieur ! fit Lambert sur un ton de triomphe personnel qui mit le comble à l’inquiétude de M. le directeur…
– Quoi ? glapit Eustache Grimm, en claquant des dents… Est-ce que je serais enfermé ?…
– Dites que nous sommes enfermés ! Et vous approcherez de la vérité.
– Et pourquoi serions-nous enfermés ?… implora d’une voix expirante le malheureux directeur.
– J’allais vous le demander…
– C’est un traquenard, c’est une trahison… On veut me tuer !… On veut… Au secours !… Au secours !…
Soudain, Eustache Grimm se tut. Il venait de sentir sur son front le froid d’un canon de revolver. Le bon Lambert lui disait :
– Si vous appelez encore une fois au secours, monsieur le directeur, je serai dans l’obligation de vous tuer !…
Grimm se laissa tomber sur un escabeau.
– Vous ne feriez pas cela, Lambert… Pourquoi voudriez-vous me tuer, Lambert ?…
– Parce que je suis là pour cela !…
– Vous êtes là pour me tuer ?
– Pour vous tuer, si vous criez !…
– Et si je ne crie pas ?…
– Si vous ne criez pas, alors je suis là pour vous faire la lecture…
Ce disant, le bon Lambert alla pousser un petit loquet de bois qui ferma complètement le jour du judas, alluma une chandelle qu’il trouva dans un coin, apporta la chandelle sur la table, entre le livre, le carnet de chèques, la cruche à eau et le morceau de pain ; puis il s’assit et ouvrit le livre… Eustache Grimm le regardait, ne comprenant rien à son manège, et se demandait s’il rêvait… Une hypothèse effroyable cependant commençait à lui apparaître au fond, tout au fond de sa conscience épouvantée, c’est que l’heure de la vengeance et de l’expiation pouvait bien avoir sonné pour les crimes d’autrefois… Et que Lambert, l’huissier Lambert, ce bon Lambert, semblait être l’un des principaux instruments de cette vengeance et de cette expiation.
– Voulez-vous, monsieur, que je vous lise quelque chose d’amusant ? Et qui nous fera passer quelques minutes agréables dans cette solitude ?… Nous avons justement là les aventures du comte de Monte-Cristo, je ne les connais pas et j’en ai souvent entendu parler ; ce me sera une véritable joie que de vous les lire ; seulement, permettez-moi une petite faiblesse… Je suis fort curieux de ma nature, et quand je lis un roman je commence toujours par la fin, sans quoi, je n’aurais pas le courage d’en attendre le dénouement.
Sur quoi, Lambert ouvrit le volume dans ses dernières pages, commença de lire à l’instant où le baron Danglars, qui était un banquier dont Monte-Cristo avait à se venger, se trouve enfermé dans une caverne de bandits, aux environs de Rome. Le baron Danglars était gardé par un sieur Peppino, comme dans la minute même Eustache Grimm était gardé par ce bon Lambert ; tout cela ne manquait point d’une certaine analogie avec la situation présente et fit dresser l’oreille à Eustache Grimm.
Lambert lisait :
« Votre Excellence veut-elle manger ? demanda le bandit Peppino au banquier Danglars. – À l’instant même si c’est possible, répondit celui-ci, qui avait grand-faim. – Rien de plus aisé, dit Peppino. Ici l’on se procure tout ce que l’on désire, en payant bien entendu, comme cela se fait chez tous les honnêtes chrétiens. – Cela va sans dire ! s’écria Danglars, quoiqu’en vérité les gens qui vous arrêtent et qui vous emprisonnent devraient au moins nourrir leurs prisonniers ! Mais Peppino répondit que ce n’était pas l’usage. Sur quoi, le baron demanda qu’on lui servît un poulet. Le poulet fut apporté sur un plat d’argent. – On se croirait à la Maison Dorée, murmura Danglars, et il se mit en devoir de découper la volaille. – Pardon, Excellence, dit Peppino, ici on paie avant de manger ; on pourrait n’être pas content en sortant. Danglars jeta un louis à Peppino qui le ramassa. – C’est un louis d’acompte, fit-il. – Quand je disais qu’ils m’écorcheraient, murmura Danglars ; voyons combien vous redoit-on pour cette volaille étique ? – Votre Excellence a donné un louis d’acompte, ce n’est plus que quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf louis que Votre Excellence me redoit. Danglars ouvrit des yeux énormes croyant à une plaisanterie ; comment, cent mille francs un poulet ! – Excellence, c’est incroyable comme on a de la peine à élever la volaille, dans ces maudites grottes ! »
– Assez !… Assez !… Ferme ce livre ! Ferme ce livre ! s’écria Eustache Grimm, soudain transporté de rage, j’ai compris !… J’ai compris pourquoi on m’a enfermé ici… pourquoi cette cruche et ce pain sont sur cette table !… Pourquoi ce carnet de chèques… pourquoi ce maudit maître d’hôtel me disait tout à l’heure que l’occasion ne se retrouverait plus pour moi d’apprécier à si bon compte sa cuisine !… Tais-toi, Lambert !… Tu es un misérable !… Vous êtes tous des bandits !… Vous avez résolu de me ruiner ! Mais je résisterai ! Je ne mangerai que du pain, je ne boirai que de l’eau !…
– C’est comme M. le directeur voudra, répondit Lambert avec humilité… Du reste, depuis M. Alexandre Dumas père, le pain a augmenté, et un pain de deux livres coûte aussi cher que…
– Aussi cher que quoi ?… interrogea, haletant, le prisonnier…
– Aussi cher que le poulet de M. Danglars !…
L’idée qu’il lui faudrait payer un pain de deux livres cent mille francs fit dresser les cheveux sur la tête de M. le directeur…
– Dans huit jours, gémit-il en retombant sur son escabeau, je serai ruiné…
– Mettons-en quinze, rectifia Lambert, qui semblait déjà avoir fait ses calculs…
– Et après ?
– Après, monsieur le directeur… eh bien ! Mais après… je n’entrevois guère pour vous d’autre solution que celle de mourir de faim !…
XV – PLAISIR D’AMOUR NE DURE QU’UN INSTANT
Quarante-quatre jours – jour pour jour – après la terrible menace, disons plutôt la condamnation à mort prononcée par le Roi des Catacombes contre Sinnamari, celui-ci se trouvait fort bien portant du reste, et, semblait-il, à l’abri des coups de son ennemi, dans cette petite maison de la rue des Saules qui a joué un rôle si important dans cette histoire.
Comme nous l’avons expliqué dans un précédent chapitre, Sinnamari, jugeant qu’on ne pouvait rien contre lui dans l’affaire Carel, qu’autant que l’on parviendrait à retrouver le cadavre qui avait échappé jusqu’alors aux recherches mêmes du fils de ses victimes, avait résolu de veiller lui-même sur cette pièce à conviction macabre. Et il avait été justement aidé dans ce dessein par la fantaisie de sa belle maîtresse, qui s’était, malgré qu’il s’en défendît et par des procédés que, seul, un amant épris peut pardonner, rendue propriétaire du logis abandonné de Montmartre. « C’est là, disait-elle, qu’elle voulait être aimée ! » et il avait d’autant mieux cédé à son désir qu’il ne pouvait être mieux que là pour déjouer les projets de R. C.
R. C. avait ouvertement offert au procureur une trêve de quarante-quatre jours, et Sinnamari savait par sa police que, en quittant le Palais de Justice, son étrange visiteur s’était rendu, en compagnie d’une jeune fille et d’un vieillard qu’il avait tout lieu de croire être le père Desjardies lui-même, à la gare de Lyon, et que là, tous trois avaient pris des billets pour Bordeaux. Il les avait fait rechercher à Bordeaux, mais on n’avait pu retrouver leurs traces. Chacun sait que la police officielle est aussi mal faite que possible. Sinnamari s’était dit que R. C. avait songé tout d’abord à mettre en lieu sûr Mlle Desjardies et son père, en quoi il ne se trompait point, et que, cette besogne relativement facile accomplie, il reviendrait à Paris livrer le suprême combat au procureur impérial.
Celui-ci avait fait tout de suite surveiller discrètement la petite maison de la rue des Saules par des agents qui étaient du reste, sans qu’il s’en doutât, à la solde du roi des Catacombes et qui se gardèrent de lui signaler l’arrivée d’un équipage d’où était descendu, quelques jours après le souper chez Teramo, son ami Eustache Grimm.
Eustache Grimm avait disparu depuis, n’ayant donné d’autre signe de vie qu’une lettre dans laquelle il priait son ami Sinnamari de ne point s’inquiéter de son absence, l’avertissant qu’il faisait un petit voyage à l’étranger pour se remettre des émotions que lui avait causé la soirée de Teramo-Girgenti ! Il ajoutait que, bien qu’il eût été prié par Sinnamari lui-même, il n’avait point jugé bon d’accepter l’invitation à déjeuner du comte et qu’il serait heureux de voir Sinnamari se méfier autant que lui de ce comte qui paraissait être un dangereux compère du roi des Catacombes, s’il n’était le roi des Catacombes lui-même !
Cette dernière hypothèse semblait du reste, aux yeux avertis de Sinnamari, corroborée par la soudaine disparition du comte. Car en vérité, depuis l’éclat de cette fameuse fête, tout le monde disparaissait. Il n’y avait que Sinnamari qui fût resté à Paris, à peu près visible pour tout le monde, et confiant toujours dans sa force. Régine, lui aussi, avait disparu. Il est vrai que les petites filles, les jumelles qui, un moment, avaient, elles aussi, disparu, étaient réapparues dans les conditions annoncées à Régine par Teramo-Girgenti… mais elles avaient disparu à nouveau avec Régine lui-même et sa femme… Tout ce monde s’était enfui sans qu’on en pût dire exactement la cause, pour des pays inconnus ou pour des drames que l’on ignorait…
Sinnamari avait donc demandé et obtenu un congé. Il ne vint rue des Saules que lorsque sa maîtresse le lui permit, c’est-à-dire quarante-huit heures environ après que ce pauvre Eustache Grimm eût été mis au pain et à l’eau dans la masure du fond du jardin où il était surveillé nuit et jour par cet excellent M. Lambert, et d’où il n’eût pu s’échapper, cette masure n’ayant d’autre ouverture que la porte en travers de laquelle M. Lambert couchait.
Liliane semblait avoir pris plaisir à meubler les vieilles pièces de la petite maison de la rue des Saules, à rajeunir avec quelques tentures à la mode et quelques meubles modernes ce pavillon dont les papiers et décorations tombaient en loques sous la moisissure et la dégradation des années, et l’abandon des hommes.
Sinnamari, dans le nid d’amour de la rue des Saules, perdit tout à fait la faculté de raisonner. Sa raison avait pris un congé, et il ne connaissait plus que la douleur et le tourment d’aimer. Qui eût pu venir le troubler dans l’exercice normal de sa passion ? Est-ce qu’il n’était point descendu, un soir qu’on le croyait endormi et que nul n’avait pu le voir, dans le sinistre caveau par l’escalier secret ? Est-ce qu’il n’avait pas constaté lui-même que toutes choses étaient restées en l’état ? Toutes choses qui cachaient le cadavre !… car pour les autres choses, comme cette terre par exemple, ce sol remué, bouleversé, creusé par endroits à une profondeur étonnante, elles présentaient un spectacle nouveau pour lui, mais qui ne l’épouvantait guère, car tout ce travail était la preuve de l’inutilité des recherches de l’homme qui avait osé une nuit descendre ici, derrière lui !…
Enfin, ne se contentant point de sa police ordinaire, il avait chargé Dixmer d’organiser autour de sa personne une surveillance parfaite de tous les instants. Quand Sinnamari se transporta rue des Saules, Dixmer qui, pour avoir appartenu à la bande du roi des Catacombes, avait appris à se méfier de tout et de tous, ne montra aucune confiance dans les agents de la Sûreté qui surveillaient, du haut de la terrasse de l’Auberge du Bagne, la petite maison et son jardin. Il les congédia et amena la nouvelle garde.
En vérité, il eût été impossible d’approcher du procureur. Si bien gardé à l’extérieur, et le cadavre en place à l’intérieur, Sinnamari pouvait être tranquille. Il l’était. Il goûtait, avons-nous dit, la douceur et le tourment d’aimer ; car, si Liliane était pleine d’amabilité pendant le jour, elle avait souvent la migraine quand tombait le soir. Ah ! cette Liliane !… Quelquefois, il lui paraissait qu’il aimait une morte.
Ainsi arriva-t-il au quarante-quatrième jour, date fixée pour sa mort. Il se réveilla plutôt gai.
– Tu ne sais pas, Liliane, dit-il à sa maîtresse qui ouvrait les yeux, tu ne sais pas que c’est aujourd’hui que je dois mourir ! C’est malheureux, car il fait beau temps.
Liliane se réveillait également ce jour-là avec une humeur charmante. Elle embrassa tendrement son amant et lui reprocha de gâter sa joie de vivre par des propos aussi stupides. Sinnamari affirma qu’il ne plaisantait point et qu’il avait été bel et bien condamné à mort.
– Par qui ? demanda-t-elle en souriant.
– Mais par le roi Mystère !
– Par l’ami du comte ! s’écria-t-elle joyeusement. Crois-tu, que ce cher comte nous en a raconté une histoire !
– Avoue qu’elle t’a impressionnée, puisque tu t’en es trouvée mal !
– Dame ! après un aussi excellent dîner, on n’a pas idée de vous offrir un dessert pareil… Il n’est pas Parisien pour un sou, ce cher comte !… Mais dis-moi, Sinna… ça n’a jamais existé, n’est-ce pas ?
– Qu’est-ce qui n’a jamais existé ?
– Eh bien ! mais toute cette affaire de crime, de viol, d’assassinat…
– Le roi des Catacombes existe, répliqua en riant Sinnamari, puisqu’il m’a condamné à mort !…
– Encore ! Tu es bête !
– Je t’aime !
– Moi aussi !
– Tu me dis ça, c’est pour que je te mette sur mon testament. J’ai envie de faire venir Me Mortimard…
– Inutile ! fit sur un ton si étrangement sérieux la belle Liliane, que Sinna, en un autre moment, s’en fût inquiété… Inutile, je ne veux plus rien de toi que toi-même…
La matinée se passa le plus gaiement du monde, le déjeuner aussi…
Il faisait si beau et le soleil se montrait si chaud que Sinnamari proposa de prendre le café au jardin.
Liliane battit des mains comme un enfant à cette idée. Les domestiques descendirent un guéridon et des chaises devant le perron et Liliane, laissant Sinnamari s’installer, partit comme une petite folle, annonçant qu’elle allait préparer le café elle-même, prétendant qu’il n’y avait qu’elle qui savait le faire comme ils l’aimaient.
– Liliane ! appela le procureur.
Celle-ci revint à cet appel, et se pencha amoureusement sur le perron.
– Ne sois pas trop longtemps, Liliane… tu sais l’heure qu’il est ?
– Non ! En voilà une idée !
– Eh bien, il est deux heures et quart, et le Roi des Catacombes a fixé mon exécution à deux heures et demie !
– C’est vrai ! s’écria-t-elle dans un rire triomphant. C’est vrai ! Tu n’as plus qu’un quart d’heure à vivre !…
– N’oublie pas le verre de rhum ! cria encore le procureur.
Mais Liliane s’était déjà envolée !… Dix minutes se passèrent. Liliane ne revenait pas. Ennuyé, Sinnamari appela le maître d’hôtel. Mais ce fut la femme de chambre qui vint.
– Où est madame ? demanda Sinna.
– Oh ! monsieur, répondit la femme de chambre, qui paraissait fort affairée, figurez-vous que tout à l’heure, madame, dans la cuisine, s’est appuyée contre le mur, à la place même où se trouvait hier encore le buffet… Le mur a bougé.
– Comment ? Le mur a bougé ? fit Sinnamari en se levant.
– Oui, monsieur, le mur a bougé ! Une porte s’est ouverte donnant sur un petit escalier tout noir… Madame a été effrayée d’abord !…
– Il y avait de quoi ! Et qu’est-ce qu’elle a fait, madame ?
– Eh bien, elle a eu le courage de descendre dans cet escalier… Nous ne voulions pas… le maître d’hôtel le lui défendait… On ne sait jamais !… Nous voulions vous prévenir, mais elle nous l’a défendu !… Seulement, monsieur, elle ne remonte pas ! Nous avons beau l’appeler, elle ne remonte pas !… Il lui est peut-être arrivé quelque chose !…
Sinnamari, très mécontent de ce malheureux hasard, qui avait fait découvrir à Liliane l’escalier secret, et ne comprenant pas, du reste, comment les choses avaient pu se passer, rentra vivement dans la maison et s’en fut à la cuisine. Les domestiques étaient penchés au-dessus de l’escalier et n’osaient pas avancer. Sinnamari appela :
– Liliane !… Liliane !…
Mais rien ne lui répondit.
– C’est bizarre, fit-il. Elle sera peut-être tombée… elle se sera évanouie…
Et il appela encore :
– Liliane !… Liliane ! Donnez-moi une lumière ! commanda-t-il.
On lui alluma une petite lanterne de jardin.
– Voulez-vous que je descende avec vous, monsieur ? demanda le maître d’hôtel.
– C’est inutile !… Restez tous ici !
Et Sinnamari entra dans le trou noir et descendit les premières marches du petit escalier.
Les domestiques le regardaient s’enfoncer dans la terre. Soudain, la muraille, devant eux, remua. Le mur, de lui-même, se refermait !… Et quand ils se ruèrent dessus, il ne bougea plus… pas plus, comme on dit, que « la pierre du tombeau ! »
Alors le maître d’hôtel de Liliane, qui ressemblait à s’y méprendre au maître d’hôtel qui avait servi son dernier dîner à ce pauvre Eustache Grimm, dit :
– Que la volonté du Maître soit faite !
En quittant Sinnamari, Liliane n’était point descendue dans le mystérieux escalier, comme l’avait raconté la femme de chambre ; elle était montée tout droit dans cette chambre que nous connaissons bien, dont l’unique fenêtre était garnie de barreaux, et qui avait servi de prison à sa mère.
Quand elle en eut poussé la porte, elle se trouva en face de son frère qui, sous les aspects du comte de Teramo-Girgenti, vint à elle et l’embrassa longuement, tendrement.
– Allons ! Le moment est venu…
Et il fit asseoir Liliane sur cette petite chaise où s’était assise leur mère quand elle rédigeait ses horribles mémoires, aux heures sinistres de son martyre et de sa folie.
– Qu’allez-vous faire, mon frère ? demanda Liliane.
– Je vais ressusciter notre mère, Liliane… répondit le comte.
Et il ajouta qu’il avait apporté dans cette chambre tout ce qu’il fallait pour cela. Alors, il prit entre ses mains le visage de Liliane, qui lui obéissait docilement, et avec les ingrédients qui se trouvaient à sa portée, il eût tôt fait de transformer ses joues fleuries, ce front jeune et charmant en une effroyable tête de morte…
Soudain Teramo-Girgenti la prit par la main et la conduisit devant une glace. Liliane poussa un tel cri d’horreur que toute la petite maison de la rue des Saules en retentit comme aux temps où l’on martyrisait la morte. Elle avait vu son propre spectre !
– Je suis morte ! s’écria-t-elle en fuyant son image.
– … Non ! ma mère… fit Teramo d’une voix tremblante, car son œuvre lui aussi l’épouvantait… tu es ressuscitée !…
Le cri de Liliane avait attiré les domestiques dans le vestibule et dans l’escalier de l’étrange petite maison… Ils n’osaient aller frapper à cette porte cependant, car ils savaient que derrière cette porte se trouvait le Maître !
Tout à coup la porte s’ouvrit et ils virent descendre un vieillard et une morte… Alors ils s’enfuirent de toutes parts… et, le chemin se trouvant libre, le vieillard et la morte arrivèrent au perron, sortirent de la petite maison, et rentrèrent de compagnie sous la petite voûte qui se trouvait sous le perron. Là, ils disparurent : la morte semblait avoir entraîné le vieillard dans la terre…
XVI – TU TE RÉVEILLERAS D’ENTRE LES MORTS
Sinnamari ne s’était point aperçu que la porte secrète se refermait derrière lui. Il descendait toujours. La lanterne l’éclairait peu. Et, prudemment, il tâtait du pied les marches de pierres. Il pensait que Liliane avait dû trébucher, que, peut-être, parvenue sur le sol du caveau, elle était tombée dans quelque excavation. Il arriva aux dernières marches de l’escalier.
Un parfait silence régnait autour de lui. Il était dans la paix suprême de la terre. Sans qu’il parvînt à en démêler la cause, une inquiétude soudaine vint l’étreindre au cœur. Il se fit violence. Il avança encore. Il quitta l’escalier. Et, tout à coup, sa lanterne s’éteignit, comme si on avait soufflé dessus. Il fut dans la nuit du caveau. Il s’arrêta, formidablement inquiet.
Subitement, la nuit s’éclaira de la flamme de torches. Il recula. Mais deux mains formidables s’abattirent sur ses épaules, et une voix laissa tomber ces mots :
– Au nom du Roi, je vous arrête !…
Vingt visages étaient penchés sur lui, éclairés fantastiquement par le flamboiement écarlate des torches, que tenaient contre les murs des géants immobiles… D’où venaient ces gens ? Par quel sortilège trouvait-il tout à coup, dans ce caveau qu’il croyait connu de lui seul, cette silencieuse assemblée ? Qui l’avait réunie ? Par quel chemin était-elle venue ? Pour quoi faire ? Pour le juger, sans doute, puisqu’on venait de l’arrêter au nom du Roi ! Non, non, ce n’était pas possible ! Eux, des juges ! Allons donc !… Il les reconnaissait bien. Ce n’étaient point là figures de magistrats qu’il avait accoutumé de croiser tous les jours dans les couloirs et dans les chambres du Palais, mais des figures amies, des gens qui se disaient fort honorés de lui serrer la main, quand, par hasard, il daignait les distinguer dans la cohue de la vie parisienne : figures de sportsmen, de clubmen, de gentlemen, figures du Tout-Paris de toutes les premières et qui avaient été rassemblées, sans doute, bon gré, mal gré, au fond de ce trou, pour y assister à quelque sinistre « farce », inventée par ce pince-sans-rire de Teramo-Girgenti ou par R. C. lui-même…
Une farce ?… Une plaisanterie ?… Dans la petite maison de la rue des Saules ?… Dans cette cave-tombeau ?… R. C… mais, malheureux, c’est Robert Carel ! C’est son fils à elle !… Et il t’a condamné à mort !… R. C. va tenir sa parole, Sinnamari !…
Le terrible procureur commença de frissonner terriblement… Alors, ils étaient venus là, en spectateurs de sa mort !… Car, maintenant, il n’en doutait plus ! Il allait mourir !… Il allait mourir !… Il entendait encore la voix de R. C. ! « Dans quarante-quatre jours, jour pour jour, heure pour heure !… »
Sinnamari voulut secouer l’étreinte de ses deux geôliers… Mais son effort fut vain… Il sentit ses cheveux se dresser sur sa tête… Il avait peur… peur !… Sinnamari avait peur !…
Ses yeux épouvantés faisaient le tour des choses… ne reconnaissaient plus l’ancien caveau, transformé en une véritable chambre mortuaire… Des draps noirs, des draperies noires où pleuraient des larmes d’argent, tout l’ornement des exécutions de première classe, en honneur au dernier acte des aventures romantiques, formaient un cadre sinistre au drame qui allait se dérouler là et dont il était le principal acteur… celui qui allait mourir.
Tout autour de ce caveau en deuil, il y avait une double rangée de soldats, oui de soldats, dont il n’avait encore jamais vu l’uniforme, avec des fusils, des armes dont l’acier flamboyait à la lueur des torches… Est-ce qu’on allait le fusiller ?…
Car, de quelle mort allait-il mourir ?…
Au fond du caveau, un large rideau rouge avait été tiré complètement, de bout en bout, entre les draperies noires. On eut dit qu’il y avait là, derrière, quelque théâtre en miniature, quelque tréteau… quelque chose enfin qu’on cachait, mais que, certainement, on allait montrer tout à l’heure et dont la pensée en délire de Sinnamari ne pouvait se détacher. Qu’est-ce qu’il y avait derrière le rideau rouge, le rideau rouge tiré entre les draperies noires ?
Pour la première fois, Sinnamari avait peur.
Et cette sensation inconnue lui ôtait toute faculté autre que celle d’avoir peur… d’avoir peur de mourir…
En vérité, en vérité, il n’y avait là que des amis. Il reconnaissait les principaux invités de la soirée Teramo-Girgenti.
Ainsi, ils avaient voulu assister à ses derniers moments… Des gens qui le craignaient, qui travaillaient avec lui, dont il faisait tous les jours la fortune, qu’il avait accablés de faveurs !… Jusqu’à Mme Demouzin qui avait tenu à être de cette petite partie, ma parole !… Jusqu’à Philibert Wat qui se tenait, muet et immobile, telle une statue de la terreur, dans ce coin… Tout à coup, une voix sourde et lugubre annonça :
– Monsieur le procureur général !
… Bien vivant le procureur général ! Et derrière lui, bien vivant, le comte de Teramo-Girgenti !
Le procureur général !…
Il semblait tout étonné, le grave et honnête magistrat, de se trouver dans un lieu pareil, au milieu de tant de gens qui paraissaient du reste aussi inquiets que lui. Comment était-il venu là ? Quelle curiosité le comte avait-il excité chez ce juge austère ? Quelle visite « à l’envers de Paris » avait-il promise ? Le procureur général avait cru certainement faire une promenade ordinaire au fond des Catacombes… Oh ! la chose avait dû être admirablement préparée, et ce souterrain, que les yeux de Sinnamari venaient d’apercevoir, aboutissant à sa cave, n’avait pas été creusé en un jour.
Non… il avait fallu quarante jours pour le creuser. Les quarante-quatre jours de trêve que lui avait si insolemment accordés le roi des Catacombes…
Le procureur général n’avait pas vu Sinnamari resté entre ses deux gardes tout au fond du caveau, appuyé contre le mur… presque dans l’ombre de l’escalier !… Le haut magistrat regardait cette salle étrange, ces soldats bizarrement accoutrés, ces personnages muets et effrayés, ces porteurs de torches, et ce rideau rouge !
– Monsieur le procureur général, expliqua Teramo-Girgenti d’une voix fort naturelle et dénuée de toute emphase, monsieur le procureur général, peut-être seriez-vous moins étonné de vous trouver tout à coup transporté dans un décor si vous m’aviez fait l’honneur, il y a quarante-quatre jours, d’assister à la petite fête qui a inauguré mon hôtel.
» Sans quoi, continua Teramo-Girgenti, vous n’ignoreriez pas que j’ai promis de ressusciter une morte !…
– Ah ! très bien ! très bien ! reprit le procureur général sur un ton doucement ironique… Nous allons donc assister à une séance de magie !… La chose me sera d’autant plus agréable que je ne m’y attendais pas. C’est parfait !… Votre ressuscitée va être tout à fait contente !… Pour les morts comme pour les vivants, vous faites bien les choses, monsieur de Teramo-Girgenti !…
Et le procureur général, très franchement, rit… et puis brusquement il cessa de rire parce que personne, contrairement à son attente, ne riait avec lui.
Si bien que ce rire solitaire l’étonna lui-même et qu’il en fut tout impressionné ! Il regarda les visages les plus proches, mais ceux-ci se détournèrent de lui, funèbres et mystérieux. Car eux tous qui se rappelaient l’histoire de Teramo et qui avaient vu apparaître Sinnamari, tous sentaient qu’ils allaient assister à de l’horreur et à de l’épouvante !…
Quant à Sinnamari, ses yeux, quittant peu à peu le rideau rouge et se tournant vers l’autre extrémité du caveau, venait de découvrir que la tenture noire qui couvrait, à cet endroit, le mur, avait été soulevée, et que, devant la pierre mise ainsi à nu, un groupe de trois terrassiers, immobiles, appuyés au manche de leurs pioches, attendaient…
Les terrassiers ne se tenaient donc point là, dans ce coin-là, justement, justement dans ce coin-là de pierre nue, laissée à découvert par la tenture préalablement relevée, ne se tenaient point là, dis-je, à cause du travail qu’ils avaient fait, mais à cause du travail qu’ils avaient à faire… Quel travail ? Sans doute, Sinnamari en eut-il la vision bien nette, et cette vision suffit-elle à lui enlever ce qui lui restait de force, car comme il avait ouvert la bouche pour crier, il la referma sans qu’elle eût laissé échapper aucun son. Et ses yeux se fermèrent aussi pour ne plus voir les terrassiers !…
Tout de même, on entendit une sorte de glapissement, un petit rire aigre et qui parut singulièrement démoniaque en ce lieu, d’autant qu’on ne pouvait se rendre compte d’où il venait. Raoul Gosselin, qui se trouvait là et qui tenait, toute serrée contre lui la tremblante Marcelle Férand, finit par découvrir tout en haut d’un pilier, accroupi sur une petite planchette scellée dans la brique, la figure énigmatique, terrible, ridicule, de M. Macallan. Il le montra du doigt à son amie, qui en fut encore plus épouvantée.
Le comte de Teramo-Girgenti, entraînant le procureur général à travers l’assistance qui les laissait passer avec effroi, s’en était allé vers le coin devant lequel se tenaient les trois ouvriers terrassiers. Il montra la pierre et dit – :
– La morte est là !
Tout l’effort du procureur général consistait à ne point paraître trop étonné des phénomènes surnaturels qu’on lui promettait. Quand Teramo-Girgenti lui eut dit : « La morte est là », c’est donc sur le ton de la même ironie aimable et d’une curiosité polie qu’il demanda :
– Mais où donc sommes-nous, cher monsieur… dans un cimetière ?
– Non, répliqua froidement le comte, dans un tombeau !… un tombeau connu seulement du propriétaire de cette maison et de moi !… Monsieur le procureur général, ceci est la cave d’un petit pavillon perdu sur les hauteurs de Montmartre, dans lequel il y a plus de vingt ans, un homme tortura si bien une femme, que celle-ci qu’il tenait prisonnière, mourut de mort violente, à l’issue d’une scène d’orgie, en donnant prématurément le jour à un enfant.
– Quelle lugubre histoire ! fit le procureur général, beaucoup plus impressionné qu’il ne voulait le paraître… Et personne ne l’a su ?… La justice ?…
– La justice, monsieur le procureur général, l’ignora… mais un juge la connaissait…
– Et ce juge n’en a rien dit ?
– Ce juge a caché l’histoire, comme il a caché le cadavre de sa victime !… Et il a cru enterrer pour toujours l’une et l’autre de ses propres mains quand, dans cette cave, le lendemain de son forfait, il a traîné le corps de la malheureuse !…
– Et le mari ? demanda le procureur général.
– Le juge dont je vous parle avait eu la précaution d’envoyer le mari, pour un crime dont lui, juge était seul coupable, à l’échafaud !
– De qui tenez-vous cette histoire, monsieur de Teramo-Girgenti ? interrogea solennellement le procureur général.
– Du fils aîné des deux victimes : de Robert Carel lui-même !…
– Robert Carel !… murmura le procureur général. Ce nom eut, je crois, quelque retentissement jadis, dans les annales judiciaires !…
– C’était aussi le nom du père qui fut jugé par les assises de la Seine…
– Mais il me semble, monsieur, que si vous n’avez, pour étayer une pareille accusation, que le témoignage du fils, ce témoignage devrait vous paraître au moins suspect…
– Je ne vous demande point d’y ajouter foi !…
– Que me demandez-vous donc, monsieur ? Je ne vous comprends plus !…
– Le témoignage des vivants est devenu si suspect, monsieur le procureur général, que je ne vous demande qu’une chose : c’est d’écouter les morts !…
– Et qui les fera parler ?
– Moi !…
Teramo-Girgenti se tourna alors du côté des trois ouvriers et leur fit signe. Ils s’approchèrent.
– Ces hommes vont s’attaquer à cette maçonnerie. Approchez-vous, monsieur le procureur impérial, et regardez-la, examinez-la, c’est une vieille maçonnerie, à laquelle on n’a point touché depuis vingt ans.
Un premier coup de pic vint frapper le mur. En même temps, un grincement étrange, une plainte rauque se fit entendre dans un coin, des ténèbres, comme si on y étranglait quelqu’un !… C’était Sinnamari qui commençait à mourir !
Les trois ouvriers eurent vite fait de desceller pierres et briques et de faire sauter plâtres et gravats. Soudain, ils s’arrêtèrent et reculèrent, effrayés… Une niche venait d’apparaître… à la hauteur de leurs têtes, et, dans cette niche, une figure… une figure extraordinairement momifiée de femme… L’un d’eux approcha une torche et recula encore… La torche vacillait affreusement dans sa main débile… Le comte la lui prit et s’approcha à son tour du trou nouvellement pratiqué dans la muraille… La tête apparut encore dans la lueur… elle paraissait flamber dans un brasier d’enfer… Il y eut des cris d’effroi… C’était une tête fort bien conservée et qui avait dû être remarquablement belle ; les cheveux étaient tout blanc et tombaient en mèches désordonnées sur ce visage ravagé par une douleur qui y laissait encore ses traces, après vingt ans de mort !
Le procureur général se tourna vers Teramo-Girgenti, et lui demanda d’une voix qu’il essayait en vain d’affermir :
– Comment avez-vous appris, monsieur, qu’il y avait un cadavre ici ?
– Par suggestion, répondit Teramo.
– Qui avez-vous interrogé ?… Toujours les morts ?…
– Non, monsieur le procureur général, un vivant !
– Pourrais-je savoir son nom ?
– Oh ! Tout le monde vous le dira. La chose s’est passée devant tous ces messieurs chez moi. Et du reste je suis sûr qu’il vous le dira lui-même… C’est M. le procureur impérial, votre collègue, M. Sinnamari !
– Le procureur impérial ?
– Cela vous étonne ?… Évidemment, monsieur le procureur général, M. Sinnamari, à première vue, ne paraît guère suggestionnable !… C’est une forte et puissante nature qui pourrait apparaître, au profane, rebelle à tout ce qui touche à l’hypnotisme. Et, cependant, je n’ai eu qu’à prendre la main de M. Sinnamari et à lui demander : « Où est le cadavre ? » Sa main m’a répondu qu’il était ici !… Ah ! c’est une science encore bien mystérieuse que celle de l’hypnotisme… Songez donc que si la main de M. le procureur impérial avait scellé elle-même ces pierres sur ce cadavre, sa main n’en aurait pas su davantage !
Les ouvriers travaillaient maintenant avec précaution… mais bientôt toute la niche où s’allongeait le corps de la morte, qui avait été placé debout dans la maçonnerie, fut visible… Le corps était revêtu de longs voiles blancs, d’une sorte de peignoir qui l’enveloppait, encore d’un suaire, de la tête aux pieds.
À ce moment, la plainte de tout à l’heure se renouvela dans l’ombre, et puis, cette plainte, sourde d’abord, devint un cri éclatant. On entendit, toujours dans le même coin d’ombre, comme un bruit de lutte acharnée…
– Qu’est-ce que c’est ? demanda le procureur général.
– Oh ! ce n’est rien, répondit le comte, c’est M. le procureur impérial qui, fort impressionné par ce spectacle, demande sans doute à s’en aller ! Gardes, faites avancer M. le procureur impérial ! commanda la voix étonnamment vibrante de Teramo-Girgenti.
Et alors on vit…
On vit s’avancer en face de la tête de la morte la tête de Sinnamari. Toutes les manifestations de l’horreur étaient gravées en traits affreux sur cette face de damné. Ses yeux, où se lisait une épouvante sauvage, fixaient maintenant, sans pouvoir s’en détacher, les paupières closes de la morte !
Comment était-elle restée, après tant d’années de tombeau, si semblable à elle-même ? Comment l’œuvre de destruction était-elle si peu avancée qu’on eût pu croire que cette femme n’était descendue au tombeau que de la veille ! Sa gaine de ciment et de plâtre l’avait sans doute préservée de la rapide pourriture !… En vérité, elle paraissait encore si vivante dans la mort que Sinnamari, les cheveux dressés sur la tête, la repoussa d’un geste instinctif et désordonné, comme s’il l’avait déjà vue s’avancer vers lui, d’un pas d’outre-tombe !…
Derrière Sinnamari, un homme prononça alors des paroles étranges dans une langue inconnue. Et ces paroles furent accompagnées d’un geste si souverain que la morte lui obéit. Oui, à l’appel de Teramo-Girgenti, la morte elle-même répondit. Les yeux que l’on croyait clos à jamais s’ouvrirent, la bouche respira… la poitrine haleta… et la morte se mit en marche !… se mit en marche vers Sinnamari…
L’assemblée recula dans un désarroi indescriptible… Deux femmes s’évanouirent de terreur… Les hommes tremblaient comme des enfants dans les ténèbres ; le procureur général saisit le poignet de Teramo-Girgenti, mais retira aussitôt sa main, car il avait eu la sensation de toucher un bras de feu… et il raconta plus tard que Teramo, à ce moment, brûlait comme un fer rouge !
La morte sortit du mur… Sinnamari était tombé à genoux… On assista à ce spectacle plus extraordinaire encore que celui d’une morte qui se met en marche : Sinnamari, ne pouvant plus marcher, tombant à genoux. La morte le toucha. Et il crut tout de suite qu’il allait mourir !… Elle ne dit qu’un mot :
– Assassin !
Et lui ne répondit qu’un mot :
– GRÂCE !
Et ce mot, le mot de l’aveu, ayant passé comme un souffle sur la tête de tous les assistants, le caveau fut aussitôt plongé dans les ténèbres. Et chacun resta ainsi un instant, se demandant ce qui allait sortir des ténèbres. Il en sortit cette chose effrayante qui fit hurler Sinnamari… À la place de la morte, il y avait Liliane !… Sinnamari comprit de quelle illusion formidable il avait été le jouet et de quelle trahison sa maîtresse s’était rendue coupable ! C’est elle qui l’avait perdu, elle dont il se croyait aimé !…
– Comédie !… hurlait-il. Comédie !
Mais une voix couvrait déjà la sienne…
– La comédie est terminée, proclamait une voix, que la tragédie commence !
On se retourna vers celui qui avait parlé ainsi. C’était Teramo-Girgenti qui, d’un geste, venait de se débarrasser de tous les accessoires de la vieillesse. Ses cheveux blancs, sa barbe blanche tombèrent, et il apparut dans tout le rayonnement de sa fulgurante jeunesse.
– Je ne suis ni comte, ni Teramo-Girgenti, je suis le roi des Voleurs, le roi des Cavernes, le roi des Catacombes !
Et il s’avança vers Sinnamari qui recula, malgré l’effort de ses gardiens, car il crut que l’autre allait le poignarder ou lui brûler la cervelle.
– Assassin de mon père, assassin de ma mère, je t’accuse encore d’avoir fait de moi, Robert Carel, qui était né pour être un honnête homme, un bandit !…
Puis, tourné vers Liliane :
– Je t’accuse d’avoir fait de ma sœur, une prostituée ! Une prostituée qui a roulé, jusqu’au fond de ton lit, pour mieux te perdre, Sinnamari !
Dans la gorge de Sinnamari passa une sorte de grondement. Le roi des Catacombes continua :
– Et maintenant, tu vas mourir ! Il y a un prêtre ici, il y a tout ce qu’il faut ici pour mourir, Sinnamari… Mais, avant de mourir, il faut que tu saches encore ce qu’est devenue ta dernière victime, le troisième enfant de Robert Carel, qui est venu au monde la nuit, où, ici même, dans cette maison, mourait sa mère… notre mère… Sais-tu ce que tu as fait de celui-là ?… Eh bien ! regarde, regarde ce que tu as fait de mon frère !…
Et le geste du Roi des Catacombes sembla tirer lui-même le rideau rouge qui voilait tout le fond du caveau. Le rideau glissa et l’on sut ce qu’il cachait. Il cachait un échafaud ! l’antique échafaud de planches, sur lequel on voyait un lourd billot. Et près du billot, dans toute sa force au repos, immobile, debout, les mains jointes au pommeau de l’épée colossale, un homme, un géant, dont aucun masque ne dissimulait le profil d’oiseau de proie… Le Vautour !
– Tu en as fait le bourreau !
À la vue de cet échafaud dressé au milieu d’eux, tous les spectateurs de cette horrible scène eurent la sensation exacte de l’épouvantable réalité. Certains avaient pu, jusqu’alors, se demander jusqu’où irait cette inquiétante comédie ; ils le savaient maintenant, ils ne pouvaient plus en douter… elle irait jusque-là, c’est-à-dire jusqu’à l’échafaud.
La chose était tellement gigantesque, tellement folle, que le procureur général se dit une dernière fois : « Allons ! Allons ! Je rêve !… Ou l’on se rit de moi, ou j’assiste à quelque mascarade ! » Mais il n’eut qu’à regarder celui qu’on appelait le roi des Catacombes et celle que l’on appelait Liliane d’Anjou et l’homme rouge que nous appelons le Vautour, pour comprendre d’une façon définitive que ceci n’était pas un jeu. Il voulut parler, crier, protester, et, avec lui, derrière lui, autour de lui, vingt voix s’élevèrent, étranglées par l’angoisse.
– Silence à tous, commanda R. C., et que personne ne bouge ! Sous peine de mort !
Ces paroles furent accompagnées d’un mouvement des soldats qui entouraient la caverne et qui mirent tranquillement l’assistance en joue…
Ils étaient quatre maintenant à entourer Sinnamari. Celui-ci s’était levé. Il avait regardé l’échafaud, il avait regardé le bourreau… et, il se montrait maintenant aussi calme, disons le mot, aussi fort qu’il avait été tout à l’heure faible, pusillanime et lâche.
Les quatre hommes le poussèrent vers l’échafaud. Quelques marches conduisaient à la plate-forme où attendait le bourreau ; avant de les lui faire gravir, les gardiens de Sinnamari lui entravèrent les jambes, lui enlevèrent sa jaquette et son faux col. Sinnamari avait les cheveux courts, taillés en brosse, et le cou haut, bien dégagé. La dernière toilette fut donc vite faite, sans l’aide des ciseaux. Les poignets ramenés dans le dos furent solidement liés.
Pendant ces rapides préparatifs, Sinnamari, plus maître de lui que jamais, aussi paisible que s’il eût continué d’être le maître des autres, laissait faire. Il semblait penser à autre chose… Vraiment, il était beau de dédain, d’insouciance et d’insolence…
On le poussa… Il obéit… Il monta sur la plate-forme d’un pas assuré. Alors un homme que d’autres hommes maintenaient et sur la bouche duquel on essayait en vain de glisser un bâillon pour qu’il ne troublât pas de ses cris ce moment suprême, le procureur général, parvint encore à se faire entendre…
– Vous n’accomplirez pas ce crime devant moi ! criait-il… ou alors, tuez-moi comme lui !… Vous n’êtes que des assassins !… Vous n’êtes que des assass…
Le bâillon lui ferma enfin la bouche et clôtura sa folle indignation. Mais on ne pouvait mettre des bâillons à tout le monde, et la vocifération du procureur général eut au moins la vertu d’entraîner à sa suite quelques protestations. Puis l’assistance, dans un mouvement irréfléchi, se précipitait vers l’échafaud, oubliant la menace des fusils. Mais les protestataires furent rejetés les uns sur les autres, entourés d’un quadruple cordon de troupe, réduits à l’impuissance. S’écrasant les uns les autres, ils firent encore entendre une clameur désespérée où dominaient les cris hystériques des femmes.
Et puis soudain, un silence mortel régna. L’homme qui allait mourir avait fait un signe. Il demandait à parler. Le roi des Catacombes ordonna qu’on le laissât parler. Sinnamari dit :
– Tout à l’heure, quelqu’un ici même a demandé grâce ! Je ne sais pas qui, mais assurément ce ne peut être moi… Mais s’il semblait à quelqu’un d’entre vous que j’aie réellement prononcé ce mot de pardon imbécile, que celui-là se souvienne qu’avant de mourir, j’ai demandé pardon d’avoir demandé pardon !…
Sinnamari se retrouvait lui-même, avec toute sa puissance morale, à la seconde même de la mort, et il en conçut un orgueil incommensurable. Avant de s’avancer vers le billot, il regarda R. C. et, dans un geste de mépris infini, il haussa les épaules…
Le Vautour lui mit aussitôt la main sur les épaules et le courba. Sinnamari se ploya alors à genoux et allongea la tête sur le billot. Soudain, il releva un peu la tête et avec un retour de blague faubourienne qu’il affectait dans les grandes circonstances, il dit :
– Ah ! pardon ! Avant de mourir, j’aurais quelque chose à vous demander ! J’ai assez vu vos figures. Vous ne pourriez pas tirer le rideau !…
Ce fut le Vautour lui-même qui s’avança au bord de l’échafaud… Il paraissait troublé par tous ces cris et il tira le rideau. On eût dit que sa main tremblait… Le rideau était tiré… Deux, trois, quatre secondes s’écoulèrent… On entendait le bruit rauque des respirations… Et puis, il sembla que le sifflement d’une épée passait dans l’air, au-dessus de toutes les têtes qui s’inclinèrent comme si le même coup allait les frapper – et, formidable, un coup retentit dont l’échafaud tout entier résonna, derrière le rideau rouge. Et après le coup, on entendit un cri de douleur atroce et des plaintes… et des plaintes… et il y eut un autre coup… et il y eut encore des plaintes… un gémissement lamentable qui ne demandait qu’à finir.
Et on entendit encore un coup !…
Et puis l’échafaud se tut !…
Dans le caveau, c’était la folie déchaînée ; certains étaient tombés à genoux et pleuraient, d’autres riaient, comme rient les fous !… Alors, on vit l’homme rouge sortir du rideau rouge, s’avancer devant le rideau rouge et il dit :
– C’est fait !…
Et il resta devant le rideau comme s’il avait été changé en statue.
Les rangs des soldats s’écartèrent… Les invités de ce funèbre spectacle s’esquivèrent en poussant des cris insensés, par le souterrain qui s’ouvrait devant eux… En un instant, le caveau fut vide… Le roi des Catacombes lui-même le quitta, la tête basse, le front soucieux, la poitrine gonflée d’un affreux soupir.
Il ne resta dans le caveau que cet homme rouge debout, devant ce rideau tragique… et que le corps allongé sur le sol de Liliane d’Anjou évanouie…
Dix minutes plus tard, à quelques pas de la petite maison de la rue des Saules, dans ce cimetière où nous avons introduit une fois déjà le lecteur, Robert Carel se tenait debout devant un tertre qui ne portait aucun nom ; le vent glacé qui passait dans les branches des cyprès eût pu seul l’entendre murmurer :
– Vous qui êtes ici, vous que j’ai réunis ici dans une même tombe anonyme, mon père, ma mère… dormez en paix, vous êtes vengés !… Vos bourreaux ont été frappés selon la justice de Dieu !… L’un d’eux est devenu fou en apprenant que les deux enfants qu’il chérissait plus que sa vie étaient le fruit de l’adultère ! Le second est mort de faim ; le troisième, mon père, est mort, comme vous, sur l’échafaud ! Priez pour moi !… Ayez pitié de moi !… Adieu !…
Les yeux en pleurs, Robert Carel se retourna alors vers Paris, dont les dômes et les flèches d’or flambaient déjà sous les feux du soleil couchant.
– Adieu, Paris ! s’écria-t-il… Adieu, ville bénie, ville maudite ! La plus belle et la plus détestable des cités du monde !… Tu ne me reverras jamais. R. C. est mort !… Robert Carel est mort !… Le roi des Catacombes est mort !… L’œuvre de vengeance est morte !… Mais Robert Pascal est vivant, lui, et l’œuvre commence !…
Et par-delà l’espace, Robert Pascal, loin de Paris, loin du monde, loin des hommes, dans le coin de nature heureuse où celle qui l’aimait l’attendait, sourit à sa belle fiancée !
XVII – À LA FIN DUQUEL M. MACALLAN SE DÉCLARE DÉGOÛTÉ DE LA VIE ET LE PROUVE
À peu près dans le même moment, M. Macallan s’asseyait à la table de l’auberge du Bagne devant une fenêtre ouverte qui donnait presque en face de la porte du jardin de la petite maison de la rue des Saules. La mère Fidèle lui avait apporté son papier, sa plume et son encre, et M. Macallan écrivit à son ami d’Inverness, lord Iverdeen… C’était une longue, très longue lettre, dont nous traduisons quelques passages, comme par exemple ceux-ci :
« Ah ! mon cher ami, qu’est-ce que je vais devenir maintenant ? La vie est triste !… Je ne veux pas assurément refaire un nouveau roman-feuilleton… celui qui vient de se terminer m’a coûté trop cher. Tout compte fait, j’en suis de cent soixante quinze millions. Je vous donne ici le compte arrêté hier soir, et dans lequel n’entrent pas les frais d’exécution de Sinnamari que l’on va m’apporter tout à l’heure. »
M. Macallan poussa un soupir, regarda la porte de la petite maison de la rue des Saules et reprit le cours de sa correspondance, que nous continuons à traduire…
« J’ai dit adieu à Robert Carel. Ce garçon-là me dégoûte et je suis fort heureux de rompre d’une façon définitive avec lui !… Ah ! by jove ! Si j’avais su, je me serais peut-être mieux arrangé avec son frère le Vautour, qui aurait pu être un roi des Catacombes étonnant ; Robert, au fond, n’était qu’une mazette sentimentale… Enfin, tout de même, j’ai su en tirer quelque chose, et mon roman-feuilleton finit mieux que j’aurais pu l’espérer !…
» J’ai pu croire à un moment donné que tout allait rater par la faute de ce petit imbécile, qui était tombé amoureux !… J’avais tout prévu dans cette histoire, et selon les règles des meilleurs auteurs, de ceux qui ne quittent jamais mon chevet, sauf que R. C. deviendrait amoureux ! Le mal d’amour ! C’est mal terrible pour un bandit, qui ne doit pas avoir de cœur, qui n’a pas le droit d’avoir de cœur !…
» Malgré cela, je me suis bien amusé et je ne regrette pas la fantaisie que j’ai eue de faire vivre DANS LA VIE des héros de roman ! Ça m’a coûté plus cher qu’un yacht, mais je connais peu de milliardaires américains qui puissent se vanter d’avoir eu de pareilles sensations…
» Vous savez combien je m’ennuyais, mon ami, quand j’ai rencontré à Chicago cette pauvre Française qui faisait métier de sage-femme et qui m’a raconté cette histoire qui lui était arrivée à Paris, dans laquelle il y avait une pauvre femme enfermée, un père exécuté innocent, des enfants abandonnés, des magistrats criminels, etc., etc., et le cri de perroquet qu’elle avait entendu : « Tu es la Marguerite des Marguerites ; tu es la perle des Valois ! »
» Justement, je venais de terminer la série des romans de M. Capendu, qui commence par cet extraordinaire Hôtel de Niorres et qui se continue avec le Roi des Gabiers, le Roi du Bagne et quelques autres rois. J’avais relu trois fois le Comte de Monte-Cristo et je commençais à connaître par cœur les œuvres de M. Fortuné du Boisgobey. Vous savez, cher ami, que je ne peux pas lire les auteurs de ce temps-ci, à quelque nation qu’ils appartiennent, tant je les trouve inférieurs et d’une si mince et si pauvre imagination !
» Hélas, je raffolais du bon roman-feuilleton français, le seul qui compte à mes yeux dans la littérature, le seul qui ait le sens commun et qui se déroule d’après des règles et des lois admirables et pleines d’ingéniosité. Or, il n’y avait plus de roman-feuilleton ! Le récit de l’aventure réelle de cette pauvre femme me donna l’idée d’en faire un à mon tour… Seulement, moi, je ne sais pas écrire ! Alors, je résolus de le vivre !…
» Vous vous rappelez… quelle joie ! quels transports ! quels enthousiasmes délirants quand cette pensée fut entrée dans mon esprit… Comme j’eus vite fait de terminer toutes mes affaires et de quitter l’Amérique !… J’allais au-devant de celui qui allait être un héros, au-devant du fils du guillotiné, au-devant du futur roi des Catacombes !… Je l’avais déjà nommé ainsi… »
Nous jugeons inutile de reproduire ici tous les passages de la lettre où M. Macallan prenait plaisir à se rappeler à lui-même les étapes par lesquelles il avait dû passer avant de retrouver les enfants de Robert Carel et de les faire élever à sa convenance pour le rôle qu’il leur destinait plus tard. M. Macallan était arrivé assez vite à découvrir la petite maison de la rue des Saules, et c’est pourquoi depuis longtemps il avait établi son siège d’observation à l’auberge du Bagne. Il n’avait eu garde de faire part à R. C. de sa découverte. Il désirait que le jeune héros trouvât tout lui-même, selon les moyens raisonnables d’un roman-feuilleton bien compris.
Ceci dit, nous ne serons plus étonnés maintenant des bizarreries, ni de l’attitude, ni du langage de l’outrecuidant avorton, du mystérieux gnome, ni des mouvements d’impatience de R. C. dans ses rapports avec lui. Robert Carel brûlait du désir de venger père et mère, ainsi qu’il sied à un cœur bien né, mais parfois il agissait en dehors des règles, allait trop vite en besogne ou se montrait trop paresseux, et Macallan n’était pas content.
C’était surtout lorsque le Vautour, par une indiscrétion de la Mouna, qui avait deviné la chose du premier coup, en observant dans le salon de la Roquette R. C. et Mlle Desjardies, c’est surtout, disons-nous, lorsque le Vautour eut appris à Macallan que le roi des Catacombes était amoureux… que Macallan ne se connut plus de rage. Il résolut de tout faire pour sauver son élève de l’influence de la jeune fille, et nous avons vu qu’il n’avait même pas hésité un instant à s’allier à ses ennemis pour l’enlèvement de Gabrielle… D’un autre côté, la puissance que ses millions avaient donnée à R. C. était telle, que celui-ci ne se gênait guère pour secouer de temps à autre la tutelle de Macallan lorsqu’elle le gênait…
« Dès qu’il fût devenu amoureux, je ne l’ai plus reconnu, écrit à son ami M. Macallan… Il me traitait comme de la semelle de botte.
» Songez, cher ami, que tout avait été réglé entre nous à l’avance… Un si beau drame, et, ma foi, tout fait… Comme dans le Comte de Monte-Cristo, nous avions un magistrat, Sinnamari, dans le rôle de Villefort ; un soldat, le colonel Régine, dans le rôle du général de Morcef, et un fonctionnaire concussionnaire, Eustache Grimm, auquel on ferait jouer le rôle du banquier Danglars !…
» Avec l’affaire Didier-Lamblin, nous les tenions tous !… On les déshonorait d’abord ! On les conduisait ensuite à l’échafaud comme par la main !
» Toutes nos précautions avaient été prises, et il n’y avait plus qu’un signe à faire pour que tout éclatât. Mais une nuit, il eut besoin de sa sœur, Liliane. Et pourquoi avait-il besoin de Liliane d’Anjou ?… Tout simplement pour reprendre à Sinnamari, qui les cachait chez lui, tous les papiers compromettants de l’affaire des décorations.
» Ce dernier incident, sans doute, entrait dans le programme et il était entendu depuis longtemps que, pendant que Liliane retiendrait Sinnamari dans sa chambre, on le volerait dans son cabinet de travail… Cécily, dans les Mystères de Paris[1] d’Eugène Sue, n’agit pas autrement, et abuse de sa beauté pour participer au châtiment du notaire Ferrand. Mais le misérable, aussitôt qu’il fut mis en possession des papiers de Sinnamari par le dévouement héroïque de Liliane, alla les rendre à Sinnamari pour rentrer en possession de sa maîtresse !…
» Ça, mon ami, comment appelez-vous cela ?… Ça n’a plus de nom dans aucune langue ! En vérité, en vérité plus j’y songe, et plus je regrette d’avoir dépensé tant de millions pour un homme dont le cœur était si fragile !
» Et, ma foi, je n’aurais pas été fâché de le voir écrasé par la jalousie du Vautour que j’avais fait élever dans l’ignorance de sa naissance. Le Vautour tenta bien de supplanter mon amoureux, mais, au dernier moment, il se réconcilia avec R. C., celui-ci lui ayant enfin appris, malgré mes ordres, qu’il était son frère. Le Vautour, alors, oublia tout pour ne plus songer qu’à venger ses parents. Je vous dis que le Vautour au fond était plein de nobles sentiments. Enfin il est trop tard, n’y pensons plus. »
Longuement encore, Macallan, plume en main, se lamenta. Il gémit sur la belle ordonnance de son roman-feuilleton-vivant, à jamais détruite par la folie amoureuse de R. C. Et il ne parvint à se consoler un peu qu’en faisant un récit des plus dramatiques de la scène finale où le crime se trouvait tout de même puni par la mort de Sinnamari ! Ici, nous devons encore lui laisser la parole :
« Ah ! mon cher ami ! Caché sur une petite planchette d’où je pouvais tout voir, je puis dire que j’ai ressenti là la plus belle émotion de ma vie !… R. C., il faut que je l’avoue, rachetait bien des choses en me procurant de telles délices ! Certes, il faut encore regretter là que la pusillanimité des spectateurs ait fait glisser le rideau au moment le plus intéressant, de telle sorte que je n’ai pas vu l’exécution, mais je l’ai entendue ! Et cela, je crois bien n’en était que plus magnifique. Apprenez, cher ami, que Sinnamari a crié comme un sourd ! Et qu’il a fallu au moins trois coups pour le décoller !… Ah ! à ce moment, by jove, je n’ai pas regretté mes cent soixante quinze millions.
» Et maintenant, c’est fini : Régine fou, Eustache Grimm mort de faim, Sinnamari décollé… Que vais-je devenir ?… Tout cela se termine beaucoup trop tôt… Je commence déjà à m’ennuyer. Or, comme rien ne m’effraie tant que l’ennui, je me décide à partir pour des régions nouvelles, de tous inconnues.
» Vous apprendrez par les journaux le jour et l’heure de mon départ.
Cordial shake-hand.
Macallan »
Macallan, ayant signé d’une main ferme, s’abîma dans une longue rêverie. Un masque de morne ennui couvrit ses traits. Longtemps il resta immobile, perdu dans ses songes, puis soudain il se leva, saisit sa plume et la brisa. Ensuite, prenant dans la poche de son pantalon un revolver qu’il arma, il se fit sauter la cervelle.
Le mot d’ordre fut donné en haut lieu d’ignorer tout de cette mystérieuse affaire. Rapide l’oubli se fit, mais, comme dans la vie, le vice et la vertu furent à la fois récompensés.
Dixmer fut nommé chef de la Sûreté.
Et le Professeur, de son vivant, vit dresser son buste, par les soins de ses amis de Montmartre, au centre de la place Pigalle.
FIN
À propos de cette édition électronique
Texte libre de droits.
Corrections, édition, conversion informatique et publication par le groupe :
Ebooks libres et gratuits
http://fr.groups.yahoo.com/group/ebooksgratuits
Adresse
du site web du groupe :
http://www.ebooksgratuits.com/
—
Mai 2010
—
– Élaboration de ce livre électronique :
Les membres de Ebooks libres et gratuits qui ont participé à l’élaboration de ce livre, sont : Jean-Yves, Jean-Marc, AlainC, PatriceC, Coolmicro et Fred.
– Dispositions :
Les livres que nous mettons à votre disposition, sont des textes libres de droits, que vous pouvez utiliser librement, à une fin non commerciale et non professionnelle. Tout lien vers notre site est bienvenu…
– Qualité :
Les textes sont livrés tels quels sans garantie de leur intégrité parfaite par rapport à l'original. Nous rappelons que c'est un travail d'amateurs non rétribués et que nous essayons de promouvoir la culture littéraire avec de maigres moyens.
Votre aide est la bienvenue !
VOUS POUVEZ NOUS AIDER À FAIRE CONNAÎTRE CES CLASSIQUES LITTÉRAIRES.