
Paul d’Ivoi
COUSIN DE LAVARÈDE !
Voyages excentriques – Volume III
Librairie Furne, Jouvet et cie, 1897
Illustrations Lucien Métivet
Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » – http://www.ebooksgratuits.com/
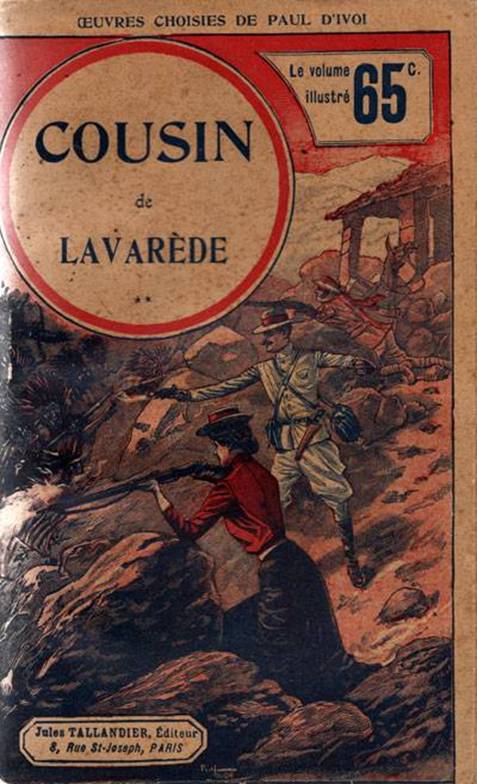
Table des matières
PREMIÈRE PARTIE LE DIAMANT D’OSIRIS
CHAPITRE III UN RÉVEIL BIZARRE
CHAPITRE IV EN VUE DE LA CÔTE D’ÉGYPTE
CHAPITRE VII LA CRYPTE DE TEPURABOË
CHAPITRE VIII SINGULIÈRE DEMANDE EN MARIAGE
CHAPITRE IX LES JOIES DE LA ROYAUTÉ
CHAPITRE X AU PAYS DES DERVICHES
CHAPITRE XII LE DIAMANT D’OSIRIS
CHAPITRE XIII L’ESCALIER DU DIABLE
CHAPITRE XIV LA REVANCHE DE RADJPOOR
CHAPITRE XV L’AUSTRALIE OCCIDENTALE
CHAPITRE XIX LE PLAN DE RADJPOOR
CHAPITRE XX LOYAUTÉ ET FÉLONIE
CHAPITRE II L’ŒUVRE D’UN FOU DE GÉNIE
CHAPITRE III QUELQUES INSTANTS DANS LA LUNE
CHAPITRE IV SOUS LE CERCLE POLAIRE ARCTIQUE
CHAPITRE V COURSE VERS LE PÔLE
CHAPITRE VII UN CADEAU PRINCIER
CHAPITRE VIII CONFIDENCE INATTENDUE
CHAPITRE X L’AMÉRIQUE À VOL D’OISEAU
CHAPITRE XII LE BOLIDE DE LAVARÈDE
CHAPITRE XIII DEUX CORRESPONDANTS DU « LONDON MAGAZINE »
CHAPITRE XIV L’IDÉE D’ARMAND LAVARÈDE
CHAPITRE XV AU-DESSUS DU PAYS DE LOBEMBA
CHAPITRE XVI UN DUEL À 2870 MÈTRES D’ALTITUDE
CHAPITRE XVII L’OBSERVATOIRE DE PARIS DEVIENT UTILE
À propos de cette édition électronique
Texte établi d’après l’édition Boivin et cie, ancienne librairie Furne, 1927
À Monsieur HIPPOLYTE MARINONI
Directeur du Petit Journal.
C'est à vous et à votre appui que l’ancien Lavarède dut son heureuse fortune. Laissez-moi le plaisir de vous dédier le nouveau, en témoignage de mon affectueuse et profonde reconnaissance.
Paul d’IVOI
PREMIÈRE PARTIE
LE DIAMANT D’OSIRIS
CHAPITRE I
DEUX BOLIDES
– Je t’en prie, mon cher Ulysse, quitte ce télescope.
– Un instant encore, mon bon Robert.
– Plus une seconde. Tu ne songes pas, malheureux, que de ses mains rouges, ma peu attrayante concierge prépare en ce moment le thé que je te conviai à déguster.
– Si… mais…
– Mais la dame du cordon est exacte. Elle connaît mes habitudes ; à 8 heures précises, elle met la bouilloire sur le feu ; à 8 h. 25, elle verse l’eau à 100 degrés sur les feuilles aromatiques. Et il est 35. Depuis dix minutes, le thé infuse ; nous avons un grand quart d’heure de route pour gagner mon logis de la rue Lalande. Le thé sera trop fort, il nous énervera. Par ta faute, nous aurons une nuit sans sommeil.
– Pour mon compte, je suis déjà sûr de ne pas dormir.
– Égoïste, va !
Ces répliques s’échangeaient entre deux jeunes gens, sous la coupole de l’observatoire de Paris.
L’un, perché à quatre mètres en l’air, dans le fauteuil d’observation placé en face de l’oculaire du télescope géant, dit « Grand Équatorial », appartenait évidemment au personnel de la maison. Son aspect ne permettait pas le moindre doute. Sa face large encadrée de cheveux blond-pâle, son nez court et épaté, ses yeux petits et étonnés, sa bouche libéralement fendue, lui assuraient une ressemblance réelle avec l’astre des nuits : Isis, Sélènè, Hécate, Phœbé, comme disaient les anciens ; la Lune ainsi que l’appellent les modernes.
Ulysse Astéras occupait l’emploi de calculateur, humble commis de l’administration de savants qu’abrite l’Observatoire ; mais il avait « une boule d’astronome ».
Le mot était de son compagnon, un grand garçon de vingt-cinq à vingt-six ans, aux yeux noirs très doux, à la peau brune, sur laquelle la moustache châtaine traçait une ligne plus claire. Autant Ulysse semblait nerveux, agité, autant ce dernier paraissait calme.
Nonchalamment étendu sur le socle d’une respectable lunette astronomique, il s’était soulevé à demi pour morigéner son ami.
– Égoïste, va ! avait-il dit.
Du, haut de son perchoir, Astéras agita frénétiquement les bras, sans quitter des yeux l’orifice de son télescope.
– Égoïste ! tu l’es plus que moi. Il s’agit de mon avenir. Prends la peine…
– Je ne veux prendre que le thé.
– Sempiternel railleur. Songe donc à la gloire que je poursuis. Je serais classé parmi les notabilités de la science si…
– 8 heures 40 !
– Si je parvenais à observer cet astre errant, ce bolide… à déterminer ses éléments.
– Je ne connais qu’un élément indispensable. Le thé !
– Ce bolide, continua Ulysse sans s’inquiéter de l’interruption, ce bolide, apparu dans l’atmosphère terrestre depuis quinze jours, ce bolide qui met en ébullition tous les observatoires du globe.
Le calculateur se dressa tout droit, désignant de l’index le sommet de la coupole.
– Car cet astéroïde unique, étrange, paradoxal, bouleverse toutes les lois célestes, Galilée et Newton se sont trompés… Un corps animé d’un mouvement propre et abandonné dans l’espace…
– Tombe sur le plancher, ricana Robert en voyant son ami se cramponner au fauteuil, pour éviter une chute.
Mais l’enragé Astéras continua :
– Ce corps ne décrit pas forcément l’une des trois courbes géométriques : ellipse, parabole, hyperbole. La preuve en est faite. Nous avons sous les yeux…
– Sur les yeux, rectifia son interlocuteur.
– Un bolide à marche constante, mais irrégulière.
Robert éclata de rire et tranquillement :
– Voilà pourquoi tu te mets les sens à l’envers ?
– Il me semble que cela en vaut la peine.
– Il te semble mal. Le sage ne court pas après les météores fantaisistes.
– Ce sage-là ignore les météorites.
– Point ! car tout homme a son bolide.
À cette affirmation, Astéras sursauta :
– Que dis-tu ?
– L’exacte vérité.
– Alors toi, Robert Lavarède, caissier de la maison Brice et Molbec, fabricants d’instruments d’optique…
– J’ai mon bolide et je le prouve.
– Je t’écoute.
Insidieusement le calculateur reprit son observation, enchanté du répit que lui annonçait l’exorde de son ami. Celui-ci, sans quitter son attitude nonchalante, commença :
– Né dans une ferme, située à cinquante kilomètres d’Ouargla, en plein sud Algérien, je fis mes études à Alger. À quinze ans, j’étais orphelin. L’un de mes professeurs s’intéressa à moi ; il m’adopta, et lorsqu’il fut nommé principal du collège de Nîmes, il m’emmena avec lui. J’étais bi-bac, c’est-à-dire gratifié de mes baccalauréats ès-lettres et ès-sciences, quand mon protecteur mourut à son tour.
Ému par ces souvenirs, le causeur se tut un moment, et dans le silence, on entendit ces paroles marmottées par Astéras :
– Il a été signalé avant-hier dans la constellation des Gémeaux, il ne peut être loin.
Évidemment cette remarque ne s’appliquait pas au récit de Robert. Absorbé, celui-ci ne l’entendit même pas, D’une voix lente, assourdie, il poursuivit :
– J’étais seul. Durant trois années je rencontrai une famille dans l’armée. Puis l’époque de ma libération arriva, je me retrouvai isolé. Je suis un affectueux. La solitude me pesait. Pas un parent, pas un ami avec qui partager ma pensée. C’est dans cette disposition d’esprit que j’appris, par les journaux, l’existence et l’adresse d’Armand Lavarède, mon cousin. Oh ! cousin au cinquantième degré, à la mode de Bretagne et de Provence ! Je ne l’avais jamais vu. Mon père n’avait pas davantage rencontré son père. Les deux branches de la famille avaient vécu sans se donner la moindre marque de souvenir. Mais bah ! c’était un parent. Je me rappelais que mon père m’en avait entretenu quelquefois. N’ayant rien à lui demander qu’un peu d’amitié, je n’avais aucune crainte d’être mal reçu. Je vins à Paris.
– Rien, rien, grommela Ulysse du haut de son observatoire.
– Ici j’appris que mon cousin avait quitté la France. Pour obéir aux clauses d’un testament, il effectuait le tour du monde avec vingt-cinq centimes en poche. J’avais trouvé mon bolide.
– Tu as trouvé le bolide… où cela, clama Astéras, tiré de sa préoccupation par ce mot magique ?
– Eh ! je ne te parle pas de ton astre errant. Il s’agit de mon cousin.
– Je le regrette.
– Qu’est-ce que tu dis ?
– Rien. Continue je t’en prie.
– Je le veux bien. Il fallait vivre. J’entrai comme commis dans la maison Brice et Molbec, pour attendre le retour du voyageur. Les mois se passent. On m’envoie à Saint-Gobain pour une vérification de lentilles destinées à l’observatoire de Pulkowa. Je reste quinze jours absent. Je reviens. Misère ! Armand Lavarède avait traversé Paris, mais il était reparti en Angleterre afin d’épouser une charmante miss, qui l’avait accompagné avec son digne père, durant son tour du monde. On l’attendait prochainement. Une attaque d’influenza me force à garder la chambre. Une semaine à peine. Je suis guéri. Je cours chez mon cousin. Il avait passé à Paris avec sa jeune femme, mais il était loin déjà, faisant un voyage de noces en Amérique. Et maintenant j’espère toujours. Trouve donc beaucoup de bolides à marche aussi constante et aussi irrégulière ?
Un rugissement d’Astéras répondit :
– Je le tiens enfin.
– Quoi donc ? interrogea tranquillement Robert.
– Mon bolide.
Le bouillant calculateur s’était déjà remis à son télescope. Ses bras étendus frétillaient joyeusement :
– Oui, c’est bien lui ! Avec sa lumière propre signalée par tous les observateurs ! Elle semble en effet provenir d’une origine électrique plutôt que d’une combustion.
– 9 heures, remarqua Lavarède. Veux-tu, oui ou non, venir prendre le thé ?
– Éteint ! gémit Astéras.
– Tu dis ?
– Éteint comme une bougie que l’on souffle. Invisible, introuvable.
– Mais, triple fou, abandonne à son sort ce morceau d’astre qui se moque de toi, et mettons-nous en route.
– Tu as raison, gronda le calculateur dépité par la brusque disparition du météore. Au diable ce fantasque passant céleste !
Il dégringola l’échelle d’observation, et entraîna son ami à travers les couloirs de l’Observatoire. Un instant plus tard, tous deux franchissaient le portail de l’édifice, gagnaient la rue Cassini, le boulevard Saint-Jacques, traversaient la place Denfert, l’avenue d’Orléans et s’engouffraient dans la rue Daguerre. Il faisait une nuit noire, brumeuse de novembre. Les rues humides étaient désertes et silencieuses.
Tout en marchant d’un bon pas, Astéras exhalait sa mauvaise humeur :
– A-t-on jamais vu cet astéroïde qui s’éteint à la seconde où j’allais m’assurer de son identité.
– Il craint peut-être les indiscrétions de la police, fit placidement Robert.
– Plaisante, mon ami, plaisante. Tant pis pour toi si tu ne t’intéresses pas aux merveilles de la science. Si, au lieu d’un être matériel, j’avais à mes côtés un intellectuel, il s’étonnerait avec moi de la variabilité extraordinaire de l’éclat de ce monde minuscule.
Et du ton d’un professeur en chaire :
– Certes ! le ciel, ce livre de l’immensité, où l’histoire de l’univers est écrite par des soleils, certes, le ciel contient des étoiles variables. T de la constellation de la Couronne est descendue, du 12 au 21 mai 1866, de la 2e à la 9e grandeur ; X du Cygne varie, dans une période régulière de 406 jours, de la 4e à la 13e grandeur ; V des Gémeaux passe par 3 grandeurs en 21 heures ; mais aucune n’a la variabilité intensive du singulier mondicule qui nous occupe. D’une seconde à l’autre, celui-ci va d’un éclat insoutenable au noir absolu.
– Tous les astronomes te ressemblent ? interrompit Lavarède.
– Oui. Tous sont épris comme moi de l’infini mystérieux.
– Alors, sais-tu dans quelle constellation je placerais l’Observatoire ?
– Je ne vois pas…
– Je le vois, moi ; dans celle de Charenton, dont il deviendra, s’il ne l’est déjà, le pourvoyeur principal.
Du coup, le calculateur leva les bras au ciel en un geste d’éloquent désespoir :
– Que je reconnais bien ton esprit terre à terre. Des calembours. Voilà tout ton rêve. Ton idéal, c’est ton bureau où tu arrives chaque matin.
– À 9 heures, ami poète ; dont je sors à six ; où j’ai ma petite besogne méthodiquement ordonnée. Tandis que tu parcours en imagination des millions de lieues dans le ciel, moi je pousse l’horreur des voyages jusqu’à ne pas laisser voyager ma pensée. Peut-être suis-je ainsi parce que mon cousin a accaparé toutes les facultés de déplacement des Lavarède. En tout cas, je suis heureux d’être tel. Oh ! se déplacer, se déranger, changer chaque jour d’habitat et d’habitudes ; quelle épouvante pour moi ! Je suis casanier, tranquille, paisible, homme d’accoutumance. Je suis caissier, j’espère l’être toujours. Plus heureux que plusieurs de mes collègues, je suis certain de ne jamais puiser illicitement à la caisse qui m’est confiée, car si cette idée malheureuse me pouvait venir, tout mon « moi » se révolterait à la pensée du voyage en Belgique et en fugitif, qui devient de rigueur en pareil cas. Et je me connais ; je résisterais.
– Tu ne parleras pas toujours ainsi.
– Ah ça ! tu deviens insolent, Ulysse. Prétendrais-tu insinuer que je dilapiderai les fonds confiés à ma garde ?
– Eh non ! tu es un honnête homme. Je voulais seulement dire que l’ambition te pousserait un beau matin.
– Ni matin, ni soir.
– Et avec elle viendra le besoin de déplacement, qui t’apparaît aujourd’hui comme une chose monstrueuse.
– Monstrum horrendum ! Tu erres, mon bel ami. Charitablement je t’avertis ; si tu t’établis nécromancien, tu feras faillite.
– Oh que non !
– Oh ! que si !
Et clignant des yeux d’un air fin, le calculateur reprit :
– Tu sais que je ne connais rien de la vie. Perpétuellement penché sur mes tableaux de parallaxes, de minima, et cétera, je n’ai point le loisir d’étudier l’humanité qui grouille sous les étoiles.
– Ça, c’est vrai, souligna Robert. À preuve qu’au mardi gras tu prenais un costume de Folie pour un habit de cour.
– Je ne suis pas un homme de nuances, c’est vrai. Mais je dîne parfois chez une vieille amie de ma famille. Elle prétend qu’il existe de par le globe des jeunes filles qui sont des anges.
– Toutes les jeunes filles sont des anges.
– Ah ! fit Astéras de la meilleure foi du monde, c’est bien possible. Eh bien donc, il est, paraît-il, une loi mathématique qui nous régit. Cette loi fait que l’on rencontre un de ces anges. On l’épouse, et alors l’ambition naît.
Son interlocuteur l’interrompit par un rire sonore :
– Mon cher devin, ta prophétie tombe d’elle-même.
– Où prends-tu cela ?
– Dans ma résolution de ne me marier jamais.
– Ta résolution se brisera contre la loi dont je parlais l’instant.
– Non, ami Ulysse. Tu peux rayer cela de tes papiers.
– Parce que ?
– Parce que je ne veux pas me marier.
Le jeune homme avait scandé ces derniers mots avec énergie. D’un ton plus posé, il affirma :
– Vois-tu. La jeune fille étant d’essence angélique, moi je ne suis qu’un homme. Conséquence fatale : ma femme userait sa vie et la mienne à exprimer des avis contraires aux miens.
– Par bonheur, tout le monde ne pense pas comme toi.
– Je ne l’ignore pas. Mais pour satisfaire mon instinct de combativité, il me suffit d’avoir sous la main un ami comme toi. Je te vois juste assez pour ne pas souffrir de ton caractère. Tu me fatigues, je te quitte. Rien de plus commode.
– Ah ! murmura Ulysse en haussant, les épaules, à t’entendre on ne croirait pas que tu es un brave garçon, plein de cœur, de générosité.
– Je ne suis pas assez riche pour répandre cette croyance.
– Oui, mais je te connais, moi. Tu as beau t’en défendre tu te marieras, mon ami Robert, et tu seras le meilleur mari qui se puisse rêver.
Tout à leur conversation, les promeneurs ne remarquèrent pas, à vingt mètres en avant d’eux, un groupe qui, à leur approche se dissimula dans la baie d’une porte basse, dont le battant ouvert laissa apercevoir un corridor sombre.
Deux hommes étaient là :
– C’est lui, fit l’un d’eux à voix basse.
– Ce Robert Lavarède que vous m’avez désigné, seigneur ?
– Lui-même. Je reconnais son organe.
– Mais il n’est pas seul.
– Tant pis. L’autre sera de la partie. Nous ne pouvons laisser en liberté un individu qui clabauderait sur l’aventure.
– Ce serait gênant en effet.
– Attention. Les voici. Sois adroit.
Robert et son compagnon approchaient. Ils passèrent devant les mystérieux causeurs. Ils allaient s’engager dans la rue Lalande où demeurait Lavarède.
Soudain un bruissement d’étoffe les fit tressaillir. Avant qu’ils eussent pu se rendre compte de la cause du bruit, une sorte de manteau ample s’abattit sur leurs têtes, les emprisonnant dans ses plis lourds.
Presqu’aussitôt des mains nerveuses les saisissaient, et ils étaient entraînés dans le corridor sombre, à l’entrée duquel stationnaient un instant plus tôt les causeurs inconnus.
CHAPITRE II
EN PLEIN MYSTÈRE
Si rapide avait été l’attaque, que ni Robert, ni son ami, n’avaient pu esquisser la plus légère résistance. À demi portés par leurs agresseurs, ils se sentirent brutalement poussés dans une salle. À travers l’étoffe qui les aveuglait, ils perçurent le bruit assourdi d’une porte qui se refermait, puis le silence se fit.
Encore tout ahuris de l’incident, ils parvinrent, non sans peine, à se débarrasser du manteau-filet qui avait assuré leur capture. Voir où ils se trouvaient était leur pensée.
Espoir vain ! Une obscurité opaque les environnait. Avec colère, Lavarède frappa le sol du pied.
– Où sommes-nous ?
– Oh ! déclara naïvement Astéras, nous ne sommes pas éloignés de la rue Lalande.
– Satané rêveur. Cela, je le sais aussi bien que toi. Je demande où nous nous trouvons en ce moment ; ce que signifie cette sotte plaisanterie ?
– J’en suis victime ainsi que toi-même. Je ne puis donc t’éclairer.
– Éclairer, voilà un mot juste. J’ai des allumettes. Éclairons notre prison ; peut-être que la situation suivra ce bel exemple.
Le grésillement du phosphore annonça que Robert joignait le geste à la parole, et une faible lueur tremblotta dans la salle.
– Victoire ! des becs de gaz.
Ce cri était arraché au jeune homme par la vue d’appliques, garnies de bougies de porcelaine, et placées de chaque côté de la glace surmontant une cheminée de marbre blanc.
Les becs enflammés permirent aux captifs d’examiner leur geôle dans ses moindres détails.
Ils se trouvaient dans une petite salle de quatre mètres de côté, meublée sommairement de deux couchettes, d’une table de sapin et de quelques chaises. Détail particulier : sauf la porte de chêne massif, la pièce n’avait aucune ouverture apparente.
– Bah ! exclama Robert. La porte existe, il s’agit de la forcer à s’ouvrir.
Dans une maison parisienne, le bruit appelle forcément l’attention. Faisons du bruit.
Et s’armant d’une chaise, il en porta un coup formidable contre le battant. Mais, à sa grande surprise, le choc n’eut point le retentissement prolongé qu’il espérait. Le son fut sec, bref, comme étouffé. Évidemment une double porte capitonnée arrêtait la vibration.
Cette découverte porta au paroxysme la colère du caissier de la maison Brice et Molbec. Sa main brandit sa chaise comme un bélier, et durant quelques minutes il frappa l’huis. Le résultat de cet exercice était facile à prévoir. La chaise céda tout à coup. Les morceaux roulèrent sur le plancher, et Robert désarmé regarda autour de lui pour trouver quelque autre moyen d’apaiser son courroux.
Déjà Astéras s’était assis philosophiquement devant la table. De sa poche, il avait tiré des papiers couverts de chiffres et, insoucieux de sa captivité, il s’était absorbé dans la recherche passionnante d’un problème de réfraction.
Sa tranquillité gagna incontinent Lavarède. Il se laissa choir sur un siège, en grommelant :
– Le fait est que je me donne bien du mal en pure perte.
Mais, presqu’aussitôt, il se redressa :
– En pure perte ! Ce n’est pas exact. Le thé nous attend. Il ne sera plus buvable, si notre séquestration se prolonge.
Et élevant la voix :
– Monsieur, Madame ou Mademoiselle, déclama-t-il avec le plus grand sérieux. J’ignore le sexe, l’âge, le caractère, le nom de la personne qui nous contraint à accepter son hospitalité. Seulement je la conjure de nous délivrer sans retard, afin que mon ami Ulysse Astéras et moi puissions déguster le thé qui nous attend.
Comme pour répondre à cette parole, un claquement sec se fit entendre ; un panneau de la cloison s’abattit, démasquant un monte-plats, sur lequel une théière fumante apparut au milieu d’un service à thé.
Un instant, le jeune homme demeura immobile, stupéfait de cette réplique d’allure fantastique, mais, reprenant son sang-froid.
– Après tout, profitons de l’attention.
Délicatement il transporta sur la table théière, pot au lait, tasses, soucoupes chargées de « rôties » dorées du plus appétissant aspect. Le monte-plats dévalisé, Lavarède reprit :
– Merci beaucoup, nous sommes servis.
Il n’avait pas achevé que le panneau de la muraille se refermait. Décidément, un spectateur invisible épiait les prisonniers. Cette pensée engagea Robert à faire bonne contenance.
Quelqu’un, sans nul doute, s’amusait à ses dépens. On l’avait enfermé pour voir « la tête qu’il ferait ». Eh bien ! il accepterait gaiement l’aventure, et les rieurs seraient de son côté.
Cette résolution prise, il frappa sur l’épaule d’Astéras, plus enfoncé que jamais dans ses calculs.
– Hein ? fit ce dernier en sursautant.
– Le thé est servi, mon bel ami.
– Le thé. Parfait ! Alors je serre mes paperasses.
Tout en réintégrant ses feuilles dans sa poche, Ulysse roulait des yeux effarés ?
– Ah ça ! demanda-t-il enfin. Tu as donc changé ton mobilier !
– Moi. Où prends-tu cela ?
– Ici donc. Ces couchettes, ces meubles…
– Tu te figures donc être chez moi ?
– N’y serions-nous pas ? bégaya le calculateur d’un air ébahi.
Du coup Lavarède éclata de rire. Son ami, distrait comme toujours par ses études célestes, avait déjà oublié l’aventure dont il était victime.
Quelques mots le rappelèrent à la situation. Mais le thé répandait un délicieux parfum, les rôties beurrées sollicitaient l’appétit, et le calculateur ne se fit point tirer l’oreille pour faire honneur à la collation offerte par un inconnu.
Robert, du reste, prêchait d’exemple. Avec une rapidité remarquable, liquide et solide disparurent. Seulement il se produisit alors un phénomène étrange.
Les deux amis, bavards et joyeux durant le repas, cessèrent brusquement de parler. Il leur sembla qu’un voile s’abaissait sur leurs yeux, noyant les objets dans une sorte de brouillard. Puis leurs paupières se fermèrent lentement, et ils demeurèrent immobiles, vaincus par un sommeil aussi soudain que violent.
Le silence régnait dans la salle. Les flammes du gaz dansaient capricieusement, promenant sur les objets des alternances d’ombres et de lumières mobiles.
Un quart d’heure s’écoula ainsi, puis la porte, si vainement brutalisée par Robert, tourna lentement sur ses gonds. Dans l’entre-bâillement, deux hommes se montrèrent.
L’un grand, le teint brun comme Lavarède lui-même, était mis avec cette recherche un peu prétentieuse particulière aux exotiques qui habitent Paris. Il était joli garçon, mais son regard manquait de franchise ; son front trop bas indiquait le cerveau où les larges idées ne sauraient se développer à l’aise. Avec cela, dans son allure générale, quelque chose de veule, d’abattu comme chez tous ceux qui s’adonnent à l’oisiveté élégante, la plus ardue, la plus déprimante des occupations.
Son compagnon, petit de taille, sec, brun, nerveux, sarrazin de type, semblait empêtré dans ses vêtements à l’européenne. À première vue, on sentait en lui l’être accoutumé aux tuniques flottantes de l’Orient. Ce fut lui qui parla le premier :
– Vous le voyez, Seigneur, ils dorment.
– Tu avais raison, Niari. Je n’aurais jamais cru que deux gouttes de sève d’euphorbe les réduiraient si promptement.
– C’est que Votre Seigneurie a oublié les coutumes d’Égypte.
– Bien oublié en effet. Et si j’ai un regret aujourd’hui, c’est d’être obligé d’y penser. Enfin, je compte bien ne pas être absorbé longtemps.
Et d’un ton dolent :
– Combien d’heures dormiront-ils ?
– Cinq ou six tout au plus.
– Cinq ou six, dis-tu ? Mais alors nous n’aurons pas le temps de les transporter.
– Si, Seigneur, je vais transformer leur sommeil en léthargie. Vous savez bien que votre fidèle Niari a étudié, chez les Brahmes Hindous, les connaissances mystérieuses qu’ils empruntèrent, il y a six mille ans, aux hiéroglyphites de la vallée du Nil.
– Oui, oui, je sais cela, fit son interlocuteur d’un ton indifférent. Mais agis vite. J’ai hâte de partir, de me débarrasser de la fastidieuse besogne que tu m’as apportée.
– Votre Seigneurie ne m’accuse pas, je pense. Mon dévouement ne sacrifie-t-il pas un peuple à sa fantaisie !
– Si, mon bon Niari. Ne prête aucune attention à mes paroles. Je suis si ennuyé, que j’ai l’air de t’en vouloir. Il n’en est rien, sois-en sûr.
Niari s’inclina cérémonieusement, fouilla dans les poches de son pardessus, et en tira une boîte ronde qu’il ouvrit.
À l’intérieur, on apercevait une sorte de pommade de couleur émeraude.
– Voilà qui empêchera le réveil de ces dormeurs, aussi longtemps que vous le désirerez.
– Trois ou quatre jours suffisent.
– Bien, Seigneur.
À l’aide d’une spatule de bois, le singulier personnage prit une parcelle de la préparation, et l’introduisit entre les lèvres de Lavarède. Il procéda de même avec Astéras.
– Maintenant, déclara-t-il en terminant, durant quatre jours, ils seront immobiles, muets, comme morts. Leur respiration va s’arrêter. Leur cœur cessera de battre.
À mesure qu’il parlait, la transformation s’accomplissait.
Le visage de Robert, celui d’Ulysse, se décoloraient. Leurs narines se pinçaient, la respiration, s’affaiblissant graduellement, devenait imperceptible.
– Très curieux, remarqua l’élégant auquel Niari témoignait un grand respect, mais es-tu certain que l’expérience est sans danger ?
– Absolument, Seigneur. La préparation que j’emploie est le Niemb-Vohé, que les brahmes vont récolter en grand secret dans les jungles du bassin du Gange. Grâce à elle, ils peuvent accomplir ces miracles qui ont stupéfié la science européenne. Suivant la dose absorbée, ils se mettent en léthargie pour vingt, trente, quarante, cent jours, se font ensevelir après avoir annoncé la date de leur réveil. À l’époque fixée, on ouvre le tombeau, d’où le brahme adroit sort en excellente santé. Les Anglais ont cru d’abord à une supercherie ; ils ont pris toutes les précautions de contrôle nécessaire, et ont dû reconnaître que les « miraculeux » restaient bien couchés dans leur cercueil. Mais ils ignorent le secret si simple de l’affaire. Les brahmes le gardent.
Un silence suivit. La tête courbée, les yeux fixés à terre, celui à qui on donnait le titre de : Seigneur, semblait avoir perdu la conscience du lieu où il se trouvait. Comme l’attente se prolongeait, Niari appela timidement son attention.
– Seigneur !
– Quoi ? murmura l’interpellé en relevant brusquement le front.
– Je demande pardon à Votre Grandeur de l’avoir arrachée à ses pensées. Mais j’attends ses ordres.
– Mes ordres ?
– Oui. Les deux « Roumis » sont plongés dans le sommeil. Faut-il agir ainsi que vous l’aviez décidé ?
– T’ai-je donc dit le contraire ?
Les sourcils de l’élégant s’étaient froncés. Ses yeux noirs brillaient d’une lueur fauve.
Niari se courba, les mains réunies en coupe au-dessus de sa tête, et d’une voix basse :
– Ne frappez pas d’un regard courroucé votre fidèle. Si j’ai péché, c’est par excès de dévouement. Alors que le Scarabée sacré qui, dans les nuits transparentes, bourdonne autour des sommets effrités des hautes pyramides, alors que l’ibis dépossédé de ses autels séculaires demande à l’étoile Anubis la force de terrasser le licorne britannique, il est permis à celui qui est attendu, à celui dont le sol d’Égypte est le bien, de ne pas persister dans sa résolution de neutralité. Il peut, celui-là, saisir la hampe de l’étendard des Pharaons, et grouper sous les plis de l’emblème antédiluvien les hommes du Nil lassés de la servitude. Il peut les conduire contre les conquérants anglais… Il peut…
– Il pourrait, ricana son interlocuteur. Il pourrait, mais il ne le veut pas.
D’une voix sèche, mordante :
– Non, brave Niari. Je n’abuserai pas de ma naissance illustre, pour entraîner mes compatriotes dans une lutte sans issue. L’Égypte est le fauve tombeau du passé. L’Angleterre est l’avenir. Et puis, je ne suis pas un héros, moi. Donner ma vie pour l’indépendance d’un pays que j’ai quitté tout enfant, auquel rien ne m’attache… Ce serait de la folie. Bien plus, ce serait de l’ingratitude pour l’Angleterre.
– Seigneur, ne parlez pas ainsi. Mon âme égyptienne frissonne de douleur.
– Il faut bien appeler les choses par leur nom. Depuis dix ans, le gouvernement de Sa Gracieuse Majesté me paie une pension de 50.000 livres sterling (1.250.000 francs). Grâce à lui, je suis riche, heureux. Le plaisir me tresse des couronnes fleuries. Mais en acceptant ces bienfaits, je me suis tacitement engagé à ne rien tenter pour chasser du Caire, d’Alexandrie, de Suez, les soldats de la Grande-Bretagne.
– Oui. On a acheté mon maître.
– Acheté, si le mot te plaît, Niari. En tout cas, reconnais qu’on y a mis le prix. Aujourd’hui que les Égyptiens, réunis en affiliation secrète sous le nom de Néo-Égyptiens, veulent se révolter, l’Angleterre double ma pension. Elle me charge d’apaiser les esprits, me reconnaissant en toute propriété le diamant inestimable dit « La goutte de sang d’Osiris ». J’accepte !
Il regardait son serviteur en face, avec une expression de défi.
– Après tout, je suis bon prince. Pas un filet de sang égyptien ne coulera à la faveur de mon plan.
Son accent se fit plus doux, presque caressant :
– Songe, Niari, mon ami, que la victoire est incertaine. En prenant le commandement, j’assumerais une responsabilité trop lourde pour mes épaules, tandis qu’en substituant le roumi à moi, tout danger disparaît.
Il désignait Lavarède endormi. Un pétillement joyeux passait dans son regard faux.
– Je l’ai cherché et trouvé avec peine. Né dans le Sud-Algérien, sans parents, ses dénégations ne s’appuieront sur rien. Qu’il soit présenté aux conjurés, qu’on lui remette le diamant d’Osiris. Alors, il me suffit de le livrer aux autorités anglaises, pour mettre fin à la révolte et épargner aux rives du Nil les sanglantes hécatombes. Crois-moi, cela est mieux ainsi.
Et comme Niari hochait la tête, il reprit d’un ton dur.
– D’ailleurs, je le veux.
– Vous serez obéi, Seigneur, murmura son compagnon.
Sur ces mots, il frappa dans ses mains. La porte s’ouvrit à ce signal, et plusieurs hommes parurent. Niari montra Robert aux nouveaux venus :
– Voici le chef que les fils d’Osiris espèrent. Il refusait de se placer à notre tête. Je l’ai endormi, Nous l’emporterons avec nous. Et là-bas, en ce pays plein des souvenirs d’autrefois, il se ressaisira. Les hypogées lui parleront des grandeurs disparues, les sphinx lui diront le devoir attendu.
Ces phrases, apprises sans doute à l’avance, étaient débitées sans conviction, d’un ton monotone. Niari obéissait aux ordres de son compagnon, mais son âme se rebellait contre sa volonté. Elle se refusait à participer au mensonge, à la substitution humaine qui devait tromper tout un peuple.
Mais les survenants ne s’en aperçurent point. Ils entouraient le caissier de la maison Brice et Molbec, se confondant en génuflexions.
Le chef fit un signe, et Niari reprit :
– L’emballage est-il prêt ?
– Certes, répliqua l’un des hommes. Il est dans la salle voisine.
– Alors, hâtons-nous.
À ce commandement, les personnages présents saisirent Robert et Ulysse.
Ils soulevèrent les deux dormeurs et les transportèrent dans la pièce, sur laquelle s’ouvrait la porte du mystérieux réduit.
Sur le plancher s’étalait une large caisse de bois. Chose étrange, sous la surface extérieure s’alignaient des lamelles de verre de faible longueur, réservant, au centre, un espace libre suffisant pour que deux hommes y pussent tenir à l’aise. Les compagnons de Niari y couchèrent les victimes de l’euphorbe. Puis ils posèrent le couvercle de la boîte, le clouèrent, mettant en lumière les inscriptions suivantes : Haut. Bas. Fragile. Verrerie.
Leur tâche terminée, tous se tinrent immobiles, semblant attendre un commandement.
Niari se rapprocha de son chef, et baissant la voix, l’attitude suppliante :
– Maître, il en est temps encore. Tu peux dissuader ces hommes. L’autre tourna sur ses talons, avec ces seuls mots :
– Tu m’ennuies.
L’Égyptien devint pâle, sa main se crispa sur sa poitrine. Puis d’un brusque effort de volonté, il se calma.
– Le camion est-il dehors ? demanda-t-il sans que rien dans sa physionomie trahît l’angoisse qu’il venait d’éprouver.
– Il attend à la porte.
– Alors, frères, enlevez le colis.
S’arc-boutant, les assistants soulevèrent la lourde caisse, la firent passer dans le corridor sombre accédant à la rue Daguerre. Déserte était la voie. Le brouillard s’était épaissi. Il arrêtait la vue à quelques pas.
Au bord du trottoir un camion stationnait, ses lanternes formant un halo de lumière rouge dans la brume.
La caisse fut chargée. L’un des hommes monta sur le siège.
– Où allons-nous ? demanda-t-il.
Niari répondit :
– À la gare de Lyon. Enregistrez la caisse pour Marseille, grande vitesse. Destinataire : capitaine du yacht Pharaon.
– Entendu !
La lourde voiture se mit en marche et disparut bientôt dans la brume.
Alors les personnages se dispersèrent, après avoir échangé des signes bizarres avec Niari.
Celui-ci demeura seul auprès de l’homme qu’il accompagnait depuis le début de la soirée.
– Qu’ordonnez-vous maintenant, Seigneur ?
– Nous nous rendons nous-mêmes à la gare de Lyon.
– Nous prenons le train de minuit 45 ?
– Oui. À moins que cela ne te déplaise ?
– Ne raillez pas, maître. Vous savez bien que mon plaisir n’est point mon conseiller.
– Alors quitte cet air tragique.
– Je tâcherai.
– Voilà une bonne parole. En route, bon Niari. Je crois que, ce soir, nous avons bien mérité de l’Angleterre.
Et tous deux se dirigèrent d’un pas rapide vers l’avenue d’Orléans.
Soudain le chef s’arrêta :
– Un mot encore, Niari.
– Votre serviteur écoute, maître.
– Désormais, évite de m’appeler ainsi. Oublie que j’ai été moi. C’est celui que nous avons endormi qui sera désormais ton chef.
– Mais vous-même ?
– Moi, je conserverai le nom sous lequel on me connaît à Paris. Je suis le prince hindou Radjpoor. Rien de plus, tu m’entends ?
– Soyez-en certain.
– C’est grâce à mon concours, à mes relations, que tu as pu trouver celui que les conjurés t’avaient chargé de rechercher en Europe. Tu me ramènes en Égypte comme un ami sûr, un allié courageux…
– Niari mentira autant que vous l’exigerez.
Le jeune homme qui avait adopté le nom de Radjpoor haussa les épaules, puis avec un sourire narquois :
– Marchons donc. Allons rejoindre celui qui dorénavant sera Moi.
CHAPITRE III
UN RÉVEIL BIZARRE
Par le hublot d’une cabine, le soleil matinal entrait en gerbe d’or animée par la farandole des poussières dansantes. L’ombre, un instant plus tôt maîtresse de l’étroit espace, s’évanouissait comme à regret, refoulée dans les angles par la lumière victorieuse. Sur des couchettes superposées, deux hommes dormaient. Celui d’en bas fit entendre un bâillement sonore ; celui d’en haut allongea un bras hésitant. Le premier se livra à son tour à ce mouvement naturel chez quiconque passe du sommeil à la veille ; leurs mains se rencontrèrent au bord de la planchette séparative, plafond de l’un, plancher de l’autre.
Ce simple contact parut les galvaniser.
Tous deux se dressèrent sur leur séant ; ils eurent un même cri empreint d’inquiétude :
– Qu’est-ce que c’est que ça ?
Avec un touchant ensemble, encore qu’ils ne pussent s’apercevoir, ils regardèrent autour d’eux :
– Ah ça ! murmura l’occupant de la couchette inférieure, j’ai la berlue.
– Et moi le cauchemar, repartit aussitôt le personnage assis à l’étage supérieur.
– Cette voix, clama le premier. Astéras, est-ce toi ?
– C’est moi-même. Mais il me semble reconnaître l’organe de Robert Lavarède.
– En personne !
Ce disant, le jeune homme se leva. Le mouvement terminé, sa tête dépassa la cloison qui isolait les couchettes, et il se trouva nez à nez avec le calculateur.
– Que fais-tu là-haut ? interrogea-t-il ?
– Je n’en sais rien, ma parole !
Un geste brusque de Robert lui coupa la voix. Le caissier de la maison Brice et Molbec se cramponnait à la couchette comme un homme qui craint de tomber.
– Qu’est-ce, hasarda Ulysse ?
– Eh ! c’est le plancher qui vacille.
– Le plancher ?
– On dirait le roulis. Sapristi, nous sommes sur un navire !
– Sur un navire ? Rue de Lalande, cela ne se serait jamais vu !
– Et pourtant cette pièce ressemble à une cabine… Cette ouverture, qui livre passage au jour, est un hublot, ou bien je suis halluciné. Astéras, je t’en prie, que vois-tu ? Parle ; ne te semble-t-il pas que ceci est un vaisseau ?
Lentement le calculateur quitta sa couchette.
– Je ne saurais te renseigner. L’Observatoire et la marine n’ont rien de commun.
– Peu importe, tu sais comment est aménagé un steamer ?
– Pas du tout. À quoi cela me servirait-il pour étudier les étoiles ?
Robert haussa les épaules, et s’appuyant à la cloison gagna le hublot. Mais à peine eut-il jeté un regard au dehors qu’il poussa un véritable rugissement :
– La mer !
– Où cela, bégaya l’astronome en se levant ?
– Partout. Je ne vois que l’étendue liquide. Pas une terre, pas un rocher.
À son tour, Astéras prit place au hublot :
– C’est vrai, fit-il. C’est bien l’Océan – et d’un ton inspiré : – Puissance insondable de la nature ! À l’endroit où s’élevait Paris, avec ses monuments orgueilleux, son peuple spirituel, les vagues s’entrechoquent, et le ventre des Léviathans frôle les ruines de la ville qui fut le flambeau du monde !
– Sapristi ! grommela Lavarède, qu’est-ce que tu chantes là ?
– Le chant de mort de Lutèce.
– Quoi ? que veux-tu dire ?
– Qu’un phénomène plutonien a précipité les flots de l’Atlantique sur la France, et que nous flottons au-dessus de notre patrie soudainement immergée.
– Tu divagues !
– Alors que penses-tu donc ?
– Moi, rien. Seulement, à ton sens, ce phénomène plutonien, qui inonda la vallée de la Seine, nous aurait transportés à bord d’un navire.
À cette question, le calculateur se gratta l’oreille, geste qui, dans les sociétés savantes et même dans les autres, est un indice d’embarras.
– En effet, déclara-t-il enfin, la présence de ce navire…
– Et notre présence dans ses flancs, appuya Robert.
– Compliquent étrangement le problème. Toutefois la solution n’en est pas impossible. Un bouleversement cosmique développe une prodigieuse quantité d’électricité, d’où il serait permis d’inférer que nous avons bénéficié d’une sorte de choc en retour, analogue aux faits maintes fois observés après la chute de la foudre.
Le calculateur s’arrêta en voyant son compagnon hausser nerveusement les épaules.
– Joli, ton « choc en retour », ricana le jeune homme. Il nous enferme dans une cabine, nous couche sur le cadre…
– Alors, comment expliqueras-tu la chose ? demanda vivement Astéras blessé dans son amour-propre de savant, lequel serait le plus susceptible de tous, si chaque corporation ne sacrifiait avec prodigalité à la vanité.
– Je ne l’explique pas ; mais comme je suppose que ce navire ne vogue pas tout seul, je vais demander au premier matelot que je rencontrerai la clef du mystère.
– C’est vrai, tu m’ouvres une idée.
– Parbleu. Avec une clef !
Et bras dessus, bras dessous, se soutenant pour résister aux attaques sournoises du roulis, les jeunes gens quittèrent la cabine.
Filant le long des coursives, ils atteignirent un escalier accédant au pont.
Éblouis par le soleil, ils s’arrêtèrent un instant, fermant les yeux sous l’averse lumineuse. Puis leurs paupières se rouvrirent.
– Ah ça ! quel est ce pavillon ?
Cette exclamation était arrachée à Robert par la vue du drapeau flottant à l’arrière.
– Connais pas, susurra Astéras. Un étendard bleu avec un croissant et trois étoiles blancs. Mais j’y songe, la figuration de ces astres semble indiquer…
– Indiquer quoi ?
– L’amour de l’astronomie. Donc…
– Ce navire serait un observatoire ambulant. Bravo, doux rêveur ! Mais je me souviens que ce pavillon est celui de l’Égypte…
– L’Égypte, si tu veux. C’est la terre antique des astronomes. La religion, 4.000 ans avant notre ère, était celle des astres. Osiris personnifiait le soleil, Isis, la lune ; Anubis, l’étoile du berger ; Horus, la révolution diurne. Pour ma part, je suis heureux de fouler le pont d’un bateau appartenant à cette grande nation.
– Mon bonheur est plus curieux. J’ai besoin de savoir pourquoi je le foule.
Sur ces mots, Robert retint par la manche un matelot qui passait, et demanda :
– Mon ami, pourriez-vous m’apprendre par suite de quelles circonstances je me trouve à bord de ce vaisseau ?
L’homme s’inclina, les bras tendus en avant, les doigts écartés, dans l’attitude mystique des personnages gravés sur les murailles de l’ancienne Thèbes, capitale des Pharaons, mais il ne répondit pas.
Sans plus de succès, Lavarède répéta sa question.
Cette fois, cependant, le matelot indiqua par signes qu’il ne comprenait pas et s’esquiva prestement.
Du coup, le caissier de la maison Brice et Molbec s’emporta. Cela devenait exaspérant. Depuis la veille, – il pensait n’avoir dormi qu’une nuit – sa patience était mise à trop rude épreuve. Être enlevé en plein Paris, séquestré dans une prison privée, étaient déjà choses désagréables. Mais s’endormir à deux pas de l’Observatoire et se réveiller en pleine mer, sans parvenir à comprendre de quelle façon on a changé d’élément ; non, cela dépassait les bornes !
Pourtant une réflexion calma Robert, au moins momentanément. Le matelot auquel il s’était adressé pouvait être une exception à bord, un simple sauvage, un rustre pour qui les beautés de la langue française étaient lettre morte. Il serait sage et facile de s’en assurer en procédant à l’interrogatoire d’un autre marin.
Mais Lavarède, docilement suivi par Astéras, eut beau s’adresser à chaque matelot, accentuer les syllabes, à faire pâmer d’aise le fin diseur qui a nom Silvain, de la Comédie-Française, une conviction désolante s’implanta dans son esprit ; personne, sur cet odieux bateau, ne parlait la langue de M. Félix Faure.
En allant de l’un à l’autre, les deux passagers avaient parcouru toute la longueur du navire. Arrêtés à l’avant, muets, découragés, ils embrassaient d’un regard morne l’immensité bleue qui les entourait. Moins préoccupé, Robert aurait admiré l’élégant steamer frémissant sous ses pieds. Il se fût étonné de voir la proue ornée d’une statue de femme, au front surmonté du Croissant Isiaque. Il n’eût pu s’expliquer l’étrange attitude de l’équipage, qui semblait veiller sur lui avec une sollicitude respectueuse.
Mais il n’était pas en humeur d’observation. Son horreur des déplacements l’étreignait. Il se sentait navré, écrasé, à la pensée qu’il était entraîné loin de son bureau vers une destination inconnue, au milieu d’êtres d’une autre race que lui. S’il avait eu quelque chance de vaincre, il se fût précipité sur les marins ; mais ceux-ci étaient trop nombreux. Et puis la victoire même ne le laisserait-elle pas captif sur ce navire, qu’il serait impuissant à diriger.
Comme il ruminait ces pensées moroses, il sentit qu’une main se posait sur son bras. Il regarda. Une fillette de quatorze à quinze ans était debout devant lui. Singulière était l’apparition.
Le teint brun, la face maigre, trouée par des yeux énormes au regard velouté, l’enfant était enveloppée dans une sorte de pagne de laine blanche, qui laissait apercevoir ses bras et ses pieds nus. Mignonne, chétive même, elle avait une grâce maladive et mélancolique dont Astéras, en dépit de sa distraction habituelle, parut frappé. Comme son ami, le calculateur eut l’intuition qu’une victime du destin se trouvait sur son chemin.
Et ce fut d’une voix douce, où ne grondait aucun écho de son mécontentement passé, que Robert demanda :
– Que veux-tu, mon enfant ?
Elle eut un geste timide, indiquant qu’elle ne pouvait parler.
– Allons bon ! s’écria Lavarède, encore une qui ne comprend pas le français. Alors pourquoi venir nous troubler ?
– Ce n’est pas là ce qu’elle exprime, interrompit Ulysse.
– Parfait ! L’astronomie t’a enseigné les secrets de la pantomime.
– Peut-être bien.
Et lentement, détachant bien les mots, le jeune savant demanda :
– Tu entends le français, n’est-ce pas, petite ?
La gamine sourit et fit oui de la tête.
– Tu vois, exclama Astéras triomphant. Elle sait notre langue ! – Puis, revenant à son interlocutrice – pourquoi ne réponds-tu pas ?
Une surprise douloureuse passa sur les traits de la frêle créature. Lentement elle montra sa langue rose entre les rangées d’émail de ses dents.
– Serais-tu muette ?
Elle frappa dans ses mains, heureuse d’être devinée et abaissa à plusieurs reprises la tête de haut en bas.
Puis elle saisit la main du calculateur et voulut l’entraîner.
– Elle a sans doute son idée, fit celui-ci tout fier d’avoir compris la petite, suivons-la.
– Soit, acquiesça Robert.
Derrière leur guide, ils parcoururent le pont, descendirent l’escalier des cabines et pénétrèrent bientôt dans une pièce plus vaste que celles où dorment les passagers.
Aux murs étaient fixés des portraits d’acteurs, d’actrices, de danseuses, des photographies représentant des scènes de pièces en vogue. Une table-bureau, éclairée par un hublot, supportait un tas de papiers maintenu par une règle de fer.
La muette les désigna aux jeunes gens. Et comme ils hésitaient à mettre la main sur ces feuillets, retenus par la longue habitude de la discrétion, elle les prit et les leur tendit.
Machinalement Astéras porta les yeux sur la première feuille, et une exclamation de surprise lui échappa :
– Ton nom, mon brave Robert.
– Où cela ?
– Ici, au haut de la page.
En effet, les noms « Robert Lavarède » s’étalaient en grosses lettres à la première ligne du papier.
– Peut-être ces notes nous donneront-elles le mot de l’énigme. En tout cas, nous pouvons lire, puisqu’il s’agit de nous.
Et avec un étonnement croissant, le caissier de la maison Brice et Molbec lut ce qui suit :
Robert Lavarède,
Né à la ferme du Djebel-Gzam, à cinquante kilomètres ouest d’Ouargla (Algérie), orphelin. A fait ses études au collège d’Alger, puis à celui de Nîmes. Soldat au 105ème de ligne. Ni parents, ni amis anciens.
– Ah ça ! grommela le jeune homme, c’est ma biographie cela.
– Continue, répondit Astéras :
Le document relatait ensuite minutieusement les moindres habitudes de Robert, ses relations avec Ulysse, le chemin qu’il suivait pour venir de l’Observatoire à la rue de Lalande.
En bas de la feuille, une autre main avait tracé à l’encre rouge : « Accepté. Cachette préparée. Pharaon attend. Agir vite. »
Les voyageurs malgré eux s’entre-regardèrent. Que signifiait tout cela ?
Et comme, avec un touchant ensemble, ils haussaient les épaules, geste désespéré qui, ainsi que le disait Brasseur dans une pièce du répertoire, prouve que l’on donne sa langue aux chiens, un sifflement suivi d’un cri de douleur les fit se retourner.
Accotée contre la cloison, la muette se tenait toute pâle, le bras gauche marqué d’une meurtrissure rougeâtre, et sur le seuil se montrait un homme, qui portait à la main une cravache.
C’était le personnage étrange qui, avec Niari, avait enlevé les jeunes gens. D’un geste brusque, le nouveau venu montra la porte du doigt. La fillette s’enfuit aussitôt.
Puis, sans laisser aux Français le temps d’exprimer leur sentiment sur le brutal traitement infligé à la pauvre petite :
– Messieurs, dit-il, l’indiscrétion d’une esclave m’oblige à me présenter à vous, avant l’heure que j’avais fixée. Au fond, la chose est sans importance. Je suis le prince hindou Radjpoor, et je me félicite de me rencontrer avec vous. Les circonstances me paraissent avoir été heureuses pour moi.
– Les circonstances qui ont amené cette rencontre, exclamèrent les passagers du navire inconnu. Vous les connaissez donc ?
– Soyez-en certains.
– Mais alors, vous allez nous expliquer comment, nous étant endormis hier, rue Daguerre…
– Vous faites erreur quant à la date. Votre sommeil remonte à quatre jours.
– Quatre jours ? Vous plaisantez.
– Je ne plaisante jamais.
– Enfin, ne discutons pas. Nous avons hâte de pénétrer le mystère de notre présence sur ce navire. Parlez, Monsieur.
Radjpoor sourit :
– Je ne parlerai pas longtemps. Les indications qu’il m’est permis de vous donner seront brèves. Endormis à l’aide d’un narcotique…
– D’un narcotique ?
– Pour des raisons que vous apprendrez plus tard, vous avez été transportés à Marseille.
Du coup, Robert bondit :
– À Marseille ! Depuis quatre jours ! Que doit-on penser chez Brice et Molbec ?
– Et à l’Observatoire, appuya Astéras ?
– Ceci je l’ignore, reprit le prince sans se départir de son flegme ; mais ce que je sais, c’est que nous sommes à cette heure par le travers de la Sicile, à bord du brick Pharaon.
– La Sicile maintenant, clama Lavarède avec désespoir !
– Le bateau nous conduit en Égypte.
– En Égypte ? Mais je proteste. J’ai affaire à mon bureau.
Plus fort que son ami, Astéras glapit :
– Et moi j’ai un travail commencé qui ne souffre aucun retard. La révision des tableaux de parallaxes.
Tranquillement Radjpoor laissa tomber ces paroles :
– Sans nul doute, Messieurs, vos travaux sont urgents ; mais moins cependant que les devoirs qui vous réclament.
– Quels devoirs ?
L’interrogation formulée par Robert dénotait une colère naissante :
– Je ne puis répondre, à mon grand regret, poursuivit le pseudo Hindou. Attendez.
– Attendre, mais je refuse, hurla le calculateur.
– À votre aise.
– Je veux retourner en France.
– Personne ne vous en empêche. Si vous êtes bon nageur, montez sur le pont et piquez une tête. Nul ne fera obstacle à votre détermination.
Et arrêtant un geste de rage qu’esquissait Robert, le singulier personnage conclut :
– Croyez-moi. Restez calmes. Deux hommes, si résolus qu’ils soient, ne luttent pas contre l’équipage d’un navire. Soyez assurés que des raisons graves ont seules motivé votre enlèvement. On ne vous veut aucun mal. Au contraire. Les honneurs, la fortune sont au bout de l’aventure. Sur les trente-huit millions de Français, vos compatriotes, il en est plus des neuf dixièmes qui voudraient être à votre place.
Honneurs, fortune, mots magiques auxquels nul emportement ne résiste. En les entendant, les voyageurs malgré eux s’apaisèrent soudain, et ce fut d’un ton conciliant qu’Astéras demanda :
– Que nous faudra-t-il faire ?
– Vous laisser conduire et ne résister en rien.
– C’est tout ?
– Absolument tout.
– Alors, déclara le calculateur, pour ma part je m’engage volontiers. Je vous prierai seulement de faire passer une dépêche à l’Observatoire de Paris, afin de rassurer mes chefs, inquiets sans doute de ma disparition.
– Dès notre arrivée en Égypte, votre désir sera satisfait.
– Pourquoi pas de suite ?
Robert ne put s’empêcher de rire :
– Parce qu’il n’y a pas de bureau télégraphique à bord d’un navire.
Réplique qu’Ulysse accueillit d’un air ahuri. Évidemment l’astronome s’était figuré que le steamer était en communication avec la terre, idée saugrenue, comme toutes celles que ce grand enfant professait pour les détails de la vie étrangers à l’étude sidérale.
Fût-ce la désillusion que lui causa la réponse de son ami ? on ne saurait le dire. Toujours est-il que, regardant Radjpoor bien en face :
– La question est vidée en ce qui nous concerne, et de même que l’étoile a est englobée par la constellation du Centaure, nous sommes emportés par votre mouvement. Je ne résisterai pas, mais je vous prierai de ne plus vous livrer à des actes de brutalité.
L’Hindou fronça le sourcil. Mais Astéras, si pacifique à l’ordinaire, se sentait à cette heure des velléités batailleuses :
– Cette enfant, qui nous a conduits ici, ne méritait pas d’être cravachée.
Radjpoor sourit.
– Ne vous occupez point de cela.
– Si fait ! je tiens à m’en occuper.
Son interlocuteur haussa les épaules :
– Ces Français ! toujours les mêmes !
– Vous l’avez dit, prince. Toujours disposés à défendre les faibles, à se dévouer à l’idée de justice.
– Même les astronomes ?
– Ceux-là comme les autres. C’est que l’idée juste est aussi un soleil, et la rechercher appartient encore à notre profession. Mais je m’égare. Je plaidais pour notre pauvre petite « cicerone ».
– Ne parlons plus de cette esclave, fit l’Hindou avec impatience.
– Esclave, répétèrent les Français avec un serrement de cœur.
– Eh oui. Je l’ai achetée au marché du Caire. Elle m’appartient, ayant pour moi moins de valeur qu’un chien qui, lui, ne trahirait pas son maître.
Et changeant brusquement de ton :
– Laissons cela. Le sujet nous diviserait, car nous autres Orientaux ne pensons pas comme les gens d’Europe. Montons sur le pont, et puisque les circonstances me contraignent à être votre geôlier, facilitez-moi la tâche en me considérant…
Il se reprit :
– En feignant de me considérer comme un ami.
Un instant plus tard, tous trois assis sur des rocking-chairs se balançaient mollement sous la poussée d’un roulis peu accentué. Seulement, si le seigneur Radjpoor s’était penché sur Lavarède, il l’aurait entendu murmurer :
– Le diable emporte la fortune s’il faut voyager. À la première escale, je fausse compagnie à ce prince, et je retourne à mon bureau. Pourvu que cet imbécile ne m’ait pas fait perdre ma place ?
CHAPITRE IV
EN VUE DE LA CÔTE D’ÉGYPTE
– Causons, avait dit Radjpoor. Invitation ironique au possible, car s’il parla, durant les jours suivants, ce fut de tout, sauf de ce qui intéressait les voyageurs involontaires.
– Où nous conduit-on ? murmurait Robert avec une rage croissante.
Et rongeant son frein, se promettant de glisser, dès la première occasion, entre les doigts de celui qu’il appelait son geôlier, il écoutait impatiemment ses dissertations sur l’Égypte, but avoué de la traversée.
Sur ce point, Radjpoor se montrait prolixe. Il racontait avec une éloquence particulière, empreinte d’une vague raillerie, les splendeurs éteintes de la terre des Pharaons et des Ptolémées. Il disait l’histoire de l’Égypte.
– C’est l’histoire de son fleuve, affirmait-il. Le Nil, le cours d’eau le plus long du globe, car il dépasse 6470 kilomètres, de la Méditerranée aux grands lacs, a fait éclore la plus gigantesque civilisation des siècles écoulés. Sur ses rives, ont surgi des monuments à sa taille, les pyramides, les obélisques, les sphinx, les palais de Memphis et de Thèbes, dont chacun eût contenu l’une des bourgades nées sur les bords de ces ruisselets, que l’Européen décore pompeusement du nom de fleuves. Le Nil était-il l’objet des préoccupations des gouvernements ; ses digues, barrages, canaux latéraux apparaissaient-ils en bon état ; aussitôt le peuple égyptien devenait puissant, dominateur. Négligeait on le « chemin qui marche », l’empire perdait toute énergie, les invasions asiatiques triomphaient. Alors que les armées des Pharaons, que leurs fantassins à la plume d’aigle, leurs chars de guerre au timon d’airain subjuguaient l’immense territoire qui s’étend du Delta à la côte de Mozambique ; alors que leurs colonies guerrières campaient aux bords du lac Tchad, dans la boucle du Niger, au Sénégal[1], le Nil apportait le tribut de ses eaux à la mer par sept branches, la Canopique, la Bolbytique, la Sébénytique, la Phatnitique, la Mendésienne, la Tanitique Saïtique et la Pélusiaque. Sous la treizième dynastie, l’incurie gouvernementale laisse s’obstruer deux de ces embouchures. Immédiatement les Hycsos, pasteurs nomades venus d’Asie Mineure, soumettent l’Égypte qu’ils dominent pendant plus de trois cents ans. Leur administration rétablit les sept bras du Delta ; c’est le signal d’un mouvement patriotique irrésistible. Les Égyptiens, qui avaient fui vers le sud devant l’envahisseur, et s’étaient fixés en Éthiopie, en Abyssinie, descendent le cours du Nil ; ils rejettent les Hycsos dans les déserts d’Arabie par l’isthme de Suez. Aujourd’hui, la grandeur de la terre antique d’Osiris est bien finie, car son fleuve ne communique plus avec la mer que par deux branches ! celles de Damiette et de Rosette, les antiques Bolbitique et Phatnitique.
D’une oreille distraite, Robert Lavarède écoutait en grommelant tout bas.
– Les Égyptiens, les Pharaons, le Nil… comme je donnerais bien tout cela pour être à ma caisse, dans la maison Molbec, Brice et Cie.
Quant à Ulysse Astéras, il ne semblait pas regretter l’Observatoire de Paris. Peut-être, avec sa distraction habituelle, avait-il même oublié son existence.
Deux problèmes occupaient sa pensée :
L’un, nocturne, était posé par le bolide dont l’apparition avait bouleversé le monde savant. Le soleil couché, le petit homme s’installait sur le pont et scrutait, avec une attention béate, l’indigo du ciel taché par l’or des myriades d’étoiles.
L’autre, diurne celui-là, l’agaçait profondément. Ses amis et connaissances eussent été prodigieusement surpris s’ils avaient pu deviner que le calculateur, qui jusque-là n’avait connu l’existence des femmes que par ouï-dire, se livrait à des recherches par tout le navire, pour retrouver la muette un instant entrevue.
Car on ne la voyait plus nulle part. Sans doute, le seigneur Radjpoor la séquestrait, afin d’éviter qu’elle trahit ses desseins. Et à l’idée que la pauvrette souffrait pour lui, Astéras ressentait une désolation comme jamais il n’en avait éprouvée dans sa carrière d’astronome, pas même le jour néfaste où il avait relevé une erreur dans l’un des tableaux communiqués par lui à l’Annuaire du bureau des Longitudes.
L’esclave Maïva – il avait appris son nom – jouait dans sa vie le rôle d’une petite étoile terrestre. Et elle faisait tort à ses collègues de la sphère céleste, car le brave Ulysse, sans bien s’en rendre compte, était plus dépité de son éclipse persistante que de celle du bolide.
Oh ! il avait découvert sa prison.
En se glissant le long des coursives, les sons plaintifs d’une guzla, sorte de guitare, étaient arrivés jusqu’à lui. Pas un instant il n’avait hésité. Le gémissement musical émanait de Maïva. L’enfant muette confiait sa tristesse à la corde vibrante.
Tout troublé, il s’était élancé dans la direction de l’harmonie, mais un homme s’était dressé devant lui. Petit, sec, noir, menaçant, Niari, le fidèle de Radjpoor car c’était lui, avait enjoint à Astéras de diriger sa promenade d’un autre côté du navire. Le calculateur avait voulu parlementer, mais Niari sans répondre avait fait glisser son poignard hors du fourreau, avec un froissement métallique si éloquent que son interlocuteur n’avait pas insisté.
Ulysse n’était pas très brave, il le faut avouer. Cela n’a rien de surprenant. Un savant n’est point un militaire, et ce sont métiers différents que s’adonner à la diffusion des lumières ou à l’effusion du sang.
Seulement de la constatation de son infériorité batailleuse, naquit chez le bon garçon la pensée de tourner l’obstacle par la ruse. Jamais auparavant il ne lui était venu à l’esprit qu’il fût possible de biaiser. Il regardait bien en face les astres, qui le lui rendaient sans fausse modestie. Et tout à coup, ce que le ciel ne lui avait pas fait soupçonner, un méchant Égyptien le lui enseignait ; à savoir que pour lutter contre la force, la faiblesse doit se doubler d’habileté.
Mais pour être adroit, il ne suffit pas de le vouloir. Astéras en fit la cruelle expérience. Toutes ses tentatives pour déjouer la surveillance de Niari furent inutiles. Si bien que, lorsque le Pharaon arriva en vue du phare d’Alexandrie, son exaspération atteignait son paroxysme.
C’était le soir. Au loin, à l’ouest, dans des vapeurs rouges de fournaise, le soleil s’enfonçait lentement sous la ligne d’horizon, colorant la tour du phare, les murs de l’enclos qui l’entoure, de couleurs pourprées.
Accoudé sur le bastingage, le calculateur monologuait nerveusement. Soudain une main s’appuya doucement sur son épaule, et la voix de Robert susurra tout bas à son oreille :
– Nous allons entrer dans le port d’Alexandrie ?
Le savant haussa les épaules avec indifférence.
– Voici ce que j’ai résolu, poursuivit Lavarède. Le Pharaon s’arrêtera dans l’un des bassins. La nuit venue, je me laisse glisser à l’eau, je gagne le quai, et je cours chez le consul de France pour qu’il te fasse remettre en liberté et qu’il nous renvoie à Paris.
– À Paris ? répéta le calculateur d’un air ahuri.
– Certainement, à Paris. Ah ça ! éternel songe-creux, as-tu rayé la capitale du monde de tes souvenirs ?
– Non, mais…
– Mais quoi !
La bouche du savant s’ouvrit en accent circonflexe ; sa face ronde exprima la gêne, et d’un ton hésitant, il répliqua :
– Quoi ? Dame, je pensais… enfin, tu consentirais à revenir sans avoir mis le pied sur le sol égyptien ?
– Non pas.
– À la bonne heure !
– J’y mettrai le pied, comme tu dis, pour me rendre au consulat.
Un instant éclairée, la figure d’Astéras se rembrunit :
– Comment… ? Pas une visite aux Pyramides, aux hypogées, au Labyrinthe ?
Robert leva les bras avec ahurissement.
– Tu es fou… Des marches, des contremarches. Par ma foi, ce voyage n’a que trop duré. Il me tarde d’être réinstallé dans ma caisse, derrière mon guichet, de reprendre mes habitudes, ma bonne vie tranquille, d’oublier ce déplacement-cauchemar dont je souffre depuis quelques jours.
– Ah ! gronda Ulysse, nature prosaïque.
– Je m’en vante.
– Tu ne ressens aucune émotion devant cette terre classique.
– Tu te trompes… elle me fait horreur… Je me souviens de mes pensums au collège. Les Pharaons… cinq cents lignes… la mythologie du Nil… mille lignes… Osiris se présente à mon esprit avec la tête d’un pion barbare me privant de sortie le dimanche, et Thèbes aux cent portes me rappelle seulement que celles du lycée se fermaient sur moi.
– Ainsi les ruines géantes… ?
– Tas de pierres !
– Les hiéroglyphes ?
– Grimoire !
– Les rois Chléphrem, Chéops… ?
– Souverains d’opérette !
– Les études des Égyptiens, les plus anciens astronomes du monde… ?
– Charlatanisme !
– Ah ! gémit Astéras… vraiment tu n’as pas de cœur !
À cette conclusion inattendue, Robert demeura sans voix. Il lui fallut un instant pour se remettre de son étonnement.
Enfin il demanda :
– Pas de cœur ? Où prends-tu cela ?
– Dans tes paroles.
– Parce que je n’aime pas Osiris, Anubis, Nephtis, Isis, Apis et autres confettis de la mascarade de Memphis.
– Eh ! il s’agit bien de cela !
Du coup, Lavarède sursauta.
– Il ne s’agit pas de cela… Alors de quoi me parles-tu ?
– De quoi ? Tu oses le demander. Tu n’as pas conscience d’avoir contracté une dette de gratitude…
– J’ai fait des dettes, moi, gémit le caissier de la maison Molbec, Brice et Cie complètement abasourdi ?
– Sans doute… cette petite Maïva…
– L’esclave ?
– Elle-même ! Pour t’avoir manifesté quelque intérêt, elle est prisonnière, gardée par un geôlier rébarbatif. Mais cela t’est bien égal. Tu ne songes qu’à ta caisse, sans t’inquiéter de savoir quel sera le sort de cette pauvre enfant.
– C’est là que le bât te blesse. Rassure-toi. Elle est enfermée pour qu’elle ne puisse communiquer avec nous. Notre liberté reconquise assurera sa délivrance.
– Libres ! Nous serons libres, et elle restera l’esclave de cet homme qui la frappe.
– Le moyen de l’empêcher, mon pauvre Ulysse ?
– Le moyen… il y en aurait bien un…
– Lequel, je te prie ?
– Ne pas fausser compagnie au seigneur Radjpoor.
Lavarède toisa son interlocuteur, porta la main à son front, geste qui indique chez tous les peuples une estime mince pour les facultés intellectuelles de qui le motive. Après quoi, il gonfla ses joues, et pivotant sur ses talons, se mit en devoir de s’éloigner du savant.
Mais dans ce mouvement, ses yeux parcoururent un demi cercle d’horizon, et loin déjà dans l’ouest, étincelant dans les brumes grises du crépuscule, il aperçut le fanal du phare d’Alexandrie.
– Le Pharaon avait passé devant le port, continuant sa marche vers l’Est.
D’un bond, Robert se retrouva auprès de son ami et lui désignant le feu tournant :
– Regarde, dit-il.
– Le phare, balbutia Astéras qui ne comprenait pas encore ?
– Oui, il reste en arrière, nous ne touchons pas à Alexandrie.
– Nous ne touchons pas, répéta joyeusement l’astronome !… Alors c’est parfait !
L’exclamation allait lui attirer une verte réplique de son compagnon, mais celui-ci n’eut pas le temps de donner cours à sa mauvaise humeur.
Radjpoor s’avançait vers eux.
– Nous ne débarquons pas à Alexandrie, questionna Lavarède d’un ton sec ?
L’Hindou se prit à rire :
– Non, cher Monsieur.
– C’est un tort, il me semble que…
– Nul point n’était plus favorable. C’est exact. Le chemin de fer nous conduisait au Caire.
– Au Caire, nous allons au Caire maintenant ?
– Et même plus loin.
– Plus loin… ah mais je m’insurge, à la fin.
Radjpoor secoua la tête d’un air satisfait.
– C’est bien ce que je craignais.
– Ce que vous craigniez ?
– Vous ne voulez pas vous laisser conduire. Alors, au lieu de choisir le chemin le plus court, le plus commode, le plus rapide, vous m’obligez à des détours. Voilà ce que j’avais à vous dire. Et sur ce, Messieurs, bien le bonsoir.
Il fit un pas en arrière, puis se ravisant :
– À propos, un conseil. Couchez-vous, car vers minuit, il vous faudra vous lever.
Et sur cet avertissement donné d’un ton dégagé, il quitta les voyageurs muets de surprise.
Dire quels rugissements s’échappèrent de la poitrine de Robert, quelles épithètes malsonnantes il accumula sur la tête du maître du Pharaon, est impossible. Quant à l’astronome, après avoir assisté un instant au débordement de la colère de son compagnon d’aventures, il lui dit d’un air narquois :
– Je vais me conformer à l’invitation de M. Radjpoor. Tu serais sage d’en faire autant.
– Va-t-en au diable, gronda Lavarède exaspéré.
– Tu ne veux pas, bien, bien… Je te souhaite le bonsoir.
Et d’un pas léger, un sourire satisfait épanouissant sa face arrondie, le calculateur gagna sa cabine.
Tout en s’étendant sur sa couchette, il murmurait :
– Par bonheur, ce Radjpoor est un malin. Sans cela, Robert lui jouait un tour de sa façon… C’eût été dommage… une excursion si bien commencée… Maintenant, une occasion d’arracher Maïva à l’esclavage, et je serai parfaitement heureux de mon déplacement.
Puis il se tut. Sa respiration régulière indiquait qu’il dormait. Par le hublot, un rayon de lune se glissa dans la cabine et vint se jouer dans les cheveux de l’astronome. Phœbé rendait visite au savant qui, si souvent durant les nuits sereines, lui avait fait les doux yeux à travers les lentilles de son télescope.
CHAPITRE V
LE NIL
Demeuré seul, Lavarède s’était calmé. Immobile à la même place, il suivait du regard la côte qui fuyait à tribord du steamer.
C’était une ligne basse ; traçant une teinte plus sombre dans la nuit transparente. De temps à autre, un feu fixe ou intermittent dénonçait l’emplacement d’un phare. À l’estime, le jeune homme jugea que l’on prolongeait le rivage de la baie d’Aboukir. Une agglomération lumineuse et lointaine lui indiqua la ville de Rosette. Mais le navire ne ralentit pas son allure, conservant imperturbablement le cap à l’est.
Maintenant, il côtoyait, à un mille de distance, une série de dunes peu élevées. Robert tira sa montre : Elle marquait onze heures et demie.
À ce moment, l’hélice cessa brusquement de battre les flots, et le navire, courant sur son erre avec une vitesse décroissante, stoppa enfin juste en face d’une trouée, qui perçait de part en part la ligne des dunes et laissait apercevoir au delà une vaste nappe d’eau dormante.
Un mouvement inaccoutumé se produisit sur le pont. Glissant de ses palans, une chaloupe à vapeur était mise à la mer. Et comme Robert regardait sans comprendre, Radjpoor parut. Il s’avança vers le caissier, et avec sa politesse froide :
– Monsieur, lui dit-il, nous allons débarquer. Veuillez, je vous prie, descendre dans l’embarcation qui doit vous conduire à terre.
– Mais où sommes-nous ?
– En face le hameau de Bourlos, qui a donné son nom au lac intérieur que vous voyez au delà de la passe.
Et avec une ironie à peine perceptible :
– C’est le détour que je vous ai annoncé.
Après tout, quitter le Pharaon était un premier succès. Sur la terre ferme, il serait plus aisé d’échapper à ses geôliers. Sans récriminer, Lavarède gagna la chaloupe. Déjà Astéras était assis à l’arrière. Il se pencha à l’oreille de son ami, et lui désigna deux ombres accroupies à l’autre extrémité du bateau :
– La muette Maïva et son gardien Niari.
Quatre matelots, puis Radjpoor rejoignirent les voyageurs. Aussitôt l’embarcation se mit en marche, tandis que le Pharaon, évoluant de son côté, reprenait en sens inverse le chemin parcouru dans la nuit.
Nul ne parlait. À travers la passe, le canot filait ainsi qu’une mouette rasant les eaux. Durant quelques centaines de mètres, les dunes formèrent de chaque côté une muraille de sable qui arrêtait les regards. Puis le chenal s’élargit encore, et à toute vapeur, l’esquif entra dans le lac de Bourlos. Suivant une diagonale, il se dirigea vers l’ouest, laissant en arrière un sillage allongé que les feux stellaires pailletaient d’argent.
Immobiles, engourdis par la fatigue, gênés d’ailleurs par la présence du seigneur Radjpoor, Robert et Ulysse gardaient le silence. Mais de temps à autre, le savant oubliait son regard sur la forme sombre de Maïva, assise à l’avant, de la chaloupe, et il hochait la tête lentement.
Et puis la navigation se prolongeant, les voyageurs sans le vouloir sentirent leurs paupières s’appesantir. La terre d’Égypte, la surface brillante du lac, se confondirent dans un brouillard, ils perdirent la conscience de leur situation.
Un choc brusque, un bruit de voix les rappelèrent à eux-mêmes. Le bateau accostait, et Radjpoor, une main appuyée sur l’épaule des amis, les secouait sans pitié.
– À terre, dit-il seulement en les voyant rouvrir les yeux.
Chancelants comme des gens arrachés sans précaution au sommeil, tous deux débarquèrent. Avant qu’ils eussent eu le temps de se reconnaître, les matelots les avaient saisis, enlevés et hissés sur des ânes, tenus en main par des fellahs, qui évidemment attendaient l’arrivée de la petite troupe. Un sifflement léger se fit entendre, une grêle de coups de bâton s’abattit sur la croupe des coursiers aux longues oreilles, et la caravane s’ébranla au grand trot.
Emportés comme en songe, les Français entrevirent au passage les silhouettes du bourg de Berimba, du village de Metoubi, environnés de champs admirablement cultivés, au milieu desquels se dressait de loin en loin le fût élancé d’un palmier.
Les arbres devinrent moins rares, ils se rapprochèrent, formèrent des bouquets, puis une véritable forêt. Tout à coup, la route eut un coude brusque, s’élançant hors de la lisière du bois, et Astéras poussa un cri d’admiration.
– Le Nil !
C’était vrai. Le bras de Rosette, qui limite le delta à l’ouest, s’étendait devant eux. L’eau coulait lentement dans un mouvement majestueux, sur lequel les castes sacerdotales de l’antique Égypte avaient rythmé la marche des processions isiaques.
Et sur les rives basses, à perte de vue s’alignaient des palais, des jardins, des fourrés de dattiers, derrière lesquels des disques lumineux indiquaient le tracé de la voie ferrée de Rosette à Tamanhout.
Contre le rivage, un bateau était amarré, un yacht à vapeur, gracieux dans sa forme rappelant celle des « baris », qui transportaient, 4.000 ans avant notre ère, le corps des défunts de marque aux Memnonia. À la poupe, sur le bordage, s’allongeait l’œil osirien bordé d’antimoine ; la cabine des passagers affectait la disposition des naos, et nonobstant ses chaudières et ses aubes modernes, le vapeur avait conservé les mâts et les voiles triangulaires des temps écoulés.
Une passerelle volante reliait le pont à la rive.
Lavarède et Astéras, poussés par leurs compagnons, la traversèrent. On les conduisit à la cabine, où on les enferma, et la vibration des pistons les avertit que le steam-boat se mettait en marche.
Mais quelle que fût leur curiosité, leur fatigue fut la plus forte. D’ailleurs des divans moelleux, appuyés aux cloisons de la cabine, invitaient au repos. Ils s’y étendirent, et après quelques minutes ronflèrent à qui mieux mieux.
C’est ainsi que s’écoulèrent leurs premières heures de navigation sur le Nil. Il faisait grand jour quand, ils se réveillèrent. D’un même mouvement, ils écartèrent les rideaux du naos et promenèrent un regard curieux à l’extérieur.
Le steam remontait le fleuve. Lentement les rives fuyaient en sens inverse, toujours bordées d’habitations coquettes, de jardins fleuris, de palmiers géants. Au loin, empruntant à l’atmosphère une teinte violacée, se profilaient les premières rampes de la chaîne Lybique[2] qui, sur un parcours de trois mille kilomètres, borde le Nil et limite à l’ouest la zone utilisable pour la culture.
Et comme ils restaient là, pris par la beauté du spectacle qui se déroulait devant eux, le yacht dépassa une pointe de terre qui masquait l’horizon à bâbord, et le grand fleuve égyptien leur apparut dans toute sa splendeur triomphante.
Ils étaient parvenus au sommet du Delta, ainsi nommé, on le sait, à cause de sa ressemblance avec la lettre grecque D. Derrière eux, les branches de Rosette et de Damiette s’ouvraient. En avant, le Nil, bleu sous le ciel bleu, semblait un lambeau de la voûte céleste tendu au milieu de la plaine d’Égypte, un tapis immense jeté sur le chemin d’un triomphateur gigantesque. Et, haletant au départ de la gare de El-Menami, un train soufflait sa fumée blanche sur la rive gauche du cours d’eau.
Et alors, pour la première fois, Robert Lavarède éprouva une émotion étrange. Les grandeurs, les monarques, les religions éteintes, toutes ces choses que la lente poussière des siècles recouvre d’un manteau d’oubli, ainsi que les sables du désert dévorant les plaines cultivées, toutes ces choses prirent corps en son esprit.
Il oublia l’heure présente. Ce n’était plus l’Angleterre qui commandait en Égypte, c’était un Pharaon de la VIème dynastie, le front ceint du pschent (le bandeau royal), la main armée du sceptre, sur le manche duquel était gravée la formule hiéroglyphique de la vie. Gravement il s’inclina devant des ibis, les anciens oiseaux sacrés, qui, dans les roseaux du rivage, se livraient tranquillement à la pêche.
La voix d’Astéras s’éleva soudain et le fit frissonner.
– Vois, disait le savant, elle nous a fait signe.
– Elle, qui cela, balbutia-t-il ?
– Maïva.
Avec humeur, il regarda dans la direction indiquée par Ulysse. Sur le pont, surveillée de près par Niari, la muette se promenait, et elle souriait de loin aux voyageurs.
Lavarède haussa les épaules. Que lui importait cette petite Égyptienne moderne à lui, dont le rêve, sur l’aile du souvenir, explorait le sépulcre d’un féerique passé.
– Où sont les ruines de Memphis ? demanda-t-il après un silence.
– Memphis ?
– Oui.
– Au sud du Caire. Comme nous nous arrêterons dans cette dernière ville, à ce que j’ai cru comprendre du moins, nous ne les apercevrons pas.
– Ah ! tant pis.
Et sans prendre garde à la surprise de son interlocuteur, il se replongea dans sa rêverie.
Cependant, le vapeur poursuivait sa route ; il dépassa le barrage inachevé que Mehemet-Ali avait entrepris en 1848, afin que les branches du Nil fussent navigables en toute saison, puis les pyramides de Chéops et de Chléphrem. Il fila devant les quais de Boulak, le port du Caire, et enfin vogua devant l’énorme agglomération qui forme la capitale du pays.
Les dômes arrondis, les terrasses, les minarets se succédèrent. Les quais interminables, encombrés par une foule grouillante et multicolore, parcourus par des omnibus, des voitures, des âniers, défilèrent sous les yeux des Français.
Une impatience les prenait. C’était là, dans cette ville, où ils allaient aborder, qu’on leur apprendrait sans doute le mot de l’énigme qui les avait entraînés de Paris sur la terre africaine.
Enfin ils allaient comprendre quelque chose à leur aventure.
Et rassérénés par cette pensée, ils suivirent de bonne grâce Niari, qui vint leur annoncer que le seigneur hindou Radjpoor les attendait au salon d’arrière pour déjeuner.
Coquette était la pièce, délicats furent les mets arrosés, luxe auquel ils furent sensibles, d’excellent champagne frappé.
Mais ils ne pouvaient plus observer le fleuve, ni ses berges, car les hublots étaient placés trop haut pour qu’un homme assis vît au dehors.
Aussi le repas leur parut-il interminable.
Toujours le clapotement des aubes battant l’eau arrivait à leurs oreilles.
Le steam ne stoppait donc pas. Quelle était l’étendue de cette ville du Caire, qu’il fallût si longtemps pour arriver au point de débarquement.
Leur hôte ne paraissait pas s’apercevoir de leur inquiétude. Il mangeait lentement, buvait à petits coups, causait de Paris, de ses théâtres, et, pour taquiner Astéras sans doute, affirmait que les étoiles de la scène étaient bien supérieures à celles du firmament.
Mais tout a une fin. Après avoir absorbé un moka parfumé préparé à l’orientale, les Français furent libres de quitter la table. D’un pas pressé, ils gagnèrent aussitôt le pont et regardèrent sur la rive droite où ils supposaient être le Caire.
Une exclamation de dépit leur échappa.
Bien loin en arrière déjà étaient restées les maisons, palais, mosquées de la ville. Le yacht voguait derechef entre des prairies largement arrosées.
Sur la rive gauche, une plaine tourmentée, semée de crevasses, se montra. Bornée par un massif rocheux, de teinte rougeâtre, que les rayons du soleil piquaient de facettes brillantes, elle avait l’aspect morne, tragique, désolé d’une nécropole.
En regardant mieux, Robert distingua des ruines, des colonnes trapues, brisées pour la plupart, des monolithes aux arêtes usées par le temps. Et comme il se retournait vers Astéras, celui-ci murmura entre haut et bas :
– Tu demandais Memphis, tu es servi à souhait.
– Quoi ! ces ruines ?
– Sont tout ce qui reste de la plus populeuse, de la plus riche cité de l’antiquité.
Cette réplique arracha un cri de désespoir à Lavarède.
– Mais alors nous sommes déjà loin du Caire ?
– Quelques kilomètres au sud.
– Et ce damné bateau ne s’arrêtera pas. Oh ! mais j’en ai assez.
Comme il disait ces mots, Radjpoor fumant un cigare émergea de l’écoutille conduisant au salon d’arrière.
Le caissier courut à lui, et d’une voix tremblante de colère :
– Monsieur, s’écria-t-il, je trouve que la plaisanterie a assez duré…
– De quelle plaisanterie parlez-vous ? fit l’Hindou avec le plus grand flegme.
– De celle qui consiste à nous faire voyager contre notre volonté.
Radjpoor s’inclina.
– Malheureusement, Monsieur, il ne dépend pas de moi d’interrompre cette excursion.
– Mais c’est la torture, c’est l’inquisition.
– Bien douce en ce cas, permettez-moi de vous le faire remarquer. Tous mes efforts tendent à vous épargner la fatigue et à vous assurer le confort.
– Mais non la tranquillité d’esprit.
– Qui ne dépend que de vous.
– Pardon, de vous aussi. Et à ce propos, vous vous étiez engagé à télégraphier à ma maison et à l’Observatoire pour expliquer l’absence de mon ami Astéras et la mienne.
– Eh bien mais, c’est fait.
– Allons donc.
– Je tiens toujours ce que je promets, affirma l’Hindou avec une pointe de hauteur. Le brick Pharaon est entré dans le port d’Alexandrie. En quittant le bord, j’ai laissé au capitaine le texte de deux télégrammes qu’il a câblés dès son arrivée.
– Deux télégrammes.
– Par précaution, j’en ai conservé un double.
Sans se départir de son calme, le mystérieux personnage tira son portefeuille, y prit un carré de papier, et le tendant à son interlocuteur :
– Lisez, Monsieur Lavarède.
Le jeune homme obéit et à voix haute énonça les phrases suivantes :
Molbec, Brice et Cie. – Paris-France.
Parti sans pouvoir prévenir. Bientôt de retour. Il s’agit de ma fortune. Respects.
Robert LAVARÈDE.
– Ceci vous concerne, expliqua Radjpoor imperturbable ; au-dessous, vous trouverez la dépêche relative à votre ami.
– Il s’agit de ma fortune, grommela Robert, influencé malgré lui par la formule magique. C’est la seconde fois que vous déclarez cela. Saprelotte, dites-moi au moins où nous allons ?
– Vous tenez à le savoir ?
– Énormément.
– Eh bien, vous allez être satisfait. Aussi bien, maintenant, je ne crains plus que vous me glissiez entre les doigts.
– Mais enfin…
L’Hindou eut un ricanement.
– Nous voguons vers l’île de Philæ.
À ce nom, comme mû par un ressort, Robert sauta en l’air.
– À l’île de Philæ, rugit-il, à plus de mille kilomètres de la côte.
– Exactement quatorze cent vingt-cinq, rectifia placidement Radjpoor.
La réponse n’était pas pour calmer le Français.
– 1425, et vous vous figurez que je vous suivrai.
– Je me le figure.
– Jour de ma vie, j’aime mieux gagner le rivage à la nage.
Ce disant, Robert courait au balcon qui entourait le pont et faisait mine de l’enjamber.
Sans un mouvement, son geôlier se borna à dire d’une voix paisible :
– Je dois vous prévenir que le Nil est infesté de crocodiles.
À l’évocation du hideux saurien, Lavarède qui avait déjà passé une jambe par dessus le balcon la ramena prudemment en arrière.
– Les crocodiles, poursuivit impitoyablement l’Hindou, sont très friands, de chair humaine ; c’est un défaut, mais qui n’en a pas ? En somme, je pense que vous êtes mieux installé sur ce bateau que dans l’estomac d’un de ces animaux.
– Mais, sarpejeu, que voulez-vous que je fasse à Philæ ?
– Y assister à des choses curieuses.
– Je ne suis pas curieux.
– Tant mieux, car vous n’aurez l’air surpris de rien, et c’est précisément ce qu’il faut.
– Ah ! gémit Robert en se prenant la tête à deux mains, voilà les rébus qui recommencent.
– Mais non. Tenez, prêtez-moi cinq minutes d’attention, vous vous rendrez compte que la consigne est d’une simplicité enfantine.
– La consigne, à présent, bégaya le jeune homme.
– La consigne est le mot juste, car en ne l’observant pas, vous encourriez les risques les plus graves.
Et sans prendre garde à la mimique furibonde de son interlocuteur, Radjpoor continua :
– Nous filons vers l’île de Philæ, ainsi que je vous le disais à l’instant.
Là, des amis nombreux vous attendent.
– Des amis, clama désespérément Robert. J’ai des amis en Égypte, moi ?
– Un jour, cela ne vous étonnera plus, mais je reprends : ces amis vous parleront une langue étrange. Il est nécessaire que vous la compreniez, ou du moins que vous sembliez la comprendre.
– Et si je ne comprenais pas ?
– Un coup de poignard vous ouvrirait la poitrine, à défaut de l’intelligence.
Et sur un mouvement de Robert :
– Soyez donc raisonnable. Laissez-vous conduire. Et si votre caractère frondeur de Français vous pousse à la résistance, dites-vous que l’obéissance est d’or, tandis que la rébellion est… d’acier… d’acier pointu.
Puis s’inclinant gravement devant son prisonnier :
– Vous savez maintenant tout ce qu’il m’est permis de vous apprendre.
Quittez cet air morose, et durant les quelques journées que nous avons à passer ensemble, profitez de l’occasion pour étudier cette vallée du Nil, si féconde en souvenirs.
CHAPITRE VI
ENCORE LE BOLIDE
L’Hindou n’avait pas menti. Toute évasion était impossible. N’étant pas le plus fort, le caissier de la maison Brice, Molbec et Cie devait être résigné.
Il le fut, aidé d’ailleurs par l’exemple d’Astéras, qui décidément prenait goût au voyage.
Sur le pont il s’installa sur un rocking-chair, satisfaisant ainsi dans la mesure du possible sa tendance à la situation paisible, et avec un intérêt qu’il cherchait vainement à dissimuler, il vit défiler devant lui les pyramides, tombeaux de granit des souverains de Memphis, le labyrinthe des douze rois, Kephr-El-Ayat, Atfieu, bâtie sur l’emplacement de Cynopolis magna, la ville où les chiens étaient vénérés.
Le jour s’écoula. Les palettes des roues du steam faisaient incessamment écumer les eaux du fleuve. Sans qu’il ralentît sa course, la nuit vint.
La nuit, si l’on peut appeler ainsi le moment où la lune et les astres lointains répandent sur la terre une pluie de rayons lumineux. Dans ce pays où l’air est sec, il n’y a point d’obscurité et comme le disait Théophile Gautier, ce peintre exquis de la légende des Pharaons : ici, un jour bleu succède à un jour jaune.
Cependant la disparition du soleil semblait donner le signal du réveil à la nature endormie sous les feux du jour. Les roseaux s’agitaient, des claquements de mâchoires, des cris plaintifs résonnaient au loin. C’étaient les crocodiles, hôtes sacrés du Nil, qui secouaient leur paresse diurne pour se mettre en chasse.
Astéras, Lavarède, caressés mollement par la fraîcheur du soir, s’abandonnaient à la douceur de vivre sans pensée dans un décor de rêve.
Et tout à coup, ils tressaillirent. Les cordes d’une guzla avaient vibré dans l’espace, jetant dans la nuit transparente les notes d’un prélude.
Tous deux se levèrent, cherchant le musicien. Et debout à la poupe relevée, drapée dans sa tunique blanche, ils aperçurent la forme frêle et gracieuse de Maïva.
Imprécise dans la nuit transparente, elle semblait la divinité du fleuve, la berceuse poétique et tendre fille de Hopi-Mou, père des eaux.
Auprès d’elle un matelot se tenait.
Elle préluda encore, puis commença un accompagnement large et grave, tandis que son compagnon chantait.
Tout l’équipage du léger yacht s’était dressé ; tous écoutaient dans une attitude de respect, la tête découverte. Les coups sourds des pistons formaient une basse étrangement rythmée à l’harmonie troublante des musiciens.
Les syllabes sonores du dialecte d’Égypte passaient dans l’air, et leurs vibrations courant sur les eaux éveillaient les échos endormis des rives, donnant l’illusion d’un chœur éloigné qui aurait répondu au chanteur.
Charmés, surpris aussi par l’attitude des matelots, les Français écoutaient sans comprendre le sens des paroles. Un trouble indicible les envahissait, et ils se demandaient :
– Quelle est donc cette mélopée qui nous émeut ainsi, bien que l’idiome employé nous soit inconnu ?
Comme pour répondre à leur pensée, Radjpoor s’approcha d’eux.
Il était pâle, une expression douloureuse contractait ses traits, et il murmura d’une voix tremblante :
– Ceci est la légende d’Oph, la Thèbes aux cent portes, la Diospolis magna. C’est le chant d’agonie et d’espoir des Pharaons expirants sous le glaive de l’étranger ; c’est l’hymne de liberté de l’Égypte asservie !
Puis d’un ton lent, frémissant d’une émotion intérieure inexplicable, il traduisit les strophes énoncées par le matelot :
Le retour de l’étoile libre
« Les Pharaons sont morts. – Le collège des hiéroglyphites, dépositaires de la sagesse des siècles – est en ruines et la ronce croît sur ses murs écroulés. – Les tarischeutes n’embaument plus les corps pour l’éternité – mais Ammon-Ra et Phré – dans le palais sans bornes de l’infini, veillent.
Sous l’ongle rigide du temps – lentement les pyramides s’effritent. – Les nécropoles de la chaîne Lybique, les Memnonia – sont profanées par les barbares, mais le sphinx mutilé, informe, – garde le secret des grandeurs futures de l’Égypte, – qu’Ammon-Ra et Phré, dans le palais sans bornes de l’infini, lui confièrent.
Tout est nuit, tout est néant, tout est poussière. – Le sein du Nil-Roi est déchiré – par la proue des barques de l’envahisseur – Sous le talon des barbares, le sol gémit – mais les étoiles brillent au ciel inviolé, flambeaux – qu’Ammon-Ra et Phré, dans le palais sans bornes de l’infini, allumèrent.
L’espoir n’est pas mort au cœur des vaincus – un libérateur viendra, tenant l’épée – sur son front scintillera le diamant d’Osiris – il sera précédé par l’astre errant en tous sens – libre soleil des résurrections – qu’Ammon-Ra et Phré, dans le palais sans bornes de l’infini, créèrent. »
La musique s’éteignit, le chant se tut, et Radjpoor cessa de parler.
Les voyageurs restaient muets, bercés encore par la cantilène, toute parfumée de la poésie astronomique et mystérieuse des grammates disparus depuis de longs siècles.
Un cri, répété par tous les matelots, les fit se lever en sursaut.
Les Égyptiens, les bras tendus vers le ciel, désignaient une magnifique étoile filante en hurlant avec enthousiasme :
– Hathor ! Hathor !
– Que disent-ils, interrogea Lavarède ?
– Hathor, dans l’ancienne mythologie du pays, était le génie du feu, de la lumière.
Il s’interrompit brusquement :
– Ah ! sapristi !
– Qu’est-ce qui te prend ?
– Mais là, cet astre qui file dans le ciel.
– Eh bien ?
– C’est mon satané bolide… et avec leur chanson de tout à l’heure, tu comprends leur joie.
– Rien du tout.
– Mais si. Le poète leur prédit que la liberté sera proche, lorsque l’on verra dans le ciel un astre errant en tous sens, libre soleil des résurrections, qu’Ammon-Ra et Phré, dans le palais sans bornes de l’infini, créèrent.
– Alors, tu crois ?
– Parbleu ! Ce coquin de bolide répond au signalement… Ils se figurent déjà être délivrés des conquérants… présentement natifs de la Grande-Bretagne.
Et changeant de ton :
– Dire que je ne possède aucun instrument pour observer ce phénomène céleste !
Oubliant l’endroit où il se trouvait, Astéras se précipita en avant, comme pour se rapprocher du météore. Mais, repris par sa passion astronomique, il calcula mal son élan. Il vint buter dans le garde-fou. Celui-ci était assez bas, si bien que le savant, emporté par sa vitesse, bascula, et le haut du corps continuant le mouvement commencé, tandis que les jambes étaient retenues par le balcon, il piqua une tête dans l’eau claire du Nil.
Aux cris de Lavarède, la machine stoppa aussitôt ; le yacht décrivit un cercle et revint vers l’endroit où Ulysse barbottait désespérément.
On le repêcha, on le remonta sur le pont à demi évanoui.
Mais il reprit promptement ses sens, et la première personne qu’il aperçut auprès de lui fut la muette Maïva. Profitant du désarroi général, la jeune fille avait couru à l’astronome, et son joli visage contracté par l’inquiétude, elle lui avait pris la main qu’elle pétrissait nerveusement.
Il lui sourit. Aussitôt la figure de Maïva s’éclaira, et Ulysse voulant lui expliquer la cause de l’accident, lui montra le bolide qui fuyait vers l’horizon, en lui donnant le nom que les matelots lui avaient appliqué :
– Hathor !
À son grand étonnement, Maïva inclina la tête d’un air reconnaissant, et porta à ses lèvres la main du savant. Avant qu’il eût pu chercher à deviner la signification de cette pantomime, Niari surgissait brusquement devant lui et entraînait brutalement la jeune esclave.
Furieux, Astéras voulut se ruer sur le sinistre personnage, mais des matelots l’entourèrent, et malgré sa résistance le conduisirent à la cabine où ils l’enfermèrent.
La fraîcheur de ses habits mouillés calma bien vite le bouillant astronome. Il s’empressa de les dépouiller et de revêtir un complet de rechange qu’une main inconnue avait disposé bien en vue sur le divan.
Comme il finissait, Lavarède vint le rejoindre, et tout en se préparant à dormir, il lui posa cette question :
– Dis donc, Astéras. Crois-tu qu’une fois à Philæ, on nous lâchera ?
– Oh ! je n’en sais rien, du reste je ne pense pas à cela.
– Moi, je ne pense qu’à cela, voilà la différence.
Et d’un ton boudeur :
– C’est égal, si j’avais su ce qui devait arriver. Je te jure bien que je n’aurais pas été te chercher à l’Observatoire.
Il se jeta sur le divan qui lui servait de lit, en bougonnant.
– Ah ! mon pauvre bureau ! Quand te reverrai-je ?
Mais l’influence bienfaisante de la station horizontale apaisa bientôt ses nerfs surexcités. Il étendit les bras, s’accota confortablement, et avec un bâillement sonore :
– Si encore on pouvait dormir toujours, on ne s’apercevrait pas que l’on voyage.
Observation judicieuse, à laquelle Ulysse ne répondit pas et pour cause. Les émotions de sa baignade involontaire avaient épuisé ses forces. Il dormait à poings fermés.
La nuit s’écoula sans incident.
Au jour, Robert s’étira, se frotta les yeux, s’assit sur son séant, après quoi il alla secouer l’astronome, et celui-ci tout ensommeillé demandant d’un air ahuri :
– Hein ? Quoi ? Que veux-tu ?
– Te questionner.
– Tu aurais pu attendre.
– Pas une seconde. La chose est d’un trop haut intérêt. Là, es-tu bien éveillé ?
Il le secoua une dernière fois pour lui débrouiller les idées et curieusement :
– Hier, quand tu es tombé à l’eau, aucun crocodile n’a tenté de te dévorer !
– Non, aucun, fit Astéras en frissonnant ; mais si c’est pour cela que tu m’as réveillé en sursaut ?…
– Laisse-moi parler. Je conclus de l’expérience que ces animaux ne sont pas aussi terribles que le seigneur Radjpoor voulait bien le dire.
– Et alors ?
– Alors, j’ai grande envie de reprendre mon projet. Sauter dans le fleuve et tirer ma coupe vers le bord.
Du coup, le calculateur sauta sur ses pieds.
– Ne fais pas cela.
– Et pourquoi, s’il te plaît ?
– Parce que tu serais sûrement dévoré.
– Allons donc ! Tu vas me faire croire que les crocodiles ont des préférences ; ils ne t’ont pas mangé, toi…
– Par une raison simple.
– Ils respectent l’astronomie en ta personne, peut-être.
– Non, mais je suis tombé au milieu du courant qu’ils évitent. Ils se tiennent généralement près de la rive ; c’est là qu’ils attendent leur proie, et le péril n’est pas dans la traversée du fleuve, mais bien dans l’atterrissage.
– Tu crois ? insista Robert dont cette explication avait assombri le front.
– Je suis certain de ce que j’affirme.
– Alors, ne pouvant filer, il me faut aller jusqu’à l’île…
– De Philæ, oui, mon ami, c’est le plus sage, avec ou sans calembour.
À dater de cette conversation, le caissier de la maison Brice, Molbec et Cie, ne parla plus d’évasion.
– La fatalité pèse sur moi, disait-il, les Lavarède sont destinés à voyager de gré ou de force. Témoins : mon cousin et moi.
Mais s’il se déplaçait, c’était avec la mauvaise volonté la plus évidente. Tout le jour, il s’étendait sur une chaise à bascule. Le soir venu, il regagnait sa cabine et se vautrait sur les divans.
Et cependant le steam poursuivait sa route vers le sud, laissant peu à peu l’Égypte civilisée en arrière. La vallée se rétrécissait. De chaque côté, les chaînes de montagnes Lybique et Arabique se rapprochaient du fleuve, limitant à quelques kilomètres la plaine cultivable. Au delà, derrière ces remparts de granit, le désert aux sables fauves commençait.
Abidos, Diospolis parva, Coptos étaient dépassés. Le point terminus du chemin de fer qui longe le Nil était perdu de vue. Et dans la campagne silencieuse, où travaillaient des fellahs demi-nus, serrés dans un pagne étroit, comme les contemporains de Mosche et d’Aharon, plus rien ne trahissait la vie actuelle.
L’ancienne Égypte se montrait dans sa grandeur puissante, dédaigneuse des stériles agitations des conquérants d’Europe. Ses monuments restés debout, alors que des empires, des nations, des religions même ont disparu sans laisser de traces, bordaient le Nil de témoignages irrécusables d’une civilisation auprès de laquelle la nôtre n’est que barbarie.
L’Allée de Karnac, ornée jadis de deux mille sphinx à tête de bélier, les ruines stupéfiantes de Thèbes, amas de colonnes, de chapiteaux, de temples, de palais déserts s’étendaient sur la rive droite, tandis qu’à gauche, se voyaient les vestiges du quartier des Memnonia, les flancs des monts Lybiques percés de trous innombrables ainsi qu’une éponge de pierre. Les voyageurs songeaient que là, dans les cavernes, les générations disparues, les habitants contemporains de la gloire de Diospolis, avaient dormi leur dernier sommeil sous des bandelettes enduites de natron. Plus loin s’ouvrait la Vallée de Biban-El-Molouch, gorge torréfiée par le soleil, où de patients troglodytes avaient fouillé dans le flanc même de la montagne, les palais aux salles spacieuses, aux couloirs interminables destinés à recevoir la dépouille des rois de Thèbes.
Toutes ces ruines, ces nécropoles, gardaient comme un rayonnement des temps superbes où les Pharaons régnaient. Sous les corniches branlantes, où se posaient paresseusement les ibis indolents, sous les frontons ébréchés autour desquels les gypaètes décrivaient de larges cercles, il restait quelque chose de la vénération des hommes d’Égypte pour leurs dieux détrônés. L’âme du plus grand peuple de l’antiquité planait encore sur ces solitudes.
Et Astéras, avec sa face ronde comme le cercle emblématique qui couronne les statues d’Isis, semblait une divinité d’autrefois, lorsqu’il expliquait à Robert la religion des Thébains.
– Pour le peuple, déclarait-il, toutes les figures symboliques étaient devenues les dieux ; mais pour les prêtres, les grammates, les hiéroglyphites, les classes sacerdotale et guerrière, chaque image correspondait à une loi des nombres. La divinité était une, infinie, inexplicable, intraduisible, et pour tout dire d’un mot, astronomique ainsi que chez nos druides gaulois. Dès l’origine, l’astronomie a passionné les Égyptiens. Les mouvements des astres, les éclipses, les variations de l’écliptique, la position exacte des constellations au début des crues du Nil, tout avait été noté, classé, catalogué, traduit en nombres. Ce sont ces nombres que l’on représentait sous formes d’hommes à tête de chien, de bélier, de renard, d’oiseaux. Osiris, Isis, Horus, tous symboles de phénomènes astronomiques, dont le sens réel échappait aux foules, mais était jalousement conservé dans les collèges des rites.
Lavarède ne bronchait pas sous cette averse d’érudition. Bercé par le mouvement du bateau, alourdi par la tiédeur du jour, alangui par l’inaction, il avait l’impression brumeuse de vivre un songe, de dormir dans la veille.
Tout se confondait en son imagination, les époques mythologiques et l’heure présente ; il mêlait, dans un même respect de moderne pour les anciens, de jeune homme pour les ancêtres, les villes mortes et les nouvelles cités poussées sur les ruines, ainsi que les pariétaires entre les pierres disjointes d’une muraille ébranlée par les vents.
Taphium, Latopolis, Apollinopolis, Tanyès, Onibos, noms de centres détruits, conservés par l’histoire, se heurtaient sous son crâne aux réalités présentes d’Esheb, de Bédézien, d’Assouan, et nonobstant son complet d’allure très anglaise, il eût par moment été bien empêché de dire s’il était un Gaulois du dix-neuvième siècle, ou bien un scribe de l’époque reculée où régnait le Pharaon Ménephta[3].
Pour sa raison, il était grand temps que le voyage finît. Enfin, après huit journées de navigation, ayant dépassé Assouan, cité construite en face de l’Éléphantine des Grecs, le steam rallia la rive gauche.
La manœuvre tira Robert de sa torpeur.
– Nous allons aborder, demanda-t-il à Radjpoor qui se tenait près de lui comme à l’ordinaire.
– Oui. La chaloupe ne saurait aller plus loin. Le cours du Nil est barré par la première cataracte.
– Qui, si je me souviens bien, n’a de cataracte que le nom. Elle est composée en réalité d’une succession de rapides…
– Précisément… limitée au nord par Éléphantine, elle l’est au sud…
– Par l’île de Philæ, point terminus de nos pérégrinations.
L’Hindou eut un sourire énigmatique, mais ne répondit pas.
D’ailleurs le steam abordait. Aussitôt, comme des diables sortant d’une boîte, un groupe de chameliers, tirant après eux des dromadaires sellés, s’élancèrent hors d’un bouquet voisin de palmiers et de lentisques. Les nouveaux venus se rangèrent en face de l’endroit où le yacht avait stoppé.
– Que veulent ces gens, murmura Robert ?
– Ils nous amènent nos montures, déclara Radjpoor.
– Comment, je devrai me hisser sur un chameau ?
– Sans doute !
– En voilà une occupation pour un caissier… Enfin, le vin est tiré, il faut le boire…
Puis avec un sourire :
– Mon proverbe est inepte… Parler de boire devant un animal qui s’en passe si facilement.
La passerelle de débarquement avait été jetée entre le pont et la rive. Sur l’invitation de leur guide, les Français la traversèrent. Au même instant, les chameliers faisaient agenouiller leurs bêtes, et les deux amis, saisis par dix mains se trouvaient sans savoir comment à califourchon sur deux mehari aux jambes nerveuses, qui se redressèrent aussitôt.
Radjpoor, Niari, Maïva étaient déjà en selle. Un sifflement déchira l’air, et les bêtes, comme si elles avaient attendu ce signal, partirent d’un trot allongé, dont leurs cavaliers étaient agités ainsi que par le tangage d’un navire ballotté par la tourmente.
Cramponnés au pommeau de la selle, secoués comme salades en un panier, ni Robert, ni Ulysse n’eurent le loisir d’admirer les eaux du Nil bondissant écumeuses entre deux murailles de rochers. Le spectacle des rapides devient indifférent à des gens qui ont peur d’être précipités à terre. Furieux, Lavarède cria, menaça, sans que personne y fît attention. Ses clameurs n’eurent d’autre effet que d’accélérer la course de sa monture, et bientôt, lassé, essoufflé, moulu, l’infortuné cavalier renonça à se plaindre, concentrant tous ses efforts sur un objectif unique : se tenir en selle.
Combien de temps dura cette épreuve. Ni lui, ni l’astronome n’auraient pu le dire ; mais le cours du fleuve devint moins tumultueux, le trot des dromadaires se ralentit, et au fond d’une anse où clapotait une eau tranquille, en face d’une île verdoyante émergeant comme un bouquet du milieu du courant, la caravane s’arrêta enfin.
Une barque légère était amarrée au rivage. Deux fellahs bronzés, au torse demi nu, indolemment étendus sur le sable, se levèrent à la vue de la petite troupe. Ils coururent au devant de Niari.
Celui-ci leur parla vivement, désignant successivement du geste Radjpoor et les Français qui se laissaient glisser de leurs dromadaires. La surprise se peignit sur le visage des indigènes, et comme Robert s’approchait, tous deux d’un même mouvement, mirent un genou en terre, étendant les bras en avant, dans l’attitude anxieuse et suppliante des « Adorateurs » des bas-reliefs égyptiens.
Le caissier de la maison Brice et Molbec les considéra d’un air ahuri, il allait demander l’explication de cette étrange attitude, mais Radjpoor se pencha à son oreille, et d’une voix à peine perceptible, murmura :
– Paraître tout comprendre ; sinon, la mort.
Lavarède tressaillit. Son regard croisa le regard dur et ironique de l’Hindou. Puis il répondit :
– Tout comprendre est le moyen d’arriver à la fortune ?
Son interlocuteur abaissa la tête pour affirmer.
– Alors, je me laisse faire – et avec l’emphase comique d’un grand seigneur d’opérette – relevez-vous, mes braves. C’est très fatigant d’être à genoux, laissez cette posture aux petits enfants qui ont mérité le bonnet d’âne.
Une vive douleur au côté lui coupa la parole. Radjpoor venait de le piquer de la pointe de son poignard, et il lui disait d’un ton menaçant :
– Le silence est d’or… la parole est d’acier…
– C’est vrai, balbutia le jeune homme en se frottant la partie blessée, seulement laissez-moi vous donner aussi un avertissement. Une autre fois, prévenez-moi plus doucement, ne me lardez plus ; car vous apprendriez que, si le silence est d’or et la parole d’acier, mon poing est… de plomb.
Un éclair livide passa dans l’œil sombre de l’Hindou ; ses lèvres se contractèrent découvrant ses dents blanches, acérées comme celle d’un chacal, mais ce fut d’un ton calme qu’il prononça ces mots :
– Que Votre Seigneurie me pardonne de lui rappeler que nos frères attendent sa venue. Le soleil précipite sa course, il est temps d’embarquer.
Et sans prendre garde à l’air hébété dont Lavarède écoutait ce discours, il l’entraîna vers le bord du fleuve avec les apparences du plus profond respect, et le fit monter dans la barque amarrée au rivage.
Rapidement, Ulysse, Niari, Maïva et lui-même s’entassèrent au fond du bateau, tandis que les fellahs, prenant place au banc des rameurs, se penchaient sur les avirons.
L’embarcation s’éloigna de la berge, piquant droit sur l’île de Philæ – car c’était elle – dont les verdures s’étalaient au milieu du fleuve.
CHAPITRE VII
LA CRYPTE DE TEPURABOË
Luttant contre le courant, les rameurs contournèrent la pointe extrême de l’île, puis longèrent ses berges escarpées, formées de rochers rougeâtres.
Une fissure étroite, aux parois à pic, se découpa dans la muraille rocheuse. On eût dit la coupure nette d’un sabre manié par un Titan. Lentement, la barque s’y engagea. Les avirons touchaient presque le roc de chaque côté du canot. Après s’être frayé un passage à travers un léger rideau de lianes, dont les linéaments effleurèrent le visage des passagers, tous se trouvèrent brusquement plongés dans l’obscurité. La « coupée » devenait tunnel.
Cependant l’allure de l’esquif n’en fut pas ralentie. Loin dans l’ombre, une lueur indécise vacillait, comme un phare indiquant la route aux navigateurs.
Un grincement fugitif, un choc léger se produisirent ; la quille traînait sur le fond ; le canot s’arrêta. D’un bond les rameurs s’élancèrent sur une étroite corniche qui formait quai, et soutenus par eux, les Français débarquèrent. À pied maintenant, la main frôlant les parois de la roche, ils continuèrent à avancer dans la direction de la clarté.
Au bout de cent pas, les guides les avertirent que l’eau finissait en cet endroit ; désormais toute la largeur du corridor était praticable.
Le sol, couvert de sable fin, était doux sous les pieds. Sans doute, les habitants inconnus du souterrain l’entretenaient avec soin. Silencieux, le bruit de leurs pas assourdis résonnant seul sous la voûte, Robert et Ulysse allaient toujours, ayant à la fois hâte et crainte d’arriver là, où on les menait.
Que verraient-ils ? Quel mystère effrayant les attendait au bout du chemin ? Ce mystère en face duquel, selon l’expression concise et tragique de Radjpoor, le silence était doré et la parole mortelle ?
Peu à peu, la lueur qui les dirigeait augmentait d’intensité, emplissant l’étroit boyau de lumière diffuse, de scintillements arrêtés au passage par les facettes de la roche.
Enfin par une large baie, que fermait à demi une lourde draperie, la petite troupe pénétra dans une salle de vastes dimensions.
Évidée dans le massif granitique, son plafond était soutenu par six colonnes prises dans la masse de la couche géologique.
Sur les murs s’étalaient des peintures, des bandelettes de fresques séparées par des lignes verticales d’hiéroglyphes. Des formes d’éperviers, de scarabées aux élytres jaspées de vert se distinguaient tout d’abord. Sur les colonnes, des baris (barques) mystiques, des bœufs Apis portant des momies étaient figurées en relief méplat. Juste en face des arrivants, deux personnages gravés et peints sur la pierre, coiffés de mitres et la main étendue sur un cercle jaune, semblaient deux sentinelles veillant à côté d’une porte trapézoïdale, dont le linteau était orné de deux cartouches tenus par des femmes ceintes de pagnes étroits, qui déployaient ainsi que des ailes leurs bras garnis de plumes.
– Ah ça ! dit Astéras, nous sommes dans un tombeau contemporain des Pharaons. Ceci ressemble à la pièce qui servait d’antichambre à la salle du sarcophage. Tous les palais funèbres de l’Égypte ancienne sont creusés suivant le même modèle… Les études des Champollion, des Belzoni, des Wilkinson, des Lepsius, des Nauër et des Felistein ne laissent aucun doute sur ce point. Et même, à la dimension de cette crypte, au soin qui a présidé à son ornementation, il est à présumer que cette tombe était celle d’un puissant personnage, peut-être même d’un souverain.
Mais l’attention des jeunes gens est détournée par des apparitions, bien vivantes celles-là.
Masqués jusqu’alors par les colonnes, des hommes se montrent. Tous ont la peau d’un brun rougeâtre, comme les rameurs qui ont conduit les voyageurs. N’était leur costume, on reconnaîtrait en eux des fellahs ; mais leur accoutrement étrange fait écarter cette pensée.
L’un porte sur la cuisse un tambour au ventre bombé tendu de peau d’onagre. Nu jusqu’à la ceinture, il a pour vêtement une jupe courte plissée ornée de serpents bleus. Son voisin emprisonne son torse dans une tunique, serrée par une ceinture à palmettes d’or, dont les extrémités retombent jusqu’à ses pieds. Un troisième porte une enseigne représentant un chacal sacré. Les deux suivants, la tête couverte d’un léger casque surmonté d’une plume d’autruche, les reins enveloppés d’un pagne à plis raides, la targe ou épée d’airain suspendue à un baudrier d’azur, reproduisent avec exactitude la tenue des oëris ou chefs militaires de la légende pharaonienne.
Et parmi ces gens, qui semblent descendus des fresques funéraires des nécropoles d’autrefois, un grand gaillard au teint basané, coiffé d’un tarbouch, couvert de la veste étriquée, du long jupon plissé des derviches tourneurs d’aujourd’hui, fait l’effet d’un anachronisme animé, d’un Égyptien fin de dix-neuvième siècle jeté par une facétie osirienne en pleine cour d’un souverain de Thèbes.
– Qu’est-ce que c’est que cela, commence Lavarède ?
Mais Radjpoor, avec un regard expressif, pose un doigt sur ses lèvres, et le jeune homme renfonce sa surprise.
Quant aux personnages bizarrement costumés, ils viennent au caissier, s’agenouillent comme ont fait les rameurs, puis l’un d’eux se relève et d’une voix lente :
– Maître, dit-il, permets à tes serviteurs de te guider dans ton palais. Les poussières de la route ont terni ta beauté. Le bain parfumé t’attend. Abandonne-toi à nos soins, avant de revêtir la tunique de lin et de ceindre ton front du pschent.
– Le pschent, mais c’est le bandeau royal, murmure l’astronome !
– Vrai, réplique Robert sur le même ton ; alors cela devient amusant et puis… le silence étant d’or, je n’ai qu’à obéir.
D’une voix plus haute, il continue :
– Je remercie mes serviteurs et suis prêt à les suivre.
À cette déclaration, les singuliers personnages s’inclinèrent derechef, et processionnellement se dirigèrent vers la porte située au fond de la salle.
Derrière eux, Lavarède la franchit, parcourut des corridors aux murs couverts de peintures hiéroglyphiques et éclairés par des lampes de cuivre. Il descendit un escalier de quinze marches hautes et raides, et enfin pénétra dans une pièce, dont les parois était colorées d’une teinte lilas tendre que rehaussait une corniche enluminée de tons éclatants et de motifs dorés. Sur les panneaux, des gerbes de fleurs, des oiseaux, des damiers aux couleurs alternées. Et sur le sol revêtu d’un carrelage blanc, où des arabesques d’ocre rouge figuraient un tapis, une baignoire de marbre affectant la forme curieuse d’un bœuf agenouillé, courbant son dos pour recevoir le baigneur, gonflant ses flancs tachetés de noir comme l’Apis. Auprès de cet animal-meuble, un escabeau de cèdre et une table de marqueterie précieuse supportant un miroir à pied d’ivoire, des buires d’agate rubanée contenant des eaux de senteur, des spatules à parfums, des ciseaux, des limes, mille objets de toilette aux formes contournées et gracieuses.
À l’entrée de ce cabinet de toilette, calqué sur ceux des élégantes d’il y a quarante siècles, Robert s’arrêta un moment. Barbare moderne, accoutumé au confort industriel, il ressentait son infériorité devant cet art exquis, prodigue et prodigieux de l’Égypte, qui ruisselait à profusion sur toutes choses, depuis la pyramide géante jusqu’à la lime minuscule à polir les ongles.
L’escorte de Lavarède s’était retirée.
Comme des statues de bronze, deux Éthiopiens à la face simiesque, couverts seulement d’un caleçon court, montraient leurs torses noirs, à la peau brillante, sous laquelle saillaient les muscles.
Ils s’emparèrent du caissier, le dépouillèrent de ses vêtements, le plongèrent dans la baignoire emplie d’eau tiède et parfumée. Puis ils le massèrent, enduisirent ses membres d’huiles aromatiques.
– Jusqu’à présent, se confia le jeune homme, l’aventure n’est pas désagréable. S’il suffit de se laisser dorloter pour arriver à la fortune, je serais bien bête de résister.
Et sur cette réflexion, il revêtit docilement une tunique de lin bordée d’un large galon d’or, sur lequel se dessinaient en arabesques des croissants isiaques et des serpents azurés. Sur sa chevelure lissée et parfumée, il permit aux nègres de poser le pschent, dont les barbes cannelées tremblottaient le long de ses joues.
Un des noirs lui présenta le miroir. Il se regarda et eut peine à retenir un cri de surprise. Celui dont la glace lui renvoyait l’image n’était plus le Robert qu’il connaissait, mais bien un être nouveau, tel que ces Pharaons reproduits par le ciseau patient des sculpteurs Égyptiens sur les pages de granit des temples.
Il était prince d’une dynastie oubliée. Sa figure brune prenait une étrange majesté sous le pschent dont le bandeau était troué, juste au milieu du front, par l’œil osirien à la prunelle rouge. Et comme il restait là, hypnotisé par sa brusque transformation, ceux qui l’avaient accompagné naguère reparurent, et l’oëri qui déjà lui avait adressé la parole, reprit :
– Maître, Yacoub, fils de Hador, et le conseil des Sages attendent ton bon plaisir.
– Eh bien, répliqua gaiement Lavarède, ne les faisons pas languir. Après tout, l’exactitude est la politesse des rois ; guide ton maître vers Yacoub et les Sages dont tu parles.
On quitta la salle de bain. De nouveau on parcourut des corridors étroits, puis l’on arriva devant une porte massive encadrée de globes verts, qui semblaient soutenus par des ailes d’or déployées.
Celui qui paraissait être le chef de l’escorte frappa l’huis de plusieurs coups espacés de façon particulière. Le battant tourna lentement sur ses gonds, et une exclamation admirative s’échappa des lèvres du caissier.
Il était sur le seuil d’une salle immense, dont la voûte teintée en bleu, ornée de palmettes jaunes, s’arrondissait en dôme à trente pieds de haut. Sur les murs des peintures aux couleurs éclatantes, des globes symboliques ailés, des cartouches royaux, des serpents gonflant leurs gorges rouges, carminées, vertes, des dieux à têtes d’animaux, des scarabées prenant leur vol, Isis et Nephtis secouant leurs bras empennés ; toute la mythologie égyptienne enfin s’agitant en un dessin intense, en une peinture éclatante.
À l’une des extrémités de la salle, une estrade était dressée, gardée par des oëris, le sabre nu au poing, et entourée de flabellifères agitant au bout de hampes dorées des éventails de plumes. Trois fauteuils, dont l’un plus élevé que les autres, figuraient des lions d’or dressés et supportant les sièges formés de couronnes de lotus bleus et roses recouvertes de coussins de pourpre.
Le trône le plus haut était inoccupé. Sur le siège placé à la droite de celui-ci était assis un vieillard à la longue barbe blanche, la tête rasée, le corps couvert d’une peau de panthère, les pieds chaussés de sandales de biblos, et portant à la main une canne d’airain.
Sur celui de gauche, immobile, comme absente, se tenait une jeune fille d’une merveilleuse beauté. Ses traits offraient l’idéal du type égyptien le plus pur. Des tons d’ambre et de rose coloraient sa pâleur ; ses grands yeux noirs, allongés d’antimoine suivant l’usage des femmes de la vallée du Nil, regardaient dans le vide avec une indicible tristesse que l’on s’étonnait de remarquer sur un visage si jeune, à la bouche enfantine, au nez d’un exquis modelé. Une pintade, dont les ailes éployées retombaient sur les oreilles de la jeune fille, la coiffait d’une sorte de casque constellé de points blancs ; de grands disques d’or luisaient à ses oreilles, et sur sa poitrine, cachant la robe blanche terminée par une large bordure bleue, un pectoral entrechoquait au moindre mouvement, avec un cliquetis harmonieux, les émaux, les perles, les figurines d’or dont il était composé.
Vis-à-vis de ces deux personnages, des bancs étaient rangés supportant une assemblée de guerriers, de prêtres, dont les costumes empruntés aux temps de la grandeur égyptienne coudoyaient les burnous, les vestes soutachées, les larges grègues et les cnémides ou guêtres d’Arabes et de derviches soudanais de notre temps.
En arrière, Astéras, Radjpoor, Niari et la muette Maïva se tenaient debout, adossés au mur.
À l’apparition de Lavarède, nul ne bougea. On eût dit une assemblée de statues ; mais Niari, suivi de Radjpoor, s’avança d’un pas lent vers l’estrade. Parvenu à trois pas du vieillard à la barbe blanche, il s’arrêta, croisa les bras sur sa poitrine, et la tête courbée, l’émotion du mensonge imposé par le faux Hindou faisant grelotter sa voix, il dit :
– Yacoub, chef et initiateur des Neo-Égyptiens, tu as confié une mission à ton esclave Niari. Grâce à Osiris et à Radjpoor-Sahib ici présent, ennemi juré de ceux que nous haïssons, j’ai pu la mener à bonne fin.
Son interlocuteur ainsi que la jeune fille avaient levé la tête au son de sa voix. Une flamme joyeuse s’était allumée dans les yeux de Yacoub, tandis que les regards de l’Égyptienne exprimaient la terreur, et que ses joues se couvraient d’une rougeur ardente.
– Tu as réussi, mon fidèle, répondit enfin le vieillard. Celui que nous attendons est avec toi ?
Niari désigna Robert et prononça ces seuls mots :
– Le voici !
Il n’avait pas achevé que, soulevé comme par une commotion électrique, Yacoub était debout.
D’un pas assuré, il descendit de l’estrade, vint à Robert et se prosterna devant lui, frappant du front les dalles qui recouvraient le sol. Le caissier ne broncha pas. Il commençait à s’accoutumer à ces marques de respect, et il coula un regard vers Radjpoor, comme pour le prendre à témoin de sa belle contenance.
Il vit l’Hindou, un doigt sur ses lèvres, une main sur le manche de son poignard, double geste qui rappelait au Français l’opportunité du silence.
Cependant Yacoub se relevait, et d’un accent chevrotant il parlait en excellent français :
– Sois béni, toi qui as répondu à notre appel. Les haines de races, de familles s’apaisent aujourd’hui pour la résurrection de la patrie opprimée. Mets ta main dans la mienne. Que mon exemple serve à tous ; que tous t’obéissent comme moi, Yacoub fils des Hadors, dont le sol d’Égypte a bu le sang, comme moi qui t’aide à gravir les marches du trône.
Entre ses doigts maigres, aux veines bleuâtres, il avait saisi la dextre du voyageur. Irrésistiblement il l’entraînait vers l’estrade, lui faisait gravir les degrés, le conduisait au trône, et lui mettait en main un long sceptre d’or terminé par un bouton de lotus.
Et tandis que le jeune homme, quelque peu empêtré de sa grandeur, murmurait à part lui :
– C’est aussi cocasse qu’une féerie au Châtelet de Paris, ou à l’Alhambra de Londres !
Yacoub, dressé sur la pointe des pieds, les bras étendus, clamait d’une voix sonore dont vibrait la vaste salle :
– Frères ! c’est lui que nous attendions. Et vous, derviches, guerriers du noir Soudan, dont nous avons sollicité l’appui contre l’ennemi commun, nous le refuserez-vous ? Celui qui fut annoncé est au milieu de nous. Il vient conquérir le diamant d’Osiris et faire revivre les gloires disparues.
Un rugissement sauvage répondit. Toute l’assistance était debout, les épées, yatagans, poignards tirés du fourreau, brandis frénétiquement par des bras fauves, croisaient leurs éclairs sous la lueur jaune des lampes :
– Le reconnaissez-vous pour roi, demanda encore Yacoub ?
Il y eut un seul cri, vibrant comme une fanfare, éclatant comme un coup de tonnerre :
– Oui, oui… qu’il soit notre roi !
Le vieillard se retourna vers Lavarède auquel, il faut bien l’avouer, tous ces gens apparaissaient ainsi que des maniaques agités par un transport de folie.
– Et toi, fils de Chléphrem, veux-tu nous commander ?
Robert hasarda un regard dans la direction de Radjpoor. Par un signe imperceptible, l’Hindou lui conseilla d’accepter :
– Très volontiers, répondit alors le caissier.
– Frères, vous l’entendez, il consent. Salut, ô roi. Tu sais ce que nous attendons de toi ?
– Oh ! certainement, balbutia à tout hasard l’ami d’Astéras.
– Tu iras chercher le diamant d’Osiris ?
– Sans doute, acquiesça Robert avec plus d’énergie. Et pour lui-même il ajouta : Un diamant, cela devient clair, c’est le commencement de la fortune annoncée.
– Et tu le conserveras toujours.
– Cela ne se demande pas.
Puis continuant son monologue intérieur, le jeune homme conclut :
– Je t’écoute que je le conserverai. Un diamant ! Vous pouvez m’en offrir plusieurs. Pas de danger que je vous dise : « n’en jetez plus ! »
Mais ses réponses, bien simples et bien naturelles à son idée, avaient sur les assistants une influence incompréhensible. Ils se serraient les mains, s’entretenaient avec de grands gestes, et soudain, une voix grave entonna un chant large et terrible dans sa simplicité. Les paroles étaient d’une langue inconnue, mais la musique révélait le chant de guerre.
L’attitude de l’assemblée ne permettait pas de doute. On heurtait les épées les unes contre les autres, et le cliquetis de l’acier semblable à l’écho d’une bataille engagée rythmait de façon saisissante l’hymne guerrier.
Tous s’étaient découverts. Mû par une habitude invétérée de politesse, Lavarède oublia qu’il n’avait plus de chapeau, et instinctivement il arracha le pschent de son front. Ce geste inconscient lui valut un triomphe. Un hourrah retentit.
– Le bandeau royal lui-même rend hommage au chant de liberté.
Comme une meute, les guerriers, prêtres, derviches se ruèrent vers l’estrade, et Robert, assis dans son fauteuil, fut enlevé par vingt bras vigoureux, promené autour de la salle, tandis que l’hymne, non plus chanté, mais rugi, formait une basse formidable aux clameurs frénétiques de : Vive le Roi ! Gloire au Roi !
Enfin Lavarède amusé d’abord, bientôt inquiet d’être ainsi ballotté au-dessus des têtes de l’assistance, fit signe que l’on le déposât à terre. On lui obéit. Alors souriant, ravi de ces ovations sur lesquelles il n’était pas blasé, mais guidé par son sens pratique, il s’écria :
– Mes amis, certes, je suis obligé de votre accueil. Jamais nulle part je n’ai été reçu comme cela. Mais je pense, et votre amabilité pensera probablement de même, qu’il serait bon de ne pas oublier le diamant d’Osiris.
Il n’avait pas fini, que les hurrahs recommençaient, bien qu’une partie de l’assistance seule eût pu comprendre le sens de ses paroles. Un peu surpris, il murmura :
– Sapristi ! Voilà de braves gens. Sont-ils heureux de me bourrer de diamants.
Mais Yacoub, agitant la main, rétablit le silence.
– Notre roi a bien parlé, fit-il, je vais le conduire à son appartement et lui apprendre ce qu’il lui reste à faire. Vous, frères, songez aussi à l’avenir !
Au milieu des vivats que soulevait sa courte harangue, le vieillard entraîna Lavarède, et, précédés par deux guerriers armés de l’épée, ils quittèrent la salle, non sans que Yacoub eût jeté à la jeune fille qui, silencieuse et désolée, avait assisté à la scène, ces paroles énigmatiques :
– Lotia, l’heure espérée est venue. Chasse tes pensées funèbres, que ton visage prenne l’expression de l’allégresse, la seule qui se marie avec les vêtements de fête. Souviens-toi !
Une porte retomba sur Robert et son guide, étouffant le bourdonnement confus de l’assemblée.
CHAPITRE VIII
SINGULIÈRE DEMANDE EN MARIAGE
De nouveau Robert parcourait le dédale des corridors de l’hypogée. Mais cette fois, la promenade fut courte. Au bout de cinquante pas, une porte basse se présenta. Les oëris rouvrirent, et s’adossant au mur, élevant leurs épées verticalement, la coquille à hauteur des lèvres, ils laissèrent passer Yacoub et le Français.
Ceux-ci se trouvèrent seuls, dans une petite pièce simplement meublée d’une table de bois commun et de chaises de bambou et de roseaux tressés.
Le vieillard désigna l’un des sièges à Lavarède :
– Daigne t’asseoir, ô Roi. Avant de te conduire auprès de ma fille Lotia, je voudrais t’adresser quelques paroles.
– Je vous en prie, ne vous gênez pas, répliqua gracieusement le caissier en prenant place.
– Quoi que t’ait dit Niari, tu pouvais conserver quelques doutes sur la sincérité de ma résolution.
– Ah ! se récria poliment le jeune homme.
– Pourquoi le nier ? Ici nul ne saurait nous entendre, à quoi bon déguiser ton âme ?
– Puisque vous l’exigez, je conservais en effet des doutes.
Et cette phrase conciliante prononcée, Robert se déclara in petto :
– Ah ! mais, il m’ennuie, le vieux bonze. Il va me faire dire quelque sottise.
Yacoub sourit :
– Tu n’avais pas à t’en défendre. Les siècles avaient passé sans éteindre la haine qui divisait les races de Thanis, issue de Chléphrem et de Hador, descendant des conquérants Hycsos venus d’Arabie.
Sur un geste de vague approbation de son interlocuteur, qui « donnait sa langue aux chiens » devant ce discours incompréhensible pour lui, l’Égyptien poursuivit :
– Aujourd’hui, l’heure est grave. Il ne faut plus de malentendus, d’arrière-pensées. Il faut que notre situation soit nette et claire.
– Ah ! je ne demande pas mieux, s’écria légèrement Robert.
– Je le sais et te remercie de l’affirmer.
– Cela n’en vaut pas la peine.
– Si, il est rare qu’un roi ait ta franchise.
– Mettons que je suis un bon roi et parlez.
– Soit donc ! Écoute. Longtemps nos races luttèrent, élargissant, à chaque génération, le fleuve de sang qui les séparait. Tantôt un Thanis abattait un Hador, tantôt un Hador vengeait ses victimes sur un Thanis.
– Bien, bien, murmura Lavarède, je connais ça, Roméo et Juliette, les Capulets et les Montaigus.
– La terre sacrée a bu le sang des jeunes hommes qui n’aurait dû couler que pour la défendre contre les envahisseurs. Ceux-ci survinrent et nous manquâmes de guerriers pour les combattre. Les luttes intestines avaient coûté la vie aux plus braves, aux plus audacieux. Nous fûmes vaincus. Le dernier des Thanis s’enfuit. Il y a quinze années, il revint, et sourd aux cris de la patrie opprimée, n’entendant que la voix des haines séculaires, il songea seulement à frapper les Hador exécrés. Son poignard arracha la vie à ma femme, ma vénérée Aïssa, la mère de ma Lotia.
– Tuer une femme, oh ! c’est lâche cela, s’écria Lavarède pris par le récit.
– Ce cri prouve ton bon cœur, interrompit virement Yacoub, mais n’accuse point le meurtrier, souviens-toi que c’était ton père.
– Mon père !
Robert allait protester. Soudain le souvenir des recommandations de Radjpoor lui revint. Il devait ne s’étonner de rien. Une parole imprudente ferait s’abaisser sur lui un invisible poignard déjà levé. Mais sa surprise avait été remarquée par son interlocuteur.
– D’où vient ton étonnement, ô roi. Ignorais-tu le crime ?
– Je l’avais oublié, balbutia le caissier ne sachant plus « à quel génie se vouer ».
Le vieillard leva la main et d’un air entendu :
– Je comprends ta pensée.
– Par ma foi, grommela Robert, il est bien heureux : je voudrais être à sa place.
– Tu désires m’indiquer, continua Yacoub, que nous avons vu la vérité, toi dans l’exil, moi devant l’invasion ; qu’il convient de jeter un voile sur les tristesses du passé, et de marcher la main dans la main au devoir. Tu as raison. Excuse un vieillard qui doutait de la sagesse profonde de ta jeunesse. Excuse-moi, nous sommes bien alliés pour la même cause, éclairés par la même lumière. Fils de Thanis, le vieil Hador sera le plus fidèle, le plus dévoué de tes sujets.
Et Lavarède inclinant la tête, mouvement qui ne lui semblait pas compromettant, Yacoub conclut.
– Thanis et Hador sont amis comme Damon et Pythias, comme l’étoile double de Castor et Pollux. C’est entendu, c’est promis, c’est juré. Maintenant occupons-nous de l’Égypte.
– Occupons-nous de l’Égypte, répéta docilement l’ex-caissier de la maison Brice, Molbec et Cie.
– Tu sais ce que j’ai fait déjà. J’ai formé une affiliation secrète sous nom de « Néo-Égyptiens ». Nos emblèmes sont ceux de l’Égypte glorieuse, du temps où notre empire s’étendait sur toute l’Afrique. Les derviches du Soudan sont avec nous, à présent qu’ils t’ont vu. Les femmes fellahs fondent des balles, la nuit, dans leurs cabanes ; les noirs Éthiopiens aiguisent leurs sabres ; au ciel s’est montrée l’étoile errant en tous sens prédite par la légende.
– Ah ! oui, se confia Robert, le bolide d’Astéras.
– Tu es parmi nous, pour nous conduire contre les Anglais roux et les forcer à reprendre la mer.
– Moi, moi, bégaya le jeune homme bouleversé par cette conclusion inattendue !
– Hésiterais-tu, gronda sévèrement Yacoub ?
Son accent ramena Lavarède au sentiment de la situation :
– Hésiter ? Jamais de la vie… Vous ne me connaissez pas. Seulement suis-je capable de faire ce que vous attendez de moi ?
– Les prédictions sont formelles.
– Et puis, cela sera peut-être long.
Malgré lui, l’involontaire voyageur exprimait sa crainte de voir se prolonger son absence de Paris. Mais son interlocuteur riposta avec chaleur :
– Qu’importe le temps, pourvu qu’on ait la gloire. Relève la tête, fils de Thanis ; remémore-toi les guerres d’antan ! Tes ancêtres n’ont-ils pas guerroyé contre les miens durant trois cents ans ?
– Trois cents ans, gémit le caissier ! Et, si bas que le vieillard ne put l’entendre, il acheva d’un air lamentable : ils vont me faire perdre ma place… Jamais ma caisse ne restera trois cents ans sans titulaire.
Mais par réflexion, son visage se rasséréna. Il songeait au diamant d’Osiris. S’il le possédait, il n’aurait plus besoin d’être l’humble employé de fabricants d’instruments d’optique. Et tout naturellement il demanda :
– Mais nous ne parlons pas du diamant d’Osiris ?
– Nous y arrivons, Roi. L’exorde que tu viens d’ouïr était nécessaire.
Et doucement :
– Pour que les derviches combattent dans nos rangs, il faut que le diamant unique brille sur ton casque de bataille. Donc nous irons le prendre là où il est caché aux regards profanes.
– Cela me va.
– Restent les guerriers d’Égypte. Ceux-ci sont divisés en deux parties, les amis des Thanis, les clients des Hador. Nous devons les fondre en un seul bloc, et pour cela leur prouver qu’aucune rivalité n’est possible entre nous ; leur démontrer d’éclatante façon, pour les grouper eux-mêmes, que nous sommes unis en une même aspiration.
– Allez toujours.
– Ce moyen, tu le connais comme moi.
– C’est égal, faites comme si je ne le connaissais pas.
Le vieillard hocha la tête d’un air mécontent :
– Toujours tu te défies de moi. Tu ne crois pas encore à la réalité des propositions que t’a portées le brave Niari.
– C’est que sa mission était si peu officielle, commença Robert se souvenant bien mal à propos de la manière dont il était entré en relations avec le farouche Égyptien ; mais changeant d’accent devant le regard surpris de Yacoub : Je veux dire qu’il n’avait point qualité pour traiter la question, et que je serais heureux de vous entendre me répéter…
– Ses paroles. Tu acceptes donc en principe ?
La question embarrassa prodigieusement le jeune homme. Accepter une chose que l’on ne connaît pas est toujours imprudent, mais aussi dans le cas présent, refuser pouvait devenir dangereux. Le plus sage, au fond de ce souterrain, était de ne pas mécontenter son hôte. C’était à coup sûr le moyen de revenir à l’air libre. Or, une fois en rase campagne, le prisonnier-roi trouverait bien une chance de fausser compagnie à ses mystérieux geôliers.
Le résultat de ces réflexions, qui traversèrent le cerveau du caissier dans l’espace d’un éclair, fut qu’il répondit le plus naturellement du monde :
– Voyons ! si je n’acceptais pas, je ne serais pas ici.
Les traits durs de l’Égyptien s’adoucirent ; ses mains sèches serrèrent celles du Français et d’une voix émue :
– Alors, je puis te nommer mon fils…
– Comment donc, avec plaisir ! Seulement, marmotta notre héros entre ses dents, il pleut des papas dans cette grotte ; et quels papas ? Tout à l’heure un assassin, en ce moment ce vieux fou.
– Mon fils, redisait Yacoub, viens sur mon cœur. La mort d’Aïssa s’efface de ma mémoire. Peuple, réjouis-toi ; jette sur son chemin les palmes vertes des dattiers, entonne l’hymne de délivrance ; les vieux partis sont défunts, et l’Égypte unifiée va reprendre son vol vers ses éternelles destinées.
Avec effusion, il donna l’accolade au jeune homme qui s’en serait bien passé.
– Attends-moi, Roi ; dans peu d’instants, ton serviteur reviendra te prendre.
Il se dirigeait vers la porte. Il rouvrit, franchit le seuil, et comme il ramenait le panneau sur lui, il termina :
– Sous peu de minutes, je te guiderai vers ta fiancée !
Le claquement de la porte couvrit l’exclamation ahurie de Robert :
– Ma fiancée !
Cri d’un étonnement si sincère qu’il l’eût certainement trahi.
Par bonheur, Yacoub ne l’avait point perçu. Seul dans la salle de pierre, le caissier donna libre cours à sa rage. Dans quelle sotte aventure l’avait-on engagé ? Chasser les Anglais, être roi, se marier, on n’exigeait que cela de lui. Ah ! mais, il en avait par dessus les oreilles des grandeurs ! Certes il était disposé à accepter avec reconnaissance le diamant d’Osiris, mais se marier… cela dépassait les bornes ! Et contre qui encore ? Il n’en savait rien. Pour qu’on lui eût tendu un pareil guet-apens, bien certainement la future était un monstre de hideur. Autrement cela ne s’expliquerait pas. Les pères de famille n’ont pas l’habitude de jeter ainsi leurs filles et leurs diamants à la tête du premier venu.
Ce mariage n’était pas fait au reste. Il se révolterait… Il… Oui, mais voilà, s’il récriminait, s’il s’expliquait, ce damné Radjpoor entrait en scène avec son éternel poignard.
– Quel dilemme stupide, gronda Robert, marié ou égorgé… Sans compter que les Anglais ne manqueront pas de me pendre s’ils me prennent au milieu de ces conspirateurs. Et moi qui dédaignais mon emploi de commis ; moi qui me laissais bercer par un vain rêve de fortune. Eh bien, je suis gentil maintenant ! Ah ! tu veux des diamants, mon gaillard, prends-en donc et qu’ils t’étranglent !
Il s’interrompit brusquement. La porte venait de se rouvrir, et dans l’encadrement, Yacoub incliné disait d’un ton obséquieux :
– La fiancée du Pharaon Thanis est à ses ordres !
Lavarède fut sur le point de se ruer sur le vieillard, mais la silhouette des oëris armés d’épées apparut au dehors. La partie n’était pas égale, et puis, en admettant même qu’il réduisît ces ennemis à l’impuissance, comment sortirait-il du labyrinthe souterrain où il était enfermé ?
La soumission s’imposait, sous la réserve mentale d’abandonner conjurés, future, pierres précieuses, Radjpoor et Yacoub à la première occasion.
Et se contraignant à sourire, le jeune homme suivit ses adversaires, c’est ainsi qu’il les désignait désormais.
Des couloirs aux circuits capricieux, aux parois couvertes de fresques, des escaliers étroits semblant s’enfoncer au centre de la terre, furent parcourus. Les oëris s’arrêtèrent devant une ouverture, au-dessus de laquelle la pintade symbolique étendait ses ailes ocellées. Des servantes parurent, et sans un mot, du pas raide et gracieux des danseuses de la vallée du Nil, elles marchèrent devant les visiteurs.
À leur suite, ceux-ci pénétrèrent dans une chambre peinte de rose tendre, que rehaussaient des bouquets géants de fleurs éclatantes.
Accoudée sur une table, soutenue par un ibis de bronze émaillé arc-bouté sur ses pattes, Lotia était là, ses yeux pensifs et attristés, attachés sur la porte.
Dans la salle du conseil, Lavarède étourdi par les cris, absorbé par le spectacle, l’avait à peine regardée ; mais en cet endroit où rien ne le distrayait, elle lui apparut soudain comme l’incarnation de la beauté. Sa colère, ses projets de fuite s’évanouirent. Toutes les vagues rêveries dont l’aile capricieuse nous porte vers l’idéal, depuis le songe enfantin causé par les contes de fées, jusqu’aux hallucinations plus précises de l’adolescence, tout cela était effacé, dépassé, anéanti par la réalité vers laquelle, après un enlèvement merveilleux, un voyage incroyable, un vieillard inconnu l’amenait.
Une impression de surnaturel le saisit. Il fut sur le point de plier les genoux, mais Yacoub prit la parole :
– Lotia, dit-il, Thanis entre dans la demeure d’Hador. Que la joie brille sur ton front, car l’hôte est envoyé par les dieux.
Son accent était étrange ; il trahissait l’ordre, alors que son attitude semblait celle de la prière.
Lotia eut un léger frisson, sa pâleur s’accrut ; mais elle répondit :
– Que Thanis soit le bienvenu chez la fille d’Hador !
Le vieillard inclina le chef d’un air satisfait.
– Ce soir, reprit-il, en présence des cheiks arabes, des Égyptiens de noble lignée, des derviches du Soudan, groupés autour de nous pour chasser l’envahisseur, votre mariage sera célébré suivant les rites antiques de la cité d’Oph. Ainsi se renouera la tradition pharaonienne, et la nouvelle dynastie des rois continuera les dynasties effacées. Demain, vous partirez vers le temple où le diamant d’Osiris attend le libérateur, et tandis, que vous ferez le voyage, des courriers se répandront par toute l’Égypte, annonçant aux patriotes qu’Hador a donné son enfant à Thanis ; que les vieilles rivalités ont pris fin, et qu’une seule cause aujourd’hui doit faire couler le sang ; celle de l’émancipation de la terre où dorment nos glorieux ancêtres !
Yacoub se tut un moment. Son visage resplendissait d’enthousiasme, ses mains frémissaient. Mais redevenant maître de lui :
– Thanis, dit-il doucement, approche-toi de Lotia. Sur son front, pose le baiser des fiançailles. C’est ainsi que tes aïeux désignaient celle qu’ils avaient choisie pour épouse.
– Ma foi, bredouilla Robert, si mademoiselle veut bien me permettre… je ne demande pas mieux que d’imiter mes aïeux.
La jeune fille avait fermé les paupières, une indicible expression d’horreur couvrit ses traits, puis elle coula vers son père un regard éperdu et suppliant. Elle le vit droit, raide, immobile, l’œil fixe.
Alors d’un effort elle se leva, vint à Lavarède, et s’arrêtant devant lui, tendit son front. Troublé au dernier point, le caissier y appuya ses lèvres, et avec une secrète terreur qu’il n’eût pu expliquer, il remarqua que la peau de Lotia était glacée.
Sous son baiser elle avait fléchi ; ses jambes la soutenaient à peine, et son visage blême, ses yeux égarés autour desquels se marqua soudain une meurtrissure bleuâtre, lui donnaient l’aspect d’une statue lamentable de la douleur.
Mais le Français n’eut pas le loisir de s’informer. Yacoub l’entraîna hors de la pièce et le ramena dans la salle du conseil, où Radjpoor, Astéras, Niari, Maïva, attendaient.
Et cependant Lotia restée seule fondait en larmes. Au bruit de ses sanglots, une servante accourut :
– Vous pleurez, maîtresse, clama-t-elle d’une voix attristée ?
Nourrice de la jeune fille, elle l’aimait.
– Oui, je pleure, gémit la jolie Égyptienne à travers ses larmes, car je vais me sacrifier. L’heure est venue. Jusqu’alors j’espérais… Quoi ? Je ne sais, le miracle impossible… Hélas, l’espérance même est morte. Thanis est ici.
Et comme la nourrice, avec la tendresse ingénue que l’on témoigne aux petits enfants, essuyait les grands yeux de Lotia avec un fin mouchoir de batiste, celle-ci continua :
– Un jour, mon père me dit : Pour relever l’Égypte humiliée, il faut que tous ses enfants unissent leurs efforts, oublient leurs désirs personnels, leurs rêves de bonheur, pour les remplacer par un seul et même souhait. Je veux prêcher d’exemple. Je hais Thanis dont le père a mis à mort mon épouse, ta mère. Thanis est en Europe, il vit largement d’une pension que lui paient nos ennemis. Mais dans ses veines coule un sang noble, généreux. L’appel de la patrie ne saurait lui demeurer indifférent. Je vais lui envoyer mon fidèle Niari. Il le cherchera dans les cités des Européens, il le trouvera. Et alors, il lui dira : Viens, l’Égypte asservie espère en toi. Elle t’offre la couronne, et Hador sollicite ton alliance. Effaçons nos rivalités qui furent fatales à la cause de la liberté. Épouse Lotia, mon enfant bien-aimée, et conduis-nous à la victoire.
Elle s’arrêta un moment, et avec un découragement profond :
– Je tentai de résister… comme si j’avais assez de forces pour lutter contre la volonté de mon père. Niari partit. Longtemps ses recherches furent infructueuses. Je me rassurais. Thanis, pensais-je, ne songe plus à la vieille Égypte ; il est l’ami du vainqueur, son pensionné. Jamais il ne reviendra. Et quel que fût mon amour pour ma patrie, je me réjouissais de la défection de celui que tous appelaient comme chef et comme roi. Insensée, je me figurais qu’un homme issu de cette race avide et hautaine dédaignerait la couronne, le pouvoir. Et Niari l’a ramené, et ce soir, je serai contrainte de mettre ma main dans celle du meurtrier de ma mère Aïssa. Ses doigts teints du sang des miens déteindront sur mes doigts. Mais c’est ainsi. Sur l’autel de la patrie, les guerriers donnent leur existence ; moi, vierge timide, je dois immoler mon cœur. Je suis prête au sacrifice, au moins laissez-moi pleurer sur ma jeunesse qui était faite pour le rire et les chansons, laissez-moi pleurer sur le bonheur auquel je pouvais aspirer comme toutes les jeunes filles, sur ma vie étouffée dans sa fleur, sur mon âme offerte en holocauste aux divinités cruelles des combats.
Sur ses joues brunes, les larmes coulaient lentement, tandis qu’elle exhalait sa plainte. Et la nourrice, impuissante à la consoler, appuyait sa tête charmante sur son épaule, et dans ce dialecte égyptien, si doux, si caressant, lui prodiguait les appellations affectueuses qui apaisent les chagrins des tout petits.
Tout autre était l’humeur de Lavarède. Radjpoor, à son retour dans la salle du conseil, l’avait considéré avec une nuance d’inquiétude, et Yacoub s’étant éloigné afin de donner les ordres nécessaires pour l’installation du caissier devenu roi, le faux Hindou s’approcha vivement de ce dernier :
– Eh bien, lui demanda-t-il ?
– Tout s’est bien passé, répliqua gaillardement le Français. Il y a bien la guerre contre l’Angleterre qui me chiffonne un peu, mais le diamant d’Osiris, et surtout Mlle Lotia (une perle cette jeune fille) me font vous pardonner le passé.
– Quelle Lotia ? Quelle jeune fille ? questionna curieusement Astéras se mêlant aussi à la conversation.
– La plus jolie personne que j’aie jamais rencontrée, mon cher, et elle sera ma femme dès aujourd’hui.
– Ta femme ? Tu te maries ?
– Il paraît.
– Comment, toi ! Il y a quinze jours encore, tu ne jurais que par le célibat.
– Eh bien ! je ne jure plus, voilà tout. Du reste on ne me demande pas mon avis, et le seigneur Radjpoor te dira, que si j’essayais de me dérober à la chaîne de roses que l’on veut me passer autour du col, je descendrais immédiatement au tombeau.
Et laissant Ulysse stupéfait de ces paroles bizarres, Robert revint à l’Hindou.
– À propos, Seigneur, si j’ai bien compris, on me prend ici pour un autre, pour un certain Thanis…
– Plus bas, malheureux, interrompit Radjpoor en regardant avec crainte autour de lui.
– Soit, je baisse le ton, mais je répète ma question plus bas.
– Vous avez bien compris !
– Parfait… Seulement si le vrai Thanis se présente… ? À cette seule pensée, ma tête vacille sur mes épaules.
– Que votre tête reprenne son assiette. Jamais Thanis ne réclamera contre la substitution.
– Vous en êtes certain ?
– Absolument.
– Vous affirmez avec une autorité… Est-ce que vous le connaîtriez par hasard ?
– Que vous importe ? Avez-vous confiance en moi ?
Robert se gratta la tête d’un air hésitant :
– Confiance ! Confiance ! grommela-t-il… je n’en sais rien.
Sans se formaliser de l’aveu, l’Hindou se pencha vers lui, et d’une voix assourdie :
– Vous ai-je trompé jusqu’ici ? Je vous ai promis la fortune, le bonheur… ; il me semble que vous les touchez.
– À moi aussi. Mais vous ne m’aviez pas parlé des troupes anglaises à combattre.
– Pour ne pas vous inquiéter d’avance. J’étais persuadé du reste qu’elles passeraient par-dessus le marché.
– Oh ! elles passent, ratifia le caissier avec une grimace, elles passent… difficilement par exemple.
– Voulez-vous renoncer à Lotia, aux richesses ?
– Non.
– Alors, croyez-moi. Laissez votre fortune s’établir, je vous donne ma parole que le véritable Thanis ne vous disputera pas la place.
– Pourquoi ?
– Mon cher, railla Radjpoor en tournant le dos à son interlocuteur, ne cherchez pas à percer mon secret, il est de ceux qui tuent.
Lavarède ne put retenir un geste de mécontentement :
– Au diable ! Vous ne parlez que de tuer.
Mais Yacoub accourait vers le jeune homme. Il avait surpris son mouvement, et se méprenant sur sa véritable cause :
– Vous vous impatientez, Sire. Pardonnez si je vous ai fait attendre, c’était pour vous mieux recevoir. Je vais vous conduire à votre appartement.
– Avec mon ami Astéras, compléta Robert en appuyant sa main sur l’épaule de l’astronome.
– Astéras ?
– Oui, un cœur dévoué, un homme sûr.
– Il suffit, Roi. Il est de ceux que tu aimes, tous nous l’aimerons.
Et s’inclinant cérémonieusement devant Ulysse, qui considérait tout cela avec la plus complète placidité.
– Seigneur Astéras, veuillez nous suivre. On vous fera préparer une salle dans l’appartement du roi.
CHAPITRE IX
LES JOIES DE LA ROYAUTÉ
Bientôt dans une autre portion de la crypte, Robert et Astéras se trouvèrent seuls en présence d’une collation, servie par des chambellans qui circulaient autour d’eux dans un silence respectueux. Yacoub s’était discrètement retiré. Sur un geste de Lavarède, les serviteurs l’imitèrent.
– Ouf ! fit alors le jeune homme. On peut respirer enfin.
– Non pas, s’empressa de répondre l’astronome. Je demande des explications.
– Sur ?…
– Sur ce qui fait que l’on t’appelle roi, on te traite en grand seigneur ?
– Je ne suis pas très fixé moi-même. Cependant, je vais te conter ce qu’il m’a semblé deviner.
Et brièvement, l’ex-caissier mit son compagnon au courant. Le petit homme à face lunaire l’écouta avec attention, puis quand il eut achevé :
– En somme, tu es roi. Tu peux ce que tu veux ?
– Relativement. Tous ici sont disposés à m’obéir, sauf cependant sur un point.
– Lequel ?
– Eh bien mais… mon désir de retourner en France.
– Tu m’as fait peur, cela n’a pas d’importance.
– Merci bien… Tu trouves toi, esprit léger. Et l’Observatoire ? Et mon bureau ?
– Bah ! ils ne s’envoleront pas, nous les rejoindrons toujours, Donc, je reprends. Tu es tout puissant, tu es le gouvernement, par conséquent tu peux commettre une injustice en ma faveur.
– Du népotisme, déjà ?
– Sans vergogne : En route, le sieur Radjpoor commandait ; ici, la situation est retournée. Je te conjure d’en profiter pour arracher la pauvre Maïva aux mains de son bourreau.
– Ah ça ! tu t’intéresses bien à cette fillette.
Une légère teinte rose s’épandit sur les joues rondes du savant, et avec une nuance d’embarras :
– Intérêt scientifique, mon bon Robert, tout ce qu’il y a de plus scientifique. Je souhaite de rendre la parole à cette infortunée et d’apprendre d’elle le fond et le tréfonds de notre aventure.
L’argument frappa Robert.
– Au fait ! tu as raison, j’y songerai… Cela nous fera plaisir et nous vengera un peu de ce seigneur mystérieux. Ne me parle plus de rien ; laisse moi chercher le moyen de réussir.
La collation terminée, les serviteurs avaient emporté la desserte. D’autres les remplacèrent et se mirent en devoir de revêtir Robert de vêtements de fête.
On le drapa dans un étroit jupon de lin plissé, retenu aux hanches par une ceinture, sur laquelle des plaquettes d’émail et d’or figuraient des écailles ; son buste fut enfermé dans une brassière quadrillée de mauve et de bistre, aux manches courtes, rayées transversalement de lignes d’or, de mauve et de rose. Un large gorgerin de pierres précieuses et d’or recouvrit sa poitrine ; ses pieds furent chaussés de sandales à pointes recourbées. Enfin sur son front fut posée une sorte de mitre bleue, constellée d’yeux emblématiques, formés de cercles concentriques noirs, blancs et rouges, et surmontée d’une vipère d’or se tordant menaçante au dessus du crâne du singulier souverain.
Ainsi paré, Robert ressemblait à s’y méprendre au pharaon des fresques de la pyramide de Chéops, revenant vainqueur d’une guerre en Éthiopie, avec son cortège de chars, de soldats, de captifs et de prêtres.
Le jeune homme se prêtait docilement à cette mascarade. Puisque les Néo-Égyptiens avaient jugé bon d’adopter les insignes des générations éteintes, et qu’il était leur roi, sans s’expliquer clairement pourquoi pareille fonction, lui était échue, il devenait tout naturel qu’il se mît à la dernière mode des Pharaons.
Et puis, les larges glaces qui garnissaient la salle lui renvoyaient son image, faisant naître en lui une coquetterie ignorée. Vraiment quand il était couvert de ses vêtements étriqués, veston, pantalon de coupe anglaise, il ne se doutait pas qu’il pût avoir aussi grand air. Avec une satisfaction inavouée, masquée d’une allure de plaisanterie, il murmurait :
– Si Chéops lui-même sortait du tombeau, il me tendrait la main en m’appelant son cousin. Car je suppose que les monarques d’autrefois étaient cousins comme ceux de nos jours, histoire de taquiner les républiques grecques.
Il s’interrompit soudain pour jeter un regard sur Astéras, et un accès de folle hilarité le secoua tout entier.
– L’astronome aussi était transformé. Une tunique bleu clair tombait en plis larges de ses épaules jusqu’à ses pieds. Une coiffure en dôme, de chaque côté de laquelle se dressaient les cornes d’or du croissant isiaque, lui donnait la plus hétéroclite des physionomies.
Du reste, le savant n’en avait cure. Il considérait avec satisfaction ses manches, sur la bordure blanche desquelles se succédaient en rouge les signes du zodiaque :
Et il murmurait le distique latin du poète Ausone donnant les noms des douze constellations zodiacales :
– Sunt : Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo,
Libraque, Scorpius, Arcitinens, Caper, Amphora, Pisces.
L’éclat de rire de son ami ne le troubla pas dans son petit exercice astronomique, et il se borna à riposter par ces mots :
– Pour toi, esprit terre à terre, je traduis : Ces constellations sont : Le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et les Poissons.
Puis avec une emphase lyrique :
– Quel peuple que ces Égyptiens ! Au lieu des fantaisies banales des dessinateurs, c’est l’astronomie qu’ils utilisaient pour leurs motifs ornementaux. Le poète a pu le dire : Peuple-Soleil qui vivait au milieu des étoiles !
La résonnance métallique d’un gong coupa court à l’improvisation d’Ulysse. Presque aussitôt Yacoub se présenta. Après des salamalecs compliqués, le vieillard demanda à Lavarède s’il était prêt pour la cérémonie du mariage. L’heure avait sonné de proclamer la réconciliation d’Hador et de Thanis.
Gravement, habitué déjà à son nouveau rôle, l’ancien caissier se déclara tout disposé à marcher à l’autel. Sur l’invitation du père de Lotia, il le suivit, escorté d’Astéras, qui retroussait sa longue tunique, pour ne pas se prendre les pieds dans l’étoffe flottante.
Au seuil de l’appartement, de nombreux guerriers formaient une haie d’honneur, et le pseudo-roi passé, ils se rangèrent derrière lui.
Lentement, le cortège serpenta dans les corridors de l’hypogée. Un silence religieux planait sur l’assistance, et le froufrou des étoffes, la vibration étouffée de l’acier semblaient les chuchottements[4] d’esprits invisibles accompagnant la marche nuptiale.
Soudain une bouffée d’air frais vint caresser le visage de Robert. Il frissonna, leva les yeux, et dans l’encadrement d’une porte, il aperçut des arbres, le ciel noir piqué d’étoiles de feu.
On sortait donc du souterrain. On allait se retrouver à l’air libre. Le dôme transparent du firmament remplacerait les voûtes de granit du tombeau royal.
Quelques pas encore et le seuil fut franchi. Sur le sol croissait une herbe courte qui craquait sous les pieds. Des buissons épais, des palmiers balançant à dix mètres de haut leurs panaches verts, charmaient les yeux du Français.
Dans une sente que des parfums de fleurs invisibles embaumaient, on cheminait maintenant. L’étroit passage s’élargit, se développa en clairière, le grondement des rapides du fleuve s’entendait à droite et à gauche.
– Allons, murmura Robert, la carrière a une seconde sortie dans l’île. C’est bon de respirer un peu.
Yacoub allait toujours, s’engageant dans une avenue de vastes dimensions. Entre les arbres, les lianes, les arbustes enchevêtrés, des apparitions de pierre se montraient : sphinx, colonnes brisées, pyramides, obélisques.
Une harmonie lointaine arrivait aux oreilles de Lavarède sur l’aile tiède du vent. Il percevait la vibration des harpes, le murmure sourd des tympanons, les notes brèves de la guzla.
Brusquement un pylône de briques termina l’avenue. Comme sous un arc triomphal le cortège passa, et Robert stupéfait se trouva à l’entrée d’une vaste place, forum où le peuple se réunissait alors que l’histoire bégayait encore. Palais ruinés, dont les corniches à jour couraient sur des alignements de colonnes, tours en gradins, statues colossales, vision grandiose de granit et de porphyre se dessinant sur le fond vert des végétations.
Et dans ce cadre merveilleux, sous la lumière bleue tombant du ciel, une foule étrange, se pressant, se poussant, devant un orchestre installé sur les marches d’un temple au fronton écroulé.
Juste en face de l’escorte du jeune homme, un autre cortège apparaissait. En tête, conduite par un prêtre reconnaissable à la peau de léopard dont il était couvert, Lotia s’avançait lentement, couronnée de fleurs de lotus, drapée dans la tunique blanche à palmettes vertes des fiancées.
Les deux groupes s’arrêtèrent à quelques mètres d’un autel bizarre dressé au milieu de la place.
C’était une réduction du tombeau d’Osymandias de Thèbes. Des degrés minuscules l’entouraient du bas jusqu’au sommet, sur lequel était placé un cercle d’argile séchée, divisé en trois cent soixante-cinq degrés. Entre chaque ligne séparative était figurée l’étoile correspondant à un jour de l’année : Régulus, Aldébaran, les Pléïades, Algenib, Anteria. Autour du monument, formant une ronde, des prêtres se tenaient par la main, couverts des emblèmes des divinités de l’Olympe de la vieille Égypte. Ils représentaient Knef, Bouto, Phia, Pan-Mendès, Hathor, Phré, Isis, Rempha, Pi-Zéous, Ertosi, Pi-Hermes, Imuthès, les Décans ou démons familiers des divisions de l’année, puis Osiris, Haroëri, Typhon, Nephtis, Anubis, Thoth, Busiris, Babastis et enfin Sérapis.
La ronde se disloqua. Les fiancés furent poussés vers l’autel, leurs mains droites unies, tandis que leurs mains gauches, serrées l’une contre l’autre par une bandelette de toile, étaient placées successivement sur chacun des degrés du cercle d’argile.
Pendant ce temps, les prêtres psalmodiaient. L’orchestre s’était tu. Comme pétrifiée, la foule assistait, sans un geste, sans un murmure à la cérémonie. Et dans ce décor invraisemblable, parmi cette agglomération de choses d’autrefois, Robert sentait son cœur accélérer ses pulsations, l’émotion l’étreindre à la gorge.
Et un remords cuisant le prenait. Cette belle jeune fille, qu’on lui donnait pour épouse, croyait s’unir à ce Thanis inconnu dont il usurpait la place. C’était grâce à un subterfuge, à un mensonge, qu’elle lui accordait sa main. Il avait envie d’interrompre le mariage, de crier la vérité ; mais il se rendait compte que pareille conduite le mettrait dans un danger terrible, sans profit pour personne.
Tout en réfléchissant, il considérait sournoisement Lotia, et en voyant ses paupières nacrées, chastement abaissées, son profil délicat, sa chevelure lustrée, il trouvait des excuses à son action. Après tout, il n’était pas libre ; d’ailleurs le Thanis invisible aurait-il assuré à la fiancée un bonheur plus grand que lui-même ? Que diable ! un Français vaut bien un Égyptien. Et mille autres raisons tout aussi mauvaises, à l’aide desquelles il tentait d’endormir sa conscience.
Soudain, la bandelette qui enserrait les mains des époux fut dénouée. L’un des prêtres s’élança sur l’autel, et d’une voix perçante clama :
– Peuple d’Égypte ! Hador et Thanis ont scellé le pacte d’alliance. Plus de rivalités, plus de divisions désormais. Groupez-vous tous dans une même pensée, Thanis et Hador confondent leurs âmes ; en eux mettez votre espoir, à leur volonté immolez la vôtre pour la patrie égyptienne !
Une acclamation s’éleva.
– Vive Thanis ! Vive Hador ! Vive la liberté !
– Thanis, montre-toi à tes fidèles. Que ta voix leur donne le courage et la haine de l’oppresseur.
Ces mots prononcés par Yacoub avaient à peine impressionné le tympan de Lavarède, que poussé par les uns, tiré par les autres, le jeune homme se trouva juché sur l’autel, auprès du prêtre.
– Parle, ô roi, murmura celui-ci. Parle à tes fidèles.
– Parler… Parler, bredouilla Robert. Je ne suis pas orateur moi !
De fait, il aurait voulu être à cent lieues de là. Mais son interlocuteur reprit :
– Permets que je prête à ton esprit le secours de mon expérience.
Et soufflé par lui, l’ex-caissier harangua le peuple :
– Frères, je vous salue. L’indignation fait bouillir votre sang, ainsi qu’un fleuve de lave, à la vue du sol sacré de la patrie meurtri par la botte brutale du conquérant. Le jour est proche où notre cri de guerre changera en terreur la quiétude de nos maîtres. Mais alors il sera trop tard ; les glaives se seront échappés du fourreau, la poudre crépitera, lançant la mort. Et sur les cadavres amoncelés, sur les citadelles démantelées, nous proclamerons, devant le monde surpris de ce brusque réveil, l’émancipation de la terre égyptienne.
Un cri formidable ébranla l’atmosphère. Les hommes brandissaient leurs armes, les femmes lançaient des clameurs aiguës, qui dominaient le tumulte comme des coups de sifflet.
– Bien… parfait, murmura le prêtre qui venait de remplir avec tant de succès les fonctions de souffleur. Maintenant, ô roi ; affirme l’union de Thanis et d’Hador en désignant Yacoub comme ton premier lieutenant.
– Ceux que je choisirai ne pourront se dérober, interrogea le jeune homme ?
– Ils ne l’oseraient.
– Vraiment. En ce cas, je tiens mon affaire.
– Quelle affaire ?
– Rien. Une chose personnelle. Fais taire ces braillards, et laisse-moi proclamer ma confiance en Hador.
L’Égyptien fit un signe. Aussitôt un roulement de tambours bourdonna. Les cris, les hurrahs s’éteignirent comme par enchantement, et Robert se tournant vers son compagnon :
– Guide ma voix. Si longtemps j’ai vécu en exil, que j’ai oublié les paroles qui font vibrer le cœur de ces braves gens.
– Écoute donc, Sire.
Lentement le prêtre prononça ce discours, que l’ancien caissier répéta sans se tromper :
– Pour être forts, il faut être unis. Une haine impie animait Hador contre Thanis. La paix est conclue entre eux. Lotia, fille de Yacoub, est mon épouse ; Yacoub devient mon père. Je veux qu’il soit plus encore ; que tous lui obéissent comme à moi-même, que son regard soit le mien, que son bras soit mon bras, que sa volonté soit mon vouloir. À dater de ce jour, il est le premier de mes lieutenants, et dans le Conseil, il occupera la place d’honneur auprès de moi.
Les applaudissements recommencèrent ; mais à la grande surprise du prêtre, Lavarède commanda :
– Tambours ! un roulement.
Les peaux d’âne vibrèrent aussitôt sous les baguettes.
– Que fais-tu, interrogea le compagnon de Robert ?
– Je réclame le silence.
– Pourquoi donc ?
– Parce que je n’ai pas fini.
– Si tu veux que je conduise ta parole, indique-moi au moins…
– Inutile… je n’ai plus besoin de toi.
Et s’adressant à la foule attentive :
– Frères, je viens de consacrer l’étroite union des défenseurs de la patrie, il me reste à accomplir un acte de justice.
Il s’arrêta une seconde, fit planer sur l’assemblée un regard dominateur, et d’une voix claire :
– Un homme, un étranger venu de l’Inde, n’ayant d’autre intérêt qu’une haine commune contre nos oppresseurs, a aidé le fidèle Niari dans ses recherches. Il a découvert ma retraite, m’a accompagné, veillant sur mes jours avec le plus entier dévouement. Cet homme, ai-je besoin de le nommer ? Sur vos lèvres, je lis son nom : Radjpoor-Sahib.
– Vive Radjpoor-Sahib, hurla la foule !
– Je vois, poursuivit Robert se tenant à quatre pour ne pas rire, je vois que vous appréciez sa conduite à sa juste valeur. Il a été à la peine, il est juste qu’il soit à l’honneur. Devant vous, je le nomme mon écuyer, car je veux qu’il m’accompagne partout ainsi que dans le passé.
Un tonnerre de vivats ponctua la phrase. Profitant du tapage, Radjpoor s’était approché du monument. Sa face sombre exprimait la colère :
– Que signifie cette plaisanterie, questionna-t-il ?
Avec un geste ironique, Lavarède se pencha au-dessus de lui :
– Ce n’est pas une plaisanterie, mon bon.
– Quoi, moi. Je serais votre écuyer ?
– Parfaitement ! Vous m’avez fourré dans une intrigue de tous les diables, eh bien, vous en serez avec moi.
– Mais c’est impossible.
– Que non, cher Monsieur Radjpoor. Vous avez voulu que je sois roi. Parfait ! je le suis, donc vous me devez obéissance.
– Permettez !
– Je vous permets seulement de remercier ma Grandeur.
Le public, remarquant ce colloque dont il ne comprenait pas le sens, avait fait trêve à ses démonstrations. L’ancien caissier se redressa, souriant, épanoui par la vengeance qu’il tirait de son geôlier.
– Frères, fit-il, Radjpoor-Sahib m’exprimait sa reconnaissance. Mon cœur est plein de joie au souvenir de ses paroles. Ô roi, m’a-t-il dit, je serai ton écuyer dévoué, je n’aurai qu’une pensée, être ton bouclier vivant, te préserver des coups des ennemis. Laisse-moi offrir un dévouement semblable à Lotia, ma souveraine. Je possède une esclave muette, Maïva est son nom. Daigne l’accepter pour le service de la reine.
Et comme Radjpoor, furieux d’être ainsi berné, faisait un mouvement pour protester, Lavarède impitoyable s’écria :
– J’accepte, digne écuyer, j’accepte – et appelant deux oëris. – Messieurs, ordonna-t-il, Radjpoor-Sahib va vous conduire auprès de l’esclave Maïva. Il la remettra entre vos mains, et vous l’amènerez chez la reine. Elle commencera son service dès aujourd’hui.
D’un mouvement, très noble ma foi, il étendit la main au-dessus de la tête de l’Hindou, contraint de dévorer sa rage impuissante ; il le regarda s’éloigner avec les oëris, puis se souvenant de la posture de la statue du maréchal Ney, il leva le bras en l’air et avec un enthousiasme parfaitement simulé :
– Vive l’Égypte libre, cria-t-il d’une voix de stentor !
Des hurlements lui répondirent. Au milieu d’un fracas épouvantable, il descendit de l’autel, reçut les compliments de Yacoub et des principaux officiers. Astéras s’approchant à son tour, il lui serra fortement la main, et lui murmura à l’oreille :
– Es-tu content ?
– Parbleu, fit l’astronome sur le même ton, tu as été superbe.
Guidé par son beau-père, l’ancien caissier se trouva il côté de Lotia. Il lui prit la main sur l’ordre de Yacoub, et du même pas processionnel qu’à l’arrivée on retourna à l’hypogée.
Dans une salle tendue de soie bleue constellée d’étoiles d’argent, les époux furent laissés seuls.
Les portes étaient refermées, les parents, les amis s’éloignaient, et le jeune homme debout en face de Lotia qui, silencieuse et attristée semblait oublier sa présence, se dit :
– Le Français est aimable, à ce que l’on prétend. Sans doute, ma charmante femme attend que je lui tourne un compliment sterling.
Et souriant, la bouche en cœur, les mains appuyées sur sa poitrine, ainsi qu’un jeune premier de comédie :
– Mademoiselle Lotia, susurra-t-il d’un accent tremblé, vous êtes trop jolie pour être méchante ; laissez-moi cependant m’étonner que vous ayez été assez bonne pour m’épouser.
Mais il demeura pétrifié dans cette attitude ridicule. Lotia s’était reculée, une teinte pourpre avait envahi ses joues brunes ; l’indignation brillait dans ses yeux.
– Ah ! fit-elle d’un ton méprisant, épargnez-moi au moins cette comédie.
Effaré, Robert bredouilla :
– Je vous assure que je suis sincère. J’avais horreur du mariage, je vous ai vue et j’ai changé d’avis. Mes paroles expriment un sentiment juste, mais modeste. Je ne vois pas comment j’ai pu mériter votre affection.
– Mon affection, redit-elle.
Toute sa gracieuse personne frémissait.
– Mon affection, répéta-t-elle encore. Vous avez pensé que, fille indigne, j’oubliais la chère morte ; que je donnais mon âme à celui dont le front est marqué d’une tache de sang.
Vivement Lavarède tira son mouchoir et se frotta le front, renversant dans sa précipitation la mitre dont il était casqué.
– Mademoiselle, essaya-t-il de protester…
Elle l’interrompit :
– Quel mépris avez-vous donc des filles d’Hador ?
– Du mépris, s’écria l’ancien caissier éperdu. Mais je n’ai que de l’admiration, de la tendresse.
D’un geste plein d’autorité, elle lui imposa silence :
– Vous voulez une explication ? Soit ! Sachez que les paroles que vous me contraignez à prononcer sont l’expression de la vérité. Sachez que ma résolution est irrévocable, et inclinez-vous devant ce qui ne saurait être empêché.
Un instant elle se recueillit. Lui, la considérait avec stupeur, troublé par la gravité douloureuse de son visage, par l’amertume de sa voix. Elle reprit avec lenteur :
– Toute enfant j’ai appris à vous haïr, vous et ceux de votre race.
– Ma race, gronda Robert, ma race… quelle race ? les Thanis encore… Ces Thanis dont on m’assomme depuis ce matin. Saprelotte, je veux bien être Thanis pour combattre, mais si vous me détestez, alors, bonsoir, je dépose ce nom décidément trop lourd à porter ; je ne suis plus Thanis.
Il se tut soudain. Emporté par sa mauvaise humeur, il s’était trahi. Mais s’il avait conçu quelque inquiétude, il fut vite rassuré. La jeune fille murmurait avec un accent impossible à rendre :
– Il renie ses ancêtres… Le dicton populaire est vrai : Fourbe comme Thanis !
Il essaya de parler encore, mais elle ne l’écoutait pas. S’animant par degrés, elle continua :
– La patrie commandait, j’ai immolé ma liberté ; j’ai endormi mes haines, mes répulsions, et fermant les yeux pour ne pas voir l’abîme où je roulais, j’ai placé ma main dans celle du meurtrier.
– Eh ! meurtrier, fit-il en grinçant des dents. Il y a longtemps que l’on n’avait pas parlé de cela.
Sans prendre garde à l’interruption, elle allait toujours :
– Je sacrifiais ma vie, mes espoirs, à la cause supérieure d’un peuple. Mais mon cœur demeurait libre. J’assurais la couronne sur ton front, mais je te refusais ma tendresse. Écoute ce que j’ai résolu, Thanis. Avec toi, je me rendrai à Axoum.
– À Axoum, en Abyssinie, rugit Lavarède galvanisé par cette déclaration ?
– À Axoum, en Abyssinie, oui. Là, le diamant d’Osiris te sera remis. Tu entreras en campagne contre nos oppresseurs. Ma tâche sera terminée. Alors je me retirerai dans un couvent, je vivrai dans le souvenir de ma mère assassinée, et si, dans les nuits d’insomnie son ombre éplorée vient s’asseoir à mon chevet, je lui dirai : Mère, je t’aime et j’abhorre ceux qui t’ont précipitée jeune et belle dans le néant. J’ai dû paraître oublier pour la patrie. Toi-même m’eusses conseillé d’agir ainsi. Mais ce devoir rempli, je renonce au monde puisque je ne puis plus te venger.
Elle avait prononcé ces mots avec une énergie sauvage. Laissant Lavarède effaré, elle se dirigea vers une porte aux panneaux couverts d’hiéroglyphes bleus. Il eut un mouvement comme pour la retenir. D’un geste rapide elle se campa devant le seuil. Un poignard brillait dans sa main crispée.
– Fourbe comme Thanis, fit-elle pour la seconde fois. Mais un poignard est un ami sûr, il permet d’échapper aux embûches de la trahison.
La pointe de la lame acérée s’appuyait sur sa gorge délicate, rougissant la peau. Robert resta immobile, épouvanté par la froide résolution qu’il lisait dans ses yeux noirs. Elle comprit son angoisse, haussa dédaigneusement les épaules et sortit.
La porte se referma avec un bruit de verroux.
Dans la salle nuptiale, le Français était seul ; une tristesse inconnue gonflait son cœur. Dans sa tête les idées s’entrechoquaient, l’emplissant de bourdonnements confus.
Il se laissa aller sur un siège, et se prenant le crâne à deux mains :
– En Abyssinie maintenant, ils veulent que j’aille en Abyssinie ! Ah ! mon pauvre bureau, mon grattoir poli, mon buvard rose, combien je vous regrette.
Soudain il leva le bras d’un air désolé, et couvrant d’un regard humide la porte par laquelle avait disparu Lotia.
– Si encore ce n’était que cela… Mais ma femme m’a en horreur, et moi, moi, nom d’un chien, je crois que je l’aime… Sur mon honneur, oui, je le crois.
CHAPITRE X
AU PAYS DES DERVICHES
La nuit s’écoula lentement. Robert aurait voulu dormir, mais sa pensée en éveil ne le lui permettait pas. De plus, sur une console, une horloge de forme antique, dont le mouvement était réglé par un sablier qui se renversait de quart d’heure en quart d’heure en actionnant une sonnerie, eût suffi à elle seule pour justifier l’insomnie.
Et le jeune homme, attristé autant que penaud, se répétait sans trêve :
– J’irai en Abyssinie puisqu’ils le veulent. Je prendrai ce diamant d’Osiris, origine de tous mes maux. Et après, bonsoir la compagnie. Mais le voyage sera long, durant de longs jours encore je verrai Lotia… et je serai très malheureux. Que la foudre écrase l’Égypte et les Égyptiens… et l’Hindou Radjpoor par la même occasion !
Puis la lassitude vint. Le cerveau vide, les membres engourdis, il se jeta sur un lit, dont le bois curieusement ouvragé figurait une barque portant à la proue l’épervier sacré aux ailes déployées.
Mais là non plus le sommeil ne vint le visiter. En se retournant sur sa couche, il aperçut, soigneusement étendus sur une chaise, ses vêtements européens. Il comprit qu’on les avait mis là, afin qu’il les revêtit. Il eût été insensé, en effet, de partir pour Axoum dans l’uniforme par trop voyant d’un pharaon. Parbleu ! ce costume le ferait arrêter, livrer aux Anglais ! Il ne manquerait plus que cela.
Avec une hâte rageuse, Robert se leva, dépouilla les insignes de la royauté, endossa ses propres habits et reprit ainsi sa physionomie habituelle.
Mais sa belle placidité d’antan ne lui revint pas, et son esprit troublé continua ses divagations où Lotia, le diamant d’Osiris, l’Abyssinie se succédaient ainsi que les images du cinématographe.
Les heures ennuyeuses elles-mêmes ont une fin. Les aiguilles de la pendule marquaient sept heures, quand la porte par laquelle Lotia s’était retirée se rouvrit. La jeune fille parut sur le seuil. Elle aussi s’était européanisée. Sa taille souple s’emprisonnait dans une robe de flanelle légère, un chapeau de paille muni d’un voile de gaze allongeait son bord doré au-dessus de ses yeux noirs. Ainsi parée, elle était charmante. Ce que la tunique égyptienne donnait de trop théâtral à sa beauté avait disparu, et il restait une fille exquise, joignant à la grâce raidillonne d’une miss anglaise, un parfum discret et pénétrant d’orientalisme.
– Nous allons partir, dit-elle froidement, je sonne pour avertir que nous sommes prêts.
En parlant, elle tirait une bandelette d’étoffe servant de cordon de sonnette.
– Un instant, fit Lavarède avec un geste pour l’arrêter.
Elle le toisa sévèrement :
– Pourquoi, je vous prie ?
– Pour qu’il me soit permis de vous parler, d’éteindre un malentendu fâcheux.
Elle haussa les épaules, et regardant son interlocuteur avec une fixité gênante.
– N’insistez pas ; je me suis sacrifiée, je vous ai mis à même d’atteindre le pouvoir, objet de votre ambition.
– Ambitieux, moi, voulut se récrier l’ancien caissier ?
– En échange de cela, poursuivit-elle sans se soucier de l’interruption, j’ai droit, je pense, à quelque pitié. Lorsque nous serons seuls, ayez la générosité de m’éviter la tristesse de vous entendre.
À cette réplique sanglante, Robert demeura bouche bée. Presque aussitôt du reste la svelte Maïva, entrée en fonction de suivante, répondait à l’appel de la sonnerie et montrait sa gracieuse silhouette à la porte :
– Prévenez mon père que nous sommes disposés au départ.
À cet ordre donné par Lotia, l’esclave disparut, pour revenir bientôt en compagnie de Yacoub.
Celui-ci se confondit en révérences compliquées, dont se fut contenté le monarque le plus « à cheval sur l’étiquette », puis d’une voix basse, respectueuse, comme s’il avait eu l’intuition de parler il un demi-dieu :
– Si Votre Majesté y consent, j’aurai l’honneur de la conduire à l’embarcation qui lui permettra de continuer son voyage.
D’un mouvement de tête, Robert acquiesça à la proposition du vieillard qui, marchant le premier, le guida à travers les méandres de l’hypogée. On atteignit la sortie empruntée la veille au soir, mais au lieu de se diriger vers le forum, où l’union des fiancés avait été célébrée, Yacoub tourna en sens inverse, et par une pente raide, sur laquelle des rochers, trouant l’humus, formaient des gradins, il escalada l’éminence dont le palais funèbre était recouvert ainsi que d’un dôme de granit.
Du sommet, un sentier moins déclive descendait vers l’extrémité sud de l’île de Philæ. À travers les arbres, on apercevait près du bord, une légère chaloupe à vapeur de moindre tonnage que celle qui avait amené les voyageurs. Les matelots étaient à leurs postes, et sur le pont, Astéras, Niari, Radjpoor attendaient, les yeux fixés du côté des époux.
– Offre la main à ton épouse, ô Roi, dit alors le vieil Yacoub, les rites l’exigent.
Lavarède obéit. Il prit la main de Lotia. Cette main était glacée, elle tremblait, et avec un serrement de cœur, l’ancien caissier surprit ces paroles s’échappant des lèvres frémissantes de sa compagne :
– Pour la Patrie !
Une larme tremblotta à la naissance de ses cils ; il la renfonça par un énergique effort. Il comprenait le sens de l’exclamation de l’Égyptienne. C’était par seul dévouement à la cause de son pays, par pur patriotisme qu’elle lui abandonnait sa main fine, aux doigts fuselés. Sans cela comme elle l’aurait repoussé loin d’elle. Et de cela il souffrait cruellement, lui qui la trouvait belle, et qui savait bien n’être pas le Thanis meurtrier, lui, bienveillant petit Français, casanier peut-être, mais si disposé à se faire violence pour lui être agréable.
Cependant on atteignait l’embarcation. Robert, Lotia et la muette Maïva montèrent à bord, entre une double haie de matelots ; un coup de sifflet strident déchira l’air, et la chaloupe, dans un remous d’écume, évolua, mettant le cap au sud, tandis que Yacoub, debout sur la rive, les bras croisés, sa longue barbe agitée par la brise, les regardait partir.
La navigation devait durer des semaines. Tant que le soleil brillait, le bateau filait à toute vapeur sur les eaux bleues du fleuve. Le soir venu, on ralliait le rivage, et sous des tentes de poil de chameau, on passait la nuit. On entrait dans la période des basses eaux, car l’inondation annuelle qui atteint son maximum en juillet, décroît ensuite jusqu’en février.
La végétation se réduisait à une étroite bande verte bordant le fleuve ; au delà, à quelques centaines de mètres s’étendaient, tantôt des chaînes de hauteurs nues, torréfiées par le soleil, tantôt les plaines jaunes du désert. Bakleh, Korosko, Houadi-Halfa, agglomérations peu importantes, furent laissées en arrières. En ce dernier point, Robert apprit que la chaloupe était démontable, car les morceaux en furent transportés par terre au-delà de la deuxième cataracte. Puis on rencontra Ahache, Salebi. Le petit steam put traverser les passes rocheuses du seuil de Kaïbar, qui, un mois plus tard, les eaux ayant l’étiage le plus bas de l’année, eût barré complètement le cours du Nil.
On parlait peu à bord. Radjpoor et Niari avaient bien de mystérieux conciliabules, mais sans éprouver le besoin de confier leurs pensées à leurs compagnons de route. Lotia restait immobile, les paupières closes, comme étrangère à ce qui se passait autour d’elle, et Robert la regardait, s’enivrant de sa beauté délicate et originale, jusqu’au moment où il se souvenait de la haine imméritée que l’Égyptienne faisait peser sur lui. Alors il se glissait à l’avant du bateau, et ses yeux erraient avec une indifférence ennuyée sur les alternances de massifs verdoyants et de sables aux tons d’or rouge.
Sans doute, la muette Maïva s’était aperçue de son chagrin ; à diverses reprises, elle s’était approchée de Lotia, essayant de lui faire comprendre par gestes son injustice. Mais la fille d’Yacoub l’avait repoussée. Dans son esprit, cette servante, imposée par Lavarède, ne pouvait être qu’une créature à sa dévotion, indigne par conséquent de toute confiance.
Et la pauvre petite avait fini par se réfugier auprès d’Astéras, qui, lui au moins, ne la rudoyait pas. Le savant, du reste, avait commencé son traitement du mutisme. Pour démontrer à Maïva qu’il est bon de parler, il bavardait pour tout le monde. Et elle écoutait surprise, charmée, ses longs discours sur l’astronomie ; car tel était le sujet des monologues d’Ulysse. De quoi aurait-il causé, sinon de l’armée des soleils évoluant dans le champ de manœuvres sans limites de l’infini.
De fait, nulle chose n’aurait intéressé au même degré la jeune Égyptienne. Issue de ces peuples, pour qui les premiers dieux furent les voyageurs lumineux de l’espace, elle avait l’amour atavique des merveilles célestes, et tout naturellement, le calculateur avait trouvé le chemin de son attention et de son cœur.
Il lui disait l’histoire féerique et grandiose de la terre, d’abord amas de vapeurs embrasées perdu dans la nébuleuse solaire, puis le refroidissement insensible produit par le rayonnement ; la formation autour du noyau central d’anneaux concentriques semblables à ceux qui entourent encore la planète Saturne ; puis ces anneaux se condensant, et sous les influences combinées de leur contraction et de leur mouvement, prenant la forme de sphères en fusion ; satellites nomades emportés par la loi de la gravitation universelle autour du noyau igné, devenu le soleil de ces planètes.
Et le refroidissement continue ; les satellites, plus petits que le soleil, deviennent liquides ; ils passent du blanc éclatant à la teinte jaune. La température s’abaisse encore ; des parcelles se solidifient ; une à une, la Terre, Vénus, Mars, Jupiter, Uranus, Saturne, Neptune, pages sidéraux qui accompagnent le Soleil roi, passent du jaune au rouge, puis au noir. Ce sont maintenant des boulets sombres, tournant dans les déserts de l’espace autour d’une sphère de lumière. Elles sont mûres pour que la vie s’établisse à leur surface.
Les premières cellules organiques se montrent, se groupent, donnent naissance à des plantes élémentaires d’abord, puis à des êtres embryonnaires. Les formes, indécises au début, se précisent, s’affinent. L’instinct rudimentaire du végétal, qui conduit la racine vers le point où elle trouvera sa nourriture, se complique chez le reptile, puis chez le mammifère ; il grandit ; des apparences imprécises de volonté et de raisonnement s’y ajoutent. L’heure de l’intelligence a sonné ; l’homme apparaît. Barbare primitif, il domine bientôt les autres espèces animées. D’un pas lent, hésitant, il marche vers le progrès. Au commencement, il admire la force brutale, mais la pensée s’éveille ; des philosophes inspirés prêchent la bonté, le respect du faible, l’infériorité de la vigueur physique sur la puissance morale. Les révolutions se succèdent, car ce n’est point en un seul mouvement que l’on parvient à la lumière. La conscience obscure de l’humanité s’éclaire peu à peu. Elle a l’intuition vague qu’elle doit deviner les lois immuables de la nature ; la société se développe ; on comprend l’axiome qui veut que certains soient faits pour concevoir et d’autres pour exécuter. Il faut une tête, il faut des bras.
Qui sera cette tête ? Quels seront ces bras ? Là, de longs flottements se produisent. À la tête on place les guerriers, les sorciers, ils sont reconnus insuffisants. Par quoi les remplacera-t-on ? Une période de bouleversements, dans laquelle nous vivons hélas ! est la première réponse à cette formidable question. Le capital, travail de la veille, le travail, capital du lendemain, se disputent la suprématie. Cela dure et durera jusqu’au jour où l’on s’apercevra, que l’un et l’autre sont des convenances sociales et non des principes de la nature. Alors viendra le règne de l’intelligence, fin des luttes fratricides, apothéose de la pensée, apogée des races humaines !
Et puis à son tour le soleil s’éteindra. Déjà des taches nombreuses paraissent à sa surface. En quantité, en dimension, elles augmentent de siècle en siècle, et le moment arrivera où Phœbus ne sera plus qu’un globe de nuit emportant dans le vide d’autres sphères noires. La vie ne sera pas éteinte pour cela ; elle subira un temps d’arrêt, une sorte de sommeil.
Le soleil n’est pas un point immobile autour duquel nous tournons. Il est lui-même un astre en marche. Suivant une ligne dont l’origine est figurée par l’étoile Sirius, il se dirige vers les constellations d’Hercule et de la Lyre, avec une vitesse de 200,000 lieues par jour. De leur côté, ces constellations s’avancent vers nous à une allure deux fois plus rapide. La distance qui nous sépare d’elles diminue donc de 600,000 lieues par vingt-quatre heures. Cet énorme parcours est un point dans l’espace, il faudra 40,000,000 d’années pour que notre système solaire soit en contact avec ces groupes stellaires ; mais pareil nombre d’années n’est rien dans l’éternité. Un choc formidable se produira alors. Selon les lois de la physique, le mouvement des corps, au moment de la collision, se transformera en chaleur. Les mondes éteints seront réduits en vapeur, formeront une nouvelle nébuleuse, qui elle-même donnera naissance à un nouveau système solaire, sur lequel se développeront des races intelligentes, sans doute aussi supérieures à nous-mêmes, que nous le sommes aux animalcules rudimentaires qui façonnent le corail. Et la vie se renouvelle partout ainsi dans l’espace, allant sans trêve vers un progrès irrêvé. C’est là le mystère géant, que les anciens peuples d’Égypte et de Bactriane avaient symbolisé par la fable du Phénix renaissant de ses cendres.
Il s’était tu. Maïva l’écoutait encore. Soudain elle se dressa devant l’astronome, lui appuya les mains sur les épaules, et la figure contractée par un violent effort, elle fit entendre un son inarticulé.
– Je comprends, s’écria Astéras ravi. Tu voudrais parler, Maïva.
Elle inclina la tête, satisfaite d’être devinée.
– Eh bien ! enfant, je t’apprendrai.
Et tirant de sa poche une pièce de monnaie d’argent, il la tendit à la muette.
– Tiens, mets ceci dans ta bouche, et essaie de prononcer a… a… tu entends ?
De nouveau elle fit signe qu’elle entendait :
– Exerce-toi toute seule. Quand tu sauras, le reste ira bien.
D’un mouvement brusque, il attira la petite à lui, et l’embrassa sur le front, en ajoutant d’une voix émue.
– Tu parleras, mignonne, tu parleras et nous bavarderons.
Radjpoor n’avait rien perdu de cette scène. Le soir, au moment de l’atterrissage, il prit Astéras à part :
– Un mot, je vous prie.
– Plusieurs, si vous le désirez.
– J’ai remarqué tantôt votre recommandation à Maïva. Vous pensez qu’une pièce de monnaie introduite dans sa bouche lui permettra de parler.
– Peut-être. Sous l’action de la salive, le cercle métallique produit un faible courant d’électricité. Il n’en faut parfois pas davantage, pour stimuler le système nerveux et rendre son fonctionnement normal à l’organe.
– Alors, acceptez un conseil.
– Bien volontiers.
– Renoncez à l’expérience que vous projetez.
– Pourquoi ?
– Parce que Maïva mourra si elle parle !
Et laissant le calculateur bouleversé par cette déclaration, l’Hindou s’éloigna tranquillement.
Mais la perplexité d’Ulysse ne lui inspira aucun moyen de résister à son terrible compagnon, et il regagna sa tente en murmurant :
– Quel cynisme ! Refuser à cette malheureuse le moyen de s’exprimer. Oh ! je la préviendrai… Elle parlera sans qu’il s’en doute…, elle parlera ou bien j’y perdrai mon nom !
Vaines résolutions. Le lendemain, avant le départ, Radjpoor s’entretint avec Lotia. Le visage de la jeune femme trahit la surprise, la colère. Elle appela Maïva, et d’un accent courroucé lui interdit de s’approcher d’Astéras, sous peine d’être abandonnée sur le rivage, à la première infraction à cet ordre.
De grosses larmes roulèrent sur les joues brunes de la muette, mais elle n’eut pas un geste de révolte. Dans le bateau, elle s’assit à la place qui lui fut désignée. Seulement, s’il lui était défendu d’aborder Ulysse, il lui était permis de le regarder, et ses yeux disaient éloquemment sa reconnaissance et sa volonté d’obéir au savant.
Une fois elle essaya de glisser entre ses lèvres la pièce de monnaie que lui avait remise le calculateur ; mais Niari, qui épiait tous ses mouvements, se précipita sur elle, lui arracha le disque d’argent et le jeta dans l’eau du fleuve.
Elle haussa les épaules et parut demeurer indifférente à cette brutalité.
Pourtant Astéras, qui l’observait aussi, la vit détacher un sequin de son collier et le faire disparaître dans sa bouche, tandis que Niari, rassuré par son acte d’autorité, avait la tête tournée d’un autre côté.
– Pauvre petite, murmura Ulysse, elle se perd. Si elle parle, elle mourra.
Désolé d’avoir mis la muette en danger, n’osant faire un geste que ses ennemis auraient surpris, il attendit anxieux, la poitrine serrée, une occasion favorable d’avertir l’Égyptienne.
Cependant l’embarcation avait franchi les rapides d’Hannek, qui forment la troisième cataracte. Dongola-le-Neuf et Dongola-le-Vieux étaient dépassés ; on se dirigeait vers Kosti et Abou-Hamed, suivant le coude du Nil, emprisonné entre le désert de Nubie et le désert de Bayouda.
Le temps était superbe. Le soleil versait des torrents de lumière sur le sable, et dans cette aveuglante clarté, de rares palmiers se dessinaient en noir sur la surface étincelante de la plaine.
Ce jour-là et les jours suivants, on franchit les rapides de la quatrième cataracte, puis ceux de la cinquième, désignés sous les noms d’étranglements de Gueracheb et de Mogrât. Enfin un soir, on campa au delà du bourg de Berber, au confluent du Nil et de la grande rivière Atbara, dont la source est située sur les hauts plateaux d’Abyssinie.
Le panorama était grandiose. Le large lit du Nil s’étendait vers le sud jusqu’aux confins de l’horizon, bien loin derrière lequel se cachait Karthoum, la ville sainte des derviches ; l’Atbara se voyait à l’est, formant avec le fleuve égyptien un angle presque droit. Entre les deux cours d’eau une plaine immense, sablonneuse, ornée de quelques bouquets de palmiers, terre jadis féconde que les anciens appelaient l’île de Méroë ; aujourd’hui pays inculte envahi par les dunes du désert.
Sur ce sol dépeuplé, aucune surprise ne paraissait à craindre. Personne ne fut chargé de la garde du camp. Mal en prit aux voyageurs qui, au milieu de la nuit, furent brutalement réveillés. Des hommes armés avaient pénétré dans les tentes et, d’un air menaçant, tiraient leurs habitants au dehors.
C’étaient de grands gaillards bronzés ou noirs, offrant les types les plus variés, depuis le Berbère Targui jusqu’au nègre soudanien. Sous la clarté de la lune, drapés dans leurs amples manteaux, ils avaient quelque chose de farouche et de terrifiant.
Au milieu d’un cercle hostile, tout étourdis de l’aventure, Lavarède, Maïva, Astéras, Lotia, Radjpoor, Niari, pêle-mêle avec l’équipage de la chaloupe, s’interrogeaient du regard sans parvenir à comprendre ce qui leur arrivait.
Soudain le silence se fit. Les rangs des agresseurs s’ouvrirent, et un jeune homme portant le costume des officiers de l’armée égyptienne entra dans le cercle.
– Qui commande ici, demanda-t-il d’une voix calme ?
Les voyageurs se consultèrent et Radjpoor prit la parole :
– Qui es-tu et de quel droit nous interroges-tu ?
L’officier eut un sourire qui découvrit ses dents blanches.
– J’étais sabelcher – lieutenant – dans les troupes du khédive, mais l’oppression étrangère me pesait. Avec beaucoup d’autres, les plus nobles, les plus courageux, j’ai quitté ma patrie asservie et suis venu prendre un commandement chez les guerriers derviches. C’est encore une façon de lutter contre les envahisseurs. La facilité avec laquelle je te réponds doit te prouver que tu n’as à attendre aucun secours de ceux-là.
– Alors, nous sommes amis, répliqua Radjpoor, en tirant de sa poitrine un parchemin couvert de caractères bizarres et agrémenté de larges cachets de cire verte.
À peine le sabelcher y eut-il jeté les yeux que son attitude changea. Il s’inclina profondément devant Lavarède, puis s’adressant à ses hommes :
– Inssallah ! parava banlaou, cria-t-il.
Ces syllabes étranges produisirent un effet merveilleux. En une seconde, le terrain occupé par le campement fut déblayé. Le groupe des guerriers derviches se massa à une distance respectueuse, et l’officier qui les commandait se retira après s’être excusé en ces termes :
– Que le fils de Thanis pardonne à Oussaya. Il ignorait qu’il était devant son roi. Pour racheter cette erreur, il foncera dans les rangs ennemis, comme un coin de fer dans le bois tendre du dattier.
Puis doucement :
– Vous allez remonter l’Atbara et son affluent, la rivière Takazé, pour atteindre Axoum. Le long de leurs rives, Sire, vous verrez un spectacle qui vous réjouira. Partout les tribus se lèvent à notre voix. Elles marchent vers la citadelle de Kassala, que les Italiens, ces serviteurs inconscients de l’Angleterre, occupent. Il faut que cette forteresse tombe en notre pouvoir, afin que nous puissions sans inquiétude faire face vers le Nord. Tes serviteurs travaillent pour toi.
Et avec une lente révérence, retirant le tarbouch rouge dont il était coiffé, il ajouta :
– Longue vie et gloire à Thanis !
D’un pas élastique il s’éloigna, rejoignit ses hommes, et tous, après une acclamation puissante, disparurent dans la nuit.
Ce que les voyageurs avaient de mieux à faire était de reprendre leur somme interrompu. Ils n’y manquèrent pas, après avoir au préalable distribué aux matelots les quarts de veille, afin d’éviter une nouvelle surprise.
Rien ne vint troubler leur quiétude. Au jour, tous se rembarquèrent, et le petit vapeur, cessant de battre de son hélice les eaux du Nil, s’engagea à toute vitesse sur le cours indolent de l’Atbara.
Des journées se succédèrent. Maintenant les voyageurs voguaient sur la Takazé, tantôt élargie en nappes stagnantes, tantôt bondissant entre des murs de rochers. À maintes reprises, il fallut contourner par terre des passages par trop dangereux.
L’officier égyptien avait dit vrai. À chaque instant, on rencontrait des troupes indigènes en marche vers Kassala. Des patrouilles venaient reconnaître la caravane, et sur la présentation du firman dont Radjpoor était muni, rejoignaient leurs camarades avec des cris d’allégresse.
Tout le pays s’agitait, se levait en masse. Les étendards verts du Prophète, les enseignes hideuses des fétichistes allaient côte à côte, emportés par un même élan à la rencontre des soldats d’Italie, voués au carnage.
Et devant ce peuple en ébullition, soulevé tout entier pour défendre sa liberté, Lavarède oubliait sa tristesse, Lotia perdait son indifférence dédaigneuse, Radjpoor et Niari surveillaient moins étroitement Maïva. Si bien que l’astronome, qui seul n’était pas en extase devant les nations prêtes à s’entredéchirer, parvint sans éveiller l’attention à informer la muette de sa brève mais significative conversation avec l’Hindou.
C’était à la nuit tombante. On établissait le camp, et tous étaient absorbés par le dressage des tentes. Se courbant derrière de maigres buissons épineux, Astéras avait pu arriver près de Maïva.
– Ne bouge pas la tête, ne fais pas un mouvement, lui dit-il, mais écoute.
Mot pour mot, il lui redit les paroles de son ennemi. Quand il eut achevé, en dépit de sa recommandation, l’Égyptienne se retourna vers lui. Ses yeux brillaient. Ses lèvres s’ouvrirent à plusieurs reprises ; ses traits exprimèrent la tension de sa volonté, et enfin de sa bouche s’échappa nettement ce son :
– A…
Une joie intense pénétra le calculateur ; il saisit les mains de la fillette, les serra nerveusement. Mais les tentes étaient en place, il ne fallait pas se laisser voir par Radjpoor ou Niari. Très vite, il murmura :
– Bien, je suis content... tu parleras. Tu dis A.
Elle répéta :
– A.
– Essaie maintenant O… tu saisis O ?
Elle inclina sa jolie tête.
– Tu sais O, la lettre toute ronde quand on écrit.
Et comme elle le considérait d’un air interrogateur.
– Car tu écris, acheva-t-il ?
Elle fit un geste négatif.
– Non. Pourtant dans la cabine du Pharaon, tu nous as montré les papiers où il était question de mon ami Lavarède ?
Du doigt la jeune fille désigna son oreille, puis son front.
– Ah ! expliqua le savant, tu as entendu et retenu.
Elle frappa ses mains l’une contre l’autre et baissa le front pour affirmer. Ulysse allait parler encore, mais un bruit de pas se fit entendre. On venait de leur côté.
– O… O… dit-il tout bas. Rappelle-toi… O.
Et rampant sur les mains et sur les genoux, il disparut derrière les buissons, à l’instant même où Niari arrivait auprès de Maïva et lui intimait durement l’ordre de se retirer sous sa tente.
Astéras entendit sa voix acerbe. Il dut se maîtriser pour ne pas se ruer sur le sinistre personnage. Il sentait grandir en lui des ardeurs belliqueuses qu’il ne s’était jamais connues à l’Observatoire. Mais cette fois encore, le raisonnement triompha de la colère, et dans un rictus ironique, il murmura :
– Elle dit A, sans que tu le soupçonnes, sauvage Niari. Elle va dire O. Elle m’apprendra ton secret, et je pourrai alors la délivrer, elle, délivrer Robert et me délivrer moi-même.
Il s’interrompit, mordu au cœur par une soudaine tristesse.
– Alors il s’agira de lui trouver un emploi, car elle ne peut habiter avec moi. Je ne la verrai plus comme à présent. C’est curieux combien cela me paraît pénible. Je me suis attaché à cette pauvre enfant… Bah ! je dis cela, mais quand j’aurai repris mes travaux astronomiques…
Sans achever la phrase, il secoua la tête de façon désolée. Décidément, la muette concurrençait victorieusement les étoiles dans l’esprit de l’astronome, et chose qu’il eût déclarée impossible autrefois, la terre était en voie de lui faire oublier le ciel.
CHAPITRE XI
AXOUM
Cependant le voyage se poursuivait. La navigation, entravée à chaque instant par des marais encombrés de joncs géants, par des chutes, des barrages de rochers, était de plus en plus difficile. Une fois au moins par jour, il fallait démonter la chaloupe et la transporter à bras d’hommes au-delà d’un obstacle infranchissable autrement.
Après plusieurs journées fatigantes, au prix d’efforts incroyables, la petite troupe parvint à Kassala, ville d’une dizaine de mille habitants, alors au pouvoir des troupes italiennes, et qui devait, plus tard, tomber sous l’assaut furieux des derviches.
L’embarcation fut encore tirée de l’eau, et les voyageurs décrivant un large cercle, contournèrent la place. Il eût été imprudent, en effet, de s’exposer aux investigations des patrouilles italiennes, qui n’eussent pas laissé passer des Européens à destination de l’Abyssinie. Car la guerre battait son plein en ce coin du monde. Conduite par le général Baratieri, une colonne expéditionnaire, partie de Massaouah, port de la colonie Érythrée sur la mer Rouge, avait envahi l’Abyssinie, suivant l’itinéraire d’Asmara, de Goura, Sénafé, Adigrat, Adoua, Ada-Agamus, Makallé, Amba-Alaghi. Mais la fortune lui avait été défavorable. Battue à Amba-Alaghi, à Makallé, à Ada-Agamus, l’armée italienne avait dû reculer de cent soixante-dix kilomètres. Massée autour d’Adoua, à quelques lieues à l’est d’Axoum, elle demeurait là, arrêtée dans sa retraite par un faux point d’honneur national, tandis que les troupes de Ménélik, négus d’Abyssinie, l’enveloppaient lentement. Déjà la famine apparaissait dans le camp italien ; la plupart des convois de ravitaillement expédiés de Massaouah étaient enlevés en route par des groupes de partisans qui, le coup fait, s’éloignaient sans laisser de traces, comme si la terre les avait soudainement engloutis.
Et trompés par les incessants mouvements de l’ennemi, les bataillons d’Italie s’épuisaient en marches vaines, en contremarches inutiles, grillés dans les ravins profonds de la Suisse africaine égale en superficie aux quatre cinquièmes de la France, gelés sur les hauts sommets couverts de neige, rationnés comme nourriture, souvent privés d’eau, mangeant les attelages de l’artillerie, et hypnotisés pourtant par l’espoir décevant d’une victoire impossible, mourants déjà penchés sur la tombe, inconscients de leur agonie commencée.
On juge par ce rapide exposé de la situation, si la garnison de Kassala eût fait bon accueil à une caravane se dirigeant vers Axoum, la capitale religieuse des Abyssins, la cité sainte où les négus se font sacrer empereurs, de même que nos rois de France en la cathédrale de Reims.
Mais grâce aux précautions prises, les voyageurs ne furent pas inquiétés. Kassala fut laissée en arrière. Mais le fleuve s’encombrait de plus en plus ; à Ténem, on dut abandonner la chaloupe qui fut mise à la garde du cheik du village, et à dos de mulets, la petite troupe franchit la frontière abyssine.
La période la plus pénible du voyage était arrivée. Longeant autant que possible le cours de la rivière Takazé, la caravane traversait les Kolla ou basses terres de l’empire du négus. À travers des plaines marécageuses, couvertes d’une végétation touffue, sous les branches entrecroisées des baobabs ou doumas et des ébéniers, on avançait péniblement. Des nuées d’insectes avides se ruaient sur les voyageurs, perforant leur épiderme de leurs aiguillons empoisonnés. Au bruit de leurs pas, des reptiles géants, des boas, des pythons de dimensions démesurées, tels que l’on n’en rencontre nulle part ailleurs, s’enfuyaient dans le lacis inextricable des lianes, déroulant leurs anneaux avec des résonnances métalliques.
Brisés, ahuris, tous campaient à la nuit sur un tertre, et malgré les piqûres de maringouins sanguinaires, s’endormaient d’un lourd sommeil, dont ils sortaient plus las encore.
Vers le cinquième jour de marche, Niari annonça que, dès le lendemain, on gravirait les premières rampes du plateau abyssin. On allait quitter les Kolla pour entrer dans les terres d’altitude moyenne, les Ouaïna-Déga. Réconfortés par cette assurance, les voyageurs dînèrent d’assez bon appétit. Un buisson de pazaltéguo, dont la sève a la propriété d’éloigner les moustiques, avait été fauché par les matelots, et chacun s’était frotté le visage, le cou, les mains de ses feuilles à la senteur violente. Plus de piqûres, l’espoir d’une étape moins pénible ; il n’en fallait pas davantage pour ramener le sourire sur toutes les lèvres.
Entourés d’un cercle de feu, barrière flamboyante allumée pour écarter les fauves affamés, tous devisaient, sans hâte de regagner leurs tentes, Parfois Lotia, Maïva tressaillaient au rugissement lointain des carnassiers en chasse, et puis la conversation reprenait.
Lavarède interrogeait Radjpoor. Avant trois jours, on rencontrerait, sur la rive gauche de la Takazé, un ruisseau limpide, le Hassam. Il suffirait de le suivre durant quinze kilomètres pour atteindre Axoum.
Et l’ancien caissier, se promettant in petto de gagner, avec le diamant d’Osiris, la côte d’Érythrée, demanda :
– Au fait ! pourquoi la pierre précieuse en question se nomme-t-elle diamant d’Osiris ?
Un silence stupéfait suivit ces paroles. Un éclair haineux avait traversé les yeux noirs de Lotia. Enfin elle dit d’une voix frémissante :
– Thanis a-t-il donc oublié les saintes légendes d’Égypte ?
– Bon, fit ironiquement Robert, je ne les ai pas oubliées, par la raison que je ne les ai jamais connues.
– Il faut songer qu’il a quitté l’Égypte tout petit et qu’il a grandi dans l’exil, s’empressa d’ajouter Radjpoor.
Et comme Lotia ne répondait pas ; il conclut :
– C’est à vous, gracieuse souveraine, qu’il appartient d’enseigner à notre roi ce qu’il ignore encore.
Les traits de la jeune femme s’adoucirent. Elle eut, à l’adresse de l’Hindou, un regard bienveillant et d’un ton affectueux :
– Seigneur Radjpoor, à vous qui sans y être forcé, sans être appelé – elle appuya sur ces dernières paroles – à vous, qui librement êtes venu vous joindre aux opprimés pour le combat de la liberté, je n’ai rien à refuser.
Lavarède fut agité par un frisson. Une torture jalouse envahit son cœur.
Combien l’intonation de l’Égyptienne était douce, alors qu’elle s’adressait à l’Hindou, quand pour lui-même, elle n’avait que des airs dédaigneux et des mots cruels. Est-ce que, trompée par l’infernal quiproquo dans lequel il se débattait, elle se prenait de tendresse pour l’artisan mystérieux de l’intrigue incompréhensible dont le but, la raison, la pensée lui échappaient.
– Ô terre des sphinx, murmura-t-il, tout est incompréhensible chez toi, les êtres et les choses ! Seulement, acheva-t-il tout bas, ce qui est clair pour moi, c’est que je hais ce Radjpoor.
Il s’interrompit, Lotia, de sa voix musicale, disait la tradition attachée au diamant d’Osiris. Comme une harmonie, les paroles s’égrenaient dans l’air, faisant palpiter les ombres du sous-bois. Voici ce que l’Égyptienne narrait :
– Au commencement, l’univers était un océan de ténèbres. Osiris se dressa dans la nuit, et par trois fois appela la lumière. Et soudain du fond de l’infini, le soleil, la lune, les étoiles accoururent, peuplant de rayons la tunique noire du chaos.
De nouveau Osiris parla, et les terres se balancèrent dans le ciel, les mers roulèrent leurs vagues sur les grèves, et dans son lit, bordé de feuillages d’émeraude, le Nil coula à travers l’Égypte.
Aussitôt les lions rugirent, les oiseaux chantèrent dans les branches, l’essaim bourdonnant des insectes dispersa ses rondes ailées dans les airs. Osiris souriait à son œuvre, mais il se demanda tout à coup : – à qui donnerai-je la royauté de la création ? Et il tomba dans une rêverie profonde, qui se changea peu à peu en sommeil.
Un moustique l’aperçut, étendu sur la rive du Nil, dont son corps couvrait plus de cinquante coudées. Curieux il s’approche, et sans reconnaître le divin dormeur, il perce son épiderme de son aiguillon acéré.
La douleur tire le Maître de son engourdissement. Il regarde sa main. Sur la peau brune, de la légère blessure s’est échappée une goutte du sang blanc, cristallin, qui coule dans les veines du dieu. Ainsi qu’une sphère où le soleil se mire, elle tremblotte, prête à tomber ; mais il la touche, elle se coagule, devient la pierre précieuse qu’aucune n’égalera, car la volonté de celui qui peut tout, a enfermé dans ses flancs la Transparence et la Clarté.
– Ceci, dit-il, sera le signe de la royauté de l’homme.
Puis il saisit le moustique par les ailes.
– Chétif insecte, fait-il, je t’avais donné le moyen de t’élever dans les airs, de t’approcher des astres qui roulent dans les profondeurs de l’espace, et cependant tu n’as pas craint de t’attaquer à ton créateur. Je vais te donner un maître qui te pourchassera sans cesse ; l’homme. Toi, tu seras fatalement poussé à le piquer, afin qu’il se souvienne de ta faute et qu’il n’y tombe jamais.
Et frappant le sol du talon, il en fit sortir le premier des Pharaons.
C’est depuis ce jour que les moustiques s’acharnent à la poursuite de l’homme, et que le diamant d’Osiris est l’insigne du pouvoir.
Comme tous, bercés par le naïf récit, se taisaient, un rauquement formidable ébranla la forêt. Au-dessus de la barrière de flammes, une ombre décrivit une courbe, et une panthère noire, exaspérée par la faim, les yeux sanglants, s’abattit sur le sol à deux pas de Lotia.
Un cri d’épouvante s’échappa de toutes les poitrines, mais plus prompt que la pensée, sans armes, n’écoutant que son désir de protéger celle à qui appartenait son âme, Lavarède s’était déjà jeté entre l’Égyptienne et la bête féroce. Celle-ci, surprise d’abord, se rasa avec un grondement sourd. Elle allait bondir sur l’imprudent, le déchirer de ses griffes acérées… deux coups de feu retentirent, éclairant la scène de deux éclairs rougeâtres, et le félin atteint en plein cœur se tordit sur l’herbe dans une suprême convulsion.
Profitant de la diversion opérée par Robert, Radjpoor et Niari avaient saisi leurs carabines et avaient dénoué à la satisfaction générale l’aventure tragique.
Lotia, pâlie par l’effroi, vint à eux, les remercia avec effusion, mais elle n’eut pas un regard pour l’ancien caissier qui n’avait pas hésité à lui faire un rempart de son corps. Et tandis qu’Astéras s’empressait seul auprès de lui, Radjpoor quittant Lotia à l’entrée de sa tente, murmurait tout en gagnant la sienne avec Niari.
– Cette panthère avance. Dans quelques jours, ce coquin de Français ayant le diamant d’Osiris, elle fût devenue providentielle.
– Bah ! riposta Niari. Il y a tant d’occasions de supprimer un homme. Il ne faut pas t’inquiéter, Seigneur.
Les deux hommes se considéraient avec une expression étrange.
– Et qui sait, poursuivit Niari, si lui mort, tu ne reviendras pas sur ta décision d’abandonner l’Égypte à son sort.
Radjpoor esquissa un geste impatient ; son interlocuteur reprit vivement :
– Pardonne si je m’abuse. Il m’avait semblé que tes yeux s’arrêtaient volontiers sur Lotia.
– Et quand cela serait ?
– Elle-même te traite avec bienveillance. Avant peu, elle sera veuve. Tu pourrais aspirer à sa main, au pouvoir. La victoire est assurée, puisque « l’astre errant en tous sens » a paru dans le ciel, Thanis, les dieux t’envoient la tendresse pour te rappeler ce que tu dois à ta race.
Mais le faux Hindou, auquel son compagnon venait de rendre son véritable nom, secoua la tête :
– Ni guerre, ni massacres. En ce siècle l’Égypte est la barbarie, l’Angleterre est la civilisation. C’est à elle qu’appartient le triomphe.
Et d’un ton changé :
– Épouser Lotia, parbleu, je le voudrais ; j’y songerai. Mais la patrie égyptienne, non, cent fois non.
– Pourtant !
– N’insiste pas, Niari. Tu es un ancien client des Thanis, tu leur dois tout.
– Je m’en souviens, Seigneur.
– Je le sais. C’est pourquoi je t’ordonne de ne plus me parler jamais de tes rêves patriotiques. Des rêves, mon pauvre ami, de simples rêves… pourquoi les transformer en cauchemars sanglants ?
Radjpoor-Thanis était parvenu au seuil de sa tente. Amicalement sa main s’appuya sur l’épaule de Niari.
– Jamais, tu m’entends, jamais. Lotia veuve, oui, de cela seulement occupe-toi.
Et soulevant l’étoffe qui masquait l’entrée, il se glissa sous l’abri, tandis que son interlocuteur s’en allait pensif à petits pas.
À ce moment même, à l’autre extrémité du campement, Robert, désolé par l’ingratitude dont Lotia avait fait montre à son égard, exhalait sa douleur devant Astéras.
Le savant l’écoutait sans prononcer une parole, bien que ses lèvres fussent agitées de petits mouvements. À part lui, Ulysse murmurait :
– Bientôt on démasquera le Radjpoor. Maïva a dit A. Elle parlera, et alors… alors… on verra de quel bois se chauffe un astronome.
Et dans la tente voisine, Lotia s’endormait en disant avec une tristesse profonde :
– Radjpoor-Sahib m’a sauvée. Pourquoi n’est-ce point lui, si brave, si loyal, que j’ai épousé au lieu du fourbe et criminel Thanis ? Pourquoi, oui, pourquoi ?
Quels que soient les sentiments qui agitent les humains, les heures passent insouciantes ; la nuit s’écoula. À l’orient, l’aurore effeuilla ses roses sur le chemin du char du soleil. Le campement fut levé, et par une succession de pentes insensibles, la caravane s’éleva jusqu’aux premiers gradins du plateau abyssin.
En une demi-journée, le spectacle avait changé. Aux floraisons débordantes des basses terres succédaient les essences de l’Europe du sud. On eût cru traverser les forêts des Apennins ; le cours de la Takazé s’encaissait, roulant torrentueusement au fond de gorges, à trois cents mètres au-dessous du sentier suivi par les voyageurs.
La température était douce. Des brises fraîches éventaient la caravane. Les moustiques avaient presque disparu.
Et cependant, il y avait comme un chagrin, une anxiété sur les personnages composant la troupe. Lotia, Radjpoor, Niari, Lavarède, Astéras, Maïva s’absorbaient en des réflexions diverses. Quant aux matelots, gênés par l’attitude de leurs chefs, ils devisaient à voix basse, suivant sans bruit, sans gaieté leurs maîtres taciturnes.
Durant trois fois vingt-quatre heures il en fut ainsi. Le dernier jour, le camp fut établi au confluent de la Takazé et du Hassam, ce ruisselet annoncé par Radjpoor et qui indiquait le chemin d’Axoum.
L’expédition touchait à sa fin ; le lendemain on pénétrerait dans la ville sainte, Le diamant d’Osiris serait remis à Robert. Et pourtant celui-ci éprouvait un déchirement en songeant que l’heure de s’évader allait sonner. C’est qu’il se rendait compte que sa paresse physique seule le poussait à revenir en Europe. Son âme ne lui appartenait plus, elle resterait éplorée et douloureuse autour de l’insensible Lotia.
Aux premières lueurs de l’aube, la marche fut reprise, Par des sentiers de chèvres, serpentant sur des rampes abruptes, on escalada les contreforts qui dominent la vallée d’Axoum, On avançait lentement ; contraints à chaque instant à de longs détours, les voyageurs n’atteignirent les crêtes que vers midi.
On déjeuna rapidement, avec la hâte de poursuivre. À deux heures, la marche fut reprise. Maintenant on descendait, au milieu de bois touffus, un escalier de géants taillé dans le granit par les eaux pluviales.
Les arbres, les buissons se rapprochaient, s’enchevêtraient en une muraille de verdure.
– Nous sommes près de la lisière de la forêt, fit remarquer Niari, la végétation devient toujours plus exubérante au débuché.
Il achevait à peine que, s’ouvrant un passage à travers les broussailles, la caravane déboucha dans une immense plaine verdoyante. Tous s’arrêtèrent. Leurs yeux, déshabitués des larges horizons, se délectaient devant le vaste panorama qui se déroulait devant eux.
Au loin Axoum étageait ses palais, ses temples, ses obélisques – il en existe 64 dans la ville sainte – mélangés dans un pittoresque désordre à des huttes de terres surmontées de toits coniques.
Mais ce qui frappa surtout nos voyageurs, c’est le prodigieux mouvement qui animait la plaine. Une armée était là, se livrant à une manœuvre incompréhensible. Des fantassins se formaient en bataillons, des groupes de cavaliers se réunissaient aux ailes. Et vers le centre, autour d’une tente abattue, des batteries d’artillerie se massaient.
– Qu’est-ce que c’est que ça, s’écria Lavarède ?
Comme pour répondre à cette question, un gros de cavaliers se détacha de la masse grouillante et se dirigea ventre à terre vers la caravane.
– Ce sont des Abyssins, déclara Niari après un moment. Marchons à leur rencontre. Nous n’avons rien à craindre.
On poussa aussitôt les montures. Cette manœuvre fut remarquée des cavaliers indigènes, qui s’arrêtèrent et attendirent que la caravane les eût rejoints.
Lorsqu’elle fut arrivée à hauteur du groupe, l’un des Abyssins, un chef sans doute, s’approcha des voyageurs et leur intima très courtoisement d’ailleurs l’ordre de le suivre. Sans attendre leur réponse, il se dirigea vers l’endroit où était massée l’artillerie. Il n’y avait pas à résister, on le suivit, et les cavaliers fermant la marche, le cortège passa devant les rangs pressés des fantassins de Ménélik.
Curieuse était cette armée. Sauf le corps des artilleurs, uniformément coiffés d’un bandeau d’andrinople sous une calotte verte, et vêtus d’une tunique galonnée de vert, les soldats abyssins n’ont point de costume distinctif. Les chapeaux les plus bizarres, les chaussures les plus hétéroclites, des vêtements variés depuis la tobe – tunique blanche à bordure carminée – jusqu’au simple pagne laissant le torse nu, donnaient aux guerriers une apparence risible. Mais en y regardant de plus près, on comprenait à leurs regards étincelants, à leurs armes perfectionnées, que ces hommes affublés d’oripeaux étaient de redoutables adversaires. Tels les soldats de la République, couverts de haillons, sans pain, sans souliers, qui, à la fin du dix-huitième siècle firent trembler le monde.
On avançait toujours, À trois cents mètres, un groupe brillant semblait attendre les voyageurs. En avant, un homme de haute taille, monté sur un cheval noir qu’un lion domestique paraissait garder, se distinguait tout d’abord. En approchant, Lavarède distingua sa figure noire et grêlée, entourée d’une barbe grisonnante. Sa tenue se composait d’une chemise de soie bleue, d’une chamma blanche et d’un burnous de satin noir s’ouvrant sur un pantalon de coton blanc ; un large feutre noir posé sur un serre-tête de mousseline claire complétait son ajustement.
– L’empereur Ménélik, roi des rois, murmura le guide en le désignant.
À dix pas du négus, il s’arrêta, porta les deux mains à son front, puis allongea les bras à droite et à gauche. Ce salut fait, il vint au roi, lui parla un instant à voix basse, puis se rapprochant des étrangers.
– Ménélik, maître de l’Abyssinie, demande qui vous êtes ?
Cette fois encore, Radjpoor présenta son firman à l’officier. Celui-ci le remit à l’empereur qui le parcourut rapidement. Son regard exprima une surprise joyeuse, ses talons pressèrent les flancs de son cheval qui l’amena vers les voyageurs et doucement :
– Lequel d’entre vous est Thanis ? Lequel veut faire l’Égypte libre et renouer ainsi les bonnes relations établies jadis entre son peuple et le mien ?
À cette question, tous s’écartèrent, formant le cercle autour de Robert.
– C’est toi, frère, reprit l’empereur ? Sois le bienvenu dans mon empire, et souviens-toi que Ménélik a la haine de l’invasion, et que ses guerriers seront toujours prêts à combattre côte à côte avec les tiens.
Puis tirant son épée suspendue à l’arçon de sa selle.
– Approche, frère. L’empereur te fait chevalier d’Abyssinie. Toi et les tiens, grâce à la médaille d’or que voici, pourrez circuler librement dans tout le pays.
Et Lavarède s’inclinant, il lui frappa les épaules du plat de son épée.
– Tu es chevalier, viens que je te donne l’accolade.
Les chevaux étaient flanc contre flanc. Le négus serra l’ancien caissier dans ses bras, puis dénouant son étreinte, il lui tendit un collier de fer, au bout duquel scintillait un disque d’or portant sur une face l’effigie de l’empereur et sur l’autre cette devise hautaine : L’Abyssinie tend seulement la main vers l’infini.
Et quand les anneaux de fer entourèrent le col du jeune homme :
– Frère, je ne puis te recevoir ainsi que je le souhaiterais. Moi-même je défends l’indépendance de mon peuple contre les conquérants italiens. J’ai levé mon camp, je dois partir avec mon armée. Mais l’un de mes officiers t’accompagnera à Axoum : il dira à l’Abouma, le chef de notre église, nommé par le patriarche d’Alexandrie : Celui-ci est l’ami de Ménélik, Et l’on fera ce que tu désires.
Lavarède s’embrouillait dans ses remerciements ; le négus l’interrompit :
– Viens, frère ; que je te présente à ma compagne bien-aimée, à mes vaillants lieutenants qui, un jour peut-être, se joindront à tes soldats pour balayer la terre d’Égypte.
Il entraînait l’ancien caissier vers le groupe qu’il avait laissé en arrière. Avec une émotion dont il ne fut pas maître, le Français fut présenté à la reine Taïtou, Rehetiepa Beheran, soleil et lumière de l’Éthiopie, au visage énergique et charmant d’Espagnole ; au ras Makonnen, vice-roi du Harrar, à la physionomie fine et mélancolique, au ras Mikaël, époux de la fille du négus, au ras Mangasha, fils de l’empereur Johannès et jadis compétiteur de Ménélik, au ras Aloula, au ras Walé, frère de Taïtou, et enfin au lion de l’Abyssinie, le téméraire et chevaleresque Dedjaz-Gabayou.
Et après une nouvelle accolade, s’excusant encore d’être tenu par son devoir de généralissime, l’empereur chargea un officier de conduire la caravane égyptienne vers Axoum.
Pour lui, levant l’étendard royal, il donna le signal du départ. Aussitôt l’armée s’ébranla dans un ordre parfait, et traversant la plaine verdoyante, s’engouffra dans une gorge sombre, ainsi qu’un gigantesque serpent d’acier.
Cependant l’Abyssin désigné comme guide pressait les voyageurs de gagner Axoum. Son conseil était sage, et un temps de trot conduisit la caravane aux portes de la ville.
Ville morte, cité en ruines, dans les ruelles étroites de laquelle le sabot des chevaux résonnait sans qu’un habitant curieux sortît des paillottes éventrées, des palais aux corniches chancelantes. De loin en loin un obélisque dressait sa flèche de pierre au milieu d’une place déserte, car les jours de splendeur sont passés pour Axoum. Cinq cents habitants à peine sont encore groupés autour de la basilique, centre religieux de l’Abyssinie. Les autres ont fui vers la ville nouvelle, vers Adoua.
Enfin, les hautes murailles du temple où réside l’abouma se dressèrent devant les voyageurs. Une porte de fer s’ouvrit lentement. Ils traversèrent des passages voûtés, des cours silencieuses, où l’herbe croissait entre les pavés disjoints, et ils mirent pied à terre devant un perron aux marches branlantes.
Au haut des degrés, un vieillard, dont le corps maigre dessinait ses angles sous une ample tunique violette, souhaita la bienvenue aux voyageurs.
– Durant trois journées seulement, dit-il, la basilique d’Axoum peut recevoir les étrangers. Mais pendant ce laps, les hôtes sont les maîtres. Commandez ; on vous obéira.
Pour toute réponse, Radjpoor lui tendit le firman aux cachets verts. L’abouma, c’était lui-même, en prit connaissance :
– Ah ! ah ! continua-t-il d’un air pensif. Thanis a signé le traité d’alliance avec Hador. Les temps prédits seraient-ils proches ?
Puis d’un ton bienveillant :
– Ce soir, à l’heure où la nuit coquette égrène dans le ciel ses chapelets d’étoiles, j’attendrai Thanis dans cette cour, et je le conduirai lui seul, à la cachette ignorée où s’abrite le joyau d’Osiris. Maintenant prenez du repos, car la route a été longue.
Il frappa ses mains l’une contre l’autre. Aussitôt des prêtres, à la robe blanche agrémentée de palmettes violettes, accoururent. Courtoisement ils invitèrent les voyageurs à les suivre et les installèrent dans les appartements réservés aux visiteurs. Les salles étaient spacieuses, et le mobilier accusait un mélange de luxe raffiné et de simplicité primitive. On avait là l’impression exacte de l’âme abyssine, incomparablement supérieure à celle des peuples noirs qui l’entourent, mais gênée dans son essor par les vagues vivantes qui viennent battre les flancs de l’îlot rocheux qu’elle habite et qui domine les déserts.
Partout en effet, dans ce pays singulier, se rencontrent les mêmes oppositions. Chrétiens grecs, les Abyssins mêlent au rite russe certaines pratiques païennes. Auprès de leurs monuments, qui indiquent un goût raffiné de l’architecture, se dressent des paillottes aux murs d’argile séchée, coiffées de toits coniques de chaume, identiques aux constructions éphémères des peuplades soudaniennes.
Ils n’ont point adopté l’ère russe, qui a, avec la nôtre, un écart de treize années. Ils comptent d’après l’ère d’Antioche, dont l’origine est placée 5493 ans avant J.-C., laquelle fut apportée au quatrième siècle par Frumentius ; si bien que notre année 1896 est pour eux l’an 7389.
Avides de liberté, ils maintiennent l’esclavage. Désireux de transformer leur organisation guerrière, ils conservent, comme castes privilégiées, la noblesse et le clergé, reléguant au bas de la hiérarchie sociale, les marchands et les cultivateurs. Et comme si ces divisions ne creusaient pas un abîme infranchissable entre l’aristocratie et le populaire, les lois du pays imposent une langue différente à chacun des deux groupes. Les chefs, les ras, les guerriers parlent l’amharic, le peuple emploie l’idiome agaou, de telle sorte qu’un seigneur et un artisan sont exposés à ne se comprendre qu’à la condition d’être assistés par un interprète.
Dans une même chambre, Lavarède et Astéras causaient.
– Eh bien, disait le premier avec une pointe de tristesse, le diamant d’Osiris va nous faire riches ; il s’agit à présent de quitter… à l’anglaise, nos compagnons.
– En emmenant Maïva, se récria Ulysse.
– Que ne puis-je en même temps entraîner Lotia, ma femme, vers des contrées plus clémentes ?
– Bah ! laisse donc. Une sauvage sans cœur.
Robert se leva avec impatience.
– Mais non, pas sans cœur du tout. La preuve est qu’elle me déteste.
– Eh bien mais…
– Et je l’approuve.
– Tu es vraiment trop bon.
– Non, je suis juste. Elle me croit Thanis, fils d’un homme qui a tué sa mère, Je ne comprends qu’à moitié, mais pour elle, cela doit être très clair. Sa haine montre son amour filial. Je l’estime de me refuser son affection.
– Ton raisonnement biscornu prouve…
– Quoi ?
– Qu’il ne faut jamais dire : Fontaine, je ne boirai pas de ton eau.
D’un regard étonné, Robert enveloppa son interlocuteur. L’astronome sourit :
– Tu ne te souviens pas de notre conversation, le soir où nous sortîmes de l’Observatoire ?
– Ma foi non.
– Je t’affirmais, sur la foi d’une amie de ma famille, qu’il existe de par le monde des anges dont la vue seule donne l’horreur du célibat.
– Eh bien ?
– Tu me répondis : Jamais cela n’arrivera pour moi. Hélas ! tu avais raison. Car ta Lotia n’est pas un ange, mais un démon.
Les sourcils de l’ancien caissier se froncèrent :
– Raille, raille, mon bel ami. Il me semble que tu es logé à la même enseigne que moi ; ton intérêt pour la muette Maïva.
– Eh là, je t’arrête ! D’abord je n’ai pas dit comme toi : Jamais. Et ensuite…
– Ensuite ?
– Maïva est un ange.
– Parbleu !
– Un pauvre être opprimé, qui nous montre sans cesse son attachement, son dévouement.
Avec un haussement d’épaules, Robert fit ironiquement :
– Entendu ! Elle est bonne, dévouée. Elle s’intéresse à l’astronomie et force ainsi la tendresse de l’astronome.
– Que veux-tu dire ?
– Qu’une fois en France, tu l’épouseras.
– Moi ?
Le savant écarquilla les yeux, ouvrit la bouche, exprimant par cette mimique une surprise non équivoque. Sa physionomie était si cocasse, que son ami ne put s’empêcher de rire.
– Toi-même, appuya-t-il enfin. Toi qui, sans t’en douter, as donné toute ton affection à cette petite esclave que tu protégeais.
– Tu crois ?
– Il ne faut pas être grand clerc pour arriver à la certitude.
– Eh bien, déclara résolument le savant, je l’épouserai.
Puis devenu soudainement joyeux :
– Au fait ! c’est le moyen de ne pas la quitter, de la voir tous les jours. Moi qui me creusais la tête pour trouver. Cela y est, et grâce à toi, mon bon Robert. Tu seras de la noce.
Mais de nouveau le visage de Lavarède s’était assombri.
– En attendant, nous sommes prisonniers. Comment regagner la France ?
La question calma les transports de l’astronome. Emporté par la satisfaction de voir clair en lui-même, il avait oublié la situation présente. Et grave maintenant il répéta :
– Comment regagner la France ?
Aucune solution ne se présenta à l’esprit des jeunes gens. Un lourd silence pesa sur la salle. Ils songeaient, sans réussir à faire jaillir de leur cerveau la combinaison libératrice.
Et comme ils demeuraient là, immobiles, absorbés, la porte tourna lentement sur ses gonds et Maïva parut.
Repoussant le battant, elle s’approcha d’Ulysse qui la regardait, ravi de la voir, la trouvant plus charmante depuis que, grâce à son ami, il comprenait combien elle lui était chère. Elle déploya devant lui un papier qu’elle tenait à la main, et lui fit signe d’y jeter les yeux.
Il obéit. C’était une carte rudimentaire de la région, où les sentiers, les passages de montagnes étaient figurés par des traits, Au centre à peu près, en caractères latins, le mot : Axoum, s’allongeait auprès d’un fouillis de maisonnettes représentant la ville sainte.
– Une carte, murmura le savant. Que veux-tu que j’en fasse ?
Derechef elle lui conseilla par gestes de lire le plan.
Robert s’était levé. Il examinait la feuille par dessus l’épaule de son compagnon :
– Pour fuir, dit-il entre haut et bas, il est bon de connaître la topographie du pays.
Les yeux de la muette brillèrent ; ses lèvres s’épanouirent en un sourire.
– Ah ! c’est cela, s’écria Astéras à qui ces signes n’avaient pas échappé.
Elle inclina affirmativement la tête.
– Bon… alors cherchons à nous entendre.
Et mettant le doigt à l’endroit où Axoum était représenté :
– Nous sommes ici, à Axoum, Voyons, de quel côté penses-tu que nous devons nous diriger ?
Il s’arrêta et avec chagrin :
– Je suis bête. Tu ne sais pas lire.
De la main, elle lui ordonna d’attendre. Son regard perçant parcourut la pièce, puis elle allongea les bras en avant, les ramena contre sa poitrine, simulant le geste d’un rameur.
– Parfait… en bateau… il faut gagner l’eau… Laquelle ?
De l’index, la petite muette montra un fauteuil recouvert de velours rouge.
– Quoi… demanda Lavarède, un fauteuil ? Non… alors sa couleur peut-être… ? Oui… l’eau rouge… ? Il y a un fleuve rouge aux environs ? Non… pas un fleuve… Ah ! la mer Rouge !
Rapidement la tête de l’esclave s’abaissa d’arrière en avant.
– Marchons vers la mer Rouge, continua l’astronome… Nous passons par Adoua.
– Oui, mima encore Maïva.
– Adoua, où sont les Italiens, ennemis de nos geôliers et amis des Anglais.
La jeune fille répéta le même geste.
– En effet, un de leurs convois nous ramènerait à Massaouah. Seulement comment sortir d’ici ?
À cette interrogation, la muette se pencha sur une table qui occupait le centre de la salle et fit mine d’écrire.
– Écrire, à qui ?
Elle revint au fauteuil rouge.
– À la mer Rouge… ? non, à ceux qui peuvent nous y conduire… aux Italiens ?
Elle sauta joyeusement.
– Aux Italiens ?… Ah ! j’y suis. Leur dire que nous sommes captifs ici ; que les Abyssins se sont éloignés, et qu’une reconnaissance nous délivrerait…
À mesure qu’Astéras parlait, la muette devenait plus gaie. C’était bien cela qu’elle désirait.
– Écrire, je veux bien, mais qui portera la lettre ?
Elle mit la main sur sa poitrine.
– Toi, le pourras-tu ?
Elle affirma de la tête.
– Quand ?
La fillette s’approcha de la fenêtre. Son bras se tendit dans la direction du soleil et décrivit un cercle vers l’horizon.
– Après le coucher du soleil, traduisit Robert palpitant. La nuit en un mot. Mais nos compagnons ?
Dans le fauteuil Maïva se laissa tomber, les yeux clos, simulant le sommeil.
– Ils dormiront. Eh bien, soit ! pauvre mignonne ; nous nous confierons à toi, et pour commencer, nous allons écrire ce que tu désires.
Et, s’installant à la table, sur laquelle une attention délicate avait rassemblé des feuilles d’un papyrus grossier, des plumes de roseau et une encre rougeâtre obtenue par la macération dans l’alcool d’une argile ocreuse, l’ex-caissier traça les lignes suivantes :
À MM, les officiers des troupes italiennes au camp d’Adoua.
« Messieurs,
« Deux voyageurs captifs en la métropole d’Axoum vous prient de les délivrer. Ils ont assisté au départ de l’armée du Négus. Le chemin est donc libre, et une compagnie suffirait à la tâche. Au nom de la civilisation et de la solidarité européenne, nous vous supplions de répondre à notre appel ».
Il signa : Robert Lavarède, employé de commerce ; fit apposer à son ami sa griffe : Ulysse Astéras, de l’Observatoire de Paris, et pliant la missive, après l’avoir relue à haute voix, il la remit à Maïva qui la cacha aussitôt dans son gorgerin.
Ulysse avait saisi les mains de la muette :
– Tu est bonne, Maïva, dit-il d’un ton ému, tu es bonne et je t’aime.
Elle le regarda tendrement et doucement, avec une caresse dans la voix :
– A… O… A… O… gazouilla la fillette.
L’astronome eut un cri de joie :
– Deux voyelles déjà… tu parleras bientôt… Tu pourras exprimer tout ce qu’il y a d’exquis en ta petite âme. Travaille, Maïva… il faut apprendre à dire U.
Elle inclina sa jolie tête, mit un doigt sur ses lèvres, et d’un pas silencieux gagna la porte. D’un regard rapide elle s’assura qu’aucun fâcheux n’était aux écoutes, et sans bruit elle se glissa dehors.
CHAPITRE XII
LE DIAMANT D’OSIRIS
Vers minuit, le long des murailles sombres qui ceignent à l’est la basilique d’Axoum, une masse blanche glissa jusqu’au sol. Parvenue à terre, elle se redressa, et Radjpoor, Niari, s’ils eussent été là, eussent reconnu avec surprise la silhouette élégante de Maïva.
Dès son arrivée, la muette s’était aperçue que sa chambre était située près du mur extérieur. Une étroite fenêtre, percée comme une meurtrière dans l’enceinte s’ouvrait à trente pieds du sol. L’idée de s’évader, de sauver les Français qui lui avaient appris la bonté, avait aussitôt germé dans son cerveau. Une vieille carte, piquée au mur, lui avait servi de trait d’union entre sa pensée et celle de ses amis. Et maintenant elle venait d’utiliser une natte découpée en lanières en façon de corde pour atteindre le pied du mur.
Elle riait silencieusement au souvenir de Niari, qui, la nuit venue, l’avait enfermée dans sa chambre avec un luxe de précautions bien inutile. Il n’était, point venu à l’esprit de l’Égyptien que la courageuse créature irait à la liberté, suspendue à dix mètres du sol, à un faible lien que le poids léger de son corps souple eût pourtant suffi à rompre. Elle, insouciante du danger, avait accompli heureusement son tour de force, et maintenant, longeant les maisons, dans la zone d’ombre qu’elles projetaient, Maïva marchait d’un pas élastique et rapide, à travers la cité endormie.
Bientôt elle se trouva dans la campagne. Des bruits menaçants s’élevaient autour d’elle : rugissements de fauves, cris plaintifs de gazelles effrayées ; mais rien ne ralentit son allure. Elle traversa la plaine, atteignit une gorge rocheuse et noire, qui trouait la chaîne de montagnes dont la vallée d’Axoum est entourée ainsi que d’une ceinture, et s’enfonça dans l’obscurité.
Au même instant, Lavarède, se conformant aux instructions de l’abouma, descendait seul dans la cour, où le grand prêtre avait reçu les voyageurs.
L’endroit était lugubre ; on eût dit le fond d’un puits d’ombre. De tous cotés, les hautes murailles de la basilique s’élevaient perpendiculaires, découpant entre les arêtes de leurs sommets un polygone du ciel où de rares étoiles scintillaient.
– Me ferait-on poser, murmura le jeune homme impressionné par le morne silence qui régnait autour de lui ?
Il avait à peine achevé que le grincement léger d’une porte lui arriva, et que sur le perron, il distingua une forme qui se mouvait plus sombre que l’obscurité ambiante.
– Es-tu là, mon fils, demanda une voix que Robert reconnut ?
– Oui, Abouma, je t’attendais.
– Tu es exact, c’est bien. Le roi qui pratique l’exactitude est soucieux du bonheur de ses sujets. Viens, mon fils, et puisse le bijou précieux que je vais remettre entre tes mains te donner la victoire.
Ce disant, il descendait les degrés du perron. Parvenu auprès de l’ex-caissier, il lui prit la main :
– Laisse-toi conduire. Dans le temple, j’allumerai la lanterne dont je suis muni. Mais nous accomplissons une œuvre de mystère, et nulle lueur ne doit déceler notre passage.
Tâtonnant, butant contre des marches invisibles, Lavarède suivit son guide dans la nuit. Ils parcoururent ainsi des corridors obscurs, des salles dallées dont les vastes dimensions se trahissaient seulement par la répercussion prolongée du bruit de leurs pas.
L’abouma se dirigeait dans ce dédale comme s’il eût fait grand jour. À chaque instant, il avertissait doucement son compagnon de la présence d’un obstacle.
– Courbe le front, car la voûte s’abaisse. Attention ! deux marches à gravir, etc., etc.
Soudain le grand prêtre fit halte. Une faible lumière brilla. Il avait enflammé une allumette. De sa main maigre et tremblante, il ouvrit une lanterne attachée à sa ceinture et communiqua le feu à la bougie de cire fichée à l’intérieur.
Alors Robert distingua devant lui une porte de fer, sur laquelle d’énormes clous dorés formaient une croix grecque.
L’abouma introduisit une clef dans la serrure, la porte s’ouvrit, et un courant d’air froid vint fouetter le visage du jeune homme.
– Entre, mon fils, marmotta son compagnon ; le temple supérieur d’Axoum est prêt à te recevoir.
– Le temple supérieur, répéta le Français ?
– Oui. Avance sans crainte et tu comprendras.
Le voyageur céda à cette injonction. Sur le sol formé de dalles blanches et noires alternées il fit quelques pas, et la nef se dessina confusément à ses yeux sous la clarté tremblottante de la lanterne.
Non prévenu, il eût cru se trouver dans une mosquée sarrazine. Partout des piliers légers, élancés, jaillissant du sol ainsi que des fûts de palmiers, montant à une prodigieuse hauteur et se rejoignant en ogives allongées. L’autel étincela dans la pénombre avec ses ornements d’or et de lazzulite. Toujours suivant son guide, Robert le contourna et vit à ses pieds un escalier tournant qui s’enfonçait en spirale dans la nuit.
L’abouma descendit les degrés. Robert l’imita, comptant cinquante-deux marches.
– Le temple médian, dit encore le grand prêtre.
Autour de lui, l’ancien caissier promena un regard effaré. Sous la mosquée musulmane, il distinguait une église romane, aux assises trapues, aux pleins-cintres massifs. Là aussi il y avait un autel ; mais celui-ci était de marbre uni. Pas de dorures, pas de pierres précieuses ; la grandeur austère des premiers siècles du christianisme.
Il se retourna vers l’abouma pour l’interroger, pour apprendre par quels événements ces deux temples étaient ainsi superposés ; mais le prêtre s’éloignait déjà, précédé du cercle lumineux de sa lanterne et laissant derrière lui une ombre démesurée. Robert pressa le pas pour le rejoindre. Dans ses traces, il traversa la nef à la voûte basse. Dans l’angle opposé à l’entrée, l’Abyssin lui désigna une dalle portant un anneau de fer.
– Nul n’a soulevé cette trappe depuis que le diamant d’Osiris nous a été confié. Prends le pic que tu vois appuyé au mur, descelle-la, et tu seras libre alors de pénétrer dans le temple inférieur, celui que les Pharaons avaient construit au temps de leur grandeur.
Dominé par l’étrangeté de la scène, Robert saisit le pic, dégagea le tour de la dalle ; puis glissant avec peine l’extrémité de l’instrument sous la plaque de pierre, il la fit, par une lente pesée, sortir de son alvéole. Un nouvel escalier se présenta.
– Mon fils, psalmodia le prêtre. Je ne puis te suivre dans cet asile de l’ancien paganisme ; je t’attendrai ici. Emporte la lanterne et le pic. Au bas de l’escalier tu apercevras un coffre de pierre au couvercle en dos d’âne. Ouvre-le, et tu y trouveras ce que tu cherches.
Robert ne se le fit pas dire deux fois. S’emparant des objets désignés, il s’engagea dans l’escalier étroit aux marches glissantes. Il s’enfonçait dans un air lourd, concentré, enfermé depuis des siècles en la crypte souterraine, où nul ne pénétrait, ainsi que l’avait affirmé l’abouma.
Il se sentait envahi par un étrange malaise ; les ombres mobiles projetées sur les murs par la lueur tremblottante de la lanterne, prenaient l’apparence d’êtres animés, gardiens impalpables du trésor des Pharaons. Et il songeait, non sans trouble, qu’il allait enlever le bijou précieux, lui, citoyen sans importance de la république française ; que ses mains plébéiennes toucheraient la pierre étincelante qui brillait jadis au front des souverains.
Certes, celui qui s’approprie le bien d’autrui est un voleur, mais Lavarède n’était-il pas contraint par tous d’agir ainsi. Par suite d’un quiproquo fantastique dont la cause lui échappait, il était devenu Thanis, roi des Égyptiens révoltés, ami des derviches, chevalier d’Abyssinie. Il eût été héroïque, il se l’avouait, de braver la colère de ses sujets, de crier à tous :
– Je ne suis pas Thanis, mais Robert Lavarède, caissier de la maison Brice, Molbec et Cie.
Caissier… ce mot le fit sourire. L’était-il encore seulement ? Sans doute un autre commis avait pris sa place, tandis que lui-même prenait celle de Thanis, de ce Thanis mystérieux, fils d’un assassin.
Tout en réfléchissant, il avait atteint le bas de l’escalier. Il promena autour de lui le rayon de sa lanterne. Il était dans une vaste salle plus longue que large, dont les piliers, aux corniches desquels s’enroulaient des boutons de lotus, étaient couverts de caractères hiéroglyphiques ainsi que les murs. Dans son ellipse d’or, un cartouche était reproduit partout, figurant cette image : Il indiquait à quelle divinité le temple était jadis consacré. Les hiéroglyphes inscrits à l’intérieur sont ceux de la planète Vénus ; – l’Oiseau d’Osiris – c’était donc en son honneur que les prêtres d’autrefois brûlaient en ce lieu la myrrhe et l’encens.
Mais Robert, qui n’avait rien de commun avec Champollion, chercha vainement le sens du cartouche, portant à sa partie inférieure le contour du scarabée sacré.
– Après tout, se dit-il enfin, je ne suis pas ici pour déchiffrer les rébus égyptiens ; où est l’écrin qui renferme le diamant d’Osiris ?
Il l’aperçut bientôt. C’était une énorme boîte de basalte noir, sarcophage poli, sur lequel des sculpteurs des temps écoulés avaient gravé des scènes de la vie antique, modelant dans ce rocher, sur lequel s’émoussent les aciers les mieux trempés, des figures gracieuses, parfaites comme des camées. Aux angles, des statues de dieux à la barbe tressée en fines nattes, regardaient de leurs yeux immobiles ce moderne qui venait troubler leur séculaire repos.
– Allons, fit Lavarède à haute voix, comme pour se donner du courage, voici l’écrin et il est d’une belle dimension ; il s’agit de le débarrasser de son couvercle.
Tout en parlant ainsi, il introduisit le pic qu’il portait, sous la plaque de basalte dont le sarcophage était fermé. Lentement, à l’aide de pesées répétées, il le fit glisser à terre.
Aussitôt, des senteurs aromatiques se répandirent dans l’air ; odeurs inconnues de nos jours, distillées jadis par les femmes Colchytes pour la toilette funèbre des rois. Frissonnant sous ces émanations ignorées, Lavarède éleva sa lanterne pour éclairer l’intérieur du coffre. Un cri de stupeur s’échappa de ses lèvres. Étendu sur le fond, un squelette recouvert d’une toge de pourpre, le front ceint du pschent, le sceptre d’or dans sa main décharnée, montrait le ricanement éternel et figé de sa mâchoire. Au centre du pschent, formant la prunelle d’un œil osirien, un diamant énorme, double au moins du « Régent » de France, brillait avec un insoutenable éclat.
Certes, après les aventures dont il était assailli depuis quelques semaines, l’ancien caissier devait s’attendre à tout, mais l’apparition de ce squelette, image grimaçante du pouvoir, emblème philosophique et funèbre du néant des grandeurs humaines, le médusa.
Qu’osait-on exiger de lui ? Qu’il arrachât le bandeau royal au front de ce mort inconnu ; qu’il dépouillât de leur dernière parure ces ossements abandonnés en cette crypte obscure. Il fut sur le point de renoncer à son projet, mais en lui s’éleva la voix de l’instinct de la conservation. Comment expliquerait-il à ses compagnons l’émotion qui arrêtait sa main à l’instant décisif ? Ne serait-ce pas avouer la supercherie, bien involontaire de sa part, dont tous avaient été victimes ? Et quelles représailles tragiques seraient la conséquence de cet aveu !
– Ma foi, dit-il en regardant le squelette bien en face, vous êtes défunt, digne détenteur du joyau d’Osiris ; cela ne vous rendrait pas la santé, si je vous rejoignais au tombeau. Bien contre ma volonté, on m’a fait votre héritier, permettez que j’entre en possession d’un bijou dont vous n’avez que faire.
D’un geste brusque, il saisit le pschent, le fit glisser sur le crâne poli et se redressa.
Le diamant étincelait dans sa main. Sous le volume d’une noix, le caillou précieux représentait une fortune princière.
– Cette pierre transparente, murmura Robert, vaut des châteaux, des parcs, des fermes, des prairies, des chevaux, des voitures, tout ce qui embellit et charme l’existence. Et ce n’est qu’un peu de carbone solidifié qu’une flamme réduirait en cendres. Enfin puisque les hommes y attachent tant de prix, c’est un trésor inestimable.
Et reprenant son pic qui avait glissé à terre, il se dirigea vers l’escalier.
Une réflexion lui fit faire la grimace :
– Quelle tête j’aurais, si un joaillier allait me dire que c’est du strass.
Mais chassant cette pensée morose :
– Allons donc, les Pharaons ne portaient pas du « toc » ; les Lère-Cathelain et les Bluze ne fleurissaient pas sur les rives du Nil.
Rassuré par cette constatation historique, il gravit deux à deux les degrés et rejoignit bientôt l’abouma. Sans une parole, le grand prêtre remit en place la dalle qui cachait l’escalier, puis les deux hommes, reprenant en sens inverse le chemin qu’ils avaient parcouru, parvinrent bientôt au perron d’où ils étaient partis.
L’abouma regagna sa chambre et Lavarède en fit autant.
Mais il ne dormit pas de la nuit. Il se souvenait que Maïva s’était engagée à porter aux Italiens campés à Adoua la missive qu’il lui avait confiée. Aurait-elle réussi à tromper la surveillance de ses gardiens, à sortir de la basilique, à atteindre le camp ?
Si elle échouait, on serait ramené vers l’Égypte, et alors… que de complications : Robert devrait se résoudre à être général, à marcher à la tête des rebelles, que sais-je encore ? Et la perspective, il le faut reconnaître, n’avait rien de réjouissant pour un homme casanier, de mœurs paisibles, désireux seulement de rentrer en France, pour s’y livrer à une existence régulière, sans imprévu, sans émotions. Grâce à la réalisation du diamant d’Osiris, il serait riche, il pourrait faire beaucoup de bien. Certes il n’y manquerait pas, mais il le ferait à heure fixe, comme tout le reste ; car pour la charité, comme pour le repos, la promenade, les repas, la méthode est tout, et Lavarède, ballotté depuis trop de jours par des événements désordonnés, caressait le rêve d’être méthodique avec passion.
À ce tableau enchanteur il n’y avait qu’une ombre, importante il est vrai ; c’était d’abandonner Lotia. Ah ! certes, l’ancien caissier eût été complètement heureux s’il avait pu lui faire partager sa vie rangée, mais hélas ! cette partie de son rêve était plus irréalisable que les autres. Sa femme, – elle l’était à la mode de l’Égypte antique – ne dissimulait pas son aversion pour lui. Et puis, comme son père Yacoub, elle était fanatisée par l’idée de délivrer sa patrie. En admettant même que Robert arrivât à lui persuader qu’il n’avait rien de commun avec le sanglant Thanis, elle considérerait son départ pour la France comme une défection.
Et se retournant sur son lit, le jeune homme grommelait à haute voix, comme s’il répondait à la belle Égyptienne :
– Que diable ! Je suis avant tout soldat français. Si je dois me faire rompre les os pour le bassin d’un fleuve, ce n’est pas pour celui du Nil bien certainement ; il ne contient ni Strasbourg, ni Metz.
Vers le jour, Lavarède s’assoupit enfin. Un vacarme épouvantable le réveilla. C’était Astéras qui venait d’entrer dans sa chambre avec tant de précipitation, qu’il avait heurté une chaise ; la chaise était tombée sur la table qui s’était renversée, tandis que l’astronome s’allongeait sur le parquet.
– Hein ? Qu’y a-t-il, balbutia l’ancien caissier en se frottant les yeux ?
– Il y a, clama triomphalement Ulysse sans quitter sa position horizontale. Il y a que Maïva s’est enfuie cette nuit.
– Enfuie… Comment ? par où ?
– Par la fenêtre de sa chambre, brave enfant, en se servant d’une natte comme d’une corde… Mais nous la féliciterons plus tard. Radjpoor est furieux, il craint quelque manigance de la mignonne. Il veut quitter Axoum ce matin même. Alors je suis accouru te prévenir. Tu es le roi, donc tu commandes. Arrange-toi pour attendre le retour de Maïva.
Il se releva enfin et venant à son ami :
– As-tu compris ? Tu me regardes comme si j’étais tombé de la lune.
– Là, là, calme-toi, irascible savant. J’ai parfaitement entendu. Nous resterons ici jusqu’à l’arrivée de nos libérateurs.
Et prenant dans sa poche le diamant d’Osiris, il le balança devant le nez de son interlocuteur :
– Rentrons en Europe au plus vite, après fortune faite, continua-t-il. Avec un pareil joyau, tu penses bien que j’ai hâte de quitter la brousse… Quand on possède des pierreries, il n’y a encore que les pays civilisés, avec de bons gendarmes et des coffres-forts incombustibles.
– Il est superbe, déclara Ulysse en retournant le bijou sous toutes ses faces. Superbe ! Cela vaut vingt ou trente millions.
– Au moins, cher ami ; avec cela je te bâtirai un observatoire pour toi tout seul. L’observatoire Astéras.
– C’est trop, beaucoup trop.
– Pas du tout. Moi j’aurai une maison de commerce, avec une petite caisse vitrée comme chez Brice et Molbec. J’y passerai ma journée. Le soir j’irai te chercher sous ta coupole. Nous reprendrons nos anciennes habitudes.
– Et Maïva ?
– Elle en sera. Ce voyage m’a formé, j’admets quelques visages nouveaux et même…
– Même quoi ?
– Je sens en moi une soif de débauche… Nous irons parfois au théâtre ; et le lendemain matin, comme je serai mon patron, je me permettrai d’arriver au bureau une heure plus tard.
Gravement Astéras leva l’index en l’air, et d’un ton railleur :
– Prends garde, Robert, tu te déranges.
– Que veux-tu ? répliqua sérieusement l’ancien caissier, je suis vraiment trop riche pour ne pas me permettre quelques extras. Fortune oblige, parbleu… et pour me faire pardonner ces infractions administratives, j’obligerai les autres, le plus possible. Je leur dirai comme aux petits enfante auxquels on offre une friandise : « Ouvre la bouche, et ferme les yeux. »
Deux coups secs frappés à la porte interrompirent les projets d’avenir de Lavarède.
Il s’était jeté tout habillé sur son lit. D’un bond, il sauta à terre, releva la table et la chaise que le distrait Astéras n’avait pas songé à ramasser, et d’une voix forte, cria :
– Entrez !
Sur le seuil Radjpoor se montra aussitôt. Le pseudo-Hindou était souriant ; son regard cauteleux se posa tour à tour sur chacun des Français, puis avec l’accent du plus grand respect :
– J’ose espérer que Sa Majesté a bien dormi.
À ces mots, à ce titre, Lavarède regarda autour de lui, mais se frappant le front :
– C’est vrai, La Majesté, c’est moi. Oui, seigneur Radjpoor, Ma Majesté a parfaitement dormi.
Le visiteur inclina la tête avec satisfaction.
– J’en suis bien heureux. Je craignais que son expédition nocturne n’eût troublé le repos de mon roi.
Ses prunelles noires se fixaient en même temps sur le diamant que l’astronome tenait toujours à la main. Robert intercepta ce regard. D’un geste rapide il enleva le bijou à son ami et le fit disparaître dans sa poche.
– Mais, continua Radjpoor sans paraître s’apercevoir de ce mouvement, puisque Morphée, la bienfaisante déesse, a daigné verser ses pavots sur vos paupières, vous ferez bon accueil je pense, Sire, à la proposition de votre sujet ?
Lavarède échangea un coup d’œil avec le savant :
– Voyons la proposition, Seigneur.
Le sourire de l’Hindou s’accentua, sa voix se fit plus mielleuse :
– Les nobles Égyptiens attendent votre retour avec impatience. Le but de notre long voyage est atteint, l’emblème du pouvoir se trouve entre vos mains ; il serait bon de revenir sans retard vers ceux qui vous espèrent.
De nouveau Robert regarda Astéras :
– Sans retard, que voulez-vous dire ?
– Que nous pourrions dès aujourd’hui quitter Axoum et reprendre la route du Nil.
– Dès aujourd’hui ?
Le Français se passa la main dans les cheveux, fit mine d’hésiter, et enfin répondit :
– Décidément, non, seigneur Radjpoor, cela ne me va pas.
– Songez que l’aristocratie d’Égypte est dans l’attente.
– Oh ! une journée de plus ou de moins, cela n’a pas d’importance.
Avec un geste de colère aussitôt réprimé l’Hindou insista.
– Quelques heures ont parfois compromis des empires.
– Et parfois aussi un léger retard en a sauvés.
– C’est vrai, mais comme en politique, on ne sait jamais, le plus sage…
– Le plus sage est de se taire, acheva Lavarède. Se taire et écouter son instinct. Or, le mien me pousse à prendre un peu de repos, à faire, après le déjeuner, une promenade dans la ville.
– Et à remettre le départ à demain, demanda Radjpoor en serrant les dents ?
Son interlocuteur haussa insoucieusement les épaules :
– Je n’ai pas dit cela, Seigneur Radjpoor. L’homme raisonnable ne préjuge pas ce que sera demain.
– Enfin, Sire, vous n’avez pas l’intention de séjourner longtemps en cette cité !
Agacé par la résistance inattendue du caissier, l’Hindou perdait toute mesure. Mais Lavarède se redressa de toute sa hauteur et d’un ton sans réplique :
– Monsieur, les rois reçoivent des explications et n’en donnent pas. Veuillez rentrer dans votre chambre et y demeurer aux arrêts pour avoir oublié cette vérité fondamentale de toute autorité. Quand il me conviendra de partir, je vous ferai prévenir… Allez.
D’un geste digne, il congédia celui qui l’avait fait souverain et qui devait sincèrement le regretter en ce moment, puis resté seul avec l’astronome :
– Es-tu content, questionna-t-il ?
– Certes, fit le petit homme. Seulement cet énigmatique personnage ne l’est pas.
– Que m’importe ! Il m’a donné le titre de roi, je lui ai octroyé celui d’écuyer. Donc…
– Donc ?
– Il n’a qu’à s’incliner devant ma volonté.
Et se mettant à rire :
– C’est égal, va, mon cher ami, si nous étions encore à Paris et ce monsieur aussi, il ne se donnerait plus autant de mal pour nous traîner en Égypte.
Mais tandis qu’il se réjouissait, l’Hindou farouche, le visage pâli par la colère, rejoignait Niari et lui faisait part de son insuccès. Son complice l’écouta, puis lentement :
– Il était d’accord avec Maïva. Elle s’est enfuie sur son ordre. Il attend son retour.
– Tu penses, mais alors…
– Il veut nous échapper. Qu’a-t-il imaginé, combiné ? Je n’en sais rien, mais je suis certain de ne pas me tromper.
– Il renoncerait au pouvoir ?
– Ah ! maître, tu ne l’as pas regardé. S’il a tout accepté jusqu’à ce moment, du moins n’a-t-il éprouvé aucun plaisir. Je crois comprendre qu’il tenait à posséder le diamant d’Osiris. Il est en sa possession maintenant, et il lui plairait sans doute de nous glisser entre les doigts en emportant ce royal butin.
Les yeux de Radjpoor se remplirent d’éclairs.
– Il nous volerait ce diamant ?
– Certainement ! Ah ! maître, pourquoi as-tu repoussé les conseils de ton fidèle serviteur, alors qu’il en était temps encore ?
– Tais-toi, ordonna brutalement l’Hindou. Je t’ai défendu de me parler de cela. Au lieu de faire de la morale à ton maître, tu ferais mieux de chercher comment on pourrait réduire ce Français. Car moi, Thanis, issu du sang le plus noble de toute la vallée du Nil, je ne puis servir de hochet à cet individu que j’ai tiré de son obscurité.
Et s’exaltant par degrés :
– Il ose jouer au souverain, ce fantoche que d’un souffle je réduirais en poussière. Il me tient en échec. Sa résistance même démontre que notre intérêt est de l’entraîner loin d’ici. Que résoudre ? Que faire ? L’enchaîner ?…
Froidement Niari secoua la tête :
– Cela est impossible, Seigneur. Pour notre escorte, il est Thanis, il est le roi. Quiconque porterait la main sur lui serait massacré.
– Et pourtant je ne puis plier le genou devant ce fantôme de roi, ce mannequin sur les épaules duquel j’ai jeté la pourpre ! Et puis, je le sens, quelque chose se trame contre nous… Vers quel but Maïva a-t-elle porté ses pas ?
– Je l’ignore. Mais je pense que la gracieuse Lotia réussirait peut-être, là où vous avez échoué.
– Lotia… Comment lui expliquer ?…
– Vos inquiétudes causées par l’évasion de la muette ?… Quoi de plus simple ! En cette contrée où les bandes armées vagabondent, qui sait si la petite esclave ne va pas rencontrer un parti d’aventuriers ; si, pour sauver sa vie menacée, elle ne désignera pas notre retraite. Si enfin, tout est supposable, elle ne s’est point enfuie uniquement pour ramener des soldats, délivrer les Français, ses amis, et leur permettre de retourner en Europe, et d’y mener joyeuse vie, grâce au talisman d’Osiris ?
Une bordée de malédictions s’échappa de la bouche de Radjpoor. Dans son traité secret avec l’Angleterre, il avait trahi, vendu son pays pour une pension annuelle dépassant un million, et il avait stipulé de plus que le merveilleux diamant lui appartiendrait. Et soudain Lavarède, dans lequel il n’avait vu qu’un pantin docile, menaçait de lui enlever ce trésor. Cela ne pouvait se passer ainsi. Sur son ordre, Niari gagna l’appartement occupé par Lotia et fit demander à la jeune femme de consentir à recevoir Radjpoor-Sahib pour une communication urgente.
L’audience fut accordée, et bientôt le faux Hindou exprimait à l’Égyptienne les craintes que faisait naître en son esprit la disparition de Maïva. C’était l’allié dévoué, l’ami fervent de la liberté de la vallée du Nil qui se permettait de parler ainsi, qui osait, malgré la défense du roi, supplier la reine d’user de son influence pour que l’on ne séjournât pas un jour, pas une heure de plus à Axoum.
Lotia fut dupe du fourbe. Elle partagea ses terreurs imaginaires et se rendit chez Robert. Trop tard, malheureusement, car le jeune homme et son ami étaient descendus, après avoir annoncé leur intention de déjeuner et de visiter Axoum.
Elle ne se découragea pas cependant et les joignit au « réfectoire », où les étrangers sont servis par des « novices » de cette Chartreuse Abyssine.
Nerveuse, agitée, elle s’approcha de l’ancien caissier.
– Thanis, lui dit-elle, sans hésiter, j’ai foulé aux pieds mes rêves de jeune fille, j’ai mis ma main dans la vôtre, afin d’assujettir sur votre front la couronne royale. À votre tour de ne pas rester sourd à ma voix. Je vous adresse une prière, j’ai peur d’un ennemi inconnu. Partons sans perdre une minute ; retournons là-bas, où mon père, où nos amis attendent, les yeux fixés vers le sud.
Il avait levé la tête, il la considérait, oubliant à sa vue ses projets d’évasion, de rentrée heureuse et triomphante en Europe.
– Accordez-moi ce que je demande, supplia-t-elle, et je vous bénirai.
Elle suppliait. Son regard altier était humide. Tout à l’heure, Lavarède était irrésistiblement attiré vers Paris. Maintenant, la capitale lumineuse, enfiévrée, se résolvait en une ombre confuse, se noyait dans le brouillard. Il ne percevait plus que l’éclatante beauté de celle dont les dédains l’avaient si souvent attristé.
– Vous ne me haïssez plus, demanda-t-il d’une voix hésitante ?
Et, sans faire attention à la mine désolée d’Astéras :
– Répondez, je vous en conjure, Lotia.
Elle eut un instant d’hésitation, puis se décidant enfin :
– Non je le jure.
– Eh bien ! qu’il soit fait ainsi que vous le désirez, nous allons partir.
Et tout bas il ajouta :
– Tant pis pour l’Europe, c’est Lotia que je préfère.
Il s’était levé, prêt à retourner en Égypte, à combattre pour l’indépendance des fellahs, à sacrifier ses rêves de tranquillité. Mais une pimpante sonnerie de trompettes vibra dans l’air, secouant les trois personnages d’un tressaillement.
– Qu’est cela ? balbutie Robert.
Dix secondes se passent. La porte du réfectoire s’ouvre, l’abouma essoufflé, les vêtements en désordre, se précipite. Il clame d’une voix épouvantée :
– Les Italiens envahissent la métropole d’Axoum ?
Et sur ses talons, paraissent des bersaglieri – chasseurs piémontais – qui font sonner sur le sol la crosse de leurs fusils. Parmi eux se glisse Maïva. Elle court à Astéras, et lui montrant les soldats, elle murmure :
– A… O… U…
L’astronome la serre sur son cœur. Mais Lotia a tout vu. Le complot lui est apparu dans sa terrifiante clarté. C’est celui qu’elle prend toujours pour Thanis qui a appelé les Italiens. Il a trahi la cause de la liberté égyptienne. Elle est prisonnière, elle le sait. Alors elle croise ses bras sur sa poitrine, et foudroyant le caissier ahuri de son regard enflammé, elle prononce ce seul mot :
– Lâche !
Puis elle va se placer au milieu des soldats italiens qui l’entraînent, ainsi que Robert et Ulysse, dans la cour, où déjà, entourés par un groupe de bersaglieri, Radjpoor, Niari et les matelots sont rangés, les mains liées, sombres, silencieux et stupéfaits.
CHAPITRE XIII
L’ESCALIER DU DIABLE
Un jeune officier, à la fine moustache noire, s’avança vers Lavarède, auprès duquel la muette se tenait rayonnante de joie :
– Monsieur, dit-il, la présence à vos côtés de cette gentille messagère me fait supposer que vous êtes le voyageur qui nous a appelés ici.
– Vous ne vous trompez pas. Mais une question, seriez-vous Français ? Vous parlez notre langue avec une facilité…
– Toute naturelle. Originaire de la frontière piémontaise, j’ai appris en même temps l’italien et le français. C’est même ce qui m’a valu l’honneur de commander le détachement envoyé à votre secours.
– Je vous remercie, Monsieur. Permettez-moi de mettre encore votre courtoisie à l’épreuve ?
– Trop heureux de vous être agréable, parlez.
– Eh bien. Si vos soldats ne sont pas trop fatigués, partons à l’instant.
– J’allais vous le proposer.
– Alors en route. Je ne serai tranquille qu’au milieu du campement italien.
L’officier fit entendre un commandement bref, et les bersaglieri, encadrant les prisonniers, sortirent de la basilique.
On traversa la ville, plus déserte encore que de coutume. Ses rares habitants avaient fui à rapproche des Italiens. Il était sage de ne pas perdre de temps, car sans aucun doute quelque fuyard rejoindrait l’armée du Négus pour l’informer de la pointe poussée sur Axoum.
D’un pas alerte, les chasseurs filaient par les rues silencieuses. Plusieurs hommes partis en avant éclairaient la marche.
Précaution inutile. À cette heure, la cité sainte, en dehors des prêtres de la basilique, ne contenait pas un être vivant.
Sans encombre on gagna la plaine. On la traversa et bientôt la petite troupe s’engouffra dans un étroit défilé, passage rocheux qui trouait à l’Est la ceinture de granit de la plaine d’Axoum.
Avec une brusquerie saisissante, le paysage avait changé. Aux champs verdoyants succédait un terrain tourmenté, difficile. Les voyageurs arrivaient dans « la citadelle », ainsi que Georges Charlet du Petit Journal a justement dénommé le plateau abyssin qui domine la mer Rouge.
Partout des rochers de teinte brune amoncelés en un effrayant désordre, surplombant la route étroite ; dans les anfractuosités croissaient des chardons géants, aux ardillons acérés, dont les villages se font un rempart infranchissable, puis le djibara aux feuilles rigides d’un vert sombre allongées en forme de sabre, le kolkoual, arbuste gracieux et perfide, car sa sève est empoisonnée.
On montait sur des crêtes balayées par des vents glacés, puis le caprice du chemin conduisait la caravane dans des vallées encaissées, où l’on haletait sous une température torride, îlots verdoyants, humides et malsains cachés au fond d’un entonnoir rocheux.
C’était le pays formidable et mortel qui, par des gradins escarpés, s’abaisse jusqu’à la mer, et que les Anglais, en 1868, lors de leur expédition contre Théodoros, avaient appelé The devil’s stairs, l’Escalier du Diable.
Après deux heures de marche, on fit halte sur un petit plateau abrité par une muraille de rochers. Le besoin d’un peu de repos se faisait sentir. Lotia n’avançait plus que péniblement – dans la précipitation du départ, on avait oublié sa monture – et Maïva, malgré son courage, semblait exténuée.
Tous, soldats et prisonniers, s’étendirent sur la mousse dure et roussie qui tapissait le sol. Les regards vagues parcoururent l’horizon tourmenté comme celui d’une mer furieuse brusquement figée, puis les paupières lourdes s’abaissèrent. Tous dormaient en dehors des sentinelles vigilantes placées autour du plateau.
Durant quelques minutes, personne ne bougea, puis Radjpoor couché auprès de Niari rouvrit les yeux, releva lentement la tête, s’assura que nul ne l’observait, et rassuré par l’immobilité de ses compagnons, il appela doucement :
– Niari.
L’Égyptien tressaillit. Ses paupières battirent, il coula autour de lui un regard perçant et répondit :
– Je vous écoute, Seigneur.
– Nous sommes joués. Notre homme va se faire conduire à Massaouah. Il prendra passage sur un navire pour l’Europe, échappant ainsi à l’Angleterre, qui a besoin de le tenir mort ou vif, pour tuer dans l’œuf la révolte égyptienne.
– Comme patriote, Sahib, je m’en réjouis.
– Tu as tort, te dis-je. Tu m’es dévoué, tu dois donc penser seulement ce que je pense.
Niari ne répliqua pas. Une contraction douloureuse plissa sa face et ce fut tout.
– Es-tu prêt à m’obéir, reprit Radjpoor après un silence ?
– Je l’ai juré, fit soudainement son complice. Quoi que vous ordonniez, j’obéirai.
– Bien, c’est tout ce que je désire. Niari, il faut que tu t’évades.
– Je m’évaderai.
– Que tu gagnes Massaouah avant nous.
– J’irai.
– Tu verras le consul anglais, tu lui exposeras la situation. Qu’il prenne des ordres à Londres ; un cablegramme, sa réponse, en vingt-quatre heures, il sera édifié.
– Quand dois-je partir ?
– Le plus tôt sera le mieux.
– Alors, Sahib, approchez-vous de moi, et si vos mains ne sont pas trop étroitement serrées, déliez les cordes qui entourent les miennes.
De nouveau Radjpoor promena aux alentours un regard soupçonneux. Personne ne l’observait. Les factionnaires immobiles sur les roches tournaient le dos au campement. Par des mouvements lents, insensibles, les deux hommes se rapprochèrent, leurs mains se touchèrent. Puis chacun reprit sa place et feignit de dormir.
Cependant si quelqu’un avait pu se glisser près du faux Hindou, il eût pu l’entendre murmurer :
– J’aurai le diamant d’Osiris. C’est la fortune colossale, indépendante. Mon rêve !
Le soleil commençait à s’abaisser vers l’horizon, quand l’officier qui commandait le détachement donna le signal du départ.
En un instant, les soldats furent debout, rompirent les faisceaux, et assujettissant leurs cartouchières se préparèrent à reprendre la marche. Les prisonniers s’arrachèrent à la sieste avec plus de lenteur, mais enfin la colonne fut reformée. Au premier signe, les éclaireurs, pointe d’avant-garde et flanqueurs, s’étaient éloignés.
On quitta le plateau. Le sentier sinueux et accidenté se déroula de nouveau devant les voyageurs. Dans un silence accablant, on avançait toujours. Soudain, les blocs granitiques qui resserraient le passage se terminèrent par une falaise à pic, dont le pied se perdait à deux cents mètres plus bas, dans un vallon encaissé, où à travers un fouillis inextricable de plantes entrelacées, courait un ruisseau tumultueux, torrent minuscule, écumant dans son lit de rochers. En face, à un kilomètre de là, une autre falaise dressait sa masse énorme. Comme un barrage géant, le chemin allait de l’une à l’autre, coupé au milieu par un pont de bois jeté sur le cours d’eau. De chaque côté, des pentes raides couvertes de genévriers au feuillage raide, à la silhouette grimaçante.
Avec précaution, ralentissant leur allure, les bersaglieri s’engagèrent en file indienne sur le sentier. Au centre étaient les prisonniers. En avant et en arrière les soldats.
La moitié du chemin fut parcourue sans encombre. La tête de la colonne s’engageait sur le pont, à cinq cents pieds au-dessous duquel mugissait le torrent. Soudain Niari chancela, perdit l’équilibre, et se renversa sur la pente qu’il dévala avec une rapidité vertigineuse.
Avant que l’on eût pu se rendre compte de l’événement, l’Égyptien avait disparu.
L’officier commanda une halte. Des chasseurs furent envoyés à la recherche du prisonnier. Ils descendirent dans la vallée, fouillèrent les taillis, mais sans retrouver la moindre trace de Niari. Un à un ils revinrent. À leur avis, le captif avait dû tomber dans la rivière qui, bien que de faible profondeur, avait un courant assez violent pour emporter le corps d’un homme. Le malheureux avait dû être brisé contre les rochers dont le lit du torrent était encombré.
Impressionnés par cet incident tragique, tous se remirent en route. Seule, Lotia, à qui Radjpoor avait parlé à voix basse, ne semblait pas émue. Un vague sourire errait sur ses lèvres roses, et ses yeux se fixaient avec une ironie cruelle sur Lavarède.
Vers cinq heures du soir, épuisés, brisés, les voyageurs parvinrent au camp italien. L’officier, qui les avait guidés jusque-là, les conduisit au mess – baraque primitive – où ses collègues se réunissaient pour prendre leur repas.
Ceux-ci reçurent Lavarède et Ulysse avec courtoisie. Sur leur demande, Lotia et Maïva s’assirent à la table dressée pour eux. Une nouvelle idée avait germé dans l’esprit de l’ancien caissier. Lotia était son épouse. Pourquoi ne l’emmènerait-il pas en Europe, où il lui démontrerait, preuves en main, qu’il n’était pas le Thanis qu’elle abhorrait. Il régulariserait, à la mode de France, son union égyptienne et il pourrait être heureux.
Aussi, après avoir répondu de son mieux aux questions de ses hôtes, s’enquit-il des moyens de gagner Massaouah.
– Il n’en est qu’un, lui répondit le jeune officier, son cicerone ; c’est de partir avec un de nos convois. Seulement, je dois vous avertir que le trajet n’est pas sans danger. Des bandes pillardes parcourent la montagne, et il est rare qu’un voyage s’effectue sans coups de fusil.
Il ne disait pas que les partisans de Ménélik interceptaient à peu près deux convois sur trois, affamant ainsi l’armée italienne. Il ne disait pas que déjà l’on avait abattu les attelages de l’artillerie pour nourrir les troupes, et que l’heure était proche où il faudrait vaincre ou mourir.
Il ne le croyait pas sans doute. Avec sa belle confiance de la jeunesse et du courage, il ajouta :
– Avant peu une grande bataille se livrera par ici. Nous occupons solidement un triangle formé par Enfiscio, Adoua et Adigrat, attendant une occasion d’écraser les Abyssins. Vous feriez mieux de rester avec nous, et après la victoire, vous gagneriez sans péril le port de Massaouah.
Pauvre garçon ! quelques jours plus tard, il devait trouver la mort dans cette bataille d’Adoua qu’il annonçait. Avec dix mille soldats, il devait dormir l’éternel sommeil sur cette terre de granit qu’il rêvait de conquérir pour sa patrie.
Mais bien qu’il ne devinât pas cet avenir sombre, Lavarède insista pour partir le plus promptement possible. Sa tendresse pour Lotia, son aversion pour les aventures le poussaient irrésistiblement vers Paris, ce Paris paisible où il irait chaque matin à son bureau, sur des trottoirs admirablement plats, sans être contraint de franchir des abîmes ou d’escalader des montagnes.
Et avec une bonne grâce parfaite, le jeune officier s’informa, apprit qu’un convoi de ravitaillement, retournait le surlendemain à Massaouah. Il obtint de ses chefs la permission pour les voyageurs de profiter de l’escorte. Robert, Astéras, Maïva et Lotia seraient amenés au port de l’Érythrée, où ils seraient libres. Quant à Radjpoor et aux matelots égyptiens, on les remettrait aux mains de la justice italienne qui statuerait sur leur sort.
L’attente du départ sembla interminable aux Français. Astéras encore la supporta, car il occupait ses loisirs forcés à continuer la cure de la muette, qui en quittant le camp italien, prononçait presque sans difficulté les cinq voyelles : a, e, i, o, u.
Mais l’ancien caissier, auquel Lotia refusait de répondre, devenant, par un jeu d’équilibre de la fatalité, muette volontaire alors que Maïva commençait à parler, l’ancien caissier errait à travers le camp, surprenant sur les visages pâles, amaigris par la fièvre et par la famine, le secret douloureux de cette effroyable expédition d’Abyssinie qui a coûté à l’Italie tant d’or et tant de sang. Il les plaignait ces malheureux soldats, victimes comme lui d’une volonté étrangère ; ces braves gens qui sans être consultés, toujours ainsi que lui-même, avaient été arrachés de leur pays fertile, dont on avait interrompu les rires et les chansons pour les amener sur ce sol ingrat, grand « mangeur d’Européens », dont le chaos granitique se dresse comme un tombeau géant au-dessus des rivages desséchés de la mer Rouge.
De ces promenades, il revenait profondément triste, et ce lui fut un soulagement quand, le convoi formé, lui et ses compagnons juchés sur des mulets, il serra pour la dernière fois la main de l’officier italien.
La caravane s’ébranla, traversa le camp, répondant aux adieux des soldats, héros souriants dont si peu devaient survivre à la bataille d’Adoua.
Dire ce que fut cette descente vers la côte est impossible. L’Escalier du Diable ménageait chaque jour une surprise nouvelle aux voyageurs. À chaque instant, des remparts de granit rouge barraient la route. On les escaladait au prix de mille peines, et quand on atteignait les sommets de 2 à 3,000 mètres, c’était pour apercevoir d’autres obstacles de même nature, séparés entre eux par de profondes vallées.
Si loin que pussent se porter les regards, des cubes, des pyramides, des aiguilles rocheuses, des montagnes éventrées, déchiquetées, disloquées, s’entassant les unes sur les autres, apparaissaient ainsi qu’un troupeau de monstres vomis par l’enfer. Les unes figuraient des châteaux en ruines, d’autres semblaient de gigantesques animaux, gonflant étrangement leurs échines, comme pour bondir sur les audacieux qui passaient à leurs pieds.
Et dans ce pays désolé, dans ce décor effrayant, on comprenait le succès des rapides coups de main des « guérillas » abyssines ; on craignait à tout instant d’être surpris. Dans les vallées, on considérait avec effroi les hauteurs, pris par la crainte de les voir se couronner de guerriers. Durant la traversée des gorges, un vague malaise faisait courber la tête aux soldats de l’escorte. Ils se souvenaient que, peu de jours auparavant, un convoi avait été littéralement broyé sous une avalanche de pierres lancées d’en haut par un ennemi invisible. Cependant on contourna sans encombre la place forte d’Adigrat, on passa à Sénafé, à Goura.
Encore soixante-dix kilomètres à parcourir et l’on atteindrait la baie d’Adulis, où Massaouah, construite sur une île peu éloignée de la côte, offrirait à l’escorte, aux voyageurs, un asile gardé par la mer.
Les visages se rassérénaient. Et cependant le danger était proche.
À deux lieues d’Asmara, la caravane, après une montée fatigante, déboucha sur un plateau couvert de broussailles et tomba en plein bivouac de partisans Abyssins. Sans doute, les éclaireurs s’étaient relâchés de leur surveillance en approchant du but.
Toujours est-il qu’en un instant les ennemis se dispersèrent, devinrent invisibles, et qu’une grêle de balles s’abattit sur le chemin. Rapidement, l’escorte s’était formée en tirailleurs et répondait au feu des assaillants.
Lotia immobile sur la route, un peu pâle mais la tête droite, regardait. D’un bond, Robert fut auprès d’elle, et lui appuyant la main sur l’épaule, il la força à s’accroupir sur le sol.
– Vous avez peur, Thanis, dit-elle avec une moue méprisante ?
Il rougit sous l’injure :
– Oui, peur pour vous ; car en ce qui me concerne, il n’en est rien.
Et se dressant de toute sa hauteur :
– Après tout, cela m’habituera à la fusillade. Cela peut toujours servir.
Pendant quelques minutes, les détonations se succédèrent. Des fumées blanches s’élevaient lentement, semblant ramper à la cime des broussailles. Des sifflements rapides passaient dans l’air, chant lugubre des balles dans leur vol homicide. Puis les coups de feu se firent plus rares ; l’ennemi battait en retraite, mollement poursuivi par les Italiens.
À un coup de sifflet du chef de l’escorte, ceux-ci rallièrent le convoi, rapportant deux blessés et un mort, qui furent placés sur un chariot.
– Eh bien, murmura Lavarède, je n’avais jamais vu de combat sérieux… En somme, ce n’est pas terrible.
Et tirant son chapeau, il envoya un grand salut dans la direction qu’avait prise la bande des indigènes. Mais son mouvement commencé ne s’acheva pas. Au bout de son bras, son couvre-chef était à hauteur de ses yeux, et il voyait au travers. Un projectile en avait traversé la partie supérieure, déchirant la coiffe.
– Les imbéciles, gronda l’ancien caissier, ils m’ont abîmé mon chapeau – puis par réflexion, il ajouta en souriant – Lotia, regardez ceci, vous verrez que je n’ai pas peur.
L’Égyptienne leva les yeux, elle considéra les trous laissés par la balle à la partie supérieure de la coiffure, et blême, comme effrayée de ce qu’elle disait, elle pensa à haute voix :
– Un peu trop haut !
– Trop haut, répéta le jeune homme sans comprendre ?
Mais le sens des paroles de sa compagne lui apparut. Elle exprimait un regret. Si le projectile avait frappé un pouce plus bas, il traversait le crâne de Robert.
Il ne trouva rien à répondre, mais son regard se voila, et comme la colonne se remettait en marche, il suivit en gémissant :
– Comme elle me hait, moi qui l’aime tant.
Le soir même on campa à Asmara. À partir de ce point, on n’avait plus aucune surprise à redouter. Des troupes nombreuses gardaient la route, et jusqu’à Massaouah aucun retour offensif de l’ennemi n’était possible. En outre on quittait la montagne. La plaine de sable succédait, brûlante, desséchée, aride, mais permettant une allure plus rapide, n’exigeant pas un effort aussi violent.
Le surlendemain la mer apparut au loin. On hâta le pas, talonnant les mules exténuées, et bientôt on arriva sur la plage, entre les baraquements provisoires dressés pour recevoir les troupes de réserve. Un bras de mer séparait seul les voyageurs de l’île de Massaouah !
Et comme ils aspiraient a pleins poumons l’air que le voisinage de la nappe liquide chargeait de vapeur d’eau, un homme d’une trentaine d’années, qui causait avec deux matelots assis dans une grande chaloupe amarrée à un piquet de bois fiché en plein sable, se retourna, examina le groupe formé par les soldats et leurs prisonniers, puis s’avança vivement.
Le nouveau venu, grand, blond, rose de teint, était vêtu avec cette propreté correcte qui distingue les Anglo-Saxons. Coiffé d’un casque colonial, couvert d’un veston et d’un pantalon blancs, une cravate bleue à pois soigneusement ajustée au cou, il vint au chef de l’escorte et l’attira à l’écart :
– Vous arrivez d’Adoua, demanda-t-il, lorsqu’il fut à quelques pas des voyageurs ?
– Oui, Monsieur, en effet.
– Et ces Européens qui vous accompagnent sont ceux que l’on retenait captifs à Axoum ?
– Comment, vous savez cela ?
– Je suis sir Polson, consul de Grande-Bretagne à Massaouah.
L’Italien s’inclina cérémonieusement :
– Pardon, Monsieur, je ne vous connaissais pas.
– Don’t mention it, please. Veuillez seulement jeter les yeux sur ce papier signé de M. le gouverneur général de l’Érythrée.
Ce disant, sir Polson tendait à son interlocuteur une feuille administrative, à en-tête du gouvernement. Celui-ci la parcourut du regard, examina attentivement la signature, et lentement :
– Ordre de vous remettre les voyageurs ramenés d’Axoum. Où vous plaît-il que je les conduise ?
L’Anglais désigna la chaloupe, près de laquelle il se tenait un instant plus tôt :
– Veuillez les faire embarquer.
– Immédiatement, Monsieur le Consul.
Avec empressement l’Italien rejoignit sa troupe. Lavarède et ses amis furent menés auprès de l’embarcation et priés d’y prendre place.
Ils obéirent sans protester, pensant que le canot allait les transporter dans l’île de Massaouah. Alors le fonctionnaire britannique sauta dans l’esquif, s’assit au banc d’arrière et commanda :
– Go ahead !
Les matelots frappèrent l’eau de la pelle de leurs avirons, et l’on s’éloigna du rivage, tandis que l’escorte italienne, faisant volte face, se dirigeait d’un pas accéléré vers les baraquements.
CHAPITRE XIV
LA REVANCHE DE RADJPOOR
Un sourire narquois distendait les lèvres de Radjpoor. En arrivant sur la plage, il avait d’abord paru inquiet ; mais à la vue de sir Polson, son visage brun avait exprimé une satisfaction, que le colloque du consul avec le chef du convoi, puis l’embarquement précipité des voyageurs, n’avaient fait qu’accentuer.
– Allons, murmura-t-il entre ses dents, Niari a réussi.
Et avec un ricanement, il ajouta :
– Je commence à croire que le diamant d’Osiris m’appartiendra bientôt, et que la belle Lotia sera veuve. Il est temps, je pense, de la mettre au courant, afin qu’elle apprécie ma conduite ainsi que je le désire.
La jeune femme était auprès de lui, droite, les yeux clos, indifférente en apparence à ce qui se passait autour d’elle. Il la poussa légèrement du coude, et se penchant, il prononça quelques paroles à voix basse. Elle fut secouée par un frisson, ses paupières battirent, un voile de rougeur s’épandit sur ses joues.
– Est-ce possible, fit-elle en joignant les mains ?
– Cela est, repartit le faux Hindou. Et baissant le ton : comme cela, la révolte n’est point brisée sans espoir. Le souvenir de Thanis demeure intact, et les conjurés peuvent attendre son retour, ou s’il ne doit pas revenir, le brave qui sera envoyé par lui pour prendre le commandement.
– Vous, compléta Lotia ?
Il appuya un doigt sur ses lèvres, et avec une finesse astucieuse, évitant de s’engager :
– Qui sait !
Mais l’Égyptienne était trop loyale pour s’arrêter à cette réticence. Elle pressa la main de Radjpoor dans la sienne et laissa tomber ce seul mot :
– Merci !
Puis le silence se rétablit. Le traître Thanis-Radjpoor considérait en dessous la fille de Yacoub, qui eût été épouvantée si elle avait pu deviner son monologue intérieur :
– Veuve, elle deviendra ma femme. Fortune, tendresse j’aurai tout. D’ici là, sur mes indications, les fauteurs de la rébellion seront arrêtés, mis dans l’impossibilité de nuire. Je puis donc sans danger me poser en héros. – Un sourire compléta sa pensée. – Ô filles romanesques, il faut vous leurrer toujours de prouesses chevaleresques ! Vous ne comprenez rien à l’existence pratique, heureuse, vouée au seul plaisir.
Cependant les rames battaient régulièrement les flots. Le rivage demeurait loin en arrière. Mais au lieu de se diriger sur l’île de Massaouah, le canot prolongeait la côte, semblant vouloir doubler un promontoire qui, masquait la haute mer.
Lavarède s’étonna de cette évolution.
– Nous n’atterrissons donc pas de ce côté, questionna-t-il ?
Le matelot auquel il s’adressait, répondit :
– Ship.
– Ship, navire, traduisit l’ancien caissier. Nous allons vers un vaisseau qui nous transportera sans doute ?
– Yes.
– Ah ça, remarqua Robert, les matelots italiens parlent anglais à présent ?
– English sailor, fit l’homme d’un ton sec.
– Un marin anglais au service de l’Italie alors ?
Le rameur haussa les épaules et se courba sur l’aviron, sans ajouter une parole.
– Ils sont aimables ces Anglais, grommela Lavarède. Un mélange de hérisson et de porc-épic.
– Bah ! intervint Astéras qui écoutait. Un bon bateau va nous ramener en France. Peu importe si son équipage est poli ou non. Tu entends, ma douce Maïva, la France où tu seras libre ! Une quinzaine de jours de traversée. Je veux qu’en arrivant, tu parles pour dire ta joie de n’être plus esclave.
À ce moment, le canot, parvenu à l’extrême pointe de l’île, appuya à bâbord. Quelques coups de rame encore et le promontoire fut contourné. La pleine mer s’étendait devant les passagers, et leurs yeux ravis se posèrent sur un élégant vapeur qui se balançait à moins de trois encablures.
Des fumées légères fusaient par les cheminées, indiquant que le steam était sous pression, prêt à partir. On allait le rallier, monter à bord, et sans une minute de retard prendre la route de l’Europe.
Et comme ils le considéraient avec émotion, Ulysse remarqua :
– C’est bizarre, il me semble que je distingue des canons.
Lavarède sursauta :
– Des canons, tu es fou. Cependant, en regardant mieux, tu as raison. C’est un navire de guerre, un croiseur. Nous nous sommes trompés ; ce n’est pas lui qui nous emmènera, car ces vaisseaux-là ne prennent point de passagers comme nous.
La remarque était juste, et pourtant la chaloupe gouvernait droit sur le croiseur.
– Mais c’est un vapeur anglais, reprit Robert après un moment, le pavillon du Royaume-Uni flotte à l’arrière.
Astéras l’interrompit :
– Le pavillon m’est indifférent. Le principal est qu’il marche vite, afin de nous déposer bientôt chez nous.
Il n’y avait plus à en douter, l’embarcation avait pour but le steamer. Bientôt elle stoppa le long de ses flancs percés d’embrasures pour l’artillerie. Un à un les voyageurs se hissèrent sur le pont.
En y arrivant, Lavarède eut un serrement de cœur. Auprès du capitaine correct et grave, se tenait un homme basané qu’il reconnut aussitôt. C’était Niari. Le fidèle serviteur de Radjpoor désigna le Français. Aussitôt le capitaine fit un signe. Quatre matelots armés de fusils, baïonnette au canon, entourèrent le malheureux.
Hébété, sentant qu’un nouveau malheur fondait sur lui, l’ancien commis de la maison Brice, Molbec et Cie demanda :
– Qu’est-ce que cela veut dire ?
Ce fut Lotia qui répondit :
– Cela veut dire que vous êtes prisonnier de l’Angleterre.
– Prisonnier ! moi, pourquoi ?
– Parce que d’autres – elle eut un regard reconnaissant pour l’Hindou – d’autres, Thanis, ont éprouvé pour votre honneur plus de souci que vous n’en avez vous-même.
– D’autres !… que le diable les patafiole. C’est sans doute encore une aménité du seigneur Radjpoor.
– Ne le blâmez pas, je le remercie, moi. Il vaut mieux être captif et honoré de ceux qui avaient remis leur sort entre vos mains, que libre et méprisé comme un traître et un parjure.
Du coup, Robert perdit patience. D’un bond, il fut sur l’Hindou, le saisit à la gorge. Il l’aurait étranglé, si les marins armés ne l’avaient empoigné, réduit à l’impuissance et entraîné à l’arrière, où ils l’enfermèrent dans une cabine.
Furieux, bouleversé par la double pensée de la liberté ravie et de la vengeance impossible, Lavarède cria, hurla, rugit, tempêta. Et tout à coup une secousse le fit chanceler. Une oscillation lente du navire, le ronflement de l’arbre de couche, la trépidation de la machine, lui firent comprendre que le croiseur se mettait en marche, l’emportant vers une destination inconnue.
Alors son irritation se changea en désespoir. C’en était fait de ses rêves de tranquillité, de monotone et délicieuse régularité. Quel démon, jaloux des gens paisibles, s’amusait donc à bouleverser sa vie, à le lancer sans cesse dans de nouvelles aventures.
Où le conduisait-on maintenant ? Était-ce en Angleterre ? Allait-on rééditer, pour lui les lugubres histoires de pontons ? Ou bien, chose pire encore, le steam l’entraînait-il vers une des innombrables colonies anglo-saxonnes ? Incertitude horrible, qui bientôt lui pesa à tel point qu’il voulut coûte que coûte être éclairé.
Il frappa à la porte de sa cabine. Du dehors une voix rude s’éleva. Un factionnaire veillait. Décidément on le traitait en personnage dangereux. C’était trop fort !
– Que voulez-vous, interrogea la voix en pur anglais ?
Dans la même langue.
– Parler au capitaine, répondit Robert.
– Il n’a pas le temps, attendez. Il vous appellera plus tard.
– Soit. Mais enfin, où suis-je ?
– À bord du Rob-Roy, croiseur de deuxième classe.
– Et nous allons ?…
– Je ne sais pas.
Le jeune homme eut beau prier, multiplier les questions, il ne put tirer autre chose du matelot qui le gardait. Évidemment ce marin ne savait rien. Robert s’avoua du reste qu’il en devait être ainsi, le commandant d’un navire de guerre ne pouvant être tenu de confier à son équipage la teneur des ordres à lui adressés par l’Amirauté.
Il fallait donc attendre qu’il plût à cet officier de lui accorder un moment d’entretien.
Avec la résignation, Lavarède retrouva le raisonnement :
– Après cinq minutes d’explications, tout s’arrangera, se dit-il. Quand j’aurai raconté au capitaine par quel hasard je me suis vu traîné de Paris à Massaouah, il n’aura plus qu’à me présenter ses excuses. Que diable ! on n’enferme pas les gens sans les entendre, et fût-il sourd, je crierai si fort qu’il m’entendra.
Sur cette réflexion encourageante, il s’approcha du hublot qui éclairait la cabine et regarda au dehors. Déjà la baie d’Adulis était invisible, masquée par le promontoire qui la limite au sud, et la côte basse, sablonneuse, dorée par les rayons du soleil, s’étendait à l’ouest, bornée par les cimes bleues des montagnes abyssines.
– Nous descendons vers le sud, vers Aden et Obok, murmura le Français.
Bah ! on me ramènera vers le nord.
Et frappant sur sa poche où le diamant d’Osiris était enfoui :
– J’ai d’ailleurs de quoi payer mon voyage.
Puis par réflexion :
– C’est ce coquin de Niari qui m’a dénoncé comme chef de la conspiration. Pourquoi ? Quel jeu joue donc le drôle ? Je n’en sais rien. Après tout, cela m’est indifférent. L’Angleterre n’est pas l’Égypte, et on ne me poignardera pas si je révèle ma véritable identité.
Songeur, suivant d’un œil vague les sinuosités du rivage qui se déroulaient devant lui, il resta près d’une heure ainsi. Il commençait à s’impatienter, quand un bruit métallique le fit sursauter. On introduisait une clef dans la serrure. Le déclic du pêne résonna sec, rapide, et la porte de la cabine s’ouvrit, laissant apercevoir plusieurs matelots.
– Monsieur, dit l’un d’eux, le commandant désire vous voir.
D’un bond, Lavarède fut auprès du nouveau venu :
– Il désire, ce cher commandant, et moi donc. Ne le faisons pas attendre. Pour ma part, j’en serais désolé.
Entre quatre marins armés, il suivit les coursives, traversa l’entrepont et arriva bientôt dans la cabine du capitaine qui, un carnet à la main, lisait rapidement deux pages couvertes d’une écriture fine et serrée. À son entrée, l’officier leva la tête, lui indiqua un siège. D’un geste il congédia les matelots, et, la porte refermée, il commença d’un ton aimable :
– Avant toute chose, permettez-moi de m’excuser si je ne vous ai pas reçu de suite ; mais les devoirs de ma charge rendaient l’audience impossible.
Il eut un sourire :
– Je dis audience, pardonnez-moi, Monseigneur ; c’est votre titre qui m’a inspiré ce mot bien prétentieux pour un simple commandant de croiseur.
– Vous tombez mal, fit gaiement Robert. Je venais justement vous prier de ne pas me donner du Monseigneur.
– N’ajoutez rien, je vous en prie. Je sais les égards qui vous sont dus, et je ne prendrai jamais sur moi de les oublier.
– Il le faudra cependant, car je n’y ai aucun droit.
– Vous dites ?
– Que ma présence à votre bord, les honneurs dont vous me gratifiez, sont le résultat d’un malentendu.
Lavarède ne put continuer. Son interlocuteur s’était levé, et d’un ton respectueux mais ferme :
– Monseigneur, je suis Anglais, baronnet. Certes, le livre du « peerage and baronetage » du Royaume-uni contient des noms avec lesquels je ne mettrais en balance aucun des grands noms du continent, mais le vôtre, c’est différent. Toute l’aristocratie saxonne doit s’incliner devant un fils de roi, dont l’arbre généalogique pousse ses rameaux depuis 6,000 ans.
– Hé ? fit seulement le jeune homme avec stupeur.
Puis reprenant son sang-froid :
– C’est là que gît le malentendu, mon cher monsieur, je ne suis pas fils de roi.
– Pas fils de roi ?
Et clignant des yeux, l’officier railla :
– Ah ! Monseigneur, vous me traitez en juge d’instruction, et je ne suis qu’un soldat exécutant une consigne, auquel tout ce que vous pourriez dire ne servirait de rien.
– Vous ne me comprenez pas.
– Que si. Vous m’avez fait l’honneur de me dire que vous n’êtes pas fils de roi.
– Justement !
– S’il plaît à votre Altesse de plaisanter.
– Mais je ne plaisante pas.
Et d’une voix impatiente :
– Je ne compte aucun monarque parmi mes ascendants. Mon nom est plébéien, Robert Lavarède. Mon père était un fermier, un colon des environs d’Ouargla.
– C’est bien loin du Nil, souligna l’Anglais en s’abandonnant à une douce hilarité.
– Très loin, parbleu… et la charrue paternelle est loin du trône.
– Oui, oui, fit l’officier redevenu sérieux, les rois en exil.
– Encore les rois. Puisque je vous affirme…
– Je supplie votre Altesse de ne pas poursuivre.
À cette réplique, Robert frappa du pied. Vraiment l’entêtement de ce marin à le prendre pour un haut personnage justifiait son exaspération. Élevant la voix, il s’écria :
– Mais, nom d’un chien, c’est de l’obstination. Je m’appelle Lavarède, j’ai fait mes études à Alger et à Nîmes ; je suis Français, soldat ; j’ai servi au 105e de ligne, et en dernier lieu j’étais caissier de la maison Brice, Molbec et Cie, instruments d’optique, à Paris. Sapristi, ce n’est pas une raison pour me traiter d’Altesse.
Le commandant hocha lentement la tête :
– L’adversité supportée vaillamment double le respect.
– Eh, sarpejeu, il n’y a pas d’adversité là-dedans. Faut-il que je vous répète…
Du geste, l’Anglo-Saxon l’arrêta :
– Inutile, Monseigneur.
– Encore ce titre ?
– Toujours. Je savais tout ce que vous venez de me raconter.
– Eh bien alors ?
– L’Angleterre n’agit pas à la légère, et elle surveille de près ceux dont elle craint ou espère quelque chose.
– Je ne suis pas de ceux-là.
– Attendez. Il est vrai que votre naissance fut déclarée à Ouargla ; que votre état civil fut établi au nom de Robert Lavarède, fils de Marc-Albert Lavarède et de Laure-Angèle, née Darriance.
– Bon.
– Il est également vrai qu’après de brillantes études à Alger et à Nîmes, vous fûtes incorporé dans l’armée française, et plus tard admis comme employé dans la maison Brice et Molbec.
– Tout est vrai, vous le reconnaissez. En ce cas, qu’est-ce que je fais ici ?
Robert était ravi ; tout allait s’expliquer. Mais l’Anglais ne le laissa pas continuer :
– Il est impossible que Votre Altesse l’ignore.
– Altesse, voilà que vous y revenez ?
Le jeune homme se prit la tête à deux mains.
– Entendons-nous, je vous en prie. Altesse ou caissier, mais pas tous les deux.
– Il ne dépend pas de moi qu’il en soit autrement, affirma flegmatiquement l’officier.
– Alors je ne comprends plus.
– Votre Altesse veut rire.
– Je n’en ai pas la moindre envie. C’est à devenir fou ! On m’enlève à Paris, on me traîne à travers l’Égypte, l’Éthiopie. On me raconte des histoires à dormir debout. Sur un steamer anglais, j’avais le droit d’espérer que la mystification prendrait fin. Pas du tout, cela continue de plus belle Je vous en conjure, éclairez-moi.
Un sourire passa sur les lèvres du commandant, mais sans se départir de son attitude respectueuse :
– Oh ! s’il convient à Votre Altesse que je lui narre son histoire, je suis à ses ordres.
– Ma foi, je vous en serai très obligé.
– Écoutez donc, Monseigneur.
Et toujours placide, l’Anglais parla ainsi :
– 3,800 avant notre ère, régnait sur l’Égypte Hem-Oph, souverain glorieux, dont les armées victorieuses avaient soumis l’Éthiopie, le Soudan, le pourtour des grands lacs, tandis que les caravanes marchandes gagnaient le Zambèze, le fleuve Orange, découvraient les gisements aurifères du pays montagneux appelé aujourd’hui Transvaal, et revenaient chargées d’or et de diamants. L’Égypte, remarqua complaisamment le narrateur, semble avoir tenu à cette époque le rôle de la Grande-Bretagne.
– Pardon, interrompit Robert, est-il nécessaire de reprendre aussi loin ?
– Sans doute, Altesse, car le pharaon Hem-Oph se nommait aussi Thanis.
– Thanis ! Ah bon ! Thanis ; il m’a assez corné aux oreilles, celui-là.
Son interlocuteur le considéra avec une muette surprise. Sans doute, il trouvait le Français bien irrespectueux pour une famille aussi ancienne, puis il reprit :
– La race des Hador était rivale des Thanis. Ce furent, durant des siècles, des luttes sans fin entre les familles ennemies. Puis elles furent définitivement écartées du trône. Mais, alors que toutes les races nobles disparaissaient une à une, Thanis et Hador se perpétuaient, ainsi que leurs divisions intestines.
– On m’a déjà appris cela, après ?
– Comme vous voudrez, Altesse. Il y a trente ans, les Hador triomphaient. Ils obtinrent du khédive un arrêté d’expulsion contre votre père.
– Mon père, il était tout expulsé, car il n’a jamais mis le pied en Égypte.
– Vous voulez parler de Sir Lavarède.
– Et de qui donc, s’il vous plait ?
L’Anglais écarquilla les yeux, murmura à part lui :
– Il plaisante. Very « humbug », ce gentleman !
Et poursuivit paisiblement :
– Sir Lavarède n’était pas votre père.
– Patatras ! clama Robert avec un sursaut. Celle-là est plus forte que toutes les autres. Mon père n’était pas mon père ?
– Non, Altesse. Il remplissait une sorte de fidéicommis. L’auteur de vos jours, fugitif, vous avait confié à lui. Puis inconnu, déguisé, il rentra en Égypte pour se venger des Hador. Il n’y réussit que trop bien. L’épouse et le fils aîné de Yacoub moururent, elle, sous son poignard, lui d’une maladie étrange qui peut-être eut pour cause le poison. Les Hador n’avaient plus d’héritiers mâles. Voilà pourquoi, oubliant ses rancunes, passant l’éponge sur le sang versé, Hador vous offrit le commandement suprême des rebelles assez fous pour essayer de lutter contre la vieille Angleterre. Voilà pourquoi, vous êtes prisonnier à mon bord.
Attentivement Lavarède écoutait. Le jour se faisait enfin dans son esprit. Un quiproquo dont le but lui échappait encore, lui avait donné la place peu enviable du descendant des Pharaons.
– Tout cela est bel et bon, fit-il, mais c’est de la fiction pure.
– De la fiction ?
– Sans aucun doute, et vous même ne douterez plus, si à la première escale, vous voulez bien télégraphier en France… ?
– Inutile, l’amirauté avait pris cette précaution.
– Mais, saperlipopette, je suis soldat français, je me réclame de mon pays.
– Il ne l’est plus.
– Comment ? Vous prétendez… ?
– Que mon gouvernement a obtenu du vôtre la radiation de votre nom sur les états de l’armée.
Cette fois, ce fut un rugissement qui s’échappa des lèvres du prisonnier.
– On m’a rayé, moi ; mais je ne veux pas.
– Votre volonté ne saurait être prise en considération.
– C’est trop fort. On me dénaturalise sans me consulter. Qu’est-ce que je suis alors ?
– Égyptien.
– Au diable !
– C’est-à-dire, conclut imperturbablement l’officier, un sujet anglais, et même un sujet rebelle.
Puis d’un accent courtois :
– Mais l’Angleterre est la plus généreuse des nations. Vous avez appelé les indigènes aux armes ; elle aurait eu le droit de vous traiter en traître, de vous faire fusiller. Elle a préféré écouter les conseils de la clémence.
– Elle est charmante, gémit Robert découragé… et sa clémence consiste ?…
– À vous mettre simplement hors d’état de nuire.
– Ce qui signifie ?
– Que vous serez traité avec honneur et déférence ; qu’une habitation, des serviteurs seront mis à votre disposition, que tout le confort possible vous sera assuré ; mais des soldats de ma nation veilleront à ce que vous ne quittiez jamais la demeure qui vous sera affectée ?
– Alors, je suis prisonnier à perpétuité ?
– Oh ! pas prisonnier, Altesse ; du moment où vous ne vous éloignerez pas du district désigné, vous aurez toute liberté. Alors que vous étiez employé à Paris, vous étiez moins libre.
– Oui, oui, répondit Lavarède qui, tout étourdi de l’aventure, ne savait plus trop ce qu’il disait. J’étais moins libre.
Et tout bas, il murmura avec une angoisse impossible à rendre :
– Seulement j’avais l’illusion de l’être davantage. C’est bizarre…, les Anglais réalisent mon rêve de tranquillité. Toute ma vie doit s’écouler à la même place. Et cependant, cela me révolte. Est-ce que décidément la liberté serait capable de me révolutionner à ce point ?
Il leva les yeux sur l’Anglais, qui gardait le silence, afin de ne pas interrompre ses réflexions.
– À propos, commandant, vous est-il permis de m’apprendre où je serai… logé et surveillé aux frais de la clémente Angleterre ?
– Parfaitement, Altesse.
– C’est… ?
– En Australie.
Le jeune homme ne s’irrita pas. Il n’eut aucune révolte :
– En Australie, répéta-t-il lentement, le pays des kangourous et des eucalyptus. J’aurais pu voir tout cela au Jardin d’acclimatation, sans quitter Paris. Mais enfin, puisqu’un démon péripatéticien s’acharne après moi, va pour l’Australie.
Puis, avec une placidité qui trompa le commandant :
– Voilà donc qui est entendu. Je descends des Pharaons, je suis Égyptien ; mais qui donc vous a si bien instruit ?
– Un de vos serviteurs, Altesse.
– Niari ?
– Lui-même.
– Et que vous a-t-il conté ?
– À moi, rien ; mais à sir Polson, consul à Massaouah, il a confié que pour échapper aux mains des Abyssins, vous aviez dû implorer le secours des troupes italiennes, auxquelles vous aviez caché votre véritable nom.
– Parfait ! et ma femme ?
– La princesse Lotia ?
– Quel sera son sort ?
– Elle partagera le vôtre, ainsi que tous ceux qui vous accompagnent. Obligée de prendre des précautions contre vous, l’Angleterre veut cependant vous être agréable, autant qu’il lui sera possible de concilier ce sentiment avec le soin de sa sécurité. Vous verrez, Monseigneur, que lorsque vous nous connaîtrez mieux, vous aimerez notre pays.
– Je l’aime déjà, Monsieur.
– Cette parole me réjouit, Altesse.
– Je l’aime à la façon des Normands… qui ont conquis l’Angleterre.
Et sans prendre garde à l’air furibond avec lequel cette plaisanterie, souverainement désagréable à des oreilles anglaises, était accueillie, le jeune homme tourna le dos au commandant, en grommelant :
– En attendant, c’est moi qui suis conquis. Il s’agit de secouer le joug !
CHAPITRE XV
L’AUSTRALIE OCCIDENTALE
– James Parker, squatter and surveyor du district de Youle ; c’est moi-même.
– De plus, mon geôlier ?
– Oh non, Monseigneur, pas geôlier ; seulement administrateur des plaisirs de Votre Altesse.
– Et vous me conduisez à Youle ?
– Dans la province dont je suis le premier magistrat, le surveyor. Pays superbe, bordant le grand désert de Victoria, mais assez fertile encore, abrité qu’il est des vents du nord par le mont Youle. Vous vous y plairez, et s’il vous convient de vous intéresser à mon élevage de bestiaux, cela en vaut la peine… Je suis certainement le plus riche squatter de l’ouest Australien.
– Éloigné de la côte votre district ?
– À peine 450 milles. J’ai franchi la distance en dix jours, au reçu du télégramme qui m’invitait à venir vous chercher à l’embouchure de la rivière Gardner. Il faudra nous hâter au retour, car les pluies ont commencé, et nous allons entrer dans la période des inondations. Vous ne savez ce que c’est. – Des milliers de lieues carrées transformées en lac, d’où émergent seulement les collines et la cime des forêts. C’est merveilleusement beau à la fin de mars. Puis mai et juin arrivent, les eaux s’écoulent ou s’évaporent ; des végétations luxuriantes, pâturages, arbres, taillis, couvent la terre jusqu’en août. Alors la sécheresse se fait sentir, les feuilles tombent, les herbages s’appauvrissent, et la contrée devient un désert assez semblable au Sahara africain. Ici, chaque saison a un aspect si particulier que l’on se croirait transporté dans des régions différentes, Ah ! Altesse ! vous l’aimerez notre Westland, vous l’aimerez.
Ces répliques étaient échangées entre Robert Lavarède et James Parker, premier magistrat du district de Youle, situé dans l’État de Victoria (ouest-australien). Tous deux à cheval, suivis à peu de distance par Astéras, Lotia, Radjpoor, Maïva et Niari qu’escortait un groupe de cavaliers armés, ils remontaient la rive gauche de la rivière Gardner, qui va se jeter à la mer sur la côte occidentale de la grande île océanienne, par 30 degrés de latitude et 113° 23’de longitude.
C’est en cet endroit, qu’après avoir traversé la mer Rouge et l’océan Indien, le Rob-Roy, croiseur de deuxième classe de la marine britannique, avait remis ses prisonniers au digne squatter Parker.
Celui-ci, gros, large d’épaules, la figure colorée, était le type accompli de ces Australiens pour lesquels l’Australie seule existe. Content de lui, gentleman-farmer et fonctionnaire, réunissant dans ses mains épaisses et larges la fortune et l’autorité, le nouveau geôlier de Lavarède bavardait volontiers, à la condition toutefois de faire les demandes et les réponses, car la moindre interruption lui apparaissait comme une atteinte à sa dignité.
Toutefois, Robert lui ayant été annoncé comme un prince illustre, dernier survivant de l’antique race des rois d’Égypte, le squatter était flatté, lui qui descendait probablement d’un convict – forçat – colon primitif de la vaste possession anglaise, il était flatté, disons-nous, de voyager avec un grand personnage. Il en témoignait par une condescendance particulière, permettant à son compagnon de placer de temps à autre une courte phrase. Jamais de mémoire d’homme, il n’avait laissé personne parler autant.
Donc Lavarède et sa suite – amis et ennemis – avaient passé des flancs du Rob-Roy sur la terre australienne, troqué leurs gardiens de la marine anglaise contre des employés de James Parker, qui les occupait tantôt à garder ses troupeaux, tantôt à assurer l’ordre dans le district. À la fois bouviers et gendarmes, ces gaillards étaient robustes, bien armés, bons tireurs et cavaliers à rendre des points aux Gauchos de l’Amérique méridionale.
Comme on l’a vu par la conversation qui précède, M. Parker avait pris livraison du Thanis malgré lui, à l’endroit où la rivière Gardner se perd dans l’Océan, et suivant la rive gauche du cours d’eau, il se dirigeait vers l’est.
Depuis deux jours déjà durait le voyage. La rivière devenait de plus en plus étroite. Au sol bas et plat de la côte, avait succédé une région légèrement montueuse, dont les roches de quartzite, de gneiss, de schistes argileux, affleuraient la surface et s’effritaient en fine poussière sous le sabot des chevaux.
À l’horizon, noyé dans la brume, un massif de montagnes apparaissait.
– Les collines Marshall, avait répondu le surveyor à une question de Robert. Pas bien hautes, 6 à 700 mètres, pas davantage ; mais cela suffit pour former un rebord qui, en temps d’inondation, transforme le pays situé sur l’autre versant en une immense cuvette, où les eaux s’accumulent, roulent en tous sens, impuissantes qu’elles sont à se frayer un chemin vers la mer. Nous y serons demain soir, avait-il ajouté, et nous devrons pousser nos montures ensuite, car des nuages commencent à se montrer au ciel. Il y a dix mois que nous n’en avions vu, Monsieur ; dix mois, hein ! cela enfonce les plus beaux ciels du monde.
– Mais en quoi ces nuages nous obligent-ils à nous hâter ?
– En quoi, vous le demandez ? Il est vrai que, n’étant pas du pays, vous êtes excusable. Eh bien donc, ces nuées annoncent que la saison des pluies est proche. Dans quelques jours, – combien ? on ne sait jamais – les cataractes célestes fondront sur la terre, et il sera bon de ne pas se promener en plaine.
– Si je comprends bien… la pluie tombe à ce point qu’elle est dangereuse pour le voyageur ?
– Dangereuse, dites mortelle, Monsieur. Du jour au lendemain, des fleuves naissent, débordent, couvrent la plaine de dix pieds d’eau. Vous pensez bien que l’Australie ne renfermant pas de hautes montagnes, il n’y a point de glaciers ; partant la plupart de nos rivières coulent seulement pendant la saison humide, mais à ce moment-là, elles se rattrapent, elles s’en donnent pour toute l’année.
Et dans sa mémoire, prodigieusement bourrée de souvenirs locaux, le squatter puisait des anecdotes, racontait les épisodes des explorations entreprises par Forrest, Giles, Brown, Warburton, Gosse, Stuart, Bucke, MacKinley, à travers le continent australien, qui atteint la dimension des quatre cinquièmes de l’Europe, et est certainement le coin du monde le moins connu, de nos jours, en dépit des travaux des hardis pionniers dont il citait les noms.
Au soir, on reçut l’hospitalité dans une ferme, hospitalité primitive comme les gens qui habitaient en cet endroit. Lavarède, fatigué, avait pu se procurer de la paille et s’était confectionné, sous un hangar, une couche moelleuse sur laquelle il dormait à poings fermés.
Alors le fermier, sa femme, leurs quatorze enfants, auxquels le vaniteux Parker n’avait pu se tenir de confier le titre attribué au jeune homme, vinrent le voir dormir. Puis, pénétrés de respect pour eux-mêmes, depuis que leur toit abritait un si grand personnage, ils firent part de l’honneur inespéré dont ils jouissaient à leurs serviteurs.
Ceux-ci, à leur tour, voulurent considérer l’auguste physionomie du fils de rois dont la race remontait à plusieurs milliers d’années ; Européens, indigènes noirs à la tignasse crépue, au front fuyant, à la bouche énorme se pressèrent devant le hangar. De la différence de leurs idiomes naquit la plus réjouissante des confusions, et par la suite, un noir Zaké, originaire d’une tribu de l’intérieur, affirma avoir vu un homme blanc qui avait atteint l’âge respectable de 6,000 ans. Sur quoi, les sorciers de sa tribu s’empressèrent d’expliquer que cet homme avait dû recourir à un philtre ; ils retrouvèrent le secret de la préparation merveilleuse et en vendirent avec la même impudeur que nos marchands d’eau à faire repousser les cheveux sur les crânes chauves, démontrant ainsi que, sous tous les climats, sous les épidermes les plus différemment colorés, se cache toujours le même homme avide, prompt au mensonge et à l’exploitation de ses semblables.
Bien entendu, le Français ne se douta de rien. Au jour, il se leva frais et dispos, et profita de la paresse de ses gardiens pour échanger quelques paroles avec Astéras ; – satisfaction qui lui était refusée le reste du jour, car Sir James Parker, en homme de bonne compagnie qu’il se piquait d’être, pensait que lui seul était digne de converser avec le prince Thanis, dont il éloignait sévèrement les autres voyageurs.
C’est ainsi que l’ancien caissier apprit que Maïva commençait l’étude des consonnes. Ses progrès étaient plus rapides maintenant, et l’astronome croyait pouvoir affirmer qu’avant deux mois elle serait en état de parler. L’espérance de son ami faisait plaisir à Robert. Lui, qui au fond de lui-même, songeait constamment à l’inflexible Lotia, il lui était doux de recevoir les confidences du savant, qui, pour rendre la voix à une petite muette aux grands yeux noirs, oubliait l’astronomie.
Sir Parker mit fin au tête à tête des deux Français. Il s’excusa, avec les grâces d’un éléphant joueur de flûte, d’avoir prolongé son sommeil plus longtemps que Son Altesse, avala un grand verre d’eau-de-vie obtenue par la macération du bois de l’eucalyptus à manne sucrée, et se déclara prêt à se mettre en route, « aux ordres de monseigneur Thanis ».
Maudissant in petto l’importun, Robert donna le signal du départ. On prit congé des fermiers, et au trot allongé des chevaux la troupe s’éloigna.
Vers midi, on atteignit le lac de Caw-Cowing, dont on suivit la rive pendant quelques kilomètres, puis à travers une forêt de red cedars – cèdres rouges – de Tristanias, de Mellas Azédarack, dans le tronc desquels les indigènes creusent leurs canots, on gravit les pentes insensibles des monts Marshall.
Au soir, on campa sur le sommet de la chaîne, au milieu d’un plateau couvert d’une herbe rare, dure, à l’odeur âcre que les chevaux refusèrent de brouter.
– C’est l’herbe du porc-épic, expliqua Sir James Parker, ainsi nommée parce que les troupeaux la refusent. Par opposition, les pâturages des vallées sont désignés sous l’appellation d’herbe du kangourou. Un conseil maintenant, dormons et partons de grand matin. Il importe de faire les étapes doubles, car le ciel devient de plus en plus menaçant.
L’ancien caissier leva le nez en l’air. Des nuages peu nombreux encore, ainsi que des flocons de légères fumées, glissaient lentement, poussés par un faible vent d’ouest. Certes, ces buées ne semblaient point annoncer une tempête prochaine.
– Que craignez-vous donc, questionna-t-il en abaissant son regard sur l’Australien ?
– The cataract, répondit ce dernier, employant le mot local qui désigne les grandes pluies.
– Ces petites nuées-là, allons donc !
– C’est comme je vous le dis, Monseigneur. L’Australie est un pays qui ne ressemble à aucun autre ; sa faune, sa flore ne se retrouvent nulle part ailleurs, et sa climatologie est tout aussi étrange. Vous croyez ces nuages sans importance. Eh bien, si une seule goutte d’eau s’en échappe, vous changerez d’avis. À peine la pluie a-t-elle humecté la terre, que les nuées s’accumulent, deviennent noires, opaques, interceptant presque la clarté du jour, et l’averse diluvienne commence. Puissions-nous être à mon exploitation de Youle avant ce moment !
Le ton dont le surveyor prononça ces paroles impressionna Lavarède.
Il comprenait qu’il se trouvait en face d’un péril inconnu. Aussi, se conformant aux instructions de son guide, se glissa-t-il, aussitôt après avoir soupé, sous la tente de feutre dressée pour lui. Dès l’aube, il fut debout. Déjà Parker faisait seller les montures, tout en examinant la voûte céleste d’un air soucieux.
– Vous êtes inquiet, interrogea le jeune homme ?
Le squatter hocha la tête :
– Oui et non. Pourtant, il me semble que les vapeurs ont bien augmenté cette nuit.
C’était vrai. De lourds cumulus erraient en masses compactes dans l’atmosphère, et les rayons du soleil n’en perçaient qu’avec peine l’écran mobile.
– Hâtons-nous ! Hâtons-nous, fit Sir James en se mettant en selle.
Bientôt on dévala les rampes du mont Marshall. En avant, on apercevait une plaine basse, unie, couverte d’herbes. De loin en loin, des bouquets de bluegum, gommiers au feuillage vert-bleu, et, partageant l’immense prairie, une ligne de Xanthonéa, dont les longues feuilles étroites retombaient ainsi que les rameaux de saules pleureurs, se continuait jusque par delà l’horizon. Des manguiers se distinguaient en taches plus sombres dans ces verdures tendres.
Parker montra les arbres à son compagnon :
– Ils indiquent le lit desséché de la rivière Seabrook. Absorbée par la terre pendant la saison sèche, cette rivière coule sous le sol, et fournit ainsi aux plantes l’humidité dont elles ont besoin.
Longeant la barrière verdoyante, la caravane s’engagea dans la plaine. Fréquemment le squatter regardait le ciel, mais maintenant les nuages semblaient demeurer stationnaires, et Sir James, après chaque observation, éperonnait son cheval en murmurant :
– Oui, nous arriverons peut-être.
On passa la nuit près du lac Seabrook, profonde dépression alimentée par la rivière du même nom.
À l’aube, un brouillard épais environnait le campement.
– Mauvais signe, déclara le surveyor tout en activant la levée du camp. Talonnant sa monture, il prit la tête de la caravane, et forçant le train, entraîna les voyageurs et l’escorte à travers la prairie.
Peu à peu, la brume se dissipait, mais quand elle se fut résolue en impalpables vapeurs, les cavaliers constatèrent que le ciel était couvert de nuages. Plus un coin de bleu, plus un interstice par où pût filtrer un rayon de soleil. Partout, à perte de vue, le dôme du firmament était uniformément gris.
Les chevaux avançaient avec peine. Aux herbages avait succédé un terrain rocailleux portant des buissons épineux, des gommiers rabougris. C’était « le bush », ainsi que le dénomment les Anglais.
Soudain, sans que rien fît prévoir sa venue, une rafale passa, soulevant une nuée de poussière. Les coursiers eurent un hennissement d’effroi ; le squatter, tout pâle, se dressa sur ses étriers, et désignant des hauteurs qui se profilaient à la gauche du chemin parcouru par la caravane :
– Au galop, vers le mont Jackson.
Les hommes de l’escorte répétèrent :
– Au galop !
On eût cru que les animaux eux-mêmes avaient compris l’ordre du chef. Tous bondirent en avant dans un élan affolé. Alors commença une course échevelée, incompréhensible pour les Européens. Leurs montures emportées dans un galop furieux, franchissaient les buissons, les crevasses, les blocs de rochers. Un instinct mystérieux les avertissait du danger imminent, et les flancs battant sous leur respiration précipitée, la sueur ruisselant écumeuse sur leurs croupes, elles allaient toujours.
De nouvelles rafales s’élevèrent, plus rapprochées, plus brutales encore. La poudre soulevée ne retombait plus. Elle flottait dans l’air, remplissant les yeux, les narines des voyageurs, apportant jusqu’au fond des poumons, une sensation de gêne et de brûlure.
Dans ce brouillard, on apercevait sur les flancs de la colonne, des silhouettes étranges, sautant, courant à qui mieux mieux vers le mont Jackson. Kangourous, sarigues, wallabis, opossums, emeus ou casoars, terrifiés par l’approche de la tempête, gagnaient la colline ainsi que les membres de la caravane.
On en était à 400 mètres, quand des gouttes de pluie, larges, espacées, fouettèrent le sol.
– En avant ! rugit une dernière fois sir Parker.
Si terrifiante était son intonation, que sans réfléchir, tous enfoncèrent leurs éperons dans le flanc de leurs chevaux. Les braves animaux hennirent de douleur, et redoublant d’efforts, atteignirent le premier gradin de l’éminence, au moment où, ainsi que d’une digue effondrée, une pluie torrentielle, invraisemblable, auprès de laquelle nos averses les plus abondantes ne sont que faible rosée, s’abattait sur la campagne.
En dix secondes, tous furent trempés. Ruisselants, aveuglés par cette trombe d’eau, ils se laissaient guider par leurs montures qui, haletantes, les naseaux fumants, galopaient, malgré la pente rapide, dans les traces du cheval du squatter.
Presque au sommet de l’éminence, une grotte s’ouvrait. Parker sauta à terre, et conduisant son cheval par la bride, il pénétra dans l’excavation. Tous l’imitèrent en hâte, n’ayant qu’une pensée : se soustraire à la douche glacée qui tombait du ciel. Après avoir parcouru un couloir sombre, ils se trouvèrent dans une vaste caverne circulaire, dont la voûte, percée de crevasses, laissait filtrer la lumière… et aussi la pluie ; car sous les ouvertures des flaques boueuses se marquaient déjà.
Tel quel, l’abri n’était pas à dédaigner. Les chevaux furent entravés dans un coin, et à l’autre extrémité de la grotte, les hommes du surveyor allumèrent, non sans peine, un feu autour duquel tous les voyageurs se groupèrent pour se réchauffer.
Un vacarme épouvantable se faisait entendre à l’entrée :
– Qu’est-ce là, demanda Robert ?
– Ça, fit en riant sir Parker, c’est notre garde-manger.
Et comme le jeune homme le considérait avec surprise, ne saisissant pas le sens de ses paroles.
– Je veux dire que les animaux de la plaine ont fui, comme nous, vers le mont Jackson. Vous avez dû les apercevoir en route ?
– En effet.
– Notre présence les gêne. N’osant envahir la caverne, ils se sont entassés dans le couloir qui y donne accès.
– Mais pourquoi les désigniez-vous tout à l’heure sous cette appellation le « garde-manger » ?
– Vous ne devinez pas ?
– Ma foi non.
– C’est pourtant clair. L’inondation va nous bloquer ici, jusqu’au moment où l’on enverra de ma ferme d’Youle des embarcations à notre recherche.
– Eh bien ?
– Eh bien, nous n’avons pas de provisions.
– Je comprends. Ces animaux serviront à notre nourriture.
– Tout simplement. Dans les intervalles des averses, ils se répandront sur les pentes de la hauteur, pour brouter, se sustenter. L’inondation les empêchera de s’éloigner, et nous les retrouverons toujours.
– Mais la plaine ne va pas être inondée si vite que cela ?
– Elle l’est déjà !
– Déjà ? Il pleut depuis deux heures à peine.
– C’est suffisant. Au reste, venez vous en rendre compte, Monseigneur.
Le squatter entraîna Robert vers l’entrée de la caverne. Passant au milieu des animaux sauvages, tellement bouleversés par le déchaînement de la tempête qu’ils ne songeaient pas à s’effrayer du voisinage de l’homme, tous deux parvinrent à l’ouverture.
La pluie effrayante, torrentielle, éclairée par les zig-zags flamboyants des éclairs, limitait la vue à quelques pas.
– Impossible d’apercevoir la campagne, murmura Lavarède.
– Attendez un instant.
Sir James avait à peine achevé sa phrase, qu’un coup de vent formidable s’abattit sur la montagne, avec le retentissement d’une explosion d’artillerie.
Sous l’irrésistible poussée des couches atmosphériques, la pluie fut comme volatilisée. Au loin, la plaine apparut. Mais l’eau déjà avait recouvert les herbes et les buissons. C’était un lac désormais d’où le mont Jackson émergeait ainsi qu’un îlot.
Le vent cessa de souffler, l’averse reprit violente, voilant de nouveau l’horizon. Le Français demeurait à la même place, anéanti devant cette nature australienne, soudaine, excessive, antithèse de celle de l’ancien monde.
Soudain il prêta l’oreille. À travers le fracas de la tourmente, le grondement de la chute de l’eau, il lui avait semblé entendre comme un aboiement. Il se retourna vers son guide pour l’interroger. Il le vit soucieux, les sourcils froncés. Il fut frappé également de l’agitation des animaux groupés derrière lui. Tous frissonnaient, cherchant à se glisser aux derniers rangs.
De nouveau, l’aboi retentit plus rapproché.
– Les dingos, gronda sir James Parker.
– Les dingos… Qu’est-ce encore ?
– Des chiens sauvages, nombreux, féroces, coureurs infatigables, nageurs intrépides. Leur instinct les conduit vers notre asile.
– Eh bien, on les recevra.
– Soyez-en sûr ; mais avec ces animaux-là, on n’est jamais certain du lendemain, et je ne vous cache pas que j’aimerais mieux avoir affaire à une tribu d’Australiens indigènes qu’à ces loups du bush.
– Ils sont donc terribles ?
– Vous ne le verrez que trop tôt, Monseigneur. En attendant, il faut nous préparer à soutenir un rude assaut.
Et laissant son compagnon, le squatter rentra dans la caverne, en criant à pleins poumons :
– Alerte, les dingos !
CHAPITRE XVI
LES DINGOS
Comme une commotion électrique, l’appel de sir Parker secoua les hommes de son escorte. En un instant, tous furent à l’orifice de la caverne, écoutant les hurlements toujours plus éclatants des ennemis à quatre pattes qui approchaient.
Puis, sur un signe de leur chef, ils refoulèrent à l’intérieur tous les herbivores craintifs entassés dans le couloir, et ils se mirent en devoir d’obstruer l’entrée. Roulant les blocs de rochers épars, ils les empilèrent. Ils se hâtaient, stimulés par les abois rauques des dingos. Bientôt le rempart atteignit la hauteur d’un homme. À ce moment, la pluie redoubla de violence, le vent rugit plus lugubrement, et des aboiements sonores, nombreux partirent du bas même de l’éminence.
Les dingos prenaient pied sur l’îlot.
À leur cri sauvage répondit un gémissement affolé. Pris de panique à l’approche de leur ennemi, le terrible loup du bush, les animaux enfermés dans la grotte, kangourous, casoars, wallabis, les chevaux des voyageurs eux-mêmes rompant leurs entraves, se ruèrent sur la barricade, la renversèrent et s’enfuirent dans toutes les directions, laissant sur le sol un jeune kangourou qui, pressé par la troupe éperdue, avait eu le poitrail défoncé sur les roches.
Parker s’approcha de la pauvre bête, et d’un coup de revolver mit fin à ses souffrances.
– Allons, fit-il, il faudra nous rationner, nos provisions courent les champs ; pas pour longtemps, du reste, car les dingos vont rapidement les exterminer. Tenez, écoutez-les, les voilà en chasse.
En effet, les aboiements des chiens sauvages avaient changé ; ils étaient courts, brefs, comme ceux d’une meute sur la piste. Ils résonnaient de toutes parts, effrayants, sinistres.
– By devil’s horn ! grommela le surveyor, ils sont là par centaines ; l’assaut va être terrible.
Puis avec cette insouciance que donne l’habitude de la vie du désert :
– Après tout, cette chasse infernale nous assure quelque répit. Profitons-en pour consolider notre fortification.
Sans doute, ses subordonnés avaient fait des réflexions analogues, car tous réparaient la brèche pratiquée par les animaux terrorisés. Après quoi, ils renforcèrent la barricade en roulant au pied de nouveaux blocs de pierre.
– Placez des factionnaires, commanda sir James. On se relaiera de deux en deux heures.
Et s’adressant à Robert, à qui tous ces événements semblaient un rêve :
– Les dingos ont mangé ce soir. Ils ne nous attaqueront pas avant demain. Venez, Monseigneur. Soupons et dormons. Une fois le siège commencé, les minutes de repos seront rares.
Machinalement Lavarède le suivit dans la caverne.
Déjà, deux cavaliers de l’escorte avaient dépouillé le kangourou. Ils découpaient sa chair en minces lanières qu’ils enfilaient sur une baguette de fusil, puis ils les suspendaient au-dessus d’un feu de broussailles, qui produisait plus de fumée que de feu.
– Que se passe-t-il donc ?
C’est par cette question que l’astronome salua le retour de son ami. Le squatter ne laissa pas au Français le temps de répliquer :
– Il se passe qu’une bande de chiens du bush est sur la montagne. Ces animaux féroces et braves marchent généralement par troupes de plusieurs centaines. Quand ils ont faim, ils attaquent l’homme.
– Diable !
– Et ils auront faim demain.
– Ces chiens sont-ils dangereux pour nous, reprit Lotia de sa voix douce ?
– Oui, d’autant plus que les eaux nous bloquent et que nous n’avons pas de vivres.
Un morne silence accueillit ces paroles du surveyor. La situation apparaissait terrible à tous, prisonniers de l’inondation sur une colline dénudée, sans aliments, en face d’une invasion de carnivores dont le nombre n’avait d’égal que la voracité.
Mais Robert releva la tête :
– Pas de vivres, dit-il. Parbleu, si, nous en avons. Les chiens du bush veulent nous manger, mangeons-les… par représailles et pour nous soutenir. Nous rendrons les honneurs… culinaires à ceux qui succomberont dans la mêlée.
– N’espérez pas cela, interrompit Parker.
– À cause de quoi, s’il vous plaît ?
– À cause d’une habitude de ces horribles bêtes. Celles qui sont blessées sont aussitôt saisies par leurs voisines, entraînées à l’écart et dévorées. Bref, nos fusils fourniront des provisions de bouche à nos ennemis, mais pas à nous-mêmes.
– Mais alors l’avenir est folâtre, soupira Robert. Le kangourou durera deux jours. Après cela, ayant de l’eau,… en abondance hélas ! nous tiendrons encore autant… total : quatre journées.
Il regardait Lotia avec une émotion dont il n’était pas maître. Ces paroles qu’il venait de prononcer contenaient l’arrêt de mort de la jolie Égyptienne. S’aperçut-elle de son trouble ; voulut-elle montrer encore en face du trépas l’orgueil de sa race et son mépris pour celui dont elle était la femme. Mystère ! Toujours est-il qu’elle dit à haute voix, sans lever les yeux sur Robert :
– La mort sera la bienvenue. J’ai sacrifié ma vie, et le sacrifice a été inutile. Bénie soit l’heure où mon esprit délivré quittera mon corps immobile et froid !
– Mais vous ne songez pas à ce que sera l’agonie, s’écria l’ancien caissier, insensible à l’insulte, n’écoutant que sa pitié et son affection ?
Elle eut un geste dédaigneux :
– Les lâches seuls ont l’effroi de la lente agonie. Les courageux savent comment elle s’abrège.
Et après un temps :
– J’ai toujours mon poignard, acheva-t-elle.
Lui, la considérait toujours, pris par une épouvantable angoisse. Quoi ! cette enfant qu’il chérissait malgré son injustice, cette enfant se frapperait ? Il la verrait pâle, sanglante, endormie du sommeil glacé de l’éternité ? Cela ne serait pas, ne pouvait pas être. Il fallait trouver un moyen de la sauver, et saisissant le bras du squatter :
– Sir James, dit-il nerveusement, comment comptez-vous sortir de ce mauvais pas !
– Je vous l’ai déjà appris, je crois. La saison des pluies commence tôt. À la ferme de Youle, mon épouse, Mistress Parker, et mes fils enverront certainement des pirogues à ma recherche. Ces embarcations visiteront tous les points de la plaine qui émergent. Le tout est qu’ils arrivent ici assez tôt. Sinon, on ne trouvera plus que nos os, nettoyés comme des pièces anatomiques par ces gredins de dingos.
Son flegme exaspéra Robert.
– Mais sapristi, ne pourrait-on pas guider les recherches, un signal de feu au sommet de la hauteur pendant un arrêt de la pluie.
– Sans doute, Monseigneur. J’y songeais quand nous sommes arrivés ici.
– Vous voyez bien.
– Seulement, la chose est devenue impossible.
– Impossible, allons donc ?
– Les chiens du bush ne nous permettraient pas de mettre ce plan si simple à exécution.
La remarque était juste. L’armée des chiens tenait les voyageurs prisonniers. Quiconque sortirait de la caverne serait mis en pièces, dévoré. Il fallait donc compter uniquement sur une chance improbable, à savoir que les gens envoyés à la découverte dirigeraient leurs premières recherches vers le Mont Jackson.
Et comme Lavarède s’avouait mentalement qu’il y avait gros à parier que la chose ne se passerait pas ainsi, un coup de feu vibra, suivi d’un concert effrayant de hurlements.
Les hommes avaient sauté sur leurs armes, mais la voix lointaine du factionnaire s’éleva :
– Ce n’est rien. Un dingo trop curieux. Il regardait par-dessus la barricade ; je l’ai brûlé.
– Parfait, remarqua Parker, tâchons de ne pas brûler aussi le kangourou.
Les cavaliers préposés à la cuisine se levèrent vivement et coururent au foyer, au-dessus duquel se boucanait la viande du marsupiau[5]. Les grillades étaient sèches, mais non grillées, à point par conséquent pour être conservées.
Sous l’œil du squatter, on les divisa en quatre portions, chacune devant servir à un repas, puis on les roula dans un manteau, qui fut enfermé dans un coffre porté précédemment par l’un des chevaux. Pour ce soir-là, on soupa du reste des provisions emportées la veille de la ferme, puis chacun s’étendit à sa guise sur le sol. Sauf le factionnaire placé derrière le rempart de rochers, nul ne demeura éveillé.
C’est une chose étrange en effet que la fatigue triomphe des appréhensions les plus vives. Lassés par la route, Australiens ou étrangers, tous trouvaient le repos dans cette grotte sombre, dont les chiens du bush, aux crocs acérés, gardaient l’issue.
Aucun incident ne troubla la nuit.
La lumière revint. Curieusement, les voyageurs s’approchèrent de la sortie et regardèrent au dehors. Un spectacle saisissant les attendait. Sur le plateau rocheux qui s’étendait devant la barricade, sur les pentes voisines, les dingos pullulaient. Ils étaient là par centaines, allongeant vers la grotte leurs museaux pointus, dressant les oreilles, se réunissant par groupes comme pour se consulter. Certains, plus philosophes ou moins affamés, restaient paresseusement étendus sur le sol. La pluie avait cessé, mais, sur la plaine transformée en lac, filaient d’épais nuages, bas et sombres, indice d’averses prochaines.
En somme, les chiens du bush étaient assez calmes. Leur attaque ne semblait pas imminente. Peut-être d’ailleurs, ces animaux, qui ont un instinct stratégique étonnant, avaient-ils compris la difficulté d’enlever la position, et essayaient-ils d’un blocus, que bientôt leur faim, aiguisée par l’attente, les amènerait à changer en assaut furieux.
Quoi qu’il en soit, la matinée s’écoula sans incident. On grignotta du bout des dents quelques tranches de viande de kangourou, arrosées de l’eau claire des flaques qui s’étaient formées au-dessous des fissures du rocher, puis on se remit en observation. Les chiens sauvages continuaient le même manège.
Vers le soir ; pourtant, ils manifestèrent quelque inquiétude. Ils se rapprochèrent de l’entrée de la caverne tandis que les assiégés se livraient à leur repas, et par instants, l’un d’eux poussait un hurlement lugubre, que les autres répétaient aussitôt. C’était un sabbat à faire dresser les cheveux sur la tête.
La nuit s’étendit sur la plaine. La pluie s’était remise à tomber, les cataractes du ciel s’écroulaient sur la terre avec un crépitement assourdissant. Des éclairs déchiraient les nues de leurs éblouissantes lignes brisées, le tonnerre rugissait, et dominant le fracas de la tourmente, les chiens sauvages hurlaient à la mort.
C’était horrible et tragique.
Personne ne songeait au repos. Assis en cercle, échangeant de rares paroles à voix basse, les assiégés, la main sur leurs armes, attendaient, l’âme angoissée, l’attaque des fauves. Mais les heures nocturnes s’écoulèrent, sans que les bush’s dogs tentassent l’assaut.
Un jour gris, blafard, se leva. On déjeuna tristement de la troisième ration de chair de kangourou.
Encore un repas, et le spectre de la faim habiterait la caverne, ajoutant une épouvante aux horreurs de la situation, apportant une torture nouvelle au lent supplice des voyageurs.
Abattus, tous songeaient au lendemain. Les provisions seraient épuisées. Les forces diminueraient lentement, à l’heure précise où les dingos, exaspérés par l’attente, se rueraient sur la barricade improvisée.
Au moment où les défenseurs de la place auraient besoin de toute leur vigueur, les fusils échapperaient à leurs mains défaillantes.
Les loups envahiraient la grotte.
Un suprême combat se livrerait, et puis la victoire resterait aux farouches quadrupèdes.
La victoire ! Ce mot évoquait un tableau sanglant. Aux oreilles bourdonnantes des prisonniers résonnaient de stridents bruits de mâchoires. Ils seraient dévorés, à moins d’un secours miraculeux sur lequel personne ne comptait plus.
Seul, Astéras semblait étranger à la préoccupation générale. Il était allé s’asseoir auprès du factionnaire placé à l’entrée de la grotte, là où la clarté était plus grande, et sur son carnet, il dressait un tableau, alignait des signes bizarres, avec un sourire satisfait :
– Cela amusera Maïva, monologuait-il tout en se livrant à ce singulier travail. Elle apprendra ainsi à lire et à prononcer les lettres du même coup.
Une fois de plus, l’éternel distrait avait oublié la situation où il se trouvait. Et il avait quelque mérite à cela, car plus le temps avançait, plus les grognements des chiens du bush devenaient aigus. La faim et la colère grandissaient chez eux. Évidemment, l’instant était proche où le combat commencerait.
Cela dura jusqu’à cinq heures du soir. Le vent tomba tout coup, l’averse se calma, les dingos eux-mêmes se turent, surpris par cette brusque accalmie ; mais soudain quelques abois secs, rapides, résonnèrent. Comme si cela eût été un signal attendu, tous les chiens se dressèrent sur leurs pattes, se massèrent en un bataillon compact, présentant, à l’entrée de la grotte, une rangée terrifiante de dents acérées.
– À la barricade, cria le factionnaire !
À cet appel, tous coururent au rempart. Il était temps. L’armée des chiens s’ébranlait.
Ainsi qu’une vague furieuse déferlant sur la falaise, les carnassiers vinrent se briser sur l’obstacle.
Des coups de feu pressés éclatèrent. Les assiégés tiraient dans la masse, au hasard, sans viser.
Des hurlements de douleur répondirent à cette décharge. Les blessés étaient entraînés par leurs congénères, qui les déchiraient sans pitié. Mais l’attaque ne fut pas arrêtée.
Troupe grouillante, compacte, les dingos se hissaient les uns sur les autres, se cramponnant des griffes et des dents aux aspérités des blocs de rochers. Ils arrivaient à la hauteur du rebord supérieur, et leurs mâchoires avides soufflaient à la face des assiégés leur haleine brûlante.
Le temps de recharger les armes manquait. Les fusils, les révolvers se transformaient en massues, s’abaissant sans relâche, broyant les crânes des bush’s dogs.
Mais de nouveaux assaillants surgissaient toujours, hurlant, grinçant des dents, les yeux injectés, avides de mordre.
Ce que dura cette infernale vision, aucun des assiégés n’aurait pu le dire. Soit par lassitude, soit que les nombreuses victimes des armes européennes eussent suffi à apaiser la fringale des plus affamés, l’attaque des chiens sauvages mollit subitement, et tous, tournant le dos à la barricade, s’enfuirent et disparurent dans les brumes de la nuit tombante.
Ainsi que l’avait affirmé Parker, aucun cadavre ne restait en vue. Les assiégés avaient fourni des aliments à leurs ennemis, mais rien à eux-mêmes.
Tristement ils prirent leur dernier repas, et quand ils eurent mastiqué avec peine les languettes de chair séchée, ils se regardèrent avec un découragement profond.
Le premier acte du drame, auquel le Mont Jackson servait de théâtre, était achevé. Le second allait commencer, avec un adversaire nouveau : la famine !
Aussi fut-ce un étonnement général, lorsque l’astronome d’un air enchanté appela Maïva.
– Viens, petite, je vais te montrer des images qui t’intéresseront.
Tous regardèrent de son côté. Sa large face exprimait la joie. Il clignait de l’œil d’un air malin, en toisant Radjpoor, absorbé par de sinistres réflexions. Sa main brandissait une feuille arrachée à son carnet.
– D’où provient ta satisfaction, interrogea Robert en s’approchant !
– De ce que j’ai trouvé le moyen d’activer les progrès de cette bonne petite Maïva.
Les lettres de l’alphabet sont difficiles à retenir, parce qu’on les enseigne comme des sons, ne représentant rien à l’esprit.
Eh bien, en fouillant dans mes souvenirs, j’ai réussi à rétablir le sens et l’origine des lettres. Par l’image, elle les apprendra en quarante-huit heures !

Et sans s’apercevoir de l’air ahuri de son interlocuteur, surpris qu’en un pareil moment il pût être préoccupé de lecture, le savant lui montra triomphalement le tableau que voici :
– Toutes les lettres primordiales y sont, clama l’astronome en forçant son ami à examiner le tableau.
Les Aryas de l’Inde, les Égyptiens, les Phéniciens ne connurent que dix-neuf lettres, ou plus exactement dix-neuf hiéroglyphes, dont la forme se modifia avec le temps, et dont la signification s’obscurcit, à mesure, qu’ils s’éloignaient du dessin primitif.
Tu ne vois pas figurer ici les lettres k, f, j, w, x, y et z, lesquelles sont de simples variantes des signes c, e, i, v et s.
Si nous écrivions les nombres en chiffres romains, je ferais un travail du même genre.
Chez les anciens la main servit d’abord à compter. 1 était représenté par le pouce, 2 par le pouce et l’index, et ainsi de suite jusqu’à 5 et 10 figurés par une ou deux mains ouvertes.
Avec le temps, les doigts disparurent et furent remplacés par de simples lignes, comme ceci.
Et rapidement il traça le petit croquis suivant :
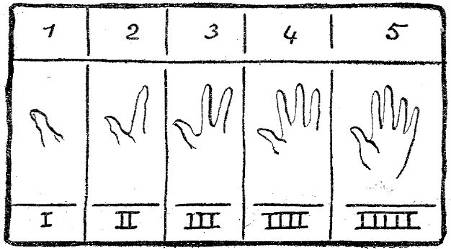
– Prends les deux doigts extrêmes de la main, le pouce et l’auriculaire, poursuivit Ulysse, tu obtiens la forme du V, adoptée par abréviation pour représenter le 5, ce qui conduisit à écrire 4 : IV ; 6 : VI, jusqu’à dix dont l’X est simplement la réunion de deux V, c’est-à-dire deux fois 5.
Pour les chiffres arabes, leur origine phénicienne est un peu plus compliquée.
Les Phéniciens avaient groupé les jours par périodes de 10 ; à chacun des jours de ces décades – reprises plus tard comme semaines par la révolution française – un animal correspondait, et sa forme servait à désigner dans quelle division un fait s’était produit.
C’est ainsi, conclut-il en griffonnant de nouveau, que
nous obtenons la liste que j’indique grossièrement : 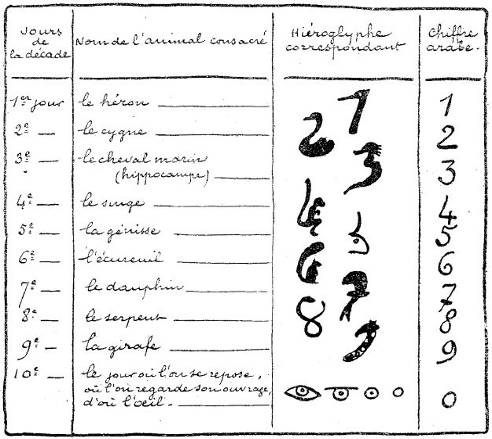
Tout à son idée, Astéras allait poursuivre sa conférence ; par bonheur Lavarède, un instant suffoqué par tant d’inconscience, retrouva la voix :
– Tu es fou, dit-il.
Le savant leva la tête d’un air effaré :
– Fou ! mais malheureux, ce que je viens de te dire n’est pas une supposition en l’air, une hypothèse sans fondement, c’est…
– Je me soucie bien des origines de l’alphabet et de la numération. Sempiternel rêveur, peux-tu songer à de telles balivernes, alors qu’il faut peut-être nous préparer à mourir.
– Tu dis ?
– Que les dingos nous assiègent et que nous n’avons plus une miette de nourriture.
La figure ronde de l’astronome se rembrunit. Il se donna une calotte sur la tête et répliqua d’un ton penaud :
– Tu as raison, je suis fou, cette pauvre Maïva…
– Maïva, comme Lotia, toi, moi, tous ceux qui nous entourent sont en danger de mort, à moins d’un secours providentiel.
– Il faut le provoquer ce secours.
– Comment, mon pauvre Ulysse ?
– N’avais-tu pas parlé d’un signal de feu, allumé au sommet de la montagne !
– Si, mais les chiens sauvages veillent. Personne ne tromperait leur flair.
– Oh ! dit simplement le savant. On ne sait jamais. J’essaierai, si tu veux.
Et sans se rendre compte qu’avec une insouciance sublime, il offrait d’accomplir un acte de folie héroïque, l’astronome se leva et se dirigea vers l’entrée de la caverne. Robert lui barra le chemin et lui serrant les mains, avec une émotion qui faisait trembler sa voix :
– Non, cher illuminé, non, ne tente pas cela. Ton dévouement serait inutile. Tu n’arriverais qu’à transformer en réalité l’horrible vision du songe d’Athalie et à nous montrer
Un horrible mélange
D’os et de chairs meurtris et traînés dans la fange
Que des chiens dévorants se disputaient entre eux,
Puis avec un sourire, sa bonne humeur native reprenant le dessus :
– Reste ce que tu es, un astronome, gardien vigilant de la Grande et de la Petite Ourse, du Dragon et de cent autres constellations aux noms féroces. Ce serait déchoir que te faire dépecer par de vulgaires chiens de la brousse.
Il redevint grave, le sentiment aigu de la situation le ressaisissant.
– Seulement il faut sortir d’ici et au plus tôt – et avec une sourde irritation – au diable l’existence sédentaire et bureaucratique où l’on n’apprend pas à se tirer du danger. J’aurais dû me faire colon en Afrique, comme mon père. J’aurais chassé le lion, la panthère, et aujourd’hui je ne serais pas bloqué, empêtré par ces maudits caniches.
Pensif, il ramena son ami dans la caverne. Leurs compagnons étaient étendus sur le sol, enveloppés dans leurs manteaux. Dormaient-ils, ou bien feignaient-ils le sommeil, afin de n’avoir pas à échanger leurs pensées sur l’avenir désespérant ouvert devant eux. Lavarède ne se le demanda même pas.
Parmi ces corps immobiles, une forme seule attirait son regard, celle de Lotia. À pas de loup, il s’approcha d’elle. Elle ne bougeait pas ; ses paupières étaient closes ; de ses lèvres vermeilles s’échappait un souffle régulier.
Il allait se retirer quand elle ouvrit les yeux ; avec une expression indéfinissable elle considéra le Français debout ; sa physionomie s’éclaira d’un sourire cruel et d’une voix ironique :
– Tu le vois, Thanis, dit-elle. La lâcheté est mauvaise conseillère. Tu pouvais laver la tache ancestrale dans le sang des oppresseurs de ta patrie. Le peuple t’aurait acclamé, adoré, et moi-même peut-être un jour, éblouie par ta gloire, j’aurais pardonné. Au lieu de cela, tu as fui bassement, en fils de chiens, et ce sont les chiens qui te châtieront.
Elle se tut un instant, comme si elle attendait une réponse. Désespéré par ses paroles, ne trouvant rien pour lui expliquer son erreur, Robert garda le silence. Alors elle eut un imperceptible mouvement d’impatience.
– Éloigne-toi, Thanis. Ta présence blesse la vue de celle dont tu as fait une victime.
La tête basse, le cœur saignant sous l’outrage, Robert obéit à la jeune femme. Chaque mot prononcé par elle était une insulte, une blessure nouvelle, et cependant il n’éprouvait pas de colère. Il avait pitié, et tout bas il murmurait en s’éloignant :
– Une idée, une simple idée. Que je donne ma vie, mais qu’elle soit sauvée par moi. Elle est bonne au fond ; elle me regretterait si elle croyait que je me suis sacrifié pour elle.
CHAPITRE XVII
LE PHARE
Les dingos avaient certainement éprouvé des pertes sensibles, car de toute la nuit, ils ne tentèrent aucune attaque nouvelle. La lumière reparut et la journée s’écoula sans incident. Des averses, accompagnées de tonnerre et d’éclairs, se succédaient, séparées par des périodes de calme.
Dans la caverne, le découragement prenait les assiégés. Depuis bientôt vingt-quatre heures, ils n’avaient plus d’aliments. Sombres, muets, l’estomac tenaillé par les crampes de la faim, ils échangeaient des regards farouches.
De loin en loin, un juron, une plainte échappait à l’un d’entre eux, puis le silence morne pesait de nouveau sur les malheureux.
Au dehors, les chiens des fourrés s’étaient rapprochés de l’entrée de la grotte. Leurs grognements parvenaient jusqu’aux assiégés avec des modulations ironiques. On eût dit que les maudites bêtes avaient connaissance de la situation désespérée de leurs ennemis ; qu’elles se réjouissaient à la pensée de la curée prochaine, inévitable.
Pour la quatrième fois depuis que les compagnons de Sir Parker étaient bloqués sur le Mont Jackson, l’ombre couvrit la terre. Après une nuit sans sommeil, les infortunés durent repousser, aux premières lueurs du jour, un assaut des bush’s dogs. Ils arrêtèrent encore les assaillants, mais après le combat, ils se sentirent plus découragés, plus anéantis qu’auparavant.
L’effort avait épuisé leurs forces. Privés de nourriture depuis quarante heures, trompant leur faim en absorbant l’eau des flaques de la grotte, ils étaient envahis par une faiblesse qui croissait de minute en minute.
Leurs visages pâlissaient, leurs yeux brillaient de fièvre ; une sueur abondante ruisselait sur leurs fronts, les épuisant encore. Un des hommes de l’escorte, réputé grand mangeur, et qui, par cela même, souffrait plus de la disette que ses camarades, parlait de tenter une sortie, de gagner un piton élevé, de le couronner d’un bûcher, dont la lueur annoncerait au loin le lieu de la retraite de la petite troupe.
Et à ceux qui lui rappelaient l’impossibilité de sortir, il répondait obstinément :
– Eh bien quoi ! Mourir pour mourir…, autant tomber en se vengeant qu’attendre ici d’être paralysés par la famine.
– Silence, ordonna Parker. Notre seul espoir est que l’on vienne à notre aide du dehors, attendons.
– Mais un signal de feu…
– Eh ! interrompit le squatter, avec quoi l’allumerais-tu ? Nous n’avons plus de bois, plus rien qui puisse flamber.
Un murmure terrifié accueillit cette déclaration.
– Plus rien, répétèrent les assistants.
– Plus rien, reprit le surveyor d’un ton ferme. Mais ce n’est pas une raison pour s’abandonner au désespoir. Chaque instant diminue la distance qui nous sépare de ceux qui sont sûrement à notre recherche. Donc, faisons bonne garde, et tant qu’il nous restera une parcelle de force, défendons-nous.
Bien qu’il cherchât à encourager ses compagnons, il n’espérait plus. Il savait par expérience combien souvent des colons, surpris par l’inondation, avaient péri misérablement sur un îlot. On les découvrait certes, mais morts après la longue agonie de la faim, Sur la plaine couverte d’eau, les éminences forment un archipel, dans lequel les recherches s’égarent, se prolongent, s’éternisent. En philosophe de la prairie, il avait fait son deuil de tout espoir, mais il croyait de son devoir de soutenir jusqu’au bout le moral de ceux qu’il commandait.
Les Égyptiens furent réconfortés par ses paroles ; mais les Australiens, qui connaissaient la prairie tout aussi bien que leur chef, haussèrent les épaules, et celui qui déjà avait parlé, traduisit ainsi l’opinion de tous :
– Je ne donnerais pas un farthing de notre peau !
Cependant la journée s’avançait. Tantôt l’un, tantôt l’autre se traînait, d’un pas mal assuré, vers l’entrée de la grotte et interrogeait l’horizon d’un regard anxieux. Inspection vaine ! Sur le lac aux eaux limoneuses qui recouvrait la prairie, aucune embarcation ne se montrait, Alors l’observateur revenait plus morose auprès de ses compagnons.
Les dingos faisaient bonne garde. Ils surveillaient étroitement le refuge des assiégés, avertis par leur instinct infaillible que le dénouement de la tragédie n’était plus éloigné. À de longs intervalles, un aboiement clair retentissait, répété sur tout le flanc de la colline. C’était comme un appel de sentinelles, se conviant à veiller.
Le jour baissait quand Lavarède qui, depuis plus d’une heure, réfléchissait, le visage caché dans ses mains, releva soudainement le front.
– Sir James Parker, appela-t-il.
Le squatter se glissa aussitôt près de lui :
– Que désirez-vous, Monseigneur ?
– Vous soumettre un plan que je viens de combiner.
– Un plan ?
– Pour enflammer cette nuit un fanal, qui servira de phare à vos amis, et cela sans risquer d’être déchiré par les chiens sauvages.
Parker accueillit cette déclaration par un sourire incrédule.
– Nous ne possédons pas un brin de combustible, commença-t-il…
– Pour cela vous êtes dans l’erreur.
– Comment ? Vous prétendez affirmer ?
– Que les selles de vos chevaux sont en bois recouvert de cuir, et qu’à défaut d’autre chose, cela brûlera suffisamment.
– Tiens ! c’est vrai, je n’y avais pas songé, exclama le surveyor. Soit ! nous pouvons faire du feu, mais cela ne nous donne pas la possibilité de sortir d’ici.
– Vous vous trompez encore, Sir James.
À cette affirmation, tous les assiégés se rapprochèrent des causeurs, les enveloppant de regards avides.
– Ma foi, Monseigneur, prouvez-moi cela, répondit Parker, et je vous en serai bien reconnaissant.
– C’est ce que je vais faire.
Et lentement, comme pour graver plus sûrement ses paroles dans le cerveau de ses auditeurs, Robert reprit :
– Vous avez remarqué comme moi que cette caverne est située presque au sommet du Mont Jackson ?
– En effet, mais…
– Attendez donc. Ce sommet est au-dessus de nos têtes. Des fissures assez larges laissent pénétrer jusqu’à nous l’air, la lumière et la pluie. Or, il me semble que la voûte n’étant élevée que de quatre mètres environ, il ne serait pas très difficile d’y fixer une corde formée par les brides des chevaux attachées bout à bout.
– Dans quel but ?
– Vous l’allez voir. L’un de nous, moi par exemple, s’élèverait par ce moyen jusqu’à une crevasse assez large pour livrer passage à un homme ; celle-ci, compléta le Français en montrant du doigt une fissure qui s’ouvrait au milieu du plafond de la grotte. Par ce conduit naturel, je parviens au dehors. Un de vos hommes lie successivement les selles, les petits morceaux de bois, tout ce qui est susceptible de brûler enfin, à l’extrémité de la corde. Je hisse ces matériaux, je les entasse au bord du trou, sur le plateau, et j’y mets le feu.
– Très ingénieux, mais vous serez dépisté par les dingos.
– Si ces horribles bêtes me serrent de trop près, je me réfugie dans la crevasse. Du reste, rien ne vous empêche de les occuper pendant mon opération. En vous postant à l’entrée de la grotte et en les fusillant, vous attirerez leur attention de ce côté, et vous me donnerez ainsi toute liberté de dresser et d’enflammer mon phare.
Toutes les mains, sauf celles de Lotia, se tendirent vers l’ancien caissier. Certes, le signal de feu n’était pas le salut, mais c’était un regain d’espérance. Les tortures de la faim étaient momentanément oubliées ; et puis on agirait, au lieu de s’abandonner sans lutte à la mort. L’action porte en elle-même sa récompense, elle console et réconforte.
Avec une impatience nerveuse, les assiégés attendirent les ombres propices de la nuit. Peu à peu, le jour déclina. Pour tromper leur anxiété, les prisonniers des chiens avaient, à l’aide d’un crampon, fixé la corde dans la paroi de la crevasse indiquée par Lavarède. L’opération n’avait été ni longue, ni difficile. Quelques blocs de pierre amoncelés avaient permis aux travailleurs d’atteindre le sommet de la voûte.
Enfin l’obscurité se fit. L’instant d’agir était venu.
Tous eussent voulu se charger d’allumer le foyer, mais Robert insista pour obtenir la préférence. L’idée lui appartenait en somme, et toute contestation était impossible. Un des hommes de l’escorte fut choisi pour demeurer dans la caverne et faire parvenir au Français les matériaux du bûcher. Les autres apprêtèrent leurs armes, afin d’opérer la diversion imaginée par Lavarède.
– Monsieur, quand il vous plaira, prononça enfin Sir Parker. Il ne pleut pas, et il fait noir comme dans un four.
– Il me plaît de suite, Monsieur.
Et s’approchant de Lotia, Robert lui dit à voix basse :
– Ni lâche, ni haineux, ni traître. Si je succombe en essayant de vous sauver, demandez à mon ami Astéras qui je suis, Croyez-le, et accordez-moi un souvenir.
Sans lui donner le loisir de répondre, il escalada le monticule factice dressé sur le sol de la grotte. Il serra la main d’Astéras, assura son fusil en bandoulière, et saisissant les courroies de cuir qui devaient faciliter son ascension, il atteignit la crevasse où il disparut.
Quelques minutes se passèrent. Silencieux, frémissants, tremblant que les chiens du bush ne dépistassent leur compagnon, les assiégés demeuraient rangés sous la fissure, les regards fixés sur le trou d’ombre dans lequel Lavarède s’était englouti.
Une voix qui semblait venir du ciel arriva jusqu’à eux :
– Tout va bien. Commencez la manœuvre.
Aussitôt, tous, sauf l’homme chargé du service d’alimentation du signal de feu, coururent à l’entrée de la caverne et commencèrent une fusillade en règle contre les dingos, surpris par cette soudaine attaque.
Cependant Lavarède qui, grâce à la cheminée naturelle, avait gagné le sommet du plateau, s’occupait avec une précipitation fébrile à édifier le bûcher. Une à une il hissait les selles que son aide resté en bas attachait à l’extrémité des courroies. Il déchiquetait les enveloppes de cuir, mettant le bois de la forme à nu, disposait ses matériaux en ménageant de grands « jours », de façon à faciliter l’embrasement.
Bientôt le monceau de matières combustibles atteignit la hauteur d’un mètre.
– Il n’y a plus rien, cria d’en bas l’Australien.
– Parfait ! alors j’allume.
Le jeune homme fouilla dans sa poche, pour prendre la boîte d’allumettes dont il s’était muni. À son grand étonnement, il ne la trouva pas. Sans doute, elle était tombée pendant son ascension.
– Bah ! dit-il philosophiquement, mon « associé » va m’en faire parvenir.
Et se penchant sur la fissure, ainsi qu’un ramoneur sur une cheminée :
– Ohé ! clama-t-il.
– Que voulez-vous, répondit l’organe de l’Australien !
– Des allumettes, je n’ai plus les miennes.
– À l’instant !
Il fallait quelques secondes pour que les « australian matches » attendues fussent attachées solidement à l’extrémité de la lanière de cuir. Lavarède se dressa et regarda autour de lui. La fusillade des assiégés retentissait toujours, jetant dans les ténèbres de rapides lueurs et soulevant un assourdissant tumulte de hurlements.
Soudain le cœur du jeune homme cessa de battre. Au bord du plateau une forme indécise était apparue.
– Un dingo, murmura-t-il. S’il me signale, j’aurai dans une minute toute la bande sur les bras. Vais-je échouer au port ?
Le dingo s’avançait lentement vers le bûcher derrière lequel Lavarède se dissimulait. Ses yeux brillaient de lueurs phosphorescentes. Ses oreilles sans cesse en mouvement, la lenteur de sa marche indiquaient une vague inquiétude. Évidemment le fauve se demandait que était ce monceau d’objets inconnus subitement poussé sur le sommet du mont Jackson.
Robert a la main sur la lanière de cuir. Une secousse l’avertit que l’homme de la caverne a amarré les allumettes. Avec mille précautions, il hale sur la courroie. Sous ses doigts, il sent la boîte ; mais tout à coup un frisson le secoue jusqu’aux moelles. Arrêté à dix pas du bûcher, le chien sauvage vient de lancer dans l’espace un aboiement prolongé.
– Il appelle les autres, hâtons-nous, gronde le Français.
D’un seul coup, il enflamme le contenu de la boîte, glisse les allumettes pétillantes sous l’amas des selles et souffle avec rage afin de déterminer l’incendie.
Mais des pas nombreux résonnent sur le flanc de la colline. L’armée des chiens du bush accourt ; en rangs pressés ils envahissent le plateau. Ils vont rouler vers le foyer, le disperser, car la flamme qui les effraierait ne darde pas encore ses langues dansantes vers le ciel. Il faut à tout prix les retarder, donner au phare le temps de s’embraser.
Le péril est terrible, mais Robert n’y songe même pas, absorbé qu’il est par une pensée unique : faire le signal de feu ainsi qu’il l’a promis.
D’un coup d’épaule, il fait glisser son fusil dans sa main. L’arme est chargée, il tire dans la masse grouillante qui le menace, Pour cela, il s’est redressé. Sa brusque apparition, la détonation surprennent les bush’s dogs. Ils glapissent, hurlent de colère et de crainte. Le jeune homme a rechargé son fusil. De nouveau il épaule, son doigt presse la gâchette, mais une tempête d’aboiements furieux répond à l’explosion, et la bande de chiens se rue sur lui.
Une seconde ils s’arrêtent en face du bûcher. Des flammèches s’élancent de la masse, léchant les parois. Cela les effraie ; ils contournent l’obstacle.
Devant leurs yeux flamboyants, leurs gueules avides, dont le souffle fétide arrive jusqu’à lui, le Français a un moment de trouble ; mais il le chasse bien vite. Il doit combattre, protéger encore le foyer, de l’éclat duquel dépendent peut-être la vie de ses compagnons, l’existence chère de Lotia.
Saisissant son fusil par le canon, il décrit de terribles moulinets, défonçant les crânes, brisant les mâchoires, maintenant autour de lui un cercle infranchissable, au-delà duquel les fauves bondissent.
Et le feu crépite ; dans la fumée, des flammes claires montent, illuminant l’ombre. Les dingos reculent, chassés par cette lumière. Robert a accompli sa tâche, il peut rejoindre ses amis. Il profite de l’effroi momentané de ses adversaires, et se coulant rapidement dans la crevasse, il se laisse glisser jusqu’au sol.
Il tombe au milieu des assiégés éperdus. De l’entrée de la grotte, ils ont vu les chiens du bush s’élancer vers le sommet du Mont Jackson. Ils ont compris le but de ce mouvement. Le but, c’était leur courageux compagnon. Aussi le revoient-ils avec une joie délirante.
– Le signal flambe, leur crie Robert.
Tous l’entourent, lui serrent les mains.
– Mais vous êtes blessé ! exclame Parker.
En effet, le Français a été mordu au bras. Son sang coule.
– C’est ma foi vrai, dit-il en souriant. Bah ! ce n’est pas une affaire ! Venez voir comment notre phare se comporte.
Et tamponnant sa blessure avec son mouchoir, il entraîne les assiégés vers l’issue de la grotte.
Debout derrière la barricade, ils regardent. Une grande lueur éclaire le plateau, se reflète au loin sur les eaux de la plaine inondée.
Le signal de feu est fait. Si dans le vaste cercle de l’horizon, des pirogues sont à la recherche des prisonniers du Mont Jackson, on verra la flamme éclatante, on viendra les délivrer.
Longtemps ils restent là. La lumière diminue graduellement. Elle s’éteint faute d’aliments ; l’averse reprend formidable, torrentielle ; un instant mise en fuite, l’obscurité revient victorieuse et noie la terre sous ses voiles opaques.
Alors il semble aux assiégés que leur espérance elle-même s’est évanouie. Leur fatigue pèse plus lourdement sur eux, leur faim prend une recrudescence d’acuité. Ils se trouvent fous d’avoir pu penser un instant qu’ils seraient sauvés parce qu’un feu brillerait à la crête de la montagne.
Influence néfaste de la nuit, le doute remplace la croyance. À leur reconnaissance pour Robert succède un sentiment intraduisible, complexe. Pour un peu, on lui en voudrait d’avoir risqué ses jours pour ne donner qu’une espérance.
Taciturnes, tous sont revenus dans la caverne. Ils se sont étendus sur le sol. Ainsi ils restent jusqu’au jour. Il y a plus de cinquante heures qu’ils n’ont pas mangé.
Chez Lotia, plus faible que les autres assiégés, la faim exerce des ravages plus rapides. Eux sont affaiblis, elle a la fièvre. Vers le milieu de la journée, elle est prise de délire, et une plainte monotone et douce s’échappe de ses lèvres décolorées.
Elle rêve que sous ses yeux s’étend la terre d’Égypte enfin reconquise par les fellahs soulevés. Il lui semble que sur un char de triomphe elle passe, avec Thanis, au milieu de la multitude enthousiaste ; elle murmure des phrases étranges :
– Thanis, la morte elle-même m’ordonne de pardonner. Les tiens m’ont ravi ma mère ; tu me rends une mère plus grande, la patrie.
Puis elle tombe dans un lourd sommeil, d’où elle ne sort que pour divaguer encore.
Décidément la fortune est contre les assiégés. En vain, les jambes flageolantes, ils se traînent à la barricade pour interroger du regard la surface déserte du lac immense dont ils sont environnés, Aucune barque, aucune pirogue n’apparaît.
Deux fois les chiens sauvages tentent de forcer le passage. Deux fois on les repousse encore, mais les hommes sentent qu’un troisième assaut sera peut-être le dernier. Leur vigueur décline rapidement, leurs armes sont lourdes à leurs bras fatigués. Un engourdissement invincible les couche sur la terre. De temps à autre, ils se soulèvent brusquement, hantés par la pensée de l’attaque des dingos, de la lutte suprême où ils doivent succomber.
L’après-midi s’écoule, la clarté baisse, tout est ténèbres. Plus personne ne bouge : on dirait que les assiégés ont cessé de vivre, Certes, si les chiens du bush se ruaient à ce moment dans la caverne, ils auraient bon marché de leurs adversaires épuisés.
Mais le jour reparaît sans que les fauves aient fait le moindre simulacre d’attaque. Aucun des compagnons de Lavarède ne fait un mouvement. Sont-ils déjà endormis du long sommeil de la mort. Robert se soulève péniblement. Avec effort, il se traîne auprès de Lotia. L’Égyptienne a les yeux clos, elle respire péniblement.
Une pâleur livide s’est répandue sur ses traits. Elle se meurt. Et il la considère effaré, stupide, avec l’impression angoissée que son propre cœur va éclater, que son âme s’envolera en même temps que celle de la fille de Yacoub Hador.
À l’autre extrémité de la grotte, Ulysse est assis auprès de Maïva. La muette est allongée sur le rocher. Son mignon visage est contracté par l’approche du trépas, mais ses yeux noirs sont rivés sur ceux de l’astronome. De sa main défaillante, elle lui a montré la voûte céleste. Il a compris, il lui parle d’une voix lente et assourdie des étoiles. Et au fond de lui-même, il ressent une gratitude infinie pour l’astronomie, cette science pour laquelle il a vécu, et dont il berce les derniers instants de sa douce compagne de voyage.
Radjpoor, adossé à la muraille de granit, semble inconscient des choses de la terre. Niari est auprès de lui, regardant de ses yeux étranges et profonds de sphinx.
Combien de temps dure cette scène lugubre. Nul ne le sait. Tout à coup un fracas de mousqueterie, des voix humaines retentissent. Les moribonds sortent de l’immobilité. Ils ont entendu. Est-ce la délivrance ! La fusillade continue, se rapproche.
Alors, galvanisés, ils se lèvent, ils courent à l’entrée de la caverne et un cri de joie s’élance dans l’espace. Des pirogues sont amarrées au pied de la colline. Des squatters gravissent les pentes, pourchassant les dingos affolés. Les assiégés se précipitent au dehors, prenant les quadrupèdes à revers, et épuisés par cet ultime effort, ils tombent sans connaissance dans les bras de leurs libérateurs.
Ce sont les fils, les amis de Sir Parker. Le surveyor avait pensé juste. L’inondation s’étant produite, tous s’étaient mis en quête de l’Australien et de ses compagnons. La nuit précédente, ils avaient aperçu la lueur du bûcher allumé par Lavarède, mais ils étaient loin. Ils n’avaient pu arriver au mont Jackson qu’au soir. Les aboiements des dingos les avaient avertis du danger qu’ils courraient en débarquant dans les ténèbres, et ils avaient attendu le matin.
Une heure plus tard, les assiégés, après avoir pris un peu de nourriture, étaient étendus dans le fond des embarcations qui s’éloignaient à force de rames du Mont Jackson, sur lequel les survivants de la troupe des chiens sauvages couraient follement en faisant retentir l’atmosphère de cris aigus.
CHAPITRE XVIII
LE MONT YOULE
Brisés par les émotions violentes qu’ils venaient de subir, Lavarède et ses compagnons restèrent constamment affalés au fond des pirogues, Ils ne virent point l’aspect étrange de la plaine noyée. Parfois c’était comme un bief immense que, poussés par le vent, parcouraient des flots limoneux ; puis des éminences rapprochées s’égrenaient en îlots à la surface, créant un dédale de canaux, où des gens moins accoutumés au pays se fussent inévitablement égarés.
Quand la pluie se mettait à tomber, on étendait sur les bordages des claies, et ainsi provisoirement pontées, les embarcations ne risquaient pas d’être emplies par le déluge céleste.
Le soir venu, on aborda sur un plateau peu élevé. Les pirogues furent tirées à terre et retournées la quille en l’air, offrant ainsi un abri aux voyageurs.
Mais quelque désir que pussent en avoir les rameurs, il leur fut impossible de dormir. Dans l’obscurité des bruits bizarres se produisaient. Des cris aigus, le piétinement de troupes nombreuses d’êtres inconnus réveillaient en sursaut ceux que la fatigue terrassait.
Ce ne fut qu’aux pâles clartés de l’aube que l’on eut l’explication du phénomène. Des milliers de lapins s’étaient réfugiés en ce lieu. Le plateau était un gigantesque terrier dont les entrées innombrables vomissaient à chaque minute des bandes de rongeurs.
– Une des plaies de l’Australie, expliqua sir Parker à Lavarède qui regardait ce spectacle avec intérêt. Primitivement le sol se divisait en deux zones bien tranchées, la région des forêts, celle des déserts. Peu de pâturages, partant peu d’herbivores. Mais les colons ont défriché, ils ont créé des prairies pour l’élevage des moutons. Aussitôt kangourous et lapins de pulluler, à ce point que de 1889 à 1893, ils ont failli ruiner la contrée. Il a fallu que toute la population s’armât pour les détruire, que l’on allouât des primes au chasseurs. Il était temps, car les pasteurs voyaient leurs troupeaux décimés par la faim, les lapins leur enlevant l’herbe de la bouche ; les banques chancelaient, un krack formidable était imminent. Enfin, grâce à d’énergiques mesures de protection, les hommes, après trois années de guerre, ont eu raison des lapins et l’Australie a été sauvée.
Robert ne put s’empêcher de rire :
– Un peuple dévoré par les lapins, voilà qui n’est pas ordinaire. Le Marseillais lui-même n’aurait pas trouvé celle-là.
– Pour notre malheur, nous l’avons trouvée, répliqua gravement le squatter ; et pour nous le lapin est le plus irréconciliable des ennemis. Ce qui d’ailleurs ne nous empêche pas de le faire figurer sur nos tables, car il est succulent.
Les fils du surveyor, Paul et Harry, qui avaient dirigé l’expédition de secours, pensaient sans doute comme lui au sujet du lapin, considéré comme animal comestible, car on les aperçut bientôt rapportant une ample provision des innocents quadrupèdes qu’ils avaient massacrés le plus aisément du monde.
Parker présenta ses enfants cérémonieusement à Monseigneur Thanis, « un gentleman qui remonte à plus de 4000 ans », dit-il, puis on revint vers le rivage. Les embarcations avaient été remises à l’eau.
– Ce soir, nous arriverons chez nous, déclara l’Australien. Ne retardons pas le départ. Mistress Parker nous attend certainement avec impatience, et elle trompe son inquiétude en nous confectionnant un dîner de choix. Vous verrez, Monseigneur, que la maison d’un squatter n’est pas du tout un lieu de privations.
Sur quoi, il embarqua après avoir aidé « Monseigneur » à s’installer. La petite flottille prit aussitôt le large se dirigeant vers l’Est.
Un soleil radieux se mirait dans les eaux. Ainsi qu’il arrive parfois, durant la saison pluvieuse, une saute de vent avait momentanément balayé le ciel. Pas un nuage n’était visible jusqu’aux confins de l’horizon.
Mais au loin, une ligne noirâtre dessinait sa courbe sinueuse au-dessus de l’onde.
– Les premiers gradins du Mont Youle, expliqua encore Parker. Ce sont mes prairies, où j’élève cent cinquante mille moutons, quinze mille bœufs et douze cents chevaux. Enfant du pays, j’ai choisi ce qu’il y avait de mieux, cinquante mille hectares bien arrosés, mais d’une altitude suffisante pour n’être jamais inondés. Grâce à cette situation, pas de voisins à craindre, car ma propriété est bornée de trois côtés par des plaines basses, recouvertes chaque année par l’eau des pluies, et du quatrième par le désert de Victoria, vaste étendue de steppes arides.
– Enfin, conclut Lavarède, trop d’eau d’une part, pas assez de l’autre.
– Tout juste, approuva le squatter avec un gros rire.
Peu à peu, la terre vers laquelle se dirigeaient les embarcations se précisait davantage. On distinguait les pentes douces du massif montagneux, couvertes de prairies verdoyantes, au milieu desquelles des petits bois se dressaient, donnant à l’exploitation l’apparence d’un parc anglais.
Des kraals, enceintes fermées par des piquets accolés et contenant des baraquements couverts, attirèrent les regards des voyageurs.
– Quelles sont ces constructions, fit curieusement Lavarède, intéressé malgré lui par la nouveauté du spectacle ?
– Des étables, s’empressa d’expliquer Sir Parker. Durant la saison pluvieuse, les animaux s’y réfugient à leur guise. Parfois des moutons imprudents s’abritent insuffisamment et meurent. Ce sont là des pertes inévitables, car, vu le nombre de nos têtes de bétail, il nous est impossible de soigner nos troupeaux ainsi qu’on le fait en Europe, à ce que j’ai entendu dire du moins. Nous fournissons les hangars, et nous comptons sur l’instinct des animaux pour en profiter.
Comme il terminait, des fumées légères s’élevèrent sur les rampes de la montagne, bientôt suivies par l’écho affaibli de détonations d’armes à feu.
– Des bergers, des cowboys nous ont aperçu, reprit le squatter. Ils annoncent notre arrivée.
En effet, un mouvement insolite se produisit bientôt sur la rive. Des formes humaines accouraient, s’agitaient. Des cavaliers galopaient au bord de l’eau. Sir James avait repris sa lorgnette.
– Bon, dit-il, voici Mistress Parker en personne. Pauvre chère lady, elle a dû avoir bien de l’inquiétude, je vais la rassurer.
Et déchargeant son fusil en l’air :
– Là… elle reconnaîtra la voix de mon rifle, et elle comprendra ainsi que tout va bien.
Les rameurs redoublèrent d’énergie, les barques filèrent comme des flèches sur les eaux jaunâtres, et un quart d’heure plus tard, au milieu des cris frénétiques du personnel de l’exploitation, de coups de feu, de hennissements de chevaux, la flottille atteignait la côte.
Au bord de la rive, une femme forte, haute en couleur, abritant sous un chapeau d’homme à larges bords sa tignasse abominablement rousse, glapissait en tendant les bras au surveyor :
– Vivant ! Sans blessures au moins ! Pauvre de moi, Parker, quelles transes vous m’avez causées.
Ce disant, elle l’enlaçait et le pressait nerveusement contre son cœur.
À demi suffoqué, Sir James se dégagea de l’étreinte de sa tendre moitié et répondit :
– Oui, tout est bien, darling Bérenitz, mais laissons les effusions. Je vous ramène des hôtes qui, je pense, meurent de faim comme moi-même.
– Vous avez raison, Parker. La sensibilité naturelle à mon faible sexe me fait oublier les devoirs de maîtresse de maison. Mais n’ayez crainte, la table est dressée ; l’oxtail soup (soupe à la queue de bœuf) fume dans le chaudron, le kangourou rôti se dore devant le feu, le beefstake pie (pâté de bifteck) et le plum-pudding sont prêts.
Et saluant Lavarède et ses amis, avec une prétention grotesque qu’elle prenait sans doute pour la grâce elle-même, Mistress Parker ajouta :
– Nobles étrangers, vous êtes les maîtres sur mon domaine, car je suis honorée de vous recevoir. Oui, parfaitement, honorée ; le mot est celui qui rend exactement ma pensée.
Puis avec une pétulance qui surprenait chez une personne aussi ronde, elle prit la tête du cortège, et processionnellement, avec l’escorte bruyante des vachers, bergers et autres employés de l’exploitation Parker, on suivit le chemin de la ferme.
Vingt minutes de marche conduisirent le cortège sur un plateau uni, que couronnaient la maison d’habitation, coquettement rustique, et d’innombrables dépendances. Le fer et la brique formaient les principaux éléments de ces constructions.
Mais si l’art avait tenu peu de place dans les préoccupations de l’architecte, les salles étaient vastes, largement aérées. Les meubles en bois d’Eucalyptus Xilomelum, que sa dureté a fait choisir pour la confection des bois de fusil, manquaient d’élégance, mais en revanche ils étaient éminemment pratiques. En outre, le culte de la musique s’affirmait par la présence de pianos, et durant le trajet du vestibule à la salle à manger, Lavarède n’en compta pas moins de six, ce qui lui suggéra cette réflexion.
– S’il y a dans la colonie autant de virtuoses que d’instruments, ce doit être un enfer où Wagner est dieu !
Comme on le voit, l’ancien caissier appartenait à cette race de pianophobes pour qui les Érard, Pleyel et autres sont de simples appareils de torture, et qui considèrent que le clavier aux dents blanches n’a d’autre but que de déchirer les oreilles délicates.
Constater le fait, n’est point l’apprécier. Aussi, sans vouloir défendre le jeune homme, dirons-nous seulement aux pères, aux époux, dont les filles, les femmes charmantes embellissent les jours des accords du piano :
– Que celui qui ne pense pas comme Robert lui jette la première pierre !
Peut-être échappera-t-il ainsi au danger d’être lapidé.
Cependant Mistress Parker désignait à ses hôtes leurs places autour de la table. Lavarède et Lotia avaient les postes d’honneur, avec l’aggravation de sièges plus élevés que les autres. La femme du surveyor affirmait volontiers qu’elle connaissait les habitudes des cours et laissait supposer aux auditeurs bénévoles que le hasard lui livrait que ses ancêtres avaient tenu à la noblesse. C’était d’ailleurs une vérité approximative, car son père avait rempli les délicates fonctions de maître d’hôtel dans une vieille famille d’Écosse.
Quoi qu’il en soit, elle s’empressa autour de l’ancien caissier, lui prodiguant les : Monseigneur, les Altesses et les meilleurs morceaux, le menaçant le plus respectueusement du monde d’une double indigestion d’honneurs et de victuailles.
Saturé de flatteries un peu lourdes et de nourriture non moins pesante, le Français vit arriver avec joie le moment de se coucher, Avec des égards qui retardèrent d’une grande demi-heure cet instant impatiemment attendu, son altesse Thanis fut conduit au pavillon, désormais glorieux, affirma la grosse dame avec un fin sourire, à qui incombait l’insigne fortune d’abriter sa tête royale.
Enfin on le laissa seul. Avec un sentiment de délivrance, il dépouilla ses vêtements et s’étendit dans le lit, un peu dur comme tous les lits australiens, destiné à supporter son illustre personne. Habitué aux rochers du Mont Jackson, la couche du reste lui parut moelleuse par comparaison, et bientôt, fermant les yeux, il oublia ses soucis, son voyage involontaire, sa transformation en prince exotique, et s’abandonna à un repos réparateur.
De grand matin, Parker se présenta chez lui, s’informa poliment de sa santé, et après les compliments d’usage :
– J’ai fait seller un cheval pour vous, Monseigneur. Si la chose vous agrée, nous parcourrons mon domaine. J’ai hâte de vous montrer notre existence, de vous amener à l’aimer, et de changer ainsi en lieu de délices le district d’internement dont le gouvernement anglais m’a fait geôlier.
L’offre fut acceptée. Devant le pavillon, trois chevaux attendaient, et déjà l’astronome se hissait sur l’un d’eux avec des contorsions qui démontraient jusqu’à l’évidence son peu d’habitude de l’équitation.
Robert et son hôte l’imitèrent. Puis, à un petit galop de chasse, tous trois s’éloignèrent de Youle-House – nom de la ferme, – non sans que Mistress Parker leur eût souhaité bonne promenade de la façon la plus emphatique :
– Voyez-vous, Monseigneur, déclara le surveyor après un temps, j’ai tenu à vous présenter votre domaine dès aujourd’hui, car des coquins de petits nuages se forment à l’horizon, et la pluie, interrompue un moment, reprendra avec une nouvelle intensité. Mais ne vous effrayez pas de ce pronostic. Quand la promenade est impossible, on passe le temps agréablement à la maison ; nous ne sommes pas des sauvages, et nous vous ferons entendre d’aussi bonne musique que dans les salons de Londres, de Paris ou du Caire.
– Précisément ce que je craignais, murmura le jeune homme, si bas que son interlocuteur ne l’entendit pas.
– Mais ne songeons pas à cela, poursuivit le squatter. Admirez ces plaines qui s’étendent jusqu’à l’horizon et même au delà. Voyez nos troupeaux, que nos bergers à cheval surveillent. Je suis certain que vous ignorez à quel point l’élève de ces bêtes est passionnante et demande de précautions.
D’un geste vague, Lavarède indiqua son ignorance absolue, et tandis qu’il regardait ces herbages sans bornes, où d’innombrables moutons paissaient, Parker continua :
– Il faut veiller sur eux comme sur des enfants, les mener suivant le temps sur des pâturages plus ou moins verts, afin d’éviter les maladies, songer aux agneaux ; mais l’opération capitale est la tonte de la laine.
Et désignant des baraquements situés à droite et à gauche de la route :
– Allons de ce côté, Monseigneur. Vous serez surpris de voir que nos moutons sont traités, ma parole, mieux que bien des humains.
Un court galop à travers la plaine herbeuse conduisit les trois hommes auprès des baraques qui recouvraient un large espace. Tout alentour le sol était saupoudré d’un sable fin, jaune comme de l’or.
– Figurez-vous, Altesse, reprit l’incorrigible bavard, que le point capital de la tonte est de fournir une laine blanche, dépouillée de suint, Elle se conserve mieux ainsi et double de valeur. Dans les exploitations peu importantes, on lave les moutons dans un cours d’eau, mais les propriétaires sérieux, qui ne craignent pas les lourdes dépenses de premier établissement, préfèrent recourir au lavage à l’eau chaude.
Tout en parlant, il mettait pied à terre, et ses compagnons l’ayant imité, il pénétra dans le hall le plus proche.
Les Français eurent un cri de surprise. Devant eux s’étendait un hangar de soixante à quatre-vingts mètres de longueur. Des pompes à vapeur, des chaudières se groupaient d’un côté. De l’autre, le sol descendait par une pente légère jusqu’à un abreuvoir, auprès duquel nos piscines eussent paru de simples cuvettes. Au-dessus, fixés à la toiture par des tiges de fer, étaient suspendus des « doucheurs ». Lances, pommes d’arrosoir pour la douche en pluie, s’alignaient par centaines.
– Les pompes à vapeur font monter l’eau nécessaire au lavage, expliqua Parker ; cette eau passe par les chaudières où elle devient tiède, puis elle est dirigée, soit sur le réservoir où on plonge les moutons, soit dans les appareils doucheurs. Soumises au bain et à la douche, les petites bêtes sont vite décrassées. Après cette opération, on les parque dans des prés enclos, que l’on débarrasse soigneusement de toute ordure. Là, les moutons sèchent. Il ne reste plus ensuite qu’à les conduire dans les hangars, où les tondeurs opèrent, aidés chacun par un gamin, qui ramasse la laine, et par un « wool roller » dont la fonction consiste à séparer les débris de la toison, et à mettre à part celle du dos formant la première qualité et celle du cou et du ventre, qui n’est que la seconde.
Ces diverses opérations achevées, la laine est mise en balles et expédiée. Vous suivrez ce travail en détail, quand la saison sera venue, conclut l’Australien. Aujourd’hui, je désire seulement vous donner un aperçu de la vie du squatter, et vous convaincre que l’on n’a pas le loisir de s’ennuyer. Remontons à cheval et poursuivons notre excursion.
Tout le jour, les cavaliers parcoururent les terres du surveyor, passant de surprise en surprise devant les curiosités de cet élevage géant. Vers midi, ils avaient déjeuné dans une cabane de cow-boys. Un quartier de mouton, rôti dans un trou creusé en terre, et quelques verres de Trichelia wine, liqueur à la couleur de saphir, obtenue par la fermentation des baies du Trichelia, arbre curieux dont le feuillage a le parfum de la rose, leur avaient rendu leurs forces, et grisés d’air pur, baignés de lumière, ils avaient galopé dans les traces de leur guide, jusqu’au moment où celui-ci avait déclaré qu’il était l’heure de reprendre le chemin du logis.
Ils revenaient vers la ferme en suivant le bord de l’eau, devisant de ces gigantesques exploitations agricoles d’Australie, auprès desquelles nos fermes d’Europe semblent des jouets d’enfants.
Soudain, l’attention de Lavarède fut appelée sur un point noir, qui se mouvait avec rapidité à la surface de la plaine submergée.
– Qu’est-ce là ? demanda-t-il ?
Parker saisit aussitôt sa longue vue, et après avoir examiné l’objet désigné.
– Rien de grave. Une pirogue montée par un indigène. L’homme est seul, partant inoffensif ; mais il est singulier qu’un bushman insoumis se hasarde si près de ma propriété.
– Un bushman insoumis, répétèrent les Français ? à quoi reconnaissez-vous cela ?
– À son costume, composé uniquement d’un jupon court. De plus, il porte les amulettes d’expédition : les dents d’ours dans les cheveux, l’os de kangourou fiché dans les narines et surtout le boomerang.
Il passa la jumelle à Robert.
– Le boomerang, fit celui-ci, n’est-ce pas cet instrument bizarre, en forme de croissant qui est à côté du rameur ?
– Si, c’est cela même.
– Une arme unique au monde, particulière aux seuls Australiens ?
– Précisément, une arme dont, seuls, ils savent se servir ; une arme étrange comme tout ce que produit cette terre curieuse.
Et profitant de l’occasion pour placer un discours :
– Le boomerang, reprit le squatter, est une sorte de massue recourbée que le guerrier papou lance au loin. Mais, tandis que tous les projectiles décrivent entre leur point de départ et le but visé une trajectoire à peu près droite, celui qui nous occupe suit une ligne brisée, analogue au parcours d’une bille de billard qui rencontre la bande.
Comme ses auditeurs le considéraient avec l’air hésitant de gens qui ne comprennent pas très bien, sir Parker traça sur le sable avec le bout de sa canne, la figure ci-contre :
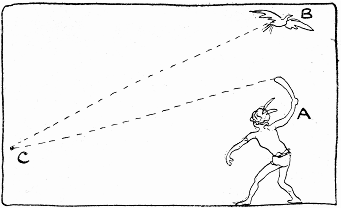
– Un noir, placé en A veut atteindre un oiseau qui se trouve en B. Il ne lui lancera pas directement le boomerang. La massue ira frapper un point C, et par une sorte « d’effet en retour » reviendra sur elle-même pour abattre le gibier convoité. Cent fois, j’ai assisté à ce tir invraisemblable, et parmi les premiers colons, plus d’un a trouvé la mort en regardant un indigène qui, debout à côté de sa victime, lui paraissait viser un objet situé à quelque distance en avant. Maintenant, vous me demanderez sans doute comment les bushmen produisent ce curieux mouvement. Je vous répondrai franchement que je l’ignore. Il y a là un lancé particulier, un coup de main spécial qu’aucun blanc, à ma connaissance, n’a pu attraper. L’arme nationale australienne n’est maniable que pour les indigènes.
Tandis qu’il parlait, la pirogue qui motivait cette digression avait fait du chemin. Elle n’était plus qu’à quelques centaines de mètres des Européens, vers lesquels le rameur semblait se diriger.
Il maniait ses pagaies avec une rare vélocité, et son esquif volait littéralement sur les flots. La distance diminuait à vue d’œil ; enfin le noir imprima un dernier élan à la pirogue dont l’avant vint glisser en grinçant sur le sable. D’un bond, le rameur fut à terre et s’inclinant devant Parker, en appliquant les mains sur sa nuque, il prononça d’une voix gutturale en mauvais anglais :
– Tu es James Parker, surveyor du district. Moi, je suis Racawene, de la tribu des Chaap-Whuurongs et je sollicite ton hospitalité.
– L’hospitalité est due au voyageur, répliqua le squatter sans hésiter. Tu es mon hôte. Ne crois donc pas que j’obéisse à un mouvement de défiance en te demandant quelle aventure t’a entraîné aussi loin des territoires où chassent tes frères ?
– Je te répondrai loyalement. Je suis bien, en effet, des districts où, là-bas, dans l’Est, par delà la plaine sans eau (le désert) sont établis les Chaap-Whuurongs. Si j’ai quitté ma hutte, mon village, les miens, c’est qu’une fille des Kuurn-Kopan-Noot avait ravi mon âme.
– Les Kuurn-Kopan-Noot ne sont-ils pas ennemis de ta tribu ?
L’indigène inclina la tête à plusieurs reprises :
– Si, si, nos campements sont en guerre depuis longtemps, et bien souvent les eucalyptus se sont dépouillés de leurs feuilles sans que nos mains cessassent de serrer le boomerang et la lance, mais le divin Ouadnu-Buroo se rit des haines des tribus.
– Ouadnu-Buroo, murmura Lavarède en regardant Parker ?
– Le dieu du mariage, répondit ce dernier.
– Il m’a fait diriger ma course vers les territoires de chasse des adversaires de ma tribu, continua l’Australien, et j’ai rencontré Mareahu, la plus belle d’entre leurs filles. Pour les contraindre à me la donner pour épouse, j’ai attendu une nuit obscure. Sur les mains, sur les genoux, je me suis glissé dans leur village. J’ai atteint la hutte où reposait Mareahu. Elle dormait ainsi que les Abcor-Gova, génies bienfaisants au ciel de Tohuatepee. J’ai dérobé une tresse de sa chevelure, et maintenant, ses parents seront obligés de venir me prier d’être son mari.
En parlant, il ouvrait un sac formé d’une peau d’opossum repliée, et en tirait une mèche de cheveux rudes et noirs, ayant plus d’analogie avec les crins du cheval qu’avec une chevelure humaine ; mais le système pileux des Australiens n’est pas réputé pour sa délicatesse. Parker et ses compagnons le savaient, aussi ils ne manifestèrent aucune surprise.
Toutefois Lavarède, toujours prompt à questionner, demanda à son hôte :
– En quoi le larcin commis par cet indigène, oblige-t-il les parents de la jeune fille à les unir ?
– Une superstition des bushmen. Ils s’imaginent que celui qui détient une mèche de cheveux acquiert un pouvoir occulte sur la personne dépossédée, sur sa famille et même sur sa tribu. Dès lors, le seul moyen de conjurer le mauvais sort est de marier le voleur et la volée. Rien ne prévaut contre ce préjugé. Les haines de tribu à tribu, l’insulte au chef, tout s’efface devant l’idée saugrenue qu’une tresse enlevée confère une puissance surnaturelle à qui la possède.
– Je comprends. Pas bête, le Rocawene qui nous parle. Il a la face d’un singe, mais aussi il en a la malice.
– Enfin, pourquoi as-tu choisi ma demeure pour y attendre les parents de ta fiancée, fit Parker se retournant vers l’Australien ?
Celui-ci eut un large sourire, qui découvrit ses dents blanches, taillées en pointe :
– Pourquoi ? Parce que tu es magistrat Ageü (Anglais), et que, si les Kuurn-Kopan-Noot voulaient plus tard se venger de moi, les miens n’auraient qu’à les signaler à ceux de ta nation, pour qu’ils arrêtent les meurtriers et les suspendent au bout d’une corde jusqu’à ce que mort s’ensuive. Or, tu le sais, la pendaison prive à jamais qui en est victime des joies que Tehuatepee promet aux guerriers frappés au combat. On me laissera donc vivre en paix avec Mareahu.
– Soit donc. Viens avec nous, et puisses-tu être heureux ?
L’indigène remercia Parker de ce souhait par une inclination et tous revinrent à la ferme.
Le dîner se passa avec le même cérémonial que la veille. Il fut suivi par une séance de musique dont Lavarède pensa devenir fou.
Durant près de deux heures, avec des grâces de femme colosse, Mistress Parker chanta d’une voie tonitruante des opéras surannés. Elle s’accompagnait sur le piano dont elle touchait comme d’autres battent de la grosse caisse. Évidemment la bonne dame confondait tapage avec mélodie et croyait ingénument qu’en tapant comme une sourde, elle prouvait qu’elle avait de l’oreille.
Parker, enthousiasmé de ces accents brutaux qui rappelaient les mugissements de la tempête dans la plaine, applaudissait avec fracas, et bon gré, mal gré, Lavarède exaspéré dut faire chorus. Mistress Parker, ainsi encouragée, redoubla de cris et d’accords tumultueux, Une fois de plus, l’ancien caissier maudit sa politesse française qui prolongeait son supplice.
Enfin, enrouée, la sueur ruisselant sur son large visage écarlate, la virtuose s’arrêta ; l’ouragan de sonorités fit trêve. Trop tard hélas ! Robert avait une migraine caractérisée, et il courut s’enfermer dans son pavillon, où il maudit à l’aise les cruels inventeurs des gammes chromatiques ou autres.
Il avait de l’Australie par-dessus la tête et en arrivait inconsciemment à regretter l’Égypte, l’Abyssinie, voire même la fastidieuse traversée de Massaouah à la Nouvelle-Hollande.
Le lendemain devait lui apporter une curieuse distraction.
La pluie s’était remise à tomber, et le déjeuner achevé, le jeune homme voyait avec épouvante mistress Parker rôder autour du piano, comme pour renouveler la séance de la veille, quand une douzaine d’Australiens « peints en fête », c’est-à-dire zébrés de lignes d’ocre rouge, entrèrent dans la cour de la ferme.
Il y eut un moment d’émoi. Parker, ses fils, ses serviteurs avaient sauté sur leurs armes, mais la venue des indigènes s’expliqua bientôt de la façon la plus pacifique. C’étaient les proches parents de la belle Mareahu, qui l’amenaient cérémonieusement à son fiancé Rocawene.
Cette beauté, tant vantée par l’Australien, était un véritable monstre. Le front fuyant auréolé d’une crinière rude ; les yeux stupides, à fleur de tête, la bouche énorme, les bras et les jambes grêles, les tibias terminés par des pieds larges, disproportionnés, elle ne rappelait que vaguement la forme gracieuse de Diane, ou de Vénus.
Mais, comme le fit remarquer judicieusement Astéras, la beauté est une pure convention de race. Si les Chinois, les Indiens Peaux-Rouges, les Africains avaient la même esthétique que nous, ils seraient les plus malheureux des hommes. En réalité nous décorons du nom de beauté les images qui se présentent le plus fréquemment à notre vue, auxquelles nous sommes accoutumés, et qui, dès lors, ne nous choquent plus. Dans nos pays mêmes n’en avons nous pas des exemples tous les jours. Les contemporains de la crinoline ne la trouvaient pas disgracieuse, et si nous déclarons jolis les petits pieds, nous ne devons pas oublier que les Français du moyen âge les considéraient comme une difformité. Berthe aux longs pieds qui, dans notre cordonnerie moderne, aurait chaussé du cinquante-trois, passait alors pour posséder le pied type, le pied idéal.
– Donc, conclut philosophiquement l’astronome, admettons que Mareahu est belle pour un Australien, et que si elle ne nous apparaît point telle, c’est uniquement parce que notre éducation incomplète ne nous permet pas d’apprécier.
Comme toujours, le naïf calculateur débitait cela d’un air convaincu, ne comprenant pas que Lavarède ne se rendît pas à ses raisons, un peu agacé même de voir qu’il continuait à sourire ironiquement.
Mais Parker, au courant des usages du pays, faisait apporter du vin, et le verre en main, engloutissant gloutonnement le liquide auquel nous devons les ivrognes, ils signaient à leur manière le contrat des mariés.
Après quoi, tous touchèrent la main de Rocawene. Avec un sourire niais, Mareahu lui offrit une tige fleurie de Rhizocarpi des marais, sorte de haricot qui croît dans les bas fonds humides, et dont les fleurs, rouges et blanches, exhalent un vague parfum d’iris.
Il la prit et l’enroula autour de son cou.
Alors les assistants se levèrent en tumulte, ils se précipitèrent dans la cour, se divisèrent en deux camps et faisant voler dans l’air, avec une merveilleuse adresse, leurs terribles boomerangs, ils simulèrent un combat acharné.
Après quelques minutes de cette étrange fantasia, Mareahu tendit la main à Rocawene, et tous deux sortirent à leur tour, marchant lentement entre les combattants. Le simulacre de bataille cessa aussitôt ; les deux camps se rapprochèrent et commencèrent, autour des nouveaux époux, une ronde infernale, accompagnée de sourds murmures et de cris aigus.
Puis sur un signe de l’héroïne de la fête, tous rentrèrent à la ferme, burent une dernière rasade et prirent congé du surveyor.
Mais avant de suivre sa nouvelle famille, Rocawene tendit les deux mains à Parker.
– Surveyor, lui dit-il lentement, Rocawene n’oubliera jamais qu’il te doit le bonheur. Accepte cet os de kangourou, où sont gravés les signes de ma tribu et de mes ancêtres. Si tu dois jamais traverser le désert, te rendre au-delà dans la région des grands bois, où les Chaap-Whuurongs sont les maîtres, cet os te rendra sacré, et parmi mes frères tu n’auras que des amis.
Sur ce discours, il salua gravement à la ronde et s’éloigna d’un pas pressé pour rejoindre ses compatriotes.
Curieusement Robert s’approcha du squatter et considéra le singulier sauf-conduit que venait de lui remettre l’Australien.
Sur l’os, de bas en haut, s’alignaient les caractères inconnus que voici :

Il le tourna et le retourna sans parvenir à deviner le sens de ces caractères. Et comme il restait là, un bruit léger lui fit lever les yeux. C’était Lotia qui, pensive, s’appuyait à la fenêtre et regardait tristement, au loin déjà, le groupe des indigènes regagnant les pirogues qui les avaient amenés au mont Youle.
– Elle pense que ceux-là ont de l’affection l’un pour l’autre, murmura mélancoliquement le jeune homme. Et d’un geste las, montrant à Astéras debout auprès de lui, l’Égyptienne et la troupe des indigènes : s’il suffisait de couper une de ses boucles brunes pour faire cesser l’affreux malentendu qui nous sépare, comme je sauterais sur les ciseaux !
– Bah ! répliqua l’astronome, à quoi bon cela ? N’avons-nous pas Maïva, qui parlera bientôt et nous aidera à faire triompher la vérité.
Robert l’interrompit d’un signe brusque. À deux pas du calculateur, Radjpoor était assis. Mais l’Hindou ne fit pas un mouvement. Sans doute, il n’avait pas entendu, et les deux amis se retirèrent à l’écart pour continuer leur conversation. Un instant plus tard, sous couleur de mettre leurs notes en ordre, ils quittèrent la salle et regagnèrent leur pavillon.
Alors un ricanement distendit les lèvres de Radjpoor, qui se leva lentement, rejoignit Parker debout sur le seuil et regardant la pluie frapper le sol.
– Sir Parker, lui dit-il, je crois l’heure arrivée de vous expliquer ma présence en ce lieu.
– Votre présence, fit le squatter avec étonnement ? Mais elle n’a pas besoin d’explications. Vous êtes de la suite de Monseigneur Thanis, cela suffit.
– Non, cela ne suffit pas. Veuillez m’accompagner dans une salle où nul ne pourra entendre mes paroles, nous avons à causer sérieusement.
Tout à l’heure Parker considérait Radjpoor comme l’un des prisonniers dont il avait la garde. Maintenant, à son accent de commandement, il pressentait vaguement un maître. Aussi n’essaya-t-il même pas de résister :
– S’il vous plaît de me suivre, sir Radjpoor, je vous montre le chemin ?
– Je vous en prie.
Tous deux quittèrent la salle commune et se trouvèrent bientôt seuls dans une pièce que le surveyor décorait du nom de bureau.
La porte refermée avec soin, le gros homme s’assit en face de Radjpoor et attendit.
– Sir Parker, reprit ce dernier, le gouvernement anglais m’a spécialement attaché à Son Altesse Thanis, bien entendu sans que ce seigneur le sache, pour le surveiller et agir, selon les circonstances, au mieux des intérêts britanniques.
Le squatter eut une inclination respectueuse ; Radjpoor continua :
– Vous comprendrez l’importance de ma mission, en prenant connaissance du plein pouvoir qui m’a été remis à cet effet.
Il mettait en même temps sous les yeux de son interlocuteur une feuille de papier couverte de timbres, de cachets et de signatures. L’Australien fit mine de la repousser, mais le faux Hindou insista :
– Lisez, je vous en prie, lisez.
Et avec une stupeur pleine de déférence, le surveyor déchiffra les lignes suivantes :
« Ordre à tout fonctionnaire militaire ou civil de prêter le concours le plus dévoué à Sir Radjpoor, Esqre, auquel nous conférons le titre de commissaire spécial de la couronne et de représentant de H. M. Victoria, reine de Grande Bretagne, Impératrice des Indes… »
Tout d’une pièce Parker se dressa. Sa figure rougeaude exprimait une déférence presque craintive, et il balbutia :
– Ah ! Seigneur, si j’avais su ?…
– Vous ne pouviez deviner, répondit Radjpoor avec condescendance. Ne vous excusez donc pas. Et maintenant, reprenez place en face de moi, et écoutez d’une oreille attentive les ordres verbaux que les circonstances m’incitent à vous donner.
– Soyez assuré que je ne perdrai pas une de vos paroles. Mon dévouement à la Reine est absolu.
– J’en suis certain. Et d’abord une recommandation : Personne, pas même votre gracieuse compagne ne doit soupçonner ma mission.
– Que demandez-vous là ? Je tremblerai sans cesse qu’elle ne vous témoigne pas les égards auxquels vous ayez droit.
– Il faut que tous et vous-même me traitiez comme par le passé.
– Le pourrai-je, Sir ?
– Je le veux ainsi.
– Alors, acquiesça Parker avec un geste désespéré, j’obéirai, puisque vous l’ordonnez.
Radjpoor approuva de la tête.
– Parfait ! Autre chose maintenant. Dans la suite de Son Altesse Thanis, se trouve une jeune fille ; Maïva est son nom.
– Je sais, je sais, affirma Parker empressé.
– Cette jeune fille a surpris mon secret. Elle est muette par bonheur, mais l’ami de Thanis, Ulysse Astéras, s’est mis en tête de lui rendre la parole. Si elle parle, elle me trahira. Il est donc nécessaire qu’elle soit séparée de son maître.
– Diable, ce ne sera pas aisé. L’inondation annuelle transforme ma propriété en une île…
– Très simple au contraire. Votre domaine est vaste. Reléguez Maïva au loin ; vous l’emploierez à quelque travail peu rude, mais suffisant pour justifier son éloignement.
– Son Altesse ne manquera pas de me questionner sur les causes de ma soudaine détermination.
– Vous lui répondrez, cher monsieur Parker, que vous obéissez aux instructions qui vous ont été données, lorsque vous fûtes chargé d’héberger le seigneur Thanis et sa suite.
– Si pourtant il désire en savoir davantage ?
– Vous affirmerez que vous ignorez les motifs qui ont inspiré vos chefs hiérarchiques. Vous pouvez même manifester votre surprise des mesures exceptionnelles appliquées à une fillette inoffensive.
– Oh ! comme cela…, je ne crains pas de trop parler. Et quand vous plaît-il que Miss Maïva quitte la ferme ?
– Aujourd’hui même.
– Dans une heure, elle sera en route pour les fromageries que j’ai installées sur l’autre versant du Mont Youle.
– J’y compte et je vous remercie de votre empressement.
Puis tendant la main à son interlocuteur, qui y plaça timidement la sienne.
– Soyez assuré, Sir Parker, que la Reine sera informée de votre libéralisme.
À ces mots, le squatter devint cramoisi de joie. Il toussa, et d’une voix tremblante bredouilla :
– Vous aurez cette bonté… La Reine saura… ?
– Je m’y engage.
– Vive la Reine, clama le gros homme enthousiasmé.
Mais il s’arrêta sur un geste expressif de l’Hindou.
– Pas de bruit. C’est un secret d’État que je vous ai confié. Gardez-vous de le divulguer.
Ceci dit, Radjpoor se leva. Parker s’empressa de l’imiter, et une heure ne s’était pas écoulée, qu’un chariot, attelé de deux bœufs puissants, aux longues cornes recourbées, sortait de la cour de la ferme, emportant Maïva.
La fillette avait bien tenté de résister, mais des serviteurs du squatter avaient eu tôt fait de paralyser sa résistance. On l’avait enroulée dans un puncho, portée dans le chariot, où un noir robuste avait pris place, afin de prévenir toute évasion.
Enfermés dans leur pavillon, Robert et Astéras n’avaient rien vu, rien entendu. Ce fut seulement à l’heure du dîner qu’ils remarquèrent l’absence de l’Égyptienne. Poussé par son ami, très inquiet de cette disparition, Lavarède interrogea le squatter :
– Votre Altesse désire savoir où est cette jeune personne, fit ce dernier d’un air détaché ?
Et sur la réponse affirmative de l’ancien caissier :
– Je l’ai envoyée à quelques milles d’ici.
– Mais pourquoi ?
– Pour me conformer aux ordres du gouvernement.
– Comment, on vous a prescrit… ?
– Oui, Altesse.
– Dans quel but ? Cette enfant ne pouvait porter ombrage à personne.
– C’est mon avis, Monseigneur. Cependant, il ne m’appartient pas de discuter les décisions arrêtées en haut lieu. Je devais observer les prescriptions de mes chefs. Je l’ai fait. Ne m’en demandez pas davantage, car je ne suis pas plus renseigné que vous-même.
Quoi qu’il fît, Lavarède n’en put tirer autre chose.
Il eut l’intuition fugitive que l’enlèvement de la muette était encore une idée de Radjpoor. Avec colère, il regarda l’Hindou. Celui-ci ne parut pas s’en apercevoir. Il parlait avec animation à Lotia. Cet artisan en perfidies expliquait à la fille de Yacoub – à sa façon, bien entendu – l’incident qui irritait Lavarède et désolait Astéras :
– Vous vous souvenez, ô reine, disait-il, que lorsque nous remontions le Nil pour gagner Axoum, je vous avertis que Maïva était dévouée à Thanis et à son ami.
– Sans doute ; c’est à ce moment que je lui interdis de les entretenir, sous peine d’être débarquée et abandonnée sur la rive.
– Précisément ! Eh bien, j’ai découvert qu’elle préparait la fuite de votre époux et de son fidèle Ulysse.
– La fuite, murmura-t-elle avec horreur.
– Ne le regardez pas, je vous en conjure. Il est inutile qu’il se sache percé à jour.
Elle leva les yeux et d’une voix anxieuse :
– Mais enfin, quel était son but ?
– Retourner en Europe probablement.
– Pour y traîner une existence misérable, au lieu d’accepter la gloire que mon père lui offrait.
– Pas si misérable que cela, insinua l’Hindou, insensible au reproche qui s’adressait indirectement à lui-même.
– Que voulez-vous dire ?
– Qu’il a en sa possession le diamant d’Osiris, et qu’une pièce de cette beauté trouvera toujours un acquéreur.
Avec un cynisme révoltant, il prêtait ses projets au Français.
Une rougeur ardente colora les joues de Lotia ; un éclair fauve illumina ses yeux noirs.
– Oh ! le misérable, gronda-t-elle. À des mercantis, il vendrait le talisman sacré, l’emblème de la liberté, pour lequel un peuple tout entier se sacrifierait. Ah ! comme ma nourrice avait raison. Fourbe comme Thanis, disait-elle. On pourrait ajouter : cupide, et lâche, et infâme et traître. Pourquoi nos Oëris ne sont-ils pas ici, afin de le punir.
Puis avec l’accent d’une ardente prière :
– Mais vous êtes auprès de moi, vous, Seigneur Radjpoor, qui librement avez consenti à partager nos périls, vous qui êtes victime de votre dévouement à la cause d’un peuple opprimé. Je remets mon honneur entre vos mains. Je suis une femme faible, ballottée par la tourmente d’une révolution, et le hasard m’a faite l’épouse de ce traître. Oh ! je vous en conjure, épargnez-moi la suprême honte. Surveillez-le, et si l’opprobre de la désertion ne l’arrête pas, frappez-le sans pitié. Que l’infamie de Thanis ne rejaillisse pas sur Hador ! Que mon père, ce vieillard vénérable, ne voie pas sa vieillesse finir dans la fange. Que la patrie égyptienne puisse encore espérer, le jour où dans le costume des veuves, j’irai lui crier : Thanis trahissait, Thanis est mort, mais la bannière d’Hador est sans tache. Suivez-la, guerriers. C’est la main d’une femme qui la porte, ne craignez rien cependant, c’est au fort de la mêlée que vous la trouverez toujours.
Elle s’animait en parlant ainsi. Curieusement Lavarède fit quelques pas vers elle.
Radjpoor veillait. Rapidement il glissa à l’oreille de la vaillante jeune femme, trompée comme tout le monde par son infernale habileté :
– Thanis vient. Dissimulons et comptez sur votre serviteur.
Puis rappelant le sourire sur ses lèvres, donnant à sa voix l’accent indifférent des conversations banales :
– Fâcheuse cette pluie, certes ; car elle nous oblige à garder la maison. Un peu de patience cependant, car à ce que m’a affirmé notre hôte, la saison pluvieuse est relativement courte dans ces régions. Jamais elle ne dure plus de deux mois, et souvent elle finit bien avant cette période.
Il eut l’air de s’apercevoir alors de la présence de Robert et avec un sourire narquois :
– Ma foi, Monseigneur, nous parlions de vous.
– Ah ! grommela le jeune homme, démonté par l’aplomb de son adversaire.
– Oui, nous disions que par ce temps d’averses incessantes, la prison devait vous paraître pénible à supporter.
Et pirouettant sur ses talons avec une affectation d’insouciance, le rusé personnage s’adressant à Mistress Parker :
– Serais-je indiscret, Mistress, en vous priant humblement de mettre en fuite nos idées noires ? La musique, le piano, une virtuose incomparable…
L’énorme moitié du squatter minauda, mais ne se fit pas prier. Un instant après, elle chantait en ouragan, et les vitres tremblaient sous une tempête de mélodie.
CHAPITRE XIX
LE PLAN DE RADJPOOR
Dire ce que furent les semaines suivantes est impossible. La pluie fouettait la terre sans trêve, sans relâche. Des nuages lourds, bas, sombres, interceptaient la lumière du jour. Les habitants de la ferme s’agitaient tristement dans une clarté grise, douteuse, frissonnant aux hurlements sinistres des rafales, auxquels, pour comble de malheur, répondaient les accords tonitruants de Mistress Parker.
Le piano, instrument de musique et de supplice, était la grande distraction de l’hivernage, et encouragée par les applaudissements hypocrites de Radjpoor, la maîtresse du logis s’en donnait à cœur joie. À tout instant, elle se précipitait au clavier, tapant à tour de bras, sous le prétexte ingénu de mettre de l’expression, de rendre la pensée des compositeurs.
Le plus « rendu » était certainement Lavarède. Il se répandait en lamentations tragiques et secrètes, donnant au diable les facteurs de pianos, comparant l’horrible boîte à musique aux plus odieux instruments de torture des temps passés.
Cacus, le Sphinx, le lion de Némée, Méduse, le Minotaure, les Cyclopes, les ogres, les goules, guivres ou lymnies, lui semblaient moins cruels que ce clavier, aux touches blanches et noires, toujours prêtes au vacarme sous les mains grasses et rouges de Mistress Parker.
Il se vengeait comme il pouvait, confiant à Astéras sa haine pour ce piano de l’inquisition, cette musique de Torquemada, cette terreur harmonique. Du do au si toutes les notes devenaient des tortionnaires ; les dièzes le crucifiaient ; dans les bémols, il reconnaissait les fauves, que les belluaires des cirques romains lâchaient dans l’arène. Seuls, les silences trouvaient grâce à ses yeux. Il aurait tressé des couronnes au compositeur génial, qui aurait écrit un morceau uniquement avec des pauses et des soupirs ; des soupirs surtout, car il ressentait pour ce signe, emblème de ses chagrins, une estime particulière.
Mais tout a une fin ici-bas. La saison s’avança ; la pluie devint moins fréquente, et les promenades étant possibles, le piano s’ouvrit moins souvent.
Enfin le soleil brilla dans un ciel sans nuages, ruisselant en cascade d’or sur les hauteurs verdoyantes, sur les vallées transformées en lacs.
De jour en jour, les eaux baissèrent ; les bas-fonds apparurent, et du sol saturé d’eau s’élancèrent des herbes qui croissaient à vue d’œil. Les arbres se couvraient de pousses d’un vert tendre. C’était un printemps rapide, hâtif, illuminé, qui succédait à la saison des nuées.
Chaque matin, Lavarède, Astéras partaient à cheval avec le squatter. Ils parcouraient les pâturages, les ateliers de tonte, les fromageries, éprouvant la joie intense de collégiens en vacances, aspirant à pleins poumons l’air tiède dont le plateau était sans cesse éventé.
Désireux de leur être agréable, le surveyor leur fit faire des excursions qui les retinrent plusieurs jours hors de la ferme. On s’aventurait à la poursuite des casoars et des kangourous, dans le désert de Victoria, alors paré d’un tapis vert, qui, deux mois plus tard, serait grillé par la sécheresse et ne présenterait plus qu’une immensité fauve, desséchée, où la soif implacable, mortelle, guette le voyageur égaré dans ces solitudes.
Mais à cette époque, les bas-fonds conservaient encore l’eau. Des étangs nombreux brillaient à la surface du sol, et les Français se disaient, avec d’étranges palpitations de cœur, qu’ils pourraient, si une occasion favorable se présentait, s’enfuir à travers le désert, gagner les territoires habités et fertiles du nord de l’Australie et reprendre sur un navire le chemin de l’Europe.
Chacun était retenu par une affection. Robert souffrait à la pensée de quitter Lotia.
Quant à l’astronome, il n’eût consenti pour rien au monde à partir sans Maïva.
Au cours de ses promenades, il avait découvert sa retraite sur le versant Est du plateau ; il avait dû se contenter de voir la jeune fille à distance. Les vaqueros, stylés par leur maître, ne lui avaient pas permis d’approcher.
Radjpoor surprit-il les pensées des Français, ou bien jugea-t-il le moment propice pour mettre à exécution ses projets de trahison et de fortune ? Il serait téméraire de se prononcer. Toujours est-il qu’un soir, après une journée de chasse, il appela du geste Niari auprès de lui. L’Égyptien accourut aussitôt :
– Vous avez besoin de moi, Sahib ?
– Oui.
– Parlez.
– Ainsi vais-je faire. Écoute. La vie dans cette contrée me pèse. J’ai soif de Paris, de ses fêtes, de son mouvement. Je suis las de voir cet inepte Lavarède promener triomphalement le diamant merveilleux, pour la possession duquel je ne suis mêlé des affaires égyptiennes. Il est temps que ce jeu prenne fin.
– Le bras de Niari, Maître, vous appartient comme sa pensée. Est-ce votre désir que je frappe celui qui a usurpé le nom de Thanis ?
Lentement le faux Hindou secoua la tête :
– Non, mon bon Niari, ce serait maladroit.
– Maladroit ? Je ne vous comprends pas, Monseigneur.
– Aussi vais-je m’expliquer.
Il prit un temps, puis d’une voix aussi tranquille que s’il n’eût point parlé de la mort d’un homme, il continua :
– Pour que j’aie tenu ma promesse vis-à-vis de l’Angleterre ; pour que la révolte des fellahs soit étouffée à jamais, il faut que Thanis cesse de vivre.
Et avec un sourire ironique :
– Quand je dis Thanis, tu conçois bien que j’entends celui qui, pour tout le monde sauf pour nous, est détenteur de ce nom dangereux. Thanis défunt, je ne m’en porterai pas plus mal.
– Seigneur ! Seigneur ! balbutia Niari, gêné par la façon irrévérencieuse dont son interlocuteur traitait la question égyptienne.
L’Hindou lui prit la main :
– Ne t’offusque pas de mes paroles, mon brave Niari. Tu crois à toutes les billevesées du patriotisme, je n’y crois pas ; voilà pourquoi je n’exprime pas les folies généreuses qui hantent ton cerveau. Mais je reprends. Thanis trépassé, son décès officiellement constaté, j’hérite du diamant d’Osiris et la révolte n’a plus de chef ! L’Angleterre est tranquille en Égypte et moi en France. Seulement, il faut qu’il disparaisse, sans que l’on puisse accuser le gouvernement de la Grande-Bretagne d’avoir médité sa mort. Il convient que ce soit un accident, mieux encore, une provocation de sa part qui amène un dénouement fatal.
Radjpoor s’arrêta une minute, un rire mauvais contractait sa physionomie.
Il poursuivit :
– J’ai bien réfléchi à cela, et ton concours m’est nécessaire.
– Comme toujours je ferai ce qui vous conviendra, Maître.
– Je l’espère bien.
Et après avoir jeté autour de lui un regard perçant, afin de s’assurer qu’aucune oreille indiscrète n’était à proximité :
– Captif dans cette ferme, gardé par un squatter dont la conversation, en dehors de l’élevage des bestiaux, est parfaitement insipide, Thanis doit s’ennuyer.
L’Égyptien opina du bonnet.
– Tu conçois cela. Donc il s’ennuie. Dès lors il doit penser qu’il vaudrait mieux pour lui être ailleurs.
Et sur un nouveau signe affirmatif de son auditeur.
– Il a par conséquent l’intention de fuir.
– Oui, Sahib, dit enfin Niari.
– Or, tu as surpris ses projets. Tu as entendu un entretien qu’il avait à ce sujet avec son ami.
– Moi ?
– Toi-même. Voici ce que tu as appris, et ce que tu raconteras, sur ma prière, à Sir James Parker, propriétaire du Mont Youle. Son Altesse Thanis a remarqué que les écuries ne sont pas gardées la nuit. Il serait possible de prendre des chevaux, de gagner le désert au galop. Au jour, quand on s’apercevrait de la fuite des prisonniers, ils auraient une avance telle qu’il resterait bien peu de chances de les rejoindre.
– Mais c’est exact cela, s’écria Niari.
– Parbleu ! Sans cela, ta dénonciation n’aurait aucune valeur.
Eh comme son serviteur baissait le front sous son regard moqueur.
– Seulement, il y a un seulement, l’ami de Thanis ne veut pas abandonner Maïva, et Lavarède Thanis priera Sir Parker de la faire rentrer à la ferme.
L’Égyptien considéra Radjpoor avec une surprise non dissimulée.
– Il ne tentera pas cette démarche ?
– Tu te trompes, il la tentera ; car cela est nécessaire pour démontrer au surveyor la certitude de tes renseignements.
– Mais comment en viendra-t-il là ?
– Ceci me regarde, Niari.
Le fidèle serviteur des Thanis s’inclina avec soumission :
– Je n’interroge plus, Maître. Tes commandements seront ponctuellement exécutés.
– C’est bien.
– Quand devrai-je parler ?
– Demain. Je serai là d’ailleurs, et je te ferai signe.
– Rien d’autre à faire ?
– Non. Je me charge du reste.
De la main, l’Hindou congédia son compagnon. Il le regarda s’éloigner avec un sourire indéfinissable :
– Brave homme, ce Niari, murmura-t-il. Il va m’assurer le diamant d’Osiris, la forte pension anglaise, la tendresse de Lotia, et l’existence fastueuse et tranquille, exempte désormais de tout Thanis.
Il s’allongea sur l’herbe et ricana :
– Thanis est décédé, hip, hip, hurrah pour Radjpoor. Amusons-nous for ever.
Le lendemain matin, comme Lavarède montait à cheval pour faire sa promenade quotidienne, il vit accourir vers lui un cavalier. Ce dernier arrêta sa monture à deux pas de celle du Français. C’était Radjpoor.
D’un geste courtois, il salua Robert et doucement :
– Vous alliez partir, questionna-t-il ?
– Vous le voyez, seigneur Radjpoor.
– Permettez-moi de vous accompagner.
– Vous ?
Le jeune homme se mordit les lèvres. Il avait été sur le point de refuser, mais quel prétexte invoquer, quelle raison donner à son refus ?
Du reste, sans paraître soupçonner son hésitation, l’Hindou fit tourner son cheval, se plaça botte à botte avec l’ancien caissier, et se penchant légèrement vers lui.
– J’ai à vous entretenir de choses intéressantes. Voici là-bas, Sir Parker qui vient vous prendre ; mais il aura sans doute en chemin à parler à des vachers, des bergers, des employés quelconques, et je pourrai, sans éveiller son attention, vous mettre au courant.
Le ton dont ces paroles furent prononcées donna à réfléchir au Français, et il poussa son cheval dans les pas de celui du squatter, en se demandant avec une vive curiosité quel mystère nouveau cachait la démarche de l’Hindou.
Celui-ci d’ailleurs ne semblait plus s’occuper de lui. Il bavardait amicalement avec Parker, supputant les sommes dépensées sur la propriété, son rapport, le nombre de têtes de bétail, etc. ; toutes choses que le squatter, dans son inconscient égoïsme, trouvait les plus intéressantes de la terre. N’est-ce point humain et peut-on causer un plaisir plus grand à un millionnaire qu’en lui parlant de sa fortune, à un négociant qu’en vantant sa boutique.
Cependant, passant du pas au trot et du trot au galop, la caravane avançait toujours ; à plusieurs reprises, le surveyor avait interpellé des gardiens, leur avait distribué des conseils, des éloges ou des réprimandes, mais sans s’écarter de ses compagnons. Lavarède s’impatientait. Peu à peu, sur la confidence de Radjpoor, son imagination se donnait carrière, et il arrivait à désirer violemment savoir ce que ce personnage bizarre avait à lui proposer.
Enfin l’occasion attendue se présenta.
Dans un pâturage, un vaquero, fatigué sans cloute, s’était endormi sur son chevaI. Les bœufs confiés à sa surveillance en avaient profité pour descendre dans un vallon marécageux, où ils s’ébrouaient, dans l’eau jusqu’à mi-jambes. À cette vue, Parker poussa un cri de colère. Le séjour dans les endroits humides prédispose les bestiaux à une maladie de la corne pédestre, dont on les guérit rarement. C’est alors une perte sèche pour le propriétaire, qui est obligé de les faire abattre.
Enfonçant ses éperons dans le ventre de sa monture, le gros homme partit à fond de train vers le gardien négligent. Il le rejoignit, l’apostropha vivement, et l’aida à faire sortir les animaux du marais.
Pendant ce temps, Radjpoor se plaçait auprès de l’ancien caissier, et de sa voix tranquille, disait, tout en désignant l’Australien :
– Le moment souhaité.
Robert tressaillit. Il regarda l’Hindou dans les yeux :
– En effet, seigneur Radjpoor. Profitez-en donc pour me révéler ce que vous tenez tant à m’apprendre.
– Oh ! j’y tiens dans votre intérêt, plaisanta le fourbe.
– Dans mon intérêt ?
– Absolument.
– Ma foi, si vous me démontrez cela…
Radjpoor ne lui permit pas d’achever la phrase :
– Mon cher Monsieur, fit-il plus sérieusement ; je tiens toujours ce que je promets. Ce n’est pas ma faute si les circonstances m’entraînent parfois en dehors de la ligne la plus directe. Vous êtes intelligent, curieux. Aussi n’êtes-vous pas sans vous être aperçu que tous, tant que nous sommes, nous nous débattons au milieu d’une intrigue embrouillée, Vous y discernez peu de chose, je semble beaucoup mieux renseigné. Au fond, je suis, ainsi que vous-même, le jouet d’événements dont le but final m’échappe, et tout aussi ardemment que vous, je souhaite retourner à Paris et envoyer un éternel adieu à ces pays exotiques où, d’honneur, je ne m’amuse pas.
Cela était débité avec une telle rondeur, un tel accent de sincérité que Lavarède fut dupe de l’Hindou.
– Mais encore, ce n’est point pour me faire cet aveu que vous vous êtes imposé cette longue et fatigante promenade ?
– Évidemment non.
– Alors, veuillez continuer, car Sir Parker ne nous laissera pas longtemps en repos.
Radjpoor jeta un coup d’œil dans la direction du squatter. Il l’aperçut galopant à la poursuite du troupeau qu’il chassait vers le plateau avec de grands cris.
– Il en a pour un bon quart d’heure encore, mais ainsi que vous le faisiez si justement observer, ce n’est pas une raison pour m’attarder à des circonlocutions inutiles.
Et levant son doigt d’un air grave, comme pour assurer plus de poids à ses paroles :
– Je vous ai promis, si docilement vous vous laissiez conduire, la fortune et le bonheur. La fortune, vous l’avez en poche, sous la forme d’un diamant évalué à plusieurs millions ; j’ai donc tenu la moitié de mon engagement. Est-ce vrai ?
– Oui, répliqua Robert, mais vous l’auriez tenu tout à fait si à Massaouah…
– Je ne vous avais pas fait arrêter par le consul d’Angleterre… c’est bien cela que vous voulez dire ?
– Je n’ai aucun motif de le dissimuler.
L’Hindou leva les bras au ciel et d’un ton pathétique :
– Vous ne vous doutez pas, cher Monsieur, qu’en cet instant vous êtes prodigieusement injuste. Il m’est défendu de vous apprendre certains secrets de haute politique, mais je puis vous affirmer de la façon la plus formelle : primo, que si vous n’aviez pas appelé les Italiens à Axoum, vous seriez aujourd’hui bien tranquille en France ; secondo, que sans votre mise en arrestation à Massaouah, vous étiez un homme mort.
Et comme la figure de Lavarède prenait l’expression de l’ahurissement, il poursuivit d’un air bon enfant :
– Je ne vous demande pas de reconnaissance, et je vous pardonne de nous avoir contraints à passer une ennuyeuse saison au Mont Youle. Depuis que nous sommes ici, je cherche à faire honneur à ma parole, à vous assurer, après la fortune, le bonheur, et pour atteindre le bonheur, à vous aplanir la route de la liberté.
– De la liberté, répéta le Français étourdi par un brusque espoir. Vous voulez me tirer d’ici ?
– Pas autre chose.
D’un mouvement involontaire, Robert et Astéras se rapprochèrent. L’Hindou se mit à rire :
– Ah ! ah ! cela commence à vous intéresser, j’en étais sûr ; écoutez-moi donc ; car aussi bien, fit-il en désignant du regard Parker qui avait réussi à l’assembler son troupeau, notre hôte ne tardera pas à revenir se mettre entre nous.
– Parlez, parlez, dirent impétueusement les deux Français.
– Le désert de Victoria, actuellement bien arrosé, couvert de végétation, peuplé de gibier, offre un chemin facile à des fugitifs.
– Je l’avais pensé, appuya Lavarède, mais à pied…
– Rien de plus simple que d’avoir des chevaux.
– Vous croyez ?
– J’en suis sûr et je le prouve.
– Je vous en prie.
D’un coup d’œil rapide, Radjpoor s’assura que Sir Parker, tout occupé à morigéner son vacher, ne l’observait point, et d’un ton insidieux :
– J’ai remarqué que, durant la nuit, les écuries de la ferme ne sont pas gardées.
– Pas gardées ? redirent ses auditeurs avec un tressaillement.
– Non. Par conséquent, un soir, on se retire de bonne heure sous couleur de fatigue. À minuit on gagne avec précaution l’écurie ; on selle silencieusement des chevaux, on part, au pas d’abord pour ne point faire de bruit, puis au galop quand on est assez loin des habitations. Lorsque l’on s’aperçoit que les oiseaux sont dénichés, on a sept ou huit heures d’avance, et comme on a eu le soin de choisir les bêtes les plus vigoureuses, on défie toute poursuite. En un mois, on arrive dans la zone fertile du Nord-Australien, on atteint la côte, on s’embarque sur le premier navire en partance et la farce est jouée, Cela vous convient-il ?
Robert et Ulysse ouvrirent la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit de leurs lèvres. Une même pensée étranglait la parole dans leur gosier. Certes oui, ils avaient envie de fuir, d’échapper à un geôlier qui, tout aimable qu’il s’efforçât de se montrer, ne réussissait point à leur faire oublier que son hospitalité était une captivité déguisée ; mais il y avait Lotia, il y avait Maïva !
Sevrés d’affection, le caissier et l’astronome s’étaient laissé prendre à la grâce des jeunes filles, et maintenant, alors que les portes de leur prison s’entrebâillaient, ils ne se sentaient plus le courage de fuir. À quoi bon s’évader si leur âme, leur pensée, devaient rester captives auprès de ces fleurs de beauté écloses au bord du puissant Nil bleu.
Un ricanement fugitif passa sur les traits de Radjpoor pour s’éteindre aussitôt, et ce fut d’un ton exempt de persiflage que le faux Hindou murmura :
– Je vois ce qui vous arrête. Lotia vous suivra. J’ajouterai même que, à notre arrivée en Europe, toute la vérité lui sera révélée, et que les motifs de haine qu’elle pense avoir contre vous, s’évanouiront comme des fumées légères dans un rayon de soleil.
– C’est vrai cela, balbutia Lavarède dont le cœur se prit à sauter éperdûment ?
– Rigoureusement vrai.
– Alors partons quand vous voudrez… ou plutôt non, rectifia-t-il en apercevant le visage désolé d’Astéras… il faut aussi qu’Astéras soit heureux.
– C’est de Maïva qu’il s’agit, sans doute, dit froidement l’Hindou ?
– Eh bien oui, là, c’est d’elle.
– Qu’à cela ne tienne. Je donnerai volontiers cette esclave à monsieur Astéras.
– Mais elle est éloignée de la ferme.
– Faites-la revenir.
Lavarède sursauta :
– Moi… que je… ?
– Vous-même. Je pense d’ailleurs que vous n’aurez qu’à demander la chose à Sir Parker. Le digne homme est très satisfait de vous. À son insu, j’ai pris connaissance d’un rapport qu’il adressait, ces jours derniers, au gouvernement de l’État. Il ne tarissait pas en éloges sur vous, sur la philosophie sereine avec laquelle vous acceptiez l’existence monotone de la ferme. Il sera très heureux de vous être agréable, de vous remercier ainsi de ne pas lui avoir suscité d’ennuis.
– En êtes-vous bien persuadé, insista Ulysse d’une voix anxieuse ?
– Croyez que sans cela, je ne parlerais pas comme je le fais. Au surplus, vous ne risquez pas grand’chose à tenter la démarche. Elle réussit, nous fixons le moment de notre évasion. Elle ne réussit pas, alors nous attendons et nous combinons un autre plan. Est-ce dit ?
– Oui.
– Vous adresserez votre requête à Sir Parker ?
– Ce soir même.
– À la bonne heure !
Et tendant les mains aux deux Français :
– Oubliez, je vous prie, que parfois j’ai dû adopter une attitude étrange pour vous. Sous peu, vous serez libres, heureux et riches. Et cependant, c’est encore moi qui vous serai redevable, car votre confiance m’a permis de mener à bien la tâche la plus ardue qui ait jamais été imposée à un homme.
Ils allaient interroger ; Radjpoor les arrêta du geste :
– Sir Parker revient vers nous. Vous saurez tout plus tard. Qu’il ne soupçonne rien de notre entente.
En effet, le squatter arrivait au grand trot.
– Je vous prie de m’excuser, s’écria-t-il à vingt pas, mais un troupeau dans un marais est une méchante affaire, et j’ai couru au plus pressé.
– Vous êtes excusé, Sir James, répliqua gaiement Robert ; nos préoccupations étaient les mêmes. Tandis que vous pourchassiez les bêtes à cornes, nous causions chevaux.
– Les chevaux ont toujours intéressé les rois, remarqua gracieusement le surveyor en s’inclinant devant Lavarède.
Celui-ci eut toutes les peines du monde à s’empêcher de pouffer de rire.
– C’est vrai, c’est vrai, parvint-il à dire, question d’affinité. Les rois sont déjà en exil, et les chevaux le seront bientôt. La république chasse les uns, les automobiles expulsent les autres.
– Bah ! Altesse, vous avez un bien plus précieux qu’un royaume : la gaieté.
Sur cette remarque, la marche fut reprise, Parker pressait ses compagnons, car la tournée devait être courte et il avait promis à sa ménagère de rentrer pour l’heure du déjeuner.
Éperonnant leurs montures couvertes de sueur, les quatre cavaliers arrivèrent à la ferme à midi sonnant.
Déjà la table était servie et les convives firent honneur aux mets apprêtés par Mistress Parker, ce qui mit cette dernière en joie. Sir James devait retourner dans les pâtis. Il absorba viandes, légumes, desserts et café avec rapidité, puis, s’excusant auprès de ses hôtes d’être esclave des devoirs de sa charge, il les laissa seuls.
Lavarède, dont la satisfaction éclatait malgré lui, entraîna Astéras dans une promenade aux environs. Loin de leurs geôliers, ils pourraient parler à l’aise, exprimer le contentement dont ils étaient pleins.
Quant à Radjpoor, il les regarda partir avec un signe d’intelligence aux éloignés, il manifesta un grand désir d’admirer le poulailler établi par Mistress Parker, il pria Lotia de vouloir bien l’accompagner.
Avertie par un regard expressif, l’Égyptienne accepta et contourna avec lui les dépendances de la ferme, pour gagner l’enclos où poules, dindons, canards, oies, criaient, barbottaient et picoraient ensemble.
Debout devant le treillage, ils semblaient s’intéresser aux ébats des volatiles.
– Pas un mouvement, pas un geste imprudent, recommanda Radjpoor à sa compagne.
– Pourquoi ?
– Parce que je vais vous apprendre des nouvelles incroyables.
– Incroyables à ce point ?
– Oui. Thanis consent à rentrer en Égypte et à engager la lutte contre l’Angleterre.
La jeune femme pâlit. Elle s’appuya à la clôture pour ne pas tomber.
– Il consent, dit-elle enfin ? Les efforts de mon père, de ses amis, mon sacrifice personnel ne seraient pas inutiles ?
– Oui.
– Mais comment ce prodige s’est-il opéré ?
– À la suite d’un entretien que j’ai eu avec lui.
Elle l’enveloppa d’un regard brillant de reconnaissance :
– Vous, toujours vous, murmura-t-elle ?
– Non, le hasard, voilà tout, un hasard que j’ai simplement aidé… par amitié pour vous.
Il l’enveloppa d’un regard caressant.
– Des chevaux nous emporteront une des nuits prochaines à travers le désert. Par mes soins un navire nous attendra sur la côte Nord et nous conduira sur la côte de la mer Rouge. Entre deux maux : la captivité perpétuelle et la guerre, Thanis choisit le moindre. Il me reste à vous adresser une recommandation, gardez le silence. Que nul ne soupçonne que je vous ai mise au courant. Un mot maladroit remettrait tout en question. Attendez que le roi soit en notre pouvoir, qu’il ne puisse plus nous échapper.
Douloureusement, elle secoua la tête :
– Je comprends, vous le menez au devoir malgré lui.
– Je n’ai pas dit cela.
– Non, sans doute ! Cependant je devine que par une supercherie sainte vous avez rendu aux Égyptiens un chef indigne mais nécessaire.
Hypocritement Radjpoor appuya un doigt sur ses lèvres :
– N’ajoutez pas une parole, ô reine. Si vous croyez que le plus dévoué de vos sujets mérite une récompense, consentez à lui serrer la main, il sera payé et au delà de ses peines.
– Oh ! de grand cœur, s’écria-t-elle en serrant nerveusement les doigts du traître.
Un instant ils demeurèrent ainsi, puis l’Hindou se dégagea doucement.
– Rentrons, ma souveraine. On s’étonnerait peut-être d’une plus longue absence.
Avec un respect affecté, il la ramena à la ferme. Il la quitta dans la cour. D’un geste imperceptible il appela Niari, qui se promenait philosophiquement devant la maison principale, et suivi de son complice, il gagna la campagne en murmurant :
– Au grand jeu maintenant. Avant quarante-huit heures, Lavarède sera mort, et Lotia veuve acceptera ma main. Le diamant et la beauté… Par ma foi, je ne regrette plus mon voyage.
CHAPITRE XX
LOYAUTÉ ET FÉLONIE
Au bout de cinq cents pas, Niari rejoignit son maître. Sans mot dire, il marcha à ses côtés.
– Où est Sir Parker, demanda soudain l’Hindou ?
– Au pâturage numéro trois, Sahib. Il choisit et marque les moutons à expédier comme viande de boucherie.
– Numéro trois. C’est de bon augure, car numero deus impare gaudet. Allons donc retrouver ce digne squatter.
Un quart d’heure de marche conduisit les promeneurs au pâturage désigné. Il y régnait une animation insolite. Dans une enceinte de pieux, que des palissades divisaient en plusieurs sections, trois ou quatre mille moutons se pressaient, se bousculaient avec des bêlements éplorés. Des bergers, les bras nus, se frayaient un passage à travers la masse grouillante, s’arrêtaient soudain, enlevaient l’un des quadrupèdes et l’apportaient devant Sir Parker qui, assis au centre, examinait les sujets présentés, les acceptant ou les refusant d’un signe.
Dans le second cas, l’animal était remis sur ses pieds et courait rejoindre le troupeau ; dans le premier, on le marquait d’un P. de couleur rouge et il était enfermé dans un compartiment spécial.
Les deux Égyptiens regardaient, quand le surveyor les aperçut :
– Arrivez donc, cria-t-il. L’opération ne durera pas longtemps, je ne fais qu’une expédition insignifiante : six cents têtes.
Ils obéirent, et debout auprès de leur hôte, amusés par les manœuvres des bergers, ils attendirent patiemment que Sir Parker fût libre.
Tout en procédant à son choix, celui-ci les tenait au courant :
– Encore cinquante, disait-il. Plus que trente-cinq, vingt, douze, cinq… Embarquez le dernier. Voilà qui est fait.
Et s’adressant à l’un de ses employés :
– Pritge, emmène les bêtes à la ferme. Les chariots sont attelés. Tu embarqueras et partiras sur l’heure. On m’a recommandé de faire diligence.
– Bien, Sir !
Et tandis que l’homme rassemblait les quadrupèdes, il entraîna les visiteurs hors de l’enceinte :
– Accompagnez-moi jusqu’au pré numéro 11, une jatte de lait chaud nous fera du bien, car le soleil commence à être brûlant.
Une fois sur la route, Radjpoor passa sans façon son bras sous celui du squatter :
– Sir Parker, commença-t-il, si je suis venu vous troubler…
– Mais vous ne me troublez pas.
– C’est que j’avais à vous faire une communication grave, laquelle ne souffrait aucun retard.
À cet exorde, le surveyor dressa l’oreille.
– Une communication grave, redit-il ?
– Très grave.
– De quoi s’agit-il ?
– Du service de Sa gracieuse Majesté.
D’un mouvement brusque, Parker porta la main à son large chapeau, et après avoir salué :
– Que dois-je faire ?
– Je vais vous l’apprendre, Sir James. Mais auparavant, veuillez interroger Niari qui nous suit…
– L’interroger, sur quoi ?
– Sur une conversation qu’il a surprise…
– Mais encore…
– Il vous expliquera lui-même.
Et appelant Niari :
– Répète à Sir Parker ce que tu m’as confié tout à l’heure.
L’Égyptien inclina la tête et d’une voix sourde :
– Le déjeuner terminé, je me promenais autour de la ferme. Le hasard de ma promenade me conduisit auprès du pavillon habité par monseigneur Thanis. Un bruit de paroles arriva jusqu’à moi ; je reconnus sans peine que, dans une salle du rez-de-chaussée dont la fenêtre était ouverte, Son Altesse s’entretenait avec l’Européen, son ami.
– Ulysse Astéras, souligna le surveyor.
– Ulysse Astéras, en effet. J’allais m’éloigner, quand certains vocables attirèrent mon attention, je me blottis contre le mur, à deux pas de la fenêtre ; et j’écoutai.
– Mais c’est de l’espionnage, cela, hasarda Sir James.
Radjpoor lui lança un regard courroucé et sévèrement :
– Espionner pour la plus grande gloire de la Reine, c’est du loyalisme.
– Parfaitement ! c’est ce que je voulais dire, balbutia le surveyor tout penaud, mais continuez, mon ami, continuez, je vous en prie.
– Or, voici ce que j’entendis, poursuivit nettement Niari. Son Altesse parlait de fuir, de retourner en Égypte afin de soulever le pays.
– Que me contez-vous là, clama Parker en levant les bras au ciel ? Mais je serais un homme perdu, déshonoré, s’il réussissait.
– Et il aurait réussi, déclara Radjpoor, sans l’intervention heureuse de ce brave Niari.
– Son Altesse, reprit ce dernier, a constaté que vos écuries ne sont pas gardées la nuit.
– C’est vrai !
– Donc, rien de plus aisé que de prendre des chevaux et de gagner le désert.
Dans ses mains épaisses, le squatter emprisonna celles de l’Égyptien et les étreignant avec une vigueur qui prouvait sa gratitude :
– Vous me sauvez tout simplement. Dès ce soir, j’établirai des gardes d’écurie.
Il s’arrêta en voyant le faux Hindou secouer négativement la tête.
– Non, vous ne voulez pas ?
– Non, Sir Parker.
– Alors qu’exigez-vous ?
– Il faut que l’évasion s’exécute.
– Il faut… bredouilla le gros homme stupéfait ?
– Oui.
– Je n’y suis plus alors, Seigneur ; daignez me donner quelques éclaircissements.
– Je ne suis pas venu pour autre chose.
Et d’un ton emphatique :
– Sir Parker, vous êtes arrivé à un de ces instants où la carrière d’un homme se dessine ; une fausse manœuvre vous ferait révoquer de vos fonctions de surveyor…
– Révoquer, répéta sir James blêmissant.
– Au contraire, une adroite opération vous met en vue, attire les honneurs sur votre tête, et probablement la décoration de la Jarretière.
Du blanc le squatter passa au rouge.
– L’ordre de la Jarretière, fit-il d’une voix tremblante, Cet ordre que la Reine ne décerne qu’aux souverains, ou aux citoyens ayant rendu un signalé service à l’Angleterre !
– Oui, gentleman.
– Et comment pourrait-elle songer à moi pour cette distinction ?
– Par cela même qu’elle compte sur vous pour rendre à la couronne un signalé service, ainsi que vous le disiez à l’instant.
– Ah ! Seigneur Radjpoor, parlez, je suis prêt.
Un sourire distendit les lèvres de l’Hindou. Avec son habileté ordinaire, il avait préparé le terrain. Emporté par la vanité, l’Australien lui appartenait. Pourtant rien ne trahit sa satisfaction intérieure. Ce fut d’un ton calme qu’il reprit :
– Sir Parker, l’heure est venue de vous initier aux dessous de la politique. Je n’ai pas besoin de vous recommander le secret le plus absolu, vous êtes homme d’honneur.
– Certes.
– D’ailleurs, conclut négligemment Radjpoor, en cas d’indiscrétion, je vous désavouerais et vous seriez la première victime de votre imprudence.
– Je sais garder un secret.
– J’en suis persuadé, aussi je m’explique, Thanis, chef reconnu des rebelles égyptiens, est une menace perpétuelle pour la domination anglaise dans la vallée du Nil. Sa mort seule mettra un terme à l’agitation.
– Sa mort, fit en écho le squatter ?
– Oui. Or, il a été élevé en France, il a servi dans l’armée de ce pays. Il a fallu par voie diplomatique obtenir sa radiation des cadres de l’armée. Donc l’attention était attirée sur lui, et la Reine a dû, pour éviter des complications extérieures, commuer en exil la peine de mort qu’il avait encourue.
Le surveyor opina de la tête d’un air parfaitement convaincu.
– On attend seulement une occasion de le faire disparaître. Cette occasion, c’est lui-même qui nous l’offre.
– Lui-même, dites-vous ?
– Suivez-moi bien. Par une nuit sombre, il se glisse hors de son pavillon. Moi, qu’il croit dévoué à sa personne et qu’il compte certainement emmener avec lui, je me suis rendu un peu avant aux écuries, j’ai fait sortir les chevaux, je les ai conduits à quelque distance de la ferme dans un fourré. La tentative d’évasion est bien caractérisée, n’est-ce pas ?
– Oh, je ne puis pas dire le contraire.
– Bien. Mais vous, dont la surveillance inquiète ne se dément jamais, vous avez surpris des conciliabules, saisi quelques bribes de conversation. Bref ! vous veillez ; vous avez vu ma manœuvre. Avec quelques serviteurs armés, vous gagnez les taillis où j’ai caché les chevaux, et vous fusillez Thanis, au moment où il va sauter en selle.
Le squatter eut un frisson.
– Vous avez, continua Radjpoor en élevant la voix, vous avez sauvé l’Angleterre, mérité l’estime de la Reine et accompli votre devoir strict de gardien d’un révolté.
– Mais est-il bien certain que Sa gracieuse Majesté désire ?
– Vous oubliez que je suis commissaire spécial de la Couronne.
– C’est vrai. En somme, vous me transmettez des ordres…
– Dont le but est de préparer un accident, de façon à ne pas entacher la réputation de magnanimité de l’Angleterre. La reine peut compter sur vous ?
– Oui, Seigneur Commissaire.
– Songez que Thanis est un ennemi.
– J’y songe.
– Un ennemi acharné. Qu’il peut soulever des millions d’hommes, faire ruisseler le sang.
– C’est vrai.
– Que le patriotisme et l’humanité vous commandent de détruire ce monstre ; car, broyée la tête, morte la bête.
– Il mourra, Mais est-il certain que sa fuite… ?
– Je viens de vous l’affirmer, Sir James. Le prisonnier, du reste, se trahira lui-même. Pour satisfaire à son séide, le nommé Astéras qui s’est pris d’une belle affection pour Maïva, il tiendra à emmener cette petite. Ceci n’est qu’une supposition, mais je parierais volontiers qu’il vous priera de la faire rentrer à la ferme.
– Ah ! s’il fait cela !…
– Il le fera, allez, c’est probable.
– En ce cas, que lui répondrai-je ?
– Que vous aviez reçu l’ordre d’isoler cette enfant, mais que la précaution vous paraît déraisonnable, et que vous prenez sur vous de satisfaire au désir de monseigneur. Il ne faut pas l’inquiéter, vous comprenez ?
– Parfaitement !
Et d’un ton hésitant, qui démontrait bien que le digne surveyor eût préféré toute autre combinaison que celle qu’on lui proposait :
– C’est pour la patrie ! pour la Reine !
– Qui sera fière de son féal sujet et le lui prouvera royalement !
Au pâturage n° 11, les trois hommes burent la jatte de lait promise par le squatter, mais celui-ci laissa son bol à moitié plein. Évidemment la haute politique, à laquelle il se voyait mêlé, influait défavorablement sur son appétit.
Radjpoor, lui, semblait avoir oublié leur conversation. Il dissertait joyeusement. Tout avait marché au gré de ses désirs, et il se déclarait sans remords qu’il avait bien mené son affaire. En imagination, il apercevait dans un lointain embrasé, Paris, où il reprendrait bientôt son existence oisive et frivole.
Toujours pensif, le surveyor ramena ses hôtes à la ferme. Ils y arrivèrent un peu avant le dîner.
Sans ostentation, l’Hindou parvint à se glisser auprès de Lavarède :
– Agissez vite, lui dit-il tout bas. Le personnel est réduit en ce moment, plusieurs hommes sont partis aujourd’hui pour accompagner une expédition de moutons, cela facilite notre besogne.
– C’est vrai. Dès ce soir, je vais m’occuper de Maïva. Pourvu que le surveyor consente !
– Bah ! essayez toujours. Nous verrons bien.
Durant le repas, qui fut monotone, chacun s’entretenant avec sa pensée, Lavarède surprit, à plusieurs reprises, les yeux de Lotia fixés sur lui avec une expression plus douce qu’à l’ordinaire. Cela lui donna du courage. Le loyal garçon ne pouvait se figurer qu’il devait cette joie aux manœuvres sournoises de l’Hindou.
Aussi, ce qui ne lui était pas habituel, il insista pour que mistress Parker se mît au piano. Il l’y conduisit même, ce dont la commère faillit se pâmer d’aise. Songez donc, être guidée par une altesse. Et quand elle eut entonné à pleine voix un air de Guillaume Tell, qui certainement ne fut jamais chanté ainsi à l’Opéra, Lavarède vint s’asseoir à côté du fermier et d’un air conciliant :
– Sir James, vous êtes le plus courtois des hôtes ; cela m’encourage à faire appel à votre amabilité.
Le surveyor, tiré brusquement de ses réflexions, eut un regard effaré à son adresse, et répondit en s’inclinant :
– Votre appel ne sera pas inutile, Altesse.
Le début était bon, Robert se décida :
– Parmi mes compagnons, il en est un que j’honore d’une estime particulière. J’ai nommé Ulysse Astéras.
– J’ai remarqué en effet.
– Eh bien ! il est en proie à une tristesse que vous seriez en mesure de faire cesser.
Le gros homme lança un coup d’œil à Radjpoor, assis en face de lui. La supposition émise par le commissaire spécial prenait corps. Parker pressentait ce que son interlocuteur allait lui demander. Et avec un frisson, il pensait que Son Altesse Thanis signait ainsi son arrêt de mort. Aussi murmura-t-il d’une voix hésitante :
– Je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir.
– Voilà une bonne parole, déclara rondement Robert. J’irai droit au but. Astéras aime beaucoup une enfant muette, à laquelle il a juré de rendre la parole. Il s’afflige de ne plus la voir, et il serait heureux si vous consentiez à la rappeler parmi nous.
La farce sanglante commençait. Thanis avait parlé. Sir James sentit une sueur froide mouiller ses tempes, et le cœur tressautant dans sa poitrine, il bredouilla :
– Tout ce que votre Altesse voudra. J’ai reçu des ordres, vous savez, des ordres pour isoler la petite Maïva… car c’est d’elle qu’il s’agit n’est-ce pas ?… Mais je pense, oui certes, je pense cette mesure vexatoire, vexatoire est le mot, et je prendrai sur moi… de la faire revenir ici.
– Alors, demain…
– Demain matin, oui, Monseigneur. Trop heureux – il exhala un profond soupir – Oui, je dois le dire, bien heureux de vous prouver mon désir de vous être agréable… Car je souhaite, je souhaite positivement que vous n’ayez pas à vous plaindre de moi.
Ravi du succès de sa négociation, l’ancien caissier l’interrompit :
– Ne craignez rien à cet égard, Sir Parker, vous êtes le meilleur des hommes.
Et il étreignit solidement la main de son interlocuteur, ce qui porta à son comble l’émotion de ce dernier.
Cinq minutes plus tard, Mistress Parker achevait son morceau au milieu des applaudissements. Profitant du brouhaha, Lavarède s’approcha d’Ulysse et d’une voix contenue que la satisfaction faisait tremblotter :
– Demain, lui dit-il, Maïva rentrera à la ferme.
– Est-ce possible ?
– Du calme. Va remercier sir Parker. C’est pour t’éviter un chagrin qu’il a accédé à ma prière.
L’astronome ne se le fit pas répéter. Il courut au squatter qui parlait à Radjpoor et le remercia avec effusion.
Sa reconnaissance eût été fort diminuée s’il avait pu entendre le court dialogue échangé entre les deux hommes.
– Il m’a demandé Maïva, avait confié le surveyor à l’Hindou.
Et celui-ci avait répliqué :
– Cela ne pouvait manquer. Choisissez les hommes pour l’embuscade, de bons tireurs surtout.
Puis sans que son visage exprimât la moindre émotion, l’astucieux personnage se faufila auprès de Lavarède, et le sourire aux lèvres :
– Vous avez réussi, à ce que je vois.
– Sans difficulté.
– Quand Maïva vous sera-t-elle rendue ?
– Demain.
– Rien ne nous empêche de partir demain dans la nuit.
– Mais Lotia ?
– Elle est prévenue et elle accepte.
Du coup, Robert murmura :
– Vous pensez à tout. Va donc pour la nuit de demain.
Mistress Parker, à la demande générale, reprenait place au piano. Radjpoor s’installa sur une chaise voisine de celle du Français.
– Profitons du tapage de cette hallucinée, poursuivit-il, pour causer. Vous avez remarqué ce bouquet d’eucalyptus situé au bas de la montagne, et qui semble marquer la limite du désert ?
– Oui, en effet.
– Eh bien, demain soir, j’y conduirai les chevaux ; nous sommes six, vous, M. Ulysse, Lotia, Maïva, Niari et moi. Donc, six bêtes et des meilleures. Cela simplifiera les allées et venues. D’autre part, si l’on me surprenait, comme je ne suis pas un prisonnier important, je m’en tirerais plus facilement que vous.
– C’est juste !
– Il vous suffira donc, vers minuit, de quitter votre chambre, et de vous rendre en flânant au lieu du rendez-vous. Je préviendrai tout le monde, acheva le fourbe avec un sourire dont son interlocuteur ne comprit pas le véritable sens.
Comment aurait-il pensé qu’une demi-heure après, alors que, enfermé dans le pavillon, il devisait avec Astéras de la liberté bientôt reconquise, de Maïva, de Lotia, Radjpoor prenait sir Parker à part, et lui disait avec un ricanement cruel :
– Demain, à minuit, au taillis d’eucalyptus, à la lisière du désert, vous gagnerez la Jarretière.
Comme les autres, l’Hindou se retira chez lui. Tout en se couchant, il monologuait :
– Bah ! la Reine, l’Angleterre s’étonneront un peu de la façon dont j’ai usé des pouvoirs qui m’ont été confiés, mais après tout, la solution que je prépare concilie tous les intérêts. J’encours un léger blâme, cela n’est pas pour me préoccuper.
Et seul peut-être de tous les habitants de la ferme, il goûta un sommeil paisible qui attestait à la fois sa bonne santé et l’élasticité de sa conscience.
Le jour vint. Sur tous les visages l’insomnie avait laissé des traces, dans tous les yeux se lisait l’attente anxieuse. Au moindre bruit, les Français et leurs compagnons tressaillaient. Lentement, les heures s’écoulèrent, le déjeuner fut expédié et l’après-midi commença.
Vers quatre heures, les conjurés furent distraits par l’apparition de Maïva, qu’un cavalier était allé quérir de bon matin.
Astéras courut à elle, il lui saisit les mains et la regarda sans mot dire. Elle lui sourit, tandis que de grosses larmes perlaient au bord de ses paupières, puis secouant son émotion d’un mouvement mutin de sa jolie tête, elle articula nettement, presque sans effort :
– Ami !
– Ami ! elle a dit ami, s’écria l’astronome transporté. Oui, ton ami, ma douce Maïva, ton ami dévoué jusqu’à la mort.
Pour un peu il aurait dansé. Mais Radjpoor s’étant approché, les yeux de l’Égyptienne se voilèrent, la crainte fit trembloter ses lèvres.
– Il n’y prit pas garde et du ton le plus affable :
– Maïva, déclara-t-il, je ne suis plus ton maître.
Et comme elle levait sur lui un regard étonné, indécis :
– Je te répète que tu n’es plus mon esclave ; je t’ai donnée à M. Ulysse Astéras, puisque tu parais avoir pour lui plus d’affection que pour moi.
Une lueur passa dans les prunelles de la jeune fille. Elle se tourna vers l’astronome, l’interrogeant d’un geste suppliant. Lui, riant, hocha la tête :
– C’est vrai ! Le seigneur Radjpoor a consenti à me faire présent de toi, gentille Maïva. Cela veut dire que tu n’es plus esclave de personne. Je ne prétends te garder près de moi que si ton amitié te conseille d’y rester.
Avec un mouvement charmant, elle posa sur sa tête la main d’Astéras, et gazouilla de nouveau avec une indicible intonation de trouble et de tendresse :
– Ami, oui, ami !
Elle ne pouvait croire encore à son affranchissement. Plus d’une fois elle considéra en dessous Radjpoor qui ne s’inquiétait plus d’elle, et elle ne fut complètement rassurée, que quand sir Parker rentrant au moment du dîner, lui confirma de tous points l’affirmation de l’Hindou.
Alors, péniblement elle réussit à faire comprendre qu’elle ne voulait pas se séparer d’Astéras. Elle passerait la nuit dans une pièce voisine de sa chambre. Ulysse insista pour que l’on donnât satisfaction à ce caprice d’enfant. Il songeait qu’ainsi, il serait assuré que la jeune fille ne resterait pas en arrière, qu’elle partagerait ses chances d’évasion.
Et avec un étonnement non dissimulé, Maïva entendit Radjpoor joindre ses prières aux siennes.
Sir Parker consentit d’ailleurs sans difficulté. Celui qu’il considérait comme un délégué de la reine avait parlé ; il ne lui restait aucune raison pour refuser.
L’Égyptienne eut alors un cri de joie. Elle vint au squatter, agita les lèvres, parut chercher un moment, puis d’un coup elle lança ce mot :
– Merci !
On applaudit la muette, qui décidément faisait des progrès rapides. Radjpoor la félicita tout particulièrement. À cet instant même, le cruel et perfide personnage se disait :
– Il était temps d’agir. Avant quinze jours, cette petite peste aurait dévoilé mon secret. Enfin, parle, parle, ma fille, les morts resteront sourds à ta voix.
Il était à peine dix heures quand on se sépara. Les premières journées de soleil fatiguent, avait affirmé bénévolement le squatter. Aussitôt, avec un touchant ensemble, chacun avait renchéri sur cette affirmation. Jamais pareille lassitude n’avait pesé sur les hôtes du Mont Youle.
Bref on se souhaita le bonsoir et chacun s’en fut de son côté.
Mais une demi-heure après, une dizaine d’hommes, armés jusqu’aux dents, sortaient furtivement de l’habitation, descendaient avec précaution les pentes de la hauteur, atteignaient la prairie et disparaissaient dans un épais fourré d’eucalyptus, au delà duquel s’étendait la plaine sans limites du désert.
Sir Parker et ses gens prenaient l’affût pour fusiller les Français, que le traître Radjpoor allait leur amener à portée de fusil.
CHAPITRE XXI
L’INATTENDU
Robert et Ulysse, flanqués de Maïva, étaient rentrés dans leur pavillon.
Tous trois s’étaient réunis dans une salle du rez-de-chaussée, et la jeune fille, fatiguée du voyage effectué dans la journée, avait pris place sur un fauteuil, où elle s’était endormie presque aussitôt.
Sans lumière, afin qu’aucune lueur ne décelât leur veille, les Français attendaient minuit. Une émotion poignante comprimait leur poitrine. Ils ne parlaient pas. Qu’auraient-ils pu se dire à cet instant décisif. Et dans la pièce sombre, où la fenêtre découpait un parallélogramme plus clair, la respiration régulière de la dormeuse s’entendait seule.
Immobiles, muets, les deux amis semblaient indifférents. Mais de temps à autre, chacun se levait, s’approchait de la croisée et consultait furtivement sa montre, suivant ainsi sa préoccupation.
– Onze heures, murmura enfin Lavarède.
Comme s’il n’avait attendu que ces mots, Astéras le rejoignit, et avec un accent intraduisible :
– Encore une heure.
– Oui, une heure encore.
Et ils restèrent là sans ajouter un mot, percevant seulement le bruit de leur cœur battant avec force les parois de sa prison thoracique.
– Onze heures quinze, dit Astéras après un long silence.
– Dans quarante-cinq minutes, nous partirons, répliqua son ami.
– Et nous serons libres.
– Je l’espère.
– Libres ! Moi qui constamment étais enfermé à l’Observatoire, je ne comprenais pas le bonheur dont je jouissais : le droit d’aller et de venir à ma guise ; je n’en profitais pas, mais je possédais ce bien inestimable, j’étais libre.
Lavarède haussa les épaules :
– Tu as raison. Il nous a fallu perdre la liberté pour l’apprécier à sa juste valeur.
– Ah ! continua l’astronome avec une nervosité croissante, je vais donc reprendre mes chères études. De nouveau ma pensée planera au-dessus des misères terrestres, ravie, transportée, parmi les sphères de lumière, dans les rangs pressés des étoiles. Captif, le rossignol ne chante plus ; enchaîné je négligeais l’astronomie.
Et avec un geste amical vers Maïva :
– Sans cette pauvre enfant qui m’a apporté le secours de sa jeunesse et de sa bonté, je crois, ma parole, que je serais devenu enragé.
– Onze heures et demie, prononça Robert.
– Dans un quart d’heure, il faudra réveiller notre gentille compagne. Va-t-elle être surprise ? Car avec tout cela je ne lui ai pas appris nos projets. Entouré de geôliers, je craignais qu’un mouvement involontaire n’attirât leur attention soupçonneuse.
– Tu as agi prudemment.
– Deux précautions valent mieux qu’une.
– Et le trop en cela ne fut jamais perdu, comme disait La Fontaine, acheva l’ancien caissier.
Derechef il consulta sa montre :
– Quarante-cinq ! Quand je songe que maintes fois, des gens ont exprimé en ma présence cette pensée ridicule : Le temps vole. Facétie grotesque. Le temps me fait l’effet de parcourir l’éternité à cheval sur une tortue.
– Pas même, ou plutôt…
– Plutôt quoi ?
– Ce dieu, inspirateur de l’horlogerie, est un cruel plaisantin. Il franchit les heures heureuses en train express et les autres sur le chélonien que tu désignais.
– Horreur de l’attente, conclut Robert. Voilà que nous philosophons. Cinquante ! je pense que nous ferons bien de tirer Maïva de son rêve.
– Tu as toujours raison.
Sur la pointe des pieds, avec les précautions d’une mère éveillant son baby, Astéras alla à l’Égyptienne. Doucement il la secoua.
Elle poussa un long soupir, ses paupières palpitèrent. Elle ouvrit les yeux et reconnaissant le savant, elle susurra de sa voix caressante :
– Ami !
– Un méchant ami, répondit Ulysse. Un méchant ami qui t’éveille. Mais tu lui pardonneras, car il ne pouvait agir autrement.
Et aidant la jeune fille à se soulever.
– Maïva, nous allons partir.
Elle le considéra avec étonnement. Évidemment, le sens des paroles lui échappait.
– Oui, partir, reprit l’astronome. Dans quelques instants, nous quitterons la ferme. Des chevaux nous attendent au pied de la montagne et nous fuirons.
Elle se dressa toute droite, les yeux brillants. Son attitude disait clairement :
– Je suis prête, allons.
– Attends encore, enfant. L’heure n’a pas sonné. Je pourrai ainsi t’apprendre ce que tu ignores. C’est pour t’emmener avec nous, que nous avons sollicité et obtenu ton retour.
Elle saisit les mains de son interlocuteur, les serrant avec transport dans ses doigts fluets.
– Radjpoor a dérobé les montures nécessaires.
Astéras se tut soudain. Un faible cri s’était échappé des lèvres de Maïva. Une expression d’effroi couvrait ses traits et un tremblement convulsif agitait son corps.
– Qu’as-tu donc, demanda Ulysse étonné par son attitude ?
Elle essaya de parler, mais sa langue n’était pas encore assez assouplie.
Désespérément elle secoua la tête, indiquant ainsi son impuissance.
– Voyons, je vais t’aider, poursuivit le savant. Le nom de Radjpoor t’effraie ?
Elle fit oui du geste.
– Il a été brutal avec toi, brutal et cruel ; c’est de là que vient ton aversion ?
Avec énergie elle nia.
– Non ? alors d’où provient ta frayeur ?
L’enfant se serra contre lui et avec une tendresse infinie :
– Ami !
– C’est pour moi que tu as peur, interrogea Astéras éclairé par son accent ?
La jolie tête affirma vite, très vite. Puis de son doigt étendu, Maïva toucha la poitrine du savant et celle de Lavarède.
– Pour lui et pour moi, expliqua l’astronome. Tu te défies de Radjpoor ?
Sur un signe affirmatif, il continua :
– Tu es peut-être dans le vrai. Pourtant il a tenu ses promesses jusqu’à, ce jour. Il s’était engagé à guider mon ami vers la fortune et le bonheur. Il l’a mené à la cachette du diamant d’Osiris, et maintenant…
Maïva l’interrompit en frappant le sol d’un pied impatient. Elle tenta encore de parler, mais n’y pouvant réussir, elle se tordit les bras avec désespoir.
– Calme-toi, chère petite, calme-toi, supplia Ulysse. Laisse-moi chercher à te comprendre. Ne te désole pas ; va, le jour est proche où la parole te sera complètement rendue.
Et l’entraînant près de la fenêtre :
– Regarde-moi bien en face. Dans tes yeux clairs, je lirai la vérité. Tu n’as aucune confiance en Radjpoor… ne bouge pas… tes regards ont répondu : non. Cela vient, sans doute, du secret que tu as surpris, et que tu as tenté de nous apprendre à bord du yacht Pharaon ?
Le visage de l’Égyptienne s’épanouit.
– Je suis dans la bonne voie. Ce secret est donc terrible ?
Elle étendit les bras en avant, la tête renversée, dans l’attitude de l’épouvante.
– Oui, il l’est. Cet homme qui nous a enlevés, transportés en Égypte, mêlés à une conspiration, qui a imposé à Lavarède ce nom supposé, de Thanis, avait un intérêt capital à agir ainsi ?
– Oui, oui, murmura-t-elle.
– Un intérêt à ce que Robert prit la place de Thanis.
Elle affirma plus énergiquement encore.
– Mais lequel, lequel ?
Les petites mains de la jeune fille se crispèrent sur celles de l’Astronome, sa bouche s’entrouvrit, se contracta dans un effort surhumain…
– Tha… Tha… bégaya-t-elle la poitrine haletante.
Et soudain laissant retomber les mains du savant, elle se redressa, allongea le bras dans la direction où se trouvait la ferme, et les yeux dilatés, toute sa gracieuse personne vibrant sous le pouvoir de sa volonté :
– Thanis ! lança-t-elle avec éclat.
Les deux hommes s’entreregardèrent ; que voulait-elle dire ? Toujours sa main se tendait du même côté et elle répétait :
– Thanis ! Thanis !
– Ah ça ! fit Lavarède, est-ce qu’elle voudrait indiquer que Radjpoor… ?
Il n’avait pas achevé que Maïva bondissait auprès de lui, fixant sur ses lèvres son regard ardent :
– Radjpoor est-il Thanis, termina le jeune homme ?
Elle eut un cri de délivrance. À coups saccadés, sa tête se leva et s’abaissa plusieurs fois, puis elle fondit en larmes. La tension nerveuse avait été trop violente, la réaction se produisait.
Tout en s’empressant autour de la mignonne créature, les Français se consultaient. La révélation de l’Égyptienne changeait la face des choses. Radjpoor n’était plus ce qu’il paraissait, mais bien le Thanis véritable dont l’ancien caissier avait malgré lui joué le rôle.
Et une question brûlante montait aux lèvres des jeunes gens :
– Quel mobile avait poussé Thanis ? Vers quel but mystérieux se dirigeait implacablement cet homme étrange ?
Ils comprenaient qu’ils n’avaient été en ses mains que de vains jouets, et ils avaient l’intuition que, devenus inutiles à ses projets, il les briserait sans pitié.
– Que devons-nous faire, prononça Astéras, résumant ainsi ses rapides réflexions ?
Maïva essuya vivement ses pleurs. Elle fit le geste de prendre quelque chose à sa ceinture, puis le bras droit à demi replié, le poing fermé à hauteur des yeux, elle sembla viser un point de l’espace.
– Un revolver traduisit le savant. Elle a raison, il nous faut des armes.
Mais son ami haussa les épaules :
– Des armes ! où en trouver ? On nous a confisqué les nôtres, lors de notre arrestation, et dans notre empressement à recouvrer la liberté, nous n’y avons pas même songé. Maintenant, il est trop tard !
Puis prenant son parti :
– Après tout, on ne meurt qu’une fois. Il est minuit, partons.
– Tu le veux, partons donc, consentit Astéras.
– Une poignée de mains avant d’aller au danger possible, mon bon Ulysse.
– Un shake-hand, c’est trop peu. L’accolade, mon bon Robert. C’est ainsi que jadis les compagnons de bataille se préparaient à marcher au combat.
Avec une émotion intense, les Français tombèrent dans les bras l’un de l’autre.
– Et maintenant, ordonna Robert, en avant !
Maïva n’avait pas fait un geste. À ce moment elle saisit le bras d’Astéras, non pour le retenir, mais pour le suivre. En fille courageuse de la vallée du Nil héroïque, elle comprenait la résolution des jeunes gens.
Ils allaient sortir, quand un bruit léger les cloua sur place. Des coups secs étaient frappés sur la vitre de la croisée, et derrière se dessinait la silhouette noire d’un homme.
Était-ce un geôlier ? Non. Un coup d’œil suffit aux Français pour reconnaître le nouveau venu :
– C’est Radjpoor, commença Robert.
– C’est Thanis, rectifia Ulysse.
– Eh bien… rejoignons-le.
Délibérément, tous se glissèrent dehors et se trouvèrent face à face avec le faux Hindou.
– Je suis venu vous prendre, dit celui-ci. Niari attend dans le fourré avec les chevaux. Lotia est à quelques pas d’ici.
– Je vous remercie, répondit Lavarède sans que sa voix trahît l’inquiétude dont il était assiégé. Mais j’ai fait une réflexion.
– Laquelle ?
– Il nous faudrait des armes. Autrement, durant la traversée du désert, nous risquerons de mourir de faim.
– Ne craignez point ce trépas, s’empressa de répliquer Radjpoor avec une nuance imperceptible d’ironie. J’ai songé à tout. J’ai réussi à me procurer trois révolvers, deux carabines et des cartouches.
– Pour qui les carabines, questionna le Français défiant ?
– Mais pour vous et pour moi, si vous le trouvez bon.
– Où sont ces armes ?
– Les révolvers dans les fontes de nos chevaux. Les fusils accrochés à l’arçon. – Puis changeant de ton : – Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, nous ne tarderons pas davantage à nous mettre en route. Une fois hors de portée, nous aurons le loisir de bavarder.
Il n’y avait qu’à s’incliner. L’Hindou avait tout prévu. Impossible de découvrir la moindre hésitation dans ses réponses, de concevoir le plus léger doute sur sa sincérité.
Derrière lui, Robert, Astéras et Maïva se faufilèrent en silence à travers les bâtiments de la ferme. Tout semblait dormir. Aucun bruit, aucune lumière. Et cependant les cœurs des fugitifs battaient d’émotion. La pleine lune versait sur la terre sa clarté argentée, et quand il fallait traverser un espace découvert, tous hâtaient le pas, avec l’angoisse d’être aperçus par un gardien victime de l’insomnie. Ils ne se rassuraient qu’en se plongeant de nouveau dans l’ombre.
Pourtant, ils se trouvèrent sans encombre sur le plateau. Comme ils approchaient de l’endroit où la pente vers le désert s’accusait, une forme se dressa soudainement derrière un buisson.
Il y eut un moment d’émoi, vite dissipé du reste, car l’apparition n’était autre que Lotia. Ainsi que l’avait annoncé Radjpoor, la fille de Yacoub attendait ses compagnons au passage. Elle se joignit à eux et l’on s’engagea sur le sentier en rampe douce aboutissant à la plaine.
Au bout de quelques pas, la crête du plateau masqua les constructions de la ferme, et les Français en éprouvèrent une sorte de soulagement. Ils ne voyaient plus, donc on ne pouvait plus les voir.
La descente était facile. La lune éclairait nettement les moindres aspérités du Mont Youle, l’immense surface de la plaine, sur laquelle un bouquet de bois se dessinait ainsi qu’une tache noire, à quelques centaines de mètres. C’était le taillis d’eucalyptus désigné comme lieu du rendez-vous.
Radjpoor le montra à Lavarède, et d’un accent bizarre, dont le jeune homme ne perçut pas la perfidie.
– Quand nous serons là, je serai tranquille.
– Moi aussi, riposta le Français qui commençait à se rassurer.
L’Hindou sourit :
– Oui, pensait-il, tu seras tranquille et pour toujours.
Il n’avait point pitié de la victime qu’il menait confiante à la mort. Cependant, côtoyant les rochers dont la sente était bordée, parcourant les sinuosités du chemin, on avançait toujours. La déclivité devenait de plus en plus faible, venant mourir par une rampe insensible dans la plaine couverte de hautes herbes.
Tous s’arrêtèrent soudain effrayés. Une bande de casoars, troublés dans leur sommeil par la venue de la petite troupe, s’était brusquement levée de son gîte et s’enfuyait avec de grands cris aigus en agitant les ailes.
Un instant les compagnons de Radjpoor demeurèrent immobiles, regardant avec anxiété vers le sommet du Mont Youle. Si les clameurs des oiseaux avaient réveillé les habitants de la ferme, si des poursuivants allaient apparaître.
Mais non, les casoars se perdirent dans le lointain sans qu’un ennemi se montrât.
Les pieds des Français foulaient le sol de la plaine. Dans cinq minutes, ils entreraient dans le petit bois d’eucalyptus ; ils sauteraient en selle, et dans un galop furieux, ils jetteraient entre eux et leurs geôliers des kilomètres de désert.
Une hâte nerveuse accélérait leurs pas, qui faisaient craquer les herbes, On approchait. On n’était plus qu’à deux cents mètres du fourré, quand Lavarède, qui marchait en avant, crut percevoir comme un éclair entre les branches.
On eût dit la réflexion d’un rayon sur une plaque métallique polie.
Il fit halte, observant attentivement le point où s’était produite la manifestation lumineuse.
– Que cherchez-vous donc ? demanda d’un ton indifférent Radjpoor en rattrapant l’ancien caissier.
Robert l’enveloppa d’un regard scrutateur, et secouant la tête, reprit sa marche en répondant :
– Rien, rien du tout !
Seulement ses yeux fouillaient obstinément le bouquet d’arbres. Il ne distinguait rien, et il se gourmandait déjà de sa pusillanimité, quand un second éclair se produisit.
Cette fois, il s’arrêta net. Sans s’occuper de Radjpoor qui s’informait de la cause de cette manœuvre, il s’adressa à ses compagnons.
– Il se passe quelque chose d’insolite là-bas.
– Là-bas ? se récrièrent tous les assistants, troublés par ces paroles.
– Oui, à deux reprises, il m’a semblé reconnaître les lueurs produites par le reflet de la lune sur de l’acier.
– Sur de l’acier, murmura Astéras. Dans un bois, on ne trouve généralement pas ce métal industriel.
– C’est sans doute Niari, fit dédaigneusement l’Hindou.
On eût dit qu’il reprochait à Robert sa couardise. Lotia rougit et d’une voix impérieuse :
– C’est Niari évidemment. Pressons-nous, car avec toutes ces lenteurs, nous serons encore ici au lever du jour.
L’explication donnée par Radjpoor était plausible, mais l’ancien caissier, chez lequel la méfiance se réveillait, ne se rendit pas :
– Lotia, dit-il avec autorité ; quelle que soit votre façon de voir, je vous ai épousée, à la mode d’Égypte c’est vrai, mais je ne m’en considère pas moins comme votre mari. Je ne me pardonnerais pas de vous faire courir un danger inutile. Permettez-moi donc d’aller en avant en reconnaissance.
Et se courbant vers le sol, de façon à être complètement caché par les hautes herbes :
– C’est du service en campagne cela ; je me souviens que j’ai été soldat de France.
Tout en parlant, il se glissait dans les fouillis herbeux, il disparaissait.
Une expression de rage contracta le visage de Radjpoor. Le Français allait découvrir l’embuscade. Lotia peut-être devinerait sa trame odieuse. Elle le haïrait, alors qu’il pensait avoir trouvé le chemin de son cœur, et la moitié de son rêve se fondrait en vapeurs.
Oui, certes, il voulait la mort de Lavarède, la possession du diamant d’Osiris, mais il voulait aussi que Lotia, veuve du faux Thanis, se consolât de son deuil en lui accordant sa main.
Aux pulsations désordonnées de son cœur, au trouble de ses idées, il comprenait que sans elle, le bonheur lui serait impossible. Non qu’il ressentît pour la fille de Yacoub, la tendresse dévouée, indulgente, entière que Lavarède éprouvait pour elle ; cette affection d’honnête homme ne lui était pas permise. Mais enfin il l’aimait autant qu’il le pouvait, c’est-à-dire ainsi qu’un bibelot de prix, une pierre précieuse, un fruit rare, un plaisir inaccoutumé.
Tous attendaient, frissonnants, agités de sentiments différents par l’acte du Français.
Et tout à coup, un même cri de terreur jaillit de leurs lèvres. À la lisière du fourré, une flamme rougeâtre avait apparu une seconde. Elle était à peine éteinte que le bruit d’une détonation arrivait jusqu’à eux.
Aussitôt, à cent mètres d’eux, un grand corps bondit au-dessus des herbes, et Lavarède haletant, couvert de terre, accourut comme le vent en leur criant :
– Fuyez ! Fuyez… le bois est gardé.
Éperdus, comprenant que leur fuite était découverte, leur liberté perdue, tous coururent vers le Mont Youle.
Mais du taillis sortent des ombres humaines, des coups de feu précipitent la course des fugitifs. Plus rapides qu’eux, les balles sifflent à leurs oreilles, ainsi que des oiseaux chantant la mort.
Ils galopent toujours, affolés, hors d’haleine, revenant, sans savoir pourquoi, vers le Mont Youle, mais la fusillade se fait plus pressée. Les projectiles frappent la terre autour d’eux. Une balle soulève un nuage de poussière à côté de Lotia.
À cette vue, Robert oublie tout.
– Si cela continue, ils vont la tuer. Ma foi, puisque c’est à moi que l’on en veut certainement, autant me rendre de suite, et la sauver.
Il s’arrête, les bras croisés sur la poitrine, attendant l’ennemi contre lequel il ne saurait se défendre, car il est sans armes.
Radjpoor le voit, il comprend. Ses compagnons ne l’observent pas. Ils l’ont dépassé et courent toujours. Il a un ricanement diabolique ; de sa poche, il tire un révolver et ajuste froidement Lavarède.
Le jeune homme est perdu. Il semble qu’aucune puissance humaine ne saurait le sauver.
Et cependant l’Hindou ne tire pas.
Une ombre gigantesque a paru sur la plaine inondée de la clarté lunaire. Elle va comme le vent. Poursuivants, fugitifs l’ont aperçue ; ils demeurent immobiles, stupéfaits de ce prodige. L’ombre approche, couvre le terrain où sont Robert et ses compagnons.
Un cri de stupeur échappe à tous presque au même instant. Un corps dur les a frappés l’un après l’autre aux jambes, les a fait culbuter pêle-mêle dans une sorte de poche formée d’un vaste filet, et étourdis par leur chute, incapables d’expliquer ce qui leur arrive, ils se sentent enlevés de terre et emportés vers le nord avec une vertigineuse rapidité.
Un vent violent les frappe, ils respirent avec peine, le sang afflue à leurs tempes. Ils perdent connaissance, tandis que bien loin déjà dans la plaine, sir Parker et ses hommes usent inutilement leurs cartouches pour atteindre la chose inconnue qui leur enlève leurs victimes.
DEUXIÈME PARTIE
LE BOLIDE
CHAPITRE I
UN PROBLÈME
Robert Lavarède étendit les bras, se frotta les yeux et promena autour de lui un regard troublé.
Mal remis de la secousse qu’il venait d’éprouver, étourdi encore par l’afflux du sang à la tête, il voyait confusément, comme dans un brouillard, les objets qui l’entouraient, et ces objets il ne les reconnaissait pas.
Il se trouvait dans un petit salon, meublé de divans et de sièges bas. Au plafond un motif figurait une couronne de feuillages, dans laquelle des lampes électriques formaient des fleurs lumineuses.
– Qu’est-ce que cela, murmura le jeune homme ?
Un instant il ferma les yeux, puis les rouvrit de nouveau ; la vision persista. En regardant mieux, Robert aperçut Astéras, Lotia, Maïva, Radjpoor. Tous étaient assis comme lui-même, mais leurs paupières closes, l’immobilité de leurs traits indiquaient qu’ils n’avaient point conscience de leur situation.
Avec effort, le Français se dressa sur ses pieds. Son sang n’avait pas encore repris son cours normal ; il chancelait. Cependant, s’appuyant aux meubles, il réussit à arriver auprès de l’astronome.
– Ulysse, appela-t-il !
Mais le savant ne répondit pas.
– Ah ça ! c’est le château de la Belle au bois dormant, reprit Robert. Ils ont tous l’air de s’être saturés de chloroforme. Cela ne peut pas durer.
Sur cette conclusion, il se mit à secouer vigoureusement son ami. L’effet de ce massage primitif ne se fit pas attendre. Astéras eut une grimace, ses yeux s’entrouvrirent, ses mains s’agitèrent, et d’une voix pâteuse il prononça :
– Maïva !
Lavarède ne put s’empêcher de sourire.
– Les voilà bien les savants. Il ne se demande pas où il se trouve, mais seulement où elle est. Elle est à côté de toi, rêveur. Tu vas la rappeler à elle, tandis que j’agirai de même à l’égard de Lotia. Pour le seigneur Radjpoor, il se tirera d’affaire tout seul.
Il sentait s’évanouir l’engourdissement qui l’avait terrassé. La vie revenait à flots. L’astronome se penchait déjà sur la muette ; Robert s’occupa de Lotia.
Cinq minutes ne s’étaient pas écoulées que les jeunes Égyptiennes parcouraient la salle d’un œil effaré.
– Où sommes-nous, firent-elles avec un touchant ensemble ?
– Nous allons nous en informer, riposta Robert. Le plus pressé était de vous tirer de votre évanouissement.
– C’est vrai, reprit Lotia d’un ton hésitant, comme si elle cherchait à préciser ses souvenirs. J’ai perdu connaissance.
– Oui.
– Je me rappelle une ombre sur la prairie, un choc dont je fus renversée.
– Comme nous.
– Qu’était-ce ?
À cette question, tous se regardèrent avec embarras.
– Ma foi, grommela Robert après un instant de silence, je n’en sais rien. Au fait ! que nous est-il arrivé ?
– Oui, que nous est-il arrivé ? répéta la voix dolente de Radjpoor. L’Hindou avait ouvert les yeux, et de même que ses compagnons, il paraissait très intrigué par l’aspect du salon où tous se trouvaient réunis.
– Le mieux est de nous informer, murmura Lavarède.
Et se dirigeant vers une des portes, il ajouta :
– Ensuite, Seigneur Radjpoor, je vous demanderai quelques explications sur le guet-apens, auquel nous avons miraculeusement échappé – puis par réflexion – quand je dis échappé, je n’en suis pas certain, car du diable si je comprends ce qui nous arrive !
– Cela ne vous empêche pas d’accuser, fit Lotia d’un ton grave.
Le jeune homme eut à son adresse un regard attristé. L’abîme qui le séparait de l’Égyptienne n’était pas comblé. Ainsi que par le passé, elle prenait contre lui la défense de l’Hindou.
Cependant, il n’ajouta pas une parole. Il gagna la porte et essaya de l’ouvrir. Elle résista. Une seconde ouverture existait en face de celle-ci. Robert s’en approcha, mais vainement encore il tenta de sortir. Évidemment les voyageurs étaient enfermés.
– Prisonniers, gronda Robert, mais où ? Car par la morbleu, nous ne sommes pas à la ferme de Sir Parker.
Puis sa colère augmentant, il revint à Radjpoor.
– Seigneur Radjpoor, je vous connais maintenant. C’est vous qui avez dirigé toutes les aventures dont je fus victime. Vous êtes donc certainement en mesure de m’expliquer la dernière.
– Vous vous trompez, répondit tranquillement l’Hindou, qui cette fois disait la vérité.
Mais son interlocuteur ne le laissa pas achever :
– Pardon ! Vous essayez de me tromper encore, voilà l’expression juste. Peine inutile. Je veux, j’exige une réponse catégorique, et si vous me la refusez…
– Si je vous la refuse ?…
– Je vous contraindrai par la force à me la donner.
Radjpoor haussa les épaules, tira de sa poche un revolver, le même avec lequel il avait été sur le point d’assassiner le Français, et d’un ton railleur :
– Je me mets donc sur le pied de légitime défense.
Mais l’ironie s’étrangla dans sa gorge. Rapide comme la pensée, Robert s’était rué sur lui, avait fait sauter le revolver au loin d’un revers de main, et sous son élan irrésistible, avait renversé le fourbe qu’il tenait maintenant sous son genou.
Lotia éperdue fit un mouvement pour s’interposer, mais elle trouva devant elle Astéras et Maïva qui lui barraient le passage.
Et Lavarède parlait à son ennemi terrassé :
– Vous savez bien, vous, que je suis Français, qu’un méchant pistolet ne m’effraie pas. Vous avez trop compté sur ma mansuétude. Depuis des mois, par votre faute, je suis tiraillé, ballotté en tout sens. J’en ai assez, j’en ai trop, et vous allez confesser vos mensonges.
Suffoqué, haletant, les nerfs tendus pour échapper à l’étreinte de Lavarède, Radjpoor devenait livide ; ses yeux s’injectaient de sang.
– Mais vous l’étouffez, gémit Lotia, cherchant en vain à repousser Astéras et Maïva.
– Bah ! riposta Robert, il a un moyen bien simple de retrouver la respiration. Ne pas mentir…, pour une fois.
Et se penchant sur l’Hindou :
– Comprenez-vous les charmes de la loyauté ?
– Je n’ai rien à dire, fit le vaincu d’une voix sifflante. Renversé par traîtrise…
– Par traîtrise, c’est le mot juste. Vous aviez un revolver, j’étais sans armes… donc, je suis un traître. Je ne m’élève pas contre ce raisonnement dépourvu de logique. Je veux me montrer bon prince. Un petit aveu et vous êtes libre. Du reste, je vais vous aider.
Et d’un ton impossible à rendre :
– Dites-moi, cher Monsieur Radjpoor, vous connaissez Thanis ?
L’Hindou eut un soubresaut brusque, il parvint à se soulever ; mais Lavarède était vigoureux. De nouveau il l’étendit sur le sol.
– Ne faites pas le méchant. Vous êtes confortablement couché sur le plancher, position commode entre toutes pour causer ; restez-y. Je répète ma question. Vous connaissez Thanis ?
Un instant Robert attendit une réponse qui ne vint pas.
– Vous craignez de parler, reprit-il. À quoi bon… je le connais moi. Il est présentement à terre, avec mon genou sur la poitrine.
– Mensonge, gronda l’Hindou !
– Oui, mensonge cruel, fit Lotia en écho. Pourquoi cette comédie ?
– Pourquoi ? continua Lavarède en s’animant, pourquoi ? Parce que je suis las de jouer le rôle d’un personnage équivoque, traître à son pays, serviteur de l’Angleterre sans doute ; parce que je veux reprendre mon nom de Lavarède et rendre à Thanis ce qui appartient à Thanis.
– Il devient fou, gémit Lotia en se tordant les bras.
– Fou ! Parbleu, une tête moins solide que la mienne y aurait succombé. Mais rassurez-vous, je jouis de tout mon bon sens, et je le prouve. Radjpoor et Thanis ne font qu’un. Cet homme m’a enlevé par surprise, jeté avec menace de mort dans la plus incompréhensible aventure. Je n’ai vu clair que cette nuit, grâce à Maïva, son esclave. Interrogez cette enfant ; elle vous désignera le véritable Thanis.
D’une voix rauque, Radjpoor s’écria :
– Complot tramé par vous pour chasser du cœur de Lotia la haine qu’elle a vouée au meurtrier de sa mère.
– Vérité, riposta Astéras !
– Oui, appuya Maïva.
– Vos complices diront comme vous.
Les mains de Robert se crispèrent sur les bras de l’Hindou.
– Prenez garde ! Je vais vous retourner vos recommandations d’autrefois. Radjpoor, la vérité est d’or, le mensonge est d’acier.
– Eh ! tuez-moi. Je ne veux pas vous aider à tromper Lotia.
– Vous avez de la volonté, mais moi aussi. Ulysse, des cordes. Nous allons garrotter ce gaillard-là et aviser au moyen de modifier son caractère. Ah ! dame, je le conçois, il est dur de tomber de félonie en loyauté.
Déjà l’astronome furetait dans tous les coins pour se procurer un lien. Avec une pitié grandissante, Lotia considérait l’Hindou. Son attitude, courageuse en somme, avait chassé le doute, né une seconde auparavant des paroles de Robert. De nouveau elle était conquise. Oui, on avait voulu égarer son esprit, avec l’aide de l’esclave Maïva. Une fois de plus, l’astuce de Radjpoor triomphait de la franchise de ses adversaires.
Pourtant la résolution de Lavarède allait peut-être vaincre toutes les résistances. Il était disposé à se porter à toute extrémité. Dût-il torturer son ennemi, il lui arracherait l’aveu de ses machinations. Mais l’heure de la lumière n’avait pas encore sonné, car tandis qu’il maintenait l’Hindou, que le savant cherchait vainement des liens, que Lotia et Maïva, en proie à des sentiments contraires, demeuraient spectatrices de la scène, le bruit d’une clef tournant dans la serrure se fit entendre.
Tous eurent un frémissement, ils tournèrent les yeux vers la porte de droite, qui lentement pivota sur ses gonds, livrant passage à deux personnages inconnus : un homme et une femme.
L’homme salua de la main et d’une voix tranquille :
– Relevez-vous, Messieurs. Sur le Gypaète, les colères humaines ne doivent point élever la voix.
Dominé par l’accent du nouveau venu, Lavarède lâcha Radjpoor, qui, chancelant, se remit sur ses pieds, et avec une surprise non dissimulée les voyageurs considérèrent les visiteurs.
Ils étaient de taille moyenne, souriants, doués l’un et l’autre d’un cou long, supportant une tête allongée au profil d’oiseau. Le veston de l’homme, le corsage de la dame étaient bordés de plumes multicolores. Et, chose étrange, ces singulières personnes secouaient incessamment de droite à gauche leurs chefs, appuyant leurs joues alternativement sur chaque épaule, ayant l’air en un mot de se livrer à un de ces exercices d’assouplissement, qualifiés par les professeurs de gymnastique de « préparatoires ».
– À qui ai-je l’honneur de parler, questionna enfin l’homme ?
Il employait un français très pur, mais avec des inflexions gutturales indiquant que la France n’était point sa patrie.
– Robert Lavarède, Français, s’empressa de répondre l’époux de Lotia.
Mais Radjpoor l’interrompit :
– Pardon ! Thanis, Égyptien.
Le jeune homme eut un cri de rage.
– Mille diables ? Je suis Français et…
Le nouveau venu l’apaisa du geste :
– Calmez-vous, Monsieur. Ici les nationalités sont sans importance. Les divisions de la surface du globe n’ont pas d’écho parmi les libres citoyens de l’atmosphère.
Et comme ses auditeurs le considéraient avec ahurissement, ne comprenant rien à ses étranges paroles, il poursuivit paisiblement :
– Quant à vos noms, je ne sais vraiment où j’avais la tête pour vous les demander ; puisque je dois vous prier de les oublier.
– Les oublier, firent-ils tous d’une même voix stupéfaite ?
– Sans doute ! les appellations terrestres seraient un non-sens pour des habitants du ciel. Ainsi tenez, vous, Monsieur, – le singulier homme désignait Lavarède. – Vous avez le front large, le regard loyal, courageux, vous serez désormais Monsieur l’Aigle.
– Hein ? permettez ?
– Quand j’aurai achevé, je vous prie. Votre voisin – il s’agissait d’Astéras – avec sa figure ronde, ses yeux de nyctalope, deviendra le Grand-Duc.
Puis regardant successivement Radjpoor, Lotia et Maïva.
– Celui-ci sera Milan, oiseau de proie sans courage, et ces jolies dames deviendront Mésange et Fauvette. Ceci dit, il me reste à vous présenter vos hôtes. Je suis Monsieur Ramier, et voici ma femme, ma compagne fidèle, qui répond au doux nom de Madame Hirondelle.
Peindre l’étonnement des voyageurs est impossible. Ils écoutaient l’inconnu avec une crainte vague, que Robert traduisit enfin en murmurant à l’oreille d’Ulysse :
– Ce gaillard-là est fou.
Et soudain, prenant son parti, il questionna :
– Où sommes-nous ?
– À bord du Gypaète, Monsieur.
– Le Gypaète… un navire ?
– Aérien. J’ai résolu le problème ardu de l’aviation, la navigation dans l’atmosphère au moyen d’un appareil plus lourd que l’air. Découverte heureuse pour vous, soit dit sans me flatter, car sans elle vous n’auriez pas échappé aux ennemis qui vous pourchassaient dans la plaine du désert de Victoria.
Et comme ses auditeurs se considéraient avec une impression de rêve, le mystérieux personnage poursuivit d’un ton dogmatique :
– Toute chose créée suit une courbe fermée. La planète, issue d’un soleil, décrit une ellipse. L’humanité, née de la terre, parcourt dans son évolution une orbe que l’on peut figurer graphiquement par une circonférence, laquelle n’est, en somme, qu’une ellipse dont les deux foyers se confondent.
Sans s’apercevoir que Robert, troublé par ces formules scientifiques, ouvrait des yeux effarés, M. Ramier continua.
– Donc, l’humanité doit repasser forcément par les mêmes phases ; si l’on déterminait les différentes étapes de ses origines, on serait en mesure de prévoir le cycle entier de ses inventions.
– Vous croyez, balbutia Lavarède abasourdi ?
Le maître du Gypaète ne sembla pas l’entendre :
– Eh bien, moi, j’ai découvert l’ancêtre indéniable de l’homme.
– Le singe, interrompit Astéras, d’aucuns l’affirment.
– Ils se trompent, clama le petit homme en piétinant d’impatience. Le singe est une espèce voisine, annexe, si j’ose m’exprimer ainsi, et non pas un point de départ. Du chimpanzé au zaimziri en passant par le gibbon, l’espèce simiesque fait partie de l’humanité, mais n’en est point la source.
À cette affirmation singulière, tous demeurèrent cois.
– L’ancêtre de l’homme, reprit M. Ramier avec enthousiasme, il faut le chercher parmi les oiseaux, parmi les grands volateurs des âges disparus. L’homme a commencé par avoir des ailes ; il lui en est resté l’admiration des étoiles et le désir de regarder en haut. Nous sommes les fils des Ptérodactyles géants.
– Des chauves-souris antédiluviennes, murmura Robert ?
– Oui, des chauves-souris qui, au-dessus des marécages tièdes de la croûte terrestre en formation, traversaient les airs, effleuraient de leurs ailes membraneuses la cime des conifères, des champignons plus hauts que nos chênes modernes, des fougères qui eussent abrité nos baobabs d’aujourd’hui. Donc partant du principe de la courbe fermée, que je formulais tout à l’heure, je suis arrivé à cet axiome : L’homme a volé dans l’espace, donc il doit voler de nouveau. C’est ainsi que j’ai été amené à me poser le problème de l’aviation, à résoudre cette difficulté réputée insurmontable : « Étant donné un appareil plus lourd que l’air, le déterminer à s’élever et à flotter dans l’atmosphère. »
Lavarède, Astéras, Maïva, Lotia, Radjpoor s’entre-regardèrent.
Une même pensée naissait dans leurs cerveaux. Celui qui leur parlait était un fou. Comment expliquer sans cela qu’il osât donner pour parrain à l’homme le ptérodactyle, qu’il prétendit avoir inventé le navire aérien ?
Le résultat de cette réflexion fut que Robert grommela tout bas :
– Il ne faut pas contrarier les lunatiques.
Et il reprit à haute voix :
– Alors nous sommes dans un aéronef ?
– Baptisé : Le Gypaète, répondit M. Ramier en s’inclinant.
– Et nous flottons dans l’air ?
L’homme consulta un manomètre accroché au mur :
– Exactement à 953 mètres de la surface du globe. Flotter n’est pas le mot juste, car actuellement nous nous déplaçons vers le Nord avec une vitesse de 66 milles à l’heure.
– 120 kilomètres environ ?
– À peu près.
Un instant l’ex-caissier se sentit troublé. Les réponses du fou étaient si précises, qu’il se demandait si l’impossible n’était pas réalisé, si vraiment lui et ses compagnons n’étaient pas devenus les passagers d’un aéronef ; mais il chassa bien vite cette pensée saugrenue. La découverte d’un appareil volant à travers l’espace eût fait grand bruit dans le monde. Les journaux, les revues périodiques se seraient emparés de la question. Il y aurait eu une avalanche d’articles, de chroniques, de polémiques, de réfutations. À Massaouah, au Mont Youle même, l’écho de ce vacarme serait arrivé. Or, il n’en était rien, donc la première supposition restait la bonne. M. Ramier était un simple maniaque qu’il importait de fuir au plus vite.
Le meilleur moyen semblait consister à flatter sa « toquade ». Aussi le jeune homme dit-il du ton le plus insinuant :
– Ma foi, ce doit être un beau spectacle que de voir la terre fuir sous ses pieds.
– Sublime, riposta le fou.
– Je voudrais pouvoir en régaler mes yeux.
– Rien de plus simple.
– Comment ? Vous trouvez cela simple, balbutia Robert bouleversé par la tranquillité de son interlocuteur ?
– Très simple. Veuillez me suivre. Nous allons monter sur le pont, et vous regarderez tout à votre aise.
– Sur le pont ?
– Sans doute. Mon appareil a sensiblement la forme d’un bateau, et la partie supérieure, entourée d’une balustrade légère, forme pont.
Et s’adressant à sa compagne, muette et souriante :
– Ma chère Hirondelle, passez la première, vous nous montrerez le chemin.
CHAPITRE II
L’ŒUVRE D’UN FOU DE GÉNIE
Véritablement très émus, les voyageurs suivirent leurs hôtes. On quitta le salon. Tous se trouvèrent alors dans un couloir étroit éclairé de loin en loin par de petites lampes électriques.
Tout en marchant, Lavarède tâtait les murs. Avec surprise, il constata qu’ils étaient formés de plaques métalliques.
– Sapristi, murmura-t-il, est-ce que ce M. Ramier aurait dit la vérité ? Mais il secoua la tête. Non l’aéronef n’était qu’une chimère ; l’aviation, ce problème ardu qui a coûté la vie à tant de chercheurs, n’était pas résolu ! Et pourtant le jeune homme se rappelait vaguement de quelle façon ses amis et lui avaient échappé à la poursuite des assassins conduits par M. Parker. Il n’y avait pas à le nier, ils avaient eu l’impression d’être enlevés dans les airs. Alors, que conclure, sinon qu’à l’heure présente ils étaient captifs dans un appareil aérien ? Non pas un aérostat ordinaire, un ballon, car pour élever une nacelle de la dimension de celle où ils se trouvaient, il eût fallu une enveloppe de taffetas gonflée d’hydrogène d’une étendue superficielle égale à la moitié de Paris.
Il interrompit soudain son monologue intérieur. On était arrivé dans une petite pièce circulaire. Une échelle de fer se dressait du plancher au plafond.
Avec une agilité surprenante, M. Ramier la gravit, tira sans bruit un verrou, puis il appuya la main sur le plafond, le fit lentement tourner sur lui-même et démasqua ainsi une ouverture carrée, par laquelle s’engouffra un vent frais.
Stupéfaits, incapables de prononcer une parole, les voyageurs regardaient le ciel étoilé, que laissait apercevoir l’écoutille ouverte.
– Montez, ordonna leur guide !
– Montez, répéta Mme Hirondelle d’une voix chantante !
– Ma foi, autant être fixé de suite, grommela Lavarède en posant les pieds sur les échelons de métal.
Un instant après, il se trouvait debout auprès du fou, sur une plate-forme de 50 pieds de long sur 10 de large, autour de laquelle courait une légère balustrade d’acier ; ses compagnons le rejoignirent et tous demeurèrent anéantis devant le spectacle le plus étrange qu’il fût possible de rêver.
Au-dessus de leurs têtes, la voûte du ciel où les constellations étalaient leurs lignes sinueuses, semblant former cortège à la lune, qui baignait le pont de ses rayons argentés ; à leurs pieds, la plate-forme, et au-delà, de chaque côté du parapet, une surface métallique, brillante, s’infléchissant en une courbe gracieuse vers l’endroit où devait se trouver la terre.
– Approchez-vous de la balustrade, conseilla M. Ramier, et regardez en bas. Le vertige n’est pas à craindre, puisque les flancs de mon aéronef prolongent le pont et ne vous permettent pas de regarder perpendiculairement.
Lentement, gagnés par le vague effroi de l’invraisemblable devenant vrai, de la chose réputée impossible transformée en réalité, les passagers obéirent.
Un même cri de stupeur s’échappa de toutes les lèvres.
Loin au-dessous d’eux s’agitait une surface mouvante que les rayons lunaires pailletaient d’éclairs.
– La mer, expliqua tranquillement le fou. Nous planons en ce moment au-dessus de l’océan Pacifique. Eh tenez, ajouta-t-il après un instant, ces lumières qui se déplacent lentement sont les feux d’un navire. Il est ballotté par les lames, il tangue, il roule, alors que nous voguons dans l’atmosphère sans secousses et sans bruit.
Puis élevant la voix :
– Tenez-vous bien, je vais donner l’ordre d’accélérer la vitesse. J’avais fait ralentir tout à l’heure, pour que vous ne soyez pas surpris par la chasse d’air.
Et se penchant sur un porte-voix analogue à celui des officiers de quart dans la marine.
– À six cents tours de roue, cria-t-il ?
– Vous avez donc un équipage, murmura Lavarède ?
– Oui… cramponnez-vous.
Presque aussitôt un ronflement partit de l’avant de l’aéronef. Des bras aux formes étranges battirent l’air, et comme un cheval auquel on rend la main, le Gypaète s’élança à travers l’espace.
Tous comprenaient maintenant l’utilité de la recommandation du fou. Assourdis par les grondements de la machine motrice, fouettés par un courant d’air violent, ils se rendaient compte du déplacement rapide de l’appareil. En quelques minutes, le steamer dont ils considéraient les feux, restait en arrière, il disparaissait dans la nuit.
Avec peine, se glissant le long de la balustrade, Robert rejoignit M. Ramier.
– Quels sont ces organes bizarres qui se meuvent à l’avant.
– Ce sont les ailes de mon Gypaète.
Et avec une nuance d’orgueil :
– Cela paraît vous intéresser. Descendons. J’aurai grand plaisir à vous montrer ma machine. Je ne l’expliquerais pas aux hommes de la terre, mais puisque le hasard vous a jeté à mon bord, je ne vois pas pourquoi j’aurais des secrets pour vous.
Sans laisser à son interlocuteur le loisir de s’étonner de cette confiance subite, M. Ramier lança un ordre nouveau dans le porte-voix. Les ronflements du moteur s’apaisèrent, le vent diminua de violence, et tous, sur l’invitation du singulier personnage, regagnèrent l’intérieur de l’aéronef dont le panneau fut refermé avec soin.
Et tandis que Mme Hirondelle, souriante et empressée, ramenait Lotia, Maïva et Radjpoor dans le salon où ils étaient tout à l’heure, le fou entraînait sur ses pas Robert et son ami Astéras.
Dans le couloir, il ouvrit une porte.
– Entrez, messieurs, fit-il. Avant de vous faire visiter les appareils, quelques mots d’explication sont nécessaires. Cette salle est mon bureau, nous y serons fort bien pour causer.
Les Français promenèrent autour d’eux un regard curieux. Sur trois côtés de la pièce spacieuse où ils entraient, les murs étaient cachés par des planchettes sur lesquelles se mêlaient, dans un pittoresque désordre, des livres, des ustensiles de chimie, de mécanique, de physique. La quatrième face était entièrement couverte par un tableau noir, couvert d’équations algébriques, dont les rangs pressés arrachèrent une grimace à l’ancien caissier. Comme meubles, de larges planches à dessin portées par des chevalets, un fourneau encombré de ballons, d’éprouvettes et de flacons, puis des sièges de paille.
Avec la sûreté de main d’un professeur faisant une démonstration, M. Ramier traça sur le tableau diverses figures.
– Messieurs, dit-il en terminant, excusez-moi si je vous présente mon Gypaète sous une forme pédagogique. Mais la rencontre de gens intelligents est rare lorsque l’on habite au pays des nuages, et je tiens à vous faire connaître complètement mon appareil, afin que vous l’aimiez comme moi.
Et désignant la figure 1 :
– Ceci est l’épure de mon navire aérien. Elle vous donne sa forme générale. Vous y voyez le pont où nous étions à l’instant, les ailes motrices placées à l’avant, l’hélice de démarrage à l’arrière, ainsi que le gouvernail mobile dans un plan vertical autour d’un axe horizontal.
– Mais, objecta Astéras, qui écoutait avec un intérêt non dissimulé, il me semble que vous avez indiqué, non pas deux ailes, mais bien quatre. Votre machine volerait donc moins à la façon des oiseaux, qu’à celle des hannetons ?
– Des hannetons que ce bon monsieur a dans le plafond, soupira Robert si bas que ses compagnons ne purent entendre cette remarque désobligeante.
M. Ramier, du reste, s’empressait de répondre à l’observation d’Astéras :
– Non, non, vous vous méprenez le Gypaète est actionné par une seule paire d’ailes à la fois. Les autres, appliquées sur la paroi extérieure, restent immobiles. Ce sont les ailes de sûreté.
– De sûreté ?
– Absolument. Admettez que l’une de mes ailes en mouvement subisse une avarie.
– L’appareil cesse d’être soutenu et une chute épouvantable commence…
– Commencerait, si, au même instant, l’aile de sûreté correspondante ne se déclenchait automatiquement et ne fonctionnait en lieu et place de l’organe abîmé.
– Je comprends, je comprends, clama l’astronome enthousiasmé, il est à peu près impossible de tomber.
– À peu près, grommela encore Lavarède, à peu près, et cela te suffit.
– Seulement, poursuivit le savant sans prendre garde à l’interruption, permettez-moi encore une objection.
– Je vous écoute, déclara M. Ramier en s’inclinant.
– Il me semble que, étant donnée la masse de l’aéronef, vos ailes n’ont pas les dimensions suffisantes… en un mot que l’envergure de votre machine volante est bien faible.
Un sourire satisfait illumina le visage du fou :
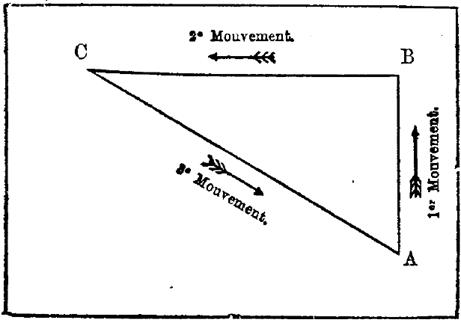
– C’est de cela que je suis fier, articula-t-il lentement. Vous avez mis le doigt sur la vraie difficulté du problème. En effet, obtenir les trois mouvements de l’aile de l’oiseau, de bas en haut, d’arrière en avant et d’avant en arrière suivant une diagonale, de façon à lui faire parcourir le contour d’un triangle – il traçait en même temps sur le tableau la figure suivante – c’était un jeu d’enfant ; un système de leviers réunis par des articulations ou joints Goubet, y suffisait. Fabriquer les ailes au moyen de lamelles qui, de même que les plumes des volateurs animés, se laissent traverser par l’air dans le mouvement ascendant, mais deviennent imperméables dans la course descendante, seule utile à la propulsion, aisé encore. Le nœud de la question était la dimension des ailes, car la force et le poids du moteur nécessaire sont en proportion de leur surface. Avec des ailes normales, tout mon appareil eût été employé uniquement à soulever les moteurs. Cela était inadmissible.
– J’en conviens, appuya l’astronome ; mais comment avez-vous résolu cette difficulté. J’avoue qu’elle me paraît insurmontable.
Cette déclaration amena un nouveau sourire sur les lèvres de M. Ramier.
– Suivez-moi bien, reprit-il avec une condescendance orgueilleuse. Vous savez que chez les oiseaux géométriquement semblables, les dimensions linéaires étant dans un certain rapport, les surfaces croîtront comme les carrés et les poids comme les cubes de ce rapport.
– C’est évident, dit Astéras.
Lavarède haussa les épaules :
– Évident ! Tu comprends, toi ?
– Sans doute !
– Allons donc, ces carrés qui gambadent sur des cubes ?
– C’est clair comme de l’eau de roche.
– De l’eau de Seine, veux-tu dire ?
Un geste d’impatience de M. Ramier l’empêcha de continuer.
– Cela ne se discute pas, fit le petit homme d’un ton sec. Pompéïen-Picaud, mon précurseur en aviation, et avant lui une pléiade d’esprits éminents : Édison, Dandrieux, Tatin, Kaufmann, de Groof, de Bris, Michel Loup, Degen, Guard, le marquis de Bocqueville, Besnier, Jean-Baptiste Dante, Paul Guidotti et Léonard de Vinci lui-même, le grand artiste de la Renaissance, ont démontré expérimentalement que plus l’oiseau est gros, moins son envergure proportionnelle est étendue.
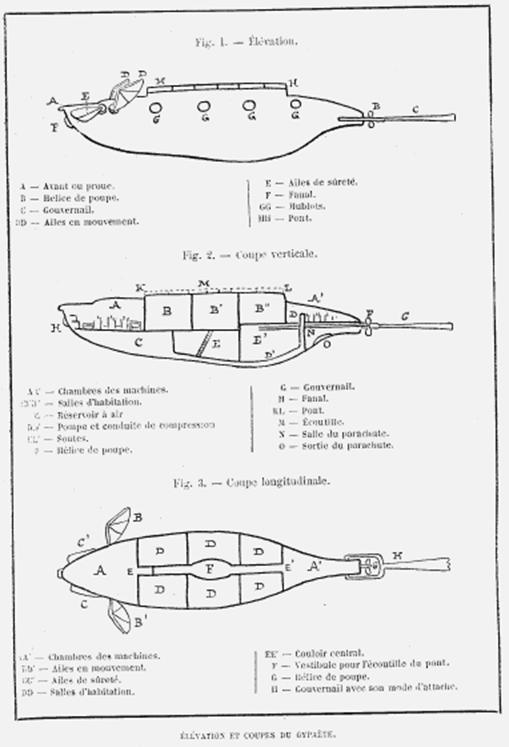
– C’est trop fort. Alors un oiseau, qui serait cent fois, mille fois plus lourd que les espèces existantes, n’aurait plus d’ailes du tout ?
Le jeune homme croyait embarrasser son adversaire, mais le fou répliqua tranquillement :
– Votre raisonnement est ce que l’on appelle le raisonnement à l’infini.
– Vous dites ?
– Que c’est là une argutie théorique. Dans la pratique, pour obtenir une surface, il faut des lignes.
– Au diable, s’écria Robert, j’ai connu un pêcheur émérite. Il ne m’a jamais parlé de surfaces. Avec ses lignes, il n’attrapait que du poisson.
Le calembour ne fit pas sourciller le maître du Gypaète. Il se tourna vers Astéras et continua flegmatiquement :
– J’ai cherché à réduire l’étendue des ailes, d’abord pour la question du moteur, ensuite pour diminuer les chances d’avaries et j’ai trouvé. J’ai purement remplacé l’étendue par la vitesse. Les ailes de mon aéronef donnent jusqu’à mille battements à la minute.
– Mille ?… C’est prodigieux, mais votre force motrice ?
– Est insignifiante, car l’effort répété aussi fréquemment peut être presque nul. Si je donnais, en effet, un coup d’aile par minute, il devrait produire la même quantité de travail utile ; ce serait effroyable. Tandis qu’avec ma vitesse, chaque palpitation ne doit apporter qu’un millième de cette quantité.
– Très exact, reste la question du moteur.
À ces mots, Ramier prit une pose avantageuse, et saisissant son bâton de craie, il dessina rapidement sur le tableau noir.
– Voici le schéma de l’appareil que j’ai imaginé, dit-il enfin d’un ton triomphant. À la partie supérieure se trouve un réservoir de carbure.
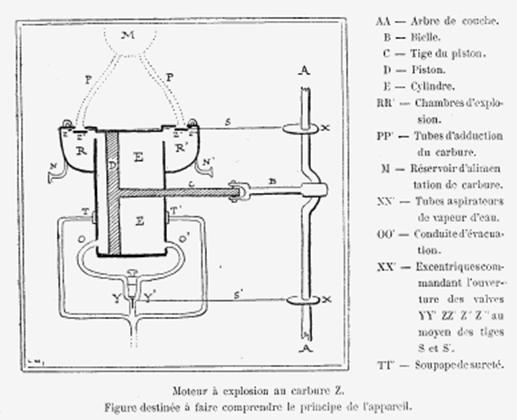
– Ah ! s’exclama l’astronome, une machine à acétylène.
Le fou eut une moue dédaigneuse :
– Non pas. C’est un carbure nouveau, découvert et liquéfié par moi, dont la puissance est à celle de l’acétylène comme un à 10. Une gouttelette du liquide tombe alternativement dans les godets placés de chaque côté du corps de pompe. N’étant plus comprimée, cette goutte se réduit en gaz et pousse le piston à la façon de la vapeur dans les locomotives. La tige du piston actionne un arbre de couche qui agit sur les ailes. Cet arbre porte deux excentriques réglant au moyen de tiges l’ouverture des soupapes qui permettent l’introduction du carbure liquide et l’expulsion du gaz carburé.
Et comme Astéras battait des mains, le fou conclut :
– J’ai à bord dix machines de ce genre. Deux pour chaque aile, deux pour l’hélice d’arrière et le gouvernail, chacune pèse trente kilogrammes.
– Superbe !
– Pour m’éclairer, j’ai l’électricité. Un système de peignes métalliques suspendus à des fils conducteurs, soutire pendant la marche, l’électricité de l’atmosphère et l’emmagasine, dans des accumulateurs spéciaux.
– Renversant !
– Maintenant vous connaissez le Gypaète au point de vue mécanique. Comme habitabilité, il ne laisse rien à désirer. Un couloir central le dessert. À droite et à gauche sont les cabines, le salon, la salle à manger ; à l’avant et à l’arrière, les chambres des machines, où se tiennent les quatre hommes de mon équipage.
Lavarède poussa un cri :
– Vous avez un équipage ? Ce n’est pas une navigation ?
– Naturellement.
– Vous avez trouvé des hommes qui ont consenti à vivre entre ciel et terre ?
– Oui, gronda Ramier avec amertume. Des gens que les êtres brutaux, qui rampent à la surface du sol, appelaient fous… comme moi.
– Ah ! on vous traitait… ?
– En fous. Enfermé à l’asile Sainte-Anne, c’est parmi mes codétenus que j’ai rencontré la sagesse. Nous nous sommes évadés. Ma femme restée libre avait réalisé notre fortune. Nous avons quitté notre pays, fait fabriquer dans des maisons différentes les diverses pièces du Gypaète, nous les avons montées nous-mêmes dans les déserts glacés du nord de l’Amérique. Puis nous nous sommes envolés dans les airs, en disant un adieu définitif aux terres habitées par les hommes injustes et stupides.
Le petit homme s’était animé. Ses yeux brillaient étrangement, une expression hagarde envahissait sa physionomie. Avec inquiétude, Astéras et Robert échangèrent un regard.
– Vous n’atterrissez donc jamais, hasarda timidement ce dernier ?
– Dans quel but ?
– Mais pour déposer sur le sol des voyageurs comme nous.
Les traits du fou se contractèrent, et d’une voix irritée il répondit :
– Jamais vous ne me quitterez.
– Pourtant, s’écria Lavarède avec un commencement de colère… ?
– Jamais, jamais, répéta l’insensé. Comme moi vous vivrez de la vie libre du ptérodactyle aux premiers jours du monde, et si vous jouissez de votre bon sens, vous ne vous souviendrez de l’humanité que pour la maudire.
Vivement Astéras se rapprocha de son ami :
– Ne l’irrite pas. Qui sait à quelles extrémités le pourrait porter sa folie. N’oublie pas que nous sommes à plusieurs centaines de mètres du sol.
La réflexion apaisa sur-le-champ la fougue de l’ancien caissier. D’un brusque effort il se domina, et ce fut d’un ton conciliant qu’il tenta de prendre son hôte par la vanité.
– Oh ! dit-il, je ne tiens pas pour mon compte personnel à retourner parmi les hommes.
– À la bonne heure, approuva Ramier, calmé par cette déclaration.
– Seulement je trouve triste qu’un génie comme le vôtre reste ignoré ; si je parlais de descendre à terre, c’était pour répandre votre merveilleuse découverte, pour peupler les villes de vos statues…
Il aurait continué longtemps sur ce ton, mais le fou secoua la tête :
– Je ne veux rien des humains. Qu’ils m’ignorent toujours ; ils m’ont enfermé dans une maison de fous, j’ai peur d’eux.
– Ils n’avaient pas compris, mais aujourd’hui que le Gypaète existe, qu’il fend majestueusement les airs…
– Eh ! clama impétueusement le petit homme, je ne veux pas qu’ils le soupçonnent.
– Trop tard, plaisanta Robert.
– Que voulez-vous me faire entendre ?
– Que durant les nuits sombres, le fanal du Gypaète a attiré l’attention sur lui. Que les astronomes le cherchent. – Il regarda railleusement Astéras et continua : – Ils pensent être en présence d’un bolide, mais bientôt un observateur découvrira la nature de cette lumière errant dans l’espace.
Ramier écoutait en dodelinant la tête. Robert crut un instant qu’il hésitait. Il voulut porter un dernier coup à son interlocuteur ; celui-ci ne lui en laissa pas le temps :
– Ah ! fit-il avec un accent singulier, les observatoires s’occupent de moi ?
– Beaucoup. Sans cesse des lunettes explorent le ciel… depuis le jour où le colonel Mooger, directeur de l’observatoire libre de Barget au Kamtchatka, a télégraphié qu’il avait remarqué dans le ciel un objet lumineux se déplaçant avec une grande rapidité.
– Ah ! Ah ! murmura le fou, c’est le colonel Mooger, de la station de Barget… ?
– C’est lui-même.
– Eh bien nous irons lui rendre visite.
Lavarède sursauta :
– Vous prétendez nous emmener au Kamtchatka ?
– Puisque j’y vais moi-même ; vous ne regretterez pas le voyage, vous verrez… Ah ! ce bon colonel Mooger ! Vous verrez.
Et d’un bond, Ramier gagna la porte, rouvrit et disparut, tandis que Robert, décidément exaspéré, rugissait :
– En Sibérie maintenant ! C’est donc le voyage forcé à perpétuité. Ah mais, j’en ai assez, j’en ai trop. Je suis paisible, sédentaire, je ne veux plus être traité en nomade.
Astéras s’efforçait vainement de le calmer, quand la porte se rouvrit. Un grand gaillard entra. Il était vêtu d’une vareuse et d’un pantalon, sur lesquels des plumes d’oiseaux figuraient des arabesques bizarres.
– Messieurs, dit-il, veuillez m’accompagner à la cabine qui vous est réservée. Vous pourrez vous reposer sans crainte. Dans l’air il n’y a pas de mauvaises gens comme sur la terre. Personne ne vous enfermera à Sainte-Anne.
Le nom de l’asile d’aliénés, résonnant pour la seconde fois aux oreilles de Lavarède, transforma son courroux en terreur. Celui qui parlait était un homme de l’équipage du Gypaète, un fou encore. Il songea à Lotia, emportée comme lui dans la course mystérieuse d’un aéronef dirigé par des insensés.
Sa situation était effrayante, épouvantable, mais nulle résistance n’était possible. Il fallait céder, attendre une occasion favorable de tromper la manie de leurs gardiens.
Il courba le front et, accompagné par Astéras, il suivit le matelot aérien. Ce dernier ouvrit une porte donnant sur le couloir central, s’effaça pour laisser passer les Français et s’esquiva après les avoir salués d’un « dormez bien » guttural.
Les deux amis étaient seuls dans une cabine assez spacieuse, garnie de deux couchettes, d’une table de toilette bien garnie et de quelques chaises.
Chacun s’affaissa sur un siège et demeura là, sans voix, sans pensée, hébété par ce concours déconcertant de circonstances qui l’avait entraîné de Paris à bord d’un navire aérien portant un équipage d’aliénés.
CHAPITRE III
QUELQUES INSTANTS DANS LA LUNE
La lassitude triomphe des pensées les plus moroses. Robert et Ulysse succombèrent au sommeil. Ils furent réveillés par un matelot qui leur annonça que le déjeuner était servi.
Avec effort, ils se dressèrent sur leurs pieds, et, les jambes raides, la tête lourde, ils gagnèrent la salle à manger, où déjà, autour de la table, leurs compagnons et leurs geôliers avaient pris place.
Il leur suffit d’un coup d’œil pour s’assurer que ni Lotia, ni Maïva, ni Radjpoor n’avaient trouvé à bord du Gypaète plus de repos qu’eux-mêmes.
Les jeunes filles étaient pâles, leurs yeux étaient cernés ; une expression d’inquiétude attristait leurs jolis visages. Quant à Radjpoor-Thanis, il semblait encore plus mal en point que les douces Égyptiennes. Évidemment elles et lui avaient parlé à Mme Hirondelle.
Ils savaient aux mains de qui ils se trouvaient.
– Eh ! vous voici, dit gaiement Ramier. Hein ! on dort bien en plein ciel ? On n’est pas dérangé, comme dans les grandes villes, par le bruit de la foule, le roulement des voitures, les cornes de tramways. Vous adorerez votre nouvelle existence quand vous la connaîtrez mieux. En attendant, veuillez prendre place et ne craignez pas de manger. Dans cet air pur, où le microbe est inconnu, l’appétit est de rigueur.
Il désignait de la main deux sièges restés vides, l’un à la gauche de sa femme, l’autre auprès de Maïva.
Astéras s’empara de ce dernier, laissant la place d’honneur à son ami. Un furtif serrement de main de Maïva le récompensa aussitôt, et la mignonne se penchant vers lui, murmura de sa voix chantante :
– Peur !
L’astronome la rassura du geste et le repas commença. En vérité, les convives du fou pensaient rêver. Le menu était celui d’une maison bourgeoise, terrestre.
Sardines
Tripes à la mode de Caen
Tanches grillées sauce tomates
Filet de bœuf aux champignons
etc., etc.
Au filet, Lavarède n’y tint plus, et s’adressant à Ramier qui mastiquait avec bruit :
– Vous m’avez affirmé que vous ne descendiez jamais à terre.
– C’est exact.
– Eh bien, à moins que je ne sois le jouet d’une hallucination, nous dégustons en ce moment un filet de bœuf ?
– Vous ne vous trompez pas.
– En ce cas, je ne comprends plus. Les filets de bœufs n’ayant pas l’habitude d’aller se promener dans les nuages, comment celui-ci figure-t-il sur votre table ?
Ramier éclata de rire, Mme Hirondelle l’imita. Leur gaieté était si franche, que les voyageurs, oubliant leurs craintes, finirent par s’associer à leur hilarité. Enfin le fou parvint à se dominer.
– Vous n’êtes pas observateur, fit-il avec indulgence.
– En quoi ai-je manqué d’observation ? questionna l’ancien caissier.
– En ceci, que mieux que personne vous devriez être en mesure de répondre à votre question, puisque vous êtes arrivé à bord du Gypaète de la même façon que ce morceau de bœuf… Une petite tranche encore, n’est-ce pas ?
Tout en tendant son assiette, Lavarède reprit :
– Je vous avouerai que je ne me suis pas rendu compte de l’événement. Comme je courais dans le désert, j’ai senti un choc aux jambes, je suis tombé à la renverse, j’ai perdu connaissance et me suis retrouvé ici.
– Comme moi, firent d’une seule voix les compagnons du jeune homme.
– Alors c’est différent. Je vais vous instruire. Au-dessous de nos appartements, se trouvent des caves en quelque sorte, où se trouvent mes provisions de carbure, de vivres, mes pièces de rechange pour les machines et cœtera. Des cloisons les divisent en compartiments. Dans l’un est enfermée une vaste poche en filet. Veux-je chasser : j’adapte à cette poche une tige souple et résistante faite de fanons de baleine réunis ensemble ; j’ouvre une trappe située à la partie inférieure de l’aéronef, et je laisse filer mon appareil au bout d’un câble jusqu’à ras de terre. Alors je commande en avant, je poursuis l’animal que je désire, je l’atteins, la perche le frappe aux jambes, le renverse dans le filet et je le hisse à bord. En un mot je chasse au vol.
Et comme tous se regardaient avec une surprise évidente :
– C’est ainsi que j’ai procédé pour vous-mêmes. J’avais juré de n’avoir plus aucun rapport avec l’humanité, mais en vous voyant traqués par des ennemis qui cherchaient à vous fusiller, j’ai été pris de pitié. Ceux-là, me suis-je dit, sont des victimes comme moi, je dois leur porter secours. Voilà comment nous déjeunons ensemble aujourd’hui.
Ces dernières paroles avaient été prononcées d’un ton ému, avec une réelle noblesse. Toutes les mains se tendirent vers le fou qui, obéissant à une impulsion généreuse, avait arraché les captifs de Sir Parker à une mort certaine.
Ramier parut enchanté. Il serra les doigts de ses invités et doucement :
– Je vais faire modérer la vitesse du Gypaète, nous prendrons le café sur le pont, et en face du sublime spectacle qui s’offrira à vos yeux, vous deviendrez tout à fait des nôtres.
Cinq minutes après, tous étaient rassemblés sur le pont, qu’un léger velarium abritait des ardeurs d’un soleil de feu.
Ramier avait dit vrai. Penchés sur la balustrade, les voyageurs regardaient pétrifiés par l’admiration. L’aéronef planait par 3.000 mètres d’altitude au-dessus de l’océan Pacifique. À cette distance, la mer prenait une teinte sombre sur laquelle se détachaient comme des plaques d’émeraude d’interminables chapelets d’îlots verdoyants. Cela tenait du rêve, et en voyant de si haut la terre, Lavarède se surprit à oublier qu’il était un des enfants les plus sédentaires du globe qui fuyait sous ses pieds.
– Que cela est beau, murmura-t-il enfin en tendant la main, dans un besoin d’effusion, à la personne la plus proche de lui.
Il tressaillit en la reconnaissant. C’était Lotia. Elle aussi le considéra, le regard troubles comme au sortir d’un songe. Elle aussi avança sa main fine, mais le mouvement commencé ne s’acheva pas. Elle tourna la tête vers Radjpoor qui, immobile à l’extrémité opposée du pont, l’observait d’un air sombre.
Alternativement ses yeux se portèrent sur les deux hommes. Une incertitude poignante se peignit sur son visage, et elle murmura :
– Qui donc a menti ?
– Bon, ce n’est pas moi, répliqua le Français.
Elle le considéra encore. L’expression douloureuse de ses traits s’accentua et tristement :
– Le sais-je ? Perdue au milieu du ciel, dans les régions que parcourt seul l’esprit d’Osiris, c’est à lui que je demande de faire éclater la vérité à mes yeux.
Puis avec un soupir :
– Peut-être ne m’as-tu pas trompée ; peut-être la sincérité est-elle chez Radjpoor-Sahib. J’hésite, je flotte ; des pensées contradictoires se heurtent sous mon front. Infortunée Lotia ! Pauvre Égypte !
D’un pas lent, elle s’éloigna sans que Robert fît un mouvement pour la retenir. Une joie immense chantait en lui. Lotia ne l’accusait plus brutalement.
Le doute avait germé dans son esprit. Et ce doute n’était-il point l’aurore d’une période heureuse, où la jolie Égyptienne comprendrait et partagerait son affection.
Bercé par cette idée radieuse, il continua de remplir ses yeux de l’admirable panorama qui défilait sous l’aéronef.
La fille de Yacoub s’était approchée de Maïva, à qui Astéras parlait. Ni l’un ni l’autre ne s’aperçurent de sa présence. L’astronome disait :
– Oui, Maïva, l’aventure est bienfaisante. Mon pauvre Robert était triste, sous le coup des plus noires accusations. Mais ici, en plein ciel, voisins du soleil, proches des étoiles dont la lumière ne nous apparaîtra plus obscurcie par les brumes de la terre, il est impossible que Lotia n’atteigne pas à la vérité.
Celle dont il prononçait le nom frissonna. Le savant exprimait la pensée que tout à l’heure, elle-même avait trouvée sur ses lèvres. Est-ce que vraiment son âme s’était égarée à ce point d’avoir confondu l’innocent et le coupable.
Du regard elle chercha Lavarède. Il était accoudé sur la balustrade ; un sourire béat éclairait sa figure loyale. Puis elle tourna les yeux vers Radjpoor, et rencontrant sa prunelle noire obstinément fixée sur elle, une sorte de malaise l’envahit. Elle avait cru en lui, et maintenant, il lui semblait que sa foi chancelait, que les ténèbres l’environnaient. Impatiemment elle secoua la tête.
Mais Astéras continuait sans prendre garde à elle :
– Vois-tu, Maïva, faisait-il, toute bonté, toute justice, sont dans les étoiles. Ce qui rend les hommes cruels, pervers, c’est qu’ils s’hypnotisent dans la contemplation de la terre qu’ils prétendent se partager, comme si la mort fatale, inévitable, ne devait pas mettre un terme à leurs ambitions. Les sages lèvent la tête, ils regardent en haut, et leurs yeux se troublant aux rayons des astres, soleils lointains gravitant dans l’espace, ils pressentent que l’homme n’est rien dans l’infini, qu’une petite mousse parasitaire grandie à la surface du globe ; que l’idée du bien et du juste sont tout, et qu’eux-mêmes ne seront quelque chose dans l’harmonie de l’univers qu’en se consacrant au triomphe de cette idée.
Et souriant à l’ex-muette, qui l’écoutait religieusement :
– En dehors de cela toute science est vaine, nos moyens d’investigation étant bornés. Toute ma vie a été employée à étudier le ciel. Suis-je plus avancé qu’au premier jour ? Oui, en ce qui concerne ses dimensions ; j’ai appris son immensité, j’ai senti que, si, depuis l’apparition de l’homme sur la terre jusqu’à nos jours ? des calculateurs avaient compté sans cesse, énoncé les dizaines, les centaines, les milliers, les millions, celui qui continuerait cette tâche ardue se trouverait en présence de nombres de neuf cents ou de douze cents chiffres, et que ces nombres formidables, incompréhensibles pour notre entendement, seraient seulement la mesure d’un point dans l’infini. Mais après ? Sur la constitution de l’espace, sur celle des innombrables systèmes solaires de l’univers, que sais-je ? Rien. Des hypothèses plus ou moins rationnelles et c’est tout.
– Encore, encore, soupira la voix douce de Maïva, gourmande de cette poésie grandiose de l’Astronomie.
– Tiens, poursuivit sans se faire prier Astéras, dont la face rayonnait de la joie d’exprimer ses idées les plus chères ; prenons la Lune, notre voisine immédiate, qui se balance à une distance ridicule, 90,000 lieues en chiffres ronds. Pour les uns, c’est un astre mort. Privée d’air et d’eau, disent-ils, la Lune n’est pas habitable. Pardon, répondent les autres, ce n’est point là une raison ; ne pouvons-nous imaginer des êtres à la vie desquels ni l’eau ni l’air ne soient nécessaires. La différence qui existe entre les habitants des mers et ceux des continents ne prouve-t-elle point que les moyens dont dispose la nature n’ont pas de limites, et dès lors, pourquoi déclarer déserte une planète, simplement parce que notre humanité n’y saurait vivre ? Lesquels ont raison ?
– Ce sont les seconds, dit auprès d’eux une voix tranquille.
Astéras, Maïva, Lotia elle-même se retournèrent. Ramier s’était approché sans bruit, et il se dandinait d’un air avantageux :
– Ceux qui prétendent la lune habitée, reprit-il, ont raison.
– Comment pouvez-vous affirmer cela, interrogea l’astronome en se levant précipitamment ?
– Grâce à un modeste auxiliaire.
– Qui se nomme ?
– La photographie.
Et d’un ton emphatique, le fou ajouta :
– Si vous daignez m’accompagner, je vous montrerai des clichés qui ne laisseront subsister aucun doute dans votre esprit.
Point n’était besoin de répéter cette alléchante observation. Tous se portèrent au panneau donnant accès à l’intérieur du Gypaète, et bientôt ils furent rassemblés dans le bureau, où déjà Robert et Ulysse avaient pénétré lorsque Ramier leur avait exposé les principes de son appareil.
Tranquillement le petit homme ouvrit une boîte de chêne et en tira une plaque qu’il mit sous les yeux de ses compagnons.
– Ceci, dit-il est une photographie directe de la montagne lunaire désignée sur les cartes sélénographiques sous le nom de Mont-Copernic. C’est évidemment un ancien volcan. La ceinture montagneuse annulaire a une vingtaine de kilomètres d’épaisseur. Une plaine de soixante kilomètres de diamètre environ occupe le fond du cratère, et plusieurs pics s’élèvent vers le centre.
– Tout cela m’est familier, répliqua vivement Ulysse. À l’observatoire de Paris, on possède des clichés aussi nets, mais il n’y a rien là qui prouve l’existence d’êtres animés.
Le fou ne se troubla point.
– Attendez. Grâce à un système d’agrandissement que j’ai imaginé, j’ai trouvé la preuve que vous cherchez, la voici :
Et fouillant prestement dans un carton à demi dressé le long de la cloison, il en sortit une feuille de papier épais.
– Qu’est cela ?
– C’est l’agrandissement de la partie ouest du cratère de Copernic.
– Mais cette ligne sinueuse qui descend les pentes et vient aboutir au massif central ?
– C’est une route.
– Une route ?
La voix de l’astronome tremblait. Quoi, le problème ardu de l’habitabilité de la Lune serait résolu dans le sens de l’affirmative. Des routes sillonneraient la surface de l’astre des nuits ! Mais cela supposerait l’existence d’êtres pensants, d’ingénieurs, de terrassiers.
– Quel rêve, murmura-t-il sans s’apercevoir qu’il parlait à haute voix.
Mais le fou répliqua avec une pointe d’impatience :
– Ce n’est pas un rêve.
– Pourtant il faut se défier des apparences.
– Oui, mais il faut aussi accueillir les certitudes. Ici la certitude existe. Vous l’allez voir tout à l’heure. Auparavant laissez-moi vous rappeler que la lune ne connaît ni le printemps, ni l’automne. Son année se compose d’un jour de 364 heures, c’est l’été, et d’une nuit d’égale durée qui est l’hiver. Durant le jour, la température dépasse celle du Sénégal, soit 60°, au-dessus de zéro ; la nuit vient, et soudain le climat du pôle Nord se fait sentir, c’est-à-dire que la surface lunaire est glacée par 40 ou 60 degrés au-dessous de zéro.
– Nous nous écartons de notre sujet, grommela le savant non sans humeur.
– Pardon, répondit Ramier, ce préambule était nécessaire. Étant donné l’écart de près de cent degrés entre les deux saisons de notre satellite, il est permis de supposer que les habitants vivent de façon différente pendant chacune d’elles.
– Les habitants, s’il y en a, marmotta Lavarède.
Sans relever l’interruption, le petit homme poursuivit :
– Nous voyons, en Russie, les populations, se tenir enfermées à l’époque des frimas et vivre au dehors dès que les souffles tièdes du printemps réchauffent l’atmosphère.
Par analogie, les lunatiques, on peut le penser, sont susceptibles d’agir de même.
Ceci établi, veuillez remarquer que la route du cirque de Copernic, part d’un point sombre et aboutit à un point également noir ; sans doute ce sont là des entrées de cavernes, de cités souterraines où ils se cloîtrent pendant leurs longues nuits.
– C’est la fable des troglodytes, s’exclama ironiquement Robert.
– Mais, reprit imperturbablement le fou, le soleil reparaissant au-dessus de l’horizon, ils sortent de leurs cavernes, vaquent à leurs travaux, trafiquent, échangent, cultivent, chassent, au milieu d’une faune et d’une flore dont nous ne saurions avoir idée.
S’ils existent comme je le prétends, si ce que représente mon cliché est une route, il doit s’y produire des mouvements.
– Eh bien, interrogea avidement l’astronome, devinant que son interlocuteur arrivait au point intéressant de sa communication ?
– Eh bien, dit paisiblement Ramier, cela est.
Un véritable rugissement s’échappa des lèvres d’Ulysse.
– Cela est. La preuve… la preuve.
– Je vais vous la présenter.
Et tout en fouillant de nouveau dans le carton, le capitaine du Gypaète parla ainsi :
– À diverses reprises mon attention avait été appelée sur la présence de points noirs à la surface blanche de la route de Copernic. Dans l’ordre des pensées où je me trouvais, je me demandai si ce n’étaient point là les Sélénites que je pressentais.
Dans l’impossibilité d’obtenir des agrandissements plus considérables de mes clichés – je cherche actuellement à résoudre ce problème et j’y réussirai – je compris que le seul moyen de m’éclairer était de me démontrer à moi-même que ces points imperceptibles étaient doués de mouvement.
– Et ?
C’était Astéras qui, incapable de se contenir, formulait cette ardente interrogation.
– J’ai appliqué la cinématographie à mon examen. Des clichés successifs obtenus ainsi m’ont permis de déterminer la marche de mes points noirs sur la route. Voici une des images dont il s’agit :
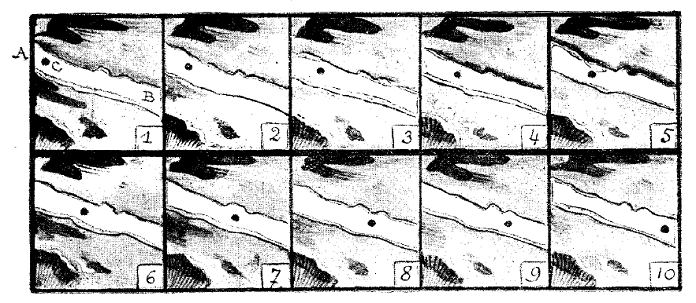
Et tandis qu’Astéras, les pupilles dilatées, regardait les dix clichés Ramier susurra avec une modestie affectée :
– Un point C étant figuré sur une section de route A B, il est évident que si la projection cinématographique le porte de A en B, il est doué d’un mouvement propre, c’est-à-dire qu’il est animé. Or, dans la résultante de ces diverses épreuves ledit point C, occupant successivement les positions marquées sur chacune, marche de A en B. Êtes-vous convaincu ?
– Oui, oui, balbutia l’astronome d’une voix haletante. On ne saurait le nier. Des êtres animés parcourent cette route lunaire ! Mais quels sont ces vivants ! Quels sont-ils ?
Ramier leva un doigt en l’air et d’un ton prophétique :
– Patience ! Patience ! Mes grossissements ne me permettent pas encore de répondre, mais puisque cela vous intéresse, nous chercherons ensemble ; nous surprendrons la forme de ce point animé. Allez, vous bénirez le jour où vous avez mis le pied à bord de mon Gypaète. Bientôt nous photographierons l’intérieur des cavernes où les Sélénites se réfugient, alors que la nuit de douze jours couvre le sol de leur planète.
À ces mots, Ulysse stupéfait ne trouva rien à répondre, la voix lui manquait ; mais sa mimique expressive disait sa curiosité.
– Vous connaissez les rayons noirs, fit complaisamment son interlocuteur.
On les appelle noirs, ultra violets, Rœntgen, X. Ils ont la propriété de traverser les corps opaques. Eh bien ! j’ai inventé, sauf quelques menus détails à trouver encore, des plaques photographiques insensibles aux rayons lumineux, et qui seront impressionnées par ces seuls rayons X, ainsi les rayons noirs émanant de la lune nous révèleront les secrets de la vie sélénite !
Il semblait transfiguré ; une émotion communicative faisait trembler sa voix. D’un mouvement brusque l’astronome lui prit les mains et avec un accent d’inexprimable admiration :
– Ah ! Maître ! Maître ! bégaya-t-il, quel génie y a-t-il donc en vous !
La physionomie de Ramier se contracta, un rire strident s’élança de ses lèvres.
– Du génie, mon pauvre ami Grand-Duc, – pour la première fois, il appliquait au savant le surnom dont il l’avait gratifié lors de son arrivée, – du génie, mais je suis fou, fou à lier. Vos amis l’Aigle, Milan, Mésange et Fauvette le pensent. – il désignait les assistants – on le pensait sur la terre, puisque l’on m’a enfermé à Sainte-Anne. Ah ! ah ! ah ! Je suis fou ! Les sages sont ceux qui se promènent en liberté sans penser à rien. Ah ! ah ! je suis fou, fou, fou comme Salomon de Caus dont le génie s’éteignit entre les murs d’un cabanon.
Il aurait continué longtemps sur ce ton, si Mme Hirondelle ne s’était avancée vers lui en disant avec calme :
– Oublions cela, Ramier, nous n’avons plus rien de commun avec l’humanité !
Ces simples paroles apaisèrent le fou comme par enchantement. Son exaltation tomba, ses yeux se voilèrent :
– C’est vrai, au fait, s’écria-t-il joyeusement. Où avais-je la tête de me tracasser pour les terriens – et passant amicalement son bras sous celui d’Astéras. – Venez, mon cher Grand-Duc, nous allons travailler.
Poliment, il confia les autres voyageurs à sa femme et s’enferma avec l’astronome qui allait devenir le confident de ses travaux.
CHAPITRE IV
SOUS LE CERCLE POLAIRE ARCTIQUE
Les voyageurs étaient désormais tiraillés par des sentiments opposés. Ni la folie, ni le génie de Ramier n’étaient niables, et tandis que la première les faisait trembler, ils se sentaient pénétrés de respect pour le second.
Trois jours se passèrent ainsi. Astéras consacrait chaque matin une heure à compléter la guérison de Maïva, puis il s’enfermait avec Ramier dans le laboratoire. Lui au moins ne souffrait pas du voyage, absorbé qu’il était par l’étude passionnante de l’infini. Quand ses amis, un peu jaloux de sa superbe tranquillité, la lui reprochaient, il se contentait de répondre avec un bon sourire :
– Bah ! Pourquoi me tarabuster ? Je me réfugie dans la science qui fait tout oublier. Mes recherches d’ailleurs ne sont pas exemptes d’amertume, car j’ai conscience que chacun de mes efforts rapproche l’instant terrible où l’homme saura de l’infini tout ce qu’il est permis à notre race d’en surprendre.
Et mélancoliquement il ajoutait :
– Le jour viendra où nos télescopes, de plus en plus puissants, découvriront des étoiles de plus en plus éloignées. Les points brillants, qui parsèment le ciel, augmenteront en nombre, se serreront incessamment et finiront par se toucher. Alors il faudra s’arrêter, car entre nos yeux et l’infini s’étendra un rideau de soleils. De même, le microscope, scrutant la goutte d’eau, à force de découvrir des organismes plus ténus, atteindra la limite des investigations qui lui sont permises, en rencontrant le rideau compact des infiniment petits. Ce jour-là, l’humanité aura accompli son œuvre qui est de mesurer une minime section de l’espace entre une barrière de bacilles et une barrière d’étoiles. Elle aura ainsi préparé, chaînon modeste dans la chaîne sans fin des êtres, l’avènement d’une race plus vigoureuse, plus intelligente qui, à son tour, poursuivra l’ascension éternelle vers la Vérité.
Puis, laissant ses auditeurs un peu abasourdis, il retournait au laboratoire.
Lavarède, Lotia, Radjpoor, Maïva lisaient. Après les repas, ils montaient sur le pont. La température se rafraîchissait à chacune de ces ascensions. Évidemment le Gypaète poursuivait sa course vers le Nord avec une inconcevable rapidité.
Dès le troisième jour, les voyageurs avaient dû revêtir des casaques ouatées de plumes, que Mme Hirondelle avait gracieusement mises à leur disposition.
Le quatrième, en arrivant sur le pont, ils poussèrent un même cri de surprise. L’aéronef planait au-dessus d’une région glacée. À perte de vue, la campagne était couverte de neige, et la configuration de la côte était indiquée par un chaos titanique de blocs de glace. Comme toujours, la pression, dans le voisinage des terres, avait disloqué l’ice-field[6] étendu sur la surface de la mer. C’était un enchevêtrement indescriptible d’aiguilles, de cubes, de polyèdres. En certains endroits, soit qu’il existât un courant sous-marin constant, soit pour toute autre cause, la croûte glacée affectait la forme d’une rue bordée de palais ruinés.
– Où sommes~nous, demanda Robert ?
Ramier qui avait rejoint ses hôtes répondit :
– Kamtchatka !
Et désignant au loin un dôme neigeux émergeant du sol, il ajouta :
– Observatoire de Barget.
Le Français ressentit comme un choc dans la poitrine. L’observatoire de Barget était le but indiqué par le fou, quand il avait appris que ce poste d’observation avait le premier signalé l’apparition du Gypaète dans le ciel. Certes, les astronomes n’avaient point cru à l’existence d’un aéronef, ils l’avaient qualifié de « bolide irrégulier », mais leur curiosité avait irrité Ramier, lui avait fait modifier sa route. Songeait-il donc à se venger d’une indiscrétion toute scientifique ?
Sous l’empire de ces pensées, Robert interrogea le petit homme, et avec une crainte vague :
– Pourquoi donc êtes-vous venu en ce point désolé du globe ?
L’autre ricana :
– Pour donner une leçon à des observateurs impertinents.
– Mais inconscients. Ils ignoraient quel appareil ils avaient dans le champ de leur lunette.
– S’ils l’avaient su, croyez-vous qu’ils auraient gardé le silence.
Lavarède se tut, embarrassé par cette question si nette.
– Vous ne le pensez pas, reprit le fou. Ils se seraient empressés de me dénoncer à tous les observatoires de l’univers. L’humanité s’occupe de moi, je ne le veux pas, et désormais la guerre est allumée entre les établissements astronomiques et moi. Pour ceux-ci je serai clément, car je suis pressé d’atteindre le pôle.
Le pôle ! Robert chancela.
– Le pôle ? fit-il avec effort, nous allons au pôle ?
– Aussitôt ma petite affaire avec Barget-house réglée. J’ai besoin de renouveler ma provision de carbure, et ma réserve est là-bas.
L’ancien caissier n’eut pas l’énergie de protester, mais il lança un mauvais regard à Radjpoor, puis il se retira à l’écart. Si l’un de ses amis s’était approché de lui, il l’eût entendu murmurer avec un découragement profond :
– Ce misérable Thanis ne périra que de ma main. Au pôle nord ? moi qui étais né pour l’existence paisible des caissiers honnêtes, on me lance vers le pôle, on m’oblige à recommencer les exploits de Behring, de Cook, de Franklin, de Bellot, de Nordenskiold, de Payer et Weyprecht, de Lockrood, de Baffin, de Nansen. On me traîne dans les pays froids, alors que je ne me sens aucune vocation pour ce genre de pérégrinations. Je me vengerai.
Il était en train de formuler les plus terribles serments de haine, quand Astéras, qui venait de causer quelques instants avec Ramier, accourut vers lui, et sa face ronde rayonnant de joie :
– Tu ne sais pas, nous gagnons le pôle.
– Si, je le sais !
– Et tu ne te réjouis pas !
La figure de Robert exprima l’ahurissement.
– Me réjouir, quand je suis emporté vers ce point mystérieux qui a coûté la vie à tant d’explorateurs ?
– Ils n’avaient point un Gypaète.
– Jolie invention que le Gypaète.
– Tu as tort d’en médire. Songe donc, quelle gloire à notre retour lorsque nous présenterons à l’Académie un mémoire sur le pôle jusqu’à nous inabordable.
C’en était trop. La colère de Lavarède éclata :
– Va-t-en au diable ! Garde-toi qu’un ours blanc ne mette fin à tes rêves ambitieux. Va, va, quand tu seras dans l’estomac d’un de ces carnassiers, nous verrons bien si tu prépares des mémoires à l’Académie.
Et l’astronome voulant discuter encore, le jeune homme lui tourna le dos et quitta le pont de l’aéronef.
Il faut bien le dire, Maïva et Lotia ne partagèrent pas le courroux de l’ancien caissier. Les jeunes filles s’accoutumaient à leur nouvelle existence. L’idée du danger s’affaiblissait, et même elles s’enthousiasmèrent avec Astéras à la pensée de fouler du pied le point précis que traverse l’axe idéal autour duquel s’exécute le mouvement de rotation de la terre.
Radjpoor seul ne manifesta pas son opinion. Toujours sombre, replié sur lui-même, il n’échangeait que quelques paroles brèves avec ses compagnons de captivité.
Au fond, il enrageait de l’aventure qui l’avait jeté avec eux à bord de l’aéronef. Il avait perdu la confiance de Lotia. Le diamant d’Osiris restait en la possession de Robert. Son mécontentement était encore exacerbé par l’insistance que mettait Maïva, à présent qu’elle prononçait quelques mots, à le désigner toujours sous le nom de « Thanis ».
Chaque fois, il voyait tressaillir Lotia ; chaque fois, il lisait dans les yeux de la fille de Yacoub une irrésolution plus douloureuse ; il étouffait de devoir réfréner sa rage, de ne pouvoir frapper celle qui le démasquait.
Cependant, ce jour-là, le Gypaète avait modéré sa vitesse. Il décrivait dans l’atmosphère des crochets incessants autour de l’observatoire de Barget. On eût dit un milan prêt à fondre sur sa proie.
Malgré la promesse faite par Ramier de se montrer clément, tous étaient angoissés, attendant anxieusement que le fou dévoilât son plan de vengeance.
Le jour baissa, la nuit vint, nuit opaque dont les voiles noirs cachèrent la terre. Les Européens étaient rassemblés dans le salon. Ramier pensif ne prenait aucune part à leur conversation. Il semblait attendre, et tous, comprenant qu’il attendait l’heure de frapper, avaient le cœur serré.
Qu’allait-il faire ? Incapables de s’opposer à sa volonté, les passagers du Gypaète allaient-ils devenir les spectateurs impuissants, les complices involontaires d’une criminelle vendetta ?
Soudain il se leva.
– L’heure est venue, prononça-t-il d’une voix lente.
Il appliqua ses lèvres sur l’embouchure du tube acoustique qui se balançait le long de la paroi, et donna des ordres rapides. Les assistants entendaient le murmure de sa voix sans parvenir à discerner le sens de ses paroles.
Enfin il se redressa et s’adressant à ses hôtes :
– Nous allons rire. S’il vous plaît de m’accompagner, je crois que vous vous amuserez.
Sans attendre de réponse, il sortit du salon. Tous le suivirent. On gagna ainsi la chambre des machines, située à l’arrière. Là, le fou souleva une trappe découpée dans le plancher, et une échelle de fer apparut au milieu de l’ouverture béante.
On descendait donc à la cale du navire aérien, dans cette cale où Ramier enfermait ses provisions de carbure, ses vivres et ses appareils de chasse ? Sur ses pas, tous s’engouffrèrent dans la trappe.
Les dispositions de ce second étage reproduisaient exactement celles du premier, le seul où les voyageurs eussent été admis jusqu’alors : couloir central éclairé par des lampes électriques, et de chaque côté, des portes indiquant les divers compartiments.
Ramier ouvrit l’une d’elles et pénétra dans une salle assez spacieuse, plus large du haut que du bas, car l’une des parois épousait la forme curviligne du navire aux approches de la quille.
Le ronflement léger de la machine indiquait que l’appareil n’avait pas stoppé. Ramier se croisa les bras et, la tête baissée, attendit. Un silence de mort pesait sur l’assistance. Qu’eût-on pu dire à ce moment solennel, où allait se produire un événement préparé par un fou ?
Soudain le bruit des pistons cessa. Une minute longue comme un siècle s’écoula encore, puis deux hommes de l’équipage parurent.
– Allez ! ordonna Ramier !
Les matelots s’avancèrent sans hésiter vers la cloison courbe et se mirent à dévisser plusieurs boulons, qui bossuaient la paroi. Le flanc du Gypaète parut se déchirer, et tournant lentement sur ses charnières, une plaque de son revêtement s’ouvrit ainsi qu’une fenêtre.
Emporté par sa curiosité, Astéras se pencha vivement. Heureusement pour le distrait astronome, Robert le saisit d’une main ferme et le ramena en arrière. En effet, sous le panneau s’ouvrait le vide. À une quinzaine de mètres plus bas, on apercevait confusément un dôme couvert de neige.
– Filez le câble, commanda Ramier.
Aussitôt les matelots déclenchèrent un treuil, que les voyageurs n’avaient pas remarqué, et par l’ouverture béante une corde, portant à son extrémité un sac de toile, descendit lentement.
– Stop, fit encore le fou !
Le treuil enclenché, il regarda ses subordonnés et prononça ce seul mot :
– Allez.
L’un après l’autre, les marins de l’air empoignèrent le câble et se laissèrent glisser dans le vide.
Retenant leur respiration, les hôtes de Ramier suivaient tous leurs mouvements. Ils les virent prendre pied sur le rebord du dôme qui, de même que ceux de tous les observatoires, était mobile et tournait sur des galets. Un instant, les singuliers excursionnistes parurent chercher, puis ils atteignirent le secteur découvert, à travers lequel un équatorial était braqué sur le ciel ainsi qu’un obusier ; ils firent passer la corde par cette entrée astronomique, qui découpait sur le dôme blanc son triangle curviligne en noir, et disparurent à leur tour.
Dix minutes s’écoulèrent ; soudain, ainsi que des diables sortant d’une boîte, les matelots émergèrent de la coupole. Ramier actionna la manivelle du treuil, et bientôt le sac gonflé à se déchirer était hissé à bord. De nouveau le câble fut filé, et par le même procédé les matelots regagnèrent l’aéronef. Le panneau refermé, les boulons serrés « à bloc », le fou se tourna vers les assistants :
– Venez, dit-il, tandis que toute sa personne frétillait de joie, nous allons jouir de la surprise de ces bons astronomes.
Lavarède voulut l’interroger, mais déjà le petit homme s’était enfoncé dans le couloir central.
Force fut à ses hôtes de le suivre. D’un pas rapide, tous remontèrent à la salle des machines et revinrent dans le laboratoire. En y entrant, un changement dans la disposition du lieu les frappa. Devant le tableau noir s’étalait un écran de toile blanche.
Ramier le désigna du geste :
– Ceci est l’écran d’un téléphote, appareil qui permet de voir à distance. Mon téléphote est doublé d’un téléphone. Or, mes hommes ont posé les récepteurs sur la coupole. De la sorte, nous pourrons entendre et admirer les astronomes, lorsqu’ils s’apercevront que les objectifs, les miroirs de leurs lunettes et de leurs télescopes ont disparu. Ces objets sont maintenant à mon bord, et par suite de sa situation à l’extrémité du monde civilisé, l’observatoire du Kamtchatka sera durant de longs mois dans l’impossibilité de les remplacer.
Adieu les observations ! Cela apprendra aux savants impertinents à mettre le nez dans mes secrets.
Tous respirèrent plus librement après cette confidence. En somme, la vengeance du fou n’était pas cruelle. Le drame pressenti se terminait en vaudeville.
Et ma foi, les meilleurs d’entre les hommes étant disposés à se moquer de leurs semblables, les voyageurs furent pris d’une douce hilarité, en songeant à la mine déconfite des astronomes kamtchatkadales devant leurs instruments impuissants.
Cependant, Mme Hirondelle avait obstrué, à l’aide de volets pleins, les hublots par lesquels filtrait la pâle lumière des étoiles. Ramier éteignit le globe électrique, et la salle fut plongée dans l’obscurité.
Tous les yeux se portèrent sur l’écran. Lui-même était presque noir. Toutefois, en le considérant avec attention, on distinguait vaguement les détails de l’intérieur de la coupole, dont l’image, cueillie par les récepteurs, se projetait sur la surface de la toile.
C’était une vaste salle circulaire ; des instruments d’optique y étaient groupés dans un pittoresque désordre.
Personne ne s’y trouvait. Mais au fond de la pièce, une raie lumineuse, passant par les ais mal joints d’une porte, indiquait que les habitants n’étaient pas loin.
La lanterne magique du téléphone-téléphote présentait son décor aux passagers attentifs de l’aéronef.
Soudain le panneau s’éclaira. La porte de l’observatoire venait de s’ouvrir et l’image de deux hommes se reproduisait sur l’écran. C’étaient sans nul doute les astronomes dont les matelots de Ramier avaient violé le domicile.
Tous deux firent quelques pas dans la salle, échangeant des paroles dans un idiome incompréhensible pour les spectateurs. C’était du russe probablement. Puis l’un s’approcha de la lunette d’observation, avec l’intention évidente de mettre l’œil à l’oculaire.
Il eut un geste de surprise et parla vivement à son compagnon.
À ce moment, Ramier fit entendre un ricanement, et désignant l’écran :
– Ils s’aperçoivent que l’oculaire est enlevé. Ah ! ils vont être bien étonnés en constatant qu’il ne leur reste plus une lentille, ni un miroir.
Cependant les astronomes discutaient avec animation. Bien que le sens de leurs paroles échappât aux assistants, leur mimique était claire. Ils se demandaient où était l’oculaire, bien loin de soupçonner qu’à vingt mètres au-dessus de leurs têtes, des étrangers s’amusaient de leur déconvenue.
Mais la farce prenait corps. Après avoir vainement cherché, l’un des habitants de la coupole saisit une lunette, son camarade en prit une autre. Rien ne saurait peindre l’ahurissement de leurs physionomies. Les verres manquaient encore.
Alors ils se précipitèrent sur les divers instruments à leur portée, et constatant que tous étaient dépouillés de leurs lentilles, de leurs miroirs, ils se livrèrent à la plus extravagante des pantomimes.
À leur appel, d’autres hommes accoururent, et tous, effrayés et effarés, brandissant, qui un télescope, qui une lunette, avaient l’air de fous se livrant à un sabbat fantastique.
Les voyageurs riaient aux larmes. Quelque pitié qu’ils ressentissent pour les malheureux astronomes, le comique de la situation les prenait irrésistiblement.
Renversés sur des chaises, les yeux fixés sur l’écran, ils étaient secoués par un rire inextinguible.
Enfin Ramier prit la parole.
– Cela leur apprendra à s’occuper de moi, dit-il. Maintenant reprenons la route du nord.
Appuyant sur un bouton électrique, il transmit un ordre à la machinerie. Aussitôt la vision s’effaça ; un flot de lumière remplit la chambre, et le sourd murmure de l’arbre de couche annonça aux passagers que le Gypaète se remettait en marche.
Il était tard du reste. Chacun regagna sa cabine, et bientôt tout dormit à bord de l’aéronef, qui filait avec une rapidité vertigineuse au-dessus d’immenses plaines glacées.
CHAPITRE V
COURSE VERS LE PÔLE
Quand les Français ouvrirent les yeux, ils remarquèrent que les vitres circulaires des hublots étaient couvertes de fleurs de glace. Ils se levèrent et tout grelottants procédèrent à leur toilette.
Encore que le Gypaète fût chauffé, le froid extérieur s’y faisait sentir.
Si pressés que fussent les jeunes gens, ils s’arrêtèrent plusieurs fois pour écouter. Il leur semblait percevoir le bruit d’une querelle violente. Des cris étouffés, des éclats de voix parvenaient jusqu’à eux.
Inquiets, ils se hâtèrent et coururent au salon. Leurs compagnons y étaient déjà rassemblés, et Lotia tremblante leur apprit que Ramier venait de s’abandonner à un terrible accès de colère, dont les conséquences pouvaient être effroyables.
Dès l’aube, il s’était rendu sur le pont, afin de jeter par-dessus bord les instruments dérobés à l’observatoire de Barget. Or, parmi les objets entassés en hâte dans le sac dont les matelots s’étaient munis, le fou avait découvert un exemplaire du Petit Journal vieux de six semaines déjà. Il l’avait déplié machinalement, et, en première page, avait lu l’entrefilet suivant :
LA LUNE À UN KILOMÈTRE
« Une dépêche d’Amérique nous apprend que l’on monte en ce moment, à l’observatoire des Montagnes Rocheuses, la plus gigantesque lunette que l’industrie ait encore fabriquée.
Longue de 220 pieds, munie de lentilles de 2 mètres de diamètre, elle donnera des grossissements qui laisseront loin derrière eux tous ceux obtenus jusqu’à ce jour.
Pour en donner une idée, il suffira de dire que cet instrument géant ramènera la lune à 1 kilomètre, ce qui permettra enfin d’observer pratiquement la surface de notre satellite et de décider si, oui ou non, la vie y est éteinte.
C’est là un gros événement dans le monde savant. Grâce à sa puissance extraordinaire, le nouvel engin scientifique mettra les astronomes à même de vérifier expérimentalement certaines théories en cours. Il leur fournira notamment la possibilité de déterminer la nature d’un astre errant depuis plusieurs mois dans la zone d’attraction de la terre, et dont l’éclat variable, la marche irrégulière, ont mis en émoi tous les observateurs du globe. »
Ces dernières lignes s’appliquaient clairement à l’aéronef. De là, chez le fou, qui, on l’a remarqué, ne professait pas de tendres sentiments à l’égard des observateurs, une explosion de rage dont tout le navire aérien avait retenti. Il avait proféré à l’endroit des stations astronomiques les plus épouvantables menaces, puis s’était enfermé dans son laboratoire, laissant Lotia et Maïva éperdues de terreur.
Les Français essayèrent vainement de les rassurer. Leurs paroles manquaient de conviction. Ils avaient l’arrière-pensée que l’articulet du Petit Journal avait étrangement compliqué la situation.
Si le capitaine du Gypaète, emporté par son imagination maniaque, se mettait en tête d’exercer des représailles contre les observatoires, on ne pouvait prévoir où il s’arrêterait. Maître d’un appareil qui, par sa nature, échappait à toute poursuite, quelles catastrophes Ramier était capable de préparer ?
Et les passagers, captifs dans les flancs de l’aéronef, impuissants et désolés, devraient assister à l’œuvre sinistre éclose dans une cervelle de dément.
Cependant en interrogeant les matelots, ils apprirent que le Gypaète n’avait pas changé sa direction. Il conservait le cap au Nord, donc la réalisation des projets du fou était ajournée. Cette certitude rendit un peu de tranquillité aux voyageurs. Rien n’est mobile comme la pensée d’un insensé, et puisque l’aéronef ne se ruait pas sur l’Amérique, il y avait lieu d’espérer que l’incident n’aurait pas de suites.
– Au surplus, déclara Robert, trois hommes résolus, unis pour un même but, sauront bien venir à bout d’un fou.
– Où prends-tu trois hommes, questionna Ulysse, tandis que les yeux noirs de Lotia se posaient avec une surprise mal dissimulée sur l’ancien caissier ?
– Je les prends où ils se trouvent. Toi, moi et le seigneur Radjpoor. Ennemis pour tout le reste, il me semble sage de nous allier, lui et moi, pour la cause de l’humanité.
L’Hindou répondit par un geste vague. Acquiescement ou refus, on n’aurait su l’affirmer.
Pour Lotia, elle murmura comme malgré elle, une rougeur montant à ses joues veloutées :
– Thanis ou Lavarède, votre pensée est bonne et généreuse. Si une femme peut vous aider dans la tâche que vous assumez, je serai heureuse de vous apporter mon concours.
Robert la regarda, un rayonnement joyeux éclairait son visage. Il ouvrit la bouche comme pour prononcer les mots dont son cœur était plein. Mais une réflexion arrêta la parole sur ses lèvres, et ce fut seulement après un instant de silence qu’il articula froidement :
– Attendons, Mlle Lotia. Ma petite démonstration batailleuse est peut-être injustifiée, partant ridicule. Il nous suffira, sans doute, pour écarter les malheurs que prévoit notre imagination trop prompte, de parler à M. Ramier qui, au fond, est un excellent homme.
Mais l’éclat de ses yeux, le frémissement de tout son être qui se communiquait à sa voix, juraient avec son calme voulu. Lotia comprit-elle tout ce qu’il ne disait pas ? Mystère ! Toujours est-il qu’elle détourna la tête, et que ses paupières frangées de longs cils s’abaissèrent.
Mouvement inutile. Maïva l’observait. Doucement la petite se glissa auprès de Robert et désignant la fille de Yacoub de la main, montrant ses yeux clos, elle dit tout bas, avec ce charme hésitant des premiers bégaiements :
– Larmes. Pleure.
Lavarède parut prêt à s’élancer vers la jolie Égyptienne. Mais il se contint. Il sentait que le courant sympathique s’établissait entre elle et lui. Il ne fallait pas, par une expansion intempestive, compromettre l’avenir. Comme il était loin le moment où, lui donnant sa main selon le rite d’Égypte, la jeune fille lui crachait à la face, avec l’accent d’une haine sauvage, cette affirmation :
– C’est pour la patrie !
Maintenant de douces larmes coulaient sur ses joues. Le doute s’était implanté dans son esprit. Elle n’osait plus accuser, et l’indécision de sa pensée s’était trahie tout à l’heure encore.
– Thanis ou Lavarède, avait-elle dit.
Radjpoor songeait aux mêmes choses. Les sourcils froncés, l’œil dur, il assistait au triomphe de ce Français maudit, dont il avait imaginé faire un jouet. Est-ce que décidément il perdrait la partie ? Le diamant d’Osiris, l’âme de Lotia lui échapperaient en même temps ? Non cela ne serait pas. Il saurait bien tisser une trame si serrée que Robert y serait définitivement emprisonné, que la défiance ressusciterait dans le cœur de la jeune fille !
Et tandis qu’il cherchait les mensonges propices à son dessein, Lavarède, désireux de mettre fin à une scène qui, en se prolongeant, devenait embarrassante, empoigna l’Astronome par le bras et l’entraînant vers la porte :
– Arrive, nous allons un peu catéchiser Ramier, nous assurer de ses dispositions. Et si nous le trouvons trop menaçant pour la tranquillité de l’observatoire des Montagnes Rocheuses, nous verrons ce qu’il conviendra de faire pour déjouer ses projets.
Et tous deux sortirent, accompagnés par un regard bienveillant de Lotia.
– Ah ! murmura la fille de Yacoub quand ils eurent disparu, qui me dira où est la vérité ?
– Moi, fit une voix douce auprès d’elle.
Maïva s’était approchée sans bruit, et lentement, le bras étendu vers la porte close :
– Vérité là… Eux vrais.
Puis braquant son index accusateur sur Radjpoor.
– Lui… mentir… Thanis ! Thanis !
Lotia cacha sa tête dans ses mains et s’absorba en de profondes réflexions. Durant ce temps, Robert et son ami frappaient à l’huis du laboratoire où Ramier s’était enfermé.
Mais ils eurent beau heurter, appeler, se nommer, le battant ne tourna pas sur ses gonds ; aucun bruit ne leur répondit. De guerre lasse, ils revinrent au salon, se promettant bien de voir le fou dans la journée.
Vaine promesse. Le capitaine du Gypaète ne se montra pas. Lassés d’errer dans le couloir central, les voyageurs, après s’être emmitouflés de fourrures, – ou plus exactement de houppelandes doublées de plumes – prirent le parti de monter sur le pont.
Il faisait un froid intense. À quelques centaines de mètres au dessous de l’aéronef, fuyait vers le sud, avec la rapidité d’un express, un océan figé par la gelée. C’était l’ice-field immense des mers polaires, uni, monotone, décourageant. Parfois des îles se devinaient aux brusques mouvements de la croûte glacée qui, brisée sur leurs côtes, se solidifiait en icebergs, en aiguilles, en éminences formées de blocs mal équilibrés qui semblaient prêts à tomber.
Une tristesse infinie montait de la plaine blanche dans l’air froid. Et comme ils regardaient sans parler ce paysage désolé, une même émotion fit battre leurs cœurs à l’unisson. Sous une croûte de neige durcie un navire, une épave était là.
On ne pouvait en douter. Les formes du bâtiment, alourdies par le manteau de glace, restaient trop nettes, trop précises, pour que l’on pût supposer qu’il y avait dans sa silhouette un simple jeu de la nature.
Du reste, en approchant, les voyageurs reconnurent les mâts, rompus par le milieu et trouant encore le linceul blanc dont l’épave était recouverte. Sur le gaillard d’arrière, des ours blanc grattaient furieusement la neige. Peut-être flairaient-ils des cadavres enfermés dans ce bateau perdu au milieu de l’immensité polaire. Une plaque de glace se détacha soudain sous leurs griffes, démasquant une partie du tableau d’arrière, et Robert, Astéras, Lotia lurent en même temps.
… RAM
Le nom du navire abandonné se terminait par ces trois lettres, seules visibles.
À tous vint la même idée. Ce fut Ulysse qui l’exprima d’un ton assourdi :
– Serait-ce le Fram ?
Le Fram ! Ce nom rappelait celui d’un héros de la science : Nansen, le hardi Scandinave, qui a fait construire un bateau de forme spéciale pour résister à la pression des glaces, et qui est parti vers ce pôle Nord, tombe lointaine de tant de vaillants explorateurs. Il se flattait d’arriver là où nul encore n’a pris le pied, en s’abandonnant aux courants qui vont de l’Atlantique au Pacifique en traversant diamétralement le cercle polaire. Depuis son départ, aucune nouvelle n’est parvenue en Europe. Poursuit-il son audacieuse expédition ? Ou bien ce navire abandonné, entraîné irrésistiblement dans la marche lente de la plaine de glace, est-il le sien ? Son courage, son énergie, son dévouement surhumain n’ont-ils abouti qu’à une catastrophe, et faut-il ajouter son nom au martyrologe déjà long des régions arctiques ?[7]
Voilà ce que les voyageurs se demandaient tout bas.
Que ce fût le Fram ou tout autre vaisseau, le navire désert disait la catastrophe. Captif de la banquise, voyant les vivres s’épuiser, l’équipage sans doute avait abandonné le bateau. Il avait confectionné des traîneaux, était parti à l’aventure, marquant sa route de cadavres. Et peut-être en ce moment même, à bout de forces et de provisions, le dernier survivant du drame tombait-il anéanti en un coin perdu de l’ice-field.
Les Français se le représentaient couché sur le sol glacé, rampant encore vers le Sud, vers le soleil, dans un dernier transport de volonté, et puis, brisé par ce suprême effort, s’allongeant pour mourir, les membres raidis par le froid, glaçon déjà et vivant encore, ultime torture, les espérances déçues et les impitoyables regrets.
L’aéronef ne ralentit pas sa course, indifférent à l’épave qu’il laissait en arrière. Transis, affligés, Robert, l’astronome et l’Égyptienne redescendirent au salon. Ramier n’avait pas paru. À déjeuner, à dîner, il fut également invisible. Mme Hirondelle ne semblait pas émue par ce brusque amour de l’isolement. Elle pria ses hôtes d’excuser son mari, très occupé, dit-elle ingénument, et parla tranquillement comme à l’ordinaire des menus incidents du bord.
– Demain, conclut-elle au moment où les passagers prenaient congé d’elle pour s’aller coucher, demain nous serons au pôle. Vous verrez comme la nature avait préparé un splendide appartement à notre Gypaète.
Sur ces paroles énigmatiques, elle souhaita le bonsoir à ses hôtes et s’éloigna.
Rentrés dans leur cabine, Robert et Ulysse décidèrent que, Ramier fuyant toute explication, ils s’opposeraient de vive force à ses projets criminels, car ils ne doutaient plus de leur existence ! Pour cela, il leur fallait se procurer des armes.
– Eh, déclara l’astronome, dans la pièce voisine du laboratoire, il y a des fusils.
– Des fusils, s’écria Lavarède avec joie ?
– Oh ! ce ne sont pas des armes comme tu as l’habitude d’en voir. Ce sont des carabines à carbure Z de l’invention de Ramier.
– Des carabines à carbure… Voilà une idée de fou !
– Et même de sage, riposta l’astronome. Je suis convaincu que l’industriel qui l’exploiterait ferait fortune dans notre beau pays de France.
– Comment ? c’est sérieux ?
– Tout ce qu’il y a de plus sérieux. La chose m’a intéressé à ce point que j’en ai pris un croquis sur mon carnet.
Et, tirant son portefeuille de sa poche, Ulysse mit sous les yeux de son ami la page où s’étalaient les figures que voici :
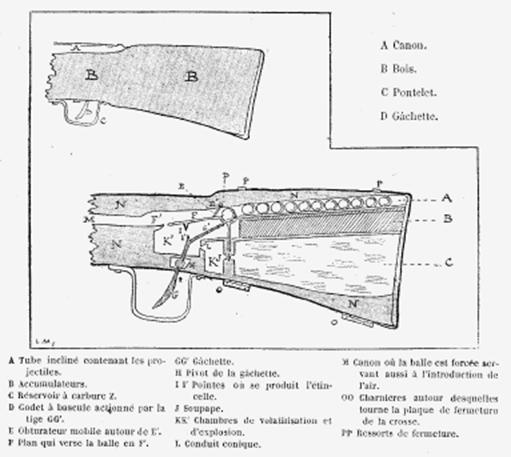
– Du diable si j’y comprends un traître mot ! grommela Robert en se grattant l’oreille.
– C’est pourtant simple.
– La simplicité scientifique, je connais ça. Après quinze années d’études, on arrive à la goûter. Tu ferais bien de m’expliquer…
– Volontiers. La crosse, qui s’ouvre comme une boîte, est divisée en trois compartiments. Le premier, A, renferme douze balles de nickel ; le second, B, contient un accumulateur électrique, et le troisième, C, est tout bonnement un réservoir à carbure liquide analogue à l’acétylène. Le problème est celui-ci : Étant donné que le carbure Z gazeux, mélangé à l’air dans une certaine proportion, forme une combinaison détonante dont la moindre étincelle détermine l’explosion, il s’agit, par un mouvement très simple, d’amener automatiquement la balle en E, extrémité intérieure du canon, le carbure et l’air dans la chambre d’explosion K prime.
– Catherine ? fit ironiquement Lavarède.
– Non, K prime, et de les mettre en présence d’une étincelle électrique.
– Comme tu le disais à l’instant, rien n’est moins compliqué. Du reste, on te prierait de hisser le Panthéon sur l’arc de l’Étoile que tu ne t’étonnerais pas.
Astéras eut un sourire bonasse :
– Attends donc, sempiternel railleur. Remarque la gâchette GG’. Tu veux charger ton arme.
Tu pousses la gâchette d’arrière en avant ; la tige G pousse le culot du godet D, qui pivote et verse la balle sur le plan incliné F qui l’amène en F’. Cela fait, tu vises le but à atteindre, et tu presses la gâchette d’avant en arrière.
Qu’arrive-t-il ?
La tige G fait basculer le godet D en sens inverse de tout à l’heure, ce qui permet à la balle suivante de venir s’y placer. De plus, le mouvement du godet actionne la soupape J qui cesse de fermer le réservoir de carbure. Une ou deux gouttes tombent dans la chambre de volatilisation K et remplissent de vapeurs K et K’. Or la chambre K’contient déjà de l’air puisque, par le canon de l’arme, elle est en communication avec l’atmosphère. Le mélange détonant est obtenu, il ne manque plus que l’étincelle qui l’enflammera.
– C’est curieux, murmura l’ancien caissier, intéressé malgré lui.
– Tu y viens, mon bel ami. Eh bien ! admire l’ingéniosité de l’inventeur.
Le godet D, basculant sous la poussée du levier G’, touche l’accumulateur de son bord et établit le courant électrique, qui produit une étincelle entre les pointes l et l’, au beau milieu du gaz détonant. Explosion, dilatation brusque et projection de la balle au dehors. La portée est de douze à quatorze cents mètres. As-tu compris maintenant ?
– Si j’ai compris mais c’est-à-dire que je n’ai qu’un désir : avoir une de ces carabines entre les mains pour te montrer si je sais m’en servir.
– Je crois que Ramier nous en confiera sans difficulté.
L’ancien caissier accueillit cette affirmation par une moue dubitative.
– Tu doutes ? reprit Astéras.
– Ma foi, il n’est pas assez fou pour armer ses prisonniers.
– Voilà en quoi tu te trompes.
– Tu as l’air sûr de ton fait ?
– Je le suis, puisqu’il m’a développé ses idées à ce sujet.
– Et ces idées… ?
– Sont fort raisonnables. En me montrant ses fusils, il me dit : La salle n’est jamais fermée, s’il vous paraît agréable de tirer quelques oiseaux au vol, il vous suffira de prendre les armes au râtelier et de garnir la crosse de projectiles. Les accumulateurs et le réservoir sont toujours chargés.
– Il t’a dit cela ?
– En propres termes. Et comme je ne pouvais dissimuler ma surprise, il devina ce qui se passait dans ma tête, et ajouta négligemment : « Cela m’est égal de vous voir armés, puisque vous ne pouvez tourner vos armes contre moi ».
– Comment ? nous ne pouvons pas ? interrompit Lavarède avec violence.
– Eh non, mon pauvre Robert, car nous ignorons la manière de diriger le Gypaète ; aussi, en nous révoltant, en réduisant Ramier à l’impuissance, nous ferions une chose assez semblable à un suicide, car notre navigation se terminerait vraisemblablement par une chute vertigineuse.
– Nous le forcerions bien à nous indiquer…
– Lui ? Tu ne le connais pas. Il se ferait hacher plutôt que de divulguer le détail de sa mécanique.
– Alors, des armes nous sont inutiles, puisque nous sommes dans l’impossibilité de nous opposer à ses desseins.
– Aussi je n’en considère qu’une comme ayant une valeur.
– Laquelle, je te prie ?
– La persuasion, ami Robert, la persuasion.
Puis, commençant à se dévêtir, l’astronome ajouta :
– Mais il est l’heure de dormir ; couchons-nous…
– Et la nuit portant conseil…
– Nous aurons peut-être trouvé demain le moyen de concilier le soin de notre sécurité avec le salut des astronomes des Montagnes Rocheuses.
CHAPITRE VI
LA PÊCHE À L’OURS
Le jour venait à peine de poindre, que déjà les Français sortaient de leur cabine. Dans le couloir central, un courant d’air glacial les surprit désagréablement.
– Bigre, s’écria Lavarède, le panneau du pont est ouvert. Hâtons-nous de nous réfugier au salon ; sans cela nous allons être « frappés » comme de simples carafes.
Et déjà il poussait la porte de la pièce désignée, quand une réflexion lui vint :
– Mais j’y songe. Si le panneau est ouvert, c’est que quelqu’un est sur le pont. Sans doute Ramier qui, à cette heure matinale, pense ne pas être dérangé.
– Cela est possible, appuya l’astronome.
– Alors, tâchons de le surprendre…
– Et surtout d’apprendre ses projets.
D’un pas pressé, Robert s’élança dans le couloir, mais Astéras l’arrêta brusquement.
– Un moment, cher ami, revêtons d’abord nos manteaux de plumes et nos couvre-chefs. Sous ces latitudes inclémentes, la moindre imprudence peut être mortelle.
L’observation était juste, et maintes fois les navigateurs des régions boréales ont été frappés de congestion pour avoir négligé de se vêtir suffisamment. Robert le comprit et, nonobstant son impatience, s’emmitoufla avec soin.
Mais cet hommage rendu à la prudence, il courut au panneau, escalada l’échelle de fer et sauta sur le pont.
À l’avant, le fou, accoudé sur la balustrade, regardait fixement vers le Nord.
– Nous le tenons, murmura l’astronome qui rejoignait son impétueux compagnon.
Ils se glissèrent auprès de Ramier qui, absorbé dans sa contemplation, n’avait pas remarqué leur venue, et, s’accoudant de chaque côté du petit homme, ils dirent avec un touchant ensemble :
– Bonjour, M. Ramier, comment vous portez-vous ?
L’insensé tressaillit, un nuage passa sur ses traits, mais, se remettant soudain, il répondit d’un ton de bonne humeur :
– Aussi bien que possible, mais vous-mêmes ne semblez point malades.
Puis avec un sourire peut-être ironique :
– Il paraît que vous vous faites aux habitudes du bord, vous devenez matineux.
Lavarède échangea un coup d’œil avec Ulysse. La pseudo-question du capitaine du Gypaète lui fournissait une entrée en matière.
– Oh ! reprit-il d’un air détaché, ce n’est point précisément par plaisir que nous nous sommes levés si tôt ; je dois à la vérité d’avouer que l’inquiétude y est bien pour quelque chose.
– L’inquiétude ?
– Elle-même. Nous ne vous avons pas aperçu hier. Or, sachant qu’un article du Petit Journal vous avait irrité, nous craignions…
– Oui, interrompit le maniaque d’un ton sombre, il m’a profondément irrité.
Une lueur fauve s’était allumée dans ses yeux :
– J’ai fui l’humanité, continua-t-il comme se parlant à lui-même. Je n’ai plus rien de commun avec elle. Je ne lui demande rien, et elle prétend me torturer de sa curiosité. Ils trouvent naturel d’installer une lunette géante sur les Montagnes Rocheuses, pour violer le secret de mon existence. Fous qui ne comprennent pas que je puis réduire leurs projets à néant.
– Vous voulez empêcher le montage de la lunette ?
– Certes, glapit le petit homme. Il faut un exemple, je le donnerai. Je raserai cet observatoire maudit. J’ai dans mes soutes des cartouches de carbure Z, dont la puissance explosive est infinie. S’il me plaisait, je réduirais Londres ou Paris en poussière. Dans quelques jours, l’observatoire des Montagnes Rocheuses ne sera plus qu’un monceau de ruines.
– Vous ne ferez pas cela, gronda Robert oubliant toute prudence devant l’immensité de la catastrophe annoncée.
Le fou se redressa comme s’il avait été piqué par un serpent. Avec un ricanement rageur, il demanda :
– Qui donc m’en empêcherait ?
– Moi ! articula nettement l’ancien caissier.
– Vous ?
Ramier jeta ses mains comme des pinces sur les bras de son interlocuteur :
– Vous. Voilà la gratitude humaine. On sauve la vie aux gens, on les reçoit dans sa demeure. Aussitôt ils prétendent commander. Misérable ! il ne tient qu’à moi de te punir. Que j’appelle mes matelots, ils te saisiront, te précipiteront dans l’espace, et ta carcasse ira se briser sur la surface de l’ice-field.
Les jeunes gens ne purent se défendre d’un frisson en entendant cette terrible menace, que l’insensé était homme à mettre à exécution.
Mais avec la mobilité d’impressions qui caractérise les fous, Ramier lâcha soudain Robert. Il se prit à rire nerveusement.
– Même si tu me réduisais à l’impuissance, dit-il, que ferais-tu ? Saurais-tu diriger le vol du Gypaète ? Va, va, tes révoltes sont platoniques ; tu ne peux me nuire sans signer ton arrêt de mort. C’est pour cela que je te pardonne.
Un silence suivit.
– Votre hospitalité est horrible, reprit enfin Lavarède ; vous nous contraignez à assister impassibles au plus monstrueux des crimes.
Le fou eut un nouveau ricanement :
– Ce que tu appelles crime, je le nomme, moi, justice. Au reste, je ne veux pas discuter. Si ma société te pèse, rien ne t’empêche de la fuir. Va-t-en !
– Eh ! vous savez bien que je ne le puis pas. Vous parlez d’évasion à un homme prisonnier de l’espace ; mais si vous persistez dans votre détermination, je vous en conjure, abandonnez-nous dans le désert de glace…
– Avec les jeunes filles qui t’accompagnent, questionna ironiquement Ramier ?
Du coup, Robert pâlit. Quelque horreur qu’il eût pour le crime qui s’apprêtait, il ne devait pas condamner à la douloureuse agonie du froid, de la faim deux êtres innocents : Lotia ! Maïva !
– Oh ! s’écria-t-il, vous vous jouez de moi. Et pourtant je ne veux pas être votre complice.
– Ah ! fit en riant le capitaine du Gypaète. C’est là que le bât vous blesse, Monsieur l’Aigle. Rassurez-vous. Vous ne serez pas complice, non plus que vos amis.
Et arrêtant l’interrogation prête à s’échapper des lèvres du Français :
– Ne demandez pas d’explications, ce serait inutile. Contentez-vous de ma parole : Vous ne serez pas complices.
Puis, d’un ton brusquement changé :
– Abandonnons ce sujet de conversation qui nous divise. Savez-vous ce que je regardais lors de votre arrivée ? Non ! Eh bien je vais vous rapprendre. Vous n’ignorez pas sans doute que les phoques, amphibies qui, ainsi que nous, sont doués de la respiration pulmonaire, se ménagent, dans la croûte glacée dont la mer est couverte, des sortes de puits, par lesquels ils remontent à la surface et renouvellent leur provision d’air.
– En effet, répliquèrent les amis interloqués par le brusque crochet que faisait l’entretien.
– Parfait ! Nous arrivons dans une région où ces intéressants animaux pullulent. Rien d’étonnant à cela, l’homme n’a jamais pénétré dans ces solitudes ; nous sommes par 88° de latitude Nord.
– 88 degrés, répéta l’astronome, à deux degrés du pôle ?
– Oui, affirma tranquillement le fou, nous parviendrons au pôle même dans la journée, mais il ne s’agit pas de cela. Les phoques abondent et je veux vous régaler du spectacle d’une chasse comme nous les pratiquons.
– Une chasse ?
– Au filet. Tenez, nous approchons du territoire giboyeux. Apercevez-vous ces ouvertures à la surface du champ de glace ?
– Ce sont les trous des phoques ?
– Précisément. Venez, Messieurs, nous allons déjeuner, et ensuite nous prendrons des fusils.
Lavarède eut un haut le corps.
– Des fusils ?
– Naturellement. Quand l’animal est hissé à bord, il faut bien l’abattre. Et puis, il peut vous être agréable de canarder au vol quelque pièce de gibier. Sur ce, à table. Un bol de chocolat n’est pas à dédaigner par ce froid. Nous ferons le second déjeuner au pôle.
Le petit homme, tout en parlant, gagnait l’écoutille et s’engageait sur l’échelle de fer.
Lavarède retint son ami en arrière :
– Des armes, fit-il à voix basse, il va nous donner des armes.
– Ne te l’avais-je pas dit ? Va, il est bien certain que nous n’en userons pas contre lui.
– C’est égal, riposta l’ancien caissier, je ne serai pas fâché d’être armé. Et à son tour, il s’engouffra dans l’écoutille.
Déjà Lotia, Maïva et Radjpoor étaient rassemblés dans la salle à manger où Mme Hirondelle remplissait ses devoirs de maîtresse de maison volante avec une bonne grâce parfaite.
L’annonce de la chasse au phoque fut accueillie avec enthousiasme. C’était une distraction pour les prisonniers, une trêve à leurs pensées moroses.
Le chocolat accompagné de rôties beurrées disparut avec une rapidité merveilleuse. Sur la fin du repas, Ramier s’absenta un moment, puis revint en disant :
– Mes hommes ont préparé l’affût. Quand il vous plaira, nous ouvrirons la chasse.
En même temps, il tendait à Robert et à Ulysse des fusils à carbure qu’il rapportait.
Tous se levèrent en tumulte, et, dans les traces du fou, se rendirent à l’étage inférieur de l’aéronef. Mais cette fois, ils ne pénétrèrent pas dans la salle qu’ils avaient occupée pendant le pillage de l’observatoire de Barlet. Leur guide les conduisit dans une pièce plus spacieuse, située à l’avant du navire aérien.
En y entrant, ils eurent un cri d’admiration angoissée. Au centre du plancher, un large panneau enlevé, laissait un trou béant, à travers lequel on apercevait ; à deux cents mètres plus bas, la nappe blanche de l’ice-field.
Autour de l’ouverture, courait une légère balustrade mobile ; au-dessus, une grosse poulie, fixée au plafond, laissait se dérouler un câble, dont une extrémité pendait au dehors, tandis que l’autre était attachée à un treuil placé près de la muraille. En se penchant, les voyageurs virent, se balançant au bout libre de la corde, une vaste poche en filet. Leurs lèvres s’écartèrent pour sourire. Ils se souvenaient que c’était par cette voie, peu poétique, qu’ils avaient été apportés dans l’aéronef.
Cependant la poulie cessa de tourner. Un matelot, debout près du treuil, venait d’embrayer. Le filet rasait le sol.
– Tout est paré, déclara le fou. À vous, Mesdames, de choisir votre victime. Du geste il désignait l’ice-field, dont la blancheur était tachée de formes noires et mouvantes.
– Les phoques sont au rendez-vous, continua-t-il gaiement. Ne les faisons pas attendre.
Une minute s’écoula. Lotia, Maïva, Mme Hirondelle scrutaient la plaine de glace, considérant les monstres marins qui se traînaient péniblement à sa surface. Bientôt leurs regards s’arrêtèrent sur un superbe animal qui, paresseusement étendu au pied d’un monticule de neige, semblait dormir.
Elles le montrèrent à Ramier.
– Puisque celui-ci obtient vos préférences, fit galamment le petit homme, nous allons lui fournir le moyen de s’élever jusqu’à vous pour vous présenter ses hommages.
Il se pencha sur le tube acoustique communiquant avec la chambre des machines.
Aussitôt le Gypaète évolua, et, à une vitesse modérée, se dirigea vers l’éminence auprès de laquelle reposait le phoque.
À mesure que l’on approchait, on distinguait mieux l’animal. Il mesurait environ sept pieds de long et représentait un superbe échantillon de son espèce.
Il ne bougeait pas, plongé dans une douce quiétude provenant de l’ignorance du danger. Les bêtes, en effet, ne deviennent timides et craintives que lorsqu’elles ont vu l’homme, ce roi de la création, dont la mission semble être de détruire.
Le Gypaète s’avançait toujours. Le filet rasait le sol à 50 mètres de la proie convoitée, quand un grognement formidable retentit. Tous eurent un brusque mouvement de surprise.
– Il y a un ours blanc aux environs, se contenta de dire Ramier, mais cela nous est égal.
Par bonheur, il ne s’est pas trahi plus tôt, sans cela notre gibier nous aurait échappé. Voyez comme il se hâte vers son trou.
En effet, le phoque tiré de son sommeil par le rugissement du terrible carnassier du cercle arctique, rampait sur la terre aussi rapidement que le lui permettait sa conformation.
Longeant l’éminence, il cherchait évidemment à atteindre un trou ouvert à peu de distance.
Tout occupé d’échapper à l’ours, qui demeurait invisible, le malheureux amphibie n’aperçut pas la poche béante dont il était menacé.
– Au treuil, ordonna soudain Ramier.
Tous tournèrent les yeux vers le matelot préposé à la manœuvre de l’appareil.
À ce moment même, le filet happait le phoque. Une secousse légère ébranla le navire aérien, et presque aussitôt le déclic du treuil se fit entendre. Courbé sur la manivelle, le subordonné du fou remontait le filet.
– Mâtin, murmura-t-il, c’est lourd !
Sur un signe de Ramier, tous s’étaient reculés jusqu’à la cloison ; la balustrade s’était abaissée, dégageant les abords de l’ouverture. Le matelot continuait à tourner péniblement la manivelle.
– Un peu de courage, cria le fou, on aperçoit la partie supérieure du filet. Quelques tours du treuil, et le sac entrait dans la salle ; le panneau se refermait de lui-même avec un claquement sec, et tous se précipitaient en avant pour admirer leur capture.
Mais ils s’arrêtent dans leur élan.
Le grognement de l’ours polaire a résonné de nouveau, et cette fois dans la salle même où ils se trouvent.
– Qu’est cela ? glapit Ramier.
Comme pour lui répondre, l’ouverture du filet s’écarte, distendue par une force irrésistible, et une tête énorme, velue, couverte de poils blancs hérissés se montre.
Cette apparition soulève une clameur éperdue :
– Un ours blanc !
C’en est un, en effet, et de taille colossale. Tout à l’heure, sur l’ice-field, il guettait le même gibier que les chasseurs.
Masqué par l’éminence de neige, il se glissait vers lui. Il s’était élancé au moment même où le filet enlevait l’amphibie, et il avait roulé au fond du sac en même temps que sa proie.
Maintenant de ses griffes puissantes, il lacère les mailles qui entravent ses mouvements.
En dix secondes il est libre ; il marche sur les chasseurs épouvantés, balançant lourdement sa tête, faisant craquer ses dents aiguës, promenant sur ses ennemis son regard rouge comme pour choisir celui qu’il va dévorer.
Lotia, pétrifiée d’épouvante, subit une sorte de fascination. Inconsciemment elle fait un pas en avant, elle va se jeter dans les griffes du carnassier, mais Lavarède la voit, il se précipite, la repousse, et, dans l’espace d’un éclair, introduisant le canon de sa carabine dans la gueule du fauve, il presse la gâchette.
Une détonation sèche éclate. Un jet de sang s’échappe de la gueule menaçante. L’ours a un effroyable soubresaut.
Un instant il demeure debout, tremblant sur ses pattes trapues, puis il roule sur le plancher, renversant dans une convulsion suprême, celui qui vient de lui faire sauter le crâne.
Le jeune homme se relève de suite, un peu froissé mais sans blessures, et tandis que l’on s’empresse autour de lui, le fou, déjà remis en possession de son sang-froid, assomme le phoque étendu sur le sol, cause innocente du drame qui a failli coûter la vie à la fille de Yacoub.
CHAPITRE VII
UN CADEAU PRINCIER
En voyant tomber Robert, Lotia avait fait un pas vers lui ; mais lorsqu’il se releva, elle s’enfuit. Le Français, tout étourdi encore de l’aventure, ne remarqua pas l’étrangeté de sa conduite.
Ce fut seulement quand Ramier l’invita à quitter la cale, afin de laisser les matelots dépecer les animaux couchés sur le plancher, qu’il s’aperçut de l’absence de l’Égyptienne.
Ce lui fut une tristesse aiguë. Pour la seconde fois, il se jetait entre elle et la mort. Pour la seconde fois, elle ne croyait pas lui devoir un remerciement. Combien tenace était donc la haine de la jeune fille. Depuis quelques jours, elle semblait douter que Lavarède fût le cruel Thanis, fils de l’assassin de sa mère. Il avait espéré que l’abîme, creusé entre lui et celle que les Néo-Égyptiens lui avaient donnée pour épouse, allait se combler. Et soudain, le précipice se faisait plus profond, plus infranchissable. Il exposait sa vie pour elle, elle lui refusait le merci banal qu’un adversaire quelconque lui eût accordé sans difficulté.
Astéras devina sa pensée – il lui était poussé de grandes délicatesses de cœur depuis qu’il enseignait la parole à Maïva, – la petite muette aussi comprit, car ils se placèrent de chaque côté de Robert ; chacun saisit une main du jeune homme et la serra énergiquement, sans une parole.
Qu’eussent-ils pu dire d’ailleurs pour amoindrir l’affliction de leur ami. Sa douleur était de celles que les mots ne sauraient guérir. Il fallait se borner à lui montrer qu’il n’était pas isolé, que des amitiés sincères l’entouraient, que l’ingratitude d’une seule ne devait pas le conduire à la misanthropie.
C’est ainsi qu’ils regagnèrent le salon.
Radjpoor s’y trouvait déjà, nonchalamment étendu sur un divan. Il ne se dérangea pas à l’entrée de ceux qu’il avait entraînés dans une aventure sans issue. Il ne fit pas un mouvement, lorsque Ramier et Mme Hirondelle s’étonnèrent naïvement de la brusque retraite de Lotia. Et pourtant, de son regard sombre il étudiait la physionomie de Robert. Il vit la souffrance de ce dernier, et un fugitif sourire desserra ses lèvres.
Allons, tout n’était pas perdu ! La fille de Yacoub luttait contre le courant de sympathie qui l’entraînait vers le Français. Un coup frappé juste l’éloignerait de lui à jamais.
Et ce coup, il le porterait dans la journée même. Dans son cerveau fécond en ruses, une idée était née. Le diamant d’Osiris, gardé pieusement durant les siècles par les prêtres d’Axoum, ce diamant dont la cachette n’avait jamais été révélée, malgré les tortures musulmanes, malgré les menaces anglaises, ce bijou, destiné à l’avènement d’une ère de liberté pour le peuple d’Égypte, il allait l’utiliser pour terrasser la loyauté de Robert, pour déchirer l’âme délicate de Lotia.
Ramier se retira au bout d’un instant pour s’enfermer dans son laboratoire. Quant à Mme Hirondelle, désireuse de présider elle-même à la confection d’une sauce inédite, elle s’excusa auprès de ses hôtes et se rendit à la cuisine de l’aéronef.
Robert, Maïva, Astéras et l’Hindou restèrent seuls en présence.
Aucun n’avait envie de parler. Allongés sur leurs sièges, l’œil vague, ils demeuraient immobiles sous le lourd silence pesant sur eux.
Soudain un bruit léger leur fit tourner la tête. La porte venait de glisser sans bruit sur ses gonds, et Lotia se tenait debout sur le seuil.
L’Égyptienne était pâle, ses yeux rougis disaient qu’elle avait pleuré. Toute sa personne trahissait l’affaissement dont est toujours suivie une lutte morale.
Elle s’appuya un instant au chambranle, comme si ses jambes refusaient de la soutenir, puis son gracieux visage se contracta. On voyait que sa volonté tendait ses nerfs, et d’un pas lent, hésitant, elle marcha vers Lavarède.
Il la regardait venir, troublé de son trouble, brisé par son émotion, n’osant lui parler. Il voulut se lever, aller à sa rencontre, mais il retomba sur son siège. Ses membres lui refusaient le service.
Quand elle fut devant lui, elle pâlit encore et sa poitrine se soulevant à coups précipités, elle murmura d’une voix basse, à peine distincte :
– En Abyssinie, devant une panthère noire, vous vous êtes précipité sans armes pour me protéger. Tout à l’heure encore vous m’avez sauvée. Je ne veux pas que vous me croyiez ingrate. Pourquoi ma pensée est-elle ainsi faite ? Je l’ignore, mais cela est ainsi. Je sens peut-être que vous m’êtes dévoué, entièrement dévoué, mais je songe en même temps que peut-être, malgré vos dénégations, vous êtes Thanis, le fils du meurtrier de ma mère Aïssa. J’ai juré de vous haïr, et cependant vous êtes mon sauveur. Je suis pénétrée de reconnaissance et je ne dois pas l’exprimer, car on ne peut à la fois être l’obligé et l’ennemi. Ah ! si vous avez dit vrai, si vous n’êtes pas du sang de celui qui a frappé, parlez, donnez-moi une preuve de votre innocence, donnez-moi l’apaisement de l’esprit.
– Eh ! fit tranquillement Astéras, les preuves abondent. Ma parole d’abord, à moi qui suis l’ami de Robert, celle de Maïva ensuite, qui fut l’esclave du seigneur Radjpoor et pénétra ses combinaisons.
L’esclave se dressa d’un mouvement ; sa main mignonne se tendit vers l’Hindou :
– Thanis ! lui ; lui, Thanis !
Sans un geste, celui-ci avait écouté. À l’accusation précise de Maïva, il répondit par un ricanement ironique :
– Ah ! Lotia est sur le point de renier le sang des Hador, elle va pactiser avec l’ennemi de sa race, avec l’homme qui a menti aux siens, qui s’est dérobé au devoir, à la cause de l’indépendance égyptienne.
D’un regard anxieux, la fille de Yacoub interrogea Lavarède :
– Eh ! gémit le jeune homme, que vous dirai-je que je ne vous aie déjà dit ?
Je suis Français ; je vivais tranquille à Paris, sans m’occuper des querelles anglo-égyptiennes. Thanis est venu ! On m’a enlevé, jeté dans un imbroglio auquel je ne comprends rien.
– Naturellement, souligna l’Hindou de sa voix railleuse. On ne comprend rien, c’est bien plus facile que d’expliquer le plan machiavélique que vous me prêtez. Car enfin, si j’étais Thanis, comme vous le prétendez, quel serait mon intérêt dans toute cette affaire ?
À cette question insidieuse, Robert demeura court. Il ne pouvait deviner les mobiles de son ennemi.
– Vous gardez le silence, reprit celui-ci d’un air triomphant. L’occasion est cependant unique. Lotia vous prie de chasser ses doutes. Dites-lui donc quelle raison a été assez forte pour conduire le véritable Thanis à renoncer à sa main, à la donner à un autre avec l’inestimable diamant d’Osiris.
Lotia se cacha la figure dans ses mains :
– C’est vrai ! c’est vrai !
Un rugissement de rage s’échappa des lèvres de Robert. Il se sentait enchaîné par la logique du raisonnement de l’Hindou. Quel était donc l’intérêt de cet homme ?
– Fâchez-vous tout à votre aise, Thanis, poursuivit le rusé personnage, cela n’empêchera pas d’exister ce qui est. Et puisque Lotia hésite encore, puisque la colère ne gronde pas en elle, à la vue du fils de celui qui a poignardé sa mère, je lui rappellerai que, roi sans courage, vous refusiez de suivre Niari en Égypte, que nous avons dû vous plonger dans un sommeil factice pour vous emporter à bord du brick Pharaon. J’ajouterai que, plus tard, par crainte de l’Angleterre, vous avez songé à trahir la cause de ceux qui s’étaient confiés à vous. Sans moi, à Massaouah, vous vous embarquiez pour l’Europe, abandonnant vos soldats, volant à la vallée du Nil la plus belle de ses jeunes filles et le plus merveilleux de ses diamants.
Lavarède était devenu livide. Ses mains se crispaient furieusement sur les bras de son fauteuil.
– Oh ! gronda-t-il, vous, je vous tuerai ; mais auparavant, il faut que je vous démasque.
Il s’arrêta. Maïva venait de lui toucher le bras. Tout son corps frêle était agité d’un frissonnement. Évidemment elle voulait parler, mais sa langue rebelle se refusait à prononcer les mots désirés.
Ses yeux ardents se fixaient sur Radjpoor.
– Tu veux nous apporter le mot de l’énigme, demanda Ulysse ?
Elle fit oui de la tête. Lotia vit le mouvement. Angoissée, elle se rapprocha de l’esclave, et d’une voix émue :
– Tu sais, toi, tu sais et nous ne pouvons deviner ce qui se passe dans ton cerveau. Cherche, je t’en prie, cherche, car l’incertitude me tue.
Et tout à coup, une lueur joyeuse dansa dans les prunelles de la muette. Son poing désigna Radjpoor, et avec éclat !
– Lui… Anglais… argent… donner !
– Les Anglais lui faisaient une pension, clama Ulysse enthousiasmé ?
– Oui.
Sans sourciller l’Hindou laissa tomber ces mots.
– Parbleu ! jolie preuve. Thanis doit bien savoir ce qu’il touchait du gouvernement anglais pour se désintéresser des affaires d’Égypte. Mais avide comme tous ceux de sa race, il a voulu davantage. De là, ses mensonges en se trouvant parmi ses fidèles.
– Mes mensonges, cria Robert exaspéré ?
– Sans doute ! N’as-tu pas affirmé à Yacoub, au peuple assemblé, à Lotia elle-même que je supplie de se souvenir, que tu étais Thanis ?
– Oui, oui, murmura la jeune fille accablée.
– Sarpejeu ! C’est vous-même, maître drôle, qui m’avez conduit à cela. Je veux vous mener à la fortune, m’avez-vous déclaré. Pour l’atteindre, il suffit de ne vous étonner de rien. Rappelez-vous au surplus que, si le silence est d’or, la parole est d’acier pointu.
Radjpoor haussa les épaules :
– Contes à dormir debout !
Et comme Lavarède, Lotia se considéraient avec une défiance renaissante, il profita de son avantage :
– Voyez-vous, Thanis, vos accusations me laissent froid, parce que j’ai agi loyalement.
– Ne parlez pas de votre loyauté, interrompit l’ancien caissier, elle est hors de cause.
– Sans doute !
– Hors de cause par raison d’absence, acheva le Français.
De nouveau les épaules de l’Hindou esquissèrent un haussement dédaigneux.
– La défense est faible. Mais puisque vous m’y contraignez, je vais vous confondre.
– Je vous en prie.
– Pensionné de l’Angleterre…
– Encore ?
– Je le suppose. Votre séjour en Australie et sur le Gypaète vous permettront sans doute de réclamer quelques arrérages, si nous rentrons en Europe !
– Oh ! ces insinuations dépassent les bornes.
– Aussi je les laisse de côté, et je procède par affirmations.
Et les lèvres écartées par un sourire narquois, le fourbe ajouta :
– Tenez-vous à ce que j’explique votre conduite ?
– Énormément, quoique vous ne paraissiez pas tirer vos renseignements du puits où habite la Vérité.
– La vérité est sur mes lèvres.
– Bien changée alors, car je ne la reconnais pas.
– Vous avez acquis de l’esprit en France, cela n’a rien d’étonnant du reste ; en vivant au milieu du peuple le plus spirituel de la terre, on prend ses qualités… et aussi ses défauts. Le principal de ces derniers, vous le possédez, notre discussion le démontre surabondamment. Vous manquez de raisonnement.
– On ne vous fera pas le même reproche. Vous raisonnez juste, même le faux.
– Très joli le mot ; mais ce n’est qu’un mot, et comme tel il ne prouve rien. Laissant donc de côté les effets oratoires, je vais droit au but. Conduit en Égypte malgré vous, par le brave Niari, vous avez appris de lui l’existence du diamant d’Osiris. Vous aimez la fortune, je ne vous en blâme pas, je constate simplement. Le bijou en question vaut plusieurs millions. Son possesseur a évidemment l’indépendance. Vous vous êtes avoué que l’Angleterre pouvait un beau jour se lasser de vous couvrir de ses libéralités. Avec le diamant, cette occurrence n’était plus inquiétante. Mais pour le posséder, il fallait sembler marcher de pair avec les patriotes de la vallée du Nil. Vous n’avez pas hésité. Votre but ressort de vos actes, car une fois à Axoum ; détenteur du joyau royal, vous avez averti les Italiens de votre présence, afin qu’ils vinssent vous délivrer d’une escorte trop zélée, et qu’ils vous ramenassent en Europe, d’apparence malgré vous.
Le Français avait écouté cette harangue sans sourciller. Dès les premières paroles du l’Hindou, il avait deviné où il tendait, et sa résolution avait été prise :
– Alors, fit-il, vous m’accusez d’avoir menti pour m’approprier le diamant d’Osiris ?
– Demandez à Lotia si elle ne pense pas de même.
Malgré lui Robert regarda l’Égyptienne. Elle détourna la tête. Mais l’ancien caissier ne parut pas troublé par ce mouvement, qui équivalait cependant à une réponse affirmative :
– Parfait ! se borna-t-il à murmurer. Je suis un pleutre ; pour un caillou brillant, je sacrifierais une nation, je tromperais un vieillard vénérable comme Yacoub, une noble enfant comme Lotia ! C’est exquis et je suis un joli monsieur.
Puis élevant la voix :
– Seulement, il y a un seulement. Par suite de votre habileté infernale, M. Thanis, il m’est impossible de démontrer que je ne suis pas Vous ; grâce au ciel, je puis au moins me laver du reproche de cupidité.
Il avait enfoncé sa main droite dans sa poche, il la retira vivement. Entre le pouce et l’index, il tenait le bandeau Royal enlevé dans la basilique d’Axoum, et au milieu duquel le diamant d’Osiris étincelait de mille feux.
– Voilà cette pierre précieuse, plus précieuse en ce moment qu’elle ne l’a jamais été, car je vais m’en défaire.
Et le tendant à Lotia :
– Lotia, murmura-t-il d’une voix douce, prenez ce bijou, et en échange donnez-m’en un qui, pour moi, a cent fois plus de prix : votre confiance.
Dans les doigts de la jeune fille, il glissait le joyau royal. Elle leva les yeux vers lui ; deux larmes perlaient entre ses longs cils. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais Radjpoor ne lui en laissa pas le temps :
– Cadeau princier, fit-il en riant. Lotia est prisonnière comme nous à bord du Gypaète et le diamant se retrouvera toujours.
De nouveau, les paupières de l’Égyptienne s’abaissèrent.
– C’est juste, répliqua tranquillement Robert, et je remercie le seigneur Thanis-Radjpoor de me signaler les suppositions malveillantes auxquelles on pourrait se livrer.
Puis s’adressant à Lotia d’un ton plus doux :
– Lotia, je donnerais ma vie pour que vous eussiez foi en moi. Ce bijou nous divise. Montons ensemble sur le pont et jetez-le dans l’espace. De cette façon, il sera bien perdu pour tous. Et cette pierre brillante, qui n’a fait naître autour d’elle qu’infamies et mensonges s’abîmera, au premier dégel, au fond de l’Océan, avec les glaces qui la supporteront. Je suppose que, de la sorte, vous ne me croirez plus un lâche adorateur de la richesse.
Il marchait vers la porte. Lotia le rappela :
– Non, dit-elle, je garde ce diamant. Il est sacré pour une Égyptienne, car il est l’emblème de liberté.
– Me soupçonnez-vous encore, demanda-t-il d’une voix suppliante ?
– Le sais-je, gémit la jeune fille. Cherchez la vérité, faites qu’elle éclate à tous les yeux, et alors…
Elle s’interrompit brusquement. Une teinte rosée envahit son visage et d’une voix abaissée :
– Alors ?… Folle que j’étais de songer à cet instant qui peut-être n’arrivera jamais. Seulement, vous m’avez sauvée deux fois, et que vous soyez ou non Thanis, je vous dis : Merci !
Sur ces mots, elle courut à la porte, l’ouvrit et disparut, avant que Robert ravi, Radjpoor irrité eussent pu s’opposer à son départ et lui demander le sens des paroles bizarres qu’elle venait de prononcer.
CHAPITRE VIII
CONFIDENCE INATTENDUE
Les deux rivaux n’eurent pas le loisir d’échanger leurs impressions, ce qui, entre des gaillards aussi exaspérés, eût pu avoir les conséquences les plus fâcheuses. Ramier reparut et lança ce mot magique :
– La mer libre !
– La mer libre ! répétèrent les passagers ?
– Sans doute ! Vous n’ignorez pas que de nombreux savants, s’appuyant sur ce fait que le pôle du froid, c’est-à-dire l’endroit précis où la température atteint la limite minima, se trouve sensiblement au Sud du pôle de rotation, ont soutenu cette théorie que, dans le voisinage même du pôle, l’Océan pouvait être libre de glaces. Mac Clure crut reconnaître les rivages de cette mer, lors d’une pointe au Nord exécutée en traîneau à travers la banquise. Eh bien ! ces chercheurs avaient raison. Autour du pôle, le climat s’adoucit ; durant la plus grande partie de l’année, l’océan roule ses flots liquides. Il en est de même d’ailleurs au pôle Sud. Daignez m’accompagner sur le pont. Il vous sera loisible de contempler la mer polaire sur laquelle nulle créature humaine n’a vogué.
Si indifférent que l’on soit en matière scientifique, on ne saurait taxer de banale une proposition de ce genre : embrasser du regard une région inexplorée.
Aussi, en dépit de leurs préoccupations personnelles, les assistants suivirent le fou sur le pont.
En y arrivant, ils éprouvèrent une impression bizarre. Tout là-bas, semblant rouler sur la ligne d’horizon, le soleil éclairait de ses rayons obliques la mer libre, donnant des colorations, des reliefs dont les habitants des zones tempérées ne sauraient avoir idée.
Sur des îlots nombreux, couverts de mousses, de lichens verts, les vagues déferlaient, se disloquant en pluie d’écume.
Une faune nombreuse animait le paysage. Sur les rivages, des morses, des phoques prenaient leurs ébats. Les falaises étaient garnies de rangées de pingouins, d’eiders, d’oies au plumage éclatant. Et à la surface des eaux profondes, des baleines jouaient, soulevant en nuages l’onde battue par leurs formidables queues.
C’était un tableau de l’âge d’or, alors que les bêtes étaient heureuses et que l’homme, sous prétexte d’intelligence et de progrès, n’avait pas élevé à la hauteur d’un dogme la loi de destruction, où la brutalité du plus fort a raison du droit du plus faible.
Une brise relativement tiède éventait les passagers du Gypaète, et vers le Sud, la limite extrême de la banquise se découpait sur l’horizon en une dentelure d’un bleu violet.
Le regard des jeunes gens se portait surtout de ce côté. Malgré eux, ils subissaient l’attraction des pays lointains où le soleil vivifie de ses rayons une nature exubérante. En présence des mousses, ils regrettaient sans bien préciser leur sentiment, le baobab géant et l’eucalyptus élancé.
– Veuillez regarder au Nord, leur dit Ramier.
Ils obéirent. D’abord ils ne comprirent pas le pourquoi de l’ordre du fou. Mais en fixant leurs yeux dans la direction indiquée, ils aperçurent comme une tache sombre s’élevant au dessus des eaux.
On eût dit un brouillard prêt à se dissiper au moindre souffle. Et cependant le capitaine du Gypaète désignait cette fumée légère :
– Le pôle Nord, murmura-t-il d’un accent étrange.
Nul ne répondit. Tous venaient de recevoir une commotion morale. C’était donc vrai ? Le génie d’un fou avait triomphé des obstacles glacés accumulés par la nature entre le pôle et la curiosité humaine ; il avait réussi là où les plus audacieux, les plus intelligents avaient échoué. Sans effort, en pressant seulement un bouton de son merveilleux appareil, il avait franchi les remparts éternels de glace ; il allait toucher à ce point précis où l’axe idéal de la planète troue la couche terrestre !
Ramier souriait d’un air satisfait de lui-même. Nul ne songea à lui reprocher cette petite manifestation d’orgueil.
– Le pôle, reprit le petit homme ; le pôle où dame Nature avait ménagé au Gypaète un spacieux logement. Le pôle où personne avant moi n’avait posé le pied.
Il secoua la tête d’un air pensif et continua :
– Je dis personne, et pourtant…
De nouveau il s’arrêta. Mais la singulière hésitation du fou n’avait pas échappé à Astéras. Quel mystère nouveau cachaient ses réticences ?
Le savant voulut l’apprendre et d’un ton détaché :
– Oh ! personne avant vous, bien certainement. Mieux que tout autre vous avez le droit de l’affirmer.
L’insensé esquiva un geste impatient.
– Moins qu’un autre, devriez-vous dire.
– Moins qu’un autre… et pourquoi ?
– Parce que là-bas, la première fois que mon Gypaète est entré dans le sanctuaire dont je parlais tout à l’heure, j’ai trouvé, moi… une chose étrange, tellement étrange que je n’ose formuler ma conviction… Mais cela est, cela a été un document humain. Sont-ce les hommes qui l’ont apporté là ? Sont-ce les éléments, les hasards d’une débâcle ? Qui affirmerait ? Qui nierait ?
Et l’astronome le questionnant du geste, du regard, Ramier murmura :
– Vous ne comprenez pas ? Non, n’est-ce pas ? Eh bien, tâchez d’expliquer ceci. Quand mon aéronef fut construit sur la côte de la baie d’Hudson, je l’essayai. Satisfait de ses qualités, j’accomplis un voyage autour du globe. Je voulus atteindre le pôle, but décevant de tant d’explorations manquées. Il me plaisait à moi, victime des humains, de respirer un air que jamais l’haleine d’un homme n’avait vicié.
– Il me semble que pas un point du globe n’était mieux indiqué…
– Ah ! vous pensez comme je pensais alors.
– Vous avez donc changé d’idée ?
– Je ne sais pas. Voici ce qui advint. À un soixantième de degré du pôle même…
– À une minute ?
– Une minute exactement, c’est-à-dire environ dix-huit cents mètres, je découvris une caverne gigantesque de basalte, auprès de laquelle les grottes de Fingal ne sont que des bibelots d’étagère. Je m’y aventurai avec prudence. La mer en avait envahi une partie, mais au delà, le sol s’élevait et… dans une salle si large, si élevée, que l’on eût cru y voir, avec un peu d’imagination, la nef d’une cathédrale de géants, je conduisis mon navire aérien. Il avait en cet endroit un refuge assuré, dans lequel ni les flots, ni la tempête, ni les hommes ne viendraient le troubler.
Un profond soupir s’échappa des lèvres du fou qui, fixant ses prunelles troubles sur ses auditeurs muets, continua :
– J’opérai une reconnaissance des grottes. Jamais fantaisie plus admirable n’était sortie du creuset séculaire de la nature. J’étais émerveillé. Songez donc, quel rêve enchanteur : arriver là où l’homme n’existe pas et y trouver un palais réduisant à néant les colossales manifestations de l’art égyptien ou Kmer. On pourrait jucher la pyramide de Chléphrem sur celle de Chéops sans atteindre la voûte, et les ruines des vallées du Nil et du Gange, celles de la plaine d’Angkor s’accumuleraient en vain dans cette caverne sans parvenir à la remplir. Il me fallut des jours pour explorer mon nouveau domaine. Depuis huit fois vingt-quatre heures j’y séjournais, lorsque m’approchant d’un enfoncement dont je ne m’étais pas inquiété encore, j’y remarquai un tas de blocs de basalte empilés symétriquement.
– Hein ? s’écria Ulysse avec un haut le corps.
– Je fis le même mouvement que vous, gémit Ramier. Puis le raisonnement dominant la surprise, je me déclarai que, mes semblables n’ayant jamais atteint le pôle, je devais me trouver en face d’une construction accidentelle, plus bizarre que tout ce que j’avais vu déjà, et je continuai ma promenade de découverte. Seulement ma joie était diminuée, j’emportais avec moi une sourde inquiétude. J’eus beau me tenir les discours les plus probants, toujours le souvenir de ces blocs de basalte entassés régulièrement me hantait. Le lendemain, n’y pouvant tenir, je retournai au singulier monument.
– Et, interrogea avidement l’astronome ?
– Et pierre à pierre je le détruisis. Or, sous l’amoncellement, sous le tumulus, savez-vous ce que je rencontrai ?
– Non.
– Un coffret de fer dévoré par la rouille, mais résistant encore… et dans ce coffret… Au surplus, vous l’allez voir.
Le fou se pencha sur le tube acoustique, puis il se releva et demeura immobile.
Les assistants n’osaient le questionner, et cependant ils attendaient avec une impatience anxieuse le mot de l’énigme posée par leur interlocuteur.
Leur attente fut courte. Un matelot surgit de l’écoutille et remit à l’insensé un paquet assez volumineux, puis il se tint à quelques pas, les talons réunis, les bras pendants, dans une attitude militaire.
Avec une hâte fébrile, Ramier dépliait l’enveloppe du ballot. Il mit à jour un coffret de fer. Sous la couche de rouille dont il était couvert se devinaient vaguement des sculptures effacées.
Ramier fit sauter le couvercle, sa main s’enfonça un instant dans la cassette, et quand elle reparut, ses doigts se crispaient sur un parchemin jauni, piqué par les émanations salines.
– Voici, dit-il, ce qui était enfoui sous le tumulus.
– Ce parchemin ?
– Oui.
Et le dépliant lentement, il ajouta :
– Un parchemin couvert de caractères qui n’appartiennent à aucune écriture connue. Et comme si cette étrangeté ne suffisait pas, des sceaux reproduisant des monnaies astronomiques lui forment une sorte d’encadrement.
– Mais ces monnaies elles-mêmes n’indiquent-elles pas l’origine de ce curieux document ?
– Non, hélas ! Car elles furent frappées chez des peuples qui ne sont pas précisément voisins. Au surplus, voyez vous-mêmes.
Il tendit la feuille à Astéras :
– Remarquez que la première médaille reproduite au haut de la feuille est japonaise ; la seconde est chinoise et les suivantes sont des monnaies gauloises, frappées dans l’ancienne France des druides. Quant aux caractères, ils ne sont ni chinois, ni assyriens, ni hindous, ni arabes, ni européens. Que conclure de cela ? Que penser ?
Les sourcils froncés, les veines du front gonflées par l’effort qu’il faisait pour deviner le mystère proposé à sa sagacité, Astéras considérait le singulier parchemin.
Mais il cherchait vainement. Le fou avait dit vrai. Les signes employés par l’écrivain inconnu n’avaient jamais frappé ses regards, et les sceaux monétaires dont la confusion avait sans doute un sens pour l’explorateur ignoré du pôle Nord, n’en présentaient malheureusement aucun pour lui-même.
De guerre lasse, il rendit la feuille à Ramier.
– Que pensez-vous, demanda celui-ci ?
– Je ne sais trop que vous répondre. Pourtant une chose me semble évidente.
– Laquelle ?
– C’est que coffret et parchemin ne sont pas venus tout seuls au pôle.
– Alors votre avis ?
– Est qu’un voyageur, dont l’histoire n’a pas conservé le nom, a réussi à franchir la banquise. Quel était-il ? À quelle race appartenait cet audacieux ? Cela je ne puis le deviner. Peut-être même son secret est-il mort avec lui. Après avoir laissé ce témoignage de son passage, il a repris la route de sa patrie, et sans doute que, moins heureux au retour, il a péri dans la banquise, sans que l’humanité ait appris le succès de sa téméraire expédition.
Le fou eut un ricanement joyeux :
– Déjà je me suis fait des réflexions analogues.
– Cela ne m’étonne pas.
– Mais je suis réjoui de vous les entendre exprimer. Ainsi, d’après vous, nous serions seuls à posséder ce secret du passé ?
– Oh ! bien certainement !
– Alors qu’il disparaisse.
Et déjà le petit homme faisait mine de déchirer le parchemin, quand Astéras l’arrêta brusquement :
– Pourquoi détruire ceci ?
– Pour que le nom d’un rival disparaisse à jamais.
– Ne faites pas cela. Vous avez eu à vous plaindre des foules, mais un homme de génie ne saurait prendre ombrage d’un génie différent.
L’argument frappa l’insensé. Il replia soigneusement la feuille, puis la mettant dans la main d’Ulysse :
– Vous avez raison, lui dit-il, vous m’épargnez un acte bas. Mais gardez vous-même ce document, car je ne suis pas certain de résister à l’envie de revendiquer pour moi seul l’honneur de la conquête du pôle.
Et soudain il éclata d’un rire aigre, douloureux :
– L’honneur ! Je suis affolé de vanité, en vérité. L’honneur ! Qui donc me l’accordera, puisque je me suis mis en dehors de l’humanité, que je ne dois plus avoir de rapports avec elle. Ma parole ! Le ridicule amour-propre survit à toutes les résolutions. Vanitas vanitatum ! Imbécile, il y a donc encore de l’homme en toi.
Des larmes de rage roulaient sur ses joues contractées. Il cacha son visage dans ses mains et s’appuya sur la balustrade.
Robert et Ulysse le considéraient avec pitié.
Dans ce maniaque qui, jusqu’à ce moment, ne leur avait inspiré que terreur, admiration ou mépris, ils venaient de pressentir un martyr. Sans doute, celui que les sanglots secouaient devant eux avait vu son puissant génie méconnu, nié, par la tourbe des incapables envieux, et d’une intelligence d’élite l’infâme jalousie avait fait ce pauvre déséquilibré, en qui les rêves de gloire s’agitaient encore, cet infortuné qui, après avoir brutalement rompu avec l’humanité, sentait encore le besoin d’être applaudi par les hommes.
Longtemps ils restèrent ainsi. L’aéronef volait rapidement au-dessus de la mer libre, franchissant les îlots, diminuant sans cesse la distance qui le séparait du massif aperçu à l’horizon.
Maintenant, les Français distinguaient de hautes falaises, dominées par une chaîne de montagnes de huit à neuf cents mètres d’altitude. Ils discernaient, entre deux pointes de rochers, l’entrée d’une sorte de golfe resserré, analogue aux fjords des côtes de Norwège.
– Serait-ce l’ouverture qui donne accès dans les grottes, murmura Lavarède qui se trouvait auprès de Ramier ?
Celui-ci parut être ramené à lui-même par la question. Il se redressa et montrant aux deux amis sa face congestionnée, mouillée de larmes :
– Oui c’est là !
Et après un silence :
– Quoi qu’il en soit, mon prédécesseur est mort depuis des siècles sans doute, et moi, je suis le seul et légitime maître du pôle.
Il secoua la tête d’un mouvement brusque, comme pour chasser une pensée importune, et, d’un ton changé :
– Je vous laisse, Messieurs. Les abords du refuge sont difficiles. Je vais prendre place aux leviers de direction. Restez ici, je vous le conseille. L’entrée de ma caverne vaut la peine d’être vue.
Un salut rapide ponctua sa phrase. D’un pas pressé, il traversa le pont, se coula par l’écoutille conduisant à l’intérieur de l’aéronef et disparut, laissant seuls les Français et leur ennemi Radjpoor.
CHAPITRE IX
LE PÔLE NORD
Aucun des trois hommes ne songea à reprendre la querelle que la venue de Ramier avait empêchée. Leurs idées suivaient à présent un autre cours. Le pôle, ce point mystérieux était devant eux. Leurs pieds fouleraient le sol qu’aucun navigateur n’avait eu le bonheur d’atteindre. Il y avait bien l’auteur anonyme de la feuille manuscrite qu’Ulysse avait précieusement enfermée dans son carnet ; mais celui-là, comme l’avait déclaré l’Astronome, était évidemment mort sans avoir pu faire part de sa découverte aux gens de sa nation. Peut-être même l’avait-il ignorée. Il ne faut pas oublier en effet que la détermination du point est d’invention récente ; les anciens naviguaient en vue des côtes, et si par hasard le vent ou les courants les en éloignaient, ils voguaient au hasard, témoin le sage Ulysse qui mit dix années à revenir d’Ilion à Ithaque, alors que nos vaisseaux actuels effectuent le trajet en trois jours. Cette réflexion aidant, l’aventureux inconnu ne gênait plus l’enthousiasme des passagers du Gypaète.
La vitesse de l’aéronef avait été modérée. Décrivant un large cercle dans l’air, il avait évolué de façon à présenter son avant à la passe étroite remarquée par Lavarède. Sous petite pression, si l’on peut s’exprimer ainsi, il se dirigeait vers la coupure étroite et profonde qui déchirait le flanc de la falaise.
Les détails de la côte devenaient distincts. La roche d’apparence unie à distance, se montrait maintenant formée de colonnes basaltiques, polies par l’incessant ressac des flots.
Des remous tumultueux se produisaient dans le fjord dominé par des murailles rocheuses de près de cent mètres d’élévation. Le navire aérien atteignit l’étroite coupure ; sa marche se ralentit encore, et à une allure lente, il s’engagea dans le passage.
La route était presque droite. Au dessus de leurs têtes, les passagers distinguaient une bande lumineuse du ciel qui semblait tendue ainsi qu’un voile sur les arêtes de la crête. Au dessous, la lumière décroissait peu à peu. Bien avant le fond, l’œil était arrêté par les ténèbres. On planait sur un gouffre noir d’où montaient comme des plaintes, des clapotis d’eau se heurtant aux parois de basalte.
Soudain toute clarté disparut. La partie du golfe à ciel ouvert se terminait brusquement par un mur perpendiculaire de rocs, troué par une large ouverture béante et sombre.
Le Gypaète s’était engouffré dans cette baie naturelle. Presque aussitôt son fanal s’alluma, illuminant un couloir large de trente mètres. Les rayons électriques se brisant sur les facettes de la roche, remplissaient l’espace d’éclairs. Les voyageurs éprouvaient une sorte d’éblouissement lorsqu’ils jetaient les yeux sur les parois latérales, que le fanal striait de lignes de feu. Le ronflement de la machine éveillait des échos sonores, et par instant on eût cru entendre les rauquements d’une armée de fauves.
Durant quelques minutes ce chemin extraordinaire se continua, puis les parois s’écartèrent, le plafond s’éleva, et avec un grondement de tonnerre, l’aéronef pénétra dans une caverne de dimensions colossales.
Ramier n’avait pas exagéré en parlant de son « palais de basalte ».
Les murailles, hautes de quatre cents mètres, étaient formées de rangées de colonnes prismatiques accolées. Le ciel de la carrière, formé de cristallisations à facettes, renvoyait la lumière du fanal avec un insoutenable éclat.
Et dans cette demeure cyclopéenne, le Gypaète descendit lentement sur le sol où il se posa sans secousse ainsi qu’un oiseau fatigué qui se prépare au repos.
À peine le mouvement de l’aéronef avait-il cessé, que le fou reparut sur le pont. À sa suite venaient Maïva, Lotia, Radjpoor, escortés de Mme Hirondelle et des matelots du navire aérien.
– Ici, dit le petit homme, on peut descendre à terre, car l’humanité avec ses vices et ses hontes n’a pas encore pénétré en ce coin de monde.
Comme pour compléter ses paroles, les matelots fixaient à la balustrade du pont une échelle de corde, dont l’extrémité atteignait le sol.
Les voyageurs ne se firent pas répéter l’invitation. Emprisonnés depuis plusieurs jours dans les flancs du Gypaète, ils éprouvaient le besoin de fouler la terre ferme.
La terre était au pôle, il est vrai ; des océans liquides ou glacés la séparaient des continents habités ; mais enfin c’était la terre, et de même qu’Antée reprenait des forces lorsqu’il touchait la glèbe, les captifs, en mettant le pied sur le rocher, se sentirent une énergie nouvelle, une espérance plus vigoureuse.
Armés de lanternes, ils parcoururent la cavité souterraine. Des passages étroits réunissaient des grottes de dimensions variables, et sous les voûtes sonores, si loin des civilisations que celles-ci semblaient tenir du rêve, les explorateurs malgré eux eurent l’impression de vivre un conte des mille et une nuits ou de Perrault, de parcourir le palais enchanté du Roc fabuleux ou de l’ogre du petit Poucet. À chaque détour des couloirs, derrière chaque colonne soutenant la toiture basaltique, ils regardaient curieusement, comme s’ils se fussent attendus à rencontrer là, filant le lin de son rouet d’or, la sultane Scheherazade, Peau-d’Âne, Cendrillon, ou quelqu’autre belle dame du pays merveilleux de la légende.
Marchant ainsi, ils arrivèrent devant une ouverture que barrait une cloison de planches. À la vue de ce travail humain, leur illusion s’évanouit, et par une brusque projection de la pensée, ils retombèrent de l’âge des fées et des génies à notre époque. Scheherazade, le Roc, Peau-d’Âne disparurent de leur esprit ; ils se souvinrent qu’ils étaient captifs d’un fou ; que la caverne était la plus sûre des prisons, car mieux que des soldats, des geôliers, les éléments en gardaient les issues.
Et tandis que ses compagnons gardaient le silence, tristement impressionnés par ce retour involontaire à la réalité, Astéras, frappant de la main la barrière de bois, demanda de sa voix tranquille :
– Qu’est cela ?
– Cela, répliqua Ramier, est l’entrée de ma réserve. C’est là que j’ai accumulé mes provisions de carbure Z, de vêtements, mes pièces de rechange pour la réparation de mes appareils. C’est, en résumé, mon magasin et mon atelier.
Ce disant, il tirait une clef de sa poche, ouvrait un cadenas qui assurait la fermeture de la grossière clôture, et prouvait en même temps la continuelle défiance de l’insensé qui, dans ces régions inabordables, désertes, avait cru devoir recourir à un produit de l’industrie humaine pour préserver son bien des voleurs.
Les planches s’abattirent, démasquant une ouverture sombre, dans laquelle tous s’engouffrèrent à la suite du capitaine du Gypaète.
Ce réduit ressemblait à une cave basse. Le long des murailles étaient amoncelés des caisses, des tubes métalliques, des cordages, des pièces de fer, d’acier ou d’aluminium. Au centre, creusé dans le roc même, un bassin de forme irrégulière était rempli de potasse à demi liquéfiée.
– Une précaution que j’ai prise, dit le fou en s’adressant à Astéras. La potasse absorbe l’humidité de l’air et mes aciers s’oxydent moins.
Puis d’un ton brusquement changé :
– Maintenant vous connaissez la configuration générale des cavernes. Promenez-vous à votre guise, tandis que mes matelots et moi, nous procèderons au ravitaillement du Gypaète.
Sous sa forme amicale, l’invitation était un ordre. Les passagers de l’aéronef ne s’y trompèrent pas, et saluant Ramier, ils quittèrent la réserve.
De nouveau ils parcoururent les grottes immenses, repris par l’impression étrange qui déjà, à leur arrivée, les avait, pour ainsi dire, dépouillés de leur personnalité pour les transporter, sur les ailes de l’imagination, à l’époque imprécise où Simbad le Marin sillonnait les étranges océans de la légende.
Sans parler, ils marchaient, regardant, selon l’expression populaire, de tous leurs yeux. Les salles succédaient aux salles. Ils avaient repassé auprès de l’aéronef qui, couché sur un socle de basalte, semblait un monstre de la fable guettant une proie. Dans l’irradiation de son fanal, ils avaient hâté le pas, pressés de se retrouver dans la lumière plus douce de leurs lanternes. Ils allaient maintenant vers l’entrée des souterrains, suivant le large couloir parcouru naguère par le navire aérien.
Tout à coup Robert, qui précédait ses compagnons, se rejeta en arrière avec une exclamation. Le chemin praticable s’interrompait brusquement, coupé par une tranchée sombre, dont les rayons des lanternes ne permettaient pas d’apercevoir le fond. Un pas de plus et le jeune homme aurait été précipité !
Arrêtés au bord de l’abîme, tous regardaient. Un bruit monotone, régulier comme le clapotis des vagues, montait des profondeurs du gouffre. Et comme les voyageurs demeuraient immobiles, inquiétés par les ténèbres qui s’épaississaient au delà du cercle lumineux formé par leurs lampes, la voix de l’astronome s’éleva dans le silence :
– Là haut… le ciel… levez la tête, la Grande Ourse brille !
Tous obéirent. Le savant ne s’était pas trompé. Dans leur promenade, les captifs de Ramier avaient atteint l’endroit où le couloir était à ciel ouvert. Les sept étoiles principales de la constellation de la Grande Ourse se détachaient avec un incomparable éclat sur un fond d’un noir absolu, On eût dit sept diamants jetés sur une bande de velours. Un peu plus loin, une étoile isolée attira l’attention d’Ulysse. Il la désigna du geste :
– L’étoile polaire !
Puis sans transition, éprouvant le besoin de penser à haute voix, il continua :
– Dire qu’en face de ces soleils perdus dans l’infini, les cosmographes n’ont eu qu’une idée : grouper les astres en constellations, de façon à obtenir des figures grossières d’hommes ou d’animaux. Si ces niais avaient vu, comme nous, au sortir d’un tombeau de granit, les sept étoiles étinceler sur la voûte céleste ainsi que des flambeaux d’espérance, certes ! ils ne les eussent pas groupées sous la silhouette grotesque et lourde d’un ours.
Et s’enflammant peu à peu, le savant poursuivit en élevant la voix :
– Un ours ! Et quel ours ! un quadrupède ridicule, balourd, tel que jamais il n’en fut enfanté par la nature, qui cependant s’est montrée avare de beauté à l’égard des plantigrades.
Puis tirant de sa poche un carnet quelque peu froissé par l’usage, il le feuilleta et présentant un dessin à ses compagnons :
– Regardez-moi cela. Est-ce assez laid ? Comparez les astres flamboyants qui scintillent là-haut à cette odieuse caricature. Ah ! les représentations graphiques sont à refaire en astronomie. Il semble que cette science idéale, qui eût dû être présentée seulement par des poètes, ait été confiée à des bouffons, désireux avant tout d’amuser les ignorants par des « charges » de rapins en délire. Durant des siècles on a accumulé les fantaisies bizarres, torturant les lignes, contorsionnant les figures. Il serait grand temps que le meilleur, le plus pur de l’art fût consacré à la plus grandiose des connaissances humaines.
Il feuilletait nerveusement son carnet :
– J’entre en fureur, reprit-il, quand je songe qu’Andromède par exemple, ce type de la beauté grecque, qui a donné son nom à l’une des plus brillantes constellations du ciel, a pu inspirer à un monsieur, qui n’était ni astronome, ni poète, la complainte barbare que vous voyez transcrite sur ces deux pages.
LA COMPLAINTE D’ANDROMÈDE
Andromède avait deux poissons,
Deux gros poissons sur l’es-
Tomac.
Elle sautait comme un goujon,
Quand le bon docteur Persées
Passa
Ce qu’un poisson craint plus que tout,
Dit ce savant, ce sont les cou-
Rants d’air.
Pour enchifrener ces filous,
De l’œil aux pieds, perçons des trous,
C’est clair !
Changea la belle en écumoire,
Sitôt le vent siffla parmi
Ses os.
Pris de fièvre sternutatoire
Un poisson tombe à terre, expi-
Rando.
L’autre meurt de ballonnement,
Et Andromède en sa grati-
Tude,
L’offrit au docteur en paiement.
–––
Regret
–––
De si modeste émolument
Esculape a perdu l’habi-
Tude !
Signé : Un Astronome.
Extrait du premier et unique numéro de l’Astronomie Poétique, publication scientifico-littéraire éclose et défunte en mars 1827.
Un éclat de rire accueillit la présentation de ce singulier document. Astéras leva les bras en l’air avec une mine désolée :
– Vous riez, clama-t-il, vous riez, au lieu d’éprouver de la rage, et contre les dessinateurs sans art, et contre le poète irrémédiablement brouillé avec Pégase. Vous riez, alors que du ciel, asile de toute poésie, on a fait un vaudeville. Voilà bien les peuples de la terre, voilà l’esprit humain. Mais nous changerons cela malgré vous, malgré ceux qui vous ressemblent. Dans ce carnet, j’ai groupé une foule d’exemples analogues ; je les mettrai sous les yeux des vrais astronomes, et j’en suis sûr, ils soulèveront un tolle tel, que l’on sera obligé de représenter ce qu’il y a de plus beau dans notre univers, par les images les plus belles nées dans le cerveau de nos artistes. Riez, riez donc !
Le savant enrageait pour tout de bon. Robert eut peine à lui faire entendre que ses amis et lui partageaient sa manière de voir. Leur hilarité provenait de la fantaisie bizarre des illustrateurs astronomiques, mais elle ne constituait pas une approbation ; loin de là.
Non sans résistance, Astéras se laissa fléchir, et l’harmonie était rétablie quand les promeneurs remontèrent à bord du Gypaète.
Cependant Ramier et ses hommes n’avaient pas perdu leur temps. Les approvisionnements nécessaires étaient arrimés dans la cale de l’aéronef, et le petit homme annonça à ses passagers que, dès le lendemain, on reprendrait le chemin du Sud.
– Où nous conduisez-vous, demanda Lavarède, ravi malgré sa captivité, de revenir vers les pays du soleil ?
– En Amérique.
– Ah ! en Amérique, murmura philosophiquement l’ancien caissier. Nous avons déjà touché en Afrique, en Océanie, en Asie ; à présent nous allons parcourir le Nouveau-Monde ; nous finirons peut-être bien par songer à la vieille Europe.
Comme on le voit, le jeune homme finissait par prendre son parti de ses voyages obligatoires ; mais une réflexion lui vint :
– À propos, cher Monsieur, vers quelle partie de l’Amérique dirigez-vous votre vol ?
– États-Unis… Observatoire des Montagnes-Rocheuses.
Ces quelques mots jetèrent à bas la résignation de Lavarède. Un instant il avait oublié le serment de vengeance proféré par le fou contre l’observatoire des Montagnes-Rocheuses. L’arrivée au Pôle Nord, la visite des cavernes avaient chassé l’angoisse de son esprit ; maintenant elle se représentait plus aiguë, plus lancinante.
Le capitaine du Gypaète avait parlé de faire un exemple terrible. Un crime allait être commis que nul ne pourrait empêcher. Et les passagers de l’aéronef, captifs dans leur prison ailée, assisteraient à la catastrophe qu’ils prévoyaient devoir être effroyable.
Tous avaient entendu les brèves répliques échangées entre les deux hommes. Aussi, sur l’invitation de Ramier, descendirent-ils à la salle à manger, le cœur serré, une vague terreur pesant sur eux ainsi qu’un linceul de plomb.
CHAPITRE X
L’AMÉRIQUE À VOL D’OISEAU
Cette nuit-là, on dormit mal à bord du Gypaète. Des cauchemars sinistres assiégèrent les prisonniers de Ramier, et dans une ronde infernale, ils virent défiler devant eux une armée d’astronomes privés de têtes, de bras ou de jambes, qui bondissaient éperdument sur les ruines fumantes d’observatoires incendiés.
Aussi, lorsque de grand matin, la trépidation des machines les avertit que l’aéronef se remettait en marche, furent-ils debout en un instant et se trouvèrent-ils réunis, sans s’être donné le mot, sur le pont du navire aérien.
Déjà l’appareil avait quitté les cavernes. Il suivait maintenant le fjord resserré qui s’ouvrait sur la mer libre. À l’extrémité du conduit, il vira avec une admirable précision et mit le cap au Nord.
– Tiens, grommela Lavarède avec surprise, nous ne nous dirigeons donc pas vers l’Amérique. Notre geôlier aurait-il changé d’avis ?
Mais Ulysse secoua la tête :
– La terre est ronde, répondit-il enfin, et du pôle, point d’intersection des lignes qui figurent les divisions du globe en longitude, nous redescendrons tout droit vers le Sud et vers l’observatoire que menace notre insensé.
– Ne ferez-vous rien pour le protéger ?
La question était prononcée d’une voix émue par Lotia. Les yeux de la douce Égyptienne se fixaient anxieusement sur Robert.
Celui-ci étendit la main vers elle, et avec un accent profond :
– Si, Lotia, je vous le jure, nous tenterons l’impossible pour empêcher le crime que vous redoutez.
Un geste effrayé de Maïva arrêta la parole sur ses lèvres. Suivant la direction des regards de la mignonne créature, Lavarède aperçut le fou qui, glissant silencieusement sur la surface du pont, se rapprochait du groupe formé par les passagers.
Il ne semblait pas les voir. Évidemment leurs propos n’étaient pas arrivés jusqu’à lui.
Passant auprès de ses prisonniers, il alla s’accouder sur la balustrade, et, la tête rejetée en arrière, il regarda avec persistance dans la direction du Nord.
Muets maintenant, tous l’observaient. Une brise légère, plutôt fraîche que froide, caressait les voyageurs.
À quatre cents pieds d’eux, la mer se déroulait paresseusement, agitée par une houle faible, et venait lécher mollement de ses lames allongées les rivages d’innombrables îlots.
Soudain l’astronome poussa une exclamation de surprise. Tous tressaillirent, et répondant à leur muette interrogation, Astéras montra un récif isolé s’élevant d’une vingtaine de mètres au-dessus des eaux :
– Voyez là, dit-il. Mes yeux me trompent sans doute, mais il me semble voir un drapeau flotter sur ce rocher.
Non, il ne se méprenait pas. Le Gypaète piquait droit vers le roc ; la distance diminuait rapidement, et bientôt tous distinguèrent nettement un pavillon noir sur lequel se détachait une ancre blanche.
Et comme ils regardaient, stupéfaits de rencontrer en ce point une trace du passage de l’homme, le fou se retourna brusquement. Il courut au porte-voix, prononça un ordre bref dans l’embouchure ; aussitôt un claquement sec retentit à l’arrière de l’aéronef.
Les prisonniers dirigèrent leurs yeux de ce côté, et avec stupeur, ils virent émerger de la surface polie un pavillon semblable à celui que portait le rocher.
Ramier revint à eux, et un sourire orgueilleux crispant ses traits :
– Mon drapeau, dit-il. Il a la couleur du deuil, mais il contient l’ancre blanche de l’espérance. Celui qui vole à la suite de mon Gypaète salue celui que j’ai arboré au point précis qui marque le pôle.
Avec une sorte de respect, tous les regards se reportèrent sur le récif, modeste bloc de rocher, situé par un caprice de la nature à l’endroit où l’axe terrestre perce la croûte du globe.
Et ils se surprirent à s’étonner de ne point trouver le paysage plus étrange. L’eau de la mer ressemblait à l’eau d’un océan quelconque. Le récif était tel que tout autre écueil. De cela ils éprouvèrent comme une désillusion. Quoi, le pôle du monde que tant de navigateurs ont tenté d’atteindre, pour la découverte duquel les nations civilisées ont sacrifié sans compter les millions et les existences humaines, c’était ce petit morceau de pierre, sans caractère, sans grandeur, que par les gros temps, les vagues de la mer libre devaient recouvrir.
L’auréole mystérieuse du pôle s’évanouissait pour eux. Il n’était plus l’inconnu, l’inabordable, et dégagé du brouillard des légendes, il se montrait dans sa prosaïque et attristante nudité.
Cependant le rocher restait en arrière. Il disparaissait bientôt, et suivant le 110e de longitude, l’aéronef s’élançait à toute vitesse vers le sud.
Durant quelques jours, aucun incident ne troubla l’existence monotone du bord. Le navire franchit la mer libre, l’immense étendue de glaces qui l’entoure. Les passagers entrevirent au passage le Groenland, les plaines neigeuses du Labrador, traversèrent à la vitesse d’un express le Canada et franchirent la frontière des États-Unis.
Souvent l’un ou l’autre avait été sur le point d’interroger le fou, de lui demander quels projets il nourrissait contre l’observatoire des Montagnes Rocheuses, mais toujours, comme s’il eût pressenti la question suspendue au-dessus de sa tête, le petit homme s’était dérobé, glissant entre les doigts de ses interlocuteurs, avec une prestesse telle que le découragement s’emparait d’eux.
Et pourtant chaque minute rapprochait le moment où le navire aérien atteindrait le but de sa course rapide ; chaque seconde aggravait le danger dont les paisibles astronomes des Great-Mountains étaient menacés.
À tout hasard, Robert et Astéras s’étaient munis de fusils à carbure ; ils les conservaient dans leur cabine. Certainement Ramier n’ignorait pas ce détail, mais il ne jugea pas à propos de faire à ce sujet la moindre observation.
Les prairies du Far-West, les territoires de chasse des indiens Pawnies défilaient sous les yeux des prisonniers ; mais ce spectacle magique ne les intéressait pas. Ils ne prêtaient aucune attention aux villes nouvelles entrevues, aux forêts impénétrables, aux fleuves larges comme des bras de mer.
Les voies ferrées sillonnant les solitudes de la prairie, les bandes de bisons migrateurs, les chevauchées hurlantes des guerriers indiens, toute la vie des déserts herbeux de l’Ouest, sollicitaient vainement leurs regards indifférents. Une crainte aiguë les absorbait, plus intense, plus insupportable à mesure que le voyage se prolongeait.
Vague jusque-là, leur terreur se précisa tout-à-coup lorsque la silhouette dentelée de la chaîne des Montagnes-Rocheuses barra l’horizon. C’était là, au milieu de cette nature tourmentée, de ces pics pointant leurs cimes vers le ciel, que le malheur allait s’accomplir.
Alors une rage les prit. Non, ils ne consentiraient pas à devenir les complices de leur geôlier. L’inaction, en pareil cas, serait une lâcheté ; ils agiraient. Réunis au salon, les passagers du Gypaète tinrent conseil.
Ils ne connaissaient pas l’emplacement exact de l’observatoire, mais ils le sentaient proche. Sans tarder, il fallait paralyser la volonté de Ramier. Peut-être, en privant le navire aérien de son capitaine, préparait-on un épouvantable accident, une chute vertigineuse ou l’aéronef et son équipage rouleraient broyés, pulvérisés, dans les gorges ouvertes, ainsi que des gueules avides, au milieu des escarpements. Tel était l’état d’esprit de tous que cette perspective ne les arrêta pas. L’horreur du crime les haussait jusqu’à l’héroïsme. Ils acceptaient d’être victimes pour ne pas devenir bourreaux.
Il fut décidé que Robert et Astéras se muniraient de leurs armes, et que le soir, alors que le fou serait avec eux dans la salle à manger, ils le saisiraient, le ligotteraient et ne lui rendraient la liberté que sous promesse formelle d’épargner l’observatoire et ses habitants.
– Et puis, conclut Lavarède, qui sait si, du même coup, nous ne pourrons obtenir du « Capitaine » qu’il nous dépose à terre.
En parlant ainsi, il regardait Lotia. La jeune fille baissa la tête avec embarras. Il comprit ce qui se passait en son esprit, et d’une voix lente :
– À terre, Lotia, vous serez libre. Je vous l’ai affirmé, je suis Français, et je ne considère pas que la cérémonie célébrée dans l’île de Philæ soit un mariage. Vous n’êtes pas enchaînée. Si un jour, vous croyez enfin que je n’ai jamais menti, je solliciterai votre main et vous supplierai de me l’accorder suivant les rites de ma patrie.
Elle leva ses paupières, fixant sur son interlocuteur le regard clair de ses yeux noirs.
– Je vous remercie de me parler ainsi, murmura-t-elle. Je sens bien que vous exprimez la vérité ; je crois qu’en effet je serais libre si je foulais la surface du sol.
– Ah ! vous avez donc confiance en moi !
– Pour le présent, oui… Pour le passé, je ne dois pas.
– Vous ne devez pas ?
– Non, car je ne suis plus seule en jeu. Moi, je puis obéir à une impression, à un instinct ; mais il ne faut pas que je me contente de cela pour tout ce qui touche à l’honneur de ma race. Là, je suis contrainte d’exiger des preuves indiscutables, puisqu’il est nécessaire de persuader aussi les autres qui m’attendent là-bas, et qui, sans cela, m’accuseraient de félonie.
Son accent était douloureux. On sentait qu’elle souffrait de refuser sa confiance entière au Français, mais que rien ne vaincrait l’obstination dont elle pensait devoir faire montre pour l’honneur de l’antique famille des Hador.
Robert n’insista pas, mais il tendit la main à la belle Égyptienne avec ces seuls mots, murmurés sur le ton de la prière :
– Pour me porter bonheur !
Elle eut un pâle sourire, laissa tomber sa main dans celle de l’ancien caissier, et d’une voix grave elle répéta :
– Pour vous porter bonheur !
Radjpoor avait assisté à l’entretien. Il n’attendit pas davantage, se glissa dehors sans que ses compagnons fissent attention à son mouvement, et parcourant le couloir central d’un pas rapide, il alla frapper à la porte du laboratoire de Ramier.
Cependant, Robert et Astéras, après quelques explications complémentaires, se séparaient de Lotia véritablement très émue, de Maïva rayonnante de joie, et entraient dans leur cabine afin de prendre leurs armes et de se préparer à la lutte.
Mais à leur grande surprise, ils ne trouvèrent plus les fusils. Ceux-ci avaient disparu, enlevés par une main invisible.
Les deux amis se regardèrent interdits, mais secouant son inquiétude, Robert s’écria :
– Bah ! le matelot qui fait le ménage, les a sans doute reportés au râtelier d’armes ; allons-y.
– Tu as raison, acquiesça l’astronome, allons-y.
Tous deux coururent à la porte, mais le battant s’était refermé derrière eux, et malgré tous leurs efforts, ils ne parvinrent pas à le faire tourner sur ses gonds.
Cette fois, il n’y avait pas à en douter. On les avait enfermés, après les avoir dépouillés de leurs armes.
Pourquoi ? Dans quel but ? Ramier avait-il surpris leur complot et avait-il voulu les empêcher d’agir ?
Cela devait être, et pourtant ils ne se souvenaient pas de s’être trahis en sa présence, d’avoir laissé échapper une parole imprudente. Étaient-ils donc l’objet d’une surveillance constante, et les cloisons du Gypaète avaient-elles des oreilles ainsi que les murs des palais des rois ?
Questions insolubles. Ce qui n’était pas niable, par exemple, c’est que les jeunes gens étaient captifs dans leur cabine, et que leurs forces réunies ne parvenaient pas à ébranler la porte métallique fermée sur eux.
Cette constatation amena d’abord une explosion de colère chez le patient Ulysse comme chez son bouillant compagnon ; mais une réflexion soudaine les glaça. Si l’on avait cru bon de prendre tant de précautions contre eux, c’est que l’heure du crime n’était pas éloignée.
Peut-être déjà l’observatoire condamné par le fou était-il en vue.
À cette proposition formulée par l’astronome, les prisonniers se portèrent au hublot qui éclairait la cabine. Ils regardèrent avidement au dehors. Le crépuscule tombait, noyant de sa cendre grise la région tourmentée que dominait l’aéronef. C’était le chaos de la montagne, effrayant et sublime, mais rien n’indiquait la présence d’êtres vivants ; on ne voyait nulle trace d’habitation.
Les jeunes gens respirèrent. Ils s’étaient trompés. Ainsi que tout homme sous le coup d’une aventure menaçante, ils ressentaient une joie profonde de la savoir différée.
Leur satisfaction fut brève.
Le navire aérien modifia sa direction, et, dans le champ de l’ouverture du hublot, les Français découvrirent un dôme que trouait le tube d’une puissante lunette.
Cette fois, la catastrophe était imminente. À cent mètres à peine du Gypaète, se dessinait la terrasse en gradins établie à grands frais par le gouvernement des États-Unis. Il n’a pas fallu, en effet, moins de seize mille fourneaux de mine pour déblayer l’emplacement où l’observatoire fut édifié. Par ce seul détail il est aisé de juger du reste.
Robert, Astéras s’étaient pris la main. Cloués à la vitre par une force supérieure, incapables de se mouvoir ou de parler, ils regardaient. L’aéronef cessa de marcher en avant.
La nuit venait. Dans l’obscurité de plus en plus opaque, les jeunes gens aperçurent des ombres humaines glissant le long de cordes tendues du navire aérien à la plateforme de l’observatoire. Ils devinèrent que l’équipage allait procéder à la sinistre besogne ordonnée par le fou. Les hommes disparurent dans les bâtiments.
Un quart d’heure, un siècle se passa, puis les hommes reparurent, furent hissés à bord, et tout aussitôt les ailes de l’appareil frappèrent l’air avec un grondement inaccoutumé.
À toute vitesse, l’aéronef s’éloignait de l’observatoire. Qu’avaient fait les matelots ? Quelle vengeance Ramier avait-il tirée des astronomes assez malheureux pour avoir découvert son fanal ?
La réponse à ces questions, que s’adressaient tout bas les Français, ne se fit pas attendre.
Soudain une gerbe de flammes jaillit de la montagne comme d’un cratère, suivie, après quelques secondes, par une épouvantable détonation. Un brusque appel d’air, déterminé par l’explosion, fit virer l’aéronef, mais comme un coursier généreux, il se redressa aussitôt, et, dans une fuite éperdue, reprit la route du sud.
Frappés de stupeur, Robert et son ami restaient à la même place. La vérité horrible leur apparaissait.
À l’aide de tubes de carbure liquide, Ramier avait provoqué une effroyable explosion, et maintenant sans doute, sous le manteau de la nuit, les murailles de l’observatoire des Montagnes Rocheuses s’écroulaient, écrasant sous leurs débris les savants qui, en croyant rechercher une étoile, avaient innocemment troublé la quiétude d’un fou.
Abasourdis, désespérés, ils s’arrachèrent enfin de ce hublot maudit, qui leur avait permis d’assister au forfait ; mais alors un cri leur échappa, cri d’effroi, de rage, de stupéfaction.
La porte de la cabine était ouverte au large, sans qu’ils eussent entendu le bruit de la clef restée à l’extérieur dans la serrure.
Le crime commis, on leur rendait la liberté. Chancelants, ils se rendirent au salon.
Lotia et Maïva y pénétraient au même instant. Comme les Français, elles avaient été enfermées et délivrées de la même façon mystérieuse.
Frissonnantes, elles écoutèrent le récit de leurs compagnons. Elles n’avaient rien vu, elles ; mais elles avaient perçu le bruit de la détonation, la secousse imprimée à l’aéronef par le courant d’air qui avait suivi.
Et à cette heure, elles mesuraient avec épouvante l’étendue du désastre.
Pour Robert, le premier moment de stupeur passé, il lui restait une indignation généreuse, une horreur du contact du fou criminel. Quoi qu’il pût advenir, il dirait à Ramier son mépris.
Mais ses projets furent réduits à néant par l’absence du capitaine du Gypaète. Celui-ci, non plus que Mme Hirondelle, ne se montra les jours suivants. Les matelots servaient les repas aux passagers, mais ils restaient muets, ne répondant pas une parole à leurs interrogations exaspérées.
Désœuvrés, irrités, Lavarède et ses compagnons demeuraient la plupart du temps sur le pont, regardant, avec une rage croissante, défiler sous leurs yeux les paysages grandioses des deux Amériques.
À la Prairie des États-Unis succédaient les terras calientes – terres chaudes – du Mexique, le massif volcanique des petites républiques du centre américain, les forêts de Colombie, du Vénézuela, des Guyanes, l’immense vallée de l’Amazone, les llanos de la République Argentine.
Au bout de quelques journées, après avoir suffoqué sous le soleil brûlant de l’Équateur, les voyageurs commençaient à ressentir les premières atteintes du froid, en planant au-dessus des plaines interminables de la Patagonie.
Puis ils aperçurent le détroit de Magellan, la Terre de Feu, île située à l’extrémité sud du continent. Mais le Gypaète ne s’arrêta point. Audacieusement il poursuivit son vol au-dessus de l’Océan, sa proue inflexiblement dirigée vers le sud. Après avoir visité le pôle Nord, les prisonniers enfermés dans ses flancs allaient-ils être entraînés par sa course irrésistible vers le pôle antarctique ?
CHAPITRE XI
CYCLONE
Très aisément les captifs de Ramier s’étaient rendu compte du chemin parcouru. Chaque matin, sur une carte fixée à la cloison de la salle à manger, une main invisible marquait le point. Une épingle, portant un petit drapeau noir, avec au centre une ancre blanche, était piquée à l’endroit précis que dominait l’aéronef.
Maintenant les renseignements ne discontinuaient pas. Le Gypaète franchissait les mers illustrées par les explorations de Wilkes, de James Ross, de Dumont-d’Urville. Il filait vers la terre de Graham, située à la limite extrême du cercle polaire. On ne pouvait plus douter. Le but du voyage était le pôle Sud.
Et Robert, avec un mélange d’ironie et de mauvaise humeur, répétait dix fois par heure :
– Non, cela n’a pas le sens commun ! Moi, qui n’aime pas voyager, on me fait faire le tour du monde en passant par les deux pôles !
Récrimination bien platonique, car celui qui la causait persistait à demeurer invisible.
Par instants, l’ancien caissier se répandait en reproches à l’adresse d’Astéras, reproches que celui-ci écoutait d’un air étonné. Le distrait astronome, à même pour la première fois de contempler les constellations de l’hémisphère Sud, ne se souvenait plus de Ramier, ni de son odieux attentat contre l’observatoire des Montagnes Rocheuses.
Dans une vitrine du salon, il avait trouvé un fragment de bas-relief, évidemment d’origine égyptienne.
Une étiquette, collée sur la tranche, portait ces mots.
Ruines du MASHONALAND
(Afrique Australe).
Représentation hiéroglyphique du Ciel et de la Terre.
Cette découverte avait été le point de départ d’interminables dissertations astronomiques, que Maïva seule avait écoutées. Mais comme le savant avait plaisir à parler à la jeune fille, que celle-ci ne se lassait pas d’entendre Ulysse, il résultait de cette satisfaction en partie double que l’éloquence de l’astronome était intarissable.
Après avoir vanté le peuple des Pharaons, avoir démontré qu’en effet il avait dû établir des colonies dans l’Afrique méridionale, puisque sur certains de ses monuments est figurée la constellation de la Croix du Sud, invisible de l’Égypte proprement dite, Astéras s’était lancé à corps perdu dans une discussion dont il faisait tous les frais, afin de prouver à l’ex-muette que seuls les hiéroglyphes de la vallée du Nil sont astronomiques. Les étoiles, les soleils, les sculpteurs des pyramides se mêlaient en un pittoresque désordre, et quand Ulysse, lassé mais non rassasié de monologue, s’arrêtait, Maïva le priait de continuer. Décidément ces deux êtres, nés sous des latitudes différentes, avaient été créés l’un pour l’autre.
De son carnet, inépuisable recueil de documents scientifiques, l’astronome avait tiré, à l’appui de sa thèse, des reproductions de sculptures arias, assyriennes, perses, indiquant les différences capitales qui les distinguaient des œuvres similaires de la patrie des Pharaons.
– Tous les peuples, disait-il, lorsqu’ils ont voulu fixer leurs idées sur la pierre, ont figuré des choses terrestres, matérielles. Seuls les Égyptiens ont entrevu l’idéal. Seuls, ils ont brisé les liens qui les attachaient au sol et ont permis à leur pensée de voler librement dans l’espace. Ce qui est vrai pour l’antiquité, l’est également chez les modernes. Les peuples inférieurs de nos jours usent encore de l’écriture hiéroglyphique. Où vont leurs pensées ? Simplement à des choses vulgaires, aux menus faits de la vie usuelle.
Et comme preuve de cette affirmation, il avait montré triomphalement à Maïva, qui, il faut l’avouer, en parut ravie, le calendrier des Peaux-Rouges Dakotahs pendant la période comprise entre les années 1799 et 1870.
– Ce document, commentait-il, a été trouvé à la fin de 1869, lorsque les milices américaines, après un siège de plusieurs semaines, enlevèrent le village fortifié de la tribu indienne. Tous les survivants furent faits prisonniers et transportés dans l’Ouest.
On avait besoin de leur territoire pour les colons. Sans m’appesantir sur ce procédé de civilisation, je poursuis ma démonstration. J’ai noté quelques uns des faits que les Peaux-Rouges relatent dans leur calendrier. Guerres, chasses, maladies, incendies ; voilà pour cette tribu les incidents annuels dignes d’être rapportés. Deux fois seulement en soixante et onze ans, nous voyons figurer des événements astronomiques : une pluie de bolides et une éclipse de soleil. Mais il ne faudrait pas croire qu’il y a là un embryon d’observation céleste. Les Dakotahs ont signalé ces phénomènes uniquement parce qu’ils en ont eu peur, car ils les attribuaient à des génies terrestres, dispensateurs des ténèbres et de la lumière.
C’était sur le pont, vers quatre heures du soir, que l’astronome pérorait ainsi. À quelques pas de lui, Robert et Lotia examinaient l’horizon qui semblait éclairé d’une lueur étrange. C’était le blink, réverbération de la banquise sur laquelle le Gypaète allait bientôt s’engager.
Cela formait une ligne claire, sauf vers le Sud-Ouest, où une tache noire se développait lentement sur le ciel.
Le Français considéra ce point sombre, sans parvenir à discerner sa nature, et il finit par se demander à voix haute :
– Qu’est donc cela ?
Lotia se crut interrogée.
– Je ne sais, dit-elle ; on penserait que ce sont des nuages, mais si noirs, si noirs qu’ils annonceraient une tempête.
Il y avait une nuance de crainte dans les paroles de la jeune fille. En effet l’ouragan est déjà terrifiant à la surface du sol ; mais, dans le navire aérien, l’idée que l’on allait essuyer le choc des vents déchaînés prenait quelque chose d’horrible et de fantastique.
Du reste, l’hésitation des observateurs ne fut pas de longue durée. L’armée des nuées gagnait rapidement sur le ciel. Bientôt un tiers de l’horizon fut noyé dans un brouillard gris-jaunâtre, cotonneux, où se confondaient la mer et la voûte céleste.
– Rentrons, murmura Lotia, et prévenons l’équipage.
– Vous avez raison, acquiesça Robert. L’assaut du vent sera terrible, et il est bon sans doute de prendre quelques dispositions pour le supporter.
Il appela Ulysse et Maïva qui n’avaient rien vu.
Mis au courant, ceux-ci partagèrent les craintes de leurs compagnons, et tous quittèrent le pont. Mais ils eurent beau parcourir l’aéronef, ils ne rencontrèrent ni le fou, ni Mme Hirondelle. De guerre lasse, ils se rendirent à la machinerie.
Les matelots les écoutèrent tranquillement. Ils souriaient comme si les terreurs des passagers leur paraissaient puériles.
En vain Robert insista. Tout ce qu’il obtint, ce fut cette réponse d’un marin :
– Le Gypaète se rit du vent. Soyez paisibles. Il ne déviera pas de sa route.
Loin d’être calmées par le flegme de l’équipage, les appréhensions des prisonniers de Ramier s’accrurent.
Rassemblés dans le salon, penchés aux hublots, ils considéraient, avec un serrement de cœur, les nuages qui montaient toujours. Si le Gypaète ne modifiait pas sa route ; il serait pris en flanc par la tempête ! et quelque admiration qu’ils eussent pour l’appareil volant, c’était avec angoisse que les voyageurs se demandaient comment il supporterait la tourmente.
Cependant un calme lourd, précurseur de l’orage, pesait sur la nature ; la surface de la mer avait pris une teinte livide, mais elle s’étalait sans une ride sans un remous, ainsi qu’un lac d’huile.
Soudain un éclair rouge fendit la nue, une détonation épouvantable assourdit les passagers. Comme si la foudre avait donné le signal de la lutte des éléments, un vent violent s’abattit sur l’Océan, le creusant en gouffres sombres, le soulevant en lames déchiquetées.
Le Gypaète avait tressailli sous le choc, sa membrure craquait ; à chaque rafale, il était secoué par un roulis violent. Pourtant il continuait sa marche, fonçant intrépidement dans la tourmente. Les éclairs se croisaient, les coups de tonnerre se succédaient avec des sonorités assourdissantes, de l’Océan montait le bruit des vagues se fracassant les unes sur les autres, et au milieu de ce vacarme, parmi les hurlements de la tempête, il volait imperturbablement vers le pôle Sud.
Ahuris, confondus par l’audace de cette manœuvre, les passagers restaient debout auprès des hublots. Le visage pâle, les dents serrées, ils assistaient à cette lutte désordonnée d’un frêle aéronef contre le gigantesque cyclone. Malgré eux, la bonne tenue du Gypaète ranimait leur confiance. Ils se surprenaient à penser qu’il vaincrait l’ouragan. Les balancements que lui imprimait le vent cessaient de les inquiéter.
Et comme ils se regardaient, prêts à se communiquer leur espérance, voilà qu’un coup sec fait trembler tout l’appareil. Le Gypaète se couche sur le flanc ; il paraît prêt à se retourner complètement, mais il se redresse soudain pour se coucher encore.
Personne n’a le temps de demander une explication.
La porte du salon s’ouvre violemment, et Ramier se précipite dans la pièce. Il est blême, ses cheveux se hérissent sur son front. Il court au tube acoustique, y jette des ordres rapides.
Presque aussitôt les mouvements désordonnés de l’aéronef cessent, il retrouve sa stabilité ; il file mollement à travers la bourrasque.
Le fou se redresse ; son visage a repris son calme habituel. Il se dirige vers la porte ; il va sortir sans adresser la parole à ses hôtes, qu’il n’a point l’air de voir.
Mais Lavarède ne l’entend pas ainsi. Il se plante devant le petit homme et s’inclinant :
– Bonjour, Monsieur Ramier. Un vilain temps, n’est-ce pas ?
L’insensé secoue la tête :
– Vilain, parce que nous avons une avarie, sans cela mon Gypaète…
– Une avarie, interrompt le Français ?
– Oui ; une aile brisée net. Ce sont les ailes de sûreté qui fonctionnent maintenant. Par prudence j’ai ordonné de fuir dans le vent.
– Alors l’ouragan nous emporte ?
– Parfaitement.
– Où cela ?
– Je n’en sais rien. La direction est Sud-Ouest Nord-Est. Qu’importe, d’ailleurs en plein ciel, il n’y a pas d’écueils à éviter. Et puis, vu l’avarie dont je parlais, la tempête me met presque dans mon chemin.
– Elle vous éloigne cependant du pôle Sud ?
– Absolument.
– Ne désiriez-vous pas l’atteindre ?
– Si, mais j’ai dû changer d’avis. Mon atelier de réparations, mes pièces de rechange sont au pôle Nord. Il me faut donc y retourner.
– Alors, nous revenons là-bas, dans la caverne, balbutia Robert perdant tout sang-froid devant cette fatalité qui le condamnait à un nouveau voyage au pôle arctique ?
Le fou se méprit sur son sentiment :
– Oh ! en huit jours, le dommage sera réparé, et alors, je vous le promets, je vous conduirai à ce pôle Sud qui paraît tant vous intéresser, bien qu’il ressemble furieusement à l’autre.
– Ensuite au pôle Sud, répéta le Français d’une voix étranglée et laissant retomber ses bras avec abattement.
Ramier fit oui de la tête, et se glissant prestement entre la cloison et son interlocuteur incapable de s’opposer à son mouvement, il s’élança dehors et disparut dans le couloir.
Quant au jeune homme, il ne prit pas garde à cette fuite. Il regarda ses compagnons et hochant la tête d’un air désolé :
– Hein, dit-il, est-ce assez complet ? Un pôle nous renvoie à l’autre ; c’est une partie de raquettes, et nous sommes le volant !
Un coup de tonnerre plus violent arrêta la parole sur les lèvres de ses amis ; une gerbe de flammes jaillit des nuages et alla s’éteindre dans la mer, rappelant toute l’attention des passagers aux hublots.
L’ouragan sembla redoubler d’intensité ; une brume épaisse environnait l’aéronef, et de la mer, rendue invisible par le brouillard, s’élevaient des bruits singuliers. On eût cru entendre des plaintes, des gémissements, des clameurs d’agonie.
– Un navire en détresse, s’écria Robert ?
Astéras fit un geste de dénégation :
– Non, un navire naufragé, eût-il deux mille hommes à bord, ne réussirait pas à couvrir les hurlements du vent. Ce que tu entends, c’est la voix même de la tempête. Ce sont ces cris qui faisaient dire à nos ancêtres, les Gaulois, que, durant l’ouragan, les âmes des nautoniers morts en mer revenaient à la surface implorer l’assistance des druides, pour gagner le monde meilleur, où les guerriers étaient reçus après leur trépas.
Ces voix de la tourmente furent l’origine des mystères de l’île française de Sein. Durant les orages, des prêtresses, vêtues de longues tuniques blanches, les cheveux dénoués, couraient sur les falaises qui regardent l’Armorique.
Parfois, l’une d’elles, prise du délire sacré, s’offrait volontairement en sacrifice aux divinités des eaux. Alors elle appelait ses compagnes, désignait le nombre d’âmes errantes que sa mort devait racheter, puis elle se mettait à danser avec de grands cris. Elle tournait sur elle-même, toujours plus vite, se rapprochant sans cesse du bord de la falaise surplombant les flots. Elle atteignait ce rebord, et, sans interrompre sa danse, elle se laissait tomber dans l’abîme.
Cette fois, tous prêtaient une oreille attentive au savant, et quand leurs yeux se fixaient sur les hublots derrière lesquels on n’apercevait qu’un rempart de ténèbres, ils croyaient assister au spectacle lointain qu’il évoquait.
Faisant un brusque retour sur eux-mêmes, ils songeaient qu’une nouvelle avarie pouvait se produire, et qu’alors, tous, ainsi que la prêtresse de l’île de Sein, seraient précipités dans le gouffre rugissant sous leurs pieds.
Certes ! ces réflexions n’avaient rien de récréatif. Aussi le dîner fut-il morose, la nuit détestable.
En face du péril imminent, les voyageurs ne voulurent pas se séparer. Ils s’installèrent tant bien que mal dans le salon, qui sur un fauteuil, qui sur un divan, et attendirent le sinistre qu’ils considéraient presque comme inévitable.
Quand l’aube vint, ils étaient brisés, mais le cyclone n’avait rien perdu de son intensité.
Cependant la clarté, encore qu’elle fût indécise, leur apporta une sorte de soulagement. La journée s’écoula sans apporter un changement à la situation.
Le soir revint avec son cortège de terreurs.
Quand la lumière reparut, il sembla aux prisonniers de Ramier que le vent se calmait.
Ce n’était pas une illusion.
Les nuages disloqués permettaient de voir quelques coins de ciel bleu, et vers midi, le soleil brilla dans une atmosphère apaisée.
CHAPITRE XII
LE BOLIDE DE LAVARÈDE
Comme des convalescents pressés de respirer l’air pur, Robert et ses compagnons montèrent hâtivement sur le pont. La voûte du firmament s’était dégarnie de nuages ; quelques rares vapeurs seules flottaient ainsi que des flocons blancs sur l’indigo céleste. Une brise légère et tiède passait par bouffées.
Heureux de se retrouver vivants, ils demeuraient là, sans songer à rien, tout au plaisir de se baigner dans les rayons d’or du soleil. Tout à coup, un cri de Maïva les tira de leur béate rêverie :
– Un chemin de fer ! clamait la petite Égyptienne.
Courant à la balustrade, tous regardèrent vers la terre. L’élève d’Astéras ne s’était point trompée. Au milieu d’un pays verdoyant, sur lequel l’aéronef voguait à une allure modérée, un train suivait les lacets d’une voie ferrée, en soufflant sa fumée blanche.
– Ah ça ! s’écria Lavarède, nous sommes dans… ou plutôt sur un pays civilisé. Dans quelle partie du monde nous a donc conduits ce brave cyclone qui nous a tant effrayés ?
Tous avouèrent leur ignorance.
– Mais, hasarda Ulysse, notre capitaine a dû, comme chaque jour, faire le point. Descendons consulter la carte de la salle à manger.
La proposition fut adoptée sans contestation, et déjà les voyageurs se dirigeaient vers le panneau, quand Ramier émergea brusquement de l’ouverture.
Il fut aussitôt entouré.
– En quel endroit sommes-nous ?
– Exactement par 26° 13’7’’ de longitude Est et par 25° 55’22’’ de latitude Sud. En d’autres termes, nous planons à quelques kilomètres de Prétoria, ville de la république des Boers, du Transvaal, au-dessus de la ligne ferrée du Cap à Prétoria et à Lourenço-Marquez.
Le petit homme fit une pause, puis d’une voix tranquille :
– D’après mes ordres, le Gypaète s’élève en ce moment. Je ne veux pas être aperçu de la terre. Mais s’il vous plaît d’examiner le pays riche en mines d’or, que les Anglais et les habitants d’origine néerlandaise se disputent, je vais vous faire remettre des lunettes marines.
Il se pencha à l’écoutille, prononça quelques mots dans une langue inconnue ; peu d’instants après, un matelot montait sur le pont, chargé d’une demi-douzaine de lunettes, qu’il distribua aux assistants.
Le besoin s’en faisait sentir. Par suite du mouvement ascensionnel de l’aéronef, les détails de la surface du globe devenaient vagues, imprécis. Bientôt tous les passagers furent penchés sur la balustrade, fouillant de leurs lunettes le pays situé au-dessous d’eux.
Grâce à la puissance des instruments, ils distinguaient les trains, les lourds chariots traînés par des bœufs, les piétons, les cavaliers parcourant les routes. Puis une ville s’étala sous leurs yeux, avec ses habitations coquettes entourées de jardins.
Ramier désigna l’une de ces maisons :
– Voici la demeure du chef suprême de la République Transvaalienne, du président Krüger.
Toutes les lunettes furent aussitôt braquées sur l’endroit indiqué. C’était une villa spacieuse, à un seul étage, précédée d’une vérandah soutenue par des colonnettes de bois. Devant la porte, les observateurs eurent le temps d’apercevoir un gros homme, à la face bienveillante, qui, à demi couché sur un siège de rotin, fumait gravement une longue pipe.
Puis l’aéronef dépassa la maison, derrière laquelle se trouvait une cour précédant un jardin ombreux. Près d’une fontaine, les manches retroussées, une forte commère, penchée au-dessus d’un cuveau, faisait la lessive.
– C’est la présidente Krüger en personne, déclara le fou. Elle lave le linge de la famille.
Et avec un respect attendri, il ajouta :
– Mœurs patriarcales, vénérables. Si je consentais à retourner parmi les humains, c’est chez ces Boers que je m’établirais ; chez ces êtres simples et honnêtes, où la femme du premier magistrat de la République ne craint pas de se livrer aux soins du ménage. Chez eux l’orgueil, la sotte vanité, le désir mesquin de jeter de la poudre aux yeux, sont inconnus. La mère de famille, la femme d’intérieur y sont honorées, alors que chez des peuples prétendus policés, les femmes mettent toute leur fierté à n’être bonnes à rien. Mères, elles ne veulent point s’occuper de leurs enfants ; épouses, elles refusent de surveiller leur maison. De pareils soucis, disent-elles, sont bons pour les petites gens. Tout beau, Mesdames, cela est bon, en effet, pour de petites gens… de cœur et d’esprit. Vous, vous vous ravalez au rang de coûteuses poupées, qui, dans la maison vide de dévouement, tiennent une place intermédiaire entre le cheval de race et le chien de luxe.
Durant le monologue de Ramier, l’aéronef poursuivait sa course, laissant en arrière le gros de l’agglomération. Maintenant les maisons s’espaçaient, séparées par de larges espaces boisés. Les reliefs du sol s’accusaient. On pénétrait dans une région montueuse, accidentée. Vers trois heures, la cité de Pietersburg, centre des exploitations aurifères, se profila à l’horizon. À la nuit, sur une falaise rocheuse dominant le cours du neuve Limpopo qui, né près de Prétoria, va se jeter après une vaste courbe dans l’océan Indien, le Gypaète atterrit doucement.
Le fou voulait profiter de la solitude et de la nuit pour visiter soigneusement ses appareils, et se rendre un compte exact de l’étendue des dégâts causés par le cyclone.
Au jour, il annonça d’un air radieux à ses prisonniers que, sauf une aile emportée par la tourmente, aucune des machines n’avait souffert. Il était nécessaire de regagner le pôle Nord pour réparer le dommage, mais somme toute, l’accident n’aurait pas de suites graves.
À son signal, le navire aérien s’était remis en marche. Franchissant le fleuve Limpopo, il suivait à moins de deux cents mètres, les sinuosités de la plaine du Matabéléland. Dans ces régions, habitées seulement par des nègres fétichistes, il était inutile de se perdre dans les nuages. Qu’importait que les noirs aperçussent l’aéronef, dont ils étaient incapables de deviner la nature.
Le pays, largement arrosé par les affluents du Limpopo, de l’Omaramba et du Zambèze, offrait aux regards une succession de prairies immenses, coupées de forêts et de marécages. Des antilopes, des éléphants, des rhinocéros se montraient. Dans les alluvions vaseuses qui bordaient les cours d’eau, des hippopotames s’ébrouaient lourdement, sans souci des alligators, qui ainsi que des troncs d’arbres dépouillés, s’abandonnaient paresseusement au courant.
Devant ce district giboyeux, les instincts de chasseur des passagers se réveillèrent. Oubliant leurs soucis, leur captivité, ils demandèrent à Ramier la permission d’abattre quelques pièces. Le fou leur déclara que, son filet de chasse, naguère déchiré par l’ours, avait été réparé avec peine, et qu’il ne se souciait pas de l’exposer à de nouvelles avaries en le faisant traîner sur une plaine sous les hautes herbes de laquelle pouvaient se cacher des troncs d’arbres ou des rochers, dont la rencontre serait désastreuse. Un peu plus au nord, on trouverait des terrains plus propices, et il se ferait un plaisir de donner satisfaction à ses hôtes.
– Toutefois, conclut-il, s’il vous plaît, en attendant, de brûler un peu de carbure, je mets des fusils à votre disposition. Nous ne saurions nous arrêter pour ramasser le gibier abattu, mais enfin un exercice de tir est toujours une distraction.
Si pesante était la monotonie du bord, que Robert et Ulysse acceptèrent la proposition. Cinq minutes plus tard, ils se postaient à l’avant, armés de fusils à carbure Z, prêts à faire feu sur le premier animal qui passerait à portée.
Selon son habitude, Radjpoor-Thanis n’avait pas profité de l’invitation de Ramier. Un moment il avait paru sur le pont, puis il s’était retiré dans sa cabine, et là, seul, il cherchait vainement l’idée ingénieuse qui devait à jamais séparer Lotia et Lavarède.
Celui-ci ne songeait pas à son ennemi. À quelques centaines de mètres, il venait d’apercevoir un troupeau de springbocks et de blessbocks[8] qui, sous la garde d’un mâle adulte, reconnaissable à ses longues cornes noires recourbées en forme de lyre, paissaient insoucieusement. La course de l’aéronef devait conduire les chasseurs aériens à bonne portée.
– Une balle à ce superbe animal, dit Robert en désignant l’antilope aux longues cornes.
– Si tu le veux, répliqua tranquillement Astéras. Seulement, si tu n’es pas plus adroit que moi, je pense que nous ne lui ferons pas grand mal.
L’ancien caissier haussa les épaules :
– Je ne tiens pas à lui être désagréable. L’important est de faire du bruit, de s’étourdir un peu, d’oublier une minute que nous sommes captifs !
Tout en parlant, il épaulait. Son ami l’imita. Les deux détonations se confondirent en une seule, mais elles eurent un résultat inattendu.
Tandis que les antilopes, saines et sauves, s’enfuyaient à travers la plaine, une voix, qui semblait partir d’un ravin boisé, s’éleva.
– À moi, criait-elle ! À moi !
Ces mots prononcés en français bouleversèrent les chasseurs. Un blanc, un compatriote était près d’eux, et il demandait du secours. D’un même mouvement, les deux hommes s’élancèrent vers Ramier :
– Vous avez entendu ?
Le fou sourit doucement :
– Oui, que voulez-vous que j’y fasse ?
– À moi, répéta la voix déjà affaiblie par l’éloignement !
– Ce que je veux, dit avec force Robert, troublé jusqu’au fond de l’âme par ce nouvel appel. Que vous modifiiez votre route, que vous ne passiez pas indifférent auprès d’une créature humaine que peut-être vous pouvez sauver.
– Et qui, une fois à mon bord, deviendra mon ennemie, comme vous, comme vos compagnons.
– Qui sera impuissante comme nous-mêmes. Voyons, M. Ramier, soyez généreux. Qu’exigez-vous de nous ?
Le capitaine du Gypaète considéra Lavarède sans répondre, puis hochant la tête :
– Il est bon, il a un cœur pitoyable, murmura-t-il enfin. Pourquoi est-il de ces insensés, pour qui la société des hommes est nécessaire ? S’il me comprenait, je l’aimerais ; il deviendrait le plus cher de mes amis.
Et soudain prenant son parti, il fixa son regard pénétrant sur le jeune homme :
– Jurez-moi que vous ne tenterez rien contre moi, contre mon équipage, ni contre mon appareil, et je ferai ce que vous désirez.
– Ah ! s’écria Robert emporté par un élan de pitié, je le jure. Je vous donnerai même ma parole de ne pas chercher à m’échapper.
– Je ne vous demande pas cela. La fuite est impossible. Je vous laisse toute liberté de me quitter, si vous en trouvez le moyen. Il me suffit de savoir, qu’à mon bord, je n’ai rien à craindre de vous.
– J’engage mon honneur.
– C’est bien. Nous allons tâcher de découvrir l’inconnu auquel vous vous intéressez.
À ces mots, le petit homme courut au tube acoustique sur lequel il se pencha. Aussitôt le Gypaète évolua et revint en arrière à une allure ralentie.
Bientôt il plana au-dessus du ravin d’où était parti l’appel de détresse. Accrochés à la balustrade, la moitié du corps suspendue dans le vide, tous fouillaient du regard les pentes broussailleuses.
Ils ne virent rien d’abord. Leurs yeux ne parvenaient pas à percer la voûte de feuillage. Mais soudain les arbres s’espacèrent, laissant libre une large clairière, et de toutes les poitrines s’échappa ce cri :
– Des blancs ! Prisonniers des Matabélés !
C’était vrai. On était en présence d’un village indigène.
Tout autour de la clairière s’élevaient des huttes de bambou, d’où sortaient incessamment des guerriers noirs armés de lances, d’arcs, voire même de mauvais fusils. Au centre, d’autres nègres enfonçaient dans le sol un poteau rayé de lignes rouges.
– Le poteau du supplice, remarqua Ramier.
Le poteau du supplice ! Ces mots donnaient à la scène une terrible clarté.
Les Matabélés avaient des prisonniers, et selon leur cruelle coutume, ils allaient les torturer.
Mais ces captifs, où étaient-ils ? En parcourant des yeux la clairière, les voyageurs ne tardèrent pas à les distinguer. Étroitement garrottés de liens de paille, ils étaient couchés sur le sol un peu à l’écart. C’étaient des blancs : un homme et une femme, jeunes tous deux ; lui, châtain, le visage expressif et intelligent coupé par une fine moustache brune ; elle blonde et rose. Et malgré leurs liens, ils se regardaient avec une tristesse affectueuse, semblant, chacun pour sa part, oublier le supplice qui l’attendait pour ne se souvenir que des tortures dont l’autre était menacé.
Tout à coup, l’homme aperçut l’aéronef. Une expression d’espérance stupéfaite se peignit sur ses traits. Sa bouche s’ouvrit toute grande pour laisser passer le même cri que tout à l’heure :
– À moi !
Les noirs se retournèrent. L’un d’eux marcha sur les prisonniers en brandissant sa lance d’un air menaçant, mais Robert ne lui permit pas d’aller loin. D’un mouvement brusque il reprit son fusil, épaula et pressa la détente. L’indigène roula sur le sol, le torse troué, avec un rugissement de douleur.
Au bruit de la détonation, tous les Matabélés avaient levé les yeux. En voyant planer au-dessus de leurs têtes le Gypaète, une épouvante folle s’empara d’eux. Les uns s’enfuirent avec des hurlements aigus ; les autres se prosternèrent en poussant des clameurs gutturales.
Profitant de leur surprise, Ramier multipliait les ordres dans le tube acoustique. Le filet de chasse descendait vers le sol, l’aéronef accélérait sa vitesse, et bientôt, les captifs des noirs, cueillis au vol, étaient emportés dans sa course rapide. La clairière disparaissait, et reprenant la direction du nord, le navire aérien laissait bien loin derrière lui le village Matabélé, poursuivi par les cris assourdissants des indigènes.
Sans plus s’occuper de ces braillards, Robert, Ulysse, Maïva, Lotia s’engouffraient dans le panneau, descendaient dans la cale du Gypaète. Ils arrivèrent juste au moment où les matelots hissaient le filet à bord.
Les Européens étaient enfermés dans ses mailles, évanouis, à demi asphyxiés par la célérité du mouvement. Ils entraient dans l’aéronef de la même manière que ceux qui venaient de les sauver.
Lotia fit transporter la jeune femme dans sa cabine, toute émue de la voir si jolie avec ses paupières closes. Quant à Robert, il saisit l’homme par les épaules, tandis qu’Astéras le prenait par les pieds, et tous deux, refusant l’aide des matelots, emportèrent l’inconnu dans leur propre cabine.
Là, avec un trouble qu’il ne s’expliquait pas, l’ancien caissier se mit à frictionner le malade pour le rappeler à lui.
Mais la secousse violente qu’il venait d’éprouver avait assommé le nouveau passager du Gypaète.
Il demeurait inerte, insensible au massage vigoureux dont il était l’objet.
– De l’eau, il faudrait de l’eau, s’écria Robert inquiet de cette immobilité persistante.
Courant au lavabo, il trempa une serviette dans le pot à eau et en bassina le visage de l’inconnu.
La lotion eut un effet presque immédiat. Un profond soupir s’échappa des lèvres de l’homme, une teinte rosée monta à ses joues.
– Encore un peu de fraîcheur, fit l’ancien caissier en retournant au pot à eau.
À ce moment, le malade ouvrit les yeux. Astéras resté près de lui eut un cri de joie, et appelant son ami :
– Lavarède, clama-t-il, il ouvre les yeux, il regarde.
Mais lui, mais Robert, qui à sa voix avait brusquement pirouetté sur ses talons restèrent pétrifiés, en voyant l’inconnu se soulever sur le coude et demander avec un étonnement non dissimulé :
– Tiens ! vous savez mon nom ? Qui êtes-vous donc ?
Et comme ils ne répondaient pas, le trouble de leur esprit ne leur permettant p’as de comprendre ce qui se passait, l’homme reprit :
– Enfin, vous me connaissez, puisque vous avez prononcé mon nom.
– Quel nom, bégaya Robert retrouvant la parole ?
– Mais… Lavarède donc !
– Vous vous appelez Lavarède ?…
Dire de quel ton l’ancien caissier formula cette interrogation est impossible. C’était de l’espoir, de l’effarement qui faisaient trembler la voix.
L’inconnu, pour qui son émotion était incompréhensible, répondit avec calme :
– Sans doute, Lavarède.
– Armand ?
– Oui.
– De Paris ? journaliste ?… époux de Miss Aurett Murlyton ?
– Oui… mais ma femme, où est-elle ?
Il y avait une angoisse dans l’accent du journaliste.
– Rassurez-vous, s’empressa de répliquer Robert en riant sans pouvoir s’en empêcher, elle est sauvée.
Puis dans un besoin d’expansion, assénant sur l’épaule d’Astéras une tape dont l’astronome fut plié en deux :
– Victoire. Tout comme toi j’ai rencontré mon bolide !
Et comme Armand l’enveloppait d’un regard curieux.
– Je vais vous expliquer. Je suis Robert Lavarède, d’Ouargla.
– Ah ! interrompit le mari d’Aurett, mon cousin dont j’ai trouvé la carte chez moi, à mon dernier passage à Paris.
– Précisément !
– Parbleu ! je ne m’attendais pas à vous voir en plein Centre-Africain. Qu’à cela ne tienne, serrons-nous la main, cousin, et causons.
Les deux jeunes gens échangèrent un vigoureux shake-hand, en disant avec une raillerie émue :
– Bonjour, cousin.
CHAPITRE XIII
DEUX CORRESPONDANTS DU « LONDON MAGAZINE »
– Causons, avait dit Armand.
Mais avant de s’engager dans la voie des confidences, il voulut prendre des nouvelles de sa jeune femme. Guidé par Robert, il fut bientôt auprès d’elle. La gentille Anglaise dormait. Sans secousse, elle avait passé de l’évanouissement au sommeil. Le mieux était de ne pas troubler son repos. Aussi les deux cousins, la laissant sous la garde de Maïva, revinrent-ils à la cabine de l’ancien caissier.
Là, pour encourager son interlocuteur, Armand se mit à narrer son histoire, à la grande satisfaction de ses auditeurs, nous disons : ses, car Astéras n’avait eu garde de s’éloigner.
– Donc, mon cher cousin Robert, vous savez… Au fait ! entre parents on se tutoie ; je pense que vous êtes comme moi, et que les mots : cousin, vous, jurent à votre oreille.
– Tout à fait.
– Alors… ?
– Pour les empêcher de jurer, transformons vous en tu…
– À la bonne heure. Je reprends. Mon cher cousin, tu sais sans doute que, pour obéir aux clauses du testament de mon cousin Richard…
– Vous avez… non, pardon ! tu as fait le tour du monde, avec cinq sous en poche pour toute ressource. J’ai appris aussi qu’un digne gentleman, Sir Murlyton, t’accompagnait avec sa gracieuse fille, Miss Aurett, aujourd’hui ma cousine par alliance.
– Tant mieux ! cela abrégera mon récit. Moins bavard que Théramène, je m’en réjouis. De retour à Paris, je m’empressai de gagner Londres, où j’épousai la plus courageuse, la plus dévouée des femmes ; ma compagne de tour du monde.
– C’est à ce moment que je me présentai pour la première fois chez toi. La seconde, tu étais déjà marié et parti en voyage de noces en Amérique, me dit-on.
– Le renseignement était exact. Mais nous avions compté sans l’ennui. Tu penses, des gens qui viennent de parcourir un parallèle sans argent, c’est-à-dire avec toutes les ressources de l’imprévu, doivent naturellement trouver bien plat le voyage banal accompli avec de l’or plein leurs poches. New-York, les chutes du Niagara, Baltimore, Chicago, la Nouvelle-Orléans, c’était toujours le même « meilleur hôtel », avec le même stewart souriant, qui nous servait des mets semblables avec une déférence égale. Plus de difficultés à vaincre, plus d’initiative à déployer ; nous étions devenus des machines à parcourir des kilomètres ou des milles, à passer du railway dans un hôtel, de l’hôtel dans un railway, et ainsi de suite. Non, vraiment, pour apprécier les États-Unis il faut être sans le sou. De guerre lasse, Aurett et moi résolûmes un beau jour de quitter ce pays, dont l’originalité n’existe que dans les articles des revues d’Europe, et de nous mettre en quête de contrées d’où la fantaisie fut moins sévèrement bannie. Un journal nous tombe sous la main. Il consacrait deux colonnes au Transvaal, dont le président avait je ne sais quels démêlés avec ses voisins de la colonie anglaise du Cap. Nous nous regardons, Aurett et moi. – Tiens ! dit-elle, le Transvaal… – Pourquoi pas, répondis-je ? Et l’excursion fut décidée.
– Oh ! bolide ! bolide à marche constante mais irrégulière, soupira comiquement Robert !
– Tu dis ?
– Rien, continue. Cette exclamation fait partie intégrante de mon histoire.
– À tes ordres. Nous arrivâmes au Cap, et évitant soigneusement le chemin de fer qui relie cette ville à Prétoria, nous marchâmes délibérément vers le Nord. Un chariot traîné par des bœufs, quelques serviteurs Cafres, composaient tout l’équipage. Il fallait chasser pour se nourrir, passer des rivières à gué, tracer sa route dans le bush. Parfois on manquait d’eau ou bien de rôti. Bref, nous étions au comble de nos vœux. Tout alla bien jusqu’au moment où nous nous engageâmes sur le territoire des Matabélés. Il paraît que ces indigènes étaient en guerre avec l’Angleterre. Nous l’apprîmes trop tard, en tombant aux mains d’une troupe de guerriers noirs auxquels les compatriotes d’Aurett venaient d’administrer une formidable raclée. Tu juges de leurs dispositions à notre égard. Du reste, la situation dont tu nous as tirés te prouve que nous n’étions pas précisément sur un lit de roses.
Et roulant délicatement une cigarette entre ses doigts, le journaliste conclut :
– Tu connais maintenant mes aventures, elles sont d’une simplicité enfantine. À ton tour maintenant. Je meurs d’envie de savoir comment toi qui, s’il m’en souvient bien, inscrivais sur ta carte la mention « Caissier de la Maison Brice, Molbec et Cie », tu vagabondes dans le Sud-Africain, à bord d’un navire aérien ?
– Eh ! mon pauvre cousin, c’est bien contre mon gré que je m’y trouve.
– Allons donc !
– S’il ne dépendait que de moi, je t’assure que je serais bien loin d’ici.
– En ce cas, je ne t’aurais pas rencontré.
– Ta présence tempère mes regrets. Mais sache que si tu as échappé aux Matabélés, tu n’es pas libre pour cela.
– Pas libre ?
– Non. Comme moi, comme mon ami Astéras, tu es prisonnier dans cet aéronef.
– Prisonnier. Que ne le disais-tu de suite ? Et dans un aéronef encore ! C’est très intéressant.
– Le Gypaète est son nom.
– Joli !
– Et son capitaine est fou.
– Fou ! Aéronef ! Prisonnier ! Ah ! mon bon cousin, que tu me fais plaisir. Voilà qui est amusant, Aurett sera la plus heureuse des femmes quand je lui conterai cela.
Et sans paraître s’apercevoir de l’air ahuri dont Robert écoutait ces étranges exclamations :
– Mais procédons avec ordre. Narre-moi, par le menu, de quelle façon tu es parvenu de la position de caissier à celle bien plus élevée de captif du Gypaète. Prison pas ordinaire, hein ? Et qui aurait fourni quelques chapitres intéressants aux « Souvenirs de Latude ».
Aussi brièvement que possible, Robert apprit au journaliste ce qu’il désirait savoir.
Il dit son horreur des voyages, son enlèvement par Radjpoor, son passage en Égypte, en Abyssinie, la façon dont il avait conquis le diamant d’Osiris, enfin son internement en Australie, son sauvetage par l’aéronef. Mais, sans en avoir conscience, il s’appesantit surtout sur les détails concernant Lotia. Si bien que lorsqu’il se tut, Armand murmura :
– En somme, notre prison volante nous a tous sauvés d’une mort certaine, n’en médisons donc pas. Elle est d’ailleurs une des plus belles inventions du siècle, et très sincèrement, sans arrière-pensée, j’adresserai mes félicitations à son capitaine-constructeur.
Puis avec un sourire :
– Ceci dit, voilà où la chose va devenir intéressante. Captifs au pays des nuages, il s’agit de s’évader. Comme la liberté ne vaut rien sans le bonheur, il faut d’abord démasquer ce monsieur Radjpoor-Thanis qui t’ennuie, et permettre à la jolie Lotia d’avoir foi entière en toi.
Et comme Robert secouait tristement la tête.
– Ne te désole donc pas. On trouve toujours quand on cherche. Va, nous « roulerons » le Radjpoor, et nous retournerons chez nous.
Il se frappa soudain le front :
– Tiens, au fait, la première moitié du problème est déjà résolue. C’est la moins difficile, il est vrai.
– Comment ? Tu as déjà trouvé…, s’exclama Robert, qui ne connaissait pas les facultés inventives de son cousin !
– Le moyen d’amener ce coquin de Radjpoor à se trahir ? Oui.
– Oh ! si tu disais vrai.
– Je dis vrai.
– Mais sans l’endommager, car il ne doit périr que de ma main.
Armand approuva du geste :
– Voilà une parole qui me fait plaisir, cousin. Je te croyais un peu mou ; excuse mon erreur dont je m’accuse. On ne te l’abîmera pas, ton ennemi, sois tranquille.
– Mais enfin, que prétends-tu faire ?
– Ceci.
Le journaliste allait s’expliquer, quand deux coups discrets, frappés à la porte, figèrent la parole sur ses lèvres. Le battant s’ouvrit aussitôt ; et Ramier parut sur le seuil.
– Le capitaine du Gypaète, glissa l’ancien caissier à l’oreille de son cousin.
– Ah ! ah ! le fou, répliqua celui-ci sur le même ton.
Ramier s’avança lentement, s’inclina devant Armand, et avec une extrême politesse :
– Je venais m’enquérir de votre santé, Monsieur, dit-il. Nos procédés de sauvetage sont brutaux, et je craignais de vous trouver quelque peu froissé. Je vois avec plaisir qu’il n’en est rien.
– Et moi, déclara le journaliste parisien en affectant, à la grande surprise de ses compagnons, un léger accent anglais, je regrette que votre visite prévienne la mienne. Je voulais vous exprimer ma gratitude et vous adresser mes félicitations au sujet de votre merveilleux appareil de locomotion.
Le fou s’inclina derechef.
– Bien que les noms de vos hôtes vous soient indifférents, s’empressa de dire Robert, permettez-moi de vous présenter…
Il allait ajouter : mon cousin. Armand lui saisit brusquement le bras et termina la phrase commencée par ces mots :
– Sir William Burke, correspondant du London Magazine, venu avec sa jeune femme pour suivre les opérations de la guerre du Matabéléland, fait prisonnier par les indigènes et délivré par vous, ce dont toute la presse britannique vous remercie par ma bouche.
Puis désignant Robert qui se creusait vainement la tête pour deviner à quel propos son cousin changeait ainsi sa personnalité :
– Monsieur, continua-t-il gravement, m’a appris que, dans ce navire volant, les noms de la terre n’ont pas cours.
– C’est exact, souligna Ramier, et je vous prierai d’accepter le nom de : Albatros. C’est un oiseau courageux, de large envergure, qui ne craint ni la terre ni l’eau.
Avec un sourire aimable, Armand salua son interlocuteur :
– Je l’accepte volontiers. Mais je pense qu’auparavant la présentation de mon être terrestre était nécessaire ; des gentlemen ne peuvent entrer en relations sans se connaître.
Soudain il changea de ton :
– Un mot encore, Sir Ramier. La rencontre de votre aéronef est un incident de voyage remarquable, et pour moi, publiciste, il serait important de l’annoncer bon premier. Ne pourrais-je faire passer une dépêche au London Magazine.
Le corps du capitaine du Gypaète fut agité par un tressaillement :
– Mon navire et ceux qu’il porte ne doivent plus avoir de rapports avec l’humanité !
– Aoh ! modula le journaliste sans se départir de son sérieux, vous désirez garder le secret de votre découverte ?
– Précisément !
– Oui, je comprends. Mais en ce cas, vous ne consentirez pas à me déposer à terre !
– Non, jamais.
– Seulement je puis m’évader ?
– Vous êtes libre d’essayer, rectifia le fou avec une grimace ironique.
– Bon, fit flegmatiquement le faux Anglais, je m’évaderai.
Sa tranquille assurance arracha un geste d’étonnement à Ramier :
– Vous ne doutez de rien, fit-il comme malgré lui.
– De rien, je suis Anglais.
Et comme le petit homme, après un salut, se dirigeait vers la porte, Armand glissa à l’oreille de Robert abasourdi :
– Anglais, ce ne serait rien, mais je suis Parisien. C’est pour cela que nous fausserons compagnie à ce monsieur.
À peine Ramier avait-il franchi le seuil, que l’ancien caissier se plantait devant son cousin :
– Que signifie tout cela ? Te voilà Anglais à présent.
– Eh ! C’est pour démasquer ton Radjpoor ; si je m’étais présenté comme ton cousin, il se fût défié de moi, la belle Lotia aurait conservé toutes ses hésitations. Tandis qu’un étranger ne lui inspirera aucune méfiance.
– Soit, mais que veux-tu faire ?
– D’abord me rendre auprès de ma femme, afin de l’avertir de mon avatar ; cela l’amusera beaucoup de me voir devenir Anglais. Pressons-nous, de peur qu’une parole imprudente ne bouleverse mes combinaisons.
Et entraînant à sa suite Robert et Astéras, intrigués et réjouis par sa promptitude de décision :
– Surtout, cousin, tutoyons-nous en particulier, mais en public, du vous, encore du vous, toujours du vous !
Tous trois traversèrent le couloir et entrèrent dans la cabine, où ils avaient laissé Maïva auprès d’Aurett endormie.
L’Anglaise s’était éveillée. À la vue d’Armand, une rougeur colora son gracieux visage, ses yeux bleus devinrent humides. Elle courut à lui :
– Vous, mon ami, j’étais inquiète de ne pas vous voir. Sans blessures, au moins ?
– Comme vous-même, ma chère Aurett.
Et rapidement :
– Mais le temps nous presse ; ne nous laissons pas aller à l’émotion, j’ai à vous parler.
Il s’arrêta en apercevant Maïva qui, immobile, regardait de ses grands yeux noirs.
Astéras comprit son indécision. Il prit la jeune égyptienne par la main :
– Parlez sans crainte devant elle, Monsieur. C’est une amie sûre qui ne nous trahira pas.
Robert approuva du geste :
– S’il en est ainsi, reprit Armand, je n’hésite plus.
Et souriant à Aurett :
– Ma chère Aurett, nous cherchions des aventures. Nous en avons rencontré une qui dépasse toutes celles qui nous sont arrivés dans le passé.
Un éclair joyeux passa dans les yeux de l’anglaise. Le journaliste avait dit vrai ; sa femme, tout comme lui, avait horreur du voyage monotone.
– Nous sommes prisonniers, poursuivit-il, dans les flancs d’un navire aérien, dont le capitaine inventeur est fou et vient de me déclarer que jamais plus nous ne toucherions la surface du sol.
Une ombre fugitive assombrit le front d’Aurett.
– Mon père ! murmura-t-elle.
Puis le sourire revint à ses lèvres.
– Nous réussirons bien à tromper sa surveillance, acheva-t-elle.
– À la bonne heure, fit Armand, tandis que Robert et Astéras s’inclinaient malgré eux devant le calme de la jeune femme.
– J’ai confiance en vous, dit-elle en regardant son mari. Vous m’avez habituée à ne m’étonner de rien.
– Parce qu’il n’y a rien d’étonnant au monde, ma chère Aurett. Donc nous nous évaderons. Mais auparavant, nous devons assurer le bonheur de Robert Lavarède, mon cousin, captif ainsi que nous à bord du Gypaète.
Et tandis qu’Aurett tendait la main à l’ancien caissier :
– Pour cela, continua le journaliste, j’ai déjà changé de nom. Nous ne sommes plus Armand et Aurett Lavarède, mais bien Sir et Mistress William Burke, correspondants du London Magazine, suivant pour cette publication la guerre du Matabéléland.
La jeune femme sourit, découvrant ses dents petites et blanches :
– Oh ! Burke, c’est compris. Et vous êtes Anglais ?
– Parfaitement !
– J’en suis heureuse pour mon pays, dit-elle gaiement ; bien que je sois devenue Française, acheva-t-elle en fixant son regard bleu sur le Parisien.
Il lui prit la main :
– Donc, Aurett, nous sommes Anglais, et mon cousin n’est plus mon cousin, sauf lorsque nous serons entre nous.
Ravie, elle frappa ses mains l’une contre l’autre :
– Une comédie maintenant, c’est charmant. Ah ! je crois que notre voyage va devenir réellement amusant !
CHAPITRE XIV
L’IDÉE D’ARMAND LAVARÈDE
Personne ne soupçonna le subterfuge imaginé par Armand. Au déjeuner, Ramier présenta cérémonieusement à Mme Hirondelle et à ses hôtes, Sir et Mistress William Burke, qui désormais s’appelleraient M. et Mme Albatros.
Radjpoor examina les nouveaux venus. Leur léger accent britannique, réel chez Aurett, affecté chez le journaliste, le dérida. C’étaient bien des Anglais, c’est-à-dire des alliés pour lui, qui travaillait pour le compte de l’Angleterre.
Aussi se mit-il en frais d’amabilité avec eux, et, le repas achevé, les suivit-il sur le pont.
L’aéronef avait marché. Il dominait actuellement le pays forestier arrosé par le Zambèze. Loin encore au Nord se profilaient dans une teinte violette, les cimes des Monts Mouchinga, qui limitent au sud la vaste dépression connue sous le nom de région des Grands Lacs.
Le faux Burke regardait. Il disait l’histoire sanglante des explorateurs du pays, les territoires à la végétation luxuriante bordant le long chapelet de mers intérieures, évoquant les luttes épiques livrées sur les rives des Lacs Demba, Moero-Nkata, Tanganika, Victoria Nyanza ou Kiséoué, Ouregga, Albert-Nyanza, Basso-Narok, Stéphane. Il parlait avec enthousiasme de Livingstone, de Stanley, et soudain, comme sans réflexion, il prononça le nom du Congo belge, désigné sous l’épithète de : État Libre du Congo.
Alors, avec l’âpreté d’un véritable Anglais, il tonna contre cet État, qui coupait l’Afrique en deux.
– Il nous a empêchés, dit-il, de relier notre colonie du Cap à nos possessions du Nil et nous a conduits à un échec, dont tous les citoyens du Royaume-Uni ont ressenti le contre coup.
– De quel échec parlez-vous, interrogea Radjpoor ?
– Mais de notre échec en Égypte !
Ce disant, Armand considérait son interlocuteur avec un étonnement si parfaitement joué, que l’Hindou, malgré toute sa ruse, ne se douta pas que, par une habile manœuvre, le pseudo-Anglais venait d’amener la conversation au point précis vers lequel il tendait depuis le début de l’entretien.
– En Égypte ? répéta Radjpoor en tressaillant.
– Ne seriez-vous pas au courant, demanda Armand du ton le plus naturel ?
– J’ignore absolument de quoi il s’agit.
– C’est vrai, vous êtes mal placé pour recevoir des nouvelles ; la poste n’a pas encore établi un service aérien. Laissez-moi donc combler cette lacune postale.
Et tranquillement :
– Vous savez que nos troupes occupaient l’Égypte ?
– Oh cela, oui !
– Bien. Le gouvernement de Sa Majesté attendait une occasion favorable de transformer cette occupation en annexion, et déjà le haut commerce britannique escomptait cette mesure, dont les conséquences auraient été incalculables.
– Qu’est-il donc arrivé ?
– Une chose incroyable, imprévue, qui a éclaté dans le monde politique ainsi qu’un coup de foudre. Les Cabinets de Paris et de Saint-Pétersbourg ont provoqué un Congrès Européen. Sans doute ils avaient déjà gagné les représentants des autres puissances territoriales, car à l’unanimité, le congrès a décidé que la pacification de l’Égypte étant achevée, nos troupes devaient évacuer la vallée du Nil dans un délai de trois mois.
Radjpoor se leva d’un bond :
– Le Congrès a décidé cela ?
– Hélas oui. Et nous ne pouvons résister à la coalition de toute l’Europe.
– C’est vrai. Mais alors l’Égypte est libre ?
– Totalement.
– Elle aura un souverain de son choix ?
– C’est certain.
À deux mains, l’Hindou se pétrit le crâne en murmurant :
– Imbécile ! Triple brute ! Et je n’ai pas deviné cela.
En un instant l’amer regret de ses fourberies avait grandi en lui. Il se reprochait comme une stupidité de n’avoir pas répondu à l’appel des Néo-Égyptiens, d’avoir substitué à lui-même Robert Lavarède. Sans cette idée malencontreuse, il serait roi, époux de Lotia, il gouvernerait l’Égypte. Les trésors, les pompes, les esclaves lui appartiendraient ! Qu’était à côté de cela sa situation présente. Après l’évacuation, l’Angleterre qui, selon le cas, sait être prodigue ou économe, lui supprimerait sans doute sa pension. Il s’emparerait bien du diamant d’Osiris, il en tirerait quelques millions, mais après ? Ne serait-ce point la pauvreté relative pour lui, qui aurait pu monter sur le trône, avoir la ressource inépuisable de l’impôt, voir courbés devant lui dix millions de sujets ayant la seule liberté de le flatter, de lui complaire en tout.
À grands pas, il parcourait le pont, avec des gestes brusques, oubliant dans son emportement que des yeux étrangers suivaient tous ses mouvements.
Et cependant les regards du pseudo-Burke eussent pu l’intéresser. Ils se fixaient sur lui avec une expression d’ironie railleuse, qui certainement, eût éveillé le soupçon dans son esprit. Mais il ne songeait guère à observer.
Il fut tout interloqué, lorsqu’Armand l’arrêtant au passage, lui demanda avec un flegme bien britannique :
– Vous êtes sujet anglais ?
– Oui, non, balbutia-t-il, c’est-à-dire si, je suis Hindou.
– Et vous ressentez profondément notre injure.
– Votre injure ?
Dans son trouble, Radjpoor allait crier :
– Elle m’est indifférente.
Mais une lueur de raison empêcha cet aveu maladroit. Tendant ses nerfs, il se ressaisit et avec un accent sombre :
– Oui, reprit-il, je la ressens profondément !
D’un mouvement cordial, le journaliste lui tendit la main :
– Cela me fait plaisir. Je vous prierai seulement de ne pas parler de tout cela aux autres passagers. Ce sont, si j’ai bien compris, des Français et des Égyptiens. Ils montreraient une joie que je ne saurais tolérer.
– Ne craignez rien à ce sujet, promit distraitement Radjpoor-Thanis, je serai muet.
Un silence suivit. Armand ne paraissait plus s’occuper de son interlocuteur. Les paupières baissées on eût dit qu’il était absorbé en de sombres réflexions. Soudain il murmura, comme se parlant à lui-même :
– Et dire que si cet homme n’avait pas disparu, notre échec se transformait en éclatante victoire. À quoi tiennent les destinées des nations !
Radjpoor tressaillit. Une secrète intuition l’avertit que la remarque s’appliquait à lui-même. Il toucha du doigt l’épaule de celui qu’il croyait fermement être William Burke, correspondant du London Magazine, et d’une voix assourdie :
– Je vous demande pardon, Sir, de paraître céder à la curiosité ; mais ma conduite est dictée par mon ardent dévouement à la Reine.
– Je n’en doute pas, répliqua Armand frémissant de joie, car il comprenait que son adversaire, que le fourbe qu’il s’était juré de démasquer, allait s’enferrer. Je n’en doute pas, mais de quoi s’agit-il ?
– Vous avez prononcé des paroles mystérieuses.
– Moi ?
– Un homme, disiez-vous, aurait pu transformer l’évacuation de l’Égypte en triomphe.
– C’est exact, soupira le Parisien avec un geste découragé. Malheureusement ! cet homme a disparu.
– Quel était-il ?
Si maître qu’il fût de lui-même, Radjpoor posa cette question d’une voix tremblante. Un sourire fugitif contracta les lèvres d’Armand, mais ce fut d’un ton grave qu’il répliqua :
– Oh ! un homme d’une intelligence remarquable, une de ces natures d’élite dont l’Angleterre aime à s’assurer le concours. Il se nommait Thanis.
À ce nom, Radjpoor frissonna de la tête aux pieds. Sans en avoir conscience, il se redressa sous l’éloge. Intelligence remarquable, nature d’élite, il y avait de quoi chatouiller délicieusement sa vanité, et Lavarède n’avait pas en vain appliqué le proverbe : On prend les mouches avec du miel, non avec du vinaigre !
– Thanis, redit-il avec un pétillement joyeux dans les yeux.
– Oui, Thanis, reprit imperturbablement le faux Anglais. Égyptien d’origine, il avait compris que l’Angleterre seule était capable de faire refleurir la civilisation sur les rives du Nil. Il s’était dévoué à faire son jeu. Aussi, après la décision néfaste du Congrès, le cabinet britannique songea-t-il aussitôt à faire donner la couronne à cet ami fidèle. Par sa naissance il pouvait prétendre au trône ; la noblesse égyptienne était toute disposée à l’acclamer, paraît-il. Lui régnant, c’était l’influence anglaise restaurée indirectement. Mais baste ! il avait disparu sans laisser de traces. Ajoutez à cela, qu’une note du ministère interdit à tout journal de livrer ce secret d’État à la publicité ; sans cela, on eût appelé Thanis par la voix de la presse, et bien certainement il aurait répondu !
Puis avec un soupir :
– Vous me croirez facilement, je suppose, quand j’affirmerai que je donnerais six ans de ma vie pour retrouver ce gentleman et le ramener en Angleterre.
Il regardait Radjpoor de ses yeux clairs. Celui-ci était en proie à une lutte intérieure. Des sentiments contradictoires bouleversaient sa physionomie. Cette couronne qu’un instant plus tôt il croyait perdue, l’Angleterre la lui offrait ; on l’appelait, on l’attendait comme un sauveur.
Il ouvrit la bouche comme pour parler, mais ses prunelles inquiètes rencontrèrent les silhouettes gracieuses de Lotia et de Maïva qui, à quelques pas, écoutaient Astéras et Robert.
Il eut un geste mécontent, puis se penchant vers Armand, il lui glissa à voix basse ces mots :
– Sir, permettez-moi de vous adresser une prière.
– Bien volontiers, répondit le Parisien, sentant que son ennemi allait se livrer.
– Ce soir, après le dîner, veuillez entrer dans ma cabine.
– Dans votre cabine, répéta le pseudo-Burke en feignant la surprise ?
– Oui, je vous apprendrai des choses intéressantes. Soyez assuré que s’il n’en était pas ainsi, je ne solliciterais pas cette entrevue.
– Cela suffit, Monsieur, j’irai.
– Merci. Et que nul ne devine notre entente.
Sur cette recommandation, l’Hindou pirouetta sur ses talons, gagna l’écoutille et disparut à l’intérieur de l’aéronef. Il s’enferma dans sa cabine. Il avait peur de se trahir. Le hasard lui amenait un allié, un gentleman anglais qui lutterait avec lui contre Robert. Et quel allié ? Un homme actif, intelligent, énergique. En cela seulement il ne se trompait pas ; il avait bien jugé Lavarède, mais sa perspicacité de fourbe n’avait point su découvrir le Parisien sous l’apparence de l’Anglais.
Cependant, au bout d’un instant, Armand se leva sans affectation, s’approcha du panneau de l’allure lente d’un flâneur, s’assura d’un regard rapide que l’Hindou n’était pas resté dans le couloir central, et ces précautions prises, il fit signe à Robert de venir le joindre.
Celui-ci ayant obéi, le journaliste lui dit sans préliminaires :
– Tu sais où se trouve la cabine du Radjpoor ?
– Sans doute !
– Qui occupe la cabine voisine ?
– Astéras et moi.
– C’est au mieux. Eh bien, ce soir, amène sous un prétexte quelconque Lotia et Maïva dans ta chambre. Qu’elles ne fassent aucun bruit, mais qu’elles écoutent religieusement ce qui se dira chez le coquin, qui s’est amusé à embrouiller ta situation. La cloison est mince.
– Que veux-tu dire ?
– Tu le verras. Mais j’y pense. Te sachant son voisin, il baissera la voix. Tâche donc, durant cet après-midi, de percer quelques trous dans la cloison séparative.
– C’est aisé. Je prendrai un vilebrequin à la machinerie. Mais explique moi.
– À quoi bon. Tu veux que Lotia croie en toi ?
– Certes !
– Eh bien, fais ce que je te dis, et elle croira. Maintenant retourne auprès d’elle, et agis comme tu l’entendras.
Une demi-heure plus tard, quand Radjpoor, un peu calmé, remonta sur le pont, il vit les passagers divisés en deux groupes comme à l’instant où il les avait quittés. À l’avant, sir Burke et sa femme regardaient le paysage. À l’arrière, Astéras et Robert continuaient leur conversation avec les Égyptiennes. Le traître les considéra avec une ironie sournoise, puis il marcha vers les correspondants du London Magazine.
En leur compagnie, il se prit à discuter sur la contrée que parcourait l’aéronef, mettant un soin si jaloux à ne pas jeter du côté de l’ancien caissier un coup d’œil qui, dans son idée, aurait pu le trahir, qu’il ne s’aperçut pas que le jeune homme se glissait par l’écoutille et, après une absence d’une vingtaine de minutes, revenait sur le pont, le visage rayonnant de joie.
Suivant à la lettre les instructions de son cousin, Robert avait percé de plusieurs trous la cloison qui séparait sa cabine de celle de Thanis.
CHAPITRE XV
AU-DESSUS DU PAYS DE LOBEMBA
À l’heure du dîner, le Gypaète franchit les frontières du pays de Lobemba, dont les habitants sont accusés, à tort ou à raison, de goûts culinaires d’une rare perversion. On prétend qu’ils préfèrent l’homme à toute autre nourriture, l’homme blanc surtout ; cette préférence est on ne peut plus flatteuse pour les Européens, et elle démontre surabondamment, quoi qu’en disent les esprits chagrins, que les blancs sont capables de causer de grandes joies aux pauvres nègres.
Comme la situation élevée de l’aéronef le mettait hors de la portée des anthropophages les plus affamés, les voyageurs ne ressentirent aucune inquiétude en apprenant que, si les Lobembaous les prenaient, ils les inviteraient à paraître, non pas autour de leur table, mais bien dessus. Tranquillement ils se rendirent à la salle à manger, et se mirent en devoir de bien dîner.
Le repas fut gai. Avec une présence d’esprit admirable, étant donnée la nature de ses préoccupations, Armand fit tous les frais de la conversation. Il parlait d’abondance, racontant des anecdotes sur Gladstone, The great oldman, sur Lord Salisbury, sur les hommes politiques de l’Europe continentale, si nombreux, disait-il, qu’en les réunissant, on trouverait peut-être la monnaie d’un grand homme.
Encore que Robert se sentît le cœur serré, à l’idée de la partie décisive qui allait se jouer, il ne put résister à la verve de son cousin. Comme les autres il se laissa emporter par le courant de l’improvisation du journaliste. Il rit, s’émut, et fut tout interloqué, quand au dessert, le causeur lui indiqua d’un signe rapide que l’heure était venue de se retirer et de prendre place à son poste d’observation.
Du reste il se ressaisit de suite et négligemment :
– Je propose, pour terminer cette excellente soirée, de monter sur le pont. Sous ces latitudes, la fraîcheur de la nuit n’est pas à craindre.
– Très bonne idée, s’empressa d’appuyer Astéras, qui sachant que le bonheur de son ami était en jeu, s’était abstenu de toute distraction. Allons mademoiselle Lotia ; allons, Maïva, venez respirer là-haut.
Armand prit alors la parole :
– Je vous prie de m’excuser. Ici, comme sur terre, je reste journaliste, et j’ai quelques notes à jeter sur mon carnet ; mais mistress Burke vous accompagnera.
– Certainement, s’écria Aurett, et tandis que vous serez seul en face, de vos vilains papiers, nous nous désaltérerons d’air tiède et parfumé.
Elle se levait en même temps. Tous l’imitèrent. Il y eut un instant de brouhaha, de chaises remuées, puis les hôtes du Gypaète sortirent. Il ne restait plus autour de la table que Ramier somnolent, Mme Hirondelle qui bâillait, car elle avait l’habitude de s’endormir dès le coucher du soleil, Radjpoor et le pseudo-correspondant du London Magazine.
Celui-ci attendit que le bruit des pas de ses amis dans le couloir central se fût éteint, puis s’adressant au capitaine du Gypaète :
– Je vous prierai de m’excuser, Sir Ramier ; mais ainsi que je le disais tout à l’heure, je tiens à consigner sur mes tablettes les aventures étranges de la journée ; aussi vous demanderai-je la permission de me retirer.
– Très volontiers, bredouilla le petit homme brusquement tiré de son engourdissement. Je suis obligé d’ailleurs de faire ma tournée d’inspection à la machinerie, et ma femme, vous le voyez, victime d’un instinct d’imitation sidérale, ne songe qu’à dormir une fois Phœbus couché.
Le Parisien se leva aussitôt et prit congé de ses hôtes. Radjpoor fit de même, et les deux hommes gagnèrent ensemble la porte. Le battant retombé sur eux, un sourire ironique crispa les lèvres de l’Hindou :
– Tout est pour le mieux, fit-il d’une voix légère comme un souffle. Nous causerons sans crainte d’être dérangés. Veuillez me suivre, Sir Burke. Je crois décidément que, de notre rencontre, jaillira quelque chose d’heureux pour l’Angleterre.
Il atteignait la porte de sa cabine. La poussant avec précaution, il fit passer Armand et entra derrière lui. Le battant retombé, il pressa le bouton donnant la lumière électrique, avança un siège au faux Anglais, s’assit lui-même, et d’un ton satisfait :
– À présent, Sir Burke, daignez m’écouter.
– Soyez assuré que je ne perds pas une de vos paroles, déclara le Parisien, avec une nuance de raillerie trop légère pour être perçue par son interlocuteur. Commencez donc, je vous prie.
L’Hindou inclina la tête :
– Sir, fit-il lentement, Thanis vit et je sais où il est.
Bien qu’il s’attendît à un aveu de ce genre, Armand affecta une profonde surprise, et avec un trouble parfaitement simulé :
– Vous connaissez la retraite de ce gentleman ? Ah ! sir Radjpoor, parlez. Fût-il au bout du monde, j’irais vers lui sans hésiter.
– Oh ! vous n’avez pas besoin d’aller aussi loin.
– Que prétendez-vous dire ?
– Je vous expliquerai d’abord comment il se fait qu’aucun des agents anglais n’ait pu le rejoindre.
Et après un temps :
– Il y a quelques mois déjà, les Néo-Égyptiens, société secrète dont fait partie toute l’aristocratie égyptienne, résolurent de se soulever contre la domination anglaise.
– Ah ! ah ! murmura Armand d’un ton intraduisible, voyez-vous cela.
– Ils prétendaient que si, depuis des siècles, leur patrie était asservie, cela provenait uniquement des rivalités sanglantes de deux familles puissantes, les Hador et les Thanis. Les premiers descendant des rois Hycsos, les seconds sont issus des souverains nationaux.
– Bien, bien. Allez toujours, je vous suis.
– Il était de bonne politique d’éteindre cette haine séculaire. Or les Hador étaient représentés par un vieillard, du nom de Yacoub, et par une jeune fille d’une beauté merveilleuse, qui habitaient l’Égypte ; un seul Thanis vivait encore à Paris, grâce à une large subvention de l’Angleterre, qui n’avait pas voulu qu’un fils de rois fût déchiré par les ongles acérés de la misère.
– All right ! souligna le Parisien d’un air pénétré.
– Yacoub Hador songea qu’il était vieux, et que Thanis était jeune. Il se dit : Si je lui donnais ma fille en mariage, nos rivalités anciennes disparaîtraient ; tous les guerriers de la vallée du Nil se grouperaient sous nos drapeaux, et nous balayerions sans peine les envahisseurs jusqu’à la mer.
– Pas mal raisonné.
– Oh ! Yacoub est intelligent. Ce plan arrêté, il envoya en Europe un serviteur fidèle, Niari était son nom, avec mission de trouver Thanis, de lui porter les propositions de son ancien ennemi et de le ramener en Égypte. Au prix de mille peines, Niari découvrit celui qu’il cherchait.
– Très intéressant. Ma parole ! On dirait un roman de Georges Hobert Sims ou de Miss Una Treffry.
– Attendez. Thanis, lié vis-à-vis de l’Angleterre par les liens de la reconnaissance, ne pouvait pas accepter. Il atermoya et s’en fut conter la chose à l’ambassadeur de Grande-Bretagne. Celui-ci en référa à son gouvernement. Au bout de quelques jours, il fit appeler Thanis, et lui tint à peu près ce langage : « Seigneur Thanis, la conspiration des Néo-Égyptiens constitue un danger permanent pour notre domination. Ces rebelles appellent Thanis, qui est leur suprême espoir. Si Thanis mourait, l’association se dissoudrait d’elle-même. Donc il faut que Thanis meure.
– Diable ! Diable, fit le jeune homme, ceci demande réflexion.
– Je crois bien, murmura Armand.
– Mais le ministre plénipotentiaire reprit : Thanis doit continuer à se bien porter, à toucher la rente que lui paie le gouvernement anglais, laquelle sera doublée. – Mais alors ? – Alors il s’agit de se procurer un faux Thanis, un homme sans importance, qui sera présenté aux Égyptiens comme le vrai, et dont le trépas sera le signal de la pacification définitive de la vallée du Nil.
– Jolie combinaison politique, grommela le journaliste.
Radjpoor ne comprit pas l’ironie de cette remarque :
– N’est-ce pas, appuya-t-il. Niari était un ancien client de sa famille, Thanis le décida à entrer dans ses vues. Restait à découvrir le faux Thanis. Il fallait un homme qui n’eût pas d’attaches, pas de parents, dont l’état civil pût être contesté en cas de réclamations.
– Difficile !
– Très difficile. Mais le hasard est propice aux audacieux. Il permit à Thanis de découvrir un certain Robert Lavarède.
À ce nom, Armand ne put dissimuler un brusque mouvement :
– Vous le connaissez ? interrogea vivement l’Hindou.
Mais déjà le Parisien s’était remis :
– Pas le moins du monde, répondit-il placidement. Seulement, je m’étonne qu’il se soit trouvé une personne remplissant les conditions nécessaires.
– Bon ! vous allez voir, reprit le fourbe, rassuré par cette explication. Robert Lavarède était né en plein Sud-Algérien, dans une ferme éloignée d’Ouargla d’une cinquantaine de kilomètres. Dans ces conditions, un état civil peut être discuté autant qu’on le veut.
– D’accord, mais pour le reste.
– Il était orphelin, sans parents d’aucune sorte.
– Vraiment ? fit Armand, se souvenant bien mal à propos que Robert et lui étaient cousins.
– Comme je vous le dis. Bref, Thanis jeta son dévolu sur ce personnage, l’enleva, le conduisit en Égypte, et, le cajolant par des promesses de fortune, l’effrayant par de terribles menaces, réussit à lui faire jouer parmi les rebelles le rôle désiré. Je ne vous raconterai pas par suite de quelles circonstances, Robert fut remis aux mains des Anglais et interné en Australie. Qu’il vous suffise de savoir que Thanis l’accompagnait, qu’avec lui, il fut enlevé par le navire aérien où nous sommes en ce moment.
– Et il est à bord ? demanda le Parisien.
– Oui.
– Hurrah pour la vieille Angleterre. Conduisez-moi vers lui.
– Telle a été ma première pensée, Sir.
– Auriez-vous changé d’idée ?
– Non, car Thanis…
– Thanis ?
– C’est moi !
L’Hindou avait à peine prononcé ces mots, qu’un véritable rugissement retentit dans la cabine voisine ; une porte battit violemment les parois du couloir, puis celle de la chambre fut poussée comme par une catapulte, et Robert, pâle, les yeux flamboyants, parut sur le seuil.
À la fin du dîner, il avait proposé de monter sur le pont, on s’en souvient. Une fois dehors, il avait entraîné Lotia, Maïva, Astéras dans sa cabine. Il les avait installés auprès des trous forés par lui dans la cloison, répondant seulement aux questions de la fille de Yacoub par ces paroles énigmatiques :
– Lotia, voulez-vous avoir la preuve de ma loyauté ?
– Certes, dit la jeune fille en baissant les yeux.
– Alors écoutez, et surtout pas de bruit.
Ainsi, tous avaient vu l’Hindou s’enfermer avec Armand, ils avaient suivi l’intrigue compliquée dont tous avaient été victimes. Bien avant que Radjpoor eût dit : Thanis, c’est moi ! Lotia l’avait deviné. Une joie intense avait chanté dans son cœur. Elle avait regardé Robert et s’était sentie prise de regrets cuisants. Comme elle s’était montrée cruelle, injuste pour ce dévoué, ce fidèle qui n’avait jamais menti. D’un mouvement inconscient, elle lui avait pris la main dans les siennes en murmurant :
– Pardon ! pardon !
– Pourquoi ? avait-il répondu. Vous n’êtes pas coupable, Lotia. Comme moi, vous étiez emprisonnée dans les filets de ce misérable traître.
Il palpitait de colère. Lui, soldat français, on l’avait fait travailler à la gloire de l’Angleterre, on l’avait mis en lutte avec les intérêts de sa patrie en Orient. Ses poings se crispaient, des frissons rapides couraient sur son visage ainsi que des ondes. Et quand Radjpoor affirma être Thanis, il ne fut plus maître de lui. Un cri s’échappa de ses lèvres, il bondit vers la porte qu’il ouvrit avec fracas, et furieux, affolé, pénétra chez son ennemi.
À sa vue, celui-ci avait prestement porté la main à sa poche et en avait tiré un revolver. Ce geste apaisa soudain Robert ; il eut un rire méprisant.
– Rassure-toi, Thanis, je ne suis pas un traître à la solde des conquérants de ma patrie. Je ne viens pas t’assassiner.
– Alors que voulez-vous ?
– Te dire que tu es enfin démasqué. Dans la cabine voisine, j’ai entendu tes aveux de fourbe.
– Que m’importe ?
– Et auprès de moi étaient mon ami Astéras, Maïva… Lotia.
Une teinte livide envahit les traits de Thanis.
– Lotia, as-tu dit ? bégaya-t-il d’une voix étranglée.
– Oui, Lotia qui te méprise, qui pleure d’avoir cru en toi.
– Alors je me venge.
Rapide comme la pensée, le traître avait braqué son revolver sur Lavarède, mais aussi prompt que lui, le journaliste, d’un coup sec, lui fit sauter l’arme des mains.
– Que faites-vous, glapit Radjpoor, il s’agit du triomphe de l’Angleterre.
– Dont je me soucie comme de l’an neuf, railla le Parisien reprenant son véritable accent, attendu que je suis Français de Paris.
Et comme, hébété, le fourbe reculait jusqu’à la cloison :
– L’Angleterre d’ailleurs n’a que faire de vos services, elle a des hommes d’État qui lui assurent assez de victoires sans recourir à des moyens inavouables.
– Enfin que voulez-vous ? gronda Thanis avec une vague terreur.
Ce fut Robert qui lui répondit :
– Je veux vous tuer.
Et sur un geste du traître.
– Mais vous tuer loyalement, reprit le jeune homme. Reconnaissez-vous m’avoir offensé ?
– Oui !
– Acceptez-vous une rencontre à l’épée ?
Un instant Thanis hésita à répondre. Enfin il se décida :
– Si je refusais, que feriez-vous ?
– Je vous tuerais comme un chien.
– Bien, alors j’accepte. Nos témoins – il désignait Armand et Astéras, dont la figure ronde paraissait à la porte, – nos témoins régleront les conditions du combat.
– À quoi bon, s’écria impétueusement Robert. Nous nous battrons au lever du jour, sur le pont, et le combat ne prendra fin que par la mort de l’un de nous.
Un éclair fauve étincela dans les yeux de Thanis.
– Soit, dit-il lentement. Au surplus l’un de nous est de trop.
– Et je dois vous prévenir, acheva Armand avec son plus charmant sourire, que si vous vous débarrassiez par hasard de votre adversaire, j’aurais l’indiscrétion de vous prier de vous aligner avec moi.
– Avec vous ? Mais c’est un guet-apens !
– Du tout, c’est un acte correct. Vous m’avez insulté également.
– Vous !
– Ne m’avez-vous pas proposé de vous aider à rentrer en Angleterre ?
– Si, mais où voyez-vous une insulte ?
– Oh ! Monsieur Thanis, vous vous faites tort. Comment ? Vous ne trouvez pas insolent d’offrir à un galant homme, de devenir le complice d’un coquin…
Frémissant de colère, le fourbe ne répondit pas, et de son ton gouailleur, le Parisien conclut :
– Voilà donc qui est entendu. Sans doute ! Vous avez quelques dispositions à prendre, nous ne voulons pas vous déranger plus longtemps. Bonsoir, Monsieur Thanis ; dormez bien, si cependant votre conscience le permet.
Sur cet adieu ironique, les cousins se retirèrent. Dans le couloir, ils trouvèrent Lotia. La jolie Égyptienne pleurait. D’un geste douloureux elle saisit les deux mains de Robert, les serrant avec force, et tout à coup ses larmes se firent jour :
– Ne vous battez pas ; il vous tuera. Je vous en supplie, ne vous battez pas !
– Il le faut, répliqua doucement le jeune homme, troublé par l’accent de son interlocutrice.
Elle secoua la tête avec désespoir :
– C’est vrai, c’est l’honneur. L’honneur, répéta-t-elle avec un rire pénible. Ah ! je vous méprisais comme un fourbe, un menteur, et à l’heure où je me repens, où j’estime en vous l’homme courageux et loyal, il faut que vous risquiez votre existence.
Armand crut devoir intervenir.
– Mademoiselle, fit-il doucement ; je vous en prie, montrez du courage pour ne pas lui enlever le sien.
Cette simple exhortation rappela à elle-même la fille des Hador. Elle releva le front, retenant ses larmes, et d’une voix ferme :
– Vous avez raison, j’aurai du courage. Monsieur Robert vous m’avez offert votre nom. Si nous parvenons jamais à quitter le Gypaète, je l’accepte avec gratitude. Demain, c’est notre existence à tous deux que vous défendrez, et si le sort vous est contraire, je le jure, Lotia vous suivra.
Telles furent les fiançailles tragiques des jeunes gens.
CHAPITRE XVI
UN DUEL À 2870 MÈTRES D’ALTITUDE
Le lendemain, vers cinq heures du matin, Armand, Robert, Astéras et Thanis se glissaient lentement sur le pont. Dans la salle d’armes de Ramier, ils avaient trouvé sans peine une paire d’épées, qui allait servir à la rencontre.
Sur le terrain, tandis que l’astronome et le journaliste, faisant fonctions de témoins, arrêtaient les derniers détails du duel à mort qui allait avoir lieu, Robert, accoudé sur la balustrade, regardait au-dessous de lui. Le jeune homme était calme, mais au moment d’engager un combat suprême à l’issue douteuse, il ne pouvait se défendre d’une certaine mélancolie. Il disait tout bas adieu à cette terre lointaine, sur laquelle peut-être il ne remettrait pas les pieds vivant.
Le Gypaète s’était élevé durant la nuit, sans doute pour éviter de se heurter à quelque sommet. Il glissait rapidement parmi de légères buées, qui s’interposaient ainsi qu’un voile de gaze, entre le sol et lui. Parfois, un coup de vent écartait ces draperies de brouillard, une éclaircie se faisait, et tout en bas, le voyageur apercevait la surface miroitante d’un grand lac, dont les rives basses, couvertes de fourrés de roseaux, se prolongeaient au delà de l’horizon.
Enfin Armand vint le tirer de sa rêverie :
– Es-tu prêt, cousin ?
– Oui, répondit-il d’un ton ferme.
– Bien. Et surtout du sang-froid.
– J’en aurai.
– Le Radjpoor doit connaître quelque coup de gredin. Défie-toi de la garde basse.
– Sois tranquille.
Et sur ces mots, l’ancien caissier prit place en face de son adversaire. Astéras remit les épées aux combattants, les retenant par la pointe, afin de les contraindre à attendre le signal du journaliste.
À ce moment même, au pied de l’échelle de fer montant vers l’écoutille, deux femmes s’arrêtaient chancelantes. C’étaient Lotia et Maïva.
Ni l’une ni l’autre n’avait pu trouver le sommeil. Des hallucinations sanglantes avaient peuplé leur veille. Quelques précautions qu’eussent prises les témoins et leurs clients, les jeunes filles avaient perçu leurs pas furtifs dans le corridor central. Alors elles s’étaient levées, s’étaient vêtues à la hâte, puis elles étaient venues là, pour être plus près de ceux qui allaient jouer leur vie.
Pourquoi avaient-elles agi ainsi ? Elles n’auraient su l’expliquer. À cette heure, rien ne pouvait empêcher la rencontre. Peut-être leur semblait-il que là, à deux pas de lui, leur présence serait une protection pour Robert. Elles obéissaient enfin à une de ces impulsions secrètes et toutes-puissantes auxquelles les femmes, plus sages que les hommes, ne cherchent point à résister.
Et au bas de l’échelle, elles attendaient, la gorge sèche, la respiration haletante. Le froissement de l’acier les fit frissonner. Armand venait de prononcer le sacramentel :
– Allez, Messieurs.
Les deux adversaires étaient debout, l’épée à la main. Le combat commençait.
Tous deux avaient la volonté de rester calmes ; aussi les premiers contacts furent-ils larges, peu précipités, académiques si l’on peut s’exprimer ainsi. Évidemment ils s’observaient, se tâtaient. Armand, qui n’était pas exempt d’inquiétude à l’endroit de la science de son cousin, respira. Les ennemis étaient à peu près de force égale.
Bientôt cependant Thanis s’échauffa. Il avait plus de haine au cœur que Robert, car alors que celui-ci avait enfin conquis la foi de Lotia, l’Égyptien avait perdu en même temps ses espérances de fortune et d’affection.
Thanis s’irritait visiblement de la résistance flegmatique du Français. Il multipliait les attaques, se dépensait en feintes, cherchant à énerver son ennemi, à lui faire commettre quelque faute.
Mais guidé par la conviction que son épée défendait, non seulement sa vie mais encore son bonheur, Robert conservait une garde impeccable, se bornant à parer. Il attendait une occasion favorable pour risquer une riposte foudroyante.
Soudain le jeu de Thanis changea brusquement ; sa main descendit, passa à la garde basse.
Le journaliste s’en aperçut, il pressentit qu’une botte perfide allait suivre, et il feignit de tousser pour avertir son cousin.
Celui-ci eut un vague sourire. Ses yeux se fixèrent avec obstination sur ceux de son adversaire.
Rapide comme l’éclair, Thanis simula un coup droit, et comme Robert venait d’instinct à la riposte, son épée ne rencontra que le vide. L’Égyptien s’était laissé choir à terre et portait à l’ancien caissier un furieux coup de pointe de bas en haut.
Armand, Astéras poussèrent un cri. Ils crurent le jeune homme transpercé ; mais plus prompt que la pensée, celui-ci s’était jeté de côté ; il évita l’arme de son adversaire, qui glissa sur la hanche, égratignant simplement l’épiderme.
Les témoins voulurent s’interposer, mais il les arrêta du geste :
– À quoi bon, cria-t-il, Thanis se bat ainsi que les assassins. En le faisant, il prouve qu’il a peur.
Tout penaud de son insuccès, l’Égyptien s’était redressé. De nouveau les fers se croisèrent.
Mais la physionomie du duel avait changé.
Maintenant Robert passait à l’offensive, il attaquait à son tour. Soit que Thanis fût pris de crainte, ainsi que l’avait dit le jeune homme, soit qu’il éprouvât un commencement de fatigue, il rompait. Bientôt il fut acculé contre la balustrade de fer.
Alors une pâleur livide couvrit son visage, ses traits se contractèrent. Par une série de bottes pressées, il tenta d’éloigner son adversaire. Dans le silence, les épées se froissaient avec des bruits secs. Si hâtifs étaient leurs battements, si fulgurants leurs éclairs, que les assistants étaient éblouis.
Tout à coup, avec une vigueur irrésistible, Robert fit un pas en avant, se fendit, et la lame d’acier disparut tout entière dans la poitrine de son adversaire. Puis il se redressa, se remettant en garde.
Précaution inutile. Son ennemi était hors d’état de lui nuire. Le corps raide adossé à la balustrade, la tête penchée en arrière, une écume rougeâtre aux lèvres, il faisait entendre un sourd gémissement. L’épée avait traversé le poumon. Avant que les témoins fussent arrivés auprès de lui, sa main défaillante laissait échapper son arme, et il se renversait en arrière.
Mais à ce moment une chose imprévue, effroyable, se passa. Dans cette chute soudaine, ses reins vinrent frapper le garde-fou, son corps bascula, et, glissant sur le flanc de l’aéronef, il fut lancé dans l’espace.
Un même mouvement réunit Robert et ses amis à la place que le traître occupait une minute plus tôt. Machinalement ils regardèrent. Thanis tombait dans le vide, se rapetissant, devenant un point noir, à mesure qu’il s’éloignait du navire aérien avec une vitesse uniformément accélérée.
Cela dura près d’une minute ; enfin la petite tache sombre, qui avait été un homme, atteignit la surface du lac. Les spectateurs distinguèrent vaguement un éclaboussement, une gerbe d’eau projetée en l’air par la violence du choc, puis plus rien.
Et comme ils se redressaient, profondément troublés par ce dénouement du drame qui venait de se jouer, Lotia, soutenue par Maïva apparut à l’écoutille.
Le silence succédant au choc des épées avait épouvanté la fille de Yacoub ; ses jambes tremblaient sous elle, et son joli visage avait revêtu une teinte de cire.
Elle vit Robert debout, sans blessure. Elle voulut courir à lui, mais ses genoux fléchirent et elle tomba sur le pont.
D’un bond il la rejoignit, la releva. Alors soutenue par lui, elle se prit à sanglotter :
– Vivant ! vivant ! disait-elle à travers ses larmes… La mort n’a pas été cruelle. Songez donc, j’ai été si coupable envers vous. Ma vie suffira-t-elle à expier mon injustice !
Mais elle se calma ; le désir de savoir la prit. Elle interrogea. Avec une stupeur heureuse elle apprit les incidents du duel, et quand son fiancé, car il l’était désormais, lui raconta comment Thanis avait été précipité, elle hocha doucement la tête et murmura :
– Coup terrible de la destinée ! Traître à tous, il croyait nous vaincre par la ruse, et maintenant il dort sous les eaux profondes d’un lac perdu au centre de l’Afrique. Nul ne reconnaîtra l’endroit où il s’est abîmé, nul ne lui creusera une sépulture. Justice ! Justice ! comme tu sais toujours atteindre le coupable !
Elle parlait comme en rêve, puis elle secoua le souvenir de l’auteur de tous ses maux ; elle redevint joyeuse pour féliciter encore Robert, pour remercier Armand et Astéras. Les couleurs étaient remontées à ses joues. Longtemps elle aurait exprimé son bonheur, si le journaliste ne l’avait interrompue.
Ramassant les épées, il dit :
– Je vais ranger ces joujoux. Inutile de mettre le sire Ramier dans la confidence. Nous lui déclarerons que Thanis est tombé par accident. Rien de plus.
Tous ayant promis de se conformer à son désir, il se rendit à la salle d’armes, replaça soigneusement les épées, puis revenant à ses amis qui l’avaient suivi, il enveloppa Robert et Lotia d’un regard souriant :
– La première partie du programme est remplie, cousin. Tu es heureux. Reste maintenant à quitter notre prison.
– Ce sera plus difficile encore.
– Bah ! Tu connais le vieil axiome des prisons d’État : Quand un geôlier a pris toutes les précautions, il peut être certain qu’il en a oublié au moins une dont profitera le captif, car le prisonnier a sur son gardien l’avantage indiscutable de ne nourrir qu’une seule pensée, recouvrer la liberté. Tu le verras, nous profiterons de cet avantage.
Et reprenant son ton de bonne humeur :
– À présent, promenez-vous, tenez-vous en gaieté, faites des projets d’avenir. Moi, je vais parcourir le Gypaète. Pour sortir d’un cachot, il est bon de le connaître.
Robert eut un geste dubitatif :
– Celui-ci défie toutes les tentatives. Le seul chemin qui nous conduirait à la liberté a été indiqué à l’instant par Thanis.
– Mauvais chemin, railla le journaliste sans se déconcerter, c’est le bon que je cherche.
– En est-il ?
– Voilà que tu sacrifies au doute ?
– Puis-je faire autrement ?
– Je ne sais si tu le peux, mais j’affirme que tu le dois. Et sur ce, je pars en reconnaissance. Je suppose que ma chère Aurett s’est arrachée au sommeil. Je la prierai de m’accompagner. Avec elle, ma curiosité inspirera moins de soupçons.
Et saluant ses interlocuteurs :
– Il est bien entendu que pour nos hôtes, je suis toujours Sir William Burke. L’utilité de ce pseudonyme britannique est indiscutable, puisque nous voulons les quitter « à l’anglaise ».
Sur cet à peu près, il se sépara de ses amis, et tandis que ceux-ci regagnaient le pont, il alla frapper à la porte de la cabine d’Aurett.
La jeune femme ouvrit aussitôt Elle se disposait à sortir :
– Vous avez bien dormi, mon amie, dit doucement le Parisien, cela se voit. Vos joues sont des parterres de lis et de roses.
Elle sourit gentiment, heureuse d’être complimentée par son époux.
– Mais voyez un peu l’influence du repos réparateur, continua ce dernier. Vous vous êtes levée avec une curiosité insatiable de mécanique.
– Moi, fit-elle surprise ?
– Vous-même, ma douce Aurett. Aussi, pour vous être agréable, vais-je vous mener visiter minutieusement l’aéronef qui nous emporte. Je vous connais, vous admirerez tout, et à chaque instant, vous m’adresserez des questions auxquelles je ne serai pas en mesure de répondre, si bien qu’il me faudra me renseigner auprès des hommes de l’équipage.
La gracieuse fille d’Albion indiqua d’un mouvement de tête qu’elle comprenait.
– Oh ! termina Armand, avec le plus aimable sourire, croyez que je ne me plains pas, et que j’aurai au contraire grand plaisir à vous servir de cicerone.
Galamment il offrit le bras à sa compagne. Tous deux suivirent le couloir central, avec la gravité un peu raide d’Anglo-Saxons visitant un musée et pénétrèrent dans la machinerie.
CHAPITRE XVII
L’OBSERVATOIRE DE PARIS DEVIENT UTILE
Pendant plusieurs jours, Armand ne parla plus d’évasion. Il semblait avoir oublié ses projets. Cependant son cousin, qui épiait tous ses mouvements, remarqua que la présence du journaliste sur le pont, au salon, partout enfin, coïncidait toujours avec celle de Ramier.
Selon l’expression d’Astéras, on eût dit que le Parisien était un satellite retenu par la zone d’attraction du fou.
Par exemple si le capitaine du Gypaète s’enfermait dans son laboratoire, aussitôt Armand disparaissait. À plusieurs reprises, on le surprit trinquant, bavardant, fumant avec des hommes de l’équipage.
Et comme on le plaisantait, en insinuant que peut-être il désirait se faire inscrire au rôle, il se contenta de répondre :
– Molière a trouvé le succès en lisant ses pièces à sa cuisinière. Il est certain que je ne vaux pas Poquelin, mais un matelot n’est pas inférieur à un cordon-bleu.
Cette réponse quelque peu obscure dut suffire à ses interlocuteurs. Pour lui, il continua tranquillement son étrange manège.
Cependant l’aéronef franchissait de vastes espaces. Traversant l’Équateur, il s’était élancé dans l’hémisphère Nord, et sous les pieds des voyageurs, avaient fui les immenses marais du Bahr-El-Ghazal, recouverts d’une flore exubérante, les riches districts du Darfour et du Kordofan.
À cette heure, le Gypaète dominait le Sahara tripolitain, dont les dunes de sable rougeâtre se succédaient désolées, arides, sans cesse semblables, avec la tristesse monotone d’un océan figé, à la houle soudainement immobilisée.
Or, un soir, en se mettant à table, Robert constata avec surprise que son cousin n’a l’ait pas son air placide habituel. Tout son visage accusait la joie, des lueurs rieuses dansaient dans ses yeux, ses lèvres se pinçaient pour arrêter l’éclat de rire prêt à s’échapper.
L’ancien caissier regarda Lotia. Elle aussi considérait Armand avec un mélange confus de surprise et d’espérance. Depuis qu’il avait amené le fourbe Thanis à se dénoncer, l’Égyptienne, tout aussi bien qu’Aurett, le croyait capable de sortir des passes les plus difficiles, et elle se demandait tout bas si la gaieté visible de l’aimable Parisien ne venait pas de ce qu’il avait enfin découvert le moyen de s’évader de sa prison flottante.
Sans doute, il entrait dans les vues du pseudo Sir Burke que sa bonne humeur fût remarquée, car il se mit à débiter des folies, riant bruyamment, donnant en un mot l’impression d’un homme satisfait des autres et de lui-même.
– Quel joyeux compagnon vous êtes ! dit enfin Ramier. Au moins vous rendez justice aux mérites de mon Gypaète, vous ne vous ennuyez pas à bord.
– M’ennuyer… serait-ce possible ?
– Il paraît, car sans aller bien loin, je pourrais citer des personnes qui préfèreraient de beaucoup être ailleurs.
– Allons donc, ce n’est pas sérieux ; ou bien il se produit chez ceux dont vous parlez une sorte de perversion du goût, qui les rend incapables d’apprécier le bonheur intense que procure cette course incessante dans les nuages.
– Le bonheur ! Ah ! comme vous dites vrai.
– Je le sais bien.
– Tenez, s’écria le fou enthousiasmé par ces paroles, le jour où je vous ai recueilli sur mon navire céleste, doit être marqué d’une croix blanche.
Avec élan, le journaliste tendit par-dessus la table sa main à son interlocuteur, et d’un ton plein de chaleur, il reprit :
– Depuis ce jour que vous rappelez, sir Ramier, je suis au comble de mes vœux.
– De vos vœux ?
Il y avait une nuance d’étonnement dans le ton dont la question fut posée.
– Oui, de mes vœux les plus chers… cela vous surprend ?
– Oui et non. Il n’est pas ordinaire qu’un habitant de la terre aspire à vivre en plein ciel.
– Mettons que je ne suis pas un homme ordinaire.
– J’en suis convaincu, sir Albatros. Il existe entre nous des affinités de caractère véritablement étonnantes. Comme moi, vous aviez le pressentiment de l’aviation.
Armand sursauta avec une expression d’étonnement parfaitement feinte :
– Comment, le pressentiment ? Où prenez-vous le pressentiment ?
– Mais, répliqua l’insensé, dans votre désir de planer au-dessus des misères humaines.
– Ce désir, permettez-moi de vous le dire, n’était point basé sur une supposition, mais bien sur une certitude.
Du coup, la face de Ramier trahit la stupéfaction.
– Une certitude, grommela le petit homme, une certitude, comme vous y allez. Au demeurant, vous n’allez pas prétendre avoir résolu le problème de l’aviation.
Levant les bras en l’air avec une moue empreinte de modestie :
– Loin de moi cette pensée orgueilleuse, s’écria le journaliste. Je voulais seulement dire que j’étais assuré que l’aviation était découverte.
– Assuré ?
– Absolument. D’ailleurs, interrogez mistress Burke – et Armand lançait sur Aurett un regard malicieux, – interrogez-la. Elle vous répondra que je passais mes journées, le nez en l’air, fouillant l’espace des yeux, et qu’il ne s’écoulait pas une heure, sans qu’elle m’entendît me plaindre de ne pouvoir me trouver à bord de l’aéronef mystérieux qui errait à travers l’atmosphère terrestre !
Si le Parisien avait voulu produire un effet, il dut être content du résultat de son affirmation.
Comme mus par des ressorts, Ramier, Mme Hirondelle s’étaient redressés.
Ils faisaient, suivant l’image populaire, des yeux ronds.
– L’aéronef, glapit l’épouse du fou.
– Vous aviez deviné mon aéronef, hurla Ramier ?
– Deviné, fit tranquillement le journaliste, que non pas, j’avais simplement lu les conclusions…
– Quelles conclusions ?
– Celles des astronomes.
– Quels astronomes ?
– Je ne me souviens pas de leurs noms. Ce que je me rappelle, c’est qu’ils faisaient partie de l’observatoire de Paris.
La figure de l’insensé se contracta affreusement ; ses dents grincèrent. Un moment, les assistants crurent qu’il allait bondir sur son interlocuteur, mais il vainquit son emportement pour demander d’une voix lente et calme, tandis que ses mains se crispaient sur le rebord de la table :
– Et qu’avaient écrit vos astronomes ?
– Ils exposaient qu’après une série d’observations et de calculs précis, ils se refusaient à admettre qu’un bolide, un corpuscule de l’espace abandonné à son propre mouvement pût suivre une ligne brisée sinueuse comme celle de l’objet lumineux sur lequel s’exerçait la sagacité de tout le monde astronomique.
Ceci posé, ils affirmaient qu’un gouvernement, ou peut-être un riche excentrique, avait surpris la formule de la navigation aérienne au moyen du « plus lourd que l’air », et que la chose observée était bel et bien un aéronef.
Et, comme le capitaine du Gypaète, pétrifié par cette révélation, gardait un silence menaçant :
– Je n’avais pas grand mérite, vous le voyez, à connaître l’existence de votre navire volant. Tout l’honneur de la découverte en revient à l’observatoire de Paris, je le proclame hautement, car je n’aime à me parer, ni des plumes du paon, ni de celles des astronomes.
À cet instant, Ramier murmura d’une voix sourde :
– Ainsi l’observatoire de Paris a pénétré mon secret ?
– Oh ! relativement, rectifia hypocritement le faux Anglais. On connaît la nature de votre engin ; mais sur son but, sur son propriétaire, on n’a aucun renseignement.
– On en aura. Parbleu ! On découvrira les maisons qui ont fabriqué les diverses parties de l’appareil ; on apprendra que ma femme avait fait les commandes ; de là à prononcer mon nom, il n’y a qu’un pas, il sera vite franchi. Et dans les journaux, mon nom terrestre ce nom que je croyais oublié à jamais, sera reproduit à des centaines de mille exemplaires. De nouveau l’humanité s’acharnera sur moi, et impuissante à atteindre mon corps, elle me flagellera moralement.
Tout à·coup, le bras du petit homme se tendit menaçant, un flot de sang envahit sa face pâle, et d’une voix grinçante qui terrifia les assistants :
– C’en est fait ! La guerre est déchaînée entre les observatoires et moi. Faux savants, curieux ineptes, je vous briserai.
Et après une pause :
– D’abord je raserai cet odieux observatoire de Paris, de la ville lumière. Je signerai mon œuvre de destruction, afin que le monde tremble, que ces potiniers de la cosmographie, qui s’embusquent derrière un télescope, ainsi que le bandit derrière un buisson, sachent qu’il convient de garder le silence, sinon que rien ne les sauvera de ma vengeance.
Il jeta violemment sa serviette sur sa chaise et se dirigeant vers la porte du couloir central, il appela d’un organe tonitruant. Un marin parut.
– C’est toi, fit le maniaque avec un hideux ricanement. Va à la machinerie d’avant ; que l’on mette le cap sur Paris et que l’on force de vitesse.
– Bien, Capitaine.
– Va… ou plutôt je t’accompagne.
Ramier sortit sur ses pas. Mme Hirondelle, oubliant, tant elle était troublée, sa politesse habituelle, se précipita dehors.
Les prisonniers restaient seuls.
– Eh bien, murmura Robert en regardant son cousin, tu viens de faire un joli coup !
– En quoi donc, dit ce dernier, sur les lèvres duquel se jouait un fin sourire.
– Il va détruire l’observatoire de Paris.
– Rien du tout ; car avant de l’atteindre, il aura reçu une lettre de moi qui modifiera complètement ses idées.
– Il sera furieux !
– J’y compte bien.
– Et tu jongles avec la colère d’un fou ?
– Décidément, mon pauvre Robert, tu manques de logique.
– Moi ?
– Toi-même. Voyons, j’exaspère Ramier, c’est convenu. Je te dis que je lui écrirai une missive qui arrangera l’affaire. Tu aurais dû comprendre aussitôt que si j’employais la plume au lieu de la parole, c’est qu’à l’instant précis où ma correspondance lui sera remise, je me serai, moi, absenté de son aéronef.
Tous eurent un même cri :
– Absenté ! Vous avez donc un moyen d’échapper à nos gardiens ?
– Naturellement ! C’est même pour cela que je viens de le décider à faire route pour la France. Car enfin, ce n’est pas le tout de sortir du Gypaète, encore faut-il mettre le pied sur une terre civilisée, où nous ne risquions de mourir, ni de chaleur, ni de froid.
Armand disait ces choses d’un air bonhomme, avec l’ironie sans fiel dont il avait le secret :
– Mais ce moyen ? demandèrent Robert, Lotia, Aurett, Maïva et Astéras, anxieux de connaître le plan qui avait germé dans le cerveau inventif du journaliste.
– Oh ! répliqua-t-il, c’est bête… comme toutes les choses simples. Je m’étonne de n’y avoir pas songé de suite.
– Mais enfin, qu’est-ce ?
– Vous allez le trouver vous-mêmes. Tenez, une supposition : Vous êtes en ballon, l’aérostat s’enflamme. Il vous faut le quitter. De quel appareil vous servirez-vous ?
– D’un parachute, firent tous les assistants.
– Justement, mes bons amis, un parachute.
Tous parurent désillusionnés, et Robert exprima le peu de confiance de ses compagnons par ces mots :
– Mais nous n’en avons pas.
D’un air railleur, le Parisien imita son cousin :
– Nous n’en avons pas. Ô cœur simple ! Tu es captif, et voilà comment tu scrutes ta prison. Mais si, malheureux, il y a un parachute à bord, pouvant soutenir sept ou huit personnes, un parachute merveilleux, convenablement roulé sur le cylindre d’un treuil prêt à fonctionner. Et tu ne l’as pas vu, parce que tu n’as pas eu l’idée élémentaire de visiter la cale.
Puis reprenant un ton plus posé :
– À terre est placée la nacelle, juste au-dessus d’un panneau qui, débarrassé de deux boulons, se rabat au dehors. La nacelle alors descend, par son propre poids et le parachute se déroule. Par l’orifice supérieur du parachute passe un câble de soutien, dont les deux extrémités sont fixées au centre du plancher de la nacelle, l’une par un nœud, l’autre par un crochet. Les personnes qui veulent utiliser ce mode de descente se placent dans la nacelle. Alors le panneau s’ouvre, le treuil tourne et le parachute se déroule jusqu’au moment où, étendu ainsi qu’un vaste parapluie fermé, il n’est plus retenu que par le câble qui entoure le rouleau du treuil, on détache alors le nœud fait à l’un de ses bouts et l’appareil tombe normalement.
Tous écoutaient avec une angoisse.
Certes, la fuite était possible ainsi, mais se confier à un parachute, alors que l’on n’a pas l’habitude de ce genre d’exercice, est un expédient assez hasardeux.
– Oh ! murmura Lotia d’une voix faible, je n’oserai jamais.
– En ce cas, répondit Armand, vous condamnerez l’observatoire de Paris à la destruction, et vous causerez sans doute, du même coup, le trépas de quelques astronomes.
– Oh ! je dirais plutôt à M. Ramier…
– La vérité ! il ne vous croira pas. Il pensera que vous voulez sauver le monument de la ruine. Tandis que, notre évasion effectuée, la situation devient autre. Nous partis, il trouve une lettre de moi. Je l’informe que, désireux de le quitter en pays civilisé, j’ai imaginé la fable dont il a été dupe. Il ne doute pas, car notre fuite est un fait précis, qui démontre jusqu’à l’évidence la véracité de mon dire.
– Et puis, ajouta Aurett en souriant, j’ai déjà fait de l’aérostation. La traversée aérienne de Pékin au Thibet m’a donné confiance, j’adopte le parachute.
– Moi aussi, appuya crânement Maïva.
– Il n’y a aucun danger, ajouta Armand d’un ton insinuant.
Fut-ce cette dernière remarque, fut-ce l’exemple de l’ex-muette, Lotia cessa de résister.
Chacun se déclara prêt à se confier au journaliste.
– À propos, demanda soudain Robert à son cousin. Comment as-tu découvert l’existence de ce parachute ?
– En causant avec les matelots. Depuis un an environ, le Gypaète parcourt les airs. Au début, M. Ramier et son équipage souffraient un peu d’être constamment enfermés dans ses flancs. De là, la nécessité de descendre parfois à terre.
Or, comme la manœuvre de l’atterrissage est délicate, on confectionna un parachute.
Quand le besoin de se dégourdir les jambes devenait trop violent, les hommes prenaient place dans la nacelle, et Ramier, demeuré seul à bord, atterrissait de son côté avec son appareil, après maint tâtonnement.
– Ah ! s’écria joyeusement Lotia, le parachute a déjà été éprouvé ?
– Une dizaine de fois.
– Eh bien alors ! va pour ce mode de délivrance. Recevez, du reste, Monsieur, les remerciements qu’au premier moment nous n’avons pas songé à vous adresser.
Toutes les mains pressèrent celles du Parisien, et ce fut avec une émotion profonde que les voyageurs remontant sur le pont, tournèrent les yeux vers le N.-O., où se cachait, bien loin derrière l’horizon, la terre libre de France, sur laquelle ils allaient tenter de reconquérir leur liberté.
CHAPITRE XVIII
LE PARACHUTE
La patience des captifs fut mise à une rude épreuve pendant les jours suivants. Le Gypaète, malgré son allure rapide, leur semblait se déplacer avec la lenteur désespérante d’une tortue. Et cependant il avait traversé le Sahara en trente heures !
Mais l’idée de liberté faisait palpiter tous les cœurs. Les craintes s’étaient envolées. Les hasards de la descente disparaissaient, cachés par cet espoir lumineux : marcher librement à la surface du globe.
De plus, Robert et Lotia songeaient que là-bas, en France, ils se marieraient. Quant à Ulysse, il avait déclaré à Maïva que, si elle ne consentait pas à lui accorder sa main, il se précipiterait du Gypaète sur la terre sans le moindre parachute, résolution extrême dont la jeune Égyptienne l’avait aussitôt dissuadé en lui tendant les deux.
Et les projets de bonheur allaient leur train. Le diamant d’Osiris, impuissant à assurer la félicité des fellahs, suffirait à celle des voyageurs. Astéras et Maïva se plongeraient de concert dans les études astronomiques. Mais Robert ne parlait plus d’aller à son bureau ; au cours de son voyage, il avait trouvé une gentille femme et un diamant, deux pierres précieuses, seulement il avait perdu son goût obstiné pour la vie sédentaire. Il se proposait de passer le printemps à Paris, l’été au bord de la mer, l’automne à la chasse et l’hiver à Nice. Comme on le voit, son humeur était devenue vagabonde.
Sur le pont presque tout le jour, les prisonniers du fou devisaient, relevant avec une attention inquiète le chemin parcouru. Le désert traversé, l’aéronef avait volé au-dessus de la Tripolitaine, quitté le continent africain au fond de la grande Syrte, battu l’air de ses ailes à deux mille mètres des flots bleus de la Méditerranée ; on avait entrevu la Sicile au passage, puis l’extrémité Nord-Est de la Sardaigne, le détroit de Bonifacio, la Corse et ses maquis. D’un dernier élan, on avait atteint la côte de France entre Marseille et Toulon.
Les Français s’étaient découverts silencieusement à la vue de la terre natale. Mais, sans suspendre son vol, le navire aérien poursuivait sa course. Il franchissait comme une flèche les départements des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse, passait, à Pont-Saint-Esprit, le Rhône, un instant visible comme un ruban d’argent, escaladait les Cévennes ardéchoises, entrait dans la Haute-Loire.
– Demain ! dit alors Armand à Robert, nous planerons sur les plaines du Cher. Qu’après le déjeuner tout le monde se tienne prêt.
Et sur cette injonction, qui avait causé à tous un trouble extraordinaire, chacun s’était retiré dans sa cabine. Croire que les voyageurs trouvèrent le sommeil durant la dernière nuit qu’ils comptaient passer à bord, serait contraire à la vérité.
Si parfois ils s’abandonnaient à un vague engourdissement, ils se réveillaient en sursaut, avec l’impression de chutes vertigineuses. Ah ! dame ! le parachute les tracassait.
Tant que l’évasion n’était pas une chose immédiate, ils avaient fait bonne contenance. Un danger lointain ne fait pas grand’peur. Mais à l’instant de l’affronter, il en est autrement.
Enfin le jour vint. Un à un les passagers arrivèrent sur le pont.
Ils se regardaient curieusement, étonnés de se trouver pâles et défaits.
Seuls Armand et Aurett conservaient leur visage habituel.
Ils restèrent ainsi, considérant vaguement la campagne cultivée qui défilait sous leurs pieds, jusqu’à l’heure du déjeuner.
Comme à regret, ils descendirent à la salle à manger.
Par bonheur, Ramier ne se montra pas. Depuis sa conversation avec le journaliste, il ne paraissait plus, obéissant probablement à une « crise de solitude » analogue à celle dont il avait été pris, après son attentat, contre l’observatoire des Montagnes Rocheuses.
Le repas fut morne. Il se termina pourtant. Sur un signe d’Armand, tous se levèrent avec un serrement de cœur, et d’un pas lourd, comme hésitant, marchèrent dans les traces du jeune homme.
Celui-ci avait bien choisi son moment. À cette heure, les matelots, réunis à l’avant, prenaient leur nourriture ; la manœuvre était confiée à tour de rôle à l’un d’eux qui se tenait au tableau de direction, placé à l’arrière dans une petite cabine ménagée à cet effet. Les captifs purent donc gagner la cale sans être aperçus.
Une fois là, Armand poussa une porte à droite et fit entrer ses compagnons dans une pièce spacieuse. Au milieu, à mi-hauteur du plafond, s’étendait un énorme rouleau de treuil, dont les axes étaient fixés sur de solides supports appuyés aux cloisons.
À terre, une sorte de panier, long de trois mètres, large de deux, était rattaché par des cordelettes à l’extrémité d’un parachute de soie enroulé sur le treuil. Sur le plancher de cette « sorte de manne » ; deux fusils à carbure étaient couchés.
Tous frissonnèrent à cette vue :
– Dépêchons, ordonna le Parisien ; – et, montrant les fusils : – Des souvenirs du voyage.
Dominés par son accent, tous s’entassèrent non sans peine dans la nacelle.
L’opération d’ailleurs nécessitait une gymnastique assez pénible, car les rebords avaient environ 1 mètre 50 d’élévation.
– Tenez-vous bien, fit encore Armand, quand ils furent installés. Demeurez assis au fond de la nacelle ; comme cela, le vertige n’est pas à craindre. Attention, je dévisse les boutons de la trappe.
Avec une clef anglaise qu’il s’était procurée, le courageux journaliste défit les boulons ; le plancher se rabattit aussitôt, et la nacelle se balança mollement, tendant les cordes qui la rattachaient au parachute.
Robert ne put résister à sa curiosité, il se dressa lentement et regarda par-dessus le bord. Une exclamation lui échappa.
Au-dessous de lui, il avait aperçu le vide, et à plus de deux kilomètres de profondeur, la terre se déplaçant en sens inverse de la marche de l’aéronef avec une prodigieuse rapidité.
– Immobile et assis, gronda Armand.
Et tandis que son cousin se laissait glisser au fond du panier d’osier, il fit jouer le déclic de l’engrenage du treuil.
Le rouleau se prit à tourner lentement. La nacelle s’abaissa d’un mouvement insensible, déroulant le parachute.
Mais Ulysse eut un cri effrayé :
– M. Armand reste sur l’aéronef !
Le journaliste l’entendit :
– Eh ! cria-t-il en se penchant à l’ouverture, il faut bien que je dirige la manœuvre. Je vous rejoindrai par la corde, soyez tranquilles.
Il disait cela simplement, comme s’il avait pensé que descendre, suspendu à un cordage, à six mille pieds du sol, était l’opération la plus naturelle du monde.
Cependant le parachute, complètement déroulé, flottait au dehors, retenu seulement par le cordage passé sur le rouleau du treuil.
– Attention, je descends, cria le Parisien.
Et avec un merveilleux sang-froid, il saisit le cordage et se laissa glisser dans la nacelle auprès de ses amis épouvantés de son audace.
Puis, sans s’inquiéter de leur mine effarée, il prit la main d’Aurett, la porta doucement à ses lèvres. D’un geste brusque, il la lâcha, et se penchant sur le fond de la nacelle, se mit en devoir de dénouer l’extrémité du câble.
Tous fermèrent les yeux, et soudain ils sentirent qu’ils tombaient. Le mouvement de chute, rapide d’abord, se ralentit bientôt, leur rendant le courage de regarder.
Au-dessus d’eux, ainsi qu’un immense parapluie déployé, le parachute dessinait sa circonférence concave, percée au centre d’une ouverture circulaire, destinée à permettre l’échappement de l’air comprimé et à éviter ainsi les oscillations dangereuses.
À une certaine distance déjà, un grand oiseau, aux ailes courtes, filait dans l’espace en s’éloignant du parachute. C’était l’aéronef. Ainsi, le plan hardi d’Armand Lavarède avait été couronné de succès. Les captifs avaient quitté leur prison et ils allaient atteindre la terre.
Seul debout, le journaliste considérait la surface du sol. Il se rapprochait peu à peu ; les détails devenaient plus distincts.
Avec joie, Armand constatait que le parachute, déviant légèrement sous la poussée d’un vent faible, flottait au-dessus de vastes prairies, au milieu desquelles se dressaient de distance en distance des peupliers aux formes élancées.
– Tout va bien, dit-il en s’adressant à ses amis, le terrain est aussi favorable que possible.
Bientôt le parachute se balança à quatre cents mètres du sol. Il descendit encore.
Soudain un cri de Maïva fit tressaillir tous les passagers.
– Gypaète, faisait l’Égyptienne avec l’accent de la terreur, il revient.
Tous se retournèrent vers le point de l’espace désigné par la jeune fille, et avec une épouvante indicible, ils distinguèrent l’aéronef qui se dirigeait vers eux à tire d’aile.
Sans aucun doute, leur évasion était découverte, et le fou, dans sa manie, craignant que son secret ne fût livré à la publicité, voulait frapper ceux qu’il ne pouvait plus reprendre. Il fonçait à toute vitesse sur le parachute. Il l’atteindrait, le déchirerait, et les passagers précipités se briseraient sur le sol.
Mais dans cet instant critique, Armand ne perdit pas la tête. Il se baissa vivement, empoigna l’un des fusils posés par lui dans la nacelle, les souvenirs du voyage, comme il les avait appelés, et montrant l’autre à son cousin :
– Allons, Robert, prends cela et vise les ailes. C’est le point faible du Gypaète.
Déjà il épaulait son arme. La détonation éclata, suivie d’un cliquetis métallique. La balle avait frappé l’aile droite de l’aéronef, brisant une des lames mobiles figurant les plumes.
Le résultat de cette mince avarie fut que le vaisseau aérien dévia légèrement. Ses flancs frôlèrent le parachute, lui imprimant une légère secousse, et, emporté par sa vitesse, il s’éloigna, tandis que la descente continuait.
Mais Ramier ne se tenait pas pour battu. Les fugitifs, qui suivaient d’un œil hagard tous les mouvements du Gypaète, le virent décrire un cercle et la proue menaçante dirigée sur leur frêle support, revenir avec une rapidité inconcevable.
Ils se crurent perdus cette fois, leurs mains se crispèrent désespérément sur les rebords de la nacelle, mais la voix joyeuse d’Armand s’éleva :
– Nous atterrirons, mes amis ; nous sommes protégés par un rempart ! En effet, la cime d’un haut peuplier dépassait la nacelle, et la descente se poursuivant, ne tardait pas à masquer le parachute lui-même.
Évidemment, Ramier avait reconnu l’obstacle ; il ne voulait pas risquer de briser son appareil en le lançant contre l’arbre. L’aéronef évolua pour contourner le peuplier tutélaire.
Durant cette manœuvre, la nacelle touchait le sol, et le parachute, cessant d’être tendu, se rabattait auprès d’elle. En quelques secondes, les fugitifs se dégagèrent des cordages. Avec un bonheur infini, ils foulaient la terre. Ils étaient sauvés.
Non, pas encore. Le Gypaète s’était abaissé. Sur le pont, Ramier paraissait avec plusieurs matelots armés de fusils.
– Ah ça ! grommela le journaliste, ils vont nous canarder comme de simples lapins.
D’un coup d’œil, il inspecta le terrain environnant. Pas un abri, pas une cachette où l’on pût défier les projectiles. Seul, le peuplier étalait son feuillage touffu à quinze mètres de lui.
– Au peuplier, cria-t-il.
Et tandis que tous se précipitaient vers l’arbre, il épaula lentement, visant le fou.
Ses ennemis le prévinrent, une grêle de balles s’abattit autour de lui, soulevant un nuage de poussière, mais il ne s’en émut pas et lâcha son coup de feu.
Un matelot, debout auprès de Ramier, chancela. Il y eut à bord de l’aéronef un moment de confusion, dont le Parisien profita pour rejoindre ses compagnons.
Derrière le peuplier dont les branches basses effleuraient le sol, on avait tout au moins un abri relatif.
Ramier devait être furieux.
Impossible de voir ses adversaires. Impossible également de les enlever au filet, car le voisinage de l’arbre empêchait le lancement.
Sa rage, son incertitude se trahissaient par les mouvements du Gypaète. L’aéronef décrivait de grands cercles autour du peuplier, mais les fugitifs exécutaient le mouvement en sens inverse, restant toujours masqués par le feuillage.
Et toujours une fusillade inoffensive continuait.
On ne sait quelle eût été l’issue de ce bizarre combat s’il se fût prolongé.
Soudain des appels lointains retentirent. Sur une route qui serpentait à travers les prairies, des paysans armés de fourches accouraient au bruit. Les amis d’Armand répondirent à leurs cris. C’étaient des sauveurs qui arrivaient.
Ramier les aperçut aussi.
Il eut un geste de rage ; sa vengeance et son secret lui échappaient. Il donna un ordre ; les matelots rentrèrent dans le navire aérien, qui s’éleva tout à coup, suivant un plan incliné et se perdit bientôt dans les nuages.
Une heure après, les voyageurs, entourés des braves cultivateurs qui les avaient délivrés, faisaient une entrée triomphale dans le village de La Guerche-sur-l’Aubois, près Bourges, à dix-huit cents mètres duquel le parachute les avait déposés.
CHAPITRE XIX
SURPRISES
Le lendemain, après une nuit paisible qui les reposa de leurs émotions, les voyageurs gagnèrent Bourges, d’où un train les emporta sur Paris.
Ils éprouvaient une joie débordante, des fredons leur montaient aux lèvres. Ils étaient en France, et la voix enrouée des employés criant le nom des stations d’arrêt semblait à leurs oreilles la plus douce des musiques.
Ils étaient dans cet état particulier de l’exilé revenant sur le sol natal. À Paris, ce fut bien autre chose. Tandis qu’Armand et sa jeune femme emmenaient Lotia et Maïva dans l’ancien appartement de garçon du journaliste, devenu le « pied-à-terre » du ménage, Robert et Ulysse voulurent absolument courir, qui à son domicile, qui à l’Observatoire.
Une voiture les emporta tous deux. Elle suivit les boulevards St-Marcel, de Port Royal.
Tous deux rayonnaient, parlaient haut, poussaient des exclamations admiratives, à ce point que leur cocher, qui les observait du coin de l’œil, murmura entre ses dents :
– Mâtin ! voilà des provinciaux qui ont bien déjeune.
L’homme attribuait aux vins généreux la griserie du retour.
À l’Observatoire, Ulysse descendit et Robert continua son chemin.
Certes, sous la coupole astronomique, on marqua quelque surprise de la soudaine réapparition du savant, mais ses explications suffirent à faire excuser son absence involontaire. Les documents qu’il rapportait sur la constitution et la nature de l’aéronef, lequel était toujours l’objet de violentes controverses, lui valurent un véritable triomphe. Il fut incontinent prié de rédiger un rapport circonstancié qui serait soumis à l’Académie des sciences.
Quelque chose comme la gloire couronnait l’odyssée de l’astronome.
Or, tandis que le doux rêveur marchait de satisfaction en satisfaction, Robert s’apercevait avec stupeur qu’il était, non seulement oublié, mais encore en état de vagabondage.
Chez Brice et Molbec, fabricants d’instruments d’optique, on le reçut froidement. Un autre caissier trônait à son bureau, il était remplacé dans son emploi et dans la confiance de ses anciens patrons. Il s’y attendait un peu, d’ailleurs, et en fut d’autant moins ému que le diamant d’Osiris lui assurait une existence à l’abri du besoin.
Mais à son ancien domicile, ce fut bien autre chose. Comme il franchissait le seuil, la concierge l’arrêta :
– Monsieur, Monsieur, où allez-vous ?
– Mais chez moi, fit le jeune homme : ne me reconnaissez-vous pas ?
La bonne femme le dévisagea, et aussitôt elle prit une attitude embarrassée.
– Ah ! bon !… M. Robert Lavarède… ah bon !… Vous voilà revenu… on vous croyait mort ! Dame ! une année sans nouvelles.
– Il n’existait pas de bureau de poste où j’étais, fit-il. Je vous raconterai cela plus tard. Pour l’instant, il me tarde de revoir mon petit logement…
Il s’engageait dans l’escalier, la concierge le retint encore :
– Ne montez pas. Votre logement est occupé.
– Occupé ?
– Sans doute. Le propriétaire a attendu six mois. Au bout de ce temps, ne vous voyant pas revenir, il a fait enlever le mobilier, qui a été transporté dans un garde-meuble, et il a loué l’appartement.
L’ancien caissier sans emploi, l’ancien locataire sans logis écoutait d’un air ahuri.
– Mais alors où sont mes meubles ?
– Je ne sais pas au juste. Le propriétaire est en voyage. À son retour, je lui en parlerai, et vous pourrez reprendre ce qui vous appartient, moyennant le payement des deux termes échus.
Tout abasourdi, Robert salua et revint chez Armand. Chacun s’amusa de la mésaventure qui, en somme, n’avait aucune gravité. Pendant qu’Aurett hébergerait Mlle Lotia et Maïva, le jeune homme prendrait une chambre à l’hôtel ou accepterait l’hospitalité d’Ulysse, lequel, plus heureux que lui, avait retrouvé sa garçonnière en bon état.
Du reste, les jours suivants devaient être bien remplis. On allait préparer le double mariage de Robert avec Lotia, d’Astéras avec Maïva.
La fille de Yacoub écrivit à son père, afin d’obtenir et son consentement et les papiers nécessaires.
Armand se chargea de faire dresser un acte de notoriété pour Maïva qui, vendue toute enfant comme esclave, ignorait le lieu de sa naissance et son véritable nom ; Aurett se préoccuperait des corbeilles de noce.
Quant aux deux fiancés, ils auraient suffisamment à faire à réunir les pièces nombreuses que la loi exige.
Donc chacun se mit en campagne.
Pour sa part, Robert télégraphia à Ouargla, afin qu’on lui envoyât son acte de naissance ainsi que les actes de décès de ses père et mère.
Or, au bout de huit jours, il reçut la lettre suivante, qui le plongea dans une stupeur voisine de l’abrutissement :
Ouargla, ce 24 octobre 1896.
Monsieur,
Par votre honorée du 16 courant, vous avez bien voulu me prier de vous faire tenir copie des actes de l’État Civil vous concernant.
À mon grand regret, il m’est impossible de déférer à ce désir. Il résulte en effet d’instructions émanant des départements de l’Intérieur et des Affaires Étrangères que c’était par suite d’une erreur, provoquée au moyen de déclarations délictueuses, que la qualité de Français et le nom de Robert Lavarède vous avaient été attribués. Il appert d’une note communiquée par le gouvernement britannique, à la date du 12 février de l’année courante, que vous êtes de nationalité égyptienne et que votre véritable nom est Thanis.
Veuillez donc vous adresser pour recevoir duplicata des pièces vous concernant aux autorités compétentes. Afin de faciliter vos démarches, je vous autorise à produire la présente lettre, par laquelle je déclare que toutes les écritures relatives à votre état civil ont été annulées sur les registres de la commune d’Ouargla ; la dite déclaration à telles fins que de droit.
Agréez, Monsieur, l’assurance de ma parfaite considération.
L’Officier de l’état civil.
Signé : ILLISIBLE. »
Suivaient les cachets, timbres et estampille de la municipalité d’Ouargla. Cette fois la surprise était violente, irréparable. Armand lui-même, à qui Robert communiqua cette lettre étrange, parut embarrassé.
S’adresser aux autorités égyptiennes, il n’y fallait pas songer. C’était indiquer le lieu de la retraite du jeune homme aux Anglais, à qui l’ancien caissier, ayant joué le rôle de Thanis, paraissant vouloir le reprendre, semblerait un personnage dangereux.
Il s’exposerait ainsi à une surveillance gênante, peut-être même à l’un de ces guet-apens que la morale réprouve, mais que la politique absout. Car, il n’y avait pas à s’y méprendre, c’était le gouvernement anglais qui avait dirigé tout cela. Le voyageur se rappelait d’ailleurs les paroles du capitaine du croiseur qui l’avait conduit en Australie.
Et puis, dernière raison, Robert avait été Français et il prétendait le redevenir.
Sur le conseil de son cousin, aidé par celui-ci, il remua ciel et terre, s’adressant successivement à l’Administration civile et à l’Administration militaire.
Peines inutiles ! la première lui répondit froidement :
– Robert Lavarède ? Rayé de l’état civil.
La seconde répliqua :
– Robert Lavarède ? Rayé des cadres.
Et un beau soir, lassé, découragé, désespéré, le jeune homme dit à Lotia qui s’attristait autant que lui :
– Je n’ai plus de nom, plus de patrie, Lotia. Le rêve que je caressais s’évanouit. Le bonheur me repousse loin de lui. Il ne m’est plus permis de vous épouser. Maïva et Astéras se marient à la fin de la semaine, et nous, que Thanis mort poursuit encore de sa vengeance, nous sommes à jamais séparés par la fourberie humaine.
Un sanglot de la fille de Yacoub fut sa seule réponse.
– Eh ! sapristi, du courage, murmura Armand, tout désolé devant ce malheur auquel il ne voyait pas de remède. Votre union est retardée soit, mais elle n’est pas impossible.
– Que veux-tu dire, questionna Robert ranimé par une vague espérance ?
– Je veux dire que, pour épouser Lotia, il te faut une nationalité. Eh bien ! puisque la France ne veut plus de toi, que l’Égypte est trop dangereuse, on t’en fera une autre.
– Comment ?
– Eh ! si je le savais, ce serait déjà fait.
Et prenant les mains des deux fiancés éplorés, il les réunit en disant d’un ton à la fois gouailleur et tendre :
– Mes enfants ! foi de Lavarède, je vous le promets, vous serez consolés. Le bonheur, c’est comme le reste. Quand on le cherche bien, on le trouve… et nous allons chercher !