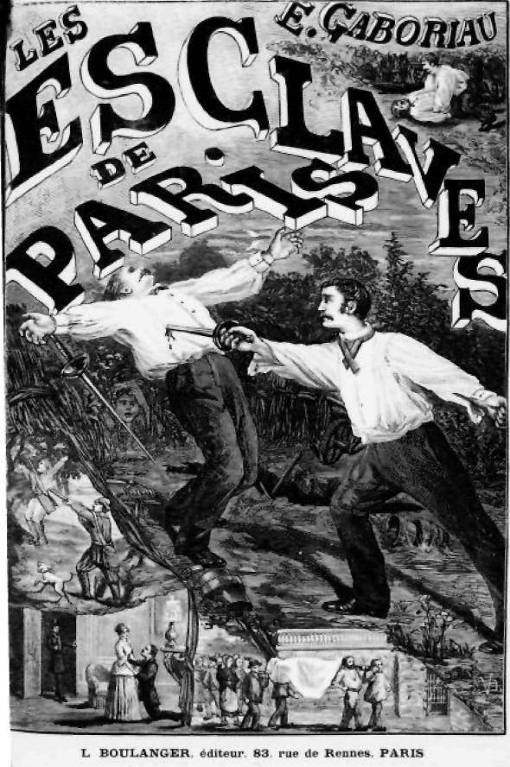
Émile Gaboriau
LES ESCLAVES DE PARIS
Tome I
(1868)
Table des matières
À propos de cette édition électronique
PREMIÈRE PARTIE – LE CHANTAGE
I
La journée du 8 février 186. fut une des plus rigoureuses de l’hiver.
À midi, le thermomètre de l’ingénieur Chevalier, qui est l’oracle des Parisiens, marquait 9 degrés 3 dixièmes au-dessous de zéro.
Le ciel était sombre et chargé de neige.
La pluie de la veille était si bien gelée sur les pavés que la circulation était périlleuse et que les fiacres et omnibus avaient interrompu leur service.
La ville était lugubre.
À Paris, bien qu’on y puisse mourir de faim, tout comme sur le radeau de la Méduse, on ne s’inquiète pas démesurément de ceux qui n’ont pas de pain.
Il semble que du banquet quotidien d’un million de convives il doit tomber assez de miettes pour rassasier ceux qui n’ont pas trouvé place à table.
Mais l’hiver, quand la Seine charrie, involontairement, on pense à ceux qui n’ont pas de bois et on les plaint.
Cela est si vrai, que ce jour du 8 février, la maîtresse de l’Hôtel du Pérou, Mme Loupias, une âpre et dure Auvergnate, se préoccupa de ses locataires autrement que pour augmenter leur loyer ou les harceler de ses incessantes demandes d’argent.
– Quel froid d’ours ! dit-elle à son mari, occupé à bourrer de charbon de terre le poêle de la loge. Par des temps pareils, je suis toujours inquiète, depuis cet hiver où nous avons trouvé un de nos locataires pendu là-haut. L’accident nous coûta bien cinquante francs, sans compter les injures des voisins. Tu devrais voir ce que font nos gens des mansardes.
– Baste !… répondit Loupias, ils sont sortis pour se réchauffer.
– Tu crois ?
– J’en suis sûr. Le père Tantaine a filé au petit jour, et j’ai vu peu après descendre M. Paul Violaine. Il n’y a plus là-haut que Rose, et je pense qu’elle aura eu le bon esprit de rester couchée.
– Oh ! celle-là, fit la Loupias d’un ton méchant, je ne la plains guère. Si je n’ai pas eu la berlue l’autre soir, elle ne tardera pas à planter là M. Paul. Elle est trop belle pour notre maison, cette fille.
C’est rue de la Huchette, à vingt pas de la place du Petit-Pont, qu’est situé l’Hôtel du Pérou, et jamais enseigne ne fut plus cruellement ironique.
L’extérieur sordide de la maison, l’allée étroite et boueuse, les fenêtres à carreaux ternes, tout crie aux passants : « Ici on loge la misère. » Au premier abord, on soupçonne un repaire ; point, l’endroit est honnête.
C’est un de ces asiles, de plus en plus rares dans notre Paris tout neuf, où les pauvres honteux, les déclassés, les vaincus de toutes les luttes sociales trouvent, en échange de leur dernière pièce de cent sous, un abri et un lit. On se réfugie là comme un naufragé prend pied sur un écueil, on respire un moment, et dès qu’on en a la force, on repart.
Impossible, si misérable qu’on soit, de concevoir la pensée d’habiter sérieusement l’Hôtel du Pérou.
Du haut en bas, au moyen de châssis de toile et de papiers d’occasion, tous les étages ont été divisés en quantité de petites cellules que la Loupias appelle fastueusement ses chambres.
Les châssis se disloquent, les papiers éraillés pendent en loques, c’est hideux.
C’est splendide comparé aux mansardes.
Il n’y en a que deux, heureusement, conquises sur un grenier, séparées de la toiture par un faux plafond, éclairées par des fenêtres en tabatière, si basses qu’à peine on peut s’y tenir debout.
Elles ont pour meubles : un lit à matelas de varech, une table boiteuse et deux chaises.
Telles quelles, la Loupias les loue 22 francs chacune par mois, à cause de la cheminée, assure-t-elle, un trou informe dans le mur. Et elles ne restent jamais vides !…
C’est dans une de ces mansardes, que par cet horrible froid se trouvait la jeune femme dont Loupias avait prononcé le nom.
Jamais plus admirable créature ne fut mise au monde pour le ravissement des yeux.
Elle venait d’avoir dix-neuf ans, elle était blonde et blanche. De longs cils recourbés voilaient à demi l’éclat un peu dur de ses yeux bleus à reflets d’acier. Ses lèvres, qui s’entrouvraient sur des dents fines et nacrées, ne semblaient faites que pour sourire. Ses cheveux dorés, lumineux et vivants, crêpelés sur le front, étaient retenus à demi sur la nuque par un peigne de quatre sous, et retombaient à flots, narguant les fausses tresses, sur des épaules d’un dessin exquis.
Elle n’était pas restée couchée, ainsi que l’avait supposé Loupias. Elle s’était levée, et, jetant en guise de châle, sur sa mauvaise robe d’indienne, la couverture du lit, une couverture digne du logis, sale, reprisée, pelée, elle était venue s’établir près de la cheminée.
Pourquoi là plutôt qu’ailleurs ? C’était bien une idée. L’âtre était froid. Dans le fond, deux tisons gros chacun comme le poing, faisaient bien à eux deux autant de fumée qu’une cigarette, mais ne donnaient aucune chaleur.
N’importe ! Accroupie sur une loque immonde que la Loupias décorait du nom de tapis de foyer, Rose se tirait les cartes, essayant de se consoler des souffrances du présent par les promesses de l’avenir.
Elle apportait à cette grave opération une attention si grande, un tel recueillement, qu’elle ne semblait pas sentir le froid qui bleuissait ses mains.
Devant elle, en demi-cercle, elle avait étalé ses cartes molles et crasseuses, et du bout du doigt, en prenant bien garde de ne pas se tromper, elle comptait de trois en trois, ainsi que cela se pratique, comme on sait.
Chacune des cartes sur lesquelles s’arrêtait son doigt, ayant pour elle une signification favorable ou fâcheuse, elle se réjouissait ou se dépitait.
– Une, deux, trois, disait-elle, un jeune homme blond… ce doit être Paul. Une, deux, trois… démarches. Une, deux, trois… de l’argent pour moi. Une, deux, trois… non, voilà des retards. Une, deux, trois… le neuf de pique ! c’est-à-dire des chagrins, l’abandon, le dénuement ! toujours le neuf de pique !
En vérité, elle était consternée comme si elle eût reçu l’assurance d’un désastre prochain.
Mais elle se remit vite. De nouveau elle mêla le jeu, le battit, le coupa scrupuleusement de la main gauche, l’étala devant elle et recommença à compter : une, deux, trois…
Les cartes, cette fois, se montrèrent propices, et n’eurent que des promesses séduisantes.
– On t’aime, lui dirent-elles en leur langage, qui est celui des sorcières, beaucoup, de tout cœur, au loin ; tu auras une fortune, on pense à toi ; tu recevras mystérieusement une lettre d’un jeune homme brun très riche !
Le jeune homme était représenté par le valet de trèfle.
– Encore l’autre !… murmura Rose. Décidément, c’est la destinée qui le veut !…
Aussitôt elle retira d’une fente de la cheminée, sa cachette, une lettre pliée menu, sale, fripée, qu’elle avait lue bien souvent. Pour la vingtième fois, depuis la veille, elle relut bien lentement :
« Mademoiselle,
« Je vous ai vue et je vous aime. Parole d’honneur.
« C’est vous dire que votre place n’est pas dans le quartier infect où vous couchez votre beauté.
« Un ravissant appartement – citronnier et palissandre – vous attend rue de Douai.
« Je suis carré en affaires, le loyer sera à votre nom.
« Réfléchissez, allez aux informations, je présente des garanties sérieuses. Je ne suis pas majeur, mais je le serai dans cinq mois et trois jours et je serai libre alors de disposer de l’héritage de ma mère. De plus, mon père est vieux, infirme ; peut-être, en s’y prenant bien, arriverait-on à le faire interdire.
« Dois-je faire prévenir la couturière ?
« Pendant cinq jours, à partir d’aujourd’hui, j’irai, de quatre à six, attendre en voiture votre décision, au coin de la place du Petit-Pont.
« Gaston de Gandelu. »
Cette lettre abominable, honteuse, ridicule, bien digne d’un de ces jeunes drôles que le mépris public a baptisés du nom de « petits crevés », ne semblait nullement révolter Rose. Bien plus, cette prose idiote l’enivrait et lui paraissait la plus délicieuse musique.
– Si j’osais ! murmurait-elle frémissante de convoitise, si j’osais !…
Elle restait pensive, le front appuyé sur sa main, quand un pas jeune et leste fit craquer le frêle escalier.
– Lui, fit-elle, effrayée, Paul !…
Et d’un mouvement effarouché, rapide et précis comme celui d’une chatte, elle fit disparaître la lettre dans la fente du mur.
Il était temps, Paul Violaine entrait.
C’était un tout jeune homme de vingt-trois ans à peine, svelte, admirablement pris dans sa taille.
Son visage, du plus pur ovale, avait la pâleur unie et mate des races du Midi. Une moustache fine et soyeuse estompait sa lèvre, un peu épaisse, juste assez pour donner à sa physionomie un caractère viril. Ses cheveux blonds bouclés naturellement autour d’un front intelligent et fier, faisaient ressortir l’étrange vivacité de ses grands yeux noirs.
Sa beauté, plus saisissante que celle de Rose, était encore rehaussée par cette distinction innée qui, sans être précisément le privilège des héritiers des grandes maisons, ne saurait s’acquérir.
La Loupias a toujours prétendu que son locataire des mansardes lui imposait beaucoup et lui faisait l’effet d’un prince déguisé.
Pauvre prince en ce moment !
Ses vêtements, en dépit d’une propreté miraculeuse, décelaient la misère, non celle qui s’étale et sans vergogne vit de la pitié, mais celle bien autrement cruelle qui rougit d’un regard de commisération, qui se tait et se cache.
Il portait, par cette température sibérienne, un pantalon, un gilet et un habit de drap noir, élimé par la brosse, mince à donner le frisson. Il avait encore, il est vrai, un léger pardessus d’été de couleur claire, presque aussi épais que le tissu d’une forte araignée. Ses souliers étaient supérieurement cirés, mais ils accusaient des courses désespérées après la fortune.
Paul, à son entrée, avait sous le bras un rouleau de papier qu’il déposa, qu’il laissa tomber plutôt, sur le grabat.
– Rien ! fit-il, d’un ton d’affreux découragement, encore rien !…
La jeune femme, oubliant ses cartes sur le tapis, s’était redressée. Sa figure, tout à l’heure encore souriante, avait pris une expression de morne lassitude.
– Quoi ! répondit-elle, simulant une surprise que certes elle n’éprouvait pas, quoi ! rien… après ce que tu m’avais dit en partant ce matin !
– Ce matin, Rose, j’espérais. Je croyais, je t’ai dit de croire. On m’a trompé, ou plutôt je me suis trompé moi-même. J’avais pris des assurances en l’air pour des promesses sincères. Ici les gens n’ont même pas la charité de vous dire : « Non. » Ils vous écoutent d’un air d’intérêt ; ils se mettent à votre disposition ; la main tournée, ils ne pensent plus à vous. Des protestations banales ! Voilà la seule monnaie qu’ait cette ville maudite au service des malheureux.
Il y eut un long silence. Paul était trop profondément absorbé pour remarquer de quel air de mépris Rose le considérait, elle semblait indignée au spectacle de cette consternation résignée.
– Nous voilà dans une belle position ! dit-elle enfin. Qu’allons-nous devenir ?
– Eh ! le sais-je moi-même ?
– Alors, c’est fini. Hier, en ton absence, je n’avais pas voulu te le dire pour ne point te troubler inutilement, la Loupias est montée me réclamer les onze francs de la quinzaine échue. Si d’ici trois jours elle n’a pas son argent, elle nous mettra dehors ; elle me l’a dit, elle le fera, je la connais… Oui, elle le fera, quand ce ne serait que pour avoir la jouissance de me voir sur le pavé, car elle me hait, l’affreuse grêlée !
– Être seul au monde, murmurait Paul, isolé, perdu, n’avoir pas un parent, pas un ami, personne !…
– Nous ne possédons plus un centime, poursuivait Rose avec une persistance féroce, j’ai vendu la semaine passée mes dernières nippes, nous n’avons plus de bois, enfin nous n’avons pas mangé depuis hier matin.
À ces objections formulées comme des reproches poignants, le malheureux jeune homme étreignait son front de ses mains crispées, comme s’il eût espéré en faire jaillir une idée de salut.
– Voilà le tableau !… continuait l’imperturbable Rose. Moi, je dis qu’il serait bon de trouver un moyen, un expédient, quelque chose, n’importe quoi.
Brusquement, Paul se débarrassa de son léger pardessus et le jeta sur une des chaises :
– Tiens, porte cela au mont-de-piété.
La jeune femme ne bougea pas.
– C’est tout ce que tu trouves pour nous tirer d’affaire ? interrogea-t-elle.
– On te prêtera bien trois francs ; ce sera toujours de quoi acheter du bois et du pain.
– Et après ?
– Après !… nous verrons, je réfléchirai, je chercherai. Qu’est-ce que je veux ? gagner du temps. Je finirai bien par briser le cercle fatal qui m’étreint. Le succès me viendra, et avec le succès la fortune. Mais il faut savoir attendre.
– Il faut pouvoir.
– N’importe… fais toujours ce que je te dis, et demain…
Moins troublé, Paul eût bien reconnu à la contenance de Rose qu’elle était résolue à le pousser à bout.
– Demain !… fit-elle avec une ironie de plus en plus accentuée, toujours demain !… Voici des mois que nous vivons sur ce mot. Tiens, Paul, tu n’es qu’un enfant, et il faut que tu aies enfin le courage de regarder la vérité en face. Que me prêtera-t-on sur ce vêtement usé ? Trois francs… si on me les prête. Combien de jours vivrons-nous avec ces trois francs ? Mettons trois jours. Et ensuite ? Déjà, ne le comprends-tu pas ? tu es trop pauvrement vêtu pour être bien reçu. Seuls, les solliciteurs élégants sont favorablement écoutés. Pour obtenir une chose, il faut surtout avoir l’air de n’en pas avoir besoin. Où iras-tu quand tu n’auras que ton habit ? Tu seras ridicule ; tu n’oseras plus sortir.
– Tais-toi, interrompit Paul, je t’en prie, tais-toi. Hélas ! je ne le vois que trop clairement, à cette heure, tu es comme les autres, comme tout le monde : ne pas réussir te semble un crime. Autrefois, tu avais confiance en moi, tu ne parlais pas ainsi.
– Autrefois, je ne savais pas.
– Non, Rose, non, mais tu m’aimais. Mon Dieu ! n’ai-je donc pas tout essayé, tout tenté !… Je suis allé de porte en porte offrir mes compositions, ces mélodies que tu chantais si bien, j’ai demandé des leçons à tous les échos de Paris. Qu’aurais-tu fait de plus, à ma place ? parle, réponds…
Paul s’animait par degrés. Rose, au contraire, affectait une irritante nonchalance.
– Je ne sais, répondit telle enfin, pourtant il me semble que si j’étais homme, je ne laisserais jamais manquer du nécessaire la femme que je prétendais aimer, non, jamais. J’irais, je travaillerais…
– Je ne suis pas un ouvrier, malheureusement, je n’ai pas d’état.
– Moi, j’en apprendrais un. Combien gagne-t-on par jour à servir les maçons ? C’est peut-être pénible, ce n’est pas, ce me semble, bien difficile. Tu as, à ce que tu prétends, un rare talent ? Je ne dis pas non. Mais si j’étais un grand compositeur et s’il n’y avait pas de pain chez moi, j’irais, sans hésiter, jouer dans les rues et dans les cafés, je chanterais dans les cours. Enfin, j’aurais de l’argent quand même, n’importe comment, n’importe d’où, à tout prix, quand je devrais…
– Tu oublies que je suis un honnête homme, Rose !
– Vraiment ! ne dirait-on pas que je te propose une mauvaise action ! Ta réponse, Paul, est celle de tous ceux qui, faute d’adresse ou d’énergie, restent en chemin. On va vêtu comme un mendiant, le ventre vide, crevant de jalousie, mais on se redresse pour dire : Je suis honnête. Comme si on ne pouvait absolument être riche ou faire fortune sans être le dernier des coquins. C’est trop bête, à la fin !
Elle parlait d’une voix vibrante, et une infernale hardiesse étincelait dans ses yeux. C’était bien là une de ces créatures redoutables, énergiques surtout pour le mal, qui peuvent conduire un homme faible sur le bord de l’abîme, l’y pousser et l’oublier avant même qu’il ait roulé jusqu’au fond.
Sous le fouet de ses sarcasmes, la nature violente de Paul se réveillait ; la colère empourprait ses joues.
– Que ne m’aides-tu toi-même, s’écria-t-il, que ne travailles-tu !
– Oh !… moi… c’est autre chose, je ne suis pas faite pour travailler.
Paul eut un geste terrible, il marcha la main levée sur la jeune femme.
– Malheureuse, disait-il, tu n’es qu’une malheureuse !
– Non… j’ai faim !
Une querelle arrivée à ce point devait finir mal, lorsqu’un bruit assez fort attira l’attention des jeunes gens ; ils se retournèrent.
La porte de la mansarde était ouverte, et sur le seuil se tenait, debout, un vieux homme qui les regardait avec un sourire paternel.
Il était grand et légèrement voûté. De son visage, on ne découvrait que les pommettes couleur brique et le nez rouge ; une barbe grisonnante, longue, épaisse, inculte, cachait le reste. Il portait des lunettes de pacotille à verres teintés, mais il avait eu le soin d’entourer d’un ruban noir la monture de fer.
En lui, tout respirait la misère et l’incurie à leur apogée. Son paletot, à larges poches éraillées, informe, graisseux, portait les traces de toutes les murailles essuyées à boire. Il devait être un de ces cyniques nomades qui, jugeant fastidieux de quitter les vêtements pour dormir, couchent tout habillés, à terre ou sur leur grabat.
Ce vieux, Paul et Rose le connaissaient bien. Ils l’avaient déjà rencontré dans les escaliers, et savaient qu’il habitait le taudis voisin et qu’on l’appelait le père Tantaine.
Sa vue rappela à Paul que d’une mansarde à l’autre on distinguait les moindres paroles, et cette idée qu’on l’avait écouté l’exaspéra.
– Que voulez-vous, monsieur, demanda-t-il brutalement, et qui vous a permis d’entrer chez moi sans frapper ?
Cette question, adressée d’un ton presque menaçant, ne sembla ni fâcher ni déconcerter le vieil homme.
– Je mentirais, répondit-il, si je n’avouais pas que me trouvant par hasard chez moi, et vous entendant causer de vos petites affaires, j’ai prêté l’oreille.
– Monsieur !…
– Attendez donc, bouillante jeunesse !… Vous en êtes vite venus à une querelle, et, par ma foi ! cela s’explique. Quand il n’y a rien dans le râtelier, les chevaux les plus jolis, les mieux élevés, se battent, je connais ça, moi !
Il parlait de l’air le plus bénin, sans paraître avoir conscience de son indiscrétion.
– Eh bien ! monsieur, fit Paul, profondément humilié, vous savez au juste, maintenant, jusqu’où la pauvreté peut faire descendre un homme de cœur. Êtes-vous satisfait ?…
– Allons, bon ! reprit le vieux, voilà que vous vous fâchez. Si je suis venu, sans dire gare, c’est qu’à mon avis des voisins se doivent aide et secours, surtout des voisins logés à notre enseigne. Quand j’ai été au courant de vos petits chagrins, je me suis dit : Voici de jolis enfants que je veux tirer de peine.
Cette déclaration, cette promesse d’assistance, dans la bouche d’un personnage de si piteuse apparence, avait quelque chose de si véritablement comique, que Rose ne put dissimuler un sourire.
Elle pensait que le vieux voisin allait tirer son porte-monnaie et offrir la moitié de sa fortune, une pièce de vingt sous ou de quarante, pour le moins.
Paul eut une idée pareille ; mais il fut touché, lui, de cette obligeance si simple et si belle, sachant que l’argent emprunte aux circonstances une prodigieuse valeur, et que l’unique franc qui nous assure pour deux jours le pain du pauvre est un million de fois plus précieux que le billet de mille francs du riche.
– Hélas ! monsieur, fit-il, visiblement radouci, que pouvez-vous pour nous ?
– Qui sait !
– Vous voyez à quel extrême dénuement nous sommes arrivés peu à peu. Tout nous manque. Ne sommes-nous pas perdus ?
Le père Tantaine leva les bras, comme pour prendre le ciel à témoin d’un blasphème.
– Perdus !… dit-il. Ah ! la perle cachée au fond de la mer et qui ignore sa valeur est perdue pareillement, si un pêcheur adroit ne la découvre. Les pêcheurs sont des malheureux qui ne portent pas de perles, mais ils en savent le prix et ils les confient à des joailliers…
Il acheva sa pensée par un petit rire discret dont le sens devait échapper à deux pauvres enfants qui avaient en germe tous les instincts mauvais, que poignaient toutes les convoitises, mais qui étaient ignorants et inexpérimentés.
– Enfin, monsieur, reprit Paul, je serais un sot orgueilleux si je n’acceptais pas vos offres généreuses.
– Parfait !… Cela étant, il va falloir tout d’abord descendre chercher un bon repas. Il faut aussi faire monter du bois : il fait un froid ici !… Ma vieille carcasse est à moitié gelée. Plus tard, nous songerons aux vêtements.
– Tout cela, soupira Rose, va nécessiter une grosse somme !
– Eh ! qui vous dit que je ne l’ai pas ?
Lentement, le père Tantaine déboutonna son paletot, et de la poche intérieure il retira un petit papier sale qui y était fixé au moyen d’une épingle.
Ce chiffon, il le déplia soigneusement et le déposa tout ouvert sur la table.
– Un billet de 500 francs ! exclama Rose stupéfaite.
– Juste !… ma belle demoiselle, répondit le vieux d’une voix triomphante.
Paul se taisait. Il eût vu un des barreaux de la chaise sur laquelle il s’appuyait bourgeonner tout à coup et donner des feuilles, qu’il n’eût pas été plus surpris.
Comment imaginer une telle somme cachée sous les haillons de ce vieux. D’où tenait-il ce billet ?
L’idée d’une action punissable, d’un vol, pour le moins était si naturelle et ressortait si nettement de la situation, qu’elle vint en même temps aux deux jeunes gens.
Ils échangèrent le regard le plus cruellement significatif, et Paul, décontenancé, rougit jusqu’aux oreilles.
Le bonhomme avait compris le soupçon.
– Oh ! fit-il, sans avoir aucunement l’air choqué, de vilaines pensées !… Il est vrai que les billets de cinq cents ne poussent pas spontanément dans des poches comme les miennes, mais celui-ci m’appartient légitimement.
Rose n’écoutait pas. Que lui importait l’explication ! Le billet était là, et cela lui suffisait. Elle l’avait pris, elle le maniait, comme si le contact du papier soyeux lui eût communiqué les plus délicates sensations.
– Il faut vous dire, continuait le père Tantaine, que je suis clerc d’huissier.
– Ah !…
– Oui, et cela doit vous flatter. Être obligé par un clerc d’huissier, voilà un triomphe ! Mais ce n’est pas tout. Je suis chargé, par diverses personnes, du recouvrement de créances litigieuses. De la sorte, j’ai parfois en compte des sommes assez importantes. Vous prêter cinq cents francs, pour un certain temps, ne peut donc pas me gêner.
Entre les suggestions de la nécessité et les résistances de sa conscience, Paul restait interdit, ému comme on l’est à l’instant d’un acte décisif, tout tremblant.
– Non, commença-t-il enfin, je ne saurais accepter ; mon devoir…
– Ah ! mon ami, interrompit Rose, ce n’est pas honnête ce que tu fais là. Ne vois-tu pas qu’en refusant tu chagrines monsieur ?
– Elle a parbleu raison ! s’écria le père Tantaine. Donc, c’est entendu. Allons, la belle enfant, descendez vite chercher les provisions, vite… il est plus de quatre heures.
Ce fut au tour de Rose de tressaillir et de rougir, comme si elle se fût sentie devinée par le vieux voisin.
– Quatre heures ! murmura-t-elle, pensant à la lettre.
Cependant, elle obéit vivement. Se posant devant la vieille glace, elle disposa presque gracieusement ses haillons, elle descendit, emportant le billet de banque.
– Belle personne… remarqua le père Tantaine, avec l’accent d’un connaisseur, très belle… Et quelle intelligence ! Ah ! si elle est bien conseillée, elle ira loin !…
Paul ne releva pas l’observation. Il recueillait ses idées en déroute. Maintenant qu’il n’était plus sous l’obsession du regard de Rose, la frayeur le prenait.
Il trouvait à la physionomie de ce soi-disant clerc d’huissier quelque chose de singulier et d’inquiétant.
Où a-t-on vu jamais des vieux de cette espèce jetant des 500 francs à la tête des gens ? Pour sûr, cette générosité devait cacher quelque mystère et lui, Paul, il allait peut-être se trouver compromis.
– Toutes réflexions faites, monsieur, reprit-il résolument, accepter de vous une telle somme ne serait pas délicat de ma part. Qui sait si je pourrai jamais m’acquitter.
– Bon ! voici que vous doutez de vous, maintenant. Ce n’est pas le moyen de réussir. Si vous avez échoué, jusqu’ici, c’est que l’expérience vous manquait. Désormais, vous saurez comment vous y prendre. La misère, mon enfant, forme les hommes, de même que la paille mûrit les nèfles. D’abord, moi, j’ai confiance en vous. Ces 500 francs, vous me les rendrez quand vous voudrez, je ne suis pas pressé, seulement vous me donnerez six pour cent, et vous allez me souscrire un billet.
– Comment cela, balbutia Paul…
– Conclu !… c’est un placement.
Paul n’était qu’un pauvre niais. Cette perspective de billet suffisait à le rassurer, comme si sa signature au bas d’un papier timbré eût pu servir à autre chose qu’à enlever à ce papier la valeur qu’il avait étant blanc.
De son côté, le père Tantaine, explorant de nouveau sa poche, en tirait une feuille de papier timbré qui s’y trouvait tout à point.
– Écrivez, dit-il : « Au huit juin prochain, je paierai, à l’ordre de M. Tantaine, etc.… »
Le jeune homme terminait le paraphe de sa signature lorsque Rose reparut, les bras chargés de provisions.
Elle était radieuse comme si un événement extraordinairement heureux fût survenu dans sa vie ; ses yeux avaient une expression étrange.
Mais Paul ne remarqua rien de cela. Il observait le vieux clerc d’huissier qui, après avoir relu le billet, le serrait aussi précieusement qu’une valeur de premier ordre.
– Il est bien entendu, monsieur, reprit-il enfin, que la date n’est qu’une formalité. Il n’est pas probable que d’ici quatre mois je puisse économiser ce que je vous dois.
Le père Tantaine eut un bon sourire.
– Que diriez-vous, prononça-t-il, si après vous avoir prêté ces 500 francs, je vous mettais à même de me les rendre avant un mois ?
– Quoi ! monsieur, vous pourriez !…
– Par moi-même, mon enfant, je ne puis rien, cela se voit. Mais j’ai un ami qui a le bras long. Ah ! si je l’avais écouté, autrefois, je ne serais pas à l’Hôtel du Pérou. Enfin !… Voulez-vous aller le trouver de ma part ?
– Si je le veux ! Mais je serais un fou de repousser cette occasion qui se présente.
– Eh bien ! je vais voir mon ami ce soir même, je lui parlerai de vous. Soyez chez lui demain à midi précis. Si vous lui plaisez, s’il s’occupe de vous, votre fortune est faite.
Il tira de sa poche une carte et la présentant à Paul, il ajouta :
– Mon ami se nomme Mascarot et voici son adresse.
Cependant Rose, avec cette merveilleuse dextérité qui semble être un privilège de la Parisienne, accoutumée à se mouvoir dans un petit espace, avait tiré l’ordre du chaos et terminé ses préparatifs.
La table était dressée, table digne du taudis avec ses tessons ébréchés et ses papiers en guise de plats ; un bon feu flambait dans la cheminée, et deux bougies éclairaient la scène, fichées, l’une dans le chandelier bossué de l’hôtel, l’autre dans une bouteille fêlée.
Ce spectacle superbe pour des yeux de vingt ans, remplissait Paul de satisfaction. Les affaires sérieuses étaient finies, les pressentiments sombres s’étaient envolés.
– À table !… s’écria-t-il, à table !… Voici enfin le dîner qui sera le déjeuner. Allons, Rose, à ton poste. Et vous, mon cher voisin, vous allez, je l’espère, nous faire le plaisir de partager le repas que nous vous devons.
Mais le père Tantaine, bien qu’un tel festin fût fait pour le tenter et le séduire, ainsi qu’il le confessa, s’excusa avec beaucoup de protestations et de regrets.
Il n’avait pas grand faim, assura-t-il, puis il avait pour cinq heures et demie un rendez-vous de la dernière importance à l’autre bout de Paris.
– Enfin, dit-il à Paul, il est indispensable que je vois Mascarot ce soir. Je dois le prévenir, le disposer en votre faveur.
Rose, assurément, ne tenait pas à la compagnie du bonhomme. Laid, malpropre, misérable, il lui inspirait un sentiment de dégoût dont ne triomphait pas la reconnaissance.
Puis, bien qu’on ne vît pas ses yeux, elle devinait instinctivement, sous les verres foncés de ses lunettes, un regard aigu et subtil, très capable de lire au fond de sa pensée.
Ce qui n’empêche que se faisant chatte et câline autant qu’il était en son pouvoir, elle joignit ses instances à celles de Paul pour garder leur ami.
Mais il fut inébranlable, et après avoir, une fois encore, rappelé à Paul qu’il devait être exact, le lendemain, à midi, il sortit en criant de sa meilleure voix, aux jeunes gens qui venaient de s’attabler :
– Au revoir ! bon appétit !
Seulement, une fois dehors, sur le palier, la porte refermée, le père Tantaine s’arrêta, s’appuyant à la rampe grossière, écoutant.
Les tourtereaux, comme il les appelait, étaient d’une gaieté folle, et les éclats de leurs voix jeunes et fraîches emplissaient le dernier étage de l’Hôtel du Pérou.
Pourquoi non ? Paul après des angoisses affreuses, trouvait une sécurité relative ; il avait en poche l’adresse d’un homme qui devait faire sa fortune ; enfin, sur le coin de la cheminée brillait la monnaie du billet de cinq cents francs, un de ces tas d’or qui, au temps des riantes illusions, semblent inépuisables.
Quant à Rose, elle ne pouvait cesser de s’égayer au sujet de ce vieux clerc d’huissier, qu’en dedans d’elle-même elle jugeait absolument idiot, et qu’elle trouvait du dernier grotesque.
– Courage, mes mignons, grommela le père Tantaine, courage ! Ce pourrait bien être la dernière fois que vous riez ensemble.
Cela dit, avec les plus louables précautions, il descendit le raboteux escalier de l’Hôtel du Pérou, que la Loupias n’éclaire que le dimanche, parce que le gaz, dame ! cela coûte de l’argent.
Le père Tantaine ne sortit pas directement.
Ayant, par la petite porte vitrée de la loge des propriétaires de l’hôtel, aperçu la Loupias qui cuisinait sur son poêle des ragoûts de son pays, il entra, après avoir gratté timidement, saluant bas, en homme que la misère a accoutumé à toutes les rebuffades.
– Je viens pour vous payer ma quinzaine, madame, annonça-t-il tout d’abord.
Et en même temps il déposait sur le coin de la commode une pièce de dix francs et une pièce de vingt sous.
Puis, pendant que Loupias, qui sait écrire, lui confectionnait un reçu, il se mit à parler de ses affaires, racontant comme quoi il venait de recueillir un héritage inattendu, qui allait lui donner l’aisance sur ses vieux jours.
À l’appui de ses assertions, avec le naïf orgueil de la pauvreté qui craint de n’être pas crue sur parole, il montrait plusieurs billets de banque renfermés dans un portefeuille.
Ces chiffons produisirent si bien leur effet que, lorsque le bonhomme se retira, Loupias voulut à toute force le reconduire, sa lampe d’une main, sa casquette de l’autre.
Le vieux clerc ne semblait d’ailleurs aucunement sensible à ces prévenances. Il allait d’un air préoccupé, en homme qui poursuit un plan.
Arrivé dans la rue, il s’orienta, examina les magasins des environs, et, sans hésiter, il marcha droit à la boutique d’un épicier qui fait presque le coin de la rue du Petit-Pont et de la rue de la Bûcherie.
Cet épicier, grâce à un certain vin que lui fabrique un chimiste de Bercy, et qu’il vend neuf sous le litre, jouit dans le quartier d’une vogue bien légitime.
Il est petit, gros, court, rouge, irritable, plein d’importance ; il porte des favoris à l’anglaise, est veuf, sergent de la garde nationale et répond au nom de Mélusin.
Cinq heures, dans les quartiers pauvres, c’est en hiver le moment du « coup de feu » pour les boutiquiers.
Les ouvriers reviennent de leur chantier et les femmes qui ont quitté leur travail à la nuit hâtent les préparatifs du souper.
M. Mélusin était donc si fort affairé au milieu de ses pratiques, recevant et rendant, surveillant, criant après ses garçons, qu’il ne remarqua pas l’entrée du père Tantaine.
L’eût-il remarqué, il ne se serait pas dérangé pour un acheteur aussi misérablement vêtu.
Mais le vieux clerc d’huissier avait en sortant de l’Hôtel du Pérou, quitté ses apparences humbles et bénignes. Se plaçant dans le coin le moins encombré de la boutique, c’est d’un ton impératif qu’il appela :
– Monsieur Mélusin !…
L’épicier, surpris, laissa tout pour accourir.
Tiens ! ce bonhomme qui me connaît, se disait-il, sans penser que son nom brille en lettres d’un demi-pied au-dessus de la devanture.
Le père Tantaine ne lui laissa pas le loisir de demander des explications.
– Monsieur, commença-t-il avec un bel accent d’autorité, n’est-il pas venu ici il n’y a qu’un moment une jeune femme qui a changé un billet de 500 francs ?
– Oui, monsieur, oui, répondit Mélusin, mais comment avez-vous pu savoir…
Il s’interrompit pour se donner sur la tête un grandissime coup de poing et reprit vivement :
– J’y suis !… un vol a été commis, n’est-il pas vrai, et vous êtes sur la piste du voleur. Connu !… Faut-il vous le dire ? Quand cette jeune fille qui avait l’extérieur d’une pauvresse a changé ce billet, j’ai conçu un soupçon. Je l’ai observée attentivement et j’ai remarqué que sa main tremblait.
– Excusez, interrompit le père Tantaine, je ne vous ai point dit qu’il s’agit d’un vol. Reconnaîtriez-vous cette jeune fille ?
– Comme moi-même, si je me rencontrais, oui, monsieur. Une créature superbe, avec des cheveux !… À telles enseignes que je l’avais distinguée déjà, car elle vient ici quelquefois, et j’ai de fortes raisons de croire qu’elle habite un hôtel borgne de la rue de la Huchette.
Le boutiquier parisien n’aime pas toujours les agents qui dressent contre lui des procès-verbaux lorsqu’il se trouve en contravention.
Cependant, encouragé par la pensée de rendre service à la société, il aide volontiers les investigations. Pour faciliter une capture importante, il est capable de traits héroïques, comme de manquer la vente, par exemple.
– Voulez-vous, continuait M. Mélusin, que j’envoie un de mes garçons aux informations, faut-il requérir des sergents de ville ?
– Inutile…, cher monsieur, répondit le vieux clerc d’huissier, et même, je vous serais obligé de me garder le secret jusqu’à nouvel ordre.
– Oh ! je comprends, une indiscrétion pourrait donner l’éveil.
– Juste ! Seulement, je vous demanderai, si vous avez conservé ce billet, la permission d’en prendre le numéro d’ordre. Je vous prierai aussi d’inscrire ce numéro sur vos livres, avec une petite mention, à la date d’aujourd’hui. Autant que possible il faut tout prévoir.
– Et mes livres feraient foi devant le tribunal, n’est-il pas vrai ? Je le crois bien, les livres d’un négociant !… Vous voyez que je suis au courant. Une minute et je suis à vous.
Tout se passa ainsi que l’avait souhaité le bonhomme et rapidement.
Du reste, M. Mélusin ne le laissa pas s’éloigner sans toutes sortes de politesses. Il le reconduisit jusque sur le seuil de sa boutique, et le suivit des yeux, convaincu qu’il venait de rendre un service éminent à un employé supérieur de la préfecture déguisé en mendiant.
Mais qu’importait au père Tantaine l’opinion qu’on pouvait avoir de lui !
Il avait gagné la place du Petit-Pont et paraissait y chercher quelqu’un. Déjà il en avait fait deux fois le tour, scrutant les coins sombres, lorsqu’il laissa échapper une exclamation de satisfaction ; il avait aperçu celui qu’il venait retrouver.
C’était un affreux garnement d’une vingtaine d’années, n’en paraissant guère que quinze ou seize, maigre, dégingandé, mal bâti.
Il se tenait posté à l’angle du quai Saint-Michel et du Petit-Pont, et effrontément demandait l’aumône, guettant de l’œil les sergents de ville, sans souci du réverbère qui l’éclairait en plein.
Du premier coup, on reconnaissait en lui l’œuvre malsaine de la civilisation des grandes villes, l’ancien gamin de Paris, qui, à huit ans, fumait les bouts de cigares ramassés à la porte des cafés et se grisait avec de l’eau-de-vie.
Ses cheveux, d’un jaune sale, étaient déjà rares, il avait le teint flétri et plombé, un rictus ironique contractait sa large bouche à lèvres plates, et la plus cynique audace flambait dans ses yeux.
Vêtu d’une blouse grisâtre, il en avait relevé la manche droite et exposait à nu un bras tordu, rabougri, contorsionné, hideux à point pour exciter la commisération des passants.
Il psalmodiait en même temps une légende monotone où sans cesse les mêmes mots revenaient : « Pauvre ouvrier… vieille mère à nourrir… incapable de travailler… estropié par une machine. »
Le père Tantaine marcha droit à ce bon pauvre, et, d’un vigoureux revers de main, appliqué sur la tête, fit sauter sa casquette à trois pas.
L’autre se retourna furieux ; mais, apercevant le bonhomme, il sembla fort penaud et murmura :
– Pincé !…
Aussitôt grâce à une brusque contraction de l’épaule, il détordit son bras, aussi droit et aussi sain que l’autre, en réalité, rabattit sa manche et ramassa sa casquette.
– C’est donc ainsi, reprit le père Tantaine, que tu exécutes les commissions dont on te charge !
– Quoi !… elle est faite depuis longtemps, votre commission !
– Ce n’est pas une excuse. Grâce à ma recommandation, M. Mascarot t’a procuré une bonne position, n’est-ce pas ? Je te fais assez souvent gagner de l’argent ; ainsi, tu ne manques de rien. Il était convenu que tu ne mendierais plus.
– Excusez, bourgeois, je n’en fais plus mon état. Seulement, dame ! il fallait bien tuer le temps en vous attendant. D’abord, c’est plus fort que moi, je ne peux pas rester sans rien faire. J’ai récolté sept sous. C’est toujours ça…
Toto-Chupin, prononça gravement le vieux clerc d’huissier, Toto-Chupin, vous finirez mal ; c’est moi qui vous le prédis. Mais arrivons au fait. Qu’as-tu vu ?
Ils avaient quitté le coin du pont et remontaient lentement le quai désert, le long des vieux bâtiments de l’Hôtel Dieu.
– J’ai vu bourgeois, ce que vous m’aviez annoncé, répondait le garnement. À quatre heures précises, une voiture est arrivée sur la place et s’y est arrêtée comme pour y prendre racines, tenez là-bas, en face de la boutique du perruquier. Voiture flambante, cheval superbe, cocher très bien mis !…
– Passe. Il y avait quelqu’un dans la voiture ?
– Naturellement. J’y ai reconnu le particulier que vous m’avez dit. Bien vêtu, ma foi ! Chapeau rogné, tout plat, pantalon clair, en fourreau de parapluie, veston court, oh ! mais d’un court… enfin, le dernier genre. Pour plus de sûreté, comme il faisait déjà sombre, je suis allé le regarder sous le nez. Il était descendu de voiture, vous m’entendez, et il battait la semelle sur le trottoir, avec un cigare non allumé aux dents. Moi, voyant le coup de temps, j’accours avec une allumette en disant : « Du feu, mon prince ! » Il m’a donné une pièce de dix sous. Autant de pris. C’était bien lui : laid, ratatiné, cagneux, une figure à gifles avec un pince-nez… un singe, quoi !
Quand Toto-Chupin raconte, le mieux est de le laisser aller. C’est au moins le plus court pour obtenir les renseignements qu’on désire.
Pourtant, le vieux clerc d’huissier s’impatienta.
– Qu’est-il arrivé ensuite ? demanda-t-il.
– Pas grand chose. Mon individu n’avait pas l’air content du tout, de faire le pied de grue. Pauvre ami !… Il allait de ci et de là, sur le trottoir, il faisait des moulinets avec sa badine et dévisageait les femmes. Dieu qu’il me déplaît, ce cocodès ! Si jamais il vous prend envie de lui repasser une bonne volée, bourgeois, je suis votre homme. Je l’ai toisé, il n’est pas moitié si fort que moi.
– Mais va donc Chupin, va donc.
– Bon, j’y suis ! Donc, il était là, c’est-à-dire, nous étions là, depuis une grande demi-heure, quand tout à coup une femme tourne la rue et vient droit au cocodès. Ah ! bourgeois, la belle fille ! Non, de votre vie, vous n’avez rien vu de si admirable. Moi, j’en suis resté ébloui. Mais quelle misère ! Il se sont mis à parler tout bas.
– Et tu n’as rien entendu ?
– Pour qui me prenez-vous, bourgeois ?… La belle fille a dit : « – C’est entendu, à demain. » Le cocodès a demandé : « – Bien vrai ? » Et elle a répondu : « – Oui, parole d’honneur, vers midi. » Là-dessus ils se sont quittés, elle a regagné la rue de la Huchette, lui est remonté dans sa voiture, et fouette cocher !… En voilà pour cent sous, bourgeois !
La réclamation ne parut nullement choquer le vieux clerc d’huissier.
Il tira de sa poche une pièce de cinq francs et la remit au précoce vaurien en disant :
– Chose promise, chose due. Mais souviens-toi de ma prédiction, Chupin, tu finiras mal. Sur quoi, bonsoir, nous ne suivons pas le même chemin.
Pendant un moment encore, le père Tantaine resta en place, observant Toto qui s’éloignait dans la direction du Jardin des Plantes, et c’est seulement lorsqu’il l’eût perdu de vue, qu’il revint sur ses pas et s’engagea sur le pont.
Il marchait fort vite et semblait aussi satisfait que possible.
Voilà qui va bien, murmurait-il, je n’ai pas perdu ma journée. J’ai tout prévu, même l’improbable. Flavie sera contente.
II
C’est rue Montorgueil, à quelques pas du passage de la Reine-de-Hongrie, qu’est situé l’établissement du puissant ami du père Tantaine, M. B. Mascarot.
B. Mascarot est directeur d’un bureau de placement pour employés et domestiques des deux sexes.
Deux grands tableaux, accrochés de chaque côté de la porte de la maison, apprennent aux intéressés les demandes et les offres de la journée, et annoncent aux passants que l’agence, fondée en 1844, est encore régie par son fondateur.
C’est sans nul doute à ce long exercice d’une profession ordinairement ingrate, que M. B. Mascarot doit sa réputation et la grande considération dont il jouit, non seulement dans son quartier, mais encore dans tout Paris.
Les maîtres, assure-t-on, n’ont jamais eu à se plaindre d’un serviteur garanti par lui.
Parmi les domestiques, il est avéré qu’il ne procure que des places où on a toutes les douceurs de la vie.
Les employés, enfin, savent très bien que, grâce à ses connaissances, grâce à ses nombreuses relations et ramifications partout, il a toujours un bon emploi au service de qui sait lui plaire.
B. Mascarot a d’autres titres à l’estime publique.
C’est lui qui, le premier, vers 1845, conçut le projet d’organiser en société les « gens de maison ». On s’est emparé depuis de son idée et de son programme, mais il n’a pas réclamé.
Il s’est consolé en prenant un associé, un sieur Beaumarchef, et en installant dans la maison même de son agence un hôtel garni où les domestiques sans place trouvent à crédit le logement et la nourriture.
Si ces diverses entreprises ont servi la société, elles ont aussi profité à B. Mascarot.
Il est propriétaire pour partie, – on dit pour un quart, – de la maison qu’il occupe.
Eh bien ! c’est devant cette maison, qu’à midi, l’heure convenue, était arrêté Paul Violaine.
Il avait utilisé les cinq cents francs de son vieux voisin, et un confectionneur lui avait improvisé une élégance qui n’était pas de trop mauvais goût.
Même, il était si bien, sous ses nouveaux vêtements, que les femmes qui passaient se retournaient pour le voir encore.
Lui n’y prenait garde. Il avait réfléchi depuis la veille, et maintenant, il se prenait à douter beaucoup du pouvoir de cet inconnu, qui, selon l’expression du père Tantaine, pour faire la fortune de quelqu’un n’avait qu’à le vouloir.
– Un placeur ! murmurait-il ; sûrement il va me proposer quelque emploi de cent francs par mois !
Cependant, il était un peu ému, et avant d’entrer il étudiait la maison, comme si elle eût pu lui apprendre quelque chose de celui qui l’habitait.
Elle ressemblait à toutes les autres, avec ses deux corps de logis séparés par une cour mal tenue.
Le bureau de placement et l’hôtel étaient au fond.
Sous la porte cochère, l’encombrant de ses ustensiles, était un marchand de marrons, un jeune drôle à l’air insolent.
– Allons, se dit Paul, rester ici ne m’avance à rien, il faut voir.
Il traversa donc résolument la cour, monta un escalier en face, et arrivé au premier étage, voyant sur une porte le mot : Bureaux, il frappa.
– Entrez ?… cria une grosse voix.
La porte n’était pas fermée, mais seulement maintenue par un poids glissant au bout d’une corde. Paul n’eut qu’à pousser.
La pièce où il pénétra ressemblait à tous les bureaux de placement de Paris.
Tout autour, régnait un large banc de chêne noirci et poli par l’usage. Au fond, se trouvait une manière de loge grillée, entourée d’un rideau de serge verte, que dans la clientèle on appelait le confessionnal.
Entre les deux fenêtres, sur une plaque de zinc, on lisait :
AVIS
L’INSCRIPTION EST PAYABLE D’AVANCE
Dans un des angles de la pièce, un monsieur était assis devant une grande table, et, tout en écrivant sur un énorme registre, il donnait audience à une femme debout.
– Monsieur Mascarot ? demanda Paul timidement.
– Que lui voulez-vous ? fit le monsieur sans saluer ; s’agit-il d’une affaire ? je le remplace ; désirez-vous vous faire inscrire ? nous avons en ce moment trois tenues de livres, une caisse, une correspondance, six emplois de ville. Vous avez de bonnes références ?…
On eût juré que le monsieur récitait le tableau des offres accrochées à la porte.
– Pardon, interrompit Paul, je voudrais parler à M. Mascarot lui-même ; je lui suis envoyé par un de ses amis.
Cette simple déclaration parut impressionner le monsieur. Il quitta son air rogue, et c’est presque poliment qu’il dit à Paul :
– Mon associé est en conférence, monsieur, mais il sera libre bientôt ; prenez la peine de vous asseoir.
Paul prit place sur le banc et, faute de mieux, se mit à examiner l’associé.
Grand, robuste, éclatant de santé, cet associé porte les cheveux courts et, sous un nez odieusement busqué, il étale une paire de moustaches farouches, longues, lustrées, cirées, terminées en pointe.
Ton, tenue, cheveux, moustaches, décèlent l’homme qui tient à ce que chacun sache bien qu’il a été militaire.
Il a servi, en effet, assure-t-il dans la cavalerie. C’est même au régiment qu’il a gagné le nom sous lequel il est connu : Beaumarchef, abréviation soldatesque de beau maréchal-des-logis-chef. Son vrai nom est Durand.
Il était jeune, en ce temps, il a plus de quarante-cinq ans, maintenant, ce qui ne l’empêche pas de jouir encore d’une réputation incontestable d’homme superbe.
Sa besogne, qui consistait à écrire des noms à la suite les uns des autres, ne l’empêchait nullement de répondre juste à la femme placée devant lui.
Cette cliente, qui, par sa mise, tenait le milieu entre la cuisinière et la marchande des Halles, était ce qu’à Paris on appelle une forte commère.
Elle ponctuait ses phrases de larges prises de tabac. Elle s’exprimait avec un accent alsacien des plus prononcés.
– Finissons-en, disait le sieur Beaumarchef ; voulez-vous réellement vous replacer ?
– Oui, là, vraiment.
– Vous en disiez autant, la dernière fois que vous êtes venue, il y a plus de six mois. On vous trouve une bonne condition, vous y entrez et paf !… le troisième jour vous rendez votre tablier, sans raison.
– Alors, je n’étais pas dans le besoin.
– Et à cette heure ?
C’est différent, je commence à voir la fin de mes économies.
M. Beaumarchef posa sa plume, et regardant finement la grosse femme comme s’il eût cherché la confirmation de quelque soupçon, il dit lentement :
– Vous aurez fait quelque folie !
Elle détourna la tête, et, sans répondre directement, se mit à se répandre en plaintes sur la dureté des temps, sur la ladrerie des maîtres, sur la rapacité des jeunes dames qui ne permettent plus à leurs cuisinières de faire danser l’anse du panier, se chargeant très bien elles-mêmes de ce soin.
Beaumarchef approuvait de la tête, exactement comme un quart d’heure plus tôt il donnait raison à une bourgeoise qui se plaignait amèrement de ses serviteurs. Son état d’intermédiaire exige cette diplomatie.
Cependant, la grosse femme avait fini. Elle sortit d’un porte-monnaie bien garni le prix de l’inscription, le posa sur la table, et dit :
– Allons, mon bon monsieur Beaumar, prenez mon nom. Caroline Schimel, et tâchez de me trouver une bonne maison. Mais rien que pour la cuisine, vous m’entendez. Je fais le marché moi-même, et je n’aime pas à avoir la patronne sur le dos.
– C’est bien ; on cherchera.
– Ah ! si vous me trouviez un homme veuf ! cela m’irait assez, ou bien encore une toute jeune femme avec un mari très vieux… Enfin, faites comme pour vous ; je repasserai après-demain.
Et, humant une prise de tabac plus forte que les autres, elle se retira.
Paul, qui avait écouté, était confondu et aussi humilié que possible. C’est grâce au père Tantaine, pourtant, qu’il se trouvait attendre en ce lieu en pareille compagnie. Et attendre quoi ?…
Déjà il cherchait un prétexte honnête pour s’éloigner, résolu à ne plus revenir, quand la porte du fond s’ouvrit, donnant passage à deux hommes qui, sur le point de se séparer, achevaient une conversation.
L’un, jeune, élégamment vêtu, avec cette mine suffisante et cette désinvolture facile que d’aucuns prennent pour le suprême bon ton. Plusieurs ordres étrangers illustraient sa boutonnière.
L’aspect de l’autre était celui d’un bon vieil avoué de petite ville. Il portait une chaude douillette de mérinos brun, avait aux pieds des chaussures fourrées, et gardait sur la tête une calotte de velours, brodée sûrement par une main bien chère. Sa barbe rude, soigneusement taillée, s’appuyait sur une épaisse cravate blanche, et la délicatesse de sa vue lui imposait des lunettes bleues.
– Ainsi, cher maître, disait le jeune homme, je puis espérer, n’est-ce pas ? Mon intérêt vous répond de moi. N’oubliez pas combien la situation est tendue !…
– Je vous l’ai dit, monsieur le marquis, répondait l’homme à cravate blanche, si j’étais le maître, ce serait : oui ; mais je dois consulter mes associés.
– Enfin, cher monsieur, conclut l’élégant, je compte sur vous.
Paul s’était levé, réconcilié avec la maison, à la vue de ce jeune homme si décoré. – L’autre, pensait-il qui a une si bonne figure et les dehors d’un homme de loi, doit être M. B. Mascarot.
Le marquis sortit, Paul allait se présenter, quand Beaumarchef, le devançant, vint se placer devant l’homme à la cravate blanche :
– Devinez, patron, lui dit-il respectueusement, qui je viens de voir ?
– Qui cela ? Parle.
– Caroline Schimel, vous savez…
– L’ancienne domestique de la duchesse de Champdoce ?
– Précisément.
M. Mascarot eut une exclamation de joie.
– Voilà un vrai bonheur ! s’écria-t-il ; où demeure-t-elle ?
Cette question, si naturelle, consterna Beaumarchef. Lui qui toujours, – oui, toujours, puisque c’était la consigne, demande l’adresse de ses clientes, il n’avait pas demandé celle de Caroline.
L’aveu de cet oubli fit bondir M. Mascarot, même il s’oublia jusqu’à lâcher un juron qui eût fait frémir un charretier.
– Sacrebleu ! criait-il, on n’est pas inepte et sot à ce point. Voici une fille que, depuis cinq mois, je cherche par tout Paris, tu le sais, le hasard nous la livre et tu la laisses échapper !
– Elle reviendra, patron, elle l’a dit ; elle ne voudra pas perdre l’argent de l’inscription.
– Eh ! elle se moque bien de dix sous ou de dix francs. Elle reviendra si c’est sa fantaisie, sinon… une fille qui boit, qui est à moitié folle…
Mais voici que Beaumarchef, enflammé d’un espoir soudain, avait pris son chapeau.
– Elle ne fait que partir, dit-il, je cours ; je suis capable de la rejoindre.
Il s’élançait, M. Mascarot le retint.
– Attends, fit-il, tu n’es pas le limier qu’il faut. Prends avec toi Toto-Chupin ; qu’il campe là ses marrons. Et si vous rattrapez cette coquine, ne lui parlez pas, mais qu’il la suive et qu’il ne la lâche plus. Je veux savoir heure par heure tout ce qu’elle fait !… tout, tu m’entends !…
Beaumarchef dehors, B. Mascarot continua à donner cours à sa mauvaise humeur.
– Être servi comme cela, disait-il, quelle misère ! Ah ! il faudrait pouvoir faire tout soi-même. Je m’épuise à étudier une énigme indéchiffrable, et cette ivrognesse en a certainement le mot !…
Il était bien évident pour Paul qu’il n’avait pas été aperçu. Honteux de son indiscrétion involontaire, il prit le parti de tousser.
M. Mascarot se retourna menaçant, terrible.
– Vous m’excuserez… commença Paul.
Mais déjà le placeur avait repris sa bonne et honnête figure.
– Ah ! j’y suis, fit-il, monsieur Paul Violaine, n’est-ce pas ?
Le jeune homme s’inclina.
– Eh bien ! reprit M. Mascarot, je suis à vous à la minute.
Il disparut vivement par la porte du fond, et Paul avait à peine eu le temps de se remettre qu’il s’entendit appeler.
– M. Paul !… Par ici, je vous prie, je n’ai pas de secrets pour vous !
Comparé à la pièce d’entrée, à l’agence proprement dite, le cabinet particulier de M. B. Mascarot est un séjour de délices et de splendeurs.
On voit que les carreaux des fenêtres sont lavés quelques fois, le papier vert de la tenture est propre, il y a un tapis à terre.
Aussi, combien de clients, parmi les meilleurs, peuvent se vanter d’avoir mis le pied dans ce sanctuaire ? Extraordinairement peu.
Les affaires courantes du matin, à l’heure de la halle, se brassent en public autour de la table de M. Beaumarchef. Les négociations qui exigent plus de précautions se traitent à voix basse, dans le crépuscule du « confessionnal ! »
Mais Paul, ignorant les usages de la maison, ne pouvait apprécier convenablement l’immensité de la faveur qui l’admettait lui, le nouveau venu, à l’intimité du laboratoire.
Lorsqu’il entra, B. Mascarot se chauffait à un bon feu de bois, assis dans un excellent fauteuil, le coude appuyé à son bureau.
Et quel bureau ! Un monde. C’était bien là le meuble de l’homme que harcèlent mille préoccupations diverses.
Les cartons et les registres s’y entassaient en montagnes. La tablette était couverte de quantité de petits carrés de papier très fort qu’on appelle des fiches, portant un nom en grosses lettres et au-dessous des notes et des indications d’une écriture menue et presque illisible.
D’un geste paternel, M. Mascarot daigna indiquer à Paul un siège en face de lui, et c’est de la voix la plus encourageante qu’il dit :
– Causons.
Non, en vérité, on ne feint pas, on ne saurait feindre les patriarcales apparences de B. Mascarot.
Sa physionomie calme, reposée, miroir d’une conscience pure, est bien de celles qui font dire d’un homme : « J’aimerais à lui confier ma fortune. »
En l’examinant ainsi, Paul subissait l’ascendant de l’honnêteté, et il se sentait porté vers lui comme la faiblesse vers la force.
Il s’expliquait l’enthousiasme du père Tantaine et il bénissait le hasard qui l’instant d’avant, l’avait empêché de s’esquiver.
– Nous disons donc, reprit M. Mascarot, que vos ressources actuelles sont insuffisantes, nulles même, et que vous êtes décidé à tout entreprendre pour vous assurer une position. Je vous répète là les propres expressions de ce pauvre diable de Tantaine.
– Il a été, monsieur, le fidèle interprète de mes sentiments.
– Très bien. Seulement, avant de parler du présent et de songer à l’avenir, nous allons, si vous le voulez bien, nous occuper du passé.
Paul eut un tressaillement très léger, que le placeur remarqua pourtant, car il ajouta :
– Vous excuserez l’indiscrétion, mais elle est nécessaire. J’ai ma responsabilité à mettre à couvert. Tantaine dit que vous êtes un charmant jeune homme, honnête, bien élevé. En vous voyant, je suis convaincu qu’il ne se trompe pas. Mais il me faut plus que des présomptions. Vous devez comprendre qu’avant de me porter votre garant, avant de répondre de vous à des personnes tierces…
– C’est trop juste, monsieur, interrompit Paul, aussi suis-je prêt à vous répondre, je n’ai rien à cacher.
Un fin sourire, que le jeune homme ne surprit pas, vint effleurer les lèvres de l’honorable placeur, et d’un geste qui lui était familier, il rajusta ses lunettes sur son nez.
– Merci de vos bonnes dispositions, fit-il. Quant à me cacher quelque chose, eh ! eh !… ce n’est peut-être pas aussi aisé que vous le supposez.
Il prit sur un coin de son bureau un petit paquet de fiches, les fit glisser sous son pouce comme un jeu de cartes, et poursuivit :
– Vous vous nommez Marie-Paul Violaine ?
Paul inclina la tête.
– Vous êtes né à Poitiers, rue des Vignes, le 5 janvier 1843 ; vous êtes, par conséquent, dans votre vingt-quatrième année.
– Oui, monsieur.
– Vous êtes un enfant naturel ?
La seconde question avait un peu surpris Paul, celle-ci le stupéfia.
– C’est vrai, monsieur, répondit sans essayer de cacher son étonnement. J’étais loin de supposer M. Tantaine si bien informé. Je reconnais que la cloison qui sépare nos chambres est plus mince encore que je ne croyais.
M. Mascarot ne sembla pas entendre l’épigramme adressée au vieux clerc d’huissier, il continuait à remuer ses carrés de papier et à les consulter.
Si Paul, moins naïf, se fût penché, il eut vu ses initiales P. V., en tête de chacune des fiches.
– Madame votre mère, reprit le digne placeur, a tenu, pendant les quinze dernières années de sa vie, un petit magasin de mercerie ?
– En effet.
– Que peut rapporter un petit commerce comme celui-là, à Poitiers ? Pas grand chose, n’est-il pas vrai ? Par bonheur, elle avait, en outre, pour l’aider à vivre et à vous élever, une pension annuelle de mille francs.
Cette fois, Paul bondit sur son fauteuil.
Ce secret, il était bien certain que le vieux locataire de l’Hôtel du Pérou n’avait pu le surprendre.
– Monsieur, balbutia-t-il, absolument abasourdi ; monsieur !… qui a pu vous révéler un fait dont je n’ai parlé à personne depuis que je suis à Paris, une circonstance de ma vie que Rose elle-même ignore ?
Le placeur haussa bonnement les épaules.
– Vous devez bien comprendre, répondit-il, qu’un homme de ma position est obligé à des moyens particuliers d’investigation. Eh ! sans cela, ne serais-je pas trompé quotidiennement, et, par contre, exposé à tromper les autres !…
Il n’y avait pas une heure que Paul avait passé le seuil de l’agence, mais déjà il savait à quoi s’en tenir sur les « moyens particuliers. »
Il se rappelait l’ordre donné au sieur Beaumarchef.
– D’ailleurs, poursuivait le placeur, si je suis curieux par état, je suis discret aussi. Ne craignez donc pas de me répondre franchement. Comment cette rente parvenait-elle à votre mère ?
– Tous les trois mois, par l’intermédiaire d’un notaire de Paris.
– Ah !… Connaissez-vous la personne qui les servait ?
– Aucunement.
Cependant Paul commençait à s’inquiéter de cet interrogatoire. Mille appréhensions vagues et inexpliquées tressaillaient en lui.
Il avait beau chercher, il ne voyait ni le but, ni la portée, ni l’utilité de toutes ces questions.
Puis l’explication qui lui avait été donnée ne lui paraissait pas claire. On a beau disposer de moyens puissants, ce n’est pas en une matinée qu’on recueille des notions précises à ce point sur la vie d’un homme.
Et, cependant, rien dans l’attitude du digne placeur ne justifiait les craintes du jeune homme.
Il semblait ne questionner ainsi que par habitude, avec l’insouciance de l’homme qui remplit les formalités de son état, sans conscience de son horrible indiscrétion.
Ce n’est qu’après un assez long silence qu’il reprit la parole :
– Je suis là que je réfléchis, dit-il, et je vois que, selon toute probabilité, c’est votre père qui servait cette rente.
– Non, monsieur, non.
– Qui vous l’a affirmé ?
– Ma mère, monsieur, qui me l’a juré sur son salut, et c’était une sainte. Pauvre mère !… je l’aimais et je la respectais trop pour lui parler de ces choses. Une fois, pourtant, poussé par je ne sais quelle misérable curiosité, j’ai osé la questionner, lui demander le nom de notre protecteur. Ses larmes m’ont cruellement fait sentir l’ignominie de ma conduite. Ce nom, je ne l’ai jamais su, mais je sais que mon père est mort avant ma naissance.
M. Mascarot ne voulut pas remarquer l’émotion de son jeune client.
– Comme cela, fit-il, la pension ne vous a pas été continuée après la mort de madame votre mère ?
– Cette pension, monsieur, ne nous était plus servie depuis ma majorité. Ma mère à cet égard était prévenue. Il me semble que c’est hier qu’elle m’a appris cette nouvelle. Un soir, et comme c’était l’anniversaire de ma naissance, elle avait préparé un repas meilleur que de coutume. Car elle fêtait ma venue au monde, qu’elle eût dû maudire. Pauvre mère !… « Paul, me dit-elle, lorsque tu es né, un ami généreux m’a promis qu’il m’aiderait à t’élever. Il a tenu sa parole, tu as vingt et un ans, nous ne devons plus rien espérer de lui. Te voici un homme, mon fils, tu ne dois plus compter, je ne dois plus compter que sur toi. Travaille, sois honnête, et si jamais un devoir te paraît pénible, souviens-toi que ta naissance t’impose double obligation !… »
Paul s’interrompit, l’émotion le gagnait, deux larmes chaudes roulèrent le long de ses joues.
– Dix-huit mois plus tard, reprit-il, ma mère mourait subitement, sans avoir eu le temps de se reconnaître… Désormais, j’étais seul au monde, sans famille, sans amis. Oh ! oui, je suis bien seul. Je puis mourir, il n’y aura personne derrière mon corbillard. Je puis disparaître, nul ne s’inquiètera, car nul ne sait que j’existe.
La physionomie de M. Mascarot était devenue sérieuse.
– Eh bien ! je crois que vous vous trompez, monsieur Violaine, je crois que vous avez un ami…
M. Mascarot s’était levé, comme s’il eût voulu dissimuler une émotion dont il n’était pas le maître, et il arpentait son cabinet de long en long, tracassant son beau bonnet de velours, ce qui chez lui est l’indice manifeste de sérieuses délibérations intérieures.
Ce n’est qu’après un bon moment de cet exercice que, sa résolution prise, il s’arrêta brusquement, les bras croisés devant son jeune client.
– Vous m’avez entendu, mon jeune ami, prononça-t-il. Je ne poursuivrai pas un interrogatoire qui a dû vous blesser…
– Je pensais, monsieur, répondit Paul diplomatiquement, que mon seul intérêt vous dictait toutes ces questions.
– C’est vrai. Je voulais vous éprouver, juger votre franchise ; je puis bien vous l’avouer. Pourquoi ? Vous le saurez plus tard. Dès à présent, soyez bien persuadé que je n’ignore rien de ce qui vous concerne. Ah ! vous vous demandez comment ? Permettez-moi de ne pas vous le dire. Admettez une intervention miraculeuse du hasard. Le hasard ! cela répond à tout.
Jusqu’alors, Paul n’avait été que fort intrigué. Ces paroles ambiguës lui causaient un véritable effroi que trahit aussitôt sa mobile physionomie.
– Allons, bon ! fit le digne placeur en redressant ses lunettes à travers lesquelles il voyait merveilleusement, voici que vous vous épouvantez.
– Il est vrai, monsieur, balbutia Paul.
– Pourquoi ! Je me demande vainement ce que peut craindre un homme dans votre position. Allons, cessez de vous creuser la cervelle, vous ne devinerez pas, et abandonnez-vous à moi, qui ne veux que votre bien.
Il dit cela du ton le plus doux et le plus rassurant, et regagnant son fauteuil, il continua :
– Arrivons à vous. Grâce au dévouement de votre mère, qui était, vous l’avez dit justement, une sainte et digne femme, au prix d’héroïques privations, vous avez pu faire vos études au lycée de Poitiers, ni plus ni moins qu’un fils de famille. À dix-huit ans, vous avez été reçu bachelier. Pendant un an, sous prétexte d’attendre une inspiration du ciel, vous avez flâné ; enfin, en désespoir de cause, vous êtes entré en qualité de clerc chez un avoué ?
– C’est parfaitement exact.
– Le rêve de votre mère était de vous voir établi aux environs, à Loudun ou à Civray. Peut-être comptait-elle, pour payer une charge, sur l’aide de l’ami qui l’avait si noblement assistée.
– Je l’ai toujours pensé.
– Malheureusement, le papier timbré ne vous plaisait pas.
À ce souvenir, Paul en put retenir un sourire qui déplut à M. Mascarot, car il ajouta avec une certaine sévérité :
– Je dis malheureusement, et vous avez assez souffert pour être de mon avis. Au lieu de grossoyer à l’étude, que faisiez-vous ? Vous vous occupiez de musique, vous composiez des romances et même des opéras ; vous n’étiez pas fort éloigné de vous croire un génie de premier ordre.
Paul, qui jusqu’alors avait tout subi sans trop se révolter, atteint en plein cœur par ce sarcasme, essaya de protester, en vain.
– En somme, poursuivit le placeur, un beau matin vous avez abandonné l’étude, et vous avez déclaré à votre mère qu’en attendant d’être un illustre compositeur, vous vouliez donner des leçons de piano. Vous n’en avez pas trouvé, et même vous étiez assez naïf d’en chercher. Faites-moi le plaisir de vous regarder, et dites-moi si vous avez la figure et la tournure d’un professeur à placer près de jeunes demoiselles.
Craignant sans doute quelque trahison de sa mémoire, M. Mascarot s’arrêta pour consulter ses fiches.
– Finissons, reprit-il. Votre départ de Poitiers a été votre dernière folie et la plus grande. Le lendemain même de la mort de votre mère, vous vous êtes occupé de réaliser tout ce qu’elle possédait, vous avez recueilli un millier d’écus, et vous avez repris le chemin de fer.
– C’est qu’alors, monsieur, j’espérais…
– Quoi ? Arriver à la fortune par le chemin de la gloire. Fou ! Tous les ans, mille pauvres garçons qu’ont enivrés les louanges de leur sous-préfecture arrivent à Paris enfiévrés d’un pareil espoir. Savez-vous ce qu’ils deviennent ? Au bout de dix ans, dix au plus ont, tant bien que mal, fait leur chemin, cinq cents sont morts de misère, de rage et de faim, les autres sont enrôlés dans le régiment des déclassés.
Tout cela, Paul se l’était dit, il avait mesuré ce qu’il faut au juste d’énergie pour vouloir chaque matin, en s’éveillant, ce qu’on voulait la veille, et cela durant des années. Ne trouvant rien à répondre, il baissait la tête.
– Si encore, disait M. Mascarot, si encore vous étiez venu seul ? Mais non. Vous vous étiez épris à Poitiers d’une jeune ouvrière, une certaine Rose Pigoreau, vous n’avez rien trouvé de plus sage que de l’enlever.
– Eh ! monsieur, si je vous expliquais…
– Inutile ! les résultats sont là. En six mois les trois milles francs ont été flambés, puis la gêne est venue, puis la détresse, puis la faim… et en dernier lieu, échoué à l’Hôtel du Pérou, vous pensiez au suicide quand vous avez rencontré mon vieux Tantaine.
Ces vérités étaient cruelles à entendre, et Paul avait une furieuse envie de se fâcher. Mais alors, adieu la protection du puissant placeur. Il se contint.
– Soit, monsieur, fit-il amèrement, j’ai été fou, la misère m’a rendu sage. Si je suis ici, c’est que j’ai renoncé à toutes mes chimères.
– Renoncez-vous aussi à Mlle Pigoreau ?
Le jeune homme, à cette question ainsi posée, pâlit de colère.
– J’aime Rose, monsieur, répondit-il d’un ton sec, je croyais vous l’avoir dit. Elle a eu foi en moi, elle partage courageusement ma mauvaise fortune, je suis sûr de son affection !… Rose sera ma femme, monsieur !
Lentement, M. Mascarot retira son superbe bonnet grec, et de l’air le plus sérieux, sans la moindre nuance d’ironie, il s’inclina très bas en disant :
– Excusez !…
Mais il ne pouvait entrer dans ses intentions d’insister sur ce sujet :
– Voici donc, reprit-il, votre bilan établi. Il vous faut un emploi, et vite. Que savez-vous faire ? Peu de choses, n’est-ce pas ? Vous êtes comme tous les jeunes gens élevés dans les lycées, apte à tout et propre à rien. Si j’avais un fils, eussé-je cent mille livres de rentes, il apprendrait un métier.
Paul se mordait les lèvres, ne reconnaissant que trop la justesse de l’appréciation. N’avait-il pas, la veille, souhaité le sort de ceux qui peuvent gagner leur vie avec leurs bras ?
– Et cependant, disait le placeur, il faut que je vous case. Je suis votre ami et mes amis ne restent jamais en route. Voyons, que diriez-vous d’une situation d’une douzaine de mille francs par an ?
Ce chiffre, comparé aux plus audacieuses espérances de Paul, était encore si fabuleux, qu’il pensa que le placeur s’amusait de son inexpérience.
– Il est peu généreux à vous de me railler, monsieur, fit-il.
Mais B. Mascarot ne raillait pas.
Seulement, il lui fallut un bon quart d’heure pour prouver à son jeune client que, de sa vie, il n’avait parlé plus sérieusement d’une affaire sérieuse.
Très probablement il eût perdu ses frais d’éloquence, si, à bout de raisons, il ne lui était venu à la pensée de dire :
– Pour me croire, vous exigez des preuves… Voulez-vous que je vous avance votre premier mois ?
Et il tendit un billet de mille francs qu’il avait pris dans le tiroir de son bureau.
Paul repoussa le billet, mais force lui était de se rendre devant ce puissant argument. Alors, pris d’anxiétés terribles, il demandait si cet emploi si magnifique, si inespéré, il serait capable de le remplir.
– Eh !… vous le proposerais-je s’il était au-dessus de vos moyens ? répondait le digne placeur. Je vous connais, n’est-ce pas ? Si je n’étais très pressé, je vous expliquerais sur-le-champ la nature de vos fonctions… Ce sera pour demain. Soyez ici, comme aujourd’hui, entre midi et une heure.
Si bouleversé que fût Paul, il comprit qu’en restant il serait importun, et il se leva.
– Un mot encore, fit le placeur. Vous ne pouvez rester à l’Hôtel du Pérou. Cherchez-vous immédiatement une chambre dans ce quartier, et, dès que vous l’aurez trouvée, apportez-moi l’adresse. Allons, à demain, et soyons forts et sachons porter la prospérité.
Pendant près d’une minute encore, M. Mascarot resta debout près de son bureau, prêtant l’oreille, étudiant le bruit des pas de Paul, qui s’éloignait chancelant sous le poids de tant d’émotions diverses.
Lorsqu’il fut bien certain qu’il avait quitté l’appartement, il courut à une porte vitrée qui donnait dans sa chambre, et l’ouvrit en disant :
– Hortebize !… docteur !… tu peux venir, il est parti.
Un homme aussitôt entra vivement et alla se jeter dans un fauteuil, près du feu.
– Brrr ! disait-il, j’ai les pieds engourdis. On me les couperait que je ne les sentirais pas. C’est une glacière, ta chambre, ami Baptistin. Une autre fois, tu me feras faire du feu, hein ?
Mais rien ne peut détourner M. Mascarot du but de ses pensées.
– Tu as tout entendu ? demanda-t-il.
– J’entendais et je voyais comme toi-même.
– Eh bien ! que penses-tu du sujet ?
– Je pense que Tantaine est un homme très fort et qu’entre tes mains ce joli garçon ira loin.
III
Le docteur Hortebize, cet intime de « l’agence », qui appelait ainsi familièrement M. Mascarot par son prénom : Baptistin, a bel et bien cinquante-six ans sonnés.
Il n’en avoue que quarante-neuf et n’a pas tort. C’est à peine si on les lui donnerait, tant il porte lestement son embonpoint de chanoine, tant ses grosses lèvres sensuelles sont fraîches encore, tant il a les cheveux noirs, l’œil vif et sain.
Homme du monde, et du meilleur monde, souple, élégant, spirituel, voilant sous une ironie du meilleur goût un monstrueux cynisme, il est très entouré, très recherché, très fêté.
Cela tient à ce qu’il n’a pas de défauts, mais seulement quelques bons gros vices qu’il étale avec un sans-gêne absolu.
Ces dehors d’épicurien cachent, assure-t-on, un médecin distingué, un savant.
Ce qui est sûr, c’est que n’étant pas ce qui s’appelle un travailleur, il exerce le moins qu’il peut.
Même, il y a quelques années, voulant, à ce qu’il a prétendu, dégoûter de lui sa clientèle qui devenait importante, un beau matin il s’improvisa homéopathe et fonda un journal médical : le Globule, qui eut cinq numéros.
Cette conversion pouvait prêter à rire ; il en a ri le premier, prouvant ainsi la sincérité de la philosophie qu’il professe.
De sa vie, le docteur Hortebize n’a rien pu ou voulu prendre au sérieux.
En ce moment même, M. Mascarot, qui cependant le connaît bien, semble déconcerté et blessé de son ton léger.
– Si je t’ai écrit de venir ce matin, dit-il d’un ton mécontent, si je t’ai prié de te cacher dans ma chambre…
– Où j’ai failli geler.
– … c’est que je tenais à avoir ton avis. Nous engageons une grosse partie, Hortebize, une partie terriblement périlleuse, et tu es de moitié dans le jeu.
– Bast !… j’ai en toi, tu le sais bien, une confiance aveugle. Ce que tu feras sera bien fait. Tu n’es pas homme à te risquer sans atouts.
– C’est vrai, mais je puis perdre, et alors…
Le docteur interrompit son ami en agitant gaiement un gros médaillon d’or suspendu à la chaîne de sa montre.
Ce geste sembla particulièrement désagréable au placeur.
– Quand tu me montreras ta breloque ! fit-il. Voici vingt-cinq ans que nous la connaissons. Que veux-tu dire ? qu’il y a dedans de quoi t’empoisonner en cas de malheur ! C’est une louable prévoyance, mais mieux vaut tâcher de la rendre inutile en me donnant un bon conseil.
Le souriant docteur avait pris la pose ennuyée du marquis de Moncade écoutant les comptes de son intendant.
– Si tu tenais tant, dit-il, à une consultation, il fallait mander à ma place notre honorable ami Catenac ; il connaît les affaires, lui, il est avocat.
Ce nom de Catenac irrita tellement M. Mascarot, que lui, l’homme calme et contenu par excellence, il arracha son magnifique bonnet grec et le lança violemment contre la tablette de son bureau.
– Est-ce sérieusement, Hortebize, demanda-t-il, que tu me dis cela ?
– Pourquoi non ?
L’honnête placeur souleva ses lunettes, comme si, avec ses yeux seuls, il eût pu lire plus sûrement jusqu’au fond de la pensée de son interlocuteur.
– Parce que, fit-il en appuyant sur chaque syllabe de chaque mot, parce que tu es comme moi, docteur, tu te défies de Catenac. Combien y a-t-il de temps que tu l’as vu ? Voici plus de deux mois qu’il n’est venu chez Martin-Rigal.
– Il est de fait que ses façons sont au moins singulières, de la part d’un associé, d’un ancien camarade.
M. Mascarot eut un sourire si mauvais, que certainement il eût donné beaucoup à réfléchir au Catenac en question, s’il lui eût été permis de le voir.
– Ajoute, fit-il, que sa conduite est sans excuses de la part d’un homme dont nous avons fait la fortune. Car il est riche, notre ami, très riche, quoiqu’il prétende le contraire.
– Vraiment, tu crois ?…
– S’il était ici, je lui prouverais qu’il a plus d’un million à lui.
Les yeux de l’aimable docteur pétillèrent.
– Un million !… murmura-t-il.
– Oui, au moins. C’est que, vois-tu, Hortebize, tandis que toi et moi, follement sans compter avec nos caprices, nous laissions couler l’or comme du sable, entre nos mains prodigues, notre ami, lui, se privait et amassait.
– Que veux-tu ? Il n’a pas d’estomac, ce pauvre Catenac, pas de tempérament, pas de passions…
– Lui !… il a tous les vices, il est hypocrite. Pendant que nous nous amusions, il prêtait à la petite semaine, à quinze ou vingt pour cent. Tiens, combien dépenses-tu par an, docteur ?
– Par an !… Tu m’embarrasses beaucoup. Enfin, mettons une quarantaine de mille francs.
– Tu dépenses plus, mais peu importe. Calcule ce que cela fait depuis vingt ans que nous sommes associés.
Jamais le docteur n’a su faire une addition, et il en tire vanité. Cependant, pour complaire à son ami, il essaya :
– Quarante et quarante…, commença-t-il, comptant sur ses doigts, font quatre-vingts… puis encore quarante…
– En tout, interrompit M. Mascarot, cela fait huit cent mille francs. Mets-en autant pour ma part, c’est en tout seize cent mille francs que nous avons dissipés.
– C’est énorme !
– Sans doute, et tu vois bien que Catenac qui a eu même part que toi et moi est riche. C’est pour cela que je le redoute. Nos intérêts ne sont plus les mêmes. Il vient encore ici tous les jours, mais uniquement pour empocher son tiers. Il veut bien partager les bénéfices, mais il ne voudrait plus de risques. Voici deux ans qu’il ne nous a pas apporté une seule affaire. Quant à compter sur lui, bonsoir ! Tu peux lui proposer l’opération la plus belle et la plus sûre, il te refusera net son concours. Monsieur, maintenant, voit des dangers partout, et ses scrupules ressemblent aux hauts-le-cœur d’un goinfre qui a trop dîné.
– Mais il est incapable de nous trahir.
M. Mascarot ne répondit pas immédiatement, il réfléchissait.
– Je crois, répondit-il enfin, que Catenac a peur de nous. Il sait quel lien nous lie. Il sait que la perte de l’un de nous peut entraîner la perte des deux autres. Voilà notre garantie et notre sûreté. Mais s’il n’ose pas nous trahir ouvertement, il est bien capable de faire avorter toutes nos combinaisons. Notre association lui pèse. Sais-tu ce qu’il me disait, la dernière fois qu’il est venu ? Il me disait : « Nous devrions fermer boutique et nous retirer. » Nous retirer !… Eh bien !… Et vivre donc ! Car enfin s’il est riche, lui, nous sommes pauvres. Que possèdes-tu, toi, Hortebize ?
Le docteur, ce savant médecin que son portier croit millionnaire, tira en riant son porte-monnaie de sa poche, compta ce qu’il contenait, et répondit en riant :
– Trois cent vingt-sept francs. Et toi !
L’honorable placeur ne prit pas la peine de dissimuler une grimace.
– Moi ! répondit-il, je suis logé à ton enseigne.
Il soupira profondément, et à demi-voix, comme se parlant à soi-même, il ajouta :
– Et j’ai des obligations sacrées que tu n’as pas, toi.
Cependant un nuage, le premier depuis le commencement de cet entretien, assombrissait le front du docteur.
– Diable ! fit-il d’un ton contrarié, et moi qui comptais sur toi pour un millier d’écus dont j’ai besoin.
L’inquiétude du docteur Hortebize fit sourire M. Mascarot.
– Rassure-toi, dit-il, je puis te les donner. Il doit bien y avoir six ou huit mille francs en caisse.
Le docteur respira.
– Mais c’est tout, poursuivit le placeur, c’est le fond du sac social. Et cela, après des années de risques, d’efforts, de travaux, de…
– Et nous n’avons plus vingt ans.
D’un geste résolu, M. Mascarot assura ses bonnes lunettes.
– Oui, reprit-il, nous vieillissons : raison de plus pour prendre un grand parti. Ce n’est pas avec le courant que nous assurerons l’avenir. Que donne-t-il ce courant ? Au plus 4 à 5.000 francs par mois ; nos agents nous ruinent. Et que je tombe malade demain, la source est tarie.
– C’est pourtant vrai, approuva le docteur, frissonnant à cette idée.
– Donc il faut, coûte que coûte, risquer un grand coup. Voici des années que je me dis cela, et que je prépare les éléments d’un coup de filet miraculeux. Comprends-tu maintenant pourquoi, au dernier moment, c’est à toi que je m’adresse et non à Catenac ? Comprends-tu pourquoi je viens de passer deux heures à t’expliquer le plan des deux opérations que j’ai en vue ?
– Oh ! qu’une seule réussisse, notre affaire est faite !
– Oui. La question est de savoir si nous avons assez de chances de succès pour entrer en campagne… Réfléchis et réponds.
C’est un observateur très fin que le docteur Hortebize, en dépit de ses apparences frivoles, un esprit délié et fertile en expédients de toute nature, un conseiller d’autant plus sûr dans les circonstances graves, que jamais, si imminent que puisse être le péril, son souriant sang-froid ne l’abandonne.
B. Mascarot le savait bien lorsqu’il insistait pour avoir son opinion.
Mis au pied du mur, ayant à opter pour ainsi dire, entre le contenu du médaillon et la continuation de sa voluptueuse existence, le docteur perdit son air enjoué et parut se recueillir.
Renversé sur son fauteuil, les pieds appuyés sur la tablette de la cheminée, il analysait les combinaisons qui lui avaient été proposées avec l’application d’un général étudiant le plan de bataille que lui soumet le ministre dont il dépend.
Cette analyse fut favorable à l’entreprise, car B. Mascarot, qui examinait le docteur de toutes les forces de son attention, vit, petit à petit, le sourire refleurir sur ses lèvres vermeilles.
Enfin, après un long silence :
– Il faut attaquer, prononça Hortebize. Ne nous dissimulons rien : tes projets ont des côtés extrêmement dangereux, et un échec peut nous mener loin. D’un autre côté, si nous attendons une affaire absolument sûre, nous risquons d’attendre longtemps. Ici, nous avons bien une vingtaine de chances contre nous, mais nous en avons quatre-vingt pour nous. Dans de telles conditions, et surtout, nécessité n’ayant pas de loi, comme on dit… en avant ?…
Il se redressa en prononçant ces paroles, et tendant la main à son honorable ami, il ajouta :
– Je suis ton homme !…
Cette décision parut ravir B. Mascarot. Il est tel moment où, si fort que l’on puisse être, on doute de soi, on hésite, et alors l’approbation d’un ami compétent est un puissant secours. C’est le poids qui entraîne le plateau de la balance trébuchante.
Cependant avec le loyal placeur, de même qu’avec tous les gens à probité scrupuleuse, il n’y a jamais de surprise.
– Tu as bien tout pesé, insista-t-il, tout examiné ? Tu sais que de mes deux affaires, l’une, celle du marquis de Croisenois est prête, que toutes les combinaisons sont arrêtées…
– Oui, oui !…
– Tandis que pour l’autre, celle du duc de Champdoce, j’ai encore à rassembler d’indispensables éléments de succès. Qu’il y ait dans la vie du duc et de la duchesse un secret qui nous les livre, cela ne fait pas l’ombre d’un doute, mais quel est ce secret ?… Est-ce celui que je soupçonne ? je le parierais, mais il nous faut plus que des soupçons, plus que des probabilités, je veux une certitude absolue…
– Peu importe, ce que j’ai dit est bien dit !…
Le docteur espérait en être quitte, pour le moment du moins ; il se trompait.
– Tout étant ainsi convenu, reprit le placeur, je reviens à ma question de tout à l’heure, et j’attends une réponse sérieuse. Que penses-tu de ce garçon, qui, en somme, doit être l’instrument indispensable de notre fortune, de Paul Violaine, enfin ?
M. Hortebize se leva, fit deux ou trois tours dans le cabinet, et finalement vint se placer en face de son ami, le dos appuyé à la cheminée.
C’est sa position favorite lorsque, dans un salon, après s’être bien fait prier, il conte une de ses anecdotes graveleuses qu’on ne fait passer qu’à force d’esprit, d’adresse et de sous-entendus, et qui sont une de ses spécialités.
– Je pense, répondit-il, que ce garçon présente beaucoup des qualités requises et qu’il serait difficile de trouver mieux. D’ailleurs, il est enfant naturel et ne connaît pas son père, c’est une porte ouverte aux suppositions, il n’est pas de bâtard qui n’ait le droit de se croire fils d’un roi. En second lieu, il n’a ni famille, ni parents, ni protecteurs connus, ce qui nous assure que, quoi qu’il advienne, nous n’aurons de compte à rendre à personne. De plus, il est pauvre ; s’il n’a pas grand bon sens, il a un certain brillant et il est vaniteux. Enfin, il est prodigieusement joli garçon, ce qui peut aplanir bien des difficultés. Seulement…
– Ah !… il y a un seulement ?…
Le docteur qui sait que l’amitié ne vit que de ménagements et de concessions, dissimula un sourire discret.
– Il n’y en a pas un, répondit-il, j’en vois trois pour le moins. Tout d’abord, cette jeune femme, cette Rose Pigoreau, dont la beauté a si fort émerveillé notre digne Tantaine, me paraît un sérieux danger pour l’avenir.
M. Mascarot fit de la main un tout petit geste très significatif.
– Sois tranquille, nous en débarrasserons Paul de cette demoiselle.
– Parfait ! Mais ne t’y trompe pas, insista le docteur d’un ton sérieux qui ne lui était pas habituel, il s’en faut, le danger n’est pas celui que tu penses, celui que tu as songé à éviter. Tu es persuadé que ce garçon aime cette fille, et lui-même croit l’aimer. Pour la plus légère satisfaction d’amour-propre, il l’aura oubliée demain.
– C’est possible.
– Mais elle, qui s’imagine détester ce beau garçon, se trompe pareillement. Elle est tout simplement lasse de la misère. Donne-lui un mois de repos, de luxe, de fantaisies satisfaites, de bonne chère, et tu la verras rassasiée de ce qu’elle croit être le plaisir, revenir à son Paul. Oui, tu la verras le poursuivre, l’obséder, s’acharner comme s’acharnent les femmes de cette sorte qui ne redoutent rien, et venir le réclamer jusqu’aux pieds de Flavie.
– Qu’elle ne s’en avise jamais ! fit le doux placeur d’un air menaçant.
– Quoi ! Que feras-tu ? L’empêcheras-tu de parler ? Elle connaît Paul, elle, depuis son enfance ; elle a connu sa mère, elle a été élevée près de lui, dans la même rue peut-être. Crois-en ma vieille expérience, surveille de ce côté.
– Il suffit, je prendrai mes mesures.
Il suffisait, en effet, pour B. Mascarot, de connaître un danger pour le prévenir. Un bon averti, dit-on, en vaut deux ; quand il est prévenu, lui, il en vaut quatre.
– Mon second « seulement », poursuivit le prévoyant docteur, m’est inspiré par ce protecteur mystérieux dont ce jeune homme t’a parlé. Son père est mort, prétend-il, sa mère le lui a juré… soit, je consens à le croire. Mais alors, qu’est-ce que cet inconnu qui servait une rente à Mme Violaine ? Un sacrifice immédiat, si gros qu’il soit, ne prouve rien. Un dévouement si persévérant me taquine.
– Tu as raison, docteur, raison mille fois. Là est le défaut de la cuirasse. Mais je veille, mon ami, je cherche.
Le docteur commençait à se lasser, il était aisé de le voir.
– Ma troisième objection, poursuivit-il, est peut-être la plus forte. Il va falloir utiliser ce garçon dès demain sans avoir eu le loisir de le disposer à son rôle, sans l’avoir préparé. S’il allait être honnête, par hasard !… Si à tes propositions les plus éblouissantes, il répondait par un non bien ferme et bien catégorique !…
À son tour, M. Mascarot se leva.
– Cette supposition, déclara-t-il du ton le plus dégagé, n’est pas admissible.
– Pourquoi ?
– Parce que, docteur, lorsque Tantaine, après avoir trié ce garçon entre mille, nous l’a amené, il l’avait étudié. Tu ne l’as donc pas étudié, lorsque je le faisais poser pour toi ? Il est plus faible et plus volage qu’une femme, vaniteux comme un faiseur de romans qu’il est, dévoré de convoitises et honteux d’être pauvre. Va, entre mes mains, il prendra telle forme que je voudrai, comme la cire sous les doigts du modeleur. Ce qu’il faudra qu’il soit, il le sera.
M. Hortebize ne voulait pas discuter.
– Es-tu sûr, dit-il simplement, que Mlle Flavie ne soit pour rien dans ton choix ?
– Sur cet article, répondit le placeur, tu me permettras de ne pas m’expliquer…
Il s’interrompit prêtant l’oreille.
– On a frappé, je crois, fit-il, écoute…
Le bruit s’étant renouvelé, le docteur s’apprêtait à s’esquiver, M. Mascarot le retint.
– Reste, dit-il, c’est Beaumarchef.
Et au lieu de répondre, il appuya le doigt sur un timbre de vermeil, – encore un présent, sans doute, – qui brillait au milieu de ses paperasses.
Le digne placeur ne s’était pas trompé.
L’ancien sous-off, il aimait à se qualifier ainsi lui-même, parut presque aussitôt.
D’un air moitié respectueux, moitié familier, il salua militairement – la main au front, le coude à la hauteur de l’œil, – le docteur d’abord, puis son associé qu’il appelle son patron.
– Eh bien ! Beaumar, lui demanda gaiement le docteur, nous buvons donc toujours des petits verres ?
L’ex-sous-off, – fait prodigieux – rougit autant qu’une fillette prise par sa maman le doigt dans le pot aux confitures.
– Oh !… si peu, monsieur le docteur, répondit-il modestement, si peu !…
– Trop encore, Beaumar, beaucoup trop, penses-tu que je ne le vois pas ? Mais regarde donc ton teint, malheureux, ton nez, tes paupières enflammées !…
– Cependant, monsieur le docteur, je vous assure…
– Si ce n’était que cela, encore ! Mais tu sais ce que je t’ai dit : tu es menacé d’un asthme. Quand tu feras : non, avec la tête, c’est comme cela. Vois comme tu es essoufflé, examine les mouvements des muscles pectoraux, décelant une obstruction du poumon…
– C’est que j’ai couru, monsieur le docteur.
Mais cette consultation ne pouvait être du goût de M. Mascarot.
– Si Beaumar est hors d’haleine, interrompit-il, c’est qu’il a dû jouer des jambes. Il avait à réparer une inexcusable ineptie. Voyons ton expédition, Beaumar ?
L’ancien sous-officier aimait bien mieux cela que les observations taquines du docteur Hortebize.
– Nous la tenons, patron ! répondit-il d’un air triomphant.
– Ce n’est pas malheureux.
– Qui tenez-vous ? interrogea le docteur.
D’un doigt placé sur la bouche, M. Mascarot fit à son ami un signe d’intelligence, et, d’un ton leste qui ne lui est pas habituel, il répondit :
– Caroline Schimer, une ancienne servante de l’hôtel de Champdoce, qui a un petit renseignement à me donner. Continue, Beaumar, comment l’avez-vous rattrapée ?
– Grâce à une idée qui m’est venue, patron.
– Peste ! si tu te mets à avoir des idées, maintenant.
Le sieur Beaumarchef se rengorgea.
– C’est comme cela, répondit-il. En sortant de la maison, avec Toto-Chupin, je me suis dit : notre gaillarde a dû remonter la rue, mais il est impossible qu’elle soit allée jusqu’au boulevard sans entrer chez un marchand de vins.
– Bien raisonné ! approuva le docteur.
– En conséquence, Toto et moi, nous avons examiné tous les débits devant lesquels nous passions. Bien nous en a pris. Arrivés rue du Petit-Carreau, nous avons aperçu notre Caroline chez un marchand de tabac qui vend des liqueurs.
– Et Toto a pris la piste !
– C’est-à-dire, patron, qu’il a juré qu’il marcherait dans son ombre jusqu’à ce qu’on lui crie : assez ! De plus, il nous fera parvenir un rapport tous les jours.
M. Mascarot se frottait les mains.
– Bonne revanche ! prononça-t-il, Beaumar, je suis content de toi.
Le compliment parut enchanter l’ancien sous-officier. Il s’essuya le front, mais ne se retira pas.
– Ce n’est pas tout, patron, commença-t-il.
– Quoi encore ?
– J’ai rencontré en bas La Candèle, qui revenait de la place du Petit-Pont, vous savez ?…
– Ah !… qu’a-t-il vu ?
– Il a vu la jeune personne s’envoler dans un coupé à deux chevaux. Naturellement, il l’a suivie. Elle est maintenant installée rue de Douai, dans un appartement qui est tout ce qu’on peut voir de plus splendide, a dit le concierge. Ah ! patron, il paraît qu’elle est supérieurement jolie, cette jeune personne ! La Candèle était comme un fou, en en parlant. Il prétend qu’elle a des yeux !… Oh ! mais des yeux… à faire descendre un homme de l’impériale d’un omnibus.
À cette description, le regard du docteur pétilla.
– C’est donc vrai, demanda-t-il, ce que nous a conté ce vieux roquentin de Tantaine ?
Mais ce n’est pas l’austère placeur qui s’arrête jamais aux bagatelles.
– C’est vrai, répondit-il en fronçant le sourcil, et cela prouve, Hortebize, la justesse de ton objection de tout à l’heure. Oui, c’est un danger qu’une fille si furieusement belle, que tout le monde la remarque. Poussé par elle, le jeune idiot qui l’a enlevée pourrait bien devenir très gênant.
M. Beaumarchef osa toucher le bras de son patron, il était en veine ; une idée lui venait encore.
– S’il ne s’agit que de se débarrasser du petit crevé, dit-il, ce n’est pas bien difficile.
– Comment ?
Au lieu de répondre, l’ancien sous-officier tomba en garde, fit deux appels du pied et se fendit en criant d’un ton de prévôt de régiment :
– Une, deux !… Du liant, donc !… Une, deux, dégagez, filez droit !… Et voilà.
– Une querelle de Prussien, murmura le placeur, un duel !… La fille ne nous en resterait pas moins sur les bras. D’ailleurs, les moyens violents me répugnent, ils sont compromettants.
Il réfléchit un moment, puis, relevant lentement ses lunettes, il chercha des yeux les yeux du docteur. Quand il les eût rencontrés :
– Que n’avons-nous, fit-il en donnant à chaque mot une valeur particulière, que n’avons-nous à nos ordres une bonne épidémie ? Suppose, docteur, cette belle fille atteinte de la petite vérole !… La voilà défigurée.
Ce fut au tour du docteur de se recueillir.
– En l’état de la science, répondit-il enfin, on peut donner un coup d’épaule à l’épidémie. Mais après ? Rose défigurée n’en sera que plus acharnée après Paul. La ténacité d’une femme croit en raison de sa laideur.
– Ceci est à examiner, dit M. Mascarot. En attendant, il doit y avoir quelque mesure à prendre, pour écarter tout danger immédiat. Voyons, Beaumar, je t’ai dit ces jours-ci de préparer le dossier de ce Gandelu, quelle est sa situation ?
– Il est criblé de dettes, patron, mais ses créanciers le ménagent à cause d’un héritage prochain ; Clichy, d’ailleurs, n’existe plus.
L’honorable placeur haussa les épaules.
– Tu n’es qu’un sot, Beaumar, interrompit-il. Un gaillard de la trempe de ce Gandelu, endetté et amoureux d’une fille comme Rose, donnera tête baissée dans tous les traquenards. Il est impossible que parmi ses créanciers, il n’y ait pas deux ou trois de nos gens prêts à agir selon mes volontés. Étudie cela, tu me rendras réponse ce soir. Et sur ce… laisse nous.
Une fois seuls, les deux amis restèrent assez longtemps enfoncés dans leurs réflexions. L’instant était décisif. Ils étaient maîtres encore de leurs résolutions, mais ils savaient qu’une première démarche les engageait irrémissiblement. Or, ils étaient assez forts, l’un et l’autre, pour regarder bien en face et pour mesurer le péril.
L’éternel sourire du docteur Hortebize, pâlissait, et c’est d’une main fiévreuse qu’il tracassait son médaillon.
B. Mascarot le premier domina la torpeur qui l’envahissait.
– Assez de réflexions, fit-il, fermons les yeux et marchons… Tu as entendu les promesses du marquis de Croisenois ? Il se donne à notre œuvre, mais non sans conditions. Pour lui comme pour nous, il faut qu’il soit le mari de Mlle de Mussidan.
– C’est un mariage qui n’est pas fait.
– Mais qui se fera, puisque nous le voulons. Et la preuve, c’est qu’avant deux heures, les projets de mariage qui existent entre Mlle Sabine et le baron de Breulh-Faverlay seront rompus. Nous tenons le comte et la comtesse de Mussidans, n’est-ce pas ?…
Le docteur, tant bien que mal, étouffa un gros soupir.
– Vrai ! murmura-t-il, je comprends les scrupules de Catenac. Ah ! si comme lui j’avais un million !…
Pendant ces dernières phrases, B. Mascarot, allant et venant de son cabinet à sa chambre à coucher, remplaçait par sa tenue de ville son costume d’intérieur. Quand il eut terminé :
– Es-tu prêt ? demanda-t-il au docteur.
– Il le faut bien !
– Partons alors.
Et, entrebâillant la porte de son cabinet, B. Mascarot cria :
– Beaumar, une voiture !
IV
S’il est à Paris un quartier privilégié, c’est assurément celui qui se trouve compris entre la rue du Faubourg-Saint-Honoré d’un côté, et la Seine de l’autre, qui commence à la place de la Concorde et finit à l’avenue du bois de Boulogne.
Dans ce coin béni de la grande ville, les millionnaires s’épanouissent naturellement, comme les rhododendrons à certaines altitudes.
Aussi, que de somptueuses demeures, avec leurs vastes jardins, leurs massifs fleuris, leurs pelouses toujours vertes, leurs grands arbres peuplés de merles familiers, de rossignols et de fauvettes !
Mais, entre tous ces riants hôtels que lorgne le passant, il n’en est pas de plus souhaitable que l’hôtel de Mussidan, la dernière œuvre de ce pauvre Sévair, mort à la peine, le jour où on reconnaissait enfin son mérite.
Bâti au milieu de la rue de Matignon, entre une grande cour sablée et un jardin ombreux, l’hôtel de Mussidan a un aspect somptueux qui n’exclut pas l’élégance.
Peu de sculptures autour des fenêtres et le long des corniches, pas de bariolages sur la façade. Un perron de marbre à double rampe, protégé par une légère marquise, conduit à la grande porte.
Lorsque le matin, vers sept heures, on passe devant la grille, le mouvement des domestiques dans la cour trahit la grande et riche maison.
C’est le carrosse de cérémonie qu’on remise, ou le phaéton de monsieur le comte, ou le coupé plus simple que prend madame la comtesse lorsqu’elle court aux emplettes.
Cette bête de race, dont on lustre si soigneusement la robe, c’est Mirette, la favorite que monte parfois avant le déjeuner Mlle Sabine.
C’est à quelques pas de cette belle demeure, au coin de l’avenue de Matignon, que le placeur et son digne ami firent arrêter leur voiture. Ils descendirent, payèrent le cocher et remontèrent la rue.
B. Mascarot avait arboré son plus grand air. Avec ses vêtements noirs, sa cravate éblouissante de blancheur et ses lunettes, on l’eût pris aisément pour quelque grave magistrat.
Le docteur, lui, en route, s’était fait une raison, et s’il était très pâle encore, sa physionomie était redevenue souriante comme d’ordinaire.
– Prenons nos dernières dispositions, disait le placeur, tu es reçu chez M. et Mme de Mussidan, tu es presque de leurs amis.
– Oh !… de leurs amis, non. Un simple guérisseur, n’ayant pas eu l’avantage d’avoir eu un aïeul aux croisades, n’existera jamais pour un Mussidan.
– Enfin, la comtesse te connaît, elle ne s’épouvantera pas dès que tu ouvriras la bouche, elle ne criera pas à l’assassin. En te retranchant derrière un coquin quelconque, tu peux même, à ses yeux, sauver ta réputation. Moi je me charge de parler au comte.
– Hum !… fit le docteur, méfie-toi. Ce cher comte est affreusement violent. Il est homme, au premier mot malsonnant, à te jeter par la fenêtre.
M. Mascarot eut un geste de défi.
– J’ai de quoi le mater, dit-il.
– N’importe !… Tiens-toi sur tes gardes.
Les deux amis passaient alors devant l’hôtel de Mussidan, et le docteur en expliqua brièvement la disposition intérieure ; puis, ils poursuivirent leur route.
– À moi le mari, disait B. Mascarot, à toi la femme. Du comte, j’obtiens qu’il retire sa parole à M. de Breulh-Faverlay, mais je ne prononce pas le nom du marquis de Croisenois. Toi, au contraire, tu poses carrément la candidature Croisenois et tu glisses sur le Breulh-Faverlay.
– Sois sans inquiétude, mon thème est fait, je saurai me tenir.
– C’est là, cher docteur, qu’est le beau de notre affaire. Le mari s’inquiètera surtout à l’idée de sa femme. La femme sera très occupée de la pensée de son mari. Quand, après nous avoir vus, ils se trouveront ensemble, le premier qui abordera la question ne sera pas peu surpris de voir l’autre abonder dans son sens.
Ce résultat parut assez comique au docteur pour lui arracher un sourire.
– Et comme nous allons agir sur chacun d’eux par de moyens différents, dit-il, jamais ils ne se douteront de rien !… Décidément, ami Baptistin, tu es encore plus ingénieux qu’on ne croit.
– Bien !… bien !… tu me feras des compliments après le succès.
Ils venaient de s’engager dans la rue du Faubourg-Saint-Honoré, et de l’autre côté de la rue on apercevait un café. M. Mascarot s’arrêta.
– Tu vas, dit-il, docteur, entrer dans ce café, pendant que je ferai la course que tu sais. En repassant je te préviendrai. Si c’est : oui, je me présenterai le premier chez le comte, toi, un quart d’heure après moi, tu demanderas la comtesse.
Quatre heures sonnaient, lorsque ces honorables associés se séparèrent sur une poignée de main.
Le docteur Hortebize avait gagné le café indiqué.
B. Mascarot continua à remonter le faubourg Saint-Honoré. Ayant dépassé la rue du Colysée, il s’arrêta devant la boutique d’un marchand de vin et entra.
Le patron de cet établissement bien connu, il faudrait dire célèbre, dans le quartier, n’a pas jugé convenable de mettre son nom au-dessus de sa boutique. On l’appelle le père Canon.
Le vin qu’il sert aux passants, à son comptoir d’étain, ne vaut pas le diable, il le confesse sans pudeur ; mais il tient en réserve, pour sa nombreuse clientèle, composée uniquement de domestiques du voisinage, un certain Mâcon qui a causé plus d’un congé immédiat.
En voyant entrer chez lui un personnage d’apparence sévère, le père Canon daigna se déranger. En France, le pays du rire, une mine grave est le meilleur des passeports.
– Monsieur désire quelque chose ? demanda le marchand de vin.
– Je voudrais, répondit le placeur, parler à M. Florestan.
– De chez le comte de Mussidan, sans doute ?
– Précisément, il m’a donné rendez-vous ici.
– Et il s’y trouve, monsieur, dit le père Canon ; seulement il est en bas dans la salle de musique ; je cours le chercher.
– Oh ! inutile, ne vous dérangez pas, je descends.
Et, sans attendre une réponse, B. Mascarot se dirigea vers l’escalier d’une cave, dont l’entrée s’apercevait au fond de la boutique.
– Il me semble maintenant, murmura le père Canon, que j’ai déjà vu cet homme de loi qui connaît les êtres de ma maison.
L’escalier n’était ni trop noir ni trop raide, et de plus il était orné d’une rampe.
M. Mascarot descendit une vingtaine de marches et arriva à une porte matelassée qu’il tira.
Aussitôt, de même que le gaz d’un ballon se précipite par une fissure, des sons étranges, formidables, effroyables, s’élancèrent par cette issue.
Le placeur ne sembla ni effrayé ni surpris.
Il descendit trois marches encore, poussa une autre porte, matelassée comme la première, et se trouva sur le seuil d’une vaste pièce voûtée, disposée comme celle d’un café, éclairée au gaz, avec des tables et des chaises tout autour. Plusieurs consommateurs y buvaient du fameux vin de Mâcon.
Au milieu de la salle, deux hommes en bras de chemise soufflaient, jusqu’à en être cramoisis, dans des trompes à la Dampierre, entourées du galon vert traditionnel.
Près d’eux, un très vieux bonhomme, chaussé de grandes guêtres de cuir montant au-dessus du genou, ayant une ceinture de cuir fauve à plaque armoriée sur un gilet rouge, sifflait l’air que s’efforçaient de reproduire les joueurs de trompe.
Le silence se fit dès que parut M. Mascarot, qui, son chapeau à la main, saluait poliment à la ronde.
– Eh !… c’est le papa Mascarot, s’écria un jeune homme à beaux favoris, portant culotte courte et bas blancs bien tirés. Arrivez donc, je vous attendais si bien que voici un verre propre pour vous.
M. Mascarot, sans se plus faire prier, alla prendre place à la table, trinqua, but et fit claquer sa langue en signe de satisfaction.
– Comme cela, reprit le jeune homme, qui n’était autre que Florestan, le père Canon vous a dit que j’étais à la salle de musique. Hein !… on est bien ici.
– Admirablement.
– Vous nous voyez en train de prendre notre petite leçon. La police vous savez, ne veut pas qu’on joue de la trompe à Paris. Alors, savez-vous ce qu’a fait le père Canon ? Il nous a installés dans cette cave. On peut y souffler tant qu’on veut, personne au-dehors n’entend rien. L’air vient par les deux tuyaux que vous voyez.
Les deux élèves ayant repris leur leçon, Florestan était obligé de se faire un porte-voix de ses deux mains, et de crier de toutes ses forces.
– Ce vieux-là, poursuivait-il, est un ancien piqueur du duc de Champdoce. Ah ! quel professeur ! Il n’a pas son pareil pour la trompe ! Tel que vous me voyez, je n’ai que vingt leçons, et je vais déjà très bien. Il faut dire que j’ai, à ce qu’il paraît, une embouchure comme on n’en voit guère. Tenez, voulez-vous que je vous sonne un débuché, un bien-aller, un changement ?
M. Mascarot eut peine à dissimuler un mouvement d’épouvante.
– Merci ! cria-t-il, un jour que j’aurai le temps, je serai ravi de vous entendre ; mais aujourd’hui, je suis un peu pressé et je voudrais vous parler.
– À vos ordres ! Mais j’y songe, ici vous ne serez peut-être pas très bien pour causer, montons, nous demanderons un cabinet.
Si les « cabinets de société » du père Canon ne sont pas précisément somptueux, ils ont l’inestimable mérite d’être discrets.
Bien que séparés par de minces cloisons de verre rayé, rarement ils laissent s’évaporer les confidences qui s’y échangent, confidences dont les « maîtres » sont l’éternel sujet.
– Ah ! ils en conteraient de belles, ces cabinets, s’ils pouvaient parler !…
Ainsi disait Florestan, en prenant place en face de M. Mascarot à une petite table que le père Canon venait de charger d’une bouteille et de deux verres.
– Je le crois, approuva le digne placeur, mais ce n’est point de cancans qu’il s’agit. Si je t’ai fait demander un rendez-vous par Beaumar, c’est que tu es en position de me rendre un petit service.
– À vos ordres.
– En ce cas, nous y reviendrons. Commençons par parler de toi. Comment te trouves-tu chez ton comte de Mussidan ?
Une outrageante familiarité est un des traits distinctifs de B. Mascarot. Il ne saurait s’empêcher de tutoyer ses clients. Il ignore sans doute qu’au mépris d’un homme pour ses semblables, on peut presque toujours juger de quel mépris lui-même est digne.
Cependant, ce tutoiement n’offusquait nullement Florestan.
– Je suis très mal, répondit-il, chez ce noble de malheur, si mal que j’ai déjà demandé à Beaumarchef de me chercher une autre condition.
– C’est à n’y pas croire. Tous mes renseignements affirment que le service du comte est très doux, et ton prédécesseur…
– Merci !… interrompit le domestique avec une grimace significative, je voudrais vous y voir. D’abord, il est rat !…
D’un mouvement éloquent, l’honorable placeur blâma ce vilain défaut.
– Ensuite, continua Florestan, il est plus soupçonneux qu’un chat. Jamais rien à la traîne, pas une lettre, pas un cigare, pas un louis. La moitié de sa vie se passe à ouvrir et à fermer ses serrures, et il dort avec ses clés sous son oreiller.
– J’avoue qu’une telle méfiance est singulièrement blessante.
– N’est-ce pas ? Ajoutez à cela qu’il est d’une violence terrible. Pour un rien, les yeux lui sortent de la tête. On dirait toujours qu’il va vous tuer ou vous battre, pour le moins. Moi, d’abord, il me fait peur.
Ce portrait, après l’avertissement du docteur, devait donner à réfléchir à B. Mascarot.
– Le comte est-il donc toujours ainsi ? demanda-t-il.
– Les jours ordinaires, oui. Il est pire quand il a beaucoup joué ou beaucoup bu. Et Dieu sait s’il s’en fait faute. Il ne rentre jamais avant quatre heures du matin, quand il rentre toutefois.
– Diable ! cette conduite ne doit guère être du goût de la comtesse.
Florestan éclata de rire, jugeant l’observation naïve.
– Madame !… fit-il. Elle se soucie bien de monsieur, en vérité. Souvent ils sont des semaines sans se voir. Cette femme-là, pourvu qu’elle dépense, elle est contente. Aussi, il faut voir les créanciers chez nous.
– Cependant M. et Mme de Mussidan sont très riches.
– Énormément riches, papa Mascarot, immensément. Ce qui n’empêche pas qu’il y a des moments où il n’y a pas cent sous à l’hôtel. Alors, madame est comme une tigresse, elle envoie emprunter à toutes ses amies, n’importe quoi, cent francs, vingt francs, dix francs…, et on les lui refuse.
– C’est humiliant.
– À qui le dites-vous ? Cependant, quand il faut absolument une grosse somme, c’est au duc de Champdoce que madame s’adresse. Oh !… celui-là, il ne dit jamais non. Et elle ne lui en écrit pas long, allez.
M. Mascarot daigna sourire.
– On dirait, fit-il, que tu sais ce que la comtesse écrit.
– Dame ! vous comprenez, on aime à savoir ce qu’on porte. Elle dit simplement : « Mon ami, j’ai besoin de tant… » et il paie sans rechigner. Il faut, voyez-vous, qu’il y ait eu quelque chose entre eux.
– D’après cela, je le croirais.
– Parbleu !… Aussi qu’arrive-t-il ? Quand monsieur et madame se trouvent ensemble, c’est pour se disputer. Et quelles disputes !… Dans les ménages d’ouvriers, quand le mari a un peu bu, il cogne et la femme crie. Mais ce n’est rien. On se couche là-dessus, on s’embrasse sur les bleus et tout est dit. Tandis qu’eux, papa Mascarot, je les ai entendus se dire froidement de ces choses qu’on ne peut pas pardonner…
À l’air distrait dont le brave placeur écoutait ces détails, on eut pu croire qu’il les connaissait.
– Comme cela, fit-il, je ne vois, dans la maison, que Mlle Sabine dont le service ne soit pas désagréable.
– Oh ! elle, il n’y a rien à lui reprocher, elle est bonne, pas regardante, polie.
– De telle sorte que son prétendu, M. de Breulh-Faverlay, sera un très heureux mari.
– Heureux, c’est selon. Le mariage n’est pas fait. D’ailleurs…
Florestan s’interrompit comme s’il eût été pris d’un scrupule soudain.
Il promena son regard autour du cabinet, pour bien s’assurer que nul ne pouvait l’entendre, et c’est à voix basse, de l’air le plus mystérieux, qu’il continua :
– D’ailleurs, Mlle Sabine, je peux bien vous confier cela, à vous, a toujours été abandonnée à elle-même, elle est libre autant que le serait un garçon… Enfin, vous m’entendez.
B. Mascarot était subitement devenu fort attentif.
– Bah !… fit-il, Mlle Sabine aurait un amoureux ?
– Tout juste.
– Impossible !… mon garçon. Et même, tiens, laisse-moi te le dire, tu as tort de répéter des suppositions malveillantes.
Cette simple observation parut indigner le discret domestique.
– Des suppositions !… fit-il. Jamais… On sait ce qu’on sait. Si je parle de l’amoureux, c’est que j’ai vu, de mes yeux, non pas une, mais deux fois.
À la façon dont le bon placeur tracassa ses lunettes, Beaumarchef eût reconnu qu’il était intéressé au plus haut point.
– Vraiment ! dit-il. Conte-moi donc cela.
– Eh bien !… La première fois, c’était à l’église, un matin, que mademoiselle était allée seule faire, soi-disant, ses dévotions. Tout à coup le temps se met à la pluie, et Modeste, la femme de chambre, me prie d’aller porter un parapluie. Bon, je pars, j’arrive. En entrant, qu’est-ce que je vois ? Mademoiselle debout, près du bénitier, causant avec un jeune homme. Naturellement, je ne me montre pas, j’observe.
– C’est là ce que tu appelles être sûr ?
– Positivement, et vous ne douteriez pas, si vous aviez vu de quels yeux ils se regardaient.
– Comment était ce jeune homme ?
– Très bien : de ma taille à peu près, parfaitement mis, ayant l’air pas commode et même un peu extraordinaire.
– Passe à la seconde fois.
– Oh ! c’est toute une histoire. Cette fois, on me charge d’accompagner mademoiselle chez une de ses amies, qui demeure rue Marbeuf. Très bien. Mais voilà qu’au coin de l’avenue, mademoiselle me fait signe d’approcher. J’approche. – « Tenez, Florestan, me dit-elle, j’oubliais la lettre que voici, courez la jeter à la poste. Je vous attends ici. »
– Et tu as lu cette lettre ?
– Moi, jamais. Je me dis : « Mon bonhomme, on veut t’éloigner, c’est qu’il y a quelque chose ; il faut rester. » En effet, au lieu de courir à la poste, je me cache derrière un arbre et j’attends. J’avais à peine disparu que je vois avancer, qui ? mon particulier de l’église. Si changé, par exemple, que j’ai eu de la peine à le reconnaître. Il était vêtu comme un ouvrier, avec un pantalon de toile et une grande blouse pleine de plâtre. Ils ont bien causé dix minutes. Mademoiselle lui a remis quelque chose qui m’a paru être une photographie. Et voilà !…
La bouteille de Mâcon était vide. Florestan allait frapper pour en demander une autre. B. Mascarot l’arrêta.
– Non, non, prononça-t-il, l’heure avance, et il faut que je te dise quel service j’attends de toi. Le comte de Mussidan est chez lui en ce moment ?
– Ne m’en parlez pas ; voici deux jours qu’à la suite d’une chute de rien dans l’escalier, il ne sort pas.
– Eh bien !… mon garçon, j’ai absolument besoin de parler à ton patron. Si je lui faisais passer ma carte, il ne me recevrait pas, j’ai compté sur toi pour m’introduire près de lui.
Florestan resta bien une bonne minute sans répondre.
– C’est raide, fit-il enfin, ce que vous me demandez là. Il n’aime pas les visites improvisées, le patron, et il est bien capable de me fourrer à la porte. Mais bast ! puisque je veux le quitter, je me risque.
Déjà M. Mascarot était debout.
– Nous ne pouvons arriver ensemble, dit-il. File, je vais régler ici, et, dans cinq minutes, je me présenterai. Surtout, n’aie pas l’air de me connaître.
– Soyez tranquille !… Et, vous savez, cherchez-moi une bonne place.
Ainsi qu’il était convenu, l’honnête placeur paya, puis passa au café prévenir le docteur Hortebize.
Et quelques instants plus tard, Florestan, de sa plus belle voix, annonçait à son maître :
– M. Mascarot.
V
Il est certain que B. Mascarot, directeur d’une agence de placement, sise rue Montorgueil, – pour employer ses expressions – est doué d’un prodigieux aplomb.
Son esprit audacieux a si souvent parcouru le champ inexploré de toutes les probabilités, qu’il n’est rien qui puisse le prendre au dépourvu.
Tant de fois, par la pensée, il s’est placé au milieu des circonstances les plus invraisemblables, que la réalité ne saurait avoir de surprises pour lui.
Quoi qu’il advienne, il est en garde naturellement.
Lui-même aime à se comparer à ces écuyers habiles qui, ayant longtemps monté des chevaux dressés à jeter bas leur cavalier, peuvent, sans crainte d’être désarçonnés, enfourcher n’importe quelle monture.
Cet orgueil est légitime et même justifié par des faits indiscutables. B. Mascarot a fait ses preuves.
Néanmoins, pendant qu’il gravissait les marches du magnifique escalier de l’hôtel de Mussidan, éclairé, car la nuit était venue, par des lanternes d’une richesse extrême, l’intrépide placeur – lui-même, quelques heures plus tard, l’avouait au docteur – sentait ses jambes fléchissantes et cotonneuses.
Son cœur battait plus vite et sa salive s’épaississait autour de sa langue, lorsque Florestan, après lui avoir fait traverser une antichambre à divans de velours, l’introduisit dans la bibliothèque, une pièce très vaste, du goût le plus sévère.
À ce nom trivial de Mascarot, qui éclatait là plus dissonant qu’un juron d’ivrogne dans une chambrette de jeune fille, M. de Mussidan leva vivement la tête.
Le comte était établi au fond de la pièce, et il lisait à la lueur des quatre bougies d’un candélabre d’un merveilleux travail.
Laissant tomber son journal sur ses genoux, il posa son binocle sur son nez et considéra d’un air profondément surpris le placeur, qui, le chapeau à la main, la bouche en cœur, l’échine en cerceau, s’avançait balbutiant d’inintelligibles excuses.
Cet examen sommaire ne lui apprenant rien, M. de Mussidan se leva à demi, et demanda :
– Vous désirez, monsieur ?…
– Monsieur le comte, répondit B. Mascarot, daignera m’excuser si, n’ayant pas l’honneur d’être connu de lui, j’ai osé… je me suis permis…
D’un geste brusque et impérieux, le comte lui coupa la parole.
– Attendez !
Cette fois, il se leva tout à fait, alla tirer violemment un des cordons de sonnette qui pendait de chaque côté de la cheminée, et revint prendre place dans son fauteuil.
B. Mascarot, demeurait toujours au milieu de la bibliothèque, muet, un peu interdit, se demandant, car cela entrait dans ses prévisions, si on allait le faire reconduire jusqu’à la grille.
Il s’était bien écoulé une minute lorsque, la porte s’ouvrant, le fidèle domestique qui avait introduit « son placeur » parut.
– Florestan, lui dit le comte du ton le plus calme, voici la première fois que vous vous permettez de faire entrer quelqu’un ici, sans que je vous en aie donné l’ordre. Si cela vous arrivait une seconde fois, vous quitteriez mon service.
– Je puis assurer à monsieur le comte…
– Vous voilà prévenu. Il suffit.
Durant cette minute d’attente, pendant ce colloque rapide, B. Mascarot étudiait le comte avec toute l’intensité d’attention que communique un intérêt personnel en jeu.
M. le comte Octave de Mussidan ne ressemblait en rien à l’homme qu’on se serait imaginé après avoir entendu les histoires de Florestan.
Déjà, du temps de Montaigne, il ne fallait se fier qu’à demi au portrait d’un maître tracé par ses serviteurs.
Le comte, qui avait alors cinquante ans à peine, en paraissait bien soixante. D’une taille un peu au-dessus de la moyenne, il était desséché plutôt que maigre. Ses cheveux sur son crâne était rares, et ses favoris, qu’il portait fort longs, étaient complètement blancs. Les chagrins ou les passions de sa vie s’accusaient en rides profondes sur sa figure tourmentée. L’expression amère encore plus que hautaine de sa physionomie trahissait l’homme qui, ayant bu l’existence jusqu’à la lie, ne souhaite plus que briser la coupe.
Tels on se représente ces lords orgueilleux de l’Angleterre, qui ne vivent plus que par les excitations de la tribune ou la fièvre de leur ambition.
Florestan sorti, M. de Mussidan se retourna vers l’intrus, et du même ton glacial, dit :
– Expliquez-vous maintenant, monsieur.
M. Mascarot s’est des centaines de fois, exposé à des réceptions fâcheuses, mais jamais il n’avait été reçu ainsi.
Blessé dans sa vanité, car il est vaniteux comme tous ceux qui exercent un pouvoir occulte, il ressentit contre M. de Mussidan le plus violent mouvement de colère.
– Misérable grand seigneur ! pensa-t-il, nous verrons bien si tu seras aussi fier tout à l’heure.
Mais son visage ne trahit rien de ses pensées. Son attitude resta servile, son sourire bassement obséquieux.
– Monsieur le comte, commença-t-il, ne peut me connaître, et il me permettra de prendre la liberté de me présenter moi-même. Monsieur le comte a entendu mon nom. Pour ce qui est de ma profession, je suis placeur et aussi agent d’affaires, quand l’occasion se présente.
La volonté, la pratique, ont donné aux imitations de M. B. Mascarot une perfection si rare, que son humilité, sur ton de miel, trompèrent absolument son interlocuteur.
M. de Mussidan n’eut pas un soupçon, pas un pressentiment, il ne devina pas sous ces lunettes bleues des regards menaçants.
– Ah ! vous êtes agent d’affaires, dit-il d’un air ennuyé. Ce sont alors mes créanciers qui vous envoient vers moi, monsieur…
– Mascarot, monsieur le comte.
– Mascarot, soit ! Eh bien ! monsieur Mascarot, ces gens-là sont absurdes, je le leur ai souvent répété. Comment sont-ils assez ridicules pour donner signe de vie, lorsque je ne chicane jamais sur le total d’une facture, quand je paye sans sourciller des intérêts extravagants ? Ils savent qu’ils ne peuvent manquer d’être payés, n’est-il pas vrai ? Ils n’ignorent pas que je suis riche, ils ont dû vous le dire. C’est vrai : j’ai une fortune territoriale des plus considérables. Si jusqu’ici je n’ai voulu ni vendre, ni emprunter, c’est que cela m’a convenu ainsi. Emprunter est ridicule, quand on ne se suffit pas avec ses revenus. On se grève d’intérêts qui s’accumulent et qui conduisent tout doucement à l’expropriation, qui est la ruine. Le Crédit foncier me donnerait un million demain, rien que de mes terres du Poitou, je n’en veux pas.
La preuve que B. Mascarot avait bien recouvré son sang-froid, c’est qu’au lieu de chercher à ramener le comte à la question qui avait décidé sa démarche, il le laissait dire, écoutant bien attentivement, songeant à mettre à profit ce qu’il entendait.
– Ce que je vous dis là, reprit le comte, rapportez-le textuellement aux gens dont vous êtes l’ambassadeur.
– Je demanderai pardon à monsieur le comte, mais…
– Mais quoi ?
– Je me permettrai…
– Ne vous permettez rien, ce serait inutile. Ce que j’ai promis, je le tiendrai. Le jour où il me faudra doter ma fille, je liquiderai la situation, pas avant. Seulement, je veux bien ajouter qu’il ne s’écoulera pas beaucoup de temps avant qu’elle épouse M. de Breulh-Faverlay. J’ai dit.
Ce « j’ai dit » signifiait on ne peut plus clairement : « Retirez-vous ! »
Pourtant M. Mascarot ne bougea pas. D’un geste prompt comme celui d’un maître d’armes rajustant son masque, il ajusta ses lunettes sur son nez, et c’est sans un tremblement dans la voix qu’il lui dit :
– Eh bien, monsieur le comte, c’est justement ce mariage qui m’amène.
Positivement, M. de Mussidan crut avoir mal entendu.
– Vous dites ? interrogea-t-il.
– Je dis, insista le placeur, que je suis envoyé vers vous, monsieur le comte, au sujet du mariage de M. de Breulh et de Mlle Sabine.
Lorsqu’ils parlaient de la violence du caractère de M. de Mussidan, ni le docteur ni Florestan n’exagéraient.
En entendant le nom de sa fille prononcé par ce louche agent d’affaires, il devint fort rouge et un éclair de colère brilla dans ses yeux.
– Sortez ! dit-il d’un ton bref.
Ce n’était certes pas l’intention du digne placeur.
– Il s’agit de choses importantes, monsieur le comte, prononça-t-il.
Cette insistance était faite pour exaspérer M. de Mussidan.
– Ah ! vous vous obstinez à rester ! cria-t-il.
Et en même temps, assez péniblement à cause de sa jambe malade, il se leva pour aller à la sonnette.
Mais B. Mascarot avait deviné le mouvement.
– Prenez garde, fit-il, si vous sonnez, vous vous en repentirez toute votre vie.
Cette menace parut transporter de fureur M. de Mussidan. Laissant la sonnette, il saisit une canne déposée près de la cheminée et il allait châtier l’insolent, quand celui-ci, sans rompre d’une semelle, de la voix la plus ferme, dit :
– Des violences, monsieur le comte, souvenez-vous de Montlouis !…
Lorsqu’aux prudentes recommandations du docteur Hortebize, B. Mascarot répondait : « sois tranquille, je sais comment mater le comte, » c’est à peine s’il avait conscience de son pouvoir.
À ce nom de Montlouis, M. de Mussidan devint plus blanc que sa chemise et se recula, laissant échapper la canne dont il s’était armé.
Un spectre, se dressant devant lui, les bras étendus pour protéger le placeur ne l’eût pas plus vivement impressionné.
– Montlouis !… murmura-t-il, Montlouis !…
Mais déjà B. Mascarot, assuré désormais du succès de sa négociation avait repris l’humble attitude du solliciteur.
– Croyez, monsieur le comte, prononça-t-il, qu’il ne m’a pas fallu moins que l’imminence du danger, pour me décider à prononcer ce nom qui éveille en vous les plus pénibles souvenirs.
M. de Mussidan paraissait à peine entendre. C’est en chancelant qu’il avait regagné son fauteuil.
– Ce n’est pas moi, continuait le placeur, qui jamais aurais conçu la pensée de m’armer contre vous d’un accident… malheureux. Voyez en moi ce que je suis réellement, un intermédiaire entre des gens que je méprise, et vous, pour qui je professe le plus profond respect.
Grâce à une énergie de volonté peu commune, M. de Mussidan avait réussi à rendre à ses yeux et à sa physionomie leur expression habituelle.
– En vérité, monsieur, dit-il, d’un ton qu’il s’efforçait de rendre indifférent, je ne vous comprends pas. Mon émotion n’est que trop explicable. Un jour, à la chasse, j’ai eu le malheur affreux de tuer un pauvre garçon, mon secrétaire, qui portait le nom que vous dites. Les tribunaux ont été appelés à se prononcer sur cet horrible événement, et, après avoir entendu les témoins, ils ont jugé que ce n’était pas à moi, mais à la victime, qu’on devait imputer l’imprudence.
Le sourire de B. Mascarot devenait si ironique et si éloquent à la fois que M. de Mussidan s’arrêta.
– Ceux qui m’envoient, répondit le placeur, savent ce qui a été dit devant les juges. Malheureusement, ils connaissent le fait vrai, celui que trois hommes d’honneur avaient juré de taire et de cacher à tout prix.
Le comte, sur son fauteuil, eut un tressaillement ; mais M. Mascarot ne voulut pas s’en apercevoir.
– Rassurez-vous, monsieur le comte, poursuivit-il. Ce n’est pas volontairement que vos témoins ont trahi leur serment. La Providence, en ses desseins mystérieux…
– Au fait, monsieur, interrompit le comte d’une voix frémissante ; au fait !…
Jusqu’alors M. Mascarot avait parlé debout.
Voyant que bien décidément on ne lui offrirait pas de siège, il s’avança familièrement un fauteuil et s’assit.
À cette audace, M. de Mussidan frémit de colère, mais il n’osa rien dire. Et cette résignation seule eût suffi pour lever tous les doutes du placeur s’il en eût eu encore.
– J’arrive, dit-il. L’événement auquel nous faisons allusion avait deux témoins : un de vos amis d’abord, le baron de Clinchan, puis un de vos valets de pied, un certain Ludovic Trofeu, actuellement piqueur chez M. le comte de Commarin.
– J’ignore ce qu’est devenu Ludovic.
– Mais nos gens le savent, monsieur le comte. Ce Ludovic, lorsqu’il vous promettait un silence éternel, était garçon. Marié, quelques années plus tard, il a tout raconté à sa jeune femme, tout absolument. Cette femme, qui a mal tourné, a eu des amants, et c’est par l’un d’entre eux que la vérité est arrivée jusqu’aux oreilles de ceux qui m’envoient.
– Et c’est sur la parole d’un valet, s’écria le comte, sur le rapport d’une fille perdue, qu’on ose m’accuser, moi !…
Pas un mot d’accusation directe n’avait été prononcé, et déjà M. de Mussidan se défendait. Le digne placeur le remarquait bien.
– On a mieux que la parole de Ludovic, dit-il.
– Ah ! fit le comte, qui était bien sûr de son ami, oserez-vous me dire que M. de Clinchan a parlé.
Il fallait que son trouble fût immense, car lui, l’homme du monde, si fin, le grand seigneur rompu à toutes les dissimulations, il ne remarquait pas la perfidie des questions de son adversaire, il ne s’apercevait pas que chacune de ses réponses était une arme qu’il fournissait contre lui.
– Non, répondit l’honorable placeur, le baron n’a pas parlé, il a fait pis, il a écrit.
– C’est faux !…
B. Mascarot, qui n’en est pas à un démenti près, ne broncha pas.
– M. de Clinchan a écrit, insista-t-il, seulement il croyait bien n’écrire que pour lui seul. M. de Clinchan, vous ne pouvez l’ignorer, monsieur le comte, est l’homme le plus méthodique de la terre, soigné et ordonné jusqu’à la puérilité.
– C’est connu, passez.
– En ce cas, vous ne serez pas surpris d’apprendre que, depuis l’âge de raison, M. de Clinchan tient registre de sa vie. Chaque soir, il relate sur son journal l’état de sa santé, les variations de la température, les moindres incidents de sa journée inoccupée.
En effet, le comte connaissait cette particularité, qui avait valu à son ami plus d’une plaisanterie.
Maintenant, il commençait à entrevoir le péril.
– En apprenant les révélations de Ludovic, continua M. Mascarot, nos gens ont pensé que, si le fait était vrai, on en trouverait une mention sur le journal de M. de Clinchan. Grâce à des prodiges d’adresse et d’audace, ils ont eu entre les mains, pendant une journée, le volume de ce journal correspondant à l’année 1842.
– Infamie !… murmura le comte.
– Ils ont cherché et ils ont rencontré non pas une mention, mais trois.
M. de Mussidan eut un mouvement si violent que le brave placeur, un peu effrayé, recula son fauteuil.
– Des preuves, disait le comte, des preuves !
– Rien n’a été oublié. Avant de remettre en place le volume, on en a arraché les trois feuillets qui vous concernent. C’est aisé à vérifier…
– Où sont ces pages ?
B. Mascarot prit son grand air d’honnête homme indigné.
– On ne me les a pas remises, fit-il, sans cela !… mais on les a fait photographier et on m’en a confié une épreuve, afin de vous mettre à même d’examiner l’écriture.
Il présentait en même temps trois épreuves d’une admirable netteté.
Longtemps, le comte les examina avec la plus scrupuleuse attention, et c’est d’une voix qui trahissait son découragement, qu’il dit :
– Oui, c’est bien l’écriture de Clinchan.
Pas un des muscles de la terne figure du placeur ne trahit la joie qu’il ressentait.
– Avant tout, reprit-il, je crois indispensable de prendre connaissance de la relation de M. de Clinchan. Monsieur le comte désirerait-il la parcourir lui-même, ou veut-il que je lui en donne lecture.
– Lisez ! répondit M. de Mussidan, qui plus bas ajouta : Je n’y vois plus.
Le placeur, pour obéir, traîna son fauteuil près des bougies.
– À en juger par le style, observa-t-il, M. de Clinchan doit avoir rédigé ceci le soir même de l’accident. Enfin, je commence :
« An 1842. – 26 octobre. – Aujourd’hui, de grand matin, je suis parti pour chasser avec Octave de Mussidan. Nous étions suivis du piqueur Ludovic et d’un brave garçon nomme Montlouis, que Octave dresse pour en faire son futur intendant.
La journée promettait d’être superbe. À midi, j’avais déjà trois lièvres. Octave était d’une gaieté folle.
Vers une heure, nous traversions les taillis de Bivron. J’allais devant, à cinquante pas, avec Ludovic, lorsque des éclats de voix nous font nous retourner. Octave et Montlouis avaient une discussion de la dernière violence, et nous voyons le comte lever la main sur son futur intendant.
J’allais accourir, quand je vois Montlouis venir vers nous. Je lui crie : Qu’y a-t-il ?
Au lieu de me répondre, le malheureux se retourna vers son maître en proférant des menaces et en criant un mot qui, dans la position d’Octave, nouvellement marié, était une injure abominable.
Ce mot, Octave l’entendit.
Il avait à la main son fusil armé ; il épaule, ajuste et fait feu.
Montlouis tombe nous accourons. L’infortuné avait été tué raide. Le coup avait fait balle.
J’étais consterné, mais je n’ai rien vu d’aussi horrible que le désespoir d’Octave. Il s’arrachait les cheveux, il embrassait le cadavre !…
Seul de nous, Ludovic avait gardé son sang-froid.
– Ceci, nous dit-il, doit être un accident de chasse. Le terrain y prête merveilleusement. Monsieur aura tiré de là-bas.
Là-dessus, nous avons arrangé une version, et fait le serment de la soutenir.
C’est moi qui ai fait la déclaration au juge de paix de Bivron, il n’a pas douté de mon récit.
– Mais quelle journée !… Je crains bien un gros rhume ! Mon pouls bat quatre-vingt-six pulsations, j’ai la fièvre, et je sens que je dormirai mal.
Octave est comme fou. Mon Dieu !… Qu’arrivera-t-il ?… »
Enfoncé dans son fauteuil, le comte de Mussidan écouta cette lecture sans donner le plus léger signe de sensibilité.
Était-il tout à fait accablé, cherchait-il quelque moyen pour replonger dans l’oubli de la tombe ce fantôme du passé qui, tout à coup, surgissait menaçant en travers de son chemin ?
Voilà ce que se demandait le placeur, qui n’avait cessé d’épier l’effet produit.
Mais aux derniers mots le comte se redressa de l’air d’un homme qui à son réveil constate qu’il vient d’être le jouet d’un affreux cauchemar.
– C’est de la folie ! fit-il avec le plus beau sang-froid.
– Folie bien lucide, en ce cas, murmura M. Mascarot, folie jouant assez bien la raison pour surprendre les plus experts. On n’est ni plus net, ni plus précis, ni plus bref.
– Et si je prouvais, moi, reprit le comte, que ce récit est faux, absurde, ridicule, qu’il ne peut être que l’œuvre d’un maniaque, d’un halluciné…
B. Mascarot secoua tristement la tête.
– Ne nous laissons point endormir par de trompeuses illusions, monsieur le comte, soupira-t-il, notre réveil n’en serait que plus terrible.
Il disait « nous » audacieusement, associant par ce pluriel sa personne à lui, B. Mascarot, et celle du comte de Mussidan. Et le comte, loin de se révolter, eut comme un sourire.
À la grande rigueur, poursuivait le placeur, si M. de Clinchan se fût borné à cette relation, on pourrait s’inscrire en faux, opposer un système basé sur son état mental à un moment donné, étant provenant de la commotion par lui éprouvée. Malheureusement le baron se dépense encore. Permettez que je vous fasse entendre en quels termes il revient à la charge.
Soit, j’écoute.
Trois jours se sont écoulés, reprit B. Mascarot ; M. de Clinchan a eu le temps de se remettre, et cependant, voici ce qu’il dit :
« An 1842 – 29 octobre. – Ma santé m’inquiète. Je ressens des douleurs à toutes les articulations. Ce malaise vient peut-être des tourments incroyables que me cause l’affaire d’Octave.
J’ai été forcé tantôt de me transporter chez le juge d’instruction. Il a, ce diable de juge, des regards à faire remuer la vérité au fond des entrailles.
Je remarque avec terreur que ma version a quelque peu varié. Il faut, si je ne veux pas me couper, que je rédige une déposition et que je l’apprenne par cœur. Cela me sera surtout utile pour l’audience.
Ludovic se tient bien. Il est fort intelligent ce garçon, je serais bien aise de l’avoir à mon service.
C’est à peine si j’ose sortir tant je suis obsédé de gens qui me demandent le récit de l’accident. Rien que dans la famille de Sauvebourg, je l’ai raconté dix-sept fois.
Je m’ennuie extraordinairement ici. »
– Eh bien !… monsieur le comte, demanda le placeur, que pensez-vous de ces réflexions ?
M. de Mussidan ne répondit pas à cette question.
– Achevez votre lecture, monsieur, dit-il.
Volontiers. La troisième mention, pour brève qu’elle est, n’en est pas moins décisive. Voici ce que le baron écrivait un mois après les événements :
« An 1842. – 23 novembre. – Enfin, c’est fini. J’arrive du tribunal. Octave est acquitté.
Ludovic a été admirable. Il a expliqué l’accident avec une si rare habileté que personne, dans l’auditoire, n’a pu concevoir l’ombre d’un soupçon. Tout bien pesé, ce garçon est trop fort, je ne le prendrai pas à mon service.
Mon tour de déposer est venu. Il m’a fallu lever la main et jurer de dire la vérité. Je ne pouvais prévoir l’émotion qui s’est emparée de moi.
Non, il faut avoir passé par là pour se faire une idée de ce que c’est un faux témoignage. J’ai cru que je ne parviendrais pas à lever le bras, il me semblait de plomb.
En regagnant ma place, je constatai une forte oppression. Mon pouls, certainement, n’avait pas quarante pulsations.
Voilà pourtant où peut conduire la colère !… Il faut que pendant un an j’écrive chaque jour cette maxime : « Ne jamais céder à mon premier mouvement. »
– Et, en effet, ajouta le placeur, une année durant, M. de Clinchan a écrit cette phrase en tête de toutes les pages de son journal. Je tiens ces faits des gens qui ont eu les volumes entre les mains.
C’était bien la dixième fois que B. Mascarot mettait en avant ces « gens » dont il se prétendait le mandataire contraint, et M. de Mussidan s’obstinait à ne le pas remarquer, s’entêtait à ne pas demander : « Quels sont donc ces gens ? » Cela était extraordinaire, sinon un peu inquiétant.
Le comte s’était levé et il arpentait son cabinet, soit qu’il cherchât des idées, soit qu’il voulût enlever au placeur la possibilité de suivre dans ses yeux le reflet de ses émotions.
– C’est tout ? demanda-t-il après un silence.
– Oui, monsieur le comte.
– Cela étant, savez-vous ce que vous répondrait un juge impartial ?
– Oui, je serais assez curieux de savoir…
– Il vous répondrait ceci, interrompit le comte : Un homme en possession de son bon sens n’écrit pas des choses pareilles. Il est de ces secrets qu’on s’efforce d’oublier, qu’on ne dit pas à son bonnet de nuit, qu’à plus forte raison on ne confie pas à une feuille de papier qui s’égare, qui peut être volée, qui doit tomber entre les mains d’héritiers. Il est impossible qu’un homme sensé, coupable d’un faux témoignage, c’est-à-dire d’un crime qui entraîne les travaux forcés, aille s’amuser à en coucher les détails sur un registre, en y joignant l’analyse de ses sensations.
L’honnête placeur ne put retenir un mouvement de commisération.
– Mon avis, monsieur le comte, dit-il, est que vous avez tort de chercher une issue de ce côté. Votre thèse n’est pas soutenable, pas un avocat ne l’accepterait. Si, pour arriver à des preuves certaines, j’entends des preuves judiciaires, on examinait les trente et quelques volumes du journal de M. de Clinchan, on y trouverait, paraît-il, bien d’autres énormités.
M. de Mussidan réfléchissait, mais sa physionomie ne portait aucune trace d’appréhension si légère qu’elle fût. Il paraissait avoir arrêté un parti et ne plus discuter que pour la forme.
– Soit, fit-il, j’abandonne ce système.
– Oui, cela vaut autant.
– Mais qui m’assure que je n’ai pas sous les yeux l’œuvre d’un faussaire ? On imite terriblement bien les écritures, en un temps où la Banque a eu de la peine à reconnaître des billets faux mêlés aux siens.
– On peut vérifier. Manque-t-il ou non des feuillets à un des volumes de M. de Clinchan ?
– Qu’est-ce que cela prouve ?
– Tout, monsieur le comte. Laissez-moi vous montrer que ce système ne vaut pas mieux que l’autre. Tout d’abord, j’abandonne le témoignage de M. de Clinchan ; il est clair qu’il répondrait conformément à vos intérêts.
– Passons, passons !…
– Mais en l’état de cause, le journal de M. de Clinchan est pour nous comme un livre à souche. Les fragments des feuillets déchirés remplissent le rôle du talon. Si les deux déchirures se rapportent, n’y a-t-il pas évidence ? Hélas ! les gens qui m’envoient vers vous sont bien habiles, ils n’ont rien oublié.
Le comte eut un sourire ironique, un de ces sourires d’hommes qui tient en réserve un argument vainqueur.
– Est-ce vraiment votre opinion ? demanda-t-il.
– En mon âme et conscience, oui !
– Alors, autant avouer.
– Oh !… avec de telles preuves contre soi, on n’avoue pas, on est convaincu.
– Alors, oui, c’est vrai, Montlouis a été tué comme le dit Clinchan. Et Clinchan, s’il est un imprudent est un homme de cœur. Il a su quelles raisons, dans ma discussion avec Montlouis, m’ont exalté jusqu’au délire, et ces raisons, il ne les a pas consignées.
B. Mascarot eut un soupir de soulagement, quoique, en vérité, il fut inquiet de la tournure de l’entretien et du ton dégagé de son adversaire.
– Seulement, reprit le comte, ce sont des niais, ceux qui ont prétendu se faire une arme contre moi de cet immense malheur.
Il prit en parlant ainsi, un volume sur les rayons de sa bibliothèque, le feuilleta et le plaça tout ouvert devant B. Mascarot en disant :
– Voici le code d’instruction criminelle, lisez, tenez, ici, article 637 :
« L’action publique et l’action civile résultant d’un crime de nature à entraîner la peine de mort ou des peines afflictives perpétuelles… se prescriront après dix années révolues, etc., etc. »
M. de Mussidan espérait bien que ce seul article écraserait le louche personnage. Point.
Loin de sembler surpris, M. Mascarot eut un large et bon sourire.
– Eh !… répondit-il, je suis agent d’affaires, monsieur le comte, c’est vous dire que je connais mon code. Le jour où ceux que je représente sont venus me trouver, mon premier mouvement a été de leur lire cet article.
– Ah !… Et qu’ont-ils répondu ?
– Ceci, textuellement : « Pardieu !… nous savons cela. S’il n’y avait pas prescription, nous n’aurions pas besoin de vos services ; nous irions tout bonnement trouver le comte, nous lui demanderions la moitié de sa fortune, et il se ferait un plaisir de nous la donner. »
Il n’y avait pas à se tromper à l’air et à l’accent d’assurance de B. Mascarot.
M. de Mussidan comprit bien que des misérables, d’une audace et d’une habileté supérieures, devaient avoir trouvé quelque infaillible moyen d’utiliser contre lui le crime de sa jeunesse.
Mais s’il fut saisi, à cette certitude, d’une inquiétude si grande que son cœur se serra, il était assez maître de lui pour n’en rien laisser échapper.
– Allons, fit-il la moitié de ma fortune l’échappe belle, à ce qu’il paraît. Les prétentions, je l’imagine et je l’espère, sont plus modestes, maintenant que les feuillets volés à mon ami ne sont plus que d’inutiles chiffons.
– Oh ! inutiles !…
– Le code, à cet égard, est précis, ce me semble ?
M. Mascarot prit la peine d’ajuster ses lunettes, signe manifeste qu’il allait dire quelque chose de grave.
– Vous avez raison, monsieur le comte, prononça-t-il. On ne doit pas songer à vous atteindre par les voies judiciaires. Vous ne pouvez être ni recherché ni poursuivi pour ce meurtre qui date de vingt-trois ans.
– Donc !
– Pardon !… Les malheureux au nom desquels je parle, et j’en rougis, ont imaginé une petite combinaison qui ne laisserait pas que d’être bien désagréable, je dirais volontiers désastreuse, pour vous d’abord, puis pour M. le baron de Clinchan.
– Et peut-on connaître cette combinaison… ingénieuse ?
– Certes !… c’est justement pour vous l’expliquer, pour vous en démontrer le succès certain, que j’ai été envoyé vers vous.
Il s’arrêta, cherchant sans doute comment exposer le mieux et le plus nettement le projet, et enfin reprit :
– Admettons d’abord, monsieur le comte, que vous rejetiez la requête que je suis chargé de vous présenter.
– Peste !… c’est là ce que vous appelez une requête ?
– Mon Dieu ! le nom ne fait rien à la chose. Je me suppose repoussé par vous. Qu’arrive-t-il ? Dès demain, mes clients – j’ai honte de les appeler ainsi, – font imprimer dans un journal le récit émouvant de M. de Clinchan, avec ce simple titre : Histoire d’une chasse. On ne met que des initiales, bien entendu, mais suffisamment transparentes. De plus, on ajoute un détail.
– Vous oubliez qu’il y a des tribunaux, monsieur, et qu’en matière de calomnie la preuve n’est pas admise.
Le digne placeur eut une petite grimace ironique.
– Oh !… nos gens n’oublient rien, fit-il, et c’est même sur la particularité que vous indiquez que leur plan est basé. C’est pour cela que dans la version donnée à un journal, ils introduisent un cinquième personnage, un homme à eux, un complice qu’ils nomment en toutes lettres. Cet homme, dès le lendemain de la publication, dépose une plainte contre le signataire. Il pousse les hauts cris, il se prétend calomnié, il demande à prouver devant les tribunaux qu’il ne faisait pas partie de cette funeste partie de chasse.
– Et alors ?
Alors, monsieur le comte, cet homme qui veut qu’il soit avéré, qu’il soit reconnu que le journal s’est trompé, fais assigner comme témoins, vous d’abord, puis M. de Clinchan, puis Ludovic. Comme il demandera des dommages-intérêts, il aura un avocat, qui est trouvé et qui est du complot. Naturellement, cet avocat parlera. « Que M. de Mussidan soit un assassin, dira-t-il, c’est ce dont nous ne saurions douter d’après les documents que nous avons entre les mains. M. de Clinchan est un faux témoin, il l’a écrit. Ludovic suborné a surpris la religion de la justice. Mais mon client, cet homme honorable, ne saurait être confondu, etc., etc. » Et comptez qu’on trouvera l’occasion de lire et de relire les fameux feuillets ! Je ne sais si je m’explique bien clairement !…
Hélas ! oui, si clairement et avec une logique si implacable que l’idée ne pouvait même venir de se soustraire à cette odieuse machination.
D’un rapide coup d’œil, le comte embrassa l’avenir.
Il vit l’éclat déshonorant, le scandale affreux d’un tel procès. Il vit la France entière occupée de ces débats. Il se vit, ainsi que les siens, au ban de l’opinion.
Et cependant, tel était son caractère entier et impatient de toute contrainte, qu’il était bien plus désespéré encore que consterné.
Il connaissait la vie et les hommes. Il savait que les misérables qui le tenaient là, sous le couteau, lui demandant la bourse ou l’honneur, devaient redouter l’œil de la justice. Il se disait que s’il repoussait leurs prétentions, ils n’oseraient probablement pas accomplir leurs menaces.
S’il ne se fût agi que de lui, il eût certainement couru les risques de la résistance, et pour commencer il se fût donné l’indicible satisfaction de bâtonner l’impudent personnage qui était là, devant lui.
Mais pouvait-il exposer aux périls d’un refus Clinchan, cet ami dévoué qui s’était compromis pour lui.
Clinchan, nature timide et peureuse, incapable de survivre à éclat.
Toutes ces pensées et bien d’autres tourbillonnaient dans son esprit pendant qu’il arpentait sa bibliothèque. Il était ballotté entre les résolutions les plus opposées, tantôt résigné à subir l’affront, tantôt près de se jeter sur le digne placeur.
Ses gestes désordonnés, ses exclamations trahissaient la violence de ses sensations, et pour braver les emportements de ce furieux, qui, lorsque le sang affluait à son cerveau, tirait sur un homme comme sur un lapin, il fallait une impudence montée jusqu’à l’héroïsme.
Mais B. Mascarot en a bien vu d’autres.
Pendant qu’avec un petit frisson taquin il se demandait s’il sortirait de la bibliothèque, par la porte ou par la fenêtre, il tournait ses pouces d’un air bonasse.
À la fin, le comte, se faisant une violence inouïe, la plus dure de son existence, se décida pour le parti de la prudence.
Il s’arrêta brusquement devant le placeur, et sans prendre la peine de dissimuler son dégoût, d’une voix brève, il dit :
– Finissons !… Combien voulez-vous vendre ces papiers ?
B. Mascarot eut la mine contrite de l’honnête homme méconnu.
– Oh !… monsieur le comte, protesta-t-il, pouvez-vous bien me croire complice…
M. de Mussidan haussa les épaules.
– Au moins, interrompit-il, faites-moi l’honneur de m’accorder autant d’intelligence qu’à vous. Quelle somme exigez-vous ?
Pour la première fois depuis son entrée, le placeur parut embarrassé, il hésita.
– On ne veut pas d’argent, dit-il enfin.
– Pas d’argent !… fit le comte surpris, que voulez-vous donc ?
– Une chose qui n’est rien pour vous, qui est énorme pour ceux qui m’envoient. Je suis chargé de vous dire que vous pouvez dormir tranquille, si vous consentez à rompre les projets d’union qui existent entre Mlle de Mussidan et M. de Breulh-Faverlay. Les feuillets du journal de M. de Clinchan vous seront restitués le jour du mariage de Mlle Sabine avec tout autre prétendant que vous choisirez.
Ces exigences, au moins bizarres, étaient si loin des prévisions du comte qu’il demeurait immobile, comme pétrifié.
– Mais c’est de la folie ! murmura-t-il.
– Rien jamais n’a été plus sérieux.
Tout à coup M. de Mussidan tressaillit ; un soupçon atroce venait de traverser son esprit.
– Voudriez-vous, demanda-t-il, oseriez-vous me présenter et m’imposer un gendre ?…
L’honorable placeur se redressa.
– J’ai assez d’expérience, monsieur, répondit-il, pour être certain que jamais vous ne consentiriez à sacrifier votre fille à votre salut.
– Mais alors…
– Vous vous êtes mépris, monsieur le comte, sur le mobile de mes clients. Ils vous menacent, c’est vrai, mais c’est à M. de Breulh qu’ils en veulent. Ils ont juré qu’il n’épouserait pas une jeune fille qui aura près d’un million de dot. Leurs procédés à votre égard sont ceux de misérables, leur but pourrait presque s’avouer.
Tel était l’étonnement de M. de Mussidan, que, sans y prendre garde, il donna une apparence toute nouvelle à l’entretien.
Ils résistait encore, mais sans passion. Il répondait bien plutôt aux objections de son esprit qu’à son interlocuteur.
– M. de Breulh a ma parole, dit-il.
– Un prétexte n’est pas difficile à trouver.
– La comtesse de Mussidan tient beaucoup à ce mariage. Elle en parle sans cesse, je trouverai de ce côté bien des obstacles.
Le placeur jugea sage de ne pas répondre.
– Enfin, continua le comte, je crains que ma fille ne ressente un grand chagrin de cette rupture.
Grâce à Florestan, B. Mascarot connaissait la valeur de cette objection.
– Oh !… fit-il. Une jeune demoiselle du rang de Mlle Sabine, à son âge, avec son éducation, ne saurait avoir des impressions bien profondes.
Pendant un quart d’heure encore, le comte lutta. Subir la loi de vils coquins abusant d’un secret volé l’humiliait affreusement.
Mais il était pris. Il était à la merci de ces gens. Il céda.
– Soit, fit-il, ma fille n’épousera pas M. de Breulh.
B. Mascarot triomphait, mais sa physionomie pour cela ne changea pas. C’est à reculons qu’il sortit, saluant plus bas que jamais, outrant les témoignages de respect.
Mais en descendant l’escalier, il se frotta les mains.
– Si Hortebize a réussi comme moi, murmurait-il, l’affaire est dans le sac.
VI
Pour être admis à l’honneur de présenter ses hommages à Mme la comtesse de Mussidan, le docteur Hortebize n’avait besoin d’aucun des expédients imaginés par son ami Mascarot pour arriver jusqu’au comte.
Dès qu’il parut, c’est-à-dire cinq minutes après l’entrée du placeur, les deux valets de pied qui bâillaient dans le grand vestibule reconnurent en lui l’homme du monde, l’hôte de la maison.
Cependant, leur ton, le regard qu’ils échangèrent en disant : « – Oui, Mme la comtesse reçoit, » auraient donné à réfléchir à un visiteur moins complètement initié que le docteur aux détails de l’intérieur.
La physionomie des valets trahissait la surprise profonde qu’ils éprouvaient d’avoir à répondre :
– Mme la comtesse est ici.
C’était, en effet, une rare aventure, presque un miracle.
Jamais un des amis de Mme de Mussidan, ayant à lui parler, ne s’aviserait de venir sonner à sa porte. À quoi bon ?
On peut espérer la rencontrer à l’Exposition, aux courses, aux séances de l’Académie, au restaurant, au théâtre, dans un magasin ; on la trouve aux cours publics, à une répétition de l’Opéra, dans les ateliers en renom, chez le professeur qui fait entendre un ténor qu’il vient de découvrir, partout en un mot, excepté chez elle.
Elle est de ces femmes qu’un esprit inquiet, remuant, incapable de se poser, mobile à l’excès, curieux de futilités, mène et mène furieusement.
Son mari, sa fille, sa maison n’ont jamais un moment occupé sa pensée. Elle a bien d’autres soucis, vraiment ! Elle quête pour les pauvres, elle préside une société de « filles repenties, » elle aide à administrer un hospice de vieillards.
Avec cela, son désordre est de ceux qui viennent vite à bout des plus immenses fortunes. C’est à se demander si elle a une notion, la plus vague, de la valeur de l’argent.
Les poignées de louis, entre ses mains, fondent comme des poignées de neige. Qu’en fait-elle ? Nul ne le sait. Elle-même ne saurait le dire.
À tous ces travers, on attribue les relations pénibles du comte et de la comtesse de Mussidan.
Marié, le comte a toutes les charges du mariage sans en avoir les bénéfices. Il a une maison montée et pas d’intérieur.
On assure que pendant des années, chaque jour, à chaque repas, il a attendu sa femme. Elle arrivait ou elle n’arrivait pas.
De guerre lasse, il s’est résigné à manger à son club et à vivre tout à fait en garçon.
Tout cela, le docteur le savait, avec bien d’autres choses encore, aussi est-ce sans la moindre préoccupation qu’il suivit le valet chargé d’ouvrir la porte du grand salon et d’annoncer.
Il est splendide, ce salon, très vaste, d’une hauteur de plafond désormais inusitée, et meublé avec une richesse extrême.
Et pourtant il est froid et triste. On sent dès le seuil que personne ne s’y tient jamais.
À demi étendue sur une causeuse, devant la cheminée, la comtesse de Mussidan lisait.
À la vue du docteur, elle se leva, laissant échapper une exclamation de plaisir.
– Que c’est donc aimable à vous, docteur, de me venir visiter.
Elle disait cela, et en même temps elle faisait signe au domestique d’avancer un fauteuil.
Assez grande, svelte, la comtesse de Mussidan garde, à quarante-cinq ans passés, la tournure d’une jeune fille.
Sa chevelure est encore d’une abondance extrême, et grâce à sa nuance, d’un blond cendré, on ne distingue pas les cheveux blancs qui déjà foisonnent et qui de loin semblent une auréole de poudre.
De toute sa personne s’exhale le parfum le plus aristocratique et ses yeux d’un bleu pâle, presque laiteux, expriment habituellement la plus noble hauteur et le plus froid dédain.
– Il n’y a que vous, vraiment, docteur, reprit-elle, pour savoir ainsi choisir les moments. Je me mourais d’ennui. Les livres m’excèdent. Tout ce que je lis, il me semble que je l’ai déjà lu quelque part. Pour arriver si à propos, il faut que vous ayez signé un pacte avec le hasard.
Le docteur avait bien signé un pacte, en effet ; en se présentant il était sûr de trouver la comtesse, seulement son hasard se nommait B. Mascarot.
– Je reçois si peu, poursuivit Mme de Mussidan, qu’on ne daigne plus se déranger pour me venir visiter. Décidément je veux prendre une après-midi par semaine pour mes amis. Dès que je reste chez moi, ma solitude est affreuse. Or, voici deux mortels jours que je n’ai mis les pieds hors de l’hôtel. Je soigne M. de Mussidan.
L’assertion était assez hardie et assez singulière pour surprendre un homme bien informé.
Cependant le docteur ne sourcilla pas, et même la façon dont il dit : « – Ah ! vraiment !… » valait une phrase de félicitations.
– Oui, continua la comtesse, M. de Mussidan a glissé dans l’escalier avant-hier et il s’est blessé. Notre médecin assure que ce ne sera rien, mais je n’ajoute guère foi à ce que les médecins disent.
– Je sais cela par expérience, madame la comtesse.
– Oh !… vous, docteur, c’est autre chose. Je vous jure que j’ai eu très confiance en vous, autrefois. Vous quitter m’a fait beaucoup de peine. Seulement, après votre conversion subite à l’homéopathie, je le confesse, j’ai eu peur.
Hortebize eut un geste insouciant.
– Bast !… fit-il, cette école vaut bien l’autre.
– Vous croyez ?
– Comment, si je le crois ? C’est-à-dire que je le parierais.
Mme de Mussidan daigna sourire.
– Puisqu’il en est ainsi, reprit-elle, j’ai bien envie de vous demander une petite consultation.
– Vous êtes indisposée, madame la comtesse ?
– Moi !… non pas, Dieu merci ! Il ne manquerait plus que cela. Mais vous me voyez très inquiète de la santé de ma fille.
– Ah !…
Cette maternelle inquiétude était le pendant du dévouement conjugal de tout à l’heure, aussi le « ah ! » du docteur valut son « vraiment. »
– C’est ainsi, docteur. Il est bon que vous sachiez que depuis plus d’un mois j’ai à peine vu Sabine. J’ai tant d’occupations ! Hier, je l’ai regardée et je l’ai trouvée bien changée.
– Lui avez-vous demandé si elle souffrait ?
– Certainement. Elle m’a répondu que non, et qu’elle se portait à merveille.
– N’aurait-elle pas eu quelque petite contrariété ?
– Elle, docteur ! Ignorez-vous donc que ma Sabine bien-aimée est la plus heureuse jeune fille de Paris ! Au surplus vous allez la voir, car vous permettez, n’est-ce pas ?
Elle sonna sur ces mots. Un domestique parut.
– Lubin, lui dit la comtesse, faites prier Mlle Sabine de descendre.
– Mlle Sabine est sortie, madame la comtesse.
– Ah !… Y a-t-il longtemps ?
– Mademoiselle est sortie un peu avant trois heures.
– Qui l’accompagne ?
– Sa femme de chambre, Mlle Modeste.
– Mademoiselle a-t-elle dit où elle allait ?
– Non, madame la comtesse.
– C’est bien.
Le domestique s’inclina et sortit.
L’imperturbable docteur ne laissait pas que d’être un peu étonné.
Quoi ! Sabine de Mussidan, une jeune fille de dix-huit ans, était libre à ce point ! Elle sortait sans prévenir, on ne savait où elle était allée, et sa mère trouvait cela tout naturel !
– Voilà un fâcheux contre-temps, reprit la comtesse. Enfin, espérons que l’indisposition que je crains n’empêchera pas une noce d’avoir lieu à l’hôtel de Mussidan.
Hortebize jouait de bonheur. Le sujet qu’il avait à traiter, qu’il ne voyait trop comment aborder, arrivait tout naturellement sur le tapis.
– Vous mariez Mlle Sabine, madame la comtesse ? demanda-t-il.
Mme de Mussidan posa mystérieusement un doigt sur ses lèvres.
– Chut ! fit-elle, c’est un grand secret, et il n’y a rien encore de décidé. Mais vous êtes médecin, c’est-à-dire aussi discret, par profession, qu’un confesseur, on peut se fier à vous. Il est plus que probable qu’avant la fin de l’année, Sabine sera Mme de Breulh-Faverlay.
Il est certain que le docteur Hortebize est bien moins audacieux que B. Mascarot. Souvent, en face des conceptions de son ami, le docteur a pâli, reculé, demandé grâce.
Mais une fois engagé, quand il a dit : Oui, on peut compter sur lui. Il va droit au but, sans hésitations, sans faiblesses.
– Je dois vous avouer, madame la comtesse, dit-il, que j’ai ouï parler de vos projets.
– Vraiment, on s’occupe de nous ?
– Beaucoup. Et tenez, permettez-moi, madame, de vous le dire, ce n’est pas le hasard, comme vous l’avez cru, qui m’amène chez vous, c’est ce mariage.
Mme de Mussidan aimait assez le docteur Hortebize et avait souvent pris plaisir à entendre sa conversation spirituelle et tous les petits cancans dont il était toujours largement approvisionné.
Elle ne voyait à le recevoir de temps à autre aucun inconvénient, et volontiers elle l’admettait à une sorte de familiarité banale.
Mais qu’il s’autorisât de ce qu’elle jugeait des concessions, pour oser s’occuper de sa fille, à elle, comtesse de Mussidan, née Diane de Sauvebourg, c’est ce qui lui parut intolérable.
– En vérité, docteur, dit-elle, c’est bien de l’honneur que vous nous faites, au comte et à moi, de vous intéresser à ce mariage.
Cette simple phrase fut soulignée d’un regard à faire bondir, comme sous un coup de fouet, l’homme le moins sensible aux blessures d’amour-propre.
Mais le docteur n’était pas venu pour se fâcher.
Il était venu pour dire quand même et d’une certaine façon certaines choses.
D’avance il avait étudié et préparé son rôle, et rien n’était capable de l’en détourner parce qu’il s’était préparé à toutes les répliques.
Sur ce terrain, il était supérieur à B. Mascarot, qui n’eût pas su, comme lui, nuancer, préparer les transitions, ménager des sous-entendus, tout dire enfin, sans blesser de puériles susceptibilités.
Cette supériorité d’Hortebize, B. Mascarot la connaissait, et s’il l’enviait, il ne la jalousait pas.
– « C’est affaire de naissance, disait-il à ce sujet. Hortebize appartient à une excellente famille, il a reçu une belle éducation ; tout jeune il a été admis dans la meilleure compagnie, tandis que moi, ce que je sais, je me le suis appris tout seul ; je suis le fils de mes œuvres ! »
Hortebize courba donc la tête sous l’affront, – provisoirement.
– Croyez, madame, répondit-il, que pour accepter la mission que je remplis, il n’a pas fallu moins de toute la force de mon respectueux dévouement.
– Ah !… fit la comtesse, traînant la voix et clignant des yeux de la façon la plus impertinente, ah !… vous vous êtes dévoué ?
– Beaucoup, oui, madame. Et je suis sûr qu’après m’avoir entendu vous n’en douterez pas.
Il dit cela d’un ton si sec que Mme de Mussidan tressaillit comme au contact d’une pile électrique.
– Voici vingt-cinq ans que j’exerce, reprit le docteur, c’est-à-dire vingt-cinq ans que je pénètre dans les familles, que j’assiste à d’horribles drames d’intérieur, que je suis le confident forcé des plus affreux secrets. Souvent je me suis trouvé dans des situations délicates et difficiles, jamais je n’ai été aussi embarrassé qu’en ce moment.
– C’est donc bien grave ? demanda la comtesse, qui oublia d’être impertinente.
– Peut-être. Si j’ai eu affaire à un fou, comme je l’espère encore… je n’aurai qu’à vous demander les plus humbles excuses. Si, au contraire, celui qui m’est venu trouver a son bon sens, si ce qu’il prétend savoir est vrai, s’il a entre les mains les irrécusables preuves qu’il affirme posséder…
– Alors, docteur ?…
– En ce dernier cas, madame, je vous dirai : usez de mon dévouement, parce qu’il y a un homme qui, moralement, a sur vous droit de vie et de mort, un homme dont les volontés devront être les vôtres…
La comtesse eut un grand éclat de rire, aussi faux qu’une larme d’héritier.
– En vérité, docteur, dit-elle, votre mine funèbre et votre accent lugubre me feront mourir… de rire.
Le docteur réfléchissait.
Elle rit trop fort, se disait-il ; Baptistin ne m’a pas trompé. Soyons prudent.
Puis, tout haut, il reprit :
– Puissé-je aussi, moi, madame, rire bientôt de craintes chimériques. Mais quoiqu’il arrive, permettez-moi de vous rappeler ce que vous me disiez il n’y a qu’un instant : le médecin est un confesseur. Cela est vrai, madame. Comme le prêtre, le médecin sait oublier les secrets que sa mission lui révèle ; il sait conseiller et consoler. Mieux que le prêtre, parce qu’il est mêlé plus directement aux intérêts et aux passions, il comprend et excuse les fatalités de la vie, les entraînements…
– Docteur, interrompit la comtesse, vous oubliez de dire que, aussi bien que le prêtre, il prêche…
Pour lancer ce sarcasme, elle était parvenue à donner à sa physionomie la plus comique expression de gravité.
Mais elle n’arracha pas un sourire à Hortebize qui, de plus en plus, paraissait navré.
– Tant mieux si je suis ridicule, dit-il, tant mieux si je n’avive pas quelque douloureuse blessure que vous aviez lieu de croire fermée…
– Ne craignez rien, docteur.
– Alors, madame, je commencerai par vous demander si vous avez gardé souvenir d’un jeune homme de votre monde, qui, vers les premières années de votre mariage, jouissait à Paris d’une grande réputation… Je veux parler du marquis Georges de Croisenois.
Mme de Mussidan se renversa sur sa causeuse, les yeux fixés au plafond, le front plissé, comme si elle eût fait le plus énergique appel à sa mémoire.
– Georges de Croisenois, murmurait-elle, il me semble… Attendez donc, docteur !… Non, j’ai beau chercher… je ne vois pas.
Le docteur crut de son devoir d’aider cette mémoire rebelle.
– Le Croisenois dont je parle, insista-t-il, a un frère nommé Henri, que vous connaissez certainement, car je l’ai vu, cet hiver, chez le duc de Sairmeuse, danser avec Mlle Sabine.
– C’est juste !… Oui, docteur, vous avez raison, je me souviens maintenant…
On eût parlé à la comtesse d’un indifférent qu’elle n’eût pas gardé un plus magnifique sang-froid.
– Cela étant, reprit Hortebize, vous devez vous rappeler qu’il y a maintenant un peu plus de vingt-trois ans, Georges de Croisenois disparut tout à coup. Cette disparition fit un tapage affreux, ce fut presque un événement, le sujet d’une interpellation au ministère…
– Oui, en effet.
– La dernière fois qu’on aperçut Georges, ce fut au Café de Paris. Il y dînait en compagnie de quelques amis. Au coup de neuf heures, il se leva brusquement et s’apprêta à sortir. Un de ses intimes lui offrit de l’accompagner, il refusa. On lui demanda si on le reverrait dans la soirée, il répondit que oui peut-être, à l’Opéra, mais qu’il ne fallait pas compter sur lui. On supposa qu’il allait à quelque rendez-vous.
– Ah ! on supposa cela !
– Oui, à cause de sa mise, qui était plus soignée que de coutume, bien qu’il fût tout à fait un élégant, un lion, comme on disait alors. Toujours est-il que Georges de Croisenois sortit seul, et qu’on ne l’a plus revu.
– Plus jamais ! fit la comtesse, un peu trop gaiement peut-être.
Le docteur ne sourcilla pas.
– Non, madame, répondit-il, jamais. Les deux ou trois premiers jours, cette disparition parut extraordinaire ; au bout d’une semaine, elle inquiéta.
– Oh ! docteur, que de détails !…
– C’est vrai, madame. Je les ai connus autrefois, je les avais oubliés, on me les a remis en mémoire ce matin. Ils se trouvent avec bien d’autres, dans les procès-verbaux d’enquête. Car il y eut une enquête, et des plus minutieuses. Les amis de M. de Croisenois avaient commencé des recherches ; comme elles n’aboutissaient pas, ils s’adressèrent au préfet de police. Les plus habiles agents furent mis sur pied. La première idée fut celle d’un suicide. Georges pouvait fort bien être allé se tirer un coup de pistolet au fond de quelque bois. L’état de ses affaires aussi prospères que possible, sa grande fortune, son caractère gai, son constant bonheur, démontrèrent le peu de fondement de cette supposition. Alors, on songea à un crime, et les investigations furent dirigées en ce sens. Rien, on ne trouvait rien.
La comtesse étouffa un bâillement d’une sincérité douteuse, et, comme un écho, dit :
– Rien.
– La police était aussi déconcertée que possible quand trois mois plus tard, un beau matin, un des amis de Georges reçut une lettre de lui.
– Ah !… il n’était donc pas mort.
Le docteur nota l’air et l’accent de la comtesse pour les analyser à loisir.
– Qui sait !… répondit-il. Cette lettre était datée du Caire. Georges annonçait que, las de la ville de Paris, il allait essayer de pénétrer dans l’intérieur de l’Afrique, et qu’on n’eût pas à s’inquiéter de lui. Cette lettre, vous le comprenez, parut suspecte. On ne s’embarque pas sans argent, et il a été prouvé que le marquis n’avait pas sur lui plus de mille francs, dont moitié en pièces d’or portugaises, gagnées au whist avant le dîner. On crut à une ruse de faussaire. Point. Les plus habiles experts déclarèrent reconnaître l’écriture de Croisenois. Vite, deux agents furent expédiés au Caire ; mais, ni au Caire, ni le long de la route, personne n’avait vu celui qu’ils cherchaient. Depuis lors, pas un indice…
Il parlait avec une lenteur savamment calculée, mais la comtesse était de bronze.
– Quoi ! fit-elle quand il s’interrompit, c’est déjà fini ?
Hortebize chercha du regard le regard de Mme de Mussidan, et c’est seulement quand il l’eut rencontré qu’il répondit :
– Peut-être bien que non. Un homme, hier matin, est venu me trouver, qui prétend que vous savez, vous, madame, ce qu’est devenu le marquis Georges de Croisenois.
L’homme le plus fort n’aura jamais l’énergie de résistance de la plus faible femme.
Si solidement trempé qu’un homme soit, si endurci, si impudent qu’on le suppose, il laissera paraître quelque chose de ses intentions là où une femme jugée simple gardera le secret de ses tortures sous un visage riant.
Sur le terrain de la dissimulation, une jeune fille battra toujours le diplomate le plus retors, réunît-il à lui seul l’astuce et le génie de Fouché et de Talleyrand.
Quand, écrasé par l’évidence, l’homme tombe à genoux, la femme se redresse et lutte encore.
Dieu dit à Caïn : « Qu’as-tu fait de ton frère Abel ? » et Caïn est frappé de stupeur. Une femme, à sa place, eût ergoté, nié, cherché des raisons.
Au seul nom de Montlouis, M. de Mussidan avait pâli et chancelé comme après un coup de massue.
À l’accusation si formelle du docteur, la comtesse partit d’un grand éclat de rire, bien plein, bien sonore, qui, pendant près d’une minute, sembla l’empêcher de répondre.
– Ah ! docteur, dit-elle à la fin, vous me contez des choses de l’autre monde. C’est charmant, en vérité, cette histoire d’inconnu qui veut que je sache, moi, ce qu’est devenu M. Georges de Croisenois. C’est une somnambule, docteur, qu’il vous faut aller consulter.
Mais le docteur, lui aussi, quand il s’y met, donne joliment la réplique et joue passablement son petit rôlet.
Loin de sembler surpris ou décontenancé de l’accès d’hilarité de la comtesse, il eut l’air ravi et respira bruyamment comme s’il eût été soulagé d’un poids énorme.
– Dieu soit loué, fit-il ; on m’avait trompé.
Il prononça cet acte de grâce si naturellement, avec une telle expression de foi naïve, que la comtesse y fut prise.
– Cependant, reprit-elle, je ne serais pas fâchée de savoir quel est le mauvais plaisant qui m’accuse d’être si bien instruite.
– Bast !… répondit Hortebize, à quoi bon !… Il s’est joué de moi, il m’a exposé à vous déplaire, madame la comtesse, cela suffit. Demain mon domestique le recevra de la belle façon, s’il se présente. Même, si j’écoutais mon indignation, je déposerais une plainte…
– Y songez-vous, interrompit Mme de Mussidan, une plainte !… Ce serait donner à une niaiserie une importance qu’elle ne mérite pas. Dites-moi seulement le nom de votre mystérieux personnage. Est-ce que je le connais ?
– Vous ne pouvez le connaître, madame, il est si loin de vous !… Son nom ne vous apprendra rien. C’est un bonhomme que j’ai soigné, autrefois, qui est clerc d’huissier, si j’ai bonne mémoire, et qu’on appelle le père Tantaine.
– Tantaine ?
– Ce doit être un sobriquet. Ce vieux drôle est tout ce qu’on peut imaginer de plus misérable, une manière de philosophe cynique, ne manquant pas d’intelligence, et c’est là ce qui m’épouvantait. Je me disais qu’évidemment il ne venait pas de son chef, et qu’il devait être l’instrument de gens d’autant plus dangereux, qu’arriver jusqu’à eux était impossible.
La comtesse ne put s’empêcher de trouver que le docteur se rassurait trop vite et trop complètement.
– Mais enfin, docteur, insista-t-elle, vous m’avez parlé de menaces, de preuves irrécusables, de pouvoir occulte.
– D’après le père Tantaine, oui, madame. Ce vieux drôle m’a dit : « Mme de Mussidan connaît le sort du marquis Georges, cela résulte clairement, pour moi, des lettres qu’elle a reçues, tant de M. de Croisenois lui-même que de M. le duc de Champdoce. »
La comtesse, cette fois, était touchée au bon endroit.
Elle se dressa tout d’une pièce, comme si elle eût été mue par un ressort, la joue livide, la pupille dilatée, la lèvre frémissante.
– Mes lettres !… dit-elle d’une voix rauque.
On eût eu pitié d’Hortebize, rien qu’à voir combien il était ému et consterné de l’effet produit.
– Vos lettres, madame, répondit-il avec une visible hésitation, ce coquin de Tantaine prétend les avoir entre les mains.
Mme de Mussidan poussa un cri terrible, le cri de la lionne qui s’aperçoit qu’on lu a ravi ses petits.
– Ah ! misérable !…
Et aussitôt, oublieuse de sa noble impassibilité, sans se soucier d’Hortebize, elle s’élança hors du salon et on entendit dans l’escalier ses pas précipités et le froufrou de sa robe de soie s’éraflant aux barres de la rampe.
Ainsi abandonné, le docteur s’était levé.
– Cherche !… murmurait-il avec un sourire cynique, cherche, tu vas bien voir que les oiseaux se sont envolés.
Il s’était approché d’une des fenêtres, et machinalement, du bout des doigts, il tambourinait sur les vitres.
– Il est dit, pensait-il, que Mascarot ne se trompera jamais ! Comment ne pas admirer son infernale pénétration, sa logique implacable ! Sur la plus futile circonstance, il devine une existence entière, il en déduit toutes les péripéties, comme le savant qui, à la vue de la feuille d’arbre que le vent roule à ses pieds, dit quel arbre l’a produite, et décrit ses graines, ses fleurs et ses fruits. Ah !… s’il avait appliqué à quelque but noble et grand ses facultés surprenantes, sa dévorante activité, son audace que rien ne déconcerte !
À ces pensées, son front s’assombrit, et il se mit à arpenter le salon de long en large, poursuivant son monologue.
– Mais non, disait-il ; en ce moment Baptistin est là-haut, occupé à martyriser M. de Mussidan, de même que moi, ici, je torture la comtesse. Quel métier !… Et voilà vingt-cinq ans que cela dure. Ah !… il y a des jours où je trouve que je paye cher ma bonne et heureuse vie !… Sans compter…
Il tourmenta le médaillon de sa chaîne et ajouta :
Sans compter que nous pouvons trouver nos maîtres, échouer, et alors quelle fin !…
Il s’interrompit, la comtesse rentrait.
Ses cheveux à demi dénoués, le tremblement qui la secouait, sa pâleur, son regard fixe et comme hébété, tout en elle exprimait son épouvante et le désordre affreux de sa pensée.
– On m’a volée !… disait-elle dès le seuil.
Si grand était son trouble, qu’elle parlait très haut, oubliant que le salon restait ouvert et que les valets de pied du vestibule pouvaient l’entendre.
Heureusement que le docteur ne perd jamais la tête, et c’est avec l’aisance d’un acteur réparant un oubli du chef des accessoires, qu’il alla refermer la porte.
– Qu’a-t-on volé ? interrogea-t-il.
– Mes lettres, je ne les retrouve plus.
Elle se laissa tomber plutôt qu’elle ne s’assit sur sa causeuse, et de cette voix brève et saccadée que donne la conscience d’un péril imminent, elle continua :
– Et cependant ces lettres étaient cachées dans une cassette de fer fermant à secret, et cette cassette était enfouie au fond d’un tiroir dont la clé ne me quitte jamais. Et pas de traces de vol !…
Hortebize avait repris sa mine consternée.
– Tantaine aurait donc dit vrai ? fit-il.
– Il a dit vrai, reprit la comtesse. Oui, il est à cette heure des gens dont moi je suis l’esclave, qui peuvent ployer ma volonté comme une baguette de saule, qui sont maîtres de ma vie autant que s’ils tenaient un poignard sur ma gorge.
Elle cacha sa figure entre ses mains, comme si, par un reste de fierté, elle eût voulu dissimuler le spectacle de son désespoir.
– Ces lettres sont donc accablantes ? demanda le docteur.
– Je suis perdue !…
Qui eût vu le docteur, eût supposé qu’il se torturait l’esprit à chercher une issue à une inextricable situation.
– Ah !… j’ai été bien coupable autrefois, poursuivit la comtesse, j’ai été bien insensée. Hélas ! je ne savais rien de la vie. Je haïssais, et j’ai été frappée de vertige. Pauvre malheureuse !… C’est contre moi que se tournent toutes les armes préparées pour ma vengeance. J’ai creusé un abîme espérant y précipiter tous mes ennemis, et voici que j’y roule !…
Le digne Hortebize se gardait bien d’interrompre. La comtesse était dans une de ces crises de désespoir où tout ce qu’on a au fond de l’âme remonte à la surface, comme les varechs pendant la tempête.
– J’aimerais mieux mourir, disait-elle, oui, mourir plutôt que de voir ces lettres entre les mains de M. de Mussidan. Pauvre Octave ! N’a-t-il donc pas assez souffert par moi ! Ah !… je l’ai connu trop tard ! Et cependant, c’est là ce dont on me menace, n’est-il pas vrai, docteur ? On lui remettra ces lettres fatales si je ne consens pas à certaines choses. C’est de l’argent qu’on veut, n’est-ce pas, beaucoup d’argent, combien ?…
Le docteur fit un signe négatif.
– Non, reprit la comtesse, ce n’est pas de l’argent qu’on exige ? Quoi alors ? Ah ! ne me laissez pas dans cette anxiété mortelle, parlez, que veut-on de moi ?
Quand il est seul, en face de sa conscience, Hortebize s’avoue qu’il se livre à des spéculations fâcheuses, il reconnaît qu’il joue gros jeu, et même, comme il n’est point né méchant, il plaint ses victimes.
Mais une fois la partie engagée, il oublie ses inquiétudes, rien n’est capable de l’attendrir et il fait tout pour gagner.
– Ce qu’on exige de vous, madame la comtesse, reprit-il, est selon qu’on l’envisage, peu de chose ou une énormité !
– Parlez, je suis forte.
– Ces lettres fatales vous seront toutes rendues le jour où Mlle Sabine épousera le frère de Georges… le marquis Henri de Croisenois.
La stupeur de Mme de Mussidan fut telle qu’elle demeura immobile comme foudroyée.
– On m’a chargé de vous dire, poursuivit le docteur, qu’on vous accordera le délai que vous demanderez pour modifier les projets existants. Mais voici où éclate l’odieux : on vous prévient que si Mlle Sabine venait à épouser tout autre que M. de Croisenois, les lettres seraient portées à M. le comte de Mussidan, votre mari.
Tout en parlant, Hortebize, du coin de l’œil, surveillait l’effet produit.
Il dépassa ses prévisions.
La comtesse se leva, si défaillante, qu’elle fut contrainte de s’appuyer au marbre de la cheminée.
– Voici donc que tout est fini ! prononça-t-elle. Ce qu’on me demande, il est hors de mon pouvoir de l’accorder. Cela vaut mieux. Ainsi, je n’aurai ni les angoisses, ni la lutte. Désormais mon sort est fixé. Allez, docteur, allez dire au misérable, qui a réussi à s’emparer de mes lettres, qu’il peut les porter au comte.
L’accent de la comtesse accusait une résolution si irrévocablement arrêtée, que Hortebize ne savait que penser.
– Il est donc vrai, poursuivit-elle, qu’il existe des scélérats lâches et vils autant que les plus odieux assassins, qui font commerce des hontes et des douleurs qu’ils surprennent, et qui en vivent ! On me l’avait affirmé, je refusais de le croire. Ce sont là, me disais-je, des imaginations malsaines de faiseurs de romans à court d’inventions. Je me trompais. Pourtant qu’ils ne se hâtent pas de se réjouir, les infâmes qui pensent me tenir en leur pouvoir. Ils ne profiteront pas de leur ignominie. Il est un refuge où ils ne sauraient m’atteindre…
– Madame !… suppliait le docteur, madame la comtesse…
Il suppliait en vain.
Elle était hors d’état de l’écouter ou même de l’entendre.
Elle continuait avec une violence croissante, s’exaltant au souvenir des souffrances endurées :
– Pensent-ils donc, les misérables, que je crains la mort ? Ah ! il y a des années que je demande comme une grâce, à Dieu qui me châtie, le calme, le néant de la tombe. Cela vous surprend, n’est-ce pas, de m’entendre parler ainsi, moi qui ai été la belle, l’adorée Diane de Sauvebourg, comtesse de Mussidan. Voilà comment le monde juge…
Au temps de mes plus belles fêtes, quand mon bonheur faisait envie, j’avais épuisé toutes les tortures d’ici-bas, et sué toutes les agonies de la passion. Et depuis…
Maintenant, mes meilleures amies, examinant et jugeant ma conduite, se demandent si je ne suis pas folle. Folle !… Que je le suis-je, en effet !
Ils ne se doutent pas, ceux qui s’étonnent de mes inquiétudes fiévreuses, de mes agitations, de mes jours emplis de tumulte ; ils ne comprennent pas que je fuis le fantôme du passé qui me poursuit partout. Ils ne peuvent deviner que la solitude m’épouvante, que je me fuis moi-même, que je cherche l’oubli. Malheureuse !… je devais pourtant le savoir, tout le fracas de l’univers n’étouffera jamais le murmure de la conscience.
Elle parlait en femme dont le sacrifice est fait, qui n’a plus rien à ménager ni à redouter.
Sa voix vibrante emplissait l’immense salon.
Et le docteur blêmissait, lui qui entendait à côté, dans le vestibule, les allées et les venues des valets que l’heure du repas mettait en mouvement.
– Comment ai-je pu vivre ainsi ? disait la comtesse. C’est que toujours dans les brumes de l’avenir lointain, tremblote la chétive lueur de l’espérance. Et on va vers cette lumière décevante ; on tombe, on se relève meurtri, mais on marche quand même…
Aujourd’hui, cependant, tout espoir s’évanouit. Je n’aperçois plus que ténèbres. Oh ! non, la force ne me manquera pas pour anéantir l’implacable pensée. Cette nuit, pour la première fois depuis bien des années, Diane de Mussidan dormira d’un sommeil profond et sans rêves !…
La comtesse était à ce point hors d’elle-même, que le docteur se demandait avec effroi comment contenir cette explosion qu’il n’avait pas prévue.
Ces éclats de voix pouvaient appeler les domestiques, amener le comte en ce moment sous le couteau de B. Mascarot.
Alors, qu’arriverait-il ? Le complot se découvrirait, tout serait perdu.
Voyant bien que Mme de Mussidan allait s’élancer dehors, que des paroles vaines ne l’arrêteraient pas, Hortebize osa lui saisir les poignets et presque de force la renversa sur la causeuse.
– Au nom du ciel, madame, lui disait-il de sa voix la plus onctueuse, au nom de votre fille, daignez m’écouter. Ne vous abandonnez pas ainsi. Serais-je ici, me serais-je résigné à ce rôle d’intermédiaire de misérables qui me font horreur, si je croyais tout perdu ? Mon dévouement vous reste ? c’est celui d’un homme de cœur et d’expérience. Ne pouvons-nous lutter ensemble, conjurer l’orage ?
Le docteur parla longtemps, d’un air pénétré, faisant autant d’efforts maintenant pour rassurer la comtesse, qu’il en avait fait le moment d’avant pour lui bien démontrer l’immensité du danger.
Hortebize est médecin. Il sait, lorsqu’il s’est décidé à une opération indispensable, calmer les élancements de la blessure, et la guérir.
Au moins eût-il la satisfaction de constater promptement que ses peines n’étaient pas perdues.
Aux flots de cette éloquence émolliente, qui tombait comme une douche sur son désespoir, Mme de Mussidan se sentait prise d’engourdissement.
Elle était accablée de cette prostration qui suit les grandes crises, lorsque les nerfs, bandés à se briser, tout à coup se détendent et deviennent lâches.
Après un quart d’heure, grâce à des prodiges d’habileté, le docteur l’avait amenée à regarder la situation en face et à la discuter.
Alors seulement il respira et s’essuya le front.
Il savait que qui discute est vaincu.
Accepter la discussion, c’est tout au plus demander à son adversaire un appoint de bonnes raisons pour céder.
– C’est odieux, répétait la comtesse, c’est odieux !
– D’accord, madame. Cependant examinons le fait en lui-même. Avez-vous contre M. de Croisenois quelque motif personnel d’exclusion ?
– Aucun.
– Il est de bonne maison, aimé et estimé, il est fort bien de sa personne, il a trente-quatre ans à peine, car il était de quinze ans au moins plus jeune que son frère… N’est-ce pas un parti sortable ?
– Oui, mais…
– Il a fait des folies ? Quel jeune homme n’en a pas fait ? On le dit criblé de dettes, ruiné. C’est faux ; mais, en ce cas, Mlle Sabine est assez riche pour deux. D’ailleurs, Georges de Croisenois a laissé une fortune considérable, deux millions, je crois ; il est impossible que Henri n’obtienne pas, un jour ou l’autre, d’être envoyé en possession de l’héritage de son frère.
Mme de Mussidan était encore trop sous le coup d’une épouvantable émotion pour songer aux objections si fortes qu’elle eût pu présenter au docteur. C’est à peine si, en se faisant une violence inouïe, elle pouvait rassembler ses idées confuses.
– Je dirais oui, reprit-elle, que cela ne servirait de rien. M. de Mussidan a décidé que Sabine serait la femme de M. de Breulh-Faverlay. Je ne suis pas la maîtresse.
– Vous pouvez tout sur votre mari, et si vous le voulez bien…
La comtesse, à plusieurs reprises, secoua tristement la tête.
– Autrefois, dit-elle, c’est vrai, j’ai régné en souveraine sur le cœur et sur l’esprit d’Octave, j’ai été l’arbitre de ses volontés. Il m’aimait alors, et depuis ! Ne vous ai-je pas dit que j’ai été insensée. J’ai lassé un amour si robuste qu’il semblait devoir être éternel. J’ai rendu tout retour impossible, et maintenant…
Elle s’arrêta, comme confondue de ce qu’elle allait dire, et ajouta :
– Maintenant, je ne suis plus qu’une étrangère pour M. de Mussidan. Et je ne puis me plaindre, je l’ai voulu… il est, lui, juste et bon.
– On peut toujours essayer, gagner du temps…
– J’essayerai, docteur. Mais Sabine ! qui nous dit que Sabine n’aime pas M. de Breulh ?
– Oh ! madame, une mère a toujours une influence telle…
D’un geste violent, la comtesse avait saisi la main du docteur, et la serrant à lui faire mal :
– Faut-il donc, dit-elle d’une voix sourde, que je vous montre la profondeur de mes misères ? Je suis une étrangère pour mon mari. Ma fille, c’est autre chose : elle me méprise et elle me hait.
Beaucoup de gens pensent qu’il serait tout simple et très aisé de faire deux parts distinctes de la vie.
On donnerait la première au plaisir, à l’assouvissement de toutes les fantaisies, puis plus tard, quand les tombées de cendre du temps ont amorti le feu des passions, on consacrerait la seconde au repos, aux joies pures de la famille.
Il n’en peut être ainsi.
Selon ce qu’a été la jeunesse, la vieillesse est la récompense ou l’expiation.
Cela n’apparaît pas toujours clairement dans la vie. Il est tant de bonheurs mensongers !
Mais tous ceux que leur mission conduit dans l’intérieur des familles, le magistrat, le médecin, le prêtre, savent que cela est.
La comtesse de Mussidan expiait.
Mais le docteur Hortebize n’avait pas le loisir de s’oublier en ces réflexions ; le temps pressait ; d’une minute à l’autre, le comte pouvait entrer, un domestique en tout cas allait paraître pour annoncer le dîner.
Il renonça, quant au présent, à toute investigation, ne s’appliquant plus qu’à calmer la comtesse, à lui démontrer qu’elle s’épouvantait de chimères, qu’elle ne pouvait être une étrangère pour son mari, que sa fille ne pouvait la haïr.
– Ah ! docteur, lui dit-elle d’une voix émue, c’est au jour du malheur seulement qu’on connaît ses véritables amis.
De même que M. de Mussidan, la comtesse se sentait prise.
Elle se rendait, après une bien plus longue résistance, mais elle se rendait.
Elle promit que dès le lendemain elle s’occuperait de rompre les engagements pris, et que, dès qu’elle trouverait une ouverture, elle mettrait en avant M. Henri de Croisenois.
Que pouvait-on souhaiter de mieux ?
Le docteur en échange de ses promesses, jura qu’il saurait bien contenir Tantaine, le misérable, et le faire patienter. Il affirma aussi qu’il donnerait de fréquentes nouvelles…
Il y avait bien deux heures qu’Hortebize était près de la comtesse, lorsqu’il put enfin se retirer.
Il était brisé, on ne remporte pas impunément de pareils triomphes. Pour être associé de Mascarot, on n’en est pas moins homme.
Bien qu’il fît très froid, l’air du dehors parut délicieux au docteur ; il respirait à pleins poumons, ainsi qu’il arrive quand on vient d’accomplir une tâche difficile ou qu’on reconnaît s’être heureusement tiré d’un mauvais pas.
Lentement, il remonta la rue de Matignon, regagna le faubourg Saint-Honoré, et enfin entra dans le café où il avait déjà attendu son associé, et où ils s’étaient donné rendez-vous une fois la bataille gagnée.
L’honorable placeur était déjà arrivé.
Assis dans un coin, devant une chope intacte, enfoui derrière un journal qu’il ne lisait pas, B. Mascarot se mourait d’impatience, tressaillant à chaque bruit de la porte.
Mille appréhensions l’assaillaient. Comme Hortebize tardait ! Avait-il donc rencontré quelque obstacle imprévu et insurmontable, cet imperceptible grain de sable qui disloque les plus solides combinaisons ?
Dès que le docteur parut :
– Eh bien ! demanda-t-il, non sans un chevrotement dans la voix.
– Victoire !… répondit Hortebize.
Et il se laissa tomber sur un tabouret, en ajoutant :
– Ouf !… Ç’a été dur !
VII
Après avoir pris congé de B. Mascarot, désormais son protecteur, c’est du pas mal assuré d’un homme pris de boisson et en se tenant à la rampe, que Paul Violaine descendit le sale escalier de la maison de placement.
Cette fortune subite, inattendue, qui lui arrivait comme une tuile sur la tête, l’avait absolument enivré, étourdi.
En un moment, sans transition, d’une position si horrible qu’en traversant les ponts il regardait la Seine d’un œil enfiévré, il arrivait à une situation de douze mille francs par an.
Car c’était bien là le chiffre fantastique, inouï, que le placeur avait fait miroiter à ses yeux.
Il avait bien dit : Douze mille francs par an, mille francs par mois, et il avait offert d’avancer le premier mois.
C’était à devenir fou, et Paul l’était presque.
Ses idées étaient à ce point troublées, que hors le fait merveilleux il n’apercevait rien ; qu’il ne cherchait aucunement à se rendre compte des incidents divers.
Non, il trouvait toute naturelle cette succession d’événements bizarres : Ce vieux clerc d’huissier apparaissait à point pour lui prêter 500 francs ; ce placeur qui connaissait aussi bien que lui sa vie entière, et qui là, tout à coup, sans marchander, lui proposait les appointements d’un chef de section du ministère.
Cependant, une fois dans la rue, sous l’empire de sensations délirantes, Paul n’eut pas l’idée de courir à l’Hôtel du Pérou pour y porter la grande nouvelle.
Rose devait l’y attendre, il n’y songea pas, justifiant ainsi les pronostics du docteur Hortebize.
Après cette première gorgée de prospérité, il était pris d’un irrésistible désir de mouvement. Il ressentait un impérieux besoin de dépenser, d’épandre son exaltation. Il lui semblait que sa joie serait doublée s’il pouvait raconter son bonheur, le dire, le clamer.
Mais où aller par le temps qu’il faisait. Et il n’avait pas d’amis à désoler de son succès.
En cherchant bien, pourtant, il se souvint qu’aux jours de ses premières misères à Paris, il avait emprunté quelque argent, oh !… bien peu, vingt francs, à un jeune homme de son âge, nommé André, qui ne devait guère être plus riche que lui.
Il lui restait plus de la moitié du billet du vieux clerc d’huissier, une quinzaine de louis environ qui frétillaient dans sa poche, il se sentait des billets de mille francs sur la planche, n’était-ce pas le cas de s’acquitter, en même temps qu’une occasion superbe d’afficher une immense supériorité ?
Le malheur est que ce jeune homme demeurait fort loin, tout en haut de la rue de La Tour-d’Auvergne.
La distance effrayait un peu Paul, et il hésitait, quand une voiture vide vint à passer. Il y monta, jetant l’adresse au cocher, du ton d’un homme qui n’est pas habitué à aller à pied.
Le fiacre se mit en marche, et Paul se prit à songer à ce généreux créancier chez lequel il se rendait. André n’était pas un ami ; à peine était-ce un camarade.
Paul avait fait sa connaissance dans un petit établissement du boulevard de Clichy, le café de l’Épinette, où il allait souvent avec Rose, lorsque, nouveau venu à Paris, il habitait Montmartre.
Le café de l’Épinette n’est guère fréquenté que par des artistes : peintres, musiciens, comédiens, journalistes, tous grands hommes en herbe, qui discutent furieusement en buvant d’énormes quantités de bière.
Quant au nom de l’établissement, il lui vient d’un piano installé dans une des salles du haut, instrument infortuné, soumis aux plus sévères épreuves, rarement d’accord, et dont on entend les gémissements du milieu de la chaussée.
André, d’après ce que savait Paul, qui ne lui connaissait même pas d’autre nom et qui jamais n’avait été chez lui, André était artiste et avait plusieurs cordes à son arc.
D’abord, il était sculpteur ornemaniste, c’est-à-dire qu’il exécutait, à la journée ou à la tache, ces motifs si souvent ridicules dont les propriétaires ont bien le droit d’orner leurs bâtisses, mais qu’ils ont le tort de faire payer à leurs locataires.
C’est un métier assez pénible que celui de sculpteur ornemaniste.
Le plus souvent, il faut travailler à des hauteurs vertigineuses, sur des échafaudages que fait osciller le plus léger mouvement ; il faut se confier à des planches étroites ou se risquer au sommet d’échelles branlantes. De plus, à de rares exceptions, on est exposé à toutes les intempéries, gelé en hiver, grillé en été, sans autre abri contre la pluie qu’une toile déchirée. Il est vrai que si l’état est dur, il est lucratif.
Donc, André devait vivre assez bien de ses figures et de ses guirlandes.
Seulement, pendant bien des années, ce qui lui était venu par le maillet et le ciseau s’en était allé par les pinceaux et par les couleurs.
Car il était peintre aussi, mais alors pour son plaisir, pour la satisfaction de son ambition, pour obéir à une vocation irrésistible.
Il avait beaucoup étudié, beaucoup travaillé chez plusieurs maîtres, puis enfin, un beau jour, se sentant assez fort pour marcher seul, il avait pris un atelier.
De ce moment la peinture ne lui coûta plus rien. Deux fois déjà il avait exposé et les marchands commençaient à apprendre le chemin de sa maison.
On tenait André en haute estime à l’Épinette. On disait qu’il avait un talent très réel, une originalité saisissante et que certainement il arriverait, étant, de plus, un forcené « bûcheur ».
Paul ne s’était pas trouvé vingt fois à la même table que lui, lorsqu’un soir, comme ils se retiraient ensemble, pressé par la misère, il lui avait emprunté vingt francs, promettant de les lui rendre le lendemain.
Mais le lendemain, Paul et Rose s’étaient trouvés plus pauvres que la veille, leurs affaires avaient été de mal en pis, puis ils avaient déménagé, ils étaient allés s’établir de l’autre côté de l’eau… Bref, il y avait huit mois que Paul n’avait revu André.
Le fiacre, en ce moment, s’arrêtait rue de La Tour-d’Auvergne, devant le N°…
Paul sauta sur le trottoir, jeta deux francs au cocher et s’engagea dans l’allée très large et très bien tenue de la maison.
Au fond de l’allée, une vieille femme grasse, fraîche, proprette, avec un bonnet à papillons, bien blanc, polissait les poignées de cuivre de la porte de la cour. Ce ne pouvait être que la concierge.
– Monsieur André ? demanda Paul.
– Il est chez lui, monsieur, répondit la vieille femme avec une volubilité extraordinaire, et même, sans manquer à la discrétion qui distingue tout concierge qui se respecte, je puis dire que c’est un miracle. Toujours dehors, M. André ! Ah ! c’est que, voyez-vous, il n’a pas son pareil comme travailleur.
– Mais, madame !…
– Et rangé donc qu’il est, continuait la vieille femme, et économe ! Je ne lui connais pas un sou de dettes. Jamais je ne l’ai vu gris qu’une fois. Je dirais même : et pas de connaissance !… n’était une jeune dame qui, depuis un mois…
J’ai même eu assez de mal à la voir, rapport à son voile. Mais cela ne me regarde pas, n’est-il pas vrai ? Moi, je la trouve très bien, elle a toujours une femme de chambre avec elle, et certainement quelque jour…
– Morbleu ! interrompit Paul impatienté, m’indiquerez-vous enfin l’atelier de M. André ?
Cette violente interruption sembla choquer affreusement la concierge.
– Quatrième… porte à droite ! répondit-elle d’un ton sec.
Et pendant que Paul montait lestement elle grommelait :
– Vilain mal élevé ! couper la parole à une femme d’âge !… Mais laisse faire mon joli garçon, si jamais tu te représentes, je te reconnaîtrai, et tu me trouveras pas souvent M. André chez lui.
Paul était déjà au quatrième étage, – le dernier.
Au milieu de la porte de droite, une carte de visite était clouée. Paul s’approcha et lut : André. Il ne risquait pas de se tromper.
Comme il n’apercevait pas de sonnette, il frappa, prêtant ensuite l’oreille, comme on fait toujours, machinalement, en pareil cas.
Aussitôt il entendit un piétinement, puis le bruit d’un meuble qu’on roulait, puis le grincement d’anneaux de cuivre glissant sur une tringle de fer.
Enfin, une voix jeune et bien timbrée cria :
– Entrez !
Le protégé de B. Mascarot ouvrit et entra.
Il se trouvait dans un atelier éclairé d’en haut par un large vitrage, assez vaste, modeste, mais d’une propreté poussée jusqu’à la minutie.
Des esquisses, des dessins, des tableaux inachevés garnissaient entièrement les murs. À droite se trouvait un divan très bas, recouvert d’un tapis tunisien. Au fond, au-dessus de la cheminée, était une glace à bordure de bois qu’un amateur eut incontinent marchandée. À gauche, se dressait un très grand chevalet à manivelle, mais un rideau de serge verte cachait le tableau qu’il supportait, et dont on n’apercevait que la bordure, une bordure d’un grand prix.
Au milieu de l’atelier, sa palette dans le pouce, des pinceaux à la main, un jeune homme se tenait debout : André.
C’était un grand garçon, admirablement campé, très brun, ayant les cheveux coupés courts, portant toute sa barbe, une barbe aristocratique, fine, soyeuse, bouclée, noire, avec des reflets bleuâtres.
Comparé à Paul, André certainement était laid.
Mais le jeune peintre avait ce qui manquait au protégé de B. Mascarot : une de ces physionomies qu’on n’oublie pas.
Le voir, d’ailleurs, c’était le connaître. Son front large et fier, sa bouche du dessin le plus ferme, son sourire, ses yeux noirs pleins d’éclairs disaient du premier coup sa nature mâle et loyale, son intelligence, la bonté de son cœur et l’énergie de sa volonté.
Détail singulier et qui frappa Paul tout d’abord, André, qui était en train de peindre, on le voyait à sa palette et à son pinceau, n’avait point un costume d’atelier.
Il était vêtu non à la mode, mais avec une recherche extrême.
À la vue de Paul, André déposa sa palette, et s’avança, la main largement tendue.
– Eh !… vous voici donc, s’écria-t-il, de sa bonne voix sympathique et loyale, qu’êtes-vous devenu, depuis qu’on ne vous voit plus ?
Cet accueil si amical ne laissa pas que de gêner un peu le protégé de B. Mascarot.
– J’ai eu des déceptions, commença-t-il, mille soucis…
– Et Rose ? interrompit André, vous allez, j’espère, m’en donner les meilleures nouvelles. Est-elle toujours aussi jolie ?
– Toujours, répondit Paul d’un air pincé. Mais vous m’excuserez, reprit-il très vite, d’avoir disparu si longtemps. Je viens vous remercier et vous rendre ce que je vous dois.
Le jeune peintre eut un geste insouciant.
– Bast ! fit-il, de nous deux vous seul pouviez vous souvenir de cette bagatelle. Pas de façons avec moi, n’est-ce pas ? si cela vous gênait le moins du monde…
Cette phrase sonna mal aux oreilles du vaniteux Paul. Il crut y démêler, sous une feinte générosité, l’intention de l’humilier.
Jamais plus magnifique occasion d’attester sa supériorité ne s’était présentée.
– Oh ! dit-il de l’air le plus fat, cela ne me gêne aucunement. J’ai été, je l’avoue, fort misérable autrefois, mais j’ai maintenant un emploi de douze mille francs.
Il pensait que ce chiffre allait éblouir l’artiste, lui arracher des exclamations d’envie ; il se trompait si bien qu’il se crut obligé d’ajouter :
– À mon âge, c’est joli.
– C’est-à-dire que c’est superbe. Et que faites-vous, sans indiscrétion ?
Cette question était amenée par les circonstances mêmes. Cependant, comme Paul n’y pouvait répondre, ignorant quel emploi lui était destiné, elle le blessa autant qu’une insulte préméditée.
– Je travaille, prononça-t-il en se redressant.
Son air, en lançant ce mot, était si singulier, qu’André, qui était à mille lieues des sensations, parut tout surpris.
– Il m’arrive rarement de rester à rien faire, dit-il.
– Oui, mais moi je suis forcé de travailler plus qu’un autre, n’ayant personne qui s’inquiète de mon avenir, ni parent, ni protecteur.
L’ingrat, il oubliait l’honorable B. Mascarot.
Cependant, son ton emphatique sembla réjouir considérablement le peintre.
– Parbleu ! répondit-il, vous imaginez-vous que l’administration des hospices fournit des protecteurs à ses enfants trouvés !
Paul ouvrit de grands yeux.
– Quoi ! commença-t-il, vous seriez…
– Précisément, et je n’en fais pas mystère, estimant qu’il y a là de quoi pleurer, peut-être, mais non de quoi rougir. Tous mes camarades, même ceux du chantier, le savent, et je m’étonne que vous l’ignoriez. Je suis tout simplement un enfant de l’hôpital de Vendôme, où même, entre parenthèse, j’ai dû laisser le renom d’un détestable garnement.
– Vous ?…
– Moi-même, et franchement je n’ai pas le plus léger remords. Je m’explique. Jusqu’à douze ans, j’avais été le plus heureux des gamins, la sœur-professeur était enchantée de ma mémoire ; le jour, je travaillais au grand jardin qui s’étend le long du Loir ; le soir, je barbouillais d’immenses quantités de papier ; je voulais être peintre. Hélas ! rien n’est durable ici-bas ! J’eus douze ans, et la supérieure eut l’idée de me placer en apprentissage chez un corroyeur.
Paul s’était assis sur le divan, et tout en écoutant, il avait roulé une cigarette.
Il allait l’allumer, quand André le retint en lui disant :
– Vous me feriez vraiment plaisir en ne fumant pas.
Sans trop se rendre compte du caprice, car le peintre fumait beaucoup d’ordinaire, Paul jeta son allumette.
– J’obéis, fit-il, mais il me faut la fin de l’histoire.
– Oh !… volontiers, d’autant qu’elle est courte. Du premier coup, ce métier de corroyeur me déplut. Pour comble, dès le second jour, un ouvrier maladroit me renversa sur le bras un seau d’eau bouillante qui me brûla si cruellement que je faillis en mourir et que j’en porte encore les traces.
Il relevait en même temps sa manche droite et montrait une large cicatrice qui, partant de la saignée, remontait vers l’épaule.
– Dégoûté et échaudé, je conjurai la supérieure, une terrible femme à lunettes, de me faire apprendre un autre état. Prières vaines, elle avait juré que je serais corroyeur.
– C’était dur.
– Plus que vous ne croyez. Aussi, de ce jour mon parti fut pris. Décidé à fuir dès que j’aurais amassé une petite somme, je devins le plus soumis et le plus appliqué des apprentis. Au bout d’un an, grâce à des prodiges de travail et de dégoût vaincu, j’avais économisé sou à sou quarante francs. Je me dis que c’était assez, et par un beau matin d’avril, muni d’une chemise, d’une blouse et d’une paire de souliers de rechange, je prenais à pied la route de Paris.
– Et vous n’aviez que treize ans !
– Pas même. Seulement, j’ai reçu du ciel une assez forte dose de cette volonté raisonnée que les imbéciles appellent de l’entêtement. J’avais juré que je serais peintre…
– Vous l’êtes.
– Non sans peine, allez. Ah ! je vois encore l’auberge où j’ai couché la première nuit de mon arrivée à Paris ; elle était située tout en haut du faubourg Saint-Jacques. J’étais si las, que je dormis seize heures de suite. À mon réveil, je déjeunai d’abord fort bien ; puis, ayant reconnu que mes fonds baissaient terriblement, je me dis : « Il s’agit, mon garçon, de trouver de l’ouvrage tout de suite. »
Un sourire monta aux lèvres de Paul.
Il se rappelait ses premières déconvenues, en arrivant à Paris, et lui, cependant, il n’avait pas treize ans, mais vingt-deux ans ; il ne possédait pas quarante francs, il en apportait trois mille.
– Vous espériez, interrogea-t-il, trouver des travaux à faire ?
– Non, répondit l’artiste, j’était plus fort que cela. Je me disais que pour savoir une chose, il faut l’avoir apprise, et si je désirais si passionnément gagner de l’argent, c’était afin de pouvoir payer mes études.
Il y avait cent raisons pour que Paul ne soufflât mot.
– Heureusement, continua André, près de moi, pendant que je mangeais, un gros homme déjeunait :
« Monsieur, lui dis-je, regardez-moi, j’ai treize ans, mais je suis fort comme si j’en avais seize, je sais lire et écrire, j’ai du courage, une bonne volonté sans pareille, que dois-je faire pour gagner ma vie ? » Il me toisa une bonne minute, et d’une voix rude me répondit : « Va demain matin à la Grève, tu trouveras quelque maître maçon qui t’embauchera. »
– Et vous y êtes allé ?
– Heureusement pour moi. Dès quatre heures, le lendemain, je me promenais autour de l’Hôtel-de-Ville. Je rôdais dans les groupes d’ouvriers depuis assez longtemps, quand, tout à coup, je reconnais mon gros homme de la veille. Lui aussi, m’aperçoit. Il vient droit à moi : « Garçon, me dit-il, décidément tu me plais. Je suis entrepreneur de sculptures, veux-tu être mon apprenti ? tu aideras mes ouvriers ornemanistes, et ils t’enseigneront l’état ? »… Apprendre la sculpture ! Je crus voir les cieux s’entrouvrir. « Certes, je le veux, » répondis-je. Ce qui fut dit fut fait. Ce brave homme était Jean Lantier, le père de mon patron actuel.
– Mais votre peinture ?
– Oh !… la peinture n’est venue que plus tard. Il fallait commencer par me donner une certaine éducation. Tout en m’appliquant à mon apprentissage, je travaillais ; je fréquentais les écoles du soir, je suivais des cours de dessin, j’achetais des livres, et le dimanche… je me payais un professeur pour moi tout seul.
– Sur vos économies ?
– Mais oui. J’ai été bien des années avant d’oser m’offrir un verre de bière. – Six sous !… Diable ! c’était une somme. Enfin, le jour est arrivé où j’ai gagné quatre-vingts ou cent francs par semaine, comme les camarades, et c’est alors que je me suis mis à la peinture, mais les mauvais temps étaient passés…
– Et vous n’avez jamais été tenté de retourner à Vendôme ?
– Si, mais je n’y retournerai que le jour où il me sera possible de constituer une rente de 500 francs pour un pauvre moutard abandonné comme je l’ai été.
Si André, connaissant Paul, eut pris à tâche de le blesser et de faire saigner les plaies de sa vanité malade, il ne se fût pas exprimé autrement.
Chacune de ses phrases était tombée sur le cœur du protégé de B. Mascarot, plus douloureuse qu’un soufflet sur la joue.
Pourtant. Paul comprenait que la plus élémentaire politesse lui imposait une phrase flatteuse.
Il se fit donc violence, et dit :
– Quand on a votre talent on n’a besoin de personne.
Aussitôt, comme s’il eût voulu chercher une confirmation de son opinion, il se leva et se mit à tourner autour de l’atelier.
En apparence, il examinait les esquisses.
En réalité, il était attiré par ce tableau à bordure si riche, placé en face de lui, et caché par un rideau.
Ce tableau agaçait sa curiosité.
Pendant que se déroulait le récit d’André, si irritant et si humiliant pour lui Paul n’avait pu détacher ses regards de cette toile si exactement cachée.
Il réfléchissait, et plusieurs circonstances insignifiantes, inaperçues sur le moment, se représentaient vivement à son esprit, et lui paraissaient avoir entre elles une étroite relation.
Tout d’abord, il se souvenait des remarques de Mme Poileveu, la discrète concierge, au sujet de cette dame voilée qui, accompagnée d’une femme de chambre, venait parfois visiter le peintre.
En second lieu, quand il avait frappé, n’avait-on pas tardé à l’admettre ? N’avait-il pas entendu rouler un chevalet et tirer un rideau.
Puis encore, pourquoi cette tenue soignée ?
Enfin, quels motifs poussaient André à le prier de ne pas fumer ?
De tout cela, Paul concluait que le jeune peintre attendait ce jour-là même sa visiteuse mystérieuse, et que ce tableau ne pouvait être que son portrait.
De là, à souhaiter de soulever ce rideau importun, qu’André y consentît ou non, il n’y avait qu’un trait.
Aussi, tout en s’arrêtant et s’extasiant devant les esquisses, tout en prodiguant les « fort bien ! » et les « Ah ! très réussi ! » Paul manœuvrait de façon à se rapprocher insensiblement du chevalet.
Lorsqu’il se vit à portée, il étendit brusquement la main en disant :
– Et ceci, qu’est-ce ? La perle de l’atelier, sans doute.
Mais André, s’il manquait absolument de défiance, n’était pas dépourvu de finesse. Il avait remarqué la tactique de Paul et deviné ses intentions. Blessé dans sa délicatesse, il ne voulut rien dire, craignant peut-être de se tromper, mais il veilla.
En conséquence, au moment précis où Paul allongeait rapidement le bras, André étendit le sien plus vivement encore et l’arrêta.
– Si je cache ce tableau, dit-il en même temps, c’est que je ne veux pas qu’on le voie.
– Oh !… pardon, fit Paul en s’excusant.
Il cherchait à tourner en plaisanterie son indiscrétion, mais au fond il était très choqué du ton de l’artiste et le jugeait fort ridicule.
– Ah !… c’est ainsi, pensa-t-il, eh bien ! je vais prolonger ma visite, et si je n’ai pas réussi à voir le portrait, je verrai du moins l’original.
Sur cette belle résolution, il se jeta dans le grand fauteuil de cuir placé près de la table de travail et commença une longue histoire, bien décidé à ne pas apercevoir les gestes significatifs d’André, qui, à tout moment, tirait sa montre et semblait sur les épines.
Il parlait… il parlait… et il mettait à son récit d’autant plus d’animation que, presque sous sa main, il venait d’apercevoir une photographie représentant une jeune femme.
Profitant d’une distraction d’André, il put la prendre et l’examiner un moment avant de dire :
– Ma foi !… voici une jolie personne.
À cette remarque, le jeune peintre devint plus rouge que le feu, ses lèvres tremblèrent, et c’est avec une violence inouïe, qu’arrachant la carte des mains de Paul, il la serra dans un livre.
Ce mouvement brutal trahissait si bien une terrible colère, que le protégé de B. Mascarot se leva fortement ému. Et pendant une minute au moins, les deux jeunes gens restèrent debout, face à face, silencieux, se mesurant du regard comme auraient pu le faire deux ennemis mortels.
Ils se connaissaient à peine ; le hasard qui les avait réunis allait les séparer, et cependant chacun d’eux sentait vaguement, comprenait et se disait que l’autre aurait sur sa vie une influence décisive.
André, plus maître de soi, revint le premier.
– Je vous demande pardon, dit-il, je suis dans mon tort de laisser traîner des objets qui devraient être précieusement serrés.
Paul s’inclinait déjà en homme qui accepte une explication, quand le peintre ajouta :
– Cette confiance vient de l’habitude où je suis de ne recevoir chez moi que des amis. Il a fallu aujourd’hui une de ces exceptions imprévues…
D’un geste, Paul interrompit l’artiste.
– Croyez, monsieur, prononça-t-il d’un ton qu’il s’efforçait de rendre blessant, croyez que, sans l’impérieux devoir que vous savez, je n’aurais pas pris la liberté de pénétrer chez vous.
Il dit, pirouetta sur ses talons, et sortit en tirant violemment la porte.
– Eh !… va-t-en au diable, sot indiscret, murmura André ; aussi bien j’allais être forcé de te mettre dehors.
Quant à Paul, c’est le cœur gros de colère qu’il quittait l’atelier du peintre.
Venu avec l’honnête projet d’humilier de l’étalage de sa prospérité suspecte un obligeant camarade, il se retirait écrasé.
Se comparant à ce héros de la Volonté, si grand et si modeste, il se sentait petit, mesquin, ridicule, presque odieux ; et il le haïssait pour toutes les nobles qualités qu’il était contraint de lui reconnaître ; oui, il le haïssait à la mort.
– C’est égal, se disait-il, je n’en aurai pas le démenti, je la verrai, cette invisible inconnue.
En effet, sans réfléchir à la bassesse de sa conduite, il traversa la rue et alla se mettre en observation devant la maison d’André.
Il grelottait, mais les piètres esprits ont pour la satisfaction de leurs puériles rancunes une ténacité qu’ils ne sauraient appliquer aux choses sérieuses.
Il attendait bien depuis une bonne demi-heure, quand enfin un fiacre s’arrêta devant le n°… Deux femmes en descendirent, l’une très jeune, dont la distinction sautait aux yeux ; l’autre vêtue comme les suivantes de bonne maison.
Sans vergogne, Paul s’approcha, et, en dépit d’un voile assez épais, il reconnut parfaitement la jeune femme de la photographie.
– Et bien ! fit-il, franchement, j’aime mieux Rose, et la preuve c’est que je vais la rejoindre de ce pas. Nous allons payer la Loupias et quitter pour toujours cet abominable Hôtel du Pérou.
VIII
Le protégé de B. Mascarot n’avait pas été le seul à épier la visiteuse du jeune peintre.
Au bruit de la voiture, Mme Poileveu, la plus discrète des concierges, était venue se planter sur le seuil de la porte, les yeux obstinément attachés sur la jeune dame.
Lorsque les deux femmes entrèrent, au lieu de s’effacer pour leur livrer passage, Mme Poileveu sortit. Elle avait son idée.
– Mauvais temps, n’est-ce pas ? dit-elle au cocher. Il ne fait pas bon sur le siège, l’hiver.
– Ne m’en parlez pas, répondit l’homme, j’ai les pieds morts.
– Vous deux pratiques viennent peut-être de loin ?
– Du diable ! Je les ai prises tout en haut des Champs-Élysées, près de l’avenue de Matignon.
– Une fameuse trotte !
– Oui, et quatre sous de pourboire. Quel malheur !… Tenez, ne me parlez pas des femmes honnêtes.
– Oh !… honnêtes !…
– Ça, je le garantis. Les autres donnent plus, je m’y connais.
Et en même temps, satisfait d’avoir fait preuve de pénétration, il enveloppa son cheval d’un coup de fouet inoffensif et s’éloigna.
Mme Poileveu, elle, regagnait sa loge à moitié contente.
– Je sais toujours, murmurait-elle, le quartier de la princesse. C’est bien le cadet de mes soucis ; mais enfin !… la prochaine fois j’offrirai quelque chose à la femme de chambre, un rien, du doux, et elle me dira tout…
C’est un chimérique espoir que caressait là Mme Poileveu.
Cette femme de chambre, absolument dévouée à sa maîtresse, étaient indignée des regards obstinés qui chaque fois lui étaient adressés et, tout en gravissant l’escalier, elle se plaignait amèrement de ce qu’elle appelait une horrible insolence.
Dans sa colère, elle ne parlait rien moins que de raconter ces avanies à André, qui ne manquerait pas de rendre cette mégère plus respectueuse.
Mais la seule idée d’une plainte effraya si fort la jeune dame qu’elle s’arrêta, se retournant vers sa femme de chambre :
– Je te défends, Modeste, fit-elle bien bas, je te défends expressément de dire un seul mot de cela à André.
– Mais, mademoiselle…
– Chut !… Veux-tu donc me faire de la peine ? Allons, viens, il m’attend.
Oh ! oui, elle était attendue avec ces transes délicieuses, ces anxiétés divines de la vingtième année.
Depuis le départ de Paul, André ne restait plus en place : il lui semblait qu’il eût fait tenir l’éternité dans chaque seconde qui s’écoulait. Il avait laissé la porte de son atelier ouverte, et à chaque moment, croyant distinguer quelque bruit, il courait à l’escalier.
Enfin, il l’entendit réellement, ce bruit harmonieux comme une musique céleste, le froissement de la robe de la femme aimée.
Penché sur la rampe, il l’aperçut, c’était bien elle, oui, elle arrivait au second étage, au troisième… enfin elle entrait chez lui, dans son atelier dont il refermait la porte.
– Bonjour, André, dit-elle, en lui tendant la main, vous voyez que je suis exacte.
Pâle d’émotion, plus tremblant que la feuille, André prit cette main qui lui était tendue et l’effleura respectueusement de ses lèvres en balbutiant :
– Mademoiselle Sabine… Oh ! vous êtes bien bonne… Merci !…
C’était bien Sabine, en effet, l’unique héritière de l’antique et orgueilleuse maison de Mussidan, qui était là, chez André, l’enfant trouvé de l’hôpital de Vendôme.
C’était Sabine, une jeune fille naturellement réservée et timide, élevée dans le respect des conventions sociales, qui risquait ainsi ce qu’elle avait de plus précieux au monde, son honneur, sa réputation.
C’était elle qui, bravant les préjugés de son éducation et de sa race, osait franchir l’effrayant abîme qui séparait le salon de la rue de Matignon de l’atelier de la rue de La Tour-d’Auvergne.
Il est de ces témérités que la raison admet à peine, mais que le cœur se charge d’expliquer aisément.
Depuis près de deux ans Sabine et André s’aimaient.
C’est au château de Mussidan, au fond du Poitou, qu’ils s’étaient rencontrés pour la première fois, réunis par un de ces concours de petits événements qui seront l’éternelle confusion de la prudence humaine.
L’homme conçoit et combine des projets, mais au-dessus plane la Providence – les imbéciles disent : le hasard – dont la main prévoyante arrange et dispose tout pour l’accomplissement de ses impénétrables desseins.
À la fin de l’été de 1865, André, dont un travail excessif altéra la santé, projetait un voyage, lorsque Jean Lantier, son patron, le fit, un soir, prier de passer chez lui.
– Si vous voulez, lui dit-il, vous reposer et gagner trois ou quatre cents francs du même coup, j’ai, je crois, votre affaire. Un architecte me demande un sculpteur pour quelques travaux en province, dans un pays magnifique, vous plairait-il de vous en charger ?
La proposition convenait si bien à André, que dès la fin de la semaine il se mit en route, se promettant un mois de bon temps.
Tout devait lui réussir. Le jour même de son arrivée à Mussidan, ayant examiné le travail pour lequel on l’avait mandé, il reconnut qu’il serait un jeu pour lui. Il s’agissait d’exécuter quelques raccords le long d’un balcon récemment réparé. Le tout pouvait être aisément fini en moins d’une quinzaine.
Mais il ne se pressa pas. Le pays lui plaisait, il trouvait dans les environs des motifs d’études charmants, et sa santé se rétablissait à vue d’œil.
Puis, raison impérieuse et qu’il ne s’avouait qu’à demi, de ne pas se hâter, il avait entrevu dans le parc, glissant comme une ombre entre les arbres, une jeune fille dont un seul regard l’avait ému d’une émotion nouvelle pour lui et délicieuse.
Cette jeune fille était Sabine.
Les chaleurs venues, le comte de Mussidan était parti pour l’Allemagne, la comtesse s’était réfugiée à Luchon, et ils n’avaient trouvé rien de plus sage que d’envoyer leur fille passer quelques mois en ce vieux manoir de famille, sous la protection d’une de leurs parentes très âgée, la douairière de Chevauché.
L’histoire des deux jeunes gens, histoire simple et naïve, fut celle de tous ceux qui ont été vraiment jeunes et qui ont aimé.
Une niaiserie fut le prétexte des premières paroles qu’ils s’adressèrent en rougissant autant l’un que l’autre.
Le lendemain, Sabine vint sur le balcon voir travailler André, prenant un plaisir enfantin au mouvement des outils façonnant la pierre dure.
Qui lui eût dit qu’elle s’intéressait au sculpteur et non à la sculpture l’eut certes profondément surprise. Cela était ainsi, pourtant.
Quoiqu’il fût plus troublé qu’il ne l’avait été de sa vie, André osa lui adresser la parole.
Ils causèrent longtemps, et elle était stupéfiée de l’élévation des pensées de ce jeune homme qui, avec sa grande blouse blanche et son chapeau de feutre souple, lui avait paru un ouvrier ordinaire.
Ignorante et inexpérimentée, Sabine pouvait ne pas démêler au juste les sentiments qui tressaillaient en elle.
André ne s’abusa pas.
Un soir, après un sévère examen de conscience, il fut obligé de s’incliner devant la réalité.
– Il est clair que je suis amoureux ! murmura-t-il.
Puis une lueur de raison éclairant sa folie, il mesura les infranchissables obstacles qui le séparaient de cette jeune fille si noble et si riche, et il fut saisi d’effroi.
– Il faut fuir, s’écria-t-il, bien vite, sans réfléchir, sans retourner la tête ; il ne fait pas bon pour moi ici.
On dit cela de la meilleure foi du monde, on prend parti, et ensuite… On reste… Ainsi fit André.
Il est vrai que la fatalité, comme toujours, sembla s’en mêler.
Le château de Mussidan est assez éloigné de tout centre de population. Pour gagner le village le plus proche, il faut traverser une partie des bois de Bivron. En conséquence, lorsque André arriva, il fut décidé qu’il prendrait ses repas au château.
Il mangeait seul, aux heures qu’il indiquait, dans la grande salle, servi par le vieux domestique de Mme de Chevauché.
Bientôt cet isolement parut à Sabine la plus énorme des inconvenances et la plus juste des humiliations.
– Pourquoi M. André ne prend-il pas ses repas avec nous ? demandait-elle à sa tante. Il est certes bien mieux que nombre de gens que nous recevons, et il te distrairait.
La vieille dame adopta cette idée. Assurément, il lui paraissait prodigieux d’admettre à sa table un jeune homme qui, grimpé sur une échelle, taillait des pierres à la journée ; mais elle s’ennuyait tant !… L’imprévu la décida.
Invité sur le moment même, André accepta, et la vieille dame faillit tomber de son haut quand, à l’heure du dîner, elle vit entrer un convive qui avait la tenue, les façons, l’aisance d’un gentleman en villégiature.
C’est à n’y pas croire, disait-elle en se couchant, à sa nièce, voici un tailleur de pierres qui a tout l’air d’un grand seigneur. C’est la fin. Il n’y a plus de rang ; je n’aperçois que confusion ; nous marchons vers le chaos ; il est temps que je meure.
Malgré tout, André avait su se concilier les bonnes grâces de la douairière, et comme il n’était pas dépourvu d’adresse, il acheva sa conquête en lui brossant un portrait qui, pour être réussi et ressemblant, n’en était pas moins outrageusement flatté.
Admis de ce moment à l’intimité, ne craignant plus d’être froissé, il devint, lui si réservé d’ordinaire, expansif et causeur.
Même une fois, Mme de Chevauché l’ayant un peu taquiné, il conta l’histoire de sa vie, simplement, comme il l’avait contée à Paul, mais avec plus de détails.
Ce récit était bien fait pour enflammer l’imagination d’une jeune fille, non pas romanesque, l’expression serait exagérée, mais chevaleresque.
Sabine fut émerveillée de cet héroïsme obscur, le seul possible, le seul vrai, à notre époque. Elle fut stupéfiée de l’énergie de cet homme, qui, jeté tout enfant au milieu de la mêlée atroce des intérêts, avait su prendre sa place. Elle admira sa grandeur, son génie, son ambition. Elle vit en lui, et elle voyait bien, cet être supérieur que rêvent les jeunes filles.
Enfin, elle l’aima et elle osa s’avouer qu’elle l’aimait. Et pourquoi non ?
Leurs destinées, si dissemblables en apparence, n’étaient-elles pas pareilles en réalité ?
Entre un père et une mère qui fuyaient avec une égale horreur le foyer domestique, Sabine était aussi abandonnée qu’André.
Mais alors, leurs journées s’envolaient plus rapides que des secondes.
Oubliés, pour ainsi dire de la terre entière, au fond de ce château perdu, ils étaient libres comme l’air.
Ce n’était certes pas Mme de Chevauché qui les gênait.
Régulièrement, après le déjeuner, la vieille dame priait André de lui lire sa gazette, et régulièrement aussi entre la vingtième et la trentième ligne, selon que le temps était orageux ou non, elle s’endormait d’un sommeil profond qu’il était défendu, sous les peines les plus sévères, de troubler.
Les deux jeunes gens alors s’échappaient sur la pointe du pied, riants, gais comme des écoliers qui ont trompé la surveillance du maître.
Et ils allaient, au hasard, tantôt marchant à petits pas le long des immenses avenues du parc, à l’ombre des grands chênes, tantôt courant en plein soleil le long des roches rouges du bois de Bivron.
D’autres fois, montant un vieux bateau vermoulu qu’André étanchait tant bien que mal, ils s’aventuraient sur la petite rivière bordée d’iris et de glaïeuls, tout encombrée de canetée et de nénuphars.
Deux mois s’écoulèrent ainsi, deux mois pleins, enchantés, splendides.
Deux mois du plus pur et du plus noble amour, pendant lesquels le mot amour ne monta pas une seule fois de leur cœur à leurs lèvres.
Après avoir lutté longtemps contre l’entraînement d’une passion qu’il sentait devoir être sa vie, et à laquelle, cependant, il ne voyait pas d’issue, André avait fini par ne plus vouloir réfléchir.
Il se défendait de songer à l’avenir comme un poitrinaire s’interdit de penser à son mal.
Il pressentait un coup de foudre… mais en l’attendant, chaque soir il remerciait Dieu de lui avoir accordé encore un jour de rémission.
– Non, se disait-il parfois, ce bonheur est trop grand ; il ne saurait durer.
Il ne dura pas.
Préoccupé de l’idée de justifier son séjour à Mussidan, André, après avoir achevé ses raccords, s’était imaginé de doter le vieux manoir d’un chef-d’œuvre moderne.
Il avait entrepris de faire jaillir de la pierre de l’antique balcon une guirlande de volubilis et de vigne folle. Chaque jour, alors que tout le monde dormait encore, il avançait sa tâche.
Un matin, il allait se mettre à la besogne, lorsque le vieux valet qui l’avait servi dans les premiers temps vint le prévenir que Mme de Chevauché désirait lui parler.
– Madame m’a ordonné, ajouta le bonhomme, de vous amener tout de suite, tel que vous seriez.
Un pressentiment sinistre, plus aigu que la lame d’un poignard, traversa le cœur du jeune artiste. Il devina, il comprit que c’en était fait de son rêve, et c’est du pas du condamné qu’on traîne à l’échafaud qu’il suivit le domestique.
Au moment d’ouvrir la porte du salon où se trouvait la tante de Sabine :
– Prenez garde à vous, monsieur, recommanda le bon serviteur, madame est dans un état !… Je ne l’ai jamais vue ainsi depuis le jour où défunt notre maître… Enfin, suffit.
Elle était, en effet, dans une effroyable colère, la vieille dame, et, en dépit de son rhumatisme, elle allait de long en large dans le salon, son haut bonnet monté campé de travers, gesticulant, faisant sonner sur le parquet sa canne à bec de corbin.
À la vue d’André, elle s’arrêta soudain, la tête rejetée en arrière, choisissant la plus imposante des attitudes.
– Eh bien !… mon garçon, s’écria-t-elle de cette voix bonasse que tenaient en réserve pour les belles occasions les femmes de l’ancienne aristocratie, tu t’avises, à ce qu’on me rapporte, d’aimer ma nièce et de lui faire la cour !…
Elle le tutoyait, ma foi !… ni plus ni moins qu’un valet de ferme, pensant ainsi lui faire comprendre et la bassesse de sa condition et son audace.
De pâle qu’il était, André devint cramoisi jusqu’à la racine des cheveux.
– Madame !… balbutia-t-il.
– Vertu de ma mère !… interrompit la douairière ; vas-tu pas nier, quand tu as sur la face un pouce de fard qui avoue pour toi ! Sais-tu qu’il faut que tu sois un drôle bien outrecuidant d’avoir osé élever tes regards jusques à Mlle Sabine de Mussidan. D’où t’es venue cette impertinence ! De mes trop grandes bontés, sans doute ? Espérais-tu la séduire ou comptais-tu demander sa main ?…
– Je vous jure, madame, sur mon honneur !…
– Sur ton honneur !… Ne croirait-on pas entendre un gentilhomme ? Jour de Dieu !… si feu le chevalier de Chevauché était encore de ce monde, il te ferait sortir le dernier souffle du corps sous le bâton. Moi, je me contente de te chasser. Ramasse tes outils, mon garçon, et va tailler tes pierres ailleurs.
André ne bougeait pas. Il était comme pétrifié. Lui, d’ordinaire si impatient du mépris, il ne remarquait pas l’outrageante façon dont on le traitait.
Il ne voyait qu’une chose, c’est qu’on le chassait, c’est qu’il ne verrait plus Sabine.
Sa mâle énergie ne tint pas contre ce malheur, le plus affreux qu’il pût imaginer, et il éclata en sanglots, comme un enfant.
L’explosion de cette douleur immense était si inattendue, si déchirante chez un tel homme, que la vieille dame en fut bouleversée.
Elle se détourna brusquement et fut plus d’une minute avant de pouvoir reprendre la parole.
– J’ai été dure avec vous, monsieur André, dit-elle enfin, – revenant au vous. J’ai le malheur d’être vive. Ce qui est arrivé est de ma faute, ainsi que me l’a fait sentir M. le curé de Bivron, qui s’est dérangé au petit jour pour venir me prévenir, ce dont je lui rends grâces. Je suis si vieille que j’ai oublié ce qu’est la jeunesse. J’étais seule à ne me douter de rien, quand tout le pays jasait de vous et de ma nièce.
André eut un geste de menace si terrible, que rien qu’en le voyant, les six cents habitants de Bivron eussent pris la fuite, terrifiés.
– Ah ! s’écria-t-il, si je tenais les misérables qui ont osé…
– Bon !… interrompit Mme de Chevauché à qui cette vigoureuse indignation ne déplaisait pas, espérez-vous couper toutes les mauvaises langues ? Il n’y a point eu de mal, c’est l’essentiel, partez, oubliez ma nièce.
Partez, oubliez !… Autant valait dire à André : Mourez !
– Madame, commença-t-il avec un accent désolé, de grâce, écoutez-moi. Je suis jeune, j’ai du courage !…
Son désespoir avait une telle intensité d’expression, ses regards suppliaient si bien, sa voix était à ce point brisée, que la vieille dame émue, attendrie, sentit une larme chaude glisser le long de sa joue ridée.
– À quoi bon me dire tout cela ? fit-elle. Est-ce que Sabine est ma fille ? Tout ce que je puis faire, c’est de ne rien dire au père de ma nièce de cette algarade. Jour de ma vie ! Si Mussidan se doutait seulement de cela ! Allons ! en voilà assez, je me sens toute remuée… Je suis capable de n’en pas manger de deux jours.
André sortit, se tenant aux murs. Il lui semblait que le parquet, sous ses pas, oscillait comme le pont d’un navire. Ses idées tourbillonnaient comme la feuille sèche au gré de l’ouragan ; il n’y voyait plus.
Mais, dans le grand vestibule qui précède le salon, il sentit qu’on lui prenait la main. Il fit un effort pour ressaisir sa pensée ; il parvint à regarder, à voir.
Plus immobile, plus blanche et plus glacée qu’une statue, Sabine était devant lui.
– J’étais là, monsieur André, dit-elle, j’ai tout entendu !
– Oui, balbutia-t-il, c’est fini, on m’a chassé, je pars.
– Où allez-vous ?
– Eh !… le sais-je ? répondit-il, avec un geste d’horrible résignation, je vais obéir, je sortirai d’ici, et puis… j’irai, je marcherai.
Il sentait la folie envahir son cerveau, il voulut s’éloigner, Sabine le retint.
– Vous désespérez donc ? demanda-t-elle.
Il la regarda avec des yeux qui lui firent peur et d’une voix éteinte répondit : Oui.
Jamais Sabine n’avait été si belle. Ses yeux brillaient de la flamme des plus généreuses résolutions, son visage avait une expression sublime.
– Si cependant, reprit-elle, si je vous montrais au loin, dans l’avenir, une espérance… que feriez-vous ?
– Ce que je ferais ! s’écria André avec une exaltation délirante, tout ! oui, tout ce qui humainement est possible à un honnête homme. Qu’on multiplie autour de vous les obstacles, je les renverserai ; qu’on m’impose les plus difficiles conditions, je les remplirai. Faut-il une fortune ? je la gagnerai ; du talent ? un nom illustre ? je l’aurai.
– Il faut autre chose encore, monsieur André, que vous oubliez : de la patience.
– Mais j’en ai, mademoiselle ; j’en aurai ! Ne comprenez-vous donc pas qu’avec un mot de vous je puis vivre trois existences, heureux, attendant et espérant !
Mlle de Mussidan, à ces mots, posa une de ses mains sur le bras d’André et leva l’autre vers le ciel qu’elle prenait à témoin.
– Alors, dit-elle, travaillez et espérez, André !… Car, je vous le jure devant Dieu, je serai votre femme ou je mourrai fille. S’il faut lutter, je lutterai, parce que je vous…
Un bruit terrible, au fond du vestibule, lui coupa la parole.
C’était la vieille dame de Chevauché, qui, de sa canne à bec de corbin, frappait contre la porte de toutes ses forces.
– Encore ici !… criait-elle de sa voix plus éclatante qu’une trompette.
André s’enfuit, éperdu de bonheur, emportant au fond de son âme un de ces espoirs enivrants qui font épuiser, sans une plainte, tous les dégoûts de la réalité.
Que se passa-t-il, après son départ, entre Mme de Chevauché et sa nièce ? Les domestiques remarquèrent qu’après une longue conférence elles avaient les yeux fort rouges l’une et l’autre.
Peut-être Sabine réussit-elle à ramener la vieille dame à son parti. Ce qui est sûr, c’est que, lors de sa mort, survenue deux mois plus tard, la douairière laissa tout son bien, deux cent mille livres, à Sabine, directement.
Par un testament très bien fait et inattaquable, elle assurait à la jeune fille les revenus d’abord, puis le capital entier le jour de sa majorité ou de son mariage « conclu avec ou sans l’assentiment de ses parents. »
Cette clause fit même dire à la comtesse de Mussidan :
– Notre pauvre tante perdait un peu la tête sur la fin.
Non, elle ne perdait pas la tête, et Sabine et André le comprenaient bien, lorsqu’ils pleuraient l’excellente femme qui, par ses dispositions dernières, avait voulu venir en aide à leurs amours.
Ils étaient alors à Paris l’un et l’autre, et si André redoublait d’énergie, Sabine tenait toutes ses promesses.
À Paris, Mlle de Mussidan était, s’il est possible, plus libre qu’au fond du Poitou.
Pour contrôler et surveiller ses actions, elle n’avait que sa fidèle Modeste, qui lui eût été dévouée jusqu’au crime, s’il l’eût fallu.
Sabine, à son tour, avait donc permis à André de lui écrire, et elle lui répondait fort exactement.
Plus tard, elle lui accorda quelques entrevues. En dernier lieu, cédant à ses vives instances, elle avait consenti à venir à son atelier, toujours accompagnée de Modeste.
Il est vrai de dire que jamais souveraine visitant des sujets dévoués, que jamais madone menée en procession ne furent l’objet d’une adoration aussi respectueuse que celle qui entourait Sabine dans l’humble logis de l’artiste.
IX
Il avait fallu à Mme de Mussidan la certitude complète, absolue, d’un respect sans bornes, pour la décider à venir chez André.
Sûre de son empire, elle n’avait rien à redouter.
En pénétrant dans cet humble atelier, tout plein de sa pensée, elle devait se sentir chez elle, comme la vierge dans son sanctuaire, encore parfumé de l’encens de la veille.
Aussi, à la voir si parfaitement simple, si calme, si naturelle, jamais on ne se serait douté qu’elle osait la plus grave, la plus périlleuse démarche que puisse hasarder une jeune fille.
Après avoir donné la main à André, elle dénoua lentement les brides de son chapeau, le retira et le remit à Modeste en disant :
– Suis-je bien ainsi, mon ami ?
L’exclamation passionnée de l’artiste à cette demande la fit sourire, et c’est gaiement qu’elle ajouta :
– Je veux dire : Suis-je bien comme je dois être pour mon portrait ?
Sabine de Mussidan était belle ; mais comparer sa beauté à celle de Rose, comme l’avait fait Paul, eût été une sottise et un blasphème.
Belle d’une beauté grossière et sensuelle, Rose pouvait tout au plus surprendre les sens et allumer les caprices d’un libertin.
La beauté de Sabine était de celles qui empruntent à l’idéal une irrésistible puissance et des séductions presque immatérielles à force d’être profondes.
Rose enchaînait le corps aux boues de la terre ; Sabine emportait l’âme vers le ciel.
Pour juger Mlle de Mussidan, on devait la connaître et, en quelque sorte, être digne d’elle.
Sa chaste beauté n’était pas de celle qui rayonnent et éblouissent. Une expression de placidité résignée, une réserve un peu hautaine en obscurcissaient l’éclat. Elle pouvait passer inaperçue comme un Raphaël oublié sous une couche de poussière, au fond d’une pauvre église de village.
Mais, quand on l’avait remarquée, on ne se lassait plus d’admirer son front impérieux couronné d’un diadème de cheveux noirs, fins et ondés, ses grands yeux profonds et doux, ses lèvres exquises de délicatesse, son teint si transparent qu’on voyait le sang frémir sous la peau.
Elle avait adopté pour son portrait une coiffure depuis longtemps passée de mode, qui lui seyait à merveille, et c’est en songeant à cette coiffure qu’elle avait dit : Suis-je bien ?
– Hélas ! répondit André, c’est en vous voyant que je reconnais mon impuissance. Il y a une heure, en contemplant mon ouvrage, je me disais : C’est achevé. Je reconnais que je n’ai rien fait.
Il avait écarté le rideau de serge, et le portrait de Sabine apparaissait en pleine lumière.
Ce n’était pas un chef-d’œuvre, André n’avait pas vingt-quatre ans, et avant d’étudier il était obligé de gagner son pain de chaque jour. Mais c’était une de ces compositions qui portent le cachet d’une individualité puissante, et dont les défauts même et les inexpériences ont une saveur d’originalité qui attire et qui charme.
Sabine resta une minute immobile devant la toile, et c’est de l’accent de la plus sincère conviction qu’elle dit :
– Cela est beau !
Le jeune peintre était bien trop découragé pour être sensible à cet éloge.
– C’est ressemblant, dit-il, mais la photographie que vous m’avez donnée est ressemblante aussi. Je n’ai pas su fixer sur la toile un reflet de votre âme. C’est une ébauche vulgaire, je recommencerai, et alors…
D’un geste, Sabine l’interrompit !
– Vous ne recommencerez pas, fit-elle d’une voix douce, mais ferme.
– Pourquoi ? demanda-t-il, tout surpris.
– Parce que, mon ami, à moins d’événements graves, ma visite d’aujourd’hui sera la dernière.
Cette réponse foudroya André.
– La dernière !… balbutia-t-il, que vous ai-je fait, ô mon Dieu ! pour que vous me punissiez si cruellement ?
– Je ne vous punis pas, André, répondit Sabine. Vous avez voulu mon portrait, j’ai cédé à vos instances, je ne m’en repens pas. Écoutons maintenant la voix de la raison. Ne comprenez-vous donc pas, malheureux, que je ne puis continuer à jouer mon honneur de jeune fille qui est le vôtre ? Avez-vous songé à ce que dirait le monde, s’il venait à savoir que je viens chez vous, que j’y passe des après-midi ?… Répondez.
Il ne répondit pas, il se raidissait contre le coup affreux.
– D’ailleurs, reprit Mlle de Mussidan, à quoi nous avance une toile qu’il faut cacher comme une mauvaise action ? Oubliez-vous que de votre succès rapide dépend notre avenir, notre… mariage ?
– Oh ! non, non, je n’oublie pas.
– Poursuivez donc le succès. Ce n’est pas tout que je dise : « Je n’ai pas fait un choix vulgaire, » il faut que vous le prouviez par vos œuvres.
– Je le prouverai.
– Je le crois, ô mon unique ami ! J’en suis sûre. Mais rappelez-vous nos chères conventions d’il y a un an. Je vous ai dit : « Devenez célèbre, et alors venez hardiment demander ma main au comte de Mussidan, mon père. S’il vous la refuse, si mes prières ne le touchent pas, eh bien ! en plein midi, je sortirai de l’hôtel à votre bras. Et après un tel éclat…
André était convaincu.
– Vous avez raison ! s’écria-t-il. Fou je serais si je sacrifiais tout un avenir de félicités pour un bonheur de quelques jours, si grand qu’il puisse être. Vous entendre d’ailleurs, c’est obéir.
Mlle de Mussidan s’était assise dans le grand fauteuil, André prit place près d’elle, sur un petit escabeau de chêne sculpté.
– Nous voici donc d’accord, fit-elle, avec un bon sourire qui versait des flots d’espérance dans le cœur de son ami, profitons-en un peu pour causer de nos intérêts que nous négligeons, ce me semble, terriblement.
– Leurs intérêts !… c’était le succès d’André.
Tout ce que tentait le jeune artiste, tout ce qui lui était proposé, il le disait à son amie, et gravement ils tenaient conseil.
– Eh bien !… commença André, je suis cruellement embarrassé. Avant-hier, le prince Crescenzi, le célèbre amateur, est venu visiter mon atelier. Une de mes esquisses lui a plus, il m’a commandé un tableau qu’il me paiera six mille francs.
– Mais c’est un coup de fortune, cela ?
– Oui, malheureusement, il le veut tout de suite. D’un autre côté, Jean Lantier, surchargé de travail, m’offre de me charger de toute l’ornementation d’une maison immense que fait bâtir aux Champs-Élysées un riche entrepreneur, M. Gandelu, je prendrais des ouvriers, et je pourrais gagner là sept ou huit mille francs.
– Où est l’embarras ?
– Voilà. J’ai vu déjà deux fois M. Gandelu, il a choisi des cartons, et il veut que je me mettre à sa bâtisse la semaine prochaine. Je ne puis accepter les deux choses, il faut choisir.
Sabine se recueillit un instant.
– Moi, dit-elle, je choisirais le tableau.
– Eh !… moi aussi, seulement…
Mlle de Mussidan connaissait assez les affaires de son ami pour deviner les causes de son hésitation.
– Ah ! murmura-t-elle, que ne m’aimez-vous assez pour vous rappeler que je suis riche ? Nos projets n’iraient-ils pas plus vite si vous consentiez…
André était devenu blême.
– Voulez-vous donc, s’écria-t-il, empoisonner la pensée de notre amour ?
Elle soupira, mais elle n’insista pas.
– Choisissons donc, fit-elle, je dois, mon ami, vous instruire d’une contrariété qui me menace. Il est question pour moi d’un mariage avec M. de Breulh-Faverlay.
– Ce millionnaire qui fait courir ?
– Précisément. Résister aux désirs de mon père amènerait une explication, et je n’en veux pas. J’ai donc décidé que j’avouerais la vérité à M. de Breulh. Je le connais, c’est un honnête homme ; il se retirera. Que pensez-vous de mon idée ?
– Hélas ! fit André désolé, je pense que si celui-là se retire, un autre se présentera.
– C’est probable… et nous le congédierons pareillement. Ne dois-je pas avoir ma part de difficultés ?
Mais ces difficultés épouvantaient le malheureux artiste.
– Quelle vie sera la nôtre, murmura-t-il, quand il vous faudra résister aux obsessions de votre famille !
Elle le regarda fièrement et répondit :
– Est-ce que je doute de vous, André ?
Mlle de Mussidan était prête. André voulait aller lui chercher une voiture ; elle refusa, disant que Modeste et elle étaient de bonnes marcheuses, et que certainement elle trouveraient un fiacre en route.
Comme à son entrée, elle abandonna sa main à André, et enfin elle sortit en disant :
– Je verrai M. de Breulh demain. À demain une lettre.
André était seul. Lorsque Mlle de Mussidan s’était éloignée, il lui avait semblé sentir la vie se retirer de lui.
Mais son abattement ne dura pas. Une triomphante inspiration venait de traverser son cerveau.
– Sabine, se dit-il, est partie à pied, il ne dépend donc que de moi de la voir quelques instants encore. Je puis, sans la compromettre, la suivre de loin…
Dix secondes plus tard, il était dans la rue.
Il faisait nuit, et cependant au bas de la pente de la rue de La Tour-d’Auvergne, il reconnut, il devina plutôt, Sabine et sa femme de chambre.
C’est encore du bonheur ! pensa-t-il, en s’élançant sur leurs traces.
Elles allaient rapidement, mais il eut vite amoindri la distance, et c’est à dix pas en arrière qu’il suivit, comme elles, la rue de Laval, puis la rue de Douai.
Il allait, et il admirait la démarche de Sabine, sa distinction, la façon charmante dont elle détournait sa robe au lieu de la relever.
– Et dire, songeait-il, qu’un jour viendra peut-être où j’aurai le droit de sortir avec elle. Je sentirai son bras charmant s’appuyer sur le mien…
Cette seule idée le faisait tressaillir comme le contact d’une pile électrique.
Sabine et Modeste arrivaient alors à la rue Blanche. Elles arrêtèrent un fiacre et y montèrent. La vision s’évanouit.
La voiture était déjà bien loin, qu’André restait encore au coin du trottoir, planté sur ses pieds, regardant de toutes ses forces.
Cependant il ne pouvait demeurer là éternellement.
Il s’était décidé à reprendre lentement le chemin de son atelier, lorsque vers le milieu de la rue de Douai, comme il passait devant une boutique éclairée, il entendit une voix jeune et joyeuse qui l’appelait par son nom.
– Monsieur André ! monsieur André !
Il leva la tête, brusquement, comme un homme qu’on éveille, et regarda.
Devant lui, près d’un coupé tout neuf, attelé de deux beaux chevaux, une jeune femme en toilette tapageuse lui faisait des signes d’amitié.
Il eut besoin d’un effort de mémoire pour la reconnaître.
– Je ne me trompe pas, dit-il enfin… Mademoiselle Rose, n’est-ce pas ?
Mais, derrière lui, presque à son oreille, une voix de fausset éclata, qui le reprit :
– Dites Mme Zora de Chantemille, s’il vous plaît.
André se retourna et se trouva nez à nez avec un jeune monsieur qui venait de donner des ordres au cocher du coupé.
– Ah ! fit-il un peu surpris et reculant d’un pas.
– C’est ainsi, appuya le jeune monsieur. Chantemille est le nom de la terre que je donne à madame le lendemain de la mort de papa.
C’est avec une manifeste curiosité que le peintre examina ce donneur de terres.
Veston court, gilet rond, chapeau plat, jambes cagneuses, médaillon énorme pendu à une chaîne d’or, binocle, gants rouges… Il était d’un ridicule achevé.
Quant à la physionomie, en disant : « Un singe !… » Toto-Chupin n’avait pas sensiblement exagéré.
– Bast !… s’écria Rose, que fait le nom !… L’important est que monsieur, qui est de mes amis, dîne avec nous.
Et sans attendre une réponse, brusquement, elle poussa André dans un vestibule brillamment éclairé.
– Eh bien !… disait le jeune monsieur, elle est bonne celle-là ! Oui, je la trouve très bonne !… Enfin… Les amis de nos amis sont nos amis.
Tout ahuri de cette attaque imprévue, André se défendait de son mieux mais sans avantage. Jalouse de montrer son pouvoir naissant, Rose était placée devant la porte, et elle répétait :
– Vous dînerez avec nous, je le veux !… je le veux !
Puis comme elle était experte en belles manières, elle prit en même temps la main d’André et celle du jeune monsieur, en disant :
– Monsieur André, je vous présente M. Gaston de Gandelu. M. de Gandelu…, M. André, artiste peintre.
Les deux jeunes gens s’inclinèrent.
– André !… faisait le jeune M. Gaston, j’ai entendu ce nom-là. J’ai vu la figure aussi… Ah ! j’y suis, c’est chez papa. N’est-ce pas vous, monsieur, qui devez sculpter sa maison ?
– En effet, monsieur.
– Alors, vous êtes des nôtres. Nous pendons une crémaillère, ce soir… Hein ! elle est forte celle-là !… Vous savez, plus on est de fous, plus on rit.
André résistait encore.
– Je ne puis, disait-il, j’ai un rendez-vous urgent !…
– Un rendez-vous !… Ah ! mais non !… je la connais, celle-là, on ne me la fait pas.
André se taisait, indécis. Il était dans un de ces moments de tristesse morne, où on éprouve le secret désir de se dissiper, d’échapper en quelque sorte à soi-même.
– Au fait, pensa-t-il, pourquoi ne pas accepter ! Si les amis de ce jeune homme lui ressemblent, ce sera drôle.
– Allons, s’écria Rose en s’élançant vers l’escalier, voilà qui est dit.
André s’apprêtait à la suivre, mais M. de Gandelu, mystérieusement, le retint par le revers de son pardessus.
– Hein ! lui dit-il d’un air ravi, quelle femme !… Et encore, vous ne voyez rien… Attendez que je l’aie formée, je ne vous dis que ça. D’abord moi, pour lancer une femme, je n’ai pas mon pareil. Demandez plutôt à Auguste de chez Riche.
– Cela se voit, fit André le plus sérieusement du monde.
– N’est-ce pas ? Moi, d’abord, je suis comme ça, carré, et il faut marcher. Zora… hein ! un rude nom, n’est-ce pas ? c’est moi qui l’ai choisi. Donc, Zora n’est pas très épatante ce soir, mais laissez faire. Je lui ai tantôt commandé six robes, chez Van Klopen. Oh ! mais des robes… Vous connaissez Van Klopen ?
– Pas du tout.
– Eh bien !… elle est forte. Quand je dirai ça à Jules, il m’appellera blagueur, vous verrez. Van Klopen, mon bon, est un tailleur pour dames. C’est un Alsacien qui enfonce toutes les couturières. Il vous a un goût, une invention, un chic… Il n’y a que lui pour habiller une femme…
Arrivée à son appartement, Zora-Rose s’impatientait.
– Viendrez-vous, enfin ! cria-t-elle.
– Vite, fit Gandelu entraînant André, montons. Quand on la fâche, elle a des crises de nerfs terribles. Elle n’a pas voulu me l’avouer, mais on ne me monte pas le coup, à moi, je connais les femmes…
Rose et Paul n’étaient pas fait pour s’entendre. Ils se ressemblaient trop.
Si la nouvelle dame de Chantemille avait tant insisté pour avoir André à dîner, c’est qu’elle comptait l’éblouir de sa splendeur.
Pour commencer, elle lui montra ses deux domestiques, la cuisinière et la femme de chambre, qui avaient, la dernière surtout, un air !… Puis il fallut qu’André visitât tout l’appartement, on ne lui fit grâce ni d’une pièce ni d’un meuble.
Il dut s’extasier devant l’éternel et horripilant salon bouton d’or à agréments gros bleu. Il fut forcé de palper les étoffes et d’essayer le moelleux des fauteuils.
Gandelu triomphant ouvrait la marche, armé d’un candélabre à huit branches, dont les bougies l’inondaient de leurs larmes. Il faisait remarquer le bon goût de chaque chose, et disait le prix de tout, d’un ton de commissaire-priseur.
En outre, il entremêlait cette visite domiciliaire de réflexions philosophiques.
– Cette pendule, disait-il, c’est cent louis, c’est pour rien. Est-ce drôle que vous connaissiez papa ! N’est-ce pas qu’il a une bonne tête ?… Cette jardinière, c’est trois cents francs !… c’est donné !… Mais méfiez-vous, il est rat. Ne voudrait-il pas me forcer à travailler ? Je la trouve mauvaise. Moi travailler !… Il s’en ferait mourir… N’est-ce pas, que ce n’est pas cher, ce guéridon, vingt louis ?… Moi, d’abord, quand il me la fait à la vertu, je me la brise. Un bonhomme qui n’en a pas seulement pour six mois, disent les médecins, il ferait mieux…
Il s’interrompit. On entendait un grand bruit dans l’antichambre.
– Ah ! voilà mes invités, fit-il.
En posant son candélabre sur la table, il sortit précipitamment.
André était émerveillé. Il avait bien ouï parler de ces jeunes messieurs qui font les délices des courses de Vincennes, mais il n’en avait approché aucun.
Son air stupéfait devait flatter Rose.
– Comme vous voyez, fit-elle, j’ai quitté Paul. D’abord, il m’ennuyait, puis il n’avait pas seulement de quoi m’acheter du pain.
– Lui !… Plaisantez-vous ? Aujourd’hui même il est venu chez moi et il m’a dit qu’il gagnait douze mille francs par an.
– Dites douze mille mensonges. À moins que… Sait-on ce dont est capable un garçon qui accepte des billets de cinq cents francs de gens qu’il ne connaît pas…
Elle se tut, mais en faisant signe qu’elle en avait encore long à dire.
Le jeune Gandelu introduisait et présentait ses amis.
– Mes enfants, disait-il, tout est de chez Potel. Nous allons rire un peu, et après, vous savez… le petit bac de santé.
Les invités valaient l’hôte, et André commençait à se féliciter d’être venu, quand un domestique, en cravate blanche ouvrit les portes du salon et cria :
– Madame la vicomtesse est servie ! ! !
X
Quand on demande à B. Mascarot ce qu’il faut pour arriver, invariablement il répond :
– De l’activité, encore de l’activité, toujours de l’activité !…
Mais il a sur le commun des hommes à principes, une immense supériorité qui constitue sa force.
Les maximes qu’il professe, il les met en pratique.
C’est pourquoi, le lendemain de son expédition à l’hôtel de Mussidan, dès sept heures et demie du matin, il était à son bureau et travaillait.
Bien que, par suite d’un brouillard assez épais, il fit à peine jour, les clients commençaient à emplir la première salle de l’agence de placement.
Cette clientèle matineuse inquiète peu l’honorable placeur.
Elle se comporte surtout de servantes de crémeries ou de cuisinières qui, nourrissant à forfait les employés des grands magasins, ont avantage à s’approvisionner aux Halles centrales.
Ces pratiques, en général, ne savent rien de ce qui se passe dans les maisons où on les emploie, ou ce qui s’y fait n’offre aucun intérêt.
B. Mascarot les abandonne donc absolument à Beaumarchef, et ne se dérange que s’il survient quelque maître d’hôtel, ou encore un cuisinier de grande maison ce qui arrive parfois.
L’honorable placeur ne s’inquiétait donc pas plus du bruit de la salle voisine, qu’un grand personnage du tumulte des solliciteurs encombrant ses antichambres. Il mettait toute son attention à déchiffrer, à annoter et à classer dans un certain ordre ces petits carrés de papier qui avaient si fort intrigué Paul.
Et telle était sa préoccupation que, pareil à un vase qui déborde, il laissait échapper le trop plein de son cerveau en un monologue bizarre.
– Quelle entreprise ! marmottait-il, mais aussi, quel résultat !… Je suis seul, cependant, tout seul, pour porter le faix de cette tâche énorme. Mon dernier mot, personne le sait. Seul, je tiens en mes mains puissantes le bout de tous les fils que depuis vingt ans, avec la patience de l’araignée tissant sa toile, j’attache à mes pantins. Que je fasse un mouvement, tout remue. Qui croirait cela, à me voir ? Quand je passe rue Montorgueil, on dit : « C’est Mascarot, placeur pour les deux sexes et autres. » Et on rit, et je laisse rire. Il n’est de puissances solides que les puissances ignorées. Celles qu’on connaît, on les attaque et on les démolit. Personne ne me connaît, moi !
Une fiche plus importante que les autres passait sous ses yeux.
Rapidement, il traça en marge quelques lignes, et, après un silence, il reprit :
– Je puis échouer, c’est incontestable. Il peut se trouver un hardi mâtin qui rompe une maille de mon filet, les timides s’évaderont par la déchirure, et alors… Cet imbécile de comte de Mussidan ne me demandait-il pas si je connais mon code ! Oui, je l’ai étudié, mon code pénal, et je sais que, livre 3, titre II, se trouve un certain article 400, qui semble avoir été rédigé spécialement en vue de mes opérations. Travaux forcés à temps, s’il vous plaît… sans compter que si un magistrat madré me joint avec l’article 305, il s’agit des travaux forcés à perpétuité !…
Sur ces mots, qu’il prononça lentement, comme pour en bien mesurer la portée, un frisson courut le long de son échine ; mais ce fut qu’un éclair, car, avec un triomphant sourire, il poursuivit :
– Oui… mais pour envoyer B. Mascarot respirer l’air de Toulon, il faut pincer B. Mascarot, et ce n’est pas précisément l’enfance de l’art. Vienne une alerte sérieuse, et… bonsoir, plus de Mascarot, il disparaît, évanoui, fondu, évaporé !… Peut-on remonter à ces timides joueurs qui sont mes associés. Catenac, l’avare, et Hortebize, l’épicurien ? Non, je les ai placés hors de toute atteinte. Inquièterait-on Croisenois ? Jamais. Et il périrait plutôt que de parler. Au fond de tout, on trouverait Beaumarchef, La Candèle, Toto-Chupin et deux ou trois autres pauvres diables. La belle prise ! Ils ne diraient rien, ceux-là, pour cent raisons, dont la première est qu’ils ne savent rien.
Ces raisonnements lui semblaient si péremptoires, qu’il s’oublia jusqu’à rire tout haut.
Puis, d’un geste fier rajustant ses lunettes, il ajouta :
– J’irai droit à mon but, comme un boulet de canon. Ce que je veux, sera. Par Croisenois, j’enlèverai d’un coup quatre millions… j’ai fait mon compte. Paul épousera Flavie… je l’ai juré, et après, pour que Flavie soit heureuse et enviée, elle sera duchesse à trois cent mille livres de rentes…
Ses fiches étaient en ordre.
Il retira d’un tiroir secret de son bureau un petit registre qui ressemblait à un répertoire, avec son alphabet collé le long de la tranche.
Il l’ouvrit, ajouta quelques noms à ceux qui s’y trouvaient déjà et le resserra en disant d’un ton de menace :
– Vous êtes tous là, mes bons amis, tous, et vous ne vous en doutez guère. Vous êtes tous riches, vous êtes heureux et honorés, vous vous croyez libres. Allons donc ! Il est un homme à qui vous appartenez, âme, corps et biens, et cet homme qui vous tient ainsi, c’est B. Mascarot, le placeur de la rue Montorgueil. Vous êtes bien fiers tous, et pourtant, quand il le voudra, vous serez à ses pieds, vous disputant l’honneur de dénouer ses souliers. Or, il va vouloir, mes petits amis, ce bon papa Mascarot, il trouve qu’il a travaillé assez comme cela, il est las des affaires, il veut se retirer et il lui faut servir quelques petites rentes.
Il se tut, on frappait à la porte.
Du bout du doigt il toucha son timbre, et la vibration n’était pas éteinte, que Beaumarchef parut.
– C’est à n’y pas croire, patron, s’écria dès le seuil l’ancien sous-off… Vous m’avez demandé, n’est-ce pas, de compléter le dossier du jeune M. de Gandelu.
– Après ?
– Eh bien, patron, il se trouve que la cuisinière qu’il a donnée à sa petite dame a été placée par nous. C’est une de nos anciennes pratiques de l’hôtel. Même elle nous devait onze francs, et elle nous les apporte ; elle est là, c’est une nommée Marie… Voilà un hasard ?
B. Mascarot haussa les épaules.
– Tu n’es qu’un sot, Beaumar, prononça-t-il, de t’extasier ainsi. Je t’ai cependant expliqué ce qu’est au juste que le hasard. C’est un champ comme un autre, plus fertile cependant et plus vaste, et qui n’a d’autre propriétaire que les habiles. Or, voici vingt-cinq ans que je l’ensemence, ce champ ; c’est s’il ne me donnait pas de récolte, qu’il faudrait s’étonner.
C’est d’un air pénétré que l’ex-sous-off… écoutait son patron, la bouche béante, comme si par cette ouverture les leçons eussent pu entrer en lui plus facilement pour s’aller loger dans les cases de sa cervelle.
– Qu’est-ce que cette cuisinière ? demanda le bon placeur.
– Oh !… patron, rien qu’en la regardant, vous le devinerez. C’est une vieille cliente, et il y a longtemps que je l’ai classée dans la catégorie D, vous savez : cuisinières à placer près des demoiselles très lancées.
L’estimable placeur n’écoutait plus, il réfléchissait.
– Va me chercher cette fille, dit-il enfin.
Et pendant que Beaumarchef obéissait, il ajouta, répondant à quelque objection de son esprit :
Négliger le plus léger renseignement est folie, l’expérience me l’a démontré.
Mais déjà la cuisinière de la catégorie D était devant lui, toute fière d’être introduite dans le sanctuaire de l’agence.
Et certes, il n’était besoin que d’un seul coup d’œil pour comprendre les causes déterminantes de la classification de Beaumarchef.
C’est, du reste, avec cette aménité onctueuse qui a établi sa réputation par tout Paris que B. Mascarot l’accueillit.
– Eh bien ! ma fille, lui demanda-t-il, vous avez donc trouvé une place à votre convenance et où vous serez selon vos mérites ?
– Ma foi, monsieur, je crois que oui. Je ne connais Mme Zora de Chantemille que d’hier à deux heures…
– Ah !… elle s’appelle Zora de Chantemille.
– C’est-à-dire, vous comprenez, c’est un nom comme ça qu’elle a pris. Mais elle s’est assez disputée à ce sujet avec monsieur. Elle voulait, elle, s’appeler Raphaële, mais monsieur en tenait pour Zora, si bien…
Zora est fort joli, prononça gravement le placeur.
– Tenez, c’est justement ce que nous avons dit à madame, la femme de chambre et moi. Belle personne, du reste, pas regardante, et qui s’entend à faire danser les écus. Je puis vous garantir que, déjà, à mon su, vu et entendu dire, elle a fait dépenser à monsieur plus de trente mille francs.
– Diable !
– Oh ! elle va bien. Et tout à crédit, s’il vous plaît. Monsieur de Gandelu n’a pas le sou, à ce que m’a dit un garçon de chez Potel ; mais il paraît que son père ne connaît pas sa fortune. Ainsi, hier, pour la crémaillère, comme ils disaient, il y a eu un dîner, mais un dîner !… Enfin, il coûtait plus de mille francs avec les vins.
Jusque-là, le digne placeur n’apercevait pas l’ombre d’un renseignement à utiliser, et il se disposait à congédier sa cliente, lorsque celle-ci, qui avait deviné son intention, reprit vivement :
– Minute ! je ne vous ai encore rien dit.
Certainement, B. Mascarot n’attendait rien de cette fille, mais il est patient, mais il a appris à se contraindre, mais ils sait qu’un ambitieux, si haut qu’il soit, ne doit jamais repousser un collaborateur, si infime qu’il puisse être, si inutile qu’il paraisse.
Il se renversa donc sur son fauteuil, et d’un air aussi satisfait que s’il eût été prodigieusement intéressé, il dit :
– Voyons le reste.
– Donc, reprit la cuisinière de Rose-Zora, nous avons eu un grand dîner : huit invités, et madame était la seule femme. Ah ! monsieur, quels hommes distingués, et aimables, et spirituels, et bien mis !… Mais c’est encore monsieur qui était le mieux.
– Peste !…
– C’est ainsi. Sur les dix heures ils étaient tous très gris. Alors, savez-vous ce qu’ils ont fait ? Ils ont envoyé dire au concierge de veiller à ce que personne ne traversât la cour, parce qu’ils voulaient jeter la vaisselle par la fenêtre. Et ils l’ont jetée. Plats, assiettes, verres, bouteilles, tout y a passé. C’est comme cela dans le grand monde. Les garçons de chez Potel m’ont dit que c’est une mode qui a été apportée à Paris par des princes russes.
L’honorable placeur tracassait terriblement ses lunettes. La résignation la plus héroïque a des bornes.
– Enfin, demanda-t-il, qu’avez-vous remarqué de curieux ?
– Voilà !… Parmi tous ces messieurs, il y en avait un qui faisait comme une tache dans la société, un grand brun à l’air mauvais, mal mis, et qui ne disait rien. On aurait juré qu’il se moquait des autres ; manant, va !…
– Eh bien ?
– Eh bien ! Madame n’avait d’amabilité que pour lui. Elle était toujours à lui offrir les meilleures choses : Voulez-vous de ceci, prenez donc de cela, vous ne buvez pas, et patati, et patata… Après le dîner, quand les autres se sont mis à jouer, lui, qui n’avait probablement pas le sou, il est resté à causer avec madame.
– Et vous savez ce qu’ils disaient ?
– Naturellement. Ils étaient près de la porte de la chambre à coucher ; je suis allée l’entrebâiller et j’ai écouté.
– Ce n’est peut-être pas très bien ?
– Tant pis !… J’aime à connaître les affaires des gens que je sers. Donc, ils parlaient d’un monsieur que madame a connu autrefois, et qui est l’ami du grand brun, un nommé… attendez donc… un nommé…
Beaumarchef estima que c’était le cas de montrer son excellente mémoire.
– Paul Violaine,… fit-il.
– Précisément, répondit la cuisinière.
Puis l’étonnement lui venant avec la réflexion, elle ajouta :
– Ah ça ! mais… comment savez-vous ce nom, vous ?
B. Mascarot avait relevé ses lunettes pour lancer à son associé un regard foudroyant.
– Beaumar sait tout, répondit-il négligemment, c’est son état.
L’explication ne satisfit peut-être pas complètement l’estimable cuisinière, mais comme elle tenait à son récit, elle continua :
– Donc, madame racontait que ce n’était qu’un pas grand’chose, qu’il fallait se défier de lui, qu’il était capable de tout, qu’il avait volé douze mille francs…
Le placeur s’était redressé, son attention était devenue très réelle, sa patience était récompensée.
– Avez-vous retenu, demanda-t-il, le nom de ce grand brun ?
– Ma foi !… non. Les autres l’appelaient l’artiste.
Ce vague renseignement ne pouvait suffire au méthodique placeur.
– Écoutez, ma fille, commença-t-il d’une voix de miel, voulez-vous me rendre un service signalé ?
– À vous, le roi des hommes pour les domestiques !… Faut-il passer dans le feu.
– Non. Il faudrait simplement m’avoir le nom et l’adresse de ce grand brun. Il ressemble tellement, d’après ce que vous dites, à un artiste qui me doit de l’argent…
– Suffit, vous pouvez compter sur moi.
Elle aspira une large prise et ajouta :
– Aujourd’hui, il faut que je file pour mon déjeuner. Demain ou après-demain, vous aurez votre adresse. Au revoir !…
Elle sortit, et la porte n’était pas refermée sur elle que B. Mascarot ébranla son bureau d’un formidable coup de poing.
– Hortebize, s’écria-t-il, est incomparable pour flairer un danger. Heureusement, j’ai le moyen de supprimer cette drôlesse et le jeune crétin qui voudrait se ruiner pour elle.
Comme toujours, quand le verbe supprimer monte au lèvre de son patron, l’ex-sous-off tomba en garde : une, deux !… Il ne connaît que cela, lui.
– Dieu ! que tu es ridicule avec tes gestes, interrompit le doux placeur en haussant les épaules. Va, j’ai mieux que cela. Rose avoue dix-neuf ans, mais elle ment, elle en a bel et bien vingt et un passés. Donc elle est majeure. Le jeune idiot, lui, est mineur encore. De sorte que si le papa Gandelu avait un peu de nerf, eh ! eh !… ce serait drôle et moral, tout à la fois ; l’article 354 est élastique.
– Vous dites, patron ? interrogea Beaumarchef, qui ne comprenait pas.
– Je dis qu’il me faut, avant quarante-huit heures, des détails précis sur le caractère de M. Gandelu, le père. Je veux savoir aussi quels sont ses rapports avec son fils.
– Bien, je vais mettre La Candèle en campagne.
– De plus, puisque le jeune M. Gaston cherche de l’argent partout, il faut lui faire connaître notre honorable ami Verminet, le directeur de la Société d’escompte mutuel.
– Mais c’est l’affaire de M. Tantaine, ça, patron.
B. Mascarot était trop préoccupé pour entendre.
– Quant à cet autre, murmurait-il, répondant à ses craintes secrètes, quant à ce grand garçon brun, cet artiste, qui me paraît de beaucoup supérieur aux autres comme intelligence, malheur à lui si je le trouve en travers de mon chemin. Quand on me gêne, moi…
Un geste effroyablement significatif compléta sa pensée.
Puis, après un silence, il ajouta :
– Retourne à ta besogne, Beaumar, j’entends du monde.
L’ancien sous-off ne bougea pas, si formel que fût le congé.
– Excusez-moi, patron, dit-il, mais La Candèle est de l’autre côté, qui reçoit. J’ai à vous faire mon rapport.
– C’est juste. Prends un siège et parle.
Cette faveur de parler assis, qui ne lui est pas souvent octroyée, sembla ravir Beaumarchef.
– Hier, commença-t-il, rien de nouveau. Ce matin, je dormais encore, quand on est venu tambouriner à ma porte. Je me lève, j’ouvre, c’était Toto-Chupin.
– Il n’a pas lâché Caroline Schimel, au moins ?
– Pas d’une minute, patron. Même, il a réussi à lier conversation avec elle, et ils ont déjà pris un café ensemble.
– Allons, ce n’est pas trop mal.
– Oh ! il est assez adroit, ce vaurien de Toto, et, s’il était un peu plus honnête… Enfin, il prétend que si cette fille boit, c’est pour s’étourdir, parce qu’elle se croit toujours poursuivie par des gens qui lui ont fait des menaces horribles. Elle a tellement peur d’être assassinée, qu’elle n’ose loger seule. Elle s’est mise en pension chez des ouvriers honnêtes qui la couchent et la nourrissent, et elle leur fait du bien, car elle a de l’argent…
L’honorable placeur semblait fort contrarié.
– C’est fort gênant, cela, murmura-t-il, on ne peut pas aller lui rendre visite incognito, à cette fille… Cependant, où demeurent les ouvriers qui l’ont recueillie ?
– Tout en haut de Montmartre, bien plus haut que le Château-Rouge, rue Marcadet.
– C’est bien, Tantaine avisera. Surtout que Toto ne laisse pas cette folle lui glisser entre les doigts.
– Il n’y a pas de danger, et même il m’a dit qu’il allait s’informer de ses habitudes, de ses relations et de la source de son argent.
L’ex-sous-off s’arrêta tiraillant terriblement ses longues moustaches cirées.
Ce geste prouve si évidemment qu’une idée lui trotte par la cervelle, que son patron lui demanda :
– Qu’y a-t-il encore ?
– Il y a, patron, que, si j’osais, je vous dirais de vous défier de Toto-Chupin. J’ai découvert que le garnement chasse pour son compte. Il nous vole et il vend notre marchandise au rabais.
– Rêves-tu ?
– Pas du tout. J’ai tiré ce renseignement d’un grand gaillard de mauvaise mine qui est venu demander Chupin en se disant son ami.
Les hommes forts ont toujours été prompts à prendre un parti.
– C’est bien, prononça le placeur. Je vérifierai le fait, et s’il est vrai, nous tendrons à maître Chupin un joli traquenard qui le conduira en correctionnelle.
Cette fois, sur un signe, Beaumarchef se retira, mais il reparut presque aussitôt.
– Patron, dit-il, c’est un domestique de M. Croisenois avec une lettre…
B. Mascarot ne prit pas la peine de dissimuler sa mauvaise humeur.
– Le marquis est diablement pressé, fit-il… N’importe, amène-moi ce domestique.
Ce nouveau venu sentait d’une lieue sa grande maison.
Irréprochable était sa tenue.
Démarche, maintien, port de tête, tout disait en quelle haute estime il se tenait.
Évidemment, il visait et outrait le genre anglais.
Un faux col, cruellement empesé, lui sciait les oreilles. Il avait si bien serré sa cravate, que sa figure, écorchée par le rasoir, en était toute congestionnée.
C’était, à coup sûr, un tailleur londonien qui avait, à coups de hache, taillé dans du bois ses vêtements raides.
Il paraissait de bois lui-même et semblait se mouvoir sous l’impulsion de quelque mécanisme habilement dissimulé sous son gilet rouge.
Remuait-il, on était tout surpris de n’entendre pas grincer un rouage.
– Voici, dit-il en tendant une lettre à B. Mascarot, ce que monsieur le marquis m’a chargé de remettre à monsieur.
Tout en prenant le pli, le digne placeur, par dessus ses lunettes, examinait et étudiait ce serviteur modèle.
Il ne le connaissait pas.
Croisenois, l’ingrat, n’avait jamais voulu accepter un serviteur de sa main, trié par lui entre mille sur le volet.
– Il paraît, mon garçon, remarqua-t-il, que ton maître, contrairement à ses habitudes, s’est levé avec l’aurore, aujourd’hui.
Non seulement, le domestique, genre anglais, ne sourit point de l’épigramme, mais il parut vivement choqué.
– Monsieur le marquis, prononça-t-il, me donne par an quinze louis en sus de mes gages pour se passer la fantaisie de me tutoyer. Il est le seul à avoir ce droit.
– Ah !… fit le placeur sur trois tons différents, ah ! ah !…
Sa pantomime, en même temps, était des plus expressive.
– Je vous demande un peu, pensa-t-il, où vont se loger la dignité et l’amour-propre ! Son maître, si l’idée me prenait de le tutoyer, ne se formaliserait pas, lui !
L’envoyé de M. de Croisenois, son observation faite, revint à sa mission.
– Je pense, reprit-il, que monsieur le marquis dort encore à cette heure. Il a écrit ce billet en rentrant de son cercle.
– Et il y a une réponse ?
– Yes, sir.
– En ce cas, attendez.
D’un geste exercé, B. Mascarot fit sauter l’enveloppe et lut :
« Mon cher maître,
« Le bac a des rigueurs… vous devinez le reste, n’est-ce pas ? J’ai joué si malheureusement, cette nuit, que j’ai perdu, outre tout mon argent comptant, trois mille francs sur parole. Cette somme doit être chez mon débiteur avant midi. Mon honneur l’exige… »
L’honorable placeur ne se gêna pas pour hausser les épaules.
Puis, entre haut et bas, de façon que le domestique, qu’il épiait du coin de l’œil, pût, selon sa conscience, l’entendre ou non, il murmura :
– Son honneur !… Ma parole, c’est à mourir de rire ; son honneur !…
Pas un muscle du visage si bien rasé du serviteur si formaliste ne bougea.
Il restait raide autant qu’un soldat prussien à la parade, semblant ne rien voir, ne rien entendre.
B. Mascarot avait repris sa lecture :
« … Ai-je tort de compter sur vous pour cette bagatelle ? Je pense que non. Je suis même certain que vous m’enverrez cent cinquante ou deux cents louis de plus, car je ne puis rester sans un sou.
Et pour la grande affaire, quelles nouvelles ? C’est les pieds dans le feu que j’attends votre décision.
« Votre dévoué,
« Henri, marquis de Croisenois. »
– Et voilllà !… grommela le placeur, cinq mille francs, là, hic et nunc ! Paie, bon Mascarot, tire de l’argent de ta caisse. On n’est pas plus régence ! Méchant noble, va ! Si je n’avais pas irrémissiblement besoin du beau nom que t’ont légué tes ancêtres et que tu traînes dans le ruisseau, tu pourrais les chercher tes cinq mille francs !
Le malheur est que Croisenois était une des pièces importantes de la grosse partie de l’aventureux placeur.
Lentement et visiblement à regret, il sortit de la caisse où, la veille, il puisait pour Hortebize, cinq billets de mille francs qu’il tendit à l’envoyé du marquis.
– Monsieur désire-t-il un reçu ? demanda le domestique.
– Inutile, la lettre m’en tiendra lieu. Cependant, attendez.
Mascarot, ce ponte prudent et assidu de la banque du hasard, cherchait dans son gousset une pièce de vingt francs.
L’ayant trouvée, il la poussa, de l’air le plus engageant, sur la tablette de son bureau, en disant :
– Prenez ceci, mon ami, pour votre course.
Mais l’autre, au lieu d’avancer la main, recula.
– Monsieur m’excusera si je refuse, dit-il nettement. Quand j’entre dans une maison, j’exige des gages assez élevés pour n’avoir aucunement besoin de pourboires.
Sur cette stoïque réponse, il salua, sérieux et grave comme un quaker, et se retira à pas comptés.
Ma foi ! le placeur était désorienté.
Vingt années d’expérience ne lui fournissaient pas le pendant d’une aussi invraisemblable aventure.
– C’est à n’y pas croire, murmurait-il. Où diable Croisenois va-t-il recruter ses gens ? Serait-il, par impossible, bien plus fort que je ne l’ai supposé jusqu’ici ?
Une inquiétude inexplicable, vague et confuse comme un pressentiment, troublait son assurance habituelle.
– Ou plutôt, continua-t-il, ce gaillard si sûr ne serait-il pas un faux domestique ? J’ai tant amassé d’ennemis en ma vie, et de toutes sortes, qu’ils doivent maintenant former comme une avalanche. Si habilement que je tienne mes cartes, on peut avoir vu dans mon jeu.
Cette seule pensée le fit frissonner.
Il est de ces parties si périlleuses qu’à l’instant décisif tout devient sujet de méfiance et de crainte.
B. Mascarot en était à ce point d’avoir peur de son ombre.
C’est surtout quand on n’est plus séparé du but que par la longueur du bras que l’anxiété est terrible.
– Non, répondit-il, je suis un fou, et je me mets martel en tête pour des soupçons chimériques. S’il se trouvait un homme habile à ce point de m’avoir pénétré, patient jusque-là d’endosser la livrée de Croisenois pour me surveiller de plus près, cet homme ne serait pas assez simple pour se créer cette originalité qui me l’a fait remarquer.
Il disait cela, mais il se raisonnait aussi vainement qu’un poltron siffle dans l’obscurité pour dissiper ses terreurs.
Entre tous ces expédients, parmi ses moyens d’investigations, il devait bien s’en trouver un qui lui permît de fouiller dans le passé de ce domestique si susceptible, et il cherchait.
Il se creusait la tête, lorsque Beaumarchef parut de nouveau tout effaré.
– Encore toi ! dit durement le placeur ; qui t’a appelé ? Je ne saurais donc rester tranquille une minute aujourd’hui ?
– Patron, c’est que…
– Va-t’en.
Mais le docile sous-off ne recula pas d’une semelle.
– C’est le petit qui est là, insista-t-il.
– Paul ?
– Lui-même, patron.
– Comment, à cette heure !… Je ne lui avais donné rendez-vous que pour midi. Lui serait-il survenu quelque aventure ?
Il s’interrompit.
La porte que Beaumarchef avait laissée entrebâillée s’ouvrit, livrant passage à Paul Violaine.
En effet, il avait dû lui arriver quelque chose d’extraordinaire.
Il était pâle, défait, ses yeux avaient cette indicible expression d’égarement de l’animal longtemps poursuivi par une meute.
Ses vêtements étaient en désordre, son linge fripé trahissait une nuit passée à errer au hasard.
– Ah ! monsieur, commença-t-il…
D’un geste impérieux, le placeur lui imposa silence.
– Laissez-nous, Beaumar, fit-il, et vous, mon enfant, asseyez-vous.
Paul s’assit, ou plutôt se laissa tomber comme une masse sur un fauteuil.
– Ma vie est finie, murmurait-il, je suis déshonoré, perdu !…
L’estimable directeur de l’agence de placement avait la mine abasourdie d’un homme qui tombe des nues.
Mais cette grande stupéfaction était feinte, un de ses familiers l’eût reconnu au mouvement de ses lunettes bleues, cet indispensable accessoire de son individu, qui, à la longue, faisaient comme partie intégrante de sa personne et semblaient ressentir quelque chose de toutes ses impressions.
Les causes de l’état où il voyait Paul, il les connaissait pour les avoir préparées avec le soin du dramaturge qui, dès le premier acte, apprête les scènes du dénouement.
S’il était surpris, ce ne pouvait être que du résultat prompt et violent de ses combinaisons. Si expérimenté qu’on soit, il est difficile, quand on charge, d’en calculer exactement l’effet.
C’est cependant avec le naturel admirable d’un auditeur bénévole qui s’attend à des émotions, qu’il se tassa dans son fauteuil, en disant :
– Voyons, mon enfant, remettez-vous, ayez confiance en moi, ouvrez-moi votre cœur. Que vous arrive-t-il ?
Paul se leva à demi, et c’est du ton le plus tragique, avec un geste désolé, qu’il répondit :
– Rose m’a abandonné.
B. Mascarot leva les bras au ciel, paraissant le prendre à témoin de l’insigne folie de son protégé.
– Et c’est pour cela, fit-il, que vous dites que votre vie est perdue, à votre âge, lorsque vous ne pouvez même vous douter de toutes les revanches que vous réserve l’avenir !…
– J’aimais Rose, monsieur !
Si comique que fut son emphase, qu’un imperceptible sourire glissa sur les lèvres pâles du placeur.
– Diable !… fit-il.
– Mais ce n’est pas tout, reprit le pauvre garçon, qui faisait, pour retenir ses larmes, les plus héroïques et les plus inutiles efforts, je suis accusé d’un vol infâme.
– Vous ? demanda le placeur, qui, en même temps, se disait : Nous y voici donc !…
– Moi, monsieur, et seul au monde, vous pouvez affirmer mon innocence, parce que seul vous savez la vérité.
– La vérité !…
– Oui, par vous je puis être sauvé. Hier, vous avez daigné me témoigner tant de bienveillance, que j’ai songé à vous tout de suite, et que, devançant l’heure que vous m’aviez fixée, je viens vous demander aide et assistance.
– Mais, que puis-je ?
– Tout, monsieur. De grâce, permettez que je vous raconte de quelle fatalité je suis victime.
La physionomie de B. Mascarot exprima le plus vif intérêt.
– Parlez, dit-il.
– Hier, monsieur, reprit Paul, peu de temps après vous avoir quitté, j’ai regagné l’Hôtel du Pérou. J’arrive, je monte à ma mansarde, et bien en évidence, sur la cheminée, j’aperçois cette lettre de Rose.
Il tendait la lettre en même temps ; mais le placeur ne daigna pas la prendre.
– Rose, monsieur, me déclare qu’elle ne m’aime plus et me prie de ne jamais chercher à la revoir. Elle me dit que, lasse de partager ma misère, elle accepte une fortune qui lui est offerte, des diamants, une voiture…
– Cela vous surprend.
– Ah !… monsieur, pouvais-je m’attendre à cette trahison infâme, lorsque la veille encore elle n’avait pas assez de serments pour m’affirmer son amour ? Pourquoi mentir ? Voulait-elle me rendre sa perte plus cruelle ! Partie !… Je suis tombé comme assommé sous le coup. Moi qui arrivais me faisant fête de sa joie quand je lui apprendrais vos promesses !… Pendant plus d’une heure je suis resté dans ma chambre, sans avoir conscience de moi-même, pleurant comme un enfant à cette idée affreuse que je ne la reverrais plus…
C’est avec son attention et sa pénétration habituelles que B. Mascarot étudiait son sujet.
– Toi, pensait-il, mon garçon, tu répands trop de paroles pour que ta douleur soit aussi sincère et surtout aussi profonde que tu dis.
Puis, tout haut, il demanda :
– Mais enfin, ce vol, cette accusation ?…
– J’y arrive, monsieur. Le premier étourdissement passé, je résolus de vous obéir, de quitter cet Hôtel du Pérou qui, plus que jamais, me faisait horreur.
– À la bonne heure.
– Je descendis donc et j’allai donner congé à madame Loupias et la payer. Ah !… monsieur, quelle honte ! Lorsque je lui ai tendu le montant de mes deux quinzaines, c’est-à-dire vingt-deux francs, elle m’a toisé de l’air le plus méprisant en me demandant où j’avais pris cet argent.
B. Mascarot eut quelque peine à dissimuler un mouvement de satisfaction. C’était le succès de sa petite machination que Paul lui annonçait.
– Qu’avez-vous répondu ? interrogea-t-il.
– Rien, monsieur, j’étais pétrifié, et les paroles s’arrêtaient dans ma gorge. Loupias s’était approché de sa femme, et tous deux me regardaient en ricanant. Après avoir bien joui de ma confusion, ils m’ont déclaré qu’ils étaient certains que, de concert avec Rose, j’avais volé M. Tantaine.
– Et vous ne vous êtes pas défendu ?
– J’avais perdu l’esprit. Je voyais que tout semblait donner raison à ces gens et cette conviction m’accablait. La veille même, la Loupias avait demandé de l’argent à Rose, qui lui avait répondu que je n’en avais pas et que même je ne savais où m’en procurer. Or, voilà que, du jour au lendemain, on me voyait vêtu d’habits neufs, payant mes dettes, Rose avait disparu, moi-même j’annonçais mon départ.
– Il est certain que toutes ces circonstances devaient frapper vos hôteliers !…
– Pour comble de malheur, c’est chez un épicier qui nous connaît, un certain Mélusin que Rose était allée changer le billet de 500 francs que nous avait prêté M. Tantaine. C’est ce misérable qui a soulevé l’opinion contre nous. N’a-t-il pas osé dire qu’un agent de police chargé de nous arrêter, s’est présenté chez lui.
Mieux que Paul, B. Mascarot connaissait l’histoire et savait au juste ce qu’avait pu dire Mélusin : cependant il interrompit son protégé.
– Entendons-nous, fit-il, la violence de votre chagrin trouble vos idées, et je ne vous comprends plus bien. Y a-t-il eu, oui ou non, un vol de commis ?
– Eh ! monsieur, comment vous le dire !… Je n’ai pas revu M. Tantaine, et il n’a pas reparu à l’Hôtel du Pérou. On prétend, est-ce vrai ? que des valeurs importantes lui ont été enlevées, et que, par suite de ce malheur, il est en prison.
– Pourquoi n’avez-vous pas dit la vérité ?
– À quoi bon ? Il est prouvé que je ne connaissais pas M. Tantaine, que jamais je ne lui ai adressé la parole. On m’aurait ri au nez si j’avais dit : Hier soir, tout à coup, il est entré chez moi, et là, de but en blanc, il m’a offert 500 francs, et je les ai acceptés.
Le digne placeur avait la physionomie sérieuse de l’homme qui cherche la solution d’un difficile problème.
– Il me semble, fit-il enfin, que je comprends tout, et cela tient à la connaissance exacte que j’ai du caractère de Tantaine.
Paul écoutait comme si sa vie eût dépendu d’une parole.
– Tantaine, reprit B. Mascarot, est le plus honnête homme que je sache et le meilleur cœur qui soit au monde, mais il a des lacunes dans le cerveau. Il a été riche autrefois, et sa générosité l’a ruiné. Il est pauvre comme Job, maintenant, et il a, comme autrefois, la passion de rendre service quand même.
– Cependant, monsieur…
– Laissez-moi finir. Le malheur est que dans la petite situation qu’il occupe, et qu’il me doit, il a des fonds en maniement. Saisi de pitié à la vue de votre profonde misère, il a disposé du bien d’autrui comme du sien propre. Mis en demeure de rendre ses comptes le soir même, se trouvant en face d’un déficit, il a perdu la tête et a déclaré qu’on l’avait volé. On est allé aux informations, vous êtes son voisin, on vous a vu de l’argent, dont on ne s’explique pas l’origine, les soupçons se sont portés sur vous.
C’était net, précis, indiscutable. Paul frissonnait, une sueur froide trempait ses cheveux, il se voyait arrêté, jugé, condamné.
– Cependant, ajouta-t-il, M. Tantaine a un billet de moi qui est une preuve de ma bonne foi.
– Pauvre enfant !… croyez-vous donc que, s’il espère se sauver en vous accusant, il laissera voir ce billet ?
– Mais vous savez la vérité, vous, monsieur, heureusement !…
Le digne placeur hocha tristement la tête.
– Me croirait-on ? répondit-il. La justice est une institution humaine, mon ami, c’est-à-dire qu’elle est sujette à l’erreur. Ayant à choisir entre la vérité et le mensonge, elle ne peut se décider que pour la vraisemblance. Or, dites-moi si toutes les probabilités ne sont pas contre vous ?
Cette logique impitoyable devait écraser Paul.
– Je n’ai donc plus qu’à mourir, balbutia-t-il, si je veux échapper au déshonneur.
La combinaison imaginée par l’honorable placeur pour s’emparer de Paul Violaine était d’une simplicité véritablement enfantine, mais il l’avait jugée suffisante et il avait bien jugé.
Paul avait été si complètement étourdi, qu’entre le prêt si extraordinaire d’un billet de 500 francs et l’accusation de vol basée sur le change de ce même billet, il n’avait pas aperçu le trait d’union qui pourtant sautait aux yeux.
Facile à épouvanter, comme tous ceux qui ne sont pas bien sûr de leur conscience, il avait commencé par fuir et maintenant il venait se livrer pieds et poings liés.
C’était là ce qu’avait voulu, prévu et préparé B. Mascarot.
Le chirurgien qui se décide à une périlleuse opération commence par affaiblir son malade. Avant d’entreprendre sérieusement un sujet, l’ami d’Hortebize s’applique à briser les derniers ressorts de sa volonté. Or, Paul, en ce moment, ne s’appartenait plus. Il gisait là, éperdu, anéanti, inerte, ne voyant d’autre issue que le suicide à la plus épouvantable des situations.
Le moment était venu de frapper les derniers coups.
– Voyons, mon enfant, commença le placeur, il ne faut pas vous désespérer ainsi.
Pas de réponse. Paul entendait-il ou non ? À coup sûr, il semblait hors d’état de comprendre.
Mais le digne placeur voulait qu’il entendît et comprît. Il allongea le bras et le secoua assez rudement.
– Morbleu !… disait-il, où donc est votre courage ? C’est dans les situations difficiles qu’un homme fait ses preuves.
– À quoi bon !… gémit Paul. Ne venez-vous pas de me démontrer que jamais je ne réussirai à établir mon innocence ?
Cette faiblesse impatienta terriblement B. Mascarot, mais il dissimula.
– Non, répondit-il, non. J’ai tenu simplement à vous exposer les côtés fâcheux de votre affaire.
– Elle n’en a pas de bons.
– Mais si !… Seulement vous ne m’avez pas laissé finir. J’ai tout mis au pis, mais je dois me tromper. D’abord, l’accusation existe-t-elle réellement ? Nous supposons que Tantaine a disposé de fonds à lui confiés. Est-ce démontré ? Nous l’imaginons arrêté. L’est-il ? Nous admettons qu’il a rejeté la faute sur vous. Est-ce vrai ? Avant de jeter le manche après la cognée, que diable ! on vérifie.
À mesure que parlait le digne placeur, Paul revenait à lui.
– C’est vrai, murmura-t-il, on peut vérifier.
– Certainement. Sans compter que je pense avoir assez d’influence sur Tantaine pour lui faire confesser la vérité.
Les natures nerveuses comme celles de Paul ont ceci de précieux que si, au moindre souffle du malheur, elles ploient, elles relèvent au plus léger rayon d’espérance.
Paul, qui, la minute d’avant, se jugeait perdu, se vit sauvé.
– Oh ! monsieur ! s’écria-t-il, me sera-t-il jamais donné de vous prouver l’étendue de ma reconnaissance !
B. Mascarot souriait paternellement.
– Peut-être, répondit-il, peut-être. Et, pour commencer, il faut prendre sur vous d’oublier le passé. Le jour venu, on chasse le souvenir des mauvais rêves de la nuit, n’est-ce pas ? Je vous éveille pour une vie nouvelle ; soyez un autre homme.
Paul soupira profondément.
– Oublier Rose !… murmura-t-il.
L’honnête placeur fronça le sourcil à ce nom.
– Quoi ! s’écria-t-il, vous pensez encore à cette créature ! Il est, je le sais, des gens qui se consolent aisément d’être dupés, dont l’amour même redouble à chaque trahison. Si vous êtes de cette pâte facile, serviteur, nous ne nous entendrons jamais. Courez après votre infidèle, jetez-vous à ses pieds, suppliez-la de vous pardonner votre pauvreté.
Sous le fouet de l’ironie, Paul se cabra.
– Je prétends au contraire me venger d’elle ! fit-il avec emportement.
– C’est aisé : oubliez-la.
En dépit du ton résolu de Paul, on lisait dans ses yeux une certaine hésitation qui déplut à Mascarot.
– Voyons, reprit-il, vous êtes ambitieux, vous voulez parvenir ?
– Oh !… oui, monsieur, oui…
– Et vous songez à vous embarrasser d’une femme comme Rose !… Il faut avoir les deux bras libres, mon garçon, si on veut jouer profitablement des coudes dans la mêlée. Que diriez-vous d’un coureur qui, ayant des prétentions au prix, s’attacherait un boulet à la jambe ? Vous diriez : Il est fou ! Eh bien !… vous êtes ce coureur.
– Je suivrai vos conseils, monsieur, prononça Paul, sans arrière-pensée, cette fois.
– Voilà qui est parlé. Croyez-moi, avant longtemps, vous bénirez le ciel d’avoir donné à Rose l’idée et les moyens de vous abandonner. Vous pouvez aller haut et loin !…
Il y a trente ans que B. Mascarot spécule sur les passions humaines et met les faiblesses en coupe réglée. Il connaît les hommes.
Avec dix phrases, il venait de prendre sur Paul une influence décisive.
– Alors, monsieur, commença le jeune homme, cette place de douze mille francs…
– Eh !… il n’y a jamais eu de place, mon ami.
Paul devint extrêmement pâle.
Il se revoyait sans un sou, dans quelque taudis comme celui de l’Hôtel du Pérou, et seul cette fois.
– Cependant, monsieur, balbutia-t-il, vous m’aviez fait espérer…
– Quoi ! douze mille francs ? Rassurez-vous, vous aurez cela et même davantage ; mais vous ne me quitterez pas, je me fais vieux, je n’ai pas de famille, vous serez mon fils…
À cette proposition, le front de Paul s’assombrit.
L’idée qu’il serait placeur aussi, lui, qu’il s’enfermerait dans le confessionnal de la pièce d’entrée pour inscrire les offres et les demandes, révoltait sa vanité.
B. Mascarot, qui, par dessus ses lunettes, épiait ses impressions, vit bien ce qui se passait en lui.
– Et ça n’a pas de pain !… pensait-il. Sot orgueilleux ! Ah !… si ce n’était Flavie, si ce n’était l’affaire Champdoce !
Puis, tout haut il reprit :
– N’allez pas croire, mon cher enfant, que je veuille vous condamner au rude et obscur métier de placeur. Non. J’ai sur vous d’autres vues plus dignes de vos mérites.
Paul respira.
– Pourquoi ne pas vous dire la vérité ? poursuivit Mascarot. Vous m’avez plu, et je me suis promis de réaliser tous vos rêves d’ambition. Pour parvenir, vous avez tout… sauf cependant ce qui manquera toujours aux jeunes gens, la prudence et la constance de volonté. Eh bien !… je serai, moi, votre volonté et votre prudence.
Il s’arrêta un moment comme pour donner plus de poids à ses paroles, et bientôt reprit :
– Tenez, je pensais à vous hier, et je bâtissais dans ma tête l’édifice de votre avenir. Il est pauvre, me disais-je, et à son âge, avec ses idées, c’est cruel. Mais pourquoi n’épouserait-il pas une de ces héritières qui apportent un million dans leur tablier à l’homme qui a su toucher leur cœur ?
– Hélas !…
– Comment, hélas !… Penseriez-vous encore à Rose ?
– Oh ! non, certes, non !… je voulais dire…
– Si je vous parle d’héritière, c’est que j’en connais une, et si je le voulais bien, si mon ami le docteur Hortebize s’en mêlait… Rose est jolie, mais elle est presque aussi jolie que Rose, et, de plus, elle est bien née, elle est sage, elle est spirituelle… Elle a de grandes relations, et si son mari était un artiste de talent, un poète, un compositeur, il pourrait prétendre à tout.
Paul était devenu plus rouge que le feu ; tout cela, il l’avait rêvé, autrefois.
– Bien plus, disait le placeur, songeant à votre naissance illégitime, je poursuivais le plus magnifique roman. Avant 93, tout bâtard, vous le savez, était tenu pour gentilhomme. Connaissez-vous votre père ? Non. Qui vous dit qu’il ne porte pas un des grands noms de France et qu’il n’a pas, pour rehausser l’éclat de son écusson, 500 000 livres de rentes ? Peut-être, en ce moment, vous fait-il rechercher pour vous donner sa fortune et son nom. Cela vous plairait-il d’être duc ?
– Monsieur, balbutia Paul, monsieur…
B. Mascarot éclata de rire.
– Nous n’en sommes encore qu’aux suppositions, fit-il.
Le jeune homme ne savait que penser.
– Enfin, monsieur, demanda-t-il, qu’exigez-vous de moi ?
Le placeur redevint sérieux.
– J’exige l’obéissance, répondit-il. Une obéissance passive, absolue, immédiate, sans réflexions, sans examen.
– J’obéirai, monsieur, mais, de grâce, ne vous jouez-vous pas de moi ?
Au lieu de répondre, B. Mascarot sonna Beaumar, qui parut.
– Je te laisse seul, dit-il, je vais chez Van Klopen.
Puis se retournant vers Paul :
– Je ne plaisante jamais, lui dit-il, et aujourd’hui même vous en aurez la preuve. Nous allons aller déjeuner ensemble au restaurant ; j’ai à causer avec vous, et après…
Il s’arrêta pour jouir de la surprise de Paul, et ajouta :
– Après, je vous montrerai la jeune fille que je vous destine : il faut bien que je sache si elle vous plaît.
XI
Ce n’est pas sans mille bonnes raisons que le jeune M. Gaston de Gandelu, ce miroir de la nouvelle chevalerie parisienne, s’était récrié, lorsqu’il avait découvert qu’André, un peintre de genre, ignorait jusqu’à l’existence du sieur Van Klopen.
Ce surprenant industriel jouit, on peut le dire, d’une renommée européenne.
Pour s’en convaincre, il suffit de jeter les yeux sur ses factures, illustrées de médailles conquises à toutes les expositions.
On lit d’un côté : Breveté de S. M. C. la reine d’Espagne, et de l’autre : Fournisseur des cours du Nord.
Mais Van Klopen n’est pas Alsacien, ainsi que le disait l’intelligent Gandelu, lequel estime, probablement, que l’Allemagne est un arrondissement de l’Alsace ; Van Klopen est bel et bien Hollandais.
Vers 1850, cet homme intelligent, établi tailleur au centre de sa ville natale, coupait dans des draps achetés à crédit ces vastes habits et ces redingotes monumentales qui prêtent aux bourgmestres de Rotterdam une dignité si particulière.
Le métier ne lui réussit pas.
Déclaré en faillite après des opérations troubles, il fut forcé de fermer boutique et de fuir pour échapper à la rancune de ses créanciers.
À Paris, ce centre fiévreux de toutes les concurrences, il semblait destiné à mourir de faim. Point.
On le vit, un matin, louer, rue de Grammont, un appartement de 26 000 francs par an, écrire fièrement sur deux plaques de marbre, de chaque côté de la porte :
VAN KLOPEN
Tailleur pour Dames.
Puis, dans ses réclames, répandues à profusion, il se déclarait le « régénérateur des modes », et se décernait le titre « d’arbitre souverain des élégances féminines » et de « couturier des reines ».
Quel audacieux avait déposé le germe de ces idées au fond de la cervelle de l’épais Hollandais ? Quels capitalistes lui fournissaient les fonds ? Il ne l’a jamais dit.
Le fait est que, pour commencer, la tentative eut peu de succès.
Un mois durant, Paris se tint les côtes en songeant aux bouffonnes prétentions du « Régénérateur de Rotterdam ».
Lui laissait rire, courbant la tête sous l’orage de quolibets.
Il avait grandement raison.
Ses prospectus multipliés venaient de lui amener les deux clientes qui devaient sonner les premières fanfares de sa gloire.
L’une était une fort grande dame, plus aventureuse et plus excentrique encore que noble, la duchesse de Sairmeuse.
L’autre n’était rien moins qu’une illustration du demi-monde, la belle Jenny Fancy, que protégeait alors le comte de Trémorel.
Il est certain qu’il composa pour elles des toilettes qui s’éloignaient prodigieusement de tout ce qu’on avait fait ou rêvé jusqu’alors.
De ce moment, il était lancé. Le succès lui arriva comme il arrive à Paris : foudroyant. Et pour comble, le chœur immense des femmes de chambre qui semblaient s’être donné le mot, chantait ses louanges…
Aujourd’hui, la réputation de Van Klopen peut braver toutes les concurrences, défier toutes les tentatives.
Il en est réduit à refuser les commandes.
– J’aime à choisir mon monde, dit-il, à trier mes pratiques.
Et il choisit, et il trie !… Monsieur a ses caprices.
C’est pourquoi les plus nobles et les plus riches briguent l’honneur d’être habillées par lui.
Les plus fières ne rougissent pas de le voir scruter les mystères de leur taille. Elles lui confient des secrets qu’elles n’avouent pas à leur mari. Elles supportent très bien que ses larges et grosses mains se promènent sur leurs épaules pour en prendre la mesure.
C’est la mode !…
Ses salons sont comme un terrain neutre où se rencontrent, se confondent, se mêlent, se provoquent du regard les femmes de tous les mondes.
Peut-être est-ce un des éléments de la vogue !
Mme la duchesse de R… n’est pas fâchée de voir de près la célèbre Bischy, pour qui le baron de N… s’est brûlé le peu de cervelle qu’il avait. Peut-être, en prenant son tailleur, espère-t-elle prendre quelque chose de ses séductions.
De son côté, Mlle Diamant qui gagne, c’est connu, cent écus par an aux Délassements, éprouve une délicate jouissance à écraser, par les splendeurs de ses commandes, les grandes dames dont sa victoria croise les équipages autour du lac.
Entre ces clientes si diverses, l’adroit Van Klopen tient égale la balance de ses faveurs. Aussi est-il le plus choyé, le plus adoré des hommes.
Que de fois il a entendu de belles bouches dédaigneuses lui dire :
– D’abord, mon petit Klopen, si je n’ai pas ma robe pour mardi, je me meurs !…
L’hiver, les soirs de grandes fêtes, les équipages font la queue dans sa rue.
Entre neuf heures et minuit, deux cents femmes prennent d’assaut sa maison, jalouses de se faire attacher la dernière épingle de la main du maître, ambitieuses de son sourire approbateur.
Lui, grave, froid, impassible, le cigare aux dents quelquefois, – tout lui est permis, – il regarde défiler le brillant escadron. Il est sobre d’éloges. Il sait qu’un « très bien » de sa bouche enivre l’élue et désole vingt rivales.
Mais il a su s’attacher sa clientèle par des liens moins fragiles que ceux de la vanité.
Quand il a pris ses renseignements, si on lui offre des garanties sérieuses, il fait crédit.
Oui, il donne à crédit non seulement ses façons, mais encore les étoffes. Au besoin, il ferait entendre raison à des fournisseurs récalcitrants ; à la rigueur, il prête de l’argent.
Aussi, en ces jours de sarabande furieuse de l’anse du panier conjugal, le tailleur pour dames est la terreur des maris.
Honnêtes maris ! Ils dorment sur leurs deux oreilles, ils admirent l’ordre, l’économie, le savoir faire de leur femme, et, tout à coup, atroce réveil, le flegmatique Hollandais apparaît une facture de 20 000 francs à la main.
Que faire ? Payer.
Oui, payer ou plaider, car il plaide, Van Klopen. N’a-t-il pas fait, à la même audience, comparaître la brillante marquise de Reversay et l’aventureuses Chinchette, celle-là, précisément, qui périt si misérablement il y a trois mois !…
La marchande à la toilette, qui exploite les misères des filles, reculerait devant les manœuvres de cet usurier de la soie et du velours.
Malheur donc à la femme qui se laisse prendre au piège du crédit qu’il tend. La femme qui lui doit mille écus est perdue, car elle ne peut dire jusqu’où elle descendra pour chercher de l’argent quand on lui en réclamera.
Pourtant, on trouve bien des noms honorables sur ses livres !…
Est-il surprenant que tant de prospérités aient tourné la tête de Van Klopen ? Le contraire serait incroyable.
Il est donc gras, rose, impudent, vaniteux, cynique !… Ses flatteuses vont jusqu’à dire qu’il a de l’esprit.
Tel est, aussi exactement que possible, l’homme chez lequel B. Mascarot et son protégé Paul Violaine se rendaient après un long déjeuner chez Philippe.
La tenue de la maison de Van Klopen mérite une mention. Un tapis superbe, posé à ses frais, habille l’escalier jusqu’au premier étage qu’il occupe.
Dans l’antichambre, très vaste, deux chasseurs en grande livrée, reluisants d’or, étaient assis près des bouches du calorifère.
À la vue de B. Mascarot, ils se levèrent respectueusement, et l’un d’eux s’empressa d’éviter au placeur la peine d’une question.
– M. Van Klopen travaille en ce moment avec Mme la princesse Korasof, dit-il ; mais dès qu’il va savoir que monsieur le demande, il se dérangera. Monsieur veut-il prendre la peine de passer dans les appartements particuliers de monsieur ?…
Le beau chasseur se mettait déjà en mouvement ; B. Mascarot l’arrêta.
– Nous ne sommes pas pressés, dit-il, nous attendrons dans le grand salon avec les clients. Y a-t-il beaucoup de monde ?
– Une douzaine de dames au moins, les bals donnent…
Très bien, cela me distraira.
Aussitôt, sans attendre la réplique du chasseur, B. Mascarot tourna le bouton de cristal d’une porte à deux battants et poussa Paul dans la vaste pièce que le facétieux Van Klopen appelle sa « salle des Pas-Perdus. »
Ce salon, superbement décoré, doré, ornementé, peinturluré, est d’un goût exécrable ; mais il surprend par une particularité bizarre.
Le papier des murs disparaît entièrement sous une prodigieuse quantité de petites aquarelles représentant des femmes en toilettes variées.
Chaque tableau a sa légende, et si on approche, on lit avec les noms en toutes lettres :
Robe de Mlle de C…, pour un dîner à l’ambassade russe ;
Garnitures de la marquise de V…, pour un bal à l’Hôtel-de-Ville ;
Costume d’eaux de Mlle H… de R…
Péplum de Mlle S…
C’est le tailleur lui-même qui a imaginé ce moyen de léguer ces conceptions à la postérité.
Tel qu’il est, ce salon surprit si bien Paul par sa magnificence, que, décontenancé, ébloui, il restait sur le seuil, n’osant avancer, n’apercevant pas de siège où s’asseoir.
Mais B. Mascarot a du sang-froid pour deux.
Saisissant son protégé par le bras, il l’attira près de lui sur un canapé en murmurant à son oreille :
– De la tenue, morbleu ! l’héritière est là !
L’entrée de B. Mascarot et de son protégé, dans la « salle des Pas-Perdus » de l’illustre Van Klopen, avait presque fait scandale.
Il est si rare qu’un homme ose pénétrer dans ce sanctuaire des élégances, que toutes les belles dames qui attendaient patiemment le bon plaisir du roi des couturiers furent stupéfaites et comme saisies de la témérité de ces intrus.
L’impression était peut-être augmentée par la surprenante beauté de Paul, cet adolescent aux yeux tremblants, plus timide et plus rougissant qu’une vierge.
Les conversations avaient cessé comme par enchantement, et sous le feu d’une douzaine de paires d’yeux, sentant ses joues brûlantes, Paul perdait contenance, tourmentait son chapeau comme un paysan devant un tribunal, et n’osait lever la tête.
Cette confusion ne pouvait convenir à l’honorable placeur.
Il avait amené son protégé pour voir : il voulait qu’il regardât.
C’est qu’il n’était pas intimidé, lui, par cette imposante assemblée.
Dès en entrant, il avait salué à la ronde avec les grâces surannées d’un mirliflor de 1820, et maintenant, sur son canapé, il semblait aussi à l’aise qu’à son agence, au milieu des cordons bleus.
L’imperturbable assurance de B. Mascarot tient, c’est lui qui l’avoue, à son mépris profond de l’humanité et à ses lunettes.
Si on savait au juste quels services peuvent rendre ces verres de couleur derrière lesquels s’abritent et se cachent toutes les impressions, l’univers entier chausserait des lunettes bleues.
Cependant le bon placeur voulut laisser à son protégé quelques minutes pour se remettre et aussi pour s’habituer à l’atmosphère tiède et trop chargée de parfums du salon.
Mais, à la longue, voyant que Paul s’obstinait à rester le nez dans son gilet, légèrement, du coude, il lui poussa le bras.
– C’est donc la première fois, lui dit-il à l’oreille, que vous voyez des femmes en grande toilette ? Avez-vous peur ?
Paul fit un effort pour se redresser.
– Regardez à droite, murmurait Mascarot, entre le piano et la fenêtre… c’est elle !
Près de la fenêtre, à côté de sa femme de chambre, était assise une toute jeune fille qui paraissait avoir dix-huit ans à peine.
Elle n’était pas aussi jolie que l’avait annoncé l’estimable placeur, mais sa beauté avait quelque chose de vif, d’étrange, d’inquiétant, même pour l’observateur.
Elle était petite, mignonne, frêle en apparence et très brune.
Ses traits manquaient de régularité, mais ses cheveux noirs et lumineux semblaient lancer des gerbes d’étincelles ; ses yeux, d’un bleu sombre, avaient d’irrésistibles langueurs. La pourpre de ses lèvres un peu charnues affirmait les ardeurs du sang qui y affluait, aussi sûrement que son front bombé trahissait une opiniâtreté exagérée jusqu’à l’absurde.
Tout, en elle, respirait la passion, ou plutôt elle paraissait être la passion même.
Il fallut à Paul un appel énergique à sa volonté pour prendre sur lui de la regarder.
Cependant, il osa : leurs yeux se rencontrèrent, et tous deux en même temps tressaillirent comme au choc de la même batterie électrique.
Paul demeura immobile fasciné. Quant à la jeune fille, si violente fut son émotion, qu’elle se détourna brusquement, craignant d’être remarquée.
Mais personne ne songeait à observer.
La conversation avait repris son cours, et toutes les clientes du célèbre Van Klopen écoutaient avec une religieuse admiration une jeune dame aux airs évaporés qui décrivait une de ses dernières toilettes de bois.
– C’était renversant, disait-elle, et il n’y a que Klopen pour des créations pareilles. Toutes ces demoiselles à calèches à huit ressorts étaient furieuses. Je tiens du marquis de Croisenois que Jenny Fancy en pleurait de rage. Imaginez trois jupes vertes, de nuances différentes, découpées et étagées…
L’excellent Mascarot ne s’intéressait pas à la description.
Il avait épié et il avait vu.
Le frémissement des deux jeunes gens fit monter un sourire à ses lèvres flétries.
– Eh bien ? demanda-t-il à son protégé.
Paul eut quelque peine à étouffer une exclamation d’admiration.
– Adorable ! murmura-t-il.
– Et millionnaire !… insista le placeur.
– Elle n’aurait pas un sou qu’on serait encore fou d’elle.
B. Mascarot toussa et éprouva le besoin de rajuster ses lunettes.
– Maintenant, pensa-t-il, je te tiens, mon garçon ! Que ton émotion soit feinte ou réelle, que tu adores la femme ou la dot, peu importe ; tu passeras partout où je voudrai.
Sur cette paternelle réflexion, il se pencha de nouveau vers son protégé.
– Voulez-vous savoir son nom ? souffla-t-il.
– Oh ! dites, je vous en prie.
– Flavie.
Paul était en extase. Il osait maintenant regarder la jeune fille, elle s’était un peu détournée et il pensait, oubliant le jeu des glaces, qu’elle ne pouvait le voir.
La jeune dame ne tarissait toujours pas.
– C’est navrant ! disait-elle, ce qui arrive à cette pauvre comtesse de Luxé qui est un ange. Oui, mesdames, elle mettait des tirettes à ses jupes et faisait teindre ses robes. Elle économisait. Quelle duperie ! Pendant ce temps, M. de Luxé faisait des folies pour une demoiselle des Bouffes. En apprenant cela, elle a failli mourir de douleur, et moi, j’ai juré que si mon mari est jamais ruiné, ce sera par moi et non par une autre.
Elle s’interrompit.
La porte du fond s’ouvrait avec fracas, et Van Klopen, en personne, apparaissait dans sa gloire.
Il a cinq pieds et demi ; il est large plus qu’à proportion ; sa face rouge tient registre des petits verres qu’i boit ; il a l’œil insolent, la voix doucereuse et le pur accent de Rotterdam.
Comme toujours, il portait un coin de feu de velours grenat, avec jabot et manchettes de dentelles. Un énorme diamant étincelait à son doigt.
– De laquelle de ces dames est-ce le tour ? demanda-t-il.
C’était le tour de la dame évaporée ; elle se levait déjà, lorsque le grand couturier l’arrêta d’un geste.
Il venait d’apercevoir B. Mascarot, et s’avançait vers lui avec un empressement marqué.
Comment, c’est vous, cher monsieur, qui êtes là, disait-il, on vous a fait attendre, oh !… que d’excuses !…
Il y eut un murmure dans l’assemblée, mais si léger, si léger !…
– De grâce, prenez la peine de passer dans mon cabinet, poursuivait Van Klopen ; monsieur est avec vous ? très bien ; passez, messieurs, passez…
Il entraînait, tout en parlant, B. Mascarot et son protégé ; il les poussait devant lui.
Il allait se retirer sans une excuse, quand une des clientes bondit jusqu’à lui et le poussa presque de force dans le corridor, tirant la porte après elle.
– Monsieur, disait-elle, au nom du ciel, un mot.
Van Klopen la toisa d’un air ennuyé.
– Qu’y a-t-il encore ? demanda-t-il.
– Monsieur, c’est demain l’échéance du billet de 3 000 francs que je vous ai souscrit.
– C’est fort possible.
– Eh bien ! je n’ai pas d’argent pour le payer.
– Ni moi non plus.
– Je viens pourtant vous conjurer de me le renouveler, à deux mois, monsieur, à un mois même, aux conditions que vous voudrez…
Le tailleur pour dames haussa les épaules.
– Dans deux mois, fit-il, vous serez encore moins en mesure qu’aujourd’hui. Si le billet n’est pas acquitté demain, on poursuivra…
– Mon Dieu !… mais alors mon mari saura…
– J’y compte bien, et je sais qu’il paiera.
La malheureuse femme était glacée d’effroi.
– Oui, dit-elle, mon mari paiera, mais je suis perdue, moi.
– Je n’y puis rien, j’ai des associés…
– Oh !… ne me dites pas cela, monsieur, je vous en supplie… sauvez-moi. Mon mari a déjà payé mes dettes trois fois, et il m’a juré… s’il ne s’agissait que de moi !… Mais j’ai des enfants, mon mari est capable dans sa colère de me les retirer… Par pitié !… monsieur, mon bon monsieur Van Klopen…
Elle se tordait les mains, elle sanglotait, elle était presque à genoux.
L’illustre couturier restait de glace.
– Quand on est mère de famille, prononça-t-il, on prend une couturière à la journée, il y en a qui bâtissent des robes charmantes.
Elle essaya pourtant encore de le toucher, elle lui avait pris les mains, pour un mot elle les eût portées à ses lèvres.
– Monsieur, si vous saviez… je n’oserai jamais rentrer chez moi… je n’aurai pas le courage d’avouer à mon mari…
Van Klopen eut un ricanement d’un épouvantable cynisme.
– Eh bien ! dit-il, si votre mari vous fait peur, adressez-vous à un autre !…
Et se dégageant brutalement, abandonnant la malheureuse dans le couloir, il rentra dans son cabinet où l’attendaient Paul et Mascarot.
Il était vraiment mécontent, l’arbitre des élégances, et la preuve c’est qu’il ferma la porte de son cabinet avec une violence éloignée de son caractère et de ses habitudes. Les véritables puissances sont calmes et sereines.
– Avez-vous entendu, dit-il à Mascarot, cette scène pitoyable ? Il m’en arrive comme cela de temps à autre, et ce n’est pas gai.
Il s’interrompit, parce qu’il sentait à la main un léger chatouillement ; il l’examina curieusement et l’essuya en disant avec un rire épais :
– Tiens !… elle m’a pleuré sur la main !…
Paul était franchement révolté.
La première inspiration de son cœur était encore bonne. S’il eût eu trois mille francs, il les eût porté à cette pauvre femme, dont on entendait encore dans le couloir les gémissements étouffés.
– C’est épouvantable !… fit-il.
L’exclamation sembla scandaliser Van Klopen.
– Ah !… dit-il avec un intraduisible cynisme d’expressions, monsieur donne dans les crises de nerfs !… Si monsieur était à ma place, il saurait promptement ce que cela vaut au juste. C’est mon argent, après tout, et celui de mes associés que je défends. Vous ne savez donc pas que toutes ces farceuses que j’habille sont comme folles de vanité et enragées de toilettes. Père, mère, mari, elles donneraient tout, avec les enfants par-dessus le marché, pour se faire ouvrir un compte. Vous ne pouvez savoir ce dont une femme est capable pour se procurer la robe qui ferai crever une rivale de dépit… Ce n’est jamais qu’au moment de régler qu’elles songent à la famille…
– Cependant, vous savez qu’avec celle-ci, vous ne perdrez rien ; son mari…
– Ah ! oui, les maris, s’écria Van Klopen, qui s’animait à la discussion, parlons-en. Ils me font encore mourir de rire, ceux-là. Apporte-t-on des robes ? Ils vous reçoivent avec toutes sortes de politesses, car ils aiment les belles étoffes, eux aussi, qui leur font honneur. Quand on présente la facture, c’est une autre paire de manches. Ils roulent des yeux terribles et parlent de vous faire jeter à la porte…
De la meilleure foi du monde, Paul s’imaginait plaider la cause de la pauvre débitrice.
– Les maris sont souvent trompés, objecta-t-il.
– Laissez-moi donc !… Ils savent ; et dans tous les cas, leur métier est de s’informer. Mais non… ils font les ignorants, c’est plus commode. Quand ils ont donné cent louis par mois, ils se croient quittes et regardent défiler à la douzaine des toilettes à faire cabrer des chevaux de fiacre. S’ils ne se disent pas que leurs femmes les achètent à crédit, où pensent-ils donc qu’elles les prennent ?… Mais, non, on s’entend. Madame commence par se faire ouvrir un compte, et Monsieur, après, discute le total et demande des réductions. Je connais ce jeu !…
Le grand couturier paraissait si fort en colère que B. Mascarot jugea son intervention nécessaire.
– Vous avez peut-être été un peu dur, dit-il.
Van Klopen lui jeta un coup d’œil d’intelligence.
– Bah !… répondit-il, demain je serai payé, je sais bien par qui et comment, et j’aurai une autre commande. Pour agir comme je l’ai fait, j’avais mes raisons…
Ces raisons n’étaient peut-être pas fort honnêtes, car il n’osa les dire tout haut.
Il entraîna l’honorable placeur dans l’embrasure d’une fenêtre, et là, tous deux, ils se mirent à causer très bas, riant abondamment comme au récit d’un bon tour.
N’entendant pas un traître mot, Paul se mit à examiner ce que Van Klopen appelle son « cabinet de consultations ».
On n’y voyait rien de ce qu’il faut pour écrire, mais bien quantité de mètres, de ciseaux, des règles, puis des monceaux d’échantillons, des masses de croquis de toilette ; enfin, dans le fond, six mannequins supportaient les patrons en papier des nouvelles créations du tailleur pour dames.
Paul n’avait pas eu le temps de tout inventorier que déjà les deux amis, il les jugeait tels, étaient de retour au coin du foyer.
– Nous perdons notre temps, prononça B. Mascarot ; j’aurais cependant bien voulu jeter un coup d’œil sur nos livres, mais il y a tant de monde dans le salon.
– Et cela vous arrête, fit insoucieusement le couturier ; attendez une minute.
Il sortit sur ces mots, et presque aussitôt on entendit sa grosse voix douceâtre.
– Désolé, mesdames, disait-il, désespéré, parole d’honneur, mais je suis en conférence avec un marchand de tissus, vous comprenez, c’est pour vous, en somme, ce sera peut-être long…
– Nous attendrons, répondit le chœur intrépide des clientes…
Van Klopen reparut, étincelant de fierté :
– Ce n’est pas plus malin que ça, prononça-t-il, elles resteront là jusqu’à la nuit pour attendre leur petit Klopen. Pauvres chattes !… Voilà les clients de Paris. Courez après eux, épuisez-vous en gracieusetés… ils se sauvent comme des lièvres. Au contraire, moquez-vous d’eux, recevez-les mal, ils affluent. Si jamais la vogue me quitte, je ferme ma boutique, j’écris dessus : « Le public n’entre pas ici », et le lendemain la foule aura défoncé mes portes.
B. Mascarot daigna approuver de la tête, pendant que le tailleur pour dames tirait d’un chiffonnier un gros registre.
– Les affaires n’ont jamais été mieux, reprit Van Klopen ; à vrai dire, nous sommes en pleine saison. Depuis neuf jours que vous n’êtes venu, nous avons pour 87 000 francs de commandes.
– C’est superbe ! Mais laissons le courant pour les affaires douteuses, je suis pressé.
L’arbitre des élégances feuilletait son registre.
– Voici, dit-il. Du 4 février, Mlle Virginie Cluche demande cinq toilettes de théâtre et de soirée, deux dominos, trois costumes de ville.
– C’est beaucoup.
– Aussi ai-je demandé à me consulter. Elle ne doit qu’une misère : 1 800 francs.
– C’est déjà trop, si, comme on l’a dit, son protecteur est ruiné. Ne refusez pas, mais ne faites rien jusqu’à nouvel ordre.
Pour toute réponse, Van Klopen traça en marge de son registre un signe cabalistique, traduction mystérieuse des volontés du placeur.
– Du 6, même mois, commande importante de la comtesse de Mussidan, pour elle. Une robe sans garniture pour sa fille. Son compte est des plus élevés ; le comte ne paie pas, il m’a prévenu.
– N’importe ! allez, et même poussez-la !
Nouveau signe sur le registre.
– Du 7 : Demande d’ouverture de compte de Mme Flavie Martin-Rigal ; une nouvelle cliente, la fille du banquier, sans doute.
À ce nom, Paul tressaillit ; mais l’estimable négociant ne sembla pas y prendre garde.
– Mon compère, fit-il du ton le plus sérieux, retenez bien ce nom. Quoi que vous demande cette jeune fille, fût-ce votre maison entière, c’est d’avance accordé. Et surtout, le plus profond respect. La moindre irrévérence vous causerait des désagréments. Elle est dans votre salon, aussitôt après mon départ, vous la ferez entrer.
À l’air surpris du couturier, il était aisé de voir que Mascarot n’abuse pas de ce genre de recommandation. Paul n’était pas moins ébahi pour d’autres motifs.
– Vous serez obéi, monsieur, répondit Van Klopen. À la date du 8, un jeune monsieur, Gaston de Gandelu, m’est présenté par M. Luper, le bijoutier. Son père est très riche, dit-on, et personnellement il doit recueillir à sa majorité, qui est proche, un héritage considérable. Ce jeune homme demande un crédit de quinze ou vingt mille francs pour une jeune dame.
Le placeur dissimula un sourire. Par-dessous ses lunettes, il observait son protégé. Paul ne bougeait pas. Ce nom de Gandelu ne lui apprenait rien.
– La dame, poursuivait le couturier, m’a été présentée hier. Elle s’appelle soi-disant Zora de Chantemille. Le fait est qu’elle est furieusement jolie.
B. Mascarot réfléchissait.
– Compère, dit-il, enfin, vous ne sauriez croire combien ce jeune homme me gêne. On ne peut plus compter sur Clichy… Qu’imaginerions-nous pour pouvoir l’éloigner de Paris ?
Le visage de Van Klopen devenait écarlate à vue d’œil. Le moindre effort de réflexion charriant son sang à la tête, produit cet effet.
– Eh !… fit-il en se frappant le front, le moyen est trouvé. Ce Gandelu qui m’a l’air d’un étourneau vaniteux, est capable de tout et de bien d’autres choses encore, pour cette belle fille blonde.
– Je le crois.
– Alors, voici la chose. Je lui ouvre un petit compte pour lui mettre l’eau à la bouche ; bien !… Arrive une commande très importante, je taille, j’essaye ; mais, au moment de livrer, je fais semblant d’avoir peur et je demande quelques petites valeurs que je jure de ne pas négocier… à deux signatures, s’entend. On met alors le gaillard en rapport avec la Société d’escompte mutuel, et notre cher Verminet lui persuade aisément d’écrire de sa main un nom connu au bas d’un chiffon de papier. Il m’apporte ces valeurs, je les accepte, nous le tenons.
– Un petit faux !…
– Dame, je ne vois pas d’autre moyen, à moins que…
Il s’interrompit ; on entendait dans l’antichambre un tapage inusité et comme un bruit de voix se disputant.
L’impassible Van Klopen s’était levé, un peu ému, et il prêtait l’oreille, écoutant de toutes ses forces.
– Je voudrais bien savoir, murmura-t-il, quel est l’impertinent qui se permet de venir faire du scandale chez moi. Vous verrez que ce sera encore quelque mari ridicule…
Si les maris détestent et redoutent le couturier des reines, on doit convenir qu’il le leur rend bien, et qu’ils sont le cauchemar de son existence.
Si on l’écoutait, l’institution serait abolie demain.
– Allez voir ce que c’est, conseilla B. Mascarot.
– Moi !… me commettre avec je ne sais qui, risquer d’essuyer une avalanche d’injures ; pas si bête ! Je paye des domestiques pour m’épargner ces ennuis.
C’était sage et prudent.
Le bruit d’ailleurs allait s’éteignant, le diapason des voix baissait. On entendit encore ouvrir et se refermer la porte du salon, puis rien. Tout était rentré dans le silence.
– Revenons à nos moutons, reprit l’inestimable placeur. Votre proposition me va. J’avais bien un autre expédient, mais il peut manquer. Un joli petit faux est une arme toujours chargée…
Il quitta son fauteuil et entraîna le couturier à l’extrémité de la pièce.
Après ce qu’ils venaient de se confier, que pouvaient-ils avoir à dire de plus affreux, de plus indigne ?
Depuis le commencement de cette odieuse conversation, Paul était devenu plus pâle que la mort.
Si ignorant qu’il fût des choses de la vie, il ne pouvait ne pas comprendre.
Déjà, chez Philippe, pendant le déjeuner, B. Mascarot lui avait laissé entrevoir des choses étranges, ce qu’il entendait maintenant achevait de l’éclairer.
Il devenait évident pour lui que cet homme, dont il avait accepté la protection bizarre, machinait quelque ténébreuse et détestable intrigue.
Actes, démarches, discours, tout, de sa part, avait une signification, une raison d’être, et tendait à quelque but mystérieux.
Analysant et comparant ce qu’il avait vu, entendu ou surpris, Paul devinait ou plutôt sentait une trame patiemment ourdie.
Il entrevoyait d’inexplicables rapports entre cette Caroline Schimel qu’on faisait espionner, et ce marquis de Croisenois, si fier et si humble, et cette comtesse de Mussidan, qu’on poussait à la ruine, et Flavie, cette riche héritière dont on lui faisait espérer la main, et ce Gaston de Gandelu, à la passion de qui on allait arracher un faux, un de ces crimes qui conduisent au bagne.
Et lui, Paul, n’était-il pas un instrument rendu forcément docile ? Vers quels abîmes et à travers quels bourbiers allait-on le conduire ?
Ce placeur obscur, ce couturier illustre, n’étaient pas deux amis, comme il l’avait cru, mais deux complices.
Il voyait à quelques sources impures B. Mascarot puisait son pouvoir terrible et sans bornes : il savait, il était comme le remords vivant, la menace perpétuelle poursuivant ses tremblantes victimes le fouet à la main.
Et Paul se sentait aux mains de ce doucereux despote. L’évidence d’un complot entre lui et Tantaine éclatait à ses yeux. Trop tard !
Lui, innocent, il se trouvait sous le coup d’une accusation de vol.
Lorsqu’il était sans défiance, B. Mascarot l’avait lié, ficelé, garrotté, avec la redoutable adresse de ces mygales nocturnes des forêts de Salcette, qui surprennent l’oiseau endormi sur sa branche et l’enveloppent de leurs fils sans l’éveiller.
Pouvait-il lutter avec quelques bonnes chances de succès ? Non. Au moindre effort pour rompre le filet fatal, il devait être brisé.
Cette certitude le faisait frémir, mais il n’éprouvait pas la noble horreur de l’honnêteté pour le crime.
Il faut bien l’avouer : tous les instincts mauvais dont le germe était en lui fermentaient comme la pourriture au soleil.
Il était encore ébloui des splendides espoirs que le tentateur avait fait briller à ses yeux. Il se souvenait qu’on lui avait dit que son père était un grand seigneur, il songeait à cette jeune fille millionnaire, dont un seul regard avait fait vibrer en lui des cordes inconnues.
Il se disait qu’un homme comme Mascarot, tout puissant, méprisant les lois et les préjugés, fort, patient, devait quand même arriver à ses fins.
Quels risques courait-il à se livrer au torrent qui déjà l’entraînait ? Aucun. Mascarot devait être un nageur assez vigoureux pour lui tenir la tête hors de l’eau…
Paul ne s’était jamais exercé à se contraindre, il ne pouvait se croire observé, aussi était-il aisé de saisir sur sa mobile physionomie le reflet de toutes ses sensations.
Ainsi faisait l’honorable placeur.
Si cette conversation infâme avait eu lieu devant son protégé, c’est qu’il l’avait voulu ainsi.
Avant de lui donner le mot de son secret, avant de lui révéler ce qu’il attendait de lui, il tenait à accoutumer son esprit timide à envisager froidement les plus atroces combinaisons.
Il avait observé que mieux mille fois que les plus subtiles théories, le fait brutal qui surprend, démoralise et hâte la corruption.
Il lut dans l’œil de Paul sa résolution de s’abandonner, et c’est avec la certitude absolue de son influence qu’il reprit à haute voix la conversation :
– Arrivons, dit-il, à la question sérieuse, qui est le post-scriptum de ma visite. Où en sommes-nous avec la vicomtesse de Bois-d’Ardon ?
Le tailleur pour dames eut un geste suffisant, comme il lui arrive quand on parle d’une de ses clientes de prédilection.
– Elle va bien, répondit-il. Je viens de lui livrer une série de toilettes inouïes.
– Que doit-elle ?
– Au plus 25 000 francs ; elle a dû bien plus.
B. Mascarot tracassait furieusement ses lunettes.
– Voilà, certes, dit-il, une femme calomniée. Elle est légère, coquette, vaniteuse, dépensière, mais rien de plus. Depuis quinze jours, je fouille son passé, et je n’y trouve pas le plus petit pêché véniel qui la mette à notre discrétion… Heureusement, sa dette nous la livre. Son mari sait-il qu’elle a un compte ici ?
– Lui !… certes non. Il donne à sa femme un argent fou, et s’il s’en doutait…
– Parfait ! Il faut lui présenter sa facture.
– Mais, monsieur, remarqua Van Klopen surpris, elle a donné la semaine passée un acompte important.
– Raison de plus pour agir : elle ne doit pas être en fonds.
L’arbitre des élégances grillait de présenter mille objections, un geste impérieux du digne placeur lui ferma la bouche.
– Je vous prierai de m’écouter, reprit B. Mascarot, de bien retenir ce que je vais vous dire, et surtout faites-moi la grâce de me dispenser de vos remarques.
Van Klopen avait perdu cette superbe impudence qui impose tant à sa clientèle.
– Êtes-vous connu chez la vicomtesse de Bois-d’Ardon ? demanda le placeur.
– Oh !… comme le loup blanc.
– Très bien. Cela étant, après-demain, à trois heures précises, – ni plus tôt, ni plus tard, réglez-vous sur la Bourse, – vous vous présenterez chez la vicomtesse. On vous répondra que madame a une visite.
– J’attendrai.
– Point. Vous insisterez pour voir madame sur-le-champ. Si les domestiques étaient par trop récalcitrants, menacez-les de moi.
– Inutile ; je saurai forcer la consigne.
– Vous pénétrerez donc dans le salon, et vous trouverez la vicomtesse en grande conversation avec M. le marquis de Croisenois. Vous le connaissez, j’imagine ?…
– Oui, mais seulement de vue…
– Cela suffit. Vous ne vous inquièterez nullement de lui, vous tirerez votre facture de votre poche, et brutalement, vous réclamerez de l’argent.
– Oh !… monsieur, y pensez-vous ? La vicomtesse me menacera de me faire jeter à la porte.
– C’est très probable. Mais vous la menacerez, vous, de porter votre facture à son mari. Elle vous ordonnera de sortir, mais au lieu d’obéir, vous vous camperez insolemment dans un fauteuil en déclarant que vous ne vous retirerez pas sans argent.
– Mais ce sera affreux.
– Sans doute. Mais le marquis de Croisenois mettra fin à la scène. Il vous jettera à la tête un portefeuille, en vous disant : Paye-toi, faquin !…
– Et je déguerpirai.
– Oui, mais avant, comme vous aurez en poche un crayon bien taillé, vous libellerez un reçu au nom de M. Croisenois pour le compte de Mme de Bois-d’Ardon.
Jamais homme ne se vit humilié et piteux autant que l’était l’arbitre des élégances…
– Si j’y comprends quelque chose… murmurait-il.
– Inutile. Vous m’avez entendu ?
– J’obéirai, monsieur, mais nous perdrons la clientèle de la vicomtesse.
– Et après !…
Van Klopen allait peut-être essayer de se retrancher derrière sa dignité, lorsque la voix piaillarde qui, l’instant d’avant, emplissait l’antichambre éclata de nouveau, mais tout près, cette fois, dans le couloir même.
– Elle est mauvaise ! criait cette voix. On ne me la fait pas à la pose, à moi. Attendre une heure !… plus souvent !… Où est mon sabre ? Le sabre, le sabre !… Van Klopen occupé !… Je la connais. Vous allez voir qu’il se dérangera pour moi.
Ces exclamations eurent au moins le résultat de dissiper comme par enchantement les nuages qui assombrissaient le front des deux associés.
Ils échangèrent un regard gros de réticences, comme s’ils eussent connu cette voix aigre et fausse qui perçait le tympan.
– C’est lui ! murmura Mascarot.
La porte s’ouvrit en même temps, et le jeune M. Gaston de Gandelu fit irruption dans le cabinet du tailleur pour dames.
Il portait, ce jour-là, un veston plus court encore que d’habitude, un pantalon plus clair et plus étroit, un faux-col plus vaste, une cravate plus étourdissante.
Sa plate figure était rouge et bouffie de colère.
– C’est moi ! s’écria-t-il dès le seuil. Hein !… vous la trouvez forte, celle-là ! Je suis comme cela, moi, bon enfant, mais carré, comme dit Achille de chez Vachette. Attendre plus de vingt minutes, moi !… Ah !… mais non.
Il est sûr que cette infraction aux règles immuables de sa maison, que ce mépris d’une étiquette consacrée mettaient le couturier des reines hors de soi.
Mais il était sous l’œil du placeur, il avait reçu l’ordre de s’emparer du jeune M. de Gandelu, il savait qu’on ne prend point de mouches avec du vinaigre, il se résigna à filer doux.
– Croyez, monsieur, commença-t-il, sans réussir, toutefois, à dépouiller son air gourmé ; croyez que si j’avais su…
Cette simple explication enchanta le spirituel jeune homme.
– Des excuses !… interrompit-il, je les accepte. Qu’on remporte les épées !… Farceur, va ! Mais n’importe, il ne faudrait pas me la refaire. J’ai en bas mes chevaux qui sont capables d’avoir pris un rhume. Vous les connaissez, mes chevaux ? Quelles bêtes, hein ! Et dire que Zora voulait continuer de poser !… Est-elle assez jeune !… Mais je la formerai, vous verrez… Je cours la chercher.
Sur ces mots, il disparut dans le couloir en criant :
– Zora !… Madame de Chantemille !… Chère vicomtesse !…
Le grand couturier semblait aussi à l’aise, à peu près, qu’un homme sur les charbons ardents. Quel affront pour sa maison !… Il lançait des regards désespérés à B. Mascarot, qui, placé près de la porte donnant sur l’escalier, gardait une physionomie d’augure.
Quant à Paul, il n’était peut-être pas éloigné de prendre ce jeune monsieur, qu’un équipage attendait à la porte, pour le modèle achevé des grâces et façons du grand monde.
Même son cœur se serrait en songeant à l’odieux traquenard où allait être pris ce garçon si intéressant.
Cette dernière impression fut si vive qu’il s’approcha du placeur, afin de la lui communiquer.
– N’y a-t-il donc aucun moyen, demanda-t-il à voix basse, d’épargner cet infortuné jeune homme ?
B. Mascarot eut un de ces sourires pâles qui font frémir ceux qui le connaissent pour l’avoir vu à l’œuvre.
– Avant un quart d’heure, répondit-il, je vous adresserai cette même question, en vous laissant maître de la résoudre à votre guise.
– Oh ! dans ce cas…
– Chut !… voici venir votre première épreuve. Si vous n’êtes pas l’homme fort que j’ai cru, bonsoir. Tenez ferme !… Une cheminée va vous tomber sur la tête.
Les expressions étaient triviales, mais le ton était si expressif que Paul, effrayé, entrevit les plus fantastiques dangers et rassembla toute son énergie.
Bien lui en prit, car il put étouffer le cri de surprise et de colère que devait lui arracher la vue de la femme qui entrait.
La vicomtesse, la Zora du jeune M. de Gandelu, c’était sa Rose, à lui, dans une toilette qui, pour avoir été achetée toute faite, n’en était pas moins étourdissante.
Évidemment, elle avait de belles dispositions, et, conseillée par l’intelligent Gaston, elle devait aller loin… Et la preuve, c’est qu’elle avait sur le nez un binocle qu’elle maintenait à grand peine, et qui paraissait la gêner énormément.
Elle était intimidée pourtant, et M. de Gandelu, la traînait presque.
– Auriez-vous peur ; lui disait-il. Je la trouverais drôle ?… Arrivez donc, puisque je vous affirme qu’il va chasser ses domestiques.
Zora-Rose installée dans un fauteuil, le séduisant jeune homme se retourna vers le célèbre fournisseur des cours du Nord.
– Eh bien ! lui demanda-t-il, avez-vous pensé à nous ? Avez-vous cherché et composé la toilette qui convient à la beauté de madame ?
Van Klopen ne répondit pas. Il avait les sourcils froncés, le visage contracté du devin qui, assis sur le trépied, attend l’inspiration.
– J’y suis !… s’écria-t-il enfin avec un geste grandiose, j’y suis, j’ai trouvé, je vois !
– Hein !… fit Gaston influencé, quel homme !
– Écoutez, poursuivit le couturier, l’œil brillant de l’enthousiasme des grands inventeurs. Costume de ville d’abord : polonaise à corsage large, cordelières croisées à la pensionnaire ; corsage, manches et sous-jupe d’un marron vigoureux ; jupe de dessus « cheveux de la reine », avec échancrures ovoïdes ; robe bouffante relevée en coquilles.
Il eût pu parler longtemps ainsi, Zora-Rose ne l’entendait plus.
Elle venait d’apercevoir Paul, et, en dépit de son audace nouvelle, sa terreur était si grande qu’elle était près de se trouver mal.
Qu’allait-il advenir de cette inexplicable rencontre ?
Comment Paul pouvait-il rester calme en apparence, se contenir, lorsqu’elle lisait dans ses yeux les plus épouvantables menaces ?
Son malaise devenait si manifeste, qu’à la fin le jeune M. de Gandelu le remarqua.
Mais ne connaissant pas Paul, qu’il avait à peine aperçu en entrant, doué d’une perspicacité un peu bornée, il se méprit complètement aux causes du trouble affreux de Rose-Zora.
– Arrêtez ! cria-t-il à Van Klopen, arrêtez ! arrêtez !… Voyez l’effet de la joie ! Je connais cela, moi. Dix louis qu’elle va avoir une crise de nerfs ! Ah ! mais non, il n’en faut pas !…
Durant cette scène, B. Mascarot n’avait pas perdu son protégé de vue. Le jugeant près d’éclater, il pensa que prolonger l’épreuve serait à la fois absurde et imprudent.
– Je vous laisse, cria-t-il à Van Klopen ; n’oubliez pas nos conventions. Monsieur et madame, mes respects.
Sachant comment se retirer sans traverser le salon, il prit le bras de Paul et l’entraîna. Il était temps.
Lorsqu’ils furent sur l’escalier, délivrés des empressements des chasseurs de l’antichambre, alors seulement l’honorable placeur respira.
– Que pensez-vous de l’aventure ? demanda-t-il.
Si pénible avait été la contrainte que Paul s’était imposée, la rage de l’amour-propre offensé serrait si bien ses dents, qu’il lui fut impossible de répondre autrement que par un gémissement sourd.
– Diable !… pensa l’honnête directeur de l’agence de la rue Montorgueil, il a été rudement touché. Peu importe, il s’est assez bien tenu et le grand air va le remettre.
Point. Arrivé dans la rue, Paul eût été contraint de s’arrêter, tant ses jambes flageolaient, s’il n’eût eu un point d’appui.
Son digne protecteur ne pouvait le traîner en cet état, aussi eut-il un soupir de satisfaction en apercevant un petit café à sa convenance.
– Entrons ici, dit-il, vous prendrez quelque chose, et cela vous remontera le moral.
Ils allèrent s’établir dans une étroite salle où ils étaient seuls, et au bout de dix minutes, après avoir bu deux verres de rhum, Paul reprit figure humaine, le sang remontait à ses joues.
– Cela va mieux ? demanda le placeur.
– Oui.
Il faut battre le fer pendant qu’il est chaud. Quand B. Mascarot a étourdi son homme, il l’achève sans lui laisser le loisir de respirer.
– Il y a un quart d’heure, reprit-il, je vous ai promis de vous rappeler vos bonnes dispositions au sujet de M. de Gandelu…
– Assez, interrompit violemment Paul, assez !…
Le digne placeur eut un paternel sourire.
– Voyez pourtant, fit-il, comme, selon la position, les points de vue changent. Voici que vous commencez à devenir raisonnable.
– Oui, je suis raisonnable, c’est-à-dire que je veux être riche, moi aussi… Ah ! vous n’aurez plus à me presser. C’est moi qui vous sommerai de réaliser vos promesses. Je ne veux plus avoir à subir une humiliation comme celle d’aujourd’hui.
B. Mascarot eut un haussement d’épaules que son protégé ne vit pas.
– Vous êtes en colère ? fit-il.
– La colère passera, mes dispositions resteront les mêmes.
Maintenant que Paul s’avançait, le placeur battait en retraite. C’est la tactique indiquée.
– Ne vous engagez pas sans réfléchir, dit-il. En ce moment, vous êtes encore votre maître ; demain, si vous vous abandonnez à moi, il vous faudra abdiquer votre libre arbitre.
– J’irai jusqu’au bout.
Le placeur triomphait enfin.
– C’est bien !… fit-il froidement. Le docteur Hortebize vous présentera chez M. Martin-Rigal, le père de Mlle Flavie, et moi, huit jours après le mariage, je vous donnerai une couronne de duc à faire peindre sur vos équipages.
XII
Lorsqu’elle avait annoncé à André qu’elle s’en remettait à la loyauté de M. de Breulh-Faverlay, Mlle de Mussidan avait consulté les intérêts de son amour bien plus que ses forces.
Elle dut le reconnaître lorsque seule, en face d’elle-même, elle se demanda comment tenir sa promesse.
Tout son être se révoltait à cette idée qu’elle allait être forcée de demander un rendez-vous à un homme, et qu’il faudrait le laisser lire jusqu’au fond de son âme.
Un étranger l’eût moins épouvantée que M. de Breulh.
Il lui paraissait, et c’était juste, que par ce seul fait qu’il avait recherché sa main, c’est-à-dire désiré sa personne, il avait acquis des droits sur sa pensée même.
Tout le long de la route, dans le fiacre où elle était montée avec sa dévouée Modeste, Sabine ne prononça pas un mot.
On allait se mettre à table lorsqu’elle arriva à l’hôtel de Mussidan.
Le dîner fut lugubre.
Si les plus cruelles incertitudes torturaient la jeune fille, le comte et la comtesse se taisaient, obsédés par les menaces du docteur Hortebize et de l’honorable B. Mascarot.
Autour d’eux, dans la magnifique salle à manger, les domestiques allaient et venaient, remplissant leur service avec cette apparence d’empressement que donne l’habitude.
Que leur importait la tristesse des maîtres, et qu’avaient-ils à y voir ? N’étaient-ils pas bien logés, mieux nourris, payés régulièrement ! N’allaient-ils pas tout à l’heure, à l’office, prendre leur revanche de la gravité qui leur était imposée au même titre que la livrée ?
Ils se souciaient bien du reste ! À eux véritablement était l’hôtel. Pour eux, surtout, le comte de Mussidan touchait ses fermages.
Combien de maisons à Paris sont ainsi, où les maîtres semblent les hôtes de passage de leurs gens.
Dès neuf heures, Sabine, retirée dans sa chambre, s’efforçait d’accoutumer son esprit à la démarche terrible, s’exerçant pour ainsi dire aux souffrances qu’elle endurerait lorsqu’elle serait en présence de M. de Breulh.
Elle ne dormit pas cette nuit-là.
Au matin, elle se trouva toujours aussi défaillante. Mais la pensée ne lui venait pas d’éluder sa promesse, ni même de gagner du temps.
D’abord, elle avait juré, et André devait attendre une lettre avec une mortelle impatience.
Puis, à mesure qu’elle étudiait mieux sa situation, elle sentait plus impérieusement la nécessité d’une prompte détermination.
Laisser les choses s’engager, c’était s’exposer à rencontrer d’invincibles obstacles.
On ne marie pas, prétend-on, une jeune fille contre son gré. C’est une erreur. Sabine ne l’ignorait pas.
Et elle ne pouvait se confier à son père, encore moins à sa mère.
Sans jamais avoir été admise aux épanchements de leur intimité, elle était sûre qu’il y avait sur la maison une menace de malheur.
Lorsqu’au sortir du couvent elle était rentrée dans sa famille, elle avait compris qu’elle y était de trop, qu’elle y gênait.
Elle était sûre à n’en pouvoir douter que le comte et la comtesse appelaient de tous leurs vœux le jour où, par son mariage, elle les affranchirait. Ils seraient libres alors de se séparer, de fuir, chacun de son côté, après s’être juré de ne se revoir jamais.
Elle était le lien de deux haines.
Toutes ces circonstances, qui se représentaient à son esprit, redoublaient ses angoisses.
Alors, sans aucun doute, elle était dans une de ces dispositions d’esprit qui inspirent aux jeunes filles les résolutions désespérées.
Oui, il lui eût semblé moins pénible, moins cruel de quitter pour toujours le toit paternel, que d’affronter le regard de M. de Breulh, quand elle lui dirait la vérité.
Par bonheur, elle devait à l’habitude de vivre repliée sur elle-même une énergie virile.
Pour André, encore plus que pour elle-même, elle voulait rester dans le cercle étroit des conventions sociales. Elle eût souffert d’une félicité qu’il faut cacher comme une honte, et dont le monde hypocrite et méchant se venge tôt ou tard. Il fallait à ses désirs ce bonheur permis, d’accord avec les préjugés et la passion, qui s’affirme hautement à la face de Dieu et des hommes.
À midi, elle n’était pas encore décidée, et, agenouillée à son prie-Dieu, elle priait et pleurait.
Hélas ! pourquoi n’avait-elle pas de mère ?
Un moment elle eut l’idée d’écrire. Mais elle comprit que c’est folie de confier au papier les phrases qu’on n’ose prononcer.
Le temps pressait, et Sabine se reprochait amèrement ce qu’elle appelait sa pusillanimité, lorsqu’elle entendit les grilles de l’hôtel tourner sur leurs gonds.
Une voiture entrait dans la cour de l’hôtel.
Machinalement, la jeune fille s’approcha de la fenêtre, regarda et poussa un cri de joie.
Elle venait de voir M. de Breulh-Faverlay descendre d’un phaéton qu’il conduisait lui-même malgré le froid.
– Dieu m’a entendue, murmura-t-elle ; le plus pénible de mon entreprise m’est épargné.
– Quoi ! mademoiselle, demanda la dévouée Modeste, vous allez parler à M. de Breulh ici ?
– Oui. Ma mère n’est pas habillée, on n’ira pas avertir mon père dans la bibliothèque sans un ordre exprès ; en arrêtant M. de Breulh au passage et en le faisant entrer au salon, j’ai un quart d’heure à moi ; c’est plus qu’il ne faut.
Rassemblant alors tout son courage, triomphant de ses dernières hésitations, elle sortit.
Certes André eût le droit de s’enorgueillir d’être préféré, lui, le pauvre peintre, l’enfant trouvé, à l’homme que le comte de Mussidan avait choisi entre tous pour sa fille unique.
M. de Breulh-Faverlay est un des dix hommes dont Paris s’inquiète en dehors du monde officiel.
Il semble que la fortune ait pris plaisir à vider sur sa tête le trésor de ses faveurs.
Il n’a pas quarante ans ; il est remarquablement bien de sa personne, son intelligence est supérieure, on redoute son esprit ; enfin, il est un des plus riches propriétaires de France.
Comment reste-t-il, en apparence, étranger aux affaires de son pays et de son temps, pourquoi se tient-il à l’écart ? On le lui a souvent demandé.
– J’ai bien assez à faire, répond-il, de dépenser ma fortune sans me donner trop de ridicules.
Est-ce modestie réelle ou affectation ? On ne sait.
Ce qui est sûr, c’est qu’il est comme l’expression dernière de tout ce que la noblesse française eut autrefois de beau, de brillant, de poétique. Il en a la loyauté parfaite, la courtoisie spirituelle, l’esprit chevaleresque et la généreuse disposition à se dévouer pour des causes perdues.
Il a eu, prétend-on, de grands succès auprès des femmes. Si les « on dit » sont vrais, il a su être assez habile pour ne jamais compromettre personne.
Une sorte d’ombre mystérieuse et romanesque, qui plane sur ses jeunes années, ajoute encore à son prestige.
Il n’a pas toujours été riche, il s’en faut.
Orphelin, n’ayant qu’un insignifiant patrimoine, M. de Breulh s’embarqua, lorsqu’il n’avait guère que vingt ans, pour l’Amérique du Sud. Il y est resté douze ans, tantôt faisant la guerre de partisans, tantôt demandant aux plus singulières professions sa vie de chaque jour, préludant par deux expéditions aux tentatives avortées de Raousset-Boulbon et de Pindray.
À son retour en France, il n’était guère plus riche qu’avant son départ, lorsque son oncle, le vieux marquis de Faverlay, mourut en lui léguant ses propriétés, à la condition de joindre, par un trait d’union, à son nom de Breulh le nom de Faverlay menacé de s’éteindre.
On ne lui connaît qu’une passion sérieuse, les chevaux. Mais s’il fait courir, c’est en grand seigneur et non en palefrenier.
Voilà ce que savait le monde sur l’homme qui allait tenir entre ses mains les destinées d’André et de Mlle de Mussidan.
Il venait d’entrer dans le vestibule, et il allait adresser la parole aux valets de pied qui s’étaient levés à son approche, lorsque apercevant Sabine sur les dernières marches de l’escalier, il salua profondément.
La jeune fille vint droit à lui.
– Monsieur, dit-elle, si émue que sa voix était à peine intelligible, monsieur, je vous demanderai de m’accorder un moment d’entretien. Je voudrais vous parler, à vous seul… sur-le-champ.
M. de Breulh s’inclina profondément sans rien laisser voir de son étonnement.
– Ce m’est un grand honneur, mademoiselle, répondit-il, d’avoir à me mettre à vos ordres.
Sur un signe de Sabine, un des valets de pied avait ouvert la porte de ce même salon où le docteur Hortebize avait vu presque à genoux l’orgueilleuse comtesse de Mussidan.
La jeune fille entra la première, peu soucieuse de l’opinion et conjectures des domestiques.
Elle n’offrit point de siège à M. de Breulh.
Debout, près de la cheminée, elle s’appuyait à la tablette, comme si elle eut craint d’être trahie par ses forces.
Ce n’est qu’après un long silence, horriblement embarrassant pour tous deux, que Mlle de Mussidan réussit enfin à surmonter l’horreur que lui inspirait sa démarche.
– Ma conduite extraordinaire, commença-t-elle, vous prouvera, monsieur, mieux que les plus longues explications, la sincérité de mon estime pour votre caractère, ma confiance absolue en vous…
M. de Breulh ne sourcilla pas.
Où voulait en venir Sabine ? Son esprit s’égarait en mille suppositions contradictoires.
– Vous êtes un ami de notre famille, poursuivit la jeune fille, vous avez pu mesurer les misères secrètes de notre intérieur. Vous avez dû reconnaître qu’entre mon père et ma mère, je suis abandonnée autant qu’une orpheline…
Elle s’arrêta, interdite et honteuse.
L’idée que M. de Breulh allait peut-être se méprendre à ses expressions et s’imaginer que, devançant son blâme, elle cherchait à s’excuser, révoltait sa fierté.
C’est donc avec une nuance de hauteur, qui devait paraître étrange à coup sûr, dans sa situation, qu’elle reprit :
– Mais ai-je donc à me justifier ?… Si j’ai osé vous demander un entretien, monsieur, c’est que je veux vous conjurer de renoncer au… projet dont il a été question, et vous prier de prendre sur vous la responsabilité d’une rupture.
Si inattendue était cette déclaration, que M. de Breulh, malgré cette puissance de dissimulation que donne l’usage du monde, laissa voir sa surprise profonde, voilée d’un certain dépit.
– Mademoiselle… commença-t-il.
Sabine l’interrompit.
– C’est un grand service, dit-elle, que j’implore de votre générosité. Il dépend de vous de m’épargner de cruels chagrins…
Elle eut un sourire triste et ajouta :
– J’ai conscience de ne vous demander qu’un léger sacrifice. C’est à peine si j’ai l’honneur d’être connue de vous, je ne puis que vous être bien indifférente.
La physionomie de M. de Breulh trahissait une profonde souffrance.
– Vous vous trompez, mademoiselle, prononça-t-il d’une voix grave, et vous me jugez mal. J’ai passé l’âge des déterminations prises à la légère. Si j’ai sollicité votre main, c’est que j’ai su apprécier comme il convient les nobles qualités de votre cœur et de votre esprit. Je crois qu’il sera heureux entre tous, celui dont vous daignerez accepter le nom.
Mlle de Mussidan ouvrait la bouche pour répondre, mais déjà M. de Breulh poursuivait :
– En quoi vous ai-je déplu assez pour être ainsi repoussé ? Je l’ignore. Seulement, mademoiselle, sachez-le bien, c’est un malheur dont je ne me consolerai de ma vie.
La sincérité de la douleur de M. de Breulh était si évidente, que Sabine en fut émue.
– Croyez, monsieur, dit-elle, que je suis touchée plus que je ne saurais l’exprimer. Vous ne m’avez pas déplu, monsieur, et votre recherche m’honore au delà de mes mérites. J’aurais été heureuse et fière d’être votre femme, si…
Elle fut obligée de s’interrompre, tant le sang affluait à sa gorge.
Mais M. de Breulh fut cruel, il insista :
– Si ?… demanda-t-il.
Mlle de Mussidan détourna la tête pour dérober le spectacle de sa confusion, et c’est presque défaillante qu’elle répondit :
– Si je n’avais donné mon cœur et promis ma main à un autre.
M. de Breulh ne put retenir une exclamation :
– Ah !
Intention, hasard ou jalousie, il avait, ce « Ah ! » comme une apparence d’ironie qui blessa et révolta Sabine.
Elle se retourna irritée, et c’est la tête haute, après avoir cherché et rencontré le regard de M. de Breulh, qu’elle reprit :
– Oui, monsieur, un autre, choisi par moi entre tous, librement, à l’insu de ma famille ! Un autre, pour qui je suis tout, de même qu’il est tout pour moi…
M. de Breulh ne répondit pas.
– Et ce choix ne saurait vous offenser, reprit la jeune fille. Vous ignoriez jusqu’à mon existence, quand je l’ai rencontré, cet autre. D’ailleurs, est-il une comparaison possible entre vous et lui ? Non. Vous êtes, vous, tout en haut de l’échelle sociale ; il est, lui, tout en bas. Autant vous êtes noble, autant il est peuple. Vous êtes fier de ne pas porter de titre : on dit les sires de Breulh comme on dit les sires de Coucy ; lui n’a pas même de nom. Votre fortune dépasse vos fantaisies ; lui se débat et lutte obscurément pour le pain de chaque jour. Car il en est là ! oui, monsieur. Peut-être est-ce un homme de génie ; les difficultés les plus misérables de l’existence enchaînent son essor. Pour conquérir le droit de devenir un grand artiste, il est ouvrier… Et si jamais vous serrez sa main loyale, vous y sentirez les callosités du travail…
Mlle de Mussidan eût pris à tâche de désoler ce galant homme, dont elle attendait un grand service, un sacrifice plus grand encore, qu’elle n’eût pas parlé autrement.
Dans son inexpérience, elle faisait tout pour aviver la blessure qu’elle venait de lui faire.
Et jamais elle n’avait été si belle qu’en ce moment, où elle vibrait tout entière au souffle de sa passion. Sa voix avait des sonorités étranges. Son âme même montait à ses yeux.
– Maintenant, monsieur, reprit-elle, comprenez-vous ma préférence ? Plus est large, profond, infranchissable, en apparence, l’abîme qui le sépare de moi, plus je me dois d’être fidèle aux serments échangés. Je sais mon devoir. La femme digne de ce nom doit être, pour qui l’aime, l’espérance et la foi, qui enfantent des miracles. Qu’on me juge insensée, j’y consens. Je sais quels dangers on court à heurter les préjugés. Il se peut que l’avenir me réserve un châtiment terrible… on ne m’entendra jamais me plaindre. Enfin, cet autre…
Elle hésita un moment, et, enfin, d’un ton simple mais ferme, elle ajouta :
– Cet autre… je l’aime.
M. de Breulh écoutait, plus immobile en apparence, et plus froid que le marbre. En réalité, la plus terrible des passions, la jalousie, grondait au fond de son cœur.
C’est que s’il avait laissé entrevoir la vérité, il ne l’avait pas dite tout entière.
Il aimait Sabine, et il l’aimait depuis longtemps. C’était l’édifice entier de son avenir que, sans paraître le remarquer, Mlle de Mussidan renversait. Oui, il était noble, oui, il était riche, mais titres et fortune, il eut tout donné pour être à la place de cet autre qui gagnait son pain, qui était un enfant trouvé, mais qui était aimé.
Bien d’autres, à sa place, eussent haussé les épaules et expliqué Sabine d’un seul mot : romanesque.
Lui, non. Il était digne de la comprendre.
Ce qu’il admirait le plus en elle, c’était cette belle franchise qui va droit au but, sans réticences et sans ambages, cette hardiesse à braver le danger après l’avoir reconnu et raisonné.
Elle était certes, inhabile et imprudente ; mais cela même la grandissait à ses yeux. Ce n’est d’ordinaire ni la prudence ni l’habileté qui manquent aux jeunes demoiselles élevées comme Sabine au noble et moral couvent des Oiseaux.
Par ce temps de galanteries banales, d’intrigues amoureuses bêtes et plates comme un livre obscène, à une époque où le notaire qui rédige le contrat représente toute la poésie de la moitié des mariages, M. de Breulh se trouvait en présence d’une femme capable d’une grande et vigoureuse passion.
Cette femme, il avait espéré qu’elle serait sienne, et voici qu’elle lui échappait.
Il brûler d’interroger cependant, de savoir, soit qu’il gardât une ombre d’espérance, soit qu’il trouvât comme une âcre volupté à se bien convaincre de son malheur.
– Mais cet autre, demanda-t-il à Sabine, comment vous est-il possible de le voir ?
Elle comprit qu’elle n’avait rien à cacher.
– Je le rencontre à la promenade, répondit-elle ; je suis allée chez lui…
– Chez lui !…
– Oui : je lui ai donné quinze séances pour mon portrait.
Et fièrement elle ajouta :
– Une fille comme moi peut aller sans danger chez l’homme qu’elle a choisi : il ne s’y passe rien dont elle ait à rougir.
M. de Breulh se taisait, il était confondu, abasourdi.
– Vous savez tout, monsieur… Je me suis fait violence à ce point de vous dire, moi, jeune fille, ce que je n’ai pas osé avouer à ma mère. Que dois-je maintenant espérer ?
Ceux-là seuls qui, passionnément épris, ont trouvé une femme assez loyale pour leur dire :
– « Je ne vous aime pas, j’ai donné ma vie à un autre, je ne vous aimerai jamais, renoncez à toute espérance. »
Ceux-là seuls peuvent se faire une juste idée de la situation d’esprit de M. de Breulh et des tortures qu’il endurait.
Certes, s’il eut appris par quelque voie détournée les amours de Sabine, il ne se serait pas retiré. Il eut accepté la lutte, avec l’espoir de triompher de ce mortel heureux qu’on lui préférait.
Mais ici, lorsque Mlle de Mussidan se mettait à sa discrétion, abuser de sa confiance était impossible.
– Il sera fait selon vos désirs, mademoiselle, répondit-il, non sans une certaine amertume. Ce soir même, j’écrirai à votre père pour lui rendre sa parole. Ce sera la première fois que je ne tiendrai pas la mienne. Je me demande quel prétexte j’imaginerai pour colorer ma retraite ; ce qui est sûr, c’est que si précieuse que ma défaite puisse être, M. de Mussidan m’en voudra cruellement. Mais vous l’exigez…
À l’exaltation de Sabine avait succédé cette prostration physique et morale qui suit inévitablement les dépenses excessives d’énergie.
– Je vous remercie, monsieur, murmura-t-elle, et du plus profond de mon âme. J’éviterai, grâce à vous, une lutte dont la pensée seule me glaçait d’horreur, car j’étais résolue à résister aux désirs de ma famille. Tandis que maintenant !…
M. de Breulh ne paraissait nullement partager la sécurité de la jeune fille.
– Malheureusement, mademoiselle, je tremble de vous voir reconnaître, avant peu, l’inutilité de mon sacrifice… De grâce, laissez-moi m’expliquer. Jusqu’ici vous n’êtes allée que fort peu dans le monde, et dès que vous y avez paru, on a su que des projets d’union existaient entre vos parents et moi. De là vient que vous avez été peu entourée. Qu’on sache demain que je me retire, vingt prétendants se mettront sur les rangs.
Mlle de Mussidan soupira. C’était là l’objection d’André.
– Reconnaissez-le, poursuivait M. de Breulh, votre situation sera des plus difficiles. Si vos nobles qualités sont faites pour exalter les sentiments les plus élevés, votre grande fortune doit irriter les plus sordides convoitises.
Pourquoi ces mots de « fortune » et de « convoitise » ? Était-ce une allusion à la pauvreté d’André ? Elle regarda fixement M. de Breulh : ses yeux ne trahissaient pas la plus légère intention d’ironie.
– C’est vrai, fit-elle tristement, j’ai une grosse dot.
– Que répondrez-vous à ceux qui se présenteront ?
– Je ne sais ; sans doute je trouverai des raisons plausibles de refus. D’ailleurs, j’obéis à la voix de mon cœur et de ma conscience, je ne puis mal faire, Dieu aura pitié de moi.
Cette dernière phrase était un congé. M. de Breulh, homme du monde, ne pouvait s’y méprendre ; cependant il ne bougea pas.
– Si j’osais, mademoiselle, commença-t-il, si je me supposais assez votre ami pour me permettre un conseil…
– Parlez, monsieur, je vous en prie.
– Eh bien ! pourquoi ne pas rester dans les termes où nous sommes ? Tant que notre rupture ne sera pas ébruitée, votre tranquillité est assurée. Il me serait aisé de retarder d’un an les démarches décisives, et je serais toujours prêt à me retirer au moindre signe.
Cette proposition cachait-elle une arrière-pensée ? Non. Mais Sabine ne s’en inquiéta même pas.
– Non, monsieur, répondit-elle vivement, non. Ce serait abuser de votre dévouement et vous condamner à un rôle affligeant. Et d’ailleurs, réfléchissez, ce subterfuge ne serait-il pas indigne de vous, de moi… et de lui ?
M. de Breulh n’insista pas. À son premier mouvement de dépit succédait un invincible attendrissement.
Un projet digne de son caractère chevaleresque obsédait son esprit, et il hésitait à le traduire, tant cette belle jeune fille, si craintive et si vaillante à la fois, si pure et si imprudente le frappait de respect.
Il parvint cependant à vaincre cette timidité si nouvelle pour lui.
– Serait-ce, commença-t-il avec des hésitations d’adolescent, serait-ce abuser de la confiance que vous avez daigné me témoigner, que de vous dire… de vous exprimer combien je serais… heureux de connaître l’homme que vous avez choisi ?…
Sabine rougit excessivement.
Je n’ai rien à vous cacher, monsieur, dit-elle. Il se nomme André, il est peintre, il demeure rue de La Tour-d’Auvergne, n°…
M. de Breulh ne devait oublier ni ce nom ni cette adresse.
– De grâce, reprit-il avec plus de fermeté, ne croyez pas à une vaine curiosité. Le seul désir de vous servir a décidé ma question. Il me serait si doux de devenir votre allié, d’être pour quelque chose dans votre vie. J’ai des amis puissants, les relations que donne une grande fortune…
La passion est maladroite. C’est le trait essentiel qui la trahit.
Avec les plus délicates intentions, M. de Breulh, ce gentilhomme si expert et si fin d’ordinaire, n’avait pour ainsi dire pas prononcé une phrase sans blesser Sabine.
Voici que maintenant il paraissait proposer sa protection à André ! C’est-à-dire qu’il semblait établir sa supériorité à lui sur l’homme aimé. C’est ce que jamais femme ne tolèrera.
– Pour ceci encore, monsieur, répondit-elle, merci. Mais je connais André. Une offre de service l’humilierait affreusement. C’est ridicule ? Oui, je le sais. Excusez-nous, notre condition particulière nous impose des scrupules exagérés. Pauvre cher !… Sa fierté est toute sa noblesse !
Ayant dit, et voulant couper court à un entretien qui était pour elle un supplice, Mlle de Mussidan sonna. Un valet parut.
– Avez-vous prévenu ma mère de la visite de ce monsieur ? demanda-t-elle.
– Non, mademoiselle, monsieur et madame nous ont fait avertir qu’ils ne pouvaient recevoir.
– Comment donc ne m’avez-vous rien dit ? fit durement M. de Breulh.
Et sans attendre la justification fort simple du valet de pied, il s’inclina cérémonieusement devant Sabine, s’excusa de l’avoir involontairement importunée, et sortit en laissant paraître juste assez de mécontentement pour qu’on le remarquât.
– Celui-là aussi, pensait Sabine, est digne d’être aimé !…
Elle s’apprêtait à remonter chez elle, lorsque le bruit d’une sorte de discussion dans le vestibule l’arrêta.
La porte du salon avait été entrebâillée et elle entendait les instances d’un visiteur qui voulait absolument voir le comte de Mussidan, sur-le-champ, malgré les objections des valets de pied qui résistaient respectueusement mais fermement.
– Trédame !… disait la voix de ce visiteur obstiné, que me chantez-vous donc avec vos ordres !… Est-ce que votre consigne me concerne ? Me reconnaissez-vous ? Suis-je, oui ou non, l’ami intime de votre maître ? Oui. Allez donc lui dire à l’instant que je suis ici, que je l’attends… sinon je vais monter moi-même.
L’entêtement de cet intime eut à la fin raison de la résistance des domestiques, et la preuve, c’est qu’il pénétra dans le salon.
Ce visiteur n’était autre que M. de Clinchan en personne, le camarade de jeunesse de M. de Mussidan, le seul témoin avec Ludovic de la mort de l’infortuné Montlouis, M. de Clinchan, celui-là même qui confiait au papier l’analyse de ses sensations au moment d’un faux témoignage.
M. de Clinchan n’était ni grand ni petit, ni gras ni maigre, ni beau ni laid. Sa personne est effacée comme son esprit, comme son costume.
En lui, rien de saillant où accrocher une remarque. Si, pourtant. Il porte en breloque une énorme main de corail. Il craint le mauvais œil.
Jeune, il était méthodique. En vieillissant, il est devenu maniaque. À vingt ans, il notait chaque jour le nombre de ses pulsations. À quarante ans, il rédige quotidiennement l’histoire de ses digestions.
Si le paradis est la réalisation de nos vœux impossibles ici-bas, M. de Clinchan sera pendule dans un autre monde.
Pour l’instant, il était si terriblement agité qu’il ne salua pas Sabine.
– Quelle émotion, disait-il, et pour comble, j’avais mangé plus que d’usage. Si je n’en meurs pas, je m’en ressentirai encore dans six mois.
À la vue de M. de Mussidan qui entrait, il s’interrompit. Il courut à lui, il se jeta sur lui plutôt, en criant :
– Octave, sauve-nous ! C’en est fait de nous, si tu ne romps pas le mariage de ta fille avec…
La main nerveuse de M. de Mussidan s’appliquant sur sa bouche lui coupa la parole.
– Tu es donc fou, disait le comte, tu ne vois donc pas ma fille !
Obéissant à un regard impérieux de son père, Mlle de Mussidan s’était empressée de s’enfuir.
Mais M. de Clinchan en avait dit assez pour emplir son cœur d’alarmes et de défiances.
Qu’était-ce que cette rupture ? avec qui ? pourquoi ? Comment le salut de son père et de Clinchan pouvait-il dépendre de son mariage à elle ?
À coup sûr, il y avait quelque chose, une énigme : l’empressement qu’avait mis le comte à fermer la bouche à son ami le prouvait.
Le nom que n’avait pu prononcer M. de Clinchan, elle ne le devinait que trop, c’était le nom de Breulh-Faverlay.
Un de ces pressentiments sinistres, qu’il serait puéril de nier, lui disait que ce commencement de phrase surpris par elle contenait toute sa destinée.
Elle avait comme la certitude absolue que sa vie, son bonheur, sa personne même, allaient être l’enjeu d’une partie qui se décidait en ce moment.
Mais comment entendre ce qu’allaient dire son père et le comte de Clinchan ? car elle brûlait de les entendre, elle le voulait, quoiqu’il pût lui en coûter. Une curiosité, une anxiété plutôt de savoir, la poignait.
Elle cherchait un expédient, lorsqu’elle pensa qu’en faisant le tour de la salle à manger, il lui serait possible de s’établir dans un des salons de jeu séparés du grand salon par une simple portière.
Elle y courut. Elle y distinguait les moindres paroles des deux interlocuteurs.
M. de Clinchan en était encore à se plaindre.
Si brusque, il faudrait dire si brutal avait été le geste de M. de Mussidan, qu’il avait fait mal à son ami et l’avait presque renversé.
– Trédame !… geignait M. de Clinchan, comme tu y vas. Quelle journée, mon Dieu ! Songe un peu… déjeuner trop abondant, émotion violente, course rapide, colère provoquée par tes domestiques, joie en te voyant, puis choc et interruption des fonctions respiratoires… C’est dix fois ce qu’il faut pour prendre une maladie qui… à notre âge…
Mais le comte, plein d’indulgence habituellement pour les manies de son ami, n’était pas dans des dispositions à l’écouter.
– Au fait !… interrompit-il d’un ton bref et dur, que se passe-t-il ?
– Il arrive, gémit M. de Clinchan, qu’on sait l’histoire des bois de Bivron. Une lettre anonyme, reçue il y a une heure, me prédit les plus épouvantables malheurs, si je ne t’empêche de donner ta fille à de Breulh… Ah !… les coquins qui m’écrivent connaissent la vérité, et ils ont des preuves.
– Où est cette lettre ?
M. de Clinchan tira de sa poche cette lettre. Elle était explicite et menaçante autant que possible, mais elle n’apprenait rien à M. de Mussidan qu’il ne sut déjà.
– As-tu vérifié ton journal ? demanda-t-il à son ami. Y manque-t-il véritablement trois feuillets ?…
– Oui.
– Comment a-t-on pu te les enlever ?
– Ah !… comment ? C’est ce que je ne puis m’expliquer, et si tu peux me le dire…
– Es-tu sûr de tes domestiques ?
– Eh ! ne sais-tu pas que Lorin, mon valet de chambre, est à mon service depuis seize ans, qu’il a été élevé chez mon père, et que je l’ai façonné à ma ressemblance ? Jamais aucun autre de mes domestiques n’a mis le pied dans mes appartements. Les volumes de mon journal sont déposés dans un meuble de chêne dont la clé ne me quitte jamais.
– Il faut cependant qu’on ait pénétré chez toi ?
M. de Clinchan réfléchit un moment, puis tout à coup se frappa le front, éclairé par un souvenir qui était comme une révélation.
– Trédame !… s’écria-t-il, je vois…
– Quoi ?…
– Écoute. Il y a de cela quelques mois, un dimanche, Lorin était allé à une fête des environs de Paris, but un coup de trop avec des gens dont il avait fait connaissance en chemin de fer. Après boire il se prit de querelle avec ces amis de bouteille, et fut si cruellement maltraité, qu’il est resté six semaines sur le lit. Il avait, ma foi ! un bon coup de couteau dans l’épaule.
– Qui t’a servi pendant ce temps ?
– Un jeune homme que mon cocher est allé prendre au hasard dans un bureau de placement.
M. de Mussidan crut qu’il tenait un indice. Il se souvenait de cet homme qui était venu le trouver, et qui avait eu l’impudence de lui laisser sa carte, B. Mascarot, agence pour les deux sexes, – rue Montorgueil.
– Sais-tu, demanda-t-il, où est situé ce bureau ?
– Parfaitement, rue du Dauphin, presque en face de chez moi.
Le comte eut une exclamation de fureur.
– Ah ! les misérables sont forts, s’écria-t-il, très forts. Il faut se rendre. Et cependant, si tu partageais mes idées, si tu te sentais assez d’énergie pour braver le scandale, nous tiendrions tête à l’orage…
Il suffit de cette simple proposition pour faire frissonner M. de Clinchan de la tête aux pieds.
– Jamais, s’écria-t-il, non, jamais. Mon parti est pris. Si tu prétends résister, déclare-le-moi franchement, je rentre chez moi et je me fais sauter la cervelle.
Il était homme à faire comme il le disait. Outre qu’en dehors de ses ridicules, sa bravoure était incontestable, il était d’un tempérament à recourir aux dernières extrémités plutôt que de rester exposé à des tracasseries qui troubleraient ses digestions.
– Je céderai donc ! fit M. de Mussidan avec la rageuse résignation de l’impuissance.
Alors seulement M. de Clinchan osa respirer à pleins poumons. Ignorant quels assauts son ami avait subis, il ne croyait pas qu’il serait si facile de l’amener à composition.
– Une fois en ta vie, s’écria-t-il, tu es donc raisonnable.
– C’est-à-dire que je te parais l’être, parce que j’écoute les conseils de ta frayeur ! Ah !… maudits feuillets !… Et maudite aussi soit ton inconcevable fureur de confier au papier les secrets de ta vie et de la vie des autres.
Mais, sur l’article de son journal, M. de Clinchan est intraitable.
– Trédame !… s’écria-t-il, ne vas-tu pas t’en prendre à moi ! Si tu n’avais pas commis un crime, je n’aurais pas eu à en commettre un pour t’obliger, et à l’enregistrer ensuite.
Un silence assez long suivit cette cruelle réponse.
Glacée d’horreur, plus tremblante que la feuille, Sabine avait tout entendu. Ses plus affreux pressentiments étaient dépassés par l’horrible réalité… Un crime !… Il y avait un crime dans la vie de son père !…
Cependant, le comte de Mussidan avait repris la parole…
– À quoi bon des reproches !… dit-il. Pouvons-nous faire que ce qui est ne soit pas ? Non ! Soumettons-nous. Aujourd’hui même tu as ma parole, j’écrirai à de Breulh pour lui signifier la rupture de nos projets.
Pour M. de Clinchan, c’était le salut, la paix. Mais après ses angoisses, cette joie eut un effet terrible.
De rouge qu’il était, il devint blême, il chancela, fit un tour sur lui-même, et s’affaissa sur le canapé en murmurant :
– Repas trop copieux !… émotions violentes !… c’était indiqué !…
Il se trouvait mal.
M. de Mussidan, presque effrayé, se pendit aux sonnettes.
À ce tocsin, les domestiques accoururent de toutes les parties de l’hôtel et, derrière eux, la comtesse elle-même.
Il fallut plus de dix minutes et un flacon d’eau de Cologne au moins, pour faire revenir à lui M. de Clinchan.
Enfin il fit un mouvement, il ouvrit un œil d’abord, puis l’autre, puis il se souleva sur le coude.
– Je m’en tirerai, balbutiait-il avec un sourire pâle. Faiblesse, éblouissements, je sais ce que c’est, et j’ai mon remède : Élixir des Carmes, deux cuillerées dans un verre d’eau sucrée, repos…
Tout en parlant, il avait réussi à se dresser.
– Je rentre, dit-il à son ami, j’ai ma voiture, heureusement ; toi, Octave, sois prudent.
Et prenant le bras d’un des valets de pied, il sortit, laissant seuls en présence le comte et la comtesse de Mussidan.
À côté, dans le petit salon de jeu, Sabine écoutait toujours.
XIII
Depuis la veille, c’est-à-dire depuis le moment où il avait saisi sa canne avec l’intention d’administrer une correction à l’honorable B. Mascarot, le comte de Mussidan était dans un état à faire pitié.
Oubliant la douleur de son pied malade, il avait passé la nuit à arpenter sa bibliothèque, demandant vainement à son esprit un expédient pour se soustraire à la plus humiliante des tyrannies.
Il sentait la nécessité d’aviser promptement, car il avait assez d’expérience pour comprendre que, en dépit des belles protestations du doux placeur, cette première tentative n’était que la préface d’exigences qui deviendraient de plus en plus exorbitantes.
Mille projets se présentaient à son esprit, repoussés et repris tour à tour, puis définitivement abandonnés.
Tantôt il avait envie d’aller confesser toute l’histoire au préfet de police.
Tantôt il songeait à faire appeler quelqu’un de ces policiers in partibus qui opèrent pour le compte des particuliers en dehors de la préfecture, et souvent malgré elle. Il en est d’habiles, dit-on.
Mais plus le comte réfléchissait et se débattait, plus il sentait solides et perfidement noués les liens qui le garrottaient.
De quelque façon qu’il s’y prît, il arrivait toujours à un scandale, et B. Mascarot n’offrait aucune prise.
Cependant, vingt heures de colère avaient affaissé les ressorts de son caractère violent, lorsqu’on était venu lui annoncer la visite de M. de Clinchan.
Grâce à cette disposition, il avait pu accueillir son vieil ami avec un calme relatif.
La lettre anonyme ne l’avait pas surpris. On pourrait presque dire qu’il s’attendait à quelque chose de pareil. Lui dépêcher M. de Clinchan était habile et dénotait une connaissance parfaite de l’homme.
Tourmenté par toutes ces idées, qui bouillonnaient en son cerveau, M. de Mussidan allait de long en long, se préoccupant si peu de la présence de sa femme, qu’il laissait, par moments, échapper des lambeaux de phrases et de sourdes exclamations.
Ce manège, à la longue, irrita la comtesse, dont les derniers mots de l’homme au journal avaient éveillé la curiosité.
Ne devait-elle pas être toujours sur le qui-vive, ainsi que ceux qui se trouvent dans une position menacée ?
– Qu’avez-vous donc à vous agiter ainsi, Octave ? demanda-t-elle. Serait-ce l’indigestion de M. de Clinchan qui vous inquiète ?
Le comte connaissait sa femme pour en souffrir depuis des années.
Il devait être accoutumé à cette voix de tête si affreusement agaçante adoptée par elle. Il devait être habitué à ce sardonique sourire qui était comme figé sur ses lèvres.
Cependant, cette apparence de raillerie en un tel moment le transporta d’indignation.
– Ne parlez pas ainsi, fit-il d’une voix frémissante.
– Bon Dieu ! comme vous me dites cela ! Qu’avez-vous, mon ami ? Est-ce que vous êtes malade, vous aussi ?
– Madame !…
– Enfin, daignerez-vous me dire ce qu’il se passe d’extraordinaire ?
La face du comte s’était empourprée ; sa colère revenait avec une violence d’autant plus grande qu’elle avait été longtemps réprimée.
Il s’arrêta brusquement devant le fauteuil où la comtesse était assise, et, les yeux flamboyants de haine et de menace, il dit :
– Il y a que votre fille ne peut épouser M. de Breulh-Faverlay, qu’elle ne l’épousera pas.
Cette inconcevable déclaration eût du combler de joie Mme de Mussidan. C’était la moitié de la tâche imposée par le docteur Hortebize, et la plus difficile qui se trouvait accomplie sans effort.
Cependant son premier mouvement fut de chercher des objections.
Les femmes commencent toujours, systématiquement et instinctivement, par s’opposer aux desseins qu’elles approuvent le plus. C’est leur façon de les faire entrer profondément dans l’esprit de qui les leur propose.
Chacune de leurs objections est calculée pour produire l’effet d’un coup de maillet sur un coin.
– Plaisantez-vous ? dit-elle. Repousser M. de Breulh !… Retrouverez-vous jamais un parti aussi brillant, je dirai presque inespéré ?
– Oh !… ne craignez rien, répondit le comte avec la plus amère ironie, on se chargera de vous fournir un prétendant.
Cette phrase, arrachée à M. de Mussidan par l’intensité de ses craintes, serra jusqu’à l’angoisse le cœur de la comtesse.
Qu’est-ce que cela voulait dire ? Était-ce une allusion ?
Son mari avait-il voulu désigner Croisenois ? Savait-il sous l’empire de quelles obsessions abominables elle était condamnée à agir ?
Mais elle était brave. Elle était de celles qui, à l’anxiété du désastre, préfèrent le désastre lui-même, si complet et si effroyable qu’il puisse être. Elle voulut savoir.
– De quel prétendant parlez-vous ? demanda-t-elle avec une nonchalance affectée. Présenté par qui ? comment ? Qui donc aurait osé disposer de l’avenir de ma fille sans me consulter ?…
– Moi !…
La comtesse eut un petit ricanement qui fut pour le comte comme un coup de cravache à travers la figure. Il perdit la tête, il oublia tout.
– Ne suis-je donc pas le maître ! s’écria-t-il d’une voix terrible. Et je saurai le montrer, parce que telle est la volonté des misérables qui ont surpris le secret de ma vie, de mon crime, et qui ont entre les mains assez de preuves pour déshonorer mon nom.
Mme de Mussidan s’était levée. Elle se demandait si la raison de son mari ne s’égarait pas.
– Un crime, balbutia-t-elle, vous !
– Oui, moi ! Ah ! cela vous surprend et vous ne vous en doutiez guère. C’est ainsi. Vous vous souvenez peut-être d’un accident de chasse qui attrista les premiers mois de notre mariage. Ce jeune homme… dans les bois de Bivron. Eh bien ! il n’y a pas eu d’accident. C’est volontairement que je l’ai ajusté, que j’ai fait feu. Je l’ai assassiné, enfin ?… Et on le sait, et on peut le dire et le prouver.
La comtesse, terrifiée, reculait, les bras étendus en avant, comme pour écarter un danger.
– Ah ! vous êtes épouvantée !… reprit le comte avec un rire sinistre. Je vous fais horreur, peut-être ? Ne tremblez pas, ne vous éloignez pas ainsi, je n’ai pas de sang aux mains, soyez tranquille…
Il appuya ses deux mains sur son cœur, comme si la respiration lui eût manqué, et il poursuivit :
– C’est là qu’il est le sang, et il m’étouffe ! Il y a vingt-trois ans de cela, et cependant, parfois encore, la nuit, je m’éveille baigné de sueur, parce que dans mon sommeil j’ai entendu le dernier râle de l’infortuné.
Mme de Mussidan s’était laissée glisser sur un fauteuil.
– C’est horrible, murmurait-elle…
– N’est-ce pas ?… Et cependant vous ne savez point encore pourquoi j’ai tué. Savez-vous ce qu’il avait osé me dire, ce malheureux !… Il m’avait dit que ma jeune femme que j’adorais avait eu un amant.
La comtesse de Mussidan se dressa, la protestation aux lèvres, mais M. de Mussidan ayant ajouté froidement :
– Et c’était vrai, j’en ai acquis plus tard la certitude.
Elle retomba comme assommée, cachant son visage entre ses mains.
– Pauvre Montlouis !… poursuivait le comte, il était aimé, lui. Il avait une maîtresse, une grisette qui allait en journée pour gagner sa vie. Mais elle était plus noble cent fois par le cœur, cette pauvre fille, que l’orgueilleuse héritière que je venais d’épouser et qui était une Sauvebourg.
– Octave !… Monsieur !…
– Ah !… c’est ainsi, elle l’a prouvé. Elle s’était donnée à Montlouis, cependant, et il devait l’épouser ; il me l’avait dit. Tout le monde la croyait sage, elle était enceinte. À la mort de son amant elle a été déshonorée. On est impitoyable dans les petites villes. La première fois qu’elle sortit de l’hospice avec son enfant sur les bras, de vieilles femmes prirent de la boue au ruisseau et l’en couvrirent. Il fallait fuir…
Quand il se serait agi de la vie, la comtesse n’aurait pu articuler une parole.
– Elle serait morte de faim sans moi ! disait le comte. Pauvre fille ! C’était bien peu, ce que je lui donnais. Eh bien ! avec ce peu, à force de privations, elle a élevé son fils comme celui d’un bourgeois. L’enfant est un homme aujourd’hui, et quoi qu’il arrive, son avenir est assuré, car je suis là, moi…
Pour les grands mouvements de l’âme, il n’est pas de circonstances extérieures. Moins profondément émus, M. de Mussidan et sa femme eussent entendu des sanglots étouffés, qui, lorsqu’ils cessaient de parler, rompaient lugubrement le silence.
Souvent Mme de Mussidan avait eu, – prétendait-elle, – à souffrir des violences de son mari.
Mais jamais le comte n’avait été ainsi.
Même en ses plus furieux emportements, il ne dépassait pas certaines bornes, comme si d’avance il eut pu dire à sa colère : Tu n’iras pas plus loin.
En ce moment, une circonstance inouïe rompait toutes les digues imposées par une ferme volonté, et le torrent faisait irruption.
Et, il faut le dire, il semblait éprouver une âcre et délicieuse jouissance, un soulagement immense à donner un libre cours à toutes les amertumes qui, depuis des années, s’étaient amassées goutte à goutte en son âme.
– Dites-moi maintenant, madame, s’il n’y aurait pas injustice à vous comparer à cette pauvre fille qui était la maîtresse de Montlouis ? Vous n’êtes donc jamais descendue au fond de votre conscience ? Vous n’avez jamais tremblé en songeant que Dieu, certainement, vous punirait un jour, vous qui avez été fille coupable, épouse criminelle et mère indigne ?…
D’ordinaire, la comtesse tenait tête à son mari, elle se redressait sous ses justes reproches ; aujourd’hui, elle n’osait.
– Avec vous, poursuivait le comte, la honte et le malheur sont entrés dans ma vie. Qui donc eût pu prévoir cela, en vous voyant courir insouciante et rieuse sous les grands arbres de Sauvebourg ? Que de fois, en ce temps où mon seul rêve était d’unir ma destinée à la vôtre, je vous ai observée sans soupçonner que j’étais dupe d’une odieuse comédie ! Jeune fille ; vous aviez atteint la perfection de la dissimulation. Jamais les détestables pensées qui vous bouleversaient n’ont jeté une ombre sur votre front. Jamais vos plus affreux desseins n’ont altéré la pureté de votre regard. Ah ! qui n’y eût été trompé comme moi !… En entrant dans cette petite église où a été bénie notre union maudite, intérieurement je vous demandais pardon d’être si peu digne de vous. Misérable fou !… J’en étais encore aux premières ivresses de la possession que, déjà, vous aviez installé l’adultère à mon foyer.
La comtesse eut un geste de dénégation.
– C’est faux !… murmura-t-elle… on vous a menti !…
M. de Mussidan eut un de ces rires glacés qui sont l’expression la plus saisissante du désespoir.
– Non, répondit-il, j’ai eu des preuves. Ah ! cela vous paraît extraordinaire. Vous m’avez toujours pris pour un de ces maris benêts, qu’on bafoue impunément. Vous pensiez m’avoir noué sur les yeux un bandeau épais. Erreur. J’y voyais… Comment ne vous ai-je jamais dit cela ? Ah ! voilà !… Je ne pouvais pas ne pas vous aimer. C’était plus fort que ma volonté, que mon orgueil, que ma raison. Il n’y a à rire des épouvantables lâchetés, des transactions misérables de la passion, que ceux qui n’ont jamais aimé de toute la puissance de leur cœur et de leur chair…
Il parlait avec une véhémence extraordinaire et la comtesse écoutait, confondue de ces transports, respirant à peine.
– Je me taisais, continuait M. de Mussidan, parce que je savais que le jour où je dirais un mot, vous seriez perdue pour moi. Or, j’aurais pu vous tuer, il était hors de mon pouvoir de vivre séparé de vous. Non, vous ne saurez jamais combien vous avez été à deux doigts de la mort. Au moment de vous embrasser, il me semblait voir votre visage marbré par les baisers d’un autre, et il me fallait d’héroïques efforts pour ne pas vous étouffer entre mes bras. Je ne savais plus au juste, à la fin, si je vous aimais ou si je vous haïssais…
– Octave ! de grâce ! balbutia la comtesse, en joignant les mains, Octave !
Le comte haussa les épaules.
– Je pourrais vous surprendre étrangement, fit-il, si je voulais !… Mais, bast !…
La comtesse frissonnait. Son mari connaissait-il, oui ou non, l’existence des lettres ? Pour elle, tout était là.
Par exemple, elle était certaine qu’il ne les avait pas lues. Il se serait exprimé autrement, s’il eut connu le mystère qu’elles expliquaient.
– Laissez-moi vous dire, commença-t-elle…
– Rien !… répondit durement M. de Mussidan.
– Je vous jure…
– Oh ! inutile. Tenez, je veux vous avouer ma présomption en ces années de notre jeunesse. Vous raillerez !… peu importe. Je me berçais de l’espoir de vous ramener à moi. La lâcheté a son héroïsme, elle aussi. Je me disais que tôt ou tard vous seriez touchée de ce grand amour, si profond et si doux, que j’avais pour vous. Quelle dérision ! Comme si jamais un sentiment avait fait battre votre cœur plus vite !
– Ah ! vous êtes impitoyable.
Il la regarda avec des yeux emplis d’une haine de vingt années, et froidement dit :
– Et vous, qu’avez-vous donc été ?
– Si vous saviez…
– Je sais où ont abouti mes efforts. C’est jusqu’à la lie que j’ai vidé le calice empoisonné que verse une femme adorée à un mari trompé. Chaque jour a élargi et creusé l’abîme qui nous séparait, et nous en sommes venus à vivre de cette existence infernale qui me tue.
– Vous n’aviez qu’à vouloir…
– Quoi ? Vous retenir de force, me faire votre geôlier ? À quoi bon ? Ce que je voulais de vous, c’était l’âme… J’aurais emprisonné le corps, mais qui sait à quel rendez-vous serait allée la pensée ? Comment ai-je eu la force de rester près de vous ? C’est qu’il fallait sauver non l’honneur, il était perdu, mais les apparences de l’honneur. Moi présent, le nom ne pouvait traîner dans la boue.
Mme de Mussidan, une fois encore, essaya de protester ; son mari ne sembla même pas entendre l’interruption.
– Je voulais aussi sauver la fortune, poursuivait-il, car votre prodigalité est un gouffre où s’engloutiraient des millions. Au feu de quelles fantaisies flambez-vous donc les billets de mille francs, qu’on n’en retrouve même pas la cendre ? On vous refuse crédit. Vos fournisseurs me croient ruiné, et cette croyance empêche ma ruine. Pourquoi n’ai-je pas liquidé notre position ? C’est que je ne veux pas que nous finissions à l’hôpital. Il faut aussi doter Sabine ; je la doterai richement, et cependant…
Il hésita. D’où pouvait venir cette hésitation, après tout ce qu’il avait dit ?
Mme de Mussidan interrogea :
– Et cependant ?…
– Cependant, répondit-il avec une terrible explosion de rage, je ne l’ai jamais embrassée sans ressentir une horrible douleur jusque dans les entrailles. Sabine est-elle ma fille !…
La comtesse se dressa frémissante. Cela, elle ne pouvait, non, elle ne pouvait le supporter.
– Assez, s’écria-t-elle, assez. Oui, Octave, j’ai été coupable, bien coupable ; mais non pas comme vous croyez.
– À quoi bon vous défendre ?
– Je défendrai Sabine, à tout le moins.
M. de Mussidan eut un geste de dédain.
– Mieux eût valu l’aimer, répondit-il, surveiller l’éclosion de ses premières idées, l’initier à ce qui est beau et à ce qui est bien, apprendre à lire comme en un livre ouvert dans ce jeune cœur, être sa mère, en un mot.
La comtesse était dans une telle agitation, que, certainement, son mari eût été surpris s’il l’eût remarqué.
– Ah !… Octave, s’écria-t-elle, que n’avez-vous parlé plus tôt !… Si vous saviez !… Mais je veux tout vous dire… oui… tout…
Mais le comte, malheureusement, l’arrêta.
– Épargnez-nous, dit-il, ces explications. Si j’ai rompu le silence que je m’étais imposé, c’est que rien de vous ne saurait me toucher ni m’émouvoir…
Mme de Mussidan se laissa retomber sur le canapé, elle comprit que tout était anéanti. Dans le petit salon de jeu, les sanglots avaient cessé. Sabine avait eu la force de se traîner jusqu’à sa chambre.
Le comte se préparait à regagner sa bibliothèque, quand un domestique gratta respectueusement à la porte. Il apportait une lettre.
M. de Mussidan rompit le cachet. La lettre était de M. de Breulh ; il rendait sa parole.
Après tant d’émotions, ce coup frappa le comte. Il crut y reconnaître la main de cet homme qui était venu le menacer chez lui, et il fut épouvanté du terrible et mystérieux pouvoir de ces gens dont il était l’esclave.
Mais il n’eut pas le temps de réfléchir, la femme de chambre de Sabine, Modeste, pâle et effarée, se précipita dans le salon.
Monsieur ! criait-elle, madame ! au secours ! mademoiselle se meurt !…
XIV
Van Klopen, l’illustre tailleur pour dames, connaît son Paris – hommes et choses – sur le bout du doigt.
Comme tous les industriels dont les opérations sont basées sur de larges crédits, il a besoin de quantités de renseignements qu’il puise un peu partout et qu’il n’oublie plus.
Sa tête carrée est un bottin revu et augmenté qu’il laisse feuilleter à ses amis.
Aussi, lorsque B. Mascarot lui avait parlé du père de cette brune Flavie, dont les yeux avaient si fort impressionné Paul Violaine, l’arbitre des élégances avait répondu sans hésiter :
– Martin-Rigal ? Connu ! C’est un banquier.
Banquier, M. Martin-Rigal l’est en effet, et il habite une des plus belles maisons de la rue Montmartre, presque en face de Saint-Eustache.
Son logement particulier est situé au second étage, ses bureaux occupent tout le premier.
Pour n’avoir pas son nom inscrit au livre d’or de l’aristocratie financière, M. Martin-Rigal n’en est pas moins très connu, extrêmement puissant et suffisamment estimé.
Il est en relations surtout avec ce petit commerce parisien qui vivote plutôt qu’il ne vit, et qui se trouverait heureux sans ce fantôme périodique et implacable qui s’appelle l’échéance.
Tous les gens qui s’adressent à lui, ou presque tous, il les tient dans la main.
Que deviendraient-ils si fantaisie lui prenait de fermer ses guichets ! ils manqueraient à leurs engagements, les jugements arriveraient à la suite des protêts, puis la faillite, la ruine.
Il peut donc tout oser, et il ose, il use et il abuse.
Son despotisme n’admet pas d’objection. Si, en présence d’une nouvelle mesure, quelque audacieux risque un : Pourquoi ? On lui répond nettement :
– Parce que…
Et pas autre chose avec.
C’est le caissier, bien entendu, qui répond cela, et non M. Martin-Rigal.
Lui, on ne le rencontre guère. Dans la matinée, il est toujours invisible ; il travaille dans son cabinet, à l’extrémité des bureaux.
Et pas un de ses employés ne serait assez hardi pour aller frapper à sa porte.
À quoi bon, d’ailleurs ? Il ne répondrait pas. L’expérience a été tentée. Le feu prenant à la maison ne le tirerait pas de ses comptes.
Physiquement, M. Martin-Rigal est grand et chauve. Sa face osseuse est toujours scrupuleusement rasée, et ses petits yeux gris ont une inquiétante mobilité. Lorsqu’il parle, si un mot lui échappe, s’il poursuit une idée, il promène sur son nez l’index de sa main droite : c’est son tic.
Sa politesse est parfaite. C’est d’une voix de miel qu’il dit les choses les plus cruelles. Il ne manque jamais de reconduire jusqu’à la porte, avec force salutations et excuses, les gens auxquels il refuse de l’argent.
Dans son costume, il affecte cette sorte d’élégance juvénile qui est un trait des mœurs des manieurs d’argent de la jeune école.
En dehors des affaires, il est aimable, obligeant et spirituel par dessus.
Volontiers il recherche les douceurs qui aident à traverser la vie, cette vallée de larmes. Il ne déteste pas un bon dîner et n’a jamais boudé un jeune et joli visage.
Cependant il est veuf et on ne lui connaît qu’une passion au monde : sa fille unique, sa Flavie.
Il est vrai que son amour paternel a quelque chose du fanatisme idiot de l’Indien qui se fait écraser sous les roues du char de son idole.
La maison Martin-Rigal n’est pas montée sur un fort grand pied, mais on dit dans le quartier que Mlle Flavie a des dents aiguës à croquer des millions.
Le banquier ne va qu’à pied : c’est hygiénique, prétend-il ; mais sa fille a une jolie voiture attelée de deux chevaux de prix pour aller au bois, sous la protection d’une duègne moitié domestique, moitié parente, qu’elle a fini par rendre un peu folle.
M. Martin-Rigal en est encore à répondre : Non, à une fantaisie de Flavie.
Parfois des amis ont essayé de lui faire entendre que cette adoration perpétuelle préparait à Flavie un avenir très malheureux ; sur ce chapitre, il est intraitable.
Invariablement, il répond qu’il sait ce qu’il fait, et que s’il travaille comme un cheval, c’est à la seule fin que sa fille puisse se permettre tout ce qui lui passe par la tête.
Et c’est vrai, au moins, qu’il travaille à lui seul autant que tous ses employés ensemble.
Après être resté, depuis le matin, le nez sur les chiffres, à quatre heures du soir il ouvre son cabinet et reçoit ceux qui ont à l’entretenir d’affaires.
Ainsi, le surlendemain du jour où Paul Violaine et Flavie s’étaient rencontrés chez le couturier célèbre, sur les cinq heures et demie, M. Martin-Rigal donnait audience à une de ses clientes.
Elle était très jolie, toute jeune et mise avec une simplicité charmante ; mais elle paraissait bien triste, ses beaux yeux étaient pleins de larmes, à grand’peine retenues.
– À vous, monsieur, disait-elle, je dois l’avouer, si vous nous refusez notre bordereau, comme le mois passé, il nous faudra déposer notre bilan. Nous avons fait argent de tout pour l’échéance de janvier. Tous les bijoux dont je pouvais disposer sans qu’on s’en aperçût sont au Mont-de-Piété ; nous mangeons dans du fer…
– Pauvre petite femme !… murmura le banquier.
Ce mot lui donna plus d’assurance.
– Et pourtant, reprit-elle, notre position n’a jamais été meilleure, voici notre établissement payé, la vente marche très bien…
Elle s’exprimait d’un petit air entendu qui semblait charmer M. Martin-Rigal, s’expliquant clairement, nettement.
La Parisienne excelle en ces démarches difficiles. Plus futée que son mari, pleine de confiance en soi, elle garde l’esprit libre là où il perd la tête.
Aussi, le plus souvent, dans les crises du petit commerce, pendant que l’homme se désole, c’est la femme qui agit.
En écoutant l’exposé d’une situation qu’il connaissait fort bien, le banquier dodelinait sa tête chauve.
– Tout cela est fort joli, dit-il enfin, mais ne rend pas meilleures les signatures que vous m’offrez. Si j’avais confiance, ce serait en vous…
– Oh ! monsieur, nous avons plus de trente mille francs de marchandises en magasin.
– Ce n’est pas cela que j’ai voulu dire…
Il souligna ces mots d’un sourire et d’un regard si singulièrement expressifs, que la pauvre femme en rougit jusqu’à la racine des cheveux et perdit presque contenance.
– Comprenez donc, reprit-il, que vos marchandises ne me donnent pas plus confiance que vos valeurs. Supposez un malheur. Que vendrait-on tout cela ? Sans compter que ces diables de propriétaires ont des privilèges…
Il s’interrompit. La femme de chambre de Flavie, s’autorisant du despotisme de sa maîtresse, entrait dans le cabinet sans frapper.
– Monsieur, dit-elle, mademoiselle vous demande tout de suite, tout de suite !…
M. Martin-Rigal se leva :
– J’y vais, répondit-il, j’y vais !…
Et prenant la main de sa cliente pour la mettre plus vite dehors, il ajouta :
– Voyons, ne vous désolez pas… revenez me voir, nous arrangerons cela.
Elle voulait le remercier ; mais déjà il s’était élancé dans l’escalier.
Si Flavie avait envoyé chercher son père, c’est qu’elle tenait à lui faire admirer sa toilette nouvelle, que venait de lui envoyer Van Klopen, qu’elle essayait et qu’elle trouvait miraculeuse.
Il est de fait que le « couturier des reines », outre qu’il avait été d’une rare promptitude, s’était surpassé.
Le costume de Flavie était un de ces chefs-d’œuvre de mauvais goût, – à la mode, hélas ! – qui donnent à toutes les femmes une même et odieuse tournure de poupée, imaginée, croirait-on, pour leur enlever d’un coup grâce, distinction et poésie.
Ce n’étaient que garnitures, découpures et dentelures, jupes étagées, couleurs désagréables bizarrement assemblées.
Van Klopen avait été fidèle à son système, car il a un système qu’il résume en deux axiomes fort clairs :
1° Donner aux robes une coupe telle que, sitôt défraîchies, elles soient absolument inserviables ;
2° Rechercher les étoffes bon marché, ce qui plaît aux maris, et multiplier les garnitures qui sont la bouteille à l’encre des modes.
Il a trouvé cela, ce Hollandais madré, et il n’est plus une couturière bourgeoise qui ne s’efforce de profiter de sa découverte.
Seulement, Flavie se souciait infiniment peu de la question économique.
Debout, au milieu de salon paternel, dont elle venait de faire allumer les lustres, car le jour baissait, elle étudiait quelques effets nouveaux, – c’est-à-dire qu’elle répétait sa toilette.
Et en vérité, elle était si naturellement jolie, mignonne et gracieuse, que l’œuvre de Van Klopen ne l’enlaidissait presque pas.
Mais tout à coup, elle se retourna.
Elle venait d’apercevoir, dans la glace, son père qui entrait tout essoufflé d’avoir grimpé si vite les escaliers.
– Comme tu as tardé ! lui dit-elle.
Certes, il n’avait pas perdu une seconde. Cependant, il s’excusa.
– J’étais avec un client, répondit-il, de sorte que…
– Eh ! il fallait le renvoyer.
Il allait chercher d’autres explications encore, mais la jeune fille se tint pour satisfaite.
– Voyons, père, commença-t-elle, ouvre les yeux bien grands, regarde-moi et dis-moi, oh !… franchement, comment tu me trouves.
Point n’était besoin de le lui demander. L’admiration la plus parfaite s’épanouissait sur sa physionomie.
– Charmante, murmura-t-il, divine !
Si accoutumée qu’elle fut aux parfums de l’encens paternel, Flavie parut enchantée.
– Alors, reprit-elle, tu crois que je lui plairai ?
– Lui !… c’était Paul Violaine ; M. Martin-Rigal ne le savait que trop. Il soupira profondément en répondant :
– Comment veux-tu ne pas lui plaire ?
– Hélas ! fit-elle, devenant songeuse, s’il s’agissait de tout autre, je ne douterais pas de moi, je ne craindrais rien, je ne sentirais pas ces transes cruelles qui me serrent le cœur…
M. Martin-Rigal était assis près de la cheminée : il attira sa fille par la taille pour lui mettre un baiser au front, et elle, avec des mouvements coquets et onduleux de jeune chatte guettant des caresses, elle s’établit sur les genoux de son père.
– C’est que, vois-tu, continuait-elle, poursuivant sa pensée, s’il allait ne pas faire attention à moi, si je lui déplaisais !… Tiens, père, je le sens, j’en mourrais.
Le banquier détourna la tête pour cacher sa douloureuse impression.
– Tu l’aimes donc bien ? demanda-t-il.
– Oh !…
– Plus que moi ?
Flavie prit entre ses mains la tête de son père et la secoua doucement, tout en riant d’un petit rire sonore et pur comme le tintement du cristal.
– Que t’es bête, pauvre père, disait-elle, que t’es bête !… Je te demande un peu si cela peut se comparer ! Toi, je t’aime, parce que tu es mon père… d’abord. Je t’aime ensuite, parce que tu es bon, que tu veux tout ce que je veux, que tu dis toujours : Oui ; je t’aime, parce que tu es comme les enchanteurs des féeries, tu sais, qui sont bien vieux, bien vieux, qui ont des barbes qui n’en finissent plus, et qui réalisent tous les souhaits de leurs filleules. Je t’aime pour cette bonne vie heureuse que tu me donnes, pour ma voiture, pour mes jolis chevaux, pour mes belles toilettes, pour les pièces d’or neuves dont, sans te lasser, tu emplis ma bourse, pour cette parure de perles que j’ai au cou, pour ce bracelet… pour tout enfin.
L’énumération était désolante. Chaque mot trahissait un égoïsme féroce en sa naïveté. Et cependant le banquier écoutait d’un air riant, ravi, engourdi dans une sorte de béatitude irraisonnée.
– Et lui ? interrogea-t-il.
– Oh !… lui, répondit Flavie devenue subitement sérieuse, lui, je l’aime parce qu’il est lui, d’abord ; puis, parce que… parce que je l’aime.
L’accent de la jeune fille trahissait une telle intensité de passion que le pauvre père ne put retenir un geste de colère.
Elle vit ce geste et éclata de rire.
– Vilain jaloux ! fit-elle de ce ton qu’on prend pour faire honte à un enfant d’une faute légère, fi !… que c’est laid, monsieur. Vous montrez le poing à cette pauvre fenêtre, parce que c’est de cette fenêtre que j’ai aperçu mon Paul pour la première fois. C’est mal, monsieur, c’est très mal !…
Comme l’enfant pris en faute et grondé, M. Martin-Rigal baissa la tête.
– Eh bien ! reprit Flavie, je l’aime, moi, cette fenêtre, qui me rappelle les plus fortes et les plus douces émotions de ma vie. Voici pourtant quatre mois de cela. Tiens, père, il me semble que c’était ce matin… J’étais venue me mettre à la fenêtre sans savoir pourquoi… et on dit que nous sommes maîtres de nos destinées ! Quelle folie !… Je regarde machinalement, quand tout à coup, à la croisée de la maison d’en face, je l’ai aperçu. Ça été comme un éclair. Mais cette seconde a suffi pour décider de ma vie. Moi, qui jamais n’avais rien senti là – elle mettait la main sur son cœur – j’y ai éprouvé une douleur épouvantable, aiguë, la sensation d’un fer rouge.
Le banquier paraissait être au supplice, mais sa fille ne s’en apercevait pas.
– Toute la journée, poursuivait-elle, j’ai été comme jamais… il me semblait qu’il n’y avait plus d’air pour respirer, j’avais comme un poids immense, là, au creux de la poitrine, et autour de la tête un cercle de fer. Ce n’était plus du sang qui circulait dans mes veines, mais de la flamme… La nuit, impossible de dormir, je frissonnais et j’étais trempée de sueur. Sans savoir pourquoi, j’avais peur, je tremblais…
Le banquier secoua tristement la tête.
– Flavie, murmura-t-il, chère adorée, pauvre folle enfant, que ne t’es-tu confiée à moi, alors ?
– J’en avais bien envie…
– Eh bien !…
– Je n’ai pas osé.
M. Martin-Rigal leva les bras au plafond. Il prenait le ciel à témoin que si sa fille n’avait pas osé, ainsi qu’elle le disait, elle n’avait pour cela aucune raison, aucune.
– Tu ne comprends pas cela, fit Flavie. Ah !… voilà. Tu as beau être le meilleur des pères, tu es un homme. Si j’avais une mère, elle me comprendrait.
– Eh ! qu’aurait fait ta pauvre mère, que je n’aie tenté, essayé ? murmura M. Martin-Rigal.
– Rien peut-être, tu as raison. Parce que, vois-tu, il y a des jours où je ne me comprends pas moi-même. Et cependant, va, après cette première aventure, j’ai été terriblement courageuse. J’avais juré que jamais, non plus jamais, je n’ouvrirais cette croisée. J’ai lutté trois jours, oh ! lutté comme il n’est pas possible. Le quatrième, je n’y ai plus tenu. J’ouvre, je regarde… Il était à la fenêtre, lui aussi, le front appuyé contre la vitre, et triste… si triste que je me suis mise à pleurer.
Le banquier, cet homme si dur que jamais le désespoir d’un client malheureux ne l’avait touché, avait lui-même les yeux pleins de larmes.
– Depuis ! reprit Flavie, dont la voix avait une douceur pénétrante, depuis je n’ai plus résisté. Est-ce qu’on lutte contre la destinée !… Tous les jours je me mettais à la fenêtre. J’ai eu bien vite deviné ce qu’il faisait. Il donnait des leçons de piano à ces deux longues demoiselles si maigres, que nous rencontrons quelquefois. Pauvre garçon !… J’épiais son arrivée et aussi sa sortie. Si tu savais, père, comme il avait l’air malheureux !… Il y avait des jours où il était si pâle, où il se traînait si péniblement que je me demandais s’il avait mangé. Te fais-tu une idée de cela ? Lui !… souffrir la faim, lorsque moi je suis riche ! Car nous sommes riches, n’est-ce pas ? J’avais fini par connaître toutes les expressions de sa physionomie. Tiens, quand il était content, il faisait comme cela avec son bras…
Elle imitait en même temps un geste de Paul, geste qui lui était familier quand il lui arrivait quelque chose d’heureux.
– Mais, hélas !… continuait Flavie, un jour il a disparu… Pendant une semaine je suis restée à la fenêtre, attendant, espérant… En vain. C’est alors que je suis tombée malade, et que je t’ai tout avoué, et que je t’ai dit : Celui-là est mon mari, je l’aime !…
C’est d’un air sombre et avec une visible contrainte que M. Martin-Rigal écoutait ce récit que Flavie lui répétait pour la centième fois, au moins, depuis trois mois.
– Oui, murmurait-il, c’est bien ainsi que tout s’est passé. Tu étais malade, je te voyais déjà mourante, je t’ai promis que ce jeune homme, cet inconnu dont tu ne savais même pas le nom, serait ton mari…
Dans un élan de reconnaissance, la jeune fille jeta ses bras autour du cou de son père, et couvrit son front de baisers sonores.
– Et aussitôt, reprit-elle, j’ai été guérie. Et tu tiendras ta parole, n’est-ce pas ? Ah !… père chéri, je t’aime pour cela plus que pour tout le reste. Dire que le jour même, rien qu’avec les renseignements que je te donnais, tu t’es mis en quête de mon mystérieux artiste.
– Hélas !… je suis sans forces contre tes volontés.
Flavie se redressa, menaçant gaiement son père, d’un mouvement mutin.
– Que signifie cet hélas ! monsieur ? demanda-t-elle. En seriez-vous par hasard à regretter votre bonté parfaite, votre obéissance ?
Il ne répondit pas. Il regrettait en effet.
– Par exemple, reprit Flavie, je donnerais bien mon beau collier pour savoir comment tu t’y es pris pour le découvrir. Pourquoi ne m’as-tu jamais conté le plus petit détail ? Voyons, ne me cache rien, qu’as-tu imaginé pour arriver jusqu’à lui, d’abord, et ensuite pour l’amener jusqu’à nous sans éveiller ses soupçons.
M. Martin-Rigal sourit bonnement.
– Ceci, répondit-il, est mon secret.
– Soit, garde-le. Au fait, que m’importent les moyens employés, puisque tu as réussi ! Car tu as réussi, n’est-ce pas, je ne rêve pas, je ne deviens pas insensée ! Ce soir, avant une heure, dans quelques instants peut-être le docteur Hortebize va nous le présenter. Et il s’assoiera à notre table, je le regarderai à mon aise, j’entendrai le son de sa voix…
– Folle !… interrompit le banquier, malheureuse enfant !…
Elle ne pouvait pas ne pas protester.
– Oh !… répondit-elle vivement, folle ?… peut-être. Mais malheureuse ? pourquoi ?
– Tu l’aimes trop, répondit le banquier, avec l’accent d’une conviction profonde, il abusera.
– Lui !… fit la jeune fille avec la certitude admirable de la passion, lui, jamais !…
– Fasse Dieu, pauvre chère adorée, que mes pressentiments me trompent. Mais que veux-tu ? ce n’est point là l’homme que je rêvais pour toi. Un artiste…
Flavie, sérieusement fâchée cette fois, quitta les genoux de son père.
– Et voilà donc, s’écria-t-elle, tout ce que tu trouves contre lui. Il est artiste. Serait-ce un crime ! Que ne lui reproches-tu aussi sa misère ? Oui, il est artiste mais il a du génie, je l’ai lu sur son front. Oui, il est affreusement pauvre, mais je suis assez riche pour deux. Il me devra tout, tant mieux ! Quand il aura de la fortune, il ne sera pas forcé de s’épuiser à donner des leçons de piano ; il lui sera permis d’utiliser son talent. Il écrira des opéras comme ceux de Félicien David, plus beaux que ceux de Gounod. On les représentera dans les théâtres et les salles crouleront sous les applaudissements. Moi, cependant, toute seule au fond d’une loge fermée, je m’enivrerai de la gloire de l’élu de mon cœur. Le monde aura la poésie, moi j’aurai le poète, et, quand je le voudrai, c’est pour moi seule que chanteront ses divines mélodies…
Elle parlait avec une exaltation extraordinaire, si pénétrée de son rêve, qu’elle ressentait, dans toute leur intensité, les sensations exactes de la réalité.
Mais elle dut s’arrêter, une quinte de toux lui coupait la parole.
Et pendant que les efforts secouaient sa poitrine et que le sang affluait à ses pommettes, M. Martin-Rigal la contemplait avec une expression navrante.
La mère de Flavie avait été emportée à vingt-quatre ans par cette implacable maladie qu’on nomme la « phtisie galopante, » qui ne pardonne pas, qui est le désespoir de la science impuissante, et qui, en quinze jours, d’une fille rayonnante de vie et de santé, fait un cadavre.
– Tu souffres, Flavie ? demanda le banquier d’un ton qui trahissait une inquiétude trop poignante pour pouvoir être complètement dissimulée.
– Moi ! souffrir ? répondit-elle avec un regard extatique, ce serait donc de joie ?
M. Martin-Rigal eut un geste terrible.
– Par le tonnerre du ciel !… s’écria-t-il, si jamais ce misérable te fait verser une larme, c’est un homme mort !
L’accent du banquier était à ce point menaçant, que sa fille eut presque peur.
– Qu’as-tu ? père, demanda-t-elle ; qu’ai-je dit qui te mette en colère ? Pourquoi appeler Paul misérable ?
– Pourquoi ?… répondit M. Martin-Rigal, incapable de se maîtriser, parce que je tremble pour toi. Il m’a volé le cœur de ma fille, et je ne puis le lui pardonner que si tu trouves près de lui plus de bonheur que près de ton vieux père. Oui, je suis épouvanté, parce que, si tu ne le connais pas, je le connais, moi ! Du jour où tu me l’as désigné dans la foule, tous mes amis, tous les gens qui m’ont des obligations ont été sur pied. De ce moment, il a été entouré d’espions, surveillé, suivi. Je ne me suis pas contenté de connaître sa vie actuelle, on a fouillé son passé. Il n’a pas eu une pensée que je n’aie sue, par prononcé une parole qui ne m’ait été rapportée. Je l’ai étudié… c’est-à-dire mes amis l’ont étudié avec une si scrupuleuse persistance, qu’il ne cache pas au fond de sa conscience un secret que nous n’ayons surpris.
– Cependant, père, tu m’as dit qu’on n’avait rien trouvé contre lui.
– Non, rien… Seulement, il est plus faible que le brin d’osier, plus inconstant que la feuille sèche qui tournoie au moindre souffle. Non, rien !… Mais c’est un de ces êtres neutres, indécis pour le bien comme pour le mal, qui vont où on les pousse, sans but arrêté, sans énergie, sans volonté.
– Tant mieux !… Ma volonté sera la sienne.
M. Martin-Rigal sourit tristement.
– Tu te trompes, chère fille, dit-il, comme toutes les femmes, d’ailleurs. Tu crois que les natures faibles, hésitantes, vacillantes, sont celles qu’on gouverne le plus aisément. Erreur. On ne domine véritablement que les forts, de même qu’on ne s’appuie sûrement que sur ce qui résiste. Ferme la main sur un morceau de marbre, il ne t’échappera pas. Essaie de serrer et d’étreindre une poignée de sable, elle glissera entre tes doigts.
Flavie se taisait.
Son père, doucement, la saisit par la taille et l’attira sur ses genoux.
– Écoute ton vieux père, fillette aimée, poursuivit-il, ton meilleur ami. N’as-tu donc pas confiance en moi ? Ne sais-tu pas qu’il n’y a pas dans mes veines une goutte de sang qui ne soit à toi ? Toutes mes pensées ne t’appartiennent-elles pas ? Paul va venir, sois prudente. Tiens-toi en garde contre une désillusion possible…
– Impossible !…
– Soit ! Mais alors, dans l’intérêt même de ton avenir, de ton bonheur, je t’en conjure, dissimule, ne laisse rien deviner de ce qui se passe en toi, crains les trahisons de tes regards. Les hommes sont ainsi faits que tout en se plaignant bêtement de la duplicité des femmes, ils ne leur pardonnent pas la franchise. Crois-en l’expérience de ton vieil ami. Souviens-toi que la sécurité absolue tue l’amour…
Il s’interrompit, on sonnait à la porte de l’appartement.
À ce coup de sonnette, tout le corps de Flavie vibra comme le timbre même sous le marteau.
– C’est lui !… dit-elle d’une voix étranglée, lui !…
Et, faisant un effort, elle ajouta :
– Je t’obéis, père, je me sauve ; je veux, avant de me montrer, tuer mon opinion et cette malheureuse sensibilité… Je reviendrai lorsque d’autres personnes seront arrivées. Sois sans inquiétude, je vais te prouver que ta fille serait une comédienne, au besoin…
Elle s’enfuit comme la porte du salon s’ouvrait.
Mais ce n’était point Paul.
Ce premier arrivant était un ami de M. Martin-Rigal, un gros fabricant, qui donnait le bras à sa femme, aussi parfaitement mise qu’insignifiante.
Pour ce soir-là, le banquier avait cru devoir inviter une vingtaine de personnes. Un grand dîner expliquait et justifiait la présentation de Paul.
En ce moment, précisément, le protégé de B. Mascarot entrait chez le docteur Hortebize, l’honorable parrain qui allait lui ouvrir les portes du monde.
Paul ne se ressemblait plus. Il sortait des mains d’un tailleur en renom, et même c’était là ce qui l’avait retardé.
Grâce à l’influence du digne placeur, ce tailleur avait, en quarante-huit heures, exécuté un de ces costumes de soirée qui, à première vue décident un mariage.
Le moelleux des étoffes, « la perfection de la coupe », la richesse des accessoires, mettaient en relief tous les « avantages » de Paul et rehaussaient sa bonne mine naturelle.
Peut-être était-il un peu gêné par ces élégances si nouvelles, mais à l’âge qu’il avait, ou plutôt qu’il paraissait avoir, cet embarras qu’on devait prendre pour de la timidité était une grâce de plus.
En tout cas, il était si bien, que le docteur, en le voyant, eut un sourire approbatif.
– Décidément, murmura-t-il, Flavie a bon goût.
Puis, interrompant Paul qui s’accusait d’arriver en retard :
– Il n’y a pas de mal, lui dit-il, asseyez-vous, le temps de mettre une cravate fraîche, et je suis à vous.
Laissé seul par le docteur qui venait de passer dans son cabinet de toilette, Paul Violaine s’assit ou plutôt se laissa tomber lourdement sur un fauteuil.
Il était harassé de fatigue.
Depuis cinq nuits, il ne dormait pas.
Dès qu’il se couchait, une fièvre terrible s’emparait de lui, le brûlait et le chassait de son lit.
C’est que si son corps était gêné dans ses beaux habits neufs, sa pensée se débattait, à la torture, au milieu des angoisses d’une situation impossible, absolument imprévue.
Son honnêteté, qu’il vantait à Rose d’un air si sûr de soi, avait été mise à l’épreuve et n’avait pas résisté.
Quand, au sortir de chez l’illustre Van Klopen, Paul avait dit au placeur : « je suis à vous », il avait obéi aux inspirations de sa vanité blessée et de ses rancunes.
D’ailleurs, il était encore étourdi de la terrible puissance du placeur, ébloui des regards de Flavie, fasciné par ces fantastiques millions qu’on faisait miroiter à ses yeux.
Le soir, seulement, il fut épouvanté en se demandant de quels ténébreux desseins il devenait l’instrument, en songeant à cet engagement qu’il ne pouvait plus reprendre.
Mais le lendemain, il avait dîné avec son protecteur chez Hortebize, et la certitude de la complicité active de cet excellent docteur l’avait décidé à étouffer les dernières convulsions de sa conscience.
C’est ainsi : selon les sphères où il se trouve, le vice, – il faudrait dire le crime, – peut être une provocation ou un salutaire enseignement.
Laid, sale, idiot, abattu, il répugne et raffermit la vertu chancelante. Riche, heureux, spirituel, triomphant, il éveille dans l’âme des faibles de furieuses jalousies caressées par l’espoir de l’impunité.
Le luxe du docteur, ses façons d’homme du monde, son importance, ses paradoxes ingénieux à l’endroit des préjugés du Code, devaient achever la besogne de corruption du digne B. Mascarot.
– Je ne serais qu’un sot, pensait Paul, si je luttais, si j’hésitais encore, quand ce médecin que je vois riche, heureux, honoré, n’a pas de scrupules.
Il eût hésité, cependant, s’il eût su quelle relique renfermait ce médaillon d’or qui battait le ventre prospère du prudent associé de l’honorable placeur.
Mais Paul ne pouvait savoir, et, admis pour la première fois à l’intimité d’une vie large et facile, il admirait le magnifique appartement du docteur, qui occupe tout le premier étage d’une vieille maison de la rue du Luxembourg.
Dès l’antichambre, on devine l’égoïste aimable, le spirituel épicurien, qui ne croit perdus ni le temps ni l’argent qu’il dépense à ouater son bien-être.
– Je veux être logé comme cela, s’était dit Paul, mordu au cœur par toutes les vipères de l’envie.
Le docteur reparut, vêtu comme toujours quand il va dans le monde, avec la dernière recherche.
– Je suis à vos ordres, dit-il au protégé de B. Mascarot, devenu le sien ; partons, nous n’arriverons que bien juste à l’heure.
Dans la cour, la voiture du docteur, un coupé Binder, attelé d’un vigoureux trotteur, attendait.
En s’installant sur les coussins, Paul se disait :
– J’aurai aussi un coupé comme celui-ci.
Mais si le jeune homme oubliait pour des chimères les choses positives, le docteur qui avait reçu ses instructions, veillait.
– Voyons, commença-t-il dès que la voiture fut dans la rue, causons un peu, mais bien. On vous offre une occasion telle que bien des fils de famille n’en trouvent pas une pareille en leur vie, il s’agit d’en profiter.
– J’en profiterai, répondit Paul avec une nuance de fatuité.
– Bravo !… Mon cher garçon, j’aime cette audace juvénile. Seulement, permettez-moi de la doubler de ma vieille expérience. Et pour commencer, savez-vous au juste ce que c’est qu’une héritière ?
– Je pense, monsieur…
– Laissez-moi parler. Une héritière, fille unique, surtout, est le plus ordinairement une jeune personne fort désagréable, capricieuse, fantasque, pénétrée de ses mérites et complètement affolée par les adulations dont elle a été l’objet dès sa plus tendre enfance. Certaine, grâce à sa dot, de ne pas manquer de mari, elle se croit tout permis.
– Oh !… fit Paul, singulièrement refroidi, serait-ce le portrait de Mlle Flavie que vous m’esquissez là ?
Le docteur eut un franc éclat de rire.
– Pas précisément, répondit-il, je dois vous prévenir que notre héritière a son grain de fantaisie. Je la crois, par exemple, très capable de faire tout pour tourner la tête d’un soupirant, à la seule fin de le planter là après, et de s’égayer de son air déconfit.
Paul, qui, jusqu’à ce moment, n’avait examiné que les côtés brillants de l’aventure, fut consterné de cet envers qu’on lui montrait et qu’il n’avait pas soupçonné.
– Si c’est ainsi, demanda-t-il tristement, à quoi bon me présenter ?
– Mais pour que vous réussissiez donc. N’avez-vous pas tout ce qu’il faut pour cela ? Il se peut que Mlle Flavie vous accueille avec une distinction flatteuse : n’en tirez aucune conclusion immédiate. Elle se jetterait à votre tête que je vous dirais : Doutez, soyez prudent, c’est peut-être un piège. Entre nous, une fille qui possède un million est bien excusable d’essayer de savoir au juste si c’est à elle que s’adressent les hommages ou à son argent.
La voiture s’arrêtait : ils étaient arrivés rue Montmartre.
Après avoir donné à son cocher l’ordre de venir le reprendre à minuit, le docteur entraîna son protégé.
Paul était si ému, au moment de la démarche décisive, qu’il ne pouvait parvenir à mettre ses gants.
Il y avait quinze personnes dans la maison du banquier, quand le domestique annonça M. le docteur Hortebize et M. Paul Violaine.
Si M. Martin-Rigal détestait l’homme choisi entre tous par sa fille, il n’y parut guère à sa réception.
Après avoir serré la main de son vieil ami le docteur, il le remercia avec une effusion bien sentie de lui présenter un homme aussi distingué que M. Violaine.
Cet accueil rendit à Paul une partie de son assurance perdue. Mais il avait beau regarder, il n’apercevait pas Mlle Martin-Rigal.
Le dîner était pour sept heures. À sept heures moins cinq minutes seulement, Flavie parut et fut aussitôt entourée par les invités.
Elle avait réussi à cacher sa sensibilité. Si émue qu’elle fût, elle dominait son émotion, et ses yeux, en s’arrêtant sur Paul, qui s’inclinait devant elle, exprimaient une indifférence parfaite.
M. Martin-Rigal ne s’attendait certes ni à tant d’énergie ni à tant de réserve.
Mais Flavie avait médité ses dernières paroles et compris leur justesse. Placée assez loin de Paul, à table, elle eut le courage de s’abstenir de le regarder.
Après le dîner seulement, lorsque les tables de whist furent organisées, Flavie osa s’approcher de Paul et d’une voix tremblante, elle lui demanda de faire entendre au piano quelques-unes de ses compositions.
Paul était médiocre exécutant ; sa musique ne valait pas grand chose, et pourtant Flavie l’écoutait avec un recueillement béatifique comme si Dieu lui eût envoyé un de ses anges pour lui donner une idée des symphonies célestes.
Assis l’un près de l’autre, M. Martin-Rigal et le docteur Hortebize suivaient d’un regard plein de sollicitude les émotions de la jeune fille.
– Comme elle l’aime !… murmurait le banquier, et ne savoir au juste les pensées de ce garnement, qui certes ne se doute pas de son bonheur !
– Bast !… Mascarot le confessera demain.
Le banquier ne répondit pas.
– Je crois que demain, reprit le docteur, ce cher Baptistin aura diablement de l’occupation. À dix heures, conseil général. Nous verrons donc enfin le fond du sac de notre ami Catenac. Je suis curieux aussi de voir quelle figure fera le marquis de Croisenois quand on lui apprendra ce qu’on attend de lui.
Cependant, l’heure s’avançait, et les invités se retiraient un à un.
Le docteur fit un signe à son protégé, et ils sortirent ensemble.
Flavie, ainsi qu’elle l’avait promis, avait été si bonne comédienne, que Paul se demandait s’il devait croire et espérer.
XV
Lorsque B. Mascarot réunit en conseil ses honorables associés, Beaumarchef a l’habitude de revêtir ce qu’il nomme sa « grande tenue ».
Outre que très souvent il est appelé pour donner des renseignements et qu’il tient à paraître avec tous ses avantages, il a la vénération innée de la hiérarchie, et sait ce qu’on doit à ses supérieurs.
Il garde pour ces occasions solennelles, le plus beau de ses pantalons à la hussarde, qui n’a pas moins de sept plis sur chaque hanche, une redingote noire qui dessine cette taille mince et cette poitrine bombée dont il est si fier ; enfin, des bottes armées de gigantesques éperons.
De plus, et surtout, il empèse avec une vigueur particulière ses longues moustaches dont les pointes ont percé tant de cœurs.
Ce jour-là, cependant, bien que prévenu depuis l’avant-veille, qu’une assemblée aurait lieu, l’ancien sous-off., à neuf heures du matin, avait encore ses vêtements ordinaires.
Il en était sérieusement affligé, et s’efforçait de se consoler en se répétant que cet acte d’irrévérence était bien involontaire.
C’était la vérité pure. Dès l’aurore, on était venu le tirer du lit, pour régler le compte de deux cuisinières qui, ayant trouvé une condition, quittaient l’hôtel où B. Mascarot loge les domestiques sans place.
Cette opération terminée, il espérait avoir le temps de remonter chez lui, mais juste comme il traversait la cour, il avait aperçu Toto-Chupin, lequel venait lui faire son rapport quotidien, et il l’avait fait entrer dans la première chambre de l’agence.
Beaumarchef supposait que ce rapport serait l’affaire de quelques minutes : il se trompait.
Si Toto n’avait rien de changé extérieurement, s’il conservait sa blouse grise, sa casquette informe, son ricanement cynique, ses idées s’étaient terriblement modifiées.
Ainsi, lorsque l’ancien sous-off le pria de lui donner brièvement, car il était pressé, l’emploi de sa journée de la veille, le garnement, à sa grande surprise, l’interrompit par un geste narquois et une grimace des plus significatives.
– Je n’ai pas perdu mon temps, répondit-il, et même j’ai découvert du nouveau ; seulement avant de parler… avant de vous dire…
– Eh bien ?
– Je veux faire mes conditions, là.
Cette déclaration, appuyée d’un expressif mouvement de mains, abasourdit si bien l’ancien sous-off, qu’il ne trouva pas un mot à répondre.
– Des conditions ! répéta-t-il, la pupille dilatée par la stupeur.
– C’est comme cela, insista Chupin, à prendre ou à laisser. Pensez-vous donc que je vais me tuer le tempérament jusqu’à la fin des fins pour rien, pour un grand merci ? Ce ne serait pas à faire. On sait ce qu’on vaut, n’est-ce pas ?
Beaumarchef était exaspéré.
– Je sais que tu ne vaux pas les quatre fers d’un chien, exclama-t-il.
– Possible.
– Et tu n’es qu’un petit misérable d’oser parler ainsi, après toutes les bontés du patron pour toi.
Toto-Chupin éclata de rire.
– Des bontés !… fit-il de sa voix la plus odieusement enrouée, oh ! là, là… Ne dirait-on pas que le patron s’est ruiné pour moi ? Pauvre homme ! Je voudrais bien les connaître ces bontés.
– Il t’a ramassé dans la rue, une nuit qu’il tombait de la neige, et depuis tu as une chambre à l’hôtel.
– Un chenil.
– Il te donne tous les jours le déjeuner et le dîner…
– Je sais bien, et à chaque repas une demi-bouteille de mauvais bleu qui ne tache seulement pas la nappe, tant il y a d’eau dedans.
Voilà comment Toto-Chupin pratique la reconnaissance.
– Ce n’est pas tout, continua Beaumarchef, on t’a monté une boutique de marchand de marrons.
– Oui, sous la porte cochère. Il faut rester debout du matin au soir, gelé d’un côté, grillé de l’autre, pour gagner vingt sous. J’en ai assez. D’ailleurs, il y a trop de chômage dans cet état-là !…
– Tu sais bien que pour l’été on t’installera un réchaud à pommes de terre frites.
– Merci ! l’odeur de la graisse me donne mal à l’estomac.
– Que voudrais-tu donc faire ?
– Rien. Je sens que je suis né pour être rentier.
L’ancien sous-off était à bout d’arguments.
– Je dirai tout cela au patron, fit-il, et nous verrons.
Mais cette menace n’impressionna nullement Toto.
– Je me fiche un peu du patron, répondit-il. Il me renverra ? Bonne affaire.
– Méchant drôle !…
– Tiens, pourquoi donc ? Est-ce que je ne mangeais pas avant de connaître le patron ? Je vivais mieux et j’étais libre. Rien qu’à mendier, à chanter dans les cours et à ouvrir les portières, je me faisais mes trois francs par jour. On les buvait avec des amis, et ensuite on allait coucher à Ivry, dans une fabrique de toiles où la police n’a jamais mis les pieds. C’est là qu’on est bien l’hiver, près des fours… Je m’amusais alors, tandis que maintenant…
– Plains-toi donc !… Maintenant, quand tu surveilles quelqu’un, je te donne cent sous tous les matins.
– Tout juste. Et je trouve que ce n’est pas assez.
– Par exemple !…
– Oh ! ce n’est pas la peine de vous fâcher. Je demande de l’augmentation ; vous répondez : Non. C’est très bien ; moi, je me mets en grève.
Beaumarchef eût volontiers donné dix sous de sa poche pour que B. Mascarot entendit maître Chupin.
– Tu n’es qu’un coquin ! s’écria-t-il. Tu fréquentes des sociétés qui te mèneront loin. Ne dis pas non. Il est venu ici te demander un certain Polyte, portant casquette cirée, accroche-cœurs collés aux tempes, jolie cravate à pois : je suis sûr que ce gaillard-là…
– D’abord, mes sociétés ne vous regardent pas.
– C’est pour toi, ce que j’en dis ; il t’arrivera des désagréments, tu verras.
Cette prédiction parut révolter Toto-Chupin ; elle cachait, il le comprenait bien, une menace fort sérieuse.
– De quoi ! fit-il, rouge de colère, de quoi !… Qui donc me ferait arriver de la peine ? Le patron ? Moi, je l’engage à se tenir tranquille.
– Toto !…
– C’est que vous m’ennuyez fameusement à la fin. Méchant drôle par ci, garnement par là, chenapan, coquin !… Ah ça ! qu’êtes-vous donc, vous et le patron ? Définitivement, vous me prenez pour un autre. Vous croyez peut-être que je ne comprends pas vos manigances et que je gobe les bourdes que vous me contez ! Allons donc !… On y voit clair, Dieu merci ! Quand vous me faites suivre celui-ci ou celui-là pendant des semaines, ce n’est pas pour porter des secours à domicile, n’est-ce pas ? Qu’il m’arrive malheur, je sais bien ce que je dirai au commissaire. Vous verrez alors qu’un bon ouvrier vaut un peu plus de cent sous par jour.
Certainement Beaumar est un ancien militaire ; incontestablement, il est très brave ; il tire avec distinction la pointe et la contrepointe, mais il se laisse aisément démonter.
La surprenante impudence de Toto lui donnait à penser que le précoce gredin obéissait à quelque conseiller expérimenté. Dès lors, il était impossible de calculer la portée de ses menaces.
Ne sachant comment agir en cette difficile conjoncture, n’ayant pas de consigne, l’ancien sous-off pensa que le plus prudent, en tout cas, était de filer doux.
– Enfin, demanda-t-il, qu’exiges-tu ?
– D’abord, je veux sept francs par jour.
– Peste !… tu vas bien, toi. N’importe, je dirai tes prétentions au patron, et en attendant, je te donnerai aujourd’hui ce que tu demandes. Ainsi, tu peux parler…
Mais c’est avec le plus insolent dédain que le jeune garnement accueillit cette conciliante proposition.
– Ah ! bien !… ouiche !… fit-il.
– Quoi ?
– Vous espérez me faire jaser pour quarante sous ? Plus souvent ! D’abord, je jure de ne pas desserrer les dents si vous ne me donnez pas immédiatement cent francs.
– Cent francs ! répéta Beaumar, confondu.
– Ni plus ni moins.
– Et en quel honneur, te donnerait-on cette somme ?
– Parce que je l’ai gagnée, donc…
Beaumarchef haussa les épaules.
– Tu es fou, prononça-t-il. Que veux-tu faire de cent francs ? à quoi les dépenseras-tu ?
– Soyez tranquille, ce ne sera pas à acheter de la pommade comme celle que vous mettez sur vos moustaches.
Imprudent Chupin !… Toucher à la moustache de Beaumarchef.
Il allait recevoir un maître coup de pied, lorsqu’un léger bruit à la porte, restée entrebâillée, le fit retourner ainsi que l’ancien sous-off.
C’était le père Tantaine, en personne, qui entrait.
Brave et digne père Tantaine !…
Tel il était apparu à Paul, dans sa mansarde, tel il était encore avec sa longue redingote noire, feutrée par des couches successives de graisse et de poussière, avec la flasque loque noire et luisante qu’il appelait son chapeau.
Son éternel sourire voltigeait sur ses lèvres flétries.
– Eh bien ! eh bien !… disait-il, qu’est-ce que cela signifie ? On se fâche, je crois, et les portes ouvertes encore !…
Intérieurement, Beaumarchef bénit la Providence, protectrice des causes justes, qui lui envoyait ce renfort.
– Monsieur, commença-t-il, c’est Toto-Chupin qui prétend…
– J’ai tout entendu, interrompit doucement le père Tantaine.
À ces mots, Toto jugea prudent de se reculer hors de portée.
C’est un profond observateur que ce précoce gredin. Depuis des années qu’il vit en écumant le ruisseau de Paris, la nécessité a aiguisé sa pénétration naturelle.
À trier de l’œil, dans la foule, ses dupes quotidiennes, il est devenu physionomiste, comme tous les gens dont l’existence et à la merci du caprice de ceux qu’ils exploitent.
Toto-Chupin connaissait à peine B. Mascarot et s’en méfiait.
Il méprisait prodigieusement Beaumarchef dont il avait reconnu la niaiserie sous ses airs de matamore.
Mais il craignait comme le feu ce doucereux Tantaine, en qui il devinait un maître qu’on ne brave pas impunément.
Aussi, chercha-t-il bien vite à s’excuser.
– Laissez-moi vous dire, m’sieu, hasarda-t-il…
– Quoi ? interrompit le bonhomme. Que tu es un garçon intelligent ? Nous le savons ; ce qui n’empêche que tu finiras mal.
– C’est que, m’sieu, je voudrais…
– De l’argent ? C’est fort naturel… Peste !… tu es un auxiliaire trop précieux pour se priver de tes services. Allons, Beaumar, vite un billet de cent francs à ce joli garçon.
L’ancien sous-off, stupéfait de cette générosité, allait certainement résister, mais sur un geste du bonhomme, que Toto n’aperçut pas, il s’exécuta et tira de sa caisse cinq pièces de vingt francs qu’il tendit au jeune drôle.
Mais voici que Chupin n’osait plus prendre cet argent si impérieusement réclamé.
Supposait-il qu’on voulait se moquer de lui ? Flairait-il un piège caché sous cette surprenante facilité ?
– Prends, insista Tantaine, si tes renseignements ne valent pas ce que tu demandes, je te repincerai. Tu parleras, à cette heure, j’espère…
– Oh ! oui, m’sieu !… fit Toto triomphant.
– Cela étant, suis-moi dans le confessionnal, nous n’y serons pas dérangés par les clients.
On n’y voit pas fort clair, dans le confessionnal de l’agence de B. Mascarot, les rideaux verts qui entourent le grillage interceptent le jour, mais on n’y est pas mal.
Il s’y trouvait un fauteuil à coussinet, deux chaises et une petite table.
En familier de la maison, Tantaine s’empara du fauteuil, et s’adressant à Chupin qui restait debout, tortillant sa casquette, il dit simplement :
– Je t’écoute.
Le mauvais drôle avait repris son impudence habituelle. Ne sentait-il pas, à travers la toile de sa poche, les cinq louis de Beaumarchef !
– Il y a cinq jours, commença-t-il, que je surveille Caroline Schimel, je la connais à présent comme ma tante. C’est une horloge pour les habitudes, cette femme-là, et les petits verres qu’elle boit marquent les heures.
Le vieux clerc d’huissier daigna sourire de la métaphore.
– Elle se lève vers dix heures, poursuivit Toto, prend son absinthe, déjeune chez le premier marchand de vin venu, sirote son café et fait sa partie de bésigue avec n’importe qui. Voilà pour la journée. À six heures sonnant, elle file au Turc, et n’en sort qu’à la fermeture, après minuit, pour aller se coucher.
– Au Turc ?… interrogea le père Tantaine.
– À la table d’hôte de la rue des Poissonniers, quoi !… Parlez-moi d’un établissement comme celui-là ! On y trouve à dîner, à boire, à danser… Tous les agréments de la vie, enfin, sans se déranger. C’est d’un beau là-dedans, à ce qu’il paraît !
– Comment, à ce qu’il paraît !… Tu n’y es donc pas entré ?
D’un geste piteux, Toto-Chupin montra son costume délabré.
– On me refuserait au contrôle, répondit-il. Mais laissez faire, j’ai mon plan.
Tout en causant, le père Tantaine prenait l’adresse de ce séjour de délices. Lorsqu’il eut fini :
– C’est là, fit-il sévèrement, ce que tu évalues cent francs ? maître Toto ?
Le garnement eut une grimace de singe méditant un méchant tour.
– Attendez donc, bourgeois, fit-il. Pour mener la vie de Caroline, il faut de l’argent, n’est-ce pas ? Elle n’est pas propriétaire, cette fille… mais moi je sais où elle prend sa monnaie.
Le demi-jour du confessionnal permit au vieux clerc d’huissier de dissimuler la satisfaction que lui causait cette révélation.
– Ah !… fit-il sur deux tons différents, ah ! tu sais cela !…
– Un peu, bourgeois, et d’autres choses aussi. Écoutez l’histoire : Hier, après son déjeuner, voilà ma Caroline qui se met à jouer aux cartes avec deux individus qui avaient mangé un morceau à la table voisine. C’étaient des lapins, allez, des vrais. Rien qu’à voir leurs mains tripoter les cartons, je me suis dit : « Toi, ma bonne femme, tu vas te faire nettoyer ! » ça n’a pas manqué. Au bout d’une heure, elle était si bien à sec, que n’ayant plus le sou pour payer sa consommation, elle a offert au marchand de vin une de ses bagues en gage. Lui, a répondu qu’il n’en voulait pas, ayant confiance. Alors elle a dit : « C’est bon, je monte chez moi, et je reviens. » J’ai vu et entendu, j’étais au comptoir à prendre un canon.
– Et ce n’est pas chez elle qu’elle est allée ?
– Non, bourgeois, non. Elle sort, traverse tout Paris d’un pas de chasseur à pied, et va sonner droit à la plus belle maison de la rue de Varennes, un vrai palais. On ouvre, elle entre, et moi j’attends.
– Sais-tu au moins qui l’habite, ce palais ?
– Naturellement. L’épicier du coin m’a dit que cet hôtel appartient au duc de… attendez donc… au duc de… Champdoce ; oui, c’est bien ce nom-là. Champdoce ; un noble qui a, paraît-il, ses caves pleines d’or, comme la Banque.
Le père Tantaine n’est jamais si indifférent que lorsqu’il est sérieusement intéressé.
– Abrège, Toto dit-il, abrège, mon garçon.
Chupin, qui avait compté produire une vive impression, parut très vexé.
– Faudrait me laisser le temps !… répondit-il. Donc, au bout d’une demi-heure, ma Caroline reparaît, gaie comme un pinson. Une voiture passait, elle grimpe dedans, et fouette cocher !… chien de fiacre !… il allait d’un train !… Heureusement j’ai des jambes, et j’arrive au Palais juste pour voir Caroline descendre, entrer chez un changeur et changer deux billets de deux cents francs.
– Comment as-tu deviné cela ?
– Tiens, on a des yeux, peut-être. Les papiers étaient bleus.
Le bon Tantaine eut un paternel sourire.
– Tu te connais donc en billets de banque ? dit-il.
– Pourquoi pas ? On a fait ses études le long des boutiques. Seulement, je n’en ai jamais manié. On dit que c’est doux à la main comme du satin. Une fois, j’ai voulu savoir, et je suis entré chez un changeur pour lui demander de me laisser tâter un billet de mille… Oh ! rien que tâter : il m’a donné une claque. Gredin, va ! Mais je lui ai répondu : « Tiens, pourquoi exposez-vous des fortunes en tas derrière une vitrine ? C’est donc pour faire bisquer le monde ? »
Mais le père Tantaine n’écoutait plus.
– C’est tout, n’est-ce pas ? demanda-t-il.
– Minute !… répondit Chupin, j’ai gardé le nanan pour la fin. J’ai à vous dire que nous ne sommes pas seuls à surveiller Caroline.
Cette fois Toto dut être content de l’effet. Le vieux clerc fit sur son fauteuil un tel bond que son chapeau tomba.
– Pas seuls ! fit-il, que me chantes-tu là ?
– Je chante ce que j’ai vu, bourgeois. Depuis trois jours, je voyais rôder autour de notre gibier un grand drôle avec une harpe sur le dos, et je me défiais. J’avais raison. Il a fait la course du faubourg Saint-Germain, lui aussi…
Le père Tantaine réfléchissait.
– Un grand drôle, murmurait-il, un musicien… Hum !… il y a du Perpignan là-dessous, ou je me trompe fort. On verra…
Et s’adressant à Toto :
– Il faut lâcher Caroline, lui dit-il, et « filer » le drôle à la harpe. Et sois prudent, surtout… Allons, va, tu as gagné tes cent francs !…
Chupin sortit, le vieux clerc hocha tristement la tête.
– Trop intelligent, cet enfant, grommela-t-il, beaucoup trop, il ne fera pas de vieux os…
Beaumarchef ouvrait la bouche pour demander au père Tantaine de garder la boutique pendant qu’il irait se mettre en grande tenue, mais le bon vieux l’arrêta.
– Bien que le patron n’aime pas à être dérangé, dit-il, j’entre chez lui. Et quand ces messieurs arriveront, introduisez-les bien vite, parce que, voyez-vous, monsieur Beaumar, la poire est si mûre, que si on ne la cueillait pas, elle tomberait.
XVI
C’est le docteur Hortebize qui, le premier, arriva au rendez-vous assigné par B. Mascarot à ses honorables associés.
Se lever avant dix heures est un supplice pour lui, et la journée entière s’en ressent. Mais les affaires avant tout.
L’agence, lorsqu’il se présenta, était pleine de clients, et Beaumarchef en bénit le ciel. D’abord on remarquait ainsi bien moins le négligé de sa mise, puis il échappait de la sorte à l’inévitable : « trop de petits verres, Beaumar », du bon docteur.
– Monsieur est là, dit l’ancien sous-off, et il vous attend avec impatience. M. Tantaine est avec lui.
Une idée comique brilla dans les yeux de M. Hortebize, mais c’est du ton le plus sérieux qu’il répondit :
– Pardieu !… je serai ravi de le voir ce brave père Tantaine.
Cependant, lorsque le docteur pénétra dans le sanctuaire de l’agence, il trouva B. Mascarot seul, classant ses éternelles petites fiches.
– Eh bien !… lui demanda-t-il, après une cordiale poignée de main, quoi de neuf ?
– Rien.
– Tu n’a pas encore vu Paul ?
– Non.
– Viendra-t-il, au moins ?
– Oui.
L’estimable placeur est laconique d’ordinaire, mais non tant que cela.
– Ah ça ! qu’as-tu, demanda l’excellent docteur, tu me parais funèbre, serais-tu souffrant ?
– Je ne suis que préoccupé, ce qui est bien excusable, la veille d’une bataille décisive.
Il y avait de cela, dans la tristesse du placeur, mais il y avait autre chose encore, qu’il se gardait bien de dire à son ami.
Toto-Chupin l’inquiétait. Une paille, et le plus solide essieu d’acier forgé se brise. Toto, le triste drôle, pouvait être le grain de sable qui, glissant dans l’engrenage d’une machine, l’arrête et fait tout éclater.
B. Mascarot cherchait comment supprimer le grain de sable.
– Bast !… fit le docteur, en caressant son médaillon, nous réussirons. Qu’as-tu à redouter ? Une résistance de Paul ?
L’honnête placeur haussa dédaigneusement les épaules.
– Paul résistera si peu, dit-il, que j’ai résolu de le faire assister à notre séance d’aujourd’hui, qui sera orageuse. On pourrait lui mesurer la vérité comme le vin à un convalescent, j’aime mieux la lui verser d’un coup.
– Diable ! c’est grave. S’il allait prendre peur et s’envoler avec notre secret ?
– Il ne s’envolera pas, prononça B. Mascarot, avec un accent qui eût fait frémir son protégé, pas plus que ne s’envole le hanneton qu’un enfant tient au bout d’un fil. Ne connais-tu donc pas ces natures molles et flasques ? Il est le gant, je suis la main nerveuse qui, sous la peau, garde sa puissance et sa force.
Le docteur n’entreprit point de discuter.
– Amen ! prononça-t-il.
– Si nous trouvons une résistance, reprit le placeur, elle viendra de Catenac. Je puis obtenir de lui une coopération apparente, sincère, non…
– Catenac !… fit le docteur surpris ; tu te proposais, disais-tu, de te passer de lui.
– Telle était mon intention, en effet.
– Pourquoi changer d’avis ?
– Parce que j’ai reconnu que nous ne pouvions nous priver de son concours, parce que pour renoncer à ses services, il faudrait confier le fin mot de notre société à un homme d’affaires, parce que…
Il s’interrompit en disant :
– Écoute !
Dans le corridor, on entendait les : broum ! broum ! d’un homme qui, ayant, comme on dit vulgairement, la poitrine grasse, tousse dès qu’il change de température, dès qu’il passe du froid de la rue à la chaleur des appartements.
– C’est lui, fit Hortebize.
La porte s’ouvrit. C’était Catenac, en effet.
Don naturel ou résultat d’un savant exercice, maître Catenac a cette tournure, ces façons, cet « on ne sait quoi », qui, à première vue, font dire : « Voici un honnête homme. »
Sur la seule foi de son enseigne, c’est-à-dire de sa bonne figure à minces favoris châtains, on serait heureux de lui confier sa fortune.
Tartuffe avec l’œil louche, la lèvre cauteleuse et pincée, la physionomie fuyante, éveillerait la méfiance et ainsi ne serait pas Tartuffe.
Le regard de Catenac, clair et droit, croise franchement le regard de son interlocuteur. Sa voix est pleine et ronde. Il a le secret d’une brusquerie joviale qui ne manque jamais son effet.
Avocat très estimé au Palais pour son savoir, Catenac plaide peu et mal.
S’il gagne trente mille francs par an, c’est qu’il a une spécialité.
Il arrange les contestations qui ne peuvent se plaider, pour cette raison que, soumises à un tribunal, elles enverraient au bagne les deux parties ou les déshonoreraient à tout le moins.
Tous les jours, à Paris, il s’entame des procès de ce genre.
Le plus violent des adversaires lance une assignation, commence des poursuites ; le public, qui flaire un scandale, attend… Rien.
Les deux adversaires épouvantés sont allés trouver Catenac, tout est arrangé !…
À combien de fripons insignes, de voleurs considérés, prêts à se dénoncer mutuellement, a-t-il fait entendre raison !…
Il a mis d’accord des assassins qui se disputaient les dépouilles de leur victime, prêts à invoquer des juges pour le règlement des parts.
Et ce ne sont pas là ses plus hideuses affaires.
Lui-même le dit parfois : « J’ai remué en ma vie des monceaux de boue. »
Dans son cabinet de la rue Jacob, il s’est chuchoté des aveux à faire tomber le crépi du plafond.
Ce genre de conciliation rapporte au conciliateur ce qu’il veut.
Le client qui a mis à nu devant son avocat les ulcères de sa conscience, lui appartient, comme le malade appartient au médecin qui a soigné ses maladies honteuses, comme la pénitence appartient à son directeur.
De sa spécialité, Catenac a gardé cette faconde prolixe, oiseuse, diffuse, indispensable aux gens qui, pris pour arbitres, doivent, avant tout, calmer la violence des adversaires mis en présence.
– Me voici, s’écria-t-il tout d’abord. Tu m’as appelé, ami Baptistin, tu m’as convoqué, assigné, mandé, et j’arrive, j’accours, j’obéis, je me rends…
– Prends donc une chaise, interrompit le placeur.
– Merci, cher ami, mille grâces, bien des remerciements ; mais je suis pressé, vois-tu, affairé, tiraillé ; on m’attend ; je suis lié, engagé…
– Eh bien ! prononça le docteur, assieds-toi quand même. Ce que veut te dire Baptistin est autrement important que n’importe quel rendez-vous.
Catenac obéit, toujours souriant en apparence, au fond très en colère et un peu inquiet.
– De quoi donc s’agit-il ? disait-il, qu’est-ce, qu’y a-t-il ?
B. Mascarot s’était levé et était allé pousser les verrous.
Lorsqu’il eut repris sa place :
– Voici le fait, répondit-il. Nous sommes décidés, Hortebize et moi, à lancer la grande affaire dont je t’ai vaguement entretenu autrefois. Nous avons un homme important à mettre à la tête, le marquis de Croisenois.
– Mon cher… commença l’avocat…
– Attends. Ton concours nous est indispensable, de sorte…
Maître Catenac se leva brusquement.
– Assez, interrompit-il, suffit, la cause est entendue. Si c’est pour me proposer, pour m’offrir une affaire, que tu m’as écrit de venir, de passer, tu as eu tort, tu t’es trompé, tu as fait fausse route, je te l’ai dit, redit, affirmé, répété cent fois…
Il se retournait déjà, se préparant à battre en retraite ; mais, entre la porte et lui, se tenait debout le bon docteur Hortebize, qui le regardait d’un air singulier !…
Certes, le Catenac n’est pas homme à se laisser aisément effrayer.
Mais l’attitude de l’excellent Hortebize était si expressive, le pâle et froid sourire de B. Mascarot – qu’il regarda – lui offrit une si édifiante signification, qu’il demeura interdit.
– Qu’est-ce que cela signifie, balbutia-t-il, qu’est ceci ? Que voulez-vous de moi ? que souhaitez-vous, que désirez-vous ?
– Nous voulons d’abord, prononça le docteur en appuyant sur chaque mot, que tu prennes la peine d’écouter quand on te parle.
– Mais j’écoute, ce me semble.
– Reprends donc ta chaise, et ouvre ton esprit aux propositions de notre ami Baptistin.
Le visage de Catenac ne trahissait rien de ses impressions. Il l’a exercé et assoupli à ce point qu’un soufflet ne ferait pas monter une seule goutte de sang à ses joues.
Seulement, son geste, lorsqu’il se rassit, disait l’irritation qu’il éprouvait de cette violence qui lui était faite.
– Que Baptistin s’explique donc, dit-il.
À part un mouvement machinal pour assurer ses lunettes sur son nez, l’honorable placeur n’avait pas bougé.
– Avant d’aborder les détails, dit-il d’un ton glacé, j’aurais dû demander à notre respectable ami – et associé – si oui ou non il est avec nous.
– Eh !… cela doit-il faire l’ombre d’un doute, interrompit l’avocat, est-ce que tous mes vœux…
– Pardon ! Il n’est pas question de vœux stériles. Ce qu’il nous faut, c’est un concours loyal, une coopération active.
– C’est que mes amis…
– Je dois te prévenir, insista B. Mascarot, que nous avons toutes les chances pour nous, et que si nous gagnons, chacun de nous aurait près d’un million.
Hortebize n’avait pas la patience du placeur.
– Voyons, fit-il, prononce-toi. Réponds : oui ou non.
Catenac, ses amis pouvaient le voir, était cruellement indécis. Il fut plus d’une minute sans répondre : il se recueillait.
– Eh bien !… non !… s’écria-t-il avec une violence qui trahissait l’effort de la lutte ; tout bien vu, réfléchi, considéré, pesé, je vous répondrai nettement et carrément : Non.
B. Mascarot et le docteur Hortebize eurent la même exclamation :
– Ah !…
Ce n’était pas surprise, mais bien ce sentiment mal défini qu’on éprouve à voir une prévision, même fâcheuse, réalisée.
– Permettez, poursuivit Catenac, que j’explique ce que sans doute vous appelez ma défection.
– Dis trahison, ce sera plus juste.
– Soit. Je ne chicanerai pas sur les mots, je serai franc.
– Oh !… murmura le docteur, une fois n’est pas coutume.
– Il me semble, cependant, que je ne vous ai jamais caché ma façon de penser. Voici à coup sûr plus de dix ans que je vous ai parlé de rompre notre association. Vous rappelez-vous ce que je vous disais alors ? Je vous disais : Notre extrême besoin, notre dénuement ont pu justifier toutes nos entreprises, elles sont maintenant inexcusables.
– En effet, répondit le placeur, tu nous as fait part de tes scrupules.
– Ah !… vous voyez donc bien.
– Seulement ces scrupules ne t’ont jamais préoccupé au moment d’encaisser ta part, que tu es toujours venu toucher régulièrement.
– C’est-à-dire insista le docteur, que si tu répudiais les risques, tu acceptais fort bien les bénéfices. C’est-à-dire que tu voulais bien gagner au jeu, mais que tu prétendais ne point exposer d’argent.
L’argument, bien qu’il parût sans réplique, ne décontenança point Catenac.
– C’est vrai, reprit-il, j’ai toujours palpé mon tiers. Mais n’ai-je pas autant que vous contribué à mettre l’agence sur son pied actuel ? Ne va-t-elle pas toute seule maintenant, sans bruit, sans effort, comme une machine parfaite ? N’avons-nous pas réussi à donner à nos opérations comme un cachet commercial ? Tous les mois, sans se déranger, on peut palper de beaux bénéfices, et, incontestablement, j’ai droit à un tiers. Vous plaît-il de laisser les choses aller leur petit train ? Topez là, je suis votre homme.
– C’est fort heureux, en vérité !
– Mais voici que tout à coup vous prétendez m’embarquer dans des dangers incalculables, alors je vous crie : Halte-là !… je n’en suis plus. Je lis dans vos yeux que vous me trouvez absurde. Fasse Dieu que les événements ne vous montrent pas impitoyablement que j’ai raison. Songez-y ; voici plus de vingt ans que la chance est pour nous. Que faut-il pour qu’elle tourne ? Un rien. Croyez-moi, ne la tentez pas. La fortune, vous le savez, se venge tôt ou tard de ceux qui, au lieu de lui faire la cour et de l’épouser sagement, l’ont violentée.
– Oh !… grâce d’homélies, fit le docteur.
– Très bien !… je me tais. Mais encore une fois, pendant qu’il en est temps encore, réfléchissez. L’impunité n’a qu’un temps. Si prodigieuses que soient vos espérances, elles sont peu de chose en comparaison de ce que vous allez exposer.
Cette faconde à froid devait exaspérer le docteur Hortebize.
– Parler ainsi, t’est facile, dit-il, tu es riche, toi.
– J’ai de quoi vivre, en effet ; en dehors de ce que je gagne, j’ai deux cent mille francs à moi. Et s’il ne faut que les partager pour vous déterminer à renoncer à vos projets, dites un mot et c’est fait.
B. Mascarot, qui jusqu’alors avait laissé le débat s’agiter entre les deux associés, jugea qu’il était temps d’intervenir.
– Pauvre ami ! fit-il, as-tu vraiment deux cent mille francs ?
– Ou peu s’en faut.
– Et tu nous en offres un tiers !… Ah ! maître, c’est un beau trait, et nous serions des ingrats si nous n’étions pas profondément touchés ; seulement…
Il s’arrêta, tracassa ses lunettes, et d’un ton incisif ajouta :
– Seulement, quand tu nous auras donné à chacun cinquante mille francs, il t’en restera encore plus de onze cent mille.
Catenac eut un éclat de rire si franc, si juste d’intonation, qu’un observateur y eût été pris.
– Que ne dis-tu vrai !… fit-il.
– Et si je te prouvais que je dis vrai ?
– Je serais bien surpris.
Le digne placeur ouvrit un de ses tiroirs, en sortit un petit registre qu’il feuilleta et le présenta à son associé en disant :
– Regarde alors, car voici l’état exact de ta fortune à la fin du mois de décembre de l’année dernière. Depuis, tu as fait divers achats par l’intermédiaire de M. L… Je ne les ai pas portés en compte, mais j’en ai la note. Dois-je te la montrer ?…
Pour le coup, l’impassible visage de Catenac exprima quelque chose ! Il se redressa furieux. Ses yeux lançaient des éclairs.
– Eh bien ! oui ! s’écria-t-il, oui ! j’ai douze cent mille francs de fortune, et c’est pour cela que je ne veux plus d’association. Oui, j’ai soixante mille livres de rentes, c’est-à-dire soixante mille bonnes raisons pour ne pas me compromettre, et je ne me compromettrai pas. Ah !… vous êtes jaloux ! Est-ce donc ma faute si nos conditions sont devenues inégales ? N’étais-je pas comme vous sans un sou quand nous avons commencé ! Ma vie n’a pas été la vôtre, voilà tout. Vous dépensiez sans compter, moi j’économisais. Vous ne songiez qu’au présent, je pensais à l’avenir. Hortebize faisait tout pour chasser ses clients, je m’épuisais en effort pour attirer les miens. Et maintenant, parce que je suis riche et que vous n’avez rien, il me faudrait subir vos exigences !… Allons donc. Quand je touche au but de mon ambition, il me faudrait revenir en arrière avec vous ! Jamais. Suivez votre chemin, je suis le mien, je ne vous connais plus.
Il se levait déjà et prenait son chapeau ; un geste du placeur l’arrêta.
– Si je te disais, insistait Mascarot, que tu nous es utile, indispensable !…
– Je répondrais : Cela est fâcheux pour vous.
– Si cependant nous voulions bien…
– Quoi ?… Me contraindre ? Comment ? Vous me tenez, mais je vous tiens. Vous ne pouvez rien contre moi que je ne puisse contre vous. Essayer de me perdre serait vous perdre.
– Es-tu bien sûr de cela ?
– Si sûr, que je vous le répète encore : Entre vous et moi, il n’y a plus rien de commun.
– Je crois que tu te trompes, maître !…
– Moi ! pourquoi ?
– Parce que voici un an que je loge et nourris gratis à notre hôtel une jeune fille du nom de Clarisse. Ne la connaîtrais-tu pas, par hasard ?…
Ce n’est pas sans intentions habilement calculées que, depuis dix minutes, B. Mascarot laissait son ami Catenac se débattre, s’épuiser en efforts aussi inutiles que ceux du poisson engagé dans la nasse.
Il avait voulu ainsi pénétrer les intentions de cet honorable associé et connaître ses ressources.
S’il avait comme pris à tâche de l’irriter, s’il avait encouragé Hortebize à le fouetter de ses ironies, c’est qu’il savait combien peut être indiscrète la colère de l’homme le plus maître de soi.
Se jugeant suffisamment éclairé, d’un seul mot l’estimable placeur reprit sa supériorité.
À ce nom de Clarisse, l’avocat fut comme un promeneur qui, marchant en pleine sécurité, apercevait tout à coup à ses pieds la mèche allumée d’une mine prête à éclater.
Instinctivement il recula, les bras en avant, secoué par un spasme nerveux, la pupille dilatée par l’effroi.
– Clarisse !… balbutiait-il, qui t’a dit… comment as-tu pu savoir ?
Mais l’ironique sourire qu’il put surprendre sur les deux lèvres de ses deux associés cingla si cruellement son orgueil, qu’il reprit aussitôt les apparences du sang-froid.
– Décidément, fit-il, je deviens fou. Ne voilà-t-il pas que je leur demande comment ils s’y sont pris pour tout découvrir ! Ne dirait-on pas que j’ai oublié quels moyens nous employons pour surprendre les secrets de ridicule ou d’infamie que nous exploitons !…
– Je t’avais bien jugé, dit le placeur.
– En quoi ?
– J’avais prévu que le jour où tu te sentirais assez fort pour te passer de nous, tu tenterais de rompre les liens qui nous unissent. Aujourd’hui, tu voudrais nous abandonner. Tu nous trahirais demain si tu le pouvais sans danger. J’ai pris mes précautions.
Le bon docteur se frottait vigoureusement les mains.
– Voilà ce que c’est, disait-il, on ne s’avise jamais de tout.
– Ce que je ne conçois pas, poursuivit Mascarot, c’est que toi, Catenac, un homme fort, tu nous aies fait le jeu si beau. Comment, il y a un an de cela, tu nous haïssais, tu songeais à nous perdre, et tu nous offres cette prise. C’est à n’y pas croire.
– À n’y pas croire !… fit le docteur comme un écho.
– Et cependant, continuait le placeur, ton… comment dirai-je ? ton imprudence est des plus communes, de celles que nous avons le plus souvent observées et qui nous ont le plus rapporté. Pardieu !… Tous les jours cela se voit. Tu ne lis donc plus la Gazette des Tribunaux ?
Hier encore, j’y lisais une histoire qu’on jurerait être la tienne.
Un bourgeois ambitieux et hypocrite, frais verni d’honnêteté, fait venir de la campagne une jeune et jolie bonne, éclatante de santé, assez naïve, ayant les mains bien rouges…, et il se donne le délicat plaisir de la séduire.
Pendant quelques mois, tout va bien ; mais voici qu’un matin la pauvre fille ne peut plus cacher qu’elle est enceinte. Voilà le bourgeois épouvanté. Que diront les voisins et le portier ?
L’enfant est supprimé et la mère jetée sans pitié sur le chemin de Saint-Lazare. C’est simple…
– Baptistin, de grâce !…
– … Mais c’est fort imprudent. Ces choses-là se découvrent toujours. Si le crime a pour lui ses combinaisons et ses ruses, la justice a pour elle ces hasards que l’on dit invraisemblables, et qui se présentent à chaque minute de la vie. Tu as un jardinier à ta maison de Champigny ? Suppose que la fantaisie vienne à cet homme de creuser la terre autour de ce puits qui est au fond du jardin. Sais-tu ce qu’il trouverait ?
– Assez !… prononça Catenac, je me rends.
B. Mascarot, comme toujours au moment décisif, ajusta ses lunettes.
– Toi, dit-il, te rendre… Pas encore. En ce moment tu cherches à parer le coup que je te porte.
– Je t’assure…
– Épargne-toi cette peine. Ton jardinier ne trouverait rien.
L’avocat eut une exclamation de rage. Il commençait à comprendre dans quel horrible piège il était tombé.
– Il ne trouverait rien, reprit le placeur. Et pourtant il est bien vrai, n’est-ce pas, qu’au mois de janvier de l’année dernière, une nuit, tu as creusé là un trou et que dans ce trou tu as déposé le corps d’un enfant roulé dans un châle… Et quel châle !… celui-là même que toi, Catenac, pour hâter la défaite de la mère, tu étais allé acheter à Pygmalion ; les commis en témoigneraient, s’il le fallait. Maintenant, tu peux chercher, tu ne trouveras rien…
– Et c’est toi, c’est toi qui as enlevé…
– Non, interrompit le placeur du ton le plus ironique, c’est Tantaine. Que veux-tu ? je suis prudent. Je sais où est le cadavre, comme on dit vulgairement, et tu ne le sais pas. Mais sois tranquille, il n’est pas perdu. Il est en bon lieu. Une seule tentative de trahison, et le lendemain tu liras dans le Petit Journal, à l’article Paris : « Hier, des terrassiers qui travaillaient à tel endroit, ont découvert le cadavre d’un nouveau-né. Le commissaire de police, aussitôt prévenu, s’est transporté sur le terrain et a commencé une enquête… » Tu lirais cela, et tu me connais assez pour être persuadé d’avance que l’enquête aboutirait. Tu devines bien qu’au châle de cette pauvre Clarisse, j’ai ajouté assez d’indices pour qu’on puisse aisément remonter jusqu’au coupable… jusqu’à toi.
À la colère de Catenac avait succédé une affreuse prostration. Cet homme, que rien n’aurait dû surprendre ni étonner, était assommé et paraissait avoir perdu la faculté de réfléchir et de délibérer.
Son désespoir s’échappait en paroles incohérentes, et il laissait voir sa souffrance, comme s’il eût espéré toucher ses implacables associés.
– Vous m’assassinez, murmurait-il, vous me tuez au moment où j’allais recueillir le prix de vingt années de travaux et de privations.
– Travaux est joli ! observa le docteur.
Mais l’heure pressait ; d’un instant à l’autre, Paul et le marquis de Croisenois pouvaient arriver. B. Mascarot comprit combien il était important de remonter le moral de son associé.
– Voyons, reprit-il, tu cries comme si nous voulions t’égorger. À quoi bon ? Nous supposes-tu assez niais pour nous exposer sans des certitudes presque absolues de succès ? Hortebize, tout comme toi, s’est cabré quand je lui ai parlé de la grande opération. Je la lui ai expliquée, et maintenant il approuve.
– C’est exact, déclara Hortebize.
– Donc, reprit le placeur, tu n’as, pour ainsi dire, rien à craindre. Tu es, nous en sommes convaincus, trop beau joueur pour nous garder rancune…
Catenac eut un sourire forcé.
– Je ne vous en veux pas, répondit-il ; parle, j’obéirai.
B. Mascarot se recueillit un moment.
– Ce que j’attends de toi, répondit-il, ne peut te compromettre en rien. J’ai à te demander de nous dresser un acte de société dans des conditions que je dirai tout à l’heure. Tu t’occuperas ensuite de l’affaire, mais non ostensiblement.
– Bien !…
– Ce n’est pas tout. Tu as été chargé par le duc de Champdoce d’une mission très difficile, très délicate… Il s’agit de recherches qui doivent rester secrètes…
– Quoi !… tu sais cela aussi ?
– Je n’ignore rien de ce qui peut nous être utile. J’ai appris, par exemple, qu’au lieu de t’adresser à moi, tu es allé sottement trouver le seul homme que nous ayons à craindre, Perpignan, un gaillard presque aussi fort que nous, et bien autrement âpre.
– Enfin, qu’exiges-tu de ce côté ?
– Peu de chose. Tu me tiendras au courant de tes recherches. Tu ne diras jamais au duc un seul mot dont nous ne soyons convenus à l’avance.
– C’est entendu.
La querelle semblait terminée, le digne Hortebize était ravi.
– Là !… fit-il, était-ce la peine de crier comme un écorché.
– Soit, fit Catenac, j’ai eu tort.
Il tendit la main à ses deux amis et ajouta avec un pâle sourire :
– Que tout soit donc oublié !…
Était-il sincère ? Le rapide regard qu’échangèrent Mascarot et le docteur était gros de soupçons.
Mais depuis un moment déjà, on frappait à la porte ; le docteur alla ouvrir, et Paul parut, saluant affectueusement ses deux protecteurs.
– Avant tout, mon enfant, commença le placeur, je veux vous présenter à un de mes vieux amis.
Et se retournant vers Catenac, il ajouta :
– Mon cher maître, je te demande tes bontés pour mon jeune ami Paul, un brave garçon qui n’a ni père ni mère, et que nous pousserons dans le monde.
À ces mots, soulignés d’un étrange sourire, l’avocat bondit sur son fauteuil.
– Sacrebleu ! s’écria-t-il, que n’as-tu parlé plus tôt !
Confident du duc de Champdoce, Catenac venait d’entrevoir le plan de B. Mascarot.
XVII
Le marquis de Croisenois se fait toujours attendre. Chez lui, c’est un système qui dégénère en manie.
Peut-être croit-il ainsi affirmer son importance. Le calcul est faux. L’homme habile se soucie peu d’arriver en avance ou en retard, il ne se préoccupe que de paraître au moment précis où on le souhaite le plus.
Arriver à propos, tout est là. C’est le secret de bien des fortunes qu’on ne s’explique pas.
M. de Croisenois avait été convoqué par B. Mascarot pour onze heures. Il était plus de midi quand il se présenta, ganté de frais, le lorgnon à l’œil, agitant sa badine, grimé de cette débonnaireté impertinente et familière qu’affectent les imbéciles quand ils croient faire acte de condescendance.
À trente-cinq ans, Henri de Croisenois affiche les dehors évaporés d’un beau-fils de vingt ans. Cette légèreté insoucieuse est son armure de guerre, l’excuse toujours prête des folies les plus risquées.
On dit encore de lui, après des fredaines un peu fortes :
C’est un étourdi, un véritable lycéen, on ne saurait lui en vouloir, il est si bon enfant, il a un si excellent cœur !…
En lui-même, il doit bien rire de cette opinion du monde.
Calculateur féroce, cet aimable gentilhomme, qui de sa vie n’a eu un bon mouvement, s’est exercé à se défier de l’inspiration première.
Sous le masque de son laisser-aller, ce facile compagnon dissimule une remarquable âpreté. En matière de chicane, il en remontrerait à l’avoué le plus retors. Il a roulé et dupé jusqu’aux usuriers auxquels il a eu affaire.
S’il n’est ruiné, c’est qu’il s’est entêté à régler son train sur celui d’amis dix fois plus riches que lui. Toujours la même histoire.
Mêlé à ce groupe de viveurs brillants, dont le comte de Trémorel fut longtemps le parangon, et qui maintenant prend le mot d’ordre du fils aîné du duc de Sairmeuse, Croisenois a voulu, lui aussi, avoir son écurie de courses.
Entre tous les moyens de fondre une fortune, celui-là est le plus sûr et le plus expéditif.
Le léger marquis en sait quelque chose. Il avait abusé de tous les expédients et était à la veille de faire le plongeon, lorsque B. Mascarot lui tendit la main.
Il s’y cramponna désespérément, comme un homme qui se noie se raccrocherait à une barre de fer rouge.
Mais si les inquiétudes les plus aiguës le tenaillaient, son aplomb ne s’en ressentait nullement, et c’est du ton le plus aisé qu’après avoir salué les personnes présentes, il dit au placeur :
– Je vous ai peut-être fait un peu attendre, cher maître ; vrai, j’en suis désolé, j’avais des préoccupations… Mais me voici tout à vous, et s’il vous plaît que nous causions, j’attendrai volontiers que vous ayez terminé avec ces messieurs…
Sur quoi, son cigare qu’il avait gardé étant près de s’éteindre, il en tira deux ou trois bouffées.
La phrase était supérieurement impertinente, et cependant le digne Baptistin n’en fut pas offusqué. Non, il ne dit rien, lui qui abomine l’odeur du tabac.
Les forts ont de ces longanimités. On peut bien passer quelque chose à un fat, quand on sait qu’il dépend de soi de l’écraser sous l’ongle…
D’ailleurs, B. Mascarot avait besoin de Henri de Croisenois. Il était un des indispensables pions de sa partie.
– Nous commencions à désespérer de vous voir, répondit-il. Je dis nous, parce que ces messieurs sont ici pour vous, pour notre affaire…
Le marquis ne prit point la peine de dissimuler une petite moue contrariée.
– Ces messieurs, poursuivit le placeur, sont mes associés. Monsieur est le docteur Hortebize, monsieur est maître Catenac, du barreau de Paris, enfin monsieur – et il montrait Paul – est notre secrétaire.
Cette présentation avait une gravité comique.
Si M. de Croisenois était dépité de trouver quatre confidents au lieu d’un, Catenac était furieux de voir qu’on livrait l’association à un inconnu.
C’est chose subtile qu’un secret, plus volatile que l’éther, qui s’évapore, si hermétiquement clos que soit le flacon où on le verse.
Hortebize, en dépit de sa confiance aveugle, ne laissait pas que d’être surpris.
Quant à Paul, il n’avait ni assez d’yeux, ni assez d’oreilles.
Seul, le placeur conservait cet imperturbable sang-froid de l’homme qui, ayant un but, va droit vers ce but, comme le boulet que n’arrêtent ni ne font dévier les branchages ni les broussailles.
– Monsieur le marquis, commença-t-il, lorsque Croisenois fut assis, je ne vous laisserai pas une minute d’incertitude. Toute diplomatie serait puérile entre gens comme nous.
Ce pluriel parut si singulier à M. de Croisenois, que c’est avec une nuance très accusée de persiflage qu’il répondit :
– Vous me flattez, cher maître.
Plus attentif, le léger marquis eut remarqué le mouvement des lunettes de B. Mascarot, mouvement qui signifiait clairement :
– Vous me faites pitié !…
Hortebize prétendait que les lunettes de l’honorable placeur étaient « parlantes », et il avait raison.
C’est vainement que des fourbes illustres, redoutant la trahison du regard, dissimulent leurs yeux sous des verres épais. Les lunettes, à la longue, font comme partie de qui les porte : elles vivent, pour ainsi dire, elles tressaillent, elles finissent par avouer ce qu’avouerait l’œil qu’elles cachent.
– Je vous confesserai sans ambages, monsieur le marquis, reprit le placeur, que votre mariage est conclu si nous le voulons, mes associés et moi. Nous pouvons vous garantir le concours actif du comte et de la comtesse de Mussidan. Reste à obtenir le consentement de la jeune fille.
Croisenois eut un geste magnifique de suffisance.
– Oh ! je l’aurai, s’écria-t-il, je m’en charge. Chaque époque a ses moyens de séduction, j’ai étudié et pratiqué ceux de la nôtre. Je promettrai les plus beaux chevaux de Paris, une loge aux Italiens, un crédit illimité chez Van Klopen, une liberté absolue… Quelle jeune fille résisterait à de tels éblouissements. Oui, je réussirai… Ah ! à une condition, toutefois, c’est que je serai patronné par une personne jouissant d’une certaine influence dans la maison…
– Pensez-vous que la vicomtesse de Bois-d’Ardon, soit une marraine convenable ?
– Peste !… je le crois bien, une parente du comte !…
– Eh bien !… le jour où nous le voudrons, Mme de Bois-d’Ardon appuiera vos prétentions et chantera vos louanges.
Le marquis se dressa triomphant.
– En ce cas, s’écria-t-il d’un ton à faire coiffer sainte Catherine à toutes les héritières, en ce cas l’affaire est dans le sac.
Paul se demandait s’il était éveillé. Quoi !… on lui avait promis une femme riche, à lui, et voici qu’on mariait cet autre !
– Ces gens-ci, se dit-il, outre qu’ils placent les domestiques des deux sexes et autres, m’ont tout l’air de faire fonctionner, moyennant espèces, « la profession matrimoniale. »
Cependant le marquis interrogeait de l’œil B. Mascarot, hésitant à découvrir toute sa pensée.
– Oh !… parlez, encouragea le digne placeur, nous sommes entre nous.
– Reste donc, fit M. Croisenois, à fixer le… comment dirai-je ?… le courtage, le droit de commission…
– J’allais aborder la question.
– Eh bien !… mon cher maître, je n’ai qu’une parole. Je vous ai dit que je vous donnerais le quart de la dot. Le lendemain du mariage, je vous signerai des lettres de change pour le montant de ce quart.
Cette fois, Paul croyait comprendre tout à fait.
– Voici le grand mot lâché, pensa-t-il. Si j’épouse Flavie, j’aurai à partager la dot avec ces honnêtes messieurs. Je m’explique maintenant l’intérêt qu’ils me portent et leurs caresses.
Mais les offres du marquis n’avaient point paru satisfaire l’honorable placeur.
– Nous sommes loin de compte, prononça-t-il.
– Eh bien !… je consens à payer en dehors, et comptant, ce que je vous dois.
B. Mascarot hocha la tête, au grand désespoir de Croisenois, qui reprit :
– Vous voulez le tiers ?… Soit, j’en passerai par là.
Le placeur restait de glace.
– Ce n’est pas le tiers qu’il nous faut, déclara-t-il, ni même la moitié. La dot entière ne nous suffirait pas. Vous la garderez donc, ainsi que ce que je vous ai prêté… si nous nous arrangeons.
– Qu’exigez-vous ? Parlez… parlez.
Mascarot assura solidement ses lunettes.
– Je parlerai, répondit-il, mais avant il est absolument indispensable que je vous dise l’histoire de l’association dont je suis le chef.
Jusqu’à ce moment, Catenac et Hortebize avaient écouté sans se permettre seulement un geste, silencieux et graves comme des sénateurs romains sur leur chaise curule.
Ils pensaient assister à une de ces comédies auxquelles B. Mascarot les avait accoutumés, comédies dont les péripéties variaient, mais dont le dénouement était comme fatal.
À suivre ce débat, entre le marquis de Croisenois et le placeur, ils prenaient ce plaisir méchant qu’éprouvent certaines gens à voir un chat jouer avec une misérable souris avant de la dévorer.
Mais lorsque B. Mascarot annonça qu’il allait livrer leur dangereux secret, tous deux se dressèrent en même temps, furieux, épouvantés.
– Deviens-tu fou ?… s’écrièrent-ils ensemble.
B. Mascarot haussa les épaules.
– Pas encore, répondit-il d’un ton calme, et je vous prie de me laisser poursuivre.
– Sacrebleu !… cependant, essaya Catenac, nous avons voix au chapitre.
– Assez !… fit violemment le placeur, je suis le maître, n’est-ce pas ?
Et d’un ton d’amère ironie, il reprit :
– Est-ce qu’on ne peut pas tout dire devant monsieur ?
Le médecin et l’avocat avaient repris leur place. Croisenois pensa qu’il serait adroit et tout à fait conforme à ses intérêts de les rassurer.
– Entre honnêtes gens… commença-t-il.
– Nous ne sommes pas honnêtes, interrompit Mascarot.
Puis, pour répondre à l’air de stupeur profonde du marquis, il ajouta avec un accent écrasant et en le regardant bien :
– Ni vous non plus, d’ailleurs.
Cette brutale déclaration fit monter un flot de sang au front de Croisenois. Le code de la bonne compagnie n’interdit-il pas expressément de dire aux gens, en face, ce qu’on pense d’eux ?
Il avait bonne envie de se fâcher, mais c’était se brouiller, c’était laisser échapper la perche de salut. Il courba la tête sous l’insulte, décidé à la prendre en plaisanterie.
– Parbleu !… fit-il, le paradoxe est raide.
Mais l’honorable placeur ne daigna pas remarquer cette lâcheté, qui fit sourire le bon docteur Hortebize.
– Je vous serai obligé, monsieur le marquis, reprit-il, de m’écouter attentivement.
Il se retourna vers Paul et dit :
– Et vous aussi, mon cher enfant.
Il y eut un moment de silence presque solennel, pendant lequel on entendit le murmure des clients qui se pressaient autour de Beaumarchef dans la première pièce.
Si Hortebize et Catenac semblaient confondus, Croisenois était si stupéfait qu’il laissait éteindre son cigare, et Paul frémissait d’avance.
B. Mascarot, lui, paraissait transfiguré. Il n’avait plus rien du placeur bénin, le sentiment de son pouvoir le grandissait, ses lunettes lançaient des éclairs.
– Tels que vous nous voyez, monsieur le marquis, commença-t-il, mes respectables associés et moi, nous n’avons pas toujours été ce que nous sommes.
Il y a vingt-cinq ans, nous étions jeunes, nous étions honnêtes, toutes les illusions de l’adolescence nous souriaient encore, nous avions la foi qui soutient dans les épreuves, nous avions ce courage qui enflamme le soldat marchant à l’assaut d’une batterie.
Nous habitions tous trois un misérable hôtel garni de la rue de la Harpe, et nous nous aimions comme trois frères !…
– Comme c’est loin, ce temps !… murmura Hortebize, comme c’est loin !…
– Oui, c’est loin, continua le placeur, et cependant pour moi le temps n’a pas de brumes ; je nous revois tels que nous étions, et mon cœur se serre en comparant les espérances d’alors aux réalités d’aujourd’hui !…
Il me semble, mes amis, que tout cela est d’hier.
Nous étions pauvres, alors, monsieur le marquis, affreusement pauvres, et cependant le monde nous avait bercés de ses plus décevantes caresses. Les directeurs de toutes les serres chaudes consacrées à l’éclosion des talents encore en leur œuf, avaient murmuré aux oreilles de chacun de nous des paroles magiques : Tu réussiras, tu Marcellus eris…
Croisenois dissimula un sourire. L’histoire ne lui semblait pas palpitante.
– Tiens, fit-il ; vous savez le latin.
– Je l’ai su du moins. C’est que je dois vous le dire, chacun de nous semblait promis à une destinée brillante. Catenac, avocat de la veille, venait de recevoir un prix pour sa thèse De la transmission de la propriété ; Hortebize avait été couronné pour un travail sur l’Analyse des matières suspectes, travail reproduit presque en entier par l’illustre Orfila, dans son Traité des poisons. Moi-même, je venais de subir victorieusement les épreuves de la licence, de l’agrégation et du doctorat ès sciences et ès lettres…
Paul ouvrait des yeux énormes. Il ne s’était jamais demandé ce que deviennent les neuf dixièmes des élus des concours.
– Malheureusement, poursuivait le placeur, Hortebize était brouillé avec sa famille, la famille de Catenac était aux prises avec la misère, et moi je n’ai pas de famille… Nous mourrions de faim décemment.
Seul de nous trois, je gagnais un peu d’argent à préparer des élèves aux examens de Saint-Cyr et de l’École polytechnique.
Moyennant trente-cinq sous par jour, – la moitié d’un salaire du manœuvre, – je bourrais de géométrie et d’algèbre des fils de famille qui se moquaient de ma maigreur et de mes habits râpés.
Trente-cinq sous !… et là-dessus nous étions trois à prendre notre pain, et j’avais une maîtresse, aimée jusqu’au délire, qui se mourait de la poitrine !
Qui jamais eût cru cela de ce sphinx à lunettes vertes qui avait nom B. Mascarot !…
– J’abrège, reprit-il. Un jour vint où, entre nous trois, nous ne pûmes trouver un sou. Et Hortebize venait de m’avouer que, faute d’aliments substantiels, de viande, de vin, ma maîtresse allait mourir.
– Eh bien ! m’écriai-je, attendez-moi, mes amis, je saurai bien trouver de l’argent.
Sans savoir ce que j’allais faire, je m’élançai dehors. J’étais fou furieux, j’étais enragé. Je me demandais s’il fallait tendre la main pour quelques sous ou étrangler un passant pour lui prendre sa bourse. J’étais descendu jusqu’à la Seine, et j’allais le long des quais livrant au vent des exclamations incohérentes. Tout à coup, un éclair sillonna les ténèbres de mon désespoir.
Je me rappelais que nous étions au mercredi, jour de la sortie de l’École polytechnique, et je me dis qu’en me rendant au Palais-Royal, au café Lemblin, je trouverais infailliblement quelqu’un de mes anciens élèves, qui, peut-être, consentirait à me prêter cent sous…
Cent sous ! ce n’est guère, n’est-il pas vrai, monsieur le marquis ? Eh bien !… ce jour-là, cent sous représentaient pour moi la vie de mes amis et le salut de ma maîtresse. Avez-vous jamais eu faim, monsieur le marquis ?
Croisenois tressaillit. Non, il n’avait jamais souffert de la faim. Mais savait-il ce que l’avenir lui réservait, à lui dont les ressources étaient à ce point épuisées, qu’il pouvait demain, tomber du faîte de ses apparentes splendeurs sur le pavé, dans la boue.
– Quand j’arrivai au café Lemblin, poursuivit B. Mascarot, je n’y trouvais pas un seul élève de l’école. Le garçon auquel je m’adressai, me toisa d’abord dédaigneusement, mes vêtements tombaient en lambeaux. Mais lorsqu’il sut que j’étais un répétiteur, il daigna me répondre que ces messieurs étaient déjà venus et qu’ils ne tarderaient pas à revenir. Je déclarai que j’allais les attendre. Le garçon me demanda ce que je voulais prendre ; je répondis : rien, et je m’assis dans un coin.
Depuis ma sortie, j’avais eu comme un brasier dans le cerveau ; mais en ce moment, j’éprouvai un bien-être relatif. J’espérais. Parmi les noms que m’avait cités le garçon, il s’en trouvait deux de jeunes gens qui avaient été bons pour moi.
J’attendais depuis un quart d’heure environ, lorsque tout à coup entra dans le café un homme dont jamais, dussé-je vivre cent ans, je n’oublierai la figure.
Il était plus blanc que sa chemise. Ses traits étaient contractés et comme crispés. Il avait l’œil hagard et la bouche entrouverte, comme un agonisant qui râle.
Une douleur, horrible autant que la mienne, poignait cet homme ; je le compris.
Mais il était riche, lui, on le voyait bien.
Lorsqu’il se fut laissé tomber sur le divan, les garçons accoururent pour lui demander ce qu’il désirait prendre.
D’une voix rauque, si peu intelligible que les garçons durent le faire répéter deux fois, il demanda :
– Une bouteille d’eau-de-vie et de quoi écrire !
C’était bien une histoire réelle, que racontait B. Mascarot. La vérité seule a cette émotion profonde, ces notes poignantes qui font vibrer les entrailles.
Le placeur s’était interrompu, et aucun de ses auditeurs n’osait souffler mot.
L’excellent et souriant Hortebize lui-même était devenu sombre.
– La vue de cet homme, continua l’honorable placeur, me soulagea. Nous sommes ainsi faits que le malheur d’autrui est un adoucissement, une atténuation à notre malheur.
Il était évident pour moi que cet inconnu souffrait horriblement, et je me disais avec une sorte de satisfaction malsaine :
« Il n’y a donc pas que les misérables à maudire la vie ; les riches, eux aussi, ont donc leurs tortures ? »
Cependant les garçons s’étaient empressés d’obéir. Ils avaient apporté de l’eau-de-vie, du papier, de l’encre.
L’homme commença par se verser un grand verre, qu’il avala comme de l’eau. L’effet fut soudain et terrible. Il devint cramoisi, comme s’il allait avoir un coup de sang, et resta plus d’une minute privé de sentiment, anéanti.
Je l’observais avec une curiosité ardente. Une voix me criait que désormais un lien mystérieux existait entre cet inconnu et moi, qu’il serait pour quelque chose dans mon existence, et que son influence me serait fatale.
Si effrayante était cette voix, qu’un moment j’eus l’idée de sortir. Je résistai. La curiosité m’ardait.
L’inconnu cependant revenait à lui.
Il saisit sa plume, et rapidement traça quelques lignes sur une feuille du cahier de papier à lettres placé devant lui.
Elles ne le satisfirent pas, car brusquement il s’interrompit, tira de sa poche un briquet et brûla cette première épreuve.
Le courage lui manquait. Il se versa et but un second verre d’eau-de-vie.
Une nouvelle lettre ne le satisfit pas plus que la première, car il la chiffonna rageusement et la glissa dans le gousset de son gilet.
Il recommença pour la troisième fois, décidé sans doute à faire un brouillon, car je le voyais tour à tour réfléchir, écrire, raturer.
Pour moi, il était clair qu’il n’avait conscience ni de soi ni du lieu où il se trouvait. Il gesticulait, laissait échapper des exclamations sourdes comme s’il eût été chez lui, seul dans son cabinet, à l’abri des indiscrets.
Ayant relu une troisième fois son brouillon, il en parut content. Il le recopia, ce qui fut l’affaire d’une minute, et ensuite le déchira en menus morceaux qu’il jeta sous la table.
Sa lettre soigneusement fermée, il appela le garçon :
– Prenez ces vingt francs, lui dit-il, et portez vous-même cette lettre à son adresse. Vous viendrez me rendre réponse, – car il y aura une réponse, – chez moi. Voici ma carte, allez, hâtez-vous…
Le garçon sortit en courant, et presque sur ses pas le monsieur se retira après avoir payé sa consommation.
Quel drame venait de se jouer là, devant moi ? Je devinais quelqu’une de ces ténébreuses intrigues qui s’agitent dans l’ombre de la vie privée. Cet homme pouvait être un mari trompé, un joueur ruiné, un père dont le fils venait de déshonorer le nom.
J’essayais de penser à autre chose ; je ne pouvais.
Ces petits fragments de papier, jetés sous le divan par l’imprudent, me fascinaient. Je brûlais de les ramasser, de les assembler, de savoir…
Mais je vous l’ai dit, j’étais honnête, et une telle action révoltait tous mes instincts.
J’aurais triomphé de la tentation, je le crois, sans une de ces circonstances futiles qui décident de l’existence entière.
On ouvrit une porte, un courant d’air s’établit, et le vent fit tournoyer et chassa jusqu’à mes pieds, un fragment du brouillon.
J’eus comme un éblouissement. J’étais vaincu. Je ramassai l’étroit morceau de papier et j’épelais ces quatre mots :
… me brûle la cervelle…
Je ne m’étais donc pas trompé. J’étais en présence d’une affreuse énigme, et il ne tenait qu’à moi d’en avoir le mot.
Ayant cédé une première fois à une détestable obsession, j’avais le bras pris dans l’engrenage, j’étais perdu. Je ne discutais plus.
Les garçons allaient et venaient, nul ne faisait attention à moi, je me rapprochai insensiblement de la place qu’occupait l’inconnu, et je ramassai deux nouveaux fragments. Sur le premier, je lus :
… la honte et l’horreur…
Et sur le second :
Ce soir, cent mille francs…
J’étais fixé. J’avais voulu surprendre un secret, je le tenais. Ces trois bouts de phrase étaient pour moi plus clairs que le jour.
Dès lors, à quoi bon poursuivre ? Je poursuivis cependant. Je réussis à réunir tous les fragments, je les assemblai et je lus ce billet affreusement laconique :
« Charles,
« Il me faut ce soir même cent mille francs et à toi seul je puis les demander sans ébruiter la honte de ma situation.
« Peux-tu réunir cette somme en deux heures ?
« Selon que ta réponse sera : oui, ou non, je suis sauvé ou je me brûle la cervelle. »
Vous vous étonnerez peut-être de la précision de ma mémoire, monsieur le marquis. Vous devez pourtant le savoir : il est des choses qu’on ne peut oublier.
En ce moment encore, je revois ce brouillon, et je pourrais vous en dire les virgules et les ratures.
Mais je passe.
Au-dessous de ces neuf lignes était la signature d’un grand industriel, très connu, presque célèbre, et qui, tout en était le plus estimable des hommes, traversait une de ces crises où un commerçant peut laisser à la fois sa fortune, son honneur et sa vie.
B. Mascarot s’interrompit un moment, succombant sous le poids de ses souvenirs ; mais il ne vint à l’esprit d’aucun de ses auditeurs de risquer seulement une observation.
Le brillant Croisenois avait jeté son cigare.
– Je puis vous le dire, reprit le placeur, ma découverte m’atterra. J’oubliai mes anxiétés pour ne songer qu’aux siennes. N’éprouvions-nous pas les mêmes angoisses, lui, pour cent mille francs, moi, pour cent sous !…
Mais déjà, au milieu des ténèbres de mon malheur, une idée infernale commençait à poindre.
Ne pouvais-je tirer parti de ce secret volé ?
Ce fut une inspiration. Je me levai et j’allait demander au comptoir des pains à cacheter et un almanach de Paris.
Revenu à ma place, je collai rapidement les fragments sur une seconde feuille de papier, je pris l’adresse du négociant et je sortis.
Cet homme malheureux habitait rue de la Chaussée-d’Antin.
Pendant plus d’une demi-heure, je me promenai devant la superbe maison qu’il habitait.
Vivait-il encore ? Cet ami, ce Charles, avait-il répondu : oui ?
Enfin, je me décidai à entrer.
Un domestique en livrée me répondit brutalement que son maître ne me recevrait pas, que d’ailleurs, en ce moment, il dînait avec sa famille.
L’insolence de ce valet me révolta.
– Eh bien !… m’écriai-je, si vous voulez éviter de grands malheurs, allez dire à votre maître qu’un pauvre diable lui rapporte le brouillon de la lettre qu’il vient d’écrire au café Lemblin.
L’indignation m’avait donné un accent si impérieux que le domestique n’hésita pas.
L’effet de cette annonce dut être terrible, car le valet reparut presque aussitôt tout effaré, et me dit :
– Vite !… arrivez… monsieur vous attend.
Il m’introduisait en même temps, ou plutôt me poussait dans un vaste cabinet magnifiquement décoré.
Au milieu, le négociant se tenait debout, pâle, menaçant.
Moi, j’étais dans un état à faire pitié. J’étouffais.
– Vous avez ramassé le brouillon que j’avais déchiré ? me demanda cet honnête homme.
De la tête je fis signe que oui, et en même temps je montrais les fragments assemblés et appliqués sur une seconde feuille de papier.
– Combien voulez-vous de cette lettre ? fit-il. Je vous offre mille francs.
Je vous le jure, messieurs, je n’étais pas venu pour vendre ce secret. J’étais venu pour dire à cet homme : Un autre que moi pouvait trouver cet écrit et en abuser ; moi, je vous le rapporte ; c’est un service que je vous rends ; à votre tour, soyez-moi utile, prêtez-moi cinquante, cent francs…
Oui, voilà ce que je voulais dire ; mais voyant comme il me traitait, moi, je fus saisi d’un mouvement de rage, et je répondis :
– Je veux deux mille francs !…
Il ouvrit son tiroir, arracha à une liasse énorme deux billets de banque, les froissa et me les lança à la figure en disant :
– Tiens, misérable, paye-toi !
C’est avec une violence inouïe que B. Mascarot s’exprimait.
Qui donc jamais eût supposé que cet homme, figé d’ordinaire dans une glaciale apathie, pût se montrer à cet état d’exaltation !
Sa voix, onctueuse habituellement et toute de miel, avait l’éclat strident d’un instrument de cuivre.
Ce n’était plus une histoire qu’il contait.
Plaidait-il les circonstances atténuantes d’une cause perdue, la sienne ? Tentait-il cette tâche impossible de se disculper aux yeux de ses associés ? Essayait-il de s’excuser, sinon de se réhabiliter, devant le tribunal de sa conscience ?
Paul et Croisenois tremblaient autant que si on leur eût mis à la main un poignard pour un assassinat.
– Ce que je ressentis, continua le placeur, sur le coup de cette injure abominable et imméritée, je ne saurais vous le dire. Il y eut en moi un déchirement aussi affreux que si on m’eût arraché les entrailles.
Certainement, je perdis la libre disposition de moi-même. En bonne conscience, devant Dieu, je n’aurais pas été responsable d’un crime commis là, en cet instant.
Et je fus sur le point d’en commettre un.
Jamais l’homme dont je vous parle ne verra la mort d’aussi près qu’une seule fois. Sur son bureau était un de ces redoutables couteaux catalans dont on se sert en guise de coupe-papier ; je m’en saisis, j’allais frapper…
La pensée de ma maîtresse qui se mourait faute d’aliments arrêta mon bras…
Je jetai violemment le couteau à terre, et je sortis éperdu, la tête en feu.
J’étais entré dans cette maison maudite le front haut, fier de ma misère et de mon honnêteté, j’en sortais déshonoré.
Certes, à l’exception de Paul, tous les hommes qui étaient là connaissaient les envers de la vie. Leur esprit s’était sali à toutes les boues de la civilisation, les angoisses du mal avaient émoussé et usé leur sensibilité. Et cependant ils ne pouvaient s’empêcher de frissonner.
– Mais continuons, reprit le placeur. Une fois dans la rue, ces deux billets de banque que j’avais ramassés et que je serrais convulsivement me causèrent une épouvantable sensation de douleur. Il me semblait qu’à les toucher la chair de ma main se crevassait comme au contact d’un fer rouge. J’entrai, je me précipitai, plutôt, chez un changeur, qui dut me prendre pour un fou ou pour un assassin. Comment ne me fit-il pas arrêter ? Je ne sais. Peut-être eût-il peur. En échange de mes deux billets, il me remit, non de l’or – en 1843 l’or était rare et se vendait, – mais deux pesants sacs de mille francs, en pièces d’argent. C’est chargé de ce fardeau que je regagnai notre misérable logement de la rue de la Harpe. Hortebize et Catenac m’attendaient avec une impatience, avec une inquiétude plutôt, inexprimable. Vous en souvient-il, mes amis ?… Vous saviez si bien que nous étions à bout de ressources, vous m’aviez vu sortir si désespéré, moi, dont le courage, jusqu’alors, avait soutenu le vôtre, vous me sentiez si convaincu de la mort prochaine d’une femme tendrement aimée, que sans vous communiquer vos affreux pressentiments, vous vous demandiez si, en traversant les ponts, j’aurais le courage de résister aux provocations du suicide, à la tentation d’en finir avec une existence devenue intolérable… Car voilà où nous en étions, marquis. En me voyant entrer, mes amis voulurent me sauter au cou, mais brutalement je les repoussai. « Arrière !… m’écriai-je, arrière ! je ne suis plus digne de vous, mais nous ne manquerons plus de rien !… » Sur ces mots, je jetai violemment les sacs à terre ; l’un d’eux se rompit, et les pièces d’argent s’éparpillèrent et roulèrent de tous côtés. À ce bruit, ma maîtresse, qui râlait presque sur son grabat, se dressa comme un fantôme. « De l’argent ! murmurait-elle, beaucoup d’argent !… Nous allons donc manger à notre faim !… Je suis sauvée… »
Mes amis, marquis, n’étaient pas ce qu’ils sont aujourd’hui. Ils s’éloignèrent de moi avec une horreur qu’ils ne pouvaient dissimuler, ils croyaient à un crime. « Non, leur dis-je, non, il n’y a pas de crime, puisque la loi ne saurait m’atteindre. Si cet argent est le prix de notre honneur, personne ne s’en doutera. »
Nous ne dormîmes pas cette nuit-là, marquis.
Mais lorsque le jour vint nous surprendre autour d’une table chargée de bouteilles, nous avions, nous, les vaincus de la vie, déclaré la guerre à la société, nous avions juré que, par tous les moyens, nous arriverions à la fortune ; le plan de notre redoutable association était arrêté.
XVIII
Décidé à laisser Paul et Croisenois sous une impression forte, B. Mascarot se leva et se mit à arpenter de long en large son cabinet.
S’il avait surtout l’intention de produire un prodigieux effet, il pouvait se féliciter, le résultat devait dépasser son attente.
Paul chancelait sur sa chaise comme s’il eût reçu sur la tête un coup de massue.
Croisenois, lui, luttait. Mais c’est vainement qu’il cherchait quelqu’une de ces plaisanteries qui atteste la liberté d’esprit de l’homme fort ; sa mémoire, à défaut de son imagination, ne lui fournissait pas un trait présentable.
Il comprenait fort bien qu’entre ce récit et son affaire un rapport intime existait ; mais lequel ? Il ne l’entrevoyait pas.
Quant à Hortebize et à Catenac, qui croyaient, eux, connaître à fond leur Baptistin, ils échangeaient des regards surpris et inquiets.
Ils se demandaient :
– Est-il de bonne foi ou bien joue-t-il une comédie dont le but nous échappe ?
Avec B. Mascarot, savoir au juste à quoi s’en tenir est difficile, pour ne pas dire impossible.
Lui, cependant, paraissait se soucier infiniment peu des impressions de ses auditeurs. Il était revenu prendre sa place devant son bureau.
Son visage, enflammé le moment d’avant de tous les feux de la colère et de la haine, avait recouvré sa placidité accoutumée, et c’est de son geste habituel qu’il rajustait ses lunettes.
– J’espère, monsieur le marquis, reprit-il, que vous excuserez cette longue, mais indispensable préface.
Cette introduction est, comme qui dirait le côté romanesque. Écoutez maintenant la partie réelle… et pratique.
Sachant tout ce que l’attitude imprime d’autorité à la parole, B. Mascarot se leva de nouveau et vint s’adosser à la tablette de la cheminée.
Ses lunettes, il est vrai, cachaient ses yeux ; mais il se dégageait de toute sa personne comme un fluide magnétique, émanation subtile de son énergique volonté, qui commandait, qui imposait l’attention.
– En cette nuit dont je vous parle, monsieur le marquis, reprit-il, nous avons, mes amis et moi, rompu violemment les liens de la morale et de l’honneur, nous avons secoué toutes les tyrannies du devoir. Et le plan qui était sorti entier et complet de mon cerveau, je puis vous le développer en me servant des expressions que j’employais il y a vingt ans pour l’exposer à mes amis.
Vous devez le savoir, marquis, lorsque l’été s’avance il n’est plus une cerise qui ne renferme un ver. Les plus belles, les plus rouges, les plus fraîches en apparence, sont celles dont l’intérieur, si on les ouvre, est le plus infecté.
De même, dans une société raffinée comme la nôtre, il n’est pas de famille, – je dis pas une, entendez-moi bien, – qui ne cache en son sein quelque plaie secrète, quelque mystère de douleur, de ridicule ou de honte.
Maintenant, supposez un homme connaissant le secret de tous les autres.
Celui-là ne sera-t-il pas le maître du monde ? Ne sera-t-il pas plus puissant que le plus puissant monarque ? Ne disposera-t-il pas, selon son caprice et sans contrôle possible, de tout et de tous ?
Eh bien !… je m’étais dit que je serais cet homme…
Depuis des mois qu’il était en relations avec l’honorable placeur, le marquis de Croisenois n’avait pas été sans soupçonner son genre d’opérations.
– Mais c’est la théorie du chantage que vous me prêchez ! fit-il.
B. Mascarot s’inclina ironiquement.
– Tout juste ! répondit-il. Oui, marquis, c’est bien là ce qu’on appelle le chantage.
Relativement le mot est nouveau, mais la spéculation est vieille comme le monde, probablement. Le jour où un homme, surprenant l’action infâme d’un autre homme, le menaça de la divulguer s’il ne subissait pas certaines exigences, le chantage était inventé.
Si tout ce qui est vieux est respectable, le « chantage » l’est à coup sûr.
Comment vivait, s’il vous plaît, le « divin Arétin, » ce poète obscène qui s’intitulait si fièrement « le fléau des princes ? » Il faisait chanter des rois. Et quels rois !… François Ier et Charles Quint. Mais tout se démocratise, marquis, et nous autres, nous nous contentons de faire chanter le peuple, j’entends tous ceux qui ont de l’argent…
L’aveu était si affreusement cynique, qu’une légère rougeur colora les joues de Croisenois.
– Oh ! monsieur, protesta-t-il, monsieur…
– Bah !… s’écria le digne placeur, êtes-vous pudibond à ce point que le mot propre vous épouvante ! Qui donc en sa vie n’a pas fait un peu de chantage ? Et tenez, vous-même… vous souvient-il qu’une nuit de cet hiver, à votre club, vous avez surpris, trichant au jeu, les mains pleines de cartes préparées, un jeune étranger fort riche ? Que lui avez-vous dit sur le moment ? Rien. Seulement, le lendemain vous êtes allé lui emprunter dix mille francs. Quand les lui rendrez-vous ?
Pour le coup Croisenois faillit tomber à la renverse.
– Prodigieux !… balbutia-t-il, effrayant !
Mais déjà B. Mascarot poursuivait :
– Je connais, moi, à Paris, deux mille individus qui vivent bien et qui n’ont d’autres moyens d’existence que le chantage. Je les ai tous étudiés, oui, tous, depuis l’ignoble forçat qui extorque de l’argent à son ancien compagnon de chaîne, jusqu’au gredin à dog-cart qui, parce que le hasard l’a fait le confident des faiblesses d’une pauvre femme, force cette femme à lui donner sa fille en mariage…
Si jamais, près de vous, sur le boulevard, le prince de S… venait à croiser J…, ce boursier si taré que je ne voudrais pas le saluer, regardez, vous verrez le prince, qui est bien le plus fier grand seigneur que je sache, serrer affectueusement la main du misérable. Pourquoi ? Je n’ai pu le découvrir, et cependant je flaire là un secret de cent mille francs.
J’ai connu, dans les environs de la rue de Douai, un commissionnaire qui, en cinq ans, a amassé une jolie fortune. Devinez comment ? Quand on lui remettait une lettre, il commençait par la décacheter et la lire. Si elle contenait une seule ligne compromettante, il ne la portait pas et revenait vite la vendre à qui l’avait écrite.
Il n’est pas une affaire industrielle importante qui n’ait ses parasites, gens adroits qui ont découvert quelque ressort suspect et qui font payer leur silence.
Je sais une grande et honnête société qui, pour avoir violé une fois ses statuts, est condamnée à servir une pension de vingt-cinq mille francs à un gredin tout chamarré de croix étrangères qui a su soustraire des preuves.
Tout cela, il est vrai, se négocie mystérieusement, avec mille précautions. En matière de « chantage, » les tribunaux français ne plaisantent pas et la police est alerte…
B. Mascarot s’était sans doute donné la tâche de faire parcourir à ses auditeurs la gamme entière des émotions.
À ces mots de « tribunaux » et de « police » ainsi jetés après des aveux extraordinaires, ils furent secoués par le frisson de la peur.
Lui les regardait d’un air de défi.
– Sur ce terrain, poursuivit-il, les Anglais sont nos maîtres.
À Londres, un secret honteux se négocie aussi facilement qu’une lettre de change. Il y a, dans la Cité, un bijoutier bien connu qui, sur la simple consignation d’une lettre dangereuse, signée d’un nom « respectable », avance des fonds. Sa boutique est comme le Mont-de-Piété de l’infamie.
Les « maîtres chanteurs » de Londres ont, en diverses fois, tiré du noble lord Palmerston, cinquante mille livres sterling, au bas mot, plus d’un million. Le vieux Pam avait le défaut d’aimer plus que de raison la femme de son prochain et le tort de craindre affreusement le scandale.
En Amérique, c’est mieux encore. Le « chantage », élevé à la hauteur d’une institution, a pignon sur rue, tient boutique et paie patente. Le citoyen de New-York qui médite un mauvais coup s’inquiète des trafiquants de secrets bien plus que de la police…
Depuis longtemps déjà, Hortebize, Catenac surtout, donnaient les signes les plus manifestes d’une sérieuse impatience.
C’était un réquisitoire en règle qu’ils subissaient.
Mais ni leurs regards, ni les signes du docteur qui montrait Paul près de se trouver mal, ne troublèrent l’imperturbable placeur.
– Nos commencements furent rudes, monsieur le marquis, poursuivit-il ; nous semions, alors, et vous arrivez lorsqu’il n’est plus question que de moissonner. Heureusement, les études de Catenac et de mon cher Hortebize étaient comme choisies en vue de nos opérations. L’un était avocat, l’autre médecin. Ils soignaient l’un les plaies du corps, l’autre les plaies de la bourse. Vous comprenez tout ce qu’a dû leur révéler l’exercice bien entendu de leur profession. Quant à moi, chef de l’association, je ne pouvais ni ne voulais rester les bras croisés. Mais que faire ? Pendant une longue semaine je flottai indécis entre bien des partis divers, et il fallait se hâter, notre mise de fonds diminuait. Enfin, après bien des réflexions, je vins louer cet appartement où nous sommes, et je fondai mon agence de placement. Un placeur n’inquiète personne… Du reste, les calculs qui déterminèrent mon choix étaient justes. Le résultat l’a prouvé, mes associés sont là pour vous l’affirmer.
Catenac et Hortebize inclinèrent la tête en signe d’assentiment.
– À notre époque, continua le placeur, et nos mœurs admises, on doit reconnaître que la domesticité, dans les grandes villes surtout, est comme un filet immense, à mailles fortes et serrées, sous lequel se débattent les classes aisées.
Rechercher les « pourquoi » et les « comment » serait trop long.
Ce qui est clair et positif, c’est que le riche, en son hôtel, au milieu de ses gens, est plus strictement surveillé que le prévenu au fond de son cachot, entouré d’invisibles espions.
Rien de ce que fait l’homme riche n’échappe à une curiosité qu’attise l’intérêt toujours en éveil. Qu’il parle ou se taise, qu’il soit irrité ou satisfait, triste ou gai, on l’observe.
Paroles, gestes, regards, mouvements imperceptibles de la physionomie, tout est recueilli, examiné, commenté, analysé.
Cacher huit jours, non une de ses actions, mais une de ses pensées lui est impossible.
Du secret que la nuit, les portes closes, il confie à sa femme, sur le traversin, de bouche à oreille, toujours il s’évapore quelque chose…
M. de Croisenois qui, faute de pouvoir faire autrement, avait pris bravement le parti de se résigner, daigna sourire.
– Connu !… murmura-t-il, connu !…
– En effet, monsieur le marquis, vous devez avoir médité ces vérités, vous qui ne m’avez jamais laissé vous choisir un valet de chambre.
– Oh ! j’ai la main si heureuse !
– Je le sais. Vous trouvez des serviteurs uniques, impayables, qui refusent les louis qu’on leur offre. En suis-je moins exactement informé de vos actions ? Non. En revanche, vous avez près de vous, est-ce bien prudent ? un homme que vous ne connaissez pas…
– Oh !… Morel m’a été recommandé par un de mes amis, sir Waterfield…
– Possible !… Ce qui n’empêche qu’il m’inquiète, ce gaillard à allures raides… Nous y reviendrons… Pour en finir, je vous dirai qu’ayant reconnu et calculé la puissance énorme dont disposent les domestiques, je conçus le projet de m’approprier cette puissance sans emploi, de l’emmagasiner, pour ainsi dire, comme de la vapeur, et enfin de l’utiliser à notre profit après l’avoir réglée. Et cela, je l’ai fait. Ce bureau, qui n’a l’air de rien, est comme le centre d’une toile d’araignée qui a coûté vingt ans d’efforts et de patience, mais qui enveloppe Paris.
Je suis ici, les pieds devant le feu, mais j’ai partout des yeux écarquillés et des oreilles largement ouvertes, qui voient et entendent pour moi.
La police dépense des millions pour entretenir ses agents. J’ai, moi, sans bourse délier, une armée d’agents incorruptibles et dévoués.
Je reçois, en moyenne, tous les jours, cinquante domestiques des deux sexes. Comptez ce que cela fait au bout de l’année.
Et pendant que les espions de la police en sont réduits à rôder furtivement autour des maisons qu’ils observent, les miens sont au cœur de la place, ils y vivent, ils sont mêlés aux intérêts, aux passions, aux intrigues qui s’agitent. Et ce n’est pas tout. Par les employés que je place, caissiers ou teneurs de livres, j’ai un pied dans le commerce. Par mes garçons de restaurant, j’ai la clé des cabinets particuliers les plus mystérieux.
C’est avec l’accent de l’orgueil satisfait que B. Mascarot expliquait les rouages de sa redoutable machine. Ses lunettes étincelaient.
– Et ne croyez pas, reprit-il, que tous ces gens sont dans le secret. Non, Dieu merci !… Ils ne savent, pour la plupart, ce qu’ils font, et là est ma force. Chacun d’eux m’apporte incessamment son brin de fil, et c’est moi qui en fais la corde qui attache mes esclaves. Ils viennent ici, ils causent, ils sont indiscrets et médisants, voilà tout. Nous sommes ici trois qui passons notre vie à écouter.
Puis, le soir, nous passons au crible tout ce qui nous a été dit, et toujours, parmi les bavardages, surnage quelque renseignement que j’utilise.
Tous ces gens qui me servent sans s’en douter, je ne puis les comparer qu’à ces oiseaux singuliers des solitudes du Brésil, dont la présence annonce infailliblement une source souterraine. À l’endroit précis où l’un d’eux a chanté, le voyageur mourant de soif peut creuser, il trouvera de l’eau. Mes oiseaux à moi me révèlent simplement l’existence d’un secret. Creuser est ensuite mon affaire. Je mets en campagne mes agents spéciaux, je cherche et je trouve… Voilà, monsieur le marquis, ce qu’est au juste notre association.
– Et par certaines années, insista le docteur Hortebize, elle a rapporté plus de deux cent cinquante mille francs.
Si M. de Croisenois détestait les longs discours, il était fort sensible à l’éloquence des chiffres.
Il connaissait trop la vie de Paris pour ne pas comprendre qu’à jeter ainsi quotidiennement son filet en eau trouble, B. Mascarot devait prendre beaucoup de poisson, – c’est à dire considérablement d’argent.
De là à s’unir plus étroitement à des hommes de tant d’expédients, la pente était naturelle.
Il arbora donc sa plus aimable physionomie, pour demander d’un ton de douce raillerie :
– Enfin, par quels services mériterai-je la protection de la société ?
B. Mascarot était bien trop fin pour ne pas apercevoir immédiatement la nuance. Ses explications n’eussent-elles obtenu que cette indispensable bonne volonté, elles étaient justifiées.
Mais elles avaient un autre résultat encore, vivement souhaité par l’estimable placeur.
Paul glacé d’effroi au début, s’était visiblement rassuré. Il reprenait confiance en mesurant la puissance de ces hommes, qui se chargeaient de son avenir. Il oubliait l’infamie de la spéculation pour en admirer les combinaisons ingénieuses.
– Monsieur le marquis, reprit B. Mascarot, j’arrive au fait : Si jusqu’ici nous n’avons pas eu de désagréments, c’est que tout en semblant être d’une témérité inouïe, nous avons été très prudents. Nous avons usé des armes que nous savions conquérir ; nous n’en avons pas abusé. C’est d’une main discrète que nous tondons nos… comment dirai-je ? nos tributaires. Nous n’en avons jamais écorché un seul. Jamais nous n’avons tourmenté un insolvable, et nous faisons crédit à ceux qui sont gênés. C’est ainsi. Je vends des secrets « à tempérament, » comme certains tapissiers vendent des meubles aux lorettes. D’ailleurs, comptez que nous n’avons pas toujours exigé de l’argent. Catenac a trouvé moyen de caser très bien toute sa famille qui est fort nombreuse. Hortebize a recueilli une foule de petits bonheurs qui sont comme les menus suffrages de notre… profession. Enfin, moi-même, j’ai souvent recherché des satisfactions d’amour-propre. Nul n’est parfait.
Cependant, monsieur le marquis, si lucrative que soit une profession, on finit toujours par s’en dégoûter. Voici vingt-cinq ans que nous exerçons, mes amis et moi, nous vieillissons, nous avons besoin de repos. Donc, nous sommes décidés à nous retirer. Mais, avant, nous voulons liquider, écouler avantageusement, s’il se peut, notre fonds de boutique.
– Ce n’est que juste, approuva Croisenois.
– J’ai entre les mains, continua l’honorable placeur, une masse énorme de documents. Mais ils sont d’une nature particulière, et en tirer parti n’était pas précisément facile. J’ai compté sur vous pour faire entrer les sommes considérables qu’ils représentent…
À cette déclaration, Croisenois devint d’une pâleur livide.
Quoi !… il irait, lui, plus vil que l’assassin des grandes routes, lequel a du moins l’excuse du péril bravé, il irait armé de papiers compromettants, demander aux gens : La bourse ou l’honneur ?
Il consentait bien à partager les profits d’un trafic ignoble ; il ne pouvait supporter l’idée de mettre, comme on dit vulgairement, la main à la pâte.
– Jamais !… s’écria-t-il, jamais !… Ne comptez pas sur moi !…
L’indignation du marquis semblait si sincère, sa détermination paraissait si irrévocablement arrêtée que le docteur Hortebize et maître Catenac se regardèrent, un peu inquiets de la tournure que prenait la conférence.
Le coup d’œil qu’ils adressèrent à B. Mascarot les rassura.
Il haussait les épaules et rajustait tranquillement ses lunettes.
– Ça, dit-il, assez d’enfantillage, monsieur, vous ne m’avez fait perdre que trop de paroles. Attendez avant de vous récrier. Je vous ai dit que mes documents sont d’une nature spéciale, voici pourquoi : La grande difficulté de notre genre d’affaires, est que souvent nous nous heurtons à des gens mariés qui, bien que forts riches, n’ont pas la libre disposition de leur fortune. Les maris disent : « Détourner dix mille francs de la fortune sans que ma femme le sache, est impossible ! » Les femmes répondent : « Je ne puis avoir d’argent qu’en en demandant à mon mari. » Et ces gens sont sincères. Combien en ai-je vu qui, désespérés de savoir entre mes mains un secret important, se jetaient à mes genoux et me criaient : Grâce !… je ferai tout ce que vous voudrez ; vous aurez plus que vous ne demandez, trouvez seulement un prétexte… Le prétexte à fournir à tous ces actionnaires de bonne volonté, je l’ai cherché et trouvé. Ce prétexte sera la société industrielle que vous lancerez avant un mois.
– D’honneur !… commença le marquis, je ne vois pas…
– Pardon !… vous voyez très bien. Tel mari qui n’aurait pu nous donner cinq mille francs sans mettre le feu à son ménage, nous en versera gaiement dix mille, parce qu’il pourra dire à sa femme : « C’est un placement. » Telle femme qui n’a pas dix sous vaillant saura bien déterminer son mari à nous apporter la somme que nous lui fixerons.
– Que dites-vous de cette idée ?
– Elle est excellente, mais en quoi vous suis-je indispensable ?
– En ce sens qu’à la tête d’une compagnie il faut un homme.
– Mais vous…
– Plaisantez-vous, marquis ? Me voyez-vous, moi, placeur, lancer une affaire ? On me rirait au nez. Hortebize, un médecin, et homéopathe encore, ne recueillerait que des quolibets. Quant à Catenac, sa situation lui interdit toute spéculation ; il se contentera d’être notre conseil. Or, pour que le prétexte soit bon, il faut que la société paraisse bien sérieuse.
M. de Croisenois était cruellement embarrassé.
– C’est que vraiment, reprit-il, je ne me reconnais aucune des qualités qu’on exige d’un financier, d’un spéculateur.
– Vous êtes trop modeste. D’abord, vous avez votre titre et votre nom.
– Oh ! un nom…, un titre !
– Cela ne signifie rien, je le sais, mais cela manque rarement son effet. N’y a-t-il pas des compagnies qui payent, et très cher, les noms et les titres qu’elles gravent en tête de leurs prospectus, tout comme les tables d’hôte entretiennent des majors constellés de décorations qui président le repas…
– Ma situation, financièrement parlant, est impossible.
– Elle est excellente, au contraire. Avant de lancer l’affaire, vous payez vos dettes, et aussitôt on en conclut que vous disposez de capitaux énormes. L’héritage de votre frère, si déprécié en ce moment, reprend une importance énorme. Enfin, on apprendra en même temps votre mariage avec Mlle de Mussidan. Que voulez-vous de plus ?
– Ma réputation est détestable. On me dit léger, dépensier, frivole.
– Tant mieux ! Le jour où vous annoncerez la liquidation de votre société, vous ne rencontrerez qu’indulgence. On dira en riant : « Ce sacré Croisenois !… Quelle diable d’idée lui a pris de se mêler d’industrie ! » Mais comme à ce jeu-là vous aurez gagné votre part d’abord, et en second lieu le million de dot de Mlle Sabine, vous laisserez rire.
Quelles perspectives, pour un homme dont l’existence était comme un problème qu’il lui fallait résoudre chaque matin !
– Admettons que j’accepte, fit-il, comment finira la comédie ?
– Le plus simplement du monde. Quand tous mes actionnaires se seront exécutés, vous mettrez la clé sous la porte, et tout sera dit.
Croisenois se dressa furieux.
– C’est-à-dire, s’écria-t-il, que vous comptez me sacrifier. Mettrez la clé sous la porte !… Vous voulez donc m’envoyer au bagne ?
– L’ingrat ! répondit B. Mascarot ; voilà comment il me remercie de faire tout au monde pour l’empêcher d’y aller !…
– Monsieur !…
Mais à son tour Catenac s’était levé.
N’ayant pu se dégager, il était de son intérêt d’aider de tout son pouvoir à la réussite des projets de B. Mascarot.
– Vous vous méprenez, cher monsieur, dit-il à Croisenois ; n’avons-nous pas les sociétés à responsabilité limitée ?
Écoutez plutôt. Demain vous vous présentez chez un notaire, et vous déclarez que vous faites appel aux capitaux intelligents pour l’exploitation de n’importe quoi… des marbres des Pyrénées, si vous voulez. Nous trouverons mieux, soyez tranquille.
En conséquence, vous ouvrez une liste de souscription. Cette liste, les actionnaires de mon ami Baptistin la remplissent.
Quand nous avons les fonds, que faisons-nous ? Tranquillement, nous remboursons les souscripteurs étrangers, et nous écrivons aux autres que l’affaire n’a pas réussi, que tout a été contre nous ; bref, que le capital est perdu !…
Or, Baptistin, ayant obtenu ou fait obtenir de chacun de ses gens une décharge en règle, aucun ne soufflera mot… C’est simple comme bonjour.
Le marquis avait écouté de toutes ses forces ; il réfléchissait.
– Mais, messieurs, s’écria-t-il, tous ces souscripteurs contraints sauront que j’ai fait une spéculation ignoble.
– Possible.
– Ils me mépriseront.
– Probablement ; mais nul ne sera assez hardi pour le laisser voir.
– Oh !…
– Quoi ! oh ! Est-ce que les apparences ne vous suffisent pas ? Vous êtes diantrement difficile. Entre nous, qui estime-t-on sincèrement et sans restriction à notre époque ? Personne. On paraît estimer, voilà tout ! Même, pour exprimer ce sentiment singulier, on a créé un mot nouveau : la considération, c’est-à-dire l’hommage rendu à la force unie à l’adresse. Vous serez considéré.
Le brillant marquis était fort ébranlé.
– Et vous êtes sûr de vos… actionnaires ? demanda-t-il. En tenez-vous vraiment assez pour être certain de couvrir les frais qui seront considérables ?
Cette question, l’honorable placeur l’attendait pour porter le dernier coup.
– Mes calculs sont faits, prononça-t-il, et ils sont exacts.
Il prit en même temps, sur son bureau, un paquet de ces fiches qu’il passait sa vie à annoter, et les faisant claquer sous ses doigts comme un jeu de cartes, il continua :
– J’ai là les noms de 350 personnes qui, en moyenne, verseront chacune dix mille francs.
– Trois millions cinq cent mille francs !…
– C’est là le total, si Barême ne ment pas. Et vous plaît-il, à cette heure, de connaître la nature de nos armes ? Accordez-moi deux minutes encore et jugez, je ne choisis pas.
D’une main exercée, il battit et mêla les fiches qu’il tenait à la main, et c’est au hasard qu’il lut :
N…, ingénieur – Cinq lettres décisives adressées à la femme du protecteur qui lui a procuré sa position, et qui d’un mot peut la lui faire perdre. – Versera 15.000 francs.
P…, négociant. – Un agenda établissant que sa dernière faillite était frauduleuse et qu’il a détourné 200.000 francs de l’actif, – Donnera certainement 20.000 francs.
Mme V…, – Son portrait photographié dans un costume trop léger. N’est pas riche. – Fera cependant verser 3.000 francs.
Mme H…, – Trois billets de sa mère ne laissant aucun doute sur une aventure fâcheuse avant son mariage. Lettre d’une sage-femme à l’appui. – Domine son mari. – Doit faire verser au moins 10.000 francs.
L… – Une chanson obscène et impie, écrite de sa main et signée. – Peut donner 2.000 francs.
S… – Employé supérieur de la Cie de *** – Minute de son traité avec un fournisseur, stipulant pour lui un pot de vin considérable. – Ira, si on le pousse, jusqu’à 15.000 francs.
X… – Partie de sa correspondance avec L… en 1848. – Versera 3.000 francs.
Mme M… de M… – Un petit roman qui est l’histoire exacte de ses aventures avec M. J…
Il n’en fallait pas tant pour décider M. de Croisenois.
– C’est assez, interrompit-il, je me rends. Oui, je m’incline devant votre mystérieuse puissance, plus formidable que celle de la police…
– Et bien autrement sérieuse, ajouta l’excellent docteur. Nous n’avons jamais examiné nos opérations à ce point de vue. C’est un tort. N’entreprenez rien contre le droit, la loi ou la foi, et on ne vous fera pas chanter. Donc, le « chantage » est un moyen de moralisation…
Mais le marquis de Croisenois était trop agité pour goûter la plaisanterie. Il se retourna vers B. Mascarot et, d’une voix brève, dit :
– J’attends vos ordres, monsieur.
Comme toujours, B. Mascarot l’emportait. Successivement il avait battu le comte de Mussidan, Paul Violaine et Catenac lui-même. Maintenant il voyait M. de Croisenois à ses pieds.
Entré le front haut, rayonnant d’audace et d’impudence, le brillant marquis se résignait à passer sous les fourches caudines du placeur, si bas qu’il fallut ramper pour cela.
Dix fois, pendant la discussion, l’idée lui était venue de dire :
– Et si je n’acceptais pas, cependant, si je refusais !…
La réflexion avait dix fois arrêté sur ses lèvres cet imprudent défi.
Il avait compris que des hommes comme ces trois associés ne livrent pas leur secret à la légère.
Et, plus B. Mascarot montrait d’abandon et de cynique franchise, mieux Croisenois sentait qu’il devait être, qu’il était entièrement au pouvoir de ce personnage étrange.
Il ne pouvait pas ne pas tout savoir, celui qui avait réussi à découvrir sa déshonorante transaction de jeu.
Or, le marquis avait sur la conscience juste assez de peccadilles pour trembler sous le regard qu’à travers ces lunettes vertes il sentait arrêté sur lui, persistant et aigu comme celui d’un juge d’instruction qui s’efforce de faire tressaillir la vérité au fond de l’âme d’un prévenu.
Sans doute sa vanité souffrait cruellement de cette humiliante et déshonorante dépendance, et les quelques gouttes de sang généreux qui coulaient encore dans ses veines se révoltaient.
Mais, d’un autre côté, tout ébloui de l’éclat de cette puissance mystérieuse qui se révélait à lui, il se réjouissait d’avoir désormais pour associés dans la vie de pareils lutteurs.
S’il avait craint tout d’abord d’être sacrifié, il était rassuré par l’évidence d’une indissoluble communauté d’intérêts.
De toutes ces considérations avait jailli cette phrase qui, une heure plus tôt, eût écorché sa bouche orgueilleuse :
– J’attends vos ordres !…
Humilité perdue ! Seuls les débiles éprouvent une inepte satisfaction à faire sentir le poids de leur tyrannie. B. Mascarot n’abuse jamais. Il sait que si le vaincu peut oublier sa défaite, il ne pardonne pas l’insulte inutile.
C’est donc avec la plus parfaite courtoisie qu’il répondit :
– Je n’ai pas d’ordre à vous donner, monsieur le marquis. Nous avons tous au succès un intérêt égal ; nous ne pouvons que délibérer, nous concerter avant d’adopter définitivement les mesures les plus convenables.
Croisenois s’inclina, touché de cette politesse inattendue succédant à tant de brutalité.
– Il est oiseux, n’est-ce pas, reprit le digne placeur de vous montrer tous les avantages de votre résolution ? Notons seulement, pour éviter les récriminations ultérieures, votre situation actuelle. Vous m’écriviez, l’autre jour : « J’attends les pieds dans le feu… » En bon français, vous êtes à bout d’expédients, et vous n’avez plus rien d’heureux à espérer de l’avenir.
– Pardon… permettez… J’ai à espérer l’héritage de mon pauvre frère Georges, disparu d’une façon si inexplicable…
B. Mascarot eut un joli geste d’amicale menace.
– Puisque vous voici des nôtres, cher marquis, laissez-moi vous dire qu’entre nous la franchise est de rigueur. Demandez plutôt à notre bon ami Catenac.
– En effet !… répondit l’avocat, à qui cette pointe de fine ironie arracha une grimace plutôt qu’un sourire.
Le marquis prit l’air le plus étonné.
– Je ne vois pas, interrogea-t-il, en quoi je manque de franchise…
– Que diable nous parlez-vous de cet héritage !…
– Mais il existe, monsieur, mais il est considérable !…
– Assez, assez !… Nous sommes fixés sur ce point. On peut encore, malgré beaucoup de non-valeurs, l’évaluer à douze ou quatorze cent mille francs !…
– Eh bien !… Ne puis-je obtenir un arrêt d’envoi en possession ? Les articles 127, 129 et suivants du Code Napoléon…
Il s’interrompit, surprenant sur la figure du bon docteur Hortebize tous les signes de la violente envie de rire.
– Ne nous dites donc pas de ces choses-là, répondit le placeur. Tant qu’il s’est agi d’obtenir une déclaration d’absence et un envoi en possession provisoire permettant de palper les revenus, vous vous êtes fort remué ; mais votre situation a changé, et, tout dernièrement, vous avez fait secrètement des pieds et des mains pour éviter un envoi en possession définitif.
– Quoi !… vous pouvez croire…
– Chut !… vous avez sagement agi. Cette succession est si bien escomptée et surescomptée qu’elle ne suffirait pas à désintéresser vos créanciers. Qu’elle soit liquidée demain, après-demain votre crédit est perdu. En ce moment ce fameux héritage n’est pour vous qu’un miroir à alouettes qui vous sert à éblouir vos fournisseurs.
C’était un beau joueur que Croisenois. Se voyant percé à jour, il prit le parti d’éclater de rire.
– On fait ce qu’on peut !… dit-il.
L’honorable placeur avait regagné son fauteuil. Toute son animation avait disparu. Il paraissait accablé de fatigue.
– Il y aurait barbarie, marquis, reprit-il, après un moment de silence, à vous retenir davantage. Nous nous reverrons ces jours-ci pour aviser à faire capituler vos créanciers au meilleur marché possible. En attendant, Catenac voudra bien s’occuper de la constitution de la société, et de plus il vous donnera le vernis financier qui vous est indispensable.
Était-ce un congé ?
M. de Croisenois et l’avocat le prirent ainsi, car ils se levèrent, et, après de larges poignées de main à B. Mascarot et au docteur, après un léger salut à Paul, ils sortirent ensemble, ressemblant plutôt à de vieux amis qu’à des connaissances d’une couple d’heures.
Dès que la porte fut refermée sur eux :
– Eh bien ! Paul, mon enfant, demanda le placeur, que pensez-vous de notre histoire ?
Chez les natures molles et friables, les impressions peuvent être vives et profondes, elles ne sont jamais durables.
Après avoir été sur le point de succomber à la violence de ses émotions, Paul, s’il était un peu pâle encore, avait repris tout son sang-froid.
Maintenant qu’il avait presque réussi à étouffer les cris de sa conscience, il devait, conseillé par sa déplorable vanité, mettre son amour-propre à afficher un cynisme digne de celui de ses honorables patrons.
– Je pense, monsieur, répondit-il sans trop de tremblement dans la voix, je suis sûr, même, que vous avez besoin de moi. Tant mieux !… Moi qui ne suis pas marquis, je vous obéirai sans toutes les façons de M. de Croisenois !
L’assurance toute nouvelle de Paul ne parut aucunement surprendre l’honorable placeur.
Mais lui plut-elle ? Lui fut-elle au contraire, essentiellement désagréable ? Il eût été malaisé de le discerner.
Toujours est-il qu’un observateur exercé eût surpris sur sa physionomie d’ordinaire indéchiffrable, les traces d’une lutte entre deux sentiments contraires : une vive satisfaction et une sérieuse contrariété.
Quant au bon docteur Hortebize, il fut tout simplement émerveillé de l’impudente audace de ce néophyte qui était un peu son élève.
Le sens exact de la scène qui venait d’avoir lieu éclatait si bien à ses yeux qu’il se frappa le front en homme qui s’étonne et se gourmande de n’avoir pas eu une idée d’une extrême simplicité.
– Que je suis niais !… pensa-t-il. Ce n’est pas au marquis de Croisenois qu’en réalité Baptistin s’adressait. Il posait pour Paul. Quel merveilleux comédien. Avec quelle prestigieuse sûreté chacune de ses paroles est allée faire taire un remords ou éveiller une convoitise dans l’âme de ce garçon si faible et si vaniteux !
Cependant Paul s’inquiétait du silence de son protecteur.
Si d’abord il avait été épouvanté en se sentant aux mains de cet homme extraordinaire, il tremblait maintenant à la seule idée d’être abandonné par lui et livré à ses propres forces.
– J’attends, monsieur, insista-t-il.
– Quoi ?
– Que vous me disiez à quelles conditions je puis conquérir un grand nom, devenir millionnaire et épouser Mlle Flavie Rigal… que j’aime.
B. Mascarot eut un sourire amer, presque méchant.
– Dont vous aimez la dot… interrompit-il, ne confondons pas.
– Excusez-moi, monsieur, j’ai bien dit ce que je voulais dire.
Le docteur, qui n’avait pas pour être sérieux les raisons de son honorable ami, ne prit pas la peine de dissimuler un geste ironique.
– Déjà !… fit-il. Et Rose, et cette jolie Rose !…
– J’ai jugé Rose, monsieur, répondit le jeune homme, et j’ai compris ma simplicité. Pour moi, elle n’existe plus…
Sans aucun doute, Paul disait vrai. C’est du moins avec l’accent si difficile à feindre de la simplicité, qu’il ajouta :
– Et j’en suis à maudire la fortune de Mlle Rigal, qui creuse un abîme entre nous.
Cette déclaration dissipa les nuages qui obscurcissaient le front du placeur, et ses lunettes semblèrent tressaillir d’aise.
– Rassurez-vous, fit-il gaiement, nous comblerons l’abîme. N’est-ce pas, Hortebize ? Seulement, Paul, mon enfant, ne vous le dissimulez pas, le rôle que je vous destine sera plus difficile que celui de M. de Croisenois, plus périlleux surtout.
– Tant mieux !
– La récompense, il est vrai, sera bien autrement magnifique.
– Soutenu et conseillé par vous, je me sens capable de tout oser, de tout braver et de réussir.
– C’est qu’il vous faudra de l’audace, en effet, et beaucoup, et de l’esprit de suite, surtout. Il vous faudra peut-être renoncer à votre personnalité…
– J’y renoncerai de grand cœur.
– Vous devrez revêtir la personnalité d’un autre, prendre à cet autre son nom, son passé, ses habitudes, ses idées, ses mérites et ses vices. Force vous sera d’oublier que vous êtes vous, pour arriver à vous persuader à vous-même que vous êtes lui ; c’est le seul moyen de le persuader aux autres. Vous avez vécu non votre vie à vous, mais la vie de cet autre. Ah ! la tâche sera lourde !…
– Eh !… monsieur, s’écria Paul avec ce facile enthousiasme des faibles, s’occupe-t-on des obstacles de la route lorsqu’on marche les yeux fixés sur un but éblouissant !
Le bon docteur ne put s’empêcher de battre doucement des mains.
– Bien, cela, fit-il.
– Puisqu’il en est ainsi, reprit le placeur, dès qu’on aura soulevé le dernier coin du voile, on n’hésitera pas à vous révéler le secret de vos hautes destinées. Et d’ici-là préparez votre courage, exercez votre front à rester impassible, vos yeux à ne jamais trahir votre pensée intime. Vous m’entendez… monsieur le duc ?…
Il s’interrompit.
Beaumarchef se présentait après avoir discrètement annoncé son entrée par trois ou quatre petits coups à la porte.
L’ancien sous-off en était venu à ses fins.
Profitant d’un moment où il n’y avait presque personne dans « l’agence, » il était monté chez lui et avait revêtu sa grande tenue.
– Qu’y a-t-il ? demanda B. Mascarot.
– Patron, pendant que vous étiez « en séance » avec ces messieurs, on a apporté les deux lettres que voici.
– Donne… Merci, et laisse-nous.
Pendant que Beaumar, accoutumé à ces brusques congés, se retirait, l’honorable placeur examinait la suscription des deux lettres.
– Voici, murmura-t-il, des nouvelles de Van Klopen et de l’hôtel de Mussidan. Voyons d’ailleurs ce que dit notre illustre tailleur pour dames.
Il prit l’enveloppe et lut à haute voix :
« Cher monsieur,
« Soyez satisfait. Notre ami Verminet a exécuté fort adroitement vos ordres.
« À son instigation, le jeune monsieur Gaston de Gandelu a fort proprement imité sur cinq effets de mille francs la signature de M. Martin-Rigal, ce banquier dont vous m’avez recommandé la fille.
« Je tiens ces cinq effets à votre disposition.
« Et je suis, en attendant vos nouveaux ordres, relativement à Mme de Bois-d’Ardon, votre humble serviteur.
« Van Klopen »
– Et d’un !… s’écria B. Mascarot. Si jamais celui-là s’avisait de barrer le chemin de notre ami Paul…
– Lui, monsieur, comment pourrait-il ?…
Le placeur ne répondit pas. Il ouvrit l’autre lettre, et tout haut il lut :
« Je vous annonce, monsieur, la rupture du mariage de Mlle Sabine et de M. Breulh-Faverlay. Elle est, je crois, inutile. Mademoiselle est au plus mal. Je viens d’entendre les médecins dire entre eux qu’elle ne passera peut-être pas la journée.
« Florestan »
À cette nouvelle qui menaçait tous ses projets, B. Mascarot fut saisi d’une telle colère, qu’oubliant son impassibilité, il brisa presque, d’un formidable coup de poing, la tablette de son bureau.
– Tonnerre du ciel !… s’écria-t-il, pourvu que cette péronnelle ne nous joue pas le tour de se laisser mourir !… Nous serions jolis garçons avec le Croisenois sur les bras !… Ce serait tout un plan à refaire…
Il avait violemment repoussé son fauteuil et arpentait rageusement son cabinet.
– Florestan ne se trompe-t-il pas ? disait-il. Qu’est-ce que cette maladie de Mlle de Mussidan coïncidant avec la rupture de son mariage ?… Il y a quelque chose là-dessous. Quoi ?… Il faut le savoir : nous ne pouvons pas demeurer dans cette incertitude.
– Veux-tu, demanda le docteur, que j’aille jusqu’à l’hôtel de Mussidan ?
– Oui, c’est une idée. Ta voiture est à la porte, n’est-ce pas ?… Tu es médecin, on te laissera voir Sabine.
Le docteur se hâtait de passer les manches de son pardessus, B. Mascarot l’arrêta.
– Inutile, fit-il, reste. J’ai réfléchi. Ni toi, ni moi ne pouvons nous montrer dans cette maison. Ce sont nos mines, docteur, qui éclatent. Elles étaient trop chargées… Il y aura eu, vois-tu, une explication entre le comte et la comtesse, et entre deux colères la fille aura été brisée…
– Alors, comment savoir…
– Je vais courir moi-même aux renseignements, je verrai Florestan, j’aurai des détails !…
Et sans attendre la réponse du docteur il s’élança dans sa chambre à coucher.
Il avait laissé la porte ouverte, et tout en se dépêchant de changer de vêtements, il continuait à s’adresser, d’une pièce à l’autre, à son ami Hortebize.
– Ce coup ne serait rien, poursuivait-il, si je n’avais à m’occuper que de Croisenois. Mais je songe à Paul. L’affaire de Champdoce ne peut souffrir aucun délai… Et Catenac, ce traître qui a mis Perpignan et le duc en rapport ! Il faut que je voie Perpignan, que je sache au juste ce qu’on lui a dit de l’affaire et ce qu’il en a deviné… J’ai à voir Caroline Schimel aussi, à lui arracher le dernier mot de l’énigme ! Ah ! le temps ! le temps !
Il était prêt, il attira le docteur jusqu’au milieu de sa chambre à coucher.
– Je file, lui dit-il ; toi, ne laisse pas Paul. Nous ne sommes pas encore assez sûrs de lui pour le laisser se promener avec notre secret. Mène-le dîner chez Martin-Rigal, et trouve un prétexte pour lui offrir l’hospitalité cette nuit… Allons, à demain.
Et il sortit, trop préoccupé pour entendre le docteur qui lui criait :
– Bonne chance !
XIX
Au sortir de l’hôtel de Mussidan, après sa promesse à Sabine, M. de Breulh-Faverlay ne remonta pas dans le phaéton qui l’avait amené et qui l’attendait au bas du perron.
– Rentrez doucement à l’hôtel, dit-il à ses domestiques, j’irai à pied.
Il éprouvait, comme après toutes les crises, un impérieux besoin de mouvement. Il voulait marcher, se lasser s’il était possible, pour se remettre, pour tasser ses idées, pour ressaisir son sang-froid en déroute.
S’il était profondément et péniblement affecté, il était plus surpris encore. Il se sentait étourdi, comme après une chute.
Il y avait tant d’années qu’il n’avait été remué par un sentiment profond et durable, qu’il ne se reconnaissait plus.
Ses amis ne l’auraient pas reconnu davantage, à le voir descendre à grandes enjambées les Champs-Élysées.
Qu’était devenue sa belle impassibilité glaciale, admiration et modèle de tous les jeunes gens de son cercle ? Son visage, dont rien jamais ne dérangeait les lignes correctes, était bouleversé.
L’émotion, la passion, la stupeur l’emportaient si bien hors de lui-même, que tout en marchant il parlait à haute voix, s’exclamait et gesticulait, ce qui est d’un commun à faire frémir et contre toutes les règles.
– Voilà donc la vie !… disait-il. On se croit bronzé, blasé, usé, vieilli, fini, on juge tout mort en soi, et il suffit d’un regard de beaux yeux pour vous rendre les palpitations de l’adolescence. On se trouble autant qu’un lycéen, on balbutie, on rougit, et même… le diable m’emporte !… on sent une larme taquine au coin de l’œil.
Certes, il aimait déjà Sabine, le jour où il avait demandé sa main au comte de Mussidan, il l’aimait… mais non comme en ce moment.
Depuis qu’il la savait perdue pour lui, il lui découvrait des mérites extraordinaires. Elle lui paraissait plus belle, plus spirituelle, parée de surprenantes qualités, mille fois plus désirable, enfin.
Qui donc eût jamais pu prévoir cela, que lui, le grand seigneur adulé, envié et recherché par excellence, lui, adoré de toutes les femmes, si tous les hommes le redoutaient, il serait repoussé le jour où, pris d’une passion sérieuse, il offrait à une jeune fille sa fortune et son nom.
– Ah ! c’était bien là, murmurait-il, la compagne que je rêvais. Retrouverai-je jamais cette âme tendre, cet esprit viril, tant d’innocence et de chaste témérité, parmi toutes ces agaçantes poupées que je vois autour de moi, s’habillant, babillant, chevauchant, parlant argot et copiant les excentricités des filles. Est-il une Sabine, parmi ces extravagantes pour qui la vie est comme un cotillon perpétuel, et qui prennent un mari, comme elles choisissent un valseur… parce qu’on ne peut valser seule.
Toutes les femmes lui paraissaient haïssables en ce moment, et il avait par avance des rassasiements rien qu’à songer aux héritières de sa connaissance.
Quelle expression sublime avaient ses yeux, pensait-il, pendant qu’elle parlait de lui !… Elle lui croit du génie et elle a adopté toutes ses pensées. C’est son âme, à lui, qui palpite en elle. Avec quelle noble fierté elle disait : Nous ! – Nous sommes pauvres… Nous n’avons pas de nom !…
Cependant il essaya de secouer la tristesse affreuse qui l’envahissait.
– Bast !… s’écria-t-il en décrivant un moulinet avec sa canne, de cette affaire je mourrai garçon. Mon valet de chambre, sur mes vieux jours, deviendra mon meilleur ami. Je ferai un dieu de mon ventre. Le baron Brisse prétend qu’on peut faire jusqu’à quatre repas par jour… C’est quelque chose… Puis, pour égayer mes digestions, j’aurai autour de mon fauteuil la comédie de mes héritiers.
Il eut un ricanement nerveux, mais presque aussitôt il ajouta, non sans un douloureux soupir :
– Ah !… n’importe, ma vie est manquée !
Cependant, si cruelle que fût la déception, si cuisante que fût la blessure, M. de Breulh n’en voulait ni à Sabine, ni à cet autre dont il enviait l’étonnant bonheur.
Orgueilleux au suprême degré, il était au-dessus des absurdes vanités des gens médiocres. Il ne voyait rien d’extraordinaire, d’anormal, de monstrueux à ce qu’une femme lui préférât un autre homme. Il en gémissait, voilà tout.
Sabine avait bien jugé, lorsqu’elle s’était dit : « Celui-là aussi est digne d’être aimé ! »
M. de Breulh méritait un autre piédestal que celui que lui avaient élevé des amitiés et des rivalités également idiotes.
Il valait mieux que sa réputation, que sa vie, que son époque ; il valait mieux surtout que ses nombreux amis.
À la mort de son oncle, il s’était lancé dans ce qu’on appelle « le tourbillon de la haute vie » ; mais il avait été vite las de cette existence vide et agitée.
Posséder une écurie victorieuse, voir ses déplacements signalés par les journaux de sport, être trompé à raison de deux ou trois cents louis par mois par une demoiselle de théâtre, ne suffisait pas au bonheur de ce difficile mortel.
Depuis longtemps déjà, rongé d’ennui sous ses frivoles apparences, il cherchait un but à son ambition, une tâche à la hauteur de ce qu’il se sentait d’énergie et d’intelligence.
Il s’était bien juré que la veille de son mariage il vendrait ses chevaux de courses et romprait avec des habitudes qui l’excédaient. Et voici que ce mariage tant souhaité devenait impossible !…
Lorsqu’il entra à son club, les traces de ses émotions étaient si évidentes, que plusieurs jeunes gens occupés à battre les cartes laissèrent voir leur surprise et ne purent s’empêcher de lui demander si par hasard « Chamboran », un de ses chevaux, déjà classé pour le Grand Prix, n’était pas indisposé.
Il répondit que « Chamboran » se portait à merveille, et se hâta de passer dans un des petits salons réservés à la correspondance.
– Sur quelle herbe a donc marché de Breulh ?… remarqua un des joueurs.
– Qui sait ?… Le voilà en train d’écrire.
Il écrivait, en effet, à M. de Mussidan pour retirer sa parole, et la besogne n’était pas aisée.
En relisant sa lettre, M. de Breulh dut s’avouer que sous chaque phrase perçait une pointe d’ironie, et que le ton général accusait un dépit dont on ne manquerait pas de lui demander les raisons.
On a beau être chevaleresque, on est homme, et toujours quelques levains mauvais fermentent et s’agitent sous les plus généreuses résolutions.
– Non, dit M. de Breulh, cette lettre est indigne de moi.
Et sur cette réflexion, il recommença, cherchant, pour les exposer, les excuses les plus naturelles, parlant vaguement de sa vie, d’habitudes enracinées, de certaine liaison qu’il ne se sentait pas le courage de briser.
Ce petit chef-d’œuvre de diplomatie terminé, il le remit à un des domestiques du club avec l’ordre de le porter immédiatement à son adresse.
M. de Breulh pensait que ce devoir d’honneur rempli, ses vaisseaux brûlés, il se sentirait l’esprit et le cœur plus libres. Point.
Il se mit au jeu, mais au bout d’un quart d’heure il en avait assez. Il voulut dîner, il n’avait pas faim et ne put manger. Il entra à l’Opéra, il y bâilla, la musique lui portait sur les nerfs.
De guerre lasse, il rentra chez lui sur les deux heures, ce qui ne lui était pas arrivé depuis près d’un an.
L’obsession persistait.
Détacher sa pensée de Sabine lui était aussi impossible que d’empêcher son pouls de battre plus vite qu’à l’ordinaire.
Qui était cet homme qu’on lui préférait.
Il estimait trop le caractère de Mlle de Mussidan pour la soupçonner d’un choix indigne.
D’un autre côté il avait vu en sa vie tant de passions inexplicables !…
Quand les gens les plus expérimentés se laissent prendre à des pièges grossiers, comment une jeune fille se défendrait-elle contre les surprises de son cœur ?
– Si pourtant elle s’était trompée ! se disait M. de Breulh. S’il était possible de lui ouvrir les yeux !
Puis, pour s’excuser, sans doute, de garder cette espérance, il ajoutait :
– S’il est digne d’elle, au contraire, eh bien !… je l’aiderai à renverser les obstacles.
Il se complaisait à cette idée, savourant à l’avance l’âpre plaisir qu’il goûterait à assurer le bonheur de celle qu’il aimait et qui le repoussait.
Peut-être cependant, à son insu, se mêlait-il à cette belle générosité un désir vague d’affirmer sa supériorité et de l’étaler aux yeux de Sabine.
À quatre heures du matin, il était encore dans son fauteuil, au coin de son feu éteint.
Il était presque décidé à aller voir André. Quand on est riche, on a toujours en poche un prétexte pour visiter l’atelier d’un peintre.
Quant à ce qu’il ferait ou dirait, il ne s’en occupait pas, s’en remettant au hasard des événements et à son expérience. Il se coucha sur cette détermination.
Mais le lendemain, à son réveil, sa résolution chancelait. Pourquoi se mêlerait-il de cette affaire ?… D’un autre côté, la curiosité le poignait.
Enfin, sur les deux heures, il donna l’ordre d’atteler, et quelques instants plus tard, il prenait au grand trot le chemin de la rue de La Tour-d’Auvergne.
Mme Poileveu, la discrète concierge d’André, était debout sur sa porte, appuyée sur le manche de son balai, lorsque le magnifique attelage de M. de Breulh s’arrêta devant la maison.
La digne femme eut comme un éblouissement. De sa vie elle n’avait vu de près des chevaux si luisants sous leurs harnais plaqués d’argent avec leurs bouffettes aux oreilles, une voiture à ce point étincelante, des domestiques si richement habillés.
– Grand Dieu !… pensa-t-elle, est-ce bien pour nous que vient ce seigneur ? Ne se trompe-t-il pas ?
Mais son ahurissement n’eut plus de bornes lorsque M. de Breulh, descendu de son coupé, s’avança vers elle et lui demanda :
– M. André, artiste peintre ?
– Pour sûr, répondit-elle, c’est ici qu’il demeure… et voilà déjà plus de deux ans qu’il est notre locataire. Ah !… si tous les artistes lui ressemblaient ! Ce n’est pas lui qui serait en retard pour son terme !… Et rangé, qu’il est, et poli, et complaisant… Jamais de noces chez lui, ni de tapage. Un être parfait, quoi !… Et sans la petite dame des Champs-Élysées… mais quoi !… vous savez, on est jeune ou on ne l’est pas…
Elle parlait, elle parlait, sans trop savoir ce qu’elle disait, tant elle appliquait son attention à considérer le possesseur de cette superbe voiture.
– Indiquez-moi son atelier, interrompit M. de Breulh impatienté.
– Eh bien !… c’est au quatrième, à droite, le nom est sur la porte, on ne peut se tromper… Mais c’est égal, je vais conduire monsieur.
– Inutile, ma brave dame, je trouverai, ne vous dérangez pas.
M. de Breulh se dirigea vers l’escalier, et Mme Poileveu demeura sur le seuil, la bouche ouverte jusqu’au gosier, aussi immobile que la femme de Loth après sa cristallisation.
– Voilà une histoire, pensa-t-elle. On vient voir M. André en grand tralala à cette heure. Quel genre. Un garçon qui n’a l’air de rien du tout… Il y a bien quatre jours que Poileveu n’a pas fait son ménage, et il ne s’est seulement pas plaint !… Ah !… mais cela ne peut durer ainsi. Un artiste qui a des connaissances comme ça, on le soigne !… Lui qui est bon enfant, il est capable de nous faire avoir un bureau de tabac !… Mais quel peut être ce grand personnage ?
Sur cette réflexion, elle rentra poser son balai derrière sa porte, décidée à revenir, selon son expression, tirer les vers du nez des domestiques.
Pendant ce temps, M. de Breulh-Faverlay montait lentement, et en homme qui ménage sa respiration, le raide escalier.
Il était arrivé au dernier étage et allait frapper à la porte sur laquelle il lisait le nom de André, quand, au bruit d’un pas jeune et leste, derrière lui, il se retourna.
Il était sur l’étroit palier, face à face avec un jeune homme, grand et très brun, vêtu d’une de ces longues blouses blanches comme en portent les ornemanistes à leur travail. Il tenait à la main un grand broc de zinc, qu’il venait de remplir d’eau au réservoir de la maison.
– Monsieur André ? demanda M. de Breulh.
– C’est moi, monsieur.
– Je désirerais vous parler…
– Veuillez alors, monsieur, prendre la peine d’entrer chez moi.
Ce disant, le jeune peintre se glissa entre la rampe et M. de Breulh et ouvrit la porte de son atelier, où il précéda son visiteur.
La première impression de M. de Breulh avait été favorable à André. Il avait été frappé, lui qui avait l’expérience des hommes, de cette physionomie ouverte et hardie, de ce regard lumineux et franc, de cette voix ronde et sonore.
– En tout cas, pensa-t-il, celui-là est un homme.
D’un autre côté, bien que les épreuves de sa jeunesse l’eussent dépouillé de quantité de préjugés, le costume d’André l’étonnait.
Il avait bien du mal à imaginer l’homme distingué par Sabine de Mussidan en blouse, allant chercher lui-même son eau à la pompe.
Mais on ne voyait rien de sa surprise ; il avait eu le temps, depuis la veille, de reprendre cet air parfaitement détaché de tout, qui lui était habituel.
– Je dois, monsieur, commença André, vous prier de m’excuser de vous recevoir ainsi… Mais, que voulez-vous, tant qu’on n’est pas très riche, on n’est bien servi que par soi, et encore !…
Il montrait en même temps, sans embarras mais sans forfanterie, sa blouse et son broc qu’il venait de déposer dans un coin.
Le ton plut à M. de Breulh, qui eut un sourire et un geste cordial.
– C’est à moi plutôt, qui vous dérange, fit-il, de vous demander pardon. Je vous suis adressé par un de mes amis, un de mes…
Il cherchait.
– Par le prince Crescenzi, peut-être ! demanda André.
C’est à peine si M. de Breulh connaissait le célèbre armateur, mais il saisit avec empressement la perche que lui tendait son interlocuteur.
– Précisément ! répondit-il. Le prince fait le plus grand cas de votre talent et n’en parle qu’avec enthousiasme. Connaissant la sûreté de son goût, je me suis dit qu’il me faudrait un tableau de vous… Soyez tranquille, vous serez chez moi en bonne compagnie…
André s’était incliné, plus rougissant qu’une pensionnaire à un compliment de monseigneur l’évêque.
– Je ne saurais trop vous remercier, monsieur, dit-il, d’avoir ainsi cru le prince Crescenzi sur parole, malheureusement vous vous serez dérangé, et je crains, inutilement…
– Pourquoi cela ?
– J’ai eu tant d’occupation, les mois derniers, tant de travail, que je n’ai rien achevé, rien de présentable…
M. de Breulh l’interrompit.
– Qu’importe ? Est-ce que l’avenir n’est pas un peu à nous ? Ce qui n’est pas fait, vous le ferez…
– Il est vrai, monsieur, que si vous avez en moi assez de confiance…
– Comment, si j’ai confiance !… Crescenzi n’est-il pas votre garant !
– Alors, nous pourrions convenir d’un sujet…
Sans s’en douter, André achevait la conquête de son visiteur.
– C’est particulier, pensait M. de Breulh, je devrais le haïr, ce garçon, j’ai pour cela mille bonnes raisons, et jamais cependant personne ne m’a été si sympathique.
Comme il se taisait, cherchant à se bien rendre compte de ses sentiments encore confus, André reprit la parole.
– J’ai là, monsieur, poursuivit-il, une trentaine d’esquisses, qui deviendront, je l’espère, des tableaux passables ; si l’une d’elles vous convenait…
– Oui !… voyons, répondit avec empressement M. de Breulh.
Ayant jugé le caractère, il n’était pas fâché de juger le talent, et c’est avec la plus sérieuse attention qu’il commença à passer en revue les toiles accrochées aux murs.
André, sans mot dire, le laissait faire…
Cette commande qui lui venait pensait-il, par l’entremise du prince Crescenzi, pouvait être le point de départ de sa fortune artistique. Le prince est un des sept ou huit amateurs de l’Europe qui, d’un mot, peuvent faire vendre 10 000 francs la plus indigne croûte.
Mais André n’était pas en disposition de se réjouir de ce bonheur.
Rarement, en sa vie si tourmentée, il avait éprouvé une tristesse pareille à celle qui, en ce moment, lui serrait le cœur.
C’est que, l’avant-veille, après lui avoir annoncé une démarche décisive, Sabine l’avait quitté en lui disant : « À demain une lettre. »
Or, ce lendemain, impatiemment attendu, était passé, on était au surlendemain, trois heures venaient de sonner, et il n’avait reçu ni un mot, ni un signe de vie… rien…
Depuis quarante-huit heures, il était sur des charbons ardents.
Il ne doutait pas de Sabine, il eut douté de soi avant ; mais que s’était-il passé là-bas, à cet hôtel de Mussidan, dont les portes lui étaient fermées ?
Il endurait cet intolérable supplice qui torture un homme énergique, lorsqu’il sent sa destinée se décider, et qu’il sait ne rien pouvoir pour hâter la solution et se la rendre favorable.
Cependant M. de Breulh avait terminé son examen.
Pour lui, désormais, le talent de André était évident, indiscutable.
Sur toutes ces toiles, esquissées à la hâte, on pouvait relever de grands défauts, des inexpériences, des témérités malheureuses, mais chacune d’elles était marquée au cachet d’une puissante individualité.
André était un « homme » dans la forte acception du mot ; il était « artiste » aussi, – en restituant à ce titre magnifique son véritable sens.
Dire que l’orgueil de Breulh-Faverlay ne saignait pas sous les griffes aiguës de la jalousie serait trop dire. Mais il sut dompter les révoltes des sentiments mauvais. C’est franchement et loyalement qu’il tendit la main au jeune peintre.
– Lorsque je suis entré chez vous, monsieur, lui dit-il, je désirais un tableau de vous ; maintenant je le veux… Ce n’est plus sur la foi d’un autre que je crois à votre talent.
Et comme André ne répondait pas :
– J’ai choisi mon esquisse, ajouta-t-il, arrêtons nos conditions.
Pauvre, sans protecteurs, sans influence d’école, attaché à la rude tâche quotidienne qui lui donnait du pain, André n’avait eu ni le temps ni les moyens d’aller étudier aux pays classiques les secrets des poésies de convention. Il se contentait de rendre ce qu’il voyait et sentait. Il estimait que faire palpiter sur la toile la passion et la vie est un peu plus difficile que d’y peinturlurer des bonshommes en costumes étrangers.
Entre toutes ses esquisses, il s’en trouvait une qu’il avait appelée : Le Lundi à la Barrière.
Au premier plan, deux hommes luttaient qu’un troisième s’efforçait de séparer. Les vêtements déchirés laissaient voir les torses nus. Les muscles saillaient sous les chairs palpitantes. Les visages avaient les contorsions de l’ivresse, de la haine et de la colère.
Un peu à droite, une femme, la cause du combat, était étendue à terre, les cheveux épars, une large blessure à la tempe, et deux de ses compagnes accroupies près d’elle, s’efforçaient de lui faire reprendre ses sens.
Quelques badauds faisaient cercle ; des enfants se sauvaient, et dans le lointain on apercevait les tricornes des sergents de ville qui accouraient.
Chose vulgaire ! oui. Scène vraie.
Et seule, la vérité, à cette heure, peut sauver l’art… mais la vraie, non la convenue, celle qui agrandit et généralise, non celle qui particularise et rapetisse…
C’est cette esquisse que désigna M. de Breulh.
– Voilà, dit-il, ce que je voudrais.
Alors, André, avec cette insistance pratique que donne l’habitude des déceptions, entra dans les détails de l’exécution, s’expliquant sur la composition, sur les proportions à donner au sujet, sur les dimensions de la toile, sur tout, enfin.
M. de Breulh, du geste et de la voix, approuvait.
– Ce que vous ferez, disait-il, sera bien fait ; que rien ne vous gêne ni ne vous inquiète : obéissez à vos inspirations.
Il brûlait, maintenant, d’en finir et de se retirer, ayant trop de délicatesse pour ne pas souffrir de la fausseté de la situation. La confiance d’André le gênait considérablement : il en perdait son assurance.
Toutes les conventions étaient arrêtées, et il fallut à M. de Breulh un effort de volonté pour aborder la question du prix de ce tableau qu’il commandait.
Peut-être s’attendait-il à des tergiversations, aux simagrées d’une fausse modestie et d’un désintéressement ridicule. Point.
– Monsieur, répondit dignement André, la valeur de la peinture étant toute de convention, je ne puis rien vous dire. Une toile de la dimension que nous disons, coûte, blanche, quatre-vingt francs. Couverte de couleur, elle peut n’avoir plus aucune valeur, ou valoir…
– Pensez-vous, interrompit M. de Breulh, qu’en vous offrant dix mille francs…
André eut un geste de protestation.
– Trop, fit-il, beaucoup trop.
– Cependant…
– En l’état actuel, n’étant pas plus connu que je ne suis, quatre mille francs seront un prix magnifique. Si cependant je réussissait au delà de mes espérances, eh bien !… je vous demanderais six mille francs.
– Soit, répondit M. de Breulh, voilà qui est dit.
Il avait tiré de sa poche un élégant portefeuille à son chiffre. Il y prit deux billets de mille francs qu’il posa sur la table, en disant :
– Voilà toujours la moitié d’avance.
Le jeune peintre devint plus rouge que le carmin de sa palette.
– Vous voulez plaisanter, monsieur, balbutia-t-il.
– Pas le moins du monde, répondit gravement M. de Breulh, j’ai en affaires des principes dont je ne m’écarte jamais.
Puis, du ton le plus encourageant, il ajouta :
– Qui vous dit que je ne prétends pas vous lier, mon cher maître ? Ces deux billets nous tiennent lieu de contrat.
Ainsi présentée, l’action de M. de Breulh n’avait rien que de très flatteur. Cependant, la susceptibilité un peu excessive peut-être d’André s’effarouchait.
– C’est que, monsieur, commença-t-il, je ne pourrai vous livrer ce tableau avant cinq ou six mois… J’ai traité avec un riche entrepreneur, M. Gandelu, pour les sculptures d’une maison.
– Qu’importe ! insista M. de Breulh, je ne reviens jamais sur ce que je dis.
Décemment, à moins d’être fou, André ne pouvait résister davantage. Il inclina la tête en signe d’assentiment, ne pouvant s’empêcher de s’avouer que cet argent arrivait singulièrement à propos.
M. de Breulh, lui, s’apprêtait à se retirer.
– Donc, fit-il, en ouvrant la porte de l’atelier, bonne réussite, mon cher peintre. Si vous étiez aimable, vous viendriez un matin me demander à déjeuner, je vous montrerais un Murillo qui, à lui seul, vaut le voyage…
Et, autant pour affirmer son invitation que pour faire savoir qui il était, il tendit sa carte et sortit.
En présence de ce visiteur, André n’avait pas donné un regard à cette carte, mais dès qu’il fut seul, il regarda.
Ce nom de Breulh-Faverlay lui sauta aux yeux plus flamboyant que l’éclair qui précède la foudre.
Pendant une seconde, il fut assommé. À la seconde suivante, une épouvantable colère charria tout son sang à son cerveau.
Il se vit joué, raillé, humilié…
Sans se rendre compte de ce qu’il faisait, il se précipita sur le palier et, se penchant le long de la rampe, il appela à pleine voix :
– Monsieur !… monsieur !…
M. de Breulh, qui déjà était arrivé au second étage, releva la tête.
– Remontez !… cria André.
Après un mouvement insaisissable d’hésitation, le gentilhomme obéit.
Lorsqu’il fut rentré dans l’atelier :
– Reprenez votre argent, monsieur, lui dit André d’une voix que la colère rendait à peine intelligible, reprenez ces billets.
– Qu’avez-vous ?… Qu’y a-t-il ?
– Rien, sinon que j’ai réfléchi ; je ne puis faire, je ne ferai pas votre tableau.
– Ah ça… pourquoi ?
Pourquoi !… M. de Breulh le savait parfaitement. Il comprenait que Sabine avait prononcé son nom et dit ses espérances. Peu généreux en cette circonstance, imprudent même, il abusait de la position si difficile et si délicate du jeune peintre.
– Parce que ! répondit André.
– Mais ce n’est pas une raison, cela !
André perdait la tête. Dire les raisons de son revirement soudain était impossible. Il fût mort plutôt que de prononcer le nom de Sabine. Il ne vit que la violence pour sortir d’une situation sans issue.
– Eh bien ! monsieur, fit-il avec un regard chargé de haine, admettez que votre figure m’a déplu !… C’est une raison, cela !…
– Mais c’est une provocation, cela, monsieur André.
– Ah ! ce sera ce que vous voudrez !…
La patience n’était pas la vertu dominante de M. de Breulh. Il devint plus blanc que sa chemise et eut un mouvement terrible.
Mais sa nature généreuse reprenant aussitôt le dessus, c’est d’une voix émue qu’il dit :
– Acceptez mes excuses sincères, monsieur André… Tenez, je l’avoue, j’ai joué un rôle qui n’était digne ni de vous ni de moi… Je devais, dès en entrant, me nommer et vous dire : Je sais tout.
– Je ne vous comprends pas, monsieur, répondit André d’un ton glacé…
– Si, vous me comprenez, mais vous vous défiez de moi… J’ai mérité cette injure. Cessez de feindre, cependant ; Mlle Sabine m’a tout confié, tout, entendez-vous bien… Et, s’il vous fallait une preuve, je vous dirais que cette toile que j’aperçois là, tournée du côté du mur, doit être le portrait de Mlle de Mussidan.
André gardant toujours le silence, M. de Breulh eut un triste sourire.
– J’ajouterai, reprit-il, pour dissiper tous vos soupçons, que hier, sur la prière de Mlle Sabine, j’ai retiré la demande que j’avais faite de sa main.
Aux explications de ce galant homme, reconnaissant si noblement ses torts, André avait senti, peu à peu, sa colère se dissiper.
– Je ne saurais trop vous remercier, monsieur, commença-t-il…
– Oh !… interrompit vivement M. de Breulh, on ne doit pas de remerciements à qui n’a fait que strictement son devoir… Je mentirais en vous disant que je n’ai pas été douloureusement surpris… Mais enfin, ce que j’ai fait, vous l’eussiez fait à ma place.
– C’est vrai, monsieur.
– Et nous sommes amis, maintenant, n’est-ce pas ?… dit M. de Breulh en tendant la main.
Ce n’est pas sans une violente émotion que André serra cette main loyale qui lui était tendue.
– Oui, amis, balbutia-t-il, amis !…
M. de Breulh devait croire que tout était oublié.
– Cela étant, reprit-il, avec une gaîté un peu forcée, ne parlons plus de ce tableau qui n’était qu’un prétexte… Tenez, je serai franc, avec vous comme avec moi-même. En venant ici, je me disais : « Si l’homme que Mlle Sabine me préfère est digne d’elle, je ferai tout au monde pour qu’il soit accepté de sa famille. Je suis venu, monsieur, je vous ai jugé et je vous dis : Faites-moi un grand plaisir et un grand honneur, laissez-moi mettre au service de votre amour ma personne, ma fortune, mes influences et mes amis. »
C’est avec l’enthousiasme du dévouement le plus pur, et dans toute la sincérité de son âme, que M. de Breulh-Faverlay se mettait à la disposition de ce jeune homme, dont il enviait le bonheur.
La générosité a ses entraînements, et le sacrifice librement consenti, si pénible qu’il puisse être, procure comme une amère jouissance, qui est la récompense première.
Cependant André secouait tristement la tête.
– Je n’oublierai jamais vos offres, monsieur, prononça-t-il, seulement…
Il hésitait, M. de Breulh insista.
– Seulement ?…
– Eh bien ! je ne saurais les accepter.
Le gentilhomme eut un geste de surprise.
– Pourquoi ?… interrogea-t-il.
– Ah !… tenez, monsieur, répondit André, moi aussi je serai franc avec vous, et je vous dirai toute ma pensée… Vous trouverez peut-être mes susceptibilités ridicules, mais que voulez-vous, le malheur, lorsqu’il ne brise pas le ressort de la dignité, exalte et irrite l’orgueil. J’aime mademoiselle de Mussidan de toutes les forces de mon être, il n’est pas dans mes veines une goutte de sang qui ne lui appartienne, je donnerais avec transport la moitié des années que j’ai à vivre pour combler l’abîme qui nous sépare, et pourtant…
Il s’interrompit, cherchant les expressions justes pour rendre ce qu’il ressentait, et enfin, avec une violence contenue, il ajouta :
– De grâce, ne vous offensez pas de ce que je vais vous dire… Je renoncerais à Mlle Sabine plutôt que d’accepter votre assistance.
– Mais c’est de la folie !… s’écria M. de Breulh.
– Non, monsieur, non, ce n’est pas folie, mais sagesse. Il est de ces dévouements qu’on doit repousser, car on ne peut que les payer de la plus noire ingratitude. Si je me rendais à vos désirs, votre rôle serait trop beau, trop sublime, je me sentirais affreusement humilié, je serais jaloux. Ne suis-je donc pas déjà assez écrasé par votre supériorité ?… Pendant que vous êtes des plus nobles et des plus riches de Paris, je suis des plus pauvres, et je n’ai pas d’état-civil. Je suis si bien seul, ignoré, perdu en ce monde, que je n’ai même pas été appelé à tirer à la conscription. Tout ce qui me manque, vous l’avez, et vous voudriez…
– Mais j’ai été pauvre aussi, moi, répétait M. de Breulh, j’ai été malheureux autant et plus que vous.
André, qui ne connaissait rien du passé de M. de Breulh, qui ne voyait que les éblouissements du présent, s’arrêta stupéfait.
– Savez-vous ce que je faisais à votre âge ? continua le gentilhomme : je mourais de faim au fond de la Sonora. Pour vivre, j’étais réduit à endosser la chemise de laine du manouvrier ou à entrer au service d’un spéculateur de Guaymas comme toucheur de bœufs… Pensez-vous qu’en ces instants je m’estimais amoindri ?
– Eh ! s’écria le jeune peintre, tant mieux si vous avez souffert, vous me comprendrez plus aisément. Croyez-vous donc que je ne me juge pas votre égal ? Détrompez-vous. Mais je cesserais de l’être le jour où j’aurais recours à vous… N’est-ce pas à mon énergie et à mon courage que je dois d’avoir été distingué par Mlle de Mussidan ? Elle a eu foi en moi, le jour où elle m’a dit : « Élevez-vous jusqu’à moi ! » Ce qu’elle a ordonné, je le ferai ou je périrai à la tâche. Mais, dans tous les cas, je suis résolu à réussir ou périr seul. Je ne veux pas de remords après la victoire. Je ne veux pas qu’un homme puisse dire de moi : « C’est à ma rare générosité, à ma chevaleresque abnégation que celui-ci doit son bonheur. »
– Oh ? monsieur, protesta M. de Breulh, monsieur…
– Non, sans doute, interrompit André, vous ne diriez pas cela hautement, votre délicatesse est bien trop grande. Mais ne le penseriez-vous pas ? Et cela serait, en effet, et je le saurais, et la fille du noble comte de Mussidan, devenue la femme du peintre André, le saurait aussi. C’est-à-dire que j’arriverais à Sabine dépouillé de ma seule noblesse, ma sauvage fierté. Notre mariage arrivant ainsi serait sa première désillusion. Est-ce que, involontairement, elle ne nous comparerait pas de nouveau ? Que serais-je alors à ses yeux ! Infailliblement, l’avenir changerait le bienfait en une mortelle et ineffaçable injure. Ah !… tenez, ma vie serait empoisonnée. Toujours entre ma femme et moi votre fantôme se dresserait.
Il s’arrêta court, comme effrayé de sa violence. Une phrase encore, et il allait menacer ce galant homme qui se conduisait si noblement.
Il fit à sa volonté un énergique appel, et c’est d’un ton de courtoisie parfaite qu’il ajouta :
– Mais en vérité, je ne sais ce que je dis !… Nous vous devons trop déjà, monsieur, pour que je ne tienne pas à l’honneur de rester votre ami.
Ainsi, comme Sabine, il disait : Nous. Ce que Mlle de Mussidan avait prédit se réalisait, à l’idée seule d’une apparence de protection, André se révoltait.
Mais M. de Breulh était digne de comprendre cet emportement d’André, emportement qui eût fait rire bien des gens à une époque où tourner en ridicule tout sentiment sérieux et profond est considéré comme une preuve d’esprit et de goût.
Même, il était si violemment ému, que la pensée ne lui vint pas d’ajouter un seul mot.
Lentement, il replaça dans son portefeuille les deux billets de mille francs restés sur la table, et d’une voix vibrante, il dit :
– Je vous approuve, monsieur. Quoi qu’il arrive, souvenez-vous, qu’à toute heure de jour et de nuit, vous pouvez compter sur Breulh-Faverlay… Adieu !…
Resté seul, André se trouva moins malheureux qu’il ne l’était depuis deux jours.
Grâce à M. de Breulh, il savait maintenant que Sabine n’avait pas rencontré d’obstacles imprévus, et s’il s’étonnait de n’avoir pas encore de ses nouvelles, il ne s’en inquiétait plus.
Cependant, il était si agité encore, qu’il lui fut impossible de profiter d’un reste de jour pour terminer certaines maquettes qu’il devait soumettre à M. Gandelu le père.
Il se jeta dans son fauteuil et s’efforça de ressaisir les moindres détails de la scène qui venait d’avoir lieu.
Il eût très probablement oublié l’heure du dîner, si, au moment où il était enfoncé le plus avant dans ses rêveries, Mme Poileveu n’était entrée – sans frapper.
– Voici une lettre que le facteur apporte, dit-elle.
C’était miracle de voir Mme Poileveu monter une lettre au quatrième étage ; mais, renseignée sur la personnalité de M. de Breulh, elle avait décidé que « son artiste » serait désormais servi mieux qu’un prince.
Mais André était si préoccupé que cette complaisance surprenante ne le frappa pas. Il ne songea qu’à Sabine.
– Une lettre !… s’écria-t-il en se dressant d’un bond, vite, donnez.
Et il la prit, il l’arracha plutôt, des mains de la portière.
Mais ce n’était pas Sabine qui avait tracé les caractères communs et irréguliers de l’adresse. Pourtant, il était aisé de reconnaître une écriture de femme.
Avec une impatience nerveuse, André déchira l’enveloppe, chercha la signature et vit : « Modeste ».
Modeste ! la femme de chambre de Mlle de Mussidan ! Qu’est-ce que cela signifiait ?
Il frissonna, pressentant quelque malheur horrible, et c’est comme à travers un brouillard qu’il lut :
« Je vous adresse la présente à la seule fin de vous faire savoir que Mlle Sabine a bien réussi pour vous ce que vous savez.
« Si je me permets de vous écrire sans ordres, c’est que, hélas ! mademoiselle est si malade qu’elle ne peut vous donner de ses nouvelles. »
Ces quelques ligner foudroyèrent André.
– Sabine malade !… balbutiait-il, sans penser aux avides oreilles de la Poileveu, Sabine trop malade pour pouvoir m’écrire… Mais alors… elle est en danger, elle est morte, peut-être…
Il demeurait immobile, l’œil fixe, les traits décomposés, et il répétait comme un mot vide de sens :
– Morte ! morte !…
Mais presque aussitôt la réaction se produisit. Il froissa la lettre de Modeste, la jeta à terre, et, tête nue, vêtu de sa blouse de chantier, il s’élança dehors.
La stupéfaction de la Poileveu était évidente.
– En voilà une d’aventure ! murmurait-elle. Ah ça ! mais…
Elle s’arrêta souriante. Elle venait d’apercevoir à ses pieds la lettre… Elle la ramassa et lut.
– Tiens ! tiens ! tiens !… marmottait-elle, la petite dame s’appelle Sabine. Joli nom !… Ah !… elle est malade !… C’est donc ça qu’il est comme un fou ! C’est égal, j’ai idée que ce vieux si mal mis et si aimable qui est venu me questionner sur M. André me donnerait bien quelque chose de cette lettre… Ah ! mais non ! pour ça, non !… On est honnête ou on ne l’est pas.
XX
Lorsqu’elle disait que son artiste était devenu fou, la discrète Mme Poileveu ne semblait pas fort éloignée de la vérité.
Son opinion dut être celle de tous les gens qui aperçurent ce grand jeune homme, habillé de blanc, qui courait avec une incroyable rapidité le long des rues qui conduisent du quartier des Martyrs aux Champs-Élysées.
En sortant de sa maison, il avait croisé un fiacre vide dont le cocher lui avait fait un signe engageant ; la pensée d’y monter ne lui vint pas. Même il sourit de pitié. Est-ce que jamais les maigres rosses de la Compagnie auraient pu approcher de sa vitesse !
Il allait à fond de train, les coudes au corps, ménageant son haleine, guidé à travers la foule par le pur instinct machinal. Son visage avait une si étrange expression qu’on s’écartait devant lui, et qu’ensuite on se retournait pour le suivre des yeux.
Il n’avait, d’ailleurs, pas l’ombre d’un projet. Pourquoi il courait rue de Matignon, ce qu’il ferait ou dirait, il l’ignorait. Il ne se demandait pas s’il lui restait une espérance.
Sabine était malade, mourante, croyait-il ; il se rapprochait d’elle, voilà tout.
À chaque moment, dans Paris, on rencontre des gens qui vont ainsi, traversant la foule affairée sans la voir ni l’entendre, poussés par leur passion comme les boulets par l’explosion de la poudre.
C’est seulement en arrivant à l’entrée de la rue de Matignon, que André recouvra la faculté de réfléchir, de délibérer, de souffrir.
Autant pour recueillir ses idées que pour reprendre haleine, – il n’avait pas mis vingt minutes à faire ce trajet, – il s’assit sur une borne, à quelques pas de l’hôtel de Mussidan.
S’il était venu, c’est qu’il voulait des nouvelles précises, exactes, des détails. Mais comment s’en procurer, quel expédient imaginer ?
Il faisait nuit. Le mince filet de gaz des réverbères tremblotait rougeâtre et sans rayonnements au milieu d’un de ces brouillards de février qui suivent toutes les reprises des gelées.
Il faisait froid. La rue de Matignon, rarement animée, même de jour, était absolument déserte. Pas un fiacre, pas un passant, rien. Nul bruit que le roulement sourd et continu des voitures le long du faubourg Saint-Honoré.
Mais les pensées du jeune peintre étaient plus lugubres encore que cette nuit, que cette solitude, que ce silence.
Il reconnaissait avec un mortel désespoir son impuissance absolue. La moindre de ses démarches pouvait compromettre celle qui lui avait confié son honneur.
Il se leva, cependant, et alla se poster près de la grille de l’hôtel de Mussidan. Il espérait que l’aspect seul de l’hôtel lui apprendrait quelque chose. Il lui semblait que si véritablement Sabine était mourante, les pierres elles-mêmes le lui crieraient.
Triste folie ! La maison était comme perdue dans le brouillard, et il ne distinguait même pas quelles fenêtres étaient éclairées…
La voix de la raison lui disait de se retirer, d’espérer, d’attendre…
Plus impérieuse et plus pressante, la voix de la passion lui criait : – Reste !…
Et il s’obstinait à rester. Pourquoi ? Il ne savait. Il lui semblait que Modeste, lui ayant écrit, devait deviner qu’il était là, dévoré par les plus horribles angoisses, et qu’elle allait sortir, le chercher…
Mais voici que, tout à coup, il eut un cri de joie. Une idée de salut, pareille à l’éclair rayant la nuit, venait d’illuminer son cerveau.
– M. de Breulh !… s’écria-t-il. Ce que je ne puis, il le peut, lui ; il lui est facile d’envoyer prendre des nouvelles !…
Par bonheur, il avait dans sa poche la carte du généreux gentilhomme, tant bien que mal il déchiffra l’adresse et s’élança, comme un trait, dans la direction indiquée.
M. de Breulh-Faverlay occupe, avenue de l’Impératrice, un bel hôtel où il est fort mal, assure-t-il, et pour cent raisons. Mais ses chevaux y ont de l’air, de l’espace, ils y sont très bien… et il y reste.
Lorsque André pénétra dans la cour, une voiture y stationnait. Dans le vestibule, brillamment éclairé, quatre ou cinq domestiques causaient et riaient. Il alla droit à eux.
– M. de Breulh ?… demanda-t-il.
Les valets le toisèrent d’un œil à la fois curieux et surpris.
– Monsieur est sorti, répondirent-ils enfin, et pour longtemps.
André, qui avait retrouvé sa lucidité, comprit et n’insista pas. Il tira la carte de M. de Breulh, et rapidement y traça au crayon ces cinq mots :
« Une minute – un service – André. »
– Tenez, remettez ceci à votre maître dès qu’il sera rentré.
C’est lentement qu’il s’éloigna. Il était certain que M. de Breulh venait de rentrer ; il était sûr que, dès que la carte lui serait remise, il le ferait poursuivre, rattraper.
Ce qu’il prévoyait arriva, et, trois minutes plus tard, un laquais l’introduisait dans un magnifique cabinet de travail.
À la seule vue de André, M. de Breulh devina une catastrophe.
– Qu’y a-t-il ? demanda-t-il.
– Sabine se meurt, répondit le jeune peintre.
Et rapidement il raconta sa soirée, la lettre de Modeste, sa course folle à travers Paris, sa station douloureuse devant l’hôtel de Mussidan…
Mais, à sa grande surprise, à mesure qu’il parlait, le front de M. de Breulh se rembrunissait. Lorsqu’il eut fini :
– Cette incertitude est affreuse, intolérable et pourtant il ne dépend pas de moi de la faire cesser…
– Cependant…
– C’est ainsi, mon cher André… malheureusement ! Réfléchissez un peu : Hier j’ai écrit à M. de Mussidan pour lui signifier la rupture d’un mariage presque décidé… Envoyer prendre des nouvelles de la santé de sa fille serait la pire des outrecuidances, une impardonnable impertinence… Expédier un de mes domestiques serait dire : « Je me suis retiré, donc cette fille doit être sur le point de mourir de chagrin !… »
– C’est pourtant vrai ! murmura André abasourdi.
M. de Breulh était aussi agité que le peintre, et la preuve, c’est qu’avant de se désespérer, il ne se demandait pas jusqu’à quel point était fondées des craintes qu’il partageait d’instinct. Il réfléchissait, cherchant un expédient praticable.
– J’ai notre affaire !… s’écria-t-il enfin. Je suis un peu parent d’une jeune femme qui est la cousine germaine de Mussidan, la vicomtesse de Bois-d’Ardon ; elle sera ravie de nous rendre service. C’est une folle, mais elle a un cœur d’or… Ma voiture est attelée, venez vite…
Les valets étaient confondus de l’intimité qui semblait régner entre leur maître et ce jeune homme en blouse. Et lorsque la voiture s’éloigna, les emportant au galop, un vieux valet de pied, vétéran de la livrée émit cette opinion qu’il devait y avoir quelque chose là-dessous.
Pas un mot ne fut échangé entre les deux hommes, durant le trajet, qui fut très court – l’hôtel habité par Mme de Bois-d’Ardon, ayant sa façade sur l’avenue des Champs-Élysées.
La voiture n’était pas arrêtée que déjà M. de Breulh était à terre.
– Attendez-moi là, dit-il à André, je reviens.
D’un bond il fut dans la maison.
– Madame ?… demanda-t-il aux domestiques qui le connaissaient.
– Madame reçoit.
Blanche, dodue, fraîche, souriante, blonde naturellement, rouge grâce à un artifice de toilette, – ah ! la mode ! – ayant les plus jolis yeux du monde, Mme de Bois-d’Ardon passe pour une des plus agréables femmes de Paris.
Elle a trente ans. Elle sait tout, connaît tout, a tout vu, ne doute de rien, parle sans cesse, rencontre l’esprit souvent et la méchanceté toujours. On la dit très redoutable.
Elle dépense quarante mille francs par an pour sa toilette, mais quand elle dit à son mari : « Je n’ai pas une robe à me mettre sur le dos, » elle dit vrai. Elle est gâcheuse.
Capables des plus insignes imprudences, d’escapades inouïes, elle est fort calomniée. On lui prête libéralement des amants à la douzaine, jamais elle n’en a eu un seul.
Avec ses allures incroyables, en dépit des vertiges de sa vie tourbillonnante, elle adore son mari et le craint comme le feu.
Lui le sait et ne s’en vante pas ; c’est un sage. Il laisse bien la vicomtesse s’agiter dans le vide, comme la marionnette au bout d’un fil, mais il tient ce fil d’une main ferme…
Telle est en toute vérité la femme vers laquelle un valet, en livrée trop voyante, guidait M. de Breulh.
Mme la vicomtesse de Bois-d’Ardon était dans un ravissant petit salon attenant à sa chambre à coucher, quand on lui annonça M. de Breulh-Faverlay.
Elle venait de mettre les dernières épingles à sa toilette, la cinquième seulement de la journée.
Pour tuer le temps, elle examinait un costume coquet de vivandière Louis XV – chef d’œuvre de Van Klopen – qu’elle devait revêtir en sortant des Italiens pour se rendre à un bal travesti à l’ambassade d’Autriche.
À la vue de M. de Breulh, elle eut une exclamation de plaisir et battit gaiement des mains.
Quoique se voyant rarement ailleurs que dans le monde, M. de Breulh et la vicomtesse s’aimaient beaucoup. Lorsqu’ils étaient plus jeunes l’un et l’autre, ils avaient passé bien des mois ensemble, au château de leur oncle, le vieux comte de Faverlay.
Ils avaient gardé de leurs relations d’enfance une affectueuse familiarité, ils s’appelaient par leurs prénoms.
– Comment, c’est vous, Gontran ! s’écria la jeune femme, à cette heure, chez moi !… Mais c’est un fait inexplicable et bizarre, un miracle, un rêve…
Elle s’interrompit brusquement, frappée de la physionomie bouleversée de son visiteur.
– Mais qu’avez-vous ! interrogea-t-elle, votre mine est funèbre, vous est-il arrivé quelque malheur ?
– J’espère encore que non, mais je suis horriblement inquiet : on vient de m’apprendre que Mme de Mussidan est dangereusement malade.
– Ah !… mon Dieu !… je m’explique votre chagrin. Et qu’a-t-elle, cette pauvre Sabine ?
– Je l’ignore, et c’est là ce qui m’amène. Je viens, ma chère Clotilde, vous prier d’envoyer un de vos gens à l’hôtel Mussidan s’informer de ce qu’il y a de vrai dans ce qu’on m’a dit.
Mme de Bois-d’Ardon ouvrait de grands yeux.
– Plaisantez-vous ! fit-elle. Pourquoi ne pas envoyer vous-même ?
– Je ne puis. Et, tenez, si vous êtes charitable, ne me demandez pas mes raisons. D’abord, je vous mentirais… De plus, je vous conjure de ne parler à personne de ma démarche.
Si oppressée de curiosité que fût la jeune femme, elle n’interrogea pas.
– Soit, répondit-elle, je respecte votre secret. Seulement, vous pensez bien que j’irai moi-même chez Octave. Je partirais à l’instant, n’était que Bois-d’Ardon, qui ne peut souffrir de manger seul, me gronderait. Mais en sortant de table, je me mets en route.
– Merci, mille fois merci. Cela étant, je rentre chez moi attendre un mot de vous.
– Chez vous ? Oh !… pour cela non. Vous dînez ici.
– Impossible, un de mes amis m’attend en bas.
À l’accent de M. de Breulh, la vicomtesse comprit qu’insister serait parfaitement inutile, elle se tint pour battue, elle se promettait bien de prendre sa revanche. Elle flairait vaguement une énigme et elle se jurait de la déchiffrer.
– Puisque c’est ainsi, fit-elle du ton le plus détaché, je vous promets une lettre dans la soirée… Et maintenant, allez vite rejoindre votre ami.
M. de Breulh serra affectueusement la main de la jeune femme et se hâta de descendre.
Dès qu’il sortit de la maison, André courut à lui.
– Eh bien ?
Si courte qu’eût été l’absence de son compagnon, le jeune peintre n’avait pas eu la patience de l’attendre dans la voiture ; il piétinait fiévreusement sur le trottoir.
– Reprenez courage, répondit M. de Breulh, Mme de Bois-d’Ardon n’a pas été informée de la maladie de Mlle Sabine, c’est bon signe. En tout cas, avant trois heures, nous aurons des nouvelles précises.
– Trois heures !… soupira André, du même ton qu’il eût dit : Trois siècles !…
– Oui, c’est long, je le sais, mais nous parlerons d’elle en attendant. Car nous ne nous quittons pas, je vous emmène, vous partagerez mon dîner.
André fit un signe d’assentiment, et reprit sa place dans le coupé, qui rebroussa chemin au galop.
Il n’est pas d’énergie qui résiste à plusieurs heures d’angoisses et de luttes.
André, depuis le matin, avait eu plus d’émotions peut-être qu’en toute sa vie. Après une exaltation voisine de la folie, il se laissait aller à cet invincible engourdissement qui suit toutes les crises douloureuses.
Les gens de M. de Breulh avaient été bien surpris lorsque leur maître était sorti avec ce grand jeune homme en blouse blanche. Ils furent stupéfaits de les voir rentrer ensemble.
L’aventure, enfin, prit des proportions fantastiques quand ils virent le hautain gentilhomme qu’ils servaient s’asseoir en face d’André dans la magnifique salle à manger et faire retirer jusqu’au maître d’hôtel pour causer plus librement.
La chère était exquise, mais les convives étaient trop émus pour y faire honneur. C’est presque machinalement qu’ils remuaient leur couteau et leur fourchette ; ils ne mangeaient ni ne buvaient.
À dix reprises, ils essayèrent d’aborder des sujets étrangers à leur préoccupation ; dix fois, après quelques monosyllabes, la conversation tomba.
Ils reconnurent si bien l’inutilité de leurs efforts, qu’étant passés, après le dîner, dans le cabinet de M. de Breulh, où le café avait été servi, ils gardèrent le silence, chacun s’enfonçant dans ses réflexions.
Leur situation, après les explications de l’après-midi, était au moins extraordinaire. Mais l’entraînement des événements est tel, qu’ils ne le remarquaient pas.
André, qui était allé s’asseoir dans un coin, ne quittait pas la pendule des yeux. M. de Breulh, installé près de la cheminée, tracassait le feu.
Enfin, sur les dix heures, ils entendirent du bruit dans le vestibule, des chuchotements, le frou-frou d’une robe de soie.
M. de Breulh se levait, quand la porte s’ouvrit brusquement.
Mme de Bois-d’Ardon, en personne, entra comme un ouragan.
– C’est moi !… fit-elle dès le seuil.
La démarche était un peu plus que hardie. Mais la vicomtesse n’en était pas à une extravagance près.
– Si j’ose venir chez vous, Gontran, reprit-elle avec une véhémence extraordinaire, c’est que je tiens à vous dire en face ce que je pense de votre conduite : elle est abominable, indigne d’un galant homme !…
– Clotilde !…
– Taisez-vous, vous êtes un monstre. Ah !… je comprends que vous n’ayez pas osé envoyer prendre des nouvelles de la pauvre Sabine. Vous aviez prévu l’effet de votre lettre.
M. de Breulh eut un sourire, et se retournant vers André :
– Que vous avais-je dit ? fit-il.
Il fallut cette observation pour que Mme de Bois-d’Ardon s’aperçut de la présence d’un étranger. Elle pensa qu’elle venait de commettre une horrible indiscrétion.
– Ah ! mon Dieu !… s’écria-t-elle en se reculant instinctivement, et moi qui vous croyais seul.
– C’est au moins comme si je l’étais, répondit gravement M. de Breulh, monsieur est un de ces amis pour qui on n’a pas de secrets.
Il prit en même temps la main de André, et l’attirant près de la vicomtesse :
– Permettez, ma chère Clotilde, ajouta-t-il, que je vous présente M. André, un peintre dont le nom, inconnu aujourd’hui, sera célèbre demain.
André s’inclina profondément, mais la vicomtesse était si stupéfaite qu’elle resta court.
– Monsieur, balbutia-t-elle, cherchant quelque chose à dire, monsieur…
Le costume de cet ami intime la confondait. Puis, pourquoi cette singulière présentation ?
– Enfin, reprit M. de Breulh, on ne nous a pas trompés, – il insista sur le nous, – Mlle de Mussidan est véritablement malade.
– Hélas !…
– Vous l’avez vue ?
– Oui, je l’ai vue, Gontran. Ah ! que n’étiez-vous avec moi pour regretter cette fatale rupture. Pauvre Sabine !… Elle en m’a pas reconnue lorsque je suis entrée dans sa chambre, m’a-t-elle vue, seulement ?
Elle est dans son lit, plus blanche que les draps, froide et immobile comme une statue, les yeux grands ouverts, sans chaleur, sans expression. Pas une parole, pas un mouvement, rien ! Et voilà plus de vingt-quatre heures qu’elle est ainsi. On la croirait morte, m’a dit sa mère, n’étaient de grosses larmes qui, par moments, glissent le long de ses joues…
André s’était promis de se maîtriser quand même, en présence de Mme de Bois-d’Ardon. Mais en apprenant la désolante vérité, son émotion fut plus forte que sa volonté, et il fut impossible d’étouffer les sanglots qui lui montaient à la gorge.
– Ah !… elle est perdue, s’écria-t-il, je le sens bien…
L’explosion de sa douleur était si déchirante que l’insoucieuse vicomtesse se sentit le cœur serré.
– Je vous assure, monsieur, répondit-elle, que vous vous exagérez la gravité de la situation. Il n’y a nul danger, au moins pour le moment. Les médecins disent que c’est une sorte de catalepsie… Il paraît qu’on a fréquemment observé des accidents pareils chez des personnes nerveuses, sous le coup de quelque catastrophe inattendue, après un grand chagrin…
– Mais quel chagrin ? insista André.
Mme de Bois-d’Ardon ne répondit pas. Elle s’était retournée vers M. de Breulh et ses regards brillants de la curiosité la plus vive suppliaient.
Comment ce jeune homme qui semblait un ouvrier se trouvait-il là ? D’où venait cet intérêt extraordinaire qu’il portait à Sabine ?
– Mon Dieu !… répondit-elle enfin, personne ne m’a dit que la maladie de Sabine fût causée par la rupture de son mariage, mais je l’ai supposé…
– Non, interrompit M. de Breulh, ce ne peut être cela.
– Cependant…
– J’en suis sûr, et mes sérieuses alarmes viennent de cette certitude. Que s’est-il passé ? Vous ne vous êtes donc pas informée, Clotilde, on ne vous a donc rien dit ?
L’assurance extraordinaire de M. de Breulh, un regard d’intelligence surpris entre André et lui, commençaient à éclairer la vicomtesse.
– Vous pensez bien que j’ai interrogé, répondit-elle. D’abord, moi, je déteste les cachotteries. Mais les réponses ont été très vagues. Si Sabine ressemble à une morte, Octave et sa femme, près du lit de leur fille, ont l’air de deux spectres. Ils l’auraient tuée de leurs mains qu’ils ne seraient pas dans un plus affreux état. Ils se regardent avec des yeux si effrayants qu’ils m’ont fait peur. Maintenant, après vos affirmations, je jurerais qu’on ne ma pas tout avoué, car, voyez-vous…
M. de Breulh ne prit point la peine de dissimuler un geste d’impatience.
– Enfin ! interrompit-il, qu’a-t-on répondu à vos questions ?
– Le voici exactement : D’abord, toute la matinée, Sabine a paru si extraordinairement agitée que sa mère lui a demandé si elle n’était pas souffrante.
– Nous le savons ; nous savons aussi pourquoi elle était ainsi.
– Ah ! fit la vicomtesse stupéfaite, alors je passe. Dans l’après-midi, vous êtes resté une demi-heure environ avec Sabine. Où est-elle allée en vous quittant ? On l’ignore. Il est prouvé seulement qu’aucune lettre ne lui a été remise, qu’elle n’est pas sortie de l’hôtel… Toujours est-il qu’une heure plus tard elle est remontée à sa chambre, où se trouvait une fille qui la sert et qui lui est extrêmement attachée, Modeste. Sabine avait la figure absolument décomposée et balbutiait des mots inintelligibles. Voyant qu’elle chancelait, Modeste courut à elle. Trop tard. Sabine est tombée à terre en poussant un cri déchirant. On l’a relevée et couchée, et depuis elle est dans l’état que je vous ai dit, elle n’a pas repris connaissance, elle n’a ni prononcé une parole ni fait un mouvement.
On eût dit la vie d’André suspendue aux lèvres de Mme de Bois-d’Ardon. Pour lui, ce n’était pas un récit. Grâce à ce phénomène magique de l’imagination, qui supprime le temps et l’espace, il assistait aux scènes décrites, il voyait Sabine à terre, il la voyait sur son lit immobile et glacée.
Plus maître de soi, n’ayant pas la passion qui exaltait André jusqu’au délire, M. de Breulh écoutait moins la jeune femme qu’il ne s’efforçait de pénétrer sa pensée intime.
– Et c’est là tout ? demanda-t-il d’un ton singulier.
– Mais oui, répondit la vicomtesse, c’est tout.
– Le jureriez-vous ?
La jeune femme tressaillit, et son hésitation fut visible.
– Comme vous me dites cela ? fit-elle avec un sourire forcé ; comme vous me regardez !… Savez-vous que vous feriez un excellent juge d’instruction.
– Peut-être, dit M. de Breulh, peut-être…
Il s’interrompit. Mille soupçons vagues, et qu’il lui eût été difficile de formuler, assiégeaient son esprit.
Il avait, lui, l’expérience de la vie, il savait, pour l’avoir appris à ses dépens, qu’il faut surtout se défier de ces apparences trompeuses que les imbéciles appellent l’évidence des faits.
Cependant, au moment de prendre un parti fort grave, il hésitait, il en calculait les conséquences, et, pour cacher ses irrésolutions, il se mit à arpenter son cabinet d’un pas saccadé.
Après une minute du silence le plus gênant, il s’arrêta brusquement devant la vicomtesse qui s’était assise au coin du feu.
– Ma chère Clotilde, commença-t-il d’un ton solennel, je ne vous apprendrai rien en vous disant que vous avez été souvent calomniée.
– Bast !… je laisse dire…
– Mais je vous déclare que je vous juge bien autrement que le monde. Vous êtes l’imprudence même ; votre présence chez moi, à cette heure, en est une preuve ; vous êtes mondaine, frivole, étourdie, un peu… folle… Mais vous êtes aussi, je le sais, une brave et digne femme, et vous avez bon cœur.
La vicomtesse, dont la timidité n’est pas le défaut, paraissait absolument déconcertée.
– Ah ça !… balbutia-t-elle, où voulez-vous en venir ?
– À ceci, ma chère Clotilde, qu’on peut, n’est-ce pas, sans courir le moindre risque, vous confier un secret d’où dépendent l’honneur et peut-être la vie de plusieurs personnes ?
Beaucoup plus émue encore qu’elle ne le semblait, Mme de Bois-d’Ardon se leva.
– Je vous remercie, Gontran, répondit-elle simplement, vous m’avez bien jugée.
Mais André, qui comprenait enfin les intentions de M. de Breulh, s’avança tout à coup :
– Avez-vous bien le droit de parler, monsieur, demanda-t-il.
M. de Breulh lui prit la main qu’il garda un moment entre les siennes.
– Mon ami André, répondit-il, mon honneur, en cette circonstance, est aussi bien en cause que le vôtre. Manqueriez-vous de confiance ?
Puis, se retournant vers Mme de Bois-d’Ardon :
– Dites-nous le reste… fit-il. Je parlerai après.
– Oh ?… le reste, commença la jeune femme, est bien peu de chose, et c’est de Modeste que je le tiens. Vous étiez à peine sorti de l’hôtel de Mussidan, que M. de Clinchan est arrivé…
– Clinchan !… un vieux maniaque, n’est-ce pas, qui est l’ami intime du comte ?
– Précisément. Ils ont eu ensemble une… comment dire ? une altercation si terrible, qu’à la fin M. de Clinchan s’est trouvé mal, qu’il a fallu l’inonder d’eau de mélisse, et qu’à grand peine il a pu regagner sa voiture au bras d’un domestique.
– Ah !… c’est déjà un indice, cela.
– Attendez… Le Clinchan parti, Octave et sa femme ont eu une discussion de la dernière violence. Vous connaissez mon cher cousin. Les éclats de sa voix faisaient trembler la maison. C’est pendant cette scène que Sabine est arrivée mourante dans sa chambre. Modeste croit qu’elle aura entendu quelque chose.
Il n’était pas un mot de ce récit qui ne fortifiât un des soupçons de M. de Breulh.
– Vous voyez bien, ma chère Clotilde, s’écria-t-il, qu’il y a quelque chose, et vous direz comme moi quand vous saurez tout.
Et aussitôt, brièvement, clairement, sans omettre un détail important, il raconta l’histoire de André et de Sabine, et la sienne aussi.
Pendant que parlait M. de Breulh, Mme de Bois-d’Ardon frissonnait un peu de peur, un peu de plaisir. Elle allait donc pouvoir satisfaire, en tout bien tout honneur, cette passion d’anxiété qui tourmente les femmes inoccupées et qui souvent est la cause de leurs pires folies.
Lorsque M. de Breulh eut fini, la vicomtesse lui tendit la main.
– Pardonnez-moi mes injustes reproches, mon bon Gontran, dit-elle. Maintenant je suis de votre avis. Oui, il y a quelque chose.
– Et quelque chose qui doit être pour notre ami André un obstacle de plus.
– Oh !… demanda le jeune peintre, pourquoi cela ?
– Je ne sais rien. Ce n’est qu’un pressentiment, je n’ai pas de preuves, et pourtant je ne doute pas. Or, notez bien ceci, ajouta-t-il d’un ton menaçant, j’ai pu, sur les prières d’une jeune fille sublime, me retirer devant vous… je ne veux pas avoir ouvert le champ aux prétentions d’un autre. Mlle de Mussidan ne pouvant être ma femme… il faut qu’elle soit la vôtre.
– Oui, murmura la vicomtesse ; mais comment deviner ce qui s’est passé ?
– Nous le découvrirons, ma chère Clotilde… si vous êtes pour nous, si vous consentez à nous aider.
Il n’est pas de femme, jeune ou vieille, que n’enchante la perspective d’avoir à s’occuper d’un mariage.
Mme de Bois-d’Ardon fut ravie à la seule idée d’avoir à servir une passion si noble et si pure, et dont les commencements étaient si romanesques.
Loin de la décourager, les obstacles qu’elle découvrait irritaient sa vaillance. Ne lui fourniraient-ils pas l’occasion de prouver une fois de plus la supériorité de la pénétration et de la diplomatie féminines ? Il lui faudrait lutter, se cacher, négocier, s’entourer de précautions et de mystères… Quelle joie !
– Je suis absolument à votre disposition, mon cher Gontran, dit-elle. Avez-vous un projet ?
Non, M. de Breulh n’avait pas de projet, mais il cherchait.
– Avec Mlle de Mussidan, commença-t-il, on aurait tort de ne pas agir franchement. Adressons-nous à elle directement. Notre ami André va lui écrire pour lui demander une explication, et si demain elle va mieux, comme il faut l’espérer, vous lui remettrez la lettre.
La proposition était… vive, la commission étrange ; mais c’est, certes, ce dont se préoccupa le moins la vicomtesse.
– Mauvais moyen ! fit-elle d’un petit air capable qui lui seyait à merveille, très mauvais moyen !
– Vous croyez ?
– J’en suis sûre. Au surplus. M. André nous écoute ; qu’il juge.
André écoutait en effet. Il avait pu paraître brisé par la violence de ses sensations, mais il n’était pas de ceux qui abdiquent leur libre arbitre, et qui, aux moments décisifs, s’abandonnent aux inspirations d’autrui.
Interpellé par Mme de Bois-d’Ardon, il s’avança.
– Je pense, répondit-il, que madame a raison. Apprendre brusquement à Mlle de Mussidan que nous avons disposé d’un secret qui est le sien plus que le nôtre, serait une imprudence.
La vicomtesse approuva du geste.
– Il est un expédient plus simple et plus sûr, continua le peintre. Si demain matin, madame la vicomtesse veut bien prier Modeste de se trouver au coin de la rue et de l’avenue de Matignon, elle m’y trouvera, j’y serai, et j’aurai par elle les renseignements les plus précis.
– À la bonne heure !… déclara Mme de Bois-d’Ardon, voilà qui est sage !… Demain, monsieur André, de bon matin, je serai chez Octave et vos intentions seront fidèlement remplies…
Elle s’arrêta court et laissa échapper un petit cri de jolie femme effrayée. Son regard venait de tomber sur la pendule qui marquait minuit moins vingt minutes.
– Ah !… Seigneur !… s’écria-t-elle, en se dressant brusquement, et moi qui vais à l’ambassade d’Autriche et qui ne suis pas habillée !…
Aussitôt, d’un geste coquet, elle ramena son grand cachemire sur ses épaules et s’élança dehors en criant :
– À demain, Gontran, je m’arrêterai chez vous en allant au Bois.
Ce fut si prestement fait, que M. de Breulh n’eut le temps ni de sonner pour qu’on l’éclairât, ni de la reconduire. Il sortit, elle était déjà loin.
Plus tranquille désormais, André et M. de Breulh restèrent longtemps encore à causer au coin du feu, expansifs comme des gens qui, ayant souffert ensemble, poursuivent un but commun.
Au matin, ils ne se connaissaient pas. Lorsqu’ils se séparèrent, ils étaient comme deux vieux amis dont l’affection, basée sur une estime inébranlable, ne compte plus les services reçus ou rendus.
M. de Breulh avait offert à André de le faire conduire en voiture, mais le jeune peintre refusa, demandant seulement une coiffure et un paletot, qu’il passa sur sa blouse blanche.
– Demain, murmura-t-il en se retirant, demain Modeste me donnera des détails… Pourvu toutefois que cette femme si excellente et si légère ne m’oublie pas.
Mais Mme de Bois-d’Ardon – ainsi qu’elle se plaît à l’affirmer – sait être sérieuse à l’occasion. En rentrant du bal, elle ne se coucha pas, afin d’être avant dix heures chez M. de Mussidan.
Aussi, lorsqu’à midi André arriva au rendez-vous, il aperçut Modeste qui déjà l’attendait.
La brave fille avait une mine de déterrée. Ses joues blêmes, ses yeux rougis disaient qu’elle avait ressenti le contrecoup de toutes les douleurs de son adorée maîtresse.
Sabine n’avait pas repris connaissance. Le médecin de la maison ne paraissait pas inquiet, mais il demandait une consultation.
Voilà ce que tout d’abord Modeste apprit à André. Mais à ses pressantes questions, elle ne put rien répondre ; elle avait bien réellement dit à la vicomtesse tout ce qu’elle savait.
Cependant la conversation entre eux fut longue, et en se quittant ils convinrent de se rencontrer matin et soir à la même place.
Pendant deux jours encore, la situation de Sabine resta la même. André menait une existence affreuse. Il passait sa vie à courir de chez lui rue de Matignon, et de là chez M. de Breulh, où il rencontrait souvent Mme de Bois-d’Ardon.
Enfin le troisième jour, au matin, il trouva Modeste plus désolée.
La catalepsie avait cessé, mais maintenant Sabine se débattait contre les convulsions d’une fièvre nerveuse.
La fidèle femme de chambre et André étaient si bien isolés par leur douleur, qu’ils ne virent pas passer près d’eux des domestiques de l’hôtel de Mussidan, le beau Florestan, qui allait jeter à la poste une lettre à l’adresse de B. Mascarot.
– Écoutez, Modeste, interrompit André d’une voix à peine distincte ; elle est en danger, en grand danger, n’est-ce pas ?
– Le médecin a dit qu’une crise pareille ne peut se prolonger. Avant la fin de la journée, on saura : Revenez à cinq heures.
André s’éloigna de ce pas rapide, particulier aux infortunés qui ont perdu la raison. Il délirait quand il arriva chez M. de Breulh. L’idée que Sabine se mourait peut-être, et qu’il ne pouvait recueillir le dernier soupir de cette âme qui avait été toute à lui, le transportait jusqu’à la fureur.
Il perdait si bien la tête, que le moment venu d’aller chercher des nouvelles qui semblaient devoir être fatales, M. de Breulh insista pour l’accompagner.
Comme ils quittaient la contre-allée de l’avenue, ils virent une femme, Modeste, qui accourait vers eux.
– Elle dort, cria-t-elle, le médecin dit qu’elle est sauvée.
André chancelait, et M. de Breulh fut obligé de le soutenir jusqu’à un banc, sur lequel il tomba mourant…
Ils ne se doutaient pas qu’ils étaient observés.
À vingt pas du banc, deux hommes, B. Mascarot et le beau Florestan, épiaient tous leurs mouvements.
Tiré de sa trompeuse sécurité par le billet trop laconique de Florestan, l’honorable placeur, en sortant de chez lui, s’était emparé sans façon du coupé du docteur Hortebize.
Le cheval, un trotteur de premier ordre n’avait pas mis un quart d’heure à franchir la distance assez considérable qui sépare la rue Montorgueil du faubourg Saint-Honoré.
Cependant l’anxiété de B. Mascarot était si pressante, que dix fois le long de la route, et bien que la voiture brûlât le pavé, il se pencha hors de la portière, pour crier au cocher :
– Nous ne marchons pas.
C’est devant l’établissement du père Canon, ce protecteur éclairé du cor de chasse, que le placeur se fit arrêter.
Fait surprenant ! C’était l’heure de l’absinthe, et cependant Florestan n’était pas chez le marchand de vin.
– Il va venir, répondit-on.
Mais B. Mascarot, incapable de supporter une plus longue incertitude, l’envoya chercher à l’hôtel de Mussidan, et il accourut.
Lorsque le beau domestique l’eut informé de la crise heureuse qui était survenue, et qui, très probablement, assurait le salut de Sabine, alors seulement le placeur respira.
Depuis un moment il se demandait si le patient et fragile édifice de vingt années d’intrigues n’était pas brisé en mille pièces.
Par exemple, il fronça le sourcil lorsque Florestan le mit au fait des entrevues quotidiennes de Modeste et de ce jeune homme, qu’il appelait l’amoureux de Mademoiselle.
– Ah ! murmura-t-il, que ne puis-je assister, fût-ce de loin, à ces rendez-vous !
Mais il me semble que rien n’est plus facile, répondit Florestan.
Et tirant de son gousset une ravissante petite montre d’or qui devait être un présent de l’amour, il ajouta :
– C’est à cette heure-ci, à peu près, que nos gens se retrouvent, toujours au même endroit, par conséquent, papa, si le cœur vous en dit…
– Oui, sortons.
Ils sortirent aussitôt, et craignant d’être aperçus ensemble, pour plus de sûreté, c’est par la rue du Cirque qu’ils gagnèrent les Champs-Élysées.
Pour eux, l’endroit était favorable. Non loin du trottoir de l’avenue de Matignon, du côté du Cirque de l’Impératrice, s’élevait une demi-douzaine de ces petites boutiques en planches, où, l’été, de vieilles femmes vendent des jouets et des gâteaux poussiéreux.
– Nous serons divinement derrière une de ces baraques, proposa Florestan.
La nuit tombait. Déjà des allumeurs de réverbères avec leur petite lanterne au bout d’une longue percher passaient en courant pour aller commencer leur besogne en haut de l’avenue. Cependant, on distinguait encore très nettement les objets et les personnes.
Il y avait environ cinq minutes que l’honorable placeur était à l’affût, lorsque son digne compagnon le poussa vivement du coude :
– Attention !… disait-il, voici Modeste… pourvu qu’elle ne s’avise pas de venir de notre côté !… Non… elle prend sa course… Tiens !… l’amoureux est avec un de ses amis, ce soir. Allons, bon, on dirait qu’il se trouve mal !… Heureusement l’autre le soutient. Voyez-vous, papa ?…
B. Mascarot ne voyait que trop. Cette scène, qui trahissait la plus ardente passion, lui causait un vif déplaisir.
S’attaquer au bonheur d’un homme qui aime véritablement et se sait aimé est toujours périlleux.
– Ainsi, demanda le placeur, c’est bien ce grand brun qui se pâme comme une carpe sur ce banc qui est l’adorateur de la demoiselle ?…
– Vous l’avez dit.
– Décidément, murmura B. Mascarot, il faut savoir au juste qui est ce gaillard-là !
Florestan prit son air le plus diplomatique, et ricana d’un petit ton friand :
– Eh ! eh !…
– Tu le connais ? interrogea vivement le placeur.
– Allons, papa Mascarot, répondit le beau domestique, ne vous emportez pas, on va tout vous dire sans vous faire languir. Vous êtes un bon enfant, vous !… Donc, avant-hier, je fumais ma pipe devant la grille de l’hôtel, quand je vois passer notre jeune coq. Dame ! il avait la crête basse ! Mais je comprends ça. Si ma connaissance tombait malade, je serais tout chose…
Bref, n’ayant rien à faire, je me dis : « Toi, je saurai qui tu es. » Et là-dessus, je me mets à le suivre, les mains dans mes poches. Il marche, il marche… moi aussi, naturellement. Enfin il entre dans une maison. Bon ! J’entre derrière lui une minute après. Je vais droit à la portière, et lui montrant ma blague que j’avais tirée de ma poche, je lui dis : « Voici ce que vient de perdre le jeune homme qui monte, le connaissez-vous ? » – Certainement, répond-elle, c’est l’artiste du quatrième, M. André !…
– Mais cela se passait rue de la Tour-d’Auvergne, n°… interrompit B. Mascarot.
– Juste !… répondit le beau domestique abasourdi. Ah !… vous me faites poser, vous êtes mieux informé que moi.
Non, l’honorable placeur ne faisait pas poser Florestan.
Lui-même, il était confondu de l’étrange insistance du hasard à pousser ce jeune homme à travers ses combinaisons.
Le lendemain du jour où la cuisinière de Rose – devenue de par le jeune Gaston de Gandelu la vicomtesse Zora – lui avait parlé d’un artiste connaissant le passé de Rose et de Paul Violaine, et pouvant le raconter, il s’était mis sur ses gardes.
Tantaine était allé aux informations et était arrivé jusqu’à Mme Poileveu, c’est-à-dire jusqu’à André.
Aujourd’hui, cet amoureux de Mlle de Mussidan, si gênant pour le présent, et qui pouvait devenir si menaçant, se trouvait être ce même André.
– Au moins, demanda B. Mascarot au beau domestique, as-tu redemandé ta blague à la concierge ?
– Ma foi, non. J’avais dit que je venais de la trouver, je la lui ai laissée. Je m’en moque : je n’y tenais pas.
– Imprudent ! s’écria le placeur, fou !…
– Moi !… pourquoi ?
B. Mascarot hésita une minute et finit par répondre :
– Pour rien !…
La vérité, il ne pouvait pas la dire à Florestan.
La vérité est qu’il était aussi mécontent que possible en songeant que cette preuve d’investigations qu’il n’avait pas ordonnées resterait entre les mains de la Poileveu.
Il faut si peu de choses pour mettre un homme habile sur la voie de l’intrigue la plus compliquée !
N’a-t-il pas suffi à Canler d’un chiffon de papier qui avait enveloppé une chandelle pour remonter jusqu’à la bande de la rue Saint-Denis ?
C’est une pincée de cendre de cigare trouvée sur le marbre d’une cheminée qui a livré Corvinsi à M. Lecoq.
– Voilà, murmura-t-il, si bas que Florestan ne put l’entendre, de ces inepties qui ne se réparent pas…
Mais il s’arrêta pour concentrer sur André toute son attention. Le jeune peintre était revenu à lui, il s’était redressé et il causait avec une animation singulière. Il devait dire des choses très fortes, car Modeste en paraissait effrayée et levait les bras au ciel.
– Ah ça ! maintenant, reprit B. Mascarot, qui est l’autre, qui a un peu l’air d’un Anglais !
– Quoi ! vous ne connaissez pas M. de Breulh-Faverlay.
– De Breulh !… Celui qui…
– Celui qui devait épouser Mademoiselle… précisément.
L’honorable placeur était ce ces redoutables aventuriers que rien déconcerte ni n’étonne, toujours prêts à tout, qu’un coup de poignard dans le dos fait à peine retourner ; cependant, il ne fut pas maître d’un mouvement de terreur, et laissa échapper un effroyable juron.
– Tonnerre du ciel !… s’écria-t-il, Breulh et André sont donc amis ?…
– Ah !… pour ça, vous n’en savez rien ni moi non plus, papa, vous êtes trop curieux !
Il fallait que B. Mascarot fût hors de son sang-froid pour demander cela. Tout dans l’attitude de ces deux hommes décelait une grande intimité.
Modeste venait de les quitter, et ils s’éloignaient dans la direction de l’avenue de l’Impératrice, se tenant familièrement par le bras.
– Je vois, reprit le placeur, que M. de Breulh se console d’avoir été congédié.
– Congédié !… lui !… Je ne vous ai donc pas dit ?… Mais, au fait, non. Eh bien ! c’est M. de Breulh qui a écrit pour retirer sa demande.
Cette fois, B. Mascarot eut la force de garder le secret du coup terrible qui lui était porté. C’est même d’un air riant, qu’après quelques questions encore il se sépara de Florestan.
Mais il était affreusement bouleversé. Après avoir cru sa partie gagnée, il la voyait, non perdue, mais compromise.
– Quoi !… grondait-il, les poings crispés par la colère, lorsque je touche au but, la sotte passion d’un enfant m’arrêterait !… Non, cela ne sera pas !… Il faut que j’arrive. Je le trouve en travers de mon chemin… Tant pis pour lui !
XXI
Il y a longtemps que le digne docteur Hortebize a renoncé à discuter les volontés de B. Mascarot.
Baptistin ordonne, il obéit, – Cela lui donne bien moins de peine.
L’honorable placeur lui avait recommandé de ne pas perdre Paul de vue ; il ne l’avait pas abandonné une minute.
Successivement, il l’avait conduit chez M. Martin-Rigal, où ils avaient dîné, bien que le banquier fût absent, puis à son cercle, puis chez lui, où il avait fini par lui faire accepter un lit.
Ayant veillé fort avant dans la nuit, M. Hortebize et son disciple s’étaient levés tard.
Cependant, vers onze heures, ils avaient terminé leur toilette et s’apprêtaient à faire honneur à un excellent déjeuner, quand le domestique annonça M. Tantaine.
Sur ses talons, le bonhomme parut dans la salle à manger, l’échine ployée en arc, toujours souriant et débonnaire.
À la vue de ce protecteur fatal, Paul sentit tout son sang bouillonner dans ses veines.
Brusquement il se dressa rouge comme le feu, l’œil flamboyant de colère, si menaçant qu’on eût dit qu’il allait se jeter sur le vieux clerc d’huissier.
– Enfin, je vous retrouve, monsieur !… s’écria-t-il, nous avons un compte à régler !…
Le bon père Tantaine semblait tomber des nues.
– Un compte !… demanda-t-il.
– Oui, monsieur, oui !… Nierez-vous que c’est grâce à vos manœuvres perfides que j’ai été accusé de vol par Mme Loupias ?
– Et après ?
– N’est-ce pas vous qui êtes venu à moi ?
L’ancien clerc d’huissier haussa les épaules.
– Je supposais, répondit-il d’un ton de miel, que M. Baptistin vous avait tout expliqué ; je croyais que vous vouliez épouser Mlle Flavie… On m’avait dit que vous étiez un jeune homme rempli d’intelligence et de pénétration !…
Le docteur ne se gênait pas pour rire. Paul comprit qu’en effet, sa tardive indignation était bien ridicule, il baissa la tête et se rassit, humilié et confus.
– Si je vous dérange, monsieur le docteur, reprit le père Tantaine, c’est que je vous suis dépêché par le patron.
– Il y a du nouveau ?
– Oui et non. D’abord Mlle de Mussidan est hors de danger. Son était hier soir était plus rassurant ; ce matin, elle va tout à fait mieux. M. de Croisenois peut poser sa candidature. Il a bien surgi un obstacle de ce côté, mais on le supprimera.
Le docteur avala une gorgée de son excellent bordeaux, fit claquer ses lèvres, et dit :
– En ce cas… au mariage de ce cher marquis et de Mlle Sabine.
– Amen, répondit le doux Tantaine. Autre chose : M. Paul est prié de ne pas quitter M. Hortebize. Il enverra prendre ses effets à l’hôtel où il loge et s’installera ici…
Le docteur eut une grimace si significative, que Tantaine s’empressa d’ajouter :
– Oh !… provisoirement. J’ai mission de louer et de meubler pour monsieur un petit appartement. Il ne peut rester en garni, c’est trop compromettant.
Paul ne dissimula pas la satisfaction que lui causait ce nouvel arrangement. Être dans ses meubles est le commencement de la fortune.
– Eh bien ! mon brave Tantaine, s’écria gaiement le docteur, maintenant que vos commissions sont faites, asseyez-vous et déjeunez…
Mais le vieux clerc secoua négativement la tête.
– Bien des mercis de l’honneur ! dit-il, mais j’ai déjeuné. D’ailleurs, pas une seconde à perdre. L’affaire du duc de Champdoce presse terriblement, et il faut, avant d’ouvrir le feu, que je vois ce gredin de Perpignan. Je vais chez lui de ce pas.
À un signe qu’il fit, et que Paul n’aperçut pas, Hortebize se leva et accompagna le bonhomme jusque dans l’antichambre. Arrivés là :
– Ne lâche toujours pas le petit, fit à demi voix le père Tantaine, je t’en débarrasserai demain… Et, tu sais, chauffe-le, prépare-le…
– Fie-toi à moi, répondit le docteur.
Et revenant se mettre à table, il cria :
– Mes hommages à ce cher Perpignan !…
Ce cher Perpignan, qui avait préoccupé B. Mascarot, et chez lequel se rendait le père Tantaine, est fort connu à Paris. D’aucuns disent : trop connu.
De par son extrait de naissance, il s’appelle Isidore Crocheteau, mais il a adopté et conservé le nom de sa ville natale.
Vers 1845, Perpignan, qui, à cette heure, frise la cinquantaine, eut des malheurs.
Chef des cuisines d’un restaurant à 32 sous, du Palais-Royal, il fut pris en flagrant délit de tripotages avec des fournisseurs, traduit en police correctionnelle et condamné à trois ans.
Mais à quelque chose malheur est bon.
C’est pendant ces trois années de prison qu’il conçut le plan de sa grande affaire qui devait, pensait-il, l’enrichir sans dangers.
Huit jours après sa libération, il faisait imprimer et lançait son prospectus, dont voici l’exacte copie :
I.-C. PERPIGNAN
Informations et Recherches
Surveillances privées
DISCRÉTION
Monsieur,
« Il n’est personne qui, en sa vie, n’ait ressenti le besoin d’un agent habile et discret à qui confier certaines investigations, délicates de leur nature et mystérieuses.
« Les créanciers dont les débiteurs se cachent, les pères que préoccupe la conduite d’un fils prodigue, les familles désireuses de connaître les habitudes d’un de leurs membres, tous ceux, en un mot, qui voudraient faire exercer des investigations morales ou des recherches judiciaires, peuvent s’adresser en toute sécurité à M. Perpignan, dont l’habileté comme observateur est reconnue, et dont l’honorabilité est au-dessus de tout soupçon.
« On traite à forfait. »
Par cette circulaire impudente, Perpignan annonçait la création d’une de ces honteuses boutiques de police privée, qui n’ont jamais servi que les passions malpropres.
Il lui fallait une spécialité, il en eut une. Il fut la providence des maris jaloux.
L’idée de l’ancien cuisinier lui réussit si merveilleusement qu’après un an d’exercice il employait jusqu’à huit de ces odieux espions que, rue de Jérusalem, on nomme des fileurs.
Il est vrai qu’abusant du succès, il jouait un double jeu.
N’ayant même pas la probité de l’infamie, il flouait indignement ses pratiques, et sans scrupule vendait deux fois sa marchandise.
Régulièrement, quand il était chargé de suivre, de « filer » une femme soupçonnée, il allait trouver cette femme et lui tenait ce langage :
– On me promet tant si je découvre et si je dis la vérité ; que m’offrez-vous pour ne livrer que des renseignements que vous me dicterez ?
C’est sur ce terrain de l’espionnage qu’à deux ou trois reprises les « hommes » de Perpignan s’étaient heurtés aux agents du placeur.
S’il n’y eut pas conflit, c’est qu’ils se firent peur mutuellement, et que par un accord tacite ils évitèrent d’exploiter les mêmes parages de cette grande forêt de Bondy qui s’appelle Paris.
Mais tandis que l’ex-chef mal servi par d’horribles drôles n’avait jamais réussi à pénétrer le mystère de l’agence de placement, B. Mascarot, admirablement secondé par ses volontaires, n’ignorait rien des affaires du directeur du bureau des renseignements.
B. Mascarot, par exemple, avait tout de suite vu que les revenus de l’espionnage privé ne pouvaient suffire aux dépenses de Perpignan.
Car Perpignan mène grandement et largement la vie. Si son établissement n’est guère dispendieux, il paye en ville le loyer d’un ménage qui doit lui revenir furieusement cher, et il a une voiture au mois.
Il prétend de plus avoir des « goûts d’artiste ». Ces goûts, pour lui, consistent à porter des gilets mirifiques et à se couvrir de bijouterie. Il avoue son faible pour la bonne chère, ne saurait dîner sans vins fins, et fait volontiers un doigt de cour à la dame de pique.
Enfin, il aime à se produire, s’exhiber, s’étaler. On le rencontre aux courses et au bois : il fréquente les grands restaurants et rechercher les premières représentations.
Où prend-il de l’argent ? s’était dit B. Mascarot.
Et le digne placeur avait cherché et il avait trouvé.
– C’est par là que nous le tenons, pensait le bon Tantaine, et c’est en vérité fort heureux pour nous. Perpignan est un dangereux coquin, sans foi ni loi, trop taré pour rien craindre, mais les perspectives d’un voyage de santé à Cayenne le tiendront toujours en respect. Au pis aller, si Catenac a eu la langue trop longue, on lui découpera une petite part dans le gâteau.
Le vieux clerc était arrivé à la porte de l’ancien cuisinier, porte historiée de toutes sortes de plaques, il sonna.
Une grosse femme à l’air affreusement commun, vint lui ouvrir.
– M. Perpignan ? demanda le bon Tantaine.
– Il est sorti.
– À quelle heure reviendra-t-il ?
– Je ne sais s’il rentrera avant ce soir.
– Je connais ça. Cependant, comme il faut que je lui parle aujourd’hui même, je vous serai obligé de me dire où je puis le rencontrer.
– Il ne m’a pas dit où il allait. Mais, si monsieur vient pour des renseignements…
Le bonhomme eut un de ces sourires qui donnait à sa face rougeaude l’expression du plus pur idiotisme.
– Ne serait-il pas à la fabrique ? demanda-t-il.
La grosse femme prévoyait si peu cette question, qu’elle tressaillit et recula.
– Comment ! balbutia-t-elle, vous savez ?…
– Parbleu !… Ainsi, ne vous gênez pas avec moi. Est-il là-bas ?
– Je le crois.
– Merci. Je l’y rejoins.
Et saluant assez peu poliment, contre son habitude, l’affreuse mégère, le bon Tantaine tourna les talons.
– Voilà, grondait-il, un désagréable contretemps, une course d’une lieue !… merci !… D’un autre côté, cependant, pris à l’improviste au milieu de ses honnêtes occupations, le gaillard, n’étant pas sur ses gardes, sera plus bavard et plus coulant. Marchons donc.
Il ne marchait pas, il courait avec une agilité qu’on n’eût jamais attendue de ses maigres jambes.
C’est avec une vitesse double de celle d’un fiacre à l’heure, qu’après avoir suivi la rue de Tournon et traversé diagonalement le Luxembourg, il se lança dans la rue Gay-Lussac.
Toujours du même train, il suivit la rue des Feuillantines, remonta, l’espace de cent pas, la rue Mouffetard, et enfin s’élança dans les ruelles qui s’enlacent et se croisent entre la manufacture des Gobelins et l’hôpital de Lourcine.
C’est là un quartier étrange, inconnu, à peine soupçonné de la part des Parisiens.
On se croirait à mille lieues du boulevard Montmartre, quand on longe ces rues – il faudrait dire ces chemins – inaccessibles aux voitures, où s’élèvent de loin en loin des masures inhabitables et pourtant habitées, bordées presque partout de murs qui tombent en ruines.
Des hauteurs de la rue des Gobelins, le spectacle est saisissant.
À ses pieds, on a une vallée au fond de laquelle coule, ou plutôt reste stagnante, la Bièvre, noire et boueuse. De tous côtés, des usines, des tanneries aux toits rouges avec leurs énormes amas de tan, des séchoirs à mottes ou des étendoirs de teinturiers, puis, de-ci de-là, au milieu de bouquets d’arbres, des taudis, des bouges, parfois une haute maison d’aspect désolé.
À gauche on a les bâtisses de la populeuse et travailleuse rue Mouffetard. À droite, l’œil suit les ombrages des boulevards extérieurs.
En face, de l’autre côté de la place d’Italie, un rideau de peupliers qui indique le cours de la Bièvre ferme l’horizon.
Si on se retourne, on domine Paris…
Involontairement, le père Tantaine s’arrêta et regarda.
Une pensée s’agita en son cerveau qui amena sur ses lèvres un sourire amer.
Mais la seconde d’après il haussa les épaules et continua sa route.
Il semblait un habitant du quartier, tant il allait sûrement par ces chemins capricieusement tracés.
Il se risqua dans ce casse-cou qui s’appelle la rue des Reculettes, tourna la rue Croulebarbe et enfin arrivé rue Champ-de-l’Alouette, il eut un soupir de satisfaction en murmurant :
– C’est ici.
Il était devant une maison à trois étages, très vaste, précédée d’une cour qu’entourait une clôture de planches à demi pourries.
La maison était isolée, l’endroit sinistre. On devait se demander si ce logis n’était pas abandonné et si le feu n’y avait pas passé, dévorant jusqu’au châssis des fenêtres.
Le vieux clerc, après une minute de délibération, traversa la cour où broutait une chèvre attachée à un piquet, et entra bravement dans la maison.
L’intérieur répondait au dehors.
Deux pièces seulement composaient le rez-de-chaussée.
Dans l’une on avait étendu de la paille à terre, en assez grande quantité, et sur cette paille se trouvaient des lambeaux d’étoffes grossières et des débris de couvertures.
L’autre pièce était transformée en cuisine, et on y avait dressé une table, c’est-à-dire qu’on avait ajusté de longues planches sur deux tréteaux.
Devant la cheminée de cette cuisine, une affreuse mégère au teint enflammé par l’alcool, à l’œil pétillant de méchanceté, coiffée d’un madras, repoussante, malpropre, surveillait, armée d’une spatule de bois, l’ébullition d’un immense chaudron où cuisaient des choses indescriptibles.
Dans un renfoncement, près de la cheminée, sur une espèce de lit de fer, maigrement garni d’un matelas varech, geignait et grelottait un petit garçon d’une dizaine d’années.
Sa figure, sur l’étoffe déchirée et ignoblement sale de l’oreiller, ressortait plus blanche que la cire ; ses petites mains étaient effrayantes de maigreur, et la fièvre donnait à ses grands yeux noirs un éclat de mauvais augure.
Par moments, la souffrance lui arrachait un gémissement plus fort que les autres, mais aussitôt la vieille femme se retournait et le menaçait de sa spatule. – Te tairas-tu, méchant « môme ? » disait-elle.
– Ah ! j’ai mal, geignait le malheureux avec un accent italien des plus prononcés, j’ai bien mal !…
– Il fallait travailler, mauvais fainéant, reprit la vieille. Si tu avais rapporté de bonnes journées, on ne t’aurait pas battu ; si on ne t’avait pas battu, tu ne serais pas là !…
– Ah !… J’ai mal, j’ai froid, je voudrais retourner au pays, revoir maman !…
Si émoussée que puisse et doive être la sensibilité d’un vieux clerc d’huissier habitué à procéder au milieu des plus déchirantes explosions de la misère et de la ruine, la scène était si affligeante, que le bon Tantaine en fut remué.
À plusieurs reprises, et en y mettant l’insistance de l’affectation, il toussa pour annoncer sa présence.
La mégère, à la fin, se retourna avec un grognement de dogue qui redoute de se voir arracher un os.
– Que voulez-vous ? demanda-t-elle d’une voix dont des torrents de mêlé-cassis avaient brisé les cordes.
– Le bourgeois ?
– Pas arrivé.
– Viendra-t-il ?
– Ah ! voilà !… ça dépend. C’est bien son jour, mais il n’est pas exact. Au surplus adressez-vous à M. Poluche.
– Qui ça, Poluche ?
L’horrible vieille eut une grimace de dédain. Il lui parut prodigieux que celui dont elle parlait ne fût pas plus connu que cela.
– C’est le professeur, répondit-elle.
– Où est-il ?
– Eh !… là-haut, vieux serin !… dans le conservatoire.
Et, se retournant vivement, car le chaudron débordait, à cause du bouillon trop fort, elle ajouta :
– Voilà assez de questions comme ça, n’est-ce pas ? On n’est pas de la police, pour vous répondre. Faites-moi le plaisir de me montrer vos talons.
Ce brusque congé ne sembla nullement offenser le vieux clerc d’huissier.
Avant de monter, il examinait l’escalier dont la rampe avait été arrachée et dont un assez bon nombre de marches manquaient.
Il était si raide et si délabré, il paraissait si bien sur le point de s’effondrer, qu’un acrobate, avant de s’y hasarder, eût demandé à réfléchir.
Mais le père Tantaine est brave. Il se risqua, non sans précautions, par exemple, non sans avoir bien soin de se tenir le plus près possible du mur.
À mesure qu’il montait, des sons bizarres, qui l’avaient frappé dès la cour, arrivaient plus distincts à son oreille, non formidables et ronflants comme ceux de la cave à musique du père Canon, mais stridents, perçants, grinçants, lamentables.
On eût dit un concert de scies qu’on aiguise à la lime, accompagné de piaulements de chats.
Par instant, l’abominable cacophonie cessait brusquement.
On entendait alors les éclats d’une voix grave qui jurait, puis un bruit sec, puis des hurlements de douleur.
Ce pitoyable charivari pouvait affecter l’ouïe du père Tantaine, mais il ne le surprenait pas.
Arrivé au premier étage, il se trouva en face d’une porte disloquée qui pendait de travers à une seule charnière placée tout en haut.
Il tira sur cette porte. Elle ouvrait sur ce que la mégère de la cuisine appelait le conservatoire.
C’était une salle immense, formée de la réunion de toutes les pièces qui autrefois divisaient l’étage.
Les cloisons avaient été brutalement abattues par des mains inhabiles, et on en reconnaissait les vestiges tant au plafond qu’au ras de terre.
Cinq fenêtres qui n’auraient pu à elles seules fournir trois vitres intactes, éclairaient le conservatoire.
Était-il carrelé ou planchéié ? on ne pouvait le deviner, tant étaient épaisses les couches successives de boue, d’ordures et de poussière tassées, foulées, piétinées sur le sol primitif.
Les murs, blanchis à la chaux, effrayaient, tant ils étaient maculés de taches ignobles, couverts d’inscriptions, d’essais informes et de dessins obscènes.
À l’odeur âcre des tanneries voisines se mêlaient des émanations singulières, et le tout composait une puanteur infâme qui remuait l’estomac jusqu’à la nausée.
En fait de meubles… rien : une chaise boiteuse, et sur cette chaise, en travers, une forte cravache de manège.
Certes, depuis qu’il glisse à travers tous les bas-fonds de Paris, comme une anguille dans sa bourbe, le père Tantaine a beaucoup vu et beaucoup retenu.
Cependant, il s’arrêta sur le seuil du conservatoire, muet, immobile, presque heureux de n’être pas aperçu, pour un moment, tant ce qu’il apercevait le stupéfiait.
Tout autour de la pièce, adossés au mur, étaient rangés une vingtaine d’enfants de sept à douze ans, affreusement déguenillés, repoussants d’incurie et de malpropreté.
Les haillons qui les couvraient n’avaient pas été ajustés à leur taille. Ils grelottaient dans des paletots dont les pans tombaient jusqu’à terre ou dans des pantalons dont la ceinture leur montait jusqu’au cou. De linge point.
Les uns étaient armés d’un violon, les autres s’accrochaient à une harpe plus haute qu’eux. Le long du manche de tous les violons, Tantaine remarqua des raies à la craie.
Au milieu de la pièce se tenait debout un homme d’une trentaine d’années, long et mince comme un cierge, remarquablement laid, avec son visage glabre, son nez épaté et ses cheveux noirs et gras tombant sur ses épaules.
Sa redingote d’une couleur perdue, vert olive, pendait le long de son maigre torse et de ses jambes dégingandées misérablement, comme une voile après un mât quand il n’y a pas de vent.
Tout comme les enfants, il était armé d’un violon qu’il ne tenait pas sous le menton, mais qu’il s’appuyait au pli de la cuisse.
Évidemment celui-là était Poluche, le professeur, – il donnait sa leçon.
– Attention !… criait-il, chacun va répéter à son tour. À toi, Ascanio, le refrain du Château de la Marguerite… et en mesure.
Et il se mit à chanter et à jouer pendant que l’enfant désigné râclait désespérément son instrument et répétait d’une voix éraillée et avec le plus pur accent nasillard des campagnes piémontaises :
Ah ! mon Dieu ! mon Dieu ! qu’il est beau,
Le château de…
– Scélérat !… interrompit Poluche, petit gredin !… Ne t’ai-je pas répété mille fois qu’au mot « château » il faut placer la main gauche sur le quatrième cran et tirer l’archet !… Recommençons.
L’enfant recommença :
Ah ! mon Dieu !…, mon Dieu !… qu’il est…
– Halte !… s’écria le professeur d’une voix terrible, halte !… Graine de filou !… Le fais-tu donc exprès ?… Tu vas reprendre, et si tu ne répètes pas le refrain entier, sans une seule hésitation, gare à toi. Allons… le doigt sur le premier cran, et en poussant :
Ah mon Dieu !…
Hélas ! Ascanio s’était encore trompé. Il fallait pousser l’archet, il le tira.
Gravement le professeur saisit la cravache placée sur la chaise à sa portée, et froidement, sans apparence de colère, il en cingla à cinq ou six reprises les jambes du petit malheureux, qui se mit à pousser des hurlements lamentables.
– Cela t’apprendra, prononça Poluche, à faire attention une autre fois à ce que je dis. Quand tu auras fini de brailler, nous recommencerons. Et si ça va aussi mal, tu sais, pas de soupe ce soir. Te voilà prévenu. Allons, au lieu de braire comme un âne, ouvre les yeux et les oreilles, et regarde faire tes voisins. À toi, Guiseppe.
Quoique plus jeune de deux ou trois ans que Ascanio, Guiseppe était bien autrement fort sur le violon.
Il répéta sans se tromper le refrain entier :
Ah !… mon Dieu !… mon Dieu !… qu’il est beau !
Le château de la Margueri… i… ite…
– Pas mal, approuvait Poluche, qui, lui aussi, s’escrimait de l’archet, pas mal du tout !… Encore deux ou trois jours de bonne volonté, et tu sortiras. Hein !… tu seras content de sortir ?
– Oh !… oui, monsieur !… répondit l’enfant d’un air ravi, je rapporterai, moi aussi, des petits sous.
Mais le consciencieux professeur ne gaspille pas en conversations vaines le temps précieux des leçons.
Il se retourna vers un autre de ses élèves en criant :
– À Fabio !… et en mesure !…
Fabio, un tout petit, petit garçon de sept ans au plus, à la mine futée, à l’œil noir et éveillé comme celui d’une souris, ne s’empressa pas d’obéir.
Il venait d’apercevoir le vieux clerc d’huissier debout sur le seuil du Conservatoire, et le montrait au professeur.
– Moussiou !… oh !… un homme.
Vivement Poluche se retourna et se trouva presque sur le père Tantaine, qui, se voyant découvert, s’avançait.
La brusque apparition d’un spectre se dressant à ses pieds n’eût pas beaucoup plus effrayé le professeur. Il est comme cela des professions où on n’est jamais tranquille, où on redoute particulièrement les inconnus, les curieux, les indiscrets.
– Que demandez-vous ? fit-il d’une voix altérée ; qui êtes-vous ? que voulez-vous ?
La frayeur de Poluche enchanta le père Tantaine.
Elle était pour lui comme le gage du succès de sa démarche, en lui indiquant sur quel ton il devrait le prendre avec Perpignan lorsqu’il arriverait jusqu’à cet important personnage.
Aussi se plut-il à prolonger les perplexités de la situation, et durant une bonne minute il tint suspendu à son sourire goguenard le pauvre professeur, qui, de plus en plus, perdait contenance.
À la fin, il eut pitié.
– Rassurez-vous, monsieur, dit-il, je suis un ami intime du bourgeois, et si j’ai pris la liberté de venir jusqu’ici, c’est que j’ai à l’entretenir d’affaires très pressantes, relatives à son commerce.
Poluche respira longuement et bruyamment, en homme allégé d’un pesant fardeau.
– Cela étant, monsieur, fit-il en offrant au bonhomme la chaise unique du Conservatoire, daignez donc vous asseoir, le patron ne saurait tarder à arriver.
Mais le père Tantaine refusa poliment, protestant qu’il serait désolé de gêner, affirmant qu’il attendrait fort bien debout, et qu’il se retirerait plutôt que de troubler une leçon qui lui avait paru bien intéressante.
– Oh !… reprit vivement le professeur, la leçon touchait à sa fin. Voici l’heure où la Butor donne la pâtée à mes coquins.
Et, se retournant vers ses élèves dont pas un n’avait osé broncher :
– Assez pour aujourd’hui, prononça-t-il, leste, sauvez-vous.
Les gamins ne se le firent pas répéter deux fois. Ils posèrent leurs instruments à terre, et avec des cris d’écoliers entrant en récréation, non sans bousculades, ils se précipitèrent dans l’escalier, au risque de se rompre le cou.
Peut-être espéraient-ils que leur maître, préoccupé de son visiteur, oublierait certaines menaces faites pendant la leçon.
Vain espoir !… Le sévère mais juste Poluche est doué d’une mémoire impitoyable.
Gravement il se dirigea vers le palier, et se penchant au-dessus de la cage de l’escalier, il appela d’une voix formidable qui dominait le bruit :
– Holà !… mère Butor !…
L’atroce vieille de la cuisine l’entendit.
– Quoi, monsieur ? demanda-t-elle d’en bas.
– Vous ne donnerez pas de pâtée à Morel, répondit le professeur, et Ravouillat n’aura qu’une demi-portion.
Ces ordres importants donnés, il reparut avec cet air satisfait que donne l’accomplissement d’un devoir.
– Voilà mes comptes réglés, expliqua-t-il au père Tantaine. Ce ne sont pas, remarquez-le, des étrangers que je punis. Nos Piémontais et nos Calabrais vont toujours passablement. Mais ne me parlez pas de ces Italiens des Batignolles ou de Montrouge que le bourgeois m’amène depuis quelque temps. Il y trouve de l’économie, assure-t-il ; moi, je périrai à la peine. Ces petits scélérats sont pétris d’impudence et d’orgueil, corrompus au point de me faire rougir, moi qui vous parle ; leur tête est plus dure que du fer, et enfin ils n’ont aucune vocation, ils ne sont pas organisés, quoi !…
Le vieux clerc d’huissier, sous ses lunettes, ouvrait des yeux énormes.
Pour lui, ce qu’il voyait et entendait était absolument neuf, et comme on apprend à tout âge et qu’il aime à s’instruire, il était tout attention.
– Vous faites un difficile métier, monsieur, prononça-t-il. Enseigner la musique à de si jeunes enfants doit être pénible.
Le professeur jeta au plafond un regard désespéré.
– Plût à Dieu ! s’écria-t-il, que j’enseignasse l’art sublime ! Les premiers principes, si arides, auraient des charmes pour mon cœur. Mais non !… le patron ne le veut pas, il me l’a déclaré. S’il découvrait ici grand comme la main de papier réglé, il me chasserait…
– Cependant, tout à l’heure.
– Je serinais, monsieur, répondit Poluche, humilié et navré, je serinais…
– Ah !
– C’est comme cela. Vous n’êtes pas, j’imagine, sans avoir entendu parler de ces vieilles femmes, propriétaires d’une serinette, qui, à raison de vingt centimes le cachet, vont à domicile donner des leçons aux serins ? On les appelle des serineuses.
Non : le père Tantaine ne connaissait pas cette industrie, il le confessa en toute humilité.
– Eh bien !… reprit le professeur avec un sourire amer, cette profession est la mienne. Au lieu de seriner des oiseaux, je serine des moutards. Ce n’est pas de mon côté qu’est l’avantage. Triste tâche, monsieur, pour un homme d’imagination. Il y a des jours où j’envie le sort des gens qui se sont voués à l’éducation des perroquets. Ah ! quelle patience, quelle patience !
Sur ce mot, le doux clerc d’huissier ne put s’empêcher de montrer du bout du doigt l’énorme cravache déposée sur la chaise.
– Et ceci ! demanda-t-il.
Poluche haussa les épaules.
– Je voudrais, cher monsieur, répondit-il, vous voir à ma place. Le bourgeois, n’est-ce pas, se procure un gamin et me l’amène, bien. L’enfant est désolé, ahuri, tant pis ! Je dois, en quinze jours, trois semaines au plus, lui apprendre à râcler quelque chose. Il ne sait ni ce qu’est un violon, ni ce qu’est un archet, peu importe ! Il faut que mécaniquement je lui mette dans les doigts les dix ou quinze positions qu’exige l’air le plus simple. Naturellement, le coquin me résiste, alors, moi… j’insiste. Avez-vous jamais fait entrer un clou dans une planche de chêne sans un marteau ? Non, n’est-ce pas ? Eh bien !… ma cravache est le marteau avec lequel j’enfonce des airs dans la tête de mes élèves.
Et ne vous imaginez pas qu’ils ont peur des corrections. Ces petits misérables se blasent sur les coups comme les enfants gâtés sur les confitures. Après un mois d’exercice, il faut leur enlever la peau pour leur arracher, non un cri, – dès que je lève la main, ils hurlent, – mais une vraie larme.
Par bonheur, j’ai d’autres moyens. Je prends mes gredins par l’estomac. Je leur supprime le quart, le tiers, la moitié de leur pâtée, la pâtée entière, au besoin. Rien de tel que le jeûne pour développer l’intelligence.
Pour les récalcitrants, j’ai mieux encore, je les prive de sommeil. Voilà un traitement ! Une séance de nuit avance plus un entêté que quatre leçons de jour.
Je tiens cette recette infaillible d’un écuyer du Cirque, lequel l’employait pour dresser un cheval à jouer de l’orgue de Barbarie…
Pendant ces longues explications, le bon Tantaine, à diverses reprises, avait senti courir le long de son échine comme un petit frisson taquin.
Certes, ses préjugés ne l’importunaient guère, mais ce système d’éducation musicale lui paraissait vraiment exagéré.
– Si seulement, reprit le professeur, je pouvais disposer de l’instrument de popularité que j’ai entre les mains !…
– J’avoue…
– Quoi !… Vous ne comprenez pas ?… Eh ! monsieur, j’ai quarante élèves qui, dès huit heures du matin, se répandent dans Paris et ne rentrent jamais avant minuit. Que demain je serine un morceau… dans huit jours il sera populaire. Tenez, depuis trois mois, je leur serine le Château de la Marguerite, dites-moi ce qu’en ce moment vous entendez partout gratter, racler, pincer sur les instruments les plus variés ? Toujours mon refrain de tout à l’heure : « Ah ! mon Dieu !… mon Dieu !… qu’il est beau !… »
Le vieux clerc d’huissier s’expliquait maintenant la persistance étrange de certains airs qui, tout à coup, s’abattent sur tous les quartiers à la fois, et poursuivent le Parisien, où qu’il aille.
Poluche, lui, avait mis son violon sous son bras, et armé de son archet, il gesticulait.
– Ah !… si le patron voulait, continua-t-il, je donnerais aux Français le goût de la bonne musique. Mais non… il n’est pas artiste. N’a-t-il pas failli me jeter dehors pour avoir seriné à mes élèves un air d’un de mes opéras !…
Le temps passait, mais le père Tantaine ne s’ennuyait pas.
– Comment… de vos opéras ? interrogea-t-il.
– Oui ! répondit Poluche d’un tout autre ton qu’il avait eu jusqu’alors. Il n’est pas un théâtre qui n’ait dans ses cartons un opéra de moi. Un de mes amis, qui était poète, et qui est devenu fou à force de boire de l’absinthe, me composait des livrets sublimes ! Oh !… ne riez pas. J’ai eu, tel que vous me voyez, un prix au Conservatoire. J’ai eu des illusions, je voulais être célèbre et être aimé !… Je buvais de l’eau claire et je travaillais la nuit !… Un jour pourtant je me suis lassé de danser devant le buffet de la gloire, et j’ai cherché des leçons… Hélas !… je suis si ridicule et si laid qu’on ne voulait pas de moi dans les pensionnats. Je mourais de faim quand j’ai rencontré le bourgeois. Il m’a tenté, j’ai succombé. J’ai cinq francs par jour de fixe et deux sous par élève. Je fais un métier ignoble, je me méprise, mais je mange !…
Il s’interrompit tout à coup et prêta l’oreille d’un air inquiet.
– Voici le bourgeois !… fit-il ; j’ai reconnu son pas. Si vous voulez lui parler, descendons ; il ne monte jamais, l’escalier lui fait peur.
XXII
Voir ce marchand de renseignements que Poluche appelle « le bourgeois », et qui glorifie le nom de Perpignan, c’est le juger.
Impossible de se méprendre à cette superbe nature de gredin où il se trouve à la fois du charlatan, du garçon coiffeur, du mouchard et du maquignon.
Perpignan est un petit homme apoplectique, très gros, trop court, fort rouge, à la lèvre impudente et à l’œil cynique.
Il est toujours trop bien mis. On jurerait qu’il vient de voler à la devanture d’un bijoutier ses bagues, ses chaînes et ses breloques.
Parle-t-il, c’est des profondeurs de son ventre, siège de ses pensées, qu’il tire sa forte voix de basse, dont il se plaît à exagérer le volume.
Tel, effrayant en sa vulgarité, apparut l’ancien cuisinier au bon père Tantaine qui descendait à la suite du patient professeur, le dangereux escalier.
Si Poluche avait été troublé, en apercevant l’ancien clerc d’huissier, son bourgeois ne le fut pas beaucoup moins, mais pour d’autres causes. Il connaissait Tantaine pour être le bras droit du placeur de la rue Montorgueil.
– Tonnerre !… pensa-t-il, pour que ces gens-là se soient donné la peine de pénétrer le mystère de mon exploitation et viennent me relancer jusqu’ici, il faut qu’ils aient de bonnes raisons. Tenons-nous bien !
Et dissimulant sous un rire, trop gai pour être de bon aloi, sa fâcheuse impression, il tendit la main à Tantaine.
– Ravi de vous voir, cher monsieur, disait-il, oui, ravi, parole sacrée. Je vais pouvoir vous être agréable en quelque chose ! Car, avouez-le, vous avez quelque petit service à me demander.
– Oh !… protesta le bonhomme, un rien, une bagatelle…
– Tant pis ! corbleu ! tant pis !… J’aime M. Mascarot, moi !…
Cet amical colloque avait lieu dans le corridor de la maison, et à tout moment il était troublé par les cris et les rires des élèves de Poluche, qui, attablés jusqu’au menton, dévoraient le contenu du chaudron de la mère Butor.
En même temps que ces cris, on entendait, continus et sourds comme un accompagnement de basses, des pleurs et des gémissements.
– Ah çà ! mille tonnerres ! s’écria Perpignan, d’une voix qui eût fait frémir les vitres, si les vitres n’eussent été absentes, qui est-ce qui n’est pas content ici ?
Nulle réponse ne venant, Poluche crut devoir intervenir.
– Ce sont, répondit-il, deux de nos garnements de Parisiens que j’ai mis à la diète. Je veux être pendu s’ils mangent un pain à cacheter avant d’avoir appris…
Il s’arrêta béant, interloqué, sous les regards foudroyants que lui lançait le bourgeois.
– À la diète !… hurlait Perpignan, on ose, chez moi, à mon insu, priver de pauvres petits enfants de nourriture… Mais c’est infâme, c’est monstrueux, c’est canaille. Vingt mille tonnerres !… monsieur Poluche, d’où vous vient cette audace ?
– Mais, bourgeois, balbutia le triste professeur, vous m’avez dit cent fois…
– Quoi ?… Que tu n’es qu’un sot ? C’est une grande vérité. Tais-toi, et va dire à la Butor de donner la pâtée à ces chérubins.
La scène était fâcheuse, mais réparable.
Sans en paraître affecté, bien que furieux en réalité, Perpignan prit le bras du père Tantaine et l’entraîna vers le fond du corridor.
– Vous venez, disait-il, pour me parler en particulier ? Oui. Très bien. Prenez la peine d’entrer dans ce petit réduit… c’est mon bureau.
L’endroit n’était pas brillant. C’était une petite pièce sale, nue, délabrée comme toute la maison. Trois chaises, une table de bois blanc, une planche étagère supportant quelques registres, constituaient le mobilier.
Une fois assis, les deux hommes se regardèrent assez longtemps sans mot dire, chacun s’efforçant de pénétrer les secrètes réflexions de l’autre.
Deux adversaires qui, l’épée à la main, attendent le signal de leurs témoins pour commencer le combat, ne s’observent pas avec une plus ardente attention.
Mais, dans cette lutte préalable, tous les avantages étaient du côté du vieux clerc d’huissier, retranché derrière ses impénétrables lunettes.
Aussi est-ce Perpignan qui, le premier, rompit le silence.
– Comme cela, commença-t-il, vous aviez entendu parler de mon petit établissement ?
– Oh !… bien par hasard !… répondit le père Tantaine, de l’air le plus détaché. À courir comme moi, on apprend des tas de choses… Par exemple, nous savons fort bien qu’ici toutes vos précautions sont prises pour n’être pas compromis.
– Comment !… comment !…
– Sans doute. Vous êtes le bailleur de fonds, le maître en réalité… en apparence, vous n’êtes rien. Pour tout le monde, c’est le mari de votre ménagère, un nommé Butor, qui a monté l’affaire et le bail est à son nom. S’il arrivait un désagrément, si le parquet vous serrait de près, crac !… vous disparaîtriez comme un diable à boudin dans sa boîte, et la police sous sa large main ne trouverait que l’homme de paille, Butor. Comme idée, c’est élémentaire, mais dans la pratique, ce truc réussit toujours.
Il sembla réfléchir et ajouta, avec une lenteur calculée :
– Quand je dis toujours : Toujours… je veux dire : Toutes les fois qu’il ne se trouve pas un ennemi assez habile pour rendre les précautions inutiles, en apportant des preuves de… complicité.
L’ancien cuisinier était trop intelligent pour ne pas comprendre la menace et sa portée.
– Sacré tonnerre !… pensait-il, ces gens-ci doivent savoir quelque chose. Mais quoi ?… Bast !… bavardons toujours.
Et tout haut il reprit :
– Le plus sûr est d’avoir la conscience nette. C’est mon cas. Je n’ai rien à cacher, moi. Vous avez vu ma maison, qu’en pensez-vous ?
– Elle me semble montée sur un bon pied.
– N’est-ce pas ? Vous me direz peut-être que la spéculation n’est pas faite pour m’attirer la considération publique ? Je le sais, sacrebleu, bien. Je préfèrerais certainement une bonne fabrique à Roubaix. Mais on fait ce qu’on peut.
Le vieux clerc d’huissier approuvait de la tête.
– Il n’y a pas de sot métier, prononça-t-il.
– Voilà ce que je me dis, poursuivit l’ancien cuisinier. D’ailleurs, je ne suis pas seul à exercer. Allez rue Sainte-Marguerite, j’y ai des confrères. Mais je n’aime pas le faubourg Saint-Antoine. Ici, mes chérubins sont en bien meilleur air.
– Sans compter, ajouta Tantaine le plus innocemment du monde, que si, par hasard, ils crient quand on les corrige un peu, il n’y a pas de voisins pour les entendre.
Perpignan ne jugea pas à propos de relever l’observation.
– Les journaux, continua-t-il, nous ont beaucoup attaqués. Sacré tonnerre !… ils feraient bien mieux de s’occuper de politique. À qui faisons-nous tort, en définitive ? à personne, n’est-ce pas ? Le malheur est qu’on s’exagère énormément nos bénéfices.
– Allons… allons… vous gagnez votre vie.
– Certainement, je n’y suis pas de ma poche, mais je vous assure qu’il y a bien des non-valeurs dans le métier. Tenez, en ce moment, j’ai six de mes chérubins malades, trois là-haut et trois à l’hôpital, sans compter que celui que vous avez vu à la cuisine m’a l’air de filer un mauvais coton…
– Vrai, fit sérieusement le bonhomme, je vous plains beaucoup.
L’inaltérable sang-froid du père Tantaine commençait à agacer singulièrement l’ancien cuisinier.
– Sacrebleu !… s’écria-t-il, si la spéculation est si bonne, pourquoi Mascarot ne l’entreprend-il pas ? Ma parole sacrée, on dirait à vous entendre, qu’on trouve comme cela des moutards tant qu’on en veut. Mais c’est le diable, mon cher monsieur, pour s’en procurer. Il faut aller en Italie, les ramasser, les passer à la frontière comme des objets de contrebande, les amener ici. Tout cela ruine positivement !…
Ce n’est pas sans intention que Perpignan se livrait ainsi avec le plus amical abandon.
Il allait au-devant des questions. À parler seul, on dit mieux et plus juste ce qu’on veut dire.
Mais le bon Tantaine n’est pas de ceux dont on noie la volonté sous des flots de paroles.
Perpignan s’étant arrêté pour reprendre haleine, il jugea sage d’abréger une exposition qu’il trouvait un peu longue.
– En somme, demanda-t-il de son air le plus innocent, combien avez-vous d’élèves ?
– De quarante à cinquante.
– Peste ! vous opérez en grand. Et… quelle somme exigez-vous de chacun d’eux tous les soirs ?
La question était si indiscrète que l’ancien cuisinier hésita.
– Cela dépend, répondit-il.
– Bah ? vous avez bien une moyenne.
– Mettons trois francs !
La physionomie du vieux clerc d’huissier était si naturellement candide, qu’en vérité il était impossible de lui soupçonner la moindre arrière-pensée.
– Va pour trois francs, fit-il, et comptons seulement sur quarante chérubins, comme vous dites, c’est une somme ronde de cent vingt francs par jour que vous empochez ainsi…
La douce obstination du bonhomme ne laissait pas que de surprendre Perpignan.
– Comme vous y allez ! interrompit-il. Pensez-vous donc que chacun de mes drôles me rapporte la somme indiquée !…
– Farceur !… comme si vous n’aviez pas des moyens pour la leur faire rapporter.
L’ex-cuisinier ne put dissimuler un tressaillement.
– Sacrebleu !… fit-il d’une voix un peu enrouée par l’inquiétude, que voulez-vous dire ?
– Oh ! rien qui vous offense, répondit le doux Tantaine avec effusion. Qui veut la fin veut les moyens, n’est-ce pas. Seulement, je mentirais si je disais que l’opinion vous est favorable. Entre nous, la Gazette des Tribunaux vous nuit. Elle a porté à la connaissance du public certains procédés, un peu vifs, peut-être, employés par d’aucuns de vos collègues pour encourager leurs moutards au travail. N’avez-vous pas ouï parler de ce patron qui attachait ses enfants sur une couchette de fer et qui les y laissait un jour, un jour et demi, deux jours quelquefois. À quoi donc a-t-il été condamné ?
Depuis un moment, Perpignan, qui commençait à sembler fort mal à l’aise se leva :
– Est-ce que je sais, moi !… s’écria-t-il d’un ton bourru. Est-ce que je m’occupe de ces histoires !… De ma vie, je n’ai commis un acte de brutalité.
Le vieux clerc d’huissier tracassait ses lunettes, comme toujours lorsqu’il aborde ce qu’il appelle le nœud des questions.
– On peut être, reprit-il, l’homme le plus humain de la terre, avoir un cœur d’or, et cependant être… entraîné, engagé par les événements.
Le moment décisif approchait. Perpignan le sentait bien, cependant il paya d’audace.
– Je veux que le tonnerre m’écrase, s’écria-t-il, si je comprends !…
– Alors, prenons un exemple : Supposons que ce soir vous ayez à vous plaindre d’un de vos chérubins. Que faites-vous ? Vous l’enfermez dans la cave. À cela, rien à dire. Vous vous couchez donc, la conscience tranquille, et vous dormez comme un loir. Mais voilà que dans la nuit une pluie torrentielle survient. Un monceau de sable obstrue le ruisseau de votre rue, qui est fort en pente, et toute l’eau du ciel se précipite dans votre cave. Au matin, quand vous allez ouvrir au chérubin, on ne trouve qu’un cadavre, il a été noyé…
La face, si rouge d’ordinaire, de l’ancien cuisinier, était devenue livide.
– Et après ? interrogea-t-il.
– Ah !… c’est ici que l’entraînement commence. Naturellement on se demande quel parti prendre. Aller trouver le commissaire de police et lui conter l’accident serait le plus simple ; mais ce serait provoquer une enquête, appeler l’attention du parquet… D’un autre côté… Mais on est seul ; on se dit que nul ne sait l’enfant là ; on creuse un trou, et… ni vu ni connu.
Perpignan était allé s’adosser à la porte de son bureau, fermant ainsi toute retraite au vieux clerc d’huissier.
– Vous savez beaucoup de choses, monsieur Tantaine, prononça-t-il, trop de choses !…
Il n’y avait pas à se tromper à l’accent du « bourgeois » de Poluche.
Son attitude seule, devant la porte, était plus significative que toutes les explications.
Cependant, le père Tantaine ne semblait aucunement remarquer ces dispositions hostiles.
Loin de là. Il souriait de son plus bénin sourire, content de soi, en apparence, comme un enfant après quelque affreuse espièglerie dont il n’a pu calculer les conséquences funestes.
– Ceci n’est rien, reprit-il. Un homicide par imprudence, tout au plus. Il faudrait un ministère public diablement malin, pour en extraire une condamnation à plus de cinq ans de prison. Encore serait-il forcé d’insister sur les antécédents.
– Je vous rappellerais, si vous y teniez, quelque chose de bien autrement grave : certain voyage dans les environs de Nancy…
C’en était trop, l’ancien cuisinier éclata :
– Cent mille tonnerres !… s’écria-t-il, expliquez-vous. Que voulez-vous de moi, à la fin !
– J’ai déjà eu le plaisir de vous le dire, un petit service…
– Vraiment !… et c’est pour si peu que vous essayez de m’intimider, ni plus ni moins que si vous prétendiez me faire chanter ?
– Oh !… cher monsieur.
– Vous n’oubliez qu’une chose, c’est qu’on ne m’épouvante pas aisément, et que d’ailleurs j’ai perdu la voix depuis longtemps.
– Pardon !… c’est vous qui, le premier, avez parlé de votre… industrie.
– Alors, c’est pour m’être agréable que, depuis une heure, vous me contez toutes sortes d’histoires absurdes.
Pour toute réponse, le vieux clerc haussa légèrement les épaules.
– Eh bien !… reprit Perpignan en s’efforçant de contenir les éclats de sa voix, voulez-vous qu’à mon tour je vous dise ce que je pense ?
– Allez, ne vous gênez pas.
– Je vous dirai alors qu’il est de ces expéditions qu’on ne doit pas entreprendre seul. Pour venir dire à un homme comme moi, chez lui, face à face, les choses que vous me dites, il faut être un peu moins vieux que vous, et un peu plus solide. Je vous apprendrai qu’il n’est pas prudent, quand on tient à sa peau, de s’aventurer dans une maison comme celle-ci, qui est absolument isolée…
– Eh ! bon Dieu !… que voulez-vous qu’il m’arrive ?
Perpignan ne répondit pas. Sa face convulsée, ses yeux injectés de sang, ses lèvres devenues blanches trahissaient un de ces accès de rage folle où l’homme le plus maître de soi perd son libre arbitre.
Il avait glissé sa main droite sous son paletot et il remuait évidemment quelque chose dans sa poche de côté.
Mais le bon Tantaine, fort attentif sans le paraître, ne perdait pas de vue son interlocuteur. À un brusque mouvement qu’il fit, à un éclair atroce de haine qui brilla dans son œil, il se dressa et bondit jusqu’à lui.
L’ancien cuisinier, avec son cou de taureau, est d’une force peu commune ; cependant lorsque la main du bonhomme s’abattit sur lui, il plia sur les jarrets et chancela.
Un effort héroïque le redressa, il se débattit, envoya au hasard quelques coups de poing en vain. Tantaine avait empoigné sa cravate, l’avait tortillée entre ses doigts et l’étranglait. Il râla.
La lutte ne dura pas quatre secondes. Par trois fois, le bonhomme fit pirouetter son robuste adversaire, puis, tout à coup, le saisissant par les reins avec une vigueur dont jamais on ne l’eût cru capable, il le fit basculer, l’enleva et le lança, à demi asphyxié sur une chaise.
Et ce fut tout. Pas un cri. Pas un mot.
Mais personne, certes, en ce moment, n’eût reconnu le doux père Tantaine. Il semblait grandi d’un pied et rajeuni de vingt ans ; sa physionomie d’habitude si bénigne, exprimait le mépris le plus profond et la plus froide méchanceté.
– Ah !… tu voulais jouer du couteau, disait-il à Perpignan, qui avait bien du mal à retrouver sa respiration ; ah !… tu voulais tuer un tout petit peu un pauvre vieux inoffensif qui ne t’a jamais rien fait !… Me crois-tu donc naïf à ce point de me hasarder sans précautions dans ton repaire ?
Il sortit à demi et montra la crosse d’un revolver.
– J’avais, comme tu vois, de quoi te répondre… Allons, jette ton petit couteau à terre.
Le flair du bonhomme ne l’avait pas trompé. C’était un poignard fort pointu que Perpignan avait essayé d’ouvrir dans sa poche… mais il était maintenant si démoralisé, si aplati, qu’il obéit à l’ordre du bonhomme et lança son arme dans un coin.
– À la bonne heure !… approuva le vieux clerc d’huissier ; voici que tu deviens raisonnable, de fou que tu étais tout à l’heure… Comment, c’est toi, un homme qu’on dit adroit, qui voulais… Mais tu n’avais donc pas réfléchi, malheureux ! Je suis venu seul, c’est vrai, mais on sait que je suis ici, puisqu’on m’y envoie. Si je n’étais pas rentré ce soir, penses-tu que mon patron, M. Mascarot, n’aurait pas été surpris ? Demain, il aurait été très inquiet. Après-demain, il serait allé trouver le procureur, et deux heures plus tard tu aurais été serré… Ah ! tu me dois une fière chandelle, et si tu ne consens pas à faire tout ce que je te demanderai, tu n’es qu’un ingrat.
Les traits décomposés de l’ancien cuisinier exprimaient la plus douloureuse mortification. On l’avait battu et on le raillait ! Il ne se rappelait pas avoir souffert une telle humiliation.
– Il faut bien obéir, dit-il d’un air farouche, quand on est pas le plus fort.
– Tout juste. Seulement tu aurais dû comprendre cela du premier coup.
– J’ai perdu la tête. Vous me menaciez, je prévoyais bien que vous alliez exiger de moi des choses… des choses…
– Voilà où tu te trompes. Je viens peut-être t’apporter une affaire superbe…
– Alors, mille tonnerres !… pourquoi tant de façons ? Pourquoi !…
D’un geste impérieux, le père Tantaine l’arrêta.
– Parce que, répondit-il d’un ton sec, je voulais, avant de te rien dire, te prouver que tu appartiens à Mascarot bien plus que tes pauvres Italiens ne t’appartiennent. Ils sont tes esclaves… tu es le sien. Tu es dans sa main, mon bonhomme, comme un œuf dans la main d’un fort de la halle. Un mouvement, et tu es écrasé… Il sait tes histoires et il a des preuves à fournir.
L’ex-cuisinier baissa la tête et balbutia :
– Votre Mascarot est le diable ; on ne résiste pas au diable.
– Allons donc !… te voilà tel que je te souhaitais ! Nous pouvons maintenant causer comme une paire d’amis.
C’est de l’air le plus piteux que Perpignan vint prendre place en face du père Tantaine, de l’autre côté de la petite table de bois blanc.
Tant bien que mal, il se remettait et réparait le désordre de sa toilette.
– Allons, murmurait-il, tournant, faute de ne pouvoir faire autrement, la scène en plaisanterie, me voici bridé, libre à vous d’en abuser à votre aise…
Mais le vieux clerc n’était pas homme à abuser. Il était venu avec un plan tout fait ; ses prévisions avaient été en partie trompées, il se consultait avant d’engager l’action.
– Ça, reprit-il, oublions ce qui vient de se passer et commençons par le commencement. Voici plusieurs jours que vous faites suivre une certaine Caroline Schimel.
– Moi ?…
– Un peu, mon neveu ! Vous employez à la suivre l’aîné de tous vos chérubins, un grand drôle de seize à dix-sept ans qui joue de la harpe, qui répond au nom de Ambrosio, lequel n’est pas le sien.
– C’est pourtant vrai !
– Même, il est assez maladroit, ce garnement, c’est une justice à lui rendre. D’abord, il accepte trop facilement le petit canon de l’amitié, sur le comptoir : puis, défaut énorme pour un « fileur », il porte mal la boisson. Comme nous redoutions, l’autre soir, que son absence vous donnât l’éveil, nous avons été obligés de le hisser dans un fiacre, et de le déposer à deux pas d’ici, au coin de la rue des Anglaises…
Illuminé par un souvenir lointain, l’ancien cuisinier se frappa le front.
– C’est donc vous, s’écria-t-il, qui observez cette Caroline.
– Vous devinez cela !…
– Eh !… je savais très bien que je n’étais pas seul à la « filer », mais qu’y faire ? On voit que vous ne connaissez pas l’envers de Paris. À côté de la vraie police, et malgré elle, s’agitent, se remuent, intriguent je ne sais combien de polices clandestines. Si on s’obstine à tirer certaines choses au clair, on risque sa peau, et je tiens énormément à la mienne.
Évidemment, Perpignan cherchait à égarer la conversation.
– Voyons, voyons, interrompit le bonhomme, revenons à nos moutons ; pourquoi épiez-vous Caroline Schimel ?
– Pourquoi ?… Dame… parce que… En vérité, je ne sais si je dois… Vous connaissez la devise de mes circulaires : Célérité et discrétion. Vous touchez à un secret qui ne m’appartient pas, qui a été confié à ma probité…
Le bon Tantaine eut un mouvement d’impatience et de dépit.
– Jouons-nous cartes sur table ? fit-il.
– Oui, assurément.
– Alors, pourquoi parler de discrétion, lorsque précisément vous suivez Caroline pour votre compte, espérant arriver par elle à pénétrer un mystère dont on ne vous a confié qu’une toute petite partie ?
Si abasourdi que fût l’ex-cuisinier, il essaya encore de dissimuler.
– Êtes-vous sûr de ce que vous avancez ? demanda-t-il.
– Si sûr que je puis vous dire que le client au secret vous a été amené par un avocat, Me Catenac.
Décidément, Perpignan était battu. Ce n’était plus de la surprise qu’exprimait sa physionomie, c’était la stupeur, l’effroi.
– Sacré tonnerre !… s’écria-t-il, en levant les bras au ciel, quel mâtin que ce Mascarot ! Il sait tout ! tout !…
Enfin, le vieux clerc d’huissier obtenait l’effet attendu, et c’est avec une visible jubilation qu’il tracassait ses lunettes.
– Non, répondit-il, le patron ne sait pas tout, et la preuve, c’est que je viens vous demander de nous apprendre ce qui s’est passé entre le client de maître Catenac et vous. Voilà le service que nous attendons de votre obligeance.
– Et je vous le rendrai, sacrebleu !… Mascarot, décidément, est un solide lapin, je parie de son côté. Et, tenez, parole sacrée !… Je serai franc… Voilà la chose :
Il y a de cela trois semaines, un matin, je venais d’expédier une douzaine de clients, chez moi, rue du Four, quand ma bonne m’apporte une carte : Je lis : Catenac, avocat. Je réponds : connais pas, faites entrer. Il entre, et après un bout de conversation, il me demande si je suis de force à retrouver une personne dont on a perdu la trace depuis très longtemps. Je lui affirme que oui, naturellement, puisque c’est mon métier.
Là-dessus, il me prie de rester chez moi le lendemain matin, parce que sur les dix heures on viendra m’en apprendre plus long.
En effet, le lendemain, à dix heures précises, je vois entrer un homme respectable et pauvrement vêtu. Soixante ans, redingote de garçon de bureau retraité, chapeau fatigué, mais propre.
Mais on a du flair, Dieu merci ! Je regarde le linge : blanc comme neige, fin comme satin. Je lorgne la chaussure : souliers de premier choix. J’examine les mains : peau fine, soignée, ongles limés et polis.
Alors, je me dis : Parfait ! Voici un innocent vieillard qui se croit supérieurement déguisé, laissons-lui ses illusions, mais ouvrons l’œil.
Poliment, je lui avance mon propre fauteuil, il s’assoit, et, sans se faire prier, il me dégoise sa petite affaire.
« – Monsieur, me dit-il, tel que vous me voyez, je n’ai pas toujours été heureux. J’étais, à une certaine époque, si absolument dénué de ressources que je fus contraint de porter aux Enfants-Trouvés un petit garçon que je venais d’avoir d’une maîtresse que j’adorais et qui est morte.
« Il y a de cela vingt-quatre ans.
« Aujourd’hui, je suis vieux, je suis seul dans la vie, je possède une certaine aisance.
« Je donnerais la moitié de ma fortune pour retrouver cet enfant.
« Pensez-vous que cela soit possible ? »
Outre qu’il a été cuisinier, qu’il dirige un bureau de renseignements, et qu’il possède une troupe de petits Italiens, Perpignan est beau parleur.
Il était superlativement flatté de l’attention du père Tantaine et n’était pas fâché de lui prouver, croyait-il, que sous certains rapports il vaut bien B. Mascarot.
Aussi parlait-il avec une lenteur calculée pour exciter l’impatience de son auditeur, soulignant ses intentions, triant ses phrases et épluchant ses mots.
– Vous comprenez aisément, cher monsieur Tantaine, reprit-il après une pause, que la naïve proposition de ce vieillard me réjouit considérablement.
Je n’apercevais à faire qu’une démarche fort simple, consistant à aller prendre des renseignements à l’hospice où avait été déposé l’enfant en question. Je me disais que ce vieux serait bien pauvre si la moitié, le quart même de sa fortune ne me dédommageait pas amplement de mes peines.
Je lui répondis donc bravement que je me faisais fort de le satisfaire, pourvu qu’il consentît à m’accorder un peu de temps.
Mais, ainsi que vous l’allez voir, je me réjouissais beaucoup trop tôt, et le bonhomme était un fin renard.
Après m’avoir bien laissé causer et m’enferrer, il m’arrêta :
« – Vous ne m’avez pas laissé finir, reprit-il, laissez-moi vous expliquer toutes les circonstances, et peut-être votre zèle sera-t-il refroidi, et jugerez-vous la tâche moins aisée. »
Naturellement, je lui répondis qu’avec les surprenants éléments d’investigations que je possède, nul ne saurait se dérober à mes recherches, et que pour moi l’Europe n’est qu’une cage où je n’ai qu’à allonger la main pour saisir l’oiseau que bon me semble, si sûrement qu’il se présume caché.
C’est qu’en effet, l’organisation de mon bureau de renseignements est telle que, sans vanité, je puis me vanter…
– Passons ! passons !… dit le père Tantaine, je connais.
– Soit, fit l’ancien cuisinier. Aussi bien vous êtes de force à deviner tout ce que je puis dire à un client.
Lui, qui ne connaît pas « la partie » comme vous, m’écoutait de l’air le plus satisfait.
« Tant mieux, répondit-il, si vous êtes habile comme le prétend Me Catenac et puissant autant que vous l’affirmez. Jamais occasion plus rare et plus belle d’exercer votre perspicacité ne s’est présentée.
« Ainsi que vous pouvez le croire, j’ai, de mon côté, tenté quelques démarches, elles ont été bien inutiles.
« Pour commencer, je me suis transporté à l’hospice où mon enfant avait été déposé.
« On s’y souvient parfaitement de lui.
« On m’a montré le registre sur lequel il avait été inscrit à la date du dépôt.
« Seulement, on ne sait ce que ce pauvre abandonné est devenu.
« À l’âge de douze ans et demi, il s’est échappé de l’hospice, et depuis on n’a pas eu de nouvelles de lui. Toutes les tentatives faites, lors de sa fuite, pour retrouver ses traces, sont restées infructueuses. On ne sait ni où il est allé, ni ce qu’il est devenu, ni même s’il est vivant ou mort. »
– Eh ! eh ! ricana le père Tantaine, le problème est joli, il n’y a pas à soutenir le contraire.
– Joli !… répondit Perpignan, cela vous plaît à dire, moi je prétends et je soutiens qu’il est à peu près insoluble. Allez donc au bout de dix ans passés retrouver la piste d’un moutard qui est devenu un homme.
– On a vu plus fort que cela.
L’accent du vieux clerc d’huissier dénotait une si ferme conviction que Perpignan en fut troublé et lui lança un regard gros de défiances.
Il put supposer que l’affaire avait été offerte à B. Mascarot, qui l’avait acceptée et la poursuivait avec quelque espoir de succès.
– Acceptable ou non, reprit-il, sans trop dissimuler le froissement de sa vanité, comme je n’ai pas la prétention d’être aussi fort que votre patron, la proposition de mon client me cassa bras et jambes.
Je fis bonne figure, cependant, et je lui demandai s’il serait possible de se procurer un signalement du moutard.
Il me répondit qu’on me le donnerait très exact et très minutieux, car plusieurs personnes, la supérieure de l’hôpital entre autres, se le rappelaient fort bien, et que de plus on me procurerait divers autres renseignements qui me seraient très utiles.
– Et vous avez sans doute ce signalement et ces renseignements ?
– Pas encore.
– Allons donc ! c’est une plaisanterie !…
– C’est la vérité pure, parole sacrée !… Je ne sais si le bonhomme avait lu dans mon œil ma déconvenue et mes hésitations, toujours est-il qu’il refusa net de s’expliquer plus clairement sur le moment.
Peut-être n’était-il venu ce jour-là que pour prendre une consultation.
« Une affaire comme celle-ci, me dit-il, mérite qu’on réfléchisse, qu’on se consulte. Elle est d’autant plus épineuse et délicate, que toutes les recherches doivent être faites dans le plus profond secret. Il ne faut songer ni à réclamer l’aide de la police ni à employer la publicité des journaux. »
Je pensai que le vieux avait surtout besoin d’être rassuré, et je me mis à lui expliquer que mon établissement est avant tout le tombeau des secrets.
Il me répondit simplement qu’il le croyait bien. Puis, après m’avoir prié de lui rédiger un projet d’investigations que je remettrais à Me Catenac, il me déclara qu’il ne voulait pas abuser de mon temps pour rien, et il tira de son portefeuille un billet de 500 francs qu’il déposa sur ma table.
Je le repoussai, quoiqu’il m’en coûtât. C’était trop ou pas assez, et j’espérais mieux pour plus tard.
Mais il insista, m’affirmant que nous nous reverrions, et m’annonçant qu’en attendant j’aurais affaire à son avocat, Me Catenac.
Sur quoi, il se leva et sortit, me laissant bien moins occupé de ses recherches qu’intrigué à son sujet.
Voilà tout !…
Il était clair pour le père Tantaine que l’ex-cuisinier disait la vérité. Cependant, comme il omettait un point essentiel :
– Quoi !… lui demanda-t-il, vous n’avez pas cherché à savoir qui est ce vieillard qui avait recours à un travestissement.
Pendant un moment, Perpignan parut se consulter. Mais il comprit vite qu’avec un homme aussi bien renseigné que l’envoyé de B. Mascarot, les réticences étaient puériles.
– Si !… répondit-il. Mon client était encore dans les escaliers que déjà j’avais passé une blouse, puis une casquette, et que je m’élançais sur ses traces. Arrivé dans la rue, je le vis à dix pas en avant. Je le suivis, et bientôt je le vis entrer, comme chez lui, dans un des beaux hôtels de la rue de Varennes.
C’était bien cela, et cette franchise devait aller au cœur du vieux clerc d’huissier.
– Et votre client était bien chez lui, interrompit-il, vous aviez eu l’honneur de donner une consultation au duc de Champdoce en personne.
– Vous l’avez dit. J’ai dans ma clientèle le duc de Champdoce, ce qui est, j’ose le dire, un peu flatteur. Seulement, je veux être étranglé par le diable, après avoir failli l’être par vous, si je devine comment vous avez découvert tout cela.
– Oh !… répondit modestement Tantaine, le hasard est si grand !… Mais ce que je n’aperçois pas, c’est le trait d’union entre le duc et Caroline.
L’ancien cuisinier eut une grimace narquoise.
– Vraiment !… fit-il. Alors pourquoi la faites-vous suivre ?… Mes raisons, à moi, sont fort simples. Comme bien vous pensez, j’ai pris sur le duc de Champdoce tous les renseignements à ma portée. C’est, m’a-t-on dit, un très grand seigneur immensément riche et de mœurs très austères. Il est marié et vit très bien avec sa femme. Ils avaient un fils unique, ils l’ont perdu l’an passé, et depuis cette mort, ils sont inconsolables.
Alors, je me suis dit ceci :
On a beau être duc, on est homme. M. de Champdoce, dans sa jeunesse, aura eu, de quelque goton, un enfant qu’on aura porté à l’hospice et qu’on aura oublié.
Son héritier légitime étant mort, n’ayant personne à qui léguer sa fortune et son nom, le duc s’est souvenu du fils de la goton, qui après tout est le sien, et il voudrait le retrouver.
– Que pensez-vous de la conclusion ?…
– Elle me semble logique, mais elle ne me dit rien de vos vues sur Caroline Schimel !…
Il est sûr que Perpignan était loin d’être de la force du doux émissaire de B. Mascarot. Mais il n’était point assez simple pour ne pas sentir qu’il subissait un interrogatoire en règle.
S’il ne se révoltait pas, lui si arrogant, c’est qu’il n’avait que trop conscience de sa dépendance absolue.
D’ailleurs, la confession une fois commencée, autant la faire entière et sincère. Enfin, au bout de toutes ces questions, il pressentait, il entrevoyait quelque proposition avantageuse.
– Vous devez penser, cher monsieur Tantaine, reprit-il, que mon opinion, une fois arrêtée sur le mobile du duc de Champdoce, mon premier soin a été de m’enquérir de son passé. Je n’avais pas la prétention de remonter jusqu’à la mère de l’enfant, mais j’espérais fort recueillir sur elle quelques détails biographiques. Je regrette de l’avouer, mes investigations sont restées absolument infructueuses.
– Quoi !… avec tous les éléments que vous possédez !…
– Raillez-moi, c’est ainsi. Des trente domestiques qui emplissent les antichambres, les cuisines et les écuries de l’hôtel de Champdoce, il n’en est pas un qui soit dans la maison depuis plus de douze ans. Où sont allés ceux qui servaient le duc quand il était jeune ? Je n’ai pu les retrouver.
J’étais aussi dépité que possible, quand un jour, par le plus grand des hasards, étant entré chez un marchand de vins de la rue de Varennes, j’entendis parler d’une servante qui était chez notre homme il y a vingt-cinq ans et qui encore maintenant en reçoit une petite rente.
Cette servante était Caroline Schimel.
J’ai eu son adresse par un valet de pied et je la fais suivre.
– Qu’espérez-vous donc d’elle ?
– Pas grand chose, je l’avoue. Cependant, cette petite pension qu’on sert à cette fille me porte à croire qu’elle a rendu autrefois quelque service à ses maîtres. Ne peut-on pas supposer qu’elle a eu connaissance de la naissance de cet enfant naturel ?
– La présomption est peu probable ! fit le vieux clerc d’huissier, de l’air le plus indifférent du monde.
– Du reste, reprit Perpignan, je n’ai plus revu M. de Champdoce.
– Mais avez-vous vu M. Catenac ?
– Oui, trois fois.
– Et il ne vous a donné aucune indication nouvelle ? Il ne vous a même pas dit à quel hospice a été déposé l’enfant ?
– Rien… C’est à ce point qu’à ma dernière visite, je lui ai déclaré que je commençais à me lasser d’être tenu le bec dans l’eau. Il devait tout me révéler, cette fois-là… Ah bien ! ouitche ! Je l’ai trouvé tout chose. C’était à jurer qu’il grillait de renoncer à l’affaire, et que même il regrettait de s’en être mêlé.
Le bon Tantaine n’en était pas à s’étonner des tergiversations de l’honorable avocat. Il reconnaissait l’effet des menaces de B. Mascarot. Cependant il parut partager le mécontentement de son interlocuteur.
– Est-ce que tous ces faux-fuyants ne vous semblent pas singuliers ? demanda-t-il.
– Pas trop. Je parierais que ce M. Catenac n’est pas plus avancé que moi. Le duc, très probablement, hésite à se livrer tout à fait. Dame ! c’est grave, convenez-en. À sa place, je craindrais de retrouver mon moutard encore plus que je ne le désirerais. Qui sait ce que fait le futur héritier des Champdoce ? Il doit écumer les barrières, à moins qu’il n’achève ses études dans quelque maison centrale. Que voulez-vous que devienne un garnement qui, à treize ans, s’est enfui d’un endroit où il était très bien ?
Mieux que tout autre, Perpignan, le tyran de quarante pauvres petits musiciens des rues, peut savoir quel abîme de misère et d’infamie attendent les enfants abandonnés.
– J’avais cependant imaginé un plan assez beau, continua-t-il. Avec de l’argent et de la patience, on peut, en matière d’investigations, accomplir des miracles.
– Je suis de votre avis.
– Eh bien !… voici ce que je comptais faire. Je traçais autour de la ville, comme un cercle idéal, que je parcourais méthodiquement. Je me disais : J’entrerai dans toutes les maisons de tous les villages, dans toutes les auberges dans toutes les cabanes isolées, j’en rassemblerai les habitants, et je leur tiendrai ce langage :
« Quelqu’un de vous se souvient-il d’avoir, à telle époque, recueilli, ou logé, ou nourri, ou même vu un enfant de tel âge, vêtu comme ça et comme ça, fait de telle façon ? etc. » Et indubitablement je rencontrerais quelqu’un qui me répondrait : « Oui, je me souviens ! » Or, fiez-vous à moi. Du moment où j’aurais entre les doigts un bout de fil conducteur, je serais bien venu à bout de démêler l’écheveau.
La méthode parut si ingénieuse et si pratique au bon père Tantaine, qu’il ne crut pas devoir taire son impression :
– Pas mal imaginé !… fit-il.
L’ancien cuisinier n’osa cependant pas trop s’enorgueillir de cette approbation. Le bonhomme avait une si singulière façon de distribuer le blâme et l’éloge, que bien malin eût été celui qui eût pu dire ce qu’il en fallait prendre ou laisser.
– Eh ! mille tonnerres !… s’écria Perpignan, vous me feriez croire à la fin que je ne suis qu’un sot ! Je vous semble niais ? Ce n’est pas surprenant, vous me tenez. Tout cela ne m’empêche pas d’avoir des inspirations. Ainsi, par exemple, au sujet de cet enfant, il m’est venue une petite idée qui, bien conduite, pouvait devenir très avantageuse.
– Peut-on la connaître ?
– À vous on peut tout révéler sans danger, n’est-ce pas ? Donc je m’étais dit : Découvrir cet enfant est à peu près impossible, mais pourquoi n’en pas supposer un, qu’on stylerait et qu’on lui substituerait adroitement ?
À cette proposition inattendue, le bon Tantaine bondit sur sa chaise et porta précipitamment la main à ses lunettes. C’est son geste des grandes circonstances. Peut-être s’assure-t-il ainsi que son œil est bien à l’abri et ne peut rien révéler de ce qui se passe en lui.
– C’était hardi !… prononça-t-il, c’était audacieux.
Perpignan avait fort bien vu le tressaillement du bonhomme, mais il le prit pour un involontaire hommage rendu à sa belle conception. Plus habile, moins convaincu surtout de son infériorité, ce qui est la plus grande des faiblesses, il eût bien senti qu’il venait de trouver le défaut de la cuirasse.
– Oui !… c’était crâne, reprit-il, et même diablement chanceux. Mais je n’y pense plus.
– Vous avez peur ?
– Moi !… C’est vous qui me demandez si… Sacré tonnerre ! vous ne me connaissez donc pas !… Peur !… moi !…
Le vieux clerc d’huissier était certainement ému, car sa voix devenait de plus en plus onctueuse.
– Alors pourquoi renoncer ? interrogea-t-il.
– Pourquoi ?… La belle malice ! Parce qu’il n’y a pas moyen, mon vieux papa, parce qu’il y a un obstacle.
– Je n’en vois pas, prononça nettement Tantaine, qui voulait aller jusqu’au fond de la pensée de son interlocuteur.
– Tiens !… sacrebleu ! Au fait, j’ai peut-être omis ce détail… Le duc de Champdoce m’a dit expressément qu’il était certain de pouvoir constater l’identité de son enfant, grâce à certaines cicatrices.
– De quelle sorte ?
– Ah ! dame… vous m’en demandez trop long.
Sur cette réponse, le vieux clerc se dressa brusquement, dissimulant ainsi à son interlocuteur la violence de son émotion.
– Par ma foi !… cher monsieur Perpignan, dit-il de l’air le plus dégagé, je suis au désespoir d’être venu vous troubler… Mon patron avait supposé que vous chassiez le même lièvre que lui, il se trompait… C’est dire que nous vous laissons le champ libre.
L’ex-cuisinier voulait répondre, mais déjà le bonhomme avait ouvert la porte, et poursuivait :
– À votre place, je m’en tiendrais au premier plan que vous m’aviez soumis. Vous n’arriverez certes pas à l’enfant, mais si vous savez vous y prendre, vous tirerez du duc de Champdoce bien des billets de mille francs. Mes excuses… et au revoir.
L’ancien cuisinier était-il dupe de l’explication ? Le doux Tantaine ne se le demanda même pas. Que lui importait !… L’important était de ne rien laisser apercevoir de ses sensations, il craignait de se trahir, et c’est en toute hâte qu’il quitta la « fabrique » de Perpignan.
– Il y a des cicatrices, grommelait-il, tout en remontant la ruelle des Reculettes, et je l’ignorais, et Catenac, le traître, ne me prévient pas !
XXIII
B. Mascarot expliquait d’une façon aussi simple que saisissante la façon d’opérer, lorsqu’il se comparait à ces montreurs de marionnettes qui, invisibles pour les spectateurs, tiennent les ficelles de tous les pantins qui s’agitent sur leur petit théâtre.
Dès que volontairement ou fortuitement un personnage se trouvait mêlé à l’action dont il préparait depuis si longtemps et avec tant de patience le dénouement, B. Mascarot lui attachait, – pour parler son langage, – « un fil de manœuvre ».
En d’autres termes, plus clairs que cette image théâtrale, il mettait ce personnage sous la surveillance discrète d’un de ses anges gardiens.
Ainsi, il n’y avait pas deux heures que André avait quitté Modeste, au coin de l’avenue de Matignon, que déjà il avait à ses trousses un espion chargé de rendre compte de toutes ses actions, de ses démarches les plus insignifiantes, à l’honorable placeur.
Ce « fileur » n’était autre que le collègue de Beaumarchef, La Candèle, un garçon de mérite, assure Mascarot. Il avait surtout ordre d’être prudent et de se cacher avec un soin extrême.
Mais, en vérité, il n’était pas besoin de précautions.
L’idée que Sabine de Mussidan était sauvée emplissait bien trop le cœur et l’esprit d’André pour qu’il pût prêter la plus légère attention aux choses extérieures. L’univers s’écroulant ne l’aurait pas distrait de son bonheur.
Maintenant, d’ailleurs, son amour entrait dans une phase nouvelle, et jamais ses espérances ne lui avaient parues si réalisables.
Il avait un ami, à cette heure, M. de Breulh-Faverlay ; une confidente, Mme de Bois-d’Ardon, deux alliés dont l’influence, à un moment donné, pouvait être décisive.
Or, il n’en était plus à s’indigner presque du dévouement de M. de Breulh.
Leurs communes angoisses, pendant trois jours, avaient établi entre eux une de ces amitiés solides comme le temps seul n’en cimente pas.
Mais plus l’avenir souriait à André, plus il se répétait qu’il lui fallait se remettre à l’ouvrage avec une ardeur nouvelle. Il avait bien du temps perdu à se désoler à rattraper.
Il quitta donc, ce soir-là, M. de Breulh de fort bonne heure, après un dîner qui fut excessivement gai.
– À partir de demain, lui dit-il en lui serrant la main, s’il vous plaît de lever le nez quand vous traverserez les Champs-Élysées, vous m’apercevrez, hissé sur un échafaudage, en train de gratter le moellon.
Il fallut à André une partie de la nuit pour achever les dessins qu’il devait soumettre à M. Gandelu, cet entrepreneur si riche, dont il devait sculpter la maison depuis les soupiraux des caves jusqu’aux corniches des cheminées.
Levé de bon matin, il donna comme tous les jours un regard et une pensée à ce portrait de Sabine qu’il cachait à tous les yeux, et, prenant son carton à dessins, il sortit pour se rendre chez M. Gandelu, l’heureux père du jeune M. Gaston.
C’est rue de la Chaussée-d’Antin, dans une maison qui lui appartient et qui ne semble pas exposée à l’expropriation, que demeure cet entrepreneur presque célèbre depuis qu’il a fait construire le joli théâtre des Comédies-Parisiennes.
Lorsque André se présenta chez lui, sur les dix heures, le domestique auquel il s’adressa lui conseilla fortement de remettre sa visite à un autre moment.
– Je ne sais ce qu’a monsieur, ce matin, lui dit cet homme ; mais jamais, non, jamais, depuis cinq ans que je suis à son service, je ne l’ai vu dans un état pareil… Il a tout saccagé dans son cabinet. Et, tenez… écoutez !
Point n’était besoin de prêter l’oreille pour distinguer les éclats d’une voix puissante, un bruit de meubles qu’on brisait, et des jurons à faire frémir un sous-officier de cavalerie.
– Monsieur est comme cela depuis une heure, ajouta le domestique ; ça l’a pris après la visite de son avocat, M. Catenac, qui est venu dès potron-minet ; ainsi, à la place de monsieur.
Mais André était pressé.
– Qu’importe ! fit-il, votre maître ne me mangera pas… Annoncez-moi.
Le domestique obéit, non sans quelques observations encore, et ouvrit à André la porte d’une pièce immense, fort richement décorée, au milieu de laquelle l’entrepreneur gesticulait furieusement, armé du montant d’une chaise dont les débris étaient à ses pieds.
À soixante ans passés, M. Gandelu peut, hardiment, ne s’en laisser donner que cinquante.
C’est une manière d’Hercule limousin, au torse noueux, aux épaules carrées, à la main velue, plus large qu’une épaule de mouton, gros, grand, large, travaillé par le sang, gêné dans ses paletots doublés de satin, et paraissant toujours regretter la libre blouse de ses jeunes années.
Est-il fier ou importuné de cette idée qu’il peut aligner trois millions, peut-être quatre ? Le discerner est malaisé.
Il a le droit, en tout cas, de parler de sa fortune. Elle a deux nobles origines : le travail et l’économie. Ses envieux, en remontant jusqu’à la source, c’est-à-dire jusqu’à la première pièce de cinq francs portée à la caisse d’épargne, ne réussiraient pas à trouver une tache de boue.
Cependant il ne fait pas sonner haut ses écus. Il aime bien mieux parler de ce bon temps où il était si malheureux, et où il escaladait les échelles, pliant sous le faix d’une « truellée gâchée serrée ».
Pour grossier, il l’est autant que du pain d’orge, et vulgaire, et brutal, et violent plus que la poudre, et mal élevé. Seulement…
Seulement, sous cette rude enveloppe, se cachent, comme le diamant sous sa gangue, les plus nobles et les plus généreux sentiments et une probité intacte.
Il jure comme un païen, c’est vrai ; il fait des cuirs, c’est incontestable : il tire toutes ses comparaisons du « bâtiment », c’est ridicule. Mais il est bon, mais il n’a jamais refusé un service, mais il comprend toutes les délicatesses. Il a les mains calleuses, mais non le cœur.
Dès que la porte s’ouvrit :
– Quel est, s’écria-t-il, le jean-sucre !… – Il disait : jean, mais non pas : sucre. – Quel est le jean-sucre qui se permet de venir me déranger.
– Vous m’aviez donné rendez-vous, monsieur, commença André.
Le jeune peintre ornemaniste avait bien fait d’insister pour entrer ; il s’en aperçut vite.
En le reconnaissant, le front de l’entrepreneur se dérida.
– Ah ! c’est vous, dit-il d’une voix subitement radoucie ; venez, jeune homme, votre visite ne pouvait mieux tomber ; vous voir me plaît. Entrez, et asseyez-vous… s’il y a encore une chaise d’aplomb.
Le domestique avait eu raison d’affirmer que son maître venait d’avoir une crise terrible. Il n’y avait pour ainsi dire pas un meuble du cabinet qui fût intact. La garniture même de la cheminée était à terre.
– Je vous aime, moi, poursuivait M. Gandelu, qui ne lâchait toujours pas son montant de chaise, parce que vous êtes solide et franc comme un bloc de liais. Je vous aime, parce que vous avez du cœur, de l’honneur, vous, et l’envie de bien faire ; parce que vous ne boudez pas au travail…
– En vérité, monsieur…
– Ne rougissez pas comme une mariée, jeune homme, quoique ce soit beau d’être aussi modeste. Je vous ai toisé et cubé, moi, du premier coup d’œil ? Est-ce que Jean Lantier, votre patron et mon ami, ne m’a pas conté votre histoire ? Est-ce qu’on ne sait pas que vous vous êtes fait tout seul, à la force du poignet ?…
– Oh !… monsieur, je dois ce que je sais à Jean Lantier.
– Oui, Jean est un brave, lui aussi ; c’est connu. Mais c’est égal. Où il n’y a pas de pierre d’attente, on n’accroche pas une bâtisse. Quand un garçon n’a rien ici – il se battait la poitrine à la briser, – quand il n’a rien là – il se frappait le front, – on perd son temps, ses soins et ses peines. Vous n’étiez rien, vous, et vous êtes quelque chose…
C’est vainement que André essayait d’arrêter M. Gandelu ; ce panégyrique ne laissait pas que de l’embarrasser.
Mais l’entrepreneur était lancé.
– Oui, insista-t-il, vous êtes quelque chose. Vous faut-il cent mille francs pour entreprendre quelque affaire ? ils sont à votre service, à trois, pour le temps que vous voudrez. Ah !… si j’avais une fille et qu’elle vous plût ! Je vous dirais : Tope, garçon !… elle est à toi, voilà la dot, écus, et je vous bâtirais une maison !…
André ne connaissait pas assez M. Gandelu pour comprendre d’où soufflait l’orage.
– Il faut bien se remuer, fit-il, quand on ne peut compter que sur soi.
– C’est vrai, fit l’entrepreneur d’une voix profonde qui trahissait une cruelle souffrance ; vous n’avez jamais connu vos parents. Vous ne savez pas ce qu’est un père, vous, un bon père… vous aimeriez le vôtre, vous !…
Il s’interrompit, et comme André ne répondait pas, brusquement il lui demanda :
– Vous connaissez mon fils ?…
Le ton de M. Gandelu, cette question à brûle-pourpoint : « Connaissez-vous mon fils ? » devaient éclairer André.
Le sens de toutes les paroles de l’entrepreneur, obscur jusqu’alors, éclatait à ses yeux. Les raisons de toutes ces violences, il les pressentait.
Il se trouvait, c’était évident, en présence d’un père justement irrité, qui prenait une triste et amère satisfaction à comparer son fils à un jeune homme dont il estimait l’intelligence et l’énergie.
André, qui se souvenait trop du dîner donné chez Rose, et qui avait encore sur le cœur certaines expressions de M. Gandelu fils, hésita quelque peu à répondre.
Il se demandait si, pour couper court, il ne serait pas sage de dire : « Non », tout simplement. Puis il pensa que ce serait là, probablement, un mensonge inutile, et c’est en devenant fort rouge qu’il dit :
– J’ai eu le plaisir de me trouver une ou deux fois avec M. Gaston.
L’entrepreneur à ces mots, bondit comme s’il eût reçu un coup de fouet en pleine figure, et d’un terrible revers du montant de chaise qu’il ne lâchait toujours pas, il fit voler en éclats un des panneaux d’une magnifique armoire de chêne.
– Saint bon Dieu ! s’écria-t-il avec un accent terrible, ne prononcez jamais ce nom-là devant moi ! Gaston ?… Est-ce que véritablement vous croyez que mon fils à moi, Nicolas Gandelu, se nomme Gaston ? Il a été baptisé Pierre, du nom de défunt mon père, qui était terrassier de son état, qui était un homme. Ce nom de Pierre a fait honte à ce sot qui est mon fils. Il ne le trouve pas assez relevé. Il lui faut un petit nom d’amour bien doux, et surtout distingué, à donner comme sien à ces créatures qui le grugent en se moquant de lui. Pierre !… c’est commun, ça pue le travail et l’honnêteté ! Tandis que Gaston !… Diable ! ça sent son prince et ça fleure la pommade. Gentil, Gaston, mignon, joli… donnez patte à maîtresse !
L’expression de l’entrepreneur, en même temps qu’il s’efforçait d’imiter une voix flûtée, était si réellement comique, en dépit de sa douleur, que André, à grand peine, dissimula un sourire.
– Si c’était tout, poursuivit M. Gandelu, je hausserais les épaules et ne dirais mot. Mais avez-vous vu ses billets de visite ? Il fait mettre dessus : Gaston de Gandelu, et il y a une couronne de marquis dans un des angles. Marquis ! lui, le fils d’un homme qui a servi les maçons ! marquis ! quand moi, son père, je n’ai pas encore essuyé sur mon échine la trace des sacs de plâtre que j’ai portés !… Ah ! je t’en ferai voir des de ! Ah ! je t’en donnerai des marquisats !…
– Les très jeunes gens, essaya André, ont de ces petites faiblesses…
Mais M. Gandelu n’était pas un père à admettre des enfantillages de ce genre.
– Non !… répondit-il, avec une violence croissante, vous ne sauriez excuser cela. Monsieur mon fils rougit de moi. Porter un nom pur et sans tache le gêne. Il y en a tant comme cela ! Il trouverait meilleur d’être le fils d’un gredin titré. Il prétend que ce titre le pose dans la société. Elle est bien, et vaut qu’on y tienne, sa société ! Un ramassis de fripons, de filles perdues et de dupes ! Je connais ses amis, des désœuvrés, des drôles, qui sont vêtus comme des poupées, frisés, gantés, des caricatures d’hommes. Méchants crevés ! On les saignerait à blanc, que d’eux tous on ne tirerait pas une pinte de sang pur. C’est pour ce monde-là qu’il s’est donné un de… Quand les garçons de restaurant lui disent : « Monsieur le marquis, » il est aux anges. Idiot !… Avec la moitié de ce qu’il dépense, je voudrais qu’on m’appelât sire, ou pour le moins monseigneur… Et il ne voit pas qu’on se moque de lui ! On l’entoure, on le flatte, on le caresse, et il croit qu’on rend hommage à son esprit, à sa beauté… Propre à rien ! C’est aux écus de ton père le maçon qu’on fait la cour…
La situation d’André devenait de plus en plus pénible et délicate. Il eut donné bien des choses pour échapper à ces confidences arrachées à la colère, mais il ne pouvait se faire entendre, et il n’osait se retirer.
– Il n’a que vingt ans, poursuivait M. Gandelu, et déjà il est usé, fané, flétri, fini. Il est vieux, ses yeux clignotent et ses cheveux tombent. Il ne tient pas debout, il n’a que le souffle, et il passe ses nuits à boire. Mais c’est de ma faute, aussi, j’ai été trop bon. J’ai toujours été à plat ventre devant sa volonté. Il m’aurait demandé ma vieille peau pour lui faire une descente de lit, je la lui aurais donnée. Depuis qu’il sait parler, il n’a eu qu’à dire : Je veux, et il a eu…
J’avais perdu ma pauvre femme, je n’avais que lui…
– Savez-vous ce qu’il a ici ? Un appartement de prince, deux domestiques et quatre chevaux à sa disposition. Je lui donne tous les mois 1.500 francs pour ses cigares ; il m’en carotte autant… et il va partout répétant que je suis un vieux pingre, un grippe-sous, et il s’endette, et il a déjà escompté la fortune de sa pauvre mère…
Il s’interrompit brusquement, et de cramoisi qu’il était, devint livide. Un frémissement convulsif fit trembler ses lèvres, et ses yeux lancèrent des éclairs.
La porte venait de s’ouvrir, et le jeune M. Gaston, – Pierre de son vrai nom, – apparaissait pimpant, suffisant, luisant, l’air ravi, comme toujours, de son séduisant personnage.
Il s’avança d’un pas délibéré, le chapeau sur la tête, le cigare aux dents.
– Bonjour, papa, dit-il ; ça va bien, ce matin ?
Mais le père recula tout frissonnant.
– Ne m’approchez pas ! cria-t-il, arrière !
Le jeune M. Gaston s’arrêta un peu surpris, interrogeant André de l’œil.
– Pas content ce matin, papa, ajouta-t-il. Est-ce que la goutte reviendrait ? Mauvaise affaire…
L’entrepreneur étouffa le cri de douleur de l’homme blessé au cœur, et fit avec sa barre de bois un si terrible moulinet, que son fils jugea prudent de se reculer.
André s’était précipité entre le père et le fils.
– Oh ! ne craignez rien, dit l’entrepreneur d’un ton funèbre, j’ai encore ma raison !
Et soit qu’il voulût rassurer le jeune peintre, soit qu’il se défiât de sa violence, il jeta dans un coin l’arme, terrible entre ses mains, qu’il tenait.
Certainement, M. Gaston avait été quelque peu effrayé ; mais c’est un garçon solidement trempé, et qui ne perd pas facilement sa belle assurance.
– De quoi !… murmura-t-il, un infanticide ! Ah ! mais non ! je la trouve mauvaise ! Je demande à ne pas être de cette petite fête de famille, comme dit Dupuis des Variétés, dans…
Il n’acheva pas la citation. André venait de lui saisir le poignet, et le lui serrait à le faire crier, en lui soufflant à l’oreille :
– Plus un mot.
Mais le silence lugubre qui suivit ne pouvait faire le compte de M. Pierre-Gaston.
– Oui, reprit-il, silence et mystère… connu. Seulement, je voudrais bien savoir de quoi il retourne, et ce que cela signifie ?
C’est à André que répondit M. Gandelu.
– Je vais tout vous expliquer, monsieur André, commença-t-il, et vous me plaindrez, vous, et vous comprendrez ma souffrance. Hélas ! mon malheur doit être celui de bien des pères. On dit que c’est notre destinée, à nous autres parvenus, de bâtir sur le sable et de voir s’effondrer tous les projets que nous formons pour l’avenir de nos enfants. Nos fils, qui devraient être la glorification de notre travail, deviennent comme le châtiment de notre orgueil.
– Pas mal ! pour un homme qui n’en fait pas son métier, murmura le jeune monsieur Gaston, j’ai toujours dit que papa finirait dans les bénisseurs.
M. Gandelu, par bonheur, ne put entendre cette nouvelle impertinence. Il poursuivait d’une voix rauque et brève :
– Ce malheureux qui est là, monsieur André, est mon fils. Sur la mémoire de sa sainte mère, défunte ma femme, je jure que depuis vingt ans il a été ma seule et unique préoccupation. Voici vingt ans que sa pensée emplit mon cœur, ma tête, mes veines, que je ne vis que par lui et pour lui. Eh bien ! la semaine passée, il pariait, il jouait sur ma vie ou ma mort, comme vous parieriez sur une de ces rosses qu’on va voir sauter des haies aux courses de Vincennes…
– Ah ! mais non ! s’écria le jeune M. Gaston, celle-là est trop forte.
L’entrepreneur eut un geste de mépris éclatant.
– Ayez donc au moins, dit-il, le courage de votre infamie, de votre crime. Pauvre garçon !… vous m’avez cru aveugle, parce qu’il ne me plaisait pas de vous dire : Je vois ! Il m’a bien fallu ouvrir les yeux à la fin…
– Cependant, papa…
– Ne niez pas… Ce matin, mon homme d’affaires, Me Catenac, est venu me rendre visite, et il a eu cet affreux courage, que les vrais amis ont seuls, de me dire la vérité. Je sais tout…
L’accent de M. Gandelu trahissait un tel excès d’horreur, on sentait si bien que pour lui, désormais, c’en était fait de tout bonheur ici-bas, que André se demandait, non sans effroi, quelle révélation il allait entendre.
Ce devait être horrible, car l’assurance du jeune M. Gaston faiblissait, et sa verve si spirituelle et si brillante paraissait éteinte.
– C’est pour vous dire, monsieur André, reprit l’entrepreneur, que la semaine passée j’ai été pris d’une attaque de goutte comme on n’en a pas deux dans sa vie. Pendant trois jours on a cru, et je pensais bien moi-même, que j’avais gâché mon dernier sac. J’avais fait mon testament. Les bâtisses solides s’écroulent tout d’un coup, et je me sentais ébranlé des fondations au faîte. Durant ces longues heures de souffrances, mon fils ne m’a pour ainsi dire pas quitté. Et moi, pauvre niais de père, en le voyant à mon chevet, attentif et le visage triste, je me sentais pénétré d’une joie profonde.
« Il m’aime donc, me disais-je, je m’étais trompé. Sa tête est folle, mais il a bon cœur. Il me pleurerait si je mourais, il répandrait de vraies larmes. »
D’autres fois je pensais :
« C’est tout de même bon d’être malade, on a son fils près de soi. »
Hélas ! c’est lorsque je disais ou que je pensais cela que j’errais misérablement.
Ce n’était pas la vie que guettait l’infâme ; il épiait la mort qui devait lui livrer ma fortune.
Si son visage était si triste, c’est qu’il était poursuivi, traqué, harcelé par des créanciers qui le menaçaient de s’adresser à moi.
S’il s’éloignait à peine de ma chambre, c’est que, spéculant sur mon agonie, il négociait un emprunt, et qu’il avait intérêt à faire croire mon état plus désespéré qu’il ne l’était en réalité.
Il s’était adressé à un abject usurier nommé Clergeot et en avait obtenu la promesse d’un prêt de cent mille francs, en lui affirmant, en lui écrivant que je n’avais plus que quelques jours à vivre.
Je tenais entre mes mains, il n’y a pas une heure, le papier sur lequel on été stipulées les conditions provisoires.
Il y est dit, en propres termes, que si je meurs dans les huit jours du prêt, mon fils ne donnera que 20.000 fr. de commission. Il s’engage à rendre 150.000 fr. si je passe le mois. Enfin, si j’en échappe, il se reconnaît débiteur d’une somme de 200.000 fr.…
L’entrepreneur s’arrêta. Sa respiration devenait haletante, il étouffait.
Il avait tiré son mouchoir, et d’un geste fou, il essuyait son front moite d’une sueur glacée.
– Mon Dieu !… pensait André, voici un malheureux homme qui ne me pardonnera jamais d’avoir été l’involontaire confident de ses souffrances.
Mais le jeune peintre se trompait. Les natures primitives ne sauraient souffrir en silence, il faut une issue à leur douleur quant elle est trop forte.
Ce qu’il disait à André, M. Gandelu, sans hésiter, l’eût dit à tout homme, estimable selon lui, qui fût entré en ce moment.
– Tout cela n’est encore rien, reprit-il. Avant de livrer une somme si forte, car c’est une fortune, cent mille francs, Clergeot tenait à savoir si véritablement j’étais aussi bas qu’on le prétendait. Il demandait des sûretés, il exigeait des certificats ! Comment s’y prendre pour le satisfaire, pour lui donner confiance ? Mon fils chercha et trouva. Oui, c’est alors que mon fils se mit à me parler sans relâche d’un médecin spécialiste, unique au monde, me jurait-il en m’embrassant, pour les maladies comme la mienne.
Je le voyais si tourmenté, si agité ; il insistait avec de si douces prières dans la voix, que je me rendis à ses supplications, et qu’un soir je lui dis :
– Amène donc ce docteur, puisque tu crois qu’il me guérira.
Et il me l’amena.
– Car, il faut vous le dire, monsieur André, il s’est trouvé un médecin pour accepter la mission infâme de l’usurier ; un médecin que je devrais dénoncer au mépris public et à la juste indignation de ses confrères.
Il est venu, cet homme, et il est resté plus d’une demi-heure près de moi. Il me semble le voir encore, penché sur mon lit, me tâtant le pouls, m’examinant, me touchant, m’accablant de questions.
En sortant, après une prescription insignifiante, il a dit – devant mon fils qui l’avait suivi – à Clergeot, qui attendait dans la rue, le résultat de cette consultation monstrueuse :
– Vous pouvez lâcher votre monnaie, le bonhomme ne s’en tirera pas.
Voilà pourquoi, cinq minutes plus tard, mon fils reparut heureux, souriant, et me cria de la voix la plus joyeuse :
– Cela va bien, papa !
– Non, cela n’alla pas bien. Cela n’alla pas, du moins, selon les prédictions du docteur.
La journée fut très mauvaise ; mais la nuit, après une crise, un mieux sensible se déclara. Le surlendemain j’étais sur pied.
Or, il avait fallu quarante-huit heures à Clergeot pour rassembler ses fonds. Il apprit mon rétablissement : la négociation fut rompue… Mon fils n’a pas eu ses cent mille francs…
Il pleurait, ce pauvre vieux père, et c’était un spectacle lamentable, de voir de grosses larmes rouler silencieuses le long de ses joues et se perdre dans les rides de son visage.
C’est d’un ton déchirant qu’il ajouta :
– Que n’as-tu eu, malheureux ! l’effroyable courage de hâter la mort de ton père, puisque tu la souhaites avec tant d’ardeur ! Peut-être ne savais-tu pas qu’un des remèdes qu’on me faisait prendre est un poison qui ne pardonne pas ? Que n’en as-tu mis dans le verre que tu portais à mes lèvres, dix gouttes au lieu d’une ! Tout serait fini maintenant… et ce crime ne serait pas bien plus grand que le tien…
André ne quittait pas des yeux le jeune monsieur Gaston.
Il s’attendait à tout moment à le voir se jeter aux pieds de ce père qu’il avait si mortellement offensé et implorer le pardon, l’oubli d’une action abominable. Point.
Le jeune monsieur Gaston demeurait immobile, raide, les lèvres serrées.
Il semblait humilié, irrité, mais non touché ni ému. Et, en effet, en ce moment même, il se demandait comme l’histoire de sa négociation avec Clergeot avait pu arriver aux oreilles de l’avocat de son père, et comment surtout M. Catenac avait pu produire des preuves et montrer le projet de contrat.
Comme André, l’entrepreneur avait espéré que son fils allait demander grâce ; il s’apprêtait peut-être déjà à pardonner…
Mais voyant qu’il s’obstinait au silence :
– Vous connaissez, mon cher André, reprit-il avec une violence nouvelle, le noble emploi que mon fils ferait de ma fortune ? Il la porterait à une créature ramassée au ruisseau, dont il a fait sa maîtresse, et qui le berne comme les autres. Il l’a établie vicomtesse, comme il s’était installé marquis. Vicomtesse de Chantemille !… Marquis Gaston !… Ils sont dignes l’un de l’autre !
Cette fois, Gaston-Pierre tressaillit. On attaquait l’objet aimé, il se révolta.
– Ah !… mais non !… s’écria-t-il, je ne veux pas qu’on touche à Zora, moi !
L’entrepreneur eut un éclat de rire nerveux.
– Tu ne veux pas !… répondit-il. Et si je veux, moi ? Quand vous aurez vingt et un ans sonnés, vous direz : Je veux ; mais, jusque-là, moi, je ferai fourrer en prison toutes les vicomtesses qui abusent de votre imbécillité !…
– De quoi !… de quoi !… vous ne feriez pas cela.
– Non, fit M. Gandelu, que cette résistance exaspérait, je me gênerais… Je sais mes droits, maintenant que Me Catenac me les a expliqués… Vous êtes mineur ; votre Zora, qui s’appelle Rose, est majeure… le Code est précis, j’ai lu l’article.
– Mon père !…
– Oh ! inutile de prier. Mon avocat a rédigé une plainte pour le procureur impérial, elle lui sera remise à midi, et avant la nuit votre vicomtesse sera payée de ses peines.
Si cruel fut ce coup, pour le séduisant jeune homme, que les larmes jaillirent de ses yeux.
– Zora en prison !… fit-il douloureusement.
D’abord au dépôt, puis en police correctionnelle, et enfin à Saint-Lazare. Catenac me l’a dit, c’est réglé…
Cette dernière raillerie transporta le jeune monsieur Gaston.
– Ah !… vous abusez, s’écria-t-il, c’est honteux !… Ô Zora !… toi qui portes si bien la toilette. Mais laisse faire, si tu vas en police correctionnelle, j’y serai, et je ferai venir tous mes amis. Oui, papa, je suis comme ça, moi ! J’irai m’asseoir à côté d’elle et je prouverai que c’est une femme honnête, voilà ? Je dirai que je l’aime et que je l’estime. Si on la condamne, je lui achète des diamants. Et quand j’aurai vingt et un ans, je vivrai avec elle, et je l’épouserai plus tard !… Allez-y ! On parlera d’elle et de moi dans les journaux ; ça me va ; ça nous posera…
Si grand que puisse être l’empire d’un homme sur toi, il lui est pour ainsi dire impossible de résister aux alternatives d’une longue lutte.
M. Gandelu qui avait eu assez d’énergie pour se contenir, lorsqu’il reprochait à son fils le plus odieux des crimes, ne put tolérer les grotesques et cyniques menaces de ce fils.
Des flots de sang affluèrent à son cerveau, il perdit la tête et se précipita vers l’arme qu’il venait de jeter à terre, sans avoir certes conscience de ce qu’il allait faire.
Par bonheur, André qui ne quittait pas de l’œil l’entrepreneur, comprit le mouvement.
Prompt comme la pensée, il ouvrit la porte, saisit par la ceinture le jeune monsieur Gaston, et le poussa sur le palier.
Et quand l’entrepreneur se retourna le bras levé, il se trouva en face du jeune peintre seul.
La surprise suffit pour lui rendre, sinon la plénitude de sa raison, au moins la faculté de réfléchir.
– Saint bon Dieu !… s’écria-t-il, qu’avez-vous fait ?
– Monsieur, de grâce !…
– Eh !… ne voyez-vous donc pas que le misérable va courir chez cette coquine de femme, la prévenir, lui donner les moyens de s’échapper !… Laissez-moi passer !
Puis, comme André, qui redoutait un affreux malheur, s’efforçait de le retenir, il l’écarta d’un revers de son bras d’hercule, et se précipita dehors en appelant tous ses domestiques.
Le jeune peintre était confondu, et véritablement glacé d’horreur.
Il avait beau chercher, il ne trouvait point de termes pour qualifier cette scène incroyable, où, bien malgré lui, il avait tenu un rôle.
André n’était ni un puritain ni un niais, il avait beaucoup vécu ayant beaucoup souffert.
Il avait rencontré, en sa vie, bien des méchants et coudoyé bien des coquins ; il connaissait de ces libertins dont les débauches épouvantent les familles, et de ces cerveaux brûlés qu’emportent des passions frénétiques.
Mais il n’avait jamais été à même d’observer de près un de ces pâles et malfaisants drôles sans jeunesse, sans intelligence et sans cœur, qui se flattent entre eux de représenter la fine fleur de la gentilhommerie française, et qui ont le secret de ravaler jusqu’à leurs vices.
Il s’était égayé de leurs ridicules dont le théâtre s’est emparé, non sans succès ; mais il ne se doutait pas de leurs côtés odieux.
Il ne savait pas tout ce que peut contenir la vaniteuse impudence, de scélératesse froide et de plate bêtise la cervelle étroite d’un « petit crevé ».
Mieux que tout autre, il pouvait juger la conduite du jeune M. Gaston, lui qui s’était trouvé seul, à seize ans, aux prises avec les difficultés de l’existence, lui dont le cœur se serrait quand il pensait aux joies douces et salutaires de la famille dont il avait été sevré.
Mais il n’eut pas le loisir de réfléchir beaucoup. M. Gandelu reparut.
Il avait dû faire à son courage un appel désespéré, car il avait réussi à reprendre sa physionomie accoutumée, son air à la fois rude et bon.
– Voilà qui est fait, dit-il d’une voix encore un peu tremblante, mon fils est enfermé à clef dans sa chambre, et gardé à vue par un de mes domestiques, un vieux qui a été mon compagnon de truelle, et qu’il ne pourra ni corrompre ni tromper.
– Ne redoutez-vous rien, monsieur, de son exaltation ?…
– L’entrepreneur haussa les épaules.
– Plût à Dieu ! répondit-il, qu’on eût à craindre quelque chose ! Hélas ! vous ne le connaissez pas. Vous battriez longtemps son paletot avant d’en faire sortir un homme. Savez-vous ce qu’il fait en ce moment ? Il est couché à plat ventre sur son lit, et il sanglote, il pleure en appelant sa princesse. Zora ! je vous demande si c’est un nom de chrétienne. Saint bon Dieu ! qu’est-ce qu’elles leur font donc boire, ces créatures, pour les abêtir comme ça ! Et c’est mon fils ! Ô Françoise ma pauvre défunte, si je ne savais pas que tu es une sainte au ciel, je dirais : « Non, il n’est pas possible que ce propre à rien soit de moi ! »
Il s’était laissé tomber sur un fauteuil, et s’accoudait à son bureau, le front entre ses mains.
– Vous souffrez, monsieur, demanda André.
– Oui ! ça saigne en dedans. Mais j’ai été assez père comme cela, je veux être homme à présent. Je sais ce que j’ai à faire : Me Catenac m’a tracé ma ligne de conduite. Ah !… malheureux !… tu souhaites ma mort pour manger ma succession. Eh bien ! tu n’auras pas même celle de ta mère. La loi est pour moi. Dès demain, j’assemble un conseil de famille et je provoque l’interdiction de mon fils. Et après cela, plus un sou. Il verra bien, quand son gousset sera vide, si on l’adore tant qu’il croit, et si on l’appelle marquis. Quant à la fille, tant pis !… elle ira en prison, elle payera pour toutes les autres.
Il s’interrompit, et ce n’est qu’après un moment de douloureuses réflexions qu’il reprit tristement :
– J’ai bien envisagé toutes les conséquences de ma plainte au procureur impérial. Elles sont affreuses. Mon fils fera comme il nous a dit, c’est certain. Je le vois d’ici, s’affichant aux côtés de cette créature perdue, la regardant tendrement, criant qu’il l’adore, se glorifiant de sa bêtise et de sa honte à la face de tout Paris… Je sais bien que les journaux s’empareront de ce scandale, que le ridicule de mon fils rejaillira sur moi, que mon nom sera comme déshonoré…
– Il y aurait peut-être quelqu’autre moyen, hasarda André.
– Non. Il faut un exemple. Si tous les pères avaient mon courage, nous ne verrions pas nos enfants épuisés à vingt ans. C’est l’avis de Me Catenac. D’ailleurs, il est impossible que ces idées d’emprunt sur ma mort et de comédie de médecin aient poussé dans l’esprit de mon fils. C’est un enfant, il est la faiblesse même : on l’aura conseillé.
Déjà ce père infortuné en était à chercher des excuses à son fils.
– Mais en voici assez, dit-il, je me connais : si je m’enfonce dans mes idées noires, je suis perdu. Je verrai vos dessins un autre jour. Sortons.
Il se leva, et regardant autour de lui :
– Voyez un peu, reprit-il, en quel état j’ai mis tout ici ! Des meubles si beaux. Quand j’y voyais une tache, je la frottais avec le pan de ma redingote. Mais, quand je suis en colère, je deviens comme une bête brute, il faut que je détruise.
D’un brusque mouvement il saisit les mains d’André, et les serrant à les broyer contre les siennes :
– Vous avez peut-être sauvé la vie de mon garçon et la mienne, prononça-t-il d’une voix profonde ; quand j’ai ramassé une barre de bois, j’y voyais rouge…
Et comme André se défendait :
– Oh !… ajouta-t-il, je sais que ces services-là ne se payent pas, mais c’est un compte à régler… Partons ; allons jusqu’à ma bâtisse des Champs-Élysées : nous déjeunerons en chemin.
Cette bâtisse, dont André avait entrepris les sculptures à forfait, s’élève presque à l’angle de la rue de Chaillot et de l’avenue des Champs-Élysées, et était encore masquée par les échafaudages.
Déjà une douzaine d’ornemanistes, embauchés par André, y étaient à la besogne. Depuis le matin, ils attendaient leur jeune camarade, devenu pour un moment leur patron, fort surpris de son inexactitude. Aussi, le saluèrent-ils d’amicales interpellations lorsqu’il leur apparut, précédant le riche entrepreneur.
Mais M. Gandelu, qui n’est pas fier d’ordinaire, c’est connu dans le bâtiment, ne sembla même pas apercevoir les jeunes ouvriers.
C’est d’un pas de spectre qu’il parcourut les divers étages, et c’est certainement sans les voir qu’il examinait les derniers travaux.
Le corps seul allait, sous l’impulsion de l’habitude ; la pensée était restée rue de la Chaussée-d’Antin, dans la chambre du jeune Gaston.
Au bout d’un quart d’heure au plus, il revint vers André.
– Je ne me sens pas bien, dit-il ; je rentre, à demain.
Et il s’éloigna, la tête basse, si affaissé sur lui-même, que les ouvriers ne purent s’empêcher de le remarquer.
Décidément, firent-ils, depuis son attaque de goutte, le père Gandelu ne va plus ; il a été rudement touché.
XXIV
À peine arrivé à la « bâtisse » du riche entrepreneur, André avait quitté son paletot et revêtu une blouse de travail, roulée dans sa boîte à outils.
– Il s’agit, avait-il dit, de regagner le temps perdu.
Il comptait le regagner, en effet, mais il n’avait pas donné vingt coups de maillet, lorsqu’un petit apprenti monta le prévenir qu’un monsieur le demandait en bas.
Et un homme un peu cossu, même, ajouta le gamin, tout ce qui se fait de mieux dans le grand genre.
Fort contrarié d’être dérangé, André abandonna son ciseau et descendit, mais toute sa mauvaise humeur se dissipa lorsque, sur le trottoir, il aperçut M. de Breulh-Faverlay.
C’est avec l’empressement le plus sincère et le plus vif qu’André s’avança vers M. de Breulh.
Sa reconnaissance était grande pour ce généreux gentilhomme, qui, après s’être effacé devant lui avec tant d’abnégation, devenait l’auxiliaire le plus utile et le plus dévoué de ses espérances.
– Ah !… voilà qui est bien, monsieur, s’écria-t-il, de sa voix la plus joyeuse, merci de vous être souvenu de moi.
Et montrant ses mains, déjà toutes blanches de plâtre, il ajouta :
– Vous m’excuserez de ne pas vous les tendre, le métier, voyez-vous…
Les paroles expirèrent sur ses lèvres. Il remarquait enfin l’expression soucieuse du visage de M. de Breulh, et son silence contraint.
– Qu’y a-t-il ? demanda-t-il tout inquiet, Mlle de Mussidan aurait-elle eu une rechute ?
M. de Breulh hocha tristement la tête. Il n’y avait pas à se méprendre à ce mouvement, il signifiait clairement :
– Plût à Dieu qu’il n’y eût que cela !…
Hormis cela, pourtant, André n’apercevait rien qui pût l’atteindre gravement. Aussi n’interrogea-t-il pas, il attendit.
– Voici deux fois déjà que je viens vous chercher, mon cher ami, reprit le gentilhomme ; il est indispensable que nous causions. Il s’agit d’une affaire bien importante et qui exige une prompte détermination. Avez-vous quelques instants de liberté ?
– Mais… je suis à vos ordres, répondit le jeune peintre, surpris et troublé.
– En ce cas, remontons jusque chez moi. Je n’ai pas ma voiture, mais c’est à peine si nous en avons pour un quart d’heure de chemin.
– Je vous suis, monsieur. Je vous demanderai seulement une minute, le temps d’escalader quatre étages.
– Avez-vous donc des ordres à donner là-haut.
– Non, monsieur.
– Eh bien ! alors ?
– Je voudrais reprendre un vêtement plus présentable.
M. de Breulh eut un geste d’insouciance.
– À quoi bon ? fit-il. Est-ce que cela vous gêne ou vous fâche, de sortir ainsi ?
– Moi ? non, certes ; j’y suis accoutumé ; c’est à cause de vous, monsieur…
– Oh ! alors, en route, hâtons-nous.
– Mais, monsieur, on va vous remarquer…
– On me remarquera…
– Il se peut qu’on dise…
– Bast ! laissez dire.
Et sans attendre une nouvelle objection d’André, il lui prit le bras et l’entraîna.
Évidemment, les prévisions du jeune peintre étaient justes.
Les nouveaux amis n’avaient pas fait dix pas, que dix personnes déjà s’étaient arrêtées pour regarder cet homme si élégant, qui avait la tournure d’un duc et pair d’Angleterre, donnant familièrement le bras à ce garçon, dont la blouse était toute maculée de taches de plâtre et qui était coiffé d’un chapeau gris, de feutre mou.
Cet effet produit, le gentilhomme ne pouvait pas ne l’avoir pas prévu.
Les hommes placés en vue comme lui sont peu suspects d’étourderie. Sûrs que leurs moindres actes seront commentés, ils s’exercent et s’habituent à résister aux entraînements du premier mouvement.
Si donc M. de Breulh se montrait au bras d’André avec une sorte d’affectation, c’est qu’il entrait dans ses vues de faire parler de cette amitié surprenante. Il savait qu’on ne manquerait pas de s’informer et il se proposait de répondre aux curieux, de façon à servir puissamment le talent et l’avenir du jeune peintre.
Mais cette démarche semblait trop voulue et préméditée pour ne pas intriguer profondément André. Son esprit se perdait en mille conjectures, toutes plus invraisemblables les unes que les autres.
Il avait bien essayé d’interroger son compagnon, mais à ses questions M. de Breulh avait répondu d’un ton qui n’admettait pas d’insistance :
– Attendez que nous soyons chez moi.
Enfin ils arrivèrent, sans avoir échangé vingt paroles en route, et s’enfermèrent dans la bibliothèque.
Là, M. de Breulh ne laissa pas languir son jeune ami.
– Ce matin, vers midi, commença-t-il aussitôt, comme je traversais l’avenue de Matignon, j’ai aperçu Modeste, qui, depuis plus d’une heure, vous guettait.
– Ah ! ce n’est pas de ma faute si j’ai manqué au rendez-vous…
– Peu importe. En m’apercevant, Modeste est venue à moi. Elle désespérait de vous voir, et sachant quelle amitié nous unit, elle m’a chargé de vous faire tenir une lettre de Mlle de Mussidan.
André frissonna. Cette lettre ne pouvait annoncer que quelque grand malheur, il le sentit au ton de M. de Breulh.
– Où est-elle ? demanda-t-il.
M. de Breulh la lui tendit en disant :
– Du courage, mon ami, du courage !…
D’une main que l’émotion faisait plus tremblante que celle d’un vieillard, André brisa l’enveloppe et lut :
« Mon ami,
« Je vous aime, et jamais, je le sens, je ne cesserai de vous aimer de toutes les forces de mon âme.
« Mais il est de ces devoirs sacrés auxquels une Mussidan ne saurait se soustraire. Je les remplirai, dût-il m’en coûter la vie.
« Nous ne nous reverrons jamais, et cette lettre est la dernière que vous recevrez de moi.
« Avant peu, sans doute, vous apprendrez mon mariage. Plaignez-moi. Si grand que puisse être votre désespoir, il ne sera rien comparé au mien.
« Dieu ait pitié de nous ! Essayez de m’oublier, André. Moi, je n’ai même pas le droit de mourir…
« Encore une fois, ô mon unique ami, la dernière, adieu !…
« Sabine »
Si M. de Breulh avait tenu à amener André jusque chez lui, c’est que sachant à peu près, par Modeste, le contenu de cette lettre, il s’attendait à quelque crise déchirante de douleur. Il s’abusait.
André, à cette lecture, devint livide ; ses yeux pendant cinq secondes, eurent une affreuse expression d’égarement ; un spasme nerveux le secoua, mais il ne laissa pas même échapper une exclamation.
C’est avec un geste automatique, pour ainsi dire, qu’il tendit la lettre à M. de Breulh en lui disant :
– Lisez !…
Le gentilhomme obéit, plus effrayé du calme de André que de la plus terrible explosion…
– Il ne faut pas vous laisser abattre, mon ami, commença-t-il.
André se redressa fièrement, le regard étincelant.
– Moi !… s’écria-t-il, me laisser abattre ! Vous m’avez mal jugé. C’est vrai, quand je croyais Sabine mourante, je pleurais comme un enfant. Je suis homme à l’heure du combat et du danger !…
M. de Breulh ouvrait la bouche pour répondre, mais déjà il poursuivait :
– Qu’est-ce que ce mariage que Mlle de Mussidan m’annonce comme sa condamnation à mort ? On allait donc rompre avec vous quand vous avez rompu. Peut-on espérer un parti plus brillant ? Non. D’où vient donc ce prétendant qui soudain est agréé ? Elle n’en avait pas ouï parler quand elle vous a confié notre secret. Quel affreux événement est survenu depuis ? Ma noble et vaillante Sabine n’est pas de ces filles faibles et lâches qu’on marie contre leur volonté. Elle me l’a dit cent fois : « Si on voulait me contraindre, je sortirais en plein midi de l’hôtel de mon père pour n’y plus rentrer. » Et c’est elle qui changerait ainsi ? Ah !… tenez, nous sommes victimes de quelque abominable machination…
Toutes ces réflexions d’André, M. de Breulh les avait faites, d’autant que s’il avait dit la vérité il n’avait pas dit toute la vérité.
C’est bien à lui et non au jeune peintre que Modeste avait tenu à remettre le billet de Sabine.
Avertie de la résolution de sa jeune maîtresse, sans en connaître les raisons, la fidèle servante avait senti son sang se glacer dans ses veines, à la seule pensée des extrémités auxquelles le désespoir pouvait pousser André.
Elle avait donc guetté M. de Breulh, et après lui avoir conté tout ce qu’elle savait, elle avait ajouté, non sans fondre en larmes :
– Vous êtes son ami, monsieur, au nom du ciel, surveillez-le.
De là, toutes les précautions de M. de Breulh, précautions inutiles, il le reconnaissait à l’intrépide sang-froid du jeune peintre. Loin de s’abandonner, il se raidissait contre le malheur, et tout en en mesurant, sans illusions, l’étendue, il songeait évidemment à y trouver un remède.
– Vous avez dû remarquer, monsieur, reprit bientôt André, cette coïncidence étrange de la maladie de Mlle de Mussidan et de sa lettre désolée. Vous la quittez gaie et souriante, heureuse de votre magnanimité, et une demi-heure plus tard, à peine, elle tombe comme foudroyée. D’horribles convulsions nerveuses la mettent un moment entre la vie et la mort ; puis, à peine revenue à la raison et au sentiment de sa situation, elle m’écrit cette lettre affreuse…
Le jeune peintre en ce moment était comme transfiguré. L’œil fixe, la pupille démesurément dilatée, les bras étendus, il semblait suivre dans le vide quelque lueur chétive, à peine saisissable, qui devait le guider jusqu’à la vérité.
– Souvenez-vous, monsieur, poursuivait-il, que tant que Mlle Sabine a eu le délire, M. et Mme de Mussidan sont restés, à tour de rôle, près de son lit, écartant de la chambre tous les domestiques, ne permettant pas qu’on partageât leurs fatigues. C’est Modeste qui nous l’a dit.
– Oui, je me rappelle même ses expressions.
– Eh bien !… n’est-ce pas la preuve que, entre le comte, la comtesse et leur fille, un secret existe, qu’ils gardent comme on garde un trésor, comme on garde son honneur ?
Cela encore, M. de Breulh se l’était dit, mais ses suppositions, à lui, avaient eu, en quelque sorte, une base. Il connaissait le comte et la comtesse, il avait été admis dans leur intérieur, il savait ce que disait le monde de leurs relations, de leur façon de vivre.
– J’ai toujours supposé, mon cher ami, répondit-il, que depuis bien longtemps la famille de Mussidan est en proie à quelqu’une de ces plaies secrètes comme on en trouverait dans beaucoup de familles, si on cherchait bien.
– C’est là votre avis, sur l’honneur ?
– Oui.
Sans plus se préoccuper de M. de Breulh que s’il n’eût point été là, André se mit à arpenter d’un pied fiévreux l’immense bibliothèque.
La contraction de ses sourcils et de sa bouche disait l’effort de sa pensée.
Il revoyait, comme aux lueurs sinistres d’un éclair, toute sa vie, depuis qu’il connaissait Sabine.
Il se rappelait jusqu’à leurs plus courts rendez-vous et aux plus périlleux. Il repassait toutes les paroles qu’elle lui avait dites, mêmes les plus insignifiantes, ayant trait à ses parents. Il s’efforçait de ressaisir jusqu’aux moindres discours de la feue douairière de Chevauché, au château de Mussidan.
Et de tant de mots, de tant de lambeaux de phrases, épars dans un espace de plusieurs années, il tâchait de reconstituer une déclaration précise, qu’il pût articuler, se livrant à un travail pareil à celui d’un homme qui rassemble des anneaux brisés et dispersés, pour en recomposer une chaîne.
Après huit ou dix tours, il s’arrêta brusquement en face de son hôte.
– Eh bien, oui !… s’écria-t-il, oui, il y a là un mystère que nous pénétrerons, parce que je le veux. Ce qu’on veut, on le peut, quand chaque matin on se lève en souhaitant plus ardemment ce qu’on souhaitait la veille… Je sais vouloir, moi !…
Il prit une chaise, s’assit près de M. de Breulh, à demi étendu sur un canapé, et d’une voix sourde, comme s’il eût craint d’être écouté du dehors, il reprit :
– Le seul raisonnement, monsieur, nous conduit près de la vérité. Écoutez-moi, et si j’avance quelque chose qui ne soit pas absolument démontré, arrêtez-moi. Êtes-vous convaincu que Mlle Sabine m’aime ?
– Oh !… du plus profond de son cœur.
– C’est donc sous l’empire d’une nécessité mortelle qu’elle m’écrit ?
– Évidemment.
– Donc voici déjà Mlle de Mussidan hors de cause.
Il s’interrompit, paraissant chercher la façon la plus saisissante et la plus claire de présenter ses idées, et, toujours à demi-voix, il poursuivit :
– Vous étiez agréé comme gendre par la comtesse et le comte de Mussidan, n’est-il pas vrai ? Votre mariage avec Mlle Sabine était comme arrêté…
– Je vous l’ai dit.
– Eh bien ! je vous le demande, M. de Mussidan peut-il trouver pour sa fille un parti plus brillant, plus avantageux, présentant également toutes les convenances de personnes, d’âge, de fortune, de considération…
Le gentilhomme ne put s’empêcher de sourire.
– Par ma foi ! fit-il, vous m’en demandez trop.
– Eh ! monsieur, il s’agit bien de modestie, vraiment !… Répondez.
– Soit. Je vous déclare alors que si nous n’envisageons que les conditions enviables selon le monde, M. de Mussidan me remplacera difficilement.
– Vous l’avouez donc !… Alors, comment le comte et la comtesse qui rencontraient en vous le phénix des gendres, n’ont-ils rien tenté pour vous retenir ?
– L’amour-propre blessé…
– Non, ne dites pas cela. Le jour où vous avez retiré votre parole, M. de Mussidan allait vous redemander la sienne : vous ne l’ignorez pas ; on nous l’a affirmé ; on nous a donné des preuves.
– C’est au moins la conviction de Modeste.
André se redressa, comme pour donner plus de poids à ses paroles.
– Donc, reprit-il, ce prétendant dont nous parle la lettre qui a surgi soudainement, s’il épousait Mlle de Mussidan, l’épouserait malgré sa volonté, à elle, malgré la volonté de ses parents. Pourquoi ? D’où vient à cet homme cette mystérieuse puissance ? Cette influence est trop grande, trop indiscutable, pour être avouable. Si le comte et la comtesse se résignent à cette honte de forcer la main de leur fille, c’est qu’eux-mêmes ont la main forcée. Et croyez que la contrainte est purement morale. Sabine n’en souffrirait pas d’autre, je la connais. On lui a montré le sacrifice en lui disant : « Là est le devoir, » et elle se sacrifie… Donc cet homme, quel qu’il soit, ne peut être que le dernier des misérables !…
C’était net, précis, indiscutable.
Toutes ces pensées, M. de Breulh les avait vaguement entrevues dans la demi-obscurité du doute, mais il n’en avait pas trouvé la formule.
– Et ceci admis, demanda-t-il, que comptez-vous faire ?
Un éclair brilla dans les yeux d’André, terrible pour qui connaissait son indomptable énergie.
– Moi, répondit-il, rien pour le moment. Sabine me conjure de l’oublier, j’aurai l’air de lui obéir. Modeste a en moi assez de confiance pour me servir et se taire. Je saurai attendre, me préparer à la lutte. Le misérable qui en ce moment brise ma vie ne sait pas que j’existe… Là est ma force et mon espoir. Je lui révèlerai mon existence le jour où je l’écraserai.
Mais M. de Breulh ne partageait pas cette belle confiance.
– Prenez garde, mon cher André, murmura-t-il, prenez garde, le moindre éclat perdrait votre cause à tout jamais.
Le jeune peintre secoua fièrement la tête.
– Il n’y aura pas de scandale, répondit-il, rassurez-vous. Maintenant, je vois quelle conduite tenir. Dans le premier moment, je m’étais dit : « Dès que je connaîtrai le misérable, j’irai à lui, je le provoquerai, nous nous battrons, je le tuerai ou il me tuera ! » c’était bien simple.
– Malheureux !… c’était rendre votre mariage impossible.
– Peut-être, mais ce n’est pas là ce qui m’a arrêté. La vérité est que je ne veux pas qu’il y ait un cadavre entre Sabine et moi, les taches de sang sur une robe de noces portent malheur. Puis, croiser mon épée avec cet homme, s’il est tel que je le soupçonne, tel qu’il doit être, serait lui faire trop d’honneur. Il me faut une vengeance plus entière, plus complète. Je n’oublierai jamais qu’il a failli tuer Mlle de Mussidan.
Il se recueillit quelques secondes et reprit :
– Pour abuser de son pouvoir comme il le fait, il faut que cet homme soit un vil scélérat. On ne devient pas tout à coup un misérable sans honneur et sans entrailles. Sa vie doit être semée de hontes et d’infamies. Eh bien ! je le démasquerai et je lui infligerai une telle flétrissure, qu’il sera forcé de fuir, obligé de se cacher.
– Oui, voilà ce qu’il faut faire !…
– Et nous le ferons, monsieur, s’il plaît à Dieu ! Je dis nous, parce que je compte absolument sur vous. Vos offres si généreuses, dans mon atelier, quand je les repoussais, j’avais raison. Maintenant, après toutes les preuves d’amitié que vous me donnez, je ne serais qu’un sot orgueilleux si je ne vous demandais pas aide et assistance. À nous deux, dévoués à une cause commune, nous devons réussir. Nous ne sommes ni l’un ni l’autre de ces hommes abêtis par le luxe et le bien-être au point d’être incapables de ne rien tenter eux-mêmes. Vous et moi nous avons eu ces deux maîtres dont les enseignements ne s’oublient pas, le malheur et la pauvreté. Nous saurons nous taire et agir…
André se tut, attendant peut-être une objection ; mais le gentilhomme ne répondant pas, il continua :
– Mon plan est la simplicité même.
Dès que nous connaîtrons ce prétendant mystérieux, il sera à nous. Sans qu’il puisse s’en douter, nous nous attacherons à lui, et nous ne le quitterons pas plus que son ombre.
Il y a des agents de police qui, pour une faible somme, se chargent de reconstituer la vie entière d’un homme, et de voir clair dans toutes ses actions. Est-ce que la passion ne me donnera pas la pénétration et le jugement de ces gens-là ?
À nous deux, monsieur, nous nous complétons merveilleusement pour cette tâche, car nous pouvons opérer à notre aise dans des sphères différentes, vous en haut, moi en bas.
Vous, dans votre monde, à votre club, dans les salons, partout, vous vous informerez, vous recueillerez les on-dit, les propos, les cancans de l’opinion. Vous aurez ainsi le côté brillant et extérieur de notre ennemi.
Moi, en bas, dans l’ombre, j’étudierai le dessous de l’existence, l’envers. Je fouillerai le passé, je descendrai dans les détails les plus intimes. Je puis passer partout, moi, suivre un homme jour et nuit le long des rues, stationner sous les portes cochères, arracher la vérité à des fournisseurs, offrir un canon sur le comptoir à des domestiques… Jamais on ne se défiera de moi. Je suis souple, moi ; quand j’ai une blouse et une casquette, je ne suis pas déguisé.
M. de Breulh se leva enthousiasmé.
C’était un intérêt énorme, palpitant, qui tombait dans son existence si désœuvrée.
Il allait avoir une préoccupation constante de toutes les heures, qui remplirait ses journées si souvent longues et vides.
C’était une partie, cela, une vraie, poignante, dont l’enjeu était la vie de trois personnes, et qui ne ressemblait en rien à ses parties autour du tapis vert, où il risquait insoucieusement des poignées de louis, perdant ou gagnant sans plaisir ni peine, sans seulement ressentir une émotion.
– Oui, je suis à vous ! s’écria-t-il. Et s’il faut de l’argent, beaucoup d’argent, souvenez-vous que je suis immensément riche.
Le jeune peintre n’eut pas le temps de répondre, on frappait fort rudement à la porte de la bibliothèque.
– Ah ça !… murmura le gentilhomme, dont les sourcils s’enfoncèrent, qui est-ce qui se permet chez moi…
Il s’arrêta court. Au même moment une voix de femme se faisait entendre ; elle criait :
– Gontran !… c’est moi !… Êtes-vous fou !… Ouvrez donc !…
M. de Breulh se frappa le front.
– Eh ! fit-il, c’est Mme de Bois-d’Ardon.
Il ne se trompait pas. Le verrou retiré, la vicomtesse se précipita dans la bibliothèque, selon son habitude, à la manière des tourbillons, et courut se jeter sur un divan.
Alors, André aussi bien que M. de Breulh purent remarquer combien ses traits charmants étaient décomposés, et combien il coulait de larmes de ses jolis yeux, qu’elle essuyait incessamment.
M. de Breulh ne laissa pas que d’être un peu effrayé. Mme de Bois-d’Ardon pleurer, au risque de se gâter le teint, ce ne pouvait être que pour une vraie catastrophe, ou pour rien…
– Qu’avez-vous, ma chère Clotilde, demanda-t-il affectueusement, que vous arrive-t-il ?
– Ah !… un grand malheur ! C’est-à-dire que je n’ose réfléchir à ce que j’ai entrevu. Mais vous pouvez peut-être me sauver…
– Si je le puis…
– Avez-vous vingt mille francs à me prêter ?
M. de Breulh respira, et même ne put s’empêcher de sourire.
– S’il ne s’agit que de cela, dit-il, soyez sauvée.
– Ah !… c’est qu’il me les faut tout de suite, là, à l’instant.
– Je ne les ai pas ici ; mais je puis les avoir dans une demi-heure.
– Bien, alors.
M. de Breulh écrivit rapidement dix lignes qu’il remit à un valet de pied en lui recommandant de se hâter.
– Merci, s’écria la vicomtesse, merci mille fois ; mais ce n’est pas tout encore, outre l’argent il me faut un conseil.
Supposant que Mme de Bois-d’Ardon devait souhaiter se trouver seule avec M. de Breulh, André s’apprêta discrètement à se retirer.
Mais la jeune femme, d’un geste amical et gracieux, le retint.
– Restez, monsieur André, dit-elle, restez, vous n’êtes pas de trop.
Et comme il hésitait encore :
– Il va être question, ajouta-t-elle, d’une personne qui vous tient bien fort au cœur.
– De Mlle de Mussidan, peut-être ?
– Précisément. Ah !… vous n’avez plus envie de vous éloigner, j’espère !…
De sa vie, l’aimable vicomtesse n’a pu rester cinq minutes de suite sur la même impression, surtout si cette impression est triste. Elle s’en excuse en affirmant que le sérieux est hors de sa nature.
Entrée chez M. de Breulh sous le poids d’une émotion poignante, elle oubliait la gravité de sa situation, pour n’en plus voir que le côté comique.
– Véritablement, mon cher Gontran, reprit-elle, jamais on n’a vu une aventure aussi surprenante que celle qui vous vaut ma visite. Il n’y a qu’à moi qu’il arrive des choses pareilles !
Encore une prétention de Mme de Bois-d’Ardon. Elle est persuadée que sa vie n’est qu’une longue suite d’incidents tout à fait particuliers.
– Je vous écoute, ma chère Clotilde, dit M. de Breulh.
– Et vous ne perdrez pas votre temps, allez ! Imaginez-vous que ce matin, c’est-à-dire il y a deux heures, j’étais horriblement en retard, ayant eu pour le moins une vingtaine de visites. J’allais monter m’habiller, quand on m’a annoncé encore un visiteur. J’étais furieuse, mais l’importun arrivait sur les talons du valet de pied ; il me voyait de l’antichambre, impossible de le congédier. Bien malgré moi, je donne l’ordre de le faire entrer. Il entre. Devinez quel était ce visiteur ? Je vous le donne en dix, en cent, en mille… Y êtes-vous ?
– Pas du tout.
– Eh bien !… c’était le marquis de Croisenois.
– Le frère de ce Croisenois disparu si mystérieusement il y a une vingtaine d’années ?
– Lui-même.
– Il est donc de vos amis ?
– C’est-à-dire que je ne le connais pas du tout. Je l’ai rencontré dans le monde, je dois avoir dansé avec lui ; il me salue au bois, et c’est tout.
– Et il venait comme cela…
D’un joli geste mutin, la vicomtesse imposa le silence à M. de Breulh.
– Chut donc ! fit-elle d’un petit ton fâché, vous me coupez tous mes effets. Oui, il venait comme cela. C’est d’ailleurs un fort joli cavalier, mis avec goût, fort aimable, causant bien. Il se présentait chez moi sous le meilleur patronage. Il m’arrivait porteur d’une lettre de recommandation d’une vieille amie de ma grand-mère et de la vôtre, la marquise d’Arlange ; vous la connaissez bien.
– N’est-ce pas cette excentrique personne qui est la grand-mère de la jeune comtesse de Commarin ?
– Juste !… Moi d’abord je raffole de cette vieille femme ; elle jure comme un sapeur, et quand elle se met à raconter des histoires de sa jeunesse, elle est « épatante ».
Ce dernier mot fit bondir André sur sa chaise. Il était fort naïf. Il ne connaissait de femme de l’aristocratie que Sabine, et, selon lui, toutes devaient ressembler à ce parfait modèle.
Il ignorait que, pour l’heure, les jeunes femmes du monde, des meilleures et des plus honnêtes en réalité, se donnent un mal affreux pour affecter le plus détestable ton possible. Peut-être croient-elles ainsi faire preuve de désinvolture, d’indépendance et d’esprit.
Émailler leurs conversations de tous les mots d’argot qu’elles peuvent accrocher sur les lèvres de leurs frères ou de leur mari, leur procure un vif plaisir.
Ressembler le plus qu’elles peuvent à ces « demoiselles » qu’elles appellent « des horreurs, » mais dont elles copient les façons et singent les toilettes, paraît être leur plus chère ambition.
Mme de Bois-d’Ardon raconte, non sans orgueil, que deux ou trois fois dans sa vie elle a été prise pour une… « demoiselle. » C’est la grande mode.
Cependant, elle poursuivait :
– Dans la lettre que me remit M. de Croisenois, la marquise d’Arlange me disait qu’elle est fort de ses amis, et me priait de lui rendre, pour l’amour d’elle, un grand service qu’il avait à me demander.
– Eh !… que ne l’accompagnait-elle !
– Pas moyen, elle est clouée sur son lit par des rhumatismes. Raison de plus pour bien accueillir son protégé. Me voilà donc le faisant asseoir et m’efforçant de le mettre à l’aise pour me présenter sa requête. Pour de l’esprit, il en a. Il m’a conté une histoire d’une demoiselle des Variétés et de M. de Clinchan, qui est tout ce qu’on peut rêver de plus… pittoresque.
Je m’amusais divinement, quand voilà que tout à coup j’entends dans le vestibule comme une dispute. On parlait, on criait, on jurait, et j’allais sonner pour m’informer, quand la porte s’ouvre, et je vois paraître Van Klopen, rouge, l’œil allumé…
– Van Klopen ?…
– Eh ! oui, mon tailleur. Tout d’abord je me dis : « S’il pénètre ainsi, c’est qu’il vient d’imaginer quelque nouveau modèle plein de chic, et qu’il veut me le soumettre. » Point. Savez-vous ce qu’il voulait, le coquin ?
M. de Breulh garda son sérieux, mais un sourire pétilla dans son œil.
– Je gagerais, fit-il, qu’il voulait de l’argent.
La vicomtesse parut confondue de cette perspicacité.
– C’est pourtant vrai !… répondit-elle d’un ton grave. Il venait me présenter ma facture chez moi, dans mon salon, devant un étranger ; il était entré malgré mes gens ! Qui jamais se fût attendu à un tel excès d’impudence de la part de Van Klopen, un homme qui fournit la plus haute société !…
– Oui, c’est inimaginable.
– Aussi ai-je été indignée, et lui ai-je ordonné de sortir sur-le-champ. Je me figurais qu’il allait se retirer en se confondant en excuses. Quelle erreur ! Voilà un coquin qui se met à se fâcher, à parler tout haut, et qui me menace, si je ne le paye pas sur-le-champ de s’adresser à mon mari.
M. de Bois-d’Ardon est le plus généreux des époux ; il donne à sa femme, tous les mois, une somme considérable pour sa toilette ; mais sur l’article dettes, il ne plaisante pas. M. de Breulh le savait.
– Terrible menace, fit-il. La facture était donc bien importante ?
– Elle s’élevait à dix-neuf mille et tant de cent francs !… Vous concevez ma frayeur ; elle était si grande que, toute rouge de honte, je priai humblement Van Klopen de patienter, lui promettant de passer chez lui dans la journée avec un acompte ; mais ma faiblesse redoubla son audace, et perdant toute mesure, il osa s’asseoir sur un fauteuil, déclarant qu’il ne s’en irait pas avant d’avoir reçu de l’argent ou vu mon mari.
M. de Breulh eut un geste dont la vue seule eût fait frissonner le couturier des reines.
– Que faisait donc M. de Croisenois ? s’écria-t-il.
– Il n’avait rien dit jusqu’alors. Mais sur cette insolence, il se leva, tira un portefeuille et le lança à la figure de Van Klopen en lui disant : « Paye-toi, drôle, et sors ! ».
– Et il est sorti ?
– Oh ! pas ainsi. « Il faut, monsieur, a-t-il dit au marquis de Croisenois, que je vous donne une quittance. » Et, en effet, il a sorti de sa poche de quoi écrire, et je l’ai vu mettre au bas de la facture : « Reçu de M. de Croisenois, pour le compte de Mme la vicomtesse de Bois-d’Ardon la somme de… etc., etc. »
– Oh ! fit M. de Breulh sur trois tons différents, oh ! oh ! J’imagine du moins qu’après le départ du sieur Van Klopen, M. de Croisenois n’a plus hésité à vous présenter sa requête !
La vicomtesse hocha la tête d’un air singulier.
– C’est ce qui vous trompe, répondit-elle, il n’a plus parler que de se retirer, j’ai eu toutes les peines du monde à lui arracher son secret.
– Enfin que voulait-il ?
Il venait m’avouer qu’il est amoureux fou de Mlle de Mussidan, et me prier de le présenter à Octave et me conjurer de le servir de toute mon influence.
André et M. de Breulh se dressèrent, comme cinglés par une même secousse électrique.
– C’est lui !… s’écrièrent-ils ensemble.
Le mouvement fut à la fois si brusque et si menaçant que Mme de Bois-d’Ardon ne put retenir un petit cri de surprise.
– Lui !… interrogea-t-elle, toute brûlante de curiosité, que voulez-vous dire ?
– Que votre marquis de Croisenois est un misérable qui a surpris la bonne foi de Mme d’Arlange.
– Je suis loin d’affirmer le contraire, mais je crois…
– Avant tout, ma chère Clotilde, écoutez nos raisons.
Et aussitôt, avec une vivacité extrême, M. de Breulh mit la vicomtesse au courant de la situation, lui montra la lettre si cruellement significative de Sabine et lui exposa presque mot pour mot la déduction d’André.
Il fallait que Mme de Bois-d’Ardon fût terriblement intéressée, car elle n’interrompit pas une seule fois. Elle se contentait d’approuver ou d’improuver de la tête.
Lorsque le gentilhomme eut achevé :
– Tout cela est fort bien trouvé, reprit-elle d’un petit air capable qui lui allait à merveille. Le malheur est que votre raisonnement pèche absolument par la base.
– Par exemple !
– Vous doutez ? Alors, je prouve. Voici un prétendant mystérieux qui se dessine, n’est-ce pas. Très bien. S’il obtenait la main de cette pauvre Sabine, à quoi la devrait-il ? À un incompréhensible pouvoir sur le comte et la comtesse de Mussidan, à des manœuvres infâmes, à des menaces.
– Il me semble que cela saute aux yeux.
– Oui, mon cher Gontran, oui, mais il est évident aussi que cet inconnu doit avoir des relations avec la famille dont il va faire le désespoir. On ne tient pas à sa merci des étrangers. Or, M. de Croisenois n’a jamais mis les pieds à l’hôtel de Mussidan. Il connaît si peu Octave, qu’il est venu me demander de le présenter.
Si précieuse et si péremptoire était cette observation, que M. de Breulh en resta tout interdit.
– Diable ! murmura-t-il, l’objection est forte.
Mais André n’était pas d’un caractère à se laisser si aisément déconcerter.
– J’avoue, fit-il, que c’est une circonstance singulière et peu explicable. Est-ce un habile artifice destiné à dépister les informations et les on dit du monde ? J’incline à le croire. Ce qui est sûr, c’est que plus je réfléchis à la scène que vient de nous décrire madame la vicomtesse, plus je sens grandir et se fortifier mes soupçons.
– Cependant, monsieur.
– Excusez-moi, madame, si j’ose vous interrompre ; mais il me semble entrevoir des particularités qui peuvent nous éclairer. Permettez que nous revenions à ce qui s’est passé chez vous. Est-ce que le procédé de ce tailleur ne vous a pas paru étrange ?
– Monstrueux, monsieur, révoltant, inouï !
– Car vous étiez pour lui une bonne pratique ?
– Sa meilleure. J’ai dépensé chez lui une fortune.
André eut un mouvement de satisfaction.
– Très bien ! fit-il. Voici donc que notre point de départ est déjà un fait anormal.
Tel n’était pas l’avis de M. de Breulh.
– Pas si anormal que vous croyez, objecta-t-il. J’ai ouï dire que l’illustre Van Klopen ne plaisante pas quand on lui doit de l’argent. N’a-t-il pas traîné la marquise de Reversay devant les tribunaux ?
– D’accord ! Reste à savoir s’il avait osé s’asseoir dans son salon devant un étranger.
– Reste à savoir, aussi, insista la vicomtesse, si elle lui avait donné 17.000 francs d’acompte comme moi le mois dernier.
– L’insulte n’en est que plus inexplicable, prononça André, mais passons.
Il se retourna vers M. de Breulh et poursuivit :
– Connaissez-vous M. de Croisenois ?
– Oh !… fort peu. Je sais qu’il est d’une très grande famille, je sais que son frère aîné Georges, disparu si singulièrement, était fort estimé ; hormis cela…
– Est-il riche ?
– On m’a assuré que d’un jour à l’autre, il peut être envoyé en possession d’un héritage fort considérable. En attendant, je lui crois plus de dettes que de rentes.
– Et cependant, il avait à point nommé 20.000 francs dans sa poche. C’est une fort grosse somme d’abord, qu’on porte rarement sur soi en visite, et qui de plus s’est trouvée être juste la somme nécessaire.
Depuis un moment André ne se ressemblait plus. Lui si réservé d’ordinaire, il s’était pour ainsi dire emparé de la situation. C’est d’un air d’autorité, presque d’un ton impérieux, qu’il multipliait ses questions, comme si la grandeur de sa passion lui eût donné des droits.
– Donc, reprit-il, encore une circonstance bizarre à noter. Je prierai maintenant madame la vicomtesse de bien rassembler ses souvenirs. Qu’a dit Van Klopen en recevant le portefeuille à travers la figure ?
– Rien !
– Quoi ! pas un mot ? Il a accepté cette insulte sans sourciller, froidement, paisiblement ? Il n’a seulement pas engagé cet étranger à se mêler de ses affaires ?
– En effet, c’est drôle, et moi…
– Oh ! attendez. Le tailleur a-t-il ouvert le portefeuille et compté les billets de banque ?
Mme de Bois-d’Ardon parut faire un énergique appel à sa mémoire :
– Cela, répondit-elle avec une visible hésitation, je ne saurais le dire. J’étais, vous le comprenez, très émue et très troublée. Cependant, il me semble, j’affirmerais presque… je jurerais que je n’ai pas vu de billets entre les mains de Van Klopen.
La physionomie d’André rayonnait.
– De mieux en mieux !… s’écria-t-il. On lui a dit : « Paye-toi, » à ce couturier, et il s’est tenu pour payé. Il n’a pas douté une minute que le portefeuille ne contînt vingt mille francs, et il l’a empoché. Observons de plus que, par un hasard admirable, M. de Croisenois n’avait dans ce portefeuille ni une lettre, ni une adresse, ni un papier, rien en un mot, que ces vingt mille francs.
– Il est certain, murmura M. de Breulh, que tout cela n’est pas absolument naturel.
– Bast ! je vois mieux encore. Entre le total de la facture et le contenu du portefeuille, il y avait bien une petite différence.
– Oui, répondit Mme de Bois-d’Ardon, cent trente ou cent cinquante francs, je ne sais plus au juste.
– Parfait !… Et cette différence, le tailleur l’a rendue ?
– Non : seulement, il était lui-même très agité.
– Le croyez-vous, madame ? Est-ce donc pour cela qu’il avait si naturellement dans sa poche de quoi écrire, de quoi donner un reçu ?
L’insoucieuse vicomtesse était atterrée. Il lui semblait qu’elle avait eu devant les yeux un brouillard épais, et qu’il se dissipait.
– Puis, reprit André, comment était libellée cette quittance ? Au nom de M. de Croisenois. Ils se connaissaient donc ? Enfin, comme Van Klopen est un homme prudent en affaires, il ajoute : « Pour le compte de Mme la vicomtesse de Bois-d’Ardon. »
M. de Breulh était enthousiasmé.
– La complicité est comme prouvée ! s’écria-t-il.
– Une dernière particularité nous fixera. Qu’est devenue la facture du sieur Van Klopen, cette facture portant reçu ?
Il s’interrompit ; Mme de Bois-d’Ardon était devenue fort pâle, elle frissonnait.
– Ah !… balbutia-t-elle, quelque chose me disait bien que j’étais sous le coup de quelque malheur affreux. C’est pour cela, Gontran, que je voulais vous demander un conseil.
– Parlez, ma chère Clotilde.
– Eh !… ne comprenez-vous pas que je ne l’ai pas, cette facture. M. de Croisenois l’a froissée d’un air furieux, puis il l’a mise dans sa poche comme par distraction. Je n’ai pas osé la lui demander sur le moment.
André triomphait.
– Eh bien !… s’écria-t-il, la comédie est-elle assez évidente ? M. de Croisenois avait besoin de votre influence, madame ; il a voulu vous mettre dans l’impossibilité de la lui marchander. Admettez que vous n’ayez pas été assez généreuse pour vous intéresser à lui, ne vous croiriez-vous pas engagée par le seul fait de ces vingt mille francs si généreusement prêtés ?
– Oui, c’est vrai, c’est vrai…
Maintes fois déjà en sa vie, l’aimable vicomtesse de Bois-d’Ardon s’était jetée à l’étourdie dans les aventures les plus périlleuses.
À vingt reprises, pour un caprice, pour une niaiserie, par dépit, par oisiveté, pour rien, elle avait risqué son nom, sa réputation, son bonheur et celui de son mari.
Elle avait eu parfois des transes terribles, mais jamais, autant qu’en ce moment, elle ne s’était sentie le cœur serré par une affreuse angoisse.
– Mon Dieu ! murmura-t-elle, pourquoi m’effrayer ainsi ? Ce n’est pas généreux. Que voulez-vous que M. de Croisenois fasse de cette quittance ?
Ce qu’il pouvait en faire !… Elle ne le sentait que trop, et cependant, par une faiblesse d’esprit inconcevable bien que très commune, elle se refusait, pour ainsi dire, à constater le danger, à le reconnaître.
– Ce qu’il fera, répondit M. de Breulh, rien, si vous embrassez sa cause avec chaleur. Mais hésitez à le servir, et vous verrez s’il ne vous fait pas sentir que bon gré mal gré vous devez être son alliée, parce qu’il tient votre honneur entre ses mains.
– Et malheureusement, approuva André, la réputation d’une femme a toujours été à la merci d’un infâme ou d’un fat.
Mme de Bois-d’Ardon essaya encore de protester.
– Oh ! vous exagérez, fit-elle du ton d’un enfant qui commence à douter de Croquemitaine, vous vous créez des fantômes.
– Eh quoi ! fit tristement M. de Breulh. En êtes-vous à ignorer que par les folies de luxe et les rages de toilettes qui courent, les femmes du monde qui se conduisent mal passent pour ruiner leurs amants aussi lestement que les filles les plus adroites ? Mais c’est archi-connu, cela !…
– Quelle honte !…
– Que demain, à son club, M. de Croisenois dise : « Cette petite Bois-d’Ardon me coûte les yeux de la tête ! » puis qu’il montre négligemment votre facture de vingt mille francs, acquittée à son nom, que pensera-t-on, je vous le demande ?
– On me fera bien l’honneur, je suppose…
– Non, Clotilde, non, on ne vous fera aucun honneur. Qui diable ira s’imaginer que c’est là un prêt ? On dira simplement : « Cette chère vicomtesse est horriblement coquette, l’argent que son mari lui donne ne suffisant pas à son appétit, voici qu’elle grignote Croisenois ! » Et on rira. Cela ne va-t-il pas de soi et ne se voit-il pas tous les jours ? Vous savez des exemples. Et si le misérable y tient, huit jours plus tard le propos arrivera aux oreilles de Bois-d’Ardon, embelli, enjolivé, envenimé…
L’infortunée vicomtesse se tordait les mains de désespoir.
– Ah ! c’est affreux !… disait-elle, c’est horrible !… Savez-vous que c’est à peine si mon mari douterait ! Il prétend qu’une femme qui, comme moi, suit les modes et est citée parmi les plus élégantes, est capable de tout pour conserver une supériorité qui désole les autres femmes. Oui, il dit cela, et il le croit…
Le silence d’André et de M. de Breulh apprit à la vicomtesse que leur avis était absolument celui de M. de Bois-d’Ardon.
– Ah ! maudits chiffons, poursuivit-elle, misérables toilettes !… Moi qui ai si bien tout pour être la plus heureuse des femmes. Non, je le jure, je ne ferai plus de dettes !…
Ces héroïques résolutions, Mme de Bois-d’Ardon ne manque jamais de les prendre après chaque folie un peu forte. Mais serments de coquette et serments d’ivrogne se ressemblent. Elle oublie vite ses repentirs périodiques.
– Enfin, reprit-elle, comme sortir de là, mon bon Gontran ? J’espérais que vous me trouveriez un expédient. Si vous alliez redemander cette malheureuse facture à M. de Croisenois ?
M. de Breulh réfléchit un moment.
– Je le puis, certes, répondit-il ; mais cette démarche, loin de vous être utile, vous nuirait. Ai-je des preuves décisives de l’infamie de M. de Croisenois ? Non. Il niera tout et n’en clabaudera pas moins. Aller le trouver, c’est lui dire que vous avez pénétré ses desseins, c’est vous préparer une inimitié mortelle.
– Sans compter, reprit André, que cette réclamation mettrait M. de Croisenois sur ses gardes, et qu’une fois prévenu il nous échapperait.
L’infortunée vicomtesse courbait le front sous ces objections si concluantes.
– Suis-je donc perdue ! s’écria-t-elle, éclatant en sanglots. Suis-je pour toute ma vie au pouvoir de cet être odieux, condamnée à lui obéir quand même, réduite à trembler sous son regard comme l’esclave sous le fouet !
Mais André avait eu le temps d’étudier la situation et de reconnaître ses avantages.
– Non, madame, répondit-il, non, rassurez-vous. Avant longtemps, je l’espère, j’aurai mis M. de Croisenois hors d’état de nuire à qui que ce soit. Une question, pourtant, une seule : Qu’avez-vous répondu à sa demande de présentation ?
– Rien de positif ; je pensais à vous et à Sabine.
– Oh !… en ce cas, madame, dormez tranquille. Tant qu’il aura l’espoir de gagner votre influence, M. de Croisenois se gardera de troubler votre repos. Servez-le donc, ne soufflez mot de la facture, témoignez-lui estime et amitié, ouvrez-lui les portes de l’hôtel de Mussidan, appuyez-le, chantez ses louanges.
– Mais vous, monsieur, vous…
– Moi, madame, aidé de M. de Breulh, je travaillerai à démasquer l’infâme et notre tâche sera d’autant plus facile que sa sécurité sera d’autant plus grande…
Il s’interrompit ; le domestique dépêché par M. de Breulh-Faverlay revenait avec les fonds.
Lorsqu’il se fut retiré, le gentilhomme prit les vingt billets de banque, et les présentant à la jeune femme :
– Voici toujours, ma chère Clotilde, lui dit-il, de quoi payer le Croisenois. Si vous m’en croyez, vous lui enverrez cela ce soir même, avec un billet tout gracieux…
– Merci, Gontran, je ferai ce que vous dites.
– Surtout, glissez dans votre lettre un mot d’espoir au sujet de la présentation. Qu’en pense maître André ?
Maître André était fort préoccupé.
– Je pense, répondit-il, que si on pouvait obtenir du Croisenois un reçu de cette somme, ce serait toujours cela de gagné.
– Plaisantez-vous ?
– Pas du tout.
– Ces serait éveiller les soupçons du drôle.
– Qui sait !… murmura le jeune peintre, en s’y prenant bien !…
Et se retournant vers Mme de Bois-d’Ardon :
– Il est impossible, continua-t-il, que madame la vicomtesse n’ait pas à son service quelque camériste bien futée…
– J’en ai une plus fine que l’ambre.
– Eh bien ! ne peut-on pas remettre à cette fille la lettre et les billets de banque séparément ? On lui aura fait la leçon d’avance. En arrivant chez M. de Croisenois, elle semblera épouvantée de la somme qu’elle apporte, elle semblera habilement maladroite, elle aura des défiances ridicules ; bref, elle exigera un reçu qui dégage sa responsabilité.
– Ah ! comme cela, oui, la chose est faisable.
– Et elle sera faite, je vous le garantis, affirma la vicomtesse. Joséphine n’a pas sa pareille pour jouer la comédie.
À ces idées de comédie, de tromperie, de ruse, le sourire refleurissait sur les lèvres de la jolie vicomtesse. La fermeté d’André et de M. de Breulh dissipait toutes ses inquiétudes. Elle ne pouvait croire que, protégée par ces deux hommes, elle courût le moindre danger.
– De plus, reprit-elle, fiez-vous à moi pour endormir le Croisenois. Avant quinze jours, je veux être sa confidente, et tout ce qu’il me dira, vous le saurez.
Elle eut un joli geste de menace, et poursuivit :
– C’est de franc jeu, n’est-ce pas ? Pourquoi venir me « monter un coup ? » C’est odieux… et ce Van Klopen, qui « était de l’affaire ! » À qui se fier, bon Dieu ! Un homme sans rival pour inventer un costume. Qui est-ce qui m’habillera maintenant ? Car il faut que je « lâche, » il n’y a pas à dire !…
Le naturel revenait au galop, et l’argot aussi. La vicomtesse se leva.
– Allons ! fit-elle, « je me la casse. » J’ai quatre amis de Bois-d’Ardon à dîner ce soir. Adieu, ou plutôt au revoir.
Et, légère, toute souriante, elle regagna sa voiture.
– Voilà comme elles sont toutes aujourd’hui ! s’écria M. de Breulh. Et encore celle-ci a du cœur, si elle n’a pas de cervelle.
Mais André était trop à son idée fixe pour relever l’observation.
– Maintenant, s’écria-t-il, le Croisenois est à nous. Notre point de départ est trouvé. Il tient M. de Mussidan comme il croit tenir Mme de Bois-d’Ardon. Nous connaissons les façons de travailler de cet honorable gentilhomme, il vous vole vos secrets et il vous fait chanter après… Mais nous sommes là : M. de Mussidan ne chantera pas…
XXV
Être le maître du plus confortable des intérieurs, y trouver toutes ses aises, avoir pris la délicieuse habitude d’y cuver en paix les égoïstes jouissances du célibataire, puis, tout à coup, être dépossédé !
Peut-on imaginer un plus affreux supplice.
Ce fut précisément celui du docteur Hortebize, lorsque le bon père Tantaine au nom de B. Mascarot, vint le prier de donner l’hospitalité à Paul Violaine.
Il pâlit et frémit, l’aimable épicurien, à la seule idée de cette invasion. Partager son appartement ou en être chassé par les huissiers lui semblait tout un.
Il vit, comme en un tableau sombre, sa vie dérangée, ses habitudes troublées, sa liberté compromise.
Que faire, que devenir, où aller, quels plaisirs prendre, avec ce garçon pour commensal obligé, dormant sous son toit, mangeant à sa table, le suivant dehors, pendu à son paletot comme le moutard au tablier de sa bonne ?
Plus de délicats dîners au restaurant, en compagnie de spirituels gourmets. Plus de ces visites mystérieuses qu’il attendait souvent avec impatience, le soir, les rideaux tirés, après avoir envoyé ses domestiques au spectacle.
Aussi, de quel cœur il vouait au diable l’honorable placeur et son intéressant protégé.
Mais l’idée ne lui vint pas d’essayer seulement de se soustraire à cette écœurante corvée.
Initié presque complètement aux projets de B. Mascarot, il sentait que surveiller Paul pendant les premiers jours était d’une importance capitale.
Il fallait le dépayser, ce garçon, le dérouter, l’étourdir, le transformer, creuser entre son passé et le présent un si profond abîme, qu’il ne pût revenir sur ses pas.
N’était-il pas indispensable, sans dire absolument la vérité à Paul, de le préparer à l’entendre ? On devait aguerrir son esprit contre les révoltes, sinon probables, du moins possibles, de sa conscience au dernier moment.
Le docteur se résigna donc et sut faire, comme on le dit vulgairement, contre fortune bon cœur.
Paul trouva en lui le plus agréable des compagnons, un spirituel causeur, un conseiller facile, prêchant une morale à la douce et une philosophie sans scrupules.
Pendant cinq jours, ils ne se quittèrent pas, déjeunant dans les grands restaurants, se promenant au bois, dînant au club du docteur.
Quant à leurs soirées, elles étaient prises.
Ils les passaient exactement chez M. Martin-Rigal. Le docteur jouait avec le banquier, lorsqu’il n’était pas sorti, – et Paul et Flavie causaient, à demi-voix, ou faisaient de la musique.
Mais rien n’est éternel ici-bas.
Le cinquième jour de cette agréable existence, le bon Tantaine parut, annonçant qu’il venait chercher Paul et son bagage.
– Je vous ai déniché et arrangé, lui dit-il, le plus charmant réduit qu’on puisse rêver. Dame !… c’est beaucoup moins beau qu’ici, mais tout y est conforme à la position qu’il convient que vous affichiez.
– Où est-ce ?
Le bonhomme eut un sourire qui voulait être très malicieux :
– J’ai songé à économiser vos chaussures, répondit-il, vous ne serez pas à une lieue de chez M. Martin-Rigal.
– Partons donc !… s’écria le jeune homme, que la curiosité ardait.
Comme factotum, le vieux clerc n’a pas son pareil. Il sait tout, connaît tout, prévoit tout, pense à tout.
Paul dut s’en convaincre au premier coup d’œil donné à sa nouvelle demeure.
C’est rue Montmartre, presque au coin de la rue Joquelet, que le père Tantaine avait rencontré ce qu’il cherchait.
C’était bien, ainsi qu’il l’avait fait pressentir, le logis modeste d’un artiste à ses débuts, mais d’un artiste ayant déjà vaincu les premières difficultés, songeant à l’avenir et se préoccupant du bien-être présent.
L’appartement, situé au troisième étage, se composait d’une petite entrée, de deux jolies pièces et d’un assez grand cabinet de toilette. Une des pièces était la chambre à coucher, l’autre était disposée en petit salon de travail, et près de la fenêtre se trouvait un piano.
Meubles, rideaux, tentures, bibelots, tout était propre, rien n’était neuf.
Une particularité frappa Paul.
Cet appartement, qu’on lui disait loué et meublé pour lui depuis trois jours seulement, paraissait habité. La vie y palpitait. On eût juré que le locataire venait de sortir à la minute, et qu’il allait rentrer.
Tout, depuis le lit qu’on aurait supposé tiède encore, jusqu’aux bouts de bougie des candélabres, trahissait des habitudes quotidiennes non interrompues.
Il y avait, sous le lit, des pantoufles qui avaient servi, le feu du matin n’était pas tout à fait éteint, on apercevait dans l’âtre des bouts de cigare, sur la table du salon de travail était une feuille de papier de musique, où on avait commencé de noter un air.
Cette sensation de la présence d’un maître était si forte, que Paul ne put s’empêcher de s’écrier :
– Mais cet appartement est habité, monsieur, nous sommes chez quelqu’un.
– Nous sommes chez vous, mon enfant.
– Maintenant, peut-être, parce que vous aurez acheté ici tout en bloc ; mais celui qui vous a vendu son mobilier ne fait que partir…
Le doux Tantaine avait l’air ravi d’un écolier après une espièglerie.
– Depuis plus d’un an, répondit-il, le seul locataire de céans, c’est vous. Ne reconnaîtriez-vous plus votre logis ?
Paul écoutait bouche béante, flairant une mystification ou un mystère.
– Quelle plaisanterie ! dit-il, pour dire quelque chose.
– De ma vie je n’ai été aussi sérieux. Voici plus d’une année que vous avez installé vos pénates ici. En voulez-vous une preuve ? Je vais vous la donner.
Il n’attendit pas la réponse. Il courut se pencher au-dessus de la cage de l’escalier, et, de toutes ses forces, cria :
– Mère Brigot !… Ohé !… Montez donc !…
Puis revenant à Paul :
– C’est la concierge de la maison, dit-il, vous allez voir.
Au même moment, un grosse vieille, répugnante d’obésité, au nez écarlate, ayant une mine obséquieuse que démentait son petit œil méchant caché sous de gros sourcils gris, fit son entrée dans l’appartement.
– Bonjour la mère, lui dit le vieux clerc d’huissier ; je vous ai appelée pour un petit renseignement…
– Bien à votre service, monsieur Tantaine.
Du doigt, le bonhomme montra Paul, tout en continuant à s’adresser à la portière.
– Vous connaissez monsieur ? demanda-t-il.
– Cette malice ! Un locataire.
– Comment se nomme-t-il ?
– Paul.
– Tout court ?
– Mais oui ; Paul de Rien-Avec, autrement dit. N’allez-vous pas lui reprocher de n’avoir connu ni père ni mère…
– Quelle est sa profession ?
– Artiste donc ! il donne des leçons de piano, il compose des airs et il copie de la musique.
– Que gagne-t-il à ce métier ?
– Ah !… je n’ai pas compté avec lui. À vue de nez, ça doit aller dans les trois ou quatre cents francs par mois.
– Et cette somme lui suffit ?
– Certainement. Mais, dame ! c’est si sage, si économe ! une vraie fille, quoi ! Au point que moi qui ai une demoiselle, je voudrais qu’elle lui ressemblât. Et travailleur, et distingué, et propre…
Elle sortit sa tabatière, huma une copieuse prise, et, avec l’accent d’une conviction bien arrêtée, ajouta :
– Et joli garçon !…
L’air connaisseur de la grosse femme parut réjouir beaucoup le bon Tantaine. Cependant, il poursuivit :
– Pour être si bien informée, il faut que vous connaissiez M. Paul depuis longtemps, et qu’il vous ait parlé de ses affaires.
– Pardine !… il y aura quinze mois, au terme prochain qu’il a emménagé ici, et depuis ce temps, tous les jours que le bon Dieu fait, c’est moi qui arrange son ménage…
– Savez-vous où il logeait avant ?
– Naturellement, puisque je suis allée aux renseignements. Il demeurait rue Jacob, de l’autre côté de l’eau. On l’y a même bien regretté, allez, mais il fallait qu’il se rapprochât de son travail, qui est près d’ici, rue Richelieu, à la bibliothèque.
D’un geste, le bonhomme arrêta la portière.
– Cela suffit, mère Brigot, dit-il, laissez-moi seul avec monsieur.
Ce bizarre, ce surprenant interrogatoire, Paul l’avait écouté de l’air ahuri d’un homme qui se tâte pour savoir au juste s’il dort ou s’il veille, s’il vit ou s’il rêve.
Le doux père Tantaine, lui, ferma soigneusement la porte sur les talons de la portière, et revint vers son protégé en riant aux éclats, trop fort pour que son rire fût complètement naturel.
– Eh bien ! lui demanda-t-il, que dites-vous de l’aventure ?
Paul fut bien deux minutes au moins pour recouvrer la parole. Il faisait d’héroïques efforts pour rassembler ses idées en déroute, il appelait à la rescousse sa fermeté vacillante.
Il se rappelait les conseils que depuis cinq jours le docteur Hortebize lui chantait sur tous les tons : « Attendez-vous aux événements les plus extraordinaires, ne vous étonnez de rien, soyez prêt à tout. »
Pour un premier assaut, sa contenance ne fut pas trop fâcheuse.
– Je suppose, monsieur, reprit-il enfin, que vous avez fait la leçon à cette femme.
La grimace du vieux clerc ne laissait pas de doute sur le vif désappointement que lui causa cette réponse.
– Diable !… fit-il d’un ton d’ironie qu’il ne prit pas la peine de dissimuler, si c’est là tout ce que vous avez compris, nous ne sommes pas près de nous entendre !
Cette raillerie devait piquer la vanité toujours à vif du protégé de B. Mascarot.
– Pardon, reprit-il d’un air gourmé, je comprends que cette scène n’est qu’une préface, et j’attends le roman.
Cela fut dit avec une belle assurance qui enchanta le vieux clerc d’huissier.
– Oui, mon enfant, s’écria-t-il tout attendri d’une effusion paternelle, oui, ce n’est qu’une préface indispensable ! Le roman, on te le révèlera quand le moment propice sera venu, et tu verras quel magnifique rôle on t’y réserve, et tu comprendras quel succès t’attend, si tu sais être un acteur de talent !
– Pourquoi ne pas dire la vérité tout de suite ?
Le bonhomme hocha doucement la tête.
– Patience, répondit-il en revenant au « vous, » patience, impétueuse jeunesse ! On n’a point bâti Paris en un jour. Laissez-vous guider, ô mon fils ! laissez-nous mesurer le fardeau à vos forces, abandonnez-vous à nos lisières protectrices ! C’en est assez pour aujourd’hui. Vous venez de recevoir votre première leçon, repassez-la, méditez-la.
– Une leçon ?
– Ou une répétition, comme vous voudrez, oui, mon enfant. Ce que j’avais à vous apprendre, je l’ai mis en action, pour vous frapper plus vivement, pour le graver plus profondément dans votre esprit.
– C’était précis, cela : il n’y avait ni à douter, ni à évoquer, ni à hésiter.
– Tout ce que cette bonne femme a dit, poursuivit le doux Tantaine en appuyant sur chaque mot pour lui donner une valeur plus grande, tout ce qu’elle a répondu doit être la vérité. Donc, c’est la vérité. Quand vous serez arrivé à vous le persuader à vous-même, vous serez prêt pour la lutte ; jusque-là, non. Souvenez-vous de ceci : on n’impose que les croyances auxquelles on ajoute foi. Il n’est pas un imposteur illustre qui n’ait été sa première dupe et sa plus entêtée.
À ce vilain mot : imposteur ! le protégé de B. Mascarot ne fut pas maître d’un haut-le-corps. Il essaya de protester.
Mais ce fut une raison pour Tantaine d’insister sur son idée et de souligner sa réplique comme on accentue la phrase décisive qui livre la clé d’une situation indéchiffrable.
– Un de mes amis, prononça-t-il, a vécu dans l’intimité d’un faux Louis XVII, qui eût ses partisans, et il m’a raconté une foule de particularités de son existence. Ce garçon, qui était le fils d’un cordonnier d’Amiens, avait si parfaitement fait abstraction de soi pour se pénétrer de son personnage d’emprunt, que, mis inopinément en présence d’une fille de son pays, qui avait été sa maîtresse et qu’il avait aimée à la folie, il ne la reconnut pas.
– Oh !… interrompit Paul ; quelle histoire !…
– Non, il ne la reconnut pas. Et voilà à quelle perfection vous devez prétendre. Ne souriez pas, le cas est sérieux. Il vous faut réussir à vous dégager totalement de vous-même pour entrer dans la peau d’un homme nouveau. Paul Violaine, le fils illégitime d’une petite mercière de Poitiers, le trop naïf amant de la Belle Rose, n’existe plus. Il est mort d’inanition dans un grenier de l’Hôtel du Pérou, ainsi qu’en témoignerait au besoin Mme Loupias.
C’est qu’il ne plaisantait pas, le vieux clerc d’huissier.
Il avait arraché son masque de bénigne niaiserie, il avait cet accent irrésistible qui enfonce les idées comme des pointes acérées dans les cerveaux les plus rebelles.
– Vous dépouillerez, poursuivait-il, cette individualité importune comme un vêtement usé qu’on jette et qu’on oublie. Le succès est à ce prix. Et je ne vous commande pas seulement de perdre la mémoire de l’intelligence, celle-là n’est rien ; je vous ordonne de perdre la mémoire du corps, qui est idiote, absurde, terrible, qui trahit toujours. Il ne faut pas que si, dans la rue, un inconnu crie : Violaine !… vous vous retourniez machinalement.
Si préparé que dût être Paul à cette leçon, il sentait sa raison vaciller comme la flamme d’une bougie au vent. Le cauchemar continuait.
– Qui suis-je ?… balbutia-t-il.
Le doux Tantaine se permit un ricanement sardonique.
– La portière vous l’a dit, répondit-il, aussi bien, mieux même que je n’aurais su vous le dire. Vous avez nom Paul, tout court, vous avez été élevé aux Enfants-Trouvés, vous n’avez jamais connu vos parents. Voici quinze mois que vous habitez ici, et vous demeuriez l’an passé rue Jacob. Votre femme de ménage n’en sait pas davantage… Mais lorsque vous viendrez avec moi rue Jacob, les concierges vous reconnaîtront, et ils vous diront où était, avant, votre domicile ; et si nous y allons, on se souviendra de vous pareillement.
– Et il me sera possible de remonter ainsi le passé ?…
– Mon Dieu, oui, jusqu’au jour de votre naissance. Peut-être en cherchant bien, arriveriez-vous jusqu’à votre père…
– Oh !… monsieur !…
– À moins qu’il n’arrive jusqu’à vous.
Le front de Paul devenait de plus en plus soucieux.
– Mais si on me demandait des détails sur ma vie, sur ce que j’ai fait ? Cela peut arriver ; je puis être interrogé par M. Martin-Rigal, par Mlle Flavie…
– Nous y voici donc !… Eh bien ! rassurez-vous ; on vous communiquera des documents si explicites, si précis, qu’il vous sera aisé de donner, heure par heure pour ainsi dire, l’emploi de vos vingt-trois ans.
– Mais alors, monsieur, il était donc, comme moi, musicien, compositeur, cet autre dont je prends la place ?
Le vieux clerc d’huissier, impatienté, ne se gêna pas pour lâcher un maître juron.
– Sacrebleu !… s’écria-t-il, jouez-vous la simplicité ? Vous ai-je dit que vous preniez la place de qui que ce soit ? Que me parlez-vous d’un autre ? Il n’y a que vous ici. Vous n’avez donc pas écouté la portière.
– Si, mais…
– Eh bien ! elle vous l’a appris, vous êtes artiste. Vous vous êtes fait seul, comme les hommes qui ont du nerf. Est-ce que le talent a besoin de maître ! Pour vivre en attendant que vos œuvres arrivent à l’Opéra, vous donnez des leçons.
– À qui ? On me questionnera.
Le père Tantaine prit dans une coupe, sur la cheminée, trois cartes de visite, et les présenta à Paul en disant :
– Voici le nom et l’adresse de trois élèves que vous avez et qui vous donnent chacun cent francs par mois pour deux séances par semaine. Ces deux-ci vous affirmeraient si vous en doutiez, que vous êtes leur professeur depuis longtemps. La troisième, Mme veuve Grodorge, témoignera même en justice, sous la foi du serment, qu’elle doit à vos leçons tout ce qu’elle sait, et elle est forte. Demain, vous vous présenterez chez ces élèves, aux heures indiquées sur les cartes. Vous serez reçu comme un familier de la maison, tâchez d’y être à l’aise autant qu’un ancien maître…
– Je tâcherai.
– Encore un mot. En dehors de vos leçons, et pour augmenter votre bien-être, vous copiez à la bibliothèque, pour des amateurs riches, des fragments d’anciens opéras inédits. Voici sur le piano le travail que vous achevez pour M. le marquis de Croisenois, une œuvre charmante de Valserra : I tredici mesi…
C’était tout pour le moment. Il prit le bras de Paul et lui fit visiter en détail l’appartement.
– Vous le voyez, disait-il, on n’a rien oublié, on vous croirait ici depuis des siècles. Bien plus, comme, en garçon rangé que vous êtes, vous ne dépensez pas ce que vous gagnez, vous trouverez dans le tiroir de votre bureau huit obligations d’Orléans et un millier de francs, ce sont vos économies.
Mille questions se pressaient sur les lèvres de Paul, mais déjà le bonhomme avait ouvert la porte pour se retirer.
– Je reviendrai demain avec le docteur, dit-il.
Puis adressant à son élève une bénédiction ironique, il ajouta, comme jadis B. Mascarot :
– Tu seras duc !…
Debout devant sa loge, la concierge de la maison, la mère Brigot, guettait la sortie du vieux clerc d’huissier.
Dès qu’elle l’aperçut descendant lentement l’escalier, la tête baissée en homme écrasé sous le poids de ses préoccupations, elle courut à lui, autant toutefois que son obésité lui permettait de courir.
– Êtes-vous content de moi, monsieur Tantaine ? lui demanda-t-elle de sa voix affreusement pateline…
– Chut !… interrompit le bonhomme en la poussant brutalement dans la loge, dont la porte était restée ouverte, chut donc ! Êtes-vous folle de parler ainsi tout haut, au risque d’être entendue du premier venu !
Il paraissait si furieux, ce bon Tantaine, que la portière baissait le nez, tremblante comme une coupable devant la justice.
– J’espérais, balbutia-t-elle, que j’avais bien répondu.
– Très bien, en effet, mère Brigot ; vous m’aviez parfaitement compris. Je rendrai bon compte de vous à M. Mascarot.
– Quel bonheur !… Alors, nous sommes sauvés, Brigot et moi ?
Le vieux clerc eut un geste équivoque.
– Sauvés… répondit-il, pas encore tout à fait. Le patron, certainement, a le bras long, mais vous avez des ennemis, beaucoup d’ennemis. Tous les domestiques de la maison vous exècrent, et ils seraient ravis, je ne vous le cacherai pas, de vous faire arriver de la peine.
– Oh !… monsieur, est-ce possible ; peut-on dire des choses pareilles ! Nous qui sommes si bons pour eux, mon mari et moi.
– Maintenant peut-être, parce que vous redoutez leur témoignage ; mais autrefois ?… Ah ! vous vous êtes mis dans de bien vilains draps, votre mari et vous. La loi est précise : Article 386, paragraphe 3. Il y va de la réclusion. Vous avez surtout cette diable de circonstance de paquets de clés vus entre vos mains par les deux bonnes du second étage, qui est terrible.
Ce fut au tour de la grosse femme de frémir. Elle joignit les mains en murmurant d’une voix suppliante :
– Plus bas ! monsieur, je vous en conjure, plus bas !…
– Votre grand tort, poursuivait le père Tantaine, est d’être venu trouver le patron trop tard. On avait beaucoup jasé déjà, la police avait été prévenue et ne pouvait se dispenser d’agir.
– C’est égal, si M. Mascarot voulait…
– Mais il veut, chère dame, il ne demande qu’à vous être utile. Je suis persuadé qu’il réussira à égarer l’enquête ; déjà beaucoup de témoins ont promis de vous être favorables… Seulement, vous savez, service pour service, il faut lui obéir ponctuellement.
– Oh ! le cher homme !… nous passerions dans le feu pour lui, Brigot et moi ; ma fille Euphémie y passerait aussi…
Prudemment le vieux clerc recula.
Il put craindre que, transportée d’espoir, dans l’effusion de sa reconnaissance, la portière ne se jetât à son cou.
– Le patron n’exige pas de tels sacrifices, dit-il ; tout ce qu’il vous demande, c’est de ne jamais varier dans vos déclarations au sujet de Paul. Ce qu’il attend, c’est une discrétion impénétrable. Un seul mot du secret qui vous a été confié, il vous abandonne, et alors, je vous l’ai dit, l’article 386…
Décidément, l’énoncé de cet article qui édicte les peines applicables aux vols domestiques avait la vertu de donner des coliques à l’honnête concierge.
– La tête sur le billot, monsieur, s’écria-t-elle, je soutiendrais mordicus que M. Paul est mon locataire depuis un an, qu’il est artiste, que je le connais, et le reste. Quant à lâcher une traître parole de ce que vous m’avez conté, je me couperais plutôt la langue, et j’y tiens… allez !
Si véritablement sincère était l’accent de cette déclaration, que le vieux clerc d’huissier revint à sa bénignité accoutumée.
– Dans ces conditions, prononça-t-il, je suis autorisé à vous dire : Espérez. Oui, le jour où l’affaire de notre jeune homme sera terminée, on vous obtiendra une petite déclaration qui vous rendra blancs comme neige et qui vous permettra de dire le front haut que vous avez été calomniés.
C’était un marché, la mère Brigot ne devait pas s’y méprendre.
– Qu’il réussisse donc bien vite, dit-elle, ce cher enfant mignon.
– Ce ne sera pas long, je vous le garantis. Mais jusque-là, vous savez, surveillance attentive de tous les instants.
– On ouvrira l’œil.
– À qui que ce soit, en dehors du patron, de son médecin ou de moi, qui viendrait demander Paul, vous répondrez qu’il est sorti.
– Entendu, personne ne montera.
– De plus, il vous faudrait tâcher de savoir le nom du visiteur et venir nous avertir rue Montorgueil.
– S’il vient quelqu’un, vous serez prévenu dans les cinq minutes.
Le bon Tantaine se recueillit cherchant s’il n’avait pas quelque autre recommandation à faire.
– C’est bien tout, dit-il au bout d’un moment. Ah ! encore ceci. Tenez exactement note des heures de sortie et de rentrée de ce joli garçon, parlez-lui le moins possible, mais épiez ses moindres actions.
Cela dit, sans s’arrêter aux protestations de la portière toute brûlante du zèle d’un intérêt bien entendu, il s’éloigna en répétant :
– Surveillez ! surveillez !… qu’il ne fasse pas de sottises.
Cette dernière préoccupation, pour le moment du moins, était absolument superflue.
Paul était hors d’état de tenter quoi que ce fût.
Tant qu’il s’était senti sous l’œil du père Tantaine, il avait puisé dans sa détestable vanité assez d’énergie pour garder une ferme contenance.
Mais, une fois seul, après le départ du bonhomme, il fut saisi d’un tel effroi qu’il se laissa tomber comme anéanti sur un fauteuil.
C’est qu’entre toutes les idées qui doivent répugner à l’imagination, il n’en est pas de plus odieuse que celle de la perte de sa personnalité.
Si l’esprit accepte facilement la nécessité d’un travestissement imposé par les circonstances, c’est que ce travestissement n’est que momentané, et que d’ailleurs, sous un faux nom pris au hasard, sous le costume d’emprunt, on reste soi.
Tel n’était pas le cas de Paul.
Non seulement il se voyait réduit à renoncer à son individualité, mais il se trouvait prendre l’individualité d’un autre.
Il serait peut-être heureux et riche, il épouserait Flavie, il aurait un grand nom ; mais femme, argent, noblesse, bonheur, il devrait tout à une infâme comédie.
Et le pacte conclu, et il l’était presque, il lui deviendrait impossible de revenir sur ses déclarations. Il serait comme un acteur condamné à vivre avec le masque et le costume de son rôle. Il lui faudrait, jusqu’à sa mort, être cet autre dont il volait le passé.
Il frissonnait en se rappelant cette lugubre parole du père Tantaine :
– Paul Violaine est mort.
Et il lui semblait, en effet, que quelque chose venait de se briser en lui.
Il torturait sa mémoire à chercher parmi ses souvenirs quelques exemples de cette situation étrange ; il n’en trouvait pas.
Si, cependant.
Il se rappelait l’histoire de Cognard, ce bandit si audacieux, incarné en comte de Sainte-Hélène, dont tout Paris admirait la tournure martiale et le brillant uniforme, sur le front des troupes, aux revues royales.
Cognard, ce forçat trahi par un ancien compagnon de chaîne.
Car c’était là ce qu’il risquait, à jouer cette périlleuse partie : le bagne.
Ne serait-il pas reconnu, lui aussi, par quelque camarade oublié, qui au moment du triomphe le montrerait du doigt et crierait :
– Arrêtez !… Celui-ci est Paul Violaine, de Poitiers, le fils de la petite mercière de la rue des Vignes.
Que ferait-il alors, que répondre ? Aurait-il sur les émotions poignantes d’un tel moment assez de puissance pour payer d’audace, pour regarder, d’un œil riant cet accusateur en lui disant :
– Vous vous trompez, je ne vous connais pas.
Il ne se sentait pas cette impudence imperturbable, et la conviction de n’être pas à la hauteur de son rôle ajoutait à son effroi.
S’il n’eût pas été engagé déjà, s’il eût su que devenir, où aller, comment vivre, il eût pris la fuite.
Le pouvait-il ?
Hélas ! bien que fort inexpérimenté, il comprenait que des gens comme le placeur, comme Hortebize et comme Tantaine ne sèment pas leurs secrets au hasard. Ils lui avaient fait, à eux trois, assez d’étranges confidences pour lui bien prouver qu’ils le considéraient comme absolument en leur pouvoir.
Or, il savait à quoi s’en tenir sur la puissance de B. Mascarot. Il était certain que, quoi qu’il pût faire, il n’échapperait pas à sa vengeance.
Accepter le traité, c’était courir un danger ; mais un danger lointain, probable peut-être, mais non pas assuré.
Éluder le traité c’était s’exposer à un péril immédiat et parfaitement défini.
Pris entre ces menaces, Paul devait choisir les plus éloignées.
Ce furent d’ailleurs les dernières convulsions de son honnêteté expirante.
– J’accepte, murmura-t-il, en avant !…
Il faut bien le dire, les cinq jours passés en compagnie de l’excellent Hortebize pesaient d’un poids énorme dans la balance des décisions de Paul.
Il possédait au suprême degré, ce respectable docteur, l’art de rendre le vice aimable et de le mettre à la portée de toutes les consciences.
Pour exposer ses odieuses théories, il savait toujours rencontrer le terme congruant, l’expression agréable et de bonne compagnie.
Paraissait-on néanmoins surpris, vite il trouvait parmi ses souvenirs des exemples rassurants à citer.
Si bien qu’il semblait impossible qu’à son contact l’honnêteté à peine trempée d’un adolescent dévoré de convoitises, tout flambant de passions inassouvies, ne fût pas désorganisée.
Un garçon bien autrement affermi que Paul en d’honorables principes, eût très probablement succombé à ces incessantes attaques, ayant l’apparence inoffensive et la redoutable puissance de la goutte d’eau qui, à la longue, use le rocher.
Nul comme le docteur ne savait émettre à propos ces maximes dissolvantes qui sont comme le lien commun de la corruption.
Il professait, prétendait-il, le catéchisme des forts.
Il prêchait deux morales, celle des intelligents et celle des imbéciles.
– De quelle postérité voulez-vous être, demandait-il à Paul, de celle d’Abel ou de celle de Caïn ? Entre les deux, il faut opter sans rémission. Eternels moutons, les fils d’Abel seront toujours tondus. Les descendants de Caïn, au contraire, savent s’armer de ciseaux et tondre. Que redoutez-vous ? Ce n’est plus Dieu maintenant qui, du haut des nuages, crie : « Caïn, qu’as-tu fait de ton frère ? » C’est la justice humaine qui se contente de demander si on s’est débarrassé d’Abel selon les règles prescrites par le code.
Puis, tous ces discours, il les condensait en aphorismes mis en pratique, affirmait-il, par les heureux du monde.
Il disait à Paul :
« Le succès justifie tout. »
« Une bonne grosse infamie qui enrichit d’un coup, épargne quantité de petites infamies de détail que se permettent les plus honnêtes gens. »
Ou encore :
« Le grand chemin de la fortune est si encombré, que ceux-là seuls arrivent au but qui ont l’adresse de prendre un chemin de traverse. »
Or, les renseignements du docteur avaient cela de terrible, qu’à tout instant il pouvait se proposer pour modèle, et dire :
– Regardez-moi !
Et, en effet, son exemple était de ceux qui feraient douter de la conscience et de la justice.
En lui le vice triomphait, jouissait, s’engraissait, roulait voiture, éclaboussait en riant l’honnêteté pauvre.
Quant au châtiment qui toujours arrive, tôt ou tard, s’il le redoutait, il se gardait bien de l’avouer.
Il ne disait pas à Paul que ce médaillon enrichi de pierreries qui battait son ventre de financier, renfermait un poison subtil sur lequel il comptait en cas de catastrophe.
Non. Il répétait :
– Du courage, ami Paul, abandonnez-vous à Mascarot, comme moi, comme le marquis de Croisenois, comme Van Klopen, comme tant d’autres. Mascarot peut tout ce qu’il veut, il est dévoué et sûr. Quand entre la fortune et un de ses amis se trouve un bourbier, il n’hésite pas, il prend, nouveau Saint-Christophe, son ami sur ses robustes épaules, et le passe.
Sur ce dernier point, le docteur prêchait un croyant.
Loin de douter de la force de B. Mascarot, Paul se la serait plutôt exagérée. Après cette dernière scène, il n’apercevait pour ainsi dire pas de limites à une puissance établie sur la terreur.
Si depuis sa sortie de l’Hôtel du Pérou, il avait été ébloui par la rapidité des événements, son installation dans cet appartement de la rue Montmartre, lui paraissait tenir du prodige.
Il était stupéfait de la quantité de gens que l’honorable placeur savait faire mouvoir et forcer de concourir à la réussite de ses projets.
Cette portière qui assurait le connaître, ces concierges de la rue Jacob près desquels on pouvait aller aux renseignements, ces élèves qu’on lui procurait, tous ces gens n’étaient-ils pas comme autant d’esclaves qu’un secret livrait pieds et poings liés à la discrétion de B. Mascarot ?
Était-il à craindre d’échouer avec de tels éléments de succès ? Risquait-on même quelque chose, protégé par un homme à qui rien n’échappait, qui semblait disposer à son gré des événements, qui organisait le hasard à son convenance ?
– Et j’hésiterais, se disait Paul en arpentant d’un pied fiévreux son nouvel appartement, et j’aurais des scrupules ! Ah ! ce serait trop bête.
Il dormit mal cependant cette première nuit. À diverses reprises, il s’éveilla en sursaut. Il lui semblait voir rôder autour de son lit l’ombre vengeresse de l’homme dont il volait la personnalité.
Mais le lendemain, lorsque l’heure arriva d’aller donner sa première leçon, il se sentait en veine de courage, il faudrait dire d’impudence, et c’est d’un pas leste, la tête haute et la mine assurée qu’il se rendit à l’adresse indiquée sur la carte de Mme veuve Grodorge, celle qui devait se déclarer la plus ancienne de ses élèves.
Certes, il ne se doutait guère que deux de ses protecteurs, dissimulés derrière un lourd camion, le surveillaient et l’observaient.
C’était ainsi, cependant.
Amenés par le même désir de savoir comment Paul acceptait sa situation nouvelle, depuis qu’il était livré à lui-même, le bon Tantaine et le docteur Hortebize s’étaient rencontrés au coin de la rue Joquelet, juste à temps pour voir passer leur disciple et saisir sur sa physionomie l’expression de ses sensations.
En le voyant s’éloigner tout pimpant, ils échangèrent un coup d’œil de triomphe.
– Eh ! eh ! ricana le vieux clerc d’huissier, notre jeune coq redresse sa crête qui était bien basse hier au soir… cela va bien !
– Oui, approuva le docteur ; le voilà lancé maintenant, il ira loin.
Pour plus de sûreté, cependant, ils entrèrent se renseigner près de la mère Brigot.
C’est avec les témoignages les plus serviles d’un respect sans bornes que la grosse femme les accueillit et répondit à leurs questions.
– Personne ne s’est présenté pour notre jeune homme, déclara-t-elle. Hier, il n’est descendu qu’à sept heures. Il m’a demandé de lui indiquer le restaurant le plus voisin ; je l’ai envoyé au bouillon Duval, ici à côté. À huit heures, il était de retour ; il est remonté se pomponner et est ressorti. À minuit, il était couché.
– Passons à aujourd’hui.
– Voilà ! Quand je suis montée chez lui, ce matin, il pouvait être neuf heures. Il venait de se lever et finissait de s’habiller. Quand j’ai eu fini son ménage, il m’a priée de lui aller chercher à déjeuner et de lui préparer du café. J’ai obéi. Il s’est mis alors à manger de si bon appétit, que je me suis dit : « Allons, voilà l’oiseau habitué à sa cage ! »
– Et après ?
– Il s’est mis à chanter, toujours comme un oiseau. Puis il a touché du piano. Ah ! le cher mignon, sa voix est aussi agréable que sa figure. Foi de femme !… on en deviendrait folle de ce petit homme-là ! Heureusement, ma fille Euphémie ne vient pas me voir souvent…
Le reste de la phrase se perdit dans le mouvement qu’elle fit en aspirant une énorme prise de tabac.
– Enfin, s’il est sorti, reprit le père Tantaine, a-t-il dit s’il serait longtemps dehors ?
– Le temps de donner sa leçon. Il sait que monsieur doit venir…
– C’est bien.
Satisfait de la surveillance, le bonhomme se retourna vers l’excellent M. Hortebize.
– Vous alliez peut-être à l’agence, monsieur le docteur ? demanda-t-il.
– Précisément, je comptais voir M. Mascarot.
– Il est absent, mais si vous avez quelque chose à lui faire dire, prenez la peine de monter avec moi jusque chez notre jeune homme ; il faut que je lui parle, et je vais l’attendre.
– Soit, répondit le docteur.
C’était comme un ordre pour l’obséquieuse concierge. Elle s’empressa de remettre à ses deux visiteurs la clé que lui avait laissée son locataire, et ils montèrent rapidement.
Mieux que Paul, l’excellent Hortebize pouvait juger l’habileté qui avait présidé à l’arrangement de cet appartement destiné à donner l’idée d’un long séjour et d’une existence calme et laborieuse.
– Sacrebleu !… mon vieux, s’écria-t-il avec l’accent de la sincère admiration, quel metteur en scène tu ferais !…
D’un coup d’œil, il avait embrassé les détails les plus futiles en apparence, et il poursuivait :
– Parole d’honneur ! sur la seule vue de ce petit salon de travail, un père donnerait sa fille au garçon qui l’habite…
Mais il s’interrompit, surpris du silence du vieux clerc d’huissier. Il le regarda et fut frappé de son air sombre.
– Qu’as-tu, demanda-t-il avec une nuance d’inquiétude, qu’y a-t-il ?…
Tantaine fut un moment sans répondre. Il s’était assis les jambes croisées devant le feu près de s’éteindre, et tisonnait furieusement.
– Il y a, grommela-t-il enfin, il y a que nos cartes se brouillent.
À cette déclaration le front du souriant docteur se rembrunit.
– C’est Perpignan qui te gêne, fit-il. Tu auras rencontré près de lui des difficultés insurmontables…
– Non. Perpignan n’est qu’un sot. Il fera naturellement juste ce que je voulais lui conseiller de faire. Nous tenons le Champdoce…
Le digne M. Hortebize, fort oppressé depuis un moment, eut un gros soupir de satisfaction.
– Alors, murmura-t-il, je ne vois pas…
– Quoi !… tu oublies le mariage de Croisenois ! Là est l’obstacle. Une affaire si sagement combinée, cependant, conduite avec tant de prudence. Hier encore j’aurais répondu sur ma tête d’un succès sans anicroche.
– Eh !… c’est cela, tu marchais avec trop d’assurance…
– Point. J’ai joué de malheur, voilà tout. Est-ce que la sagesse humaine existe !… La sagesse humaine !… ce n’est qu’un mot. On fait la part de l’imprévu, on ne fait pas celle de l’impossible.
– Cependant…
– C’est ainsi. Jamais ennemi habile n’eût imaginé contre nous la série de combinaisons invraisemblables que nous oppose le hasard. Toi qui vas dans le monde, connais-tu, en 1868, une héritière très belle et très noble, insensible aux jouissances du luxe et de la vanité et capable d’une grande et vraie passion…
Le docteur eut un sourire qui, certes, était la plus explicite des négations.
– Eh bien ! poursuivit le bonhomme, cette héritière existe, et elle a nom Sabine de Mussidan. Elle aime, et sais-tu qui ?… un homme que par trois fois déjà j’ai trouvé en travers de ma route, un artiste, un peintre, et il faut que ce garçon soit doué de la plus redoutable énergie qu’on puisse concevoir.
– Bast !… un artiste sans fortune, sans doute, sans relations…
Un geste de son interlocuteur l’interrompit…
– Cet artiste n’est pas sans relations, malheureusement, déclara le doux Tantaine, il a un ami, et quel ami !… le gentilhomme qui devait épouser Mlle Sabine, M. de Breulh-Faverlay.
Cette nouvelle était si étrange, que l’excellent Hortebize demeura sans voix.
– Comment est venu ce rapprochement, poursuivit Tantaine, je ne puis me l’expliquer. Ce doit être un coup du génie de Mlle Sabine. Enfin le fait est là. Et à eux deux ils ont gagné à leurs intérêts la femme que je destinais à pousser la candidature de Croisenois.
– Mais c’est impossible.
– C’est mon avis. Ce qui n’empêche que, hier soir, ils étaient réunis tous les trois, et juraient, je le présume du moins, de tout tenter pour empêcher le mariage du marquis.
L’excellent docteur bondit sur son fauteuil.
– Quoi ! s’écria-t-il, quoi !… ils ont pénétré les projets de Croisenois ! Ah ! ça, comment ?
Le vieux clerc eut un geste découragé.
– Ah ! voilà ! répondit-il. Un général ne peut être sur tous les points d’une grande bataille, et toujours parmi ses lieutenants il se trouve des imbéciles ou des traîtres. J’avais arrangé entre Van Klopen et Croisenois une comédie qui devait nous livrer la vicomtesse. Tout avait été prévu, combiné, arrangé : j’avais soigné les détails comme seul je sais les soigner. Je ne pouvais pas ne pas compter sur un triomphe complet.
Malheureusement, après une répétition générale excellente, la représentation a été détestable. Ni Croisenois, ni Van Klopen n’ont pris la peine de jouer leur rôle sérieusement. Je leur avais préparé un chef-d’œuvre de finesse et de transitions, ils ont exécuté une scène brutale, ridicule, révoltante, une parade !… Ils ont cru, les idiots ! qu’il est aisé de tromper une femme !
Et pour comble, le marquis, à qui j’avais recommandé la plus extrême réserve, a démasqué immédiatement ses batteries ; oui, ce niais vaniteux a parlé de Sabine.
Dès lors, tout était perdu. La vicomtesse, qui sur le moment avait été dupe, a réfléchi, et la connivence des deux acteurs lui a sauté aux yeux. Flairant un piège, la peur l’a prise et elle a couru crier : « Au secours ! » chez M. de Breulh.
Le docteur écoutait, la consternation peinte sur le visage.
– Qui donc, demanda-t-il a pu t’informer ainsi ?
– Personne, je devine. Je vois les résultats, je pénètre la cause. Oh ! l’éveil est donné, va !…
Le doux Tantaine n’est pas homme à gaspiller en inutiles discours ce capital qui s’appelle le temps.
Quand il ouvre la bouche, c’est qu’il a quelque chose à dire, et ses paroles, les plus oiseuses en apparence, ont toujours une portée sérieuse.
Le docteur le savait bien.
De là son anxiété de plus en plus poignante, à mesure qu’il sentait qu’on se rapprochait d’un but qu’il ne pénétrait pas.
– Pourquoi me dis-tu tout cela, interrogea-t-il, que n’avoues-tu plutôt sans ambages que la partie est désespérée !
– C’est qu’elle ne l’est pas.
– À t’entendre, cependant !…
– J’ai déclaré qu’elle était fort compromise, rien de plus, et c’est bien différent. Quand tu joues à l’écarté, en cinq points, que ton adversaire en a quatre et que tu n’en as pas un seul, jettes-tu tes cartes et abandonnes-tu ton enjeu ? Non. Tu gardes l’espoir de piquer sur quatre, comme on dit vulgairement.
L’inaltérable flegme du vieux clerc d’huissier exaspérait vraiment le digne M. Hortebize.
– Ainsi, s’écria-t-il, tu t’obstines à lutter.
– Naturellement.
– Mais c’est de la démence, c’est de l’aberration, c’est courir de gaieté de cœur à un abîme dont on a mesuré la profondeur.
Le vieux clerc se permit un petit sifflement on ne peut plus agaçant.
– Que devrions-nous donc faire, demanda-t-il, au jugement de Votre Excellence ?
– Rien. Abandonner cette combinaison et en chercher une autre, moins lucrative, peut-être, mais aussi moins périlleuse. Ne vas-tu pas te piquer au jeu ? Ce serait, par ma foi ! de la vanité bien placée. Tu as voulu mordre un morceau, il est trop dur, n’est-ce pas ? abandonne-le ; à t’obstiner tu te casserais les dents. Nous avons tâté ces gens, ce sont des lutteurs au-dessus de nos forces ; laissons-les. Au fond, que nous importe que Mlle de Mussidan épouse Croisenois ou de Breulh, ou tout autre ! La spéculation est-elle là ? Non. Heureusement. L’idée vraiment productive, l’idée d’une société à laquelle tu fais souscrire tous nos contribuables, reste pleine et intacte. Nous la reprendrons. Mais, en attendant, crois-moi, confessons entre nous notre défaite, battons en retraite et faisons les morts.
Il s’arrêta, déconcerté par l’expression gouailleuse du sourire du bon père Tantaine.
– Il me semble, ajouta-t-il, d’un ton blessé, que ma proposition n’a rien de ridicule, qu’elle est raisonnable.
– Peut-être. Reste à savoir si elle est pratique.
– Je ne découvre rien qui t’empêche de l’accepter.
– Vraiment ! C’est qu’alors la frayeur te montre la position à travers de singulières lunettes. Nous nous sommes trop avancés, mon bon docteur, pour avoir encore notre libre arbitre. Aller de l’avant nous est impérieusement commandé. Reculer maintenant, serait attirer nos adversaires sur notre piste. Quoi que nous fassions, il faudra en découdre. Or, bataille pour bataille, mieux vaut choisir son terrain et commencer. À forces égales, l’agresseur gagne trois chances sur dix, on l’a calculé.
– Ce sont des mots !…
– Bah !… sont-ce des mots aussi, nos confidences à Croisenois ?…
L’argument, s’il n’ébranla pas le docteur, le frappa vivement.
– Serait-il donc assez infâme pour nous trahir ? fit-il.
– Pourquoi non, si c’est son intérêt évident ? Réfléchis et juge : Croisenois est au bout de son rouleau ; nous l’avons ébloui des perspectives d’une fortune princière : à quel parti s’arrêtera-t-il si nous allons lui dire : « Pardon ! il n’y a rien de fait ; vous êtes dans la misère, restez-y. »
– On pourrait le désintéresser, l’assister.
– Et cela nous conduirait, où ? Veux-tu payer ses dettes, dégager son héritage, défrayer son luxe et ses passions ? Quelles limites auront ses exigences ? Depuis que je lui ai livré le secret de l’association, il nous tient autant que nous le tenons ; plus même, car il a moins à risquer. Nous lui avons appris la musique, docteur, il nous ferait joliment chanter.
– Ah !… tu as été bien imprudent.
– Sacrebleu ! il faut pourtant se confier à quelqu’un. D’ailleurs, les deux affaires, celle du duc de Champdoce et celle de Sabine, se tiennent. Je les ai conçues ensemble, ensemble elles réussiront ou me craqueront entre les mains.
– Ainsi, tu persistes ?
– Plus que jamais.
Depuis un moment, le docteur, avec une affectation qui ne pouvait échapper à son interlocuteur, agitait et faisait sonner le médaillon d’or pendu à la chaîne de sa montre.
– J’ai juré autrefois, prononça-t-il avec un pâle sourire, que nos destinées seraient communes. Je ne me dédis pas. Marche, si périlleuse que me semble la route où tu t’obstines, je te suivrai jusqu’au bout… jusqu’au fossé de la culbute. J’ai sous la main ce qu’il faut pour éviter les angoisses de la chute : Une contraction du gosier, comme pour avaler une pilule amère, une convulsion foudroyante, un vertige, un hoquet… et tout est fini.
La lugubre précaution du docteur avait toujours offusqué le bon Tantaine. Elle lui fut en ce moment particulièrement désagréable.
– Oh !… assez, fit-il. Si tout tourne mal, tu utiliseras ton médaillon ; jusque-là, par grâce, laisse-le en repos.
Il se leva de l’air le plus mécontentent, s’adossa à la cheminée, et poursuivit :
– Pour des gens de notre trempe, un danger connu n’est plus un danger. On nous menace, nous nous défendrons. Malheur à qui me gêne. Au pis aller, j’aurai recours aux grands moyens.
Il s’interrompit, alla ouvrir toutes les portes pour se bien assurer que personne n’écoutait derrière, et, revenant à sa place, il reprit d’une voix sourde :
– En résumé, un seul homme nous fait obstacle : André. Supprime-le, tout va comme sur des roulettes.
L’excellent Hortebize tressauta comme s’il eût été touché d’un fer rouge.
– Malheureux ! s’écria-t-il, tu voudrais…
Le vieux clerc eut un petit rire des plus effrayants.
– S’il le fallait, pourtant ! répondit-il. Ne vaut-il pas mieux tuer le diable que d’être tué par lui ?
L’effroi du digne M. Hortebize était tel que ses dents claquaient comme des castagnettes. Il consentait bien à demander aux gens : « La bourse ou l’honneur ! » Mais demander : « La bourse ou la vie ! » et frapper…
– Et si nous étions découverts ! balbutia-t-il.
– Nous ? Allons donc ! Suppose le crime commis : la justice cherchera à qui il profite. Arrivera-t-elle à nous ? Jamais. Par exemple, elle saura que cette mort rend à M. de Breulh la main d’une femme qu’il adore, et qui lui préférait André…
– Horrible !… fit le docteur révolté.
– Eh ! je le sais bien. Aussi ferai-je tout au monde pour éviter cette extrémité. Les moyens violents me répugnent autant qu’à toi. Je chercherai, je trouverai mieux…
Il s’arrêta court. Paul rentrait une lettre à la main.
Le protégé de B. Mascarot rayonnait, et c’est d’un air de suffisance bien plaisant qu’il tendit la main au docteur Hortebize et au vieux clerc d’huissier.
– Par ma foi !… messieurs, dit-il, du ton le plus dégagé, je comptais bien sur votre aimable visite, mais non de si bonne heure. Je remercie le hasard qui m’a inspiré la pensée de monter un moment.
Le père Tantaine eut bien du mal à s’empêcher de hausser les épaules.
Involontairement, il comparait cette crânerie toute nouvelle de Paul à ses défaillances vingt-quatre heures plus tôt, à cette même place.
– Les affaires vont donc comme nous voulons ? interrogea le docteur.
– Elles vont au moins assez bien pour que, même en cherchant bien, je ne puisse trouver un sujet de plainte.
– Vous venez de donner votre leçon ?
– Précisément. Je quitte à l’instant Mme Grodorge. Quelle femme aimable et charmante ! Vous dire de quelles prévenances elle m’a comblée est impossible.
Paul eût ignoré totalement pourquoi et comment la porte de Mme Grodorge lui était ouverte, qu’il ne se fût pas exprimé autrement.
– On s’explique, cela étant, votre satisfaction si légitime, fit le docteur avec une nuance de persiflage que Paul ne saisit pas.
– Oh !… répondit-il, je ne m’en fais pas accroire pour si peu de chose. Si je vous semble ravi, c’est que j’ai d’autres raisons… plus sérieuses.
– Serait-ce une indiscrétion de vous demander lesquelles ?
Paul prit la mine grave et mystérieuse de l’adolescent qu’étouffe son premier secret d’amour.
– Je ne sais trop si j’ai le droit de parler, confiance oblige.
– Diable !… une aventure, déjà !
L’amour-propre de l’élève du placeur s’épanouissait délicieusement.
– Gardez votre secret, mon cher enfant, conseilla le père Tantaine, gardez-le.
C’était bien le moyen de lui délier promptement la langue ; le malicieux bonhomme l’avait prévu.
– Oh ! monsieur, protesta-t-il, me croyez-vous ingrat à ce point d’avoir quelque chose de caché pour vous !…
Il agita triomphalement le papier qu’il tenait à la main, et ménageant autant que possible ses effets, il poursuivit :
– Voici une lettre que m’a remis la concierge lorsque je suis entré. Elle m’a été apportée par un garçon de banque. Devinez-vous de qui elle peut être ? Allez, ne cherchez pas, elle est de mademoiselle Flavie Rigal et ne me laisse aucun doute sur ses sentiments à mon égard.
– Oh !…
– C’est ainsi. Le jour où je prendrai la peine de le vouloir sérieusement, Mme Flavie deviendra Mme Paul.
Une fugitive rougeur, aussitôt disparue, courut sous la peau épaisse et ridée du vieux clerc d’huissier.
– Vous êtes heureux !… fit-il, non sans un tremblement fort appréciable de la voix, bien heureux !…
L’autre, négligemment, releva le revers de son paletot, et, passant son pouce dans l’entournure de son gilet, répondit :
– Mon Dieu oui !… Mais sans grands efforts je vous prie de le croire. Je n’ai pas déplu à Mlle Flavie, et à ma troisième visite, elle me le confessait bien gentiment.
Comme s’il eût jugé ses lunettes insuffisantes à dissimuler ses émotions, le père Tantaine écoutait, le visage caché entre ses mains.
– Hier soir, cependant, poursuivit Paul, Mlle Flavie avait été d’une réserve et d’une froideur désespérantes. Vous pensez peut-être que je me suis efforcé de l’attendrir ? Point. Je me suis dit : « Mignonne, tu perds ton temps, » et je l’ai quittée de meilleure heure que de coutume.
Il mentait ; il avait été horriblement inquiet.
– Et j’agissais sagement, continuait-il. La pauvre fille ! Pour me tenir rigueur, elle luttait contre son cœur. Écoutez plutôt ce qu’elle m’écrit :
Il rejeta ses cheveux en arrière, se posa de la façon qu’il jugeait la plus avantageuse, et lut :
« Mon ami,
« J’ai été méchante hier, et je m’en repens. Je n’ai pu dormir de la nuit, en me rappelant la grande tristesse qu’on lisait dans vos yeux quand vous vous êtes retiré. Paul, c’était une épreuve. Me pardonnerez-vous ? J’ai plus souffert que vous, croyez-le.
Quelqu’un qui m’aime bien, hélas ! plus que vous peut-être, me répète sans cesse qu’une jeune fille qui livre à celui qu’elle aime sa pensée entière, risque son bonheur. Est-ce vrai cela ?
Hélas ! ce serait bien malheureux, Paul, car moi je ne saurais jamais feindre. Et, la preuve, c’est que je vais tout vous dire. Mon bon père est le meilleur, le plus excellent des hommes, et tout ce que je veux il le veut. Je suis bien sûre que si votre ami, notre bon docteur Hortebize venait de votre part lui présenter une certaine requête, il ne dirait pas : non. Je suis bien sûre que si je le priais d’une certaine manière, il me répondrait : oui… »
– Et cette lettre ne vous a pas touché ? demanda le père Tantaine.
– Franchement, si. Écoutez donc, il y a un million de dot.
Sur cette vanterie, le vieux clerc d’huissier se dressa d’un bon si menaçant, que Paul recula, stupéfait de ce soudain mouvement de colère.
Mais, sur un coup d’œil de l’excellent Hortebize, le bonhomme se contint.
– Si encore il pensait ce qu’il dit, gronda-t-il ; si son vice n’était pas pure fanfaronnade.
– C’est notre élève !… fit le docteur avec un sourire.
Le bon Tantaine, cependant, s’était approché de Paul. Il posa sa large main sur sa tête, et froissant presque brutalement ses beaux cheveux blonds, il lui dit :
– Tu ne sauras jamais, mon garçon, tout ce que tu dois à Mlle Flavie !
Cette scène rapide impressionna Paul d’autant plus vivement, qu’il n’en pouvait comprendre ni les motifs ni la portée.
Voilà deux hommes qui avaient mis en œuvre les deux plus puissantes ressources de leur funeste esprit pour pervertir en lui tout sens moral ; il essayait de mettre leurs leçons en pratique, espérant s’attirer leurs éloges, et, au lieu de cela, ils le traitaient avec le dernier mépris. C’était inexplicable.
Mais, avant qu’il fût assez revenu de sa surprise pour interroger, le père Tantaine avait maîtrisé son émotion.
– Mon cher enfant, reprit-il, voici ma commission faite. Si je tenais à vous voir, c’est uniquement parce que je craignais quelque défaillance de votre énergie.
– Cependant, monsieur…
– Oh !… réparation d’honneur. Vous êtes fort, bien plus fort que je ne le pouvais supposer.
– Il a fait des progrès, l’enfant ! approuva le docteur.
– Tant de progrès, que le moment est venu de le traiter en homme. Ce soir, mon cher Paul, M. Mascarot aura par Caroline Schimel le mot de l’énigme qu’il poursuit. Demain à deux heures, trouvez-vous à l’agence, vous saurez tout.
Paul voulait répliquer, s’informer, le bon Tantaine ne lui en laissa pas le temps.
Il lui coupa la parole d’un adieu des plus secs, et sortit en entraînant le docteur, de l’air d’un homme qui fuit une explication irritante ou périlleuse.
– Partons, lui disait-il à l’oreille, une minute encore et je battrais ce misérable petit farceur. Ah !… Flavie !… Ta folie d’aujourd’hui te coûtera plus tard des larmes de sang !…
Les deux associés étaient déjà au bas de l’escalier, que le protégé de B. Mascarot demeurait encore debout, au milieu de son petit salon de travail, un bras en avant, la bouche entrouverte, frappé d’immobilité, offrant le plus parfait modèle d’une statue de la confusion.
Toute la fierté qui le gonflait l’instant d’avant s’était évaporée comme le gaz d’un ballon crevé d’un coup d’épingle.
– Dieu sait, pensait-il, ce que doivent dire de moi ce misérable médecin et cet odieux clerc d’huissier. Sans doute ils rient de ma naïveté, ils se moquent de mes prétentions !…
Cette pensée l’exaspérait jusqu’à le faire grincer des dents ; colère bien injuste, en vérité ! Ni le docteur, ni le bon Tantaine n’avaient prononcé le nom de Paul une fois hors de chez lui.
Tout en remontant la rue Montmartre, Tantaine et le docteur ne s’occupaient que de trouver un moyen de paralyser les démarches d’André.
– Mes informations sont beaucoup trop vagues, disait le bonhomme ; j’ai trop peu étudié le terrain pour prendre un parti. Ma tactique pour le moment est de ne pas donner signe de vie, et j’ai donné, dans ce sens, mes instructions à Croisenois. Mais j’ai attaché un de nos agents à chacun de nos adversaires. André, M. de Breulh, la vicomtesse, ne sauraient faire un mouvement sans que je sois prévenu. J’ai une oreille à leur porte, un œil au trou de leur serrure, lorsqu’ils se croient le plus en sûreté. Bientôt je verrai clair dans leur jeu, et alors… Va, reprends ton heureuse insouciance et fie-toi à moi.
Ils étaient arrivés au boulevard ; le vieux clerc d’huissier s’arrêta brusquement et tira sa grosse montre d’argent.
– Déjà quatre heures ! s’écria-t-il. Comme le temps file ! Je te quitte, je n’ai plus une minute à perdre. Ce n’est pas quand on a du lait sur le feu qu’on peut s’endormir. J’ai dix courses indispensables à faire. Ne dois-je pas surveiller mes observateurs et m’assurer qu’ils sont à leur poste.
– Du moins, on te verra ce soir ?
– C’est peu probable. Tel que tu me vois, je me propose d’aller dîner dans quelque restaurant des boulevards extérieurs.
Le docteur ouvrit de grands yeux.
– Oh !… pas pour mon plaisir, je te l’affirme, ajouta le bonhomme. J’ai ce soir rendez-vous au Grand-Turc, avec ce garnement de Toto-Chupin. Je dois y trouver cette Caroline, qui possède, j’en mettrais ma main au feu, le secret des Champdoce. Elle est discrète, rusée, sous le coup très probablement de menaces effroyables, mais elle adore les petits verres, et ce sera bien le diable si je ne découvre pas la liqueur qui lui délie la langue. Sur ce, je suis pressé, à demain !…
XXVI
Oui, il était pressé, le père Tantaine, et la preuve, c’est que lui, l’infatigable marcheur, il prit une voiture à l’heure et promit cent sous de pourboire pour être mené grand train.
C’est au coin de la rue Blanche et de la rue de Douai qu’il se fit conduire tout d’abord. Il ordonna au cocher de l’attendre et gagna d’un pas leste l’heureuse maison où le jeune M. de Gandelu avait installé sa divinité.
Il passa sans rien demander devant le concierge, en homme qui connaît les êtres, il sonna sans se tromper à l’appartement si somptueusement meublé où Rose s’était métamorphosée en vicomtesse Zora de Chantemille.
On fut assez longtemps à venir à son appel.
Enfin, au bout de deux minutes, la porte fut ouverte par une grosse fille au teint enluminé, le bonnet de travers. C’était la cuisinière de Zora-Rose, cette Marie qui avait si religieusement rapporté à B. Mascarot les onze francs qu’elle lui devait.
À la vue du vieux clerc, elle laissa échapper une exclamation de plaisir.
– Eh ! s’écria-t-elle, c’est le père Tantaine qui arrive comme marée en Carême.
– Chut ! fit le bonhomme d’un air inquiet.
– Tiens, pourquoi se gêner ?
– Si votre maîtresse entendait, elle pourrait venir.
La cuisinière éclata de rire.
– Pas de danger !… répondit-elle ; madame est dans un certain endroit d’où on ne revient pas comme cela. Vous savez, les bijoux précieux risquent de s’égarer, on les serre.
Cette périphrase, qui signifiait que la pauvre Rose avait été arrêtée, sembla surprendre beaucoup le vieux clerc.
– Pas possible ! s’écria-t-il.
– C’est comme cela. Mais entrez donc, on vous contera la chose pendant que vous trinquerez avec notre société.
Dans la salle à manger, où pénétra le père Tantaine, six convives, assis devant une table chargée de bouteilles, achevaient un déjeuner commencé vers midi.
L’honorable société était composée de quatre femmes, que le bonhomme reconnut pour des pratiques de l’agence, et de deux messieurs. Sur la seule physionomie de ces messieurs, on ne leur eût pas confié sa bourse.
– Comme vous le voyez, papa, commença le cordon bleu, après que son nouvel invité eut trinqué et bu, on se passe du bon temps. C’est tout de même une drôle d’affaire. Imaginez-vous qu’hier, comme je venais de mettre mon dîner en train, deux messieurs se présentent pour parler à madame. On les fait entrer et tout de suite ils lui déclarent qu’ils viennent la chercher pour la conduire en prison. Là-dessus, la voilà à pousser des cris si perçants, qu’on devait l’entendre de la rue Fontaine. Elle ne voulait pas marcher ; elle s’accrochait aux meubles. Alors eux, très proprement, vous l’ont prise par la tête et par les pieds et l’ont portée à un fiacre qui attendait en bas. Emballée. Cela fait ma quatrième patronne qui a du désagrément… Mais vous ne buvez pas !
Le doux Tantaine tenait le renseignement qu’il était venu quérir ; il s’excusa poliment et se retira, laissant continuer le festin qui semblait ne devoir finir qu’avec la dernière bouteille de la cave.
– De ce côté-ci, murmurait-il en montant en voiture, tout va pour le mieux… Voyons ailleurs.
Ailleurs, ce fut d’abord aux Champs-Élysées…
Il descendit non loin de la bâtisse de M. Gandelu père, et s’approcha d’un petit homme brun qui, armé d’une latte, écartait les passants, qu’eussent pu atteindre les gravats tombant des échafaudages.
– Quoi de neuf, La Candèle, demanda-t-il.
– Rien, monsieur Tantaine ; dites bien au patron que j’ouvre l’œil.
Successivement le bonhomme alla causer quelques instants avec un valet de pied de M. de Breulh et une fille de service de Mme de Bois-d’Ardon.
Puis, congédiant sa voiture, il gagna d’un pied leste l’établissement du père Canon, le marchand de vins de la rue Saint-Honoré, où il trouva Florestan.
Autant le beau domestique est humble avec B. Mascarot, autant il est fier avec le pauvre Tantaine.
Cette fois, pour mieux constater sa supériorité, il le força d’accepter à dîner. Mais il ne put rien lui apprendre, sinon que Mlle Sabine était d’une tristesse morne.
Il allait être huit heures, quand le vieux clerc put enfin se débarrasser de Florestan et sauter dans un fiacre pour se faire conduire au Grand-Turc.
C’est rue des Poissonniers, au 18ème arrondissement, à cent pas du boulevard extérieur, que se balance au vent l’enseigne du Grand-Turc, cet établissement dont les séductions multiples irritaient si fort depuis huit jours les convoitises de Toto-Chupin.
Éloquente plus qu’un pitre de foire, la façade qui crie aux passants : « Entrez ! » promet à l’intérieur un résumé de toutes les joies de ce monde : Bonne table d’hôte à six heures, café, bière, liqueurs, et par-dessus le marché, danse, pour précipiter la digestion.
Un couloir assez long donne aux élus l’accès de ce paradis terrestre.
Les deux portes qu’on trouve au fond conduisent, celle de droite au bal, celle de gauche à la table d’hôte.
Là viennent prendre leur repas du soir quantité d’employés, des artistes à leurs débuts et des rentiers des environs.
Le dimanche, il n’y a jamais assez de place, et encore on tient les enfants au-dessous de sept ans sur les genoux, comme dans les omnibus.
À coup sûr, le baron Brisse demanderait parfois à remanier le menu : mais comme les appétits les plus robustes y trouvent leur satisfaction, tout est pour le mieux.
La table d’hôte, d’ailleurs, est la moindre des attractions.
Les dernières bouchées du dessert sont à peine avalées, que sur un signe du patron, tout à coup il se fait un grand remue-ménage.
En un clin d’œil, la vaisselle et les nappes sont enlevées. Le restaurant devient café, la bière coule à flots. Le bruit des dominos remplace le cliquetis des fourchettes.
Ce n’est rien encore. À ce second signal, on ouvre à deux battants une large porte, et aussitôt on cesse de s’entendre. C’est l’orchestre du bal qui verse dans la salle d’hôte ses torrents d’harmonie.
Libre alors aux dîneurs de profiter des cornets à pistons, le prix d’un repas donne l’entrée gratuite au bal.
Pourtant, malgré cette faveur, les deux clientèles de l’établissement, celle de l’estomac et celle des jambes, ne se mêlent guère.
Cela tient-il à la spécialité du bal ? On ne s’y amuse pas, comme ailleurs, à l’éternel quadrille, on n’y danse presque exclusivement que des « danses tournantes, » des polkas, des mazurques, des valses. Oh !… des valses surtout. Le Grand-Turc est le conservatoire de la valse, c’est connu.
Tout, on le voit vite, a été sacrifié à cette danse jalouse. Le milieu de la salle, qui affecte la forme d’une rotonde, est isolé par une banquette décrivant un cercle parfait.
Le décor du dôme qui représente des colombes planant dans l’azur, manque peut-être de fraîcheur, mais le parquet est merveilleusement soigné et entretenu, glissant à point et uni comme un miroir.
N’est-ce pas à dire que la Germanie parisienne se précipite à ce bal avec une passion qui rappelle celle des enfants de l’Auvergne pour leur musette ?
Au Grand-Turc, il doit parler allemand, le galant cavalier qui se risque à inviter une dame pour la prochaine, ou tout au moins connaître le gracieux idiome des environs de Strasbourg.
Mais aussi quels duos de totons, quels vertiges, quels tourbillonnements ! C’est au Turc qu’il faut voir les cordons bleus de l’Alsace, raides, sans un mouvement de tête, la bouche entrouverte, l’œil mourant, tourner pendant des quarts d’heure avec la grâce de ces petits danseurs de bois des orgues de Barbarie.
Pour la dixième fois déjà dans la soirée, le maître des cérémonies du bal venait de crier de sa voix la plus enrouée : « En place ! en place ! » quand le bon père Tantaine se présenta, après avoir jeté au guichet ses cinq sous d’entrée.
La fête était alors fort animée, et l’atmosphère commençait à se charger de lourdes émanations et de parfums étranges. Tout nouveau venu eût été suffoqué. Mais le vieux clerc d’huissier ressemble en ceci à Alcibiade, que partout où conduisent les nécessités de sa profession, il est à l’aise autant que chez lui.
C’était la première fois qu’il venait au Turc, et cependant c’est de l’air d’un vieil habitué qu’il parcourut les endroits réservés aux buveurs, le rez-de-chaussée, d’abord, puis la galerie du premier étage.
Mais c’est en vain qu’il essuya les verres de ses lunettes, troublés et obscurcis par la buée du bal, il n’aperçut ni Caroline Schimel ni Toto-Chupin.
– Aurais-je fait une course inutile, grommela-t-il, ou suis-je simplement arrivé trop tôt ?
Attendre, c’était impossible. Il redescendit donc, alla s’installer dans la partie la plus éclairée, près du comptoir, et se fit servir une chope de bière.
Pour se distraire, il avait en face de lui le tableau symbole de l’établissement.
C’est une grande peinture où les couleurs terribles n’ont pas été ménagées.
Cela représente un homme affligé d’une gênante obésité, coiffé d’un mouchoir blanc, vêtu d’un maillot bleu, assis dans un fauteuil rouge, près d’une tenture verte, les pieds sur un tapis jaune. D’une main, il tient son ventre ; et, de l’autre, il tend un verre pour qu’on lui serve à boire.
On voit très bien que c’est un Grand Turc, à sa pipe d’abord, qui est énorme, au lion qui est près de lui, et enfin à la sultane qui, de l’air le plus gracieux, emplit sa coupe d’une bière écumeuse.
Cette sultane elle-même, superbe personne blonde, bien portante et richement mise, est née, cela saute aux yeux, en Alsace, ce qui est une délicate flatterie de l’artiste à l’adresse des danseuses de l’établissement.
Le vieux clerc d’huissier admirait, lorsqu’il fut troublé par une voix piaillarde qui discutait loin de lui.
Machinalement, il prêta l’oreille ; il lui semblait reconnaître cette voix.
Mais c’est Chupin, se dit-il, le misérable garnement ! Où donc est-il, que je ne l’ai pas aperçu.
Il se retourna, et à deux tables plus loin, dans un recoin assez obscur, il finit par distinguer celui qu’il cherchait.
Qu’il fût passé près de Toto sans le reconnaître, il n’y avait rien de surprenant à cela : Toto ne se ressemblait plus.
Non, Toto n’avait plus rien du piteux drôle qui grelottait sous une lamentable blouse percée ; il reluisait, il rayonnait, il resplendissait.
Son plan était fait le jour où il avait arraché cent francs au doux Tantaine, et ce plan, il l’avait mis à exécution.
Il s’était juré qu’il serait beau ; il était superbe. Toutes les splendeurs d’un magasin de confections d’occasion y avaient passé. Après s’être outrageusement moqué du jeune M. Gaston de Gandelu, qu’il comparaît à un singe, il avait évidemment cherché à le copier.
Il portait un petit veston court et clair, un gilet surprenant de couleur et de dessin et un pantalon à sous-pieds. Lui, qui jadis méprisait les chemises, il tournait péniblement le cou dans un faux-col terriblement raide qui lui descendait jusqu’au milieu de la poitrine. Comme il était tête nue, on voyait clairement qu’il avait confié sa tête à un coiffeur ; ses cheveux, d’un jaune sale, frisaient.
Il était assis devant une table chargée de plusieurs mooss vides, et, en face, buvant avec lui, se tenaient deux messieurs qui avaient l’air d’être ce qu’ils étaient. Ils avaient la cravate à la Colin, la coquette casquette de toile cirée, et leurs cheveux, ramenés sur le côté, formaient deux accroche-cœurs soigneusement collés et maintenus aux tempes.
À l’importance de Toto-Chupin, à sa mine fière, à son verbe haut, il n’était pas difficile de comprendre qu’il régalait et qu’il jouissait de la supériorité qu’a celui qui paye à boire sur celui qui accepte.
Le bon Tantaine se levait pour aller prendre le garnement par l’oreille, quand une réflexion soudaine l’arrêta.
Cauteleusement, avec une prudente lenteur, sans le moindre mouvement qui pût attirer l’attention de l’aimable trio, il se retourna, enjamba deux bancs et parvint à se rapprocher beaucoup en se dissimulant derrière un des piliers qui soutiennent la galerie supérieure.
Grâce à cette manœuvre, qui lui prit bien cinq minutes, il se trouvait à la portée de tout entendre.
C’était Chupin qui avait la parole :
– Vous avez beau me « blaguer, » disait-il à ses deux amis, et m’appeler petit crevé, je resterai toujours comme je suis ; d’abord c’est mon idée, et ensuite, pour travailler dans le grand, comme je veux, il faut avoir l’air cossu.
Les deux messieurs riaient aux larmes.
– Oh ?… je sais bien, poursuivait Toto, que j’ai une bonne tête avec mes habits, mais cela vient de ce que je n’en ai pas l’habitude. La belle malice ! On s’y fera bien vite. S’il le faut, je me payerai des leçons d’un maître de danse pour ressembler à quelqu’un de très chic.
– Voilà une pose !… fit un des messieurs. Dis donc Chupin, quand tu iras au bois en voiture, tu m’emmèneras ?
– Tiens ! pourquoi pas ! Qu’est-ce qu’il faut pour avoir une voiture ? de l’argent. Quels sont ceux qui gagnent de l’argent ? Ceux qui ont un « truc » Eh bien ! moi j’en ai un qui a crânement réussi à ceux qui me l’ont appris. Pourquoi ne me réussirait-il pas ?
C’est avec une réelle terreur que le père Tantaine venait de s’apercevoir que Toto était ivre. Que savait-il au juste, qu’allait-il dire ?
Le bonhomme se tenait sur ses gardes, prêt à renfoncer d’un bon coup de poing dans la gorge du garnement la première parole compromettante.
Les deux invités de Toto, eux aussi, savaient bien qu’il avait trop bu.
Depuis qu’il semblait disposé à leur livrer le secret de ses intentions, ils étaient devenus fort attentifs et échangeaient des regards d’intelligence.
Pourquoi, en effet, ce précoce gredin n’aurait-il pas, ainsi qu’il le prétendait, un « truc » ingénieux ?
Ses habits neufs, sa suffisance, ses libéralités prouvaient en tout cas qu’il possédait de l’argent. Où l’avait-il pris ? Le lui faire confesser pour puiser aux mêmes sources était indiqué. Il avait le vin si expansif que lui arracher les dernières confidences ne pouvait pas être bien difficile.
D’un coup d’œil, ces messieurs à accroche-cœurs s’entendirent mieux que larrons en foire et se distribuèrent les rôles.
Le plus jeune secoua la tête d’un air incrédule et ironique à la fois.
– Toi, un « truc » jamais de la vie.
L’autre, aussitôt, prit le parti du jeune garnement, ce qui était le sûr moyen de caresser sa vanité et de lui délier la langue.
– Pourquoi donc pas ? dit-il.
– J’en ai un, affirma Toto.
– Dis-le donc, si tu ne veux pas que l’on croie que tu te vantes.
– C’est simple comme bonjour, fit-il enfin, seulement il s’agissait d’inventer la chose. Je vais vous en donner une preuve. Supposons que j’ai vu Polyte, que voilà, « lever » deux paires de bottes à un étalage.
Le susdit Polyte protesta avec une telle énergie, que le bon Tantaine, qui ne perdait pas un mot de la conversation, ne douta pas qu’il n’eût sur la conscience quelque méfait de ce genre.
– Ce n’est pas la peine de « t’enlever, » continua Toto, puisqu’on te dit que c’est une supposition. Mettons que ce soit arrivé et que je le sache. Savez-vous ce que je fais ? Je vais tout droit trouver mon Polyte, et je lui dis dans le tuyau de l’oreille : « Part à deux, ou je vends la mèche. »
– Possible, mais alors, moi, pour ta part, je te casserai la figure.
Oubliant le rôle d’homme distingué, Toto eut le geste narquois des gamins de Paris.
– Tu ne casserais rien, dit-il, parce que tu n’es pas une bête. Tu te dirais : « Si je fais mal à ce garçon, il criera comme un aveugle, cela donnera l’éveil et on m’arrêtera. » Et au lieu de cela tu tâcherais de t’en tirer au meilleur marché possible ; tu marchanderais et nous finirions par nous arranger très bien.
– Et c’est là ce que tu nommes un « truc ? »
– Mais oui. Est-ce qu’il n’est pas bon ? On laisse les imbéciles courir seuls tous les risques, et ensuite on les force à partager les bénéfices.
– Connu, le système ! C’est tout simplement du chantage.
– Précisément, je m’en flatte.
Et, sur cette fière déclaration, Toto empoigna un mooss vide et se mit à frapper sur la table de toutes ses forces, criant qu’il avait soif et qu’on apportât à boire pour lui et ses deux amis.
Les deux messieurs, pendant ce temps, se regardaient d’un air passablement penaud. La comparaison de Toto ne leur apprenait rien de neuf, rien de pratique surtout.
Le chantage est une spéculation d’une simplicité primitive, à la portée de toutes les intelligences ; le difficile est de trouver quelqu’un à faire chanter, et quelqu’un ayant de la voix, c’est-à-dire de l’argent.
L’objection de Polyte trahit immédiatement cette préoccupation.
– Je ne dis pas qu’il n’y a pas de bons coups à faire dans cette partie, remarqua-t-il, mais il doit y avoir du chômage, dans cet état-là. On n’est pas réveillé tous les matins par un filou qui vous dit : « Viens-t-en voir un peu comment je décroche les bottes aux étalages ! »
– Cette idée exclama Chupin en haussant les épaules, c’est dans ce métier-là comme dans les autres : il faut se remuer pour gagner de l’argent. Certainement, si on attend les clients à domicile, ils ne viennent guère ; mais on les cherche, et on les trouve !
– Où ?
– Ah ! voilà !…
Il y eut un silence dont le doux Tantaine eut envie de profiter pour se montrer. Il était certain ainsi de couper court aux confidences. Mais d’un autre côté il jugeait utile de connaître les idées du garnement. Il se rapprocha donc encore, au point qu’il n’était plus séparé du trio que par un pilier.
Toto, lui, oubliant l’harmonie de sa frisure, se grattait la tête avec cette mine si plaisamment grave que prennent les ivrognes quand ils vont à la pèche de leurs idées…
– Bast !… prononça-t-il enfin, pourquoi pas ?
Il se pencha vers ses invités, et mystérieusement, il ajouta :
– On est entre amis, on peut parler ?
– N’aie pas peur.
– Eh bien ! c’est aux Champs-Élysées que je trouve mon affaire, et deux fois par jour plutôt qu’une.
– Pourtant, je ne vois pas d’étalage à dégarnir par là.
Chupin haussa dédaigneusement les épaules.
– Pensez-vous donc, reprit-il, que je m’adresse aux voleurs ? Mauvaise affaire ? Parlez-moi des honnêtes gens, voilà des pratiques qui aiment à chanter ! les honnêtes gens, c’est doux, c’est généreux.
Le père Tantaine frémit. Il se souvenait d’avoir entendu B. Mascarot prononcer une phrase dans ce genre. Il fallait que Toto eût écouté aux portes.
– Allons donc !… exclama Polyte, les honnêtes gens n’ont pas de raisons pour chanter.
Toto faillit briser sa chope, tant il la posa rudement sur la table.
– Me laisserez-vous parler ? fit-il.
– Cause, Toto, répondirent les autres.
– M’y voilà. Donc, quand on a besoin de monnaie, on file aux Champs-Élysées, les mains dans les poches, et on va s’asseoir sur un banc, le long d’une des avenues qui sont entre la grande allée et le quai. Sur son banc, on fait ce qu’on veut ; on peut « en griller une ou deux, » mais en même temps on guigne les fiacres qui marchent doucement. Dès qu’il s’en arrête un, on court voir qui en descend. Si c’est une honnête femme, on a gagné sa journée.
– Et tu sais reconnaître une honnête femme, toi !
– Un peu ! Est-ce que cela ne se voit pas ! Une honnête femme qui descend d’une voiture où elle ne devrait pas être fait une drôle de figure, je vous le promets. Elle est à la portière, qui allonge la tête, qui guette de droite à gauche, qui baisse son voile si elle en a un. Dès qu’elle croit que personne ne la regarde, elle saute à terre, et elle part comme si elle avait le diable à ses trousses…
– Et ensuite ?
– Ensuite !… On prend le numéro de la voiture et on « file » la dame jusque chez elle.
Pour le coup, le bon Tantaine n’en pouvait douter, Toto intéressait prodigieusement ses auditeurs.
– Pour lors, continua-t-il, on pose à la porte pour donner à la dame le temps de monter chez elle. Dès qu’on la suppose arrivée, on se précipite chez le concierge en disant : « Excusez ! je désirerais savoir le nom de la dame qui vient de rentrer ? »
Et tu crois que les portiers disent les noms comme cela ?
– Pas du tout. Aussi a-t-on toujours sur soi une ficelle, qui consiste en un joli portefeuille de treize ou vingt-cinq. Quand le pipelet vous a répondu d’un ton rogue : « Connais pas ! » On sort le calepin de sa poche, et on dit d’un air de n’y pas toucher : « C’est vexant, car elle vient de laisser tomber ceci devant la maison, sur le trottoir, je voulais le lui rendre. »
Ravi de l’effet qu’il produisait, Toto vida, comme le plus vieil Allemand du Grand-Turc, un énorme verre de bière, et poursuivit :
– Là-dessus, le portier devient aimable et poli, il dit le nom, il indique l’appartement, et l’on monte. Pour cette première fois, il s’agit de s’informer si la femme est mariée ou non, ce qui n’est pas malin. Si elle ne l’est pas, on a perdu son temps. Si elle l’est tout va bien !…
– Que dit-on dans ce cas ?
– Rien. Seulement on va aux renseignements ; puis, le lendemain, de bonne heure, on vient se mettre en faction devant la maison pour guetter la première sortie du mari. Dès qu’il s’est éloigné, on ne fait ni une ni deux, on va sonner chez lui, et on demande à parler à son épouse : c’est là qu’il faut de l’aplomb ! « Madame, lui dit-on, j’ai pris hier dans la journée le fiacre numéro tant, – on indique le numéro de son fiacre à elle, – et j’ai eu le malheur d’y oublier mon porte-monnaie, qui contenait cinq cents francs. Comme je vous ai vue monter dans cette voiture immédiatement après moi, je viens vous demander, si, par hasard, vous ne l’auriez pas trouvé. »
Vous pensez bien que voilà une femme pas contente. Elle nie, elle se défend, elle se fâche, elle menace. Mais on ajoute poliment :
« Puisque c’est ainsi, madame, je m’adresserai à votre mari. »
Aussitôt, la peur la prend, et… elle chante.
– Et le tour est fait ?
– Pour ce jour-là, oui, mais non pour toujours. Plus tard, dès que les fonds baissent, on retourne visiter la dame, et on joue le même jeu : « C’est moi, madame, qui suis ce pauvre jeune homme dont l’argent s’est trouvé perdu dans le fiacre n°…, etc.…, etc. »
Et quand on a une douzaine de pratiques pareilles, on vit de ses rentes. Comprenez-vous, maintenant, pourquoi je tiens à être si bien mis ? Autrefois, quand j’avais ma blouse, on m’aurait offert cent sous ; tandis que maintenant, je peux demander carrément mon billet de mille.
La verve railleuse des invités de Toto-Chupin peu à peu s’était éteinte. Ils réfléchissaient.
Il parut au père Tantaine que chacun d’eux, à part soi, tirait les dernières conséquences de ce qu’il venait d’entendre.
Pourtant leur physionomie n’exprimait qu’un ironique dédain.
– Pas neuf le « truc ! » déclara Polyte au bout d’un moment.
– Non, pas neuf du tout ! approuva l’autre.
C’est vrai. Cette abominable spéculation est vieille comme le mariage, comme la trahison, comme la jalousie.
Et il semble qu’elle doive durer et se perpétuer, tant qu’il y aura des maris jaloux de leur honneur et des femmes oublieuses de leurs devoirs.
Hélas ! qui saurait compter, à Paris seulement, combien il est de malheureuses qu’un instant d’égarement, amèrement regretté quelquefois, livre sans défense à tous les caprices de la plus lâche et de la plus affreuse des tyrannies.
Un jour, lorsque heureuses et palpitantes, elles couraient à un rendez-vous d’amour, elles ont été épiées et suivies par un misérable. Et quelques jours après, en même temps que le remords, souvent, ce misérable est venu, bien autrement impitoyable, la prière aux lèvres et la menace dans les yeux, demander le prix de son silence, le prix d’une sorte de monstrueuse complicité.
Et depuis, pour ces esclaves infortunés du « chantage », l’existence n’a été qu’une longue angoisse. Plus de calme, plus de paix, de contentement, de repos d’esprit. À chaque coup de timbre de leur porte d’entrée, elles tressaillent et pâlissent. Qui vient ? Serait-ce encore lui, l’être exécrable et vil, qui veut présenter quelque requête formidable, dans le goût de celle imaginée par Toto :
« Madame ne refusera pas un petit secours à un pauvre jeune homme qui a eu le malheur de perdre son porte-monnaie dans une voiture où madame est montée après lui ! madame se souvient sans doute… »
Parfois, la Gazette des Tribunaux révèle au public quelque turpitude de ce genre, mais qui donc y prend garde ?
Pour bien des gens encore LE CHANTAGE, ce détestable crime qu’on retrouve partout, du premier au dernier degré de l’échelle sociale, n’est qu’un mot, un vain mot. On rit, on ne se croit pas menacé.
Qui n’a connu, cependant, l’histoire de la pauvre Mme de V… ?
Un matin, elle se résout à une démarche horriblement compromettante et périlleuse ; innocente, pourtant.
Elle se détermine à aller visiter, chez lui, dans la chambre qu’il occupe dans une maison meublée près de l’École-Militaire, un jeune chef d’escadron de hussards, qui tout l’hiver a été son courtisan assidu, qui lui a écrit trois ou quatre lettres qui l’ont touchée.
Si elle ose ainsi aller chez lui, c’est qu’il est dangereusement malade, qu’il voudrait la voir une dernière fois avant de mourir.
Elle prend une toilette de circonstance : robe sombre, chapeau à voile très épais. Elle sort, elle monte dans la voiture d’un de ces cochers marrons, qui sortent on ne sait d’où, et se fait conduire avenue de Lowendal.
Elle avait bien les allures effarouchées, l’air effrayé, les mouvements inquiets que Toto-Chupin décrivait à ses amis. Comme autant de preuves infaillibles d’honnêteté.
Même, ces signes étaient si visibles, que le cocher les remarqua. Il se promit qu’il saurait qui était cette femme, se jurant bien qu’il tirerait parti de sa faute, si faute il y avait.
Les moyens d’investigation ne lui manquaient pas.
Après être restée une demi-heure environ près du malade, qui ne la reconnut même pas, Mme de V… descendit tout en larmes, remonta en voiture, et se fit reconduire non devant sa maison, mais à une certaine distance.
Précautions vaines. Le misérable donna sa voiture à garder à un commissionnaire, et s’attacha aux pas de la pauvre femme.
Le soir même, il savait son nom, qu’elle était mariée et avait deux petites filles, que son mari était fort soupçonneux sans avoir raison de l’être, et enfin qu’ils passaient pour être riches. Il sut enfin où elle était allée.
Le lendemain, il se présentait, en l’absence du maître de la maison, et réclamait à Mme de V… 500 francs de pourboire.
Elle eut l’imprudence, la faiblesse de les lui donner.
Quelle misère ! Elle se disait que d’un mot cet homme pouvait la perdre, briser sa vie, ruiner son honneur à elle, et aussi le bonheur et l’honneur de son mari et de ses enfants.
L’homme vit bien quelle terreur il produisit et projeta d’en abuser. Huit jours plus tard il reparut, implorant la petite charité de 1.000 francs, qui lui furent accordés. Cette somme dura peu. Il revint une troisième fois, puis une quatrième, une dixième, une vingtième, toutes les semaines, sans cesse, sans trêve.
Et si Mme de V… hésitait, se plaignait, marchandait, protestait qu’elle était sans ressources, qu’il la ruinait, il répétait avec son cynique sourire :
Il faudra donc que je m’adresse à M. de V…, il sera plus généreux, lui ; que ne donnerait-il pas pour savoir…
Et jamais le vil gredin ne se retira les mains vides.
Il ne conduisait plus de voitures, il s’amusait, vivait bien, buvait outre mesure. Il entretenait une maîtresse, et quand cette fille le tourmentait pour quelque fantaisie coûteuse, il courait chez Mme de V…
Comme à la longue il s’était accoutumé à l’ignominie, qu’il finissait par croire à l’impunité, il ne prenait plus de précautions. Il venait le matin, le soir, à toute heure, sans demander seulement si M. de V… était absent ou non. Plusieurs fois il se présenta complètement ivre, jurant, balbutiant des menaces incohérentes. Et les domestiques entre eux ne pouvaient expliquer qui était cet homme ni comment leur maîtresse ne lui parlait qu’à mains jointes.
Cela en vint au point que Mme de V… se trouva complètement dépouillée. Tout ce dont elle pouvait disposer avait passé aux mains du brigand. Elle en était à envoyer de l’argenterie de la maison au Mont-de-Piété, à n’oser plus s’acheter une robe, à économiser sur les dépenses du ménage, a faire danser – extrémité flétrissante – l’anse du panier conjugal.
C’est dans ces circonstances que le cocher s’avisa d’exiger d’un seul coup une somme considérable, afin, disait-il, de s’épargner des démarches désagréables.
Mme de V… ne pouvant la lui remettre, il s’emporta, il jura, il fit dans le salon une scène révoltante, atroce.
Ne pouvant rien obtenir d’une femme qui n’avait plus rien, il sortit en déclarant qu’il accordait vingt-quatre heures de réflexion, et que c’était trop de bonté de sa part.
Il était à peine sorti, qu’il fallut porter Mme de V… à son lit. Elle était en proie à une violente crise de nerfs, la fièvre la prit, et ses jours furent en danger.
Ce fut un bonheur pour elle. Son délire révéla la vérité à son mari, et quand le misérable se présenta pour réclamer « son dû, » il trouva un officier de paix qui le pria de le suivre au dépôt.
Aujourd’hui, ce cocher doit réfléchir dans quelque maison centrale, sur les dangers qu’il y a de trop « tirer sur la ficelle. »
C’est que la justice ne plaisante pas, lorsqu’il s’agit du « chantage, » une plaie hideuse où il faut porter le fer et le feu. Quant à la police, partout où elle le soupçonne, elle le poursuit, le cerne, le traque et venge les victimes. Cependant les auditeurs de Toto-Chupin, en dépit de leurs mines dédaigneuses, étaient excessivement surpris.
Eux qui avaient pratiqué tant de métiers honteux, ils ignoraient celui-là, dont la simplicité les séduisait. Raison de plus pour le déprécier en apparence, afin de tirer de Chupin des renseignements plus exacts.
– Ces choses-là, commença Polyte, ça se dit, mais ça ne se fait pas.
– Ça se fait, soutint Toto.
– As-tu essayé ?
En tout autre moment, le vaniteux garnement eût répondu bravement : Oui ! Mais en ce moment, les fumées de son ivresse s’épaississaient de plus en plus, et la vérité sortait des mooss de bière.
– Pas précisément, répondit-il, mais j’ai vu manœuvrer le « truc. » Beaucoup plus en grand, c’est vrai, raison de plus pour que je réussisse en petit.
– Tu as vu, tu as vu !…
– Comme je te vois remplir ta chope.
– Tu étais donc de l’affaire ?
– J’en étais, et je mettais la main au pétrin. Ah ! j’en ai suivi de ces voitures !… J’en ai filé, de ces beaux messieurs et de ces belles dames ! Seulement, je ne travaillais pas à mon compte. J’étais comme qui dirait le chien qui attrape le gibier et ne le mange pas. Quel malheur !… Si encore on m’eût jeté un os, de temps en temps ! Mais rien ! du pain sec, des injures avec, des coups au dessert ! Il n’en faut plus. Je vais m’établir.
– Et pour qui travaillais-tu comme cela ?
Chupin se redressa avec une fierté extraordinaire. Loin de songer à dire du mal de B. Mascarot, il ne pensait qu’à exalter ses mérites, comme si de la gloire de ses maîtres il eût rejailli quelque chose sur lui.
– Pour des gens, répondit-il, qui n’ont pas leurs pareils à Paris. Ah !… ils ne s’amusent pas à la bagatelle de la porte, ceux-là !… Aussi sont-ils riches à faire trembler. Tout ce qu’ils veulent, ils le peuvent, et si je vous contais…
Il s’arrêta court, la bouche béante, la pupille dilatée par la surprise et par la peur…
Il venait de voir se dresser devant lui le bon père Tantaine.
En apparence, l’épouvante de Chupin ne s’expliquait pas.
Jamais la physionomie du vieux clerc d’huissier n’était arrivée à une si parfaite expression de bénignité niaise.
C’est d’une voix toute paternelle qu’il s’écria :
– Enfin, voici Toto, ce mauvais sujet que je cherche depuis plus d’une demi-heure. Sac à papier !… est-il assez beau ! On dirait un fils de prince.
Mais le garnement demeura insensible à ce compliment, qui eût dû l’enchanter. Cette indulgence inaccoutumée le déconcertait.
Il est vrai que la seule vue du bonhomme avait suffi pour dissiper, comme par magie, les brouillards de bière et de vin qui obscurcissaient sa cervelle.
À mesure qu’il reprenait son sang-froid, il se rappelait vaguement tout ce qu’il venait de raconter. Il était navré de sa sottise et accablé du pressentiment d’un malheur indéterminé et pourtant certain.
C’est que la naïveté ne comptait pas au nombre des défauts de cet enfant de Paris. Sans cesse aiguisée aux meules de la nécessité, son intelligence était bien au-dessus de son âge.
Sa foi aux apparences doucereuses du père Tantaine était fort chancelante.
Il se sentait en face d’un problème, comprenant que de sa profonde résolution dépendait en quelque sorte son existence. Avait-il ou non été entendu ? Tout était là, pour lui.
– Si ce vieux coquin m’a écouté, pensait-il, je suis perdu.
Et il l’examinait avec toute l’attention dont il était capable, comme s’il eût espéré déchiffrer cette vivante énigme.
Il était trop adroit cependant pour ne pas dissimuler ses inquiétudes. Le moindre silence d’angoisse devait le trahir.
C’est donc avec une gaîté trop bruyante pour n’être pas forcée, qu’il répondit :
– Je vous attendais, bourgeois, et c’est pour vous faire honneur que je me suis mis sur mon trente et un.
– À la bonne heure. C’est gentil, cela.
– Mais oui. Aussi j’espère bien que vous me permettrez de vous offrir quelque chose : un bock, un petit verre, un rien, histoire de trinquer…
Toto s’enhardissait jusqu’à proposer une « politesse » à son bourgeois, cela était prodigieux. Mais il eût osé bien d’autres énormités pour se grandir dans l’opinion de ses deux amis qu’il croyait avoir écrasé de sa supériorité.
Il s’attendait à voir son invitation rejetée bien loin ; il se trompait. C’est fort honnêtement que le vieux clerc s’excusa, et comme d’une offre toute naturelle.
– Je sors de table, répondit-il.
– Raison de plus pour avoir soif, insista Chupin.
Il montra d’un geste fier les mooss vides restés sur la table, et ajouta :
– Voici ce que nous avons bu, mes amis et moi, depuis le dîner.
C’était une présentation. Le père Tantaine souleva légèrement son chapeau gras, et les messieurs à accroche-cœurs s’inclinèrent profondément.
Ces messieurs ne laissaient pas que d’être effarouchés par la présence de ce vieux.
En outre, estimant que le quart d’heure de Rabelais ne pouvait tarder à sonner, ils jugèrent prudent de s’esquiver, pour le cas où Toto se fût avisé de revenir sur sa générosité. Au Grand-Turc, comme ailleurs, c’est parfois l’invité qui est obligé de s’exécuter et de payer la carte.
L’instant leur était propice. Une valse venait de finir, et le maître des cérémonies hurlait son éternel : « En place ! en place ! »
Les messieurs serrèrent la main de Toto, saluèrent le bonhomme et se perdirent dans la foule.
– Bons garçons ! exclama Toto, qui ne rougit pas de ses amitiés.
Le vieux clerc modula du bout des lèvres un petit sifflement fort méprisant.
– Tu fréquentes des sociétés déplorables, Toto, fit-il, qui te gâteront…
– Oh !… c’est fait, bourgeois.
– Je le crains pour toi. Enfin, cela te regarde ; tu sais ce que je t’ai répété maintes fois, tu finiras mal.
Cette prédiction à laquelle il est si bien accoutumé rendit à Toto presque toute sa tranquillité d’esprit.
– Si le vieux coquin se doutait de quelque chose, se dit-il, certainement il ne me menacerait pas.
Infortuné Chupin, c’est au moment même où son impudence rassurée reprenait le dessus, que le péril était le plus imminent.
Définitivement, pensait le père Tantaine, ce garnement a trop d’esprit, il ne vivra pas. Ah !… si je devais continuer les affaires, je me l’attacherais ; il me rendrait de grands services. Mais, au moment de fermer boutique, laisser après soi un gredin si bien instruit serait une impardonnable imprudence de la part de gens qui sont payés pour savoir ce que peut coûter un secret envolé.
Cependant, Toto avait appelé le garçon. Il jeta sur la table une pièce de dix francs en criant d’un air superbe : « Payez-vous ! »
Mais le vieux clerc s’opposa à cette dépense, et c’est de sa poche que sortirent les dix francs qui étaient dus.
Cette générosité ne pouvait manquer de mettre le garnement en belle humeur.
– Autant d’économisé ! fit-il. Allons maintenant trouver Caroline Schimel.
– Es-tu sûr qu’elle soit ici ? Je n’ai pu la découvrir.
– C’est que vous n’avez pas su chercher. Elle fait son piquet dans la salle du café. Arrivez, bourgeois.
Le père Tantaine ne s’empressa pas de suivre le jeune drôle.
– Un instant, fit-il, convenons de nos faits. Tu as bien répété à cette fille tout ce que je t’avais dit ?
– Mot pour mot, bourgeois.
– Répète, car il s’agit de ne pas se couper.
Chupin qui était déjà debout se rassit.
– Donc, commença-t-il, voilà cinq jours qu’il n’y a plus que Toto pour votre Caroline. J’ai trouvé le joint. Nous jouons au piquet des cinq heures d’horloge, et tout à coup je lui donne quatorze d’as. Pour lors, tout en battant le carton, je lui ai glissé la chose en douceur, je lui ai confié que j’ai un brave homme d’oncle, dans les prix de cinquante ans, encore bien propre, garanti bon teint, allant au feu et à l’eau, un peu bête si on veut, mais bien aimable, veuf, sans enfants, et grillant de se remarier avec une personne… très bien, qu’elle connaissait, vu que l’ayant aperçue il en était tombé amoureux…
– Pas mal, Toto, pas mal !… Et qu’a-t-elle répondu ?
– Dame ! elle a souri, cette fille, ça la flattait. Seulement, comme elle est plus défiante que notre chat, j’ai bien vu qu’elle craignait qu’on n’en voulût qu’à sa monnaie. Alors, moi, bien vite, sans avoir l’air d’y toucher, je me suis mis à chanter que mon oncle est un vrai oncle, un solide fait sur mesure, ayant le sac, propriétaire et gagnant au moins quatre mille francs par an.
– Et tu m’as nommé ?
– Oui, à la fin. Sachant qu’elle vous connaît, ce n’est pas pour vous flatter, je me disais : Ce sera dur. Au contraire, dès que j’ai eu prononcé votre nom, ses yeux ont flambé : « Ché lé gônnais, a-t-elle dit dans son langage, ché lé gônnais peaugoub ! » C’est chez le patron qu’elle vous a remarqué ; vous lui allez… À quand la noce, bourgeois ? J’en suis. Elle vous attend ce soir…
Le vieux clerc assura ses lunettes d’un geste décidé, se leva et dit :
– Marchons.
Le jeune garnement ne s’était pas trompé. L’ancienne fille de service du duc de Champdoce était attablée à son éternelle partie.
Mais dès qu’elle aperçut le soi-disant oncle de Toto, et bien qu’elle eût une quinte au roi et un quatorze de dix, elle jeta ses cartes pour faire à cet amoureux le plus gracieux et le plus encourageant accueil.
Il s’en montra digne. Toto-Chupin négociateur de mariages par occasion n’avait jamais vu son « bourgeois » si empressé, si aimable, si causeur.
Il avait, ce bon Tantaine, des grâces de roquentin passionné qui parurent faire une vive impression sur le cœur de Caroline Schimel.
Jamais, non jamais, elle n’avait entendu chanter à son oreille des phrases si tendres d’une voix si harmonieuse. C’était à en perdre la tête.
Oui, on l’eût perdue à moins, car le vieux clerc faisait noblement les choses, il avait demandé un bol de punch au kirsch, et doux propos et verres de dur se succédaient et alternaient.
Tantaine n’avait plus que vingt ans ; il but, il chanta, il dansa. Oui, sur un mot de Caroline, il la saisit par la taille et l’entraîna dans la salle de bal, et Toto, stupide d’étonnement, les vit se lancer dans le tourbillon des valseurs.
Mais aussi, quelle récompense ! À dix heures, le mariage était arrêté, et Caroline, subjuguée, sortait au bras de son futur époux. Elle venait de lui permettre de lui offrir au restaurant le souper des fiançailles.
Le lendemain, au petit jour, des balayeurs descendant des hauteurs de Montmartre, trouvaient sur le boulevard, étendue à terre, inanimée, une femme.
Ils eurent la charité de la porter au poste. Elle n’était pas morte, comme on le crut d’abord, mais seulement étourdie.
Revenue à elle, cette malheureuse déclara qu’elle se nommait Caroline Schimel, qu’elle était rentrée dans un restaurant pour souper avec son fiancé, et que de ce moment elle ne se rappelait plus rien.
Sur sa demande, on la reconduisit à son domicile, rue Marcadet.
XXVII
« Il n’est, pour voir, que l’œil du maître, » a dit La Fontaine, et une fois de plus on pouvait vérifier l’exactitude du proverbe, au bureau de placement de la rue Montorgueil.
Depuis huit jours à peine, B. Mascarot avait cessé de prendre place, tous les matins, au confessionnal, et déjà l’agence et l’hôtel des domestiques sans place, son annexe, souffraient. La clientèle se plaignait ; on trouvait Beaumarchef charmant, mais insuffisant.
L’ancien sous-off, qu’effrayait sa responsabilité, avait risqué de timides observations, mais il avait été rembarré si durement qu’il ne soufflait plus mot, et se contentait de gémir tout bas.
Mais qu’importait à B. Mascarot son agence ! Se soucie-t-on du moyen, quand on touche le but ?
Ainsi, le lendemain de l’expédition du bon Tantaine au Grand-Turc, pendant que Beaumar répondait à tous ses clients : « Monsieur est sorti, » monsieur était enfermé dans son cabinet.
Ce jour-là, sa physionomie portait les traces de fatigues écrasantes. À plusieurs reprises, il souleva ses lunettes pour essuyer ses yeux ; ses paupières étaient rouges et enflammées. Sur sa cheminée était posée une tasse de tisane, et de temps en temps il y trempait ses lèvres comme pour éteindre un feu intérieur.
Lui, toujours froid et calme d’ordinaire, si maître des mouvements de sa passion, il était en proie à une agitation terrible.
Les grands capitaines, la veille d’une bataille décisive, peuvent paraître impassibles à leurs familiers, mais ils n’échappent pas pour cela à l’accès de fièvre qui précède l’action.
Or, pour B. Mascarot, l’heure de la lutte suprême sonnait. Il allait faire ce pas après lequel on ne peut plus reculer.
Il attendait Catenac, Hortebize et Paul pour leur révéler son plan tout entier. Le premier au rendez-vous fut le docteur Hortebize.
– J’ai reçu tes instructions, Baptistin, dit-il dès le seuil, et je t’ai obéi. J’arrive en droiture de l’hôtel de Mussidan.
– Quelle figure y fait-on ?
– Triste, mais résignée. Mlle Sabine n’a jamais été d’une gaîté folle ; elle est plus pâle et plus grave qu’avant sa maladie, voilà tout.
– As-tu pu te trouver seul avec la comtesse ?
– Parfaitement. Je lui ai dit que j’étais harcelé par les gens qui détiennent sa correspondance, qu’elle devait prendre garde. À quoi elle a répondu, avec un soupir à fendre l’âme, que Croisenois épouserait, puisqu’il le fallait ; qu’elle était au désespoir, mais qu’elle était assurée du consentement de son mari et de la docilité de sa fille.
Autant le doux Tantaine était démonstratif, autant l’honorable placeur l’était peu. Bien qu’il dût être ravi de ces nouvelles, c’est presque froidement qu’il répondit :
– Ce que j’ai décidé sera. J’ai vu Croisenois ce matin, et s’il m’obéit, et il ne peut faire autrement, nous gagnerons en vitesse André et M. de Breulh. Le marquis sera le mari de Sabine qu’ils en seront encore à guetter la publication des bancs. La noce faite, je me moque d’eux. Quant à notre grande rafle finale, j’ai mûri l’idée de la Société dont Croisenois sera le directeur, et dans huit jours les prospectus seront lancés. Mais aujourd’hui, il ne s’agit que de l’affaire de Champdoce…
Il fut interrompu par l’entrée de Paul, qui arrivait fort timidement, appréhendant fort une fâcheuse réception, après le singulier adieu du père Tantaine…
Contre toute attente, l’accueil fut aussi amical que possible, soit que le vieux clerc d’huissier n’eût rien dit, soit que l’honorable placeur eût une autre manière de voir.
– Tous mes compliments, fit-il, de vos succès chez M. Martin-Rigal. Outre que vous plaisez à la fille, vous avez séduit le père…
– Je l’ai bien peu vu, cependant ; hier soir encore il était absent…
Nous le savons. Il dînait chez un de nos amis, qui a sondé ses intentions à votre endroit. Si demain Hortebize va lui demander, pour vous, la main de Mlle Flavie, il ne dira pas : non.
Paul chancela. Le million de dot de Mlle Rigal venait de passer devant ses yeux plus éblouissant que l’éclair…
– Attention !… interrompit Hortebize, j’entends dans le corridor le pas trottinant de Catenac.
Le digne docteur ne s’était pas trompé ; c’était bien l’avocat qui arrivait en retard, selon sa coutume, voilant sa contrariété sous le plus amical sourire.
Rien qu’à sa vue, B. Mascarot parut hors de soi, et s’avança d’un air si menaçant que prudemment Catenac fit un saut en arrière.
– Qu’est-ce que cela signifie ? balbutia-t-il.
– Ne le devines-tu pas ? répondit le placeur d’une voix terrible. J’ai mesuré la profondeur de ton infamie. Je t’avais ramené à nous l’autre jour, mais à peine seul, tu n’as plus songé qu’à nous vendre. Je croyais à ton concours sincère, et tu me tendais le piège où je devais tomber à l’heure du triomphe.
– Je te jure, Baptistin…
– Oh ! pas de serment. Un mot de Perpignan m’a éclairé. Ignores-tu que le duc de Champdoce peut reconnaître sûrement l’enfant qu’il cherche, à des cicatrices ineffaçables ?
– J’avais oublié…
Il s’arrêta court, déconcerté, malgré son aplomb, par le regard du placeur.
– Tiens, poursuivit Mascarot, veux-tu que je te dise, tu n’est qu’un lâche et un traître ! Les forçats, entre eux, ne se manquent pas de parole. Je te savais vil, mais pas à ce point…
– Pourquoi m’employer malgré moi, alors ?
Cette velléité de révolte transporta B. Mascarot d’une telle fureur, que saisissant Catenac au collet, il le secoua comme s’il eût voulu l’étrangler.
– Je me sers de toi, bête venimeuse, continua-t-il, parce que je t’ai mis hors d’état de nuire. Et tu me serviras quand il te sera prouvé que ta réputation volée, ton argent, ta liberté, et peut-être ta vie, dépendent de notre succès. Ah ! je sais où est le cadavre, heureusement ! Les preuves irrécusables de ton crime, entends-moi bien, sont entre les mains d’une personne sûre. Que j’échoue, pour quelque cause que ce puisse être, et ces preuves seront adressées au procureur impérial.
Il y eut un silence qui parut formidable à Paul.
– Et prie Dieu, ajouta le placeur d’un ton glacé, de nous préserver de tout accident, Hortebize, Paul et moi. Si l’un de nous venait à mourir un peu rapidement, ta condamnation serait jetée à la poste le jour même. C’est dit, un bon averti en vaut deux… Je compte sur ton intelligence.
Catenac demeurait la tête basse, immobile, foudroyé.
Sa physionomie, contractée par la rage, n’annonçait certes rien de bon, mais qui s’en inquiétait ? On le lui avait dit, et il ne le sentait que trop, il était lié, enchaîné, hors d’état d’essayer même un mouvement.
Plus de tergiversations possibles ; nul espoir de vengeance.
Sa position, qu’il devait au chantage, le chantage la menaçait.
B. Mascarot, lui, avala un verre de tisane, et tranquillement, comme s’il ne se fût rien passé que d’ordinaire, il revint s’asseoir dans son fauteuil, au coin du feu, rajustant ses lunettes dérangées par la véhémence de ses mouvements.
– Je dois te dire aussi, maître Catenac, qu’à ce détail près, que tu me cachais, je connais un peu mieux que toi l’affaire de Champdoce. Qu’en sais-tu, toi ? Juste ce qu’il a plus au duc de vous confier, à toi et à Perpignan. T’imaginerais-tu qu’il vous a dit la vérité ? Par bonheur, je suis un peu mieux informé. Cela ne te surprendra pas, quand je t’avouerai qu’il y a des années que je suis cette affaire…
– Oui, il y a longtemps, affirma le digne docteur.
– Du reste, il faut que vous sachiez comment j’ai été mis sur la trace de cette opération. Il vous souvient peut-être de cet écrivain public qui avait son échoppe près du Palais de Justice, et qui s’avisait de faire chanter le monde. Une spéculation maladroite le conduisit en police correctionnelle et il attrapa deux ans de prison.
– En effet je me rappelle…
– C’était un gaillard intelligent. Il achetait au poids des papiers manuscrits de toutes sortes, et ces montagnes de paperasses, il les triait, les dépouillait, les épluchait et les lisait.
Dire quelles trouvailles on peut faire dans des correspondances abandonnées au chiffonnier est impossible.
Songez qu’il n’est pas un homme qui, une fois dans sa vie au moins, n’ait regretté d’avoir su écrire à un moment donné. Avez-vous une cause célèbre sans quelque lettre accablante déterrée par la police ?
Ces faits m’ont si souvent frappé, que je me demande comment les gens prudents n’écrivent pas avec ces encres particulières qui, au bout de trois, quatre, huit jours, s’effacent et s’évaporent sans laisser trace sur le papier.
Bref, je fis comme l’écrivain public. J’achetai des vieux papiers, et entre autre choses curieuses, je découvris ceci…
Il prit sur son bureau un fragment de papier chiffonné, sali, maculé, et le tendit à Hortebize et à Paul en leur disant :
– Regardez.
En haut de ce fragment, une main tremblante avait écrit :
Tnafneertoniomzedneréitipzeyaetneconnisiusejecarg.
Et au-dessous de ces deux lignes de lettres se trouvait ce seul mot, d’une grosse écriture :
Jamais !
Il était évident que j’avais sous les yeux un cryptogramme, c’est-à-dire une lettre composée selon des conventions particulières, conventions destinées à mettre à l’abri d’une indiscrétion certaines communications compromettantes.
Ceci démontré par la nature même des choses, je me dis qu’on emploie guère des précautions si gênantes pour les relations ordinaires de la vie. Je conclu donc que ce chiffon recelait quelque aveu dangereux…
C’était avec un parti bien pris de dénigrement que Catenac écoutait.
Il était de ces entêtés et inintelligents lutteurs qui jamais ne consentent à reconnaître que leurs épaules ont touché le sable de l’arène, et qui vaincus et à terre, s’obstinent encore à nier leur défaite.
La conclusion était indiquée, fit-il d’un ton railleur.
Elle était élémentaire, c’est vrai, mais encore fallait-il la trouver. Ces choses sont celles dont on ne s’avise jamais, tant ce qui est naturel répugne à la vanité humaine. Témoin l’œuf cassé de Colomb. Pour moi, je me croyais d’autant plus intéressé à pénétrer le sens de l’énigme qui m’était offerte, que je suis le chef d’une association dont les membres doivent à l’habile exploitation des secret d’autrui, non seulement l’argent qu’ils prêtent à la petite semaine, mais encore la fausse considération dont ils se drapent.
Hortebize lança à Catenac un regard moqueur.
– Empoche, murmura-t-il, on te tient quitte du reçu.
D’un geste, l’honorable placeur remercia son ami.
– C’était un matin, poursuivit-il, je fermai ma porte, et je me jurai que je ne sortirais de mon cabinet qu’après avoir traduit cet hiéroglyphe.
L’un après l’autre, Paul, le docteur Hortebize et même Catenac, examinèrent avec la plus scrupuleuse attention la lettre que leur tendait B. Mascarot.
Ces caractères assemblés comme au hasard ne présentaient aucun sens à leur esprit.
– Ma foi ! fit le docteur impatienté, je donne ma langue aux chiens. De ma vie je n’ai su deviner un logogriphe.
L’honorable placeur souriait. Il ne péchait pas précisément par le manque d’amour-propre, et il avait ses raisons pour prolonger, tout en en jouissant, l’étonnement de ses auditeurs.
– Vous ne devinez pas ? demanda-t-il en retirant des mains de Paul le fragment de lettre.
– Oh ! pas du tout, répondit l’avocat d’un ton rogue.
– Eh bien ! je le confesse, reprit B. Mascarot, à première vue, je n’ai pas plus compris que vous en ce moment. Pourtant je ne jetai pas au panier ce chiffon qui m’arrivait après avoir traîné partout, ainsi que le prouvaient les taches et les maculatures dont il était couvert. À la couleur jaunâtre du papier, à la pâleur de l’encre, il était aisé de voir que ce document était ancien déjà. Puis, au fond de moi-même, une voix secrète parlait, qui m’assurait que je tenais là, entre mes doigts, l’instrument de notre fortune à tous.
– Tous les prédestinés ont comme cela leur voix, murmura l’avocat.
B. Mascarot ne jugea pas à propos de relever cette raillerie.
– Dans les replis de l’esprit de tout homme, poursuivit-il, se cachent un besoin irraisonné de savoir, un inexplicable instinct de curiosité. C’est à cela que doivent leur succès les rébus et les charades, futiles aliments jetés à la curiosité désœuvrée.
Et notez que je n’avais pas, pour m’exciter, l’enthousiasme d’une puérile confiance. Je pouvais arriver à une niaiserie aussi bien qu’à une découverte immense. Les chances étaient égales, et je ne m’abusais pas.
Tout d’abord, en étudiant attentivement cet énigmatique fragment, j’y reconnus deux écritures parfaitement distinctes. Si c’est une femme qui a composé le rébus, c’est certainement un homme qui, au-dessous, a ajouté ce mot : Jamais.
Ce « jamais », cela tombe sous le sens, est une conséquence forcée des incompréhensibles lignes qui précèdent.
Donc, le tout est comme un dialogue entre ces deux personnes. La femme demande une grâce, l’homme la refuse.
Maintenant, pourquoi cet emploi de deux langues, pour ainsi dire ? Pourquoi cette phrase mystérieuse, pourquoi ce mot écrit selon les règles de l’alphabet usuel ?
De courtes réflexions me donnèrent les raisons de cette apparente anomalie.
La demande de la femme, dangereuse de sa nature, pouvait révéler des faits qu’on avait un intérêt puissant à dissimuler, tandis que cette laconique réponse « Jamais » ne compromettait rien.
Mais comment se fait-il, me demanderez-vous, que prière et refus se trouvent sur la même feuille de papier, sur la même page. Cette question que je me posai, aussi, moi, fut vite résolue.
La lettre dont nous tenons les fragments, n’était pas destinée à la poste et n’y a jamais été mise. Elle a été échangée entre deux maisons voisines, entre deux étages de la même maison, et, qui sait ? peut-être entre deux pièces du même appartement.
Sous l’empire d’émotions terribles, de circonstances urgentes, une femme a écrit ces deux lignes et les a fait porter par un domestique à l’homme dont elle implorait la pitié. Lui, transporté de colère en ce moment, a saisi une plume, a écrit ce refus impitoyable et a rendu le papier au domestique en lui disant : « Retournez ceci à votre maîtresse ! » Ces préliminaires posés, restait à déchiffrer le cryptogramme. Fort neuf à cette besogne, j’éprouvai, je ne vous le cacherai pas, d’horribles difficultés. C’est que par suite de cette rage si commune de supposer à autrui une finesse supérieure, je cherchais midi à quatorze heures.
C’est le hasard qui me livra la clé que je cherchais vainement.
Ayant machinalement élevé au jour ce fragment, le verso tourné de mon côté, je lus couramment ce qui était écrit sur le recto.
J’étais en face d’un échantillon de cryptographie véritablement enfantine. Lettres et mots, au lieu d’aller de gauche à droite, allaient de droite à gauche, et pour obtenir le sens, il ne s’agissait que de les replacer dans leur ordre.
Vite je pris un crayon, et sur mon sous-main, je reproduisis toutes les lettres en commençant par la fin, g, r, a, c, e, j, e, s, etc.… Je divisai les mots confondus avec intention, et j’obtins cette phrase significative :
« Grâce, je suis innocente, ayez pitié, rendez-moi notre enfant !… »
Le digne M. Hortebize s’était déjà emparé du chiffon resté sur le bureau, et il répétait la manœuvre indiquée.
– C’est pourtant vrai, s’écria-t-il, c’est l’enfance de l’art.
L’honorable placeur poursuivait :
– J’avais donc lu, mais c’était la moindre des choses. Ce fragment de lettre avait été trouvé parmi cinq ou six cents livres de paperasses achetées lors de la vente d’un château des environs de Vendôme ; comment remonter jusqu’à ses auteurs ?
Je désespérais d’y parvenir, lorsque, dans l’angle de ce chiffon, tenez, là, j’aperçus ces traces d’une devise. Illisible pour moi, elle ne le fut pas pour un de mes amis, ancien élève de l’École des chartes. Cette devise est celle de la fière et noble maison de Champdoce…
Il se leva, comme pour laisser tomber ses paroles de plus haut, s’adossa à la cheminée et continua :
– Tel fut, messieurs, mon point de départ. L’idée était faible. Chétive était la lueur qui devait me guider. Un autre eût été dédommagé ; moi, non. Je suis patient et je sais me réveiller chaque matin avec l’idée de la veille.
Six mois plus tard, je savais que cette phrase suppliante avait été adressée par la duchesse de Champdoce à son mari, comment et en quelles circonstances.
Puis, le temps aidant, j’ai pénétré le mystère que cette lettre m’avait fait soupçonner.
Si je n’ai pas agi plus tôt, c’est qu’un point, un seul, restait encore obscur pour moi. Depuis hier il ne l’est plus…
– Ah !… fit le docteur, Caroline Schimel a parlé.
– Oui, l’ivresse lui a arraché le secret qu’elle gardait depuis vingt-trois ans.
Sur ces mots, l’honorable placeur ouvrit un des tiroirs de son bureau et en tira un volumineux manuscrit qu’il brandit d’un air de triomphe.
– Voici mon chef-d’œuvre, s’écria-t-il, l’explication de mes manœuvres depuis quinze jours. Après ce récit vous comprendrez comment, sous le même filet, je tiens le duc et la duchesse de Champdoce et Diane de Sauvebourg, comtesse de Mussidan. Écoute, docteur, toi qui a eu en moi une aveugle confiance ; écoute aussi, Catenac, toi qui a voulu me trahir ; vous me direz ensuite si je m’abuse lorsque j’affirme que je suis sûr du succès.
Il tendit le cahier à Paul et ajouta :
– Et vous, mon cher enfant, lisez. C’est pour vous surtout que j’ai écrit ceci. Lisez avec toute l’attention dont vous êtes capable, c’est l’histoire d’une grande maison. Et pénétrez-vous bien de ceci qu’il n’est pas un détail, si futile qu’il puisse vous paraître, qui n’ai pour votre avenir une énorme importance…
Paul avait ouvert le cahier, et c’est d’une voix tremblante d’abord, mais qui alla en s’affermissant, qu’il lut la douloureuse histoire rédigée par Mascarot :
LE SECRET DE LA MAISON DE CHAMPDOCE.
FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE
À propos de cette édition électronique
Texte libre de droits.
Corrections, édition, conversion informatique et publication par le groupe :
Ebooks libres et gratuits
http://fr.groups.yahoo.com/group/ebooksgratuits
Adresse du site web du groupe :
http://www.ebooksgratuits.com/
—
Avril 2010
—
– Élaboration de ce livre électronique :
Les membres de Ebooks libres et gratuits qui ont participé à l’élaboration de ce livre, sont : Richard, Jean-Marc, Coolmicro et Fred.
– Dispositions :
Les livres que nous mettons à votre disposition, sont des textes libres de droits, que vous pouvez utiliser librement, à une fin non commerciale et non professionnelle. Tout lien vers notre site est bienvenu…
– Qualité :
Les textes sont livrés tels quels sans garantie de leur intégrité parfaite par rapport à l'original. Nous rappelons que c'est un travail d'amateurs non rétribués et que nous essayons de promouvoir la culture littéraire avec de maigres moyens.
Votre aide est la bienvenue !
VOUS POUVEZ NOUS AIDER À FAIRE CONNAÎTRE CES CLASSIQUES LITTÉRAIRES.