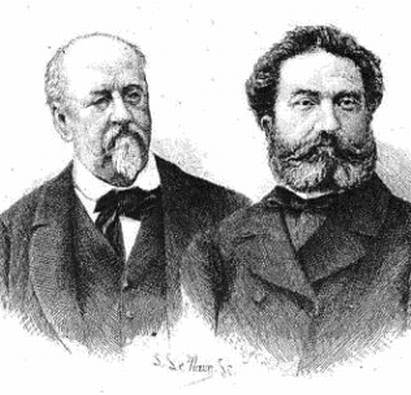
Erckmann-Chatrian
WATERLOO
(1865)

Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » – http://www.ebooksgratuits.com/
Table des matières
À propos de cette édition électronique
I
Je n’ai jamais rien vu d’aussi joyeux que le retour de Louis XVIII, en 1814. C’était au printemps, quand les haies, les jardins et les vergers refleurissent. On avait eu tant de misères depuis des années, on avait craint tant de fois d’être pris par la conscription et de ne plus revenir, on était si las de toutes ces batailles, de toute cette gloire, de tous ces canons enlevés, de tous ces Te Deum, qu’on ne pensait plus qu’à vivre en paix, à jouir du repos, à tâcher d’acquérir un peu d’aisance et d’élever honnêtement sa famille par le travail et la bonne conduite.
Oui, tout le monde était content, excepté les vieux soldats et les maîtres d’armes. Je me rappelle que, le 3 mai, quand l’ordre arriva de monter le drapeau blanc sur l’église, toute la ville en tremblait, à cause des soldats de la garnison, et qu’il fallut donner six louis à Nicolas Passauf, le couvreur, pour accomplir cette action courageuse. On le voyait de toutes les rues avec son drapeau de soie blanche, la fleur de lis au bout, et de toutes les fenêtres des deux casernes les canonniers de marine tiraient sur lui. Passauf planta le drapeau tout de même, et descendit ensuite se cacher dans la grange des Trois-Maisons, pendant que les marins le cherchaient en ville pour le massacrer.
C’est ainsi que ces gens se conduisaient. Mais les ouvriers, les paysans et les bourgeois en masse criaient : « Vive la paix ! À bas la conscription et les droits réunis ! » parce que tout le monde était las de vivre comme l’oiseau sur la branche, et de se faire casser les os pour des choses qui ne nous regardaient pas.
On pense bien qu’au milieu de cette grande joie, le plus heureux c’était moi ; les autres n’avaient pas eu le bonheur de réchapper des terribles batailles de Weissenfelz, de Lutzen, de Leipzig, et du typhus ; moi, je connaissais la gloire, et cela me donnait encore plus l’amour de la paix et l’horreur de la conscription.
J’étais revenu chez le père Goulden, et toute ma vie je me rappellerai la manière dont il m’avait reçu, toute ma vie je l’entendrai crier en me tendant les bras : « C’est toi, Joseph !… Ah ! mon cher enfant, je te croyais perdu ! » Nous pleurions en nous embrassant. Et depuis nous vivions ensemble comme deux véritables amis ; il me faisait raconter mille et mille fois nos batailles, et m’appelait en riant : le vieux soldat.
Ensuite, c’est lui qui me racontait le blocus de Phalsbourg ; comment les ennemis étaient arrivés devant la ville en janvier, comment les anciens de la République, restés seuls avec quelques centaines de canonniers de marine, s’étaient dépêchés de monter nos canons sur les remparts ; comment il avait fallu manger du cheval à cause de la disette, et casser les fourneaux des bourgeois pour faire de la mitraille. Le père Goulden, malgré ses soixante ans, avait été pointeur sur le bastion de la poudrière, du côté de Bichelberg, et je me le figurais toujours avec son bonnet de soie noire et ses besicles, en train de pointer une grande pièce de vingt-quatre ; cela nous faisait rire tous les deux et nous aidait à passer le temps.
Nous avions repris toutes nos vieilles habitudes ; c’est moi qui dressais la table et qui faisais le pot-au-feu. J’étais aussi rentré dans ma petite chambre, et je rêvais à Catherine jour et nuit. Seulement, au lieu d’avoir peur de la conscription, comme en 1813, alors c’était autre chose. Les hommes ne sont jamais tout à fait heureux ; il faut toujours des misères qui les tracassent ; combien de fois n’ai-je pas vu cela dans ma vie ! Enfin, voici ce qui me donnait du chagrin :
Vous saurez que je devais me marier avec Catherine ; nous étions d’accord, et la tante Grédel ne demandait pas mieux. Malheureusement, on avait bien licencié les conscrits de 1815, mais ceux de 1813 restaient toujours soldats. Ce n’était plus aussi dangereux d’être soldat que sous l’Empire. Beaucoup d’entre ceux qui s’étaient retirés dans leur village vivaient tranquillement sans voir arriver les gendarmes ; mais cela n’empêchait pas que, pour me marier, il fallait une permission. Le nouveau maire, M. Jourdan, n’aurait jamais voulu m’inscrire sur les registres, sans avoir cette permission, et voilà ce qui me troublait.
Tout de suite à l’ouverture des portes, le père Goulden avait écrit au ministre de la guerre, qui s’appelait Dupont, que je me trouvais à Phalsbourg, encore un peu malade, et que je boitais, depuis ma naissance, comme un malheureux, mais qu’on m’avait pris tout de même dans la presse ; – que j’étais un mauvais soldat, qui ferait un très-bon père de famille, et que ce serait un véritable meurtre de m’empêcher de me marier, parce qu’on n’avait jamais vu d’homme plus mal bâti ni plus criblé de défauts ; qu’il faudrait me mettre dans un hôpital, etc., etc.
C’était une très-belle lettre et qui disait aussi la vérité. Rien que l’idée de repartir m’aurait rendu malade.
Enfin, de jour en jour, nous attendions la réponse du ministre, la tante Grédel, le père Goulden, Catherine et moi. J’avais une impatience qu’on ne peut pas se figurer ; quand le facteur Brainstein, le fils du sonneur de cloches, passait dans la rue, je l’entendais venir d’une demi-lieue ; cela me troublait, je ne pouvais plus rien faire et je me penchais à la fenêtre. Je le regardais entrer dans toutes les maisons, et quand il s’arrêtait un peu trop, je m’écriais en moi-même : « Qu’est-ce qu’il a donc à bavarder si longtemps ? Est-ce qu’il ne pourrait pas donner sa lettre tout de suite et ressortir ? C’est une véritable commère, ce fils Brainstein ! » Je le prenais en grippe, quelquefois même je descendais et je courais à sa rencontre en lui disant :
« Vous n’avez rien pour moi ?
– Non, monsieur Joseph, non, je n’ai rien, » disait-il en regardant ses lettres.
Alors je revenais bien triste, et le père Goulden, qui m’avait vu, criait :
« Enfant ! enfant ! voyons, un peu de patience, que diable ! cela viendra… cela viendra…nous ne sommes plus en temps de guerre.
– Mais il aurait déjà pu répondre dix fois, monsieur Goulden. !
– Est-ce que tu crois qu’il n’a d’affaire que la tienne ? Il lui arrive des centaines de lettres pareilles tous les jours ; chacun reçoit la réponse à son tour, Joseph. Et puis, tout est bouleversé maintenant de fond en comble. Allons, allons, nous ne sommes pas seuls au monde ; beaucoup d’autres braves garçons, qui veulent se marier, attendent leur permission. » Je trouvais ses raisons bien bonnes, mais je m’écriais en moi-même : « Ah ! si ce ministre savait le plaisir qu’il peut nous faire en écrivant deux mots, je suis sûr qu’il écrirait tout de suite. Comme nous le bénirions, Catherine et moi, et la tante Grédel et tout le monde ! » Enfin, il fallait toujours attendre.
Les dimanches, on pense bien aussi que j’avais repris mon habitude d’aller aux Quatre-Vents, et ces jours-là je m’éveillais de grand matin. Je ne sais quoi me réveillait. Dans les premiers temps, je croyais encore être soldat ; cela me donnait froid. Ensuite j’ouvrais les yeux, je regardais le plafond et je pensais : « Tu es chez le père Goulden, à Phalsbourg, dans la petite chambre. C’est aujourd’hui dimanche et tu vas chez Catherine ! » Cette idée me réveillait tout à fait ; je voyais Catherine d’avance, avec ses bonnes joues roses et ses yeux bleus. J’aurais voulu me lever tout de suite, m’habiller et partir ; mais l’horloge sonnait quatre heures, les portes de la ville étaient encore fermées.
Il fallait rester ; ce retard m’ennuyait beaucoup. Pour prendre patience, je recommençais depuis le commencement toutes nos amours ; je me figurais les premiers temps : la peur de la conscription, le mauvais numéro, le Bon pour le service ! du vieux gendarme Werner à la mairie ; le départ, la route, Mayence, la grande rue de Capougnerstrasse, la bonne femme qui m’avait fait un bain de pieds ; plus loin, Francfort, Erfurt, où j’avais reçu la première lettre, deux jours avant la bataille ; les Russes, les Prussiens, enfin tout… Et je pleurais en moi-même. – Mon idée de Catherine revenait toujours. Cinq heures sonnaient, alors je sautais du lit, je me lavais, je me faisais la barbe, je m’habillais, et le père Goulden, encore sous ses grands rideaux, le nez en l’air, me disait :
« Hé ! je t’entends, je t’entends. Depuis une demi-heure, tu te tournes, tu te retournes. Hé ! hé ! hé ! c’est dimanche aujourd’hui ! » Cela le faisait rire, et moi je riais aussi en le saluant et descendant l’escalier d’un trait.
Bien peu de gens étaient déjà dans la rue ; le boucher Sépel me criait chaque fois :
« Hé ! Joseph, arrive donc, il faut que je te raconte quelque chose. »
Mais je ne tournais seulement pas la tête, et deux minutes après j’étais déjà sur la grande route des Quatre-Vents, hors de l’avancée et des glacis. Ah ! le bon temps, la belle année ; comme tout verdissait et fleurissait, et comme les gens se dépêchaient de rattraper le temps perdu, de planter leurs choux hâtifs, leurs petites raves, de remuer la terre piétinée par la cavalerie ; comme on reprenait courage, comme on espérait de la bonté de Dieu, le soleil et la pluie dont on avait si grand besoin !
Tout le long de la route, dans les petits jardins, les femmes, les vieillards, tout le monde bêchait, travaillait, tout courait avec les arrosoirs.
« Hé ! père Thiébeau, criais-je, hé ! la mère Furst, du courage, du courage !
– Oui, oui, monsieur Joseph, vous avez bien raison, il en faut ; ce blocus a tout retardé, nous n’avons pas de temps à perdre.
Et les brouettes, les chariots de briques, de tuiles, de planches, de poutres, de madriers, comme tout cela roulait de bonne heure vers la ville, pour rebâtir les maisons et relever les toits enfoncés par les obus ! Comme les fouets claquaient et comme les marteaux retentissaient au loin dans la campagne ! De tous les côtés on voyait les charpentiers et les maçons autour des gloriettes. Le père Ulrich et ses trois garçons étaient déjà sur le toit du Panier-Fleuri, rasé par les boulets de la ville, en train d’affermir la charpente neuve ; on les entendait siffler et frapper en cadence. Ah ! oui, c’était un temps d’activité ; la paix revenait ! Ce n’est pas alors qu’on redemandait la guerre, non, non ! chacun savait ce que vaut la tranquillité chez soi ; chacun ne demandait qu’à réparer autant que possible toutes ces misères ; on savait qu’un coup de scie ou de rabot vaut mieux qu’un coup de canon ; on savait ce qu’il en coûte de fatigues et de larmes, pour relever en dix ans ce que les bombes renversent en deux minutes.
Et comme je courais joyeux alors ! Plus de marches, plus de contre-marches ; je savais bien où j’allais, sans en avoir reçu la consigne du sergent Pinto. Et ces alouettes qui s’élevaient et montaient au ciel en tremblotant, comme elles chantaient bien, et les cailles, les linottes ! Dieu du ciel, on n’est jeune qu’une fois ! Et la bonne fraîcheur du matin, la bonne odeur des églantiers le long des haies ; et la pointe du vieux toit des Quatre-Vents, la petite cheminée qui fume. « C’est Catherine qui fait du feu là-bas, elle prépare notre café… » Ah ! comme je courais ! Enfin me voilà près du village, je marche un peu plus doucement pour reprendre haleine, en regardant nos petites fenêtres et riant d’avance. La porte s’ouvre, et la mère Grédel, encore en jupon de laine, un grand balai à la main, se retourne ; je l’entends qui crie : « Le voilà !, le voilà !… » Presque aussitôt Catherine, toujours de plus belle en plus belle, avec sa petite cornette bleue, accourt : « Ah ! c’est bon… c’est bon… je t’attendais ! » Comme elle est heureuse ! et comme je l’embrasse ! Ah ! vive la jeunesse ! Tout cela, je le vois. J’entre dans la vieille chambre avec Catherine ; et la tante Grédel, en levant son balai d’un air d’enthousiasme, crie :
« Plus de conscription… c’est fini ! »
Nous rions de bon cœur, on me fait asseoir ; et, pendant que Catherine me regarde, la tante recommence :
« Eh bien ! ce gueux de ministre n’a pas encore écrit ? il n’écrira donc jamais ? Est-ce qu’il nous prend pour des bêtes ? L’autre se remuait trop, et celui-ci ne se remue pas assez ! C’est pourtant bien ennuyeux, qu’il faille toujours être commandé. Tu n’es plus soldat, puisqu’on t’avait laissé pour mort ; c’est nous qui t’avons sauvé, tu ne les regardes plus.
– Sans doute, sans doute, vous avez raison, tante Grédel, lui disais-je ; mais nous ne pouvons pourtant pas nous marier sans aller à la mairie, et si nous n’allons pas à la mairie, le curé n’osera pas nous marier à l’église. »
La tante alors devenait grave et finissait toujours par dire :
« Vois-tu, Joseph, ces gens-là, depuis le premier jusqu’au dernier, ont tout arrangé pour eux. Qui est-ce qui paye les gendarmes et les juges ? qui est-ce qui paye les curés ? qui est-ce qui paye tout le monde ? C’est nous. Eh bien ! ils n’osent pas seulement nous marier. C’est une chose abominable ! Si cela continue, nous irons nous marier en Suisse. »
Ces paroles nous calmaient un peu, et nous passions le reste de la journée à chanter et à rire !
II
Au milieu de cette grande impatience, je voyais tous les jours des choses nouvelles, qui me reviennent maintenant comme une véritable comédie qu’on joue sur la foire : je voyais les maires, les adjoints, les conseillers municipaux des villages, les marchands de grains et de bois, les gardes forestiers et les gardes champêtres, tous ces gens que l’on regardait depuis dix ans comme les meilleurs amis de l’Empereur, –et qui même étaient très-sévères quand on disait un mot contre Sa Majesté, – je les voyais, soit à la halle, soit au marché, soit ailleurs, crier contre le tyran, contre l’usurpateur et l’ogre de Corse. On aurait dit que Napoléon leur avait fait beaucoup de mal, tandis qu’eux et leurs familles avaient toujours eu les meilleures places.
J’ai pensé bien souvent depuis que c’est ainsi qu’on a toujours les bonnes places sous tous les gouvernements, et malgré cela j’aurais eu honte de crier contre ceux qui ne peuvent plus vous répondre et qu’on a flattés mille fois ; j’aurais mieux aimé rester pauvre en travaillant, que de devenir riche et considéré par ce moyen. Enfin voilà les hommes !
Je dois reconnaître aussi que notre ancien maire et trois ou quatre conseillers ne suivaient pas cet exemple ; M. Goulden disait qu’au moins ceux-là se respectaient, et que les criards n’avaient pas d’honneur.
Je me rappelle même qu’un jour le maire de Hacmatt étant venu faire raccommoder sa montre chez nous, se mit tellement à parler contre l’Empereur, que le père Goulden, se levant tout à coup, lui dit :
« Tenez, monsieur Michel, voici votre montre, je ne veux pas travailler pour vous. Comment… comment ! vous qui disiez encore l’année dernière « Le grand homme ! » à tout bout de chemin, et qui ne pouviez jamais appeler Bonaparte, Empereur tout court, mais qui disiez « l’Empereur et Roi, protecteur de la Confédération helvétique, » comme si vous aviez eu la bouche pleine de bouillie, vous criez maintenant que c’est un ogre, et vous appelez Louis XVIII, Louis le Bien-Aimé ? Allez… vous devriez rougir ! Vous prenez donc les gens pour des bêtes, vous croyez qu’ils n’ont pas de mémoire ? »
Alors l’autre répondit :
« On voit bien que vous êtes un vieux jacobin.
– Ce que je suis ne regarde personne, fit le père Goulden ; mais, dans tous les cas, je ne suis pas un flagorneur. »
Il était tout pâle et finit par crier :
« Allez, monsieur Michel, allez… les gueux sont des gueux sous tous les gouvernements. »
Ce jour-là son indignation était si grande, qu’il ne pouvait presque pas travailler, et qu’il se levait à chaque minute en criant :
« Joseph, si j’avais eu du goût pour les Bourbons, ce tas de gueux m’en auraient déjà dégoûté. Ce sont des individus de cette espèce qui perdent tout, car ils approuvent tout, ils trouvent tout beau, tout magnifique, ils ne voient de défaut en rien ; ils lèvent les mains au ciel avec des cris d’admiration quand le roi tousse ; enfin ils veulent avoir leur part du gâteau. Et quand, à force de les entendre s’extasier, les rois et les empereurs finissent par se croire des dieux, et qu’il arrive des révolutions, alors des gueux pareils les abandonnent, et recommencent la même comédie sous les autres. De cette façon, ils restent toujours en haut, et les honnêtes gens sont toujours dans la misère ! »
Cela se passait au commencement du mois de mai, dans le temps où l’on affichait à la mairie que le roi venait de faire son entrée solennelle à Paris, au milieu des maréchaux de l’Empire, « que la plus grande partie de la population s’était précipitée à sa rencontre, que les vieillards, les femmes et les petits enfants avaient grimpé sur les balcons pour jouir de sa vue, et qu’il était entré d’abord dans l’église Notre-Dame, rendre grâces au Seigneur, et seulement ensuite dans son palais des Tuileries. » On affichait aussi que le sénat avait eu l’honneur de lui faire un discours magnifique, disant qu’il ne fallait pas s’effrayer de tous nos désordres, qu’il fallait prendre courage, et que les sénateurs l’aideraient à sortir d’embarras. Chacun approuvait ce discours.
Mais peu de temps après nous devions jouir d’un nouveau spectacle, nous devions voir revenir les émigrés du fond de l’Allemagne et de la Russie. Ils arrivaient les uns en patache, les autres en simples paniers à salade, qui sont des espèces de chariots en osier, à deux et quatre roues. Les dames avaient des robes à grands ramages, et les hommes portaient presque tous le vieil habit à la française, avec la petite culotte, et le grand gilet pendant jusque sur les cuisses, comme on les représente dans les images du temps de la République.
Tous ces gens semblaient fiers et joyeux ; ils étaient contents de revenir dans leur pays. Malgré les vieilles haridelles qui les traînaient, malgré leurs misérables voitures remplies de paille, et les paysans qu’ils faisaient monter devant en guise de postillons, malgré tout, cela m’attendrissait ; je me rappelais la joie que j’avais eue, cinq mois avant, de revoir la France, et je me disais : « Pauvres gens, vont-ils pleurer en revoyant Paris, vont-ils être heureux ! »
Comme ils s’arrêtaient au Bœuf-Rouge, l’hôtel des anciens ambassadeurs, des maréchaux, des princes, des ducs et de tous ces richards qui ne venaient plus, on les voyait dans les chambres en train de se peigner, de s’habiller, de se faire la barbe eux-mêmes. Sur les midi, tous descendaient, criant, appelant : « Jean ! Claude ! Germain ! » avec impatience, ordonnant comme des personnages, et s’asseyant autour des grandes tables, leurs vieux domestiques tout râpés debout derrière eux, la serviette sur le bras. Et ces gens, avec leurs habits de l’ancien régime, leur air joyeux et leurs belles manières, faisaient tout de même bonne figure ; on se disait : « Voilà des Français qui reviennent de loin ; ils ont eu tort de partir et d’exciter l’Europe contre nous ; mais à tout péché miséricorde ; qu’ils soient heureux, qu’ils se portent bien, c’est tout le mal qu’on leur souhaite. »
Quelques-uns de ces émigrés arrivaient en voiture de poste ; alors notre nouveau maire, M. Jourdan, chevalier de Saint-Louis, M. le curé Loth, et le nouveau commandant de place, M. Robert de la Faisanderie, en grand uniforme brodé, les attendaient devant la grille ; quand les coups de fouet retentissaient dans les remparts, ils s’avançaient la figure riante, comme lorsqu’il vous arrive un grand bonheur ; et dès que la voiture s’arrêtait, le commandant courait ouvrir, en poussant des cris d’enthousiasme. Quelquefois aussi, par respect, ils ne bougeaient pas, et j’ai vu que ces gens se saluaient lentement, gravement, une fois, deux fois, trois fois, en s’approchant toujours un peu plus.
Le père Goulden, derrière nos vitres, disait en souriant :
« Vois-tu, Joseph, c’est le grand genre, le genre noble de l’ancien régime. Rien que de regarder à notre fenêtre, nous pouvons apprendre les belles manières, pour nous en servir quand nous serons ducs ou princes. »
D’autres fois, il disait ;
« Ces vieux-là, Joseph, ont fait le coup de feu contre nous aux lignes de Wissembourg ; c’étaient de bons cavaliers, ils se battaient bien, comme tous les Français se battent : – nous les avons dénichés tout de même ! »
II clignait des yeux et se remettait à l’ouvrage tout joyeux.
Mais le bruit s’étant répandu, par les servantes et les domestiques du Bœuf-Rouge, que ces gens ne se gênaient pas de dire entre eux « qu’ils nous avaient enfin vaincus ; qu’ils étaient nos maîtres ; que le roi Louis XVIII avait toujours régné depuis Louis XVII, le fils de Louis XVI ; que nous étions des rebelles, et qu’ils venaient nous remettre à l’ordre ! » le père Goulden me dit d’un air de mauvaise humeur :
« Cela va mal, Joseph ! Sais-tu ce que ces gens vont faire à Paris ? Ils vont redemander leurs étangs, leurs forêts, leurs parcs, leurs châteaux, leurs pensions, sans parler des bonnes places, des grandeurs et des respects de toute sorte. Tu trouves leurs robes et leurs perruques bien vieilles, eh bien, leurs idées sont encore plus vieilles que leurs robes et leurs perruques ! Ces gens-là sont plus dangereux pour nous que les Russes et les Autrichiens, car les Russes et les Autrichiens vont partir, et ceux-ci resteront. Ils voudront détruire ce que nous avons fait depuis vingt-cinq ans. Tu vois comme ils sont fiers ! Beaucoup d’entre eux ont pourtant vécu dans une grande misère de l’autre côté du Rhin ; mais ils croient qu’ils sont d’une autre race que nous, d’une race supérieure ; ils croient que le peuple est toujours prêt à se laisser tondre comme avant 89. – On dit que Louis XVIII a du bon sens, tant mieux pour lui ! car s’il a le malheur d’écouter ces gens-là, si l’on devine seulement qu’il est capable de suivre leurs conseils, tout est perdu. Ce sera la guerre contre la nation. Le peuple a réfléchi depuis vingt-cinq ans, il connaît ses droits, il sait qu’un homme en vaut un autre, et que toutes leurs races nobles sont des plaisanteries : chacun veut garder son champ, chacun veut avoir l’égalité des droits, chacun se défendra jusqu’à la mort. »
Voilà ce que me dit le père Goulden ; et comme la permission n’arrivait pas, je pensai que le ministre n’avait pas le temps de nous répondre, avec tous ces comtes, ces vicomtes, ces ducs et ces marquis sur le dos, qui lui redemandaient leurs bois, leurs étangs et leurs bonnes places. Je m’indignais et m’écriais : « Quelle misère, Seigneur Dieu ! lorsqu’un malheur est fini, tout de suite un autre recommence, et ce sont toujours les gens paisibles qui souffrent par la faute des autres. Mon Dieu ! délivrez-nous des anciens et des nouveaux nobles ! Comblez-les de vos bénédictions, mais qu’ils nous laissent tranquilles. »
Un matin, la tante Grédel vint nous voir, un vendredi, jour de marché. Elle avait son panier sous le bras et paraissait joyeuse. Je regardais déjà du côté de la porte, pensant que Catherine arrivait derrière elle, et je dis :
« Eh ! bonjour, tante Grédel ; Catherine est bien sûr en ville, elle va venir ?
– Non, Joseph, non, elle est aux Quatre-Vents, répondit la tante ; nous avons de l’ouvrage par-dessus la tête, à cause des semailles. »
Comme je devenais triste et que même cela me fâchait intérieurement, parce que je m’étais réjoui d’avance, la tante posa son panier sur la table, et dit en levant la serviette :
« Tiens, voici quelque chose pour toi, Joseph, quelque chose de Catherine. »
Je vis un gros bouquet de petites roses de mai, des violettes et trois gros lilas autour, avec leurs feuilles ; cette vue me fit plaisir, je me mis à rire en disant :
« Cela sent bon ! »
Et le père Goulden, qui s’était retourné, riait aussi :
« Tu vois qu’on pense toujours à toi, Joseph, » disait-il.
Nous riions tous ensemble.
Enfin cela m’avait tout à fait remis, j’embrassai la tante Grédel :
« Vous porterez cela de ma part à Catherine, » lui dis-je.
Et tout aussitôt j’allai mettre le bouquet dans un vase au bord de la fenêtre, près de mon lit. Je le sentais, en me figurant que Catherine était sortie de grand matin cueillir les violettes et les petites roses à la fraîcheur, qu’elle les avait arrangées l’une après l’autre dans la rosée, les gros lilas par-dessus, en les sentant aussi, de sorte que l’odeur m’en paraissait encore meilleure, et que je ne cessais de les regarder. À la fin, je sortis en me disant :
« Tu pourras les sentir toute la nuit ; demain matin tu leur mettras de l’eau fraîche ; après-demain ce sera dimanche, alors tu verras Catherine, et tu l’embrasseras pour la remercier. »
Je rentrai donc dans la chambre, où la tante Grédel causait avec M. Goulden du marché, du prix des grains, etc., tous deux de bonne humeur. La tante avait mis son panier à terre et me dit :
« Eh bien ! Joseph, la permission n’est pas encore venue !
Non… pas encore… C’est pourtant terrible.
– Oui, répondit-elle, tous ces ministres ne valent pas mieux les uns que les autres ; il faut qu’on choisisse tout ce qu’il y a de plus mauvais, de plus fainéant pour remplir cette place ! »
Ensuite elle ajouta :
« Mais sois tranquille, j’ai maintenant une idée qui va tout changer ! »
Elle riait, et comme le père Goulden et moi nous écoutions :
« Tout à l’heure, reprit-elle, pendant que j’étais à la halle, le sergent de ville Harmentier a publié qu’on allait dire une grande messe pour le repos des âmes de Louis XVI, de Pichegru, de Moreau et d’un autre.
– Oui, de Georges Cadoudal, fit le père Goulden brusquement ; j’ai lu cela hier soir dans la gazette.
– Justement, de Cadoudal, dit la tante. Eh bien ! vois-tu, Joseph, en écoutant les publications, j’ai pensé tout de suite : « Cette fois, nous aurons la permission !… On va faire des processions, des expiations ; nous irons tous ensemble, Joseph, Catherine et moi ; nous serons dans les premiers, et tout le monde dira : « Ceux-ci sont de bons royalistes, des gens de bien… M. le curé l’apprendra ; – maintenant les curés ont le bras long, comme dans le temps les généraux et les colonels ; – nous irons le voir… il nous recevra bien… il nous fera même une pétition ! Et je vous dis que cela marchera, que cela ne peut pas manquer ! »
En nous expliquant ces choses, la tante Grédel parlait bas, elle levait la main et paraissait bien contente de sa finesse. –Moi, j’étais aussi content et je pensais : « Elle a raison, voilà ce qu’il faut faire. Cette tante Grédel est une femme remplie de bon sens. » Mais ensuite, regardant le père Goulden, je vis qu’il était devenu très-grave, et même qu’il s’était retourné, comme pour regarder dans une montre avec la loupe, en fronçant ses gros sourcils blancs. Je voyais d’abord à sa figure lorsqu’une chose ne lui plaisait pas, et je dis :
« Écoutez, tante Grédel, moi je crois que cela peut aller ; mais avant de ne rien faire, je voudrais savoir ce que M. Goulden en pense. » Alors il se retourna et dit : « Chacun est libre, Joseph, chacun doit suivre sa conscience. Faire un service en expiation de la mort de Louis XVI… bon !… les honnêtes gens de tous les partis n’ont rien à dire, pourvu qu’on soit royaliste, bien entendu… car si l’on s’agenouille par intérêt, il vaudrait mieux rester chez soi. Je passe donc sur Louis XVI. Mais pour Pichegru, pour Moreau, pour Cadoudal, c’est autre chose. Pichegru a voulu livrer son armée à l’ennemi, Moreau s’est battu contre la France, et Georges Cadoudal est un assassin ; trois espèces d’hommes ambitieux qui ne demandaient qu’à nous asservir, et qui tous les trois ont mérité leur sort. Voilà ce que je pense.
– Hé ! mon Dieu ! s’écria la mère Grédel, qu’est-ce que cela nous fait ? Nous n’irons pas là pour eux, nous irons pour avoir la permission. Je me moque bien du reste, et Joseph aussi. N’est-ce pas, Joseph ? »
J’étais bien embarrassé, car ce que venait de dire M. Goulden me paraissait juste. Lui, voyant cela, dit :
« Je comprends l’amour des jeunes gens ; mais il ne faut jamais, mère Grédel, se servir de pareils moyens pour entraîner un jeune homme à sacrifier ce qui lui parait honnête. Si Joseph n’a pas les mêmes idées que moi sur Pichegru, Cadoudal et Moreau, qu’il aille à la procession, c’est très-bien ; jamais il ne m’arrivera de lui faire des reproches à ce sujet. Mais, quant à moi, je n’irai pas.
– Et ni moi non plus, dis-je alors ; je pense comme M. Goulden. »
Je vis que la tante Grédel allait se fâcher, elle devint toute rouge ; mais elle se calma presque aussitôt et dit :
« Eh bien ! Catherine et moi nous irons, parce que nous nous moquons de toutes ces vieilles idées. »
Le père Goulden ne put s’empêcher de sourire en voyant sa colère ;
« Oui, dit-il, tout le monde est libre ; faites ce qu’il vous plaira ! »
La tante alors reprit son panier et sortit, et lui riant, me fit signe de la reconduire.
Je mis ma redingote bien vite et je rattrapai la tante au coin de la rue.
« Écoute, Joseph, me dit-elle en remontant vers la place, ce père Goulden est un brave homme, mais c’est un vieux fou. Depuis les premiers temps que je le connais, il n’a jamais été content de rien. Il n’ose pas le dire, mais son idée c’est toujours la République… il ne pense qu’à sa vieille République, où tout le monde était souverain : les mendiants, les chaudronniers, les savetiers, les juifs et les chrétiens. Ça n’a pas de bon sens. Enfin que veut-on faire ? Si ce n’était pas un si brave homme, je ne me gênerais pas tant avec lui ; mais il faut penser que sans lui tu n’aurais jamais appris un bon état, qu’il nous a fait beaucoup de bien, et que nous lui devons le respect. Voila pourquoi je me suis dépêchée de partir, car j’aurais été capable de me fâcher.
– Vous avez bien fait, lui dis-je ; j’aime M. Goulden comme un père, et vous comme si vous étiez ma propre mère ; rien ne pourrait me causer plus de peine que de vous voir brouillés ensemble.
– Moi, me brouiller avec un homme pareil ! répondit la tante Grédel, j’aimerais mieux sauter par la fenêtre… Non, non… Mais il ne faut pas non plus écouter tout ce qu’il dit, Joseph, car je soutiens, moi, que cette procession est une très-bonne chose pour nous, que M. le curé nous aura la permission, et voilà le principal. Catherine et moi nous irons ; toi, puisque M. Goulden reste à la maison, tu resteras aussi. Mais je suis sûre que les trois quarts de la ville et des environs viendront ; et que ce soit pour Moreau, pour Pichegru, pour Cadoudal ou n’importe qui, ce sera très-beau, tu verras.
– Je vous crois, lui dis-je. »
Nous étions arrivés à la porte d’Allemagne ; j’embrassai de nouveau la tante, et je revins tout joyeux.
III
Si je me rappelle cette visite de la tante Grédel, c’est que huit jours après commencèrent les processions, les expiations et les prédications, qui ne cessèrent qu’au retour de [‘Empereur en 1815, et qui reprirent ensuite jusqu’au départ de Charles X en 1830. Tous ceux de ce temps savent que cela ne finissait plus. Aussi, quand je pense à Napoléon, j’entends le canon de l’arsenal tonner le matin et nos petites vitres grelotter ; le père Goulden me crie de son lit : « Encore une victoire, Joseph !…, Hé ! hé ! hé ! toujours des victoires ! » Et quand je pense à Louis XVIII, j’entends sonner les cloches ; je me figure le père Brainstein et ses deux grands garçons pendus à toutes les cordes de l’église, et M. Goulden qui me dit en riant : « Ça, Joseph, c’est pour saint Magloire ou saint Polycarpe ! »
Je ne puis pas me représenter ces temps d’une autre manière.
Sous l’Empire, je vois aussi, à la nuit tombante, le père Coiffé, Nicolas Rolfo et cinq ou six autres vétérans qui bourrent leur canon pour répéter les vingt et un coups, pendant que la moitié de Phalsbourg, sur le bastion en face, regarde la lumière rouge, la fumée, et les bourres qui sautent dans les fossés ; puis le soir les illuminations, les pétards, les fusées, les enfants qui crient Vive l’Empereur ! et, quelques jours après, les actes de décès et la conscription.
Sous Louis XVIII, je vois les reposoirs, les paysans qui viennent avec des voitures de mousse, de genêts et de petits sapins, les dames qui sortent des maisons avec les grands vases de fleurs, les gens qui prêtent leurs chandeliers et leurs crucifix, et ensuite les processions : M. le curé et ses vicaires ; les enfants de chœur Jacob Cloutier, Purrhus et Tribou qui chantent ; le bedeau Kœkli en robe rouge, avec la bannière qui balaye le ciel ; les cloches qui sonnent à pleines volées ; M. Jourdan, le nouveau maire, avec sa grosse figure rouge, son bel uniforme et sa croix de Saint-Louis ; le nouveau commandant de place, M. Robert de la Faisanderie, son tricorne sous le bras, sa grosse perruque poudrée à frimas, et ses broderies étincelant au soleil ; et, derrière, le conseil municipal et les cierges innombrables qu’on rallume l’un à l’autre quand il fait du vent ; le suisse Jean-Pierre Sirou, la barbe bleue bien rasée, son magnifique chapeau en travers des épaules, le large baudrier en soie blanche, parsemé de fleurs de lis, sur la poitrine, la hallebarde toute droite, qui reluit en l’air comme un plat d’argent ; les jeunes filles, les dames et les milliers de gens de la campagne en habit des dimanches, qui prient tous ensemble ; les vieilles en tête de chaque village, qui répètent sans cesse d’une voix claire : « Bett fer ouns ! Bett fer ouns ! [1] » les rues pleines de feuilles, les guirlandes et les drapeaux blancs aux fenêtres ; les juifs et les luthériens derrière leurs persiennes en haut, qui regardent dans l’ombre, pendant que le soleil éclaire ce beau spectacle ! – Oui, cela dura depuis 1814 jusqu’en 1830, excepté les Cent-Jours, sans parler des missions, de la tournée des évêques et des autres cérémonies extraordinaires. J’aime autant vous dire cela tout de suite, car de vous raconter chaque procession l’une après l’autre, ce serait trop long.
Eh bien ! cela commença le 19 mai 1814. Et le jour même où Harmantier publiait la grande expiation, il nous arriva cinq prédicateurs de Nancy, des jeunes gens qui se mirent à prêcher toute la semaine, depuis le matin jusqu’à minuit. C’était pour préparer l’expiation ; on ne parlait que d’eux en ville, et les gens se convertissaient ; toutes les femmes et les filles allaient à confesse.
Le bruit courait aussi qu’il faudrait rendre les biens nationaux, et que la procession séparerait les gueux d’avec les honnêtes gens, parce que les gueux n’oseraient pas s’y montrer. On peut se figurer mon chagrin, de rester en quelque sorte malgré moi parmi les gueux. Dieu merci ! je n’avais rien à me reprocher pour la mort de Louis XVI, je n’avais pas non plus de biens nationaux, et tout ce que je souhaitais, c’était d’obtenir la permission de me marier avec Catherine. Je pensais aussi, comme la tante Grédel, que M. Goulden avait tort de s’obstiner ; mais je n’aurais jamais osé lui parler de cela. J’étais bien malheureux, d’autant plus que ceux qui venaient nous apporter leurs montres à réparer, des gens respectables, des maires, des gardes forestiers, approuvaient tous les prédications, et disaient qu’on n’avait jamais rien entendu de pareil. M. Goulden, en les écoutant, continuait son ouvrage sans répondre, et quand c’était prêt, il se retournait en disant : « Voici, monsieur Christophe, ou monsieur Nicolas… cela fait tant. » Il n’avait pas l’air de s’intéresser à ces choses, et seulement, lorsque l’un ou l’autre venait à parler des biens nationaux, de la rébellion de vingt-cinq ans, de l’expiation des anciens crimes, alors il ôtait ses besicles en levant la tête pour écouter, et disait d’un air surpris :
« Ah bah ! ah bah !… Comment… comment… c’est aussi beau que cela, monsieur Claude ? Tiens… tiens…, vous m’étonnez… Ces jeunes prédicateurs parlent si bien !… Ah ! si l’ouvrage ne pressait pas tant, j’irais aussi les entendre… j’aurais aussi besoin de m’éclairer. »
Je pensais toujours qu’il changerait d’idée sur la procession de Louis XVI, et la veille au soir, comme nous finissions de souper, je fus bien content lorsqu’il me dit tout à coup d’un air de bonne humeur :
« Hé ! Joseph, est-ce que tu ne serais pas curieux d’entendre les prédicateurs ? On raconte tant de belles choses sur leur compte, que je voudrais pourtant savoir ce qu’il en est.
– Ah ! monsieur Goulden, lui dis-je, je ne demande pas mieux ; mais il ne faudrait pas perdre de temps, car l’église est toujours pleine au second coup.
– Eh bien ! partons, dit-il en se levant et décrochant son chapeau ; oui, je suis curieux de voir cela… Ces jeunes gens m’étonnent. Allons. »
Nous descendîmes. La lune brillait tellement dehors, qu’on reconnaissait les gens comme en plein jour. Au coin de Fouquet, nous voyions déjà le perron de l’église couvert de monde. Deux ou trois vieilles : Annette Petit, la mère Balaie, Jeannette Baltzer, avec leurs grands châles bien serrés et leurs bonnets à longues franges sur les yeux, passaient auprès de nous en se dépêchant.
« Hé ! fit M. Goulden, voici les anciennes ; hé ! hé ! hé ! toujours les mêmes ! »
Il riait, et dit en marchant que depuis le père Colin on n’avait pas vu tant de monde au service du soir. Je ne pouvais pas me figurer qu’il parlait du vieux cabaretier des Trois-Roses, en face du quartier d’infanterie, et je lui dis ;
« C’était un prêtre, monsieur Goulden ?
– Non, non, répondit-il en souriant, je parle du vieux Colin. En 1792, quand nous avions le club à l’église, tout le monde pouvait prêcher, mais c’est Colin qui parlait le mieux. Il avait une voix superbe, il disait des choses fortes et justes ; on venait de Saverne, de Sarrebourg, et même de plus loin pour l’entendre ; les dames et les demoiselles, – les citoyennes, comme on les appelait alors, – remplissaient le chœur, les galeries et les bancs ; elles avaient de petites cocardes au bonnet, et chantaient la Marseillaise pour animer la jeunesse. Tu n’as jamais rien vu de pareil. Tiens, Annette Petit, la mère Baltzer, toutes celles que tu vois courir devant nous avec leur livre d’heures, étaient les premières ; mais elles avaient alors des dents et des cheveux ; elles aimaient la liberté, l’égalité et la fraternité. – Hé ! hé ! hé ! pauvre Bével, pauvre Annette… maintenant elles vont se repentir ; c’étaient pourtant de bien bonnes patriotes, et je crois que le bon Dieu leur pardonnera… »
Il riait en se rappelant ces vieilles histoires. Mais sur les marches de l’église, il devint triste et dit :
« Oui… oui… tout change… tout change ! Je me rappelle que, le jour où Colin parla de la patrie en danger, en 93, trois cents garçons du pays partirent pour l’armée de Hoche ; lui les suivit et devint leur commandant ; c’était un terrible homme au milieu de ses grenadiers. Il refusa de signer pour nommer Bonaparte empereur. Maintenant il verse des petits verres sur un comptoir. »
Puis me regardant, comme étonné de ses propres pensées :
« Entrons, Joseph, » dit-il. Nous entrâmes sous les gros piliers de l’orgue. Nous étions serrés l’un contre l’autre. Il ne disait plus rien. Quelques lumières brillaient au fond du chœur, par-dessus les têtes. Les bancs qui s’ouvraient et se refermaient troublaient seuls le silence. Cela dura bien dix minutes ; les gens venaient toujours derrière nous. Enfin on entendit la hallebarde de Sirou retentir sur le pavé, et M. Goulden me dit : « Le voilà ! » Une lumière, au haut du bénitier, nous donnait un peu de jour. En même temps une ombre monta dans la chaire à gauche, et la perche de Kœkli alluma deux ou trois cierges autour. – Ce prédicateur pouvait avoir de vingt-cinq à trente ans ; il avait une bonne figure rose, et de grands cheveux blonds au-dessous de sa tonsure, qui lui tombaient en boucles sur la nuque.
On commença par chanter un cantique ; c’étaient les demoiselles de la ville qui chantaient en chœur : « Quel bonheur d’être chrétien ! » Après cela, le prédicateur dans sa chaire dit qu’il venait défendre la foi, la religion, le droit divin de Louis XVIII, et demanda si quelqu’un aurait l’audace de soutenir le contraire. Mais personne n’avait envie d’être lapidé ; chacun gardait le silence. Au même instant, un grand maigre, dans le banc en face, un homme de six pieds, brun, avec une capote noire, se leva en criant :
« Moi… moi… je soutiens que la foi, la religion, le droit des rois et le reste sont de véritables superstitions. – Je soutiens que la république est juste, que le culte de la raison vaut mieux que tout !… »
Ainsi de suite. Les gens étaient indignés ; jamais on n’avait rien vu de semblable. Quand il eut fini de parler, je regardai M. Goulden ; il riait tout bas et me dit : « Écoute… écoute ! »
Naturellement j’écoutai : le jeune prédicateur priait Dieu pour cet infidèle ; ensuite il se mit à tellement bien parler, que la foule en était dans le ravissement. Et le grand maigre répondait, disant « qu’on avait bien fait de guillotiner Louis XVI, Marie-Antoinette et toute la famille ! » En sorte que l’indignation grandissait toujours, et que vers la fin les Baraquins du Bois-de-Chênes, et principalement leurs femmes, voulurent entrer dans le banc pour l’assommer. Mais alors Sirou arriva criant :
« Place !… place !… »
Et le vieux Kœkli, en robe rouge se précipita devant cet homme, qui se sauva dans la sacristie, levant les deux mains au ciel et s’écriant qu’il était converti, qu’il renonçait à Satan, à ses pompes et à ses œuvres. L’autre fit une prière pour l’âme de ce pécheur : – ce fut un véritable triomphe pour la religion.
Tout le monde sortit vers onze heures, et l’on annonça que la procession aurait lieu le lendemain dimanche.
À cause de la grande presse qui nous avait repoussés dans un coin, M. Goulden et moi nous restâmes les derniers ; quand nous sortîmes, les paysans des Quatre-Vents, des Baraques, de Saint-Jean-des-Choux, du Bigelberg étaient déjà hors de la porte d’Allemagne. On n’entendait plus que les volets des gens de la ville se refermer, et quelques vieilles s’en aller dans la rue de l’Arsenal, causant entre elles de ces choses extraordinaires.
Le père Goulden et moi nous marchions de notre côté dans ce grand silence ; il ne disait rien et souriait la tête penchée. C’est ainsi que nous arrivâmes dans notre chambre.
J’allumai la chandelle, et pendant qu’il se déshabillait, je lui dis :
« Eh bien ! monsieur Goulden, est-ce qu’ils parlent bien ?
–Oui !… mais oui, Joseph, répondit-il en souriant ; pour des jeunes gens qui n’ont rien vu, ce n’est pas mal. » Ensuite il se mit à rire tout haut, et dit : « Mais si le vieux Colin avait représenté le jacobin, je crois tout de même qu’il aurait terriblement embarrassé le jeune homme. »
J’étais bien étonné de cela. Comme j’attendais encore, pour entendre ce que M. Goulden allait dire, il tira lentement son bonnet de soie noire sur ses oreilles, en disant d’un air pensif :
« C’est égal… c’est égal… ces gens-là vont trop vite…, beaucoup trop vite ! On ne me fera jamais croire que Louis XVIII sache tout cela… Non ! il a vu trop de choses dans sa vie, pour ne pas mieux connaître les hommes. Enfin, bonsoir ! Joseph, bonsoir ! Espérons qu’il arrivera bientôt un ordre de Paris pour renvoyer ces jeunes gens dans leur séminaire… Bonne nuit ! »
J’entrai dans ma chambre, et m’étant couché, je rêvai longtemps de Catherine, du jacobin et de la procession que nous allions voir.
IV
Le lendemain les cloches commencèrent à sonner au petit jour. Je me levai, je poussai mes volets, et je vis le soleil rouge qui montait derrière la poudrière, au-dessus du bois de la Bonne-Fontaine. Il pouvait être cinq heures ; on sentait d’avance la chaleur qu’il allait faire, et l’odeur des feuilles de chêne, de hêtre et de houx répandues dans les rues remplissait l’air. – Des paysans arrivaient déjà par bandes, causant au milieu du silence. On reconnaissait tous les villages : ceux de Wéchem, de Metting, du Graufthal, de Dosenheim, à leurs grands tricornes rabattus en visière, à leurs habits carrés, les femmes en longues robes noires et gros bonnets piqués en forme de matelas, sur la nuque ; – ceux du Dagsberg, de Hildehouse, du Harberg, de la Houpe, à leurs larges feutres ronds, les femmes en cheveux et jupe courte, petites, brunes, sèches et vives comme la poudre. Les enfants suivaient, tenant leurs souliers dans les mains ; mais ils s’asseyaient tous à la file sur les poteaux de Luterspech, et se chaussaient pour la procession.
Quelques curés arrivaient aussi par trois ou quatre derrière leurs villages, causant et riant entre eux de bonne humeur.
Moi, les coudes sur ma fenêtre, je regardais cela, me représentant que ces gens avaient dû se mettre en route avant minuit, pour arriver de si grand matin, qu’ils avaient dû traverser leurs montagnes, marchant sous les arbres pendant des heures, et passant sur les petits ponts au clair de lune. Je pensais que la religion était pourtant une belle chose, que ceux des villes ne le savaient pas, mais que des milliers de travailleurs aux champs, des bûcherons, des laboureurs, des êtres rudes et bons tout de même, aimant leur femme et leurs enfants, honorant la vieillesse de leurs parents, les aidant et leur fermant les yeux dans l’espoir d’une vie meilleure, n’avaient que cette unique consolation sur la terre.
Et, regardant la foule qui passait sans cesse, je me figurais que la tante Grédel et Catherine avaient les mêmes idées ; j’étais heureux de savoir qu’elles priaient pour moi.
Le jour montait, les cloches sonnaient, je regardais toujours. J’entendais aussi M. Goulden qui se levait et s’habillait ; quelques instants après il entra dans ma chambre en manches de chemise, et, me voyant là tout pensif, il s’écria :
« Joseph, ce qu’on peut voir de plus beau dans le monde, c’est la religion du peuple ! »
Et comme j’étais tout étonné de l’entendre dire justement ce que je pensais :
« Oui, fit-il, l’amour de Dieu, l’amour de la patrie, l’amour de la famille ne sont qu’une même chose. Seulement ce qui vous rend triste quelquefois, c’est de voir que l’amour de la patrie soit détourné pour satisfaire l’ambition d’un homme, et l’amour de Dieu pour exalter l’orgueil et l’esprit de domination d’un petit nombre. »
Ces paroles me frappèrent ; j’en ai gardé le souvenir, et j’ai pensé depuis bien souvent que c’était la triste vérité.
Enfin, pour en revenir à ce jour, vous saurez que depuis le blocus nous travaillions aussi le dimanche, parce que M. Goulden, en faisant le service des pièces sur les remparts, avait négligé son ouvrage, et que nous étions en retard. Ce jour-là donc, comme les autres, j’allumai le feu dans notre petit poêle et je préparai le déjeuner. Les fenêtres restaient ouvertes, on entendait la grande rumeur du dehors.
Le père Goulden, penché à l’une des fenêtres, disait :
« Tiens, toutes les boutiques restent fermées… excepté les auberges et les cabarets. »
Il riait, et je lui dis :
« Est-ce que nous ouvrirons notre devanture, monsieur Goulden ? Cela peut nous causer beaucoup de tort. »
Il se retourna comme surpris :
« Écoute, Joseph, dit-il, je n’ai jamais connu de meilleur garçon que toi, mais tu manques de caractère. Pourquoi donc est-ce que nous fermerions notre devanture ? Parce que Dieu a créé le monde en six jours et qu’il s’est reposé le septième ? Mais nous n’avons pas créé le monde, nous, et nous avons besoin de travailler pour vivre. Si nous fermions notre devanture par intérêt, si nous voulions faire les bons apôtres et gagner ainsi de nouvelles pratiques, ce serait de l’hypocrisie. Tu parles quelquefois sans réfléchir. »
Je vis aussitôt que j’avais eu tort et je répondis :
« Monsieur Goulden, laissons plutôt notre devanture ouverte, on verra que nous vendons des montres ; cela ne peut faire de tort à personne. »
Nous n’étions pas plutôt à table, que la tante Grédel et Catherine arrivèrent. Catherine était habillée tout en noir, à cause du service de Louis XVI ; elle avait un petit bonnet de tulle noir, une robe très-bien faite, et cela lui donnait un teint si blanc, si rose, si délicat, que je ne pouvais pas croire en quelque sorte que c’était l’amoureuse de Joseph Bertha ; son cou était blanc comme de la neige, et sans ses lèvres et son petit menton rose, sans ses yeux bleus et ses cheveux blonds, j’aurais cru que c’en était une autre qui lui ressemblait, mais encore plus belle. Elle riait, voyant mon admiration extraordinaire. À la fin, je lui dis :
« Catherine, maintenant tu es trop belle, je n’ose plus t’embrasser.
– Oh bien ! dit-elle, il ne faut pas te gêner tout de même. »
Et comme elle se penchait sur mon épaule, je l’embrassai longtemps, de sorte que le père Goulden et la tante se regardaient en riant, et que j’aurais voulu les voir bien loin, pour dire à Catherine que je l’aimais de plus en plus, et que je donnerais ma vie mille et mille fois pour elle ; mais devant eux, cela ne convenait pas. Je pensais ces choses et j’en étais attendri. La tante avait aussi sa robe noire, et son livre d’heures sous le bras.
« Viens donc aussi m’embrasser, Joseph, dit-elle ; tu vois bien que j’ai ma robe noire, comme Catherine. »
Je l’embrassai pendant que le père Goulden disait :
« Vous viendrez dîner avec nous… c’est une affaire entendue…, mais en attendant vous allez prendre quelque chose. –Nous avons déjeuné, répondit la tante. – Cela ne fait rien… cette procession finira Dieu sait quand… vous serez toujours sur pied… il faut se soutenir. »
Alors elles s’assirent, la tante à ma droite, Catherine à gauche, le père Goulden en face. On but un bon verre de vin, et la tante dit que la procession serait magnifique… qu’il y aurait au moins vingt-cinq curés des environs… que M. le curé Hubert des Quatre-Vents était aussi venu… que le grand reposoir du quartier de cavalerie montait jusque par-dessus les toits… que les sapins et les peupliers autour avaient des crêpes, et que l’autel était couvert d’un drap noir. – Elle parla de tout, pendant que je regardais Catherine et que nous pensions ensemble sans rien dire : « Oh ! mon Dieu ! quand aurons-nous la permission de nous marier !… Quand ce gueux de ministre prendra-t-il le temps d’écrire : Mariez-vous et laissez-moi tranquille ! »
Enfin, vers neuf heures, le second coup s’étant mis à sonner, il fallut bien se séparer ; la tante dit :
« C’est le second coup… eh bien ! nous viendrons dîner le plus tôt possible.
– Oui… oui… mère Grédel, répondit M. Goulden, nous vous attendrons… »
Aussitôt elles se levèrent. Je reconduisis Catherine jusqu’au bas de l’escalier, pour l’embrasser encore une fois. La tante Grédel criait,
« Dépêchons-nous ! dépêchons-nous ! »
Elles sortirent, et je montai me remettre à l’ouvrage. – Mais, depuis ce moment jusque vers onze heures, je ne pus rien faire. La foule de monde était tellement grande, qu’on n’entendait plus dehors qu’un bruit immense, un bruit de feuilles sur lesquelles on marche ; et quand la procession sortit de l’église, cela produisit un effet si grandiose, que M. Goulden lui-même cessa de travailler, pour écouter ces chants et ces prières.
Moi, je me figurais Catherine dans la multitude, plus belle que toutes les autres, et la tante Grédel auprès d’elle, répétant d’une voix claire : Bett fer ouns ! Bett fer ouns [2] !… –Je me les représentais bien fatiguées, et toutes ces voix, tous ces chants me faisaient rêver ; je tenais bien une montre et j’essayais de travailler, mais mon esprit était ailleurs… Plus le soleil montait, plus mon ennui redoublait, lorsque tout à coup M. Goulden me dit en riant :
« Hé ! Joseph, cela ne marche donc pas aujourd’hui ? »
Et comme je devenais tout rouge :
« Oui… fit-il, dans le temps, quand je rêvais à Louise Bénédum, j’avais beau regarder les ressorts et les roues, c’était toujours ses yeux bleus que je voyais. »
Il fit un soupir ; moi je me mis à soupirer aussi, pensant : « Ah ! vous avez bien raison, monsieur Goulden, vous avez bien raison ! »
« C’est assez, Joseph, dit-il au bout d’un instant, en me prenant la montre des mains. Va, mon enfant, tâche de retrouver Catherine… On ne peut pas surmonter son amour… c’est plus fort que soi ! »
En l’entendant me dire ces paroles, j’aurais voulu m’écrier : « Oh ! homme bon… Oh ! homme juste… Oh ! vous ne saurez jamais combien je vous aime ! » Mais il s’était levé pour s’essuyer les mains à la serviette derrière la porte, et je lui dis :
« Puisque vous le voulez absolument, monsieur Goulden…
–Oui… oui… absolument. »
Je n’en écoutai pas davantage, mon cœur sautait de joie ; je mis mon chapeau et je descendis d’un trait en m’écriant :
« Dans une heure, monsieur Goulden. » J’étais déjà dehors. Mais quel monde… quel monde !… tout fourmillait : les tricornes, les feutres, les bonnets, et au-dessus de tout cela, l’église sonnait lentement.
Durant plus d’une minute, sur nos marches, je regardai sans savoir où tourner ; et voyant à la fin qu’il n’était pas possible de faire un pas dans cette foule, je pris la ruelle de Lanche pour gagner les remparts et courir attendre la procession sur le talus de la porte d’Allemagne, car alors elle remontait la rue du Collège. – Il pouvait être onze heures. En ce jour, je devais voir des choses qui m’ont fait réfléchir depuis bien souvent : c’étaient les signes de grands malheurs, et personne ne les voyait, personne n’avait le bon sens de comprendre ce que cela signifiait. Ce n’est que plus tard, quand tout le monde fut encore dans la misère jusqu’au cou, quand il fallut reprendre le sac et le fusil, pour se faire hacher en morceaux ; c’est alors seulement que chacun se dit : « Ah ! si l’on avait eu du bon sens… si l’on avait eu de la justice… si l’on avait eu de la prudence ! Nous étions si bien !… Nous serions encore chez nous, au lieu que maintenant la débâcle recommence. Qu’est-ce qu’il fallait faire ? Rien du tout… nous n’avions qu’à nous tenir en repos… ce n’était pourtant pas bien difficile. » Quelle misère !
Je remontais donc la ruelle de Lanche, où l’on fusillait les déserteurs sous l’Empire. Le bruit s’éloignait, les chants, les prières, le son des cloches aussi ! Toutes les portes et les fenêtres étaient fermées, tout le monde avait suivi la procession. Au milieu de ce grand silence, je m’arrêtai quelques instants à l’ombre du vieux quartier pour reprendre haleine ; un petit vent frais soufflait des champs par-dessus les remparts ; j’écoutais le tumulte au loin, je m’essuyais la figure couverte de sueur, et je pensais :
« Où trouver Catherine maintenant ? » J’allais repartir en grimpant l’escalier de la poterne, lorsque j’entendis quelqu’un s’écrier ; « Margarot, marquez donc les points ! » Et seulement alors je vis les fenêtres du père Colin ouvertes au premier, et des gens en bras de chemise qui jouaient au billard. C’étaient des figures de vieux soldats, les cheveux courts et les moustaches en brosse. Ils allaient et venaient, criant autour du billard, sans s’inquiéter de Louis XVI, ni du maire, ni du commandant, ni des bourgeois. L’un d’eux, court, trapu, les favoris en canon de pistolet, selon la mode des hussards, la cravate défaite, se pencha même dehors, sa queue de billard appuyée au bord de la fenêtre, et regarda du côté de la place en criant :
« Nous remettons la partie en cinquante ! »
L’idée me vint aussitôt que ce devaient être des officiers en demi-solde, qui dépensaient là leurs derniers liards, et qui seraient bientôt embarrassés pour vivre. J’avais repris mon chemin, et j’allongeais le pas sous la voûte de la poudrière, derrière le collège, rêvant à ces choses ; mais, une fois sur le talus de la porte d’Allemagne, tout fut oublié ; la procession tournait au coin de Bockholtz, les chants éclataient en face du reposoir comme des trompettes ; les jeunes prêtres de Nancy couraient dans la foule, la croix en l’air, pour maintenir le bon ordre ; le suisse Sirou se dressait majestueusement sous la bannière ; devant, tous les prêtres et les enfants de chœur chantaient, les prières s’élevaient jusqu’au ciel ; derrière, la foule répondait, et cela produisait un murmure sourd et terrible.
Moi, sur la pointe des pieds, à demi-couvert par le hangar, je ne songeais plus qu’à Catherine, j’aurais voulu la découvrir au milieu de cette multitude ; mais combien de drapeaux, de tricornes et de bonnets je vis défiler dans la rue d’Ulrich ! On n’aurait jamais pu s’imaginer que tant de monde existait dans notre pays ; il faut que pas une âme – excepté les petits enfants et quelques vieilles pour les garder – ne soit restée dans les villages.
Cela durait depuis au moins vingt minutes, et je n’espérais plus apercevoir Catherine, lorsque tout à coup je la vis avec la tante Grédel. La tante priait d’une voix si claire, qu’on l’entendait par-dessus toutes les autres ; Catherine, elle, ne disait rien et s’avançait à petits pas, les yeux baissés. – Ah ! si j’avais pu l’appeler, elle m’aurait peut-être entendu ; mais c’était bien assez de ne pas aller à la procession, sans faire encore du scandale. Tout ce que je puis dire, et pas un ancien de Phalsbourg ne soutiendra le contraire, c’est que Catherine n’était pas la moins jolie fille du pays et que Joseph Bertha n’était pas à plaindre.
Enfin, depuis un bon moment, elle avait passé, la procession venait de faire halte sur la place d’Armes, devant le grand reposoir, à droite de l’église ; M. le curé officiait, le silence s’étendait sur toute la ville. Dans les petites ruelles, à droite et à gauche, tout se taisait comme si on avait pu voir le prêtre à l’autel, un grand nombre s’agenouillaient, d’autres se reposaient sur les marches des maisons, car la chaleur était excessive et plusieurs étaient partis avant le jour. Ce spectacle me touchait, je priais pour la patrie, pour la paix, pour tout ce que je sentais en moi, et je me souviens que dans ce moment même des voix s’entendaient au bas du talus, sous la porte d’Allemagne, des voix qui disaient d’un ton de bonne humeur :
« Allons… allons… un peu de place, mes amis ! »
La procession barrait la route, les voyageurs se trouvaient arrêtés, et ces voix troublaient un peu le recueillement de la multitude. Quelques personnes, devant la porte, se dérangeaient ; le suisse et le bedeau regardaient de loin ; moi-même, par curiosité, je m’étais un peu rapproché de la rampe, sous le hangar. Alors, cinq ou six vieux soldats, tout blancs de poussière, les épaules courbées et l’air abîmé de fatigue, se glissèrent contre le talus, pour gagner la ruelle de l’Arsenal, où sans doute ils espéraient trouver le passage libre. Je crois encore les voir avec leurs souliers usés, leurs guêtres blanches, le vieil uniforme rapiécé, et le lourd shako défoncé par la pluie, le soleil et les misères de la campagne ; ils s’avançaient à la file, un peu sur le gazon de la rampe, pour gêner le moins possible les gens assis en bas, un vieux à trois chevrons, qui marchait devant et qui ressemblait à mon pauvre sergent Pinto, tué près du Hinterthôr, à Leipzig, m’attendrissait le cœur ; il avait les mêmes longues moustaches grisonnantes, les mêmes joues creuses et le même air content, malgré les souffrances et l’infortune ; il souriait, un petit paquet au bout de son bâton, et disait tout bas : « Faites excuse, Mesdames et Messieurs, faites excuse. » Les autres le suivaient pas à pas.
C’étaient les premiers prisonniers que nous rendait la convention du 23 avril ; depuis, nous en avons vu passer tous les jours jusqu’en juillet. Ceux-là sans doute avaient doublé les étapes pour revoir plus tôt la France.
En arrivant au bout de la ruelle, ils s’aperçurent que la foule allait encore bien loin du côté de l’arsenal ; pour ne pas déranger le monde davantage, ils entrèrent dans l’enfoncement de la poterne et s’assirent sur la marche humide, leurs petits paquets à terre auprès d’eux, attendant le départ de la procession ; ils revenaient de loin, sachant à peine ce qui s’était passé chez nous.
Malheureusement, les Baraquins du Bois-de-Chênes, le grand Horni, Zapheri Roller, Nicolas Cochart le cardeur, Pinacle le colporteur – qu’on avait fait maire pour le récompenser d’avoir montré le chemin du Falberg et du Graufthal aux alliés pendant le blocus– tous ces gueux, et d’autres encore, qui voulaient avoir la fleur de lis – comme si la fleur de lis avait pu les rendre meilleurs – malheureusement, toute cette mauvaise race, qui vit de fagots volés dans les bois, avait découvert de loin la vieille cocarde tricolore au haut des shakos, et chacun pensait : « Voici l’occasion de montrer que nous sommes les vrais soutiens du trône et de l’autel. »
Ils arrivaient en bousculant le monde. Pinacle, le cou dans une grosse cravate noire, un crêpe d’une aune à son chapeau, le col de sa chemise à deux lignes au-dessus des oreilles, et l’air grave comme un bandit qui veut se donner une mine d’honnête homme, Pinacle arriva le premier. Le vieux soldat à trois chevrons ayant découvert de loin ces gens qui les menaçaient, s’était levé pour voir ce que cela signifiait.
« Allons, ne vous pressez pas tant, disait-il… nous n’avons pas l’habitude de nous sauver… Voyons, qu’est-ce qu’on nous veut ? »
Mais Pinacle aurait craint de perdre une si belle occasion de montrer son zèle pour Louis XVIII ; au lieu de lui répondre, il abattit son shako d’un grand soufflet, en criant :
« À bas la cocarde ! »
Naturellement, ce vétéran indigné voulut se défendre, mais ceux des Baraques arrivaient en masse, hommes et femmes ; ils se précipitèrent sur les soldats, les renversèrent, leur arrachèrent la cocarde, les épaulettes, et les foulèrent aux pieds sans honte ni pitié. Le pauvre vieux se releva plusieurs fois, en criant d’une voix qui vous déchirait le cœur :
« Ah ! tas de lâches !… Ah ! vous êtes Français !… Ah ! canailles !… »
Et chaque fois il recevait de nouveaux coups. Finalement on les laissa dans ce coin, tout pleins de sang, les habits déchirés ; et M. le commandant de la Faisanderie étant arrivé dit qu’il fallait les conduire au violon.
Moi, si j’avais pu descendre, sans réfléchir à Catherine, à la tante Grédel, à M. Goulden, j’aurais été capable d’aller à leur secours, et les Baraquins m’auraient assommé comme eux. Quand j’y pense aujourd’hui, cela me fait frémir ; heureusement le mur de la poterne a plus de vingt pieds, et voyant qu’on les emmenait tout couverts de sang, voyant cette chose abominable, je me mis à courir du côté de l’arsenal, et je rentrai chez nous tellement pâle que le père Goulden s’écria :
« Joseph, est-ce que tu viens d’être écrasé ?
– Non, monsieur Goulden, non, lui dis-je, mais je viens de voir quelque chose d’affreux. »
Et je me mis à pleurer en lui racontant ce que j’avais vu. Il se promenait de long en large, les mains sur le dos, et s’arrêtait de temps en temps pour m’écouter, les yeux brillants et les lèvres serrées.
« Joseph, me disait-il, ces gens ont fait quelque chose.
– Non, monsieur Goulden.
– C’est impossible… ces hommes ont dû s’attirer ce traitement… Nous ne sommes pas des sauvages, que diable ! Les Baraquins eux-mêmes doivent avoir d’autres raisons que la cocarde. »
Il ne pouvait pas me croire ; ce n’est qu’après avoir tout entendu deux fois dans les détails, qu’il finit par dire :
« Eh bien ! je te crois… Oui, puisque tout s’est passé sous tes yeux, je te crois. Et c’est un plus grand malheur que tu ne penses, Joseph. Si cela continue, si l’on ne met pas une bride solide à tous ces vauriens, si les Pinacles doivent avoir le dessus, les honnêtes gens ouvriront l’œil. »
Il n’en dit pas plus, car la procession étant finie, Catherine et la tante Grédel arrivaient.
Nous dînâmes ensemble ; la tante était bien contente et Catherine aussi ; mais tout le plaisir que j’avais à les voir ne m’empêchait pas de conserver quelque chose sur le cœur. M. Goulden était tout pensif.
Enfin, à la nuit, je reconduisis Catherine et la tante jusqu’à la Roulette, et là, nous étant embrassés, je leur souhaitai le bonsoir. Il pouvait être huit heures, je rentrai tout de suite. M. Goulden était sorti lire la gazette à la brasserie de l’Homme sauvage, selon son habitude les dimanches. Je me couchai. Vers dix heures, il rentra, et, voyant encore ma chandelle briller sur la table, il poussa la porte et me dit :
« Il paraît que l’on fait des processions partout, Joseph ; on ne voit que cela dans la gazette. »
Il me dit aussi que quatre-vingt mille prisonniers allaient rentrer, et que c’était heureux pour le pays.
V
Le lendemain, il fallut remonter les horloges en ville, M. Goulden, qui se faisait vieux, m’avait chargé de ce soin, et je sortis de bonne heure. Un coup de vent, pendant la nuit avait chassé les feuilles le long des murs : chacun venait reprendre aux reposoirs, l’un ses flambeaux, l’autre ses vases de fleurs. Ce spectacle me rendait triste et je pensais : « Maintenant ils ont fait leur service funèbre, ils doivent être contents ! Pourvu que la permission arrive, tout sera bien ; mais si ces gens croient nous amuser avec des cantiques, ils se trompent. Du temps de l’Empereur, on partait pour la Russie ou pour l’Espagne, c’est vrai ; mais au moins les ministres ne faisaient pas languir la jeunesse. Je voudrais bien savoir à quoi sert la paix, si ce n’est pas pour se marier. »
Ces idées me mettaient en colère ; j’en voulais à Louis XVIII, au comte d’Artois, aux émigrés, à tout le monde, et je m’écriais : « Les nobles se moquent du peuple ! »
En rentrant chez nous, je trouvai M. Goulden qui venait de dresser la table -, pendant le déjeuner, je lui dis tout ce que je pensais ; il m’écoutait en souriant et disait :
« Prends garde, Joseph, prends garde ! ne te laisse pas emporter, tu m’as l’air de devenir jacobin ! »
Il s’était levé pour ouvrir l’armoire ; je le regardais, pensant qu’il allait prendre une bouteille, lorsqu’il me tendit une grosse lettre carrée, avec un large timbre rouge.
« Tiens, Joseph, me dit-il, voici quelque chose que le brigadier Werner m’a chargé de te remettre. »
En ce moment, je sentis mon cœur remuer, et je regardai la lettre les yeux troubles.
« Allons ; ouvre donc ! » me disait le père Goulden.
J’ouvris et j’essayai de lire, mais il me fallut du temps, et tout à coup je m’écriai ;
« Monsieur Goulden, c’est la permission !
– Tu crois ? dit-il.
– Oui, c’est la permission ! m’écriai-je les deux mains en l’air.
– Ah ! le gueux de ministre, il n’en fait pas d’autres, » dit M. Goulden.
Mais je lui répondis :
« Écoutez, moi je ne connais rien à la politique : puisque la permission est venue, eh bien ! le reste ne me regarde pas. »
Il riait tout haut et s’écriait :
« Ah ! bon Joseph ! bon Joseph ! »
Je voyais bien qu’il se moquait un peu de moi, mais cela m’était égal.
« Maintenant il faut tout de suite prévenir Catherine et la tante Grédel, m’écriai-je dans la joie de mon cœur ; il faut bien vite envoyer le fils Chardron.
– Hé ! vas-y toi-même, cela vaudra mieux, me dit cet excellent homme.
– Et le travail, monsieur Goulden ?
– Bah ! bah ! dans une occasion pareille, on oublie le travail. Va, mon enfant, dépêche-toi. Comment voudrais-tu travailler à cette heure ? Tu ne vois plus clair ! »
C’était vrai, je n’aurais rien pu faire. Je me levai tellement content que j’en pleurais. J’embrassai même M. Goulden ; puis, sans prendre le temps de changer d’habit, je partis en courant. Et voyez ce que fait la joie, j’avais déjà dépassé depuis longtemps la porte d’Allemagne, le pont, l’avancée, l’auberge de la Roulette et la poste aux chevaux sans rien voir, et ce n’est qu’en découvrant, à deux ou trois cents pas le village, notre cheminée et les petites fenêtres, que je me rappelai tout comme un rêve, et que je me remis à relire la permission et à me répéter : « C’est vrai ! oui, c’est vrai !… Quel bonheur !… Qu’est-ce qu’elles vont dire ? »
Voilà comment j’arrivai devant chez nous. Je poussai la porte en criant :
« La permission ! »
La tante Grédel, en sabots, balayait justement la cuisine, et Catherine descendait le vieil escalier de bois à droite, les bras nus, son mouchoir bleu en croix autour des seins. Elle venait de chercher des copeaux dans le grenier, et toutes deux, en me voyant et m’entendant crier : « La permission ! » restèrent comme saisies. Mais je répétai : « La permission ! » Et la tante Grédel d’un seul coup se mit à lever les deux mains, comme j’avais fait, en criant :
« Vive le roi ! »
Catherine, toute pâle, s’appuyait sur la rampe. Dans le même instant, je fus près d’elle, et je me mis à l’embrasser tellement, qu’elle finit par se reposer sur mon épaule en pleurant comme une Madeleine, et que je la portai pour ainsi dire en bas, pendant que la tante sautait, tournait autour de nous et criait :
« Vive le roi ! vive le ministre ! »
Enfin on n’avait jamais rien vu de pareil. Notre voisin, le vieux forgeron Rupper, avec son tablier de cuir et sa chemise débraillée, arriva même en disant :
« Eh bien… eh bien ! qu’est-ce que c’est donc, voisine ? »
Il tenait sa grosse pince, et regardait en ouvrant ses petits yeux. Alors nous reprîmes un peu de calme, et je répondis :
« Nous avons reçu la permission pour nous marier.
– Ah ! c’est donc ça ! dit-il ; maintenant, je comprends… je comprends. »
Il avait laissé la porte ouverte, et cinq ou six voisins et voisines, Anna Schmoutz la fileuse, Christophe Wagner le garde champêtre, Zaphéri Gross et plusieurs autres arrivèrent aussitôt ; la salle était pleine de monde. Je me mis à lire la permission tout haut. Chacun écoutait ; quand ce fut fini, Catherine se reprit à pleurer et la tante dit :
« Ce ministre, vois-tu, Joseph, c’est le meilleur des hommes… S’il était ici, je l’embrasserais et je l’inviterais à la noce ; il aurait la place d’honneur avec M. Goulden. »
Ensuite les voisines étant parties pour répandre la nouvelle, je me remis à faire des déclarations à Catherine, comme si les anciennes n’avaient pas compté, et je lui fis aussi répéter mille et mille fois qu’elle n’avait jamais aimé que moi, de sorte que nous étions attendris, et puis joyeux, et puis encore attendris, et puis encore joyeux, ainsi de suite jusqu’au soir. La tante, qui faisait la cuisine, criait, se parlant à elle-même : « Voilà ce qu’on peut appeler un bon roi ! » Ou bien : « Si mon pauvre Frantz revenait sur la terre, il aurait du bonheur en ce jour, mais on ne peut pas tout avoir ! »
Elle disait aussi que la procession nous avait fait du bien. Catherine et moi nous ne répondions rien, notre joie était trop grande. Nous dînions, nous goûtions, nous soupions sans rien voir et sans rien entendre ; et ce n’est que vers neuf heures du soir que je m’aperçus tout à coup qu’il était nuit et qu’il fallait repartir. Alors, la tante, Catherine et moi nous sortîmes ensemble. Il faisait un beau clair de lune. Elles me reconduisirent jusqu’à la Houlette, et pendant la route nous tombâmes d’accord que le mariage aurait lieu dans la quinzaine. Devant la ferme, sous les vieux peupliers, la tante m’embrassa, moi j’embrassai Catherine, ensuite je les regardai remonter la côte jusqu’au village. Elles se retournaient en levant la main, et je levais aussi la mienne. Enfin, quand elles furent rentrées, je me remis en route pour la ville, où j’arrivai sur les dix heures. Je traversai la grande place et je rentrai chez nous.
M. Goulden veillait encore dans son lit ; il m’entendit ouvrir la porte tout doucement. Comme je venais d’allumer la lampe et que j’allais entrer dans ma chambre, il m’appela :
« Joseph ! »
Aussitôt je m’approchai, et, me regardant tout attendri, il me tendit les bras. Nous nous embrassâmes, puis il me dit :
« C’est bien, mon enfant, tu es heureux et tu le mérites. Va te coucher maintenant ; demain, nous causerons. »
Alors j’allai me coucher, mais longtemps je ne pus dormir ; à chaque instant, je me réveillais en pensant : « Est-ce que c’est vrai ? est-ce que la permission est venue ? » Et je m’écriais en moi-même : « Oui, c’est vrai ! » Vers le matin pourtant, je finis par m’endormir. Quand je m’éveillai, le grand jour était là ; je sautai du lit pour m’habiller ; dans le même instant M. Goulden, de la chambre voisine, me criait tout joyeux :
« Joseph, viens donc te mettre à table !
– Ah ! pardon, monsieur Goulden, lui dis-je, j’étais si content, que je n’ai presque pas pu m’endormir.
– Oui… oui… je t’ai bien entendu, » répondit-il en riant.
J’entrai dans notre atelier, où la table était déjà mise.
VI
Après le bonheur d’épouser Catherine, ma plus grande joie était de penser que j’allais devenir un bourgeois ; car de se battre pour le roi de Prusse, ou de travailler pour son propre compte, cela fait une grande différence. M. Goulden m’avait dit qu’il m’associerait à son commerce, et je me figurais d’avance Joseph Bertha qui conduisait sa petite femme les dimanches à la messe, puis à la promenade, du côté de la Roche-Plate ou de la Bonne-Fontaine. Cette vue me produisait un bon effet. En attendant, j’allais tous les jours voir Catherine ; elle m’attendait dans le verger, pendant que la tante Grédel préparait les kuchlen et les kougelhof de la noce ; nous nous regardions des heures entières ; elle était fraîche et riante, elle embellissait tous les jours.
M. Goulden, en me voyant rentrer le soir toujours plus content, me disait :
« Eh bien ! Joseph, cela m’a l’air d’aller mieux que du côté de Leipzig ! »
Quelquefois j’aurais voulu me remettre au travail, mais il m’en empêchait, disant :
« Bah ! les jours de bonheur sont si rares dans la vie ! Va voir Catherine, va ! Plus tard, si l’idée me prend aussi de me marier, tu travailleras pour nous deux. »
Il riait. Ah ! des hommes pareils devraient vivre cent ans. Quel bon cœur ! quel homme juste et simple ! c’était pour nous un véritable père ; et souvent encore aujourd’hui, quand je me le représente avec son bonnet de soie noire tiré sur les oreilles, sa barbe grise longue de huit jours, ses yeux plissés d’un air de bonne humeur et le sourire sur les lèvres, souvent, après tant d’années, il me semble entendre encore sa voix, et les larmes m’en viennent aux yeux.
Mais à cette heure je dois vous raconter une chose qui survint l’avant-veille de notre mariage, et dont le souvenir ne s’effacera jamais de ma mémoire. C’était le 6 juillet, les noces devaient avoir lieu le 8 ; toute la nuit je n’avais fait que rêver de cela. Le matin, entre six et sept heures, je me lève ; le père Goulden travaillait déjà, les fenêtres ouvertes. Je me lavais la figure, pensant à courir aux Quatre-Vents ; mais voilà qu’un coup de trompette et deux coups de baguette de tambour retentissent sous la porte de France, comme lorsqu’un régiment arrive : les trompettes essayent leur embouchure, et les tambours donnent deux ou trois petits coups pour bien s’emmancher les baguettes. Rien que d’entendre cela, les cheveux m’en dressèrent sur la tête, et je criai : Monsieur Goulden, c’est le 6e !
– Eh ! oui, dit-il, depuis huit jours toute la ville en parle, mais toi tu n’écoutes plus rien ; c’est le bouquet de la noce, Joseph, j’ai voulu te garder cette surprise ! »
Alors je n’écoutai plus rien, je traversai la chambre comme le vent et je descendis d’un trait. Notre vieux tambour-maître, Padoue, levait déjà sa canne sous la porte sombre, les tambours arrivaient derrière en se balançant sur les hanches ; et plus loin le commandant Gémeau, à cheval, les grands plumets rouges de nos grenadiers et les baïonnettes s’avançaient lentement : c’était le 3e bataillon. La marche commença et mon sang ne fit qu’un tour. Du premier coup d’œil, je reconnus les longues capotes grises que nous avions reçues le 22 octobre 1813 sur les glacis d’Erfurt ; elles étaient devenues toutes vertes par la pluie, la neige et les vents. C’était pire qu’après Leipzig. Les vieux shakos avaient des trous de balles, le drapeau seul était neuf, dans son bel étui de toile cirée, la fleur de lis au bout…
Ah ! ceux qui n’ont pas fait campagne ne sauront jamais ce que c’est de revoir son régiment, d’entendre les mêmes roulements de tambour qu’en face de l’ennemi et de se dire : « Voici tes camarades qui reviennent battus, humiliés, écrasés ! les voilà qui penchent la tête avec une autre cocarde. » Non, je n’ai rien senti de pareil. Plus tard, beaucoup de ces hommes du 6e, mes anciens officiers, mes anciens sergents, sont venus s’établir à Phalsbourg, où les vieux soldats ont toujours été bien reçus : ce sont les Laflèche, les Carabin, les Lavergne, les Mouyot, les Padoue, les Chazi et bien d’autres encore. Ceux qui m’avaient commandé à la guerre ont été mes scieurs de bois, mes hommes de peine, mes couvreurs, mes charpentiers, mes maçons… Après m’avoir donné des ordres, ils ont dû m’obéir, car moi j’avais un bon état, j’avais un commerce ; eux, ils étaient de simples ouvriers ; mais c’est égal, en leur parlant, j’ai toujours conservé le respect de mes anciens chefs, j’ai toujours pensé : « Là-bas, à Weissenfelz, à Lutzen, à Leipzig, ces gens forcés de se courber et de travailler péniblement pour faire vivre leur famille, là-bas, à l’avant-garde, ils représentaient l’honneur et le courage de la France. » Ces changements sont arrivés après Waterloo !… et notre ancien porte-aigle, Faizart, a balayé quinze ans le pont de la porte d’Allemagne. Ce n’est pas beau… non…, la patrie devrait être plus reconnaissante !
C’était donc le 3e bataillon, qui revenait dans une misère qui saignait le cœur des honnêtes gens. Zébédé m’a raconté qu’ils étaient partis de Versailles le 31 mars, après la capitulation de Paris, et qu’on les avait fait marcher de Versailles à Chartres, à Châteaudun, à Blois, à Orléans, ainsi de suite, comme de véritables bohémiens, pendant six semaines, sans solde et sans équipements. Enfin, à Rouen, ils avaient reçu l’ordre de traverser toute la France pour revenir à Phalsbourg, et partout les processions, les services funèbres avaient excité le peuple contre eux. Il avait fallu tout supporter ! même de bivouaquer dans les champs, lorsque les Russes, les Autrichiens, les Prussiens et les autres gueux vivaient tranquillement dans nos villages.
En me racontant ces misères beaucoup plus tard, Zébédé en pleurait de rage :
« Est-ce que la France n’est plus la France ? disait-il. Est-ce que nous n’avons pas défendu son honneur ? »
Mais ce qui me fait encore plaisir dans mes vieux jours, c’est la manière dont le 6e fut reçu chez nous. On savait déjà que le 1er bataillon arrivait aussi d’Espagne, et que les débris du régiment et ceux du 24e d’infanterie légère devaient former le 6e régiment de Berry ; de sorte que toute la ville se réjouissait en pensant que nous allions avoir deux mille hommes de garnison, au lieu de quelques canonniers de marine qui ressemblaient à des vétérans. –C’était une grande joie, tout le monde criait : « Vive le 6e ! » Les enfants avaient couru jusque sur la côte de Saint-Jean à sa rencontre, et le bataillon n’avait été reçu nulle part de cette manière depuis 1813. Plusieurs vieux en pleuraient, criant dans les rangs : « Vive la France » Malgré cela, les officiers baissaient la tête d’un air abattu ; seulement ils faisaient signe de la main, comme pour remercier les gens d’un si bon accueil.
Moi, sur le pas de notre maison, je regardais défiler ces trois ou quatre cents hommes, si déguenillés que je ne reconnaissais plus que notre numéro. Mais tout à coup je vis Zébédé, – qui marchait en serre-file, – tellement maigre que son grand nez crochu lui sortait de la tête comme un bec, sa vieille capote lui pendait en franges le long du dos ; mais il avait les galons de sergent, et ses larges épaules osseuses, comme un brancard, lui donnaient l’air solide. En le voyant, je fis un cri qu’on entendit par-dessus le roulement des tambours :
« Zébédé ! »
Il se retourna ; je lui sautai dans les bras, pendant qu’il posait la crosse à terre au coin de Fouquet. Je pleurais comme un enfant ; lui disait :
« C’est toi, Joseph ? Ah ! ça fait au moins qu’il en reste deux.
– Oui, c’est moi, lui dis-je, et je vais me marier avec Catherine ; tu seras mon garçon d’honneur. »
Nous continuâmes alors à marcher. Plus loin, au coin de Hoûte, le vieux Furst attendait en regardant, les yeux troubles. Ce pauvre vieux pensait : « Maintenant mon fils pourrait aussi revenir ! » Et voyant Zébédé s’approcher avec moi, il rentra bien vite dans la petite allée sombre de sa maison. Sur la place, le père Klipfel et cinq ou six autres regardaient aussi le bataillon en ligne. Ils avaient bien reçu les actes de décès, mais c’est égal, ils espéraient que peut-être on avait commis des erreurs, car leurs garçons n’aimaient pas écrire. Ils regardèrent, et ensuite ils partirent pendant le roulement.
On fit l’appel ; dans ce moment, le vieux fossoyeur arriva. Il avait toujours sa petite veste de velours jaune et son bonnet de coton gris. Il regarda derrière les rangs, où je causais avec Zébédé, et Zébédé s’étant retourné, le vit ; alors il devint tout pâle. Ils se regardèrent un instant. Je pris le fusil, et le vieux embrassa son fils. Ils ne disaient rien et restèrent longtemps embrassés. Après cela, comme le bataillon faisait par file à droite pour aller à la caserne, Zébédé demanda la permission au capitaine Vidal d’aller avec son père, et remit son fusil au premier soldat. Nous partîmes ensemble pour la rue des Capucins. Le père disait :
« Tu sauras que la grand’mère est si vieille, qu’elle ne peut plus se lever du lit ; sans cela, elle serait aussi venue. » Je les suivis jusque sur la porte et je dis : « Vous viendrez dîner chez nous, père Zébédé, et toi aussi.
– Je veux bien, répondit le père ; oui, Joseph, nous viendrons. »
Ils entrèrent alors chez eux, et je revins prévenir M. Goulden de mon invitation, ce qui le réjouit d’autant plus que Catherine et la tante Grédel devaient aussi venir.
Moi, je n’avais jamais été plus heureux qu’en pensant que mon meilleur ami, mon amoureuse et tous ceux que j’aimais seraient à la maison ensemble.
Ce jour-là, sur les onze heures, notre grande chambre au premier offrait un joyeux coup d’œil : le plancher bien récuré, la table ronde au milieu, couverte d’une belle nappe à filets rouges, et six gros couverts d’argent autour ; les serviettes pliées en bateau dans les assiettes étincelantes ; la salière, les bouteilles cachetées, les gros verres à facettes, tout brillait à la lumière du soleil, qui s’étendait par-dessus les caisses de lilas rangées au bord des fenêtres.
M. Goulden avait voulu que tout fût fait largement, grandement et magnifiquement, comme pour des princes et des ambassadeurs ; il avait tiré de la corbeille son argenterie, chose tout à fait extraordinaire, et sauf le pot-au-feu, –que j’avais surveillé moi-même, –où se trouvaient trois livres de bonne viande, une tête de chou, des carottes en abondance, enfin tout ce qu’il fallait, sauf cela, qu’on ne peut jamais avoir aussi bon à l’hôtel, tout le reste devait venir de la Ville de Metz, où M. Goulden était allé lui-même commander le dîner.
De sorte que, vers midi, nous nous regardions l’un l’autre, souriant et nous frottant les mains ; – lui dans son bel habit noisette, bien rasé, sa grosse perruque un peu rousse à la place du bonnet de soie noire, sa culotte marron bouclée proprement sur ses gros bas de laine, les souliers à larges boucles aux pieds ; et moi dans mon habit bleu de ciel à la dernière mode, la chemise fine plissée sur le devant, et le contentement dans le cœur.
Il ne manquait plus que les convives : Catherine, la tante Grédel, le fossoyeur et Zébédé, Nous nous promenions de long en large, la figure riante, nous disant : « Tout est bien, tout est à sa place ; maintenant il faut dresser la soupière. » Et de temps en temps je jetais un regard dehors, pour voir si l’on venait.
Enfin la tante Grédel et Catherine tournèrent le coin de Fouquet, – elles rentraient de la messe, le livre de prières sous le bras ; –et plus loin je vis le vieux fossoyeur dans son bel habit à larges manches, l’ancien chapeau à cornes en travers les épaules, et Zébédé, qui avait changé de chemise et s’était fait la barbe. Ils arrivaient du côté des remparts, en se donnant le bras d’un air grave, comme des gens attendris, parce qu’ils sont tout à fait heureux.
Alors je dis :
« Les voilà, monsieur Goulden ! »
Nous n’eûmes que le temps de verser le bouillon sur le pain déjà grillé, et de poser la grande soupière fumante au milieu de la table, ce qui se fit heureusement. Presque aussitôt Catherine et la tante Grédel entrèrent. Je vous laisse à penser leur surprise en voyant cette belle table. Nous nous étions à peine embrassés que la tante s’écriait :
« C’est donc aujourd’hui la noce, monsieur Goulden ?
– Oui, madame Grédel, répondit le brave homme en souriant, –car les jours de cérémonie il l’appelait madame Grédel, au lieu de ma commère ou de mère Grédel, –oui, c’est la noce des bons amis. Vous saurez que Zébédé vient de revenir et qu’il dîne chez nous avec le vieux fossoyeur.
– Ah ! dit la tante, cela me fait plaisir. » Et Catherine, devenue toute rouge, me dit tout bas :
« Maintenant tout est bien… Voilà ce qui nous manquait pour être tout à fait contents. »
Elle me regardait en me tenant la main. Et comme nous attendions, quelqu’un ouvrit la porte ; le vieux Laurent, de la Ville de Metz, avec deux hauts paniers à anses, où les plats étaient rangés dans un bel ordre les uns au-dessus des autres, cria de l’allée :
« Monsieur Goulden, voici le dîner. –Bon, bon, répondit M. Goulden, arrangez-nous cela sur la table vous-même. »
Laurent mit alors les petits radis, la fricassée de poulet, une belle oie grasse à droite et à gauche le bœuf, que nous avions nous-mêmes posé dans du persil ; il mit aussi un bon plat de choucroute avec de petites saucisses, près de la soupière, de sorte que jamais notre chambre n’avait vu de dîner pareil.
Dans le même instant nous entendîmes le vieux fossoyeur et Zébédé monter ; le père Goulden et moi nous courûmes à leur rencontre, et M. Goulden, embrassant Zébédé, lui dit :
« Je suis content de te voir ! Oui, je sais que tu t’es montré bon camarade pour Joseph, au milieu des plus grands périls. »
Ensuite il serra la main du vieux fossoyeur en lui disant :
« Père Zébédé, je vous glorifie d’avoir un fils pareil. »
Et comme Catherine était arrivée derrière nous, elle dit à Zébédé :
« Je ne peux faire de plus grand plaisir à Joseph qu’en vous embrassant. Vous avez voulu le porter à Hanau, lorsque les forces vous ont manqué… Je vous regarde comme un frère. »
Zébédé, tout pâle, embrassa Catherine sans rien répondre, et nous entrâmes dans la chambre en silence, Catherine, Zébédé et moi ; le père Goulden et le vieux fossoyeur derrière. La tante Grédel arrangeait encore les plats, et aussitôt elle s’écria :
« Soyez les bienvenus ! soyez les bienvenus ! Ceux qui se sont rencontrés dans le malheur se retrouvent dans la joie. Le Seigneur étend ses regards sur tout le monde. »
Elle embrassa Zébédé, qui lui dit en souriant :
« Toujours fraîche et bien portante, madame Grédel ; c’est un plaisir de vous voir !
– Voyons, père Zébédé, mettez-vous ici, à la tête de la table, criait M. Goulden tout réjoui : et toi, Zébédé, là, –que je vous aie à ma droite et à ma gauche ; –et plus loin, Joseph, en face de Catherine, près de Zébédé ; et madame Grédel, à l’autre bout, pour surveiller. »
Chacun était content de sa place ; Zébédé me regardait en souriant, comme pour me dire : « Si nous avions eu le quart d’un dîner pareil à Hanau, nous ne serions pas tombés au bord de la route ! » Enfin la joie et le bon appétit brillaient sur toutes les figures. Le père Goulden, devenu grave, enfonça la grosse poche d’argent dans la soupière, sous les yeux des convives ; il servit d’abord le vieux fossoyeur, qui ne disait rien et semblait attendri de ces honneurs ; ensuite son fils ; après cela Catherine, la tante Grédel, moi et lui. Et le dîner commença dans une sorte de recueillement.
Zébédé clignait de l’œil et me regardait de temps en temps d’un air de satisfaction. On déboucha la première bouteille et l’on emplit les verres. On but de ce vin ordinaire très-bon ; mais il devait en arriver de meilleur, c’est pourquoi l’on attendit pour boire à la santé les uns des autres. On mangea une bonne tranche de bœuf. Le vieux fossoyeur disait :
« Voilà quelque chose de bon… c’est du bon bœuf ! »
Et comme il trouvait aussi la fricassée de poulet très-bonne, je vis que Catherine était une femme d’esprit, car elle dit :
« Vous saurez, monsieur Zébédé, que nous aurions invité votre grand’mère Marguerite, que je vais voir de temps en temps, mais elle est trop vieille pour se lever ; c’est pourquoi, si vous le voulez bien, puisqu’elle ne peut venir, qu’elle mange au moins un morceau avec nous, et qu’elle boive un verre de vin à la santé de son petit-fils. Qu’en pensez-vous, père Zébédé ?
– Justement, dit le vieux fossoyeur, je pensais à cela. »
Le père Goulden regardait Catherine les larmes aux yeux ; comme elle se levait pour choisir un morceau convenable, il l’embrassa, et j’entendis qu’il l’appelait sa fille !
Elle sortit avec une bouteille et une assiette. Pendant qu’elle était dehors, Zébédé me dit :
« Joseph, celle qui bientôt sera ta femme mérite tous les bonheurs ; ce n’est pas seulement une honnête fille, ce n’est pas seulement une femme qui mérite l’amour, elle mérite aussi le respect, car elle a de l’esprit qui vient du cœur. Elle a vu ce que mon père et moi nous pensions devant ce bon dîner ; elle a vu qu’il nous ferait mille fois plus de plaisir si la grand’mère en avait sa part, et voilà pourquoi je l’aimerai toujours comme une sœur. »
En même temps, il détourna la tête et me dit tout bas :
« Joseph, c’est dans la joie que l’on sent le chagrin d’être pauvre ; ce n’est pas assez de donner son sang pour la patrie, il faut qu’à cause de cela la misère reste à la maison, et quand on revient, il faut qu’on ait ce spectacle ! »
Moi, comprenant qu’il allait devenir triste, je remplis son verre, nous bûmes, et ces pensées se dissipèrent. –Catherine revint aussi, disant que la grand’mère était très-heureuse, qu’elle remerciait M. Goulden, que c’était un beau jour pour elle !… enfin cela réveilla tout le monde. Et comme le dîner continuait, la tante Grédel, ayant entendu sonner les vêpres, sortit ; mais Catherine resta, et l’animation que vous inspire le bon vin étant venue, on se mit à parler de la dernière campagne.
C’est alors que nous connûmes cette grande marche en retraite depuis le Rhin jusque derrière Paris ; les combats du bataillon à Bibelskirchen et à Sarrebruck, – où le lieutenant Baubin avait passé la Sarre à la nage, pendant qu’il gelait à pierre fendre, pour détruire quelques barques encore au pouvoir de l’ennemi ; –le passage à Narbefontaine, à Courcelles, à Metz, à Enzelvin, à Champlon, à Verdun, toujours en retraite ; la bataille de Brienne. Il ne restait déjà plus d’hommes, mais le 4 février on avait remonté le bataillon avec les restes du 5e léger, et depuis ce moment tous les jours on était au feu : le 5, le 6 et le 7 à Méry-sur-Seine ; le 8 à Sézanne, où les soldats mouraient dans la boue, n’ayant plus la force de s’en retirer ; le 9 et le 10, à Murs, où Zébédé, le soir, s’était enterré dans le fumier d’une ferme pour se réchauffer ; le 11, la terrible bataille de Marché, où le commandant Philippe avait été blessé d’un coup de baïonnette ; le 12 et le 13, le passage à Montmirail ; le 14, la bataille de Beauchamp ; le 15 et le 16, la marche rétrograde sur Montmirail, où les Prussiens étaient revenus ; les combats de la Ferté-Gauché, de Jouarre, de Gué-à-Train, de Neufchettes, ainsi de suite ! Quand on avait battu les Prussiens, arrivaient les Russes ; après les Russes, les Autrichiens, les Bavarois, les Wurtembergeois, les Hessois, les Saxons, les Badois.
J’ai souvent entendu raconter cette campagne de France, mais jamais comme par Zébédé. Quand il parlait, sa grande figure maigre grelottait, son long nez se recourbait sur ses quatre poils de moustaches jaunes et ses yeux devenaient troubles ; il étendait la main dans sa vieille manche creuse, et ce qu’il disait on croyait le voir :–on voyait ces grandes plaines de la Champagne, où les villages fumaient à droite et à gauche ; les femmes, les enfants, les vieillards qui s’en allaient par bandes, à demi nus, emportant l’un sa vieille paillasse, l’autre quelques vieux meubles sur une charrette ; pendant que la neige descendait du ciel, que le canon grondait dans le lointain, et que les Cosaques couraient comme le vent, les batteries de cuisine et même les vieilles horloges pendues à leurs selles, en criant : – Hourrah !
On voyait ces batailles furieuses, un contre dix ; les paysans désespérés qui venaient aussi avec leurs fourches ; et le soir l’Empereur, dehors, à cheval sur une chaise, le menton au bord du bâton sur ses mains croisées, en face d’un petit feu, les généraux autour. C’est ainsi qu’il dormait et qu’il rêvait ! Il devait lui passer terriblement d’idées par la tête depuis Marengo, Austerlitz et Wagram !
Ah ! de se battre, de souffrir la faim, le froid, la misère, les marches et les contre-marches, ce n’est rien, disait Zébédé ; mais d’entendre pleurer et gémir en français des femmes et des enfants au milieu de tous ces décombres, de savoir qu’on ne peut pas les sauver ; que plus on tue d’ennemis, plus il en revient ; qu’il faut reculer, toujours reculer, malgré les victoires, malgré le courage, malgré tout… voilà ce qui vous déchire le cœur, monsieur Goulden ! »
En l’écoutant, nous nous regardions les uns les autres ; personne n’avait plus envie de boire, et le père Goulden, sa grosse tête penchée d’un air rêveur, disait tout bas :
« Oui… oui… voilà ce que coûte la gloire ! Ce n’est pas assez de perdre la liberté, de perdre tous les droits qu’on avait gagnés avec tant de peine, il faut encore être pillé, saccagé, brûlé, haché par des bandes de Cosaques ; il faut voir ce qu’on n’avait jamais vu depuis des centaines d’années : des tas de brigands qui vous font la loi ! Va… va… nous t’écoutons… raconte tout ! »
Catherine, voyant notre tristesse, remplissait les verres :
« Allons, à la santé de M. Goulden ! à la santé du père Zébédé ! disait-elle ; tous ces malheurs sont passés… ils ne reviendront plus.
Et nous buvions ! Et Zébédé racontait comment il avait fallu renouveler encore une fois le bataillon, sur la route de Soissons, avec des soldats du 16e léger ; comment ils étaient arrivés à Meaux, où l’hôpital de la Piété répandait la peste, malgré l’hiver, à cause des masses de blessés qu’on ne pouvait pas soigner.
C’était épouvantable ! Mais le pire de tout, c’est quand il nous raconta leur arrivée à Paris, par la barrière de Charenton : l’Impératrice, le roi Joseph, le roi de Rome, les ministres, les nouveaux princes, les nouveaux ducs, tout ce grand monde qui se sauvait dans des calèches du côté de Blois, abandonnant la capitale à l’ennemi ; – pendant que les pauvres ouvriers en blouse – qui n’avaient pourtant rien eu de l’Empire que d’être forcés de lui donner leurs enfants, – se précipitaient par milliers autour des mairies, en demandant des armes pour défendre l’honneur de la France, et que la vieille garde les repoussait à la baïonnette !… – Alors le père Goulden tout à coup s’écria :
– C’est assez ! c’est bon, Zébédé… Tiens… laissons cela… parlons plutôt d’autre chose !
Il avait pâli d’un coup. Dans le même instant la mère Grédel, étant revenue des vêpres et nous voyant là tous muets et M. Goulden bouleversé, demanda :
– Hé ! qu’est-ce qui se passe donc ici ?
– Nous parlions de l’Impératrice et des ministres de l’Empereur, répondit le père Goulden en riant d’un air étrange.
– Ah ! je ne m’étonne plus si le vin nous tourne sur le cœur, dit-elle. Moi, chaque fois que j’y pense et que je me regarde par hasard dans le miroir, je vois que cela me rend toute verte. Ah ! les gueux ! Heureusement ils sont partis.
Zébédé semblait de mauvaise humeur ; M. Goulden s’en aperçut et s’écria :
– C’est égal, la France est toujours un grand et glorieux pays. Si les nouveaux nobles valent juste autant que les anciens, le peuple au moins est ferme. On a beau faire, les bourgeois, les ouvriers et les paysans sont ensemble ; ils ont les mêmes intérêts, ils ne lâcheront pas ce qu’ils tiennent, et ne se laisseront pas non plus mettre le pied sur la nuque. – Et maintenant mes amis, allons prendre l’air, il se fait tard ; la mère Grédel et Catherine ont du chemin pour retourner aux Quatre-Vents, Joseph les accompagnera.
— Non, dit Catherine, aujourd’hui Joseph doit rester avec son ami, nous retournerons toutes seules.
— Eh bien ! soit, Catherine a raison, dit M. Goulden ; un jour pareil, les amis doivent tous rester ensemble.
Nous étions sortis bras dessus bras dessous, la nuit venait. Sur la place d’Armes on s’embrassa de nouveau ; la tante et Catherine prirent le chemin du village, et nous, après avoir fait quelques tours sous les grands tilleuls, nous entrâmes à la brasserie de l’Homme sauvage. On se rafraîchit avec de la bonne bière mousseuse. M. Goulden raconta le blocus, l’attaque de la tuilerie de Pernette, les sorties au Bigelberg, aux baraques d’en haut, et le bombardement. C’est là que j’appris pour la première fois qu’il avait été chef de pièce, et qu’il avait eu le premier l’idée de casser les fourneaux de fonte pour faire de la mitraille. Ces histoires se prolongèrent jusqu’à la retraite de dix heures. Enfin Zébédé nous quitta pour aller à la caserne, le vieux fossoyeur retourna dans la rue des Capucins, et nous dans notre lit, où nous dormîmes jusqu’au lendemain huit heures.
VII
Deux jours après eut lieu mon mariage avec Catherine, chez la tante Grédel, aux Quatre-Vents. M. Goulden représentait mon père ; j’avais choisi Zébédé pour garçon d’honneur, et quelques anciens camarades, restés au bataillon, étaient aussi de la noce.
Le lendemain, Catherine et moi nous demeurions déjà chez M. Goulden, dans les deux petites chambres au-dessus de l’atelier.
Bien des années se sont écoulées depuis. M. Goulden, la tante Grédel et les camarades ont disparu de ce monde, Catherine est devenue toute blanche ; eh bien ! souvent encore, quand je la regarde, ces temps lointains ressuscitent : il me semble la revoir comme à vingt ans blonde et rose : je la vois ranger nos pots de fleurs au bord des fenêtres en haut, je l’entends chanter tout bas, je vois le soleil en face, je crois encore descendre avec elle le petit escalier un peu raide, et dire ensemble en entrant dans l’atelier : « Bonjour, monsieur Goulden. » Lui, se retourne en souriant, et nous répond : « Bonjour, mes enfants, bonjour. » Il embrasse Catherine qui se met à balayer, à cirer les meubles, à dresser le pot-au-feu, pendant que nous regardons le travail qu’il faudra faire dans la journée. – Ah ! le bon temps !… la belle vie !… Quelle joie… quelle satisfaction d’être jeune, d’avoir une femme simple, bonne, laborieuse ! Comme tout rit dans votre âme… Comme on voit l’avenir s’étendre devant soi, loin… bien loin !… On ne sera jamais vieux… on s’aimera toujours… On conservera toujours ceux que l’on aime… On aura toujours du courage… On ira toujours se promener le dimanche bras dessus bras dessous, à la Bonne-Fontaine ! On s’assiéra toujours sur la mousse dans les bois, en écoutant les abeilles et les hannetons bourdonner autour des grands arbres pleins de lumière… On se sourira toujours !… Quelle existence, mon Dieu, quelle existence !
Et puis, le soir on rentrera tout doucement au nid ; et les grandes traînées d’or qui s’étendent dans le ciel, de Wéchem au bois de Mittelbronn, on les regardera longtemps en silence, en se serrant la main, quand la petite cloche de Phalsbourg commence à sonner l’Angelus, et que toutes celles des villages lui répondent sur la campagne déjà sombre… Ah ! la jeunesse… la vie… tout est encore là devant moi, c’est la même chose aujourd’hui qu’il y a cinquante ans, d’autres alouettes et d’autres fauvettes nichent au printemps, d’autres fleurs blanchissent les grands pommiers… faut-il donc que nous ayons changé ! faut-il que nous soyons devenus vieux, comme d’autres étaient vieux de notre temps ! – Rien que cela me ferait croire que nous redeviendrons jeunes, que nous nous aimerons encore, que nous retrouverons le père Goulden, la tante Grédel et tous les autres honnêtes gens. Autrement, ce serait trop malheureux de vieillir : Dieu ne voudrait pas nous donner ce chagrin sans espérance. Catherine pense aussi comme moi.
Enfin nous étions tout à fait heureux, nous voyions tout en beau ; rien ne pouvait troubler notre bonheur.
C’était le temps où les alliés, par centaines de mille, infanterie, cavalerie et artillerie, à pied et à cheval, avec des feuilles de chêne sur leurs shakos, sur leurs casques, au bout de leurs fusils et de leurs lances, passaient autour de la ville pour retourner chez eux. Ils poussaient des cris de joie qu’on entendait d’une lieue, comme on entend les cris des pinsons, des grives, des merles et des mille autres oiseaux du ciel à la saison des faînes. Dans un autre temps, cela m’aurait fait de la peine, parce que c’était le signe de notre défaite ; mais alors je me consolais en pensant : « Qu’ils s’en aillent, et qu’ils ne reviennent plus ! » Et quand Zébédé venait me dire que tous les jours des officiers russes, autrichiens, prussiens, bavarois, traversaient la ville pour aller voir notre commandant de place, M. de la Faisanderie, un ancien émigré qui les comblait d’honneurs, que tel officier du bataillon avait provoqué l’un de ces étrangers ; que tel autre officier en demi-solde en avait tué deux ou trois en duel, soit à la Roulette, à l’Arbre Vert ou bien au Panier fleuri, – car on s’alignait partout ; les nôtres ne pouvaient supporter la vue des ennemis ; partout on jetait son habit dans l’herbe, et les brancards de l’hôpital ne faisaient qu’aller et venir, – quand Zébédé me racontait ces choses, ou qu’il nous disait qu’on avait mis tant d’officiers en demi-solde, pour les remplacer par d’autres de Coblentz ; que les soldats allaient être forcés d’assister en grande tenue à la messe ; que les curés étaient tout, et que l’épaulette n’était plus rien ! au lieu de me chagriner, je me disais : « Bah ! bah ! tout cela finira par s’arranger… Pourvu que nous conservions le repos, pourvu que nous puissions travailler et vivre en paix, c’est le principal. »
Je ne pensais pas que, pour conserver la paix, ce n’est pas assez d’être content soi-même, mais qu’il faut que les autres le soient aussi. J’étais comme la tante Grédel qui trouvait tout très bien depuis notre mariage. Elle venait souvent nous voir, son panier plein d’œufs frais, de fruits, de légumes et de galettes pour notre ménage, et s’écriait :
– Hé ! monsieur Goulden, on n’a pas besoin de demander si les enfants vont bien, on n’a qu’à regarder leur mine.
Elle me disait aussi :
– Hé ! Joseph, ça fait une différence d’être marié, n’est-ce pas, ou de se trimbaler avec un sac et un fusil du côté de Lutzen ?
– Oui… oui… maman Grédel, je vous crois ! lui répondais-je en riant de bon cœur.
Alors elle s’asseyait, les mains sur ses genoux et disait :
– Tout cela vient de la paix… la paix fait le bonheur de tout le monde ! et quand on pense qu’un tas de gueux, de va-nu-pieds osent encore crier contre le roi !
D’abord M. Goulden, qui travaillait, ne répondait pas ; mais quand elle continuait, il disait :
– Allons, mère Grédel, un peu de calme, que diable ! Vous savez bien que maintenant les opinions sont libres ; nous avons deux chambres, nous avons une constitution, chacun peut avoir son avis.
– C’est pourtant la vérité, faisait la tante en me regardant de côté d’un air de malice ; du temps de l’autre, il fallait se taire, cela montre encore une différence !
M. Goulden n’allait pas plus loin, car il considérait la tante comme une bonne femme, mais qui ne valait pas la peine d’être convertie. Il souriait même quand elle ne criait pas trop fort, et les choses se passaient ainsi sans aigreur, lorsqu’il arriva du nouveau.
D’abord un ordre arriva de Nancy, pour forcer les gens de fermer les devantures de leurs boutiques pendant l’office du dimanche ; les juifs et les luthériens étaient forcés de fermer comme les autres. Depuis ce moment on ne criait plus dans les auberges, ni dans les cabarets ; tout était comme mort en ville pendant la messe et les vêpres ; les gens ne disaient plus rien, on se regardait comme si on avait eu peur.
Le dimanche où l’on ferma pour la première fois notre devanture, comme nous dînions dans l’ombre, le père Goulden, qui paraissait triste, dit :
– J’avais espéré, mes enfants, que tout serait fini, que l’on respecterait le bon sens, et que nous aurions le calme pour des années ; je vois malheureusement que ces Bourbons sont des espèces de Dagoberts… Tout cela devient grave !
Il n’en dit pas plus ce dimanche, et sortit dans l’après-midi pour lire les gazettes. Tous les gens qui savaient lire, – pendant que les paysans étaient à la messe – allaient lire les journaux, après avoir fermé leur boutique. C’est depuis ce temps que les bourgeois et les maîtres ouvriers ont pris l’habitude de lire la gazette, et même, un peu plus tard, ils voulurent avoir un casino.
Je me rappelle que tout le monde parlait de Benjamin Constant et qu’on mettait sa confiance en lui. M. Goulden l’aimait beaucoup ; comme il avait pris l’habitude de sortir tous les soirs, pour lire chez le père Colin ce qui se passait, nous savions aussi les nouvelles. Il nous disait :
– Le duc d’Angoulême est à Bordeaux, – le comte d’Artois est à Marseille, – ils promettent ceci, – ils ont dit cela.
Catherine était plus curieuse que moi, elle aimait à entendre les nouvelles du pays, et, quand M. Goulden disait quelque chose, je voyais dans ses yeux qu’elle lui donnait raison. – Un soir, il nous dit :
— Le duc de Berry vient chez nous.
Nous fûmes bien étonnés.
— Qu’est-ce qu’il vient donc faire ici, monsieur Goulden ? lui demanda Catherine.
— Il vient passer la revue du régiment, dit-il en souriant. Je suis curieux de le voir ; les journaux racontent qu’il ressemble à Bonaparte, mais qu’il a beaucoup plus d’esprit. Ce n’est pas étonnant pour un prince légitime ; s’il n’avait pas plus d’esprit que le fils d’un paysan, ce serait bien malheureux ! Enfin, toi, Joseph, qui connais l’autre, tu jugeras de la chose.
On pense combien cette nouvelle réveilla le pays. Depuis ce jour, on ne pensait plus qu’à dresser des arcs de triomphe, à faire des drapeaux blancs ; tous les villages des environs devaient arriver sur des charrettes enguirlandées. – On fit un arc de triomphe à Phalsbourg et un autre sur la côte de Saverne. Cela se passait à la fin du mois de septembre. Tous les jours Catherine et moi, le soir après notre souper, nous allions voir avancer l’arc de triomphe ; il était entre l’hôtel de la Ville de Metz et le confiseur Dürr, sur la route. Le vieux charpentier Ulrich et ses garçons l’élevaient ; c’était comme une grande porte, que l’on couvrait de guirlandes en feuilles de chêne, et sur les façades se déployaient des drapeaux blancs magnifiques.
Pendant qu’on finissait cet ouvrage, Zébédé vint nous voir deux ou trois fois ; le prince devait arriver par Metz ; on recevait des lettres au régiment, des lettres qui le représentaient comme aussi sévère que s’il avait gagné cinquante batailles. Mais ce qui fâchait surtout Zébédé, c’est que le prince appelait nos anciens officiers, des officiers de fortune.
Enfin il arriva le 1er octobre à six heures du soir ; on tirait déjà le canon, qu’il était encore sur la côte du Gerberhoff. Il descendit à la Ville de Metz, sans passer sous l’arc de triomphe. La place était encombrée d’officiers en grande tenue ; de toutes les fenêtres on criait : Vive le Roi ! vive le duc de Berry ! comme on avait crié, du temps de Napoléon : Vive l’Empereur !
M. Goulden, Catherine et moi, nous ne pouvions pas approcher, tant la place était encombrée de monde -nous vîmes seulement défiler les calèches et les hussards. Un piquet, du côté de chez nous, fermait la route.
Ce même soir, le duc reçut le corps d’officiers ; il daigna accepter un dîner que les officiers du 6e lui firent offrir, mais il n’invita que le colonel Zaepfel. À la suite du dîner, qui se prolongea jusqu’à dix heures, les notables lui donnèrent un bal au collège. Tous les officiers, tous les amis des Bourbons, en habit noir, culotte et bas de soie blancs, s’y rendirent avec le prince ; les demoiselles de bonne famille, en robe blanche, s’y trouvaient en foule. Je crois encore entendre, au milieu de la nuit, les chevaux du cortège passer, et les mille cris de : Vive le Roi !… vive le duc de Berry !
Toutes les fenêtres étaient illuminées ; devant celles du commandant de place, on voyait un grand écusson bleu de ciel ; la couronne et les trois fleurs de lis en or brillaient dans l’ombre. La grande salle du collège retentissait de la musique du régiment. Mlle Brémer, qui possédait une très jolie voix, devait chanter au prince l’air de Vive Henri IV ! Mais toute la ville sut le lendemain qu’elle avait été comme éblouie par la vue du prince, ce qui l’avait empêchée de dire un seul mot, et tout le monde répétait :
– Pauvre mademoiselle Félicité ! pauvre mademoiselle Félicité !
Le bal se prolongea toute la nuit. Depuis longtemps Catherine, M. Goulden et moi nous dormions, lorsque vers trois heures du matin, le passage des hussards et les cris de : Vive le duc de Berry ! nous réveillèrent. Il faut pourtant que les princes aient une bonne santé pour aller à tous ces bals, à tous ces dîners qu’on leur offre le long de la route. Ce doit être pour eux un bien grand ennui, surtout à la longue, quand on les appelle : – Sa Majesté ! Sa Dignité ! Son Excellence ! Sa Bonté ! Sa Justice ! enfin tout ce qu’on peut inventer d’extraordinaire et de nouveau, pour leur faire croire qu’on les adore et qu’on les regarde comme des dieux. Oui, s’ils finissent par mépriser les hommes, ce n’est pas étonnant : si on nous en faisait autant, nous finirions aussi par croire que nous sommes des aigles.
Enfin, ce que je viens de raconter est l’exacte vérité, et je n’ai rien dit de trop.
Le lendemain, cela recommença pour ainsi dire avec un nouvel enthousiasme. Il faisait très beau temps ; mais, comme le prince avait mal dormi, comme il s’était beaucoup ennuyé de voir ces petits bourgeois, qui voulaient imiter la cour sans réussir ; comme il trouvait aussi peut-être qu’on ne lui faisait pas encore assez d’honneur et qu’on ne criait pas assez : Vive le Roi ! vive le duc de Berry ! – car tous les soldats gardaient le silence, – il était de très mauvaise humeur.
Ce jour-là, je le vis très bien pendant la revue qui tenait les côtés de la place ; nous étions, M. Goulden, Catherine et moi, chez le marchand de cuir Wittman, au premier, et pendant la bénédiction du drapeau et le Te Deum à l’église, nous le vîmes aussi, car nous avions le quatrième banc en face du chœur. On disait bien qu’il ressemblait à Napoléon, mais ce n’était pas vrai ; c’était un bon gros garçon court et trapu, les joues pâles à cause de la fatigue, et pas vif du tout, au contraire. Pendant tout l’office, il ne faisait que bâiller et se balancer sur les hanches lentement, comme un pendule. Je vous dis ce que j’ai vu moi-même, et cela montre combien les gens sont aveugles ; ils veulent trouver des ressemblances partout.
Pendant les revues, je me souviens aussi que l’Empereur venait à cheval, et que d’un coup d’œil il découvrait si tout était en ordre ; au lieu que le duc s’approcha des rangs à pied, et même, deux ou trois fois, il fit des reproches à de vieux soldats en les regardant du haut en bas. Ce fut le pire. Il avait regardé Zébédé de cette manière, et Zébédé n’a jamais pu lui pardonner.
Voilà pour la revue. Mais une chose plus grave, c’est la distribution des croix et des fleurs de lis. Quand je vous dirai que tous les maires, les adjoints, les conseillers des Baraques-d’en-Haut, des Baraques du Bois-de-Chênes, du Holderloch et de Hirschland reçurent la fleur de lis, parce qu’ils étaient en tête de leur village, avec le drapeau blanc, et que Pinacle, – pour être arrivé le premier, avec la musique du bohémien Waldteufel qui jouait : Vive Henri IV, et cinq ou six drapeaux blancs, plus grands que les autres, – reçut la croix d’honneur ! quand je vous dirai cela, vous comprendrez ce que pensaient les gens raisonnables : ce fut un véritable scandale.
Dans l’après-midi, vers quatre heures, le prince partit pour Strasbourg, accompagné de tous les royalistes du pays, à cheval, les uns sur de bons chevaux, les autres, comme Pinacle, sur de vieilles rosses. On lui avait préparé le dîner sur la côte de Saverne.
Une chose que tout les Phalsbourgeois de ce temps se rappellent encore, c’est que le prince était déjà dans sa calèche et qu’il partait lentement, lorsqu’un officier émigré, la tête nue, en uniforme, se mit à courir derrière, en criant d’une voix lamentable qu’on entendait sur toute la place ;
– Du pain !… mon prince… du pain pour mes enfants !
Cela faisait rougir les gens qui se sauvaient de honte.
Nous étions rentrés chez nous en silence ; le père Goulden semblait rêveur, lorsque la tante Grédel arriva.
– Eh bien ! mère Grédel, lui dit-il, vous devez être contente ?
– Et pourquoi ?
– Pinacle est décoré.
Elle devint toute verte et s’assit en disant au bout d’une minute :
– Ça c’est la plus grande gueuserie qu’on puisse voir. Mais si le prince avait su ce que Pinacle vaut, monsieur Goulden, au lieu de lui donner la croix, il l’aurait plutôt fait pendre.
– Voilà justement le mal, répondit M. Goulden ; ces gens-là font beaucoup de choses pareilles sans le savoir, et, quand ils le sauront, ce sera peut-être trop tard.
VIII
C’est ainsi que Mgr le duc de Berry visita les départements de l’Est ; le bruit de ses moindres paroles se répandit au loin ; les uns célébraient ses grâces infinies, et les autres gardaient le silence.
Depuis ce moment, plus d’une fois l’idée me vint que tous ces émigrés, tous ces officiers en demi-solde, tous ces prédicateurs avec leurs processions et leurs expiations, finiraient par tout bouleverser ; et, quelque temps après, à l’entrée de l’hiver, nous sûmes que ce n’était pas seulement chez nous, mais que c’était jusqu’au fond de l’Alsace, que les affaires se gâtaient de la sorte.
Un matin que le père Goulden et moi nous travaillions, entre onze heures et midi, rêvant chacun à sa manière, et que Catherine dressait la table, je sortis me laver les mains à la pompe, ce que je faisais toujours avant de dîner. Une vieille, au bas de l’escalier, s’essuyait les pieds sur le paillasson ; elle secouait ses jupes couvertes de boue et tenait un bâton avec un grand chapelet qui lui pendait au coude. Comme je la regardais du haut de la rampe, elle se mit à monter, et je reconnus tout de suite, à ses petits yeux plissés et à sa petite bouche entourée de rides innombrables, que c’était Anna-Marie, la pèlerine de Saint-Witt.
Cette pauvre vieille nous apportait souvent des montres à raccommoder, pour les personnes pieuses qui mettaient leur confiance en elle ; sa vue réjouissait toujours le père Goulden.
– Hé ! s’écriait-il, c’est Anna-Marie ; nous allons prendre une bonne prise. Et comment va M. le curé un tel ? Comment se porte M. le vicaire un tel ? A-t-il toujours bonne mine ? Et M. Jacob de tel endroit ? Et le vieux sacristain Niclausse ? c’est toujours lui qui sonne les cloches à Dann, à Hirschland, à Saint-Jean ? Il commence à se faire bien vieux !
– Ah ! monsieur Goulden, merci pour M. Jacob ; vous savez qu’il a perdu Mlle Christine la semaine dernière.
– Comment… comment… Mlle Christine !…
– Mon Dieu, oui…
– Quel malheur !… Enfin, il faut penser que nous sommes tous mortels.
– Oui, monsieur Goulden ; et puis, quand on a la grâce de recevoir les saintes consolations de l’Église…
– Sans doute… sans doute… c’est le principal ! Voilà comment ils causaient, et le père Goulden riait intérieurement. Il savait tout ce qui se passait dans la sacristie à six lieues autour de la ville. De temps en temps, il me lançait un regard malin. J’avais vu cela cent fois depuis mon apprentissage ; mais on comprend combien M. Goulden devait être encore plus curieux ce jour-là d’apprendre ce qui se passait au pays.
– Hé ! c’est Anna-Marie, dit-il en se levant ; depuis combien de temps on ne vous a pas vue ?
– Depuis trois mois, monsieur Goulden, trois grands mois ; j’ai fait des pèlerinages à Saint-Witt, à Sainte-Odile, à Marienthal, à Hazlach ; j’avais des vœux pour tous les saints en Alsace, en Lorraine et dans les Vosges. Enfin me voilà presque débarrassée ; il ne me reste plus que Saint-Quirin.
– Ah ! tant mieux, vos affaires vont bien, cela me fait plaisir. Asseyez-vous, Anna-Marie, reposez-vous.
Je voyais dans ses yeux combien il était content de faire dévider son chapelet à la vieille. Mais il paraît qu’Anna-Marie avait des affaires ailleurs.
– Ah ! monsieur Goulden, dit-elle, je ne peux pas aujourd’hui, les autres sont en avance : la mère Evig, Gaspard Rosenkrantz et Jacob Heilig. Il faut que j’aille encore à Saint-Quirin ce soir ; je suis seulement entrée pour vous dire que l’horloge de Dosenheim est dérangée, et qu’on vous attend pour la remettre.
– Bah ! bah ! restez donc un instant.
– Non, je ne peux pas ; je suis bien fâchée, monsieur Goulden, mais il faut que je finisse ma tournée.
Elle avait déjà repris son paquet, et M. Goulden paraissait contrarié, lorsque Catherine, posant le grand plat de choux sur la table, se mit à dire :
— Comment ! vous voulez partir, Marie-Anne ? Vous n’y pensez pas… Voici déjà votre assiette.
Alors elle, tournant la tête, vit la grande soupière fumante, et les choux qui répandaient une odeur délicieuse.
– Je suis bien pressée, dit-elle.
– Bah ? vous avez de bonnes jambes, répondit Catherine en clignant de l’œil du côté de M. Goulden.
– Ah ! pour cela, Dieu merci, les jambes sont encore bonnes.
– Eh bien donc, asseyez-vous, reprenez un peu de force ; c’est un métier bien dur de marcher toujours.
– Oui, madame Bertha, certainement ; on gagne bien les trente sous qu’on vous donne, allez !
J’avançais les chaises :
– Asseyez-vous, Marie-Anne, et donnez-moi votre bâton.
– Il faut donc que je vous écoute, dit-elle ; mais je ne m’arrêterai pas longtemps : je ne veux prendre qu’une bouchée, ensuite je pars.
– Oui, oui, c’est entendu, Marie-Anne, on ne vous retardera pas trop, dit M. Goulden.
Chacun avait pris sa place. M. Goulden servait déjà, Catherine me regardait en souriant, et je me disais :
« Les femmes sont pourtant plus fines que nous ! »
J’étais tout réjoui. – Qu’est-ce qu’un homme peut souhaiter de mieux que d’avoir une femme d’esprit ? C’est un véritable trésor, et j’ai vu souvent que les hommes sont heureux en se laissant conduire par des femmes pareilles.
On pense bien qu’une fois à table, près d’un bon poêle, – au lieu d’être dehors, les pieds dans la boue, et de sentir la bise de novembre souffler dans ses jupes, l’on pense qu’Anna-Marie ne songeait plus à se mettre en route. C’était une bonne créature, qui soutenait encore à soixante-cinq ans deux petits enfants de son fils, mort depuis quelques années. Et de courir le pays à cet âge, de recevoir le vent, la pluie et la neige sur le dos, de dormir dans les granges et les étables sur la paille, de ne manger les trois quarts du temps que des pommes de terre, et pas toujours autant qu’on en voudrait, ce n’est pas pour vous faire mépriser une bonne assiettée de soupe bien chaude, un bon morceau de lard fumé, avec de bons choux, et deux ou trois verres de vin qui vous réchauffent le cœur ! Non, il faut voir les choses comme elles sont ; la vie de ces pauvres gens est bien triste ; chacun ferait bien d’aller en pèlerinage pour son propre compte.
Enfin Anna-Marie comprenait la différence d’être à table ou sur la route ; elle mangeait de bon appétit, et se faisait un véritable plaisir de nous raconter ce qu’elle avait appris dans sa dernière tournée.
– Oui, maintenant tout va bien, disait-elle ; toutes ces processions et ces expiations que vous avez vues ne sont encore rien, il faut que cela grandisse de jour en jour. Et vous saurez qu’il va venir parmi nous des missionnaires comme dans le temps parmi les sauvages, pour nous convertir, et qu’ils viennent de M. de Forbin-Janson et de M. de Rauzan, parce que la corruption du siècle est trop grande. Et l’on va rebâtir partout les couvents ; et l’on remettra les barrières sur les routes, comme avant la rébellion de vingt-cinq ans ! Et quand les pèlerins arriveront à la porte des couvents, ils n’auront qu’à sonner, on leur ouvrira tout de suite, le frère servant viendra leur apporter des écuelles de soupe grasse, entremêlées de viande les jours ordinaires, et des écuelles de soupe maigre, avec du poisson, les vendredis, les samedis et tout le temps du carême. – De cette manière, la piété grandira, tout le monde voudra se faire pèlerin. Mais les dames religieuses de Bichofsheim ont dit que les anciens pèlerins de père en fils, comme nous, oseraient seuls aller en pèlerinage, parce que chacun doit rester dans son état : les paysans doivent être attachés à la terre, et les seigneurs doivent ravoir leurs châteaux pour gouverner. J’ai moi-même entendu ces choses de mes propres oreilles, chez les dames religieuses, qui vont aussi ravoir leurs dots, parce qu’elles sont revenues de l’exil, et qu’il faut leur restituer la dot pour rebâtir la chapelle ; c’est une chose très sûre.
Ah ! Seigneur, si c’était déjà fait seulement, et que je puisse en profiter dans ma vieillesse. Voilà bien assez longtemps que je jeûne, et mes petites filles aussi. Je les mènerais avec moi, je leur apprendrais les prières et j’aurais la consolation, à ma mort, de leur laisser un bon état.
En l’écoutant raconter ces choses contraires au bon sens, nous étions encore tout émus, parce qu’elle pleurait d’attendrissement de voir d’avance ses petites-filles mendier à la porte des couvents, et le frère servant leur apporter de la soupe.
– Et vous saurez aussi, dit-elle, que M. de Rauzan et le révérend père Tarin veulent qu’on rebâtisse les châteaux, qu’on rende les bois, les prés, les champs aux nobles, et qu’on remette tous les étangs en eau provisoirement, parce que les étangs sont aux révérends pères, qui n’ont pas le temps de labourer, de semer ni de récolter : il faut que tout vienne seul.
– Mais dites donc, Marie-Anne, ce que vous racontez là, demandait le père Goulden, est-ce bien sûr ? Je ne puis presque pas croire qu’un si grand bonheur nous soit réservé.
– C’est tout à fait sûr, monsieur Goulden, disait-elle ; M. le comte d’Artois veut faire son salut, et pour qu’il puisse faire son salut, tout doit rentrer dans l’ordre. À Marienthal, M. le vicaire Antoine disait encore ces choses la semaine dernière. Ce sont des choses, voyez-vous, qui viennent d’en haut. Seulement, il faut un peu de patience, il faut que le cœur des gens s’habitue par les prédications et les expiations. Ceux qui ne voudront pas s’habituer, comme les juifs et les luthériens, on les forcera. Et les jacobins…
En parlant des jacobins, Anna-Marie regarda tout à coup M. Goulden et devint rouge jusqu’aux oreilles ; mais elle se remit, car il souriait.
— Parmi les jacobins, dit-elle alors, il s’en trouve quelques-uns de très bons tout de même ; mais il faut pourtant que les pauvres vivent… les jacobins ont pris les biens des pauvres, ce n’est pas beau.
– Mais où donc et quand ont-ils pris les biens des pauvres, Marie-Anne ?
– Écoutez, monsieur Goulden, les moines et les capucins avaient les biens des pauvres, et les jacobins se sont tout partagé entre eux.
– Ah ! je comprends, je comprends, dit le père Goulden, les moines et les capucins avaient votre bien, Marie-Anne ? Je n’aurais jamais deviné cela.
M. Goulden souriait toujours, et Marie-Anne dit :
– Je savais bien que nous serions d’accord à la fin.
– Oui, oui, nous sommes d’accord, fit-il avec bonté.
Moi j’écoutais sans rien dire, étant naturellement curieux d’apprendre ce qui pouvait nous arriver. Il était facile de voir que Marie-Anne nous rapportait ce qu’elle avait entendu dans son dernier voyage.
Elle disait aussi que les miracles allaient revenir ; que saint Quirin, sainte Odile et les autres n’avaient pas voulu faire des miracles sous l’usurpateur ; mais que maintenant les miracles recommençaient déjà, que le petit saint Jean noir à Kortzeroth, en voyant revenir l’ancien prieur de l’exil, s’était mis à verser des larmes.
– Oui, oui, je comprends, dit M. Goulden, cela ne m’étonne pas, après les expiations et les processions, il faut aussi que les saints fassent des miracles ; c’est tout naturel, Marie-Anne, c’est tout naturel.
– Sans doute, monsieur Goulden ; et quand on verra les miracles, la foi reviendra.
– C’est clair, c’est clair.
Le dîner était alors fini ; Marie-Anne, ne voyant plus rien venir, se souvint qu’elle était en retard et s’écria :
– Seigneur Dieu, voici une heure qui sonne ; les autres doivent être déjà près d’Ercheviller. Maintenant il est temps que je vous quitte.
Elle s’était levée et prenait son bâton d’un air affairé.
– Allons, bon voyage, Anne-Marie, lui dit M. Goulden, et ne vous faites plus si longtemps attendre.
– Ah, monsieur Goulden, fit-elle à la porte, si je ne suis pas tous les jours assise à votre table, ce n’est pas ma faute.
Elle riait, et dit encore en prenant son paquet :
– Allons, au revoir, et, pour tout le bien que vous me faites, je vais prier le bienheureux saint Quirin de vous envoyer un bon gros garçon, rose et frais comme une pomme d’api. Voilà, madame Bertha, tout ce qu’une pauvre vieille femme comme moi peut faire.
En entendant ces bonnes paroles, je me dis : « Cette pauvre vieille Anne-Marie est pourtant une bonne âme. Justement ce qu’elle vient de dire, c’est ce que je souhaite le plus au monde. Que Dieu l’entende ! » J’étais attendri de ce bon souhait. Elle, alors, descendait l’escalier, et, lorsqu’on l’entendit refermer la porte en bas, Catherine se mit à rire en disant :
– Cette fois elle a bien vidé son sac.
– Oui, mes enfants, répondit M. Goulden, qui semblait tout pensif, voilà bien ce qu’on peut appeler l’ignorance humaine. On voudrait croire que cette pauvre créature invente tout cela ; malheureusement, elle ramasse tout à droite et à gauche ; c’est mot à mot ce que pensent les émigrés, c’est ce que répètent leurs journaux tous les jours, et ce que les prédicateurs prêchent ouvertement dans toutes les églises. Louis XVIII les gêne ; il a trop de bon sens pour eux ; leur véritable roi, c’est Mgr le comte d’Artois, qui veut faire son salut ; et pour que monseigneur fasse son salut, il faut que tout soit rétabli comme avant la rébellion de vingt-cinq ans ; il faut que les biens nationaux soient rendus à leurs anciens maîtres, il faut que la noblesse ait ses droits et privilèges comme en 1788, et qu’elle occupe tous les grades de l’armée ; il faut que la religion catholique, apostolique et romaine soit la seule religion de l’État ; il faut l’observation des dimanches et jours de fête, il faut que les hérétiques soient chassés de toutes les places, et que les prêtres donnent seuls l’instruction aux enfants du peuple ; il faut que cette grande et terrible nation, qui, pendant vingt-cinq ans, a porté ses idées de liberté, d’égalité, de fraternité dans tout l’univers, à force de bon sens et de victoires – et qui n’aurait jamais été vaincue si l’empereur n’avait pas fait alliance avec les rois à Tilsit, – il faut que cette nation, qui, dans quelques années, a produit autant de grands capitaines, de grands orateurs, de grands savants et de génies de toute sorte, que ces races nobles en deux mille ans, il faut qu’elle cède tout, qu’elle se remette à gratter la terre pendant que les autres, qui ne sont pas un contre mille, se gobergeront de père en fils et feront les jolis cœurs à ses dépens ! Oh ! bien sûr qu’elle va rendre les champs, les prés, les étangs, comme dit Anna-Marie, et qu’elle rebâtira les châteaux et les couvents, cela ne peut manquer ; pour être agréable à M. le comte d’Artois et l’aider à faire son salut, c’est bien le moins qu’elle lui doive… Un si grand prince !
Alors le père Goulden, joignant les mains et regardant le plafond, se mit à dire :
– Seigneur Dieu… Seigneur Dieu… vous qui faites faire tant de miracles au petit saint Jean noir de Kortzeroth, si vous faisiez seulement entrer un seul rayon de bon sens dans la tête de monseigneur et de ses amis, je crois que ce serait encore plus beau que les larmes du petit saint ! – Et l’autre, là-bas dans son île, avec ses yeux clairs, c’est comme un épervier qui fait semblant de dormir, en regardant des oies patauger dans une mare… Seigneur Dieu, songez qu’en cinq ou six coup d’aile il sera dessus… les oies se sauveront ; mais nous autres, nous aurons encore une fois l’Europe sur le dos !
Il disait ces choses d’un air grave, et moi je regardais Catherine, pour savoir s’il fallait rire ou pleurer. Tout à coup il s’assit en disant :
– Allons, Joseph, tout cela n’est pas gai ; mais qu’est-ce que nous pouvons y faire ? il est temps de se remettre à l’ouvrage. Regarde un peu ce qui manque à la montre de M. le curé Jacob.
Catherine alors levait la nappe, et chacun se remettait au travail.
IX
L’hiver était venu ; c’était un hiver pluvieux, mêlé de neige et de vent. Les toits, dans ce temps, n’avaient pas encore de chéneaux, la pluie tombait des tuiles, et le vent la chassait jusqu’au milieu des rues. On entendait ce clapotement toute la journée, pendant que le poêle bourdonnait, que Catherine courait autour de nous, surveillait le feu, levait le couvercle des marmites, et quelquefois se mettait à chanter tout bas, en s’asseyant à son rouet. Le père Goulden et moi, nous étions alors tellement habitués à cette existence que l’ouvrage se faisait en quelque sorte sans y penser. Nous n’avions plus à nous inquiéter de rien ; la table était mise et le dîner servi juste sur le coup de midi. C’était la vie de famille.
Le soir, M. Goulden sortait, après le souper, pour aller lire la gazette au café Hoffmann, son vieux manteau bien tiré sur les épaules et son gros bonnet de renard enfoncé dans la nuque. Malgré cela, souvent, le soir après dix heures, lorsque nous étions déjà couchés, nous l’entendions revenir en toussant, il avait eu les pieds mouillés ; Catherine me disait :
– Le voilà maintenant qui tousse, il se croit toujours jeune comme à vingt ans.
Et le matin, elle ne se gênait pas pour lui faire des reproches.
– Monsieur Goulden, disait-elle, vous n’êtes pas raisonnable, vous avez un gros rhume, et vous sortez tous les soirs.
– Hé ! que veux-tu, mon enfant, maintenant j’ai l’habitude de lire la gazette ; c’est plus fort que moi, je veux savoir ce que disent Benjamin Constant et les autres ; c’est comme une seconde vie, et bien souvent je pense : « Ils auraient encore dû parler de telle chose… Si Melchior Goulden avait été là, il aurait encore réclamé sur tel chapitre et cela n’aurait pas manqué de produire un grand effet. »
Alors il riait en hochant la tête, et disait :
– Chacun croit avoir plus d’esprit et de bon sens que les autres, mais Benjamin Constant me fait toujours plaisir.
Nous ne savions que répondre, car son amour pour la gazette était trop grand. Un jour Catherine lui dit :
– Monsieur Goulden, puisque maintenant vous voulez savoir les nouvelles, ce n’est pas une raison pour vous rendre malade. Vous n’avez qu’à faire comme le vieux menuisier Carabin ; il s’est entendu la semaine dernière avec le père Hoffmann, qui lui envoie le journal après sept heures – quand les autres l’ont déjà lu – moyennant trois francs par mois. De cette manière, sans se déranger, Carabin sait tout ce qui se passe, et sa femme, la vieille Bével, aussi ; ils causent entre eux de ces choses au coin du feu, ils disputent ensemble, et voilà ce que vous devriez faire.
– Hé ! sais-tu, Catherine, que c’est une fameuse idée ! dit M. Goulden. Oui… mais trois francs !…
– Les trois francs ne sont rien, dis-je alors, le principal, c’est de ne pas tomber malade ; vous toussez tous les soirs comme un malheureux, et cela ne peut pas continuer.
Ces paroles, bien loin de le fâcher, le réjouissaient, car il voyait que nous lui parlions ainsi par affection, et qu’il devait nous croire.
– Eh bien ! dit-il, nous tâcherons d’arranger les choses comme vous voulez ; d’autant plus qu’une masse d’officiers en demi-solde remplissent le café du matin au soir, qu’ils se passent les gazettes les uns aux autres et qu’il faut attendre quelquefois deux heures pour en attraper une. Oui, Catherine a raison.
Et ce jour même il alla voir le père Hoffmann, de sorte que Michel, l’un des garçons du café, nous apportait la gazette tous les soirs après sept heures, au moment de nous lever de table. Chaque fois que nous l’entendions monter, c’était une véritable joie pour nous, tout le monde disait :
– Voici la gazette !
On se levait ; Catherine se dépêchait de lever la nappe et de tout mettre en ordre ; je fourrais une bonne bûche au fourneau ; M. Goulden tirait ses besicles de l’étui, et pendant que Catherine filait, que je fumais ma pipe comme un vieux soldat, en regardant la flamme danser dans le poêle, il nous lisait les nouvelles de Paris. – Ce que nous avions de bonheur et de satisfaction d’entendre Benjamin Constant et deux ou trois autres, soutenir ce que nous pensions nous-mêmes, ne peut pas s’imaginer. Quelquefois M. Goulden était forcé de s’interrompre pour essuyer ses lunettes, et Catherine s’écriait aussitôt :
– Comme ces gens parlent bien ! Voilà ce qui s’appelle des hommes de bon sens… Oui, tout ce qu’ils soutiennent est juste, c’est la pure vérité.
Chacun de nous approuvait. Le père Goulden seulement pensait qu’il aurait encore fallu parler de ceci ou de cela, mais que le reste était bien. Il reprenait sa lecture, qui nous menait jusqu’à dix heures, et l’on allait ensuite se coucher en rêvant à ce qu’on venait d’entendre.
Dehors, le vent soufflait comme il souffle à Phalsbourg, les girouettes tournaient sur leur tringle en grinçant, la pluie fouettait les murs ; et nous, bien au chaud, nous écoutions et nous bénissions le Seigneur, jusqu’à ce que le sommeil vînt nous faire tout oublier. – Ah ! que l’on dort bien et qu’on est heureux avec la paix de l’âme, la force, la santé, l’amour et le respect de ce qu’on aime ! Que peut-on souhaiter de plus dans ce monde ? – Les jours, les semaines, les mois se passaient ainsi ; nous devenions en quelque sorte des politiques, et quand les ministres allaient parler, nous pensions d’avance :
« Ah ! les gueux, ils veulent nous tromper… Ah ! la mauvaise espèce… on devrait tous les chasser. »
Catherine surtout ne pouvait pas souffrir ces gens, et quand la mère Grédel venait nous parler, comme autrefois de notre bon roi Louis XVIII, nous la laissions dire par respect, en la plaignant d’être aveugle sur les affaires du pays.
Il faut reconnaître aussi que ces émigrés, ces ministres et ces princes se conduisaient vis-à-vis de nous comme de véritables insolents. Si M. le comte d’Artois et ses fils s’étaient mis à la tête des Vendéens et des Bretons, s’ils avaient marché sur Paris et remporté la victoire, ils auraient eu raison de nous dire : « Nous sommes vos maîtres et nous vous donnons la loi. » Mais d’avoir été chassés d’abord, puis d’avoir été ramenés chez nous par les Prussiens et les Russes, et de venir ensuite nous humilier, voilà quelque chose de bien méprisable ! Plus j’avance en âge, plus je suis dans cette idée : – c’était honteux.
Zébédé venait aussi de temps en temps nous voir, et tout ce que nous lisions dans la gazette, il le savait. C’est lui qui nous apprit le premier que de jeunes émigrés avaient chassé le général Vandamme de la présence du roi. Ce vieux soldat, qui revenait des prisons de Russie, et que toute l’armée respectait malgré son malheur de Kulm, ils l’avaient conduit dehors, en lui disant que ce n’était pas sa place. Vandamme avait été colonel d’un régiment à Phalsbourg, toute la ville le connaissait ; on ne peut pas se figurer l’indignation des honnêtes gens à cette nouvelle.
C’est encore Zébédé qui nous dit qu’on faisait des procès aux généraux en demi-solde, et qu’on volait leurs lettres à la poste pour les faire considérer comme des traîtres. – Il nous dit un peu plus tard qu’on allait renvoyer les filles des anciens officiers, qui se trouvaient à l’école de Saint-Denis, en leur donnant une pension de deux cents francs, – et, plus tard, que les émigrés voulaient seuls avoir le droit de mettre leurs fils aux écoles de Saint-Cyr et de la Flèche, pour sortir comme officiers ; pendant que le peuple resterait soldat à cinq centimes par jour dans les siècles des siècles !
Les gazettes racontaient les mêmes choses, mais Zébédé savait bien d’autres détails ; les derniers soldats savaient tout. Je ne pourrais jamais vous représenter la figure de Zébédé, assis derrière le fourneau, son bout de pipe noire entre les dents, lorsqu’il nous racontait ces misères ; son grand nez pâlissait, il avait des tremblements au coin de ses yeux gris-clair, et de temps en temps il faisait semblant de rire et murmurait :
– Ça marche !… ça marche !…
– Et qu’est-ce que les autres soldats pensent de tout cela ? demandait le père Goulden.
– Hé ! ils pensent que ça va bien. Quand on a donné son sang vingt ans pour la France, quand on a dix, quinze, vingt campagnes, trois chevrons et qu’on est criblé de blessures : d’apprendre qu’on chasse vos anciens chefs, qu’on met leurs filles dehors, et que les fils de ces gens-là vont devenir vos officiers à perpétuité, ça vous réjouit, père Goulden, faisait-il, pendant que ses joues tremblotaient jusqu’à ses oreilles.
– Sans doute, sans doute, c’est malheureux, disait M. Goulden ; mais la discipline est toujours là ; les maréchaux obéissent aux ministres, les officiers aux maréchaux, et les soldats aux officiers.
– Vous avez raison, répondait Zébédé. Mais voici qu’on bat le rappel.
Il nous serrait la main et se dépêchait de courir à la caserne.
Tout l’hiver s’écoula de la sorte ; l’indignation augmentait de jour en jour. La ville était pleine d’officiers en demi-solde qui n’osaient plus rester à Paris : des lieutenants, des capitaines, des commandants, des colonels de tous les régiments de cavalerie et d’infanterie, des gens qui vivaient d’une croûte de pain et d’un petit verre, et d’autant plus malheureux qu’ils étaient forcés d’avoir une tenue. Qu’on se représente des hommes pareils, les joues creuses, les cheveux coupés ras, les yeux luisants, avec leurs grosses moustaches et leurs vieilles capotes d’uniforme, dont il avait fallu changer les boutons. Qu’on se les représente qui se promènent par trois, six, dix sur la place, la grande canne à épée pendue à la boutonnière, le grand chapeau à cornes en travers des épaules, toujours bien brossés, mais tellement râpés, tellement minables, que l’idée vous venait tout de suite qu’ils ne mangeaient pas au quart de leur appétit. On était pourtant forcé de se dire : « Voilà les vainqueurs de Jemmapes, de Fleurus, de Zurich, de Hohenlinden, de Marengo, d’Austerlitz, de Friedland, de Wagram… Si nous sommes fiers d’être Français, ce n’est pas le comte d’Artois, ni le duc de Berry ou d’Angoulême qui peuvent se vanter d’en être cause, ce sont bien ceux-ci. Et maintenant on les laisse dépérir, on leur refuse jusqu’au pain, pour mettre des émigrés à leur place. C’est une véritable abomination. » Il ne fallait pas avoir beaucoup de bon sens, ni de cœur, ni de justice, pour reconnaître que c’était contre nature.
Moi, je ne pouvais pas voir ces malheureux, cela me retournait le cœur. Quand on a servi, ce ne serait que six mois, le respect de vos anciens chefs, de ceux qu’on a vu les premiers au feu, vous reste toujours. J’étais honteux pour mon pays de souffrir des indignités pareilles.
Une chose que je n’oublierai jamais, c’est qu’à la fin du mois de janvier 1815, deux de ces officiers en demi-solde, – dont l’un grand, sec, la tête déjà grise, connu sous le nom de colonel Falconette, et qui semblait avoir servi dans l’infanterie ; l’autre petit, trapu, qu’on appelait le commandant Margarot, et qui conservait encore les favoris des hussards, – vinrent nous proposer d’acheter une montre superbe. Il pouvait être dix heures du matin ; je les vois encore entrer gravement, le colonel avec son col relevé, et l’autre la tête dans les épaules. Leur montre était en or, à double bassin et sonnerie, elle marquait les secondes et se remontait tous les huit jours ; je n’en avais jamais vu d’aussi belle. Comme M. Goulden l’examinait, moi, tourné sur ma chaise, je continuais à regarder ces hommes, qui paraissaient avoir un grand besoin d’argent. Le hussard surtout, avec sa figure brune, osseuse, ses grandes moustaches roussâtres, ses petits yeux bruns, ses larges épaules et ses longs bras qui lui pendaient jusqu’aux genoux, m’inspirait un grand respect. Je pensais : « Quand celui-là tenait son sabre de hussard au bout de son bras, cela devait aller loin ; ses petits yeux devaient briller sous ses gros sourcils ; la parade et la riposte devaient arriver comme un éclair. » Je me le figurais dans une charge, à moitié caché derrière la tête de son cheval, la pointe en avant, de sorte que mon admiration s’en augmentait d’autant plus.
Je me rappelai tout à coup que le commandant Margarot et le colonel Falconette avaient tué des officiers russes et autrichiens en duel derrière l’Arbre vert, et que toute la ville ne parlait que d’eux quatre ou cinq mois auparavant, au passage des alliés. Le grand alors, avec son col sans chemise, quoique mince, sec et pâle, les tempes grises et l’air froid, me parut aussi très respectable.
J’attendais ce que le père Goulden allait dire de leur montre. Lui ne levait pas les yeux, il regardait avec une sorte d’admiration profonde ; tandis que ces deux hommes attendaient d’un air calme, mais comme des gens qui souffrent de ne plus pouvoir cacher leur gêne.
M. Goulden finit par dire :
– Ceci, messieurs, est un ouvrage de toute beauté, c’est ce qu’on peut appeler une montre de prince.
– Sans doute, répondit le hussard, et c’est aussi d’un prince que je l’aie reçue, après la bataille de Rabbe.
Il jeta un coup d’œil à l’autre qui ne dit rien.
M. Goulden, les regardant alors, vit qu’ils étaient dans un grand besoin ; il ôta son bonnet de soie noire et se leva lentement en disant :
– Messieurs, ne vous offensez pas de ce que je vais vous dire, je suis comme vous un ancien soldat, j’ai servi la France sous la République, et je crois que ce doit être un véritable déchirement de cœur d’être forcé de vendre un objet pareil, un objet qui nous rappelle une belle action de notre vie et le souvenir d’un chef qui nous est cher.
Je n’avais jamais entendu le père Goulden parler avec un pareil attendrissement, sa tête chauve, courbée d’un air triste, et les yeux à terre, comme pour ne pas voir la douleur de ceux auxquels il parlait. Le commandant était devenu tout rouge, ses petits yeux semblaient troubles, ses grands doigts s’agitaient ; le colonel était pâle comme un mort. J’aurais voulu m’en aller.
M. Goulden reprit :
– Cette montre vaut plus de mille francs ; je n’ai pas cette somme en main, et d’ailleurs vous auriez sans doute un grand regret de vous séparer d’un tel souvenir. Voici donc ce que je vous offre : la montre restera, si vous voulez, à ma devanture ; – elle sera toujours à vous, – et je vais vous avancer deux cents francs que vous me rendrez en venant la reprendre.
En entendant cela, le hussard étendit ses deux grandes mains velues, comme pour embrasser le père Goulden.
– Vous êtes un bon patriote, vous ! s’écria-t-il. Colin nous l’avait bien dit… Ah ! monsieur, je n’oublierai jamais le service que vous me rendez… Cette montre… je l’ai reçue du prince Eugène pour une action d’éclat… J’y tiens comme à mon propre sang… Mais la misère…
– Commandant ! fit l’autre tout pâle.
Mais le hussard ne voulut pas l’écouter et s’écria en l’écartant du bras :
– Non, colonel, laissez-moi… nous sommes entre nous… un vieux soldat peut nous entendre… On nous affame… on se conduit vis-à-vis de nous comme des Cosaques… On est trop lâche pour nous fusiller !
Il remplissait toute la maison de ses cris. Moi, j’avais couru dans la cuisine avec Catherine, pour ne pas voir ce triste spectacle. M. Goulden le modérait ; nous écoutions :
– Oui, je sais tout cela, messieurs, disait-il, je me mets dans votre position…
– Allons… Margarot… du calme ! disait le colonel. Ces cris durèrent près d’un quart d’heure. À la fin nous entendîmes M. Goulden compter l’argent, et le hussard lui dire :
– Merci, monsieur, merci ! Si jamais l’occasion se présente, souvenez-vous du commandant Margarot.
En même temps la porte s’ouvrit, et ils descendirent l’escalier, ce qui nous soulagea beaucoup, Catherine et moi, car nous avions le cœur serré. Nous rentrâmes dans la chambre. M. Goulden, qui venait de reconduire ces officiers, remonta presque aussitôt, la tête nue. Il était bouleversé.
– Ces malheureux ont raison, dit-il en remettant son bonnet, la conduite du gouvernement à leur égard est horrible ; mais ces choses-là se payent tôt ou tard.
Tout le reste de cette journée, nous étions tristes. M. Goulden pourtant m’expliqua les beautés de la montre, et me dit qu’on devrait toujours avoir de semblables modèles sous les yeux ; ensuite nous la suspendîmes à notre devanture.
Depuis ce moment, l’idée ne me quitta plus que tout finirait mal, et que, même en s’arrêtant, les émigrés en avaient déjà trop fait. J’entendais toujours la voix du commandant crier dans notre chambre qu’on se conduisait vis-à-vis de l’armée comme des Cosaques ! Le souvenir des processions, des expiations, des prédications sur la rébellion de vingt-cinq ans et la restitution des biens nationaux, le rétablissement des couvents et le reste… tout cela me paraissait un terrible mélange, qui ne devait rien produire de bon.
X
Nous en étions là quand, au commencement du mois de mars, le bruit se répandit comme un coup de vent que l’Empereur venait de débarquer à Cannes. D’où venait ce bruit ? Personne n’a jamais pu le dire : Phalsbourg est à deux cents lieues de la mer : bien des plaines et des montagnes le séparent du Midi ; – moi-même je me rappelle une chose extraordinaire. Le 5 mars, en me levant, j’avais poussé la fenêtre de notre petite chambre, qui s’ouvrait au bord du toit ; je regardais en face les vieilles cheminées noires du boulanger Spitz, il restait encore un peu de neige derrière ; le froid était vif, pourtant le soleil donnait, et je pensais : « Voilà ce qui s’appelle un bon temps pour la marche ! » Je me souvenais comme nous étions contents en Allemagne, après avoir éteint les feux le matin au petit jour, de partir par un temps pareil, le fusil sur l’épaule, et d’entendre les semelles du bataillon retentir sur la terre durcie. Et je ne sais comment, tout à coup l’idée de l’Empereur me vint ; je le vis avec sa capote grise, le dos rond, la tête enfoncée dans son chapeau, qui marchait, la vieille garde derrière lui. Catherine balayait notre petite chambre. C’était comme un rêve par ce temps clair et sec.
Pendant que j’étais là, nous entendîmes quelqu’un monter l’escalier, et Catherine en s’arrêtant dit :
– C’est M. Goulden.
Aussitôt je reconnus le pas de M. Goulden, ce qui me surprit, car il ne venait pour ainsi dire jamais chez nous. Il ouvrit la porte et nous dit tout bas :
– Mes enfants, l’Empereur a débarqué le 1er mars à Cannes, près de Toulon ; il marche sur Paris.
Il n’en dit pas plus et s’assit pour respirer. On pense comme nous nous regardions l’un l’autre ; seulement au bout d’un instant Catherine demanda :
– C’est dans la gazette, monsieur Goulden ?
– Non, fit-il, on ne sait encore rien là-bas, ou bien on nous cache tout. Mais au nom du ciel, pas un mot de tout cela, nous serions arrêtés ! Ce matin, Zébédé, qui montait la garde à la porte de France, est venu me prévenir vers cinq heures ; il frappait en bas, vous l’avez sans doute entendu ?
– Non, monsieur Goulden, nous dormions.
– Eh bien ! j’ai ouvert la fenêtre pour savoir ce que c’était, et je suis descendu tirer le verrou. Zébédé m’a raconté la chose comme tout à fait sûre, le régiment reste consigné à la caserne jusqu’à nouvel ordre. Il paraît qu’on a peur des soldats ; mais alors comment arrêter Bonaparte ? Ce ne sont pas non plus les paysans, auxquels on veut ôter les biens, qu’on peut envoyer contre lui, ni les bourgeois, qu’on traite de jacobins. Voilà maintenant une bonne occasion pour les émigrés de se montrer. Mais surtout le plus grand silence… le plus grand silence !…
Il levait la main en disant cela, et nous descendîmes dans l’atelier. Catherine fit un bon feu, chacun se remit au travail comme à l’ordinaire.
Ce jour-là tout resta tranquille, et le lendemain aussi. Quelques voisins, le père Réboc et Offran vinrent bien nous voir, soi-disant pour faire nettoyer leur montre.
– Rien de nouveau, voisin ? disaient-ils.
– Mon Dieu ! répondait M. Goulden, les affaires sont toujours calmes. Vous ne savez rien non plus ?
– Non.
Et l’on voyait pourtant dans leurs yeux qu’ils savaient la grande nouvelle. Zébédé restait à la caserne. Les officiers en demi-solde remplissaient le café du matin au soir : mais pas un mot encore ne transpirait : c’était trop grave.
Le troisième jour seulement, ces officiers en demi-solde, qui bouillonnaient dans leur peau, commencèrent à perdre patience ; on les voyait aller et venir, et rien qu’à leur figure il était facile de reconnaître leur terrible inquiétude. S’ils avaient eu des chevaux ou seulement des armes, je suis sûr qu’ils auraient tenté quelque chose. Mais la gendarmerie, le vieux Chancel en tête, allait et venait aussi ; toutes les heures on voyait un gendarme partir en estafette pour Sarrebourg.
L’agitation augmentait ; personne n’avait plus de goût au travail. Bientôt on apprit, par des voyageurs de commerce arrivés à la ville de Bâle, que le Haut-Rhin et le Jura étaient en l’air ; que des régiments de cavalerie et d’infanterie se suivaient à la file du côté de Besançon ; que des masses de forces se portaient à la rencontre de l’usurpateur, etc. Un de ces voyageurs, qui parlait trop, reçut l’ordre d’évacuer la ville à la minute ; le brigadier avait visité ses papiers, heureusement ils se trouvaient en règle.
J’ai vu depuis d’autres révolutions, mais jamais une agitation pareille, surtout le 8 mars, entre quatre et cinq heures du soir, quand l’ordre arriva de faire partir sans retard le 1er et le 2e bataillon armés en guerre, pour Lons-le-Saunier. C’est alors que l’on comprit tout le danger, et que chacun pensa : « Ce n’est pas le duc d’Angoulême ou le duc de Berry qu’il faudrait pour arrêter Bonaparte, c’est toute l’Europe. »
Enfin les officiers en demi-solde respiraient ; leur mine était comme éclairée d’un coup de soleil.
À cinq heures, le premier roulement bourdonnait sur la place, lorsque Zébédé entra brusquement.
– Eh bien ? lui cria le père Goulden.
– Eh bien ! dit-il, les deux premiers bataillons partent.
Il était pâle.
– On les envoie pour l’arrêter, dit M. Goulden.
– Oui, ils vont l’arrêter ! fit-il en clignant de l’œil. Le roulement continuait.
Il se mit à redescendre quatre à quatre. Je le suivais. En bas, et déjà le pied sur la première marche, il m’attira par le bras et me dit à l’oreille en levant son shako :
– Regarde au fond, Joseph, la reconnais-tu. Je vis la vieille cocarde tricolore dans la coiffe.
– C’est la nôtre, celle-là, fit-il. Eh bien ! tous les soldats en ont autant.
J’avais à peine eu le temps de voir, qu’il me serrait la main et tournait, en allongeant le pas, au coin de Fouquet. Je remontai, me disant en moi-même : « Voici la débâcle qui recommence, voici l’Europe qui se remet en travers ; voici la conscription, Joseph, l’abolition de toutes les permissions, et caetera, comme on lit dans les gazettes. Au lieu d’être tranquille, il va falloir se remuer ; au lieu d’entendre les cloches, on entendra le canon ; au lieu de parler des couvents, on parlera de l’arsenal ; au lieu de sentir l’encens et les guirlandes, on sentira la poudre. Dieu du ciel, cela ne finira donc jamais ! Tout pouvait aller si bien sans les missionnaires et les émigrés ! Quelle misère !… quelle misère ! Et c’est toujours nous autres, c’est toujours nous qui payons… C’est toujours pour notre bonheur qu’on fait toutes les injustices, pendant qu’on se moque de nous et qu’on nous traite comme de véritables bûches !
Bien d’autres idées justes me passaient par la tête ; mais à quoi cela me servait-il ? Je n’étais pas le comte d’Artois ni le duc de Berry ; il faut être prince, pour que les idées servent à quelque chose et que chaque parole qu’on dit passe pour un miracle.
Depuis ce moment jusqu’au soir, le père Goulden ne tenait plus en place ; il avait la même impatience que moi du temps où j’attendais la permission de me marier ; à chaque instant, il regardait par la fenêtre et disait :
– Aujourd’hui, les grandes nouvelles vont venir… les ordres sont donnés… on n’a plus besoin de rien nous cacher.
Et de minute en minute il s’écriait :
– Chut !… voici la malle-poste.
Nous écoutions : c’était la charrette de Lanche avec ses vieilles haridelles, ou la patache de Baptiste qui passait sur le pont.
La nuit était venue, Catherine avait mis la nappe, lorsque, pour la vingtième fois, M. Goulden dit :
– Écoutez !
Cette fois un grondement lointain s’entendait dans l’avancée. Alors, lui, sans attendre, courut dans l’alcôve et mit sa grosse camisole en criant :
– Joseph, arrive !
Il descendait pour ainsi dire en roulant ; moi, rien que de le voir si pressé, l’idée d’avoir des nouvelles me gagnait aussi et je le suivais. – Nous arrivions à peine sur les marches de la rue, que la malle sortait de la porte sombre avec ses deux lanternes rouges, et passait devant nous comme le tonnerre. Nous courions, mais nous n’étions pas les seuls ; de tous les côtés on entendait galoper et les gens crier :
– La voilà !… la voilà…
Le bureau de poste se trouvait dans la rue des Foins, près de la porte d’Allemagne ; la malle descendait tout droit jusqu’au coin du collège et puis elle tournait à droite. – Plus nous courions, plus la rue fourmillait de monde, il en sortait de toutes les portes ; l’ancien maire, M. Parmentier, son secrétaire Eschbach, le percepteur Cauchois et beaucoup d’autres notables couraient aussi, se parlant entre eux et disant :
« Voici le grand moment ! »
Lorsque nous arrivâmes au tournant de la place d’Armes, nous vîmes le monde qui stationnait déjà devant le bureau de poste, et des figures innombrables qui se penchaient le long de la balustrade en fer, écoutant, s’allongeant les uns par-dessus les autres, interrogeant le courrier, qui ne répondait pas.
Le maître de poste, M. Pernette, ouvrit la fenêtre éclairée à l’intérieur, le paquet de lettres et de journaux vola du haut de la chaise dans la chambre, la fenêtre se referma, et les coups de fouet du postillon avertirent la foule de s’écarter.
– Les journaux ! les journaux !
On n’entendait que cela de tous les côtés. La malle se remit à courir et s’engouffra sous la porte d’Allemagne.
– Allons au café Hoffmann, me dit M. Goulden, dépêchons-nous, les journaux vont venir ; si nous attendons, il n’y aura plus moyen d’entrer.
Comme nous traversions la place, nous entendions déjà courir derrière nous. Le commandant Margarot disait de sa voix claire et forte :
– Arrivez… je les tiens !…
Tous les officiers en demi-solde le suivaient, la lune donnait : on les voyait approcher à grands pas. – Nous entrâmes dans le café bien vite, et nous étions à peine assis près du grand poêle de faïence, que tout le monde se précipitait à la fois par les deux portes.
C’est la figure des officiers en demi-solde qu’il aurait fallu voir dans ce moment ! leurs grands chapeaux à cornes, défilant sous les quinquets, leurs mines décharnées, leurs moustaches pendantes, leurs yeux luisants qui regardaient dans l’ombre les faisaient ressembler à des êtres sauvages en train de rôder autour de quelque chose ; plusieurs louchaient à force d’impatience et d’inquiétude, et je crois qu’ils ne voyaient rien, mais que leur esprit était ailleurs, avec Bonaparte : – cela faisait peur.
Les gens entraient, entraient toujours, tellement qu’on étouffait et qu’il fallut ouvrir les fenêtres. Dehors, la rue de la Caserne de cavalerie et la place de la Fontaine étaient pleines de rumeurs.
– Nous avons bien fait de venir tout de suite, me dit M. Goulden en se dressant sur sa chaise, la main sur la plaque du grand fourneau, car beaucoup d’autres venaient de se dresser de la sorte.
Je suivis le même exemple, et je ne vis plus autour de moi que des têtes attentives, les grands chapeaux des officiers au milieu de la salle, et la foule qui s’étendait sur la place au clair de lune. – Le tumulte redoublait. Une voix cria :
– Silence !
C’était le commandant Margarot, qui venait de monter sur une table. Derrière lui, sous la double porte, les gendarmes Keltz et Werner regardaient ; et, de toutes les fenêtres ouvertes, des gens se penchaient à l’intérieur. Dans le même instant, jusque sur la place, on répétait : « Silence ! silence ! » Et le silence devint si profond, qu’on aurait dit que pas une âme ne se trouvait là.
Le commandant lisait la gazette. Cette voix claire, qui prononçait chaque mot avec une sorte de frémissement intérieur, ressemblait au tic-tac de notre horloge dans la nuit profonde ; on devait l’entendre jusqu’au milieu de la place d’Armes. Et cela dura longtemps, parce que le commandant lisait tout, sans rien passer. Je me souviens que la gazette commençait par dire que le nommé Buonaparte, l’ennemi du bien public, celui qui, pendant quinze ans, avait tenu la France dans la servitude du despotisme, s’était échappé de son île, et qu’il avait eu l’audace de remettre les pieds dans un pays inondé de sang par sa faute ; mais que les troupes, fidèles au roi et fidèles à la nation, étaient en marche pour l’arrêter ; et que, voyant cette horreur générale, Buonaparte venait de se jeter dans les montagnes avec la poignée de gueux qui le suivaient ; qu’il était entouré de tous les côtés, et qu’il ne pouvait manquer d’être pris.
Je me souviens aussi que, selon cette gazette, tous les maréchaux s’étaient empressés d’aller mettre leur épée glorieuse au service du roi, le père du peuple et de la nation ; et que l’illustre maréchal Ney, prince de la Moskowa, lui avait baisé la main, promettant de ramener Buonaparte à Paris mort ou vif.
Après cela venaient des mots latins que je ne comprenais pas, et qu’on avait mis sans doute pour les curés.
De temps en temps j’entendais derrière moi des gens rire et se moquer du journal. Ayant tourné la tête, je vis que c’étaient M. le professeur Burguet et deux ou trois autres notables, qu’on a pris après les Cent-Jours et qu’on a forcés de demeurer à Bourges, parce qu’ils avaient trop d’esprit, à ce que disait le père Goulden. – Ce qui montre bien qu’il vaut mieux se taire dans des occasions pareilles, lorsqu’on n’a pas envie de se battre pour ou contre, car les paroles ne font ni chaud ni froid, et ne servent qu’à nous attirer des désagréments.
Mais une chose bien plus forte, c’est vers la fin, quand le commandant se mit à lire les ordonnances. La première marquait le mouvement des troupes, et la seconde ordonnait à tous les Français de courir sur Buonaparte, de l’arrêter et de le livrer mort ou vif… parce qu’il s’était mis lui-même hors la loi. En ce moment, le commandant, qui jusqu’alors s’était contenté de rire en prononçant le nom de Buonaparte – et dont la figure osseuse, près du quinquet, avait eu seulement de petits frémissements, tandis que les autres au-dessous l’écoutaient : – en ce moment sa figure changea, je n’ai jamais rien vu de plus terrible ; ce n’était plus que pli sur pli, ses petits yeux brillaient comme ceux d’un chat, ses moustaches et ses favoris se dressaient. Il prit la gazette et se mit à la déchirer en mille morceaux ; puis il devint tout pâle, et se dressant, ses deux longs bras étendus, il poussa un cri de : Vive l’Empereur ! d’une voix tellement forte, que cela nous donna la chair de poule. À peine avait-il poussé ce cri, que tous les officiers en demi-solde levèrent leurs grands chapeaux, les uns à la main, les autres au bout de leurs cannes à épée, en répétant d’un seul coup : Vive l’Empereur ! – On aurait dit que le plafond allait tomber. Moi, c’était comme si l’on m’avait versé de l’eau froide dans le dos. « À cette heure, me dis-je en moi-même, tout est fini… Allez donc prêcher l’amour de la paix à des gens pareils. » Dehors, au milieu des groupes de bourgeois, les soldats du poste de l’Hôtel de ville répétaient le cri de : Vive l’Empereur ! Et comme je regardais dans un grand trouble ce que les gendarmes allaient faire, ils se retirèrent sans rien dire, étant aussi de vieux soldats.
Mais ce n’était pas encore fini ; au moment où le commandant voulait descendre de sa table, un officier cria qu’il fallait le porter en triomphe, et tout aussitôt les autres le prirent par les jambes et le portèrent autour de la salle, en repoussant le monde, et criant comme des forcenés ! Vive l’Empereur ! – Lui, ses deux longues mains velues sur leurs épaules et sa tête au-dessus de leurs chapeaux, en se voyant porter en triomphe par ses camarades, et les entendant crier ce qu’il aimait le mieux, il pleurait !… et l’on n’aurait jamais cru qu’une figure pareille pouvait pleurer ; cela seul vous bouleversait et vous faisait frémir. – Il ne disait rien, ses yeux étaient fermés, et les larmes coulaient au-dessous jusqu’au bout de son nez et le long de ses moustaches.
Je regardais, comme on peut s’imaginer, quand le père Goulden me tira par le bras ; il était descendu de sa chaise et me disait :
– Joseph ! partons, partons… il est temps ! Derrière nous la salle était déjà vide, tout le monde s’était dépêché de sortir par l’allée du brasseur Klein, dans la crainte d’être mêlé dans une mauvaise affaire ; nous sortîmes aussi par là.
– Ceci risque de prendre une mauvaise tournure, me dit le père Goulden en traversant la place. Demain la gendarmerie peut se mettre en campagne… Le commandant Margarot et les autres n’ont pas l’air de gens qui se laissent arrêter… Les soldats du 3e bataillon se mettront de leur côté, s’ils n’y sont déjà… La ville est à eux.
Il se faisait ces réflexions à lui-même, et je pensais comme lui. – Chez nous, dans l’atelier, Catherine tout inquiète nous attendait. Nous lui dîmes ce qui venait de se passer. La table était mise, mais personne n’avait faim. Après avoir pris un verre de vin, M. Goulden, en ôtant ses souliers, nous répéta :
– Mes enfants, d’après ce que vous venez de voir, l’Empereur arrivera pour sûr à Paris ; les soldats le veulent, les paysans – qu’on a menacés dans leurs biens – le veulent aussi ; et les bourgeois, pourvu qu’il ait fait de bonnes réflexions dans son île, qu’il renonce à ses idées de guerre et qu’il accepte les traités, ne demanderont pas mieux, surtout avec une bonne Constitution qui garantisse à chacun sa liberté, le plus grand des biens. – Souhaitons-le pour vous et pour lui. – Et bonsoir !
XI
Le lendemain, vendredi, jour de marché, toute la ville n’était pleine que de la grande nouvelle. Des quantités de paysans d’Alsace et de Lorraine, en blouse, en veste, en tricorne, en bonnet de coton, arrivaient à la file sur leurs charrettes, soi-disant vendre du blé, de l’orge ou de l’avoine, mais pour savoir ce qui se passait. On n’entendait crier dehors que : « Hue, Foux ! – Hue, Schimmel ! » et les voitures rouler, les fouets claquer. Les femmes n’étaient pas non plus les dernières ; elles arrivaient de la Houpe, du Dagsberg, d’Ercheviller, de Lutzelbourg, des Baraques, en petite jupe relevée, leurs grands paniers sur la tête, allongeant le pas et se dépêchant. Tout ce monde passait sous nos fenêtres, et M. Goulden disait :
– Comme tout s’agite ! comme tout galope !… Ne croirait-on pas que l’esprit de l’autre est déjà dans le pays ! On ne marche plus maintenant en arrondissant la jambe, avec des cierges à la main et des surplis sur le dos.
Il paraissait content, ce qui prouve combien toutes ces cérémonies l’avaient ennuyé. Enfin, vers huit heures, il fallut pourtant se remettre à l’ouvrage, et Catherine sortit, comme à l’ordinaire, acheter notre beurre, nos œufs et quelques légumes pour la semaine. À dix heures, elle revint :
– Ah ! Seigneur Dieu ! dit-elle, tout est déjà retourné.
Elle nous raconta que les officiers en demi-solde se promenaient avec leurs grandes cannes à épée – le commandant Margarot au milieu d’eux – et que sur la place, à la halle, entre les bancs, autour des étalages, partout, les paysans, les bourgeois, tout le monde se serrait la main, s’offrait des prises et se disait :
– Eh ! eh ! le commerce reprend.
Elle nous dit aussi que la nuit dernière on avait affiché des proclamations de Bonaparte à la mairie, sur les trois portes de l’église, et même contre les piliers de la halle ; mais que les gendarmes les avaient arrachées de bonne heure ; enfin, que tout se remettait en mouvement. Le père Goulden s’était levé de notre établi pour l’écouter ; moi, retourné sur ma chaise, je pensais :
« Oui, c’est bon… c’est très bon… mais à cette heure mon congé va bientôt finir. Puisque tout remue, il va falloir aussi te remuer, Joseph ! Au lieu de rester ici tranquillement avec ta femme, on va bientôt te remettre la giberne, le sac, le fusil et deux paquets de cartouches sur le dos ! » Et regardant Catherine, qui ne songeait pas au vilain côté de la chose, Weissenfelz, Lutzen, Leipzig me repassaient dans l’esprit ; je devenais mélancolique.
Pendant que nous étions là tout pensifs, voilà que la porte s’ouvre et que la tante Grédel entre. D’abord on aurait cru qu’elle était paisible.
– Bonjour, monsieur Goulden ; bonjour, mes enfants, dit-elle en posant son panier derrière le fourneau.
– Vous allez toujours bien, mère Grédel ? lui demanda M. Goulden
– Hé ! la santé… la santé !… fit-elle.
Je voyais déjà qu’elle serrait les dents et qu’elle avait des plaques rouges sur les joues. Elle fourra d’un seul coup sous son bonnet ses cheveux, qui lui pendaient le long des oreilles, et nous regarda l’un après l’autre avec ses yeux gris, pour voir ce nous pensions ; ensuite elle commença d’une voix claire :
– Il paraît que le gueux s’est sauvé de son île ?
– De quel gueux parlez-vous, mère Grédel ! lui demanda M. Goulden d’un ton calme.
– Hé ! vous savez bien de qui je parle, fit-elle, je parle de votre Bonaparte.
Le père Goulden, qui voyait sa colère, s’était remis à notre établi pour tâcher d’éviter une dispute ; il avait l’air de regarder dans une montre, et moi je faisais comme lui.
– Oui, dit-elle en criant encore plus haut, le voilà qui recommence ses mauvais coups, quand on croyait tout fini… le voilà qui revient pire qu’auparavant… Quelle peste !
J’entendais sa voix qui tremblait en dessous. M. Goulden, lui, faisait semblant de continuer son ouvrage.
– À qui la faute, mère Grédel ? dit-il sans se retourner. Croyez-vous donc que ces processions, ces expiations, ces prédications contre les bien nationaux et la rébellion de vingt-cinq ans, ces menaces continuelles de rétablir l’ancien régime, l’ordre de fermer les boutiques pendant les offices…, etc., etc., croyez-vous que cela pouvait continuer ? Je vous le demande ! a-t-on jamais rien vu de pareil depuis que le monde existe, de plus capable de soulever une nation contre ceux qui voulaient la ravaler ? Est-ce qu’on n’aurait pas dit que Bonaparte lui-même soufflait à l’oreille de ces Bourbons toutes les sottises capables de dégoûter le peuple ? Dites… ne fallait-il pas s’attendre à ce qui se passe ?
Il regardait toujours sa montre avec la loupe, pour rester paisible ; moi, pendant ce discours, j’observais la mère Grédel du coin de l’œil. Elle avait changé deux ou trois fois de couleur, et Catherine dans le fond, près du fourneau, lui faisait signe de ne pas commencer un esclandre chez nous ; mais cette femme obstinée se moquait bien des signes.
– Vous êtes donc aussi content, vous ? dit-elle. Vous changez du jour au lendemain comme les autres… Vous plantez là votre République quand ça vous convient.
Le père Goulden, en entendant cela, toussa tout bas, comme si quelque chose l’avait gêné dans sa gorge, et pendant plus d’une demi-minute il eut l’air de réfléchir ; la tante derrière nous, regardait. À la fin, M. Goulden, qui s’était remis, répondit lentement :
– Vous avez tort, madame Grédel, de me faire un pareil reproche ; si j’avais voulu changer, j’aurais commencé plus tôt. Au lieu d’être horloger à Phalsbourg, je serais colonel ou général tout comme un autre ; mais j’ai toujours été, je suis et je resterai jusqu’à la mort pour la République et les Droits de l’homme.
Ensuite il se retourna brusquement, et regardant la tante de bas en haut, en élevant la voix :
– Et c’est à cause de cela que j’aime encore mieux Napoléon Bonaparte que le comte d’Artois, les émigrés, les missionnaires et les faiseurs de miracles, dit-il ; au moins il est forcé de conserver quelque chose de notre Révolution, il est forcé de respecter les biens nationaux, de garantir à chacun ses propriétés, ses grades, et tout ce qu’il a gagné d’après les nouvelles lois. Sans cela, quelle raison aurait-il d’être empereur ? S’il ne maintenait pas l’égalité, quelle raison la nation aurait-elle de le vouloir ? Les autres au contraire ont tout attaqué… Ils veulent détruire tout ce que nous avons fait… Voilà pourquoi j’aime mieux celui-ci, comprenez-vous ?
– Hé ! s’écria la mère Grédel, c’est du nouveau ! Elle riait d’un air de mépris, et j’aurais tout donné pour la voir aux Quatre-Vents.
– Dans le temps, vous parliez autrement, s’écria-t-elle ; quand l’autre rétablissait les évêques, les archevêques et les cardinaux ; quand il se faisait couronner par le pape, avec de l’huile sauvée de la sainte ampoule ; quand il rappelait les émigrés, quand il rendait les châteaux et les bois aux grandes familles ; quand il nommait des princes, des ducs, des barons par douzaines, combien de fois ne vous ai-je pas entendu dire que c’était abominable… qu’il trahissait la Révolution… que vous auriez mieux aimé les Bourbons… qu’au moins ceux-là ne connaissaient pas autre chose ; qu’ils étaient comme les merles, qui sifflent toujours le même air parce qu’ils n’en connaissent pas d’autre, et qu’ils croient que c’est le plus bel air du monde !… Au lieu que lui sortait de la Révolution… que son père avait eu quelques douzaines de chèvres dans les montagnes de la Corse, et que cela devait lui montrer dès l’enfance que les hommes sont égaux, que le courage, le génie seuls les élèvent ! que toutes ces vieilles guenilles, il aurait dû les mépriser, et qu’il n’aurait dû faire la guerre que pour défendre les nouveaux droits, les nouvelles idées, qui sont justes, et que rien ne pourra jamais arrêter ! L’avez-vous dit, quand vous causiez avec le père Colin, derrière, dans notre jardin, de peur d’être arrêtés si l’on vous entendait ? N’est-ce pas cela que vous disiez entre vous, et devant moi ?
Le père Goulden était devenu tout pâle ; il regardait à ses pieds et faisait tourner sa tabatière entre ses doigts, comme lorsqu’il rêvait ; je voyais même une sorte d’attendrissement peint sur sa figure.
– Oui, je l’ai dit, fit-il, et je le pense encore. Vous avez bonne mémoire, mère Grédel. C’est vrai, pendant dix ans, Colin et moi nous avons été forcés de nous cacher pour dire des choses justes, qui finiront par s’accomplir, et c’est le despotisme d’un seul homme né parmi nous, que nous avions élevé de notre propre sang, qui nous a contraint à cela. Mais aujourd’hui les choses sont changées ; cet homme, auquel on ne peut refuser le génie, a vu ses flagorneurs l’abandonner et le trahir ; il a vu que sa vraie racine est dans le peuple, et que ces grandes alliances dont il avait la faiblesse d’être si fier ont causé sa perte. Eh bien ! il vient nous débarrasser maintenant des autres, et j’en suis content.
– Vous n’avez donc pas de courage vous-même ? Avez-vous donc besoin de lui ? cria la tante Grédel. Si les processions vous gênaient, et si vous étiez ce que vous dites : – le peuple ! – pourquoi donc avez-vous besoin de lui ?
Alors le père Goulden se mit à sourire et dit :
– Si tout le monde avait la franchise d’agir d’après sa conscience, si bien des personnes ne s’étaient pas mises de ces processions, les unes par vanité, pour montrer leurs belles robes, les autres par intérêt pour avoir de bonnes places ou pour obtenir des permissions, alors vous auriez raison, madame Grédel, on n’aurait pas eu besoin de Bonaparte pour renverser tout cela ; on aurait vu que les trois quarts et demi de la nation ont du bon sens, et peut-être que le comte d’Artois lui-même aurait crié : « Halte ! » Mais, comme l’hypocrisie et l’intérêt cachent et obscurcissent tout et font la nuit en plein jour, il faut malheureusement des coups de tonnerre pareils pour voir clair. C’est vous et tous ceux qui vous ressemblent qui êtes la cause que les gens comme moi, qui n’ont jamais changé d’idée, sont forcés de se réjouir quand la fièvre remplace la colique.
Le père Goulden avait fini par se lever ; il se promenait de long en large avec une grande agitation ; et comme la tante Grédel voulait encore parler, il prit son bonnet et sortit en disant :
– Je vous ai dit ce que je pense ; maintenant parlez avec Joseph, qui vous donnera toujours raison.
Aussitôt il sortit, et la mère Grédel s’écria :
– C’est un vieux fou… il a toujours été le même. Maintenant, toi, si tu ne t’en vas pas en Suisse, je te préviens qu’il faudra aller Dieu sait où. Mais nous recauserons de cela, mes enfants ; le principal, c’est que nous soyons prévenus. Il faut attendre ce qui va se passer ; peut-être que les gendarmes arrêteront Bonaparte, mais, s’il arrive à Paris, nous courrons ailleurs.
Elle nous embrassa, reprit son panier et sortit.
Quelques instants après, le père Goulden, étant revenu, se remit à l’ouvrage avec moi, sans plus causer de ces choses. Nous étions tout pensifs, et, le soir, ce qui me surprit le plus, c’est que Catherine me dit :
— Nous écouterons toujours M. Goulden… il a raison…
Il en sait plus que ma mère, et ne nous donnera que de bons conseils.
En entendant cela je pensai :
« Elle tient avec le père Goulden, parce qu’ils lisent la gazette ensemble. Cette gazette dit toujours ce qui leur plaît le plus, mais cela n’empêche pas que, s’il faut reprendre le sac et partir, ce sera terrible, et qu’il vaudrait mieux être en Suisse, soit à Genève, ou bien à la fabrique du père Rulle, de la Chaux-de-Fonds, qu’à Leipzig ou ailleurs. »
Je ne voulais pas contrarier Catherine, mais ses paroles m’ennuyaient beaucoup.
XII
Depuis ce moment la confusion était partout ; les officiers en demi-solde criaient : Vive l’Empereur ! Le commandant de place aurait bien donné l’ordre de les arrêter, mais le bataillon tenait avec eux, et les gendarmes avaient l’air de ne rien entendre. On ne travaillait plus ; les percepteurs, les contrôleurs, les droits réunis, le maire, les adjoints, etc., se faisaient des cheveux gris et ne savaient plus sur quel pied danser. Personne n’osait se déclarer pour Bonaparte ni pour Louis XVIII, excepté les couvreurs, les maçons, les charpentiers, les gagne-petit, qu’on ne pouvait pas destituer, et qui n’auraient pas mieux demandé que de voir les autres à leur place. Ceux-là, leur hachette dans la ceinture de cuir et le paquet d’ételles sur l’épaule, ne se gênaient pas pour crier : À bas les émigrés ! – Ils riaient même de la débâcle qui grandissait à vue d’œil. Un jour la gazette disait : « L’usurpateur est à Grenoble, – le lendemain, – il est à Lyon, – le lendemain, – il est à Mâcon, – le lendemain, – à Auxerre ; » ainsi de suite.
M. Goulden, en lisant ces nouvelles le soir, se faisait du bon sang.
– On voit maintenant, s’écriait-il, que les Français sont pour la Révolution, et que le reste ne pourra jamais tenir. Tout le monde crie : À bas les émigrés ! – Quelle leçon pour ceux qui voient clair ! Ces Bourbons voulaient nous rendre tous Vendéens ; ils doivent se réjouir maintenant d’avoir si bien réussi.
Mais une chose l’inquiétait encore, c’était la grande bataille qu’on annonçait entre Ney et Napoléon.
– Quoique Ney ait baisé la main de Louis XVIII, disait-il, c’est toujours un vieux soldat de la Révolution, et je ne croirai jamais qu’il se batte contre la volonté du peuple… Non ce n’est pas possible ; il se rappellera le vieux tonnelier de Sarrelouis, qui lui casserait la tête avec son marteau, s’il vivait encore, en apprenant que Michel a trahi la nation pour faire plaisir au roi.
Voilà ce que disait M. Goulden ; mais cela n’empêchait pas les gens d’être inquiets, quand tout à coup la nouvelle arriva que Ney avait suivi l’exemple de l’armée, des bourgeois, de tous ceux qui voulaient être débarrassés des expiations, et qu’il s’était rallié. Alors la confiance fut plus grande ; mais la crainte d’un coup extraordinaire réduisait encore les hommes prudents au silence.
Le 21 mars, entre cinq et six heures du soir, M. Goulden et moi nous travaillions, la nuit venait ; dehors, une petite pluie coulait sur le vitrage, et Catherine allumait la lampe. Théodore Rœber, qui dirigeait le télégraphe, passa ventre à terre sous nos fenêtres ; il montait un gros cheval gris pommelé ; l’air enflait sa blouse, tant il courait vite ; d’une main il tenait son grand feutre sur sa tête, et de l’autre il tapait encore avec un bâton sur son cheval, qui galopait comme le vent. M. Goulden, essuyant la vitre, se pencha pour mieux y voir et dit :
– C’est Rœber qui vient du télégraphe ; une grande nouvelle est arrivée !
Ses joues un peu pâles rougirent ; moi, je sentis mon cœur battre avec violence. Catherine vint poser la lampe auprès de nous, et j’ouvris la fenêtre pour tirer le volet. Cela m’avait pris quelques instants, car il fallait déranger les verres de l’établi, pour ouvrir la fenêtre et décrocher les montres. M. Goulden rêvait. Comme je mettais le crochet, nous entendîmes battre le rappel des deux côtés de la ville à la fois, près du bastion de Mittelbronn et sur celui de Bigelberg ; les échos des remparts et ceux du vallon de la cible répondaient, et ce bourdonnement sourd remplissait toute la place, à l’heure où la nuit commence.
M. Goulden s’était levé :
– Les affaires sont décidées maintenant, dit-il d’une voix qui me donna froid ; ou bien on se bat aux environs de Paris, ou bien l’Empereur est dans son vieux palais comme en 1809.
Catherine courait déjà chercher son manteau, car elle voyait bien qu’il allait sortir, malgré la pluie. Lui, tout en parlant, ses grands yeux gris ouverts, se laissait mettre les manches sans y faire attention ; puis il sortit, et Catherine, me touchant l’épaule, car je restais là, me dit :
– Va donc, Joseph, suis-le.
Je descendis aussitôt. Nous arrivâmes sur la place au moment où le bataillon débouchait de la grand-rue, au coin de la mairie, derrière les tambours qui couraient la caisse sur l’épaule. Une foule de monde les suivait. Sous les vieux tilleuls, le roulement commença ; les soldats en tumulte prirent leurs rangs, et presque aussitôt le commandant Gémeau, qui souffrait de ses blessures et ne sortait pas depuis deux mois, parut en uniforme sur les marches de la maison Minque. Le sapeur de planton tenait son cheval à la main, et lui prêta l’épaule pour monter. De tous les côtés on regardait. L’appel était commencé.
Le commandant traversa la place, les capitaines allèrent vivement à sa rencontre ; ils se dirent quelques mots ; ensuite le commandant passa devant le front du bataillon, pendant que derrière lui s’avançait un simple sergent à trois chevrons, qui portait un drapeau dans son étui de toile cirée.
La foule grandissait toujours. M. Goulden et moi nous venions de monter sur la borne, en face de la voûte du corps de garde. Après l’appel, au bout d’un instant, le commandant tira son épée, et donna l’ordre de former le carré.
Je vous raconte ces choses simplement parce qu’elles étaient simples et terribles. On voyait à la pâleur du commandant qu’il avait la fièvre, et pourtant il faisait presque nuit. Les lignes grises du carré sur la place, le commandant à cheval au milieu, les officiers autour, sous la pluie, les bourgeois écoutant, le grand silence, les fenêtres qui s’ouvrent aux environs, tout est encore présent à mon esprit, et voilà qu’il s’est passé bientôt cinquante ans !
Personne ne parlait, car chacun savait bien qu’on allait apprendre le sort de la France.
– Portez arme !… Arme bras !… cria le capitaine Vidal. Après le bruit des armes, on n’entendit plus que la voix du commandant, cette voix claire que j’avais entendue de l’autre côté du Rhin, à Lutzen et à Leipzig, celle qui nous criait : « Serrez les rangs ! » Elle me traversait jusqu’à la moelle des os.
– Soldats, dit-il, S. M. Louis XVIII a quitté Paris le 20 mars, et l’Empereur Napoléon a fait son entrée dans la capitale le même jour.
Une sorte de frémissement s’étendit partout, mais cela ne dura qu’une seconde, et le commandant poursuivit :
– Soldats ! le drapeau de la France, c’est le drapeau d’Arcole, de Rivoli, d’Alexandrie, de Chébreisse, des Pyramides, d’Aboukir, de Marengo, d’Austerlitz, d’Iéna, d’Eylau, de Friedland, de Sommo-Sierra, de Madrid, d’Abensberg, d’Eckmuhl, d’Essling, de Wagram, de Smolensk, de la Moskowa, de Weissenfelz, de Lutzen, de Bautzen, de Wurtschen, de Dresde, de Bischofs-warda, de Hanau, de Brienne, de Saint-Dizier, de Champaubert, de Château-Thierry, de Joinvilliers, de Méry-sur-Seine, de Montereau, de Montmirail… – C’est ce drapeau que nous avons teint de notre sang… c’est celui qui fait notre gloire.
Le vieux sergent avait sorti le drapeau tricolore tout déchiré de son étui. Le commandant le prit :
– Ce drapeau, le voilà !… vous le reconnaissez… c’est celui de la nation… C’est celui que les Russes, les Prussiens, les Autrichiens, tous ceux que nous avions épargnés cent fois, nous ont ôté le jour de leur première victoire, parce qu’ils en avaient peur.
Un grand nombre de vieux soldats, en entendant ces paroles, détournaient la tête pour cacher leurs larmes ; d’autres, tout pâles, regardaient avec des yeux terribles.
– Moi, cria le commandant enlevant son épée, je n’en connais pas d’autre. Vive la France… Vive l’Empereur !
À peine avait-il poussé ce cri, que tout éclatait, on ne s’entendait plus ; de toutes les fenêtres, sur la place, dans les rues, partout des cris de : Vive l’Empereur ! Vive la France ! partaient comme des coups de trompette. Les gens et les soldats s’embrassaient ; on aurait dit que tout était sauvé, que nous avions retrouvé tout ce que la France avait perdu en 1814.
Il faisait presque nuit ; on s’en allait à droite, à gauche, par trois, par six, par vingt, criant : Vive l’Empereur ! quand du côté de l’hôpital un éclair rouge passa dans le ciel… le canon tonne ! derrière l’arsenal l’autre lui répond, et cela continue de seconde en seconde.
Le père Goulden et moi nous traversions la place bras dessus bras dessous, en criant aussi : Vive la France ! Et comme, à chaque coup de canon dans la nuit sombre, la lumière arrivait jusque sur la place, dans un éclair nous vîmes Catherine qui venait à notre rencontre avec la vieille Madelon Schouler. Elle avait mis son petit capuchon et sa bouffante ; son nez rose était bien caché du brouillard ; elle dit en nous voyant :
– Madeleine, les voilà ! L’Empereur est le maître, n’est-ce pas, monsieur Goulden ?
– Oui, mon enfant, répondit le père Goulden, c’est décidé !
Alors Catherine prit mon bras, et je ne sais pas pourquoi je me mis à l’embrasser deux ou trois fois en rentrant chez nous. Je sentais peut-être d’avance qu’il faudrait partir bientôt, et que je ne l’embrasserais plus longtemps. Le père Goulden, devant nous avec Madelon, disait :
– Ce soir, je veux boire un bon coup. Montez, Madeleine, je vous invite.
Mais elle ne voulut pas, et nous laissa sur la porte.
Tout ce que je puis dire, c’est que la joie du monde était aussi grande qu’à l’arrivée de Louis XVIII, et peut-être encore plus.
Une fois dans notre chambre et débarrassé de son manteau, M. Goulden s’assit à table, car le souper attendait ; Catherine courut à la cave chercher une bonne bouteille. Nous buvions et nous riions, et le canon faisait grelotter nos vitres. Quelquefois les gens perdent la tête, même ceux qui n’aiment que la paix ; ces coups de canon nous réjouissaient, nous rentrions en quelque sorte dans nos vieilles habitudes.
M. Goulden disait :
– Le commandant Gémeau a bien parlé ; mais il aurait pu continuer jusqu’à demain, en commençant par Valmy, Hundschott, Wattignies, Fleurus, Neuwied, Ukerath, Frœschwiller, Geisberg, jusqu’à Zurich et Hohenlinden. C’étaient aussi de grandes victoires, et même les plus belles de toutes, puisqu’elles sauvaient la liberté. Il n’a parlé que des dernières, cela suffit pour le moment. Que les autres arrivent… qu’ils osent remuer ! la nation veut la paix ; mais si les alliés commencent la guerre, malheur à eux ! Maintenant on va reparler de la liberté, de l’égalité, de la fraternité. Par ce moyen, toute la France se lèvera… je vous en préviens… tous en masse se lèveront. On fera des gardes nationales ; les vieux comme moi, les hommes mariés défendront les places ; les jeunes marcheront, mais on ne dépassera pas les frontières. L’Empereur, instruit par l’expérience, armera les ouvriers, les paysans et les bourgeois ; si les autres viennent, quand ils seraient un million, pas un ne sortira de chez nous. Le temps des soldats est passé ; les armées régulières sont bonnes pour la conquête, mais un peuple qui veut se défendre ne craint pas les meilleurs soldats du monde. Nous l’avons fait voir aux Prussiens, aux Autrichiens, aux Anglais, aux Russes, de 1792 jusqu’en 1800 : et, depuis, les Espagnols nous l’ont fait voir à nous, et même, avant, les Américains l’avaient fait voir aux Anglais. L’Empereur va nous parler de liberté, soyez-en sûrs. S’il veut lancer des proclamations en Allemagne, beaucoup d’Allemands seront avec nous ; on leur a promis des libertés pour les faire marcher en masse contre la France, et maintenant les souverains réunis à Vienne se moquent bien de tenir leur promesse : leur coup est fait… ils se partagent les gens comme des troupeaux. Les peuples de bons sens tiendront ensemble ; de cette façon, la paix s’établira par force. Les rois seuls ont intérêt à la guerre ; les peuples n’ont pas besoin de se conquérir, pourvu qu’ils se fassent du bien par la liberté du commerce, voilà le principal !
Dans son exaltation, il voyait tout en beau. Moi-même je trouvais ce qu’il disait tellement naturel, que j’étais sûr que l’Empereur agirait de cette manière. Catherine le croyait aussi. Nous bénissions tous le Seigneur de ce qui venait d’arriver ; et vers onze heures, après avoir bien ri, bien parlé, bien crié, nous allâmes nous coucher au milieu des plus belles espérances. Alors toute la ville était illuminée, nous avions mis aussi des lampions à nos fenêtres. À chaque instant on entendait partir des pétards, les enfants crier : Vive l’Empereur ! et les soldats sortir des auberges en chantant : À bas les émigrés !
Cela se prolongea bien tard, et seulement vers une heure nous dormions à la grâce de Dieu.
XIII
La satisfaction dura bien encore cinq ou six jours. – On renomma les anciens maires, les adjoints, les gardes champêtres, et tous ceux qu’on avait mis de côté quelques mois auparavant. Toute la ville, jusqu’aux dames, portait de petites cocardes tricolores que les couturières se dépêchaient de festonner avec des rubans rouges, blancs et bleus. Ceux qui, dans le temps, se déchaînaient contre l’Ogre de Corse n’appelaient plus Louis XVIII que le Roi panade. Le 25 mars on chanta le Te Deum ; toute la garnison et les autorités civiles y assistèrent en grande cérémonie.
Après le Te Deum, les autorités donnèrent un dîner magnifique à l’état-major de la place ; le temps s’était remis, les fenêtres de la Ville de Metz étaient ouvertes, des grappes de quinquets pendaient au plafond. Catherine et moi nous étions sortis le soir pour jouir de ce spectacle. On voyait les uniformes et les habits noirs fraterniser ensemble autour des longues tables ; et jusqu’à minuit, tantôt le maire, tantôt un adjoint, ou le nouveau commandant de place, M. Brancion, se levaient pour boire à la santé de l’Empereur, à la santé des ministres, à la santé de la France, à la santé de la paix, à la santé de la victoire, etc., etc.
Les verres tintaient. Dehors les enfants tiraient des pétards ; on avait mis un mât de Cocagne devant l’église ; des chevaux de bois étaient arrivés de Saverne avec des joueurs d’orgues ; le collège avait congé ; dans la cour de Klein, au Bœuf, on livrait un combat de chiens contre deux ânes ; on faisait comme on a fait en 1830, en 1848, et plus tard. C’est toujours la même chose ; les gens n’inventent rien de nouveau pour glorifier ceux qui montent et se moquer de ceux qui descendent.
Mais il paraît que l’Empereur n’avait pas de temps à perdre en réjouissances. La gazette disait bien que Sa Majesté voulait la paix, qu’elle ne demandait rien, qu’elle était d’accord avec son beau-père l’empereur François, que Marie-Louise et le roi de Rome allaient revenir… qu’on les attendait… – Oui, mais, en attendant, l’ordre d’armer la place arrivait. Deux ans auparavant, Phalsbourg était à cent lieues de la frontière, les remparts tombaient en ruine, les fossés se comblaient, il ne restait plus à l’arsenal que de vieilles patraques du temps de Louis XIV, des fusils de remparts qu’on allumait avec des mèches, et des canons tellement lourds sur leurs affûts massifs, qu’il fallait des files de chevaux pour les traîner. Les vrais arsenaux étaient à Dresde, à Hambourg, à Erfurt ; mais alors, sans avoir remué, nous étions à dix lieues de la Bavière rhénane, et c’est sur nous que devait tomber la première averse d’obus et de boulets. Aussi jour par jour on recevait les ordres de relever les remparts, de nettoyer les fossés, de mettre les patraques en bon état.
Au commencement d’avril, on établit un grand atelier à l’arsenal, pour la réparation des armes. Il arriva des soldats du génie et des artilleurs de Metz, pour faire les terrassements à l’intérieur des bastions et les embrasures autour. C’était un mouvement plus grand encore que de 1805 à 1813 ; et je pensai plus d’une fois que les grandes frontières au loin avaient pourtant leur bon côté, puisque ceux de l’intérieur sont préservés des coups et peuvent vivre en paix très longtemps, pendant qu’on bombarde déjà les autres.
Enfin nous éprouvions de grandes inquiétudes, car naturellement, lorsqu’on replante des palissades neuves sur les glacis, qu’on met des fascines aux demi-lunes, qu’on ajuste des bouches à feu dans tous les recoins des places fortes, c’est qu’il faut aussi du monde pour garder et manœuvrer tout cela. Plus d’une fois, en écoutant lire ces décrets le soir, Catherine et moi nous nous regardions les lèvres serrées. Je sentais bien d’avance qu’au lieu de rester là tranquillement à nettoyer et raccommoder des horloges, il me faudrait peut-être recommencer la charge en douze temps, et cela me produisait un mauvais effet. La tristesse me gagnait de plus en plus ; souvent M. Goulden, en me voyant tout pensif, s’écriait d’un ton joyeux.
– Allons ! du courage, Joseph : tout finira bien. Il voulait me remonter le cœur, mais je pensais :
« Oui, oui, vous me dites ces choses pour m’encourager ; mais, à moins d’être aveugle, on voit quelle tournure cela prend ».
Tout marchait tellement vite, que les décrets se suivaient comme la grêle, toujours avec de grands mots pour les embellir. On apprenait que les régiments allaient reprendre leurs anciens numéros « illustrés dans tant de glorieuses campagnes ». Sans avoir beaucoup de malice, chacun comprenait bien que les vieux numéros sans régiments allaient en ravoir. Et comme ce n’était pas encore assez, on apprit que les cadres des 3e, des 4e et des 5e bataillons d’infanterie, des 4e et 5e escadrons de cavalerie, de trente bataillons du train d’artillerie, de vingt régiments de jeune garde, de dix bataillons d’équipages militaires, de vingt régiments de marine, que tous ces cadres allaient être créés, soi-disant pour donner de l’emploi aux officiers en demi-solde de toutes les armes de terre et de mer ; mais c’était bon à dire : quand on crée des cadres, c’est pour les remplir, et quand ils sont remplis, il faut que les soldats partent. Oh ! quand je vis cela, ma confiance fut perdue. Et l’on répétait toujours : « La paix ! la paix ! la paix !… Nous acceptons le traité de Paris… Les rois et les empereurs réunis à Vienne s’entendent avec nous… Marie-Louise et le roi de Rome sont en route ». Plus on répétait ces nouvelles, plus ma défiance augmentait. M. Goulden avait beau me dire :
– Il a pris Carnot ! Carnot est un bon patriote !… Carnot l’empêchera de faire la guerre !… Ou, si nous sommes forcés de faire la guerre, il lui montrera que c’est chez nous qu’il faut attendre l’ennemi… qu’il faut soulever la nation… déclarer la patrie en danger… etc.
Il avait beau me dire des choses pareilles, je m’écriais toujours en moi-même : « Tous ces cadres ne sont pas pour rien… ces cadres seront remplis… c’est sûr !… »
On apprit aussi que dix mille soldats d’élite allaient entrer dans la garde, et que l’artillerie légère était réorganisée. L’artillerie légère suit les armées, chacun sait cela. Pour rester derrière les remparts et se défendre chez soi, l’artillerie légère est inutile. Cette idée me vint tout de suite, et même, le soir, je ne pus m’empêcher de le dire à Catherine ; j’avais toujours eu soin de lui cacher mes craintes, mais cette fois c’était trop fort. Elle ne répondit pas, ce qui montre bien qu’elle avait du bon sens, et qu’elle pensait comme moi.
Toutes ces choses m’ôtaient beaucoup de mon enthousiasme pour l’Empereur ; quelquefois en travaillant je me disais :
« J’aimerais pourtant mieux voir de ma fenêtre les processions que d’aller me battre contre des gens que je ne connais pas ! Au moins cette vue ne me coûterait ni bras ni jambe, et si cela m’ennuyait trop, je pourrais aller faire un tour aux Quatre-Vents ».
Mon chagrin s’augmentait d’autant plus que, depuis sa dispute avec M. Goulden, la tante Grédel ne venait plus nous voir. C’était une femme obstinée ; elle n’écoutait pas la raison, et gardait rancune aux gens durant des années et des années. C’était pourtant notre mère et nous devions lui céder ; elle ne voulait que notre bien. Mais comment faire pour nous accorder avec elle et M. Goulden ? Voilà ce qui nous embarrassait ; car si nous devions notre amour à la tante Grédel, nous devions aussi le plus grand respect à celui qui nous considérait comme ses propres enfants, et nous comblait chaque jour de ses bienfaits.
Ces pensées nous rendaient bien tristes, et j’avais résolu de dire à M. Goulden que Catherine et moi nous étions des jacobins comme lui, mais que, sans vouloir faire tort aux idées des jacobins et sans les abandonner, nous devions pourtant honorer notre mère et lui demander des nouvelles de sa santé. Je ne savais pas comment il recevrait notre déclaration, lorsqu’un matin, jour de dimanche, en descendant vers huit heures, nous trouvâmes cet excellent homme qui venait de s’habiller ; il paraissait de bonne humeur, et nous dit :
– Mes enfants, voici près d’un mois que la tante Grédel n’est pas venue nous voir ; elle s’obstine. Eh bien ! je veux montrer plus d’esprit qu’elle, et je veux bien céder. Entre gens comme nous, il ne doit exister aucun nuage. Après déjeuner, nous irons aux Quatre-Vents lui dire qu’elle est une entêtée, et que nous l’aimons malgré ses défauts. Vous verrez comme elle sera honteuse !
Il riait, nous étions tout attendris.
– Ah ! monsieur Goulden, que vous êtes bon ! lui dit Catherine ; ceux qui ne vous aimeraient pas auraient bien mauvais cœur.
– Hé ! s’écria-t-il, ce que je fais n’est-il pas tout naturel ! Est-ce qu’il faut rester divisés pour des mots ? Dieu merci, l’âge nous apprend que le plus raisonnable fait toujours le premier pas ; et vous saurez que c’est même écrit dans les Droits de l’homme, afin de maintenir la concorde entre les honnêtes gens.
Quand il avait cité les Droits de l’homme, tout était dit. On peut s’imaginer notre satisfaction ; Catherine, dans sa joie, pouvait attendre à peine la fin du déjeuner ; elle courait à droite, à gauche, chercher la canne, les souliers carrés, la boîte où se trouvait la belle perruque fixée sur sa patère. Elle aidait M. Goulden à passer les manches de son habit noisette ; lui, la regardait en souriant ; il finit par l’embrasser.
– Ah ! je savais bien, dit-il, que cette démarche te rendrait heureuse ; aussi ne perdons pas une minute et partons.
Nous sortîmes donc ensemble. Le temps était très beau. M. Goulden donnait le bras à Catherine, gravement, comme il faisait toujours en ville, et moi je marchais derrière, dans la jubilation de mon âme. J’avais sous les yeux les êtres que j’aimais le plus au monde, et je songeais à ce qu’allait dire la mère Grédel. Nous dépassâmes l’avancée, ensuite les glacis, et vingt minutes après, sans nous presser trop, nous arrivions devant la porte de la tante.
Il pouvait être alors dix heures. Comme j’avais pris un peu d’avance à l’auberge de la Roulette, j’entrai d’abord dans l’allée de sureaux qui longe la maison, et je regardai par la lucarne ce que faisait la tante. Elle était assise juste en face de moi, près de l’âtre qui fumait ; elle avait sa petite jupe à raies bleues, les grandes poches pardessus, son corset de toile à bretelles et ses savates. Elle filait, les yeux baissés d’un air triste ; ses grands bras maigres sortant des manches de la chemise jusqu’au coude, et ses cheveux gris tortillés sur la nuque sans bonnet.
En la voyant ainsi toute seule, je me dis : « Pauvre tante Grédel, elle pense à nous, pour sûr… elle s’obstine dans son chagrin… C’est pourtant une triste vie d’être seule et de ne pas voir ses enfants ! » Cela me serrait le cœur ; quand au même instant la porte s’ouvrit du côté de la route, et le père Goulden entra tout joyeux avec Catherine, en s’écriant :
– Ah ! vous ne venez plus nous voir, mère Grédel, il faut donc à cette heure, que je vous amène vos enfants, et que je vienne aussi moi-même vous embrasser ! Vous allez nous faire un bon dîner, entendez-vous ? et que cela vous serve de leçon !
Il paraissait grave dans sa joie. La tante, en les voyant, s’était dépêchée d’accourir et d’embrasser Catherine ; ensuite elle tomba dans les bras de M. Goulden et se pendit à son cou.
– Ah ! monsieur Goulden, s’écria-t-elle, que je suis donc heureuse de vous voir ! Vous êtes un homme bon, vous valez mille fois mieux que moi.
Voyant que tout prenait une bonne tournure, je courus à la porte, et je les trouvai tous deux les larmes aux yeux. Le père Goulden disait :
– Nous ne parlerons plus de politique !
– Non ! qu’on soit jacobin ou tout ce qu’on voudra, s’écriait la tante, le principal c’est qu’on ait bon cœur.
Ensuite elle vint aussi m’embrasser en disant :
– Mon pauvre Joseph, je pensais à vous du matin au soir… Maintenant tout est bien… je suis contente.
Elle courait déjà dans la cuisine, remuant toutes les marmites pour nous régaler ; pendant que M. Goulden déposait sa canne dans un coin, son grand chapeau dessus, on s’asseyait d’un air de contentement auprès de l’âtre.
– Quel beau temps ! s’écriait-il, tout verdit, tout refleurit… comme je serais heureux de vivre aux champs, de voir des haies par mes fenêtres, des pommiers, des pruniers tout blancs et tout roses !
Il était gai comme une alouette, et nous l’aurions tous été, sans les idées de guerre qui nous trottaient en tête.
– Laissez cela, ma mère, disait Catherine, asseyez-vous tranquillement près de M. Goulden. C’est moi qui ferai le dîner comme dans le temps.
– Mais tu ne sais plus la place de rien… j’ai tout dérangé, disait la tante.
– Je vous en prie, asseyez-vous, faisait Catherine ; soyez tranquille, on trouvera le beurre, les œufs, la farine et tout ce qu’il faut.
– Allons… allons… je vais donc t’obéir, dit la tante en descendant à la cave.
Catherine pendit son beau châle au dos de ma chaise, elle mit du bois au feu, du beurre dans la poêle et regarda dans les marmites pour voir si tout était bien en train. Au même instant, la tante remontait de la cave avec une bouteille de vin blanc.
– Vous allez d’abord vous rafraîchir avant le dîner, dit-elle ; et pendant que Catherine fera la cuisine, j’irai mettre mon casaquin et me donner un coup de peigne, car, Dieu merci ! j’en ai besoin. Vous… sortez… allez au verger… Tiens, Joseph, prends ces verres et la bouteille… asseyez-vous dans le rucher… le temps est beau… Dans une heure tout sera bien avancé… j’irai boire et trinquer avec vous.
Le père Goulden et moi nous sortîmes donc, traversant les hautes herbes, les pissenlits jaunes, qui nous montaient jusqu’aux genoux. Il faisait une grande chaleur, tout bourdonnait. Nous allâmes nous mettre à l’ombre du rucher, regardant ce magnifique soleil entre les ruches tourbillonnantes. M. Goulden pendit sa perruque derrière lui pour être plus à l’aise, je débouchai la bouteille et nous bûmes de ce bon petit vin blanc.
– Allons, tout va bien, disait-il ; si les hommes font des folies, le Seigneur Dieu veille toujours sur ses affaires. Regarde ces blés, Joseph, comme cela pousse… Quelle moisson dans trois ou quatre mois d’ici ! Et ces navettes, ces colzas, ces arbustes, ces abeilles, comme tout travaille, comme tout vit, comme tout grandit !… Quel malheur que les hommes ne suivent pas un pareil exemple, que les uns travaillent pour nourrir la paresse des autres, et qu’il faille toujours des fainéants de toute espèce qui nous traitent de jacobins, parce que nous voulons l’ordre, la justice et la paix !
Ce qu’il aimait le plus au monde, c’était la vue du travail, et non pas seulement celle du nôtre, qui n’est rien, mais des derniers insectes qui courent sur la terre entre les herbes, comme dans les forêts sans fin, qui se bâtissent des demeures, qui s’accouplent, qui couvent leurs œufs, qui les entassent dans des magasins, qui leur donnent de la chaleur en les exposant au soleil, qui les rentrent à la nuit, qui les défendent contre les ennemis ; enfin cette grande vie où tout chante, où tout est à sa place, depuis l’alouette qui remplit le ciel de sa musique joyeuse, jusqu’à la fourmi qui va, vient, court, fauche, scie, traîne, et fait tous les métiers. Oui, voilà ce que M. Goulden admirait ; mais il n’en parlait qu’aux champs, à la vue de ce grand spectacle ; et naturellement alors il parlait de Dieu, qu’il appelait l’Être suprême, comme les anciens calendriers de la République, il disait que c’était la raison, la sagesse, la bonté, l’amour, la justice, l’ordre, la vie. Les anciennes idées du calendrier lui revenaient aussi ; c’était magnifique de l’entendre parler de pluviôse, saison des pluies ; de nivôse, saison des neiges ; de ventôse, saison des vents ; et puis de floréal, prairial, fructidor. Il disait que les idées des hommes dans ce temps se rapportaient à celles de Dieu, tandis que juillet, septembre, octobre ne signifiaient rien, et même n’étaient inventés que pour tout embrouiller et tout obscurcir. Une fois sur ce chapitre, il ne finissait jamais, on voyait tout par ses yeux. Malheureusement, je n’ai pas l’instruction que cet homme de bien avait, sans cela je me ferais un véritable plaisir de vous raconter ses idées.
Nous étions justement sur ce chapitre lorsque la mère Grédel, bien lavée, bien peignée, en habits des dimanches, s’avança du coin de la maison vers le rucher, et tout de suite il se tut pour maintenir la concorde.
– Hé ! maintenant me voilà, dit la tante ; tout est en ordre.
– Allons, asseyez-vous, dit M. Goulden en lui faisant place sur le banc.
– Hé ! s’écria la tante, savez-vous l’heure qu’il est ? Le temps ne vous dure pas… Écoutez !…
Alors prêtant l’oreille, nous entendîmes l’horloge de la ville sonner lentement ses douze coups.
– Comment ! il est déjà midi ? s’écria le père Goulden ; j’aurais cru que nous n’étions pas entrés depuis dix minutes.
– Eh bien ! il est midi, fit la tante, et le dîner vous attend.
– À la bonne heure, dit M. Goulden en lui prenant le bras ; eh bien ! arrivez ma commère : depuis que vous m’avez dit l’heure, j’ai bon appétit.
Ils traversèrent l’allée bras dessus bras dessous ; je les suivais tout joyeux, et lorsque nous fûmes sous la porte, le plus agréable spectacle s’offrit à nos regards : la grande soupière peinte de fleurs rouges fumait sur la table, une poitrine de veau farcie remplissait la chambre de sa bonne odeur, des kuchlen à la cannelle s’élevaient dans un grand plat, au bord du vieux buffet de chêne, et deux bouteilles, avec les verres étincelants comme du cristal, brillaient sur la nappe blanche devant les assiettes. Enfin, rien qu’à voir cela, l’idée vous venait que la joie du Seigneur est de combler ses enfants de bénédictions innombrables.
Catherine, avec ses bonnes joues rouges et ses dents blanches, riait de notre satisfaction, et l’on peut dire que pendant tout le dîner nos inquiétudes sur l’avenir furent oubliées. On ne songeait qu’à se faire du bien, à rire, à trouver que tout était en bon état dans ce bas monde.
Ce n’est que plus tard, en prenant le café qu’une sorte de tristesse nous revint ; sans savoir pourquoi, chacun se mit à réfléchir. On ne voulait pas parler de politique, et ce fut la tante Grédel elle-même qui tout à coup demanda les nouvelles. M. Goulden alors dit que l’Empereur désirait la paix, qu’il se mettait seulement en état de défense, chose nécessaire afin de prévenir les ennemis que nous n’avions pas peur. Il dit que, dans tous les cas, malgré leurs mauvaises intentions, les alliés n’oseraient pas venir chez nous, parce que le beau-père François, sans avoir beaucoup de cœur, en avait pourtant assez pour ne pas vouloir renverser deux fois son gendre, sa propre fille et son petit-fils ; que ce serait contre nature, et que d’ailleurs maintenant la nation se lèverait en masse, qu’on déclarerait la patrie en danger, que ce ne serait plus seulement une guerre de soldats, mais une guerre de tous les Français contre ceux qui voudraient les opprimer. Cela devait faire réfléchir les souverains alliés, etc., etc.
Il dit encore bien d’autres choses qui ne me reviennent pas. La tante Grédel écoutait sans répondre. À la fin, elle se leva, ouvrit l’armoire et prit dans une écuelle un papier gris qu’elle remit à M. Goulden, en lui disant :
– Lisez un peu, des papiers pareils courent le pays ; celui-ci me vient de M. le curé Diemer. Vous allez voir si la paix est sûre.
M. Goulden n’avait pas ses lunettes, c’est moi qui lus le papier à sa place. J’ai mis tous ces vieux écrits de côté depuis des années, c’est devenu jaune, on n’y pense plus, on n’en parle plus, et pourtant c’est toujours bon à relire. Que peut-on savoir ? Les anciens rois, les anciens empereurs qui nous en voulaient, sont morts après nous avoir fait tout le mal possible ; mais leur fils et leurs petits-fils sont toujours là, qui ne nous veulent pas trop de bien ; ce qu’ils ont dit dans le temps, il peuvent encore le redire, et ceux qui ont aidé les anciens peuvent encore aider les nouveaux. Enfin, voici ce papier :
« Les puissances alliées, qui ont signé le traité de Paris, réunies en congrès à Vienne, informées de l’évasion de Napoléon Bonaparte et de son entrée à main armée en France, doivent à leur dignité et à l’intérêt de l’ordre social une déclaration solennelle des sentiments que cet événement leur a fait éprouver.
» En rompant ainsi la convention qui l’avait établi à l’île d’Elbe, Bonaparte détruit le seul titre légal auquel son existence était attachée. En reparaissant en France avec des projets de trouble et de bouleversement, il s’est privé lui-même de la protection des lois et a manifesté à la face de l’univers qu’il ne saurait y avoir ni paix ni trêve avec lui. »
Les alliés continuaient ainsi deux grandes pages ; et ces gens qui n’avaient rien de commun avec nous, que nos affaires ne regardaient pas, et qui se donnaient le titre de défenseurs de la paix, finissaient par déclarer qu’ils se réunissaient en masse pour maintenir le traité de Paris et pour rétablir Louis XVIII.
Quand j’eus fini, la tante, regardant M. Goulden, lui demanda :
– Qu’est-ce que vous pensez de cela ?
– Je pense, dit-il, que ces gens se moquent des peuples, et qu’ils extermineraient le genre humain sans honte et sans pitié, pour maintenir quinze ou vingt familles dans l’abondance. Je crois que ces gens se regardent comme des dieux, ou qu’ils nous prennent pour des bêtes.
– Sans doute, fit la tante Grédel, je ne dis pas le contraire ; mais tout cela n’empêche pas que Joseph sera forcé de partir.
J’étais tout pâle en voyant que la tante avait raison.
– Oui, répondit M. Goulden, je le savais depuis quelques jours, et voici ce que j’ai fait. Vous avez sans doute appris, mère Grédel, que l’on forme de grands ateliers pour la réparation des armes. Il en existe un à l’arsenal de Phalsbourg, mais les bons ouvriers manquent. Naturellement les bons ouvriers rendent autant de services à l’État, en réparant les armes, que ceux qui vont se battre ; ils ont plus de peine ; mais au moins ils ne risquent pas leur vie et restent chez eux. Eh bien ! aussitôt je me suis rendu chez le commandant d’artillerie, M. de Montravel, et j’ai fait une demande pour que Joseph soit accepté comme ouvrier. La réparation d’une batterie de fusil n’est rien pour un bon horloger ; M. de Montravel a tout de suite accepté. Voici son ordre, dit-il, en nous montrant un papier qu’il avait dans sa poche.
Alors je crus revenir au monde, et je m’écriai :
– Oh ! monsieur Goulden, vous êtes plus que notre père, vous me sauvez la vie.
Et Catherine, que l’inquiétude suffoquait depuis longtemps, sortit aussitôt, tandis que la tante Grédel, qui s’était levée, embrassait M. Goulden pour la seconde fois en disant :
– Oui, vous êtes le meilleur des hommes… un homme de bon sens… un homme de très grand esprit… Ah ! si tous les jacobins vous ressemblaient, les femmes ne voudraient plus avoir que des jacobins.
– Mais ce que j’ai fait est tout simple, disait-il.
– Non… non… ce n’est pas tout simple ; c’est le bon cœur qui vous donne de bonnes idées.
Moi, dans mon étonnement et ma joie, les paroles me manquaient, et pendant que la tante parlait, je sortis au verger prendre l’air. Catherine était là, dans le coin du four ; elle pleurait à chaudes larmes.
– Ah ! maintenant, dit-elle, je respire… je vais revivre.
Je l’embrassai dans un attendrissement extraordinaire. Je voyais ce qu’elle avait dû souffrir depuis un mois ; mais c’était une femme courageuse, qui me cachait ses inquiétudes ; elle savait bien que j’en avais assez pour mon propre compte. Nous restâmes là plus de dix minutes pour essuyer nos larmes ; ensuite étant rentrés, M. Goulden nous dit :
– Eh bien ! Joseph, c’est pour demain, tu partiras de bonne heure ; l’ouvrage ne te manquera pas.
Quel bonheur de penser que je ne serais pas forcé de partir ! Ah ! j’avais encore d’autres raisons pour vouloir rester ; Catherine et moi nous espérions quelque chose !… Mon Dieu ! mon Dieu ! ceux qui n’ont pas éprouvé cela ne sauront jamais ce que les hommes peuvent souffrir, ni quel poids une bonne nouvelle vous ôte du cœur.
Nous restâmes encore environ une heure aux Quatre-Vents. Et puis, au moment où les gens revenaient des vêpres, à la nuit tombante, nous repartîmes pour la ville. La tante Grédel nous accompagna jusqu’à la poste aux chevaux, et sur les sept heures nous remontions notre escalier.
C’est ainsi que l’accord se rétablit entre la tante Grédel et M. Goulden. Depuis, elle venait nous voir aussi souvent qu’autrefois. Moi j’allais tous les jours à l’arsenal, et je travaillais à la réparation des batteries. À midi sonnant je rentrais dîner. À une heure, je repartais jusqu’à sept heures. J’étais à la fois soldat et ouvrier, dispensé des appels, mais accablé d’ouvrage. Nous espérions que je resterais dans cette position jusqu’à la fin de la guerre, si par malheur elle commençait, car on n’était sûr de rien.
XIV
La confiance nous était un peu revenue depuis que je travaillais à l’arsenal ; mais nous avions pourtant encore de l’inquiétude, car des centaines de semestriers, d’anciens soldats rengagés pour une campagne et des conscrits, passaient le sac au dos avec leurs habits de village. Ils criaient tous : Vive l’Empereur ! et paraissaient furieux. Dans la grande salle de la mairie, les uns recevaient une capote, les autres un shako, les autres des épaulettes, des guêtres, des souliers aux frais du département. Ils repartaient ainsi pour rejoindre, et je leur souhaitais bon voyage.
Tous les tailleurs de la ville faisaient des uniformes par entreprise, les gendarmes cédaient leurs chevaux pour remonter la cavalerie, et M. le maire, le baron Parmentier, excitait les jeunes gens de seize à dix-sept ans à s’engager dans les partisans du colonel Brice, qui devait défendre les défilés de la Zorne, de la Zinselle et de la Sarre. M. le baron allait partir pour le Champ de Mai ; cela redoublait son enthousiasme :
– Allez !… courage ! leur criait-il, en parlant des Romains qui s’étaient battus pour la patrie.
Je pensais en l’écoutant :
« Puisque tu trouves cela si beau, pourquoi n’y vas-tu pas toi-même ? »
On peut se figurer avec quel courage je travaillais à l’arsenal ; rien ne me coûtait, j’aurais passé les jours et les nuits à raccommoder les fusils, à rajuster les baïonnettes, à serrer les vis. Quand le commandant de Montravel venait nous voir, il m’admirait :
– À la bonne heure ! disait-il, c’est bien ! Je suis content de vous, Bertha.
Ces paroles me remplissaient de satisfaction, je ne manquais pas de les rapporter à Catherine pour lui remonter le cœur ; nous étions presque sûrs que M. de Montravel me garderait à Phalsbourg.
Les gazettes ne parlaient plus que de la nouvelle Constitution, qu’on appelait l’Acte additionnel, et du Champ de Mai. M. Goulden trouvait toujours à redire, tantôt sur un article, tantôt sur un autre ; mais je ne me mêlais plus de ces affaires ; je me repentais même d’avoir crié contre les processions et les expiations ; j’avais bien assez de politique.
Cela dura jusqu’au 23 mai. Ce jour-là, vers six heures du matin, je me trouvais dans la grande salle de l’arsenal, en train de remplir des caisses de fusils. La grande porte restait ouverte à deux battants ; les soldats du train, avec leurs fourgons, attendaient devant le parc à boulets pour charger les caisses. Je clouais la dernière, lorsque le garde du génie Robert me toucha l’épaule en me disant tout bas :
– Bertha, le commandant de Montravel désire vous voir ; il est au pavillon.
Qu’est-ce que le commandant avait à me dire ? Je n’en savais rien, et tout de suite j’eus peur. Malgré cela je partis aussitôt en traversant la grande cour, où donne le hangar des affûts ; je montai l’escalier, et je frappai doucement à la porte.
– Entrez ! me dit le commandant.
J’ouvris tout tremblant, le bonnet à la main. Le commandant de Montravel était un homme de haute taille, maigre, brun, la tête un peu penchée. Il se promenait de long en large, au milieu de ses livres, de ses cartes et de ses armes pendues aux murs.
– Ah ! c’est vous, Bertha, dit-il en me voyant ; je vais vous apprendre une fâcheuse nouvelle : le 3e bataillon, dont vous faites partie, part pour Metz.
En entendant cette terrible nouvelle, je sentis mon cœur se retourner et je ne pus rien répondre. Le commandant me regardait.
– Ne vous troublez pas, fit-il au bout d’un instant ; vous êtes marié depuis quelques mois, et d’ailleurs bon ouvrier, cela mérite considération. Vous remettrez cette lettre au colonel Desmichel, à l’arsenal de Metz ; c’est un de mes amis, il vous trouvera de l’emploi dans ses ateliers, soyez-en sûr.
Je pris la lettre qu’il me tendait, en le remerciant, et je sortis plein d’épouvante.
Chez nous, Zébédé, M. Goulden et Catherine causaient ensemble dans l’atelier ; la désolation était peinte sur leurs figures, ils savaient déjà tout.
– Le 3e bataillon part, leur dis-je en entrant ; mais cela ne fait rien, M. le commandant de Montravel vient de me donner cette lettre pour le chef de l’arsenal de Metz. N’ayez pas d’inquiétudes, je ne ferai pas campagne.
J’étouffais presque. M. Goulden prit la lettre et dit :
– Elle est ouverte, c’est pour que nous puissions la lire.
Alors il lut cette lettre, où M. de Montravel me recommandait à son ami, disant que j’étais marié, bon ouvrier, plein de zèle, nécessaire à ma famille, et que je rendrais de véritables services à l’arsenal. On ne pouvait rien écrire de mieux. Zébédé s’écria :
– Maintenant ton affaire est sûre !
– Oui, dit M. Goulden, te voilà retenu dans l’arsenal de Metz.
Et Catherine vint m’embrasser, toute pâle, en disant :
– Quel bonheur, Joseph !
Tous faisaient semblant de croire que je resterais à Metz, et moi je voulais aussi leur cacher mon épouvante. Mais cela me suffoquait, je ne pouvais presque pas m’empêcher de sangloter ; heureusement, l’idée me vint d’aller annoncer la nouvelle à la tante Grédel.
– Écoutez, leur dis-je, quoique ce ne soit pas pour longtemps et que je doive rester à Metz, il faut pourtant que j’annonce cette bonne nouvelle à la tante Grédel. Ce soir, entre cinq et six heures, je reviendrai ; Catherine aura le temps d’arranger mon sac, et nous souperons.
– Oui, va, Joseph, me dit M. Goulden.
Catherine ne dit rien, car elle avait de la peine à ne pas fondre en larmes. – Je partis comme un fou. Zébédé, qui s’en retournait à la caserne, me prévint sur la porte que l’officier d’habillement se trouvait à la mairie et qu’il faudrait être là vers cinq heures. J’écoutais ses paroles comme en rêve, et je me sauvai jusque hors de la ville. Sur les glacis, je me mis à courir sans regarder où, dans les chemins couverts ; je passai par la fontaine des Trois-Châteaux et les Baraques-d’en-Haut, le long du bois pour aller aux Quatre-Vents. Les idées qui me traversaient l’esprit ne sont pas à décrire ; j’étais effaré, j’aurais voulu courir jusqu’en Suisse. Mais le pire, c’est quand j’approchai des Quatre-Vents, par le sentier de Danne. Il pouvait être trois heures ; la mère Grédel, qui mettait des perches à ses haricots, derrière dans le jardin, m’avait vu de loin, Elle s’était dit :
– Mais c’est Joseph !… Qu’est-ce qu’il fait donc au milieu des blés ?
Moi, une fois dans le chemin creux, rempli d’ornières et de sable que le soleil chauffait comme un four, je remontais lentement, la tête penchée, en pensant : « Tu n’oseras jamais entrer ! » lorsque tout à coup, derrière la haie, la tante me cria :
– C’est toi, Joseph ? Alors je frémis.
– Oui… c’est moi, lui dis-je.
Elle sortit dans la petite allée de sureaux, et me voyant là tout pâle.
– Je sais pourquoi tu viens, mon enfant, me dit-elle ; tu pars, n’est-ce-pas ?
– Oh ! lui dis-je, je suis retenu pour l’arsenal de Metz… Les autres partent… moi je vais rester à Metz… c’est bien heureux !
Elle ne dit rien. Nous entrâmes dans la cuisine bien fraîche à cause de la grande chaleur qu’il faisait dehors. Elle s’assit et je lui lus la lettre du commandant. – Elle écoutait et dit :
– Oui… c’est bien heureux !
Et nous restâmes à nous regarder l’un l’autre sans parler. Ensuite elle me prit la tête entre les mains et m’embrassa longtemps, et je vis qu’elle pleurait à chaudes larmes sans pousser un soupir.
– Vous pleurez… lui dis-je. Mais puisque je reste à Metz !…
Elle ne répondit pas et descendit à la cave chercher du vin. Elle m’en fit boire un verre et me demanda :
– Qu’est-ce que dit Catherine ?
– Elle est contente de voir que je resterai à l’arsenal, lui dis-je, et M. Goulden aussi.
– C’est bien, fit-elle. Est-ce qu’on te prépare ce qu’il te faut ?
– Oui, tante Grédel, et je dois être avant cinq heures à l’hôtel de ville, pour recevoir mon uniforme.
– Eh bien ! va, dit-elle, embrasse-moi… Je n’irai pas là-bas… je ne veux pas voir partir le bataillon… je resterai… je veux vivre longtemps… Catherine a besoin que je vive…
Elle se mettait à crier, mais tout à coup elle se retint et me dit :
– À quelle heure partez-vous ?
– Demain, à sept heures, maman Grédel.
– Eh bien à huit heures j’arriverai… Tu seras déjà loin… mais tu sauras que la mère de ta femme est là… qu’elle reprend sa fille… qu’elle vous aime… qu’elle n’a que vous au monde !…
En parlant ainsi, cette femme si courageuse se mit à sangloter. Elle me reconduisit dehors sur la route, et je partis. Je n’avais plus une goutte de sang dans les veines. J’arrivai devant la mairie sur le coup de cinq heures. Je montai, je revis cette salle où j’avais perdu, cette salle maudite où tout le monde tirait de mauvais numéros. Je reçus une capote, un habit, un pantalon, des guêtres, des souliers. Zébédé, qui m’attendait là, dit à l’un de ses fusiliers de porter tout à la chambrée.
– Tu viendras mettre cela de bonne heure, me dit-il, ton fusil et ta giberne sont au râtelier depuis ce matin.
– Viens avec moi, lui dis-je.
– Non, fit-il, la vue de Catherine me crève le cœur et puis il faut que je reste avec mon père. Qui sait si je retrouverai le pauvre vieux dans un an ? J’ai promis de souper avec vous, mais je n’irai pas.
Il fallut donc rentrer seul. Mon sac était prêt, mon vieux sac, la seule chose que j’eusse réchappée de Hanau, la tête appuyée dessus dans le fourgon. M. Goulden travaillait. Il se retourna sans rien me dire.
– Où donc est Catherine ? lui demandai-je.
– Elle est en haut.
Je pensais qu’elle pleurait ; j’aurais voulu monter, mais les jambes et le courage me manquaient. Je dis à M. Goulden comment les choses s’étaient passées aux Quatre-Vents ; ensuite nous attendîmes en rêvant l’un en face de l’autre, sans oser nous regarder. – La nuit venait, elle était déjà sombre lorsque Catherine descendit. Elle dressa la table dans l’obscurité, puis je lui pris la main et je la fis asseoir sur mes genoux ; nous restâmes là près d’une demi-heure encore.
– Zébédé ne vient pas ? demanda M. Goulden.
– Non, il est retenu par le service.
– Eh bien ! soupons, fit-il.
Mais personne n’avait faim. Catherine leva la table vers neuf heures, et l’on alla se coucher. C’est la plus terrible nuit que j’aie passé de ma vie. Catherine était comme morte ; je l’appelais, elle ne répondait pas. À minuit, j’allai prévenir M. Goulden. Il s’habilla et monta. Nous lui fîmes prendre de l’eau sucrée. Elle revint et se leva. Je ne puis pas tout vous dire ; je sais seulement qu’elle se mit à mes genoux, en me priant de ne pas l’abandonner, comme si j’avais fait cela volontairement ; mais elle était folle. M. Goulden voulait chercher un médecin, je l’en empêchai. Elle se remit tout à fait vers le jour, elle pleura longtemps et finit par s’endormir dans mes bras. Alors je n’osai pas seulement l’embrasser, et nous sortîmes tout doucement. C’est là qu’on voit les misères de la vie et qu’on pense : « Mon Dieu, pourquoi donc m’avez-vous mis au monde !… pourquoi ne m’avez-vous pas laissé dormir dans les siècles des siècles ! Qu’est-ce que j’avais donc fait avant de naître, pour mériter de voir ceux que j’aime souffrir sans ma faute ? » Mais ce n’est pas Dieu qui fait de pareilles choses ; ce sont les hommes qui vous arrachent le cœur !
Enfin M. Goulden et moi nous étions descendus ; il me disait :
– Elle dort… elle ne sait rien… c’est un bonheur… tu partiras pendant son sommeil.
Je bénissais le Seigneur de l’avoir endormie.
Nous rêvions en écoutant les moindres bruits, lorsqu’enfin le rappel se mit à battre. Alors M. Goulden me regarda gravement, et nous nous levâmes. Il prit le sac et me le boucla sur les épaules en silence.
– Joseph, me dit-il, va voir le commandant de l’arsenal, à Metz, mais ne compte sur rien. Le danger est tellement grave, que la France a besoin de tous ses enfants pour la défendre. Et cette fois il ne s’agit plus de prendre le bien des autres, mais de sauver notre propre pays. Souviens-toi que c’est toi-même, ta femme, tout ce que tu possèdes de plus cher au monde, qui se trouve en jeu. Je voudrais avoir vingt ans de moins pour t’accompagner et te montrer l’exemple.
Nous descendîmes ensuite sans faire de bruit ; nous nous embrassâmes et je gagnai la caserne, Zébédé lui-même me conduisit à la chambrée, où je mis mon uniforme. Tout ce qui me revient encore, après tant d’années c’est que le père de Zébédé, qui se trouvait là, fit un paquet de mes habits, en disant qu’il irait chez nous après notre départ ; et qu’ensuite le bataillon défila par la ruelle de Lanche, sous la porte de France.
Quelques enfants nous suivaient. Les soldats du corps de garde, à l’avancée, portèrent les armes. Nous étions en route pour Waterloo.
XV
À Sarrebourg nous reçûmes des billets de logement. Le mien était pour l’ancien imprimeur Jâreisse, qui connaissait M. Goulden et la tante Grédel ; il me fit dîner à sa table avec mon nouveau camarade de lit, Jean Buche, le fils d’un schlitteur du Harberg, qui n’avait jamais mangé que des pommes de terre avant d’être conscrit. Il croquait jusqu’aux os de la viande qu’on nous servait. Moi, j’étais tellement mélancolique que de l’entendre croquer ces os, cela me tombait sur les nerfs.
Le père Jâreisse voulait me consoler, mais tout ce qu’il me disait augmentait encore mon chagrin.
Nous passâmes le reste de cette journée et la nuit suivante à Sarrebourg. Le lendemain, nous fîmes route jusqu’au village de Mézières, le surlendemain jusqu’à Vic, et puis jusqu’à Soigne ; enfin le cinquième jour nous approchions de Metz.
Je n’ai pas besoin de vous raconter notre marche : les soldats tout blancs de poussière, qui vont d’étapes en étapes, le sac au dos, l’arme à volonté, parlent, rient, traversent les villages en regardant les filles, les charrettes, les fumiers, les hangars, les montées et les descentes, sans s’inquiéter de rien. Et quand on est triste, quand on laisse à la maison sa femme, de vieux amis, des gens qui vous aiment et qu’on ne reverra peut-être jamais, tout défile sous vos yeux comme des ombres ; à cent pas plus loin, on n’y pense plus.
Pourtant la vue de Metz, avec sa haute cathédrale, ses vieilles maisons et ses remparts sombres, me réveilla. Deux heures avant d’arriver, nous croyions être aux chemins couverts. Il faisait très chaud, on allongeait le pas pour se mettre plus tôt à l’ombre. Le souvenir du colonel Desmichel me revenait ; j’avais une petite espérance, bien petite, et je m’écriais en moi-même : « Ah ! si la chance voulait ! » Je tâtais ma lettre. Zébédé ne me parlait plus, de temps en temps il se retournait pour me jeter un coup d’œil. Ce n’était plus tout à fait comme dans le temps ; il était sergent, et moi simple soldat. Que voulez-vous ? nous nous aimions toujours, mais cela faisait tout de même une différence.
Jean Buche, lui, marchait près de moi, le dos rond et les pieds en dedans comme les loups. La seule chose qu’il me disait quelquefois, c’est que les souliers vous gênent pour la marche et qu’on ne devrait les mettre qu’à la parade. Depuis deux mois le sergent instructeur n’avait pu lui retourner les pieds ni lui redresser les épaules ; mais il marchait terriblement bien à sa manière, et sans se fatiguer.
Enfin, sur les cinq heures de l’après-midi, nous arrivâmes à l’avancée. On vint nous reconnaître ; le capitaine de garde lui-même nous cria :
– Quand il vous plaira !
Les tambours se mirent à battre, et nous entrâmes dans cette ville, la plus vieille que j’aie jamais vue. C’est à Metz que la Seille et la Moselle se rencontrent, et c’est là qu’on voit des maisons de quatre et cinq étages, les murs décrépits pleins de poutrelles, comme à Saverne et à Bouxviller ; des fenêtres rondes et carrées, grandes et petites sur la même ligne, avec des volets et sans volets, avec des vitres et sans vitres. C’est vieux comme les montagnes et les rivières, et tout en haut le toit s’avance de six pieds, en allongeant son ombre dans les eaux noires où passent des savates, des guenilles et des chiens noyés.
Quand on regarde par hasard en l’air, dans ces recoins, au fond d’une lucarne, on est presque sûr de voir la figure d’un vieux juif, avec sa barbe grise, et son nez crochu, ou bien un enfant qui risque de tomber, ou quelque chose de pareil, car, à proprement parler, Metz est une ville de juifs et de soldats. Les pauvres gens n’y manquent pas non plus ; c’est bien pire qu’à Mayence, à Strasbourg et même à Francfort. À moins qu’on n’ait tout changé depuis ; les gens aiment leurs aises maintenant, et les villes s’embellissent de jour en jour.
Enfin nous traversions ce spectacle, et malgré ma grande tristesse, je ne pouvais m’empêcher de regarder ces ruelles. La ville fourmillait alors de gardes nationaux ; il en arrivait de Longwy, de Sarrelouis et d’ailleurs, les soldats partaient, les gardes nationaux les relevaient.
Nous arrivâmes sur une place encombrée de matelas, de paillasses et d’autres effets de literie que les bourgeois fournissaient aux troupes. On nous fit mettre l’arme au pied, devant une caserne dont toutes les fenêtres étaient ouvertes du haut en bas. Nous attendions, pensant que nous serions logés dans cette caserne ; mais, au bout de vingt minutes, le prêt commença ; nous reçûmes vingt-cinq sous par homme, avec un billet de logement. On fit rompre les rangs, et chacun partit de son côté. Jean Buche, qui n’avait vu d’autre ville que Phalsbourg, ne me quittait pas.
Notre billet de logement était pour Elias Meyer, boucher dans la rue de Saint-Valéry. Quand nous arrivâmes en face de la maison, ce boucher, – qui découpait de la viande à sa fenêtre en forme de voûte, garnie d’une grille, – se fâcha et nous reçut très mal. C’était un gros juif tout rouge, la figure ronde, avec des bagues d’argent à ses doigts et des boucles d’oreilles ; sa femme, maigre et jaune, descendit en s’écriant qu’ils avaient logé la veille, l’avant-veille… que le secrétaire de la mairie leur en voulait, qu’il leur envoyait des soldats tous les jours, que les voisins n’en avaient pas… ainsi de suite. Ils nous laissèrent pourtant entrer. Leur fille vint nous voir ; derrière elle se tenait une grosse servante crépue, très sale. Il me semble que ces gens sont encore là, devant moi, dans la vieille chambre boisée de chêne, la grande lampe de cuivre pendue au plafond et la fenêtre grillée ouvrant sur une petite cour.
La fille, très pâle et les yeux noirs, dit quelques mots à sa mère, et la servante reçut l’ordre de nous conduire au grenier, à la chambre des mendiants ; car tous les juifs ont des mendiants qu’ils nourrissent le vendredi. Mon camarade du Harberg trouvait cela très bien ; moi j’étais indigné. Malgré cela, nous montâmes derrière la servante, dans un escalier tournant où l’on glissait à force de crasse ; et nous arrivâmes au grenier, dans une chambre formée de lattes à travers desquelles on voyait le linge sale pour la lessive. Le jour venait par une lucarne en tabatière dans le toit. Sans ma désolation, j’aurais trouvé ce lieu vraiment abominable ; nous n’avions qu’une seule chaise et une paillasse étendue sur le plancher avec sa couverture pour nous deux. La servante nous regardait encore sur la porte, comme si nous avions dû lui faire des compliments.
Je m’assis et me débarrassai de mon sac, bien triste, comme on pense ; Buche en fit autant de son côté. La servante se mettait à descendre, quand je lui criai :
– Attendez une minute… Nous descendons aussi… nous ne voulons pas nous casser le cou dans l’escalier. Après avoir changé de souliers et de bas, nous refermâmes la porte avec un cadenas, et nous descendîmes dans la boucherie acheter de la viande. Jean alla chercher du pain chez le boulanger en face, et comme nous avions place au feu, nous entrâmes dans la cuisine faire la soupe.
Le boucher vint nous voir vers huit heures, il avait une grosse pipe d’Ulm ; nous finissions de manger. Il nous demanda de quel pays nous étions ; moi, je ne lui répondis pas, parce que j’étais trop indigné, mais Jean Buche lui dit que j’étais horloger à Phalsbourg, sur quoi cet homme me prit en considération. Il dit que son frère voyageait en Alsace et en Lorraine pour les montres, les bagues, les chaînes de montres et autres objets d’orfèvrerie et de bijouterie ; qu’il s’appelait Samuel Meyer, et que peut-être nous avions déjà fait des affaires ensemble. Je lui répondis alors que j’avais vu son frère deux ou trois fois chez M. Goulden, et c’était vrai. Là-dessus il prévint la servante de nous monter un oreiller ; mais il n’en fit pas plus pour nous, et nous allâmes nous coucher. La grande fatigue nous endormit bien vite. Je pensais me lever de bonne heure et courir à l’arsenal ; mais je dormais encore quand mon camarade me secoua, en disant :
– Le rappel !
J’écoutais ; c’était le rappel. Nous n’eûmes que le temps de nous habiller, de boucler notre sac, de prendre le fusil et de descendre. Comme nous arrivions sur la place de la caserne, l’appel commençait. Après l’appel, deux fourgons s’avancèrent, et nous reçûmes cinquante cartouches à balle par homme. Le commandant Gémeau, le capitaine et tous les officiers étaient là. Je vis que tout était fini, qu’il ne fallait plus compter sur rien, et que ma lettre pour le colonel Desmichel serait bonne après la campagne, si j’en réchappais, et s’il fallait finir mes sept ans. – Zébédé me regardait de loin ; je détournais la tête. Dans le même instant on cria :
– Portez armes ! Arme à volonté ! Par file à gauche, en avant, marche !
Les tambours battaient, nous marquions le pas ; les toits, les maisons, les fenêtres, les ruelles et les gens défilaient. Nous traversâmes le premier pont, ensuite le pont-levis. – Les tambours cessèrent de battre ; nous allions du côté de Thionville.
D’autres troupes suivaient le même chemin, de la cavalerie et de l’infanterie.
Nous arrivâmes le soir au village de Beauregard, le lendemain soir au village de Vitry, près de Thionville, où nous fûmes cantonnés jusqu’au 8 juin. Je logeais, avec Buche, chez un gros propriétaire qui s’appelait M. Pochon, un honnête homme qui nous faisait boire de bon vin blanc, et qui se plaisait à parler de politique comme M. Goulden.
Pendant notre séjour dans ce village, le général Schœffer arriva de Thionville, et l’on nous fit prendre les armes, pour aller passer la revue près d’une grande ferme, qu’on appelait la ferme de Silvange.
Ce pays est plein de bois ; nous allions à plusieurs nous promener dans les environs. Un jour Zébédé vint me prendre et me conduisit dans la grande fonderie de Moyeuvre, où nous vîmes couler des boulets et des obus. Nous causions de Catherine, de M. Goulden ; il me disait d’écrire, mais j’avais peur en quelque sorte de recevoir des nouvelles ; je détournais mon esprit de Phalsbourg.
Le 8 juin, de grand matin, le bataillon partit du village et repassa près de Metz, mais sans entrer. Les portes de la ville étaient fermées et les canons sur les remparts, comme en temps de guerre. Nous allâmes coucher à Chatel, le lendemain à Étain, le jour suivant à Dannevoux, où je fus logé chez un bon patriote qui s’appelait M. Sébastien Perrin. C’était un homme riche. Il voulait tout savoir en détail, et comme avant nous un grand nombre d’autres bataillons avaient suivi la même route, il disait :
– Dans un mois ou peut-être avant, nous saurons de grandes choses… Toutes les troupes marchent sur la Belgique… L’Empereur va tomber sur les Anglais et les Prussiens !
C’était notre dernière bonne étape, car le lendemain nous arrivâmes à Yong, qui est un mauvais pays. Nous allâmes coucher le 12 juin à Vivier ; le 13, à Cul-de-Sard. Plus nous avancions, plus nous rencontrions de troupes, et comme j’avais déjà vu ces choses en Allemagne, je disais à mon camarade Jean Buche :
– Maintenant ça va chauffer !
De tous les côtés, dans toutes les directions, la cavalerie, l’infanterie, l’artillerie s’avançaient par files, couvrant les routes à perte de vue. On ne pouvait voir de plus beau temps ni de plus magnifiques récoltes ; seulement il faisait trop chaud. Ce qui m’étonnait, c’était de ne découvrir aucun ennemi, ni devant ni derrière, ni à droite ni à gauche. On ne savait rien. Le bruit courait entre nous que, cette fois, nous allions tomber sur les Anglais. J’avais déjà vu les Prussiens, les Autrichiens, les Russes, les Bavarois, les Wurtembergeois, les Suédois ; je connaissais les gens de tous les pays du monde, et maintenant j’allais aussi connaître les Anglais. Je pensais : « Puisqu’il faut s’exterminer, j’aime autant que ce soit avec ceux-ci qu’avec les Allemands. Nous ne pouvons pas éviter notre sort ; si je dois en réchapper, j’en réchapperai ; si je dois laisser ma peau, tout ce que je ferais pour la sauver, ou rien, ce serait la même chose. Mais il faut en exterminer le plus possible des autres ; de cette façon, nous augmentons les chances pour nous.
Voilà les raisonnements que je me tenais à moi-même, et s’ils ne me faisaient pas de bien, au moins ils ne me causaient pas de mal.
XVI
Nous avions passé la Meuse le 12 ; le 13 et le 14, nous continuâmes à marcher dans de mauvais chemins bordés de champs de blé, d’orge, d’avoine, de chanvre, qui n’en finissaient plus. – Il faisait une chaleur extraordinaire, la sueur me coulait sous le sac et la giberne jusqu’au bas des reins. Quel malheur d’être pauvre, et de ne pas pouvoir s’acheter un homme qui marche et qui reçoive des coups de fusil pour nous ! – Après avoir supporté la pluie, le vent, la neige et la boue en Allemagne, le tour de la poussière et du soleil était venu.
Je voyais aussi que l’extermination approchait ; on n’entendait plus dans toutes les directions que le son des tambours et des trompettes ; quand le bataillon passait sur une hauteur, des files de casques, de lances, de baïonnettes se découvraient à perte de vue. Zébédé, le fusil sur l’épaule, me criait quelquefois d’un air joyeux :
– Eh bien ! Joseph, nous allons donc encore une fois nous regarder le blanc des yeux avec les Prussiens ?
Et j’étais forcé de lui répondre :
– Oh ! oui, la noce va recommencer !
Comme si j’avais été content de risquer ma vie et de laisser Catherine veuve avant l’âge, pour des choses qui ne me regardaient pas.
Ce jour même, vers sept heures, nous arrivâmes à Roly. Des hussards occupaient déjà ce village, et l’on nous fit bivouaquer dans un chemin creux, le long de la côte.
Nos fusils étaient à peine en faisceaux, que plusieurs officiers supérieurs arrivèrent. Le commandant Gémeau, qui venait de mettre pied à terre, remonta sur son cheval et courut à leur rencontre ; ils causèrent un instant ensemble et descendirent dans notre chemin, où tout le monde regardait en se disant :
« Quelque chose se passe ! »
Un des officiers supérieurs, le général Pécheux, que nous avons connu depuis, ordonna le roulement et nous cria :
– Formez le cercle !
Mais comme le chemin était trop étroit, les soldats montèrent des deux côtés sur le talus ; d’autres restèrent en bas. Tout le bataillon regardait, et le général se mit à dérouler un papier en nous criant :
– Proclamation de l’Empereur !
Quand il eut dit cela, le silence devint si grand, qu’on aurait dit qu’il était seul au milieu des champs. Depuis le dernier conscrit jusqu’au commandant Gémeau, tout le monde écoutait ; et même aujourd’hui, quand j’y pense après cinquante ans, cela me remue le cœur : c’était quelque chose de grand et de terrible.
Voici ce que le général nous lut :
« Soldats ! c’est aujourd’hui l’anniversaire de Marengo et de Friedland, qui décidèrent deux fois du sort de l’Europe. Alors, comme après Austerlitz, comme après Wagram, nous fûmes trop généreux, nous crûmes aux protestations et aux serments des princes que nous laissâmes sur le trône. Aujourd’hui cependant, coalisés entre eux, ils en veulent à l’indépendance et aux droits les plus sacrés de la France. Ils ont commencé la plus injuste des agressions ; marchons à leur rencontre : eux et nous, nous ne sommes plus les mêmes hommes ! »
Tout le bataillon frémit et se mit à crier : Vive l’Empereur ! Le général leva la main, et l’on se tut en se penchant encore plus pour entendre.
« Soldats ! – À Iéna, contre ces mêmes Prussiens, aujourd’hui si arrogants, nous étions un contre trois, et à Montmirail, un contre six. Que ceux d’entre vous qui ont été prisonniers des Anglais vous fassent le récit de leurs pontons et des maux affreux qu’ils y ont soufferts.
» Les Saxons, les Belges, les Hanovriens, les soldats de la Confédération du Rhin gémissent d’être obligés de prêter leurs bras à la cause de princes ennemis de la justice et des droits de tous les peuples ; ils savent que cette coalition est insatiable : après avoir dévoré douze millions de Polonais, douze millions d’Italiens, un million de Saxons, six millions de Belges, elle devra dévorer les États de second ordre de l’Allemagne.
» Les insensés ! Un moment de prospérité les aveugle ; l’oppression et l’humiliation du peuple français sont hors de leur pouvoir. S’ils entrent en France, ils y trouveront leur tombeau.
» Soldats, nous avons des marches forcées à faire, des batailles à livrer, des périls à courir ; mais avec de la constance, la victoire sera à nous ; les Droits de l’homme et le bonheur de la patrie seront reconquis. Pour tout Français qui a du cœur, le moment est arrivé de vaincre ou de périr.
» Napoléon. »
On ne se figurera jamais les cris qui s’élevèrent alors ; c’était un spectacle qui vous grandissait l’âme ; on aurait dit que l’Empereur nous avait soufflé son esprit des batailles, et nous ne demandions plus qu’à tout massacrer.
Le général était parti depuis longtemps, que les cris continuaient encore, et moi-même j’étais content ; je voyais que tout cela c’était la vérité : que les Prussiens, les Autrichiens, les Russes, qui dans le temps ne parlaient que de la délivrance des peuples, avaient profité de la première occasion pour tout happer ; que tous ces grands mots de liberté, qu’ils avaient mis en avant en 1813 pour entraîner la jeunesse contre nous, toutes les promesses de constitutions qu’ils avaient faites, ils les avaient mises de côté. Je les regardais comme des gueux, comme des gens qui ne tenaient pas à leur parole, qui se moquaient des peuples, et qui n’avaient qu’une idée très petite, très misérable : c’était toujours de rester à la meilleure place, avec leurs enfants et descendants bons ou mauvais, justes ou injustes, sans s’inquiéter de la loi de Dieu.
Voilà ce que je voyais. Cette proclamation me paraissait très belle. Je pensais même que le père Goulden en serait très content, parce que l’Empereur n’avait pas oublié les Droits de l’homme, qui sont la liberté, l’égalité, la justice, et toutes ces grandes idées qui font que les hommes, au lieu d’agir comme les animaux, se respectent eux-mêmes et respectent aussi les droits de leur prochain.
Notre courage était donc beaucoup augmenté par ces paroles fortes et justes. Les anciens disaient en riant :
– Cette fois, nous n’allons pas languir… à la première marche, nous tombons sur les Prussiens !
Et les conscrits, qui n’avaient pas encore entendu ronfler les boulets, se réjouissaient plus que les autres. Les yeux de Buche brillaient comme ceux d’un chat ; il s’était assis au bord du chemin, son sac ouvert sur le talus, et repassait lentement son sabre, en essayant le fil à la pointe de son soulier. D’autres affilaient leur baïonnette, ou rajustaient leur pierre à fusil, ce qui se fait toujours en campagne, la veille d’une rencontre. – Dans ces moments, mille idées vous passent par la tête, on fronce le sourcil, on serre les lèvres, on a de mauvaises figures.
Le soleil se penchait de plus en plus derrière les blés ; quelques détachements allaient chercher du bois au village, ils en rapportaient aussi des oignons, des poireaux, du sel, et même des quartiers de vache pendus à de grandes perches sur leurs épaules.
C’est autour des feux, lorsque les marmites commençaient à bouillonner et que la fumée tournait dans le ciel, qu’il aurait fallu voir la mine joyeuse qu’on avait ; l’un parlait de Lutzen, l’autre d’Austerlitz, l’autre de Wagram, d’Iéna, de Friedland, de l’Espagne, du Portugal, de tous les pays du monde. Tous parlaient ensemble ; mais on n’écoutait que les anciens, les bras couverts de chevrons, qui parlaient mieux et montraient les positions à terre avec le doigt, en expliquant les par file à droite et les par file à gauche, par trente ou quarante en bataille. On croyait tout voir en les écoutant.
Chacun avait sa cuiller d’étain à la boutonnière et pensait :
« Le bouillon va bien… c’est une bonne viande bien grasse. »
La nuit alors était venue. Après la distribution on avait l’ordre d’éteindre les feux et de ne pas sonner la retraite, ce qui signifiait que l’ennemi n’était pas loin, et qu’on craignait de l’effaroucher.
Il commençait à faire clair de lune. Buche et moi nous mangions à la même gamelle. Quand nous eûmes fini, durant plus de deux heures il me raconta leur vie au Harberg, leur grande misère lorsqu’il fallait traîner des cinq et six stères de bois sur une schlitte, en risquant d’être écrasés, surtout à la fonte des neiges. L’existence des soldats, la bonne gamelle, le bon pain, la ration régulière, les bons habits chauds, les chemises bien solides en grosse toile, tout cela lui paraissait admirable. Jamais il ne s’était figuré qu’on pouvait vivre aussi bien ; et la seule idée qui le tourmentait, c’était de faire savoir à ses deux frères, Gaspard et Jacob, sa belle position, pour les décider à s’engager aussitôt qu’ils auraient l’âge.
– Oui, lui disais-je, c’est bien ; mais les Russes, les Anglais, les Prussiens… tu ne penses pas à cela.
– Je me moque d’eux, faisait-il ; mon sabre coupe comme un tranchet, ma baïonnette pique comme une aiguille. C’est plutôt eux qui doivent avoir peur de me rencontrer.
Nous étions les meilleurs amis du monde ; je l’aimais presque autant que mes anciens camarades Klipfel, Furst et Zébédé. Lui m’aimait bien aussi ; je crois qu’il se serait fait hacher pour me tirer d’embarras. – Les anciens camarades de lit ne s’oublient jamais ; de mon temps, le vieux Harwig, que j’ai connu plus tard à Phalsbourg, recevait encore une pension de son ancien camarade Bernadotte, roi de Suède. Si j’étais devenu roi, j’aurais aussi fait une pension à Jean Buche, car s’il n’avait pas un grand esprit, il avait un bon cœur, ce qui vaut encore mieux.
Pendant que nous étions à causer, Zébédé vint me frapper sur l’épaule.
– Tu ne fumes pas, Joseph ? me dit-il.
– Je n’ai pas de tabac.
Aussitôt il m’en donna la moitié d’un paquet.
Je vis qu’il m’aimait toujours, malgré la différence des grades, et cela m’attendrit. Lui ne se possédait plus de joie, en songeant que nous allions tomber sur les Prussiens.
– Quelle revanche ! s’écriait-il. Pas de quartier… Il faut que tout soit payé depuis la Katzbach jusqu’à Soissons.
On aurait cru que ces Prussiens et ces Anglais n’allaient pas se défendre, et que nous ne risquions pas d’attraper des boulets et de la mitraille, comme à Lutzen, à Gross-Beren, à Leipzig et partout. Mais que peut-on dire à des gens qui ne se rappellent rien et qui voient tout en beau ? Je fumais tranquillement ma pipe et je répondais :
– Oui !… oui !… nous allons les arranger, ces gueux-là !… Nous allons les bousculer… Ils vont en voir des dures…
J’avais laissé bourrer sa pipe à Jean Buche ; et comme nous étions de garde, Zébédé, vers neuf heures, alla relever les premières sentinelles à la tête du piquet. Moi, je sortis de notre cercle, et j’allai m’étendre quelques pas en arrière, l’oreille sur le sac, au bord d’un sillon. Le temps était si chaud, qu’on entendait les cigales chanter longtemps encore après le coucher du soleil ; quelques étoiles brillaient au ciel, pas un souffle n’arrivait sur la plaine, les épis restaient droits, et dans le lointain les horloges des villages sonnaient neuf heures, dix heures, onze heures. Je finis par m’endormir. C’était la nuit du 14 au 15 juin 1815.
Entre deux et trois heures du matin, Zébédé vint me secouer.
– Debout, disait-il, en route !
Buche était aussi venu s’étendre près de moi, nous nous levâmes. C’était notre tour de relever les postes. Il faisait encore nuit, mais le jour étendait une ligne blanche au bord du ciel, le long des blés. À trente pas plus loin, le lieutenant Bretonville nous attendait au milieu du piquet. C’est dur de se lever, quand on dort si bien après une marche de dix heures. Tout en bouclant notre sac, nous avions rejoint le piquet. Au bout de deux cents pas, derrière une haie, je relevai la sentinelle en face de Roly. Le mot d’ordre était : « Jemmapes et Fleurus ! » Cela me revient d’un coup… Comme pourtant les choses dorment dans notre esprit durant des années ! ce mot d’ordre ne m’était pas revenu depuis 1815.
Je crois encore voir le piquet qui rentre dans le chemin, pendant que je renouvelle mon amorce à la lueur des étoiles ; et j’entends au loin les autres sentinelles marcher lentement, tandis que les pas du piquet s’éloignent à l’intérieur de la colline.
Je me mis à marcher l’arme au bras le long de la haie. Le village, avec ses petits toits de chaume et plus loin son clocher d’ardoises, s’élevait au-dessus des moissons. Un hussard à cheval, en sentinelle au milieu du chemin, regardait, son mousqueton appuyé sur la cuisse. C’est tout ce qu’on voyait.
Longtemps j’attendis là, songeant, écoutant et marchant. Tout dormait. La ligne blanche du ciel grandissait.
Cela dura plus d’une demi-heure. La lumière matinale grisonnait au loin le pays ; deux ou trois cailles s’appelaient et se répondaient d’un bout de la plaine à l’autre. Je m’étais arrêté tout mélancolique, car, en entendant ces voix, je me représentais les Quatre-Vents, Danne, les Baraques-du-Bois-de-Chênes ; je pensais : « Là-bas, dans nos blés, les cailles chantent aussi sur la lisière du bois de la Bonne-Fontaine. Est-ce que Catherine dort… et la tante Grédel, et M. Goulden, et toute la ville ?… Les gardes nationaux de Nancy nous ont relevés maintenant ! » Et je voyais les sentinelles des deux poudrières, les corps de garde des deux portes ; enfin des idées innombrables me venaient, quand, dans le lointain, le galop d’un cheval s’entendit. Je regardai d’abord sans rien voir. Ce galop, au bout de quelques minutes, entra dans le village ; ensuite tout se tut. Seulement il se fit une rumeur confuse. Qu’est-ce que cela signifiait ? Un instant après, le cavalier sortit de Roly dans notre chemin, ventre à terre ; je m’avançai au bord de la haie, l’arme prête, en criant :
– Qui vive ?
– France !
– Quel régiment ?
– Douzième chasseurs… estafette.
– Quand il vous plaira.
Il poursuivit sa route en redoublant de vitesse. Je l’entendis s’arrêter au milieu de notre campement et crier :
– Le commandant ?
Je m’avançai sur le dos de la colline pour voir ce qui se passait. Presque aussitôt il se fit un grand mouvement : les officiers arrivaient ; le chasseur, toujours à cheval, parlait au commandant Gémeau ; des soldats s’approchaient aussi. J’écoutais, mais c’était trop loin. Le chasseur repartit en remontant la côte. Tout paraissait en révolution ; on criait, on gesticulait.
Tout à coup la diane se mit à battre. Le piquet qui relevait les postes tournait au coude du chemin. Zébédé de loin m’avait l’air tout pâle.
– Arrive ! me dit-il en passant.
Deux sentinelles restaient plus loin sur la gauche. On ne parle pas sous les armes, malgré cela Zébédé me dit tout bas :
– Joseph, nous sommes trahis ; Bourmont, le général de la division d’avant-garde, et cinq autres brigands de son espèce viennent de passer à l’ennemi.
Sa voix tremblait. Tout mon sang ne fit qu’un tour, et, regardant les autres du piquet, deux vieux à chevrons, je vis que leurs moustaches grises frissonnaient ; ils roulaient des yeux terribles, comme s’ils avaient cherché quelqu’un à tuer, mais ils ne disaient rien.
Nous pressions le pas pour relever les deux autres sentinelles. Quelques minutes après, en rentrant au bivouac, nous trouvâmes le bataillon déjà sous les armes, prêt à partir. La fureur et l’indignation étaient peintes sur toutes les figures ; les tambours roulaient. Nous reprîmes nos rangs. Le commandant et le capitaine adjudant-major, à cheval sur le front du bataillon, attendaient, pâles comme des morts. Je me souviens que le commandant, tout à coup tirant son épée pour faire cesser le roulement, voulut dire quelque chose ; mais les idées ne lui venaient pas, et, comme un fou, il se mit à crier :
– Ah ! canailles !… ah ! misérables chouans !… Vive l’Empereur ! Pas de quartier !…
Il bredouillait et ne savait plus ce qu’il disait ; mais tout le bataillon trouvait qu’il parlait très bien, et l’on se mit à crier tous ensemble comme des loups :
– En avant !… en avant !… À l’ennemi !… Pas de quartier !
On traversa le village au pas de charge ; le dernier soldat s’indignait de ne pas voir tout de suite les Prussiens. Ce n’est qu’au bout d’une heure, après avoir fait chacun ses réflexions, qu’on se remit à jurer, à crier, d’abord tout bas, ensuite tout haut, de sorte qu’à la fin le bataillon était comme des révoltés. Les uns disaient qu’il fallait exterminer tous les officiers de Louis XVIII, les autres qu’on voulait nous livrer tous en masse ; et même plusieurs criaient que les maréchaux trahissaient, qu’ils devaient passer au conseil de guerre pour être fusillés, et d’autres choses semblables.
Le commandant alors ordonna de faire halte, et passa devant nous en criant « que les traîtres étaient partis trop tard ; que nous allions attaquer le même jour et que l’ennemi n’aurait pas le temps de profiter de la trahison, qu’il serait surpris et culbuté ».
Ces paroles calmèrent la fureur d’un grand nombre. On se remit en marche, et l’on répétait tout le long de la route que les plans avaient été livrés trop tard.
Mais ce qui changea notre colère en joie, c’est lorsque, vers dix heures, nous entendîmes tout à coup le canon gronder à gauche, à cinq ou six lieues, de l’autre côté de la Sambre. C’est alors que les hommes levèrent leurs shakos à la pointe de leurs baïonnettes, et qu’ils se mirent à crier :
– En avant ! Vive l’Empereur !
Beaucoup de vieux en pleuraient d’attendrissement. Sur toute cette grande plaine, ce n’était qu’un cri immense ; quand un régiment avait fini, l’autre recommençait. Le canon grondait toujours, on redoublait le pas et comme nous marchions sur Charleroi depuis sept heures, l’ordre arriva par estafette d’appuyer à droite.
Je me rappelle aussi que, dans tous les villages où nous passions, les hommes, les femmes, les enfants regardaient par leurs fenêtres et sur leurs portes ; qu’ils levaient les mains d’un air joyeux et criaient :
– Les Français !… les Français !…
On voyait que ces gens nous aimaient, qu’ils étaient du même sang que nous ! et même, dans les deux haltes que nous fîmes, ils arrivaient avec leur bon pain de ménage, le couteau de fer-blanc enfoncé dans la croûte, et leurs grosses cruches de bière noire, en nous tendant cela sans rien nous demander. Nous étions arrivés en quelque sorte pour leur délivrance sans le savoir. Personne dans leur pays ne savait rien non plus, ce qui montre bien la finesse de l’Empereur, puisque, dans ce coin de la Sambre et de la Meuse, nous étions déjà plus de cent mille hommes, sans que la moindre nouvelle en fût arrivée aux ennemis. La trahison de Bourmont nous empêcha de les surprendre dispersés dans les cantonnements : tout aurait été fini d’un seul coup ; mais alors il était bien plus difficile de les exterminer. Nous continuâmes à marcher tout l’après-midi, par cette grande chaleur, dans la poussière des chemins. Plus nous avancions, plus nous voyions devant nous d’autres régiments d’infanterie et de cavalerie. On se tassait pour ainsi dire de plus en plus, car derrière nous il en venait d’autres encore. Vers les cinq heures, nous arrivâmes dans un village où les bataillons et les escadrons défilaient sur un pont de briques. En traversant ce village, que notre avant-garde avait enlevé, nous vîmes quelques Prussiens étendus à droite et à gauche dans les ruelles. Je dis à Jean Buche :
– Ça, ce sont des Prussiens… J’en ai vu pas mal du côté de Lutzen et de Leipzig, et tu vas en voir aussi, Jean !
– Tant mieux ! fit-il, c’est tout ce que je demande ! Le village que nous traversions s’appelait Châtelet ; la rivière, c’était la Sambre : une eau jaune pleine de terre glaise, et profonde ; ceux qui par malheur y tombent ont de la peine à s’en tirer, car les bords sont à pic ; nous avons reconnu cela plus tard.
De l’autre côté du pont, on nous fit bivouaquer le long de la rivière. Nous n’étions pas tout à fait l’avant-garde, puisque les hussards avaient passé devant nous ; mais nous étions la première infanterie du corps de Gérard.
Tout le reste de ce jour, le quatrième corps défila sur le pont et, nous apprîmes à la nuit que l’armée avait passé la Sambre ; qu’on s’était battu près de Charleroi, à Marchiennes et à Jumet.
XVII
Une fois sur l’autre rive de la Sambre, on mit les armes en faisceaux dans un verger, et chacun put allumer sa pipe et respirer en regardant les hussards, les chasseurs, l’artillerie et l’infanterie défiler d’heure en heure sur le pont et prendre position dans la plaine.
Sur notre front se trouvait une forêt de hêtres ; elle s’étendait du côté de Fleurus, et pouvait avoir trois lieues d’un bout à l’autre. On voyait à l’intérieur de grandes places jaunes ; c’étaient des chaumes, et même des carrés de blé, au lieu de ronces, de genêts et de bruyères comme chez nous. Une vingtaine de maisons, vieilles et décrépites, dépassaient le pont, car le Châtelet est un village très grand, plus grand que la ville de Saverne.
Entre les bataillons et les escadrons, qui défilaient toujours, arrivaient des femmes, des hommes, des enfants, avec des cruches de bière vineuse, du pain et de l’eau-de-vie blanche très forte, qu’ils nous vendaient moyennant quelques sous. Buche et moi nous cassâmes une croûte en regardant ces choses, et même en riant avec les filles, qui sont blondes et très jolies dans ce pays.
Tout proche de nous se découvrait le petit village de Catelineau, et, sur notre gauche, bien loin, entre le bois et la rivière, le village de Gilly.
La fusillade, les coups de canon et les feux de peloton roulaient toujours dans cette direction. La nouvelle arriva bientôt que les Prussiens, repoussés de Charleroi par l’Empereur, s’étaient mis en carrés au coin de la forêt. De minute en minute, on s’attendait à marcher pour leur couper la retraite. Mais entre sept et huit heures, la fusillade cessa ; les Prussiens s’étaient retirés sur Fleurus, après avoir perdu l’un de leurs carrés ; le reste s’était sauvé dans le bois ; et nous vîmes arriver deux régiments de dragons. Ils prirent position à notre droite le long de la Sambre.
Le bruit courut quelques instants après que le général Le Tort, de la garde, venait de recevoir une balle dans le ventre, à l’endroit même où, dans sa jeunesse, il menait paître le bétail d’un fermier. Que de choses étonnantes on voit dans la vie ! Ce général avait combattu partout en Europe depuis vingt ans, et c’est là que la mort l’attendait.
Il pouvait être huit heures du soir, et l’on pensait que nous resterions au Châtelet jusqu’après le défilé de nos trois divisions. Un vieux paysan chauve, en blouse bleue et bonnet de coton, sec comme une chèvre, qui se trouvait avec nous, disait au capitaine Grégoire que de l’autre côté du bois, dans un fond, se trouvaient le village de Fleurus et celui de Lambusart, plus petit et sur la droite ; que depuis au moins trois semaines les Prussiens avaient des hommes dans ces villages ; qu’il en était même arrivé d’autres la veille et l’avant-veille. Il nous disait aussi que le long d’une grande route blanche, bordée d’arbres, qu’on voyait filer tout droit à deux bonnes lieues sur notre gauche, les Belges et les Hanovriens avaient des postes à Gosselies et aux Quatre-Bras ; – que c’était la grande route de Bruxelles, où les Anglais, les Hanovriens, les Belges avaient toutes leurs forces ; tandis que les Prussiens, à quatre ou cinq lieues sur la droite, occupaient la route de Namur ; qu’entre eux et les Anglais, du plateau des Quatre-Bras jusque sur le plateau de Ligny, en arrière de Fleurus, s’étendait une bonne chaussée, où leurs estafettes allaient et venaient du matin au soir, de sorte que les Anglais apprenaient toutes les nouvelles des Prussiens, et les Prussiens toutes celles des Anglais ; qu’ils pouvaient ainsi se secourir les uns les autres, en s’envoyant des hommes, des canons et des munitions par cette chaussée.
Naturellement, en entendant cela, l’idée me vint tout de suite que nous n’avions rien de mieux à faire que de prendre cette grande traverse, pour les empêcher de s’aider ; cela vous tombait sous le bon sens, et je n’étais pas le seul auquel cette idée venait ; mais on ne disait rien dans la crainte d’interrompre ce vieux. Au bout de cinq minutes, la moitié du bataillon était en cercle autour de lui. Il fumait une pipe de terre et nous montrait toutes les positions avec son tuyau ; étant commissionnaire pour les paquets entre le Châtelet, Fleurus et Namur, il connaissait les moindres détails du pays et voyait journellement ce qui s’y passait. Il se plaignait beaucoup des Prussiens, disant que c’était des êtres fiers, insolents, dangereux pour les femmes ; qu’on ne pouvait jamais les contenter, et que les officiers se vantaient de nous avoir ramenés depuis Dresde jusqu’à Paris, en nous faisant courir devant eux comme des lièvres.
Voilà ce qui m’indigna ! Je savais qu’ils avaient été deux contre un à Leipzig, que les Russes, les Autrichiens, les Saxons, les Bavarois, les Wurtembergois, les Suédois, toute l’Europe nous avait accablés, lorsque les trois quarts de notre armée étaient malades du typhus, du froid, de la faim, des marches et des contre-marches ; ce qui ne nous avait pas encore empêché de leur passer sur le ventre à Hanau, et de les battre cinquante fois, un contre trois, en Champagne, en Alsace, dans les Vosges et partout. Ces vanteries des Prussiens me révoltaient ; je pris leur race en horreur, et je pensai :
« Ce sont pourtant des gueux pareils qui vous aigrissent le sang ! »
Ce vieux disait aussi que les Prussiens répétaient sans cesse qu’ils allaient bientôt se réjouir à Paris, en buvant les bons vins de France, et que l’armée française n’était qu’une bande de brigands.
En entendant cela, je m’écriai en moi-même :
« Joseph, maintenant, c’est trop fort… tu n’auras plus de pitié… C’est l’extermination de l’extermination ! »
Neuf heures et demie sonnaient au village du Châtelet, les hussards sonnaient la retraite et chacun s’arrangeait derrière une haie, derrière un rucher ou dans un sillon pour dormir, lorsque le général de brigade Schœffer vint donner l’ordre au bataillon de se porter de l’autre côté du bois, en avant-garde. Je vis aussitôt que notre malheureux bataillon allait toujours être en avant-garde comme en 1813. C’est triste pour un régiment d’avoir de la réputation ; les hommes changent, mais le numéro reste. Le 6e léger avait un bien beau numéro, et je savais ce que cela coûte d’avoir un si beau numéro !
Ceux d’entre nous qui avaient envie de dormir n’eurent pas longtemps sommeil ; car lorsqu’on sait l’ennemi très proche et qu’on se dit : « Les Prussiens sont peut-être là, qui nous attendent embusqués dans ce bois ! » cela vous fait ouvrir l’œil.
Quelques hussards déployés en éclaireurs à droite et à gauche du chemin précédaient la colonne. Nous marchions au pas ordinaire, nos capitaines dans l’intervalle des compagnies, et le commandant Gémeau à cheval, au milieu du bataillon, sur sa petite jument grise.
Avant de partir, chaque homme avait reçu sa miche de trois livres et deux livres de riz ; c’est ainsi que la campagne s’ouvrit pour nous.
Il faisait un clair de lune magnifique, tout le pays et même la forêt, à trois quarts de lieue devant nous, brillait comme de l’argent. Malgré moi, je songeais au bois de Leipzig où j’avais glissé dans un trou de terre glaise avec deux hussards prussiens, pendant que le pauvre Klipfel était haché plus loin en mille morceaux ; cette idée me rendait très attentif. – Personne ne parlait ; Buche lui-même dressait la tête, en serrant les dents, et Zébédé, sur la gauche de la compagnie, ne regardait pas de mon côté, mais dans l’ombre des arbres, comme tout le monde.
Il nous fallut près d’une heure pour arriver au bois ; à deux cents pas, on cria : « Halte ! » Les hussards se replièrent sur les flancs du bataillon, une compagnie fut déployée en tirailleurs sous bois. On attendit environ cinq minutes, et, comme aucun bruit, aucun avertissement n’arrivait, on se remit en marche. Le chemin que nous suivions dans cette forêt était un chemin de charrettes assez large. La colonne marquait le pas dans l’ombre. À chaque instant de grandes places vides donnaient de l’air et de la lumière. On avait fait aussi quelques coupes, et le bois blanc, en stères entre deux piquets, brillait de loin en loin. Du reste, rien ne s’entendait ni ne se voyait.
Buche me disait tout bas :
– J’aime pourtant sentir l’odeur du bois ; c’est comme au Harberg.
Et je pensais : « Je me moque bien de l’odeur du bois ! pourvu que nous ne recevions pas de coups de fusil, voilà le principal ». Enfin, au bout de deux heures, la lumière reparut au fond du taillis, et nous arrivâmes heureusement de l’autre côté sans avoir rien rencontré. Les hussards qui nous suivaient repartirent aussitôt, et le bataillon mit l’arme au pied.
Nous étions dans un pays de blé comme je n’en ai jamais vu de pareil. Ces blés étaient en fleur, encore un peu verts, les orges étaient déjà presque mûres. Cela s’étendait à perte de vue. Nous regardions tous au milieu du plus grand silence, et je vis alors que le vieux ne nous avait pas trompés, car, au fond d’une espèce de creux, à deux mille pas en avant de nous, et derrière un petit renflement, s’élevaient la pointe d’un vieux clocher et quelques pignons couverts d’ardoises où donnait la lune. Ce devait être Fleurus. Plus proche de nous, sur notre droite, se découvraient des chaumières, quelques maisons et un autre clocher ; c’était sans doute Lambusart. Mais beaucoup plus loin, au bout de cette grande plaine, à plus d’une lieue et derrière Fleurus, le terrain se renflait en collines, et ces collines brillaient de feux innombrables. On reconnaissait très bien trois gros villages, qui s’étendaient sur ces hauteurs, de gauche à droite, et que nous avons su depuis être Saint-Amand, le plus proche de nous, Ligny au milieu, et plus loin, à deux bonnes lieues au moins, Sombref. Cela se voyait mieux qu’en plein jour, à cause des feux de l’ennemi. L’armée des Prussiens se trouvait là dans les maisons, dans les vergers, dans les champs. Et derrière ces trois villages en ligne, s’en découvrait encore un autre plus haut et plus loin, sur la gauche, où des feux brillaient aussi ; c’était celui de Bry, où les gueux devaient avoir leurs réserves.
Tout cela, je le comprenais très bien, et même je voyais que ce serait très difficile à prendre. Enfin nous regardions ce spectacle grandiose.
Dans la plaine, sur notre gauche, brillaient aussi des feux, mais il était clair que c’étaient ceux du troisième corps, qui, vers huit heures, avait tourné le coin de la forêt, après avoir repoussé les Prussiens, et qui s’était arrêté dans quelque village encore bien loin de Fleurus. Quelques feux le long du bois, sur la même ligne que nous étaient aussi de notre armée ; je crois me rappeler que nous en avions des deux côtés, mais je n’en suis pas sûr ; la grande masse, dans tous les cas, était à gauche.
On posa tout de suite des sentinelles aux environs, après quoi chacun se coucha sur la lisière du bois, sans allumer de feux, en attendant les nouveaux ordres.
Le général Schœffer vint encore cette même nuit, avec des officiers de hussards. Le commandant Gémeau veillait sous les armes ; ils causèrent tout haut à vingt pas de nous. Le général disait que notre corps d’armée continuait à défiler, mais qu’il était bien en retard ; qu’il ne serait pas même au complet le lendemain ; et j’ai vu par la suite qu’il avait raison, puisque notre quatrième bataillon, qui devait nous rejoindre au Châtelet, n’arriva que le lendemain de la bataille, lorsque nous étions presque tous exterminés dans ce gueux de Ligny, et qu’il ne nous restait plus seulement quatre cents hommes ; au lieu que, s’il avait été là, nous aurions donné ensemble, et qu’il aurait eu sa part de gloire.
Comme j’avais été de garde la veille, je m’étendis tranquillement au pied d’un arbre, côte à côte avec Buche, au milieu des camarades. Il pouvait être une heure du matin. C’était le jour de la terrible bataille de Ligny. La moitié de ceux qui dormaient là devaient laisser leurs os dans ces villages que nous voyions, et dans ces grandes plaines si riches en grains de toutes sortes ; ils devaient aider à faire pousser les blés, les orges et les avoines pendant les siècles des siècles. S’ils l’avaient su, plus d’un n’aurait pas si bien dormi, car les hommes tiennent à leur existence, et ce serait une triste chose de penser : « Aujourd’hui, je respire pour la dernière fois ».
XVIII
Durant cette nuit l’air était lourd, je m’éveillais toutes les heures malgré la grande fatigue ; les camarades dormaient, quelques-uns parlaient en rêvant. Buche ne bougeait pas. Tout près de nous, sur la lisière du bois, nos fusils en faisceaux brillaient à la lune.
J’écoutais. Dans le lointain à gauche, on entendait des « Qui vive ? » sur notre front, des : « Ver da ? »
Beaucoup plus près de nous, les sentinelles du bataillon se voyaient immobiles, à deux cents pas, dans les blés jusqu’au ventre. – Je me levais doucement et je regardais : du côté de Sombref, à deux lieues au moins sur notre droite, il arrivait de grandes rumeurs qui montaient et puis cessaient. On aurait dit de petits coups de vent dans les feuilles ; mais il ne faisait pas le moindre vent, il ne tombait pas une goutte de rosée, et je pensais :
« Ce sont les canons et les fourgons des Prussiens qui galopent là-bas sur la route de Namur, et leurs bataillons, leurs escadrons qui viennent toujours. Mon Dieu ! dans quelle position nous allons être demain, avec cette masse de gens devant nous, qui se renforcent encore de minute en minute ! »
Ils avaient éteint leurs feux à Saint-Amand et à Ligny, mais du côté de Sombref il en brillait beaucoup plus : les régiments prussiens, qui venaient d’arriver à marches forcées, faisaient sans doute leur soupe. – Des idées innombrables me passaient par la tête ; je me recouchais et je me rendormais pour une demi-heure. Quelquefois aussi je me disais :
« Tu t’es sauvé de Lutzen, de Leipzig et de Hanau, pourquoi ne te réchapperais-tu pas encore d’ici ? »
Mais ces espérances que je me donnais ne m’empêchaient pas de reconnaître que ce serait terrible.
À la fin, je m’étais pourtant endormi tout à fait, lorsque le tambour-maître Padoue se mit à battre lui-même la diane ; il se promenait de long en large sur la lisière du bois, et se complaisait dans ses roulements et ses redoublés. Les officiers étaient déjà réunis sur la colline dans les blés, ils regardaient vers Fleurus, causant entre eux.
Notre diane commence toujours avant celle des Prussiens, des Russes, des Autrichiens et de tous nos ennemis ; c’est comme le chant de l’alouette au tout petit jour. Les autres, avec leurs larges tambours, commencent après leurs roulements sourds, qui vous donnent des idées d’enterrement. Mais leurs trompettes ont de jolis airs pour sonner le réveil, au lieu que les nôtres ne donnent que trois ou quatre coups de langue, et semblent dire :
« En route ! nous n’avons pas de temps à perdre. »
Tout le monde se levait, le soleil magnifique montait sur les blés, on sentait d’avance quelle chaleur il allait faire sur les midi. Buche et tous les hommes de corvée partaient avec les bidons chercher de l’eau, pendant que d’autres secouaient l’amadou dans une poignée de paille pour allumer les feux. Le bois ne manquait pas, chacun cherchait sa brassée dans les couples. Le caporal Duhem, le sergent Rabot et Zébédé vinrent causer avec moi. Nous étions tous partis ensemble en 1813 ; ils avaient été de ma noce, aux Quatre-Vents, de sorte que, malgré la différence des grades, ils conservaient toujours un bon fond pour Joseph.
– Eh bien ! me cria Zébédé, la danse va recommencer ?
– Oui, lui dis-je.
Et, me rappelant tout à coup les paroles du pauvre sergent Pinto, le matin de Lutzen, je lui répondis en clignant de l’œil :
– Ça, Zébédé, comme disait le sergent Pinto, c’est une bataille où l’on gagne la croix à travers les coups de refouloir et de baïonnette ; et si l’on n’a pas la chance de l’avoir, il ne faut plus compter dessus.
Alors tous se mirent à rire, et Zébédé s’écria :
– Oui, le pauvre vieux, il la méritait bien ; mais c’est plus difficile de l’attraper que le bouquet au mât de cocagne.
Nous riions tous, et comme ils avaient une gourde d’eau-de-vie, nous cassâmes une croûte en regardant les mouvements qui commençaient à se dessiner. Buche était revenu l’un des premiers avec son bidon ; il se tenait derrière nous, les oreilles tendues comme un renard à l’affût. Des files de cavaleries sortaient du bois et traversaient les blés en se dirigeant sur Saint-Amand, le grand village à gauche de Fleurus.
– Ça, disait Zébédé, c’est, la cavalerie légère de Pajol, qui va se déployer en tirailleurs ; ça, ce sont les dragons d’Exelmans. Quand les autres auront éclairé la position, ils s’avanceront en ligne, je vous en préviens ; cela se fait toujours de la même manière, et les canons arrivent avec l’infanterie. La cavalerie fait un à droite ou un à gauche ; elle se replie sur les ailes, et l’infanterie se trouve en première ligne. On formera les colonnes d’attaque sur les bons chemins et dans les champs, et l’affaire s’engagera par la canonnade pendant une demi-heure, vingt minutes, plus ou moins ; la première distribution est toujours entre canonniers. Quand ils en en ont assez, quand la moitié des batteries est à terre, l’Empereur choisit un bon moment pour nous lancer ; mais nous autres, c’est de la mitraille que nous attrapons, parce que nous sommes plus près. On s’avance l’arme au bras, au pas accéléré, en bon ordre, et l’on finit toujours au pas de course, à cause de la mitraille qui vous cause des impatiences. Je vous en préviens, conscrits, pour que vous ne soyez pas étonnés.
Plus de vingt conscrits étaient venus se ranger derrière nous. La cavalerie sortait toujours du bois.
– Je parie, dit le caporal Duhem, que le 4e corps est en marche derrière nous depuis la pointe du jour.
Et Rabot disait qu’il lui faudrait du temps pour arriver en ligne, à cause des mauvaises traverses dans le bois.
Nous étions là comme des généraux qui délibèrent entre eux, et nous regardions aussi la position des Prussiens autour des villages, dans les vergers et derrière les haies, qui s’élèvent à six et sept pieds dans ce pays. Un grand nombre de leurs pièces étaient en batterie entre Ligny et Saint-Amand ; on voyait très bien le bronze reluire au soleil, ce qui vous inspirait des réflexions de toute sorte.
– Je suis sûr, disait Zébédé, qu’ils ont tout barricadé, qu’ils ont creusé des fossés, qu’ils ont percé des trous dans les murs, et qu’on aurait bien fait de pousser hier soir, à la retraite de leurs carrés, jusqu’au premier village sur la hauteur. Si nous étions au même niveau qu’eux, tout irait bien ; mais, de grimper à travers des haies, sous le feu de l’ennemi, cela coûte du monde, à moins qu’il n’arrive quelque chose par derrière, comme c’est l’habitude de l’Empereur.
De tous les côtés, les anciens causaient de la sorte et les conscrits écoutaient.
En attendant, les marmites pendaient sur le feu, mais avec défense expresse d’employer à cela les baïonnettes, qui se détrempent.
Il pouvait être sept heures, tout le monde croyait que la bataille serait livrée à Saint-Amand, celui des trois villages le plus à notre gauche, entouré de haies et d’arbres touffus, une grosse tour ronde au milieu ; et plus haut, derrière, d’autres maisons avec un chemin tournant bordé de pierres sèches. – Tous les officiers disaient :
– C’est là que se portera l’affaire.
Parce que nos troupes venant de Charleroi s’étendaient dans la plaine au-dessous ; infanterie et cavalerie, tout filait de ce côté : tout le corps de Vandamme et la division Gérard. Des mille et mille casques brillaient au soleil. Buche, auprès de moi, disait :
– Oh !… oh !… oh !… regarde, Joseph, regarde… il en vient toujours.
Des files de baïonnettes innombrables se voyaient dans la même direction à perte de vue.
Les Prussiens s’étendaient de plus en plus sur la côte en arrière des villages, où se trouvaient des moulins à vent.
Ce mouvement dura jusqu’à huit heures. Personne n’avait faim, mais on mangeait tout de même, pour n’avoir pas de reproches à se faire ; car, une fois la bataille commencée, il faut aller, quand cela durerait deux jours.
Entre huit et neuf heures, les premiers bataillons de notre division débouchèrent aussi du bois. Les officiers venaient serrer la main à leurs camarades, mais l’état-major restait encore en arrière.
Tout à coup nous vîmes des hussards et des chasseurs passer en prolongeant notre front de bataille sur la droite : c’était la cavalerie de Morin. L’idée nous vint aussitôt que, dans le moment où le combat serait engagé sur Saint-Amand, et que les Prussiens auraient porté toutes leurs forces de ce côté, nous leur tomberions en flanc par le village de Ligny. Mais les Prussiens eurent la même idée, car, depuis ce moment, ils ne défilaient plus jusqu’à Saint-Amand et s’arrêtaient à Ligny ; ils descendaient même plus bas, et l’on voyait très bien leurs officiers poster les soldats dans les haies, dans les jardins, derrière les petits murs et les baraques. On trouvait leur position très solide. – Ils continuaient à descendre dans un pli de terrain entre Ligny et Fleurus, et cela nous étonnait ; car nous ne savions pas encore que plus bas passe un ruisseau qui partage le village en deux, et qu’ils étaient alors en train de garnir les maisons de notre côté ; nous ne savions pas que si nous avions la chance de les bousculer, ils auraient encore leur retraite plus haut, et nous tiendraient toujours sous leur feu.
Si l’on savait tout dans des affaires pareilles, on n’oserait jamais commencer, parce qu’on n’aurait pas l’espoir de venir à bout d’une entreprise si dangereuse ; mais ces choses ne se découvrent qu’à mesure, et dans ce jour nous devions en découvrir beaucoup auxquelles on ne s’attendait pas.
Vers huit heures et demie, plusieurs de nos régiments avaient passé le bois ; bientôt on battit le rappel, tous les bataillons prirent les armes. Le général comte Gérard et son état-major arrivaient. Ils passèrent au galop jusque sur la colline au-dessus de Fleurus, sans nous regarder.
Presque aussitôt la fusillade s’engagea ; des tirailleurs du corps de Vandamme s’approchaient du village, à gauche ; deux pièces de canon partaient aussi traînées par des artilleurs à cheval. Elles tirèrent cinq ou six coups du haut de la colline ; puis la fusillade cessa, nos tirailleurs étaient à Fleurus, et nous voyions trois ou quatre cents Prussiens remonter la côte plus loin, vers Ligny.
Le général Gérard regarda ce petit engagement, puis il revint avec ses officiers d’ordonnance, et passa lentement sur le front de nos bataillons, en nous inspectant d’un air pensif, comme pour voir la mine que nous avions. C’était un homme brun, la figure ronde ; il pouvait avoir quarante-cinq ans ; il avait le bas de la figure large, le menton pointu, la tête grosse ; on trouve beaucoup de paysans chez nous qui lui ressemblent, ce ne sont pas les plus bêtes.
Il ne nous dit rien, et, quand il eut parcouru la ligne d’un bout à l’autre, tous les commandants et les colonels se réunirent sur notre droite. On nous commanda de mettre l’arme au pied. – Les officiers d’ordonnance allaient alors comme le vent, on ne voyait que cela ; mais rien ne bougeait. Seulement le bruit s’était répandu que le maréchal Grouchy nous commandait en chef, et que l’Empereur attaquait les Anglais à quatre lieues de nous, sur la route de Bruxelles.
Cette nouvelle ne nous rendait pas de bonne humeur ; plus d’un disait :
– Ce n’est pas étonnant que nous soyons encore là depuis ce matin sans rien faire ; si l’Empereur était avec nous, la bataille serait engagée depuis longtemps ; les Prussiens n’auraient pas eu le temps de se reconnaître.
Voilà les propos qu’on tenait, ce qui montre bien l’injustice des hommes, car, trois heures après, vers midi, tout à coup des milliers de cris de : Vive l’Empereur ! s’élevèrent à gauche ; Napoléon arrivait. Ces cris se rapprochaient comme un orage, et se prolongèrent bientôt jusqu’en face de Sombref. On trouvait que tout était bien ; ce qu’on reprochait au maréchal Grouchy, l’Empereur avait bien fait de le faire, puisque c’était lui.
Aussitôt l’ordre arriva de se porter à cinq cents pas en avant, en appuyant sur la droite, et nous partîmes à travers les blés, les orges, les seigles, les avoines, qui se courbaient devant nous. La grande ligne de bataille, sur notre gauche, ne bougeait toujours pas.
Comme nous approchions d’une grande chaussée que nous n’avions pas encore vue, et que nous découvrions aussi Fleurus, à mille pas en avant de nous, avec son ruisseau bordé de saules, on nous cria :
– Halte !
Dans toute la division on n’entendait qu’un murmure :
– Le voilà !
L’Empereur arrivait à cheval avec un petit état-major ; de loin, on ne reconnaissait que sa capote grise et son chapeau ; sa voiture, entourée de lanciers, était en arrière. – Il entra par la grande route à Fleurus, et resta dans ce village plus d’une heure, pendant que nous rôtissions dans les blés.
Au bout de cette heure, et lorsqu’on pensait que cela ne finirait plus, des files d’officiers d’ordonnance partirent, les reins pliés, le nez entre les oreilles de leurs chevaux ; deux s’arrêtèrent auprès du général comte Gérard, un resta, l’autre repartit. Après cela, nous attendîmes encore, et tout à coup, d’un bout du pays à l’autre, toutes les musiques des régiments se mirent à jouer ; tout se mêlait : les tambours, les trompettes ! et tout marchait ; cette grande ligne, qui s’étendait bien loin derrière Saint-Amand jusqu’au bois, se courbait, l’aile droite en avant. Comme elle dépassait notre division par derrière, on nous fit encore obliquer à droite, puis on nous cria de nouveau :
– Halte !
Nous étions en face de la route qui sort de Fleurus. Nous avions à gauche un mur blanc ; derrière ce mur s’élevaient des arbres, une grande maison, et devant nous se dressait un moulin à vent en briques rouges, haut comme une tour.
À peine faisions-nous halte, que l’Empereur sortit de ce moulin avec trois ou quatre généraux, et deux paysans en blouse, deux vieux qui tenaient leur bonnet de coton à la main. C’est alors que la division se mit à crier : Vive l’Empereur ! et que je le vis bien, car il arrivait juste en face du bataillon par un sentier, les mains derrière le dos et la tête penchée, en écoutant un de ces vieux tout chauve. Lui ne faisait pas attention à nos cris ; deux fois il se retourna, montrant le village de Ligny. Je le voyais comme le père Goulden, lorsque nous étions assis l’un en face de l’autre à table. Il était devenu beaucoup plus gros et plus jaune depuis Leipzig ; s’il n’avait pas eu sa capote grise et son chapeau, je crois qu’on aurait eu de la peine à le reconnaître : il avait l’air vieux et ses joues tombaient. Cela venait sans doute de ses chagrins à l’île d’Elbe, en songeant à toutes les fautes qu’il avait commises ; car c’était un homme rempli de bon sens et qui voyait bien ses fautes : il avait détruit la Révolution qui le soutenait ; il avait rappelé les émigrés, qui ne voulaient pas de lui ; il avait pris une archiduchesse qui restait à Vienne ; il avait choisi ses plus grands ennemis pour leur demander des conseils… Enfin, il avait tout remis dans le même état qu’avant la Révolution ; il n’y manquait plus que Louis XVIII ; alors les rois avaient mis Louis XVIII à sa place. – Maintenant il était venu renverser le roi légitime ; les uns l’appelaient despote et les autres jacobin ! C’était malheureux, puisqu’il avait tout arrangé lui-même d’avance pour rétablir les Bourbons. Il ne lui restait plus que son armée ; s’il la perdait, tout était perdu pour lui, parce que, dans la nation, les uns voulaient la liberté comme le père Goulden, et les autres voulaient l’ordre et la paix, comme la mère Grédel, comme moi, comme tous ceux qu’on enlevait à la guerre.
Ces choses le forçaient de réfléchir terriblement. Il avait perdu la confiance de tout le monde. Les vieux soldats seuls lui conservaient leur attachement ; ils voulaient vaincre ou mourir ; avec des idées pareilles, on est toujours sûr que l’un ou l’autre ne vous manquera pas ; tout devient très simple et très clair ; mais bien des gens n’avaient pas les mêmes idées, et, pour ma part, j’aimais beaucoup plus Catherine que l’Empereur.
En arrivant au coin du mur, où des hussards l’attendaient, il monta sur son cheval, et le général Gérard, qui l’avait vu, descendit au galop jusque sur la chaussée. Lui se retourna deux secondes pour l’écouter, ensuite ils entrèrent ensemble dans Fleurus.
Il fallut encore attendre.
Sur les deux heures, le général Gérard revint ; on nous fit obliquer une troisième fois à droite, et toute la division, en colonnes, suivit la grande chaussée de Fleurus, les canons et les caissons dans l’intervalle des brigades. Il faisait une poussière qu’on ne peut s’imaginer, Buche me disait :
– À la première mare que nous rencontrons, coûte que coûte, il faut que je boive.
Mais nous ne rencontrions pas d’eau.
Les musiques jouaient toujours ; derrière nous arrivaient des masses de cavalerie, principalement des dragons. Nous étions encore en marche, lorsque le roulement de la fusillade et des coups de canons commença comme une digue qui se rompt, et dont l’eau tombe, en entraînant tout de fond en comble.
Je connaissais cela, mais Buche devint tout pâle ; il ne disait rien et me regardait d’un air étonné.
– Oui, oui, Jean, lui dis-je, ce sont les autres là-bas, qui commencent l’attaque de Saint-Amand, mais tout à l’heure notre tour viendra.
Ce roulement redoublait, les musiques en même temps avaient cessé ; on criait de tous les côtés :
– Halte !
La division s’arrêta sur la chaussée, les canonniers sortirent des intervalles et mirent leurs pièces en ligne, à cinquante pas devant nous, les caissons derrière.
Nous étions en face de Ligny. On ne voyait qu’une ligne blanche de maisons à moitié cachées par les vergers – le clocher au-dessus – des rampes de terre jaune, des arbres, des haies, des palissades. Nous étions de douze à quinze mille hommes, sans compter la cavalerie, et nous attendions l’ordre d’attaquer.
La bataille du côté de Saint-Amand continuait, des masses de fumée montaient au ciel.
En attendant notre tour, je me mis à penser avec une tendresse extraordinaire à Catherine, l’idée qu’elle aurait un enfant me traversa l’esprit, je suppliai Dieu de me conserver la vie, mais la bonne pensée me vint aussi que, si je mourais, notre enfant serait là pour les consoler tous, Catherine, la tante Grédel et le père Goulden ; que si c’était un garçon, ils l’appelleraient Joseph, et qu’ils le caresseraient ; que M. Goulden le ferait danser sur ses genoux, que la tante Grédel l’aimerait, et que Catherine, en l’embrassant, penserait à moi. Je me dis que je ne serais pas tout à fait mort. Mais j’aurais bien voulu pourtant vivre, et je voyais que ce serait terrible.
Buche aussi me dit :
– Écoute, j’ai une croix… si je suis tué… il faut que tu me promettes quelque chose.
Il me serrait la main.
– Je te le promets, lui dis-je.
– Eh bien ! elle est là sur ma poitrine ; je veux que tu la rapportes au Harberg, et que tu la pendes dans la chapelle, en souvenir de Jean Buche, mort dans la croyance du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Il me parlait gravement, et je trouvais sa volonté très naturelle, puisque les uns meurent pour les droits de l’homme, d’autres en pensant à leur mère, d’autres à l’exemple des hommes justes qui se sont sacrifiés pour le genre humain : tout cela, c’est une seule et même chose, qu’on appelle autrement, selon sa manière de voir.
Je lui promis donc ce qu’il me demandait, et nous attendîmes encore près d’une demi-heure. Tous ceux qui sortaient du bois vinrent se serrer contre nous ; nous voyions aussi la cavalerie se déployer sur notre droite, comme pour attaquer Sombref.
De notre côté, jusqu’à deux heures et demie, pas un coup de fusil n’avait été tiré, lorsqu’un aide de camp de l’Empereur arriva ventre à terre sur la route de Fleurus, et je pensai tout de suite : « Voici notre tour. Maintenant, que Dieu veille sur nous ; car ce n’est pas nous autres, pauvres malheureux, qui pouvons nous sauver dans des massacres pareils ! »
J’avais à peine eu le temps de me faire ces réflexions, que deux bataillons partirent à droite sur la chaussée, avec de l’artillerie, du côté de Sombref, où des uhlans et des hussards prussiens se déployaient en face de nos dragons. Ces deux bataillons eurent la chance de rester en position sur la route toute cette journée pour observer la cavalerie ennemie, pendant que nous allions enlever le village où les Prussiens étaient en force.
On forma les colonnes d’attaque sur le coup de trois heures ; j’étais dans celle de gauche, qui partit la première, au pas accéléré, dans un chemin tournant. De ce côté de Ligny se trouvait une grosse masure en briques ; elle était ronde et percée de trous ; elle regardait dans le chemin où nous montions, et nous la regardions aussi par-dessus les blés. La seconde colonne au milieu partit ensuite, parce qu’elle n’avait pas tant de chemin à faire et montait tout droit ; nous devions la rencontrer à l’entrée du village. Je ne sais pas quand la troisième partit, nous ne l’avons rencontrée que plus tard.
Tout alla bien jusque dans un endroit où le chemin coupe une petite hauteur et redescend plus loin dans le village. Comme nous entrions entre ces deux petites buttes couvertes de blé, et que nous commencions à découvrir les premières maisons, tout à coup une véritable grêle de balles arriva sur notre tête de colonne avec un bruit épouvantable : de tous les trous de la grosse masure, de toutes les fenêtres et de toutes les lucarnes des maisons, des haies, des vergers, par-dessus les petits murs en pierres sèches, la fusillade se croisait sur nous comme des éclairs. En même temps, d’un champ en arrière de la grosse tour à gauche, et plus haut que Ligny, du côté des moulins à vent, une quinzaine de grosses pièces mises exprès commencèrent un autre roulement, auprès duquel celui de la fusillade n’était encore, pour ainsi dire, rien du tout. Ceux qui, par malheur, avaient déjà dépassé le chemin creux tombaient les uns sur les autres en tas dans la fumée. Et dans le moment où cela nous arrivait, nous entendions aussi le feu de l’autre colonne s’engager à notre droite, et le grondement d’autres canons, sans savoir si c’étaient les nôtres ou ceux des Prussiens qui tiraient.
Heureusement, le bataillon n’avait pas encore dépassé la colline ; les balles sifflaient et les boulets ronflaient dans les blés au-dessus de nous, en rabotant la terre, mais sans nous faire de mal. Chaque fois qu’il passait des rafles pareilles, les conscrits près de moi baissaient la tête. Je me rappelle que Buche me regardait avec de gros yeux. Les anciens serraient les lèvres.
La colonne s’arrêta. Chacun réfléchissait s’il ne valait pas mieux redescendre, mais cela ne dura qu’une seconde ; dans le moment où la fusillade paraissait se ralentir, tous les officiers, le sabre en l’air, se mirent à crier :
– En avant !
Et la colonne repartit au pas de course. Elle se jeta d’abord dans le chemin qui descend à travers les haies, par-dessus les palissades et les murs où les Prussiens embusqués continuaient à nous fusiller. – Malheur à ceux qu’on trouvait, ils se défendaient comme des loups, mais les coups de crosse et de baïonnette les étendaient bientôt dans un coin. Un assez grand nombre, les vieux à moustaches grises, avaient préparé leur retraite ; ils s’en allaient d’un pas ferme, en se retournant pour tirer leur dernier coup, et refermaient une porte, ou bien se glissaient dans une brèche. Nous les suivions sans relâche ; on n’avait plus de prudence ni de miséricorde, et finalement nous arrivâmes tout débandés aux premières maisons, où la fusillade recommença sur nous des fenêtres, du coin des rues et de partout.
Nous avions bien alors les vergers, les jardins, les murs de pierres sèches qui descendaient le long de la colline, mais tout saccagés, bouleversés, les palissades arrachées, et qui ne pouvaient plus servir d’abri. Les cassines en face, bien barricadées, continuaient leur feu roulant sur nous. En dix minutes, ces Prussiens nous auraient exterminés jusqu’au dernier. Alors, en voyant cela, la colonne se mit à redescendre, les tambours, les sapeurs, les officiers et les soldats pêle-mêle sans tourner la tête. Moi je sautais par-dessus les palissades, où jamais de la vie, dans un autre moment, je n’aurais eu l’amour-propre de croire que je pouvais sauter, principalement avec le sac et la giberne sur le dos ; et tous les autres faisaient comme moi : – tout dégringolait comme un pan de mur.
Une fois dans le chemin creux, entre les collines, on s’arrêta pour reprendre haleine, car la respiration vous manquait. Plusieurs même se couchaient par terre, d’autres s’essuyaient le dos contre le talus. Les officiers s’indignaient contre nous, comme s’ils n’avaient pas suivi le mouvement de retraite ; beaucoup criaient :
– Qu’on fasse avancer les canons !
D’autres voulaient reformer les rangs, et c’est à peine si l’on s’entendait, au milieu de ce grand bourdonnement de la canonnade, dont l’air tremblait comme pendant un orage.
Je vis Buche revenir en allongeant le pas ; sa baïonnette était rouge de sang ; il vint se placer près de moi sans rien dire, en rechargeant.
Plus de cent hommes du bataillon, le capitaine Grégoire, le lieutenant Certain, plusieurs sergents et caporaux restaient dans les vergers ; les deux premiers bataillons de la colonne avaient autant souffert que nous.
Zébédé, son grand nez crochu, tout pâle, en m’apercevant de loin, se mit à crier :
– Joseph… pas de quartier !
Des masses de fumée blanche passaient au-dessus de la butte. Toute la côte, depuis Ligny jusqu’à Saint-Amand, derrière les saules, les trembles et les peupliers qui bordent ces collines, était en feu.
J’avais grimpé jusqu’au niveau des blés, les deux mains à terre, et, voyant ce terrible spectacle, voyant jusqu’au haut de la côte, près des moulins, de grandes lignes d’infanterie noire, l’arme au pied, prêtes à descendre sur nous, et de la cavalerie innombrable sur les ailes, je redescendis en pensant :
« Jamais nous ne viendrons à bout de cette armée ; elle remplit les villages, elle garde les chemins, elle couvre la côte à perte de vue, elle a des canons partout ; c’est contraire au bon sens de s’obstiner dans une entreprise pareille ! »
J’étais indigné contre nos généraux, j’en étais même dégoûté.
Tout cela ne prit pas dix minutes. Dieu sait ce que nos deux autres colonnes étaient devenues ; toute cette grande fusillade arrivant de la gauche, et ces volées de mitraille que nous entendions passer dans les airs étaient sans doute pour elles.
Je croyais que nous avions déjà notre bonne part de malheurs, lorsque le général Gérard et deux autres généraux, Vichery et Schœffer, arrivèrent de la route au-dessous de nous, ventre à terre, en criant comme des furieux :
– En avant !… en avant !…
Ils allongeaient leurs sabres, et l’on aurait dit que nous n’avions qu’à monter. Ce sont ces êtres obstinés qui poussent les autres à l’extermination, parce que leur fureur gagne tout le monde.
Nos canons, de la route plus bas, ouvraient leur feu dans le même moment sur Ligny ; les toits du village s’écroulaient, les murs s’affaissaient ; et d’un seul coup on se remit à courir en avant, les généraux en tête, l’épée à la main, et les tambours par derrière battant la charge. On criait : Vive l’Empereur ! Les boulets prussiens vous raflaient par douzaines, les balles arrivaient comme la grêle, les tambours allaient toujours : Pan ! pan !… pan !… On ne voyait plus rien, on n’entendait plus rien, on passait à travers les vergers ; ceux qui tombaient, on n’y faisait pas attention et deux minutes après on entrait dans le village, on enfonçait les portes à coups de crosse, pendant que les Prussiens vous fusillaient des fenêtres. C’était un vacarme mille fois pire que dehors, parce que les cris de fureur s’y mêlaient ; on s’engouffrait dans les maisons à coup de baïonnette ; on se massacrait sans miséricorde. De tous les côtés ne s’élevait qu’un cri :
– Pas de quartier !
Les Prussiens surpris dans les premières maisons n’en demandaient pas non plus. C’étaient tous de vieux soldats, qui savaient bien ce que signifiait : « Pas de quartier ! » Ils se défendaient jusqu’à la mort.
Je me souviens qu’à la troisième ou quatrième maison d’une rue assez large, qui passe devant l’église et plus loin sur un petit pont, je me souviens qu’en face de cette maison, à droite, – pendant que les grosses tuiles creuses, les ardoises, les briques pleuvaient dans la rue, que les incendies allumés par nos obus remplissaient l’air de fumée, que tout criait, sifflait, pétillait autour de nous, – Zébédé me prit par le bras d’un air terrible en criant :
– Arrive !
Et que nous entrâmes dans cette maison, dont la grande chambre en bas, toute sombre parce qu’on avait blindé les fenêtres avec des sacs de terre, était déjà pleine de soldats. On apercevait dans le fond un escalier en bois, très roide, où le sang coulait ; des coups de fusil partaient d’en haut, et leurs éclairs montraient, de seconde en seconde, cinq ou six des nôtres affaissés contre la rampe, les bras pendants, et les autres qui leur passaient sur le corps, la baïonnette en avant, pour forcer l’entrée de la soupente.
C’était quelque chose d’horrible que tous ces hommes, – avec leurs moustaches, leurs joues brunes, la fureur peinte dans les rides, – qui voulaient monter à toute force. En voyant cela, je ne sais quelle rage me prit, et je me mis à crier :
– En avant !… pas de quartier !…
Si j’avais eu le malheur d’être près de l’escalier, j’aurais été capable de vouloir monter et de me faire hacher. Par bonheur, tous avaient la même idée, pas un n’aurait donné sa place. C’est un vieux tout criblé de coups qui monta sous les baïonnettes. En arrivant à la soupente, il étendit les bras en lâchant son fusil, et se cramponna des deux mains à la balustrade ; deux balles à bout portant ne purent le faire descendre ; et derrière lui trois ou quatre autres, qui se bousculaient pour arriver les premiers, le jetèrent dans la chambre en enjambant les dernières marches.
Alors nous entendîmes là-haut un vacarme qu’on ne peut pas se figurer ; les coups de fusil se suivaient dans cette chambre étroite, les piétinements, les cris faisaient croire que la maison s’abîmait, que tout éclatait. Et d’autres montaient toujours ! – Lorsque j’arrivai derrière Zébédé, tout était encombré de morts et de blessés, les fenêtres en face avaient sauté, le sang avait éclaboussé les murs, il ne restait plus un Prussien debout, et cinq ou six des nôtres se tenaient adossés aux meubles en souriant et regardant d’un air féroce ; ils avaient presque tous des balles dans le corps ou des coups de baïonnette, mais le plaisir de la vengeance était plus fort que le mal. – Quand je songe à cela, les cheveux m’en dressent sur la tête.
Aussitôt que Zébédé vit que les Prussiens étaient bien morts, il redescendit en me répétant :
– Arrive ! il n’y a plus rien à faire ici.
Et nous sortîmes. Dehors, la colonne avait déjà dépassé l’église ; des milliers de coups de fusil pétillaient sur le pont, comme le feu d’une charbonnière qui s’effondre. La seconde colonne, en descendant la grand-rue à droite, était venue rejoindre la nôtre, pendant qu’une de ces grandes colonnes de Prussiens, que j’avais vues sur la côte, en arrière de Ligny, descendait pour nous rejeter hors du village. C’est là qu’on se rencontrait pour la première fois en masse. Deux officiers d’état-major filaient par la rue d’où nous venions.
– Ceux-ci, dit Zébédé, vont chercher des canons. Lorsque nous aurons des canons ici, tu verras, Joseph, si l’on peut nous dénicher.
Il courait, et je le suivais.
L’engagement près du pont continuait. La vieille église sonnait cinq heures ; nous avions alors exterminé tous les Prussiens de ce côté du ruisseau, excepté ceux qui se trouvaient embusqués dans la grande masure à gauche, en forme de tour et les murs percés de trous. Des obus avaient mis le feu dans le haut, mais la fusillade continuait au-dessous ; il fallait éviter ce passage.
En avant de l’église nous étions en force ; nous trouvâmes la petite place encombrée de troupes, l’arme au bras, prêtes à marcher ; il en arrivait encore d’autres par une grande rue qui traverse Ligny dans sa longueur. Une seule tête de colonne restait engagée en face du petit pont. Les Prussiens voulaient la repousser ; les feux de file se suivant sans interruption, comme une eau qui coule. On ne voyait sur place, à travers la fumée, que des baïonnettes, la façade de l’église, les généraux sur le perron donnant leurs ordres, les officiers d’ordonnance partant au galop, et dans les airs la vieille flèche d’ardoises, où les corneilles tourbillonnaient effrayées de ce bruit.
Le canon de Saint-Amand tonnait toujours.
Entre les pignons à gauche, on apercevait sur la côte de grandes lignes bleues et des masses de cavalerie en route du côté de Sombref, pour nous tourner. C’est là-bas, derrière nous, que devaient se livrer des combats à l’arme blanche entre les uhlans et nos hussards ! Combien nous en avons vu, le lendemain, de ces uhlans étendus dans la plaine !
Notre bataillon, ayant le plus souffert, passait alors en seconde ligne. Nous retrouvâmes tout de suite notre compagnie, que le capitaine Florentin commandait. Des canons arrivaient aussi par la même rue que nous ; les chevaux galopaient en écumant et secouant la tête comme furieux ; les pièces et les caissons écrasaient tout ; cela devait produire une grand vacarme ; mais, au milieu des coups de canon et du bourdonnement de la fusillade, on n’entendait rien. Tous les soldats criaient, quelques-uns chantaient la main en l’air et le fusil sur l’épaule, mais on ne voyait que leurs bouches ouvertes.
J’avais repris mon rang auprès de Buche, et je commençais à respirer, lorsque tout se remit en mouvement.
Cette fois, il s’agissait de passer le ruisseau, de rejeter les Prussiens de Ligny, de remonter la côte derrière, et de couper leur armée en deux ; alors la bataille serait gagnée ! Chacun comprenait cela, mais avec la masse de troupes qu’il tenait en réserve, ce n’était pas une petite affaire.
Tout marchait pour attaquer le pont ; on ne voyait que les cinq ou six hommes devant soi. J’étais content de savoir que la colonne s’étendait bien loin en avant.
Ce qui me fit le plus de plaisir, c’est qu’au milieu de la rue, devant une grange dont la porte était défoncée, le capitaine Florentin arrêta la compagnie, et qu’on posta les restes du bataillon dans ces masures à moitié démolies, pour soutenir la colonne d’attaque en tirant par les fenêtres.
Nous étions quinze hommes dans cette grange, que je vois encore avec son échelle qui monte par un trou carré, deux ou trois Prussiens morts contre les murs, la vieille porte criblée de balles, qui ne tenait plus qu’à l’un de ses gonds, et, dans le fond, une lucarne qui donnait sur l’autre rue derrière. – Zébédé commandait notre poste ; le lieutenant Bretonville s’établit avec un autre peloton dans la maison en face, le capitaine Florentin ailleurs.
La rue était garnie de troupes jusqu’aux deux coins, près du ruisseau.
La première chose que nous essayâmes de faire, ce fut de redresser et de raffermir la porte ; mais nous avions à peine commencé cet ouvrage, qu’on entendit dans la rue un fracas épouvantable : les murs, les volets, les tuiles, tout était raflé d’un coup ; deux hommes du poste, restés dehors pour soutenir la porte, tombèrent comme fauchés. En même temps, dans le lointain, près du ruisseau, les pas de la colonne en retraite se mirent à rouler sur le pont, pendant qu’une dizaine de coups pareils au premier soufflaient dans l’air et vous faisaient reculer malgré vous. C’étaient six pièces chargées à mitraille, que Blücher avait masquées au bout de la rue et qui commençaient leur feu.
Toute la colonne, tambours, soldats, officiers, à pied et à cheval, repassèrent en se poussant et se bousculant, comme un véritable ouragan. Personne ne regardait en arrière ; ceux qui tombaient étaient perdus. – À peine les derniers avaient-ils dépassé notre porte, que Zébédé se pencha dehors pour voir, et, dans la même seconde, il nous cria d’une voix terrible :
– Les Prussiens !
Il fit feu. Plusieurs d’entre nous étaient déjà sur l’échelle ; mais avant que l’idée de grimper me fût venue, les Prussiens étaient là. Zébédé, Buche et tous ceux qui n’avaient pas eu le temps de monter les repoussaient à la baïonnette. Il me semble encore voir ces Prussiens, – avec leurs grandes moustaches ; leurs figures rouges et leurs shakos plats, – furieux d’être arrêtés. Je n’ai jamais eu de secousse pareille. Zébédé criait :
– Pas de quartier ! comme si nous avions été plus forts. Aussitôt il reçut un coup de crosse sur la tête et tomba.
Je vis qu’il allait être massacré, cela me retourna le cœur… Je sortis en criant :
– À la baïonnette !
Et tous ensemble nous tombâmes sur ces gueux, pendant que les camarades tiraient d’en haut, et que les maisons en face commençaient la fusillade.
Ces Prussiens alors reculèrent, mais il en venait plus loin un bataillon tout entier. Buche prit Zébédé sur ses épaules et monta. Nous n’eûmes que le temps de le suivre, en criant :
– Dépêche-toi !
Nous l’aidions de toutes nos forces à grimper. J’étais l’avant-dernier. Je croyais que cette échelle n’en finirait jamais, car des coups de fusil éclataient déjà dans la grange. Enfin nous arrivâmes heureusement.
Nous avions tous la même idée, c’était de retirer l’échelle ; et voyez quelle chose affreuse ! en la tirant à travers les coups de fusil qui partaient d’en bas, et qui firent sauter la tête d’un de nos camarades, nous reconnûmes qu’elle était trop grande pour entrer dans le grenier. Cela nous rendit tout pâles. Zébédé, qui se réveillait, nous dit :
– Mettez donc un fusil dans les échelons !
Et cette idée nous parut inspiration d’en haut.
Mais c’est au-dessous qu’il fallait entendre le vacarme. Toute la rue était pleine de Prussiens, et notre grange aussi. Ces gens ne se possédaient plus de rage ; ils étaient pires que nous et répétaient sans cesse :
– Pas de prisonniers !
Nos coups de fusil les indignaient ; ils enfonçaient les portes, et l’on entendait les combats dans les maisons, les chutes, les malédictions en français et en allemand, des commandements du lieutenant Bretonville en face, ceux des officiers prussiens ordonnant d’aller chercher de la paille pour mettre le feu. Par bonheur, les récoltes n’étaient pas faites ; ils nous auraient tous brûlés.
On tirait dans notre plancher ; mais c’étaient de bons madriers en chêne, où les balles tapaient comme des coups de marteau. Nous, les uns derrière les autres, nous continuions la fusillade dans la rue ; chaque coup portait.
Il paraît que ces gens avaient repris la place de l’Église, car on n’entendait plus le roulement de notre feu que bien loin. Nous étions seuls, à deux ou trois cents hommes, au milieu de trois ou quatre mille.
Alors je m’écriai en moi-même :
« Voici ta fin, Joseph ! jamais tu ne te réchapperas d’ici, c’est impossible ! »
Et je n’osais pas seulement penser à Catherine, mon cœur grelottait. Nous n’avions pas de retraite ; les Prussiens tenaient les deux bouts de la rue et les ruelles derrière, ils avaient déjà repris quelques maisons. – Mais tout se taisait… ils préparaient quelque chose : ils cherchaient du foin, de la paille, des fagots, ou bien ils faisaient avancer leurs pièces pour nous démolir.
Nos fusiliers regardaient aux lucarnes et ne voyaient rien, la grange était vide. Ce silence près de nous était plus terrible que le tumulte de tout à l’heure.
Zébédé venait de se relever, le sang lui coulait du nez et de la bouche.
– Attention ! disait-il, nous allons voir arriver l’attaque ; les gueux se préparent. – Chargez.
Il finissait à peine de parler que la maison tout entière, depuis les pignons jusqu’aux fondements, était secouée comme si tout entrait sous terre ; les poutres, les lattes, les ardoises, tout descendaient dans cette secousse, pendant qu’une flamme rouge montait d’en bas sous nos pieds jusqu’au-dessus du toit.
Nous tombâmes tous à la renverse. Une bombe allumée, que les Prussiens avaient fait rouler dans la grange, venait d’éclater.
En me relevant, j’entendis un sifflement dans mes oreilles ; mais cela ne m’empêcha pas de voir une échelle se poser à notre lucarne, et Buche qui lançait au dehors de grands coups de baïonnette.
Les Prussiens voulaient profiter de notre surprise pour monter et nous massacrer ; cette vue me donna froid, je courus bien vite au secours de Buche.
Ceux des camarades qui n’avaient pas été tués arrivèrent aussi criant :
– Vive l’Empereur !
Je n’entendais pour ainsi dire plus. Le bruit devait être épouvantable, car la fusillade d’en bas et celle des fenêtres éclairaient toute la rue, comme une flamme qui se promène. Nous avions renversé l’échelle, et nous étions encore six : deux sur le devant qui tiraient, quatre derrière qui chargeaient et leur passaient les fusils.
Dans cette extrémité, j’étais devenu calme, je me résignais à mon malheur, en pensant :
« Tâche de conserver ta vie ! »
Les autres sans doute pensaient la même chose, et nous faisions un grand carnage.
Ce moment de presse dura bien un quart d’heure ; ensuite le canon se mit à tonner, et quelques secondes après, les camarades en avant se penchèrent à la fenêtre et cessèrent le feu.
Ma giberne était presque vide, j’allai reprendre des cartouches chez les morts.
Les cris de Vive l’Empereur ! se rapprochaient : tout à coup notre tête de colonne, son drapeau tout noir et déchiré, déboucha sur la petite place en gagnant notre rue.
Les Prussiens battaient en retraite. Nous aurions tous voulu descendre, mais deux ou trois fois notre colonne s’arrêta devant la mitraille. Les cris et la canonnade se confondaient de nouveau. Zébédé, qui regardait dehors, courut enfin descendre l’échelle ; notre colonne dépassait la grange, et nous descendîmes tous à la file, sans regarder les camarades, hachés par les éclaboussures de la bombe, et dont plusieurs nous criaient d’une voix déchirante de les emporter.
Mais voilà les hommes : la peur d’être pris les rend barbares !
Longtemps après, ces choses abominables nous reviennent. On donnerait tout pour avoir eu du cœur, de l’humanité : mais il est trop tard.
XIX
C’est ainsi que nous sortîmes à six de cette grange, où nous étions entrés quinze une heure avant, Buche et Zébédé se trouvaient dans le nombre des vivants ; les Phalsbourgeois avaient eu de la chance.
Une fois dehors, il fallut suivre l’attaque.
Nous avancions sur des tas de morts : tout était mou sous nos pieds. On ne regardait pas si l’on marchait sur la figure d’un blessé, sur sa poitrine ou sur ses membres ; on avançait. Nous avons su le lendemain que cette masse de Prussiens entassés dans la rue du Petit-Pont avaient été mitraillés par quelques pièces en batterie devant l’église : l’obstination de ces gens avait causé leur ruine.
Blücher n’attendait que le moment de nous en faire autant ; mais au lieu de passer le pont, on nous fit obliquer à droite et garnir les maisons qui longent le ruisseau. Les Prussiens tiraient sur nous de toutes les fenêtres en face. Lorsque nous fûmes embusqués dans les maisons, nous ouvrîmes le feu sur leurs pièces, ce qui les força de reculer.
On parlait déjà d’attaquer l’autre partie du village, quand le bruit se répandit qu’une colonne prussienne, forte de quinze à vingt mille hommes, arrivait de Charleroi sur nos derrières. – Personne n’y comprenait plus rien ; nous avions tout balayé depuis les rives de la Sambre. Cette colonne, qui nous tombait sur le dos, était donc cachée dans les bois.
Il pouvait être alors six heures et demie, le combat de Saint-Amand semblait grandir, Blücher portait toutes ses forces de ce côté ; c’était le beau moment pour emporter l’autre partie du village, mais cette colonne nous forçait d’attendre.
Les rangées de maisons, des deux côtés du ruisseau, étaient pleines de troupes : à droite les Français, à gauche les Prussiens. La fusillade avait cessé, quelques coups de fusils partaient bien encore, mais c’étaient des coups visés. On s’observait les uns les autres, comme pour dire :
« Respirons ! tout à l’heure nous allons nous rempoigner. »
Les Prussiens, dans la maison en face, avec leurs habits bleus, leurs shakos de cuir, leurs moustaches retroussées, étaient tous des hommes solides, de vieux soldats, le menton carré et les oreilles écartées de la tête. On aurait cru qu’ils devaient nous bousculer d’un coup. Les officiers regardaient aussi.
Le long des deux rues qui suivent le ruisseau, et dans le ruisseau même, les morts ne formaient que deux longues files ; un grand nombre étaient assis le dos au mur : ceux-là, blessés dangereusement pendant le combat, avaient encore eu la force de se retirer de la bagarre ; ils s’étaient accroupis contre un mur, où la perte de leur sang les avait fait mourir. Dans le ruisseau, plusieurs restaient debout, les mains cramponnées au bord comme pour grimper, mais ils ne bougeaient plus ; et, dans les recoins obscurs où descendaient les rayons du soleil, on voyait aussi des malheureux écrasés sous les décombres des pierres et des poutres en travers du corps.
Le combat de Saint-Amand devenait plus terrible, les roulements de la canonnade semblaient s’élever les uns sur les autres, et, si nous n’avions pas été tous en face de la mort, nous n’aurions pu nous empêcher d’admirer ce bruit grandiose.
À chaque roulement, des centaines d’hommes avaient péri, et cela ne s’interrompait pas ; la terre en tremblait.
Nous respirions, mais bientôt nous sentîmes une soif extraordinaire. En se battant, personne n’avait éprouvé cette soif terrible ; alors tout le monde voulait boire.
Notre maison formait le coin à gauche du pont, et le peu d’eau qui coulait sur la bourbe était rouge de sang. Mais entre notre maison et la voisine, au milieu d’un petit jardin, se trouvait un puits d’arrosage ; nous regardions tous ce puits avec sa margelle et ses deux poteaux de bois. Malgré la mitraille, les seaux pendaient encore à la chaîne ; trois hommes, la face contre terre et les mains en avant, étaient couchés dans le sentier qui menait à cet endroit ; ils avaient aussi voulu boire, et les Prussiens les avaient tués.
Nous étions tous donc l’arme au pied à regarder le puits. L’un disait :
– Je donnerais la moitié de mon sang pour un verre d’eau.
L’autre :
– Oui, mais les Prussiens attendent !
C’était vrai ; les Prussiens, à cent pas de nous et qui peut-être avaient aussi soif, devinaient ce que nous pensions.
Les coups de fusil qu’on tirait encore venaient de cela : quand, le long de la rue, quelqu’un sortait, on le fusillait aussitôt, et de cette manière nous nous faisions souffrir tous comme des malheureux.
Cela durait au moins depuis une demi-heure, lorsque la canonnade s’étendit entre Saint-Amand et Ligny, et tout de suite nous vîmes qu’on tirait à la mitraille sur les Prussiens à mi-côte entre les deux villages, car à chaque décharge leurs colonnes épaisses étaient traversées ; cette nouvelle attaque produisit une grande agitation. Buche, qui jusqu’à ce moment n’avait pas bougé, sortit par la ruelle du jardin et courut au puits ; il se mit derrière la margelle, et les deux maisons en face commencèrent la fusillade sur lui, de sorte que bientôt la pierre et les poteaux furent criblés de balles. Mais alors nous recommençâmes à tirer sur les fenêtres, et dans une minute la fusillade fut rallumée d’un bout du village à l’autre ; la fumée s’étendait partout. Dans cet instant, une voix criait en bas :
– Joseph… Joseph !…
C’était Buche ; il avait eu le courage de tirer le seau, de le décrocher et d’arriver après avoir bu.
Plusieurs anciens voulaient lui prendre le seau, mais il criait :
– Mon camarade d’abord ! Lâchez, ou je verse tout !
Il fallut bien m’attendre. Je bus tout ce que je pouvais ; ensuite les autres, et ceux qui restaient en haut descendirent et burent tant qu’il en resta.
C’est en ce moment que Buche montra qu’il m’aimait.
Nous remontâmes ensemble bien contents.
Je pense qu’il était alors plus de sept heures, le soleil se couchait, l’ombre de nos maisons s’allongeait jusque sur le ruisseau ; celles des Prussiens restaient éclairées, ainsi que la côte de Bry, où de nouvelles troupes descendaient au pas de course. La canonnade n’avait jamais été si forte de notre côté.
Tout le monde sait aujourd’hui qu’entre sept et huit heures du soir, à la nuit tombante, l’Empereur ayant reconnu que la colonne de Prussiens qu’on avait signalée sur nos derrières était le corps du général d’Erlon, – égaré entre la bataille de Ney aux Quatre-Bras contre les Anglais, et la nôtre, – avait ordonné tout de suite à la vieille garde de nous soutenir.
Un lieutenant, qui se trouvait avec nous, disait :
– Voici la grande attaque. Attention !
Toute la cavalerie des Prussiens fourmillait entre les deux villages. On sentait, sans le voir, un grand mouvement derrière nous. Le lieutenant répétait :
– Attention au commandement ! Que personne ne reste après le commandement ! Voici l’attaque.
Nous ouvrions tous l’œil.
Plus la nuit s’avançait, plus le ciel devenait rouge du côté de Saint-Amand. À force d’entendre la canonnade, on n’y faisait plus attention ; mais, à chaque décharge, on peut dire que le ciel prenait feu.
Le tumulte augmentait derrière nous.
Tout à coup, la grande rue qui longe le ruisseau fut pleine de nos troupes, depuis le pont jusqu’à l’autre bout de Ligny. Sur la gauche et plus loin encore, les Prussiens tiraient des fenêtres ; nous ne répondions plus. On criait :
– La garde !… c’est la garde !
Je ne sais pas comment toute cette masse d’hommes passa le fossé plein de bourbe ; c’est bien sûr avec des planches, car d’un instant à l’autre nos troupes en masse étaient sur la rive gauche.
La grande batterie des Prussiens au haut du ravin, entre les deux villages, faisait des rues dans nos colonnes ; mais elles se refermaient aussitôt et montaient toujours.
Ce qui restait de notre division courait sur le pont ; des canonniers à cheval avec leurs pièces suivaient au galop.
Alors nous descendîmes aussi, mais nous n’étions pas encore au pont que des cuirassiers se mettaient à défiler ; après les cuirassiers arrivèrent des dragons et des grenadiers à cheval de la garde. Il en passait partout, à travers et même autour du village : c’était comme une armée toute neuve, une armée innombrable.
Le massacre recommençait en haut ; cette fois, c’était la bataille en rase campagne. La nuit venait, les carrés prussiens se dessinaient en feu sur la côte.
Nous courions, enjambant les morts et les blessés.
Une fois hors du village, nous vîmes ce que l’on peut appeler une mêlée de cavalerie ; on ne distinguait pour ainsi dire que des cuirasses blanches qui traversaient les lignes des uhlans… Tout se mêlait, puis les cuirassiers se reformaient et repartaient comme un mur.
Il faisait déjà sombre, la masse de fumée empêchait de voir à cinquante pas devant soi. Tout s’ébranlait, tout montait vers les moulins ; le roulement du galop, les cris, les commandements, les feux de file bien loin, tout se confondait. Plusieurs carrés étaient rompus. De temps en temps, un coup de feu vous montrait quelques cavaliers, un lancier penché sur son cheval, un cuirassier avec son gros dos blanc, son casque et sa queue de cheval flottante, lancé comme un boulet, deux ou trois fantassins courant au milieu de la bagarre : cela passait comme un éclair ! Et les blés foulés, la pluie qui rayait le ciel, car un orage venait d’éclater, les blessés sous les pieds des chevaux, tout sortait de la nuit un quart de seconde.
À chaque coup de fusil ou de pistolet, on voyait des choses pareilles, par mille et par mille, qu’on ne peut s’expliquer. Mais tout montait, tout s’éloignait de Ligny ; nous étions les maîtres, nous avions enfoncé le centre de l’ennemi ; les Prussiens ne se défendaient plus que tout en haut de la colline, près des moulins, et dans la direction de Sombref, sur notre droite : Saint-Amand et Ligny nous restaient.
Alors, nous autres, à dix ou douze de la compagnie, contre les décombres des cassines, la giberne presque vide, nous ne savions plus de quel côté tourner. Zébédé, le lieutenant Bretonville et le capitaine Florentin avaient disparu ; le sergent Rabot nous commandait. – C’était un petit vieux, sec, mal bâti, mais dur comme du fer ; il clignait de l’œil et devait avoir été roux dans sa jeunesse. Rien qu’en parlant de lui, je l’entends nous dire tranquillement :
– La bataille est gagnée ! Par file à droite, en avant marche !
Plusieurs demandaient à faire la soupe, car, depuis douze heures on commençait à sentir la faim ; et le sergent, le fusil sur l’épaule, descendait la ruelle en riant tout bas, et répétant d’un air moqueur :
– La soupe ! la soupe ! Attendez, l’administration des vivres va venir.
Nous le suivions dans la ruelle sombre ; vers le milieu se trouvait un cuirassier à cheval qui nous tournait le dos ; il avait un coup de sabre dans le ventre et s’était retiré là ; le cheval s’appuyait au mur pour l’empêcher de tomber. Comme nous défilions, il nous appela :
– Camarades !
Personne ne tourna seulement la tête. À vingt pas plus loin se trouvait une vieille cassine toute criblée de boulets, mais elle avait encore la moitié de son toit de chaume ; c’est pourquoi le sergent Rabot la choisit, et nous entrâmes dans ce réduit à la file.
On n’y voyait pas plus que dans un four ; le sergent fit partir une amorce, et nous vîmes que c’était une cuisine ; l’âtre à droite, l’escalier à gauche, et cinq ou six Prussiens et Français étendus à terre, blancs comme de la cire, et les yeux ouverts.
– Allons, dit le sergent, voici la chambrée, que chacun s’arrange ; les camarades de lit ne nous donneront pas de coups de pieds.
Comme on voyait bien qu’il ne fallait pas compter sur la distribution, chacun, sans rien dire, déboucla son sac, le mit au pied du mur et s’étendit l’oreille dessus. On entendait encore la fusillade, mais bien loin sur la côte. La pluie tombait à verse. Le sergent tira la porte qui grinçait, puis alluma sa pipe tranquillement pendant que plusieurs ronflaient déjà ; je le regardai debout contre la petite fenêtre, dont toutes les vitres étaient éclatées ; il fumait.
C’était un homme dur et juste, il avait trois chevrons et savait lire et écrire ; il aurait dû passer officier, ayant des blessures, mais n’était pas bien bâti. Il finit aussi par se coucher sur son sac, et bientôt après nous dormions tous.
Cela durait depuis longtemps, lorsque je fus réveillé par un bruit… On rôdait autour de notre cassine… Je me levai sur la main pour écouter… Dans le même instant, on essayait d’ouvrir la porte. Alors je ne pus retenir un cri.
– Qu’est-ce que c’est ? demanda le sergent.
Et comme des pas s’éloignaient en courant, il dit en se retournant sur son sac :
– Ah ! les oiseaux de nuit… Allez… canailles !… allez, ou je vais vous envoyer une balle !
Ensuite il ne dit plus rien. Moi, je m’étais approché de la fenêtre, et je voyais tout le long de la ruelle des maraudeurs en train de fouiller les blessés et les morts. Ils allaient doucement de l’un à l’autre, la pluie tombait par torrents : – c’était quelque chose d’horrible.
Je me recouchai pourtant et me rendormis à cause de la grande fatigue.
Au petit jour, le sergent était debout et criait :
– En route !
Nous ressortîmes de la cassine en remontant la ruelle. Le cuirassier était alors à terre ; le cheval attendait toujours.
Le sergent prit ce cheval par la bride et le conduisit une centaine de pas dans les vergers, il lui retira le mors en s’écriant :
– Va, mange : on te retrouvera bientôt. Et cette pauvre bête partit doucement.
Nous allongions le pas dans un sentier qui longe Ligny : les sillons et quelques carrés de jardinage aboutissaient sur ce chemin. – Le sergent regardait en passant, il se baissa pour déterrer quelques restes de carottes et de navets. Je me dépêchai de faire comme lui, pendant que les camarades se pressaient sans tourner la tête.
Je vis là que c’est une bonne chose de connaître les fruits de la terre, car je trouvai deux beaux navets et des carottes, qui sont très bonnes crues ; mais je suivis l’exemple du sergent et je les mis dans mon shako.
Je courus ensuite pour rattraper le peloton, qui se dirigeait sur les feux de Sombref.
Et quant au reste, je n’ai pas seulement l’idée de vous peindre le plateau derrière Ligny, où nos cuirassiers et nos dragons avaient tout massacré. Ce n’étaient que des tas d’hommes et de chevaux : les chevaux, leur long cou allongé à terre ; les hommes pris dessous, morts ou blessés. Quelques-uns levaient la main pour faire signe ; les chevaux essayaient de se lever et les écrasaient encore mieux en retombant.
Du sang ! toujours du sang ! La direction des boulets et de la mitraille était marquée en traînées rouges sur les pentes, comme on voit chez nous, à la fonte des neiges, le passage des torrents dans le sable. Eh bien ! voulez-vous savoir la vérité ? Cela ne me touchait presque plus.
Avant de partir pour Lutzen, un pareil spectacle m’aurait fait tomber à la renverse. J’aurais pensé :
« Nos maîtres regardent donc les hommes comme des animaux ? Est-ce que le bon Dieu nous donne à manger aux loups ? Est-ce que nous avons des mères, des sœurs, des amis, des êtres qui nous aiment sur la terre et qui ne crient pas vengeance ? »
J’aurais pensé mille choses pareilles, encore plus fortes et plus justes ; mais alors je ne pensais rien. À force d’avoir vu des massacres et des injustices en masse, de toutes les façons et tous les jours, je me disais :
« Les plus forts ont toujours raison. L’Empereur est le plus fort, il nous fait signe de venir, et malgré tout, il faut arriver de Phalsbourg, de Saverne ou d’ailleurs, se mettre en rang et marcher. Celui qui ferait seulement la mine de résister, serait fusillé tout de suite. Les maréchaux, les généraux, les officiers, les sous-officiers et les soldats, depuis le premier jusqu’au dernier, suivent la consigne, ils n’osent pas faire un mouvement sans ordre ; et les autres obéissent à l’armée. C’est l’Empereur qui veut tout, qui peut tout et qui fait tout. Eh bien ! est-ce que Joseph Bertha ne serait pas une bête d’oser seulement croire que l’Empereur peut avoir une seule fois tort dans sa vie ? Est-ce que ce ne serait pas contraire au bon sens ?
Voilà ce que nous pensions tous, et si l’Empereur était resté, toute la France aujourd’hui n’aurait pas d’autre idée.
Mon seul plaisir alors, c’était d’avoir des carottes et des navets, car en passant derrière les bivouacs pour demander la place du bataillon, nous avions appris que les distributions n’avaient pas été faites ; on n’avait reçu que la ration d’eau-de-vie et des cartouches.
Les anciens étaient en route pour emplir les marmites. Les conscrits qui ne savaient pas encore la manière de vivre en campagne, et qui par malheur avaient déjà mangé leur pain, comme il arrive à vingt ans, lorsqu’on marche et qu’on a bon appétit, ceux-là devaient se passer de tremper la cuiller.
Vers sept heures nous arrivâmes enfin au bivouac. Zébédé, en me voyant, parut joyeux ; il vint à ma rencontre et me dit :
– Je suis content de te voir, Joseph ; mais qu’est-ce que tu apportes ? Nous avons trouvé un biquet bien gras ; nous avons aussi du sel, mais pas une croûte de pain.
Je lui fis voir le riz qui me restait, mes carottes et mes navets. – Il me dit :
– C’est bien : nous allons avoir le meilleur bouillon du bataillon.
Je voulus que Buche pût aussi manger avec nous, et les six hommes de notre marmite qui s’en étaient tous réchappés par hasard, avec des coups de crosse et des égratignures, y consentirent. Le tambour-maître Padoue dit en riant :
– Les anciens sont toujours les anciens, ils n’arrivent jamais les mains vides.
Nous regardions de côté la marmite de cinq conscrits, où l’on ne voyait bouillir que du riz dans de l’eau claire, et nous clignions de l’œil, car nous avions une bonne soupe grasse qui répandait son odeur dans tous les environs.
À huit heures, nous mangeâmes avec un appétit qu’on peut s’imaginer. Non, pas même le jour de mes noces, je n’ai fait un meilleur repas ; c’est encore une satisfaction aujourd’hui pour moi d’y penser. Quand l’âge arrive, on n’a plus l’enthousiasme de la jeunesse pour de pareilles choses ; mais ce sont toujours d’agréables souvenirs. Et ce bon repas nous a soutenus longtemps ; les pauvres conscrits, avec leur reste de pain trempé comme de la pâte par l’averse, devaient en voir de dures le lendemain 18. Nous devions avoir une campagne bien courte et bien terrible. Enfin tout est passé maintenant ; mais ce n’est pas sans attendrissement qu’on songe à ces grandes misères, et qu’on remercie Dieu d’en être réchappé.
Le temps semblait se remettre au beau, le soleil recommençait à briller dans les nuages. Nous venions à peine de manger que le rappel battait sur toute la ligne.
Il faut savoir qu’en ce moment les Prussiens retiraient seulement leur arrière-garde de Sombref, et qu’il était question de se mettre à leur poursuite. Plusieurs même disaient qu’on aurait dû commencer par là, en envoyant bien loin notre cavalerie légère pour récolter des prisonniers. Mais on ne les écoutait pas ; l’Empereur savait bien ce qu’il faisait.
Je me rappelle pourtant que tout le monde s’étonnait, parce que c’est l’habitude de profiter des victoires. Les anciens n’avaient jamais vu cela. On croyait que l’Empereur préparait un grand coup, qu’il avait fait tourner l’ennemi par Ney, et d’autres choses semblables.
En attendant, l’appel commença ; le général Gérard vint passer la revue du 4e corps. Notre bataillon avait le plus souffert, à cause des trois attaques où nous avions toujours été en tête : – nous avions le commandant Gémeau et le capitaine Vidal blessés ; les capitaines Grégoire et Vignot tués ; sept lieutenants et sous-lieutenants et trois cent soixante hommes hors de combat.
Zébédé disait que c’était pire qu’à Montmirail, et qu’on allait nous compléter pour sûr avant de partir.
Heureusement le quatrième bataillon, commandant Delong, arrivant de Metz, vint alors nous remplacer en ligne.
Le capitaine Florentin, qui nous commandait cria :
– Par file à gauche ! – et nous descendîmes au village jusque près de l’église, où stationnaient une quantité de charrettes.
On nous distribua par escouades pour surveiller l’enlèvement des blessés. Quelques détachements de chasseurs eurent l’ordre d’escorter les convois jusqu’à Fleurus, parce qu’à Ligny la place manquait ; l’église était déjà pleine de ces malheureux.
Ce n’est pas nous qui choisissions les blessés, mais les chirurgiens militaires et quelques médecins du pays mis en réquisition ; il était trop difficile de reconnaître un grand nombre de ces blessés d’entre les morts. Nous aidions seulement à les étendre sur la paille dans les charrettes.
Je connaissais cela depuis Lutzen ; je savais ce qu’il fallait souffrir pour réchapper d’une balle, d’un biscaïen, ou d’un coup de pointe, comme en donnent nos cuirassiers. Chaque fois que je voyais enlever un de ces malheureux, je louais le Seigneur de ne pas m’avoir réduit à cet état, et, pensant que la même chose aurait pu m’arriver, je me disais : « Tu ne sais pas combien de balles et de morceaux de mitraille ont passé près de toi ; sans cela, cette idée te ferait horreur. »
Je m’étonnais que tant d’entre nous eussent pu réchapper de ce carnage, – bien pire qu’à Lutzen et même qu’à Leipzig, – parce que la bataille n’avait duré que cinq heures, et que les morts, dans bien des endroits, s’élevaient jusqu’à deux et trois pieds. Le sang coulait au-dessous comme des ruisseaux. Dans toute la grande rue, où les pièces avaient passé, c’était de la boue rouge : de la boue de chair et d’os écrasés.
Il faut bien qu’on dise cela pour éclairer la jeunesse. Moi, je n’irai plus me battre, j’ai dépassé l’âge, Dieu merci ! Mais tous ces jeunes gens qui ne pensent qu’à la guerre, au lieu de vouloir travailler honnêtement et d’aider leurs vieux parents, doivent savoir comment les hommes sont traités. Ils doivent se figurer ce que les malheureux qui n’ont pas rempli leurs devoirs pensent lorsqu’ils sont couchés dans une rue, ou sur la grande route avec un membre de moins, et qu’ils entendent arriver ces pièces de canon, qui pèsent douze à quinze mille et leurs gros chevaux bien ferrés qui sautent en hennissant.
C’est dans cette minute qu’ils doivent voir les pauvres vieux qui leur tendaient les bras devant la petite maison du village, pendant qu’ils s’éloignaient en s’écriant :
– Je pars… je reviendrai avec la croix et les épaulettes !
Oui ! oui ! s’ils pouvaient pleurer et demander pardon à Dieu, ceux-là, on entendrait leurs cris et leurs plaintes ! Mais il n’est plus temps, – les canons et les caissons avec leurs charges d’obus et de boulets arrivent, – ils entendent eux-mêmes craquer leurs os d’avance… et tout cela leur passe sur le corps comme dans la boue.
Quand on est vieux et qu’on a des enfants qu’on aime, c’est une chose abominable de songer que des malheurs pareils pourraient leur arriver, on donnerait jusqu’à sa dernière chemise pour les empêcher de partir.
Mais tout cela ne sert à rien ; les mauvais cœurs sont incorrigibles, et les bons font leur devoir. S’il leur arrive des malheurs, au moins la confiance dans la justice de Dieu leur reste. Ceux-ci ne vont pas tuer leurs semblables pour l’amour de la gloire… ils y vont par force ; ils n’ont pas de reproches à se faire : ils défendent leur vie, et le sang répandu ne retombe pas sur eux.
Enfin, il faut pourtant que je finisse de vous raconter cette bataille et ce relèvement des blessés.
J’ai vu là des choses qu’on ne peut presque pas croire : des hommes tués au moment de la plus grande fureur, et dont les figures horribles n’étaient pas changées ; ils tenaient encore leurs fusils, debout contre les murs, et rien qu’en les regardant il vous semblait les entendre crier :
– À la baïonnette ! Pas de quartier !
C’est avec cette pensée et ce cri qu’ils étaient arrivés d’un seul coup devant Dieu… C’était lui qui les attendait. Il pouvait leur dire :
– Me voilà… tu veux tuer tes frères ?… tu ne veux pas de quartier ? On n’en fera point !
J’en ai vu d’autres à demi morts qui s’étranglaient entre eux. Et vous saurez qu’à Fleurus il fallait séparer les Prussiens des Français, parce qu’ils se levaient de leurs lits ou de leurs bottes de paille pour se déchirer et se dévorer !
La guerre !… ceux qui veulent la guerre, ceux qui rendent les hommes semblables à des animaux féroces, doivent avoir un compte terrible à régler là-haut !…
XX
Le relèvement des blessés continua jusqu’au soir. – Vers midi, les cris de : Vive l’Empereur ! se prolongeaient sur toute la ligne de nos bivouacs, depuis le village de Bry jusqu’à Sombref. Napoléon avait quitté Fleurus avec son état-major ; il passait la revue de l’armée sur le plateau. Ces cris durèrent environ une heure, puis tout se tut ; l’armée devait être alors en marche.
Nous attendîmes longtemps l’ordre de suivre ; comme il ne venait pas, le capitaine Florentin finit par aller voir, et revint ventre à terre en criant :
– Battez le rappel !
Les détachements du bataillon se réunirent, et l’on se mit à remonter le village au pas accéléré. Tout était parti. Bien d’autres pelotons n’avaient pas reçu d’ordres, et du côté de Saint-Amand les rues étaient pleines de soldats. Quelques compagnies, restées en arrière, gagnaient à travers champs la route à gauche, où l’on voyait s’étendre une queue de colonne à perte de vue : des caissons, des fourgons, des bagages de toute sorte.
J’ai souvent pensé que nous aurions eu de la chance en ce jour d’être laissés en arrière comme la division Gérard, à Saint-Amand ; on n’aurait jamais pu nous faire de reproches. Puisque nous avions ordre de relever les blessés, nous étions en règle ; mais le capitaine Florentin se serait cru déshonoré.
Nous marchions en allongeant le pas. Il s’était remis à pleuvoir ; on glissait dans la boue, et la nuit venait. Jamais je n’ai vu de temps plus abominable, pas même en Allemagne, à la retraite de Leipzig ; la pluie tombait comme d’un arrosoir, et nous allions en arrondissant le dos, le fusil sous le bras, le pan de la capote sur la batterie, tellement trempés, qu’en traversant une rivière ce n’aurait pas été pire. – Et quelle boue ! – Avec cela, on recommençait à sentir la faim. Buche me répétait de temps en temps :
– C’est égal, une douzaine de grosses pommes de terre cuites sous la cendre, comme au Harberg, me réjouiraient joliment la vue. On ne mange pas tous les jours de la viande chez nous, mais on a des pommes de terre !
Moi, je revoyais en rêve notre petite chambre de Phalsbourg, bien chaude, la table blanche, le père Goulden assis devant son assiette, et Catherine qui nous servait de la bonne soupe grasse, pendant que les côtelettes fumaient sur le gril. La tristesse d’être là m’accablait ; s’il n’avait fallu que me souhaiter la mort pour être débarrassé de tout, depuis longtemps je ne serais plus de ce monde.
La nuit était venue ; elle était toute grise ; sans les ornières, où l’on enfonçait jusqu’aux genoux, on aurait eu de la peine à reconnaître son chemin ; mais on n’avait qu’à marcher dans la boue, et l’on était sûr de ne pas se tromper.
Entre sept et huit heures, on entendit au loin comme des roulements de tonnerre ; les uns disaient :
– C’est l’orage !
Les autres :
– C’est le canon !
Beaucoup de soldats débandés nous suivaient. À huit heures, nous arrivâmes aux Quatre-Bras. Ce sont deux maisons en face l’une de l’autre, au croisement de la route de Nivelles à Namur avec celle de Bruxelles à Charleroi ; ces maisons étaient encombrées de blessés. – C’est là que le maréchal Ney avait livré bataille aux Anglais pour les empêcher d’arriver au secours des Prussiens, par le chemin que nous venions de suivre. Il n’avait que vingt mille hommes contre quarante mille, et Nicolas Cloutier, le tanneur, soutient encore aujourd’hui qu’il aurait dû nous envoyer la moitié de ses troupes pour prendre les Prussiens par derrière, comme si ce n’avait pas été bien assez d’arrêter les autres. Enfin, pour des gens pareils, tout est facile ; seulement, s’ils commandaient eux-mêmes, on les mettrait en déroute avec quatre hommes et un caporal.
Au-dessous, dans les champs d’orge et d’avoine, tout était plein de morts. C’est là que je vis les premiers habits rouges étendus sur la route.
Le capitaine nous ordonna de faire halte ; il entra seul dans la maison à droite. Nous attendions depuis quelque temps à la pluie, lorsqu’il ressortit sur la porte avec le général de division Donzelot, qui riait parce que nous aurions dû suivre l’armée de Grouchy du côté de Namur, et que le manque d’ordres nous avait fait tourner vers les Quatre-Bras. Nous reçûmes pourtant l’ordre de continuer notre chemin sans nous arrêter.
Je croyais à chaque minute tomber en faiblesse ; mais cela devint encore pire lorsque nous eûmes rattrapé les bagages ; car il fallait marcher sur le revers de la route, dans les champs, et plus on avançait, plus on enfonçait dans la terre grasse.
Vers onze heures, nous arrivâmes dans un grand village appelé Genappe, qui s’étend sur les deux côtés de la route. L’encombrement des fourgons, des canons et des bagages dans cette rue nous força de passer la Thy à droite sur un pont, et depuis cet endroit nous ne fîmes plus que marcher à travers des champs, dans les blés, dans les chanvres, comme des sauvages qui ne respectent rien. La nuit était si sombre, que des dragons à cheval, posés de deux cents pas en deux cents pas, comme des poteaux, vous criaient :
– Par ici ! par ici !
Nous arrivâmes à minuit au tournant d’un chemin, près d’une espèce de ferme couverte en chaume et pleine d’officiers supérieurs. Ce n’était pas loin de la grande route, car on entendait défiler la cavalerie, l’artillerie et les équipages comme un torrent.
Le capitaine venait à peine d’entrer à la ferme, que plusieurs d’entre nous se précipitèrent dans le jardin à travers les haies. Je fis comme les autres, et j’empoignai des raves. Presque aussitôt tout le bataillon suivit ce mouvement, malgré les cris des officiers ; chacun se mit à déterrer ce qu’il put avec sa baïonnette, et, deux minutes après, il ne restait plus rien. Les sergents et les caporaux étaient venus avec nous ; lorsque le capitaine revint, on avait déjà repris les rangs.
Ceux qui volent et pillent en campagne méritent d’être fusillés, mais que voulez-vous ? les villages qu’on rencontrait n’avaient pas le quart de vivres qu’il aurait fallu pour nourrir tant de monde. Les Anglais avaient déjà presque tout pris. Il nous restait bien encore un peu de riz, mais le riz sans viande ne soutient pas beaucoup. Les Anglais, eux, recevaient des bœufs et des moutons de Bruxelles ; ils étaient bien nourris et tout luisants de bonne santé. Nous autres, nous étions venus trop vite, les convois de vivres étaient en retard ; et le lendemain, qui devait être la terrible bataille de Waterloo, nous ne reçûmes que la ration d’eau-de-vie.
Enfin, en partant de là, nous montâmes une petite côte, et malgré la pluie, nous aperçûmes les bivouacs des Anglais. On nous fit prendre position dans les blés entre plusieurs régiments qu’on ne voyait pas, parce qu’on avait l’ordre de ne pas allumer de feu, de peur d’effaroucher l’ennemi s’il nous voyait en ligne, et de le décider à continuer sa retraite.
Maintenant, représentez-vous des hommes couchés dans les blés, sous une pluie battante, comme de véritables Bohémiens, grelottant de froid, songeant à massacrer leurs semblables, et bien heureux d’avoir un navet, une rave ou n’importe quoi pour soutenir un peu leurs forces. Est-ce que c’est la vie d’honnêtes gens ? Est-ce que c’est pour cela que Dieu nous a créés et mis au monde ? Est-ce que ce n’est pas une véritable abomination de penser qu’un roi, un empereur, au lieu de surveiller les affaires de son pays, d’encourager le commerce, de répandre l’instruction, la liberté et les bons exemples, vienne nous réduire par centaines de mille à cet état ?… Je sais bien qu’on appelle cela de la gloire ; mais les peuples sont bien bêtes de glorifier des gens pareils… Oui, il faut avoir perdu toute espèce de bon sens, de cœur et de religion.
Tout cela ne nous empêchait pas de claquer des dents, et de voir en face de nous les Anglais, qui se réchauffaient et se gobergeaient autour de leurs grands feux, après avoir reçu leur ration de bœuf, d’eau-de-vie et de tabac. Je pensais :
« C’est nous, pauvres diables, trempés jusqu’à la moelle des os, qui sommes forcés d’attaquer ces hommes remplis de confiance en eux-mêmes, et qui ne manquent ni de canons, ni de munitions, ni de rien ; qui dorment les pieds au feu, la panse bien garnie, pendant que nous couchons dans la boue ! »
Toute la nuit ce spectacle me révoltait. Buche disait :
– La pluie ne me fait rien, j’en ai supporté bien d’autres à l’affût ; mais au moins j’avais une croûte de pain, des oignons et du sel.
Il se fâchait. Pour ma part, j’étais attendri sur mon propre sort et je ne disais rien.
Entre deux et trois heures de la nuit, la pluie avait cessé. Buche et moi, nous étions dos à dos dans le creux d’un sillon, pour nous réchauffer, et la grande fatigue avait fini par m’endormir.
Une chose que je n’oublierai jamais, c’est le moment où je me réveillai, vers les cinq heures du matin : les cloches des villages sonnaient matines sur cette grande plaine ; et, regardant les blés renversés, les camarades couchés à droite et à gauche, le ciel gris, cette grande désolation me fit grelotter le cœur. Le son des cloches qui se répondaient de Planchenois à Genappe, à Frichemont, à Waterloo me rappelait Phalsbourg ; je me disais :
« C’est aujourd’hui dimanche, un jour de paix et de repos. M. Goulden a mis hier son bel habit au dos de la chaise, avec une chemise blanche. Il se lève maintenant et pense à moi… Catherine aussi se lève dans notre petite chambre ; elle est assise sur le lit et pleure ; et la tante Grédel aux Quatre-Vents pousse ses volets ; elle a tiré de l’armoire son livre de prières pour aller à la messe. »
Et j’entendais les cloches de Danne, de Mittelbronn, de Bigelberg bourdonner dans le silence. Je me figurais cette bonne vie tranquille… J’aurais voulu fondre en larmes ! Mais le roulement commençait, un roulement sourd comme dans les temps humides, quelque chose de sinistre. Du côté de la grande route, à gauche, on battait la générale, les trompettes de cavalerie sonnaient le réveil. On se levait, on regardait par-dessus les blés. Ces trois jours de marches et de combats, le mauvais temps et l’oubli des rations avaient rendu les hommes plus sombres. On ne parlait pas comme à Ligny ; chacun regardait et réfléchissait pour son propre compte.
On voyait aussi que ce serait une plus grande bataille, parce qu’au lieu d’avoir des villages bien occupés en première ligne, et qui font autant de combats séparés, ici c’était une grande plaine nue, élevée, occupée par les Anglais ; derrière leurs lignes, au haut de la côte, se trouvait le village de Mont-Saint-Jean, et beaucoup plus loin, à près d’une lieue et demie, une grande forêt qui bordait le ciel.
Entre les Anglais et nous, le terrain descendait doucement et se relevait de notre côté ; mais il fallait avoir l’habitude de la campagne pour voir ce petit vallon, qui devenait plus profond à droite et se resserrait en forme de ravin. Sur la pente de ce ravin, de notre côté, derrière des haies, des peupliers et d’autres arbres, quelques maisons couvertes de chaume indiquaient un hameau : c’était Planchenois. Dans la même direction, mais bien plus haut et derrière la gauche de l’ennemi, s’étendait une plaine à perte de vue, parsemée de petits villages.
C’est en temps de pluie, après un orage, que ces choses se distinguent le mieux ; tout est bleu sombre sur un fond clair. On découvrait jusqu’au petit village de Saint-Lambert, à trois lieues de nous sur la droite.
À notre gauche, et derrière la droite des Anglais, se voyaient aussi d’autres petits villages dont je n’ai jamais su le nom.
Voilà ce que nous découvrions au premier coup d’œil, dans ce grand pays plein de magnifiques récoltes encore en fleur, et chacun se demandait pourquoi les Anglais étaient là, quel avantage ils avaient à garder cette position. Alors on observait mieux leur ligne, à quinze cents ou deux mille mètres de nous, et l’on voyait que la grande route que nous avions suivie depuis les Quatre-Bras, et qui se rend à Bruxelles, cette route large, bien arrondie et même pavée au milieu, traversait la position de l’ennemi à peu près au centre ; elle était droite, et l’on pouvait la suivre des yeux jusqu’au village de Mont-Saint-Jean, et même plus loin, jusqu’à l’entrée de la grande forêt de Soignes. Les Anglais voulaient donc la défendre, pour nous empêcher d’aller à Bruxelles.
En regardant bien, on voyait que leur ligne de bataille se courbait un peu de notre côté sur les deux ailes, et suivait un chemin creux qui coupait la route de Bruxelles en croix. Ce chemin était tout à fait creux à gauche de la route, à droite il était bordé de grandes haies de houx et de petits hêtres, comme il s’en trouve dans ce pays. – Là derrière étaient postées des masses d’habits rouges, qui nous observaient de leur chemin couvert ; le devant de leur côte descendait en pente comme des glacis : c’était très dangereux.
Et sur leurs ailes, qui se prolongeaient d’environ trois quarts de lieue, était de la cavalerie innombrable. On voyait aussi de la cavalerie sur le haut du plateau, dans l’endroit où la grande route, après avoir passé la colline, descend avant de remonter vers Mont-Saint-Jean ; car on comprenait très bien qu’il se trouvait un creux entre la position des Anglais et ce village, pas bien profond, puisque les plumets de la cavalerie s’apercevaient, mais assez profond pour y tenir de grandes forces en réserve à l’abri de nos boulets.
J’avais déjà vu Weissenfelz, Lutzen, Leipzig et Ligny : je commençais à comprendre ce que les choses veulent dire, pourquoi l’on se place d’une manière plutôt que d’une autre, et je trouvais que ces Anglais s’étaient très bien arrangés dans leur chemin pour défendre la route, et que leurs réserves, bien abritées sur le plateau, montraient chez ces gens beaucoup de bon sens naturel.
Malgré cela, trois choses me parurent alors avantageuses pour nous. Ces Anglais, avec leur chemin couvert et leurs réserves bien cachées étaient comme dans une grande fortification. Mais tout le monde sait qu’en temps de guerre on démolit tout de suite, autour des places fortes, les bâtiments trop près des remparts, pour empêcher l’ennemi de s’en emparer et de s’abriter derrière. Eh bien ! juste sur leur centre, le long de la grande route et sur la pente de leurs glacis, se trouvait une ferme dans le genre de la Roulette, aux Quatre-Vents, mais cinq ou six fois plus grande. Je la voyais très bien de la hauteur où nous étions : c’était un grand carré, les bâtisses, la maison, les écuries et les granges en triangle du côté des Anglais, et l’autre moitié du triangle, formée d’un mur et de hangars, de notre côté ; la cour à l’intérieur. L’un des pans de ce mur donnait sur les champs avec une petite porte, et l’autre sur la route, avec une porte cochère pour les voitures. C’était construit en briques bien solides. Naturellement les Anglais l’avaient garnie de troupes, comme une espèce de demi-lune ; mais si nous avions la chance de l’enlever, nous étions tout près de leur centre, et nous pouvions lancer sur eux nos colonnes d’attaque, sans rester longtemps sous leur feu.
Voilà ce que nous avions de meilleur pour nous. Cette ferme s’appelait la Haie-Sainte, comme nous l’avons su depuis.
Plus loin, en avant de leur aile droite, dans un fond, se trouvait une autre ferme avec un petit bois, que nous pouvions aussi tâcher d’enlever. Cette ferme d’où j’étais, on ne la voyait pas, mais elle devait être encore plus solide que la Haie-Sainte, puisqu’un verger entouré de murs et plus loin un bois la couvraient. Le feu des fenêtres donnait dans le verger, le feu du verger donnait dans le bois, le feu du bois donnait sur la côte, l’ennemi pouvait battre en retraite de l’un dans l’autre.
Ces choses, je ne les ai pas vues de mes propres yeux, mais quelques anciens m’ont raconté plus tard l’attaque de cette ferme, appelée Hougoumont.
Il faut tout expliquer, quand on parle d’une bataille pareille ; mais les choses qu’on a vues soi-même sont le principal ; on peut dire : « Je les ai vues ! et les autres, je les ai seulement apprises par d’honnêtes gens incapables de tromper ni de mentir. »
Enfin, en avant de leur aile gauche, où descendait le chemin de Wavre, à quelque cent pas de notre côté, se trouvaient encore les fermes de Papelotte et de la Haye, occupées par des Allemands, et les petits hameaux de Smohain, du Cheval-de-Bois, de Jean-Loo, que par la suite des temps j’ai voulu connaître, pour me rendre compte à moi-même de tout ce qui s’était passé. – Ces hameaux, je les voyais bien alors, mais je n’y faisais pas grande attention d’autant plus qu’ils étaient en dehors de notre ligne de bataille, sur la droite, et qu’on n’y remarquait pas de troupes.
Donc chacun maintenant se figure la position des Anglais en face de nous, la grande route de Bruxelles qui la traverse, le chemin qui la couvre, le plateau derrière, où sont les réserves, et les trois bâtisses de Hougoumont, de la Haie-Sainte et de Papelotte, en avant bien défendues. Chacun doit penser que c’était difficile à prendre.
Je regardais cela vers les six heures du matin, très attentivement, comme un homme qui risque de perdre sa vie, ou d’avoir les os cassés dans une entreprise, et qui veut au moins savoir s’il a quelque chance d’en réchapper.
Zébédé, le sergent Rabot, le capitaine Florentin, Buche, enfin tout le monde, en se levant, jetait un coup d’œil de ce côté sans rien dire. Ensuite, on regardait autour de soi les grands carrés d’infanterie, les escadrons de cuirassiers, de dragons, de chasseurs, de lanciers, etc., campés au milieu des récoltes.
Alors personne n’avait plus la crainte de voir les Anglais battre en retraite ; on allumait des feux tant qu’on voulait, et la fumée de la paille humide s’étendait dans les airs. Ceux auxquels il restait encore un peu de riz suspendaient la marmite, les autres regardaient en pensant :
« Chacun son tour, hier nous avions de la viande, nous nous moquions du riz ; maintenant nous voudrions bien en avoir. »
Vers huit heures, il arriva des fourgons avec des cartouches et des tonnes d’eau-de-vie. Chaque soldat reçut double ration ; avec une croûte de pain on aurait pu s’en contenter, mais le pain manquait. Qu’on juge, d’après cela, quelle mine on avait. C’est tout ce que nous reçûmes en ce jour, car aussitôt après commencèrent les grands mouvements. Les régiments se réunirent à leurs brigades, les brigades à leurs divisions, les divisions reformèrent leurs corps. Les officiers à cheval couraient porter les ordres, tout était en route.
Le bataillon se réunit à la division Donzelot ; les autres divisions n’avaient que huit bataillons, elle en eut neuf.
J’ai souvent entendu raconter par nos anciens l’ordre de bataille donné par l’Empereur ; le corps de Reille à gauche de la route, en face de Hougoumont ; d’Erlon à droite, en face de la Haie-Sainte ; Ney à cheval sur la chaussée, et Napoléon derrière, avec sa vieille garde, les escadrons de service, les lanciers, les chasseurs, etc. C’est tout ce que j’ai compris, car lorsqu’ils se mettent à parler du mouvement des onze colonnes, de la distance des déploiements, et qu’ils nomment tous les généraux les uns après les autres, il me semble entendre parler de choses que je n’ai pas vues. J’aime donc mieux vous raconter simplement ce que je me rappelle moi-même. Et d’abord, à huit heures et demie, nos quatre divisions reçurent l’ordre de se porter en avant, à droite de la grand-route. Nous étions de quinze à vingt mille hommes, nous marchions sur deux lignes, l’arme à volonté et nous enfoncions jusqu’aux genoux. Personne ne disait rien.
Plusieurs racontent que nous étions tout réjouis et que nous chantions, mais c’est faux ! Quand on a marché toute la nuit sans recevoir de ration, quand on a couché dans l’eau, avec défense d’allumer des feux et qu’on va recevoir de la mitraille, cela vous ôte l’envie de chanter ; nous étions bien contents de retirer nos souliers des trous où l’on enfonçait à chaque pas ; les blés mouillés vous rafraîchissaient les cuisses, et les plus courageux, les plus durs avaient l’air ennuyé.
Il est vrai que les musiques jouaient les marches de leurs régiments, et que les trompettes de la cavalerie, les tambours de l’infanterie, les grosses caisses et les trombones mêlés ensemble produisaient un effet terrible, comme toujours. Il est aussi vrai que tous ces milliers d’hommes en bon ordre, allongeant le pas, le sac au dos, le fusil sur l’épaule ; les lignes blanches des cuirassiers qui suivaient les lignes rouges, brunes, vertes des dragons, des hussards, des lanciers dont les petits drapeaux en queue d’hirondelles remplissaient l’air ; les canonniers dans l’intervalle des brigades, à cheval autour de leurs pièces, qui coupaient la terre jusqu’aux essieux – tout cela traversant les moissons dont pas un épi ne restait debout – il est vrai qu’on ne pouvait rien voir de plus épouvantable.
Et les Anglais en face, bien rangés, leurs canonniers la mèche allumée, étaient aussi quelque chose qui vous faisait réfléchir. Mais cela ne vous réjouissait pas la vue autant que plusieurs le disent ; les gens amoureux de recevoir des coups de canon sont encore assez rares.
Le père Goulden me disait bien que, dans son temps, les soldats chantaient, mais c’est qu’ils étaient partis volontairement et non par force. Ils se battaient pour garder leurs champs et les droits de l’homme, qu’ils aimaient mieux que les yeux de leur tête, et ce n’était pas la même chose que de se faire éreinter pour savoir si l’on aurait d’anciens nobles ou de nouveaux. Moi, je n’ai jamais entendu chanter ni à Leipzig ni à Waterloo.
Nous marchions, les musiques jouaient par ordre supérieur ; et lorsque les musiques se turent, le plus grand silence suivit. Alors nous étions au haut du petit vallon, à mille ou douze cents pas de la gauche des Anglais. Nous formions le centre de notre armée ; des chasseurs s’étendaient sur notre flanc droit avec des lanciers.
On prit les distances, on resserra les intervalles, la première brigade de la première division obliqua sur la gauche et se mit à cheval sur la chaussée. Notre bataillon faisait partie de la seconde division : nous fûmes donc en première ligne, avec une seule brigade de la première devant nous. – On fit passer toutes les pièces sur notre front ; celles des Anglais se voyaient en face, à la même hauteur. Et bien longtemps encore d’autres divisions vinrent nous appuyer. On aurait cru que toute la terre marchait ; les anciens disaient :
– Voici les cuirassiers de Milhaud ! voici les chasseurs de Lefebvre-Desnoëttes ; voilà là-bas le corps de Lobau !
De tous les côtés, aussi loin que pouvait s’étendre la vue, on ne voyait que des cuirasses, des casques, des colbacks, des sabres, des lances, des files de baïonnettes.
– Quelle bataille ! s’écriait Buche ; malheur aux Anglais !
Et je pensais comme lui, je croyais que pas un Anglais n’en réchapperait. On peut dire que nous avons eu du malheur en ce jour ; sans les Prussiens, je crois encore que nous aurions tout exterminé.
Durant deux heures que nous restâmes l’arme au pied, nous n’eûmes pas même le temps de voir la moitié de nos régiments et de nos escadrons ; c’était toujours du nouveau. Je me souviens qu’au bout d’une heure, on entendit tout à coup, sur la gauche, s’élever comme un orage les cris de : Vive l’Empereur ! et que ces cris se rapprochaient en grandissant toujours, qu’on se dressait sur la pointe des pieds en allongeant le cou ; que cela se répandait dans tous les rangs ; que, derrière, les chevaux eux-mêmes hennissaient comme s’ils avaient voulu crier, et que dans ce moment un tourbillon d’officiers généraux passa devant notre ligne ventre à terre. Napoléon s’y trouvait, je crois bien l’avoir vu, mais je n’en suis pas sûr ; il allait si vite, et tant d’hommes levaient leurs shakos au bout de leurs baïonnettes, qu’on avait à peine le temps de reconnaître son dos rond et sa capote grise au milieu des uniformes galonnés. Quand le capitaine avait crié :
– Portez armes ! Présentez armes ! c’était fini. Voilà comment on le voyait presque toujours, à moins d’être de la garde.
Quand il fut passé, quand les cris se furent prolongés à droite, toujours plus loin, l’idée vint à tout le monde que dans vingt minutes la bataille serait commencée. Mais cela dura bien plus longtemps. L’impatience vous gagnait ; les conscrits du corps de d’Erlon, qui n’avait pas donné la veille, se mettaient à crier : « En avant ! » quand enfin, vers midi, le canon gronda sur la gauche, et dans la même seconde des feux de bataillon suivirent, puis des feux de file. On ne voyait rien, c’était de l’autre côté de la route, l’attaque de Hougoumont.
Aussitôt les cris de : Vive l’Empereur ! éclatèrent. Les canonniers de nos quatre divisions étaient à leurs pièces à vingt pas l’une de l’autre, tout le long de la côte. Au premier coup de canon, ils commencèrent à charger. Je les vois encore tous en ligne mettre la gargousse, refouler tous ensemble, se redresser, secouer la mèche sur leur bras ; on aurait dit un seul mouvement, et cela vous donnait froid. Les chefs de pièces derrière, presque tous de vieux officiers, commandaient comme à la parade ; et quand ces quatre-vingt pièces partirent ensemble, on n’entendit plus rien, tout le vallon fut couvert de fumée.
Au bout d’une seconde, la voix calme de ces vieux, à travers le sifflement de vos oreilles, s’entendit de nouveau :
– Chargez ! Refoulez ! Pointez ! Feu !
Et cela continua sans interruption une demi-heure. On ne se voyait déjà plus : mais de l’autre côté, les Anglais avaient aussi commencé le feu ; le ronflement de leurs boulets dans l’air, leur bruit sec dans la boue, et l’autre bruit dans les rangs, lorsque les fusils sont broyés, et les hommes jetés à vingt pas en arrière tout désossés, comme des sacs, ou qu’ils s’affaissent avec un bras ou une jambe de moins, ce bruit se mêlait au roulement sourd : – la démolition commençait.
Quelques cris de blessés troublaient ce grand bruit. On entendait aussi des chevaux hennir d’une voix perçante ; c’est un cri terrible, car ces animaux sont naturellement féroces ; ils n’ont de bonheur que dans le carnage ; on ne peut presque pas les retenir. Derrière nous, à plus d’une demi-lieue, on n’entendait que ce tumulte : les chevaux voulaient partir.
Et comme on ne voyait plus, depuis longtemps, que les ombres de nos canonniers manœuvrer dans la fumée au bord du ravin, le commandement :
– Cessez le feu ! s’entendit.
En même temps, la voix éclatante des colonels de nos quatre divisions s’éleva :
– Serrez les rangs en bataille ! Toutes les lignes se rapprochèrent.
– Voici notre tour, dis-je à Buche.
– Oui, fit-il, tenons toujours ensemble.
La fumée de nos pièces montait alors, et nous vîmes les batteries des Anglais qui continuaient le feu tout le long des haies qui bordaient leur chemin. La première brigade de la division Alix s’avançait sur la route vers la Haie-Sainte ; elle allait au pas accéléré. Je reconnus derrière le maréchal Ney avec quelques officiers d’état-major.
Toutes les fenêtres de la ferme, le jardin et les murs où l’on avait percé des trous, tout était en feu ; à chaque pas, quelques hommes restaient en arrière étendus sur la route. – Ney, à cheval, son grand chapeau de travers, observait l’action du milieu de la chaussée. Je dis à Buche :
– Voilà le maréchal Ney ; la seconde brigade va soutenir la première et nous arriverons ensuite.
Mais je me trompais ; en ce moment même, le premier bataillon de la seconde brigade reçut l’ordre de marcher en ligne, à droite de la route, le deuxième bataillon derrière le premier, le troisième derrière le deuxième, enfin le quatrième comme au défilé. On n’avait pas le temps de nous former en colonnes d’attaque, mais cela paraissait solide tout de même ; nous étions les uns derrière les autres, sur cent cinquante à deux cents hommes de front ; les capitaines entre les compagnies, les commandants entre les bataillons. Seulement, les boulets, au lieu d’enlever deux hommes, en enlevaient huit d’un coup ; ceux de derrière ne pouvaient pas tirer, parce que les premiers rangs les gênaient ; et l’on vit aussi par la suite qu’on ne pouvait pas se former en carrés. Il aurait fallu penser à cela d’avance, mais l’ardeur d’enfoncer les Anglais et de gagner tout de suite était trop grande.
On fit marcher notre division dans le même ordre : à mesure que le premier bataillon s’avançait, le second emboîtait le pas, ainsi de suite. Comme on commençait par la gauche, je vis avec plaisir que nous allions être au vingt-cinquième rang, et qu’il faudrait en hacher terriblement avant d’arriver sur nous.
Les deux divisions à notre droite se formèrent également en colonnes massives, les colonnes à trois cents pas l’une de l’autre.
C’est ainsi que nous descendîmes dans le vallon, malgré le feu des Anglais. La terre grasse où l’on enfonçait retardait notre marche ; nous criions tous ensemble :
– À la baïonnette !
À la montée, nous recevions une grêle de balles pardessus la chaussée à gauche. Si nous n’avions pas été si touffus, cette fusillade épouvantable nous aurait peut-être arrêtés. La charge battait… Les officiers criaient :
– Appuyez à gauche !
Mais ce feu terrible nous faisait allonger malgré nous la jambe droite plus que l’autre ; de sorte qu’en arrivant près du chemin bordé de haies, nous avions perdu nos distances et que notre division ne formait pour ainsi dire plus qu’un grand carré plein avec la troisième.
Alors deux batteries se mirent à nous balayer, la mitraille qui sortait d’entre les haies, à cent pas, nous perçait d’outre en outre. Ce ne fut qu’un cri d’horreur, et l’on se mit à courir sur les batteries, en bousculant les habits rouges qui voulaient nous arrêter.
Dans ce moment, je vis pour la première fois de près les Anglais, qui sont des gens solides, blancs, bien rasés, comme de bons bourgeois. Ils se défendent bien, mais nous les valons ! Ce n’est pas notre faute à nous autres simples soldats s’ils nous ont vaincus, tout le monde sait que nous avons montré autant et plus de courage qu’eux !
On a dit que nous n’étions plus les soldats d’Austerlitz, d’Iéna, de Friedland, de la Moskowa ; sans doute ! mais ceux-là, puisqu’ils étaient si bons, il aurait fallu les ménager. Nous n’aurions pas mieux demandé que de les voir à notre place.
Tous les coups des Anglais portaient, ce qui nous força de rompre les rangs : les hommes ne sont pas des palissades : ils ont besoin de se défendre quand on les fusille.
Un grand nombre s’étaient donc détachés, quand des milliers d’Anglais se levèrent du milieu des orges et tirèrent sur eux à bout portant, ce qui produisit un grand carnage ; à chaque seconde, d’autres rangs allaient au secours des camarades, et nous aurions fini par nous répandre comme une fourmillière sur la côte, si l’on n’avait entendu crier :
– Attention ! la cavalerie !
Presque aussitôt nous vîmes arriver une masse de dragons rouges sur des chevaux gris, ils arrivaient comme le vent ; tous ceux qui s’étaient écartés furent hachés sans miséricorde.
Il ne faut pas croire que ces dragons tombèrent sur nos colonnes pour les enfoncer, elles étaient trop profondes et trop massives ; ils descendirent entre nos divisions, sabrant à droite et à gauche, et poussant leurs chevaux dans le flanc des colonnes pour les couper en deux, mais ils ne purent y réussir ; seulement ils nous tuèrent beaucoup de monde, et nous mirent dans un grand désordre.
C’est un des plus terribles moments de ma vie. Comme ancien soldat, j’étais à la droite du bataillon ; j’avais vu de loin ce que ces gens allaient faire : ils passaient en s’allongeant de côté sur leurs chevaux tant qu’ils pouvaient, pour faucher dans les rangs ; leurs coups se suivaient comme des éclairs, et, plus de vingt fois, je crus avoir la tête en bas des épaules. Heureusement pour moi, le sergent Rabot était en serre-file ; c’est lui qui reçut cette averse épouvantable, en se défendant jusqu’à la mort. À chaque coup, il criait :
– Lâches ! lâches !
Et son sang sautait sur moi comme de la pluie. À la fin, il tomba. J’avais encore mon fusil chargé, et voyant l’un de ces dragons, qui, de loin, me regardait d’avance, en se penchant pour me lancer son coup de pointe, je l’abattis à bout portant. Voilà le seul homme que j’aie vu tomber devant mon coup de feu.
Le pire, c’est que dans le même instant, leurs fantassins ralliés recommencèrent à nous fusiller, et qu’ils prirent même l’audace de nous attaquer à la baïonnette. Les deux premiers rangs pouvaient seuls se défendre. C’était une véritable abomination de nous avoir rangés de cette manière.
Alors les dragons rouges, pêle-mêle avec nos colonnes, descendirent dans le vallon.
Notre division s’était encore le mieux défendue, car nous conservions nos drapeaux, et les deux autres, à côté de nous, avaient perdu deux aigles.
Nous redescendîmes donc de cette façon dans la boue, à travers les pièces qu’on avait amenées pour nous soutenir, et dont les attelages venaient d’être sabrés par les dragons. Nous courions de tous les côtés, Buche et moi toujours ensemble ; et ce ne fut qu’au bout de dix minutes qu’on parvint à nous rallier près de la chaussée, par pelotons de tous les régiments.
Ceux qui veulent se mêler de commander à la guerre devraient toujours avoir de pareils exemples sous les yeux et réfléchir avant de faire de nouvelles inventions ; ces inventions coûtent cher à ceux qui sont forcés d’y entrer.
Nous regardions derrière nous en reprenant haleine, et nous voyions déjà les dragons rouges monter la côte pour enlever notre grande batterie de quatre-vingts pièces ; mais, Dieu merci ! leur tour était aussi venu d’être massacrés. L’Empereur avait vu de loin notre retraite, et, comme ces dragons montaient, deux régiments de cuirassiers à droite, avec un régiment de lanciers à gauche, tombèrent sur eux en flanc comme le tonnerre ; le temps de regarder, ils étaient dessus. On entendait chaque coup glisser sur les cuirasses, les chevaux souffler ; on voyait, à cent pas, les lances monter et descendre, les grands sabres s’allonger, les hommes se courber pour piquer en dessous, les chevaux furieux se dresser et mordre en hennissant d’une voix terrible ; et puis les hommes à terre sous les pieds des chevaux, essayer de se lever en se garant de la main.
Quelle horrible chose que les batailles ! – Buche criait :
– Hardi !
Moi, je sentais la sueur me couler du front. D’autres, avec des balafres et les yeux pleins de sang, s’essuyaient en riant d’un air féroce.
En dix minutes, sept cents dragons étaient hors de combat ; leurs chevaux gris couraient de tous les côtés, le mors aux dents. Quelques centaines d’entre eux rentraient dans leurs batteries, mais plus d’un ballottait et se cramponnait à la crinière de son cheval. – Ils avaient vu que ce n’est pas tout de tomber sur les gens, et qu’il peut aussi vous arriver des choses auxquelles on ne s’attend pas.
De tout ce spectacle affreux, ce qui m’est le plus resté dans l’esprit, c’est que nos cuirassiers en revenant, leurs grands sabres rouges jusqu’à la garde, riaient entre eux, et qu’un gros capitaine, avec de grandes moustaches brunes, en passant près de nous, clignait de l’œil d’un air de bonne humeur, comme pour nous dire :
« Eh bien !… vous avez vu… nous les avons ramenés vivement. »
Oui, mais il en restait trois mille des nôtres dans ce vallon ! – Et ce n’était pas fini, les compagnies, les bataillons et les brigades se reformaient ; du côté de la Haie-Sainte, la fusillade roulait ; plus loin, près de Hougoumont, le canon tonnait. Tout cela n’était qu’un petit commencement, les officiers disaient :
– C’est à recommencer.
On aurait cru que la vie des hommes ne coûtait rien.
Enfin il fallait emporter la Haie-Sainte ; il fallait forcer à tout prix le passage de la grande route au centre de l’ennemi, comme on enfonce la porte d’une place forte, à travers le feu des avancées et des demi-lunes. Nous avions été repoussés la première fois, mais la bataille était engagée, on ne pouvait plus reculer.
Après la charge des cuirassiers, il fallut du temps pour nous reformer. – La bataille continuait à Hougoumont ; la canonnade recommençait à notre droite ; on avait amené deux batteries pour nettoyer la chaussée en arrière de la Haie-Sainte, où la route entre dans la côte. Chacun voyait que l’attaque allait se porter là. Nous attendions l’arme au bras, lorsque, vers trois heures, Buche, regardant en arrière sur la route, me dit :
– Voici l’Empereur qui vient.
Et d’autres encore disaient dans les rangs :
– Voici l’Empereur !
La fumée était tellement épaisse qu’on voyait à peine, sur la petite butte de Rossomme, les bonnets à poil de la vieille garde. Je m’étais aussi retourné pour voir l’Empereur, mais bientôt nous reconnûmes le maréchal Ney, avec cinq ou six officiers d’état-major ; il arrivait du quartier général et poussait droit sur nous au galop à travers champs. Nous lui tournions le dos. Nos commandants se portèrent à sa rencontre, et nous les entendîmes parler, sans rien comprendre, à cause du bruit qui vous remplissait les oreilles.
Aussitôt le maréchal passa sur le front de nos deux bataillons et tira l’épée. Depuis la grande revue d’Aschaffenbourg, je ne l’avais pas vu d’aussi près ; il semblait plus vieux, plus maigre, plus osseux, mais c’était toujours le même homme ; il nous regardait avec ses yeux gris clair, et l’on aurait cru qu’il nous voyait tous, chacun se figurait que c’était lui qu’il regardait. – Au bout d’un instant, il étendit son épée du côté de la Haie-Sainte, en nous criant :
– Nous allons enlever ça !… Vous aurez de l’ensemble… C’est le nœud de la bataille… Je vais vous conduire moi-même. Bataillons, par file à gauche !
Nous partîmes au pas accéléré. Sur la chaussée, on nous fit marcher par compagnies sur trois rangs ; je me trouvais dans le deuxième. Le maréchal Ney était devant, à cheval, avec les deux commandants et le capitaine Florentin ; il avait remis son épée dans le fourreau. Les balles sifflaient par centaines, le canon grondait tellement dans le fond de Hougoumont, à gauche et sur notre droite en arrière, que c’était comme une grosse cloche dont on n’entend plus les coups à la fin, mais seulement le bourdonnement. Tantôt l’un, tantôt l’autre de nous s’affaissait, et l’on passait par-dessus.
Deux ou trois fois, le maréchal se retourna pour voir si nous marchions bien réunis ; il avait l’air si calme, que je trouvais pour ainsi dire naturel de n’avoir pas peur ; sa mine donnait de la confiance à tout le monde, chacun pensait :
« Ney est avec nous… les autres sont perdus ! »
Voilà pourtant la bêtise du genre humain, puisque tant de gens restaient en route. Enfin, à mesure que nous approchions de cette grande bâtisse, le bruit de la fusillade devenait plus clair au milieu du roulement des canons ; et l’on voyait aussi mieux la flamme des coups de fusil qui sortaient des fenêtres, le grand toit noir au-dessus dans la fumée, et la route encombrée de pierres.
Nous longions une haie, derrière cette haie pétillait le feu de nos tirailleurs, car la première brigade de la division Alix n’avait pas quitté les vergers ; en nous voyant défiler sur la chaussée, elle se mit à crier : Vive l’Empereur ! Et comme toute la fusillade des Allemands se dirigeait alors sur nous, le maréchal Ney, tirant son épée, cria d’une voix qui s’entendit au loin :
– En avant !
Il partit dans la fumée avec deux ou trois autres officiers. Nous courions tous, la giberne ballottant sur les reins et l’arme prête. Derrière, bien loin, la charge battait, on ne voyait plus le maréchal, et ce n’est que près d’un hangar qui sépare le jardin de la route, que nous le découvrîmes à cheval devant la porte cochère. Il paraît que d’autres avaient déjà voulu forcer cette porte, car des tas de morts, de poutres, de pavés et de décombres s’élevaient contre, jusqu’au milieu de la route. Le feu sortait de tous les trous de la bâtisse, on ne sentait que l’odeur épaisse de la poudre.
– Enfoncez-moi cela ! criait le maréchal, dont la figure était toute changée.
Et nous tous, à quinze, vingt, nous jetions nos fusils, nous levions les poutres, et nous les poussions contre cette porte qui criait, en retentissant comme le tonnerre. À chaque coup, on aurait cru qu’elle allait tomber. À travers ses ais, on voyait les pavés à l’intérieur entassés jusqu’au haut. Elle était criblée. En tombant, elle nous aurait écrasés, mais la fureur nous rendait aveugles. Nous ne ressemblions plus à des hommes : les uns n’avaient plus de shakos, les autres étaient déchirés, presque en chemise, le sang leur coulait sur les mains, le long des cuisses ; et dans le roulement de la fusillade, des coups de mitraille arrivaient de la côte, les pavés autour de nous sautaient en poussière.
Je regardais, mais je ne voyais plus ni Buche, ni Zébédé, ni personne de la compagnie. Le maréchal était aussi parti. Notre acharnement redoublait. Et comme les poutres allaient et venaient, comme on devenait fou de rage, en voyant que cette porte ne voulait pas s’enfoncer, tout à coup les cris de : Vive l’Empereur ! éclatèrent dans la cour avec un tumulte épouvantable. Chacun comprit que nos troupes étaient dans la ferme ; on se dépêchait de lâcher les poutres, de reprendre les fusils et de sauter par les brèches dans le jardin, pour aller voir où les autres étaient entrés. C’est derrière la ferme, par une porte qui donnait dans une grange. On entrait à la file comme des bandes de loups. L’intérieur de cette vieille bâtisse, pleine de paille, de greniers à foin, les écuries recouvertes de chaume, ressemblait à l’un de ces nids pleins de sang où les éperviers ont passé.
Sur un grand fumier, au milieu de la cour, on perçait les Allemands, qui poussaient des cris et des jurements sauvages.
J’allais à travers ce massacre au hasard. J’entendais aussi crier :
– Joseph ! Joseph ! et je regardais, pensant : « C’est Buche qui m’appelle. » Dans le même instant, je l’aperçus à droite, devant la porte d’un bûcher, qui croisait la baïonnette contre cinq ou six des nôtres. Je vis en même temps Zébédé, car notre compagnie se trouvait dans ce coin, et, courant au secours de Buche, je criai :
– Zébédé !
Ensuite, fendant la presse :
– Qu’est-ce que c’est ? dis-je à Buche.
– Ils veulent massacrer mes prisonniers.
Je me mis avec lui. Les autres dans leur fureur, chargeaient leurs fusils pour nous tuer ; c’étaient des voltigeurs d’un autre bataillon. Zébédé vint avec plusieurs hommes de la compagnie, et, sans savoir ce que cela voulait dire, il empoigna l’un des plus terribles à la gorge, en criant :
– Je m’appelle Zébédé, sergent au 6e léger… Après l’affaire, nous aurons une explication ensemble.
Alors les autres s’en allèrent, et Zébédé me demanda :
– Qu’est-ce que c’est, Joseph ?
Je lui dis que nous avions des prisonniers, et tout de suite il devint pâle de colère contre nous ; mais, étant entré dans le bûcher, il vit un vieux major qui lui présentait la garde de son sabre en silence, et un soldat qui disait en allemand :
– Laissez-moi la vie, Français !… Ne m’ôtez pas la vie !
Dans un moment pareil, où les cris de ceux qu’on tuait remplissaient encore la cour, cela vous retournait le cœur. Zébédé leur dit :
– C’est bon… je vous reçois mes prisonniers.
Il ressortit et tira la porte. Nous ne quittâmes plus de là jusqu’au moment où l’on se mit à battre le rappel. Alors les hommes ayant repris les rangs, Zébédé prévint le capitaine Florentin que nous avions un major et un soldat prisonniers. On les fit sortir, ils traversèrent la cour sans armes, et furent réunis dans une chambre, avec trois ou quatre autres : c’est tout ce qui restait des deux bataillons de Nassau chargés de la défense de la Haie-Sainte.
Pendant que ceci se passait, deux autres bataillons de Nassau qui venaient au secours de leurs camarades, avaient été massacrés dehors par nos cuirassiers, de sorte qu’en ce moment nous avions la victoire : nous étions maîtres de la principale avancée des Anglais, nous pouvions commencer les grandes attaques au centre, couper à l’ennemi la route de Bruxelles, et le jeter dans les mauvais chemins de la forêt de Soignes. Nous avions eu de la peine, mais le principal de la bataille était fait. À deux cents pas de la ligne des Anglais, bien à couvert, nous pouvions tomber sur eux, et, sans vouloir nous glorifier, je crois qu’à la baïonnette et bien appuyés par notre cavalerie, nous aurions percé leur ligne ; il ne fallait pas plus d’une heure, en se ramassant bien, pour en finir.
Mais, pendant que nous étions dans la joie, pendant que les officiers, les soldats, les tambours, les trompettes, encore tous pêle-mêle sur les décombres, ne songeaient qu’à s’allonger les jambes, à reprendre haleine, à se réjouir, tout à coup la nouvelle se répand que les Prussiens arrivent, qu’ils vont nous tomber en flanc, que nous allons avoir deux batailles, l’une en face et l’autre à droite, et que nous risquons d’être entourés par des forces doubles de la nôtre.
C’était une nouvelle terrible, eh bien ! plusieurs êtres dépourvus de bon sens disaient :
– Tant mieux que les Prussiens arrivent… nous les écraserons tous ensemble !
Mais les gens qui n’avaient pas perdu la tête comprirent aussitôt combien nous avions eu tort de ne pas profiter de notre victoire de Ligny, de laisser les Prussiens s’en aller tranquillement pendant la nuit, sans envoyer de cavalerie à leur poursuite, comme cela se fait toujours. – On peut dire hardiment que cette grande faute est cause de notre désastre de Waterloo ! – L’empereur avait bien envoyé le lendemain, à midi, le maréchal Grouchy avec trente-deux mille hommes à la recherche de ces Prussiens, mais c’était beaucoup trop tard : ils avaient eu le temps de se reformer pendant ces quinze heures, de prendre de l’avance et de s’entendre avec les Anglais. Il faut savoir que le lendemain de Ligny les Prussiens conservaient quatre-vingt-dix mille hommes, dont trente mille de troupes fraîches, et deux cent soixante-quinze canons. Avec une armée pareille, ils pouvaient faire ce qu’il leur plairait ; ils pouvaient même livrer une seconde bataille à l’Empereur ; mais ce qui leur plaisait le plus c’était de nous tomber en flanc, pendant que nous avions les Anglais en tête. C’est tellement clair et simple, qu’on ne comprend pas que des gens trouvent que c’est étonnant. Blücher nous avait déjà fait le même tour à Leipzig, et maintenant il nous le faisait encore, en laissant Grouchy le poursuivre bien loin derrière. Est-ce que Grouchy pouvait le forcer de revenir sur lui, pendant que Blücher voulait aller en avant ? Est-ce qu’il pouvait l’empêcher de laisser trente ou quarante mille hommes, pour arrêter les troupes qui le poursuivaient, et de courir avec le reste au secours de Wellington ?
Notre seule espérance était qu’on avait envoyé l’ordre à Grouchy de venir nous rejoindre, et qu’il allait arriver derrière les Prussiens ; mais l’Empereur n’avait pas envoyé cet ordre.
Vous pensez bien que ce n’était pas à nous autres simples soldats que ces idées venaient, c’est à nos officiers, à nos généraux ; nous autres, nous ne savions rien, nous étions là comme des innocents qui ne se doutent pas que leur heure est proche.
Enfin j’ai dit tout ce que je pense, et maintenant je vais vous raconter le reste de la bataille, selon ce que j’ai vu moi-même, afin que chacun en sache autant que moi.
XXI
Presque aussitôt après la nouvelle de l’arrivée des Prussiens, le rappel se mit à battre ; les bataillons se démêlèrent, le nôtre, avec un autre de la brigade Quiot, resta pour garder la Haie-Sainte, et tout le reste suivit pour se joindre au corps du général d’Erlon, qui s’avançait de nouveau dans le vallon et tâchait de déborder les Anglais par la gauche.
Nos deux bataillons se dépêchèrent de reboucher les portes et les brèches comme on put, avec des poutres et des pavés. On mit des hommes en embuscade à tous les trous que l’ennemi avait faits du côté du verger et de la route.
C’est au-dessus d’une étable, au coin de la ferme, à mille ou douze cents pas de Hougoumont, que Zébédé, Buche et moi, nous fûmes postés avec le reste de la compagnie. Je vois encore les trous en ligne, à hauteur d’homme, que les Allemands avaient percés dans le mur pour défendre le verger. À mesure que nous montions, nous regardions par ces trous notre ligne de bataille, la grande route de Bruxelles à Charleroi, les petites fermes de Belle-Alliance, de Rossomme, du Gros-Caillou qui la bordaient de loin en loin, la vieille garde l’arme au bras en travers de la chaussée, l’état-major sur une petite éminence à gauche ; et plus loin, dans la même direction, en arrière du ravin de Planchenois, la fumée blanche qui s’étendait au-dessus des arbres et se renouvelait sans cesse : c’était l’attaque du premier corps des Prussiens.
Nous avons su plus tard que l’Empereur avait envoyé dix mille hommes sous les ordres de Lobau pour les arrêter. Le combat était engagé, mais la vieille garde et la jeune garde, les cuirassiers de Milhaud, ceux de Kellermann et les chasseurs de Lefèbvre-Desnoëttes, enfin toute notre magnifique cavalerie restait en position : la grande, la véritable bataille était toujours contre les Anglais.
Que de pensées vous venaient devant ce spectacle grandiose, et cette plaine immense, que l’Empereur devait voir en esprit, mieux que nous avec nos propres yeux ! Nous serions restés là durant des heures, si le capitaine Florentin n’était pas monté tout à coup.
– Eh bien, que faites-vous donc là ? s’écria-t-il ; est-ce que nous allons défendre la route contre la garde ? Voyons… dépêchons-nous… percez-moi ce mur du côté de l’ennemi.
Chacun ramassa les pioches et les pics que les Allemands avaient laissés sur le plancher, et l’on fit des trous dans le mur du pignon. Cela ne prit pas un quart d’heure, et l’on vit alors le combat de Hougoumont ; les bâtisses en feu, les obus qui de seconde en seconde éclataient dans les décombres, les chasseurs écossais embusqués dans le chemin derrière ; et sur notre droite, tout près de nous, à deux portées de fusil, les Anglais en train de reculer leur première ligne au centre, et d’emmener plus haut leurs pièces, que nos tirailleurs commençaient à démonter. – Mais le reste de leur ligne ne bougeait pas, ils avaient des carrés rouges et des carrés noirs en échiquier, les uns en avant, les autres en arrière du chemin creux ; ces carrés se rapprochaient par les coins ; pour les attaquer, il fallait passer à travers leurs feux croisés ; leurs pièces restaient en position au bord du plateau ; plus loin, dans le pli de la côte de Mont-Saint-Jean, leur cavalerie attendait.
La position de ces Anglais me parut encore plus forte que le matin ; et comme nous n’avions déjà pas réussi contre leur aile gauche, comme les Prussiens nous attaquaient en flanc, l’idée me vint pour la première fois, que nous n’étions pas sûrs de gagner la bataille. Je me figurai notre déroute épouvantable, – si par malheur nous perdions, – entre deux armées, l’une en tête et l’autre en flanc, la seconde invasion, les contributions forcées, le siège des places, le retour des émigrés et les vengeances.
Je sentis que cette pensée me rendait tout pâle.
Dans le même instant, des cris de : Vive l’Empereur ! s’élevaient par milliers derrière nous. Buche se trouvait près de moi dans le coin du grenier ; il criait avec tous les camarades : Vive l’Empereur ! et m’étant penché sur son épaule, je vis toute notre cavalerie de l’aile droite : les cuirassiers de Milhaud, les lanciers et les chasseurs de la garde, plus de cinq mille hommes qui s’avançaient au trot ; ils traversèrent la chaussée en écharpe, et descendirent dans le vallon entre Hougoumont et la Haie-Sainte. Je compris qu’ils allaient attaquer les carrés anglais et que notre sort était en jeu.
Les chefs de pièces anglais commandaient d’une voix si perçante, qu’on les entendait à travers le tumulte et les cris innombrables de : Vive l’Empereur !
Ce fut un moment terrible, lorsque nos cuirassiers passèrent dans le vallon ; je crus voir un torrent à la fonte des neiges, quand le soleil brille sur les glaçons par milliards. Les chevaux, avec leur gros portemanteau bleu sur la croupe, allongeaient tous la hanche ensemble comme des cerfs, en défonçant la terre, les trompettes sonnaient d’un air sauvage au milieu du roulement sourd ; et, dans l’instant qu’ils passaient, la première décharge à mitraille faisait trembler notre vieux hangar. Le vent soufflait de Hougoumont et remplissait de fumée toutes les ouvertures ; nous nous penchions au dehors : la seconde décharge, puis la troisième arrivaient coup sur coup.
À travers la fumée, je voyais les canonniers anglais abandonner leurs pièces et se sauver avec leurs attelages ; et presque aussitôt nos cuirassiers étaient sur les carrés, dont les feux se dessinaient en zigzags le long de la côte. On n’entendait plus qu’une grande rumeur, des plaintes, des cliquetis sans fin, des hennissements, de temps en temps une décharge ; puis de nouveaux cris, de nouvelles rumeurs, de nouveaux gémissements. Et, dans cette épaisse fumée qui s’amassait contre la ferme, des vingtaines de chevaux passaient comme des ombres, la crinière droite, d’autres traînant leur cavalier la jambe prise dans l’étrier.
Cela dura plus d’une heure !
Après les cuirassiers de Milhaud arrivèrent les lanciers de Lefebvre-Desnoëttes ; après les lanciers, les cuirassiers de Kellermann ; après ceux-ci, les grenadiers à cheval de la garde ; après les grenadiers, les dragons… Tout cela montait la côte au trot et courait sur les carrés le sabre en l’air, en poussant des cris de : Vive l’Empereur ! qui s’élevaient jusqu’au ciel.
À chaque nouvelle charge, on aurait cru qu’ils allaient tout enfoncer ; mais, quand les trompettes sonnaient le ralliement, quand les escadrons pêle-mêle revenaient au galop, – poursuivis par la mitraille, – se reformer au bout du plateau, on voyait toujours les grandes lignes rouges, immobiles dans la fumée comme des murs.
Ces Anglais sont de bons soldats. – Il faut dire aussi qu’ils savaient que Blücher venait à leur secours avec soixante mille hommes, et naturellement cette idée leur donnait un grand courage.
Malgré cela, vers six heures nous avions détruit la moitié de leurs carrés ; mais alors les chevaux de nos cuirassiers, épuisés par vingt charges dans ces terres grasses détrempées par la pluie, ne pouvaient plus avancer au milieu des tas de morts.
Et la nuit approchait… Le grand champ de bataille derrière nous se vidait !… À la fin, la grande plaine où nous avions campé la veille était déserte, et là-bas la vieille garde restait seule en travers de la route, l’arme au bras : tout était parti, à droite contre les Prussiens, en face contre les Anglais !
Nous nous regardions dans l’épouvante.
Il faisait déjà sombre, lorsque le capitaine Florentin parut au haut de l’échelle, les deux mains sur le plancher, en nous criant d’une voix grave :
– Fusiliers, l’heure est venue de vaincre ou de mourir !
Je me rappelai que ces paroles étaient dans la proclamation de l’Empereur, et nous descendîmes tous à la file. – Il ne faisait pas encore tout à fait nuit, mais dans la cour dévastée tout était gris et les morts déjà roides sur le fumier et le long des murs.
Le capitaine nous rangea sur la droite de la cour, le commandant de l’autre bataillon rangea ses hommes sur la gauche ; nos tambours résonnèrent pour la dernière fois dans la vieille bâtisse, et nous défilâmes par la petite porte de derrière dans le jardin ; il fallut nous baisser l’un après l’autre.
Dehors, les murs du jardin étaient balayés. Les blessés, le long des décombres, se bandaient l’un la tête, l’autre la jambe ou le bras ; une cantinière, avec sa charrette et son âne, un grand chapeau de paille aplati sur le dos, se tenait aussi dans ce recoin ; je ne sais pas ce que cette malheureuse était venue faire là. Plusieurs chevaux abattus de fatigue, la tête pendante, couverts de boue et de sang, ressemblaient à de vieilles rosses.
Quelle différence avec le matin ! Alors les compagnies arrivaient bien à moitié détruites, mais c’étaient des compagnies. Maintenant la confusion approchait ; il n’avait fallu que trois jours pour nous réduire au même état qu’à Leipzig au bout d’un an. Le restant de notre bataillon et de l’autre formait seul encore une ligne en bon ordre ; et, puisqu’il faut que je vous le dise, l’inquiétude nous gagnait.
Quand des hommes n’ont pas mangé depuis la veille, quand ils se sont battus tout le jour, et qu’à la nuit, après avoir épuisé toutes leurs forces, le tremblement de la faim les prend, la peur vient aussi, les plus courageux perdent l’espoir : – toutes nos grandes retraites si malheureuses viennent de là.
Et pourtant, malgré tout, nous n’étions pas vaincus, les cuirassiers tenaient encore sur le plateau ; de tous les côtés, au milieu du grondement de la canonnade et du tumulte, on n’entendait qu’un cri :
– La garde arrive !
Ah ! oui, la garde arrivait… elle arrivait à la fin ! Nous voyions de loin, sur la grande route, ses hauts bonnets à poil s’avancer en bon ordre.
Ceux qui n’ont pas vu la garde arriver sur un champ de bataille ne sauront jamais la confiance que les hommes peuvent avoir dans un corps d’élite, l’espèce de respect que vous donnent le courage et la force. Les soldats de la vieille garde étaient presque tous d’anciens paysans d’avant la République, des hommes de cinq pieds six pouces au moins, secs, bien bâtis ; ils avaient conduit la charrue dans le temps pour le couvent et le château ; plus tard, ils s’étaient levés en masse avec tout le peuple ; ils étaient partis pour l’Allemagne, la Hollande, l’Italie, l’Égypte, la Pologne, l’Espagne, la Russie, d’abord sous Kléber, sous Hoche, sous Marceau ; ensuite sous Napoléon, qui les ménageait, qui leur faisait une haute paye. Ils se regardaient en quelque sorte comme des propriétaires d’une grosse ferme, qu’il fallait défendre et même agrandir de plus en plus. Cela leur attirait de la considération. C’était leur propre bien qu’ils défendaient. Ils ne connaissaient plus les parents, les cousins, les gens du pays ; ils ne connaissaient plus que l’Empereur, qui était leur Dieu ; et finalement ils avaient adopté le roi de Rome pour hériter de tout avec eux, pour les entretenir et honorer leur vieillesse. On n’a jamais rien vu de pareil ; ils étaient tellement habitués à marcher, à s’aligner, à charger, à tirer, à croiser la baïonnette, que cela se faisait en quelque sorte tout seul, selon le besoin. Quand ils s’avançaient l’arme au bras, avec leurs grands bonnets, leurs gilets blancs, leurs guêtres, ils se ressemblaient tous ; on voyait bien que c’était le bras droit de l’Empereur qui s’avançait. Quand on disait dans les rangs : « La garde va donner ! » c’était comme si l’on avait dit : « La bataille est gagnée ! »
Mais en ce moment, après ce grand massacre, ces terribles attaques repoussées, en voyant les Prussiens nous tomber en flanc, on se disait bien :
« C’est le grand coup ! »
Mais on pensait :
« S’il manque, tout est perdu ! »
Voilà pourquoi nous regardions tous la garde venir au pas sur la route. – C’est encore Ney qui la conduisait, comme il avait conduit l’attaque des cuirassiers. L’empereur savait bien que personne ne pouvait conduire la garde mieux que Ney, il aurait dû seulement l’envoyer une heure plus tôt, lorsque nos cuirassiers étaient dans les carrés ; alors tout aurait été gagné. Mais l’Empereur tenait à sa garde comme à la chair de sa chair ; s’il avait eu sa garde cinq jours après à Paris, Lafayette et les autres ne seraient pas restés longtemps dans leur chambre pour le destituer ; mais il ne l’avait plus !
C’est donc à cause de cela qu’il avait attendu si longtemps pour l’envoyer. Il espérait que la cavalerie enfoncerait tout avec Ney, ou que les trente-deux mille hommes de Grouchy viendraient à la place de sa garde, parce qu’on peut toujours remplacer trente ou quarante mille hommes par la conscription, au lieu que, pour avoir une garde pareille, il faut commencer à vingt-cinq ans et remporter cinquante victoires ; ce qui reste de meilleur, de plus solide, de plus dur, c’est la garde.
Eh bien ! elle arrivait… nous la voyions. Ney, le vieux Friant et trois ou quatre autres marchaient devant. On ne voyait plus que cela ; le reste, les coups de canon, la fusillade, les cris des blessés, tout était comme oublié. Mais cela ne dura pas longtemps, car les Anglais avaient aussi compris que c’était le grand coup ; ils se dépêchaient de réunir toutes leurs forces pour le recevoir.
On aurait dit que, sur notre gauche, le champ de bataille était vide ; on ne tirait plus, soit à cause de l’épuisement des munitions, ou parce que l’ennemi se formait dans un nouvel ordre. À droite, au contraire, du côté de Frichemont, la canonnade redoublait, toute l’affaire semblait s’être portée là-bas, et l’on n’osait pas se dire : « Ce sont les Prussiens qui nous attaquent… une armée de plus qui vient nous écraser ! » Non, cette idée nous paraissait trop épouvantable, quand tout à coup un officier d’état-major passa comme un éclair, en criant :
– Grouchy !… le maréchal Grouchy arrive !
C’était dans le moment où les quatre bataillons de la garde prenaient à gauche de la chaussée pour remonter derrière le verger et commencer l’attaque.
Combien de fois depuis cinquante ans, je me suis représenté cette attaque à la nuit, et combien de fois je l’ai entendu raconter par d’autres ! En écoutant ces histoires, on croirait que la garde était seule, qu’elle s’avançait comme des rangs de palissade et qu’elle supportait seule la mitraille. Mais tout cela se passait dans la plus grande confusion ; cette attaque terrible, c’était toute notre armée, tous les débris de l’aile gauche et du centre qui donnaient, tout ce qui restait de cavalerie épuisée par six heures de combat, tout ce qui pouvait encore se tenir debout et lever le bras : c’était l’infanterie de Reille qui se concentrait sur la gauche, c’était nous autour de la Haie-Sainte, c’était tout ce qui vivait encore et qui ne voulait pas être massacré.
Et qu’on ne vienne pas dire que nous avons eu des terreurs paniques, et que nous voulions nous sauver comme des lâches, ce n’est pas vrai ! Quand le bruit courut que Grouchy venait, les blessés eux-mêmes se relevèrent et se remirent en rang ; on aurait cru qu’un souffle faisait marcher les morts ; tous ces misérables étendus derrière la Haie-Sainte, la tête, le bras, la jambe bandée, les habits en lambeaux et pleins de sang, tout ce qui pouvait mettre un pied devant l’autre se joignit à la garde qui passait devant les brèches du jardin, et chacun déchira sa dernière cartouche.
La charge battait, nos canons s’étaient remis à tonner. Sur la côte, tout se taisait ; des files de canons anglais restaient abandonnées, on aurait cru les autres partis, et seulement lorsque les bonnets à poil commencèrent à s’élever au-dessus du plateau, cinq ou six volées de mitraille nous avertirent qu’ils nous attendaient.
Alors on comprit que ces Anglais, ces Allemands, ces Belges, ces Hanovriens, tous ces gens que nous avions sabrés et massacrés depuis le matin, s’étaient reformés en arrière, et qu’il fallait leur passer sur le ventre. Bien des blessés se retirèrent en ce moment, et la garde, sur qui tombait le gros de l’averse, s’avança presque seule à travers la fusillade et la mitraille, en culbutant tout ; mais elle se resserrait de plus en plus et diminuait à vue d’œil. Au bout de vingt minutes, tous ses officiers à cheval étaient démontés ; elle s’arrêta devant un feu de mousqueterie tellement épouvantable, que nous-mêmes, à deux cents pas en arrière, nous n’entendions plus nos propres coups de feu, nous croyions brûler des amorces.
Finalement, toute cette masse d’ennemis, en face, à droite et à gauche, se leva, sa cavalerie sur les flancs, et tomba sur nous. Les quatre bataillons de la garde, réduits de trois mille hommes à douze cents, ne purent supporter une charge pareille, ils reculèrent lentement ; et nous reculâmes aussi en nous défendant à coups de fusil et de baïonnette.
Nous avions vu des combats plus terribles, mais celui-ci était le dernier.
Comme nous arrivions au bord du plateau pour redescendre, toute la plaine au-dessous, déjà couverte d’ombre, était dans la confusion de la déroute ; tout se débandait et s’en allait, les uns à pied, les autres à cheval ; un seul bataillon de la garde, en carré près de la ferme, et trois autres bataillons plus loin, avec un autre carré de la garde, à l’embranchement de Plan-chenois, restaient immobiles comme des bâtisses, au milieu d’une inondation qui entraîne tout le reste ! – Tout s’en allait : hussards, chasseurs, cuirassiers, artillerie, infanterie, pêle-mêle sur la route, à travers champs, comme une armée de barbares qui se sauve. Le long du ravin de Planchenois, le ciel sombre était éclairé par la fusillade ; le seul carré de la garde tenait encore contre Bulow et l’empêchait de nous couper la route ; mais plus près de nous, d’autres Prussiens – de la cavalerie – descendaient dans le vallon comme un fleuve qui passe au-dessus de ses écluses. Le vieux Blücher venait aussi d’arriver avec quarante mille hommes ; il repliait notre aile droite et la dispersait devant lui.
Qu’est-ce que je peux vous dire encore ? C’était le débordement… Nous étions entourés partout ; les Anglais nous repoussaient dans le vallon, et dans le vallon Blücher arrivait. Nos généraux, nos officiers, l’Empereur lui-même n’avaient plus d’autre ressource que de se mettre dans un carré ; et l’on dit que nous autres, pauvres malheureux, nous avions la terreur panique ! On n’a jamais vu d’injustice pareille.
Je courais sur la ferme, avec Buche et cinq ou six camarades ; des obus roulaient autour de nous en éclatant, et nous arrivâmes comme des êtres égarés, près de la route où des Anglais à cheval passaient déjà ventre à terre, en se criant entre eux :
– No quarter ! no quarter[3] !
Dans ce moment, le carré de la garde se mit en retraite ; il faisait feu de tous les côtés pour écarter les malheureux qui voulaient entrer ; les officiers et les généraux pouvaient seuls se sauver.
Ce que je n’oublierai jamais, quand je devrais vivre mille ans, ce sont ces cris immenses, infinis, qui remplissaient la vallée à plus d’une lieue, et tout au loin la grenadière qui battait comme le tocsin au milieu d’un incendie ; mais c’était bien plus terrible encore, c’était le dernier appel de la France, de ce peuple courageux et fier, c’était la voix de la patrie, qui disait : « À moi, mes enfants ! je meurs ! » Non, je ne puis vous peindre cela !… Ce bourdonnement du tambour de la vieille garde au milieu de notre désastre était quelque chose d’attendrissant et d’épouvantable. Je sanglotais comme un enfant ; Buche m’entraînait, et je lui criais :
– Jean, laisse-moi… nous sommes perdus… nous avons tout perdu !…
L’idée de Catherine, de M. Goulden, de Phalsbourg ne me venait pas. Ce qui m’étonne aujourd’hui, c’est que nous n’ayons pas été massacrés cent fois sur cette route, où passaient des files d’Anglais et de Prussiens.
Ils nous prenaient peut-être pour des Allemands, peut-être aussi couraient-ils après l’Empereur, car tous espéraient l’avoir.
En face de la petite ferme de Rossomme, il fallut tourner à droite dans les champs : c’est là que le dernier carré de la garde soutenait encore l’attaque des Prussiens ; mais il ne tint plus longtemps, car vingt minutes après, les ennemis débordaient sur la route, les chasseurs prussiens s’en allaient par bandes arrêter ceux qui s’écartaient ou qui restaient en arrière. On aurait dit que cette route était un pont, et que tous ceux qui ne la suivaient pas tombaient dans le gouffre.
À la descente du ravin, derrière l’auberge de Passe-Avant, des hussards prussiens coururent sur nous. Ils n’étaient pas plus de cinq ou six, et nous criaient de nous rendre ; mais si nous avions levé la crosse, ils nous auraient sabrés. Nous les couchâmes en joue, et voyant que nous n’étions pas blessés, ils s’en allèrent plus loin. Cela nous força de regagner la route, dont les cris et le tumulte s’entendaient au moins de deux lieues ; la cavalerie, l’infanterie, l’artillerie, les ambulances, les bagages, tout pêle-mêle, se traînaient sur la chaussée, hurlant, tapant, hennissant et pleurant. Non, pas même à Leipzig, je n’ai vu de spectacle pareil. La lune se levait au-dessus des bois, derrière Planchenois, elle éclairait cette foule de schapskas, de bonnets à poil, de casques, de sabres, de baïonnettes, de caissons renversés, de canons arrêtés ; et, de minute en minute, l’encombrement augmentait ; des hurlements plaintifs s’entendaient d’un bout de la ligne à l’autre, cela montait et descendait les côtes et finissait dans le lointain comme un soupir. Mais le plus triste, c’étaient les cris des femmes, – de ces malheureuses qui suivent les armées, – lorsqu’on les bousculait et qu’on les jetait en bas du talus avec leurs charrettes : elles poussaient des cris qu’on entendait par-dessus ce tumulte immense, et personne ne tournait la tête, pas un homme ne descendait leur tendre la main :
– Chacun pour soi ! Je t’écrase, tant pis ; je suis le plus fort. – Tu cries… ça m’est égal !… Gare !… gare !… je suis à cheval !… je tape !… Place… pourvu que je me sauve !… Les autres font comme moi ! – Place pour l’Empereur !… Place pour le maréchal !… Le plus fort écrase le plus faible… il n’y a que la force dans ce monde ! – En route !… en route !… Que les canons écrasent tout pourvu qu’on les sauve ! – Les canons ne marchent plus… qu’on dételle, qu’on coupe les traits, et tapons sur les chevaux qui nous emportent !… Qu’ils aillent tant qu’ils pourront, et puis qu’ils crèvent ! – Qu’est-ce que nous fait le reste ? Si nous ne sommes pas les plus forts, eh bien ! notre tour viendra d’être écrasés ; nous crierons, et l’on se moquera de nos cris ! – Sauve qui peut… et vive l’Empereur !… – Mais l’Empereur est mort !
Tout le monde croyait que l’Empereur était mort avec la vieille garde : – cela paraissait tout naturel.
La cavalerie prussienne passait par files, le sabre en l’air, en criant : « Hourrah ! » Elle avait l’air de nous escorter, et sabrait tout ce qui s’écartait de la route ; elle ne faisait pas de prisonniers et n’attaquait pas non plus la colonne en masse ; quelques coups de fusil partaient dessus à droite et à gauche. Derrière, bien loin, on voyait une flamme rouge dans la nuit : la ferme de Caillou brûlait.
On allongeait le pas ; la fatigue, la faim, le désespoir vous écrasaient ; on aurait voulu mourir ; et pourtant l’espoir de se sauver vous soutenait. Buche en marchant me disait :
– Joseph, soutenons-nous ! moi, je ne t’abandonnerai jamais.
Et je lui répondais :
– Nous mourrons ensemble… Je ne me tiens plus… c’est trop terrible… Il vaudrait mieux se coucher.
– Non !… allons toujours, disait-il ; les Prussiens ne font pas de prisonniers. Regarde… ils massacrent tout sans miséricorde, comme nous à Ligny.
Nous suivions toujours la direction de la route avec des milliers d’autres, mornes, abattus, et qui se retournaient tout de même en masse, et se resserraient pour faire feu quand un escadron prussien approchait de trop près. Nous étions encore les plus fermes, les plus solides. De loin en loin, on trouvait des affûts, des canons, des caissons abandonnés ; les fossés à droite et à gauche étaient remplis de sacs, de gibernes, de fusils, de sabres : – on avait tout jeté pour aller plus vite !
Mais ce qu’il y avait de plus terrible, c’étaient les grandes voitures de l’ambulance, arrêtées au milieu de la chaussée et remplies de blessés. – Les conducteurs avaient coupé les traits ; ils s’étaient sauvés avec leurs chevaux, dans la crainte d’être pris. – Ces malheureux, à demi morts, les bras pendants, qui nous regardaient passer d’un air désespéré, quand j’y pense aujourd’hui, me produisent l’effet de ces touffes de paille et de foin qui restent accrochés aux broussailles après l’inondation ; on dit : « Voilà la récolte… voilà nos moissons… voilà ce que nous laisse l’orage ! » Ah ! j’en ai fait des réflexions pareilles depuis cinquante ans !
Ce qui me désolait au milieu de cette déroute, ce qui me déchirait le cœur, c’était de ne plus voir un homme du bataillon, excepté nous. Je me disais : « Ils ne peuvent pourtant pas être tous morts ! » et je m’écriais :
– Jean, si je retrouvais Zébédé, cela me rendrait courage !
Mais lui ne me répondait pas et disait :
– Tâchons seulement de nous sauver, Joseph ! Moi, si j’ai le bonheur de revoir le Harberg, je ne me plaindrai plus de manger des pommes de terre… Non… non… c’est Dieu qui m’a puni… Je serai bien content de travailler et d’aller au bois, la hache sur l’épaule. Pourvu que je ne revienne pas estropié chez nous, et que je ne sois pas forcé de tendre la main au bord d’une grande route pour vivre, comme tant d’autres ! Tâchons de nous échapper sains et saufs.
Je trouvais qu’il était rempli de bon sens.
Vers dix heures et demie, nous approchions de Genappe ; des cris terribles s’entendaient de loin. Comme on avait allumé des feux de paille au milieu de la grande rue pour éclairer le tumulte, nous voyions là-bas les maisons et les rues tellement pleines de monde, de chevaux et de bagages, qu’on ne pouvait faire un pas en avant. Nous comprîmes tout de suite que les Prussiens allaient venir d’une minute à l’autre, qu’ils auraient des canons, et qu’il valait mieux, pour nous, passer autour du village que d’être faits prisonniers en masse. C’est pourquoi nous prîmes à gauche, à travers les blés, avec un grand nombre d’autres. Nous passâmes le Thy, dans l’eau jusqu’à la ceinture, et nous arrivâmes vers minuit aux deux maisons des Quatre-Bras.
Nous avions bien fait de ne pas entrer à Genappe, car nous entendions déjà les coups de canon des Prussiens contre le village, et la fusillade. Il arrivait aussi beaucoup de fuyards sur la route : des cuirassiers, des lanciers, des chasseurs… Aucun ne s’arrêtait !
La faim nous tourmentait d’une façon horrible. Nous pensions bien que dans ces maisons tout avait été mangé depuis longtemps ; malgré cela, nous entrâmes dans celle de gauche. Le plancher était couvert de paille, où se trouvaient étendus des blessés. À peine avions-nous ouvert la porte, que tous se mirent à crier… et, pour dire la vérité, l’odeur était tellement mauvaise, que nous ressortîmes tout de suite, en reprenant le chemin de Charleroi.
La lune était magnifique. Nous découvrions à droite, dans les blés, une quantité de morts qu’on n’avait pas enterrés. Buche descendit dans un sillon, où l’on voyait trois ou quatre Anglais étendus à vingt-cinq pas plus loin, les uns sur les autres. Je me demandais ce qu’il allait faire au milieu de ces morts, lorsqu’il revint avec une gourde de fer-blanc, – qu’il secouait auprès de son oreille, – et qu’il me dit :
– Joseph… elle est pleine !
Mais, avant de la déboucher, il la trempa dans le fossé rempli d’eau, ensuite il l’ouvrit, et but en disant :
– C’est de l’eau-de-vie !
Il me la passa et je bus aussi. Je sentais la vie qui me revenait, et je lui rendis cette gourde à moitié pleine, en bénissant le Seigneur de la bonne idée qu’il nous avait donnée.
Nous regardions de tous les côtés pour voir si les morts n’auraient pas aussi du pain. Mais comme le tumulte augmentait, et que nous n’étions pas en nombre pour résister aux attaques des Prussiens s’ils nous entouraient, nous repartîmes pleins de force et de courage. Cette eau-de-vie nous faisait déjà tout voir en beau ; je disais :
– Jean, maintenant le plus terrible est passé ; nous reverrons encore une fois Phalsbourg et le Harberg. Nous sommes sur une bonne route qui nous conduit en France. Si nous avions gagné, nous aurions été forcés d’aller plus loin, jusqu’au fond de l’Allemagne. Il aurait fallu battre les Autrichiens et les Russes ; et si nous avions eu le bonheur d’en réchapper, nous serions revenus vétérans, avec des cheveux gris, pour tenir garnison à la Petite-Pierre ou bien ailleurs.
Voilà les mauvaises idées qui me passaient par la tête ; mais cela ne m’empêchait pas de marcher avec plus de courage, et Buche disait :
– Les Anglais ont bien raison d’emporter des gourdes de fer-blanc ; si je n’avais pas vu le fer-blanc reluire à la lune, l’idée ne me serait jamais venue d’aller voir.
Pendant que nous parlions ainsi, à chaque instant des cavaliers passaient près de nous ; leurs chevaux ne se tenaient presque plus, mais à force de taper dessus et de leur donner des coups d’éperon, ils les faisaient trotter tout de même. Le bruit de la débâcle au loin recommençait avec des coups de feu ; heureusement nous avions de l’avance.
Il pouvait être une heure du matin, nous nous croyions sauvés, quand tout à coup Buche me dit :
– Joseph… voici des Prussiens !…
Et, regardant derrière nous, je vis au clair de la lune cinq hussards bruns, du même régiment que ceux qui l’année d’avant avaient haché Klipfel ; cela me parut un mauvais signe.
– Est-ce que ton fusil est chargé ? dis-je à Buche.
– Oui.
– Eh bien ! attendons… Il faut nous défendre… moi je ne me rends pas.
– Ni moi non plus, dit-il, j’aime encore mieux mourir que de m’en aller prisonnier.
En même temps l’officier prussien nous criait d’un ton arrogant :
– Mettez bas les armes !
Et Buche, au lieu d’attendre comme moi, lui lâchait son coup de fusil dans la poitrine.
Alors les quatre autres tombèrent sur nous. Buche reçut un coup de sabre qui lui fendit le shako jusqu’à la visière, mais d’un coup de baïonnette il tua celui qui l’avait blessé. Il en restait encore trois. J’avais mon fusil chargé. Buche s’était mis le dos contre un noyer ; chaque fois que les Prussiens, qui s’étaient reculés, voulaient s’approcher, je les mettais en joue : – aucun d’eux ne voulait être tué le premier ! Et comme nous attendions, Buche, la baïonnette croisée, moi la crosse à l’épaule, nous entendîmes galoper sur la route ; cela nous fit peur, car nous pensions que c’étaient encore des Prussiens, mais c’étaient de nos lanciers. – Les hussards alors descendirent dans les blés, à droite, pendant que Buche se dépêchait de recharger son fusil.
Nos lanciers passèrent et nous les suivîmes en courant. Un officier qui se trouvait avec eux nous dit que l’Empereur était parti pour Paris, et que le roi Jérôme venait de prendre le commandement de l’armée.
Buche avait toute la peau de la tête fendue, mais l’os était en bon état ; le sang lui coulait sur les joues. Il se banda la tête avec son mouchoir, et, depuis cet endroit, nous ne rencontrâmes plus de Prussiens.
Seulement, vers deux heures du matin, comme nous étions tellement las que nous ne pouvions presque plus marcher, nous vîmes à cinq ou six cents pas, sur la gauche de la route, un petit bois de hêtres, et Buche me dit :
– Tiens, Joseph, entrons là… Couchons-nous et dormons.
Je ne demandais pas mieux.
Nous descendîmes, en traversant les avoines jusqu’au bois, et nous entrâmes dans un fourré touffu, rien que de petits arbres serrés. Nous avions conservé tous les deux notre fusil, notre sac et notre giberne. Nous mîmes le sac à terre pour nous étendre l’oreille dessus ; et le jour était venu depuis longtemps, toute la grande débâcle défilait sur la route depuis des heures, lorsque nous nous éveillâmes et que nous reprîmes tranquillement notre chemin.
XXII
Un grand nombre de camarades et de blessés restèrent à Gosselies, mais la masse poursuivit sa route, et vers neuf heures on commençait à découvrir tout au loin les clochers de Charleroi, quand tout à coup des cris, des plaintes et des coups de feu s’entendirent en avant de nous à plus d’une demi-lieue. Toute l’immense colonne de misérables fit halte en criant :
– La ville ferme ses portes ! nous sommes arrêtés ici…
La désolation et le désespoir se peignaient sur toutes les figures. Mais un instant après, le bruit courut que des convois de vivres approchaient et qu’on ne voulait pas faire les distributions. Alors la fureur remplaça l’épouvante, et tout le long de la route on entendait qu’un cri :
– Tombons dessus ! Assommons les gueux qui nous affament !… Nous sommes trahis !
Les plus craintifs, les plus abattus se mirent à presser le pas en levant le sabre, ou en chargeant leur fusil.
On voyait d’avance que ce serait une véritable boucherie, si les conducteurs et l’escorte ne se rendaient pas. – Buche lui-même criait :
– Il faut tout massacrer… nous sommes trahis !… Arrive, Joseph !… vengeons-nous !…
Mais, je le retenais par le collet en lui criant :
– Non, Jean, non ! nous avons déjà bien assez de massacres… Nous sommes réchappés de tout ; ce n’est pas ici qu’il faut nous faire tuer par des Français. Arrive !…
Il se débattait. Pourtant, à la fin, comme je lui montrais un village à gauche de la route, en lui disant :
– Tiens ! voilà le chemin du Harberg, voilà des maisons comme aux Quatre-Vents ! Allons plutôt là, demander du pain. J’ai de l’argent, nous en aurons pour sûr. Arrive ! Cela vaudra mieux que d’attaquer les convois comme une bande de loups.
Il finit par se laisser entraîner. Nous traversâmes encore une fois les récoltes. Sans la faim qui nous pressait, nous nous serions assis au bord du sentier à chaque pas. Mais au bout d’une demi-heure nous arrivâmes, grâce à Dieu, devant une espèce de ferme abandonnée, les fenêtres cassées, la porte ouverte au large, et de gros tas de terre noire autour. Nous entrâmes en criant :
– Est-ce qu’il n’y a personne ?
Nous tapions contre les meubles avec nos crosses, pas une âme ne répondait. Notre fureur s’augmentait d’autant plus, que nous voyions quelques misérables venir par le même chemin que nous, et que nous pensions :
« Ils viennent manger notre pain ! »
Ah ! ceux qui n’ont pas souffert des privations pareilles ne connaissent pas la fureur des hommes. C’est horrible !… horrible !… Nous avions déjà cassé la porte d’une armoire pleine de linge, et nous bouleversions tout avec nos baïonnettes, quand une vieille femme sortit de dessous une table de cuisine, qui couvrait l’entrée de la cave ; elle sanglotait et disait :
– Mon Dieu ! mon Dieu ! ayez pitié de nous ! Cette maison avait été pillée au petit jour. On avait emmené les chevaux ; l’homme avait disparu, les domestiques s’étaient sauvés. Malgré notre fureur, la vue de la pauvre vieille nous fit honte de nous-mêmes, et je lui dis :
– N’ayez pas peur… nous ne sommes pas des monstres. Seulement donnez-nous du pain, ou nous allons périr.
Elle, assise sur une vieille chaise, ses mains sèches croisées sur les genoux, disait :
– Je n’ai plus rien… Ils ont tout pris, mon Dieu !… tout… tout.
Ses cheveux gris lui pendaient sur les joues. J’aurais voulu pleurer pour elle et pour nous.
– Ah ! nous allons chercher nous-mêmes, dis-je à Buche.
Et nous passâmes dans toutes les chambres, nous entrâmes dans l’écurie. Nous ne voyions rien, tout avait été pillé, cassé.
J’allais ressortir, quand, derrière la vieille porte, dans l’ombre, je vis un placard blanchâtre contre le mur. Je m’arrêtai, j’étendis la main ; c’était un sac de toile avec une bretelle, que je décrochai bien vite en tremblant.
Buche me regardait… Le sac était lourd… je l’ouvris… il y avait deux grosses raves noires, une demi-miche de pain sec et dur comme de la pierre, une grosse paire de ciseaux pour tailler les haies, et tout au fond, quelques oignons et du sel gris dans un papier.
En voyant cela, nous poussâmes un cri ; la peur de voir arriver les autres nous fit courir derrière, bien loin dans les seigles, en nous cachant et nous courbant comme des voleurs. Nous avions repris toutes nos forces, et nous nous assîmes au bord d’un petit ruisseau. Buche me disait :
– Écoute, j’ai ma part !
– Oui… la moitié de tout, lui dis-je ; tu m’as aussi laissé boire à ta gourde… Je veux partager.
Alors il se calma.
Je coupai le pain avec mon sabre, disant :
– Choisis, Jean, voici ta rave… voici la moitié des oignons, et le sel dans le sac entre nous.
Nous mangeâmes le pain sans le tremper dans l’eau, nous mangeâmes notre rave, les oignons et le sel. Nous aurions voulu continuer de manger toujours ; pourtant nous étions rassasiés ! Nous nous agenouillâmes au bord du ruisseau les mains dans l’eau, et nous bûmes.
– Maintenant, allons-nous-en, dit Buche, et laissons le sac !
Malgré la fatigue qui nous cassait les jambes, nous repartîmes à gauche, pendant que sur la droite, derrière nous du côté de Charleroi, les cris, les coups de fusil redoublaient, et que tout le long de la route on ne voyait que des gens se battre. Mais c’était déjà loin. Nous tournions la tête de temps en temps, et Buche me disait :
– Joseph, tu as bien fait de m’entraîner… Sans toi, je serais peut-être étendu là-bas, au bord de cette route, assommé par un Français. J’avais trop faim. Mais où nous sauver, à cette heure ?
Je lui répondais :
– Suis-moi !
Nous traversâmes bientôt un grand et beau village, aussi pillé et abandonné. Plus loin, nous rencontrâmes des paysans, qui nous regardaient d’un air de défiance, en se rangeant au bord du chemin. Nous devions avoir de mauvaises mines, surtout Buche avec sa tête bandée et sa barbe de huit jours, épaisse et dure comme les soies d’un sanglier.
Vers une heure de l’après-midi, nous avions déjà repassé la Sambre sur le pont du Châtelet ; mais comme les Prussiens étaient en route, nous ne fîmes pas encore halte dans cet endroit. J’avais pourtant déjà bonne confiance, je pensais :
« Si les Prussiens continuent leur poursuite, ils suivront certainement la grande masse, pour faire plus de prisonniers, et recueillir des canons, des caissons et des bagages. »
Voilà comment étaient forcés de raisonner des hommes qui trois jours auparavant faisaient trembler le monde !
Je me souviens qu’en arrivant, sur les trois heures, dans un petit village, nous nous arrêtâmes devant une forge pour demander à boire. Aussitôt les gens du pays nous entourèrent, et le forgeron, un homme grand et brun, nous dit d’entrer dans l’auberge en face, qu’il allait venir, et que nous prendrions une cruche de bière avec lui.
Naturellement cela nous fit plaisir, car nous avions peur d’être arrêtés, et nous voyions que ces gens étaient pour nous.
L’idée me vint aussi qu’il me restait de l’argent dans mon sac, et que j’allais pouvoir m’en servir.
Nous entrâmes donc dans cette auberge, qui n’était qu’un bouchon, les deux petites fenêtres sur la rue, et la porte ronde s’ouvrant à deux battants, comme dans les villages de chez nous. Quand nous fûmes assis, la salle se remplit tellement de monde, hommes et femmes, pour avoir des nouvelles, que nous pouvions à peine respirer.
Le forgeron vint. Il avait ôté son tablier de cuir, et mis une petite blouse bleue ; et tout de suite, lorsqu’il entra, nous reconnûmes que cinq ou six autres honnêtes bourgeois le suivaient : c’était le maire, l’adjoint et les conseillers municipaux de cet endroit.
Ils s’assirent sur les bancs en face de nous, et nous firent servir de la bière aigre, comme on l’aime en ce pays. Buche ayant demandé du pain, la femme de l’aubergiste nous apporta la miche et un gros morceau de bœuf dans une écuelle. Tous nous disaient :
– Mangez ! mangez.
Quand l’un ou l’autre nous adressait des questions sur la bataille, le maire ou le forgeron s’écriait :
– Laissez donc ces hommes finir… vous voyez bien qu’ils arrivent de loin.
Et seulement à la fin ils nous interrogèrent, nous demandant s’il était vrai que les Français venaient de perdre une grande bataille. On leur avait rapporté d’abord que nous étions vainqueurs, et maintenant un bruit se répandait que nous étions en déroute.
Nous comprîmes bien qu’ils avaient entendu parler de Ligny, et que cela leur troublait les idées.
J’étais honteux de leur avouer notre débâcle ; je regardais Buche, qui dit :
– Nous avons été trahis !… Les traîtres ont livré nos plans… L’armée était pleine de traîtres chargés de crier : « Sauve qui peut ! » Comment voulez-vous que par ce moyen nous n’ayons pas perdu ?
C’était la première fois que j’entendais parler de cette trahison ; quelques blessés criaient bien : « Nous sommes trahis ! » mais je n’avais pas fait attention à leurs paroles ; et quand Buche nous tira d’embarras par ce moyen j’en fus content et même étonné.
Ces gens alors s’indignèrent avec nous contre les traîtres. Il fallut leur expliquer la bataille et la trahison. Buche disait que les Prussiens étaient arrivés par la trahison du maréchal Grouchy. Cela me paraissait tout de même trop fort ; mais les paysans, remplis d’attendrissement, nous ayant encore fait boire de la bière et même donné du tabac et des pipes, je finis par dire comme Buche. Ce n’est que plus tard, après être partis de là, que l’idée de nos mensonges abominables me fit honte à moi-même, et que je m’écriai :
– Sais-tu bien, Jean, que nos mensonges sur les traîtres ne sont pas beaux ? Si chacun en raconte autant, finalement, nous serons tous des traîtres, et l’Empereur seul sera un honnête homme. C’est honteux pour notre pays, de dire que nous avons tant de traîtres parmi nous… Ce n’est pas vrai !
– Bah ! bah !… disait-il, nous avons été trahis ; sans cela, jamais des Anglais et des Prussiens ne nous auraient forcés de battre en retraite.
Et jusqu’à huit heures du soir nous ne fîmes que nous disputer. Nous arrivâmes alors dans un autre village appelé Bouvigny. Nous étions tellement fatigués que nos jambes étaient roides comme des piquets, et que depuis longtemps il nous fallait un grand courage pour faire un pas.
Nous croyions être bien loin des Prussiens. Comme j’avais de l’argent, nous entrâmes dans une auberge en demandant à coucher.
Je sortis une pièce de six livres, pour montrer que nous pouvions payer. J’avais résolu de changer d’habits le lendemain, de planter là mon fusil, mon sac, ma giberne, et de retourner chez nous ; car je croyais la guerre finie, et je me réjouissais, au milieu de tous ces grands malheurs, d’avoir retiré mes bras et mes jambes de l’affaire.
Buche et moi, ce soir-là, couchés dans une petite chambre, la sainte Vierge et l’enfant Jésus dans une niche au-dessus de nous, entre les rideaux, nous dormîmes comme des bienheureux.
Le lendemain, au lieu de continuer notre route, nous étions si contents de rester assis sur une bonne chaise dans la cuisine, d’allonger nos jambes et de fumer notre pipe, en regardant bouillir la marmite, que nous dîmes :
– Restons ici tranquillement ! Demain nous serons bien reposés ; nous achèterons deux pantalons de toile, deux blouses, nous couperons deux bons bâtons dans une haie, et nous retournerons par petites étapes à la maison.
Cela nous attendrissait de penser à ces choses agréables.
C’est aussi de cette auberge que j’écrivis à Catherine, à la tante Grédel et à M. Goulden. Je ne leur dis qu’un mot :
« Je suis sauvé… Remercions Dieu !… J’arrive… Je vous embrasse de tout mon cœur mille et mille fois !
» Joseph Bertha. »
En écrivant, je louais le Seigneur ; mais bien des choses devaient encore m’arriver avant de monter notre escalier, au coin de Fouquet en face du Bœuf-Rouge. Quand on est pris par la conscription, il ne faut pas se presser d’écrire qu’on est relâché. Ce bonheur ne dépend pas de nous, et la bonne volonté de s’en aller ne sert de rien.
Enfin ma lettre partit par la poste, et de toute cette journée nous restâmes à l’auberge du Mouton-d’Or.
Après avoir bien soupé, nous montâmes dormir. Je disais à Buche :
– Hé ! Jean ! c’est autre chose de faire ce qu’on veut, ou d’être forcé de répondre à l’appel.
Nous riions tous les deux, malgré les malheurs de la patrie, – sans y penser, bien entendu, car nous aurions été de véritables gueux.
Enfin, pour la seconde fois, nous étions couchés dans notre lit, lorsque, vers une heure du matin, nous fûmes éveillés d’une façon extraordinaire : – le tambour battait… on entendait marcher dans tout le village. – Je poussai Buche, qui me dit :
– J’entends bien… Les Prussiens sont dehors !
On peut se figurer notre épouvante. Mais au bout d’un instant, ce fut bien pire, car on frappait à la porte de l’auberge, qui s’ouvrit, et deux secondes après la grande salle était pleine de monde. On montait l’escalier. Buche et moi nous nous étions levés ; il disait :
– Je me défends, si l’on veut me prendre !
Moi je n’osais pas songer à ce que j’allais faire.
Nous étions déjà presque habillés, et j’espérais pouvoir me sauver pendant la nuit, avant d’être reconnu, quand des coups retentirent à notre porte ; on criait :
– Ouvrez !
Il fallut bien ouvrir.
Un officier d’infanterie, trempé par la pluie, son gros manteau bleu collé sur les épaulettes, et suivi d’un vieux sergent qui tenait une lanterne, entra. Nous reconnûmes que c’étaient des Français. L’officier nous dit brusquement :
– D’où venez-vous ?
– Du Mont-Saint-Jean, mon lieutenant, lui répondis-je.
– De quel régiment êtes-vous ?
– Du 6e léger.
Il regarda le numéro de mon shako sur la table, et je vis en même temps le sien : c’était aussi du 6e léger. De quel bataillon ? fit-il en fronçant le sourcil.
– Du 3 ».
Buche, tout pâle, ne disait rien. L’officier regardait nos fusils, nos sacs, nos gibernes, derrière le lit, dans un coin.
– Vous avez déserté ! fit-il.
– Non, mon lieutenant, nous sommes partis les derniers, sur les huit heures, du Mont-Saint-Jean…
– Descendez, nous allons voir cela. Nous descendîmes.
L’officier nous suivait, le sergent marchait devant avec la lanterne.
La grande salle en bas était pleine d’officiers du 12e chasseurs à cheval et du 6e léger. Le commandant du 4e bataillon du 6e se promenait de long en large, en fumant une petite pipe de bois. Tous ces gens étaient trempés et couverts de boue.
L’officier dit quatre mots au commandant qui s’arrêta, ses yeux noirs fixés sur nous, et son nez crochu recourbé dans ses moustaches grises. Il n’avait pas l’air tendre, et nous posa de suite cinq ou six questions sur notre départ de Ligny sur la route des Quatre-Bras et la bataille ; il clignait des yeux en serrant les lèvres. Les autres allaient et venaient, tramant leurs sabres sans écouter. Finalement le commandant dit :
– Sergent… ces deux hommes entrent dans la 2e compagnie. Allez !
Il reprit sa pipe au bord de la cheminée, et nous sortîmes avec le sergent, bien heureux d’en être quittes à si bon marché, car on aurait pu nous fusiller comme déserteurs devant l’ennemi. Le sergent nous conduisit à deux cents pas, au bout du village, près d’un hangar.
On avait allumé des feux plus loin dans les champs ; des hommes dormaient sous le hangar, contre les portes d’écurie et les piliers. Il tombait une petite pluie fine dans la rue ; toutes les flaques d’eau tremblotaient à la lune grise et brouillée. Nous restâmes debout sous un pan de toit, au coin de la vieille maison, songeant à nos misères.
Au bout d’une heure, le tambour se mit à rouler sourdement, les hommes secouèrent la paille et le foin de leurs habits, et nous repartîmes. Il faisait encore nuit sombre ; derrière nous, les chasseurs sonnaient le boute-selle.
Entre trois et quatre heures, au petit jour, nous vîmes un grand nombre d’autres régiments, cavalerie, infanterie et artillerie, en marche comme nous, par différents chemins : – tout le corps du maréchal Grouchy en retraite ! Le temps mouillé, le ciel sombre, ces longues files d’hommes accablés de lassitude, le chagrin d’être repris et de penser que tant d’efforts, tant de sang répandu n’aboutissaient pour la seconde fois qu’à l’invasion, tout cela nous faisait pencher la tête. On n’entendait que le bruit des pas dans la boue.
Cette tristesse durait depuis longtemps, lorsqu’une voix me dit :
– Bonjour, Joseph !
Je m’éveillai, regardant celui qui me parlait, et je reconnus le fils du tourneur Martin, notre voisin de Phalsbourg ; il était caporal au 6e, et marchait en serre-file, l’arme à volonté. Nous nous serrâmes la main. Ce fut une véritable consolation pour moi de voir quelqu’un du pays.
Malgré la pluie qui tombait toujours, et la grande fatigue, nous ne fîmes que parler de cette terrible campagne. – Je lui racontai la bataille de Waterloo ; lui me dit que le 4e bataillon, à partir de Fleurus, avait fait route sur Wavre avec tout le corps d’armée de Grouchy ; que, dans l’après-midi du lendemain 18, on entendait le canon sur la gauche, et que tout le monde voulait marcher dans cette direction ; que c’était aussi l’avis des généraux, mais que le maréchal, ayant reçu des ordres positifs, avait continué sa route sur Wavre. Ce n’est qu’entre six et sept heures, et quand il fut clair que les Prussiens s’étaient échappés, qu’on avait changé de direction à gauche, pour aller rejoindre l’Empereur ; malheureusement il était trop tard, et vers minuit il avait fallu prendre position dans les champs. Chaque bataillon avait formé le carré. À trois heures du matin, le canon des Prussiens avait réveillé les bivouacs, et l’on s’était tiraillé jusqu’à deux heures de l’après-midi, moment où l’ordre était venu de se mettre en retraite. C’était encore une fois bien tard, disait Martin, car une partie de l’armée qui venait de battre celle de l’Empereur, se trouvait déjà sur nos derrières, et cela nous força de marcher tout le restant du jour et la nuit suivante jusqu’à six heures du matin, pour nous en dégager. – À six heures, le bataillon avait pris position près du village de Temploux ; à dix, les Prussiens arrivaient en forces supérieures, on leur avait opposé la plus vigoureuse résistance, pour donner le temps à l’artillerie et aux bagages de passer le pont à Namur. Tout le corps d’armée avait heureusement défilé par la ville, excepté le 4e bataillon, par la faute du commandant Delong, qui s’était laissé tourner à droite de la route, et qui dut se jeter dans la Sambre pour n’être pas coupé. Plusieurs hommes avaient été faits prisonniers, d’autres s’étaient noyés en essayant de passer la rivière à la nage. – C’est tout ce que me raconta Martin ; il n’avait aucune nouvelle de chez nous.
Ce même jour, nous passâmes par Givet ; le bataillon bivouaqua près du village de Hierches, une demi-lieue plus loin. Le lendemain, après avoir passé par Fumay et Rocroy, nous couchâmes à Bourg-Fidèle, le 23 juin à Blombay, le 24 à Saulse-Lenoy, – où l’on apprit l’abdication de l’Empereur, – et les jours suivants à Vitry, près de Reims, à Jonchery, à Soissons ; de là le bataillon prit la route de Villers-Cotterets ; mais l’ennemi nous ayant déjà devancés, nous changeâmes de direction par La Ferté-Milon, et nous allâmes bivouaquer à Neuchelles, village ruiné par l’invasion de 1814, et qui n’avait pas encore été rebâti.
Nous partîmes de cet endroit le 29, vers une heure du matin, et nous passâmes par Meaux. Il fallut prendre la route de Lagny, parce que les Prussiens occupaient celle de Claye ; nous poursuivîmes notre route tout le jour et la nuit suivante.
Le 30, à cinq heures du matin, nous étions au pont de Saint-Maur. Le même jour, à trois heures du soir, nous avions passé hors de Paris, et nous bivouaquions près d’un endroit riche en toutes choses, appelé Vaugirard, sur la route de Versailles. Le 1er juillet, nous étions allés bivouaquer près d’un endroit superbe appelé Meudon. On voyait, aux jardins, aux vergers entourés de murs, à la grandeur extraordinaire des maisons, à leur bon entretien, que c’étaient les environs de la plus belle ville du monde, et pourtant nous vivions au milieu de la misère et des dangers ; le cœur nous en saignait ! Les gens sont bons, ils aiment les soldats ; on nous appelait défenseurs de la patrie, et les plus pauvres voulaient se battre avec nous.
Le 1er juillet, nous quittâmes la position à onze heures du soir, pour aller à Saint-Cloud, qui n’est que palais sur palais, jardins sur jardins, grands arbres, allées magnifiques ; tout ce qu’on peut se figurer d’admirable. À six heures, nous partîmes de Saint-Cloud, pour revenir prendre position à Vaugirard. Des rumeurs terribles couraient dans la ville… L’Empereur était parti pour Rochefort… On disait :
– Le roi de Rome va revenir… Louis XVIII est en route…
On ne savait rien dans cette ville, où l’on devrait tout savoir d’abord.
À Vaugirard, l’ennemi vint nous attaquer vers une heure de l’après-midi, dans les environs du village d’Issy. Nous nous battîmes jusqu’à minuit pour notre capitale.
Le peuple nous aidait, il venait relever nos blessés sous le feu des Prussiens ; les femmes avaient pitié de nous.
Notre souffrance d’avoir été menés jusque-là par la force ne peut pas se dire… J’ai vu Buche lui-même pleurer, parce que nous étions en quelque sorte déshonorés. – J’aurais bien voulu ne pas voir cela ! – Douze jours auparavant, je ne me figurais pas si bien la France. En voyant Paris avec ses clochers et ses palais innombrables, qui s’étendent aussi loin que va le ciel, je pensais :
« C’est la France !… Voilà ce que depuis des centaines et des centaines d’années nos anciens ont amassé. Quel malheur de dire que les Anglais et que les Prussiens arrivent jusqu’ici. »
À quatre heures du matin, nous attaquâmes les Prussiens avec une nouvelle fureur, et nous leur reprîmes les positions perdues la veille. – C’est alors que des généraux vinrent nous annoncer une suspension d’armes. – Ces choses se passaient le 3 juillet 1815. Nous pensions que cette suspension d’armes était pour prévenir l’ennemi que, s’il ne se retirait pas, la France se lèverait comme en 92 et qu’elle l’écraserait ! Nous avions des idées pareilles ; et moi, voyant ce peuple qui nous soutenait, je me rappelais les levées en masse dont le père Goulden me parlait toujours.
Malheureusement un grand nombre étaient si las de Napoléon et des soldats, qu’ils sacrifiaient la patrie elle-même pour en être débarrassés ; ils mettaient tout sur le dos de l’Empereur, et disaient que sans lui les autres n’auraient jamais eu ni la force ni le courage de venir, qu’il nous avait épuisés, et que les Prussiens eux-mêmes nous donneraient plus de liberté.
Le peuple parlait comme M. Goulden, mais il n’avait pas d’armes ni de cartouches ; on avait fait des piques pour lui !…
Et comme on rêvait à ces choses, le 4 on nous annonça l’armistice, par lequel les Prussiens et les Anglais devaient occuper les barrières de Paris, et l’armée française se retirer derrière la Loire.
Alors l’indignation de tous les honnêtes gens fut si grande, que la colère nous rendit furieux ; les uns cassaient leurs fusils, les autres déchiraient leurs uniformes, et tout le monde criait :
– Nous sommes trahis… nous sommes livrés… Les vieux officiers, pâles comme des morts, restaient là… Les larmes leur coulaient sur les joues. Personne ne pouvait nous apaiser. Nous étions tombés au-dessous de rien : – nous étions un peuple conquis !
Dans deux mille ans, on dira que Paris a été pris par les Prussiens et les Anglais… c’est une honte éternelle, mais cette honte ne repose pas sur nous.
Le bataillon partit de Vaugirard à cinq heures du soir, le 5 juillet, pour aller bivouaquer à Montrouge. Comme on voyait que le mouvement du côté de la Loire commençait, chacun se dit :
« Qu’est-ce que nous sommes donc ? Est-ce que nous obéissons aux Prussiens ? Parce que les Prussiens veulent nous voir sur l’autre rive de la Loire, nous sommes forcés d’obéir ? Non ! non ! cela ne peut pas aller. Puisqu’on nous trahit, eh bien ! partons. Tout cela ne nous regarde plus. Nous avons fait notre devoir… Nous ne voulons pas obéir à Blücher ! »
Et ce même soir la désertion commença. Tous les soldats partaient, les uns à droite, les autres à gauche. Des hommes en blouse et de pauvres vieilles femmes voulaient nous emmener dans leurs rues innombrables, et tâcher de nous consoler : mais nous n’avions pas besoin de consolations. – Je dis à Buche :
– Laissons tout cela… retournons à Phalsbourg… au Harberg… reprenons notre état, vivons comme d’honnêtes gens. Si les Prussiens, les Autrichiens ou les Russes arrivent là-bas, les montagnards et ceux de la ville sauront bien se défendre. Nous n’aurons pas besoin de grandes batailles pour en exterminer des mille et des mille. En route !
Nous étions une quinzaine de Lorrains au bataillon ; nous partîmes ensemble de Montrouge, où se trouvait le quartier général, et nous passâmes par Ivry et Bercy, qui sont des endroits de toute beauté ; mais le chagrin nous empêchait de voir le quart de ce qu’il aurait fallu regarder. Les uns conservaient l’uniforme, d’autres n’avaient que la capote, d’autres avaient acheté une blouse.
Derrière Saint-Mandé, tout près d’un bois où l’on voit à gauche de hautes tours, et que l’on nous dit être Vincennes, nous trouvâmes enfin la route de Strasbourg. C’était le 6 au matin, et, depuis cet endroit, nous fîmes régulièrement nos douze lieues par jour.
Le 8 juillet, on savait déjà que Louis XVIII allait revenir, et que Mgr le comte d’Artois ferait son salut. Toutes les voitures, les pataches, les diligences portaient déjà le drapeau blanc ; dans tous les villages où nous passions, on chantait des Te Deum ; les maires, les adjoints, louaient et glorifiaient le Seigneur du retour de Louis le Bien-Aimé.
Des gueux en nous voyant passer, nous appelaient Bonapartistes ! Ils excitaient même les chiens contre nous… Mais j’aime mieux ne pas parler de cela ; les gens de cette espèce sont la honte du genre humain. Nous ne leur répondions que par un coup d’œil de mépris qui les rendait encore plus insolents et plus furieux. Plusieurs d’entre nous balançaient leur bâton comme pour dire :
« Si nous vous tenions dans un coin, vous seriez doux comme des moutons ! »
Mais les gendarmes soutenaient ces espèces de Pinacles ; dans trois ou quatre endroits, les cris de la mauvaise race nous firent arrêter. Les gendarmes arrivaient nous demander nos papiers ; on nous menait à la mairie, et les gueux nous forçaient de crier : Vive le roi !
C’était une véritable abomination ; les vieux soldats, plutôt que de crier, se laissaient conduire en prison. Buche voulut suivre leur exemple, mais je lui disais :
– Qu’est-ce que cela nous fait de crier : Vive Jean-Claude ou : Vive Jean-Nicolas ? Tous ces rois, ces empereurs, anciens ou nouveaux, ne donneraient pas un seul de leurs cheveux pour nous sauver la vie, et nous irions nous faire échiner pour crier d’une façon ou d’une autre ? Non, cela ne nous regarde pas. Puisque les gens sont si bêtes, et que nous ne sommes pas les plus forts, il faut les satisfaire. Plus tard, ils crieront autre chose, et plus tard encore autre chose… Tout change !… il n’y a que le bon sens et le bon cœur qui restent.
Buche ne voulait pas comprendre ces raisons, mais quand les gendarmes arrivaient, il obéissait tout de même.
À mesure que nous avancions, tantôt l’un, tantôt l’autre se détachait de la troupe et s’arrêtait dans son village ; de sorte qu’après Toul, Buche et moi, nous étions seuls.
C’est nous qui vîmes encore le plus triste spectacle : des Allemands et des Russes en foule, maîtres de la Lorraine et de l’Alsace. Ils faisaient l’exercice à Lunéville, à Blamont, à Sarrebourg, avec des branches de chêne, sur leurs mauvais shakos. – Quel chagrin de voir des sauvages pareils vivre et se goberger au compte de nos paysans !… Ah ! le père Goulden avait bien raison de dire que la gloire des armes coûte cher… Tout ce que je souhaite, c’est que le Seigneur nous en débarrasse pour les siècles des siècles.
Enfin le 16 juillet 1815, vers onze heures du matin, nous arrivâmes à Mittelbronn, le dernier village sur la côte avant Phalsbourg. Le blocus était levé depuis l’armistice, des Cosaques, des landwehrs et des kaiserlicks remplissaient le pays : ils avaient encore leurs batteries en position autour de la place, mais on ne tirait plus ; les portes de la ville étaient ouvertes, les gens sortaient pour faire leurs récoltes.
On avait grand besoin de rentrer les blés et les seigles, car on peut s’imaginer la misère, avec tant de milliers d’êtres inutiles à nourrir, et qui ne se refusaient rien, qui voulaient du schnaps et du lard tous les jours.
Devant toutes les portes, à toutes les fenêtres, on ne voyait que des nez camards, de ces longues barbes jaunes, crasseuses, de ces habits blancs remplis de vermine, et de ces shakos blancs, qui vous regardaient en fumant leur pipe dans la paresse et l’ivrognerie. Il fallait travailler pour eux, et finalement les honnêtes gens furent encore obligés de leur donner deux milliards pour les décider à partir.
Combien de choses on aurait à dire sur tous ces fainéants de la Russie et de l’Allemagne, si nous n’en avions pas fait dix fois plus dans leur pays !… Mais il vaut mieux que chacun réfléchisse pour son propre compte et s’imagine le reste.
Devant l’auberge de Heitz, je dis à Buche :
– Entrons… les jambes me manquent.
La mère Heitz, qui dans ce temps était encore une jeune femme, criait déjà, les mains en l’air :
– Ah ! mon Dieu !… c’est M. Joseph Bertha !… Dieu du ciel, quelle surprise en ville !…
Alors j’entrai, je m’assis, et je me penchai sur la table, pour pleurer à mon aise. La mère Heitz courait chercher une bouteille de vin à la cave ; j’entendais aussi Buche sangloter dans un coin. Nous ne pouvions parler ni l’un ni l’autre, en songeant à la joie de nos parents ; la vue du pays nous avait bouleversés, et nous étions contents de penser que nos os reposeraient un jour en paix dans le cimetière de notre village.
En attendant, nous allions toujours embrasser ceux que nous aimions le plus au monde.
Quand nous fûmes un peu remis, je dis à Buche :
– Tu vas partir en avant… je te suivrai de loin, pour que ma femme et M. Goulden n’aient pas trop de surprise. Tu commenceras par leur dire que tu m’as rencontré le lendemain de la bataille, sans blessures ; ensuite que tu m’as encore rencontré dans les environs de Paris… et même sur la route… et seulement à la fin tu diras : « Je crois qu’il n’est pas loin et qu’il va venir ! » Tu comprends ?
– Oui, je comprends, dit-il en se levant après avoir vidé son verre, et je ferai la même chose pour la grand-mère, qui m’aime plus que les autres garçons. J’enverrai quelqu’un d’avance.
Il sortit aussitôt et j’attendis quelques instants. La mère Heitz me parlait, mais je ne l’écoutais pas ; je songeais au chemin qu’avait déjà pu faire Buche, je le voyais près du guévoir, dans l’avancée, sous la porte… Tout à coup, je partis en criant :
– Mère Heitz ! je vous payerai plus tard.
Et je me mis à courir. Il me semble bien avoir rencontré trois ou quatre personnes qui disaient :
– Hé ! c’est Joseph Bertha !…
Mais je n’en suis pas sûr. D’un coup, sans savoir comment, je montai l’escalier de notre maison, et puis j’entendis un grand cri. – Catherine était dans mes bras !… J’avais en quelque sorte la tête bouleversée, et seulement un instant après, je sortis comme d’un rêve : je vis la chambre, M. Goulden, Jean Buche, Catherine, et je me mis tellement à sangloter, qu’on aurait cru qu’il venait de m’arriver le plus grand malheur. M. Goulden ne disait rien, ni Buche. Je tenais Catherine assise sur mes genoux, je l’embrassais ; elle pleurait aussi. Et bien longtemps après je m’écriai :
– Ah ! monsieur Goulden, pardonnez-moi ! J’aurais déjà voulu vous embrasser, vous, mon père, vous que j’aime autant que moi-même !
– C’est bon, Joseph, dit-il tout attendri, je le sais… Je ne suis pas jaloux.
Il s’essuyait les yeux.
– Oui… oui… l’amour… la famille… et puis les amis… C’est naturel, mon enfant… Ne te trouble pas.
Alors je me levai et j’allai le serrer sur mon cœur. Le premier mot que me dit Catherine, ce fut :
– Joseph, je savais que tu reviendrais, j’avais mis ma confiance en Dieu !… Maintenant nos plus grandes misères sont passées. Nous resterons toujours ensemble.
Je l’avais encore fait asseoir sur mes genoux, son bras sur mon épaule, je la regardais, elle baissait les yeux toute pâle : ce que nous espérions avant mon départ était arrivé. Nous étions bien heureux !
M. Goulden, près de l’établi, souriait ; Jean, debout, à côté de la porte, disait :
– Maintenant je pars, Joseph, je vais au Harberg, le père et la grand-mère m’attendent.
Il me tendait la main, et je la retenais, disant :
– Jean, reste… tu dîneras avec nous.
M. Goulden et Catherine l’engageaient aussi, mais il ne voulut pas attendre. En l’embrassant sur l’escalier, je sentis que je l’aimais comme un frère.
Il est revenu bien souvent depuis ; chaque fois qu’il arrivait en ville pendant trente ans, c’est chez moi qu’il descendait. Maintenant il repose derrière l’église de la Hommert ! C’était un brave homme, un homme de cœur… Mais à quoi vais-je penser !
Il faut pourtant que cette histoire finisse, et je n’ai rien dit encore de la tante Grédel, qui vint une heure après. Ah ! c’est elle qui levait les bras, c’est elle qui me serrait en criant :
– Joseph !… Joseph ! te voilà donc réchappé de tout ! Qu’on vienne te reprendre maintenant… qu’on vienne ! Ah ! comme je me suis repentie de t’avoir laissé partir… Comme j’ai maudit la conscription et le reste… Mais te voilà… c’est bon… c’est bon ! Le Seigneur a eu pitié de nous.
Oui, tout cela, toutes ces vieilles histoires, quand on y pense, vous font encore venir les larmes aux yeux ; c’est comme un rêve, un songe oublié depuis des années et des années, et pourtant c’est la vie. Ces joies et ces chagrins qu’on se rappelle sont encore la seule chose qui vous rattache à la terre et qui fait que, dans la grande vieillesse, lorsque les forces s’en vont, lorsque la vue baisse, et que l’on n’est plus que l’ombre de soi-même, on ne veut jamais partir, on ne dit jamais : « C’est assez ! »
Ces vieux souvenirs sont toujours vivants : quand on parle de ses anciens dangers, on croit encore y être ; de ses vieux amis, on croit encore leur serrer la main ; de celle qu’on aimait, on croit encore la tenir sur ses genoux, et penser en la regardant : « Elle est belle ! » Et ce qui vous semblait juste, honnête, sage autrefois, est encore honnête, juste et sage.
Je me souviens, – et ceci doit finir cette longue histoire, – qu’après mon retour, durant quelques mois et même des années, une grande tristesse régnait dans les familles, et qu’on n’osait plus se parler franchement, ni faire des vœux pour la gloire du pays. Zébédé lui-même, rentré parmi ceux qu’on avait licencié derrière la Loire, Zébédé lui-même avait perdu courage. Cela venait des vengeances, des jugements et des fusillades, des massacres et des revanches de toute sorte ; cela venait de notre humiliation : – des cent cinquante mille Allemands, Anglais et Russes qui tenaient garnison dans nos forteresses, des indemnités de guerre, du milliard des émigrés, des contributions forcées et principalement des lois contre les suspects, contre les sacrilèges, et pour les droits d’aînesse qu’on voulait rétablir.
Toutes ces choses, contraires au bon sens, contraires à l’honneur de la nation, – avec les dénonciations des Pinacles et les avanies qu’on faisait souffrir aux vieux révolutionnaires, – toutes ces choses avaient fini par vous rendre sombres. Aussi souvent, quand nous étions seuls avec Catherine et le petit Joseph, que Dieu nous avait envoyé pour nous consoler au milieu de ces grandes misères, M. Goulden, tout rêveur, me disait :
– Joseph, notre malheureux pays est bien bas ! Quand Napoléon a pris la France, elle était la plus grande, la plus libre, la plus puissante des nations ; tous les autres peuples nous admiraient et nous enviaient !… Aujourd’hui, nous sommes vaincus, ruinés, saignés à blanc ; l’ennemi remplit nos forteresses, il nous tient le pied sur la gorge… Ce qui ne s’était jamais vu depuis que la France existe, – l’étranger maître de notre capitale ! – nous l’avons vu deux fois en deux ans ! Voilà ce qu’il en coûte de mettre sa liberté, sa fortune, son honneur entre les mains d’un ambitieux !… Oui, nous sommes dans une bien triste position ; on croirait que notre grande Révolution est morte, et que les Droits de l’Homme sont anéantis !… Eh bien ! il ne faut pas se décourager, tout cela passera !… Ceux qui marchent contre la justice et la liberté seront chassés ; ceux qui veulent rétablir les privilèges et les titres seront regardés comme des fous. La grande nation se repose, elle réfléchit sur ses fautes, elle observe ceux qui veulent la conduire contre ses intérêts, elle lit dans le fond de leur âme ; et malgré les Suisses, malgré la garde royale, malgré la Sainte-Alliance, quand elle sera lasse de sa misère, elle mettra ces gens dehors du jour au lendemain. Et ce sera fini, car la France veut la liberté, l’égalité et la justice ! – La seule chose qui nous manque, c’est l’instruction ; mais le peuple s’instruit tous les jours, il profite de notre expérience et de nos malheurs. Je n’aurai peut-être pas le bonheur de voir le réveil de la patrie, je suis trop vieux pour l’espérer ; mais toi, tu le verras, et ce spectacle te consolera de tout ; tu seras fier d’appartenir à cette nation généreuse, qui marche bien loin en avant des autres depuis 89 ; ses instants de halte ne sont que de petits repos pendant un long voyage.
Cet homme de bien, jusqu’à sa dernière heure, conserva son calme et sa confiance.
Et j’ai vu l’accomplissement de ses paroles ; j’ai vu le retour du drapeau de la liberté, j’ai vu la nation croître en richesse, en bonheur, en instruction ; j’ai vu ceux qui voulaient arrêter la justice et rétablir l’ancien régime, forcés de partir ; et je vois que l’esprit marche toujours, que les paysans donneraient jusqu’à leur dernière chemise pour avancer leurs enfants.
Malheureusement, nous n’avons pas assez de maîtres d’école. Ah ! si nous avions moins de soldats et plus de maîtres d’école, tout irait beaucoup plus vite. Mais, patience, cela viendra. Le peuple commence à comprendre ses droits ; il sait que les guerres ne lui rapportent que des augmentations de contributions, et quand il dira : « Au lieu d’envoyer mes fils périr par milliers sous le sabre et le canon, je veux qu’on les instruise et qu’on en fasse des hommes ! » qui est-ce qui oserait vouloir le contraire, puisque aujourd’hui le peuple est le maître ? Dans cet espoir, je vous dis adieu, mes amis, et je vous embrasse de tout mon cœur.