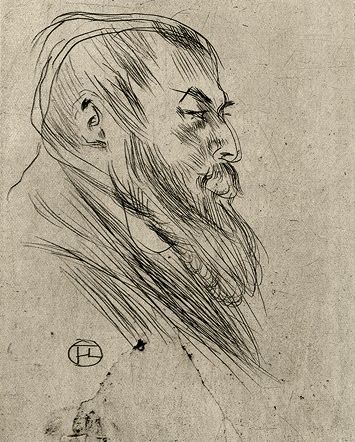
Tristan Bernard
RIRES ET SOURIRES
Œuvres choisies
(1897-1923)
Je me suis grandement plu à ce rire qui n’éclate pas.
Stéphane MALLARMÉ.
(Lettre à T.B.)
CITOYENS, ANIMAUX, PHÉNOMÈNES
(1905)
HISTOIRE DE DEUX FRÈRES SIAMOIS
Vous avez tous appris par cœur cette fable de La Fontaine où un vieillard, à son lit de mort, conseille à ses enfants de rester unis s’ils tiennent à prospérer dans la vie.
À qui cette recommandation peut-elle mieux s’adresser qu’à deux frères siamois qui, tant qu’ils sont unis peuvent se faire jusqu’à cent cinquante francs par jour dans un cirque, alors que s’ils s’avisaient de se séparer, ils gagneraient péniblement chacun trente sous par jour à écrire des adresses de prospectus ?
J’ai connu, à Londres, deux de ces jumeaux unis, appelés communément frères siamois et dénommés scientifiquement xiphopages. Edward-Edmund avaient une fortune assez considérable, qui les dispensait de s’exhiber comme phénomènes.
Edward était né à Manchester, il y a vingt-cinq ans.
Edmund était né également à Manchester, vers la même époque.
Ils se ressemblaient dans leur adolescence d’une façon extraordinaire. À tel point que les personnes qui ne connaissaient pas leur droite de leur gauche n’arrivaient pas à les distinguer.
Pourtant, avec l’âge, des différences morales assez profondes s’accusèrent entre eux. Edward avait des goûts sévères et studieux, Edmund des instincts populaciers. Ce dernier ne se plaisait que dans la société des voyous et des buveurs. Le malheureux Edward, son livre d’études à la main, était obligé de suivre Edmund dans les tavernes et les bouges. Et quand Edmund rentrait soûl au logis, Edward, le rouge au front, était obligé de zigzaguer avec lui pour ne pas se faire de mal à leur membrane.
Edward devint un érudit distingué. Mais on ne put l’inviter longtemps aux banquets des sociétés savantes où le crapuleux Edmund, dès le potage, commençait tout de suite à raconter de ces histoires obscènes que les gens convenables réservent d’ordinaire pour la fin du repas.
L’année dernière, Edward demanda la main d’une belle et riche jeune fille. Le mariage eut lieu en grande pompe. On fut bien forcé d’inviter Edmund, qui se tint d’ailleurs assez bien pendant la cérémonie. Il semblait que sa belle-sœur lui en imposât un peu. Dans le cortège nuptial, la femme d’Edward, Edward lui-même, Edmund et sa demoiselle d’honneur, s’avancèrent tous quatre sur un rang, au milieu de l’admiration générale.
Edmund, le soir du mariage, fut très convenable et très discret. Il s’endormit le premier et fit semblant, le lendemain matin, de se réveiller très tard. Pendant la lune de miel de son frère, il s’adonna moins à la boisson, surveilla ses paroles et s’habilla proprement, puisqu’il sortait avec une dame.
La jeune femme – ai-je dit qu’elle s’appelait Cecily ? – exerçait sur Edmund une grande influence… Au bout de quelque temps, il advint ce qui arrive bien souvent quand on introduit un célibataire dans un ménage. Des relations coupables s’établirent entre Cecily et le perfide Edmund.
Pendant six mois, Edward ne s’aperçut de rien.
Mais tout finit par se savoir.
Edward trouva des lettres dans un tiroir mal fermé, et apprit d’une façon irrécusable que sa femme et son frère le trahissaient tous les jours.
Quel parti lui restait-il à prendre ?
Se battre en duel avec Edmund, ce n’était guère conforme aux usages anglais. Il craignit aussi les discussions chinoises des témoins. Le duel au pistolet, à vingt cinq pas, n’était guère possible, non plus que le duel à l’épée, avec l’interdiction habituelle des corps à corps.
D’ailleurs, qu’arriverait-il s’il tuait son frère ? Pourrait-il continuer l’existence commune avec sa femme ? Toujours ce cadavre entre eux deux !
Il fit venir Cecily.
« À partir de ce jour, lui dit-il, vous ne profanerez plus le domicile conjugal. Partez.
— Bien, dit-elle.
— Bien, dit Edmund. Je l’accompagne. »
Le mari fut obligé de les suivre.
Edmund installa Cecily dans un appartement confortable. Et comme tout finit par s’arranger chez les xiphopages, ils vécurent tous trois très heureux.
MISE AU POINT
On croyait cette histoire liquidée depuis longtemps. Mais puisqu’il faut y revenir encore, précisons.
Adam et Ève se promenaient dans un jardin zoologique qui avait reçu le nom d’Éden, probablement pour attirer le monde. Il n’y venait d’ailleurs personne, et il fallait avoir un certain estomac pour avoir installé un jardin zoologique dans un pays où il n’y avait que deux habitants.
Il est vrai que les frais d’installation étaient des plus minimes.
On s’était dispensé de poser des grillages autour des fauves, ainsi qu’il est d’usage dans les jardins zoologiques ordinaires, où l’on tient à faire croire aux visiteurs payants que les lions et les tigres sont des animaux dangereux.
Il n’y avait donc aucune espèce de grillages ni de barrières, ni de ces étiquettes injurieuses où les loups sont traités de loups vulgaires, et les panthères de panthères communes.
Un Muséum très intéressant, ma foi, renfermait les squelettes de quelques animaux postdiluviens.
Quant aux animaux antédiluviens, ils erraient paisiblement dans les allées. Les plus remarquables étaient l’éléphant à tête de mouche, le rhinocéros-écureuil, la souris à deux bosses.
On admirait aussi l’ichytyosaure, le plectiosaure et le fameux harensaure dont il a été si souvent question, et qui n’était simplement qu’une sorte de lézard avec des pattes de hareng.
Le Tout-Puissant avait été très convenable avec le ménage Adam. Il leur avait dit : « Je vous donne vos entrées. Vous pourrez venir ici tant que vous voudrez. Je ne vous remets pas de ticket : je serai à la grande porte d’entrée, et je vous reconnaîtrai. Je vous connais comme si je vous avais faits. D’ailleurs, il n’y a pas de confusion possible, puisque vous êtes les seuls humains actuellement sur terre. Vous ferez ce que vous voudrez dans le jardin. Vous donnerez à manger aux phoques, vous vous promènerez toute la journée sur l’éléphant, le chameau, ou dans la petite voiture de l’autruche. Une seule recommandation cependant : ne touchez pas à mon arbre fruitier. Je n’en ai qu’un, et j’y tiens. »
Pourquoi y tenait-il ? Il ne l’a jamais dit au juste. Mais, en somme, c’était son affaire. Les Adam profitèrent de la permission et bientôt on ne rencontra qu’eux dans le jardin zoologique. Ils n’avaient aucune distraction, personne à voir dans le pays. Il fallait vraiment qu’ils manquassent de relations pour lier connaissance avec un serpent.
Ils rencontrèrent le serpent qui rampait dans une allée en sifflant. Adam lui dit : « Vous vous croyez donc dans une écurie ? » La conversation s’engagea. Les propos de ce couple naïf et de ce reptile désœuvré ne pouvaient aboutir qu’aux projets les plus futiles. Au bout de quinze jours de bavardages, le serpent leur conseilla de manger une pomme.
Quand le Tout-Puissant s’aperçut qu’il manquait un fruit à son arbre, il fut très choqué non pas du fait en lui-même, auquel il n’attachait pas une importance capitale, mais simplement du procédé. Il se borna à prier le couple Adam de ne plus remettre les pieds au jardin zoologique.
Tel est, ramené à ses justes proportions, cet incident dont on a tant parlé.
FUREUR TRAGIQUE
Le jour où le célèbre acteur anglais Harvey Shavenchin, jouant Hamlet et emporté par un mouvement tragique, tua vraiment Polonius (que jouait David Skabby) à travers la tapisserie, il y eut une forte émotion dans Londres.
Shavenchin fut traduit devant le coroner. Mais on prouva qu’il avait agi avec une espèce de fièvre, en dehors de toute responsabilité, et il fut acquitté.
Le jour où il reparut sur la scène, précisément dans le rôle d’Hamlet, on lui fit une ovation extraordinaire. Il joua les premiers actes avec plus d’ardeur que jamais et, arrivé à l’acte de la tapisserie, tua encore Polonius, que jouait Percy Moanful.
Shavenchin fut traduit à nouveau devant le coroner. L’affaire sembla plus difficile à arranger. On l’acquitta cependant, mais on lui fit défense de paraître dans Hamlet.
Il joua donc pendant six mois des rôles très calmes. Mais au bout de six mois, comme il avait l’air apaisé, on signa de nombreuses pétitions pour qu’il pût reprendre son rôle favori.
Cette fois, le directeur se procura pour le rôle de Polonius un homme dégoûté de la vie et lui assura, pour sa veuve, une indemnité raisonnable.
Puis, le jour de la représentation, la direction fit passer dans les journaux des notes de ce genre :
Il nous revient qu’on a peut-être eu tort de se fier au calme apparent de Harvey Shavenchin. Il paraît que, depuis deux jours, le sympathique comédien donne des signes inquiétants d’agitation.
Il y eut foule le soir au théâtre, et les places se vendirent de deux à cinq guinées.
Le directeur prit à part Shavenchin quelques instants avant l’acte du meurtre :
« Harvey, je vous recommande le calme. Mais la vérité m’oblige à vous dire que Jerry Bamboo, qui joue Polonius, est un homme peu satisfait de la vie. Je suis bien sûr qu’aucun accident ne se produira. À tout hasard, cependant, j’ai assuré une indemnité à Mistress Bamboo. »
Or, la pensée qu’il avait presque le droit de tuer Bamboo refroidit complètement Harvey Shavenchin.
Il ne sembla pas à son entrée en scène qu’il eût tout à fait sa fougue accoutumée. Au moment de crier : « Un rat ! un rat ! », il perça la tapisserie avec une certaine mollesse et ne dut faire à Bamboo qu’une piqûre sans importance.
Malgré la tapisserie, le public vit bien, à la langueur du geste de Shavenchin, qu’aucun accident n’était à déplorer. Des bordées de hurlements et de sifflets forcèrent Harvey à quitter la scène. Il ne put venir à bout du dernier acte et, les jours qui suivirent, le tumulte fut tel à son entrée en scène, que la police intervint enfin et l’empêcha de reparaître au théâtre – au moins dans le rôle d’Hamlet.
LA VENGEANCE DE GALUCHE
Galuche, troisième rôle au Grand-Théâtre, m’emmena ce soir-là à la représentation d’un nouveau drame qui donnait de belles espérances à la direction : Soixante-dix ans ou la Vie d’un joueur de jacquet.
Nous avions dîné ensemble, et Galuche, pendant le repas, n’avait cessé de ricaner. Au dessert, il me confia ses projets.
« Mon directeur, me dit-il, m’a joué un pied de cochon. C’est moi qui fais le traître, le traître Renardeau. Figure-toi que, jusqu’à la dernière répétition, il était convenu que j’aurais un costume de garde-chasse, en velours vert, avec des guêtres jaunes. Hier, ces cochons-là décident que je serai habillé en paysan. Je n’ai rien dit. Mais comme j’ai un engagement prêt à signer à Bruxelles et que je peux plaquer mon théâtre demain matin, je vais m’amuser ce soir à leur fiche leur pièce par terre. Écoute bien, d’un bout à l’autre. Je te réponds qu’au dernier tableau tu ne t’embêteras pas. »
Je m’installai derrière un portant, et je suivis avidement les péripéties du drame.
Le personnage principal était un rentier de village, M. Désaubiers, un vieillard d’une vertu inlassable, qui avait gagné sa fortune en semant le bien autour de lui.
Il faisait grâce d’un terme à un de ses fermiers, qui se plaignait de mauvaises récoltes. Il mariait une institutrice pauvre à un jeune contremaître. Au quatrième acte, quand le traître Renardeau essayait de le poignarder sur la place de la mairie, il pardonnait à son agresseur.
Le spectacle de cette vertu était tellement édifiant que le traître Renardeau, vaincu par tant de grandeur d’âme, devait, au dernier tableau, se jeter aux pieds du noble vieillard et s’écrier : « Je suis un misérable ! Toute une vie de contrition n’effacera pas mes fautes ! »
L’auteur, debout à mes côtés dans les coulisses, attendait avec émotion cette scène digne du couronnement de son œuvre.
Galuche fit son entrée. Il s’approcha de M. Désaubiers, qui préparait son plus onctueux visage. « Vous n’êtes qu’un vieux daim, lui dit-il, et vous me dégoûtez profondément ! »
Je regardai l’auteur. Il allait défaillir.
Mais un tonnerre d’applaudissements le ranima soudain.
Cette apostrophe de Renardeau exprimait admirablement les sentiments des spectateurs qui avaient écouté, avec une certaine impatience, les propos de l’exemplaire Désaubiers.
Ce vieillard avait écœuré tout le monde avec le récit de sa vie laborieuse et l’étalage de sa vertu. Il était arrivé à Paris en sabots et avait gagné la forte somme : il semblait étonnant que le seul amour du prochain l’eût conduit à un si beau résultat.
Les paroles de Galuche jetèrent donc une lumière nouvelle sur les intentions de la pièce. Le caractère de Désaubiers devenait une magistrale caricature, et le drame apparut à tout le monde, même à l’auteur, comme une œuvre de supérieure ironie.
UN PIGEON VOYAGEUR
Un des plus intéressants journaux de sport a été La Revue des Sports, qui n’existe plus aujourd’hui. La Revue des Sports portait en sous-titre les noms de ses différentes rubriques : Cyclisme, Yachting, Rowing, Athlétisme, Colombophilie, Tir aux pigeons.
Je n’ai jamais su si c’était le même rédacteur qui s’occupait de la colombophilie et du tir aux pigeons.
J’ai eu pour ami un tireur aux pigeons qui, à la façon constante dont il épargnait les pigeons, a senti se révéler en lui des instincts jusqu’alors inconscients de colombophile.
Déposant la carabine, il installa donc un colombier dans sa petite maison de Neuilly. Mais il y a des sportsmen qui sont malheureux toute leur vie. Celui dont je parle avait élevé des chevaux. Les poulinières de grand sang qu’il s’était procurées restèrent stériles, à l’exception d’une seule, qui mit au monde un petit mulet rachitique dû à la rencontre accidentelle d’un âne pas très bien portant.
Bien que le colombier de mon ami fût installé d’après les prescriptions les plus savantes, ses pigeons n’y revenaient jamais. Il fut obligé de leur attacher à la patte des fils légers. Et, faute de mieux, il convia ses amis à des ascensions de pigeons captifs, qu’il laissait s’envoler à deux cents mètres, et qu’il ramenait ensuite doucement au colombier en tirant sur la ficelle.
Mais, le mois dernier, je fis la rencontre de mon colombophile qui, cette fois, rayonnait de joie. Il s’était procuré un nouveau pigeon qui ne s’échappait pas du colombier et qui, même lâché à une faible distance, avait consenti à y revenir. Enhardi par cet essai il avait engagé son pigeon, nommé Fidèle, dans une de ces courses de pigeons voyageurs qui ont lieu entre Bruxelles et Paris. Fidèle avait accompli le parcours dans un temps pas très rapide, assez honorable cependant.
« Depuis, il a recommencé cet exploit deux fois, me dit mon ami. Détail curieux : qu’il parte de Bruxelles à huit heures, neuf heures ou dix heures du matin, il arrive régulièrement à Paris à sept heures du soir, noir de poussière, mais pas du tout fatigué. »
Bref, mon ami me parla de Fidèle avec tant d’éloges que je consentis à l’accompagner à Bruxelles avec son pigeon. Fidèle, au départ de Paris, fut enfermé dans un panier et placé dans le fourgon à bagages.
Le lâcher eut lieu le lendemain. Les pigeons s’élevèrent, tournèrent un instant dans le ciel et partirent dans la direction du Sud.
Il me sembla qu’un pigeon ne les suivait pas et se posait sur le toit de la gare du Midi.
Quand nous prîmes le train, à onze heures quarante, j’aperçus un pigeon – était-ce le même ? – sur le wagon-restaurant.
« C’est peut-être Fidèle ? dis-je à mon compagnon.
— C’est vrai qu’il lui ressemble. Mais ce ne peut être lui. »
À la douane de Feignies le pigeon alla se poser sur un arbre, où il attendit patiemment qu’on eût terminé la visite des bagages.
Nous oubliâmes ce fortuit compagnon de route et nous parlâmes de sujets divers pendant que le train, tout à son idée fixe, nous entraînait vers Paris. Arrivés à la gare du Nord, mon compagnon héla une Victoria dans la rue de Dunkerque.
À peine installés, nous vîmes un oiseau tournoyer au-dessus de notre tête et se poser sur le siège. C’était Fidèle qui, noir de poussière, se payait encore le trajet de la gare à Neuilly à côté du cocher !
L’HEUREUX CHASSEUR
Je vous parle d’il y a trente ans.
À cette époque, le jeune M. Jaboin suivait les grandes chasses à Compiègne, à Fontainebleau, à Rambouillet.
Mais – détail curieux – si giboyeuses que fussent les forêts où M. Jaboin était admis, il ne parvint jamais à tuer le moindre gibier.
Par exemple, il lui arriva de blesser des gardes, et maints invités, parfois, hélas ! de façon mortelle.
Il tua aussi beaucoup de chiens, deux chevaux, et une vache laitière.
Sans qu’il sût pourquoi, on l’invita de moins en moins.
On finit même par le tenir à l’écart d’une façon un peu systématique.
« Il y a certainement une raison politique là-dessous », pensa-t-il, bien qu’il n’eût jamais fait de politique.
Quand la guerre fut déclarée, M. Jaboin s’engagea.
Dès le début des hostilités, il eut l’occasion de prendre part à un petit fait d’armes.
Il était parti chercher des vivres avec un autre homme et un sergent.
Les trois hommes pensaient bien ne pas faire de mauvaise rencontre. Aussi, afin de pouvoir se charger de beaucoup de vivres, n’avaient-ils emporté qu’un fusil et une seule cartouche.
Comme ils longeaient une route, ils virent un nuage de poussière qui se formait au bout de la route.
C’était un cavalier ennemi qui s’avançait au petit galop.
« Nous allons nous dissimuler derrière ce bouquet d’arbres, dit le sergent.
— Y a-t-il un bon tireur pour nous dégoter ce particulier-là ? »
M. Jaboin s’avança, modeste.
« Je suis un assez bon fusil, dit-il. J’ai beaucoup suivi les chasses.
— Eh bien, prends-moi ce flingot, dit le sergent, et tâche de t’en servir ! »
M. Jaboin tremblait un peu. Il avait « descendu » d’autres individus dans sa carrière de chasseur, mais maintenant qu’il s’agissait de le faire exprès, allait-il aussi bien réussir ?
L’homme n’était qu’à trente pas.
« Feu ! » dit le sergent.
M. Jaboin tira.
L’homme regarda de leur côté, piqua des deux, et s’éloigna à une allure rapide.
Mais du poil avait volé, et quelque chose de jaune, à vingt pas du cavalier, avait roulé près de la route.
M. Jaboin venait de tuer son premier lièvre !
CONTES DE PANTRUCHE ET D’AILLEURS
(1897)
Dédicace à ses parents :
Chers parents, l’auteur de ces fables
Rencontrera plus d’un censeur.
Vous êtes les premiers coupables,
Étant les auteurs de l’auteur.
TRISTAN.
QU’EST-CE QU’ILS PEUVENT BIEN NOUS DIRE ?
Telle était la question que se posaient les savants, réunis au congrès de Pampelune pour chercher les moyens de communication possibles entre la planète Terre et la planète Mars. L’accord s’était fait sur ce point, que les signes lumineux observés à la surface de Mars étaient bien des signaux à notre adresse, dont il s’agissait de trouver le sens. Et ce n’était pas douteux : pourquoi voulez-vous qu’une planète perde son temps à s’éclairer ainsi à giorno, si ce n’est pour converser avec d’autres planètes ?
Le docteur Isidorus présenta une motion qui fut adoptée à l’unanimité.
« Admettons, disait ce savant docteur, que les Martiens sont beaucoup plus avancés que nous dans la voie du progrès et qu’ils se sont rendu compte, par des moyens perfectionnés de téléphonie et de téléphotie, de tout ce qui se passe à bord de notre planète. Risquons donc le coup et écrivons-leur en français. Ça ne nous coûtera jamais que vingt-deux milliards ! »
Pour écrire à des gens qui habitaient si loin, il fallait se procurer une feuille de papier énorme et surtout un endroit très plat pour l’étaler. On choisit l’endroit classique pour une expérience de ce genre, les déserts de l’Afrique centrale ; on supprima des oasis, on rasa des villages de nègres, pour empêcher que l’immense feuille fît des plis. Par la même occasion, on civilisa des quantités de Noirs, et l’on convertit au végétarisme tous les cannibales de l’Ouandsi, de l’Ouandgé et de l’Ouandga, si friands jusque-là de chair humaine qu’ils nourrissaient de leurs propres oreilles leurs ventres affamés.
On réquisitionna tous les produits des fabriques d’encre, si bien qu’en Europe l’encre manqua. Mme Séverine dut écrire sur l’écorce des arbres ses éloquents appels à la charité publique, durant que des tambours de ville, pareils aux anciens rapsodes, déclamaient dans les carrefours de Limoges, des Andelys ou de Loudéas les alexandrins de M. François Coppée.
Quand on eut rendu, par des procédés chimiques, l’encre parfaitement lumineuse, d’immenses rouleaux, traînés par des bœufs, l’étalèrent pour former les lettres sur la feuille de papier. Ce travail dura près de quatre mois. Comme les signaux de Mars continuaient de plus belle, on avait décidé d’envoyer d’abord cette brève interrogation :
PLAÎT-IL ?
Chacune de ces lettres mesurait cent lieues de hauteur. Et l’on prit soin de mettre sur les i des points d’un diamètre tel qu’une armée tout entière y pouvait évoluer.
L’inscription terminée, on attendit au grand observatoire du Gabon la réponse de la planète Mars. On n’attendit pas longtemps. Vingt-quatre heures après, courrier par courrier, la réponse de Mars arriva par lettres lumineuses isolées, qui apparaissaient l’une après l’autre, de quart d’heure en quart d’heure. L’observatoire les télégraphiait aux Terriens surexcités.
Or, la réponse à la question : « Plaît-il ? » disait simplement :
RIEN
On étala dans l’Afrique centrale une nouvelle feuille de papier sur laquelle on écrivit ces mots (le travail dura sept mois) :
ALORS, POURQUOI NOUS FAITES-VOUS DES SIGNES ?
Mars répondit :
CE N’EST PAS À VOUS QUE NOUS PARLONS.
C’EST À DES GENS DE LA PLANÈTE SATURNE.
LE COLLECTIONNEUR
I
Un matin d’avril, mon ami Lartilleur adopta un enfant de quelques mois. Il se trouvait dans les conditions légales, n’ayant pas d’enfant vivant.
Puis, il se dit : « Maintenant que j’ai un enfant adoptif, ne serait-il pas bon que j’eusse également un enfant naturel ? » Il en toucha deux mots à une modeste ouvrière, sa voisine de palier. Elle lui donna, le terme accompli, un enfant naturel, qu’il alla reconnaître à la mairie.
Après le baptême, il rentre chez lui tout soucieux : « J’ai bien, pensait-il, un enfant adoptif et un enfant naturel, mais je n’ai pas d’enfant adultérin.
« Au fait, acheva-t-il, mon notaire n’est-il pas marié ? Si je me faisais présenter à sa femme ? »
Ce qui fut dit fut fait. Il fut bientôt en bons termes avec la notairesse.
Un soir, comme il dînait chez ses parents, il eut, après le potage, un sursaut. « Sapristi ! se dit-il en lui-même, je n’ai pas d’enfant incestueux ! » Justement, il lui restait encore une sœur non mariée, et il put se procurer à peu de frais un enfant parfaitement incestueux, qui n’était pas adultérin.
Cependant, les puritains commençaient à le regarder d’un mauvais œil.
II
Alors il se dit : « Faisons taire les langues et prenons femme. »
Mais il s’agissait de s’assurer tout d’abord un enfant légitimé. Il entreprit donc la séduction d’une jeune fille très bien, et ne l’épousa qu’après qu’elle lui eut donné un petit garçon qui fut aux termes de la loi, un enfant légitimé. Puis il la rendit mère une seconde fois, pour avoir un enfant purement légitime.
Il vivait en paix, avec sa compagne, dans une petite maison de Neuilly. Autour de lui jouaient l’enfant adoptif, l’enfant naturel, le légitimé, le légitime, voire l’adultérin, que lui envoyait souvent la notairesse, et aussi Gaspard, l’enfant incestueux, qui l’appelait papa le lundi, le mercredi, le samedi, et mon oncle les autres jours de la semaine.
III
Lartilleur n’était pas complètement heureux, car souvent la santé de ses enfants le mettait dans des transes douloureuses. Il craignait qu’un malheur n’arrivât à l’enfant naturel et ne dépareillât ainsi sa collection.
Vivant en état de mariage, il ne pouvait donner le jour qu’à des enfants légitimes ou adultérins, et, pour remplacer, à l’occasion son bâtard, il eût été contraint de se séparer de sa femme (par les moyens toujours pénibles du divorce ou du meurtre).
Quant à la mort de l’enfant adoptif, c’était un cauchemar pour lui que d’y songer. Pour se trouver à nouveau dans les conditions légales, et adopter un autre enfant, il lui eût fallu primitivement supprimer tous les siens, et recommencer sa collection.
IV
Cependant, le ciel le bénit. La santé de ses enfants demeura florissante, et il vivait en paix, tel un patriarche, au milieu de cette famille de bric-à-brac.
On le rencontrait assez souvent dans le monde, dans les salons académiques et les diverses ambassades, où il aimait à vanter sa petite famille.
Un soir, au fumoir, Le Blafard ricana.
« Pas très complète, tu sais, ta fameuse collection ? Il y manque un numéro important.
— Je voudrais savoir lequel, riposta Lartilleur d’un ton très assuré.
— Il y manque, continua l’autre, un enfant posthume. »
Lartilleur blêmit à cette parole.
« Et prends garde, acheva froidement Le Blafard ; à supposer que tu meures subitement, sans que ta femme soit grosse, il est à présumer que l’enfant posthume manquera toujours à la série. D’autre part, si tu la fécondes et si tu oublies de mourir, tu seras père de deux enfants légitimes. Un numéro double : triste gaffe pour un collectionneur ! »
Lartilleur se leva d’un trait. Il passa dans un salon voisin, où sa femme jacassait paisiblement avec des dames du haut monde, et, d’un ton impératif :
« Adèle, rentrons chez nous. Illico ! »
Quelque temps après, nous apprîmes que Lartilleur s’était mortellement blessé en jouant avec une arme à feu, dont il avait imprudemment pressé la gâchette au moment même où le canon se trouvait entre ses dents. Il laissait plusieurs enfants de différents lits et l’espoir d’un enfant posthume.
La succession, avec des héritiers si divers, ne manqua pas de s’égarer dans la forêt des articles du Code et fit la rencontre du Fisc, qui l’avala tout entière, gloutonnement.
La famille de Lartilleur se trouvait sans ressources. Mais il avait prévu ces difficultés et léguait sa collection aux Enfants assistés du département de la Seine.
GANGRÈNE DES PALETOTS ET NÉVROSE DES BOTTINES
Une récente chronique scientifique du O signalait, dans un journal industriel, « une étude pleine d’aperçus nouveaux sur une maladie connue et inexpliquée des chaudières à vapeur : on la nomme la corrosion par pustules ».
« C’est là, ajoute notre confrère, une vraie maladie, analogue à la variole des humains… Vos bouillottes se garnissent d’ampoules ou de pustules… Les ampoules crèvent, grêlant la tôle… Il arrive souvent qu’une chaudière au repos contracte de sa voisine une maladie pustuleuse. »
Courteline nous a dit jadis l’histoire réjouissante d’un aliéné qui « fait des blagues » à des objets domestiques. Ne raillons plus, désormais, puisque ces compagnons inanimés de notre existence ont, eux aussi, leurs souffrances et leurs deuils.
Le savant Gugli Meyer, au cours de sa vie d’étudiant, a recueilli d’intéressantes observations sur la maladie poisseuse des tables de café, cette affection terrible qui se communique aux paletots par les coudes.
Il résulte de nombreuses expériences faites par le docteur Saint-Crasy sur les prisonniers du Dépôt, que le séjour des fortifications, arches des ponts et bancs de gare, est moins favorable aux vestons et aux redingotes que la fréquentation exclusive des salons d’ambassades.
On sait, d’autre part, que les longues veilles et les orgies ne conviennent pas toujours au tempérament un peu fragile des devants de chemise. À la suite de repas prolongés, ils contractent diverses maladies cutanées (plaques vineuses, etc.). Les chapeaux hauts de forme, eux aussi, s’accommodent assez mal des expéditions nocturnes dans les brasseries et lieux de plaisir.
Certaines personnes ont l’habitude de mettre leurs semelles de bottines en contact avec le trottoir. Il en résulte à la longue un danger réel. En effet, plusieurs de nos correspondants ont remarqué qu’il se produisait un amincissement progressif de la semelle, susceptible de dégénérer en une ulcération très grave.
On a constaté, dans un autre ordre d’idées, que les pardessus d’hiver finissaient par devenir très impressionnables, malgré leur rude aspect. J’en ai connu un qui s’est mis à dépérir tout à fait, faute d’avoir pu se consoler de la perte successive de tous ses boutons, dont chacun laissait en s’en allant un grand vide…
J’ai observé, pour mon compte, un phénomène étrange, qui relève plutôt de l’étude des maladies mentales : c’est l’effet du beau temps sur l’état cérébral des parapluies. J’ai essayé, à diverses reprises, d’acclimater chez moi un parapluie. Dans les premiers temps il revenait régulièrement au logis, avec la docilité exemplaire d’un caleçon ou d’un gilet de flanelle. Mais, si le temps se mettait au beau au cours de notre promenade, il se produisait, chez mon parapluie, une amnésie bizarre : il oubliait totalement le chemin de la maison.
Ne terminons pas cette courte étude sans signaler le pouvoir d’hypnotisme que peuvent acquérir certains individus sur les objets domestiques. Une dame, qui demeurait sur mon palier, charmait absolument les ombrelles, les mouchoirs de batiste et les presse-papiers, qui quittaient un à un les grands magasins pour la suivre jusque chez elle. Ce cas intéressant lui valut la visite de quelques curieux, et même de notre commissaire de police, lequel s’intéressait beaucoup à ces questions spéciales.
L’APPÉTIT VIENT EN MANGEANT
Les naturels de l’Ouandsi, vaste territoire qui s’étend entre le lac Rodolphe et le lac Victoria-Nyanza sont, parmi les anthropophages de l’Afrique centrale, ceux qui ont le mieux su concilier leurs habitudes de cannibalisme avec les raffinements de notre civilisation. Une délégation de l’Ouandsi, à la suite d’un séjour de quelques semaines au Jardin d’Acclimatation, a rapporté au pays natal d’intéressantes coutumes européennes.
C’est ainsi que la royauté dans l’Ouandsi se tire au sort, à la façon de la royauté de l’Épiphanie. La galette traditionnelle y est remplacée par une jeune femme, enceinte de trois mois, qu’on accommode en salmis. L’heureux gagnant est proclamé roi pour une année.
C’est lui qui, aux termes de la constitution, est chargé, trois mois avant l’expiration de son mandat, de préparer la jeune femme pour le Jour des Rois prochain.
On en prépare chaque année trois ou quatre, pour plus de sécurité.
Cet extrait du Moniteur des explorations et découvertes m’avait toujours vivement intéressé. À cette époque, mon âme jeune, éprise d’inconnu, s’exaltait aux récits des Livingstone et des Stanley. Et mon plus grand désir était de visiter des tribus d’anthropophages.
J’appris à cette époque que le docteur Pionnier, le hardi conférencier, trois fois lauréat de l’Académie des Sciences, partait en mission dans l’Afrique centrale, dans un but à la fois géographique et humanitaire. On faisait appel à tous les jeunes gens de bonne volonté possédant une bonne santé, un jarret solide, et trois mille francs pour subvenir aux besoins de l’expédition. Le docteur Pionnier réunit ainsi sept jeunes hommes d’excellente famille qui lui apportèrent vingt et un mille francs. Comme c’était un galant homme, il s’en servit immédiatement pour régler des dettes de jeu.
D’après les prospectus, une fois nos trois mille francs versés, notre voyage était payé en première classe de Marseille à Zanzibar. Mais le jour du départ, le docteur Pionnier eut une longue conférence avec le capitaine du steamer la Ville-d’Aubervilliers. Puis il vint nous expliquer qu’un voyage trop confortable nous préparerait mal aux fatigues de l’expédition. Nous coucherions donc avec les hommes de l’équipage, et nous rendrions de petits services au navire en qualité de chauffeurs et d’aides cuisiniers.
Nous arrivâmes le 16 avril en vue de Zanzibar, ville célèbre ainsi nommée parce que tous les habitants passent leur temps à jouer des consommations. Le docteur Pionnier fit alors un nouvel appel de fonds, et nous réunîmes, en vidant nos poches, sept mille sept cents francs, dont le chef de l’expédition se servit pour régler de nouvelles dettes de jeu contractées à bord du steamer.
Le sultan de Zanzibar, très flatté de notre visite, nous invita à sa table et offrit au docteur Pionnier un bateau démontable qui devait nous servir à traverser des rivières. Puis il nous donna une escorte de douze Nègres, du tabac à priser et de riches présents, dont quinze paires d’espadrilles.
Avec les hommes que nous avions amenés d’Europe, nous étions bien une vingtaine de Blancs. Nous prîmes chacun un morceau du bateau démontable sous notre bras et nous nous acheminâmes gaiement vers Bagamoyo.
La dysenterie cependant faisait des vides dans notre petit groupe. Quand l’un de nous restait en route, on lui prenait son tabac et son morceau de bateau.
Malheureusement plusieurs morceaux de bateau s’égarèrent et quand nous voulûmes reconstituer notre frêle esquif, la moitié de la coque manquait. D’ailleurs il ne devait déjà pas être au complet quand le sultan nous l’avait donné. (Le sultan de Zanzibar a, sur toute la côte orientale, la réputation d’un blagueur à froid.)
Nous arrivâmes fort à propos à Irantouni, petit royaume situé entre Bagamoyo et Mpouapoua (8°de latitude sud). Le roi d’Irantouni avait longtemps habité Paris. Il en avait rapporté douze lances d’allumeurs de réverbères dont il avait armé sa garde royale, et une quantité énorme de ces paysages peints en gris qui servent aux photographes pour les fonds. Il en avait bordé des allées entières et des places publiques.
Comme tous les vendredis l’administration du Jardin d’Acclimatation fait conduire les rois nègres dans une maison spéciale du quartier de la Bourse, le roi d’Irantouni, qui n’était pas renseigné, avait cru visiter une cour européenne ou quelque somptueuse ambassade. Aussi toutes les dames de sa cour étaient-elles désormais habillées de peignoirs en satinette de couleur, ouverts sur le devant.
Les habitants d’Irantouni n’étant pas anthropophages, nous fûmes obligés de nous avancer vers l’intérieur des terres pour pouvoir exercer notre œuvre de civilisation. Nous arrivâmes, aux premiers jours de juin, à Kakoma. Mais les habitants de Kakoma avaient été récemment convertis au végétarisme.
À Kahouélé, le roi du pays à qui nous demandions s’il était friand de chair humaine, nous répondit : « Dipaça tumféroté », ce qui voulait dire : « Je vous en prie, ne continuez pas sur ce ton-là ; vous allez me donner des haut-le-cœur. »
Nous arrivâmes enfin dans cette grande étendue de terres qui se trouve entre les lacs Tanganyika et Victoria-Nyanza.
Les villages et endroits habités devinrent rares.
Nous parcourûmes une cinquantaine de milles sans rencontrer un être vivant. Les provisions de la petite troupe s’épuisaient.
L’eau, par bonheur, ne manquait pas. Mais aucune plante comestible ne croissait dans la prairie. Le gibier faisait complètement défaut.
Le 18 juillet au soir, nous n’avions rien mangé depuis trente-six heures. Le docteur réunit tous les Blancs ; on mit solennellement dans un chapeau les noms des Nègres.
Le premier nom qui sortit fut celui d’un vieux guide qui rendait de sérieux services à l’expédition. On recommença l’épreuve par égard pour son grand âge et sa probable coriacité.
Enfin le sort désigna un jeune Nègre nommé Counou. Il était vigoureux et de belle taille. Le docteur, excellent cuisinier, fut chargé de l’accommoder.
Tout le monde, servi copieusement, en redemanda. Il nous fit trois repas.
Cependant le pays commençait à devenir giboyeux. Mais la chasse était si difficile, et c’est toujours imprudent de manger des bêtes qu’on ne connaît pas. Nous entamâmes un second Nègre le 20 juillet au soir. Puis, à l’exception du vieux guide, toute l’escorte y passa. Heureusement nous arrivions dans des régions habitées et nous pouvions retrouver d’autres Nègres.
Nous faisions, je dois le dire, horreur aux populations avec de pareilles coutumes. À Kibanga, un vieux raseur de chef noir vint nous faire une longue allocution où il nous sermonnait de la belle façon et nous disait qu’au XIXe siècle il était honteux qu’on se livrât encore à de semblables pratiques.
Enfin, après quelques semaines de marche, nous arrivâmes à Moussomba, dans l’État indépendant du Congo. Jamais une expédition ne s’était accomplie dans des circonstances aussi favorables. Nous étions tous gras et bien portants. Nous avions sans doute trouvé la nourriture qui convenait pour supporter le dur climat de l’Afrique centrale.
À notre retour en Europe, on nous combla de distinctions, et le docteur Pionnier, dès sa première conférence, fit justice de cette opinion stupide qui prétend qu’on ne trouve plus d’anthropophages sur le continent africain.
LES PRIX DE L’ACADÉMIE
M. Gaston Deschamps vient de répondre vivement à M. Rodenbach, qui s’était permis de blaguer les lauréats de l’Académie.
Il m’est arrivé à ce sujet une certaine histoire, qui aurait pu mal tourner.
J’avais acheté à une vente une paire de vieux Bottins et d’almanachs. Je trouvai dans le lot quelques exemplaires d’un volume intitulé : Comédies de château, et plusieurs exemplaires aussi d’un ouvrage d’un autre genre : Les Massacres d’Européens au Coromandel.
Or, le jour même où je fis cette banale découverte, je lus dans un journal que le délai pour la réception des ouvrages présentés aux concours académiques allait expirer la semaine suivante. Une idée me vint subitement, et je courus me procurer à l’institut la liste et les conditions des différents prix.
Après un rapide examen, il me sembla que les Comédies de château avaient des titres sérieux au prix Birougnol, « pour les meilleurs ouvrages d’art dramatique à la portée des familles ».
D’autre part Les Massacres d’Européens au Coromandel n’étaient pas indignes du prix Montrélaz « à décerner annuellement à l’auteur du livre le plus utile à l’expansion coloniale ».
J’enlevai donc la couverture et le titre de ces deux volumes, et, moyennant quelques francs, je fis composer par un imprimeur deux autres titres, dont l’un, le Théâtre de la jeune mère, était destiné aux Comédies de château, et dont l’autre, Les Derniers moments de Livingstone, devait remplacer Les Massacres d’Européens au Coromandel.
Je signai le premier ouvrage : Comtesse de Soupières, et j’inventai pour le second un nom d’abbé missionnaire.
Ayant donné mes instructions à mon imprimeur, je le priai de déposer les deux tomes à l’institut, mais en passant chez lui à quelques jours de là, je m’aperçus qu’il avait commis une assez grave erreur.
Les Massacres d’Européens au Coromandel étaient devenus le Théâtre de la jeune mère, et Les Derniers moments de Livingstone servaient de titre aux Comédies de château.
Qu’allait-il arriver ? Je me dis avec désespoir que ma fraude serait découverte et je n’osais en prévoir les conséquences.
Or, je fus avisé quelque temps après que chacun de mes ouvrages avait obtenu un beau prix de cinq cents francs.
Ce succès m’encouragea. Je fis main basse sur certains volumes intéressants qui encombraient ma bibliothèque, le Livret du Salon de 1887, La Clef des Songes, le tome XVII du Journal des voyages, le Whist à trois, un recueil de Thèmes allemands. Tous ces volumes, ornés de belles couvertures neuves, furent déposés au siège de la Ligue contre l’abus du tabac sous des titres de ce genre : Le Fléau nicotine, Les Méfaits de la pipe, La Saint-Barthélemy des mégots, etc.
J’obtins quatre des prix les plus importants, en tout une somme assez, élevée, grâce à laquelle j’aurai mon tabac assuré jusqu’à la fin de mes jours.
LES MÉDECINS SPÉCIALISTES
(1899)
LES MÉDECINS SPÉCIALISTES
LA raillerie ne désarmera jamais devant la médecine… Et pourtant, jamais, nous pouvons le dire, les médecins n’ont été aussi sérieux et aussi habiles qu’aujourd’hui.
Seulement on ne suit pas les traitements.
On va les voir comme des sauveurs et si l’on n’est pas guéri au bout de huit jours, on cesse d’obéir à leurs prescriptions. Alors on dit : « Un tel ne m’a rien fait… »
C’est que vous ne l’avez pas écouté. Si vous l’aviez écouté, il vous aurait guéri. Il fallait observer votre régime pendant quatre, huit mois, le temps nécessaire.
Vous connaissez Siméon ?… C’est ce gros garçon barbu, avec une redingote. Mais oui… voyons. Vous ne connaissez que ça. Siméon vient me voir il y a quatre ans. Il savait que j’ai toujours été en rapport avec les sommités du monde médical, à Paris. Siméon pesait à cette époque deux cent soixante-dix livres. Il voulait maigrir… Je lui indique l’adresse du docteur Belarthur, rue Lafayette… Il y va… Belarthur l’examine… et le soumet à un régime qui lui a déjà donné d’excellents résultats, les exercices de marche prolongée. Deux heures le matin, deux heures le soir. Au bout de six semaines, Siméon avait maigri de vingt-cinq livres.
Seulement il se trouve qu’il a les chevilles un peu faibles pour la masse de son corps. Il ne pouvait plus marcher. Il avait les pieds tout enflés. Il vient me voir. Je lui indique alors le docteur Schitzmer, un docteur d’origine autrichienne qui guérit les affections de ce genre par des bains de pied dans la boue, c’est-à-dire dans de la terre glaise délayée. Mon Siméon suit un traitement pendant trois mois, et au bout de trois mois il avait les pieds complètement guéris. « Ah ! me dit-il alors, combien je te suis reconnaissant ! Quel soulagement je ressens de n’avoir plus ces douleurs aux chevilles ! Je serais bien heureux si je n’avais pas ces maux de gorge ! »
Il faut vous dire, en effet, qu’à force de se tremper ainsi les pieds dans de la terre mouillée, il avait contracté une affection du larynx, qui le faisait beaucoup souffrir… Mais pour guérir ça, rien de plus facile. Je m’empressai de lui indiquer le docteur Cholamel. Cholamel a remarqué que beaucoup de maux de gorge étaient dus à une mauvaise circulation du sang dans le gosier. Il rend sa vitalité à cet organe au moyen d’un traitement à l’électricité. Siméon suivit ce traitement et ce fut l’affaire de quelques mois à peine. Son mal de gorge disparut complètement.
Malheureusement Siméon appartient à une famille de nerveux ; il souffre d’une nervosité spéciale, qui est gravement affectée par l’électricité. Il fut pris de crises d’un caractère très grave. Il avait chaque jour trois ou quatre accès… Je lui dis : « Mon vieux, il ne faut pas rester comme ça. Va voir de ma part le docteur Langlevent et soumets-lui ton cas. Il te soignera ça en un tour de main. » Langlevent lui a fait prendre du bromure. Le bromure est souverain dans les maladies de nerfs, si on le prend conformément aux prescriptions du médecin. Ni trop. Ni trop peu. Siméon se conforma scrupuleusement à l’ordonnance du docteur. Et au bout de très peu de temps – six mois – les accidents nerveux avaient disparu. Mon ami avait repris sa vie normale.
Mais il était d’une humeur un peu chagrine – comme toutes les personnes qui souffrent de l’estomac. Le bromure naturellement n’est pas fait pour l’estomac… Ça le délabre, ça l’abîme, ça donne des digestions difficiles… Quand on souffre de l’estomac, il ne faut pas hésiter. On va voir le professeur Biridoff. Il vous remet en une saison. J’envoyai Siméon chez le professeur, qui l’examina et le mit au régime des féculents. Très peu de viande, peu de vin, de l’eau et des purées de haricots, des purées de pommes de terre, des purées de pois. Siméon fut rétabli en peu de temps.
Il en fut bien heureux. Je le rencontrai chez moi dans l’escalier, comme il venait me remercier. Il soufflait un peu… parce qu’il était très gros. Dame ! rien que des farineux !… Il ne pesait pas moins de trois cent vingt-deux livres… C’était trop… « Il faut surveiller ça, lui dis-je et enrayer… – Mais, me répondit-il, si je recommence à me faire maigrir, on va me faire marcher, mes chevilles vont enfler de nouveau, etc. – Il ne s’agit pas de marche, lui dis-je. Il y a d’autres moyens de se faire maigrir. Je vais aller avec toi chez un autre de mes amis, le docteur Lerenchéry. »
Lerenchéry préconise surtout l’équitation, mais pas l’équitation au hasard. Il ne suffit pas de prendre un canasson au manège et d’aller faire un petit tour au bois. Lerenchéry fit une ordonnance de douze pages, indiquant les heures de sortie, le nombre et la durée des temps de trot, des temps de galop… Siméon choisit un cheval très fort, très vigoureux, et commença ses exercices.
Eh bien, il a commencé il y a trois jours, et son poids a déjà diminué de trente-six kilos ! C’est un résultat !
Il faut vous dire qu’il a fait une chute de cheval à sa première sortie et qu’on a dû lui couper la jambe gauche, qui pesait exactement trente-six kilos ! Voilà donc un garçon qui a toujours suivi les ordonnances à la lettre et qui a obtenu de la médecine tout ce qu’il lui a demandé !
SOUS TOUTES RÉSERVES
(1898)
LETTRE D’UNE JEUNE PHARMACIENNE
Ma chère Maman,
Si je ne t’ai pas écrit, ces temps-ci, c’est que nous avons passé de tristes moments, et que je ne tenais pas à t’affliger. Au commencement du mois, nous nous sommes vus à bout de ressources, et tu as failli apprendre des nouvelles lamentables par le journal de notre localité.
Henri n’avait pas touché les trois cents francs qu’on lui avait promis. On devait de l’argent à tous les fournisseurs, qui ne voulaient plus nous livrer à crédit. Aussi, vois-tu, jeudi dernier, nous avons failli dîner à la strychnine. Mon mari était déjà descendu pour préparer la dose, dans son laboratoire…
Mais avant d’en venir à cette extrémité, je me suis agenouillée, chère maman, j’ai prié avec ferveur et ô miracle ! le timbre de la porte a retenti, un homme s’est précipité dans la boutique.
Dieu avait entendu ma prière : un cas d’angine diphtérique venait de se déclarer dans notre ville.
Le lendemain, autre cas chez le maire. Il est très riche, maman. Il a fait chercher à profusion des pinceaux, de l’iode, que sais-je ? enfin de quoi payer notre boucher.
La chance continuant, le domestique du château tombe de cheval et se casse la jambe. On lui fait l’amputation. Nous leur avons envoyé dix paquets d’ouate antiseptique, et du sublimé ! et du taffetas gommé, chère maman, trois mètres de taffetas gommé ! Et le soir même de ce jour, tout juste à point pour payer l’école de notre petit Gaston, un homme, à côté de chez nous, se fait mordre par un chien enragé !
Hier soir, nous sommes allés au théâtre où une troupe de passage jouait Le Carnaval d’un merle blanc. Mon mari m’a payé le spectacle, grâce à une petite épidémie de cholérine qui s’était déclarée dans l’après-midi à l’asile des vieillards.
Nous t’embrassons cent fois, maman. Embrasse papa.
LUCIENNE.
P. -S. – La Providence se lasserait-elle ? Il nous arrive un malheur : le père Galouche vient de mourir. C’était un si brave homme, et qui souffrait si régulièrement et si cruellement de crises hépatiques ! Il avait un bon compte à la maison.
LE TRIOMPHE DE LA MISE EN SCÈNE
En même temps que les deux proverbes de M. Pailleron : « Mieux vaut Ibsen… et Bjœrnson », la Comédie-Française joue La Grève des Forgerons, interprétée par M. Mounet-Sully et mise à la scène d’une façon luxueuse et dramatique.
Le théâtre représente la Cour d’assises avec les juges, les jurés, les avocats et jusqu’au public de la salle d’audience, qui commente de divers signes d’émotion et de stupeur le récit du vieux forgeron.
M. Claretie se propose de mettre également à la scène Le Vase brisé, de Sully-Prudhomme.
Le Vase brisé, cet exquis petit drame en vingt vers, sera interprété par tous les sociétaires.
Le décor – complètement neuf – sera celui d’un très élégant salon mondain.
Il est cinq heures du soir. Le jour tombe. On n’a pas encore apporté les lampes.
Les invités de Mme de Brévannes (Mme Pierson) sont disposés en groupe, près de la cheminée à droite, et près de la table à thé à gauche.
Il y a là le vieux général (Leloir), l’ingénieur-poète (Mounet-Sully), le viveur-loustic des salons (Truffier), le chirurgien-philosophe (Prudhon), la petite vicomtesse futée (Mlle Reichenberg), sans oublier M. de Féraudy, le gentilhomme campagnard.
Au lever du rideau, M. Raphaël Duflos (maître de maison correct et ombrageux), s’approche du guéridon placé au milieu de la scène, et s’écrie douloureusement, en portant les deux mains à son front :
Le vase où meurt cette verveine
D’un coup d’éventail fut fêlé !
(Profonde stupeur des invités.)
« Le coup dut l’effleurer à peine », dit Mme Blanche Pierson, toujours avec son air indulgent d’arranger les choses.
« Aucun bruit ne l’a révélé », appuie le vieux général, d’ailleurs un peu dur d’oreille.
Un domestique facétieux (Coquelin cadet) apporte alors une serviette et constate en essuyant le guéridon : « Son eau fraîche a fui goutte à goutte. »
« Le suc des fleurs s’est épuisé », affirme posément, et comme un qui s’y entend, M. Prudhon.
« Personne encore ne s’en doute », chuchote aux spectateurs, à l’avant-scène de droite, le finaud M. Truffier.
Mais M. Mounet-Sully a froncé terriblement son nez et sa lèvre, et s’est écrié d’une voix effarée : « N’y touchez pas !… »
« Il est brisé », murmure angéliquement Mlle Reichenberg.
Au premier jour, Les Deux Cortèges, sonnet à grand spectacle de M. Joséphin Soulary.
LES GRANDES PREMIÈRES
COMÉDIE-FRANÇAISE. – Première représentation de Maurice, ou les joies du retour, drame en trois actes et un prologue de M. Théodore X…
La pièce que la Comédie-Française vient de représenter avec un vif succès se distingue par une qualité maîtresse : une connaissance du cœur humain (et de la marine marchande) poussée à ses extrêmes limites.
L’auteur est une femme, paraît-il, une femme du plus grand monde dont on chuchotait le nom dans les couloirs. Et de vrai, à travers maintes scènes ou maints récits, on a senti plus d’une fois « battre un vrai cœur de mère » ! C’est le plus bel éloge qu’on puisse adresser à Maurice, ou les joies du retour.
Le capitaine Mornarthur (Prudhon), au moment de partir pour la Louisiane, adresse les plus sévères recommandations à sa jeune femme, la douce et timide Henriette (Mme Bartet).
Le capitaine Mornarthur, ancien lieutenant de frégate, est réputé dans la marine marchande pour son énergie presque féroce. Aussi n’a-t-on jamais entendu parler de révolte à bord de son bateau, le Saint-Adolphe.
Avant de quitter la France, Mornarthur dit à sa jeune femme : « Je vous confie, Madame, nos enfants. Vous m’en répondez sur votre tête. »
Ces enfants sont au nombre de trois : Louisette, six ans (Mlle Reichenberg) ; Charles, cinq ans (la petite Parfait), et Maurice, deux mois (paquet de linge).
Entre le prologue et le premier acte, trois ans se sont écoulés. Nous assistons, au lever du rideau, aux perplexités de Mme Mornarthur. Le capitaine va revenir d’un moment à l’autre. De graves événements se sont passés pendant son absence. Henriette nous les expose elle-même.
Deux jours à peine après le départ de son mari, elle a perdu son plus jeune enfant, le petit Maurice, dans un feu d’artifice.
Mme Bartet nous a dit merveilleusement le récit de cet incident touchant à la suite duquel la pauvre jeune femme revint à la maison, à demi folle de douleur d’avoir égaré son enfant, et pleine de terreur à la pensée des représailles du capitaine Mornarthur.
La mère d’Henriette (Mme Blanche Pierson), lui avait dit alors : « Tu as agi avec légèreté en égarant ton enfant. Tu es la plus coupable des mères. Mais comme le capitaine ne revient que dans trois ans, tu as le temps d’avoir un autre bébé. »
On retint donc à dîner, ce jour-là, un ami de la famille, Jules d’Albatros, jeune aéronaute distingué et bien bâti (Baillet).
Au bout de trois trimestres, Henriette mit au monde un enfant qui se trouva malheureusement être une fille. Tout était à recommencer !
À peine la malheureuse jeune femme était-elle remise de ses couches que Jules d’Albatros, prévenu par un petit bleu, se présentait donc chez Mme Mornarthur. Enfin, au bout de trois autres trimestres, naquit un petit garçon. La petite fille avait été envoyée en nourrice dans une campagne lointaine.
Mme Mornarthur, dans une scène avec sa mère, nous confie ses appréhensions. L’heure du retour approchant, on a rangé les enfants dans le fond de la scène. Louisette, qui a neuf ans, et Charlot qui en a huit, sont assez grands pour leur âge. Mais le nouveau Maurice, qui devrait accuser trois ans, paraît à peine quatorze ou quinze mois. On l’a calé entre deux tabourets, car il ne marche pas encore.
Deux Chinois et un Nègre font leur entrée, apportant les nombreux bagages du capitaine. Puis le brave officier, très digne, apparaît à son tour.
On lui présente les enfants. Il admire beaucoup Louisette et Charles. Mais il trouve le petit Maurice bien arriéré pour trois ans. C’est tout juste si l’enfant dit « papa » et il n’a que deux dents !
Cependant le capitaine est de bonne humeur, et toute la famille, sur une agréable musique de scène, chante l’hymne du retour. Puis Mornarthur distribue les cadeaux qu’il a rapportés des pays exotiques, un plumeau à plumes multicolores pour sa femme, et du chocolat pour les enfants.
Au commencement du deuxième acte, sept nouvelles années se sont écoulées. On attend une fois de plus le capitaine qui est reparti presque tout de suite, et qui est donc absent depuis près de sept ans. Au moment de son départ, sa femme était dans une position intéressante. Il lui avait recommandé en partant de faire de bonnes couches.
Elle avait exagéré ses prescriptions en faisant de bonnes couches non seulement l’année suivante, mais encore deux ans après, et une troisième fois quatre ans après. L’aîné de cette seconde série d’enfants avait donc près de sept ans, le second cinq ans et le troisième trois ans.
On les présentera au capitaine comme trois jumeaux, nés quelques mois après son départ.
Mornarthur, précédé de son Nègre et de ses deux Chinois, entre en scène, sensiblement plus vieux qu’à l’acte précédent.
On lui présente les jumeaux. Il se contente de faire remarquer qu’ils n’ont pas également profité.
Puis il distribue les cadeaux, un plumeau pour sa femme et un bracelet de cuivre à tirer en tombola entre ses nombreux enfants.
Entre le deuxième et le troisième acte, il s’écoule un intervalle encore plus long : dix ans. Le capitaine est parti pour une nouvelle traversée et, plus heureux que Dumont d’Urville, il a péri dans un naufrage.
Les affaires conjugales de Mme Mornarthur sont donc arrangées au mieux. L’aéronaute a trouvé une belle place dans un aérostat qui fait les foires de banlieue. Les filles de Mme Mornarthur feront de riches mariages. Ses fils sont, suivant leur âge, élèves de l’École polytechnique, du Prytanée de la Flèche, ou lauréats de l’Académie Goncourt.
Cependant la pauvre femme n’est pas heureuse. Elle pense toujours à Maurice, son troisième enfant, perdu dans un feu d’artifice, et que la tendresse des autres n’a pu lui faire oublier.
La toile se lève sur un bal à l’ambassade d’Angleterre. Mme Mornarthur fait ses confidences à une amie. Il y a précisément vingt et un ans, jour pour jour, qu’elle a perdu son enfant.
À ce moment un jeune aspirant (Albert Lambert) entre en scène. Il a probablement vingt et un ans. Mme Mornarthur s’approche de lui, et d’une voix qu’elle s’efforce de rendre calme, elle lui demande s’il a encore sa mère.
« Oui, Madame », répond l’aspirant avec bonhomie.
Mais Mme Mornarthur a tressailli.
« Là… mon enfant !… s’écrie-t-elle d’une voix entrecoupée. Là… près de votre œil gauche… une petite tache noire !
— Je vous remercie, Madame », répond avec reconnaissance le jeune aspirant.
Et prenant son mouchoir, qu’il mouille d’un peu de salive, il fait disparaître la petite tache.
Après cette déception, Mme Mornarthur quitte la scène, que viennent d’envahir une foule de valseurs. Peu de temps après, dans la coulisse, on entend une détonation…
C’est le pétard annonçant que la fête commence dans les jardins. Les amateurs de scandale en sont pour leurs frais.
Telle est cette pièce fort intéressante et fort bien jouée, mais qui m’a paru un peu décousue et assez mal construite.
LA FIANCÉE DU STATISTICIEN
Ce fut avec une vive émotion que, le matin du grand jour, Mme Duramage pénétra dans la chambre encore virginale de sa fille.
Berthe était couchée. Sa lourde natte blonde s’était dénouée pendant son sommeil et ses 70 000 cheveux, comme autant de fils d’or, s’étaient répandus sur l’oreiller.
« Puisque c’est aujourd’hui que tu dois épouser M. Beaumartin, dit Mme Duramage…
— Je sais ce dont tu veux parler », interrompit la jeune fille.
« Il y a huit cent millions de femmes à la surface du globe, poursuivit-elle d’une voie assurée.
« Défalquons de ce total un chiffre de deux cent cinquante millions représentant les femmes qui meurent trop jeunes pour connaître l’amour.
« Parmi celles qui dépassent l’âge normal, il en est assurément qui restent chastes toute leur vie, mais ce nombre, assez insignifiant, est amplement compensé par celui des dames qui décèdent initiées, avant l’âge habituel des premiers essais.
« Le contingent des cinq cent cinquante millions de femmes à initier, se renouvelant en cinquante ans, nous donne un chiffre de onze millions d’initiées par an, soit trente mille par jour.
« Ainsi, dans les vingt-quatre heures qui vont s’écouler, trente mille dames, blanches, noires, jaunes ou cuivrées, subiront les premiers hommages.
« Je vais donc simplement faire partie, moi trente millième, de ce vaste contingent quadricolore.
« Dans ces conditions, ma bonne mère, peux-tu exiger qu’une aventure si commune me trouble et me révolutionne, et que mon sein se soulève à raison de trente-cinq à quarante aspirations par minute, au lieu des vingt aspirations normales ? »
Et Berthe, se tournant sans dire plus du côté de la ruelle, relut avec intérêt la dernière lettre de son fiancé :
… Je ne vous écrirai pas, ma chère, que vous êtes la plus jolie femme du monde. Car cette affirmation hasardée nuirait au simple constat d’une impression par elle-même assez élogieuse : je tiens pour certain qu’un jury impartial, étant donné la pureté de vos lignes, l’éclat de votre regard et la fraîcheur de votre teint, vous classerait parmi les quatre cents plus jolies femmes du type dit européen.
INSTRUIRE EN AMUSANT
Je signale à M. Paul Desjardins, qui s’efforce de moraliser la foule par l’image, la façon dont nos proviseurs de lycée moralisent la jeunesse par le livre.
La question n’est peut-être pas du rayon de M. Paul Desjardins, mais il pourra en parler à un de ces messieurs de la philanthropie.
Mon fils, qui a huit ans, a reçu pour son premier prix d’orthographe, un ouvrage assez répandu, paraît-il, et intitulé les Contes de Perrault.
Or, j’ai trouvé là-dedans une certaine histoire, qui s’appelle le Chat botté, et qui est exactement l’apologie du faiseur, du maître-chanteur et du chevalier d’industrie.
On y voit en effet un fils de meunier, laissé sans héritage, recourir aux pires moyens pour se procurer une belle position sociale.
Il commence naturellement par s’affubler d’un titre nobiliaire et par se faire appeler le marquis de Carabas.
Puis il entreprend de chambrer un monarque un peu gâteux, à qui il fait parvenir divers présents de gibier qu’il s’est procurés par le braconnage.
Il s’arrange ensuite pour se trouver au bord d’un fleuve, dans un costume de bain des plus sommaires, à l’heure précise où le roi doit passer avec sa fille sur le chemin de halage.
Comme il clame bien haut qu’on lui a volé ses habits, le roi s’empresse de le faire habiller richement avec les laissés-pour-compte des grands seigneurs.
Puis le Carabas s’installe dans le carrosse royal et fait de l’œil à la malheureuse princesse. « Il ne lui eut pas jeté deux ou trois regards, fort respectueux et un peu tendres, qu’elle en devint amoureuse à la folie. »
Cependant le chat botté est parti en émissaire sur le chemin que doit suivre le carrosse. Il enjoint violemment aux moissonneurs d’affirmer bien haut que les terrains en bordure de la route appartiennent au marquis de Carabas. Il les force à ces fausses déclarations en les menaçant de les « hacher menu comme chair à pâté » (textuel).
Or il existait déjà, à cette époque, des dispositions légales, résumées depuis dans les articles 305 et 307 du Code pénal, qui punissaient de peines assez dures les menaces de ce genre.
À retenir également l’article 405 du même Code d’après lequel « quiconque fait usage de faux noms ou qualités, ou emploie des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de crédit imaginaire », est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans.
Passons sous silence un épisode invraisemblable d’ogre changé en souris et avalé par un chat. Ce trait n’a été ajouté que pour embellir d’un peu de merveilleux cette vulgaire histoire d’escroquerie.
Il eût semblé naturel, pour l’édification des lecteurs, qu’après cette série d’aimables actions, les deux chenapans reçussent le châtiment prévu par les lois.
Vous ne connaissez pas M. Charles Perrault !
Le fils du meunier épouse la fille du roi, tout simplement, et son complice est chargé des plus grands honneurs.
Il nous reste encore, après cela, l’espoir que le conteur va s’indigner et gémir sur l’impiété d’un monde où l’escroquerie trouve une si belle récompense.
Or M. Perrault conclut par ces vers, placés impudemment sous le titre : Morale :
Aux jeunes gens, pour l’ordinaire,
L’industrie et le savoir-faire
Valent mieux que les biens acquis.
Ainsi donc, prendre un faux titre, filouter son prochain, persuader l’existence d’un crédit imaginaire, menacer les gens à main armée, cela s’appelle, pour M. Charles Perrault, avoir de l’industrie et du savoir-faire, et l’on en est brillamment récompensé !
Instruisez-vous, petits enfants.
AUTEURS, ACTEURS, SPECTATEURS
CE QUE PARLER VEUT DIRE
Bien que je sois encore un tout jeune homme (vingt ans et des, comme on dit en Belgique), je suis un vieux routier de théâtre. J’ai un excédent de bagage imposant. Si je n’ai pas fait jouer quarante pièces, je n’en ai pas fait jouer une… Or, sachez-le, jeunes gens, à chacune de mes répétitions générales, j’assiste, dans la salle, au premier contact de mon œuvre et du public… C’est un plaisir, qui ne fait pas toujours plaisir, mais c’est tout de même un plaisir.
Quand on est mêlé au public, il se passe ce phénomène curieux qu’aussitôt que l’on s’est identifié à lui, on finit par savoir, au bout de très peu de temps d’audition commune, si tel ou tel mot va porter. Et l’on prend l’habitude excellente de donner toujours raison au public contre soi. Car il a toujours raison contre vous.
Il faut vous dire, jeunes auteurs, que si vous ne lui plaisez pas, c’est toujours votre faute, ou celle de vos interprètes.
Ceci n’est pas pour vous conseiller de lui faire des concessions. Jamais de concessions ! D’ailleurs, il est très difficile de savoir quelles concessions il faut faire…
Très souvent, il arrive que le public exagère ses manifestations. On l’a vu « emboîter » tel drame, pour s’amuser. Mais la faute initiale incombait à l’auteur, ou à l’interprétation.
Je parle ici du premier public, de celui qui n’a pas lu les journaux, ou entendu des gens parler de la pièce… L’important est de ne pas lui laisser subir d’autres influences que celle de l’auteur. C’est pour cette raison qu’une pièce en un acte, où l’on tient constamment le spectateur par le bouton de son paletot, est cent fois plus facile qu’une pièce en trois actes, où il y a des entractes, où on lâche dans les couloirs ce public inconstant et volage. C’est dans ces endroits dangereux qu’il viciera son impression en essayant de l’exprimer.
Quand ils reviendront du café ou de la rue glaciale, quand ils auront jeté trop tôt leur cigarette, ou rencontré quelqu’un qui leur aura dit quelque chose de désagréable, ils ne seront plus à vous, et ce sera tout une affaire pour les « ravoir ». Aussi, tâchez de les conquérir sérieusement dans le premier acte.
Voilà de ces choses dont on se rend compte lorsqu’on écoute ses pièces dans la salle. C’est une excellente école. On s’apercevra de ses erreurs et, la fois suivante, on ne les commettra plus. (On en commettra d’autres, bien entendu. Car il y a le choix.)
C’était dans un théâtre du boulevard, il y a six ans. On jouait de moi une pièce gaie, dont je garde un souvenir très attendri, car elle est morte jeune.
Pendant les dernières (ou les premières, si vous voulez) représentations, mes camarades me racontaient toutes sortes d’histoires, à propos de ce frêle ouvrage. Il paraît qu’on avait supprimé le vestiaire, et laissé autour de chaque spectateur cinq fauteuils vides, pour qu’il y mît son pardessus, son chapeau, son cache-nez, son programme et sa lorgnette.
Un jour, quelqu’un me dit : « J’ai passé ce soir à votre théâtre. Il y a eu un scandale. Un contrôleur a emporté la recette, pour s’acheter un paquet de tabac. »
Ces fâcheuses plaisanteries ne me troublaient plus. J’en avais pris mon parti. Mais, le soir de la répétition générale, je n’étais pas encore résigné. Caché au fond d’une baignoire, pendant le deuxième acte, j’écoutais et j’évaluais les rires de la salle. On riait certainement, mais pas avec ensemble. Ce n’était pas l’orchestre de rires, bien fondu, qui se déchaîne aux pièces vraiment comiques.
Le rideau, à la fin de l’acte, se releva deux ou trois fois sous l’effort consciencieux d’une centaine de mains amies. Ça faisait presque autant de volume qu’un vrai enthousiasme ; mais ça ne sonnait pas de la même façon. C’était le coup sec, dur, de l’applaudissement décidé.
Allons ! Je me rendis dans les coulisses pour attendre les félicitations… Il en vient toujours. Mais l’arrière-ban ne donnait pas. C’était seulement l’armée active des amis résolus. On ne m’amena pas ce soir-là l’octogénaire tremblant, jadis acteur célèbre, qui veut, avant de mourir, faire la connaissance de l’auteur.
Mais j’eus cependant mon compte de :
« Eh bien, mon vieux, ça va ? »
« J’espère que vous êtes content ! »
« Mon cher, c’est un vrai succès… » (Et la voix tombe un peu, sur la fin du mot succès.)
« Mon bon ami, j’ai dans la loge à côté de moi une dame que je ne connais pas. Elle est malade de rire. »
J’attendais le gaffeur légendaire, qui aborde l’auteur en lui serrant fortement la main, et lui dit avec énergie : « Moi, je trouve ça très bien ! »
Les plus sincères vous disent que « ça n’a pas été tout à fait comme ça aurait dû », ou bien : « Oh ! que vous êtes mal joué ! » Ce dernier compliment est terrible ; on sait ce qu’il signifie.
***
Je pensais : « Qu’est-ce que je vais prendre dans la presse ? »
Eh bien, ce fut un concert de louanges, discrètes, mais très douces. Encore meurtri de l’aventure, j’étais étendu sur mon lit, entouré de coupures de journaux, et il me semblait que des sœurs de charité, ayant le visage de Catulle Mendès et de quelques autres critiques, se promenaient doucement dans ma chambre et me calmaient avec des épithètes lénitives.
Vraiment, on n’est pas juste pour les critiques.
Ils exercent un métier effrayant. Il faut que dans notre société polie, ils disent des choses désagréables à leur prochain le plus susceptible, à un moment de sa vie où ce prochain est le plus excité, le plus aveuglé. C’est bien simple : un auteur ne supporte plus les réserves. Il lui semble impossible qu’elles viennent d’un esprit impartial ou judicieux. Alors, il prête au critique le plus intègre les plus mesquins partis pris.
Obligé d’être doux avec les auteurs qu’il connaît, à qui il serre la main, le critique ne peut réserver sa sévérité aux auteurs qu’il ne connaît pas. Cette sévérité – inusitée – n’en paraîtrait que plus dure. Alors, la critique est réduite à des euphémismes dont il faut avoir la clef.
Elle ne prononcera plus le mot : insuccès, ni l’autre mot, discrédité, de succès d’estime. Elle préférera les expressions de : « gentil succès, succès assez vif ».
Un succès qui n’est pas franc s’appellera « un franc succès ».
Une pièce qui ne passe pas la rampe est une œuvre distinguée (rien ne déplaît autant aux auteurs que cette épithète accablante).
Les fours « d’art » sont de « belles et courageuses tentatives ».
Quelquefois – car le directeur de journal tient à ce que le lecteur soit informé – quelquefois le critique est obligé de constater que la pièce a été « cueillie ».
« Le drame de M. X… n’a pas été sans rencontrer, par moments, une petite résistance… »
Petite résistance veut dire : Rires grossiers continuels, et cris d’animaux.
Parfois, les expressions : grand succès, gros succès, correspondent à un succès véritable, « succès éclatant », c’est presque toujours un succès.
Quant au mot « triomphe », il est impossible de savoir ce qu’il veut exprimer.
AMANTS ET VOLEURS
(1905)
HARDI, POITEVIN !
« Tiens mieux que ça ton guidon, Lefèvre. C’est rien que tu bûches, toi, mais tu ferais bûcher Gaston. Et puis, éteins ta lanterne… Ça y gêne les yeux, à Gaston… Ça va, ça va, mon petit Gaston… Nous roulons à quarante à l’heure… De ce train-là… D’ici le prochain contrôle… Nous allons lui prendre encore cinq minutes…
— Quelle heure qu’il est, Grangé ?
— Minuit passé…
— À quelle distance qu’il est, par-derrière ?…
— Parle pas, mon fils. Tiens ta bouche fermée… Où c’est qu’il est ? Je sais pas au juste… Il n’est pas loin. T’endors pas… Si nous lui avons pris… un kilomètre… c’est bien tout.
— Tu blagues… Il est plus loin que ça… Tu me dis qu’il est là pour me presser. Tu me prends pour un gosse… Dis-moi exactement…
— Je t’affirme que je sais pas au juste où c’est qu’il est… Il est pas loin, ce qu’il y a de sûr. Et tu risques rien d’en mettre… Y a six heures tantôt que tu roules… C’était bien à c’ moment ici qu’il s’agissait de le décramponner. Il serait été avec toi sur la fin du parcours, qu’il t’aurait eu… Il a plus de résistance que toi, mon gars… Oh ! oh ! mon Lefèvre, l’entraîneur à la manque, tu faiblis ! Mouve-toi un peu… Du courage. On va te relayer dans un moment. Y a Weisner, le Prusco, qui nous attend plus loin sur la route. Il reprendra Gaston.
— C’est bien une drôle d’idée d’avoir engagé ce Weisner !
— Ah ! là-dessus, mon Lefèvre, ce que nous dirons ou rien, ce sera le même blot. C’est pas faute que je l’aie répété à meussieur Gripau, le directeur sportif de L’Excelsior. J’y ai dit tout ce qu’il fallait dire… que je m’y fiais pas du tout à ce Prusco-là, que si notre Gaston venait à faiblir et qu’on soye des fois obligé de le tirer au fil de fer pour y faire monter les côtes, ça ne serait jamais prudent de faire de ces trucs-là devant le Prusco… Mais qu’est-ce que tu veux ? Il a ce Weisner à la bonne… « Oui, oui, qu’y m’a fait, vous direz ce que vous voudrez. Weisner a du train. Il est solide pour tirer un homme pendant cinquante kilomètres à bonne allure. » C’est vrai qu’il a du train… Mais il n’est pas le seul… On aurait aussi bien engagé le petit Thiébaut, l’amateur, qu’il aurait fait l’affaire, et on l’aurait eu pour trois louis… au lieu que mon Weisner touche pour le moins cent cinquante francs…
— Tu l’appelles Prusco… Est-il de Prusse ?
— Oh ! j’en sais rien s’il est Prusco, Bavarois ou Luxembourgeois. C’est de ces alentours-là, en tout cas.
— Dis donc, Grangé ?
— Qu’est-ce qu’y a, mon Gaston ?
— Weisner va remplacer Lefèvre. Mais toi, tu vas pas encore me lâcher ?
— Non, non, Gaston, je reste à côté de toi. Je suis encore bon pour une trentaine de kilomètres. Au contrôle, je m’appuie le train express, et je te reprendrai demain matin, par là, vers Melun, pour arriver à Paris avec toi. Tu comprends, mon bébé, je tiens à faire mon entrée l’après-midi, dans le vélodrome, en ta compagnie… Ce qu’on va t’acclamer aux populaires !… Ce que ça sera chic, mon Gaston… d’avoir gratté Châtel… le fameux Châtel… l’invincible menuisier, comme i disent dans les journaux. Et après-demain… les grands placards aux annonces : « Premier, Gaston Poitevin ! sur machine Excelsior !… À la Libertas, ils vont en baver des soucoupes !… Penses-tu, leur Châtel, leur fameux champion… dans les choux !… Oh ! oh ! mon Lefèvre ! T’excite pas trop… C’est un peu vite, maintenant. Tu sens l’écurie, vieux fainéant !
— Hop !
— Tiens ! v’là Weisner devant nous. C’est toi, l’Alleboche ?
— C’est moi. Presque je fous ai manqués. Fous afez de l’afance ?
— Si nous avons de l’avance ! Nous sommes pre, mon vieux cochon ! Entends-tu ? Pre ! Nous grattons Châtel… Allons, colle-toi devant Poitevin, et tâche à y mener un train régulier.
— Non, non, Grangé ! J’aime mieux que Weisner se mette à côté… Le vent vient de travers… Et puis… dans la nuit, j’ai peur de toucher sa roue et de peller.
— Eh bien, c’est ça. Reste à côté, Weisner. Mon vieux Lefèvre, tu peux t’en aller. Par où qu’est la station, Weisner ?
— La bremière route sus la cauche. La care est à teux kilomètres.
— T’entends, Lefèvre ? Tu prends le chemin de fer. Et tu descendras à Melun. D’ailleurs, on se reverra bien dans le train. À tantôt, mon Févrot.
— À tantôt… V’là ma route…
— Dis donc, Grangé ?
— Gaston ?
— T’entends personne par-derrière nous ?… J’avais cru entendre… un coup de trompe… Le grand Godin, qui entraîne Châtel… Je sais qu’il a mis une trompe sur sa machine… pour faire garer les voitures de foin…
— Moi, je sais pas, j’entends rien. T’entends rien, l’Alleboche ?
— Attendez ! Je crois ch’entends quelque chose. Mais je crois pas c’est un drompe.
— Ah ! non de l’ là, Grangé, ça y est ! Ils vont rappliquer sur nous ! Les voilà qui vont recoller !
— C’est pas possible du moment, Gaston. En plat, à l’allure que nous faisons, Châtel ne rattrapera rien. Seulement, comme je te le dis, il faut en mettre… Allons-y, garçon !…
— Mais s’ils le tirent à la ficelle ?
— Ah ! bien, s’ils le tirent ! Mais même le tirant, il faudra qu’ils aillent un sacré train pour nous avoir… Ils auraient une auto… mais les autos sont défendues pour entraîner… Il est vrai qu’il a des hommes vites avec lui… Pousse, mon vieux !
— Ah ! nom de Tieu !
— De quoi, Weisner ?
— Je crois nous afons fait une caffe !
— Une gaffe ? En quoi faisant ?
— Afons-nous pas laissé tout de suite une route sur la troite ?
— Je ne sais pas… Bon ! C’est toi qu’étais chargé de savoir le chemin par ici… Tu nous as pas fait tromper, bougre de cochon ?
— Non, non, ne ralentissez pas ! Cette route ici, il est pas plus long comme l’autre. Il rechoint l’autre d’ici une quinçaine de kilomètres. Je crois seulement qu’il est tanchereux.
— Dangereux ? Qu’est-ce qu’i raconte ?
— Oui, je crois, je suis pas sûr, nous sommes sur un chemin qui suit le côté du mont, à la place que l’autre il traverse le plateau. Sur la cauche, plus loin, il y a un brécipice de cinquante, soixante mètres profond. Nous allons arrifer dans une tescente, lequel tourne subitt. Si tu vas tout droit au lieu que tu tournes, tu dois tomper dans le brécipice.
— Ah zut ! Grangé, je ne marche plus ! Des histoires comme ça, ça me coupe les jambes.
— Quelle brute que ce Weisner ! T’avais besoin de te tromper. Et quand t’as vu que tu t’avais trompé, t’avais bien besoin de lui raconter ça ! Tu nous aurais prévenus de ralentir au moment… C’est à une descente ?
— Oui, on sent cela. La tescente, elle est prusque pendant teux, trois cents mètres. Après, cela tourne. Et après, cela est de nouveau pien.
— On ralentira quand ça deviendra brusque. Mais c’était bien la peine, dis, que tu t’en ailles reconnaître la route !
— J’y étais avec le journaliste, l’orcanisateur. On a été reçu au Félo-Club, on a pu du champagne.
— Et tu étais plein comme un âne ! Sans doute que tu as vu des précipices où c’est qu’y en avait pas.
— Attention, Grangé, voilà que ça descend…
— Retenons… T’as pas besoin de retenir autant que ça, Gaston, ça fatigue et ça perd du temps. Ah ! nom de nom ! c’est malheureux de ne pas profiter de cette descente-là ! Eh bien ?… Ça ne tourne pas encore ?
— Grangé, on pourrait peut-être allumer une lanterne ?
— Tu parles qu’on va arrêter pour allumer ! Et puis la nuit a beau êt’ noire, on voit toujours un peu le blanc de la route, tandis qu’avec la lanterne on s’éblouit… Eh bien, Weisner, ça ne tourne pas ? Et voilà que ça ne descend plus !… Ah ! nom de nom de vache ! Quels boniments que tu nous fais avec ton précipice ?
— C’est pourtant bien la route que je disais !
— Tout ça n’est pas clair, Weisner. Je t’ai à l’œil, tu sais. Tu nous fais ralentir pour rien. Tu coupes les jambes à Gaston. On perd du temps… Je me demande pourquoi tu fais ça…
— Grangé, des pareilles choses fous ne defez pas dire. Vous poufez demander partout, afenue de la Grande-Armée, si je suis un homme malhonnête !…
— Allons, Grangé, tais-toi. C’est moi qui te parle maintenant. T’es tout le temps à suspecter le monde. Weisner s’a trompé, voilà tout.
— Le brécipice que je dis, peut-être était-il pas à la première tescente. Cela, je me soufiens pas exactement.
— Parbleu ! t’avais le nez sale ! T’étais soûl comme un cochon !
— Je crois de nouveau cela retescend.
— Ah non ! cette fois, on ne ralentit plus ! Hardi, Gaston ! Eh bien quoi ? V’là que tu restes en arrière ?
— Mon vieux, je veux bien être premier, mais je veux pas non plus me la casser.
— Ah ! nom de nom de chameau de Weisner ! Voilà c’ que t’es cause, avec tes boniments ! On ralentit encore !… Une si belle descente ! Pousse, Gaston !
— Non ! non !
— Weisner, tu nous fais perdre la course ! Si tu crois que ça va se passer comme ça !… Et voilà que ça ne descend plus !… Sale chameau ! Ah ! prends garde à ta roue d’avant ! J’en ai assez de ta hure ! Je vas te faire peller !
— Grangé, tais-toi, maintenant, et laisse-le tranquille. J’ai pas besoin de vos disputes. Si vous vous engueulez, je m’arrête et je descends !
— Tiens, v’là maintenant qu’on entend quéque chose par-derrière !
— Ch’entends pas…
— Tu diras jamais qu’ t’entends ! Sale tête d’Alleboche ! Tout ce que tu demandes, toi, c’est qu’on soye rattrapés !… Hardi, Gaston, pousse pour reprendre ce qu’on a perdu !
— J’ai la crampe d’avoir retenu.
— Je crois bien ! Ça coupe la cadence de la pédale. Mais ça va passer en poussant, cette crampe-là ! Hardi, mon petit Poitevin ! Pense à demain matin. Qu’est-ce qu’é va dire, ta petite femme ? C’est qu’il a une bath petite femme, ce mâtin-là ! Qu’est-ce qu’elle dira, dis, quand t’arriveras pre au Vélodrome ?
— J’y suis pas encore.
— T’y seras, que je te dis. Qu’est-ce tu vas te payer avec tout ce que tu vas gagner, mon Gaston ?… Tu vas gagner gros comme toi… Tu vas être riche du coup, mon bébé… Le prix de trois mille francs… plus deux mille francs de L’Excelsior… deux mille francs des pneumatiques… Sans compter un petit traité à sept-huit cents balles par mois pour l’année prochaine…
— T’entends rien derrière nous ?
— Non… Mets-en toujours, mon garçon, je vas te chanter pour te distraire…
C’est la course, la course, la course,
C’est la course qu’il nous faut !
— Je crois toujours entendre la trompe à Godin.
— C’est une idée. Et puis ils ne vont pas s’annoncer. Ils préféreront arriver sur nous en douceur.
— Oui… Mais i sont bien capables de sonner pour nous décourager et nous montrer qu’i sont sur nous, et que c’est plus la peine de pousser… Ah ! nom de d’ là, Grangé, il faut pas qu’ils nous aient ! Hardi ! Hardi !
— C’est bien, mon Gaston ! Voilà comme c’est que je t’aime !
— Ça retescend…
— Je m’en fous ! Poussons, Grangé !
— Pousse ! Vas-y, Gaston ! Vas-y aussi, l’Alleboche ! Et mets-toi bien sur la même ligne que nous, que Gaston voie que tu n’as pas peur. Bravo, Gaston !… Vive Poitevin !… Entends-tu l’ovation, demain, en arrivant au Vélodrome ? L’ovation sus tout le tour de la piste ! Les entends-tu gueuler, les populaires ?
C’est la course, la course, la course…
— Hep !
— Le brécip… »
L’INVITÉ
« Eh bien, ma femme, est-ce qu’on dîne bientôt ?
— Il est bon ! Il arrive à huit heures, et c’est lui qui s’impatiente ! Clémentine est prête depuis vingt minutes. Son filet va être trop cuit.
— Il y avait tellement de monde sur les boulevards ! Les dimanches de la belle saison !
— As-tu passé chez les enfants ?
— Oui, oui. J’ai vu Juliette et le petit. Il m’a dit : « Tu embrasseras grand-mère pour moi. » Allons ! mettons-nous à table !
— Mais tu sais qu’il y a quelqu’un au salon, un militaire ?
— Un militaire ?
— Oui, un simple soldat.
— Ah ! Est-ce que ce ne serait pas le fils Thierry ? Oui, ça doit être lui. C’est le fils du jardinier de Saint-Amand. Il fait son service à la caserne de la Pépinière.
— Et tu l’invites à dîner sans me prévenir ! Il y a largement de quoi… Mais tu aurais dû me le dire.
— Je ne savais pas qu’il viendrait précisément aujourd’hui. Je l’avais rencontré hier, sur le boulevard, et je lui avais dit de venir un de ces dimanches.
— Il n’a pas été long à profiter de l’invitation !
— Je suis sûr que c’est par politesse. Il a voulu par son empressement nous montrer qu’il y tenait. Les gens de la campagne sont comme ça, tu sais… Allons au salon… Il me fait l’effet d’un brave garçon un peu timide… Bonjour, Thierry.
— Bonjour, Monsieur !
— Madeleine, c’est le fils Thierry, de Saint-Amand… Allons, à table ! à table ! Un vieux ménage comme nous, Thierry, ça a des habitudes régulières. Et vous devez avoir faim aussi, mon garçon. Nous sommes en retard sur l’heure de la soupe… Tenez, mettez-vous là. Donne-lui une bonne assiettée, Madeleine… Moi, je ne pourrais pas dîner sans potage. C’est vrai ! Il me manquerait quelque chose. Je vous dirai que le potage, chez nous, est toujours très bon. Nous avons une cuisinière qui est ici depuis trente ans.
— Oui. C’est elle qui sert à table aujourd’hui parce que c’est le dimanche de sortie de la femme de chambre.
— Encore une assiettée de potage, Thierry ?
— Je veux bien, Monsieur.
— Vous n’en avez pas comme ça, à la caserne. On dit pourtant que la soupe n’est pas mauvaise, qu’il y a dedans parfois de bons os à moelle… Vous étouffez, dans votre capote. Vous êtes cramoisi. Vous pouvez la retirer, vous savez.
— Je vous remercie, Monsieur. Elle ne me gêne pas, Monsieur.
— C’est cette cravate bleue qui me serrerait. Quand je pense qu’ils font des trente à quarante kilomètres ainsi équipés, et le sac sur le dos ! On dira ce qu’on voudra ; mais pour la question des marches, le cavalier est moins malheureux. Pas vrai ?
— Ah ! ça, c’est certain, Monsieur !
— Seulement, il y a une chose que j’ai toujours pensée. C’est qu’arrivé à l’étape, le cavalier est obligé de s’occuper de son cheval. Tandis que le fantassin se trouve être libre comme l’air. Et c’est vraiment agréable, n’est-ce pas ?
— Oh ! oui, Monsieur, c’est bien agréable !
— Vous m’objecterez que le cavalier qui n’a pas fait la route à pied et qui n’a pas de sac, est par le fait moins fatigué en arrivant que le fantassin.
— Ah ! ça, Monsieur, c’est certain !
— Reprenez donc une bonne tranche de rôti. Vous avez combien de service maintenant ?
— Quatorze mois cinq jours, Monsieur.
— Ah ! Ah ! Et quand est-ce qu’on passe caporal ?
— Peut-être au départ de la classe, Monsieur.
— Vous serez content d’avoir les galons ?
— Oui, Monsieur, je serai content.
— Vous serez plus tranquille d’un sens. Mais d’un autre côté, vous aurez plus de responsabilité.
— Ah ! c’est bien certain, Monsieur !
— Reprenez encore du filet, allez !
— Je veux bien, Monsieur.
— À quelle heure est-ce que sonne le réveil ?
— Six heures et demie, l’hiver. L’été, ça sonne avant, Monsieur.
— Six heures ?
— Cinq heures et demie, Monsieur.
— Ah ! voyez-vous !… Il y a tant que ça de différence de l’hiver à l’été. Ça doit dépendre des régiments ?
— Probable, Monsieur !
— Ça dépend des régiments. Est-ce qu’on punit beaucoup dans votre régiment ?
— Comme ci, comme ça, Monsieur.
— Vous avez déjà eu des punitions ?
— Huit jours de consigne marqués au livret, Monsieur.
— Ah ! ah ! Et pour quel motif ?
— Inattention à la boxe, Monsieur.
— Gustave, tu ne laisses pas ce garçon manger. Encore des petits pois, monsieur Thierry ?
— Je veux bien, Madame.
— Dites donc, Thierry, vous irez aux manœuvres, cet été ?
— Je pense, Monsieur.
— De quel côté allez-vous ?
— On ne l’a point dit encore, Monsieur.
— Voyons… Qu’est-ce que je voulais vous demander ? Votre capote, vous la boutonnez d’un côté pendant la première quinzaine du mois, et de l’autre côté pendant la dernière ?
— C’est bien ça, Monsieur.
— Reprenez un peu de jambon, monsieur Thierry.
— Je veux bien, Madame.
— Vous prendrez du café ?
— Si vous en prenez, Madame.
— Nous n’en prenons pas le soir. Mais je suis bien sûre que la cuisinière en fait pour elle. Alors, vous en prenez ?
— C’est comme vous voudrez, Madame.
— Dites donc, Thierry, vous êtes au service depuis quatorze mois, vous avez donc fait les manœuvres une fois. Eh bien, vous avez certainement votre petite impression de troupier dans le rang. Entre nous – ça ne sortira pas d’ici – si la guerre, une supposition, venait à éclater, pensez-vous que nous serions prêts ?
— Je pense que oui, Monsieur.
— Eh bien, c’est mon avis aussi ! Je ne suis pas fâché d’avoir votre impression là-dessus. Tu entends, Madeleine ?
— Encore un peu de fromage, monsieur Thierry ?
— Je veux bien, Madame.
— On sonne, Madeleine.
— C’est Maurice.
— C’est mon beau-frère. Tous les dimanches, il passe nous prendre pour aller faire la petite partie chez une cousine à nous… Maurice, je te présente le fils Thierry, de Saint-Amand.
— Ah ! ah ! Un militaire ! Vous êtes caserné à Paris ?
— Oui, Monsieur.
— Ah ! ah !… Et depuis quand au service ?
— Quatorze mois cinq jours, Monsieur.
— Des punitions ?
— Huit jours de consigne au livret, Monsieur.
— Oui. Il a été puni pour distraction à la boxe. Un motif pas très grave. C’est un garçon bien tranquille. Vous fumez, Thierry ?
— Quelquefois, Monsieur.
— Vous fumerez bien un cigare ?
— Si vous voulez, Monsieur.
— Vous prenez du sucre dans votre café, monsieur Thierry ?
— Je veux bien, Madame.
— Un morceau, deux morceaux ?
— À votre convenance, Madame.
— C’est plutôt à votre goût. Vous préférez deux morceaux ?
— J’aime autant, Madame.
— Si tu avais été là, Maurice, tu aurais vu. Il nous a dit des choses très intéressantes… Neuf heures dix… Des choses très intéressantes… Quand vous voudrez vous en allez, Thierry, rejoindre vos camarades, ne vous gênez pas, vous savez.
— Oh ! Monsieur, je ne suis guère pressé !
— Oui. C’est que nous sommes obligés de sortir. Nous allons chez une cousine à nous.
— Si vous le permettez, Monsieur, Madame, je vas rester ici encore un moment jusqu’à tant qu’il ne pleuve plus !
— Comment donc ! On va desservir. Restez ici tant qu’il vous plaira… Eh bien, au revoir, mon garçon ! Maintenant que vous savez le chemin…
— Je ne pourrai guère venir avant dimanche prochain. La semaine, ça n’est guère possible.
— Oui… C’est que dimanche, précisément, j’ai peur que nous ne dînions pas à la maison.
— Si c’est ça, Monsieur, je pourrai toujours m’arranger pour venir dans le courant de la semaine !
— Oui… Ça serait très gentil… Je vous dirai que cette semaine nous allons être un peu sens dessus dessous… Je vous écrirai.
— Oh ! non, Monsieur ! Ne vous donnez pas la peine. Je viendrai sans que vous m’écriviez, Monsieur !
— Non, non, je préfère vous demander de venir. Voyez-vous que vous ne trouviez personne ?
— Oh ! ça ne ferait rien, Monsieur. Je reviendrai, Monsieur, Madame, jusqu’à tant que je vous trouve !
— Non, non… Attendez ma lettre… Maurice et Madeleine, je viens ! Au revoir, Thierry… Je vous écrirai…
— Au revoir, Monsieur. »
***
« Maintenant que les maîtres sont partis, Monsieur le soldat, je m’en vais desservir pour que vous soyez bien tranquille.
— Pensez-vous que je vais rester ici tout seul ? Je vous accompagne à la cuisine. Tenez, que je vous aide à enlever la vaisselle. Laissez donc… C’est rare si je ne porte pas ça tout seul. C’est-y dans c’te porte-là qu’on passe ?… Et dans c’te porte ici, maintenant… Oh ! oh ! la belle cuisine !
— Elle est bien vaste et bien claire. Il y a de ça quinze jours, mes deux filles sont venues avec leurs maris. Nous étions tous à l’aise là-dedans.
— Qu’est-ce que vous ferez de toute cette bonne soupe qui vous reste ?
— Je n’ai rien à en faire. Je vais la jeter.
— Faut point jeter c’te bonne soupe-là ! Je la mangerai plutôt !
— Mais vous avez déjà pris votre café et votre petit verre !
— Je dis qu’il ne faut pas jeter cette soupe-là !
— Ça vous fera du mal.
— Pensez-vous ! Une bonne soupe comme ça !… Et je vous aiderai à finir votre rôti !
— Quel appétit vous avez !
— Pas trop ! Mais je mange longtemps sans faim.
— Comme vous mangez vite ! Vous ne mangiez pas si vite à table !
— Je n’étais pas à mon aise. Je me gênais. Quand je ne suis point pour me gêner, c’est plutôt mon agrément de manger tant vite que je peux. Je me sens mieux remplir. Faut éviter de mettre de l’air entre les bouchées. Autrement, vous produisez des gaz. Alors l’estomac gonfle, gonfle et fait ballon.
— Je vois que vous aimez le rôti ! C’est égal, vous paraissez plus à l’aise que tout à l’heure, pour répondre à notre Monsieur : « Oui, Monsieur… Non, « Monsieur… » C’est tout ce que vous y répondiez.
— J’y demandais que de me laisser manger tranquille. C’est tout ce qu’y vous ont gardé de jambon ?
— J’en mange jamais.
— Bon. Quittez-le-moi !
— Prenez-le… Voilà que vous le mettez dans votre mouchoir ?
— J’en mangerai la moitié en me couchant. Et j’en vas placer un petit peu dessous mon traversin, des fois que je me réveille c’te nuit. Maintenant, je n’ai plus grand-faim. Quand j’aurai mangé mon fromage, bu par là-dessus deux ou trois coups de vin, il ne me faudra plus qu’une petite chose.
— Un verre d’eau-de-vie ?
— Ça s’entend !… C’est autre chose que je vous demande… Je vous demande de ne pas me laisser partir comme ça…
— Qu’est-ce qu’y dit ? Voulez-vous vous taire ? Et voulez-vous bien me lâcher ? En voilà des manières !
— Vous n’aurez pas le cœur de me laisser partir comme ça ?
— Lâchez-moi, que je vous dis !… Je crie !
— Tu ne crieras pas !
— Vilain gamin que vous êtes ! Lâchez-moi !… Moi qui serais facilement sa mère !… C’est qu’y ne me lâche pas ! Mon Dieu, Seigneur ! Et il m’emmène par là ! C’est la chambre à Madame !…
— Justement !
— Oh ! quelles manières ! quelles manières !… C’est qu’il est fort comme un hercule !… C’est qu’il n’y a pas moyen de résister !… Oh ! mon Dieu, Seigneur !… Oh ! le petit mal élevé !… Une veuve comme moi !… Y avait vingt-cinq ans !… »
LA VISITE DES BAGAGES
« Il y a déjà quelques années de cela, me dit le petit Tabac.
C’était un vieux marchand de paniers et de jardinières en osier qui nous avait donné le tuyau.
En faisant une tournée autour de Compiègne, il avait remarqué la maison isolée. La veuve V…, qui habitait là, était une vieille timbrée, qui n’avait pas de bonne et ne sortait jamais de chez elle. Les fournisseurs n’entraient même pas dans la maison. Ils déposaient, qui leurs paquets d’épicerie, qui leur beurre et leurs œufs sur un banc du jardin, et trouvaient la monnaie à côté, toute préparée.
Noël le Bosco me dit que puisqu’on nous avait raconté l’affaire à nous deux, on la ferait ensemble, et qu’il était inutile d’en toucher mot à personne. Avec quatre francs qu’il avait, j’achetai une petite malle d’occasion. Je ramassai dans un terrain vague quéques méchants bouts de bois, quéques pavés pour donner du poids et ne pas transporter le colis à vide à Compiègne ; ce qui, en cas de pétard plus tard, était susceptible de donner une indication.
On avait convenu, en effet, que je ramènerais la malle à Paris, plutôt que de la quitter dans la maison ou dans la campagne. On pouvait s’arranger pour fermer la maison et faire croire que la vieille était partie en voyage. Moins vite naturellement qu’on ferait du pet sur cette affaire-là, mieux ça vaudrait pour nous. À Paris, nous n’étions pas embarrassés de nous en débarrasser. Nous avions un copain qui se chargeait de brûler le tout.
La nuit était presque tombée quand on se présenta chez la vieille. On était venu soi-disant pour lui placer des échantillons de vins. Nous savions qu’elle était sauvage, et nous étions inquiets de savoir si ça prendrait bien et si elle consentirait à nous laisser entrer chez elle. Ça prit parfaitement. Entrés dans son salon, l’affaire ne fut pas longue à expédier. J’ai vu souvent travailler Noël, mais jamais comme ce jour-là. En un rien de temps, cette dame qui était lourde pas mal, il l’avait empoignée par le cou et l’avait posée sur le canapé comme sur un établi. C’était un fameux ouvrier que ce bossu ! Mais ça n’était qu’un ouvrier. Et tout ce qui était combinaisons, précautions, c’était moi qu’il fallait que je l’imagine. Ça m’était bien dû, d’ailleurs, puisque je n’étais pas bon pour la grosse besogne et que j’avais envie de vomir rien qu’à tenir les jambes de la vieille, pendant que le Bosco lui pesait tranquillement sur le cou.
Quand le corps ne bougea plus, il nous fit l’effet d’être encore assez gros. Il tenait dans la malle, mais le couvercle venait juste par-dessus, et il ne chahuterait pas dedans ; ce qui valait mieux. La malle bouclée, on visita les meubles. On trouva quelque chose comme huit cents francs d’or dans les tiroirs, et on fit tomber encore une vingtaine de petites pièces de cinq francs en retournant une vieille bottine élégante en étoffe grise où cette originale avait eu l’idée de les carrer. Dans une théière, il y avait des médailles, des bijoux et des papiers de banque écrits en anglais à n’y rien comprendre, et qu’on emporta à tout hasard.
De travailler, de fureter, de se tourner de droite et de gauche, enfin de se donner du coton, ça empêche de penser à ce qui peut arriver par la suite. Quand on porta la malle tous les deux à la gare et quand on la fit enregistrer, je ne pensais même plus à ce qu’il y avait dedans. Ce qui nous avait décidés à ramener le colis par le train, c’est que je connaissais un copain à l’octroi de la gare du Nord, un appelé Filetet avec qui il n’y aurait sûrement pas de mousse pour la visite, et qui me laisserait emporter mon colis sans le faire ouvrir.
À Compiègne, on se serra la main avec le Bosco. Il prit le train sur la direction de Tergnier pour aller dire un petit bonjour à sa famille. Dans la maison de la vieille, il avait trouvé dans un coin une gentille poupée en porcelaine qu’il rapportait à sa petite nièce.
Une fois dans le train, à rester à rien faire, les nerfs se détendent, on n’a plus la surexcitation ; on a moins de courage. En passant vers Saint-Denis, en sentant approcher la gare du Nord, j’éprouvai comme une impatience de bouger et de m’en aller de ce wagon étroit.
Le train stoppa à n’en plus finir sous un des ponts de La Chapelle… Enfin il arriva au quai. Pendant qu’on descendait les bagages des fourgons et qu’on les amenait dans la grande salle, je filai dans la rue pour arrêter un sapin. Mais ce jour-là, il y avait courses quelque part, à Enghien, je crois. Des tas de trains arrivaient en même temps et les sapins du devant de la gare étaient tous enlevés au passage. Il fallut courir presque jusque vers la gare de l’Est pour en ramener un. Aussi quand je rentrai dans la salle des bagages, la plupart des colis étaient déjà enlevés. Il n’en restait plus que sept ou huit sur cette espèce de grand comptoir où l’on fait la visite. J’aperçus entre un paquet de linge et un mannequin ma petite malle noire.
Où donc était Filetet, mon pays de l’octroi ?
Je demandai après lui à un de ses collègues. Il me répondit que Filetet était malade et n’était pas venu depuis deux jours.
Je demandai alors à cet employé de venir marquer mon colis, pour que je puisse l’emporter. J’allai jusqu’à la malle, et il s’approchait derrière moi, un bout de craie à la main, quand j’aperçus, de l’autre côté du comptoir, une espèce de vérificateur en chef, avec un képi à trois galons. Il grinchait et il faisait de la rouspète, parce qu’il venait de s’attraper avec une dame pour la visite d’un colis.
Ma main était posée sur ma malle. Il demanda rudement si je n’avais rien à déclarer et, sans attendre ma réponse, il me dit d’ouvrir le colis.
Je sentis sur la nuque une impression pas ordinaire, comme si la peau se rétrécissait. Mes bras se mirent à trembler dans mes manches. Je tapai machinalement sur mes poches comme pour chercher mes clefs que je voulais pas trouver. Mais un employé était là avec un trousseau. Je jetai un coup d’œil sur la sortie : il y avait des hommes de l’octroi tout le long du chemin et deux encore à la porte. Déjà l’employé essayait les petites clefs de son trousseau.
Je restais là, sans plus savoir où j’étais, bien loin de tous ces gens et ne pensant plus à rien de rien. Enfin une clef entra dans la serrure et tourna. Le couvercle se renversa en arrière.
Alors je me mis à rire comme un imbécile : ce qu’il y avait dans la malle, c’étaient des petits tricots d’enfants, des chaussures, des savons, des faux cols. Et durant que les employés farfouillaient à travers, je me demandais qui avait pu emporter mon colis véritable, et qui s’en allait maintenant dans Paris, avec, à côté du cocher, le corps emballé de la veuve V… Et ce qui est mieux encore, c’est que jamais plus je n’ai entendu parler de cette affaire-là. La personne a-t-elle eu peur de raconter la chose et de s’attirer quelque désagrément ? Je n’en sais rien, mais je pense souvent en rigolant à la bonne figure qu’elle a dû faire, dès qu’elle a ouvert le colis. Dans sa malle à elle, j’ai trouvé ce gilet de laine que je porte depuis trois hivers et qui me tient bougrement chaud.
LA DERNIÈRE VISITE
« Madame Léon, laissez donc mon petit jupon. Vous le terminerez demain. J’aime mieux que vous vous mettiez aujourd’hui au pardessus de mon mari ; nous sortons ce soir, et si la doublure de la manche est encore déchirée, il n’en a pas fini de faire la vie. Je vais vous donner de la satinette que j’avais mise de côté pour une jupe à moi… Mais dites donc, madame Léon, qu’est-ce que vous avez ? On dirait que vous avez pleuré ?
— Rien, Madame, ce n’est rien.
— Allons, voyons, dites-moi ce que vous avez ?
— J’aimerais mieux n’en pas parler, Madame. Ça fait aujourd’hui quatre ans… de mon pauvre garçon…
— Vous avez perdu un fils ?
— Et de quelle façon, Madame !
— Je ne vous demande pas…
— Vous avez sans doute entendu parler de Hucheux ?… C’est mon vrai nom, Madame. Ici, à Paris, ça ne fait trop rien… parce que c’est en province, chez nous, que l’affaire a eu lieu. Il faut vous dire que je me suis mariée à vingt ans avec un jeune homme qui avait un an de moins que moi.
— Vous vous étiez plu ?
— Non, Madame. On était cousins. On s’est marié ; une idée qu’est venue un jour, parce qu’on se connaissait. On s’aimait comme cousins. On n’aurait jamais songé à s’aimer autrement. C’était un bon gros garçon, qui ne disait jamais grand-chose. On a été marié six semaines. Il est mort d’un chaud et froid. Je suis restée enceinte d’un petit, qu’est arrivé huit mois après.
« Sa fluxion de poitrine, mon mari l’avait attrapée à l’enterrement de sa tante, qu’avait une mercerie dans la ville où nous habitions. J’ai donc repris la boutique, question d’avoir un état, étant femme seule, plutôt que d’aller coudre chez l’un ou l’autre. Et je me suis mise à élever mon petit moi-même, sans vouloir épouser qui que ce soit qui ne manquait pas ; ils étaient trois après moi à me dire que j’étais jolie et à me proposer le mariage, même un monsieur qui était adjudant vaguemestre, et qui se faisait en plus de ça quarante francs par mois avec des écritures, chez un boucher.
« Mon petit a grandi gentiment. Je l’ai mis à l’école. Il était des mieux élevés et savant, toujours premier, Madame, pour l’arithmétique et l’orthographe. Jusqu’à dix-huit ans, ce petit garçon-là ne m’a donné que de la satisfaction. Jamais à sortir, à lire toujours. Je croyais que c’était bon et ça, lui perdait la tête. Il semblait bien que sous le rapport des femmes et de leur fréquentation, il tenait de son père, un homme plutôt tranquille, qui n’en savait pas plus que moi quand je l’ai connu. Et puis, Madame, tout à coup, dans la maison d’un de ses petits camarades, il a fait tout justement la connaissance d’une dame, qui était la femme d’un commerçant de l’endroit.
« Un jour, il vient me trouver et me dit : « Ma mère, il me faut absolument quatre mille francs. » Il savait que j’avais un peu d’argent de côté. Comme de juste, je lui demande qu’est-ce qu’il veut en faire. D’abord, il ne me le dit pas, et puis le voilà qui me raconte toute l’histoire, comme quoi il avait des rapports avec cette dame, comme quoi le mari de cette dame allait faire faillite, et qu’il voulait empêcher ça. Naturellement je refuse. Le voilà qui me fait une scène épouvantable. Mais qu’est-ce que vous voulez ? Je ne voulais pas donner une somme pareille. C’était pour lui que je la gardais. Et puis je ne savais pas où ça s’arrêterait. Et puis on ne donne pas l’argent comme ça.
« — Ah ! c’est ainsi, qu’il me dit, je vais le demander à parrain ! »
« Son parrain habitait dehors de ville, dans la dernière maison du faubourg. C’était un ancien fabricant de tonneaux, qui allait sur ses quatre-vingts ans. « Je connais ton parrain, que je dis. Il ne te prêtera rien, mon petit. Tu l’indisposeras contre toi, ce qui sera fâcheux. »
« Bon, il s’en va tout de même. C’était un peu après l’heure du dîner. Je l’attends jusqu’à onze heures du soir. Puis je me mets au lit.
« J’étais un peu inquiète. Mais enfin, ça lui était déjà arrivé une ou deux fois de découcher. Le lendemain matin, toujours pas d’Henri. C’était jour de marché, je m’en vas sur la place avec mon panier. Et voilà, Madame, ce que j’entends.
« C’étaient deux vieilles femmes de la campagne qui causaient à deux marchandes de légumes.
« — Oui, que disait l’une, il n’a pas dû faire résistance. Un vieillard de plus de cent ans. Il lui a tapé sa tête avec un chandelier de cuivre.
« — Ça doit être quelque chemineau qui s’aura dit qu’il y avait de l’argent chez le vieux tonnelier. »
« À ce moment, Madame, comment est-ce que j’ai pu tenir debout ; je ne me l’explique pas. J’avais des tremblements dans les jambes. Je ne savais plus où j’étais. J’entendais les volailles et les femmes, avec leurs cris qui chantaient sans discontinuer. Puis voilà que j’écoute d’autres personnes qui parlaient de la chose ; et qu’est-ce qu’elles disent, celles-là ? Que c’était un soldat en permission qu’avait fait le crime et qu’il était déjà en prison… Alors, je me suis sentie heureuse, heureuse, comme jamais je n’avais été. Le bruit du marché, c’était doux, doux. Ça sentait bon le beurre et la plume de poule.
« Je ne sais plus quoi que je vais acheter, un chou ou des carottes. Et voilà qu’on parle de la même histoire. Et voilà encore ce que j’entends…
« Une demoiselle, qu’était bonne chez le pharmacien, disait qu’on ne savait pas qui avait commis le crime. Je m’approche et je dis :
« — C’est un soldat en permission.
« — Non, non ! que dit cette jeune fille. On a bien arrêté un soldat, mais on l’a relâché tout de suite. Il a bien expliqué où c’est qu’il était au moment du crime. »
« Je rentre à la maison sans faire mon marché. Je ne pensais à rien. J’avais les jambes faibles, et j’étais comme écœurée. Mais je ne savais pas si j’étais malheureuse ou tranquille. Et voilà, Madame, voilà qu’en rentrant dans la chambre de mon garçon, qu’est-ce que je vois ? Henri avec une cuvette d’eau sur le parquet et qui lavait son paletot dedans.
« Je me suis mise à pleurer, à crier comme une folle. Il a pleuré aussi, en me disant de me taire.
« — Qu’est-ce que tu as fait là, mon Henri ? »
« Et je pleurais. Je pleurais comme je pleure à présent.
— Et vous n’aviez pas un peu peur de lui ? Un peu d’éloignement ?
— Pour mon petit, Madame !… Ah ! qu’il me faisait de la peine !… Il était là, sans bouger, sans penser à se sauver des gendarmes. C’est moi qui y ai dit de partir. Mais il ne pouvait pas s’en aller par la gare. Comme il montait bien à vélo et qu’il avait même vendu le sien toujours pour cette femme, je lui donne de l’argent pour qu’il s’en achète un autre, et ce qu’il lui fallait pour s’en aller quelque temps. Il m’embrasse, il me laisse toute seule à cacher ses vêtements ; ils n’étaient pas tachés, mais ils étaient mouillés et l’on pouvait se demander pourquoi il avait lavé des effets de drap qu’on donne plutôt d’habitude au dégraisseur. Quand la nuit est venue, je les ai enterrés dans le jardin.
« Je n’ai vu personne avant le lendemain. Deux hommes de chez le commissaire sont venus demander après mon fils. Et le procureur est arrivé lui-même. Il a cherché partout sans rien trouver. Moi, je leur ai répondu que mon enfant était parti depuis plusieurs jours. Et j’étais tranquille, si vous aviez vu ! Moi qui suis craintive pour parler aux personnes, je n’aurais jamais cru ça de moi, d’avoir tant d’aplomb pour mentir à ces messieurs-là. Mais puisqu’il fallait, il fallait.
« Je pensais que ça irait bien. Il n’y avait pas grandes charges contre Henri, et il ne reviendrait pas de sitôt. Il aurait pu très facilement se sauver et se mettre à l’abri. Seulement, qu’est-ce que vous voulez ? Il est revenu dans le pays deux jours après. Il ne pouvait pas s’arracher de cette femme. C’était un bon petit garçon, bien doux et bien timide. Mais depuis qu’il était pris par elle, il n’avait plus peur de rien. Il est revenu pour la voir passer. Il a rôdé autour de chez elle dans la rue des Chaumières. C’est alors qu’un gamin l’a rencontré, l’a dit à un autre, qui savait qu’on le cherchait, et qui l’a dit à Chevalet, le garde de ville. Et Chevalet, avec un de ses camarades, n’a eu qu’à venir le prendre au coin de la rue comme on prend un petit oiseau avec la main.
« On a été très bon pour moi, dans mon entourage. Les gens ne se privaient pas d’être gentils. Je sentais même que ça les flattait de faire les généreux, et même ils m’énervaient à me répéter que ce n’était pas de ma faute si j’avais mis au monde un être, comme ils disaient, dénaturé. Ils disaient que c’était un criminel endurci, un monstre effrayant, parce que la tête de la victime avait été tout écrasée à coups de chandelier. Moi, je pensais bien que ça s’était passé dans un moment d’affolement et que, s’il avait tapé comme un sauvage, c’était parce qu’il ne savait plus ce qu’il faisait. Cela, je l’ai répété bien des fois à son avocat, maître René Ginard. Mais il ne l’a jamais dit. D’ailleurs, il n’écoutait pas ce que je lui racontais. Je crois que j’avais fait un choix malheureux, de cet avocat-là ! C’était un jeune homme qui se remuait beaucoup, toujours à organiser des réunions de jeunes avocats, et avec ça pas beaucoup de causes. C’était un grand brun, très occupé de sa belle barbe frisée. Ce que je me suis sentie colère contre lui, aux assises ! Je voyais tant et tellement qu’il ne pensait qu’à parader, et des « Monsieur le Président » par-ci, et des « Monsieur l’Avocat général » par-là ! Notre malheur à nous, ça lui était bien égal !
« Le moment dur, c’est quand le jury s’est retiré et qu’on a attendu dans la salle d’audience. Le garçon du tribunal, avant que les jurés aient fini, est rentré dans la salle. Il venait de leur porter des lampes. Il a dit quelque chose aux avocats. Et ils m’ont tous regardée.
« Quand on a fait entrer Henri pour lui lire la sentence, il l’a écoutée tout droit. Puis il a regardé autour de lui comme pour me chercher. Il ne m’a pas vue. Il s’est retourné du côté du gendarme. Il a touché gentiment sa casquette en passant devant lui. Et il est sorti comme si de rien n’était.
« Je n’avais rien dit à l’avocat à propos de Fanny, la femme, car Henri m’avait fait jurer de n’en pas parler. Cette dame, vous pensez bien que je ne l’aimais pas, suffit qu’elle soye été la cause de tout ce malheur. Et puis, elle n’avait pas donné signe de vie depuis que mon gosse était en prison. Elle n’y avait seulement rien fait dire. C’était peut-être compréhensible, vu sa situation qu’elle devait ménager, et son mari, et ses enfants. Quand Henri me parlait d’elle et qu’il me paraissait triste de ne pas la voir, j’aurais voulu lui dire qu’il fallait l’excuser. Mais, tout de même, je ne pouvais pas. J’avais un sentiment, comme de la jalousie, de voir que je comptais moins que cette Fanny. J’avais beau me dire que les enfants sont comme ça, ça me faisait de la peine.
« Maître René Ginard était allé à Paris pour la grâce. Et beaucoup de personnes trouvaient très bien qu’il se dérange et qu’il aille voir le président de la République. Moi je sentais qu’il y allait pour le plaisir de faire des démarches, et pour avoir l’avantage de voir le chef de l’État… Tout ce voyage-là n’a servi à rien.
— Ça a dû être une époque terrible pour vous !
— J’ai peur de m’en rappeler, Madame. Et pourtant, à certains instants, je ne souffrais pas, je ne pensais à rien. On venait à la veillée, le soir. On parlait du procès, de choses et autres. Je faisais du vin chaud. Il me semblait, par moments, que je rêvais, que rien n’était arrivé.
« Et puis, tout à coup, une nuit, je me suis dit que ça approchait, et je me suis mise à grelotter dans mon lit. Alors j’ai pensé qu’il fallait savoir, dès la veille, quand est-ce que ça allait avoir lieu. Je passerais une nuit affreuse, mais du moins jusque-là, tous les soirs en me couchant, je n’aurais pas la peur d’apprendre quelque chose en me réveillant le matin. Alors tous les soirs, à la tombée du jour, à l’heure du train de Paris, je m’en allais rôdailler à la sortie des voyageurs. Et c’est comme ça qu’un soir j’ai vu arriver l’homme et ses deux employés. Ils avaient des pardessus gris et des chapeaux melons. Et ils ont fait charger sur une tapissière leur colis, qui était enveloppé dans des toiles.
« Il était environ sept heures du soir. J’avais vu Henri la veille au matin, et je devais le revoir deux jours après. Je ne pouvais pas quitter ce petit-là sans lui dire adieu.
« Je savais très bien qu’on ne pouvait pas entrer dans la prison en dehors des heures indiquées. Mais je connaissais M. Bellot, le gardien-chef, et je me suis dit qu’il me donnerait peut-être la permission. Quand je suis entrée dans sa salle à manger, c’est bête ce qu’on se rappelle, je vois toujours son saladier de pommes de terre sur la table. Il mangeait avec sa dame et ses enfants. J’entre donc et je me mets à pleurer, sans pouvoir rien dire. Il savait à quoi s’en tenir sur le lendemain matin, car il ne me demande pas pourquoi je pleure. « Monsieur Bellot, que je dis, je veux le revoir ! – Ah ! Madame, qu’il me répond, c’est impossible ! Je serais révoqué sûr et certain… » Mais il m’a vue si malheureuse qu’il a eu pitié, et qu’il m’a dit de venir avec lui dans sa tournée, et que je pourrais embrasser mon garçon, en passant, une petite seconde… Nous voilà donc partis dans les couloirs. C’était une très vieille prison, où la nuit était toute sombre. C’est à peine si on voyait les lampes à chaque bout des corridors. M. Bellot tenait à la main sa lanterne qui n’éclairait que le plancher.
« Nous montons au second étage et nous arrivons devant une porte…
« — C’est là, qu’il me dit… Embrassez-le par le guichet… Hucheux, qu’il appelle à demi-voix. Il y a quelqu’un qui veut vous embrasser. »
« Alors j’ai plutôt deviné que vu qu’il était au guichet, et j’ai entendu qu’il disait à voix basse : – C’est toi, Fanny ! »
« En même temps il appuyait sa figure contre la mienne et m’embrassait comme personne ne m’avait jamais embrassée…
— Pauvre femme ! Ça a dû vous faire gros cœur, qu’il pense à l’autre ?…
— Moi, Madame ? Oh ! je ne songeais guère à ça. Il était si heureux ! si heureux ! Je sentais ça dans son baiser. Et je n’avais qu’une peur, c’était qu’il s’aperçoive qu’il se trompait. Aussi j’ai été contente quand le gardien m’a entraînée ! Et cette dernière nuit, qui m’effrayait tant, que je ne croyais pas pouvoir la passer vivante, eh bien, j’ai dormi jusqu’au grand jour. J’ai eu d’abord, en me réveillant, une défaillance affreuse en pensant que c’était fini. Puis j’ai pensé qu’il était mort heureux, et j’ai tricoté jusqu’au soir, sans rien dire, après un jersey à grosses mailles qui était à peine commencé et que j’ai terminé complètement dans ma journée. »
MORT DE PISTON
À Vaugirard, à l’hôtel Calcutta, j’ai connu un petit café où il en venait quelques-uns de bons, Charles Charlot, qui s’est établi à Clairvaux, et Bridaine, dit Riquet… qui a traversé la mer. Il y avait aussi là une mouche, un homme de la Sûreté, qui était brûlé et qui faisait semblant de ne pas s’en apercevoir afin qu’on ne le sorte pas du quartier où il avait ses habitudes. Enfin, j’y ai vu ce grand garçon que des fois on appelait Émile, et d’autres fois Télégraphe, parce qu’on l’avait employé pour porter des sacs, au bureau de poste.
Télégraphe était un grand garçon pâle, avec une moustache noire. Il m’en imposait beaucoup. Mais je crois qu’il n’était pas sans avoir pour moi une certaine considération. C’est moins par besoin de confidence que pour m’étonner un peu qu’il m’a raconté ses affaires.
« Vous vous rappelez le crime de la rue Galilée, l’assassinat de la fille Crouart ? m’a dit un soir Télégraphe.
« C’est après cette histoire-là que je me suis mis dans une bande, a-t-il ajouté après un long silence. J’ai vu qu’à travailler seul on risquait trop et qu’on n’avait pas grand-chose.
« Je m’en suis donné du mal pour cette histoire-là ! Elle en a fait du bruit, dans les journaux ! Mais chaque fois qu’on en parlait, j’étais tout tonteux. On disait : « L’assassin de la rue Galilée, en voilà un malin qui la connaissait ! » Je me serais bien giflé chaque fois que j’entendais ça. Et je me disais : ce qu’on se foutrait de sa fiole, à ce malin, si l’on savait ce qu’il a gagné rue Galilée, où il a éventré une demi-douzaine de tiroirs et forcé un secrétaire pour rapporter juste la peau. Mieux que ça, ce que je ne veux dire à personne qu’à vous, c’est que j’y ai laissé un pardessus tout neuf, un pardessus que j’avais chauffé la veille, aux courses de Longchamp. Non seulement que je ramenais peaudezébie, mais fallait encore que j’y soye du mien !
« Après donc cette affaire-là, c’est là que je me suis mis en bande. C’est moins battant, mais c’est plus sûr. La bande a des renseignements qu’un simple bibi, un margoulin comme vous et moi, ne peut pas se procurer s’il est tout seul. On ne travaille plus à l’aveuglette. On sait où c’est qu’on va.
« J’ai d’abord été dans la bande à Costo, dit Robert, qu’on appelait encore Gustave à Javel. Costo était un vieux nez fin, du temps que je l’ai connu. Il allait sus ses vingt-cinq ans. Il venait de terminer son congé. Ça rend paresseux d’ordinaire. Lui pourtant n’était pas fainéant. Une fois, rien que du samedi au lundi, on a couché quatre bonhommes dans la banlieue et déménagé deux villas. Son défaut, c’était d’être rapia. Il m’assurait comme aux autres mes huit francs par semaine, ce qui n’est pourtant pas vilain. Il vous payait en plus les frais d’omnibus et de chemin de fer, parce qu’on allait tous les jours en reconnaissance. C’était son système d’occuper ses gens l’après-midi, pour ne pas les laisser à rien faire. C’est bon, si vous voulez, et c’est mauvais d’un sens. Je serais plutôt pour envoyer des gosses, qui n’inspirent pas méfiance et qui n’ont l’air de rien. Vaut mieux pas faire remarquer celui qui doit travailler.
« Mais ce que mon Costo était chipoteur dans les comptes ! Pour se faire rembourser trois sous d’omnibus, c’était l’affaire d’une demi-journée. Le soir qu’on a été à Saint-Mandé et qu’on a étendu les deux gardes, on avait travaillé pendant trois heures ; on avait lutté à brasse-corps avec eux ; on les avait eus en force. Eh bien, mon Costo, en revenant, nous a payé un verre à la barrière ; ce verre-là, il nous l’a reproché pendant quinze jours !
« Le jour de la revendeuse, c’était un dimanche. On était quatre. On avait passé l’après-midi à la fête à Neuilly. Puis on avait été dîner au Vallois chez un ami. On devait se trouver à la Madeleine sur le coup de dix heures et demie, devant le passage. On descend donc du Vallois en tram. On prend l’intérieur, il tombait des siaux d’eau. Costo, qui payait comme de juste, prend quatre correspondances ; ça ne coûtait pas plus cher. Arrivés au passage, on monte chez la revendeuse et l’on fait un travail rapide, si bien qu’on a opéré la bonne femme et saisi les bijoux en moins de vingt-cinq minutes. Ma casquette était traversée de sueur. On décide de finir la soirée au boulevard Richard-Lenoir chez des filles que l’on connaissait. On va donc prendre l’omnibus à la station. Voilà-t-il pas mon Costo qui veut refiler ses quatre correspondances au contrôleur, qui dit qu’elles sont plus bonnes. De s’engueuler. Un rien de plus et nous allions tous au poste. C’était vraiment pas l’instant de nous faire remarquer.
« Du Costo, je suis été avec le Plombier. Le Plombier était moins ficelle que le Costo, mais son défaut c’est qu’il était pas hardi. Un maniaque. J’admets qu’on ait des précautions. Mais le Plombier, c’était à propos de tout et à propos de rien. Il perdait son temps à vouloir tout parer. Il ne pouvait jamais quitter de l’endroit où il venait de travailler peur d’y laisser un bouton de culotte ou quelque morceau de papier. Il revenait trois fois pour faire le tour des chambres. Rue Oberkampf, Monsieur, je l’ai vu remonter six étages pour placer une dizaine de coups de couteau à un client qui, j’en suis sûr, était déjà froid depuis une demi-heure !
« Et puis, dans la bande au Plombier, il y avait des mal élevés, des gens qui savaient que gueuler, avec qui n’y avait pas moyen de rien causer ni dire. Un jour qu’on travaillait chez une famille épatante, à l’hôtel de Caspian, au Cours-la-Reine, deux de ces voyous ont trouvé rigolo de poser des cochonneries en plein tapis du salon. De quoi qu’on a l’air ?
— Mais, dis-je un soir à Télégraphe, on se tient bien dans votre métier ? On ne se trahit pas ?
— C’est comme partout, dit Télégraphe. Il y a les bons et les mauvais. Faut bien croire qu’il y en a souvent de vendus, puisqu’il y en a si souvent de pris. Il n’en manque pas de braves, de gentils garçons, sur qui que l’on peut compter. On vous a jamais dit l’histoire de Piston ?
« La mère Valu tenait un garni à Grenelle, en face le puits artésien. La maison a été démolie l’été dernier. Voilà qu’il y a deux ans, un soir d’après le Grand Prix, qui c’est qu’on voit arriver au garni ? Mon cher, c’est deux Anglais, deux grands gaillards, avec des moustaches rousses qui leur tombaient sus la bouche, des casquettes à carreaux et, sauf votre respect, du pognon à la clef. Le plus grand ne quittait pas du comptoir et s’enfilait comme rien du tout des consommations de quarante centimes. Ils venaient travailler en France à différentes bricoles. Ils nous ont montré tout ce qu’ils avaient chauffé au Grand Prix, des portefeuilles de dames en maroquin, des petites montres, des mouchoirs tout ce qu’il y avait de joli.
« Mais la grosse affaire, c’était une villa à Auteuil, qui appartenait à une dame de leur pays. Cette dame devait s’absenter un certain soir et donner congé à ses domestiques. Nos deux rosbifs parlent à la mère Valu et lui demandent si elle ne connaîtrait pas un gosse pour guetter. Ils disent qu’ils donnent douze francs cinquante, que c’était le prix chez eux. « Le prix, chez nous, c’est « de quatre francs », leur dit cette bonne pie de mère Valu. Pourquoi qu’elle ne les laissait pas donner à leur idée ? Mais dès l’instant que ça ne tombait pas dans sa poche, elle voulait s’en payer de faire la grande et généreuse.
« Elle leur indique donc un gosse de treize ans, Piston, un petit gars que je vois encore, avec sa tête un peu grosse ; il jouait aux billes toute la journée dans la cour du garni. Quand on prend des gosses pour faire le guet, on aime mieux choisir ceux qui sont joueurs et qui ont des camarades, que ceux qui travaillent et qui vivent sans compagnons. Parce que de jouer tout le temps ensemble, de s’empêcher de tricher, ça rend les enfants plus loyal. Mes Anglais acceptent Piston et demandent encore un gosse pour guetter au tournant de la route. On leur donne un autre gars plus grand, un appelé Philippe qui allait bien sur ses seize ans.
« Le soir, tout notre monde se trotte à Auteuil. On installe Philippe à son coin de route, à cent pas de rentrée. Piston prend place sous l’un des piliers de maçonnerie, à côté de la grille d’entrée. La consigne, s’il y avait du danger, c’était de gueuler à toute force : « Tararaboum de Hay ! »
« Comme les Anglais étaient en train de travailler depuis dix minutes, voilà Piston, toujours en faction sur son pilier, qui voit arriver Philippe, et mon Philippe, qui les avait vendus, se met à dire à Piston qu’on est d’accord avec les mouches et qu’on va emballer ces cochons de rosbifs. « Pourquoi ça, demande Piston, ces cochons de rosbifs ? Ils m’ont donné quatre francs pour les veiller. – T’auras mieux si tu les vends, dit Philippe. T’auras deux linvés tout en or. Regarde-les briller. C’est dix fois tes quatre francs. De quoi t’acheter quinze mille billes ! » Mais le petit Piston répète qu’il a promis de garder les Anglais et qu’il les gardera. Philippe commence à rogner. « Petite punaise, souffle-t-il, si tu ne descends pas de là, je vas te descendre. »
« Et il se met à tendre sa fronde avec une grosse pierre dedans.
« Cependant, les vaches s’étaient approchées. Il y en avait bien six, avec un commissaire. « Descendras-tu, que disait Philippe, ou je t’envoie cette pierre dans la figure ? »
« Alors voilà Piston qui de toutes ses forces se met à chanter : « Tararaboum, tararaboum, tararaboum de Hay ! »
« Philippe, de colère, lâche sa fronde. Le gosse reçoit la pierre au front, juste près de la tempe, et tombe à terre comme un oiseau. Les vaches entrent dans la maison. Mais les Engliches avaient entendu et s’étaient donné de l’air.
« Qui c’est qui s’amène, l’instant d’après ? C’est madame la dame anglaise à qui qu’était la maison. Elle voit mon gosse étendu mort par terre. Elle demande qui c’est que c’est. « À cause de cet insecte-là, dit le commissaire, ils ont pu vous prendre vos bijoux et on ne les a pas pincés. ».
« Il raconte l’histoire. La dame l’écoute et, quand il a fini, elle ne dit rien, elle va à Piston, elle se baisse et l’embrasse sur son petit front sale. Puis elle regarde le commissaire et lui dit en montrant le gosse : « C’était un fidèle garçon… »
Nous quittâmes l’hôtel Calcutta. Il était tard. Télégraphe me reconduisit jusqu’à ma porte. Nous marchions sans rien dire.
« Joseph Bara avait aussi treize ans, pensai-je tout haut, quand il mourut à Cholet sous les baïonnettes vendéennes.
— Je connais ça, dit Télégraphe, je l’ai lu sus les images. Mais le tambour, lui, y allait pour la gloire. C’était en plein temps de guerre ; il était chauffé à blanc. Il se disait : « On me crève, mais je vais être bath en crevant. » Tandis que mon vieux petit Piston s’est fait coucher pour ses quatre francs : c’était compris dans son ouvrage. Il est mort pour ces deux cochons de rosbifs qu’il ne connaissait pas, mais avec qui qu’il s’était engagé et qui s’avaient fiés en lui. »
LA LETTRE D’AMOUR
Quelle sottise, en pleines vacances, sous un ciel d’une sérénité absolue, devant une mer à peine froissée de petites vagues, quelle misère, pour le jeune Adolphe, d’être ainsi tracassé par un ennui qu’il ne retrouve même pas !
Est-ce qu’il vient de penser à la maladie de sa sœur qui n’a pu quitter Paris, où elle n’est pas encore remise d’une bronchite ? Non, car il a eu ce souci la veille, toute la journée, si longtemps qu’il y est habitué.
Est-ce qu’il pense à l’argent qu’il doit ? Non, car la fin du mois est très loin encore.
Est-ce parce que son cheval boite ? Non, car si son cheval boite, il n’aura pas besoin de le sortir. Et il sera dispensé quelques jours de l’agrément de monter à cheval.
C’est sans doute qu’il s’est rappelé, en se levant, que c’était aujourd’hui mardi et qu’il fallait écrire à sa bien-aimée.
Mme Chernuzon était dans les Pyrénées avec son mari. Elle et Adolphe ne s’écrivaient que tous les trois jours, pour ne pas aller trop souvent à la poste restante. Il avait reçu la veille une lettre de huit pages, qui en valaient seize, car Mme Chernuzon avait l’habitude d’écrire dans les deux sens, en large, puis en long de la page, sur les lignes déjà écrites, ce qui rendait la lecture de ses lettres, assez pénible à un lecteur consciencieux. Adolphe avait pris le pli de ne répondre que quatre pages ; mais encore fallait-il qu’elles fussent remplies jusqu’au bout.
Il écrivait de préférence au casino, parce qu’il y trouvait du papier à en-tête où l’on voyait représentée une plage couverte d’enfants et de jolies baigneuses, devant un hôtel beaucoup plus vaste que nature et orné de drapeaux. Cette vignette, très artistique, occupait une bonne moitié de la première page.
Après son déjeuner, il se rendit donc au casino à travers les rues étroites de la petite ville normande. Il marchait lentement, pour que la route fût moins courte. Un chien qui grattait le sol l’intéressa. Il s’apitoya sur une petite fille qui pleurait ; car il ne demandait pas mieux que d’avoir de beaux sentiments, s’ils étaient facultatifs.
Il resta un long moment devant la charcuterie à examiner les rillettes de Tours, le veau piqué et le fromage de tête, et il fallut pour l’en éloigner que le charcutier vînt sur sa porte avec un sourire de bienvenue. Quelques pas plus loin, il fit concevoir des espérances aussi vaines à un très vieux marchand de jouets d’enfants et, par le nouvel arrêt qu’il fit à une autre boutique, édifia des châteaux chimériques dans l’âme jusque-là résignée d’une dame borgne qui vendait des casquettes de plage.
Arrivé au Casino, il s’installa sur la terrasse, en face de la mer paresseuse dont on entendait le souffle tranquille et régulier. Il demanda une demi-glace au café et de quoi écrire. On lui apporta de quoi écrire, implacablement.
Il attendit la glace, désireux de la manger d’abord, pour ne pas interrompre sa lettre.
Mais une glace, dans le plus languissant des casinos où se traînent les garçons les plus lymphatiques, finit toujours par arriver. Et quand elle est là, il faut la manger, pour qu’elle ne fonde point. Et si petites que soient les cuillerées, si long que soit l’intervalle entre chacune d’elles, on finit toujours par en venir à bout. Il fallut bien prendre la plume, ouvrir le buvard, écrire sous l’hôtel pavoisé :
Ma chère petite chérie.
Et après ?
Lui accuser réception de sa lettre :
J’ai reçu ta bonne lettre, ma petite chérie.
Ces répétitions ne faisaient pas mal.
Je l’ai lue et relue, embrassée dix fois, cent fois, mille fois.
Il aurait pu dire « mille fois » tout de suite ; mais la progression était très utile, et plus éloquente d’ailleurs.
Plus rien à dire sur la lettre reçue. On n’était plus qu’à deux lignes du bas de la page. Il y arriva tout doucement avec quelques véhéments : « Je t’adore ! » espacés par des points de suspension.
Il chercha du papier buvard avant de retourner la page. Pas de papier buvard. Il en demanda au garçon.
Petit repos.
La page retournée, le pli écrasé avec minutie, il se trouva en présence d’une étendue de papier blanc considérable. Il en eut le mal de mer, et se renversa sur son dossier.
Que lui dire ?
L’emploi de son temps ?
Il n’avait guère à lui raconter qu’une promenade en voiture :
Nous avons été hier en voiture jusqu’à Baquerville. C’est un petit pays assez gentil qui se trouve à huit kilomètres cinq cents. La promenade a été assez morne. Je ne m’amuse décidément pas sans toi.
Il n’y avait plus rien à lui dire sur l’emploi de son temps à lui. Mais elle, que faisait-elle ?
Et toi, petite chérie, que fais-tu ? T’amuses-tu ? Ah ! je suis sûr que, quoi que tu me dises, tu t’amuses loin de moi ! Et j’en suis tout triste et tout méchant.
Il avait mis la main sur une petite scène de jalousie, sur des lamentations qui, transcrites d’une plume joyeuse et rapide, l’amenèrent au bas de la page 2.
Au haut de la page 3, il fut de nouveau en détresse. Et, regardant ce qu’il avait déjà écrit, il se reprocha d’avoir trop serré les lignes, pourtant bien espacées déjà.
Il chercha quelques réflexions supplémentaires sur le thème de la jalousie :
C’est que, vois-tu, l’idée que tu pourrais en aimer un autre m’affole absolument…
Malheureusement le garçon, en lui demandant s’il n’avait plus besoin de la carafe d’eau frappée, lui fit perdre le fil de ce développement.
Il posa sa plume et se mit à regarder la mer. Mais la mer a autre chose à faire que de fournir des idées aux gens qui écrivent des lettres. Elle est suffisamment occupée d’elle-même et de ses heures rigoureuses de flux et reflux.
« Après tout, pensa Adolphe, je n’ai rien à faire jusqu’à cinq heures. Je vais rester là. J’ajouterai de temps en temps, sans m’en apercevoir, une petite phrase, et j’arriverai ainsi, sans m’en douter, à remplir mes quatre pages. »
À ce moment, Charles Tony apparut à l’entrée du casino, avec sa magnifique casquette d’automobile qu’il mettait pour jouer au billard.
Cette casquette avait d’ailleurs une raison d’être : Charles Tony remettait depuis trois ans pour s’acheter une automobile, dont la force augmentait chaque année de quelques chevaux.
Adolphe et Charles jouaient chaque jour au billard. Chacun d’eux pensait être un peu plus fort que l’autre. Cette rivalité les passionnait bien plus que le jeu de billard lui-même qu’ils n’aimaient pas.
Adolphe, en voyant arriver son compagnon de plage, regretta amèrement de n’avoir pas terminé sa lettre. Tony vint s’asseoir à sa table.
« Vous écrivez ?
— Oui, dit Adolphe. Mais j’ai le temps. La levée n’est qu’à cinq heures.
— Finissez votre lettre, dit Tony. Nous ferons un billard. »
Il valait mieux, en effet, terminer sa lettre pour être libre de toute préoccupation pendant la partie.
Adolphe, désespérément, se pencha sur son papier comme un élève appliqué. Mais il ne trouvait plus rien. Il ne pensait qu’au billard de la veille, où il avait battu Tony de douze points. Il le battrait aujourd’hui de vingt points… Comme il n’écrivait toujours pas, Tony se crut autorisé à lui parler :
— Vous avez vu l’accident qui est arrivé ce matin sur la côte, près de Sourdeval ? Cette barque de promeneurs, qui a chaviré ?… Ce jeune homme de vingt-deux ans dont on n’a pas retrouvé le corps ?
— Non », dit Adolphe, je n’ai pas su…
Et il se mit à écrire avec délices :
Figure-toi, ma petite chérie, que tout le pays est attristé par un affreux accident. À Sourdeval, tout près d’ici, une barque de promeneurs a chaviré ce matin. Un jeune homme n’a pu être retrouvé. Crois-tu que c’est horrible, ma pauvre amie ? Un jeune homme de vingt-deux ans ! J’ai tout de suite pensé à tes excursions dans la montagne. Ne risque pas ta vie, ma chère petite chérie. Que deviendrais-je sans toi ?…
Des considérations sur la mort l’amenèrent au bas de la quatrième page, et il fut obligé de mettre dans la marge des baisers, des baisers fous, des baisers tendres, comme si son cœur débordait du papier.
LES VEILLÉES DU CHAUFFEUR
(1909)
LE MUSÉE DE PORCELAINES
« Visitera-t-on le musée avant ou après le déjeuner ? »
Une partie des voyageurs est d’avis de déjeuner tout de suite. L’un d’eux a faim, cet autre se dit sournoisement que le déjeuner se prolongera, qu’il faudra repartir, et qu’ainsi on remettra à une autre fois la visite du musée.
Mais l’avis des amateurs d’art prévaut. C’est l’avantage des idées nobles de pouvoir être proclamées avec énergie. Les partisans du déjeuner immédiat n’ont pas le courage de leur vile opinion.
Je dois dire que je me suis rangé du côté des amateurs d’art, et pourtant j’ai faim. Ai-je ainsi agi par une espèce d’opportunisme, en pressentant que la majorité serait pour le musée ? Me suis-je dit que le devoir était là ?
***
Je suis chargé de trouver le musée, pendant que les deux mécaniciens des voitures vont à la recherche d’un garage.
Le premier passant à qui je m’adresse est un homme à casquette cirée qui prend la position militaire, regarde à droite et ensuite à gauche, et me répond qu’il est ordonnance et qu’il ne peut pas me dire… Je n’ai pas plus de succès auprès d’une vieille marchande de légumes. Mais chez un petit voyou blond qui écoutait mes questions, se révèle une compétence imprévue. Il m’apprend qu’il y a deux musées, celui des tableaux et celui des porcelaines. Je vais annoncer la bonne nouvelle à la petite troupe des chauffeurs.
Le musée des porcelaines est tout près. Il faut commencer par là… C’est peut-être intéressant… On n’y restera pas longtemps, car la peinture nous réclame… On tourne à droite, puis à gauche, et l’on arrive à une petite place, en face d’un monument d’aspect assez simple. Ce monument a l’air complètement abandonné…
« C’est peut-être fermé ? » dit quelqu’un qui s’apprête déjà à prendre un air désespéré.
Il faut tout de même frapper à la lourde porte de chêne. Je frappe doucement ; puis, comme je vois qu’il ne vient personne, je cogne avec énergie… Ciel ! J’entends des pas !
La porte s’ouvre. Apparaît un très vieux concierge, dans un très mauvais état de conservation.
« Est-ce que le musée est fermé ?
— Il est ouvert », nous répond-il dans un dernier souffle de vie.
Tout le monde entre en silence… C’est étrange !… Ce monument, de l’extérieur, paraissait être de dimensions assez restreintes, et les salles qu’il renferme sont immenses et nombreuses. Le vieillard va-t-il nous accompagner et nous décrire ces curiosités ? Non… Il rentre dans sa cage et nous laisse circuler autour des vitrines.
***
Tout cela doit être très intéressant. Mais il y a trop de choses. Il faudrait avoir quarante-huit heures devant soi et s’arrêter longuement auprès de chaque objet. Du moment qu’on n’a à sa disposition qu’un petit laps ridiculement court, toute station un peu prolongée devant une assiette ou une soupière ancienne constituerait une préférence injuste… Et puis, les tableaux nous attendent… Il faut presser le pas.
Je ne connais pas de piste qui augmente autant l’allure ordinaire de certaines personnes que le sol bien ciré des musées. Il y a des jeunes femmes languissantes qui trouvent toujours que l’on marche un peu vite dans la rue et qui, dans un musée, vous essoufflent et vous lâchent au train. Si l’on s’arrête une seconde devant un tableau ou une vitrine, on ne les retrouve plus à côté de soi. Elles ont franchi deux ou trois salles à une vitesse de circuit.
Seulement l’allure rapide que leur imprime le voisinage des curiosités ne va pas sans les fatiguer promptement.
Les parquets sont durs et peu propices à un train aussi soutenu. Aussi retrouve-t-on ces dames assises sur des banquettes de velours rouge, en extase devant une œuvre d’art belle entre toutes que la Providence a placée juste en face de ces sièges de repos.
***
Je ne crois pas qu’il existe d’architecte aussi perfide que celui qui a conçu le plan de ce musée de porcelaines. Le fameux Dédale, constructeur primé du Labyrinthe, n’avait pas autant de venin. Nous avons parcouru quatre salles ; nous n’osons revenir sur nos pas ; il n’y a aucun raccourci pour gagner la sortie. Une ingénieuse combinaison d’escaliers oblige même à visiter le premier étage…
En traversant la neuvième salle, notre bande de chauffeurs, farouches et harassés, est dégoûtée de la porcelaine pour la fin de ses jours. Pour comble de malheur, nous redescendons dans un vestibule qui ressemble au vestibule d’entrée, et qui n’est pas le vestibule d’entrée. Il donne sur toute une série d’autres salles, qu’il faut traverser coûte que coûte. Quand nous nous retrouvons en présence du concierge décrépit, notre ressentiment éclate en propos violents et nous oublions tout à fait que nous avons devant nous un homme âgé, vieux serviteur de l’État, qui a teint maint champ de bataille de son sang généreux. Puis quelqu’un de nous lui remet une pièce de deux francs en lui recommandant de tenir à l’avenir entrouverte la porte de son musée, afin que personne ne puisse le croire fermé. Car nous serions vraiment trop vexés si quelque autre troupe de chauffeurs, traversant la ville et passant sur cette place, se trouvait, contre toute justice, couper au musée de porcelaines.
SUR LES GRANDS CHEMINS
(1911)
UN VAGABOND
Je ne suis pas de ceux qui pensent que la véritable villégiature est la villégiature immobile.
L’été, il faut se déplacer – par les moyens les moins fatigants, s’entend – mais il faut aller à droite et à gauche, se créer des occupations multiples ; car rien n’est si pénible que des occupations rares, espacées : ce sont les plus tyranniques. Quand j’ai une petite lettre à écrire pour le courrier de cinq heures, j’en souffre toute la journée. Au contraire, quand je suis emporté dans le tourbillon des affaires, je m’y laisse aller délicieusement ; c’est le véritable repos ; on ne sent pas sa fatigue.
Un matin de l’été dernier, je me faisais ces tristes réflexions et je pensais à une fantaisie de Jérôme K. Jérôme qui montrait la détresse d’un paresseux dans les instants où il n’a rien à faire.
Ce jour-là donc qui était un lundi, j’étais absolument torturé par la nécessité d’écrire un tout petit article que j’avais promis pour le jeudi précèdent. J’avais déjà envoyé plusieurs lettres pour m’excuser. Chacune d’elles était plus longue à elle seule que l’article en retard.
Ce qui rendait la mise en train plus particulièrement difficile, c’est que je ne savais absolument pas de quoi parler dans mon article. Tous les sujets me semblaient pauvres et sans intérêt.
Le courrier était à cinq heures. Un facteur passait devant la maison. On lui remettait nos lettres et diverses commissions pour la ville voisine, une commande pour le boucher, une chambre à air à rapiécer. Il rapportait des lacets de bottines, du taffetas anglais de chez le pharmacien, et des cartes à jouer.
J’avais décidé la veille que je ferais mon article le matin, afin d’avoir un après-midi de tranquillité inviolable. Mais toute la matinée avait coulé sans qu’on s’en aperçût, bien qu’elle fût occupée par un constant remords. Tout prétexte était bon pour reculer l’affreux moment où je m’assoirais à ma table. Il m’avait semblé absolument nécessaire de vérifier les bandages d’une machine excellente à changement de vitesse, à roue libre, une bicyclette de première marque dont je ne me servais d’ailleurs pas. Arrivé dans le hangar où elle se trouvait remisée, il me parut indispensable de gonfler le pneu arrière. Notez que je déteste gonfler des pneus, que ça ne m’arrive pour ainsi dire jamais, que c’est pour moi le plus écœurant des labeurs. Mais cette besogne était facultative, tandis que l’autre – celle qui m’attendait dans mon cabinet de travail – l’autre était obligatoire implacablement !
Après avoir gonflé lentement, posément, mes deux pneus, je me rendis dans le potager où je me mis à arroser des fleurs, à la stupéfaction du vieux jardinier qui ne m’avait jamais vu me livrer à une occupation pareille.
Je crois même que, ce matin-là, j’allai jusqu’à ratisser les allées du jardin. Enfin, le déjeuner arriva. Je restai à table le plus longtemps que je pus. Je fis une partie de dames, que je perdis ; puis la revanche que je perdis également, et contre toute légalité je demandai à faire la belle !
Après les parties de dames, on ne pouvait vraiment se mettre tout de suite au travail. Il fallait de toute nécessité se dégourdir les jambes en faisant quelques pas sur la route.
Il faisait très chaud, abominablement chaud. J’aurais été cent fois mieux, les stores baissés, dans mon cabinet… Mais dans mon cabinet, il y avait une table impérieuse, des feuilles de papier d’une blancheur despotique, un inexorable encrier. Je me promenai sur la route déserte, épiant sans me l’avouer le moment où quelque passant surgirait au détour du chemin.
Enfin ce passant se décida. C’était une sorte de vagabond de la ville, que j’avais vu plusieurs fois sur la route et à qui je n’avais jamais songé à adresser la parole. Ce jour-là, je l’arrêtai avec beaucoup de bienveillance. Je jugeai utile de le faire causer, de tirer de lui mille détails sur sa vie. Et je souhaitai naturellement que son histoire fût la plus longue possible. Je ne l’écoutai d’ailleurs que fort distraitement.
Ce vagabond était un homme de dix-huit à cinquante-trois ans, complètement imberbe. Son visage était exempt de rides (était-ce le jeune âge ? était-ce l’absence de soucis ?) Il avait peut-être des cheveux blancs parmi ses cheveux blonds. Mais la poussière des routes en avait unifié la couleur.
Il était vêtu d’un pantalon noir, d’un pantalon de drap satin, qui était un ancien pantalon de cérémonie. Il portait un petit veston beige très usé, orné d’un brassard noir à une de ses manches.
« Pourquoi ce brassard de deuil ? » lui demandai-je tout à coup.
Il regarda sa manche et parut faire appel à ses souvenirs.
« Ça, me dit-il, c’est rapport à la mort de Mme Flinquet, la première femme du maire, qu’est décédée voilà bientôt six ans…
— C’était une de vos parentes ?
— Pensez-vous !
— Et vous portez son deuil depuis six ans ?
— Oh ! pas depuis six ans ! Il y a deux ans que M. Flinquet m’a donné ce veston que sa bonne a trouvé une fois dans la garde-robe… »
Je regardais avec bienveillance ce brave vagabond qui portait placidement le deuil de Mme Flinquet après que le mari de cette personne était déjà consolé aux côtés d’une nouvelle épouse.
Il me semble à la réflexion que c’était là un sujet d’histoire, que la Providence m’envoyait charitablement.
Je remontai dans ma chambre et je fis mon article sans plus tarder sur un sujet d’ailleurs différent.
Mais tout n’est pas perdu, en somme, puisque ce sujet je le retrouve aujourd’hui.
LA FAUNE DES PLATEAUX
(1923)
LE PRIX DE DIANE EN MATINÉE
Le marquis de Hottebrède, ses cheveux noirs cachés sous d’épais cheveux blancs, le visage soigneusement ridé, est sur le point d’entrer en scène, pour sa grande scène du troisième acte. À ce moment le traître Fourval, qui vient de poser ses conditions à la marquise, sort de scène, laissant Claire de Hottebrède effondrée sur un beau canapé ancien, prêté au théâtre par un grand tapissier.
LE MARQUIS, au traître. – Ça doit être couru à cette heure-ci. Il est quatre heures dix… Puisque tu n’es pas de la fin du trois, tu devrais faire un saut jusque chez le bistrot, où les résultats sont affichés…
LE TRAÎTRE, timidement. – Oh ! mon vieux, maquillé comme ça…
LE MARQUIS. – Ça n’a aucune importance. Il n’y a personne dans les rues… Tout Paris est à Chantilly ou à la campagne. Non, mon vieux, vas-y. J’ai six louis d’engagés dans la course, tu donneras le résultat à Fauvel. Il me l’apportera avant mon agonie.
LE TRAÎTRE. – Oh ! tu fais de moi ce que tu veux !
Il sort, pendant que le marquis, après s’être fortement voûté, entre avec trente années de plus pour la grande scène qui a fait le succès de la pièce (déjà 234 représentations), et s’avance jusqu’au canapé.
LA MARQUISE, levant la tête et suffoquée de surprise pour la deux cent trente-cinquième fois. – Renaud !
LE MARQUIS. – Je vois que vous ne m’attendiez pas.
Elle se lève. Il s’approche du canapé et s’y assied. Elle est en face de lui. Ils se regardent en silence.
LA MARQUISE, bas. – T’as l’ résultat ?
LE MARQUIS, entre ses dents. – On va l’apporter. (Haut.) Je ne suis pas seul, Madame… Notre fils me suit à quelques pas. L’heure des explications a sonné.
LA MARQUISE. – Gérald, Gérald va m’être rendu ! Ah ! quoi que vous fassiez de moi, je serai trop heureuse !… Il me semble entendre son pas… Ah ! quelle émotion !
LE MARQUIS, bas. – Je comprends.
Entre Gérald (Fauvel). Il se jette dans les bras de sa mère, qui l’embrasse avec frénésie.
GÉRALD, bas, dans le cou de sa mère. – Pellsie première.
LA MARQUISE, bas. – Et Frisky ?
GÉRALD, de même. – Nulle part !
LA MARQUISE, de même. – Crotte !
Le Marquis a suivi anxieusement cette scène. Il est un peu loin d’eux. Il se lève et, changeant pour ce jour-là la mise en scène, s’avance jusqu’au couple.
LE MARQUIS, noblement. – Quels que soient vos torts et vos fautes, je n’ai pas voulu mourir sans vous avoir réunis. (Il perd la respiration. Dans un souffle.) Eh bien ?…
LA MARQUISE, bas. – Pellsie.
LE MARQUIS, de même. – Pellsie ! (Haut, mais faiblement.) Il y a des châtiments trop inhumains pour qu’une créature humaine les prononce… (Bas.) Et je l’avais l’autre jour à Saint-Cloud. (Haut.) Je suis soulagé parce que mes forces m’ont porté jusqu’ici. Mais… mais…
Il s’abat lourdement et adroitement sur le sol. Gérald et la marquise se précipitent sur son corps.
GÉRALD. – Mon père !
LA MARQUISE. – Pardonne-moi, Renaud !
GÉRALD. – Son cœur a cessé de battre.
LE MARQUIS, bas. – Où est Esmée ?
GÉRALD. – Troisième.
LE MARQUIS. – Chouette ! Je l’avais en couverture… Ça va faire du six contre un au moins…
Il meurt heureux.
LE JEU DE MASSACRE
(1922)
VANILLE-PISTACHE
MADEMOISELLE GANTELLIER n’était peut-être pas très âgée à l’époque où elle donnait des leçons d’histoire et de français. Mais je n’avais que huit ans, et toutes les personnes qui avaient dépassés la cinquantaine m’apparaissaient, de très loin, sur un même plan qui s’appelait la vieillesse.
Mlle Gantellier était épaisse et large, avec un teint de beurre. Quelques frisures pas très fournies égayaient mal son vaste front. Elle avait une odeur, pas précisément mauvaise, mais pas agréable non plus. Et son gros livre de dictées, recouvert de papier jauni, qu’elle sortait d’une poche immense, sentait comme elle.
Elle venait trois fois par semaine, de quatre à cinq. Que c’était long, une heure, au temps où je prenais des leçons ! On avait fini par m’asseoir le dos à la pendule, pour m’empêcher de la regarder tout le temps. Mais comme je me contorsionnais sans cesse, je pouvais par moments jeter un coup d’œil furtif sur les deux aiguilles, désespérément immobiles, encore plus paresseuses que moi.
Certains jours, je répondais aux questions avec une rapidité étourdissante. D’autres fois, tout ce que j’avais d’intelligence était sorti brusquement, laissant ma bouche béante et mes yeux grands ouverts. Et Mlle Gantellier répétait et criait ses questions comme un facteur autour d’une maison vide. D’autres fois, c’était encore plus décevant, car en tire-bouchon sur ma chaise, les sourcils crispés, les lèvres serrées, je paraissais concentrer mon attention avec une terrible énergie. Et je souffrais visiblement de ne pas écouter… Puis tout à coup le contact s’établissait entre la question et la réponse, et à la demande : « Qui a gagné la bataille de Vouillé ? », je disais « Clovis », d’un ton pressé et dédaigneux.
Papa décida un jour que chaque fois que j’aurais pris une bonne leçon, la maîtresse et moi nous irions manger des glaces.
Nous partions, tous les deux, chez le pâtissier. Je prenais une glace au chocolat, et la maîtresse une vanille-pistache. Alors, c’était son tour à elle de s’isoler du monde. J’avais fini bien avant elle, et je la regardais détacher alternativement une petite cuillerée jaunâtre et une petite cuillerée verte, et les savourer en fermant les yeux.
À partir de ce jour, je ne pris que de très bonnes leçons.
Mlle Gantellier, pendant les soixante minutes qu’elle me consacrait, était d’une extrême rigueur, car la perspective de la glace au chocolat n’avait pas discipliné mon âme vagabonde. Mais quand papa ou maman arrivait à la fin de l’heure, la maîtresse répondait invariablement :
« La leçon a été bonne aujourd’hui. »
Et nous allions chez le pâtissier.
Un jour, j’avais été insupportable… C’est un des plus graves souvenirs de mon enfance. J’avais trempé mon doigt dans l’encrier, j’avais mâché du papier et dénatté les franges du tapis, et je m’étais montré incapable de terminer les noms les plus connus dont Mlle Gantellier me tendait généreusement la première et même la seconde syllabe.
À la fin de la leçon, je m’étais bien rendu compte que cette fois le verdict serait impitoyable. Alors, dans ma terreur de l’entendre formuler, j’avais pris éperdument les devants et, les larmes tout près des yeux, j’avais crié à mon père dès qu’il était apparu dans la chambre :
« Je n’ai pas été sage !
— Ah ! ah ! avait dit papa sans grande conviction, mais esclave des principes. Alors, il n’y aura pas de glace aujourd’hui. »
Un affreux silence suivit le prononcé du jugement… Soudain une voix de bonté, de suprême indulgence, sembla descendre du ciel :
« Monsieur, pardonnez-lui. Il a été étourdi. La prochaine fois, il sera plus docile et plus attentif surtout. »
Papa, dont la sévérité ne demandait qu’à être fléchie, sortit de sa poche la pièce d’argent qui servait à régler le pâtissier.
Nous partîmes, Mademoiselle et moi. Elle marchait à côté de moi, énorme et silencieuse. Enfin, elle se décida à parler :
« Dorénavant, mon enfant, souvenez-vous de ceci : ce n’est pas à vous à raconter si je suis contente ou mécontente de vous. C’est moi seule qui en suis juge, et je suis assez grande pour le dire… »
NON, CE N’EST PAS NELLY !
LÉO LEDURAND, un jeune Français de Besançon, était employé depuis trois ans dans une banque de Sheffield. Depuis trois ans moins un jour, il était amoureux de Nelly Lewis, la fille d’Abe Lewis, son patron.
Pour le troisième anniversaire de son entrée dans la maison, il apprit une fâcheuse nouvelle. Nelly était fiancée à Jerry Thomas, de Londres, qui, après son mariage, devait prendre la succession d’Abe Lewis.
À l’annonce de cet événement, Léo se décida à faire à la blonde Nelly l’aveu de sa flamme secrète, avant de regagner, désespéré, son pays natal. Et son regret fut d’autant plus cuisant que Nelly lui révéla que, s’il s’était déclaré plus tôt, elle aurait souscrit à ses vœux. C’eût été lui, Léo, qui l’eût épousée et qui fût devenu l’associé du respectable Abe Lewis. Maintenant, il était trop tard. Le père et la fille avaient agréé Jerry Thomas.
À Besançon, Léo Ledurand trouva une place bien rémunérée dans une fabrique d’horlogerie, avec une promesse d’association. Peu de temps après, par dépit, il épousa une charmante jeune fille de la ville, Madeleine Josat, qui lui apportait une dot fort sérieuse.
Madeleine était blonde comme Nelly et peut-être plus jolie. Mais ce n’était pas Nelly…
La fabrique d’horlogerie était une importante affaire et, au bout de très peu de temps, Léo s’y créa une position des plus confortables. À vue de nez, il se faisait peut-être plus d’argent qu’il n’en eût gagné à Sheffield… Mais ce n’était pas la banque Lewis…
Madeleine était une femme tendre et dévouée. Léo la payait strictement de retour. Leur union avait toutes les apparences de l’amour. Mais pour Léo, ce n’était pas l’amour. Il ne pouvait aimer qu’une femme au monde…
Le Ciel leur envoya une délicieuse petite fille, puis, l’année suivante, un petit garçon de premier ordre, puis une seconde petite fille de même qualité : mais ce n’étaient pas les enfants de Nelly !…
Le couple habitait à Besançon un appartement spacieux que Madeleine avait meublé avec beaucoup de goût. Ils y recevaient de bons amis et les soirées qu’ils y donnaient plusieurs fois par mois étaient fort appréciées. La maîtresse du logis était si avenante ! D’autre part, Léo avait la gentillesse de sourire, lui aussi, et gardait pour lui tout seul la rancœur de sa vie manquée.
Car il n’avait même pas la compensation de pouvoir se plaindre comme les gens officiellement malheureux…
Il avait rompu toute attache avec la banque Lewis et avec Sheffield. Il ne voulait pas raviver sa douleur. Il vécut vingt années sans se douter de ce qui pouvait se passer là-bas. Un mur épais, impénétrable, le séparait de l’Éden inaccessible où vivait le ménage Jerry Thomas.
Ce ne fut que vingt ans après son départ d’Angleterre qu’un hasard, au cours d’une villégiature, mit Léo Ledurand en présence d’Arthur Jefferson, qui avait été son camarade à la banque Lewis. Quand il le reconnut, il éprouva une des plus fortes émotions de sa vie. Il n’osa pas l’interroger sur ce qui se passait là-bas.
Ce fut Arthur Jefferson qui, spontanément, lui fournit des nouvelles.
Nelly Lewis, Mrs Thomas, était maintenant une grande femme sèche et sans agrément. D’ailleurs on s’était aperçu très vite, un an après son mariage, que les gracieuses promesses de la jeune fille ne seraient pas tenues par la femme. Ses premières couches lui avaient complètement abîmé le teint. Elle avait mis au monde un enfant très doux, mais un peu hydrocéphale, et qui tenait de son ascendance maternelle toute une série de symptômes inquiétants.
Nelly passait pour la femme la plus revêche de la société. Et elle avait un certain mérite à garder cette suprématie, car l’entourage du ménage Thomas était insupportable, et les réunions des cousines et des tantes donnaient l’impression d’une véritable compétition de mégères.
Quant à la banque Lewis, elle allait couci-couça… Des bruits fâcheux avaient couru à diverses reprises. La maison s’était replâtrée, mais n’était plus d’une solidité à toute épreuve.
En écoutant ces révélations, Léo Ledurand eut d’abord l’impression qu’il avait affaire à un informateur à l’esprit malveillant. Mais Arthur lui sortit un si grand nombre de faits précis qu’il n’y eut plus à douter.
Ainsi donc, c’était pour un mirage qu’il avait dédaigné tous les bonheurs que lui avait servis le destin. Son lot magnifique, il n’en avait pas profité parce que la liste des bonheurs livrés par la Providence n’était pas conforme à la commande. Il ne put s’empêcher de confesser ses erreurs à Arthur Jefferson, qui l’écouta avec sympathie. Cet employé de banque était doublé d’un philosophe (précaution, excellente contre les intempéries de la vie).
« Votre histoire n’est pas exceptionnelle, dit-il avec un accent anglais savoureux. J’ai souvent éprouvé que les prétendues chances qui nous échappent s’éloignent de nous en ne nous montrant que leur bon côté. Nous serions bien moins malheureux dans l’existence si nous pensions au côté pile de ce que nous n’avons pas eu… »
UN CHARMEUR
Le poète Boidéziles, après sa saison de Barillet-les-Bains, avait décidé de s’en aller dans le Sud-Ouest où l’attendait une invitation de parents pas très amusants, mais qui habitaient une large villa où la cuisine était bonne.
Il avait obtenu une passe de chemin de fer de la Compagnie d’Orléans, une autre de celle du Midi, et un sleeping à l’œil des Wagons-Lits… Comme il tenait à partir le mardi 2 août au soir et qu’il n’y avait plus de place dans le rapide, il avait mis en mouvement tout le haut personnel des travaux publics, et l’on avait réussi à lui procurer un sleeping à sa convenance, c’est-à-dire le lit du bas.
Je ne sais pas au juste comment on y était parvenu ; je me suis laissé dire qu’on avait évincé une vieille dame, en profitant de ce qu’elle avait négligé de faire acquitter en temps voulu le prix du voyage.
Le poète, satisfait, traversait la salle des bagages où il était venu surveiller l’enregistrement de sa malle, quand il rencontra M. Costo du Gruché avec qui il avait dîné une fois chez des amis.
***
M. Costo est un architecte de beaucoup de goût, d’esprit fin, et qui possède au plus haut degré une vertu très nécessaire dans les sociétés civilisées : la discrétion. Cette qualité consiste – d’après ce qu’on m’a dit – à ne pas mettre en première ligne, dans ses relations mondaines, la question de son bien-être personnel et à éviter de demander à ses semblables des services que leur générosité ou leur bonne éducation les obligent à nous rendre, quel que soit l’ennui qui en résulte pour eux. Bien entendu, les poètes ne sont pas tenus à cette bourgeoise vertu. Étant investis d’une sorte de mission dans le monde, ils ont, à cause de cela, un droit de réquisition qu’ils estiment d’origine divine.
Boidéziles, rencontrant M. Costo du Gruché à la gare d’Orsay, en apprenant qu’il partait le lendemain en auto pour Saint-Sébastien, lui demanda, avec une parfaite bonne grâce, de l’emmener en voiture avec lui.
M. Costo du Gruché a une torpédo à quatre places, qu’il conduit lui-même. Sa jeune femme s’assoit d’ordinaire à côté de lui et les places du fond sont remplies par une partie des bagages, le reste étant confié au chemin de fer. Il n’y eut qu’à modifier ces dispositions. Les valises étaient déjà ficelées dans le fond de la voiture. On les déficela et on les arrima avec beaucoup de précautions sur la place libre du siège, afin que M. Boidéziles, à qui Mme du Gruché était bien forcée de tenir compagnie, pût voyager aux places d’arrière.
Le couple du Gruché, pour obéir à un horaire très strict, devait venir prendre Boidéziles chez lui à sept heures du matin.
« Je serai, avait-il dit, devant ma porte. »
À sept heures dix, M. Costo, qui avait déjà fait une quinzaine d’appels de trompe, vit apparaître à une fenêtre un monsieur en pyjama, les yeux un peu bouffis, les cheveux en désordre, et qui criait :
« Je descends ! »
M. Costo n’imaginait pourtant pas que son invité ferait le voyage en cette tenue.
À huit heures tapant, Boidéziles, sa valise portée par sa bonne Eugénie, apparaissait sur le trottoir. Il s’efforçait de prendre un visage contrarié, mais M. et Mme du Gruché réussissaient assez bien à sourire. Enfin on se mit en route dans la direction de Versailles.
M. Boidéziles, bien que mal réveillé, avait déjà commencé une conversation enjouée avec Mme du Gruché. Il lui parlait de ses maux d’estomac, de ses insomnies et des troubles de sa vue… De sa vue !… Il se frappa le front… Il avait oublié ses lunettes !… À ce moment, la torpédo abordait vaillamment la côte de Picardie…
« Une paire de lunettes de chez un opticien spécial, exécutées d’après un méticuleux examen d’un maître oculiste…
— Voulez-vous qu’on retourne ? demanda faiblement M. du Gruché.
— Oh ! je ne voudrais pas… » dit Boidéziles.
Mais déjà M. du Gruché, avec une muette complaisance, exécutait un virage sur un étroit demi-cercle, et ils reprirent en silence la route de Paris.
Boidéziles, arrivé devant son domicile, s’aperçut qu’il n’avait plus sa clef. Or Eugénie n’était pas là. La torpédo fit le tour du quartier, stoppa devant la fruiterie, la mercerie, la boucherie… On trouva providentiellement la bonne en conversation avec un facteur des postes.
M. Costo du Gruché avait minutieusement établi les détails de son voyage et retenu une chambre à Angoulême où, désormais, il n’était plus possible d’arriver avant la pleine nuit… Tant pis ! On allumerait les phares…
Mais le poète, à leur passage à Poitiers, donna de tels signes de fatigue, qu’il fallut bien s’arrêter dans cette ville. Il n’y avait plus, à l’hôtel, qu’une chambre assez spacieuse, que Boidéziles accepta après des protestations, laissant, en fin de compte, ses amis s’installer dans une chambre de l’annexe, où ils seraient très bien, affirma un garçon d’hôtel, ancien combattant, que les dures fatigues de la campagne avaient rendu assez accommodant sur les questions de confort.
Le lendemain matin, ce fut le poète, admirablement reposé, qui attendit ses compagnons dans la salle à manger de l’hôtel. On reprit la route ; on reprit aussi l’histoire des malaises, lourdeurs, vapeurs de Boidéziles depuis son enfance jusqu’à nos jours.
De temps en temps, il regardait la carte. Soudain, il eut un sursaut.
Il venait de s’apercevoir que l’on passait à deux kilomètres d’un site extrêmement captivant qu’il avait contemplé jadis, mais seulement au soleil couchant… Ce n’était qu’un détour de cinq minutes… M. Costo, de plus en plus silencieux, tourna à l’endroit indiqué et prit une route qui, au début, sembla fort raboteuse.
« Le sol est mauvais, mais cela va changer », dit Boidéziles.
Cela changea. On arriva dans un sentier étroit, profilé en montagnes russes. Un craquement se fit entendre…
« Ça y est, dit M. Costo, j’ai fusillé mon… »
Il prononça un mot technique… Le poète, pour qui tout dans la nature avait un langage, qui comprenait la voix de la forêt murmurante, les intentions secrètes des nuages, les arrière-pensées des fleurs, ignorait à peu près tout du mécanisme des autos. Il savait seulement que certaines pannes exigent un travail acharné et salissant, même pour les aides les plus modestes.
Il se proposa tout de suite pour aller jusqu’à la grande route – un millier de pas – et guetter quelque auto qui, de la ville la plus proche, leur enverrait un mécanicien ou une voiture de remorque.
M. Costo inclina la tête et continua à visiter opiniâtrement sa voiture. Mme Costo, assise sur le bord de la route, évitait de regarder du côté de Boidéziles et de lui montrer l’expression de son visage.
Deux heures après, un petit paysan apportait un précieux autographe du poète, transcrit malheureusement à l’aide d’un crayon débile.
Tout va bien ! disait-il. J’ai trouvé une auto de médecin qui m’a conduit dans un petit bourg. Là, j’ai rencontré des amis avec qui je déjeune et qui m’emmènent à Bordeaux. J’ai vu un vieux mécanicien qui, dès qu’il sera libre, viendra avec une remorque. Mille mercis. Grandes amitiés. Veuillez remettre au porteur ma valise et mon étui à lunettes.
LE BON PÈRE
Quand le jeune Frédéric Crézorel manifesta des dispositions pour le dessin, la découverte de cette vocation n’enchanta pas autrement son père, qui tenait un petit bureau de messageries à Popincourt, dans les environs du boulevard Richard-Lenoir. Il aurait désiré que son fils prît la suite de ses affaires. Ce bureau n’était pas une entreprise énorme, mais enfin ça travaillait bien et, en s’occupant, on y gagnait largement sa vie. Gagner largement sa vie, pour le père Crézorel, c’était mener une petite existence étroite en mettant quelque argent de côté.
Le patron du bureau des messageries était un petit homme maigre, au cheveu gris et dur. Il portait constamment un pince-nez, dont un des verres était fendu depuis des années.
Il était resté veuf, avec un fils de dix ans. Sa femme était décédée très arbitrairement d’un chaud et froid. Crézorel supporta le coup avec un stoïcisme facile. Le petit Frédéric fut pris d’un grand désespoir ; il tenait, lui, un cœur très tendre de quelque grand ou arrière-grand-père, sensible et généreux.
Son père finit par lui faire apprendre le dessin, puis, sur le conseil d’un vieux client chevelu, le poussa doucement vers la gravure.
À vingt-deux ans, Frédéric était déjà un artiste très apprécié ; il gagnait de jolies sommes et son père s’attachait à lui de plus en plus.
Frédéric fut dispensé de tout service militaire parce qu’il était faible de constitution ; ce qui lui permit de travailler sans répit.
À vingt-cinq ans, il fit la connaissance d’une jeune orpheline, dont il aima tout de suite le doux et charmant visage.
M. Crézorel n’avait pas approuvé d’enthousiasme ce mariage. Pourtant, Mariette apportait une petite dot honorable : le produit de la cession du magasin paternel, où s’étaient vendus pendant trente ans de faux bronzes recouverts d’une épaisse et rugueuse dorure de faux or. Mais M. Crézorel craignait qu’en dépit de son air sage, sa belle-fille ne fût un peu frivole et dépensière, car elle aimait les boissons à la glace et le cinéma.
Or, il se trouva qu’après le mariage les affaires de M. Crézorel se mirent à péricliter. Il faut dire qu’il avait doublé son bureau de messageries d’une petite représentation de vins en gros qui n’avait pas donné de bons résultats ; il avoua à son fils qu’il avait eu tort d’ajouter à son arc une corde nouvelle dont il savait mal se servir, au lieu de continuer le métier qu’il connaissait bien ; il avait consenti des crédits imprudents et se trouvait pincé dans deux ou trois faillites. Frédéric, ému, lui donna toutes ses économies, puis une partie de la dot de sa femme. Il ne fut point blâmé par Mariette, une bonne et docile créature, courageuse aussi, car elle commença à se restreindre. D’ailleurs le ménage ne pouvait plus sortir le soir, la besogne étant abondante. Papa cherchait, à droite et à gauche, du travail pour son fils, et il en trouvait beaucoup ; l’ennuyeux, seulement, c’est que c’était toujours du travail pressé qui ne pouvait pas se remettre. Aussi les journées de Frédéric étaient-elles de douze à quatorze heures.
Un nouveau-né s’annonçait et Mariette avait projeté de lui préparer une jolie layette. Mais le père Crézorel eut encore besoin d’un petit coup d’épaule, et l’on réduisit le trousseau de l’enfant au strict nécessaire.
Les emprunts de M. Crézorel au jeune ménage se renouvelèrent assez fréquemment… M. Frédéric aimait à obliger son père, et Mariette aimait faire plaisir à Frédéric. Elle trouvait seulement que son mari travaillait beaucoup et qu’il n’avait pas bonne mine. Elle s’en ouvrit à son beau-père, mais celui-ci ne pouvait s’imaginer que ce fût jamais malsain de travailler et de gagner de l’argent.
Comme les commandes s’accumulaient et que les besoins du père Crézorel allaient croissant, Frédéric se priva, l’été suivant, de sa quinzaine de repos à la campagne. Mais ils durent s’absenter quand vint novembre pour un voyage dans la montagne, qui n’était pas un voyage d’agrément. À ce propos, le père Crézorel, anxieux de voir son fils malade, fut remarquable d’abnégation et de dévouement. Il ne parla plus de ses besoins d’argent et s’arrangea même, on ne sut comment, pour trouver quelques billets qu’il apporta à Mariette, et qui furent les bienvenus car elle était assez gênée.
Le séjour dans la montagne fut très court… Au retour la jeune femme, toute de noir habillée, avait pris place dans un compartiment de seconde, en face de M. Crézorel qui portait une redingote d’il y avait quarante ans, à peine plus longue qu’un veston. Le petit vieillard ne pleurait pas ; il avait les yeux fixes et ne cessait de remuer nerveusement les mâchoires.
Soudain, il s’approcha de sa bru et prit le ton solennel auquel ne renoncera jamais un homme qui a une importante révélation à faire, fût-il ministre ou simple patron d’un modeste bureau de messageries :
« Mon enfant, sache que tu n’as plus à t’inquiéter de l’avenir. Ton fils a bien à lui cent cinquante mille francs, que j’ai pu lui mettre de côté… »
Et comme elle ouvrait de grands yeux étonnés…
« Je n’ai jamais été gêné d’argent. Tout ce que j’ai demandé à ton mari, c’était pour l’économiser et pour que ça se retrouve un jour… »
Elle le regardait et comprenait mal… Le train roulait sourdement. Là-bas, dans le fourgon funèbre, auprès de la bière, un employé, assis au bord d’une caisse, faisait péniblement des comptes et des additions sur une grande feuille de papier jaune, très embarrassé par son crayon revêche et par la fumée de sa pipe qui lui venait constamment dans les yeux. Dans le cercueil, reposait le graveur après sa courte vie et ses longues heures de martyr.
Mme Crézorel regardait son beau-père. Peut-être serions-nous soulagés d’apprendre qu’elle prit à ce moment une voix irritée et vengeresse, et reprocha au cupide vieillard d’avoir tué Frédéric…
Mais elle ne dit rien de cela, soit qu’elle n’eût pas la force de le dire, soit même de le penser.
GAR IER
À la mort de son père, il était devenu le patron d’un petit magasin du boulevard Richard-Lenoir. On avait l’impression qu’il n’y entrait jamais personne. Tout de même, au bout du mois il se trouvait qu’il avait vendu un certain nombre d’articles en faux cuir, porte-monnaie, porte-cartes, porte-cigares. La devanture, peut-être brune, peut-être grise, n’avait jamais été repeinte ; et sur l’enseigne, depuis quinze ans, l’n du mot Garnier manquait.
De sorte qu’on avait pris l’habitude d’appeler Garnier : Garier. On disait Gar, et, pour exprimer le vide du milieu, on attendait un moment avant d’ajouter ier. Depuis longtemps, ce n’était plus une plaisanterie, mais un usage.
Gar ier était un petit homme sans prestige, maigre et doux. Il portait une pauvre moustache, et c’est tout juste s’il avait besoin de raser deux fois par semaine ses joues pâles et stériles. Un petit binocle le sauvait de la vulgarité, sans le faire parvenir à l’élégance.
Son commerce le faisait vivre : il était célibataire et profitait médiocrement de sa complète liberté. La grande satisfaction qu’il avait dans le monde était de faire partie d’un comité de vigilance républicaine. Cela se bornait, quand on n’était pas en période électorale, à assister une fois par mois à de petites réunions ou Gar ier se distinguait par son assiduité et son silence. Au moment des élections, il ne manquait pas de suivre les meetings organisés par son parti. Là, il attendait patiemment que les orateurs eussent fini leurs discours pour les applaudir, si ses amis en donnaient le signal.
Il comprenait peut-être admirablement ce que l’on disait sur l’estrade, mais il n’en laissa jamais rien voir.
Un jour de banquet, ses voisins le firent boire, par gageure. Il « tint », ce jour-là, une cuite bien conditionnée qui ne le rendit pas plus bruyant. Mais ses yeux humides et égarés amusèrent l’assistance et valurent à Gar ier pour toute sa vie la réputation d’ivrogne la plus usurpée.
Quand on le rencontrait, on lui disait : « Comment, Gar ier, tu n’es pas soûl aujourd’hui ? » Il souriait faiblement, à son maximum, et répondait de sa voix peu timbrée : « Ça n’est pas fête tous les jours. »
Il prenait, en somme, très bien les plaisanteries, peut-être parce qu’on ne lui offrait que cela et que c’était au moins quelque chose.
Le dimanche, il passait l’après-midi au café, assis sur la banquette de moleskine. Il regardait les joueurs de manille. Il buvait dans sa journée un mazagran et une anisette à l’eau. Il ne fumait guère, mais il avait toujours un briquet pour donner du feu, et aussi de la monnaie de cinq francs pour les personnes qui en avaient besoin.
Ses vêtements et son chapeau melon, qui lui duraient depuis des années, étaient assez convenables. La coquetterie du linge propre lui manquait cependant un peu.
Il ne se plaignit jamais de son existence étroite. Il estimait qu’il était à son aise, et avait même un pauvre à qui il donnait chaque mois une pièce de vingt-cinq centimes.
Le soir, il allait se promener sur les rives du canal Saint-Martin, et parfois poussait jusqu’à la Bastille, puis aux berges de la Seine. Un dimanche, il fut invité à la campagne. Il était entendu qu’il resterait dîner. Mais son silence fatigua un peu ses amphitryons. Il eut le tort, après le repas, de laisser passer le train de 9 h 34 et de prendre celui de 10 h 16. C’était de la politesse mal entendue. On ne le pria pas de revenir.
La vie de Gar ier n’excéda pas quarante années. Un soir qu’il prenait le frais au bord de l’eau, dans un endroit à peu près désert, il continua sa promenade dans la Seine, et l’on repêcha, à quelques centaines de mètres en aval, son mince corps inanimé. Or une vieille dame, le même soir, était tombée à l’eau à peu près dans les mêmes parages. Elle respirait encore quand on la retira, et de vigoureuses frictions prolongèrent la suite de ses vieux jours.
Deux ou trois personnes firent cette réflexion que Gar ier s’était peut-être jeté à l’eau pour sauver la vieille dame. Mais la grande majorité fut d’avis qu’il s’était noyé parce qu’il était en ribote, qu’il s’était approché trop près du bord et que le pied lui avait manqué.
La mort de Gar ier fit une certaine impression dans son quartier. Des voisins vigilants commandèrent pour lui une petite stèle. Mais le marbrier, entêté, ne consentit jamais, dans son aveugle respect de l’état civil, à inscrire sur la pierre un autre nom que le nom complet de Garnier, qui ne correspondait à rien. Les camarades se dirent qu’ils viendraient effacer l’n avec du blanc. Mais ils étaient tous occupés, et il ne fut pas donné suite à ce projet. Gar ier, rayé de la liste des vivants, ne figura même plus parmi les morts.
MADAME
Un hasard m’a fait jadis le témoin secret d’un drame assez étrange, et m’a permis de recueillir une confidence si grave qu’il m’est interdit d’en préciser la date. C’était de 1900 à 1912, dans un département de France dont je ne puis même dire s’il est au midi, au nord ou au centre.
Le jeune homme qui m’a écrit a été condamné à mort et exécuté. C’était un homme du peuple. Ceux qui l’ont jugé, ceux qui ont assisté à son procès, l’avocat même qui l’a défendu, l’ont considéré comme un être grossier d’allure et d’esprit. Il a bien réussi à donner cette impression.
Il avait tué, dans une ville de province, un vieux rentier ; il a avoué son crime. L’enquête a établi qu’il avait emporté des billets, de l’or, des bijoux : il a avoué aussi son vol.
Je sais, moi, que cet homme, qui fut un meurtrier, n’a pas été un voleur.
Le mobile du crime n’a été ni la vengeance, ni un ressentiment quelconque. J’ajoute que l’individu n’était pas fou et qu’il était parfaitement responsable de ses actes.
Devant la Cour d’assises, chacun eut l’impression d’un crime féroce et banal : un homme avait tué pour voler. Le prévenu ne manifesta aucun repentir.
On ne connaissait que son nom et son lieu de naissance. Orphelin de bonne heure, il avait quitté son village à douze ans, après être resté quelques années à l’école. Avait-il subi des condamnations ? Son signalement anthropométrique n’apprit rien sur son compte.
Son avocat l’avait obligé à signer son pourvoi et son recours en grâce. L’un et l’autre furent rejetés.
Le jour même de l’exécution, je reçus à Paris une lettre volumineuse, dûment affranchie et qui avait été mise à la poste par un intermédiaire inconnu ; en tout cas, elle n’avait pas passé par les mains du directeur de la prison.
L’homme me rappelait qu’il m’avait connu dans une autre ville, au moment où il était employé dans une grande usine qui appartenait à un de mes amis.
À ce moment, me disait-il, il vous est arrivé de m’interroger, non, je l’ai bien vu, par une simple curiosité, mais par une sorte de compassion affectueuse. Il vous avait semblé que j’étais un homme au-dessus de ma condition. Je n’ai jamais été, je dois le dire, qu’un simple ouvrier, et je suis allé quatre ans à l’école. Il se trouve seulement que j’ai lu beaucoup de livres et qu’il m’en reste quelque chose.
Je fréquentais peu mes camarades et j’allais rarement au cabaret. On n’aimait pas sortir avec moi, je n’étais pas ce qu’on appelle un bon compagnon, j’avais la figure triste… Or, vous me l’avez dit, c’est justement cette expression de mon visage qui vous a poussé la première fois à m’adresser la parole… Une fois, j’ai fini par vous dire, et c’était l’absolue vérité, que j’étais triste sans raison, ou plutôt pour la raison la plus grave, simplement parce que je me disais que le bonheur existait quelque part au monde, et que, moi, je ne le connaîtrais jamais…
Un jour, j’ai quitté l’usine sans prévenir personne, pour m’en aller loin de là, à un endroit où la vie peut-être serait relevée par un peu d’espoir…
C’est ainsi que je suis venu ici, dans la ville d’où je vous écris. J’avais trouvé une place d’aide jardinier chez des gens riches.
La maîtresse du logis, dont le mari était au Japon pour ses affaires, était une grande femme blonde, qui me sembla très belle… À partir de l’instant où je l’ai aperçue, et je l’avais à peine regardée, une autre vie commença pour moi.
Rien au monde, j’en étais sûr, ne me permettrait jamais d’approcher de « Madame ». Mais l’amour que j’avais en tête faisait de moi un homme heureux. Le plus beau jour fut celui où elle m’apparut pour la première fois. Était-ce sa beauté, était-ce qu’il faisait ce jour-là un soleil magnifique ? Je l’ai encore aperçue cinq ou six fois, et chaque fois j’ai été troublé, ému et heureux, oui, heureux…
Tous les jours, il y avait un bouquet sur l’appui de sa fenêtre… Je ne sais pas si elle en était très touchée, mais quelle joie pour moi de le déposer là ! J’étais enivré, comme Ruy Blas quand il apportait ses fleurs à la reine Maria.
Un jour, Madame m’a parlé. Elle m’a dit :
« C’est vous qui m’apportez ces fleurs ? »
J’ai répondu bêtement, les yeux baissés, en continuant mon travail, avec une voix rauque de brute :
« Oui, je sais que les bouquets, ça fait toujours plaisir… »
Vous comprenez, je ne voulais rien lui dire, ni même me montrer à elle tel que j’étais…
Un jour, je l’ai vue passer et, d’un coup d’œil furtif, j’ai pu remarquer qu’elle avait les yeux rougis… Une femme de chambre m’a dit qu’une lettre de Monsieur était venue, que les affaires allaient mal. Et j’ai appris aussi, d’autre part, et ce même jour, que ces gens ne seraient vraiment riches et à l’abri du malheur que lorsqu’ils hériteraient de leur oncle, un vieux rentier du pays.
Ce vieux rentier, vous vous doutez bien maintenant qui c’était… Quand l’idée a poussé en moi, tout mon corps a tremblé de peur, mais jamais je ne m’étais senti tant d’amour ! Il n’y avait pas à discuter, mon parti était pris déjà… Le soir même il arrivait ce qui est arrivé…
L’or, les billets, les bijoux que j’avais emportés pour faire croire à un vol, je les ai jetés n’importe où, dans la rivière. On les retrouvera ou on ne les retrouvera pas. Il y en avait pour quelque argent, mais ce n’est rien auprès de la fortune qu’il a laissée, qu’il lui a laissée.
Je vous écris tout cela en pleine confiance… Je suis sûr que vous ne me trahirez pas ; d’ailleurs, à quoi cela servirait-il ? Je serai sans doute exécuté quand vous aurez cette lettre entre les mains. Ma mémoire n’intéresse personne… Et puis, c’est un secret à moi que je vous confie, en vous demandant de ne pas le révéler.
Elle n’a jamais su rien de rien… Je l’ai vue à la Cour d’assises. Et alors, Monsieur, j’arrive au point le plus grave de ma confession…
Je l’ai vue à la Cour d’assises… Elle est entrée. Elle m’a regardé avec crainte, comme un sale assassin que je suis. Moi, je l’ai regardée mieux que je ne l’avais fait jusqu’alors… Elle s’est mise à faire sa déposition, une déposition quelconque, disant qu’elle ne s’était jamais doutée que j’étais un bandit…
Et à mesure qu’elle parlait, Monsieur, à mesure aussi que je la regardais davantage, je me disais, écoutez ça, que je n’aimais pas, pas du tout cette femme, que je ne l’avais jamais aimée, que je m’étais monté la tête… J’avais tué un homme pour elle… Et je ne l’avais jamais aimée…
Je n’ai plus rien écouté, ni les autres témoins, ni le procureur, ni mon avocat. Ah ! quelle tête d’imbécile j’avais encore sur les épaules ! Allons, vite, vite ! qu’on en débarrasse le monde et qu’on envoie voltiger ça dans le panier !
LÉONARD
Mon valet de chambre – un phénomène – s’appelle Léonard.
Je puis vous le présenter en liberté, sans qu’il y ait danger d’affronter sa modestie. Il ne lit jamais les journaux, bien qu’il soit très souvent en train de lire. Mais il lit de préférence des livres dépareillés que l’on a mis au rebut. Comme tous les gens d’imagination, il adore les volumes où il manque des pages.
Un observateur superficiel dirait de lui : « C’est un garçon distrait. » Sa prétendue distraction vient de ce qu’il a un esprit de suite tout à fait extraordinaire. Si j’ai le tort de lui demander de me préparer mes habits de soirée au moment où il est préoccupé d’un autre sujet, il n’abandonnera pas, bien entendu, son sujet de préoccupation. Aussi lui arrive-t-il de me sortir un habit noir et un pantalon gris, de disposer au pied de mon lit un soulier verni et un soulier mat, et quelquefois deux souliers du même cuir, mais aussi du même pied.
Quand je lui fais remarquer ces menues erreurs, il est le premier (et parfois le seul) à s’en amuser. Il considère qu’il y a en lui un petit être inconsidéré, qu’il contemple avec beaucoup d’indulgence.
« C’est encore moi qu’a fait ça ! » s’écrie-t-il avec jovialité.
Lorsqu’on téléphone en mon absence, il oublie rarement de me dire qu’on a téléphoné. Mais il ne se rappelle jamais le nom du monsieur qui m’a demandé à l’appareil.
« Tout ce que je puis dire à Monsieur, c’est que cette personne tient à ce que Monsieur lui téléphone tout de suite ; elle a dit comme ça que c’était important ! »
Il lui manque également la mémoire des physionomies. Mais il se rappelle fort bien les noms de quelques amis et de divers fournisseurs. Quand un ami sonne à ma porte, Léonard se croirait déshonoré s’il lui demandait son nom. Mais il puise au hasard dans le lot des noms qu’il connaît. Ensuite, il fait irruption dans ma chambre et me dit avec assurance :
« M. Maréchal attend Monsieur au salon. »
Je sais maintenant que ce nom ne s’appliquera que providentiellement à la personne qui m’attend. Mais, au début, je n’étais pas entraîné. Léonard venait m’annoncer un maître vénérable. Je quittais en toute hâte mon veston de travail pour un vêtement moins taché, je préparais un sourire d’accueil affable et déférent, et je me trouvais brusquement en présence d’un petit commis de seize ans qui apportait une facture. Un jour, il me dit :
« C’est madame… », en ajoutant le nom d’un relieur à qui j’avais à plusieurs reprises réclamé des livres.
Je pensai que ce relieur m’envoyait sa femme pour me donner des explications, que j’étais disposé à recevoir avec fureur. Et j’invectivai une vénérable personne qui venait me faire de brillantes propositions pour une tournée de conférences. Elle fut un peu froissée ; je n’arrivai à la défroisser qu’imparfaitement ; elle sortit dignement, et jamais plus je n’entendis parler de cette affaire.
Aussitôt levé, je prie Léonard de faire ma chambre pour pouvoir travailler à mon petit bureau. Quelquefois il fait le ménage avec une rapidité inquiétante. D’autres jours, il est pris d’un besoin de minutie que rien ne contente et qui lui fait pourchasser maladivement jusqu’au dernier grain de poussière. Dans ces cas-là, je n’attends pas qu’il ait fini. Je rentre dans ma chambre, je ferme d’autorité la fenêtre, et je me mets à mon travail. Léonard ne s’en formalise pas. Il continue sa besogne pendant une heure encore, en me racontant mille incidents du quartier. Si je lui demande de se taire, il y consent de bonne grâce et continue à frotter les meubles en riant silencieusement. Je pourrais en être agacé ; mais il me dit avec gentillesse :
« Ce n’est pas de Monsieur que je ris ! »
L’autre avant-midi, il est entré chez moi comme un cyclone, s’est arrêté tout à coup et m’a dit avec un bon sourire :
« Je ne sais plus du tout ce que je voulais dire à Monsieur. »
Il s’est accoudé ensuite rêveusement à la bibliothèque en se demandant à haute voix et à plusieurs reprises ce qu’il était venu me dire. Puis son regard étant tombé sur le livre que je consultais, il s’approcha avec intérêt pour en lire le titre. Il vit que c’était un ouvrage sur la guerre.
Il en prit prétexte pour me parler de ses campagnes. Il me révéla alors ce qu’il avait toujours négligé de me dire : il avait obtenu deux citations. Il en conservait sur lui les libellés, qui étaient fort honorables. Mais il les regardait avec détachement : on eût dit qu’il s’agissait de quelqu’un d’autre. Il en souriait, comme s’il s’était amusé de ses gaffes…
Il me raconta, en se moquant sincèrement de lui-même, qu’il était allé parfois se promener, par étourderie, en avant des lignes.
Puis il me fit, en y attachant cette fois une grande importance, le récit des aventures du front les plus insignifiantes. Il me rapporta, syllabe par syllabe, un très long entretien oiseux avec un vaguemestre…
« Une autre fois, voilà que le cuistot… Ah ! j’ai trouvé ce que je venais dire à Monsieur : Monsieur est servi ! »
UNE MAGNIFIQUE OCCASION
Ce train express, qui arrive à Marseille dans l’après-midi, n’avait emmené de Lyon qu’une vingtaine de voyageurs de première, répartis dans trois grands wagons-couloirs.
M. Malardin, un gros industriel de la région lyonnaise, avait pu trouver un compartiment où il était seul, et s’en était félicité, bien qu’il fût un homme sociable.
M. Malardin était un quinquagénaire de bonne carrure, qui n’avait pas trop de son ample barbe noire et de sa graisse pour masquer une grande timidité.
Il avait employé la première demi-heure du voyage à couper les feuillets de plusieurs revues qu’il s’était cru obligé d’acheter à diverses marchandes de journaux de Lyon-Perrache. Mais le plus dur n’était pas fait : il fallait maintenant se distraire en lisant ces périodiques… Il décida de dormir avant, pour aborder ensuite cette lecture avec un esprit dégagé et dispos.
Avignon était la dernière gare où l’express s’arrêtât avant Marseille. Personne ne descendit du train. Mais, au tout dernier moment, il monta un voyageur qui fit l’inspection de quelques compartiments et finit par élire domicile auprès de M. Malardin ; celui-ci retira avec empressement les brochures qui jonchaient la banquette d’en face.
Le nouveau venu portait, comme M. Malardin, une barbe assez longue. Il s’assit, enleva avec précaution un beau cache-nez de soie blanche à rayures noires, le plia avec précaution et le posa à côté de lui. M. Malardin, de l’œil soigneusement indifférent d’un homme bien élevé qui n’a pas été présenté, suivait tous les gestes de son compagnon de voyage…
Mais l’inconnu, moins homme du monde sans doute, était, plus communicatif :
« Vous admirez mon beau cache-nez ? »
M. Malardin ne sut pas s’il était plus poli de dire oui ou bien non. Il remplaça donc la réponse par un petit grognement vaguement condescendant.
« Si je me permets de vous faire cette demande, poursuivit l’inconnu, c’est qu’il s’agit d’un produit de ma fabrication… Oui, c’est une nouvelle soie artificielle que nous faisons dans le Vaucluse. Si je vous disais le prix de revient, vous seriez stupéfait… Douze francs !
— Ce n’est, en effet, pas cher, dit M. Malardin. J’aurais dit facilement cinquante ou soixante.
— Nous le vendrons vingt francs… Pardon, Monsieur, je vais être indiscret. Mais puisque vous êtes le premier à avoir vu ce cache-nez, notre premier échantillon, une sorte de superstition me pousse à vous l’offrir pour douze francs.
— Je vous remercie », dit M. Malardin sans savoir encore s’il devait accepter…
Mais déjà l’inconnu lui avait mis le beau foulard entre les mains. Alors il ne restait plus à M. Malardin qu’à tirer de sa poche quelques petits billets que le marchand de cache-nez serra précieusement dans son portefeuille, en affirmant qu’il considérait ces petites coupures comme des fétiches dont il ne se séparerait jamais.
Puis il demanda à M. Malardin de bien porter ce cache-nez pendant son séjour à Marseille…
« Vous avez certainement du monde qui vous attend à la gare ?
— Oui, dit M. Malardin, peut-être mon agent de Marseille.
— Eh bien, faites-moi le plaisir de mettre ce foulard pour descendre du train, afin que j’aie la satisfaction d’entendre votre agent vous en faire compliment et de vous entendre répondre : « C’est le premier produit de la maison Nicasse, d’Avignon. »
— Nicasse, je me souviendrai », dit M. Malardin en souriant.
Quelques instants après, M. Nicasse se leva et s’éloigna dans le couloir. Une demi-heure se passa sans qu’il revînt. M. Malardin se mit à sa recherche, bien qu’il n’eût rien de spécial à lui dire. Mais il ne vit de voyageur barbu dans aucun des compartiments de première. Un lavatory portait la mention : Occupé. M. Malardin, sans avoir l’air de rien, resta quelques instants, le front à une vitre, dans les environs du water… Il ne vit sortir de ce réduit qu’un monsieur glabre. Où était passé M. Nicasse ?
… Peut-être dans un des wagons de seconde classe, où il avait quelqu’un à voir ?… Il pouvait paraître impoli de sembler l’épier… M. Malardin revint s’installer dans son compartiment, où il reprit la lecture d’un article de revue sur les ressources en fer de l’Amérique du Sud. Cet article eût pu être pour lui d’un haut intérêt, au prix d’un certain effort. Mais il n’était capable d’effort que dans son bureau, entouré d’une vigoureuse équipe de sous-ordres.
Cependant Marseille n’était plus loin maintenant. La locomotive, qui sentait le dépôt, hennissait sur un ton aigu. On traversait en furie d’humbles petites gares frémissantes.
Enfin, la grande ville arriva. M. Malardin tout équipé, sa valise à la main, son beau cache-nez au cou, s’était avancé jusqu’au bout du couloir et criait : « Porteur ! Porteur !… » M. Nicasse n’avait toujours pas reparu.
Comme M. Malardin mettait le pied sur le quai après avoir passé son bagage à un facteur, trois hommes s’avancèrent dans sa direction. Deux de ces hommes l’empoignèrent solidement par le bras, l’autre prit impérieusement la valise des mains du facteur, et le tout, bagage et M. Malardin, fut conduit sans douceur au bureau de M. le commissaire central.
Le monsieur appréhendé protestait avec des bouts de phrases d’autant plus inintelligibles qu’il ne comprenait rien à ce qui se passait.
Son attitude était évidemment celle de l’innocent brutalisé, à moins qu’elle n’indiquât, avec la même évidence, la suffocation du criminel pris au piège.
« C’est bien le signalement du bandit d’Avignon que l’on vous a téléphoné de là-bas ? dit l’un des hommes de police à un de ses camarades.
— Pas d’erreur, dit celui-ci. Barbe et cache-nez de soie blanche rayé de noir…
… M. Malardin regarda le policier… Une petite lumière, encore bien vacillante, s’allumait dans la forêt sombre. M. Malardin, tout ému, s’efforça de raconter l’histoire du cache-nez et la mystérieuse disparition de l’inconnu…
Mais on ne l’écouta pas. Il fut conduit à la prison où il passa une nuit affreuse. On l’avait attendu vainement au dîner d’affaires où il avait été convié. Ce ne fut que le lendemain, après qu’il eut été identifié par une dizaine de notabilités de Marseille, que le commissaire central lui permit de reprendre la suite de son histoire, l’achat du cache-nez et la disparition du monsieur barbu. Le commissaire insinua que l’homme glabre qui était sorti du water avait sans doute sur lui des ciseaux et un rasoir, et que l’on retrouverait peut-être une barbe entre Avignon et Marseille dans l’entre-voie de la grande ligne, si toutefois le mistral avait eu la complaisance de l’y laisser.
On apprit à M. Malardin que le gracieux vendeur de cache-nez qui pour sortir plus modestement de la gare s’était dépouillé en sa faveur des attributs les plus visibles de sa personnalité, était poursuivi pour avoir à moitié assommé et complètement détroussé un vieillard dans une rue peu passante de la cité des Papes.
Puis on remit en liberté l’industriel lyonnais avec des excuses tout à fait exemptes d’ironie.
« Nous gardons encore votre cache-nez, dit le commissaire. S’il est à la victime, on le confisquera définitivement. S’il appartenait au bandit, vous l’avez bien et dûment acquis. Et même, permettez-moi de vous dire que vous avez fait là une magnifique occasion ! »
PIÈCES EN UN ACTE
LE FARDEAU DE LA LIBERTÉ
Comédie en un acte
Représentée pour la première fois le 15 mai 1897 au Théâtre de l’Œuvre (salle du Nouveau Théâtre).
Reprise à ce théâtre (salle du Théâtre Femina) le 25 mai 1909, et au Théâtre National de l’Odéon le 25 février 1924.
À Firmin Gémier.
T.B.
PERSONNAGES
|
|
Œuvre |
Œuvre (Fémina) |
Odéon |
|
CHAMBOLIN |
MM. Gémier |
Lugné-Poe |
Gémier |
|
REQUIN, marchand d’habits |
J. Adès |
Tramont |
G. Adet |
|
PETITBONDON, avocat |
Luxeuil Savoy |
Vattier |
|
|
PREMIER AGENT |
Zeller |
P. Rameil |
L. Dubosq |
|
DEUXIÈME AGENT |
Avernez |
Blanchard |
Fabry |
|
UN FACTEUR DES POSTES |
Flandres |
Baissac |
M. Girard |
|
LE GARÇON D’HÔTEL |
X |
X |
Seignier |
La scène représente une avenue spacieuse, à Paris, dans le quartier des Invalides. Au fond, un décor de rue ou d’avenue : murs de monuments publics ou maisons sans lumières. À droite, un hôtel garni. À gauche, un marchand d’habits.
SCÈNE PREMIÈRE
PREMIER AGENT,
DEUXIÈME AGENT
Deux gardiens de la paix entrent par la droite.
PREMIER AGENT. – Fais bien attention d’écouter à ce que je te dis, Francis. Tu n’as pas assez de méfiance. Méfie-toi au brigadier Lefèvre.
DEUXIÈME AGENT. – Crois-tu ?
PREMIER AGENT. – Si je l’ dis, c’est que je l’ crois. Si je l’ crois, c’est que tu peux m’en croire. Méfie-toi au brigadier Lefèvre… Francis, retiens un peu ce que je te dis : méfie-toi au Fèvre.
DEUXIÈME AGENT. – Il n’est pas mauvais garçon.
PREMIER AGENT. – N’en jure pas, Francis, n’en jure pas. Veux-tu, oui ou non, écouter à ce que je dis : méfie-toi au Fèvre.
DEUXIÈME AGENT. – Et que t’a-t-il fait ?
PREMIER AGENT. – Rien. Mais je m’ai toujours méfié à lui.
Silence.
DEUXIÈME AGENT. – Sais-tu que Bèche est pour passer aux brigades ?
PREMIER AGENT. – On ne me l’a point dit. Mais je m’en doutais. Et veux-tu que je te dise ? Ça, c’est encore un coup au Fèvre.
DEUXIÈME AGENT. – Tu vois du Fèvre partout.
Silence.
PREMIER AGENT. – Sais-tu, Francis, ce que je pense du moment…
DEUXIÈME AGENT, il s’arrête pour bâiller. – Et que penses-tu ?
PREMIER AGENT. – Je pense que du moment je n’aurais point été fâché de rencontrer… une petite demoiselle.
DEUXIÈME AGENT. – Qu’en ferais-tu ?
PREMIER AGENT. – Je saurais qu’en faire. (Un temps.) Quand je devrais que la caresser…
Ils sortent par la gauche. Chambolin entre par la droite. Il a des vêtements bourgeois en très mauvais état, déchirés, couverts de taches et de poussière.
SCÈNE II
CHAMBOLIN, seul
CHAMBOLIN. – Décidément, quand on possède quelques mille livres de rente, le séjour de Paris est peu supportable après le Grand Prix, pendant les mois d’été… J’ajouterai qu’il est moins agréable encore quand on ne possède que trois francs. Nous sommes aujourd’hui au 28 juin, et il me reste trois francs pour atteindre le mois d’octobre… Or il est douteux qu’il arrive avant trois mois… Il faudra voir passer auparavant juillet, août et septembre, qui sont des mois très ponctuels et qui n’ont pas l’habitude de céder leur tour. En octobre prochain, le contentieux des marchands de marrons ouvrira à nouveau ses bureaux de la rue Coquillière, et j’y retrouverai mon modeste emploi de commis aux écritures : trente francs par semaine, et des places à l’œil pour les Folies-Rambuteau ! D’ici là je devrai m’abstenir des Folies-Rambuteau, et, ce qui est plus grave, de toute nourriture un peu substantielle. Je vais en effet être obligé de composer la plupart de mes menus avec l’air du temps… dont les propriétés alimentaires s’affaiblissent de jour en jour… Je n’ai personne à qui m’adresser. Ma grand-mère, qui est morte il y a six mois à Dijon, m’a laissé quelques dettes… Du temps que j’étais gosse, on me disait qu’il fallait s’adresser à Dieu. Et le fait est qu’il est plein de bonté, quand on a confiance en lui et qu’on ne lui demande rien. Mais dès qu’on vient lui demander quelque chose, l’invisible… n’est plus jamais visible… Du temps que j’étais riche, les prêtres m’ont enseigné qu’il fallait secourir les pauvres ; je ne les ai pas écoutés, parce que je n’étais pas pauvre. Ah ! que ne suis-je riche, pour venir en aide au pauvre que je suis ! (Il s’assoit sur un banc.) Ce qui m’ennuie surtout, c’est la question du couchage. J’ai quitté depuis quatre jours ce petit hôtel meublé que voici. Nous n’avions pas les mêmes idées, la patronne et moi, sur les dates de paiement. C’est toujours ces questions-là qui finissent par brouiller les gens. Quelle rosse que ce patron d’hôtel ! Comme il m’a humilié ! Il n’a eu aucune considération pour moi. Les gens sont comme ça avec moi. Ah ! que les hommes sont méchants de ne pas m’aimer autant que je m’aime. Ils ont autant d’indifférence pour moi… que j’en ai pour eux… Ce qui m’ennuie, c’est la question du couchage. Voilà quatre nuits que je passe sur des bancs, que l’on a totalement oublié de carder.
Il s’étend sur le banc.
Cher petit oreiller, doux et chaud sous ma tête,
c’est la petite poésie qu’il y avait, quand j’étais petit, dans mon petit livre de poésies. Ce sont les vers de mon enfance ; j’en ai d’autres pour mon âge mûr :
Les bancs de la place publique
Pendant bien longtemps, je le crains,
Seront rembourrés de tes crins,
Ô balai de crin symbolique !
Il n’y a même pas de petit accotement de bois, pour reposer sa tête. On est moins bien traité qu’à la salle de police. C’est que les vagabonds se trompent un peu sur la destination de ces bancs ; ils ne sont pas faits pour qu’ils y dorment ; les bancs sont faits pour les promeneurs : les petits rentiers y digèrent. Si les vagabonds s’y étendent, c’est pas pure tolérance, à l’heure où la société ferme les yeux. (Il se relève.) Je ne peux vraiment pas me coucher de si bonne heure. Il n’est pas neuf heures. Je ne tiens pas à passer dans le quartier pour un jeune homme trop rangé. Promenons-nous un peu… Je voudrais tout de même trouver un gîte… Ici, c’est un peu haut de plafond ; l’hiver, ça doit être difficile à chauffer. Et puis ça manque d’intimité. Il y a des gens qui passent et repassent… Non, c’est stupide à la fin. Il faut que je trouve une combinaison pour passer l’été. Asseyons-nous sur notre lit et réfléchissons… Il me reste bien une ressource à laquelle j’ai déjà songé. J’ai mis au Mont-de-Piété tout ce que j’avais. Je n’ai plus à moi que mes os et ma peau. Le Mont-de-Piété ne prête rien là-dessus. Mais il y a tout de même un clou pour les objets de ce genre. Je vais aller passer trois mois à Fresnes… On dit que c’est un endroit assez fermé : je m’y ferai présenter par trois magistrats, trois juges au tribunal de la Seine. Pour ça, il faut que je me soumette à une formalité et que je commette un délit, oh ! un petit délit, car je tiens à ne pas y rester plus de trois mois. À la chute des feuilles, je veux reprendre mon modeste emploi de commis aux écritures. Un délit, un petit délit qui me rapporte trois mois de prison ? Qui pourrait m’indiquer ça ?… Il y a justement dans mon hôtel un petit jeune avocat qui vient de prêter serment. Je vais le faire descendre et lui demander son avis sur cette question délicate.
SCÈNE III
CHAMBOLIN, PETITBONDON
CHAMBOLIN, il frappe à la porte de l’hôtel. – C’est moi, garçon. C’est moi, votre ancien locataire, François Chambolin.
UNE VOIX. – Vous désirez ?
CHAMBOLIN. – Maître Petitbondon est-il à l’hôtel ?
UNE VOIX. – Je vais voir, Monsieur. Il doit être dans sa chambre, à travailler.
CHAMBOLIN. – Voulez-vous le prier de venir jusqu’ici ? C’est une affaire urgente. Dites que c’est un client… (Revenant à l’avant-scène.) Maître Petitbondon est un garçon de vingt et un ans qui a prêté serment d’avocat la semaine dernière. C’est un bon petit jeune homme, qui sera ravi d’être consulté. Je n’ai que de faibles tuyaux sur son éloquence. Mais je n’ai pas besoin d’un avocat éloquent ; j’ai besoin d’un jurisconsulte, qui me donne un conseil profitable et qui ne risque pas de me faire acquitter en me défendant trop bien.
PETITBONDON. – Tiens, monsieur Chambolin. Comment allez-vous ? C’est vous qui avez besoin de moi ?
CHAMBOLIN. – Oui, cher maître.
PETITBONDON. – Je vais vous faire entrer chez moi.
CHAMBOLIN. – Non, cher maître. J’ai des raisons spéciales pour m’abstenir d’entrer dans cette maison. Les gens y sont trop capricieux. Ils vous font bonne figure le 14 du mois ; le 16, ils vous témoignent déjà un peu de froideur ; et, vers le 20, ils ne vous marquent plus aucune amitié. On a tort d’introduire des questions d’argent dans les relations avec les patrons d’hôtel.
PETITBONDON. – Et vous désirez ?
CHAMBOLIN. – Je viens faire appel à votre éloquence, si jeune et déjà si remarquable, pour obtenir trois mois de prison.
PETITBONDON. – Pour quel délit ?
CHAMBOLIN. – Je n’en sais encore rien du tout. Et c’est là-dessus que je sollicite vos conseils. Il me faudrait un petit délit, dans les prix doux, pour me faire enfermer à Fresnes. Je m’ennuie à Paris où les sommiers sont si durs, et l’air de la rue m’est défendu par la Faculté. Ainsi donc, puisque vous connaissez le code, trouvez-moi un petit délit dont le prix maximum soit six mois de prison. En marchandant un peu, vous obtiendrez trois mois, j’en suis convaincu.
PETITBONDON. – Vous êtes un drôle de client.
CHAMBOLIN. – Je suis le client rêvé. Je vous consulte non sur le délit commis, mais sur le délit à commettre. Je vous fournis tous les éléments d’une belle plaidoirie. Adoptez le délit qui vous plaira le mieux, le plus juteux pour votre éloquence, celui qui vous permettra d’évoquer mon enfance misérable, mon éducation imparfaite, les mauvais traitements à moi infligés par une marâtre. Dissertation sur un sujet libre. Vous avez là un domaine assez vaste. Choisissez le terreau le plus favorable à la culture de vos lieux communs.
PETITBONDON. – Je veux bien, après tout. Je suis un peu nouveau dans la carrière. Je ne sais pas si le conseil de l’ordre et les anciens me verraient d’un bon œil donner des consultations de ce genre, mais ce n’est pas vous qui irez leur raconter cela… Commençons par écarter les plats chers, tels que l’assassinat et le vol. Même un petit vol pourrait vous entraîner trop loin.
CHAMBOLIN. – Et puis, il faut me trouver quelque chose de plus facile.
PETITBONDON. – De plus facile ?
CHAMBOLIN. – Mais oui. Le vol est un travail comme un autre, et souvent plus difficile qu’un autre, sans même parler des risques. Avez-vous déjà essayé de voler ?
PETITBONDON. – Jamais, voyons !
CHAMBOLIN. – Eh bien, ne parlez pas de ça. Vous avez reçu comme moi une éducation dangereuse. On s’est évertué à vous répéter que c’était très mal d’être un voleur, un escroc ou simplement de se faire entretenir par les femmes. Alors, vous avez pu vous dire à part vous : « C’est très mal, vraiment, et je ne me résoudrai à voler qu’à la dernière extrémité… mais j’aurai toujours cette petite corde à mon arc, si je suis acculé. Quand je n’aurai plus les moyens d’être honnête, j’aurai la ressource de ne l’être plus. » Vous vous êtes figuré qu’il suffisait, pour s’enrichir… que dis-je ? pour vivre par le vol, de se débarrasser de quelques scrupules ?… Ce serait vraiment trop beau. Vous n’avez jamais essayé de forcer un coffre-fort ?… Eh bien, c’est très dur. Et quand on s’est donné beaucoup de mal, savez-vous ce qu’on y trouve, dans les coffres-forts ? Des titres nominatifs, rien que des titres nominatifs, et parfois des papiers de famille, des cachets de douches sulfureuses, un livret militaire et des cartes d’entrée périmées pour l’exposition du cercle Volney… C’est comme pour se faire entretenir par les femmes. Mais, mon cher Monsieur, pour trouver une bonne place de souteneur, c’est aussi difficile que d’entrer au Conseil d’État !
PETITBONDON. – Alors, il faut vous trouver quelque chose de plus facile.
CHAMBOLIN. – S’il vous plaît.
PETITBONDON. – Que diriez-vous du vagabondage ? De trois mois à six mois d’emprisonnement.
CHAMBOLIN. – Va pour le vagabondage. Je suis vagabond stagiaire depuis quelques jours. Je vais passer vagabond en pied, vagabond officiel. Quelles sont les formalités ?
PETITBONDON. – Mettez vos plus vieux habits.
CHAMBOLIN. – J’ai mis les plus neufs… Mais ce sont les mêmes, entre nous… On dit que Georges Brummel ne voulait jamais mettre d’habits neufs, qu’il faisait porter les siens par ses domestiques avant de les endosser. Brummel trouverait sans doute que j’ai un peu exagéré ses théories de dandysme. Regardez-moi ce veston, et cet aimable gilet gris, seul survivant d’un complet gris qui eut, ma foi, son heure d’élégance.
PETITBONDON. – Eh bien, maintenant, il ne vous reste plus qu’à vagabonder.
CHAMBOLIN. – Mais, malheureux, je ne fais que ça depuis quatre jours !
PETITBONDON. – Et vous avez rencontré des agents ?
CHAMBOLIN. – Si j’ai rencontré des flics ! Il n’en manque pas. J’en rencontre tous les quarts d’heure.
PETITBONDON. – Et ils ne vous disent rien ?
CHAMBOLIN. – Ils ne sont pas familiers… Non, je ne réussis pas à attirer l’attention des flics ; non plus d’ailleurs que celle des gendarmes. Car j’ai été dans la banlieue, et j’ai rencontré des cognes avec leur fier bicorne et leur baudrier. Je croyais que les cognes étaient plus communicatifs que les flics, qu’ils demandaient volontiers leurs papiers aux gens, et que ça les flattait de rentrer dans les chefs-lieux de canton en poussant un vagabond captif devant leurs solides chevaux. Eh bien, les cognes sont blasés là-dessus. Les cognes me méprisent, eux aussi.
PETITBONDON. – J’ai une idée. Les agents et les gendarmes vous ont laissé aller, parce qu’il y a du vagabond en masse en ce moment et qu’on ne peut leur donner à tous la chasse. Mais vous pourriez vous faire remarquer entre tous les autres vagabonds par un signe distinctif, une belle décoration dont le port illégal vous vaudrait six mois de prison, ou seulement trois mois, car on pourrait vous faire acquitter sur le chef de port illégal : le tribunal, qui est moins dédaigneux que les flics, vous retiendrait sûrement sur le chef de vagabondage.
CHAMBOLIN. – Au fait, je vais essayer. J’ai connu un brave homme qui s’est fait condamner pour ça. Je vais me procurer un ruban. Où pourrais-je en trouver ?
PETITBONDON. – Voyez donc chez le marchand d’habits, s’il n’en trouve pas un après quelque redingote. Il vend aussi de la mercerie d’occasion et pourra sans doute vous donner dix centimètres de ruban rouge.
CHAMBOLIN. – Maître Petitbondon, vous me sauvez la vie, et je vous suis très reconnaissant de la consultation. Qu’est-ce que je vous dois ?
PETITBONDON. – Oh ! ce n’est rien. Trop heureux de vous être utile…
CHAMBOLIN. – Si, si. Je tiens à m’acquitter. Je n’ai d’ailleurs rien à vous donner. Mais je prétends vous devoir quelque chose. Je vous dois quarante francs. Quand j’aurai beaucoup d’argent, je vous donnerai quarante francs.
PETITBONDON. – Va pour quarante francs. C’est le premier argent que je gagne. Je vais fêter cela en m’offrant un petit souper. Avec les quarante francs que vous me devez, je vais me payer un souper… que je devrai au patron de l’hôtel.
Il rentre à l’hôtel.
SCÈNE IV
CHAMBOLIN, puis REQUIN
CHAMBOLIN. – Procurons-nous ce précieux ruban rouge, objet de tant de convoitises. (Il frappe à l’auvent.) Monsieur Requin ! Monsieur Requin !
UNE VOIX. – Qu’y a-t-il ?
CHAMBOLIN. – Est-ce à Son Excellence Eugène Requin que j’ai l’honneur de parler ?
REQUIN. – Que me voulez-vous ?
CHAMBOLIN. – Monsieur Requin, j’aurais un instant d’audience à vous demander.
REQUIN. – Une audience ?
CHAMBOLIN. – Monsieur, mes titres ne vous sont pas connus : permettez que je les rappelle. Né dans la médiocrité, j’y fus élevé et n’en sortis point. Depuis mon enfance, j’ai rendu de sérieux services à mes contemporains, car je ne leur ai jamais donné l’exemple pernicieux d’une action d’éclat. Par là, je leur ai évité toute exaltation dangereuse. J’ai vu des personnes se noyer dans la mer et je me suis borné à crier au secours et à applaudir le courageux sauveteur. Je n’ai jamais fondé d’hospice, jamais je n’ai présidé une société de tir. Je n’ai jamais exposé des produits industriels dans aucune exposition. Je viens donc solliciter de vous, monsieur Requin, la faveur de porter illégalement et illégitimement le ruban de la Légion d’honneur.
REQUIN. – Quand vous aurez fini, vous parlerez sérieusement et vous me direz ce qu’il y a pour votre service.
CHAMBOLIN. – Monsieur Requin, si vous me connaissiez mieux, vous sauriez que je suis toujours sérieux. J’ai l’air de plaisanter sur les choses ; ce n’est pas ma faute, à moi, c’est les choses qui ont commencé et n’apportent pas autant que moi de gravité dans leur manière d’être. Il me faudrait un peu de ruban rouge pour orner ma boutonnière. Si vous n’avez pas ça tout fait sur un de vos vieux habits, vous trouverez bien quelques centimètres de ruban dans un coin. Je n’hésiterai pas à vous verser vingt centimes pour les droits de chancellerie.
REQUIN. – Allez jusqu’à cinquante centimes et je vous donnerai un ruban à moi que j’ai sur mon vêtement d’été et que je porte un mois par an, à Contrexéville, où je vais pour mes rhumatismes. À Vichy, où Mme Requin va pour son foie, elle exige que j’aie la rosette d’officier.
CHAMBOLIN. – Allez, et rapportez-moi ça. (Requin sort à gauche. Seul.) Je n’ai jamais vu des gens aussi orgueilleux et aussi arrogants que les marchands d’habits. Leur profession est fort décriée, ils ont l’air de ne pas s’en rendre compte. Ils sont humbles et modestes avec les gens riches, mais c’est pour les besoins de leur commerce. Ils ont en somme une forte estime d’eux-mêmes et un grand mépris pour le reste de l’humanité. (À Requin qui revient.) N’est-ce pas, monsieur Requin, que lorsque vous portez une fausse décoration à Contrexéville, vous vous imaginez réparer une injustice de la société ?
REQUIN. – Convenez que la société est bien injuste pour nous. Je vous en parle à vous, car je vois que, malgré votre costume, vous êtes un garçon comme il faut. Quel mal est-ce que nous faisons ? Est-ce un crime de vendre de vieux habits ?
CHAMBOLIN. – Ne faites-vous que ça, monsieur Requin ? Ne vous arrive-t-il pas quelquefois, quand l’occasion s’en présente, de prêter de l’argent à des fils de bonne famille ?
REQUIN. – Si je le fais, c’est, croyez-le bien à des conditions des plus modérées et honorables.
CHAMBOLIN. – Nous les connaissons vos conditions honorables. Comment, imprudent Requin, vous exploitez les fils de famille ! Vous vous enrichissez aux dépens des riches ! On ne doit, sachez-le bien, s’enrichir qu’aux dépens des pauvres seulement. Vous vivez de la paresse de votre prochain, c’est de son travail seul que vous devez profiter.
REQUIN. – Voilà votre décoration. Mais vous n’allez pas mettre ça sur vos habits ! Ils sont en bien mauvais état !
CHAMBOLIN. – Pas la peine de les décrier. Ils ne sont pas à vendre et je n’ai pas l’intention de vous en acheter d’autres.
REQUIN. – J’en ai pourtant de bien jolis, tout à fait élégants et bon marché, qui feraient bien votre affaire.
CHAMBOLIN. – Ceux-ci me semblent parfaits et beaucoup plus à mon goût que tout ce que vous pouvez m’offrir. Il y a des endroits où il n’y a pas de doublure. Il y a d’autres endroits où il n’y a que de la doublure. Et voyez là, et voyez là : la doublure et l’étoffe se sont en allées de concert. Elles ont fait place à une ouverture très hygiénique qui laisse passer l’air. Voilà une boutonnière qui n’a pas son bouton. Voilà un bouton qui n’a pas sa boutonnière. Pourquoi faut-il que ce bouton sans boutonnière soit si loin de cette boutonnière sans bouton ?
REQUIN. – Savez-vous ce qui va arriver ? Si vous mettez votre décoration sur ce vilain paletot, vous allez vous faire arrêter.
CHAMBOLIN. – J’en accepte l’augure. Regagnez, monsieur Requin, regagnez votre gîte. Moi, je vais chercher le mien. On m’a parlé de quelque chose d’assez confortable dans la banlieue Sud. Aussitôt installé, aimable Requin, je vous fais signe et nous pendons la crémaillère.
Exit Requin.
SCÈNE V
CHAMBOLIN, seul. – Ça fait bien, cette décoration. Mais pour que ça soit bien, il faut être jeune, avoir dans mes âges, trente-deux ou trois ans. Plus tard, ça n’a plus d’intérêt : on a l’air d’un vieux chef de bureau… Il s’agit maintenant d’attendre les agents. Je vais me placer en pleine lumière, sur ce banc… Les représentants de la force publique ne vont pas tarder à arriver. J’aperçois là-bas, dans l’ombre, de l’ombre plus épaisse, qui bouge… Couchons-nous et attendons… Voilà les flics. Dormons.
SCÈNE VI
PREMIER AGENT,
DEUXIÈME AGENT,
CHAMBOLIN, étendu sur le banc.
DEUXIÈME AGENT. – Une devinette. Deux filles qui font l’trottoir se courent l’une après l’autre, se pass’, repass’ et dépassent toujours ?
PREMIER AGENT. – Dis-moi. Je sais pas deviner. Et ça m’amuse autant que tu me le dises tout d’suite.
DEUXIÈME AGENT. – Tu la d’vines pas ?
PREMIER AGENT. – Dis-la-moi donc, fourneau ! Quand j’ te dis que j’ suis pas exercé à d’viner.
DEUXIÈME AGENT. – Mais tu les as sur toi, fourneau ! (Riant.) C’est tes bottes. C’est les deux bottes du sergent de ville.
PREMIER AGENT, grave. – Ah ! celui-là n’est pas mauvais, Francis. C’en est un bon, celui-là. Tu vas me l’écrire sur un papier. Je veux le rapporter à Sophie. (Ils s’approchent du banc.) En voilà un qui fait des heures ! S’en paie-t-il de roupiller !
DEUXIÈME AGENT. – Il dort dur. Tiens !
PREMIER AGENT. – Qu’as-tu ?
DEUXIÈME AGENT. – Il a la décoration.
PREMIER AGENT. – Oui, et la bonne.
DEUXIÈME AGENT. – La Légion.
Ils s’éloignent.
PREMIER AGENT. – C’est un vieux serviteur de la patrie. Il a dû faire campagne, ce vieux-là. Il a versé son sang sur les champs de bataille.
DEUXIÈME AGENT. – Et le voilà dans la purée. (Après réflexion.) C’est une belle chose, tout de même, que la Légion.
PREMIER AGENT. – Oui, ça fait rudement bien sur une tunique. Ah ! c’est une belle affaire que ce ruban rouge !
DEUXIÈME AGENT. – Oui, mais y en a bien qui l’ont eu pour de l’argent.
PREMIER AGENT. – Eh bien, ça prouve que c’est des gars qui ont de l’argent.
DEUXIÈME AGENT. – Et puis, qu’y en a donc que c’est leur femme qui leur a fait obtenir ça, en allant voir les ministres !
PREMIER AGENT. – Eh bien, ça prouve encore qu’ils ont une jolie petite bourgeoise et qui connaît son affaire.
DEUXIÈME AGENT. – Et tous ceux qui s’ sont fait pistonner par leur député !
PREMIER AGENT. – C’est donc qu’ils ont de belles relations. Vois-tu, Francis, ça prouve toujours quéqu’ chose : qu’on a du mérite, qu’on a de l’argent, qu’on a une belle petite femme ou de jolies relations. C’est pour ça qu’il n’en faut point médire et que c’est toujours flatteur.
Ils sortent à droite.
SCÈNE VII
CHAMBOLIN, seul. – Ils ne veulent pas de moi. Je ne peux pas leur forcer la main. Je ne peux pourtant pas aller trouver le commissaire et me constituer prisonnier pour avoir porté illégalement la croix de la Légion d’honneur. Le commissaire ne me gardera que pour un beau crime… J’ai encore deux francs cinquante. Je veux les garder le plus longtemps possible et essayer de dormir sur ce banc. Ah ! un beau crime…
Il s’étend sur le banc. Un vieux facteur des postes entre en scène, à droite. Trémolo.
SCÈNE
VIII
CHAMBOLIN, LE
FACTEUR
LE FACTEUR, lisant la suscription d’une enveloppe cachetée de rouge. – Monsieur Francis Chambolin, à l’hôtel Saint-Adolphe ! Où ça peut-i être ? Le receveur des postes a vraiment du culot de m’envoyer porter une lettre à c’ t’heure ici, sous prétexte qu’elle avait été oubliée, je ne sais vraiment comment, à la distribution de cinq heures. Il est fou, ce receveur. Il veut arriver. C’est un garçon qui fait du zèle. Monsieur François Chambolin, à l’hôtel Saint-Adolphe. Où que ça peut bien être ?… Je suis bien dans la rue Duplessis-Bouquet. C’est pas moi qui fait c’te rue-là d’ordinaire… je m’y retrouve pas du tout… Les numéros ne se suivent pas dans c’te rue-là… P’tête bien qu’on les tire au sort entre les maisons… C’est pourtant bien par ici, nom de nom ! (Il va au bec de gaz et aperçoit Chambolin.) Dites donc, la pratique, vous ne savez pas où c’est, l’hôtel Saint-Adolphe ? J’ai une lettre chargée à y remettre et j’ignore où ce que ça se trouve.
CHAMBOLIN. – Une lettre chargée…
LE FACTEUR. – Oui, et une bonne. Valeur déclarée : cinq cents francs.
CHAMBOLIN. – Cinq cents francs…
LE FACTEUR. – Eh bien, l’hôtel Saint-Adolphe, tu ne connais pas ça ?
CHAMBOLIN. – Cinq cents francs… Tu tiens absolument à remettre cette lettre à son destinataire… Écoute, vieux, sais-tu ce que tu devrais faire ? Me passer la lettre chargée et nous partagerions.
LE FACTEUR, allant vers la gauche. – Moi qui n’a jamais fait de ces trucs-là, penses-tu que je vas commencer à cinquante-quatre ans.
CHAMBOLIN. – Tu auras été victime d’un faussaire. Le faussaire, c’est moi. Je prends la chose à mon compte.
LE FACTEUR. – Fiche-moi un peu la paix et montre-moi l’hôtel Saint-Adolphe… Ah ! le voici. (Il sonne, puis entre.) Une lettre chargée…
CHAMBOLIN, seul. – Ah ! Sang Dieu ! Je l’avais là tout seul… Personne dans la rue… Je lui aurais mis mon couteau sur le cou… je le forçais à me donner cette lettre… C’était si simple… On ne voit ces choses-là qu’après… Zut ! je vais fiche le camp d’ici…
Il va vers la droite quand s’ouvre la porte de l’hôtel.
LE FACTEUR. – Vous dites qu’il a quitté l’hôtel depuis quatre jours et que vous ne savez pas où il habite ?
LE GARÇON. – Ça va être le diable pour le retrouver. Vous seriez venu il y a une demi-heure, il a passé à l’hôtel.
CHAMBOLIN, se rapprochant. – Garçon !
LE GARÇON. – Mais le voilà !
LE FACTEUR. – Lui !
LE GARÇON. – C’est bien lui, M. Chambolin !
LE FACTEUR. – Elle est bonne !
CHAMBOLIN. – Je te crois qu’elle est bonne ! (Il regarde la lettre.) La lettre est pour moi ! Étude de maître Godet, notaire à Dijon… Le notaire de feu ma grand-mère… (Le facteur lui tend la plume) La lettre est pour moi ! Allons ! signons tout de même… Mais, mon ami, je tiens à ce que tout se passe régulièrement, puisque la lettre est pour moi… Je sais que vous n’avez pas le droit de me la remettre dans la rue… Venez à l’hôtel.
LE FACTEUR. – Inutile. Puisqu’on dit que c’est bien vous… (À demi-voix.) Vous êtes toujours disposé à partager ?
CHAMBOLIN. – Voilà quarante sous pour vous… Adieu, vieux frère… Déchirons proprement l’enveloppe. Les cinq cents francs y sont. Voyons la lettre du notaire :
Monsieur,
L’actif de la succession de Mme Dubrousset, votre grand-mère, se trouve considérablement augmenté par la réalisation d’une créance qu’on croyait perdue… et sur laquelle il vous revient quatorze mille cinq cents francs. Venez à Dijon, où votre présence est nécessaire. Vous trouverez ci-inclus cinq cents francs à votre débit, que j’ai cru bon de vous envoyer, au cas où vous seriez embarrassé pour les frais du voyage.
Il relit la lettre en chantant, avec le plus grand sérieux.
Quatorze mille cinq cents francs ! (Bas.) Quatorze mille cinq cents francs ! (Avec éclat.) Quatorze mille cinq cents francs ! Procurons-nous du linge propre et des vêtements confortables. Ces vêtements me sont moins odieux maintenant que je peux m’en payer d’autres. Ça m’est égal qu’on pense que je suis mal vêtu, du moment que j’ai le moyen de me vêtir richement. Cependant, leur malpropreté me fait horreur. Je vois des taches de graisse que je n’avais pas remarquées. Allons chez Requin et procurons-nous des habits. Ensuite nous irons prendre un bain et nous nous mettrons en quête d’un hôtel confortable et pas trop cher cependant. Il ne saurait être question de Fresnes, désormais. La liberté est un bien précieux, mais il faut avoir un petit capital d’exploitation pour le cultiver.
Il entre chez Requin.
SCÈNE IX
PREMIER AGENT,
DEUXIÈME AGENT
Les agents entrent par la gauche.
PREMIER AGENT. – As-tu vu le coup, Francis ? Quand je te disais qu’il fallait avoir l’œil sus el’ brigadier. On rentre au poste, la tournée finie. Ce gaillard-là nous envoie-t-i pas en tournée supplémentaire !
DEUXIÈME AGENT. – C’est pas sa faute, s’il a des ordres, et si des étudiants font du raffut dans Paris.
PREMIER AGENT. – Où donc qu’ils font du raffut ? Où donc ?
DEUXIÈME AGENT. – Hé ben oui ! qu’ils en font. On me l’a dit tantôt.
PREMIER AGENT. – Mais ils ne vont pas venir de c’ côté.
DEUXIÈME AGENT. – Et qu’ils se gêneraient donc ! Ils ont le député Frapeau qui d’meure pas loin d’ici et où qu’ils viendront faire un ban parce qu’il a parlé pour eux à la Chambre.
PREMIER AGENT. – Ça n’empêche qu’au lieu de rentrer tranquillement près de c’te femme, je vas encore être à poiroter jusqu’à des ménuits ! Ah ! n… de D… ! Ça ne se passera pas comme ça ! Le brigadier me fait des tours : je vas sûrement me venger !
DEUXIÈME AGENT. – Et quoi donc que tu peux lui faire ? Te venger ?
PREMIER AGENT. – Certainement, me venger ! Mais pas sur lui, donc ! Quoi tu veux que je lui fasse ? Sur le premier étudiant qui m’ tombe sur c’te patte !
Ils sortent à droite.
SCÈNE X
CHAMBOLIN, REQUIN
Ils sortent ensemble de chez Requin.
REQUIN. – La transformation est faite. Vous avez eu vite fait de trouver chez moi ce qu’il vous fallait, des habits neufs, jamais portés, et très confortables.
CHAMBOLIN, il porte une belle redingote, un chapeau haut de forme et tient à la main une canne à pomme d’argent. – Oui, me voilà bien conditionné. Je ne suis plus un vagabond, maintenant : je suis un badaud. Je ne suis plus un rôdeur : je suis un flâneur. Je ne suis plus un feignant : je suis un oisif. (Il s’assoit.) On n’est vraiment pas mal sur ces bancs quand il ne s’agit que de s’y asseoir… (Il se relève précipitamment.) Pourvu que je n’aille pas y attraper quelque vermine. Dire que j’ai dormi là-dessus, que j’ai failli devenir une gouape… et même quelque chose de pis !
REQUIN. – Dieu vous a transformé.
CHAMBOLIN. – En m’envoyant de l’argent. L’argent a mis en fuite tous mes mauvais instincts.
REQUIN. – Je suis sûr que maintenant que vous avez du bien, vous raisonnez plus sainement, plus clairement. Vous saisissez la différence du bien et du mal.
CHAMBOLIN. – Oui, faire le mal, c’est en vouloir à mon bien… Tant qu’on n’est pas propriétaire, on ne peut pas s’imaginer combien il est ignoble de porter atteinte à la propriété !…
REQUIN. – Oui, je sais ce que c’est, car je n’ai pas toujours été riche. Mais je savais que je le deviendrais, et j’ai toujours eu un grand respect pour la richesse.
CHAMBOLIN. – Tant que les méchants ne s’attaquent pas à nous, on ne voit pas combien ils sont méchants ; mais quand ils s’attaquent à notre bien on les voit de face : on voit la cupidité de leurs yeux.
REQUIN. – C’est qu’il y en a beaucoup, vous savez, qui rôdent autour de nous et qui en veulent à notre bien, des fripes, des gens sans aveu. Et dès qu’on leur cogne un peu sur les épaules, ils se plaignent…
CHAMBOLIN. – Est-ce nous qui sommes allés les chercher ?… Nous ne demandons qu’à rester tranquilles, dans notre coin. Que les autres en fassent autant.
REQUIN. – Allons, je vous quitte en bonnes dispositions. Vous voilà devenu un véritable honnête homme.
Exit Requin.
SCÈNE XI
CHAMBOLIN, seul.
CHAMBOLIN. – J’appartiens désormais au grand parti des honnêtes gens… Je vais me procurer un lit dans un hôtel propre. Décidément, je crois que j’y serai mieux qu’à Fresnes. J’ai failli faire connaissance avec cet établissement ! Non, ce n’est pas possible : je n’y serais pas entré. Ce n’est pas dans ma destinée. J’ai beau blaguer et faire le fanfaron, je m’arrête aux actes, fatalement. Ce n’est pas possible qu’un garçon comme moi puisse entrer à Fresnes. (On entend du bruit à droite à la cantonade.) Qu’est-ce que c’est que ça ? Ah ! des tapageurs ! Ça doit être les étudiants qui chahutaient cet après-midi, boulevard Saint-Germain. Ils passent au bout de la rue ! Une bagarre ! Les agents leur cognent dessus… Oh ! les agents sont en nombre ! Voilà un étudiant qui les engueule ! Qu’est-ce qu’il leur dit ?… Chopé ? Bravo ! Il en aura pour six mois, il aura beau nier tant qu’il voudra ! Ça le dressera !… Tiens, cet après-midi, je n’ai pas songé à ça quand je voulais me faire coffrer. J’aurais dû injurier des agents. Eh bien, je crois que je ne l’aurais pas fait ! Ce n’est vraiment pas dans mon caractère. Ah ! ces braves agents ! Cognent-ils ! Non, ce qu’ils cognent ! Leur paie n’est pas suffisante ! On devrait la leur tripler ! On est heureux d’avoir des braves garçons comme ça à son service, pour cogner sur les gouapes ! Ils cognent en aveugles, comme des marteaux-pilons ! (Il rit.) En voilà un qui vient de moucher un petit gros très proprement ! Et c’te femme, une enragée, ils la prennent par les épaules, et demi-tour à gauche ! Fouettez-la ! Fouettez-la, n… de D… ! Non, papa, ce qu’ils cognent ! En voilà un qui tape avec son sabre-baïonnette ! Ils sont bien petits, ces sabres ! On devrait leur en donner de grands !… Reculons-nous. Nous allons voir passer les fuyards. Je suis aux premières loges.
Des fuyards passent en criant.
SCÈNE XII
CHAMBOLIN, PREMIER AGENT, DEUXIÈME AGENT
PREMIER AGENT. – N… de D… ! Francis, j’en ai mouché deux ! Mais il faut que j’en emballe un. Le premier qui m’ tombe sur c’te patte, il va payer pour tout le monde !
DEUXIÈME AGENT. – En voilà un que je ne veux pas rater !
Il aborde en courant Chambolin.
PREMIER AGENT. – Ah ! c’est toi, salaud, qui gueulais : « Mort aux vaches ! »
DEUXIÈME AGENT. – C’est toi qui nous as traités de cochons !
PREMIER AGENT. – Ah ! tu nous appelles vaches !
DEUXIÈME AGENT. – Ah ! tu nous appelles cochons !
Chambolin fait des signes de dénégation.
PREMIER AGENT. – Ton affaire est bonne ! Tu n’y coupes pas de tes six mois ! Si tu ne connais pas Fresnes, on t’en montrera le chemin !
RIDEAU
LE VRAI COURAGE
Comédie en un acte
PERSONNAGES
RASCARD
BRICHETEAU
UN VIEUX MONSIEUR
UN PETIT JEUNE HOMME
UN MONSIEUR
UN GARÇON DE CAFÉ
La scène représente un café. À gauche, un groupe très animé entoure Rascard.
SCÈNE PREMIÈRE
UN MONSIEUR survenant. – Qu’y a-t-il ? Je viens de rencontrer Bricheteau. Il paraissait très animé.
UN VIEUX MONSIEUR. – Il y a… il y a que Bricheteau vient de se conduire comme un sauvage. Il a frappé Monsieur au visage, après une légère discussion. Et si Monsieur n’avait pas été raisonnable, nous aurions assisté en plein café à un véritable massacre.
RASCARD. – Je me serais rebiffé que je l’aurais envoyé dinguer contre la banquette ! Pas besoin d’avoir été à Joinville pour ça !
UN VIEUX MONSIEUR. – Vous avez montré que vous étiez le plus raisonnable.
RASCARD. – À quoi ça sert-il de se conduire comme des gamins ? Pour amuser la galerie ? Je suis bien revenu de ça. Soyez tranquille. J’ai distribué, dans ma vie, mon compte de gifles, de coups de poing et de renfoncements. Maintenant, je préfère me tenir en paix.
LE VIEUX MONSIEUR. – Et vous avez raison. C’est là le vrai courage.
RASCARD. – Et puis, vous ne voudriez pas que j’aille me colleter avec cet individu-là ? Mais c’est moins que rien ! Il n’est pas à ramasser avec des pincettes. Et puis, il n’y a pas plus capon. Il savait bien que je ne lui répondrais pas. C’est rare, sans ça, s’il aurait tapé…
UN PETIT JEUNE HOMME. – Moi, j’y aurais tout de même collé une mornifle, pour y apprendre à causer.
RASCARD. – Eh bien, allez-y donc, Monsieur, puisque vous êtes si malin ! La porte est ouverte, la rue n’est pas barrée.
LE PETIT JEUNE HOMME. – Mais je n’ai pas de motifs, moi, je n’ai pas été giflé !
RASCARD. – Eh bien, je l’ai été, moi ! Et je n’y vais pas ! Et je ne reviens pas faire le fendant pour épater la galerie. (Il jette un regard circulaire sur la galerie, mais la galerie se réserve.) Je vous préviens seulement qu’il n’est pas patient, à son ordinaire. Tout à l’heure, j’ai trouvé qu’il avait une patience d’ange. (Au vieux Monsieur.) Après tout ce que je lui avais dit ! Moi, je vous jure que je n’aurais jamais eu cette patience-là !
LE VIEUX MONSIEUR. – Je ne trouve pas que ce que vous lui avez dit motivait de sa part un acte aussi regrettable.
RASCARD. – Ce que je lui ai dit aujourd’hui, peut-être. Mais, Monsieur, ça ne date pas d’aujourd’hui ! Il y a des temps infinis que je l’embête, que je joue avec lui comme le tigre avec la souris… Il faut être juste… Il faut se mettre à la place des gens. Personne n’aurait supporté ce que je lui ai fait supporter. Mais il m’aime beaucoup. Sous le rapport du caractère, c’est un vrai bon garçon. Il a une grande considération pour moi. Et je suis sûr qu’il doit être beaucoup plus embêté que moi de ce qui arrive. Il ne sait pas comment j’ai pris ça. Il croit que je lui en veux. Sans ça, il y a longtemps qu’il serait revenu me demander de faire la paix.
LE VIEUX MONSIEUR. – Il reviendra, car il vous doit une réparation.
RASCARD. – Oh ! je ne la lui demande pas. Je l’en tiens parfaitement quitte. Mais vous ne vous doutez pas de l’importance que j’attache à ces choses-là. Qu’est-ce que c’est que ces choses-là dans la vie, quand on a passé par où j’ai passé ? J’ai eu des deuils terribles dans ma vie. J’ai assisté pendant six mois à l’agonie d’une grand-mère qui m’avait élevé et qui m’adorait ! Elle ne pouvait plus remuer les jambes, et sa tête, dans les derniers temps, était enflée du double !… Et vous voulez que je pense à ces vétilles pendant un millième de seconde ? Je n’en parle même plus. Mais je n’y pense plus, Monsieur. Je vais m’asseoir ici tranquillement, à faire une manille, et quand il viendra me demander pardon il me faudra un effort de mémoire pour me rappeler ce qui s’est passé !
LE VIEUX MONSIEUR. – Il va venir, soyez-en sûr.
RASCARD. – Oh ! il est pardonné d’avance ! Et d’ailleurs, je voudrais donner à cette affaire une autre solution que je ne le pourrais pas. Il m’a frappé avec le poing fermé. D’après les lois du duel, peut-on se battre dans ces conditions ?
LE VIEUX MONSIEUR. – Je ne crois pas.
RASCARD. – D’ailleurs, qu’est-ce que vous voulez que j’aille me battre avec ce garçon, qui est mon ami ? Je l’aime beaucoup, ce garçon, et je l’aime d’autant plus que je le sens plus faible, moins pondéré, moins bien équilibré… Je l’aime du fond du cœur… Et puis, il a fait des choses pour sa famille, des choses que je sais. Et quand on a de ces actions-là à son actif, on peut se permettre n’importe quoi vis-à-vis de n’importe qui ! On ne se venge pas d’un homme comme celui-là. Car on a beau dire, en duel, on peut attraper un mauvais coup !
LE VIEUX MONSIEUR. – Oh ! les duels d’aujourd’hui, c’est un peu de la plaisanterie.
RASCARD. – Justement. C’est pour ça que ça ne vaut pas la peine de se battre. Si j’étais un poseur, un esbrouffeur, je lui aurais envoyé deux de mes amis. On se serait égratigné à la Grande-Jatte et on se serait embrassé. Des hommes sérieux peuvent-ils s’amuser à des comédies pareilles ? Puis je suis sur ce point de l’avis des Anglais : pas de duel.
LE VIEUX MONSIEUR. – Les Anglais, en effet, sont plus simplistes. Ils règlent leur différend à coups de poing.
RASCARD, avec une moue légère. – Ben oui. Mais ça, c’est de la sauvagerie.
LE GARÇON, s’approchant. – Voilà M. Bricheteau qui vient déjeuner.
RASCARD, très ému. – Le voilà.
SCÈNE II
Rascard est assis à gauche, à côté du vieux Monsieur. Les autres consommateurs ont entamé depuis quelques instants une manille. Entre Bricheteau, qui s’assoit à droite.
BRICHETEAU. – Garçon ! Servez-moi à déjeuner.
LE GARÇON. – Nous avons le navarin aux pommes !
BRICHETEAU. – Le navarin… Et deux œufs pour commencer. Et un carafon. (Le garçon s’éloigne et fait la commande à la caisse. Bricheteau le rappelle.) Dites donc, garçon !… Rascard est encore ici ? Il attend que sa joue refroidisse ?
LE GARÇON, entre ses dents. – Oui, il ne veut pas sortir avec ça. Il a peur d’un chaud et froid… d’une fluxion.
Il s’éloigne. Rascard l’appelle à gauche.
RASCARD. – Garçon… Vous nous servirez deux madères… (Au vieux Monsieur.) Vous prendrez bien un madère ?
LE VIEUX MONSIEUR. – Puisque vous avez l’amabilité… je prendrai plutôt un bouillon… avec un œuf poché… et un petit morceau de bouilli dans le bouillon… Mais dans le bouillon, garçon… Il demeure entendu que ça ne constitue pas un plat à part.
RASCARD. – Dites donc, garçon ?
LE GARÇON. – Plaît-il ?
RASCARD. – Qu’est-ce qu’il vient de vous dire, M. Bricheteau ?
LE GARÇON. – Rien.
RASCARD. – Dites toujours.
LE GARÇON. – Non, je préfère ne pas vous dire.
RASCARD. – Si vous croyez que je fais attention à ce qu’il peut dire ! Qu’est-ce qu’il vous a dit ?
LE GARÇON. – Il m’a demandé si vous faisiez refroidir votre joue avant de sortir, pour ne pas attraper de fluxion.
RASCARD. – Allez… (Au vieux Monsieur.) Des bravades.
LE VIEUX MONSIEUR. – De pures bravades.
RASCARD. – Il ne sait pas dans quelles dispositions je suis. Alors il parle à tort et à travers.
LE VIEUX MONSIEUR. –… Si j’allais lui dire – discrètement – en quelles dispositions vous êtes vis-à-vis de lui ?
RASCARD. – Ce ne serait peut-être pas inutile. Allez-y si vous voulez. (Le vieux Monsieur va à Bricheteau. Rascard allume une cigarette d’un air dégagé.) Garçon, L’Amusant.
LE VIEUX MONSIEUR, à Bricheteau. – Eh bien, monsieur Bricheteau, vous voilà un peu calmé ?
BRICHETEAU. – Ça m’a détendu les nerfs.
LE VIEUX MONSIEUR. – Maintenant que vous n’avez plus de colère, je suis sûr que vous regrettez ce qui s’est passé.
BRICHETEAU. – Moi, pas du tout ! J’en suis ravi. Me voilà débarrassé d’un être collant et d’un sinistre raseur… Avez-vous déjeuné ?
LE VIEUX MONSIEUR. –… Je suis en train de prendre quelque chose… là-bas.
BRICHETEAU. – Mangez un de mes œufs. Deux, c’est trop pour moi.
Le vieux Monsieur s’assoit et mange.
LE VIEUX MONSIEUR. – Alors, vous ne regrettez rien ? Rascard vous aime beaucoup.
BRICHETEAU. – Il m’a toujours rasé.
LE VIEUX MONSIEUR. – Vous avez eu le rôle courageux. Moi, à votre place, je voudrais avoir le beau rôle. J’irais m’asseoir près de lui et je lui parlerais gentiment, comme si de rien n’était.
BRICHETEAU. – Mais non, je vous dis. Il a ma gifle, qu’il la garde ! Qu’il m’envoie ses témoins !
LE VIEUX MONSIEUR. – Il voulait le faire. Je l’en ai dissuadé.
BRICHETEAU. – Il s’en est dissuadé tout seul, entre nous ?
LE VIEUX MONSIEUR. – Écoutez, entre nous, dites-moi que vous regrettez un peu, si peu que ce soit, ce qui s’est passé. Ce n’est pas pour le lui répéter. C’est pour mon édification personnelle.
BRICHETEAU. – Je ne regrette qu’une chose : c’est de l’avoir connu.
LE VIEUX MONSIEUR. – C’est déjà quelque chose… Allons, je vais arranger ça.
BRICHETEAU. – N’arrangez rien du tout. Je suis ravi d’être débarrassé de cet être-là, que j’ai en horreur et qui est un raseur parfait.
LE VIEUX MONSIEUR. – Il ne s’agit pas de renouer avec lui. Il s’agit de liquider cet incident. Après, vous ne le reverrez plus si bon vous semble… Allons, je vais arranger ça.
Le vieux Monsieur va s’asseoir auprès de Rascard.
RASCARD. – Eh bien ?
LE VIEUX MONSIEUR. – Eh bien, il est certainement encore un peu fâché contre vous.
RASCARD. – Il a bien tort.
LE VIEUX MONSIEUR. – Mais évidemment, il est loin d’être satisfait de ce qui s’est passé… Il aurait préféré ne pas vous avoir connu et que rien de tout cela ne soit arrivé.
RASCARD. – C’est, en somme, des excuses !
LE VIEUX MONSIEUR. – Non, ce n’est pas des excuses. Mais il ne faut pas être exigeant.
RASCARD. – Je vous l’ai dit. Ma position est très nette : je n’exige rien… Je trouve que les entêtés sont des gens stupides… D’ailleurs, je sais qu’il m’aime beaucoup.
LE VIEUX MONSIEUR. – Oui.
RASCARD. – Qu’il vienne tranquillement s’asseoir ici. Nous ne parlerons de rien.
LE VIEUX MONSIEUR. – Non, c’est vous qui irez vous asseoir auprès de lui. Ça revient au même.
RASCARD. – Ah ! non, c’est à lui à venir ici… Du moins, il me semble…
LE VIEUX MONSIEUR. – Voyons ! Vous prenez un simple madère. Lui, il est en train de déjeuner. Il est, en somme, bien plus naturel que vous emportiez votre petit verre pour aller vous asseoir là-bas… Ce serait un protocole absurde que de l’obliger à porter ici sa nappe et son couvert.
RASCARD. – Ça me gêne un peu de traverser le café pour aller le trouver.
LE VIEUX MONSIEUR. – Faites semblant d’aller au lavabo. Vous vous assoirez à sa table en revenant du lavabo.
RASCARD. – Non, plutôt en allant. Son déjeuner tire à sa fin. Il pourrait s’en aller. Mieux vaut en finir.
Il traverse le café en se dirigeant du côté du lavabo. Puis, en passant devant Bricheteau, il semble prendre une résolution subite.
RASCARD. – Bricheteau ! (Bricheteau relève la tête.) Je vous ai toujours considéré comme un garçon intelligent… De votre côté, vous ne me prenez pas, n’est-ce pas, pour une brute ? (Bricheteau ne dit rien.) Du moins, j’aime à le croire… Eh bien, deux personnes comme nous ne doivent pas s’attarder à des stupidités. J’ai été un peu agaçant. Vous avez été un peu vif. Mettons qu’il y a là un simple malentendu et n’en parlons plus.
BRICHETEAU. – Moi, je ne tiens pas à en parler. Mais si ça vous fait plaisir de raconter cette petite scène, je ne veux pas vous en empêcher.
RASCARD. – Mon parti est pris. Je n’en parlerai pas. Voilà qui est entendu… (Il s’assoit.) Vous allez au casino, ce soir ?
BRICHETEAU. – Je n’en sais rien.
RASCARD. – On pourrait dîner ensemble ?
BRICHETEAU. – Je dîne en famille.
RASCARD. – Et demain ?
BRICHETEAU. – Je ne suis pas libre.
RASCARD. – Enfin… prochainement.
BRICHETEAU. – Prochainement.
RASCARD. –… Votre déjeuner tire à sa fin. Je vous quitte.
Il soulève du côté de Bricheteau une main timide ; mais comme celui-ci n’avance pas la sienne, Rascard transforme son projet de poignée de main en un vague signe d’adieu amical.
RASCARD, revenant au vieux Monsieur, pendant que Bricheteau se lève et s’en va. – Eh bien, tout s’est correctement passé. Je ne lui demandais pas de s’humilier. Il a été bien. (Il se lève et va aux joueurs de manille.) Intéressante, la partie ? (On ne lui répond pas.) Vous savez, il a été très convenable et très correct. L’affaire est arrangée. (Il va jusqu’à la caisse. À la caissière.) Toujours plongée dans vos feuilletons ? C’est passionnant, n’est-ce pas ?… Vous savez… mon affaire avec Bricheteau ? Complètement arrangée !… Oh ! c’était la vraie solution… (Au garçon.) Mon chapeau et mon pardessus. Voilà trois francs pour les consommations. Vous garderez la monnaie pour vous… Eh bien, vous savez, c’est complètement arrangé avec Bricheteau ! C’est préférable pour tout le monde… Oh ! entre deux camarades comme nous, ça devait bien finir !
Il se dirige vers la sortie.
RIDEAU
L’ANGLAIS TEL QU’ON LE PARLE
Vaudeville en un acte
Joué pour la première fois, le 28 février 1899, à la
Comédie Parisienne
Repris au Théâtre-Français, le 1er janvier 1907
PERSONNAGES
|
EUGÈNE, interprète |
MM. Modot |
|
HOGSON, père de Betty |
Tréville |
|
JULIEN CICANDEL |
Barbier |
|
UN INSPECTEUR |
Moriès |
|
UN GARÇON |
Gardais |
|
UN AGENT DE POLICE |
Émile |
|
BETTY |
Mlles Louise Bignon |
|
LA CAISSIÈRE |
Suzanne Rozier |
La scène est à Paris, dans le vestibule d’un hôtel meublé. À droite, une porte au premier plan. Une baie au fond donnant sur un couloir d’entrée, avec sortie à gauche. Au premier plan, à gauche, une porte ; au second plan, une sorte de comptoir en angle, avec un casier pour les clefs des chambres. Affiches de chemins de fer illustrées, un peu partout. Horaires de trains et de bateaux. Au premier plan, à droite, une table ; sur la table, des journaux, des livres et un appareil téléphonique.
SCÈNE PREMIÈRE
JULIEN, BETTY,
LE GARÇON,
LA CAISSIÈRE
JULIEN, au garçon. – Il nous faudrait deux chambres.
LE GARÇON. – Je vais prévenir Madame.
JULIEN. – Y a-t-il un bureau de poste ici, à côté ?
LE GARÇON. – Il y a celui de la Madeleine. Monsieur a-t-il quelque chose à y faire porter ?
JULIEN, comme à lui-même. – J’ai un télégramme pour Londres… Non, je préfère y aller moi-même.
Exit le garçon.
BETTY. – My dear, I should like a room exposed to the sun.
JULIEN. – Yes, my dear.
BETTY. – I am very tired. My clothes are dirty.
JULIEN. – Habituez-vous à parler français. Nous nous ferons moins remarquer.
BETTY. – Oh ! je sais si peu bien parler français.
JULIEN. – Mais non, vous savez très bien.
LA CAISSIÈRE. – Monsieur désire ?
JULIEN, à la caissière. – Deux chambres, pas trop loin l’une de l’autre.
LA CAISSIÈRE. – Nous avons le 11 et le 12. C’est au deuxième étage.
JULIEN. – Le 11 et le 12.
BETTY. – C’est trop près.
JULIEN, bas. – Tais-toi !
LA CAISSIÈRE. – Monsieur veut-il écrire son nom ?
JULIEN. – Inscrivez M. et Mme Philibert.
LA CAISSIÈRE. – Voulez-vous attendre un instant. Je vais faire préparer les chambres.
BETTY, à Julien. – Oh ! M. Phélébert ! Oh ! Mme Phélébert ! Oh !
JULIEN. – Eh bien, oui, je ne peux pas donner nos véritables noms. Si j’avais dit M. Julien Cicandel et Mlle Betty Hogson ! Vous prétendez que votre père connaît cet hôtel et qu’il est fichu de venir nous y relancer.
BETTY. – Oui, il est fichu de nous relancer.
JULIEN. – Oui, il est capable de venir nous pourchasser… to run after us.
BETTY. – C’est une abominable chose. Vous avez parlé plus que deux fois de ce hôtel à la maison. Il a beaucoup mémoire. Il doit se souvenir ce mot : hôtel de Cologne. C’est facile se souvenir… Et puis je vais vous dire encore une terrible chose. Je crois que je l’ai vu tout à l’heure, mon père. J’ai vu de loin son gris chapeau.
JULIEN. – Il y a beaucoup de chapeaux gris à Paris.
BETTY. – Je ai reconnu le paternel chapeau.
JULIEN. – La voix du sang… Tu dis des bêtises.
BETTY, tendrement. – My dear.
JULIEN. – Dis pas my dear. Dis-moi petit chéri.
BETTY, avec application. – Petit chéri !… Oh ! je voudrais je fusse mariée bientôt avec toi. Nous avons fait une terrible chose, de partir comme ça tous les deux.
JULIEN. – Il fallait bien. C’était le seul moyen de le faire consentir.
BETTY. – Mais si votre patron avait voulu vous… comment vous disiez ?… to take as partner ?
JULIEN. – Associer.
BETTY. – As-so-cier… mon papa aurait… comment vous disez ?… consenti me marier contre vous.
JULIEN. – Je le sais. Mais mon patron m’ajourne encore pour ça. Il me dit : « Nous verrons dans trois mois. » Votre père veut m’ajourner aussi et attendre que je sois associé. Zut ! Il a fallu employer les grands moyens.
BETTY. – Vous deviez… quitter tout de suite votre patron. « Vous voulez pas me associer… je pars !… » Voilà !
JULIEN. – Oui, mais je n’ai pas de position. S’il m’avait pris au mot, s’il avait accepté, je me serais trouvé le bec dans l’eau.
BETTY. – Votre bec dans de l’eau ! Oh ! pourquoi votre bec dans de l’eau ?… (Riant.) Oh ! Monsieur Phélébert !
JULIEN. – Et puis, je devais venir en France au compte de la maison, qui me fait trois mille francs de frais. Comme ça les frais de l’enlèvement seront au compte de la maison !
BETTY. – Oui, mais vous serez obligé me quitter pour les affaires.
JULIEN. – De temps en temps, j’aurai une course ; ça ne sera pas long. Et puis il vaut mieux se quitter de temps en temps ; si on était toujours ensemble sans se quitter, on finirait par s’embêter. Il vaut mieux se quitter quelques instants, et se retrouver ensuite.
BETTY. – Oh ! moi, je me embête pas avec vous.
JULIEN. – Eh bien, alors, mettons que je n’ai rien dit : je ne m’embête pas non plus. Voyez-vous ? J’ai toujours peur que vous vous embêtiez. Mais du moment que vous ne vous embêtez pas, je ne m’embêterai pas non plus… Je vais vous quitter pendant une demi-heure… Je vais aller au bureau de poste télégraphier à mon patron, et puis j’irai voir un client rue du 4-Septembre.
BETTY. – Oh ! mais vous me laissez seule ! Si je voulais demander quelque chose ?
JULIEN. – Mais vous parlez très bien le français.
Entre la caissière.
BETTY. – Je peux parler français seulement avec ceux qui sait aussi l’anglais, à cause je sais qu’ils puissent me repêcher si je sais plus. Mais les Français, j’ai peur de ne plus tout à coup savoir, et je ne parle pas.
JULIEN. – En tout cas (à la caissière) il y a un interprète ici ?
LA CAISSIÈRE. – Mais oui, Monsieur, il y a toujours un interprète. Il va arriver tout à l’heure. Il sera à votre disposition. Les chambres sont prêtes.
JULIEN, à Betty. – Je vais vous conduire à votre chambre et j’irai ensuite au télégraphe.
Ils sortent par la gauche.
SCÈNE II
LA CAISSIÈRE,
LE GARÇON,
puis EUGÈNE
LA CAISSIÈRE. – Au fait, Charles, comment se fait-il que l’interprète ne soit pas arrivé ?
LE GARÇON. – M. Spork ? Vous ne vous rappelez pas qu’il ne vient pas aujourd’hui ? C’est le divorce de sa sœur. Toute la famille dîne au restaurant, à Neuilly. Mais M. Spork a fait envoyer un remplaçant. Il vient d’arriver. Il est dans le vestibule.
LA CAISSIÈRE. – Dites-lui de venir. (Le garçon va au fond dans le couloir et fait un signe à droite. Eugène entre lentement et salue.) C’est vous qui venez remplacer M. Spork ? (Eugène fait un signe de tête.) On vous a dit les conditions. Six francs pour la journée. C’est un bon prix. Le patron tient absolument à ce qu’il y ait un interprète sérieux. Vous n’avez rien d’autre à faire qu’à rester ici et à attendre les étrangers. Vous avez compris ?
Eugène s’incline. La caissière sort un instant à gauche.
EUGÈNE, au garçon, après avoir regardé tout autour de lui. – Est-ce qu’il vient beaucoup d’étrangers ici ?
LE GARÇON. – Comme ci comme ça. Ça dépend des saisons. Il vient pas mal d’Anglais.
EUGÈNE, inquiet. – Ah !… Est-ce qu’il en vient beaucoup en ce moment ?
LE GARÇON. – Pas trop en ce moment.
EUGÈNE, satisfait. – Ah !… Et pensez-vous qu’il en vienne aujourd’hui ?
LE GARÇON. – Je ne peux pas dire. Je vais vous donner votre casquette.
Il lui apporte une casquette avec l’inscription « Interpreter ».
Exit le garçon.
EUGÈNE, lisant l’inscription. – In-ter-pre-terr !… (Il met la casquette sur sa tête.) Voilà ! Je souhaite qu’il n’en vienne pas, d’Anglais ! Je ne sais pas un mot d’anglais, pas plus que d’allemand… d’italien, d’espagnol… de tous ces dialectes ! C’est pourtant bien utile pour un interprète !… Ça m’avait un peu fait hésiter pour accepter cette journée de remplacement. Mais dame ! je ne roule pas sur l’or. Je prends ce qui se trouve. Seulement, je désire vivement qu’il ne vienne pas d’Anglais, parce que notre conversation manquerait d’animation.
LA CAISSIÈRE, entrant. – Dites donc, j’ai oublié de vous demander quelque chose d’assez important. Il y a des interprètes qui baragouinent plusieurs langues et qui savent à peine le français. Vous savez bien le français ?
EUGÈNE. – Parfaitement.
LA CAISSIÈRE. – C’est que tout à l’heure, vous ne m’aviez pas répondu, et figurez-vous, j’avais peur que vous sachiez mal notre langue.
EUGÈNE. – Oh ! vous pouvez être tranquille. Je parle admirablement le français.
LA CAISSIÈRE. – Du reste, nous n’avons pas beaucoup d’étrangers en ce moment. (Sonnerie.) Tiens ! le téléphone. (Elle va jusqu’à la table de droite. À l’appareil, après un silence.) On téléphone de Londres. (Eugène, appuyé au comptoir, ne bouge pas. Regagnant son comptoir.) Eh bien, on téléphone de Londres ! On téléphone en anglais ! Allez à l’appareil !
EUGÈNE, il va lentement à l’appareil et prend les récepteurs. – Allô !… (Au public, avec désespoir.) Ça y est ! des Anglais ! (Un silence. Au public.) Je n’y comprends rien, rien ! (Dans l’appareil.) Yes ! Yes ! (Un silence. Il fait au public des gestes de désespoir. D’un air désespéré, dans le téléphone.) Yes ! Yes !
LA CAISSIÈRE, de son bureau. – Qu’est-ce qu’ils disent ?
EUGÈNE. – Qu’est-ce qu’ils disent ? Des choses de bien peu d’intérêt !
LA CAISSIÈRE. – Enfin, ils ne téléphonent pas de Londres pour ne rien dire !
EUGÈNE, dans l’appareil. – Yes ! Yes ! (À la caissière, d’un ton embarrassé.) Ce sont des Anglais… ce sont des Anglais qui demandent à retenir des chambres. Je leur réponds : « Yes ! Yes ! »
LA CAISSIÈRE. – Mais enfin, il faut leur demander des renseignements complémentaires ! Combien leur en faut-il, de chambres ?
EUGÈNE, avec assurance. – Quatre.
LA CAISSIÈRE. – Pour quand ?
EUGÈNE. – Pour mardi prochain.
LA CAISSIÈRE. – À quel étage ?
EUGÈNE. – Au premier.
LA CAISSIÈRE. – Dites-leur que nous n’avons que deux chambres au premier pour le moment, que la troisième ne sera libre que le quinze. Mais nous leur en donnerons deux belles au second…
EUGÈNE. – Que je leur dise ça ?
LA CAISSIÈRE. – Mais oui… dépêchez-vous… (Il hésite.) Qu’est-ce que vous attendez ?
EUGÈNE, au public. – Ma foi, tant pis ! (Tout en regardant la caissière à la dérobée.). Lavatory, Manchester, chapeau ! – Chapeau, Littletich, Regent Street ! (Silence. Au public). Ce qu’ils m’engueulent ! (Il raccroche le récepteur. Au public.) Zut ! C’est fini ! S’ils croient que je vais me laisser engueuler pendant une heure !
LA CAISSIÈRE. – Il faut que ce soit des gens chics. Il paraît que pour téléphoner de Londres, ça coûte dix francs les trois minutes.
EUGÈNE. – Dix francs les trois minutes, combien que ça fait de l’heure ?
LA CAISSIÈRE, après avoir réfléchi. – Ça fait deux cents francs l’heure.
Elle sort.
EUGÈNE. – Je viens d’être engueulé à deux cents francs l’heure… J’avais déjà été engueulé dans ma vie, mais jamais à ce tarif-là !… Comme c’est utile tout de même de savoir les langues ! Voilà qui démontre plus victorieusement que n’importe quel argument, la nécessité de savoir l’anglais. Je voudrais avoir ici tous mes concitoyens et particulièrement les interprètes, et les adjurer d’apprendre les langues ! Au lieu de nous laisser moisir sur les bancs du lycée à apprendre le latin, une langue morte, est-ce que nos parents ne feraient pas mieux… Je ne parle pas pour moi, car je n’ai jamais appris le latin… Allons, espérons que ça va bien se passer tout de même !
Il s’est accoudé au comptoir et regarde vers la gauche. Hogson arrive par le fond à droite. Il va poser sa valise et son plaid sur une chaise à gauche de la table de droite. Il s’approche ensuite d’Eugène qui ne l’a pas vu et continue à lui tourner le dos.
SCÈNE III
EUGÈNE, HOGSON,
LA CAISSIÈRE
HOGSON. – Is it here hôtel de Cologne ?
EUGÈNE, se retournant. – Yes ! Yes !
Il retourne sa casquette sur sa tête de façon que l’inscription « Interpreter » ne soit pas vue de l’Anglais.
HOGSON. – Very well. I want to ask the landlady if she has not received a young gentleman and a lady.
EUGÈNE. – Yes ! Yes !
Il recule jusqu’à la porte de gauche, premier plan, et disparaît.
HOGSON, à l’avant-scène. – What is the matter with him ? I shall speak to the interpreter… Where is he ?… (Gagnant le fond.) Interpreter ! Interpreter !
La caissière, arrivant par la gauche.
HOGSON. – Oh ! good morning, madam ! Can you tell me if master Cicandel is here ?
LA CAISSIÈRE. – Cécandle ?
HOGSON. – Cicandel ?
LA CAISSIÈRE. – C’est le nom d’un voyageur !… Nous n’avons pas ici de Cécandle. (Remuant la tête.) Non ! Non !
HOGSON. – Now look here ! Have you received this morning a young gentleman and a young lady ?
LA CAISSIÈRE, souriante et un peu effarée. – Ah ! je ne comprends pas… Interprète ! Interprète ! Mais où est-il donc ? Qu’est-ce qu’il est devenu ? (Au garçon qui vient.) Vous n’avez pas vu l’interprète ?
LE GARÇON. – Il était là tout à l’heure.
HOGSON, cherche dans un petit dictionnaire. – Commissaire… police… here… (Il fait signe pour dire : ici.)
LE GARÇON. – Qu’est-ce qu’il dit ?
LA CAISSIÈRE. – Je crois qu’il voudrait un commissaire de police. (À l’Anglais, en criant et en lui montrant le fond.) Tout près d’ici !
HOGSON, tendant une pièce au garçon. – Commissaire… police… Come here.
LE GARÇON. – Il m’a donné dix francs.
LA CAISSIÈRE. – Ça vaut douze francs cinquante ce qu’il vous a donné… Eh bien, écoutez ! Trottez-vous jusqu’au commissariat. Vous lui ramènerez un inspecteur. Il lui dira ce qu’il a à lui dire.
LE GARÇON. – Il ne sait pas le français.
LA CAISSIÈRE. – Nous avons l’interprète.
HOGSON. – Now I want a room !
LA CAISSIÈRE. – Ça veut dire « chambre », ça. On va vous en donner une de room. (Au garçon.) Conduisez-le au 17 en passant. (Elle lui donne la clef.)
HOGSON, au moment de sortir par la porte de droite, premier plan. – Take my luggage.
LE GARÇON, sans comprendre. – Oui, Monsieur.
HOGSON. – Take my luggage.
LE GARÇON. – Parfaitement !
HOGSON, se montant. – Take my luggage ! (Il montre sa valise. Le garçon la prend. Avec colère.) What is the matter with this fellow. I don’t like repeating twice… Now then follow me.
Ils sortent par la droite.
LA CAISSIÈRE. – Où est donc cet interprète ?
Elle sort par le fond à droite. Entrent par le fond à gauche Betty et Julien.
SCÈNE IV
BETTY, JULIEN
BETTY. – Alors, vous partez ? Vous ne resterez pas longtemps ?
JULIEN. – Je vais jusqu’au bureau de poste.
BETTY. – J’ai si peur ! Avez-vous entendu crier tout à l’heure ? Je pense c’était la voix de mon père.
JULIEN. – Mais non, mais non. C’est une obsession. Ce matin, c’était son chapeau gris que vous aviez aperçu. Maintenant, c’est sa voix que vous croyez entendre ! Allons, au revoir.
BETTY. – Au revoir, my dear.
JULIEN. – Dites : petit chéri.
BETTY. – Petit chéri.
Elle rentre à gauche. Il sort par la droite.
SCÈNE V
EUGÈNE, LA
CAISSIÈRE, puis HOGSON, puis L’INSPECTEUR
EUGÈNE, peu après, se glisse sur la scène en entrant premier plan gauche. Il a toujours sa casquette à l’envers. – Plus personne !… Et il n’est que dix heures et demie. J’en ai jusqu’à ce soir à minuit. (Allant au fond consulter une affiche en couleur.) Il n’arrive pas de train de Londres avant sept heures. Je vais être à peu près tranquille jusque-là.
LA CAISSIÈRE, entrant par le deuxième plan droite. – Interprète ! Où étiez-vous donc tout à l’heure ?
EUGÈNE. – Tout à l’heure ?
LA CAISSIÈRE. – Oui, je vous avais dit de ne pas quitter d’ici.
EUGÈNE. – J’étais parti précipitamment… j’avais entendu crier au secours !… en espagnol… mais je m’étais trompé, ce n’était pas ici.
LA CAISSIÈRE. – Vous étiez parti si précipitamment que vous aviez mis votre casquette à l’envers.
EUGÈNE, touchant sa casquette. – Oui ! Oui !
LA CAISSIÈRE. – Qu’est-ce que vous attendez pour la remettre à l’endroit… Remettez-la… Tâchez de ne plus bouger maintenant. (Il s’assied devant le comptoir, où la caissière regagne sa place.) Il va venir un Anglais qui ne sait pas un mot de français. Il a demandé un inspecteur de police… Je ne sais pas ce qu’il lui veut…
EUGÈNE, à lui-même. – Moi non plus. Il y a des chances pour que je ne le sache jamais !
VOIX DE HOGSON, à la cantonade. – Look here, waiter !… waiter !… Give us a good polish on my patent leather boots and bring us a bottle of soda water !
EUGÈNE. – Oh ! quel jargon ! quel jargon ! Où est le temps où la langue française était universellement connue à la surface de la terre ? Il y a pourtant une société pour la propagation de la langue française ! Qu’est-ce qu’elle fait donc ?
HOGSON, entre par la droite, premier plan, en même temps que l’inspecteur entre par le fond. – Well, what about that Inspector ?
L’INSPECTEUR. – Hein ? Qu’est-ce qu’il y a ? C’est ce monsieur qui me demande ? Eh bien, vous n’avez pas peur ! Vous ne pourriez pas vous déranger pour venir jusqu’au commissariat ?
HOGSON. – Yes !
L’INSPECTEUR. – Il n’y a pas de yes ! C’est l’usage.
HOGSON. – Yes !
L’INSPECTEUR. – Je vois que vous êtes un homme bien élevé. Il faudra voir une autre fois à vous conformer aux habitudes du pays.
HOGSON. – Yes !
L’INSPECTEUR. – Allons ! il est de bonne composition.
LA CAISSIÈRE. – Il ne sait pas un mot de français.
L’INSPECTEUR. – Et moi, je ne sais pas un mot d’anglais… Nous sommes faits pour nous entendre.
LA CAISSIÈRE, à Eugène qui a gagné insensiblement le fond. – Interprète !
L’INSPECTEUR. – Faites-lui raconter son affaire.
Eugène s’approche de Hogson.
HOGSON, regardant la casquette d’Eugène. Avec satisfaction. – Oh ! Interpreter !
EUGÈNE. – Yes ! Yes !
HOGSON. – Tell him I am James Hogson, from Newcastle on Tyne… Tell him !… I have five daughters. My second daughter, Betty, ran away from home in company with a young gentleman, master Cicandel… Tell him. (Eugène continue à le regarder sans bouger.) Tell him !… (Se montant.) Tell him, I say !
L’INSPECTEUR. – Qu’est-ce qu’il dit ?
EUGÈNE. – Voilà… c’est très compliqué… c’est toute une histoire !… Monsieur que voici est Anglais !…
L’INSPECTEUR. – Je le sais.
EUGÈNE. – Moi aussi ! Il vient pour visiter Paris comme tous les Anglais…
L’INSPECTEUR. – Et c’est pour ça qu’il fait chercher le commissaire ?
EUGÈNE. – Non… attendez ! attendez ! Laissez-moi le temps de traduire !…
HOGSON. – Oh ! tell him also this youngman is a frenchman and a clerk in a bankinghouse of Saint-James Street.
EUGÈNE. – Justement !… (À l’inspecteur.) Pourquoi un Anglais à peine arrivé à Paris peut-il avoir besoin du commissaire ? (Embarrassé.) Pour un vol de bijoux… de portefeuille… (Illuminé d’une idée subite.) Voilà. Monsieur descend du rapide…
HOGSON. – Tell him that the young gentleman…
EUGÈNE, à Hogson, en abaissant la main avec le geste de lui fermer la bouche. – Ferme ! (À l’inspecteur.) – Monsieur descend du rapide à la gare du Nord, quand un individu se précipite sur lui et lui prend son portefeuille.
L’inspecteur s’écarte à gauche pour prendre des notes.
HOGSON, approuvant le récit d’Eugène. – Yes !… Very well… yes !…
EUGÈNE, étonné. – Yes ?… Eh bien, mon vieux, tu n’es pas dur !…
Il s’éloigne vers le fond. Hogson s’approche de l’inspecteur en tirant son portefeuille.
L’INSPECTEUR, étonné. – Vous aviez donc deux portefeuilles ? (À l’interprète.) Il avait donc deux portefeuilles ?
EUGÈNE. – Toujours ! toujours !… les Anglais.
HOGSON, tendant son portefeuille à l’inspecteur. – That is the likeness, the… young man’s… photo… photograph !
L’INSPECTEUR, étonné. – La photographie de votre voleur ?
HOGSON. – Yes !
L’INSPECTEUR. – Ils sont étonnants, ces Anglais ! Un inconnu les bouscule dans la rue et les vole. Ils ont déjà sa photographie !… (Après réflexion.) Mais comment a-t-il fait ?
EUGÈNE. – Je ne vous ai pas dit que l’homme qui l’a bousculé était un homme qu’il connaissait très bien ?
L’INSPECTEUR. – Non ! Comment s’appelle-t-il ? Demandez-le-lui.
EUGÈNE. – Il faut que je le lui demande ? Il m’a déjà dit son nom… Il s’appelle… John… John… (Il pousse une sorte de gloussement.) Lroukx !
L’INSPECTEUR. – Comment ça s’écrit-il ?
EUGÈNE. – Comment ça s’écrit ?… W… K… M… X…
L’INSPECTEUR – Comment diable prononcez-vous cela ?
EUGÈNE, poussant un autre gloussement. – Crouic !
L’INSPECTEUR. – Enfin ! J’ai pas mal de renseignements. Je vais commencer des recherches actives.
EUGÈNE. – Oui ! oui ! allez ! (Montrant l’Anglais.) Il est très fatigué ! Je crois qu’il va aller se coucher !
L’INSPECTEUR. – Je m’en vais. (À l’Anglais.) Je vais commencer d’actives recherches.
Il sort.
SCÈNE VI
LES PRÉCÉDENTS,
moins L’INSPECTEUR
HOGSON, à Eugène. – What did he say to me ? (Eugène incline la tête sans répondre.) What did he say to me ? (Eugène incline la tête.) (Plus fort.) What did he say to me ?
EUGÈNE. – Yes ! Yes !
HOGSON, furieux. – What : « Yes ! Yes ! » ? Damn it all !
LA CAISSIÈRE. – Qu’est-ce qu’il dit ?
EUGÈNE. – Rien !
LA CAISSIÈRE. – Il a l’air furieux !… Demandez-lui ce qu’il a.
EUGÈNE. – Non ! non ! Il faut le laisser tranquille ! Il dit qu’on le laisse tranquille ! Il dit que si on a le malheur de lui parler, il quittera l’hôtel tout de suite !
LA CAISSIÈRE. – C’est un fou !
EUGÈNE, à part. – Ou un martyr !… Non, c’est moi qui suis le martyr.
HOGSON, à la caissière, avec force. – Bad, bad, interpreter !
LA CAISSIÈRE. – Qu’est-ce qu’il dit ?
HOGSON, avec plus de force encore. – Maovais ! Maovais interpreter !
EUGÈNE, haussant les épaules. – Humph… Humph… Movey ! Movey ! Est-ce que vous savez seulement ce que ça veut dire en anglais ?
HOGSON, furieux, à la caissière. – Look here, madam !… I never saw such a damned hotel in my blooming life. (Allant à l’interprète.) Never… and such a cursed fool of interpreter. Do you think I have come all the way from London to be laughed at ? It is the last time… (En s’en allant.) I get a room in your damned inn.
Il sort, premier plan à gauche.
LA CAISSIÈRE. – Il est furieux !
EUGÈNE. – Mais non, il est enchanté !… (Il imite sa marche indignée.) C’est un air anglais !
LA CAISSIÈRE. – Je m’en vais un instant. Tâchez de rester ici et de n’en plus bouger.
Elle sort.
EUGÈNE, il tamponne son front et s’assoit, accablé, près du comptoir. – Ah ! une petite maison de campagne en Touraine, en plein cœur de la France ! Ici, nous sommes envahis par des étrangers !… J’aurais une vie paisible… Les paysans me parleraient patois. Mais je ne serais pas forcé de leur répondre. Je ne suis pas un interprète de patois !
SCÈNE VII
EUGÈNE, BETTY
BETTY. – Interpreter !
EUGÈNE. – Allons bon ! (Il fait signe à Betty qu’il a mal à la gorge.) Mal… gorge… extinction de voix. (À part.) Elle ne comprend pas. Il faudrait lui dire ça en anglais.
BETTY. – Vous ne pouvez pas parler ?
EUGÈNE, fougueusement, avec sa voix habituelle. – Vous parlez français ! Il fallait donc le dire tout de suite !
BETTY. – Vous pouvez parler, maintenant.
EUGÈNE, reprenant sa voix de fausset. – Pas tout à fait encore ! Mais ça va mieux ! (Avec sa voix naturelle.) C’est remis, ça va bien ! N’en parlons plus.
BETTY. – Do you know the post office is far from here ?
EUGÈNE. – Oh ! puisque vous savez un peu parler français, pourquoi vous amusez-vous à parler anglais ? Ce n’est pas le moyen de bien apprendre le français.
BETTY. – Je sais si peu.
EUGÈNE. – Justement ! D’ailleurs, moi, je veux vous habituer à parler français. Si vous me parlez anglais, mon parti est pris, je ne répondrai pas.
BETTY, suppliante. – Oh ! I speak french with such a difficulty.
EUGÈNE, secouant la tête avec énergie. – Je ne veux pas comprendre ! Je ne veux pas comprendre !
BETTY. – Eh bien, je vais vous dire… (Apercevant le chapeau gris de Hogson sur la table.) Oh !
EUGÈNE. – Qu’est-ce qu’il y a ?
BETTY. – Quel est ce gris chapeau ?
EUGÈNE. – C’est un chapeau qu’un Anglais a laissé, tout à l’heure.
BETTY, s’approchant. – Oh ! (Elle regarde la coiffe du chapeau.) My father’s hat. (À l’interprète, avec volubilité.) Oh ! my friend is out. My friend left me alone. He is not returned yet ! I am going in my room !
EUGÈNE. – Oui ! Oui ! C’est entendu !
BETTY. – Je vais me en aller dans ma chambre.
EUGÈNE. – Oui… oui… c’est ça… Partez ! partez ! (Elle s’en va.) Au moins, avec elle y a-t-il moyen de causer ! C’est pas comme avec cet Anglais. Ils ne seraient pas fichus d’apprendre notre langue, ces gars-là ! Voilà bien l’orgueil britannique !
SCÈNE VIII
EUGÈNE, JULIEN
JULIEN, arrivant par la gauche. – Interpreter !
EUGÈNE. – Non ! non ! la mesure est comble ! c’est fini ! Je renonce à mes prétentions ! Il y a trop d’Anglais ! Ils sont trop ! (À Julien.) Cochon de rosbif ! Ferme ta gueule ! Tu nous dégoûtes !
JULIEN. – Tu me dégoûtes encore plus ! En a-t-il du culot, celui-là ! Je vais me plaindre à ton singe qui t’enverra ton congé à travers le blair !
EUGÈNE, lui serrant la main. – Ah ! vous parlez français ! Merci ! merci ! Ça fait plaisir d’entendre sa langue maternelle ! Répétez un peu : « J’ai du culot ! À travers le blair ! » Ah ! puisque enfin je retrouve un compatriote, je vais lui demander un service, un grand service. Figurez-vous que je sais très peu l’anglais. Je ne sais que l’espagnol, l’italien, le turc, le russe et le javanais !
JULIEN. – Vous savez l’espagnol… Que hora son ?
EUGÈNE. – Ne nous égarons pas… Je vous disais donc…
JULIEN. – Je vous ai posé une question. Que hora son ? Répondez à ma question.
EUGÈNE. – Vous tenez à une réponse immédiate ? Je demande à réfléchir.
JULIEN. – Vous savez l’espagnol… Que hora me dire l’heure qu’il est ?
EUGÈNE, se rassurant. – Il est onze heures et demie… Écoutez… Vous allez me rendre un service. Il s’agit de parler à un Anglais qui est ici. Il parle un anglais que je ne comprends pas ! Je ne sais pas du tout ce qu’il me veut.
JULIEN. – Où est-il, cet Anglais ?
EUGÈNE. – Nous allons le trouver… Oh ! vous êtes gentil de me rendre ce service. À charge de revanche…
JULIEN. – Eh bien, allons-y !
EUGÈNE. – Il doit être dans le petit bureau. Tenez, voilà ma casquette ! (Il la lui met sur la tête.) Vous voilà passé interprète. (S’approchant de la porte de gauche.) Monsieur ! Monsieur !
JULIEN. – Dites-lui : Seur !
EUGÈNE. – Seur ! Seur ! (Revenant à Julien.) Je voudrais lui dire qu’il y a ici un bon interprète.
JULIEN. – Good interpreter !
EUGÈNE. – Bien ! Bien ! Good interpreter ! (Satisfait.) Nous allons, je pense, assister à une chic conversation anglaise entre ces deux gentlemannes !… (Allant à la porte.) Seur ! Seur ! Good interpreter !
Entre Hogson. Julien l’aperçoit et se retourne précipitamment.
SCÈNE IX
LES MÊMES,
HOGSON, puis L’INSPECTEUR, BETTY, LA CAISSIÈRE,
LE GARÇON,
UN AGENT
HOGSON, au-dehors. – Allo ! A good interpreter ? All right !
Il entre.
HOGSON, à Julien. – Oh ! is this the new man ? Very well. I want to get my breakfast served in the dining room, but on a separate table.
Julien gagne doucement d’abord, puis rapidement le fond, et s’en va par la droite en traversant la scène en oblique.
EUGÈNE, étonné. – Eh bien, il n’y a pas que moi que les Anglais font sauver !
HOGSON, à Eugène. – What is the matter with him ?
EUGÈNE. – Non, mon vieux, ce n’est plus moi, c’est lui ! (D’une voix aimable.) Au revoir, Monsieur ! Au revoir, Monsieur !
HOGSON, furieux. – What do you mean, you rascal, stupid scoundrel, you brute, damned frog eating beggar !
Il sort par la gauche.
EUGÈNE, seul. – Non ! je ne serai jamais en bons termes avec cet individu-là. J’aime autant en prendre mon parti une bonne fois ! (On entend du bruit à gauche.) Qu’est-ce que c’est encore que ce potin-là ? On s’assassine ! On se bat ! Ce sont des gens qui parlent français ! Ça va bien ! Ça ne me regarde pas !
L’INSPECTEUR entre, suivi d’un agent qui tient Julien par le bras. À Eugène. – Je tiens mon voleur ! Je le tiens ! Justement comme je passais devant la porte, je l’ai vu qui marchait précipitamment et je l’ai reconnu par la photographie. Ah ! Ah ! faites-moi chercher cet Anglais ! Nous allons lui montrer ce que c’est que la police française ! Aussitôt connus, aussitôt pincés ! (À l’interprète.) Allez me chercher cet Anglais ! Et revenez avec lui, car nous aurons besoin de vos services.
EUGÈNE. – Vous faites bien de me dire ça !… (À part.) Je ne connais pas les combles de l’hôtel. Je vais aller les visiter !
Il sort par le fond à gauche.
JULIEN. – Mais enfin, qu’est-ce que ça veut dire ! Vous m’arrêtez ! Vous m’arrêtez ! On n’arrête pas les gens comme ça ! Vous aurez de mes nouvelles !
L’INSPECTEUR. – Oh ! Oh ! pas de rouspète ! C’est bien vous qui vous appelez… (Il essaie de prononcer le nom écrit sur son calepin.) Doublevé Ka Emme Ix ?… Oh ! ne faites pas l’étonné !… Vous vous expliquerez au commissariat. (Au garçon.) Faites-moi venir cet Anglais de ce matin, ce grand monsieur avec un chapeau gris.
JULIEN, tâchant d’échapper à l’agent. – Avec un chapeau gris !
L’INSPECTEUR. – Ah ! ah ! ah ! Ça te dit quelque chose ! (À l’agent.) Tenez-le solidement.
BETTY, entrant par la porte de droite. – Oh ! petit chéri ! petit chéri !
L’INSPECTEUR. – Arrêtez cette femme, nous en tenons deux !
L’agent prend Betty par le bras.
BETTY. – Oh ! my dear ! Qu’est-ce que c’est ?
JULIEN. – Vous aviez raison, ce matin. Le chapeau gris est là… (Betty tressaille.)
L’INSPECTEUR. – Taisez-vous ! Pas de signes de convention ! Je me souviendrai de cette histoire de chapeau gris ! (À l’agent.) Avez-vous vu leur mouvement quand on a parlé de chapeau gris ? C’est une bande des plus dangereuses !
LE GARÇON, entrant à gauche, premier plan, avec Hogson. – Voici ce monsieur !
HOGSON, apercevant Betty qui se cache le visage. Sur un ton de prêche. – Oh ! Betty. Are you still my daughter ? Is that you ? Have you thought of your poor mother’s anxiety and despair ! (Sèchement, à l’inspecteur qui veut l’interrompre.) Leave alone, all right. (À Betty.) Have you thought of nable example of immorality for your dear sisters ! Have you thought… (À l’inspecteur.) Leave me alone, all right. (À Betty.) Have you thought of tremendous scandal…
L’INSPECTEUR. – Vous savez que vous perdez votre temps. Il y a beaux jours que j’ai renoncé à faire de la morale aux malfaiteurs !
HOGSON, à l’inspecteur d’un ton expansif. – My friend, I have five daughters. My second daughter, Betty, ran away from…
L’INSPECTEUR, montrant Julien. – C’est bon ! C’est bon ! C’est bien l’homme qui vous a volé votre portefeuille ?
HOGSON, énergiquement. – Yes !
JULIEN. – Comment ? Il m’accuse de vol, maintenant ? You told this man I robbed your pocket book ?
HOGSON. – My pocket book !… but I never said such a thing !
JULIEN. – Vous voyez ! Il dit qu’il n’a jamais dit ça !
L’INSPECTEUR. – Vous savez que je ne sais pas l’anglais. Vous pouvez lui faire raconter ce qui vous plaira… Allons ! au poste, l’homme et la femme !
JULIEN, à Hogson. – Do you know he will send your daughter to prison !
HOGSON. – My daughter ! my daughter into prison ! (Il retient sa fille par le bras.)
LA CAISSIÈRE, arrivant. – Qu’est-ce que ça veut dire ?
L’INSPECTEUR. – Ah ! vous m’embêtez tous à la fin ! Je vous emballe tous ! Vous vous expliquerez au poste !
BETTY. – Mais je suis sa fille !
L’INSPECTEUR. – Qu’est-ce que ça veut dire tout ça ?
Sonnerie prolongée du téléphone.
LA CAISSIÈRE, à l’appareil. – On sonne de Londres. M. Julien Cicandel.
JULIEN. – C’est moi !
LA CAISSIÈRE. – Vous vous appelez Philibert !
JULIEN. – Je m’appelle aussi Cicandel.
L’INSPECTEUR. – Et puis Doublevé Ka Emme Ix ! Oh ! c’est louche, ça ! c’est de plus en plus louche !
JULIEN. – Laissez-moi répondre. (Il vient à l’appareil, toujours maintenu par l’agent.) Allô ! Allô ! C’est de mon patron de Londres !… yes ! yes !… Il paraît qu’il a déjà téléphoné tout à l’heure et qu’on lui a donné la communication avec une maison de fous ! All right ! oh ! Thank you ! Thank you ! (À Betty.) C’est mon patron qui me téléphone qu’il consent à m’intéresser dans la maison.
BETTY, sautant de joie. – Oh ! papa ! papa ! He will interest Julian in the bank !
HOGSON. – He will, he really ?…
BETTY. – Yes, oh ! I am happy ! I am happy !
JULIEN. – Que votre père écoute lui-même ! (À Hogson.) Listen yourself !
HOGSON, s’approchant du téléphone, à l’inspecteur. – Ah ! It is a good thing ! (S’asseyant.) Allô ! allô ! Speak louder ; I can’t hear you… allô ! all right !… If you interest Julian, I have nothing more to say… That’s good… thank you… Good bye. (Se levant, à Julien.) My friend, I give you my daughter.
Betty l’embrasse et va dans les bras de Julien.
EUGÈNE, arrivant par la gauche, premier plan. – Qu’est-ce qui se passe ?
L’INSPECTEUR. – Il se passe des choses pas ordinaires ! Vous vous rappelez l’Anglais de tout à l’heure, qui se plaignait d’avoir été volé ? Je me donne du coton pour lui retrouver son voleur. Je le lui amène. Il lui fiche la main de sa fille ! Maintenant, tout ce qu’on me dira des Anglais, vous savez, ça ne m’épatera plus ! (Il sort)
EUGÈNE, regardant le jeune couple. – Vous êtes heureux ?
JULIEN. – Oh oui !
EUGÈNE. – C’est pourtant à cause de moi que tout ça est arrivé !
JULIEN. – Comment ça ?
EUGÈNE. – Ce serait un peu long à vous expliquer, mais si vous étiez chic, vous me trouveriez une place à Londres.
JULIEN. – Comme interprète ?
EUGÈNE, avec horreur. – Non ! Je renonce au métier d’interprète. Je veux me mettre à apprendre les langues.
JULIEN. – Mon beau-père vous trouvera ça à Londres.
HOGSON, serrant la main d’Eugène. – My fellow, since you are his friend, you are my friend.
EUGÈNE, à Hogson. – Peut-être bien ! (À Julien.) Je voudrais lui dire quelque chose de gentil, d’aimable… que je ne comprends pas un mot de ce qu’il me dit !
JULIEN. – I cannot understand !
EUGÈNE, serrant la main de Hogson. – Canote endoustan !
RIDEAU
DAISY
Pièce en un acte
Représentée pour la première fois, à Paris, le 13 mai 1902,
au Théâtre de la Renaissance
PERSONNAGES
|
CHARLEY, quarante-cinq ans |
MM. Gémier |
|
DAGO, vingt-cinq à trente ans |
Capellani |
|
BARLU |
Jarrier |
|
SHARPEY |
Valentin |
|
BEARNS, le jockey |
Mallet |
|
BRILLART, inspecteur de la Sûreté |
Jehan Adès |
|
UN JEUNE HOMME |
Cailloux |
|
LÉA |
Mmes Jane Hellier |
|
UNE JEUNE FEMME |
M. Bernier |
|
Le public ordinaire du pesage |
|
La scène représente un coin du pesage, à Longchamp. Au fond une palissade pleine, à hauteur d’homme, formant couloir avec des boxes de chevaux. – Au premier plan, à gauche, un arbre assez grand dont les racines ont formé une espèce d’exhaussement. À droite, un massif avance et forme une sorte de réduit qui cache au reste de la scène les personnes placées là. – Deux chaises en fer au pied de l’arbre ; deux autres chaises dans le réduit.
SCÈNE PREMIÈRE
UNE JEUNE
FEMME, UN
PARIEUR, puis BEARNS et SHARPEY, CHARLEY et DAGO
Charley et Dago, en scène au lever du rideau, sont dans un coin à droite.
LE JEUNE HOMME, sortant des tickets de sa poche. – Trente francs de Saint-Edme gagnant, c’est fichu ! Cinquante francs de Polichinique placée, c’est fichu également ! Je n’ai touché que la deuxième, ça n’est pas beaucoup. Allons ! je veux encore mettre cinq louis dans celle-là et je boucle. (Il se lève. À la jeune femme) Tu m’attends, toi ?
LA JEUNE FEMME. – Oui, mais je m’embête ; ne sois pas trop long.
Entrent Bearns et Sharpey.
LE JEUNE HOMME. – Regarde Bearns, c’est le jockey de Silencieuse !
LA JEUNE FEMME. – Tu le connais ?
LE JEUNE HOMME. – Non. Mais je connais le type anglais qui est avec lui. Bonjour, Monsieur.
Il lui tend la main.
SHARPEY, lui serrant négligemment la main. – Bonjour, Monsieur !
LE JEUNE HOMME, clignant de l’œil et montrant Bearns. – Qu’est-ce qu’il dit ? Est-ce qu’il compte gagner la Grande Poule ?
SHARPEY. – Il croit il gagne si les autres chevaux ne courent pas plus vite !
LE JEUNE HOMME. – Comment est la bête ?
SHARPEY. – Elle a de la crin sur le cou et quatre jambes !
Sortent Sharpey et Bearns.
LA JEUNE FEMME. – Oui ! Si tu crois qu’il te dira quelque chose !
LE JEUNE HOMME. – On voit toujours un peu d’après leur air. Moi, je vais le jouer, son cheval…
LA JEUNE FEMME. – Mets dix francs pour moi.
LE JEUNE HOMME. – Donne.
LA JEUNE FEMME. – Je te les rendrai.
LE JEUNE HOMME. – Donne toujours !
LA JEUNE FEMME, brusquement. – Ma bourse ! Où est ma bourse en or ?
LE JEUNE HOMME. – Ah ! c’est bien toi ! Est-ce que je perds jamais quelque chose ? Je perds ma galette aux courses ; mais je sais au moins où je la perds !
LA JEUNE FEMME. – Aide-moi à la chercher !
LE JEUNE HOMME. – Je n’ai pas le temps ! À tout à l’heure !
Il sort.
LA JEUNE FEMME, s’approchant de Charley qui, pendant cette scène, est resté à lire un journal, assis à côté de Dago. – Pardon, Monsieur… Vous n’avez pas vu, par hasard, une petite bourse en or avec deux breloques : une petite boîte à lait et un chapeau de marquis ?
CHARLEY. – Non, Madame. Mais si vous l’avez perdue, il faut aller tout de suite faire votre déclaration.
LA JEUNE FEMME. – Où ça, Monsieur ?
CHARLEY. – Au secrétariat, sous la tribune du milieu. Vous donnerez la description de votre bourse et des breloques et, à la fin de la journée, vous irez demander s’il n’y a rien de nouveau.
LA JEUNE FEMME. – Oh ! je vous remercie, Monsieur, vous êtes bien gentil ! Mais est-ce que vous croyez que j’aurai des chances de la retrouver ?
CHARLEY, d’un ton évasif. – Ah ! Madame !
LA JEUNE FEMME. – Je vous remercie, Monsieur, vous êtes bien gentil !
Elle s’éloigne.
CHARLEY, lui parlant à la cantonade. – Sous la grande tribune… (Il la regarde un instant s’éloigner, puis il tire de sa poche la bourse en or qu’il montre à Dago.) C’est d’un mauvais goût, ces petites breloques, cette boîte à lait, ce chapeau de marquis ! J’aime beaucoup mieux ça. (Il tire de sa poche une petite glace d’or.) Et ce petit portefeuille en maroquin avec un billet de cinquante francs et de jolies initiales en brillants.
DAGO. – Eh bien, mon vieux, tu ne t’es pas embêté, aujourd’hui !
CHARLEY. – Ça n’a pas été mauvais. J’ai encore deux porte-monnaie. Et toi, tu y reviens aussi ? Qu’est-ce que tu as fait pendant ces deux ans au moins qu’on ne t’a pas vu ?
DAGO. – Trois ans, mon vieux, si ça ne te fait rien ! J’ai été pendant trois ans secrétaire du vicomte Gréfy.
CHARLEY. – Le vicomte Gréfy ?
DAGO. – Le comte de Vaste, si tu aimes mieux, ou le chevalier Priglio, ou le marquis de La Roche Saint-Almer !
CHARLEY. – Mais il avait autant de noms qu’un grand d’Espagne, ton patron !
DAGO. – Oui, mais il les portait successivement. Il ne les portait jamais plus d’une saison !
CHARLEY. – Il te les repassait quelquefois ?
DAGO. – Quand ils étaient encore mettables. Nous avons fait de bonnes années avec le comte. Malheureusement, il avait un défaut dangereux pour un grec… Il était joueur… Quand il avait gagné pendant un certain temps, ça ne l’amusait plus et il voulait gagner sans le faire exprès. Or, c’était un déveinard… Enfin, j’ai eu avec lui quelques bons mois, quelques mois de prospérité.
CHARLEY. – Pendant qu’il gagnait ?
DAGO. – Non. Pendant qu’il perdait. Quand il gagnait, il était rat comme un cochon ; il ne voulait pas diminuer son bénéfice. Une fois qu’il s’est mis à perdre, il est devenu grand seigneur.
CHARLEY. – Alors, tu vas te remettre à travailler ici ?
DAGO. – Je voudrais bien, mais j’ai peur d’avoir un peu perdu la main. C’est dur, n’est-ce pas ?
CHARLEY. – Ah dame ! Il faut s’occuper. C’est comme dans tous les métiers, on ne gagne pas son argent à ne rien faire.
DAGO. – C’est toujours par-devant les tribunes qu’on travaille le mieux ?
CHARLEY. – Non. Par là, c’est usé. D’abord il n’y a plus rien à faire avec les femmes du monde. C’est bien rare qu’elles aient une poche sous leur sacrée jupe plate. Et celles qui en ont une l’ont trop près de la peau. On a l’air de venir là pour autre chose… un mal élevé, quoi ! Et puis, quand elles ont une poche, elles n’ont pas de porte-monnaie dedans. Elles ont leurs maris, des marquis et des comtes, qui sont tout ce qu’il y a de calé, qui font un jus épatant et qui ne leur foutent jamais un rond ! À quoi ça leur sert ? C’est leurs femmes ! Aussi, tu verras de belles madames, des duchesses qui portent des noms de pays connus, tournailler devant le buffet, quand il fait chaud, à la recherche du gigolo qui leur paie à boire. Elles font la retape pour une orangeade. (Pénétré.) Les femmes du monde, c’est cuit… Tant qu’aux volailles, elles n’apportent pas leur argent ici : elles font jouer par leurs amis et c’est le pognon de ces messieurs qui marche. Non, vois-tu, je vais te donner le tube : tu vas aller du côté du mutuel, tu guetteras auprès des caisses les gens qui viennent toucher. Tu verras où c’est qu’ils carrent leurs billets. C’est à toi de choisir les têtes. Ce qu’il y a de meilleur, c’est la grosse rentière, la bonne veuve qui se distrait. C’est méfiant de nature, mais le jeu leur met la tête à l’envers. Et puis, ces vieux wagons-là, elles ont encore le strapontin à l’ancienne mode, le bon faux derrière avec la poche dedans… Tu sais, quand on a fait passer leur porte-monnaie de leur poche à elle dans sa bonne poche à soi, et quand on s’en va en douceur en tâtant à travers le cuir, en tâchant de deviner à la dimension des pièces si ce n’est que du blanc ou si c’est du joli jaune, il n’y a pas à dire, c’est un moment bien agréable…
DAGO, pénétré. – J’irai tout à l’heure par là…
CHARLEY. – Ici où nous sommes, ça n’est pas plus mauvais non plus. Il y a quelquefois de bons Angliches. C’est rigolo de penser ça, pas ? que les Angliches passent pour nous envoyer des pickpockets et c’est peut-être dans leur poche à eux que l’on fait le meilleur travail ! Des gens qui se mouillent, mon cher, il y a de la ressource, tu comprends ! Seulement, si tu travailles avec les Angliches, veille un peu à ce qu’il t’arrive pas ce qui m’est arrivé la semaine dernière… J’avais chauffé quatre billets de cent francs, et d’ici où j’étais venu m’asseoir, je vois un petit jockey qui laisse son pardessus – cover-coat, qu’ils disent – auprès de cet arbre-là. Probable que le gamin qui devait garder ce pardessus pendant la course ne s’était pas trouvé là à temps pour le prendre avec lui… toujours est-il que mon jockey monte à cheval, s’en va… Moi, naturellement, je pose cinq sur le paletot, je fais une tournée d’inspection dans les poches… Un billet de cent balles, ce n’était pas mauvais à prendre… Seulement j’y trouve aussi une dépêche de Chantilly, qui donnait Maulevrier sûr gagnant de la dernière. Je le joue à six ; j’y mets cinq cents francs que j’avais eu de la peine à récolter… Et mon cochon de Maulevrier reste dans les choux ! Eh bien, c’était bien fait pour moi ! Monsieur s’était dit, tu comprends : je vais gagner trois mille francs et, comme une vache, tirer ma flemme pendant quelques mois ! Eh bien, je te le dis, c’était bien fait pour moi, comme pour tous ces cochons de fainéants qui veulent gagner leur vie à ne rien faire ! Mais ici, mon cher, il n’y a que nous qui ne volons pas notre argent !
DAGO. – Dis donc ! Et la rousse, les mouches ? Il doit y en avoir pas mal, ici, hein ?
CHARLEY. – Les mouches ? C’est facile à surveiller. Tout le monde les connaît. Qu’est-ce que tu veux, c’est des garçons sans place, qui gagnent leur petite vie là-dedans. De gros propres à rien qui montreraient leurs cartes de la police secrète à tout le monde, tellement qu’ils sont fiers d’entrer à l’œil aux Folies-Bergère.
DAGO. – Oui, tout le monde les connaît ; mais moi, je ne les connais pas !
CHARLEY. – Tu ne risques rien. Quand une mouche est dans les alentours, pour avertir les comme toi qui ne les connaissent pas, les comme moi qui les connaissent se mettent à chanter Daisy !
Daisy, Daisy,
Will you marry me…
DAGO, reprenant :
I’m half crasy
Out of the love for you…
CHARLEY. – Ça m’a déjà été salement utile, une bonne fois que je ne me méfiais pas. Une mouche nouvelle, tu comprends, qui venait de Lyon. Il dégottait mal comme toutes les mouches, mais y a pas que les mouches qui dégottent mal… Heureusement que le petit Albert m’a chanté Daisy ! Parce que, tu sais, ça ne m’amuserait pas d’être chauffé en ce moment… à cause de cette petite môme qui s’en vient de là-bas. (Souriant.) Tu la connais ?
DAGO. – Oui.
CHARLEY. – Ah ! Que je suis bête ! Si tu la connais ! Puisque c’est elle qui nous a fait faire connaissance ! Qu’est-ce que c’était donc ? Vous étiez du même pays, je crois ?
DAGO. – C’est-à-dire qu’on s’était connus tout petits à Reims.
CHARLEY. – Si ce n’était pas pour cette petite-là, je ne me donnerais pas autant de coton. Pourvu que j’aie de quoi manger, moi ! Mais ça m’amuse qu’elle s’achète ce qui lui fait plaisir. (Souriant.) C’était un petit trottin, tu sais ?
DAGO. – Oui.
CHARLEY. – Elle aime aller au restaurant et au café prendre des consommations avec des pailles.
DAGO. – Oui.
CHARLEY. – C’est gentil d’avoir autour de soi une petite gosse comme ça, qui ne bouge pas, qui est un peu rosse parfois, mais qui, en somme, vous laisse assez tranquille. C’est un but dans la vie, on travaille pour lui gagner quelques pépettes. (Avec attendrissement.) La voilà, la petite poison.
Léa entre.
SCÈNE II
LES MÊMES,
LÉA
CHARLEY, à Léa. – Qu’est-ce que tu veux encore, toi ?
LÉA. – J’ai perdu les vingt francs que tu m’avais donnés. J’ai déjà joué deux courses.
CHARLEY. – Mais tu vas bien, dis donc !
LÉA. – Donne-moi encore dix francs pour jouer cette course-là.
CHARLEY. – Je vais les jouer pour toi. Comme j’ai à faire du côté du Pari Mutuel, ça ne sera pas mal que j’aie l’air d’un bon parieur ! Sur quel cheval ?
LÉA. – Le 5.
CHARLEY. – Je te retrouve ici.
Il sort.
SCÈNE III
DAGO, LÉA
Dago et Léa sont assis sur deux chaises côte à côte. Léa regarde s’éloigner Charley. Au bout d’un instant, elle se retourne vers Dago… Elle lui tend la main qu’elle lui laisse…
LÉA. – Tu vois, je ne peux pas le quitter. Je ne l’aime pas, tu sais bien… Mais regarde comme il tient à moi.
DAGO. – Moi, tu sais si je t’aime. Mais je pense bien qu’il faut être raisonnable. Je sais qu’il te fait vivre, qu’il te donne des tas de petites choses que je ne serais pas en état de te donner.
LÉA. – Oh ! c’est pas ça qui me retient. Faut pas croire que je suis exigeante. Je dépense de l’argent parce que j’en ai. J’en aurais pas, j’en sentirais pas le besoin. Je dépense pour me distraire, parce que je suis avec un homme que je n’aime pas. Mais je serais avec un petit homme que j’aime, je t’assure, je ne penserais guère à m’acheter des robes et des chapeaux.
DAGO. – Écoute, Léa. Si vraiment tu n’as pas besoin de tant d’argent, il faut que tu viennes avec moi. Je souffre trop de vivre sans toi. C’est si difficile de se voir comme on voudrait. Et puis, ce qui est pénible, c’est de se dire que tu vis avec lui et que tu es à lui quand il veut.
LÉA. – Oh ! Il faut pas que ça te tourmente. Il ne veut pas souvent. C’est pas un jeune homme, et quand il veut je sais toujours bien m’en débarrasser. Ce n’est pas pour ça qu’il a besoin de moi, c’est pour ne pas être seul. Il n’a que moi dans la vie. Je ne peux pas le quitter comme ça.
Un silence.
DAGO. – Tu sais combien je t’aime !
LÉA. – Je le sais, mais tu peux me le dire encore.
DAGO. – Et toi, tu m’aimes aussi ?
LÉA. – C’est-à-dire que depuis que je t’ai revu, il y a deux mois – parce qu’avant on ne peut pas dire qu’on se connaissait – depuis qu’on s’est parlé sérieusement, je vois maintenant ce que c’est que d’aimer. Du temps que j’étais gosse, il n’y a pas encore bien longtemps, j’aimais pour dire que j’aimais, pour faire comme les grandes, pour bien me figurer que j’étais grande.
DAGO. – Oui, comme on s’amuse à fumer des cigarettes à douze ans. Tout ce que tu me dis là, j’en ai l’impression comme toi. C’est drôle tout de même qu’on pense si bien la même chose tous les deux !
LÉA. – Tu te rappelles, l’autre jour, quand on s’est arrêté de parler pendant je ne sais combien de temps, on a pensé à toutes sortes de choses ; et quand on s’est remis à parler, c’est rien qu’aux mêmes choses qu’on avait pensé et c’est la même chose qu’on a dit ensemble !
DAGO. – Nous sommes tout pareils, que je te dis. Avant de te connaître, je ne savais pas pourquoi j’étais sur terre. Je n’étais pas heureux, tu sais, et pourtant je n’ai jamais manqué de rien. Penses-tu ? En quittant mes parents, à seize ans, j’avais cinq mille francs devant moi, que j’avais chauffés dans la caisse de mon père. Cinq mille francs à soi, à seize ans, c’est joli. Puis j’ai été employé dans la confection, faubourg du Temple. Cent vingt francs par mois, c’était le fixe. Une bonne maison, mal tenue… Il y avait de quoi s’occuper… Je me suis offert en six mois plus de cent complets, que j’ai fait filer par des chemins de traverse. Depuis, en fabriquant de-ci, de-là, j’ai toujours eu de quoi vivre et de quoi m’amuser… Eh bien, je ne m’amusais pas, tu sais… J’allais avec l’une, j’allais avec l’autre : c’étaient des passe-temps. J’appelais ça des chopins, parce que je ne savais pas ce que c’était qu’un vrai chopin. Après l’hiver, quand il commençait à faire doux et que le mois de mai approchait, on était énervé. C’était embêtant de n’avoir pas dans ces moments-là une petite amie, une vraie petite amie. Eh ben, tu sais, cette année, le mois de mai n’a qu’à venir… il trouvera à qui parler !
LÉA. – Tu embrassais toujours bien les femmes avant de me connaître ?
DAGO. – Oui, je les embrassais. Les femmes ont la peau douce ; c’est toujours bon à embrasser. Mais toi, c’est encore autre chose… ça n’a aucun rapport. Quand je vais pour te prendre dans mes bras, ce n’est pas seulement une partie de plaisir que je me paie avec toi ; c’est plus complet, il n’y a pas d’erreur. Quand je t’embrasse, c’est pour me rapprocher de ce qu’il y a de meilleur au monde. Ah ! si tu savais comme je me fous de tout ce qui n’est pas toi ! (Il la regarde.) Il me semble que j’ai toujours connu tes yeux ! Je t’aime bien, mon vieux ! (S’énervant.) Non, je t’aime trop, ça ne peut pas durer, il faut qu’on se mette ensemble et qu’on ne se quitte jamais, jamais, jamais…
LÉA. – Oui… Mais comment lui dire ?
DAGO. – Il ne se doute absolument de rien ?
LÉA. – Non, il ne se doute de rien. Il ne peut pas se douter. D’abord, est-ce qu’il me connaît ? Il me prend pour une petite gosse, occupée d’amusettes, de toilettes et de chapeaux.
DAGO. – Oui, c’est ce qu’il disait tout à l’heure !
LÉA. – Il sent que je ne l’aime pas. Alors, il ne me croit pas capable d’aimer personne, c’est bien naturel.
DAGO. – Il faudra pourtant bien qu’on trouve quelque chose et que cette vie-là finisse ! On ne peut pas rester comme ça ! Chérie !
Il lui prend la main.
LÉA, retirant sa main. – Attention !
DAGO. – Qu’est-ce qu’il y a ?
LÉA. – Il est là-bas… Je crois qu’il nous a vus… Il vient par là… J’ai peur qu’il nous ait vus.
DAGO, qui tourne le dos à l’endroit d’où vient Charley, se lève négligemment, regarde du côté de Charley, puis se retourne vers Léa et lui dit tout bas. – Il a l’air préoccupé…
LÉA. – Ça ne veut rien dire. Il est toujours un peu comme ça !
Entre Charley.
SCÈNE IV
LES MÊMES,
CHARLEY
CHARLEY, d’une voix un peu altérée. – Voilà ton ticket.
LÉA, d’un ton aimable, un peu faux. – Le 5 gagnant, c’est bien ça, je te remercie.
DAGO, à Charley. – Tu as travaillé un peu, par là ?
CHARLEY, sèchement. – Non ! (Reprenant moins sèchement.) Non…
Un silence.
DAGO, regardant Léa. – Je m’en vais un peu par là-bas. (Léa lui fait un petit signe d’acquiescement. Dago, d’un ton aimable, un peu faux.) À tout à l’heure.
CHARLEY, même ton. – À tout à l’heure.
Dago sort.
SCÈNE V
CHARLEY, LÉA
CHARLEY, s’approchant de Léa au bout d’un instant. – Qu’est-ce que ça veut dire que vous vous teniez la main, avec Dago ?
LÉA, un peu embarrassée, mais surmontant son trouble. – On se tenait la main ?
CHARLEY. – Je t’ai vue.
LÉA. – Eh bien, je ne sais pas, moi… On était pour se quitter… On se disait au revoir.
CHARLEY, – Vous n’étiez pas en train de vous quitter !
LÉA. – Oh ! tu m’embêtes ! Tu ne vas pas te mettre à être jaloux, maintenant ! Tu ne vas pas me faire des scènes !
CHARLEY. – Qu’est-ce qu’il y a entre toi et Dago ?
Un silence.
LÉA, décidée. – Il y a qu’on s’aime !
CHARLEY. – C’est sérieux, ce que tu dis là ?
LÉA. – C’est sérieux ! Il m’aime, je l’aime !
CHARLEY. – Et tu me dis ça comme ça ?
LÉA. – Il y a bien longtemps que j’aurais voulu te le dire.
CHARLEY. – Mais tu ne sais pas ce que tu dis, voyons ! Tu n’es qu’une gosse ! Ça t’amuse de penser que tu peux aimer quelqu’un… et tu ne t’es pas dit quelles conséquences ça pouvait avoir sur moi ? C’est de ma faute aussi ! Je ne m’occupe pas assez de toi… Voyons, si je m’occupe de toi, je te ferai bien oublier ce gamin-là. (Souriant.) Gosse ! Petit gosse ! Mais pour la première fois dans ta vie, mets-toi un peu à réfléchir. Réfléchis à la peine que tu me fais, à la grande, grande peine. Tu vois, je ne crâne pas avec toi. Tu ne veux donc pas réfléchir un peu, dis ?
LÉA. – J’ai bien réfléchi.
CHARLEY, s’irritant. – J’ai bien réfléchi ! Est-ce que tu sais seulement ce que c’est que de réfléchir ? Si tu y avais pensé la moindre des choses, est-ce que tu n’aurais pas vu l’infamie, la saleté que tu me fais en pensant à un autre ?
LÉA. – Oh ! Charley !
CHARLEY. – Tu me forces à dire les choses comme elles sont. Tu n’as pas le droit, entends-tu ? de penser à un autre ! Après ce que j’ai fait pour toi ! Pour un caprice de petite fille, tu n’as pas le droit d’oublier ce que j’ai fait pour toi ! C’est honteux ! Pense donc un peu d’où je t’ai tirée !… Quel petit trottin ! Quelle petite grue tu étais !
LÉA. – Oh ! ne me parle pas comme ça, Charley, ne me parle pas comme ça !
CHARLEY. – Je te parle comme ça, parce qu’il n’y a pas moyen de te parler autrement. Une gosse comme toi, une misérable gosse sans cœur et sans réflexion ! Ça n’entend pas raison ! Il faut te traiter comme une gosse ! Tu es à moi, je te garde !
LÉA. – Nous verrons ça ! Tu me fais presque de la peine d’être aussi maladroit. Il n’y avait qu’une chose qui me retenait à toi, c’est la peur de m’entendre dire tout ce que tu viens de me dire là. J’en ai plus peur, maintenant. Je sais comme tu t’es mis en colère. Tous les droits que tu me dis, toutes les menaces que tu peux me faire, ça m’est bien égal. J’avais peur de te faire de la peine. La peine est faite, le coup est porté !
CHARLEY. – Rentrons !
LÉA. – Rentre tout seul ! (Charley tombe assis. À part.) Pauvre vieux ! Je n’osais pas le sacrifier, il y est venu tout seul ! (Elle fait un pas de son côté, comme si elle allait revenir à lui, mais elle aperçoit Dago.) Ah ! voilà Dago, là-bas !
Elle s’en va. Charley est resté assis, accablé.
SCÈNE VI
CHARLEY, BARLU
BARLU. – Charley, il faut venir par là, devant les tribunes. Deux grues drôlement habillées en vert… Il y a une bonne foule autour d’elles, à les regarder. Viens par là !
CHARLEY. – Ah ! mon vieux, je ne pense pas à travailler, va ! Il y aurait une fortune à chauffer par là, je ne bougerais pas ! Qu’est-ce que tu veux ? Je suis foutu, maintenant !
BARLU. – Qu’est-ce qu’il y a donc de nouveau ?
CHARLEY. – Il y a que je suis cocu !
BARLU. – Qu’est-ce que tu me racontes là ?
CHARLEY. – Tu vas pas me dire le contraire ! C’est elle qui me l’a dit. Elle me plaque pour le petit Dago.
BARLU. – Qu’est-ce que tu veux, mon pauv’ vieux, t’es pas le premier !
CHARLEY. – Ah ! si tu crois que c’est de ça que je m’occupe ! Ah ! je sais bien que je suis pas le premier. Je suis à un âge où l’on se fout bien d’être cocu ! Mais on ne se fout pas d’être plaqué !… Tu ne peux pas savoir ce que c’est pour moi, cette petite-là… Elle s’en doute pas non plus. Je me rends bien compte que je ne lui ai pas assez parlé : on garde ces choses-là pour soi. On se figure que les autres, qui vivent à côté de vous, voient ce qui se passe en vous, l’éprouvent en même temps. On ne s’explique pas… On a tort de ne pas s’expliquer. Et puis, peut-être que moi-même je me rendais pas compte, comme maintenant, de ce que j’étais attaché à elle. Aujourd’hui que ça s’arrache, je vois que ça tenait un peu… Non, non, je suis trop vieux pour supporter ça ! Il faut que je me cramponne, ça ne se passera pas comme ça !
BARLU. – Tu peux pas te débarrasser de Dago en lui foutant un mauvais coup ?
CHARLEY. – Je ne suis pas courageux. J’ai jamais été courageux. Je serais jeune, je dirais : je vais le crever ! Je le dirais et je le ferais pas. Maintenant, je me monte plus le coup sur moi-même. Je tiens pas à faire croire aux autres ni à moi que je suis un gaillard d’attaque. J’ai le courage de voler, parce que c’est mon métier ; j’en ai l’habitude ; et le pis qui pourrait m’arriver, ça serait de tirer ma flemme en prison… Mais j’ai toujours reculé devant les gros ouvrages !…
BARLU. – C’est vrai que, si tu te débarrassais de Dago, c’est pas ça qui te ramènerait la petite. Elle ne l’oublierait pas pour ça !
CHARLEY. – Si, qu’elle l’oubliera ! Elle n’y pense pas sérieusement. Elle y pense parce qu’il est là. S’il n’était pas là, elle n’en aurait pas pour quinze jours.
BARLU. – Tu crois ?
CHARLEY. – Ah ! je la connais bien !
BARLU. – Alors il faut trouver quelqu’un d’autre pour se débarrasser de lui.
CHARLEY. – Qui veux-tu ?
BARLU. – Voilà du monde. Allons par là-bas. D’abord, je n’ai pas fait ma journée encore.
Ils sortent. Le jockey Bearns entre en scène avec Sharpey. Ils sont suivis de Brillart.
SCÈNE VII
BRILLART, SHARPEY, BEARNS
BRILLART, à Sharpey. – C’est M. Bearns ?
SHARPEY. – Oui, c’est lui !
BRILLART. – Je suis inspecteur de police.
SHARPEY. – Oui, Monsieur.
BRILLART. – Voulez-vous dire à M. Bearns que nous avons été très ennuyés, l’autre jour, qu’on lui ait pris son portefeuille dans son pardessus ?
SHARPEY, à Bearns. – Billy, this gentleman is a police inspector. He told me the policy is very sorry your pocket book was robbed last sunday.
BEARNS, à Sharpey. – Yes. I was a bloody stupid fellow. I accuse myself only.
SHARPEY, à Brillart. – M. Bearns dit qu’il n’accuse que lui, qu’il n’était qu’un imbécile !
BRILLARD, à Sharpey. – Voulez-vous dire à M. Bearns que nous allons tâcher de pincer le voleur ? Nous voulons lui tendre un piège.
SHARPEY. – Piège ? (Brillart fait un geste de la main.) Trap ! Yes !
BRILLART. – Nous voudrions que M. Bearns laisse son pardessus au pied de l’arbre, comme l’autre jour, afin de tenter les malfaiteurs.
SHARPEY. – Je comprends. Je veux lui dire. (À Bearns.) This gentleman wishes you to put your covercoat, near this tree. (Il montre le pied de l’arbre.) To set a trap for the robbers.
BEARNS, à Sharpey. – I don’t like that very much, but I will do it for this french gentleman sake.
SHARPEY. – M. Bearns dit qu’il n’aime pas beaucoup faire cela, mais qu’il fera cela tout de même pour être agréable au gentleman français.
Coup de cloche. Bearns retire son pardessus.
BEARNS. – Shall I leave it there ?
SHARPEY, à Brillart. – Here ? (Se reprenant.) Ici ?
BRILLART. – Oui. (Avec empressement.) Yes !
BEARNS. – Well !
Il retire son paletot, et le dépose. Passent plusieurs personnes qui vont dans la même direction. Peu après entrent Charley et Barlu, puis Brillart, qui reste derrière la palissade.
SCÈNE VIII
CHARLEY, BARLU, BRILLART, puis DAGO
BARLU. – C’est malheureux, tu sais, d’avoir suivi cette fille pendant si longtemps, de l’avoir manquée, de l’avoir rattrapée, et une fois que j’ai réussi à lui mettre la main dans la poche, de n’avoir ramené que ça !
CHARLEY. – Qu’est-ce que c’est que ça ?
BARLU. – Un crayon anti-migraine ! (Il regarde autour de lui et lui montre le paletot au pied de l’arbre.) Tiens ! regarde, là !
CHARLEY. – Quoi ?
BARLU. – Le pardessus !
CHARLEY. – Oui, oui, hein, le covercoat du petit jockey ! Il est là comme un appât : c’est un piège à moineaux !
BARLU. – C’est pas un piège à renards. Il faut qu’ils trouvent autre chose pour nous.
CHARLEY. – On ne marche pas, on est en pantoufles ! On ne veut pas se mouiller les pieds ! (Regardant autour de lui, et désignant une barrière derrière laquelle est Brillart.) Regarde un peu l’autre daim qui fait le guet derrière la barrière ! Il y a vraiment aucun mérite à pas se laisser chauffer par des fourneaux pareils !
BARLU. – C’est vrai qu’on le connaît bien, celui-là !
CHARLEY. – Et quand on a un peu le fil pour ça, il n’est pas difficile à reconnaître.
BARLU. – Mais il faut encore avoir le fil. Regarde un peu qui c’est qui vient là-bas !
CHARLEY, vivement. – Dago !
BARLU. – Il n’a pas le fil, Dago, tu comprends ?
CHARLEY. – Oui.
BARLU. – Retirons-nous par là qu’il ne nous voie pas.
Ils vont à l’avant-scène à droite, derrière le petit massif qui les empêche d’être vus. Dago entre lentement en scène par la gauche, en passant derrière l’arbre au pied duquel se trouve le pardessus.
CHARLEY. – Hé ! il ne le verra seulement pas, le paletot, va ! Il a autre chose dans la tête en ce moment ! Il ne pense pas à travailler…
BARLU. – Si, qu’il y pense ! Il lui faut du pognon pour la môme ! Il en cherche, que je te dis ! Il verra le paletot, il le prendra, sois tranquille !
CHARLEY. – Il ne le verra pas !
BARLU. – Mais si !
CHARLEY. – Regarde donc derrière la palissade, la mouche qui est à l’observer ! Ah ! quel bougre de mal à gauche que cette mouche ! On la verrait à deux kilomètres ! Mon Dago va se méfier !
BARLU. – Non, non, il ne se méfie pas ! Attends un peu qu’il voie le paletot…
CHARLEY. – Il le verra pas !
BARLU. – Il vient ! il l’a vu !
CHARLEY. – Il l’a vu !
BARLU. – Ah ! nom de Dieu !
CHARLEY. – La mouche se cachera pas, tu sais ! Il veut se faire voir !
BARLU. – Il se croit beau ! Ça ne fait rien, va, vieux. Dago ne se méfie pas… Regarde-le, mon Dago, s’il y vient au paletot ! Ah ! là ! là !
CHARLEY. – Il y vient ! il y vient ! Mon pauvre Dago, tu vas te faire chauffer, mon Dago !
Dago s’assoit sur une chaise, non loin du pied de l’arbre.
BARLU. – Tant pis pour lui !
CHARLEY. – Ah ! oui, fallait pas qu’il y aille !
BARLU. – Il t’a fait assez de mal !
CHARLEY. – Ah ! oui, c’est bien assez ! Il y en a un de nous qui est de trop ! Qu’est-ce que tu veux, y en a un de nous deux qui doit écoper !
BARLU. – Tant mieux pour toi que ça soit lui !
CHARLEY. – C’est ce que je me dis !
BARLU. – Regarde la mouche avec son œil en dessous.
CHARLEY. – Il me dégoûte !
BARLU. – Sois tranquille, Dago ne le verra pas !
CHARLEY. – Il est bête, ce Dago…
BARLU. – Regarde donc là-bas. Il ne vient personne… (Vivement.) La môme qui s’amène là-bas… Est-ce qu’elle connaît la mouche ?
CHARLEY. – Oui, j’y ai montrée déjà.
BARLU. – Faut que j’aille à sa rencontre pour la détourner d’ici.
CHARLEY. – C’est ça ! C’est ça !
BARLU. – Elle se détourne toute seule. Elle s’en va de l’autre côté. Il y a du bon. Plus personne pour sauver Dago !
CHARLEY. – Plus personne !
BARLU. – Il se lève de sa chaise. La mouche ne le quitte pas des yeux…
CHARLEY, se cachant les yeux. – Oh ! je ne veux pas voir ça !
BARLU. – Il se baisse !…
CHARLEY, chantant :
Daisy ! Daisy !
Will you marry me !
Dago, qui avait fait un léger mouvement pour se baisser, se relève. Il regarde autour de lui et s’approche timidement de Charley.
DAGO. – Je te remercie, Charley.
CHARLEY. – Va-t-en ! Foutez-moi le camp tous les deux, que je ne vous voie plus !
Dago s’éloigne. Des gens arrivent sur la scène.
BRILLART, qui est descendu, regardant Charley. Assez haut pour être entendu de lui. – Qu’est-ce qu’il a donc, celui-là, à chanter comme ça ?
CHARLEY, amèrement. – C’est que je suis content !
BRILLART. – Vous n’en avez pas l’air !…
CHARLEY. – Je suis triste, mais je suis content.
Il chante à demi-voix.
Daisy ! Daisy !
Will you marry me ?
I’m half crasy
Out of the love for you…
Le rideau tombe pendant qu’il chante les deux derniers vers.
RIDEAU
LES COTEAUX DU MÉDOC
Comédie en un acte
Représentée pour la première fois à Paris,
sur le Théâtre du Vaudeville, le 2 décembre 1903.
À ABEL TARRIDE.
À MARTHE RÉGNIER.
Leur ami,
T.B.
PERSONNAGES
|
HENRI |
MM. Tarride |
|
LE CONCIERGE |
Aussourd |
|
BERTHE |
Mlle Marthe Régnier |
La scène est partagée en deux. Au fond de la partie gauche et au fond de la partie droite, une porte. Une porte au premier plan à droite (partie droite) et au second plan à gauche (partie gauche).
SCÈNE PREMIÈRE
HENRI, LE
CONCIERGE
Ils sont sur la partie gauche de la scène.
LE CONCIERGE. – Je portais la quittance du terme au locataire de l’appartement d’à côté… Alors, j’entrais voir en passant si Monsieur est content de son installation.
HENRI. – Oui, oui. Ça va bien, ça va très bien.
LE CONCIERGE. – Le domestique de Monsieur a dû sortir… Si Monsieur a besoin de quelque chose en son absence ?
HENRI. – Je vous remercie.
LE CONCIERGE. – Monsieur se trouvera bien à l’aise dans cet appartement et n’aura pas à se repentir de la location ; la maison est tout ce qu’il y a de paisible et convenablement habitée.
HENRI. – Dites donc. Est-ce qu’il n’est pas arrivé ce matin une grande bonbonne à mon adresse ?
LE CONCIERGE. – Non, Monsieur.
HENRI. – Vous n’avez pas vu mon domestique en descendre une à la cave ?
LE CONCIERGE. – Non, Monsieur.
HENRI. – C’est insupportable ! Je vais téléphoner aux Coteaux du Médoc.
LE CONCIERGE. – C’est une maison de vins fins, je connais. Ils ont les grands crus de Bordeaux.
HENRI. – Oui, c’est là que je prends mon eau d’Évian. Depuis que le commerce de vins a baissé, ils ont trouvé le moyen de se refaire en vendant de l’eau minérale. Au lieu de mettre leur eau dans du vin, ils la mettent dans des bouteilles d’Évian.
LE CONCIERGE. – Alors, puisque Monsieur sait ça, pourquoi ne boit-il pas simplement de l’eau du robinet ?
HENRI. – Parce que je ne suis pas absolument sûr que cette eau d’Évian soit fausse et malsaine. Tandis qu’avec l’autre, l’eau du robinet, je suis fixé. J’aime mieux garder un petit risque d’avoir de la bonne eau.
Il s’assoit et tourne la manivelle de sonnerie.
LE CONCIERGE. – Au revoir, Monsieur.
Henri continue à tourner.
HENRI, chantant :
Et pendant ce temps-là
Je tourne la manivelle !
(Parlé.) Elles ne répondent pas. Je suis dans le désert… dans la nuit… (Tournant.) Ayez pitié d’un pauvre aveugle, s’il vous plaît !
Berthe entre par la porte de droite, suivie du concierge.
BERTHE. – C’est heureux que je rentre maintenant. Vous n’auriez trouvé personne. Ma femme de chambre est allée en course… Je lui avais pourtant dit d’attendre mon retour. Si quelqu’un a téléphoné en mon absence, je n’en saurai rien… Tenez, voilà l’argent du terme.
LE CONCIERGE. – Merci, Madame.
Il sort.
HENRI. – Allô ! allô ! Donnez-moi le 202-02. (Après un temps.) Allô ! allô ! Les Coteaux du Médoc ? Oh ! je vous demande pardon, Monsieur… Allô ! allô !… Voulez-vous avoir l’amabilité de sonner de votre côté, pour qu’on me décroche… Elles sont abominables. (Un temps.) Allô ! allô ! C’est le bureau ? Vous vous êtes trompée de numéro… Voulez-vous me donner le 202… 02 ?… Je n’ai jamais vu un service si mal fait ! Allô ! Gutenberg !… Ce Gutenberg est stupide !… Allô ! allô !… (La sonnerie retentit dans l’appartement de Berthe qui vient à l’appareil, et prend le récepteur.) Enfin ! Allô ! Les Coteaux du Médoc ?
BERTHE. – Non, Monsieur.
HENRI. – Sacristi de petits chameaux !
BERTHE. – Dites donc, Monsieur !
HENRI. – C’est à ces demoiselles. Voilà la deuxième fois qu’elles se trompent. Déjà tout à l’heure… je demandais les Coteaux du Médoc, et elles m’ont adressé à un monsieur !… Je vous demande pardon, Madame. Voulez-vous avoir l’obligeance de sonner de votre côté ? Sans ça elles ne me décrocheront pas !… (Ils sonnent chacun de leur côté. Sonnerie aux deux appareils. Henri prend les récepteurs et Berthe aussi.) Allô ! allô ! allô !
BERTHE. – C’est toujours moi !
HENRI. – C’est insupportable !… C’est-à-dire… ce n’est pas insupportable que ce soit vous… C’est insupportable de ne pas pouvoir… Je vous en prie, Madame, voulez-vous quitter l’appareil et sonner en même temps que moi ?… (Même jeu. Nouvelle sonnerie.) Allô ! allô ! allô ! Le bureau ?
BERTHE. – Non, moi !
HENRI. – Nous sommes accrochés pour la vie !… Bonjour, Madame. On se retrouve pour la troisième fois. On est déjà de vieilles connaissances.
BERTHE. – Ça va bien depuis qu’on ne s’est entendu ?
HENRI. – Très bien ! Toujours aussi jolie ? Ah ! Est-ce que vous êtes jolie ?
BERTHE. – Je ne sais pas.
HENRI. – Avec ça, que vous ne savez pas !
BERTHE. – Je vous assure. Les gens me disent que je suis jolie. Mais les gens sont si polis et si flatteurs.
HENRI. – Mais vous, qu’est-ce que vous en pensez ?
BERTHE. – Je change d’avis. Il y a des jours où ma figure m’est insupportable. Et d’autres fois, je reste des demi-heures devant ma glace à trouver que je ne suis pas mal ! Et vous, est-ce que vous êtes joli garçon ?
HENRI, résolument. – Oui, Madame !
BERTHE, riant. – Vous avez bien dit ça !
HENRI. – Vous ne m’avez pas compris. Mon « oui » énergique signifie que je veux que vous me croyiez beau. Je vous aime ! Où êtes-vous que j’y coure ?
BERTHE. – En ce moment ?
HENRI. – Oui. D’où me téléphonez-vous ?
BERTHE. – De Saint-Germain-en-Laye.
HENRI. – Vous mentez effrontément !
BERTHE. – Dites donc !
HENRI. – C’est un hideux mensonge. Vous êtes à Paris. On donne souvent un abonné pour un autre, mais c’est un abonné du même bureau. Vous ne voulez pas me dire où vous êtes ? Je le saurai !
BERTHE. – Comment ça ?
HENRI. – Je demanderai au bureau le numéro de la personne avec qui je causais, et je feuilletterai une à une toutes les pages de l’annuaire pour trouver le nom qui correspond à ce numéro.
BERTHE. – D’abord, je ne crois pas que le bureau vous dise le numéro et, en admettant que vous ayez le nom de l’abonné, il ne vous apprendra rien sur moi. Je ne suis pas chez moi, je suis… dans une pâtisserie.
HENRI. – Pourquoi cette hésitation ?
BERTHE. – Je n’ai pas hésité…
HENRI. – Où est cette pâtisserie ?
BERTHE. – Dans les Champs-Élysées.
HENRI. – Décrivez… Où est le téléphone ?
BERTHE. – Dans une arrière-boutique. Il y a autour de moi des plats commandés, des pièces montées, des timbales de crevettes, des tartes aux fruits !
HENRI. – C’est exact comme description… Mais ça peut être un souvenir… Voyons… Je connais toutes les pâtisseries des Champs-Élysées. J’ai eu l’occasion de téléphoner dans chacune d’elles. La pâtisserie que vous me décrivez doit être au coin de la rue de La Boétie.
BERTHE. – C’est cela même.
HENRI. – En vous penchant un peu, vous devez apercevoir par une des vitres de l’arrière-boutique, sur la façade d’en face, une plaque bleue : rue de la Boétie.
BERTHE. – Je vois la plaque… rue… de La Boétie.
HENRI. – Eh bien, vous mentez ! Il n’y a pas de pâtisserie au coin de la rue de La Boétie !… C’est une pharmacie !… Vous avez voulu me dérouter… Vous êtes chez vous !
BERTHE. – Mais vous êtes d’une malice effroyable !… Vous me faites peur ! Je ne veux plus téléphoner avec vous !
HENRI. – Si, si, restez ! C’est lâche de vous en aller comme ça !
BERTHE. – C’est que j’ai à faire.
HENRI, avec autorité. – Vous n’avez rien à faire !
BERTHE. – Comment ! je n’ai rien à faire !
HENRI. – Vous n’avez rien à faire d’intéressant. Avez-vous un amant ?
BERTHE. – Oui.
HENRI. – Ce n’est pas vrai !
BERTHE. – Comment !… ce n’est pas vrai ?
HENRI. – J’ai senti ça à votre oui. Vous avez dit oui, en blague ! Si vraiment vous aviez un amant, vous ne plaisanteriez pas avec ces choses-là ! Vous m’auriez dit « oui » avec une certaine gravité, avec satisfaction, pour le plaisir d’avouer sans risque votre amant à un inconnu. Vous n’avez pas d’amant… (Le concierge entre chez Berthe.) Vous n’en avez pas !
BERTHE. – Eh bien, pour vous montrer que j’en ai un, je vais vous le faire entendre, attendez… (Au concierge.) Arrivez ici, et dites dans l’appareil : « Je suis le monsieur dont vous a parlé Madame » !
LE CONCIERGE, timidement. – Je suis le monsieur dont vous a parlé madame.
HENRI. – Ah ! vous êtes le monsieur dont m’a parlé madame ! Eh bien, je voudrais bien savoir où vous demeurez.
LE CONCIERGE, à Berthe. – Il voudrait savoir où c’est que je demeure.
BERTHE. – Demandez-lui pourquoi ça ?
LE CONCIERGE, dans l’appareil. – Pourquoi ça ?
HENRI. – Pour aller vous flanquer une paire de gifles !
LE CONCIERGE, après un moment de silence. –… Ah ! j’y tiens pas !
BERTHE. – Qu’est-ce qu’il dit ?
LE CONCIERGE, à Berthe. – Il dit comme ça qu’il veut me flanquer une paire de gifles. J’y réponds que j’y tiens pas. (Dans l’appareil.) J’y tiens pas !
HENRI. – Vous n’y tenez pas ! Vous êtes un pleutre, Monsieur !
LE CONCIERGE. – C’est bien possible ! (À Berthe.) Il dit que je suis… je ne sais pas quoi ! (À Henri.) Je ne sais pas ce que c’est.
BERTHE, lui prenant l’appareil. – C’est bon ! Allez-vous-en. Je vous remercie.
LE CONCIERGE. – Si des fois il vient, Madame, vous ne me connaissez plus ! Je n’ai peur de personne ! C’est vous dire que je ne tiens pas à chercher des raisons et que je ne suis pas ici pour recevoir des calottes !… (À part.) Attrape ! Je lui ai bien posé ça !
Il sort.
HENRI, à Berthe qui a repris l’appareil. – Allô !… Vous revoilà !… Pourquoi choisissez-vous vos amants dans des classes aussi modestes ? Comme c’est malin de me raconter des blagues dans le téléphone ! Comme c’est malin d’inviter des gens que la personne à qui on parle ne peut pas voir ! Mon ami Henriquez, qui est ici, trouve ça déplorable ! N’est-ce pas, Henriquez ? (Imitant l’accent espagnol.) Pour sour, ce n’est pas digne d’oune femme intellizente !
BERTHE. – Ah ! Monsieur est Espagnol ?
HENRI. – De Barcelona.
BERTHE. – Chi bagita conta se vero catalona fuentes, chi bagita loro ?
HENRI, après une grimace. – Mon ami Henriquez reste muet… Ça lui fait tellement d’émotion d’entendre sa langue maternelle !
BERTHE, riant. – Allons ! C’est vous qui êtes pincé cette fois !
HENRI. – Je l’avoue piteusement et loyalement. Nous sommes quittes. Écoutez : on va jouer maintenant à se dire la vérité. Ce n’est vraiment pas la peine d’être dans cette situation exceptionnelle et de ne pas se connaître, pour se dire des mensonges. Laissons ça aux gens qui se connaissent… Allons ! la vérité !… Avez-vous un amant ?
BERTHE. – Non.
HENRI. – Il vous en faut un. Nous allons vous chercher ça.
BERTHE. – En tout cas, je ne veux pas de vous.
HENRI. – Hé mais ! dites donc, est-ce que je me suis proposé ? Attendez, attendez ! Il faut que je m’assure mieux de vos qualités morales. Si je vous voyais, comme vous êtes probablement jolie, je passerais sur les qualités morales… Votre visage me répondrait de votre âme et me donnerait sans doute de fausses garanties.
BERTHE. – Mais, permettez, vous me demandez si j’ai un amant, et vous ne me demandez pas si j’ai un mari !
HENRI. – Je procède par ordre. La place n’est pas occupée par un amant. Est-elle encombrée par un mari ? Y a-t-il un mari ? Et quel est-il ?
BERTHE. – C’est un type dans le genre de la jument de Roland, il a toutes sortes de défauts ; mais il a une qualité admirable : il n’existe plus.
HENRI. – Mort de quoi ?
BERTHE. – De sa belle mort. Il est remarié.
HENRI. – Depuis quand est-il divorcé ?
BERTHE. – Depuis deux ans.
HENRI. – Quel motif ?
BERTHE. – Il m’a trompée.
HENRI. – Et vous avez divorcé pour ça ?
BERTHE. – Je lui ai parlé de divorce. S’il n’avait pas consenti, j’aurais laissé ça tranquille. Mais il a cru que j’y tenais absolument. Il a dit oui. Et nous avons divorcé.
HENRI. – Et depuis votre divorce, on ne vous a pas fait la cour ?
BERTHE. – Je vais vous dire une chose qui va vous sembler bête. Ça m’est un peu égal d’être bête, puisque vous ne me voyez pas. Mais c’est la première fois qu’un homme me parle aussi longtemps. Depuis mon enfance, on m’a habituée à avoir peur des hommes. Alors, dès qu’ils me parlent, j’ai peur ; comme j’ai peur, je ne les écoute pas. Je ne pense qu’à avoir peur. Et comme ils voient que je n’écoute pas, ils ne parlent plus. Vous, je peux me permettre de vous écouter un peu, je suis hors de vos atteintes.
HENRI. – Mais votre mari ?
BERTHE. – Croiriez-vous que lui ne m’a, pour ainsi dire, jamais parlé ? Quand nous étions fiancés, quand on nous laissait seuls, il m’embrassait silencieusement. Ça ne me faisait pas une forte impression quand il m’embrassait, mais je me répétais : « C’est un beau garçon. On dit que c’est agréable d’être embrassée par un beau garçon. Ça doit donc me faire plaisir. » Et puis je pensais qu’il parlerait davantage après la noce. Après la noce, il ne m’a plus rien dit du tout ! Nous voyagions. Comme nous ne nous quittions jamais, il n’avait même pas la ressource de me demander comment j’allais. Et puis, nous sommes revenus à Paris ; j’ai appris qu’il avait une maîtresse chez qui plusieurs fois par semaine il me trompait en silence. Nous avons prononcé l’un et l’autre quelques paroles froides. Je lui ai demandé de divorcer. Il a accepté sans enthousiasme. Depuis deux mois il est remarié, car il ne supporte pas la solitude et il se tait maintenant chez une autre femme… (Un temps.) Eh bien, quoi ! ça se gagne, le silence ? C’est vous qui vous taisez, à présent ?
HENRI. – Je me tais parce que j’ai beaucoup de choses à vous dire… et que je ne sais comment vous les dire.
BERTHE. – Prenez votre temps. La durée des communications est illimitée sur le réseau urbain… Non, mademoiselle, nous causons… Eh bien, qu’avez-vous à me dire ?
HENRI. – Quelle belle invention que le téléphone !
BERTHE. – C’est là le résultat de vos réflexions ?
HENRI. – C’est une invention admirable ! Je ne sais pas où vous êtes. Vous ne savez pas où je suis. Nous sommes peut-être à une lieue l’un de l’autre et peut-être à cent pas ! Et nous commençons à nous connaître mieux que si nous savions qui nous sommes ! Nous aurions pu nous voir et nous parler pendant deux ans sans nous connaître aussi bien que par cette conversation de quelques minutes ! Si nous nous étions vus, vous avec votre timidité, votre coquetterie, votre hypocrisie féminine…
BERTHE. – Merci.
HENRI. – Un peu de patience, vous allez voir comment je vais m’arranger. Moi avec ma vanité, ma fatuité, ma roublardise masculine, mon besoin d’étonner, avec tous ces mensonges réciproques chacun de nous serait arrivé à se défigurer. Et grâce à ces quelques mots que vous m’avez dits sans défiance, me voilà renseigné sur vous-même. Oui, je suis renseigné… et je suis charmé. J’ai profité de ce que je ne vous voyais pas pour vous dire des rosseries. Je ne sais pas pourquoi je ne vous dirais pas brutalement des choses aimables. Je suis charmé, nom de nom !
BERTHE. – Sacrebleu !… vous me plaisez !
HENRI. – Écoutez… écoutez, femme inconnue. Maintenant qu’on s’est assez bien parlé pour se connaître, on ne se mentira plus. Rien ne s’oppose plus à ce qu’on se voie… Qui êtes-vous ?
BERTHE. – L’inconnue !
HENRI. – Voilà ! C’est bien ça ! Voilà l’ignoble éternel féminin qui reparaît et vous vous dérobez… Sale bête, va !
BERTHE. – C’est la grande intimité… Si vous m’insultez, je raccroche le récepteur.
HENRI. – Le chantage… Le chantage à la rupture !… Écoutez, petite amie, petite amie chérie que j’aime bien…
BERTHE. – Je ferme l’appareil !
HENRI, après une grimace de rage. – Je vous préviens qu’en ce moment mon visage exprime l’impatience et la fureur… Allons ! Je ne vous appellerai ni chérie, ni sale bête. Je vous dirai seulement en termes mesurés que ce serait très mal de me priver de vous, que ce serait criminel. Je ne vous connais que par votre voix. Mais je suis conquis par elle. Il y a en elle une douceur…
BERTHE, flattée. – Ne coupez pas, mademoiselle !… Mais vous savez que ces appareils changent beaucoup la voix. Vous ne la reconnaîtriez plus.
HENRI. – Mais je reconnaîtrais votre façon de vous exprimer et les mots que vous disiez, les explications simples, naturelles… Qui êtes-vous ?
BERTHE. – Je vous le dirai encore moins que tout à l’heure… maintenant… Tout à l’heure, je n’avais pas peur.
HENRI. – Et maintenant ?
BERTHE. – Maintenant, rien…
HENRI. – Maintenant, vous avez peur. Oh ! je vous en supplie, dites-moi votre nom !… Vous êtes lâche, vous savez, d’avoir peur pour ça ! Il faut être plus forte. Et puis, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour moi. Je serai très malheureux si je vous quitte comme ça. J’en aurai le regret toute ma vie.
BERTHE. – Non, je vous en prie, ne me suppliez pas… sans ça, je vais vous le dire… Et ce n’est pas la peine. Je vais quitter l’appareil et vous demanderez vos Coteaux du Médoc. C’est beaucoup mieux comme ça. C’était bien, ce petit entretien… C’est tout ce que vous pouviez me donner de mieux.
HENRI. – Votre nom ? votre nom ?
BERTHE, faiblissant. – Je vous le dirai, mais pas tout de suite. C’est curieux de vous dire mon nom comme ça, c’est comme un abandon. Laissez-moi quelques instants, je vais vous le dire tout d’un coup, sans y penser, comme si je disais autre chose, voulez-vous ? Voulez-vous que nous parlions d’autre chose ?
HENRI. – Je n’entends plus rien. Allô ! allô ! allô !
BERTHE, à elle-même. – On nous a coupés… (Au téléphone.) Allô ! allô !
HENRI, à lui-même. – Oh ! c’est effrayant ! On nous a coupés ! (Au téléphone.) Allô ! allô !
BERTHE. – Rien ne répond plus… (Regardant autour d’elle.) C’est agaçant, c’est énervant !
Elle sort par le côté droit.
HENRI, tournant désespérément. – Ces demoiselles du téléphone, ce sont les divinités mauvaises de notre vie ; les démons insaisissables qui font le mal, on ne sait pourquoi, avec inconscience. (Il tourne.) Elles ont disparu. Je n’ai plus devant moi que le néant. Tout vient de sombrer là-dedans. Je ne la reverrai jamais !
Entre le concierge.
LE CONCIERGE. – Monsieur n’a toujours pas de nouvelles de sa bonbonne d’Évian ?
HENRI. – Il s’agit bien de ça ! On ne peut pas téléphoner aujourd’hui. C’est effrayant ! Elles ne répondent plus.
LE CONCIERGE. – L’appareil est peut-être cassé ?
HENRI. – Je n’en sais rien, je ne peux même pas savoir s’il est cassé. On ne répond pas.
LE CONCIERGE. – Si Monsieur tient absolument à téléphoner, je connais peut-être un moyen.
HENRI. – Comment ça ?
LE CONCIERGE. – Il y a d’autres locataires dans la maison, qui ont le téléphone. Monsieur pourrait peut-être téléphoner de chez l’un d’eux ?
HENRI. – Vous croyez que ce n’est pas indiscret ?
LE CONCIERGE. – Oh ! je ne crois pas. En tout cas, on peut demander.
HENRI. – Et puis, entre abonnés du téléphone, il faut s’entraider.
LE CONCIERGE. – Monsieur veut-il venir ?
HENRI. – Je viens. Mais je ne la retrouverai jamais.
Ils sortent. Pendant qu’ils sortent par le fond, Berthe rentre en scène à droite.
BERTHE. – Ça vaut mieux au fond que ça se soit arrêté comme ça… Ça vaut mieux, ça vaut mieux… Cette petite histoire m’agace… J’étais bien tranquille, je ne pensais pas à m’ennuyer. Je m’ennuie, maintenant… (On sonne.) Hein ? Qu’est-ce que c’est encore que ça ? Entrez !
Entre le concierge, puis Henri.
LE CONCIERGE. – Madame, c’est le locataire d’ici à côté qui vous demande la permission de se servir du téléphone.
Il sort.
HENRI. – Excusez-moi, Madame, je suis désolé de vous déranger, mais je ne peux pas arriver à téléphoner de chez moi. Il y a quelque chose de cassé dans l’appareil.
BERTHE. – Je crains bien que vous ne soyez pas plus heureux avec celui-là… Je ne sais pas ce qu’elles ont aujourd’hui à se tromper de numéro et à couper la communication.
HENRI. – C’est précisément ce qui vient de m’arriver. Elles sont abominables.
BERTHE. – Je vous laisse téléphoner.
Elle fait mine de se lever pour sortir.
HENRI, protestant. – Ne vous dérangez pas, Madame ; si vous vous dérangez, je m’en vais. Je n’ai rien de confidentiel à dire. Vous étiez en train de travailler, je vous supplie de ne pas vous occuper de moi. (Il s’assied et tourne la manivelle.) Il n’y a pas d’exercice aussi inutile ! Si c’était au moins plus dur à tourner, ça travaillerait les muscles ! (Il tourne.) Ça ne sert à rien !
BERTHE. – Patientez un peu. D’ici deux ou trois minutes, elles se décideront peut-être. C’est comme les esprits qu’on évoque aux tables tournantes. Il faut qu’ils soient bien disposés pour répondre.
HENRI. – L’esprit de Gutenberg ne veut rien savoir aujourd’hui. Je suis désespéré de vous déranger ainsi.
BERTHE. – Entre voisins ! Vous êtes emménagé d’aujourd’hui ?
HENRI, – Oui, Madame.
BERTHE. – C’est une maison agréable… Moi, j’habite ici depuis deux ans.
HENRI. – C’est monsieur votre mari, ce monsieur un peu grisonnant que j’ai rencontré dans l’escalier ?
BERTHE. – Non. C’est un monsieur au-dessus. Moi, je suis seule ici. Je suis divorcée.
HENRI. – C’est extraordinaire ce qu’il y a de femmes divorcées depuis quelque temps ! C’est une loi bien utile. Justement, tout récemment encore, une dame que je connais me racontait l’histoire de son divorce. Elle a divorcé parce que son mari ne lui parlait jamais !
BERTHE. – C’est curieux !… C’est un cas très fréquent, vous savez ? Oui… oui… je connais aussi une personne qui est à peu près dans ce cas-là.
HENRI. – Les mariages se font le plus souvent d’une façon si bizarre. On présente l’un à l’autre deux êtres, qui inconsciemment se jouent la comédie et qui n’arrivent jamais à se connaître. D’ailleurs, qui connaît-on dans la vie ?
BERTHE. – C’est bien vrai, ce que vous dites là… on ne se dit jamais la vérité.
HENRI. – C’est ce que je disais récemment à quelqu’un. J’ai vécu pendant des mois avec des êtres que je n’ai jamais connus. Et d’autre part, je garderai toujours l’impression d’une conversation très courte que j’ai eue avec une inconnue, une femme que je ne retrouverai peut-être jamais.
BERTHE. – C’est curieux, ce que vous me dites là. J’ai eu une impression absolument semblable. La seule voix qui m’ait émue, la seule voix que j’ai sentie amicale et familière, est la voix d’un inconnu. C’est peut-être le seul homme que j’aie écouté sans méfiance et je ne le retrouverai jamais.
HENRI, qui l’a écoutée depuis un instant. – Ce n’est pas vous que je plains, Madame.
Sonnerie. Il ne bouge pas. Deuxième sonnerie.
BERTHE. – Voici le téléphone, Monsieur.
HENRI, au téléphone. – Je suis le 204-17. Je ne vous téléphone pas du 204-17, mais je suis le 204-17. Tout à l’heure, je vous avais demandé les Coteaux du Médoc.
BERTHE, après un sursaut. – Les Coteaux du Médoc…
HENRI. – Et vous m’avez mis en communication avec une autre personne.
BERTHE, à elle-même. – C’est lui !
HENRI, après avoir écouté. – Non. Les Coteaux du Médoc, vous me les donnerez tout à l’heure. Ce que je veux savoir d’abord, c’est le numéro de cette personne.
BERTHE, le regardant, à part. – C’est lui !
HENRI. – Je vous en prie, occupez-vous de le retrouver. Négligez tous les autres abonnés ; ils ne diront rien, ils sont résignés ! Mais occupez-vous de ça. (Il raccroche les récepteurs. À Berthe.) Je crois que je vais retrouver mon inconnue.
BERTHE. – Vous y tenez donc tant que ça ?
HENRI. – On a toujours tort de désirer ces choses-là, parce qu’on se ménage souvent des déceptions.
BERTHE, le regardant. – Oui, on a d’abord une petite déception.
HENRI. – Ah ! vous croyez ?
BERTHE, d’un air entendu. – J’en suis sûre. Même si la personne qu’on retrouve est assez bien… on est déçu de la retrouver différente de ce qu’on l’avait imaginée. Puis il se fait dans votre esprit un petit travail… on s’habitue à sa figure et cette personne qu’on n’avait jamais vue, on la reconnaît peu à peu.
HENRI, un peu stupéfait. – Faut-il que vous connaissiez le cœur humain pour imaginer ça comme ça !
BERTHE. – Non, mais j’ai un peu d’expérience… Il m’est arrivé une aventure analogue.
HENRI. – Vous m’avez dit en effet tout à l’heure que vous aviez eu comme moi une conversation avec un inconnu ; mais vous me disiez que vous ne l’aviez pas revu.
BERTHE. – Si, Monsieur, je l’ai revu… Je vous ai en effet dit le contraire, mais je l’ai revu.
HENRI, après l’avoir regardée. – Ça m’ennuie ce que vous me dites là.
BERTHE. – Que j’aie revu mon inconnu ?
HENRI. – Oui, parce que si vous n’aviez pas retrouvé votre inconnu… comme moi je n’ai pas retrouvé mon inconnue, nous aurions pu les chercher ensemble, quitte à ne les retrouver ni l’un ni l’autre… Et puis, à la longue, on se serait peut-être consolés.
BERTHE, avec un peu de dépit. – Ah ! déjà ?… Eh bien, vous n’aurez pas été long à vous consoler !… Il y a un instant, quand vous me parliez de cette inconnue, il semblait que ce fût presque le grand amour… Décidément, ce n’était pas aussi sérieux que vous le disiez !
HENRI. – Mais si, c’était sérieux. Tout à l’heure, quand on m’a coupé brusquement la communication, j’ai cru que je ne m’en consolerais jamais. Et puis… depuis un instant, je commence à me dire qu’il n’y a pas que cette inconnue sur la terre. Je ne sais pas comment elle est, après tout… Ce n’est pas sûr qu’elle soit bien… (La regardant.) Tandis qu’il y a d’autres femmes qui sont certainement jolies… et qui me font une impression très vive.
BERTHE. – Mais non !
HENRI. – Je vous jure !
BERTHE. – Comment voulez-vous qu’on puisse croire à votre sincérité ? Puisqu’il y a cinq minutes vous vous déclariez épris d’une autre femme !
HENRI. – Qu’est-ce que vous voulez ? C’est comme ça ! Dans la même journée, je tombe amoureux successivement de deux personnes ! C’est ridicule, mais c’est comme ça ! (Un temps. Sonnerie au téléphone.) Allô ! Allô ! C’est le bureau !… (À Berthe.) Elle a retrouvé… (À lui-même.) Deux passions, il va falloir choisir. (Au téléphone.) Allô ! Comment ? Qu’est-ce que vous dites ? (Stupéfait.) La maison avec qui j’étais en communication tout à l’heure, c’était… (Il regarde Berthe avec stupéfaction. Au téléphone.) Je vous remercie. (À Berthe.) Je vais vous apprendre une chose extraordinaire… Mais d’abord, vous m’avez menti tout à l’heure en me disant que vous aviez retrouvé votre inconnu. Je sais qui c’est cet inconnu, je vais vous stupéfier. (Solennellement.) Cet inconnu, c’était… c’était…
BERTHE, d’un ton calme. – C’était vous.
HENRI, stupéfait. – Vous le saviez ! Et vous m’avez laissé parler !
BERTHE. – Et je vous ai laissé parler, oui… Moi, l’inconnue, j’ai assisté à mon lâchage !
HENRI. – Je ne vous ai pas lâchée… Je suis tombé deux fois amoureux de vous, voilà tout ! Vous m’avez conquis d’abord par votre voix et ensuite par votre visage. D’ordinaire, les charmes d’une femme opèrent ensemble. Les vôtres ont eu assez de force pour opérer séparément. (Avec ravissement.) C’est elle ! Ce sont elles ! Écoutez… Je… Heu… Voilà ! J’ai des tas de choses à vous dire… Et maintenant, devant vous je ne sais plus comment vous les dire, moi qui parlais si facilement tout à l’heure… J’ai envie de rentrer chez moi et de vous téléphoner…
BERTHE. – Oui, mais du moment que vous demanderez mon numéro, on ne vous le donnera plus.
HENRI. – C’est juste. Mais ne disons pas de mal de ces demoiselles ! Ce sont des êtres charmants, des instruments infiniment délicieux de la Providence ! Et je leur devrai, j’espère, le bonheur de ma vie. (Berthe fait un mouvement.) J’ai dit : « J’espère »… Vous, vous pourriez aussi me dire quelque chose… Dites-moi quelque chose.
BERTHE. – Quelle belle invention que le téléphone !… Grâce au téléphone nous sommes arrivés à nous entendre, alors que nous étions séparés par un mètre cinquante !
HENRI. – Oui, mais l’inconvénient c’est que l’abonnement soit si cher. Ne pourrions-nous pas, à partir du trimestre prochain, avoir un seul abonnement pour nous deux ?
BERTHE. – C’est à étudier.
Sonnerie au téléphone.
HENRI. – Qu’est-ce que c’est encore ? (Il prend l’appareil.) Surprise ! (À Berthe.) Savez-vous ce qui est là-dedans ? Les Coteaux du Médoc ! (Dans l’appareil.) C’est vous, chers Coteaux ! Je voulais vous faire une scène terrible… mais je vous dois trop de reconnaissance !… Envoyez-moi mon eau d’Évian… Et ce soir, j’ai du monde à dîner… (Regardant Berthe.) Oui… oui, j’ai du monde à dîner… Envoyez-moi deux bouteilles de champagne…
BERTHE. – Mais je ne bois pas de vin !
HENRI. – Elle ne boit pas de vin ! Nous étions faits l’un pour l’autre !…
RIDEAU
LE CAPTIF
Comédie en un acte
Jouée pour la première fois le 9 février 1904,
au Théâtre des Mathurins.
PERSONNAGES
|
DOUBLET |
MM. André Calmettes |
|
LE GEÔLIER |
Victor Boucher |
|
LÉA |
Mlle Louise Bignon |
La scène se passe dans une cellule.
SCÈNE PREMIÈRE
LE GEÔLIER,
DOUBLET, LÉA
LE GEÔLIER. – Vous n’avez besoin de rien ?
DOUBLET. – Non, je vous remercie.
LE GEÔLIER. – Allons, vous boudez… Ah ! que c’est désagréable de voir des gens de mauvaise humeur !
DOUBLET. – Eh bien, dites donc, ça doit vous arriver souvent dans votre métier !
LE GEÔLIER. – Oui. Mais je ne m’y habitue pas. Plus je vois des boudeurs, plus ça m’est pénible.
DOUBLET. – Je vous conseille de parler ! Si vous croyez que c’est gai d’être en prison !
LE GEÔLIER. – Parce que vous n’êtes pas raisonnable. Ce n’est pas la prison qui est triste. C’est vous. Moi qui suis ici depuis plus longtemps que vous et qui y resterai encore après votre départ, je m’y trouve bien. Et pourtant, j’ai plus de travail et de responsabilité que vous.
DOUBLET. – Mais vous pouvez sortir quand vous voulez.
LE GEÔLIER. – Aussi je ne sors jamais. Dites-vous une bonne fois que si vous pouviez sortir, vous ne sortiriez pas. Alors, où est la privation ? Qu’est-ce que vous faisiez avant d’être ici ?
DOUBLET. – Rien. Je vivais de mes rentes. Je faisais de la musique, de la peinture, je montais à cheval, j’allais à la chasse.
LE GEÔLIER. – Ça vous amusait ?
DOUBLET. – Pas toujours.
LE GEÔLIER. – Et les raseurs dont vous ne pouviez vous débarrasser ! Ici, vous n’avez que moi. Et si je vous barbe, c’est bien simple, vous n’avez qu’un signe à faire… Est-ce que vous n’aviez pas de remords d’être un oisif ?
DOUBLET. – Si fait, je suis fils et petit-fils de travailleurs. Je me levais tard ; mais je m’en voulais.
LE GEÔLIER. – Tandis qu’ici vous n’avez plus aucun remords. Vous voyez que vous avez bien tort d’être triste.
DOUBLET. – C’est dur, pourtant, de se trouver emprisonné quand on n’est pas coupable !
LE GEÔLIER. – Comment ? Vous n’êtes pas coupable ? Et vous vous plaignez ! Vous êtes une victime, vous avez cette satisfaction de pouvoir maudire l’injustice des hommes, et vous vous trouvez malheureux ? Ah ! si vous étiez coupable, je comprendrais ! Votre tranquillité serait troublée par un remords… le remords de vous être laissé pincer ! Allons, vous n’êtes pas à plaindre ! Voulez-vous des livres ? Voulez-vous une petite araignée ? L’administration nous oblige, à cause de l’hygiène, à balayer toutes les toiles. Mais nous avons, dans de petites boîtes, des araignées à l’usage des captifs ! Voulez-vous causer avec d’autres prisonniers ? Nous avons ici dans ce couloir des gens qui n’ont rien de banal : le faussaire d’en face, et le petit incendiaire du coin. Qu’est-ce que vous êtes, vous ?
DOUBLET. – Je suis bigame.
LE GEÔLIER. – Hé ! ce n’est pas mal, ça ! J’ai connu de très chics bigames. Il y avait même ici un monsieur qui s’était marié six fois, chaque fois avec cent mille francs de dot !
DOUBLET. – Moi, ce n’est pas ça. Je n’en ai jamais fait une affaire de spéculation. Je n’ai à mon actif que des mariages d’amour. Je suis un garçon foncièrement honnête, incapable de flirter avec une jeune fille autrement que pour le bon motif. Chaque fois que j’aime, j’épouse. J’ai aimé deux fois, je me suis marié deux fois.
LE GEÔLIER. – Seulement, la loi n’admet pas ça.
DOUBLET. – Mais je me défendrai tant que je pourrai. J’ai fait choix d’un avocat… ou plutôt, d’une avocate.
LE GEÔLIER. – Ah ! oui, je vois !
DOUBLET. – Qu’est-ce que vous voyez ?
LE GEÔLIER. – Il y a longtemps que vous n’avez pas vu de dames, alors vous n’êtes pas fâché d’en faire venir une ici… Voulez-vous du thé et des gâteaux ?
DOUBLET. – Y pensez-vous ! Je ne connais pas Mlle Adalbert que j’ai choisie sur la liste ; je m’imagine que c’est une personne déjà mûre et plutôt sèche. Mais c’est tout de même une âme de femme ; je ne suis pas fâché de faire mes confidences à une femme et de lui expliquer que j’ai été amené ici par une excessive tendresse de cœur.
LE GEÔLIER. – Enfin, même si vous n’êtes pas dans l’intention de manquer de respect à cette dame, vous pouvez tout de même lui offrir des gâteaux.
DOUBLET. – Vous tenez à les placer, vos gâteaux !
LE GEÔLIER. – Je vais les chercher ; mais je crois qu’on frappe à la porte… C’est votre avocate.
DOUBLET. – Faites entrer. (À lui-même.) Brune et plutôt petite, voilà comme il me la faudrait.
Entre Léa ; elle est grande et blonde. Le geôlier sort.
SCÈNE II
LÉA, DOUBLET
LÉA. – Vous m’avez choisie, m’a-t-on dit, sur la liste des avocats d’office ? Est-ce que nous avons des relations communes ?
DOUBLET. – Non, Madame, j’ai choisi d’après le nom.
LÉA. – Sans doute parce que mon nom se trouve être celui d’un jurisconsulte connu ?
DOUBLET, timidement. – Non, ce n’est pas pour ça. C’était parce que votre nom avait l’air d’être celui d’une personne… brune… Oui, j’aime bien les personnes brunes.
LÉA. – Ce ne sont pourtant pas des considérations d’un tel ordre qui doivent vous guider dans le choix d’un avocat !
DOUBLET. – Dans le choix d’un avocat, non… mais dans le choix d’une avocate. Il faut vous dire que je préférais une avocate, parce que mon affaire est d’ordre sentimental. Il y a des nuances qu’on ne peut expliquer, me semble-t-il, qu’à une femme, et à une femme brune ! Cependant, je crois qu’une blonde, à la rigueur…
LÉA, s’asseyant et prenant des notes. – Vous êtes prévenu du crime de bigamie.
DOUBLET. – Du crime de bigamie… Je me suis marié à Alger il y a cinq ans, et tout dernièrement à Paris, à la mairie du sixième.
LÉA. – Et comment avez-vous pu vous mettre dans ce cas-là ?
DOUBLET. – Voilà. Il faut vous dire que ma femme d’Alger, après deux mois de mariage, m’a trompé… C’est une chose dont je ne me vante pas. Mais enfin, le fait est là ! Ça été un grand scandale ; son amant a reçu deux balles dans la tête…
LÉA. – Vous avez…
DOUBLET. – Non, pas moi ; moi, je n’étais au courant de rien ; il a été tué par un autre amant de ma femme, un homme très violent et qui ne badinait pas ! Il avait été mis au courant par un troisième ! Ma femme, après ce scandale, ne pouvait rester à Alger. Elle est partie… avec un autre de ces messieurs ! Depuis son départ, je ne l’ai jamais revue. Je ne sais même pas où elle est. Il y a trois mois, quand j’ai rencontré aux eaux Mlle Loriot, que j’ai épousée il y a trois semaines, j’ai fait mon possible pour divorcer d’avec mon ancienne femme. Mais je ne savais pas où elle était.
LÉA. – Vous auriez pu divorcer par défaut.
DOUBLET. – C’est ce qu’on m’a dit, mais j’ai horreur de la procédure dès qu’elle est un peu compliquée. Et puis, j’avais juré à ma fiancée que je n’avais jamais connu l’amour. Je me suis dit que mon ancienne femme ne reparaîtrait plus, et qu’il valait mieux laisser ça tranquille. Seulement, le jour de mon mariage, il y eut un scandale épouvantable en sortant de l’église. Un oncle de ma fiancée, qui avait reçu une lettre anonyme, est venu faire du bruit. On a tout découvert. Mon beau-père a été très mécontent d’avoir pour gendre un bigame. Il s’est conduit avec moi brutalement ; il m’a fait arrêter tout de suite, à la sortie de l’église, sans même me permettre de passer la nuit avec sa fille. Le mariage a été cassé, et moi je vais être condamné. Et cependant, je vous jure que je n’avais pas fait une affaire de spéculation. Je n’avais pas encore touché la dot, qui était des plus modestes. Et j’avais payé d’avance à moi tout seul le lunch et les voitures de noces. Dame ! tout ça s’est trouvé perdu ! On ne pense pas à tous les frais que nous avons, nous autres bigames ! Deux mariages, vous savez, ça vaut un incendie ! Voilà tout ce que j’avais à vous expliquer. (Il la regarde.) Hé ! mais dites donc ?
LÉA. – Qu’est-ce qu’il y a, Monsieur ?
DOUBLET. – Me permettez-vous de vous dire que vous êtes très jolie ?
LÉA, gênée. – Parlons, si vous le voulez bien, de votre procès.
DOUBLET. – Et quand vous êtes comme ça, sérieuse, vous êtes encore plus gentille !
LÉA. – Votre cas me semble assez grave. Le crime de bigamie, prévu par l’article 340 du Code pénal, entraîne une condamnation aux travaux forcés à temps.
DOUBLET. – Qu’elle est gentille !
LÉA. – On ne peut espérer un acquittement que si le prévenu peut exciper de sa bonne foi, ce qui n’est malheureusement pas votre cas, et s’il établit qu’il croyait à la nullité de son premier mariage.
DOUBLET, attendri. – Elle est gentille !… Elle a travaillé gentiment sa bigamie avant de venir ici ! Mais tout ce que vous dites, je le sais aussi bien que vous. De nos jours, le niveau intellectuel des criminels s’est élevé singulièrement. Un bigame, un escroc, un faussaire, connaît beaucoup mieux son crime qu’un avocat qui ne s’est pas spécialisé là-dedans. Non, ce n’est pas pour avoir une consultation juridique que j’ai fait demander une avocate. Il m’a semblé que, dans cette affaire Doublet, il y avait un côté sentimental qu’une femme saisirait mieux.
LÉA. – Mais je ne suis pas sentimentale.
DOUBLET, attendri. – Elle a gentiment dit ça ! Vous n’êtes pas sentimentale ? Mais qu’est-ce que vous en savez ? Est-ce que vous avez eu l’occasion de l’apprendre ? Pas encore. Quel âge avez-vous ?
LÉA. – Ce n’est pas la question. Occupons-nous de notre affaire.
DOUBLET. – Une jeune femme de vingt-quatre ans…
LÉA. – Vingt-deux.
DOUBLET. – Une jeune femme de vingt-deux ans ne peut pas dire qu’elle n’est pas sentimentale. Elle peut dire simplement qu’elle n’a pas encore eu l’occasion de le constater. Je vous connais mieux que vous… Je suis sûr que vous avez l’âme tendre et délicate. Et je suis sûr que vous êtes une honnête femme…
LÉA. – Dites donc !… Dites donc !… Ce n’est pas de ceci qu’il doit être question. C’est de vous.
DOUBLET, ardemment. – Vous êtes bien plus intéressante que moi. Mon affaire à moi importe peu, au fond. J’aime autant ne pas être condamné, mais si je suis condamné, le beau malheur ! (Accablé.) Qu’est-ce que j’ai à faire dans la vie ? Je n’ai que trente-deux ans, mais je suis un homme fini. La vie est insipide, sans amour. Et je suis fait pour aimer. (Il pleure.) J’ai honte de pleurer devant vous, parce que vous ne me comprenez peut-être pas.
LÉA, un peu émue. – J’ai beau vous connaître à peine, je vous assure que je suis très peinée.
DOUBLET. – Merci. C’est ce qu’il me fallait… Ça va mieux ! Voilà l’utilité d’un véritable avocat ! C’est une assistance morale… Vous n’avez peut-être pas encore le talent de maître Barboux ni celui de maître Henri Robert, mais jamais leur présence ne m’aurait fait autant de bien que la vôtre ! J’aime mieux votre toute petite main sur mon front, que leur large et puissante main ! Mais c’est ce que la femme a de divin ! (Plaidant.) Voilà une femme – je parle de vous – voulez-vous me rappeler votre nom… mademoiselle Adalbert… enfin, peu importe le nom – voilà une femme qui a mené une existence austère malgré son aimable visage, l’éclat de ses yeux et de son teint, la grâce adorable de sa bouche…
LÉA. – Taisez-vous…
DOUBLET. – Ce n’est pas à vous que je parle ! Je me parle à moi ! Je me parle de vous ! (Plaidant avec chaleur.) Voilà une femme qui a consacré sa vie à l’étude pour arriver à défendre un jour, au moyen des textes et grâce à ses ressources oratoires, pour arriver à défendre le veuf et l’orpheline ! Cette femme a gardé dans la poussière des bibliothèques l’exquise sentimentalité féminine ! Je suis sûr – c’est une pure supposition – que si un malheureux comme moi tournait un jour vers une personne comme vous des yeux suppliants… vous l’écouteriez !
LÉA, gênée. – Je vous en prie, ne parlons pas de moi. Je suis votre avocat, je vais prendre quelques notes…
DOUBLET. – Oui, écrivez… écrivez que je vous trouve exquise !
LÉA, dignement. – Vous allez m’obliger à me retirer.
DOUBLET. – Pourquoi avez-vous choisi, vous autres femmes, la carrière d’avocat ? Pour l’exercer comme un homme ? Ce n’est pas la peine ! Nous avons assez d’avocats ! Ce que nous vous demandons, ce n’est pas d’apporter dans nos prisons des qualités de juriste, mais le charme et le sourire féminins ! Et vous êtes capable d’une délicieuse pitié !
LÉA. – Ah ! non ! non ! Je n’irai pas jusque-là…
DOUBLET. – Je sais bien. Il ne s’agit ni de vous ni de moi. Vous, vous êtes une personne que je sens inaccessible. (Désolé.) Moi, je ne suis rien pour vous. (Amer.) Vous me méprisez.
LÉA. – Mais non, je vous assure.
DOUBLET, avec une impatience un peu rageuse. – Ah ! pas de politesse ! Pas de politesse ! Vous me méprisez, je vous le dis ! Répondez-moi simplement : « Oui, je vous méprise » !
LÉA. – Mais pas du tout ! Vous me faites au contraire l’effet d’une nature un peu exaltée, mais très bonne… et assez noble.
DOUBLET, ardent. – Je le suis encore plus que vous le croyez ! Il n’y a pas d’homme qui ait plus que moi le respect des femmes ! Quand une femme me fait une impression, je suis d’une timidité terrible !… Mais jamais, entendez-vous ? je n’avais éprouvé un sentiment aussi violent que le sentiment… que je n’ai pas encore tout à fait… mais qui vient, qui vient avec une rapidité effrayante et délicieuse !… Écoutez !… Votre nom ?…
LÉA. – Mademoiselle Adalbert.
DOUBLET. – Mais votre petit nom ? (Impatient.) C’est votre petit nom qu’il me faut maintenant !
LÉA. – Ce n’est pas la peine.
DOUBLET. – Je vais vous en donner un. Il faut que je vous en donne un. Écoutez, Juliette…
LÉA. – Léa.
DOUBLET, étonné. – Léa ?… (Avec une moue.) Léa… (S’habituant au nom.) Léa ! (Avec satisfaction.) Léa… (Avec enthousiasme.) Écoutez, Léa ! Je vous aime ! Je sais très bien que, si vous m’aimiez un jour, ça ne peut pas être tout de suite… Mais je ne vous demande que de me laisser vous le dire… Et si vous ne m’aimez pas, gardez ça pour vous… Que je conserve au moins l’espérance que vous m’aimerez… et que je vous épouserai !…
LÉA. – Encore !… Mais vous êtes déjà bigame !…
DOUBLET, tombant, accablé. – C’est vrai, je suis bigame et, ce qui est pire, prisonnier. Tant que durera ma prison préventive – et nous la ferons durer le plus longtemps possible, grâce à des remises innombrables – tant que je vous verrai tous les jours, ça ira bien ; mais après… je serai condamné, flétri !
LÉA, émue. – Écoutez, ne vous désespérez pas…
DOUBLET, exalté. – Vous m’aimerez flétri ?
LÉA. – Ce n’est pas ce que je veux dire. Ce qui me fait de la peine, c’est de vous voir malheureux. S’il vous a suffi de cinq minutes pour devenir amoureux de moi, vous ne trouverez pas étonnant que j’aie senti naître en moi pour vous une sympathie… certaine.
DOUBLET, transporté. – Ah ! Ils peuvent me condamner maintenant ! Ils peuvent me jeter dans les fers et marquer mes épaules au fer rouge ! (Je sais d’ailleurs que ça ne se fait plus !) Ils peuvent me faire ramer sur les galères ! J’emporterai, dans la sûre cachette de mon cœur, une fleur qu’ils n’atteindront pas !
LÉA, empressée. – Je vais m’occuper de votre affaire avec la plus grande diligence… Le tribunal est généralement très sévère pour les bigames… Je suis navrée de n’avoir pas de talent…
DOUBLET, avec autorité. – Vous en aurez. Vous aurez de l’éloquence pour me défendre !
LÉA. – Et puis, figurez-vous que je vais plaider prochainement dans une autre affaire de bigamie… Cette fois, je plaiderai contre le bigame – qui est défendu par un grand avocat. Je noterai bien tout ce qu’il dira en faveur de son client, et quand il s’agira de vous défendre je le répéterai pour vous.
DOUBLET, tendrement. – Elle est gentille !… Alors, vous allez plaider contre un bigame !
LÉA. – Contre une bigame… Une femme qui s’est mariée quatre fois.
DOUBLET. – Ne m’humiliez pas… Mais dites-moi toujours son nom.
LÉA. – Son nom… Attendez… (Elle ouvre sa serviette et regarde dans un dossier.) Une nommée Tourteret !
DOUBLET, sursautant, – Tourteret !
LÉA. – Jeanne-Élisabeth.
DOUBLET. – Jeanne-Élisabeth !
LÉA. – Mariée pour la première fois à Genève en 90, à Bordeaux en 95, à Saint-Nazaire en 1901 et à Grenelle en 1904.
DOUBLET. – Et une autre fois, que vous ne savez pas ! Mariée à Alger en 98 ! Et mariée avec qui ? Mariée avec moi !
LÉA. – C’est votre femme ?
DOUBLET, affolé. – Oh ! mon Dieu ! mon Dieu ! Mais savez-vous les conséquences de ce que vous m’apprenez ? Quand Jeanne-Élisabeth Tourteret m’a épousé, elle était déjà mariée !…
LÉA. – Alors votre premier mariage…
DOUBLET, au comble de l’exaltation. – Mon premier mariage est nul ! Je ne suis plus bigame !… Je me croyais innocent… et je l’étais encore plus que je ne le croyais ! Mon innocence éclate à mes propres yeux !… Léa ?…
LÉA. – Monsieur ?…
DOUBLET. – Voilà qu’elle m’appelle monsieur !… Pourquoi donc qu’elle m’appelle monsieur ?
LÉA. – Il ne faut pas tenir compte de ce que je vous ai dit tout à l’heure. Je croyais parler à un malheureux condamné. Et mon devoir était de ne pas l’affliger davantage… Alors, par pitié…
DOUBLET. – Ah ! vous n’allez pas commencer à être coquette, maintenant ! S’il faut être criminel pour vous parler d’amour, je vais commettre n’importe quel crime, égorger quelque geôlier, et je remonterai vous faire la cour !… Léa… Léa… Léa… Je viens de vous faire tort en devenant subitement innocent et en vous privant d’une cause… Mais cette cause qui est la mienne, reprenez-la et plaidez-la auprès de vous. Allons ! Allons !… Je ne vous demande pas de dire oui… Ne dites pas non… Ça me suffira !
LÉA, après une hésitation. – Je crois qu’on a frappé.
DOUBLET. – Entrez !…
SCÈNE III
LES MÊMES,
LE GEÔLIER
LE GEÔLIER. – J’apporte du thé et des gâteaux.
DOUBLET. – Ah ! mon ami, j’ai à vous apprendre une nouvelle qui va vous peiner. Je vais prochainement m’en aller de cette cellule qui me rappelle désormais une des heures les plus émouvantes de ma vie…
LE GEÔLIER. – Vous nous quittez ?
DOUBLET. – Oui. Le bigame, mon cher, qui était un des plus beaux ornements de cette maison, le bigame vous quitte… pour se marier !
RIDEAU
L’INCIDENT DU 7 AVRIL
Comédie en un acte
Représentée pour la première fois le 20 mai 1911,
au Théâtre de l’Athénée
PERSONNAGES
|
LE SUBSTITUT |
MM. Larmandie |
|
TRIBADEL |
Gallet |
|
MESSADIE |
Térof |
|
LE JUGE |
Sauriac |
|
BOUSSU |
Borderie |
|
THÉVENEL |
Marseille |
|
LE PRÉSIDENT |
Cueille |
|
L’HUISSIER |
Lecomte |
|
LE GARÇON |
Fournez |
|
PREMIER AVOCAT |
Mathé |
|
DEUXIÈME AVOCAT |
Fouché |
|
MLLE KERMAGNON |
Mmes Duluc |
|
DÉA |
Goldstein |
|
MLLE NOREL |
Lukas |
Public
La scène représente une chambre correctionnelle à Paris.
Au lever du rideau, le président et un juge, tous deux en civil, et André, le garçon de salle, sont en scène.
LE PRÉSIDENT, au juge. – Voilà la salle où vous allez siéger, mon cher collègue. Elle n’est pas grande, mais c’est une des mieux éclairées.
ANDRÉ, à demi-voix au président. – Monsieur le Président, est-ce que Monsieur n’est pas notre nouveau juge ?
LE PRÉSIDENT. – Oui, André… Ah ! mon Dieu, je manquais à toutes les règles du protocole ! J’oubliais, mon cher collègue, de vous présenter André. André est notre fidèle garçon de salle, notre ancien à tous.
ANDRÉ. – Ça, c’est vrai, monsieur le Président, je suis le plus ancien de la chambre, et même de tout le tribunal. J’étais déjà ici du temps du président Tribouillard, celui qu’on appelait le président Maximum.
LE JUGE. – André regrette peut-être l’ancienne sévérité, l’implacable sévérité de nos aînés.
LE PRÉSIDENT. – Non, non. André a évolué avec son siècle. André est pour l’indulgence, comme tout le monde…
LE JUGE. – C’est très bien, c’est très bien…
LE PRÉSIDENT. – À Amiens, vous ne siégiez pas souvent à la correctionnelle ?
LE JUGE. – Non, croyez-vous, je n’ai pour ainsi dire jamais siégé qu’au civil.
LE PRÉSIDENT. – Ah ! ce sont d’autres impressions… assez pittoresques, je dois le dire, surtout à Paris, où il faudra vous familiariser avec un langage et des expressions toutes nouvelles… Enfin, on s’y fait vite, à la langue verte, et je serai là au besoin pour vous servir d’interprète. Mais dites donc, l’heure s’avance ; il est temps, je crois, d’aller s’habiller. (Au moment où ils vont pour sortir, le substitut entre par la droite.) Ah ! voici notre ministère public. Déjà en robe ! Est-ce que nous serions en retard ?
LE SUBSTITUT. – Non, non, c’est moi qui suis un peu en avance… J’avais quelque chose à voir… Bonjour !
Il serre la main du juge, puis celle du président. À ce moment, Mlle Kermagnon entre par la porte de gauche. Elle est en robe d’avocat.
LE PRÉSIDENT. – Oh ! mais nous allons avoir le plaisir d’entendre plaider aujourd’hui Mlle Kermagnon ! Mon cher collègue, il faut que je vous fasse faire la connaissance d’une de nos plus distinguées avocates du barreau de Paris, Mlle Kermagnon, qui va plaider tout à l’heure devant nous…
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Oh ! une affaire des plus banales.
Elle serre la main du juge, puis celle du président et celle du substitut.
LE JUGE. – Il n’y a pas d’affaire banale, pour un orateur de talent. Et je suis sûr que, si vous et notre ami le substitut vous voulez vous en donner la peine, nous assisterons à un véritable tournoi…
MADEMOISELLE KERMAGNON. – N’attendez rien d’exceptionnel de ma part tout au moins.
LE SUBSTITUT. – Mademoiselle Kermagnon, pas de modestie excessive…
LE PRÉSIDENT. – Dépêchons-nous d’aller nous habiller.
Ils sortent en saluant. Le substitut reste en scène avec l’avocate et le garçon.
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Dites donc, mon cher substitut, est-ce que vous croyez que cette affaire Niclès nous emmènera loin, et pensez-vous que je ferais bien de demander une remise à la septième, où je devais me présenter à midi trois quarts ?
LE SUBSTITUT. – L’affaire Niclès est la première inscrite. Mais ce serait peut-être plus prudent que vous demandiez une remise à la septième.
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Eh bien, c’est entendu. Je vais y aller…
À ce moment André fait mine de s’en aller, puis revient épousseter une table.
LE SUBSTITUT. – N’allez pas jusqu’à la septième. Envoyez-y un de vos confrères. André va vous en appeler un. Vous entendez, André ?
MADEMOISELLE KERMAGNON. – André, soyez assez aimable pour aller jusqu’au vestiaire. Mlle Norel, que vous connaissez, doit être arrivée. Vous lui direz qu’elle vienne me voir.
ANDRÉ. – Bien, Mademoiselle.
Il donne encore un coup de plumeau et sort lentement. À peine a-t-il refermé la porte que l’avocate et le substitut tombent dans les bras l’un de l’autre. Leurs lèvres se joignent dans un long baiser.
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Ah ! coco ! coco ! J’ai cru qu’il ne s’en irait pas ! Deux jours que je n’avais pas été dans tes bras… J’étais folle… Je suis sûre que tu ne trouvais pas le temps long, toi !
LE SUBSTITUT. – Imbécile… laisse-moi, avec ton col qui monte si haut, je ne peux plus aller dans mon petit coin.
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Tu peux, va, tu peux, mon col ne serre pas très fort. (Le substitut, les yeux clos, a posé amoureusement ses lèvres sur la nuque de Mlle Kermagnon.) Dis donc, qu’est-ce que tu crois qu’il faut que je plaide dans cette affaire Niclès ? Ma cliente a insulté l’agent. Si je disais que l’agent l’avait provoquée ?
LE SUBSTITUT. – Ça ne fait pas bon effet.
Il replonge son nez dans le cou de l’avocate.
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Alors quoi ? dis-moi… Mais dis-moi donc, petit ?
LE SUBSTITUT. – Ne te tourmente pas ; si tu veux, je ne requerrai pas.
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Ah ! non, parce que vis-à-vis de ma cliente et des gens qui seront là, j’aurais l’air d’avoir la tâche beaucoup trop facile. Si, requiers, coco, requiers !
LE SUBSTITUT. – Eh bien, je ne serai pas trop méchant.
Son visage disparaît à nouveau derrière la tête de Mlle Kermagnon.
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Qu’est-ce que tu as fait, vilain, pendant ces deux jours ?
LE SUBSTITUT. – Je me suis terriblement ennuyé, pendant que tu étais au mariage de ton cousin. Était-ce de ton cousin ou de ta cousine ?
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Oh ! tu penses que je me suis amusée, sans toi ! Puisque tu connais la famille, tu aurais pu venir un peu.
LE SUBSTITUT. – C’est toi qui m’as défendu de venir, sous prétexte qu’il serait très difficile de ne pas se regarder gentiment…
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Et tu te l’es laissé défendre bien facilement. Probablement que tu avais de quoi passer ton temps !… Ah ! si je savais ça…
LE SUBSTITUT. – T’es bête !
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Écoute, mon petit, rien que de penser que tu pourrais me tromper, mon chéri, j’ai envie de te tuer, de te tuer là, séance tenante ! Ne me trompe jamais, petit amour…
LE SUBSTITUT. – Tu n’as pas besoin d’avoir peur… Laisse-moi mon petit coin… (À ce moment la porte s’ouvre. Entre Mlle Norel. Le substitut, gravement.) Évidemment, la défense n’est pas astreinte à nous communiquer les pièces, mais dans l’intérêt même du client…
MADEMOISELLE KERMAGNON, après l’avoir baisé sur la bouche. – Espèce de serin, mon amie sait tout ! Regarde, Norel, comme il est rouge…
LE SUBSTITUT. – Vous n’êtes pas sérieuse, mademoiselle Kermagnon…
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Vous êtes trop austère, monsieur le Substitut. (Exit le substitut.) Il est bien gentil, et nous nous aimons.
MADEMOISELLE NOREL. – Vous ne songez pas à vous marier ?
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Il y a du tirage du côté de ma famille. Mais je crois que, lorsque j’aurai bien plaidé deux ou trois fois, on m’accordera chez moi un peu plus d’indépendance. Et peu à peu j’acquerrai assez d’autorité pour qu’on me laisse me marier à ma guise… Mais je t’avais fait appeler pour un service… Va donc demander pour moi une remise à la septième, affaire Chaubel… Pourquoi n’es-tu pas venue me prendre ce matin ?
MADEMOISELLE NOREL. – Figure-toi, ma chère, que j’étais aux Galeries. Je n’y vais jamais l’après-midi : l’aspect de ces femmes, uniquement occupées de chiffons, me met hors de moi… C’est tout de même bien de s’être émancipées comme nous avons fait, d’être sorties de la frivolité, d’être des êtres pensants… Je vais aux Galeries, ou au Printemps, quand il faut y aller. J’avais besoin d’un peu de surah mauve pour une modification à mon corsage.
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Celui qui va avec ta petite jupe plissée ?
MADEMOISELLE NOREL. – Oui. Je vais déjeuner chez le bâtonnier.
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Ah ! moi aussi ! Ah ! bien, si tu mets ta robe en surah mauve, je mettrai plutôt ma robe en taffetas vert-nil.
Elles sortent au moment où Déa Niclès entre par la gauche avec Thévenel, Boussu, le poète Messadie et André.
ANDRÉ. – Vous allez pouvoir installer vos amis là, devant, parce que s’ils attendaient l’entrée du public, ils risqueraient d’être mal placés.
MESSADIE. – Moi, je suis témoin.
ANDRÉ. – Oh ! bien alors, vous, Monsieur, il faut vous en aller par là-bas, et donner votre feuille de citation.
MESSADIE, vieillard tout chétif et chenu. – Ah ! bon, je vais aller avec les témoins…
DÉA. – Je vous suis bien reconnaissante, monsieur Messadie, vous, un monsieur si conséquent, d’avoir bien voulu vous déranger pour parler pour moi.
MESSADIE. – C’est un devoir, ma petite amie, c’est un devoir.
DÉA. – C’est égal, y a bien des messieurs comme vous, âgés, à son aise, qui ne se seraient pas dérangés !
MESSADIE. – Ça va bien, allez ! Ça va bien !
ANDRÉ. – Accompagnez monsieur, vous, Madame la prévenue, en cas que vous ayez quelque chose à signer.
Il les emmène par le fond.
THÉVENEL. – Dis donc, Boussu, Déa paraît très rassurée.
BOUSSU. – Grâce à moi.
THÉVENEL. – Grâce à toi ?
BOUSSU. – Grâce à mézig. Il y a très longtemps que je voulais passer une nuit d’amour avec Déa. Alors, je lui ai offert de lui rendre un grand service, et de lui faire faire la connaissance du substitut.
THÉVENEL. – Tu le connais ?
BOUSSU. – Ni de vue, ni de nom ! Mais une fois que Déa m’a eu accordé ses faveurs, je lui ai présenté un autre brave garçon de ma génération qui brûlait, lui aussi, du désir de passer une nuit d’amour avec l’aimable Déa. De sorte que cette gentille enfant est persuadée maintenant qu’elle a comblé les vœux de l’organe, si j’ose dire, du ministère public.
THÉVENEL. – Mais tout à l’heure, elle va bien voir que ce n’est pas lui ?
BOUSSU. – Elle verra mon œil ! Elle ne sait pas ce que c’est au juste qu’un substitut. Je lui ai dit que c’était un homme habillé en rouge, qui se tenait caché dans le mur et qui n’apparaissait que tout à la fin.
THÉVENEL. – C’est un peu cochon, ce que tu as fait là…
BOUSSU. – Oh ! mon vieux…
THÉVENEL. – C’est moi que t’aurais dû présenter comme le substitut…
BOUSSU. – Elle te connaissait, mon vieux.
THÉVENEL. – C’est égal, c’est un peu malheureux d’être obligé d’avoir recours à de pareils moyens pour obtenir les faveurs d’une personne qui a fait le bonheur d’une bonne moitié du quartier Saint-Georges !
BOUSSU. – Ah ! qu’est-ce que tu veux ? Nous sommes ses camarades. Elle ne veut pas nous demander d’argent.
THÉVENEL. – Il faut tout de même que je trouve un plan. Dire qu’il ne s’est jamais rien passé entre nous…
BOUSSU. – C’est un titre pour toi.
THÉVENEL. – C’est égal, je ne tiens pas à me faire montrer au doigt. Je suis sûr que Messadie lui-même…
BOUSSU. – Le vieux-là qui s’intitule poète-chansonnier ?
THÉVENEL. – S’il ne faisait que s’intituler ! Mais le terrible, c’est qu’il fait des chansons !
BOUSSU. – Alors, tu te figures que pour ce vieux birbe, la reconnaissance de Déa ? Il faut être deux, mon Thévenel ! Et puis, ce vieillard égrillard qui fréquente toutes les grues de Montmartre est un vieux monsieur, un rentier très convenable, qui vit avec une vieille femme sinistrement légitime et qui est aussi effritée que lui-même, car je ne sais pas si tu as remarqué ce vieillard, c’est vraiment de l’ancien, de l’ancien authentique, pas du truqué. (À ce moment la porte du public s’ouvre, et il entre du public.) Asseyons-nous au banc des avocats.
Rentre Déa, qui va s’asseoir au banc des prévenus libres. Mlle Kermagnon rentre par une autre porte et s’approche de Déa.
DÉA. – Bonjour, mademoiselle l’Avocate.
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Bonjour, bonjour ! Eh bien, c’est entendu, vous niez. Vous dites que vous n’avez pas prononcé les mots…
DÉA. – Oh ! Mademoiselle, ça ira bien, allez, je suis tranquille. Je serai acquittée.
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Écoutez, je l’espère, mais ce n’est pas absolument sûr. Je ne veux pas vous enlever vos illusions.
DÉA. – Oh ! si, je suis tranquille ! Je vous dirai que j’ai pris des précautions. Ainsi, le substitut…
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Le substitut ?
DÉA. – Je suis sûre de lui !
MADEMOISELLE KERMAGNON, inquiète. – Comment ça ?
L’HUISSIER. – Le tribunal !
DÉA, très impressionnée. – Oh ! le tribunal.
L’HUISSIER. – Le tribunal, Messieurs, levez-vous et découvrez-vous.
Entrent les trois juges, le substitut.
MADEMOISELLE KERMAGNON, inquiète. – Qu’est-ce que vous disiez, que le substitut ?…
DÉA. – Je vous dirai ça plus tard. (Très impressionnée.) Oh ! le tribunal ! le tribunal !
LE PRÉSIDENT, s’asseyant. – L’audience est ouverte. La première affaire.
L’HUISSIER. – Affaire Niclès. Injures à un agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions.
LE PRÉSIDENT. – La prévenue ?
L’HUISSIER. – Le tribunal, Messieurs, levez-vous. (S’approchant de Déa Niclès.) Levez-vous et répondez aux questions.
LE PRÉSIDENT. – Vous vous appelez bien Déa Niclès ? Vous exercez la profession de ?…
DÉA. – Je suis à l’Olympia et à la Gaîté. Je suis marcheuse.
LE JUGE, à demi-voix, au président. – Marcheuse ?
LE PRÉSIDENT. – Non… ça veut dire qu’elle est dans les corps de ballet. (À la prévenue.) Est-ce que vous êtes en ce moment au théâtre ?
DÉA. – Non, monsieur le Président, je suis en congé pour le moment.
LE PRÉSIDENT. – Oui, depuis quelque temps déjà, n’est-ce pas ?
DÉA. – Depuis quelque temps.
LE PRÉSIDENT. – Et vous occupez vos loisirs… Enfin, c’est votre affaire. Vous avez à répondre d’un fait qui s’est passé le mois dernier, le 7 avril, devant la terrasse de la brasserie Pigalle. L’agent 704, du neuvième arrondissement, que l’on va entendre tout à l’heure, ayant adressé des observations à un chauffeur de taximètre qui s’arrêtait devant la brasserie sans avoir fait le demi-tour réglementaire pour se trouver sur sa droite, l’agent 704 se vit interpeller par différentes personnes attablées à la terrasse, et notamment par vous, qui lui avez adressé des injures relatées au procès-verbal. (D’un air indifférent.) « Fourneau », « vache » et « dos ».
DÉA. – C’est faux, monsieur le Président, c’est d’autres personnes qui étaient là. Moi, je n’ai rien dit ; seulement, comme les autres personnes se sont barrées…
LE JUGE, à demi-voix, au président. – Barrées ?
LE PRÉSIDENT, de même. – Oui, se sont défilées, se sont trottées. (Devant l’air étonné du juge.) Sont parties, si vous préférez.
DÉA. –… il fallait qu’il y eût quelqu’un qui paie pour tout le monde ; alors, c’est moi qu’ai été chauffée.
LE PRÉSIDENT. – Alors, vous niez les propos qui vous sont attribués par l’agent 704 ?
DÉA. – Je ne nie pas, je dis que c’est faux !
LE PRÉSIDENT. – Nous allons entendre l’agent 704.
MADEMOISELLE KERMAGNON, anxieuse, à Déa. – Qu’est-ce que vous disiez du substitut ?
DÉA. – Je ne peux pas vous le dire maintenant.
LE PRÉSIDENT. – Appelez le premier témoin.
L’HUISSIER. – L’agent Tribadel.
LE PRÉSIDENT. – Vos nom et prénoms.
TRIBADEL. – Tribadel, Henri-Félix, agent de la brigade des voitures, neuvième arrondissement.
LE PRÉSIDENT, après l’avoir dévisagé. – Comment, c’est encore vous ?
TRIBADEL. – Oui, monsieur le Président.
LE PRÉSIDENT. – Vous vous êtes déjà présenté la semaine dernière.
TRIBADEL. – Oui, monsieur le Président. On m’avait appelé « vache » !
LE PRÉSIDENT. – Et ce n’était pas la première fois.
TRIBADEL. – J’étais déjà venu deux fois à cette chambre-ci, parce qu’aux autres chambres on m’y voit encore plus souvent.
LE PRÉSIDENT. – Toujours pour le même motif ?
TRIBADEL. – Quelquefois, c’est parce qu’on m’appelle « sale flic ».
LE PRÉSIDENT. – Mais enfin, comment se fait-il que vous soyez injurié, à vous tout seul, plus que tous vos collègues ?
TRIBADEL. – Je n’en sais rien, monsieur le Président. Je suis très doux dans mon service. Je ne fais des observations qu’à la dernière extrémité, mais je suis empoigné par tout le monde. Au régiment, c’était le même coup. Je n’ai pas eu en tout quinze jours de consigne. Mais ce que j’ai été agrafé, c’est effrayant ! Quand je suis sorti du service, je suis entré en tant que commis dans une administration. Mais je n’ai pas pu y rester. Du matin au soir, je n’arrêtais pas d’être engueulé ! Si bien que je me suis dit : « Je vais tâcher d’entrer à la Préfecture comme gardien de la paix. » J’avais d’excellents certificats, j’ai été nommé d’emblée. Ah ! monsieur le Président, jamais je n’en ai autant reçu, que depuis que j’ai sur les épaules l’uniforme de l’autorité.
LE PRÉSIDENT. – Qu’est-ce qui vous est arrivé encore, le 7 avril dernier ?
TRIBADEL. – C’était vers les six heures de l’après-midi, et j’étais au coin de la place Pigalle, de service, quand voilà qu’un taxi-auto s’arrête sans avoir fait demi-tour devant la brasserie Pigalle. Je lui fais des observations. Un monsieur qui était dans la voiture se met à m’empoigner, comme si j’avais ennuyé ce taxi-auto pour le plaisir. Comme ce monsieur ne se servait pas de termes offensants, je ne dis rien ; mais voilà des gens assis à la terrasse du café qui m’attrapent. Instinctivement, je me suis alors tourné vers un monsieur à barbe blanche, qui avait l’air très comme il faut et qui faisait des hochements de tête, comme pour me donner raison. Alors, ce monsieur m’a dit textuellement : « Espèce de barbeau, vous êtes là à gueuler comme un âne, et quand vous trouvez une petite femme seule dans un coin de rue, vous êtes le premier à vous l’envoyer ! »
LE PRÉSIDENT. – Un monsieur à barbe blanche ?
TRIBADEL. – Oh ! Monsieur le Président, à Montmartre la barbe blanche ne signifie rien.
LE JUGE, à demi-voix, au président. – Que veut dire : « espèce de barbeau » ?
LE PRÉSIDENT, de même. – Poisson.
LE JUGE, d’un air entendu. – Ah oui ! Mais je croyais…
LE PRÉSIDENT. – Barbeau est plus élégant… (À Tribadel.) Continuez.
TRIBADEL. – Pendant ce temps, un autre criait : « Oui, c’est un barbeau ! C’est un barbeau ! Sa femme couche avec les sous-brigadiers pour lui faire avoir de l’avancement ! » Ce qui est tout à fait calomnieux, monsieur le Président, vis-à-vis de ma femme. Cet individu qui criait ne la connaissait pas. Elle est très occupée comme concierge et a assez à faire de son ouvrage pour avoir le temps de voir une autre personne que moi.
LE PRÉSIDENT. – Nous en sommes persuadés. On vous injuriait donc de différents côtés.
TRIBADEL. – Calomnieusement.
LE PRÉSIDENT. – Calomnieusement, c’est entendu. Mais que disait l’inculpée ?
TRIBADEL. – Elle ne faisait que crier : « Dos ! Dos ! C’est un dos ! »
LE JUGE, au président. – Dos ?
LE PRÉSIDENT. – C’est à peu près la même acception que « barbeau ». (À la prévenue.) Vous entendez ? On vous accuse d’avoir traité l’agent de « dos ».
DÉA. – Je disais : « Dos ! Dos ! », c’est possible, mais est-ce que je m’adressais à l’agent ? Si on ne peut plus prononcer le mot « dos » dans la rue Pigalle sans qu’il le prenne pour lui !…
LE PRÉSIDENT, à Tribadel. – Allez, continuez !
TRIBADEL. – Je fus entouré, alors, de gens qui me traitèrent (il lit des notes sur sa manchette, en tournant le poignet peu à peu, à la dérobée) de « fourneau », de « vache », de « dos », de « barbeau », de « malvenu », de « légume », de « malade » ! (Il va pour lire une autre injure, mais il s’arrête.) Ils m’adressèrent encore bien des expressions que je ne peux répéter ici. Tout ce que je puis dire, c’est qu’ils me prêtaient des mœurs contre nature. Je n’ai pu mettre la main sur tout le monde, je n’ai pu emmener au poste que mademoiselle que voilà.
LE PRÉSIDENT. – C’est tout ce que vous avez à dire ?
TRIBADEL. – Oui, monsieur le Président.
LE PRÉSIDENT, sévèrement. – Sans vouloir diminuer en aucune façon la responsabilité de la prévenue, il est déplorable de voir un agent de la force publique, un représentant de l’autorité, servir constamment de cible à des facéties qui discréditent, ou tout au moins qui risquent de discréditer en lui l’autorité elle-même ! C’est inouï que cela vous arrive à vous tout le temps, et que ça n’arrive pas aux autres agents ! Vous faites le plus grand tort à votre corporation !
TRIBADEL. – Mais, monsieur le Président…
LE PRÉSIDENT. – Taisez-vous, et allez vous asseoir !…
TRIBADEL. – Puis-je m’en aller tout à fait, monsieur le Président ?
LE PRÉSIDENT. – Nous allons peut-être avoir encore besoin de vous. Vous êtes bien pressé d’aller vous faire injurier dans votre quartier ! (Avec énergie.) Allez vous asseoir !
LE SUBSTITUT. – Le fait est que c’est absolument scandaleux de nous apporter ici, presque à chaque audience, une potée des injures que vous avez reçues, et qui finissent par éclabousser l’autorité, comme disait si bien monsieur le Président !
TRIBADEL. – Mais, monsieur le Substitut…
LE SUBSTITUT. – Allez vous asseoir !
L’HUISSIER, le poussant. – Allez ! Allez ! Bougre de maladroit, voilà qu’il m’écrase le pied avec sa botte !
TRIBADEL. – Mais, monsieur l’Huissier…
L’HUISSIER. – Allez vous asseoir, empoté !
LE PRÉSIDENT. – Il y a un témoin, cité par la défense ?
L’HUISSIER. – Oui, monsieur le Président. Le témoin Messadie.
LE PRÉSIDENT. – Faites-le venir.
MADEMOISELLE KERMAGNON, très agitée, à la prévenue. – Vous avez le temps, maintenant. Dites-moi ce que vous aviez commencé tout à l’heure au sujet du substitut.
DÉA. – Voilà, je suis sûre qu’il est pour moi. Après ce que j’ai fait pour lui, il ne peut pas me condamner.
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Ce que vous avez fait pour lui ?
DÉA. – Oh ! mais voici le témoin, mademoiselle l’Avocate.
Entre Messadie, pendant que Mlle Kermagnon donne des signes d’agitation.
LE PRÉSIDENT. – Faites approcher le témoin. Votre nom, votre âge, votre profession ?
MESSADIE. – Jean-Bertrand Messadie, cinquante-neuf ans.
LE PRÉSIDENT, étonné. – Cinquante-neuf ans ?
MESSADIE. – Oui, monsieur le Président.
LE PRÉSIDENT, condescendant. – Bien, bien. Votre profession ?
MESSADIE, d’un ton léger. – Moineau franc !
LE JUGE, à demi-voix, au président. – Moineau franc ?
LE PRÉSIDENT, étonné. – Je ne sais pas ce qu’il veut dire. (Au témoin.) Moineau franc ?
MESSADIE. – Poète-chansonnier. Je suis né à Châtellerault, mais de cœur et d’âme je suis un enfant de la Butte.
LE PRÉSIDENT, le nez plongé dans ses papiers. – Dites ce que vous savez.
MESSADIE :
Je suis un enfant de la Butte,
Un gai moineau de Clignancourt,
Si l’on me blâme, je dis : « Flûte ! »
Et bien vite, je tourne court.
À ce moment, le juge fait signe au président d’écouter Messadie. Le président l’écoute avec stupéfaction.
Qu’importe que mon escarcelle
Ne regorge pas de doublons,
Si je rencontre une donzelle,
Une donzelle aux cheveux blonds.
LE PRÉSIDENT. – Mais ce sont des vers !
MESSADIE. – Je vous crois !
LE PRÉSIDENT. – Qu’est-ce que c’est que cette plaisanterie ?
MESSADIE. – Ce n’est pas une plaisanterie, c’est tout au plus une fantaisie, une fantaisie ailée. La poésie est mon langage naturel.
LE PRÉSIDENT. – Dites ce que vous savez.
MESSADIE :
Le jour même de cette affaire…
En rêvant à quelque Ninon,
Je gagnais la célèbre artère
Qui porte, ô Pigalle ! ton nom,
Quand non loin de la Blanche place,
(En souriant.) « Place Blanche. »
Quand non loin de la Blanche place,
Je vis, non sans étonnement,
Je vis que des badauds en masse
Formaient un vaste attroupement.
LE PRÉSIDENT. – Nous ne sommes pas ici pour entendre vos élucubrations. Voulez-vous vous exprimer en prose ?
MESSADIE, plaintif. – Je ne peux pas ! Je ne peux pas !
LE PRÉSIDENT, avec une sévérité croissante. – Voulez-vous vous exprimer en prose ? Vous avez entendu l’agent 704 faire des observations à un chauffeur d’auto-taxi ?
MESSADIE. – Monsieur le Président, j’étais là.
LE PRÉSIDENT. – Et vous avez entendu madame traiter l’agent de « dos » ?
MESSADIE. – Frasque de jeunesse !
LE PRÉSIDENT. – Enfin, l’avez-vous entendue ou non ?
MESSADIE. – Oui, je l’ai entendue, mais qu’importe ?
LE PRÉSIDENT, à Déa. – Vous voyez, vous entendez le témoin ?
DÉA. – Comment, vous prétendez que vous m’avez entendue traiter l’agent de « dos » ?
MESSADIE. – Qu’est-ce que ça peut faire ?
DÉA. – Enfin, c’est trop fort ! C’est vous qui me demandez de vous citer comme témoin, et vous vous mettez à parler contre moi !
MESSADIE. – Mais, à Montmartre, on a toujours fait un pied de nez à l’autorité, ça ne tire pas à conséquence.
LE PRÉSIDENT. – Allez vous asseoir.
MESSADIE :
J’allais rêvant…
LE PRÉSIDENT, furieux. – Allez vous asseoir !
MESSADIE, salue, s’en va du côté du public et dit, en s’adressant au public et aux avocats :
J’allais rêvant à ma gentille,
Ainsi qu’un enfant sans souci,
Quand j’entends un sergent de ville
Houspiller un auto-taxi !
LE PRÉSIDENT. – Voulez-vous aller vous asseoir !
MADEMOISELLE KERMAGNON, à Déa. – Cette fois-ci, vous allez me dire…
LE PRÉSIDENT. – La parole est au ministère public.
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Monsieur le Président, je vous demanderai de lever la séance… trois minutes seulement… je ne me sens pas très bien.
LE PRÉSIDENT. – Nous sommes à vos ordres, Mademoiselle. L’audience est suspendue pendant cinq minutes.
Pendant que le tribunal se lève, Mlle Kermagnon, à Déa.
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Cette fois-ci, vous allez me dire tout ! Qu’est-ce qui s’est passé avec le substitut ?
DÉA. – Eh bien, Mademoiselle, on m’avait dit qu’avec le substitut il fallait se faire recommander pour qu’il soye gentil avec moi, et qu’il ne me condamne pas… Alors, dame, il s’est trouvé un ami qui le connaissait. Cet ami m’a mise en rapport avec lui… Je ne peux pas vous dire exactement ce qui s’est passé, mais enfin, tout de même, quand on a passé une nuit avec un monsieur, ce serait un peu mufle de sa part s’il vous condamnait…
MADEMOISELLE KERMAGNON, se maîtrisant. – Bien ! Bien !… Alors, vous n’avez pas eu honte ?
DÉA. – De quoi ?
MADEMOISELLE KERMAGNON, frémissante. – Vous n’avez pas eu honte !
DÉA. – Ce qui me ferait honte, ce serait d’être condamnée par le tribunal.
MADEMOISELLE KERMAGNON, se maîtrisant encore. – Bien ! Bien ! (À elle-même.) Quelle ignoble créature ! (À Mlle Norel qui entre.) Oh ! ma petite ! Oh ! ma petite ! Si tu savais comme je suis malheureuse !
MADEMOISELLE NOREL. – Qu’est-ce qu’il y a ?
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Gaston m’a trompée ! Il m’a trompée avec cette femme !
MADEMOISELLE NOREL. – Qui est cette femme ?
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Ma cliente… Et je vais être obligée de la défendre !
MADEMOISELLE NOREL. – Comment ? Veux-tu que je la défende à ta place ?
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Oh ! non, non ! Par exemple ! Ah ! Je vais m’en charger, moi, tu vas voir comment !
DÉA, qui s’est approchée de Boussu, à demi-voix. – Quand est-ce qu’on va le voir, le substitut ?
BOUSSU, de même. – Tu le verras, ne t’inquiète pas.
DÉA. – Il est caché dans un mur, que tu m’as dit ?
BOUSSU. – Oui, oui.
DÉA. – À quel endroit ?
BOUSSU. – Ah ! ça, je ne sais pas… Je ne sais pas au juste.
L’HUISSIER. – Le tribunal.
Entre le tribunal, suivi du substitut.
LE PRÉSIDENT. – L’audience est ouverte. La parole est au ministère public.
LE SUBSTITUT. – Messieurs les juges, l’affaire qui amène devant vous Mlle Déa… Niclès…
MADEMOISELLE KERMAGNON, à Mlle Norel – Il fait semblant de ne pas se rappeler le nom…
LE SUBSTITUT. – Cette affaire, il ne faut pas s’en exagérer la gravité…
MADEMOISELLE KERMAGNON, à Mlle Norel – Naturellement !… Tu vois, il l’épargne, il l’épargne !
LE SUBSTITUT. – Notre tâche à tous, magistrats, notre tâche la plus impérieuse, notre devoir le plus certain est de faire respecter l’autorité. Mais dans quelles circonstances, Messieurs, l’autorité cette fois-ci a-t-elle été, je ne dirai pas offensée, ni injuriée, ce sont à la vérité des mots trop forts… dans quelles circonstances l’autorité a-t-elle été blaguée, mettons blaguée ?… N’oublions pas que c’est une histoire de Montmartre, que c’est une plaisanterie de gens en gaieté, plaisanterie coupable, je m’empresse de le dire, mais pour laquelle évidemment vous ne devez pas avoir la même rigueur, la même sévérité que pour beaucoup d’incartades de ce genre. Il me semble que dans votre jugement vous devez tenir compte de la personnalité même de l’agent 704, que, depuis son enfance, ainsi qu’il l’a dit, une certaine fatalité semble avoir marqué au front, et qui paraît destiné à recevoir constamment des injures. De sorte que les personnes qui les lui adressent sont, à la vérité, moins des coupables que des instruments de la fatalité… La prévenue a traité l’agent… je ne veux pas répéter le terme, vous l’avez présent à l’esprit… La prévenue a traité l’agent, prétend-il, d’une injure assez courante à Montmartre, que malheureusement beaucoup de personnes là-bas doivent mériter… Cette injure, la prévenue prétend qu’elle ne l’adressait pas à l’agent lui-même. En effet…
MADEMOISELLE KERMAGNON, à Mlle Norel. – Tu vois, tu vois ! Comme il l’épargne !… Mais c’est lui qui plaide pour elle, ce n’est pas moi, c’est lui, l’avocat !…
LE PRÉSIDENT, qui entend murmurer Mlle Kermagnon. – Chut ! un peu de silence !
LE SUBSTITUT. – En effet, le système de défense de l’accusée n’est pas absurde a priori. Il est hors de doute que l’agent 704 ne mérite pas une minute l’injure absurde dont on l’a gratifié… Pourquoi a-t-il pensé qu’elle s’adressait à lui ? Pourquoi ? Est-ce parce qu’il pense que, lorsqu’une injure part, se trouve suspendue dans l’air, c’est à lui, à lui seul, qu’elle peut être destinée ?… Évidemment, la fatalité qui le poursuit semble l’autoriser à adopter cette thèse. Mais tout de même, nous pouvons, nous, un peu changer de point de vue, et penser que, dans le brouhaha qui s’est élevé ce jour-là à la terrasse de la brasserie Pigalle, il pouvait y avoir d’autres altercations, et que des injures ont été proférées entre différents groupes sans que l’agent 704 ait été fondé à en faire le trust, à les accaparer toutes à son profit… J’ai voulu faire valoir, Messieurs, toutes les raisons qui plaident en faveur de votre indulgence… La voix publique, que je représente ici, évidemment, demande un châtiment ou une légère punition pour la demoiselle Niclès… Jamais cette voix ne sera teintée de plus d’indulgence. Et vous serez de mon avis, Messieurs les juges, en estimant que cette indulgence, non pas en raison même de la personne de la prévenue, mais en raison de la fatalité des faits, que cette indulgence n’est pas déplacée…
Il s’assoit.
MADEMOISELLE KERMAGNON, à Mlle Norel. – Tu vois, tu vois ! Il a plaidé absolument pour elle !…
MADEMOISELLE NOREL. – Mais veux-tu que je prenne la parole à ta place ?… Tu n’es pas en état de plaider.
MADEMOISELLE KERMAGNON, avec énergie. – Tu vas voir !
LE PRÉSIDENT. – La parole est à l’avocat de la prévenue.
MADEMOISELLE KERMAGNON, nerveusement, se tourne du côté du substitut qu’elle ne cesse de regarder pendant toute sa plaidoirie. – Messieurs les juges, ma tâche, en réalité, semble assez facile, puisque le ministère public, avec une indulgence à laquelle il ne nous a pas jusqu’à présent habitués, a presque pris la parole en faveur de l’accusée et prononcé à peu près tous les arguments qui semblaient réservés à la défense… Ce n’est pas à un membre du barreau de s’élever contre cette indulgence, puisque, je le sais bien, notre devoir nous oblige à présenter la défense de tous les prévenus, quelles que soient leur condition sociale et la classe de la société à laquelle ils appartiennent. Mais vous pourrez vous demander, Messieurs les juges, si, ayant une fois dans sa vie à faire entendre la voix de l’indulgence, le ministère public n’a pas fait un choix un peu étrange – je ne dis pas suspect, je me contente de dire étrange – en faisant bénéficier de cette indulgence une créature… une personne que rien, semble-t-il… à part peut-être ses charmes extérieurs… que rien, semble-t-il, ne paraissait destiner à mériter cette rare faveur… Mlle Déa Niclès, que je suis appelée à défendre devant vous, est assurément une personne intéressante et fort jolie… Certainement, elle est fort jolie… Depuis qu’il y a des juges, depuis l’aventure de Phryné, il est constant et il est presque admis que l’agrément du visage et des formes ait une influence sur le jugement des magistrats !… (Le président, les juges et le substitut regardent l’avocate avec stupéfaction.) Que Mlle Déa Niclès se serve de ces arguments éternels, ce n’est pas à moi à le regretter, mais elle n’a pas besoin d’avoir recours à mon office pour faire valoir des charmes qui, par eux-mêmes, sont assez puissants, dis-je, puisqu’ils arrivent à fausser complètement la conscience des hommes qui pourtant sont chargés de veiller au respect de l’autorité. (Avec des larmes dans la voix.) Des êtres assez indignes, assez oublieux de leurs devoirs pour sacrifier aux pieds de ces créatures tous les principes… tous les principes… Monsieur le Président, je vous demande pardon, je ne me sens pas très bien…
LE PRÉSIDENT. – Voulez-vous que je suspende la séance ?
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Non ! Non !… Une minute seulement pour reprendre mes forces…
On s’empresse autour d’elle.
UN AVOCAT, à un autre avocat. – Qu’est-ce qu’elle a ? Qu’est-ce que ça signifie ?
MADEMOISELLE KERMAGNON, au bout d’un instant, à Mlle Norel. – Ça va mieux.
DÉA, s’approchant. – Ça va mieux, Mademoiselle ?
MADEMOISELLE KERMAGNON, hostile. – Oui, oui, ça va mieux.
DÉA. – Eh bien, puisque ça va mieux, laissez-moi vous poser une question pendant que vous êtes arrêtée ? Mon ami ne peut pas me le dire. Savez-vous dans quel coin est caché le substitut ?
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Le substitut ?
DÉA. – Oui. Où est-ce donc qu’il est ?
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Vous vous moquez de moi ?
DÉA. – Mais non ! mais non !
MADEMOISELLE KERMAGNON, avec une lueur d’espoir. – C’est ce monsieur, en face.
DÉA. – Jamais de la vie !
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Comment, jamais de la vie ?
DÉA. – Je le connais mieux que vous ! C’est un petit gros avec une moustache retroussée. Il m’a donné rendez-vous à l’hôtel. Il paraît qu’il est caché dans le mur et qu’il en sort à la fin, pour le jugement !
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Monsieur le Président, je suis remise ; je demande à ce qu’on reprenne l’audience immédiatement.
LE PRÉSIDENT. – On peut encore attendre.
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Non, non, je ne veux pas attendre pour vous crier l’innocence complète, éclatante, de cette pauvre petite créature que vous avez devant vous !… Je vous ai montré tout à l’heure, en accusant ses pareilles, à quel point j’étais en garde moi-même contre les personnes de son métier, mais c’est une femme à part… il ne faut pas la confondre avec ces êtres de fange, ces êtres que la vie a maltraités, que la vie a jetés dans la galanterie, alors qu’elle était douée de tous les bons instincts, de la plus grande honnêteté… Il serait assez triste que, sur la dénonciation d’un agent de la force publique… que je ne veux pas qualifier encore, car il a déjà été suffisamment qualifié à cette audience… il serait déplorable qu’une condamnation vînt ternir la vie – je ne dis pas exempte de reproches – mais exempte des taches graves qu’y peut inscrire l’autorité judiciaire. Il faudrait tracer l’existence entière de cette pauvre fille abandonnée par ses parents dès l’âge le plus tendre, jetée pour ainsi dire au ruisseau !… Et c’est parce que la société l’a laissée tomber aussi bas qu’elle voudrait se montrer si pleine de rigueur envers elle ? Non ! Non ! C’est par un jugement d’acquittement, c’est par un jugement de réhabilitation que vous accueillerez cette pauvre femme… Je sais bien que la peine qu’elle peut encourir n’est pas grave, mais il n’y a pas de flétrissure relative ; le léger châtiment qu’elle encourt, vous ne devez pas même le prononcer, car il y a là un bel acte de justice, d’équité, à accomplir envers cet être-là, charmant, doué de toutes les grâces et qui ne s’en est jamais servi pour un but condamnable ! Elle n’a voulu devoir son acquittement, que vous allez prononcer, elle n’a voulu le devoir qu’à votre esprit impartial de justice et d’humanité…
Mlle Kermagnon s’assoit.
UN AVOCAT, à un autre avocat. – Elle a vraiment des qualités, cette petite femme-là !…
UN AUTRE AVOCAT. – C’est vrai ! Je ne l’avais jamais vue si emballée !
LE PRÉSIDENT. – Le tribunal délibère… (Il se penche vers les deux juges.) Écoutez, elle tient beaucoup à son acquittement et, surtout, je voudrais donner une leçon au 704. Au moins, il nous laissera tranquilles pendant quelque temps !… « Le tribunal, étant donné que les faits de la prévention ne sont pas suffisamment prouvés, acquitte la prévenue, ordonne sa mise en liberté immédiate… » L’audience est suspendue…
Applaudissements dans l’auditoire. « Bravo ! ».
UN AVOCAT, s’approchant de Mlle Kermagnon. – Vous savez, Mademoiselle, c’est une affaire qui n’a l’air de rien, mais c’est inouï d’avoir obtenu l’acquittement pour ça !… Le tribunal condamne toujours en ces matières… C’est un succès magnifique et qui aura son retentissement dans tous le palais ! (Se tournant vers un autre.) Ce qu’elle a été épatante !… D’abord cette façon d’avoir l’air de charger sa cliente, puis cette espèce d’évanouissement, chiqué merveilleusement !… et cette péroraison véhémente !… Elle ira loin, cette petite bonne femme !… C’est un Lachaud ! dites donc, c’est une Lachaud !
LE SUBSTITUT, s’approchant. – Permettez-moi de vous féliciter, Mademoiselle.
Il lui serre la main.
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Merci ! Merci ! Est-ce que vous continuez à siéger aujourd’hui, monsieur le Substitut ?
LE SUBSTITUT. – Je vais me faire remplacer pour les affaires suivantes.
MADEMOISELLE KERMAGNON. – C’est ça, c’est ça… J’irai vous demander une consultation juridique tout à l’heure.
MESSADIE, s’approchant de Mlle Kermagnon. – Je n’ai pas pu dire ce que je voulais dire de plus intéressant. Il m’a arrêté.
Un sbire immonde et sans aveu…
MADEMOISELLE KERMAGNON. – Excusez-moi, monsieur Messadie je n’ai pas le temps.
MESSADIE, s’approchant de Boussu :
Un sbire immonde et sans aveu…
BOUSSU. – Non, non, écoutez, vous me direz ça une autre fois. Il faut que j’accompagne Déa.
DÉA. – Dis donc, Boussu, et le substitut ?
BOUSSU. – Tu ne l’as pas vu ? Tout le monde l’a vu !… Il est apparu dans le fond de la salle, mais ça n’a pas été long !
DÉA. – Eh bien, vrai ! moi qui regardais de tous mes yeux…
BOUSSU. – Tu étais trop émue.
MESSADIE, s’approchant de Thévenel :
Un sbire immonde et sans aveu…
THÉVENEL. – Non, non ! c’est entendu, à un de ces jours, à un de ces jours !
MESSADIE, se trouve nez à nez avec l’agent Tribadel :
Un sbire immonde et sans aveu…
TRIBADEL, résigné. – Allons ! c’est encore pour moi !… Allez-y !
MOTS CROISÉS
MOTS CROISÉS
Quelques définitions
I. – Moins cher quand il est droit.
II. – Signe rarement ses rapports.
III. – Sur un outsider.
IV. – Mode de traitement peu goûté des médecins.
V. – Muet de naissance.
VI. – On le consulte, car il est capable de réflexion.
VII. – Se goudronne ou se cultive.
VIII. – Ceux que fit Mathusalem auraient intéressé les amateurs d’antiquité.
IX. – À plusieurs corps.
X. – L’amour qu’il inspire indique un profond désintéressement.
XI. – Sur un rivage, sur un mur, sur un arbre.
XII. – Prouesse… ou délit.
XIII. – Quel que soit le sens qu’on lui donne, elle réchauffe bien des gens.
XIV. – Unit des idées et des localités.
XV. – Évitait d’emprunter l’escalier.
XVI. – Cordon, S.V.P.
XVII. – Se prend dans sa cage.
XVIII. – Mine avantageuse.
XIX. – Modifie le sol.
XX. – Ne reste pas longtemps ingrat.
XXI. – Lève son drapeau en signe de liberté.
XXII. – Valut à son héros d’être envié par un poète angevin.
XXIII. – Parsemé de constructions espagnoles.
XXIV. – Son supérieur est son ennemi.
XXV. – Suit le cours des rivières.
XXVI. – Arrive assez souvent au dernier acte.
Solutions
I. – Piano.
II. – On.
III. – Écaille (de tortue).
IV. – Mépris.
V. – Cinéma.
VI. – Miroir.
VII. – Rue.
VIII. – Os.
IX. – Armée.
X. – Art.
XI. – Baie.
XII. – Vol.
XIII. – Bourrée.
XIV. – Car.
XV. – Roméo.
XVI. – Sésame.
XVII. – Escalier.
XVIII. – Or.
XIX. – Dièse.
XX. – Âge.
XXI – Taxi.
XXII. – Odyssée (« Heureux qui comme Ulysse… » Du Bellay).
XXIII. – Avenir (châteaux en Espagne).
XXIV. – Bien (le mieux est l’ennemi du bien).
XXV. – Diamantaire.
XXVI. – Notaire.
« MOTS »
Un jeune auteur qui vient d’achever une pièce lui demande conseil pour le titre. Tristan, très pressé :
« Est-ce qu’il y a des tambours dans votre pièce ?
— Non !
— Et des trompettes ?
— Non !!
— Alors, appelez-la Sans tambour ni trompette. »
***
Tristan, déambulant sur la Croisette de Cannes, arbore une magnifique casquette neuve, genre képi d’officier de marine. Il rencontre un ami :
« Eh bien, Tristan, vous en avez une belle casquette !
— N’est-ce pas ? Je me la suis offerte avec mes gains au baccara… Avec mes pertes, j’aurais pu me payer le bateau. »
***
Il est à table, en famille. On sonne à la porte d’entrée : un visiteur qui ne veut pas dire son nom. Tristan se lève et va recevoir l’importun. L’entretien dure très longtemps. Lorsque enfin il revient, tous les plats sont froids.
« C’était donc si important ?
— Très important. Une affaire urgente.
— Quel genre d’affaire ?
— Une affaire d’emprunt.
— D’emprunt ?
— Il m’a emprunté cent sous. »
***
Au dessert, sa femme aborde des questions qui semblent la préoccuper. Rien de grave, d’ailleurs, et Tristan commence à blaguer. Il n’en faut pas plus…
« C’est insupportable ! Il faut que tu blagues avec tout !
— Bien sûr ! C’est ça qui nous fait vivre ! »
***
Deux grands chirurgiens venaient d’aller sur le terrain. « Incident personnel, disait-on, ils veulent absolument s’entre-tuer. »
« Ces médecins ! fit Tristan. Voilà que nous ne leur suffisons plus ! »
***
Un ami fait de la morale à son petit garçon :
« On ne perd jamais rien à être poli, mon enfant.
— Si, murmure Tristan, on perd sa place dans le métro. »
***
D’une dame au très long nez, il disait :
« Quand on veut l’embrasser sur les deux joues, il est plus court de passer par-derrière. »
***
À sa femme de chambre :
« Demain matin, j’ai un rendez-vous important. Réveillez-moi à sept heures. Mais si à huit heures je ne suis pas levé, ne me réveillez pas avant midi. »
***
Sur une actrice dont la voix était si mince et l’articulation si déplorable qu’on la comprenait à peine :
« À cette femme-là, je confierais bien un secret. »
***
Dans les coulisses d’un théâtre, pendant un entracte, il est bousculé par une longue horloge que porte sur l’épaule un machiniste. Tristan chancelle en s’écriant :
« Dites donc, vous ne pourriez pas, comme tout le monde, porter un bracelet-montre ! »
***
Un ami, à Deauville :
« Je vous recommande ce fauteuil dans le coin du hall. Il n’y a pas d’endroit où l’on soit mieux pour dormir. »
Tristan :
« On voit que vous ne connaissez pas mon cabinet de travail ! »
***
Un dandy :
« Mon tailleur me fait des prix à condition que je dise que mon costume vient de chez lui. »
Tristan :
« Le mien aussi me fait des prix, mais à condition que je ne dise pas que mon vêtement vient de chez lui. »
***
À une répétition générale, à l’entracte on le voit s’éloigner, son pardessus sur le bras.
« Cher ami, la pièce n’est pas finie, lui dit une dame.
— Je sais, je sais. C’est pour cela que je m’en vais. »
***
Le secret du théâtre, c’est de surprendre le public avec ce qu’il attend.
***
Être bête offre cet avantage, et aussi ce danger, que soi-même on ne s’en aperçoit pas.
***
Un paresseux est un homme qui ne fait pas semblant de travailler.
***
Je crois que la paresse est utile à cause de l’effort qu’elle demande pour la surmonter.
***
Il ne faut compter que sur soi-même… et encore, pas beaucoup.
***
D’un de ses personnages :
« Il ne savait pas ce qu’il voulait, mais il le voulait énergiquement. »
***
Ce que nous aimons dans nos amis, c’est le cas qu’ils font de nous.
(Deux amateurs de femmes.)
***
Il croyait toujours à l’honnêteté des femmes. C’est-à-dire qu’il lui semblait difficile qu’une femme pût oublier ses devoirs avec un autre qu’avec lui.
(Mémoires d’un jeune homme rangé.)
***
En amour, on n’aime à être vengé que par soi-même.
(L’Affaire Larcier.)
***
Pour être heureux avec les êtres, il ne faut leur demander que ce qu’ils peuvent donner.
(L’enfant prodigue du Vésinet.)
***
S’étant présenté à l’Académie française, il n’avait eu que quatre voix. Il s’en consola d’autant plus aisément qu’il avait eu celles de Bergson, de Paul Valéry et d’Édouard Estaunié.
« Pour la quatrième voix, ajoutait-il, il y a une dizaine de postulants. »
***
Il écrivait un jour :
J’ai regardé avec bonne volonté, avec naïveté, tout ce qui ne ressemblait pas à mon opinion. Je me suis servi pour regarder
Des seuls yeux qui savent tout voir,
Les yeux clairs de la bienveillance…
***
Tristan eut toujours la nostalgie de la poésie.
Où donc est-il ce temps charmant
Où le mot m’arrivait si vite ?
Le mot venait d’abord et la pensée ensuite…
J’étais un poète vraiment.
***
Version de la fable des « Deux Pigeons » :
Deux pigeons s’aimaient d’amour tendre.
Moralité :
L’un d’eux s’ennuyait au logis.
***
Version de la fable de l’« Enfant prodigue ». :
On tuait le veau gras, et l’on faisait la noce.
Et la vache disait : « Ça va bien ! Ça va bien !
Ces gens qui retrouvent leur gosse
Commencent par tuer le mien. »
***
L’Amazone et le Centaure.
L’Amazone passait. Sur le bord de la route
Un Centaure y pensait, des plus visiblement…
Mais l’Amazone triste et qu’assiège un doute :
« Est-ce à moi qu’il en veut ou bien à ma jument ? »
***
Dédicace à une jolie femme :
Chacun de ses beaux yeux était un tel prodige,
Que le plus grand prodige était qu’ils fussent deux.
***
Sur José-Maria de Heredia :
Porte-lyre farouche aux doigts méticuleux.
***
Sur Paul Verlaine :
Paul Verlaine n’était pas sorti formé comme tant d’autres de la cuisse du père Hugo.
***
Il avait un culte pour Victor Hugo. Et pourtant, descendant l’escalier de la Comédie-Française après une représentation de Hernani, il s’arrêta devant le buste de Corneille.
« Va, fit-il, tu peux dormir tranquille. »
***
Tristan rappelait volontiers qu’il était né à Besançon, dans la Grande-Rue, comme Victor Hugo.
« Mais, ajoutait-il modestement, Hugo était né au 138 ; moi, je ne suis né qu’au 23. »
***
« Comme Victor Hugo, disait-il encore, j’ai une plaque sur ma maison natale. Mais moi, c’est une plaque de la Compagnie du Gaz ! »
***
Au cours de la Première Guerre mondiale. Extrait du « Poil civil » :
Un ami à nous, disait l’autre jour à un de nos hommes d’État :
« Méfiez-vous, monsieur le Ministre, un jour – il n’en est pas encore question – mais un jour verra surgir à l’horizon des menaces de paix. Or, nous ne serons pas prêts. »
***
EN ZONE LIBRE SOUS L’OCCUPATION
1943 !… Grand-père (mon papa) aurait cent cinq ans, grand-mère cent un ans, Louis XIV trois cent cinq ans ! Comme le temps passe ! (C’est une façon de parler, car ici il ne passe pas très vite !)
***
J’ai fait un an de volontariat à Évreux et à Saint-Omer et – cinquante-sept ans plus tard – près de deux ans d’involontariat sur la Côte d’Azur.
***
Ouvert aujourd’hui une brochure d’Iphigénie pour vérifier un vers. Recommencé pour la nième fois à lire la pièce. Mais j’ai remis le volume de côté après deux scènes. Le monde est plein de choses assez embêtantes sans encore prendre part aux embêtements d’Agamemnon. Pardon, Jean Racine !
***
Comme on lui demandait ce qu’il pensait de l’au-delà :
— Je ne sais pas. J’ai déjà beaucoup à faire avec l’en-deça. Pourtant si je vais au Paradis, j’y serai bien à cause du climat ; mais si je vais en Enfer, j’y retrouverai beaucoup plus de relations. »
***
Et un peu plus tard, ce quatrain :
Quitter ce monde-ci ? Mais pour quel avenir ?
Cette existence de l’au-delà, quelle est-elle ?
Je voudrais m’en aller… Mais serait-ce en finir ?
Mon emmerdeuse d’âme est peut-être immortelle.
***
Un matin de septembre.
Dans un hôtel de Cannes, il est arrêté par les Allemands avec Mme Tristan Bernard. Dans le camion qui les emporte, il murmure :
« Jusqu’à présent nous vivions dans l’angoisse ; maintenant, nous allons vivre dans l’espoir. »
***
Après sa libération :
« Comme vous devez les haïr ! » lui dit un ami.
Il répondit :
« Je ne hais que la haine. »
À propos de cette édition électronique
Texte libre de droits.
Corrections, édition, conversion informatique et publication par le groupe :
Ebooks libres et gratuits
https://groups.google.com/g/ebooksgratuits
Adresse du site web du groupe :
https://www.ebooksgratuits.com/
—
Juin 2025
—
– Élaboration de ce livre électronique :
Les membres de Ebooks libres et gratuits qui ont participé à l’élaboration de ce livre, sont : YvetteT, PatriceC, ChristineN, Coolmicro.
– Dispositions :
Les livres que nous mettons à votre disposition, sont des textes libres de droits, que vous pouvez utiliser librement, à une fin non commerciale et non professionnelle. Tout lien vers notre site est bienvenu…
– Qualité :
Les textes sont livrés tels quels sans garantie de leur intégrité parfaite par rapport à l'original. Nous rappelons que c'est un travail d'amateurs non rétribués et que nous essayons de promouvoir la culture littéraire avec de maigres moyens.
Votre aide est la bienvenue !
VOUS POUVEZ NOUS AIDER À FAIRE CONNAÎTRE CES CLASSIQUES LITTÉRAIRES.