
René Bazin
CHARLES DE FOUCAULD
EXPLORATEUR DU MAROC
ERMITE AU SAHARA
Paris Plon 1921
Table des matières
CHAPITRE II LES PRÉLIMINAIRES DU VOYAGE
1. – Le déguisement et les premiers pas.
2. – Histoire de Mardochée Abi Serour.
CHAPITRE VI NAZARETH ET JÉRUSALEM
CHAPITRE VII CHARLES DE FOUCAULD PRÊTRE LE CHEMIN DU DÉSERT
CHAPITRE IX LES TOURNÉES D’APPRIVOISEMENT
CHAPITRE X L’ÉTABLISSEMENT AU HOGGAR
CHAPITRE XI POÉSIES ET PROVERBES
I. – ŒUVRES DE CHARLES DE FOUCAULD »
II. – NOTICES BIOGRAPHIQUES ET NÉCROLOGIQUES.
III. – OUVRAGES ET ARTICLES RELATIFS AUX QUESTIONS ACTUELLES, AFRICAINES ET SAHARIENNES.
À propos de cette édition électronique

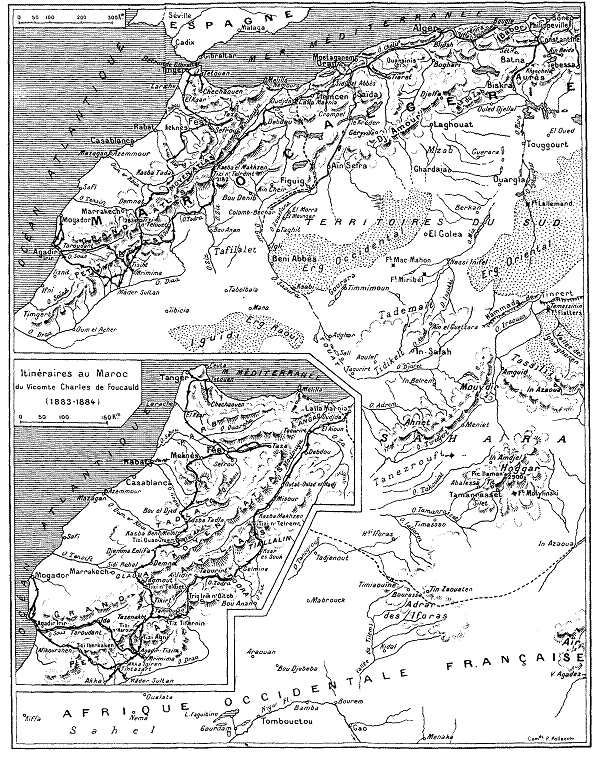
CHAPITRE PREMIER – JEUNESSE
Le 15 septembre 1858, naissait à Strasbourg Charles-Eugène de Foucauld, dont j’essaierai de raconter l’histoire.
L’enfant n’était pas d’origine alsacienne. Son père, François-Édouard, vicomte de Foucauld de Pontbriand, sous-inspecteur des forêts, appartenait à une famille du Périgord, d’ancienne chevalerie, qui donna des saints à l’Église et de bien bons serviteurs à la France, et dont il importe que je dise ici quelque chose, parce que le mérite des ancêtres, même inconnu, même oublié, continue de vivre dans notre sang et nous porte à l’imitation.
D’après le généalogiste Chabault, le nom de Foucauld est connu depuis 970, époque où Hugues de Foucauld, ayant donné une part de ses biens aux abbayes de Chancelade et de Saint-Pierre-d’Uzerches, se retirait du monde, et, afin de se mieux préparer à la mort, entrait au monastère. Un Bertrand de Foucauld, parti pour la croisade avec saint Louis, tombait à la bataille de Mansourah, en défendant son roi contre les musulmans. Un autre, Gabriel, était délégué par le roi François II, pour épouser par procuration la reine Marie Stuart. Jean, chambellan du dauphin, assistait au sacre de Reims, près de Jeanne d’Arc. Dans plusieurs lettres, Henri IV appelle Jean III de Foucauld « son bon et bien assuré amy » ; pour mieux lui dire encore son amitié, il le nomma gouverneur du comté de Périgord et vicomte de Limoges : « Je puis vous assurer monsieur de Lardimalie, lui écrit-il, que j’ai en estime vous et votre vertu, et que j’ai autant de contentement de vous que vous sauriez le désirer. » Bel autographe qui valait un gouvernement, et devait durer davantage.
D’autres Foucauld, en nombre, au cours du temps, s’étaient fait tuer à la tête de leur compagnie ou de leur régiment, en France, en Italie, en Espagne ou dans les Allemagnes, toujours au service de la France. Mais l’une de ses plus belles gloires est venue, à cette famille, d’Armand de Foucauld de Pontbriand[1], chanoine de Meaux[2], grand-vicaire de son cousin Jean-Marie du Lau, archevêque-prince d’Arles. C’était un homme d’une charité fort grande, qui distribuait aux pauvres la plus large part de son revenu, et « ne fréquentait que son église et les hôpitaux »[3]. Or, ces revenus étaient considérables, non qu’il les eût reçus d’héritage, lui fils d’un cadet et cinquième de onze enfants, mais il avait été pourvu, par le roi, deux ans avant la Révolution, de la commende de l’abbaye de Solignac, en Limousin.
En 1790, l’archevêque d’Arles adressa à son clergé la célèbre Exposition des principes de la Constitution civile du clergé, document où la tentative de schisme, décidée par les hommes de la Révolution, était dénoncée, et que signaient cent vingt-neuf évêques de France, défenseurs de la foi catholique, apostolique et romaine. Le chapitre d’Arles répondit par une adresse de la plus ferme doctrine, et au bas de laquelle on trouve, parmi celles des autres chanoines, la signature d’Armand de Foucauld. Devenus suspects par leur attachement à l’Église, les prêtres réfractaires furent bientôt condamnés à la déportation par le décret du 26 mai 1792. Armand de Foucauld partit alors d’Arles pour rejoindre à Paris Mgr du Lau, qui avait dit : « On veut faire entrer le schisme et l’hérésie dans l’intérieur de l’Église ; il ne reste plus qu’à mourir. » C’était se dévouer lui-même à la mort. Le 11 août, il fut arrêté avec son évêqu, et conduit dans l’église confisquée des Carmes, où se trouvaient déjà enfermés de nombreux prêtres. Beaucoup de ces confesseurs de la foi allaient devenir martyrs. Ils le savaient. Ils s’y préparaient tous, tremblants et fermes, attendant de la grâce de Dieu le courage dont nul n’est assuré. Le 2 septembre, les prisonniers reçoivent l’ordre de se promener dans le jardin des Carmes ; même les malades et les infirmes doivent sortir. Ils comprennent qu’ils vont au supplice. M. de Foucauld et l’autre grand vicaire d’Arles, entourant leur archevêque, se dirigent vers un petit oratoire dédié à la Sainte Vierge, au fond du jardin. Ils s’agenouillent devant la porte. Les fenêtres du couvent sont garnies d’hommes coiffés du bonnet rouge, qui brandissent leurs armes et insultent les victimes enfermées. « Remercions Dieu, messieurs, dit le prélat, de ce qu’il nous appelle à sceller de notre sang la foi que nous professons. » Il fut assassiné le premier, à coups de sabres et de piques. Un moment après, M. de Foucauld tombait près du corps de son cousin. Il avait quarante et un ans. La première des noblesses s’ajoutait à l’ancienne.
Le petit Charles de Foucauld trouvait donc dans sa race, à la douzaine, de beaux exemples à suivre.
Il ne les suivit pas d’abord, comme on le verra, mais il y fut ramené ; et nul, depuis lors, parmi les soldats, les marins ou les prêtres de sa maison, ne saurait être cité qui ait surpassé ce Charles de Foucauld en dévouement, en austérité, en bravoure, en piété.
Sa petite enfance fut pieuse. Beaucoup sont de même, en France, où il y a tant de mères prédestinées. Mme de Foucauld avait deux enfants, Charles et Marie[4]. Elle n’eut guère que le temps de leur apprendre à joindre les mains et à dire leur prière ; elle vit à peine s’entr’ouvrir l’âme passionnée de son fils Charles, sur laquelle elle aurait pleuré, si la mort n’avait pas prématurément enlevé cette Monique à cet Augustin. Pour former ses enfants à la piété, mais tout autant pour obéir à un attrait divin et à une habitude, elle visitait les églises, tantôt celle-ci, tantôt celle-là, les aimant toutes, à cause de Celui qui les habite toutes. De même elle ornait avec eux, dans sa maison, la crèche au temps de Noël, une statue de la Vierge au mois de mai ; elle donnait à Charles un petit autel qu’on plaçait sur une commode, et devant lequel il s’agenouillait le matin et le soir, relique des premières années, présage encore obscur, dont il dira plus tard : « Je l’ai gardé tant que j’ai eu une chambre à moi, dans ma famille, et il a survécu à ma foi. » Quand ils se promenaient ensemble dans les bois en pente de Saverne, où l’on passait le temps des vacances, elle recommandait aux enfants de cueillir des gerbes de fleurs et de les placer au pied des croix, dans les carrefours. Tendresse d’un cœur français, plus éducatrice en actes qu’en paroles, et dont le souvenir ne s’efface pas.
Mme de Foucauld mourut le 13 mars 1864, à trente-quatre ans ; son mari, le 9 août de la même année. Les orphelins furent alors confiés à leur grand-père maternel, M. Charles-Gabriel de Morlet, colonel du génie en retraite, qui avait près de soixante-dix ans[5]. Les hommes n’ont pas souvent cette application passionnée aux devoirs de l’éducation première, ni ce don de divination qui instruisent vite les mères, et les portent à s’alarmer des défauts de l’enfant et à les corriger. Affectueux, ardent au jeu, travailleur, très doué pour le dessin, d’esprit vif, joli enfant et de physionomie décidée, Charles devait plaire au vieux soldat. On le gâtait. M. de Morlet ne pouvait résister aux larmes de ce petit Charles : « Quand il pleure, disait-il, il me rappelle ma fille. » Les colères mêmes de Charles rencontraient une indulgence secrète et passaient pour un signe de caractère. Il était violent. La plus innocente moquerie le mettait en fureur. Un jour qu’il avait, dans un tas de sable, taillé et modelé un fort, toute une architecture de fossés et de tours, de ponts et de chemins d’accès, quelqu’un de ses proches, pensant lui être agréable, s’avisa de mettre, sur le sommet, des bougies allumées et, dans les fossés, des pommes de terre en guise de boulets. Charles, supposant qu’on se moquait de lui, entra en grande colère, piétina son œuvre jusqu’à ce qu’il n’en demeurât plus trace, puis, la nuit venue, pour se venger, jeta, dans tous les lits de la maison, les pommes de terre bien roulées dans le sable.
Nous savons, par ses lettres, qu’il fit avec ferveur sa première communion. On l’avait mis à l’école épiscopale de Saint-Arbogast, dirigée par les prêtres du diocèse de Strasbourg, puis au lycée[6]. La guerre survint, et chassa d’Alsace le grand-père et les deux enfants, qui se réfugièrent à Berne.
En 1872, M. de Morlet, ne pouvant rentrer à Strasbourg, vint habiter Nancy. C’est au lycée de cette ville que Charles commença de perdre l’habitude du travail régulier, ordonné, et perdit bientôt la foi.
Quand on parcourt toute la correspondance de Charles de Foucauld, on comprend l’amertume du souvenir qu’il a gardé de ses années d’études à Nancy. Ces années-là sont le commencement de la vie coupable, la période sur laquelle, jusqu’à la fin, sa pénitence passera et repassera pour en effacer les fautes de l’esprit et de la chair. Je dois à la vérité de citer ici quelques-unes des confessions de l’homme revenu à Dieu et jugeant le passé.
Il écrira à un ami : « Si je travaillais un peu à Nancy, c’est qu’on me laissait mêler à mes études une foule de lectures qui m’ont donné le goût de l’étude, mais m’ont fait le mal que vous savez. »
Il lui écrira encore que c’est pendant sa rhétorique qu’il a perdu toute foi, « et ce n’était pas le seul mal ».
L’année de philosophie fut pire : « Si vous saviez combien toutes les objections qui m’ont tourmenté, qui écartent les jeunes gens, sont lumineusement et simplement résolues dans une bonne philosophie chrétienne ! Il y a eu, pour moi, une vraie révolution quand j’ai vu cela… Mais on jette les enfants dans le monde sans leur donner les armes indispensables pour combattre les ennemis qu’ils trouvent en eux et hors d’eux, et qui les attendent en foule à l’entrée de la jeunesse. Les philosophes chrétiens ont résolu depuis si longtemps, si clairement, tant de questions que chaque jeune homme se pose fiévreusement, sans se douter que la réponse existe, lumineuse et limpide, à deux pas de lui. »
Plus tard encore, dans une lettre à son beau-frère, il demandera instamment que ses neveux soient élevés par des maîtres chrétiens. « Je n’ai eu aucun maître mauvais, – tous, au contraire, étaient très respectueux ; – même ceux-là font du mal, en ce qu’ils sont neutres, et que la jeunesse a besoin d’être instruite non par des neutres, mais par des âmes croyantes et saintes, et en outre par des hommes savants dans les choses religieuses, sachant rendre raison de leurs croyances et inspirant aux jeunes gens une ferme confiance dans la vérité de leur foi…
« Que mon expérience suffise à la famille, je vous en supplie[7] ! »
Ce collégien sortit du lycée bachelier, comme les autres, curieux de tout, décidé à jouir, et triste. M. de Morlet eût désiré que son petit-fils entrât à l’École polytechnique. Mais Charles avait opté pour la vie facile. Il déclara, avec cette franchise qui fut un des traits sans changement de sa vie morale, qu’il préférait entrer à l’École de Saint-Cyr, parce que le concours exigeait moins de travail. Et il partit pour Paris.
Lui-même, il s’est peint, de souvenir, tel qu’il était à l’époque où il suivait les cours préparatoires de l’école Sainte-Geneviève.
« À dix-sept ans, je commençais ma deuxième année de rue des Postes. Jamais je crois n’avoir été dans un si lamentable état d’esprit. J’ai, d’une certaine manière, fait plus de mal en d’autres temps, mais quelque bien avait poussé alors à côté du mal ; à dix-sept ans, j’étais tout égoïsme, tout vanité, tout impiété, tout désir du mal, j’étais comme affolé… Quant au degré de paresse, à la rue des Postes, il a été tel qu’on ne m’y a pas gardé, et je vous ai dit que j’avais regardé, malgré les formes mises pour ne pas affliger mon grand-père, mon départ comme un renvoi, renvoi dont la paresse n’était pas la seule cause… J’ai été si libre, si jeune ! Ce que je veux dire surtout, c’est que, pour moi et pour bien d’autres, l’âge de X… a été la plus mauvaise période… À dix-sept ans, j’ai tant fait souffrir mon pauvre grand-père, refusant le travail au point qu’au mois de février, je crois, je n’avais pas encore coupé la géométrie dans laquelle je devais étudier chaque jour depuis novembre ; lui écrivant à peu près tous les deux jours, et quelquefois des lettres de quarante pages, pour lui demander de me rappeler à Nancy, et tout le reste que vous pouvez deviner, et qui résulte d’un tel affolement…[8]. »
« De foi, il n’en restait pas trace dans mon âme[9]. »
Ailleurs, il dira et répétera que, pendant treize années, il n’a pas cru en Dieu.
La confession est nette, si elle n’est pas développée. Elle appelle, me semble-t-il, une observation, et elle pose un problème.
Il n’est pas douteux que la foi à l’Église et à la morale chrétienne avait été rejetée. Avait-elle disparu ? C’est une autre question, et je crois plutôt qu’elle se tenait très loin, invisible, comme une terre qu’un navigateur a abandonnée, où il a la ferme intention de ne pas revenir, mais dont il sait qu’elle existe, dont il aime encore, sinon les jours qu’il y a passés, du moins plusieurs des habitants qui vivent là, et qui sont de cette patrie ancienne. Tant qu’on aime un chrétien, on aime encore un peu le Christ qui l’a formé. Seule, la haine totale est une indication d’athéisme. Chez ce jeune homme qui, lisant tout, avec la superbe imprudence de son âge, avait saturé son esprit d’objections contre une doctrine qu’il connaissait mal, deux sentiments d’où le passé pouvait renaître survivaient : le respect du prêtre et le plus tendre attachement à la famille. De plus, et ce n’est pas une faible raison d’espérer un retour à la foi, il avait le goût de la lecture, et, on peut dire, de la science. Le vrai nom de sa paresse était fantaisie, imprudence et curiosité sensuelle. Mais cet ardent esprit, capable de réflexion, ne regarderait pas la vie sans en comprendre les leçons, ne lirait pas ce qui lui plaisait sans prêter attention à ce qui le condamnait, sauf à rejeter la conclusion. Foucauld était un intellectuel livré aux sens, mais capable de les dominer, si quelque grand événement – au fond, la grâce de Dieu, – lui montrait son erreur.
Je viens de dire qu’il avait gardé beaucoup d’estime pour ses maîtres religieux. Ces maîtres, qui l’avaient averti, puis menacé de renvoi, qui l’avaient même, après un peu de temps, prié de quitter l’école de la rue des Postes[10], voici ce qu’il en disait : « Vous savez ce que je pense de l’internat : bon pour beaucoup, il m’a été détestable ; …la liberté au même âge eût peut-être été pire, et, en tout cas, je dois dire que j’ai retiré de cet internat une si profonde estime pour les jésuites que, même au temps où j’avais le moins de respect pour notre sainte religion, j’en conservais toujours une très profonde pour les religieux, et ce n’est pas un petit bien[11]. »
Quand l’heure du retour sera venue, Charles de Foucauld n’aura donc pas peur du prêtre : il ira à l’un d’eux avec confiance, se souvenant des bons prêtres qu’il a connus.
Les affections de son enfance le serviront encore plus puissamment. Ces êtres qui l’ont aimé, choyé, gâté même, il continuera de les chérir, et, à mesure qu’il comprendra mieux ce qu’ils ont fait pour lui, de les admirer. En eux, il verra, non pas seulement la mère, la sœur, le grand-père, les tantes, les cousins et les cousines, mais les membres unis d’une famille très chrétienne, très dévouée au frère, au fils, au neveu, au cousin Charles, et qui a usé envers lui d’une grande miséricorde silencieuse, qui ne l’a point abandonné, pour laquelle il a été l’enfant de la prière muette, vous vous souvenez, de celle qu’on fait sans plus dire aucune parole, mais du fond de l’âme, le soir, quand on est encore à genoux, tous ensemble, et qu’on va se relever.
J’ai dit aussi qu’une question se posait. Voici laquelle.
Ce fils d’une race hardie était doué d’une volonté forte. On l’a bien vu par la suite. Comment a-t-il pu s’abandonner ainsi à la paresse, et vivre ensuite dans la lâcheté, pendant des années ? On comprendrait des passions violentes, des orages, des aventures exceptionnelles, mais cette vie sans relief et d’une plate banalité ? Que faisait sa volonté pendant ce temps, et où se cachait-elle ? Ce qu’elle faisait ? elle veillait à ce que rien ne troublât la vie voluptueuse. Ce n’est pas une faculté qui demeure sans emploi. Elle est au service de cette haute pointe de l’esprit qui choisit l’habitation, les amitiés, les habitudes, l’emploi des heures. Et si l’esprit faussé, perverti, détaché de toute morale réprimante, aperçoit son bien dans le désordre de l’imagination et la satisfaction du corps, elle s’entend à merveille à murer les fenêtres et les lucarnes mêmes par où le ciel nous apparaîtrait ; à chasser, comme importuns, les souvenirs ; à défendre l’accès de ce sommet de nous-mêmes aux paroles et aux exemples qui enferment un reproche.
Charles de Foucauld subit les épreuves du concours de l’École militaire en 1876. Admis à la limite, il fut encore sur le point d’être refusé à l’examen médical, pour cause d’obésité précoce. Le colonel de Morlet s’attristait de ce que son petit-fils eût été reçu l’un des derniers. « Au contraire, répondit Charles, c’est très chic : j’aurai l’occasion ainsi de gagner beaucoup de rangs. » Il n’en gagna point, et sortit comme il était entré. Le général Laperrine a écrit, dans un récit qu’il intitulait les Étapes de la conversion d’un housard[12], ces lignes pleines de signification et de réserve à la fois : « Bien malin celui qui aurait deviné, dans ce jeune saint-cyrien gourmand et sceptique, l’ascète et l’apôtre d’aujourd’hui. Lettré et artiste, il employait les loisirs que lui laissaient les exercices militaires à flâner, le crayon à la main, ou à se plonger dans la lecture des auteurs latins et grecs. Quant à ses théories et à ses cours, il ne les regardait même pas, s’en remettant à sa bonne étoile pour ne pas être séché. »
Il disait vrai : les portraits du saint-cyrien en font foi. Les photographies de cette époque représentent, au-dessus d’un buste et d’un cou trop épais, un visage rond, empâté et sans style, qui n’a de beau que le front, droit et large, et la ligne à peine courbée des sourcils. Enfoncés dans l’orbite, les yeux, brillants et peu commodes, ont été rapetissés par la graisse qui les presse. Quant aux lèvres, peu formées, indolentes, elles sont de celles qui goûtent, parlent peu et ne commandent pas. La chair domine. Comment cette figure deviendra-t-elle un jour, par l’énergie tendue de tous les traits, par la splendeur des yeux et la charité céleste du sourire, presque semblable à celle de saint François d’Assise ? C’est le miracle de l’âme, qui sculpte la carcasse et met sa signature.
De Saint-Cyr, Foucauld passe, en 1878, à l’école de cavalerie de Saumur[13]. Il y partage la chambre d’un camarade avec lequel il s’était lié à Saint-Cyr, Antoine de Vallombrosa, plus tard marquis de Morès, destiné à fournir une carrière éclatante et brève, et à périr assassiné, lui aussi, dans le désert. Cette chambre « devint célèbre par les excellents dîners et les longues parties de cartes que l’on y faisait, pour tenir compagnie au puni, car il était bien rare que l’un des deux occupants ne fût pas aux arrêts »[14]. Le contraste était grand entre Vallombrosa, toujours en mouvement, beau cavalier, homme de sport, et Foucauld, casanier, apathique, rêveur. Cependant, pour des raisons communes ou différentes, ils étaient tous les deux aimés des élèves-officiers : Foucauld, par exemple, comme son camarade l’était pour sa générosité, pour son intelligence de prime-saut, pour sa franchise. On riait de ses frasques et de ses travers. Il s’habillait avec une recherche extrême, ne fumait que des cigares d’une certaine marque, n’acceptait jamais qu’un garçon de café ou un cocher lui rendît la monnaie d’un louis, jouait gros jeu, et dépensait si follement que son oncle, M. Moitessier, devait bientôt, à la grande fureur de Charles, le pourvoir d’un conseil judiciaire. On devine, d’ailleurs, que les hôteliers, les bottiers, les tailleurs, les marchands de Pontet-Canet et de Corton n’étaient pas les seuls qui s’entendissent à faire des brèches dans la fortune de ce jeune grand seigneur. La vie qu’il mena à Pont-à-Mousson, au sortir de l’école de cavalerie, ne fut pas plus rangée. On raconte même qu’ayant été obligé de quitter divers logements, parce que les co-locataires se plaignaient du tapage qu’il y faisait et des compagnies fâcheuses qu’il y attirait, il finit par avoir quelque peine à trouver un garni dans cette petite ville. Heureusement, en 1880, le 4e hussards, où il était lieutenant, fut envoyé en Algérie.
Époque décisive : la passion de la terre d’Afrique, et, en somme, la passion coloniale, va s’emparer du jeune officier et grandir jusqu’à donner une orientation nouvelle à une vie mal commencée.
Le 4e hussards, devenu le 4e chasseurs d’Afrique, tenait garnison à Bône et à Sétif. Prononcez ce mot de Sétif devant un de ceux qui connaissent la légende, sinon l’histoire du Père de Foucauld, vous entendrez presque sûrement raconter une ou deux anecdotes dont le personnage principal aurait été le fameux lieutenant. Elles sont amusantes ; authentiques, le sont-elles ? j’en doute. Plusieurs de ceux qui, devant moi, ont répété ces légendes régimentaires, changeaient le nom du héros. Ce n’était plus Charles de Foucauld ; c’était un de ses camarades ; les dates variaient aussi. Je préfère m’en tenir aux faits bien établis. Les voici. À peine débarqué, le lieutenant de Foucauld part pour les manœuvres. Quelques semaines se passent ; il revient à Sétif, et s’y installe. Bientôt, des représentations lui sont faites, amicales d’abord, puis plus fermes : on lui reproche d’être un sujet de scandale, de vivre maritalement avec une jeune femme venue de France dans le même temps que lui, et qui affiche cette liaison. Il prend très mal les avis, puis l’ordre de son colonel. Les propos échangés, le refus absolu, opposé par le lieutenant à son chef, blessent la discipline. Le dénouement est prévu : il faut rompre avec cette maîtresse ou quitter le régiment. Que va faire Foucauld ? Il ne cède pas. Je ne crois pas qu’on puisse dire ici que la passion l’emporte ; non, c’est la volonté, terrible et sans maître encore, qui refuse de plier. Il quitte ses camarades, brise à demi sa carrière, se fait mettre par le ministre en non-activité temporaire, et se retire à Évian.
Il était là, loin des siens, inutile, lorsque la nouvelle lui vint, au printemps de 1881, de l’insurrection de Bou-Amama, dans le Sud-Oranais. Le 4e chasseurs allait faire campagne, ses camarades allaient se battre. Le sang de France parle plus haut que tout le reste. Aussitôt le lieutenant écrit au ministre de la Guerre. La lettre portait qu’il ne pouvait supporter la pensée que ses camarades seraient à l’honneur et au danger, tandis que lui-même il n’y serait pas, et que, pour rejoindre son régiment, il acceptait toutes les conditions qu’on lui imposerait.
La demande fut accordée. Foucauld repartit pour l’Algérie. Un événement inattendu l’avait réveillé. L’idée de sacrifice était rentrée dans cette âme. Elle est génératrice de toutes les noblesses. Charles de Foucauld n’était pas plus croyant que la veille, mais la force qui fait les chrétiens s’était affirmée en lui. Puisqu’il s’était offert pour la France, il s’était rapproché de Dieu, qui reconnaît son Fils dans le sacrifice des hommes et s’émeut à sa vue.
Un marabout indigène, Bou-Amama, des Oulad-Sidi-Cheikh-Gharaba, agitait les tribus, et prêchait la guerre sainte dans le Sud-Oranais. La campagne contre le partisan fit apparaître la première esquisse du personnage définitif que sera Charles de Foucauld. Dans ses Étapes de la conversion d’un houzard, le général Laperrine, qui était de l’expédition et pouvait juger son camarade, écrit ceci :
« Au milieu des dangers et des privations des colonnes expéditionnaires, ce lettré fêtard se révéla un soldat et un chef ; supportant gaiement les plus dures épreuves, payant constamment de sa personne, s’occupant avec dévouement de ses hommes, il faisait l’admiration des vieux Mexicains du régiment, des connaisseurs.
« Du Foucauld de Saumur et de Pont-à-Mousson, il ne restait plus qu’une mignonne édition d’Aristophane, qui ne le quittait pas, et un tout petit reste de snobisme, qui l’amena à ne plus fumer, le jour ou il ne lui fut plus possible de se procurer des cigares de sa marque préférée. »
Un des anciens soldats qui ont poursuivi Bou-Amama me racontait qu’un jour, après une grande étape, le lieutenant de Foucauld, voyant que les hommes, épuisés de chaleur, allaient se précipiter vers le puits, se porta rapidement en arrière, acheta à la cantinière une bouteille de rhum, et revint en disant : « Ce que je suis content de l’avoir, ma bouteille, pour vous la donner ! » Et les soldats mêlèrent un peu de rhum à l’eau saumâtre du puits. « Il savait se faire aimer, celui-là, ajoutait le narrateur, mais c’est qu’il aimait aussi le troupier ! Bien des années après les combats contre Bou-Amama, j’ai retrouvé mon ancien chef, monsieur, et il m’a dit, en propres termes : « L’armée d’Afrique ? elle est encore meilleure que celle du continent : la moitié des hommes de mon peloton auraient pu faire d’excellents moines. » Peut-être exagérait-il un peu : mais cela prouve l’amitié qu’il avait gardée pour nous[15]. »
« Les Arabes avaient produit sur lui une profonde impression. L’insurrection terminée, il demanda un congé pour faire un voyage dans le Sud et les étudier. N’ayant pu obtenir ce congé, il donna sa démission, et vint s’installer à Alger, pour préparer son grand voyage au Maroc[16]. »
Il avait vingt-quatre ans. Si la part d’inconnu était bien grande encore dans l’avenir de ce très jeune ancien officier, une chose était dès lors certaine : il était né pour habiter l’Orient ; il avait en lui cette vocation qui ne naît pas, comme certains se l’imaginent, de l’amour de la lumière, mais bien plutôt de l’amour du silence habituel, de l’espace, de l’imprévu et du primitif de la vie, du mystère également qu’on devine dans des âmes très fermées. Quand cette vocation parle et commande dans un cœur d’homme, il n’y a qu’à la suivre. On la combat sans la vaincre. Demandez-le aux vieux Sahariens qui ont essayé de prendre du service en France, et qui trouvent que la meilleure garnison ne vaut pas le désert, et qu’un colonel, défilant à la tête de son régiment, n’éprouve point le sentiment de libre puissance, ni le petit frisson d’isolement et d’aventure possible qui tiennent en éveil, et en joie inquiète, le petit lieutenant, chef de corps lui aussi, dont les vingt-cinq méharistes, à la file, marchent sous les étoiles, faisant crouler le sable des dunes sous le pied des chameaux, et suivant une piste vagabonde, incertaine souvent, à la recherche d’un puits ou d’une bande pillarde. Demandez-le à ceux qui ont pris leur retraite, imprudemment, aux bords de la mer de Bretagne ou sur le rivage de Nice ; à ceux-là surtout, trop vieux pour la vie errante, trop profondément dépaysés désormais dans les terres natales, et dont l’habitation est cachée aux environs d’Alger ou d’Oran, dans une villa sous les pins, où ils entendent encore le bruit du vent qui vient du sud, et reçoivent la visite des jeunes, leurs successeurs, les heureux qui frappent à la porte, et disent : « Bonjour mon commandant ! J’arrive du bled ! »
Sa démission donnée, Charles de Foucauld suivit le premier conseil de sa vocation, qu’avaient décidée les manœuvres autour de Sétif, les récits des vieux Africains, la découverte d’un peuple nouveau, la guerre enfin contre le partisan : il ne quitterait pas l’Afrique sans l’avoir étudiée, il serait homme d’action. Que ferait-il donc ? une des choses les plus difficiles qui fussent : il entreprendrait d’explorer le Maroc, pays fermé, défiant de l’étranger, cruel dans ses vengeances, mais si voisin de nos côtes, si manifestement destiné à compléter notre domaine, qu’on était sûr, en le parcourant, d’aider la France de demain. Il vint à Alger. Ressaisi par ce besoin de savoir qu’il avait servi, jusque-là, sans méthode, il s’enferma dans les bibliothèques, prit des leçons d’arabe, et se mit en relations avec les hommes qui pouvaient le préparer à une entreprise audacieuse.
L’un de ceux-ci, le plus utile peut-être, une des figures les plus connues de l’ancien Alger, s’appelait Oscar Mac Carthy. C’était un tout petit homme, « aussi brun qu’un homme blanc peut l’être, aussi maigre que peut l’être un homme en santé » [17], qui portait les cheveux coupés ras et la barbe longue, et que les Arabes nommaient tantôt : « L’homme à la grosse tête » ; tantôt : « L’homme au canon de fusil ». Ce second surnom lui venait de l’habitude qu’il avait en voyage de suspendre à son épaule, en bandoulière, un grand baromètre enfermé dans un étui de cuir. Autrefois, Mac Carthy avait eu le projet de traverser le Sahara et de gagner Tombouctou. « Il ne se mit jamais en route, mais le biscuit préparé pour cette expédition existait encore vingt ans après, et Mac Carthy parlait toujours de son prochain départ[18]. » Du moins connaissait-il à merveille l’Algérie. Il avait visité les moindres villages, séjourné dans les douars de toutes les tribus, recueilli des milliers de notes qu’il confiait, çà et là, à des amis ; il avait lu, sur les choses et les gens de l’Afrique, tout ce qui fut écrit par les voyageurs, les historiens, les archéologues, et il se souvenait de tout. « La terre africaine était la propriété de son esprit[19]. » Dans son corps frêle vivait une âme intrépide et savante. Guide sûr, mais dont les méthodes d’exploration avaient toujours été très personnelles, on pouvait deviner ce qu’il conseillerait au jeune officier qui se mettait à son école. Car, pour être à l’abri partout, devenu comme insensible au froid et au chaud, il avait voyagé sans escorte, sans bagages, ses poches bourrées seulement de carnets et de cartes manuscrites, insouciant de toutes les commodités de la vie matérielle, protégé par son dénûment même, selon le proverbe oriental qui dit : « Mille cavaliers ne sauraient dépouiller un homme nu. »
Oscar Mac Carthy était conservateur de la bibliothèque installée dans le palais de Mustapha-Pacha, rue de l’État-Major. « Tous deux accoudés à la balustrade de la cour mauresque, le vieux savant et le jeune officier passaient de longues heures, penchés sur les cartes anciennes et les poudreux in-folios, feuilletant les ouvrages des anciens géographes, que Foucauld devait laisser loin derrière lui[20]. »
Une des plus importantes questions à résoudre, pour le succès d’un voyage au Maroc, était le choix du déguisement. Impossible de pénétrer sans cacher sa qualité de chrétien, dans ce pays hostile. Seuls, les représentants des puissances européennes le pouvaient faire, mais en suivant le « chemin des ambassades », qui allait de la côte à Fez ou à Marrakech, sans pouvoir s’écarter de l’itinéraire traditionnel, constamment épiés, réduits à ne connaître du Maroc que ce que voulaient bien leur en montrer les fonctionnaires et familiers du sultan, toujours hantés par la peur de la conquête. Deux costumes seulement pouvaient permettre de passer au milieu des tribus, d’être accueilli dans les villages où nul Européen n’avait mis le pied, de converser avec les Marocains : le costume arabe, et le costume du juif, commerçant toléré et surveillé. Mais quelle connaissance des mœurs musulmanes, ou des mœurs juives, pour ne pas se trahir !
Mac Carthy conseilla, et l’officier accepta la seconde solution. Charles de Foucauld a expliqué pourquoi.
« Il n’y a que deux religions au Maroc. Il fallait à tout prix être de l’une d’elles. Serait-on musulman ou juif ? Coifferait-on le turban ou le bonnet noir ? René Caillié, Rohlfs et Lenz avaient tous opté pour le turban. Je me décidai, au contraire, pour le bonnet. Ce qui m’y porta surtout fut le souvenir des difficultés qu’avaient rencontrées ces voyageurs sous leurs costumes : l’obligation de mener la même vie que leurs coreligionnaires, la présence continuelle de vrais musulmans autour d’eux, les soupçons même et la surveillance dont ils se trouvèrent souvent l’objet, furent un gros obstacle à leurs travaux. Je fus effrayé d’un travestissement qui, loin de favoriser les études, pouvait y apporter beaucoup d’entraves ; je jetai les yeux sur le costume israélite. Il me sembla que ce dernier, en m’abaissant, me ferait passer plus inaperçu, me donnerait plus de liberté. Je ne me trompai pas. Durant tout mon voyage, je gardai ce déguisement, et n’eus lieu que de m’en féliciter. S’il m’attira parfois de petites avanies, j’en fus dédommagé, ayant toujours mes aises pour travailler ; pendant les séjours, il m’était facile, à l’ombre des mellahs, et de faire mes observations astronomiques, et d’écrire des nuits entières pour compléter mes notes ; dans les marches, nul ne faisait attention, nul ne daignait parler au pauvre juif qui, pendant ce temps, consultait tour à tour boussole, montre, baromètre, et relevait le chemin qu’on suivait ; de plus, en tous lieux, j’obtenais de mes cousins, comme s’appellent entre eux les juifs du Maroc, des renseignements sincères et détaillés sur la région où je me trouvais. Enfin, j’excitai peu de soupçons. Mon mauvais accent aurait pu en faire naître, mais ne sait-on pas qu’il y a des israélites en tous pays ? Mon travestissement était d’ailleurs complété par la présence, à mes côtés, d’un juif authentique… Son office consistait d’abord à jurer partout que j’étais un rabbin, puis à se mettre en avant dans toutes les relations avec les indigènes, de manière à me laisser le plus possible dans l’ombre ; enfin à me trouver toujours un logis solitaire où je pusse faire mes observations commodément, et, en cas d’impossibilité, à forger les histoires les plus fantastiques pour expliquer l’exhibition de mes instruments[21]. »
Cette décision de voyager déguisé, et en qualité de juif, obligea l’explorateur à apprendre l’hébreu en même temps que l’arabe, et à étudier aussi les coutumes juives.
Et ce fut encore M. Mac Carthy, à la bibliothèque d’Alger, qui présenta le rabbin Mardochée, le futur guide, à Charles de Foucauld.
CHAPITRE II – LES PRÉLIMINAIRES DU VOYAGE
Le récit de son exploration au Maroc, publié par le vicomte de Foucauld, commence à Tanger et à la date du 20 juin 1883. Or, le voyageur avait quitté Alger le 10 juin, et il ne devait pas, selon ses projets, pénétrer par le nord dans l’empire défendu, mais chercher sa route par le Rif, en traversant la frontière algéro-marocaine. Quelles raisons l’en ont empêché ? Que s’est-il passé entre le 10 et le 20 juin ? Nous n’en saurions pas grand’chose si, par bonheur, revenu à Paris, au milieu des siens, l’explorateur n’avait calligraphié, à l’intention d’un de ses neveux, et sur de belles pages de vélin qui furent reliées avec les feuillets imprimés, trois fragments importants, dont le premier raconte précisément les préparatifs du voyage et les incidents du début. Je publierai d’abord cette sorte de préface inédite de la Reconnaissance au Maroc. De même, je citerai en entier l’histoire du guide Mardochée, non pas tant parce qu’elle est amusante, dramatique, un peu folle, comme tant d’histoires orientales, mais parce qu’elle fait connaître admirablement à quelle espèce d’homme Charles de Foucauld s’était confié. Enfin, lorsqu’en analysant le livre à grands traits, je serai arrivé à ce passage, volontairement écourté, où l’auteur raconte son séjour à Bou el Djad, je publierai le troisième fragment, en tête duquel il écrivait ces lignes : « J’eus des relations avec plusieurs membres de la famille de Sidi ben Daoud. Je les ai tues dans mon ouvrage, parce que si la connaissance en était parvenue au sultan, cela aurait créé des dangers à mes amis de Bou el Djad. À toi, mon cher neveu, je vais les raconter. »
Aujourd’hui, elles peuvent être racontées au public ces entrevues au cours desquelles le jeune officier français, habilement interrogé, et se sentant deviné, s’avoua chrétien, et se confia à l’honneur de son hôte. Le temps a couru. Ce qui pouvait être une cause d’ennuis, – la mort était parmi ces ennuis possibles, – sous le règne des anciens sultans, a repris son caractère véritable de générosité rare et de chevalerie. Le traité de 1912 a permis de l’imprimer.
1. – Le déguisement et les premiers pas.
« Le 10 juin 1883, à 5 heures du matin, j’entre dans une vieille maison du quartier juif d’Alger : c’est le domicile du rabbin Mardochée. Mon compagnon y vit dans une seule chambre avec sa femme et ses quatre enfants ; il m’attend ; je dois quitter chez lui mes vêtements européens et prendre le costume israélite ; une longue chemise à manches flottantes, un pantalon de toile allant jusqu’au genou, un gilet turc de drap foncé, une robe blanche à manches courtes et à capuchon (djelabia), des bas blancs, des souliers découverts, une calotte rouge et un turban de soie noire sont préparés pour moi ; cela forme un costume juif mi-algérien, mi-syrien, qui convient aux rôles, peut-être divers, que j’aurai à jouer.
« Je m’habille, et Mardochée, sa femme, ses enfants et moi sortons, et descendons les ruelles en escalier qui conduisent au port, où est la gare d’Oran. Nous partirons pour Oran à 7 heures du matin, par le chemin de fer. Je demande deux billets en mauvais français, pour être d’accord avec mon costume ; Mardochée fait ses adieux à sa famille, et nous voici tous deux assis dans une voiture de troisième classe. Le temps est admirable, le wagon plein d’ouvriers arabes : nous partons entourés de gaieté et inondés de soleil.
» Je m’appelle le rabbin Joseph Aleman, je suis né en Moscovie d’où m’ont chassé les récentes persécutions ; dans ma fuite j’ai été d’abord à Jérusalem ; après y avoir pieusement passé quelque temps, j’ai gagné le nord de l’Afrique, et maintenant je voyage à l’aventure, pauvre mais confiant en Dieu ; une estime réciproque me lie à Mardochée Abi Serour, comme moi savant rabbin et qui a passé de longues années à Jérusalem. Mardochée porte un costume pareil au mien, cela nous donne un air de famille, il me déclare que je lui ressemble, et qu’à l’occasion il me fera passer pour son fils. Nous avons peu de bagages, un sac et deux boîtes ; les boîtes renferment : la première une pharmacie qui me permettra au besoin de me dire médecin, l’autre un sextant, des boussoles, des baromètres, des thermomètres, du papier et des cartes ; le sac contient un costume de rechange et une couverte pour chacun de nous, des ustensiles de cuisine et des provisions. Comme argent, j’emporte trois mille francs, partie en or et partie en corail. C’est dans cet équipage que nous sommes entraînés vers Oran. Je vais à Oran parce que je veux entrer au Maroc par terre ; mon projet est de me rendre de Tlemcen à Tétouan en traversant la région du Rif, laquelle forme tout le littoral entre la frontière algérienne et Tétouan. D’Oran, j’irai à Tlemcen ; là, je m’informerai des moyens de voyager dans le Rif.
« Nous arrivons à Oran à 6 heures du soir. La gare est hors de la ville ; de moitié avec deux juifs qui étaient dans le train, nous prenons un fiacre qui nous porte à un hôtel fréquenté des israélites. Nous louons une chambre à raison de deux francs par jour, et, tirant nos provisions, nous faisons en tête à tête notre premier repas du soir. Étrange maison que l’hôtel où nous sommes ! J’ai eu un moment de surprise en m’entendant tutoyer par le valet ; en Algérie on tutoie les Juifs.
« 11 juin. – Ce jour est le premier de la fête de Sbaot (Pentecôte), dans laquelle on célèbre le don de la loi fait à Moïse sur le Sinaï ; défense aux israélites de voyager aujourd’hui ni demain. Je reste dans ma chambre, Mardochée va à la synagogue et en revient à la nuit avec un de ses coreligionnaires. Ils se mettent à causer ; j’apprends que mon compagnon se livre à la recherche de la pierre philosophale, l’autre juif est un compère alchimiste ; longtemps je les vois discuter, faiblement éclairés par une bougie, leurs ombres dessinant sur les murs d’énormes silhouettes ; je m’endors sur ma paillasse, bercé par ces étranges discours.
« 12 juin. – Vers 5 heures du soir, nous montons en diligence, et partons pour Tlemcen. En me rendant à la voiture, j’entends un passant dire à son voisin, en me montrant : « Savez-vous d’où ça nous vient, ça ? Ça nous arrive en droite ligne de Jérusalem. »
« 13 juin. – Arrivée à Tlemcen à 9 heures du matin, nous nous mettons aussitôt en quête des juifs du Rif. À une heure, nous n’en avons pas trouvé un qui ait pu nous renseigner utilement ; fatigués, nous achetons du pain et des olives, et nous nous mettons à déjeuner, assis par terre sur une place ; pendant que nous sommes ainsi, passe, à deux pas de moi, une bande d’officiers de chasseurs d’Afrique sortant du cercle ; je les connais presque tous ; ils me regardent sans soupçonner qui je suis[22]. Notre après-midi est plus heureux que la matinée : nous découvrons un certain nombre d’israélites rifains ; ils viendront nous trouver à 8 heures du soir, dans une chambre que nous louons, et on discutera en réunion les moyens de traverser le Rif. Plus d’hôtel juif ici ; nous louons une chambre à une famille israélite.
« À 8 heures, tout est prêt pour recevoir notre monde : dans une pièce de deux mètres de large sur cinq de long, dont les murs, le sol et le plafond sont peints en gris, ont été placés, sur un escabeau, une bougie, une bouteille d’anisette et un verre. Les uns après les autres, une dizaine de juifs, la plupart à barbe blanche, entrent discrètement, et nous voici tous assis par terre en cercle autour de la bougie ; Mardochée remplit le verre d’anisette, l’élève et dit : « À la santé de la loi ! à la santé d’Israël ! à la santé de Jérusalem ! à la santé du pays saint ! à la santé du Sbaot ! à vos santés à tous, ô docteurs ! à ta santé, rabbin Joseph (moi) ! » Il trempe ses lèvres dans le verre, et le passe à son voisin qui le vide ; puis le verre fait le tour, et chacun des juifs le vide d’un trait. Mardochée prend la parole… »
Il raconte son histoire, et la termine par ce trait entièrement inventé : Mardochée a eu, voilà deux ans passés, une discussion avec le frère de sa femme, et le jeune homme a quitté Alger, et on ne l’a plus revu. Depuis lors, la femme de Mardochée est inconsolable. Elle ne fait que pleurer.
« Or, il y a quelques jours, on lui a dit que son frère était dans le Rif, exerçant le métier de bijoutier, sans pouvoir préciser en quelle ville. Aussitôt, elle a supplié son mari d’aller à la recherche du fugitif, et lui, bon époux, pour rendre le repos et la santé à sa femme, s’est décidé à ce voyage ; il est donc résolu à explorer le Rif, village par village s’il le faut, pour retrouver son beau-frère. C’est ce qui l’amène aujourd’hui à Tlemcen. Pour ce jeune israélite qui l’accompagne, et qu’on l’entend nommer rabbin Joseph, c’est un pauvre rabbin moscovite qui se rend au Maroc, pays des juifs pieux, pour quêter des aumônes ; Mardochée l’a emmené avec lui et a payé son voyage jusqu’à Nemours, par pure pitié. Maintenant, il supplie ces docteurs, qui tous ont habité le Rif, de recueillir leurs souvenirs, et de lui apprendre s’ils n’ont point connu celui qu’il cherche, un israélite blond et pâle, âgé de vingt-deux ans, nommé Juda Safertani. Quel présent ne fera-t-il pas à celui qui dira où il se trouve ? Les assistants réfléchissent, cherchent, discutent, mais en vain ; aucun d’eux ne connaît Juda Safertani. Mardochée soupire, et les prie de lui donner au moins des renseignements sur le Rif : par où y pénètre-t-on ? comment y voyage-t-on ? en quels lieux y a-t-il des juifs ? quels sont les hommes influents du pays ? La conversation reprend sur ce sujet, l’anisette l’anime, de nouvelles bouteilles remplacent la première, le verre fait nombre de fois le tour du cercle, on parle très haut, et la discussion devient vive sur les meilleurs moyens de parcourir le Rif. Quand nos « cousins » se retirent, il est convenu que nous partirons le lendemain pour Lalla-Marnia ; de là, nous gagnerons Nemours, d’où nous entrerons, s’il plaît à Dieu, dans le Rif.
« 14 juin. – Une diligence nous emporte de Tlemcen à 9 heures du matin, et nous arrête à 6 heures du soir dans la bourgade de Lalla-Marnia. Nous nous installons pour la nuit dans la synagogue ; elle présente l’image de tous les temples juifs que je verrai au Maroc : c’est une salle rectangulaire, avec une sorte de pupitre au milieu, et, dans le mur, un placard. Le pupitre sert à appuyer le livre de la Loi, aux lectures publiques qu’on en fait deux fois par semaine ; dans les communautés riches, il est sur une estrade et parfois sous un dais ; dans les villages pauvres, il consiste en une pièce de bois horizontale soutenue par deux poteaux. Le placard contient un ou plusieurs exemplaires de la Loi (Sifer Toura), écrits sur parchemin et roulés sur des cylindres de bois (comme les volumes romains, avec cette différence qu’ils sont roulés sur deux cylindres au lieu d’un) ; ces doubles rouleaux ont 50 centimètres de haut et sont couverts de trois ou quatre enveloppes superposées des plus riches étoffes. Telle est la synagogue, un banc appuyé au mur en fait le tour, et la complète. Nous finissions d’y dîner, lorsque entrent, les uns après les autres, trente ou quarante hommes ; ils s’asseyent sur les bancs et causent à voix basse ; ce sont les israélites du lieu, qui viennent faire en commun la prière du soir ; à un signal tous se dressent, se tournent vers l’Orient, et commencent leur prière, bas ou à mi-voix ; embarrassé, je les regarde pour faire comme eux, et, les imitant, je me balance en mesure comme un écolier qui récite sa leçon, tantôt muet, tantôt faisant entendre un bourdonnement nasillard. Au bout de huit ou dix minutes, chacun fait en même temps un grand salut ; c’est la fin. Les juifs se mettaient en mouvement pour sortir quand, à ma vive surprise, Mardochée les prie de rester et de l’entendre : il est, dit-il, un pauvre rabbin établi à Alger, qu’un malheur oblige à quitter sa femme et ses enfants pour faire, âgé et souffrant, le lointain voyage du Rif. Il va parcourir cette province à la recherche de son beau-frère,… il raconte les histoires d’hier, le désespoir et les maladies de sa femme,… enfin, et voici le comble des maux : il croyait le voyage plus facile qu’il n’est, et, si loin encore du terme, il manque déjà d’argent… Ici il se met à verser des larmes, et, d’une voix entrecoupée, il supplie ses frères de Lalla-Marnia d’avoir pitié de lui et de lui faire quelque aumône. Ils lui répondent sèchement de s’adresser au Consistoire d’Oran. Aussi étonné que mécontent de cette comédie, j’en demande, dès que nous sommes seuls, l’explication à Mardochée : « C’était pour m’habituer à mentir », répond-il.
« 15 juin. – Départ de Lalla-Marnia à 4 heures du matin, par la diligence. Arrivée à 10 heures du matin au petit port de Nemours. Nous louons une chambre dans une maison juive, et nous nous mettons en quête de renseignements sur le Rif.
« Ici notre histoire varie, la mienne surtout. Mardochée raconte la même chose qu’à Tlemcen, en ajoutant que des gens de cette ville lui ont affirmé avoir connu son beau-frère dans le Rif. Pour moi, je suis un grand médecin et un savant astrologue ; j’ai fait des cures merveilleuses ; les maux d’yeux sont mon triomphe, je guéris les yeux les plus malades, j’ai rendu la vue à des aveugles de naissance. Cette grande science et ces étonnants succès m’ont attiré l’envie des médecins chrétiens, à tel point qu’ils m’eussent fait un mauvais parti si j’étais resté dans mon pays ; j’ai dû fuir et je me suis décidé à aller exercer ma profession au Maroc, où, sur la foi de Mardochée, j’espère faire de beaux bénéfices. Mardochée raconte cela en arrivant. Lui ayant défendu de répandre l’histoire sous cette forme, il la répéta les jours suivants, en supprimant l’envie des médecins chrétiens et les dangers causés par leur haine.
« 16 et 17 juin. – Nous cherchons en vain le moyen de pénétrer dans le Rif ; beaucoup d’israélites rifains consultés déclarent qu’on ne peut y entrer par Nemours qu’avec la protection d’un certain cheikh (chef) marocain, qui viendra ici peut-être dans quinze jours ou un mois, peut-être plus tard ; et ce moyen même serait incertain ; autant, ajoute-t-on, il est difficile de traverser le Rif en partant d’ici, autant cela est facile en partant de Tétouan, où des hommes influents peuvent donner des recommandations efficaces. Je ne veux pas attendre quinze jours ou un mois à Nemours ; mieux vaut gagner Tétouan par mer et commencer de là mon voyage : je partirai pour Tanger par le prochain paquebot.
« 18 juin. – Un vapeur paraît en rade. Il va à Tanger par Gibraltar. Je m’y embarque avec Mardochée. Juifs, nous prenons la dernière classe, et nous faisons la traversée sur le pont, en compagnie d’israélites et de musulmans. Départ à 9 heures du matin, par un assez mauvais temps.
« 19 juin. – Je m’éveille en rade de Gibraltar. Le paquebot restera à l’ancre toute la journée, je descends à terre et je visite la ville ; Mardochée demeure à bord ; un petit juif de dix-huit ans qui sait l’espagnol m’accompagne ; pour moi, j’ignore toute langue hors l’arabe ; mon excursion aura un but pratique : on nous donne dans le paquebot une eau très sale, j’emporte une grande marmite de fer que je rapporterai pleine d’eau. Je me promène cinq heures à Gibraltar, ma marmite à la main ; je pousse jusqu’à un village espagnol situé à un kilomètre de la ville ; en franchissant la frontière, je vois des sentinelles anglaises et espagnoles monter la garde à 60 mètres de distance : autant les premières sont bien tenues, autant les secondes le sont mal.
« 20 juin. – Quitté Gibraltar à midi ; arrivé à Tanger à 2 h. 45…
« Le 20 juin 1883 commença vraiment mon voyage, qui dura jusqu’au 23 mai 1884. Pendant ce temps, ma prétendue histoire ne varia guère : j’étais un rabbin d’Alger allant, aux yeux des musulmans, quêter des aumônes, m’enquérir du sort et des besoins de mes frères ; aux yeux des juifs, Mardochée était de Jérusalem, pour les musulmans il demandait la charité, pour les juifs il remplissait la même mission que moi. Il ne fut plus question de Juda Safertani ni de médecine ; celle-ci avait un double inconvénient : les Marocains, pour qui tout chrétien naît médecin, étaient disposés, par cette profession, à soupçonner ma race ; puis la boîte de médicaments inspirait la convoitise : une boîte suppose un trésor et on disait que j’avais deux caisses d’or avec moi. À Fâs, dans le courant du mois d’août, instruit par l’expérience des premiers jours de route, je me défis de mes remèdes, et je modifiai mon bagage et mon costume ; les boîtes furent remplacées par un sac en poil de chèvre ; je supprimai dans ma tenue ce qui rappelait le juif d’Orient, c’est-à-dire la calotte rouge, le turban noir, les souliers et les bas, et j’adoptai la calotte noire, le mouchoir bleu et les belras (babouches) noires des rabbins marocains ; je laissai pousser des nouader, mèches de cheveux placées à côté des tempes qui tombent jusqu’aux épaules ; mon costume était dès lors celui de tous les juifs du Maroc ; il ne varia plus, si ce n’est qu’au début de l’hiver, j’y ajoutai un khenîf (burnous noir à lune jaune). À Fâs, j’organisai définitivement mes moyens de transport ; jusque-là j’avais loué des mules, j’en achetai deux qui nous portèrent, Mardochée et moi, avec notre bagage, pendant dix mois, jusqu’à notre retour à la frontière algérienne.
« Les premiers jours de mon voyage, j’avais trouvé gîte tantôt en des chambres louées dans des maisons juives, tantôt dans les synagogues. À Tanger et à Tétouan je louai des chambres ; au delà de Fâs, cela ne m’arriva plus. À partir de là, je passai mes nuits à la belle étoile dans le désert, sous des abris fournis par l’hospitalité juive ou musulmane dans les lieux habités. Lorsqu’on faisait halte dans un endroit habité, groupe de tentes ou village, s’il n’y résidait pas de juifs, mon escorte me gardait avec elle et me faisait donner l’hospitalité par la famille à qui elle-même la demandait ; lorsqu’il y avait une communauté israélite, l’escorte me conduisait à la synagogue, où Mardochée et moi déchargions nos mules et nous installions provisoirement, en attendant que le rabbin et les juifs du lieu vinssent nous offrir l’hospitalité complète : abri et nourriture. L’entretien des docteurs de passage pèse sur toutes les familles, un tour règle l’ordre dans lequel elles y participent ; dans les lieux pauvres, les rabbins gardent pour logis la synagogue, l’hospitalité porte sur les seuls aliments, et le « tour » n’exige de chaque famille qu’un jour ou qu’un repas, de sorte qu’on va successivement chez tous les habitants ; dans les localités riches, l’hospitalité comprend le logement et dure deux jours, quatre jours, huit jours ; le tour astreint à nourrir un rabbin, de sorte que, chez les juifs, Mardochée et moi étions d’ordinaire séparés pour les repas, mais on admettait que nous logeassions ensemble chez l’un des deux hôtes. Dans de rares endroits, nous fûmes reçus ensemble et pour un temps illimité, en dehors du tour, par des familles riches ; en quelques lieux misérables, les juifs nous tournèrent le dos ; nous sachant à la synagogue, ils n’y vinrent pas, et se passèrent d’y faire leur prière pour se dispenser de nous recevoir ; nous dûmes retourner à notre escorte et demander un abri à des musulmans. Chez les musulmans comme chez les juifs, l’hospitalité est gratuite : je remerciais par un cadeau consistant en sucre ou en thé, parfois en corail ou en un mouton.
2. – Histoire de Mardochée Abi Serour.
« Mardochée Abi Serour, fils de Iaïs Abi Serour, originaire de Mhamid-el-Rozlân, naquit au sud du Maroc, dans l’oasis d’Aqqa, vers 1830. Âgé de moins de quatorze ans, il quitta son pays pour compléter ses études théologiques. Il étudia à Marrâkech, à Mogador et à Tanger, où il s’embarqua pour la Palestine. Après être demeuré un ou deux ans en Terre Sainte et y être devenu rabbin sacrificateur, il gagna l’Algérie, où il passa quelques mois à Philippeville comme rabbin officiant, puis, se souvenant de sa patrie, il fit voile pour le Maroc et retourna à Aqqa. Il n’avait pas vingt-cinq ans. Séduit par la perspective d’une fortune rapide, il se jeta dans une entreprise audacieuse : le premier de sa race, il entra à Timbouktou. Son arrivée au Soudan et les débuts de son séjour furent entourés de cent périls ; il se maintint à force de courage et de ruse ; son négoce prit bientôt une grande prospérité ; avec la fortune vinrent la sécurité, le crédit, la puissance même.
« En peu de temps, il fut le marchand le plus considérable de Timbouktou ; il y eut alors pour lui dix ou douze ans de prospérité et de bonheur ; son commerce consistait dans l’échange des produits du Maroc et du Soudan, le désert était sillonné des caravanes qui portaient ses marchandises, sa fortune s’élevait à 200 ou 300 000 francs ; son nom était honoré à Timbouktou et à Mogador, et connu de toutes les tribus du Sahara. Chaque année, il venait passer deux ou trois mois au Maroc ; vers 1865, il s’y maria. Il projetait d’emmener sa femme au Soudan, et d’y fonder une communauté israélite, lorsque sa brillante étoile se voila soudain. En revenant des environs de Mogador, où s’était célébré son mariage, il reçut à Aqqa la nouvelle que plusieurs caravanes qui lui appartenaient venaient d’être enlevées par des pillards ; quelques jours après, des musulmans arrivant de Timbouktou lui rapportent que, en son absence, un de ses frères, laissé à la tête de sa maison, était mort, et qu’aussitôt le chef de la ville avait confisqué le contenu de la demeure du défunt, sous le prétexte de dettes prétendues. Prévoyant de graves difficultés, Mardochée laisse sa femme à Aqqa, chez son père, et se hâte de partir seul pour le Soudan. Tous les ennuis l’y attendaient. Le chef refusa de rendre ce qu’il avait confisqué et devint malveillant ; l’envie longtemps contenue des concurrents se déchaîna, à la vue de la disgrâce et du malheur, et éclata en hostilité bruyante. Mardochée sentit que, pour le moment, la résidence de Timbouktou ne lui était pas possible ; il réunit les débris de sa fortune, 40 000 francs, et quitta le Soudan.
« Il reprenait, triste et découragé, cette route du Maroc qu’il avait si souvent parcourue plein de joie et d’espoir ; seuls un Juif, un esclave noir et un guide arabe très sûr, nommé El Mokhtar, l’accompagnaient ; tous quatre étaient montés sur des chameaux de course et marchaient vite, sans bagages ; Mardochée avait converti tout son avoir en poudre d’or, deux petites outres contenaient le trésor, il en portait une, le juif l’autre. Ce n’est pas sans danger qu’une aussi faible troupe s’engage dans le Sahara ; d’ordinaire on le franchit en nombreuse caravane, mais les caravanes mettent trente jours pour exécuter le trajet, et, monté comme il l’était, Mardochée espérait le faire en vingt et un ; plusieurs fois, il avait ainsi traversé le désert, toujours avec succès. Les dix-huit premiers jours de route se passèrent heureusement, les voyageurs ne rencontrèrent pas un être humain : El Mokhtar les conduisait en dehors des directions suivies, et les arrêtait à des points d’eau connus de lui presque seul. Ils venaient de faire halte à l’un d’eux, que Mardochée voyait pour la première fois, c’était un petit marécage bordé de gazon, caché au fond d’un cirque de dunes ; les deux Juifs commençaient à s’y reposer le cœur plein de joie et d’actions de grâces, car ils se voyaient au terme de leurs périls : trois journées les séparaient d’Aqqa, et ils faisaient leur dernière provision d’eau.
« Tout à coup, El Mokhtar, qui était allé faire le tour du marécage, arrive en courant, l’air très inquiet : il vient d’apercevoir, à l’autre bord, les traces fraîches de nombreux chameaux ; plus de quatre-vingts se sont désaltérés ici il y a quelques heures ; reviendront-ils ? De quel côté sont-ils allés ? Il y va de la vie de le savoir. El Mokhtar s’élance sur son méhari, et vole en reconnaissance dans la direction des traces, Mardochée le suit des yeux et le voit s’éloigner dans les dunes, paraissant ou disparaissant entre les vagues de sable. Pour lui, il prend à la hâte ses mesures en prévision d’une surprise ; des vêtements musulmans et une pacotille de parfumerie avaient été apportés par précaution ; en un clin d’œil, les deux juifs se déshabillent, se travestissent en musulmans, enfouissent la poudre d’or au pied d’un gommier : « Tu t’appelles Moulei Ali, et je m’appelle Moulei Ibrahim, dit Mardochée à son compagnon ; nous sommes deux chérifs du Tafilelt, qui allons au Sahel faire le commerce des parfums. » Une question se pose : s’ils sont pillés, leur esclave dira d’où ils viennent et avouera la présence de l’or ; il faudrait le tuer ; mais ce malheureux n’a pas vingt ans et il a été nourri chez Mardochée dès son enfance ; après des hésitations, la pitié l’emporte, on ne le tuera pas. Ils se remettent à scruter l’horizon, mais n’aperçoivent pas El Mokhtar. Soudain, il apparaît sur une crête rapprochée, arrivant à toute bride et leur faisant, avec le pan de son burnous, des signes désespérés. Ils courent aux montures ; c’était trop tard. El Mokhtar n’avait pas avancé de cent mètres qu’au milieu d’une violente poussière une nombreuse troupe de méharis se profile, lancée à la poursuite du guide ; des coups de feu retentissent. El Mokhtar tombe : il était mort, une balle l’avait atteint à la tête. Un instant après, Mardochée était entouré de soixante Arabes : sans dire un mot, ils éventrent les sacs qui contiennent les effets ; n’y découvrant rien de valeur, ils saisissent les deux juifs et les déshabillent ; Mardochée a beau crier, les appeler mécréants, dire qu’il s’appelle Moulei Ibrahim, turban, burnous, chemise volent en un instant : « Impies ! enlèverez-vous le pantalon à un enfant du prophète ? » Il n’avait pas achevé et le pantalon avait suivi le chemin du reste. Les vêtements arrachés sont fouillés, retournés, examinés dans tous les sens, on n’y trouve rien. Furieux, les pillards se retournent vers les deux hommes qui sont nus sur le gazon : « D’où viennent-ils ? qui sont-ils ? demandent-ils tous à la fois. Ils ne sont pas là sans motif ! Ils ont des marchandises ! Ils doivent venir du Soudan ! Ils ont de l’or ! Où est-il ? Qu’ils avouent ou, par Dieu, on les tue sur l’heure ! »
« En criant, ils les poussent, les tirent, et brandissent leurs armes… Or, à leur langage, Mardochée a reconnu des Arabes du Sahel, région peu éloignée de sa patrie. À l’instant il change de plan, et, se mettant à rire : « Ia, que ne dites-vous que vous êtes des Regibat ? Je suis des vôtres. Que Dieu maudisse Moulei Ibrahim et Moulei Ali ! Nous nous appelons Mardochée et Isaac, et nous sommes des juifs d’Aqqa ! Vous ne ferez pas de mal à de pauvres juifs vos serviteurs ! Comment aurions-nous de l’or ? Nous venons d’Aqqa, et nous nous rendions dans votre tribu même vous vendre des parfums, voyez notre pacotille. »
« Ce discours jette le doute dans l’esprit des pillards, l’accent et le visage des deux hommes sont ceux d’Israélites, les boîtes de parfums semblent indiquer qu’ils disent vrai : ils fouillent une seconde fois les bagages. Mardochée avait changé de plan parce qu’il sentait que s’il persistait à se dire chérif, on prendrait ce qu’il avait et on le tuerait pour éviter les représailles ; juif, on lui prendrait tout, mais peut-être lui laisserait-on la vie, n’ayant pas de vengeance à redouter de lui. À aucun prix il n’avouerait avoir de l’or, ce qui accroîtrait son péril. Les Arabes ne trouvaient définitivement rien, et tout leur montrait la sincérité de Mardochée ; ils se disposaient à emmener les méharis et l’esclave avec le bagage, et à laisser les deux juifs se tirer d’affaire comme ils pourraient ; nus, sans nourriture, sans guide, ils regagneraient Aqqa ou mourraient en route, à la grâce de Dieu. Mardochée gémit, pleure, supplie qu’on lui laisse au moins un chameau et une outre, on le repousse durement. Il s’attendait à ce refus, sa demande était une comédie ; en réalité, il était content ; il gardait la vie et son or et, connaissant le pays, atteindrait facilement Aqqa ; dans moins d’une heure, quand les Arabes auraient disparu, il partirait. Ses spoliateurs chargent ses méharis, et quelques-uns déjà se mettent en marche. Tout à coup, l’un d’eux, en consolidant le bât d’un des quatre animaux, aperçoit, par une déchirure, des brins de paille du rembourrage ; il en tire un : « Ia ! revenez ! ia, revenez ! s’écrie-t-il. De la paille du Soudan ! Le juif a menti : il vient du Soudan ! » En moins de deux minutes, tous les Arabes se pressent sur Mardochée : « L’or ! l’or ! » est le seul cri qu’on entende. « Par Dieu ! je n’en ai pas. Par notre seigneur Moïse, je n’en ai pas. Ô messeigneurs, je n’en ai pas, je n’en ai pas ! » Plus d’histoires, on lui met un poignard sur la gorge : « Où est-il ? – Je n’en ai pas. » On enfonce un peu l’arme, le sang coule : « Je n’en ai pas ! » murmure-t-il à demi évanoui. La question recommencera lorsqu’il sera remis ; pendant qu’il reprend ses sens on passe à l’autre juif ; il voit couler son sang sans avouer. On le laisse pâmé et on court à l’esclave : « D’où viens-tu ? – De Timbouktou. – Tes maîtres ont-ils de l’or ? – Non. » À son tour il sent la pointe d’une lame s’appuyer sur sa gorge, le pauvre nègre tremble : « J’ignore s’ils ont de l’or, gémit-il, mais ils ont creusé tout à l’heure au pied de cet arbre, voyez… » C’était inutilement que Mardochée et son compagnon s’étaient laissé blesser et presque égorger, leur secret était découvert, Mardochée était ruiné, et probablement on le tuerait pour empêcher toute vengeance après un vol aussi considérable. Pour la seconde fois, en ce jour, la sécurité faisait place à un danger suprême… Il ne fallut pas longtemps pour déterrer le trésor. Qui peindra l’allégresse des Arabes à la vue de tant d’or ? Il ne fut plus question de partir ; on tua un chameau, et on ne pensa plus qu’à manger pour fêter une telle prise. Les deux juifs passèrent cette journée et la nuit au milieu du cercle des Arabes, assistant à leur réjouissance sans savoir ce qu’ils deviendraient.
« Le lendemain, les Arabes voulurent diviser l’or entre eux. Ils étaient soixante cavaliers ; ne sachant comment faire soixante parts égales, ils ordonnèrent à Mardochée de faire le partage : on mit entre ses mains la petite balance trouvée dans ses bagages et, durant deux journées, il dut peser son propre or sous les yeux de ses ravisseurs et s’ingénier à leur en composer soixante parts semblables. Le malheureux regardait cela comme un répit ; il s’attendait à être égorgé dès qu’il aurait achevé sa besogne. D’ailleurs n’allait-il pas périr de faim ? tout aliment lui était refusé, il se nourrissait d’herbe depuis sa captivité.
« La plupart des pillards étaient des Regibat ; quelques Oulad Deleim les accompagnaient ; le second jour du partage, Mardochée entendit un des hommes qui l’entouraient parler de la tribu des Chqarna comme en faisant partie : « Y a-t-il des Chqarna parmi vous ? » demanda Mardochée. « – Oui, nous sommes cinq Chqarna ici, un tel, un tel, un tel… » Quelques heures après, les Arabes s’était disséminés pour faire la sieste, Mardochée se dirigeait vers le Chqarni qui lui avait parlé, et tombait à ses pieds, la main attachée à son burnous : « Par Dieu et votre honneur ! Dieu me met sous votre protection, ne me le retirez pas. J’ai une debiha[23] sur les Chqarna, je m’appelle « Mardochée Abi Serour, un tel d’entre vous est mon seigneur. Par Dieu et votre honneur ! sauvez-moi, montrez que les Chqarna défendent leurs clients, et que leur sauvegarde n’est pas vaine. »
« Le Chqarni se trouvait parent du seigneur de Mardochée ; il répondit que pour l’or il ne pourrait pas le faire rendre, d’autant plus qu’on l’avait pris avant la connaissance de la debiha, mais il garantissait la vie des deux juifs, il ne pouvait prendre d’autres engagements à cause du petit nombre de Chqarna présents au rezzou[24]. Le soir du même jour, le partage terminé, les Arabes tinrent conseil ; on discuta ce qu’on ferait, il fut résolu qu’on battrait le désert dans la même région, puis on parla de Mardochée ; la plupart étaient d’avis de le tuer avec son compagnon ; les cinq Chqarna s’y opposèrent : Mardochée, reconnu client de leur tribu, était désormais, déclarèrent-ils, sous leur protection. Une discussion violente s’engagea : le chef du rezzou, un Regibi[25], voulait la mort des juifs, ses Regibat criaient avec lui. Les Chqarna furent fermes, et, quand on les vit prêts à combattre plutôt que d’abandonner les suppliants, on leur céda.
« Mardochée mena une triste vie pendant la semaine qui suivit : le rezzou avait repris ses courses ; il parcourait souvent cinquante kilomètres par jour, à une allure rapide ; les deux juifs couraient nus à côté des montures des Chqarna dont ils n’osaient s’éloigner ; la faim les tourmentait ; leurs protecteurs n’ayant que le strict nécessaire ne pouvaient rien leur donner ; des herbages, les os que jetaient les musulmans, tout impurs qu’ils étaient, une pincée de thé obtenue par charité furent, pendant cette période, la seule nourriture de Mardochée et de son compagnon. Combien de temps se prolongerait cette existence ? Mardochée se le demandait, accroupi près d’un puits où l’on campait le huitième jour : en vain il avait prié les Chqarna de le conduire à Aqqa, ils lui avaient répondu que s’ils se séparaient du rezzou, celui-ci, le pacte d’union rompu, les poursuivrait et les attaquerait après leur départ ; l’objection était fondée et Mardochée n’insista pas ; d’où viendrait donc la délivrance ? arriverait-elle à temps ? Soudain, un tourbillon de poussière apparaît au bout de la vallée, il s’approche comme un ouragan, quelques Arabes se lèvent effarés, aucun n’a encore saisi ses armes et le nuage est là, s’arrête et montre deux cents cavaliers montés sur des méharis. Un homme en sort et marche aux Regibat, son chameau blanc se couche, il pose sur la tête de l’animal un de ses pieds chaussés de hauts brodequins, et, mettant en joue le chef des Regibat : « Que Dieu maudisse les Regibat et Sidi Hamed le Regibi leur patron ! Que Dieu fasse brûler vos pères et vos ancêtres ! Vous avez opprimé nos frères et voulu mettre à mort nos clients, à cette heure vous êtes à notre merci. Ia, femmes ! qui n’avez de cœur que contre les juifs, vous allez apprendre ce qu’est la parole d’hommes ! » C’était le chef des Chqarna qui parlait ainsi ; célèbre dans le Sahara pour son éclatant courage, on le reconnaissait de loin à sa blanche monture, mieux dressée que le meilleur cheval et instruite à obéir à sa voix. L’homme qui avait pris Mardochée sous sa protection avait envoyé un serviteur l’avertir des dangers que couraient les Chqarna et leurs protégés, et il venait tirer ses frères des mains des Regibat.
« Les Chqarna n’usèrent de leur avantage que pour emmener les leurs et les deux juifs. Mardochée, renvoyé à Aqqa sous bonne escorte, retrouva enfin sa maison. Quant au rezzou, cette aventure lui porta malheur : étant allé attaquer une fraction des Berâbers, il fut si vigoureusement reçu, que son chef et la plupart des cavaliers furent tués et que très peu revinrent ; le Sahara se souvient encore, après vingt ans, du désastre de ce rezzou.
« Mardochée était de retour à Aqqa qu’il avait cru ne jamais revoir, mais il revenait ruiné, et un plus grand chagrin l’attendait : pendant son absence, son père et sa mère avaient quitté ce monde. Leur héritage aurait dû être considérable, il se trouva peu de chose. Mardochée, froidement accueilli par ses frères, qui avaient sans doute soustrait une partie de la succession, résolut d’abandonner un pays où il avait trouvé tant de tristesses. Vendant ce qui lui restait, il alla une dernière fois sur la tombe de ses parents, en détacha un petit fragment, relique qui ne devait plus le quitter, et partit avec sa femme pour Mogador.
« Là commence une nouvelle période dans la vie de Mar-dochée, période remplie par ses relations avec les Européens, et qui embrasse le reste de son existence. À Mogador, il fut découvert par M. Beaumier, consul de France, orientaliste consciencieux et membre zélé de la Société de géographie. M. Beaumier le mit en rapport avec cette société, laquelle le fit venir deux fois à Paris, et le chargea de missions dans le Maroc méridional. Dans ses voyages en France, Mardochée entra en relations avec l’Union israëlite universelle et avec divers savants tels que le docteur Cosson, qui, par les secours qu’ils lui donnèrent et les missions rétribuées qu’ils lui confièrent, l’aidèrent à vivre pendant quelques années. Mardochée fit ainsi, de 1870 à 1878, deux ou trois itinéraires pour le compte de la Société de géographie et plusieurs collections de plantes pour le docteur Cosson ; ces travaux ne répondirent pas à ce qu’on avait attendu, car à la fin de ce temps on cessa de lui en confier. Sur ces entrefaites, M. Beaumier mourut. Le gagne-pain et le protecteur disparaissaient en même temps. Sans moyen d’existence à Mogador, où il était mal vu de ses coreligionnaires, Mardochée s’embarqua pour l’Algérie avec sa femme et ses enfants, et, appuyé par la Société de géographie, demanda au gouvernement français une place qui lui fournît de quoi vivre. On le nomma rabbin instituteur à Oran, puis à Alger.
« Un jour de février 1883, j’étais à la bibliothèque de cette dernière ville, causant avec le conservateur, M. Mac Carthy, lorsque nous vîmes entrer un juif de cinquante à soixante ans, grand, fort, mais voûté et marchant avec l’hésitation de ceux qui ont mauvaise vue ; quand il fut près, je vis qu’il avait les yeux rouges et malades ; il portait une longue barbe noire mêlée de poils blancs ; sa figure respirait plutôt la bonhomie et la paix qu’autre chose. Il était vêtu à la mode syrienne : un caftan grenat serré par une ceinture lui tombait jusqu’aux pieds ; par-dessus pendait un manteau de drap bleu de même longueur ; il était coiffé d’une calotte rouge entourée d’un turban noir ; à sa main était une tabatière, où il puisait continuellement ; ses habits, autrefois riches, étaient vieux et malpropres, et toute sa personne révélait un homme pauvre et négligent. « Qui est ce Juif ? demandai-je. – C’est votre affaire : un homme qui a passé toute sa vie au Maroc, est né à Aqqa, a infiniment voyagé, a été plusieurs fois à Timbouktou, et peut vous donner des renseignements précieux ; c’est ce rabbin Mardochée dont il est question dans les bulletins de la Société de géographie. » J’allai à Mardochée et le questionnai ; jugeant qu’il pouvait me fournir de bonnes indications, je pris son adresse et allai le voir. Un musulman de Mascara, avec qui je devais partir pour le Maroc, m’ayant écrit, sur ces entrefaites, qu’il ne pouvait m’accompagner par suite d’affaires de famille, je proposai à Mardochée de l’emmener à sa place ; il y consentit, à la condition que je prendrais le costume israëlite. Je ne vis que des avantages à ce déguisement. Restait à faire mes conventions avec Mardochée. M. Mac Carthy, muni de mes pouvoirs, se chargea de la négociation, et, après de longs débats, rédigea un écrit que Mardochée et moi signâmes, et qui resta à la bibliothèque d’Alger. En voici le résumé :
« Mardochée laisserait à Alger sa femme et ses enfants durant tout mon voyage. Il m’accompagnerait et me seconderait fidèlement en tous les lieux du Maroc où il me plairait d’aller. De mon côté, je lui donnerais 270 francs par mois ; 600 francs lui seraient remis avant le départ, le reste au retour ; si mon absence durait moins de six mois, il recevrait cependant six mois d’appointements. L’entretien de Mardochée, durant le voyage serait à ma charge. Si Mardochée m’abandonnait au cours du voyage, sans ma permission, il perdait par là même ses droits à toute rémunération pour le temps passé avec moi, quelle que fût la durée de ce temps, et il devenait lui-même débiteur envers moi des six cents francs qui lui avaient été donnés d’avance.
« L’obligation, pour mon compagnon, de laisser sa famille à Alger, me garantissait contre toute idée de trahison de sa part. L’article par lequel il perdait sa rémunération, en me quittant malgré moi, m’assurait qu’il ne m’abandonnerait pas. Ces deux clauses, inspirées à M. Mac Carthy par sa connaissance des juifs algériens, sauvèrent le succès de mon voyage et probablement ma vie : que de fois Mardochée voulut me laisser ! et que de fois les conditions souscrites le retinrent seules !
« Ces conventions furent signées en mai 1883 ; quelques jours après, le 10 juin, Mardochée et moi partions ensemble pour le Maroc.
« J’ai peu parlé de Mardochée dans la relation de mon voyage, à peine l’ai-je mentionné. Sa part fut grande pourtant, car il était chargé des relations avec les indigènes, et tous les soins matériels retombaient sur lui : discours aux juifs et aux musulmans, explications sur les motifs du voyage, organisation des escortes, recherche du logis et de la nourriture, il s’occupait de tout cela ; je n’intervenais que pour approuver ou dire non. Intelligent, très et trop prudent, infiniment rusé, beau parleur et même éloquent, rabbin assez instruit pour inspirer de la considération aux Israélites, il me rendit de grands services ; je dois ajouter qu’il se montra toujours vigilant et dévoué à veiller à ma sûreté. Si j’ai tu tant de services c’est parce que celui qui me les rendit fut en même temps, par sa mauvaise volonté, un obstacle constant et considérable à l’exécution de mon voyage ; tout en contribuant au succès de mon entreprise, il fit, du premier jour jusqu’au dernier, tout ce qui fut en lui pour le faire échouer. En quittant Alger, Mardochée, qui ne connaissait du Maroc que les environs d’Aqqa et le littoral, croyait partir pour un voyage facile et sans dangers. Je lui avais détaillé les lieux que je voulais visiter, mais comme il ne connaissait même pas les noms de la plupart, cette énumération n’éveilla aucune idée dans son esprit. Au reste, il se disait sans doute qu’une fois au Maroc, il ferait ce qu’il voudrait d’un compagnon si jeune, et modifierait à son gré mes projets. Or, la route se trouva pleine de périls, et il ne put rien changer à mes desseins. Il y eut là une double déconvenue pour lui ; les conditions du voyage furent en fait très différentes de ce qu’il les avait pensées. Il ne s’y résigna pas sans lutte ; de là nos démêlés. Dès Nemours, nous eûmes de graves discussions, et il parla de retourner à Alger ; le Rif en était cause ; aux premiers mots des dangers de cette région, il déclara ne pas vouloir y entrer ; je lui ordonnai de chercher les moyens d’y pénétrer, et je les cherchai moi-même. À Tétouan, la même querelle dura quinze jours ; à Fâs, elle se renouvela avec une violence extrême, et là Mardochée fut réellement sur le point de me quitter, tant il redoutait la route qui me conduisit à Bou el Djad. Depuis Fâs, la dispute ne cessa pas ; deux motifs la faisaient renaître chaque jour : Mardochée ne voulait pas suivre l’itinéraire que j’avais fixé, et il voulait voyager lentement ; j’étais décidé, au contraire, à exécuter exactement mon plan primitif, et je tenais à marcher sans perte de temps. Sur le premier point, je ne cédai jamais à partir de Fâs, et mon itinéraire s’exécuta selon ma volonté. Sur le second point, je n’eus pas le même succès et, malgré mes reproches, nous avançâmes avec une grande lenteur jusqu’à mon départ de Tisint pour Mogador ; si la fin de mon voyage s’exécuta plus vite, c’est que je promis à Mardochée une gratification, si nous étions à Lalla-Marnia le 25 mai. Entre ces deux parties de mon voyage, je faillis me séparer de Mardochée. Lorsque j’allai à Mogador, je le laissai à Tisint, et partis avec un musulman, le Hadj Bou Rhim, excellent homme dont je ne puis assez me louer ; je voyageai avec lui du 9 janvier au 31 mars 1884 ; de retour à Tisint, je lui proposai de remplacer Mardochée et de m’accompagner jusqu’en Algérie ; il avait accepté, et j’avais déjà donné à Mardochée son certificat et la somme nécessaire pour regagner Alger, quand un obstacle empêcha le Hadj Bou Rhim de partir. Je repris Mardochée, qui en fut trop heureux.
« Si j’eus à me plaindre de la mauvaise volonté de Mardochée, il est juste de dire qu’elle ne fut inspirée par aucune intention désobligeante à mon égard : la crainte du péril causa son opposition à mon itinéraire ; l’amour du repos et l’intérêt qu’il avait à prolonger des services payés au mois entretinrent sa lenteur. »
Après son retour du Maroc en 1884, Mardochée ne sortit plus d’Alger. Retiré dans sa maison, il fut repris par sa vieille passion de l’alchimie. Trouver de l’or ! Avec celui qu’il avait reçu en paiement, il acheta du mercure, pour ses expériences de transmutation des métaux. Et comme il demeura tout le jour penché sur ses creusets, les vapeurs mercurielles, sans bien tarder, empoisonnèrent ce dernier des alchimistes.
Si la Reconnaissance au Maroc est presque muette sur le compte de Mardochée, les lettres intimes écrites par l’explorateur ne le sont pas. Je dois dire qu’elles parlent du rabbin sans grand ménagement, et que les notes vont decrescendo. La chute est curieuse à suivre. Foucauld écrit, le 17 juin 1883, peu d’heures après le départ : « Je suis très content de Mardochée. Il n’a qu’un défaut, c’est une prudence excessive. »
Le 24 juin, ayant déjà voyagé quelques jours en pays marocain, il écrit à sa sœur : « Je suis assez content de Mardochée ; il va bien, mais à condition qu’on le secoue vigoureusement. Je suis obligé, presque tous les jours, de lui donner une bonne enlevée… » Le 2 juillet : « Je ne suis pas content de Mardochée. Il est paresseux et poltron, il n’est bon que pour la cuisine. » Le 23 juillet : « Quant à Mardochée, je n’en suis pas content : c’est le plus paresseux animal qu’on puisse rencontrer. Avec cela, poltron au delà de toute expression, maladroit, et ne sachant pas du tout voyager. » Enfin, le 30 janvier 1884, il écrira : « Mardochée est une brute. »
Ce n’est que tout à la fin qu’un peu de commisération, ainsi qu’on vient de le voir, ramène les formules vers l’indulgence et l’excuse. Le voyage terminé, la route s’embellit, le compagnon aussi.
CHAPITRE III – L’EXPLORATEUR
La Reconnaissance au Maroc est, avant tout, une œuvre scientifique, à la fois géographique, militaire et politique. Les qualités d’ordre et de précision qu’on y observe à chaque page sont tout à fait étonnantes, et plus encore si l’on songe à toutes les difficultés, aux dangers même que courait l’explorateur s’il voulait prendre des notes. Il était enveloppé de gens qui soupçonnaient, et parfois devinaient sa qualité de chrétien, et donc toujours en péril. Dans les Itinéraires au Maroc, il explique comment il a pu tromper la surveillance des témoins, ou les écarter.
« L’état d’israëlite ne manquait pas de désagréments : marcher pieds nus dans les villes, et quelquefois dans les jardins, recevoir des injures et des pierres n’était rien ; mais vivre constamment avec les juifs marocains, gens méprisables et répugnants entre tous, sauf de rares exceptions, était un supplice intolérable. On me parlait en frère, à cœur ouvert, se vantant d’actions criminelles, me confiant des sentiments ignobles. Que de fois n’ai-je pas regretté l’hypocrisie ! Tant d’ennuis et de dégoûts étaient compensés par la facilité de travail que me donnait mon travestissement. Musulman, il eût fallu vivre de la vie commune, sans cesse au grand jour, sans cesse en compagnie ; jamais un moment de solitude ; toujours des yeux fixés sur soi ; difficile d’obtenir des renseignements ; plus difficile d’écrire ; impossible de se servir d’instruments. Juif, ces choses ne devenaient point aisées, mais étaient d’ordinaire possibles.
« Mes instruments étaient : une boussole, une montre et un baromètre de poche, pour relever la route ; un sextant, un chronomètre et un horizon à huile, pour les observations de longitudes et de latitudes ; deux autres baromètres holostériques, des thermomètres fronde et des thermomètres à minima, pour les observations météorologiques…
« Tout mon itinéraire a été relevé à la boussole et au baromètre. En marche, j’avais sans cesse un cahier de cinq centimètres carrés caché dans le creux de la main gauche ; d’un crayon long de deux centimètres, qui ne quittait pas l’autre main, je consignais ce que le chemin présentait de remarquable, ce qu’on voyait à droite et à gauche, je notais les changements de direction, accompagnés de visées à la boussole, les accidents de terrain, avec la hauteur barométrique, l’heure et la minute de chaque observation, les arrêts, les degrés de vitesse de la marche, etc. J’écrivais ainsi presque tout le temps de la route, tout le temps dans les régions accidentées. Jamais personne ne s’en aperçut, même dans les caravanes les plus nombreuses ; je prenais la précaution de marcher en avant ou en arrière de mes compagnons, afin que, l’ampleur de mes vêtements aidant, ils ne distinguassent point le léger mouvement de mes mains ; le mépris qu’inspire le juif favorisait mon isolement. La description et le levé de l’itinéraire emplissaient ainsi un certain nombre de petits cahiers ; dès que j’arrivais en un village où je pouvais avoir une chambre à part, je les complétais, et je les recopiais sur des calepins qui formaient mon journal de voyage. Je consacrais les nuits à cette occupation ; le jour, on était sans cesse entouré de juifs ; écrire longuement devant eux leur eût inspiré des soupçons. La nuit ramenait la solitude et le travail.
« Faire des observations astronomiques fut plus malaisé que de relever la route. Le sextant ne se dissimule pas comme la boussole. Il faut du temps pour s’en servir. La plupart de mes hauteurs de soleil et d’étoiles ont été prises dans des villages. Le jour, j’épiais le moment où personne n’était sur la terrasse de la maison ; j’y transportais mes instruments enveloppés de vêtements que je disais vouloir mettre à l’air. Le rabbin Mardochée restait en faction dans l’escalier, avec mission d’arrêter, par des histoires interminables, quiconque essaierait de me rejoindre. Je commençais mon observation, choisissant l’instant où personne ne regardait des terrasses voisines ; souvent il fallait s’interrompre ; c’était très long. Quelquefois, il ne fut pas possible d’être seul. Quels contes n’inventait-on pas alors pour expliquer l’exhibition du sextant ? Tantôt il servait à voir l’avenir dans le ciel, tantôt à donner des nouvelles des absents. À Taza, c’était un préventif contre le choléra, dans le Tâdla il révélait les péchés des juifs, ailleurs il me disait l’heure, le temps qu’il ferait, m’avertissait des dangers de la route, que sais-je ? La nuit, j’opérais plus facilement ; je pus presque toujours agir en secret. Peu d’observations ont été faites dans la campagne : il était malaisé de s’y isoler. J’y suis parvenu quelquefois, prétextant la prière ; comme pour me recueillir, j’allais à quelque distance, couvert de la tête aux pieds d’un long sisit ; les plis en cachaient mes instruments ; un buisson, un rocher, un pli de terrain me dissimulaient quelques minutes ; je revenais, ma prière terminée.
« Pour tracer des profils de montagne, faire des croquis topographiques, il fallait plus de mystères encore. Le sextant était une énigme qui ne révélait rien, l’écriture française gardait son secret : le moindre dessin m’eût trahi. Sur les terrasses comme dans la campagne, je ne travaillais que seul, le papier caché et prêt à disparaître sous les plis du burnous. »
La Reconnaissance est aussi un journal. D’ordinaire, on y trouve autant de chapitres qu’il y eut de journées. Rarement, Charles de Foucauld s’attarde à décrire. Il le fait en peu de mots, et en artiste ; chez lui, la simplification du paysage, le choix de l’expression, une certaine recherche discrète de l’harmonie révèlent un homme remarquablement doué, et qui eût pu compter parmi les écrivains qui nous ont donné quelque image des pays nouveaux. Mais il ne se permet point de céder à cette tendance de son esprit. Il écrit avec l’intention bien arrêtée, non de se faire admirer, mais de servir la France, héritière probable du Maroc, de lui préparer les voies, d’aider les camarades qui auront un jour, il le pressent, la mission de conquérir cet empire, où, en plus d’un endroit, il rencontre des chefs secrètement désireux de la venue des Français. En somme, il est déjà celui qui prépare. Ce caractère marquera toute sa vie. Plus tard, quand il réapparaîtra en Afrique, Foucauld se donnera pour mission d’« apprivoiser » les musulmans, de les rapprocher de nous et de la loi chrétienne. Tout son effort, tous ses sacrifices, jusqu’au dernier, ne tendront qu’à ceci : rendre possible, pour les missionnaires qui viendront, la prédication de l’Évangile. Il sera, religieusement aussi, le précurseur, le fourrier, l’homme de pointe.
Le vicomte de Foucauld et Mardochée quittent Tanger le 21 juin 1883, à trois heures de l’après-midi. Ils font partie d’une petite caravane ; ils sont montés sur des mules, grâce auxquelles le long voyage entrepris au Maroc se fera assez rapidement. On marche jusqu’à neuf heures du soir, une partie du temps au milieu de champs de blé magnifiques. Le lendemain, à quatre heures du matin, la caravane se remet en mouvement. Il n’y avait point de routes au Maroc, en ce temps-là, mais seulement des pistes tracées par le pas des hommes et des bêtes. Chaque jour, Charles de Foucauld notera la qualité du terrain, les principales essences d’arbres qui couvrent le sol par endroits, la couleur des roches ; il dira s’il a rencontré d’autres voyageurs, si beaucoup de perdreaux, de tourterelles se sont levés sur le passage, si des lièvres ont déboulé. Il est frappé, dans ce début de son voyage, de la multitude des ruisseaux et petites rivières qu’il traverse ou côtoie, de la vigueur de la végétation, de la beauté des cultures, et déjà il plaint le pauvre paysan marocain auquel les pillards d’un côté, le fisc de l’autre, enlèvent la meilleure part des récoltes.
Les voyageurs font presque tout de suite un crochet à l’est, et passent quelques jours à Tétouan. Ils en repartent le 2 juillet dans la direction du sud, pour Chechaouen. On est surpris, en lisant la Reconnaissance au Maroc, de la fréquence du ton idyllique. La fraîcheur des jardins, l’abondance des moissons, la douceur de l’air, sont des expressions qui reviennent sous la plume de l’explorateur, quand il décrit certaines régions, comme celle de Chechaouen, et il n’est pas douteux, d’abord, qu’il a vu juste, mais aussi qu’une espèce de sympathie naturelle l’accorde avec ce paysage, lui en fait goûter la beauté. Dès le 2 juillet, parvenu en pays de montagnes, il écrit : « Le Djebel beni Hasan présente maintenant un aspect enchanteur ; des champs de blé s’étagent en amphithéâtre sur son flanc, et, depuis les roches qui le couronnent jusqu’au fond de la vallée, le couvrent d’un tapis d’or ; au milieu des blés, brille une multitude de villages entourés de jardins ; ce n’est que vie, richesse, fraîcheur. Des sources jaillissent de toutes parts ; à chaque pas, on traverse des ruisseaux ; ils coulent en cascades parmi les fougères, les lauriers, les figuiers et la vigne, qui poussent d’eux-mêmes sur leurs bords. Nulle part je n’ai vu de paysages plus riants, nulle part un tel air de prospérité, nulle part une terre aussi généreuse, ni des habitants plus laborieux. D’ici à Chechaouen, le pays reste semblable ; le nom des vallées change, mais pareille richesse règne partout ; elle augmente même encore à mesure que l’on s’avance. »
Dès le début du voyage, dix jours après qu’il a quitté Tanger, l’explorateur est en plein inconnu. Dans cette petite ville de Chechaouen un seul chrétien était entré, un Espagnol, vers 1863 : il n’était pas revenu. Charles de Foucauld, vingt ans plus tard, le 2 juillet, s’arrêtait sur une hauteur voisine, pour prendre un croquis, d’après lequel le vicomte Olivier de Bondy a pu faire ce dessin large et précis, publié dans la Reconnaissance au Maroc. Il pénétra même dans le quartier juif, et croisa, en chemin, beaucoup de gens des Beni-Zedjel, qui lui criaient : « Que Dieu fasse éternellement brûler le père qui t’a engendré, juif ! » La nuit du 2 au 3, il la passa dans le mellah. Il ne semble pas qu’il ait visité la ville même. Mais il a été aussi loin qu’il pouvait aller, et seul. Dans ce Maroc où il entre en piètre équipage, mais avec une ambition violente et magnifique, c’est d’ailleurs l’inconnu qu’il cherche. Les régions défendues, sauvages, ont toutes ses préférences. D’un point relevé sur les cartes à un autre point également déterminé, il tâchera tout au moins d’aller par une route où personne n’a passé. Faut-il attendre ? il attendra. Payer plus cher les guides ? il paiera. Le danger, il ne s’en occupe jamais. Je crois, sur la foi de plusieurs hommes intimement liés avec lui, que le sentiment de la peur lui était étranger.
Le voyageur qui décrit et dessine ainsi les paysages relève également tous les traits de mœurs qu’il observe. Dans cette même excursion, il rencontre un hadj, c’est-à-dire, comme on le sait, un musulman qui a fait le pèlerinage de la Mecque, et il note aussitôt que ces pèlerins, qui ont pris quelque idée des Européens, sont, en général, moins fanatiques, plus polis et affables que leurs coreligionnaires. Dix pages plus loin, il analyse l’état politique différent et la misère égale des deux parties du Maroc, le blad el Makhzen soumis au sultan, et le pays libre, ou révolté, le blad es Sîba ; partout il recueille et consigne avec un soin extrême les renseignements qui peuvent servir à un géographe, à un sociologue, à un colon, à un soldat. Même s’il avait parcouru le Maroc en toute liberté, on s’étonnerait qu’il eût pu le connaître si complètement.
Parfois, il s’interrompt de noter, et il juge. Ses jugements sont d’un contour aussi ferme que ses détails de topographie ou ses croquis à la plume. Il a une sympathie certaine pour les Marocains ; j’ai fait allusion, par exemple, à ce qu’il dit des pèlerins de la Mecque. Mais il a vu de trop près, lui prisonnier de leur foule, ce que valaient, moralement, les habitants des villes ou des villages : il ne peut taire les vices qui rongent les populations musulmanes. Et il est curieux de lire les lignes que je vais citer, quand on se souvient surtout que l’homme qui les a écrites devait donner une grande partie de sa vie à la conversion de ces peuples de l’Afrique du Nord, au sujet desquels, même tout jeune, il avait peu d’illusions.
« Presque partout, dit-il, règne une cupidité extrême et, comme compagnons, le vol et le mensonge sous toutes leurs formes. En général, le brigandage, l’attaque à main armée, sont considérés comme des actions honorables. Les mœurs sont dissolues. La condition de la femme est, au Maroc, ce qu’elle est en Algérie. D’ordinaire peu attachés à leurs épouses, les Marocains ont un grand amour pour leurs enfants. La plus belle qualité qu’ils montrent est le dévouement à leurs amis ; ils le poussent aux dernières limites. Ce noble sentiment fait faire chaque jour les plus belles actions… Le Maroc, à l’exception des villes et de quelques districts isolés, est très ignorant. Presque partout, on est superstitieux, et on accorde un respect et une confiance sans bornes à des marabouts locaux dont l’influence s’étend à une distance variable. Nulle part, sauf dans les villes et districts exceptés plus haut, on ne remplit d’une manière habituelle les devoirs religieux, même en ce qui concerne les pratiques extérieures. Il y a des mosquées dans tout qçar, village ou douar important ; elles sont plus fréquentées par les voyageurs pauvres, à qui elles servent d’abri, que par les habitants. »
Il est plus sévère pour l’israélite marocain. Retenu à El Qçar pendant vingt-quatre heures, le 7 juillet, à cause du sabbat, il écrit : « Encore si l’on pouvait profiter de ce retard pour rédiger ses notes ! Mais c’est presque toujours impossible… A-t-on jamais vu, au Maroc, juif écrire durant le sabbat ? C’est défendu au même titre que voyager, faire du feu, vendre, compter de l’argent, causer d’affaires, que sais-je encore ? Et tous ces préceptes sont observés, avec quel soin ! Pour les israélites du Maroc, toute la religion est là ; les préceptes de morale, ils les nient. Les dix commandements sont de vieilles histoires, bonnes tout au plus pour les enfants ; mais quant aux trois prières quotidiennes, quant aux oraisons à dire avant et après les repas, quant à l’observation du sabbat et des fêtes, rien au monde, je crois, ne les y ferait manquer. Doués d’une foi très vive, ils remplissent scrupuleusement leurs devoirs envers Dieu, et se dédommagent sur les créatures. »
Pour visiter Tetouan, et surtout les monts Beni-Hasan et Chechaouen, Foucauld avait quitté la route de Tanger à Fez. Il la reprend, et, marchant dans une direction approximative nord-sud, il est à Fez le 11 juillet.
Là, dans cette ville connue, il espérait ne pas séjourner, mais qui n’a pas de temps à dépenser, ne doit pas s’aventurer en pays de soleil. Un homme qui veut aller vite ! Et, qui plus est, choisit les chemins périlleux ! Un homme, – un juif il est vrai, – qui semble oublier les dates et ne pas se souvenir du grand jeûne musulman ! Quelle impertinence ! On la lui fit sentir. Il a écrit, de Fez, à la date du 14 août, cette lettre adressée à son cousin M. Georges de Latouche :
« Tu me vois encore à Fez, et dois trouver que je ne suis guère avancé dans mon voyage ; ce n’est que trop vrai ; cela tient à ce que j’ai voulu passer toujours par les chemins les moins connus, et qu’il faut parfois longtemps pour trouver le moyen de les parcourir…
« De Fez, j’ai voulu aller à Tâdla ; il y a deux chemins : l’un facile et sûr, en passant par Rabat ; l’autre très peu fréquenté, très difficile, et traversant un pays complètement inexploré ; naturellement, j’ai tenu beaucoup à prendre le deuxième. Informations prises, il n’y a personne ici qui puisse nous y conduire en sûreté ; nous faisons écrire à Meknès ; là, on nous répond qu’il y a un chérif influent, qui connaît ce chemin, le prend quelquefois, connaît les tribus que nous traversons, et qui peut, en un mot, nous conduire en sécurité à Bou Jaad, capitale du Tâdla (Tâdla est une province et non une ville comme l’indiquent les cartes). Nous le faisons venir ici ; il consent à nous accompagner, mais déclare qu’il ne veut partir qu’après les fêtes qui terminent le ramadan. Force nous a été d’attendre, c’est pourquoi nous sommes restés si longtemps à Fez. Les fêtes du ramadan seront finies après-demain : aussi demain nous partons pour Mékinès, et de là, aussitôt, pour Tâdla. Pendant les trois semaines que je savais devoir séjourner à Fez, afin de ne pas perdre mon temps, j’ai été de Fez à Tâza (à trois jours de distance). J’y ai été par un chemin et suis revenu par un autre. La position de la ville était connue, mais les chemins qui y aboutissent n’avaient pas été relevés ; je l’ai fait aussi exactement que possible.
« J’y ai eu le spectacle inattendu d’une ville où tous les habitants, musulmans et juifs, ne rêvent qu’une chose : la prochaine arrivée des Français. Ces pauvres diables sont dans un pays où l’autorité du sultan est nulle, et ils sont, d’une façon continue, en proie aux violences et aux pillages de la puissante tribu kabyle des Riata ; aussi ne cessent-ils de prier Allah de leur envoyer les Français, pour les débarrasser des Riata. Je suis resté une huitaine de jours à Tâza, faute de trouver avec qui en sortir en sûreté. Enfin, nous en sommes revenus, et nous allons partir pour Tâdla.
« Jusqu’ici, je ne suis pas content du tout de Mardochée ; il est poltron et paresseux au delà de toute expression. De même que pour Figaro, on ne peut dire que ces deux vices se partagent son cœur ; ils y règnent d’accord, dans l’harmonie la plus parfaite. Par-dessus le marché, il est douillet au delà de toute expression ; il passe son temps à geindre et quelquefois même il pleure à chaudes larmes. Dans les premiers jours, ce n’était que ridicule ; à la longue, c’est fort ennuyeux. Marche-t-on, ce sont le soleil et les cahots de la mule ; est-on dans une ville, ce sont les puces et les punaises. Et puis l’eau qui est chaude, et puis la nourriture qui est médiocre. Tous ces petits détails peuvent être parfois durs à supporter, mais il n’avait qu’à ne pas m’embêter à Alger pour voyager avec moi. Je t’avoue que si je n’avais pas tenu beaucoup à accomplir mon itinéraire, et à ne pas revenir sans avoir rien fait, je l’aurais remercié il y a plus d’un mois, et je serais revenu à Alger chercher quelqu’un de plus actif, de plus entreprenant et de plus viril. Mais à aucun prix, je ne veux revenir sans avoir vu ce que j’ai dit que je verrai, sans avoir été où j’ai dit que j’irai.
« Je crois que le voyage me coûtera tout ce que j’ai emporté, ou peu s’en faut ; jusqu’ici j’ai dépensé 1500 francs, et j’ai peu marché ; il est vrai que là-dessus j’ai deux mules d’une valeur de 250 francs chacune… Ce qui coûte cher, c’est de marcher. Veut-on aller d’un point à un autre, voici ce qu’on fait : on va trouver un notable de l’endroit, qu’on sait pouvoir vous conduire en sûreté au point où on veut aller. On lui dit : je veux aller à tel endroit ; donnez-moi votre anaïa, et servez-moi de zettet. L’anaïa c’est la protection, le zettet c’est le protecteur. Il vous répond : très volontiers, c’est tant. On marchande une bonne heure, finalement on convient du prix. On lui remet la somme dite, moyennant quoi il vous accompagne lui-même, ou vous fait accompagner par un de ses parents ou de ses serviteurs jusqu’au point désigné. C’est la seule manière de voyager dans les tribus berbères et kabyles. Sans cette précaution, les gens mêmes de l’endroit que vous quittez courraient après vous, pour vous piller à un quart d’heure de la ville ou du village d’où vous sortez.
« Ce zettet est la vraie chose coûteuse dans notre voyage ; il se paie plus ou moins cher, suivant qu’on doit traverser des tribus plus ou moins dangereuses. Quelquefois, il est excessivement cher ; ainsi, en sortant de Tâza pour aller de là à un autre point, sur la route de Fez, distant de la ville seulement de six heures de chemin, j’ai payé 60 francs (il s’agissait de traverser le territoire de ces terribles Riata). Tu comprends qu’avec une telle difficulté de communication, le commerce n’est pas actif au Maroc ; quoique le pays soit merveilleusement fertile, les habitants sont pauvres ; ils cultivent juste ce qu’il leur faut pour vivre, faute de pouvoir vendre le surplus. Il n’y a aucune comparaison entre ce pays-ci et l’Algérie, qui est un désert auprès de lui. En Algérie, il n’y a d’eau nulle part, même en hiver. Ici, dans cette saison-ci, il y a de l’eau partout ; ce ne sont que rivières d’eau courante, ruisseaux, torrents, sources. Et note que depuis que j’ai mis le pied dans le Maroc, je n’ai pas vu tomber une goutte de pluie. Mais il y a de hautes montagnes boisées, et, de la terrasse de la maison où je suis, on voit des filets de neige sur les cimes éloignées du Djebel Ouaraïn, dans la direction du sud-est. »
Un mois d’arrêt ! Charles de Foucauld l’emploie à faire deux grandes excursions, l’une à Tâza, comme il a été dit, dans l’est, l’autre à Sefrou. Le récit très détaillé qu’il fait de ces deux excursions me semble être une des meilleures parties de la Reconnaissance au Maroc.
Là aussi, les phrases pittoresques abondent ; par exemple celle-ci : « À 3 heures et demie, nous atteignons un col : Tâza apparaît, une haute falaise de roches noires se détachant de la montagne et s’avançant dans la plaine, comme un cap. Sur son sommet, la ville dominée par un vieux minaret ; à ses pieds, d’immenses jardins. » Foucauld atteint la porte de la première enceinte, ôte ses chaussures et entre dans la ville.
Cité la plus misérable du Maroc ! La tribu des Riata la pillait perpétuellement. Toujours en armes, encombrant les ruelles et les places, s’ils trouvaient quelque objet ou quelque bête de somme qui leur convînt, ils s’en emparaient, et il n’y avait contre eux aucun espoir de justice. « Il est difficile d’exprimer la terreur dans laquelle vit la population ; aussi ne rêve-t-elle qu’une chose : la venue des Français. Que de fois ai-je entendu les musulmans s’écrier : « Quand les Français entreront-ils ? Quand nous débarrasseront-ils enfin des Riata ? Quand vivrons-nous en paix, comme les gens de Tlemcen ? » Et de faire des vœux pour que ce jour soit proche : l’arrivée n’en fait point de doute pour eux ; ils partagent, à cet égard, l’opinion commune à une grande partie du Maroc oriental, et à presque toute la haute classe de l’empire… »
Sefrou est florissante, au contraire, pleine de maisons bien bâties en briques et blanchies. Le voyageur s’y promène dans des « jardins immenses et merveilleux…, grands bois touffus dont le feuillage épais répand sur la terre une ombre impénétrable et une fraîcheur délicieuse ».
Ces excursions achevées, le terrible chemin étant ouvert enfin, l’explorateur peut gagner Meknès, et de là Bou-el-Djad, où il arrive le 6 septembre.
« Ici, ni sultan ni makhzen : rien qu’Allah et Sidi Ben Daoud. » Ce grand personnage, à peine l’a-t-il vu, témoigne au rabbin Joseph Aleman des égards tout à fait singuliers. La Reconnaissance au Maroc n’y fait aucune allusion, mais dans la troisième note manuscrite que j’ai annoncée, Charles de Foucauld raconte tout au long l’aventure émouvante qui lui advint dans la ville de Bou-el-Djad.
« J’arrivai à Bou-el-Djad escorté par un petit-fils de Sidi Ben Daoud ; le Sid m’avait envoyé ce protecteur distingué après avoir reçu une lettre d’un grand seigneur de Fâs, son ami, le Hadj Tîb Qçouç. Pour faire honneur jusqu’au bout à cette recommandation, il me donna audience dès mon arrivée dans sa ville ; Mardochée et moi fûmes reçus et interrogés séparément : nous nous présentâmes comme deux rabbins de Jérusalem établis depuis sept ans à Alger. À peine sortis de la demeure du Sid, nous vîmes un musulman, assis au milieu d’un groupe, nous faire signe d’approcher ; celui qui nous appelait était le second fils de Sidi Ben Daoud, Sidi Omar ; il nous introduisit chez lui, et se mit à poser des questions sur l’Algérie. Pendant ce temps, le Sid faisait venir les principaux israélites de la ville, leur commandait de nous bien recevoir, et désignait l’un d’eux pour nous donner l’hospitalité en son nom. Ces deux audiences, tant de soin de notre installation, étaient des faveurs extraordinaires.
« Le lendemain de mon arrivée, je reçois la visite d’un fils de Sidi Omar, Sidi El Hadj Edris ; c’est un jeune homme de vingt-cinq ans, très beau, bien que mulâtre ; il est grand, bien pris, ses mouvements sont souples et gracieux, sa figure intelligente, vive et gaie ; le titre de hadj, de l’esprit, de l’instruction, une belle mine, ont fait de lui un des membres les plus considérés de la famille de Sidi Ben Daoud. Il vient, dit-il, voir si nous ne manquons de rien ; trois ou quatre musulmans l’accompagnent, on cause une demi-heure de choses et d’autres, nos visiteurs montrant une affabilité extrême ; en nous quittant, S. Edris demande si nous avons vu les rabbins de Bou-el-Djad. « Pas encore. – Qu’ils viennent ou ne viennent pas, que vous restiez ici plusieurs jours ou plusieurs mois, soyez les bienvenus mille fois ! » Que signifient de telles prévenances, sans exemple pour des juifs ? Je ne tardai pas à le comprendre. Deux choses furent remarquables pendant les quatre jours suivants : d’une part, les fréquentes visites, l’excessive amabilité des parents du Sid, qui s’efforçaient de me mettre en confiance et de me faire parler ; de l’autre, un espionnage ouvert des juifs qui surveillaient mes moindres démarches, mettaient le nez sur mon calepin dès que je voulais écrire, se jetaient sur mon thermomètre aussitôt que je le touchais, étaient grossiers et insupportables… Ces deux procédés étaient trop accentués pour que la cause ne s’en devinât pas : quelque indice avait dû faire soupçonner à Sidi Ben Daoud, ou à son fils Sidi Omar, ma qualité de chrétien ; pour s’éclairer, les marabouts avaient résolu de me faire espionner par les juifs, et en même temps de m’examiner eux-mêmes ; il était évident que depuis quatre jours on poursuivait cette recherche.
« Le 11 septembre, sixième jour depuis mon arrivée, un esclave de Sidi Edris entre chez moi, dans la matinée, et me dit de le suivre avec Mardochée chez son maître. Il nous introduit dans une maison de la zaouïa, nous nous attendons à de nouvelles questions : point ; aussitôt que nous sommes assis, on apporte à déjeuner. Thé, pâtisseries, beurre, œufs, café, amandes, raisins, figues, sont placés sur des plateaux éblouissants ; S. Edris m’offre de la limonade, et s’excuse de n’avoir ni couteaux ni fourchettes ; il mange avec nous, ce qui est une faveur inouïe, et, faisant beaucoup de frais, nous raconte qu’il connaît Tunis, Alger, Bône, Bougie, Philippeville, Oran, qu’il a visitées en revenant de la Mecque. Au bout de deux heures, nous sommes congédiés, et un esclave nous reconduit à notre domicile. Mes relations deviennent de jour en jour plus intimes avec S. Edris et son père. Le 13, à midi, je suis appelé avec Mardochée chez le premier : un déjeuner nous attend encore, S. Edris le partage avec nous ; comme je lui parle de mon désir de quitter Bou-el-Djad, il me répond qu’il m’escortera lui-même ; il est un des plus hauts personnages de sa famille, et il ne se dérange que pour des caravanes de deux cents ou trois cents chameaux, mais, pour mon compagnon et moi, il n’est rien qu’il ne fasse ; nous partirons tous trois seuls, dans quelques jours ; il veut se faire des amis de nous ; nous lui écrirons à notre retour à Alger, et il ira nous y voir. Le repas fini, il me conduit à une fenêtre, et, me montrant la haute chaîne du moyen Atlas qui borde l’horizon vers le sud, il se met à me la décrire et à me donner sur elle et ses habitants une foule de détails. Pour que je jouisse mieux de ce beau spectacle, il me fait apporter une chaise et une lunette d’approche. Il est inadmissible que tant de caresses soient désintéressées ; où S. Edris et son père veulent-ils en venir ? Je ne sais ; cependant on m’a promis de m’escorter à mon départ de Bou-el-Djad, il faut cultiver cette bonne intention. Le jour même, j’envoie à S. Edris 20 francs et trois ou quatre pains de sucre, cadeau convenable pour le pays. Le lendemain, 14, S. Edris nous fait chercher vers le soir, pour dîner avec lui sur sa terrasse ; dans la conversation, il répète qu’il voudrait aller à Alger, et de là sur le continent des chrétiens ; serait-ce possible ? Rien n’est plus facile, lui dis-je, le ministre de France à Tanger le fera parvenir à Alger, où je serai tout à son service. Et lui-même, amènerait-il un chrétien à Bou-el-Djad ? Il ne demanderait pas mieux, pourvu que le chrétien fût déguisé en musulman ou en juif, et que le sultan ne sût rien ; il faudrait que la chose se négociât en secret entre lui et le ministre de France. En ce cas, ajoute Mardochée, les autorités françaises lui feront le meilleur accueil, car elles seront aises d’envoyer des Français reconnaître Bou-el-Djad, que n’a jamais vue aucun chrétien. S. Edris répond, en souriant, que des chrétiens l’ont visitée. « Sous le costume musulman ? – Non, sous le costume juif, on ignorait qui ils étaient ; mais nous les avons reconnus. » Le lendemain matin, nouvelle visite à S. Edris ; l’entretien devient tout à fait intime : après ce qu’il nous a dit hier, s’engagerait-il, dans une lettre au ministre de France, à accueillir et protéger tout Français dans sa ville ? Volontiers, dit-il, et il est prêt à faire une visite au même fonctionnaire, pour l’assurer de sa bonne volonté envers la France.
« Le même jour, nous sommes appelés chez Sidi Ben Daoud ; on nous introduit dans une belle salle, où sept ou huit marabouts de la famille du Sid sont assis autour de lui, sur des tapis. On nous fait asseoir, et de petites négresses de huit à dix ans nous apportent des tasses de thé et des « palmers ». Lorsque nous avons joui pendant une demi-heure de la vue du saint, on nous congédie avec des paroles bienveillantes, et lui-même nous dit : « Que Dieu vous aide ! » En sortant, nous sommes rejoints par S. Omar qui nous entraîne dans sa demeure : c’est lui, dit-il, qui nous a fait demander chez son père, dans la pensée que cette visite nous distrairait. Il m’interroge sur l’astronomie ; les juifs lui ont rapporté que j’étais grand astronome : je passe, paraît-il, mes nuits à regarder les étoiles. Ainsi les israélites continuent à m’espionner pour le compte des musulmans. Le 16, Sidi Edris me fait chercher de bonne heure ; il me remet d’abord deux lettres recommandant Mardochée et moi aux juifs de Qaçba-Tâdla et à ceux de Qaçba-Beni-Mellal ; signée des rabbins de Bou-el-Djad, elles n’ont point été écrites de bonne volonté : Sidi Edris a fait venir les rabbins chez lui, et leur a enjoint de signer les lettres sous ses yeux. Sidi Edris me donne ensuite un mot de recommandation pour un de ses amis qui habite Bezzou, lieu où j’irai plus tard. Enfin il compose sa lettre au ministre de France ; il me la lit avant de la fermer ; elle est conçue à peu près en ces termes : « À l’ambassadeur du gouvernement français : je t’apprends que deux hommes de ton pays sont venus auprès de moi, et que, pour l’amour de toi, je leur ai fait le meilleur accueil et les ai conduits où ils ont voulu ; je recevrai de même tous ceux qui viendront de ta part ; les porteurs de cette lettre te donneront des informations plus complètes. Si tu veux me voir, fais-le moi savoir par le consul de France à Dar-Beïda, je me rendrai aussitôt à Tanger. » Sidi Edris signe cet écrit, le plie, le cachète de son sceau, et me le confie en me recommandant le secret et la prudence : c’est sa tête qu’il met entre mes mains ; elle courrait grand risque, si la lettre se perdait et tombait sous les yeux du sultan.
« Cette affaire terminée, S. Edris m’annonce que nous partirons le lendemain pour Qaçba-Tâdla ; non seulement il m’y conduira, mais il m’accompagnera jusqu’à Qaçba-Beni-Mellal, où je quitterai le Tâdla. Je suis un frère à ses yeux, et il irait au bout du monde pour m’être agréable, mais il ne peut supporter plus longtemps que je vive chez les juifs de la ville, qui sont des sauvages : il va faire chercher mes mules et mes bagages, et désormais je serai son hôte. Une heure après, j’étais installé dans sa maison.
« À partir de ce moment, mes relations avec S. Edris prennent un nouveau caractère ; jusque-là ses caresses excessives m’avaient laissé en défiance ; le don de la lettre pour le ministre de France était une telle marque de confiance, que je ne pouvais plus douter de ses bonnes dispositions présentes ; d’ailleurs, cette lettre expliquait ses avances, en montrant qu’elles avaient pour cause le désir d’entrer en relations avec le gouvernement français. Sûr de S. Edris, j’eus dès lors avec lui les rapports qu’on a avec un ami ; je lui rendis confiance pour confiance, et, comme il s’était mis entre mes mains, je me mis entre les siennes. Je lui dis sans restriction qui j’étais, qui était Mardochée, ce que je venais faire. Sa fidélité en augmenta. Il se confondit en regrets de n’avoir pas su la vérité plus tôt ; j’eusse logé chez lui dès le premier jour ; j’y aurais travaillé, dessiné, fait mes observations à mon aise ; si je voulais retarder mon départ, il me conduirait visiter les qoubbas et les mosquées, mettrait à ma disposition la bibliothèque de la zaouïa, qui est riche en ouvrages historiques, me promènerait dans les environs… Que ne ferait-il pas ?
« Puis, de m’offrir cent choses, des vêtements musulmans, un esclave… ; comme j’avais trouvé gracieux le service fait chez Sidi Ben Daoud par de petites négresses, il m’en offre une. Dès mon arrivée, dit-il, mon visage lui a fait soupçonner que j’étais chrétien, et les israélites ont confirmé cette opinion : que je prenne garde aux juifs ! ce sont des gens sans foi, des coquins dont il faut se défier sans cesse ; ceux d’ici sont venus, dès le lendemain de mon entrée, lui rapporter que je m’occupais d’astronomie, que je ne parlais pas leur langage, que je n’écrivais pas leur écriture, que je n’allais pas à la synagogue, enfin qu’ils me croyaient chrétien ; il leur a répondu qu’ils étaient des ânes, et que les juifs d’Alger et de France étaient différents des juifs de ce pays[26].
« Le 17 septembre, Sidi Edris, Mardochée et moi quittions Bou-el-Djad. Le 20, nous arrivions à Qaçba-Beni-Mellal. Le 23, Sidi Edris nous faisait ses adieux, et reprenait le chemin de sa zaouïa. Je ne puis dire ce qu’il fut pour moi pendant les jours que nous voyageâmes ensemble : durant les marches, il plaçait sa monture près de la mienne, et me donnait des explications sur tout ce que nous parcourions, rencontrions, apercevions ; voulais-je dessiner ? il s’arrêtait ; de son propre mouvement, il choisit toujours les chemins les plus intéressants et non les plus courts. Nous arrêtions-nous dans un lieu ? il me prenait par la main, et me conduisait voir toutes les choses curieuses ; il faisait plus : comme la demeure où il recevait l’hospitalité se remplissait, dès son arrivée, d’une foule venue pour lui baiser la main, ce grand marabout cachait dans ses larges vêtements une partie de mes instruments, pendant que je portais l’autre, et me menait en un lieu écarté faire mes observations ; là, il montait la garde auprès de moi, pour empêcher qu’on ne me surprît. Que de courses nous fîmes ensemble aux environs de Qaçba-Beni-Mellal ! Je m’arrêtais pour dessiner, il s’asseyait à côté de moi, et sa conversation m’apprenait une foule de choses. Tout ce que je sais sur la zaouïa de Bou-el-Djad, la famille de Sidi Ben Daoud, les populations du Tâdla, vient de lui ; de lui sont presque tous les renseignements imprimés dans ce volume de la page 258 à la page 267, sur le bassin de l’Ouad-Oumm-er-Rebia ; lui encore dicta ce qu’on lit, de la page 67 à la page 70, sur la campagne du sultan dans le Tâdla en 1883 ; il avait suivi l’expédition de Marrâkech à Meris-el-Biod comme représentant de Sidi Ben Daoud auprès de Moulei el Hasen. Au sujet des relations de sa famille avec le sultan, il me dit : « Nous ne le craignons pas, et il ne nous craint pas ; il ne peut pas nous faire de mal, et nous ne pouvons lui en faire. » Lui ayant demandé si Moulei el Hasen était aimé : « Non, il est cupide et avare. » (C’était, mot pour mot, ce qu’on m’avait dit à Fâs.) Sidi Edris se promet d’aller me voir à Alger et en France, et m’engage à retourner plus tard à Bou-el-Djad ; que j’y revienne en Turc, je m’installerai chez lui, nous y passerons de bonnes semaines, et je voyagerai tant que je voudrai. Il me recommande la lettre qu’il m’a confiée : « Si le sultan en avait connaissance, il me ferait couper la langue et la main. » Je lui demande si son père S. Omar sait qu’il l’a écrite : Oui, c’est S. Omar qui l’a inspirée, et c’est lui qui a dit à son fils de se conduire avec moi comme il l’a fait ; mais le secret est resté entre S. Omar et S. Edris, ils ne s’en sont point ouverts à Sidi ben Daoud « parce qu’il est un peu vieux ». « Que ce pays serait riche, si les Français le gouvernaient ! » me dit sans cesse mon compagnon, en contemplant les fertiles plaines qui s’étendent à nos pieds « Si les Français viennent ici, me feront-ils caïd ? » ajoute-t-il une fois.
« La croyance à une prochaine invasion des Français fut la cause de l’accueil que je trouvai à Bou-el-Djad : les marabouts me reçurent bien parce qu’ils me prirent pour un espion. Dans la plus grande partie du Maroc, on pense qu’avant peu la France s’emparera de l’empire de Moulei el Hasen, on se prépare à cet événement, et les grands cherchent dès à présent à s’assurer notre faveur. Les caresses dont me combla la famille de Sidi ben Daoud, la lettre dont on me chargea, sont une preuve de l’état des esprits chez les plus hauts personnages du Maroc.
« Cette domination française à laquelle on s’attend, la redoute-t-on ? Les grands seigneurs, les populations commerçantes, les groupes opprimés par le sultan ou par de puissants voisins la recevraient sans déplaisir ; elle représente pour eux un accroissement de richesses, l’établissement de chemins de fer (chose très souhaitée), la paix, la sécurité, enfin un gouvernement régulier et protecteur. »
Onze ans plus tard, Charles de Foucauld, devenu prêtre et voyageant dans le Sahara, devait recevoir, à sa grande surprise, la lettre suivante, signée du jeune marabout, devenu chef de la zaouïa :
« Casablanca, le 16 août 1904.
« Je désire énormément avoir quelques nouvelles de votre part, car il y a longtemps que je ne suis pas au courant de vos bonnes nouvelles, chose qui m’intéresse beaucoup. Dernièrement, j’ai demandé sur vous M. le consul de France d’ici. Il m’a dit que vous vous trouvez à Jérusalem dans la Terre sainte, à l’honnête service de Dieu, et que vous avez sacrifié votre temps à l’Éternel.
« Je vous félicite, et je suis bien certain que le monde ne vous intéresse plus : chose qui est l’essentielle, à présent et à l’avenir. Veuillez avoir la bonté d’écrire à M. l’ambassadeur de France à Tanger, pour lui montrer mon travail et mes efforts avec vous pendant votre séjour ici. Pour que M. l’ambassadeur écrive à M. le consul de France, pour qu’il lui montre ma fidélité avec vous.
« Je vous remercie infiniment d’avance, en félicitant de nouveau le bon métier que vous obtenez.
« Votre serviteur dévoué pour toujours,
« HADJ-DRISS-EL-CHERKAOUI,
Bou-el-Djad. Que j’étais avec vous
dans le voyage de Kabil Tâdla. »
La lettre avait été adressée « à l’officier Foukou », et remise, à Alger, au commandant Lacroix, qui avait complété l’adresse.
Quand il quitte Bou-el-Djad, Charles de Foucauld est donc escorté par un des petits-fils de Sidi Ben Daoud, et cela pendant tout le temps que les voyageurs passent dans le Tâdla. On va toujours au sud et à travers des régions dangereuses. À l’occasion d’un séjour à Tikirt, il étudie les régimes politiques très différents des tribus qui habitent les pays indépendants, au nord du grand Atlas, ou au sud des montagnes. Dans les premières, le gouvernement est démocratique ; chaque fraction de tribu est gouvernée par une assemblée où chaque famille est représentée. En général, pas de lois, et, si les fractions de la même tribu ne sont point du même avis, chacune suivra sa volonté ou son caprice, et le différend pourra, parfois, être tranché à coups de fusil. Au sud de l’Atlas, il y a bien aussi un certain État démocratique, mais les tribus ne sont pas toujours isolées, et, entre elles, il y a des liens de seigneurie et de vasselage. Toutes les variétés de cette politique marocaine sont exposées, dans la Reconnaissance au Maroc, avec une abondance de détails et de nuances qui prouvent l’habileté de l’enquêteur et la richesse de ses carnets de notes.
Un peu plus loin, il décrit les trois chaînes de l’Atlas, le grand, le moyen et le petit. Après ces pages sévères, et lorsqu’il part de Tikirt pour aller à Tisint, le poète reparaît, toujours se surveillant lui-même, mais prenant plaisir à peindre en quelques lignes ces jardins des oasis, et, sous l’ombre des palmiers, la terre divisée en carrés, arrosée par une foule de canaux, couverte de maïs, de millet et de légumes. Ce sont des lieux de bonheur entre les plus sauvages, les plus pelés, les plus désolés des paysages. Il va jusqu’à écrire : « Endroit charmant, où il semble ne pouvoir exister que des heureux. »
Dans sa course au sud, il atteint la région du Maroc saharien, par Tanzida et Tisint. La description qu’il fait du paysage du sud, vu de l’oasis de Tisint, est, je crois, le tableau le plu achevé qu’il ait rapporté de son voyage d’exploration : « Lorsqu’on entre à Tisint, on met le pied dans un monde nouveau. Ici, pour la première fois, l’œil se porte vers le midi sans rencontrer une seule montagne : la région au sud du Bani est une immense plaine, tantôt blanche, tantôt brune, étendant à perte de vue ses solitudes pierreuses ; une raie d’azur la borne à l’horizon et la sépare du ciel, c’est le talus de la rive gauche du Dra. Au delà, commence la hamada. Cette plaine brûlée n’a d’autre végétation que quelques gommiers rabougris, d’autre relief que d’étroites chaînes de collines, rocheuses, entrecoupées, s’y tordant comme des tronçons de serpents. À côté du désert morne sont les oasis, avec leur végétation admirable, leurs forêts de palmiers toujours verts, leurs qçars pleins de bien-être et de richesse. Travaillant dans les jardins, étendue nonchalamment à l’ombre des murs, accroupie aux portes des maisons, causant et fumant, on voit une population nombreuse d’hommes au visage noir, haratîn de couleur très foncée. Leurs vêtements me frappent d’abord : tous sont vêtus de cotonnade indigo, étoffe du Soudan. Je suis dans un nouveau climat : point d’hiver. On sème en décembre, on récolte en mars ; l’air n’est jamais froid ; au-dessus de ma tête, un ciel toujours bleu. »
Charles de Foucauld s’arrête à Tisint deux jours seulement ; il y est l’objet de la plus vive curiosité : « Tous les Hadjs, familiers avec les choses et les gens des pays lointains, voulurent me voir. Une fois de plus, je reconnus les excellents effets du pèlerinage (de la Mecque). Pour le seul fait que je venais d’Algérie, où ils avaient été bien reçus, tous me firent le meilleur accueil. Plusieurs, – je le sus depuis, – se doutèrent que j’étais chrétien ; ils n’en dirent mot, comprenant mieux que moi peut-être les dangers où leurs discours pourraient me jeter. L’un d’entre eux, le Hadj Bou Rhim, devint dans la suite, pour moi, un véritable ami, me rendit les services les plus signalés, et me sauva des plus grands périls. » De grandes excursions dans le sud, à Tatta, au Mader et à Aqqâ, remplissent le mois suivant.
Revenu de ces deux explorations, Foucauld songe à regagner l’Algérie, en traversant, à rebours, ce Rif inhospitalier dont l’accès, par l’ouest, lui a été, au départ, interdit. Il ne peut entreprendre une pareille aventure sans de puissantes protections, et, une fois de plus, il descend vers le sud, pour aller rendre visite à un personnage de marque, Sidi Abd Allah, qui habite à Mrimima. Celui-ci fournirait sans doute les guides nécessaires.
Mais, à peine l’étranger est-il entré dans une des maisons de Sidi Abd Allah, que le bruit se répand qu’il est chrétien et chargé d’or. Aussitôt, deux bandes de pillards s’embusquent dans la montagne, et se mettent à guetter le passage de cette proie excellente et facile. Foucauld est gardé à vue par les fils de son hôte. Dans ce danger, il écrit une lettre à son ami le Hadj Bou Rhim, et la confie à un mendiant. « Le lendemain, à 7 heures du matin, grand mouvement dans le village. Une troupe de vingt-cinq fantassins et deux cavaliers y arrive tout à coup, et entre droit dans la cour. C’est le Hadj qui vient me prendre. Il a reçu mon billet cette nuit. Il s’est levé aussitôt, a couru chez ses frères et ses parents ; chacun s’est armé et l’a rejoint avec ses serviteurs ; ils se sont mis en marche, et les voici. » Une demi-heure après, délivré, il quittait Mrimima. Mais les exigences et les vols successifs dont il avait été victime avaient tellement diminué ses ressources que, rentré à Tisint, et ayant fait ses comptes, il reconnut qu’il lui était impossible d’entreprendre le voyage de retour sans renouveler sa provision d’argent. La ville la plus proche où il y eût des Européens était Mogador, au nord-ouest, sur la côte de l’Atlantique ; c’est là qu’il fallait aller ; Foucauld confie son projet à son ami le Hadj ; il est convenu que celui-ci accompagnera le voyageur jusqu’à Mogador, l’y attendra et le ramènera à Tisint. Mardochée, au contraire, restera dans ce village. On le rejoindra plus tard.
Il faut partir de nuit, dans le plus grand secret, pour ne point être attaqué et pillé. Ce départ de Tisint pour la côte atlantique eut lieu le 9 janvier 1884.
De Mrimima, et justement à une des heures vraiment périlleuses de son voyage, Charles de Foucauld avait écrit à sa sœur Marie. Ce n’était pas la première fois qu’il lui écrivait. Comment, par qui fut porté ce billet, écrit sur un petit carré de papier, plié et replié, de manière à ne pas avoir plus de surface qu’un timbre de quittance ? je l’ignore. Quelque caravane a dû s’en charger ; la lettre a été reçue, elle était datée de la Zaouïa de Sidi Abd Allah Oumbarek, 1er janvier : « Bonne année, ma bonne Mimi : si seulement je pouvais te faire savoir en ce jour que je vais bien, que je ne cours aucun danger ! Si tu savais combien je suis triste en pensant que tu es probablement sans nouvelles de moi depuis longtemps, inquiète sur mon sort, et que ce jour, qui est une fête pour tant de gens, est pour toi un jour plus triste que les autres ! À cette époque, où chacun reçoit des lettres de ses parents, de ses amis, toi seule n’en reçois pas du seul très proche que tu aies au monde. Je sais combien tu dois être triste, et que tu dois avoir le cœur bien gros. Mais peut-être me trompé-je : Dieu veuille ! peut-être une partie de mes lettres t’est-elle parvenue. Si celle-ci te parvient, ma bonne Mimi, prends confiance, sois sans inquiétude : je ne cours aucun danger, et n’en courrai aucun jusqu’à mon arrivée : le chemin est long, mais il n’est en aucune façon dangereux ; si le mauvais temps, qui retarde ma marche depuis un mois et demi, continue, je serai encore trois bons mois à revenir ; si je trouve les chemins faciles, deux mois me suffiront ; Dieu veuille qu’il en soit ainsi, et que je me retrouve bientôt près de toi… »
À Mogador, où il arrive le 28 janvier, après avoir traversé, pendant trois heures et demie, « une vaste forêt ombrageant d’immenses pâturages », il va tout droit au consulat de France, et se trouve en présence d’un israélite, secrétaire et traducteur, qui travaillait dans les bureaux et qui s’appelait Zerbib.
– Je voudrais voir le consul de France, et toucher un chèque sur la banque d’Angleterre. Je suis le vicomte de Foucauld, officier de cavalerie française.
L’autre, toisant ce piéton crasseux et vêtu de loques, et connaissant les ruses des clients de la porte, le prit fort mal.
– Va t’asseoir dehors, le dos au mur : on ne voit pas le consul comme ça !
Charles de Foucauld alla s’étendre, près du mur, et demeura là quelque temps. Puis, revenant à Zerbib :
– Donnez-moi un peu d’eau, et indiquez moi, je vous prie, un coin où je puisse me déshabiller et me laver.
Pendant qu’il se dévêtait, dans un réduit voisin, quelqu’un regardait par le trou de la serrure. C’était Zerbib. À sa grande stupéfaction, il voit que ce vagabond était porteur d’une quantité d’instruments de physique, cachés dans les poches ou les plis des vêtements, l’un après l’autre déposés sur le sol. « Après tout, se dit-il, je puis me tromper, et il peut dire vrai. »
Aussitôt, il va prévenir son chef. Le vicomte de Foucauld est introduit près de M. Montel, chancelier du consulat. La première question qu’il pose est celle-ci : « Avez-vous reçu les lettres que j’ai adressées ici, pour ma famille ? » Hélas ! de toutes les lettres qu’il a écrites, depuis huit mois, pas une n’est parvenue encore. Il écrit donc sans plus tarder à sa sœur Marie, lui disant d’abord qu’il n’a jamais été une minute malade, qu’il n’a jamais couru le moindre danger. Cette assertion n’était pas d’une parfaite exactitude. Il ajoute que quatre mille francs, sur les six mille qu’il avait à sa disposition pour le voyage, ont été dépensés, et qu’il a laissé en réserve deux mille francs qu’il vient maintenant chercher. « En partant, je te disais : Je resterai un an ; au fond du cœur, je croyais rester au plus six mois. Je ne te disais le double que pour que tu ne t’inquiètes pas, au cas où mon absence se prolongerait ; et voici que la parole que je te disais se trouve être la vraie : mon voyage aura duré bien près d’un an. Voici huit mois que je suis parti : je vais passer ici un mois environ, à attendre de tes nouvelles et de l’argent, puis je repartirai pour le sud, et je retournerai en Algérie, s’il plaît à Dieu, par le chemin suivant : Mezguita, Dadès, Todra, Ferkla, Qçabi-ech-Cheurfa, cours de l’Oued-Mlouïa, Debdou, Oudjda, d’où je rentrerai en pays français par Lalla-Marnia ; il me faudra près de deux mois et demi pour tout cela. Quel bonheur, ma bonne Mimi, aussitôt ma rentrée en Algérie, de prendre le paquebot et de courir auprès de toi !
« Mon voyage, au point de vue géographique, marche assez bien : mes instruments sont en bon état : aucun ne s’est détraqué ; j’ai visité des pays nouveaux, et je rapporte, je crois, quelques renseignements utiles ; au point de vue moral, c’est bien triste : toujours seul, jamais une personne amie, jamais un chrétien à qui parler… Si tu savais combien je pense à toi, aux bons jours d’autrefois auprès de grand-père, à ceux que nous avons passés auprès de ma tante, et combien toutes ces pensées vous absorbent quand on est aussi isolé que je viens de l’être : c’est surtout Noël et le jour de l’an qui m’ont paru si tristes. Je me rappelais grand-père, et l’arbre de Noël, et tout ce bon temps de notre enfance. Et au jour de l’an, c’est pour toi que j’étais triste… Et encore je ne savais pas qu’aucune de mes lettres ne t’était parvenue ! Je t’en ai envoyé par messager spécial, je t’en ai envoyé par des caravanes ; chaque fois que j’ai trouvé une occasion de faire partir un mot, je l’ai saisie avec empressement : et rien n’est arrivé ! Ma pauvre Mimi, que tu vas être contente de recevoir de mes nouvelles, et que je serai heureux d’avoir des tiennes ! Je ne crains qu’une chose : c’est que tu me supplies de terminer là mon voyage et de revenir immédiatement. Je t’en supplie, sois raisonnable : il ne me faudra relativement que bien peu de temps pour le terminer, et alors j’aurai fait un beau voyage, et accompli ce que je voulais. Quand on part en disant qu’on va faire une chose, il ne faut pas revenir sans l’avoir faite… » Dans la fin de la lettre, Charles de Foucauld explique comment l’argent doit être envoyé à Tanger : un banquier de cette dernière ville écrira à un de ses confrères de Mogador, et le voyageur pourra repartir.
D’autres lettres à sa sœur racontent, avec agrément et vivacité, la vie qu’il mène à Mogador ; ce n’est point une vie oisive, ou simplement de repos. « Je suis jusqu’au cou dans mes longitudes, écrit-il le 8 février, je travaille du matin au soir, et une partie de la nuit. C’est cent fois plus émouvant que le voyage même, car là est le résultat. S’il n’est pas bon, c’est huit mois de peine et de travail perdus ; mais j’espère qu’il sera présentable. Je suis ici merveilleusement pour travailler : je loge dans un hôtel-pension arrangé à l’européenne, mais tenu par des juifs espagnols ; j’y ai une chambre convenable, où je me tiens toute la journée, et j’y dîne le soir. Je ne sors qu’une fois par jour, pour aller déjeuner chez le seul Français de Mogador, M. Montel, chancelier du consulat (le consul est absent)… Je suis bien content de me retrouver chaque jour, pendant deux ou trois heures, dans un intérieur français… »
« 14 février. – Je passe mon temps de la façon la plus uniforme du monde : de 7 heures à 11 heures du matin, je travaille ; de 11 heures à une heure, je vais déjeuner chez le chancelier ; à une heure, je me remets à la besogne, je dîne à 7 heures à ma pension, – puis je me remets à travailler jusqu’à une heure du matin environ. – En fait de visite, je n’en fais aucune, puisqu’il n’y a personne à voir ; j’en reçois une chaque jour, celle du nègre qui commande l’escorte par laquelle je me suis fait accompagner. Ne te figure pas qu’elle soit énorme : elle se composait de trois hommes au départ, et n’est plus que de deux, le troisième, qui était un esclave dudit nègre, ayant été vendu ces jours-ci par son maître. Ceux qui restent attendent patiemment, ou plutôt un peu impatiemment, le moment où je me remettrai en route. Chaque jour le chef, le nègre, un chikh de Tisint, vient me rendre compte de l’état des hommes et des mules, me raconter ce qu’il a fait, et prendre l’argent de la journée : c’est une causerie, et une leçon d’arabe… Je tiens beaucoup à ce qu’on ne me remarque pas trop, pour que le gouvernement marocain n’ait pas vent de mes projets, et ne cherche pas à me créer des obstacles sur ma route : sa politique, depuis de longues années, est d’empêcher, par tous les moyens possibles, les Européens de voyager dans l’intérieur de l’empire… »
« 7 mars 1884. – Les lettres tardent bien, ma bonne Mimi. Je crois à chaque instant voir arriver un courrier, mais rien, toujours rien. Pourtant voici trente-cinq jours aujourd’hui que sont parties mes premières lettres… Je demeure toujours dans le même hôtel juif… La colonie française est ici très peu nombreuse : le consul, le chancelier et sa femme, un négociant et sa femme, un missionnaire anglican nationalisé français, un médecin alsacien. Le missionnaire est un homme fort aimable et fort comme il faut. Il est marié et a presque toujours des amis d’Europe dans sa maison. Il s’y trouve en ce moment une jeune Anglaise très bien, parlant parfaitement le français. Je trouve très agréable d’aller de temps en temps passer la soirée dans cette maison, où j’entends chanter le Lac et surtout l’Envoi de fleurs, qui me rappellent un bien heureux temps : mais qu’il est loin déjà !… Cependant, sitôt qu’arriveront vos lettres, je me sauverai au galop vers le sud. »
Charles de Foucauld, dans une lettre, prétend ne pas savoir dessiner. Si l’on ouvre la Reconnaissance au Maroc, on trouvera, en sous-titre : Ouvrage illustré de 4 gravures et de 101 dessins, d’après les croquis de l’auteur. Ces dessins, quelques traits à la plume, mais composés avec un sentiment très sûr du paysage, mais tracés avec un évident scrupule d’exactitude, ajoutent singulièrement à la beauté de l’ouvrage, et offrent du chemin à l’imagination. Sans doute, on voudrait voir la vraie couleur de ces roches, de ces montagnes, de ce désert, de ces palmeraies au bord d’un oued, mais, si imparfaite que soit une simple illustration au trait, elle suffit pour guider nos yeux, qui se souviennent aussitôt, et l’emplissent de lumière.
L’argent reçu, Foucauld, avec le Hadj Bou Rhim, repart de Mogador pour Tisint, le 14 mars 1884, par une route différente de celle qu’il a parcourue à l’aller. Parvenu à l’Oued-Sous, au sud d’Agadir, il suit à quelque distance la rive droite du fleuve :
« Je le verrai toute la journée, serpentant au milieu des tamaris, entouré de cultures, avec de grands oliviers ombrageant son cours, et deux rangées de villages échelonnés sur ses rives… Le fleuve, avec sa bordure de champs, d’arbres et d’habitations, forme une large bande verte, se déroulant au milieu de la plaine, dix mètres au-dessous du niveau général. Un talus à pente de 50 pour 100 relie la dépression au sol environnant. Je marche au nord du talus, dans la plaine du Sous. C’est une surface immense, unie comme une glace, au sol de terre rouge, sans une pierre ; elle s’étend entre le grand et le petit Atlas… Sa largeur est ici de quarante kilomètres… La vallée du Sous demeurera la même durant les trois jours que je vais la remonter : plaine d’une fertilité merveilleuse, enfermée entre deux longues chaînes, dont l’une, moins élevée et à crêtes uniformes, borde au sud l’horizon d’une ligne brune, tandis que l’autre, s’élançant dans les nuages, élève à pic, au-dessus de la campagne, ses massifs gigantesques, aux flancs bleuâtres, aux cimes blanches… »
Le 31 mars, le voyageur était de retour dans la région de Tisint, où le rabbin Mardochée l’attendait.
Il ne se dirigea pas immédiatement au nord-est. Personne ne voulut accepter de l’accompagner dans la contrée où il chercha d’abord à entrer : force lui fut de repasser par Tazenakht.
Nous savons désormais quelle était la manière de voyager de Charles de Foucauld, l’endurance et le courage qu’il montra, et de quel bel esprit de savant et de poète il fit preuve en écrivant ses souvenirs. Il ne me reste donc qu’à relever quelques noms, sur cette route de retour, qui fut rapidement parcourue.
De Tazenakht, il se rend au Mezguita, puis au Dadès, puis à Qçabi-ech-Cheurfa. En route, il est retenu deux jours par de grandes pluies. Le 8 mai, il passe à gué la Mlouïa, le plus large courant d’eau, semble-t-il, qu’il ait traversé, puisque la Reconnaissance au Maroc note ici 35 mètres de large, 1 m. 20 de profondeur.
Les dernières étapes le conduisent à Debdou, premier point faisant un commerce régulier avec l’Algérie. Le voyageur n’a plus un centime. Heureusement, il se trouve à quatre journées de marche seulement de Lalla-Marnia. Il vend ses mules, se procure ainsi de quoi en louer d’autres, et, parti d’Oudjda à 7 heures du matin, le 23 mai, arrive en terre française à 10 heures, et bientôt après à Lalla-Marnia, où il quitte Mardochée.
À la suite de la Reconnaissance au Maroc, Charles de Foucauld a rédigé, avec cet esprit méthodique si remarquable déjà dans le récit même du voyage, une seconde partie qu’il intitule : « Renseignements ». Dans cette partie toute scientifique, sont rassemblés les détails que le voyageur a pu observer ou recueillir, sur les rivières et leurs affluents, les tribus et leurs divisions, le nombre de fusils et de chevaux dont elles disposent, les routes, celles qu’il a suivies et celles dont on lui a parlé, avec l’indication de la durée des étapes : sorte de guide que les chefs de nos troupes opérant au Maroc ont consulté et consultent encore aujourd’hui. Vers la fin, se trouve un appendice sur les Israélites au Maroc, étude sociale et statistique ; puis la liste des observations astronomiques faites au cours du voyage, le tableau des latitudes et longitudes, les observations météorologiques, et un index des noms géographiques contenus dans le volume et dans l’Atlas.
Un an après le retour de Charles de Foucauld en terre française, le 24 avril 1885, on lisait, à la Société de géographie de Paris un rapport de Duveyrier sur la Reconnaissance au Maroc, dont il avait étudié le manuscrit. « En onze mois, du 20 juin 1883 au 23 mai 1884, un seul homme, le vicomte de Foucauld, a doublé, pour le moins, la longueur des itinéraires soigneusement levés au Maroc. Il a repris, en les perfectionnant, 689 kilomètres des travaux de ses devanciers, et il y a ajouté 2 250 kilomètres nouveaux. Pour ce qui est de la géographie astronomique, il a déterminé 45 longitudes et 40 latitudes ; et, là où nous ne possédions que des altitudes se chiffrant par quelques dizaines, il nous en apporte 3 000. C’est vraiment, vous le comprenez, une ère nouvelle qui s’ouvre, grâce à M. de Foucauld, et on ne sait ce qu’il faut le plus admirer, ou de ces résultats si beaux et si utiles, ou du dévouement, du courage et de l’abnégation ascétique, grâce auxquels ce jeune officier français les a obtenus. » Duveyrier indique ensuite quelles sont les parties du voyage qui peuvent justement porter le nom de découvertes ; elles sont nombreuses et importantes ; il établit que les observations du vicomte de Foucauld ont corrigé d’un degré plein vers l’ouest le tracé d’une partie du cours du Dra, telle qu’elle est portée sur la carte du docteur allemand Rohlfs. Enfin, il annonçait, en terminant son rapport, que la Société de géographie attribuait la première de ses médailles d’or au jeune explorateur.
Tel que nous l’avons raconté en abrégé, le voyage a pu paraître relativement facile. En réalité, il a présenté toutes sortes de difficultés et de dangers. Bien que, sur ce dernier point, Charles de Foucauld ait été très sobre de détails, et qu’assurément il ait omis d’autres fois, et volontairement, beaucoup d’incidents inquiétants qui ont arrêté, ou précipité sa marche, on peut aisément, en parcourant la Reconnaissance au Maroc, relever de nombreuses occasions où l’énergie, l’endurance, l’habileté de l’officier français ont été mises à l’épreuve. Par exemple, le 26 octobre 1883, le chef d’une caravane rencontrée en chemin propose aux gens de l’escorte de piller de concert le voyageur, et de partager le butin. Le 7 avril 1884, l’hôte de Charles de Foucauld lui déclare qu’il le reçoit volontiers, sur la recommandation d’un ami, mais que si lui, Abd Allah, ou ses fils, avaient découvert, dans la campagne, ce juif accompagné d’une si faible escorte, ils l’eussent indubitablement pillé. Le 12 mai, le voyageur, qui prenait des notes et marchait en tête de la caravane, est tout à coup tiré en arrière, et jeté à bas de sa monture par deux de ses guides, qui le volent de son argent et de tous les objets qui leur parurent avoir une valeur. Bien plus, pendant un jour et demi, ces voleurs pressèrent le troisième guide de les laisser tuer Charles de Foucauld, qui ne perdait pas un mot de leur conversation. Il faut ajouter, à l’honneur de Mardochée, que le rabbin, ce jour-là, se porta au secours de son compagnon : mais il fut vite écarté.
Ces quelques traits, d’autres que j’ai cités, d’autres qu’on peut deviner entre les lignes, mais surtout sa ténacité à poursuivre sa route malgré des obstacles de toute nature ; son refus d’interrompre le voyage à Mogador et de revenir en France directement ; sa patience devant l’injure ; sa fidélité à prendre quotidiennement, en marche ou au repos, toujours au péril de sa vie, des notes et des croquis ; la promptitude à discerner les dispositions secrètes d’esprits si différents du sien ; une telle puissance de volonté dans la solitude morale, un régime si austère, un travail si soutenu, révèlent, chez ce jeune homme, une maîtrise de soi, que le passé n’annonçait guère. Lui-même, il l’a reconnu, plus tard, et il a dit que les huit mois de campagne contre Bou Amama l’avaient bien changé.
La grande exploration du Maroc l’aura changé encore plus profondément, ainsi qu’on le verra bientôt.
Ce qu’il faut dire, en achevant ce chapitre, c’est que jamais Charles de Foucauld n’oubliera le Maroc. Une seule fois, il semblera tout près d’y rentrer ; il se réjouira dans son cœur, à la pensée de parcourir librement ce pays où la France est enfin venue, et, avec elle, une espérance de relèvement, de justice, d’amitié pour le peuple « assis à l’ombre de la mort ». Bientôt le projet de mission qu’il n’avait ni inspiré, ni hâté, sera abandonné, et tombera parmi les bonnes intentions politiques qui n’ont point trouvé d’homme fort pour les défendre. Mais, toute sa vie, l’officier, devenu prêtre, demeurera « à la disposition du Maroc » ; il s’établira, en 1901, presque à la frontière de cet État ; il notera, sur ses carnets, avec un bonheur qu’on devine, les visites de Marocains qu’il a reçues ; dans ses conversations, dans ses lettres, surtout dans sa prière où les infortunes de tant de nations trouveront place, il ne cessera de nommer le Maroc. Il se sentira, pour les tribus qu’il a visitées, pour le connu et l’inconnu de cette terre de sa jeunesse, une amitié renouvelée et grandissante. Car ce n’est plus seulement le géographe, l’artiste aux yeux clairs, le Français toujours songeant à la vocation de la France, qui aimera l’empire du Moghreb : ce sera le prêtre ému d’une compassion fraternelle, et qui écrira, un soir de décembre : « Je pense tant au Maroc, depuis quelque temps, à ce Maroc où dix millions d’habitants n’ont ni un prêtre, ni un autel, où la nuit de Noël se passera sans messe et sans prière ! »[27]
CHAPITRE IV – LA CONVERSION
Les premiers mois, après le retour du Maroc, furent presque entièrement passés en Algérie. Charles de Foucauld ne commença pas tout de suite à composer et rédiger le livre dont il rapportait les éléments : il vérifia ses notes, les déchiffra s’il en était besoin, consulta ses amis, prépara, en somme, le travail qu’il devait faire, un peu plus tard, à Paris. Il fit bien quelques séjours en France, des tournées de visites et de revoir, mais le « principal établissement », les papiers, la bibliothèque, les habitudes, restèrent où ils étaient avant le grand voyage. Un moment, on put même croire que l’explorateur allait se marier en Algérie. Une jeune fille lui avait plu. Elle était de bonne famille, et il arrivait de bien loin. Il écrivit à Paris, où il trouva peu d’encouragement. J’ignore s’il était fort épris, et ce qui lui fut opposé. Mais lorsqu’il eut fait une nouvelle excursion en France, dans l’été de 1885, et habité quelque temps près de Bordeaux, chez sa tante Mme Moitessier, au château du Tuquet, il renonça au projet. Il était appelé à de tout autres destinées, et, sans le comprendre, il les servait ainsi.
Une volonté supérieure le tient. Elle le pousse à l’action, elle le fouette, elle le mène vers un but caché. La voix du désert s’élève de nouveau. Dès le commencement de septembre, Charles est à Nice, chez son beau-frère, M. de Blic, confident de ses pensées. Quelles sont-elles ? Ne le devine-t-on pas ? il va repartir ; il va au sud, bien entendu ; il veut visiter les oasis et les chotts de l’Algérie et de la Tunisie. Peut-être n’est-ce là que le prélude d’un plus grand voyage ? Je connais l’un de ses intimes amis, qui croit que l’intention secrète de l’explorateur était d’étudier les moyens et de chercher le meilleur point de départ pour une traversée du Sahara. Qui peut le dire désormais ? Foucauld ne confiait guère ses projets et ne racontait pas ses souvenirs. À la veille d’entreprendre cette « excursion », comme il disait, dans les régions des chotts, il voyait se lever parfois vers lui le regard inquiet de sa sœur. « Ne crains rien, répondait-il, je n’aurai aucun mal ; avec des ménagements, on peut passer partout. »
Le 14 septembre, il s’embarqua à Port-Vendres pour Alger. Quelques semaines plus tôt, il avait écrit à son ami de Vassal, qui se trouvait à El-Goléa, le priant de lui procurer deux chameaux, deux chevaux, et d’engager un domestique arabe pour l’expédition.
L’itinéraire ne nous est pas connu dans toutes ses parties. Nous savons seulement que Foucauld, pénétrant au sud de la province d’Oran, visita Laghouat, puis encore plus au sud, l’oasis de Ghardaïa et le Mzab, si peu hospitalier, où il devait revenir un jour sous le costume de moine, et se concilier la sympathie d’un peuple entre tous hostile aux chrétiens ; puis El-Goléa, Ouargla où le lieutenant Cauvet était chef de poste (fin de novembre 1885) ; Touggourt ; la région du Djerid, entre le chott El-Gharsa et le chott El-Djerid. Route immense, dans des pays désolés, où il faut voyager bien des jours et dormir bien des nuits, avant d’apercevoir, pâlie par la lumière aveuglante, la tache verte d’une palmeraie. Si vous tentez de la suivre sur l’atlas, vous trouverez quelques noms imprimés entre ceux des étapes que j’ai citées. Mais que désignent-ils ? non pas des villages, comme en Europe, ou des rivières courantes, mais des dunes, des étendues pierreuses, des fleuves fossiles, des fondrières desséchées où, parmi les dépôts de sel des eaux évaporées, quelques touffes d’herbe rousse ou grise ont de la peine à vivre ; un puits ; l’habitat incertain d’une tribu errante. Nous savons encore que Charles de Foucauld, épris de la solitude, déjà fiancé avec elle, laissait souvent en arrière son domestique indigène et ses bagages, et gagnait le large, jusqu’à ce qu’il ne vît plus, autour de lui, que le désert. Plus d’une fois, il prit de la sorte une avance de deux journées. Il mangeait ce qu’il avait dans ses poches. La nuit, il se couchait sur le sol, et, longtemps, regardait les étoiles. Peut-être s’exerçait-il à ne pas dormir. Peut-être la crise religieuse que je vais raconter le tenait-elle éveillé, interrogeant, guettant le souffle de Dieu, qui remplit mieux le cœur dans la nuit et le silence. Il aimait les paysages, et donc le ciel étoilé, le plus grand de tous. Au matin, il sellait son cheval attaché au piquet, rejoignait son serviteur arabe, prenait des provisions, de quoi vivre un jour ou deux, et repartait.
Ayant traversé le Sud algérien, de l’ouest à l’est, il devait naturellement aboutir à la côte tunisienne. La dernière oasis qu’il visita fut, en effet, celle de Gabès, toute voisine des plages, chaude et secrète, où l’orge et les légumes poussent sous les arbustes, et les arbustes à l’ombre des hautes palmes. De là, il s’embarqua pour la France.
Revenu à Nice, le 23 janvier 1886, après plus de quatre mois d’absence, Charles s’y reposa jusqu’au 19 février. À cette date, il quitta son beau-frère et sa sœur, et vint s’installer à Paris, où il loua un petit appartement au numéro 50 de la rue de Miromesnil. La période qui s’ouvre appartiendra au travail et à l’intimité familiale. La famille, loin de laquelle il vient de vivre longtemps, l’accueille intelligemment, délicieusement. Rien que de la joie : aucun prêche, aucun reproche, aucun souhait exprimé. On le fête ; on est fier de lui ; il voit la société la plus choisie et la plus sérieuse de Paris. Des hommes, que leur passage au pouvoir a rendu fameux et n’a pas compromis, causent devant lui des affaires religieuses et des affaires politiques de la France. Ils sont chrétiens, et ne font pas mystère de leur foi. Charles les retrouve chaque semaine. De douces influences féminines l’enveloppent ; il vit dans l’intimité de parentes qui lui rappellent sa mère, et dont il reçoit, sans qu’elles y songent même, un perpétuel exemple d’esprit, de grâce, de gaieté saine et de piété. C’est la comtesse Armand de Foucauld, mère de Louis de Foucauld, le futur attaché militaire à Berlin ; c’est Mme Moitessier, et ses deux filles, la comtesse de Flavigny et la vicomtesse de Bondy.
Inès de Foucauld, tante de Charles, personne d’une grande beauté et dont Ingres a fait deux fois le portrait[28],avait épousé M. Moitessier, originaire de Mirecourt, et qui avait fait une fortune considérable dans l’importation des tabacs. Elle habitait un bel hôtel, 42, rue d’Anjou, au coin du boulevard Malesherbes, et y recevait beaucoup. Très intelligente, douée d’une volonté à la Foucauld, qui va où elle prétend aller, très femme du monde, connaissant à merveille l’art de faire valoir et de faire vouloir les autres, de paraître intéressée par des discussions dont on n’entend pas tout, de les relancer si elles faiblissent, de marquer, sans offenser jamais, d’un mot ou d’un sourire, ce qu’elle n’approuvait pas, elle avait tenu le salon politique d’un des plus jeunes ministres que nous ayons eu, Louis Buffet, neveu de son mari, et qui avait été ministre à trente ans. Louis Buffet, Aimé Buffet, son frère, inspecteur des ponts et chaussées, Estancelin, le duc de Broglie étaient demeurés les familiers de la maison. Il y avait les invités de droit, et les autres. Charles était de toutes les « dimanchées » de Mme Moitessier. Plusieurs fois par semaine, en outre, il allait dîner rue d’Anjou, à 6 heures, toujours en habit, bien entendu. Rentré chez lui, rue de Miromesnil, il enlevait son habit, endossait une gandourah, chaussait des pantoufles de cuir souple, s’enveloppait dans un burnous, mettait un coussin sous sa tête, et se couchait sur un tapis. Une des remarquables particularités de l’appartement de Charles de Foucauld, c’est qu’on n’y voyait aucun lit. Il n’y en avait point. L’ameublement était celui d’un homme de goût, qui a eu des ancêtres dans l’histoire de France, et dont le rêve est en Orient. Aux murs, pendaient, à côté de portraits de famille peints par Largillière, des aquarelles, des croquis à la plume, représentant des paysages du Maroc ; çà et là étaient accrochées des armes et des étoffes rapportées d’Algérie. La bibliothèque ne renfermait pas un grand nombre de livres, mais la plupart étaient des livres rares, ou élégamment édités. Enfermé là tout le jour, Charles écrivait, raturait, consultait ses notes, et rédigeait le livre sévère et magnifique qui allait répandre son nom parmi tous les géographes du monde et même dans d’autres milieux. Se trouvait-il embarrassé, avait-il une recherche à faire, il quittait la table de travail, et se rendait dans une bibliothèque publique, ou chez Duveyrier. Duveyrier avait été célèbre à vingt ans ; il vivait, depuis lors, enseveli dans cette gloire, incapable de la renouveler. En 1860, à l’âge où les jeunes gens ne sont encore que des bacheliers incertains de la route à choisir, lui, déjà botaniste, géologue, versé dans les langues orientales, civilisé, merveilleusement doué pour aborder et se concilier les barbares, il avait fait le voyage, alors périlleux, de Laghouat à El-Goléa. Emprisonné par les Ksouriens d’El-Goléa, puis délivré, il n’avait profité de sa liberté que pour s’enfoncer dans l’inconnu redoutable du Sahara, pour visiter le sud de la Tunisie, une partie de la Tripolitaine et le territoire des Azdjers, la plus orientale, la plus hostile également de toutes les tribus touarègues. Le livre rapporté de là l’avait très justement rendu célèbre ; mais abattu par la maladie, condamné par elle à n’être plus qu’un Saharien consultant, Duveyrier souffrait, non seulement de ne plus être celui qui repart, et découvre, et accroît sa renommée, mais de voir que la France, diminuée en 1871, et comme doutant d’elle-même, sans perdre le souvenir de l’œuvre qu’il avait faite, ne la continuait pas. Il accueillit affectueusement son émule, l’explorateur du Maroc, et recommença de voyager, mais de la manière qu’il n’aimait pas : sur les cartes, dans les livres, dans ses souvenirs et ceux des autres.
Lentement, les innombrables documents rapportés par Foucauld devenaient de la science et de la vie. On ne peut, sans quelque étonnement, assister à cette transformation des habitudes de l’ancien lieutenant de Pont-à-Mousson et de Sétif. D’où venait-elle ? Principalement d’une ambition qui s’était emparée de lui, et qu’il servait avec cette volonté tendue et sans repos qui était la marque originale de Charles de Foucauld et, on peut dire, de sa race.
Après la publication de ce livre qu’il écrivait, après l’excursion aux Chotts, il était résolu à entreprendre de nouveaux grands voyages. Il ne parlait à personne de ces projets, mais son esprit en était souvent occupé. Une autre pensée l’habitait, et le troublait.
J’ai dit que Charles de Foucauld avait été remué profondément, durant son séjour en Algérie et au Maroc, par la perpétuelle invocation à Dieu qui s’élevait autour de lui. Ces appels à la prière, ces hommes, prosternés cinq fois le jour vers l’Orient, ce nom d’Allah sans cesse répété dans les conversations ou les écrits, tout l’appareil religieux de la vie musulmane, l’avait amené à se dire : « Et moi qui suis sans religion ! » Car les juifs aussi priaient, et le même Dieu que les Arabes ou que les Marocains. Les vices qui avaient pu corrompre l’esprit ou le cœur de ces hommes n’avaient pas empêché le témoin méditatif de sentir la grandeur de la foi. De retour en Algérie, il avait même dit à quelques-uns de ses amis : « J’ai songé à me faire musulman. » Propos de sensibilité, que la raison n’avait pas ratifié. Au premier examen, il lui était apparu, comme il en a fait la confidence à l’un de ses intimes amis, que la religion de Mahomet ne pouvait être la véritable, « étant trop matérielle ». Mais l’inquiétude demeurait. Bénie soit-elle ! Car elle est la preuve d’une supériorité chez celui qui l’éprouve, un grand événement dans l’ordre de la grâce, le signe bienheureux qu’une âme va retrouver la route. Il manquait à ce jeune homme, né dans le catholicisme, de bien connaître cette religion divine, magnifique et solide, et d’en avoir au moins deviné la transcendance, pour revenir à elle, sans hésitation, au moment où la tyrannie de la matière lui pesait par trop. Il était triste, en effet, au fond de son cœur, d’une tristesse ancienne. Il avait eu beau vivre dans le plaisir, elle n’avait fait que s’accroître. Elle l’avait tenu, selon l’aveu qu’il en a écrit, « muet et accablé, pendant ce qu’on appelle les fêtes ». Depuis lors, elle n’avait été dissipée ni par les sciences humaines, ni par l’action, ni par le succès et la réputation. Aujourd’hui sans doute, il s’était soumis à une discipline de travail, et, par là, il se sentait meilleur que dans le passé, mais non point allégé de ses fautes, non point tel qu’il aurait dû être, bien loin moralement de ces êtres chers qu’il voyait vivre dans sa famille unie et heureuse.
Il lisait beaucoup. Mais une grande lâcheté secrète est en nous, lorsqu’il s’agit de reprendre une règle de vie que nous savons sévère et réprimante. Nous cherchons l’à peu près pour ne pas en venir à l’idéal de perfection, et la nature frémissante nous fait demander conseil aux hommes plutôt qu’à Dieu, parce que nous savons que Dieu est exigeant. C’est ainsi que Charles de Foucauld, aux heures où cessait le travail de rédaction de la Reconnaissance au Maroc, ouvrait les livres des philosophes païens, et les interrogeait sur le devoir, l’âme, la vie future. Les réponses lui semblaient pauvres. Elles le sont nécessairement. La raison ne va pas loin sans guide dans le problème de la création et de la destinée. Charles avait l’esprit trop net pour se contenter du bruit des mots et de l’éclat des images. Il savait aussi que la philosophie des temps anciens n’avait rien purifié, rien adouci, rien consolé, et il serait revenu, sans doute, à la formule d’absolu scepticisme adoptée dès le collège : « Les hommes ne peuvent connaître la vérité », si le spectacle de la petite société choisie où il se trouvait replacé n’avait chaque jour ébranlé l’autorité fragile de cette conclusion.
La probité, la délicatesse, la charité devenue habitude et comme naturelle, la joie aussi de ces consciences voisines qui ne se cachaient pas de lui, et où il pouvait lire, l’obligeaient à de perpétuels retours sur lui-même. Voici, se disait-il, des hommes, des femmes, tous cultivés, quelques-uns tout à fait supérieurs par l’intelligence : puisqu’ils acceptent entièrement la foi catholique, ne serait-ce pas qu’elle est vraie ? Ils l’ont étudiée, ils la vivent pleinement. Et moi, et moi, qu’est-ce que je connais d’elle ? Sincèrement, connaissé-je le catholicisme ?
La seule inquiétude de ces choses est déjà une prière, et Dieu l’écoutait. Quelques pages d’un livre chrétien qu’il avait ouvert après tant d’autres, dans un moment d’angoisse, – j’ignore quel était ce livre, – commencèrent d’éclairer cet incroyant, qui avait cherché la beauté parfaite et la tendresse infinie partout où elles ne sont pas.
Il est probable que sa tante, ses cousines, sa sœur qui vint plusieurs fois le voir à Paris, et qu’il aimait tendrement, avaient quelque soupçon de ce travail intérieur qui amenait à la vérité une intelligence et un cœur dévoyés. Elles ne le hâtaient par aucun moyen humain. Elles étaient bonnes, elles suivaient la route droite, elles priaient. Ce fut par hasard qu’un soir, chez Mme Moitessier, Charles rencontra l’abbé Huvelin, qui était lié, depuis longtemps, avec plusieurs personnes de la famille de Foucauld. Étant très humble, très simple, très homme d’oraison et de mysticité, cet ancien normalien fit grande impression sur celui qui devait lui ressembler un jour. Que dit-il ce soir-là ?
Il est très sûr qu’il n’essaya pas de briller. S’il eut de l’esprit, c’est qu’il ne pouvait faire autrement que d’en avoir. Les amitiés comme celle qui allait naître entre Charles de Foucauld et lui n’ont point, d’ailleurs, leur origine dans les mots, ni dans l’éclat du talent, ni dans la volonté de conquérir. Un homme incroyant, et qui a mal vécu, se trouve en présence d’un autre homme, non seulement croyant et chaste, mais devenu la prière même, la pitié même pour l’immense faiblesse et souffrance humaine, peut-être plus, comme on l’a dit : l’une des victimes qui, secrètement, s’offrent à Dieu pour souffrir, réparer le mal, adoucir le châtiment d’autrui[29]. Ces deux hommes peuvent n’avoir échangé que des phrases banales ; s’être salués seulement, puis regardés l’un l’autre, cinq ou six fois, dans une soirée : cela suffit, ils se sont reconnus ; ils s’attendaient ; dans leur cœur, ils nommeront désormais cette rencontre un grand événement. L’un a pensé : « Vous êtes la religion ! » L’autre : « Mon frère qui êtes malheureux, je ne suis qu’un pauvre homme, mais mon Dieu est très doux, et il cherche votre âme pour la sauver. » Ils ne s’oublieront plus.
L’abbé Huvelin, né en 1838, était donc, en 1886, un homme encore jeune, bien qu’il n’y parût guère : la vie pénitente qu’il menait depuis sa première jeunesse, et qui avait fait sourire ou s’émouvoir ses camarades de l’École normale ; la fatigue d’être et d’avoir été à la merci de toutes les douleurs en quête d’allégement, de toutes les inquiétudes humaines cherchant une décision ; la maladie aussi, une sorte de rhumatisme généralisé, qui déjà l’éprouvait, ne lui laissaient guère que la jeunesse d’un esprit prompt et d’un cœur très sensible. Il tenait la tête penchée sur l’épaule ; il avait le visage creusé de rides ; la marche lui était souvent un supplice. Ce vicaire à Saint-Augustin avait, dans Paris, une terrible clientèle de pénitents, des relations innombrables, et, ce qui compliquait encore singulièrement sa vie, la réputation d’un saint homme.
La sainteté est le plus puissant attrait qui rassemble les âmes. La sienne s’était promptement révélée dans les conférences qu’il faisait aux jeunes gens, depuis 1875, sur l’histoire de l’Église. Malgré ses protestations, il avait vu des femmes en grand nombre, et des hommes ayant dépassé la jeunesse, se mêler au public auquel ses conférences de la crypte étaient d’abord réservées. Il parlait aussi dans la chaire de la paroisse, et on se pressait pour entendre ce causeur qui ne récitait pas, ne cherchait pas à étonner, mais improvisait sur un thème toujours très étudié, laissant vivre et s’exprimer au naturel un esprit jaillissant, prudent en doctrine, hardi devant les mots qu’il faut dire, abondant en réminiscences de littérature ou d’histoire, homme de la digression, de la parenthèse, de l’exclamation, du trait inattendu, avant tout de la longue expérience du monde et de la miséricorde. Par là, il était près de chacun de ses auditeurs ; par là, il était l’ami sûr et souhaité. Sa pitié pour les pécheurs, on peut dire sa tendresse, touchait les plus indifférents. On sentait qu’il les voulait meilleurs pour qu’ils fussent plus heureux, et qu’il pensait toujours, pour ceux qui n’y songeaient guère, à l’heure définitive où ils paraîtraient devant Dieu, où ils seraient jugés, condamnés, malheureux, sans espoir de mourir, car la mort n’existe pas, même un instant : il n’y a que deux vies.
Le zèle extrême de l’abbé Huvelin, ses démarches, les visites qu’il faisait et celles qu’il recevait, son immense correspondance, – des billets courts, affectueux et nets, – le redoublement d’austérité dont, à certaines périodes, on eut la preuve sans en savoir exactement les causes : tout s’explique par cet amour des âmes aventurées.
Pour une autre raison encore, et bien puissante, il était un conseiller auquel on venait tout de suite : il avait l’intelligence de la douleur humaine. Il y compatissait ; quelle qu’elle fût, il l’avait déjà rencontrée, écoutée, relevée. Jamais elle n’avait pour lui un visage inconnu. Il disait d’elle en simplifiant, en dépouillant de la majesté du dix-septième siècle un mot de Bossuet : « La douleur nous donne le charme. » Dans le même esprit, il définissait ainsi l’Église : « L’Église est une veuve. » Et ce mot à une femme du monde est encore de lui :
– J’ai trouvé depuis longtemps le moyen d’être heureux.
– Quel est-il ?
– C’est de se passer de joies.
Mais pour mieux faire comprendre jusqu’où vont de telles paroles, il faut en citer d’autres, et je le ferai, d’après un de ses auditeurs. Du même coup on entendra parler l’orateur. Ce ne sera point un hors-d’œuvre, puisqu’il s’agit du prêtre qui va convertir Charles de Foucauld et faire de lui le Père de Foucauld[30].
« Jésus est l’homme des douleurs, parce qu’il est le Fils de l’homme, et l’homme n’est que douleur. La douleur nous accompagne de la naissance à la mort, elle nous purifie, nous ennoblit, elle nous donne le charme. C’est parce qu’elle est notre inséparable compagne que Jésus a voulu qu’elle fût sienne.
« De grandes âmes – il en faut, pour l’honneur de l’humanité, qui reproduisent les états du Christ – ont appelé, désiré la douleur. Elles ont prononcé le Fac me tecum plangere du Stabat. Nous n’avons pas une telle ambition. Nous demandons seulement d’accepter la douleur avec componction et résignation, quand elle s’offrira.
« Loin de nous surtout ces petites douleurs, moins aisées à supporter que les grandes, ces blessures si mesquines, si rageuses, si envenimées que font les passions, l’amour-propre ! C’est la honte de l’humanité de tant souffrir pour si peu de chose.
« Jésus au Jardin des Oliviers. Il est triste jusqu’à la mort. Les apôtres ne comprennent pas sa tristesse ; cette tristesse divine les dépasse trop. Pour la comprendre, il faudrait savoir ce qu’est le péché. Et ils ne savent pas, et nous ne pouvons le savoir.
« Son attitude n’est pas une attitude grecque. Il ne domine pas sa tristesse, ne dit pas, comme ferait un stoïcien : « Douleur, tu n’es qu’un mot ! » Oh ! que non ! La tristesse l’envahit par tous les pores ; son âme en est inondée ; elle a monté comme une mer, noyé tous les sommets.
« Il prie, mais sa prière n’est pas ce mouvement naturel, cette respiration heureuse de l’âme ; elle n’est pas non plus une suite de belles pensées : c’est un sanglot, un sanglot qui se résout en un amen. Ainsi soit-il ! c’est toute sa prière. Sa volonté, unie, identifiée jusqu’ici à celle du Père, pour la première fois apparaît distincte. Le poids est trop lourd : « Vous à qui tout est possible, éloignez de moi ce calice ! »
« Il cherche secours auprès de ses apôtres : il les trouve endormis. L’on est seul dans la tristesse, alors qu’on voudrait un mot du cœur. Les amis n’arrivent qu’aux moments de calme, ou, s’ils surviennent pendant l’orage, ils ne trouvent pas ce qu’il faut dire, et blessent par leur manque de tact ou leur sottise. Tels les amis de Job.
« Enfin, un ange vient le fortifier : angelus confortavit eum. Le fortifier, non le consoler. La grâce, de son essence, est fortifiante, non consolante… »
Je ne puis citer plus longuement sans dépasser mon but. Ce qu’on vient de lire, ce que j’ai dit, suffit à faire comprendre pourquoi toutes les misères humaines, tous les doutes et tous les repentirs allaient naturellement à l’abbé Huvelin. Il confessait à Saint-Augustin, il recevait beaucoup chez lui. Quel robuste et agile esprit devait avoir ce malade et ce perclus, pour imaginer, successivement, tous les problèmes d’ordre moral qu’on lui soumettait, pour les étudier et les résoudre en un moment ! Mais il était doué d’un jugement si sûr qu’il débrouillait tous les cas, et d’une vue si pénétrante des dispositions intimes des personnes qui le consultaient, que plusieurs l’ont attribuée à une grâce singulière de Dieu. On cite même des circonstances où il a fait allusion à des événements passés et secrets de la vie de ses pénitents. Ses avis étaient clairs, simples, de bon sens, et il n’en changeait pas. Il les variait selon les gens. Il ne traitait pas les ours comme les hirondelles. Plus d’une fois, on l’a entendu répéter : « Il y a des âmes auxquelles on doit dire : il faut en passer par là ! Il y a, dans les décisions canoniques, une force avec laquelle ceux qui les méprisent comptent plus qu’on ne croit. » D’habitude, on trouvait chez lui, l’après-midi, ce grand érudit dans les directions spirituelles. On rencontrait, dans sa petite antichambre, des gens de tous les âges et de tous les mondes, des Parisiens et des passants. À tour de rôle, ils entraient dans la pièce voisine, encombrée de livres et de papiers, où se tenait M. Huvelin, assis, résigné à la foule comme à la maladie, un chat sur les genoux. Les visiteurs qui lui avaient été présentés, même dans le lointain passé, étaient sûrs d’être reconnus. Il écoutait de tout son esprit. Comme il était bref, il demandait qu’on fût de même. Sa mission était rude. Lui, naturellement gai, on l’a vu bien souvent pleurer : il souffrait de toutes les douleurs qu’on lui apportait, de toutes les fautes dont il recevait l’aveu, ou qu’il devinait dans les cœurs.
Tel était le prêtre éminent en sainteté, c’est-à-dire en science de Dieu et des hommes, que Charles de Foucauld avait rencontré, un soir de l’été finissant. Ils ne se revirent pas tout de suite. Mais, dans l’âme de Charles, la grâce montait sa marée. On ne sait d’abord d’où elle vient. Elle est promise aux hommes de bonne volonté, ou plutôt elle leur est déjà donnée, et leur bonne volonté même est son œuvre. Au moment qu’elle semblait loin, elle a déjà couvert les fonds vaseux ; elle est fraîche ; elle amène ses oiseaux avec elle, et ses vagues qui déferlent, l’une après l’autre, disant toutes : « Il faut croire, être pur, être joyeux de la grande joie divine, et recevoir la lumière sur les eaux vivantes. » Cet obscur mouvement, ce désir d’illumination, il les sentait en lui, de plus en plus puissants. On le voyait, à présent, entrer dans les églises, entre deux courses, ou à la tombée de la nuit ; il s’asseyait, loin de l’autel, ne comprenant ni ce qui l’avait attiré là, ni ce qui l’y retenait, et il disait, non pas ses prières d’autrefois, mais celle-ci, qui monte droit au paradis : « Mon Dieu, si vous existez, faites-le moi connaître ! »
Un soir d’octobre, dans une de ces conversations familiales, où l’esprit et le cœur parlent librement et sans chercher la route, les enfants jouant autour des tables avant d’aller se coucher, une de ses cousines dit à Charles : « Il paraît que l’abbé Huvelin ne reprendra pas ses conférences ; je le regrette bien. – Moi aussi, répondit Charles, car je comptais les suivre. » La réponse ne fut pas relevée. Quelques jours plus tard, il dit, gravement, à cette même cousine : « Vous êtes heureuse de croire ; je cherche la lumière, et je ne la trouve pas. »
Entre le 27 et le 30 octobre, le lendemain de cette confidence, l’abbé Huvelin vit entrer dans son confessionnal, à Saint-Augustin, un jeune homme qui ne s’agenouilla pas, qui se pencha seulement, et dit :
– Monsieur l’abbé, je n’ai pas la foi ; je viens vous demander de m’instruire.
M. Huvelin le regarda :
– Mettez-vous à genoux, confessez-vous à Dieu : vous croirez.
– Mais je ne suis pas venu pour cela.
– Confessez-vous.
Celui qui voulait croire sentit que le pardon était pour lui la condition de la lumière. Il s’agenouilla, et confessa toute sa vie.
Quand il vit se relever le pénitent absous, l’abbé reprit :
– Vous êtes à jeun ?
– Oui.
– Allez communier !
Et Charles de Foucauld s’approcha aussitôt de la table sainte, et fit sa « seconde première communion ».
De sa conversion, il ne parla point. Ce fut à certains actes qu’on s’aperçut, et peu à peu, que le fond de l’âme était changé. La vie continua d’être laborieuse ; la paix y était rentrée, et elle transparaît toujours : dans les yeux, dans le sourire, ou la voix, ou les mots. Les lettres, qui n’avaient pas cessé d’être affectueuses, deviennent reconnaissantes. Le nom de Dieu y est souvent prononcé. La vie se modèle, silencieusement, sur l’idéal retrouvé. Tout est profond, discret, simple dans ce renouvellement.
Bientôt, par exemple, Charles apprendra la naissance d’un neveu, qui sera son filleul ; il partira pour Dijon, passera quelques jours près de sa sœur et de son beau-frère, et, à peine de retour à Paris, leur adressera ce remerciement dicté par un cœur rajeuni :
« Les séjours qu’on fait chez vous sont bien doux ; ils ne méritent qu’un reproche : c’est qu’on est entouré de tant de bonté et de tant d’affection qu’on se sent le cœur trop faible pour rendre autant qu’on a reçu, et on craint de n’aimer jamais assez, de n’admirer jamais assez et de n’être jamais assez reconnaissant. La vie, dans votre intérieur, non seulement est d’une douceur extrême, mais encore rend meilleur, par l’air d’affection et de calme qui s’y respire. J’espère que je pourrai revenir bientôt. En vous quittant, le retour est la seule chose à laquelle je pense ; je ne crois pas beaucoup à l’exécution des projets, mais si je ne compte pas sur mes prévisions, je garde l’espoir que quelque imprévu m’amènera chez vous avant qu’il soit longtemps.
« Vous savez mes occupations, mes idées, mes pensées vagues sur l’avenir ; nous en causions hier soir ; vous me suivrez facilement d’ici à notre revue. Pour moi, ce m’est une si grande joie, en vous quittant, de connaître tous les lieux entre lesquels vous partagez votre temps ! Je suis, en vous écrivant, auprès de vous à Dijon ; après-demain, je vous suivrai à Échalot ; je chasserai avec vous ; je traînerai la brouette avec Maurice ; j’admirerai la bibliothèque de M. de Blic ; je me chaufferai en famille au coin du feu. Je vais être bien souvent et bien agréablement avec vous, maintenant que je connais tous vos nids. »
Le manuscrit de la Reconnaissance au Maroc avait été achevé au début de 1887, et, tout de suite, les épreuves d’imprimerie avaient commencé d’affluer dans l’appartement de la rue de Miromesnil. Gros travail pour un savant aussi soigneux du détail, et qui voulait que l’œuvre fût habillée comme il l’était lui-même au temps de l’école de cavalerie ! Lourde charge, pour un budget que le voyage aux Chotts, dix excursions en France et l’installation à Paris avaient déjà grevé ! « Mes revenus suffisent à ces dépenses extraordinaires, mais juste ; aussi, depuis mon retour du Maroc, je n’ai pas eu à emprunter quoi que ce soit, mais je n’ai pas fait d’économies. J’ai le désir de faire lever mon conseil judiciaire, que j’ai depuis cinq ans… Mon conseil existant, je ne puis penser à d’autres voyages, et, mon livre allant paraître, il est temps de songer à de nouvelles expéditions[31]. »
À la fin de 1887 et au début de 1888, les ouvrages du vicomte de Foucauld, Itinéraires au Maroc, Reconnaissance au Maroc, paraissent en librairie. Le succès, ainsi que je l’ai dit, en fut très grand, dans le monde restreint des géographes, des savants et des coloniaux, soit de France, soit des pays étrangers. Mais quand un grand livre paraît, les gens qui en parlent sont de deux sortes, et ressemblent à la lune avec son halo : les uns ont lu ces pages célèbres et en portent avec eux la lumière et les idées ; les autres en ont du moins quelque clarté ; ils ont parcouru des pages ; ils ont retenu des citations ; ils répètent le titre et magnifient l’auteur, sur la foi du prochain journal, revue ou causeur de salon. Ainsi en est-il aussitôt pour la Reconnaissance au Maroc. On célèbre, de tous côtés, le jeune explorateur ; sa renommée se répand ; les lettres de félicitations affluent rue de Miromesnil ; des amis montent les étages, et viennent demander, chacun rappelant ses titres au souvenir du glorieux camarade : « Eh bien ! mon vieux, en voilà un succès ! Bien légitime, d’ailleurs ! En as-tu couru des dangers que tu ne racontes pas ! Où vas-tu aller maintenant ? Car tu nous dois, et tu dois à toi-même des explorations nouvelles ! »
L’autre, on le sait déjà, n’était pas de ceux qui discutent leurs projets en public. Les méditer avec de rares initiés lui a toujours semblé meilleur. Avant de partir pour le Maroc, il avait consulté Mac Carthy, et des livres, et des atlas. À présent, il prend conseil de Dieu, qui a résolu de prendre l’explorateur à son service. La nature n’est pas détruite par cette conversion, mais amendée et renouvelée. Désormais, ce courage, cette force de volonté, cette faculté extraordinaire d’endurance vont s’exercer pour le bien des âmes. La science n’a pas perdu un des hommes les mieux doués de notre temps pour l’aventure coloniale, l’étude des mœurs et des langues inconnues ; mais son disciple, qui ne la reniera jamais, aperçoit maintenant que le plus bel emploi des dons qu’il a reçus s’appelle charité, et consiste dans l’oblation totale qu’on fait de soi-même, de son travail, de sa pensée, de sa patience, de son sang s’il le faut, pour que les hommes reconnaissent enfin le Créateur dans ce dévouement de la créature. Il veut se préparer à cette mission par un voyage en Terre sainte. Il visitera la patrie terrestre de Jésus-Christ ; il ira prier dans la solitude qui n’a cessé de l’attirer.
Le 2 novembre 1888, il se rend au Tuquet, dans le Bordelais ; de là il gagne Nancy. Ce sont les adieux à la famille. Il annonce que son projet est de séjourner seulement quelques semaines en Terre sainte. Et il s’embarque à Marseille.
Au milieu de décembre, il est à Jérusalem, qu’il trouve couverte de neige ; il s’attarde à parcourir les rues, à visiter les églises, à monter et descendre la pente du mont des Oliviers ; il passe Noël à Bethléem, puis fait une grande excursion en Galilée, à cheval, accompagné d’un guide qui monte lui-même un cheval de bât. Dans ses lettres, il montre une dévotion vive pour Nazareth. Après avoir quitté cette ville, il y revient. Là, plus tendrement qu’ailleurs, il médite. Et si l’on veut connaître le thème principal de cette méditation, je puis l’indiquer. Cette ville blanche, aux rues escarpées et tournantes sur les flancs du Nébi-Saïn, a touché le cœur pénitent de Charles de Foucauld. Elle lui inspire un amour, qui ne s’éteindra plus, pour la vie cachée, l’obéissance, l’humble condition volontaire. Elle lui répète le mot magnifique qu’avait dit l’abbé Huvelin : « Notre-Seigneur a tellement pris la dernière place, que jamais personne n’a pu la lui ravir. » Je crois pouvoir affirmer que tout le reste de la vie de Foucauld a été travaillé et modelé par le souvenir de Nazareth.
On le vit clairement, dès que le voyageur fut rentré à Paris, au début de mars 1889. C’est l’année des résolutions, ou, en style de spiritualité, de l’élection. Que va-t-il faire ?
Depuis sa conversion, il lisait encore plus qu’auparavant, mais d’autres livres, et ses lectures le faisaient pénétrer dans ce monde de la doctrine, de la morale et de l’histoire religieuse, par quoi tout le reste est illuminé. Il s’émerveillait de voir combien la vérité est simple et combien raisonnable ; il s’étonnait qu’il eût pu être troublé autrefois, jusqu’à douter de la religion, jusqu’à la rejeter, par des objections depuis si longtemps résolues et faciles à résoudre. Il apprenait la première des sciences, celle d’où dépend la conduite de la vie. Selon le conseil de l’abbé Huvelin, il assistait chaque matin à la messe, et la fréquente communion du début était devenue le pain quotidien.
On sait déjà quel soin il avait apporté à la préparation de son principal voyage. À plus forte raison voulut-il étudier la vocation qui, de plus en plus fortement, l’attirait. Depuis le moment même de sa conversion, il s’était senti appelé à la vie religieuse. Mais les ordres sont nombreux. S’ils sont tous faits pour conduire au paradis, les hommes qui s’y engagent sont différents : chacun a son humeur, même au service de Dieu, et doit avoir son chemin. Lequel prendre ?
Pour le connaître, dans cette même année, Charles ne fait pas moins de quatre retraites. Il s’approche successivement de la règle vivante de trois grands ordres. À Pâques, il est chez les bénédictins, à Solesmes ; à la Trinité, il part pour la Grande-Trappe ; le 20 octobre, il monte à Notre-Dame-des-Neiges, passe en méditation toute une semaine, après quoi il ne prend point encore de résolution. Enfin, dans la seconde moitié de novembre, ayant repris, sous la direction d’un jésuite, à Clamart, l’examen des premières vérités et l’étude de sa vocation religieuse, l’ancien lieutenant de chasseurs d’Afrique, l’explorateur d’hier, écrit à sa sœur :
« Je suis revenu hier de Clamart, et j’y ai pris enfin, en grande sécurité et en grande paix, d’après le conseil formel, entier et sans réserve, du père qui m’a dirigé, la résolution à laquelle je pense depuis si longtemps : c’est celle d’entrer à la Trappe. C’est une chose arrêtée maintenant ; j’y pensais depuis longtemps, j’ai été dans quatre monastères ; dans les quatre retraites, on m’a dit que Dieu m’appelait, et qu’il m’appelait à la Trappe. Mon âme m’attire vers le même lieu, mon directeur est du même avis… C’est une chose décidée, et je vous l’annonce comme telle. J’entrerai dans le monastère de Notre-Dame-des-Neiges, où j’ai été il y a quelque temps… Quand ? Ce n’est pas encore fixé, j’ai diverses choses à régler, j’ai surtout à aller vous dire adieu. Mais enfin, cela ne sera jamais excessivement long.
« Quand je partirai, j’annoncerai mon départ pour quelque voyage, sans dire en aucune façon que j’entre, ni que je pense le moins du monde à entrer dans la vie religieuse. »
Il avait obtenu l’assentiment de l’abbé de Notre-Dame-des-Neiges. Mais, dans sa lettre de demande, il avait nommé la Trappe d’Akbès, en Syrie, et prié qu’après quelques mois de probation et de noviciat, il fût envoyé dans cette maison lointaine, « si cela est, comme je le crois, la sainte volonté de notre Père qui est aux cieux ».
Les plus proches parents furent seuls avertis de la grande décision. Les jours sont désormais comptés. Charles part le 11 décembre pour Dijon ; il y passe, près de sa sœur et de M. de Blic, une semaine, la dernière qu’il leur pourra donner avant la clôture, la solitude et le silence. Puis il revient à Paris, pour régler quelques affaires, notamment l’abandon qu’il fait de ses biens à sa sœur.
Il s’en ira pauvre. Le monde ne le reverra plus. Un de ses amis aperçoit Charles sur l’impériale d’un omnibus, et s’étonne grandement. Encore quelques jours, et les lettres d’invitation à l’adresse du vicomte de Foucauld, rue de Miromesnil, resteront sans réponse. Une de ses cousines le prie de venir manger du chevreuil d’Alsace, du chevreuil de Saverne, et Charles, d’habitude très exact, ne donne pas signe de vie. On s’informe. On apprend qu’il a quitté Paris.
Le 14 janvier 1890, il avait envoyé à sa sœur cette lettre d’adieu :
« Au revoir, ma bonne Mimi, je quitte Paris demain ; après-demain, vers 2 heures, je serai à Notre-Dame-des-Neiges. Prie pour moi, je prierai pour toi, pour les tiens. On ne s’oublie pas en se rapprochant de Dieu… »
Il lui avait dit, à Dijon, quelques semaines plus tôt : « Soyons tristes, mais remercions Dieu de cette tristesse. »
CHAPITRE V – LE TRAPPISTE
Pour comprendre la vie extraordinaire du Père de Foucauld, il faut considérer deux faits spirituels sur lesquels tout a été bâti : premièrement, la passion dont il était épris pour le monde oriental, et qui n’était point, je l’ai dit, un amour de la couleur et du pittoresque seulement, mais avant tout une prédilection pour la solitude, le silence, l’extrême simplicité de costume, de nourriture et d’habitation à laquelle on s’y peut réduire sans singularité ; en second lieu, l’énergie, la violence intérieure de cette volonté, qui poursuivra la perfection évangélique avec la même ardeur, la même ténacité, la même absence de toute peur qu’on a remarquées dans le jeune officier entreprenant son voyage au Maroc.
La conversion a été totale. Charles de Foucauld s’est entièrement abandonné à la volonté divine, pour être ce qu’elle voudra. Il sait déjà qu’il la doit servir dans la charité et dans l’obscurité. D’étape en étape, il apprendra le reste ; il ira où l’appelleront les âmes les plus négligées de l’univers, et, dur à son corps autrefois maître, cherchera par amour à se rapprocher de la misère de son Dieu fait homme.
En ce moment, toute cette suite est pour lui cachée ; il a seulement cette clarté : la résolution d’obéir et le désir passionné du mieux. De même, autour de lui, personne ne se doute en quelles voies exceptionnelles il sera conduit un jour. Et si l’on s’étonne qu’un conseiller aussi expérimenté et sagace que l’abbé Huvelin n’en ait rien pressenti, il faut répondre que les mieux doués d’entre nous ne le sont pas pour découvrir l’avenir ; qu’au surplus, le monde a été créé en six jours, et que Dieu n’agit point autrement pour transformer une âme, qui est un monde aussi ; qu’il use de ménagements pour notre faiblesse, et ne permet pas tout de suite aux événements de se plier à de certains rêves de perfection, qui ne lui déplaisent pas sans doute, et viennent même de lui, mais qu’il nous veut faire atteindre par degrés, lorsque notre patience exercée nous aura rendus plus prudents et plus forts.
J’ai voulu visiter la Trappe de Notre-Dame-des-Neiges. Elle est bâtie sur les hauts plateaux des monts du Vivarais, dans une contrée sauvage, qui dépendait autrefois du Languedoc[32]. Lorsqu’on est arrivé sur ces crêtes, balayées par le vent, vêtues de courtes bruyères, qui enveloppent le monastère, on ne voit autour de soi, à d’immenses distances, que des sommets à peu près d’égale hauteur, tendant à la lumière leur pierraille et leur maigre verdure, et séparés les uns des autres par l’ombre violette des ravins. Il n’y a pour ainsi dire point de fermes sur les hauteurs ; une ou deux seulement, au corps trapu, au toit surbaissé, fait pour porter six mois de neige et de tempête. Je venais de loin, par un chemin qui suit les crêtes. Le chemin descendit un peu ; l’automobile entra dans une avenue que bordaient deux bois de jeunes pins et de hêtres, puis, tout à coup, sortant de l’ombre, courut de nouveau dans le soleil et les larges espaces. Devant moi, à mi-coteau, se dressait le monastère de granit blanc, avec ses granges, ses celliers, ses étables, ses écuries ; une forêt, semée par les moines, couvrait les pentes de la montagne en face, et tout le vallon, entre les deux grands bois, n’était qu’un fleuve ondulant d’avoine mûre et de blé mûr.
Le monastère, tel qu’il est aujourd’hui, n’est plus celui où fut accueilli Charles de Foucauld. Les cellules des religieux, la salle capitulaire, l’église, ont été détruites par un incendie, le 27 janvier 1912. Mais les moines semeurs de forêts sont aussi des rebâtisseurs. Ils ont reconstruit, dans un site plus élevé et encore plus beau que l’ancien, à 1 100 mètres d’altitude, une abbaye nouvelle, claire, sobre de lignes, où la cloche parle seule, où s’abritent le travail et la paix cistercienne[33].
Quand Charles de Foucauld se présenta à Notre-Dame-des-Neiges et demanda d’être admis parmi les novices, on l’interrogea. La règle de Saint-Benoît prescrit aux supérieurs d’examiner soigneusement les postulants, de les éprouver en les interrogeant, afin de bien connaître et la personne de ces futurs frères, et les motifs qui les ont amenés à la porte de l’abbaye. Dom Martin, abbé de cette communauté de travailleurs silencieux, n’ignorait pas que l’homme qui parle de soi volontiers se déclare ainsi porté à la complaisance et à la vanterie. Il demanda :
– Que savez-vous faire ?
– Pas grand’chose.
– Lire ?
– Un petit peu.
L’abbé vit par là, et par bien d’autres réponses du même ton, que ce lieutenant de chasseurs d’Afrique était, au contraire, peu causant et déjà fort modeste. Ayant fini de l’interroger, il le pria de balayer un peu, pour voir. Il s’aperçut, au premier coup de balai, que le postulant n’avait pas été exercé. On compléterait son éducation.
Et c’est ainsi que le vicomte Charles de Foucauld entra au noviciat de la Trappe de Notre-Dame-des-Neiges, pour devenir Frère Marie-Albéric.
Le souvenir qu’il a laissé parmi les frères de ce grand ordre est celui d’un religieux serviable envers tous, très pieux, presque excessif dans son austérité, mais pondéré dans son jugement ; en somme, le souvenir d’un personnage et d’un saint. J’emploie ce terme comme tous ceux qui ont connu le Père de Foucauld : ils savaient bien, ces religieux, ces soldats, ces voyageurs, que seule l’Église a le droit de juger de la sainteté. En attendant qu’elle se prononce, si elle doit se prononcer un jour, ils ont suivi l’usage du monde, ils ont dit : j’ai vu un saint. Et comment pourrions-nous mieux dire, et plus bref, qu’en l’appelant ainsi, notre admiration pour un homme en qui nous semble vivre une vertu peu commune ? Frère Marie-Albéric édifiait surtout le monastère par son humilité. Il était simple à la perfection, et savait comment faire, étant un homme du meilleur monde qui se mettait, par vertu, au dernier rang : l’éducation sert à tout, même à se faire oublier, même à passer inaperçu, ou à tâcher de l’être. Un des moines de là-bas, faucheur de blé, toucheur de bœufs, que j’interrogeais, me répondit ce mot magnifique :
– Monsieur, je lui parlais comme à un paysan !
Il ajouta :
– Moi, je l’ai vu tous les jours ; il n’a jamais refusé un service à personne ; il était beau comme un second François d’Assise !
Le régime de la Trappe éprouve plus d’un novice solidement bâti. Frère Albéric avait une santé de fer et une volonté de même métal. Il a maintes fois déclaré que ni le jeûne, ni les veilles, ni le travail ne l’avaient jamais incommodé. La seule chose qui lui fut difficile, c’est l’obéissance, et là encore nous saisissons un trait de cette nature fière, impétueuse, faite pour le commandement, habituée à l’exercer, et qui ne pliait que sous la grâce[34].
Je citerai à présent un certain nombre de lettres écrites de Notre-Dame-des-Neiges, par Frère Albéric, soit à sa sœur, soit à d’autres personnes de sa famille. Elles feront connaître mieux que ne ferait un récit ce que pensait, dans la solitude, le novice que gouvernait un religieux très capable, un digne fils de saint Bernard, l’abbé dom Martin.
Entré au noviciat le 16 janvier 1890, il écrivait, le jour même, dans la peine que lui causait la séparation :
« … Il faut tirer la force de ma faiblesse, se servir pour Dieu de cette faiblesse même, le remercier de cette douleur, la lui offrir… Je lui demande de tout mon cœur d’augmenter ma douleur si je puis porter un plus grand poids, afin qu’il en soit un peu plus consolé et que ses enfants en aient un peu plus de bien ; qu’il la diminue si elle n’est pas pour sa gloire et selon sa volonté, mais je suis sûr qu’il la veut, lui qui a pleuré Lazare… »
Dans la seconde lettre, il annonce qu’il prendra l’habit des trappistes le 26 janvier, en la fête de saint Albéric.
« Il est probable que je donnerai ma démission d’officier de réserve, en indiquant Akbès comme ma résidence, ce qui simplifiera tout.
« Je continue à aller parfaitement bien. J’ai mené la vie régulière dès le premier jour ;… et mon âme, comment va-t-elle ? Moins mal que je ne m’y attendais : le bon Dieu me fait trouver dans la solitude et le silence une consolation sur laquelle je ne comptais pas. Je suis constamment, absolument constamment avec lui, et avec ceux que j’aime. Cette vie continuelle avec tout ce qui m’est cher au ciel et sur la terre m’a donné des consolations, sans combler le vide, mais enfin le bon Dieu m’a soutenu lui-même pendant ces premiers jours… Le travail manuel n’empêche pas la méditation ; on me recommande de travailler posément pour pouvoir méditer…
« Je n’ai pas souffert un instant du froid ; jusqu’à présent il n’y a pas de neige et il fait du soleil ; il y aura sans doute des moments durs, mais il n’y en a pas encore eu ; je n’ai pas souffert de la faim non plus [35] et, grâce à la variété des travaux et des exercices, je n’ai pas senti que j’avais faim avant de me mettre à table. C’est vous dire que le côté matériel de la vie ne m’a pas coûté l’ombre d’un sacrifice.
« … Jusqu’ici j’ai porté des branches, fait des guirlandes pour l’adoration perpétuelle, balayé l’église, astiqué les chandeliers : rien de dur, vous le voyez. »
« 6 février 1890. – Dans ce triste monde, nous avons au fond un bonheur que n’ont ni les saints, ni les anges, celui de souffrir avec notre Bien-Aimé, pour notre Bien-Aimé. Quelque dure que soit la vie, quelque longs que soient ces tristes jours, quelque consolante que soit la pensée de cette bonne vallée de Josaphat, ne soyons pas plus pressés que Dieu ne le veut de quitter le pied de la Croix… Bonne Croix, disait saint André. Puisque notre Maître a daigné nous en faire sentir, sinon toujours la douceur, du moins la beauté et la nécessité pour qui veut l’aimer, nous ne désirerons pas en être détachés plus tôt qu’il ne veut… Et pourtant, Dieu sait que le jour où cet exil finira sera le bienvenu, car la force est dans mes paroles plus que dans mon cœur[36]… »
Il lit saint Bernard, apprend par cœur les psaumes, le catéchisme, la façon de se servir du bréviaire ; il fait une heure d’Écriture sainte et lit l’abbé Fouard, Bossuet, l’Imitation, les Évangiles, la vie de sainte Gertrude, les œuvres de sainte Thérèse.
« 18 février 1890. – De moi, j’ai peu de choses à te dire. Aucun bruit du dehors ne nous atteint : c’est la solitude et le silence avec le bon Dieu. Le temps se partage en prière, lectures rapprochant de Dieu, travail manuel fait en imitation de lui et en union avec lui. Cela remplit tous les jours, sauf les dimanches et fêtes où le travail cesse… Je pourrai vivre longtemps ainsi sans avoir à te parler beaucoup de moi… On est excellent pour moi, d’une charité pleine de tendresse ; une grande charité règne dans le couvent ; je reçois de ce côté, et de bien d’autres, des exemples dont il faut prier le bon Dieu de me faire profiter. »
« Lundi de Pâques 1890. – Je ne dois pas dire que j’ai bien supporté le jeûne et le froid, je ne les ai pas sentis… ; du régime du carême (un seul repas par jour à 4 heures et demie[37] je ne puis dire qu’une chose : je l’ai trouvé agréable et commode, et je n’ai pas senti la faim un seul jour. Pourtant je ne me gavais pas trop.
« Pour mon âme, elle est absolument dans le même état que lors de ma dernière lettre, la seule différence est que le bon Dieu me soutient encore plus ; il soutient également mon âme et mon corps ; je n’ai rien à porter : il porte tout. Je serais bien ingrat envers ce père si tendre, envers Notre-Seigneur Jésus si doux, si je ne vous disais pas combien il me tient dans sa main, me mettant dans sa paix, écartant de moi le trouble, le chassant, chassant la tristesse dès qu’elle veut approcher… Cet état est trop inattendu pour que je puisse l’attribuer à un autre qu’à lui. Qu’est-ce que cette paix, cette consolation ? Ce n’est rien d’extraordinaire, c’est une union de tous les instants dans la prière, la lecture, le travail, dans tout, avec Notre-Seigneur, avec la Très Sainte Vierge, avec les saints qui l’entouraient dans sa vie… Les offices, la sainte messe, la prière où ma sécheresse m’était si pénible, me sont, malgré les distractions innombrables dont je suis coupable, très doux… Le travail manuel est une consolation par la ressemblance avec Notre-Seigneur, et une méditation continuelle (cela devrait être, je suis bien dissipé). »
Dans cette lettre, dans quelques autres documents, on a déjà pu observer le soin minutieux avec lequel Frère Albéric analyse les mouvements de son esprit et de son cœur. À n’en pas douter, c’est mieux qu’un essai et qu’une nouveauté, une habitude qu’il a prise dans les solitudes, pendant ses grands voyages, et que la vie religieuse perfectionne. Il se plaint, comme toutes les âmes adonnées à la spiritualité, des moments de sécheresse, et se déclare indigne des consolations qui suivent.
« Lundi de la Pentecôte 1890. – L’origine de ces sécheresses est presque toujours dans la lâcheté avec laquelle je résiste aux tentations : ce sont surtout des tentations contre l’obéissance d’esprit ; j’ai peine à soumettre mon sens, cela ne vous étonnera pas ; pourtant cela est peu de chose, je ne reçois pas avec assez de joie les travaux manuels qu’on me donne à faire, c’est un grand manque d’amour ; si je sentais combien cela me rapproche de Notre-Seigneur, combien tout me rendrait heureux… Que la volonté de Notre-Seigneur se fasse, et non la mienne, je le lui dis de tout mon cœur ; je lui dis au moins que je veux le lui dire de tout mon cœur, car je crains de ne le lui dire que de toutes mes lèvres,… et il est pourtant vrai que je veux uniquement sa volonté. » Oui, sûrement, il voulait la volonté de Dieu, et sans doute écrivait-il ces lignes pour préparer la famille de Dijon, celle de Paris, celle de plus loin encore, à la séparation plus complète qui venait d’être décidée.
Pourquoi Frère Albéric quittait-il la Trappe de Notre-Dame-des-Neiges ? J’ai dit qu’il avait, dès le principe, demandé qu’on l’envoyât dans le plus pauvre et lointain monastère d’Asie Mineure. Désir de la solitude absolue ? Désir d’être celui qui n’est plus qu’un nom, et dont on dit : il est là-bas, je ne sais où ? Souvenir des horizons qu’il avait aimés ? Sans doute, mais le temps n’était plus où l’Orient ne représentait pour lui que la terre préférée du voyage, de l’étude et du rêve. D’autres attraits, d’espèce âpre et mystérieuse, conduisaient vers le monastère d’Akbès cet homme à présent décidé à mater son corps longtemps maître et à faire pénitence : il allait vers l’Orient pour y être plus pauvre encore ; pour s’y sentir plus près de la Terre sainte où le Fils de Dieu avait souffert et travaillé ; il allait mû par une compassion, qui devait l’entraîner bien plus loin encore, pour les peuples enfoncés dans l’erreur ; il allait enfin vers cette demeure nouvelle parce qu’il lui était dur de quitter la France. « Je ne vous dirai pas que je ne suis pas triste ces jours-ci, écrivait-il au mois de juin ; ce sera dur de voir s’éloigner le rivage. »
Tout est préparé pour le départ. Une place est retenue, à destination d’Alexandrette, sur un bateau qui part de Marseille le 27. La veille, Frère Marie-Albéric fait ses adieux à ses frères de Notre-Dame-des-Neiges. Il écrit à sa famille :
« Je me vois sur le bateau qui m’emportera demain, il me semble que je sentirai toutes les lames qui l’une après l’autre m’éloigneront ;… il me semble que ma seule ressource sera de penser que chacune est un pas de plus vers la fin de la vie…
« De Marseille à Alexandrette, je serai seul, le frère qui devait partir avec moi reste ; je suis satisfait de cette solitude, je pourrai penser sans contrainte. L’adresse est : Trappe de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, par Alexandrette (Syrie). J’arriverai à Alexandrette le treizième jour de la traversée. On part le lendemain matin pour Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, et on y arrive le surlendemain soir, après deux jours de marche. »
Et quand la traversée est sur le point de finir, il trace sur une feuille de papier ces mots, véritable cri de tendresse angoissée : « Demain, je serai à Alexandrette, et je dirai adieu à cette mer, dernier lien avec ce pays où vous respirez tous. »
Il débarque. Le voyage commence aussitôt, vers la montagne. Frère Marie-Albéric part d’Alexandrette le jeudi 10 juillet dans l’après-midi, avec un père de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, arrivé la veille pour le chercher. « Nous avons marché toute la nuit et la journée du lendemain, sauf cinq heures de halte, montés sur des mulets, escortés de trois Turcs armés ; le vendredi à 6 heures, nous sommes arrivés à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, ensemble de maisonnettes en planches et en pisé, couvertes de chaume, installation à la Jules Verne, fouillis de granges, de bestiaux, de maisonnettes très serrées les unes contre les autres par crainte des incursions et des voleurs ; c’est ombragé de grands arbres et arrosé par une source qui sort du rocher ; mais l’extérieur seul est à la Jules Verne, l’intérieur vaut mieux : à l’intérieur est Notre-Seigneur…
« … La maison se compose d’une vingtaine de religieux et d’une quinzaine d’orphelins de six à douze ans, sans parler des gens de passage. »
Qu’est-ce que c’était que ce monastère de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, dont on vient de lire une description sommaire ? une abbaye improvisée, établie en 1882 dans les montagnes par les trappistes de Notre-Dame-des-Neiges, comme un refuge, s’ils venaient à être obligés de quitter la France. Le domaine s’appelle Cheïkhlé (prononcer Cheurlé), et fait partie du vilayet d’Adana. Pour s’y rendre, on sort d’Alexandrette par la route d’Alep. Elle monte d’abord un peu, puis la montée devient fort dure. Il faut franchir, en effet, la chaîne de l’Amanus. Les lacets se multiplient. Sur le chemin taillé dans le roc, et sans parapets, descendent ou grimpent des files de chameaux de bât, des attelages, des cavaliers, des piétons. En cinq heures, on arrive au col de Beilan, lieu fameux par où passèrent tous les envahisseurs de cette partie de l’Asie : les Assyriens, les armées de Darius et celles d’Alexandre, les armées romaines, celles des sultans arabes, celles des Croisés quand ils cherchaient la plaine où est Antioche. Les ruines des châteaux forts du moyen âge servent encore de carrière aux gens de la contrée. On s’arrête à Beilan, frontière entre les vilayets d’Alep et d’Adana, car les Turcs y ont mis un poste de douaniers. Et c’est là que les voyageurs qui viennent du large des terres, et prétendent aller à la côte, doivent remettre aux zaptiés leurs armes, ou, tout au moins, comme les Kurdes et les Circassiens n’y manquent guère, plonger et cacher leur pistolet ou leur poignard entre les plis de la ceinture. Quand on a traversé le village, on commence de descendre. Les ponts, jetés sur les torrents, sont moins sûrs que les gués. On ne quitte la route d’Alep qu’au bas de la montagne, pour prendre, à gauche, une simple piste, tracée parmi les forêts, les landes ou les cultures, qui ne s’écarte guère des dernières pentes de l’Amanus et en contourne les éperons. Après une longue marche, on parvient à un endroit où la montagne est largement entaillée. Là se trouve la petite ville d’Akbès, avec la mission des lazaristes. Les voyageurs, comme Frère Albéric et son compagnon, qui veulent se rendre à la Trappe de Cheïkhlé, s’engagent alors dans le ravin, y montent pendant deux heures, et redescendent un peu, pour gagner le fond d’une haute vallée tout à fait admirable de forme et de décor.
Imaginez un cirque de montagnes qui l’enveloppent, et qui sont toutes couvertes de forêts de grands pins parasols, sous lesquels poussent des chênes et d’autres arbres et arbustes. Elle-même est cultivée, labourée, semée comme une campagne de France ou d’Italie, puisqu’il y a des moines de saint Bernard dans ce coin sauvage de la Turquie. Des sources jaillissantes l’arrosent, forment un ruisseau qui a fini par couper une paroi de la montagne, et descend en cascades. Par cette coupure, on aperçoit, au loin, l’étendue vallonnée vers Killis et Alep. C’est la seule ouverture sur le monde. Hors de la brèche, tout n’est que verdure et bleu du ciel.
Le monastère fut bâti en hâte. C’est bien le plus pauvre qu’on puisse imaginer. Une clôture le limite et le défend des rôdeurs, mais elle est faite d’épines sèches et de piquets. On ne voit point d’église, comme en nos abbayes d’Occident, qui domine de son toit et de son clocher les autres bâtiments. La porte d’entrée de la Trappe de Cheïkhlé ouvre sur une cour de ferme. À droite, tout en longueur, sont les écuries des mules et les étables ; à gauche, une boulangerie, une cuisine, une forge, un hangar où l’on remise les instruments agricoles ; au fond, la salle du chapitre, le réfectoire, la chambre du prieur. Plusieurs autres constructions, dans la partie gauche du terrain, furent groupées selon les besoins, chapelle, menuiserie, bûcher, salles d’étude, bibliothèque, lingerie : mais la pierre ayant été réservée pour la chapelle, la salle capitulaire et les écuries, le reste fut construit en clayonnage et en terre grasse, et coiffé de toitures en planches ou en chaume. L’aspect n’avait rien de ce bel ordre dont le mot monastère éveille en nous l’idée. Il fallait, pour habiter là, des hommes solides de corps et de courage. Car, sans parler des incursions, toujours possibles, des bandes de brigands tentées par les greniers, ou excitées par le fanatisme, le confortable manquait nécessairement, et le nécessaire habituellement. Les religieux, par exemple, couchaient, en été, dans un grenier situé au-dessus des étables, et dont le plancher, aux lattes frustes et sans jointures, laissait passer le bruit et l’odeur des bêtes. En hiver, ils avaient, pour dortoir, un autre grenier, au-dessus de la salle capitulaire et du réfectoire, mais on n’y dormait guère mieux que dans l’autre, lorsque la neige couvrait la toiture en tôle, très rapprochée des paillasses, et les couvertures, rembourrées avec de la mousse, défendaient mal de la morsure du froid. Par ailleurs, si le domaine suffisait à faire vivre ceux qui le cultivaient, il ne donnait pas les ressources qu’il aurait fallu pour édifier une abbaye véritable. La terre, depuis huit ans défrichée, produisait de belles récoltes de froment, d’orge, de coton ; le jardin potager fournissait abondamment les légumes ; des vignes bien entretenues, et de cépages choisis, permettaient de faire, à la fin des étés, un vin blanc délicieux : mais l’éloignement des marchés rendait la vente à peu près vaine, et le transport mangeait la marchandise.
Voilà en quel lieu, en quels paysage et conditions de vie matérielle, Frère Albéric vient continuer son noviciat de trappiste. L’emploi du temps n’est plus tout à fait le même.
« Les travaux du corps ont été : récolter du coton, porter des pierres qui sont dans les champs, et en faire des tas à des endroits où elles ne gênent pas, laver, scier du bois ; on ne sait jamais, avant le travail, à quoi on sera occupé. À l’heure du travail, on frappe une tablette de bois, les religieux de chœur se réunissent dans une petite pièce où sont les tabliers et les sabots, le supérieur distribue le travail à chacun. Depuis que je suis ici, je passe deux jours, quelquefois trois par semaine, à laver, le reste à travailler aux champs ; là, mon travail ordinaire est de débarrasser le sol des pierres qui l’encombrent et de les porter dans des paniers en des tas… Lorsqu’il y a des travaux particuliers, des récoltes à faire, j’y suis envoyé. J’ai passé huit ou dix jours à récolter des pommes de terre, deux ou trois à la vendange, près de trois semaines à la récolte du coton. De plus, les novices ont le doux service de balayer l’église deux fois par semaine…
« Nos orphelins sont des enfants catholiques d’Akbès, où trois missionnaires lazaristes ont converti, depuis vingt ans, huit cents schismatiques. »
Quels sont les voisins de ce monastère perdu dans les montagnes d’Asie Mineure, et que peut-on attendre d’eux ? Le comte Louis de Foucauld l’avait demandé à son cousin.
« Tu veux savoir, répond Frère Marie-Albéric, si je suis en contact avec les musulmans : peu. Il me semble que ce mélange de Kurdes, de Syriens, de Turcs, d’Arméniens, ferait un peuple brave, laborieux et honnête, s’il était instruit, gouverné, converti surtout. Pour le moment, ils sont pressurés sans merci, profondément ignorants, et la religion musulmane a sur les mœurs sa triste influence : notre région est un coin de brigands. C’est à nous à faire l’avenir de ces peuples. L’avenir, le seul vrai avenir, c’est la vie éternelle : cette vie n’est que la courte épreuve qui prépare l’autre. La conversion de ces peuples dépend de Dieu, d’eux et de nous, chrétiens. Dieu donne toujours abondamment la grâce ; eux sont libres de recevoir, ou de ne pas recevoir la foi ; la prédication dans les pays musulmans est difficile, mais les missionnaires de tant de siècles passés ont vaincu bien d’autres difficultés. C’est à nous à être les successeurs des premiers apôtres, des premiers évangélistes. La parole est beaucoup, mais l’exemple, l’amour, la prière, sont mille fois plus. Donnons-leur l’exemple d’une vie parfaite, d’une vie supérieure et divine ; aimons-les de cet amour tout-puissant qui se fait aimer ; prions pour eux avec un cœur assez chaud pour leur attirer de Dieu une surabondance de grâces, et nous les convertirons infailliblement[38]… »
« 10 novembre 1890. – La principale différence avec Notre-Dame-des-Neiges, c’est qu’on me donne ici l’ordre de travailler de toutes mes forces, dût la méditation y perdre : cela est plus conforme à la pauvreté, à l’exemple de Notre-Seigneur. Mais jusqu’ici le bon Dieu n’a pas voulu que la méditation y perdît, au contraire. Il me donne pendant le travail cette pensée fidèle de lui, et de ceux que j’aime, qui fait ma vie. »
Il ajoute qu’il n’a bénéficié d’aucune exception : « Il est vrai, dit-il, que je ne demande rien[39]… »
« Nos montagnes sont entièrement boisées de grands pins parasols au-dessous desquels poussent des chênes, des chênes-verts, des oliviers sauvages, et au milieu desquels se dressent, par places, de grandes masses de rochers gris percés de quelques cavernes : cela fourmille de perdrix, de daims ; en hiver les loups, les panthères, les ours, les sangliers, très nombreux dans le voisinage, s’y aventurent. »
« Avril. – La sainte Communion est mon grand soutien, mon tout. Je n’ose pas la demander tous les jours : mon indignité est infinie.
« Mardi de Pâques 1890. – Nous devons être dans la joie, car Notre-Seigneur est ressuscité, notre bien-aimé, notre fiancé, le divin époux de nos âmes est infiniment heureux, et son règne n’aura pas de fin ;… c’est là le fond, le vrai de notre joie… Quelque triste que je sois, quand je me mets aux pieds de l’autel, et que je dis à Notre-Seigneur Jésus : « Seigneur, vous êtes infiniment heureux, et rien ne vous manque », je ne puis faire autrement que d’ajouter : « Alors moi aussi, je suis heureux, et rien ne me manque ; votre bonheur me suffit… »
« 14 juillet 1890. – La fondation est en bonne voie, les novices y sont nombreux, et arrivent les uns de France, les autres du pays… J’espère que le bon Dieu bénira ce monastère, qui peut faire tant de bien au milieu d’une population musulmane mêlée d’un certain nombre de chrétiens schismatiques.
« … Les exercices se succèdent à peu d’intervalle, et on ne peut guère faire longtemps la même chose : c’est, après et avec la grâce de Dieu, ce qui rend cette vie si facile matériellement : la grande diversité des exercices, la prière, la lecture, le travail se succédant… Je viens de l’église, je vais aller, je pense, aux champs, et ainsi toute la journée… On est, en ce moment, dans la saison des grands travaux : on bat le blé ; pour des cultivateurs, pour les trappistes, c’est une grosse affaire… »
« 11 novembre 1890. – Le bon Dieu me donne ici un maître des novices d’une science et d’un exemple admirables ; c’est un abbé démissionnaire ; ancien abbé de Notre-Dame-des-Neiges, il est venu terminer ici sa carrière religieuse déjà longue ; il est le vrai fondateur de cette maison, et y fait un bien extrême[40]. »
« 3 janvier 1891. – Je t’écris en particulier aujourd’hui pour te faire don de tout ce que contient mon appartement à Paris : c’est à toi désormais, fais-en ce qu’il te plaira, vends, donne, fais venir, enfin c’est à toi… Sauf ce qui est laissé en souvenir, et que Raymond remettra de ma part, tu trouveras la plupart des objets, tous même, auxquels nous tenions comme venant de grand-père et de nos parents[41].
« … Tu demandes des nouvelles de moi. Mon âme est dans une paix profonde, qui n’a pas cessé depuis mon arrivée ici, qui s’affermit chaque jour, bien que je sente combien peu elle est de moi, combien elle est un pur don de Dieu. C’est une paix qui augmente la foi, qui appelle la reconnaissance. Remercie pour moi, afin que je sois moins ingrat… Je sens tous les jours davantage que je suis où le bon Dieu me veut. Voici un an, dans quelques jours, que je suis à la Trappe. Je ne puis que me confondre devant la bonté infinie de Notre-Seigneur Jésus qui m’y a appelé, conduit et comblé de tant de grâces… Dans un an, je ferai profession. Il tarde à mon cœur d’être lié par des vœux, mais je le suis déjà par tous mes désirs.
« Pense bien aux pauvres, ma bonne Mimi, pendant ce rude hiver. Si tu savais combien je regrette de n’avoir pas fait pour eux davantage, quand j’étais dans le monde ! Je sais bien que tu n’as pas à avoir les mêmes regrets, mais je crois bien faire en te le disant, car, ici à la Trappe, sans souffrir nous-mêmes, nous nous rendons compte de ce qu’on doit souffrir quand on n’a pas ce que nous avons. »
« 3 juillet 1891. – Tu me demandes des nouvelles de mon couvent, nos occupations : nous sommes une vingtaine de trappistes, novices compris. Nous sommes installés, tu le vois d’après les photographies, dans d’assez vastes baraquements. Il y a des bestiaux : bœufs, chèvres, chevaux, ânes, tout ce qu’il faut pour un grand train de culture. Sous nos baraquements, logent aussi de quinze à vingt orphelins catholiques, entre cinq et quinze ans ; il y a au moins dix ou quinze ouvriers laïcs qui sont aussi abrités par nous ; enfin les hôtes dont le nombre varie : tu sais que les moines sont essentiellement hospitaliers. Tu auras assez bien une idée de notre vie en lisant les Moines d’Occident de Montalembert. Cependant, il y a une différence : les moines dont il parle étudiaient plus que nous, s’occupaient plus que nous de certains travaux, tels que la copie des manuscrits. Nous, notre grand travail c’est le travail des champs : c’est la distinction entre l’ordre de Saint-Bernard, duquel nous sommes, et les anciens moines. Ainsi notre travail, ç’a été en automne de vendanger, de nettoyer les champs ; en hiver de scier du bois ; au printemps de piocher la vigne ; en été de récolter le foin, de moissonner. Avant-hier a fini la moisson. C’est le travail des paysans, travail infiniment salutaire pour l’âme : tout en occupant le corps, il laisse à l’âme le pouvoir de prier et de méditer. Puis ce travail, plus pénible qu’on ne pense quand on ne l’a jamais fait, donne une telle compassion pour les pauvres, une telle charité pour les ouvriers, les laboureurs ! On sent si bien le prix d’un morceau de pain, quand on voit par soi-même combien il coûte de peine pour le produire ! on a tant de pitié pour tout ce qui travaille, quand on partage ces travaux !…
« Tu veux que je te décrive un de nos jours : lever à 2 heures du matin, on court à l’église, où on reste deux heures à réciter des psaumes à haute voix dans le chœur, puis, pendant une heure ou une heure et demie, ou est libre, on lit, on prie, les prêtres disent leur messe. Vers 5 heures et demie on retourne au chœur, on récite encore des psaumes, c’est l’office de prime, et on entend la messe de communauté ; de là on va au chapitre, on y dit quelques prières, le supérieur commente un passage de la règle, et si l’on a fait quelque faute, on s’en accuse à ce moment, en public, et on reçoit une pénitence (elles ne sont d’ordinaire pas dures, bien loin de là). Nouveau temps libre de trois quarts d’heure pour lire ou prier ; on dit encore au chœur un petit office, tierce ; puis, vers 7 heures, commence le travail : le supérieur le distribue à chacun en sortant de tierce. On y reste jusque vers 11 heures, on dit alors sexte, et on va au réfectoire à 11 heures et demie.
« Après déjeuner (dîner en style monastique), on monte au dortoir, où on dort jusqu’à 1 heure et demie. Office de none à 1 heure et demie. Intervalle de trois quarts d’heure pour les prières particulières, ou la lecture. À 2 heures et demie, vêpres. Après vêpres, travail jusqu’à 6 heures moins un quart. À 6 heures, oraison ; à 6 heures un quart, souper ; un peu de temps libre ; à 7 heures un quart, lecture pour toute la communauté au chapitre ; puis complies, chant du Salve et coucher. On se couche à 8 heures.
« T’ai-je assez parlé de moi, ma bonne Mimi ? j’espère que tu en es satisfaite. »
« 29 octobre 1891. –… Merci d’avoir pensé à moi le 15 septembre ; c’est bien ce jour-là que j’ai eu mes trente-trois ans, les années passent, puissent-elles nous rapprocher du bon Dieu de toutes manières ! Prions l’un pour l’autre, afin d’être fidèles à ce que le bon Dieu veut de nous, chacun dans notre vie. Elles semblent bien différentes, mais ce n’est qu’une apparence : quand le bon Dieu fait le fond de la vie comme il doit être, toutes les vies se ressemblent, le reste a peu d’importance. »
La cérémonie de la profession, religieuse pour Frère Marie-Albéric, eut lieu le jour de la Chandeleur, 2 février 1892. Elle était présidée par dom Martin, abbé de Notre-Dame-des-Neiges, venu en Orient pour la visite régulière.
Le nouveau profès écrivait, le lendemain : « Depuis hier, je suis tout à fait à Notre-Seigneur. Vers 7 heures, j’ai prononcé mes vœux ; vers 11 heures, on m’a coupé quelques mèches de cheveux à l’église, puis on m’a rasé la tête en laissant la couronne. Et voici que je ne m’appartiens plus en quoi que ce soit… Je suis dans un état que je n’ai jamais éprouvé, si ce n’est un peu à mon retour de Jérusalem… C’est un besoin de recueillement, de silence, d’être aux pieds du bon Dieu et de le regarder presque en silence. On sent, on voudrait rester indéfiniment à sentir, sans le dire même, que l’on est tout au bon Dieu, et qu’il est tout à nous. Le « n’est-ce donc rien d’être tout à Dieu ? » de sainte Thérèse, fait les frais de l’oraison[42]… »
Autour de lui, l’admiration croissait. « Notre Frère Marie-Albéric nous paraît comme un ange au milieu de nous, disait l’abbé de Notre-Dame-des-Neiges : il ne lui manque plus que des ailes. » Le prieur de la Trappe de Cheïkhlé, dom Louis de Gonzague, écrivait de même à Mme de Blic, au lendemain de la profession religieuse : « Vous savez, madame, quel saint compagnon de notre voyage vers le ciel nous nous sommes adjoints en ce jour ! Son directeur spirituel, notre vénéré Père dom Polycarpe, qui a bientôt cinquante ans de profession religieuse et plus de trente ans de supériorat, m’assure qu’il n’a point encore rencontré, dans sa longue vie, une âme si entièrement à Dieu. Permettez-moi, au sujet de cette chère et sainte âme, une petite confidence… Je voudrais faire faire à notre Père Marie-Albéric ses études théologiques, ici même bien entendu, afin qu’il puisse, un jour, être promu au sacerdoce. Je ne lui ai point encore parlé de ce dessein, mais je prévois bien que j’aurai une lutte sérieuse à soutenir contre son humilité, et, en définitive, c’est une chose que, dans notre ordre, nous ne pouvons pas ordonner en vertu de l’obéissance… Malgré ses merveilleuses austérités, sa santé se maintient excellente… [43]. »
Un peu plus tard, rentré en France après son voyage en Syrie, dom Martin, rendant compte au chapitre général de la visite qu’il avait faite à Akbès, nommera Charles de Foucauld parmi les religieux qui pourraient un jour être désignés comme supérieurs de cette fondation.
Frère Marie-Albéric se défendait de songer à l’avenir. Mais nous sommes si difficilement tout entiers au présent, qu’il lui arrivait de se demander : que fera-t-on de moi ? Pourvu qu’on ne m’enlève pas à la vie commune des frères qui sont fendeurs de bûches, sarcleurs dans les blés en herbe, moissonneurs, vendangeurs selon les saisons ? Il confiait son inquiétude à l’abbé Huvelin, et, d’après la réponse, préparait sa défense contre les dignités et les charges : « Si on me parle d’études, j’exposerai que j’ai un goût très vif pour demeurer jusqu’au cou dans le blé et dans le bois, et une répugnance extrême pour tout ce qui tendrait à m’éloigner de cette dernière place que je suis venu chercher, de cette abjection dans laquelle je désire m’enfoncer toujours plus, à la suite de Notre-Seigneur… et puis, en fin de compte, j’obéirai… Mais ce que je vous dis là est une promenade dans le jardin défendu, le bon Dieu est avec nous aujourd’hui, cela ne nous suffit-il pas ? »
L’ordre de commencer les études théologiques devait venir quelques mois après la profession.
« 22 août 1892. – Cette semaine, revient le père lazariste, supérieur d’Akbès… Depuis plus d’un an, il était arrangé, paraît-il, qu’il m’enseignerait la théologie ; il a été professeur de théologie à Montpellier et est fort savant. C’est un Napolitain (M. Destino). À l’annonce qu’on m’a faite, je n’ai pas caché que je n’avais aucun attrait pour cette nouvelle vocation, j’ai fait remarquer aussi ma grande ignorance des choses monastiques. On m’a répondu que c’était une chose décidée, et que je commencerais bientôt ; je n’ai plus insisté. »
Il s’initiait à bien d’autres travaux, en vérité, car, ayant eu, au cours de cette année, une légère maladie, Frère Marie-Albéric fut exempté provisoirement des travaux en plein air, et confié au frère linger, qui lui apprit à raccommoder et à repriser.
« 5 juillet 1892. – Que ne puis-je te donner un peu de mon goût pour la solitude ! Pour moi, je l’aime toujours davantage, et je trouve qu’il n’y en a jamais assez.
« Je pense toujours à Notre-Seigneur, à la Sainte Vierge… et je vis heureux dans cette chère société : quand je raccommode les vêtements des petits orphelins, je me dis combien je suis heureux de faire ce travail, si commun dans la maison de Nazareth… Combien je suis indigne de ces grâces ! Figurez-vous que j’ai, pendant trois jours, la semaine passée, eu un étrange travail : la bonne des orphelins étant tombée un peu malade, on m’a chargé de la remplacer pendant le jour. Vous pensez si cela m’a paru étrange, de me trouver tout d’un coup à la tête de neuf petits Turcs de six à quinze ans ! Je n’ai pu m’empêcher de penser à ceux qui disent qu’on entre en religion pour éviter les soucis de la vie, quand je me suis vu au milieu de cette petite famille. On n’a pas les mêmes, on en a de bien lourds quand Dieu le veut… Pour moi, à cause de ma grande faiblesse, il ne m’a donné que la paix… Ces pauvres petits ont été aussi gentils que possible. »
« 21 mai 1893. – Les études m’intéressent, l’Écriture sainte surtout, c’est la parole de notre Père céleste ; la théologie dogmatique aussi, c’est l’étude de ce que nous devons croire touchant la Sainte Trinité, touchant Notre-Seigneur, touchant l’Église, cela rapproche aussi beaucoup de Dieu ; la théologie morale moins… Mais ces études… ne valent pas la pratique de la pauvreté, de l’abjection, de la mortification, de l’imitation de Notre-Seigneur enfin, que donne le travail manuel. Pourtant, puisque je les fais par obéissance, ayant résisté autant que je le devais, c’est évidemment ce que le bon Dieu veut de moi en ce moment. »
Oui, il avait la certitude de ne pas s’être trompé en rejetant le monde et en devenant moine, mais il lui restait encore une longue route à faire, et une inquiétude traversait parfois cette paix, et un appel venait, de l’abîme de Dieu, vers cet homme de bonne volonté qui fendait du bois, rapiéçait une culotte ou se penchait sur un traité de théologie, et une voix lui disait : « Va plus loin dans la solitude ! » Les tentations contre l’obéissance continuaient d’exercer la vertu jeune encore du religieux ; l’esprit de défiance essayait de le troubler, et lui représentait que les supérieurs se trompaient, assurément, et ne connaissaient pas la manière de conduire chacun, et qu’il serait aisé, en tout cas, de nommer un novice dont ils ignoraient les véritables inclinations. Frère Marie-Albéric faisait taire cette voix tentatrice ; mais l’autre, celle qui disait : « Va plus loin ! » il l’entendait toujours. Très résolu à ne pas sortir de l’obéissance, il attendait, sans savoir où elle le voulait mener, un signe certain de cette volonté qui le tirait dehors. Il écrivait, dans le même temps, à son cousin le comte Louis de Foucauld : « Je goûte de plus en plus les charmes de la solitude, et je cherche les moyens de m’enfoncer dans une solitude de plus en plus profonde. » Trois lignes d’une autre lettre intime laissent plus clairement encore apercevoir cet extraordinaire attrait, qui le faisait souhaiter un ordre encore plus sévère que le plus sévère des ordres religieux. Il annonçait, à un ami, le 27 juin 1893, que les trappistes de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur avaient reçu les nouvelles constitutions de l’ordre de Cîteaux : « … C’est très pieux, disait-il, très austère, très bien de toute manière : et pourtant, soit dit une fois entre vous et moi, ce n’est pas toute la pauvreté que je voudrais, ce n’est pas l’abjection que j’aurais rêvée ;… mes désirs, de ce côté, ne sont pas satisfaits. »
Il y avait là une espèce d’excès et de singularité, qui ne pouvait manquer d’inquiéter les esprits les plus instruits et expérimentés dans la direction des âmes. Car l’idéal de la pauvreté, de l’humilité, de la mortification, de la charité, a été atteint par un grand nombre de saints religieux et religieuses, dans tous les ordres reconnus, sous des règles diverses. Depuis des siècles, toute vie chrétienne y tend, même dans le monde. Les obstacles sont en nous, bien plus que dans les circonstances extérieures et dans l’appareil de la vie. Il se trompait sur les motifs qui le poussaient hors de la Trappe ; il concevait un projet qu’il ne devait jamais accomplir, celui de grouper autour de lui « quelques âmes avec lesquelles on pût former un commencement de petite congrégation » répondant au rêve d’un esprit que ne cesse de hanter la vision de Nazareth. Quel serait le but de cette compagnie nouvelle ? Quelle en serait la règle essentielle ? Dès ce moment, frère Marie-Albéric l’expose ainsi : « Mener, aussi exactement que possible, la vie de Notre-Seigneur, vivant uniquement du travail des mains, sans accepter aucun don, ni spontané, ni quêté, et suivant à la lettre tous ses conseils, ne possédant rien, donnant à quiconque demande, ne réclamant rien, se privant le plus possible ;… ajouter à ce travail beaucoup de prière ;… ne former que de petits groupes ;… se répandre surtout dans les pays infidèles ou abandonnés et où il serait si doux d’augmenter l’amour et les serviteurs de Notre-Seigneur Jésus[44]. »
Les âmes choisies, comme Charles de Foucauld, pour une vie d’exception, sont conduites à travers des ténèbres, de moins en moins épaisses, jusqu’à la lumière. Ici on voit apparaître le désir de consacrer toutes ses forces au salut des pays infidèles, et réapparaître cette pensée, qu’il avait souvent exprimée, d’être le plus dénué et le plus inconnu des hommes. Il se sent poussé, par une force intérieure grandissante, vers cet avenir si peu défini encore, et tout plein de danger. Car, sur un point du moins, il ne se fait pas d’illusions : il sera peut-être longtemps seul. Il tremble à cette pensée, mais il ne change point de désir. « Étant dans une barque, je m’effraie de me jeter à la mer. » Effroi sans trouble, cependant, incertitude qui n’atteint point la haute partie de l’âme, où la paix domine, inaltérée. Et l’explication de cette merveille est toute simple : Frère Marie-Albéric a remis la décision de cette difficulté extrême à la plus grande puissance qui soit, à celle qui met Dieu avant nous, selon l’ordre, et qui nous met à la suite : l’obéissance. Par elle il va tout vaincre, et persuader tout le monde.
Voyez ce trappiste qui a prononcé ses premiers vœux. Il croit être appelé à sortir de l’ordre, non pour retourner à la vie séculière, ce qui ne serait pas sans précédent, mais pour suivre une inspiration tout à fait personnelle, étrange même, qui le porte à disparaître encore plus complètement que dans un monastère de la Syrie. Il a gagné la sympathie, excité l’admiration même de ses supérieurs et de ses frères : et il veut quitter ces amitiés, et c’est à elles qu’il demande de se prononcer ! Il a, en France, à Paris, très loin, un directeur qui est vicaire à Saint-Augustin : et c’est cette prudence parisienne, cette raison défiante de l’exceptionnel, modératrice par tempérament et expérience, inquiète comme une mère, qu’il va falloir convaincre et amener à prononcer cette sentence : oui, mon enfant, allez à ce prodigieux inconnu que vous rêvez !
Se confier à qui en est digne, parler librement, ne pas différer l’aveu, n’être patient que dans la suite, et s’il le faut : les hommes n’ont pas trouvé meilleur moyen de chasser de leur âme les nuées qu’amassent en nous l’incertitude et la bataille de nos raisonnements. C’est une méthode loyale, prompte, militaire. Elle devait être celle de Charles de Foucauld. Il commença donc par dire son inquiétude, vers le milieu de septembre 1893, à dom Polycarpe, qu’il avait choisi comme confesseur, et lui demanda : « Cela vient-il de Dieu, du démon ou de mon imagination ? – N’y pensez plus, répondit en substance le prieur, et attendez en paix, car le bon Dieu, si cela vient de lui, saura bien faire naître l’occasion. »
Il avait écrit, en même temps, à l’abbé Huvelin. Nous n’avons pas ces lettres, mais il en a résumé le sens, dans une sorte de journal adressé à un ami. Elles étaient d’une complète liberté d’allure et de jugement.
Alors, l’abbé Huvelin, qui connaissait fort bien son pénitent, et qui l’aimait, s’inquiéta. Sans garder le moindre espoir de maintenir à la Trappe cet homme extrême en ses désirs, néophyte chez qui il observait une espèce de recherche agitée de la perfection, il essaya de retarder le dénouement de la crise intérieure.
L’idée que Charles de Foucauld pouvait être appelé à suivre la vocation des Pères du désert entra peu à peu dans son esprit, mais, avant d’en être persuadé, avant de le dire, il devait combattre un projet qui avait les apparences d’une aventure, d’une de ces aventures, il le savait, où les âmes les mieux douées peuvent se jeter de bonne foi, et périr. Voici quelques fragments des nombreuses lettres qu’il écrira, dans les mois qui suivront l’aveu de Frère Marie-Albéric.
Elles disent la souffrance que causait, à ce prêtre au cœur si tendre, l’événement dont il sentait l’ombre déjà s’approcher, comme celle des nuées d’orage.
« 29 janvier 1894. – Continuer vos études de théologie, au moins jusqu’au diaconat ; vous appliquer aux vertus intérieures, et surtout à l’anéantissement ; pour les vertus extérieures, les pratiquer dans la perfection de l’obéissance à la règle et à vos supérieurs ;… pour le reste, on verra plus tard. Au surplus, vous n’êtes pas fait, pas du tout fait pour conduire les autres. »
« 29 juillet 1895 (à un tiers). – Il ne restera évidemment pas. Il prendra, de plus en plus, son idée pour la voix de Dieu qui parle. La beauté du but où il se croit appelé lui voilera tout le reste, et surtout l’irréalisable… »
« 30 juillet 1895 (à un tiers). – Que je suis effrayé de cette vie où il veut entrer, de ce Nazareth où il veut aller vivre, de ce groupe qu’il veut former autour de lui ! Mais je n’espère pas le tenir à la Trappe… »
« 30 septembre 1897. – Je trouve qu’il veut trop de choses, et je crains ici un peu d’inquiétude d’esprit, et de cette recherche constante du mieux qui jette dans l’agitation. »
Ainsi pensaient les deux conseillers auxquels Frère Marie-Albéric s’était adressé. Et lui, pendant ces mois d’attente, que pensait-il ? Ceci, qu’il avait confié à l’abbé Huvelin, et probablement à son confesseur trappiste : il souhaitait de n’être plus un religieux de chœur, de mener, hors de la Trappe, ce qu’il nomme « la vie de Nazareth », et, plus précisément, de devenir « simple familier, simple journalier dans quelque couvent »[45]. D’ailleurs, il était résolu à ne rien entreprendre, tant que les guides, dont on vient de voir l’avis très net, ne l’encourageraient pas à changer d’état, de règle, d’habitation et d’habit. « Tant que mes directeurs ne me le permettent pas, je croirais désobéir au bon Dieu, en faisant quoi que ce soit[46]. »
« M. l’abbé (Huvelin) me dit de chercher si je ne pourrais trouver ce que le bon Dieu me demande, ici, dans cette vie où je suis… Vous savez avec quel respect et quelle tendresse j’écoute cette parole : et cependant tout m’appelle en sens opposé… Le temps, ou la mort, en tout cas le bon Dieu arrangera le reste. Mais j’espère toujours qu’il me permettra de le suivre dans la voie qu’il me montre[47] »
Nous verrons tout à l’heure comment ces difficultés furent dénouées, comment des âmes d’une sincérité absolue, et qui priaient, se trouvèrent amenées à changer d’avis, sans quitter toute appréhension, et à donner une autorisation que Charles de Foucauld attendait dans l’obéissance parfaite.
Pendant que ces choses se passaient, inconnues du monde, deux événements attiraient l’attention, non pas d’un grand nombre d’hommes, mais de quelques-uns, sur la Trappe d’Akbès. D’abord, elle cessait, au début de 1894, de dépendre de l’abbaye de Notre-Dame-des-Neiges, pour relever de celle de Staouëli, qui pouvait moins malaisément, ayant de plus importantes cultures, et par exemple des vignobles en plein rendement, apporter de l’aide à la très pauvre Trappe de Syrie. Le second événement fut la saison de massacres que le sultan de Turquie permit ou commanda. Une fois de plus, l’Arménie en fut victime, l’Arménie et toute la bordure incertaine des pays qui l’avoisinent.
« Ce ne sont pas les Kurdes qui se remuent, ce sont les chrétiens d’Arménie, et les Turcs en profitent pour en faire des massacres épouvantables, et pour faire autant de mal qu’ils peuvent, non seulement aux Arméniens, mais à tous les chrétiens, catholiques ou autres, qui sont encore si nombreux dans ces contrées… Autour de nous, il y a eu des horreurs, une foule de massacres, d’incendies, de pillages. Beaucoup de chrétiens ont été réellement martyrs, car ils sont morts volontairement, sans se défendre, plutôt que de renier leur foi… Il reste, dans ce malheureux pays, une misère effroyable. L’hiver est très rigoureux, je ne sais comment ces malheureux, desquels on a brûlé les maisons et pris tous les biens, feront pour ne pas mourir de faim et de froid… Je vous écris pour vous quêter ; non pour nous, à Dieu ne plaise, car je ne serai jamais assez pauvre, mais pour les victimes des persécutions. Par ordre du sultan, on a massacré près de 140 000 chrétiens depuis quelques mois… Dans la ville la plus proche d’ici, à Marache, la garnison a tué 4 500 chrétiens en deux jours. Nous, Akbès, et tous les chrétiens à deux journées à la ronde, nous aurions dû périr. Je n’en ai pas été digne… Priez pour que je me convertisse, et que je ne sois plus repoussé, une autre fois, malgré ma misère, de la porte du ciel qui s’était déjà entr’ouverte.
« Les Européens sont protégés par le gouvernement turc, de sorte que nous sommes en sûreté : on a même mis un poste de soldats à notre porte, pour empêcher qu’on nous fasse le moindre mal. C’est douloureux d’être si bien avec ceux qui égorgent nos frères, il vaudrait mieux souffrir avec eux que d’être protégés par les persécuteurs… C’est honteux pour l’Europe : d’un mot, elle aurait pu empêcher ces horreurs, et elle ne l’a pas fait. Il est vrai que le monde a si peu connu ce qui se passait ici, le gouvernement turc ayant acheté la presse, ayant donné des sommes énormes à certains journaux, pour ne publier que les dépêches émanant de lui. Mais les gouvernements savent toute la vérité par les ambassades et les consulats.
Quels châtiments de Dieu ne se préparent-ils pas par de telles ignominies !… Je viens vous appeler à notre secours, pour nous aider à soulager, à empêcher de périr de faim plusieurs milliers de chrétiens échappés aux massacres et réfugiés dans nos montagnes : ils n’osent sortir de leur retraite de peur d’être massacrés, ils n’ont aucune ressource. C’est notre impérieux devoir de nous priver de tout pour eux, mais quoi que nous fassions, nous ne pourrons suffire à de tels besoins[48]. »
Enfin, pour compléter le portrait de Charles de Foucauld pendant cette période si troublée, en tant de manières, et puisque nos âmes sont à nous-mêmes un mystère, puisqu’elles peuvent être heureuses et souffrir au même moment, vaste domaine, avec l’orage en bas, quelque brume au-dessus et le clair tout en haut, je citerai ce billet, écrit par Frère Marie-Albéric à M. de Blic, nouvellement installé en Bourgogne, au château de Barbirey :
« C’est le bonheur de la campagne de pouvoir s’y entourer de tous ceux qu’on aime ;… avoir toujours autour de soi les âmes qu’on aime, c’est ce qui est doux… Pourquoi me suis-je en allé si loin, me direz-vous, si je sens si vivement ce bonheur ? Je n’ai nullement cherché la joie, j’ai cherché à suivre, « à l’odeur de ses parfums », ce Jésus qui nous a tant aimés…, et si j’ai trouvé des délices à le suivre, c’est sans les avoir cherchées. Mais ces délices ne m’empêchent pas de sentir profondément la douleur d’être séparé de tous ceux que j’aime[49]. »
Les jours, les mois passaient. Le temps venait où le cinquième anniversaire des vœux simples serait révolu. À cette date, 2 février 1897, il faudrait, ou prononcer des vœux solennels, ou demander dispense, et quitter sans doute l’ordre de Saint-Bernard. Le cœur de Frère Marie-Albéric était toujours travaillé de la même obsession. « J’ai bien soif de mener enfin la vie que je cherche depuis sept ans…, que j’ai entrevue, devinée en marchant dans les rues de Nazareth que foulèrent les pieds de Notre-Seigneur, pauvre artisan, perdu dans l’abjection et l’obscurité[50]. »
Alors, espéré mais inattendu ; arrive, à la Trappe de Cheïkhlé, le consentement de l’abbé Huvelin.
« Paris, 15 juin 1896. – Mon cher enfant, j’ai lu et relu votre lettre. Je vous ai fait bien attendre ma réponse, quand vous avez si soif ! Mais j’estimais que vous ne perdiez pas votre temps en étudiant la théologie, en prenant là des données sûres, larges, en préparant, dans cet enseignement-là, votre esprit et votre cœur pour une mysticité sûre et sans illusion…
« J’avais espéré, mon cher enfant, que vous trouveriez à la Trappe ce que vous cherchez, que vous y trouveriez assez de pauvreté, d’humilité, d’obéissance, pour pouvoir suivre Notre-Seigneur dans sa vie de Nazareth. Je croyais que vous auriez pu dire, en y entrant : Haec requies mea in sæculum sæculi ! Je regrette encore que cela ne puisse pas être. Il y a une poussée trop profonde vers un autre idéal, et vous arrivez peu à peu, par la force de ce mouvement, à sortir de ce cadre, à vous trouver déplacé. Je ne crois pas, en effet, que vous puissiez enrayer ce mouvement. Dites-le à vos supérieurs à la Trappe, à Staouëli. Dites simplement votre pensée. Dites à la fois votre estime profonde pour la vie que vous voyez autour de vous, et le mouvement invincible qui, depuis si longtemps, quoi que vous fassiez, vous porte vers un autre idéal… Non que je pense que vous êtes appelé plus haut,… je ne vous vois pas au-dessus ; oh ! non, je vois que vous vous sentez soulevé ailleurs.
Je ne vous fais donc plus attendre. Montrez ma lettre, parlez. Écrivez à Staouëli[51]. J’aurais tant voulu vous garder à une famille où vous êtes aimé, à laquelle vous auriez pu donner beaucoup !… Je trouve, mon enfant, qu’on vous a bien dirigé et formé à la Trappe ; mais, invinciblement, vous voyez autre chose. Oh ! que je prie pour vous ! »
» Vingt-neuf ans, aujourd’hui que je suis prêtre ! Que j’aurais aimé vous voir prêtre, vous ! »
À peine a-t-il pris connaissance de cette bienheureuse lettre, Frère Marie-Albéric soumet à son directeur le brouillon d’un règlement pour la future communauté des Petits Frères de Jésus, travail volumineux, où l’austérité extrême du converti devenu moine s’était donné carrière. Il espérait une approbation. Mais la réponse ne fut plus la même. Dans une note intime, l’abbé Huvelin marque nettement sa pensée : « Je reçois la lettre à l’instant. Elle est accompagnée d’une longue règle des communautés de Petits Frères de Jésus, que l’on espère fonder. Règle impossible, où il y a tout, excepté la discrétion. Je suis navré. » Et, comme il est le conseiller très ferme, capable de freiner d’une main sûre, qu’il faut à ce pénitent emporté par l’ardeur jusqu’à juger les autres d’après lui-même et leurs forces d’après les siennes propres, il répond en termes non moins nets :
« Dimanche, 2 août 1896. Fontainebleau. – Si vos supérieurs vous demandent de faire encore un essai, faites-le loyalement ! Ce qui m’effraierait surtout, mon cher enfant, ce n’est pas la vie à laquelle vous pensez pour vous, si vous restez isolé,… mais c’est de vous voir fonder, ou penser à fonder quelque chose… Votre règle est absolument impraticable… À la règle franciscaine, le pape hésitait à donner son approbation ; il la trouvait trop sévère, mais à ce règlement ! À vous dire vrai, il m’a effrayé ! Vivez à la porte d’une communauté, dans l’abjection que vous souhaitez, mais ne tracez pas de règle, je vous en supplie ! »
Ainsi, pas de fondation, pas de compagnie : Charles de Foucauld apparaît désormais, aux yeux de ce prêtre connaisseur d’âmes, comme un solitaire né. Une seule permission lui a été accordée : celle d’essayer de vivre, hors de la Trappe, d’une vie toute cachée, en quelque coin de Syrie ou de Palestine. Encore devra-t-il se soumettre à l’épreuve d’obéissance et d’étude que, sans doute, ses supérieurs lui demanderont, avant de se ranger à un parti si singulier. Mais, sur le point principal de la vocation, de l’attrait vers la complète solitude, l’abbé Huvelin n’hésite plus, et il dit encore : « Oui, comme vous, mon cher enfant, je vois l’Orient. »
Frère Marie-Albéric écrivit donc au Père général des trappistes à Rome, le priant d’obtenir du pape les dispenses nécessaires. La réponse arriva vers la fin du mois d’août. Le supérieur général de l’ordre, avant de se prononcer, imposait une épreuve à Frère Marie-Albéric : il prescrivait à celui-ci de se rendre d’abord à la Trappe de Staouëli, où des instructions seraient envoyées.
Le religieux répondit qu’il se soumettait de tout son cœur à ce qu’on lui ordonnerait, et partit par le plus prochain paquebot.
« Alger, 25 septembre 1896. – Arrivé à Marseille mercredi à 5 heures du soir, j’en suis reparti une heure après, sur le paquebot d’Alger. Songez au temps que j’ai passé en Algérie, à la vie que j’y ai menée, à mon impiété absolue d’alors, demandez pardon pour moi… »
Il se rend tout de suite à la Trappe de Staouëli, et voici ce qu’il apprend :
« 12 octobre 1896. – Je veux vous dire tout de suite une nouvelle qui vous causera beaucoup de joie :… l’épreuve qui m’est imposée est d’aller étudier la théologie, à Rome, pendant environ deux ans.
« Je pars dans quinze jours, vers le 25. C’est le Père Louis de Gonzague qui a décidé cela dans sa grande affection pour moi. C’est un grand bienfait de me faire boire ainsi à la source la plus pure de l’enseignement religieux, et cette faveur s’accorde rarement dans notre ordre… Je serai à Rome avec sept autres religieux, à la maison généralice, où nous vivrons sous la surveillance du révérendissime Père général et de son conseil ; nous irons de là assister aux cours du Collège romain.
« Vous sentez que mes désirs ne sont nullement changés, ils sont plus fermes que jamais : mais j’obéis avec simplicité, avec une extrême reconnaissance, et avec confiance qu’à la suite de cette longue épreuve la volonté de Dieu se manifestera, bien clairement, pour nous tous qui n’avons qu’un seul désir, connaître la volonté de Dieu pour la faire quelle qu’elle soit, et nous y jeter de tout notre cœur et de toutes nos forces. »
L’obéissance, la simplicité de cœur éclatent dans cette acceptation de l’épreuve imposée. Le Père général ne cherchait pas autre chose, comme l’événement le prouva par la suite. Mais Charles de Foucauld n’en savait rien. Il avait demandé à sortir de l’ordre, et, avant de lui accorder ses dispenses, on imposait à cette ardente nature deux ans d’attente. Il obéissait, non seulement sans murmure, mais avec gratitude ; il acceptait d’être retenu sous la règle de la Trappe, longtemps après que le cinquième anniversaire de ses vœux aurait été atteint.
Combien de temps demeure-t-il à Staouëli ? Quelques semaines. Et tout de suite, il forme des amitiés ; et tout de suite il est en vénération à ses frères : le souvenir de son passage est encore vivant parmi eux, comme celui d’un événement d’importance majeure. À plus de vingt ans de distance, l’un de ces témoins d’autrefois, interrogé au sujet du Père de Foucauld, s’est souvenu avec émotion de Frère Marie-Albéric, et a répondu : « J’étais alors novice. Quelle édification il produisait sur toute la communauté ! À l’église, ses yeux étaient toujours fixés sur le Saint-Sacrement. Il ne croyait pas, il voyait. Il vivait de rien, se contentant de manger les légumes qu’il trouvait sur sa soupe, sans toucher à la soupe elle-même, ni à rien autre chose, et cela seulement une fois par jour, à midi. Il ne dormait que deux heures. Il veillait jusqu’à minuit, dans une petite chapelle d’infirmerie d’où l’on pouvait apercevoir le Saint-Sacrement. À minuit, il allait prendre un peu de repos, et à 2 heures, il était au chœur avec la communauté[52]. »
Quelques jours se passent : le voici à Rome. Il demeure dans la maison généralice, 95, via San Giovanni in Laterano. Là, il fait tout ce qu’on lui a dit de faire, il redevient étudiant parmi des clercs plus jeunes que lui ; sa forte volonté le maintient dans l’obéissance, et le sauve, en vérité.
« 19 novembre 1896. – Vieux, ignorant, sans habitude du latin, j’ai grand peine à suivre les cours… Je serai un âne en théologie comme en tout… »
« 7 décembre 1896. – S’il plaît à Dieu, je passerai très probablement trois ans ici ; cette année, je fais uniquement de la philosophie. Je prends cela comme une épreuve que je tâche d’accomplir le mieux possible, avec obéissance et reconnaissance,… mais en désirant, avec une ardeur croissante, une autre vie…
« Pardonnez-moi si mes réponses ne sont pas longues. En conscience, je suis obligé de beaucoup étudier,… avec mon peu de mémoire, mes trente-huit ans et ce peu de temps, j’ai bien du mal à me tirer d’affaire, et je dois tâcher de profiter des sacrifices que mes supérieurs font pour moi, par une bonté bien pure et bien désintéressée, puisqu’ils sont si pleinement au courant de mes désirs. »
À Staouëli, Frère Marie-Albéric s’était lié avec le Père Jérôme : les lettres qu’il lui envoie de Rome sont de précieux documents. Il semble que l’âme s’y livre toute, qu’on la voie là dans ses pensées, dans sa prière habituelle, et qu’on y reconnaisse également tous les caractères d’une amitié qui ne fleurit guère qu’au cloître ou aux environs, sur les montagnes.
« Rome, 8 novembre 1896. – Après ce départ d’Alger, si douloureux pour tous, mais qui a eu ce bien de nous donner l’occasion d’offrir un sacrifice au bon Dieu, – et c’est encore le plus grand bien, le seul vrai bien qu’il y ait dans la vie, celui qui nous unit le plus à ce Sauveur béni, – quand on aime, qu’est-ce qu’il y a de plus doux que de donner quelque chose à ce qu’on aime, surtout de lui donner quelque chose à quoi on tient, de souffrir pour l’amour de lui, de lui donner tout le sang de son cœur… Je voulais vous parler de notre arrivée à Rome, mais voici que j’en suis encore au départ d’Alger… C’est qu’il m’a été si douloureux !… Mais Dieu en soit béni et bénie soit toute douleur !
Nous sommes arrivés à Rome vendredi à une heure et demie après midi ; nous ne sommes pas descendus à la station de San Paolo qui est près de Saint-Pierre, c’était peu faisable, et nous en avons béni le bon Dieu : si nous étions descendus là, il nous aurait fallu prendre fiacre sur fiacre, et cela m’aurait fait une vraie peine d’entrer si peu pauvrement, dans cette ville où saint Pierre et saint Paul entrèrent tous deux si pauvres, si misérables, et saint Paul enchaîné… Nous sommes donc allés à pied de la gare à la procure, et, sur notre passage, nous nous sommes arrêtés à deux églises où nous avons adoré le Saint-Sacrement dès notre premier pas à Rome, pour lui demander d’y vivre conformément à sa volonté… »
Il raconte qu’il passe fréquemment devant le Colysée, « où tant de martyrs ont donné, avec une telle joie et un tel amour, leur sang pour Notre-Seigneur Jésus ! Comme Notre-Seigneur a été aimé dans cette enceinte ! Quelles flammes d’amour se sont élevées de là vers le ciel ! Que sommes-nous à côté de ces âmes-là ? Et pourtant, nous avons des cœurs comme eux, Notre-Seigneur nous aime autant qu’eux, et nous pouvons, et nous devons autant l’aimer… Ô mon Père, comme nous devons aimer ! Comme vous et moi il faut que nous tâchions d’aimer ce divin Époux de nos âmes ! Si nos cœurs sont capables d’aimer passionnément, et ils le sont, noyons-nous dans cet amour !… Il est à deux pas de nous, le Colysée : je puis le voir de ma fenêtre ; c’est là que saint Ignace se faisait broyer avec cette jubilation pour Notre-Seigneur !… Comme ces pierres parlent ! Quel chant d’amour monte encore aujourd’hui de ce lieu vers le ciel !
« À Saint-Paul, de mon mieux je vous ai recommandé, en même temps que moi, à cet apôtre qui a tant aimé Jésus, qui a tant travaillé pour lui, qui a tant souffert pour lui ! Puisse-t-il nous traîner à sa suite, vous et moi, et nous apprendre à aimer ! »
« 29 novembre 1896. – Mon bien cher Père, que vous avez raison de me parler longuement de Notre-Seigneur ! S’il est deux êtres sur la terre qui doivent ne parler que de Dieu, n’est-ce pas nous, dont l’amitié n’a rien de terrestre ? Que notre conversation soit donc celle des anges, mon bien cher Père… Mais tandis que les anges ont des langues d’or et des cœurs de feu, nous bégayons, et nous sommes tièdes ; faisons ce que nous pouvons,… cela nous sera une raison de nous entr’aider, de prier beaucoup l’un pour l’autre, de nous aimer d’autant plus que nous sommes plus faibles, que nous avons besoin de nous appuyer l’un sur l’autre, de loin, pour parcourir, à la suite de Notre-Seigneur Jésus, cette voie douloureuse qu’il nous a tracée : « Prends ta croix et suis-moi. » Je vous envoie une petite fleur que j’ai ramassée pour vous, en priant pour vous, dans la catacombe de sainte Cécile, au bord de son tombeau, le jour de sa fête : que cette fleur des martyrs vous rappelle, comme à moi, ce qu’ont souffert les saints, et ce que nous devons désirer de souffrir… C’est notre avantage sur les anges !… Au moins nous avons des larmes, des douleurs, peut-être, plaise à Dieu ! du sang à offrir à Notre-Seigneur, en union avec ses larmes, ses douleurs et son sang !
« … Le travail manuel est nécessairement mis au second plan en ce moment, parce que vous êtes, comme moi, dans la période d’enfance : nous ne sommes pas encore d’âge à travailler avec saint Joseph ; nous apprenons encore à lire, avec Jésus petit enfant, sur les genoux de la Sainte Vierge. Mais plus tard le travail manuel, humble, vil, méprisé, reprendra sa place, sa grande place, et alors, avec la sainte communion, les saints livres, la prière, l’humble travail des mains, l’humiliation, la souffrance, et, s’il pouvait plaire à Dieu, pour finir, la mort de sainte Cécile et de tant d’autres !… avec cela nous aurons la vie de Notre-Seigneur et Bien-Aimé Maître Jésus… Permettez-moi, à moi qui n’ai aucun droit à vous donner l’ombre d’un conseil, à moi qui ne suis ni prêtre, ni instruit, ni rien que pécheur, de vous en donner un cependant ; il n’y a qu’une chose qui m’y autorise, c’est l’amour fraternel que j’ai pour vous en Notre-Seigneur : c’est de consulter en tout, pour tout, même pour les petites choses, votre directeur ; je vous le dis parce que je me suis toujours très bien trouvé de faire ainsi, et mal trouvé de faire autrement, et je désire que vous profitiez de mon expérience. Cette habitude de demander ce qu’on doit faire, même pour les petites choses, a mille bons effets : elle donne la paix ; elle habitue à se vaincre ; elle fait regarder comme rien les choses de la terre ; elle fait faire une foule d’actes d’amour ; obéir, c’est aimer, c’est l’acte d’amour le plus pur, le plus parfait, le plus élevé, le plus désintéressé, le plus adoratif ; elle fait faire, dans les commencements surtout, pas mal d’actes de mortification… »
« Rome, 21 décembre 1896. – Je ne veux pas laisser passer les fêtes de Noël sans vous dire que je m’unirai de mon mieux à vous aux pieds de Notre-Seigneur Jésus en ces jours de bénédiction… Voilà donc Notre-Seigneur en route pour Bethléem ; cinq jours de marche, probablement, le dernier de deux ou trois heures : de Nazareth à En-Gannim, de là à Sichar, de là à Béthel, de Béthel à Jérusalem, enfin de Jérusalem à Bethléem. Dans quel amour, dans quel recueillement, la Sainte Vierge devait faire ce voyage ! Avec quel désir brûlant du salut des hommes, pour lesquels le Fils de Dieu était descendu dans son sein !… Pendant tous les instants de ce voyage, Notre-Seigneur ne voyait pas seulement sa Mère et saint Joseph, et les anges qui l’adoraient ; il voyait le présent et le futur, et tous les instants de la vie de tous les hommes ; et ce Cœur Sacré éprouvait déjà cette douleur immense qui a été son partage durant toute sa vie mortelle, à la vue des péchés, des ingratitudes, de la damnation de tant d’âmes. Et il éprouvait aussi, à côté de la consolation profonde que lui donnait la sainteté de sa mère, une consolation moindre, mais réelle, à la vue de toutes les âmes des saints, de toutes les âmes qui l’avaient aimé et l’aimeraient un jour, de tous les cœurs qui s’uniraient à celui de Marie pour s’efforcer de ne battre que pour lui… Serons-nous de ces derniers, mon bien cher Père ? Serons-nous, pour ce Sauveur béni, une consolation ou une peine ?… Si Noël est le commencement de nos joies, c’est le commencement des douleurs de Jésus… Noël n’est qu’à huit jours de la Circoncision… Bethléem n’est qu’à huit kilomètres de Jérusalem. Quand on est en Palestine, cela frappe douloureusement : après avoir passé la Noël de 1888 à Bethléem, avoir entendu la messe de minuit et reçu la sainte communion dans la grotte, au bout de deux ou trois jours, je suis retourné à Jérusalem. La douceur que j’avais éprouvée à prier dans cette grotte qui avait résonné des voix de Jésus, de Marie et de Joseph, et où j’étais si près d’eux, avait été indicible… Mais, hélas ! après une heure de marche, le dôme du Saint-Sépulcre, le Calvaire, le mont des Oliviers se dressaient devant moi, il fallait, qu’on le veuille ou non, changer de pensées et se retrouver au pied de la Croix. »
L’étude de la théologie, quelques promenades dans Rome, des lettres comme celles qu’on vient de lire ou qu’on lira plus loin, c’est, avec la prière, l’emploi de cette fin de l’année 1896, et des deux premiers mois de la suivante. Cependant, si fort ancré que l’on soit dans l’obéissance, on ne peut manquer de s’apercevoir que les dates approchent où quelque changement doit survenir, quelque ordre nous être donné, qui nous instruira de l’avenir. Frère Marie-Albéric songeait au 2 février. Et, un peu avant cet anniversaire, il faisait à un ami – qui n’est pas, cette fois, le Père Jérôme – l’exposé des hypothèses, le calcul des probabilités.
« Cette fin de mois et le commencement du mois prochain sont graves pour moi : le 2 février, il y aura cinq ans que j’ai fait mes premiers vœux. Aux termes des constitutions, je dois, à cette date, faire mes vœux solennels ou quitter l’ordre… Pour rester dans l’ordre encore deux ans et demi, sans faire mes vœux solennels, il faudrait une dispense du Saint-Siège, qui ne s’accorde que pour de fortes raisons. Mon Père maître ne croit pas qu’ici il y ait des motifs suffisants pour demander une dispense. Il pourrait donc se faire que je sois obligé de prendre un parti définitif d’ici à quelques jours,… cela dépendra du révérendissime Père général qui arrivera demain ou après-demain… Le jour où ma vocation semblera clairement connue de mon Père général et de mon Père maître, et qu’il leur semblera évident que le bon Dieu ne me veut pas à la Trappe (du moins comme Père), ils me le diront, et m’engageront à me retirer, car ils sont trop consciencieux pour vouloir me retenir un seul jour, quand ils voient que la volonté de Dieu est ailleurs[53]. »
Il acceptait de vivre ainsi trois années ! Ses supérieurs n’eurent pas besoin d’une aussi longue épreuve pour être sûrs qu’une vertu si humble pouvait vaincre les dangers d’une vie solitaire parmi les hommes. À la perfection de son obéissance, ils reconnurent que l’appel qu’il entendait depuis les premiers temps de son entrée à la Trappe n’était pas celui d’un orgueil déguisé.
Le Père général de l’ordre, qui était en voyage, arrivait à Rome le 16 janvier 1897. Tout de suite, il se préoccupait de faire juger, par les membres de son conseil, le cas de Frère Marie-Albéric. Celui-ci ne se doutait de rien. Le Père général le fit venir, lui dit que le moment était venu d’examiner quels étaient les desseins de Dieu sur son serviteur Charles de Foucauld, et que, si les Pères, ayant prié, étudié, réfléchi, reconnaissaient que celui-ci avait une vocation exceptionnelle, hors de la règle de Saint-Benoît et de Saint-Bernard, il faudrait qu’il la suivît, sans plus tarder, et de tout son cœur.
« Je lui ai exposé, par écrit, l’état de mon âme ; puis il a réuni son conseil, et là, devant Dieu, n’ayant plus qu’une seule chose en vue, sa volonté, le Père général et tous les membres du conseil, à l’unanimité, ont déclaré que le bon Dieu m’appelait à une vie particulière de pauvreté et d’abjection, et qu’il fallait que j’y entre sans plus tarder. Par conséquent, on va me donner une dispense, et on m’ouvre toutes les portes pour que je puisse suivre, sur-le-champ, l’appel de Dieu. Notre bon Père général m’a dit cela hier. Il m’a dit en même temps que, selon lui, je devais, pour la question de vocation, rester dans l’obéissance, mais qu’en cela et en tout, le mieux pour moi était de m’adresser non à lui, mais à M. l’abbé. Je lui ai écrit hier soir. Aussitôt que j’aurai sa réponse, je partirai. Vous savez que je veux être familier dans un couvent d’Orient, M. l’abbé me désignera lequel, et je m’y rendrai[54]. »
« Mon cher enfant, répondit M. Huvelin, j’ai peur pour vous d’une autre Trappe, où je vous aimerais mieux cependant. Les mêmes pensées viendront vous y visiter, la même comparaison de la vie que vous verrez et de celle que vous poursuivez. Je préfère Capharnaüm ou Nazareth, ou tel couvent de Franciscains ; pas dans le couvent, à l’ombre seulement du couvent, demandant seulement les ressources spirituelles, et vivant de la pauvreté, à la porte. Ne pensez pas à grouper des âmes autour de vous, surtout à leur donner une règle. Vivez de votre vie, puis, s’il vient des âmes, vivez ensemble de la même vie, sans réglementer rien. Sur ce point, je suis très net.
« J’admire la bonté, la simplicité du Père général ; j’admire la charité de ces bons Pères, qui vous aiment, et qui se séparent de vous. Je suis touché de leur manière de faire avec vous. »
Les trappistes eurent la courtoisie, la délicieuse attention d’offrir un billet de passage, sur le paquebot, à celui qui cessait d’être Frère Marie-Albéric, et de le porter ainsi jusqu’au « couvent de franciscains ».
« Quelle grâce Dieu me fait ! répondait Charles de Foucauld… Comme il est bon de m’avoir fait venir si loin, à Rome, pour donner à ma vocation la confirmation la plus pleine, la plus entière qui soit possible en ce monde !
Je croyais venir à Rome étudier : j’y suis venu pour être envoyé, sans le demander, par la main même de notre général, suivre l’attrait qui m’appelait depuis si longtemps. »
La nouvelle que Frère Marie-Albéric était sorti de la Trappe, courut vite, du couvent de Rome, dans les autres monastères où il était connu. Elle fit pleurer plus d’un vieux moine. L’un d’eux, l’ancien prieur de Notre-Dame d’Akbès, devenu abbé de Staouëli, écrivit même : « En nous quittant, il m’a fait la plus grande peine que j’aie éprouvée dans ma vie[55]. »
Charles de Foucauld avait passé sept ans à la Trappe. Toute sa vie, il conservera le plus grand respect, la plus grande gratitude pour l’ordre vénérable qu’il a quitté ; il reviendra même, plus tard, demander à la Trappe de Notre-Dame-des-Neiges de le recevoir, pendant plusieurs mois, comme hôte et comme ami.
Un de ses premiers soins n’est-il pas, dès à présent, d’aviser le père Jérôme du grand événement qui transforme en un séculier le Frère Marie-Albéric, et va le faire changer d’habit, de règle et de décor.
« Rome, 24 janvier 1897. – Je crois que c’est ma vocation de descendre… ; toutes les portes me sont ouvertes, pour cesser d’être religieux de chœur et descendre au rang de familier et de valet. J’ai reçu hier cette nouvelle de la bouche même de mon bon, excellent Père général, dont la bonté pour moi me touche tant !… Mais là où j’ai eu besoin d’obéissance, c’est qu’avant qu’il ait pris cette décision, j’avais promis au bon Dieu de faire tout ce que me dirait mon Père révérendissime, à la suite de l’examen de ma vocation auquel il allait se livrer, et tout ce que me dirait mon confesseur. De sorte que si l’on m’avait dit : « Vous allez faire vos vœux solennels dans dix jours, et ensuite vous recevrez les saints ordres », j’aurais obéi avec joie, certain que j’aurais fait la volonté de Dieu… Et maintenant encore, je suis entre les mains de Dieu et de l’obéissance. J’ai demandé où il faudra aller en partant d’ici, dans quelques jours : ce sera en Orient ; mais dans quelle maison, je l’ignore entièrement. Le bon Dieu me le dira par la voix de mon directeur… Vous voyez que j’ai besoin des prières de mon frère… Je vous fais descendre aussi, mon si cher frère : être frère d’un domestique, d’un familier, d’un valet, ce n’est pas brillant aux yeux du monde… Mais vous êtes mort au monde, et rien ne peut vous faire rougir…
« Merci de m’ouvrir votre cœur sur vos désirs du sacerdoce : je bénis Dieu de toute mon âme de ce qu’il vous a inspiré ce désir : je ne doute pas une minute que ce ne soit votre vocation, et j’en remercie Dieu du fond du cœur… Il n’est pas de vocation au monde aussi grande que celle du prêtre : et en effet, ce n’est plus du monde, c’est déjà du ciel… Le prêtre est quelque chose de transcendant, de dépassant tout… Quelle vocation, mon cher Frère, et combien je bénis Dieu de vous l’avoir donnée !… Une fois, j’ai regretté de ne pas l’avoir reçue, regretté de ne pas être revêtu de ce saint caractère : c’est au fort de la persécution arménienne… J’aurais voulu être prêtre, savoir la langue des pauvres chrétiens persécutés, et pouvoir aller de village en village, les encourager à mourir pour leur Dieu… Je n’en étais pas digne… Mais vous, qui sait ce que Dieu vous réserve ?… L’avenir est si inconnu !… Dieu nous mène par des chemins si inattendus !… Si jamais l’obéissance vous porte vers ces plages lointaines où tant d’âmes se perdent faute de prêtres, où la moisson abonde et périt faute d’ouvriers, bénissez sans mesure. Là où on peut faire plus de bien aux autres, là on est le mieux : l’oubli entier de soi, le dévouement entier aux enfants de notre Père céleste, c’est la vie de Notre-Seigneur, c’est la vie de tout chrétien, c’est surtout la vie du prêtre… Aussi, si jamais vous êtes appelé vers ces pays où ces peuples sont assis à l’ombre de la mort, bénissez Dieu sans mesure, et donnez-vous corps et âme à faire briller la lumière du Christ parmi ces âmes arrosées de son sang ; on peut le faire à la Trappe avec un fruit admirable ; l’obéissance vous en fournira les moyens… »
Charles de Foucauld, en annonçant son prochain départ pour l’Orient à son beau-frère, lui avait demandé de garder le secret :
« La nouvelle vie que je vais commencer sera beaucoup plus cachée, beaucoup plus solitaire que celle que je quitte. Je désire que vous seuls sachiez où je suis : ne dites donc pas que je suis en Terre sainte, dites seulement que je suis en Orient, menant une vie très retirée, n’écrivant à personne, et ne voulant pas qu’on sache où je suis. »
Charles de Foucauld quitte Rome dans les premiers jours de février, pour s’embarquer à Brindisi. Il va mener la vie qu’il a rêvée ; elle sera extraordinaire, taillée à la mesure de l’homme. Naturellement, il est persuadé qu’il entre pour toujours sur la terre d’Asie, où ses ossements reposeront plus tard à côté de la poussière des patriarches. Il se trompe : d’autres contrées plus sauvages l’attendent, et d’autres travaux ; Nazareth et Jérusalem ne seront encore pour lui que de très belles expériences, deux marches de la Scala Santa qu’il a commencé de gravir.
CHAPITRE VI – NAZARETH ET JÉRUSALEM
« Heureux les pauvres ; c’est la béatitude que je cherche. On m’a déjà offert un coin où je crois que mon âme sera bien. En tout cas, Celui qui donne à chaque feuille sa place saura me mettre à la mienne », écrivait Charles de Foucauld à sa sœur, au moment où il quittait l’Italie pour l’Orient. Le paquebot était un de ceux qui font escale à Alexandrie d’Égypte, puis au port de Jaffa, avant de remonter vers Constantinople. Le pèlerin descendit sur la plage que bordent en demi-cercle des maisons cubiques, peintes, et qui ont le pied dans l’ordure, mais derrière lesquelles s’étendent de si beaux jardins d’orangers. Il ne s’arrêta ni dans les maisons ni à l’ombre des jardins, et partit aussitôt à pied, pour gagner, par étapes, la ville qu’il souhaitait de pouvoir habiter : Nazareth. Ayant passé par Ramleh, Saint-Jean-de-la-Montagne, Bethléem, Jérusalem et Sichar, il entrait, bien inconnu, comme les pauvres qui se tiennent encore aux portes des villes, dans Nazareth la bénie, le 5 mars 1897. Une semaine plus tard, la feuille avait trouvé sa place. Charles de Foucauld écrivait à son cousin, le colonel Louis de Foucauld, qui venait d’être nommé attaché militaire à Berlin : « Je suis fixé à Nazareth, c’est là que tu pourras m’écrire désormais, à l’adresse suivante : Charles Foucauld, Nazareth, Terre sainte, poste restante. Le bon Dieu m’a fait trouver ici, aussi parfaitement que possible, ce que je cherchais : pauvreté, solitude, abjection, travail bien humble, obscurité complète, l’imitation aussi parfaite que cela se peut de ce que fut la vie de Notre-Seigneur Jésus dans ce même Nazareth. L’amour imite, l’amour veut la conformité à l’être aimé ; il tend à tout unir, les âmes dans les mêmes sentiments, tous les moments de l’existence par un genre de vie identique : c’est pourquoi je suis ici. La Trappe me faisait monter, me faisait une vie d’étude, une vie honorée. C’est pourquoi je l’ai quittée et j’ai embrassé ici l’existence humble et obscure du Dieu ouvrier de Nazareth.
« Garde mes secrets ; ce sont des secrets d’amour que je te confie. Je suis très heureux ; le cœur a ce qu’il cherchait depuis bien des années. Il ne reste plus maintenant qu’à aller au ciel[56]. »
Que s’était-il passé, et quel emploi avait-il trouvé ?
Charles de Foucauld s’était d’abord présenté chez les Pères Franciscains qui hospitalisent les pèlerins de Terre sainte, et leur avait demandé d’être agréé comme serviteur des religieux. On n’eut pas besoin de ses services. Il s’était donc décidé à habiter comme hôte ordinaire, pendant trois jours, la maison franciscaine, Casa-Nova, lorsque, s’étant confessé à un des religieux, qui se trouvait être l’aumônier des clarisses de Nazareth, celui-ci, le voyant en grand embarras, lui dit : « Je parlerai de vous à Sainte-Claire ; il y aura peut-être une place. » Mais déjà le voyageur avait été reconnu par le frère hôtelier de Casa Nova, qui se rappelait parfaitement l’avoir vu à Nazareth, en tout autre équipage, quelques années auparavant. L’abbesse fut donc avertie qu’un étrange pèlerin viendrait au monastère s’offrir comme domestique, et que ce pèlerin voué à la pénitence, désireux de demeurer caché, s’appelait le vicomte de Foucauld. Elle était femme à comprendre ce qu’il y avait de grand autant que de singulier dans une telle conjoncture, et à tout ménager pour qu’une âme fût en paix. Le jour de la fête de sainte Colette, le Saint-Sacrement étant exposé, on vit entrer, dans la chapelle des Clarisses, un homme encore jeune, vêtu de telle sorte qu’on n’aurait pu dire à quelle nation il appartenait, si ce n’est à celle des pauvres, qui est immense et de tout pays. Il s’agenouilla devant l’autel, un peu loin, et demeura là, sans bouger, une heure, deux heures, trois heures, si bien qu’une sœur tourière, de race arabe, en prit de l’inquiétude, et dit à une de ses compagnes : « Il faut que je surveille cet homme, qui ne quitte pas la chapelle : je crains qu’il ne vole quelque chose. » L’inconnu sortit, ayant seulement beaucoup prié. Mais, trois jours plus tard, il revenait, et demandait à parler à Mme l’abbesse de Sainte-Claire, la révérende mère Saint-Michel.
Pour comprendre la suite de ce récit, il faut savoir que Charles de Foucauld, débarqué en Terre sainte, avait adopté un costume qui pouvait avoir quelque parenté avec les vêtements de certains orientaux, – on rencontre des gens de tant de races dans les foules d’Orient ! – mais qui étonnait, même en ce pays-là. Il portait une longue blouse à capuchon, rayée blanc et bleu, un pantalon de cotonnade bleue, et, sur la tête, une calotte blanche, en laine très épaisse, autour de laquelle il enroulait une pièce d’étoffe en forme de turban. Aux pieds, il n’avait que des sandales. Un chapelet à gros grains pendait à la ceinture de cuir qui serrait la tunique. Le solitaire, en adoptant cette tenue, avait eu, sans aucun doute, la pensée d’expier la coquetterie d’autrefois, de provoquer un peu et d’accepter avec joie le dédain des passants et le rire des enfants de la rue. Il connaissait la sentence de saint Ignace, expression de tant de saints qui vécurent ou vivront : « Je préfère être regardé comme nul et insensé, pour le Christ, qui avant moi a passé pour tel. » Il s’imaginait aussi que tout le monde le prendrait pour ce qu’il n’était point, un pauvre mendiant, sans nom, sans culture, sans usage. Mais, par la finesse des traits du visage, par l’accent et le choix involontaire des mots, par le geste facile et l’attitude qui change un pli, une ligne, c’est-à-dire presque tout dans le costume, il devait se trahir. C’est ce qui arriva, quand il fut devant l’abbesse de Nazareth, appelée au parloir, et qui se tenait debout de l’autre côté de la clôture. Elle ne le voyait pas, mais elle l’entendait.
L’abbesse n’eut pas plutôt interrogé ce visiteur qu’elle comprit qu’on ne l’avait pas trompée. On croit d’ici la voir sourire, tandis que le pèlerin demandait du travail, les besognes qu’on voudrait bien lui confier, n’importe lesquelles, pourvu qu’on lui laissât du temps pour prier, une cabane à l’ombre des murs du monastère, et qu’il fût assuré, pour tout salaire, d’un morceau de pain. Comme elle n’était pas seulement fine, mais avancée en spiritualité, elle eut le sentiment très net que cet homme était sincère, et qu’il fallait l’aider dans l’œuvre exceptionnelle qu’il entreprenait.
– Fort bien, dit-elle. Presque tout le travail, à l’intérieur de la clôture, est fait par nos sœurs ; mais nous avons besoin, en effet, d’un sacristain, d’un homme qui se charge aussi de nos commissions à la poste et de quelques autres petits travaux. Vous serez celui-là, et vous aurez le salaire que vous demandez.
Elle avait pensé lui attribuer un logement de jardinier. Il refusa net, et, ayant regardé autour de lui, il aperçut, hors de la cour, à une centaine de mètres, une cabane en planches, qui servait de débarras et ressemblait tout à fait à une guérite qui serait couverte en tuiles. Cette cabane était appuyée à un mur et posée en bordure d’un terrain qui appartenait aux clarisses. – Cela me suffira dit-il, je resterai là. On apporta deux tréteaux, deux planches, une paillasse, une enveloppe de laine rembourrée de chiffons, et qui devait servir de couverture : ce fut tout ce que pouvait contenir le réduit. Quand il fallut soulever les planches et la paillasse, le pèlerin, que le voyage avait épuisé, n’en put venir à bout ; ses pieds, enflés et blessés, fléchirent sous le poids ; il dut traîner son lit jusqu’à la cabane.
Le voici donc ermite, et comme perdu dans ce Nazareth tant de fois rêvé.
Pour répondre à son désir, on lui confia, dans les jours qui suivirent, quelques petits travaux : d’abord il fut prié de trier des lentilles, puis de réparer le mur de clôture en pierre sèche, qui menaçait ruine en plusieurs endroits ; puis de bêcher quelques planches du jardin. Les essais ne furent généralement pas très heureux. L’abbesse s’aperçut vite que l’hôte n’avait aucune habitude de ces choses. Elle le laissa servir les messes, balayer la chapelle, prier, dans un coin, tout le temps qu’il souhaitait de passer ainsi, incliné, immobile, et s’enfermer ensuite dans la cabane où il passait très peu d’heures à dormir, beaucoup d’heures à méditer, à lire et à écrire. Elle apprit, peu à peu, qu’il étudiait la théologie et composait plusieurs ouvrages, notamment des méditations sur l’Évangile. Très sûre d’avoir recueilli un saint homme, elle lui donna de plus en plus la liberté de vivre comme il était inspiré de vivre, et recommanda qu’on le chargeât seulement des courses que les tourières ne pourraient faire aussi bien que lui. Enfin, par discrétion, et pour ne pas le troubler, les sœurs lui laissèrent ignorer, pendant assez longtemps, qu’elles savaient son vrai nom et quelque chose de son histoire.
Il a raconté lui-même ce début de sa vie en Orient. Au colonel de Foucauld, il avait révélé le lieu de l’ermitage ; à M. et à Mme de Blic, il expose avec détails « l’emploi du temps ».
« Arrivé ici sans savoir de métier, sans certificat, sans autre papier que mes passeports, j’ai trouvé dès le sixième jour non seulement à gagner ma vie, mais à la gagner dans des conditions telles que j’ai absolument ce que je rêvais depuis tant d’années, et qu’on dirait que cette place m’attendait ; et, en effet, elle m’attendait, car rien n’arrive par hasard et tout ce qui se fait a été préparé de Dieu : je suis serviteur, domestique, valet d’une pauvre communauté religieuse.
« Vous me demandez le détail de ma vie.
« Je demeure dans une maisonnette solitaire, située dans un enclos appartenant aux sœurs dont je suis l’heureux serviteur ; je suis là tout seul à la lisière de la petite ville ; d’un côté est la clôture des sœurs, de l’autre la campagne, des champs et des coteaux ; c’est un délicieux ermitage, parfaitement solitaire… Je me lève lorsque mon bon ange me réveille, et je prie jusqu’à l’Angélus ; à l’Angélus, je vais au couvent franciscain, j’y descends dans la grotte qui faisait partie de la maison de la Sainte Famille ; je reste là jusque vers 6 heures du matin, disant mon rosaire et entendant les messes qui se disent dans ce lieu si adorablement saint, où Dieu s’incarna, où résonna pendant trente ans la voix de Jésus, de Marie et de Joseph ; il est profondément doux de regarder ces parois de roc sur lesquelles se sont reposés les yeux de Jésus et qu’il touchait de ses mains.
« À 6 heures, je vais chez les sœurs, qui sont si bonnes pour moi qu’elles sont vraiment mes mères. J’y prépare, à la sacristie et à la chapelle, ce qu’il faut pour la messe, et je prie… À 7 heures, je sers la messe… Après l’action de grâces, je mets en ordre la sacristie et la chapelle. Quand il faut balayer (le samedi seulement), je balaie ; le jeudi et le dimanche, je vais à la poste chercher le courrier (il n’y a pas de facteur, chacun va chercher ses lettres), je suis le facteur des sœurs… À ce propos, ne mettez plus poste restante sur les adresses, mettez simplement à Nazareth. Puis je fais ce qu’on me dit, tantôt un petit travail, tantôt un autre ; très souvent je dessine des petites images (d’un dessin élémentaire), les sœurs en ont besoin et m’en font faire…
« S’il y a quelque petite commission, je la fais, mais c’est très rare ; en général, je passe toute ma journée à faire des petits travaux dans ma petite chambre, près de la sacristie ; vers 5 heures, je prépare ce qu’il faut pour la bénédiction du Saint-Sacrement, quand il y en a, ce qui est très souvent, grâce à Dieu.
« Depuis ce moment, je reste à la chapelle jusqu’à 7 heures et demie du soir. Alors, je rentre dans mon ermitage, j’y lis jusqu’à 9 heures. À 9 heures, la cloche m’annonce qu’il est temps de faire la prière du soir ; je la fais, et je me couche. Je lis pendant mes repas ; je les prends tout seul ; je suis seul domestique, ce m’est très doux ; je ne vois personne au monde que mon confesseur, tous les huit jours, pour me confesser, et les sœurs lorsqu’elles ont quelque chose à me dire, ce qui est rare, car elles sont fort silencieuses.
« Je passe en outre à la chapelle une demi-heure avant 11 heures et une demi-heure à 3 heures, c’est l’heure de sexte, none et vêpres.
« Les sœurs me fournissent tous les livres que je désire ; elles sont pour moi d’une bonté infinie.
« Plus on donne au bon Dieu, plus il rend : j’ai cru donner tout en quittant le monde et entrant à la Trappe, j’ai reçu plus que je n’avais donné… J’ai encore une fois cru tout donner en quittant la Trappe : j’ai été comblé, comblé sans mesure… Je jouis à l’infini d’être pauvre, vêtu en ouvrier, domestique, dans cette basse condition qui fut celle de Jésus Notre-Seigneur, et, par un surcroît de grâce exceptionnel, d’être tout cela à Nazareth[57]. »
Il n’était plus religieux, mais il vivait toujours comme un religieux. Il faut même ajouter qu’après avoir reçu la dispense de ses vœux de trappiste, il avait fait à Rome, entre les mains de son confesseur, – un trappiste de Rome, – le vœu de perpétuelle chasteté, et cet autre encore de n’avoir jamais en sa possession ou à son usage plus que ne peut avoir un pauvre ouvrier.
En débarquant, il n’avait point apporté de bagages. Dans l’ermitage, on n’aurait pu inventorier qu’un mobilier minime : quelques images, un crucifix auquel il tenait beaucoup, et où était incrustée une parcelle de la vraie Croix, puis quelques livres, reçus en don ou empruntés. Peut-être le nombre de livres dépassait-il celui qu’on trouverait dans une bibliothèque d’ouvrier, mais on pourrait répondre que c’étaient des outils.
Pour la table, elle n’était ni abondante, ni variée. L’ermite se conformait au régime des clarisses. Le dimanche et les jours de fête, on y ajoutait quelques amandes ou des figues sèches. Mais Charles de Foucauld n’en mangeait point. Une sœur tourière découvrit un jour, dans une des stalles de la chapelle, une boîte où il serrait les amandes et les figues, afin de les distribuer, quand il sortait, aux enfants de la rue ou de la campagne. Ceux-ci, au début, se moquaient volontiers de l’étranger qui marchait les yeux baissés, un gros chapelet à la ceinture. Bientôt ils coururent après lui, quémandant les friandises qu’il avait pour eux dans sa poche, et leurs bras nus levés, et leur danse, et leurs yeux, l’enveloppaient de lumière. Les autres pauvres aussi apprirent vite sa charité. Ils venaient le chercher jusque dans sa cabane, frappant à la porte derrière laquelle l’ermite étudiait ou priait. Un dimanche, vers le soir, à l’heure où le soleil est encore maître, mais où passe déjà, sur la terre morte de chaleur, le premier souffle frais de la nuit, trois voyageurs loqueteux, venus on ne sait d’où, allant devant eux à la quête de tout, s’arrêtèrent devant l’ermite, et lui dirent : « Nous n’avons plus de quoi nous couvrir. Vois, la nuit sera froide. » Il les considéra, fut ému de pitié, songea à saint Martin, et, prenant son couteau, il coupa en deux le grand manteau de laine dont il se couvrait lui-même. Puis, saisissant la tunique de rechange qui pendait à un clou, il fit signe au troisième mendiant, à celui qui n’avait rien reçu : « Accompagne-moi ! » Tous deux, ils se rendirent dans la cour du monastère, devant la porterie.
– Ma sœur, dit Charles de Foucauld à la tourière, je vous prie d’ajuster mon vêtement à la taille de ce malheureux : il suffira de deux coups de ciseaux et de quelques points de couture.
– Mais, frère Charles, c’est dimanche aujourd’hui !
– Je vous aiderai ; je couperai, puis vous coudrez ; il est permis de travailler un peu, à cause de la nécessité où sont ces pauvres gens.
Toutes les fois qu’il en était sollicité par les rares passants, ou par l’aumônier, ou par les sœurs, il se dérangeait, et tâchait d’obliger le prochain. C’est ainsi qu’il accepta, un autre jour, de se mettre à l’affût. Un chacal dévalisait le poulailler des clarisses. Il se glissait dans le jardin, par un certain passage qu’on connaissait bien, entre deux rochers, enlevait une poule, qu’il emportait encore criant ; le lendemain, il enlevait la meilleure pondeuse, et, s’il y avait ensuite un peu de répit, c’est que le sire aux oreilles pointues rendait visite aux basses-cours des voisins. Il fallait débarrasser le pays de cette bête puante et voleuse. Et qui le ferait plus aisément qu’un ancien officier de cavalerie ? On avait emprunté un fusil de chasse à un agent consulaire. Charles de Foucauld se mit à l’affût, à bonne distance des rochers, et commença d’attendre le chacal. Mais à peine se fut-il assis sur une pierre, l’arme chargée posée sur ses genoux, qu’il se mit à réciter le rosaire, selon la coutume qui lui était chère, et à méditer les mystères joyeux, douloureux et glorieux. Le temps, pour lui passait délicieusement. Les yeux du solitaire erraient sur les terrasses de la ville qui allait dormir. Ils recevaient l’image de maisons pareilles entre elles et pareilles à celle où le Sauveur avait jadis travaillé. Il était heureux et distrait. Le chacal n’en demandait pas plus. Il vint en trottinant, s’arrêta avant de se montrer, reconnut que l’ennemi avait l’esprit ailleurs, pénétra dans le poulailler, tua net une poule choisie, et, au galop cette fois, l’emporta. Quand les tourières vinrent interroger Frère Charles, et lui demandèrent des nouvelles de la chasse :
– Je n’ai rien vu passer, répondit-il. Ce fut son premier et son dernier affût dans les collines de Nazareth.
Ces histoires, et beaucoup d’autres qu’on racontait de lui, la singularité de son costume, sa politesse, sa charité, ses longues prières quotidiennes, appelaient l’attention de quiconque habitait Nazareth ou y passait même un peu de temps. On faisait de lui un personnage considérable ; on cherchait à savoir pourquoi il était venu de si loin dans le pays ; et, comme l’idée de puissance, dans les imaginations populaires, ne va guère sans or ni pierreries, on le représentait comme un homme fort riche, ce qui lui faisait une place à part entre les serviteurs des établissements charitables de la ville. Il se rencontra par exemple, à la poste, avec un frère convers d’une maison de salésiens qu’il y a à Nazareth, et fut abordé par lui.
– Vous m’excuserez, dit le Frère, mais on rapporte de vous beaucoup de choses. Je voudrais savoir si elles sont vraies ?
– À quoi bon ?
– On dit qu’en France, vous aviez une bonne place…
– Laquelle ?
– Une place de comte ?
Frère Charles sourit, et répondit négligemment :
– Je suis un vieux soldat.
Ses lettres, pendant cette période de sa vie, sont particulièrement tendres. Il n’écrit qu’à ses proches. Que de fois, perdu dans le silence, la porte de sa cabane ouverte, regardant le ciel d’Orient, qui sertit mieux que le nôtre des étoiles plus nombreuses, il songea à sa sœur et aux enfants de sa sœur, aux paisibles collines de Barbirey, à son cousin Louis de Foucauld, à ses cousines de Paris, à l’abbé Huvelin, à ce petit groupe d’êtres chers qui connaissaient le lieu de sa retraite, et, régulièrement, écrivaient à Frère Charles de Jésus, Nazareth. Car il a définitivement adopté, ce nom qui cache le sien, mais découvre son amour. Il est dans une paix infinie. Je composerai comme un cantique, avec les phrases de joie dont ses lettres sont semées.
Je suis dans une paix infinie, une paix débordante qui m’inonde…
Si vous saviez les joies de la vie religieuse, dans quelle jubilation est mon âme !
Comme le bon Dieu, dès ce monde, rend au centuple, en grâces intérieures, ce qu’on lui donne !
Plus j’ai abandonné tout ce qui faisait ma consolation, plus j’ai trouvé de bonheur !
Je bénis Dieu, chaque jour, de la vie qu’il m’a faite, et je me confonds en reconnaissance. Remerciez, bénissez avec moi !
Les nouvelles viennent de France, de la famille dispersée. Lui, l’ermite, il n’en a point à donner en retour, mais il chante le cantique que je viens de dire, et il répond avec promptitude, laissant parler chacune de ses affections d’enfance, demeurées vives comme autrefois, toujours rapportées à Dieu par quelque bout de phrase, où se reconnaît l’habitude de la méditation.
Il a appris qu’une de ses nièces va faire sa première communion : « Comme je serai avec vous en ce jour ! écrit-il. Cherchez moi bien près de vous, à l’église, avant, après, à la maison ; partout je serai avec vous. »
Sa sœur va quitter Dijon pour habiter la campagne : » Ma petite Mimi, ne t’effraie ni d’aller à Barbirey, ni d’aucune chose au monde. Ne crains pas d’y trouver la tristesse ; crois l’expérience de ton vieux frère : le bon Dieu est le maître de nos cœurs comme de nos corps ; il nous donne, à son gré, la joie et la douleur, comme la santé et la maladie. Crois bien que c’est folie de te dire : ceci me rendra heureux, ceci me rendra malheureux, car le bonheur ou la tristesse ne dépendent pas de telle ou telle chose, mais de Dieu qui a mille millions de moyens de répandre en nous-mêmes la joie ou la douleur. »
Son beau-frère lui annonce la naissance d’un enfant : « Oh ! mon cher ami, répond Frère Charles, c’est une chose si grande, si merveilleusement belle, une âme ! Une âme en état de grâce comme celle de votre enfant, une âme qui, après ce temps d’épreuve, vivra toujours dans la gloire, le rayonnement, la béatitude, la perfection indicible des élus aux pieds de Dieu !… Je suis fixé à Nazareth… Je suis heureux, autant qu’on peut l’être ici-bas, dans ma vie d’ouvrier fils de Marie, tâchant d’imiter, autant que le peut ma misère morale, la vie cachée et perdue de notre bien-aimé Jésus, en qui je vous aime de tout mon cœur. »
L’enveloppe contenait une seconde lettre, celle-ci pour le comte Louis de Foucauld. Et frère Charles ajoutait donc, en post-scriptum, ces lignes de recommandation : « Ayez la bonté, je vous prie, de faire parvenir cette lettre à Louis de Foucauld. Cela m’ennuie de faire connaître, aux personnes qui portent mes lettres à la poste, le nom des personnes à qui j’écris : je reste solitaire, silencieux, inconnu. »
Le petit enfant, dont je viens de parler, étant mort peu de mois après sa naissance, Frère Charles console le père et la mère, selon son habitude, en entr’ouvrant les cieux. Il dit combien il comprend la tristesse des parents, mais il leur montre aussitôt leur fils dans le bonheur éternel : « Comme il est grand, comparé à vous, à nous tous ! Comme il nous domine !… Aucun de vos enfants ne vous aime autant, car il s’abreuve au torrent de l’amour divin… Je l’ai déjà invoqué, ce petit saint, mon neveu, un saint que je tutoie… Prie-le à toute heure, ma chère Marie, et remercie bien le bon Dieu de t’avoir faite mère d’un saint. Une mère vit en ses enfants : voilà déjà une partie de toi au ciel ! Plus que jamais tu auras, désormais, « ta conversation dans les cieux. »
Toute la correspondance de cette époque est de ce ton ailé. Je voudrais pouvoir citer, tout au long, une très belle série de lettres à un trappiste, sur l’obéissance monastique. Je ne puis trop souvent interrompre ce récit. Il doit être l’image de la vie qui se hâte, et de plus, c’est avant tout l’exemple qu’il faut montrer.
Je dirai donc seulement que, dans cette période de la vie érémitique en Terre sainte, les demandes de livres, les remerciements pour des livres envoyés, sont nombreux. Frère Charles prie sa sœur de lui faire parvenir, en Orient : la traduction allemande de la Vulgate et aussi une histoire de l’Église catholique en allemand (il les voulait prêter à des protestants allemands qui habitaient alors Nazareth) ; la dernière édition de deux cours de philosophie, en latin, celui du Père de Mandato et celui du Père Feretti, tous deux jésuites ; l’Ordo, pour le bréviaire et la messe, dont se sert le clergé romain ; – « Je dis le bréviaire, ajoute-t-il, et, dans mon grand amour pour Rome, je veux, n’étant tenu à rien, le dire comme le disent les prêtres de Rome » ; – quatre volumes de l’abbé Darras ; un « bon » saint Jean Chrysostome ; un peu plus tard, il fera ses délices d’un Nouveau Testament en arabe, et d’un livre de prières arabes. Prière, étude et solitude, voilà ce qui appelait sur lui la grâce de Dieu.
Il avait pris l’habitude, dès les premiers temps de sa conversion, il avait continué, chez les trappistes, de faire des retraites. Il en fit une de douze jours à Nazareth, sans parler d’une ou deux plus petites. Elle eut lieu au commencement de novembre 1897. Les méditations sont toutes écrites. J’en ai le texte sous les yeux. Elles donnent quelque idée de la ferveur de cette grande âme, de sa foi, de sa puissance d’analyse. Je publierai ici l’une d’entre elles, et, la lisant, on songera à certains chapitres des Confessions de saint Augustin ; même ardeur de contrition, même gratitude, même loyauté de l’âme.
« Moi, ma vie passée. – Miséricorde de Dieu.
(Quatorzième méditation de cette retraite.)
« Mon Seigneur Jésus, faites mes pensées, faites mes paroles. Si, dans les méditations précédentes j’étais impuissant, combien plus dans celle-ci !… Ce n’est pas la matière qui manque,… au contraire, elle m’écrase ! Y en a-t-il, mon Dieu, des miséricordes ! miséricordes d’hier, d’aujourd’hui, de tous les instants de ma vie, d’avant ma naissance, et d’avant les temps ! J’y suis noyé, j’en suis inondé, elles me couvrent et m’enveloppent de toute part… Ah ! mon Dieu, nous avons tous à chanter vos miséricordes, nous, tous créés pour la gloire éternelle et rachetés par le sang de Jésus, par votre Sang, mon Seigneur Jésus, qui êtes à côté de moi dans ce tabernacle, mais si tous nous le devons, combien moi ! moi qui ai été dès mon enfance entouré de tant de grâces, fils d’une sainte mère, ayant appris d’elle à vous connaître, à vous aimer et à vous prier aussitôt que j’ai pu comprendre une parole ! Mon premier souvenir n’est-il pas la prière qu’elle me faisait réciter matin et soir : « Mon Dieu, bénissez papa, maman, grand-papa, grand’maman, grand’maman Foucauld et petite sœur ? » Et cette pieuse éducation !… ces visites aux églises… ces bouquets au pied des croix, une crèche à Noël, un mois de Marie, un petit autel dans ma chambre, gardé tant que j’ai eu une chambre à moi dans ma famille, et qui a survécu à ma foi ! les catéchismes, les premières confessions surveillées par un grand-père chrétien,… ces exemples de piété reçus dans ma famille ;… je me vois allant à l’église avec mon père (que cela est loin !), avec mon grand-père ; je vois ma grand’mère, mes cousines, allant à la messe tous les jours… Et cette première communion, après une longue et bonne préparation, entourée des grâces et des encouragements de toute une famille chrétienne, sous les yeux des êtres que je chérissais le plus au monde, afin que tout fût réuni en un jour, pour m’y faire goûter toutes les douceurs… Et puis ces catéchismes de persévérance sous la direction d’un prêtre bon, pieux, intelligent, zélé, mon grand-père m’encourageant toujours de la parole et de l’exemple dans la voie de la piété ; les âmes les plus pieuses et les plus belles de ma famille me comblant d’encouragements et de bonté, et vous, mon Dieu, enracinant dans mon cœur cet attachement pour elles, si profondément que les orages de la suite n’ont pu l’arracher, et que vous vous en êtes servi plus tard pour me sauver, alors que j’étais comme mort et noyé dans le mal… Et puis lorsque, malgré tant de grâces, je commençais à m’écarter de vous, avec quelle douceur vous me rappeliez à vous par la voix de mon grand-père, avec quelle miséricorde vous m’empêchiez de tomber dans les derniers excès en conservant dans mon cœur ma tendresse pour lui !… Mais, malgré tout cela, hélas ! je m’éloignais, je m’éloignais de plus en plus de vous, mon Seigneur et ma vie,… et aussi ma vie commençait à être une mort, ou plutôt c’était déjà une mort à vos yeux… Et dans cet état de mort vous me conserviez encore : vous conserviez dans mon âme les souvenirs du passé, l’estime du bien, l’attachement dormant comme un feu sous la cendre, mais existant toujours, à certaines belles et pieuses âmes, le respect de la religion catholique et des religieux ; toute foi avait disparu, mais le respect et l’estime étaient demeurés intacts… Vous me faisiez d’autres grâces, mon Dieu, vous me conserviez le goût de l’étude, des lectures sérieuses, des belles choses, le dégoût du vice et de la laideur… Je faisais le mal, mais je ne l’approuvais ni ne l’aimais… Vous me faisiez sentir un vide douloureux, une tristesse, que je n’ai jamais éprouvée qu’alors ;… elle me revenait chaque soir, lorsque je me trouvais seul dans mon appartement ;… elle me tenait muet et accablé pendant ce qu’on appelle les fêtes : je les organisais, mais le moment venu je les passais dans un mutisme, un dégoût, un ennui infinis… Vous me donniez cette inquiétude vague d’une conscience mauvaise, qui, tout endormie qu’elle est, n’est pas tout à fait morte. Je n’ai jamais senti cette tristesse, ce malaise, cette inquiétude qu’alors. Mon Dieu, c’était donc un don de vous,… comme j’étais loin de m’en douter !… Que vous êtes bon !… Et en même temps que vous empêchiez mon âme, par cette invention de votre amour, de se noyer irrémédiablement, vous gardiez mon corps : car si j’étais mort alors, j’aurais été en enfer… Les accidents de cheval miraculeusement évités, avortés ! Ces duels que vous avez empêché d’avoir lieu ! Ces périls, en expédition, que vous avez tous écartés ! Ces dangers en voyage, si grands et si multipliés, dont vous m’avez fait sortir comme par miracle ! Cette santé inaltérable dans les lieux les plus malsains, malgré de si grandes fatigues !… Oh ! mon Dieu, comme vous aviez la main sur moi, et comme je la sentais peu ! que vous êtes bon ! Comme vous m’avez gardé ! Comme vous me couviez sous vos ailes lorsque je ne croyais même pas à votre existence ! Et pendant que vous me gardiez ainsi, le temps se passait, vous jugiez que le moment approchait de me faire rentrer au bercail… Vous dénouâtes malgré moi toutes les liaisons mauvaises qui m’auraient tenu éloigné de vous ;… vous dénouâtes même tous les liens bons qui m’eussent empêché de rentrer dans le sein de cette famille, où vous vouliez me faire trouver le salut, et qui m’auraient empêché d’être un jour tout à vous… En même temps, vous me donnâtes une vie d’études sérieuses, une vie obscure, une existence solitaire et pauvre… Mon cœur et mon esprit restaient loin de vous, mais je vivais pourtant dans une atmosphère moins viciée ; ce n’était pas la lumière ni le bien, il s’en faut ;… mais ce n’était plus une fange aussi profonde, ni un mal aussi odieux ;… la place se déblayait peu à peu;… l’eau du déluge couvrait encore la terre, mais elle baissait de plus en plus, et la pluie ne tombait plus… Vous aviez brisé les obstacles, assoupli l’âme, préparé la terre en brûlant les épines et les buissons… Par la force des choses, vous m’obligeâtes à être chaste, et bientôt, m’ayant, à la fin de l’hiver 86, ramené dans ma famille à Paris, la chasteté me devint une douceur et un besoin du cœur. C’est vous qui fîtes cela, mon Dieu, vous seul ; je n’y étais pour rien, hélas ! Que vous avez été bon ! de quelles tristes et coupables rechutes vous m’avez miséricordieusement préservé ! Votre seule main a fait en cela le commencement, le milieu et la fin ! Que vous êtes bon ! C’était nécessaire pour préparer mon âme à la vérité, le démon est trop maître d’une âme qui n’est pas chaste, pour y laisser entrer la vérité… Vous ne pouviez pas entrer, mon Dieu, dans une âme où le démon des passions immondes régnait en maître… Vous vouliez entrer dans la mienne, ô bon Pasteur, et vous en avez chassé vous-même votre ennemi,… et après l’avoir chassé par la force, malgré moi, voyant ma faiblesse et combien seul j’étais peu capable de garder mon âme pure, vous avez établi pour la garder un bon gardien, si fort et si doux que, non seulement il ne laissait pas la moindre entrée au démon de l’impureté, mais qu’il me faisait un besoin, une douceur, des délices de la chasteté… Mon Dieu, comment chanterai-je vos miséricordes !… Et après avoir vidé mon âme de ses ordures et l’avoir confiée à vos anges, vous avez songé à y rentrer, mon Dieu ! car après avoir reçu tant de grâces, elle ne vous connaissait pas encore ! Vous agissiez continuellement en elle, sur elle, vous la transformiez avec une puissance souveraine et une rapidité étonnante, et elle vous ignorait complètement… Vous lui inspirâtes alors des goûts de vertu, de vertu païenne, vous me les laissâtes chercher dans les livres des philosophes païens, et je n’y trouvai que le vide, le dégoût… Vous me fîtes alors tomber sous les yeux quelques pages d’un livre chrétien, et vous m’en fîtes sentir la chaleur et la beauté… Vous me fîtes entrevoir que je trouverais peut-être là, sinon la vérité (je ne croyais pas que les hommes pussent la connaître), du moins des enseignements de vertu, et vous m’inspirâtes de chercher des leçons d’une vertu toute païenne dans des livres chrétiens… Vous me familiarisâtes ainsi avec les mystères de la religion… En même temps vous resserriez de plus en plus les liens qui m’unissaient à de belles âmes ; vous m’aviez ramené dans cette famille, objet de l’attachement passionné de mes jeunes années, de mon enfance… Vous m’y faisiez retrouver, pour ces mêmes âmes, l’admiration d’autrefois, et à elles vous inspiriez de me recevoir comme l’enfant prodigue à qui on ne faisait même pas sentir qu’il eût jamais abandonné le toit paternel, vous leur donniez pour moi la même bonté que j’eusse pu attendre si je n’avais jamais failli… Je me serrai de plus en plus contre cette famille bien-aimée. J’y vivais dans un tel air de vertu que ma vie revenait à vue d’œil, c’était le printemps rendant la vie à la terre après l’hiver ;… c’est à ce doux soleil qu’avait crû ce désir du bien, ce dégoût du mal, cette impossibilité de retomber dans certaines fautes, cette recherche de la vertu… Vous aviez chassé le mal de mon cœur ; mon bon ange y avait repris sa place, et vous lui aviez joint un ange terrestre… Au commencement d’octobre 86, après six mois de vie de famille, j’admirais, je voulais la vertu, mais je ne vous connaissais pas… Par quelles inventions, Dieu de bonté, vous êtes-vous fait connaître à moi ! De quels détours vous êtes-vous servi ? Par quels doux et fort moyens extérieurs ? Par quelle série de circonstances étonnantes, où tout s’est réuni pour me pousser à vous : solitude inattendue, émotions, maladies d’êtres chéris, sentiments ardents du cœur, retour à Paris par suite d’un événement surprenant !… Et quelles grâces intérieures ! ce besoin de solitude, de recueillement, de pieuses lectures, ce besoin d’aller dans vos églises, moi qui ne croyais pas en vous, ce trouble de l’âme, cette angoisse, cette recherche de la vérité, cette prière : « Mon Dieu, si vous existez, faites-le moi connaître ! » Tout cela, c’était votre œuvre, mon Dieu, votre œuvre à vous seul… Une belle âme vous secondait, mais par son silence, sa douceur, sa bonté, sa perfection : elle se laissait voir, elle était bonne et répandait son parfum attirant, mais elle n’agissait pas. Vous, mon Jésus, mon Sauveur, vous faisiez tout au dedans comme au dehors. Vous m’aviez attiré à la vertu par la beauté d’une âme en qui la vertu m’avait paru si belle, qu’elle avait irrévocablement ravi mon cœur… Vous m’attirâtes à la vérité, par la beauté de cette même âme. Vous me fîtes alors quatre grâces : la première fut de m’inspirer cette pensée : puisque cette âme est si intelligente, la religion qu’elle croit si fermement ne saurait être une folie comme je le pense. La deuxième fut de m’inspirer cette autre pensée : puisque la religion n’est pas une folie, peut-être la vérité qui n’est sur la terre dans aucune autre, ni dans aucun système philosophique, est-elle là ? La troisième fut de me dire : étudions donc cette religion : prenons un professeur de religion catholique, un prêtre instruit, et voyons ce qu’il en est, et s’il faut croire ce qu’elle dit. La quatrième fut la grâce incomparable de m’adresser, pour avoir ces leçons de religion, à M. Huvelin. En me faisant entrer dans son confessionnal, un des derniers jours d’octobre, entre le 27 et le 30, je pense, vous m’avez donné tous les biens, mon Dieu : s’il y a de la joie dans le ciel à la vue d’un pécheur se convertissant, il y en a eu quand je suis entré dans ce confessionnal !… Quel jour béni, quel jour de bénédiction !… Et depuis ce jour, toute ma vie n’a été qu’un enchaînement de bénédictions ! Vous m’avez mis sous les ailes de ce saint, et j’y suis resté. Vous m’avez porté par ses mains, et ce n’a été que grâces sur grâces. Je demandais des leçons de religion : il me fit mettre à genoux et me fit me confesser, et m’envoya communier séance tenante… Je ne puis m’empêcher de pleurer en y pensant, et ne veux pas empêcher ces larmes de couler, elles sont trop justes, mon Dieu ! Quels ruisseaux de larmes devraient couler de mes yeux au souvenir de telles miséricordes ! Que vous avez été bon ! que je suis heureux ! Qu’ai-je fait pour cela ? Et depuis, mon Dieu, ce n’a été qu’un enchaînement de grâces toujours croissantes,… une marée montant, montant toujours : la direction, et quelle direction ! la prière, la sainte lecture, l’assistance quotidienne à la messe établies dès le premier jour de ma vie nouvelle ; la fréquente communion, la fréquente confession venant au bout de quelques semaines ; la direction devenant de plus en plus intime, fréquente, enveloppant toute ma vie et en faisant une vie d’obéissance dans les moindres choses et d’obéissance à quel maître ! La communion devenant presque quotidienne,… le désir de la vie religieuse naissant, s’affermissant,… des événements extérieurs indépendants de ma volonté me forçant de me détacher de choses matérielles qui avaient pour moi beaucoup de charmes et qui auraient retenu mon âme, l’auraient attachée à la terre. Vous avez brisé violemment ces liens comme tant d’autres. Que vous êtes bon, mon Dieu, d’avoir tout brisé autour de moi, d’avoir tellement anéanti tout ce qui m’aurait empêché d’être à vous seul !… Ce sentiment d’autant plus profond de la vanité, de la fausseté de la vie mondaine et de la grande distance qui existe entre la vie parfaite, évangélique, et celle qu’on mène dans le monde… Ce tendre et croissant amour pour vous, mon Seigneur Jésus, ce goût de la prière, cette foi en votre parole, ce sentiment profond du devoir de l’aumône, ce désir de vous imiter, cette parole de M. Huvelin dans un sermon : « Que vous aviez tellement pris la dernière place que jamais personne n’avait pu vous la ravir ! » si inviolablement gravée dans mon âme, cette soif de vous faire le plus grand sacrifice qu’il me fût possible de vous faire, en quittant pour toujours une famille qui faisait tout mon bonheur et en allant bien loin d’elle vivre et mourir ;… cette recherche d’une vie conforme à la vôtre, où je puisse partager complètement votre abjection, votre pauvreté, votre humble labeur, votre ensevelissement, votre obscurité, recherche si nettement dessinée dans une dernière retraite à Clamart… Le 15 janvier 90, ce sacrifice s’effectuant et cette grande grâce m’étant donnée de votre main… La Trappe,… la communion quotidienne,… ce que j’ai appris pendant sept ans de vie religieuse,… les grâces de Notre-Dame-des-Neiges,… les grâces de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur…, les grâces de Staouëli,… les grâces de Rome, la ville de saint Pierre et des martyrs, le Saint-Père, les basiliques, les églises, les mille traces des apôtres et des martyrs,… la théologie, la philosophie, les lectures, la vocation exceptionnelle à une vie d’abjection et d’obscurité. Après trois ans et demi d’attente, le révérendissime général me déclara, le 23 janvier 1897, que la volonté de Dieu est que je suive cet attrait qui me pousse hors de l’ordre de la Trappe pour la vie d’abjection, d’humble travail, d’obscurité profonde, dont j’ai la vision depuis si longtemps… Mon départ pour la Terre sainte,… le pèlerinage, l’arrivée à Nazareth,… le premier mercredi que j’y passe, vous me faites entrer, mon Dieu, par l’intercession de saint Joseph, comme valet au couvent de Sainte-Claire… Paix, bonheur, consolations, grâces, félicité merveilleuse que j’y éprouve… Misericordias Domini, in æternum cantabo… Venite et videte, quoniam suavis est Dominus… Il n’y a qu’à défaillir, mon Dieu, devant de telles miséricordes ; à supplier la sainte Vierge et les saints et toutes les pieuses âmes de remercier pour moi, car je succombe sous les grâces… Oh ! mon Époux, que n’avez-vous pas fait pour moi ! Que voulez-vous donc de moi pour m’avoir comblé ainsi ? Qu’attendez-vous de moi pour m’avoir accablé ainsi ? Mon Dieu, remerciez-vous en moi, faites vous-même en moi la reconnaissance, le remerciement, la fidélité, l’amour ; je succombe, je défaille, mon Dieu ; faites mes pensées, mes paroles et mes œuvres, afin que tout vous remercie et vous glorifie en moi. Amen, amen, amen. »
Ainsi se passèrent, à Nazareth, l’été, l’automne, l’hiver de 1897, le printemps de 1898. Vers cette époque, la renommée de frère Charles de Jésus parvint jusqu’à Jérusalem. L’abbesse des clarisses de Nazareth ayant écrit à celle de Jérusalem, au sujet de ce serviteur bénévole, qui se vêtait comme un pauvre, qui parlait et écrivait comme un savant, et priait comme un saint, la mère Elisabeth du Calvaire voulut voir le personnage et l’interroger. Elle avait fondé les deux monastères et demeurait, en fait, une sorte de supérieure générale. On s’empressa donc de lui obéir. Elle était femme de toute prudence, et, dans l’occasion, craignait que la communauté de Nazareth ne fût victime d’un aventurier. Elle jugerait la cause.
Frère Charles fut donc mandé par mère Saint-Michel, qui le chargea de porter aux clarisses de Jérusalem une lettre importante. Il accepta aussitôt, et se déclara prêt à partir : il n’avait aucune affaire à régler, aucun bagage à préparer. On lui proposa d’emporter quelques provisions : il refusa, disant qu’il savait la langue du pays, et qu’il mendierait son pain, dans les villages.
Il partit seul, à pied, comme il était venu, traversa la Galilée et la Samarie, songeant au Maître qui, tant de fois, pour lui et pour nous tous, avait fait ce long voyage. Les chrétiens lui donnaient le pain et l’eau qu’il demandait, ils le logeaient, et les Turcs non plus ne le refusaient pas. Il arriva, bien las, le jour de la fête de saint Jean-Baptiste, le 24 juin, en vue des murailles ; mais comme la nuit commençait, il coucha sur la terre, dans un champ voisin du couvent. Il fut reçu, le lendemain, par l’abbesse, dont la défiance ne dura guère, lorsqu’il eut parlé seulement cinq minutes. On ne pouvait penser à faire repartir avant quelque temps le voyageur, dont les pieds avaient été blessés par de mauvaises sandales. Là aussi, il y avait une cabane vide, en dehors de la clôture, et bâtie à quelque distance d’une autre où habitaient un nègre et sa femme, gardiens du petit domaine des sœurs. Frère Charles demanda qu’on lui permît d’être le voisin de ces pauvres gens, et de s’installer dans la cabane vide. Il refusa de loger dans l’appartement de l’aumônier, que l’abbesse mettait pour quelques jours à sa disposition.
Il faut dire, pour expliquer cette offre, que mère Élisabeth du Calvaire savait, par la lettre venue de Nazareth, qui elle recevait, et que, dès sa première rencontre avec frère Charles, celui-ci, se voyant compris, avait parlé de lui-même avec plus de détail qu’il ne faisait d’habitude, disant par quelles épreuves il avait passé, et ce qu’il était venu chercher en Orient. Il avait raconté quelques traits de son enfance, sa conversion, ses années à la Trappe, et laissé entrevoir que le plus dur sacrifice avait été pour lui, était encore la séparation d’avec une famille unie, excellente, aimée. Puis, soudainement, il s’était tu. L’homme de silence avait reparu. Le serviteur avait pris congé de l’abbesse et sollicité l’autorisation de loger hors de la clôture, comme je viens de le dire, non loin du gardien nègre, dans la campagne de la Ville sainte.
Le soir, mère Élisabeth, parlant de lui à ses filles, leur avait dit : « Nazareth ne s’est pas trompé : c’est vraiment un homme de Dieu, nous avons un saint dans la maison. »
Cette femme vénérable et de haute spiritualité devait avoir, ainsi que nous le verrons, une influence décisive dans la détermination que prit Charles de Foucauld, moins de deux ans plus tard, de se préparer à la prêtrise.
Pour quelques semaines au moins, il est à Jérusalem ; il y mène la même vie qu’à Nazareth, dans les mêmes conditions, et il écrit à ses parents de France : « Je reçois votre lettre à Jérusalem, où je suis définitivement installé au couvent des clarisses. La mère abbesse du couvent de Jérusalem, qui est la fondatrice des deux monastères, m’a demandé de venir ici. Je ne sais pas pourquoi elle m’a fait venir, car je ne suis guère utile ; je crois que c’est uniquement pour pouvoir à son tour exercer la charité à mon égard et me combler de bonté. C’est une sainte… Comme le bon Dieu fait de belles âmes, et comme il est bon de me les faire voir ! Quels trésors de beauté morale il y a au fond de ces cloîtres, et quelles belles fleurs s’y épanouissent pour Dieu seul !… J’ai une petite maisonnette, adossée au gros mur de clôture… Je vis comme un ermite, ou comme un ouvrier indépendant, recevant tout ce que je demande, et travaillant comme je veux, quand je veux, à un travail très doux, qu’on a la délicatesse de me donner à faire, pour que je puisse me dire que je gagne mon pain…
« Ma vie est ici exactement la même qu’à Nazareth, avec cette différence que je suis encore plus solitaire, c’est-à-dire encore mieux. Le couvent est à deux kilomètres de Jérusalem, sur la route de Béthanie, dans une position admirable, au bord du ravin de Cédron, en face du mont des Oliviers. On voit de ses fenêtres tout Jérusalem, Gethsémani, tout le mont des Oliviers, Béthanie et, dans le lointain, les monts de Moab et d’Edom, qui s’élèvent comme une sombre muraille de l’autre côté du Jourdain : c’est extrêmement beau… De l’autre côté du couvent, on aperçoit les coteaux de Bethléem au sud et ceux de Saint-Jean-Baptiste (lieu de sa naissance et déserts où il habita) à l’ouest… Le Cénacle, le chemin que suivit Jésus avec ses apôtres pour aller après la cène au jardin de l’Agonie, ce jardin, le palais du grand prêtre où on le conduisit après l’avoir lié, le palais d’Hérode, le Calvaire, la coupole de la basilique du Saint-Sépulcre, le lieu de l’Ascension, cette chère et bénie Béthanie, le seul lieu où Notre-Seigneur ait été toujours bien reçu, tout le chemin qui conduit de Jérusalem à Béthanie et que Notre-Seigneur suivit si souvent, Bethphagé, le temple où Jésus enseigna si souvent, Siloë avec la piscine où l’aveugle-né lava ses yeux, tout cela est sous nos yeux, et crie, chante sans cesse Jésus…
« Que ne pouvez-vous venir ici ! comme vous jouiriez ! comme vous sentiriez avec émotion et bonheur Jésus parler à votre cœur !
« Je ne vais jamais en ville, il ne vient personne au couvent, j’ai donc une solitude merveilleuse dont je jouis profondément… Le bon Dieu est bon !… Plus je vais, plus je trouve de jouissance. Il faut m’en humilier : cela montre que je ne suis pas assez fort pour supporter les croix, mais il faut aussi être reconnaissant envers ce Dieu si bon qui épargne, avec de si tendres soins, le moindre vent à cette brebis si chétive et si tondue[58]. »
Frère Charles ne sortait guère de sa solitude que pour aller à la chapelle. Il disait : « J’ai tout à fait la vie religieuse, moins l’habit. »
« Il retourna bientôt à Nazareth, mais il se considérait véritablement comme un serviteur au service des deux monastères, et mère Élisabeth du Calvaire lui ayant exprimé le désir qu’il revînt habiter Jérusalem, il revint, en effet, avant la fin de l’année. Que lui importait d’être ici ou là, dès lors que la vie était semblable et l’âme en sûreté ?
Nul n’échappe entièrement au regard du voisin. Si bien caché que fût Charles de Foucauld, il était jugé. Il parlait très peu ; il évitait d’entrer en conversation avec les quelques personnes qui se trouvaient sur son chemin ; l’abbesse, demeurant dans la clôture, ne s’entretenait avec lui qu’en de rares occasions, et s’il avait une permission à lui demander : néanmoins, comme à Nazareth, une opinion murmurée, la première, qui est faite d’étonnement, d’admiration encore indécise, d’estime encore retenue, mais vive déjà, se formait au sujet de ce personnage mystérieux. On le voyait qui venait chercher ses repas, comme un pauvre, chaque jour, à la porte du monastère, et qui s’en retournait, sans avoir cessé de lire dans un livre qui ne le quittait point ; on le voyait communier chaque matin, servir des messes, s’acquitter avec scrupule des petits travaux dont il était chargé, passer une heure et demie à la chapelle, après le dîner de midi, revenir le soir, s’il y avait un office ; on savait qu’il couchait sur deux planches recouvertes d’une natte, avec une pierre pour oreiller, comme à Nazareth ; qu’il ne dormait guère plus de deux heures par nuit ; qu’il était d’une tempérance extrême et d’une égale charité. Les gens de langue arabe, ou de langue française, qui avaient conversé avec lui, gardaient le souvenir de ses yeux très bons et de sa manière fraternelle. Ils étaient émerveillés aussi de la joie qu’ils avaient devinée chez cet homme sans maison, sans parents, sans richesse et sans place.
Plusieurs, dans la campagne de Jérusalem et dans la ville, le nommaient « le saint ermite des clarisses ». Quelques-uns s’informaient pour savoir si on pouvait le consulter. Les pauvres tâchaient, quand il sortait, de se trouver sur son chemin. Au consulat général de France, où il allait parfois pour traiter une affaire de la communauté, il était reçu avec honneur, et tout de suite introduit au salon, malgré l’extraordinaire costume qui ne prévenait pas en sa faveur. Le nègre lui-même et sa femme, voisins de case, et qu’il appelait toujours « mon frère, ma sœur », le traitaient avec beaucoup de considération. Un jour que, pour l’éprouver, l’abbesse disait au gardien : « Va porter ceci à l’ouvrier. » – « Au monsieur », reprit vite le nègre.
Peu de temps après son établissement à Jérusalem, et au sortir d’une retraite qu’il venait de faire, frère Charles déclara que, désormais, il suivrait le régime des trappistes : à midi, une soupe au lait, des figues et du miel ; le soir, un morceau de pain pesé comme pour une Clarisse, 180 grammes. Pendant l’avent de 1898 et le carême de 1899, il se contenta d’un morceau de pain, à midi et le soir. Quelques religieuses des monastères de Terre sainte se souviennent de ces choses, et me les ont écrites. L’une d’elles remarque, en passant : « Trappiste, il l’était resté dans la force du terme ; en toutes circonstances il disait : « Comme il est dit dans la règle des trappistes », et cette règle, il la portait toujours sur lui. »
Qu’on n’imagine pas, comme certaines gens du monde seraient peut-être disposés à le croire, que la piété et l’habituelle méditation eussent fait de Charles de Foucauld une sorte d’homme affadi, doucereux et compassé. L’homme qui vivait de la vie que je viens de dire prouvait qu’il avait le don de force. D’habitude, il l’exerçait en se domptant lui-même : en quelques occasions, et quand il le fallait, il se montrait rude à autrui. Une troupe de mendiants italiens avait un jour réussi à pénétrer dans la cour des sœurs tourières ; ils menaient grand tapage parce que celles-ci refusaient, à bon droit, de leur donner à dîner. Les pauvres filles, injuriées et menacées, ne savaient que faire, lorsque, par hasard, frère Charles survint. Sans calculer, sans un mot, il se jeta sur l’un des mauvais drôles, le saisit à bras le corps et le fit passer dehors ; puis ce fut le tour d’un second, puis d’un troisième. Avec une incroyable maëstria, il vint à bout, en une minute, de cette petite opération de police. Ses yeux étaient devenus tout ardents.
L’instant d’après, Frère Charles passait devant la loge des tourières : « Je vous ai peut-être mal édifiées ! » dit-il. – « Mais non : délivrées. Merci ! »
Quand elle l’eut ainsi vu vivre plusieurs mois, et qu’elle fut sûre de la grande intelligence et de la singulière vertu qu’il avait, mère Elisabeth commença de l’exhorter à entrer dans les ordres. Elle lui représenta qu’il rendrait de plus grands services en devenant missionnaire : mais il détourna la conversation, et rentra à l’ermitage. Comme elle était femme de très ferme volonté et habituée à la conduite des âmes, lesquelles ne se rendent pas à toutes les raisons, mais à une, elle revint sur ce sujet, et fit observer à Frère Charles que, s’il devenait prêtre, il y aurait chaque jour dans le monde une messe de plus, un nombre infini de grâces pour les hommes ; qu’il était donc maître de répandre une bénédiction nouvelle sur la terre, ou de la retenir dans les cieux. S’il avait reçu des dons, qu’il avait accrus par l’étude et par un long travail spirituel, était-ce pour ne les faire servir qu’à lui seul ? Frère Charles, que la pensée d’honorer mieux encore le Saint-Sacrement émouvait au fond de l’âme, réfléchissait aux paroles qui lui étaient dites, puis répondait : « Être prêtre, c’est me montrer, et je suis fait pour la vie cachée. »
L’abbesse, décidée à procurer à l’Église un saint prêtre de plus, mit alors ses filles en prière, et, après quelque temps, le solitaire l’ayant revue, lui dit : « Écrivez vous-même à mon directeur. » Ce qui fut fait.
Or, à ce moment, une mauvaise querelle fut élevée contre les clarisses de Nazareth, au sujet d’un terrain qui leur appartenait, de celui, je suppose, sur lequel était placée la cabane que frère Charles avait habitée. Elles écrivirent, suppliant celui-ci de reprendre possession de ce morceau contesté de leur domaine, d’y faire un peu de culture et de s’occuper lui-même d’arranger le différend, car nul ne pourrait y réussir aussi bien.
Il partit aussitôt, accompagnant un religieux qui allait là-bas pour prêcher une retraite. Les voyageurs se rendirent de Jérusalem à Jaffa, où ils s’embarquèrent pour Caïffa, et, de là, gagnèrent Nazareth, au commencement de 1899.
De toutes ces choses, l’abbé Huvelin était avisé par son pénitent, qui lui demandait conseil. Il y avait longtemps qu’il songeait que Charles de Foucauld était destiné au sacerdoce, et qu’il l’avait laissé entendre. Dans la petite cabane de Nazareth, la résolution fut enfin prise, par Frère Charles, de se préparer aux ordres sacrés. Mais il ne pouvait renoncer à sa vocation particulière, depuis tant d’années étudiée, méditée, éprouvée aussi, et il fallait trouver la solution de ce problème : une vie sacerdotale, une vie érémitique. Où la vivrait-il ? Et comment ?
Cet homme, que tourmentait une imagination débordante, parfois chimérique, toujours grandiose par le choix de son rêve, eut vite fait de se décider : il achèterait le mont des Béatitudes ; il établirait un ermitage sur le sommet, et là, tout seul, – ou peut-être avec quelques petits frères dont il espéra toujours la venue, – il garderait ce lieu sacré ; il adorerait le Saint-Sacrement, qu’il aurait porté parmi des peuplades farouches ; il recevrait les Bédouins de passage et les pèlerins qui monteraient sur les pas de Jésus-Christ. Prêtre contemplateur, exposé, austère, charitable, il « prêcherait l’Évangile en silence ».
Le cahier de notes intimes est ici bien touchant. On y découvre la pureté d’intention, la générosité de ce solitaire qui, dans sa cabane de planches, méditant l’avenir prochain, n’était préoccupé que de son propre effacement et de la gloire de Dieu. Voici ce qu’on y peut lire :
« Je crois de mon devoir de tâcher d’acheter le lieu probable du mont des Béatitudes. Voyant clairement que, soit à cause des obstacles mis par le gouvernement turc, soit à cause de leurs charges actuelles, les franciscains ne peuvent s’engager à établir immédiatement, ni dans un délai déterminé, un autel avec un tabernacle et un chapelain,… je ne vois rien de mieux que de leur proposer de me charger d’entretenir au sommet du mont un autel, un tabernacle où soit perpétuellement le Très Saint-Sacrement, et un chapelain chargé d’y célébrer la messe chaque jour, à cette condition que, le jour où les franciscains voudront prendre à leur charge l’entretien de l’autel, du tabernacle et du chapelain, le lieu leur sera immédiatement livré par moi ou mes héritiers.
« J’avais pensé d’abord établir là un chapelain ermite, dans une pauvre chambre, et à m’établir auprès de lui, pour lui servir de serviteur et de sacristain. Mais je me rends compte que je ne puis en aucune façon imposer ces charges à ma famille. Il faut donc trouver un autre moyen. Je n’en vois qu’un : c’est d’être moi-même le pauvre chapelain de ce pauvre sanctuaire. »
Frère Charles, continuant sa méditation sur ce thème, se demande s’il remplira mieux ainsi sa vocation, qui est « d’imiter, le plus parfaitement possible, Notre-Seigneur Jésus dans sa vie cachée ». Et il répond affirmativement, en comparant ce qu’il fait à Nazareth, et ce qu’il ferait au mont des Béatitudes.
« La foi en la parole de Dieu et de son Église se pratique également partout, mais là, au mont des Béatitudes, dans le dénuement, l’isolement, au milieu d’Arabes très malveillants, j’aurai, pour ne pas perdre courage, besoin d’une foi ferme et constante à ces mots : cherchez le royaume de Dieu, le reste sera donné par surcroît… Ici, au contraire, rien ne me manque, et je suis en sûreté. C’est donc là que ma foi s’exercera le mieux.
« Là, je pourrai infiniment plus pour le prochain, par la seule offrande du Saint-Sacrifice,… par l’établissement d’un tabernacle qui, par la seule présence du Saint-Sacrement, sanctifiera invisiblement les environs, comme Notre-Seigneur, dans le sein de sa mère, sanctifia la maison de Jean,… soit par les pèlerinages,… soit par l’hospitalité, l’aumône, la bienfaisance que je m’efforcerai de pratiquer envers tous.
« Ici, ma condition est, en soi, plus basse ; là, elle sera, à mes yeux, d’une hauteur infinie car rien au monde n’est, pour moi, plus grand qu’un prêtre. Mais, où y a-t-il plus d’imitation de Notre-Seigneur ? Le prêtre imite plus parfaitement Notre-Seigneur, souverain prêtre qui, chaque jour, s’offrait. Je dois mettre l’humilité où Notre-Seigneur l’a mise,… la pratiquer dans le sacerdoce, à son exemple.
« Ici, j’ai plus de distractions causées par mon entourage… Là, je pourrai être bien plus devant le Saint-Sacrement, car je pourrai me tenir à ses pieds une partie de la nuit…
« Bien qu’ici l’abjection de mon état soit plus grande au premier regard, là je serai soumis à mille fois plus d’humiliations. Ici, vis-à-vis de moi-même, je suis supérieur à ma condition,… là, prêtre ignorant et incapable, je serai, vis-à-vis de moi-même, profondément au-dessous de mon état… Me présentant sous un habit étrange, demandant à vivre un genre de vie particulier, à établir un tabernacle en un lieu saint, dont l’authenticité est discutable (elle ne fait pas de doute pour moi), je serai, dès le premier jour, l’objet de toutes les railleries, de tous les rebuts et contradictions… Seul, dans un désert, avec un chrétien indigène qu’il faudra de toute nécessité, au milieu de populations sauvages et hostiles,… le courage trouvera beaucoup plus à s’exercer. »
Il termine son « élection » en se définissant lui-même. Qui est celui, demande-t-il, qui a ainsi pesé le pour et le contre ? « ce pécheur, cet indigne, ce pauvre, cet ignorant, cette âme de bonne volonté pourtant, qui veut tout ce que Dieu veut, et cela seul ».
Telles sont les principales fins que se proposait Frère Charles, quand il songeait à acheter le mont des Béatitudes. Elles sont d’une grande âme. S’il les a, dans la suite, poursuivies autrement, et dans d’autres contrées, on remarquera qu’elles n’ont jamais cessé d’être présentes à son esprit. Il a été, ailleurs, ce qu’il méditait d’être sur la montagne où Notre-Seigneur prêcha les sept bonheurs que le monde ne connaissait pas.
En juin 1900, Frère Charles, ayant pris sa décision, se mit en route, et gagna Jérusalem. Il arriva dans cette ville la veille de la fête du Sacré-Cœur.
Il voulait voir Mgr L. Piavi, car l’autorisation de s’établir, comme prêtre ermite, au sommet du mont des Béatitudes, ne pouvait être donnée que par le patriarche. Sans doute aussi pourrait-il, dans cette audience, faire approuver le projet de règle qu’il avait rédigé, pour lui-même et les futurs « petits frères du Sacré-Cœur ». L’abbé Huvelin n’avait accepté cette idée qu’à contre-cœur. Il savait qu’il avait la garde d’une âme extraordinaire et qui « déroutait toutes les prévisions » ; et c’est pourquoi il n’osait pas aller jusqu’à une défense formelle. Les termes dont il s’était servi avertissaient cependant avec force. Il se récusait : « Moi, mon enfant, je n’ai pas la lumière pour cela, je ne vois que des objections, et je crains l’esprit propre, sous votre dévouement et sous votre piété. »
Le lendemain de son arrivée à Jérusalem, Frère Charles monta de bon matin au Calvaire et assista à une messe, puis il se dirigea vers le patriarcat. Dans quelle tenue et quel pitoyable état ! Il n’était pas de ces voyageurs qui ont un vêtement de rechange dans une valise, ou qui possèdent de quoi en acheter un neuf. Ses sandales, les jours précédents, avaient dû se rompre sur les routes, et il les avait remplacées par de simples morceaux de bois reliés par des courroies. Des bandes de gros papier, serrées par des ficelles, cachaient les trous de son pantalon, ouvert aux deux genoux. En outre, le pauvre voyageur, marchant tout le jour, en plein été, sans aucune précaution, avait reçu un terrible coup de soleil : ses paupières, son front, ses joues étaient enflés et tavelés. Quand un pareil gueux demanda à être reçu par Mgr Piavi, le personnel du patriarcat fit naturellement quelque difficulté. Ce ne fut qu’après une longue attente, et sur son affirmation renouvelée qu’il voulait parler au patriarche lui-même, que Frère Charles fut introduit auprès de Sa Béatitude.
Mgr Piavi l’écouta, puis, s’imaginant qu’il avait affaire à quelqu’un de ces illuminés qui ne sont pas rares en Orient, – ni ailleurs, – sans se douter qu’il eût, devant lui, un homme d’un puissant esprit et d’une vertu héroïque, il répondit : « Nous y réfléchirons, retirez-vous pour le moment. »
Il réfléchit, en effet, s’informa, apprit quelque chose de cette existence exceptionnelle, et tâcha de faire revenir au patriarcat l’étrange solliciteur. Mais le rêve était fini. Frère Charles considéra l’échec comme un signe de la volonté divine. Il revint donc à Nazareth. Dans le même temps, et alors qu’il se croyait déjà propriétaire du sommet du mont des Béatitudes, il découvrit qu’il avait été joué par le vendeur, et que celui-ci, – un homme d’origine allemande, – avait vendu sans droit le terrain où devaient s’élever la chapelle et la cabane. Le prix payé fut perdu.
Comment Frère Charles supporta ces déceptions et humiliations, il le dit lui-même, dans ses lettres, et sans se douter qu’il fait ainsi son propre éloge.
« J’ai vu le patriarche, et je lui ait dit ce que j’avais à lui dire. Aussi, bien qu’il m’ait renvoyé assez lestement, suis-je très content… Je suis dans une paix profonde et une grande joie ; je n’ai qu’une chose à craindre : d’être infidèle à la grâce… [59] » « Mon désir des saints ordres reste ferme, mais tout le reste dans le doute… Sois bien certaine d’une chose, ma chérie, c’est que la volonté de Dieu s’accomplira : soit par les hommes, soit contre eux, il fera pour nous ce qui nous est le meilleur. Ne t’afflige pas à la pensée que je n’irai pas en France cette année. Peut-être suis-je, sans le savoir, près de m’y rendre… [60] » « N’attachons pas d’importance aux événements de cette vie, ni aux choses matérielles ; ce sont les rêves de notre nuit d’auberge… Qu’est-ce qui nous reste, à l’heure de la mort, sinon nos mérites et nos péchés[61] ? »
L’abbé Huvelin encourageait son pénitent à se préparer au sacerdoce ; il jugeait que cette préparation serait brève, vu les études déjà faites, de philosophie et de théologie, et souhaitait qu’elle pût avoir lieu, comme Frère Charles venait d’en avoir l’idée, à la Trappe de Notre-Dame-des-Neiges. Puisque la tentative auprès de Mgr Piavi n’avait pas réussi, oui, sans doute, il serait bon de demander asile, jusqu’au sacerdoce, à cette abbaye vivaroise, où la formation serait parfaite. Rien ne pressait d’ailleurs ; lui-même, il se proposait de faire, en temps utile, les démarches nécessaires, près du père abbé, près de l’évêque. Le pauvre vicaire de Saint-Augustin, très souffrant, et, comme il disait, « enveloppé d’un réseau de douleurs », écrivait des billets assez fréquents, où les projets abandonnés et les projets en cours l’un après l’autre étaient jugés. Mais la lenteur des courriers, l’impossibilité de se faire entièrement comprendre à de telles distances, le besoin, violent comme un instinct, qui nous porte à saisir déjà par sa frange ce lendemain qui va devant nous, eurent raison de la patience de Charles de Foucauld. Il brusqua les choses, prévint d’un mot l’abbé Huvelin, et partit pour la France.
Il quittait la Terre sainte au début d’août 1900, n’emportant qu’un bréviaire et un vieux panier renfermant sa nourriture. La traversée, il la fit sur le pont, en quatrième classe, inconnu sans doute. Il allait où l’appelait une volonté qui ne dit ses secrets que peu à peu, mais qui commande nettement, suavement, ce qui est essentiel à chaque période. Il était sûr qu’il devait, désormais, accepter le sacerdoce, dont le sentiment de son indignité l’avait d’abord et longtemps écarté ; il était sûr que sa vocation consistait à porter l’Hostie dans les contrées sauvages, parmi les infidèles, et à vivre en l’adorant, sans la prêcher encore, si ce n’est par l’héroïque charité qu’elle lui mettrait au cœur. Mais il ignorait profondément, en voyant s’éloigner les maisons de Jaffa et les terres qui montent en arrière, vers quels pays et quel peuple il serait envoyé, un jour prochain. Le temps de cette parole-là n’était pas venu.
Dans la Palestine et la Judée, la renommée de Frère Charles demeurait. Déjà la légende s’était emparée de l’histoire de l’ermite de Nazareth et de Jérusalem, et la fleurissait de ses fleurs souvent inutiles et vaines. On racontait, dans les villages, que Frère Charles aimait à se faire descendre au fond des puits taris, et que là, bien sûr de ne point être troublé, il priait et méditait de longues heures. Rien n’était vrai dans ce récit ni dans plusieurs autres semblables, excepté la vénération qui les avait inspirés.
Années de préparation, voilà ce que furent, pour Charles de Foucauld, les années passées en Orient. Elles l’avaient habitué à la vie solitaire, à la discipline sans témoins, au travail sans programme imposé. Il avait fait l’apprentissage qui lui permettrait de supporter de bien plus dures épreuves, sans défaillance, dans la joie de celui qui obéit à sa vocation. Mais il ne savait pas ces choses, il allait seulement au-devant d’elles, confiant.
CHAPITRE VII – CHARLES DE FOUCAULD PRÊTRE – LE CHEMIN DU DÉSERT
La direction d’une âme, à 4 000 kilomètres de distance, est chose bien difficile.
Qu’allait penser l’abbé Huvelin de ce brusque retour en France ? Ses avis n’avaient pas été suivis ; on entreprenait ce voyage malgré l’envoi d’un télégramme qui disait : « Demeurez à Nazareth. » Il fut d’abord mécontent et inquiet, mais, à peine eut-il revu ce terrible pénitent, qu’il subit le charme, comme les autres, reconnut l’entière bonne foi, et même beaucoup plus, et même beaucoup mieux : l’appel mystérieux et certain auquel Charles de Foucauld avait obéi.
De prime abord, et quand il eut entre ses mains la lettre de Frère Charles annonçant une prochaine visite, l’abbé Huvelin, toujours vite ému et prompt à la riposte, s’écria : « Le boulet est lancé, qu’est-ce qui l’arrêtera ? » Nouvelle lettre le 16 août. Frère Charles, débarqué à Marseille, et suivant l’attrait d’une dévotion ancienne, avait couru à la Sainte-Baume, afin de prier Marie-Madeleine ; il allait prendre maintenant un des premiers trains pour Paris, et, s’il ne rencontrait pas M. Huvelin, rue de Laborde, il irait à Fontainebleau, où, en effet, se trouvait l’abbé, malade à l’ordinaire, tourmenté par la goutte. M. Huvelin se décide alors à rentrer à Paris ; il reçoit le cher ermite, vêtu étrangement, et qui a l’air très fatigué, – on le serait à moins ; – il le gronde un peu, puis l’écoute. On a mille choses à se dire, depuis tant d’années qu’on ne s’est vus. Vingt-quatre heures ne sont pas de trop pour tout raconter, tout expliquer, tout combiner. En voyant s’éloigner son pénitent, l’abbé Huvelin écrit ces lignes : « Il a dîné, couché à la maison, déjeuné avec moi, et pris le chemin de Notre-Dame-des-Neiges et de Rome… C’est une très sainte âme. Il veut être prêtre. Je lui ai indiqué le moyen. Il avait très peu, trop peu d’argent ; je lui en ai donné un peu. Il savait très bien ma pensée ; je la lui avais envoyée dans un télégramme ; mais quelque chose de plus fort le pousse, et je n’ai qu’à l’admirer et à l’aimer. »
J’imagine Frère Charles, dans son compartiment de troisième classe, pendant ce nouveau voyage. Il est assis près d’une fenêtre. Déjà rasséréné, reposé par l’approbation qu’il a reçue et l’affection non diminuée de son guide, il s’interrompt parfois de prier pour regarder le paysage. Comme cette fraîche nature émeut le voyageur, comme elle lui parle doucement des jours anciens ! Il descend la vallée du Rhône ; il reçoit, dans son âme tendre, l’image d’un de nos grands fleuves qui courent, l’image de nos campagnes, vertes même en été, celle des montagnes, au loin, dont la brume toujours amollit les arêtes et les lignes de sommet. Je le vois qui descend du train rapide, et qui en prend un autre, un train de petite allure, habitué des longs retards, et qui va s’engager dans les vallées et les rampes du massif de l’Ardèche. On s’étonne autour de lui ; on se demande quel est ce singulier personnage, moitié moine et moitié laïc, nu tête et sans tonsure, vêtu d’une robe de coton blanchâtre, un chapelet autour du corps. Il a l’air d’un bien pauvre homme ; ses traits sont creusés ; il va les yeux baissés, sans se soucier du soleil, ni des rires, ni des mots, ni de la pitié peut-être qu’il éveille en passant.
Quelle fut la gare où il s’arrêta, pour gravir les dernières pentes qui mènent à Notre-Dame-des-Neiges ? On peut aller jusqu’à La Bastide-Saint-Laurent. Mais lui, que la passion de la pauvreté et de la mortification conseillait dans les plus petites choses, j’imagine qu’il dut descendre du train bien avant Saint-Laurent, et faire la longue montée en songeant au Calvaire, et à la prêtrise prochaine et aux années passées à la Trappe, et, par moments, à la splendeur des hauts plateaux de bruyères et de roches, qui, à cette heure du couchant, livraient, pour un seul voyageur et pour Dieu, leur trésor de couleurs, de relief et de parfums. Il se trompait, en se croyant seul dans ces grands espaces. Des pauvres comme lui, – mais qui l’avaient toujours été, – des errants, plus ou moins sûrs, plus ou moins estropiés, jeunes ou vieux, dont le métier préféré est d’aller de gîte en gîte, la main tendue, voyageaient par la même route ou par les sentiers de la montagne. Il en trouva plus d’une demi-douzaine à la porte de l’abbaye, lorsqu’il arriva, fourbu, tout brun de poussière, entre la longue façade basse et les arbres tout grands plantés par les vieux moines. Le frère portier ne l’attendait point. Il n’avait pas connu Charles de Foucauld, novice de Notre-Dame, dix ans plus tôt. Quand il sortit de sa loge, à l’heure prévue par le règlement, pour compter les hôtes que le monastère accueillerait, ce soir-là, au nom de la charité du Christ, s’il remarqua que l’un des pauvres était plus blanc que les autres, dans la nuit commençante, ce fut pour sourire de l’accoutrement. Il en avait vu de toutes les couleurs. Et, ayant seulement compté ses pensionnaires :
– Entrez, dit-il, mes amis ; on va vous donner la soupe, et après, un bon coin pour dormir.
Frère Charles, heureux d’une occasion pareille de ressembler au Maître, se garda bien de se nommer. Il mangea, comme les autres, son écuelle de soupe chaude, dormit avec eux dans la grange, et ne se fit connaître que le lendemain matin, quand la cloche conventuelle sonna la première messe.
Le trait est demeuré présent, là-bas, à toutes les mémoires. Je faisais observer, au vieux frère qui me l’a raconté, que ce portier, vraiment, n’avait pas eu de bons yeux, pour se méprendre ainsi.
– Eh ! me répondit-il, en riant de tout son cœur, c’est qu’il était minable, le Père de Foucauld ; il avait de la poudre jusqu’aux épaules, et autour du corps, monsieur, un chapelet si long, si gros, si lourd : de quoi attacher un viau !
Le rire était bien franc ; l’édification dominait.
Dom Martin, ayant accueilli l’ex-frère Marie-Albéric, s’occupa aussitôt, avec zèle, d’obtenir que Mgr de Viviers l’acceptât parmi les clercs du diocèse. Il y réussit, les témoignages, de plusieurs côtés sollicités, ayant représenté Charles de Foucauld comme un homme de haute vertu. Entre l’abbé de la Trappe et celui-ci, il fut convenu qu’après un court séjour à Rome, Charles de Foucauld reviendrait à Notre-Dame-des-Neiges, et s’y préparerait au sacerdoce.
Qu’allait-il faire à Rome ? Au moment de s’engager dans les ordres sacrés et de choisir le lieu de l’habitation définitive, d’où peut-être il ne reviendrait jamais, il voulait s’entretenir avec quelques personnages qu’il avait connus là ; et je ne doute guère que parmi les sujets dont il se proposait de causer avec eux, le principal ne fût cette chère fondation des petits frères du Sacré-Cœur, son rêve depuis sept ans déjà, l’espoir où il se complaisait que l’ermitage en pays musulman, l’entreprise si difficile et si rude du pauvre Charles de Jésus ne mourût point avec lui.
Dom Martin le laissa aller, après l’avoir fait renoncer, pour les voyages en Europe, aux costumes plus ou moins orientaux, et lui avoir donné un de ces vêtements noirs que portent les oblats de la Trappe.
Au début de septembre, Frère Charles, ayant fait un court arrêt à Milan, se trouvait à Rome.
« Je suis à Rome, dans un petit nid que le bon Dieu semble avoir préparé exprès ; juste vis-à-vis des Pères du Saint-Sacrement, qui, à Saint-Claude-des-Bourguignons, ont le Saint-Sacrement exposé jour et nuit. Ces bons Pères, à qui j’avais demandé l’hospitalité et qui n’ont pu me la donner faute de place, m’ont trouvé une chambrette dans une maison très pieuse, où je suis on ne peut plus tranquille et solitaire, et d’où je puis jouir du Saint-Sacrement avec autant de facilité que si j’étais dans le couvent même.
« Il n’est plus question pour moi d’habiter le mont des Béatitudes, je crois vous l’avoir écrit ; d’après l’avis de M. l’abbé, je retournerai, une fois ordonné, à Nazareth où je continuerai à vivre comme prêtre, à l’ombre[62]. »
Même dans Rome, il mène une vie d’ermite, sortant à peine de l’église toute voisine, où, jour et nuit, le Saint-Sacrement est exposé. Il étudie là sa théologie ; il lit à genoux, le plus souvent, dans les gros livres qu’il a apportés ; de temps en temps il lève les yeux vers Celui dont ses livres lui parlent ; il se délasse en priant, et, de l’angélus du matin à l’angélus du soir, les heures passent ainsi, calmes comme à Nazareth. Il eût aimé le désert, et savait au moins chercher et se faire partout une solitude. Deux des professeurs qu’il souhaitait de consulter se trouvent à Rome. Il les voit. Un troisième religieux, son ami, rentre vers le 20 septembre. Et alors, le moment étant venu de quitter la Ville sainte, pour s’enfermer à la Trappe, Charles Foucauld attend impatiemment une réponse qu’il avait demandée à l’abbé Huvelin : la permission de s’arrêter, dans le voyage de retour, de remonter jusqu’à Barbirey. Dix ans qu’il n’a pas vu sa sœur ! Et ces neveux et ces nièces qu’il ne connaît pas ! Et ce nid, dans les collines de Bourgogne, où il n’est allé qu’en esprit !
« Je ne sais encore, écrit-il à Mme de Blic, si c’est la volonté du bon Dieu, ou s’il ne préfère pas que je me mortifie, en faisant ce sacrifice. Je ferai ce qu’on me dira être le plus parfait… Si on me dit d’aller te voir, oh ! quelle joie ce sera ! Comme je serai heureux de t’embrasser, de me trouver dans ton petit nid, entre toi, Raymond et tes enfants ! »
La réponse arrive : M. Huvelin permet. Frère Charles quitte Rome et prend le chemin de la Bourgogne. Toute la famille est en joie. Ces jours longtemps rêvés, dont on se souviendra longtemps, chacun sait qu’ils seront plus rapides peut-être que les autres, et que la douceur du revoir, dès le premier moment, est déjà diminuée par l’approche de l’adieu.
Il fallut vite repartir pour les montagnes du Vivarais, traverser les bois de pins, frapper à la porte de l’abbaye, et entrer en retraite.
Celle-ci commença le 29 septembre 1900. Depuis cette date et pendant près d’une année, l’éternel voyageur demeure dans la clôture de Notre-Dame-des-Neiges. C’est dans la chapelle du monastère qu’il reçoit les ordres mineurs, en la fête du Saint-Rosaire, le 7 octobre. Les plus vieux des Pères, les plus vieux des Frères parlent encore de l’affection qu’ils avaient tous pour Charles de Foucauld, et de la quotidienne édification qu’ils reçurent de lui. Dom Martin, dès le lendemain de la fête, écrivait : « Je ne saurais vous exprimer notre bonheur de posséder, pour quelque temps, notre cher et saint ermite. Il est un peu fatigué, en ce moment, et on ne sait comment s’y prendre pour le soigner… J’ai eu le bonheur de lui conférer les ordres mineurs, en la fête du Saint-Rosaire ; c’est peut-être le plus grand bonheur de ma vie. »
On avait résolu d’abréger, le plus possible, les délais, pour l’ordination de ce candidat qui avait déjà tant étudié, tant prié, et si amplement prouvé sa vocation. Le 22 décembre, il était fait sous-diacre, à Viviers. Presque aussitôt, il se remettait en retraite, en vue du diaconat. Sa vie s’écoulait dans une méditation continuelle. Il feuilletait, à longueur de jour, l’Évangile, la Bible, les écrits des Pères. Son âme, habituée à l’essor, se laissait emporter, comme par des ailes, par les textes sacrés, et, bien au-dessus du monde, s’épanouissait entière dans la lumière divine. Nous avons les cahiers sur lesquels cet assidu notateur écrivait certaines de ses pensées et de ses résolutions. Assez promptement, se pose devant lui la question : « Que deviendrai-je ? » et les projets s’ébauchent, et la voie apparaît.
Résumant cette période, il écrira plus tard :
« Mes retraites du diaconat et du sacerdoce m’ont montré que cette vie de Nazareth, qui me semblait être ma vocation, il fallait la mener non pas en Terre sainte tant aimée, mais parmi les âmes les plus malades, les brebis les plus délaissées. Ce divin banquet dont je devenais le ministre, il fallait le présenter non aux parents, aux voisins riches, mais aux boiteux, aux aveugles, aux pauvres, c’est-à-dire aux âmes manquant de prêtres. Dans ma jeunesse, j’avais parcouru l’Algérie et le Maroc. Au Maroc, grand comme la France, avec dix millions d’habitants, pas un seul prêtre à l’intérieur[63] ; au Sahara, sept ou huit fois grand comme la France et bien plus peuplé qu’on ne le croyait autrefois, une douzaine de missionnaires ! Aucun peuple ne me semblait plus abandonné que ceux-ci… »
On m’a montré, avec complaisance, en haut des murailles, noircies par l’incendie, de l’ancienne chapelle, la fenêtre de la cellule qu’avait choisie Frère Charles pour se préparer aux ordres. On n’y pouvait accéder qu’en montant jusqu’à la hauteur des voûtes. Mais la porte ouvrait sur une tribune ; la tribune permettait de voir l’autel, et le futur prêtre passait là beaucoup d’heures.
Dans sa cellule des combles, Frère Charles faisait sa cuisine, qui était fort simple : un plat de haricots ou un chou cuit à l’eau. Il avait là, comme à Nazareth, comme à Jérusalem, son ermitage. Son unique promenade était d’aller de la cellule à l’église. Comme la fin de l’année 1900 approchait, il résolut de beaucoup prier pour le monde qui changeait de siècle. Il passa, devant le Saint-Sacrement, les deux dernières nuits du siècle finissant et les deux premières du nouveau. Combien d’hommes, sur la terre, en ont fait autant ?
C’était l’heure où l’Église de France était durement et injustement traitée par les pouvoirs publics. Il en souffrait, à cause des âmes faibles, qui tombent dans les temps de persécution, et parce que l’offense était faite à Jésus-Christ, dont seul le doigt levé maintient la France. Il disait : « Mais Jésus reste le maître ; et plus il semble mourir, plus il se relève, Dieu et Seigneur : Stat crux dum volvitur orbis. » Il disait encore : « Mais combien malheureux sont les heureux ! » Il tâchait de bien employer, sans se laisser abattre, chacune de ces minutes qui lui étaient données, « parcelles de l’examen qu’est la vie mortelle ». Il fut ordonné diacre la veille du dimanche de la Passion.
En mai 1901, commença la grande retraite de trente jours, par laquelle il acheva sa préparation au sacerdoce. L’ordination eut lieu à Viviers le 9 juin. Charles de Foucauld fut ordonné par Mgr Montéty, en présence de Mgr Bonnet. La veille, le Père abbé dom Martin lui avait dit : « Je vous accompagnerai, prenez les provisions qu’il faudra pour nous deux. » Les deux voyageurs, quelques instants après, se mettaient en route. Lorsque l’heure du déjeuner fut arrivée, Charles de Foucauld tira de sa poche un petit paquet, ouvrit l’enveloppe, et, sur la robe de l’abbé, déposa trois figues pour chacun, deux noix, et une bouteille d’eau.
Plusieurs des clercs présents à Viviers, et que ce trait, raconté, avait amusés, se demandaient : « Que va-t-il faire, chez monseigneur, qui l’a invité à déjeuner après la cérémonie ? » Il fit comme tout le monde, et ne se singularisa en rien.
Le soir même, le nouveau prêtre regagnait les montagnes de l’Ardèche, pour dire sa première messe, le 10 juin, à Notre-Dame-des-Neiges. Sa sœur l’y avait précédé. En dehors du monastère, elle s’était logée dans une petite maison, où on lui remit, quand elle arriva, cette lettre de son frère :
« Ma bonne chérie, merci de venir, ton arrivée me touche au fond du cœur. J’arriverai la nuit de dimanche à lundi, vers minuit ou une heure du matin ; garde-toi bien de m’attendre, couche-toi au contraire de très bonne heure, comme les trappistes qui se couchent à huit heures. À mon arrivée, j’irai droit à l’église, au pied du Saint-Sacrement à qui je dois ma première visite ; et je resterai dans le silence et l’adoration jusqu’au lendemain après ma première messe. Tu ne pourras me parler avant ma première messe, mais après, nous nous dédommagerons, ma chérie ; la messe de communauté se chante à 6 heures et demie, devant le Très Saint-Sacrement exposé ; j’y ferai diacre… Aussitôt la grand’messe terminée, j’irai à la sacristie mettre une chasuble, et je reparaîtrai au même autel où se sera célébrée la grand’messe, pour dire ma première messe ; je t’y donnerai la sainte communion, par une des grilles de la petite chapelle où tu te tiendras… Après l’action de grâces de ma première messe (trois quarts d’heure ou une heure après), j’irai faire une bonne séance près de toi… Attends-moi dans ta chambre à ce moment ; aie soin de bien déjeuner après avoir communié. Sois sûre que ton arrivée ici est une vraie joie pour toute la communauté qui, pleine d’illusions sur moi, m’aime mille fois plus que je ne le mérite, et en particulier le bon Père abbé, qui va à Viviers, malgré ses occupations, exprès pour m’accompagner…
« Bien venue, ma chérie, et merci de ta venue. Je t’embrasse comme je t’aime : de tout mon cœur dans le cœur de Jésus.
« † Fr. ALBÉRIC. »
Par délicatesse, et pendant son séjour à la Trappe, Charles de Foucauld avait repris, comme on le voit, son ancien nom de trappiste. Après l’ordination, il continua d’habiter sa cellule de Notre-Dame-des-Neiges, jusqu’à ce que les négociations fussent terminées, qui devaient préparer l’établissement dans l’Afrique du Nord. Elles étaient de deux sortes : il fallait obtenir la permission de l’autorité religieuse, et celles du gouvernement général et des chefs militaires.
Les lettres que je vais citer sont belles à mon avis, belles de loyauté, de clairvoyance, d’affection, si elles parlent de Charles de Foucauld ; d’humilité et d’ardeur, si elles sont signées de lui. Il me semble que tout esprit non prévenu devra admirer ici le prêtre de France, soit dans celui qui s’offre pour une mission sans précédent, soit dans les autres qui le recommandent. Par erreur, les premières lettres furent adressées à Mgr Bazin ; on s’aperçut assez vite qu’il eût fallu écrire à Mgr Guérin, préfet apostolique du Sahara, ainsi qu’à Mgr Livinhac, supérieur général des Pères blancs.
(M. l’abbé Huvelin à Mgr Bazin). « Martigny-les-Bains, le 25 août 1901. – Monseigneur, M. le vicomte Charles de Foucauld, longtemps lieutenant dans l’armée d’Afrique puis voyageur intrépide et habile au Maroc, puis novice chez les pères trappistes d’Akbès, en Syrie, voué ensuite au service des sœurs clarisses de Nazareth, revenu enfin au monastère des trappistes de Notre-Dame-des-Neiges, où il vient de recevoir les ordres sacrés et la prêtrise, me demande de le recommander auprès de Votre Grandeur.
« Quand vous l’aurez vu, vous jugerez que ma recommandation est bien inutile, car il se recommande de lui-même.
« Vous verrez en lui le dévouement héroïque, l’endurance sans limite, la vocation d’agir sur le monde musulman, le zèle humble et patient, l’obéissance dans le zèle et l’enthousiasme qu’il possède, l’esprit de pénitence sans aucune pensée de blâme et de sévérité contre qui que ce soit.
« Je suis son père spirituel depuis quinze ans. Je l’ai toujours suivi, je l’ai toujours trouvé, au milieu même de son enthousiasme et de ses élans, prudent et sachant attendre, se réfugiant dans la prière quand l’action lui était interdite. Je l’admire et je l’aime comme ont fait les Pères trappistes qui vous rendent témoignage de lui. Le révérend Père abbé de Staouéli avait pour lui la plus vraie affection, voyait en lui une espérance pour son ordre, même après qu’il l’eut quitté.
« La difficulté pour M. de Foucauld a été la question des saints ordres. Son humilité s’y est refusée longtemps, il a fallu une vive lumière pour lui montrer que sa voie était là, dans l’apostolat soutenu par la prière.
« C’est ici un simple portrait que je vous envoie, non flatté, mais ressemblant. Je suis un inconnu pour Votre Grandeur, mais j’espère qu’elle trouvera un air de vérité à mes paroles, et qu’elle verra dans le prêtre qui se présente à elle une ressource et une bénédiction pour les œuvres d’Afrique.
« Veuillez…
« Abbé HUVELIN,
Chanoine honoraire de Paris, vicaire à Saint-Augustin. »
(Le R. P. Martin, abbé de Notre-Dame-des-Neiges, à Mgr, Bazin.) « Notre-Dame-des-Neiges, 15 juillet 1901. – Je vous adresse ci-inclus une lettre de mon cher et saint ami, pour Mgr l’évêque du Sahara.
« Je n’ai pas à juger, ni à apprécier les pieux projets : Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei et non pas les abbés. Mais ce que je puis affirmer, c’est que je connais intimement, depuis onze ans, M. Charles de Foucauld, et que je n’ai jamais vu, en ma vie, un homme réalisant à ce point l’idéal de la sainteté. Je n’avais jamais vu que dans les livres de tels prodiges de pénitence, d’humilité, de pauvreté et d’amour de Dieu.
« J’ajouterai, ce qui est moins important, que cet ancien élève de Saint-Cyr, officier de cavalerie, fut un explorateur de premier mérite au Maroc, en Algérie et en Tunisie, qu’il appartient à une très noble famille, et qu’il est allié aux meilleures familles de France. »
(Charles de Foucauld à Mgr Bazin.) « Trappe de Notre-Dame-des-Neiges, 22 août 1901 – Monseigneur, je me mets aux pieds de Votre Grandeur… Le souvenir de mes compagnons morts sans sacrements et sans prêtre, il y a vingt ans, dans les expéditions contre Bou-Amama, dont je faisais partie, me presse extrêmement de partir pour le Sahara, aussitôt que vous m’aurez accordé les facultés nécessaires, sans un seul jour de retard, puisqu’un jour d’avance peut être le salut de l’âme d’un de nos soldats. Aussi je regarde comme un devoir de charité de vous écrire de nouveau, afin de pouvoir partir le plus tôt possible.
« Je demande humblement à Votre Grandeur deux choses : 1° la faculté d’établir entre Aïn-Sefra et le Touat, en l’une des garnisons françaises n’ayant pas de prêtre, un petit oratoire public, avec la sainte réserve pour les besoins des malades, d’y résider et d’y administrer les sacrements ; 2° l’autorisation de m’y adjoindre des compagnons, prêtres ou laïcs, si Jésus m’en envoie, et d’y pratiquer avec eux l’adoration du Très Saint-Sacrement exposé.
« Si vous daignez m’accorder cette double demande, je résiderai là, chapelain de cet humble oratoire, sans titre de curé, ni de vicaire, ni d’aumônier, et sans aucune subvention, vivant en moine, suivant la règle de saint Augustin, soit seul, soit avec des frères, dans la prière, la pauvreté, le travail et la bienfaisance, sans prêcher, sans sortir, si ce n’est pour administrer les sacrements, silencieux et cloîtré.
« Le but est de donner les secours spirituels à nos soldats, d’empêcher que leurs âmes se perdent faute des derniers sacrements, et surtout de sanctifier les populations infidèles en portant au milieu d’elles Jésus présent dans le Très Saint-Sacrement, comme Marie sanctifia la maison de Jean-Baptiste en y portant Jésus.
« Je promets de tout mon cœur à Votre Grandeur de m’efforcer, avec l’aide de Dieu, de n’être jamais, malgré ma misère, une occasion de scandale, et de ne jamais être pour votre délégation une cause de frais ni de charge matérielle ; je vous promets d’avance de tout mon cœur l’amour filial et la plus fidèle obéissance.
« Je me permets d’ajouter très humblement que la présence dans le Sahara de votre indigne serviteur, quoiqu’il soit très misérable, sauvera probablement plusieurs âmes qui, sans cela, mourront sans sacrements, et qu’elle donnera à votre délégation un tabernacle de plus, et chaque jour un saint sacrifice de plus.
« Si Votre Grandeur désire me parler, sur un mot de vous, par poste ou télégraphe, j’irai immédiatement à Alger.
« Je suis avec le plus profond respect, monseigneur.
« CHARLES DE FOUCAULD
« prêtre indigne. »
(M. l’abbé Huvelin à Mgr Livinhac.) « Dimanche, 1er septembre 1901. – Monseigneur, j’ai écrit, il y a huit jours aujourd’hui, à Mgr Bazin, des Pères blancs, tous les renseignements que vous me demandez sur M. de Foucauld. Celui-ci m’avait demandé de les envoyer à Mgr Bazin.
« Ce que je puis dire à Votre Grandeur est bon en tous points : beaucoup d’enthousiasme, mais de la sagesse, – beaucoup de zèle, mais beaucoup d’obéissance, – l’amour de la vie dure, avec un minimum de soulagement, mais de la direction, – l’amour de la mortification lui est un besoin que lui fait l’amour de Dieu.
« Sa vocation l’a toujours attiré vers le monde musulman. Son séjour en Algérie, son voyage dans l’intérieur du Maroc, ses années passées en Palestine l’ont préparé, l’ont endurci pour cette mission. J’ai vu venir cette vocation. J’ai vu qu’il s’assagissait par elle, qu’elle le rendait plus humble, plus simple, plus obéissant. Quand je lui disais de l’écarter comme chimérique, il l’écartait, mais cela revenait plus fort et plus impérieux. En mon âme et conscience, je crois qu’elle vient de Dieu. Amour du silence, de l’action obscure, vous trouverez cela chez lui… La difficulté qu’il a trouvée à la Trappe est toute venue de sa répugnance à recevoir les ordres sacrés. Il n’osait pas !
« Rien de bizarre ni d’extraordinaire, mais force irrésistible qui pousse, mais instrument dur pour un rude labeur, voilà ce que Votre Grandeur trouvera chez M. de Foucauld.
« Toutes les objections qui vous viennent, que de fois me sont-elles venues ! Je ne me suis rendu qu’à l’expérience, et à de longues épreuves.
« Fermeté, désir d’aller jusqu’au bout dans l’amour et dans le don, – d’en tirer toutes les conséquences, – jamais de découragement, jamais, – un peu d’âpreté autrefois, – mais qui s’est tant adoucie !
« Laissez-le venir et voyez ! Je regrette d’avoir détruit l’admirable lettre où il me demandait si humblement de donner des renseignements sur lui. C’est en toute conscience que j’envoie ceux-ci, qui compléteront ceux que j’ai donnés à Mgr Bazin, il y a aujourd’hui huit jours. Laissez-le venir à ses risques et périls, voyez-le à l’œuvre et jugez !
« Croyez, monseigneur, à mon respect, à mon profond et religieux dévouement et bénissez-moi !
« Je ne saurais vous dire combien j’ai été touché et pénétré de votre lettre où j’ai senti l’esprit du bon Dieu. Il discernera vite celui qui mène mon cher enfant !
« L’Abbé HUVELIN. »
(Dom Henri, prieur de Notre-Dame de Staouëli à Mgr Guérin, préfet apostolique du Sahara.) « 5 septembre 1901. – … Le père Duffourd m’a parlé d’une affaire que vous aviez à traiter de vive voix avec un ancien officier de la province d’Oran qui désirait y retourner… Je pense qu’il s’agit de notre ex-Père Albéric (Charles de Foucauld, – ou mieux Charles de Jésus). Je vous envoie en communication la dernière lettre que j’ai reçue de lui… Si vous aviez le bonheur de l’avoir comme collaborateur, j’en serais bien heureux pour vous et pour lui. C’est la plus belle âme que je connaisse ; d’une générosité incroyable, il s’avance à pas de géant dans la voie du sacrifice, et a un désir insatiable de se dévouer à l’œuvre de la rédemption des infidèles. Il est capable de tout, – sauf peut-être d’accepter une direction trop étroite. Le révérend Père dom Martin a dû le recommander à Mgr Livinhac ; tout ce que je puis ajouter, c’est qu’ayant vécu dix mois dans son intimité, j’ai été profondément édifié de sa vertu héroïque. Il y a en lui l’étoffe de plusieurs saints. Sa seule présence est une prédication très éloquente, et malgré la singularité apparente de la mission à laquelle il se croit appelé, vous pouvez en toute sûreté l’accueillir dans votre préfecture apostolique… »
(Mgr l’évêque de Viviers à Mgr Livinhac.) « Notre Dame-des-Neiges, 5 septembre 1901. – Monseigneur, je recommande à votre bienveillance l’humble et saint prêtre qui vient vous apporter son concours et vous supplier de vouloir bien l’accepter.
« M. l’abbé de Foucauld est un ancien et brillant officier, qui a brisé sa carrière pour se donner plus complètement à Dieu dans le sacerdoce. Je l’ai fait ordonner prêtre, il est mon sujet, et j’estime que c’est une grande faveur pour mon diocèse d’avoir possédé quelque temps un prêtre de ce mérite et de ce caractère. Si une vocation trop vieille et trop pressante ne l’appelait pas à se dévouer à la conversion des musulmans, je serais heureux de lui donner un emploi dans mon ministère… Il a acquis ici la réputation d’un saint, et nos prêtres sollicitent comme une grande grâce le bonheur de l’approcher quelques instants.
« Tout cela vous dira, monseigneur, en quelle profonde estime je tiens le prêtre qui vient à vous, et combien je vous serais obligé de l’accueillir avec une grande bonté…
« † J.-M. FRÉDÉRIC,
« Évêque de Viviers. »
Au début de septembre, Charles de Foucauld fait ses adieux aux Pères de Notre-Dame-des-Neiges. Les caisses sont déjà prêtes, clouées, étiquetées, où les Frères ont enfermé les provisions et tous les meubles qu’emportera l’ermite. Que contiennent-elles ? le nécessaire de la chapelle, un petit nombre de livres, 50 mètres de corde, avec un petit seau pour puiser de l’eau dans les puits du désert, de la toile solide pour fabriquer une tente, et des sacs fendus, dont on fera des tapis.
Le pauvre bagage est chargé sur une charrette. L’ancien Frère Marie-Albéric reçoit une dernière bénédiction de l’Abbé, et s’en va, très ému. Quelques jours après, il traverse la mer, et débarque en Afrique, dans son Afrique. À Maison-Carrée, il est reçu par Mgr Livinhac, « l’évêque du Sahara » ; on lui donne les autorisations nécessaires pour s’établir dans le sud de la province d’Oran, à proximité du Maroc. En attendant que l’autre autorisation, celle du gouverneur de l’Algérie, lui parvienne, – c’est un vieil ami, le commandant Lacroix, un des Africains les plus connus, qui fait les démarches nécessaires[64], – il est invité à passer quelques jours à la Trappe de Staouëli. Il retrouve là des religieux qui lui sont depuis longtemps dévoués. Des amitiés nouvelles, aussitôt profondes, se nouent entre lui et les missionnaires de Maison-Carrée. Il est tout espérance et tout projet, « À Beni-Abbès, je serai actuellement seul comme prêtre, écrit-il, à 400 kilomètres du plus proche[65]. Mon préfet apostolique, Mgr Guérin, me permet d’avoir des compagnons ! » De son côté, Mgr Guérin disait : « Je n’ai connu Charles de Foucauld que depuis le commencement de septembre, mais il ne m’a pas fallu plus de temps pour l’estimer comme il le mérite et reconnaître en lui une vertu admirable. Je regarde comme une bénédiction de Dieu l’entrée de ce saint prêtre sur le territoire de la préfecture qui m’est confiée… Un véritable saint, comme Charles de Jésus, fait nécessairement du bien. Il ne peut pas ne pas laisser rayonner autour de lui quelque chose de la douceur et de la bonté de Jésus, qui désormais fait toute sa vie. »
La réponse favorable du gouverneur général et du général commandant le corps d’armée étant venue le 14 octobre, le départ pour Oran, puis pour le Sud, eut lieu dès le lendemain. Les officiers des postes échelonnés sur la route d’Oran à Beni-Abbès avaient appris que l’explorateur célèbre, leur ancien camarade devenu moine, allait passer, obéissant, lui aussi, à l’appel du désert, mais pour d’autres motifs. Ils l’attendaient, aux gares du petit chemin de fer stratégique, aujourd’hui construit jusqu’à 800 kilomètres d’Oran, et qui se terminait, en 1901, à Aïn-Sefra ; ils venaient le saluer, quelques-uns lui apportaient des provisions de voyage. À Aïn-Sefra, la petite ville blanche, bâtie au pied des dunes, il aurait pu trouver quelque auberge. Mais le général Cauchemez l’emmena au bureau arabe, château blanc parmi des arbres d’Europe, et lui donna une chambre, où Charles de Foucauld logea, cela est sûr, mais où l’on ne peut dire qu’il coucha dans un lit. Pendant les deux ou trois jours qu’il demeura chez son ami, on apprit bientôt que l’explorateur-ermite avait dormi sur le plancher. Il se déclarait bien reconnaissant envers les officiers de tout grade qui lui faisaient accueil. Et c’est pour ne pas les contrarier, qu’après quelque résistance il accepta, lui qui se proposait d’aller à pied jusqu’à Beni-Abbès, de partir avec le lieutenant Huot, qui revenait de permission, et donc de faire à cheval, – sur le cheval d’un cavalier du maghzen, – et avec une escorte, la longue route d’Aîn-Sefra à Beni-Abbès.
Ils entrèrent dans les régions désertiques.
À mi-route environ, se trouvent l’oasis de Taghit, et la redoute, qui commande une région dangereuse, fréquemment parcourue par des partisans en maraude. Comme les voyageurs français et leur petite escorte approchaient de Taghit, ils virent accourir une troupe de cavaliers. C’était le capitaine de Susbielle, commandant du poste, à la tête de son maghzen. Prévenu de la prochaine arrivée de l’ancien lieutenant de chasseurs d’Afrique, il venait à la rencontre de celui qui se dévouait à jamais aux pauvres du désert. En chemin, il avait dit à ses hommes : « Vous allez voir un marabout français ; il vient par amitié pour vous : recevez-le avec honneur. » Foucauld, reconnaissant la France, se porte vers elle, au galop, sa robe blanche flottant au vent. Il arrête son cheval à trois pas de l’officier, et répond au salut de M. de Susbielle. En même temps, les quinze cavaliers, fidèles à la politesse indigène, mettent pied à terre, enveloppent le marabout « qui vient par amitié pour eux » et, plusieurs ensemble, inclinés, baisent le bas de sa « gandourah ».
Ce fut la bienvenue du Sahara.
Frère Charles vécut quelques heures à Taghit. Le 24 octobre, avant de remonter à cheval, il célébra la messe devant les Français de la garnison. « C’est la première messe depuis l’occupation, disait-il. Il est probable qu’en aucun temps un prêtre n’y est venu. Je suis bien ému de faire descendre Jésus en ces lieux où, probablement, il n’a jamais été corporellement. »
Quatre jours plus tard, au soir d’une journée chaude, les voyageurs apercevaient les premiers palmiers de Beni-Abbès.
CHAPITRE VIII – BENI-ABBÈS
Beni-Abbès est une oasis de 7 à 8 000 palmiers. Ils poussent sur la rive gauche de la Saoura, dans les terres et les sables où sont nombreuses les fontaines, et ils forment une longue futaie épaisse, serrée contre une falaise qui la domine de haut. La Saoura elle-même n’est autre que l’oued Zousfana, venant de Figuig, et qui s’est confondue, à 40 kilomètres au nord de l’oasis, avec un fleuve plus abondant, l’oued Guir, descendu des plateaux du grand Atlas marocain. Leurs eaux mêlées se sont terrées, selon la coutume des fleuves sahariens ; pour ne pas être bues par le soleil, elles traversent en tunnel les déserts ; elles ne réapparaissent à la lumière qu’à l’entrée de la palmeraie, dont elles suivent la bordure, – la rive droite étant presque sans verdure, – pendant quinze cents mètres environ, puis disparaissent de nouveau, pour aller, peut-être, bien loin de là, gonfler mystérieusement le cours du Haut-Niger[66].
Les voyageurs qui viennent de Colomb-Béchar, en suivant la large vallée, marchent longtemps dans la rocaille, entre le lit desséché de cette Saoura et les dunes qui bornent le désert vers la gauche. Quand ils ont dépassé le bouquet de palmes de Mazzer, ils doivent mettre les pieds dans le sable et franchir des éperons successifs de dunes, qui, devant eux, limitent l’horizon. C’est seulement du sommet de la dernière dune, qu’on aperçoit entre deux falaises, tout à coup, et à courte distance, la rivière tournante, les premières flaques d’eau, les premières formes qui plient, les cimes d’une grande palmeraie verte, un haut plateau à droite, un haut plateau à gauche, et, sur la crête de celui-ci, les murailles crénelées, blanches, éblouissantes, du bordj des affaires indigènes. On sort de l’aride, on pénètre dans le domaine de l’ombre, des sources, des cultures et de la vie. L’intervalle entre les falaises qui tiennent dans leurs bras l’oasis, étroit d’abord, prend de l’ouverture comme la panse d’une aiguière, et c’est mieux qu’un couloir boisé, c’est une petite plaine qu’ils enserrent, coupée par la rivière, sans arbre sur la rive droite, toute couverte sur l’autre rive de palmiers qui abritent des abricotiers, des pêchers, des figuiers, des pieds de vigne. Là, dans la forêt, vers le milieu, il y a un village fortifié où l’on pénètre par une porte unique, où les rues sont couvertes presque partout, village peuplé d’hommes libres, qui se considèrent comme originaires du pays, les Abbabsa. Plus loin, et vers l’extrémité, un second village, aux murailles très hautes et semblables à celles d’un château féodal, est habité par des Arabes de la tribu des Rehamna, qui font paître leurs chameaux et leurs ânes dans les pauvres pâturages de la région. Les nègres, jardiniers, semeurs et moissonneurs d’orge, logent à la lisière de la palmeraie, le long d’un ravin qui donne accès au plateau du bordj. Et la population indigène, divisée ainsi en trois groupes, comptait de douze à quinze cents âmes.
Frère Charles avait choisi ce lieu d’apostolat, en raison des misères qu’il y rencontrerait et que pas un prêtre encore n’avait pu secourir ; à cause de la proximité du Maroc également, la terre très aimée, où il espérait pouvoir rentrer un jour en missionnaire ; il savait aussi que Beni-Abbès passait pour la plus jolie des oasis du Sud algérien, le plus beau fragment même de la longue avenue de palmiers qui commence à Figuig et va finir à In-Salah. Au moment où il arrivait, la grande redoute qui commande l’entrée de la palmeraie n’existait pas encore ; une autre, moins importante, aujourd’hui détruite, s’élevait un peu plus loin, sur la crête de la falaise, et abritait la garnison[67]. Il suivit le chemin tracé par le pas des hommes et des bêtes. À peine eut-il gravi la pente raide, bordée de huttes, qui conduit au sommet du plateau, qu’il fut ravi d’admiration. Au nord et à l’est, Beni-Abbès était enveloppé, à peu de distance, par les vagues de sable rose ou doré de l’Erg occidental, les grandes dunes mêlées, fuyantes et dont plusieurs s’élèvent à 150 et 200 mètres, tandis que vers l’ouest, au delà de la coupure du ravin et de la palmeraie, s’étendait le second plateau, rocheux, rigide et tabulaire, sans arbre, et qu’on eût dit sans fin. Le voyageur se trouvait à un point de jonction entre les deux déserts sahariens, entre le désert de sable qui couvre tout le Sud oranais et le désert rocheux, la Hamada, qui va jusqu’à la frontière du Maroc. Splendeur de la lumière, pauvreté du sol, pureté des nuits, silence des nuits, que de fois Frère Charles se servira de vous dans ses méditations, et dégagera le sens éternel caché dans le paysage le plus humble ou le plus magnifique ! Il chercha tout de suite la place où établir sa demeure, et acheta, sur le plateau de la rive gauche, non sur la lisière mais à 400 mètres environ en arrière, trois petits mamelons qu’il qualifia de montagnes, et deux dépressions également incultes qu’il appela vallées, et où poussaient plusieurs palmiers sauvages. Le prix, naturellement, fut excessif. Frère Charles paya 1 170 francs ces huit ou neuf hectares de désert. L’ensemble avait la forme d’une courge coudée. C’était le « terrain de culture » de la future « fraternité ». Il y avait de l’eau, heureusement, ou du moins quelque possibilité de s’en procurer. Le domaine renfermait plusieurs sources et d’anciens puits. On creusa les puits, on dégagea les sources. Frère Charles, imaginatif et l’esprit toujours en avance d’un jour, d’un mois ou d’un an sur le moment présent, ravi de cette nouvelle résidence, songeait déjà qu’il vivrait là dans une demi-clôture, que les fruits et les légumes du jardin seraient abondants, qu’il en pourrait donner, qu’on éviterait ainsi la famine des années de grande sécheresse, qu’il serait le nourricier, le consolateur, l’ami de plusieurs pauvres, particulièrement des soldats français et des esclaves.
Les premiers jours, il logea dans les bâtiments du bureau arabe. Dès le matin, il partait, avec quelques tirailleurs de bonne volonté, mis à sa disposition, pour construire l’ermitage. Ce ne fut jamais qu’un pauvre assemblage de cabanes en terre, sans caractère d’art, construites dans un ravin, fragiles tout à fait : si elles se défendaient à peu près du soleil, elles eussent fondu sous la pluie de deux jours. Heureusement il ne pleut guère qu’une fois par an dans la Saoura, et il arrive qu’il ne pleuve pas du tout. On employait, pour bâtir, des pierres glanées sur le plateau, mais surtout des briques de glaise séchée ; un peu de terre délayée était le mortier ; des planches poreuses de troncs de palmiers faisaient office de poutres, les nervures des grandes feuilles et des roseaux servaient de couverture.
La chapelle, naturellement, eut un tour de faveur, et fut bâtie d’abord. Frère Charles la décrit avec amour dans une lettre à un ami : « Le toit est horizontal, en grosses poutres de palmier brutes, couvertes de nattes en branches de palmier : c’est très rustique, très pauvre, mais harmonieux et joli. Pour soutenir les poutres, il y a au milieu quatre troncs de palmier verticaux ; dans leur rusticité, ils font très bon effet et encadrent bien l’autel ; à celui qui est près du coin de l’évangile est pendue une lampe à pétrole qui m’éclaire la nuit, et jette beaucoup de lumière sur l’autel… Au plafond est accroché un dais en forme de tente, en grosse toile vert foncé absolument imperméable, pour garantir de la pluie l’autel et son marche-pied. »
Un officier de la garnison dessine pour la chapelle quatre grandes figures de saints. Mais le principal décorateur est encore l’architecte, Frère Charles lui-même. Il peint sur étoffe – dans cette manière très moderne, réduite à quelques lignes d’une justesse extrême, dont il a donné maint exemple en illustrant la Reconnaissance au Maroc – une image qui représente le Christ « étendant les bras pour embrasser, serrer, appeler tous les hommes et se donner pour tous ». Du côté de l’évangile, est un saint Joseph, de la « fabrique » du Père. Aux murs de la « nef » pendent les quatorze tableaux d’un chemin de croix, dessinés à l’encre noire, bleue ou rouge, non sur toile ou sur papier, mais sur des planchettes de caisses, que Frère Charles a coupées et quelque peu rabotées. Il ne cessera d’orner cette chapelle saharienne, dont il disait : « Elle me va parfaitement ; elle est pieuse, pauvre et propre, très recueillie. » Du côté de l’épître, il a placé, dans une niche, un réveil-matin, – l’horloge de la Fraternité.
C’est là qu’il passera tant d’heures, de jour ou de nuit, en adoration ou en méditation ; c’est là qu’il couche, au début, seul dans cette cabane isolée. Il s’étend, tout habillé, sur le marche-pied de l’autel. Il dormira près du tabernacle, comme le chien aux pieds de son maître. Encore se juge-t-il indigne d’une pareille faveur. Dès que les premières constructions, qui devaient accompagner la chapelle, furent commencées, un sous-officier de tirailleurs, M. J., qui était de ses amis, s’étant levé de grandmatin pour venir à l’ermitage, trouva le Père couché à l’abri d’un mur inachevé. « Comment, lui demanda-t-il, vous ne couchez plus dans la chapelle ? – Non. – Vous me disiez que vous étiez bien là ! – C’est justement pour cela que j’en suis parti. » Peu de temps après, le Père de Foucauld choisissait, pour y dormir, la sacristie de la chapelle. Or, la petite pièce qu’il appelait ainsi n’était pas assez longue pour qu’un homme pût s’y coucher sur le sable. Le même adjudant de tirailleurs en fit la remarque au Père, qui répondit : « Jésus, sur la croix, n’était pas étendu. »
Les ouvriers continuaient de travailler. Au delà de la sacristie, ils édifièrent des cases en briques et en boue sèche, qui prirent le nom de cellule Saint-Pierre et de cellule Saint-Paul. Et de la sorte, ces petites constructions étant perpendiculaires au chevet de la chapelle, formèrent, avec la nef, un angle droit. En arrière, s’étendrait bientôt une cour qui serait appelée « cour de la Retraite ». Frère Charles bâtit encore quelques cases, « la chambre des hôtes non chrétiens », une infirmerie où venaient se faire soigner les malades de Beni-Abbès et des tentes voisines, un débarras, les murs d’une seconde cour, la « cour de l’Aumônerie », du côté de l’épître. Il espérait qu’un jour, bientôt peut-être, un prêtre inconnu, sollicité par la même vocation qui avait poussé, vers les âmes des pauvres gens de l’oasis, l’ancien lieutenant de cavalerie, viendrait le rejoindre à Beni-Abbès, et que l’ermitage compterait deux compagnons, en attendant mieux. Les ouvriers, hommes de troupe, débrouillards, beaucoup plus jeunes que lui, travaillaient volontiers pour un pauvre comme eux, qu’ils devinaient meilleur, et dont l’extrême bonté les touchait secrètement. Il ne se séparait point d’eux, aux heures où son règlement l’obligeait au travail manuel ; même au milieu du jour et quand la chaleur est extrême, on le voyait, avec eux, parcourir le terrain vague, autour de l’ermitage, se baisser, ramasser et soulever une pierre qui servirait aux fondations, et prendre la file, d’habitude le dernier, pour rentrer sur le chantier. La pierre qu’il rapportait sur l’épaule n’était pas très grosse quelquefois, et il s’excusait : « Mes bons amis, disait-il en riant, je sais bien, je suis la mouche du coche, mais je fais selon mes forces. »
Le soin raisonné des moindres détails était une des marques de l’esprit de Frère Charles. Ne fallait-il pas que ceux qui entreraient dans la maison fussent portés vers Dieu, et que les murs au moins parlassent de Jésus-Christ et de sa doctrine ? Tandis qu’il achevait d’édifier l’ermitage, Frère Charles ornait les pièces déjà construites avec des « écriteaux » appropriés à la destination de chacune. Il donnait à méditer, à lui-même et aux autres, les pensées dont étaient faites sa force et sa joie.
Les écriteaux de la sacristie portaient : « Toi, suis moi ! » – « Si quelqu’un veut être mon disciple, qu’il se renonce, porte sa croix, et me suive ! » – « Vivre aujourd’hui, comme si je devais mourir ce soir, martyr. » – « Soyez tout à tous, avec un unique désir au cœur, celui de donner à tous Jésus. »
Ceux de la cellule Saint-Paul : « Je suis venu porter le feu sur la terre. » – « Je suis venu sauver ce qui était perdu. » – « Tout ce que vous faites à un de ces petits, vous me le faites. » – « Notre Père, qui est dans les cieux, ne veut pas qu’un seul de ces petits périsse. » – « Allez dans le monde entier, prêchez l’Évangile à toute créature. »
Ceux de la cellule Saint-Pierre : « J’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie ; il faut aussi que je les amène ; il n’y aura qu’un troupeau et qu’un pasteur. » – « Qu’ils soient un, comme nous sommes un. »
Après la chapelle et les chambres, on fit un mur d’enceinte autour de la cour de l’Aumônerie ; puis Frère Charles songea qu’il fallait borner et clore le terrain de la Fraternité, car il avait résolu de vivre en clôture, et de ne pas sortir des limites sans une raison grave. Dans les premiers temps, il s’était contenté de marquer, avec des cailloux de la grosseur d’un œuf, disposés en lignes, les frontières de son domaine. Un des soldats qui l’ont le plus souvent approché, en ce temps-là, m’a raconté qu’il revenait parfois au camp après le soleil couché. Attentif à se concilier les âmes de bonne volonté, plus poli et prévenant encore avec les humbles gens, auxquels on ne prend point garde et qui le sentent, qu’avec les grands et les puissants de la terre, Frère Charles l’accompagnait. Il causait amicalement ; il parlait de Dieu et de la beauté de la nuit. Autour d’eux le silence absolu et l’espace désert ; au-dessus, un ciel immense où pas une étoile n’était voilée. Un air chaud se levait du sable. Et ils allaient, l’ancien officier et le soldat, sur la piste à peine visible, chacun remerciant Dieu d’une amitié inattendue dont il était le principe et la fin. Et cela durait quelques minutes. Puis Frère Charles se baissait et tâtait la terre avec la main, pour savoir s’il n’avait pas atteint la limite. Quand il avait touché les cailloux échelonnés, il disait : « Je ne puis vous reconduire plus loin, voici la clôture ; à bientôt. »
On devine si nos soldats, loin, bien loin de leur famille et du pays, étaient touchés d’une amitié comme celle-là ! Leur cœur de Français, sensible, rempli d’une politesse ancienne qui résiste à bien des leçons contraires, leur faisait craindre d’abuser. Peut-on aller causer ainsi, presque en ami, avec un ancien officier, avec un moine qui a ses affaires, après tout, et, ils le sentaient bien, avec un homme de grande éducation, que la conversation d’un tirailleur ne devait pas toujours intéresser ? Ils s’excusaient de ne pas revenir ; ils se privaient d’une bonne heure, pour ne pas la lui prendre. Alors, il leur écrivait des lettres comme celle-ci :
« Cher ami, vous m’avez dit que vous êtes triste le soir, et que vos soirées sont lourdes… Voulez-vous, – si c’est permis de sortir du camp, ce que j’ignore, – venir passer habituellement les soirées avec moi : on les prolongera autant qu’il vous sera agréable, causant fraternellement de l’avenir, de vos enfants, de vos projets,… de ce que vous désirez, espérez, pour vous et ceux que vous aimez plus que vous… À défaut du reste, vous trouverez ici un cœur fraternel.
« Vous auriez voulu une petite histoire de saint Paul… J’aurais voulu vous l’écrire, mais je ne puis, j’ai d’autres choses pressées à écrire en ce moment… Je pourrai vous la raconter, en entremêlant mes misérables paroles de passages de ses lettres, que j’ai et qui sont admirables…
« Le pauvre vous offre ce qu’il a. Ce qu’il vous offre surtout, c’est sa très tendre, très fraternelle affection, son profond dévouement dans le Cœur de Jésus.
« Frère CHARLES DE JÉSUS. »
Les indigènes qui sont curieux, entrants, tenaillés par la faim et la soif, et donc volontiers chapardeurs, respectèrent presque tout de suite, du moins d’une certaine manière, la clôture de Frère Charles. Non qu’ils se gênassent pour pénétrer dans le domaine et venir visiter le « marabout », mais la réputation de sainteté de celui-ci rendait pour eux sacrés les objets qu’ils découvraient en chemin, à l’intérieur de la clôture. Le nomade déchargeait son chameau de l’autre côté des cailloux frontières ; la pauvre femme arabe, rentrant de la corvée quotidienne de bois, y jetait son fagot ; le boucher y déposait un paquet de peaux saignantes de chevreaux : eh bien ! même si l’absence durait plusieurs heures, ou une nuit entière, le caravanier retrouvait intacte sa marchandise ; la femme son faix de racines de palmier ; le boucher son ballot de cuir frais. Dans la suite, la ligne de cailloux fut remplacée par une ligne de piquets, plus ou moins tordus, sur lesquels étaient fixés deux rangs de fil de fer barbelé. Sept grosses bornes, surmontées de deux bâtons en croix, et disposées de distance en distance, servaient d’appui à la maigre clôture et d’étendards à l’homme de Dieu.
La culture devait faire des progrès plus lents. Ce n’est pas une petite entreprise de creuser un morceau de désert qui n’a peut-être jamais été fouillé ; d’assurer l’eau, c’est-à-dire la vie, aux arbres que l’on plante et aux grains que l’on sème, lorsque la chaleur, comme à Beni-Abbès, est de 30 degrés, tout le jour, d’octobre à juin, et s’élève ensuite jusqu’à 50 degrés ! Frère Charles, ainsi que je l’ai dit, commença par approfondir les puits abandonnés de son domaine ; il creusa des rigoles, pour amener l’eau des sources au pied des palmiers poussés à l’aventure et à demi ensablés par le vent du sud. Le travail était de ceux que le pauvre jardinier de Nazareth ne pouvait continuer sans aide, car la plus énergique volonté ne suffit pas – les hommes l’apprennent vite – pour être à la fois tout à tous et tout à tout. Le Père de Foucauld, après quelques essais, engagea deux harratins[68], comme il n’en manque pas à Beni-Abbès, et qu’il nomma jardiniers pour le besoin qu’il en avait. Peut-être, après tout, connaissaient-ils mieux que le maître du domaine les soins à donner aux palmiers et les infinies précautions qu’il faut prendre, en pays chaud, pour que les semis de légumes, ayant poussé leurs premières feuilles, ne soient pas aussitôt grillés par le soleil. Ces noirs, peu surveillés, avaient affaire à un si bon maître, qu’ils lui demeurèrent fidèles fort longtemps. Celui-ci trouvait seulement qu’ils perdaient de longues heures à se rendre chaque jour de l’ermitage au ksar de l’oasis, et à revenir. Il aurait voulu les retenir et les nourrir à l’ermitage. Les noirs ne demandaient pas mieux. Ils n’étaient sûrement pas habitués à une cuisine délicate, ni même à manger à leur faim. Mais quand ils eurent partagé le repas du Père de Foucauld, plusieurs jours de suite, ils déclarèrent qu’ils pourraient mourir à ce régime-là, mais non pas vivre, car le marabout déjeunait d’un morceau de pain d’orge trempé dans une décoction d’une plante saharienne, qu’on appelle innocemment « le thé du désert », et, le soir, il dînait d’un bol du même thé, auquel il ajoutait un peu de lait condensé. Les harratins restèrent jardiniers externes. Peu à peu, leur travail améliora le terrain et rendit judicieuse la distribution des eaux. Il y eut, dans le sable, de jeunes palmiers, quelques figuiers en espérance et de même des oliviers, des pieds de vigne. Après des années, le nom de jardin, donné dès le début à ces essais de culture, commencera d’être mérité. Mais à ce moment, comme on le verra, l’ermite aura quitté Beni-Abbès, pour n’y revenir qu’à de rares intervalles.
En quelques occasions, Frère Charles acceptait l’invitation, que lui adressaient fréquemment les officiers, ses camarades, et sortait de la clôture pour aller dîner avec eux au bordj. Il ne le faisait guère que pour saluer au passage un chef saharien, comme Laperrine ou Lyautey, ou encore un savant envoyé en mission dans ce pays désolé, mais qui mène à tout, et où pourront un jour s’entrecroiser, comme à un carrefour prodigieux, toutes les richesses de l’Afrique. Ces soirs-là, il s’asseyait, non aux places d’honneur, mais à la dernière, à côté du plus jeune officier. On essayait de le faire parler, et on ne manquait pas de l’interroger sur ce Maroc tout proche qu’il était seul à bien connaître. Mais la crainte de l’orgueil le rendait muet sur ce sujet. Sur tout le reste il répondait, sans entretenir la conversation. Sa vocation était le silence, l’effacement, la retraite. Il ne consentait à paraître, dans un cercle d’hommes du monde, que pour ne pas manquer aux règles de la courtoisie, ou, en quelque sorte, de la discipline de son ancien métier. Le récit des événements militaires l’intéressait au plus haut point. Frère Charles se surveillait moins étroitement, si on lui demandait son avis sur une opération de police qui venait d’être faite, ou que l’on projetait. Si la nouvelle était venue, par exemple, de quelque randonnée de pillards enlevant des troupeaux et des femmes, assassinant et mutilant des hommes, on retrouvait aussitôt le chef ardent, le justicier qu’il avait été dans la poursuite des bandes de Bou-Amama. « Il faut les rejoindre, disait-il, et y aller rudement ! » L’instant d’après, ayant vu, dans la salle à manger, une souris attrapée par un chien : « Cette pauvre petite bête, quel dommage ! » murmurait-il. De bonne heure il se retirait ; il allumait sa lanterne, et, seul à travers l’ombre, regagnait l’ermitage.
Je ne serais pas historien fidèle, si je ne disais encore que Frère Charles, dès que la chapelle eut été construite, creusa lui-même, dans un coin du jardin, la fosse où il voulait être inhumé, et la bénit. Il en usa de même, par la suite, dans les divers points du Sahara où il séjourna un peu de temps.
Tel était le cadre et l’appareil extérieur de cette vie sans précédent, ordonnée par une volonté puissante. Le reste était presque entièrement caché aux hommes. À peine auraient-ils pu, s’ils s’étaient appliqués à le faire, découvrir l’exact partage des heures entre les devoirs de charité, de travail manuel, de lecture, et les devoirs de prière : la règle que s’était imposée le Père de Foucauld. L’âme leur échappait. Toute âme est secrète pour les autres, plus ou moins. Le mystère est plus grand quand les âmes sont grandes, et qu’elles s’écartent de nos plaisirs, de nos occupations, de nos pensées habituelles qui ne sont guère que nous-mêmes, et qu’elles se donnent à Dieu, pour être mises, par lui, au service du pauvre monde. Nous ne voyons alors que ce qu’elles nous apportent, leur bonté, leurs œuvres fraternelles, le vague reflet d’elles-mêmes sur le visage qui vient vers nous et dans les yeux qui nous regardent. Mais par quel effort se maintiennent-elles hors de la vie commune, dans la constante présence de Celui dont on perd le sourire et la paix pour une seule petite pensée ; quelles grâces elles ont eues, quels combats, quelles délices, quels rêves : cela, nous ne le savons pas.
Le règlement de cette vie, depuis le temps où nous sommes parvenus jusqu’à la fin, ne variera plus. Frère Charles l’a lui-même exposé dans une lettre adressée au préfet apostolique du Sahara[69] :
« … Lever à 4 heures (quand j’entends le réveil sonner, ce n’est pas toujours !). Angelus, Veni Creator, prime et tierce, messe, action de grâces.
« À 6 heures, quelques dattes ou figues et discipline, tout de suite après, une heure d’adoration du Très Saint-Sacrement. Puis, le travail manuel (ou l’équivalent : la correspondance, des copies de diverses choses, extraits d’auteurs à conserver, lectures faites à haute voix, ou explication du catéchisme à l’un ou à l’autre), jusqu’à 11 heures. À 11 heures, sexte et none, un peu d’oraison, examen particulier jusqu’à 11 heures et demie.
« À 11 heures et demie, dîner.
« Midi, Angelus et Veni Creator (ce dernier est chanté, vous rirez quand vous m’entendrez chanter ! Sans le vouloir, j’ai certainement inventé un air nouveau).
« L’après-midi est tout entière au bon Dieu, au Saint-Sacrement, sauf une heure consacrée aux causeries nécessaires, réponses données ici et là, cuisine, sacristie, etc., nécessité du ménage et des aumônes : cette heure se répartit sur toute la journée.
« De midi à midi et demi, adoration ; de midi et demi à 1 heure et demie, chemin de Croix, quelques prières vocales, lecture d’un chapitre de l’Ancien et d’un chapitre du Nouveau Testament, d’un chapitre de l’Imitation et de quelque pages d’un auteur spirituel (sainte Thérèse, saint Jean Chrysostome, saint Jean de la Croix se succèdent perpétuellement).
« De 1 heure et demie à 2 heures, méditation écrite du saint Évangile.
« De 2 heures à 2 heures et demie, théologie morale ou dogmatique.
« De 2 heures et demie à 3 heures et demie, heure réservée aux catéchumènes.
« De 3 heures et demie à 5 heures et demie, adoration ; c’est le meilleur moment de la journée, après la messe et la nuit : le travail est fini, je me dis qu’il n’y a plus qu’à regarder Jésus,… c’est une heure pleine de douceur.
« À 5 heures et demie, vêpres.
« À 6 heures, collation…
« À 7 heures, explication du saint Évangile à quelques soldats, prière et bénédiction du Très Saint-Sacrement avec le saint ciboire, suivie de l’Angelus et du Veni Creator. Puis les soldats partent, après une petite conversation en plein air ; je récite le rosaire (et je dis complies, si je n’ai pu les dire avant la petite explication du saint Évangile), et je m’endors à mon tour, vers 8 heures et demie.
« À minuit je me lève (quand j’entends le réveil), et je chante le Veni Creator, et récite matines et laudes ; c’est encore un moment bien doux : seul avec l’Époux, dans le profond silence, dans ce Sahara, sous ce vaste ciel, cette heure de tête à tête est une douceur suprême. Je me recouche à 1 heure. »
Le sommeil était donc de 6 heures coupées par une heure de veille, et la prière tenait la première place. Le service de charité troublait seul le règlement. C’était une épreuve des plus sensibles pour Frère Charles, dont l’âme contemplative était assoiffée de recueillement. Il l’acceptait cependant. Il était celui qui fait au plus misérable prochain, au plus inconnu, au plus indigne, un accueil fraternel ; qui ne laisse point soupçonner qu’on le dérange, et consent à perdre avec le nomade peu sûr, l’esclave corrompu, le quémandeur et l’importun, le temps qu’il avait réservé pour causer avec Dieu. À chaque moment, quelqu’un se présentait à la porte, et l’ouvrait, et Frère Charles apparaissait, les yeux, ses très beaux yeux pleins de sérénité, la tête un peu penchée en avant, la main déjà tendue. Il portait une gandourah blanche, serrée par une ceinture, et sur laquelle était appliqué un cœur surmonté d’une croix en étoffe rouge ; il avait des sandales aux pieds. Quant à la coiffure, elle était de son invention, et se composait d’un képi dont il avait enlevé la visière et que recouvrait une étoffe blanche, tombant en arrière sur les épaules, pour protéger la nuque. L’image de la Croix, celle du Sacré-Cœur, disaient de loin quelle était la foi de cet homme blanc. Nul n’en pouvait ignorer. C’est pourquoi, bien des années après les jours de Beni-Abbès, ayant lu, dans quelque poste du désert, un article où Charles de Foucauld était représenté comme un prêtre qui ne parlait jamais de ses croyances, et ne prêchait la foi en aucune manière, le général Laperrine prit sa plume, et, d’une écriture d’homme irrité, écrivit sur un carnet : « Et ses conversations ! Et son costume ! » Il disait vrai : le costume était une prédication, et, d’ailleurs, toute la vie de Frère Charles affirmait l’Évangile. Les indigènes ne s’y trompèrent jamais.
Nous pouvons, à présent, suivre les événements qui marquèrent le séjour à Beni-Abbès, et, pour le faire, nous n’aurons qu’à consulter le plus exact, le plus assidu des notateurs, le Père de Foucauld lui-même, qui, d’une écriture appliquée, sur un cahier qu’il appelait son « diaire », écrivait les menus faits de la journée, ses comptes et jusqu’aux noms de ses visiteurs.
« 29 octobre 1901. – Célébré, pour la première fois, la messe à Beni-Abbès. Ex-voto à Notre-Dame d’Afrique. »
« 5 novembre. – Érection du premier Chemin de Croix. »
« 30 novembre. – Prise de possession de la chapelle de la Fraternité du Sacré-Cœur. »
« 25 décembre. – Première exposition du Très Saint-Sacrement, pendant plus de dix heures. »
Cet homme s’était voué à l’abandon pour que, dans le très lointain Sahara, Jésus-Christ du moins ne fût pas abandonné. Les cérémonies religieuses du premier Noël à Beni-Abbès le ravirent donc, et il en écrivit à ses amis de France.
« Nous avons eu le Saint-Sacrement exposé de minuit à 7 heures du soir. Nous l’aurons, le jour de l’an, de 7 heures du matin à 7 heures du soir. J’étais donc loin d’espérer assez d’adorateurs pour que ce fût possible. Jésus les a donnés.
« La bonne volonté, la piété inespérée des pauvres soldats qui m’entourent, me permet de donner chaque soir sans exception une lecture et explication du saint Évangile (je n’en reviens pas qu’on veuille bien venir m’entendre) ; la bénédiction est suivie d’une très courte prière du soir… Cette bénédiction, avec la sainte messe, est une consolation, une joie infinie. »
Il y a vingt ans, au moment où j’écris ces lignes, qu’une poignée de tirailleurs algériens, ceux auxquels on avait jadis appris le catéchisme et qui ne l’avaient pas oublié, assistaient aux premiers offices catholiques célébrés dans la chapelle en terre de Beni-Abbès. Ils en parlent encore volontiers. L’un d’eux, que j’ai retrouvé à Paris, m’a dit : « J’étais des fidèles du Père de Foucauld. Il disait la messe à l’heure qui nous convenait. Nous eussions demandé qu’il la dît à 4 heures du matin ou à midi, qu’il aurait toujours dit oui. Et quelle messe ! Celui qui n’a pas assisté à cette messe là ne sait pas ce que c’est qu’une messe. Quand il prononçait le Domine non sum dignus, c’était avec un tel accent qu’on avait envie de pleurer avec lui. »
« 9 janvier 1902. – Premier esclave racheté : Joseph du Sacré-Cœur… Cet après-midi, il restait bien peu d’espoir de délivrer cet enfant ; son maître refusait de le vendre à aucun prix ; mais hier, mercredi, jour du bon saint Joseph, j’avais changé le nom de l’enfant en celui de Joseph du Sacré-Cœur et promis à saint Joseph de lui ériger un autel dans le bras du côté de l’Évangile de la croix de la chapelle, et un à la Sainte Vierge dans le bras du côté de l’Épître, s’il m’obtenait la libération de l’enfant. À ce bon père tout est facile : le soir à 5 heures, le maître, venant une dernière fois réclamer l’enfant, a accepté, en deux minutes, le prix que je lui ai offert. Je l’ai payé séance tenante, et vous auriez joui alors de voir la joie du pauvre « Joseph du Sacré-Cœur », répétant qu’il n’avait plus « d’autre maître que Dieu »… Il est musulman, mais de nom plus que de fait. J’espère que, naturellement et de lui-même (je ne ferai aucune démarche ressemblant à une pression, – pleine liberté !), il ira à Jésus et à ce Cœur qui lui a voulu la liberté… »
Ce jeune homme d’une vingtaine d’années, très touché de la charité du Père de Foucauld et devinant bientôt, à le voir vivre, que la religion était le principe d’une si grande perfection, demanda de lui-même à être instruit dans la foi catholique. Il commença de l’être à l’ermitage, puis, au bout d’un mois, ayant trouvé l’occasion de sortir du pays et d’échapper à l’influence du milieu où il vivait, se rendit à Alger, où les Pères Blancs s’occupèrent de lui. « Il se regardait déjà comme chrétien », écrivait l’ermite. Belle œuvre de pitié, mêlée de quelque imprudence. Car les esclaves étaient nombreux autour de Frère Charles. Beaucoup durent le supplier de « les libérer comme il avait fait pour Joseph. « Cela me fend l’âme d’être obligé de les laisser à leurs maîtres », disait-il. Et il céda plus d’une fois, autant de fois qu’il en eut les moyens. Après Joseph, il racheta un jeune homme qu’il nomma Paul, qui avait environ quinze ans, et que nous retrouverons dans la suite de ce récit[70].
Il dut, sans doute, racheter aussi le négrillon de quatre ans que l’on voit, dans plusieurs photographies, assis sur les genoux du Père, ou debout à côté de lui et gambadant. Nous savons, en tout cas, qu’il libéra d’autres captifs.
Pour racheter les esclaves du Sahara, pour en nourrir les pauvres, Frère Charles n’aurait pas voulu ruiner ses amis ; il redoutait moins de les gêner un peu. Il quêtait de petites sommes, mais souvent. La famille avait l’habitude et, tendrement, se laissait faire ; les Pères Blancs, de temps à autre, soldaient silencieusement un arriéré de charité héroïque ; les officiers du cercle de Beni-Abbès, émus de pitié pour l’esclave, prenaient leur part dans le prix du rachat ; la caisse du bureau arabe demeurait fermée, fortement défiante. Lui, le libérateur, il se rendait bien compte qu’à vouloir racheter les esclaves, il ruinait son crédit ; que l’économie politique lui donnait tort, et que, peut-être, la stricte raison était du même avis. Il faisait alors son examen de conscience :
« Je pourrais avoir une petite somme, écrivait-il, en acceptant des honoraires de messe. Le bon Père abbé de Notre-Dame-des-Neiges m’en a offert, et si je n’ai aucun moyen de vivre et de payer mes dettes, je l’emploierai ; mais tant qu’il existe une lueur d’espoir de pouvoir m’en passer, je m’en passerai, parce que je crois cela beaucoup plus parfait : je vis de pain et d’eau, cela me coûte 7 francs par mois… Comme vêtements, Staouéli m’a donné une robe et deux chemises avec douze serviettes, une couverte et un manteau ; c’est un don du bon Père Henry, ou plutôt un prêt, car, pour que je ne puisse les donner, il ne me les a que prêtés ; ici un officier très bien, le capitaine d’U…, m’a si gracieusement offert une couverte et deux petits tricots que je n’ai pu refuser ; vous voyez que je suis monté… Pour moi, je n’ai besoin de rien. Pour pouvoir réunir les esclaves, les voyageurs, les pauvres, leur parler de Jésus, les disposer à l’aimer, j’ai besoin d’une petite somme afin d’acheter de l’orge ; j’ai demandé à C… 30 francs par mois pour l’orge des esclaves, et à M… 20 pour celui des voyageurs… J’avoue qu’il faut en outre que je paie le terrain que j’ai acheté, et que je fasse quelques frais pour y planter des dattiers qui, dans trois ans, me donneront ma nourriture et celle des pauvres, s’il plaît à Dieu. Mon seul capital en quittant la France était ce qu’il est encore, la parole de Jésus : « Cherchez le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Ici, j’ai été très à l’aise jusqu’à ces derniers temps ; l’achat et la libération de Joseph du Sacré-Cœur m’ont fait trouver le fond de la petite bourse ; mais celle du Père céleste est encore pleine. »
Il disait encore : « Je veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres, à me regarder comme leur frère, le frère universel… Ils commencent à appeler la maison la Fraternité (la Khaoua, en arabe), et cela m’est doux. »
Cette expression si belle convient à l’apôtre et pourrait le définir : il a été vraiment le frère universel, non en paroles, mais en actes ; il ne s’est pas répandu en formules publiques, et en promesses qui alourdissent encore le poids de la misère, mais il s’est oublié pour les hommes ses proches voisins, et il a dépensé plus qu’il n’avait d’argent pour les nourrir, pour les racheter s’ils pouvaient être rachetés. Sa manière, à lui, était silencieuse. Il n’y avait pas quatre mois qu’il habitait Beni-Abbès, et déjà il avait fait le compte de toutes les misères matérielles ou morales qui n’y trouvaient point d’allégement. Tout de suite, dans ses longues méditations auprès de l’autel, ou tandis qu’il s’en va, portant sa pierre, en compagnie des maçons de l’ermitage, il fait un plan pour un meilleur Beni-Abbès, mais un plan où il aura lui-même la plus grande part de travail et de sacrifice. Bâtisseur d’idéal, il se demande : « Que peuvent les autres, qui sont meilleurs que moi, pour le bien de ceux-ci, et que puis-je surtout, moi qui ne suis qu’un misérable, bon à rien ? » C’est ainsi qu’il distribue les rôles, dans une lettre adressée à un ami de France. Il confie à cet ami le grand désir qu’il aurait d’obtenir, pour l’oasis de Beni-Abbès, quelques sœurs de Saint-Vincent de Paul. « Je suis navré, quand je vois les enfants du bourg vaquer à l’aventure, sans occupation, sans instruction, sans éducation religieuse. Une salle d’asile ferait un tel bien ! C’est ce qu’il faudrait pour faire pénétrer l’Évangile… Quelques bonnes sœurs de charité donneraient en peu de temps, avec l’aide de Dieu, tout ce pays à Jésus. » Puis il rassemble toutes ses pensées sur ce sujet, il compose un véritable mémoire, qu’il enverra au Père Guérin, préfet apostolique du Sahara. On y reconnaît son grand cœur et la minutie qui ne le quitte pas, même quand il rêve. Il va au delà du temps présent et au delà du bien immédiatement possible, et la complainte de ce chrétien jeté parmi tant d’infidèles emprunte, à la faiblesse des moyens qui dépendent de lui et à l’ampleur de la conquête rêvée, une grandeur émouvante. De Beni-Abbès, en désert saharien, il expédie à son chef spirituel son rapport pour le progrès du monde. Je suis obligé de résumer ces pages de la charité sans bornes.
La première œuvre à entreprendre, au dire de l’ermite, serait « l’œuvre des esclaves ». Ils sont misérables de toute manière, traités le plus durement qui soit par les Arabes de race et plus particulièrement par les marabouts ; ils ont tous les vices et n’ont pas d’espérance, ni d’amis. Mais bientôt ils regarderaient, comme des sauveurs, les chrétiens qui leur feraient du bien, et peut-être les premières chrétientés sahariennes seront-elles, un jour, comme le furent celles de Rome, en grande partie formées d’esclaves. La seconde œuvre se proposerait de donner un abri et un repas aux voyageurs pauvres, qui couchent à la belle étoile, lorsque la nuit est si froide. Il faut songer aussi à l’enseignement chrétien des enfants. Point d’autre école, dans toute l’oasis, qu’une école musulmane. Une foule d’enfants courent tout le jour, désœuvrés, vagabonds, rapidement pervertis ; il faudrait au moins une salle d’asile, où ils apprendraient la lecture, l’écriture, le français, l’histoire sainte et le catéchisme, où on leur donnerait quelques dattes le matin, un peu d’orge cuit le midi : cela coûterait « deux sous par jour, au maximum ». Et, sans doute, on aurait peu d’enfants arabes dans cette école chrétienne, mais les petits Berbères, enfants d’une race douce et bien disposée pour la latinité qu’elle a jadis connue, y viendraient tous. Les Berbères ne sont point fanatiques, ni méprisants. Et il est à croire que ce sera, dans l’avenir, « l’établissement des Berbères dans la foi qui y disposera et y fera entrer les Arabes ».
Le mémoire continue d’énumérer les œuvres nécessaires : hôpital civil, hôpital militaire, visite des malades à domicile, distribution des remèdes et des aumônes à la porte de la Fraternité, zèle pour les âmes des soldats, des officiers, des musulmans de toute sorte, des juifs, « de tous les habitants de la contrée, de la préfecture, du monde et du purgatoire ». Il y a quinze paragraphes, quinze rêves exprimés.
Ayant dit ainsi l’œuvre à faire, Frère Charles expose à Mgr Guérin l’œuvre accomplie :
« … Je suis seul pour cette immense tâche…
« Pour les esclaves, j’ai une petite chambre où je les réunis, et où ils trouvent toujours gîte, accueil, pain quotidien, amitié ; peu à peu je leur apprends à prier Jésus. Depuis le 15 janvier, jour que leur petite chambre a été terminée, j’en ai eu toutes les nuits à la Fraternité. Je vois parfois vingt esclaves par jour.
« Les voyageurs pauvres trouvent aussi à la Fraternité un humble asile et un pauvre repas, avec bon accueil et quelques paroles pour les porter au bien et à Jésus ; mais le local est étroit, la vertu du moine et son savoir-faire sont moindres encore ; plus de vertus, d’intelligence, de ressources, permettraient de faire plus de bien ;… je vois parfois trente ou quarante voyageurs par jour.
« Les infirmes et vieillards abandonnés trouvent ici un asile avec le toit, la nourriture et des soins ;… mais quels soins insuffisants et quelle pauvre nourriture !… Et je ne puis recevoir que ceux qui s’entendent avec les autres, faute de locaux séparés ; et je ne puis recevoir en aucune façon les femmes ; or, les femmes plus encore que les hommes auraient besoin d’un hospice de vieillards.
« Pour l’enseignement chrétien des enfants, je ne fais absolument rien ; et il me semble que je ne puis rien ; je vois quelquefois jusqu’à soixante enfants en un seul jour à la Fraternité, et je suis obligé de les renvoyer sans pouvoir rien pour eux, l’âme pleine de douleur. » Et la liste des réponses continue : l’hôpital militaire, l’hôpital civil pour les indigènes, la visite des malades à domicile, « sont en dehors de mon pouvoir et de ma vocation ; il faudrait des religieuses » ! De même pour la visite des pauvres à domicile. Sans doute il distribue chaque jour des remèdes à dix ou quinze personnes, mais il y met une grande réserve, ayant peu de confiance en ses talents. Il y a un médecin au bureau arabe, il est très bon, mais les femmes et les enfants ne peuvent aller le trouver, ils viennent à la Fraternité, et les hommes eux-mêmes préfèrent s’adresser au marabout. Comment faire ? Des religieuses feraient tout ce bien qu’il peut seulement apercevoir, mesurer et rêver ! À la porte de l’ermitage, dans une seule journée, prise au hasard, il a compté soixante-quinze pauvres. Il commence à connaître son monde : mais que l’aide serait nécessaire ! Quel besoin d’aumônières intelligentes, pour de si grandes misères et pour tant de mains tendues !
« Si je ne vous demande pas d’envoyer ici de Sœurs Blanches, c’est que je sais que, partout où vous pourrez en établir, vous en établirez, et que vous n’en aurez jamais assez pour en mettre partout où il en faudrait. « Je suis toujours seul : je ne suis pas assez fidèle pour que Jésus me donne un compagnon, encore moins des… Je suis de mon mieux le petit règlement que vous connaissez… »
Ce mémoire, comme toute la correspondance du Père de Foucauld, montre l’extrême humilité de cet homme, à qui les prétextes ni les occasions n’eussent manqué de se montrer orgueilleux. Race, fortune, intelligence supérieure, relations, don de sympathie, il aurait pu choisir la branche fragile sur laquelle il se dresserait pour chanter sa propre louange. Le sacrifice même qu’il avait fait en quittant le monde eût pu servir la secrète adoration de nous-mêmes, qui trouve à se camper sur les ruines, pourvu qu’elles soient hautes. Au lieu de cela, le ton le plus respectueux, la promptitude dans l’obéissance, la préférence du goût domptée jusqu’à ressembler à de l’indifférence, une grande estime des autres, un grand mépris de soi, et comme un étonnement d’être employé à une œuvre qui exige des saints pour ouvriers. Frère Charles ne cesse de s’accuser du lent progrès de son apostolat : s’il était moins indigne, tous les musulmans, les juifs et les mauvais chrétiens seraient déjà devenus ou redevenus fidèles. Du moins il aurait de l’aide, tandis qu’il s’épuise dans la solitude. Il déclare que sa propre conversion est l’évidente condition de la conversion des autres. Mais qu’il en est loin ! Il quête des prières près de tous ceux auxquels il écrit. Le souvenir des fautes de sa vie passée est rarement exprimé, même par allusion : il est toujours présent. « J’ai tout ce qu’il faut pour faire un bien immense, s’écrie-t-il, excepté moi-même ! »
Charles de Foucauld est un homme humble, et je crois bien que sa première vertu, le principe de l’action qu’il exerça sur les infidèles et sur les chrétiens, est là. Ce jugement peut surprendre. On s’imagine volontiers que l’humilité rompt l’élan de la nature, et que la passion, par exemple l’orgueil, peut davantage. Mais on ne fait pas attention que l’humilité, si elle détruit une force, la remplace aussitôt par une autre de beaucoup supérieure. Elle consiste à connaître la limite de notre pouvoir, ce qui est raisonnable, et à moins attendre de ce pouvoir, si faible, que de celui de Dieu. Dès lors, aucune entreprise ne lui semblera impossible, aucun échec ne l’arrêtera. L’humilité n’a rien à voir avec la timidité. Qu’on mesure ce qu’il y a d’audace dans le programme que vient d’établir le Père de Foucauld. Un pauvre prêtre, perdu dans une oasis saharienne, se propose de fonder et de faire vivre plus d’œuvres que n’en pourrait entretenir un monastère tout rempli de héros de la charité ; il n’oublie, dans son zèle, aucune âme ; il se laisse emporter loin des palmiers de Beni-Abbès, il souhaite, il veut la conversion de toute l’Afrique, du monde entier. Qu’est-il donc ? un dément ? Non : un homme très humble, qui connaît la puissance de Dieu.
La réponse que fit le Père Guérin à ce long mémoire ne nous est pas connue, dans son texte. Elle conseillait certainement à Frère Charles de ne racheter les esclaves que très exceptionnellement, sans quoi le pauvre ermite se fût endetté au delà du tolérable.
« Mai 1903. – Aujourd’hui trente ans que j’ai fait ma première communion, que j’ai reçu le bon Dieu pour la première fois… Voici la première fois que je célèbre la sainte messe à cette date… Quelles grâces j’ai reçu depuis trente ans ! Que le bon Dieu a été bon ! Que de fois depuis j’ai reçu Jésus en des lèvres si indignes ! Et voici que je le tiens en mes misérables mains ! Lui, se mettre entre mes mains ! Et voici que je dessers un oratoire ; que, nuit et jour, je jouis du saint tabernacle, que je le possède pour ainsi dire à moi seul ! Voici que chaque matin, je consacre la sainte Eucharistie, que chaque soir je donne, avec elle, la bénédiction ! Voici enfin et surtout que j’ai la permission de fonder ! Que de grâces ! »
Cette fondation, à laquelle il fait allusion, est celle des « Petits Frères du Sacré-Cœur de Jésus », future famille religieuse à laquelle il songeait déjà en Palestine, ainsi que je l’ai dit, famille cloîtrée, destinée à adorer nuit et jour la sainte Eucharistie perpétuellement exposée, et à vivre en pays de mission, dans la pauvreté et le travail.
Cette congrégation de missionnaires ne prêcherait donc pas l’Évangile directement, mais le ferait connaître, admirer et aimer par la vie de prière, de charité et de pauvreté que mèneraient les moines parmi les musulmans. Les Petits Frères du Sacré-Cœur seraient avant tout des adorateurs portant leur Maître au milieu des âmes infidèles. Frère Charles les veut établir, par groupes, partout où il sera possible ; il veut que « au lieu d’un oratoire à Beni-Abbès, un grand nombre s’élèvent, d’où la sainte Eucharistie et le Sacré-Cœur rayonnent, lumière du monde, sur beaucoup de régions infidèles, pendant des siècles ».
Pensée magnifique, qu’il n’a cessé d’exprimer, tout le long de ses jours ! Quand il entreprendra quelque voyage nouveau, il se réjouira, comme il l’a fait à Taghit, de consacrer le corps du Christ dans des lieux où pas un prêtre, depuis deux mille ans, n’a passé. S’il pense à Rome, il s’écrie : « J’aime tant Rome ! C’est là qu’il y a le plus de tabernacles, là que Jésus est corporellement le plus. Un de mes rêves aurait été de rétablir le culte à la petite chapelle Domine Quo Vadis, via Appia[71]. »
Ici, à Beni-Abbès, s’il demande qu’on vienne à son aide, qu’on lui envoie des compagnons, c’est qu’il cherche d’abord à multiplier la présence réelle dans le monde sans tabernacle et sans hostie. Il pense sans cesse à ces peuples immenses qui l’entourent et parmi lesquels le Sauveur n’habite pas. Il veut le leur donner. « Car les hommes meurent chaque jour, et les âmes tombent en enfer, ces âmes rachetées à un si grand prix, teintes du sang de Jésus, que sainte Colette voyait tomber en enfer, aussi pressées que les flocons de neige dans les tempêtes d’hiver. »
On verra bientôt ce qu’il advint de ces projets de fondation. Je noterai seulement ici, à ce moment où le Père de Foucauld est entré dans la vie de recueillement si longtemps souhaitée, qu’il se déclare l’homme le plus heureux du monde. Quand on compare ce bonheur à celui que nous poursuivons, les uns ou les autres, on demeure confus, pour soi-même et pour plusieurs, d’avoir si peu de hauteur d’âme qu’à peine nous pouvons imaginer de quelle joie exulte l’ermite de Beni-Abbès. Mange-t-il à sa faim et boit-il à sa soif, puisque nous entendons nommer bonheur ce contentement ? on sait que non. A-t-il gardé de son passé la moindre habitude de luxe ou de complaisance envers soi ? pas la plus petite. Cherche-t-il et trouve-t-il, dans l’étude des livres emportés au désert une diversion à la monotonie des jours, à tant d’occupations serviles et de conversations importunes ? sans doute il goûte en artiste certaines pages de saint Jean Chrysostome, par exemple, et il ressemble trop, par plus d’un point, à saint Augustin, pour n’être pas ému par la beauté humaine de la Cité de Dieu ou des Confessions : mais son bonheur est bien au-dessus de ces plaisirs. Ne serait-ce pas que des grâces exceptionnelles lui sont accordées, et que dans la communion ou la méditation, ou quand il n’en peut plus, le soir, d’avoir tant travaillé, consolé, donné du grain et des dattes, souffert de la chaleur torride, quelque douceur sans nom, sans avertissement ni mesure, descend sur ce cœur et le ravit ? Je n’en doute guère, bien que nulle part, à ma connaissance, cet humble serviteur n’ait parlé explicitement des faveurs célestes dont il pouvait être l’objet. Mais il parle de sa joie, il l’exalte. C’est, en vérité, la plus pure, la plus détachée de tout élément humain qu’une créature puisse éprouver. Nous n’en saurons pas plus.
À la Trappe, à Nazareth, il a connu des périodes d’épreuve intérieure, et comme d’obscurité. « Je ne me tirais d’affaire que par une complète obéissance, même dans les très petites choses, à M. l’abbé ; je me pendais à lui comme un enfant à la robe de sa mère… En ce moment, je suis dans une grande paix. Cela durera ce que voudra Jésus. J’ai le Saint-Sacrement, l’amour de Jésus ; d’autres ont la terre, j’ai le bon Dieu… Quand je suis triste, voici ma recette : je récite les mystères glorieux du rosaire, et je me dis : qu’importe après tout que moi je sois misérable, et que rien n’arrive du bien que je souhaite ? tout cela n’empêche pas mon bien-aimé Jésus – qui veut le bien mille fois plus que moi – d’être bienheureux, éternellement et infiniment bienheureux.
« Notre Bien-Aimé est bienheureux, que nous manque-t-il ? Vous savez qu’aimer, c’est s’oublier pour un autre qu’on aime mille fois plus que soi, qu’aimer c’est ne plus s’occuper ni désirer d’être heureux, mais désirer uniquement et de toutes les forces de son cœur que l’être aimé le soit : eh bien ! nous avons ce que nous voulons. Notre bien-aimé Jésus est bienheureux, donc rien ne nous manque ! Si nous l’aimons, bénissons Dieu sans fin, car nos vœux sont exaucés : il est heureux ! [72] »
Oublieux de lui-même, Frère Charles l’était à un point qui inquiétait parfois ses amis. Il avait la fièvre, des rhumatismes, une grande fatigue générale. Quelques officiers avaient dû écrire, à ce sujet, à la famille. Une des parentes de Frère Charles, trouvant que le régime du pain et de la tisane ne pouvait suffire à un homme encore jeune, avait demandé au missionnaire d’accepter une petite somme, chaque mois, à condition que cet argent fût employé à acheter quelque supplément de nourriture. Il lui répond : « J’accepte les 10 francs. Et pour que vous connaissiez le menu, je vous dirai que j’ajouterai au pain, des dattes, fruit très bon et très nourrissant. »
Peu après, le conseil de modération venait du directeur, l’abbé Huvelin, qui lui recommandait :
« Mon cher ami, mon cher enfant, supportez-vous ! Tenez-vous humble, patient avec vous-même, moins préoccupé de venir à bout du sommeil que de l’inquiétude, et de cette recherche inquiète du mieux qui vous tourmente. Tenez-vous paisible, pour recevoir les grâces de Dieu, et, si vous avez et gardez la haine de vous-même, que ce soit une haine tranquille comme une eau profonde… Possédez-vous ; ne vous réduisez pas trop ; mangez un peu ; dormez le temps nécessaire pour agir. »
Le Père Guérin lui écrit dans le même sens. Et je crois que ce fut le coup de grâce pour le « thé du désert ». Dans une lettre de Frère Charles, il est parlé de « couscous » au repas de midi : c’était peut-être aux grandes fêtes.
Les accès de fièvre de Frère Charles avaient ému la petite colonie militaire de Beni-Abbès. Immédiatement, tout afflue à la Fraternité : « le médecin major avec ses conseils et ses remèdes, tout le lait des chèvres des officiers et des sous-officiers, confitures, café, thé, que sais-je ! »
Et il s’étonne qu’on fasse tant pour lui !
Que peuvent craindre ceux qui possèdent une telle âme, et la tiennent, au moins par sa pointe, au-dessus du monde ? rien absolument. Dans l’été de 1902, un de ses amis lui ayant exprimé la crainte que les Berâbers n’attaquassent Beni-Abbès, Frère Charles ne nie pas le danger, mais il s’en réjouit.
« Je vous remercie de ce que vous me dites au sujet des dangers possibles ;… je les considère avec la paix des enfants de Dieu… Si vous saviez combien je désire finir ma pauvre et misérable vie, si mal commencée et si vide, de cette façon dont Jésus a dit, le soir de la Cène, « qu’il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu’on aime » ! J’en suis indigne, mais je le désire tant ! Les bruits de guerre reprennent ;… c’est un état très doux pour l’âme : se sentir toujours si près, si au seuil de l’éternité, c’est une douceur extrême et en même temps cela est bon pour l’âme. »
« 4 juillet. – Rien de nouveau dans ma vie ; oh si ! cependant : j’ai eu la grande joie de pouvoir acheter et libérer un esclave ; provisoirement, il reste chez moi, à titre d’hôte, travaillant au jardin ;… il semble avoir vingt-cinq ans… Priez pour sa conversion ! Priez aussi pour celle d’un bon turco musulman qui m’est bien dévoué,… et priez pour la mienne ! »
L’esclave dont parle ici frère Charles était un Berâber razzié par les Doui Menia, amis encore peu sûrs à cette époque, et dont une fraction campait sur le plateau de Beni-Abbès. Ému de pitié à la vue de ce beau jeune homme captif, Frère Charles dit à un sous-officier français : « Il faut l’acheter à son maître. Mais, si l’on apprend que c’est moi qui veux libérer l’esclave, on me demandera un prix que je ne pourrai donner. Allez donc, comme pour vous-même, acquérir le captif, et tenez-moi au courant des négociations. » Celles-ci durèrent trois jours. Nous avons encore les billets qu’il adressait à l’adjudant. « Ajoutez encore un douro ou deux douros, mon cher J…, mais je ne puis faire plus, non, je ne puis. »
Le lendemain, nouvelle lettre : « Eh bien ! oui, allez jusqu’à 400 francs, sans hésiter ni marchander… La liberté de notre frère est sans prix… Jésus, qui aurait pu nous racheter d’un mot, a voulu nous racheter de tout son sang, pour montrer son amour par le prix qu’il donnait. Suivons l’exemple de Dieu ! »
À la fin, le maître céda. L’esclave s’en fut remercier le grand marabout chrétien qui l’avait délivré. Ils causèrent un moment, puis Frère Charles dit au Berâber :
– Te voici libre : que vas-tu faire ?
– Laisser partir ceux qui m’avaient pris.
– Et ensuite ?
– Je retournerai chez mon premier maître, où j’étais bien. Ma femme est là encore.
« 28 juin 1902. – Le samedi est le jour de distribution d’orge. Il faut faire connaître nos dimanches et nos fêtes ! C’est une manière bien inférieure, mais la seule pratique, pour le moment, je crois, d’évangéliser… »
« 12 juillet 1902. – Premier baptême fait à Beni-Abbès : Marie-Joseph Abdjesu Carita, petit nègre de trois ans et demi[73]. »
« 21 juillet. – Quatre soldats de la garnison sont morts pendant ce mois d’extrême chaleur. Aucun n’a refusé les sacrements ; deux sont morts très pieusement après une longue maladie…
« 13 août. – Je suis toujours seul, – seul religieux, – avec Abdjesu, un nègre de vingt-cinq ans racheté et libéré il y a quelque temps, un artilleur qui me sert la messe, des tirailleurs qui réparent la chapelle dont la toiture faiblit. La Fraternité, très silencieuse la nuit et de 10 heures à 3 heures de l’après-midi, est une ruche de 5 heures à 9 heures du matin, et de 4 heures à 8 heures du soir. Je ne cesse de parler et de voir du monde : des esclaves, des pauvres, des malades, des soldats, des voyageurs, des curieux ; ceux-ci, – les curieux, – je n’en ai plus que rarement, mais les esclaves, les malades, les pauvres augmentent… Je célèbre la sainte messe, sauf le dimanche et les grandes fêtes, – je la dis, ces jours-là, à l’heure que les militaires désirent, – à laquelle jamais personne n’assiste en semaine, avant le jour, pour n’être pas trop dérangé par le bruit, et faire l’action de grâces un peu tranquille : mais j’ai beau m’y prendre de bonne heure, je suis toujours appelé trois ou quatre fois pendant l’action de grâces. »
« 12 septembre. – Ce qu’il y a de merveilleux ici, ce sont les couchers de soleil, les soirées et les nuits… Les soirées sont si calmes, les nuits si sereines, ce grand ciel et ces vastes horizons éclairés à demi par les astres sont si paisibles et chantent silencieusement d’une manière si pénétrante l’éternel, l’infini, l’au-delà, qu’on passerait les nuits entières dans cette contemplation ; pourtant j’abrège ces contemplations, et je retourne après peu d’instants devant le tabernacle, car il y a plus dans l’humble tabernacle : rien n’est rien, comparé au Bien-Aimé. »
Le 14, rachat de deux esclaves : un père de famille, et un jeune homme de quinze ans, que Frère Charles a appelé provisoirement Paul.
« 5 novembre 1902. – Il a plu deux fois, aussi je cache la sacristie sous l’autel, et l’autel, dès que le ciel se couvre, sous une couverte imperméable : une petite bâche. À la Fraternité comme au camp, comme dans le village, il pleut autant à l’intérieur des chambres (et de la chapelle) qu’au dehors. Les toits protègent exclusivement du soleil. Cela contribue au bonheur, loin de l’empêcher : en faisant sentir les intempéries, le bon Dieu nous rappelle que Jésus n’avait pas une pierre pour poser sa tête. Tout ce qui fait ressembler au Bien-Aimé unit à lui et est bonheur parfait… La vue même de mon néant, au lieu de m’affliger, m’aide à m’oublier et à ne penser qu’à Celui qui est tout. »
La fin de l’année approche. Les constructions et réparations du pauvre ermitage sont achevées, – en attendant que des Frères annoncent leur prochaine venue et ramènent ainsi les ouvriers au chantier. C’est la vie ordinaire, définitive, sans doute, qui commence. Elle doit être étroite autant que possible, et Frère Charles, songeant à cette obligation de son état, croit meilleur de se priver des services qu’un soldat lui rendait, chaque matin, en l’aidant à « faire le ménage ». On lui représente qu’il est fatigué ; il maintient sa décision ; il donne cette réponse, spirituelle et grande : « Jésus n’avait pas d’ordonnance. »
Son unique souci est celui des âmes. Grâce aux deux noirs qu’il a rachetés, il peut exposer le Saint-Sacrement, dans la chapelle qui ne sera pas tout à fait déserte, aux heures où les soldats sont retenus au camp. Et puis, le jour de Noël et le lendemain, « joie immense » : des Marocains viennent lui rendre visite. Avec quelle amitié il dut les recevoir, et de quels rêves il les suivit, qu’ils ne pouvaient entendre !
En ces mêmes jours, il eut d’autres surprises, d’une autre sorte. Noël est une époque où, dans la chrétienté, depuis bien des siècles, il est d’usage que les amis échangent des cadeaux. Frère Charles vit arriver, dans l’ermitage, un commissionnaire portant un paquet léger, soigneusement ficelé, que les âniers de la poste avaient remis au bureau des affaires indigènes. « D’où cela vient-il ? de l’Orient ? On se souvient encore de moi ? » On se souvenait si bien de lui que les religieuses d’un des couvents de Terre sainte où il avait passé, voulant faire plaisir à l’ermite qu’elles avaient connu jardinier, portier, commissionnaire, lui envoyaient un présent de Noël. Mais que donner à un ermite, quand soi-même on est pauvre ? d’abord, des reliques pour la chapelle. Il y en avait plusieurs, dans le paquet : reliques de saints, parcelles du Saint-Sépulcre ou du rocher de la Nativité. Les donatrices y avaient joint des fleurs de la Palestine, disposées en bouquet et collées sur des feuilles de vélin ; puis, ayant cherché de quels menus objets un Père de la Thébaïde pourrait avoir besoin, pour son ménage, elles avaient enfin enfermé, sous la même enveloppe, une cuillère de bois, une souricière et un mètre de drap blanc. L’homme qui avait apporté le paquet, voyant ce coupon d’étoffe et, en même temps, la misérable gandourah élimée, déchirée, percée, dont était vêtu le Père de Foucauld, s’était dit que dans ce beau drap blanc, on pourrait découper des pièces dont avait grand besoin la tunique de son ami. À peine rentré au camp, il se rendit donc chez le tailleur du bataillon, et le dépêcha vers l’ermitage. L’autre ne tarda pas beaucoup à faire la route. Peut-être voulut-il attendre que la plus rude chaleur de l’après-midi fût passée. Toujours est-il que, vers le soir, avant le soleil couché, il était de retour au camp, et, prenant une mine déconfite :
– Rien à faire !
– Comment, il ne veut pas qu’on répare sa gandourah !
– Pas précisément ; mais déjà il n’avait plus le morceau d’étoffe : il l’a donné.
En effet, sur le plateau encore ardent, ils pouvaient apercevoir, fier et courant se montrer à ses camarades, un négrillon qui sortait de l’ermitage, enveloppé dans un sac aussi blanc que la neige.
Vers le même temps, – peut-être un peu plus tôt, – un officier, qui s’occupait du ravitaillement des postes des oasis, remarqua, sur le quai de la gare d’Oran, un petit fût adressé au révérend Père de Foucauld à Béni-Abbès. « Vin de messe, pensa-t-il, et qui ne peut manquer de s’aigrir ; le voyage, la chaleur ont déjà dû l’avarier. En quel état parviendra-t-il au pauvre Père ! » Aussitôt la découverte faite, on s’empresse de loger le fût, à l’ombre, dans un magasin ; un homme de bonne volonté, et qui connaît les soins à donner au vin en danger, verse plusieurs seaux d’eau sur le baril, qui est recommandé aux convoyeurs du train d’Oran à Beni-Ounif, et deux ou trois fois aspergé le long de la route. À Beni-Ounif, le moment venu où le convoi se forme pour ravitailler Beni-Abbès, on place le fût sur le dos d’un chameau, et, comme l’amitié pour le Père de Foucauld était grande partout, on ne vit jamais colis plus surveillé, mieux recouvert de laine pendant les étapes, déchargé avec plus de soin lorsque la caravane, le soir, faisait halte pour la nuit. Enfin, le précieux baril est apporté à l’ermitage.
– Voilà votre vin de messe, mon père !
– Mais je n’en ai pas demandé.
– On vous en envoie ; regardez l’adresse.
Frère Charles se décide à débonder le fût. On s’aperçoit alors que c’était une cloche, au battant bien enveloppé de chiffons, qui avait voyagé sous les douves de châtaignier, et qu’on avait rafraîchie avec ce soin touchant. Elle fut suspendue en haut d’une sorte de petite tour rectangulaire, – je dirais campanile si le mot n’était pas ici d’une ambition démesurée, qui flanqua la chapelle. Et elle sonnait, me racontait un témoin, elle sonnait plus souvent que nous n’aurions parfois voulu, non seulement dans le jour, mais la nuit, à 10 heures, à minuit, à 4 heures du matin. Le son, dans l’air fin du désert, arrivait sur nous, dans la redoute, comme si nous avions été sous le battant. C’était Frère Charles qui s’appelait lui-même à l’office[74].
« 20 janvier 1903. – Deux harratins d’Anfid, le fagir Barka ben Ziân, et le fagir Ombarek, connus pour leur honnêteté, me demandent de les instruire de la sainte religion, et paraissent sincères. »
« 21 janvier 1903. – Un enfant de treize ans, natif du Touat, esclave depuis six ans, est racheté, et déclare, avant même son rachat, qu’il veut suivre la religion de Jésus, et rester avec moi. Racheté aujourd’hui à midi, il entre immédiatement au catéchuménat, sous le nom de Pierre. »
En mars, visite d’un ancien camarade, Henri Laperrine[75]. Il arrive à Beni-Abbès le 6. Il est commandant supérieur des oasis sahariennes, c’est-à-dire du Gourara, du Touat, du Tidikelt.
Henri Laperrine, qui réapparaît ici aux côtés de Charles de Foucauld, avait été sous-lieutenant au 4e chasseurs d’Afrique. De taille moyenne, de corps souple et musclé, le visage pâle et maigre, les traits fins, la barbe châtain clair en court éventail, les yeux vifs, d’ordinaire malicieux, durs par moments, il passait déjà, à l’époque où il arrive ainsi, faisant sa tournée de chef, à Beni-Abbès, pour un des types achevés du cavalier colonial. Presque jamais on ne le voyait coiffé du casque de toile, ou vêtu à la mode arabe, ou costumé en touareg. Il permettait ces fantaisies – et quelques autres – à ses subordonnés, dans les lieux de séjour. Lui, sous la pluie de feu du soleil, il portait le képi de drap, penché sur l’oreille gauche, et s’habillait à l’ordonnance. Il pouvait faire dix heures de cheval, par 40 degrés de chaleur, et arriver à l’étape, le col boutonné, et le corps droit sur la selle. Peu de coureurs de brousse furent, autant que lui, hommes du monde dans le désert. En revanche, il fuyait les villes et leur cérémonial, détestait les visites officielles, et déclarait qu’entre subir une heure d’attente dans l’antichambre d’un ministre et endurer une tempête de sable, il choisissait la tempête. Sa bonne humeur était connue. Il aimait les histoires gaies, même les histoires lestes, de préférence celles qui mettent en scène des gens du bled. Mais il y avait des sautes de vent. Cet impressionnable, ce nerveux, ce distrait, avait vingt fois le jour, et souvent trente, l’occasion de s’impatienter, ou de se fâcher. La seule chose qu’il ne pardonnait point, c’était la tromperie. On avait sa confiance une fois, pas deux. Pour le reste, il avait l’oubli facile, celui des torts des autres, et des siens propres ; il possédait, à la perfection, le don de sympathie qui devient un art, chez les gens de cœur. Tous les bons travailleurs, tous les serviteurs énergiques de la cause, c’est-à-dire de la France africaine, aimaient Laperrine. Il savait être amical sans être familier. Il avait son grade dans le regard, dans le geste, dans l’âme. Au désert, il faisait asseoir les sous-officiers autour du burnous étendu à terre et qui servait de nappe, pour déjeuner. Ses officiers en mission correspondaient avec leur chef, même pour affaires de service, par lettres privées, où chacun donnait de ses nouvelles, racontait, commentait, se plaignait s’il y avait lieu. Il répondait de même. Son énergie était prodigieuse, son exactitude également. À peine descendu de cheval, ou de méhari, après un parcours de 50, 60, parfois de 80 kilomètres, il faisait dresser sa table de travail, buvait une tasse de thé, et se mettait à écrire. Les courriers qui le joignaient en route pouvaient repartir, le soir même, avec la réponse. À l’heure de la sieste, il n’y avait souvent qu’un homme qui ne dormît pas : Laperrine. Là, dans le désert, il était dans son royaume, dont il connaissait tout, les hommes et les choses. Un de ses disciples et amis a dit : « Il n’était pleinement lui-même qu’à partir du moment où il posait son pied nu sur la souple encolure de son méhari. » Sa puissance, parmi tant de tribus d’Algérie, du Soudan, du Sahara, était faite de la certitude, établie par cent preuves au cœur des indigènes, que ce grand chef n’était pas leur ennemi. Laperrine ne voulait ni les humilier, ni les exploiter ; il voulait se les concilier, les faire entrer, comme protégés, comme aides et comme amis, dans une France prolongée.
Cette doctrine, qui fut victorieuse, et nous vaut un empire colonial jalousé, il ne l’a exposée ni dans un traité d’art militaire, ni dans un récit de ses campagnes. « C’est dans sa correspondance de commandant militaire qu’un historien, épris des choses sahariennes, ira chercher, tôt ou tard, les principes de la police du désert. S’il est vrai qu’un homme écrit comme il pense, Laperrine est là tout entier. Les gros cahiers d’instructions et d’ordres sont de sa main, tracés d’une ferme et expressive écriture ; le texte néglige l’accessoire pour courir à l’essentiel. Jusqu’à la bousculade de l’orthographe, – Laperrine, comme Mme de Sévigné, avait le dédain des conventions académiques, – tout révèle le feu intérieur. Partout on retrouve l’empreinte laissée dans l’esprit de Laperrine par ses années de jeunesse. S’adapter au milieu, se faire nomade avec le nomade, contre-razzieur avec le razzieur, prendre à l’indigène tout ce qu’il peut donner de son expérience instinctive, et l’emporter sur lui par l’ascendant moral, le raisonnement et la conscience[76]. »
La vocation de Laperrine et celle de Foucauld étaient donc sœurs, non pas semblables ni de même caractère, mais variétés, toutes deux, de la même espèce, très française et très chrétienne. Leur amitié, pendant quarante années, s’explique par cette commune intelligence du rôle civilisateur de la France. Mais je crois que d’autres éléments encore l’ont formée et maintenue. Foucauld, chez Laperrine, admirait une âme loyale, ardente, capable de sacrifier à l’idéal toutes les aises, le repos, la santé, la vie elle-même et, ce qui est plus rare, l’avancement. Laperrine admirait, chez Foucauld, des dons pareils aux siens, mis au service d’un idéal encore plus grand : la sainteté personnelle et le rayonnement de la sainteté parmi les indigènes. La vie militaire coloniale, qui n’est pas celle d’un pensionnat de jeunes filles, l’éloignement des milieux chrétiens, la préoccupation d’un esprit toujours tendu ou ramené vers le devoir militaire, avaient pu détourner Laperrine de la pratique religieuse. Mais cet élève des dominicains de Sorèze demeurait, au fond, un croyant. Ses deux plus chers amis étaient deux prêtres, avec lesquels il entretenait la correspondance la plus suivie : son frère, Mgr Laperrine d’Hautpoul, et le Père de Foucauld. Et, si l’on peut citer de lui telle boutade qui ferait supposer qu’il n’avait aucune foi, il faut bien se garder de tirer, d’une cause aussi menue, une conclusion si grave et si fâcheuse. On doit accorder un tout autre crédit à quelques faits positifs qui seront racontés à leur date, dans ce livre, et à l’affirmation d’un de ses familiers, qui me disait : « En toute occasion sérieuse, il parlait, au contraire, des choses de religion avec un respect inouï. »
J’aurais fait une esquisse bien incomplète de ce grand Français, si je ne disais encore qu’il était généreux. Sa bourse s’ouvrait facilement. Ses provisions de commandant, il les partageait, en voyage, avec ses officiers et souvent les sous-officiers qu’il invitait ; parmi les tribus, il aimait à distribuer les cadeaux, et l’on ne songera pas sans émotion que, bien des années après celle que je raconte ici, lorsqu’il partit pour ce voyage aérien vers le Hoggar, qui devait être son dernier voyage, Laperrine emportait, à bord de l’avion, en guise de bagages, un petit colis de soieries légères, pour les femmes et les enfants touaregs.
Tel était le visiteur dont la venue fut une grande joie pour Frère Charles. Ils durent causer longuement, un peu du passé, beaucoup de l’avenir de leur Afrique. Cependant, le diaire n’en dit rien. Ni l’arrivée de ce détachement militaire sur le plateau de Beni-Abbès, ni la réception faite au commandant déjà légendaire, ni les mots de Laperrine, ni les conversations des deux amis ne sont racontés. Comme ce Frère Charles était peu romancier ! Une simple note, très courte, une confidence : « Il (Laperrine) avait obtenu, il y a quelques jours, l’autorisation de faire, ce printemps, une triple opération : 1° d’aller d’In-Salah à Timbouktou, et de joindre définitivement et militairement, par la force au besoin, le Tidikelt au Soudan ; 2° de conquérir le Hoggar et de pousser jusqu’à Agadès ; 3° de gagner l’océan Atlantique, au sud de Dra, en occupant Tabelbalet et Tindouf. Mais, après lui avoir accordé ces autorisations, on les lui a presque aussitôt retirées, ces jours derniers. »
Et Laperrine poursuit sa tournée.
Les jours, les mois s’écoulent ; la solitude est toujours complète, je veux dire dans l’apostolat. Aucun autre homme ne s’offrait à partager la vie de celui qui était parti, comme saint Jean-Baptiste, pour être vox clamantis in deserto. Le Baptiste savait bien qu’il n’aurait pas de compagnon : Frère Charles espérait en trouver, et sûrement, dans les jours les plus rudes, quand le corps ploie de fatigue, et que l’esprit va succomber à la tentation de l’à quoi bon ? il s’était réfugié dans l’espérance de cette aide qui viendrait. Que de fois la fuite du temps, l’absence de durée, qui est une des misères de notre état, nous sert de consolation ! Mais, pour Frère Charles, l’épreuve était sensible. Il n’en souffrait pas pour lui-même, ayant l’amour de la solitude, il en souffrait pour le prochain. Seul ouvrier dans la corruption totale, l’ignorance totale, où ne se rencontrent pas même ces lueurs, ces regrets voilés, cette puissance de résurrection qu’on peut deviner au fond des âmes baptisées, il avait essayé, au cours des années, de solliciter quelques vocations de petit Frère ou de petite Sœur de la future communauté. Ses lettres, ses envois discrets de règlements semblaient ne toucher aucun cœur. En France, une idée généreuse ne pas germer ? Cela se peut-il ? Et pourquoi ?
Les réponses peuvent varier. Des personnes tant soit peu instruites de l’histoire ecclésiastique observeront sans doute que les ordres religieux ne sont pas nés dans l’abstrait ; que les constitutions n’ont pas été faites a priori, mais d’abord vécues, tâtonnées, éprouvées par un groupe d’hommes ou de femmes que la vertu d’un futur chef avait attirés. D’autres feront remarquer que les règlements de Frère Charles dépassent la mesure, violentent par trop la faiblesse humaine, supposent une vigueur de tempérament et une puissance de volonté rarement associées. On va voir cette opinion fermement, rudement même exprimée par le prieur d’une Trappe, qui n’avait pas oublié « Frère Marie-Albéric », qui le tenait pour un homme de sainteté éminente, mais ne le croyait pas appelé au gouvernement d’une communauté. Nous sommes arrivés à ce point de la biographie du Père de Foucauld, où il faut expliquer pourquoi il désire si vivement – et il le désirera jusqu’à la fin – que d’autres prêtres se fassent, comme lui, « petits Frères du Sacré-Cœur », et s’enfoncent dans les pays de l’Islam. Il avait recherché la solitude ; il l’avait achetée cher ; il y tenait. Mais l’ouvrier, plongé dans la moisson et voyant l’immensité de la tâche, se désolait pourtant de n’être pas en troupe. Il faisait plus : il s’en accusait. Sans cesse, dans sa correspondance et dans ses notes intimes, il déclare que son indignité est cause de l’isolement où il vit.
« Je suis toujours seul à Beni-Abbès, écrit-il à la marquise de Foucauld[77]. Plus que jamais je crois ce point de Beni-Abbès propice pour une communauté de solitaires pauvres, vivant dans l’adoration du Saint-Sacrement et le travail manuel ; c’est si solitaire et si central, entre l’Algérie, le Maroc et le Sahara ! Priez pour que mes infidélités ne mettent pas obstacle aux desseins du Sacré-Cœur. »
Cette coulpe ne cesse point d’être battue. Voici la même pensée, le même élan de contrition et de supplication, dans le diaire, à la date de Pâques 1903 : « Ni postulant, ni novice, ni sœur… Si le grain de blé ne meurt pas, il reste seul. Seigneur Jésus, pardonnez-moi mes infidélités, mes lâchetés sans nombre ! Secourez-moi, Vierge Marie, sainte Madeleine, bienheureuse Marguerite-Marie ! Régnez en moi, Cœur de Jésus, afin que je meure enfin à moi, au monde, à tout ce qui n’est pas vous et votre volonté, et que je rapporte du fruit pour votre gloire !
« Le catéchumène Paul m’a quitté après de grosses fautes ; le catéchumène Pierre m’a quitté, il désirait retourner chez ses parents, je l’y ai envoyé ; le catéchumène Joseph du Sacré-Cœur, envoyé à Alger chez les Pères blancs, en février 1902, et reconduit par eux au Soudan, en octobre, les a quittés et mal quittés… Il ne reste à la Fraternité que deux personnes avec moi : le petit chrétien Abdjesu et la vieille catéchumène aveugle Marie. »
Tout à coup, il semble que ces hommes de mortification, de prière, d’exemple et de charité, dont Frère Charles implore la venue, vont lui être envoyés. Deux Pères et deux Frères de la Trappe de Staouëli ont parlé – assez vaguement sans doute – d’imiter le Père de Foucauld et de se mettre sous son obéissance. Mais regardez-le et le reconnaissez : il ne cherche pas à les attirer ; il les éprouve dès le début ; il écrit à l’un d’eux :
« Cher et vénéré Père, M. de la H… m’écrit que vous, un autre Père et deux Frères trappistes vous sentez poussés à partager avec moi la vie pauvre, abjecte et solitaire de Jésus caché, cette vie divine dont il nous a donné l’exemple trente ans à Nazareth.
« Très cher Père, votre conduite à tous est simple ; Jésus ne nous demande jamais de choses compliquées, mais à tous une simplicité de petits enfants, unie à une grande prudence, laquelle consiste, comme dit saint Paul, à chercher soigneusement, par des moyens sûrs, quelle est la volonté de Dieu, pour la faire sans erreur.
« Il suffit pour vous et pour chacun de vos trois autres Père et Frères de connaître la volonté de Dieu, et ensuite il faut la faire coûte que coûte.
« Il n’y a qu’un moyen absolument infaillible de connaître la volonté divine dans une question semblable ; c’est par la direction spirituelle : ouvrir pleinement votre âme à un directeur consciencieux, instruit, intelligent, intérieur, sans parti pris, et prendre sa réponse comme la volonté divine du moment présent, en vertu de la promesse : « Qui vous écoute, m’écoute » ; voilà le moyen infaillible de faire la volonté de Jésus en cette circonstance et en toutes… S’il vous dit : Jésus vous appelle à quitter la Trappe et à rejoindre Frère Charles, venez, mes bras et mon cœur vous sont ouverts, je vous recevrai comme amenés par la main de Jésus. S’il vous dit : Attendez ; obéissez et attendez. S’il vous dit : Restez à la Trappe ; obéissez ; dans ce dernier cas, si, tout en obéissant, vous continuez à vous sentir pressé intérieurement de venir suivre Jésus dans sa pauvreté, son abjection, sa solitude, sa vie cachée, dites-le de temps en temps, de nouveau, à votre directeur, tenant toujours votre âme à nu devant lui.
« Mais pour savoir si vous êtes appelés de Dieu à partager mon humble genre de vie, il faut que vous connaissiez exactement celle-ci ; elle est fixée dès maintenant par des constitutions et un règlement que j’ai soumis à mon préfet apostolique ; celui-ci, me permettant de m’établir dans sa préfecture, m’a permis aussi d’y grouper avec moi un certain nombre de prêtres et de laïcs vivant selon ces constitutions et ce règlement. Quand on sera assez nombreux, on demandera à Rome les autorisations supplémentaires…
« Prédites-leur bien dura et aspera, montrez-leur et cette lettre, et les constitutions, et le passage des préliminaires du règlement… Dites-leur bien qu’outre ce qu’on demande d’ordinaire aux postulants, savoir, la bonne volonté de pratiquer de leur mieux les constitutions et règlement, je demande, des pierres premières de ce petit édifice, trois choses : 1° être prêt à avoir la tête coupée ; 2° être prêt à mourir de faim ; 3° m’obéir malgré mon indignité, jusqu’à ce qu’on soit quelques-uns et qu’on puisse faire une élection (qui, j’espère, me remplacera par un plus digne que moi, et me remettra à la dernière place que je mérite)…
« Ma pensée est que, puisqu’on nous accepte dans la préfecture apostolique du Sahara, où j’ai ici à l’heure présente un petit terrain suffisant pour nourrir vingt à vingt-cinq moines, et un commencement de monastère pouvant en quelques semaines et à très peu de frais se terminer, et où, qui plus est, on peut faire énormément de bien tant aux populations du Sahara qu’à celles du Maroc, – brebis perdues entre toutes, – le mieux est de nous concentrer, nous former ici, tant Frères que Sœurs, si c’est possible… »
Il ne devait jamais avoir, sauf une seule exception et pour un court moment, de compagnon d’apostolat. Déjà l’espoir était abandonné de voir s’établir prochainement quelques religieuses à Beni-Abbès. Frère Charles avait correspondu, à ce sujet, avec le Père Guérin, et, dans une de ses lettres, il accepte la réponse qu’on lui a faite : « Pour les Sœurs, oui, c’est très juste et sage, qu’on ne me les envoie pas ici, tant que j’y suis seul prêtre. Vous avez mille fois raison. »
Le motif du refus devait être, je suppose, la nécessité où se seraient trouvées les Sœurs de prendre, comme directeur de conscience, le seul prêtre qu’il y eût à cent lieues et plus à la ronde. Le droit ecclésiastique respecte la liberté des âmes, et ne permet pas, autant qu’il est possible, cette sorte de contrainte.
Donc, point de Sœurs pour les salles d’asile, point de Sœurs pour les petits négrillons, ni pour les filles des habitants de l’oasis. À plus forte raison devait-il remettre à plus tard, à bien plus tard, la fondation de ces petites Sœurs du Sacré-Cœur, pour lesquelles il avait également médité et écrit un projet de règlement.
Pour les petits Frères du Sacré-Cœur, la réponse était négative aussi, mais Frère Charles ne la connaissait pas. Il y avait des mois déjà que Mgr Guérin, désireux de l’aider et de lui envoyer des compagnons, s’était mis en relations avec le Père abbé de Notre-Dame-des-Neiges. Celui-ci avait répondu :
« … Vous m’exhortez à lui donner un aide, un compagnon. Pour le moment, je ne puis pas ; mais je le pourrais, que j’hésiterais encore. Vous le savez, monseigneur, mon estime pour les vertus héroïques du Père Albéric est profonde, et bien enracinée par une fréquentation intime durant douze ans. La seule chose dont je m’étonne, c’est qu’il ne fasse pas des miracles. Je n’avais jamais vu, hors des livres, une telle sainteté sur la terre. Mais je dois avouer que je doute un peu de sa prudence, de sa discrétion. Les austérités qu’il pratique, et qu’il pense exiger de ses compagnons, sont telles que je me sens porté à croire que le néophyte y succomberait à bref délai. De plus, la contention d’esprit qu’il s’impose, et qu’il veut imposer à ses disciples, me paraît tellement surhumaine, que je craindrais qu’il ne rendît fou son disciple, par cette tension d’esprit excessive, avant de le faire mourir sous l’excès des austérités.
« Si vous jugez que nous pouvons lui confier quelqu’un sans danger pour sa tête, et sans danger pour sa vie, je m’en remettrai aveuglément à votre décision, et je m’occuperai de lui trouver au plus tôt un compagnon. »
Staouéli n’avait pas parlé autrement. Un des religieux de cette abbaye, au début de 1902, interrogé sans doute par le commandant Lacroix, s’était expliqué avec la même franchise au sujet des compagnons souhaités.
« Notre saint ami est au comble de ses vœux ; grâce à votre fraternel appui, tout le personnel de Beni-Abbès lui est dévoué… Vous pouvez compter sur lui comme sur un instrument parfait de pacification et de moralisation. Il fera là-bas en petit ce qu’a fait le grand cardinal en Tunisie pour l’influence française. Mon seul regret est de n’avoir personne à lui envoyer pour le seconder. Sa vie est si austère, que ceux des supérieurs de notre ordre qui ont pour lui la plus sincère affection la jugent plus admirable qu’imitable, et redoutent de jeter dans le découragement les disciples qu’ils pourraient lui procurer. Il lui faudra donc très probablement vivre seul, ou recruter peu à peu, sur place, les éléments de sa future communauté[78]. »
Ces lettres, Frère Charles ne les a jamais lues. Il continua d’attendre et de se résigner. Il n’eut pas à faire en une seule fois son sacrifice : il le fit chaque année, peut-être chaque mois, tant qu’il vécut, voyant bien que personne ne venait pour la relève. Et dans quelle disposition d’âme cette épreuve si dure le trouva-t-elle ? dans la plus parfaite. Nous en avons pour preuve ces lignes qu’il écrivait à tout hasard, dans l’ignorance de ce qu’on pensait de ses projets.
« Pour les compagnons, le fond de mon cœur, mon bien-aimé Père, c’est que, quoi qu’il arrive, je serai parfaitement content. Si j’en ai un jour, je serai content de voir là l’accomplissement de la volonté de Dieu et son nom glorifié. Si je n’en ai pas… je me dirai qu’il est glorifié de tant d’autres manières, et que sa béatitude a si peu besoin de nos pauvres louanges et de nos pauvres cœurs ! Si je pouvais – mais je ne puis pas – faire autrement que me perdre totalement dans l’union à sa divine volonté, je préférerais pour moi l’insuccès total, et la perpétuelle solitude, et les échecs en tout : elegi abjectus esse. Il y a là une union à l’abjection et à la croix de notre divin Bien-Aimé, qui m’a toujours semblé désirable entre toutes. Je fais tout ce que je peux pour avoir des compagnons, le moyen d’en avoir est, à mes yeux, de me sanctifier en silence ; si j’en avais, je me réjouirais, avec bien des tracas, des croix : n’en ayant pas, je me réjouis parfaitement[79]. »
En vérité, la nature ne peut être plus complètement vaincue, et cette âme est grande parmi les grandes. Les hommes s’en sont douté : de son vivant même, ils ont appelé Frère Charles un paladin, et ils ont bien dit. Mais plusieurs ajoutaient : un paladin qui s’est trompé de siècle. Mot léger et qui date. La guerre l’a montré : jamais on ne vit autant de paladins qu’au vingtième siècle, et dans chacune des provinces de France, et dans les plus humbles familles. Ils furent bien de leur temps, ceux-là ! De même Charles de Foucauld. Dans une autre occasion de dévouement et de sacrifice, il fut l’un d’eux, né avant eux. Et, s’il n’eut pas de disciples, qui pourrait dire qu’il ne lui en viendra pas, maintenant que la mort a passé et que l’expérience est faite ? Car ce ne sont pas les héros qui manquent : c’est la connaissance qui leur manque des causes qui ont besoin d’eux.
« 5 mai 1903. – La vieille catéchumène Marie est très malade. Le médecin est absent. Craignant qu’elle ne meure, je la baptise, sur son désir très nettement exprimé, après lui avoir fait réciter en arabe le Pater, le Credo, les actes de foi, d’espérance, de charité et de contrition, et lui avoir fait demander, encore une fois, formellement le baptême. »
Joie de missionnaire, ce baptême de la pauvre négresse musulmane ; Frère Charles en fait part à un prêtre qu’il sait très dévoué à l’œuvre saharienne ; il y trouve l’occasion de s’humilier[80].
« Je demande vos prières pour cette pauvre vieille négresse dont l’âme est si blanche, qui serait ce soir en paradis si elle mourait maintenant. Je ferais bien mieux de vous les demander pour le vieux pécheur qui vous écrit.
« Hélas ! oui, monsieur l’abbé, c’est un pécheur qui vous remercie. Une seule chose égale et dépasse les péchés de ma jeunesse, les infidélités, les lâchetés, les tiédeurs de mon âge mûr, mes misères quotidiennes : ce sont les grâces, les miséricordes dont Dieu me comble et me confond. Priez, je vous en supplie, pour que je sois enfin fidèle ! Priez pour que j’aime et serve ! Priez pour que ma vie ne soit qu’alleluia et obéissance !… Priez pour que ce petit atôme que je suis fasse, au milieu de ces millions d’âmes qui n’ont jamais entendu parler de Jésus, l’œuvre pour laquelle il m’a envoyé. Priez pour ce Maroc, pour ce Sahara qui sont, hélas ! un tombeau scellé. Priez pour que, comme les anges, nous travaillions de toutes nos forces au salut des hommes, en nous réjouissant, de toute notre âme, du bonheur de Dieu ! »
Une nouvelle visite allait venir à l’ermite. Le Père Guérin, parti de Ghardaïa, et faisant une « tournée d’inspection » dans les postes des Pères Blancs, était attendu à Beni-Abbès depuis les premières semaines de l’année 1903. Frère Charles se réjouissait ; le capitaine Regnault, son ami, chef du bureau arabe, faisait le projet d’aller au-devant du voyageur jusqu’à Ksabi, politesse du désert, qui rappelle ce temps des diligences, où nos pères se rendaient jusqu’au prochain relai, à la rencontre d’un ami. Mais le voyage s’allongeait ; après le Tidikelt, le préfet apostolique du Sahara visitait le Touat, le Gourara ; il y séjournait ; et les lettres de Frère Charles le suivaient, comme elles pouvaient. Je veux citer des fragments de cette correspondance, parce qu’ils montrent, mieux encore que d’autres, l’âme ardente du solitaire, toute en affections, en prières, en espérances, en repentirs.
Il écrivait, le 27 février :
« Mon bien-aimé et très Révérend Père, de tout cœur je vous suis de la pensée, de la prière dans votre voyage… Oh ! oui, de toute mon âme je consens, malgré mon si ardent désir de vous voir, à ce que votre arrivée soit retardée au delà des prévisions, si un voyage plus loin vers le sud doit causer ce retard : Adveniti regnum tuum… Mon bien-aimé Père, je suis misérable sans fin, pourtant j’ai beau chercher en moi, je ne trouve pas d’autre désir que celui-ci : Adveniti regnum tuum ! Sancificetur nomen tuum ! Ne croyez pas que dans mon genre de vie l’espoir de jouir plus tôt de la vision du Bien-Aimé soit pour quelque chose ; non je ne veux qu’une chose, c’est faire ce qui lui plaît le plus. Si j’aime le jeûne et la veille, c’est que Jésus les a tant aimés : j’envie ses nuits de prières au sommet des montagnes ; je voudrais lui tenir compagnie ; la nuit est l’heure du tête à tête… Hélas ! je suis si froid que je n’ose pas dire que j’aime ; mais je voudrais aimer !… Voilà pourquoi j’aime la veille.
Hélas ! de moins en moins je puis veiller… Quant au jeûne, en obéissance à votre lettre, je l’allégerai de toutes mes forces, je mangerai bien et je boirai du lait ; d’ailleurs, d’après l’ordre de M. Huvelin, je me soigne fort depuis plusieurs mois, usant de lait concentré et mangeant à ma faim… Soyez certain que votre lettre, vos recommandations auront, pour mon sommeil et ma nourriture, un effet immédiat et sérieux…
« Merci de ce que vous me dites pour mon grand nègre Paul ; vous jugerez… Je ne crois pas qu’il y ait lieu de l’emmener d’ici : il n’est pas de confiance… Je ne suis pas surpris de la fuite de Joseph (un autre jeune esclave racheté) ; l’exemple le plus soutenant, celui que j’ai à me remettre à toute heure devant les yeux, pour me diriger, c’est celui de la conduite de Notre-Seigneur avec Judas Iscariote. Nous ne sommes entourés que de cela : nègres, arabes, joyeux. Je pense aussi aux épîtres aux Corinthiens, qui montrent les premiers chrétiens de saint Paul sous un si triste jour. C’est pour notre espérance que ces lignes sont écrites : car, à voir ce qui nous entoure, on est effrayé. Ce qui nous est impossible est possible à Dieu : prions-le d’envoyer son ange ôter la pierre du tombeau… »
On se prend à penser : n’est-ce pas dommage qu’un homme d’une si haute valeur se condamne à vivre parmi de pareilles gens ! Mais c’est Frère Charles qui a raison : ce sont justement les belles âmes, celles de la parenté de Jésus-Christ, qu’il faut pour rapprocher et réconcilier les plus misérables.
Pendant que le Père Guérin continue son voyage, les razzias se multiplient autour de Beni-Abbès. Le désert, ce lieu de bavardage, s’entretient des exploits des Berâbers, qui attaquent les convois et parfois les enlèvent. Les pistes de la Zousfana sont peu sûres. À plus d’un signe, on devine que les tribus s’agitent ; le gouverneur général de l’Algérie, M. Revoil, vient de donner sa démission ; les nouvelles de France sont tristes : la persécution religieuse s’étend ; les ordres d’hommes et de femmes sont inquiétés ; des Français sans reproche, injustement dépouillés de leurs biens, et privés de la liberté de leur vocation, sont réduits à quitter le cher pays ; on peut craindre que de pareilles mesures ne soient prises contre les missionnaires et les sœurs d’Algérie. Charles de Foucauld continue d’écrire, pour le Père Guérin, le journal de la pauvre chrétienté de Beni-Abbès.
L’arrivée du Père est enfin annoncée pour la fin de mai. Frère Charles se réjouit, et demande à Dieu de bénir le voyage. « Qu’il vous fasse longtemps jouir de son petit tabernacle de Beni-Abbès, et y jouisse longtemps de votre adoration ! Je rêve pour vous, ici, bien des jours et des nuits devant le Très Saint-Sacrement exposé ! Il y a longtemps que vous n’aurez joui d’heures de silence aux pieds de la sainte hostie. »
De pareilles invitations durent être envoyées par les cénobites de l’Égypte, au temps de saint Jérôme.
Le 17 mai, une lettre encore, où sont indiquées les dispositions prises, où sont faites les dernières recommandations. « Ne vous laissez pas accaparer par les autres ! Ils voudront vous recevoir ! Il y a jusqu’à trois « popotes » d’officiers, en ce moment, à Beni-Abbès. Les deux premiers jours, on se disputera votre visite… Il va sans dire que vous logez, vous et votre suite, – mehara compris, – à la Fraternité. Vous y êtes chez vous. Le capitaine Regnault a beaucoup insisté pour vous loger au bordj du bureau arabe, où vous eussiez été plus confortablement, mais je lui ai dit que votre place était sous le toit du Saint-Sacrement, et il l’a compris. Mais votre cuisinier ne chômera pas. Vous n’auriez que moi pour cuisinier, si votre chef ne s’en mêlait, et je ne veux pas vous tuer avec ma cuisine.
« Je vous recevrai comme un pauvre reçoit son père tendrement aimé, c’est-à-dire très pauvrement, mais vous ferez tout ce que vous voudrez, vous serez le maître : si vous voulez, c’est moi qui serai votre invité. Je n’insisterai pour rien, vous aurez la totale liberté, vous serez chez vous.
« Abdjesu et Marie – qui n’est pas morte, je crois que vous la trouverez vivante – vous attendent avec impatience. Dix fois par jour, Abdjesu me demande où est maintenant le pape Charles. J’ai beau faire, il ne veut pas démordre de vous appeler le pape.
« … Il va sans dire qu’à votre arrivée, je vous ferai entrer avant tout à la chapelle, aux pieds du Maître, du Tout. »
Le Père Guérin et son compagnon le Père Villard demeurèrent cinq jours à Beni-Abbès du 27 mai au 1er juin au soir. Nous pouvons supposer ce que furent la première rencontre, la prière en commun, puis les entretiens de ces moines, un moment rapprochés, au cours des longs voyages qui étaient de leur vocation. Ils durent parler à peine de ce que racontent volontiers les autres voyageurs, de leurs impressions de route, de la misère ou du confortable des gîtes, de la beauté des paysages ; ils s’occupèrent du plus grand sujet qui fut, qui est et qui sera : des âmes, de la multitude, ignorante et hostile, rencontrée dans les maisons de boue séchée et sous les tentes, et de la part de vie éternelle qui est pourtant promise à chacun de ces pauvres.
Nous savons que le 31 mai, jour de la Pentecôte, le Père Guérin célébra la messe principale. Et le diaire porte cette note : « Pour la première fois depuis bien des siècles, pour la première fois absolument peut-être, trois prêtres sont à Beni-Abbès. »
On verra tout à l’heure quelques-unes des observations que fit le Père Guérin, relativement aux méthodes d’apostolat du Père de Foucauld. Je veux citer d’abord la lettre que celui-ci écrivit à son supérieur, le surlendemain du jour où le Père Guérin, quittant le plateau de l’ermitage, eut descendu, vers le soir, la berge de la Zousfana, et pris la piste qui mène vers Taghit. Il venait d’apprendre qu’une dame Tavernier, parente du Père Guérin, – il ne savait à quel degré, – venait de mourir, et, pour le consoler, il lui adressait des condoléances qu’une âme proche de Dieu peut seule trouver, qu’une âme pareille peut seule accueillir. Quelle distance entre nos formules de sympathie, nos efforts pour consoler le prochain, nos pauvres trouvailles, même celles où nous avons mis tout notre cœur, et cette sorte de cantique de l’épreuve et d’alléluia de la souffrance, que trace à la hâte, sur une feuille de papier large comme la main, le Père de Foucauld restitué à la solitude !
« Bien-aimé et très vénéré Père, les peines suivent de près les joies… C’est avec peine que je vous écris aujourd’hui, car je sais que votre séjour de Taghit ne se passera pas sans tristesse… C’est par la croix que Jésus a voulu sauver les hommes, c’est par elle qu’il continue à les sauver : ses apôtres, ceux qui prolongent sa vie ici-bas, font du bien dans la mesure de leur sainteté, mais à condition de souffrir et dans la mesure aussi de leur souffrance… Si pour être un alter Jesus, pour que « ce ne soit plus nous qui vivions, mais Jésus qui vive en nous », il faut avant tout être saint, avant tout brûler d’amour comme son cœur, il faut aussi porter la croix et être couronné du sanglant diadème.
« L’épreuve qui vous atteint est une divine rosée pour la mission du Sahara ; toutes vos douleurs, toutes vos larmes sont des âmes… C’est par les croix que nous envoie Jésus, bien plus que par les mortifications de notre choix, que nous boirons au calice de l’époux et serons baptisés de son baptême, car bien mieux que nous, il sait nous crucifier…
« Bien-aimé Père, je ne vous dis pas : Soyez résigné ; je vous dis : Bénissez, remerciez, fondez-vous en action de grâces ; ce sont des âmes que Jésus vous donne ; votre souffrance est leur salut… Puissiez-vous beaucoup souffrir pour en sauver beaucoup !… Puissiez-vous mourir à la peine pour en sauver le plus possible !… Que Jésus est bon de nous donner part à son calice, qu’il est bon de marquer le mois de son cœur en perçant le vôtre, qu’il est bon d’entendre votre prière et de vous faire souffrir pour vous rendre sauveur !…
« Je ne sais si vous sentez comme moi : séparé depuis si longtemps d’âmes si chères, lorsque j’apprends le départ de l’une d’elles pour la Patrie, ce n’est pas une séparation, me semble-t-il, mais le commencement de la réunion ; je puis leur parler et elles m’entendent ; les prier et j’espère qu’elles me secourent ; c’est le commencement de l’union éternelle.
« Je me suis senti seul, pour la première fois depuis bien des années, lundi soir, lorsque, peu à peu, vous avez disparu dans l’ombre. J’ai compris, senti, que j’étais ermite… Puis je me suis souvenu que j’avais Jésus, et j’ai dit : « Jésus, je vous aime… » Bien-aimé Père, combien je vous remercie de votre visite, du bien que vous m’avez fait… Je ferai de mon mieux pour me conformer à toutes vos paroles, pour rectifier, améliorer, corriger, selon vos volontés et vos désirs.
« P.-S. – Dites à Abdjesu que je l’embrasse et le bénis, complexans eos, et imponens manus super illos… S’il demande jamais mon nom, dites-lui que je m’appelle Abdjesu. Priez pour que je le sois !
« Hier, longue visite de deux hommes du Tafilelt, deux marabouts. Ils ont entendu parler de vous, et m’ont demandé si vous étiez allé au Tafilelt. – Non, il ira une autre fois ! – Marhaba ! Voyage-t-il à pied ? – Non, à chameau… Cette question, posée par des marabouts, m’a fait réfléchir… Ils marchent à pied, eux, conduisant leurs ânes… Nous sommes disciples de Jésus, nous voulons que Jésus vive en nous, christianus alter Christus, nous parlons sans cesse de pauvreté,… eux sont disciples de Mahomet. Je me porte aux exemples de nos frères les apôtres… Nous sommes en pays aussi infidèle que saint Pierre et saint Paul… Si nous voulons faire leurs œuvres, suivons leur exemple…
« Chaque fois que je prie Jésus, la même réponse semble descendre : « Fais des miracles pour moi, j’en ferai pour toi… »
À présent que le vicaire apostolique du Sahara a quitté Beni-Abbès, ouvrons de nouveau le diaire, et nous saurons ce que furent les entretiens du Père Guérin et du Père de Foucauld.
« 1er juin 1903. – Départ de Mgr Guérin pour Taghit. Voici quelques-unes des observations qu’il a faites :
« 1° Parler beaucoup aux indigènes, et non de choses banales, mais, à propos de tout, en venir à Dieu ; si on ne peut leur prêcher Jésus parce qu’ils n’accepteraient pas certainement cet enseignement, les préparer peu à peu à le recevoir, en leur prêchant sans cesse dans les conversations la religion naturelle,… beaucoup parler et toujours de manière à améliorer les âmes, à les relever, à les rapprocher de Dieu, à préparer le terrain à l’Évangile.
« 2° Disposer des bancs, des abris dans les cours, et faire asseoir les visiteurs, au lieu de les laisser debout… La conversation, quand on est assis, prend plus facilement un tour intime, sérieux.
« 3° Faire profiter l’aumône temporelle au bien des âmes, en parlant de Dieu, et donnant l’aumône spirituelle des bons enseignements à ceux à qui on fait l’aumône matérielle.
« 4° Le travail des évangélisateurs en pays musulman n’est pas seulement de prendre des enfants et de tâcher de leur inculquer les principes chrétiens, mais aussi de convertir, dans la mesure du possible, les hommes faits… Les enfants ne pourront faire germer la semence évangélique jetée dans leurs âmes, s’ils ne trouvent pas le milieu où ils vivent un peu préparé, un peu bien disposé. D’ailleurs, toutes les âmes sont faites pour la lumière, pour Jésus, toutes sont son héritage, et aucune, si elle a de la bonne volonté, n’est incapable de le connaître et de l’aimer… Les musulmans ne sont donc nullement inaptes à être convertis… Appliquons-nous beaucoup à l’évangélisation des hommes d’âge mûr, d’abord par des conversations ne roulant que sur Dieu et la religion naturelle ; puis, selon les circonstances, en donnant à chacun ce qu’on espère lui faire accepter de vérité.
« 5° Tout en évangélisant les pauvres, ne pas négliger les riches. Notre-Seigneur ne les négligea pas ; saint Paul, son imitateur, non plus. Leur amélioration est un bien pour les pauvres eux-mêmes, à cause de leur influence. Leur sincérité est moins douteuse, et il y a moins à craindre qu’ils ne soient des « chrétiens de soupe », n’écoutant les vérités chrétiennes que par intérêt matériel.
« 6° Je bâtis trop : arrêter, ne pas augmenter mes bâtisses…
« 7° Les musulmans du Sahara reçoivent leur fausse religion uniquement par confiance en leurs ancêtres, en leurs marabouts, en ceux qui les entourent, uniquement par l’autorité de ceux-ci sur eux, et sans l’ombre d’un raisonnement, ni d’un contrôle… Nous devons donc tâcher de gagner davantage leur confiance, d’acquérir plus d’autorité que ceux qui les entourent et les endoctrinent. Pour cela il faut trois choses : 1° être très saint ; 2° beaucoup nous faire voir aux indigènes ; 3° beaucoup leur parler. La sainteté, qui est le principal, nous donnera tôt ou tard l’autorité, inspirera confiance. La vue fréquente fera que nous les retournerons à notre cause, et, si nous sommes saints, ce sera une prédication muette et un affermissement croissant de notre autorité.
« 8° Faut-il, pour amener à Dieu les musulmans, chercher à se faire estimer d’eux en excellant dans certaines choses qu’ils estiment : par exemple, en étant audacieux, bon cavalier, bon tireur, d’une libéralité un peu fastueuse, etc., ou bien en pratiquant l’Évangile dans son abjection et sa pauvreté, trottant à pied et sans bagage, travaillant des mains comme Jésus à Nazareth, vivant pauvrement comme un petit ouvrier ? Ce n’est pas des Chambâa que nous devons apprendre à vivre, mais de Jésus… Nous ne devons pas recevoir leurs leçons, mais leur en donner. Jésus nous a dit : « Suivez-moi. » Saint Paul nous a dit : « Soyez mes imitateurs comme je suis l’imitateur du Christ… » Jésus savait la meilleure manière de lui amener les âmes, saint Paul fut son incomparable disciple. Avons-nous espoir de faire mieux qu’eux ? Les musulmans ne s’y trompent pas. D’un prêtre bon cavalier, bon tireur, etc., ils disent : « C’est un excellent cavalier, nul ne tire comme lui » ; au besoin ils ajouteront : « Il serait digne d’être Chambi ! » Ils ne disent pas : « C’est un saint. » Qu’un missionnaire mène la vie de saint Antoine au désert, ils diront tous : c’est un saint. Avec la raison naturelle, ils donneront souvent leur amitié au premier, au Chambi ; s’ils donnent leur confiance pour ce qui regarde l’âme, ils ne la donneront qu’au second. »
La question qui fut ainsi traitée entre le Père Guérin et le Père de Foucauld est de grande importance ; elle est, en outre, pour la France et pour d’autres nations, la première des questions coloniales. Je dois donc m’y arrêter un peu, et dire, d’abord, qu’on ne la connaît guère, et que, d’habitude, on la résout légèrement.
Dans les salons, dans les réunions d’hommes, si l’on s’entretient d’une meilleure administration de nos possessions d’Afrique, on est certain d’entendre exprimer cette opinion : « Les musulmans sont inconvertissables » ou, comme on disait au début du dix-neuvième siècle : « Ils sont inassociables, inmiscibles. » Elle est devenue une maxime. Sans doute, elle chagrine, elle froisse plusieurs de ceux qui l’entendent, mais elle trouve parmi eux peu de contradicteurs. Hélas ! le monde immense qu’elle condamne et dont elle désespère est loin de nos yeux. Nous ne voyons pas assez nettement l’injustice dont nous sommes ainsi complices en nous taisant. Ceux dont les intérêts purement terrestres orientent presque toujours l’effort ne mesurent pas le danger que le développement même de notre puissance coloniale nous fait courir, si nous ne savons pas nous concilier les esprits et les cœurs. Ou bien, malgré tant d’avertissements, ils s’imaginent, – et c’est là une infirmité des intelligences dénommées « pratiques », – que la civilisation mécanique et économique a le pouvoir de changer le fond des âmes, et de transformer en amis fidèles des peuples que leur religion excite à nous mépriser et à nous maudire, et qui apprennent, sous la tente ou dans la maison de terre, à répéter le proverbe : « Baise la main que tu ne peux couper. »
Voyez cependant ce qu’il y a d’inhumain, de contraire à la charité, dans cette opinion si répandue ! Plusieurs centaines de millions d’hommes seraient donc dans l’impossibilité de connaître la vérité et de s’élever jusqu’à la civilisation véritable ? Le musulman serait à perpétuité un être inférieur ? Il y aurait, ici-bas, deux sortes d’âmes, des païennes, des bouddhistes, des juives qui peuvent apercevoir la beauté transcendante de la religion chrétienne, se convertir et fraterniser avec les peuples du Christ, puis les âmes musulmanes, incapables de comprendre ou incapables de cette part de volonté qui entre dans toute conversion ? Est-ce acceptable ? Une si grande injure peut-elle être faite aux hommes ?
N’est-elle pas faite d’abord à Dieu ? N’est-ce pas nier son pouvoir, sa grâce, sa parole formelle, puisqu’il a commandé de prêcher l’Évangile « à toute nation » ? La raison, et la révélation qui la dépasse et la contente, défendent de prononcer contre aucune race humaine, contre les sectateurs d’une fausse religion quelconque, un arrêt si cruel.
Voilà pour l’objection de principe. Je reviendrai tout à l’heure sur celle qu’on prétend tirer de l’expérience. Ce qui est hors de doute, c’est que les gouvernements successifs de la France, au siècle dernier et au nôtre, ont agi comme s’il était certain, a priori, que les musulmans ne peuvent devenir chrétiens.
Il y a quatre-vingt-onze ans que nous avons commencé de conquérir l’Algérie. Depuis lors, un domaine immense s’est ajouté à ces premiers rivages sur lesquels, en 1830, avaient débarqué les troupes françaises. Depuis lors également, bien des efforts ont été faits pour assimiler les indigènes. Notre empire africain a été doté de routes, de chemins de fer, de tramways, de bureaux de poste et de télégraphe ; on a répandu de nouvelles cultures ou de nouvelles méthodes agricoles, établi des hôpitaux et des dispensaires, bâti des écoles où tout est enseigné, excepté la religion chrétienne. Les indigènes sont-ils plus près de nous, par l’esprit, qu’au début de la conquête ? Usant, très volontiers, de plusieurs des biens que notre civilisation leur apporte, ont-ils accepté celle-ci et peut-on dire qu’ils se considèrent comme les fidèles sujets de la France, et à jamais ?
Il suffit de connaître un peu l’histoire des trente ou quarante dernières années, non pas même celle des régions nouvellement annexées, mais celle des trois départements anciens, Alger, Oran, Constantine, pour répondre : non. Il suffit de moins encore : de se promener pendant une heure au milieu de foules musulmanes, et de savoir lire dans les yeux. Sans doute, pendant la Grande Guerre, des milliers d’Arabes ou de Berbères, sujets de la France, sont venus combattre à côté de nos troupes métropolitaines, et beaucoup sont morts pour notre salut. Il y eut là une preuve de loyalisme qui ne sera jamais oubliée. Mais bien des tribus et des peuples, depuis que le monde est monde, firent la guerre pour soutenir des causes qui n’étaient point celles de leur cœur, mais plutôt celles de leur courage, de leur intérêt, de leur fierté. Il serait faux, et donc dangereux, de croire que, depuis 1914, les populations musulmanes de l’Afrique du Nord se sont assimilées à nous, ou simplement rapprochées de nous, et qu’il y a, entre elles et nous, intelligence, estime, amitié, seuls liens durables.
La faute en est aux hommes, bien différents, par l’origine et le talent, mais semblables par l’illusion ou le préjugé, qui ont conduit les affaires africaines pendant le dernier siècle et au début de celui-ci. Ils n’ont pas compris que notre civilisation est chrétienne essentiellement. Certains ont pu rejeter pour eux-mêmes toute religion : ils ne peuvent faire que toute notre histoire ne soit celle d’une nation façonnée par le catholicisme ; que notre sensibilité, nos habitudes, nos mœurs, notre charité, ne proclament pas la foi qui les a formées. S’ils ne reconnaissent pas, dans l’état présent, cette vérité, elle apparaît comme évidente aux musulmans, habitants de nos colonies, qui appellent indistinctement les Français du nom de chrétiens. Ce sont les musulmans qui ont ici raison contre des politiques à bien courte vue. Ils jugent qu’au fond, cette puissance antique, à laquelle la leur s’est heurtée plus d’une fois dans le passé, est demeurée la même. Nous sommes pour eux et nous serons les Roumis. La neutralité proclamée de l’État, les actes de persécution, les discours, même les faveurs imprudentes accordées à l’islamisme, ne les empêchent pas de voir que la vocation de la France n’a pas changé. Et d’ailleurs, si jamais, – ce dont il n’y a nulle apparence, – les Français devaient abjurer la foi catholique, nous n’aurions rien gagné auprès des musulmans de l’Afrique, et nous serions devenus plus sûrement encore et irrémédiablement un objet de mépris pour ces peuples religieux.
Une faute de cette sorte, ignorance ou négation des âmes, a des conséquences si nécessaires, qu’en cherchant à nous concilier les indigènes, nous avons souvent travaillé contre notre intérêt. Je n’en veux donner que deux preuves.
D’abord, nous nous sommes trompés en organisant l’école. Les témoignages abondent ; je ne retiens que l’un des plus récents. Dans son numéro du 11 décembre 1920, une revue française, la Renaissance, publiait sur la Politique musulmane un article d’un Africain. L’auteur dénonçait cette espèce de « fureur scolaire » qui a fait créer partout, en Algérie, pour les enfants des races primitives qui vivent là, des écoles où il semble que la principale affaire soit d’exalter « la liberté, les droits du citoyen, l’électorat, le tout considéré comme bien suprême ». Idéologie funeste en France, et qui l’est plus encore entre la mer et le désert. Quel résultat devions-nous attendre d’un enseignement si peu adapté ? Celui-ci même qu’il a donné : « L’expérience, d’une manière générale, a montré que, plus les indigènes avaient acquis de culture française, plus ils avaient tendance, en secret ou ouvertement, à nous haïr ; cette constatation, évidemment décevante, vient de l’avis unanime de ceux qui ont observé, sans parti pris, les résultats offerts. »
Des publicistes, témoins informés de l’erreur commise, et prévoyant le danger, ont proposé ce remède : que l’enseignement distribué aux indigènes fût désormais tout à fait rudimentaire. Cela n’est pas digne d’une nation comme la nôtre. On ne voit pas, d’ailleurs, comment les petits Arabes, demeurés ignorants ou à peu près, nous aimeraient d’autant mieux qu’ils auraient moins appris. Le mal dont on se plaint ne serait pas guéri. Il est dans le principe même de l’éducation donnée. Exaltant les droits de l’individu, et lui offrant, comme une vérité première, l’idée orgueilleuse et fausse d’égalité, il n’est pas étonnant qu’elle développe encore l’esprit d’insubordination de l’Arabe. Elle répand, chez les fils, le mépris du milieu et de la condition commune, et les pousse à en sortir pour occuper ce qu’on nomme « une bonne place ». Elle prépare ainsi un grand nombre de déclassés, qui seront demain des désabusés, après-demain des ennemis irréconciliables de l’autorité française[81]. Enfin, comme elle ne fournit au petit Arabe, pour toute nourriture morale, qu’un ensemble de préceptes sans obligation ni sanction, elle ne peut sérieusement le corriger d’aucun vice. Elle le laisse, muni d’une collection de proverbes, de recommandations d’hygiène et de fragments de discours électoraux, en présence de toutes les passions, de toutes les cupidités, de toutes les tentations de révolte qu’il a dans le sang, de par son âge, sa race et sa religion. S’il cède, et presque nécessairement il cédera, nous lui aurons fourni le moyen d’être socialement plus dangereux que ses pères, puisqu’il sera plus instruit.
L’autre erreur consiste à favoriser et à répandre l’islamisme. Que nous la commettions, et de propos délibéré, il est inutile d’en donner des exemples ; ils abondent, et le mufti hanéfite d’Alger pouvait raisonnablement dire à un de mes amis : « Notre culte est le seul qui soit reconnu par l’État français. » Or, l’histoire de quatorze siècles, l’expérience quotidienne de tous ceux qui habitent parmi des populations musulmanes, nous apprennent que l’animosité contre le chrétien est, en fait, développée par l’enseignement de la loi coranique. Un des hommes qui font autorité en ces questions, le Hollandais Snouck Hurgronje, disait naguère (1911), dans une de ses célèbres conférences à l’Académie des administrateurs pour les Indes néerlandaises : « D’après la lettre et l’esprit de la loi sacrée (des musulmans), c’est dans les mesures violentes qu’il faut chercher le moyen par excellence de propager la foi. Cette foi considère tous les non-croyants comme des ennemis d’Allah. Un petit groupe de mahométans se montre actuellement, il est vrai, partisan de l’adaptation de l’Islam aux conceptions modernes, mais ils représentent aussi peu la religion dont ils sont les adeptes par naissance, que les modernistes celle de l’Église catholique. On ne trouve pas de divergence, à ce sujet, entre les savants légistes des différentes écoles, aux époques successives. » Nous pouvons conclure de là que tout acte de la puissance publique qui tend à développer l’enseignement du Coran est fait contre nous-mêmes. C’est assez de ne point entreprendre sur la liberté religieuse des musulmans, de leur laisser leur culte et leurs coutumes, d’être parfaitement justes envers eux, et parfaitement bons[82] : en allant au delà, nous sommes faibles, et même un peu plus que faibles.
Lorsque ces vérités de sens commun auront été reconnues par ceux qui dirigent la politique musulmane de la France, que faudra-t-il faire ? Ni notre cœur, ni notre intérêt, ne nous conseillent de restreindre notre ambition à quelque alliance économique, inférieure et précaire, avec les peuples musulmans qui vivent dans le domaine de la France. Comme le dit bellement le Hollandais cité tout à l’heure, « il faut que l’annexion matérielle soit suivie de l’annexion spirituelle ». Or, c’est là un vœu qu’on peut former sans être catholique. Du jour où le musulman comprendra la beauté du catholicisme, il aura compris la France ; et dans la mesure où il admirera la charité chrétienne, il nous aimera.
Est-ce à dire qu’il faille chercher à convertir les musulmans, et à faire d’eux des chrétiens ? La formule serait ambiguë ; elle ne préciserait point de quelle manière lente, douce et fraternelle, une telle conversion, si Dieu le permet, doit s’accomplir. Mieux vaut dire ceci : il faut que la France, chargée d’une nombreuse famille coloniale, prenne enfin conscience de toute sa mission maternelle, et que les musulmans, comme les païens, sujets d’une grande nation catholique par son histoire, par son génie, par toute son âme et par ses épreuves mêmes, puissent connaître le catholicisme, et y venir, s’ils le veulent.
Du moins, ils le connaîtront, et d’abord par sa charité. C’est elle qui sera l’ambassadrice. Qu’on la laisse donc aller vers eux ; qu’elle ne soit pas entravée, soupçonnée, mais amicalement soutenue. Nous sommes, dans notre propre domaine, en présence d’un peuple immense, tout pétri d’erreurs, de colères entretenues depuis des siècles, de rancunes également dont plusieurs sont fondées. La première œuvre à faire est « d’apprivoiser les musulmans », selon l’expression chère au Père de Foucauld, et à son ami le général Laperrine, qui conduisit si souvent, dans le désert, des « tournées d’apprivoisement ». Les fonctionnaires, les officiers peuvent avoir là un rôle magnifique. Que par eux la justice de la France, c’est-à-dire la justice chrétienne ; la bonté de la France, c’est-à-dire la bonté chrétienne, apparaissent à ces hommes qui n’ont pas soif seulement de l’eau des puits. Mais que la charité ingénieuse et forte, celle qui connaît, depuis deux mille ans, toute douleur humaine, soit libre aussi de consoler, de soigner, de guérir, et de durer, comme dure le mal et comme dure la souffrance, en se renouvelant. Qu’elle puisse fonder ses salles d’asile et ses écoles, ses dispensaires et ses hôpitaux, ses orphelinats de jeunes gens et de jeunes filles, ses maisons de retraite pour les vieux qui sont rejetés de tous. Elle recevra la misère sans certificat de bonne vie et mœurs, sans exiger l’extrait du casier judiciaire, ni se préoccuper de la croyance de ses clients. Elle prêchera son Dieu silencieusement, si elle est assez magnifique pour qu’on ne puisse pas ne pas apercevoir en elle un rayonnement divin. Cela durera des années, peut-être beaucoup d’années. Elle a tout l’avenir devant elle ; la France aussi : on peut attendre. Sûrement, joignant ses efforts à ceux que j’ai dits déjà, elle nous obtiendra ce beau triomphe ; que les peuples musulmans, sans accepter encore la doctrine chrétienne, en auront du moins l’intelligence, l’estime et ça et là le désir secret. Et si, plus tard, des âmes musulmanes, persuadées ainsi qu’il n’y a rien dans l’Islam qui vaille la France charitable et religieuse, en venaient à dire : « Si le disciple est ainsi, que doit être le maître ? Apprenez-nous la loi qui vous fait le cœur si grand ? » quel bien pour l’État, quelle francisation de l’Afrique du Nord ! Ce serait un monde régénéré, une France prolongée, notre pouvoir reconnu, l’avenir assuré, et la plus haute gloire qu’une nation civilisée puisse vouloir et obtenir : la création à son image !
Ici, nous nous heurtons à l’objection banale : les musulmans, en fait, ne se convertissent pas ; il n’y en a, pour ainsi dire, point d’exemple. C’est une erreur moins grave que de prétendre qu’ils ne peuvent pas se convertir : c’en est une cependant.
Toute la vie d’apostolat du Père de Foucauld a été fondée sur la conviction qu’il est possible, au contraire, par la prière, l’exemple, une prédication qui tient compte de l’ancienneté de leur erreur et de la faiblesse d’une pauvre volonté humaine en lutte contre des siècles et contre un peuple entier, d’amener peu à peu les musulmans à la pleine grâce du Christ.
Il partageait l’espérance qui avait soutenu le cardinal Lavigerie ; celle, on peut l’affirmer, de l’Église, comme on le voit, par exemple, dans cette lettre du pape Léon IX, conférant à l’évêque de Carthage, au moment des plus dures persécutions par les Arabes, le titre de « premier archevêque après le pontife romain et le métropolitain majeur de toute l’Afrique », et déclarant que ce privilège durerait jusqu’à la fin des temps, « soit que Cartilage en ruines reste déserte, soit qu’un jour elle ressuscite, glorieuse »[83].
La difficulté n’est pas tant de persuader un musulman de la vérité de la religion chrétienne, que d’assurer la persévérance du converti. Les Arabes devenus chrétiens ne peuvent plus vivre où ils vivaient. Ils sont hors la loi. Tout est mis en œuvre pour leur faire abandonner la foi ; leur vie même est menacée, et la crainte de les voir apostasier, c’est-à-dire se charger d’un crime énorme, est la raison qui empêche souvent d’accueillir la demande des catéchumènes, et de les baptiser. Le temps de la préparation collective à recevoir la foi ne peut être court. Il faut changer l’esprit public avant d’achever les conversions individuelles. L’habitation dans les centres de population musulmane, le dévouement, la charité, l’école, la conversation sur les sommets accessibles à la raison, doivent préparer la prédication de la doctrine révélée. Les hommes qui ont le mieux aimé l’Afrique n’ont cessé de recommander cette méthode. Ils n’ont pas prétendu que le musulman fût inconvertissable.
Dans son diaire, après avoir résumé les conseils de Mgr Guérin, le Père de Foucauld cite des passages d’une vie de saint Pierre Claver, qui, à Carthagène des Indes, se dévouait à la conversion des Maures. Le livre raconte que le saint, par sa charité, vainquit beaucoup de ces âmes rudes et hostiles. « Dès que le Père Claver apprenait l’arrivée de quelque flotte chargée de Maures, il allait aussitôt les chercher, soit sur les vaisseaux, soit dans les rues, soit dans les maisons de la ville, il tâchait de lier peu à peu amitié avec eux, s’intéressait à leurs affaires, leur demandait s’ils avaient besoin de quelque chose. En même temps, il leur faisait entendre qu’ils pouvaient disposer de lui, et qu’il était prêt à les secourir, en tout ce qui dépendrait de ses soins. Enfin, il faisait si bien, par sa persévérance et par ses services, qu’il les gagnait insensiblement à Jésus-Christ. »
L’histoire des missions franciscaines, celle des trinitaires, celle de saint Vincent de Paul captif des pirates barbaresques, offriraient, sans aucun doute, des exemples semblables. On citerait aisément des musulmans convertis par une sorte de miracle de la grâce, ou par la méditation des dogmes chrétiens, ou par l’étude de la mystique, ou par l’admiration pour la supériorité morale de personnes chrétiennes. Il y a eu des conversions de familles musulmanes entières (familles des émirs Chéhab et Bellama, en Syrie, à la fin du dix-huitième siècle). Il y a eu des conversions en masse de colons musulmans, – souvent berbères, – en diverses provinces d’Espagne, conversion des Maragatos, des environs de Léon et d’Astorga, aux dixième et onzième siècles ; des agriculteurs de Majorque au treizième ; de ceux de Jaen au quatorzième, grâce aux prédications et aux exemples de saint Pierre Pascal ; et de même en Italie, en Crète ; de nos jours, une société russe orthodoxe s’est vouée à la conversion des musulmans de Kazan, et y réussit, par une méthode qui se rapproche de celle du Père de Foucauld. Mais n’avons-nous pas, tout près de nous, le spectacle des chrétientés kabyles groupées autour des postes des Pères Blancs ? Débuts sans doute, minces chrétientés disséminées en onze points, souvent éloignés, de ce pays de montagnes, composées chacune de trente, quarante, cinquante familles, mais preuve vivante qu’il est possible d’amener des musulmans au catholicisme. J’ai visité, en haute Kabylie, un de ces postes de missionnaires, celui des Beni-Mengallet. J’ai assisté à la grand’messe, au milieu d’une assemblée de quatre-vingts fidèles. Les hommes et les petits garçons, – une soixantaine, – occupant la partie haute, les femmes et les petites filles la partie basse de la chapelle. Je regardais ces jeunes cultivateurs berbères, blancs de visage, portant la moustache, solides, graves, attentifs, et je les trouvais assez pareils, sauf par le costume, à nos paysans de France. Après la messe, j’ai causé avec eux, car ils savent le français. Dans les yeux de la plupart, j’ai lu cette bienvenue, cette confiance préparée de loin, à quoi on ne se trompe pas. L’œuvre date d’une trentaine d’années. Là ou ailleurs, elle n’a guère été favorisée par les autorités qui représentent la France en Algérie ; elle a été contrariée souvent par la politique générale de notre pays ; pour des causes diverses, les gouverneurs généraux n’ont pas compris, ou n’ont pas paru comprendre que la paix africaine sera la suite certaine et la récompense de la conversion de l’Afrique, et que tous les autres moyens, la force et la faiblesse, la répression, la flatterie, l’abondance des richesses et des inventions, ne rapprocheront pas de nous un peuple qui ne voit en nous que des païens, et nous nomme de ce nom. Il faut qu’il aperçoive la plus grande supériorité, l’essentielle : la religieuse. C’est à des cœurs gagnés par la sainteté, qu’il sera possible un jour d’expliquer la doctrine.
On a vu que saint Pierre Claver n’avait pas agi autrement. Le fondateur des Pères Blancs, le cardinal Lavigerie, s’est expliqué là-dessus dans des documents connus, datés du 24 septembre 1871, du 3 avril et du 6 juillet 1873, du 15 décembre 1880. Il n’avait aucune illusion sur la durée de cette période première, toute de sacrifices, où les meilleurs ouvriers périraient et seraient remplacés par d’autres qui mourraient à leur tour, sans que les seconds plus que les premiers eussent goûté la joie, qui vient chaque année aux ouvriers de la terre, de voir jaunir les épis. Dans une conférence de retraite, il disait à ses missionnaires : « Avant de commencer parmi eux (les musulmans) la prédication de l’Évangile, il faut préparer la conversion en masse. Cette préparation durera peut-être un siècle. Je suis évêque ; j’ai une crosse et une mitre : eh bien ! j’aurai beau mettre ma mitre au bout de ma crosse, et élever le bras aussi haut que possible, je disparaîtrai avec vous dans les fondations de la nouvelle église d’Afrique. »
Qu’on remonte à l’Évangile : le Sauveur n’a pas usé d’une autre méthode. Lui aussi, il s’adressait à une race difficile et bien éloignée de reconnaître le Messie dans l’homme qui allait être et qui était déjà l’Homme de douleurs. Il ne commence point par exposer le dogme ; il ne découvre sa divinité que par degrés ; ayant un si magnifique message à transmettre, il ne le fait pas sans délai. Il craint d’effaroucher et de rejeter ses amis les Israélites. Mais il prêche d’abord ce qui peut le mieux attendrir les âmes, les élever, les épanouir et attirer : la charité, l’humilité, la fraternité, le pardon des injures, le mépris de la richesse. Le sermon sur la montagne rassemble ces traits de la première prédication du Christ. Et c’est le sermon sur la montagne que le Père de Foucauld a toute sa vie répété aux musulmans[84].
Si nous ne changeons pas nos méthodes présentes de colonisation, ce même témoin, très français et très sûr, n’hésitait pas à prédire qu’avant cinquante ans nous serions chassés de l’Afrique du Nord[85].
« 21 juin 1903. – J’ai reçu, il y a quelques jours, du commandant Laperrine d’Hautpoul, commandant supérieur des oasis sahariennes, une lettre contenant le passage suivant : « Lors du massacre de la mission Flatters, une femme touarègue, de famille noble, a eu une très belle attitude, s’opposant à ce qu’on achève les blessés, les recueillant et les soignant chez elle, refusant l’entrée de sa maison à Attisi, qui, revenu blessé du combat d’Amguid contre Dianoux, voulait les achever lui-même, et, après guérison, les faisant rapatrier à Tripoli. Elle a maintenant quarante à quarante-trois ans, passe pour avoir beaucoup d’influence, et est renommée pour sa charité. »
« Cette âme, continue le Père de Foucauld, n’est-elle pas prête pour l’Évangile ? N’y aurait-il pas lieu de lui écrire, pour lui dire que la charité qu’elle pratique souvent, et celle avec laquelle elle a recueilli, soigné, défendu, rapatrié les blessés de la mission française, il y a vingt-deux ans, sont connues de nous et nous remplissent de joie et de reconnaissance envers Dieu ?… Dieu a dit : « Le premier commandement de la religion est d’aimer Dieu de tout son cœur. Le second est d’aimer tous les humains sans exception, comme soi-même. » Admirant et rendant grâces à Dieu de vous voir si bien pratiquer la charité envers les hommes, nous vous écrivons cette lettre, pour vous dire que, chez les chrétiens, où des centaines de milliers d’âmes, hommes et femmes, renonçant au mariage et aux biens terrestres, consacrent leur vie à prier, méditer la parole de Dieu et pratiquer la bienfaisance, tous les religieux et religieuses qui entendront parler de vous béniront et loueront Dieu de vos vertus, et le prieront de vous combler de grâces en ce monde et de gloire dans le ciel… Nous vous écrivons aussi pour vous demander très instamment de prier pour nous, certain que Dieu, qui a mis dans votre cœur la volonté de l’aimer et de le servir, écoute les prières que vous lui adressez. Nous vous supplions de prier pour nous et pour tous les hommes, afin que tous nous l’aimions et lui obéissions de toute notre âme. À lui, gloire, bénédiction, honneur et louange, maintenant et toujours. Amen. »
« Je vais envoyer copie de ce projet de lettre à Mgr Guérin, en lui demandant s’il veut écrire lui-même, ou s’il veut que j’écrive et en lui offrant – si les relations se nouent, si je reste seul – d’aller faire une visite pédestrement à cette dame. »
L’homme du monde et le chrétien, la courtoisie et la charité ont ensemble rédigé cette lettre à une « dame » de la Croix-Rouge touarègue.
L’idée même était venue à Frère Charles de demander au pape d’écrire lui-même à cette charitable nomade. Et pourquoi pas ? On ne dut point oser.
Nous voyons ici, pour la première fois, se manifester le vœu, encore secret, que formait l’ermite, de pénétrer jusqu’aux régions habitées par les Touaregs, et de gagner à la civilisation chrétienne, puis à la religion chrétienne ce peuple de race berbère qu’on disait fier, intelligent et beaucoup moins fanatique que l’Arabe. Charles de Foucauld avait sûrement entendu parler des Touaregs par Duveyrier, à Paris, à l’époque où il rédigeait les notes de la Reconnaissance au Maroc ; il vivait parmi les officiers d’Afrique, les gens de l’oasis, les caravaniers, colporteurs de l’histoire et de la légende des tribus ; enfin, récemment, il s’était entretenu avec le commandant Laperrine, que hantait le rêve militaire et poétique du grand royaume franc, d’une Afrique renouvelée par le génie de la France, et ils avaient parlé du Hoggar autant que du Tidikelt et de Tombouctou. Partout où l’officier avait souhaité que la France s’établît, civilisatrice dans la paix durable, – que ces causeries, dont rien ne demeure, devaient être belles ! – Frère Charles s’était promis de porter la prière et la charité de la nation missionnaire. Laperrine l’avait persuadé, le diaire en porte ce témoignage :
« Fête de sainte Marie-Madeleine. – Voyant que, par suite des persécutions religieuses, le révérend Père préfet apostolique ne peut envoyer aucun prêtre chez les Touaregs, ni au Tidikelt, Touat, Gourara, ni dans la Saoura, Zousfana, j’ai, le 24 juin, écrit à Mgr Guérin, pour lui demander la permission d’aller – en attendant qu’il puisse y envoyer des prêtres – m’installer chez les Touaregs, aussi au cœur du pays que possible ; j’y prierai, j’y étudierai la langue et traduirai le saint Évangile ; je m’y mettrai en relations avec les Touaregs ; j’y vivrai sans clôture. Tous les ans je remonterai vers le nord me confesser[86]. Chemin faisant, j’administrerai les sacrements dans tous les postes, et je causerai du bon Dieu, sur mon passage, avec les indigènes. Je réserve l’autorisation de M. Huvelin… »
« 29 juin. – J’écris au commandant Laperrine, lui communiquant ce projet, et lui demandant de m’autoriser à l’exécuter. »
« 13 juillet. – Reçu lettre de M. Huvelin, autorisant. »
« 22 juillet. – Lettre du commandant Laperrine, autorisant. »
« 1er août. – Lettre de Mgr Guérin, demandant du temps pour réfléchir. »
Frère Charles, ermite et missionnaire, à la disposition de la Providence, attend que la permission lui soit donnée d’entreprendre. Dans la réponse de ses supérieurs, il verra l’ordre divin. On peut reconnaître en lui un homme fort avant pénétré de cette doctrine du Père de Caussade, qui écrivait, au dix-septième siècle, dans une œuvre célèbre : « Le moment présent est toujours comme un ambassadeur, qui déclare l’ordre de Dieu.
Toute notre science consiste à connaître cet ordre du moment présent. » Assurément, l’imagination ardente d’un Charles de Foucauld rêve, demande, prépare de grands desseins ; mais, attentif à chaque plainte, et aussi à chaque nouvelle par où s’exprime le monde où il vit, il est toujours prêt à répondre et à se considérer comme en service commandé. L’été de 1903 lui offre, soudainement, l’occasion de porter les secours de la religion à des Français en péril de mort. Il est le seul prêtre dans ces régions immenses ; nos postes n’ont pas d’aumônier ; les âmes ont été négligées, bien qu’on attende d’elles la plus haute vertu d’obéissance et de sacrifice. Il n’a pas un instant d’hésitation : il part ; il remplit un des grands offices pour lesquels il s’est avancé dans le Sahara. Voici les faits.
Les attaques de convois ou de postes se multipliaient ; l’agitation pouvait, d’un moment à l’autre, tourner à la révolte. Les tribus soumises le sont nouvellement : un grave échec les détacherait de nous. Les forces militaires françaises, disséminées en petits paquets sur de si vastes espaces, ne vont-elles pas, ici ou là, être surprises, enveloppées, contraintes de se rendre : occasion attendue, signal qui mettrait debout, pour nous jeter dehors, tous les cavaliers et tous les piétons du Sahara ?
Le 16 juillet, un rezzou de 200 Berâbers, montés sur des méharis, attaquait, à trois heures du matin, un détachement de 50 tirailleurs algériens de la compagnie d’Adrar, qui perdait 22 hommes, et, commandé par un sous-officier, battait en retraite, sans cesser de se défendre. La riposte fut prompte. Neuf jours après, le capitaine Regnault, chef du bureau arabe de Beni-Abbès, parti aussitôt la nouvelle reçue, avec 45 hommes de son makhzen et 40 méharistes de la compagnie de Timimoun, relevait les traces fraîches du rezzou dans les dunes de Tabelbala, au sud-ouest de Beni-Abbès, surprenait les Berâbers auprès du puits de Bou-Kheïla, leur tuait 30 combattants, et mettait les autres en fuite.
Bientôt, des entreprises d’une plus grande importance allaient être tentées contre nous et contre les tribus ralliées. On le savait. Les renseignements affluaient de toutes parts. On ignorait seulement quel serait le premier attaqué de nos postes de la Zousfana ou de la Saoura. Serait-ce Beni-Ounif ? Taghit ? Beni-Abbès ? Frère Charles est informé de ces rumeurs qui courent le désert. Le prêtre et l’ancien officier, tout lui-même s’émeut et demande à servir. Il devine, il calcule que le poste de Taghit est plus menacé que les autres : une compagnie de tirailleurs, une compagnie du bataillon d’Afrique, une soixantaine de cavaliers du makhzen, c’est une bien faible garnison ; en outre, le poste est dominé de plusieurs côtés. Il y aura des morts et des blessés ; il y aura du danger. Sûrement le devoir est là. Frère Charles écrit, le 12 août, au capitaine de Susbielle, commandant le bureau arabe de Taghit, lui demandant : « Pouvez-vous m’envoyer chercher ? On ne veut pas me laisser partir seul, parce que les routes ne sont pas sûres. » Il est prêt, il s’attend à quitter Beni-Abbès d’un moment à l’autre, et, par précaution, retire le Saint-Sacrement du tabernacle de sa petite chapelle. Tout à coup, les nouvelles cessent d’arriver. Pendant six jours, aucun courrier ne parvient à Beni-Abbès.
La grande nuée d’orage est en marche. Une harka, une colonne d’expédition composée de 9 000 personnes, hommes, femmes, enfants, de toutes les fractions des Berâbers, de tous les districts de la région marocaine du Tafilelt, va tomber sur la Zousfana. Elle est commandée par un de nos ennemis les plus décidés, Mouley Mostapha, chérif de Matrara. Elle compte près de 6 000 combattants, dont 500 méharistes ; la plupart sont armés de fusils se chargeant par la culasse ; 600 chameaux de bât portent les vivres.
Le capitaine de Susbielle fait mettre en état de défense le village de Taghit, où se réfugient nos protégés de quelques tribus soumises. À une armée d’ennemis, il ne peut opposer que 470 hommes et deux canons de 80 de montagne. Le 17 au matin, la harka étant signalée, le lieutenant de Ganay sort le premier, à la tête d’un détachement de cavaliers du makhzen, et va reconnaître l’énorme rassemblement, qu’il force à se déployer. Les obus mettent le désordre dans les masses marocaines, qui se retirent à l’abri dans les dunes et dans la palmeraie, à trois kilomètres de Taghit. Mais, le lendemain, la bataille recommence. Le 18, le 19, le 20 août, des assauts furieux sont livrés. Taghit se défend victorieusement ; sa petite garnison fait des prodiges, et, merveille qui donnerait du cœur au moins brave, elle est secourue. Une fois de plus, l’esprit de décision des jeunes officiers sahariens se montre, et sauve l’honneur et la vie engagés. Le 18, à la première heure du jour, le lieutenant Pointurier arrive d’El-Morra, avec sa compagnie montée de la légion étrangère, qui a parcouru 62 kilomètres dans la nuit ; le 20, c’est le lieutenant de Lachaux, qui accourt au canon, et, sous le feu, entre au galop avec ses 40 cavaliers de Beni-Abbès, partis d’Igli la veille au soir.
La harka, décimée, lève le camp dès le 21. Elle a 1 200 hommes hors de combat. Elle regagne le nord-ouest, emportant les armes et les vêtements de ses morts, au lieu du butin qu’elle s’était promis. Le succès de nos armes était magnifique. « C’est le plus beau fait d’armes de l’Algérie depuis quarante ans ! » dit Frère Charles, dans une lettre à la marquise de Foucauld.
Il se réjouit de la victoire, mais le regret le tourmente de n’avoir pas été là. Parmi les défenseurs de Taghit, 9 sont morts, 21 sont blessés. Et lui, l’aumônier du Sahara, il n’a pu consoler, absoudre, bénir ! Une conscience moins délicate et moins humble ne se serait point inquiétée. N’avait-il pas demandé à partir, parlé aux officiers d’ici, écrit à ceux de là-bas ? Sans doute, mais il n’est pas en repos. Il faut pouvoir se passer d’escorte.
« Des enseignements doivent être tirés par moi des difficultés que j’ai eues à remplir mon devoir », note-t-il dans son journal. Et aussitôt il prend des résolutions. Désormais, il veut « s’habituer à la marche par le travail manuel », afin de n’avoir pas besoin de monture : il entend n’être que le plus pauvre des voyageurs ; il ira à pied, sans serviteur, et, puisqu’il faut un guide, il est sûr d’en trouver quelqu’un, même aux heures de péril, en redoublant de bonté envers tout le monde.
Le danger s’était seulement écarté, en effet ; il n’était pas fini. Les marabouts continuaient de prêcher la guerre sainte, et les tribus soulevées parcouraient le désert de sable et le désert de pierre. Le 2 septembre, à 32 kilomètres au nord de Taghit, et à l’heure de la grande halte, c’est-à-dire vers 9 heures du matin, un peloton de la compagnie montée du 2e étranger, escortant un convoi, fut brusquement attaqué à hauteur d’El-Moungar, par une bande de plusieurs centaines de pillards. Ceux-ci, Oulad Djerir, anciens partisans de Bou Amama, après s’être détachés de la harka victorieusement repoussée de Taghit le 20 août, s’étaient embusqués dans la dune, attendant l’occasion de prendre leur revanche. Ils attaquaient le convoi sur un plateau entre l’oued Zousfana et les grands sables. Les premières décharges des bandits jettent à terre, tués ou blessés, les deux officiers de la compagnie montée, tous les sous-officiers et un grand nombre de soldats. Les survivants se groupent sur un ressaut de terrain, et, sous l’accablante chaleur qui grandit de minute en minute, décident de combattre jusqu’à la mort. Deux spahis, d’un demi-peloton qui complétait l’escorte, peuvent se frayer passage à travers les ennemis, et, au galop de leurs chevaux, courent donner l’alarme à la garnison de Taghit. Une demi-heure après qu’on l’a prévenu, le capitaine de Susbielle sort du poste, emmenant tout son makhzen et des spahis, et se porte, à toute allure, en plein après-midi, au secours de nos soldats encerclés. Il arrive à 5 heures sur le théâtre du combat. Dès qu’ils aperçoivent la poussière que font les cavaliers lancés contre eux, les pillards se débandent et se réfugient dans la dune. Il était temps de secourir les assiégés, réduits à une poignée d’hommes épuisés par la soif. Ils sont là une trentaine, commandés par un blessé, le sergent-fourrier Tisserant, qui a été frappé de deux balles ; ils continuent de tirer sur les Marocains disséminés autour d’eux, cachés derrière les moindres accidents de terrain, et de protéger ainsi, outre leur propre vie, quarante-neuf blessés étendus autour d’eux. Un détachement est envoyé au loin pour apporter de l’eau. Tisserant, la tête en sang, mais resté debout, veut remplir tout son office de fourrier. Il va de l’un à l’autre blessé, établit la liste, ramasse les cartouches et les armes tombées à terre, et, avant de quitter le lieu du combat, fait lui-même à haute voix l’appel des morts. Dans la nuit, les quarante-neuf blessés sont transportés à Taghit.
Trois jours après, à 7 heures du matin, la nouvelle du combat parvient à Beni-Abbès. Frère Charles court au bureau des affaires indigènes ; il renouvelle sa demande. Cette fois, elle est accueillie. L’aumônier du Sahara peut se rendre auprès des blessés. On lui donne un burnous, des éperons ; un des mokhazenis lui prête un cheval. À la dernière minute, un des assistants essaye de s’opposer à une aventure qu’il estime insensée :
– Comment peut-on permettre au Père de partir sans escorte ? Il sera tué en route !
– Je passerai, dit le Père simplement.
– Il passera, en effet, laissez-le aller, réplique le capitaine du bureau arabe, qui survient à ce moment ; il ne peut pas vous dire cela, mais lui, il peut traverser sans arme tout le pays soulevé ; personne ne portera la main sur lui : il est sacré.
À 10 heures, Frère Charles est en selle et part avec le courrier. En chemin, il rencontre deux cavaliers lui apportant une lettre du capitaine de Susbielle, qui lui demande de venir immédiatement auprès des blessés. On voyage tout le jour et toute la nuit ; on fait, aussi vite que possible, les 120 kilomètres qui séparent Beni-Abbès de Taghit, où on arrive vers 9 heures du matin.
À peine descendu de cheval, et sans aucun souci de la fatigue d’une pareille chevauchée, le Père de Foucauld dit d’abord la messe. Puis il demande qu’on le conduise auprès des blessés réunis dans deux chambres de la redoute, et il commence auprès d’eux sa mission d’ami et de prêtre. Il reste des témoins de cet apostolat du Père de Foucauld auprès des blessés de Taghit, et ces témoins m’ont parlé. Pendant les vingt-cinq jours qu’il passa dans la redoute, le Père de Foucauld, auquel on avait donné la chambre d’un des officiers, ne coucha pas une seule nuit dans le lit qui lui était destiné. Tout son temps, sauf les quelques heures données au sommeil, – et encore pas toutes les nuits, – sauf le temps de sa messe et des repas très rapides, le Père le consacra aux blessés. Il causait avec chacun d’eux, leur parlait de leur pays, de leur famille, écrivait leurs lettres. Quand il entrait dans une des chambres de l’ambulance, tous les blessés l’appelaient avec un ensemble parfait : « Bonjour, mon Père », et chacun voulait être le premier à recevoir la visite de l’ami de tous. Ils avaient reconnu l’homme qui aime le soldat et le comprend. Certes, ces légionnaires, pour la plupart, n’avaient pas l’habitude de converser avec un curé ; la piété n’était pas le trait dominant de leur caractère ; mais la douceur, la manière affable et enjouée, le dévouement de ce curé-là, qui leur consacrait tous ses instants, les avaient conquis l’un après l’autre et rapidement. La présence de ce religieux leur était devenue indispensable. Un officier du poste, que j’ai interrogé, m’a dit : « Il est hors de doute que l’influence qu’il exerça sur leur moral fut pour beaucoup dans ce fait singulier : un seul de ces quarante-neuf blessés, dont plusieurs avaient été grièvement atteints, et de plusieurs blessures, succomba. Je me souviens d’un certain légionnaire, d’origine allemande, que nous considérions comme un sujet peu recommandable. Il avait eu à El-Moungar la poitrine traversée par une balle. Le Père de Foucauld s’occupa de lui comme du plus gravement blessé et du moins sympathique, c’est-à-dire particulièrement. Reçu d’abord plus que fraîchement, il finit, par sa patience et sa douceur, par se concilier ce pauvre homme, au point que celui-ci le réclamait à chaque instant, et lui racontait l’histoire intime, – pas toujours belle, – d’un vieux soldat d’Afrique. Je crois pouvoir affirmer que les quarante-neuf blessés, chacun en son temps, reçurent la communion des mains du Père de Foucauld. »
Une seule fois, Frère Charles les quitta. Ce fut le 18 septembre. Ce jour-là, accompagné de quelques officiers et sous-officiers, et de deux pelotons du mahkzen, il se rendit sur le lieu du combat d’El-Moungar, et bénit la tombe des deux officiers, et la fosse où les autres victimes avaient été ensevelies.
Il reprenait le chemin de Beni-Abbès le 30 septembre. Dans les mois qui suivirent, il retourna encore rendre visite à ses convalescents de Taghit. Puis, vers la fin de l’année, il se mit en retraite. Les retraites du Père de Foucauld, on l’a déjà vu, étaient pour lui l’occasion du plus minutieux examen de conscience, et des résolutions les plus nettes. Il écrivit cette fois à son directeur, l’abbé Huvelin : « Les trois principales choses dont j’ai à demander pardon à Jésus, pour l’an 1903, sont : sensualité, manque de charité envers le prochain, tiédeur envers le bon Dieu. » Or, il ne mangeait jamais à sa faim, faisait oraison jour et nuit, et ne repoussait aucun de ceux qui l’importunaient. Mais les parfaits, pour l’avancement, ont besoin de l’humilité.
Une question fort grave occupait son esprit, et, sans doute, dans cette retraite de la fin de 1903, il l’avait étudiée jusqu’au fond, mettant en regard les unes des autres et par écrit, selon la méthode de saint Ignace, les raisons pour et les raisons contre.
On se souvient que Frère Charles avait demandé à M. Huvelin, au commandant Laperrine, à Mgr Guérin, chacun ayant un titre particulier à être interrogé, la permission d’aller en reconnaissance dans le Touat et le Tidikelt, de s’établir, éventuellement, parmi les Touaregs, ou ailleurs, sans abandonner tout à fait Beni-Abbès où il reviendrait et ferait des séjours. L’ermite aurait plusieurs hôtelleries dans le désert. La dernière autorisation lui était parvenue le 29 août. Quelques jours plus tôt, il avait reçu une lettre du commandant Laperrine, le pressant de se mettre en route, et ajoutant : « Je crois qu’il y a beaucoup de bien à faire, car si l’on ne peut espérer des conversions tout d’un coup, faire accepter le dogme, on peut, par l’exemple et le contact journalier, mettre en évidence la morale chrétienne, et la répandre. »
Les combats de Taghit et d’El-Moungar ne permirent pas à Frère Charles d’exécuter le projet. Il dut se lancer sur une piste qui n’était pas celle du pays Hoggar. Mais à la fin de l’année, au moment où il sortait de retraite, la rébellion paraissant calmée, il se demanda de nouveau : où est le devoir ? Contrairement à ce que nous serions tentés de croire, l’idée de s’enfoncer plus avant dans le désert ne lui plaisait pas, ou, plus justement, si le voyage, l’aventure, la conquête des âmes, la haute ambition surtout de porter Jésus-Christ parmi les peuplades nouvelles tentaient l’imagination et le grand cœur de l’apôtre, le regret de quitter Beni-Abbès le tirait en arrière. Qu’allaient dire ces gens qui l’aimaient, indigènes ou soldats ? Et que deviendrait l’œuvre commencée ? Il écrit à l’abbé Huvelin :
« J’ai une grosse incertitude, au sujet du voyage que j’avais projeté dans le sud, dans ces oasis du Touat, Tidikelt, qui sont absolument sans prêtre, où nos soldats n’ont jamais la messe, où les musulmans ne voient jamais un ministre de Jésus… Vous vous rappelez qu’ayant reçu les trois autorisations de vous, de Mgr Guérin, des autorités militaires, j’allais partir en septembre lorsque j’ai été appelé à Taghit auprès des blessés… Maintenant que le calme semble rétabli, faut-il donner suite à mon projet ? Voilà un gros point d’interrogation pour moi. Je sais d’avance que Mgr Guérin me laisse libre, c’est donc à vous que je demande conseil.
« Si Mgr Guérin pouvait et voulait y envoyer un autre prêtre, certainement je n’irais pas : mon devoir bien clair serait de rester à Beni-Abbès. Mais je crois qu’il ne veut y envoyer personne, je crois même qu’il ne peut y envoyer personne.
« Dans ces conditions, ne dois-je pas partir, fonder un pied-à-terre, si je puis dire, dans l’Extrême-Sud, qui me permette d’aller chaque année y passer deux ou trois ou quatre mois, et profiter de ce voyage pour administrer ou au moins pour offrir les sacrements dans les garnisons, et faire voir la Croix et le Sacré-Cœur aux musulmans, en leur parlant un peu de notre sainte religion ?…
« Cela m’est, en ce moment, on ne peut plus facile. On m’invite, on m’attend. La nature y répugne à l’excès. Je frissonne, – j’en ai honte, – à la pensée de quitter Beni-Abbès, le calme au pied de l’autel, et de me jeter dans les voyages, pour lesquels j’ai maintenant une horreur excessive. Si je ne croyais pas, de toutes mes forces, que les mots comme doux, pénible, joie, sacrifice, doivent être supprimés de notre dictionnaire, je dirais que je suis un peu triste de m’absenter de Beni-Abbès.
« La raison montre aussi bien des inconvénients : laisser vide le tabernacle de Beni-Abbès, m’éloigner d’ici où peut-être (c’est peu probable cependant), il y aura des combats ; me dissiper dans ces voyages, qui ne sont pas bons pour l’âme ; ne glorifié-je pas plus Dieu en l’adorant solitaire ?
« Malgré ce que la raison oppose, et la nature, je me sens extrêmement et de plus en plus poussé intérieurement à ce voyage.
« Un convoi part pour le Sud le 10 janvier ; faut-il le prendre ? Faut-il en attendre un autre ? Il n’y en aura peut-être pas avant plusieurs mois, et j’ai des raisons de craindre de n’avoir pas alors les mêmes facilités que maintenant.
« Faut-il ne pas partir du tout ?
« Mon sentiment bien net, est que je dois partir le 10 janvier.
« Je vous supplie de m’écrire une ligne à ce sujet. Je vous obéirai.
« Si je ne reçois rien de vous pour le 10 janvier, je partirai probablement. »
Le 10 janvier passa. La réponse de M. Huvelin ne vint pas. Le 13, un convoi devait partir pour le Touat et le Tidikelt. Frère Charles, ayant considéré qu’il avait, lui, la possibilité de visiter ces régions, et que « peut-être aucun prêtre ne l’aurait d’ici plusieurs années », se décide à entreprendre le voyage qui lui coûtait si fort. Il écrit, à la date du 13 janvier 1904 : « Je retire, ce matin, la sainte réserve du tabernacle, et je pars, à 8 heures, pour Adrar, capitale du Touat. » Il commençait ainsi une nouvelle phase de sa destinée. Il allait vers ces inconnus, les Touaregs de l’Ahaggar, qui auraient la plus large part de son amitié et de son apostolat, et chez lesquels serait consommé, un jour, son sacrifice. N’avait-il pas écrit à son supérieur le Père Guérin : « Vous demandez si je suis prêt à aller ailleurs qu’à Beni-Abbès pour l’extension du saint Évangile ? je suis prêt, pour cela, à aller au bout du monde et à vivre jusqu’au jugement dernier. » N’avait-il pas coutume de dire : « La crainte est le signe du devoir » ?
CHAPITRE IX – LES TOURNÉES D’APPRIVOISEMENT
On se mit donc en route le 13 janvier 1904, au matin. Frère Charles s’était joint à un gros convoi, escorté par cinquante soldats, que commandait le lieutenant Yvart, du 2e chasseurs d’Afrique. Il partait, selon la jolie formule d’une de ses lettres, avec le catéchumène Paul, « une ânesse portant la chapelle et les provisions, l’ânon qui ne portait rien, des sandales neuves, et deux paires d’espadrilles ».
Son ami, le capitaine Regnault, craignant pour lui la fatigue d’un tel voyage, celle surtout de la première étape, avait donné l’ordre à deux mokhazenis d’accompagner un peu de temps le convoi, et leur avait confié un cheval de main, sur lequel Frère Charles aurait pu monter, en cas de besoin. Mais ils revinrent bientôt, racontant que le marabout avait persévéré dans son idée, et soutenu la marche comme un jeune homme, derrière l’ânesse et l’ânon.
Nous avons, sur l’itinéraire suivi par la colonne, les indications précises du diaire. La première agglomération humaine, de quelque importance, vers laquelle on se dirigeait, était Adrar, capitale du Touat. Mais, en chemin, sur le carnet, Frère Charles note tous les points où l’on fait halte pour la nuit, les petits ksours qu’il a visités, les campements, les puits, les palmiers même rencontrés, et la distance parcourue. Partout où il le peut faire, il entre en relations avec les indigènes, distribue quelques remèdes, des aumônes, et regrette de n’avoir pas de graines de légumes à donner à ces très pauvres gens. Il cause avec eux. Il est bien accueilli. Les soldats se confient à lui. Chaque matin, sous la tente, la messe a pu être célébrée. Il se réjouit du bien qu’il a pu faire, inégalement sans doute, à ses paroissiens errants, aux chrétiens et aux autres.
Après dix-huit jours de route, le 1er février, le convoi entre à Adrar. « J’y trouve, écrit le Père de Foucauld, le commandant Laperrine, qui me donne, chez lui, une pièce que je transforme en chapelle. Le commandant m’apprend que, des six grandes fractions qui forment le peuple touareg, Azdjers, vers Rât ; Kel-Oui (Ahir) ; Hoggar (Djebel Ahaggar) ; Taïtoq (Ahnet) ; Iforas (Adrar de l’est) ; Illemeden (bords du Niger), trois ont fait leur soumission entre ses mains, cette année, c’est-à-dire depuis douze mois : les Iforas, les Taïtoq et les Hoggar. Le chef de ces derniers, la plus importante, la plus guerrière des six fractions, celle qui a massacré le colonel Flatters et s’est montrée, jusqu’à ce jour, la plus ennemie des chrétiens, est en ce moment même à In-Salah, où il vient d’arriver avec quatre-vingts notables Hoggar, pour faire sa soumission, et présenter celle de sa tribu. Ces nouvelles sont très graves, car elles montrent tout le pays touareg, si fermé jusqu’ici aux chrétiens, ouvert à partir d’aujourd’hui. Le commandant Laperrine est disposé à faciliter de toutes ses forces mon entrée, mes voyages, mon établissement. Il m’offre de lui-même de l’accompagner dans la très importante tournée qu’il compte faire parmi ses nouveaux sujets de l’Ahnet, de l’Adrar et du Hoggar. Je crois qu’il n’accordera pas ces facilités à d’autre prêtre que moi ; j’accepte donc, en remerciant Dieu du bien qu’il me donne à faire, et en le suppliant de me rendre fidèle. Peut-être, dans sa prochaine tournée, qui commencera dans cinq à six semaines, le commandant Laperrine poussera-t-il jusqu’à Tombouctou. S’il le fait, je l’accompagnerai, car, plus je voyagerai, plus je verrai d’indigènes, plus aussi je serai connu d’eux, et j’espère entrer en possession de leur amitié et de leur confiance… Le lieu le meilleur pour étudier le touareg (tamahaq) est Akabli, où tous les habitants le parlent, et où il y a sans cesse des caravanes touarègues[87]. Il est donc décidé que j’y vais aller et y étudier le touareg de toutes mes forces, jusqu’à ce que le commandant Laperrine vienne me prendre pour le suivre dans sa tournée. »
Frère Charles repart donc pour In-Salah, d’où il gagnera Akabli, lieu d’études. Il fait route avec un autre officier, le lieutenant Besset, et le diaire reprend l’énumération des étapes, 32, 35, 40, 45, 60 kilomètres, et des points d’arrêt qui sont ainsi désignés, dans cette région, cinq fois sur six journées de route : « désert ». Il s’arrête trente-six heures seulement à In-Salah, passe à Tit, où il note les visites qu’il a faites au caïd, le marabout Sidi-Ali, et s’installe à Akabli le 20 février. Son premier soin est de voir le sergent Brun, commandant le détachement des Sahariens d’Aoulef, le sergent commandant les puisatiers, le caïd, son khalifa, et d’autres ; et, dès le lendemain, il commence à prendre des leçons de tamacheq, d’un homme du Settaf, qui a longtemps voyagé chez les Touaregs.
Le séjour à Akabli dure un peu plus de trois semaines. Frère Charles s’inquiète d’avoir tant d’aumônes à répandre, dans ce très prochain voyage, qu’il va entreprendre en pays tout nouveau, hier encore ennemi, et de l’achat qu’il faudra bien faire, pour suivre Laperrine, d’un chameau de course et d’un chameau de bât. Où trouver cet argent ? Le mieux est d’écrire à la famille et de quêter ; au fait, qui va être l’aumônière élue ? Il songe, se décide, note les arguments qui ont fixé son choix, et, bien assuré que, dans six mois au plus, la somme qu’il a demandée sera parvenue à son trésorier, le chef du bureau arabe de Beni-Abbès, il confie à son journal de route les permissions extraordinaires que le Père Guérin lui a données, pour la célébration de la messe pendant les grands voyages. « Permission de célébrer la messe une heure après minuit ; d’user de tout luminaire, si la cire des abeilles vient à manquer ; de célébrer même sans luminaire, dans ces régions très reculées qui ne produisent point d’olives, et où les lampes ne trouvent donc pas d’aliment. » Ces formules, transcrites en latin et reproduites du droit canon, font une curieuse figure de civilisation, entre les pages du diaire toutes pleines de noms barbares.
Les semaines d’Akabli sont des semaines de travail et de recueillement. Frère Charles sera toute sa vie un travailleur extraordinaire. Il ne perd pas une heure. Ses notes ne renferment aucun élément pittoresque ; il écrit : « Les populations de cette région, comme celles du Maroc, parlent moins l’arabe que le berbère, vieille langue du nord de l’Afrique et de la Palestine, celle que parlaient les Carthaginois, celle de sainte Monique, dont le nom, berbère et non grec, signifie « reine ». Je l’avais apprise autrefois, et oubliée ; je m’y remets un peu, pour pouvoir causer avec tout le monde. » Mais ce grand travailleur est avant tout un prêtre. Ses carnets comme ses lettres seront toujours marqués du signe de la croix. La pensée du Christ lui rend la science plus précieuse, et plus chère la pauvreté. « Entre autres douceurs, j’en ai une que je demandais à Jésus depuis longtemps : c’est d’être, pour l’amour de lui, dans des conditions analogues, comme bien-être, à celles où j’étais au Maroc pour mon plaisir. Ici, comme installation, c’est la même chose. »
Le 14 mars, le commandant Laperrine, fidèle au rendez-vous, sort d’Akabli avec son compagnon et ami, qui, cette fois, monte un méhari. Son intention est bien de pousser jusqu’à Tombouctou. Il passera par In-Ziz, l’Ahnet, l’Adrar, Timissao, In-Ouzal, Mabrouk ; s’arrêtera peu de jours à Tombouctou, et reviendra par l’Adrar et le Hoggar. « Si l’état des esprits s’y prête, écrit le Père de Foucauld, notre pensée est qu’au retour on me laissera chez les Hoggar, et que je m’y fixerai. » Laperrine a sous ses ordres les lieutenants Bricogne, Nieger, Besset.
Le premier jour, on ne parcourt que 12 kilomètres et l’on s’arrête dans le désert ; le 15 au soir, on campe dans le lit de l’oued Keraan, dans le désert, après 50 kilomètres de marche ; le 16 dans le désert, près du puits de Tin-Tenaï ; le 17 dans le désert ; le 18 dans le désert, où l’on bivouaque un jour ; le 20 dans le désert encore ; le 23, au puits de Tintagart, le commandant reçoit la visite d’Aziouel, successeur désigné de l’amenokal des Taïtoq. Près d’autres puits, on reçoit la visite de guerriers Taïtoq ou Kel Ahnet ; on s’arrête, pendant la grande chaleur, près d’un campement de nomades. « Tournée pacifique, paternelle, d’apprivoisement, d’encouragement, de mise en confiance et en amitié, vraie tournée épiscopale. » Politique française, dirons-nous encore, seule digne d’une nation qui ne domine un pays que pour le pacifier, une race étrangère que pour l’élever, et qui n’a pas plutôt cessé de combattre, de punir, de soumettre, qu’elle dépose toute colère, même légitime, et n’emploie son génie qu’à se faire aimer. Frère Charles n’a pas abandonné son espoir qu’un jour les petits Frères du Sacré-Cœur entreprendront – lui vivant ou lui mort, peu importe ! – de donner à ces pauvres du désert le plus beau cadeau que la France puisse leur apporter : Jésus-Christ. Le soir du jeudi saint, 1er avril, arrêté dans l’oued In-Ziza, à 4 kilomètres du puits, il médite et rêve ainsi. « Le puits d’In Ziza est un puits dans le roc, au fond duquel il y a une source d’eau excellente et abondante en tout temps. Toute caravane peut toujours s’y abreuver. Nous y rencontrons deux caravanes, allant de Gogo à Akabli, l’une d’Iforas, l’autre de gens d’Akabli ; chacune est de cinq à six hommes, quelques chameaux, des moutons. Lorsqu’il pleut, l’oued In-Ziza se couvre d’une végétation abondante. Il y a quatre ans, après des pluies, 500 tentes, – Hoggar, Ahnet, Iforas, – y passèrent plusieurs semaines, buvant au puits. C’est un lieu où on pourrait fonder une fraternité, car il est : 1° très désert ; 2° lieu de passage de voyageurs ; 3° assez pourvu d’eau pour qu’on puisse toujours boire : 4° assez pourvu de terre pour que quelques petits jardins soient possibles. »
Même vœu, quelques jours plus tard, le 6 avril, lorsque la colonne s’arrête au puits de Timissao, le plus beau qu’elle ait rencontré, un puits où toute caravane peut s’abreuver, « non seulement sans le tarir, mais sans que l’eau soit moins limpide. Ce serait encore le lieu le meilleur pour établir une fraternité, oui, préférable à In-Ziza, car tout se trouve prêt, l’eau, la terre aisément cultivable aux abords du puits, et même le logement, puisque à peu de distance, dans la paroi d’un rocher à pic, « il y a une très grande grotte naturelle, couverte d’inscriptions, entourée de plusieurs autres moindres,… qui feront un excellent logement pour les Frères, tant qu’ils seront peu nombreux… S’établir dans la grotte avec des dattes et de la farine, commencer un petit jardin, faire couvrir d’une coupole le puits ; avoir toujours, à la disposition des voyageurs, des cordes, et, pour les pauvres, quelques dattes ou un peu de farine. »
À mesure que la mission pénètre plus avant, dans cette région où elle est engagée, elle reçoit de plus nombreuses visites d’indigènes touaregs, des tribus ralliées, Iforas, Taïtoq ou Hoggar. Un soir, un de nos plus acharnés ennemis, le marabout Abidin, qui nous a longtemps combattus, fait parvenir au commandant un message de paix assez insolent. Il a établi ses tentes à quelque distance ; il ne vient pas ; mais il envoie son messager qui saluera le grand chef. Laperrine, connaisseur du désert, fait répondre au marabout qu’il lui accorde la paix, l’aman, le pardon. Et l’autre promet alors une visite, qu’il fera à brève échéance, avec le prince des Hoggar, l’amenokal Moussa ag Amastane.
J’imagine le commandant mettant son méhari à droite de celui de Frère Charles, et parlant à son ami du pays Hoggar, où, dans quelques semaines, la mission va entrer. Car, les notes, éparses dans le diaire, et que je résumerai, ont été jetées sur le carnet, le soir, après les conversations pendant la marche. Elles sont encore parlées. Et qui pouvait être un meilleur maître, un informateur aussi sûr que Laperrine ?
« Le Hoggar, c’est un pays de montagnes et de hauts plateaux. La température y est donc plus fraîche que celle dont nous pensons parfois mourir ici. Dans la plupart des fonds, vallées, ravins, il y a des arbres, gommiers et éthels surtout : j’en ai vu de magnifiques. Le Hoggar s’étend, en latitude, du Djebel-Oudan au village de Tamanrasset ; en longitude, de l’oued Igharghar à Abalessa. On peut dire qu’il a quatre portes : In-Amadgel est la porte du nord ; Abalessa la porte de l’ouest ; Tazerouk, celle de l’est ; Tamanrasset, la porte du sud. Le village de Tit en est le centre : village fameux par le combat que le lieutenant Cottenest dut soutenir contre les Hoggar, et qui amena la soumission de tout le pays. Vous retrouverez, parmi ces pasteurs, quelques traits qui rappellent notre moyen âge : des nobles peu nombreux qui sont pauvres ; des Dag-Rali, fraction vassale, bien réduite depuis les pertes que Cottenest lui a infligées ; une autre fraction, qui n’est ni noble, ni vassale, fraction nombreuse et riche, – relativement, – une bourgeoisie nomade si vous voulez, et des Harratins, nègres du Touat ou du Tidikelt, esclaves affranchis ou descendants d’affranchis, et qui, seuls, cultivent un peu la terre. Cependant, ils ne peuvent être confondus avec nos anciens serfs attachés à la glèbe : ils sont libres de quitter le pays ; on peut les considérer comme des ouvriers étrangers. Leur part est nulle dans les affaires publiques. Et tout cela obéit, plus ou moins, à l’amenokal, roi sans faste, sans train particulier, qui n’a pour signe de son autorité qu’un gros tambour placé devant sa tente, et de qui l’autorité, variable comme celle des premiers Capétiens, dépend de la valeur de l’homme et du nombre des vassaux. Je vous ferai connaître Moussa, l’amenokal d’aujourd’hui, et je vous conterai son histoire. »
Ainsi va la mission, bien en paix, jusqu’au 16 avril. Ce jour-là, au puits de Timiaouin, dans le désert, la troupe du commandant Laperrine, arrivant vers le soir, rencontre une colonne française composée de vingt-cinq tirailleurs soudanais, de dix Kenata auxiliaires, et commandée par deux officiers. Cette troupe est partie de Tombouctou ; prévenue de la marche du commandant, elle a passé par Aslar, Souk, Attalia, Tessalit ; elle vient pour s’expliquer avec le chef de la mission du nord, et pour lui faire abandonner le projet de traverser le Sahara jusqu’à Tombouctou. Si étrange que paraisse une pareille entreprise, des Français de la colonie du Niger prétendent donc empêcher des Français de la colonie algérienne de voyager dans les territoires du sud, dans la région qu’ils considèrent comme une dépendance administrative du poste de Tombouctou. Les limites n’avaient pas été déterminées par l’autorité supérieure, Alger ou Paris. Dès lors, le sud avait résolu de défendre son morceau de Sahara. Les têtes s’étaient montées. Dans ces climats extrêmes, les jalousies deviennent féroces, les dissentiments dégénèrent en maladies mentales, les pires imaginations peuvent s’emparer d’un honnête homme et, s’il ne réagit pas, le dominer entièrement. Dès le premier salut échangé, le commandant Laperrine comprend que c’est à lui d’être le plus sage. Très maître de lui-même, il parlemente avec ses camarades du Niger ; il s’aperçoit que ceux-ci ne pardonnent pas même aux Iforas de s’être soumis à la France par l’intermédiaire de l’Algérie ; qu’à les entendre, cette tribu aurait dû demander l’aman aux autorités nigériennes. Le différend est grave, la discussion calme est impossible. Et la nuit vient. Laperrine rompt l’entretien, prend ses dispositions pour que le conflit n’éclate pas entre les deux troupes en présence, puis réfléchit. Avant tout, pas de violence ni d’éclat ! Il cédera, quelque dur que soit le sacrifice. Au jour, les deux troupes s’étaient déjà séparées, et le commandant, renonçant à une gloire enviée, celle d’avoir traversé pacifiquement le désert de part en part, retournait sur ses pas. Mais il avait obtenu que le chef de la troupe du Niger se retirât de son côté, immédiatement, sans inquiéter ni molester les Iforas soumis. La question des zones d’influence serait tranchée par le ministre, plus tard. Et c’est ce qui fut fait[88].
Le Père de Foucauld, dans cette occasion, eut peine à se contenir. Ce n’est pas le voyageur subitement arrêté et obligé à rebrousser chemin qui montre son dépit ; c’est l’officier, le colonisateur, l’ami des Sahariens nomades, le prêtre, qui juge cet incident de route avec une sévérité dont je ne connais, sous sa plume, aucun autre exemple.
Cependant, il a su ne pas montrer sa réprobation. Il a voulu se taire, et s’est tu. Les officiers du sud ont abusé de la force, – c’est là son grief principal, – en traversant les campements des Iforas. Il le note, le soir même, pour lui seul, dans son diaire, et termine ainsi : « Après leur avoir fraternellement serré la main à l’arrivée, je partirai demain sans leur dire adieu… Je ne leur dis aucune parole de reproche : 1° parce que ce serait sans profit pour eux ; 2° parce que cela les éloignerait de la religion ; 30 parce que cela pourrait faire éclater un conflit entre eux et les officiers du commandant Laperrine. »
Celui-ci renonce au rêve, change de direction, et ordonne de marcher d’abord à l’est, jusqu’à Tin-Zaouaten, par 19° 57’ de latitude nord, où il rencontre plusieurs chefs touaregs et confère avec eux. On avait traversé l’Ahnet ; on revient par l’Adrar et le Hoggar. L’année est sèche et par exemple, après que la colonne a repris son chemin vers le nord, Frère Charles note qu’aux puits de Tinghaor, il a fallu soixante heures pour abreuver les cent cinquante chameaux et pour remplir les cent cinquante outres. Partout, pendant plusieurs semaines, le mot « désert » est répété dans le diaire. Un jour, Frère Charles écrit qu’il n’a pu dire sa messe, à cause d’une tempête de vent. Un autre jour, il la célèbre à midi, en arrivant à la halte. Le 17 mai, fête de saint Pascal Baylon, il prie ainsi : « Je mets sous votre protection, ô protecteur de toutes les œuvres et familles eucharistiques, le sanctuaire, la Fraternité du Sacré-Cœur de Jésus, que je voudrais fonder au cœur du pays touareg. Je vous recommande de toute mon âme la conversion des Touaregs, je vous offre ma vie pour eux. » Puis, Frère Charles développe les divers points de sa méditation : « Si je puis rester en pays touareg, comment m’y conduire ? – Qui suis-je ? que dois-je me proposer ? – Où m’établir ? – Quels aides vais-je trouver ? » et ici Frère Charles énumère : « Jésus, la Sainte Vierge, saint Joseph, sainte Marguerite, saint Pascal Baylon, saint Augustin, tous les saints, tous les anges, toutes les âmes du Purgatoire que je supplie en ce moment, toutes les bonnes âmes vivant en ce monde et qui m’aident de leurs prières, conseils, commandements, biens de toute sorte… »« Pourquoi m’établir dans ce pays ? Comment ? » Et il répond ; « Silencieusement, secrètement, comme Jésus à Nazareth, obscurément comme lui, pauvrement, laborieusement, humblement, doucement, désarmé et muet devant l’injustice comme lui, me laissant tondre et immoler comme lui, sans résister ni parler. »
À chaque instant, dans ce voyage de découverte, un puits abondant, comme à Silet, une assez belle culture de blé, comme à Abalessa, un groupe de palmiers rappelant qu’il y eut ici ou là une palmeraie, le croisement de pistes fréquentées, éveillent chez le Père de Foucauld l’image d’une Fraternité ou d’une mission à fonder, d’un village à reconstruire, d’un couvent même à bâtir.
De petits croquis sont jetés en marge du texte, des indications minutieuses pour l’emplacement des habitations, pour les meilleures méthodes d’apprivoisement à employer, les plus utiles exemples à donner. Ici un dispensaire serait d’un grand secours ; là un centre d’agriculture ou mieux d’horticulture. Ici, deux Frères suffiraient au travail ; là, il en faudrait dix au moins et dix Sœurs. Tout le long de la route, le Père de Foucauld dispose des sujets d’un ordre qui n’existe pas encore. Sa charité l’inspire, imagine et construit. Comme les grands moines défricheurs, il voit déjà une civilisation nouvelle se lever pour ces pays sauvages ; il est seul et il ne désespère pas : l’audace de ses vœux serait justement appelée folie, s’il était de ceux dont la confiance est humaine. On s’arrête cinq jours dans Abalessa. Il y célèbre la messe, le jour de la Pentecôte (22 mai), en présence de Laperrine et de plusieurs officiers, « avec grande émotion ». Le commandant y reçoit la visite de deux notables Kel-Réla, venant à marches forcées, et apportant une lettre de Moussa ag Amastane. L’un de ces notables, très proche parent de l’amenokal et son successeur désigné, Soua, est frère de la jeune fille que Moussa aimait et n’a pu épouser. – Ce roman du désert était connu là-bas. – Dans cette lettre, le chef des Hoggars se montre très bien disposé et se déclare l’ami de la France, si bien que Frère Charles se demande si l’heure n’est pas venue, pour l’ermite, de s’arrêter et de fonder l’ermitage au village de Tit, qu’on atteint le 26 mai, et qui est le plus central du Hoggar. Le commandant Laperrine croit plus sûr de ne pas encore accorder la permission. Au pas des chameaux, on continue donc l’énorme randonnée. Chaque jour, le diaire signale la présence de quelque indigène de grande tente. Le 7 juin, c’est celle d’une femme, une Taïtoq, celle-là même qui a été si courageuse lors du massacre de la colonne Flatters, qui a recueilli nos blessés et les a défendus : Tarichat Oult Ibdakan. Frère Charles avait souhaité de lui rendre visite, autrefois ; il la rencontre et la remercie. Le diaire, qui ne raconte pas, et qui ne fut point écrit pour la curiosité, porte seulement ces mots : « Elle a de quarante à cinquante ans, distinguée, parlant peu, simple et modeste d’attitude, très bien de toute manière, parle assez bien l’arabe. » Cependant quelques pages plus loin, pour ne pas être trop incomplet, et pour se rappeler mieux, sans doute, la commission qu’il a accepté de faire, Frère Charles, au moment de quitter le campement où sont les tentes de Tarichat, ajoute ces mots : « Elle me charge d’écrire, de sa part, au tirailleur Amer, qu’elle a sauvé, rapatrié, qui lui a promis son pesant d’argent, et ne lui a jamais rien envoyé. Elle a des dettes : et 50 ou 100 douros lui feraient bien plaisir. »
L’esprit toujours occupé de ce qui pourra servir ses frères touaregs, il profite de cette halte dans le désert, pour rédiger une très longue note, où il résume l’expérience qu’il vient de faire dans ces cinq mois de voyage, de visites, de conversations avec les indigènes et avec les officiers sahariens, et il intitule cette note : Observations sur les voyages des missionnaires dans le Sahara. On peut dire que tout s’y trouve, et dans l’ordre voulu. Que doit faire le missionnaire pour bien garder son âme ? Quelles provisions doit-il emporter, et comment choisir le méhari et le chameau de bât ? Quelle place le missionnaire doit-il occuper dans le convoi militaire ou civil ? Doit-il manger avec les officiers ? etc. Je commence par citer la réponse à ces dernières questions : « Que les missionnaires soient seuls, chaque fois que cela est possible, dit le Père de Foucauld ; qu’ils mangent seuls, pour perdre moins de temps et en donner davantage aux exercices spirituels et aux bonnes œuvres, pour ne pas être obligés d’entendre souvent des conversations coupables, pour ne pas diminuer le respect qu’on a pour eux en faisant connaître leurs défauts, pour être aussi plus abordables aux pauvres. Mais quand ce sera nécessaire pour le bien des âmes, les Frères mangeront avec les officiers. »
Les autres questions sont traitées selon cet esprit pratique, victorieux du préjugé, et qui gouverne tout vers le but invariable : le bien des âmes. Le Père de Foucauld semble écrire les constitutions que suivront, après lui, les missionnaires, les civilisateurs que son expérience et sa pensée feront sortir de l’inépuisable trésor apostolique : la France.
De ces observations, on peut dire aussi qu’elles sont une espèce de portrait du Père de Foucauld peint par lui-même. J’en reproduirai donc quelque chose.
D’abord ces lignes sur l’emploi des chameaux par le missionnaire : « Comme en voyage, on peut avoir à faire de très longues étapes, à parcourir de très longs espaces sans eau, il faut compter que tous les missionnaires et leurs serviteurs seront montés. Cela n’empêchera pas les uns et les autres de faire la plus grande partie des étapes à pied, pour imiter Notre-Seigneur et par pénitence, abjection, pauvreté, et pour ménager leurs animaux et économiser la bourse de Jésus et celle des pauvres. »
Et maintenant, « que doit faire le missionnaire pour l’âme des autres », des chrétiens, des soldats indigènes, des indigènes non-soldats, des habitants, en particulier, de la Saoura ? Les conseils sont nuancés à merveille, et je regrette de n’en donner que des fragments.
« Chrétiens. – Causer beaucoup avec eux ; être l’ami de tous, bons et mauvais… Leur rendre tous les services compatibles avec notre état, avec la perfection…
« Soldats indigènes. – Leur parler toujours sérieusement, gravement des choses du ciel, jamais des temporelles ; être d’accueil facile, très gracieux avec eux, sans familiarité, sans conversations inutiles, sans accepter de cadeaux ; leur donner des conseils de perfection sur leurs affaires de famille, s’ils en demandent. Ne jamais leur en donner touchant les affaires temporelles. »
Les autres indigènes. – Il faut d’abord acquérir leur estime par une vie exemplaire et sainte, ensuite obtenir leur amitié par la bonté, la patience, les petits services de toute sorte qu’on peut rendre à tous, petites aumônes, remèdes, hospitalité… Tâcher d’avoir avec eux le plus de relations possibles ;… mais être discret, réservé ; sans empressement excessif, de manière à les attirer à soi plutôt que d’aller chez eux ;… ne pas entrer sans nécessité dans leurs villages, tentes ou maisons, à moins d’y être appelé… Vivre autant que possible comme eux ; tâcher d’être en amitié avec tous, riches ou pauvres, mais aller surtout et d’abord aux pauvres selon la tradition évangélique. Avoir grand soin de ne pas aller trop vite dans les choses, un peu nouvelles pour eux, qu’on leur dit. Tâcher de se faire questionner, et les amener à parler les premiers de ce dont on veut les entretenir… Éviter les discussions théologiques, présentement ; il y entrerait plus de curiosité que de bonne volonté ; répondre brièvement, sans accepter la discussion ; rester dans la théologie naturelle, et ne pas, sans motifs particuliers, exposer les dogmes chrétiens. L’heure actuelle, dans la majorité des cas, est celle du précepte : ne jetez pas vos perles aux pourceaux. »
Esclaves. – Le Père de Foucauld a constaté que les esclaves étaient, en général, mieux traités chez les Touaregs que dans la Saoura. Néanmoins, leur sort est digne de pitié et leur dignité d’êtres humains totalement méconnue. « Ni famille, ni chasteté, ni probité, ni vérité, ni bonté, chez la plupart des esclaves. Les négresses jeunes servent toutes d’instruments de plaisir chez les Touaregs ; il en est de même, plus ou moins, dans les autres parties du Sahara. Les Touaregs n’ont, en général, qu’une épouse, mais, quand leur fortune le leur permet, ils ont en outre plusieurs jeunes négresses pour leur plaisir… Il faut donc travailler de toutes nos forces à supprimer l’esclavage tout doucement, progressivement, réellement, de manière à améliorer non seulement le sort matériel, mais le moral des esclaves. La meilleure manière semble être de répandre la méthode du commandant Métois au Tidikelt. Il permet à tous les esclaves de se racheter, en remboursant à leur maître la somme qu’ils ont coûtée, ou celle qu’ils sont censés valoir, et, pour qu’ils puissent se procurer cette somme, il fait faire, à ceux qui le demandent, assez de journées de travail, pour que la somme des salaires de ces journées représente la rançon… La libération se fait petit à petit, habituant l’esclave au travail… Le commandant Métois forme ensuite des villages nouveaux, auprès des sources nouvellement aménagées, avec ces esclaves ainsi libérés. Tout cela est excellent, digne d’être imité. »
Par quels moyens convient-il donc de commencer l’éducation morale de ce pauvre monde musulman, et quelle part l’Évangile aura-t-il dans les premiers entretiens ? L’expérience du Père de Foucauld est trop complète, l’autorité du personnage est trop considérable, pour que je ne reproduise pas les observations qu’il a voulu laisser à ceux qui continueront ou imiteront son œuvre.
« Gens de la Saoura et Touaregs. – Il est assez difficile d’avoir des conversations religieuses avec les gens des oasis sahariennes, ou de la Saoura ; elles risquent de devenir aigres, et de creuser entre eux et nous un fossé, au lieu de resserrer la charité. Le mieux est de s’en tenir aux conseils courts, mais répétés, sur la religion naturelle et la morale chrétienne… Leur lire du saint Évangile des passages très clairs, touchant la religion naturelle, mais ne pas mettre le livre entier entre leurs mains ;… quand ils nous estimeront, alors on pourra, sans crainte de les éloigner, avoir, avec ceux qu’on connaîtra sérieux et de bonne volonté, de longues conversations religieuses ; avec certaines âmes, ce pourra être bientôt ; il faudra, dès qu’on en viendra là, être en mesure de leur présenter le saint Évangile. Il semble donc qu’il serait très utile d’en préparer dès maintenant une traduction en arabe algérien, qu’on puisse leur lire ou leur faire lire, et que même les moins cultivés comprennent.
« La même progression est à suivre avec les Touaregs… Leur préparer dès à présent une traduction des Évangiles en tamahaq. Cette traduction devra surtout leur être lue… Il n’y a pas lieu de chercher à apprendre aux Touaregs l’arabe, qui les rapproche du Coran ; il faut au contraire les en détourner. Il faut leur apprendre le tamahaq, langue excellente, très facile, y introduire peu à peu les mots indispensables pour exprimer des idées religieuses, des vertus chrétiennes, et en améliorer le système d’écriture, sans le changer… Leur lire les passages qui touchent à la religion naturelle, ou à la morale, tels que la parabole de l’enfant prodigue, celle du bon Samaritain, celle du jugement dernier, comparé à un pasteur séparant les brebis d’avec les boucs, etc. Il va sans dire que, dès que les conversions commenceront à se faire, il faudra un catéchisme en tamahaq. »
La colonne du commandant Laperrine se trouvait à Aseksen lorsque, le 12 juin, elle fut rejointe par un détachement de la compagnie du Tidikelt, commandée par le lieutenant Roussel. Tandis que le commandant retourne à In-Salah, le lieutenant Roussel, avec le maréchal des logis Duillier, deux caporaux et soixante-quinze méharistes indigènes, est chargé de continuer la « tournée d’apprivoisement ». Il devra passer trois mois parmi les Touaregs Hoggar, aller lentement, séjourner. Grand embarras pour Frère Charles, qui écrit sur son carnet : « Cœur-Sacré de Jésus, j’ai quelque chose à vous demander : faut-il aller avec lui (Roussel), si on me le permet ? Ou faut-il visiter le Touat, le Gourara, aller passer quelque temps à Ghardaïa auprès du Père Guérin, et revenir dans la Saoura, en continuant à étudier le tamahaq et à faire la traduction du saint Évangile, commencée il y a quelques jours ? Que veut votre Cœur ? » Selon sa coutume, Frère Charles met en parallèle le pour et le contre, et, ayant pris le parti qui lui semble le meilleur, c’est-à-dire le plus divinement utile, note, dans son diaire, à la date du 14 juin : « Ce matin je demande à Laperrine de me permettre de rester avec Roussel, aussi longtemps que Roussel restera en dehors d’In-Salah. Il me le permet avec joie, et, de lui-même, il dit à M. Roussel de tâcher, s’il voit Moussa, de négocier avec lui mon établissement définitif et immédiat au Hoggar. Il me quitte, après m’avoir, durant ces cinq mois, comblé de bontés de toutes sortes, dont je ne saurais jamais être assez reconnaissant, en me disant que c’est au Hoggar qu’il espère me revoir. »
Voici donc une seconde mission pacifique qui se met en route, et le Père de Foucauld qui repart avec elle. Le 22 juin, on franchit 40 kilomètres, et la troupe s’arrête pour la nuit entre Aseksen et Tin Tounin. Pour la plupart de ces voyageurs la route est nouvelle ; on rencontre des visages inconnus ; le programme demeure le même : entrer en relations, diminuer les préjugés, gagner même, si l’on peut, quelque amitié pour la France lointaine. Emploi magnifique et qui suppose chez nos officiers sahariens, même chez les plus jeunes, des qualités de tact, de patience diplomatique, de bonté, d’éducation également, qu’on ne trouverait pas aussi aisément dans toutes les armées. Cette mission du lieutenant Roussel devait réussir de tout point. Le Père de Foucauld écrivant à un ami, le 3 juillet, définissait ainsi le caractère et l’allure de ce voyage. « Nous allons de source en source, aux lieux de pâturages les plus fréquentés par les nomades, nous y installant au milieu d’eux, y passant plusieurs jours. Avec la sainte messe, les prières, les nécessités de ce corps de mort, souvent la marche, le temps donné au prochain, mes journées sont occupées par l’étude de la langue de ce pays, langue berbère très pure, et par les traductions des saints Évangiles en cette langue.
« Les indigènes nous reçoivent bien ; ce n’est pas sincère ; ils cèdent à la nécessité. Combien de temps leur faudra-t-il pour avoir les sentiments qu’ils simulent ? Peut-être ne les auront-ils jamais. S’ils les ont un jour, ce sera le jour qu’ils deviendront chrétiens. Sauront-ils séparer entre les soldats et les prêtres, voir en nous des serviteurs de Dieu, ministres de paix et de charité, frères universels ? Je ne sais. Si je fais mon devoir, Jésus répandra d’abondantes grâces, et ils comprendront. »
Tout défiants, tout haineux que lui semblent souvent ces « frères ombrageux » du Hoggar, il les juge « bien moins séparés de nous que les Arabes », et l’idée de s’établir au milieu d’eux continue de hanter son esprit. Cependant il reconnaît que l’heure n’est pas encore venue. Il rentrera, avec la mission, vers les villes sahariennes du nord.
Je ne publierai ici que de courts passages du diaire ou des lettres, qui peuvent achever la connaissance que nous avons déjà de cette grande âme d’apôtre, et je laisserai à d’autres, s’il y a lieu, le soin de relever ces mille détails sur la géographie fluviale, les essais de culture, la température, les mœurs et les noms des tribus et fractions de tribus, qui rappellent fréquemment le célèbre ouvrage Reconnaissance au Maroc. Le voyageur de 1904 est toujours le savant préoccupé de n’admettre que de très sûres observations, le géographe passionné, le psychologue qui découvre vite, dans les yeux, les gestes et les mots, les secrètes pensées de ceux qui l’abordent ; mais une singulière noblesse s’est surajoutée à tout cela : un cœur affamé de justice, pénétré de charité, prêt à se sacrifier pour chacun de ses frères inconnus et hostiles, anime ces humbles cahiers, et mêle, aux notes savantes, la prière, les vœux, les rêves.
« Amra, 2 juillet, fête de la Visitation. Fête patronale de toutes les fraternités des petits Frères et petites Sœurs du Cœur de Jésus. Bien-aimée mère,… faites auprès de tous, par la visite de la grâce céleste et par la visite de saints religieux et religieuses et de saintes âmes, ce que vous fîtes en visitant Jean-Baptiste ! Continuez votre Visitation, visitez les Touaregs, le Maroc, le Sahara, les infidèles, toutes les âmes,… moi, indigne, visitez-moi, mère chérie, convertissez-moi, je vous le demande à genoux… »
« 8 juillet. – Le séjour se prolongeant, j’ai le bonheur de placer, pour la première fois en pays touareg, la sainte réserve dans le tabernacle. Une chapelle en branchages, surmontée d’une croix de bois, a été construite ; une tente dressée dessous forme dais au-dessus de l’autel et la protège de la poussière… Cœur sacré de Jésus, merci de ce premier tabernacle en pays touareg ! Qu’il soit le prélude de beaucoup d’autres et l’annonce du salut de beaucoup d’âmes ! Rayonnez, du fond de ce tabernacle, sur le peuple qui vous entoure sans vous connaître ! Envoyez de saints et nombreux ouvriers évangéliques partout où il en faut ici ! »
« Ouad Agelil, désert, 22 juillet. – Fête de sainte Madeleine. Sainte Madeleine, je mets à vos pieds les intentions de mon âme, inspirez-moi. Y a-t-il des résolutions agréables au Cœur de Jésus que je doive prendre ? En quoi faut-il me corriger ? Que faut-il faire ? »
Le 3 août, on est au village de Tazerouk, à environ 2000 mètres d’altitude. On parle à présent du retour. « Voici les probabilités, écrit Frère Charles à un ami : je rentrerai à In-Salah vers le 20 septembre ; je ne m’y arrêterai pas, et traverserai le Tidikelt, le Touat, le Gourara, doucement, en m’arrêtant à chaque village, – il y en a environ 300, – laissant à chacun quelques remèdes, quelques paroles ; de là, j’irai à Ghardaïa, puis à Beni-Abbès. »
L’extrême fatigue d’un voyage aussi long, et dans la plus dure saison, a altéré la santé de Frère Charles. Une photographie prise à cette époque nous le montre évidemment épuisé, les yeux enfoncés sous l’orbite, le visage amaigri et entaillé de rides profondes. Il n’en veut pas convenir. À l’un de ses amis de France qui s’informe de ses nouvelles, il répond : « Oui, j’ai besoin de repos, mais pas dans le sens que vous pensez ; ce n’est pas la solitude spirituelle qui me pèse, c’est le manque de solitude matérielle : quelques jours de silence au pied du tabernacle, voilà ce dont je sens le besoin ! »
Dans le journal, il note, pour mieux affirmer sa volonté d’accomplir la seconde partie du voyage « en ouvrier du saint Évangile », quelles sont les aumônes qu’il donnera aux pauvres des villages. « Je décide de donner une aumône de sept francs dans chaque ksar petit ou moyen, quatorze francs dans chaque grand, vingt et un francs dans chaque très grand. »
Les prévisions étaient exactes. Le Père de Foucauld est le 20 septembre à In-Salah, où les troupes reprennent leur cantonnement ; lui, il n’y demeure point. Sans convoi ni force armée désormais, avec un seul soldat indigène qui lui sert de guide, il continue sa route par Inghar, Aoulef, Adrar. Selon sa promesse, partout où il y a une tente, un groupe de gourbis ou de cases en terre, il s’arrête, pour montrer à l’Afrique sauvage ce qu’est le cœur d’un chrétien de France. À Timimoun, « peuplé, riche, habitué aux Européens, et qui pourrait être un centre de mission heureux », il séjourne trois jours, puis il reprend sa route solitaire, avec son guide, couchant à la belle étoile, ne rencontrant, de toute la semaine, qu’un point habité, fort Mac-Mahon, où se trouvent quelques soldats chrétiens, d’autres musulmans « et un chef indigène qui me reçoit très bien ». Il s’arrête à peine à El-Goléa, où trois Pères Blancs l’accueillent ; il a hâte de retrouver le poste de mission de Ghardaïa, et son grand ami, le préfet apostolique du Sahara. Celui-ci attendait le voyageur avec impatience, et il voulut aller au-devant de lui. Ils se rencontrèrent donc à Metlili, à une journée de marche de la résidence, et s’entretinrent en continuant la route. Quand on vit arriver enfin les deux compagnons, on eut peine à croire que ce pauvre piéton déguenillé, fourbu, et qui marchait quand même en conduisant son chameau par la figure, fût l’ancien officier de chasseurs. Il ressemblait à quelque derviche quêteur. Mais ses yeux étaient pleins de joie, et son sourire le nommait.
Ghardaïa fut le lieu du repos. Frère Charles habite six semaines, du 12 novembre au lendemain de Noël 1904, dans cette bourgade capitale du Mzab. « Je me repose dans le silence et la solitude, dans la douce amitié du Père Guérin et de ses missionnaires. » Il a bien des questions à régler avec son supérieur et ami. Il lui remet la traduction entièrement achevée des quatre évangiles en cette langue touarègue, qu’il n’a cessé de travailler pendant les marches, ou même la nuit, sous la tente. Il expose aux missionnaires ses principales observations sur les pays nouveaux qu’il vient de traverser, il leur donne des conseils sur la future évangélisation des peuples qui vivent ou qui passent là. Et, ayant à ce sujet, pour compléter et rappeler ses conversations, « laissé copie de bien des petites choses », il fait sa retraite annuelle.
Parmi les résolutions qu’il prend dans ces jours d’examen, il en est deux que je veux dire ici, parce qu’elles montrent la profonde vie intérieure de l’homme. Il songe aux continuelles visites auxquelles il est exposé à Beni-Abbès, à tant de voyages ou de démarches qui rompent le recueillement, et il note : « Avoir soin : 1° de faire une communion spirituelle chaque fois que j’entre dans la chapelle, que je cause avec quelqu’un, que j’écris à quelqu’un ; 2° dans toutes les allées et venues, les marches, quand je ne fais pas un autre exercice spirituel, de réciter des Ave Maria, pour le règne universel du Cœur de Jésus ; de même dans le travail manuel ; quand je m’éveille la nuit ; enfin chaque fois que mon esprit n’est pas occupé par un autre devoir. »
Pendant le séjour à Ghardaïa, le plus possible, il évite de paraître entre ces maisons et ces masures, dans ces ruelles et ces petites places demi couvertes, – sol y sombra, – où la curiosité des habitants et des nomades est toujours en éveil, et toujours murmurante. Mais un personnage de cette sainteté et de ce renom déjà ne pouvait passer inaperçu. Bien que les gens du Mzab soient d’un caractère fermé, et défiants de l’Européen, on vit les notables solliciter la faveur d’être reçus par « celui qui avait vendu ce monde pour l’autre » ; les moindres gens, et qui n’osaient pas plus essayer d’apercevoir au moins par la fenêtre « le grand marabout » au travail ou en prière. L’un de ceux qui rendirent visite au Père de Foucauld, bourgeois des plus importants de la ville, racontait : « Lorsque je suis entré, il m’a dit : Que le Seigneur soit avec toi ! et cela m’a remué le cœur. » Il y avait toujours des enfants aux aguets, près de sa demeure, et ils faisaient la courte échelle pour pouvoir se vanter de l’avoir vu.
Ce fut le 26 décembre que, très ému de l’accueil de ses amis et des Mzabites, il quitta Ghardaïa. Deux Pères Blancs se rendaient avec lui de Ghardaïa à El-Goléa. Il connaissait la route, et, toujours à pied près de son méhari, pour ne pas être distrait dans ses méditations et ses prières, il prenait les devants, comme font les guides des caravanes, qui vont toujours cinquante pas devant ; n’ayant pas de montre, il avait demandé à un des Pères de l’avertir, tant que durerait le jour, du passage d’une heure à l’autre. Et chaque fois que l’aiguille arrivait en haut du cadran, le Père régulateur, monté sur son chameau, frappait quelques coups sur une marmite ou un bidon de fer-blanc. Le bruit courait dans l’air ardent, qui n’avait pas d’autre bruit à porter. Alors tout en avant, le marcheur perpétuel, sans s’arrêter, détournait la tête et faisait un salut pour remercier.
On arriva à El-Goléa le 1er janvier 1905. Frère Charles y trouva son ami Laperrine, nommé lieutenant-colonel, et lui souhaita une bonne nouvelle année. Avec lui, deux jours plus tard, il repartait pour Adrar « où il y avait une occasion pour Beni-Abbès ». En route, je vois dans le diaire qu’il fut souvent question, entre eux, des missions sahariennes. Et enfin le 24 janvier, le Père de Foucauld reprenait possession du cher ermitage. Il ne retrouvait pas le capitaine Regnault, nommé à un autre poste et remplacé par le capitaine Martin. Mais que d’autres amis l’accueillirent et le fêtèrent ! On le croyait perdu : il revenait ; il reprenait, dès le premier jour, le règlement d’autrefois ; il ne trompait personne en affirmant aux officiers, aux soldats, aux indigènes quêteurs, malades ou seulement visiteurs, qu’il souhaitait de ne plus jamais quitter l’enclos, ni la cabane de terre flambée par le soleil, dont il avait fait son domaine et son cloître. « Je reviens, disait-il, sans intention de nouvelle absence, avec grand désir surtout que les Pères Blancs puissent faire, à l’avenir, ce que j’ai fait cette année, avec grand désir de rester dans cette chère Fraternité, à laquelle il ne manque qu’une chose : des Frères au milieu desquels je puisse disparaître… Étant seul, il faut, à chaque instant, courir à la porte, répondre, parler. Les peines de la terre sont faites pour nous faire sentir l’exil, nous faire soupirer vers la patrie… Jésus choisit pour chacun le genre de souffrance qu’il voit le plus propre à sanctifier, et souvent la croix qu’il impose est celle que, acceptant toutes les autres, on aurait, si l’on osait, refusée. Celle qu’il donne est celle qu’on comprend le moins… Il nous dirige dans les pâturages amers, et qu’il sait bons. Pauvres brebis, nous sommes si aveugles ! »
À peine est-il arrivé qu’il reçoit un télégramme annonçant la mort de la mère du préfet apostolique du Sahara. Il écrit aussitôt à Mgr Guérin :
« Beni-Abbès, 28 janvier 1905. – Bien aimé et très vénéré Père, ma messe a été pour cette âme si chère, si chère à vous, bien plus chère au Cœur de Jésus. Nous aimons avec un pauvre cœur d’hommes pécheurs, il aime avec son Cœur divin. Elle est en bonnes mains, en bon lieu, en ce lieu où vous voudriez tant être, où vous serez un jour avec elle et avec Celui qu’elle vous a appris à aimer. Elle se repose. Elle n’a plus besoin de se reposer. Elle est entrée au lieu de l’inondation de paix ; où il n’y a plus ni vent, ni hiver, parce que ces premières choses ont passé. Quand serons-nous là ?… J’ose à peine y penser pour moi, à ce séjour dont je suis si indigne. Oserait-on avoir l’espérance, si le bon Dieu ne nous en faisait un devoir ? L’espérance, c’est la foi à son Cœur. Notre conversation sera de plus en plus dans le ciel. Là vous retrouverez non seulement l’unique adoré, mais encore cette chère mère. Désormais, pour elle plus de distance, plus d’absence ; jour et nuit, elle vous entend, veille sur vous, répond par ses prières à vos questions, à vos demandes ; pour elle la barrière est brisée, le mur écroulé, la nuit finie… Qu’elle est heureuse !… La séparation, pour les quelques années qui vous restent peut-être à vivre, est une croix, croix acceptée avec toutes les autres, le jour où vous avez dit à Jésus que vous l’aimiez. Croix apparente, car la joie du bonheur de cette âme tant aimée, la conversation de jour en jour plus intime et continuelle avec elle, l’aspiration croissante à l’union totale à Jésus, la fatigue croissante de la vie terrestre, ne vous laisseront bientôt que la joie de la sentir près de Jésus et le désir de l’y rejoindre… Baisons la croix que Jésus envoie. On ne peut, en cette vie, étreindre Jésus qu’en étreignant sa Croix. Et bénissons-le du bonheur de l’âme aimée.
« Je comptais vous écrire longuement… La visite à Beni-Abbès du général Lyautey, arrivé aujourd’hui et repartant après-demain pour Aïn-Sefra, m’en empêche… »
La lettre, bien belle déjà, fut donc abrégée parce qu’il y avait un hôte de marque à Beni-Abbès, et que la courtoisie devait, ce jour-là, faire fléchir les coutumes de dévotion et de silence, et passer avant plusieurs choses qu’on eût aimé achever. Le maréchal Lyautey se souvient parfaitement de cette rencontre à Beni-Abbès. Il me l’a racontée à peu près dans ces termes : « Nous avons dîné ensemble, avec les officiers, le samedi, dans la redoute. Il y eut, après dîner, un phonographe qui débita des chansons montmartroises. Je regardais Foucauld, me disant, « il va sortir ». Il ne sortit pas, il riait même. Le lendemain dimanche, à 7 heures, les officiers et moi, nous assistions à la messe dans l’ermitage. Une masure, cet ermitage ! Sa chapelle, un misérable couloir à colonnes, couvert en roseaux ! Pour autel, une planche ! Pour décoration, un panneau de calicot avec une image du Christ, des flambeaux en fer-blanc ! Nous avions les pieds dans le sable. Eh bien ! je n’ai jamais vu dire la messe comme la disait le Père de Foucauld. Je me croyais dans la Thébaïde. C’est une des plus grandes impressions de ma vie. »
Le Père de Foucauld a donc repris l’existence sédentaire qu’il menait un an plus tôt. On a recommencé à entendre la cloche sonner à minuit sur le plateau désert. Les indigènes sont plus nombreux que jamais à mendier les sous, les dattes, l’orge du marabout, et à lui raconter interminablement leurs affaires compliquées.
Lui, cependant, il n’est plus aussi robuste qu’avant le grand voyage qu’il vient d’achever, il l’avoue.
« Pas malade ! dit-il, je célèbre la sainte messe, je suis debout, mais j’ai de grands maux de tête, de la fièvre, tout un ensemble de malaises. Je les crois sans gravité. »
Les forces reviendront ; l’aide restera nulle ; des propositions nouvelles seront faites au missionnaire de revenir au Hoggar, et l’autorisation lui sera donnée de s’établir, premier prêtre, parmi les Touaregs dont il est à peu près le seul à bien parler et écrire la langue. Il quittera la résidence d’abord choisie, la chapelle pauvre et aimée, le silence des heures réservées, pour s’enfoncer encore dans les déserts, et recommencer ailleurs l’œuvre ici ébauchée et déjà promettant.
Car c’est une terrible chose qu’une vocation, lorsque celui qu’elle commande est résolu, de volonté virile, à obéir. En attendant, il se réjouit d’avoir retrouvé l’ermitage. Il écrit au commandant Lacroix : « Tu es au sommet des grandeurs, moi au fond du puits ; ma place est la plus facile et la plus douce. J’aime mille fois mieux être au Hoggar, ou dans les dunes, qu’à Alger. Oh ! que la solitude est bonne ! »
CHAPITRE X – L’ÉTABLISSEMENT AU HOGGAR
L’invitation à retourner au Hoggar vint encore du commandant Laperrine. Par deux lettres, du 1er et du 8 avril 1905, il proposait au Père de Foucauld d’aller passer l’été au Hoggar, avec le capitaine Dinaux, chef de l’annexe d’In-Salah, commandant la compagnie saharienne du Tidikelt. Celui-ci devait partir au commencement de mai, et parcourir l’Ahnet, l’Adrar des Iforas et l’Aïr.
Frère Charles répondit d’abord qu’il ne pourrait quitter la Saoura avant l’automne, qu’à ce moment, il se déciderait, soit à vivre définitivement cloîtré à Beni-Abbès, soit à partager sa vie, prêtre-voyageur, entre la Saoura, le Gourara, le Touat, le Tidikelt et les Touaregs.
Au fond, il fut extrêmement troublé. Il écrivit à l’abbé Huvelin, et l’on devine, dans sa lettre, que l’espoir d’attirer enfin quelque « petit Frère du Sacré-Cœur » à la Fraternité de Beni-Abbès, de transformer en fondation durable son œuvre personnelle et précaire, fut pour beaucoup dans l’incertaine réponse donnée à Laperrine. Lui, si prompt à imaginer, si ardent et ferme dans l’exécution, il était lent à se décider, par amour de la perfection. Il laissait entendre aussi que ces grands voyages n’allaient pas sans fatigue. Néanmoins, il ferait ce qui lui serait conseillé par son directeur et par le Père Guérin.
Le 22 avril, il recevait, du Père Guérin, alors en France, une dépêche qui exprimait l’avis du préfet apostolique et de l’abbé Huvelin : « Inclinerions à accepter invitation. »
Aussitôt Frère Charles s’informe ; il apprend que le capitaine Dinaux ne quittera Akabli que le 15 mai. Il a le temps d’arriver. Le 3 mai il part pour Adrar, avec Paul. Aux deux premiers arrêts, à 35 kilomètres de Beni-Abbès, au village de Tametert, où il couche, puis à 70 kilomètres, à Geurzim, où il déjeune et passe le temps de la grande chaleur, la gaïla, il est très bien accueilli : on ne fait pas sans recevoir quelque retour les sacrifices qu’il a multipliés, et l’inconnu, l’homme qui habite au loin, remercie quelquefois des bienfaits dont le voisin fut l’objet.
Cette même note « très bien reçu » se répète souvent, dans le diaire, accolée aux noms des ksours où le voyageur, pour une nuit, demande l’hospitalité. Dans l’un de ces villages, le 5 juin, Frère Charles rencontre Aziouel, futur successeur de l’amenokal des Taïtoq, « tout changé depuis l’an dernier, tout en confiance, tout apprivoisé ».
Trois jours plus tard, près d’un puits de la région du Touat, il trouve enfin le capitaine Dinaux, qui a pour compagnons quatre « civils » français, dont trois au moins sont fort connus : M. E. Gautier, explorateur et géographe ; M. Chudeau, géologue ; un écrivain, M. Pierre Mille, et un inspecteur des postes et télégraphes en mission, M. Étiennot. Les conversations, entre ces hommes si différents par le tempérament, les études, la curiosité de l’esprit, durent être, plus d’une fois, dignes de mémoire. Les mots sont restés dans le désert. Frère Charles avait été adjoint, pour l’ordre de marche, à M. Étiennot, qu’escortaient quinze méharistes. Mais on le trouvait souvent ailleurs, à l’écart, selon le précepte qu’il avait formulé lui-même, faisant route à pied, la tête penchée, gardant le silence afin de mieux tenir son âme en paix. « Pauvre cher Père de Foucauld, me disait Pierre Mille, je crois que nous avions tous reconnu ce qu’il valait ; c’était un homme admirable et un saint, teinté, si vous le voulez, d’orientalité ; nous l’aimions. Il nous arrivait de sourire de son extraordinaire passion du désert. Avec le sans-gêne de la jeunesse, nous l’appelions, entre nous, « celui qui trouve toujours que les tramways sont trop voisins. »
Chef de guerre, savants, artistes, religieux, ils allaient chacun cherchant son bien, et tous voulaient ainsi le bien de la France. On partait, le plus souvent, sous les étoiles, afin de faire plus de chemin avant que l’extrême chaleur n’arrêtât le pas dolent des hommes et des bêtes. Le Père de Foucauld disait la messe, fréquemment, à deux heures du matin, puis il repliait sa tente, pour ne rien retarder et ne gêner personne. Mais on dressait le camp, autant qu’il était possible, dès que le soir approchait. Le 23 juin, tandis que les méharistes enfonçaient les piquets des tentes, près du puits d’In-Ouzel, sous le regard de deux jeunes Touaregs d’une dizaine d’années et de deux esclaves, qui faisaient paître un troupeau de chameaux, un homme est signalé, qui vient, unique dans le tour d’horizon. Il presse son méhari. On le reconnaît bientôt. C’est un courrier que le capitaine Dinaux a envoyé à la recherche du nouvel amenokal du Hoggar. Il a trouvé celui-ci à Tin-Zaouaten. Il apporte une lettre de Moussa ag Amastane annonçant la prochaine venue du chef des Touaregs Hoggar. En effet, le surlendemain. Moussa entre dans le camp, et va saluer le chef français. Frère Charles le juge favorablement. « Il est très bien, dit-il, très intelligent, très ouvert, très pieux musulman, voulant le bien en musulman libéral, mais, en même temps, ambitieux et aimant argent, plaisir, honneur, comme Mahomet, la plus parfaite créature à ses yeux. Il est tout dévoué à Beï d’Attalia, de qui il dit avoir tout reçu[89]… En résumé, Moussa est un bon et pieux musulman, ayant les idées et la vie, les qualités et les vices d’un musulman logique, et en même temps l’esprit aussi ouvert que possible. Il désire beaucoup aller à Alger et en France… D’accord avec lui, mon installation au Hoggar est décidée. »
Pendant quinze jours, le jeune chef, – il a environ trente-cinq ans, – accompagnera la mission Dinaux. Enseignement mutuel dont chacun profite. Puis la colonne s’amincit. Moussa s’en va nomadiser, je ne sais où. M. E. Gautier et Pierre Mille, escortés et guidés par trois chefs des Touaregs Iforas, entreprennent de traverser le sud du Sahara, atteignent Gao, Tombouctou, et rentrent en France après avoir visité le Sénégal. Le capitaine Dinaux continue la route vers les hauts plateaux du Hoggar, et, vingt-huit jours plus tard, entre dans la vallée de Tamanrasset.
Ce nom de Tamanrasset, souligné trois fois en marge du diaire, est suivi de ces lignes où transparaît l’émotion du Père de Foucauld : « Par la grâce du divin Bien-Aimé Jésus, il m’est possible de m’installer, de me fixer à Tamanrasset, ou dans tout autre point du Hoggar, d’y avoir une maison, un jardin, et de m’y établir pour toujours… Je choisis Tamanrasset, village de vingt feux, en pleine montagne, au cœur du Hoggar et des Dag-Rali, la tribu principale, à l’écart de tous les centres importants. Il ne semble pas que jamais il doive y avoir ici garnison, télégraphe, Européen ; de longtemps il n’y aura pas de mission : je choisis ce lieu délaissé, et je m’y fixe. »
Ainsi parle la charité. Tout de suite après, le colonisateur se révèle. Il voudrait attirer et établir au Hoggar, – la liste est curieuse, et un économiste l’aurait peut-être moins bien faite, – un pépiniériste ; un puisatier ; un médecin ; quelques femmes sachant tisser la laine, le coton et le poil de chameau ; puis un ou deux marchands de cotonnades, de quincaillerie, de sucre et de sel, mais de braves gens « qui nous fassent bénir et non maudire ».
Le seul défaut de Tamanrasset, pour l’ermite, c’est l’absence de tout prêtre dans le voisinage, ou simplement à distance raisonnable. « Il me faut, à vitesse moyenne, soixante jours pour arriver à Béni-Ounif, seul point où je puis commodément trouver un prêtre. Je ne crois pas que le précepte (de la confession) oblige dans de telles conditions. Malgré ma misère, je vis tranquille et en grande paix. »
Frère Charles, ainsi qu’il l’a fait à Beni-Abbès, commence par bâtir à Tamanrasset une « maison », ou pour mieux dire une sorte de couloir de 6 mètres de long sur 1 m. 75 de large, servant de chapelle et de sacristie. Lui, il aura d’abord une hutte de roseaux, pour travailler et dormir, à quelque distance ; puis il allongera le couloir, et séparera, par un rideau, la chapelle de la bibliothèque et de la chambre. Il célèbre la première messe au Hoggar le 7 septembre 1905. Il compte demeurer là jusqu’à l’automne de 1906, partir alors pour Beni-Abbès, où il passera l’automne et l’hiver, puis revenir à Tamanrasset au commencement de l’été de 1907. Il se partagera ainsi entre les deux ermitages. Il sera le migrateur, le moine aux deux huttes, l’ami de deux peuples délaissés. Du moins tel est le projet ; s’il plaît à Dieu, est toujours sous-entendu.
Que découvre-t-il, de la porte de sa cabane, quel paysage, quels habitants ? Le haut plateau de Tamanrasset est à 1 494 mètres d’altitude. Le lit sec d’un fleuve assez large le traverse, et c’est là seulement, dans la dépression des terres, qu’il y avait quelques essais de culture, bien primitifs et mesquins, au temps où Charles de Foucauld bâtissait, près de la berge, sur la rive gauche, son oratoire et sa hutte. Tout autour, un terrain ondulé, caillouteux, où poussent des touffes d’herbes dures, une touffe tous les dix mètres : guettaf, salsolacée blanchâtre, d’un mètre de hauteur ; oum rokba, d’un vert jaunâtre, un peu moins élevé ; diss, espèce de jonc assez semblable à l’alfa : en somme un assez pauvre pâturage à chameaux. La teinte fanée de ces feuillages ne repose pas la vue et n’a point de joie en elle. La beauté de la vallée, sa grandeur, lui vient de son cadre de montagnes, car au nord, à 4 ou 5 kilomètres de l’ermitage, se lève le massif de la Koudiat, dominé par le pic Ilaman, haut de 3 000 mètres, montagnes rocheuses, entassées, nues, que le soleil colore, et surtout vers le soir, de teintes roses ou fauves, de teintes de pourpre ardente ou de pourpre violette, que ni brume ni poussière n’atténuent au passage ; à l’est, et plus rapprochée, c’est la petite chaîne de l’Hageran ; à l’ouest, les vallonnements par où tourne et s’engage la piste d’In-Salah ; au sud, la roche fendue du mont Hadrian, fameuse dans la légende touarègue[90]. À ces grandes hauteurs, enveloppées de déserts, l’air est d’une transparence parfaite et nouvelle à nos yeux ; l’automne est la plus belle saison ; les jours y sont doucement chauds, les nuits étincelantes d’étoiles ; il ne faut pas monter beaucoup pour apercevoir la croix du Sud. Quel nom magique ! Le seul rappel de ce joyau du ciel nous donne bien à rêver, et nous permet de mesurer à quelle distance de l’Europe l’infinie charité vient d’amener le Père de Foucauld.
Il est là sur le seuil de sa cabane, vêtu de sa robe blanche qui porte un cœur rouge et une croix à l’endroit de la poitrine. S’il regarde de nouveau dans la plaine, il n’y verra qu’un seul arbre, un éthel, une sorte de tamaris énorme et rond, poussé dans le lit de l’oued. À l’ombre de cette unique verdure, il a suspendu ses baromètres et ses thermomètres, sauf le grand baromètre à mercure, de 1 m. 50 de haut, qu’il a eu tant de peine à faire transporter à dos de chameau, et qu’il a accroché dans l’ermitage. Un seul arbre et pas une maison, à cette époque ; quelques zéribas seulement, des huttes de roseaux pareilles à la sienne, à demi cachées dans le lit de l’oued Tamanrasset, et où vivent des Harratins, cultivant un peu d’orge, des carottes et des piments rouges. Ce sont les compagnons ordinaires. Il y en a d’autres qui passent. Dans l’étendue errent, presque toujours, sauf dans les temps de complète sécheresse, des pasteurs touaregs, des hommes de grande tente, surveillant des troupeaux de chameaux, d’ânes, de moutons et de chèvres. Un matin, sans qu’aucun bruit ait révélé la marche d’une caravane, on aperçoit la silhouette dégingandée de quelques chameaux de plus, dont les pattes et le ventre dessinent une fenêtre, et non loin, trois ou quatre monticules qu’on n’avait pas vus la veille au soir, taupinées brunes faites en peaux de bêtes, et sous lesquelles dorment les nomades. Ces « maîtres du désert », comme on a souvent appelé les Touaregs, mènent la vie pastorale la plus nomadisante qui soit. Ils remplissent le désert de leur nom, mais ils ne sont pas très nombreux. Tamanrasset n’avait d’ordinaire qu’une soixantaine d’habitants. Le Père de Foucauld estimait que les diverses tribus Kel Ahaggar devaient compter environ 800 à 900 familles, tandis que d’autres groupes de tribus de même peuple, les Iforas par exemple, comptaient au moins 2 000 familles. L’été les chasse, les oblige à transhumer à des distances immenses, jusque dans la région soudanaise, où ils paient des droits de pacage élevés. Ils voyagent aussi pour le commerce. Des caravanes s’en vont vendre, sur les marchés du Tidikelt, des moutons et des chèvres, et rapportent des cotonnades, des dattes, du mil. D’autres Touaregs font quelque trafic avec Rhât et Rhadamès ; d’autres conduisent jusqu’à Tombouctou leurs chameaux chargés de sel des mines célèbres de Taoudéni.
Peuple misérable, au demeurant, et que tourmentent souvent la faim et la soif. Il ne sait pas d’où il vient, ni par quel événement il fut contraint de se retirer dans de si âpres régions. Longtemps on a défendu la légende de l’origine européenne des Touaregs, à cause de la blancheur de leur peau et de la croix qui figure, comme ornement, au-dessus du pommeau de leur selle, et sur leurs vêtements. L’opinion prévaut aujourd’hui que ce sont des Berbères refoulés par les invasions arabes jusqu’au fond du désert, « tout bonnement des Libyens, les derniers survivants », dit M. Émile Gautier. Et le Père de Foucauld, qui les a étudiés mieux que personne, n’était pas d’un autre avis : « Ce sont assurément des Chamites a-t-il écrit ; leur langue l’indique clairement. Leur physionomie est, lorsque le type est pur, celle des anciens Égyptiens ; très blancs, élancés, le visage long, traits réguliers, grands yeux, front un peu fuyant, bras et jambes un peu longs, un peu grêles : les Égyptiens des anciennes sculptures. Leurs usages sont très différents de ceux des Arabes ; ils sont musulmans avec beaucoup de foi, et aucune pratique ni aucune instruction[91]. » Le moyen âge semble les avoir connus ; des annales du temps des croisades parlent des hommes voilés, les Moultimin. Ils ont, en effet, le visage voilé jusqu’aux yeux, par un bandeau d’étoffe bleue, le litham. Leur orgueil est immense, leur coquetterie plus grande que celle des femmes. Quand ces hauts diables maigres, appuyés sur leur lance, s’approchent d’un étranger, ils tiennent la tête plus droite, ils affectent une démarche plus solennelle que s’ils étaient tous princes, et d’un autre temps.
La guerre, l’expédition pour la vengeance et le pillage, telle a été, jusqu’aux débuts de notre siècle, l’industrie la plus lucrative des tribus touarègues : l’homme libre ne travaille pas. Émile Gautier, artiste qui choisit bien le mot pittoresque et bref, a décrit le guerrier : « L’équipement des guerriers touaregs est bien connu : la longue lance fine, tout en fer, incrustée de cuivre, aux barbelures féroces, le grand sabre droit, à bout rond, à poignée en croix,… le bouclier en peau d’antilope, peint de graphies barbares. Ils sont prodigieusement misérables, très au delà de notre conception usuelle du mot « pauvre » ; le prix d’un winchester et de son approvisionnement annuel en cartouches, doublé ou triplé par le transport à travers 1 500 kilomètres de désert, est à peu près aussi disproportionné avec les ressources d’un Touareg moyen, que, par exemple, l’entretien d’une automobile de 60 chevaux avec le budget d’un facteur rural. »
Les combattants, quand ils vont en expédition, et que le temps est venu de la halte pour la nuit, rapprochent plusieurs boucliers et dorment sous cet abri. La tente familiale est un peu moins primitive. « Une grande peau formée d’une infinité de peaux de moutons cousues ensemble, fixée par des cordes à douze piquets, un grand piquet central qui soulève la peau, et voilà la famille touarègue logée, dit un voyageur qui a récemment visité le Hoggar[92]. Les Dag Rali que j’ai visités étant riches, avaient des tentes en belles peaux et des piquets sculptés. Pour compléter cette demeure, où le vent passe sans obstacle, on entoure la tente d’une sorte de paravent formé d’une natte en fibres, que les Touaregs fabriquent eux-mêmes. La nuit, on ferme la tente avec la natte ; le jour on roule la natte… Le mobilier se réduit à rien : quelques couvertures, les ustensiles de cuisine, le rahla pour monter à chameau, le violon (imzad) de la femme, les armes, et c’est tout. Bien entendu, le lit n’existe pas ; tous couchent à même le sol…
« Autour des tentes, nègres et négresses esclaves vaquent aux occupations du ménage. Les hommes, du moins en cette saison, ne font rien, passent le temps à palabrer ou à jouer au duel au sabre, avec les grands boucliers de peau. Les femmes s’occupent des enfants, de la cuisine qui est vraiment par trop sommaire, jouent de l’imzad, et le soir font des visites. »
Ces nomades ne se font pas seulement des visites entre elles. Fréquemment à la fin de l’après-midi, avant l’heure de la traite des bêtes, elles se rendent à une réunion galante qui rassemble les jeunes filles, les jeunes veuves ou répudiées, les jeunes hommes ou les hommes relativement jeunes et non mariés. La liberté de propos y est grande. Parfois l’ahâl se tient à l’ombre d’un arbre, s’il y en a, ou d’une roche ; d’autres fois, sous la tente d’une femme vivant seule, ou sous une tente dressée exprès. On s’assied les uns à côté des autres. On se retrouve, on cause, on invente des jeux d’esprit, une femme joue de l’imzad, le violon à une seule corde, et les hommes l’accompagnent de la voix en sourdine ; souvent les hommes récitent des vers de leur composition, ou des poésies qui se transmettent de génération en génération, dans la famille ou la tribu. De jeunes guerriers touaregs font parfois 100, 200 kilomètres, pour assister à l’ahâl d’une femme réputée pour sa beauté ou son esprit. Une étiquette traditionnelle règle toute chose dans ce coin en fête du désert. « Le vêtement, la tenue et la conversation sont régis par un code mondain nuancé, discret, absurde et inflexible. Le flirt est, bien entendu, la grande préoccupation[93]. »
La confédération du Hoggar, comme les autres confédérations touarègues, est commandée par un chef élu, l’amenokal, choisi parmi les nobles[94] ; chaque tribu obéit à un amrar. On sait déjà qu’au moment où le Père de Foucauld commençait à bâtir son ermitage à Tamanrasset, l’amenokal des Hoggars était Moussa ag Amastane. Celui-ci succédait à deux ennemis déclarés du nom français, Ahitarel, qui gouvernait la confédération lors du massacre de la mission Flatters, puis Attisi qui avait pris part personnellement au massacre. Plus habile que ses prédécesseurs, plus intelligent aussi, Moussa entra en négociation avec les chefs militaires des oasis avant même d’avoir été élu comme chef de sa nation. Au début de 1904, il concluait un traité d’amitié avec les Français, à In-Salah, se faisait reconnaître chef des Touaregs Hoggar et, – suprême adresse d’un chef de bande, – obtenait le pardon de la France pour l’ancien amenokal devenu impopulaire, Attisi, qui s’était retiré vers le sud-est, chez les Touaregs Azdjer.
Tel était le pays où le Père de Foucauld se proposait de vivre, tels étaient les Touaregs qu’il allait avoir pour compagnons et témoins. Il pouvait encore se dédire et remonter vers le nord. Cela lui fut proposé. Le capitaine Dinaux, qui avait poursuivi sa route et parcouru la région de l’Aïr, repassa au bout de cinq semaines à Tamanrasset, le 15 octobre 1905. Il s’informa des dispositions de l’ermite : elles n’avaient pas changé. Alors il lui dit adieu, consigna dans son rapport ce fait mémorable qu’un homme civilisé avait demandé, comme une grande faveur d’être laissé au Hoggar, et ajouta : « Il restera ainsi seul au milieu des Touaregs, à 700 kilomètres d’In-Salah, et ne sera relié à nous que par les courriers mensuels qu’on va essayer d’amorcer. »
Quelle foi et quelle énergie morale pour supporter victorieusement une pareille épreuve ! Pas un homme de sa race, de sa religion, de son éducation ! Aucun secours, ni pour le corps ni pour l’âme ! Pas d’espérance d’amener entièrement à soi un peuple qui ne peut, avant des années et des années, franchir tant de distance et tant d’obstacles ! Savoir de science certaine qu’on mourra, sans que la récompense, c’est-à-dire la pleine adhésion à la loi du salut et à la civilisation chrétienne ait été obtenue d’un seul ! Et cependant ne pas douter, ne pas hésiter, s’offrir résolument à une tâche qu’aucun attrait humain ne recommande, rompre avec tout ce qu’on a aimé de la terre et de l’esprit d’Europe, pour obtenir la difficile, l’incertaine, la défiante sympathie de pasteurs nomades, de guerriers habitués au pillage et de nègres misérables, voilà la vie que choisit le Père de Foucauld. La plupart des hommes, même de la trempe la plus ferme, eussent succombé à l’une ou à l’autre de ces deux tentations : le découragement ou la corruption. Il demeura pur ; il progressa dans l’art du sacrifice, le plus long de tous à apprendre et celui où la maîtrise n’est jamais assurée ; il rendit à la France le service incomparable de la faire entrevoir, car elle était présente et reconnaissable en lui ; il rendit d’autres services à la science ; il prépara tout un peuple pour les missionnaires qui viendront ; il fut le grand semeur solitaire, dont personne n’a pu compter les pas. Lui-même il ne les compta pas. Je crois tout à fait justes ces mots que m’écrivait un de ses proches parents : « Le Hoggar : c’est la période de sa vie où Charles a donné toute sa mesure. »
L’abandon semble être complet ; il va être beaucoup plus grand, comme on va le voir.
Fidèle à l’immuable résolution de préparer la conversion des infidèles, le Père de Foucauld, dès qu’il a pris possession de son ermitage, fait sa retraite, et note, dans son diaire, de quels moyens il usera en vue d’un si grand bien :
« Faire tout mon possible pour le salut des peuples infidèles de ces contrées, dans un oubli total de moi.
« Faire tous les ans la tournée des « arrhem »[95] du Hoggar ; accepter les invitations à des voyages dans le Sahara, s’ils sont utiles ; si c’est possible, passer quelques jours, chaque année, dans les tentes des Hoggar. »
Il entreprend aussitôt la traduction, en touareg, d’extraits de l’Écriture sainte, avec l’aide d’Abden Nebi, harratin de Tamanrasset, qu’il paye un prix convenu, suffisant dans le pays et en ce temps-là : 20 centimes la leçon.
Oubli total de soi, vie de prière, de charité et d’étude : comment un homme fidèle à un pareil idéal n’aurait-il pas réussi à gagner la sympathie de ces chameliers et de ces marchands sauvages, à leur faire entrevoir même la supériorité morale des chrétiens ? Comment douter que la France, dont il était ainsi un des fils modèles, bénéficiât d’un tel exil ? L’officier d’un esprit si fin et si cultivé, qui l’avait amené, puis laissé au Hoggar, le capitaine Dinaux, pouvait dire dans son rapport au gouverneur général de l’Algérie : « La réputation de sainteté du Père, les résultats qu’il a déjà obtenus dans la guérison des malades, feront plus, pour l’extension de notre influence et le ralliement à nos idées, qu’une occupation permanente du pays… La manière dont on l’y a reçu et installé est une preuve caractéristique des bonnes dispositions de Moussa. » Il ajoutait ces lignes qui lui font honneur et qui doivent être retenues : « Dans le même ordre d’idées, nous devons encourager, le plus possible, l’installation de Sœurs Blanches à demi nomades ; la situation de la femme touarègue favoriserait, au contact des femmes européennes, le perfectionnement de la race… Leur dévouement, leur douceur, leur esprit de sacrifice, auront la plus heureuse influence sur les Touaregs. »
La règle du Père de Foucauld est toujours celle des petits Frères du Sacré-Cœur, mais il a dû y apporter deux modifications : il consacre beaucoup de temps à l’étude du tamacheq, et il est obligé de sortir de la clôture, en ce début tout au moins, pour « prendre contact » avec ses voisins changeants. « Il faut faire les premiers pas » ; les Touaregs ne viennent pas d’eux-mêmes quand il n’y a pas de profit matériel à espérer. Frère Charles entrera donc dans les jardins où travaillent les harratins ; il ira causer, autour des tentes disséminées dans la plaine, avec les pasteurs et leurs esclaves. Il distribue des remèdes, il fait de petits cadeaux d’images coloriées et surtout d’aiguilles, que des femmes, de bien loin, montées sur leur âne, viennent solliciter, car la plupart du temps, elles sont réduites à coudre avec des épines, au bout desquelles elles attachent un brin de fil. Plus tard, il apprendra à tricoter, pour leur donner des leçons de tricot ; il songe au grand bienfait matériel et moral que serait l’établissement de petits ouvroirs dirigés par des Sœurs françaises, dans ces pays « où l’on travaille si peu et où l’on parle tant », où les femmes « meurent d’oisiveté ». Si on pouvait leur enseigner à tisser la laine ! Hélas ! la laine du mouton quand elle tombe, et le poil du chameau sont emportés par le vent ; « nul n’en fait rien ; une petite partie du poil de chèvre sert à faire des cordes, le reste est inutilisé ». La pensée de « son peuple » ne quitte pas ce moine colonisateur.
Il voit aussi Moussa ag Amastane, il parle de lui dans ses lettres, et la physionomie de l’amenokal, tout d’abord esquissée, devient pour nous beaucoup plus nette.
« J’ai revu une foule de Touaregs vus l’année passée ; les relations avec eux ont été bonnes. Vis-à-vis des indigènes, je ne vois pas d’autre devoir que celui de prier pour eux, de me faire aimer d’eux, de leur donner, à l’occasion, très discrètement, de bons conseils… Je m’efforce de préparer les voies aux autres, en priant Jésus de les envoyer. Il me semble que les deux choses les plus nécessaires présentement, au Hoggar, sont l’instruction et la reconstitution de la famille ; leur ignorance si profonde les rend incapables de distinguer le vrai du faux, et le relâchement de la vie de famille, suite de celui des mœurs et de divorces multipliés, laisse les enfants grandir à l’aventure sans éducation…
« L’établissement de l’autorité française, chez les Hoggar et les Taïtoq, a fait un grand pas depuis un an.
« Tant que la France n’aura pas une guerre européenne, il semble qu’il y a sécurité ; s’il y avait une guerre européenne, il y aurait probablement des soulèvements dans tout le sud, et ici comme ailleurs…
« Actuellement, les uns et les autres sont entièrement soumis et paient tribut à la France ; l’amrar des Taïtoq et l’amenokal des Hoggar ont été solennellement investis de leur autorité, au nom de la France, par le chef d’annexe d’In-Salah, de qui ils dépendent. Les Taïtoq ont pour amrar Sidi ag Geradji, vieillard intelligent mais sans grande autorité, et peu sérieux de caractère. Les Hoggar ont pour amenokal Moussa ag Amastane ; c’est un homme fort intelligent, animé de bonnes intentions, cherchant uniquement le bien des musulmans et le bien des Touaregs ; esprit large, il consacre sa vie à faire régner la paix parmi les Touaregs, à y protéger les faibles contre les violences des forts, et à s’acquérir par là, ainsi que par sa libéralité, sa piété, son amabilité, son courage, une vénération universelle d’In-Salah à Tombouctou ; le bien qu’il fait, ses efforts pour la paix et la justice ne se restreignent pas aux Hoggar mais s’étendent aux tribus voisines, Azdjers, Kel Oui, Taïtoq, Aoulimmiden ; sa modération, son esprit de paix et sa constance à soutenir les pauvres et les opprimés contre les injustices sont remarquables ; c’est un esprit ouvert, sage, modéré ; si Dieu lui prête vie, son influence ira grandissant et durera longtemps ». C’est très intéressant de voir ce mélange de grands dons naturels et d’ignorance profonde, chez cet homme qui, à certains points de vue, est un sauvage, et, à d’autres, a droit à l’estime et à la considération ; car sa justice, son courage, l’élévation et la générosité de son caractère, lui ont fait une situation hors pair, du Touat et de Rhât jusqu’au Niger. Mes relations avec lui sont excellentes. Je ne l’avais pas vu l’année dernière ; cette année, je ne l’ai pas quitté pendant près de quatre mois, il est ici même en ce moment ; il n’a pas de résidence, et est nomade comme tous ses compatriotes… Les belles qualités qu’il a excluent-elles l’ambition, la sensualité, le mépris et la haine restant au fond du cœur pour les non-musulmans ? Je ne le crois pas, mais il semble cependant qu’il y ait chez lui assez de piété vraie, pour que la recherche du bien général passe dans sa conduite avant celle de l’intérêt particulier, assez d’intelligence pour qu’il puisse modifier en bien ce qu’il y a de faux et de mauvais dans ses idées et dans son cœur[96]. »
Cette analyse détaillée du caractère de Moussa ag Amastane suppose de fréquentes relations entre lui et le Père de Foucauld. La lettre qu’on vient de lire y fait allusion, mais ne les définit pas, ne les raconte pas. Quels sujets étaient abordés, dans ces conversations entre le chrétien d’Europe et le musulman d’Afrique ? L’influence heureuse du Père de Foucauld, son autorité morale même sur le chef des Hoggars n’est pas niable. On le verra bien, plus tard, quand j’aurai à dire les derniers moments et les dernières paroles de l’amenokal. Mais quels propos l’ermite de Tamanrasset avait-il coutume de tenir, dans les visites qu’il faisait au chef ou qu’il recevait ? Se bornait-il, lui, si fervent dans sa vie privée, à de vagues conseils, n’ayant avec la loi chrétienne que des rapports lointains ou voilés prudemment ? On l’a prétendu, parce qu’il faut à nombre d’hommes des preuves positives, pour croire à des vertus, et notamment à un certain courage qu’ils n’ont pas. Et ces preuves ne pouvaient être données jusqu’à présent. Mais nous les avons.
Après la mort du Père de Foucauld, dans l’habitation qu’il occupait à Tamanrasset, on a retrouvé, parmi bien d’autres papiers dispersés et jetés dans la poussière, un carnet de notes intimes, une sorte de memento, que j’ai sous les yeux en écrivant ces lignes. Plusieurs pages portent en tête : Choses à dire à Moussa et lettres écrites à Moussa. Elles n’ont pas été dites ou écrites au début du séjour à Tamanrasset, ces choses, mais elles sont de la plus entière clarté, elles répondent à une question plus générale encore que celle qui a été posée. De quoi le Père de Foucauld parlait-il aux Touaregs, et, d’une façon plus large, aux musulmans, et jusqu’à quel point usait-il de ce droit de conseil qu’il achetait si chèrement et que son devoir strict lui eût défendu de laisser tomber ? Le voici. Je reproduirai la plus grande partie des deux documents, dont le premier porte la date de Pâques 1912, le second la date de 1914, mais qui expliquent tout le séjour à Tamanrasset, et révèlent le secret d’une action qui, toujours française, fut essentiellement et toujours religieuse.
« Dire à Moussa : 1° S’entourer de braves gens, ne pas garder dans son entourage des vauriens.
« 2° Se défendre des Arabes étrangers qui ne viennent s’installer ici que pour manger le pays, et le manger, lui, Moussa.
« 3° Favoriser la sédentarisation.
« 4° Réduire ses dépenses. Se faire petit. Dieu seul est grand. Celui qui se croit grand, ou qui cherche à être grand, ne connaît pas Dieu.
« 5° Le premier devoir est d’aimer Dieu de tout son cœur et par dessus toute chose, le deuxième, d’aimer tous les hommes comme soi-même. De cet amour du prochain comme soi-même suit la triple loi de la fraternité, de l’égalité (imrad), de la liberté (esclaves). Quand Adam bêchait et qu’Ève filait, où était le noble, où était l’amrid, où était l’esclave ?
« 6° S’il veut connaître comment pensent, parlent et agissent les prophètes, qu’il vienne me voir, je lui lirai l’Évangile.
« 7° Ne pas demander et ne pas accepter de cadeaux. En demandant des cadeaux à ses amis, il pèse lourdement sur eux ; en acceptant des cadeaux de n’importe qui, il devient l’esclave de canailles.
« 8° Payer ses dettes et ne pas en faire de nouvelles ; ne pas en faire auprès de ses amis parce que cela n’est pas digne de lui et que cela pèse lourdement sur eux. Ne pas en faire auprès d’inconnus parce que cela le rend leur esclave. Dieu, dans les livres saints, recommande maintes fois aux chefs de n’accepter aucun cadeau ; si celui de qui ils ont reçu un cadeau leur demande une chose injuste, ils ont peine à la refuser ; s’ils font le mal, ils ont peine à les punir ; il est à craindre qu’ils ne les préfèrent à d’autres aussi bons ou meilleurs qu’eux, qui n’ont rien donné.
« 9° Ne pas faire de cadeaux et ne pas donner l’hospitalité sans nécessité, sans quoi il est toujours : 1° dans les difficultés d’argent et de dettes ; 2° entouré de canailles, car c’est elles et non les braves gens qu’attire l’hospitalité ; 3° il est obligé pour y suffire de se faire faire des cadeaux considérables par ceux des imrad qui lui sont les plus dévoués, lesquels finiront par le haïr à cause de ses demandes d’argent, de son gaspillage et de son mauvais entourage.
« 10° Diminuer le nombre de ses esclaves, bande de vauriens qui le mangent, le rendent ridicule, et ne lui servent à rien.
« 11° Quand il se trouve à proximité d’un officier, aller fréquemment le voir tout seul, bien des choses se traitant mieux en tête à tête, et parler avec lui sans interprète, s’ouvrir entièrement en toute sincérité à l’officier comme à son plus réel ami : ne jamais dire l’ombre d’un mensonge. Pour toutes les affaires graves, traiter toujours en tête à tête, sans interprète, avec l’officier.
« 12° Ne jamais mentir à personne ; tout mensonge est contraire à Dieu, car Dieu est vérité.
« 13° Donner toujours comme guides des gens remarquablement bien, parce que souvent on juge d’après eux tous les autres Touaregs.
« 14° Ne jamais louer personne en face ; quand on aime et estime quelqu’un, cela paraît par la confiance et les actes ; inutile de le dire ; flatter est une bassesse bonne pour les thalebs arabes.
« 15° Ne pas être lent et paresseux, savoir ménager son temps.
« 16° Faire apprendre le français vigoureusement à son monde, pour être naturalisé Français, pour être non nos sujets, mais nos égaux, être partout sur le même pied que nous, ne pouvoir nulle part être ennuyé par personne. Cela viendra tôt ou tard ; ceux qui voient venir de loin les choses prendront les devants ; grâce à cela et probablement dans un laps de temps court, tous les militaires et employés de l’Ahaggar seront de la race du pays.
« 17° Ne jamais faire de cadeau proprement dit à aucun Français ; cela ennuie ceux à qui il les fait au lieu de leur plaire ; car c’est une charge et pour lui (à qui on désire les éviter), et à ceux qui les reçoivent (qui rendront toujours un cadeau) ; quand un Français accepte ses dons, ce n’est que par politesse seule et à regret. Ne demander au capitaine ni sucre, ni thé, ni rien ; emporter ce qu’il faut et supporter si quelque chose lui manque. En demandant, il obtient ce qu’il désire, mais en même temps, il obtient toujours ce qu’il ne désire pas, le mépris. »
« Lettres écrites à Moussa : Aime Dieu par-dessus toute chose, de tout ton cœur, de toutes tes forces, et de tout ton esprit.
« Aime tous les hommes comme toi-même pour l’amour de Dieu.
« Fais à tous les hommes ce que tu voudrais qu’on te fît.
« Ne fais à personne ce que tu ne voudrais pas qu’on te fît.
« Humilie-toi en toi-même ; Dieu seul est grand ; tous les hommes sont petits ; l’homme qui s’enorgueillit est insensé, car il ignore s’il ira au ciel ou en enfer.
« Dieu voit toutes tes pensées, tes paroles et tes actions ; souviens-toi et fais-les toutes en pensant qu’il les voit.
« Fais chaque acte comme tu voudrais l’avoir fait à l’heure de la mort.
« L’heure de la mort est inconnue ; que ton âme soit continuellement comme tu veux qu’elle soit à l’heure de la mort.
« Chaque soir, réfléchis aux pensées, paroles, actions de ta journée ; demande pardon à Dieu de ceux qui sont mauvais et de tous les péchés de ta vie, comme si tu allais mourir dans la nuit, et dis à Dieu du fond du cœur :
« Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, par-dessus tout.
« Mon Dieu, tout ce que vous voulez, je le veux.
« Mon Dieu, tout ce que vous voulez que je fasse, je veux le faire. »
N’est-ce pas là le résumé de toute la morale évangélique, et faut-il faire remarquer qu’un pareil enseignement, commenté par des conversations fréquentes, soit avec Moussa, soit avec les Touaregs et les Harratins du Hoggar, était admirablement fait pour préparer le chef et son peuple à recevoir et à comprendre le dogme catholique ? Le pauvre Saharien qui accepte de faire l’examen de conscience et de dire la prière qui termine la citation que voilà, n’est-il pas dans la disposition la plus parfaite pour mériter et désirer de connaître toute la vérité ? Et comme il serait près de nous ! Et comme les traités tiendraient mieux avec des hommes ainsi formés ! Frère Charles, habitant au milieu d’eux, et n’ayant de relations qu’avec eux, juge vite les Touaregs. Il les compare aux Arabes ; des deux côtés même ignorance et même violence. Mais l’ignorance des Touaregs peut être plus aisément combattue et vaincue, parce qu’ils sont de nature plus aimable, plus curieuse aussi. Leur défaut premier est l’orgueil. Ces nomades d’une tribu du Sahara, « les plus orgueilleux des hommes », nous regardent comme des sauvages. Ils s’estiment eux-mêmes comme les créatures humaines les plus parfaites, « ce qu’il y a de mieux sur la terre ». Ils nous prennent même pour des ignorants, et ce serait là, sans doute, comme un signe de folie, si le plus pauvre prétexte ne leur était fourni, – l’orgueil se contente de peu et parfois même de rien, – par le genre de vie qui est le leur, par l’extrême éloignement et les obstacles de tout genre qui rendent leur pays comme inaccessible. Un des officiers les plus connus de notre armée d’Afrique, expert en toute question saharienne, et que j’interrogeais à Alger sur cet incroyable dédain qu’éprouvent ou affectent les indigènes à notre égard, me répondit : « Ils ont le sentiment que nous sommes à leur merci, toutes les fois que nous leur demandons de nous servir de guides dans le désert, ou de nous conseiller pour une opération de police. Les indigènes nous sentent inférieurs à eux, dans leur milieu, et cela suffit. Notre machinisme les impressionne peu. Une image, une légende, leur semblent une explication et satisfont leur très superficiel désir de savoir. Ainsi pour eux, l’avion n’est qu’une « tente qui vole » ; la télégraphie sans fil, l’utilisation du vent que nous envoyons d’un poste à l’autre ; l’automobile, une boîte de fer où nous avons emprisonné les génies du feu. Ce sont les génies qui font tourner les roues. Et la preuve, c’est la bastonnade (le tour de manivelle) que nous leur donnons au départ, pour les forcer à travailler. Quand une fois l’indigène a entendu ces faibles démonstrations, il se tient pour renseigné, et comme il n’éprouve aucun besoin de changer ses coutumes, que les caravanes de chameaux lui semblent le meilleur moyen de transporter les dattes, le mil et le sel, de même que les coureurs pour transmettre les nouvelles, il accepte de se servir de nos inventions, mais ne nous estime pas à cause d’elles, ayant pu vivre à moins de frais, librement, comme il lui plaît, avant qu’elles fussent connues. »
L’explication de l’orgueil des indigènes n’est pas toute là. On leur a dit, ils ont cru voir, à bien des signes, que les Européens, et particulièrement les Français, étaient des hommes incrédules. C’est une autre erreur, une autre ignorance, plus grave que la première, mais qui s’explique par notre faute, et ils disent : « Vous avez la terre, mais nous avons le ciel. »
Le Père de Foucauld, à qui ce sujet était familier, pouvait donc en toute justice conclure de cette manière :
« Nos nations civilisées – qui ont parmi elles bien des sauvages, bien des gens ignorant les premières vérités, et aussi violents que les Touaregs – sont bien coupables de ne pas éclairer, répandre le bien, l’instruction, des lois de paix dans ces pays si arriérés. Cela serait si facile ! et au lieu de cela, on se consume en folies, ou en guerres, ou en contradictions insensées[97]. »
Tels étaient les compagnons parmi lesquels on peut bien dire que le Père de Foucauld vivait en solitude. Il avait son refuge dans l’adoration du Saint-Sacrement et la célébration de la messe. Mais la consécration du corps du Christ supposait, à côté du prêtre, un servant de messe. Or, une lettre au Père Guérin, datée du 2 avril 1906, laisse prévoir qu’il va être nécessaire de se séparer du nègre, l’ancien esclave amené de Beni-Abbès jusque dans l’Ahaggar. « Paul va de mal en pis, – au moral ; – l’impossibilité de dire la messe sans lui me fait seule le garder. Si j’étais obligé de me séparer de lui, ou s’il me quittait de lui-même, pourrais-je dire la sainte messe, tous les quinze jours, seul, pour renouveler les saintes espèces ? Pourrais-je me communier moi-même chaque jour, comme les prêtres en prison ?… À la grâce de Dieu ! Je suis le plus heureux des hommes ; la solitude avec Jésus est un tête à tête délicieux, mais je voudrais que le bien se fasse, s’étende, se propage ; toutefois, non mea voluntas, sed tua fiat !… Mon âme est en grande paix. Je suis plein de misères, mais sans aucune chose grave me tourmentant. Je suis heureux et paisible aux pieds du Bien Aimé ! »
La volonté de Dieu fut que l’épreuve arrivât, et que le courage de son prêtre parût avec plus d’éclat. À la date du 17 mai, le diaire nous apprend que Paul quitte la Fraternité de Tamanrasset. Frère Charles n’explique rien, il n’a qu’un mot de miséricorde : « Mon Dieu ! faites que je puisse continuer à célébrer le saint sacrifice ! Faites que cette âme ne se perde pas ! Sauvez-la ! »
Dans ses lettres il annonce une prochaine visite au Hoggar. « J’attends la visite de mon vieil et bon ami Motylinski, ancien interprète militaire, un des hommes les plus savants d’Algérie, qui a demandé à passer l’été avec moi, pour faire du tamacheq… Je prépare grammaire, lexique tamacheq-français et français-tamacheq, et traduction d’extraits de la Bible, formant à la fois une histoire sainte abrégée et une collection des passages les plus utiles, dans ce milieu, des livres poétiques, sapientiaux et prophétiques. Tout cela est assez avancé, et peut être fini d’ici deux ou trois mois. »
Le jour de la Pentecôte, 3 juin 1906, Motylinski arrive, « très bon cœur, écrit le Père de Foucauld, qui contribuera à nous faire des amis des Touaregs ». Et Motylinski accepte de répondre la messe. « Le bon Dieu l’a envoyé ici juste à point pour me permettre de continuer de la dire. »
Ce séjour de M. de Motylinski au Hoggar dura trois mois, pendant lesquels les travaux de linguistique firent de grand progrès. Au début de septembre, les deux amis partirent pour le « nord », qu’ici nous appelons l’extrême-sud oranais. Le Père de Foucauld voulait revoir Beni-Abbès. Il y trouva un accueil auquel, modestement, il ne s’attendait pas. « J’ai été très content de ce que j’ai trouvé à Beni-Abbès : les Français, parfaits pour moi, au delà de toute expression, et les indigènes de la Saoura bien au delà de tout espoir. » Ce fut un voyage très rapide : le Père de Foucauld, que Motylinski avait quitté à El-Goléa, – direction Ghardaïa et Biskra, – remonta encore au nord, passa quelques jours à Maison-Carrée, près du Père Guérin et de ses amis les Pères Blancs, puis revint en hâte vers le Hoggar. « Le Hoggar est encore si neuf, disait-il, si peu fait à notre présence, que je crois bien désirable de m’en absenter le moins longtemps possible. » Et il repartit d’Alger le 10 décembre, avec l’intention de passer quelques semaines à Beni-Abbès, puis de piquer au sud et de regagner Tamanrasset.
Merveille véritable : il avait un compagnon ! Non pas un amateur ou un savant en excursion, mais un compagnon qui se disait résolu à suivre l’ermite au désert. C’était un jeune breton, fils de pêcheur, qui avait passé trois ans chez les Pères Blancs, puis trois autres années dans un régiment de zouaves, en Afrique. Il cherchait sa voie définitive, et crut l’avoir trouvée en écoutant les récits qu’on faisait de l’apostolat du Père de Foucauld. Ils partirent donc ensemble. Après avoir passé toute la soirée et toute la nuit, en compagnie d’indigènes, dans une des voitures du petit train qui part d’Oran et s’approche de la frontière marocaine jusqu’à la toucher vers Beni-Ounif, le Père et Frère Michel vêtu à l’arabe descendirent à la station d’Aïn-Sefra, chef-lieu de la subdivision militaire. J’ai passé là ; c’est un village, presque une ville bâtie à gauche du chemin de fer, au delà d’un large espace où le sable vole ; maisons claires, bureau de renseignements et cercle construits en style mauresque ; petites boutiques d’un poste du sud ; on voit, parmi les toits, des touffes d’arbres, et, tout en arrière, des éperons de grandes dunes qui avancent, et une montagne. Une quinzaine d’officiers étaient venus attendre à la gare leur ancien camarade et, parmi eux, le général Lyautey, qui lui offrit l’hospitalité. « Je le trouvai pauvre et négligé, lui autrefois si raffiné, m’a raconté le maréchal. Et cela était voulu. Il ne restait plus rien de l’ancien Foucauld. Si, quelque chose : les yeux, qui étaient beaux, illuminés. Les officiers l’adoraient. Il monta à cheval avec eux, pieds nus. Je lui avais donné une chambre. Quand il nous quitta, le lendemain, je venais de recevoir un télégramme m’annonçant que des amis allaient arriver. Je dis à l’ordonnance :
« – Dépêche-toi de faire la chambre !
« – Ça sera vite fait, mon général !
« – Pourquoi ?
« – Le lit n’a pas été touché ; aucun objet n’a été déplacé, il a couché sur le carreau. »
C’était l’habitude.
D’Aïn-Sefra, les deux voyageurs gagnèrent Colomb-Béchar par le chemin de fer. Ils s’arrêtèrent cependant vingt-quatre heures à Beni-Ounif, et, sur l’invitation du commandant Pariel, déjà populaire et parfaitement en sécurité dans l’oasis marocaine, visitèrent Figuig, où trois ans plus tôt, le gouverneur général de l’Algérie avait été accueilli à coups de fusil. C’est peu de chose, une promenade sous les palmiers et dans les ksours, une conversation de quelques minutes avec les indigènes, tout blancs dans l’ombre bleue des ruelles tournantes, un salut, un mot d’amitié, une aumône. Cependant, certains êtres ont un pouvoir mystérieux : ils passent, et celui qui les a seulement aperçus, touchés, entendus un instant, ne peut plus les oublier. À plus de treize ans de distance, au printemps de 1920, j’ai retrouvé très vivant, à Figuig, le souvenir de la visite du Père de Foucauld. Un des soldats du maghzen, un cavalier magnifique dans son costume de haute couleur, un homme au visage grave et doux, que j’interrogeais, m’a répondu :
– Tu veux parler du marabout chrétien ? Oui, je me le rappelle.
– Qu’as-tu pensé de lui ?
– Ce que tout le monde pensait : c’était l’homme du bien.
Après Colomb-Béchar, pour gagner Beni-Abbès, il n’y a plus de chemin de fer, plus de route, et le compagnon commençait à proprement parler l’apprentissage du voyage en pays saharien. Il a écrit ses impressions ; il a jugé son « supérieur », et les pages de ce récit sont un des documents qui font le mieux connaître ce qu’était la vie du Père de Foucauld, soit pendant les jours de marche dans le désert, soit à Beni-Abbès.
Récit du Frère Michel : « Nous atteignons Colomb-Béchar, point terminus de la voie ferrée. À la gare, les officiers français de la garnison viennent encore chercher mon vénéré supérieur, qui reçoit l’hospitalité chez l’un d’eux, tandis que j’allais loger, comme il était convenu, dans un modeste hôtel. Le premier soin du Père, à notre arrivée, fut de louer un domestique qui serait chargé, pendant la traversée du Sahara, de conduire et de soigner les deux chameaux qui portent nos bagages et nos provisions. C’était un grand enfant de trente ans, un nègre, ancien esclave de Tombouctou, nommé Oubargua, buveur et entêté, vaniteux, menteur, paresseux et gourmand, d’une malpropreté repoussante et sans aucune religion. Il avait accepté avec joie de servir le Père, qu’il croyait très riche, dans l’espoir d’avoir une nourriture abondante et délicate, et aussi peu de travail. Au bout de quelques jours, grand fut son désappointement, quand il vit qu’au lieu de faire bonne chère, il avait tout juste le suffisant. Aussi était-il bien résolu à quitter cette place, dès qu’il en trouverait une autre où il serait mieux nourri.
« Le lendemain matin, nous faisions notre entrée dans le désert, escortés de cinq ou six goumiers commandés par un sergent. Les soldats nous précédaient toujours de quelques pas, et fouillaient avec soin tous les buissons, tous les plis de terrain, pour voir s’ils ne cachaient pas des pillards de caravanes. Après trois jours de marche, sans aucune fâcheuse rencontre, nous arrivons enfin à Beni-Abbès, où le Père avait établi ce qu’il appelait son premier ermitage, et où nous devions nous reposer pendant quelques jours. C’était un bien modeste couvent, construit en terre et en bois, comme toutes les cabanes du pays. Les cellules, au nombre de sept ou huit, destinées aux futurs religieux, étaient si basses qu’un homme de taille ordinaire atteignait le plafond en élevant un peu la main au-dessus de sa tête, si étroites qu’en étendant les bras en forme de croix on pouvait toucher la muraille à droite et à gauche. Point de lit, point de siège, point de table, point de prie-Dieu pour s’agenouiller. On devait coucher tout habillé sur une natte de palmier étendue par terre. La sacristie, assez grande, servait au Père de bibliothèque et de magasin, de chambre à coucher et de cabinet de travail. La chapelle était un édifice bâti comme tout le reste, en bois et en terre, et surmonté d’un campanile ; l’intérieur ne contenait d’autre meuble qu’un autel bien simple et deux prie-Dieu. On devait donc, pendant les longs offices et les exercices de piété de la journée et de la nuit, se tenir debout, ou à genoux, ou assis sur des nattes. Près de la sacristie, il y avait une belle chambre, complètement vide, réservée, dans la pensée du Père, aux étrangers de passage, au préfet apostolique, aux officiers, à d’autres personnages distingués qui pourraient venir le visiter. Nous passâmes toutes les fêtes de Noël dans cet ermitage. À la messe de minuit, il y eut une centaine d’assistants, tous officiers, sous-officiers ou soldats, qui remplissaient, non seulement l’église, mais encore la sacristie. Je remarquai une seule femme dans cette nombreuse assemblée. C’était une vieille mulâtresse, très pauvre, complètement aveugle, une belle âme enchâssée dans un vilain corps, que le Père avait baptisée depuis trois ou quatre ans, et qu’il faisait vivre de ses aumônes. Elle consacrait toutes ses journées à la prière, et ne manquait pas de communier toutes les fois que le saint sacrifice de la messe était offert à Beni-Abbès. Au départ de son bienfaiteur, elle pleurait à chaudes larmes et poussait des cris de douleur.
« Voici le règlement que nous suivions pendant les dix journées que nous avons passées dans cet ermitage. Comme nous n’avions pas de lampes pour nous éclairer, et qu’il nous fallait économiser la cire et les bougies nécessaires aux longues et fréquentes cérémonies liturgiques, notre lever et notre coucher étaient réglés sur le soleil. Le Père, qui aimait l’exactitude, remplissait lui-même la pénible fonction de réglementaire, exercée d’ordinaire, dans les communautés, par le plus jeune et le moins digne. Il venait me réveiller le matin, à la pointe du jour. Comme nous couchions tout habillés, notre toilette était vite terminée, et, quelques minutes après le lever, ayant dit dans ma cellule l’angélus au son de la clochette, j’allais à l’église. Mon supérieur récitait alors une longue prière, moitié en latin moitié en français, à laquelle je répondais ; il exposait le Saint-Sacrement au chant du Tantum ergo, puis célébrait la sainte messe que je servais, et pendant laquelle je communiais. Nous restions en silence et en adoration pendant plus de deux heures. L’action de grâces et l’oraison terminées, le Père récitait son bréviaire, à voix basse, pendant que, de mon côté, je récitais des Pater et des Ave. Avant de sortir de la chapelle, le Père donnait la bénédiction du Très Saint-Sacrement, et renfermait dans le tabernacle, le saint ciboire. Vers 9 heures, nous allions chacun à notre besogne : mon supérieur s’enfermait dans la sacristie où se trouvaient ses livres et ses manuscrits, et il faisait sa correspondance, ou travaillait à son dictionnaire de langue touarègue, écrivant toujours, à défaut de table, sur une simple caisse. Pour moi, je me retirais dans ma cellule, la seule qui eût une cheminée, et qui servait à la fois d’atelier, de cuisine et de réfectoire. Là, je faisais une lecture de piété, puis je m’occupais, soit à moudre du blé entre deux pierres, comme les gens du pays, soit à écraser, avec un pilon, des dattes dans on mortier, soit à cuire des galettes sous la cendre, soit à préparer la cuisine. À 11 heures avait lieu le repas, précédé d’une lecture d’un chapitre du Nouveau Testament et de l’examen particulier. Après avoir dit le Benedicite, le Père lisait, debout, à haute voix, deux ou trois passages d’un chapitre de l’Imitation ; alors nous nous asseyions sur nos nattes, autour de la casserole, posée à terre, sortant du feu, le Père, notre domestique nègre et moi, et nous mangions dans le plus grand silence, pêchant au plat à l’aide d’une cuillère, buvant de l’eau au même pichet. Le menu était peu varié : il se composait tantôt d’un plat de riz apprêté avec de l’eau et par extraordinaire avec du lait condensé, mélangé parfois de carottes et de navets qui poussent dans les sables du désert, tantôt d’une sorte de marmelade d’un goût assez agréable, faite avec de la farine de blé, des dattes écrasées et de l’eau. Point de serviettes, point de nappe, ni assiettes, ni couteaux, ni fourchettes pour prendre cette légère collation. Nous nous levions au bout d’un quart d’heure ou vingt minutes, et, les prières de l’action de grâces récitées, nous allions tous les deux à la chapelle en psalmodiant le Miserere, pour faire une visite au Très Saint-Sacrement et la lecture spirituelle en commun. Vers deux heures, nous retournions chacun de notre côté à nos occupations habituelles, le Père à ses études, moi à un travail manuel. À 6 heures du soir avait lieu le souper, à un seul service, comme le repas, pris de la même façon et expédié avec la même rapidité. Vers 6 heures et demie, nous allions à l’église faire oraison devant le Très Saint-Sacrement exposé, puis une longue prière du soir suivie de la bénédiction du Saint-Sacrement. Nous terminions la journée par le chant du Veni Creator. Le coucher était fixé régulièrement au crépuscule, mais il faisait toujours nuit quand nous allions prendre notre repos.
« Nous demeurâmes plus d’une semaine dans cette oasis de Beni-Abbès, fidèles observateurs du règlement austère que je viens de faire connaître. Le 27 décembre 1906, nous continuâmes notre voyage, accompagnés de plusieurs officiers, entre autres du capitaine qui commandait la garnison, et de deux soldats indigènes. Les officiers firent route avec nous pendant une journée complète. Dans l’après-midi, un troupeau de gazelles passa devant notre caravane, à une assez grande distance, et s’arrêta pour nous regarder. Un de nos méharistes, aussitôt, ajusta l’une d’elles et l’abattit d’un coup de fusil. On la dépeça et on la fit rôtir. Le souper fut un vrai régal, auquel tous prirent part, même mon vénéré supérieur.
« Le lendemain matin, les officiers nous quittèrent, après un échange de bons souhaits et de chaleureuses poignées de main, nous laissant les deux soldats indigènes pour nous protéger. Le Père, au moment de la séparation, remit la clef de son ermitage de Beni-Abbès au capitaine, en lui disant : « Gardez bien la maison du Bon Dieu, je vous la confie. »
« Pendant toute cette traversée du désert, qui eut lieu en hiver, la température du jour était de quinze à vingt degrés de chaleur, celle de la nuit de deux à trois degrés de froid. Le matin, nous trouvions quelquefois l’eau gelée dans la burette et la terre couverte d’une couche légère de glace. De temps en temps, soufflait un vent impétueux, qui formait des nuages épais de poussière, et nous envoyait du sable dans les yeux et de petits cailloux qui nous frappaient au visage. Quand nous arrivions le soir dans un village, on nous offrait toujours l’hospitalité, et nous passions la nuit dans une maison. Le plus souvent, nous couchions à la belle étoile, sans feu, dans un trou assez grand pour loger le corps d’un homme, que nous creusions nous-mêmes dans le sable avec les mains, et qui nous servait de lit. Transis de froid, roulés dans la couverture de campement, nous nous tournions et retournions sur notre natte pendant des nuits entières, pour nous réchauffer et appeler le sommeil, sans pouvoir y réussir. Vers midi, nous faisions halte d’une bonne heure, qui nous permettait d’allumer le feu, de faire la cuisine et de dîner ; le soir, un peu avant le coucher du soleil, à l’endroit où nous devions camper, avait lieu le souper ; le menu de ces deux repas était celui de l’ermitage, auquel on ajoutait une tasse de café. Un jour, le Père invita quelques officiers à sa table en plaisantant ; ceux-ci acceptèrent la gageure ; mais, pendant tout le repas, ils parurent fort gênés, mangèrent avec une extrême répugnance, et furent vite rassasiés : ils n’eurent pas envie, je présume, de recevoir une seconde invitation à pareil festin.
« Au sein de la silencieuse nature, dans cette terre morte, où jamais être humain n’a fixé sa demeure, il nous était facile de mener la vie de solitude et de contemplation. Le Père ne manqua pas une seule fois de célébrer les saints mystères sur un autel portatif, au lever du soleil, le plus souvent en plein air, trois ou quatre fois seulement, pour ne pas essuyer la bourrasque, sous la tente que nous avions dressée la veille au soir.
« Comme Moïse, je devais seulement voir de loin la terre promise. Déjà assez mal portant au départ d’Alger, je tombai sérieusement malade, un peu plus de deux mois après notre départ de Beni-Abbès, et je me sentis incapable de continuer ce pénible voyage à pied dans les sables. Je dus m’arrêter à In-Salah, et renoncer, à mon grand regret, à la mission des Touaregs. Le bon Père essaya d’abord de me retenir, mais m’ayant fait visiter par le major de la garnison,… voyant bien aussi que j’étais à bout de forces et que je serais pour lui plutôt un embarras qu’une aide, il me donna une bonne somme d’argent et des vivres en abondance, et me remit entre les mains de deux hommes de confiance…
« Je suis resté avec le révérend Père Charles de Jésus du 2 ou 3 décembre 1906 au 10 mars 1907 ; j’ai donc vécu avec lui pendant trois mois dans la plus grande intimité. Je puis affirmer, sous la foi du serment, qu’il m’a toujours grandement édifié par sa tendre dévotion au Sacré-Cœur, au Très Saint-Sacrement et à la Très Sainte Vierge Marie, par son zèle ardent des âmes et sa charité envers le prochain, par son esprit de foi, sa ferme espérance et son détachement complet des biens de la terre, par son humilité profonde, sa patience imperturbable dans les épreuves, et surtout par sa mortification effrayante. Pour dire toute la vérité, je dois cependant signaler une imperfection, assez commune aux hommes qui ont exercé longtemps l’autorité, que j’ai aperçue dans mon digne supérieur. Il lui échappait de temps en temps, quand les choses n’allaient pas à son gré, un mouvement d’impatience qui, du reste, était promptement réprimé. À part ce léger défaut, dont il a dû se corriger, j’estime que le Père Charles pratiquait à un degré héroïque les trois vertus théologales et les quatre vertus cardinales, ainsi que les vertus morales qui en sont les annexes.
« Charité envers Dieu. – Il aimait passionnément Jésus-Christ, son Dieu, son frère, son ami, et son grand bonheur était de converser avec le prisonnier d’amour, réellement présent au tabernacle. La prière faisait ses délices ; elle était vraiment sa vie et la respiration de son âme. Il passait la plus grande partie de ses journées et de ses nuits agenouillé devant le Très Saint-Sacrement, adorant, suppliant, remerciant, réparant. Comme, la nuit de Noël, il n’avait pas quitté un seul instant notre église, j’osai lui demander, le lendemain, comment il pouvait rester si longtemps éveillé au milieu des plus épaisses ténèbres : « On n’a pas besoin de voir clair, me répondit-il, pour parler à Celui qui est le soleil de justice et la lumière du monde. »
« Désir du martyre. – Il aurait voulu donner à Jésus-Christ la plus grande preuve d’affection et de dévouement qu’un ami puisse donner à un ami, en mourant pour lui, comme Il est mort pour nous. Il désirait et demandait à Dieu, avec instance, le martyre, comme le plus grand de tous les bienfaits. La perspective d’une immolation, dont la beauté et la grandeur exaltaient sa foi généreuse, transformait sa parole, toujours ferme et ardente, en véritables chants de joie. « Si je pouvais un jour être tué par les païens, disait-il, quelle belle mort ! Mon bien cher frère, quel honneur et quel bonheur, si Dieu voulait m’exaucer ! »
« Humilité. – Cet ancien saint-cyrien était le plus humble des hommes. Je ne l’ai jamais entendu parler de lui d’une manière avantageuse. Il fallait l’interroger pour savoir quelque chose de sa famille, de son passé, de ses succès. Un jour, je lui demandai combien d’âmes païennes il avait converties : « Une seule, me répondit-il modestement, cette vieille mulâtresse que vous avez vue à l’ermitage de Beni-Abbès.
« – N’avez-vous pas fait d’autres conquêtes ?
« – Oui, c’est vrai, j’ai encore baptisé un petit enfant en « danger de mort, qui a eu le bonheur de quitter presque aussitôt cette terre pour s’envoler au ciel. J’ai enfin administré le baptême à un garçon de treize ans, mais ce n’est pas moi qui l’ai converti, il m’a été présenté par un sergent français, qui lui avait fait le catéchisme et l’avait préparé à recevoir les sacrements. Vous voyez, mon cher frère, que je suis vraiment un serviteur inutile. »
« Il aime, il cherche les avanies, les dérisions, les outrages, par un extérieur qu’il s’efforce de rendre extravagant. Il marche toujours les pieds nus et crevassés par le froid, dans de grossières sandales. Il porte une robe de toile écrue, toujours trop courte, souvent maculée et déchirée. Il se coupe lui-même la barbe et les cheveux, sans se servir de miroir. Que lui importe ce qu’on peut penser et dire à son sujet ? Pourvu qu’il plaise à Dieu, il ne se met pas en peine du jugement des hommes.
« Mortification. – Comme tous les saints, le Père Charles de Jésus n’a cessé de crucifier sa chair. En chemin de fer, il choisit toujours un compartiment de troisième classe ; dans les plaines sablonneuses du Sahara, il marche toujours à pied, bien qu’il soit excellent cavalier. Les soldats qui nous escortaient nous offraient leurs montures, quand ils mettaient pied à terre pour se délasser ; une seule fois, le Père, étant extrêmement fatigué, consentit, sur mes instances, à aller à cheval. Quand nous faisions une halte, harassés et le corps en sueur, il me donnait son burnous pour me couvrir, tandis que lui, revêtu seulement de sa robe de toile légère, tremblait de froid. Je ne l’ai jamais vu boire du vin ou des liqueurs, et il ne m’a jamais permis d’en accepter, quand les officiers m’en offraient. Sur ce point de sa règle, il était inexorable, et il déclarait qu’il ne me donnerait jamais de dispense. Une seule fois, il a mangé de la viande en ma présence, avec tous les gens de la caravane. Je ne l’ai jamais vu non plus déjeuner le matin pendant que nous séjournions à Beni-Abbès ; il se contentait du dîner de 11 heures et du souper de 6 heures du soir, dont j’ai fait connaître le menu. Il m’obligeait au contraire à interrompre l’oraison, et à sortir de la chapelle pendant dix minutes, tous les jours, vers 7 heures du matin pour aller prendre une tasse de café et un morceau de galette.
« Pauvreté. – Il ne faisait jamais une dépense sans qu’elle fût absolument nécessaire. Comme il voyageait à peu près six mois de l’année, je lui conseillai d’acheter un troisième chameau qui lui servirait de monture au lieu d’aller à pied. « Non, me dit-il énergiquement, je vis aux frais de ma famille ; de plus, je dois secourir les pauvres, je n’ai pas le droit de faire cette dépense. J’ai deux chameaux, nécessaires pour porter nos provisions de route et nos bagages, un troisième serait superflu[98]. »
« Je me souviendrai jusqu’à la fin de ma vie de la messe du Père Charles, que j’ai eu le bonheur de servir si souvent. Il la disait sans lenteur comme sans précipitation, dévotement, dignement, avec une humilité, une foi, un air de componction qui m’impressionnaient vivement.
« Générosité. – Ce gentilhomme… était généreux jusqu’à la prodigalité, et donnait sans compter. Quand nous entrions dans un village, ce qui arrivait presque tous les jours, et même de temps en temps deux fois dans la même journée, les habitants, en grand nombre, le caïd à leur tête, attirés par la réputation de sainteté du grand moine, venaient à sa rencontre, et se pressaient auprès de lui pour le voir et l’entendre. Ils saluaient le Père avec vénération, lui baisaient la main en lui donnant le titre de Sidi Marabout. Dans cette foule, se glissait parfois un Européen qui, avec un appareil de photographie, essayait de prendre le portrait de cet homme extraordinaire. Une multitude de mendiants surtout accouraient, et assiégeaient celui qu’ils appelaient leur bienfaiteur, pour avoir l’aumône. Le Père alors distribuait une somme de quinze à vingt francs, en menue monnaie, à ceux qui lui paraissaient les moins misérables ; à ceux qui étaient déguenillés et presque nus, il donnait des morceaux d’étoffe, en leur recommandant d’en faire une robe pour se vêtir.
« Travail. – Le Père Charles entendait manger son pain à la sueur de son front ; il n’y avait aucun vide dans ses journées. Dans le désert, aux heures de halte, au lieu de faire la sieste ou de se reposer, même quand il était exténué par une longue marche au soleil, il travaillait à son dictionnaire, qu’« il avait à cœur de terminer avant sa mort pour faciliter la tâche des futurs missionnaires ». Je puis affirmer qu’il ne fumait jamais, même quand il était en compagnie des membres de sa famille ou de ses anciens camarades du régiment…
« Pendant notre séjour à l’ermitage, quand il n’était pas à la chapelle à prier, j’étais sûr de le trouver à la sacristie, une plume ou un livre à la main. Je ne l’ai jamais vu faire une promenade en dehors de la clôture, ou dans notre jardin. Il ne prenait jamais de récréation. Pour se reposer, après la prière et l’étude, il faisait de petites croix en bois qui faisaient toute la décoration des pauvres cellules ; il peignait des images du Sacré-Cœur ou de la Très Sainte Vierge, et dessinait toutes sortes d’emblèmes religieux dont il ornait notre modeste chapelle et la sacristie ; il écrivait en belle ronde ou en gothique, sur des pancartes, les sentences les plus édifiantes des anciens Pères de la Thébaïde, les maximes des saints docteurs ou des saints martyrs les plus propres à inspirer l’esprit de sacrifice, et les plaçait sur toutes les murailles.
« Il m’a été bien doux de parler du révérend Père Charles de Jésus, qui m’a donné tant et de si beaux exemples de toutes les vertus pendant le temps trop court que j’ai eu le bonheur de vivre dans son intimité. J’ai été son premier et son dernier disciple. Je demande à Dieu d’être, dans la mesure de mes forces, son imitateur. »
La petite espérance d’avoir un compagnon de mission, peut-être un successeur, s’en retourne vers le nord avec Frère Michel[99].
En même temps, le colonel Laperrine, passant à In-Salah, apprend au Père de Foucauld la mort de M. de Motylinski, survenue le 2 mars 1907. Cette peine, et la déception qui l’avait précédée, ne découragent pas l’homme énergique qu’est Frère Charles, mais il songe à la précarité de son œuvre. Il écrira bientôt au Père Voillard (6 mai 1907) : « Je vieillis, et je voudrais voir quelqu’un de meilleur que moi me remplaçant à Tamanrasset, un autre meilleur que moi installé à Beni-Abbès, de manière que Jésus continue à résider en ces deux lieux, et que les âmes y reçoivent de plus en plus. »
En attendant cette joie de l’ouvrier successeur qui s’éloigne toujours, Frère Charles installe, – ce qui est un bien gros mot pour un propriétaire sans mobilier, – une petite maison à In-Salah. Elle lui a coûté 160 francs. Il l’a choisie en plein quartier indigène, dans le Ksar-el-Arab, tout près de la dune. Il faut bien prévoir et préparer ses haltes, car, disait-il, « si je ne suis pas curé, ce coin de terre, qui est comme ma paroisse, a 2 000 kilomètres du nord au sud et 1 000 de l’est à l’ouest, avec 100 000 âmes dispersées dans cet espace ». Pendant ce séjour à In-Salah, il continue ses études de langue touarègue, avec Ben Messis, que l’extraordinaire puissance de travail de son élève étonne et fatigue un peu. M’ahmed ben Messis était un des personnages les plus intelligents et les plus sympathiques du Sahara. Fils de père chambi et de mère touarègue d’une tribu noble des Azdjers, il était considéré par les Touaregs comme un des leurs, malgré les vives inimitiés qu’il rencontrait parmi eux, et qui avaient pour cause le dévouement de Ben Messis à la France. Ce fut Ben Messis qui dénonça la plupart des assassins du marquis de Morès, lui encore qui servit de guide aux 150 goumiers du lieutenant Cottenest, lorsque celui-ci, le 7 mai 1902, défit 300 Touaregs à Tit, et amena la soumission de plusieurs tribus. Aucun indigène de ces régions ne parlait mieux le tamacheq, aucun ne connaissait mieux les traditions du pays. Il fut un très dévoué ami pour le Père de Foucauld[100].
Aussi, quand un détachement de 80 hommes, commandé par le capitaine Dinaux, quitta In-Salah le 8 mars pour traverser, à petites journées, l’Adrar et le Hoggar, le Père de Foucauld, qui estimait grandement cet officier, assuré en outre de voyager avec le Touareg Ben Messis, accepta-t-il volontiers de faire la tournée. Il partit donc missionnaire et philologue à la fois. On sait qu’il avait coutume de travailler pendant les marches, à la halte, la nuit même, à la lueur d’une bougie, si le vent ne soufflait pas : il ne changea pas son usage. Le voyage étant toujours d’apprivoisement, on faisait des séjours près des campements des pasteurs, et c’étaient de belles semaines pour le savant qui voulait recueillir les traditions, et aussi les poésies que personne n’a écrites, et que les hommes ont seulement gardées dans leur mémoire. « Précieux documents pour la grammaire et le lexique ; pour la grammaire, on y puise, en cas de doute, des exemples ; pour le lexique, on y trouve bien des mots qui ne reviennent pas souvent dans la conversation. En arrivant ici, – c’était à Dourit, à 100 kilomètres au sud de Timiaouin, – j’ai promis un petit salaire pour les poésies qu’on m’apporterait ; cette promesse, en un temps où le pays est pauvre, a suffi pour remplir ma tente pendant un mois ; on m’a fait dire aussi, des douars voisins, qu’on y désirait ma visite, pour que les femmes pussent à leur tour me donner des poésies. J’ai donc été plusieurs fois dans les douars, passant des heures sous un arbre ou dans une tente, au milieu de tous les enfants et les femmes, écrivant des vers et faisant de petits cadeaux. Je suis très heureux de cet apprivoisement qui s’accentue ; ce n’est qu’un premier pas, bien petit, bien humble, mais enfin, il fallait le faire pour faire tomber tant de préjugés, de répulsions, de défiances. Je ferai tous mes efforts pour achever, cette année, le lexique touareg-français. J’ai prié Laperrine de faire publier, par qui il voudrait, comme une chose lui appartenant, appartenant au commandant militaire des oasis, la grammaire touarègue et le lexique français-touareg, qui sont finis, ainsi que le lexique touareg-français auquel je travaille, et les poésies que j’ai collectionnées, à la seule condition que mon nom ne paraisse pas, et que je reste entièrement inconnu, ignoré. Je voudrais, l’année prochaine, n’avoir d’autre travail que la correction des saints Évangiles et des extraits de la Bible traduits précédemment, et ensuite n’avoir plus d’autre œuvre que de donner l’exemple d’une vie de prière et de travail manuel, exemple dont les Touaregs ont tant besoin[101]. »
Un peu plus tard, il répétera cette expresse recommandation : je veux demeurer inconnu. Son extrême humilité se révolte à l’idée que les œuvres qu’il a composées puissent lui valoir quelque réputation. « Ce ne sont pas ces moyens-là que Dieu nous a donnés pour continuer l’œuvre du salut du monde. Les moyens dont il s’est servi à la crèche, à Nazareth, et sur la Croix sont : pauvreté, abjection, humiliation, délaissement, persécution, souffrance, croix. Voilà nos armes ! Nous ne trouverons pas mieux que lui, et il n’a pas vieilli[102]. »
Frère Charles promettait un sou par vers, et tous les chants de guerre ou d’amour du peuple touareg, ceux d’un temps lointain difficile à préciser, et ceux d’aujourd’hui, ceux des poètes renommés et ceux des inconnus, passaient une fois de plus sur les lèvres d’un récitateur, et, notés par un savant, changeaient de destinée, échappaient à l’oubli, naissaient à la vie du livre qui les porterait ailleurs. Œuvre de science, indubitablement, mais pour l’apostolat. Les preuves abondent, dans la correspondance du Père de Foucauld, de cette volonté réfléchie et qui demeurera jusqu’au bout, de ne pas considérer comme un but la possession et la vulgarisation de la langue touarègue : il a cherché, par tous moyens, ces âmes éloignées de nous qui étaient la paroisse de son désir ; pour elles, afin qu’elles fussent mieux connues, plus aimées, un jour mieux évangélisées, il a traduit leurs poésies ; afin qu’elles comprissent la vérité révélée, il a entrepris la traduction de l’Écriture sainte ; pour elles et pour ceux qui viendraient, après lui, instruire et sauver, il a composé sa grammaire et son lexique. Dans les lettres de cette époque, il apparaît nettement qu’il travaillait avec l’espoir que les Pères Blancs, un jour, bientôt, commenceraient d’évangéliser ceux qu’il aurait rapprochés d’eux. La petite maison d’In-Salah serait leur gîte, au passage, autant que son gîte à lui.
En somme, la tournée dans l’Adrar et le Hoggar a été très heureuse. « Je passe encore quelques jours au pâturage, avec le détachement, pour profiter de Ben Messis, et pousser les études touarègues avec lui ; dans quatre ou cinq jours, il part pour In-Salah avec le capitaine Dinaux toujours parfait pour moi, comme tous les Français du détachement. Aussitôt, je prendrai le chemin de Tamanrasset.
« Grâce aux Français du détachement, je n’ai jamais manqué de servant pour la messe, depuis mon départ d’In-Salah. Comment ferai-je à Tamanrasset ?… C’est au divin Maître à arranger les choses[103]… »
La suite de cette lettre au Père Guérin est une réponse, et on va voir jusqu’où la charité conduit une âme d’apôtre : jusqu’à sacrifier la messe où le prêtre puisait la force pour l’épreuve quotidienne.
« La question que vous posez : vaut-il mieux séjourner au Hoggar sans pouvoir célébrer la sainte messe, ou la célébrer et n’y pas aller, je me la suis souvent posée. Étant seul prêtre à pouvoir aller au Hoggar, tandis que beaucoup peuvent célébrer le très saint sacrifice, je crois qu’il vaut mieux aller malgré tout au Hoggar, laissant au bon Dieu le soin de me donner le moyen de célébrer, s’il le veut (ce qu’il a toujours fait jusqu’à présent, par les moyens les plus divers). Autrefois, j’étais porté à voir, d’une part, l’Infini, le saint sacrifice ; d’autre part, le fini, tout ce qui n’est pas Lui, et à toujours tout sacrifier à la célébration de la sainte messe. Mais ce raisonnement dut pécher par quelque chose, puisque, depuis les apôtres, les plus grands saints ont sacrifié, en certaines circonstances, la possibilité de célébrer à des travaux de charité spirituelle, voyage ou autre. Si l’expérience montrait que je puis avoir à rester très longtemps à Tamanrasset sans célébrer, il y aurait, je crois, à y faire des séjours moins longs, non à se borner à accompagner des détachements, ce qui n’est pas du tout la même chose que de résider seul ; résider seul dans le pays est bien ; on y a de l’action, même sans faire grand’chose, parce qu’on devient « du pays » ; on y est si abordable et si « tout petit » !… Puis, à Tamanrasset, il y a, même sans messe quotidienne, le très Saint-Sacrement, la prière régulière, les longues adorations, pour moi grand silence et grand recueillement, grâce pour tout le pays, sur lequel rayonne la Sainte Hostie.
« J’ai regardé comme une grande grâce l’installation à In-Salah, plutôt pensant à l’avenir et à vous que pour moi. Sans doute, j’y passerai, aux allées et venues, plus longtemps que par le passé, et tâcherai d’avoir quelques relations avec les pauvres et de les habituer à la confiance envers le marabout, mais je suis moine et non missionnaire, fait pour le silence, non pour la parole, et, pour avoir influence à In-Salah, il faudrait entretenir des relations, aller voir et recevoir des visites, ce qui n’est pas ma vocation : je tâche seulement d’ouvrir un peu la voie à ce qui sera votre œuvre[104]. »
Frère Charles retrouve donc sa plaine et ses montagnes d’horizon de Tamanrasset. On accourt aussitôt pour lui demander l’aumône, car le Hoggar souffre d’une grande famine. L’ermite avait une provision de blé ; il la pille lui-même, en hâte ; il donne aux pauvresses qui tendent leurs écuelles vides ; il organise des dînettes d’enfants, et rassemble chaque jour les petits de la région, pour qu’ils mangent à leur faim. Il les sert, et il oublie de se réserver une part.
Une chose l’inquiète, et justement : la tentative que fait Moussa pour islamiser le Hoggar. « Profitant de ce que l’organisation du Hoggar, restée jusqu’ici un peu flottante et incertaine, est plutôt celle d’un petit royaume s’administrant lui-même que celle d’un pays directement administré par nous, il a hâte de l’organiser en pays musulman.
« Il y a deux ans, anarchie complète : ni commandement, ni obéissance, pillage partout, religion nulle. Aujourd’hui, on obéit à Moussa ; il répartit l’impôt, nomme les chefs subalternes, se fait obéir, lève des forces armées, interdit, sous des peines très sévères, les pillages, vols, meurtres ; il a établi un cadi pour juger tout selon le droit musulman. Il va construire à Tamanrasset, dont il fait sa capitale, – faut-il fuir en un lieu plus désert, ou voir la main de Jésus rendant l’influence plus facile ? – une mosquée et une zaouia. On va prélever la dîme religieuse dans tout le Hoggar, pour l’entretien de cette zaouia où probablement siégera le cadi, où des tholbas du Tidikelt ou du Touat enseigneront le coran, la religion, l’arabe aux jeunes Touaregs. C’est l’islamisation du Hoggar, et par là même des Taïtoq. C’est un fait très grave. Jusqu’à présent, les Touaregs, peu fervents musulmans, faisaient facilement connaissance avec nous, devenaient très familiers et très ouverts. Une fois que ce très mauvais esprit, très étroit, très fermé, si plein d’antipathie pour nous, des gens du Touat et du Tidikelt, les aura pénétrés, les tholbas enseignant les enfants, ce sera bien différent, et il est à craindre que, dans quelques années, la population du Hoggar ne nous soit bien plus hostile qu’aujourd’hui ; aujourd’hui, il y a chez elle défiance, crainte, sauvagerie ; dans quelques années, si l’influence musulmane touatienne prend le dessus, ce sera une hostilité profonde et durable.
« Comme je vous le disais, Tamanrasset tend à devenir la tête musulmane du Hoggar, la capitale de Moussa.
Moussa y fait de gros travaux de culture : y a désormais ses champs et ses jardins ; il campe habituellement à proximité :… il va y établir un marché perpétuel avec boutiques[105]… »
Frère Charles, témoin de ces essais d’organisation et d’enseignement islamiques, et souffrant donc dans son amour de la vérité catholique et de la chère France colonisatrice, Frère Charles, qui passe des mois sans recevoir des nouvelles d’Europe, car les courriers sont encore bien irréguliers, Frère Charles, privé de la messe, parce qu’il n’y a pas de servant, écrit à son beau-frère, le 9 décembre 1907 : « Je suis heureux, heureux d’être aux pieds du Saint-Sacrement à toute heure, heureux de la grande solitude de ce lieu, heureux d’être et de faire, – sauf mes péchés et mes misères, – ce que veut Jésus ; heureux surtout du bonheur infini de Dieu. S’il n’y avait pas cette source intarissable de bonheur et de paix, le bonheur et la paix infinis, éternels, immuables, du Bien-Aimé, le mal qu’on voit autour de soi de toutes parts, et aussi les misères qu’on voit en soi-même, conduiraient vite à la tristesse. Si, dans les pays chrétiens, il y a tant de bien et tant de mal, pensez à ce que peuvent être ces pays, où il n’y a pour ainsi dire que du mal, d’où le bien est à peu près totalement absent : tout y est mensonge, duplicité, ruse, convoitise de toute espèce, violence, avec quelle ignorance, et avec quelle barbarie ! La grâce de Dieu peut tout, mais en face de tant de misères morales,… on voit bien que les moyens humains sont impuissants et que Dieu seul peut opérer une si grande transformation. Prière et pénitence ! Plus je vais, plus je vois là le moyen principal d’action sur ces pauvres âmes. Que fais-je au milieu d’elles ? Le grand bien que je fais est que ma présence procure celle du Saint-Sacrement… Oui, il y a au moins une âme, entre Tombouctou et El-Goléa, qui adore et prie Jésus. Enfin ma présence au milieu des indigènes les familiarise avec les chrétiens et particulièrement avec les prêtres… Ceux qui me suivront trouveront des esprits moins défiants et mieux disposés. C’est bien peu ; c’est tout ce qu’on peut présentement ; vouloir faire plus compromettrait tout pour l’avenir. »
Il ne varie point dans sa volonté de demeurer là ; malgré l’épreuve, il ne cherche pas à se rapprocher des points du Sahara où il y a des chrétiens, des servants de messe, des conversations à la mesure de son esprit. Obstiné dans le devoir, il refuse des propositions de voyage qui lui sont faites : « Que la volonté du Bien-Aimé soit bénie en tout ! Pour moi, je vois bien que c’est sa volonté que je reste ici jusqu’à ce que le lexique soit terminé, car c’est un travail de première nécessité pour les ouvriers qui suivront… De plus, il produit un bien inattendu : enfermé avec un Touareg très intelligent et très bavard (le khodja de Moussa), du lever au coucher du soleil, j’apprends bien des choses, et ai l’occasion de lui en apprendre beaucoup et de rectifier, en bien des points, non seulement ses idées, mais celles des autres, car les paroles courent. Que de sa crèche, le Bien-Aimé vous bénisse ! Que sa volonté se fasse en Afrique, comme elle se fait au ciel, après une si longue nuit [106] ! »
Néanmoins, cet homme que la paix met au-dessus du découragement ne demeure point pour cela insensible. Il ne serait pas homme s’il était sans gémissement. J’ouvre le diaire ou les lettres, à ces dates de la fin de 1907, et j’y lis, comme un refrain, la plainte du prêtre qui ne jouit plus du privilège sublime de consacrer le corps du Christ. Aux jours de fête surtout, Frère Charles, qui s’en est remis à la grâce de Dieu, répète : « Ne m’oubliez-vous pas ? »
« 15 août. – Mère bien-aimée, ayez pitié de ce peuple pour lequel votre Fils est mort ; donnez-lui votre secours ; votre pauvre prêtre vous invoque pour ce peuple. »
« 8 septembre. – Aujourd’hui deux ans que vous daignez habiter cette pauvre chapelle ! Ô vous qu’on n’a jamais invoquée en vain, convertissez, visitez et sanctifiez ce peuple qui est vôtre. Pas de messe, car je suis seul. »
« 21 novembre. – Le séjour au Hoggar serait d’une douceur extrême, grâce à la solitude, surtout maintenant que j’ai des livres, sans le manque de messe.
« J’ai toujours le très Saint-Sacrement, bien entendu ; je renouvelle les saintes espèces, lorsqu’il passe un chrétien et que je puis dire la messe. Je ne me suis jamais cru en droit de me communier moi-même en dehors de la messe. Si en cela je me trompe, hâtez-vous de me l’écrire, cela changerait infiniment ma situation, car c’est ici de l’Infini qu’il s’agit. »
« 25 décembre. – Noël, pas de messe, car je suis seul. »
« 1er janvier 1908. – Unissez-moi à tous les sacrifices offerts en ce jour. Pas de messe, car je suis seul. »
Pendant qu’il suppliait ainsi, quelqu’un à Rome demandait au pape la permission extraordinaire tant souhaitée. On avait préparé une supplique que j’ai lue, écrite sur un vélin de choix. Le préfet apostolique du Sahara y disait au pape, après avoir résumé en quelques lignes la vie du Père de Foucauld : « Depuis six ans, ce très saint prêtre n’a cessé de mener la vie la plus héroïque et la plus admirable dans la préfecture apostolique de Ghardaïa. Actuellement, il se trouve absolument seul au milieu des sauvages tribus des Touaregs, qu’il est parvenu à apprivoiser, et auxquelles il fait le plus grand bien, par l’exemple de sa vie d’extrême pauvreté non moins que d’inépuisable charité et de continuelle prière… Pour longtemps encore sans doute, il est le seul prêtre qui puisse pénétrer au milieu des Touaregs. Le préfet apostolique de Ghardaïa supplie donc très humblement Votre Sainteté d’avoir égard, tout ensemble aux vertus éminentes de ce serviteur de Dieu, et au très grand bien qu’il réalise, pour daigner lui accorder la très insigne faveur… »
La supplique ne fut pas remise. Dans une audience privée, qu’il avait obtenue pour d’autres causes, le Père Burtin, procureur des Pères Blancs à Rome, demanda le privilège, qui fut aussitôt accordé, de célébrer la messe sans servant.
Ce fut par une lettre du colonel Laperrine, son grand ami, que le Père de Foucauld apprit la nouvelle, le 31 janvier 1908. « Deo Gratias ! Deo Gratias ! Deo Gratias ! Mon Dieu, que vous êtes bon ! chante l’ermite. Demain, je pourrai donc célébrer la messe ! Noël ! Noël ! Merci, mon Dieu ! » (Diaire, 31 janvier 1908.)
Cette joie lui venait au moment où la maladie obligeait ce travailleur acharné à cesser tout travail, et cet homme qui ne se plaignait jamais à parler de lui-même. Écrivant au Père Guérin, il lui confie, comme un secret à garder rigoureusement, qu’il s’agit d’un « gros accroc de santé » ; fatigue générale, perte complète de l’appétit, « puis, je ne sais quoi à la poitrine, ou plutôt au cœur, qui me rendait tellement haletant, au plus petit mouvement, que c’était à croire la fin proche ». Il est obligé de garder l’immobilité absolue. Pour le nourrir, ses amis les Touaregs vont traire toutes les chèvres qui ont un peu de lait, et apportent ce lait à la cabane du marabout chrétien.
À un ami de France auquel il disait tout, il écrivait : « À nos âges, on a toujours quelque chose qui cloche ; c’est le paternel avertissement d’en haut… Je n’ai plus ni dents, ni cheveux ; mes yeux, bons de loin, sont de plus en plus faibles de près. » Mais aussitôt il écrivait à d’autres : « Soyez sans inquiétude, je ne crois pas qu’il y ait lieu d’en avoir. Mais un repos absolu, une cessation de travail complète d’un mois s’impose, et, après, il me faudra reprendre le travail beaucoup plus modérément que par le passé… Je fais venir d’In-Salah les victuailles les plus variées pour me remonter : lait concentré, vin (! ! !), légumes secs, quelques conserves ; je fais tout le nécessaire. »
Dans la même lettre, – ce qui permet de douter un peu de ces belles résolutions de moins travailler à l’avenir, – Frère Charles demande aux Pères Blancs de lui envoyer la Somme théologique de saint Thomas, la Somme contre les gentils, c’est-à-dire une dizaine de volumes in-8° en latin, et encore trois autres volumes de philosophie. « Plus je vais, dit-il pour expliquer la demande, plus j’ai l’occasion de faire des conversations sérieuses avec quelques indigènes de choix. » Puis, revenant sur son mal, et de peur qu’on ne s’inquiète, à Ghardaïa et à Alger : « C’est un mois de recueillement et de très douce retraite que me donne Jésus par ce repos forcé ; j’en jouis à ses pieds. »
Quand il se remet de cette rude secousse, il se sent incapable d’efforts manuels un peu répétés ; il ne peut donc remplir son dessein de travailler à quelque ouvrage de corroyeur ou de sellier. « Et ce m’est un regret. D’une part, cet humble et vil travail fait partie si intime de la vie de Jésus à Nazareth, modèle de la vie monastique ; de l’autre, rien ne serait plus utile que cet exemple au milieu de ces peuples perdus d’orgueil et de paresse ! » La gravité de cette maladie, malgré les précautions prises par le Père de Foucauld, fut devinée promptement par les amis de l’ermite, et tout d’abord par le colonel Laperrine, auquel il avait dû annoncer qu’il ne pourrait se rendre à In-Salah au début du printemps. Coup sur coup, 3 février, 13 février, Laperrine écrit au Père Guérin des lettres qu’il aurait pu ne pas signer, tant les traits de la vie saharienne, le ton vif et plaisant font clairement connaître l’auteur.
« 3 février. – Mon révérend Père, j’allais répondre à votre lettre du 13 janvier, lorsque je reçois une longue lettre de de Foucauld ; il ne pense pas être ici avant le 15 mars, et encore il ne donne pas cette date comme certaine. Il se sent fatigué… Cette lettre m’ennuie beaucoup, parce que, pour qu’il s’avoue fatigué, et qu’il me demande du lait concentré, il faut qu’il soit réellement malade. Je ne sais encore ce que je ferai. J’attends des autorisations. Mais la situation actuelle me porterait de préférence vers l’Est, pour rentrer par l’Ahaggar. Je vais relire la lettre de de Foucauld à tête reposée, et, le cas échéant, je ferai le crochet de l’Ahaggar, ou y enverrai le docteur, si son état s’aggrave. Il aura voulu forcer la pénitence et le jeûne, mais les forces ont des limites. Je vais lui dire des sottises, et m’autoriser de vous pour lui dire que la pénitence allant au suicide progressif n’est pas admise… Cette date du 15 mars succédant au 15 février, qui avait succédé au 15 novembre, ne m’inspire pas confiance. Peut-être vaut-il mieux, si j’envoie un détachement là-bas, qu’il y reste, mange un peu avec l’officier, pour se remettre en état de faire la route. Pardon, mon révérend Père, de ce gribouillage. Mes respects aux Pères d’El-Goléa. Je vous prie d’agréer l’expression de mes respectueux hommages et de ma cordiale amitié.
« H. LAPERRINE. »
« 11 février. – Mon révérend Père, quelques lignes au galop, pour vous donner des nouvelles de de Foucauld. Il remet son voyage en octobre. Il a été plus malade qu’il ne l’avoue, il a eu des évanouissements, et les Touaregs, qui l’ont fort bien soigné, ont été fort inquiets. Il va mieux. Je lui ai envoyé une semonce, car je suppose fort que ses pénitences exagérées sont pour beaucoup dans sa faiblesse, et que le surmenage de son travail de dictionnaire a fait le reste.
« Comme la semonce ne pourrait tout faire, nous y avons joint trois chameaux de victuailles, lait concentré, sucre, thé, conserves diverses. D’ailleurs, il sentait qu’il fallait qu’il enraye son régime d’orge bouillie, puisqu’il demande du lait… Dans tous les cas, je crois indispensable qu’à son prochain retour dans le Nord, vous lui mettiez le grappin dessus, et le gardiez un mois ou deux à Ghardaïa ou Maison-Carrée, pour qu’il refasse sa bosse, excusez l’expression saharienne[107]. »
Le séjour à Tamanrasset du colonel Laperrine et du capitaine Nieger[108] fut une grande joie pour le Père de Foucauld, qui n’avait pas reçu de nouvelles d’Europe depuis cinq mois.
La santé se rétablit peu à peu. Les lettres du malade deviennent plus fréquentes. L’une d’elles, écrite dans cette période de convalescence, en réponse à des questions que le Père Guérin avait posées, met en lumière cette énergie de volonté et cette ardeur de courage qu’un personnage aussi attentif à ne se point vanter n’exprime que par surprise, et s’il est provoqué. Elle renferme aussi l’aveu que l’auteur des travaux sur la langue touarègue, c’est lui-même. La lettre est divisée en paragraphes, comme l’était l’interrogatoire.
« Je n’hésite pas à prolonger les conversations et à les laisser durer très longtemps, quand je vois qu’elles sont utiles aux âmes ; je passe parfois des journées à expliquer et montrer des livres d’images pieuses, ou à lire des passages du saint Évangile aux Touaregs. C’est dans cette pensée que j’ai l’intention, l’été prochain, de revoir entièrement, – ou plutôt de refaire à nouveau, car elles ne valent rien, – les traductions de l’Évangile et d’une partie de la Bible en touareg. Cela servira maintenant à moi, et après à d’autres.
« Pour la question de signer de mon nom les travaux de linguistique, malgré l’autorité du Père Voillard en qui j’ai tant de respectueuse confiance, et malgré la vôtre, je ne change pas de sentiment. Ce que vous dites avec lui serait probablement vrai d’un Père Blanc, cela ne l’est pas pour moi, voué à la vie cachée… Ce qui m’a décidé à faire ces travaux, à y mettre la dernière main, à les livrer à l’impression, c’est précisément que ce grand bien de leur publication peut se faire sans que je paraisse, ni sois nommé en rien…
« Le Bien-Aimé a fait tourner au bien des âmes les efforts de Moussa pour organiser le Hoggar en royaume musulman régulier et fervent. Ses efforts ont totalement et piteusement échoué ; non seulement échoué, mais produit l’effet inverse. Il a nommé un cadi, lui a confié des sommes importantes pour édifier mosquée et zaouia, a fait lever la dîme religieuse dans tout le Hoggar. Son cadi s’est fait, en trois mois, haïr de tous, a dissipé toutes les sommes à lui confiées, et n’a rien bâti ; la levée de la dîme a mécontenté tout le monde : de sorte que maintenant,… il ne reste plus que le souvenir d’une aventure désagréable et l’horreur des cadis et de la dîme. Prions et faisons pénitence.
« Si on m’avait appelé, pour les expéditions du Maroc, je serais parti le jour même, et j’aurais fait 100 kilomètres par jour pour arriver à temps : mais nul ne m’a donné signe de vie. Si l’on me veut, on sait que je suis prêt à venir. J’ai dit au général Lyautey qu’en quelque lieu qu’il y ait une expédition sérieuse, il n’avait qu’à me télégraphier de venir, et que j’arriverais immédiatement. »
Lui aussi, et dès le début de son apostolat, il s’était fait cette objection, qu’on n’a pas manqué de faire par la suite, et quand on a connu l’œuvre du Père de Foucauld : « Le Sahara vaut-il donc tant de sacrifices, de temps, de travaux, et n’est-ce pas dépenser trop que se donner tant de peine pour quelques tribus errantes et qui ne demandent point qu’on les convertisse ? » Le Père de Foucauld répond à ce sujet[109] :
« Sans doute le Sahara n’est pas des plus peuplés, mais enfin le territoire des oasis, Touaregs compris, comprend bien 100 000 âmes, qui naissent, vivent, meurent sans connaissance de Jésus mort pour elles il y a dix-neuf cents ans. Il a donné son sang pour chacun d’eux, et nous, que faisons-nous ? Il me semble qu’il faudrait deux choses : 1° une manière de tiers ordre, ayant pour un de ses objectifs la conversion des peuples infidèles, conversion qui est, à l’heure présente, un devoir strict pour les peuples chrétiens, dont la situation, depuis soixante-dix ans, a totalement changé vis-à-vis des infidèles. D’une part, les infidèles sont presque tous sujets des chrétiens, de l’autre, la rapidité des communications et l’exploration du monde entier donnent accès relativement facile chez tous. De ces deux faits découle un devoir tout à fait strict, surtout pour les peuples ayant des colonies : celui de christianiser.
2° Il faudrait, non partout, mais pour les pays où on a des difficultés spéciales, comme celles que vous avez, des missionnaires à la Sainte-Priscille[110] des deux sexes, soit qu’on les glane çà et là, soit qu’on les groupe pour leur donner une préparation commune avant de les envoyer. La pensée d’une espèce de tiers ordre ayant pour un de ses buts la conversion des infidèles m’est venue en septembre dernier, lors de ma retraite. Elle m’est revenue souvent depuis, avec la considération que c’est un devoir et non pas seulement une œuvre de zèle et de conseil, pour les peuples chrétiens, de travailler fortement à la conversion des infidèles et surtout de ceux de leurs colonies. Il y aurait lieu, semble-t-il, de montrer ce devoir aux âmes qui semblent ne pas s’en douter, et de les pousser à l’accomplir. Pendant la semaine sainte et la semaine de Pâques, j’ai écrit ce que pourrait être l’association ; je revois cet écrit et je le recopie… Je vous le montrerai en novembre. Si vous croyez qu’il contienne quelque chose de bon, vous vous en servirez. Mais certainement, il y a quelque chose à faire… Depuis vingt ans, la France a un empire colonial immense, qui impose des devoirs d’évangélisation aux Français chrétiens… Ce n’est pas avec 10, 15, 20, 30 prêtres, même si on vous les donnait, que vous convertirez ce vaste Sahara, il vous faut donc chercher d’autres auxiliaires.
« Pardonnez-moi, mon bien-aimé Père, de me mêler de ce qui ne me regarde pas, et d’oser, moi, vieux pécheur et tout petit prêtre, très jeune d’ordination et resté pécheur et misérable, moi qui n’ai jamais pu parvenir à rien, qui n’ai pu avoir même un compagnon, qui n’ai jamais eu que des désirs sans effet, et dont les plans de vie, constitutions, règlements, ne sont jamais restés que des papiers inutiles, d’oser vous exposer mes pensées et continuer de faire des plans. Mon excuse, c’est ces âmes qui m’entourent, qui se perdent, et qui resteront perpétuellement en cet état, si on ne cherche pas et ne prend pas les moyens d’agir efficacement sur elles. »
Dans l’été de 1908, l’administration militaire décide qu’un détachement de troupes sera envoyé et maintenu dans le Hoggar, qu’il y fera des randonnées, de temps en temps, et qu’un fort va être construit. Laperrine voulait le nommer « fort de Foucauld », mais l’ermite refusa. Ce sera donc le fort Motylinski, à 50 kilomètres de Tamanrasset. Frère Charles apprend aussi que l’année suivante, sans doute, Moussa ag Amastane sera conduit en France par un officier. Il se demande et demande au Père Guérin s’il ne serait pas bon que d’autres Touaregs pussent ainsi voyager chez nous, prendre quelque idée d’un monde si différent du leur, vivre dans quelque famille française, une huitaine de jours, afin de rapporter cette conviction du moins que nous ne sommes pas des païens et des sauvages : ce sont les noms qui servaient, au Hoggar, à désigner les Français, et, d’une manière générale, les Européens. Autre nouvelle : l’amenokal du Hoggar fait élever, à Tamanrasset, une maison importante, – en briques cuites au soleil et en boue séchée, bien entendu ; – plusieurs de ses proches parents l’imitent. Laperrine est dans le pays ; il voit Moussa, il se réjouit des essais de colonisation, il est heureux surtout de retrouver en belle santé son ami le Père de Foucauld, qu’il avait cru perdre. Le 22 juillet 1908, il donne cette bonne nouvelle au Père Guérin :
« Mon révérend Père, je vous écris quatre lignes, de Tamanrasset, où je suis avec de Foucauld depuis le 16 juillet. Il était venu au-devant de moi, à 30 kilomètres de Tarhaouhaout, le 29 juin, et nous avons passé les 30 juin, 1er, 2 et 3 juillet ensemble. Il se porte fort bien, et est resplendissant de santé et de gaieté… Le 29 juin, il est arrivé à mon camp en galopant comme un sous-lieutenant, à la tête d’un groupe de cavaliers touaregs. Il est plus populaire que jamais parmi eux, et les apprécie de plus en plus. En revanche, il a bien peu d’estime pour les nègres fixés ici, qui ne sont que des paresseux, n’ayant que des sentiments absolument bas.
« Je le quitte ce soir, pour rentrer à In-Salah par le chemin des écoliers… De Foucauld compte aller vous voir en novembre ; je le laisse ici en train de mettre la dernière main à l’énorme travail tamacheq qu’il a entrepris ; ce travail sera excessivement complet.
« Je vous prie, mon révérend Père, d’agréer l’expression de mes respectueux hommages et de mon plus cordial souvenir.
« H. LAPERRINE. »
Frère Charles, depuis plusieurs mois, avait formé le projet d’aller passer quelques jours à Ghardaïa. N’irait-il pas plus loin ? jusqu’à Alger ? pourquoi pas jusqu’en Bourgogne ? C’était l’un des sujets de conversation épistolaire entre lui et Mme de Blic. Celle-ci ne manquait pas de bons arguments pour lui prouver qu’une visite en France était mieux qu’attendue, mieux qu’utile : tout à fait nécessaire. N’était-il pas absent depuis sept années ? N’est-ce pas cruel qu’un frère et une sœur vivent ainsi séparés l’un de l’autre par des milliers de lieues ? Il était oncle aussi : cette famille de neveux et de nièces qu’il connaissait à peine, ne grandissait-elle pas ? L’ermite tâchait de trouver la réponse qui pût être acceptée. « Je suis moine, disait-il, et les moines ne doivent pas voyager pour leur plaisir. Nous offrirons ensemble ce sacrifice au Bien-Aimé Jésus. Il en a tant offert ! De tant de sortes ! Que de fois a-t-il laissé sa mère seule durant sa vie ! Dans quelle solitude il l’a laissée en mourant !
« Peut-être nous reverrons-nous ici-bas ; Dieu peut, comme il l’a déjà fait, disposer les circonstances de manière qu’il soit plus parfait d’aller vous voir que de m’en priver. Car si vous dites que vous seriez heureux de me revoir, vous si entourés, combien ne le serais-je pas moi, seul au milieu des sauvages ? Ici nul nouvel amour n’est venu prendre la place des anciens… Tu te fais de grandes illusions en croyant que je ferais du bien, ma chérie : je gagne beaucoup à ne pas être vu et à ce que, de loin, on me croie meilleur que je ne suis… »
Ébranlé par les instances de la « chère Marie », il finit par écrire : « Si tu veux que je vienne, demande-le au bon Dieu et à M. l’abbé Huvelin, interprète pour moi de sa volonté. » Il écrivait ces choses et bien d’autres sur de vieilles enveloppes, « parce que, disait-il, je suis à 700 kilomètres du marchand de papier. »
Consulté, M. Huvelin répond : « Mon cœur désire bien ce petit voyage en France, que vous ferez pour voir votre famille… Je ne vois pas d’objection à votre voyage, avec ou sans Touareg. » Mgr Guérin est du même avis.
En conséquence, Frère Charles quitte Tamanrasset, le jour de Noël à midi, seul, sans Touareg, aucun n’étant suffisamment préparé. Le 22 janvier 1909, il arrive à El-Goléa, où se trouvaient les Pères Richerd et Périer, des Pères Blancs ; quelques jours plus tard, il rencontre Mgr Guérin, venu de Ghardaïa au-devant de lui ; le 13 février, il est à Maison-Carrée, parmi ses amis les Pères Blancs, que gouverne Mgr Livinhac. Il revoit, des jardins du couvent, la Méditerranée, qu’il va traverser, et au delà de laquelle il y a la France. Maison-Carrée, comme on le sait, est une petite ville, à l’est d’Alger, près du rivage, et la résidence des Pères Blancs un peu plus à l’est et dans la pleine campagne, n’a point de colline ou de forêt devant elle, qui l’empêche de regarder vers la France. Le jardin, d’orangers et de citronniers, descend vers des champs de maraîchers, que continuent les dunes vêtues de caroubiers et de joncs, d’asphodèles et d’œillets. Les monts de Kabylie, violets, barrent l’horizon du côté de l’orient ; à l’occident, Alger, pareille à une carrière à vif de marbre rose et blanc, lève au-dessus de la mer le cap de son quartier arabe. Dans cette maison religieuse, des hommes jeunes, sous la direction de quelques missionnaires revenus du centre de l’Afrique, se préparent à conquérir au Christ, à la civilisation ici-bas, à l’éternité dans la suite, les noirs des pays qui enveloppent le Tchad, le Victoria-Nyanza, et d’autres peuples, où le nombre des chrétiens s’accroît rapidement ; ils attendent que la liberté soit donnée au Maître du monde de faire connaître aux musulmans son incarnation, sa passion et sa loi. Lieu de prière, de travail et de paix. Frère Charles l’aimait, et souhaitait que la maison fût toujours pleine d’ouvriers « et d’ouvriers spéciaux pour les terres musulmanes ».
On m’a raconté que, pendant ce séjour à Maison-Carrée, il se trouvait dans la cellule du Père de Ch…, un de ses amis, et causait avec lui, lorsque la cloche sonna.
– Excusez-moi de vous laisser seul, dit le Père de Ch… L’autre, sans réfléchir, répondit :
– Oh ! je ne suis jamais seul !
Puis, en ayant trop dit, il baissa la tête.
Bien qu’il aimât cette grande maison fraternelle, il ne s’y attarda point, et, de même, il ne fit que passer en France. La moindre tournée saharienne lui avait pris dix fois plus de temps qu’il n’en voulait donner à sa joie humaine. Il fallait reprendre au plus vite l’œuvre divine. Le 17 février, il abordait à Marseille, passager de pont, bien entendu. L’itinéraire en France comprend Paris, Nancy, Notre-Dame-des-Neiges, Toulon, Grasse, où se trouvait la sœur du Père de Foucauld. Enfin, vingt jours après avoir quitté l’Afrique, Frère Charles y rentrera, ayant juste donné à sa visite la durée suffisante pour qu’on ne pût le convaincre de « cruauté ».
Pour trois semaines, il a donc changé d’habitudes, de costume, de paysage, d’idiome dans l’habituelle conversation. Je le laisse voyager, et je profite de l’absence pour citer quelques-uns de ces proverbes touaregs qu’il recueillait, et quelques-unes de ces poésies qu’il se faisait réciter à l’entrée des tentes des nomades.
CHAPITRE XI – POÉSIES ET PROVERBES
Rien n’est plus sobre que l’orgueil ; il se nourrit de rien et se désaltère au vent qui souffle. Ne soyons pas surpris que les habitants du Sahara se considèrent comme les premiers des hommes, les plus beaux, cela va de soi, les plus intelligents, les seuls dignes de conduire le monde et de lui servir de modèles. Je suis persuadé qu’ils considèrent leurs poètes, n’en connaissant pas d’autres, comme les plus grands qui soient. Ils sauront un jour qu’ils se trompent. Mais nous devons reconnaître que ces nomades sans instruction ne sont pas sans esprit. Ils écrivent des vers, où chantent l’amour, l’inquiétude, le défi, la fierté d’être jeune et brave, ou d’être belle et courtisée. Pièces de circonstance qui ne manquent pas de trait, mais d’où la composition est absente. C’est du raisin sauvage aigrelet, qui ne donne pas de vin, mais dont on peut manger les grains, et plus d’un auteur, que les petites revues de chez nous célèbrent, n’a pas trouvé encore autant de tours heureux que n’en met, dans ses vers, un pasteur guerrier du Hoggar, qui rime sa chanson pour le prochain ahâl.
Le Père de Foucauld a dit que, chez les Touaregs, « tout le monde fait des vers, toujours rimés, et rythmés d’après plusieurs rythmes ». Le vers libre serait donc condamné au Sahara ? On le dirait d’après ces lignes, mais les questions de prosodie, dans une langue qui nous est inconnue, sont de celles que la prudence conseille d’éviter. Laissons-les aux savants. Quand seront publiées les pièces recueillies, traduites et annotées par le Père, on en pourra juger ; je crois qu’il a tout dit[111].
Je ne veux rapporter ici qu’une des observations qu’il a faites :
« Les sujets habituels des vers des Kel Ahaggar et des Kel Azdjer et des Taïtoq sont les mêmes : amour, guerre, chameaux et voyages, épigrammes. Souvent les poésies guerrières et les épigrammes donnent lieu à des réponses ; un poète du parti ennemi, ou la personne attaquée riposte par des vers ; un duel poétique s’engage parfois, les pièces de vers, attaques et ripostes, se succèdent en grand nombre. Dans les guerres, les hostilités poétiques accompagnent toujours les hostilités armées.
« Comme langue, il n’y a pas de différence entre les vers des Kel Ahaggar, des Kel Azdjer et des Taïtoq. Comme fond et comme forme, il y en a.
« Les poésies de l’Ahaggar ont parfois quelque chose de sentimental et de philosophique ; celles des Kel Azdjer sont imagées, ardentes, belliqueuses ; celles des Taïtoq, élégantes de forme, sont peu nourries de pensée, les souvenirs islamiques y sont plus fréquents qu’ailleurs[112]. »
J’ai parcouru un grand nombre des feuillets qu’on a trouvés dispersés dans la salle où travaillait, à Tamanrasset, le Père de Foucauld. C’étaient des brouillons de l’ouvrage qu’il avait achevé. Je citerai quelques-unes des pièces qui m’ont semblé savoureuses, ou curieuses, et, mêlées à celles-ci, d’autres poésies qu’a bien voulu me communiquer M. Henri Basset, chargé de cours à la Faculté des Lettres d’Alger.
Rezzou heureux de Moussa ag Amastane.
(Date : 1894.)
Moussa fils d’Amastan fait route au milieu des élévations sablonneuses.
Nous le suivons pendant qu’il presse du pied son méhari à liste,
Qui a une (haute) bosse et qu’on ne sangle qu’avec de la mousseline blanche,
Sur son flanc est appuyé le fusil,
Moussa lui a donné pour compagnon un grand nombre de chevaux.
Vous n’avez plus d’honneur, ô mauvais imrad !
Vous avez rejeté et laissé aller seul Moussa dans l’Ahnet, pays des violons, recruter des compagnons,
Point d’homme parmi vous dans lequel s’éveille le sentiment de l’honneur.
Regardez ! tout le monde suit Moussa, jusqu’aux boiteux et aux manchots, excepté vous !
Akamadou le boiteux, son chameau à balsanes chemine côte à côte de celui de Moussa,
Kaimi le manchot, avec sa trousse, marche serré aux côtés de Moussa et des siens.
C’est au puits d’I-n-belren que nous avons laissé nos femmes,
Dont les tempes et le bord des joues sont bleuis par l’indigo.
Bekki, l’amour que j’ai pour toi à qui le cacherai-je ?
Car il n’est pas dans la main, où il suffirait de le frapper pour le faire tomber,
C’est dans le cœur même qu’il est, là où il est solide.
Hekkou, sa peau a la douceur du pain
De sucre qu’aiment tous les jeunes gens ;
Elle est comme un faon d’antilope descendant l’oued Tigi,
Qui va de gommier en gommier broutant les feuilles pendant les nuits d’été.
Combat contre les Ioullemeden.
(Date : 1895.)
J’envoie à toutes les femmes qui prennent part aux réunions galantes un arrêt,
À celles de ce pays-ci et jusqu’aux femmes arabes :
Partout où se tiendront près de vous ceux qui se sont cachés durant ce combat,
Répandez sur ces lâches vos malédictions.
Nous les avons vus ce jour-là, au matin.
Lorsque vinrent à nous les Ioullemeden nous attaquant de front ;
Il s’est donné alors une fête avec la poudre et les balles,
Et les javelots lancés en tel nombre qu’ils formaient comme une tente au-dessus de la tête des combattants.
Quand les ennemis s’enfuirent, je mis la main à l’épée,
J’en frappai leurs jambes, elles volèrent comme des tiges de jerjir[113].
Je les défie de s’en servir à l’avenir pour marcher.
Combat de Tit.
(Tournée de police du lieutenant Cottenest dans l’Ahaggar.)
(Date : 1902.)
Je vous le dis, femmes qui avez de la raison,
Et vous toutes qui vous mettez du bleu entre la bouche et les narines :
Amessara[114], on s’y est mis réciproquement à bout de forces,
Avec les javelots, les fusils des païens,
Et l’épée « tahelée » dégainée.
Je suis allé à l’ennemi, j’ai frappé, j’ai été frappé,
Jusqu’à ce que le sang m’a couvert tout entier comme une enveloppe,
M’inondant depuis les épaules jusqu’aux bras.
Les jeunes femmes qui s’assemblent autour du violon n’entendront pas dire de moi que je me suis caché dans les rochers.
N’est-il pas vrai qu’à trois reprises, tombant, on a dû me relever ;
Et que sans connaissance, on m’a lié sur un chameau avec des cordes ?
À cause de cela,
Défaite n’est pas déshonneur ;
Contre le prophète lui-même, des païens ont jadis remporté la victoire.
Départ pour l’Ahâl.
Mes parents m’avaient empêché de partir pour l’ahâl, ils étaient, semble-t-il, sans arrière-pensée.
Je restai, je répandis des larmes, je rentrai sous la tente,
Je m’enveloppai, me cachai la figure et me couchai ; on eût dit que cela même accroissait mon chagrin.
Je n’y tins pas : je mis ma ceinture croisée, je parcourus le lieu où étaient accroupis les chameaux ;
J’en fis saisir un bien dressé.
Je mis sur lui la selle à l’endroit où se termine la crête de poils de la bosse ;
Je me mis bien en équilibre sur lui, je le fis descendre dans la vallée d’Isten.
Lorsque je l’arrêtai court, en arrivant près de l’ahâl, on me dit :
Qu’est-il arrivé ?
Je leur dis : « Il n’est pas arrivé la moindre chose.
Si ce n’est tristesse et visage sombre.
Et maintenant, Dieu est unique ! il est écrit
Que je verrai celle aux dents blanches.
Déclaration.
Une chose nullement douteuse, certaine,
C’est que si le tourment de l’amour tuait,
Par Dieu ! je ne vivrais pas jusqu’à ce soir,
Le soleil ne se lèverait plus pour moi le voyant.
Geggé, ton amour est rude pour le cœur :
Il a dissous la moelle au dedans de mes os ;
Il a bu mon sang et mes chairs ; je ne sais ce qu’ils sont devenus ;
Il ne me reste que les os qui se tiennent debout.
Et la respiration qui souffle lentement et silencieusement sous eux.
Vous n’avez encore jamais vu une âme dans laquelle existe une ville entière
De tourments, et qui pourtant est vivante,
Va aux réunions galantes, joue et rit([115]).
À l’Amenokal Amoud,
Kenoua oult Amâstân, femme de la tribu noble des Taïtoq, est, de toutes les personnes vivant actuellement chez les Kel-Ahaggar et les Taïtoq, et de toutes celles qui y ont existé depuis un demi-siècle, celle qui a la plus grande réputation de talent poétique.
Amoud el Mektar, personnage important, voyageant chez les Taïtoq, s’arrêta un jour pour passer la méridienne auprès d’un arbre, à proximité du campement de Kenoua. Pendant qu’il se reposait avec son compagnon, à l’ombre d’un burnous attaché aux branches, Kenoua vint à eux, et les invita à la suivre à ses tentes ; elle leur offrit l’hospitalité, et les retint deux jours. Le lendemain de leur arrivée, elle composa cette pièce de vers en l’honneur d’Amoud :
Moi, cette année, j’ai vu
Des dattes comme la main n’en donne pas à la langue ;
Moi, cette année, j’ai vu
Un dattier verdoyant chargé de dattes mûrissantes ;
Moi, cette année, j’ai vu
De l’or et de l’argent enfilés ensemble ;
Moi, cette année, j’ai vu
Le ciel, j’y suis arrivée et je n’y ai pas couché ;
Moi, cette année, j’ai vu
La Mecque, j’y ai prié et je n’y ai pas passé le midi ;
Moi, cette année, j’ai vu
Médine, j’y ai été et je n’y ai pas pris de repas ;
Moi, cette année, j’ai vu
Les eaux de Zemzem, et je n’en ai pas bu ;
Moi, cette année, j’ai vu
Des faons d’antilopes tendres comme des enfants qui parlent en adoucissant les sons :
Ils se faisaient, avec des étoffes de drap, une ombre sous laquelle ils passaient la méridienne ;
Faits pour le jeu, capables de jouer,
Ils étaient dans un lit de soie et d’argent.
Moi, cette année, j’ai vu
Un poulain dont l’amour m’a blessée :
Il est dans un champ de blé, debout, y paissant ;
Si seulement il était à vendre, je donnerais de lui
Un millier de jeunes adolescents !…
Poésie d’Eberkaou.
(Femme célèbre par sa beauté et son esprit.)
Le comparerai-je à un méhari blanc, à un bouclier de Tarmai
À une harde d’antilopes de Kita ?
À des franges de ceinture rouge de Jerba ?
À du raisin qui vient de mûrir
Dans un vallon où, à côté de lui, mûrit la datte ?
Amoûmen est le fil dans lequel sont passées les perles de mon collier.
Il est le cordon auquel sont suspendus les talismans qui sont sur ma poitrine ; il est ma vie ([116]).
Remerciement.
Une femme pauvre, d’une tribu d’imrad, ayant reçu une aumône d’un officier français, l’en remercie par ces vers :
Je pars des tentes après la prière (du matin),
Je fais une marche pleine de réflexions soucieuses ;
J’ai laissé là-bas Tekâdeit et Lilli,
Ayant faim, exténués, pleurant ;
Les sauterelles sont la mort des pauvres gens.
Je suis allée au capitaine qui a pitié de moi ;
C’est un jeune homme qui fait des efforts pour tout bien ;
Il est valeureux à la guerre ; il est bienfaisant ;
Il a les cris de joie des femmes et les mérites devant Dieu ;
Son cri de défi, nul ne le relève ;
Tous les païens, il l’emporte sur eux.
Quand on a beaucoup lu d’improvisations des poètes touaregs, on s’aperçoit qu’ils se répètent, et qu’au Sahara plus qu’ailleurs, certaines métaphores, dont nous étions d’abord amusés ou émus, sont de style et fanées. Peu importe ici. J’ai voulu simplement ajouter quelques traits à l’image que nous pouvons nous faire de ce peuple, au milieu duquel le Père de Foucauld a vécu les dernières années de sa vie, auquel il s’est tant dévoué, dont il a passé tant d’heures à étudier les traditions, les coutumes, le vocabulaire, la langue et la poésie. Et dans cette même intention, je choisirai, parmi ceux qu’il a recueillis, des proverbes touaregs. L’on y voit mieux encore l’esprit vif de ces gens de l’Ahaggar, et leur bon sens, où devait tenir, comme en sa source, tout l’espoir humain qu’avait Charles de Foucauld.
Proverbes touaregs.
Éloignez vos tentes, rapprochez vos cœurs.
Quand tu vois la lune entourée d’un halo, c’est qu’un roi voyage à sa clarté.
Crains le noble si tu le rapetisses : crains l’homme de rien si tu l’honores.
Celui qui boit dans une cruche (le sédentaire) n’est pas guide.
Si longue que soit une nuit d’hiver, le soleil la suit.
La vipère prend la couleur des pays qu’elle habite.
Rire de terre cuite.
La main que tu ne peux pas couper, baise-la !
Celui qui t’aime, fût-il un chien, tu l’aimeras aussi.
Mieux vaut passer la nuit avec la colère qu’avec le repentir.
Les raisonnements sont l’entrave du lâche.
Une seule main, si elle n’a pas sa sœur, quoi qu’elle fasse, n’ouvrira pas un double nœud.
Lorsqu’un noble étend, pour te servir de tapis, le morceau d’étoffe qu’il porte comme vêtement, ne t’assieds pas en plein milieu.
Le déshonneur, l’enfer même l’a en horreur.
Entre vivants on est de revue.
Celui qui se met une corde au cou, Dieu lui donnera quelqu’un qui la tirera.
Au pays natal, la naissance ; en pays étranger, les habits.
La paume de la main n’éclipse pas le soleil.
Le coléoptère, aux yeux de sa mère, est une gazelle.
Le chemin frayé, même s’il fait des détours ; le roi, même s’il a vieilli.
CHAPITRE XII – TAMANRASSET
Dès le dimanche de la Passion 27 mars 1909, afin qu’il y eût, ce jour-là, messe à Beni-Abbès, le Père de Foucauld, faisant le chemin en grande hâte, reprenait possession du premier ermitage. Il y passa le temps pascal, pour être jusqu’au bout à la disposition des officiers et des soldats chrétiens qui voudraient faire leurs Pâques, recevant des visites de Français, de Berbères et d’Arabes, et, aux heures de solitude, mettant la dernière main aux statuts de l’association pour le développement de l’esprit missionnaire, selon les indications de Mgr Bonnet, qui s’était intéressé à ce projet. Elle est belle, en effet, la pensée qu’a eue le grand moine africain, de grouper les chrétiens de France et d’Algérie, avant tout les Sahariens qui sont des deux pays ensemble, mais les sédentaires aussi, et ceux qui, de leur vie, ne traverseront la mer, et de les faire prier, chaque jour, pour la conversion « de nos frères musulmans, sujets de la France ». Idée simple aussi, et pratique, et qui pénétrera dans la profonde France chrétienne, habituée, de temps immémorial, à comprendre ces sortes de développements fraternels et comme indéfinis de la communion des saints. Déjà, bien que l’œuvre soit demeurée humble et sans moyen de propagande, des voyageurs, des officiers, des marins, des parents et parentes de missionnaires, des communautés d’hommes et de femmes ont promis d’intercéder pour ces peuples délaissés et qui sont nôtres. Je dirai à la fin de ce livre ce qui a été fait, et ce qu’est le règlement, bien simple, de cette union de prières, legs du Père de Foucauld à beaucoup qui n’en savent rien.
Un mois de séjour, à peu près, dans l’ermitage de Beni-Abbès, puis l’ermite se refait pèlerin : il fabrique ou achète les deux paires de sandales nécessaires ; il chaussera la seconde quand les pierres auront usé les semelles de la première, ou que la chaleur en aura durci et racorni le cuir ; et le voici en route. L’accueil qu’il reçoit partout lui est une récompense. Sans doute, les quêteurs sont nombreux, parmi ceux qui abordent le marabout. Mais à présent, et pour beaucoup, il est l’ami que l’on consulte. Tandis qu’il chemine près de son chameau, quand il traverse un ksar, ou que, dans l’ardeur du jour, à l’heure de la gaïla, il s’étend à l’ombre d’un arbre ou d’une roche, quelqu’un se glisse près de lui et lui confie une inquiétude, une peine : il y en a tant ! Si l’on veut un exemple de cette sorte d’apostolat, je puis le donner. Vers le temps que je raconte ici, un soldat vint trouver le Père. Il vivait avec une négresse, une esclave que ses maîtres arabes avaient été contraints de libérer parce qu’ils la maltraitaient. Cette femme voyait avec effroi s’approcher l’époque où le soldat retournerait en France. Celui-ci l’aimait et l’estimait ; bien qu’il vécût irrégulièrement, il avait au cœur la foi du vieux pays, et peut-être un peu par remords, et parce que nous sommes naturellement missionnaires, il enseignait à cette femme les principes de la religion chrétienne. Même il assurait qu’on la pouvait déjà regarder comme étant de notre religion, tant elle avait l’âme disposée à la recevoir. Mais comment ferait-elle quand il l’aurait quittée ? Sachant qu’elle avait les Arabes en horreur, et qu’elle ne pourrait plus vivre dans le pays où elle avait tant souffert par eux, il se tourmentait. Il exposa l’affaire au moine ambulant, au frère universel. Et je trouve la réponse qui lui fut faite, dans une lettre au Père Guérin. « Je l’ai engagé à vous demander d’accepter cette femme dans votre ouvroir de Ghardaïa. Il l’y amènerait, elle y resterait, vivant entièrement chez les sœurs, où son travail paierait sa pension. Elle est fort bien d’apparence, et le caporal l’estime et l’aime beaucoup ; de plus, ce serait sauver une âme… Elle a toujours eu une vie régulière ; à l’heure où elle a été affranchie, le Français l’a recueillie ; d’après ses idées à elle, elle n’a donc jamais cessé d’être en position régulière. » Qu’advint-il de la pauvre négresse de trente ans, « tranquille et laborieuse » ? C’est une des innombrables histoires dont nous ne saurons jamais la fin.
Rentré à Tamanrasset, le Père de Foucauld trouve son ermitage quelque peu agrandi, par les soins de ses amis de Motylinski et des Harratins du village. Il a même la surprise, que lui a faite un jeune officier, d’apercevoir, dans le couloir encombré qu’il appelle sa maison, un lit, un lit de camp apporté à dos de chameau… Il ne gronde pas, il accepte le cadeau, il remercie, et, pour la première fois depuis vingt-sept ans, persuadé par la grande lassitude, il dort étendu sur une toile. Dès qu’il a repris possession de l’ermitage, il se remet, avec la même ardeur que par le passé, à ses travaux de langue touarègue, ayant hâte de les achever, « pour travailler plus directement au but unique : voir davantage les personnes, et donner plus de temps à la prière et aux lectures religieuses ».
Cette idée d’évangélisation progressive, qui n’a jamais cessé d’être la sienne et d’inspirer ses actes, le porte à inventer, pour ses pauvres Sahariens, quelques formules de prière, et, dans la même lettre, il soumet au Père Guérin un projet de chapelet simplifié, à l’usage des infidèles. Ils diraient, au commencement, l’acte de charité, puis en n’importe quelle langue, sur les petits grains : « Mon Dieu, je vous aime » et sur les gros grains : « Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur ! » « Jugeriez-vous bon, conclut-il, de demander des indulgences pour ce chapelet très simple, qui est bon à dire aussi pour les chrétiens ? » Et la lettre se termine par cette belle échappée, où l’on voit quels souvenirs secouraient cette grande âme dans la vie misérable et presque sans réponse :
« C’est aujourd’hui la fête de saint Pierre et de saint Paul. Il m’est doux de vous écrire en ce jour. Ne nous effrayons d’aucune difficulté, ils en ont vaincu bien d’autres, et ils sont toujours là. Pierre est toujours au gouvernail de la barque. Si des disciples de Jésus pouvaient se décourager, quelle cause de découragement auraient eu les chrétiens de Rome, le soir de leur martyre à tous deux ? J’ai souvent pensé à cette soirée-là : quelle tristesse et comme tout aurait semblé avoir sombré, s’il n’y avait pas eu dans les cœurs la foi qu’il y avait ! Il y aura toujours des luttes, et toujours le triomphe réel de la Croix dans la défaite apparente. Ainsi soit-il. »
Il attend de jour en jour le colonel Laperrine ; il note, événement heureux, la nomination, comme secrétaire de Moussa, d’un jeune homme élevé à Tlemcen, parlant bien français, ayant une bonne instruction française et une excellente instruction arabe, très francisé et nullement fanatique ; on peut espérer que ce nouveau personnage détruira la mauvaise influence des prétendus thalebs, ignorants et fanatiques, qui venaient de Rhât. « Quand aurons-nous à nous réjouir, ajoute-t-il, non plus de l’arrivée de musulmans, mais de l’arrivée des prêtres catholiques ?… Avec quelle ardeur je désire un compagnon qui soit prêtre, pour instruire par l’exemple, et les conversations quotidiennes, afin d’amener peu à peu les âmes à un autre enseignement ! »
Laperrine, « après une très heureuse et fructueuse tournée poussée jusqu’à Gogo », passe une semaine à Tamanrasset, et emmène avec lui son ami le Père de Foucauld ; ils font le tour de l’Ahaggar, de manière à voir les principaux cantons habités. Cette fois, il avait résolu de recenser les guerriers Hoggars, de passer en revue les troupes disponibles contre les Azdjers, et il avait fait distribuer des fusils du modèle 1874. Preuve de confiance et gageure tout ensemble. Moussa, ayant examiné, avec le colonel, en quel lieu il convenait d’ordonner le rassemblement, s’était décidé pour la haute vallée de l’oued Tméreri, qui est « fournie d’eau et de pâturage », et couverte de très beaux éthels.
Au jour et à l’heure convenus, Laperrine se trouvait au sommet d’un mamelon, vers le milieu de la vallée, et la vallée était déserte encore. Autour de lui, se tenaient le lieutenant de Saint-Léger, le lieutenant Sigonney, le docteur Hérisson, le Père de Foucauld et quatre ordonnances. Près du chef français, on avait placé le tambour de guerre, le tebbel, qui donne le signal de l’appel aux armes.
D’une vallée voisine, où il avait convoqué ses guerriers, Moussa ag Amastane commençait à faire passer ses troupes dans la plaine de Tméreri. Entre les arbres, on vit briller les armes, on vit des boucliers, les silhouettes des premiers combattants, haut perchés, et les têtes en mouvement des méharis. Alors, le colonel fit battre le tocsin, et la poussière s’éleva entre les éthels, et 525 méharistes de Moussa s’élancèrent vers le grand chef de France immobile et secrètement enthousiaste.
Après la fantasia, il y eut une longue causerie. Laperrine parla des usages à conserver, des autres qu’il fallait abandonner, par exemple celui des razzias. Le bruit ayant couru qu’il voulait interdire l’ahâl, c’est-à-dire l’assemblée galante et « mondaine », Laperrine, qui savait imparfaitement le tamacheq, tourna la tête, cherchant un bon interprète qui pût démentir la nouvelle. « Il y avait bien, a-t-il raconté dans les Annales de géographie, il y avait bien le Père de Foucauld, mais je n’osais guère lui demander ce service… Il se mit à rire, et après m’avoir dit que je lui faisais faire des traductions peu canoniques, il traduisit ma phrase, à la grande joie de tous les jeunes gens, et en particulier d’Alkhammouk, qui apercevait là une superbe occasion de taquiner le Père pendant leurs longues chevauchées. »
Au retour de cette expédition, et vers la fin d’octobre, le Père reçoit, à Tamanrasset, la visite du capitaine Nieger. Le fort Motylinski est construit ; pour un voyageur comme Frère Charles, 50 kilomètres sont une promenade, et lorsqu’un soldat français est gravement malade, on avertit l’ermite, qui sort aussitôt de l’ermitage et va confesser le mourant. « Il n’y a rien de nouveau, écrit-il au Père Guérin, dans le pays que la présence continuelle des officiers met de plus en plus en main ; plus on va, plus il se trouve préparé à l’arrivée de vos Pères. Dans le présent, l’œuvre des officiers est tout ce qu’on peut désirer de meilleur, elle ouvre les voies, établit le contact, fait régner la sûreté, et donne bonne opinion de nous, car le colonel, le capitaine Nieger, M. de Saint-Léger, et les autres, sont d’une bonté incomparable avec les indigènes. »
Tant d’efforts ne sont pas, ne peuvent pas être vains. Les témoignages concordent, pour signaler les débuts d’une civilisation au Hoggar « L’apprivoisement marche à grands pas. » Le Père de Foucauld en rapporte l’honneur aux officiers ; mais nous savons qu’il eut, dans ce commencement de civilisation, une part très considérable. « Partout où a passé un officier, la population, de farouche et de méfiante, est devenue amicale… Une foire bisannuelle a été établie au fort Motylinski (Tarhaouhaout), en mars et en octobre ; on y est convié de tous côtés, d’Agadès, de Zinder, de l’Aïr, comme d’In-Salah, d’Ouargla, etc. La présence en tout temps, dans l’Ahaggar, d’un détachement d’une centaine de soldats, a mis en lumière les ressources de la contrée. Ce détachement trouve sur place tout son approvisionnement de blé, de viande, de légumes, ainsi que l’orge pour ses chevaux. Le blé revient à 40 francs le quintal, l’orge à 30, une chèvre à 7 fr. 50, un mouton à 10 francs, le beurre à 1 fr. 50 la livre ; tous les légumes de France se récoltent dans les jardins ; leur qualité est excellente. L’eau et la terre abondent ; on pourrait cultiver bien plus qu’on ne cultive ; les bras seuls manquent. »
Pour connaître, dans le détail, la vie quotidienne de l’ermite, et précisément les choses qu’il ne raconte pas, nous avons eu quelques pages du Frère Michel, hôte passager de Beni-Abbès. Eh bien ! nous aurons, pour nous peindre la vie à Tamanrasset, les notes qu’a bien voulu me remettre le major Robert Hérisson, et qui se rapportent aux années 1909 et 1910.
Le docteur Hérisson a séjourné au Hoggar, pendant de longs mois, comme aide-major attaché au poste de Motylinski, et chargé de mission médicale parmi les tribus touarègues. Lui aussi, et dans l’ordre scientifique, il a été l’un des agents précieux du système « d’apprivoisement » imaginé par Laperrine.
Il était dans l’oasis tripolitaine de Djanet, lorsqu’il reçut, du colonel, une lettre de service dont il fut quelque peu surpris. Le colonel lui écrivait de se rendre au Hoggar, et là, de se mettre à la disposition du Père de Foucauld, de recevoir de celui-ci des instructions sur la manière d’agir vis-à-vis des Touaregs, de lui demander, notamment, dans quelles tribus, d’accord avec Moussa ag Amastane, il convenait d’abord de faire des vaccinations et de donner des soins médicaux. À peine eut-il causé avec le jeune médecin, le Père de Foucauld l’invita, comme il avait coutume de le faire, à assister à la messe du lendemain. M. Robert Hérisson répondit qu’étant protestant, il avait le regret de ne pouvoir accepter l’invitation.
« J’abordai le Père de Foucauld avec curiosité et une certaine réserve, sachant qu’il allait être « mon instructeur ».
« Je vis un homme d’apparence chétive au premier aspect, d’une cinquantaine d’années, simple, modeste. Malgré son habit, rappelant celui des Pères Blancs que j’avais vus à Ouargla, rien de monastique dans le geste, dans l’attitude. Rien de militaire non plus. Sous une très grande affabilité, simplicité, humilité de cœur, la courtoisie, la finesse, la délicatesse de l’homme du monde. Bien qu’il parût mal vêtu, sans aucun souci d’élégance, et qu’il fût d’un abord très facile pour tous, ouvriers français, brigadiers indigènes, la vivacité de son regard, sa profondeur, la hauteur de son front, l’expression de son intelligence en faisaient « quelqu’un ». Il était de taille au-dessous de la moyenne ; il paraissait, au premier aspect, peu de chose, mais j’eus vite l’impression que le Père de Foucauld était une grande intelligence, un cœur sensible, délicat… Il me fut très sympathique. Je me sentis attiré vers lui.
« Je vis qu’il était adoré de tous les Français qui le connaissaient déjà, et qu’il y avait même, chez les sous-officiers, artisans, une certaine fierté de pouvoir causer avec le Père de Foucauld et correspondre par lettre avec lui, aussi simplement, aussi familièrement qu’avec un de leurs vieux camarades.
« Ce Père était réellement curieux.
« Que me conseillez-vous de faire auprès des Touaregs, mon Père ? lui dis-je. J’ai l’ordre de prendre vos instructions.
« Il causa longuement.
« Il fallait être simple, affable et bon vis-à-vis des Touaregs, les aimer et leur faire sentir qu’on les aimait pour en être aimé.
« Ne pas être aide-major, même pas le docteur avec eux ; ne pas se froisser de leurs familiarités ou de leur désinvolture ; être humain, charitable, être toujours gai. Il faut toujours rire, même pour dire les choses les plus simples. Moi, comme vous le voyez, je ris toujours, je montre mes vilaines dents. Ce rire met de la bonne humeur chez le voisin, l’interlocuteur ; il rapproche les hommes, leur permet de mieux se comprendre, il égaie parfois un caractère assombri, c’est une charité. Quand vous serez au milieu des Touaregs, il faut toujours rire.
« Donnez-leur vos soins médicaux avec patience, guérissez-les : ils auront une haute idée de notre science, de notre puissance, de notre bonté. S’ils vous demandent de soigner une chèvre, n’en soyez pas vexé.
« Je suis d’avis que vous séjourniez longtemps près d’un campement touareg, non pas mêlé à eux, mais en bordure, pas gênant, mais prêt à les recevoir s’ils veulent venir. Restez ici, sans bouger de place, trois semaines ; vous aurez le temps de les guérir et aussi de les connaître et de vous faire connaître.
« Ils nous ignorent. On a fait courir sur les Français des légendes absurdes. On raconte que nous mangeons les enfants, que la nuit nous nous métamorphosons en bêtes, etc.
« Racontez, en vous aidant d’un interprète, à ceux qui aimeront à venir causer avec vous, notre vie intime, familiale, nos mœurs, nos coutumes, la naissance, le parrainage, l’éducation religieuse des enfants, le mariage, les lois du mariage, les devoirs entre époux, vis-à-vis des enfants, les décès, les cérémonies, les legs, les testaments, quels faits on honore, quels faits on méprise… »
« Il me conseilla de montrer aux Touaregs des photographies vérascopiques, représentant les travaux des champs en France, nos troupeaux, la vie à la campagne, les rivières, les fermes, nos bœufs, nos chevaux… « Faites-leur comprendre que la vie des Français est faite d’honnêteté paisible, de labeur, de production. Montrez-leur que le fond de la vie de nos paysans est le même que le leur, que nous leur ressemblons, que nous vivons comme eux chez nous, mais dans un plus beau pays.
« Vous aurez sans doute des loisirs, car le pays est très sain, il y a peu de malades et puis la population est très clairsemée. Que comptez-vous faire ? – Le colonel, dis-je, m’a chargé de recueillir des échantillons de plantes pour les envoyer à Alger à M. Trabut, le professeur de botanique, qui en déterminera l’espèce. Je vais essayer aussi de créer un jardin potager à Tarhaouhaout. – Il serait intéressant, me dit le Père de Foucauld, de savoir si une autre race que les Touaregs a habité le désert. Il y a ici des tombeaux, très anciens, des tombeaux de païens, antérieurs à l’islamisme. Ce sont, très vraisemblablement, les ancêtres des Touaregs, mais ils ne veulent pas en convenir. Vous pourriez faire des fouilles. Ils ne verront aucun mal à ce que vous exhumiez ces ossements. Vous pourrez ensuite déterminer la parenté de race existant entre ces païens et les Touaregs d’aujourd’hui. »
« Le Père de Foucauld était l’âme du Hoggar. Le colonel Laperrine ne faisait rien sans prendre son avis, et Moussa ag Amastane agissait de même.
« Les indigènes avaient une telle estime pour lui qu’ils le prenaient pour juge. J’ai assisté, un matin, à cette scène fort curieuse. Il était devant sa porte, un peu incliné vers la terre, vêtu de blanc ; devant lui, au premier plan, deux immenses Touaregs, vêtus de noir, le visage voilé par le litham, en grande tenue cérémonieuse, l’épée au côté, le poignard à l’avant-bras gauche, la lance dans la main droite ; derrière, d’autres Touaregs, quatre ou cinq, accroupis, témoins ou auditeurs. Il s’agissait d’une histoire de vol de chameaux, et de coups donnés au nègre, esclave du propriétaire et gardien du troupeau.
« L’un accusait, l’autre niait. Tous deux avaient cette attitude emphatique, théâtrale des Hoggars, le geste impérieux, la voix martelée, mais assourdie par le litham qui leur faisait comme un léger bâillon.
« Finalement, on apportait un coran, et l’accusé protestait de son innocence, en jurant sur le coran devant le Père de Foucauld.
« Vers 10 heures, chaque matin, le Père appelait son nègre ; il lui donnait une écuelle en bois remplie de grains de blé, et une poignée de dattes. Le jour où il m’invita à déjeuner, il me prévint que le menu serait détestable. J’acceptai par politesse et par curiosité, mais je ne recommençai plus.
« Le nègre alla moudre le grain dans un moulin à main, en pierre, comme en ont les Berbères dans l’Atlas, les indigènes dans les campagnes marocaines. Ce moulin cassait le grain de blé mais n’en faisait pas de la farine. Avec le blé cassé, sans levain, il faisait une galette plate et ronde, qu’il mettait à cuire sous la cendre. Dans une petite casserole en fer battu, les dattes, grossières, pleines de sable et de poils de chèvre, avaient bouilli. Le déjeuner était prêt.
« Le Père de Foucauld enleva alors les livres, les feuilles qui étaient sur sa table, y disposa deux assiettes creuses et deux cuillers en fer battu, et me dit :
– Avez-vous jamais mangé du khéfis ?
– Non.
– C’est ma nourriture habituelle. Je ne sais pas si vous trouverez cela bon, mais je ne puis rien vous offrir d’autre. J’avais encore quelques petites boîtes « de singe » que le sergent de Saint-Léger avait voulu me laisser à son dernier passage : je les ai apportées au brigadier X… qui avait voulu m’inviter en passant ici. Le khéfis est une nourriture qui me paraît complète, qui est facile à préparer, et convient à mes pauvres dents.
« Voici la recette du khéfis. On prend la galette de blé, on la rompt en petits morceaux, toute fumante, dans l’assiette en fer battu. On retire les noyaux des dattes, on verse la compote de dattes sur les morceaux de galette. Puis, prenant du vieux beurre arabe liquide, on en répand sur la galette et les dattes. Il faut maintenant saisir tout cela à pleine main, le triturer, l’écraser, en faire une sorte de mastic. Le goût en est fade, sucré, mais pas mauvais.
« Un gobelet d’eau, et une tasse de café complètent le repas. « Ce soir, nous aurons un couscous sans viande, mon dîner habituel, cela vous plaira davantage. »
« Cela ne valait pas grand’chose.
« Avant le coucher du soleil, le Père se donnait une heure de récréation, il se promenait de long en large, devant son ermitage. Alors, il causait aimablement de tout. Nous nous promenions côte à côte. Il me mettait la main sur l’épaule, riait, me parlait des Touaregs, de ses souvenirs. Les premiers temps, il me demandait chaque fois comment j’avais employé mon temps dans la journée. Il me faisait faire une sorte d’examen de conscience, et me blâmait si je n’avais pas soigné des Touaregs, appris de l’arabe ou du tamacheq…
« Le jour où j’ai vu le Père de Foucauld réellement mécontent, c’est quand je lui ai avoué, quelques mois avant mon départ définitif du Hoggar, que je ne faisais plus de recherches anthropologiques depuis sept à huit mois.
« J’ai vu, lui disais-je, que je n’allais aboutir à aucun résultat, j’ignorerais aussi bien qu’avant à quelle race appartenaient ces païens. Étaient-ils les ancêtres des Hoggars, étaient-ils un autre peuple ? Mon travail était voué d’avance à la médiocrité.
« Le Père de Foucauld me reprocha d’avoir manqué de persévérance… « Le peu que vous auriez fait, et que vous auriez légué à vos successeurs, aurait été du travail déjà fait ; d’autres, en prenant les résultats, même négatifs, de vos recherches, et en continuant, auraient fait avancer la question. Vous la retardez, en vous abstenant de poursuivre vos recherches. Pour ce qui est d’être rebuté, à l’idée que votre travail serait une œuvre médiocre, ça n’est pas autre chose que de l’orgueil. Votre renoncement à poursuivre ces recherches peut décourager d’avance ceux qui viendront après vous. »
« Il fallait travailler. Un jour, il vint un nègre pendant que j’étais là, qui lui demanda l’aumône. Il mourait de faim, disait-il. Il était bien constitué, mais il paraissait maigre. Il avait environ vingt-cinq ans ; le Père de Foucauld lui demanda pourquoi il ne travaillait pas dans les centres de culture de Tit, Abalessa, etc. Il répondit qu’il n’y avait rien à faire. Alors le Père de Foucauld, lui montrant un petit coffre en bois qui avait servi de moule à briques, lui dit : « Fais-moi vingt briques, et je te donne une mesure de blé. » Il y en avait à peine pour une heure de travail ; il suffisait de faire vingt petits pâtés comme en font les enfants au bord de la mer : le nègre refusa. Le Père tint bon, et ne lui donna rien, si ce n’est le conseil de travailler pour vivre. »
Dans d’autres occasions, la leçon était pour les nobles Touaregs. Le major Robert Hérisson raconte, par exemple, qu’un soir, au coucher du soleil, c’est-à-dire à une des heures de la prière musulmane, cinq ou six Kel-Ahaggar et Kel-Rela causaient avec le Père de Foucauld et l’amenokal. Celui-ci, son cousin Akhammouk et Aflan, le mari de Dassine, se lèvent, ajustent leur litham bleu sur leur visage, et s’apprêtent à faire la prière. Les autres Touaregs, indifférents, continuent de causer. Mais le Père de Foucauld, sévèrement, les interrompt :
– Et vous, leur dit-il, vous ne priez pas ?
Il les excitait ainsi à honorer Dieu, de la seule manière qui leur fût connue et actuellement connaissable. Ils comprirent, et, aussitôt, se levèrent pour imiter Moussa.
Le docteur Hérisson a vu vivre, l’un près de l’autre, à Tamanrasset, Laperrine et le Père de Foucauld. Entre ces deux hommes, il y avait affection fraternelle et grande estime mutuelle, avec cette petite nuance de déférence que Laperrine savait garder, vis-à-vis de son grand ancien de Saint-Cyr, cavalier comme lui. Quand il se trouvait de passage dans le Hoggar, on prenait toujours les repas en commun.
« Pour déjeuner ou dîner, on étend une grande couverture par terre, à l’ombre de quelque arbre, s’il y en a, ou sous la tente du colonel, qui est assez vaste. Chacun donne son couvert, son quart, son gobelet au cuisinier qui les dispose n’importe comment. Il n’y a pas de préséance.
« Quand tout est prêt, on se met à table, on s’accroupit en tailleur, sur le bord de la couverture. Le cuisinier apporte le plat. Chacun a sa petite galette de blé cuite sous la cendre. Le colonel désigne celui qui doit se servir le premier, n’importe lequel. On bavarde ferme d’ailleurs, et personne ne fait attention. Le colonel invite toujours à sa table tous les Français du voisinage, maréchaux des logis, brigadiers, armurier, menuisier. Ils ne paieront rien à la popote. Il les fait quelquefois servir les premiers. Ils ont autour du plat une place quelconque, suivant le hasard. Le Père de Foucauld vient toujours à midi, avec une bouteille de muscat blanc, de son vin de messe. Nous en buvons la valeur d’un verre à bordeaux, à la fin du repas. On proteste, on se récrie chaque fois en voyant la bouteille : « Mon Père, vous vous démunissez, c’est trop, vous allez épuiser votre provision : on ne la boira pas ! » Mais lui, en riant, insiste : « Vous pouvez la boire, je n’apporte que ce que je puis donner. » Et on la boit avec délices, bien entendu.
« À table, on ne cause pas de choses sérieuses, on raconte des histoires, on plaisante, on taquine le cuisinier du colonel. Le Père de Foucauld rit. Le colonel a un répertoire très varié, très amusant, d’anecdotes qu’il dit être vraies. C’est un narrateur très séduisant. Le Père de Foucauld sourit, quand tout le monde rit. Mais si l’histoire sort un peu des limites permises, il n’entend plus, il devient sourd, il paraît penser à autre chose. Alors, quelqu’un fait remarquer que la conversation a pris « un ton badin » et que les oreilles du Père doivent être scandalisées. Mais si l’on s’excuse, celui-ci proteste qu’il n’écoutait pas et n’a pas entendu : aucune gêne.
« Pendant les « tournées », il venait avec un domestique nègre et un chameau de louage, sans tente, sans lit de camp. Il couchait par terre, dans ses couvertures. Il prenait la plupart du temps un chameau de bât, sans selle (sans rahla). Il aimait, pour ne pas perdre de temps, à nous laisser passer devant, et à venir nous rejoindre à l’endroit convenu, en doublant les étapes, en faisant 80 kilomètres par jour à 6 kilomètres l’heure, et en passant, autant que possible, par une route encore inexplorée des Français.
« Il arrivait alors avec des petits bouts de papier pleins de notes et de croquis, tout petits, mais très nets, comme ceux de son exploration au Maroc, et il remettait tout cela au colonel.
« Dans les assemblées, dans les palabres, il refusait de s’asseoir à côté du colonel, sur une chaise pliante ; il voulait être accroupi sur le sol, à côté de lui. Le colonel se servait de lui comme interprète : il y avait là, en effet, des Touaregs ignorant la langue arabe, ou la connaissant mal. Le Père non seulement les comprenait et s’exprimait parfaitement en langue targuie, mais, par sa connaissance de leur caractère et de leurs mœurs, il savait ce qu’il fallait éclaircir dans leur esprit, quel doute ou quelle appréhension pouvait naître, etc. Enfin, sa valeur morale était si réputée et si hautement estimée, que tout ce qui se disait par lui prenait encore plus de poids.
« Les Touaregs disaient : « Il connaît notre langue mieux que nous-mêmes. »
« Dans sa récréation du soir, quand il se promenait de long en large, devant son ermitage, au coucher du soleil, le bras appuyé sur mon épaule, il me disait que la distinction personnelle n’est pas due à la naissance ou à l’éducation, qu’elle est innée, et qu’il avait trouvé chez des simples, à la Trappe, une élévation de sentiments remarquable. « Nous vivions les uns à côté des autres sans connaître nos origines, notre nom, et chacun remplissait sa fonction suivant ses aptitudes. Il y avait un paysan sans aucune instruction, qui avait des inspirations, des pensées qui lui venaient du cœur, d’une beauté parfaite. Il ne s’en rendait pas compte. J’étais dans le ravissement de l’entendre. Sans aucun art, très naturellement et très simplement, il était éloquent.
« Le Père de Foucauld, contrairement à ce qui se dit des hommes célèbres, grandissait démesurément quand on le voyait tous les jours et de près. »
Ces lignes, par quoi se termine le manuscrit du docteur Hérisson, ne rappellent-elles par les jugements qui furent portés sur l’ermite dans le temps qu’il habitait Beni-Abbès, et ceux-ci, déjà, ne faisaient-ils pas écho à tant de louanges qui s’étaient élevées d’Akbès, de Nazareth, de Jérusalem et de Notre-Dame-des-Neiges ?
Dans l’année 1910, deux grandes amitiés, deux appuis sont enlevés au Père de Foucauld. Le 14 mai, le courrier venant d’In-Salah apportait la nouvelle que le Père Guérin était mort, à trente-sept ans, épuisé par les fatigues de la vie saharienne. La longue, la volumineuse correspondance échangée entre celui-ci et le Père de Foucauld montre le respect que ces deux hommes éprouvaient l’un pour l’autre. Lorsque deux âmes, grâce à la foi qui les remplit, sont à peu près délivrées de l’amour-propre, qu’elles sont devenues, autant que la nature le permet, des puissances toutes nobles, attentives, obéissantes au moindre signe de Dieu, l’intelligence entre elles est aussitôt parfaite, silencieuse ou exprimée, et la confiance où elles se trouvent surpasse en douceur toute autre amitié.
Je n’ai pas trouvé, dans ces nombreuses lettres, la trace d’un dissentiment. Des deux côtés, même certitude que l’ami auquel on s’adressait, l’un demandant conseil, et l’autre répondant, ne pensait qu’au règne sur le monde de la Beauté souveraine. Le Père de Foucauld soumettait tous ses projets de voyage, de fondation, d’avenir lointain, à cette amitié directrice, et, s’il ne lui rendait pas compte, comme il faisait à M. Huvelin, des mouvements de son esprit, il ne marquait pas, néanmoins, la limite de ces deux domaines, l’un extérieur, l’autre intérieur, et bien souvent les confidences d’ordre spirituel, résolutions, hésitations, tristesses passagères, avaient été exprimées, dans les lettres que l’ermite de Beni-Abbès ou de Tamanrasset envoyait au préfet apostolique de Ghardaïa.
« Le bon Dieu vient de nous infliger, à vous et à moi, une épreuve, écrivait-il au Père Voillard, deux jours après l’arrivée du courrier. Vous avez perdu un bien bon fils, et moi un bien bon père : perdu en apparence, car il est plus près de nous que jamais… Je n’avais jamais songé que, peut-être, il ne me survivrait pas, et je m’appuyais sur son amitié comme si elle ne pouvait jamais me manquer. Vous sentez le vide que me laisse son départ. Jésus reste : qu’il soit béni de tout ! Qu’il soit béni d’avoir appelé à la récompense notre si cher Père Guérin ! Qu’il soit béni aussi de nous l’avoir prêté pendant quelques années !
« Ce départ imprévu me fait désirer avec plus de force la compagnie d’un prêtre qui continue la toute petite œuvre commencée ici. Il pourrait vivre à côté de moi, en vivant de ma vie ou sans en vivre. Je ne demande pas à être son supérieur, mais son ami, prêt à le laisser seul dès qu’il sera au courant…
« Dès 1905, le capitaine Dinaux, alors chef du bureau arabe d’In-Salah, demanda des Sœurs Blanches pour l’Ahaggar ; maintenant qu’il y a une garnison permanente, un officier français, un médecin, plusieurs sous-officiers et brigadiers français, une centaine de militaires indigènes en permanence dans le pays, avec la poste deux fois par mois, une grande sécurité et facilité de vie, il y aurait peut-être lieu d’y songer ? On n’envoie pas de Sœurs sans Pères Blancs : mais pour les Pères Blancs aussi, il y aurait peut-être lieu d’examiner la possibilité d’une fondation… Actuellement les Touaregs de l’Ahaggar ne sont musulmans que par l’acte de foi et de nom ; ils détestent les Arabes ; la soumission à la France introduit dans le pays des Arabes musulmans, des khodjas musulmans au service de la France, comme militaires ou interprètes ; elle permet aux Arabes du Tidikelt et d’autres pays d’y circuler librement, d’y commercer sans crainte d’être pillés ; d’où suivra probablement une propagande islamique et une rénovation de ferveur islamique : il serait utile de prendre les devants…
« Je prépare une action plus active sur les âmes, en faisant construire, à 60 kilomètres d’ici, au cœur des plus hautes montagnes de l’Ahaggar et des lieux où sont cantonnées les tentes les plus nombreuses, un petit ermitage qu’on pourra habiter à deux. J’y serai beaucoup plus au centre des populations qu’ici. J’ai l’intention, à partir de l’année prochaine, de me partager entre lui et celui de Tamanrasset…
« Je vous demande une prière pour mon directeur M. l’abbé Huvelin ; il est mon père depuis vingt-quatre ans ; rien ne saurait exprimer ce qu’il est pour moi, ce que je lui dois. Les nouvelles qu’on me donne de sa santé sont lamentables. À chaque courrier, je crains d’apprendre que, lui aussi, il a achevé son temps d’exil. »
Moins de deux mois plus tard, en effet, le 10 juillet, l’abbé Huvelin mourait. Celui qu’il avait ramené à Dieu pleura, puis, comme les meilleurs, leva les yeux vers le ciel, et y trouva l’immuable joie consolatrice. À un des Pères Blancs qui lui exprimaient de la sympathie, en cette occasion, il répondit :
« Oui, Jésus suffit ; là où il est, rien ne manque. Si chers que soient ceux en qui brille un reflet de lui, c’est Lui qui reste le Tout. Il est le Tout dans le temps et dans l’éternité. »
Comme si tous les étais dussent être enlevés à l’édifice achevé, un troisième ami du Père de Foucauld devait s’éloigner d’Afrique, dans cette même année. Le colonel Laperrine, qui commandait les oasis depuis neuf ans, avait demandé à prendre le commandement d’un régiment de France ; il laissait en paix ces territoires organisés par lui, agrandis de tout le pays touareg[117].
Pour quel motif le grand Saharien quittait-il son Sahara ? Pour le plus beau. Frère Charles, son confident, a dit en effet : « Il trouve, avec raison, qu’il ne faut pas paraître tenir à des fonctions. » Un homme très supérieur peut seul penser ainsi. La vie et la mort de Laperrine autorisent à croire que Frère Charles ne se trompait pas.
Laperrine ne retournera plus au Hoggar, si ce n’est vers le milieu de la Grande Guerre. Il ne reverra plus son ami vivant. C’est l’adieu, comme presque toujours, ignoré. Foucauld n’a pas seulement pour l’homme, son camarade de jeunesse, une affection éprouvée, il admire le chef qui a tant travaillé pour la grandeur de la France en Afrique, c’est-à-dire pour la civilisation des peuples qui nous sont confiés. Quelques mois avant ce départ, il lui rendait cet hommage, dans une lettre : « Laperrine se dépense sans mesure ; il a imprimé, à tout ce qui est sous ses ordres, un mouvement et une activité admirables ; ce qu’ont fourni de travail, depuis six ans, les officiers sous ses ordres, est inouï, et tout ce qui a été fait au point de vue militaire, administratif, géographique, commercial. »
Le voyant s’éloigner, il résume la carrière coloniale de Laperrine : « Depuis l’âge de vingt et un ans, il n’a pas passé trois ans en France ; un an à Saumur comme lieutenant, quinze mois comme capitaine, et six mois comme commandant : tout le reste en Algérie, Tunisie, et surtout au Sénégal, au Soudan et au Sahara. C’est lui qui a donné le Sahara à la France, malgré elle, et en y risquant sa carrière, et qui a réuni nos possessions d’Algérie et notre colonie du Soudan. »
Avant de quitter l’Afrique, le colonel avait décidé le voyage, en France, de Moussa ag Amastane. Quelques nobles Touaregs accompagnaient l’amenokal ; on les fit assister à des expériences de tir au Creusot ; ils visitèrent des haras, des usines, des villes, notamment Paris et ses « curiosités », parmi lesquelles une des moins parisiennes assurément, la plus cosmopolite : le Moulin-Rouge. Ce fut la visite express, sautillante et sans répit, faite pour étonner, non pour émouvoir, telle que la peuvent régler des gouvernants qui n’ont pas le sentiment de la paternité du pouvoir. Frère Charles recevait quelques nouvelles de la promenade, trop officielle à son gré ; il se réjouissait à la pensée du profit que tirerait quand même le chef touareg de cette expérience, bien incomplète, d’une civilisation supérieure. « À son retour, écrivait-il, je tâcherai de lui faire comprendre que trois choses sont nécessaires s’il veut travailler au salut éternel de son peuple : 1° Procurer l’éducation de l’enfance et de la jeunesse, qui reste aussi abandonnée à elle-même que les animaux ; 2° procurer son instruction dans une certaine mesure ; 3° travailler à rendre son peuple sédentaire, de nomade qu’il est, tout en le laissant un peuple pasteur.
« Cette troisième chose est la condition sine qua non des deux premières, car l’éducation et l’instruction semblent incompatibles avec la vie nomade.
« Pour les Kel Ahaggar, ou du moins pour la grande majorité d’entre eux, le passage de la vie nomade à la vie sédentaire serait facile : les plus fortes tribus sont presque sédentaires ; les chameaux, sous la garde de quelques bergers, vont paître à grande distance ; mais les tentes, avec les familles et les troupeaux de chèvres, sont presque fixes ; elles ne se déplacent que dans un rayon de 40 kilomètres environ… De plus, la paix, due à ces trois années d’occupation française, a déjà eu un résultat dans le sens de la fixation des habitants. À mon arrivée, il n’y avait qu’une maison à Tamanrasset, les autres habitations étaient des huttes ; maintenant, il y a quinze ou vingt maisons ; on en construit sans cesse ; les huttes auront bientôt disparu ; il en est de même, dit-on, dans les autres villages… Les cultures se multiplient. Tout Touareg un peu à l’aise a des champs. Malheureusement, ils ne cultivent pas eux-mêmes, ils font cultiver par des harratins du Tidikelt, ou des nègres. Surveiller les travaux, moissonner, les Touaregs le font, mais mettre la main à la houe, ils le dédaignent. L’installation, dans le pays, de religieux cultivant de leurs propres mains serait un grand bienfait… »
Le chef du Hoggar, à peine rentré sur la terre d’Afrique, s’empresse d’écrire à son ami le Père de Foucauld, et voici la lettre qu’il lui adresse, sur une feuille de papier de l’hôtel de l’Oasis :
« Louange à Dieu l’unique, – et la bénédiction de Dieu sur Mahomet.
« D’Alger, pour le Hoggar, le 20e jour de septembre 1910. – À l’honoré, l’excellent, notre ami et cher entre tous, Monsieur le marabout Abed Aïssa[118], le sultan Moussa ben Mastane te salue, et te souhaite la grâce de Dieu très élevé et sa bénédiction. Comment vas-tu ? Si tu désires de nos nouvelles, comme nous demandons des tiennes, nous allons bien, grâce à Dieu, et nous n’avons que de bonnes nouvelles à te donner. Voici que nous arrivons de Paris, après un heureux voyage. Les autorités de Paris ont été contentes de nous. J’ai vu ta sœur, et je suis resté deux jours chez elle ; j’ai vu de même ton beau-frère ; j’ai visité leurs jardins et leurs maisons. Et toi, tu es à Tamanrasset comme le pauvre[119] ! À mon arrivée, je te donnerai toutes les nouvelles en détail.
« Ouani ben Lemniz et Soughi ben Chitach te saluent.
« Salut ! »
L’ermite séjourne à Tamanrasset jusqu’à la fin de l’année, et entreprend un second voyage en France au début de 1911, voyage un peu plus long que le premier. Celui-ci avait duré trois semaines. En 1911, le Père de Foucauld met un mois à parcourir l’itinéraire assez compliqué que voici : Marseille, Viviers, Nîmes, Notre-Dame-des-Neiges, Paris, Nancy, Lunéville, Saverne, Paris, Bergerac, Angoulême, Paris, Barbirey, Lyon, Marseille.
Le 3 mai, il rentrait à Tamanrasset, après avoir fait une pointe sur Beni-Abbès, où il ne passa que trois jours. Le calme du Hoggar lui parut doux, après ces quatre mois de route, et l’accueil des Touaregs le toucha. Il écrivait, le 14 mai, au Père Voillard, devenu son directeur spirituel depuis la mort de l’abbé Huvelin : « En ce moment, il y a beaucoup de monde ici, à cause de la moisson ; j’y resterai encore trois semaines environ, pour profiter de ce rassemblement, voir les uns et les autres, causer avec Moussa, donner leur part d’aumônes aux pauvres du voisinage, puis j’irai à Asekrem, l’ermitage de montagne, pour un an au moins. J’y travaillerai, de toutes mes forces, à mes travaux de langue touarègue, de manière à les achever d’ici à un an et demi… J’ai été très bien reçu par toute la population ; elle fait des progrès en confiance et apprivoisement, elle en fait aussi matériellement… Un mouvement intellectuel suivra certainement. »
L’été arrive. Brusquement, les lettres s’espacent. Les correspondants du Père de Foucauld doivent s’imaginer qu’il est malade ou perdu dans le Sahara. Perdu serait presque vrai. Celui qui s’est établi sur un des points les plus inconnus du monde a été tenté par l’inaccessible : il est parti, le 5 juillet, pour l’Asekrem, il habite dans une masure, à 2 900 mètres en l’air, le plus haut point du globe, assurément, où jamais un ermite ait vécu. Pense-t-on qu’il ait été conduit là par un caprice, par je ne sais quelle fantaisie et outrance d’une nature aventureuse ? Ce serait mal le juger, et nous le savons déjà. La villégiature de l’Asekrem n’est qu’un témoignage nouveau de la charité et de l’intrépidité de cet homme. Il va chercher là-haut, dans le froid et dans la tempête, les âmes dont il s’est fait le pasteur vagabond. La sécheresse a chassé les Touaregs des plateaux de l’Ahaggar, ils sont allés camper dans les vallées de la Koudiat, où il y a un peu d’herbe verte pour les troupeaux. Et Frère Charles est monté vers eux. Ils ne sont pas venus seulement de Tamanrasset et des environs, mais de plusieurs déserts autour du massif du Hoggar, et des nomades de diverses tribus sont là pour un peu de temps, grelottants, mais non plus affamés.
La route est longue et rude. La dernière partie ne peut guère se faire qu’à pied : les chameaux trébuchent sur les éboulis de pierrailles. Il faut trois jours au moins pour atteindre l’Asekrem, citadelle du pays, plateau enveloppé d’un paysage fantastique de pitons, d’aiguilles, de tables géantes, de portiques, sculptés au sommet des montagnes plus basses. Au nord et au sud, rien n’arrête la vue. Çà et là, ce sont des statues d’hommes ou d’animaux dressées dans l’air limpide, et qui changent de couleur, d’ombres et d’expressions, selon la hauteur du soleil et son secret pouvoir. Dans nos montagnes d’Europe, la pluie ; ici le vent, toujours soufflant et charrieur de sable, a limé les roches friables et laissé debout des piliers plus durs, des angles résistants, des flèches fines ou énormes, comme le pic Ilaman qui domine le reste. Le plateau de l’Asekrem n’a pas seulement cette étrange beauté : il rappelle au savant les premiers âges du monde ; il est le point du partage des eaux. Les grands oueds sahariens, aujourd’hui desséchés, ont coulé de ses flancs. De tous côtés, on y peut suivre la trace des lits qu’ils ont creusés, et qui s’en vont, les uns vers le bassin de Taoudéni, d’autres vers l’Atlantique, d’autres vers le Niger, comme l’oued Tamanrasset.
Le Père de Foucauld aimait cette extraordinaire solitude, de toute l’ardeur de son âme de poète et de contemplateur. « C’est un beau lieu, disait-il, pour adorer le Créateur. Puisse son règne s’y établir ! J’ai l’avantage d’avoir beaucoup d’âmes autour de moi, et d’être très solitaire sur mon sommet…
« Cette douceur de la solitude, je l’ai éprouvée à tout âge, depuis l’âge de vingt ans, chaque fois que j’en ai joui. Même sans être chrétien, j’aimais la solitude en face de la belle nature, avec des livres, à plus forte raison quand le monde invisible et si doux fait que, dans la solitude, on n’est jamais seul. L’âme n’est pas faite pour le bruit, mais pour le recueillement, et la vie doit être une préparation du ciel, non seulement par les œuvres méritoires, mais par la paix et le recueillement en Dieu. Mais l’homme s’est jeté dans des discussions infinies : le peu de bonheur qu’il trouve dans le bruit suffirait à prouver combien il s’y égare loin de sa vocation. »
À l’Asekrem comme à Tamanrasset, il avait choisi l’endroit d’où l’on peut voir. Sa maison n’était qu’un couloir, bâti en pierre et en terre, et si étroit que deux hommes n’y pouvaient passer de front. Mais, dans ce pauvre refuge, il y avait une chapelle, et, au delà, une quantité d’objets merveilleusement en ordre, des livres en grand nombre, des provisions, des caisses ouvertes ou non ouvertes. Il couchait sur l’une de celles-ci. Dans le jour, elle lui servait de table. Autour de lui le vent soufflait, avec le bruit de la mer quand elle monte sa marée. L’abbé Huvelin avait envoyé deux cents francs à son ami, pour l’aider à construire cet abri ; il lui avait donné aussi le petit autel de la chapelle, et Frère Charles, enthousiasmé, reconnaissant, s’était écrié : « J’espère qu’on dira la sainte messe sur cet autel, bien longtemps après ma mort ! »
Là, plus d’une fois par semaine, il reçoit la visite de familles touarègues : hommes, femmes, enfants, on monte tous ensemble, des vallées innombrables cachées dans la Koudiat. C’est un pèlerinage et une partie de plaisir. On vient de grande distance, d’un jour, de deux jours de marche. Il faut donc se reposer là-haut, souper, passer la nuit. Frère Charles accepte avec joie de dépenser le temps précieux, pour accueillir ses hôtes ; il leur fait de petits cadeaux ; il partage ses repas avec eux. « Un ou deux repas pris ensemble, une journée ou une demi-journée passée ensemble, mettent en relations plus étroites qu’un grand nombre de visites d’une demi-heure ou d’une heure, comme à Tamanrasset. Certaines de ces familles sont relativement bonnes, aussi bonnes qu’on peut l’être sans le christianisme. Ces âmes se dirigent par les lumières naturelles ; bien que musulmanes de foi, elles sont très ignorantes de l’Islam, et n’ont pas été gâtées par lui. De ce côté, l’ouvrage qui se fait ici est très bon. Enfin ma présence est une occasion, pour les officiers, de venir dans le cœur même du pays[120]. »
Tout le reste du temps, – et les journées sont amples quand on se lève bien avant le soleil, – Frère Charles prie ou travaille. Il a amené avec lui l’indigène qu’il appelle son « informateur de touareg », il lui donne cinq sous par heure, pour le payer de sa peine, mais, comme les séances d’interrogations et de réponses durent, en moyenne, neuf heures par jour, l’élève trouve que les honoraires du professeur sont une lourde dépense, et celui-ci que tant d’application fatigue la tête d’un nomade. Cette fatigue, si nouvelle pour un homme de l’Ahaggar, l’éloignement du puits où il va chercher l’eau chaque matin, l’austère solitude peut-être et peut-être le froid des nuits, avec l’hiver venant, font que le « coadjuteur » demande à être rapatrié. Frère Charles, qui avait fait toutes ses provisions de livres et de conserves « comme quelqu’un qui entreprend en mer un voyage de seize mois sans devoir relâcher à aucun port », est contraint de céder et de descendre. Au début de décembre, il rentre dans l’ermitage de Tamanrasset.
La vie coutumière y reprend, charitable, cachée, sollicitée par la misère, qui est toujours grande parmi les tribus. Frère Charles se met tout à l’aumône, et distribue ses provisions. Il vient d’apprendre une nouvelle ancienne déjà pour le reste du monde : la guerre entre les Italiens et les Arabes de Tripolitaine. Ses amis s’inquiètent des répercussions que cette guerre peut avoir dans le Sahara. « Soyez sans inquiétude, écrit-il à l’un d’eux, au sujet des prédications de guerre sainte. Le Sahara est grand, les Turcs font certainement leurs efforts pour faire prêcher la guerre sainte parmi les tribus arabes de la Tripolitaine, mais cela ne nous touche pas. Les Touaregs, très tièdes musulmans, ont dans une égale indifférence la guerre sainte, les Turcs et les Italiens. Cela leur est complètement égal ; ce qui les intéresse uniquement, c’est leurs troupeaux, les pâturages et les récoltes. Avant leur soumission à la France, ils joignaient à ces occupations celle de couper les routes ; maintenant qu’elle leur est interdite, ils s’adonnent avec autant d’ardeur aux autres.
« J’ai trouvé Tamanrasset et les populations voisines dans un état de misère effrayant, et j’ai cru devoir donner en aumônes beaucoup plus que je ne prévoyais. Le motif de cette misère est double : 1° la sécheresse règne depuis vingt mois ; de là il suit que le lait, le beurre, la viande de boucherie, qui sont la principale richesse du pays, manquent depuis vingt mois ; 2° en 1911, les deux récoltes (on fait une récolte de blé au printemps et une de mil en automne) ont été nulles, à cause des pucerons qui ont sucé l’intérieur des épis un peu avant maturité. Résultats : 1° il n’y a dans le pays rien à manger ; je n’ai pas pu trouver ici un litre de grains quelconques (blé, orge ou mil) à acheter ; 2° personne n’a de vêtements, parce qu’on se les procure en vendant du beurre, des animaux, etc. Moi, j’ai de quoi manger, parce que j’ai des réserves, mais il y a bien peu de gens ici qui fassent deux repas par jour, et beaucoup se nourrissent exclusivement de racines sauvages… Je ne puis nourrir les gens, mais j’ai donné beaucoup plus en vêtement que je n’en donne d’ordinaire ; c’est le moment du froid.
« Ma vie jusqu’à présent, depuis mon retour, n’a guère été occupée qu’à prier le bon Dieu et à recevoir les uns après les autres tous mes voisins… Je n’ai pas encore repris le travail du lexique et de la grammaire ; je ne m’y mettrai qu’après le jour de l’An ; d’abord, je voulais pouvoir me tenir un peu au pied de la Crèche pendant ce saint temps de Noël, puis il fallait que je voie tous mes pauvres voisins, qui commencent à être de vieux amis, car je suis dans ma septième année d’habitation à Tamanrasset. »
Il a rapporté de petits présents qu’il distribue aux visiteurs et aux visiteuses, et qui sont précieux au Hoggar. Le cadeau le plus ordinaire, ce sont les aiguilles à coudre ; au-dessus, il y a les épingles doubles, puis les boîtes d’allumettes ; on réserve les ciseaux pour les grandes dames, les couteaux pour les Touaregs les plus influents.
À mesure que le temps s’écoule et que s’accroît l’expérience, on sent se fortifier chez Frère Charles la conviction qu’il ne s’est pas trompé dans sa méthode d’apostolat. Le séjour parmi les campements de la haute montagne lui a fourni de nouvelles preuves à cet égard. « Je rends service en ce que je peux, je tâche de montrer que j’aime ; lorsque l’occasion semble favorable, je parle de religion naturelle, des commandements de Dieu, de son amour, de l’union à sa volonté, de l’amour du prochain… Les Touaregs ont le caractère de nos bons ruraux de France, des meilleurs de nos paysans : comme eux, ils sont laborieux, prudents, économes, ennemis des nouveautés et pleins de méfiance envers les personnes et les choses inconnues. Ignorants comme ils sont, ils ne peuvent recevoir l’Évangile que par autorité, et l’autorité nécessaire pour le leur faire adopter et leur faire rejeter tout ce qu’ils connaissent, aiment et vénèrent, ne peut s’acquérir qu’au bout d’un long temps, par un contact intime, une grande vertu et la bénédiction divine [121].
« … Quelques-uns, – rares, – m’interrogent sérieusement sur des points de religion ; dans mes conseils, je reste dans la religion naturelle, insistant sur la fuite du péché, la prière du soir avec examen de conscience, les actes de contrition et de charité. »
Ces bons ruraux du Sahara ne manquent pas de vices, que Frère Charles énumère, sans insister, de peur de laisser croire qu’il est mal entouré. Ils sont d’une extrême violence, d’un orgueil vraiment fou ; la licence des mœurs est générale ; les règles de l’honneur touareg permettent aux femmes et leur conseillent même de faire disparaître les enfants nés hors mariage, et le nombre des infanticides est tel, qu’on peut dire que « peut-être le tiers des enfants périssent à la naissance ».
« Envoyez des Sœurs Blanches, écrit-il à Mgr Livinhac ; elles établiront un tour pour les nouveau-nés, et ce sera le remède, en attendant la conversion. »
À chaque page, dans la volumineuse correspondance de l’ermite de Tamanrasset, on le voit préoccupé des meilleurs moyens humains de relever ce peuple, dont il est le premier apôtre. Il est venu avec toute une civilisation dans son cœur. Pour lui, la civilisation « consiste dans ces deux choses : instruction et douceur ». Rien ne lui est indifférent de ce qui peut aider à protéger l’enfant, à libérer l’esclave, à instruire les ignorants, à fixer les nomades, à les rapprocher de la France. Il préfère la solitude, et nous l’avons entendu la célébrer ; mais il faut, pour le bien des 100 000 âmes du Sahara dont il est l’aumônier, que cette solitude soit vivifiée, que le silence soit troublé. Postes, télégraphes, chemins de fer, foires bisannuelles, il appelle, avec une passion de conseiller général, ces « progrès » dont il se soucie médiocrement pour lui-même. Il se réjouit de l’arrivée prochaine d’une mission composée d’ingénieurs, d’officiers, de géologues, et chargée d’étudier le tracé définitif du chemin de fer transsaharien qui se développera selon la grande courbe que voici : Oran, Beni-Ounif, Beni-Abbès, le Touat, Aoulef, Silet (à 75 kilomètres ouest de Tamanrasset), In-Gezzam, Agadès, Tchad. « J’en suis extrêmement heureux, car le chemin de fer, dans ces régions, est un puissant moyen de civilisation, et la civilisation un puissant aide pour la christianisation ; des sauvages ne peuvent pas être chrétiens[122]. » Surtout, qu’on se hâte de construire ce chemin de fer ! Et tout de suite après l’expression du vœu, cette phrase où reparaît l’officier, le grand Français fidèle : « C’est une nécessité pour la conservation de notre empire africain, mais aussi pour pouvoir porter sur le Rhin, en cas de besoin, le maximum de forces. »
D’autres bonnes nouvelles encore : dans le voisinage, à Fort-Motylinski, un officier vient d’arriver, « charmant et très distingué, le lieutenant Depommier » ; il y a aussi un médecin « extrêmement bien ». Sujets de joie auxquels un dernier s’ajoute, qui est d’un autre ordre, et depuis longtemps souhaité, appelé, attendu : le Maroc est entré dans le protectorat de la France. Des lettres l’ont annoncé à Frère Charles, qui répond aussitôt par ces lignes qu’un homme tel que lui pouvait écrire et que tous les autres doivent méditer : « Voilà notre empire colonial bien agrandi. Si nous sommes ce que nous devons être, si nous civilisons, au lieu d’exploiter, l’Algérie, la Tunisie, le Maroc seront, dans cinquante ans, un prolongement de la France. Si nous ne remplissons pas notre devoir, si nous exploitons au lieu de civiliser, nous perdrons tout, et l’union que nous avons faite de ce peuple se tournera contre nous. »
Lui-même, dans ce constant désir de civiliser qui tient son esprit en rêve et en projets, il médite de faire bientôt, dans quelques mois, au plus tard l’année suivante, un nouveau voyage en France, et d’amener avec lui un jeune Touareg de famille bourgeoise importante, « si l’on peut dire ainsi ». Déjà il prépare Mme de Blic et ses cousins de France à recevoir ce touriste vêtu d’un pagne, et dont les cheveux sont tressés et les joues couvertes d’un voile bleu. Il le présente, et fait de lui un portrait avantageux. À l’entendre, nul dans l’Ahaggar ne vaut son candidat, non seulement affectueux, intelligent, gentil, mais exceptionnellement sérieux. Fils d’un des principaux de sa tribu, cousin germain du chef, il a été à demi adopté par ce dernier, qui n’avait pas d’enfants ; il gère entièrement les affaires matérielles de son père adoptif, dont il va épouser une belle-fille. Il est bien de toute manière et de la meilleure famille plébéienne. Nous sommes ici dans un pays de castes, il y a des plébéiens et des patriciens, les premiers incomparablement supérieurs aux autres comme valeur morale, et faisant toute la force et l’espoir du pays. Mais, avant d’entreprendre ce voyage, Frère Charles a beaucoup de pages à rédiger, et le fiancé doit partir, avec les hommes valides du pays, pour aller, en caravane, chercher du mil au Damergou.
Le printemps, comme l’hiver, comme toutes les saisons, trouve Frère Charles enfermé dans son ermitage, penché sur la caisse de bois qui lui sert de table, entouré de ses manuscrits et de ses livres, consultant, aux passages difficiles, son « informateur » qui a mal à la tête. Il achève le dictionnaire, et se promet d’envoyer prochainement l’ouvrage à M. René Basset, qui le publiera « sous le nom de notre ami commun M. de Motylinski ». La mission du transsaharien traverse l’Ahaggar. Elle séjourne à Tamanrasset. « Très bien dirigée, bien composée, elle a accompli une somme de travail extraordinaire. J’ai vu les membres de la mission ; plusieurs sont mes amis depuis de longues années. Ils espèrent que, dans un an environ, les travaux commenceront. Quels champs s’ouvrent pour le saint Évangile : le Maroc, le Soudan, le Sahara ! » Les allées et venues sont fréquentes entre le camp et l’ermitage. Frère Charles nomme le capitaine Nieger, M. René Chudeau, le capitaine Cortier de l’infanterie coloniale, M. Mousserand, ingénieur des mines. Il note aussi qu’il reçoit de nombreuses visites des Touaregs, qui ont pris l’habitude de le venir voir au coucher du soleil, et le dimanche, jour pendant lequel ils ont observé que le marabout recevait plus volontiers encore et causait plus longuement que les autres jours.
La mission s’éloigne ; la grande chaleur accable le plateau de Tamanrasset. Tout à coup, un grave accident interrompt le travail : Charles de Foucauld est mordu par une vipère à corne. Presque toujours la morsure est mortelle. Les pasteurs et les noirs des environs de l’ermitage apprennent l’événement. Ils accourent, et trouvent leur ami inanimé. Aucun médecin européen n’est là. Ils soignent donc le marabout selon leur coutume, brûlent la plaie au fer rouge, brutalement, bandent le bras pour éviter que le venin ne se répande par tout le corps, puis, la syncope persistant, appliquent le fer rouge sur la plante des pieds : révulsif terrible, administré par compassion. L’ermite revient enfin à lui. Il est d’une extrême faiblesse ; on cherche partout, dans la vallée, du lait pour le nourrir. Mais la chaleur est grande, les chèvres ne trouvent plus d’herbe : Moussa devient inquiet, et ordonne que deux vaches soient amenées, de bien lointains pays, jusqu’au Hoggar, pour sauver le marabout. Longtemps, Frère Charles demeure incapable d’étudier ou de marcher. Il finit cependant par se remettre de la morsure de la vipère, et du traitement qui l’avait sauvé.
Pas une heure il ne songea à se plaindre. Je crois qu’il devait ressembler en cela à un vieux professeur que j’ai eu, et qui enseignait la chimie. Lorsque celui-ci, pris de fièvre, eut appelé le médecin et appris que la maladie serait grave, il s’écria, tout joyeux : « Quelle chance, je vais pouvoir me reposer ! » Charles de Foucauld se reposait un instant devant sa porte, et longuement dans sa chapelle, – il n’avait qu’un pas à faire, – en méditant et priant. Et nous savons que, dans cet automne de 1912, – l’automne, on s’en souvient, est la saison préférée des Européens qui ont vécu dans l’Ahaggar, – deux pensées principales tenaient son âme en joie et rendaient légère la vie de solitude. La première était : « Plus je vais, plus je jouis de la belle nature. Que les œuvres de Dieu sont belles ! Benedicite, omnia opera Domini Domino ! » Et la seconde : « Le temps de l’Avent, toujours si doux, l’est particulièrement ici. Tamanrasset, avec ses quarante feux de pauvres cultivateurs, est bien ce que pouvaient être Nazareth et Bethléem au temps de Notre-Seigneur. »
Je rapporte à cette époque une anecdote dont je n’ai pas trouvé la date précise, et qui fut racontée et l’est encore tout de travers. Dans des revues ou des journaux, on a pu lire que « la mère de Moussa ag Amastane » étant tombée très gravement malade, le Père de Foucauld fut appelé près d’elle, et, pour l’encourager dans le passage de la mort, n’aurait trouvé rien de mieux que de réciter quelques sourates du Coran : « Il vint, il fit son office de consolateur, et il endormit la vieille dame en Allah, avec les strophes du Coran appropriées. » Lorsque mes yeux passèrent sur ces lignes, – il y a des mois et des mois, – j’eus aussitôt le sentiment que la vérité devait être différente. Je me dis qu’un prêtre catholique aurait pu, en effet, suggérer à la mourante de réciter quelque sourate énonçant une vérité certaine, opportune, exhortant, par exemple, au repentir des péchés, à la confiance en Dieu. C’eût été la simple traduction, dans le langage que cette femme comprenait le mieux, d’un acte de contrition ou de charité chrétienne. Mais que le Père de Foucauld l’eût fait, je ne le pouvais croire, sachant qu’il redoutait l’extension de l’islamisme, et qu’il devait donc, le plus possible, éviter de prononcer une formule coranique, fût-elle acceptable. Je voulus savoir si j’avais raison, et j’écrivis à l’aménokal du Hoggar. Je lui demandai de se souvenir des paroles mêmes de son ami le Père de Foucauld. Il comprit admirablement le sens de la question que je lui avais posée. Ce non-civilisé avait de l’esprit. Il me répondit, quelques mois plus tard, une lettre, dont voici la traduction :
« Louange à Dieu l’Unique ! Nul ne subsiste que lui !
« Tamanrâset, 3 chabân 1338 (25 avril 1920).
« Au très honoré, savant entre les savants français, René Bazin, de l’Académie.
« À toi, mille et mille saluts, mille faveurs divines ! De la part du serviteur de la France, l’émir Moussa, fils d’Amastane, aménokal en Hoggar.
« Ta lettre m’est parvenue, où tu me demandes de te donner des détails sur le grand ami des Touaregs-Hoggar. Soit ! Sache que le marabout Charles m’avait en très grande estime, Dieu le rende bienheureux, et le fasse habiter en Paradis, si c’est Sa volonté !
« Maintenant, voici les détails que tu m’as demandés : sur sa vie, d’abord. Les gens d’entre les Touaregs-Hoggar l’aimaient très profondément durant sa vie, et maintenant encore ils aiment sa tombe comme s’il était vivant. Ainsi les femmes, les enfants, les pauvres, quiconque passe près de sa tombe, la salue, disant : « Que Dieu élève le rang du « marabout en Paradis, car il nous a fait du bien durant sa vie ! » Aussi tous les gens du Hoggar honorent sa tombe comme s’il était vivant, vraiment oui, tout autant.
« Ensuite, tu me demandes ce qui s’est passé, quand il a assisté à la maladie de ma mère, c’est-à-dire de ma tante (Tîhit), sœur de mon père, lors de la maladie dont elle mourut. Voici : il lui rendit visite en compagnie du médecin qui lui dit, en français, s’apercevoir qu’elle allait mourir. Alors le marabout Charles lui dit en tamacheq « oksâd massinîn » (« crains Dieu ! ») puis il la quitta. Elle mourut le lendemain. Nous portâmes le corps jusqu’à la tombe, et il était avec nous ; tandis que nous priions pour elle, il était debout, la couleur [du visage] altérée, à cause de sa mort. Il ne fit pas la prière pour elle avec nous. Quand nous la plaçâmes dans sa tombe, il se tint debout sur le bord, l’enterra avec nous, et nous dit : « Dieu augmente votre consolation au sujet de Tîhit ! Qu’il lui donne le Paradis, en sa tombe ! »
« Un jour d’entre les jours, un an avant sa mort, elle était venue le voir en sa cellule, et l’avait trouvé priant ; elle se tint immobile derrière lui, attendant qu’il eût fini sa prière, puis elle lui dit : « Moi aussi, je prie Dieu, à l’heure où tu fais ta prière. »
« Quant à la renommée du marabout, elle est toujours vivante au Hoggar, et les gens à qui, comme à nous, il fit du bien, c’est-à-dire tous les gens du Hoggar, honorent sa tombe comme s’il était vivant.
« Telles sont les informations que tu m’as demandées, données sans faute. Je remets pour toi cette lettre au capitaine Depommier, le commandant en chef de chez nous.
« Que Dieu te bénisse en ta vie ! Puisses-tu vivre en bonne santé ! Salut !
« (Cachet de) MOUSSA AG AMASTANE, »
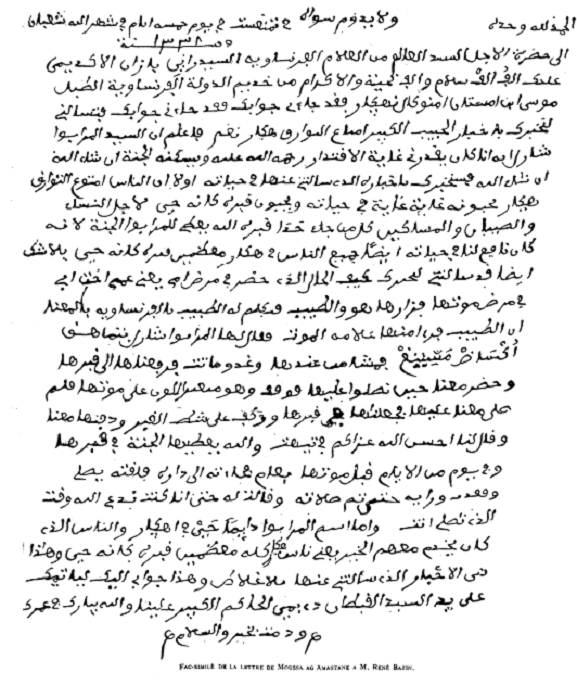
La réponse est claire : j’avais eu raison d’écrire. L’incident aura même servi, plus que je ne l’espérais, la mémoire du Père de Foucauld. Elle amena, en effet, le thaleb de Moussa, Ba-Hammou, celui-là même qui a travaillé dix ans avec le Père de Foucauld, à faire de bien intéressantes déclarations qu’un témoin m’a transmises en même temps que la lettre. Les voici :
« Nous savons parfaitement que le marabout ne pouvait nous dire de prononcer la chahada (la formule de la prière musulmane), il n’y a aucun doute pour nous à ce sujet. Cela était incompatible avec ses fonctions de prêtre catholique, nous le savons tous. Un fait, que personne n’ignore ici, le prouve. Le Père de Foucauld recevait continuellement les pauvres, les vieillards, les malades, les femmes, les enfants, et de nombreux Touaregs qui venaient le visiter, et lui demander aide ou conseil. Au début de son installation, il arrivait que certains de ses visiteurs, sortant de chez lui aux heures de la prière musulmane, s’arrêtaient près de l’ermitage pour prier. Le Père de Foucauld les invitait aimablement à s’éloigner de l’ermitage, en leur disant qu’ils devaient comprendre qu’il désirait ne pas les voir prier près de chez lui, comme eux-mêmes ne pouvaient désirer le voir prier près d’une mosquée… Il disait ces choses en termes tellement aimables et bons, que, très peu de temps après, aucun de nous ne les ignorait, et ne se serait permis d’enfreindre ses désirs[123]. »
Le témoin, particulièrement bien informé, qui me rapportait ces souvenirs du thaleb, ajoutait cette réflexion personnelle : « Si l’on veut bien dépouiller de toute question de forme les relations qu’avait le Père de Foucauld avec les Touaregs, il est absurde et mensonger de dire qu’il ait jamais rien fait ou rien dit qui ne visât à l’évangélisation, qu’en fin de compte, il poursuivait. »
Le voyage, en France, d’un jeune Touareg, était un des mille moyens auxquels sa charité songeait pour diminuer la distance entre la tribu musulmane et la France catholique : Frère Charles en attend beaucoup de bien. Déjà, il a obtenu la réponse favorable de sa sœur et d’autres parentes, qui acceptent de recevoir chez elles le Touareg. Les missionnaires d’Afrique, avertis du projet, ont promis également de donner, à Maison-Carrée, l’hospitalité aux deux voyageurs. D’autres lettres partent pour la France, demandant à des amis la même faveur, ou des recommandations. Il est touchant de voir le Père de Foucauld, si dur pour lui-même, s’appliquer à tout ménager et disposer pour que le voyage d’Ouksem soit le plus agréable, le plus « familial », le moins fatigant qu’il se pourra. Est-ce que le sort de beaucoup d’âmes ne dépendra pas, du moins un peu, du souvenir que ce jeune sauvageon rapportera de notre civilisation ? Un pareil voyage, « c’est le moyen de faire tomber, tout d’un coup, une foule d’erreurs, d’ouvrir les yeux, de se ménager, avec une âme choisie, un tête-à-tête de plusieurs mois. Il va sans dire qu’il n’est pas question de faire visiter les musées, ni les curiosités, mais de faire partager la douceur et l’atmosphère d’affection de la vie de famille dans les milieux chrétiens, et de laisser entrevoir ce qu’est la vie chrétienne, combien la religion imprègne toute la vie. »
Parmi ces lettres, il en est une que je veux citer presque entièrement. Charles de Foucauld y développe, avec force, des idées ailleurs effleurées. Elle est adressée à son ami le duc de Fitz-James, et datée du 11 décembre 1912.
Il commence par dire : « Je ne manquerai pas de t’avertir de mon passage à Marseille ; il me sera si doux de te revoir ! » Il annonce ensuite que le voyage est remis au mois de mai 1913. Ouksem ne sera guère prêt à partir avant cette époque, et, en outre : « Je n’ai pas voulu lui montrer la France par la neige, le froid, la bise, sans verdure et sans feuilles ; il eût même été bien imprudent d’exposer à notre froid et à notre humidité d’hiver cette poitrine saharienne. Aussi je me suis décidé à aller en France seulement cet été ; c’est donc vers la première quinzaine de mai que je débarquerai, avec mon jeune compagnon, à Marseille… »
Nous, Français, nous avons en Afrique deux devoirs essentiels à remplir : « La première chose, c’est l’administration et la civilisation de notre empire nord-ouest africain. Algérie, Maroc, Tunisie, Sahara, Soudan forment un immense et magnifique empire, d’un seul bloc, ayant cette unité pour la première fois… Comment nous attacher cet empire ? En le civilisant, en travaillant à élever ses habitants, moralement et intellectuellement, autant que faire se peut. Les habitants de notre empire africain sont très divers : les uns, Berbères, peuvent devenir rapidement semblables à nous ; d’autres, Arabes, sont plus lents au progrès ; les nègres sont très différents les uns des autres. Mais tous sont capables de progrès.
« La seconde chose, c’est l’évangélisation de nos colonies… Or, que faisons-nous pour l’évangélisation de notre empire nord-ouest africain ? On peut dire, rien. En Algérie, Tunisie, Sahara, les seuls prêtres s’occupant de l’évangélisation des indigènes sont les Pères Blancs ; ils sont, d’après leur bulletin 1910-1911, cinquante-six dans l’Afrique du Nord, onze au Sahara. C’est une goutte d’eau. Je comprends très bien que les Pères Blancs, voyant l’évangélisation des musulmans trop lente et difficile, aient tourné leurs efforts et envoyé la grande majorité de leurs missionnaires dans l’Afrique équatoriale, où ils font merveille, et opèrent des conversions aussi rapides que nombreuses, et procurent le ciel à une foule d’âmes. Ici ils eussent sauvé peu d’âmes, là ils en sauvent beaucoup, je comprends qu’ils aillent là. Il n’en est pas moins vrai que l’Algérie, la Tunisie et le Maroc (où il n’y a que les chapelains des consulats) sont entièrement délaissés… C’est une situation à laquelle il appartient aux chrétiens de France de remédier. C’est une œuvre de longue haleine, demandant du dévouement, de la vertu et de la constance. Il faudrait de bons prêtres, en assez grand nombre (non pour prêcher : on les recevrait comme on recevrait dans les villages bretons des Turcs venant prêcher Mahomet, et plus mal, la barbarie aidant), mais pour prendre le contact, se faire aimer, inspirer estime, confiance, amitié ; il faudrait ensuite de bons chrétiens laïcs des deux sexes, pour remplir le même rôle, prendre un contact plus étroit encore, entrer là où le prêtre ne peut guère entrer, surtout chez les musulmans, donner l’exemple des vertus chrétiennes, montrer la vie chrétienne, la famille chrétienne, l’esprit chrétien : il faudrait ensuite de bonnes religieuses soignant les malades et élevant les enfants, très mêlées à la population, éparpillées par deux ou trois, là où il y a un prêtre et quelques chrétiens… Cela se faisant, les conversions, au bout d’un temps variable, vingt-cinq ans, cinquante ans, cent ans, viendront d’elles-mêmes, comme mûrissent les fruits, à mesure que l’instruction se répandra… Mais si ces malheureux musulmans ne connaissent aucun prêtre, ne voient, comme soi-disant chrétiens, que des exploiteurs injustes, tyranniques, donnant l’exemple du vice, comment se convertiront-ils ? Comment ne prendront-ils pas en haine notre sainte religion ? Comment ne seront-ils pas de plus en plus nos ennemis ?…
« Après avoir attiré ton attention sur ces deux points si graves, j’ajouterai un mot : c’est que, soit pour bien administrer et civiliser notre empire d’Afrique, soit pour l’évangéliser, il est d’abord nécessaire de connaître sa population. Or, nous la connaissons extrêmement peu. Cela vient en partie des mœurs musulmanes, mais c’est un obstacle qu’on peut vaincre ; il reste ce fait déplorable que nous ignorons, à un degré effrayant, la population indigène de notre Afrique. Depuis trente-deux ans, je n’ai guère quitté l’Afrique du Nord (si ce n’est pendant dix ans, de 1890 à 1900, temps que j’ai passé en Turquie d’Asie, Arménie et Terre sainte) ; je ne vois personne, ni officier, ni missionnaire, ni colon ou autre connaissant suffisamment les indigènes ; moi-même je connais passablement mon petit coin de Touaregs, mais très superficiellement le reste… Il y a un vice auquel il faudra remédier : il faudrait aux administrateurs, aux officiers, aux missionnaires, un contact bien plus étroit avec les populations, de longs séjours dans les mêmes postes (avec avancement sur place pour les administrateurs et officiers), afin qu’ils connaissent, puissent renseigner exactement leurs supérieurs, et que ceux-ci connaissent par eux… »
Le diaire continue, un peu de temps encore, à mentionner les événements qui se produisent autour de l’ermitage. Il y en a un grand et plusieurs petits. Le grand, c’est l’arrivée du général Bailloud, au début de 1913, et la réussite parfaite de l’expérience dont il était chargé. Il devait s’assurer que des communications par télégraphie sans fil pourraient être établies entre Tamanrasset et Paris. Les essais furent tentés, et, à la satisfaction du Père de Foucauld, qui voyait décidément tous les progrès mécaniques s’annoncer, la capitale de l’Ahaggar put « causer » sans difficulté avec la Tour Eiffel.
Un peu plus tard, un vol de cigognes passe au-dessus de l’ermitage, allant du nord au sud.
Le 9 mars, le général Bailloud, voulant remercier les habitants du bon accueil qu’il a reçu, envoie aux pauvres une chamelle, que Charles de Foucauld fait abattre, et dont la viande est distribuée, par les soins de l’ermite, à tous les malheureux sans exception, à toutes les femmes de harratins, d’artisans, de bergers, aux mariées, aux veuves, aux répudiées.
« Le 18 au matin, fort brouillard humide et vent faible du sud : c’est le signal du printemps. Un homme d’In-Salah traverse le pays. Il me dit que la cour extérieure de ma maison, là-bas, est ensevelie sous les sables, et que le reste de la maison est menacé. » Pas de regret ; pas le moindre mot de propriétaire : on ira voir.
Enfin, avec un long retard, la plus importante des caravanes qui, chaque année, partent en septembre pour aller chercher du mil, rentre à Tamanrasset. Il était temps : la population commençait à souffrir. Parmi les chefs de la caravane était Ouksem, le fiancé, le candidat choisi pour le voyage en France.
« Je ne serai que le 25 mai à Paris, écrit Frère Charles à un ami. Priez pour mon petit Ouksem : il va se marier, une passion qui date de l’enfance. C’est arrangé depuis longtemps : il a près de vingt-deux ans ; elle, Mlle Kaubechicheka, en a dix-huit. Ils sont très proches parents, et ont été élevés ensemble. Elle est fort intelligente et a beaucoup de volonté. »
Le mariage d’Ouksem et de Kaubechicheka a lieu au commencement d’avril, et, le 28, le Père de Foucauld note sur le diaire : « Parti pour la France, à 6 heures du matin, avec Ouksem. » La veille, la maman était venue à l’ermitage, et elle avait dit : « Répétez ceci à votre sœur : ayez bien soin de mon enfant, je vous le confie. »
Pour éviter les frais d’un guide, on voyage avec la poste qui porte à In-Salah les dépêches de Fort-Motylinski. Les voyageurs sont à Maison-Carrée le 8 juin. On ne s’arrêtera que deux jours dans cette maison et ce pays où Frère Charles avait tant d’amis. Il en voit cependant quelques-uns, et pousse même jusqu’à Birmandréis, où les Sœurs Blanches ont leur établissement principal. Ceux qui connaissent les monastères savent qu’un voyageur, s’il est chrétien, surtout s’il est missionnaire, ne passe guère dans ces maisons sans être invité à raconter ce qu’il advient de Jésus-Christ et de ses serviteurs, dans les pays qu’il a visités. Il en fut ainsi, pour Frère Charles, dans la maison où les vieilles religieuses, revenues des missions des grands lacs ou de la Kabylie, forment les novices qui iront, joyeuses, vivre dans la brousse, catéchiser les nègres, élever les enfants abandonnés, soigner les malades, consoler des misères de bien des sortes, et vivre toutes pures dans des milieux qui ne le sont pas. Frère Charles, prié d’exposer ce qu’il avait fait et ce qu’il voulait faire, à Beni-Abbès et au Hoggar, parla donc dans une salle blanche que j’ai vue, à des auditrices vêtues de blanc, attentives au moindre mot noble ou plaisant, et qui s’inclinent lorsque le nom du Maître choisi est prononcé. Il n’était pas éloquent, mais la vie qu’il racontait était éloquente. En finissant, il eut l’idée de dire : « Qui de vous, mes sœurs, voudrait se dévouer pour les Touaregs ? » Silencieusement, toutes se levèrent, d’un seul mouvement.
Il faut croire que l’heure, pourtant, n’était pas venue. Frère Charles rentra à Maison-Carrée pour retrouver Ouksem. Le 10, ils s’embarquent sur le Timgad, et le pauvre marabout, habitué au régime des passagers de pont, loue, cette fois, des places de première classe, pour faire plaisir à l’infidèle qui vient visiter le pays des chrétiens ; le 13, on fait le pèlerinage de la Sainte-Baume ; le 15, Mgr Bonnet, évêque de Viviers, reçoit le Père de Foucauld, prêtre du diocèse, et Ouksem, – deux exemplaires bien différents de la civilisation, – dans sa demeure haut perchée sur les remparts de l’ancienne ville, à l’ombre de la cathédrale. Et, de ce sommet, lieu de prière et de mistral, le Touareg, pour qui les fleuves ne sont que des noms, et des lits de sable et de pierre parmi des pâturages, aperçoit le Rhône plein, nerveux, resserré, qui vient du nord entre des rives cultivées et toutes vertes, qui s’agite, tournoie, écume, et franchit, frémissant de toutes ses eaux, les portes de Provence.
Il est gai et bien portant. Tout le monde lui fait fête. Il comprend quelques mots de français. Il mange de tout, excepté du poisson et de la viande de porc.
De Viviers, on continue, le voyage par Lyon, où le Père et Ouksem deviennent les hôtes du colonel Laperrine ; puis l’on remonte en Bourgogne. Là, on s’arrête quelques heures dans une petite vallée que suit le canal, et qu’arrose une rivière bien courante, entre deux chaînes de collines boisées. À vol d’oiseau, si l’on franchissait un haut plateau vallonné, vers le nord, couvert de bois et de landes, on descendrait dans le pays des côtes célèbres et de la richesse, où les villages s’appellent Vougeot, Nuits, Musigny, Chambertin. Mais l’Ouches traverse plus d’ombre : un pli tranquille et modeste de nos campagnes de pâturage et de labour. On quitte le chemin de fer à Gissey. À 2 kilomètres de là, et touchant le bourg de Barbirey, il y a un manoir ancien à deux ailes, couvert en tuiles, où habite M. de Blic. Ce ne fut, cette fois, qu’une présentation. Ouksem, reçu par le beau-frère, la sœur, les neveux et nièces de son protecteur et ami, commença de voir ce qu’étaient une famille française et chrétienne, une habitation rurale, une journée de la vie terrienne. Il considéra avec étonnement la cour plantée et fleurie devant le château, la terrasse en arrière, la prairie qui descend, et, au delà d’un ruisseau, remonte à pente raide et rejoint les coteaux, et surtout l’extrême beauté et vigueur des arbres plantés dans le creux du parc : platanes, blancs d’Hollande, sycomores, sapins, ormes, tous branchages et feuillages nouveaux pour lui. Puis on prit congé, en se promettant qu’il y aurait, au retour, un séjour à Barbirey, d’une semaine au moins.
Les uns après les autres, les parents du Père de Foucauld se prêtent au dessein que celui-ci avait formé et reçoivent Ouksem. C’est d’abord le marquis de Foucauld, au château de Bridoire, dans le Périgord. Le souvenir est encore vivant, là-bas, de plus d’un trait émouvant qui marqua cette réception. « Je me rappelle, disait naguère l’un des témoins, je me rappelle ce sympathique enfant, son admiration pour le Père, et la bonté de ce dernier pour lui. Je les vois à quatre pattes, tous les deux, dans le fumoir, taillant sur le parquet, avec un couteau à découper, le pantalon que le jeune Touareg devait coudre pour occuper ses loisirs. Je le vois aussi, chaque soir, debout sur les marches de la chapelle, n’osant y pénétrer, par respect, ses grands yeux mouillés de larmes pendant la prière en commun. »
Après la visite au chef de la famille, on alla, en Périgord également, chez le comte Louis de Foucauld, au château de la Renaudie, puis chez la vicomtesse de Bondy, en villégiature à Saint-Jean-de-Luz. Traversant ensuite Paris, le Père revient à Barbirey vers le 20 juillet. « L’apprentissage de la vie française » se continue pour Ouksem, dans la gaieté d’une famille nombreuse et unie. Le Touareg apprend à tricoter, afin de donner des leçons, plus tard, aux femmes de sa tribu ; il devient vite adroit, tandis que son guide, le marabout, s’embrouille dans les aiguilles et les points. Ouksem monte à bicyclette, sur la route qui va vers Autun, et, pour l’aider à bien faire cet exercice, on transforme, avec quelques épingles doubles, la gandourah touarègue en culotte de zouave. « Apprends-lui le français disait le Père à son neveu Édouard ; en retour de tes leçons, quand tu viendras me voir en Afrique, il t’apprendra à monter à méhari, ce en quoi il est passé maître. » Le soir, on cause, Mlles de Blic chantent, au piano, des chansons de Botrel ; on joue au furet et à d’autres jeux de tradition. Ouksem comprend tout et rit quand il convient. L’épreuve paraît heureuse. Le Père, dans cette vie familiale, ne se singularise d’aucune manière. Il est Charles chez sa sœur Marie. Il mange ce qu’on lui sert ; ses longues prières, il les fait la nuit, quand il s’est assuré qu’Ouksem, « son enfant », est endormi. L’homme usé par la pénitence, vieilli, toujours rigoureux pour lui-même, n’a qu’une ambition, semble-t-il : ne pas empêcher toute cette jeunesse de jouir pleinement des vacances. Un dimanche, on lui demande : « Irez-vous aux vêpres ? – Cela n’est pas nécessaire. – Mais la population serait surprise de ne pas vous y voir. – Alors j’irai. »
Il s’occupait principalement de civiliser Ouksem, mais il s’était aussi promis de faire connaître, à quelques personnes choisies, l’association pieuse pour la conversion des infidèles, sujets de la France. Cette affaire devait le conduire en Champagne et en Lorraine ; il confia son projet au général Laperrine, chez lequel il s’était rendu, en quittant Barbirey, et dont Ouksem et lui étaient devenus les hôtes. Laperrine, promu général, depuis le 22 juin précédent, commandait, à Lyon, la 6e brigade de dragons. Heureux de revoir son ami de Foucauld, il lui dit : « Votre Touareg ne connaît que ses montagnes de l’Ahaggar ; il faut lui montrer les Alpes et aller en Suisse : je serai de la partie. » Il en fut si bien qu’on aperçoit sa fine silhouette, dans le coin de plusieurs photographies qui représentent Ouksem épanoui d’admiration devant la Mer de Glace, ou escaladant les roches de je ne sais quelle aiguille du mont Blanc. Les voyageurs passaient à Chamonix le 3 août, le 4 à Lucerne, le 6 à Belfort. Après l’excursion en Suisse, il y eut une seconde halte à Barbirey, la plus longue : elle dura quinze jours. Le jeune Touareg, partout promené, partout gâté, s’apprivoisait. Quand il eut quitté la Bourgogne, et repris le chemin de Paris, il reçut, d’un ami du Père de Foucauld, un cadeau dont il fut ravi : un fusil de chasse. Aussitôt, il fallut chasser et faire parler la poudre, et cette lettre fut envoyée à l’un des fils de M. de Blic ; elle était écrite en tifinar et traduite par l’oncle Charles : « Ceci, c’est moi, Ouksem, qui dis : je salue Édouard beaucoup ; je t’aime beaucoup ; j’ai le temps long après toi. J’ai tué une perdrix, un lièvre et un écureuil. Je t’embrasse. »
Quelques autres visites, notamment une en Berry, occupèrent les dernières semaines. Le 25 septembre, le Père de Foucauld, descendant vers Marseille, s’arrêtait à Viviers, passait la journée près de son cher évêque Mgr Bonnet, qui autorisait, « dans le diocèse, la petite œuvre (la confrérie), et l’encourageait par une lettre ». Trois jours plus tard, les voyageurs, achevant un voyage de trois mois et demi en France, s’embarquaient pour regagner l’Afrique, et Charles de Foucauld écrivait à sa sœur : « À moins de circonstances exceptionnelles, un missionnaire ne passe pas un si long temps chez les siens à se reposer ; le bon Dieu a fait naître, par le voyage d’Ouksem, cette circonstance exceptionnelle. Je l’en remercie de tout mon cœur… Toi aussi, je te remercie, ainsi que Raymond et tes enfants, des douces semaines que vous m’avez fait passer et de votre extrême bonté pour Ouksem, bonté qui fait tant de bien à son âme ; je me rends compte que sa joie de retrouver les siens est très tempérée par le chagrin de quitter ceux qui l’ont si bien reçu en France. L’apostolat par la bonté est le meilleur de tous. » Ces vacances, – les seules que Frère Charles se soit cru en devoir de prendre dans le cours de sa vie chrétienne, – lui ont permis de revoir à loisir presque toutes les personnes de sa famille ou de son intimité. C’étaient les adieux, peut-être l’a-t-il pensé. À plusieurs d’entre elles, et aussi à quelques âmes pieuses, çà et là rencontrées et aussitôt reconnues, – parentes éternelles que Dieu montre un instant, – il a parlé de l’œuvre qu’il voudrait tant développer, l’association qu’a bénie l’évêque de Viviers ; et non seulement elles sont entrées dans l’esprit de cette charité supérieure, toujours prête à prier et à mériter pour toute misère nouvelle, mais il a semblé que certaines bonnes volontés seraient disposées à se dévouer, autrement encore, au salut de « nos frères musulmans « . Peut-être se trompe-t-il de date : il croit que, dans un temps prochain, quelques laïques se feront « missionnaires à la Priscille », comme il disait, et viendront en Afrique, préparer par l’exemple, par les soins donnés aux malades et aux pauvres, l’évangélisation des Berbères et des Arabes, qui est le grand devoir de la France. Alors, il compose une note très curieuse, qu’il envoie à l’une de ses parentes, et qui porte ce titre : « Que faut-il à une Française pour faire du bien chez les Touaregs ? »
« Il faut :
« 1° La volonté de passer chez eux assez longtemps pour savoir leur langue (qui n’est pas difficile), et être connu d’eux, car on ne fait du bien qu’une fois qu’on connaît et qu’on est connu ;
« 2° Beaucoup de patience et de douceur : les Touaregs manquent de nuances, ne savent pas la qualité des personnes, et passent vite de l’extrême sauvagerie à l’excessive familiarité ;
« 3° Des connaissances élémentaires de médecine, surtout en ce qui concerne les maladies des jeunes femmes et des petits enfants, de manière à pouvoir soigner les malades sans médecin et sans pharmacie ;
« 4° Savoir vacciner, et avoir ce qu’il faut pour vacciner ;
« 5° Être capable d’élever des enfants que leur mère abandonne dès leur naissance ;
« 6° Pouvoir donner des notions très élémentaires d’hygiène ;
« 7° Savoir un peu laver, par les moyens les plus simples, un peu repasser (mais non pas amidonner), faire un peu de cuisine, afin de l’enseigner ;
« 8° Être capable, et pour soi, et pour enseigner par l’exemple, de donner les ordres nécessaires à l’installation d’un jardin potager, d’un poulailler, d’une étable contenant quelques chèvres. Les chèvres abondent dans le pays, mais on ne sait pas les nourrir de luzerne ou d’herbes du jardin ; il y a des poules mais de trop petite espèce, et on ne sait pas les abriter des oiseaux de proie par des par des grillages ; on cultive quelques légumes, mais sans le soin nécessaire, aussi en récolte-t-on peu, tandis qu’avec la terre et le climat de l’Ahaggar, on pourrait avoir presque tous les légumes et fruits de France, d’aussi bonne qualité qu’à Alger.
« Il serait bon, mais ceci n’est pas indispensable, de savoir quand et comment on tond les brebis et les chèvres, comment on file leur laine et leur poil, comment on fait des tissus communs avec la laine et le poil ainsi filés ; quelques jours passés avec les Sœurs Blanches de Laghouat ou de Ghardaïa suffiraient pour l’apprendre : emmener avec soi une femme indigène, experte dans ces travaux, ayant l’habitude de les faire chez les Sœurs Blanches, et d’âge mûr, serait une excellente chose.
« Les Touaregs ont beaucoup de chèvres et de brebis, mais ils ne les tondent pas, et laissent leur poil et leur laine se perdre ; nul d’entre eux ne sait tisser.
« Il serait bon aussi de savoir le tricot et le crochet pour pouvoir, au besoin, les apprendre aux femmes. Celles-ci cousent très bien, préparent très bien les peaux et font, avec beaucoup d’habileté et de délicatesse, une foule d’ouvrages en peau. Elles regardent comme indigne d’elles de filer, tisser, tricoter, etc. Conservatrices à l’excès, elles sont on ne peut plus récalcitrantes devant tout travail nouveau.
« N. B. – Une des choses qui seront le plus à enseigner aux femmes touarègues, c’est la propreté personnelle. Elles ne se lavent jamais, ne lavent guère plus souvent leurs vêtements, se couvrent les cheveux de beurre, n’ont pas de puces, car la puce n’existe pas dans le pays, mais ont en abondance d’autres parasites. Elles disent que cela les rend malades de se laver ; c’est un peu vrai pour elles qui ne se lavent qu’en plein air sans s’essuyer ; il faudrait leur apprendre l’usage de la serviette, et celui de faire sa toilette à l’abri. Une Française au pays touareg fera bien d’avoir une bonne provision de savon de Marseille et de serviettes très communes pour en donner aux femmes.
« Les Touaregs sont gais et enfants ; si on veut vite les connaître et être connu d’eux, il faut les attirer ; un gramophone, sans grands airs mais avec des airs et des chants d’allure vive et gaie, des éclats de rire, des cris d’animaux, des airs de danse, etc., est un moyen de les faire venir ; il en est de même des images ; rien ne vaut, comme images, les photographies qu’on regarde au stéréoscope, non les photographies de monuments, ni de paysages, mais celles de personnes, d’animaux, de scènes animées ; les photographies qu’ils aiment le mieux sont celles de leurs propres compatriotes, prises dans leur pays. Emporter un vérascope, faire beaucoup de photographies de groupes touaregs, les montrer, attire de nombreuses visites. Une collection de cartes postales représentant des personnes et des animaux coloriés est aussi une bonne chose.
« Il ne manque pas de femmes qui viennent demander un remède qui noircisse les quelques cheveux blancs qui commencent à paraître sur leur tête ; des flacons de teinture noir jais entreraient avec avantage dans l’approvisionnement de pharmacie : ce serait une charité et le moyen d’avoir des amies fidèles.
« Plusieurs milliers d’aiguilles à coudre de toute dimension (très fines pour les jeunes, plus ou moins grosses pour les mûres et les vieilles), et un ou deux milliers d’épingles de sûreté par an, pour donner aux femmes, sont des choses utiles à avoir.
« Il n’y a pas à établir d’hôpital, mais un simple dispensaire, avec un local pour élever les enfants abandonnés dès leur naissance, et un « tour » avec sonnette pour les recevoir discrètement. »
Le voyage du retour dut être fait à petite allure, pour deux causes, l’extrême chaleur que les voyageurs rencontrèrent dès qu’ils eurent quitté le bord de la mer, puis l’état de maigreur des chameaux de selle et de bât, qui, pendant l’absence, avaient été peu soignés ; si bien que le départ de Maison-Carrée ayant eu lieu à la fin de septembre, le Père et son compagnon n’arrivèrent en vue de l’ermitage que le 22 novembre.
Ils étaient passés par Timimoun, sur la demande d’Ouksem. Frère Charles, qui n’avait pas revu l’oasis depuis sept ans, fut stupéfait des progrès accomplis : « Grand accroissement de commerce avec le nord et le sud, accroissement de l’industrie indigène des tissus de laine, mise en main et apprivoisement de la population, accroissement et embellissement des constructions ; infirmerie indigène bien tenue ; école tenue par un instituteur français, aidé d’un moniteur arabe ; l’école a environ quatre-vingts élèves. »
Le 22 novembre, on entra avant l’aube dans la vallée de Tamanrasset.
« Je tenais à arriver avant le jour, explique le Père à M. de Blic, pour descendre de chameau tranquillement, sans concours de monde, et pour avoir toute la journée pour mettre un peu d’ordre dans mon ermitage inhabité depuis sept mois. Ouksem n’a pas été malade ni triste une minute pendant toute la route, et il n’a cessé d’être aussi gentil que possible ; il a trouvé ici tous les siens très bien portants. Que de fois il m’a parlé de vous, de Marie, de vos fils, de Barbirey et de sa belle verdure ! Il a pris goût au français, a fait beaucoup d’efforts pour ne pas oublier ce qu’il en sait. Il en apprend quelques mots à certains de ses parents, qui s’extasient en l’entendant me parler ma langue ; et il va, j’espère, commencer à donner des leçons de tricot et de crochet : il est en train de recruter des élèves. Ce voyage a eu un effet que je sens dès ces premiers jours, c’est d’augmenter la confiance qu’on a en moi, et, par suite, en tous les Français. »
Une autre lettre datée de quelques jours plus tard disait :
« Le pauvre Ouksem n’a passé ici que vingt jours, il vient de repartir pour six mois, il va à 1 000 kilomètres d’ici, du côté de Tahoua, en plein Soudan, surveiller les pâturages des chameaux de la famille. Pendant sa première année de mariage, il aura passé quarante jours avec sa femme… Quand son âme viendra-t-elle tout à fait ? Lui, son père, son beau-père, sa mère, d’autres encore, sont des âmes de bonne volonté ; mais cesser de croire ce qu’on a toujours cru, ce qu’on a toujours vu croire autour de soi, ce que croit tout ce qu’on a aimé et respecté, est difficile. »
Dans les premiers mois de 1914, les visites du père et des sœurs d’Ouksem sont presque quotidiennes, et dans une lettre au duc de Fitz-James, Frère Charles annonce qu’à Tamanrasset, depuis son retour, il a vu quatre fois des Français, officiers ou sous-officiers.
Le passage des officiers, dans l’Ahaggar tranquille et moins résistant aux prévenances des civilisés, était une joie pour le Père de Foucauld. Celui-ci en faisait une occasion de fête pour les indigènes et pour ses visiteurs. Nulle part il n’a raconté les « séances récréatives » qui se tenaient non pas autour de l’ermitage, mais quelque peu à l’est, devant la porte de la « maison des hôtes ». Les jeunes officiers, heureusement, notaient souvent leurs impressions, et j’ai eu communication de deux carnets de route.
Le 20 janvier 1914, le commandant Meynier, le docteur Vermale, aide-major, M. Lefranc, rédacteur au Temps, étaient arrivés à Tamanrasset, où ils passèrent trois jours.
« Le grand intérêt de Tamanrasset, dit le docteur Vermale[124], est la présence du Père de Foucauld. Nous avons pris le thé hier soir à son ermitage, et il prend tous ses repas avec nous. Il a une tête admirable d’intelligence. Il a acquis par sa bonté, sa sainteté et sa science, une grande renommée parmi la population. Je me promets de passer près de lui des jours intéressants… J’ai dû interrompre ma conversation écrite pour assister au déjeuner avec le Père de Foucauld, puis à la grande fête, aux réjouissances données en notre honneur. Elles ont un cachet tout particulier, à cause de la présence des femmes de la tribu des Dag-Rali, qui se trouve actuellement à proximité de Tamanrasset. Dans notre zériba, elles se sont accroupies, vêtues de leurs plus beaux atours, grandes, beaucoup jolies. Parmi elles trônait la célèbre Dassine, femme d’Aflan, renommée autrefois pour sa beauté et ayant conservé, de sa splendeur de jeunesse, de très beaux yeux, beaucoup d’esprit et de distinction. On leur a fait une distribution de cadeaux, puis séance de phonographe au succès prodigieux ; les chants d’hommes les ont un peu offusquées, mais beaucoup intéressées, car le Touareg ne chante jamais devant les femmes. Puis on a fait une grande loterie de poupées, tandis qu’au dehors les nègres se livraient à des danses effrénées. Cela a duré trois heures. »
Le second témoignage dont je puis faire état est celui du lieutenant L…, que j’ai eu le plaisir de voir à Alger. Le détachement commandé par le capitaine de Saint-Léger et par le lieutenant L…, et chargé d’une mission au Hoggar, en juin 1914, se composait, outre les officiers, de dix méharistes de la compagnie saharienne du Tidikelt, et d’un guide dont j’ai déjà parlé, collaborateur du Père de Foucauld et ami des Français, M’Ahmed ben Messis. Parti d’In-Salah, le 13 juin, il entrait le 1er juillet au matin sur le haut plateau de Tamanrasset.
« À quelques kilomètres du village, nous avons fait une petite halte pour faire notre toilette. C’est que nous allons faire notre entrée dans la « capitale » du Ahaggar, où se trouve la résidence de l’aménokal Moussa Ag Amastane, où se trouvent aussi de nombreux Touaregs nobles, et où se trouve surtout un des plus grands propagateurs de l’influence française au Sahara, celui qui, par son exemple et par la persuasion, a su contribuer dans une large mesure à rallier à notre cause le peuple touareg, réputé jusqu’à ce jour comme étant le plus inaccessible à toute idée de civilisation. Cet homme, savant autant que modeste, qui n’a pas craint de s’exiler au centre du Sahara à une époque orageuse, c’est le Père de Foucauld.
« Au premier abord, Tamanrasset paraît plus important que les autres centres déjà visités. On ne voit presque plus de zéribas ; elles ont disparu pour faire place à de nombreuses maisons faites en toubes, comme celles qu’on construit dans les ksours du Tidikelt. Ces constructions donnent à Tamanrasset l’aspect d’un petit village agricole, d’un centre producteur assez important.
« Quelques-unes de ces maisons ont même une forme européenne, avec terrasses et galeries agrémentées ; la plus jolie est certainement celle de l’aménokal Moussa Ag Amastane, qui a installé sa résidence à Tamanrasset et qui y possède même un jardin très bien cultivé. Cette maison, que nous avons visitée sur l’invitation de Akhamouk, le khodja de Moussa, est située un peu à l’écart ; elle sert de point d’appui à d’autres petits bâtiments dans lesquels habitent les familiers de Moussa, nobles Touaregs des Kel-Rela, et en particulier la célèbre Dassine, cousine de Moussa, réputée jadis pour la plus belle femme du Ahaggar.
« C’est grâce au révérend Père de Foucauld que Tamanrasset est dans une situation relativement florissante ; ce sont ses conseils et son exemple qui ont amené de nombreux Touaregs à travailler la terre généreuse qui les fait vivre. Parmi eux les Dag-Rali et leur chef Ouksem se sont intéressés tout particulièrement aux travaux agricoles, et leur persévérance porte aujourd’hui ses fruits. Les Dag-Rali étaient une tribu essentiellement nomade ; imrad des Kel-Rela, nobles Touaregs, elle avait été décimée au moment du combat de Tit, en 1902. Elle commence à se relever, les jeunes garçons sont devenus des hommes qui, sous l’énergique impulsion de leur chef Ouksem, ont renoncé presque entièrement à la vie nomade, aux longues randonnées stériles dans le désert, pour devenir des agriculteurs. »
Pendant le séjour du capitaine de Saint-Léger et du lieutenant L… à Tamanrasset, il y eut, devant la maison des hôtes, une assemblée des notables. Sur le banc de pierre placé le long du mur et qui regarde l’occident, le capitaine s’était assis ; il avait à sa droite le Père de Foucauld, et à sa gauche le lieutenant L… Devant lui, formant demi-cercle, se tenaient l’aménokal Moussa Ag Amastane, son khodja Akhammouk, le guide et interprète Ben Messis, la poétesse Dassine, et bon nombre d’hommes et de femmes dont les tentes faisaient des taupinières brunes dans la plaine rocailleuse et brûlée. Quel amusement pensez-vous que leur offrit le Père de Foucauld, leur vieil ami ? une lecture des fables de La Fontaine ! Il avait remis un exemplaire illustré des fables au capitaine, qui présidait la réunion. M. de Saint-Léger commençait par traduire les vers en arabe, et il les commentait. Ben Messis traduisait l’arabe en touareg, et il n’avait pas fini de parler que des éclats de rire s’élevaient de partout. Des conversations s’engageaient entre les assistants ; ceux qui avaient le mieux compris expliquaient aux autres le Lion et le Rat, la Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, la Laitière et le pot au lait. On s’approchait de l’officier qui avait le volume sur les genoux, afin de voir les images. Après que La Fontaine, artiste entre les artistes, et qui écrit pour les plus simples et les plus raffinés des hommes, eut ainsi diverti l’assemblée des nomades du Hoggar, il y eut, comme à Paris, « une heure de musique ».
Jours de fête, auxquels succédaient les jours ordinaires, ceux du travail excessif. On peut juger de l’ardeur non diminuée de l’érudit et de la piété du moine par ces simples lignes que j’extrais du diaire.
« 8 mai 1914. – Commencé la mise au net du dictionnaire touareg-français, complet. »
« Même date. – Par permission reçue, placé, ce soir, la sainte Réserve dans le tabernacle. »
« 31 juillet. – Ce soir j’en suis à la page 385 du dictionnaire. »
« 31 août. – J’en suis à la page 550. »
Tout à coup, la grande nouvelle arrive au Hoggar : la guerre est déclarée entre l’Allemagne et la France. Le diaire porte la preuve matérielle de l’émotion qu’elle cause ; plus que des notes en style télégraphique. J’en transcris quelques-unes, qui disent les premières dispositions prises par les jeunes officiers représentant la France au Sahara, et l’immédiate agression contre les indigènes ralliés à notre cause.
« 3 septembre. – À 5 heures du matin, reçois courrier rapide de Fort-Motylinski, m’apprenant que l’Allemagne a déclaré la guerre à la France, envahi la Belgique, attaqué Liège. M. de La Roche (commandant le poste) part le 4 ou le 5 pour l’Adrar, avec tout son groupe. Il donne l’ordre à Afegzag de rassembler un goum, et à Moussa de venir, avec vingt hommes au moins, dans l’Ahaggar[125].
« Vu Afegzag ; il donne l’ordre à 10 Dag-Rali, 10 Iklan, 10 Agouh-n-Tabli, 10 Aït-Lohen, 10 Kel-Tazoulet, de se rassembler sur-le-champ ; de sa personne, il part ce soir pour Motylinski, où il sera demain matin. »
« 7 septembre. – M. de La Roche et le brigadier Garnier arrivent à 9 heures du matin. M. de La Roche partira demain matin pour Adrar. »
« 9 septembre. – Reçu 1 500 cartouches 1874, pour Moussa. »
« 10 septembre. – Courrier d’In-Salah ; lettre de Saint-Léger et nouvelles officielles. J’en prends connaissance et envoie sur-le-champ au fort Motylinski[126].
« 11 septembre. – Reçu courrier à midi. Capitaine de Saint-Léger ordonne à M. de La Roche rester Ahaggar avec tout le groupe. J’envoie, par exprès rapide, porter cet ordre. Mauvaises nouvelles : nous reculons sur toute la frontière, devant forces supérieures. Ne pouvons secourir la Belgique. Les Allemands occupent Bruxelles. »
« 24 septembre. – Reçu nouvelles du 11 septembre In-Salah et du 3 de Paris. Toujours on recule ; le gouvernement siège à Bordeaux. »
« 30 septembre. – Ce soir page 700 du dictionnaire. »
« 12 octobre. – Victoire ! une grande victoire qui paraît décisive ! Les Allemands avaient repoussé notre armée du Nord jusque sur la Marne, au delà de la Marne même… Alors a eu lieu, du 8 au 12 septembre, sur tout le cours de la Marne, une bataille générale qui a duré cinq jours… » [127].
Quatre jours plus tard, une lettre de Moussa, écrite de Tin-Zaouaten et apportée par méhariste, apprenait qu’il avait failli être enlevé par un parti d’Ouled-Djerir, qui entouraient leur camp de branches épineuses, et tiraient des balles en cuivre rouge. Prévenu par la sœur du courrier, échappée de leurs mains, l’aménokal était parti dans la nuit, vers les plus proches campements kel-ahaggar. Il n’avait que six hommes avec lui. Il en a laissé deux en arrière-garde, et en a envoyé un en avant, pour dire à ses hommes de venir à sa rencontre. Ainsi, il a été sauvé. Eux, les dissidents, ils sont entrés à Tin-Zaouaten, ont razzié 400 chameaux, fait 10 prisonniers, puis se sont éloignés. Mais vers le milieu de décembre, Moussa se met à leur poursuite. Il les rejoint, il les attaque, à 20 contre 20, en deçà de Bir-Zemile, leur tue 7 hommes, enlève tous les chameaux de prise, tous les méharis également, et laisse ses ennemis mourir de soif dans le désert.
L’attentat contre Moussa n’était que l’annonce d’événements plus graves et d’attaques plus directes. Des bandes armées, recrutées en Tripolitaine, essaieraient sans doute bientôt de pénétrer dans nos territoires ; des émissaires seraient lancés à travers le Sahara prêchant contre nous la guerre sainte, et aucune de nos tribus ralliées ne resterait fidèle sans avoir été tentée. Dès le premier jour, Charles de Foucauld l’a prévu. Que va-t-il faire ? Va-t-il se renfermer dans le poste fortifié de Motylinski, comme on le lui offre ? Pas un instant il n’en accepte la pensée. Le devoir présent est de ne changer ni de lieu, ni de manière de vivre : il est de sourire à tous, de donner à tous, comme hier, et de souffrir une grande douleur sans que personne le puisse voir.
« Les Touaregs ignorent de l’Allemagne jusqu’au nom ;… vous sentez qu’il m’en coûte d’être si loin de nos soldats et de la frontière ; mais mon devoir est avec évidence de rester ici, pour aider à y tenir la population dans le calme. Je ne quitterai pas Tamanrasset jusqu’à la paix ;… on nous enverra tous les neuf jours un courriel spécial, porteur des dépêches officielles. Les dépêches officielles mettent vingt-cinq jours à venir de Paris, les lettres et les journaux quarante ; la lettre la plus fraîche que j’ai reçue de Paris est la vôtre du 4 août, les dernières dépêches officielles (qui viennent par télégraphe jusqu’à El-Goléa), sont du 20 août. Rien n’est changé dans l’extérieur de ma vie calme et régulière, car il faut que les indigènes n’aperçoivent rien qui dénote une émotion ou un état différent de l’état ordinaire [128]… »
Cependant, cet homme, que la pensée du mieux ne cesse de hanter, veut être confirmé dans la résolution qu’il a prise de demeurer dans l’Ahaggar. Sans doute, il lui apparaît clairement que son devoir est là, où nul ne peut le remplacer. Mais un ami, un soldat penserait peut-être autrement ? L’ermite écrit donc au général Laperrine, qui est « un esprit sage », qui se trouve en première ligne dans la bataille, et connaît aussi les choses d’Afrique. Il lui demande : « Ne serais-je pas plus utile sur le front, comme aumônier ou brancardier ? Si vous ne m’écrivez pas de venir, je reste jusqu’à la paix ; si vous me dites de venir, je pars sur-le-champ, et à bonne allure[129]. » Par retour du courrier, deux mois plus tard, il reçoit la réponse : restez.
Provisoirement la question est tranchée. Je dis provisoirement, parce que, un an plus tard, Charles de Foucauld apprendra que des prêtres se battent, et, supposant qu’il y a peut-être une dispense accordée, il demandera de nouveau : « Et moi, n’en serai-je point ? Si je pouvais servir ! »
La correspondance entre les deux grands Sahariens, le moine et le soldat, commencée dès le début de la guerre, va se continuer jusqu’à ce que l’un d’eux disparaisse. J’ai feuilleté quarante et une lettres du Père de Foucauld, adressées à son ami, depuis décembre 1914 jusqu’au 16 novembre 1916, et que le général avait soigneusement classées. Elles sont toutes militaires. Elles racontent tout ce qu’il sait des tribus ralliées et des tribus dissidentes, leurs mouvements, les intrigues nouées par les Senoussistes, qui sont en étroite relation avec les Turcs de Tripolitaine et avec les Allemands, les coups de main, toute la chronique du désert. À l’occasion, il prend parti pour les nomades, ses clients, qui se plaignent de certaines lenteurs ou de certains excès de l’administration. Ses conclusions sont toujours nettes et fermes. Quand le danger d’un soulèvement, ou d’une incursion, devient pressant, il dit : « Voici ce que je ferais. » Et je ne doute pas que, dans plus d’un cas, son avis n’ait été suivi par Laperrine, qui, de loin, exerçait son droit de conseil dans nos affaires d’Afrique. En tout cas, le grand chef était averti.
Les lettres adressées à d’autres personnes, pendant cette période de la guerre, expriment surtout l’homme intérieur. Elles sont souvent très belles par leur accent de patriotisme, leur invariable volonté d’espérance, leur ton d’autorité, par l’inquiétude aussi, secrète et enchaînée, qu’on y devine parfois. Il disait : « Aussitôt la poste arrivée, je compte les jours jusqu’à la suivante. » Je crois qu’en choisissant des passages de ces lettres, en les disposant par ordre de dates, j’aurai donné, des deux dernières années de la vie du Père de Foucauld, un tableau sans redite, et que le résumé le plus attentif ne saurait égaler.
« 15 septembre 1914. – Mon esprit et ma prière sont à la frontière. »
« 21 octobre 1914. – Ceci est la guerre d’indépendance de l’Europe contre l’Allemagne. Et la façon dont se déroule la guerre montre combien elle était nécessaire, combien la puissance de l’Allemagne était grande, et combien il était temps de briser le joug avant qu’elle ne devînt plus redoutable encore ; elle montre de quels barbares l’Europe était à demi esclave, et près de le devenir complètement, et combien il est nécessaire d’ôter définitivement la force à un peuple qui s’en sert si mal et d’une façon si immorale et si dangereuse pour les autres. C’est l’Allemagne et l’Autriche qui ont voulu la guerre ; et c’est elles qui méritaient qu’on la leur fît, et qui, j’espère, en recevront un coup qui les mettra, pour des siècles, dans l’impossibilité de nuire. »
« 7 décembre 1914. – Les troubles de Tripolitaine n’ont pas franchi la frontière. On ne peut assez remercier Dieu des faveurs sans nombre qu’il a faites à la fille aînée de son Église ; le moindre n’est pas la fidélité de nos colonies…
« Envers moi, la confiance des Touaregs ne cesse de s’accroître. Le travail de lente préparation à l’Évangile se poursuit. Puisse le Tout-Puissant faire sonner bientôt l’heure à laquelle vous pourrez envoyer des ouvriers dans cette partie de votre champ… [130]. »
« 20 février 1915. – Le sud de la Tripolitaine est troublé ; Saint-Léger et 200 ou 300 soldats sont sur la frontière, pour empêcher que des bandes révoltées contre les Italiens ne fassent irruption chez nous. Il ne reste, au fort Motylinski, qu’un adjudant français et 6 ou 7 soldats indigènes. Cet adjudant est fort bien. Nous nous écrivons souvent, mais nous ne nous voyons guère : étant seul, il ne peut pas quitter son poste, et moi, ayant beaucoup à faire, je ne me déplace pas sans raison grave. Il y a deux ans que je ne suis allé à Fort-Motylinski.
« 21 février 1915. – Comme vous, je trouve que l’œuvre (de prière pour la conversion des infidèles des colonies) est plus indispensable que jamais, à cette heure où tant de nos sujets infidèles donnent leur sang pour nous. La loyauté et le courage avec lesquels nous servent nos sujets montrent à tous qu’il faut faire pour eux plus que nous n’avons fait dans le passé. Le premier devoir est celui que nous savons, le salut des âmes ; mais tout se tient, et bien des choses qui ne sont pas l’action proprement dite des prêtres et des religieux importent beaucoup au bien de leurs âmes : leur instruction, leur bonne administration civile, leur étroit contact avec des Français honnêtes gens, pour certains leur sédentarisation et un accroissement de bien-être matériel. Aussi je voudrais que notre « union », qui doit avant tout porter chacun de nous à s’unir le plus possible à Notre-Seigneur, à se remplir de son esprit, à vivre selon sa volonté et de sa grâce, porte aussi chacun à faire, selon sa condition et ses moyens, tout ce qu’il peut pour le salut des infidèles de nos colonies. »
« 12 mars 1915. – Comme vous j’espère que du grand mal qu’est la guerre sortira un grand bien pour les âmes, – bien en France, où cette vision de mort inspirera des pensées graves, et où l’accomplissement du devoir dans les plus grands sacrifices élèvera les âmes, les purifiera, les rapprochera de Celui qui est le Bien incréé, les rendra plus propres à percevoir la vérité et plus forts pour vivre en s’y conformant ; – bien pour nos alliés qui, en se rapprochant de nous, se rapprochent du catholicisme, et dont les âmes, comme les nôtres, se purifient par le sacrifice ; – bien pour nos sujets infidèles, qui combattent en foule sur notre sol, apprennent à nous connaître, se rapprochent de nous, et dont le loyal dévouement excitera les Français à s’occuper d’eux plus que par le passé, à les administrer mieux que par le passé. »
« 15 avril 1915. – Saint-Léger quitte In-Salah, et prend le commandement d’une autre compagnie saharienne, celle du Touat… Il est remplacé par un autre ami, très aimé aussi, le capitaine Duclos, que j’ai connu là comme lieutenant, officier de grande valeur et beau caractère… Je vois sans cesse Ouksem. Marie me demande s’il tricote : il tricote à merveille, et presque toutes les personnes jeunes de son campement et du village se sont mises, sous sa direction, à tricoter et à faire du crochet : chaussettes de tricot, gilets et calottes au crochet. Cela a été long, mais, depuis son retour, grâce à une de ses belles-sœurs qui s’y est mise avec beaucoup de bonne volonté, c’est parti, et tout le monde s’y met. »
« 15 juillet 1915. – Saint Henri. – Bonne fête, mon cher Laperrine, je pense bien à vous, et prie bien pour vous aujourd’hui…
« Les Touaregs d’ici se souviennent de vous, parlent de vous, vous aiment comme si vous aviez quitté hier le Sahara.
« Je vais bien ; malgré la sécheresse et les sauterelles, les jardins de Tamanrasset s’accroissent ; il n’y a plus maintenant une seule zériba ; il n’y a que des maisons, dont plusieurs avec cheminée. Quelques harratins commencent un peu à apprendre le français ; ils viennent d’eux-mêmes me demander, presque chaque soir, comment on dit tel ou tel mot. Presque toutes les femmes Dag-Rali des environs de Tamanrasset et un certain nombre de hartanis savent tricoter les chaussettes, les calottes et les gilets, à la grande joie des vieux et de pas mal de jeunes… »
« 2 août 1915. – Mon cher Laperrine, merci de votre lettre du 14 juin arrivée hier au soir. Je suis bien heureux de vous savoir en bonne santé. Que le bon Dieu vous garde et qu’il protège la France ! Je mène ma vie ordinaire, dans un grand calme apparent, mais l’esprit étant au front avec vous, avec vos soldats. Après le dictionnaire touareg-français abrégé, et le dictionnaire des noms propres, voici le dictionnaire touareg-français plus développé qui est terminé et prêt à être imprimé. Je viens de me mettre à la copie, pour l’impression, des poésies… Cela me paraît étrange, en des heures si graves, de passer mes journées à copier des pièces de vers !…
« L’Écho de Paris m’a appris la mort à l’ennemi du révérend Père Rivet, jésuite, professeur au Collège romain, qui a donné, en 1893, sa démission d’officier de chasseurs alpins… Il me semble qu’il devait avoir au moins quarante-sept ans, et que c’est, non pas comme appelé, mais comme engagé volontaire qu’il servait : le journal dit qu’on l’avait nommé lieutenant à la légion… Je ne croyais pas qu’il fût permis, par les lois de l’Église, à un prêtre de s’engager, bien qu’il soit obligatoire d’aller au régiment quand on est appelé. Il y a pu avoir des décisions pontificales récentes, que je ne connais pas. Nul n’était plus au courant que le révérend Père Rivet, professeur de droit canon[131]. Au cas où les lois de l’Église me permettraient de m’engager, ferai-je mieux de le faire ? Si oui, comment m’y prendre pour m’engager et être envoyé au front (car mieux vaut être ici que dans un dépôt ou un bureau) !… Entre la petite unité que je suis et zéro, il y a bien peu de différence, mais il y a des heures auxquelles tout le monde doit s’offrir… Répondez-moi sans tarder ; par ce même courrier, j’écris pour demander si l’Église autorise quelqu’un dans mon cas à s’engager. »
« 2 août 1915. – Un jeune nègre qui connaît Ghardaïa, les Pères et les Sœurs, me disait il y a quelques jours : « Quand les sœurs viendront ici, je mettrai ma femme chez elles pour qu’elle apprenne à tisser, et je demanderai à être leur jardinier… » Le temps est proche où les Sœurs seront reçues par les indigènes, surtout par les cultivateurs sédentaires, avec grande reconnaissance… Le Bon Dieu arrangera-t-il les choses de manière à conduire ici Pères Blancs et Sœurs Blanches ? »
« 7 septembre 1915. – Il y aura demain, fête de la nativité de la Sainte-Vierge, dix ans que mon ermitage de Tamanrasset est construit et que j’y célèbre la messe. Je dois bien des remerciements et de la gratitude au Bon Dieu, pour toutes les grâces qu’il m’a faites ici. »
« 13 octobre 1915. – Je vous remercie, mon cher Laperrine, de votre lettre du 24 août, et du très joli insigne tricolore « espoir et salut de la France » que vous m’avez envoyé ; il est arrivé à très bon port, il est devant moi, sur ma table, souvenir de vous en cette grande année. »
« 19 novembre 1915. – Le courrier de l’Azdjer n’est pas encore arrivé. Mais j’apprends ceci : le poste de Tunisie Dehibat est attaqué par les Senoussistes, commandés par des officiers en uniforme kaki, avec jumelles et revolver (allemands sans doute). Le général Moinier a envoyé des renforts. La situation est grave sur toute la frontière tunisienne-tripolitaine[132]. »
« Janvier 1916. – Jamais je n’ai senti autant que maintenant le bonheur d’être Français : nous savons tous deux qu’il y a en France bien des misères ; mais, dans la guerre présente, elle défend le monde et les générations futures contre la barbarie morale de l’Allemagne.
« Pour la première fois, je comprends vraiment les croisades : la guerre actuelle, comme les croisades précédentes, aura pour résultat d’empêcher nos descendants d’être des barbares. C’est un bien qu’on ne saurait payer trop cher[133]. »
« 6 mars 1916. – Ouksem est toujours au loin, on n’a plus besoin de lui pour apprendre le crochet ni le tricot, toutes les jeunes femmes et jeunes filles et la plupart des enfants, pas mal d’hommes même, le savent dans le voisinage ; votre envoi de laine et de coton a mis bien des doigts en mouvement…
« On travaille actuellement avec activité à une route pour auto entre Ouargla et In-Salah…
« De plus, dans un an, nous aurons, à Motylinski, une station de télégraphie sans fil. Militairement et administrativement, ces progrès sont très heureux, politiquement aussi : ces travaux montrent aux indigènes que rien n’est changé en France, et que la France conduit la guerre légèrement et sans inquiétude. »
« 10 avril 1916. – Mon cher Laperrine, il paraît que quand, avec Moussa, vous êtes allé chez Fihroun, retour de Niamey, Fihroun a proposé à Moussa de vous assassiner avec votre escorte ; Moussa s’y étant refusé, Fihroun lui a reproché de n’avoir pas de cœur. Moussa lui a répondu : « Tu suis ta voie, je suis la mienne ; dans quelques années d’ici, nous verrons laquelle des deux est la meilleure. » C’est d’Ouksem, chef des Dag-Rali, que je tiens la chose ; je la crois vraie, et ma reconnaissance et mon affection en augmentent fort envers Moussa. »
Le 11 avril, nouvelle lettre au général. Le fort français de Djanet, sur la frontière tripolitaine, a été investi, au début de mars, par plus de 1 000 Senoussistes armés d’un canon et de mitrailleuses. Derrière les remparts, il n’y avait que cinquante hommes, commandés par le maréchal des logis Lapierre. Le bruit court, dans le désert, que la petite garnison a tenu tant qu’elle a pu tenir, et que, après dix-huit jours de siège, les défenses étant démolies, les soldats presque tous blessés, l’unique puits comblé, le sous-officier commandant a fait sauter le fort. « Les Senoussistes ont la route libre pour venir ici ajoute le Père de Foucauld. Par ce mot « ici », j’entends non Tamanrasset, où je suis seul, mais Fort-Motylinski, Capitale du pays, qui est à 50 kilomètres de Tamanrasset. Si on suit mon conseil, nous nous tirerons tous d’affaire en cas d’attaque. J’ai conseillé de se retirer, avec toutes les munitions et approvisionnements, en un lieu, inexpugnable et muni d’eau, de la montagne, où on peut tenir indéfiniment et contre lequel le canon ne peut rien. Si on ne suit pas mon conseil, et que l’on soit attaqué, Dieu sait ce qui arrivera… Mais je croie qu’on suivra mon conseil ; je ferai mon possible pour qu’on le suive. Ne vous inquiétez pas si vous êtes quelque temps sans lettre, il peut se faire que nos courriers soient interceptés, sans que pour cela il nous soit arrivé aucun malheur. Je suis en correspondance quotidienne avec le commandant du fort Motylinski, le sous-lieutenant Constant. Si je le crois utile, j’irai lui faire de courtes visites ; s’il est attaqué, je me joindrai à lui. La population est parfaite… Nous sommes tous dans la main de Dieu ; il n’arrivera que ce qu’il permet. »
Décision nette et digne de Charles de Foucauld : ne pas quitter Tamanrasset, ni les pauvres harratins, pour l’insuffisante raison qu’il peut y avoir, d’un moment à l’autre, une incursion tentée par les Senoussistes ; mais si les soldats du poste de Motylinski sont les premiers attaqués, se joindre à eux. Dans l’un et l’autre cas, être au danger. En attendant l’événement probable, chercher, dans les montagnes, un lieu facile à fortifier et à défendre, même contre le canon ; en attendant aussi, ne rien changer à ses habitudes, « garder une attitude de confiance et de sourire ». Il n’y a pas qu’en France, on le voit, que les Français avaient le sourire : ils l’avaient au Sahara, et, sûrement, sans avoir reçu le mot !
Dès le lendemain, Charles de Foucauld fait le voyage de Tamanrasset à Fort-Motylinski, afin de choisir ce lieu défendable où se retirerait, en cas d’attaque, la petite garnison du bordj. Il en avait indiqué quatre, lui qui connaissait toutes les pierres du pays[134]. Avec le sous-lieutenant Constant, il en découvre un cinquième, à quelques kilomètres seulement de Motylinski, et il rappelle le paysage au général, l’autre omnisaharien : « ces gorges étroites, où s’enfonce la vallée de Tarhaouhaout, ces gorges à l’entrée desquelles il y a une épaisse forêt de berdis (c’est-à-dire de roseaux), et ensuite de l’eau courante, pendant près de quatre kilomètres, entre des flancs très escarpés. Il a été convenu que Constant organiserait défensivement le berdi et une partie des gorges en aval, au moyen de tranchées et de fortins, qu’il y transporterait des vivres et des munitions, qu’il y mettrait une garde, et qu’il s’y installerait lui-même à la première alerte. Par bonheur, Constant a en ce moment quatre autres Français, deux bons maréchaux des logis, un caporal du génie et un simple soldat, et trente militaires indigènes, dont un excellent sous-officier, Belaïd. Avec ce nombre de fusils ainsi encadrés, et la forte position choisie, il peut se défendre avec avantage contre des ennemis très nombreux, et le canon n’a pas de prise sur lui[135]. »
L’absence de Charles de Foucauld dure seulement quarante-huit heures. Il revient au poste sans garnison ni défense : l’ermitage. La nouvelle de la prise de Djanet s’est déjà répandue. Le courrier, comme tous les courriers du désert, a été interrogé, et il a raconté, comme un facteur rural, les nouvelles qu’il savait. Le chef de la tribu imrad des Dag-Rali a aussitôt couru chez le marabout. Le représentant de Moussa l’y a suivi. Celui-ci a été troublé d’abord, mais quelques mots de l’autre, du chef Ouksem, et la tranquille physionomie du Père de Foucauld l’ont remis en confiance. Ensemble, les trois hommes ont tenu conseil et pris quelques dispositions : il a été convenu, par exemple, que des postes de vedettes seraient établis en cinq endroits, pour que Tamanrasset et Motylinski puissent être avisés de l’approche de l’ennemi.
Peu à peu, des récits plus exacts de la prise de Djanet parviennent dans la vallée. Non, le maréchal des logis Lapierre n’a pas fait sauter le fort. Après vingt et un jours de belle défense, n’ayant plus de provisions, ne pouvant plus approcher du puits de la redoute démantelée, il a fait une sortie, dans la nuit du 24 mars. Sa petite troupe a erré trois jours dans le désert, espérant d’y rencontrer quelque détachement de France. Après ce temps, elle a été enveloppée par les Fellagas et faite prisonnière. On a enjoint au maréchal des logis de prononcer la formule d’abjuration, il a refusé. Néanmoins, on ne l’a pas tué, mais emmené en captivité, d’abord dans l’oasis de Djanet, puis à Rhât, puis au Fezzan. L’histoire devient plus vraie, mais le danger n’est pas moins grand pour cela : les officiers de nos postes et le Père de Foucauld s’attendent à ce que les tribus révoltées, fières d’avoir pris aux Français une forteresse, et excitées par les agitateurs de Tripolitaine, préparent de nouveaux coups de main.
« 15 mai. – La pleine victoire est indispensable, autrement tout serait à recommencer dans quelques années, et probablement dans des conditions moins bonnes, car Dieu nous a visiblement protégés. La résistance de la Belgique, l’alliance de l’Angleterre et de la Russie, l’entrée en ligne de l’Italie, la fidélité de nos colonies et des colonies anglaises, ce sont, entre d’autres, entre bien d’autres, des grâces exceptionnelles sur lesquelles on ne peut compter. Ces grâces doivent nous donner tout espoir, car Dieu ne nous les a sans doute faites que parce qu’il veut que nous vainquions, et que nous protégions le monde contre l’inondation de paganisme allemand qui le menaçait ; que seraient devenues nos nations latines, si l’Allemagne victorieuse y avait imposé l’éducation germanique ? Quelle liberté serait restée à l’Église, si l’empereur d’Allemagne avait triomphé ? Les Alliés, le voulant ou non, le sachant ou non, font une vraie croisade. Ils combattent non seulement pour la liberté du monde, mais pour la liberté de l’Église et pour le maintien dans le monde de la morale chrétienne[136]. »
« 30 mai 1916. – Ma promotion de Saint-Cyr sert bien la patrie : Mazel, d’Urbal, Pétain en sont. Mes anciens aussi : Maud’huy, Sarrail, Driant. »
« Lundi de la Pentecôte[137]. – Chaque année, le mois de juin, en ramenant l’anniversaire de mon ordination, renouvelle et accroît ma gratitude envers vous qui m’avez adopté et avez fait de moi un prêtre de Jésus. De tout mon cœur je prie pour vous, qui m’avez accepté pour fils depuis plus de quinze ans, et je prie aussi pour le cher diocèse de Viviers.
« De corps je suis ici, où je resterai jusqu’à la paix, pensant y être plus utile qu’ailleurs ; mais combien souvent mon esprit est en France, au front, où la lutte doit être en ce moment plus ardente que jamais, et à l’arrière, où tant de familles pleurent ce qu’elles avaient de plus cher, ou sont dans de mortelles inquiétudes.
« Autour de moi, la population indigène reste calme et fidèle ; son attitude est excellente.
« Je garde le grand désir de voir établir en France la confrérie pour la conversion des colonies françaises dont vous avez bien voulu approuver le projet. En ces jours de la Pentecôte, je pense plus que jamais aux cinquante millions d’indigènes infidèles de nos colonies ; puisse l’Esprit Saint établir son règne dans leurs âmes, et puissent les Français, qui leur demandent de les aider à défendre leur patrie temporelle, les aider à obtenir la patrie éternelle ! »
Les menaces étaient trop graves pour que l’autorité militaire ne songeât pas à protéger le Père de Foucauld, et les Touaregs ou leurs serviteurs, ralliés à notre cause, et qui habitaient Tamanrasset. Au début de 1916, elle avait fait commencer, sur les plans et sous la direction du Père, la construction d’un fortin. L’ermite changea de domicile le 23 juin. Il passait ainsi de la rive gauche à la rive droite de l’oued Tamanrasset, et se trouvait plus près des maisons du village. On va voir que toutes les précautions avaient été prises pour que la petite forteresse pût soutenir un siège.
Elle formait un carré de seize mètres de côté, entouré d’un fossé de deux mètres de profondeur. Aux angles, elle était renforcée par quatre bastions garnis de créneaux, et à la terrasse desquels on montait par un escalier. Les murs, en toubes, avaient deux mètres d’épaisseur à la base, et cinq mètres de hauteur. Aucune ouverture extérieure, si ce n’est une porte très basse. Le danger était là : que la porte fût enfoncée ; que, par surprise, l’ennemi se glissât dans la place. On y avait paré autant que possible. La première porte ne permettait pas à un homme d’entrer debout ; il fallait se courber ; de plus, elle donnait accès, non pas directement dans le fortin, mais dans un couloir en briques, assez étroit pour qu’un seul homme y pût passer, et que fermait une seconde porte basse. Puis, juste en face de l’ouverture extérieure, et pour qu’elle ne fût pas attaquée à coups de pierre ou de piques, on avait élevé, sur le terre-plein, un muret solide, très rapproché de la façade, de sorte qu’il était impossible de tirer, de l’extérieur, sur une personne qui se fût trouvée devant la porte d’entrée. Celle-ci, d’ailleurs, était encore défendue par les deux bastions d’angle. Une croix, faite de deux branches de tamaris, était plantée au faîte du mur, au-dessus de la porte. Enfin, pour permettre de franchir le fossé, on avait laissé une crête de terre, qui aboutissait à gauche du muret de protection. L’intérieur était aménagé de manière à recevoir un groupe assez important de réfugiés et de combattants.
Le lieutenant L…, qui a séjourné à cette époque à Tamanrasset, décrit ainsi les diverses parties du nouvel ermitage fortifié[138].
« Au centre de la cour carrée, dont les côtés ont quatre mètres, un puits profond de six mètres environ, recouvert d’une épaisse porte en bois renforcée par des plaques de tôle. Eau abondante. Tout autour, des chambres assez spacieuses, toutes pareilles, de forme rectangulaire.
« L’une servait de chapelle au révérend Père ; une autre était réservée aux hôtes de passage ; une autre servait à entreposer les vivres, cotonnades, etc., que le Père destinait aux Touaregs, une quatrième enfin constituait l’appartement particulier du Père ; elle était à la fois chambre à coucher, cabinet de travail, salle à manger, toutes choses égales d’ailleurs et en laissant à ces dénominations, appliquées au Père de Foucauld, leur véritable signification.
« Seul le cabinet de travail méritait ce titre ; des livres partout, des manuscrits jonchaient la petite table, en bois de caisse, qui servait de bureau.
« Ainsi édifié, ce fortin est imprenable par une bande armée de fusils ; l’escalade en est presque impossible, et deux hommes, ou même un homme armé de grenades, suffiraient à en assurer la défense. »
« 16 juin 1916. – Le danger senoussiste paraît conjuré pour le moment. Notre fort de Djanet, à la frontière tripolitaine, enlevé par les Senoussistes le 24 mars, a été repris par nos troupes le 16 mai ; nos soldats poursuivent l’ennemi en fuite. Tant que les Italiens n’auront pas repris tout le sud de la Tripolitaine, qu’ils ont évacué, notre frontière tripolitaine sera menacée et des mesures sérieuses de surveillance seront nécessaires : espérons qu’on les prendra. Ce sont des pays lointains ; quand on en parle aux autorités qui résident à Alger, elles ne croient qu’à demi ce qu’on leur dit, n’accordent qu’à moitié ce qu’on leur demande, et ne consentent à prendre les mesures nécessaires que quand un accident est arrivé. »
« 16 juillet 1916. – Les missionnaires isolés comme moi sont fort rares. Leur rôle est de préparer la voie, en sorte que les missions qui les remplaceront trouvent une population amie et confiante, des âmes quelque peu préparées au christianisme, et, si faire se peut, quelques chrétiens. Vous avez en partie écrit leurs devoirs dans votre article de l’Écho de Paris : « Le plus grand service[139]. » Il faut nous faire accepter des musulmans, devenir pour eux l’ami sûr, à qui on va quand on est dans le doute ou la peine ; sur l’affection, la sagesse et la justice duquel on compte absolument. Ce n’est que quand on est arrivé là qu’on peut arriver à faire du bien à leurs âmes.
« Ma vie consiste donc à être le plus possible en relation avec ce qui m’entoure, et à rendre tous les services que je peux. À mesure que l’intimité s’établit, je parle, toujours ou presque toujours en tête à tête, du bon Dieu, brièvement, donnant à chacun ce qu’il peut porter : fuite du péché, acte d’amour parfait, acte de contrition parfaite, les deux grands commandements de l’amour de Dieu et du prochain, examen de conscience, méditation à la vue des fins dernières, devoir de la créature de penser à Dieu, etc., donnant à chacun selon ses forces et avançant lentement, prudemment.
« Il y a fort peu de missionnaires isolés faisant cet office de défricheur ; je voudrais qu’il y en eût beaucoup ; tout curé d’Algérie, de Tunisie ou du Maroc, tout aumônier militaire, tout pieux catholique laïc, pourrait l’être. Le gouvernement interdit au clergé séculier de faire de la propagande anti-musulmane ; mais il s’agit de propagande ouverte et plus ou moins bruyante : les relations amicales avec beaucoup d’indigènes, tendant à amener lentement, doucement, silencieusement, les musulmans à se rapprocher des chrétiens devenus leurs amis, ne peuvent être interdites à personne. Tout curé de nos colonies pourrait s’efforcer de former beaucoup de ses paroissiens et paroissiennes à être des Priscille et des Aquila. Il y a toute une propagande tendre et discrète à faire auprès des indigènes infidèles, propagande qui veut avant tout de la bonté, de l’amour et de la prudence, comme quand nous voulons ramener à Dieu un parent qui a perdu la foi…
« Espérons qu’après la victoire nos colonies prendront un nouvel essor. Quelle belle mission pour nos cadets de France, d’aller coloniser dans les territoires africains de la mère patrie, non pour s’y enrichir, mais pour y faire aimer la France, y rendre les âmes françaises, et surtout leur procurer le salut éternel !
« Ma pensée est que si, petit à petit, doucement, les musulmans de notre empire colonial du nord de l’Afrique ne se convertissent pas, il se produira un mouvement nationaliste analogue à celui de la Turquie ; une élite intellectuelle se formera dans les grandes villes, instruite à la française sans avoir l’esprit ni le cœur français, élite qui aura perdu toute foi islamique, mais qui en gardera l’étiquette pour pouvoir, par elle, influencer les masses ; d’autre part, la masse des nomades et des campagnards restera ignorante, éloignée de nous, fermement mahométane, portée à la haine et au mépris des Français par sa religion, par ses marabouts, par les contacts qu’elle a avec les Français (représentants de l’autorité, colons, commerçants), contacts qui trop souvent ne sont pas propres à nous faire aimer d’elle. Le sentiment national ou barbaresque s’exaltera donc dans l’élite instruite ; quand elle en trouvera l’occasion, par exemple lors de difficultés de la France au dedans ou au dehors, elle se servira de l’Islam comme d’un levier pour soulever la masse ignorante, et cherchera à créer un empire africain musulman indépendant.
« L’empire nord-ouest africain de la France, Algérie, Maroc, Tunisie, Afrique occidentale française, etc., a 30 millions d’habitants ; il en aura, grâce à la paix, le double dans cinquante ans. Il sera alors en plein progrès matériel, riche, sillonné de chemins de fer, peuplé d’habitants rompus au maniement de nos armes, dont l’élite aura reçu l’instruction dans nos écoles. Si nous n’avons pas su faire des Français de ces peuples, ils nous chasseront. Le seul moyen qu’ils deviennent Français est qu’ils deviennent chrétiens[140]. »
« 31 août 1916. – D’ici à In-Salah, la route pour auto est finie, ou bien près d’être finie. La première auto qui arrivera ici sera une joie pour moi : c’est un achèvement de prise de possession du pays. Il faudrait poursuivre immédiatement cette route jusqu’au Soudan ; il n’y a que 700 kilomètres d’ici à Agadès, premier poste soudanais, la même distance que d’ici à In-Salah : un travail de quatre mois[141]. Ce serait un énorme avantage pour l’administration et la défense, et une énorme économie. »
« 1er septembre 1916[142]. – Le coin de Sahara d’où je t’écris, mon cher Mazel, est toujours calme. Pourtant on se tient sur le qui-vive, à cause de l’agitation croissante des Senoussistes dans la Tripolitaine ; nos Touaregs d’ici sont fidèles, mais nous pourrions être attaqués par les Tripolitains. J’ai transformé mon ermitage en fortin ; il n’y a rien de nouveau sous le soleil : je pense, en voyant mes créneaux, aux couvents fortifiés et aux églises fortifiées du dixième siècle. Comme les choses anciennes reviennent, et comme ce qu’on croyait à jamais disparu reparaît ! On m’a confié six caisses de cartouches et trente carabines Gras qui me rappellent notre jeunesse…
« Je suis content que tu aies sous tes ordres notre brave Laperrine ; je souhaite que tu le gardes longtemps. C’est à lui que nous devons la tranquillité du Sahara algérien ; la sagesse et la vigueur de ses actes, et l’incomparable souvenir qu’il a laissé, sont la cause de la fidélité de ces populations réputées difficiles.
« Ci-joint la traduction d’une prière du neuvième siècle, qui a probablement été dite et chantée plus d’une fois dans la cathédrale de Reims.
« Dieu tout puissant et éternel, qui avez établi l’empire des Francs pour être dans le monde l’instrument de votre sainte volonté, la gloire et le rempart de votre sainte Église, prévenez partout et toujours, de votre céleste lumière, les fils suppliants des Francs, afin qu’ils voient ce qu’il faut faire, pour étendre votre règne dans le monde, et qu’ils grandissent toujours en charité et en vaillance, pour accomplir ce que votre lumière leur a aura révélé. »
« 15 septembre 1916. – Malheureusement, les nouvelles de la frontière tripolitaine sont mauvaises… Sans avoir subi d’échec, nos troupes se replient devant les Senoussistes : elles ne sont plus sur la frontière, mais bien loin en deçà ; après avoir repris Djanet, elles l’ont évacué ; elles ont évacué d’autres points encore ; cette reculade devant quelques centaines de fusils est lamentable. Il y a là (à quel degré de la hiérarchie, je l’ignore) une faute grave de commandement. Il est clair que si, sans même combattre, on recule, les Senoussistes avanceront. Si on ne change pas promptement de méthode, ils arriveront ici dans quelque temps. Je regrette de vous inquiéter encore, mais la chère vérité veut que je vous le dise. »
« 24 septembre 1916. – Ces jours passés, nous avons eu une forte alerte ; on a apporté la nouvelle que nous allions être attaqués ; mais la nouvelle était fausse, rien n’a paru, et les nouvelles d’hier montrent au contraire la situation comme très bonne. L’alerte n’a servi qu’à prouver la fidélité de la population : loin de faire mine de passer à l’ennemi, elle s’est groupée autour de l’officier qui commande le fort voisin, et autour de moi, prête à défendre le fort et l’ermitage. Cette fidélité m’a été très douce, et je suis très reconnaissant envers ces pauvres gens, qui auraient pu se réfugier dans les montagnes où ils n’avaient rien à redouter, et qui ont mieux aimé s’enfermer dans le fort voisin et dans mon ermitage bien qu’ils sussent que l’ennemi avait des canons, et que le bombardement était certain.
« Même époque. – Par la croisade qu’il fait faire par la fille aînée de son Église, Dieu donne l’occasion et la grâce d’actes de vertu innombrables : actes de dévouement, d’oubli de soi, de charité, de résignation, de miséricorde, sacrifices de la vie, du bonheur, de tout ce qui est cher, actes d’amour de Dieu. Sans doute, il y a aussi du mal ; le mal sera mêlé au bien jusqu’à la fin du monde ; mais depuis deux ans que dure la guerre, ont été faits une somme d’actes héroïques de vertu, et un nombre de sacrifices offerts à Dieu, en union avec celui de son Fils, comme n’en produit habituellement qu’une grande quantité d’années. Il y a là un total de mérites et d’immolations qui purifie et élève la France, et la rapproche de Dieu. J’ai bon espoir qu’elle sortira, non seulement victorieuse, mais meilleure, beaucoup meilleure, de cette croisade[143]. »
« 1er octobre 1916. – Je regarde les longs mois, pendant lesquels la guerre me retient au Sahara, comme un temps de retraite, pendant lequel je prie et je réfléchis, demandant à Jésus de me faire connaître la forme définitive à donner à notre confrérie. »
« 15 octobre 1916. – Moussa qui est à 600 kilomètres, ayant entendu dire que le fort voisin d’ici allait être attaqué, a tout de suite envoyé, à marche forcée, tout ce qu’il avait près de lui d’hommes disponibles, quatre-vingts hommes environ, pour nous aider à nous défendre… Moussa n’a cessé d’être on ne peut mieux depuis le début de la guerre. L’état des gens qui m’entourent est à faire pleurer. Ils sont tellement entourés de mal et d’erreur ! Il leur est si difficile de mener une vie même naturellement bonne ! Il y a de bonnes natures, mais dans le milieu où elles sont, et avec leur ignorance, comment se sauveront-elles ? »
« 31 octobre 1916. – En Azdjer, un seul événement militaire depuis ma dernière lettre : vers le 20 septembre, un gros convoi de ravitaillement, conduit par Duclos, de Flatters à Polignac, a été attaqué en cours de route, à l’oued Ehen, par 300 Senoussistes commandés par un ex-brigadier de la compagnie du Tidikelt, en dissidence depuis plusieurs années. Les Senoussistes ont été repoussés avec des pertes importantes ; toutes les charges du convoi sont arrivées à bon port à Polignac. De notre côté, il y a eu quelques morts et quelques blessés ; parmi les morts, un excellent adjudant, Lenoir, tué d’une balle au cœur ; on l’a transporté et enterré à Polignac. Les Senoussistes, battus, se sont retirés en hâte dans la direction d’Admer.
« Vous ai-je écrit qu’il y a environ quarante jours, un petit rezzou (vingt hommes) de Kel-Azdjer a opéré dans le Téfédest (versant est), à Amrah ? On a été assez longtemps sans avoir sur lui des détails précis : je viens d’en recevoir. Il n’a razzié que cent chameaux des Kel-Inrar et s’est replié rapidement. Il n’y a pas eu d’autres rezzou ennemi jusqu’à présent contre l’Ahaggar et, si les choses vont bien dans l’Azdjer, il n’y en aura pas d’autres.
« Un assez gros rezzou senoussiste a opéré dans le nord de l’Aïr ; au lieu de razzier, il a dit aux gens : déménagez et venez vous installer définitivement au Fezzan avec nous, et nous ne vous ferons aucun mal ; si vous refusez, nous vous razzions. Certains Kel-Aïr ont accepté, et les ont suivis en dissidence ; les tirailleurs soudanais d’Agadès les ont rejoints, ont battu les Senoussistes et ramené les dissidents. Certains Kel-Ahaggar, qui se trouvaient sur le passage du rezzou des Senoussistes, ont fait semblant d’accepter leurs conditions, les ont suivis un jour ou deux, puis de nuit, trompant leur surveillance, sont partis à marches forcées vers l’Adrar et leur ont échappé[144]. »
« 16 novembre 1916. – Que le Bon Dieu est bon de nous cacher l’avenir ! Quel supplice serait la vie s’il nous était moins inconnu ! et qu’il est bon de nous faire connaître si clairement cet avenir du ciel qui suivra l’épreuve terrestre ! »
Celui qui écrivait ces lignes n’avait plus que deux semaines à vivre. Il ne le savait pas, mais il était prêt, quotidiennement, à recevoir la mort, de la main de ces hommes pour lesquels il avait tant prié, tant marché dans le sable et la rocaille, tant souffert de la soif et de la chaleur, étudié tant de jours et tant de nuits, accepté tant de solitude, et, au bref, tant peiné de son corps et de son esprit. Les lettres que je vais citer à présent expriment ses dernières pensées : sa fermeté y transparaît autant que sa charité. Ces lettres furent trouvées, parmi d’autres, après l’assassinat, dans le fortin de Tamanrasset ; elles devaient être remises, le 1er décembre 1916, au méhariste arrivant de Motylinski, et continuant vers In-Salah, après avoir fait une halte à l’ermitage.
« 28 novembre 1916. – À la prieure des clarisses de Nazareth réfugiées à Malte. – La France, malgré les apparences, reste la France de Charlemagne, de saint Louis et de Jeanne d’Arc ; la vieille âme de la nation reste vivante dans notre génération ; les saints de France prient toujours pour elle ; les dons de Dieu sont sans repentance et le peuple de saint Remi et de Clovis reste le peuple du Christ… En choisissant la France pour le berceau de la dévotion au Sacré-Cœur et pour les apparitions de Lourdes, Notre-Seigneur a bien montré qu’il garde à la France son rang de premier né.
« Je puis dire régulièrement tous les jours la sainte messe. J’ai un autre bonheur : celui d’avoir la Sainte Réserve dans ma petite chapelle. Je suis toujours seul. Des Français viennent me voir de temps en temps : tous les trente ou quarante jours, j’en vois un, de passage.
« Nous vivons des jours où l’âme sent fortement le besoin de prière. Dans la tempête qui souffle sur l’Europe, on sent le néant de la créature, et on se tourne vers le Créateur. Dans la barque ballottée par les flots, on se tourne vers le Divin Maître, et on supplie celui qui d’un mot peut donner la victoire et faire renaître pour longtemps un grand calme. On tend les bras vers le ciel, comme Moïse pendant le combat des siens, et là où l’homme est impuissant, on prie celui qui peut tout. Devant le Saint-Sacrement on se sent si bien en présence de l’Être, alors que tout le créé paraît, avec tant d’évidence, toucher au néant !
« Priez bien, ma très révérende Mère, pour les pauvres infidèles qui m’entourent et pour leur très pauvre missionnaire. Avec vous, je prie pour la France. »
1er décembre 1916. – Réponse à un officier, interprète militaire de l’armée d’Orient, qui avait écrit, de devant Monastir, sa décision de passer dans un régiment d’infanterie coloniale, et demandait une prière au Père de Foucauld :
« Très cher frère en Jésus, je reçois ce matin vos lettres des 3 et 9 octobre, ému à la pensée des dangers plus grands que vous allez peut-être courir, que vous courez probablement déjà. Vous avez très bien fait de demander à passer dans la troupe. Il ne faut jamais hésiter à demander les postes où le danger, le sacrifice, le dévouement sont plus grands : l’honneur, laissons-le à qui le voudra, mais le danger, la peine, réclamons-les toujours. Chrétiens, nous devons donner l’exemple du sacrifice et du dévouement. C’est un principe auquel il faut être fidèle toute la vie, en simplicité, sans nous demander s’il n’entre pas de l’orgueil dans cette conduite : c’est le devoir, faisons-le, et demandons au Bien-Aimé Époux de notre âme de le faire en toute humilité, en tout amour de Dieu et du prochain…
« Ne soyez pas inquiet de votre foyer. Confiez-vous et confiez-le à Dieu, et marchez en paix. Si Dieu vous conserve la vie, ce que je lui demande de tout mon cœur, votre foyer sera plus béni parce que, vous dévouant davantage, vous serez plus uni à Jésus et aurez une vie plus surnaturelle. Si vous mourez, Dieu gardera votre femme et votre fils, sans vous, comme il les aurait gardés par vous. Offrez votre vie à Dieu par les mains de notre mère la très Sainte Vierge, en union avec le sacrifice de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et à toutes les intentions de son Cœur, et marchez en paix. Ayez confiance que Dieu vous donnera le sort le meilleur pour sa gloire, le meilleur pour votre âme, le meilleur pour les âmes des autres, puisque vous ne lui demandez que cela, puisque tout ce qu’il veut vous le voulez, pleinement et sans réserve.
« Notre coin de Sahara est en paix. J’y prie pour vous de tout mon cœur, et en même temps pour votre foyer.
« Ceci vous arrivera vers Noël et le 1er janvier. Cherchez-moi bien près de vous, en ces deux jours. Bonne et sainte année, nombreuses et saintes années, si c’est la volonté divine, et le ciel ! Que Dieu vous garde, et qu’il protège la France ! Que Jésus, Marie et Joseph vous gardent entre eux dans toute votre vie terrestre, à l’heure de la mort et dans l’éternité !
« Je vous embrasse, comme je vous aime, dans le cœur de Jésus.
« CH. DE FOUCAULD. »
Le Père de Foucauld avait la certitude qu’il serait attaqué, et son désir était, depuis bien longtemps, de mourir pour ses brebis perdues. Il continuait de vivre solitaire et en paix. Pas une ombre d’inquiétude ne diminuait l’expression de joie de son visage. Il parlait même de lointains projets à ses amis, parce que nous sommes faits pour sans cesse renaître et repartir, et que nous disposons toujours de notre vie pour plus de temps que nous n’avons à vivre. Au milieu de 1915, il avait achevé le dictionnaire touareg-français ; le 28 octobre 1916, le diaire porte : « Fini les poésies touarègues. » L’ermite était résolu à revenir en France, dès qu’il aurait appris la victoire, à y séjourner autant de mois qu’il faudrait pour implanter solidement, dans le pays généreux, l’œuvre de la prière pour les infidèles ; puis à rentrer dans l’Ahaggar, à s’y donner plus complètement et plus directement à l’apostolat religieux, à la préannonciation du Christ, maintenant que les outils de la conversion étaient préparés, les méthodes expérimentées, et qu’il avait aperçu les premiers brins d’herbes de ce qui sera la moisson.
Dieu ne l’avait fait que pour semer. Charles de Foucauld n’a pas vu la victoire ; il n’a pas revu la France ; il est allé parmi les bons serviteurs que Dieu reçoit et remercie, parce qu’ils ont sauvé leur âme et pris soin de l’âme des autres.
Pour comprendre mieux quelles causes amenèrent la mort du Père de Foucauld, il faut résumer la situation politique et militaire du Sahara oriental, à l’époque où nous sommes arrivés de notre récit. Au sud de la Tripolitaine, dans le Fezzan, Si Mohamed Labed, chef religieux senoussiste, a son quartier général, et il a rassemblé dans ce camp les Touaregs Azdjers, nos ennemis. Senoussistes, Azdjers, partisans, hors la loi, que les gens du Hoggar désignent sous le vocable commun de Fellagas, occupent Rhât, en Tripolitaine, place abandonnée par les Italiens, et où ils ont trouvé vivres, matériel, munitions de guerre. À quelques dizaines de kilomètres de Rhât, et dans nos possessions mêmes, le poste de Djanet, pris par les Fellagas, repris par nous, a été définitivement évacué, à cause d’insurmontables difficultés de ravitaillement. Évacué également le fort Polignac, un peu plus au nord. Une bande de dissidents, opérant dans la région soudanaise, assiège Agadès, sous la conduite de Rhaoussen. Sauf quelques tentes disséminées dans les montagnes du Hoggar, la plupart des campements qui relèvent de Moussa ag Amastane sont, avec les troupeaux, dans cette même région. Les méharistes de Fort-Motylinski les ont suivis et les protègent. La garnison du fort, ainsi réduite, est peu mobile, et incapable de porter secours au Père de Foucauld et à ses harratins.
Le 1er décembre, un vendredi, à la tombée de la nuit, le Père était seul chez lui, la porte close au verrou. Son domestique était au village, ainsi que deux méharistes du poste de Motylinski, venus pour affaires de service, et qui attendaient la nuit pour regagner le fort.
Or, une vingtaine de Fellagas étaient, à ce moment, près de Tamanrasset, et cherchaient à s’emparer du marabout, qu’ils eussent gardé comme otage, et à piller le fortin, où ils savaient qu’il y avait des armes et des provisions. Le pays étant dégarni de troupes, ils étaient à peu près sûrs de réussir. Néanmoins, ils recrutèrent, pour leur coup de main, quelques nomades touaregs et aussi quelques harratins, parmi ceux-là même que le Père de Foucauld soignait, secourait et traitait en frères, et, en particulier, un cultivateur d’Amsel nommé El Madani. Les gens du rezzou étaient armés de fusils italiens (chargeurs à cinq coups), leurs auxiliaires n’avaient pas tous des armes. Ensemble, les uns à pied, les autres montés sur des chameaux, ils s’avancèrent jusqu’à 200 mètres du fortin, firent accroupir les chameaux le long d’un mur de jardin et enveloppèrent silencieusement la demeure du « marabout des roumis ». Ils étaient une quarantaine. Mais il fallait qu’un familier du Père fût avec eux pour faire ouvrir la porte. El Madani, connaissant les habitudes et les mots de passe de celui qui avait été son bienfaiteur, s’approcha de la porte du fortin, et frappa. Le Père arriva après un moment, et demanda, selon sa coutume, qui se trouvait là et ce qu’on voulait ? « C’est le postier de Motylinski », fut-il répondu. Comme c’était, en effet, le jour du passage du courrier, le Père ouvrit la porte, et tendit la main. La main fut saisie et retenue fortement. Aussitôt des Touaregs, cachés tout près, se précipitèrent, tirèrent le prêtre hors du fortin, et, avec des cris de victoire, lui lièrent les mains derrière le dos, et le laissèrent sur le terre-plein, entre la porte et le muret qui la masquait, à la garde d’un homme de la bande, armé d’un fusil. Le Père de Foucauld ploya les genoux, et se tint immobile : il priait.
Je transcris ici, en les combinant, les dépositions du domestique nègre Paul, et celles d’un autre harratin, telles qu’elles ont été consignées dans deux rapports officiels, et je les compléterai d’après les données de divers documents[145].
« Le 1er décembre, après avoir servi le dîner du marabout, je m’en fus à ma zériba, située à environ 450 mètres de là. Il était environ sept heures, et il faisait nuit.
« Peu après, alors que j’achevais moi-même mon repas, deux Touaregs armés surgirent dans la zériba, et me dirent : « C’est toi Paul, le domestique du marabout ? Pourquoi te caches-tu ? Viens voir de tes yeux ce qui se passe : suis nous ! » Je répondis que je ne me cachais pas, et que ce qui se passait était la volonté de Dieu.
« En arrivant près de la maison du marabout, j’aperçus ce dernier assis, adossé au mur, à droite de la porte, les mains liées derrière le dos, regardant droit devant lui. Nous n’échangeâmes aucune parole. Je m’accroupis, sur l’ordre qui m’en fut donné, à gauche de la porte. De nombreux Touaregs entouraient le marabout ; ils parlaient et gesticulaient, félicitant et bénissant le hartani El Madani qui avait attiré le marabout dans le guet-apens, lui prédisant en récompense de son œuvre une vie de délices dans l’autre monde. D’autres Touaregs étaient dans la maison, entraient et sortaient, apportant divers objets trouvés à l’intérieur, fusils, munitions, vivres, chegga (toile), etc. Ceux qui entouraient le marabout le pressaient des questions suivantes : « Quand vient le convoi ? Où est-il ? Qu’apporte-t-il ? Y a-t-il des militaires dans le bled ? Où sont-ils ? Sont-ils partis ? Où sont les militaires de Motylinski ? » Le marabout resta impassible, il ne prononça pas une parole. Les mêmes questions me furent ensuite posées, ainsi qu’à un autre hartani, qui passant dans l’oued fut appréhendé sur ces entrefaites.
Le tout dura moins d’une demi-heure.
La maison était entourée de sentinelles. À ce moment, l’une des sentinelles donna l’alarme, en criant : Voilà les Arabes ! Voilà les Arabes ! (les militaires de Motylinski). » À ces cris, les Touaregs, à l’exception de trois, dont deux restèrent devant moi, et un autre debout, de garde près du marabout, se portèrent du côté d’où venaient ces appels. Presque aussitôt une vive fusillade éclata. Le Touareg qui était près du marabout porta la bouche du canon de son fusil près de la tête de ce dernier et fit feu. Le marabout ne bougea, ni ne cria. Je ne le croyais pas blessé ; ce n’est que quelques minutes après que je vis le sang couler, et que le corps du marabout glissa lentement en tombant sur le côté. Il était mort[146].
« Les Touaregs ne tardèrent pas à revenir, après avoir tué les deux militaires qui, de passage à Tamanrasset, venaient, selon la coutume, saluer le marabout, avant de reprendre la route de Motylinski. Ils dépouillèrent entièrement le marabout de tous ses effets, et le jetèrent dans le fossé qui entoure la maison. Ils discutèrent ensuite sur ce qu’ils allaient faire de son corps, et s’ils allaient ou non me tuer, en kafer (mécréant), comme mon maître. Sur l’intervention des harratins du bled et de leur chef qui, au bruit de la fusillade, étaient accourus, je fus épargné et rendu libre. Pour le marabout, les uns voulaient l’emporter et le cacher, les autres voulaient l’attacher à un arbre qui se trouve non loin de la maison, dans l’oued, et le livrer en pâture aux chiens du Touareg Chikkat de la tribu des Dag-Rali, qu’ils savaient être l’ami personnel du marabout[147].
« Enfin d’autres Touaregs encore, qui se désintéressaient de la question, et trouvaient suffisant de satisfaire leurs désirs à l’aide des victuailles trouvées dans la maison, mirent fin à la discussion, en obligeant chacun à veiller à sa part de butin.
« Le corps du marabout fut momentanément oublié. Les assassins passèrent la nuit à boire et à manger. Le lendemain matin, la discussion fut reprise, sans qu’une solution définitive fût adoptée, et le corps du marabout fut abandonné sans avoir été mutilé.
« Dans la matinée, les Touaregs purent encore tuer par surprise un militaire isolé, qui, ignorant tout du drame, venait de Motylinski et se rendait chez le marabout, porteur du courrier d’In-Salah.
« Vers midi, ils quittèrent Tamanrasset, emportant leur butin. Les harratins donnèrent alors une sépulture au marabout et aux militaires. Le soir, je me mis en route pour aller aviser le poste de Fort-Motylinski, où j’arrivais le 3 décembre à midi[148]. »
Le capitaine Depommier ajoutait au récit de Paul les observations suivantes :
« Quel était le but des assassins ? À quels sentiments obéissaient-ils ?
« Parmi les sentiments primordiaux qui firent agir les assassins, il faut voir, à coup sûr, le fanatisme, « guerre aux Roumis ». Depuis longtemps, la propagande en faveur de la guerre sainte était active dans la région, de nombreux propagateurs venaient de l’est, de chez les Senoussistes, et avaient acquis à leur cause la fraction des Aït-Lohen, tribu hoggar, limitrophe de la région Azdjer. Le Père de Foucauld n’en ignorait rien (le Père de Foucauld avait eu lui-même connaissance d’un complot ourdi en septembre par des hartanis d’Amsel, dans le but de l’assassiner. Des papiers trouvés après sa mort par le capitaine de La Roche en font foi. Le Père de Foucauld ne s’en ouvrit jamais à personne). Ce n’est cependant pas là, vraisemblablement, l’unique cause de la conduite des assassins.
« Pourquoi s’attaquèrent-ils au Père de Foucauld, seul et prêtre, qui avait forcé, par mille actes de charité et de bienveillance, la sympathie sinon la reconnaissance de beaucoup de ceux qui l’approchaient ? Doit-on n’y voir que l’œuvre de fanatiques, et penser que ceux-ci méconnurent les prescriptions du Coran, qui recommande d’épargner les prêtres ?
« Une autre cause du crime paraît beaucoup plus simple. La voici. Peu de choses étaient cachées chez le Père de Foucauld, et tous savaient qu’il avait en dépôt des fusils, des carabines et des munitions ; il s’agissait de s’approprier ces armes ; on trouverait peut-être, par surcroît, une forte somme d’argent chez ce généreux bienfaiteur. La bande n’ignorait pas enfin que la garnison de Motylinski, réduite à quelques hommes, ne pourrait rien contre elle.
« Mais alors, pourquoi les armes prises et la maison en leur possession, les pillards assassinèrent-ils le Père de Foucauld ? Certains bruits recueillis pourraient laisser croire que ce ne fut que l’effet de la fatalité, des circonstances. Le gardien du Père de Foucauld n’aurait pas reçu l’ordre de le tuer ; au contraire, Ebeh, suivant la consigne reçue de Si-Labed, son chef, aurait recommandé de le garder prisonnier, n’ignorant pas l’importance énorme que pouvait avoir ultérieurement un otage tel que le Père de Foucauld (on sait que l’ennemi agit ainsi plusieurs fois avec les Français faits prisonniers, à Djanet et en région Azdjer). La venue de deux militaires sur les lieux du drame, et la fusillade qui s’ensuivit, auraient été les causes déterminantes de l’acte de l’assassin. Ebeh et le meurtrier pourraient seuls faire la lumière sur ce point.
« Il convient de fixer ici un autre point. Ce n’est pas pour faire la guerre que le Père de Foucauld avait chez lui un petit arsenal ; il pouvait personnellement trouver refuge et protection au poste de Fort-Motylinski, et le commandant de poste, le capitaine de La Roche, s’était fait un devoir d’insister à plusieurs reprises auprès de lui, depuis que des craintes d’insurrection et de pillage existaient, pour qu’il vînt s’installer en lieu sûr à Ta-rhaouhaout, ou au bordj même de Motylinski. Le Père de Foucauld opposa toujours un refus obstiné. Il aimait les pauvres gens au milieu desquels il vivait depuis dix ans, et il ne voulait pas les abandonner au milieu du danger, alors qu’il estimait pouvoir leur être de quelque utilité. Il voulait les protéger, et c’est dans ce but unique, que, s’exagérant sans aucun doute les risques qu’ils couraient, il demanda des armes et fit construire un véritable petit fortin qui, en cas d’attaque, devait servir de réduit aux habitants de Tamanrasset et les aider à repousser les pillards. Eût-il été assassiné s’il n’avait eu chez lui aucune arme ?
« Quelle fut la conduite des Hoggar dans ce triste événement ? Il est possible et probable même qu’aucun des habitants présents à Tamanrasset le jour du drame n’a été au courant de la venue de la bande d’Ebeh. Il n’y avait dans le village que les harratins. Le Père de Foucauld, n’ayant aucune confiance dans le principe fondamental de la méthode senoussiste : « Guerre aux infidèles et union des croyants », craignait pour ses amis Hoggar, et il avait lui-même fait éloigner du centre les quelques imrads de la fraction des Dag-Rali qui l’habitaient en permanence ; il leur avait conseillé de demeurer dans la Koudia, en pleine montagne, avec les tentes, les femmes et les enfants.
« Beaucoup de ces pauvres gens parurent regretter leur bienfaiteur ; ils pouvaient être sincères, ne déplorassent-ils que la disparition de ses nombreux dons.
« Les meneurs de la bande des pillards assassins étaient des étrangers Azdjers, auxquels s’adjoignirent des Hoggar (Aït-Lohen) fanatiques, gagnés à la cause de la guerre sainte, habitant une région éloignée de Tamanrasset de plus de 100 kilomètres de l’autre côté du massif montagneux, et l’on ne peut s’étonner qu’ils aient pu facilement s’acquérir, en région hoggar, le concours d’un ou de plusieurs fanatiques, si nombreux dans l’Islam, parmi les hartanis, nègres au vil tempérament d’esclaves-nés.
« Rien, jusqu’à ce jour, ne laisse croire qu’un seul imrad ou noble Touareg de la région de la Koudia ait favorisé le plan des meurtriers. Toutefois l’événement est encore bien récent, et une sage prudence conseille de laisser le temps accomplir son œuvre de perquisition, avant que d’être affirmatif sur ce point…
« Au point de vue général, on peut dire qu’au moment de l’assassinat du Père de Foucauld, la totalité des cœurs Hoggar était acquise à la cause de nos ennemis, et que leur plus cher vœu était celui de notre disparition très prochaine et définitive de la région.
« Motylinski, le 11 septembre 1917.
« Le capitaine,
« Signé : DEPOMMIER[149]. »
À la suite du rapport officiel, le général Laperrine a fait écrire, sous sa dictée, une note concise et importante que voici :
« À mon avis, l’assassinat du Révérend Père de Foucauld doit se rattacher à la lettre trouvée à Agadès, dans les papiers de Kaoucen, et dans laquelle un Européen (turc ou allemand) lui conseillait, comme première mesure, avant de soulever les populations, de tuer ou de prendre comme otages les Européens connus comme ayant de l’influence sur les indigènes, et les chefs indigènes dévoués aux Français.
« Ouargla, le 30 octobre 1917.
« Pour le général Laperrine, commandant supérieur des territoires sahariens.
« P. O. Signé : BETTEMBOURG. »
Le général, causant avec le Père Nouet, des Pères Blancs, le 7 septembre 1919, a de nouveau exprimé cette conviction que l’une des causes de l’attentat du 1er décembre 1916 doit être cherchée dans la puissante influence que le Père de Foucauld exerçait sur les populations du Hoggar. Le Père Nouet résume ainsi les paroles du général :
« La Turquie, poussée par l’Allemagne, voulait faire se soulever contre nous les Touaregs d’abord, puis toutes les tribus du désert. Les agents de cette politique se rendirent compte très rapidement que leur but ne pourrait être atteint si le Père de Foucauld restait au milieu des Touaregs du nord, d’où rayonnait son influence. Ils décidèrent de s’en emparer et de le garder comme otage, mais leur résolution n’était pas, d’après le général, de le mettre à mort. Une bande fut lancée vers Tamanrasset, etc. »
En effet, il paraît tout à fait vraisemblable que, la guerre sainte étant prêchée dans toute l’Afrique française, le chef de la bande qui s’empara du Père de Foucauld ait voulu faire disparaître la cause principale qui s’opposait à la défection des Touaregs Hoggar, c’est-à-dire l’influence de ce grand personnage aimé qu’était l’ermite de Tamanrasset. Si l’on prétend que ce chef était de trop chétive espèce pour se laisser conduire par des considérations d’ordre général, et que l’appât du gain suffit pour expliquer son agression et l’acte des bandits de sa troupe, il est très facile d’admettre que les chefs principaux du mouvement insurrectionnel se servaient de ces bandits de second ordre, et les associaient à des desseins plus vastes. Il faut se persuader que le monde musulman obéit à des chefs très bien renseignés, et capables de très amples desseins.
Je dois faire plusieurs autres remarques sur ce dernier acte de la vie, la mort, à laquelle toute la vie nous prépare, si nous l’avons voulu. Le Père de Foucauld, depuis sa conversion, n’a pas cessé un jour de songer à cette heure après laquelle il n’y a plus d’heures, et qui est la suprême occasion offerte à nos repentirs et à notre puissance méritante. Il est mort le premier vendredi de décembre, jour consacré au Sacré-Cœur, et d’une manière qu’il a souhaitée, ayant toujours désiré une mort violente donnée en haine du nom chrétien, acceptée avec amour, pour le salut des infidèles de sa terre d’élection : l’Afrique. Trahi, garrotté, il a refusé de répondre aux injures comme aux questions de ceux qui l’entouraient, et n’a pas dit un seul mot, imitant, en cela encore, le modèle divin : Jesus autem tacebat. Peut-on prétendre qu’il est mort martyr, au sens exact de ce vocable, d’après la doctrine catholique ? Je dirai là-dessus ce que je sais.
Cinq semaines après l’assassinat, quand les renseignements recueillis furent apportés à In-Salah, le bruit courut que les assassins avaient enjoint au Père de Foucauld d’apostasier, en récitant la chehada c’est-à-dire la formule de prière musulmane, et qu’il avait refusé : une lettre adressée à M. de Blic, pour lui annoncer la mort de son beau-frère, en fait foi. Ni le rapport du capitaine de La Roche, ni celui du capitaine Depommier ne le mentionnent. Mais que le Père de Foucauld, pendant cette demi-heure de mauvais traitements et d’insultes qu’il a subis avant d’être tué, ait été sommé d’abjurer, cela demeure très vraisemblable, pour deux raisons : d’abord, ainsi que me l’écrit un officier saharien, parce que le contraire serait l’exception chez des musulmans, qui ne séparent jamais la mort de la chehada ; en second lieu, parce que le propos rapporté par le nègre Paul a été, par ce dernier, répété en 1921. J’ai appris, en effet, qu’interrogé de nouveau au sujet du meurtre, le serviteur du Père de Foucauld a répondu : « En ma présence, les ennemis ont simplement demandé : où est le convoi ? où sont les gens ? Après la mort de Foucauld, je les ai entendus dire, entre eux : on lui a demandé de prononcer la chehada, mais il a répondu : « Je vais mourir. » Cette dernière phrase a été dite par des Aït-Lohen dont j’ignore les noms. »
Aujourd’hui, il paraît donc probable que, selon la coutume, le Père de Foucauld a été sommé d’abjurer ; il paraît certain que l’assassinat ne suivit pas immédiatement le refus : l’arrivée des méharistes de Motylinski fut la cause déterminante de la mort. L’idée primitive était de faire prisonnier le Père de Foucauld ; l’occasion s’offre de le tuer, et on le tue, de peur qu’il ne s’échappe ou qu’on ne le délivre. Cependant la haine du chrétien ne saurait être considérée comme étrangère à ce drame, et le domestique Paul est de cet avis, puisque, dans sa déposition, il dit qu’on l’a menacé de le tuer lui aussi, comme mécréant.
Il faut remarquer encore que le Père de Foucauld, ayant construit le fortin pour que les pauvres gens du village fussent à l’abri avec lui, ne voulut jamais les abandonner, et que c’est donc de sa charité obstinée qu’il est mort.
Lorsque les gens du rezzou se furent retirés, du côté de Debnat (ouest de Fort-Motylinski), les corps des victimes ne restèrent pas longtemps abandonnés. Les harratins, n’ayant plus peur, s’approchèrent et inhumèrent les victimes dans le fossé du fortin, à quelques mètres de l’endroit où était tombé le Père de Foucauld. Le corps de celui-ci ne fut pas débarrassé des liens qui tenaient les bras attachés, mais après l’avoir déposé dans la fosse, les harratins, qui savaient que les chrétiens mettent les morts dans un cercueil, disposèrent autour du cadavre des pierres, des feuilles de papier et des fragments de caisses en bois. Puis ils murèrent la porte du fortin.
La première chose que fit le commandant du secteur du Hoggar fut de se lancer à la poursuite de la bande des Fellagas. Le rezzou fut « accroché » le 17 décembre, et perdit plusieurs hommes[150]. Ce ne fut que le 21 décembre que le capitaine de La Roche put se rendre à Tamanrasset. Il y vint accompagné d’un sergent et d’un soldat. Dès son arrivée, il alla reconnaître les tombes, fit augmenter la couche de terre qui recouvrait les corps ; sur la tombe du Père, planta une croix de bois ; puis, à ces morts pour la France, il fit rendre les honneurs militaires. Alors seulement l’officier pénétra dans l’ermitage fortifié.
« L’intérieur de la casbah avait été mis au pillage ; les bandits ont emporté tout ce qui pouvait avoir de la valeur. Le reste a été bouleversé, déchiré, brûlé en partie. Toute la bibliothèque et tous les papiers avaient été éparpillés dans la pièce qui servait de chapelle et de chambre. Ci-dessous, les divers objets retrouvés :
« Quelques objets du culte, des objets de piété, livres de piété, les quatre volumes du dictionnaire et les deux volumes de poésies ont pu être reconstitués intégralement : fournitures de bureau ; un casque colonial, une table de campement, un lit de campement, un grand thermomètre, un certain nombre de lettres écrites par le révérend Père dans la journée du 1er décembre, cachetées et timbrées, etc.[151] »
Parmi les « objets du culte » et les « objets de piété » retrouvés dans le fortin, il y avait le chapelet du saint prêtre ; un chemin de croix fait de planchettes sur lesquelles, à la plume et très finement, il avait dessiné les scènes de la Passion, une croix de bois, portant aussi l’image dessinée et très belle du corps du Christ. En remuant du pied le sol où toutes sortes d’objets avaient été jetés, le jeune officier découvrit, dans le sable, un tout petit ostensoir où paraissait être encore enfermée l’Hostie sainte. Il le ramassa avec respect, l’essuya, et l’enveloppa dans un linge. « J’étais bien ennuyé, racontait-il plus tard, car je sentais que ce n’était pas à moi de porter ainsi le Bon Dieu. » Lorsque l’heure fut venue de quitter Tamanrasset, il prit le petit ostensoir, le mit devant lui, sur la selle de son méhari, et fit ainsi les 50 kilomètres qui séparent Tamanrasset de Fort-Motylinski : ce fut, dans le Sahara, la première procession du Saint-Sacrement. Arrivé au poste, son embarras fut grand. M. de La Roche s’était souvenu en chemin d’une conversation qu’il avait eue un jour avec le Père de Foucauld. Comme il lui disait : « Vous avez la permission de garder le Saint-Sacrement ; mais, s’il vous arrivait malheur, que faudrait-il faire ? » le Père avait répondu : « Il y a deux solutions : faire un acte de contrition parfaite, et vous communier vous-même, ou bien envoyer par la poste l’Hostie consacrée aux Pères Blancs. » Il ne pouvait se résoudre à ce second parti. Ayant alors appelé un sous-officier du poste, ancien séminariste et demeuré chrétien fervent, M. de La Roche tint conseil avec lui. Il leur parut meilleur que l’un d’eux se communiât lui-même. L’officier « mit des gants blancs qui ne lui avaient jamais servi » pour ouvrir la custode de l’ostensoir, et s’assurer qu’il ne s’était pas trompé, que l’hostie y reposait. Elle était bien là, telle que le prêtre l’avait consacrée et adorée. Les deux jeunes gens se demandèrent l’un à l’autre : « est-ce vous qui la recevrez ? est-ce moi ? » Puis le sous-officier s’agenouilla, et se communia[152].
Parmi les témoignages nombreux de respect et d’admiration qui furent adressées à la famille du Père de Foucauld, obligé de choisir, je publierai seulement la lettre du chef des Touaregs Hoggar, et celles de l’évêque de Viviers.
« Lettre de Moussa ag Amastane à Mme de Blic. – Louange à Dieu unique !
« À la seigneurie de notre amie Marie, la sœur de Charles notre marabout, que les traîtres et trompeurs, les gens d’Azdjer, ont assassiné, de la part du Tebeul Moussa ag Amastane, aménokal du Hoggar. Que le salut soit beaucoup sur notre amie Marie la dénommée ! Dès que j’ai appris la mort de notre ami, votre frère Charles, mes yeux se sont fermés ; tout est sombre pour moi ; j’ai pleuré et j’ai versé beaucoup de larmes, et je suis en grand deuil. Sa mort m’a fait beaucoup de peine.
« Moi je suis loin de l’endroit où les traîtres voleurs et trompeurs l’ont tué, c’est-à-dire, ils l’ont tué en Ahaggar, et moi je suis en Adrar, mais, s’il plaît à Dieu, les gens qui ont tué le marabout, nous les tuerons jusqu’à ce que nous ayons accompli notre vengeance.
« Donnez le bonjour de ma part à vos filles, votre mari et tous vos amis, et dites-leur : Charles le marabout n’est pas mort que pour vous autres seuls, il est mort aussi pour nous tous. Que Dieu lui donne la miséricorde, et que nous nous rencontrions avec lui au paradis ! Le 20 de safar 1335 (le 13 décembre 1916)[153]. Traduit à Fort-Motylinski, le 25 décembre 1916. »
Lettre de Mgr Bonnet, évêque de Viviers, à Mme de Blic. – « Évêché de Viviers, 17 janvier 1917. – Madame, le deuil qui vous afflige m’atteint trop douloureusement pour que je m’abstienne d’unir aux vôtres mes légitimes et profonds regrets.
« J’ai le sentiment bien vif de ce que vous perdez en la personne du révérend Père de Foucauld. J’ai peu connu, dans ma longue vie, d’âmes plus aimantes, plus délicates, plus généreuses et plus ardentes que la sienne, et j’en ai rarement approché de plus saintes. Dieu l’avait tellement pénétré, qu’il débordait par tout son être en effusions de lumière et de charité.
« Vous savez mieux que moi quelle prise avaient sur son cœur et quelles ardeurs y allumaient les grandes et saintes amours de l’Église, de la patrie, de la famille ; vous savez à quel point fut héroïque son zèle pour le salut des âmes : un départ pour le ciel sera, pour les contrées dont il préparait si habilement et si courageusement le retour à la foi, un irréparable malheur, à moins que le sang qui vient de les arroser ne leur soit une semence de chrétiens.
« Je ne me consolerais pas de ce malheur qui vous frappe, si je ne songeais que votre cher et vénéré martyr est plus vivant que jamais, qu’il a cessé de souffrir, mais qu’il n’a pas cessé de nous aimer ; qu’il est plus près de ce Dieu, plus puissant sur son cœur, et qu’il l’incline vers l’Église affligée, vers la France meurtrie, vers mon diocèse qui l’implore, vers sa famille qui le pleure.
« Veuillez agréer, madame, l’hommage de mes respectueuses et bien vives condoléances.
J. M. FRÉDÉRIC,
Évêque de Viviers. »
La même année, remerciant Mme de Blic du mémento qu’il avait reçu, Mgr Bonnet écrivait cette seconde lettre, datée de la Toussaint :
« Évêché de Viviers, 1er novembre 1917.
« Cette précieuse image ne pouvait m’arriver plus opportunément que le jour où ma pensée le cherche, pour lui adresser un ardent souvenir et une fervente prière, dans l’immense légion de saints que l’Église propose aujourd’hui à notre particulière intention. Ce culte public que je lui rends aujourd’hui, d’une façon collective, je le lui rends tous les jours dans le secret de mon âme : je lui dois tant ! Il a si souvent prié efficacement pour mon diocèse et pour moi durant sa vie, et je dois taire tout ce qu’il m’a accordé de faveurs depuis qu’il est plus près de Dieu[154]. »
En décembre 1917, le grand ami du Père, le général Laperrine, passa dans le Hoggar. Quelques semaines plus tard, il écrivait, de Tombouctou, à Mme de Blic :
« Je suis passé à Tamanrasset le 9 décembre 1917. J’ai estimé que l’on avait pris trop à la lettre les dernières volontés de votre frère, disant qu’il voulait être inhumé où il tomberait, et on l’avait laissé dans la tombe provisoire faite par son serviteur Paul, dans le fossé de la maison, fossé qui avait des chances de se remplir d’eau aux premières pluies.
« À mon retour de Motylinski, le 15 décembre, je l’ai fait exhumer et inhumer sur le sommet de la colline où est son bordj, et à 200 mètres environ à l’ouest de celui-ci (cette colline est un simple mouvement de terrain, mais isolé au milieu de la plaine et se voyant de très loin). Les trois militaires indigènes tués en même temps que lui dont deux, en essayant de le délivrer, ont été la cause involontaire de sa mort, sont enterrés à ses pieds. La tombe fort simple, et sans aucune inscription, est surmontée d’une croix en bois noir, mais plus grande et plus solide que celle qui était sur la tombe du fossé. De plus, par sa position même, elle se voit de très loin.
« M. Lutaud, gouverneur général de l’Algérie, fait voter une somme pour lui élever un monument à Tamanrasset ; pour le faire sans manquer à ses dernières volontés, je compte laisser la tombe telle quelle, mais, à 5 mètres environ de la tombe, sur la crête même du mouvement de terrain, je compte faire élever une grande croix en granit du Hoggar, genre croix de mission, croix qui se verra de très loin.
« Votre frère était comme momifié lorsque nous l’avons exhumé, et l’on pouvait encore le reconnaître. Ce transfert a été bien émotionnant… »
Dans une autre lettre, adressée au Père Voillard, des Pères Blancs, le général disait[155] : « La balle entrée derrière l’oreille droite est sortie par l’œil gauche. Il a été enterré dans la position dans laquelle il a été tué : à genoux, les coudes attachés derrière le dos. Nous avons été obligés de l’enterrer dans cette position pour ne pas briser ses membres ; nous l’avons simplement enveloppé dans un linceul. »
Pendant que se faisait ce dernier ensevelissement de son ami, le général était bien ému ; il s’étonnait aussi que le corps fût demeuré sans brisure et la figure si reconnaissable, tandis que ce qui restait des Arabes enterrés près de lui n’était qu’un peu de poussière. Un des soldats indigènes lui dit alors : « Pourquoi es-tu étonné de ce qu’il est conservé ainsi, mon général ? Ce n’est pas étonnant, puisque c’était un grand marabout. »
Ces mots m’ont été rapportés par un témoin qui les a entendus.
Quand il donnait ainsi à Charles de Foucauld une sépulture définitive, et la plaçait sous le signe de la croix qui seule explique la vie et la mort de l’ermite, le général ne se doutait pas qu’il marquait la place de son propre tombeau. On sait que cet autre grand serviteur du pays, conquérant ménager du sang de la France et du sang de ses ennemis, après avoir parcouru tant de fois, à la tête de ses méharistes, le Sahara qu’il avait pacifié, fut amené à tenter la traversée de son royaume par la voie de l’air, en février 1920. L’avion, parti de Tamanrasset et qui devait le porter en peu d’heures jusque dans notre colonie du Sénégal, se perdit parmi les brumes et s’abattit dans le désert. Blessé dans la chute, ayant souffert sans se plaindre pendant de longs jours, épuisé par la soif et la faim, Laperrine mourait dans la région d’Anesbérakka, le 6 mars, et son corps, enveloppé dans les toiles de l’avion, chargé sur le dos d’un chameau, reprenait le chemin de Tamanrasset. Il fut inhumé là, près de son ami : le Père de Foucauld l’a retenu au passage.
Que sont devenus les ermitages habités par le Père en divers points du Sahara ? J’ai tâché de l’apprendre, et des témoignages me sont venus.
La « Fraternité » de Beni-Abbès a été mise sous la garde des officiers français du bureau arabe. Elle sert d’abri aux pauvres nomades qui traversent le plateau. La chapelle, sans doute, n’a plus son prêtre, qui chaque matin ordonnait au Christ d’y descendre plus inconnu qu’à Bethléem. Mais l’autel est demeuré ; les toiles où sont représentés Jésus, Marie et quelques saints, pendent aux murs ; les grosses colonnes rapprochées continuent de soutenir les soliveaux en bois de dattier et le toit de feuilles et de terre que la pluie avait un moment traversés. On a gardé le jardinier Hadj ben Ahmed, qui reçoit ses gages, de France, régulièrement. Quelques légumes poussent dans le jardin, et la palmeraie a prospéré.
À In-Salah, plus rien. Le pied-à-terre du voyageur a été recouvert par les sables, qui menacent à présent les murailles de l’enceinte, et les feront éclater au premier jour de simoun.
J’ai de mauvaises nouvelles aussi de la cabane de la Koudiat. On apprendra sans doute quelque jour que l’observatoire du Père a été détruit ; il était, au mois de mars 1920, fortement endommagé par les mulots, qui foisonnent là-haut.
Le fortin de Tamanrasset a bien tenu. La France l’occupe et le répare. Il sert de logement au lieutenant et d’abri aux bureaux du détachement de la compagnie saharienne. Les soldats cultivent le jardin ; ils y ont même semé des fleurs, qu’un voyageur de mes amis a vues épanouies en février 1920.
On peut souhaiter que ces reliques de terre et de pierre ne disparaissent pas trop vite. Mais le souvenir subsistera et s’épandra, de l’homme qui ne chercha point, comme le reste des hommes, une maison commode, défendue contre le froid, le chaud et le passant. On citera le nom de Foucauld parmi ceux des serviteurs de Dieu ; il sera exalté dans les communautés chrétiennes qui ne manqueront pas de se lever au sein de l’Islam. Des Kabyles, des Arabes, des noirs, des Hindous, l’âme ouverte à la vérité, et voyant de quel prix leur rançon fut payée, se rappelleront les apôtres qui ont travaillé pour eux dans la pauvreté, l’obscurité, l’extrême indigence de consolation. Puissent des missionnaires nouveaux hâter l’œuvre d’évangélisation préparée par le cardinal Lavigerie, par les Pères Blancs, par le grand moine fraternel Charles de Foucauld, envoyé à l’Afrique en signe de miséricorde, et comme l’annonce du salut qui va venir pour elle.
Seigneur Jésus-Christ, mêlé à nous, mêlez-vous à cette foule de peuples et de tribus qui dépendent de nous. Seul remède à la mort, Dieu vivant, amenez à vous les âmes des musulmans, depuis si longtemps abandonnées à l’erreur. Et, pour cela, touchez d’abord quelques cœurs de notre France, par essence missionnaire, mère encore incertaine et trop peu tendre de millions de sujets africains ou asiatiques. Votre serviteur Charles de Foucauld a montré la route : il a supporté leur orgueil, leur dureté, leur trahison parfois ; il vous a pour eux tant supplié ; il a été le moine sans monastère, le maître sans disciple, le pénitent que soutenait, dans la solitude, l’espoir d’un temps qu’il ne devait pas voir. Il est mort à la peine. À cause de lui, ayez pitié d’eux ! Faites part de vos richesses aux pauvres de l’Islam, et pardonnez leur trop longue avarice aux nations baptisées !
APPENDICE
ASSOCIATION – POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ESPRIT – MISSIONNAIRE, SURTOUT EN FAVEUR DES – COLONIES FRANÇAISES[156]
Fonder cette Association fut une des pensées constantes du Père de Foucauld. « Après la paix ,écrivait-il à l’un de ses amis[157], je ferai tout mon possible pour l’établissement définitif de notre Union, allant où il faudra et restant en France autant qu’il le faudra. Que la volonté de Jésus se fasse en cela et en tout ! »
Les statuts de cette Union, rédigés en 1909, ont été abrégés et simplifiés en 1913 et en 1916. Ils s’inspirent de deux idées essentielles. La première est qu’il faut faire aujourd’hui un vigoureux effort d’évangélisation des infidèles, et qu’il y a une grande négligence chez les chrétiens à l’égard de ce devoir primordial, notamment chez nous, Français, qui n’avons pas encore travaillé à l’évangélisation « de nos frères musulmans, sujets de la France ». La seconde, qui donne à l’Association sa caractéristique, c’est que ce dur travail ne s’accomplira pas si l’on cherche seulement à obtenir des aumônes et quelques prières. On doit encore demander, du plus grand nombre possible des catholiques, une préoccupation constante des infidèles, un « esprit missionnaire ». Ils y parviendront par une vie sérieusement chrétienne, qui maintiendra cette pensée et la fera passer en action. Le moyen pratique d’arriver à ce christianisme sincère, profond et actif, c’est de s’astreindre à l’observance d’une règle et de s’organiser en association.
La pensée du Père de Foucauld s’étendait à tous les infidèles. Par conséquent, selon lui, chaque mère patrie devrait être appelée à constituer une Union semblable pour les infidèles de ses colonies, qui ne peuvent ordinairement parvenir à la connaissance de la vraie religion que par l’intermédiaire des peuples chrétiens dont ils dépendent.
Il n’y a guère de plus large idée, ni de plus fraternelle, ni de plus pressante. Approuvée d’abord en 1909 par Mgr Bonnet, évêque de Viviers, et par Mgr Livinhac, supérieur général des Pères Blancs, puis par le cardinal Amette en 1919, l’Association a reçu des adhésions individuelles et des adhésions collectives, de personnes ou de communautés. Dès qu’elle sera connue, elle attirera sans doute bien des cœurs[158]. Elle est digne de réussir par son ampleur, par sa générosité, par l’aide même qu’elle fournit au clergé et aux fidèles, en proposant une règle de vie, une discipline, orientée vers l’apostolat sous toutes ses formes. C’est le legs unique, le dernier conseil du Père de Foucauld à ses amis.
SOURCES CONSULTÉES
I. – ŒUVRES DE CHARLES
DE FOUCAULD »
1°Publications scientifiques :
Vicomte Ch. DE FOUCAULD : Reconnaissance au Maroc XVI. 495 pages avec 4 photogravures et 101 dessins. Paris, Challamel, 1888.
Atlas (20 feuilles au 1 : 250 000), idem.
« Itinéraires au Maroc », ap. Bulletin de la Société de géographie de Paris, 1887.
[Le Père DE FOUCAULD] [159] : Édition révisée de l’essai de grammaire touareg de Motylinski, Alger, 1908.
Le Père DE FOUCAULD : Dictionnaire abrégé touareg-français (dialecte ahaggar), publication posthume, par les soins du gouvernement général de l’Algérie, 2 vol., Alger, 1918-1921.
M. René Basset a énuméré, dans la préface de cette publication, p. VI-VII, les quatre manuscrits de philologie berbère laissés par le Père de Foucauld, et dont le gouvernement général de l’Algérie a également entrepris la publication ; le troisième, un Essai de grammaire, vient de paraître.
2°Opuscules religieux manuscrits :
Essai pour tenir compagnie à Jésus (5 cahiers mss.).
Règle, constitutions, règlements de petits Frères et petites Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus : en deux rédactions, 1899 et 1909.
Méditations sur l’Évangile.
L’Évangile présenté aux pauvres du Sahara.
30 Documents personnels :
Pièces d’identité ; pouvoirs ecclésiastiques.
Retraite faite à Nazareth en 1897 (4 cahiers).
Notes spirituelles (4 cahiers).
Retraite à Ephrem, carême 1898 (2 cahiers).
Retraites à Beni-Abbès, 1902 et 1904.
Carnet diaire : 28 octobre 1901 au 21 juillet 1905.
Carnet diaire : suite jusqu’à sa mort.
Carnets de souvenirs d’événements importants : vœux, résolutions, etc., etc.
Carnets d’adresses.
Liste d’aumônes.
4°Correspondance :
Lettres au R. P. Guérin, préfet apostolique du Sahara 1901-1910.
Lettres au R. P. Voillard, assistant général des Pères Blancs
Lettres à S. G. Mgr Livinhac, évêque de Pacando.
Lettres à S. G. Mgr Bonnet, évêque de Viviers.
Lettres de direction de M. l’abbé Huvelin.
Lettres au commandant Lacroix (comm. par Mme Lacroix).
Lettres au général Laperrine (comm. par Mme Peigné).
Lettres à M. et Mme de Blic (1884-1916).
Lettres à la marquise de Foucauld de Lardimalie.
Lettres au comte Louis de Foucauld.
Lettres à M. l’abbé Laurain, etc.
Registre de toutes les lettres écrites de 1906 à 1916.
II. – NOTICES
BIOGRAPHIQUES ET NÉCROLOGIQUES.
Vie d’Armand de Foucauld de Pontbriand (1751-1792). Paris, Oudin, 1902.
Clarisses de Nazareth. Manuscrit : souvenirs du séjour du Père de Foucauld à Nazareth.
Clarisses de Jérusalem. Manuscrit : lettres sur le séjour du Frère Charles de Jésus à Jérusalem.
Abbé Max CARON, supérieur au Petit Séminaire de Versailles : Au Pays de Jésus adolescent. Paris, Haton, 1905, chap. VII.
Abbé Crozier, Un apôtre au Sahara (ap. Union apostolique universelle, Lyon, 1914, p. 1-10).
Vie de dom Polycarpe, premier abbé de Notre-Dame-des-Neiges.
Abbé GILLES, Dom Martin, deuxième abbé de Notre-Dame des-Neiges. Paris, Gabalda, 1912.
Récit du Frère MICHEL : document pour la vie du Père de Foucauld.
Extraits des rapports de tournées du capitaine chef de l’annexe d’In-Salah, commandant la compagnie saharienne du Tidikelt (1905, Ahnet, Adrar, Air).
Notes du major Robert HÉRISSON, 1909-1910 (Sahara).
Journal du docteur Vermale, 1914-1915 (Sahara).
[Général LAPERRINE] : « Les étapes de la conversion d’un houzard, ap. Revue de cavalerie, Paris, octobre 1913.
Rapports officiels sur la mort du Père de Foucauld, communiqués par le gouvernement général de l’Algérie.
Augustin BERNARD, Un saint français, le Père de Foucauld, Paris, Plon, 1917. – « Un héros français, le Père de Foucauld » (Je sais tout, 15 novembre 1917).
Jean LEFRANC : « Le Père de Foucauld » (Illustration, 20 janvier 1917).
Capitaine R. DE SEGONZAC : « La mort du Père de Foucauld » (Afrique française, janvier-février 1917).
E. -F. GAUTIER : « Deux Algériens » (Revue de Paris, 15 septembre 1919).
René BASSET : « L’œuvre du Père de Foucauld » (Afrique française, mars 1917).
R. CHUDEAU : « Le Père de Foucauld » (Annales de géographie, 15 janvier 1917).
L. MASSIGNON : « Charles de Foucauld » (France-Maroc, 15 mars 1917 ; cf. The Moslem world, Londres, 1915, p. 139-142)
Abbé A. JAUFFRÈS : « Le R. P. Charles de Foucauld », ap. Semaine religieuse de Viviers, 1917.
Le Père Charles de Jésus, vicomte de Foucauld, Maison-Carrée, 1918.
III. – OUVRAGES ET
ARTICLES RELATIFS AUX QUESTIONS ACTUELLES, AFRICAINES ET SAHARIENNES.
Augustin BERNARD et N. LACROIX : la Pénétration saharienne Alger, 1906.
Augustin BERNARD, le Maroc, Paris, Alcan, 1916.
R. CHUDEAU : le Sahara soudanais (t. II des Missions au Sahara, par GAUTIER et CHUDEAU), Paris, Colin.
DE LA MARTINIÈRE et LACROIX : Documents pour servir à l’étude du nord-ouest africain, t. II, gouvernement général de l’Algérie, 1896.
Henri BASSET : Essai sur la littérature des Berbères, Alger, Carbonel, 1920.
Lieutenant Maurice CORTIER : D’une rive à l’autre du Sahara, Paris, Laroge, 1908.
Bulletin de la Société de géographie et d’archéologie d’Oran décembre 1906.
Mgr Maurice LANDRIEUX : L’Islam, Paris, Lethielleux, 1912.
E. -F. GAUTIER : la Conquête du Sahara, Paris, Colin.
Général HANOTEAU : Essai de grammaire de la langue tamachek Paris, Challamel, 1896 (réédition). (Ouvrage classique, et que Charles de Foucauld prenait pour guide, dans ses propres travaux de grammaire).
C. Snouck HURGRONJE : Politique musulmane de la Hollande, Paris, Leroux, 1911.
JULES CAMBON. Le gouvernement général de l’Algérie, 1891-1897, Paris Éd. Champion ; Alger, Jourdan, 1918.
Un Africain : Qu’est-ce que la politique musulmane (ap. la Renaissance, 11 décembre 1920).
Louis ROUQUETTE : Les Espagnols à Chechaouen (ap. France-Maroc, décembre 1920).
Le siège de Djanet, rapport du maréchal des logis Lapierre (communiqué par le gouvernement général de l’Algérie).
Commandant E. GRAULLE, ancien chef de bureau arabe ; Insurrection de Bou-Amama, Paris, Lavauzelle, 1905.
Amédée BRITSCH : Une étape du général Lyautey, Aïn-Sefra (1903-1905) (ap. Correspondant, 25 juin 1920).
Édouard CAT : Biographies algériennes, Mustapha, impr. de l’Algérie nouvelle.
FROMENTIN : Un été dans le Sahel.
Ernest PSICHARI : les Voix qui crient dans le désert, préface du général Mangin, Paris, Conard, 1920.
Mgr BAUDRILLART, l’Enseignement catholique dans la France contemporaine, Paris, Bloud, 1910.
Notices sur le général Laperrine :
Capitaine R. DE SEGONZAC : Nos morts : Le général Laperrine (Afrique française, 1er avril 1920).
Un Saharien : Le général Laperrine (Afrique française, 1920).
La mort du général Laperrine, rapport du mécanicien Marcel Vaslin (Illustration, 3 juillet 1920).
ASKRI : « Le général Laperrine et la défense du Sahara (Correspondant, 20 juin 1920).
FIN
À propos de cette édition électronique
Texte libre de droits.
Corrections, édition, conversion informatique et publication par le groupe :
Ebooks libres et gratuits
http://fr.groups.yahoo.com/group/ebooksgratuits
Adresse du site web du groupe :
http://www.ebooksgratuits.com/
—
Février 2009
—
– Élaboration de ce livre électronique :
Ce livre électronique est le fruit de la collaboration de l’Association des amis de René Bazin (qui a fait l’essentiel du travail de correction et relecture) http://www.renebazin.org et de Ebooks libres et gratuits. Ont participé à l’élaboration de ce livre :
Pour l’Association des amis de René Bazin, ARB, BM, DAM, IDR, PHRB, PSG, RRB.
Pour Ebooks libres et gratuits, Jean-Marc, Coolmicro et Fred.
– Dispositions :
Les livres que nous mettons à votre disposition, sont des textes libres de droits, que vous pouvez utiliser librement, à une fin non commerciale et non professionnelle. Tout lien vers notre site est bienvenu…
– Qualité :
Les textes sont livrés tels quels sans garantie de leur intégrité parfaite par rapport à l'original. Nous rappelons que c'est un travail d'amateurs non rétribués et que nous essayons de promouvoir la culture littéraire avec de maigres moyens.
Votre aide est la bienvenue !
VOUS POUVEZ NOUS AIDER À FAIRE CONNAÎTRE CES CLASSIQUES LITTÉRAIRES.