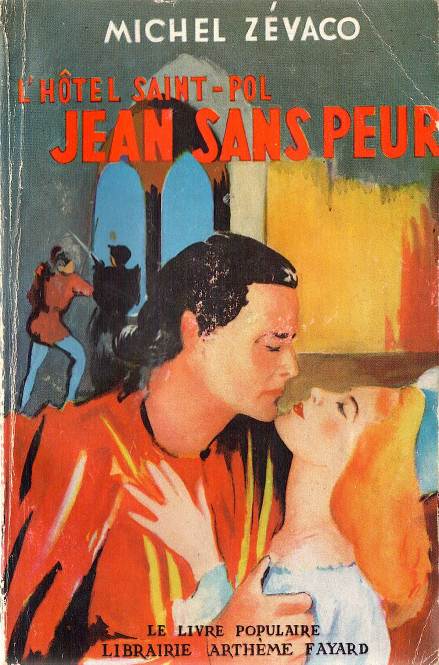
Michel Zévaco
JEAN SANS PEUR
Paru en 147 feuilletons dans Le matin, 24 avril – 18 septembre 1909
Table des matières
III LE MORT VIENT CHERCHER SA PLACE
VII COMMENT FUT DÉCRÉTÉE LA GUERRE CIVILE
IX L’ERMITAGE DE BRUSCAILLE ET Cie
XI SURPRISE DE THIBAUD LE POINGRE
XIV TRISTE AVENTURE DU SIRE DE BOIS-REDON
XV LES MYSTÈRES DU GRAND ŒUVRE
À propos de cette édition électronique
I – VOYAGE DE PASSAVANT[1]
Le chevalier de Passavant s’était donc arrêté hors des murs de Paris, en proie à un découragement qui brisait en lui tout ressort vital. Avec sa manière d’envisager choses et gens d’une façon absolue, avec son peu de connaissance de la vraie vie qui fait les événements et les êtres en demi-teinte, il s’exagérait la catastrophe.
Il n’y a qu’une chose au monde qui ne s’arrange pas : c’est la mort. Tout le reste se raccommode, se rapetasse, se replâtre, car la pensée humaine tient essentiellement à trouver un gîte, et il n’y a pas d’effort dont elle ne soit capable pour s’accommoder même d’un taudis. Quand tout craque dans notre âme, quand notre pensée se trouve expulsée des palais qu’elle s’était bâtie, elle consent des concessions, et s’accommode d’une chaumière. Passavant ne savait pas cela. Que savait-il d’ailleurs ? Pas grand’chose, et il était bien heureux de ne rien savoir.
Donc, d’avoir manqué le rendez-vous du roi, ce lui était une catastrophe. Il se trouvait déshonoré. Il ne savait pas que, même n’eût-il pas eu les prétextes légitimes qu’il pouvait présenter, Odette, s’il l’eût rejointe, lui eût pardonné d’un regard.
Passavant résolut donc de rentrer dans Paris.
Il remonta sur sa bête et résolument tourna le dos à Paris, se dirigeant au nord.
Il en est ainsi des résolutions les plus formelles de l’homme que mène une passion ; lecteurs, vous êtes doubles. Regardez-vous et vous surprendrez souvent ce phénomène.
Passavant se mit en selle en disant : « Je n’ai pas une maille. Je suis accusé d’un meurtre horrible. Je suis poursuivi par la vengeance de la reine, de Jean de Bourgogne, de ses enragés estafiers. Je suis méprisé par le roi qui m’a sauvé, par cette belle demoiselle qui a eu confiance en moi. Eh bien ! je rentre à Paris pour me faire tuer. »
En même temps, il prenait la route de Dammartin.
Passavant évita de se donner à lui-même des explications sur ce non-sens apparent qui était au fond d’une irréprochable logique.
À Dammartin, il éprouva qu’en s’assurant à lui-même qu’il n’avait pas une maille il avait proféré une cruelle vérité. Ceci lui fut durement affirmé par les tiraillements de son estomac. Il avait faim.
Il s’arrêta devant le perron de l’auberge de Saint-Éloi. Il reniflait les bonnes odeurs qui s’en échappaient et contemplait assez piteusement la jolie fille qui, accotée à la porte, le considérait avec une sympathie aussi peu déguisée que possible. Voyant que le chevalier ne disait mot, elle attaqua :
– C’est ici la meilleure auberge du pays, mon beau capitaine. Que cherchez-vous donc ?
– La route de Villers-Cotterets, dit Passavant à tout hasard.
– Ah ! fit-elle. C’est par là. – Et elle allongea le bras. – Mais vous ne pouvez pourtant pas aller jusqu’à Villers-Cotterets sans dîner ?
– C’est bien ce que je me disais, ma jolie fille. Mais…
Il mit pied à terre et sembla considérer attentivement l’image du bienheureux Éloi qui se balançait au souffle aigre de la bise. Il faisait froid. Par la porte ouverte, il voyait la claire flambée qui lui faisait signe. Il avait le cœur meurtri. Les beaux yeux de la cabaretière lui promettaient le baume consolateur. Que vouliez-vous qu’il fît ? Ce que vous auriez fait à sa place : il entra, tandis qu’un adolescent joufflu conduisait son cheval à l’écurie. Avant même que de se reconnaître, le chevalier se trouva attablé près de la grande cheminée. Il se sentit envahi par le bien-être. Il obéit d’autant mieux au besoin de ne penser à rien que, bientôt, la jolie fille plaçait devant lui la riche omelette qu’elle venait de faire sauter ; riche, disons-nous, de couleur et de parfum, ce qui est une richesse comme une autre. Le quartier de venaison qui suivit fut accueilli par le chevalier avec la gratitude d’un estomac qui crie au secours. Les champignons frais cueillis dans les bois d’alentours et sautés dans la poêle parmi de menues échalotes, du thym et du romarin lui parurent une escorte digne de la belle tranche de chevreuil également empruntée aux domaines forestiers. Un flacon de vin gris aida le chevalier à voir la vie un peu moins cruelle. Une idée qui lui passa tout à coup par la tête acheva de lui rendre toute sa belle humeur. La voici dans sa simplicité :
– Que fait cette agrafe d’argent qui attache le ruban de mon chaperon ? Ne puis-je m’en passer ? Au diable les rubans du chaperon et l’agrafe d’argent ! Holà, ma jolie fille, écoutez-moi. Je n’ai pas le moindre denier. Bon… Ne vous rembrunissez pas, et continuez-moi, je vous prie, votre clair regard qui me réconforte. Au lieu d’écus, voulez-vous accepter cette agrafe pour prix de mon dîner et du dîner de mon cheval ?
La cabaretière examina l’agrafe. Elle se trouvait, par hasard, assez honnête – nous parlons de la cabaretière – et elle dit :
– Pour le prix de cette agrafe, mon gentilhomme, vous avez droit, vous et votre bête, à un autre dîner pareil à celui que vous venez de faire.
– Eh bien ! s’écria joyeusement le chevalier, mettez dans l’une de mes fontes une bonne mesure d’avoine, dans l’autre un pâté, du pain, un flacon… et nous serons quittes.
– Tout cela va être fait, mon capitaine.
Une demi-heure plus tard, Passavant se remit en route. La jolie fille de l’auberge vint lui offrir le coup de l’étrier, les yeux baissés, un sourire au coin des lèvres.
Lorsqu’il atteignit Villers-Cotterets, l’auberge du bienheureux Éloi s’était abolie dans ses souvenirs. Il ne s’arrêta pas dans cette ville où jadis Roselys avait été exposée sous le porche de l’église, et sur une indication qu’on lui donna, continua son chemin vers le château féodal que le duc d’Orléans venait de terminer et où le roi de France avait cherché un refuge – du moins il le croyait.
Il faisait sombre. Le ciel noir était plein de neiges en réserve. Il faisait froid. Sous ses gants de daim, le chevalier se sentait l’onglée. Il faisait triste. Son cœur cherchait la vie, et il ne voyait autour de lui que l’image de la mort.
Tandis qu’il songeait ainsi, les rênes sur l’encolure, il lui arriva ce qui arrive à tout cavalier qui perd son temps à songer : il s’égara.
Le cheval grimpait une côte raide, et arriva enfin sur un large plateau où s’érigeaient, comme les colonnes d’une cathédrale, des hêtres centenaires dépouillés de leurs feuillages. Seuls, çà et là, quelques chênes se couronnaient encore de feuilles teintées de pourpre. Passavant s’arrêta près d’un tas de bois que des bûcherons rangeaient proprement.
– Où suis-je ? demanda-t-il.
– Sur le Voliard, répondit l’un des bûcherons.
– Et où se trouve ce Voliard ? Est-ce loin du château du sire d’Orléans ?
– Regardez par ici, dit l’homme, un vieillard sec et maigre – et si vous avez de bons yeux, vous apercevrez dans la brume du soir le haut des tours de guet.
Passavant regarda dans la direction indiquée, et, en effet, au fond d’une nuée de brume, distingua la silhouette fantômale du colosse aux pierres blanches, alors toutes neuves.
Il mit pied à terre.
– Gentilhomme, dit le bûcheron, voici la nuit qui vient, et la pluie va tomber. Voulez-vous accepter l’hospitalité dans notre chaumière ?
Passavant secoua la tête. Machinalement il fouilla dans sa plate escarcelle, et rougit – car déjà le digne bûcheron tendait la main pour avoir le prix de son offre d’hospitalité.
– Bûcheron, dit Passavant, je suis un pauvre chevalier, et ne puis reconnaître aujourd’hui votre générosité. Ce sera pour plus tard.
– Pour quand vous voudrez, dit le bûcheron paisible, c’était de bon cœur.
Un geste remercia. Les bûcherons s’éloignèrent. Le chevalier demeura seul sur le plateau du Voliard, sous les immenses arcades de la cathédrale que la nature avait bâtie là. Il s’était tourné vers la silhouette que là-bas, au fond de la vallée, sur la colline abrupte, près du grand étang, traçaient les tours. Bientôt, elles se fondirent dans l’obscurité. Passavant ne vit plus rien que la nuit.
– Elle est là, songea-t-il.
Un hennissement de son cheval le ramena à la vie. Il s’aperçut alors qu’il grelottait. Il faisait froid. La nuit était sombre. Selon la prédiction du vieux bûcheron aux yeux clairs, ce n’était pas de la neige qui tombait, mais une pluie pénétrante. Passavant conduisit la bête sous un fourré, la dessella, étala la couverture sur les reins, et plaça sous son nez la musette remplie d’avoine.
– Eh ! fit-il en caressant le cheval au front, te voilà guéri, mon brave ! Le coup de l’Écorcheur fut rude, mais tous deux nous avons la peau dure. Et puis, ne disons pas de mal des Écorcheurs !
Le cheval mâchait déjà son avoine, et Passavant l’enviait.
Il regarda autour de lui et aperçut une fumée qui, lente et droite, montait du sol. S’étant approché, il vit que c’était le reste d’un feu que les bûcherons avaient allumé. Il écarta les cendres, plaça des bois, souffla, et bientôt une belle flamme claire monta dans la nuit.
Passavant fouilla dans la fonte qui lui était réservée, trouva le pâté, le pain et le flacon promis par la cabaretière de Dammartin, – et sous ces provisions… l’agrafe d’argent !
La jolie fille n’avait pas voulu être payée par le pauvre chevalier !
Et devant la haute flamme claire qui montait dans la nuit, dans le vaste silence qui pesait sur le plateau du Voliard, tout seul, loin des hommes, loin de tout, sous la pluie, il commença son dîner…
Accoté à un hêtre énorme, assis sur une « tronce », couvert de son ample manteau de cavalier qui eût défié le déluge, Passavant, son appétit satisfait, allongea les jambes vers le feu, et s’endormit.
Les frissons du matin éveillèrent Passavant.
Il se secoua et jeta un singulier regard vers le château. Sans doute la résolution lui était venue pendant son sommeil, car elle vient comme elle peut, quand elle peut. Il sella son cheval, et, le conduisant par la bride passée à son bras, se mit à descendre les pentes abruptes du Voliard. Il longea quelques chaumières assises au bord de l’étang promu aujourd’hui par les habitants à la dignité de lac, et arriva à une pauvre auberge où il laissa sa monture.
Passavant monta au château. Le pont était baissé. Le chevalier le franchit sans obstacle. Rien n’indiquait que l’on se préparât dans la forteresse à un acte d’attaque ou de défense. Tout parut au chevalier paisible et inoffensif. Seulement, lorsqu’il se présenta à la deuxième enceinte, il fut arrêté par un poste d’arbalétriers aux armes du comte d’Armagnac. Sur la porte grande ouverte, il apercevait la cour avec sa galerie gothique, son escalier au fond, ses gargouilles, monstres de pierre qui descendaient le long des murs, la gueule ouverte. Plus de trois cents gentilshommes et hommes d’armes allaient et venaient. L’aspect paisible disparaissait. Un petit nombre de ces gens portaient les insignes d’Orléans. Presque tous arboraient l’écharpe blanche, insigne adopté par le comte d’Armagnac. Un officier d’arbalétrier qui commandait la porte voyant ce jeune gentilhomme arrêté là, s’avança et lui demanda poliment ce qu’il cherchait.
– Je désire parler au roi, dit Passavant. Est-ce possible ?
– Au roi ? Vous riez, monsieur, et ce n’est guère le jour. Le roi est en son hôtel.
– Quoi ! Le roi est à l’Hôtel Saint-Pol ! Il n’est pas venu ici dans une litière avec la demoiselle de Champdivers, et une forte escorte commandée par son capitaine ?
– Monsieur, dit l’officier, il n’y a ici qu’une noble veuve qui pleure un époux lâchement assassiné, et ses gentilshommes qui se concertent pour tirer vengeance de ce meurtre. Ainsi, retirez-vous. Mais… se reprit-il, soudain frappé d’un soupçon.
– Mais quoi ? fit Passavant à qui la politesse rocailleuse de l’officier commençait à échauffer les oreilles.
– Serait-ce un espion de Bourgogne ? se disait l’homme d’armes.
– Monsieur, reprenait le chevalier, frappé de son côté d’une idée subite, pourrais-je obtenir une audience de la dame d’Orléans ? Au sujet du meurtre de son noble époux, je puis peut-être lui donner des indications précieuses.
En apprenant que ni le roi ni Odette n’étaient venus au château du duc d’Orléans, le chevalier était demeuré tout étourdi – un peu de déception et aussi un peu de la joie de savoir qu’un autre n’avait pas escorté la dame de ses pensées. Brusquement, les paroles de l’officier l’arrachèrent à ces regrets et au plan qu’il formait de reprendre à l’instant le chemin de Paris.
Il songea que la veuve allait crier vengeance. Il songea que le duc d’Orléans l’avait sauvé. Il songea enfin que lui, Passavant, était publiquement accusé d’être le meurtrier, que Valentine de Milan allait maudire son nom – et il résolut de se disculper.
Quant à l’officier d’Armagnac, il regarda attentivement ce gentilhomme qui demandait à être introduit auprès de la veuve. Il lui trouva bonne mine. Sa sympathie s’éveilla.
– Monsieur, dit-il, si ce que vous dites est vrai, ce dont Dieu me garde de douter, vous aurez rendu un signalé service à Monseigneur d’Armagnac. Auriez-vous, d’aventure, entendu parler de Passavant ?
– Mieux, dit le chevalier, je le connais.
– Oh ! Oh ! Et sauriez-vous où il se trouve ?
– Je le sais.
– Venez !
Le chevalier, avec un sourire rêveur, suivit son introducteur qui le conduisit aux luxueux appartements de la châtelaine. Comme ils passaient devant une porte, Passavant entendit une rumeur pareille au lointain grondement du tonnerre.
– Qu’est ceci ? demanda-t-il.
– C’est la salle des Preuses. Deux mille hommes d’armes y sont réunis en ce moment, sans compter qu’il y en a autant dans la salle des Gardes. Mais, venez.
On arriva à l’entrée des appartements. L’officier fit signe à Passavant d’attendre, puis, revenant le chercher, l’introduisit dans une belle chambre.
– Monsieur, dit-il au moment, d’ouvrir la porte, je m’appelle Hélion de Lignac. Voulez-vous me dire qui je dois annoncer ?
– Le chevalier Hardy de Passavant.
Et Passavant ouvrit lui-même la porte, laissant Hélion de Lignac stupéfait. Il faut dire qu’il ne craignait rien pour Valentine de Milan près de qui se trouvaient huit ou dix gentilshommes de sa maison. Mais tout étourdi de l’inconcevable audace de l’assassin, il se dirigea précipitamment vers la salle des Preuses. Là, comme l’avait dit Hélion de Lignac, deux mille gentilshommes et gens d’armes étaient assemblés, tout harnachés en guerre, ce qui fait qu’à chaque houle de cette foule, des cliquetis d’armures se propageaient comme la rumeur d’un océan fait de flots d’acier. C’était un terrible spectacle. Ces gens écoutaient un homme qui, debout sur une table, parlait d’une voix calme et rude, sans gestes. Il était étincelant d’acier. De sa personne, on ne voyait que la tête brune, violente, avec un regard d’aigle. C’était le sire de Coucy, l’un des plus fermes alliés d’Armagnac.
– L’insolence des gens de Bourgogne est au comble, disait-il froidement. La gentilhommerie française est perdue si elle ne s’oppose par tous les moyens à leurs empiétements. Leur duc, soutenu par la reine et abusant de la faiblesse du roi régnant, ne cache plus son intention de dominer Paris et de rançonner la noblesse de France. Le tolérerez-vous ?
Ce fut une clameur sourde faite de cris, de trépignements, d’invectives. Puis le terrible refrain éclata en coup de tonnerre : Vengeance ! Vengeance !
– Certes, vengeance, reprenait le sire de Coucy de sa voix mordante. Vous le savez, tout porte à croire que Jean de Bourgogne a inspiré le meurtre de ce valeureux prince qui était notre véritable chef. On pouvait de bonne foi l’appeler le premier gentilhomme du royaume. Il est tombé la nuit, dans une rue perdue, sous les coups de meurtriers qu’on ne retrouvera pas. Mais le vrai meurtrier, vous le connaissez.
– Vengeance ! Vengeance ! roula longuement le tonnerre.
Hélion de Lignac, fendant péniblement la foule, se dirigeait vers le sire de Coucy…
Passavant, étant entré dans la chambre des seigneurs du château, vit une femme en grand deuil assise dans un fauteuil, tandis que quelques gentilshommes se tenaient à distance respectueuse… La pauvre Valentine ne pleurait pas parce qu’elle n’avait plus de larmes. Ce mari volage qui ne lui avait guère donné que des chagrins, elle l’avait adoré, chaste amante qui avait entrepris vainement d’éveiller le sens de fidélité dans un cœur dont la raison d’être était l’infidélité. Elle avait aimé le duc de toute son âme. Avec lui s’éteignait la lumière de sa vie, et lorsque Passavant s’approcha, il l’entendit murmurer ces paroles qu’elle devait une fois encore répéter à son lit de mort.
– Rien ne m’est plus, plus ne m’est rien.
Passavant s’arrêta devant la duchesse, et, avec cette grâce ingénue qui était chez lui d’un charme irrésistible, ploya le genou.
– Qui êtes-vous, monsieur ? dit tristement la malheureuse princesse.
– Madame, vous voyez en moi un gentilhomme que le seigneur d’Orléans a sauvé de la mort…
Valentine se sentit émue au fond de son cœur, et de l’accent de ce beau chevalier, et de l’hommage que, dès les premiers mots, il rendait à son cher mort.
– Expliquez-vous, dit-elle doucement.
– Un soir, madame, je dus tirer l’épée contre quatre déloyaux gentilshommes.
– À vous seul, vous attaquiez quatre hommes d’épée ? dit la comtesse étonnée.
– Madame, c’est qu’à eux quatre ils attaquaient une femme.
La duchesse d’Orléans ne put s’empêcher de jeter un regard de sympathie sur celui qui, avec une si belle simplicité, lui faisait une telle réponse.
– Continuez, reprit-elle, captivée.
– Ces quatre, donc, poursuivit Passavant avec un sourire qui se fit narquois, ces quatre jugèrent qu’ils n’étaient pas assez de quatre, et appelèrent à la rescousse je ne sais combien des leurs qui tentèrent les uns de m’ouvrir la poitrine, les autres de m’assommer. J’allais sûrement succomber. C’est à ce moment que parut votre noble époux. Il fit un geste. Je fus sauvé. C’était le geste d’un brave, madame, car il s’adressait à des gens qui appartenaient à son plus cruel ennemi. C’est peut-être ce geste qui l’a tué…
– Ô mon cher duc, murmura Valentine, si vaillant, si brave… Continuez, monsieur…
– Je fis vœu, madame, de chercher une occasion où je pourrais offrir ma vie soit à mon sauveur, soit à ceux qui lui étaient chers. Je suis arrivé trop tard rue Barbette, mais cette épée qui eût dû le défendre, c’est à vous, maintenant qu’il n’est plus, d’en disposer.
Valentine, le sein oppressé, l’angoisse à la gorge, écoutait cet hommage qui lui était fait, et elle en éprouvait une bienfaisante émotion.
– Merci, monsieur, dit-elle avec attendrissement. Mais pourquoi vous trouviez-vous attaqué ? Vous semblez bien jeune encore pour vous être attiré des ennemis capables de vouloir votre mort.
– Jeune, madame ? fit le chevalier avec une mélancolie sous laquelle on eût démêlé quelque scepticisme. Oui, sans doute… Et plus encore que vous ne croyez. J’ai bien peu vécu, madame, et ce m’était une raison de plus grande gratitude envers le seigneur d’Orléans qui me conservait la vie. Je dis que j’ai peu vécu, car j’ai passé douze ans de ma courte existence au fond d’un cachot.
– Au fond d’un cachot ! Si jeune ! Et qu’aviez-vous fait ?
– Je l’ignore, madame. C’est seulement pour vous dire que connaissant si peu la vie, elle ne m’en était que plus précieuse à conserver. Ce qu’il était juste et nécessaire que vous sachiez, c’est que ma reconnaissance pour votre noble époux n’était égalée que par une gratitude envers Sa Majesté la reine Isabeau.
Sur ces mots, Passavant se releva.
Il allait se nommer et protester contre l’abominable accusation inventée de toutes pièces par les Bourguignons. Mais ce nom d’Isabeau ainsi jeté tout à coup avait amené un nuage sur le front de la duchesse d’Orléans.
– La reine ! fit-elle sourdement. Vous aurait-elle sauvé, elle aussi ?
– Non, madame, dit simplement le chevalier, elle a fait mieux.
– Qu’a-t-elle fait ? Voyons !
– Madame, voici pourquoi, si la reine Isabeau me demande ma vie, je la lui donnerais d’aussi bon cœur que je vous la donnerais à vous, si vous me la demandiez. Au mois de juin de l’an 1395, une petite fille de cinq à six ans fut arrachée à sa mère par les mêmes gens qui me jetèrent, moi, dans les fosses de la tour Huidelonne.
Les derniers mots firent frissonner Valentine. Mais peut-être une étrange pensée venait-elle de se lever en elle, car elle jeta un regard pensif au chevalier et demanda :
– Vous dites au mois de juin de l’an 1395 ?
– Oui, madame. L’enfant s’appelait Roselys. La mère s’appelait Laurence d’Ambrun. C’était toute ma famille, madame. J’aimais Laurence comme une sœur. Quant à Roselys, dit-il d’une voix étranglée, elle était ma vie… et même maintenant.
Il s’interrompit brusquement. Quant à Valentine, elle suivait ce récit avec une attention passionnée.
– Roselys fut emportée vers le Nord dans les pays du Valois, m’a-t-on assuré, à Villers-Cotterets, peut-être…
– Villers-Cotterets ! murmura Valentine, en se dressant toute droite. En juin 1395 ?…
– Oui, madame ! dit Passavant étonné.
– C’était une petite fille avec des yeux d’un bleu d’azur, des cheveux blonds si fins qu’on eût dit un nuage d’or autour de son front ?…
– Oh ! cria le chevalier, vous avez connu Roselys !…
– Une petite fille qui fut exposée sous le porche d’une église ?…
– Madame ! Ah ! Madame ! Vous savez toute l’affreuse histoire de Roselys !
– Et qui fut recueillie, arrachée à l’insulte par une dame qui passa d’aventure ?
– Cette dame, c’était la reine !…
– La reine !
– Oui, madame, et c’est pourquoi je vous disais que ma vie appartient à la reine Isabeau qui pourra en disposer à son gré lorsqu’elle croira venue l’heure où je dois acquitter ma dette.
La duchesse d’Orléans s’était levée. Une étrange expression s’étendit sur son beau visage si pâle en ce moment. Elle s’avança sur Passavant, qui la vit venir en frémissant. Et alors, levant les yeux au ciel, cet ange qu’était Valentine, d’une voix grave et ferme, prononça :
– Oui, je savais tout de cette histoire, excepté le vrai nom de l’enfant, que vous venez de m’apprendre. Mais vous, monsieur, vous ne savez pas la vérité. Et comme ce serait presque un sacrilège que de vous laisser porter le poids d’une reconnaissance que vous ne devez pas…
– Madame ! Madame ! Que dites-vous ! cria le chevalier éperdu.
– Comme je sens votre sincérité profonde, continua la duchesse, et que ce serait un outrage au Dieu de justice que de laisser s’égarer votre cœur, cette vérité quoiqu’il m’en coûte, je dois vous la dire. La dame qui prit Roselys dans ses bras et l’emporta, ce ne fut pas la reine Isabeau.
Passavant recula d’un pas.
– Ce ne fut pas la reine ! murmura-t-il. Et qui donc ?
– Moi ! répondit Valentins avec une majestueuse simplicité.
Comme il avait fait en entrant, Passavant ploya le genou devant la duchesse d’Orléans. Son cœur battait à se rompre. Dans son esprit, pas un doute ne se glissa. Entre la parole de ce sorcier louche, de ce Saïtano suspect, et la parole de cet être de beauté, de suprême loyauté qu’était Valentine, aucune hésitation n’était possible. Pendant quelques minutes, le chevalier demeura ainsi courbé devant celle qui avait tenté de sauver Roselys de la mort. Il tremblait.
À ce moment elle reprit :
– Lorsque je reverrai celle que vous nommez Roselys…
Passavant se redressa, et la duchesse poussa un léger cri ; elle ne reconnaissait plus cette figure livide et terrible. Hagard, éperdu, ne sachant plus ce qu’il faisait, Passavant saisit un bras de la duchesse, et râla :
– Madame, sur Dieu, sur mon âme et ma vie, je vous en supplie ; faites attention à ce que vous dites, car vous me laisseriez croire… Oh ! l’impossible rêve !… croire que Roselys est vivante !
– Elle est vivante, dit simplement la duchesse.
– Vivante ! hurla le chevalier chancelant. Saïtano ! Saïtano ! Sorcier maudit ! Malheur à toi, pour ton effroyable mensonge ! Vivante ! Madame, vous dites que Roselys est vivante ? Où est-elle ? Que fait-elle ? Sous quel nom vit-elle ? Ah ! madame, pardonnez-moi, voyez-vous… Roselys… c’était ma vie !
Valentine allait répondre :
– Roselys vit à l’Hôtel Saint-Pol… Elle s’appelle Odette de Champdivers…
À l’instant où elle allait parler, la porte s’ouvrit violemment, Armagnac entra, suivi d’une vingtaine de gentilshommes, marcha rudement sur le chevalier, et gronda :
– Madame, savez-vous le nom de l’homme que vous avez reçu et qui vous parle avec une insolente familiarité ? Savez-vous ce nom ?
– Le nom ? balbutia la duchesse.
– Il ne l’a pas dit, j’en étais sûr ! éclata le comte d’Armagnac. L’homme qui est devant vous, madame, c’est le sire de Passavant !
La duchesse d’Orléans recula. Elle eut un mouvement d’horreur et murmura :
– L’assassin de mon mari !
Passavant, très pâle, tout droit, le front barré d’un pli, regardait Armagnac face à face. D’un accent glacial, il prononça :
– Oui, Hardy, chevalier de Passavant. Tel est mon nom, tel est mon titre. Fils de Passavant le Brave, cela seul répond de moi. Prenez garde à ce que vous allez dire, monsieur, et vous tous ! ajouta-t-il d’une voix soudain grondante. Je suis Passavant. Que trouvez-vous à redire à cela ?
La duchesse Valentine l’écoutait, le regardait, sentait s’éveiller en elle l’admiration et se réveiller la sympathie, et elle se criait : Non, non ! Celui-là n’est pas un assassin !
– Passavant ? dit durement Armagnac… Le même qui n’a eu qu’à paraître pour que les Écorcheurs de Vincennes se retirassent et que la reine Isabeau fût sauvée ?
– Le même, dit Passavant avec non moins de rudesse. Mais vous insinuez au lieu d’accuser… Silence, messieurs ! cria-t-il, et le murmure des gentilshommes s’éteignit. Il s’agit ici plus que de ma vie : de mon honneur et de mon nom ! On vient de dire qu’à l’affaire de Vincennes, les Écorcheurs se sont retirés devant moi… c’est faux ! Ils ont fui… ce n’est pas la même chose, je crois !
– Passavant ? reprit Armagnac… Le même qui, en l’une de ces soirées de débauche et d’ivresse où se complait la Bavaroise, a été remarqué par elle et s’est mystérieusement entretenu avec elle ?
– Entretenu, oui ; mystérieusement, non !
– Passavant ? Le même qui, dans une auberge de la rue Saint-Martin, a magnifiquement traité les sires de Scas, d’Ocquetonville, de Courteheuse et de Guines, âmes damnées de Jean de Bourgogne ?
Le chevalier eut un éclat de rire strident :
– Pour le coup, c’est vrai, même « magnifiquement » ! Le sire de Guines en sait quelque chose.
– Ne riez pas ! dit Armagnac avec une gravité sinistre. Je vous jure que ce n’est pas le moment !
– Bah ! fit le chevalier dont le sourire fut d’une tragique ironie, j’ai ri avec la mort, je puis bien rire avec vous, et n’était la présence de cette douleur vivante, je vous jure que je rirais bien plus fort. Madame, vous pouvez pardonner cet éclat de rire : à l’attitude de ces messieurs, je présume que ce sera le dernier.
Il y eut un silence pesant.
Armagnac, d’une voix sombre, prononça enfin :
– Madame, et vous, nobles hommes, vous avez entendu. Le sire de Passavant est l’ami de la reine, ennemie du mort. Il est affilié aux Écorcheurs, et si un doute subsistait, ce qui s’est passé dans la rue Saint-Martin suffirait à établir la vérité. Il est l’ami des Bourguignons qui, pour mieux couvrir leur maître, ont feint de vouloir arrêter cet homme hier matin, et l’ont laissé fuir. Sire de Passavant, sur Dieu et votre âme, pouvez-vous jurer que vous n’êtes pas entré dans la rue Barbette la nuit du crime ?
Le sourire du chevalier devint livide. Il leva la main, et dit :
– Sur Dieu et mon âme, je jure que dans la nuit du crime, je me suis trouvé non seulement dans la rue Barbette, mais encore près du noble duc.
Le silence, alors fut effrayant. Mais Passavant continua :
– J’attends !… J’attends que vous disiez tout haut ce que vous pensez !
– Le voici ! dit Armagnac. Je pense que vous êtes l’assassin de mon cousin d’Orléans. Est-ce votre avis, nobles hommes ?
– C’est notre avis, répondit la troupe d’une seule voix.
– Quel châtiment a mérité cet homme ? reprit Armagnac.
– La mort ! répondit la voix énorme faite de toutes ces voix furieuses. Vengeance ! Vengeance !
Passavant, d’un geste foudroyant, tira sa longue rapière flexible, en appuya la pointe sur le parquet, et, penché en avant, la figure effrayante, la voix rocailleuse :
– Et vous, que méritez-vous ? Sire d’Armagnac, gentilshommes, que méritez-vous pour, faussement et sans autre preuve qu’un ramassis de circonstances, accuser l’homme qui est devant vous ? Je vous accuse, moi ! Je vous accuse de félonie et lâcheté parce que votre accusation est vaine et que vous vous mettez à trente pour la soutenir !
– À la potence ! hurla la bande cravachée par ces paroles. À mort ! Tout de suite !
– À mort ! dit Passavant, terrible… Soit ! Tuez-moi ! Qui de vous va me tuer ?
Sa rapière siffla dans l’air.
– Allez ! rugit Armagnac.
C’était le signal. Tous ensemble, ils s’élancèrent sur Passavant, les dagues levées jetèrent des éclairs, et par des cris, par les jurons, par les insultes, ils s’excitèrent au meurtre. C’était fini. Le chevalier allait tomber. À ce moment, Valentine, d’un mouvement rapide, se plaça devant lui et cria :
– Que nul ne bouge ! Seule je commande ici !
– Mais, madame… gronda le comte d’Armagnac, tandis que la troupe entière s’immobilisait.
– Cet homme est mon hôte, dit Valentine d’une voix de souveraine majesté.
Passavant rengaina sa rapière, comme si ce mot seul l’eût fait sacré.
– Venez, monsieur ! dit-elle d’un ton de commandement, tandis que, des yeux, elle contenait encore pour quelques secondes la meute des meurtriers.
– Messieurs, dit Passavant, vous m’avez insulté. Mon insulte vous a répondu. Je tiens la vôtre pour reçue. Tenez la mienne pour valable. Où et quand vous voudrez, nous nous retrouverons.
Et il sortit paisiblement. La duchesse le suivit et ferma la porte contre laquelle elle s’appuya. Il était temps. Les Armagnacs s’élançaient pour frapper le chevalier. La porte fermée les arrêta deux minutes pendant lesquelles ils se consultèrent. Le comte d’Armagnac, en dernier ressort, jugea que l’autorité de la châtelaine pouvait être, en cette occurrence, tenue pour non avenue, et décida qu’il fallait tuer sur le champ le meurtrier du duc d’Orléans. Lui-même ouvrit la porte. Il ne trouva que la duchesse, Passavant avait disparu.
– Qu’avez-vous fait ? s’écria le comte.
– Je l’ai sauvé, dit doucement Valentine.
– Ah ! madame, c’est peut-être un plus grand malheur que vous ne pensez !
Oui, Valentine avait sauvé Passavant. À peine seule avec lui, elle ouvrit une autre porte qui donnait sur l’un des escaliers du château.
– Descendez ! dit-elle. Et vite ! Les furieux vont entrer.
– Madame, dit Passavant, paisible et respectueux, j’aime mieux mourir ici que de vous laisser croyant au crime qu’on m’impute. Sur Dieu, madame, me croyez-vous le meurtrier ?
– Sur Dieu, répondit Valentine, je crois que vous avez tenté de sauver mon malheureux époux et que vous êtes arrivé trop tard, comme vous le racontiez.
Passavant s’agenouilla, saisit la main de la duchesse.
– Madame, reprit-il, vous me croyez donc digne de revoir Roselys ?
– Oui. Et je vous dirai où elle vit, sous quel nom elle vit. Mais, allez. Plus un instant à perdre. Descendez cet escalier aussi bas qu’il vous conduira, dites simplement : « La marraine d’Odette m’envoie à vous… » Allez… et que Dieu vous garde !
– Odette ! murmura le chevalier enivré. Ce nom béni me protège donc ici comme l’ange qui le porte m’a sauvé de la Huidelonne !
Il s’élança dans l’escalier.
– Odette ! murmurait de son côté Valentine de Milan. Odette… Roselys !
Comme on le lui avait dit, Passavant descendit jusqu’au bas de l’escalier, et là, en effet, trouva un homme armé qui lui cria :
– Rebroussez chemin, on ne passe pas ici !
– Mais moi, je passe, dit Passavant, car la marraine d’Odette m’envoie à vous.
– En ce cas c’est différent, dit l’homme avec un soudain respect. Suivez-moi, mon gentilhomme, et faisons vite, car vous avez le mot d’ordre des heures tragiques.
Passavant, du fond du cœur, envoya un souvenir ému à la châtelaine de Pierrefonds, et, suivant rapidement son guide, s’élança dans un long couloir souterrain – une de ces assurances de fuite comme il en existait alors à tous les châteaux féodaux pour le cas de prise et mise à sac. Ce souterrain passait sous les murs du château et aboutissait presque au pied de la colline.
Passavant, après avoir franchi deux portes de fer, se retrouva, non sans étonnement, dans les caves même de cette auberge où il avait laissé son cheval. Sans doute l’hôte était là pour recevoir ceux qui, d’accord avec les maîtres du château, prenaient ce moyen de fuite. Sans doute l’auberge elle-même n’était là que pour masquer l’entrée du souterrain. Cet hôte, qui se montra fort empressé auprès de Passavant, lui assura que le cheval avait mangé, et lui conseilla de piquer des deux. Passavant n’entrevit ce brave que quelques secondes, dans l’obscurité, mais il lui parut avoir une telle ressemblance avec l’hôte de la Truie Pendue qu’il ne pût s’empêcher de lui demander :
– Seriez-vous d’aventure un frère de maître Thibaud Le Poingre ?
– Non, répondit l’hôte étonné. Mais si vous voulez m’en croire, sautez en selle sans plus tarder, car le mot de passe que vous avez donné ne sert que dans les circonstances où il est question de vie et de mort.
Tout compte fait, le chevalier trouva le conseil raisonnable. Il monta donc à cheval et se dirigea tout droit sur Villers-Cotterets. Comme il entrait sous le couvert de la forêt, plusieurs cavaliers chargés de le poursuivre sortirent du château. Mais le chevalier était loin déjà, et pour supprimer une inutile inquiétude aux lecteurs qui s’intéressent à lui, nous pouvons dire tout de suite que les Armagnacs ne l’atteignirent pas et rentrèrent bredouilles après avoir battu les bois d’alentour.
Après avoir failli succomber aux dagues des gens du château, le pauvre chevalier fut sérieusement menacé de mourir de faim et de soif. Il n’osait pas recommencer l’aventure de Dammartin.
– Je n’aurais, songeait-il, qu’à tomber sur une hôtesse qui refuserait la boucle de mon chapeau. Je deviendrai ainsi une dette ambulante, et toutes les jolies filles de ce charmant pays diraient de moi : C’est la statue équestre de la Dette !
Il riait avec lui-même. Il trottait avec cette joie profonde qu’on a lorsqu’on se trouve tout à coup débarrassé d’une idée funèbre. C’est à peine s’il pensait au formidable danger qu’il venait de courir et à ceux, plus formidables encore qui l’attendaient dans l’avenir avec des ennemis comme Isabeau, Jean de Bourgogne, Bernard d’Armagnac, sans compter l’innombrable menu fretin.
Sa joie était double :
D’abord, il ne devait plus rien à la reine Isabeau puisque Roselys avait été sauvée par Valentine. Donc, il se sentirait les coudées franches pour défendre Odette contre la haine de cette reine.
Ensuite, il savait maintenant que Roselys était vivante.
Et il se tourmentait l’esprit pour deviner dans quel but Saïtano lui avait dit que Roselys était morte, et que la reine Isabeau, l’ayant arrachée à l’ignominie de l’exposition, n’avait pu la sauver de la mort…
Il résolut d’éclaircir ce point étrange et d’aller chez Saïtano. Puis, bientôt, toutes ces pensées se fondirent en une seule qui faisait trembler son cœur comme les premières caresses du soleil levant font trembler une fleur : Roselys vivait ! La duchesse lui avait promis de lui dire où et sous quel nom elle vivait !… Bientôt, donc, il reverrait l’amie de son enfance…
Tout à coup, il arrêta net son cheval. Il pâlit. Un trouble étrange emplit son regard de lumière et de franchise, comme ces nuages noirs qui soudain projettent une ombre sur l’azur de la mer. Il songeait à Roselys… et c’était Odette qu’il voyait !
Clairement, avec une aveuglante et terrible évidence, il vit qu’il aimait Odette ! Il se l’affirma pour la première fois. Et ce fut avec une sorte d’angoisse que, tout bas, il se murmura :
– Roselys ?… Odette ?…
Il nous faut répéter ici que le chevalier de Passavant n’était pas de ces subtils personnages qui se posent à eux-mêmes des problèmes d’âme, des cas de conscience épineux. Le pauvre chevalier n’était pas de force à lire dans son cœur et à prendre une détermination sur un pareil sujet. Mais il fut profondément malheureux de sentir qu’il adorait encore Roselys et qu’il aimait Odette.
Ce fut là-dessus qu’il se mit à ruminer, marchant au pas. Il atteignit enfin Paris vers la chute du jour, et, heureusement, une autre préoccupation vint alors le tirer des palabres plus ou moins philosophiques qu’il essayait de se tenir avec sa bonne foi ordinaire.
En effet son estomac se mit à crier famine, et à crier si fort qu’il fallait bien l’entendre. Passavant songea à l’heure merveilleuse qu’il avait passée sur le plateau du Voliard, près du feu, dévorant le dîner que lui avait laissé dans les fontes la bonne hôtesse de Dammartin. Il arriva à l’auberge de la Truie Pendue, entra sans bruit dans la cour, plaça son cheval à l’écurie sans prévenir personne, et lui qui se fut coupé le poignet plutôt que de dérober une maille, se fit tranquillement voleur pour son cheval : il alla au coffre à avoine, et emplit la mangeoire de la bête affamée.
– Si maître Le Poingre me voyait ! songeait-il en souriant.
Il sortit sans avoir été remarqué. Pour rien au monde, il n’eût demandé à Thibaud une hospitalité qu’il ne pouvait payer. Il se mit à errer dans Paris.
En somme, il se trouvait sans gîte – et il avait faim !
Il faisait nuit. Une de ces nuits sombres et tristes : des rues submergées sous les brouillards : pas de lumières ; pas de passants.
Où allait-il en cette soirée d’abattement, de faim, de tristesse ? Il ne sut pas. Cent fois, il fut sur le point de retourner à la Truie Pendue, et chaque fois il poursuivit son chemin, se donnant pour prétexte qu’il n’avait pas d’argent, et oubliant que, sans sou ni maille, il avait forcé le même Thibaud Le Poingre à lui ouvrir un crédit illimité.
Il s’aperçut tout à coup qu’il se trouvait dans la Cité.
Il se ressouvint alors du mensonge de Saïtano. Et il se dit qu’il était temps d’aller demander au sorcier : Pourquoi avez-vous dit que Roselys fut recueillie par la reine ? Pourquoi avez-vous dit que Roselys était morte ?…
Ce lui fut d’une affreuse amertume. Brusquement, il s’arrêta dans un angle de carrefour, cacha son visage dans ses deux mains, et râla :
– Ceci serait vraiment une hideuse aventure ? Est-ce que j’ai donc le cœur d’un bourreau ? Suis-je donc plus détestable que Jean de Bourgogne et Isabeau ? Quoi ! Est-ce vrai ? Est-ce que vraiment je regrette que Roselys soit vivante ?…
Non, le pauvre naïf, il ne regrettait pas cela ! Il se calomniait affreusement. Sa joie, au contraire, que l’amie adorée de son enfance fût vivante, était immense.
Seulement… ah ! seulement, à côté de l’image de Roselys s’en dressait une autre !
Une autre fois encore, la faim lui rendit le service de l’arracher à des pensées qu’il n’était pas de force à élucider. Il se remit donc en route, renvoyant à plus tard sa visite à Saïtano, et grommelant contre la dure nécessité où se trouve l’homme de satisfaire à cet implacable tyran : l’estomac.
En somme il n’avait pas mangé depuis la veille, et il commençait à s’affaiblir lorsque des bruits confus de rires, de querelles, de jurons le tirèrent de cette léthargie morale où il s’enlisait ; en même temps, il vit de nombreuses lumières.
– Le Val d’Amour ! gronda-t-il en haussant les épaules. Il se détourna, et il allait s’enfoncer dans une ruelle noire : une main légère se posa sur son bras, une voix un peu tremblante lui dit :
– Est-ce moi que vous cherchez, beau capitaine ?
Un peu de la lumière du Val d’Amour éclairait la fille pâle qui lui parlait doucement. Il la regarda un instant, puis cherchant à se détourner :
– Excusez-moi… Je ne cherche personne.
Mais elle le retint par le bras, et avec un soupir, reprit :
– Quoi ! ne me ferez-vous pas l’honneur de vous reposer quelques minutes en mon logis ?…
Il y eut un silence. La fille pâle baissa la tête et, à voix basse, murmura :
– Vous pouvez y venir sans crainte… Jamais mon logis ne fut souillé par une pensée mauvaise. Impure je suis, mais mon logis si pauvre est pur. Vous serez le premier homme qu’il aura vu… Oh ! je serais si heureuse de vous y voir, ne fût-ce que quelques instants, afin que je garde le souvenir de votre présence !
Exaspéré par ses pensées et par les vociférations de son estomac, Passavant se recula d’un pas.
– Eh ! mort diable, gronda-t-il, je suis sans sou ni maille, ne le voyez-vous pas ? Ne voyez-vous pas que j’ai faim ?
– Faim ! Vous ! s’écria la fille pâle.
– Allons, mon enfant, reprit le chevalier avec douceur, déjà honteux qu’il était de son brusque mouvement, c’est une façon de dire. Adieu ! La vérité est que je désire aller seul par les rues…
– Non, non ! Vos yeux brillent de fièvre… vos mains sont glacées. Vous tremblez… Venez, ah ! venez, ou bien alors je croirai que le beau capitaine qui se battit pour moi ici même et qui me donna un bel écu d’or… je croirai que l’orgueil est plus fort chez vous que la pitié.
Le chevalier étonné regarda plus attentivement la pauvre fille et reconnut alors Ermine Valencienne. Elle avait pris sa main et l’entraînait dans une de ces sombres ruelles qui faisaient de la Cité un inextricable réseau de mailles serrées. Docile, il suivait.
Ermine Valencienne entra dans l’étroite allée d’une maison, monta deux étages, et ouvrit une porte. Une chambre apparut au chevalier, claire, propre, son carreau luisant ; une table en chêne, trois escabeaux, un bahut modeste, un lit tout blanc la meublaient. À la tête du lit, sous une grossière image de la Vierge, un rameau de buis béni.
Tout cela fleurait l’honnêteté, et osons le dire, la chasteté.
Passavant, sur le seuil, s’arrêta pensif.
Sur un geste de timide invitation, il entra. Ermine Valencienne l’entraîna alors jusqu’au bahut. Là, sur l’entablement, en travers, il y avait une épée de combat ; à côté, un vieux missel ; puis un chapelet et d’autres objets précieusement placés, souvenirs de l’enfance et de la famille de la pauvre fille de joie. Parmi ces objets, au milieu, sur un petit carré de velours, reposait une pièce d’or, un écu tout neuf. Ermine le prit et murmura :
– C’est l’écu que vous m’avez donné ; j’avais faim, mais je n’ai pas voulu le dépenser ; il m’a semblé qu’avec cette pièce d’or, le bonheur entrait dans mon logis, parce que vous étiez le premier qui m’eût parlé sans haine ni mépris, parce que vous avez risqué votre vie pour moi.
– Risquer ma vie, dit Passavant ; si vous saviez combien c’est peu de chose…
Ermine continua :
– Ce soir, c’est autre chose. L’écu sera dépensé.
– Ma foi, dit gaîment le chevalier, j’y consens, et nous le mangerons ensemble.
– Je cours à l’auberge où vous vous êtes battu pour moi, dit Ermine.
Et elle cria :
– Trop-va-qui-dure ! Ma chère Trop-va-qui-dure, venez un instant tenir compagnie à ce chevalier qui accepte l’hospitalité dans notre logis !
– Qu’est-ce que Trop-va-qui-dure ? fit Passavant étonné.
– C’est Jehanne… une digne créature qui habite avec moi, là, dans cette chambre ; Jehanne, de la rue Trop-va-qui-dure. Alors, on l’appelle par le nom de sa rue.
Une porte, au fond de la pièce, s’ouvrit. Une femme parut. Ermine Valencienne, toute joyeuse, rose de fierté, sortit en courant. La femme entra.
Hardy de Passavant se trouva seul, seul en présence de Laurence d’Ambrun.
II – TROP-VA-QUI-DURE
Nous avons dit que la rue Trop-va-qui-dure était une sorte de Val d’Amour situé dans la ville, mais un Val d’Amour de bas étage. Cette rue était l’une de celles que l’ordonnance de 1363 désignait comme lieu de résidence aux cinq mille filles de joie que l’on comptait dans Paris.
C’est donc dans cette rue Trop-va-qui-dure que, revenant au moment où Laurence d’Ambrun sortit de l’Hôtel Saint Pol après son entrevue avec Odette de Champdivers, nous prions le lecteur de nous suivre.
La théorie de Saïtano sur la mémoire était double.
D’abord il est possible par une certaine action sur le cerveau de créer une mémoire artificielle, c’est-à-dire de provoquer dans un esprit le souvenir d’événements qui n’ont pas existé. Si cela est possible, on doit pouvoir également abolir dans le même esprit le souvenir des événements qui ont existé. La conclusion, c’est qu’on peut donner à un esprit une personnalité nouvelle.
Exemple : abolissons en Laurence d’Ambrun le souvenir des faits successifs qui constituent sa vie, et il n’y a plus de Laurence, puisque c’est le souvenir seul qui fait la personnalité ; le futur n’existe pas, le présent est insaisissable tant qu’il n’est pas à l’état de passé.
Le passé seul existe donc. Il existe à l’état de souvenir. Plus de souvenir, plus de Laurence. En cet être amorphe, créons artificiellement le souvenir de choses qui n’ont pas existé, le souvenir d’un nom qui n’est pas le sien, le souvenir d’un logis qu’elle n’a pas habité, le souvenir d’événements qui se sont passés en ce logis ; alors, à l’être amorphe, nous avons donné une personnalité nouvelle : Laurence est devenue Jehanne.
La deuxième partie de la théorie était d’un intérêt plus poignant, plus dramatique, si l’on veut.
Nous disons : ni le présent, ni l’avenir n’existent. Seul, le passé est vivant. Il vit dans le souvenir. Ici intervient une conception remarquable et qui prouve que ce Saïtano, fou peut-être, était capable d’étranges efforts de pensée. Il disait : se souvenir, c’est créer une image de l’événement passé, non pas une image métaphorique, mais une image réelle. C’est donc revivre jusqu’à un certain degré l’événement qu’on a vécu.
Cette image est dans toute sa force à l’instant où l’événement se produit. Une seconde après, elle commence à s’affaiblir. Le souvenir la crée à nouveau, mais de plus en plus faible, jusqu’à ce que le cerveau soit impuissant à l’évoquer.
Si, à ce moment, on infuse une force nouvelle au souvenir, l’image créée sera plus distincte. Si cette force infusée est suffisante, l’image deviendra de plus en plus nette, remontant le cours des temps comme elle l’avait descendu, jusqu’au moment où l’image créée par le souvenir se confondra avec l’image créée par l’événement lui-même, c’est-à-dire qu’à ce moment on revivra complètement l’événement.
Exemple : Laurence, et la scène de l’oratoire du logis Passavant.
Douze ans, après, cette scène n’existe plus qu’à l’état de souvenir ; l’image créée s’affirme ; les détails s’estompent ; dans l’esprit de Laurence, la scène reste à son plan d’époque, elle n’est que le reflet de ce qui s’est passé jadis.
Restaurons les détails, et l’image reprend de la fraîcheur ; intensifions le souvenir, au point que les gestes, les attitudes, les costumes, les meubles, les voix, tout soit remis en état de vibration, et Laurence croira que la scène d’il y a douze ans vient de se passer il y a un an, il y a six mois, il y a deux jours, une heure, quelques minutes. Intensifions encore, et elle croira que l’événement « se passe » actuellement : elle le revivra avec les mêmes sensations.
Non seulement il nous a paru curieux d’exposer cette double théorie, mais encore cette rapide exposition était indispensable pour l’intelligence des scènes qui vont suivre ; le lecteur aura donc l’indulgence de nous passer ce morceau indigeste, nous en convenons volontiers.
Laurence d’Ambrun, on s’en souvient, se heurta à Jean sans Peur au moment où elle allait sortir de l’Hôtel Saint Pol. Là se créa un phénomène que Saïtano n’avait pas prévu.
Laurence était devenue Jehanne de la rue Trop-va-qui-dure.
La vue de Jean sans Peur faillit abolir Jehanne et ressusciter Laurence…
Pourtant, soit par des toxiques, des mélanges de stupéfiants et de révulsifs dont la liste ne nous est pas parvenue, soit par des actions plus directement exercées sur le cerveau, soit enfin par des pratiques de sorcellerie inconnues, Saïtano avait si puissamment agi sur la mémoire de la malheureuse que, quelques minutes plus tard, elle ne songeait plus à son amant, père de sa fille.
Par des chemins qu’elle « reconnut », elle gagna la rue Trop-va-qui-dure. Elle reconnut cette rue où elle n’avait jamais pénétré. Elle arriva dans une maison qu’elle ne connaissait pas, et elle dit : C’est étrange que je sois si lasse. Heureusement, me voici arrivée « chez moi »…
Elle entra sans hésiter dans cette maison, monta jusqu’au galetas, tira une clef de la poche de son tablier (partie du costume dont l’usage remonte plus haut encore que cette époque), ouvrit, entra dans le taudis, tous ces actes, tous ces gestes automatiques comme s’ils eussent été répétés très souvent.
Laurence jeta un coup d’œil indécis sur les quelques pauvres meubles du taudis. Elle eut un éclair de défiance. Un instant, les instincts de luxe artistique accumulés en elle par l’éducation combattirent les suggestions de la mémoire artificielle. Il y eut une lutte rapide entre Laurence d’Ambrun et Jehanne Trop-va-qui-dure.
Cette dernière triompha.
Ce jour, Laurence, paisiblement, se livra aux journalières et humbles besognes qu’eût exécutées la Jehanne imaginée par Saïtano. Elle récura sa vaisselle d’étain. Elle lava dans un grand baquet quelque menu linge. Elle surveilla la pauvre cuisine qu’elle mit en train sur l’âtre.
Ne se voyant plus rien à faire, elle chercha des yeux autour d’elle un objet qui lui manquait. Quoi ? Elle ne savait. D’une lente pression, elle appuya ses mains sur son front.
– C’est cela ! murmura-t-elle enfin. C’est mon missel que je cherche, pour lire !
Son missel ! Un missel chez une malheureuse comme Jehanne !… C’était Laurence qui, par subconscience, essayait de s’éveiller… Elle se mit à rire.
– Quelle idée ! fit-elle. Moi qui ne sais pas lire ! Et où aurais-je jamais eu un missel… moi ?… Pourtant, je le vois, il me semble… avec son couvercle de bois verni et son fermoir d’argent ciselé représentant deux croix… et je vois les pages avec leur belle écriture, les premières lettres peintes en azur et en rose, et à de certaines pages, les saints et la Vierge, et sainte Madeleine et tant d’autres… Où ai-je vu ce missel ?… Bon ! Je l’aurai vu chez quelque dame de bourgeoisie et cela m’a frappé l’esprit, c’est un simple souvenir.
Ce mot inconscient était terrible. Oui, c’était un simple souvenir…
Sur le soir, Laurence fut prise d’inquiétude.
Quelle inquiétude ?…
Elle éprouva tout à coup une mortelle tristesse, et comprit que tout son être se révoltait contre ce qu’elle allait faire. Elle ne voulait pas. Elle rougissait et pâlissait coup sur coup. En elle, Jehanne se souvenait de ce qu’elle avait à faire, comme tous les soirs. Et en elle, Laurence s’indignait d’avoir à le faire. Encore, Laurence fut vaincue.
Ce fut avec des soupirs d’angoisse et de honte, avec des larmes brûlantes, avec des hésitations, des reculs, des détours dans le taudis, ce fut donc après une résistance acharnée qu’elle se trouva enfin portée devant un coffre qu’elle ouvrit. Une minute, elle demeura les yeux fixes et mornes. Puis elle dit à haute voix : C’est pourtant l’heure de m’attifer et de me faire belle !
Le coffre contenait : le manteau à collet renversé ; le diadème en plumes de geai ; la fourrure de fausse hermine et la ceinture d’argent.
L’attirail des filles de joie !… Le costume dont certaines parties, telles que la ceinture et les plumes étaient obligatoires, afin que celle qui les portait comme une enseigne pût être facilement reconnue comme exerçant cet état et aussi pût être évitée par les honnêtes bourgeoises.
Laurence, devant un petit miroir d’acier poli, commença à arranger sa magnifique chevelure.
Elle était blanche cette chevelure, d’un blanc éclatant, couleur de neige pure, par les matins de soleil. Cela seul avait vieilli en elle. Le visage était adorablement jeune.
Précipitamment, avec une sorte de rage, Laurence acheva de s’habiller, ceignit la ceinture, posa sur sa tête les plumes de geai avec une dextérité qui prouvait sa longue habitude de cette manœuvre ; elle rougit ses lèvres au carmin ; elle peignit ses sourcils ; elle colora ses joues avec des pâtes qu’elle trouva dans le coffre.
Elle sortit enfin du taudis…
Elle descendit le misérable escalier…
Elle se trouva dans la rue…
La rue Trop-va-qui-dure ! Quelques misérables filles de la plus basse catégorie erraient çà et là, guettant le soldat. Quand elles aperçurent Laurence, il y eut une stupeur parmi elles. Des ricanements, d’abord, puis des rumeurs coururent. Elles s’assemblèrent. Elles grognaient entre elles des insultes, des jurons. Elles disaient :
– Qui est celle-là ? On ne la connaît pas.
– D’où sort-elle ? Que vient-elle faire en « notre » rue ?
– Si bien huppée, habillée de neuf, et avec de l’hermine !… et une ceinture de vrai argent !… et des plumes toutes fraîches !… Elle n’a pas honte, non !
– C’en est une du Val d’Amour, sûrement !
– La coquine vient nous enlever le pain de la bouche ! À quoi pense le prévôt ?
– Au Val d’Amour, voleuse, au Val d’Amour !…
La rumeur devenait menace. Farouches, les louves de la rue Trop-va-qui-dure encerclaient la malheureuse, interdite, éperdue, qui balbutiait :
– Mais je suis Jehanne ! Vous ne me reconnaissez donc pas ?
Et, comme dans un éclair de folie, elle se murmurait :
– Comment me reconnaîtraient-elles, puisque je ne me reconnais pas moi-même !
– Hors d’ici ! hurla la bande furieuse. Au Val d’Amour ! Et vite ! Ou gare les griffes :
Les griffes sortirent. Laurence, doucement, s’en allait. Où ? Elle ne savait pas. La bande gesticulante et hurlante, les griffes tendues, se tenait pourtant à distance respectueuse. Elles n’étaient pas méchantes, ces malheureuses, et il leur suffisait que l’intrigante s’en allât de leur rue. Or, elle s’en allait !
Bientôt, Laurence n’entendit plus les vociférations.
Elle se trouvait hors de la rue Trop-va-qui-dure. Quant à savoir ce qu’elle devait faire, pourquoi elle se trouvait là, et où elle devait aller, ceci était hors de sa conviction, Seulement, elle se murmurait avec effarement :
– La rue Trop-va-qui-dure n’est donc plus ma rue ? Je ne dois donc plus rentrer chez moi ? Où dois-je aller ? Elles ont dit : Au Val d’Amour. Pourquoi là et non ailleurs ?
Là encore se produisait un phénomène qui avait échappé à la sagacité de Saïtano : Hors de l’ambiance et des souvenirs imposés par le sorcier, l’esprit de Laurence devenait une épave qui devait obéir à l’impulsion de tous les vents. On lui avait crié : Au Val d’Amour ! C’est vers le Val d’Amour qu’elle se dirigea, et comme elle ignorait le chemin, elle s’adressa au premier passant venu.
Ce passant était un sergent à verges de la prévôté de Paris.
Il considéra, émerveillé, cette belle fille qui ne craignait pas de s’adresser à un agent de l’autorité justement pour enfreindre les ordres de cette autorité. La fille était en état de rébellion puisqu’elle arborait les insignes de son métier, hors des endroits où elle avait le droit de l’exercer.
Il se dit : Mon devoir est d’arrêter la vagabonde. Oui, mais elle est bien belle !
Machinalement, tout en discutant avec lui-même, les yeux en coulisse et le sourire vainqueur, il finit par se mettre en route vers le Val d’Amour ! Il se disait : « Elle me demande le chemin du Val d’Amour qu’elle connaît mieux que moi. C’est une façon de m’exprimer l’admiration que je lui fais éprouver… » L’autorité, la force, la morale et autres vertus durent se voiler la face : le sergent capitulait et escortait la délinquante, sûr de trouver au bout du chemin la récompense de sa trahison.
De ce fait que Laurence marchait près d’un sergent, il résulta qu’elle atteignit la Cité sans avoir été molestée par les passants ou arrêtée par d’autres représentants de l’ordre public.
– Eh bien, la belle, fit tout à coup le sergent, nous voici au Val d’Amour, conduisez-moi chez vous.
– Chez moi ? Mais je suis Jehanne de la rue Trop-va-qui-dure.
Le sergent fronça les sourcils, hérissa la moustache, roula des yeux féroces, et dit :
– Auriez-vous bien l’audace de vous moquer d’un sergent à verges ? Prenez garde !
– Que voulez-vous ? demanda Laurence.
– Que vous me conduisiez chez vous, grommela l’agent de l’autorité.
En même temps, il saisit Laurence par le bras. Presque aussitôt des menaces éclatèrent autour de lui. Les sergents n’étaient pas bien vus des Parisiens, peuple frondeur dans les siècles des siècles. Au Val d’Amour, c’est à peine s’ils avaient le droit de se montrer. En un clin d’œil, le pauvre diable fut entouré, houspillé d’importance et, avant d’avoir pu se reconnaître, expulsé du Val d’Amour.
– C’est bien fait, se dit-il, fort triste en lui-même, je suis puni par où j’ai péché. Mais je tiendrai cette coquine à l’œil. Il faudra bien qu’elle paye sa trahison.
La coquine, cependant, s’était mise à fuir.
Affolée, elle entra dans une ruelle, où le bruit de l’échauffourée faisait sortir tout le monde, pénétra dans la première allée qui se présenta à elle, et s’assit, haletante, sur la première marche de l’escalier. C’était l’escalier qui conduisait au logis d’Ermine Valencienne.
Ce fut là, sur cette marche, qu’Ermine la trouva, comme elle descendait une heure plus tard. Avec étonnement, Ermine vit cette figure qui était inconnue. Avec plus d’étonnement encore, elle remarqua sur cette figure un air de décence et de dignité qui la frappèrent.
– Celle-ci n’est pas du Val d’Amour, se dit-elle. Et pourtant, elle en a le costume.
Ermine Valencienne, elle, était bien du Val d’Amour. Comment avait-elle été réduite à ce triste état ? Nous l’ignorons. Ce qui est sûr, c’est qu’elle en souffrait. Cette malheureuse fille, créée pour une vie d’honnêteté, faite pour le foyer, n’avait pu, malgré ses efforts, anéantir ses instincts d’innocence. C’était un malheur pour elle qu’elle eût le cœur sain…
Ermine, après avoir attentivement considéré cette femme qui pleurait en silence, s’assit près d’elle sur la marche et lui prit la main.
– Où logez-vous ? commença-t-elle.
– Je n’ai pas de logis, répondit Laurence en hésitant, comme si elle eût interrogé des souvenirs déjà près de s’effacer. J’en avais un dans la rue Trop-va-qui-dure. Je m’appelle Jehanne de la rue Trop-va-qui-dure. Mais il paraît que ce logis n’est pas le mien, puisqu’elles m’ont crié de venir au Val d’Amour. Est-ce ici, le Val d’Amour ?
L’entretien ainsi commencé se poursuivit sur cette marche. Il en résultat avec évidence pour Ermine que Jehanne se trouvait sans logis. D’autres conclusions se présentèrent à son esprit, mais avec moins d’évidence. Elle devina vaguement qu’elle se trouvait en présence d’une inexplicable infortune. Elle précisa mieux que cette Jehanne n’avait dû jamais exercer le métier auquel, dès longtemps, elle s’adonnait. Le mystère de cette rencontre surexcita son imagination, et son bon cœur fit le reste.
– Écoutez, dit-elle enfin, voulez-vous demeurer avec moi, tout au moins quelques jours ? À côté de ma chambre, il y en a une autre qu’habitait Jacqueline, mon amie. Mais Jacqueline a été prise, voici trois jours, par les gens du guet, et Dieu sait quand elle sortira de prison. Allons venez.
Laurence se laissa conduire, et bientôt fut installée dans la chambre de Jacqueline, qui était attenante à celle d’Ermine Valencienne. Cette nuit-là, pour la première fois depuis bien longtemps, Laurence dormit d’un sommeil paisible. Elle se sentait protégée…
Le lendemain, la liaison ébauchée s’acheva. Il y eut une fort longue conversation que nous ne rapporterons pas, mais dont nous signalons un fragment. Ermine, au cours de cet entretien, avoua l’horreur que lui inspirait le Val d’Amour, et elle ajouta :
– Depuis six mois, avec Jacqueline, nous apprenons à broder. C’est difficile. Mais quand je saurai broder, je serai délivrée et je gagnerai ma vie, car je connais des dames de bourgeoisie et de noblesse qui paient généreusement les ouvrages de broderie.
– Broderie ? murmura Laurence pensive.
– Oui, c’est un talent qu’on n’apprend pas aux pauvres filles comme moi.
– Mais, dit Laurence, il me semble… oui… j’en suis sûre même… je sais broder, moi !
– Eh bien, voulez-vous que je vous dise ? Cela ne m’étonne pas. Même vous me diriez que vous savez lire et écrire, je vous croirais encore. À vous voir, à vous entendre, on devine bien, allez, que vous êtes de noblesse…
– Moi ! s’écria Laurence avec un rire contraint. Mais je vous dis que je suis Jehanne de la rue Trop-va-qui-dure !
Quoi qu’il en fût il demeura établi que Jehanne savait broder. Ermine battit des mains.
À partir de ce moment. Laurence, installée dans le logis d’Ermine Valencienne, vécut pour quelques jours une vie nouvelle. Se rendit-elle compte qu’elle recevait l’hospitalité d’une fille perdue ? C’est bien improbable. Il est possible en tout cas que sa générosité d’âme lui ait conseillé l’ignorance, Ermine, de son côté, mettait tout en œuvre pour échapper à cette sorte d’esclavage qu’elle subissait. Les écharpes, les voiles de hennins et même la lingerie n’allaient pas sans broderies. Dès le lendemain, Ermine trouva de quoi occuper le talent de sa nouvelle amie et assurer ainsi leur existence à toutes deux.
III – LE MORT VIENT CHERCHER SA PLACE
Donc le chevalier de Passavant était entré dans la chambre d’Ermine Valencienne, qui partit à la recherche d’un dîner, armée de cet écu d’or qu’elle avait gardé par une pensée de pur sentiment. Le chevalier, comme nous l’avons expliqué, mourait de faim ; il n’eut donc pas le courage de s’opposer à ce sacrifice que lui faisait Ermine. Il demeura et machinalement leva les yeux sur la femme qui entrait venant de l’autre chambre, la femme qu’avait appelée Ermine, celle qui tout simplement portait le nom de sa rue, sans doute parce qu’elle n’en avait pas d’autre.
Jehanne Trop-va-qui-dure s’avança vers Passavant et lui dit :
– Soyez le bienvenu, monsieur, dans le logis d’Ermine et de Jehanne. Ermine m’a conté la belle histoire de l’écu d’or et de la bagarre qui s’ensuivit. Sans vous connaître, je vous avais admiré.
Le chevalier demeurait immobile et muet, frappé de stupeur. Enfin, il murmura :
– Jehanne Trop-va-qui-dure… un nom de malheureuse perdue… On sait trop ce qu’est cette rue… Non, cette femme ne s’appelle pas ainsi !
L’attitude, la voix, et jusqu’aux paroles qu’elle choisissait pour s’exprimer, tout en effet révélait chez Jehanne des habitudes de dignité morale peu en harmonie avec ce nom significatif de Trop-va-qui-dure.
C’est ainsi, du moins, que le chevalier de Passavant s’expliquait cette stupeur qui l’accablait. Presque aussitôt, il eut la clef de son étonnement, et, presque malgré lui cria :
– Mais… oh ! mais je sais votre nom, moi ! Et ce n’est pas celui que vous dites !
– Mon nom ?… bégaya Laurence d’Ambrun.
Le chevalier frémissait. Toute son enfance s’évoquait à ses yeux, comme ces scènes de théâtre qu’on illumine tout à coup, au milieu d’une profonde obscurité. Oui, il la reconnaissait, en dépit des cheveux blancs.
Il s’avança vers Jehanne, lui saisit les deux mains, la regarda dans les yeux, et cria :
– Laurence ! Vous que j’appelais ma grande sœur ! Laurence ! Laurence d’Ambrun ! Voyez l’homme qui vous parle, c’est Hardy ! Souvenez-vous, Hardy de Passavant !
Laurence d’Ambrun secoua la tête d’un air farouche. En même temps elle tremblait. Elle avait cette physionomie d’obstination tragique de la femme qui refuse d’avouer, qui préfère la mort à l’aveu, sachant peut-être que l’aveu lui fera perdre plus que la vie. L’esprit de Saïtano était en elle. Tout ce qui était Laurence était aboli.
Le chevalier, devant ces gestes de dénégation, pâlit. Ses nerfs vibrèrent. Sa volonté s’exaspéra de ce qu’il y avait d’incompréhensible, d’improbable dans l’attitude de Laurence.
– Vous êtes Laurence, cria-t-il. Quoi ! Vous reniez le logis Passavant qui vous abrita ? Vous reniez ma mère qui vous recueillit ? Vous me reniez, moi, qui vous aimait en frère ?
– Je suis Jehanne, râla-t-elle, Jehanne Trop-va-qui-dure.
– Oh ! rugit le chevalier. Et votre fille vivante, entendez-vous ! Votre fille que je vais revoir, on me l’a juré, et que je puis remettre entre vos bras ! Roselys ! Roselys !…
Une sorte de secousse électrique fit chanceler Laurence, à ce nom qui fut lancé à toute volée. Elle se tordit les bras. Ses yeux se révulsèrent sous l’intense effort qu’elle faisait pour se libérer. Mais elle prononça dans une sorte de grondement, comme si les paroles lui eussent déchiré la gorge :
– Roselys ? Quel nom est cela ? Ma fille ! Je n’ai pas de fille !
– Roselys ! Roselys ! répéta le chevalier avec une rage désespérée.
– Il n’y a pas de Roselys ! dit Laurence d’un ton morne.
Passavant la lâcha, recula, la contempla, et enfin retomba dans le même étonnement que tout à l’heure. Mais, cette fois, il se disait : la ressemblance est prodigieuse… j’aurais juré… et ce n’est pas elle !
À ce moment, Ermine Valencienne rentrait dans le logis. Sur une modeste table, gaiement, elle plaça des plats d’étain et un gobelet de même métal.
Devant les victuailles, Passavant sentit gronder sa faim un instant oubliée. Il s’attabla donc et Ermine le servit, lui versa à boire. Le chevalier mangea silencieusement, ne perdant pas de vue Jehanne qui avait repris cet aspect paisible ou plutôt indifférent qui lui était habituel. Lorsque son appétit se trouva calmé, le chevalier se leva.
– Adieu, dit-il, et grand merci ; vous avez pour moi écorné ce pauvre écu ; je ne vous oublierai pas.
Passavant était ému, mais rien ne lui déplaisait autant que de laisser voir son émotion. Si l’adieu était un peu brusque, le ton le corrigeait. Ermine, un peu pâle, murmura :
– Vous m’aviez dit que vous n’aviez pas de logis…
– C’est vrai pour l’instant tout au moins.
– Je puis, reprit-elle en hésitant, je puis très bien partager pour cette nuit la chambre de Jehanne et vous laisser celle-ci… Je sais que peut-être, je ne suis pas digne d’offrir l’hospitalité à un chevalier tel que vous… mais…
Passavant lui prit les deux mains, se pencha sur elle, et, fraternellement, l’embrassa sur les deux joues en disant :
– Vous êtes digne d’offrir l’hospitalité à un prince, et je ne suis qu’un pauvre hère. Je ne veux pas que demain, au jour, on puisse dire qu’on a vu un homme sortir de chez Ermine Valencienne.
Ermine baissa la tête et pâlit, troublée par une des joies les plus pures qu’elle eût ressenties. Le chevalier la traitait en fille dont la réputation est à ménager. Elle avait donc une réputation ? Elle n’était donc pas une fille perdue ? Le jeune homme avait trouvé la flatterie la plus délicate qu’il pût offrir à la pauvre fille de joie. Il répéta doucement :
– Adieu donc. Je vous reverrai, soyez-en sûre.
Ayant jeté un dernier regard à Jehanne, adressé un dernier geste à Ermine, il sortit comme onze heures du soir sonnaient au jacquemart de l’abbaye de Cluny.
Il résulta de tout cela que cette mélancolie qui avait accablé le jeune homme disparut comme par enchantement. Une fois dans la rue, il se demanda avec surprise ce qu’il faisait là, et pourquoi il n’avait pas tout bonnement repris son gîte à la Truie Pendue.
Il se sentait fort. Il éprouvait même quelque gaieté. Son humeur narquoise lui revenait.
– Allons, se dit-il, tandis qu’un sourire sceptique errait au coin de ses lèvres, je sais maintenant une chose de plus, et tous les jours j’apprends à vivre : je sais maintenant qu’une pinte de bon vin est un remède contre les idées noires, si tant est que j’aie jamais eu des idées noires. J’en userai à l’occasion. Si je ne retrouve pas Roselys, je m’enivrerai comme Gringonneur, et tout sera dit. Comme c’est simple !
Pendant que Passavant discutait avec lui-même sur cette simplicité qui n’était peut-être pas aussi simple qu’il le disait, une autre scène se déroulait non loin de là, dans la maison de la rue aux Fèves. Là, vers l’heure même où le chevalier quittait le logis d’Ermine Valencienne, Saïtano allait et venait, achevant les derniers préparatifs de l’expérience qu’il voulait tenter : la même expérience qui avait échoué jadis parce que l’enfant mort s’était soudain redressé sur la table de marbre.
Le sorcier était inquiet.
Quelque répulsion que puissent nous inspirer ces effroyables pratiques, nous n’avons pas le droit de ne pas préciser. Saïtano cherchait l’absolu : l’élixir de longue vie, si l’on veut, – ou encore : le Grand Œuvre. En un mot, l’Immortalité. C’était le rêve de ce cerveau. L’expérience qu’il méditait devait lui prouver qu’un cadavre peut revivre en de certaines conditions. C’était l’acheminement à la découverte finale. Le document volé à Nicolas Flamel affirmait une double nécessité : d’abord, le cadavre qu’on voulait faire revivre devait être celui d’un adolescent mort de mort violente, mais sans effusion de sang. Ensuite, le sang qu’on devait infuser à ce cadavre devait être du sang vivant pris aux veines de trois adolescents.
Le sorcier allait et venait en grommelant son inquiétude.
Il fallait un mort et trois vivants.
Or Saïtano n’avait en tout et pour tout que Brancaillon, Bruscaille et Bragaille.
Il fallait que l’un des trois remplît l’office qu’il demandait jadis à Hardy de Passavant. Il fallait donc se contenter de deux vivants.
Saïtano fit un instant miroiter à la lumière du flambeau le liquide d’un flacon de verre qu’il tenait dans ses doigts maigres. Il grondait :
– Mort sans effusion de sang, voilà ce que dit le parchemin. Eh bien ! une seule goutte de ce poison va foudroyer mon homme. Une goutte sur la langue. Tout va bien. Oui, mais le parchemin dit : le sang de trois adolescents vivants… Je n’en aurai que deux, puisque je vais tuer l’un des trois… Mais Nicolas Flamel n’a-t-il pu se tromper ? Pourquoi trois et non pas deux ? Le parchemin assure qu’il faut des enfants. Mais pourquoi des enfants ?… Et puis ceux-ci ne sont pas des hommes, ce sont des enfants…
Avec un sauvage orgueil, il ajouta :
– Je les ai transformés, moi !
Il marcha sur les trois escabeaux et demanda :
– Toi, quel âge as-tu ?
– Quatorze ans, répondit Bruscaille en claquant des dents.
– Et toi ? Ton âge ? Dis-le au juste ?
– Quinze ans, répondit Bragaille en grelottant.
– Et toi ? Combien ? Ne mens pas !
– Seize ans ! répondit Brancaillon d’une voix où délirait l’épouvante.
Ils étaient là tous trois. La transformation qu’il avait opérée sur Laurence d’Ambrun, le sorcier l’avait tentée sur Bruscaille, Bragaille et Brancaillon. Par le souvenir surexcité, il les ramenait à douze ans en arrière dans leur existence. Les sensations mêmes qu’ils avaient éprouvées dans la nuit où ils furent délivrés par Passavant, ils les éprouvaient encore. Ils ne disaient plus : Nous sommes des hommes… Ils disaient parfois : Si nous étions plus forts ! Si nous étions des hommes !…
– Ce sont des enfants ! répétait Saïtano. Puisque tout en eux est revenu à l’âge d’adolescence, pourquoi leur sang seul ferait-il exception ?… C’est du sang d’adolescent, voilà le vrai !
Vers onze heures et demie, Saïtano s’approcha d’eux encore et les examina.
– Lequel ? se dit-il. Lequel des trois va être l’enfant mort sans effusion de sang ?
Il les inspecta avec une lugubre attention, et tout à coup, posa son doigt maigre, son doigt, de squelette sur le front de Brancaillon.
Brancaillon jeta un hurlement de terreur.
– À minuit, nous commencerons, dit Saïtano.
Les trois se mirent à hurler. Que devait-on commencer à minuit ? Ils ne savaient pas. Mais ils devinaient que ce serait atroce, et leur chair tremblait, leurs nerfs vibraient, leurs muscles se tendaient à se briser, dans l’effort de défense. Leur étrange clameur emplit la salle. Tout à coup, la porte s’ouvrit. Une femme parut. Elle dit :
– Vous n’entendez donc pas qu’on heurte à la porte ?
Saïtano sursauta, frissonna, et d’une voix de pathétique menace :
– Silence, vous, autres, ou je commence tout de suite !
Ils se tassèrent, les têtes rentrées dans les épaules ; ils se fussent aplatis. On n’entendit plus rien que les coups assenés sur la porte, du dehors.
– Qui frappe ? grelotta Saïtano. Sont-ils nombreux ?
Gérando haussa les épaules et répondit :
– Il n’y a qu’un homme dans la rue. Il porte l’épée.
– Tu es sûre qu’il est seul ? Qui est-ce ? N’est-ce pas un piège du prévôt ? – Silence, vous autres !
En parlant ainsi, le sorcier, rapidement, traversa les trois salles, arriva à la porte, sur laquelle, en dehors, on continuait à frapper, et il ouvrit un judas. Dans la nuit noire, il distingua confusément une ombre svelte qui s’agitait ; l’inconnu heurtait avec violence le marteau de fer.
– Qui êtes-vous ? dit rudement Saïtano. Passez au large…
– Non, par la mort du diable, c’est ici que j’ai affaire. Allons, ouvre !
– Au large, vous dis-je ! répéta Saïtano qui pourtant tressaillit au son de cette voix. Savez-vous à quelle porte vous frappez ? Savez-vous qu’il va être minuit, et que minuit c’est l’heure où les vivants n’entrent pas dans la demeure de Saïtano ?
– De Satan, veux-tu dire ! Mort ou vif, j’entrerai. Nous nous connaissons, mon maître. C’est pour la troisième fois que Hardy de Passavant franchira le seuil de cet antre.
– Hardy de Passavant ! rugit le sorcier.
– Oui. Ah ! Il paraît que ce nom est magique ! Il ouvre les portes !…
Le chevalier riait. Peut-être eût-il cessé de rire, malgré sa folle bravoure, s’il eût pu lire à ce moment dans l’esprit du sorcier. Saïtano tirait les verrous nombreux et compliqués, faisait tomber les barres, décadenassait les chaînes. Passavant riait de tout ce bruit de ferraille. Et à l’intérieur, dans les ténèbres, Saïtano riait, d’un rire silencieux, effroyable. Il songeait :
– C’est manifeste. Ce jeune homme m’est amené par les puissances qui veulent la réussite du Grand Œuvre. Sans cela, sa venue ici n’aurait aucun sens. Dommage ! Je le gardais pour ma vengeance. C’est lui qui eût frappé Jean de Bourgogne. Mais, bah ! Ce n’est pas Hardy de Passavant, c’est le mort qui vient reprendre sa place, c’est le mort qu’attendent les trois vivants. – Entrez, mon brave compagnon, ajouta-t-il humblement, dès que la porte fut ouverte.
Passavant pénétra dans la première salle, en laquelle, sur une table, Gérande déposait à ce moment un flambeau. En même temps, Saïtano refermait soigneusement la porte.
– Dites-moi, maître, fit Passavant narquois, je doute que l’enfer soit aussi bien barricadé que votre logis.
– C’est qu’il faut que je me défende, chevalier.
– Vous craignez donc les voleurs de nuit ?
– Non, chevalier, je crains les morts qui veulent ici entrer malgré moi.
– Eh ! par la Croix-Dieu, fit le chevalier un peu pâle, je suis vivant, moi !
– Qui sait ? dit Saïtano, froidement.
Hardy de Passavant sentit un long frisson le parcourir de la tête aux pieds. Mais, surmontant aussitôt cette faiblesse, il fixa un étrange regard sur Saïtano, et haussa les épaules.
– Je le disais bien, fit-il, mort ou vif. Assez ! J’ai à vous parler et à vous demander compte de certain mensonge…
Saïtano s’inclina.
– Daignez vous asseoir, fit-il. Prenez place dans ce fauteuil, seigneur chevalier, je suis à vous dans quelques instants… une petite opération à terminer… Vous m’avez interrompu au bon moment.
Passavant prit place dans le fauteuil qu’on lui désignait, ramena sa rapière en travers des genoux, et, tandis que Saïtano s’éloignait, lui cria :
– Prends ton temps. Je me trouve très bien ici, et, ma foi, j’y passerai le reste de la nuit…
– Oui ! dit Saïtano, qui disparut.
– Ainsi, continua le chevalier, ne te hâte pas de retirer du feu la chaudière où tu fais bouillir des têtes de crapauds, des vipères et des herbes maléficieuses.
Saïtano, dans la salle où attendaient les trois vivants, avait couru à l’armoire de fer qu’il ouvrit précipitamment. Il saisit un chiffon qu’il imbiba fortement d’un liquide incolore en ayant soin de ne pas respirer pendant qu’il se livrait à ce travail. Puis il plaça le chiffon sous son manteau rouge qu’il ramena prudemment par devant lui. Il avait une figure d’intense et lugubre rayonnement. Ses yeux flamboyaient. Il était effrayant.
Cette physionomie se transforma soudain lorsqu’il reparut devant le chevalier.
– Vous êtes sorcier ? fit celui-ci.
– Oui, seigneur, dit Saïtano en prenant place sur un escabeau.
– Pourquoi diable tenez-vous votre tête en arrière ? On dirait que votre manteau vous fait peur ?… Qu’importe, au surplus. Puisque vous êtes sorcier, vous devrez savoir ce qui m’amène.
– Ce n’est pas difficile dit froidement le sorcier. Vous venez du château de Mgr le duc d’Orléans, et vous me dites que vous voulez me demander compte de certain mensonge. C’est donc évident pour moi : vous avez appris que Roselys fut recueillie non par la reine, mais par la bonne duchesse Valentine ; vous avez appris en outre que Roselys n’est pas morte.
Le chevalier fronça les sourcils. Son terrible sourire d’ironie menaçante reparut au coin des lèvres.
– Pourquoi avez-vous menti ? demanda-t-il.
– Parce que j’avais alors intérêt à mentir, croyant que vous étiez vivant et que vous persistiez à vivre.
Le même frisson que tout à l’heure agita Passavant. Il renifla l’air, qui lui parut contenir un vague parfum. S’il eût cherché un nom à ce parfum, il l’eût appelé le parfum de l’Horreur.
– Ah ! ah ! fit-il en se raidissant, vous m’avez cru vivant ? Et pour cela vous avez menti ? Cette nuit, vous ne mentez plus… C’est donc…
– C’est que j’ai vu qui vous êtes, seigneur chevalier.
– Et qui suis-je ?
– Vous êtes le mort, dit Saïtano avec une affreuse tranquillité. Vous êtes le mort qu’attendent les trois vivants, avec impatience, j’ose l’assurer.
Cette fois, cette vague terreur qui s’était infiltrée dans l’esprit de Passavant plus encore par réminiscence de la scène d’autrefois que par l’attitude actuelle de Saïtano, ce sentiment disparut et le chevalier n’éprouva plus qu’une colère blanche. Il se leva, fit un pas sur Saïtano, et gronda :
– Je t’ai pardonné d’avoir voulu me tuer sur la table de marbre, mais ton hideux mensonge, tu vas le payer.
Saïtano ne perdait pas de vue le chevalier et suivait chacun de ses mouvements avec une froide attention.
– Je suis coupable, dit-il. Je dois payer, c’est juste. Mais comment ?
– Te tuer, dit le chevalier d’un ton où pétillait une sorte de gaieté vraiment étrange à ce moment, ce serait te faire trop d’honneur. Et puis, vois-tu, de savoir Roselys vivante, cela m’ôte le courage des résolutions décisives. Tout simplement, je vais te couper les oreilles.
En disant ces mots, le chevalier marcha sur Saïtano avec l’évidente intention de mettre sa menace à exécution. À ce moment, Saïtano bondit sur lui et lui sauta à la gorge. Passavant eut un rire mortel.
– Par dieu, cria-t-il, je t’aime mieux ainsi, au moins, je n’aurai pas de remords.
Et il se mit à serrer dans ses bras nerveux le corps fluet du sorcier. Presque aussitôt, il sentit que son étreinte faiblissait, que ses jambes chancelaient ; une vapeur noire s’appesantit sur ses yeux, une sueur glacée pointa à la racine de ses cheveux. Saïtano n’avait pas fait un mouvement de défense, il se laissait étouffer. Tout son effort, toute sa vigueur, il les employait à maintenir sur la bouche de Passavant le chiffon de linge.
Quelques secondes suffirent. Le chevalier essaya de se débattre, de respirer, mais plus il aspirait les vapeurs que dégageait le linge, plus il se sentait faible. Il lui parut tout à coup qu’il tombait d’une hauteur vertigineuse, il ferma les yeux, et ce fut fini.
Saïtano, suant et grondant, se redressa, terrible.
Alors il appela Gérande.
– Et vite, lui dit-il. Aide-moi à le porter sur la table de marbre.
Il souleva le chevalier par les épaules, Gérande le prit par les jambes. À eux deux ils le portèrent. Bientôt le « mort » reprit sa place sur la table.
– Il en a pour une heure à dormir, dit Saïtano. C’est plus de temps qu’il n’en faut pour avoir ici un mort violemment trépassé sans effusion de sang.
Bruscaille, Bragaille et Brancaillon avaient vu cela. Tout de suite ils reconnurent le chevalier. Alors leurs cheveux se dressèrent, leurs bouches se tordirent dans le cri d’agonie, leurs yeux reflétèrent l’épouvante qui submergeait leurs âmes.
– Quelles clameurs ! grelotta Gérande en se sauvant.
Saïtano se frotta joyeusement les mains. Il cria :
– Hé ! Qu’avez-vous à geindre ? N’êtes-vous pas contents ? Allons, mes braves, taisez-vous ! Nous sommes au complet, car voici, entendez-vous ? voici que le mort est venu reprendre sa place !
Le reste se perdit dans le bruit effroyable ; on n’entendit plus que les hurlements des trois vivants. Saïtano, cependant, avec activité, commença à dégrafer le pourpoint pour mettre à nu la poitrine.
IV – « ACTA GESTAQUE »
En cette même nuit où Passavant se présentait au logis de Saïtano, divers personnages de l’Hôtel Saint-Pol, obéissant à la tortueuse et profonde mathématique de cette force inconnue qui assemble les éléments de drame éparpillés, exécutaient des gestes que nous devons relater à ce moment de notre récit.
En tête de ces personnages, nous devons placer le chien « Major ». Nous l’avons laissé dans le bâtiment aux pâtisseries où l’avait attiré le subtil valet stylé par Isabeau.
Ce chien de grand luxe, dans les yeux de qui ne pétillait pas cette malice qu’on voit en certains de ses confrères, outre qu’il était bête, avait aussi le tort d’être gourmand.
Grâce à sa gourmandise, Major se trouva emprisonné. Dès qu’il s’en aperçut, il se mit à bondir, à hurler, renversa des étagères où s’alignaient des pâtisseries variées, fit un vacarme extraordinaire, le tout en pure perte.
Ces hurlements et ces bonds cessèrent tout à coup. Major venait d’apercevoir sur le carreau de nombreuses friandises qu’ils avaient renversées. Il se dit alors que la prison avait du bon. En raison de sa bêtise, Major avait la gloutonnerie immodérée ; il n’était pas capable, comme la plupart des chiens, de savoir s’arrêter à temps ; bref, il eut une indigestion. On l’entendit gémir et se lamenter.
Finalement, il s’endormit du sommeil des goinfres, qui est lourd, pesant et sans rêves.
Lorsqu’il se réveilla, il faisait jour. Il vit la porte ouverte, et, la queue basse, fila rapidement non sans avoir jeté à droite, à gauche, un dernier regard – peut-être dans l’espoir de se procurer une deuxième indigestion. Il n’y avait plus rien. Il avait tout dévoré.
Major erra quelques heures dans les vastes jardins, sans même se demander pourquoi on l’avait emprisonné, et pourquoi on le relâchait. Il se demandait seulement pourquoi on l’avait gavé de gâteaux. Vers le moment où Honoré de Champdivers lui servait sa pâtée – soin que le vieux brave ne laissait à personne – Major s’introduisit dans les appartements d’Odette avec cet air d’innocente indifférence qu’ils prennent quand ils ont une faute à se faire pardonner.
Alors il alla se coucher aux pieds de sa maîtresse.
Odette, assise dans son fauteuil à dossier sculpté suivant la mode de ces temps gothiques, semblait perdue en une lointaine rêverie. Parfois un soupir gonflait son sein. Parfois aussi une larme tombait de ses yeux. Une profonde mélancolie pesait sur le front de la jeune fille. Et ce n’était pas au roi Charles qu’elle songeait, à ce fou qui, en ce moment, dormait, abattu par la crise que nous avons signalée. Elle ne songeait pas non plus à Jean Sans Peur ; et pourtant elle savait maintenant que cet homme était son père et la curiosité, à défaut d’autre sentiment, eût pu porter vers lui ses rêveries. Elle ne songeait pas non plus à Passavant, – et pourtant il était présent au fond de son cœur. Elle ne songeait pas même à cette reine qui était pour elle une vivante menace de mort.
Toute la pensée d’Odette allait à Honoré de Champdivers et à la dame Margentine.
Elle avait appris à les aimer, à les respecter, ces deux êtres de bonté, de dévouement et de tendresse. Dans le fait, ils étaient tout pour elle. Eux disparus, il lui semblait que tout lui manquait à la fois de la vie.
Disparus ? Le roi l’avait affirmé : il était impossible qu’on eût attenté à leur vie. Mais une de ces mystérieuses douleurs, plus fortes que la raison et les raisons, disait à Odette que la vérité devait être plus terrible : Champdivers et Margentine étaient morts !… À ce moment, son regard tomba sur le chien. Elle tressaillit d’un faible espoir, et caressa la tête de Major en murmurant :
– Et pourtant : tu les eusses défendus, toi ?
Vers ce même moment, par une sorte d’affinité des gestes divers qui finissent par composer un événement, Isabeau se penchait vers la tigresse Impéria, et murmurait :
– C’est toi, n’est-ce pas, c’est toi qui me vengeras ?
Ceci se passait dans cette salle spécialement aménagée pour les ébats de la tigresse, vaste, sans meuble autre que cet entassement de fourrures où Isabeau se reposait.
La reine était presque joyeuse. Mais il paraît que cette joie qu’elle manifestait ne présageait rien de bon pour ses serviteurs, car un grand silence régnait dans le palais.
La reine passa cette journée tout entière en tête à tête avec la tigresse.
La nuit s’écoula sans incident digne de remarque.
C’était cette nuit où le chevalier de Passavant dormit sur le plateau du Voliard, sous la pluie, attendant l’heure de se rendre au château du duc d’Orléans.
Le lendemain matin, Isabeau de Bavière, plus joyeuse encore que la veille – et plus terrible, parut-il à ceux qui la connaissaient bien – tint sa cour et annonça que sous peu de jours aurait lieu dans son palais une nouvelle fête à laquelle elle invitait, dit-elle, tout ce qui était jeune et gracieux.
– Je ne veux pas autour de moi de figures moroses, ni laides, ajouta-t-elle. Ici, c’est le royaume de la Beauté, ici, c’est la capitale de l’amour, ici, c’est le palais de la joie.
À midi, la reine rentra dans la salle réservée à la tigresse Impéria.
Bois-Redon, capitaine des gardes, entra et dit gravement :
– Majesté, on apporte les viandes de Sa Seigneurie Impéria.
Il ne faut pas croire que le brave Bois-Redon plaisantait. On ne plaisantait avec Isabeau que lorsqu’elle le voulait. On plaisantait, on riait, on pleurait par ordre. Ces paroles du capitaine étaient l’ordinaire formule employée dès qu’il s’agissait de la tigresse favorite.
Derrière Bois-Redon se montrait un colosse habillé de vêtements en cuir épais et portant à la main une fourche en acier, à deux dents aiguës : c’était le chef des gardiens des fauves.
Derrière lui venaient deux hommes portant un large panier au fond duquel on voyait des quartiers sanglants.
Impéria se leva, le mufle tendu, les narines ouvertes, l’œil en feu.
– Qu’on remporte ces viandes ! dit froidement Isabeau.
Bois-Redon, dressé à l’obéissance passive, se tourna vers les porteurs et fit un geste. Mais le gardien des fauves, d’abord stupéfait par cet ordre, entra rapidement dans la salle, ploya le genou et dit :
– Majesté, si l’animal ne mange pas, il sera tout à l’heure impossible d’en approcher.
La reine laissa tomber sur l’homme à demi prosterné un regard de dédain sauvage, et elle prononça :
– Tu veux donc être pendu, toi ?
Le gardien des fauves se redressa, déposa sa fourche d’acier dans un coin de la salle, puis s’inclina profondément.
– La reine, dit-il, aura bientôt besoin de cette arme. Je la lui laisse.
Cette fois, Isabeau approuva d’un signe de tête. Bois-Redon, le gardien, les porteurs disparurent. Impéria, de son pas souple, marcha jusqu’à la porte, puis se tourna vers la reine et leva son regard luisant.
– Mais oui, dit Isabeau en riant, tu vas jeûner, ma belle. Je le veux ainsi. Vas-tu te fâcher ?
La tigresse commença à battre l’air de sa queue puissante, et fit entendre un grondement.
Isabeau, d’une voix calme, mais qui eût fait frissonner ceux qui l’eussent entendue et comprise, ajouta :
– Cette nuit, il faut que tu aies faim…
Puis, à coups de cravache, elle repoussa la tigresse dans la salle spéciale et ferma la porte. Elle se jeta sur son divan de peaux entassées, et, immobile, les paupières closes, les bras derrière la tête, se mit à rêver. Toute la journée, on entendit les rugissements de la tigresse.
Le soir, c’est-à-dire vers le moment où Passavant entrait dans Paris, presque aussi affamé qu’Impéria, Isabeau appela Bois-Redon.
Le capitaine entra, un peu pâle.
Pendant une longue minute, Isabeau le regarda dans les yeux. Sans doute, elle comprit ce qui se passait dans l’esprit de Bois-Redon. Elle haussa les épaules. Froidement, elle demanda :
– Est-ce fait ?…
– Oui, Majesté, répondit sourdement le capitaine. Cela n’a pas été sans mal. Mais enfin c’est fait. Le chemin est libre… le chemin, ajouta-t-il en frissonnant, qui mène à la chambre de la demoiselle de Champdivers !…
Isabeau saisit ce frisson. De nouveau son regard, d’une clarté mortelle, plongea jusqu’à l’âme de cet autre fauve qu’était Bois-Redon. Fauve, oui, mais fauve non compliqué.
Bois-Redon criminel savait à peine s’il était ou non criminel. Au fond, il n’avait qu’une pensée : obéir à la reine !… Isabeau posa ses deux mains délicates sur les robustes épaules du colosse, et on eût dit que sous ce poids à peine sensible, il était prêt à fléchir. D’une voix grave, la reine prononça :
– Tu trembles, Bois-Redon ? Tu as peur ? Dis-le.
– Oui, dit Bois-Redon, j’ai peur. C’est vrai. Jamais je n’ai eu peur ainsi.
Un sourire livide glissa sur les lèvres d’Isabeau. Elle reprit :
– Tu as peur d’Impéria ?…
– Non, gronda le capitaine, dût-elle me dévorer sous vos yeux ! Je n’ai pas peur de mourir.
– Alors ?… Voyons, parle, dis-moi toute ta pensée. D’avance, je te pardonne.
– J’ai peur de ce que nous allons faire. C’est trop horrible.
Et il se courba, tête basse, implorant ce pardon qu’on lui avait promis d’avance et sur lequel il ne comptait guère. La reine se recula. Bois-Redon trembla. Isabeau, une minute, se tût, puis :
– Eh bien, va-t-en…
– Majesté ! bégaya Bois-Redon.
– Va-t-en, puisque tu as peur. Va-t-en. Je te chasse. Que jamais plus je ne te voie devant moi. Tu vois, je te pardonne. Je ne te fais pas saisir. Je ne te fais pas jeter dans cette Huidelonne qui t’inspire tant de terreur. Je ne t’exile même pas de Paris. Je te chasse de ma présence, voilà tout. Va-t-en.
Il y eut un souffle court de bœuf qui ne veut pas se laisser assommer. Il bredouilla :
– Tuez-moi, j’aime mieux cela… Vous quitter… m’en aller… ne plus vous voir… Ah ! vous en parlez à votre aise, Majesté. Mais est-ce que c’est possible ? Est-ce qu’on peut vivre en respirant un autre air que le vôtre ? Est-ce qu’on peut vivre sans vous voir ? J’aime mieux qu’on me crève les yeux ou qu’on m’arrache le cœur, ce que vous voudrez, mais ne me condamnez pas à cela. Que suis-je, Majesté ? Un gentilhomme dont la vie date du moment où là-bas, le jour de votre arrivée en Champagne, vous avez abaissé vos yeux sur lui. Depuis, je suis votre chien. Je ne vis que ce que vous me permettez de vivre. Je mourrai quand vous voudrez. Allons, Majesté, on tue son chien quand on n’en veut plus, on ne le chasse pas.
Le colosse parlait, avec un vague étonnement de s’entendre si longuement parler. Il ne pleurait pas, mais chacun de ses accents était un sanglot.
Il y avait en lui de la stupeur, de l’effarement, de la douleur, il ne savait quoi. La reine le considéra avec orgueil. Et, en réponse à cette naïve plainte, à cette poignante lamentation du capitaine, elle se dit seulement :
– Celui-ci est bien à moi !
Et du même ton qu’elle employait pour pardonner à Impéria :
– C’est bien, dit-elle, tu resteras.
Alors le colosse eut un soupir pareil à un râle de joie. Il était bien dompté, celui-là. Isabeau reprit :
– Oui, mais plus de pâleurs, hein ? Plus de regards effarés, dis ? Plus de battements de cœur, n’est-ce pas ? Rien que de l’obéissance. Tu l’as dit, je suis tout pour toi. Si je meurs, tu meurs, est-ce vrai ?
– C’est vrai, dit Bois-Redon, d’un accent de profonde sincérité.
– Eh bien, je mourrai si cette fille vit, tu comprends ? Je ne veux pas qu’elle soit la prisonnière de Jean de Bourgogne, car moi, j’aime Jean de Bourgogne, tu comprends ?
Bois-Redon accueillit sans la moindre surprise ni le moindre chagrin cette déclaration de la reine. Au fait, que lui importait qu’elle aimât ou non ? Lui n’était que le chien.
– Majesté, dit-il en reprenant, cet air de féroce candeur qui était la marque de sa physionomie, s’il ne s’agit que de la demoiselle de Champdivers…
Un geste redoutable acheva d’expliquer sa pensée de meurtre.
– Et demain, triple brute, tout le monde saurait que la reine, la méchante reine, a fait meurtrir l’Ange de l’Hôtel Saint-Pol… Non, capitaine, je ne suis pas encore assez reine pour décréter la mort et faire exécuter la sentence. Tandis qu’un accident est dans la main de Dieu. Un fauve peut s’échapper des cages et entrer dans un appartement. Cela s’est déjà vu.
Quelques minutes, Isabeau demeura pensive. En dessous, elle étudiait Bois-Redon. Mais le capitaine ne bronchait plus. La reine eut un sourire de satisfaction. Elle continua :
– Que fait le roi ? Es-tu parvenu à le savoir exactement !
– Le roi ne sortira pas cette nuit de ses appartements, car il est aux mains des deux guérisseurs que lui envoie Jean de Bourgogne.
La reine tressaillit légèrement :
– Pierre Tosant et Martin Lancelot sont-ils donc arrivés ?
– Ces deux bons ermites sont auprès de notre sire le roi, dit Bois-Redon, étonné de cette émotion que manifestait la reine. Ils ont entrepris l’exorcisme qui, paraît-il, durera toute la nuit. C’est du moins tout ce que j’ai pu savoir.
– C’est bien, cela suffit. Retire-toi. Tiens-toi prêt à m’accompagner quand je t’appellerai et sois convenablement armé.
Bois-Redon eut un sourire vainqueur et loucha sur sa dague. Cela voudrait dire que, cette arme au poing, il ne craignait rien ni pour lui, ni pour la reine. Puis il sortit.
Isabeau demeura immobile à la même place. Elle écoutait les rugissements d’Impéria. Ces plaintes du fauve affamé devenaient en apparence moins terribles.
Isabeau écoutait cela, ou du moins se donnait le prétexte d’écouter. En réalité, elle songeait. Sa rêverie, plus loin que Bois-Redon, que Jean Sans Peur, que le roi, et même qu’Odette de Champdivers, allait chercher ce jeune chevalier que, dans la forêt de Vincennes, elle avait vu étincelant de bravoure, et qui l’avait sauvée des mains des Écorcheurs.
Passavant n’était pas mort.
Passavant s’était dressé entre elle et Odette.
La reine se sentait frémir. Elle s’excitait à la colère contre ce Passavant sans l’intervention de qui Odette eût succombé à l’attaque des Bourguignons. Et cette colère, elle s’étonnait, elle s’irritait de ne pas la trouver au fond de son cœur. Elle songeait :
– S’il était à moi, que ne pourrais-je entreprendre ! Il me vengerait de Jean Sans Peur, lui ! Il me vengerait de ce misérable fou ! Il me vengerait de l’intrigante ! Il me vengerait de ce Berry qui, dans l’ombre, conspire ma perte ! Il me vengerait de ce Bourbon qui m’insulte de sa bienveillance !
Longtemps elle rêva ainsi, et enfin, secouant la tête, d’une voix plus lointaine, elle répéta :
– Si Passavant était à moi… Allons ! gronda-t-elle tout à coup.
L’heure d’agir était venue. Elle appela Bois-Redon, et lui donna quelques ordres rapides. Bois-Redon s’élança. En somme il fallait s’arranger pour que la tigresse, une fois lâchée, ne trouvât aucun être vivant sur son passage.
Au bout d’un quart d’heure, Bois-Redon revint, et comme il avait annoncé que l’entrée du parloir était libre (sans doute par trahison), il annonça cette fois que libre était le chemin qui y conduisait.
– C’est bien. Sors, maintenant. Et quand tu me verras paraître, tu me suivras à distance. Tu seras prêt à tout.
– Mais, commença Bois-Redon, allez-vous donc seule…
– Sors, te dis-je ! Seule… Oui. Sois prêt à tout, non contre Impéria qui n’est qu’une tigresse et pour qui je suffis, mais contre des hommes, si nous en rencontrons.
Bois-Redon jeta un dernier regard d’admiration sur la reine, d’épouvante sur la porte derrière laquelle on entendait haleter Impéria – et il sortit.
Alors, rapidement, Isabeau procéda à une toilette qui était comme son branle-bas de combat. Elle supprima de son costume tout ce qui était flottant, tout ce qui pouvait être facilement agrippé, et elle se trouva cuirassée et vêtue à peu près comme le chef des gardiens. Elle saisit la fourche d’acier, et elle ouvrit la porte.
D’un bond, Impéria fut dans la salle.
Sans attendre, sans lui parler, sans la prévenir, la dompteuse marcha sur la tigresse, la fourche en arrêt. Le fauve recula, la gueule enflammée, battant l’air de ses griffes. Impéria reculait, la fourche sur le naseau. Elle se trouva acculée à un angle de la salle et s’y dressa, furieuse, plus étonnée encore que furieuse.
L’instant terrible était venu. Ou Isabeau serait tuée, ou le fauve serait dompté. La tigresse tenta le suprême effort. Elle se laissa retomber sur ses pattes et se ramassa pour bondir. Isabeau, effroyable peut-être à ce moment, mais aussi digne d’admiration, vit que le bond allait se produire, et elle attaqua la première. La fourche d’acier vigoureusement maintenue sur le nez de la tigresse, de la main droite elle la cravacha à coups redoublés. Les pointes de la fourche, violemment, frappèrent. La bête se débattait pour sortir de cet angle. Cette lutte émouvante et hideuse dura quelques secondes à peine.
Tout à coup, Isabeau jeta sa cravache et déposa la fourche d’acier.
La bête vaincue, allongée sur le tapis, râlait.
Dans ses yeux il y avait presque de la tristesse. Impéria ne comprenait pas. Isabeau ne lui adressa pas un mot. Seulement elle la fixait durement.
– Tu vois, dit-elle enfin, je suis la plus forte. Ainsi, n’essaie pas de résister !
Elle saisit un collier de cuir épais et le passa au cou de l’animal. Ce collier était là, tout préparé d’avance. Une chaîne d’acier assez courte s’y adaptait. Isabeau reprit sa cravache.
– En route, dit-elle.
Impéria obéit, stupéfaite peut-être, mais amassant en elle une rage de fureur qui, dans quelques minutes, moins peut-être, allait faire explosion. Isabeau se rendait compte avec une lucidité effrayante des dispositions d’esprit de la tigresse. En route ! Et la tigresse obéissait.
La grande galerie parcourue, le vaste escalier descendu, Impéria se trouva en plein air et eut la velléité de s’arrêter. Un violent coup de cravache la cingla. En route !… De ci, de là, des ombres fuyaient.
À vingt pas derrière venait Bois-Redon. La tigresse marchait presque paisiblement. Peut-être était-elle encore sous l’obsession de la stupeur. En route ! Dans la nuit, bientôt, se profila le palais du roi. Impéria se vit bientôt dans un large et long couloir. Au bout de ce couloir, une porte s’ouvrit. Qui ouvrit la porte ? Nous l’allons dire. Pour l’instant, il y a ceci : la porte fut ouverte, voilà tout.
La tigresse, au même instant, se sentit débarrassée de son collier. Elle demeura une seconde immobile, battant lentement l’air de sa queue onduleuse. Puis, d’une allure formidablement paisible, elle se remit en marche – en marche vers la porte ouverte là au fond du couloir !…
Maintenant, nous devons revenir à Odette de Champdivers.
En cette journée, elle s’était, comme d’habitude, préparée à recevoir la visite du roi Charles, et, comme il ne paraissait pas, elle-même, ainsi que cela lui arrivait parfois, s’était mise en route vers les appartements royaux. Mais à la porte de la grande antichambre remplie de gens d’armes, un capitaine avait annoncé à Odette que nul, pas même la reine, ce jour-là, ne pouvait entrer chez le roi, vu que deux saints ermites tentaient de l’exorciser afin de le guérir de son mal.
Odette était donc rentrée dans son appartement, étonnée, inquiète de cet exorcisme.
Une nouvelle gouvernante se présenta, se disant envoyée par le roi lui-même pour remplacer dame Margentine et veiller à la sûreté de la demoiselle de Champdivers.
Odette accepta la nouvelle gouvernante, et remettant à plus tard de l’installer dans ses fonctions, lui indiqua d’un geste la chambre qu’avait occupé dame Margentine. Quelques minutes plus tard, elle ne songeait déjà plus à la nouvelle venue.
Simplement, elle avait donné l’ordre qu’aucune de ses femmes ne vint la déranger.
Odette voulait être seule.
Une vague inquiétude la prenait. Pourquoi ne pouvait-elle arriver au roi ? Pourquoi le roi ne venait-il pas à elle ? Qu’était-ce que cet exorcisme qu’accomplissaient les deux saints ermites ? Elle sentait, elle comprenait que quelque chose se préparait. Mais quoi ?
Sur le soir, elle appela une de ses servantes favorites avec laquelle, parfois, elle aimait à s’entretenir. Au lieu de cette jeune fille, ce fut la nouvelle gouvernante qui se présenta.
Ce fut assez étrange. Cette femme semblait très familiarisée déjà avec les habitudes d’Odette, et les divers meubles et objets des appartements en général et de ce petit salon en particulier. Sans qu’on le lui eût demandé, elle alluma les cires, baissa les lourds volets qui protégeaient les fenêtres. Odette réclama sa suivante. La gouvernante assura qu’elle l’allait chercher elle-même, et sortit.
Mais plus d’une heure se passa.
Odette s’était jetée dans son grand fauteuil et se laissait aller à ses regrets, à ses rêveries. Major allait et venait en grondant parfois. Neuf heures sonnèrent. Le bruit de la cloche fit tressaillir la jeune fille, et elle se souvint alors qu’elle avait inutilement demandé sa suivante. Elle appela. Ce fut encore la gouvernante qui se présenta, silencieuse, onduleuse, glissante et souriante.
Odette remarqua alors que cette femme, solidement bâtie, devait être d’une force peu commune. Elle la regarda avec plus d’attention et, la voyant si humble, si soumise d’attitude, se reprocha l’insurmontable répulsion qu’elle sentait grandir en elle.
Le chien grondait sourdement.
La gouvernante le tenait à l’œil.
Cette inquiétude qu’Odette avait déjà éprouvée dans la journée s’empara encore d’elle.
– Faites venir mes suivantes, dit-elle – et sa voix tremblait un peu.
– Les suivantes ! s’écria la gouvernante en levant les bras au ciel. Dieu me pardonne ! Mais ai-je donc mal entendu ? Ou mal compris ? Quel malheur ! Je les ai toutes renvoyées, car vous m’avez assuré que vous vouliez être seule…
Odette pâlit. Elle jeta un rapide regard sur cette femme et, sans rien dire, courut jusqu’à l’antichambre où, d’après les ordres du roi, des gardes devaient se tenir en permanence.
Non seulement il n’y avait aucun garde dans l’antichambre, ni dans cette salle des gardes où le sire de Bois-Redon avait opéré le tour de cartes qu’on a vu, mais encore, les portes extérieures étant fermées, Odette vit qu’il lui était impossible de sortir : elle était prisonnière.
Ce ne fut pas de la crainte qu’elle éprouva alors, mais une sorte d’indignation. C’était une âme vaillante sur qui la peur avait peu de prise. Elle revint au petit salon et, d’un ton bref :
– Où sont mes gardes ?
– Le roi est le maître, dit la gouvernante. Le roi a donné des ordres. Hélas ! si j’avais prévu que ces ordres pussent vous déplaire… je vous eusse tout au moins prévenue.
– Quels ordres ? Parlez clairement.
– Le roi a voulu que tous les gens d’armes du palais fussent pour cette nuit massés autour de ses appartements. Je n’y puis rien, vraiment. Et je vois que vous me regardez comme coupable…
Odette frémissait. Elle fit lentement le tour du petit salon, et enfin, revenant s’arrêter devant cette femme, d’une voix étrangement douce, elle lui dit :
– Sa Majesté la reine a voulu me faire saisir l’avant-dernière nuit. Par quel miracle je fus sauvée, Dieu le sait… Dieu et quelqu’un qui sans doute a été écarté, puisqu’il n’est pas ici pour me défendre. Ce qu’on n’a pu faire cette nuit-là, on va maintenant le tenter. Soit. C’est donc ce soir que je mourrai. Car votre maîtresse, je pense, n’espère pas m’avoir vivante ?
– Ma maîtresse ? balbutia la femme.
– Sans doute, dit tranquillement Odette… Votre maîtresse la reine. Vous êtes ici pour me trahir, pour me livrer… Taisez-vous… Pas un mot… Écoutez seulement. Je ne parle pas à votre cœur, car vous n’eussiez pas accepté pareille besogne si vous aviez un cœur, je parle à votre intérêt. Vous devez aimer l’argent. Puisque vous avez accepté de me trahir, vous pouvez trahir votre maîtresse. Vous pouvez le faire sans danger…
– Madame, ah ! madame, quelles choses affreuses dites-vous ! balbutia la femme.
– La vérité est souvent affreuse, dit Odette. Vous pouvez me sauver sans danger. Je ne vous demande pas de me faire sortir. Je ne veux pas sortir d’ici, même si je vois la mort. Mais vous pouvez parvenir jusqu’au roi, et lui dire… ce qui doit se passer ici tout à l’heure.
– Mais quoi ! cria la femme en sanglotant. C’est horrible d’être ainsi accusée !
Odette tourna le dos, courut à un admirable petit bahut qu’elle ouvrit, saisit une cassette, la porta sur la table, et en versa le contenu, – bracelets, chaînes, anneaux, diamants, pierres de toutes couleurs dont les feux se mêlaient en une féerique flambée.
Cette flamme se répercuta pour ainsi dire dans les yeux de la gouvernante.
Odette, qui ne la perdait pas de vue, eut une seconde d’espoir. Mais cet espoir s’éteignit aussitôt, en même temps que s’éteignit dans l’œil de la femme la flamme d’avarice.
Odette comprit qu’elle était perdue. Une fois encore, elle fit le tour du petit salon, la tête basse, et encore, elle vint s’arrêter devant l’espionne. Et ce que dit alors la victime fut terrible. De sa voix douce :
– Dites-moi au moins comment je dois être tuée…
Cette fois, la femme tressaillit violemment, fut secouée d’un frisson, comme si on l’eût frappée au cœur d’un coup de poignard.
– Je ne sais pas ! répondit la femme, dans un souffle.
Ce fut tout. Il n’y eut plus qu’un silence affreux. Odette baissa encore la tête. Quand elle la releva, elle s’aperçut que la femme avait disparu…
Odette lentement, alla reprendre sa place dans le fauteuil et, au bout de quelques minutes, des larmes s’échappèrent de ses yeux. C’était le tribut qu’elle payait au regret. Le regret de la vie ! Si jeune, avec tant de choses dans le cœur, quand la vie s’ouvrait à elle, radieuse, belle, charmante, auréolée de purs rêves d’amour qui la faisaient pareille à une de ces exquises aurores de printemps, il fallait mourir !…
Très vite, cette rêverie suprême prit une forme précise.
Dans cette minute où elle allait mourir, Odette sentit que, pour elle, regretter la vie c’était regretter le chevalier de Passavant.
Le chien allait et venait, reniflait, grondait.
Odette n’y prenait pas garde.
Un bruit léger, tout à coup, la fit tressaillir. Elle leva les yeux et vit que la porte du petit salon venait de s’ouvrir. Dans le long couloir, elle entrevit une forme qui fuyait. C’était la femme, c’était la nouvelle gouvernante. Ce fut une indistincte et rapide vision qui s’évanouit.
– Ô ma bonne et chère Margentine ! murmura Odette. Ô mon pauvre Champdivers, adieu, je vais…
Elle n’en dit pas plus long. À cet instant même, elle fut debout, tremblante, saisie d’horreur. Ses yeux agrandis par l’épouvante se fixaient sur un être qui, le long du couloir, venait d’un pas souple et silencieux.
Comme dans les cauchemars, elle voulut fuir et se sentit rivée à sa place. La nausée de la terreur souleva son cœur. Elle fut livide. La sueur coula sur son front. Elle regardait. Elle eût tout donné pour pouvoir détourner ses yeux.
La tigresse !… Impéria !… La tigresse était là, à quatre ou cinq pas, fouettant l’air de sa queue, apprêtant son onduleuse échine pour le bond. Elle avait la gueule entrouverte. Un souffle chaud s’en échappait.
Odette eut un faible gémissement, et, les jambes brisées, retomba dans le fauteuil.
Puis elle ferma les yeux.
Presque au même instant, elle les rouvrit : le fauve venait de pousser son rugissement… et ce que vit alors Odette lui apparut comme la suite nécessaire, fatale, du cauchemar qui l’étreignait.
Au moment où la tigresse allait bondir, un autre être, un animal, avec une tranquillité majestueuse et terrible, s’était placé devant Odette.
C’était Major !
Le chien leva les yeux vers sa maîtresse. Clairement, il dit : N’aie pas peur.
Étonnée d’abord, une seconde hésitante devant cette rencontre imprévue, la tigresse, lentement, se mit à ramper vers le chien. Lui ne bougea pas. Seulement il frissonna. Son poil hérissé parut agité comme des vagues. Il continua à regarder le fauve. Peut-être le pauvre Major se disait-il que mieux valait ne pas voir. Mais son grondement se fit plus sourd, plus profond.
D’un battement formidable de sa queue, la tigresse renversa une table. Elle eut un long bâillement qui se termina en rugissement, et elle s’avança…
À cet instant, comme une sensation de bruits irréels, Odette entendit deux jappements brefs, et comme une vision d’image sans existence, au fond des chaos de son rêve, elle vit un entrelacement confus des deux êtres en présence. Tout de suite, les brumes qui enveloppaient ces choses, comme emportées par un souffle de tempête, se dissipèrent, – et Odette vit !
Major avait sauté sur la tigresse et l’avait coiffée.
D’un coup de sa mâchoire de fer, il lui avait arraché une oreille.
De son côté la tigresse, d’un coup de patte, avait labouré le cou du chien.
Une large flaque rouge s’étalait, et lentement gagnait de la place. Une violente odeur de sang, parmi l’âcre odeur du fauve, montait.
La lutte avait duré une demi-seconde. Et maintenant les deux bêtes, prenant de la réflexion et ramassant des forces, se regardaient dans leur attitude première : Impéria, l’échine ramassée, les lèvres soulevées par un rictus de haine, battant l’air de sa queue, très lentement ; Major, placé de côté, semblant ne pas voir l’ennemi, le poil hérissé, les dents prêtes, l’œil féroce, la tête un peu basse. Un double grognement sortait de là, mais à peine sensible.
En somme, ils étaient comme avant l’escarmouche. Seulement Impéria avait au côté gauche de la tête l’affreuse blessure de son oreille arrachée – et une large raie sanglante courait sur le cou allongé de Major.
Brusquement eut lieu la deuxième attaque. Impéria se détendit et tomba sur Major. Le chien roula en boule. Il y eut un rugissement rauque et un furieux jappement très clair, puis des grognements confus. Il n’y eut plus qu’une mêlée informe d’où parfois jaillissait une griffe, où on eût pu entrevoir la gueule sanglante du chien et le mufle rouge de la tigresse. Cela apparaissait et disparaissait. Un hurlement de douleur, un bâillement de souffrance et de rage, quelquefois, montaient de ce groupe tordu, enlacé, roulant d’un bout à l’autre de la pièce, parfois se dressant tout entier, comme composé d’un seul être, puis retombant à plat.
Aussi soudainement qu’elle avait commencé, la bataille cessa.
Elle avait duré une vingtaine de secondes.
Maintenant les deux bêtes se tenaient à cinq pas l’une de l’autre. Toutes deux étaient méconnaissables. Major à demi éventré, couturé de larges balafres rouges ; il tremblait sur ses pattes, comme on les voit vaciller à l’heure de l’agonie ; il tenait la tête basse, le museau sur le tapis ; son poil ne se hérissait plus, sa voix ne grondait plus, mais son œil, de côté, surveillait encore la tigresse. Impéria râlait. L’oreille droite était arrachée comme la gauche. Son sang coulait par cinq ou six profondes ouvertures à la gorge. La tigresse était allongée sur le tapis. Son flanc haletait. Ses griffes rentraient et sortaient.
Deux minutes se passèrent.
Impéria se remit debout. Major s’apprêta à la lutte suprême.
Et la bataille recommença.
Avec une sorte de gémissement, Impéria leva la griffe et tenta de labourer le crâne de l’ennemi. Elle fit cela avec lenteur, désespérée que ce ne fût pas un coup de foudre. La griffe traça un nouveau sillage sanglant. Major, avec la même effroyable lenteur, tourna la tête vers la gorge de la tigresse et donna son coup de mâchoire. Une nouvelle fontaine de sang s’ouvrit à la gorge d’Impéria.
Elle voulut encore donner de la griffe. Mais son énorme patte impuissante retomba lourdement.
Les deux ennemis se regardèrent : deux regards lamentables, mornes, affreux de haine.
La fin de cette étrange bataille fut plus étrange que les péripéties de la bataille. Comme ils se regardaient aussi avec le désespoir de ne pouvoir se tuer, une dernière secousse des forces nerveuses ranima le grand chien et, rudement, il donna son coup de mâchoire.
Alors, la tigresse gémit de rage désespérée.
Puis, chose vraiment terrible à voir, elle recula devant le chien, en gémissant.
Vacillant sur ses pattes, la tête basse, l’œil en dessous, Major s’avançait, et la tigresse reculait. Elle atteignit ainsi le couloir dans lequel elle entra, laissant derrière elle un sillage rouge. Elle s’en alla en gémissant. On eût dit le sanglot de quelque chef barbare pleurant sur sa défaite.
Major se mit en travers de la porte ouverte et regarda la tigresse s’en aller.
Ce fut seulement lorsque Impéria eut disparu au loin que le chien se laissa tomber sur le flanc et, exhalant un long soupir, leva un instant les yeux sur Odette.
Lorsque la reine Isabeau vit revenir sa tigresse à demi-morte et se traînant à peine, elle eut le terrible pressentiment de son malheur – et que l’intrigante lui échappait. Sur un mot d’elle, Bois-Redon s’élança.
Et maintenant, il faut la chose invraisemblable, mais véridique : pendant l’absence de Bois-Redon, Isabeau oublia Odette, le roi, Jean Sans Peur et qu’elle fût reine – elle oublia tout, pour soigner la tigresse.
Ces dix minutes pendant lesquelles elle pleura des larmes de pitié, s’ingénia à rafraîchir les blessures, à les panser, à les couvrir d’onguents, ces dix minutes durent compter parmi les plus jolies et les plus pures de sa vie.
Bois-Redon revint et fit son rapport :
– Impéria s’est rencontré avec Major, voilà le diable. Il y a eu bataille. Si vous m’aviez laissé faire l’autre nuit, le chien ne se fût pas trouvé là, et…
– Et elle ? interrogea Isabeau avec une violente impatience.
– Saine et sauve. C’était à prévoir. Ce Major, ajouta Bois-Redon avec sympathie, est aussi fort que moi.
– Mais que fait-elle ? hurla Isabeau démente de rage.
– Impossible de l’approcher. Le roi…
– Quoi ! Mais parle donc, brute ! Es-tu donc plus brute encore que le chien ?
– Voilà, dit tranquillement Bois-Redon. Le roi, maintenant, est dans les appartements de la demoiselle de Champdivers. Il a échappé à Tosant et Lancelot qui sont pourtant deux ermites de première force. Prévenu par qui ? Je ne sais. Mais il est là avec dix ou quinze de ses gentilshommes, et son capitaine.
Isabeau se tut. Elle frissonnait. Elle grelottait. Sa figure était livide. Elle ne risquait pas un geste. Elle se mordait les lèvres pour ne pas prononcer un mot. Toutes ses forces, elle les employait à triompher de l’affreuse crise de fureur qui se déchaînait en elle et qui l’eût laissée inerte pour plusieurs heures si elle se fût abandonnée.
Isabeau, frénétiquement, de toute son âme, voulut que, tout de suite, cette nuit même, la question fût tranchée. Elle ne pouvait plus attendre : il fallait qu’Odette disparût.
Comment ? À qui s’adresser ? Quel moyen employer, maintenant surtout que l’éveil était donné ?
Tout à coup un sourire crispa ses lèvres encore tremblantes de rage. Rapidement elle s’enveloppa d’un manteau, rabattit la capuche sur sa tête, et dit à Bois-Redon : En route !
– Où allons-nous ? demanda paisiblement le colosse.
– Chez Saïtano, répondit la reine.
Il était à ce moment un peu plus de onze heures et demie.
C’était le moment où le chevalier de Passavant venait de pénétrer chez le sorcier de la Cité pour lui demander compte de ses mensonges. On a vu que cet entretien avait fort mal tourné pour le chevalier, et que Saïtano était parvenu à l’endormir en lui plaçant sur la bouche un linge imbibé de quelque liquide à exhalaisons stupéfiantes.
Le chevalier, plongé dans un sommeil léthargique, fut porté par Saïtano et Gérande sur la table de marbre, dans la salle où, enchaînés sur leurs escabeaux, attendaient Bruscaille, Bragaille et Brancaillon.
Saïtano commença à découvrir la poitrine.
Ses gestes étaient calmes et méthodiques, mais un feu intense jaillissait de ses yeux. L’expérience, la divine expérience attendue depuis des ans avec une terrible patience, enfin, allait se faire. Saïtano n’entendait plus les hurlements des trois vivants. C’est à peine s’il pensait encore, dans le sens ordinaire du mot. Sûrement toute sa force de pensée, qui était prodigieuse, se concentra à ce moment sur la tentative. Il se dit froidement :
– Mort sans effusion de sang ? Eh bien, ce que je devais faire sur celui-ci (il regardait Brancaillon) je le ferai sur ce pauvre chevalier. Une goutte sur le bout de la langue, c’est la mort instantanée, c’est la foudre. Il ne s’en apercevra pas. Au fond, j’en suis content pour ce jeune homme, je n’eusse pas aimé le voir souffrir.
Il s’avança vers l’armoire de fer. À ce moment, il se sentit touché au bras. Il tressaillit comme s’il revenait du pays des songes funèbres. Il vit Gérande devant lui et murmura :
– C’est bon, je n’ai plus besoin de toi, tu peux t’en aller.
– Vous n’entendez pas qu’on frappe encore ? dit Gérande en haussant les épaules.
– On frappe ? hurla Saïtano. Tous les démons se déchaînent donc sur moi cette nuit ? Eh bien, qu’on heurte, qu’on frappe, qu’on appelle ! Laisse frapper, et va-t-en là-haut. Je veux être seul.
– Oui, dit Gérande avec son accent de funèbre ironie, mais le démon qui est à votre porte n’est pas de ceux qu’on renvoie ainsi. Il pourrait vous en cuire, maître. Ceux qui frappent, si vous les laissez se morfondre, sont gens à s’en aller tout droit chez le prévôt…
– Le prévôt ! Que veux-tu dire, chienne fieffée ?
– Je veux dire que vous seriez demain pendu ou bouilli ou rôti. Cela vous regarde, maître. Mais comme je serais pendue avec vous, je vais ouvrir.
Saïtano poussa une clameur de désespoir, saisit un poignard et se plaça devant Gérande.
– Vous êtes fou, mon maître, dit froidement la femme. C’est la reine qui frappe, entendez-vous, la reine !
– La reine ! balbutia Saïtano. Que veut-elle ?
– Vous allez le savoir, car je vais lui ouvrir. Encore une fois, je ne veux pas être brûlée, moi !
Saïtano laissa passer Gérande et gronda :
– La reine ! Chez moi ! Pourquoi cette nuit plutôt qu’une autre ? Maudite soit-elle d’être venue ici !
À ce moment, il entendit que Gérande achevait de décadenasser les chaînes. Et il reconnut la voix du sire de Bois-Redon, voix qui s’efforçait de gronder, mais qui n’était pas autrement rassurée.
– Par les cornes de Belzébuth, maître de ton maître, disait Bois-Redon, est-ce ainsi que l’on reçoit des gens comme nous ?
Saïtano s’inclina profondément devant la reine, sans dire un mot. Il était désespéré. Isabeau de Bavière n’était pas de ces gens à qui il pouvait refuser l’entrée de sa maison.
La soudaine arrivée de la reine obligeait le sorcier à renvoyer sa tentative à la nuit suivante, et il n’était pas bien sûr que d’ici là quelque événement… À cette pensée une sueur froide ruisselait sur son maigre visage. Il n’y avait qu’un moyen : renvoyer la reine satisfaite le plus tôt possible.
Dédaignant donc de répondre à Bois-Redon, Saïtano poussa un fauteuil comme pour inviter Isabeau à s’arrêter dans la première salle. Elle secoua la tête :
– Allons plus loin, maître, car j’ai à vous parler longuement.
Un soupir d’angoisse échappa à Saïtano. Cependant il obéit, entra dans la deuxième salle et murmura :
– Ici, Majesté, vous êtes en sûreté. Nul ne nous entendra, que Dieu ! ajouta-t-il en levant son doigt maigre par un geste de menace.
– Dieu ? fit Isabeau étonnée, Dieu ou Satan ?
Saïtano, humblement, l’invita à s’asseoir.
Elle refusa, et d’une voix nette reprit :
– Sorcier, je suis venue implorer la science surhumaine puisque la science humaine a échoué. Des hasards ont renversé mes calculs. C’est à toi que je vais demander de corriger le Hasard. Mais je veux d’abord savoir de quel droit tu parles de Dieu, toi qui ne devrais parler que de Satan.
La réponse de Saïtano, que nous sommes bien forcé de rapporter en la traduisant du mieux possible, pourra peut-être inquiéter le scrupule de quelques-uns de nos lecteurs. Mais quoi : Saïtano est un sorcier, c’est-à-dire un de ces êtres de haute intelligence qui ont fondé ce que nous appelons la science, mais cette intelligence exaspérée va côtoyer les sombres bords de ces régions ignorées que nous appelons la Folie.
– Madame la reine, vous me parlez de Dieu, et vous me parlez de Satan. Votre attitude, votre accent, votre physionomie m’affirment que vous accordez au premier le pouvoir du Bien, et à l’autre le pouvoir du Mal. Je pourrais vous demander où commence le Bien, où commence le Mal, et si vous avez jamais saisi avec exactitude la limite qui les sépare. Entendons-nous : je ne veux pas dire cette notion de bien et de mal que les hommes en société sont forcés de s’enseigner les uns aux autres afin d’éviter de se ruer les uns sur les autres et de se détruire afin de mettre une sorte de digue à l’appétit de mort qui est au fond de la société. Je parle seulement de ce que chacun de nous, dans sa conscience inconnue des autres, dans le secret de sa pensée nocturne, dans la profonde geôle mystérieuse où il enferme ses appétits, appelle Bien et Mal. L’homme en société, par exemple, déclare que le meurtre est un mal. Et maintenant, je vous le demande, quel est l’homme qui, une fois dans sa vie de lutte, n’a eu un autre homme pour ennemi, et n’a souhaité sa mort qu’il eût mise instantanément à exécution si, pour tuer, il lui eût suffi de penser le meurtre ?…
La reine écoutait les sombres et farouches théories du sorcier avec un calme qui prouvait que rien ne pouvait l’étonner.
– Je n’ai pas dit le Bien et le Mal. J’ai dit Dieu et Satan.
Elle prononça ces quelques mots en frissonnant. Bois-Redon écoutait, effaré.
– Eh bien, Majesté, pour les hommes, Dieu c’est le Bien, Satan c’est le Mal. Oui, il y a le Bien, il y a le Mal, comme il y a la Beauté, comme il y a la Hideur. Mais où sont-elles ? C’est là que l’humanité se trompe ou a été trompée. Dieu existe, Satan existe. Qui songe à le nier ? De cette double existence, moi-même j’ai eu des preuves mathématiques. Seulement, encore une fois, où est le Bien ? Où est le Mal ? Madame, l’humanité est régie par une épouvantable erreur, et des gens comme moi, comme vous, doivent planer au-dessus de l’erreur. Écoutez donc, car ceci est la vérité qui tôt ou tard éclatera dans le monde.
Saïtano, drapé dans son manteau rouge, le doigt levé, poursuivit :
– Il y a eu bataille, madame. Deux êtres se partageaient la domination du monde, aussi beaux, aussi puissants, aussi lumineux l’un que l’autre : Satan et Dieu, tous deux princes de l’éternelle création. Satan a été vaincu, relégué aux sombres régions. Dieu triomphe et règne. Toute la question pour nous est de savoir ce qu’ils nous veulent.
Saïtano se mit à rire, et ce fut étrange. Bois-Redon claquait des dents.
– Satan veut le Bien, continua le sorcier avec un accent de profonde conviction. Dieu, essence d’égoïsme ne veut que son bien, à lui. Les pensées douces et agréables nous sont données par Satan. Il aime le bonheur. La joie l’escorte. Dieu nous donne les pensées de haine et nous inspire le mépris du bonheur. Où est notre vrai maître, madame ? Est-ce celui qui nous menace, nous châtie, nous ordonne de souffrir comme s’il se plaisait à ne créer des hommes que pour les damner ? Est-ce celui qui pleure au fond des enfers la part qu’on lui a volée, qui pleure notre malheur, qui pense comme nous, aime comme nous, et tâche à adoucir nos souffrances ? Mon choix est fait, madame. Pour moi, Dieu, c’est Satan ! Satan qui me crie que la vie est douce et que je dois vivre dès l’heure présente, Satan qui ne conçoit pas la douleur comme un moyen de régénération, Satan qui ne me demande pas d’être son esclave et son adorateur dans les siècles des siècles. Voilà le vrai Dieu, madame. On dit que je suis un de ses suppôts. C’est vrai, mais l’heure où je serai vraiment choisi pour devenir l’un des êtres d’Enfer qui couvrent le monde à la recherche du bonheur, eh bien, cette heure-là, madame, je l’attends, elle sera ma gloire.
Brusquement, Saïtano s’arrêta, prêtant l’oreille.
Quelques minutes, Isabeau, la tête basse, rêva à ce qu’elle venait d’entendre. Puis le dédain gonfla ses lèvres. Un pli dur barra son front. Ses yeux jetèrent un éclair, et elle prononça :
– Dieu ou Satan, peu importe après tout. Moi je ne veux pas de maître… Allons, sorcier, allons ! J’ai à te parler de choses qui ont pris ma pensée au point que tes spéculations m’effleurent sans me pénétrer.
– Madame, frémit le sorcier, je suis prêt à vous entendre…
– Plus loin, dit la reine, allons plus loin…
Elle se dirigeait vers la troisième salle. Résolument, Saïtano se plaça devant la porte. La reine fronça les sourcils et fit un signe. Bois-Redon s’avança et gronda :
– Allons, place, mécréant !
Et comme Saïtano ne bougeait pas, il l’écarta de la main et ouvrit la porte. Le sorcier eut un gémissement. La reine entra. L’instant d’après, elle se penchait sur le chevalier de Passavant.
Bois-Redon avait fait deux pas dans la salle, et recula précipitamment. Il porta la main à sa dague, et, sans la présence de la reine, il est probable que la carrière du sorcier se fût terminée là. Quant aux trois vivants enchaînés sur leurs escabeaux, à l’entrée de ces étrangers, ils eurent une clameur d’espoir insensé.
La reine ne voyait et n’entendait rien. Elle contemplait Passavant endormi. Elle se redressa enfin, et d’un ton qui indiqua à Saïtano qu’il était bien près de la mort :
– Que lui avez-vous fait ? demanda-t-elle.
– Je l’ai endormi, madame, répondit le sorcier d’une voix morne.
– Endormi ?… Et que voulez-vous en faire, maintenant ?
Saïtano, précipitamment, s’approcha de la reine et s’agenouilla. Il haletait.
– Majesté, dit-il, c’est vous qui me l’avez livré. Souvenez-vous… C’est le sire de Bois-Redon qui l’apporta ici sur ses épaules…
– Moi ? fit le géant stupéfait.
– Vous me l’avez donné, continua Saïtano sans entendre. Et sans doute, c’était aussi la volonté des puissances qui veulent le Grand Œuvre, puisque, de lui-même, il est revenu reprendre sa place…
– À nous ! À nous ! hurlèrent Bruscaille, Bragaille et Brancaillon.
– Madame ! poursuivit ardemment Saïtano, voilà douze ans que vous me promettez de m’aider. Le jour de la grande expérience est venu. Il me faut trois vivants : les voici…
Le hurlement des trois enchaînés devint frénétique. Mais Saïtano n’entendait pas.
– Il me faut un mort : le voici. De lui-même, sans être conduit ni appelé, il est venu ici prendre la place que lui ont assigné les puissances. Madame, vous pouvez cette nuit remplir vos promesses de douze ans…
– Que dois-je faire pour cela ?
– Rien ! rugit Saïtano. Me laisser faire, voilà tout !…
– Et que ferez-vous ?
– Ne vous l’ai-je pas cent fois expliqué ? Ah ! madame, par pitié, retirez-vous… Il est temps. Je vois déjà chez lui les premiers tressaillements avant-coureurs du réveil. Et alors…
– Alors… quoi ? fit la reine avec un rire frais qui résonna funèbrement.
– Alors, ne voyez-vous pas que tout est perdu ? Je suis perdu ! Vous me tuez ! Reine, vous tuez l’homme qui allait trouver le secret de la vie éternelle !…
Saïtano se prit à sangloter éperdument. Sombre, le regard funeste, l’attitude raidie, la reine Isabeau contemplait Passavant endormi. Avait-elle la volonté de le sauver ? Elle n’eût pu le dire elle-même. Elle éprouvait contre le chevalier une haine qui ne pardonnerait pas. Mais peut-être d’autres sentiments, sous cette haine, étaient-ils assez forts pour combattre les suggestions mortelles.
Si le sorcier avait tué Passavant, sans doute elle n’eût pas fait un geste.
Mais le sorcier croyait que ce geste serait fait !
En lui-même, il grondait des insultes contre la reine.
– Une femme ! rugissait-il dans son cœur. Maudite soit l’heure où j’ai pu lui confier le secret de mes espérances ! Insensé ! J’ai cru que celle-ci n’était pas comme les autres… C’est une ribaude, et pour le premier ribaud qui lui plaira, elle ferait avorter l’œuvre sublime… Que lui importe, à elle ?…
Il s’était relevé. Avec une ardeur angoissée, il étudiait la marche du réveil chez Passavant. Les trois s’étaient tus. Ils grelottaient, voilà tout. Bois-Redon, dans un coin, cachait son visage dans ses deux mains pour ne pas voir.
À ce moment, la reine poussa un long soupir et détourna ses yeux de Passavant.
Elle le sacrifiait ! Elle l’abandonnait à Saïtano !
– Eh bien ? rugit Saïtano.
– Eh bien… faites…
Saïtano, d’un bond, fut à l’armoire de fer, avec l’intention d’imbiber à nouveau son linge et donner au chevalier une nouvelle dose de sommeil pendant lequel il l’eût fait mourir de mort violente et sans effusion de sang.
Un éclat de rire strident qu’il entendit derrière lui l’arrêta court.
Il se retourna, et vit Passavant assis sur la table de marbre.
V – FORTUNE DE PASSAVANT
Saïtano demeura sur place, pétrifié, comme si ce réveil eût été l’événement le plus imprévu, le plus monstrueux.
– Laissez cela ! cria Passavant assis sur la table. Une fois, par surprise, je ne dis pas, mais maintenant…
Cela, c’était le linge que le sorcier tenait à la main.
– Laissez cela, vous dis-je ! répéta le chevalier.
Machinalement, Saïtano obéit. Le linge tomba de ses mains.
Passavant continuait à rire. C’était un rire clair, sonore, vraiment joyeux, sans nulle ironie. C’était d’abord la joie d’échapper à il ne savait quoi de mortel et surtout de hideux. Ensuite, il faut le dire, Passavant qui, en somme, n’avait pas l’esprit d’un mélancolique, voyait les choses et les gens par leur côté plaisant. La figure de Saïtano était effrayante : elle lui parut piteuse à l’excès.
Bois-Redon regardait cela, tout émerveillé, car il se connaissait en bravoure.
Isabeau s’était reculée de quelques pas, et, raidie en cette attitude mortellement sérieuse qu’elle prenait parfois, elle regardait le chevalier, et songeait…
Tout à coup, il y eut dans la sombre salle de sorcellerie où ces personnages d’un drame effroyable étaient ainsi groupés comme par une macabre fantaisie de la fatalité, il y eut un deuxième éclat de rire qui se mit à rouler en tonnerre, puis un troisième, puis un quatrième. C’étaient Brancaillon, Bruscaille, Bragaille qui venaient de reconnaître le chevalier !
Et il leur parut tout naturel qu’il fût là ! Ils l’attendaient ! Ils savaient qu’il devait venir comme jadis trancher les liens qui les attachaient aux trois escabeaux !…
Et la preuve qu’ils ne se trompaient pas, c’est qu’il était là !
Il riait. Ils se mirent à rire. Cela leur sembla faire partie du rite de cette scène. Une joie énorme les soulevait.
– Croix-Dieu ! grogna Bois-Redon, voilà de joyeux drilles ! Ma foi, j’ai bonne envie de rire aussi, moi !
Il éclata. Saïtano tremblait jusque dans l’âme. C’était la sorcellerie bafouée, la science insultée, la négation insolente de son pouvoir fait de la terreur qu’il inspirait. Saïtano souffrit. Ce fut une des plus affreuses minutes de sa vie… Passavant, à ce moment, se mit debout. Il ne riait plus. Le rire de Brancaillon s’arrêta ; puis celui de Bruscaille et de Bragaille ; puis celui de Bois-Redon.
Le silence fut sinistre.
Soudain, le chevalier se retourna vers les trois enchaînés et tira sa dague. Ils le virent venir, et il y eut dans leurs yeux une frénétique admiration. C’est sûr, ils s’oublièrent. Ils ne songèrent plus que, quelques minutes avant, ils étaient condamnés. Dans leurs yeux, ce ne fut pas la gratitude éperdue qui débordait de leurs cœurs ; ce fut l’admiration.
En quelques instants, ils furent libérés. Ils grognèrent on ne sait quoi qui pouvait être un remerciement pour Passavant, ou aussi bien une insulte pour le sorcier. Saïtano n’avait pas fait un geste. Il était hébété. Si la pensée pouvait tuer, la reine, à ce moment, fût tombée foudroyée.
Cependant, les trois délivrés se frottaient avec énergie pour rétablir la circulation du sang ; mais, cette fois, ils ne songeaient pas à fuir. Ils ne quittaient pas le chevalier des yeux ; ce qu’il ferait, ils le feraient, voilà tout.
– Sire chevalier, dit la reine en s’avançant, voulez-vous m’escorter jusqu’à l’Hôtel Saint-Pol ?
– La reine ! murmura Passavant, – et il s’inclina avec autant de grâce que s’il eût été dans la galerie des fêtes le soir où il avait éprouvé pour la beauté d’Isabeau cette capiteuse admiration qui l’avait enivré.
Il souriait en se redressant. La reine attendait, calme, sérieuse, attentive.
– Madame, dit Passavant, vous m’invitez à venir en votre palais…
– C’est pour la deuxième fois que je vous fais cette prière, dit la reine.
– Une prière ? fit Passavant dont le sourire devint féroce d’ironie. La reine ne prie pas… Elle donne des ordres.
– Auxquels vous, chevalier, vous désobéissez ! Eh bien, l’ordre que je vous donnai dans la chambre de la demoiselle de Champdivers, je vous le répète ici. Obéirez-vous, cette fois ?
Passavant salua.
– Madame, dit-il, donnez-moi donc l’ordre de me tuer. Je verrai si je dois obéir…
– Vous craignez d’être assassiné chez moi ?
Passavant se redressa :
– Oui, madame. Pardonnez-moi… J’ai si peu vécu que je tiens à vivre quelque temps encore, ne fût-ce que pour voir s’il n’y a au monde que perversion et méchanceté.
Le regard d’Isabeau jeta un éclair. Elle s’avança, souriante, vers la table de marbre, et la toucha de la main. Alors, elle se tourna vers Passavant, et son attitude terriblement sérieuse le fit frissonner.
– Vous étiez là ! dit-elle avec une majesté imposante et lugubre. Si j’eusse voulu vous tuer, je n’avais même pas à en donner l’ordre. Je n’avais qu’à laisser faire. Je n’avais qu’à me taire. Je viens de vous sauver la vie… Mais vous ne me devez rien, pas même un peu de cette politesse française qu’on m’avait tant vantée ; en effet, vous m’avez sauvée, vous, dans la forêt de Vincennes ; nous sommes donc quittes. Vous êtes un bon calculateur, monsieur, et vous avez le droit de refuser à une femme l’appui de votre épée. Adieu. Viens, Bois-Redon.
Ces paroles produisirent sur le chevalier un terrible effet. Il devint très pâle.
– C’est elle qui m’a sauvé, songea-t-il. C’est sûr. Impossible qu’il en soit autrement.
– Madame, ajouta-t-il en s’avançant vers Isabeau, daignez me pardonner ce manque de courtoisie. Je suis à vous, et vous escorte jusqu’à l’Hôtel Saint-Pol. Sorcier, ouvre les portes !
Il tendit la main à Isabeau qui y appuya la sienne.
– J’eusse bien suffi… commença Bois-Redon en grondant comme un chien qui voit donner une caresse à un confrère nouveau venu.
Mais la reine le foudroya du regard. Saïtano, chancelant, livide, s’avança et ouvrit successivement les portes. Derrière la reine et Passavant venait Bois-Redon. Derrière Bois-Redon, clopin-clopant et encore tout endoloris, plus ébaubis encore, venaient Bruscaille, Bragaille et Brancaillon. Le capitaine les désigna à la reine et dit :
– Est-ce que ceux-ci font partie de l’escorte de Votre Majesté ?
– Ceux-ci… fit la reine.
– Ceux-ci sont mon escorte, dit le chevalier sans qu’on pût savoir s’il parlait sérieusement.
Une minute plus tard, ils étaient dans les rues de la Cité. Saïtano, lentement, referma sa porte. Ses mains tremblaient. Ses dents claquaient. Quand il eut fini, il voulut se diriger vers l’escalier qui montait à sa chambre où nous avons vu Laurence d’Ambrun. Mais à mi-chemin, il vacilla tout à coup, et s’affaissa, évanoui. Gérande le souleva, l’assit dans un fauteuil. Elle ricanait :
– Je vous l’avais bien dit, que vous aviez tort de relâcher le chevalier de Passavant !
La reine se dirigeait vers l’Hôtel Saint-Pol. Près d’elle marchait Passavant. Bois-Redon était soucieux et se disait : Qui sait si ce n’est pas le nouveau capitaine des gardes de la reine ? Bruscaille, Bragaille et Brancaillon boitaient, mais fiers comme ils ne l’avaient jamais été, se disaient : Nous sommes l’escorte du chevalier de Passavant !
On arriva à l’Hôtel Saint-Pol.
Bois-Redon appela, cria le mot de passe, jura, tempêta jusqu’à ce que le passage fût libre. Au moment de s’engager sur le pont-levis, la reine regarda fixement le chevalier, et, d’un accent glacial :
– Si vous avez peur, vous êtes libre de vous retirer.
Passavant, pour toute réponse, marcha en avant. Bientôt il fut sous la voûte qui séparait les deux grosses tours de garde. Il entendit la grand’porte se refermer derrière lui. Il eut un long frisson, mais, maîtrisant ses nerfs, il marcha résolument vers le palais de la reine.
Cependant, une scène courte mais intéressante pour nous se déroulait devant la grand’porte de l’Hôtel Saint-Pol. En effet, lorsqu’ils virent le chevalier entrer dans la forteresse royale, Bruscaille, Bragaille et Brancaillon, naturellement, voulurent entrer aussi, Bois-Redon les arrêta un moment, attendit que la reine et Passavant fussent assez loin, puis repoussant Brancaillon d’une secousse :
– Hors d’ici ! fit-il rudement. L’Hôtel Saint-Pol n’est pas un chenil, je pense !
Brancaillon, qui avait fléchi sous le coup, Brancaillon, qui se croyait l’homme le plus fort de Paris, toisa Bois-Redon, non sans quelque jalouse admiration, et dit simplement :
– Tiens ! Vous êtes fort, vous !
Bois-Redon, à son tour, inspecta Brancaillon en connaisseur. Lui aussi se croyait l’homme le plus fort de Paris. Le compliment de cet autre colosse le toucha. Mais revenant à son idée :
– Oui, je suis fort, et je vous le montrerai à tous trois quand vous voudrez. En attendant, hors d’ici !
– Mais, objecta Bruscaille comme un irrésistible argument, puisque nous sommes son escorte !
– L’escorte de qui ? hurla Bois-Redon. De la reine, peut-être ?
Ils haussèrent les épaules. Et Bragaille, simplement :
– L’escorte du chevalier de Passavant ! Vous l’avez bien entendu ?
Le capitaine déjà s’en allait et disparaissait dans l’Hôtel Saint-Pol. Quelques instants plus tard, les trois délivrés virent sortir une quinzaine d’archers qui criaient ; « Au large, truands ! »
– Diable ! fit Bruscaille, il va grêler tout à l’heure. Allons-nous-en !
– Pourtant, dit Brancaillon en levant le nez, le temps est clair…
Quelques flèches qui sifflèrent lui apprirent de quelle grêle Bruscaille avait voulu parler. Tous trois détalèrent, et, comme la nuit était encore profonde aucun d’eux ne fut atteint. Assemblés dans un angle que formaient deux maisons, ils tinrent conseil.
– Nous sommes sans gîte, dit Bruscaille qui résuma la situation. Nous ne possédons pas une maille à nous trois. Nous sommes affaiblis par les damnées cordes du sorcier. Nous avons faim. Nous avons soif. Nous avons froid. Voilà. Que devons-nous faire ?
– J’ai une idée, dit Bragaille : nous irons passer le reste de la nuit dans l’église de Saint-Jacques de la Boucherie, c’est un lieu d’asile.
– Oui, et le sieur Gendry qui devait être pendu s’en est bien aperçu, puisque, s’étant réfugié dans Saint-Jacques de la Boucherie, on l’y laissa mourir de faim plutôt que de le saisir pour le pendre.
– Je connais le bedeau, insista Bragaille.
– Nous donnera-t-il à manger et à boire ?
– Non, bien qu’il ait souvent des provisions de galettes qu’on lui apporte pour payer les cierges qu’il ne met pas, le ladre.
– Eh bien, fit Bruscaille, voici, mon idée à moi : Nous devons retourner à l’hôtel de Bourgogne et dire à Monseigneur : voyez que nous avons la peau dure à cuire puisque nous avons échappé au sorcier à qui vous nous avez fait porter tout endormis…
– Et alors ? fit Bragaille goguenard.
– Alors, monseigneur sera saisi d’admiration et nous gardera.
– Pour nous pendre… Non, je n’irai pas.
– J’ai une idée, fit tout à coup Brancaillon.
– Toi ? s’écrièrent-ils d’un ton qui n’avait rien de flatteur.
– Je vous emmène chez Marion Bonnecoste qui a un faible pour moi, comme vous savez ou ne savez pas ; je la connais, c’est une bonne fille ; elle nous procure mangeaille, buvaille, couchaille.
– Toutes choses qui vont au mieux avec Bruscaille et Bragaille, s’écrièrent les deux sacripants enthousiasmés.
– Et avec moi, fit Brancaillon déjà inquiet.
Il y eut une série d’énormes plaisanteries intraduisibles en langue moderne, et ils se mirent en route vers le logis de Marion Bonnecoste.
Cependant, le chevalier était entré dans le palais de la reine avec cette sensation très nette qu’il pénétrait dans un antre plus redoutable que celui de Saïtano.
Il avança donc, l’œil et l’oreille au guet, décidé à vendre chèrement sa peau.
– Et pourtant, se disait-il, pourquoi m’eût-elle sauvé chez le sorcier, si elle veut ma mort ?
Avec Isabeau, il entra dans la salle d’Imperia.
Il vit la reine se pencher sur la tigresse couchée sur les tapis et toute emmaillotée de linges. Le fauve râlait. Un homme veillait près d’Imperia. Il était chargé de renouveler les onguents et les compresses. Isabeau l’interrogea avidement. L’homme assura que la tigresse ne succomberait pas à ses blessures, et alors, avec étonnement, le chevalier vit pleurer la reine.
Des larmes de joie, peut-être… ou la réaction des violentes émotions de cette nuit.
En tout cas, ces larmes étaient sincères, et des sentiments moins hostiles s’érigèrent dans l’esprit de Passavant. La reine le fit alors entrer dans un petit salon d’une somptuosité, d’une richesse, d’une magnificence telles que le chevalier en éprouva malgré lui une rapide admiration.
– Asseyez-vous, chevalier, dit doucement Isabeau qui elle-même prit place sur les coussins de soie brochée d’or formant le siège d’un fauteuil.
Passavant obéit. Il se tenait sur ses gardes. Sans affectation, il plaça sa rapière en travers de ses genoux.
Une minute, Isabeau considéra le chevalier avec une attention non dépourvue d’intérêt.
Brusquement, elle demanda :
– Eh bien, chevalier, avez-vous retrouvé quels gens envahirent jadis le logis Passavant, selon ce que vous m’avez conté, et enlevèrent cette petite fille qui se nommait Roselys ?
– Attention ! se dit le chevalier. Il faut que du premier coup, je lui montre qu’elle ne me fait pas peur. Non, madame, je n’ai pas retrouvé ces gens. Mais j’ai retrouvé l’ange qui se pencha sur la petite Roselys, comme je vous l’ai également conté, et la sauva.
– Oh ! fit Isabeau avec intérêt. Et qui est-ce ?
– La très noble dame d’Orléans, dit froidement le chevalier.
Isabeau n’eut pas même un tressaillement. Elle continua de sourire.
– Mais, fit-elle de sa voix douce et chantante, que me disiez-vous donc que c’était moi qui avait sauvé cette petite, et qu’à cause de cela vous me vouliez offrir votre vie ? Ce n’était donc pas moi ?
– Non, madame, ce n’était pas vous. Je m’étais trompé.
– Vraiment, j’en suis fâchée. J’eusse été heureuse d’avoir été l’Ange une fois dans ma vie. Mais puisque ce ne fut pas moi, n’en parlons plus. Dites-moi mon brave chevalier…
Elle s’arrêta un instant. Elle était pareille à Impéria lorsque la tigresse préparait un coup de griffe et se ramassait prête à bondir. Le coup de griffe, soudain, partit, à fond.
– Avez-vous aussi retrouvé le véritable meurtrier de mon noble cousin d’Orléans ?
Le chevalier frissonna. Il comprit alors l’erreur qu’il avait commise en entrant à l’Hôtel Saint-Pol.
– Madame, dit-il, ce n’est pas à moi de rechercher l’assassin du sire duc d’Orléans. La justice de l’Official et celle du roi doivent suffire à cette besogne. Je sais, Majesté, ce que vous voulez dire. Que je suis accusé, moi, et que si on ne retrouve pas le vrai meurtrier, c’est moi qui serai jugé, condamné, exécuté. Soit, madame. Qu’on me prenne, si vous me livrez. Qu’on me juge, si vous traînez votre hôte au Châtelet. Qu’on me condamne, si vous m’avez appelé en votre palais pour assurer ma mort. Mais je vous jure sur mon âme, et de par mon nom, que le vrai meurtrier sera châtié. Même si vous me livrez, il sera châtié, madame, châtié par moi !
Isabeau, l’œil dilaté, le doigt tendu vers le chevalier, gronda :
– Ah ! Mais vous le connaissez donc ?
– Je le connais, madame !
– Qui ? Parlez ! Tout de suite ! Qui ?
– Madame la reine, dit Passavant, ce n’est pas à moi de dire son nom et de le dénoncer aux gens de justice. Mais il sera châtié. C’est une affaire entre lui et moi. Quant à ceux qu’il a armés pour frapper le malheureux prince, ils mourront de ma main. C’est chose promise, madame.
Isabeau écoutait, avec une stupeur mêlée d’effroi, cet homme qui se vantait de connaître les meurtriers et celui qui les avait armés… qui se vantait de préparer leur châtiment à tous…
Il y eut un long silence.
Passavant, paisible, attendait que la reine lui expliquât ce qu’elle attendait de lui. C’était justement ce qu’Isabeau ne savait pas elle-même.
En réalité, depuis l’instant où elle avait vu le chevalier sur la table de Saïtano, elle errait de vouloir en vouloir, sa résolution oscillait. Et pourtant, au fond d’elle-même, elle cherchait la haine sans la trouver. Elle s’étonnait, elle s’irritait de se sentir au cœur un sentiment qu’elle ne connaissait pas. Et ce n’était pas cette fougueuse passion qui l’avait jetée aux bras de ses amants, ni cette volonté puissante d’amour et d’ambition tout à la fois qu’elle avait offerte à Jean sans Peur…
Tout se contredisait et se heurtait donc dans sa pensée.
– Chevalier, reprit Isabeau, vous venez de dire des choses terribles… pour tous.
– Oui, madame, je le sais : savoir qui a tué le duc d’Orléans et dire qu’on le sait, peut-être est-ce plus dangereux encore que d’être le meurtrier. Je ne suis pas le meurtrier, madame. Mais je connais les noms des assassins et le nom de l’homme qui les a armés. C’est terrible pour moi. Je n’y peux rien.
– Et vous dites que vous voulez les punir ?
– C’est du moins une promesse que je me suis faite à moi, et que je leur ai faite à eux. Si je ne la tiens pas, c’est que j’aurai succombé le premier.
– Et les noms de ces hommes, vous ne voulez pas les dire ?
– Non, Majesté.
– Eh bien, dit la reine avec un accent de menace profonde, je vais les dire, moi. Les meurtriers s’appellent Guines…
– Guines est mort, madame !
Isabeau tressaillit. Une seconde, Passavant lui fit peur et lui apparut comme une de ces forces aveugles, suscitées par la fatalité, auxquelles il est inutile de résister. En cette seconde, peut-être, la peur fut-elle plus forte que l’admiration. Si Bois-Redon était entré à ce moment, elle eût sans doute donné l’ordre. Mais s’arrachant toute frissonnante à ces impressions nerveuses, elle continua :
– Les autres s’appellent Scas, Courteheuse, Ocquetonville ; sont-ils morts aussi ?
– Non, mais ils mourront. De la même main qui a tué Guines, ils mourront, madame.
Isabeau se leva. Passavant l’imita aussitôt et se tint debout dans une attitude de respect.
– Restez, gronda la reine d’une voix rauque. Restez assis. Je vous l’ordonne.
Il obéit, reprit sa position première, l’épée en travers des genoux. Il guettait la reine du coin de l’œil, et parfois souriait doucement en caressant sa rapière. Isabeau, quelques minutes, marcha lentement de long en large.
– Et quant à celui qui a inspiré le meurtre, dit tout à coup Isabeau en s’arrêtant près du chevalier, il s’appelle Jean sans Peur, duc de Bourgogne. Taisez-vous. Écoutez-moi. Tâchez de me comprendre. Écoutez-moi avec votre âme, car c’est mon âme qui va vous parler… avec votre cœur et votre esprit, écoutez-moi, car ce que je vais vous dire, jamais je ne vous le redirai.
Haletante, à demi penchée sur Passavant, l’œil sombre et la lèvre ardente, Isabeau, en proie peut-être à une de ces brusques tempêtes de passion qui parfois se déchaînaient en elle, apparut au chevalier comme le génie du mal incarné dans une splendide image de femme.
Une violente émotion l’étreignit à la gorge. Oui, sa destinée allait se décider. Isabeau allait parler. Les paroles brûlantes qui de son cœur montaient à ses lèvres allaient tomber. À ce moment même, Bois-Redon entra.
Il faut dire qu’Isabeau ne prêta aucune attention à cette soudaine arrivée de son capitaine.
C’était un animal familier, une chose qui avait sa place dans le logis.
– Cet homme, dit-elle, ardente de sa passion, ce duc, ce Jean qu’on appelle sans Peur, je l’ai aimé. Me comprenez-vous ? Je veux dire que pour lui j’étais vouée au bien et au mal, à ce que Saïtano appelle le Bien et le Mal, comprenez-vous ? J’eusse été aussi bien inspirée par Dieu que par Satan. Je l’aimais. Je le lui ai dit. Je lui ai promis l’empire du monde, et je lui eusse donné. Cet homme qu’on appelle sans Peur a eu Peur. Il m’a trahie.
– Oh ! songea le chevalier, est-ce qu’elle va maintenant me demander de tuer le duc de Bourgogne, comme le duc de Bourgogne me demandait de tuer Louis d’Orléans ? Majesté, dit-il en se levant, songez qu’on vous écoute !
– Qui ? Bois-Redon ? Il entend peut-être, mais il n’écoute pas. N’est-ce pas, Bois-Redon ?
Le géant s’avança d’un pas, s’inclina en signe d’assentiment et dit :
– Non, madame, je n’écoute pas, mais je venais vous dire…
– Tais-toi ! Tu me diras cela tout à l’heure. Ce Jean sans Peur, chevalier, n’est plus rien pour moi. Qu’il vive, qu’il meure, peu m’importe. Il n’est pas l’homme que je cherchais. Celui que je cherche doit être prêt à tout entreprendre pour sa propre gloire et pour la mienne. Il faut que je sois tout pour lui comme il sera tout pour moi. À cet homme, chevalier, j’offre la fortune la plus éblouissante qu’un chercheur d’aventures ait jamais osé regarder en face. Il ne serait rien, il n’aurait pour lui que son épée, son courage, son esprit… mais, pour le pousser s’il le faut jusque sur les marches du trône, il aurait mon amour… Mon amour, entendez-vous ? L’amour d’Isabeau ! Regardez-moi, et dites si vous en avez vu de plus belles à la cour de France. Aimée de lui, chevalier, aimée de cet homme que je cherche, capable d’élever son âme au-dessus des basses ambitions et des amours plus basses encore, capable de planer avec moi au-dessus d’une humanité que nous écraserions de notre mépris, aimée de lui ! Que ne pourrions-nous entreprendre à nous deux ! Écoutez… je vais vous dire…
Passavant, stupéfait, écoutait comme en rêve.
C’était le somptueux rêve d’une fortune qu’Isabeau pouvait bien appeler éblouissante. Lui, pauvre chevalier, sans sou ni maille – et même sans feu ni lieu – aimé d’une reine telle qu’Isabeau de Bavière ! Cela était le rêve.
La réalité, que Passavant saisissait vivante et vibrante au fond de lui-même, oui, c’était de l’horreur qu’il ressentait. La vérité aussi, c’est qu’il eût donné toutes les fortunes et tous les trônes pour un sourire de celle qui vivait en lui.
Il écoutait donc. Mais sa physionomie se figeait. Au coin des lèvres, son sourire sceptique apparaissait parfois pour s’évanouir aussitôt.
Ardemment la reine le considérait pour essayer de lire sur son visage. Et sur cette physionomie, elle ne voyait pas encore se lever l’émotion qu’elle appelait, qu’elle attendait. Un mouvement de rage lui échappa. Elle se pencha davantage.
– Eh bien, gronda-t-elle, savez-vous s’il existe au monde un homme tel que celui que je vous dépeignais ? Tel que celui que je cherche ?… Il faudrait que cet homme pût me comprendre, et pour cela il faudrait qu’il ne portât pas au cœur l’image d’une Odette de Champdivers.
Au même instant, Passavant fut debout, très pâle.
– Répondez donc ! grondait Isabeau. Est-il donc vrai que vous aimez cette fille ?
– Si je l’aime ? murmura le chevalier ébloui par ce mot beaucoup plus qu’il ne l’eût été par la fortune que lui avait offerte Isabeau.
– Vous n’osez donc pas le dire !
– Je le dis, madame. Par le ciel, je jure que j’aime…
– Par l’Enfer ! dit une voix stridente, prenez garde, chevalier ! Prenez garde à ce que vous allez dire !
La reine et Passavant, d’un même mouvement, se tournèrent vers celui qui entrait et parlait ainsi, d’une voix de menace et d’autorité.
Saïtano était là.
Il portait le costume que le chevalier lui avait vu en cette nuit de fête de l’Hôtel Saint-Pol.
La reine interrogea Bois-Redon du regard. Mais Bois-Redon leva les épaules en signe qu’il déclinait toute responsabilité. Et il murmura : « J’étais venu vous prévenir, mais vous n’avez rien voulu entendre. »
Le regard d’Isabeau se fixa ensuite sur Saïtano.
Quelques secondes, la reine et le sorcier se parlèrent, cherchèrent à se comprendre, à se dire des choses qui ne pouvaient être exprimées. Et sans doute Isabeau comprit.
L’intervention de Saïtano, c’était la mort de Passavant.
Saïtano n’était venu que pour tuer Passavant.
Voilà ce qu’elle se dit.
Et un mortel regret envahit son cœur. À cette minute où elle n’avait plus qu’à « laisser faire », où son geste à elle devenait inutile, où l’archange de mort était là prêt à frapper, elle sentit que de mystérieux liens l’attachaient à Passavant. Elle eût voulu le sauver.
S’approchant rapidement du chevalier, dont elle s’était éloignée au moment où Saïtano entrait, elle posa sur son bras une main tremblante, et elle le considéra avec un tel regard d’amour pur que Passavant se sentit bouleversé.
Elle n’était plus la reine aux ambitions formidables rêvant la restauration d’un empire dont elle eût été la Sémiramis… Elle n’était plus la femme adultère commettant l’immonde escroquerie qu’alors on punissait de la flagellation en attachant nue sur un âne la voleuse d’honneur qu’on promenait ainsi par la ville… Elle n’était plus la somptueuse et tragique ribaude qui attirait le duc d’Orléans au magique et mortel traquenard de sa beauté perverse… Elle fut toute candeur, toute pureté, elle fut femme au sens le plus poétique, elle offrit un amour de vierge. Et sa voix supplia :
– Chevalier, cette fortune étrange, inouïe, fabuleuse, dont je vous parlais, voulez-vous qu’elle soit pour vous ? Oh ! ne vous hâtez pas de me répondre. C’est une dernière grâce que je vous demande. Voulez-vous pendant trois jours être l’hôte de la reine de France ? Je jure que pendant ces trois jours vous serez sacré pour tous, même pour Jean de Bourgogne. Je jure que si alors vous vous écartez de moi, si vous me repoussez, vous sortirez sain et sauf de l’Hôtel Saint Pol… Répondez, chevalier.
Saïtano écouta avec angoisse, Bois-Redon avec terreur.
Le chevalier, sans s’incliner, sans donner à la reine l’illusion d’un respect hypocrite, la regarda dans les yeux avec une douceur sincère.
– Madame, dit-il, pardonnez à un malheureux qui devrait se prosterner à vos pieds pour vous remercier ; si j’acceptais d’être votre hôte, Majesté, je mentirais car ce serait vous laisser croire qu’il peut y avoir en moi une hésitation…
Il s’arrêta. La reine recula, très pâle, et murmura :
– Et vous n’hésitez pas ?…
– Non, reine, dit Passavant avec fermeté. Je réprouve cette aversion du mensonge qui me force à vous humilier alors que je vous devine en ce moment si belle et si grande. Mais quoi qu’il arrive, je ne mentirai pas. Lorsque cet homme est entré, j’allais jurer… je jure…
– Prenez garde ! répéta Saïtano.
Le sorcier, en même temps, plongea son regard dans les yeux de la reine. Ceci voulait dire :
– Me le livrez-vous maintenant ?
– Je te le livre ! répondit Isabeau.
Sa physionomie s’était transformée en ce peu d’instants au point d’être à peine reconnaissable. Le chevalier avec étonnement vit cette figure si douce et suppliante se marquer des taches livides de la rage, ces traits délicats devenir durs, ces yeux noyés de tendresse flamboyer d’un feu sombre.
Dès lors, il se retrouva prêt à la lutte. Il se tourna vers le sorcier et prononça :
– Par le Dieu vivant, ce n’est pas toi qui m’empêcheras de proclamer et de jurer que j’aime la noble demoiselle Odette de Champdivers, et…
– Vous avez menti ! cria Saïtano.
Il y eut un moment de stupeur. La reine se rapprocha. Bois-Redon recommença à trembler. Quant au chevalier, il avait eu d’abord un geste furieux, puis tout à coup il haussa les épaules, son sourire aigu reparut :
– Allons, dit-il, vous me devez déjà vos deux oreilles… Je vais être aussi forcé de vous couper la langue.
– Non, dit Saïtano avec un rire sinistre. Je dis que vous avez menti, et je le prouve !
– Tu le prouves ? rugit Passavant ivre de fureur cette fois.
– Je le prouve. Vous n’aimez pas Odette de Champdivers. Vous aimez Roselys d’Ambrun. Osez jurer maintenant !
Passavant recula. Une pâleur mortelle s’étendit sur son fin visage. Ses yeux se troublèrent. Tout se brisa en lui. Il se courba comme assommé par le coup porté à son cœur.
– Eh bien ! dit Saïtano d’une voix si grave qu’elle en était funèbre, qui de nous a menti, chevalier ? Si la demoiselle de Champdivers était ici, oseriez-vous en toute loyauté lui donner votre cœur, sachant que ce cœur, depuis votre enfance, est à une autre que vous cherchez, dont vous portez l’image adorée partout où le hasard vous mène ? Parlez donc…
– Démon ! murmura le chevalier en lui-même. Démon qui a su lire dans mes pensées les plus secrètes et qui fait un jeu du trouble qui me désespère !
– Vous vous taisez ?
Il se rapprocha vivement de Passavant, et à voix basse :
– Voulez-vous la revoir ? Je puis, cette nuit, dans une heure, vous conduire auprès de Roselys.
Le chevalier tressaillit. Son cœur se dilata. Un espoir insensé monta à sa tête. Il saisit la main de Saïtano, qui eut alors un terrible sourire de triomphe.
– Êtes-vous prêt à me suivre ? murmura le sorcier.
– À l’instant ! dit Passavant d’une voix ardente.
Saïtano se tourna vers la reine. De son même regard mortel, il l’interrogea. Et cette fois encore Isabeau lui répondit : « Allez, je vous le livre !… »
Puis, faisant signe à Bois-Redon, lentement elle s’éloigna. Au moment de franchir la porte, elle se retourna et contempla un instant le chevalier ; un soupir gonfla son sein ; chose affreuse, une larme tomba de ses yeux qui venaient de condamner le chevalier ; chose vraiment étrange, sa main monta jusqu’à ses lèvres, et elle envoya un baiser à cet homme qu’elle livrait.
Puis elle disparut.
VI – DANS LES TÉNÈBRES
– Venez, dit Saïtano.
– Où est-ce ? demanda Passavant.
– Sortons d’abord de l’Hôtel Saint-Pol. Ni vous ni moi n’y sommes en sûreté.
Ces derniers mots eussent fait disparaître tout soupçon de l’esprit du chevalier s’il eût eu des soupçons. Mais il n’en avait pas. Il ne pouvait pas en avoir. Tout ce qu’il savait de Saïtano lui prouvait que le sorcier avait connu et connaissait encore Roselys.
En le conduisant près d’elle, Saïtano obéissait-il à quelque pensée de remords ? Ou plutôt ne cherchait-il pas, pour d’obscures raisons, à l’écarter de la reine ? Peu lui importait. Pour un motif ou un autre, le sorcier allait le conduire à Roselys : il en avait la profonde conviction.
Ils se mirent en route. Ils sortirent de l’Hôtel Saint-Pol sans encombre. Nul ne les arrêta. Nul ne leur demanda où ils allaient. Passavant se retrouva dans les rues désertes et sombres encore, seul avec Saïtano.
Le sorcier marchait rapidement. Passavant le suivait sans hésiter. Déjà, il ne pensait plus ni à la scène qui s’était déroulée chez le sorcier ni à celle qui venait de se dérouler chez la reine.
Roselys était en lui.
Odette y était-elle encore ?… Lui-même n’eût su le dire.
Saïtano, comme on a vu, s’était évanoui au moment du départ de la reine, en voyant que les trois vivants et le mort lui échappaient, et que sa tentative avortait encore.
Les soins de Gérande le ranimèrent promptement.
Avec sa rapidité de déduction et de calcul, il établit ce qui allait se passer entre la reine et Passavant, et il frémit. « Me venger, songea-t-il. Me venger à la fois de ce Passavant, qui est maintenant pour moi un ennemi mortel, et de cette reine stupide qui place de vulgaires passions avant la recherche de la splendide découverte ! Frapper Isabeau de Bavière au cœur, et me débarrasser à tout jamais d’un homme qui me tuera si je ne le tue pas, voilà ce qu’il faut faire !… »
« Me tuer ! ajouta-t-il dans un strident éclat de rire. Me faire mourir, moi ! Tuer la vie. Faire mourir celui qui est sur le point de trouver le Grand Œuvre ! Allons, allons, cela ne sera pas, parce que cela ne doit pas être ! »
Pendant qu’il songeait ainsi, rapidement, il s’habillait.
Il ne se munit d’aucune arme. Mais sous son manteau, il cacha deux ou trois clefs, une cire courte, et tout ce qu’il fallait pour l’allumer, c’est-à-dire un bon briquet avec une mèche facilement inflammable.
Un quart d’heure après le départ de la reine, il sortait à son tour et se dirigeait rapidement vers l’Hôtel Saint-Pol. Il avait les mots de passe. Il entra facilement, parvint au palais de la reine, dit quelques mots à Bois-Redon qui montait la garde devant l’appartement. On a vu comment il attendit le moment favorable pour intervenir et quel fut le résultat de cette intervention.
Maintenant il marchait près du chevalier, avec une sorte de bonne humeur.
– Où est-ce ? demanda encore Passavant.
– Dans l’Université, répondit joyeusement Saïtano, près de l’Abbaye de Cluny. Promettez-moi, quoi que vous puissiez voir, quel que soit le lieu où je vous mène, d’avoir confiance et de ne pas vous effrayer.
– M’effrayer ?… Oh ! J’ai vu des choses qui eussent dû me faire peur, mon maître. Et sans parler de l’antre de la Cité, de la table de marbre, de la salle funèbre, je me suis vu en des lieux où la peur eût dû me tenailler le cerveau, par exemple les cachots de la Huidelonne. Allons donc, et vous ne me verrez pas trembler, je crois. Quant à la confiance que je puis avoir en vous, ceci vous répond pour moi.
Il frappa sur sa dague. Saïtano se mit à rire. Son rire était plus joyeux que jamais.
– De par tous les diables fourchus, mon brave chevalier, vous m’avez vaincu. Voilà la vérité. Je m’avoue vaincu. Je vois, je sens, je devine que vous êtes conduit dans la vie par des forces plus redoutables que celles qui m’inspirent. Ah ! diable, je ne veux pas entrer en lutte avec ces forces-là, moi ! Et je me déclare vaincu… Savez-vous que c’est une histoire prodigieuse que la vôtre, et qu’elle me cause un étonnement dont je reviendrai difficilement ?
– Quelle histoire ? fit le chevalier avec son sourire narquois et naïf.
– Comment ! Par deux fois, j’enchaîne les trois vivants sur leurs escabeaux ! Par deux fois, je vous tiens, vous l’indispensable mort, sur ma table de marbre, et à chaque fois, au bon moment, vous vous levez, vous rendez la liberté à ces drôles et…
– Sorcier, interrompit Passavant d’une voix sombre, ne me rappelle pas de tels souvenirs, ou je ne réponds pas de ma patience !
– C’est bien, n’en parlons plus. D’ailleurs, nous arrivons…
– Là où est Roselys ? fit le chevalier dont le cœur se mit à battre.
– Oui. Là où est Roselys !…
Saïtano s’arrêta, posa sa main sur le bras du chevalier, et, d’une voix grave :
– La reconnaîtrez-vous seulement ? Dites… La reconnaîtrez-vous ? Songez qu’elle n’était encore qu’une enfant lorsqu’elle fut séparée de vous. Elle était bien belle, alors. Mais maintenant, que direz-vous ? À qui pourrais-je la comparer pour vous donner une idée de sa beauté radieuse et candide ? Tenez, elle est belle comme… Oui, par ma foi ! elle est belle comme Odette de Champdivers !
Passavant tressaillit jusqu’à l’âme. Un nuage s’appesantit sur son front.
– Marchons ! gronda-t-il.
– Marchons, dit paisiblement Saïtano.
Ils avaient franchi la Cité. Ils étaient maintenant dans l’Université. Ils s’avancèrent en silence, d’un pas rapide, Près de l’abbaye de Cluny, songeait Passavant avec une sourde inquiétude. Pourquoi près de l’abbaye de Cluny ?…
– Nous y voici ! dit tout à coup Saïtano.
Passavant regarda autour de lui. Sur sa gauche, par-dessus les maisons des étroites ruelles qu’il venait de parcourir, il vit se profiler les tourelles et les clochetons de l’abbaye. Sur sa droite, il y avait une maison basse devant laquelle Saïtano s’était arrêté.
Le sorcier ouvrit la porte avec une clef qu’il avait sur lui, et il entra. Passavant le suivit. Saïtano referma la porte. Au bout de quelques instants, l’obscurité s’éclaira : le sorcier venait d’allumer sa cire (une très courte cire, avons-nous dit). Tous deux passèrent dans une deuxième salle dont la porte fut également refermée. Au fond, il y avait une trappe. Saïtano la souleva et descendit. Sans aucune hésitation, le chevalier le suivit.
Au bout d’une douzaine de marches, il se trouva dans une cave qui, bien aérée, avec ses outres de vin convenablement rangées, avait la plus honnête physionomie du monde.
Saïtano ne regardait même pas le chevalier.
Il alla droit à une solide porte qu’il ouvrit encore avec une clef qu’il portait sur lui. Là commençait un deuxième escalier qui s’enfonçait dans les ténèbres.
– Oh ! fit Passavant, est-ce donc là le chemin de l’enfer ?
– Il est encore temps, sire chevalier. Si vous voulez, nous remonterons dans la rue, et nous nous séparerons.
– Quoi ! Nous allons par ce chemin-là où est Roselys ?…
– Nous y allons, dit tranquillement Saïtano.
– Et il n’y a pas d’autre chemin ?
– Pour vous, il n’y en a pas d’autres, dit Saïtano d’une voix étrange.
Une hésitation arrêta Passavant. Saïtano continuait à descendre. L’hésitation fut si brève qu’à peine le chevalier se rendit-il compte de son propre arrêt. Mais pendant cette rapide seconde, le sorcier souffrit le mal atroce du doute. Il songea : S’il ne descend pas, il est sauvé !
– Route étrange, se disait Passavant. Mais fût-elle plus étrange encore, n’y eût-il pour moi qu’une seule chance de revoir Roselys contre cent d’être tué, je la suivrais encore. D’ailleurs, qu’ai-je à craindre ? Au moindre signe de trahison, je poignarde le sorcier.
En hâte, il l’avait rejoint.
Ils cheminaient maintenant le long d’une large galerie taillée dans la pierre blanche des sous-sols de Paris, et sur laquelle, à intervalles irréguliers, s’ouvraient d’autres galeries.
Passavant abattit sa main sur l’épaule de Saïtano.
– Eh ! l’ami, dit-il, où diable sommes-nous ici ?
– Mais vous le voyez, mon digne gentilhomme, nous sommes sous Paris. Comprenez-vous ?
– Sous Paris ? gronda le chevalier.
– Sans doute. Paris est une grande ville. Il y a des maisons, des hôtels, des forteresses, des églises, des abbayes. Tout cela, chevalier, s’est lentement érigé. Il serait maintenant difficile de calculer ce qu’il a fallu de pierre pour bâtir la Ville, la Cité, l’Université. Or, où pensez-vous qu’on ait pris cette pierre, dans les temps reculés où l’on bâtissait tous ces êtres figés qui ont vu le passé, qui verront l’avenir, qui voient couler les générations d’hommes comme des fleuves ? Eh bien, c’est Paris qui s’est fourni à lui-même son squelette ; c’est sous Paris, c’est dans ces carrières maintenant abandonnées qu’on a pris les matériaux des grandes constructions. Comprenez-vous maintenant ?
– Très bien, dit le chevalier en hochant la tête. Mais où conduisent ces sombres boyaux qui vont s’enfonçant dans les entrailles du sol ?
Saïtano se mit à rire. Et il regardait fixement la cire qu’il tenait au bout de ses doigts et qui jetait une lueur pâle à peine suffisante pour montrer l’énorme entassement de ténèbres.
Il n’y avait presque plus de cette cire !…
– Où vont ces galeries ? Nulle part, mon brave gentilhomme, nulle part ! Elles sont toutes bouchées, sauf trois ou quatre issues que peu de gens connaissent, et que je connais bien, moi ! Ces galeries sont les veines de ce grand corps qui s’appelle Paris. Veines où il n’y a pas de sang ! ajouta Saïtano avec son rire funèbre. Des veines vides de sang… Concevez-vous cela ?
– Sorcier, dit Passavant d’une voix sourde, j’espère que tu ne médites aucune trahison ?
– Moi ? Et quelle trahison ?…
Passavant tira sa dague et dit simplement :
– Ta vie me répond de la mienne.
– Soit ! dit Saïtano. Mais pour vous parler encore de ces galeries, il faut que vous sachiez, mon brave chevalier, c’est une chose curieuse à savoir : elles sont si nombreuses et si longues, elles s’entre-croisent avec tant de caprice, qu’elles forment un réseau vraiment inextricable. Voici une galerie qui s’ouvre là, sur votre droite. Où va-t-elle ? Qui le sait ? D’autres boyaux viennent s’embrancher sur elle. Sur ces boyaux, d’autres galeries viennent s’amorcer. On pourrait voyager des années sans trouver le commencement ou la fin du labyrinthe.
Saïtano se mit à rire et regarda le chevalier en face :
– Si vous étiez seul, vous mourriez ici d’une mort affreuse, après une atroce agonie qui peut durer plusieurs jours ; oui, vous mourriez de faim et de soif, vous mourriez d’épouvante, courant comme un fou sans jamais retrouver votre chemin ; chaque pas que vous feriez vous enfoncerait davantage dans l’inextricable labyrinthe… heureusement, vous êtes avec moi, et je connais très bien pour les avoir parcourues cent fois les galeries que nous longeons.
Passavant frissonnait. Il saisit un bras de Saïtano, et d’un ton rude :
– Sommes-nous bientôt arrivés ?
Saïtano regarda sa cire prête à s’éteindre et répondit :
– Bientôt !
Ils débouchaient à ce moment dans une sorte de salle ronde, carrefour auquel aboutissaient une douzaine de galeries. Saïtano reprit :
– Cent fois je suis venu jusqu’ici. Même sans lumière, je retrouverais mon chemin, car en prévision du moment où je serai forcé de me cacher, j’ai fait sur ces murs des marques faciles à retrouver au toucher, et qui me serviraient de guide. Mais vous, même avec de la lumière, vous ne pourriez vous y retrouver. Vous mourriez de faim, de soif et d’épouvante.
– Assez ! gronda le chevalier. En route ! Et tâche que nous soyons vite arrivés !
– Mais, dit Saïtano, nous sommes arrivés !
Au même instant, la cire s’éteignit. Avec un rugissement de terreur, Passavant allongea les mains pour saisir Saïtano… et alors il frémit dans tout son être…
Saïtano lui échappait. Ses mains ne le trouvaient pas. Du vide et des ténèbres : il n’y avait autour de lui que cette double sensation.
Il se mit à courir en tous sens, dans l’espoir de heurter le sorcier.
Mais bientôt il s’arrêta, avec cette effroyable conviction que déjà Saïtano était bien loin de lui.
Dans cette situation si brusquement amenée par l’infernal génie du sorcier, ce qui l’accabla tout d’abord, ce fut justement cette soudaineté de la catastrophe. Ce qui le frappa d’un véritable vertige, ce fut de ne plus entendre Saïtano. Il écouta avec l’attention la plus surexcitée. Il espérait tout au moins saisir un bruit de pas, un frôlement quelconque. Il pensait aussi que, sans doute, le sorcier voudrait lui parler avant de se retirer, l’insulter peut-être. Il attendait son rire strident et méchant.
Rien. Non, rien ne vint. Passavant était entré dans le domaine du silence avec la même soudaineté, dans le même instant où il avait été enveloppé de ténèbres.
Il faut dire qu’après la première minute d’effarement, cette âme intrépide tenta le suprême effort. Passavant se dit que s’il lui restait une chance quelconque d’être sauvé, cette chance serait anéantie par la peur. Tout ce qu’il pouvait posséder de forces, il l’employa à retrouver un peu de sang-froid.
Il y parvint. Il crut y parvenir. Il crut qu’il avait dompté l’épouvante.
Mais l’épouvante est une de ces larves sournoises qui savent faire le siège d’un cerveau et choisir le bon moment pour brusquement sauter dessus.
Le chevalier s’assit sur le sol sablonneux de la carrière, autant pour achever de calmer ses nerfs par l’absence de tout mouvement que parce qu’il se sentait réellement brisé comme par une longue fatigue.
Il écouta encore. Longtemps il écouta. Saïtano, peut-être, était encore là. Peut-être aurait-il l’affreux courage, l’imprudence de jeter au chevalier quelque parole d’insulte, avant de s’en aller. Et alors…
Longtemps, il écouta, se tenant prêt à se ruer vers le point d’où partirait la voix.
Mais non… Rien !…
Saïtano n’était pas un vulgaire esprit. Sûrement, sans risque d’être atteint, il eût pu se donner la satisfaction d’adresser quelque terrible adieu à Passavant. Il n’y songea même pas.
Dès l’instant où la cire s’était éteinte, Saïtano avait rayé Passavant de ses préoccupations. Passavant n’existait plus, c’était tout.
Le sorcier, grâce aux marques dont il avait parlé, s’était donc remis en route, et déjà il atteignait l’escalier qui allait lui permettre de remonter au jour, alors que là-bas, dans le carrefour de silence et de ténèbres, Passavant attendait encore…
Lorsque le chevalier fut certain que Saïtano s’était réellement éloigné, il se dit :
– Ce drôle a choisi pour moi le genre de mort le plus désagréable qu’il soit possible d’imaginer. Décidément, si je m’en tire, il faudra qu’il paye sa trahison. Il la paiera !
Le sourire qui accompagnait ces mots, tout paisible qu’il était, eût fait frissonner Saïtano.
– Donc, reprit le chevalier, si je m’en tire, le sorcier aura un mauvais quart d’heure à passer. D’ici là, n’y pensons plus, et songeons à trouver le moyen de sortir d’ici.
Ce fut un remarquable effort de courage ; au bout de quelques minutes, il ne pensait réellement plus au sorcier, ni à quoi que ce fût au monde, et il combinait des plans.
Il s’arrêta au plus simple, au plus logique, à celui-là seul qui offrait une chance de salut, s’il en restait : entrer dans la première venue de ces galeries qui venaient dégorger dans la rotonde leurs fleuves de ténèbres comme dans un lac de l’enfer ; et cette galerie une fois adoptée, la suivre tout droit, si loin qu’elle allât.
– Que diable, se disait le chevalier, il faudra bien qu’elle aboutisse quelque part !
Bravement, il réfréna cette horreur qui, peu à peu, l’envahissait, il dompta le tremblement des nerfs, et il se mit en route, s’enfonça dans l’un des boyaux, sans savoir lequel. Sa marche d’abord fut pénible. Le sol était uni pourtant. Mais marcher dans le noir absolu, marcher droit est presque impossible. L’obstacle surgit dans l’imagination sous toutes les formes. Le pied inhabile ne sait plus où et comment se poser.
Passavant marchait pourtant avec ardeur. Il se heurtait à droite ou à gauche aux parois de la galerie, mais il marchait. Il croyait, avancer rapidement. En réalité, chaque pas était soumis à un inconscient calcul. Il marcha peut-être plusieurs heures, et il commença alors à s’étonner que cette galerie fût si longue. Une marche pareille dans les rues de Paris l’eût conduit depuis longtemps hors des murs. Il continua, essayant d’accélérer le pas.
Tout à coup, à l’un de ces heurts qui lui survenaient de distance en distance, il put comprendre pourquoi interminable était la galerie, pourquoi il n’en trouverait jamais la fin, même s’il marchait jusqu’au jour du jugement dernier.
Ce heurt s’était produit à gauche et avait été plus rude que les autres.
Passavant recula de deux pas, puis il voulut savoir contre quoi il s’était heurté ; il refit donc deux pas sur sa gauche, c’est-à-dire exactement sur le pan de mur qui avait déchiré son épaule.
Exactement : il le croyait. Mais si court que fût le trajet, il dévia. Les mains tendues en avant pour toucher le mur, il ne toucha rien ; devant lui, il y avait du vide : c’était une autre galerie qui s’ouvrait là !…
Alors il comprit. Depuis le temps qu’il marchait, il avait dû, à droite ou à gauche, entrer dans des galeries nouvelles, tourner, peut-être, revenir peut-être au point de départ, parcourir peut-être des lieues de chemin sans avancer réellement.
Il s’assit. Une nausée lui souleva le cœur. La sueur pointa à la racine de ses cheveux, et il sentit qu’ils se dressaient. L’épouvante d’abord écartée victorieusement revenait à la charge. C’était horrible en effet. La sensation de l’absolue impuissance à suivre une route quelconque lui fut un intolérable cauchemar. Au loin, il entendit des clameurs désespérées. Il écouta, et s’aperçut alors que ces clameurs venaient de lui-même.
L’épouvante saisit alors l’esprit de Passavant.
De plus en plus forte et terrible se condensa en lui la conviction que nul ne pouvait dévider cet écheveau, que là, aucune Ariane n’avait placé le fil conducteur et sauveur, que quiconque était happé par le formidable engrenage de routes et de ténèbres ne pourrait jamais se libérer et se retrouver vivant dans la lumière.
Passavant se remit en marche.
D’un pas raide, les cheveux hérissés, les yeux agrandis, il marchait. Tantôt c’était d’un pas égal et soutenu, tantôt d’une course affolée. Parfois il s’arrêtait. Il écoutait, espérant surprendre quelque bruit lointain. Mais il n’y avait même pas de ces glissements légers de bêtes vivant au fond de ces cloaques. Ces carrières de pierre n’offraient sans doute dans leur profondeur aucune nourriture aux animaux souterrains. Alors, ayant une fois encore établi que le silence était son seul compagnon, il se remettait à marcher.
La sensation de la soif qui le dévorait fut presque soudaine. Il n’y avait pas songé encore. Il n’avait pu y songer. Il n’avait pu encore se rendre compte que ses lèvres brûlaient, que sa gorge était sèche. Ce fut seulement au moment où la soif devint un intolérable supplice qu’il commença à la ressentir, mais sous forme bénigne. Il se dit :
– Si je pouvais seulement boire…
Le mot boire qu’il prononça distinctement déchaîna la soif. Alors il s’aperçut qu’il râlait. Et alors aussi les effrayantes imaginations de la fièvre commencèrent à le torturer. Il criait :
– Là-bas ! Oh ! Là-bas, j’entends une source d’eau fraîche…
Il se précipitait. La source fuyait. Il appela Thibaud Le Poingre, lui commanda quantité de flacons, s’irrita qu’on ne les lui apportât pas à l’instant, et là, au fond de ces sinistres ténèbres, dans cette solitude, dans ce formidable silence, Thibaud fut rudement menacé d’avoir les oreilles coupées.
La faim, à son tour, fit son apparition.
Saïtano l’avait dit : vous mourrez de faim, de soif, d’épouvante. La première, l’épouvante s’était installée dans le cerveau de Passavant. La soif était venue. Le troisième spectre se montrait : mais c’était le moins hideux, le moins acharné des trois. Facilement presque, le chevalier en eut raison. Assez vite, il parvint à oublier la sourde souffrance de l’estomac révolté. Mais la soif et l’épouvante furent intraitables. La soif mettait un enfer dans sa gorge. L’épouvante peu à peu installait la folie dans son cerveau.
– À moi ! À moi ! À moi ! À moi !…
Il se mit à hurler cela sans arrêt. Qu’espérait-il ? Rien. Qu’appelait-il ? Personne. Il hurlait, voilà tout. Il eût aussi bien choisi un autre mot. Et bientôt, en effet, il cria d’autres choses. Il se prit à parler très vite, raconta à des êtres imaginaires qu’il était perdu depuis plusieurs mois dans le dédale des ténèbres, et supplia qu’on lui donnât à boire…
Les illusions tout à coup disparurent.
Une fois encore, le chevalier de Passavant se rendit compta qu’il errait dans des galeries sans commencement et sans fin.
Alors, il éprouva l’énorme lassitude de cette marche.
Il se coucha pour mourir.
Et le chevalier de Passavant mourut.
Il mourut en essayant un suprême effort pour se rappeler les choses de sa vie.
Cet effort l’amena simplement à prononcer le nom de Roselys. Peut-être était-ce une simple convulsion du souvenir. Il était entré dans les carrières pour Roselys… Il était naturel que ce nom se présentât à son esprit. Quoi qu’il en soit, il le prononça – et mourut.
Quel autre terme pourrions-nous employer ? Ce ne fut pas simplement une perte de connaissance. Il y eut en lui la fade, l’écœurante, la souverainement horrible impression de la mort. Il se dit avec l’inexprimable conviction de l’agonie : Je meurs ; dans un instant, ce sera fini…
Il respirait, mais si faiblement ! Un léger râle inconscient continuait de se faire entendre sur ses lèvres, mais toute sensation était abolie.
La résurrection fut soudaine.
En une seconde, cet être brisé de fatigue, terrassé par la faim, la soif, l’épouvante, cet homme qui respirait à peine, qui venait d’entrer dans l’anéantissement final, en un clin d’œil Passavant fut debout, éperdu d’espoir, délirant d’une joie surhumaine, écoutant, le cou tendu, écoutant de tout son être.
Un murmure lointain, un murmure de voix humaines…
Il écoutait cela. C’est cela qui l’avait galvanisé. C’est cela qui l’avait rappelé des lointaines régions de la mort. Ce murmure si faible avait frappé son oreille, parce que dans les ténèbres des galeries c’est l’oreille qui devait mourir la dernière, c’est dans l’oreille que s’étaient réfugiées les dernières lueurs de la vie.
Ce fut en frémissant qu’il fit ses premiers pas. Son cœur tremblait. À la seule pensée que le murmure pouvait s’éteindre, ou qu’il pouvait, lui, se perdre, d’atroces nausées lui donnaient des vertiges. Il marchait avec d’indicibles précautions, le cou tendu, les mains tendues, tout son être tendu vers ce murmure… vers la vie. S’il s’égarait ! S’il prenait une autre voie que celle qui aboutissait à la vie ! Si ces inconnus s’éloignaient !… Mais non !… le murmure se faisait plus distinct, et tout à coup, là, au fond de cette galerie qu’il parcourait, ô saints et anges, là, oui, la radieuse, l’ineffable impression d’une lueur !…
Une lueur bien faible, mais qu’importe ! Une lueur !…
Les ténèbres n’étaient plus les ténèbres. Les voiles de l’épouvante étaient déchirés.
À mesure qu’il avançait, le murmure se faisait grondement et parfois clameur. La lueur indécise devenait lumière violente. Au fond de la galerie, dans une vaste rotonde, Passavant apercevait des ombres qu’éclairaient plusieurs torches.
Qu’étaient ces gens ?
Que faisaient-ils dans ces carrières ?
Passavant ne se le demandait même pas. Lorsqu’il ne fut plus qu’à une centaine de pas, il ne put davantage résister, et il se mit à courir. Quels qu’ils fussent, ces hommes le sauveraient… Brusquement, à dix pas de la rotonde, il s’arrêta.
Parmi ces voix nombreuses, il venait de reconnaître une voix. Elle criait :
– Maître Caboche, voici les intentions formelles de mon maître…
Et c’était la voix d’Ocquetonville !…
Passavant regarda, comme on peut regarder l’abîme. Près d’Ocquetonville, il vit Courteheuse et Scas, puis nombre de seigneurs bourguignons. Les autres étaient des bourgeois qu’il n’avait jamais vus. Mais ce qui était sûr, c’est qu’il y avait là assez de gens qui voulaient sa mort !
Ainsi, devant lui, les Bourguignons.
Derrière lui, la galerie, les ténèbres, la faim, la soif, l’épouvante.
Passavant n’hésita pas. Il se dit que mieux valait cent fois se jeter au milieu des Bourguignons et en finir d’un seul coup plutôt que de subir encore les supplices de l’abominable labyrinthe.
Il s’avança de quelques pas.
Mais maintenant, par la seule joie que soulevait en lui la « lumière » des torches, une puissante réaction s’accomplissait dans son organisme. Échapper à l’énorme ténèbre, c’était déjà vivre. Et vivre si peu que ce fût lui rendait l’ardent amour de la vie.
Plus fort, plus maître de lui, Passavant conquit la prudence nécessaire.
Avant de se ruer à la mort en se jetant parmi les Bourguignons, il voulut voir s’il n’y avait plus pour lui aucun moyen de remonter à la surface du monde.
Il se mit à regarder, à écouter…
VII – COMMENT FUT DÉCRÉTÉE LA GUERRE CIVILE
Passavant, tout de suite, remarqua deux choses qui, pour lui, étaient d’un immense intérêt. Cette assemblée se tenait dans une salle à peu près ronde, et de dimensions assez vastes pour contenir une centaine de personnes. Or il n’y avait pas d’autre galerie aboutissant à cette rotonde que celle-là même où il se trouvait. En face de cette galerie, à l’autre extrémité, commençait un escalier par où les Bourguignons étaient descendus dans cette salle. Tout danger de se perdre à nouveau dans le sombre dédale était donc écarté pour Passavant. Ensuite, la possibilité de remonter au jour devenait formelle. Si bien que fermât la porte que sans doute il trouverait au haut de l’escalier, il pouvait venir à bout de l’ouvrir.
Dès lors, le plan de délivrance s’érigea dans l’esprit de Passavant.
Il y avait dans la rotonde une trentaine de bourgeois et une dizaine de seigneurs bourguignons. Ces gens étaient fort occupés à parler ou à écouter.
Il était possible que le chevalier pût se glisser jusqu’au groupe sans attirer l’attention, se mêler aux derniers rangs, et, lorsque la conférence prendrait fin, s’en aller tranquillement avec ces gens.
Si au contraire il lui était impossible de s’approcher, il attendrait que la salle fût vide, et tenterait de forcer la porte. Il voyait tout ce qui se passait dans la rotonde. Il entendait tout ce qui se disait.
Caboche parlait. Et il représentait vingt mille bourgeois.
Ocquetonville représentait le duc de Bourgogne seulement, mais cela valait les bourgeois de Caboche. Nous disons que ce Caboche était le porte-parole de la bourgeoisie près de se révolter. L’histoire a assez mal défini son rôle exact dans la grande tragédie qui allait prendre pour théâtre Paris tout entier.
Il est probable que Caboche avait derrière lui autre chose que cette bourgeoisie alors courageuse à coup sûr, mais dont les prétentions aujourd’hui accomplies se dessinaient déjà. Le bourgeois, tout simplement, voulait remplacer le noble, dominer comme lui, laisser peut-être cependant quelque vagues libertés au peuple, – mais le dominer.
– Maître Caboche, avait dit Ocquetonville, je vais formuler devant vous et les vôtres les formelles intentions de mon seigneur le duc de Bourgogne…
– Sire d’Ocquetonville, répondait Caboche d’une voix âpre, votre maître avait promis de venir ici de sa personne discuter avec nous la possibilité d’une guerre. Sans doute l’endroit est triste et sombre, triste comme notre existence, sombre comme nos pensées. Cette vieille carrière, c’est notre Hôtel Saint-Pol, à nous. Quoi qu’il en soit, les hôtes que nous y admettons nous sont sacrés. Peut-être votre maître a-t-il eu peur ? ajouta Caboche avec un sourire de dédain.
– Il s’appelle Jean Sans Peur ! dit Ocquetonville en se redressant avec fierté.
– Alors pourquoi n’est-il pas venu ? cria Caboche dans un sauvage éclat de voix. Nous méprise-t-il donc, s’il n’a pas peur ? J’ai bien été, moi à l’hôtel de Bourgogne ! Pourquoi le duc ne vient-il pas chez nous ? Sire d’Ocquetonville, ce n’est pas à vous de nous dire les intentions du duc de Bourgogne. Qu’il vienne, et nous l’écouterons.
– Me voici ! dit une voix rude.
Tous les assistants levèrent les yeux vers le haut de l’escalier d’où tombait cette voix. Passavant, lui aussi, regarda de ce côté. Et tous virent descendre, pas à pas, lentement, un homme de haute taille enveloppé dans son manteau. Quand il fut arrivé au bas, cet homme laissa retomber son manteau. Les seigneurs bourguignons s’inclinèrent très bas. Plus bas encore s’inclinèrent les bourgeois. Mais Caboche, après un bref signe de tête en forme de salutation, s’avança et prononça :
– Jean de Bourgogne est le bienvenu chez Caboche !
Jean Sans Peur s’avança vers une table toute chargée de gobelets d’étain déjà remplis de vin, en saisit un, et avec cette théâtrale simplicité qu’il savait prendre à l’occasion :
– Maître Caboche, dit-il, vous avez bu chez moi à ma prospérité, à ma gloire. Je bois ici au triomphe de votre espérance qui est la mienne.
Il choqua son gobelet contre celui de Caboche, et le vida d’un trait. Les seigneurs et bourgeois présents en firent autant. Il y eut des cris d’enthousiasme. Il y eut des menaces, des jurons, une sourde clameur monta de ce groupe d’ombres qui s’agitait dans la lueur rouge des torches, et enfin, dans la bande des seigneurs éclata ce cri :
– Mort aux Armagnacs !
– Mort aux tyrans ! dirent les bourgeois avec une nuance de voix qui indiquait que, pour eux, les Armagnacs n’étaient pas le seul ennemi.
– Vive la liberté ! dit Caboche, d’une voix si grave et si profonde que Jean Sans Peur et les siens en tressaillirent.
Quand ce tumulte se fut apaisé, Jean Sans Peur se tourna vers Caboche et ses amis.
– Messieurs les bourgeois, dit-il, j’arrive un peu tard au rendez-vous que vous m’avez assigné. Ce n’est ni par peur ni par dédain, comme a pu le dire maître Caboche. J’ai d’abord voulu savoir au juste ce que préparaient nos ennemis communs, les Armagnacs. Je le sais maintenant. Je vais vous le dire.
Un silence terrible s’établit dans la salle. Caboche ne perdait pas de vue le duc de Bourgogne, et à son air sombre, il devinait qu’il était porteur de graves nouvelles.
– Si cet homme est parmi nous, songeait-il, c’est qu’il a plus peur encore des Armagnacs que du peuple. Je dois donc lui vendre notre alliance le plus cher possible. Qui sait si notre liberté ne va pas sortir de cette entrevue ?
– Seigneurs et bourgeois, reprit Jean de Bourgogne, écoutez-moi. Et tâchons d’être d’accord non seulement sur la bataille qu’il va falloir engager, mais sur le partage des dépouilles si nous avons la victoire. Il faut qu’après le triomphe nul ne puisse dire qu’il a fait un jeu de dupe, pas plus vous que moi.
Ces paroles frappèrent vivement Caboche. Elles correspondaient à ses préoccupations secrètes. Il ne voulait nullement assurer le triomphe des Bourguignons sur les Armagnacs s’il ne devait rien sortir de bon pour le peuple. S’inclinant donc devant le duc de meilleure grâce qu’il ne l’avait fait à son arrivée :
– Monseigneur, dit-il, ce que vous dites là est sincère ; je puis, moi, vous assurer dès maintenant de la victoire. Laissez-moi vous remercier. Pour la première fois, on nous traite en alliés, on reconnaît notre valeur, on proclame que sans le peuple, rien de bon n’est possible. Alliance, donc, alliance royale, et nous donnerons jusqu’à notre dernier écu, jusqu’à notre dernière goutte de sang. Ah ! laissez-moi d’abord parler, monseigneur. Puisqu’il est question de partage qui doit se faire, vous devez apprécier notre part. Et pour cela, vous devez d’abord apprécier notre apport dans l’œuvre commune. Écoutez donc. La Cité !…
– Me voici, dit l’un des bourgeois en s’avançant.
– Combien d’hommes ? Combien d’argent ?…
– Deux cents hommes. Trois mille écus d’or.
À ce chiffre énorme de trois mille écus d’or, les seigneurs ouvrirent les yeux, émerveillés.
– Quoi ! dit Jean Sans Peur, tant d’argent et si peu de guerriers ?
– C’est la Cité, monseigneur, dit Caboche avec un sourire. C’est le quartier des marchands d’or. Ils font ce qu’ils peuvent. Mais écoutez ceci, maintenant. La Marine !
Un homme s’avança, petit, maigre, nerveux, et dit simplement :
– Quatre mille bons bougres tous armés, tous décidés à crever.
– Ah ! Ah ! fit Jean Sans Peur. J’aime mieux cela !
– Le Temple ! appela Caboche.
– Six cents hommes, mille écus d’argent.
– L’Université !
– Quatre cents écoliers enragés de bataille, ne rêvant que plaies et bosses !
– Ils en auront, ils en auront ! dit Jean Sans Peur.
Caboche continua l’appel des différents quartiers de Paris.
Chacun donna son chiffre en combattants, et en pièces d’or – autre genre de combattant. Ce fut avec un froid orgueil qu’il énonça le total : dix-sept mille quatre cents bourgeois et artisans, tous bien armés ; environ cent mille livres parisis.
– Avec une pareille armée, ajouta-t-il, nous pouvons tenir tête aux troupes royales, – et même aux vôtres, monseigneur. Plus que le nombre, mieux que l’argent, nous avons encore avec nous la volonté de vivre libres ou de mourir. Voilà qui nous sommes et ce que nous valons. Maintenant, monseigneur, il faut que vous sachiez ce que nous voulons.
Jean Sans Peur écoutait avec une sombre stupeur cet homme qui lui parlait avec un tel orgueil, avec une sorte de rude familiarité, avec une force audacieuse et tranquille. C’était un artisan… à peine un bourgeois. C’était un manant…
Le duc de Bourgogne, après une longue minute de silence pensif, leva la tête, toisa Caboche, et dit :
– J’estime à sa valeur l’alliance que vous me proposez. Avant de savoir ce que vous voulez, vous, je dois vous dire ce que je veux, moi.
– Inutile, monseigneur ! dit Caboche en secouant sa grosse tête.
– Par la Croix-Dieu, gronda Jean Sans Peur, êtes-vous donc à ce point enorgueillis, messieurs de la bourgeoisie, que vous ne puissiez attendre notre volonté ?
La troupe des seigneurs fit entendre un murmure de menace, et les rangs jusqu’alors confondus se séparèrent en deux bandes distinctes : près de Jean de Bourgogne se rangèrent les nobles, la main à la garde de l’épée : près de Caboche se massèrent les bourgeois, dans une attitude non moins menaçante.
Caboche leva la main, et tous écoutèrent.
– Duc et hauts seigneurs, dit-il, ce que vous voulez, nous le savons ; et c’est pourquoi il est inutile que vous le disiez. Ce que vous voulez, monseigneur, c’est le trône ! Nous sommes prêts à vous porter à l’Hôtel Saint-Pol. Cela dit tout, je pense !
Jean Sans Peur tressaillit. L’effroi, la rage, la satisfaction, l’espoir se confondirent dans son esprit. Il était étonné, humilié que ce manant, renversant les rôles, prit la direction de la conférence. Mais tout lui criait qu’avec de pareils alliés la victoire était à lui. Il jeta un rapide regard sur ses seigneurs. Cela voulait dire : « Laissons faire ; une fois dans la place, nous aviserons à étrangler l’allié qui s’impose avec tant d’insolence. »
– Le roi Charles VI est fou, reprit Caboche. Le duc d’Orléans est mort (Jean Sans Peur pâlit.) Le duc de Berry est trop fin renard pour nous. Le duc de Bourbon, qui seul peut-être nous eût aidés sans rien nous demander vit à l’écart. Dans ces conditions, Mme la reine est libre de pressurer le peuple de Paris pour satisfaire ses plaisirs. Les grands Seigneurs promènent autour de nous un faste qu’ils n’ont pas conquis et qui est fait du sang du nos veines. Nous sommes donc décidés à porter au trône un homme qui nous garantira la possibilité de vivre. Car ce n’est pas vivre que de travailler nuit et jour comme des bourriques (sic), uniquement pour vous enrichir, messieurs de la noblesse !
La voix de Caboche s’était mise à gronder. Les veines de ses tempes s’enflaient. Ses yeux ternes s’enflammaient et jetaient des éclairs. Les seigneurs, frémissant de stupeur et peut-être de terreur, l’écoutaient, immobiles, paralysés par tant d’audace. Et lui songeait :
– Oui, oui, aidez-nous d’abord à nous débarrasser des tyrans qui détiennent l’Hôtel Saint-Pol, et puis vous y passerez aussi, ruffians ! Ni Valois, ni Bourgogne ! La Liberté !…
– Voilà un homme ! songeait le chevalier de Passavant qui du fond de sa galerie, écoutait tout cela.
– Pour le moment, reprit Caboche, vous, messieurs de Bourgogne, vous êtes avec nous, et vous nous consentez des satisfactions que nous estimons à leur valeur. (Il reprenait les termes de Jean Sans Peur). Les seigneurs du comte d’Armagnac annoncent, au contraire, qu’il est temps de dompter le peuple. Notre choix est tout fait. Nous sommes avec vous contre Armagnac !
Cette fois, le front de Jean Sans Peur s’éclaira d’une joie sauvage.
– Mort à Armagnac, dit froidement Caboche. Mais une fois la bête tuée, messeigneurs, nous voulons notre part. Êtes-vous décidés à nous la donner ?
Jean Sans Peur leva la main, de ce geste rapide et assuré de l’homme à qui les serments ne coûtent que la peine de les faire :
– Parlez, dit-il, parlez sans crainte. Je jure Dieu, si je mets sur ma tête la couronne de France, de tenir pour valables toutes les conditions que vous m’imposerez.
– Et vous, seigneurs ? demanda Caboche.
– Nous ratifions, répondirent les Bourguignons.
– L’un de vous sait-il écrire ? continua Caboche.
Les seigneurs se regardèrent, haussèrent les épaules, éclatèrent de rire. Non ! Aucun ne savait ou ne voulait avouer qu’il savait écrire :
– Toute cette ribaudaille est folle d’orgueil, murmura l’un d’eux.
– Eh bien ! dit tout à coup Jean Sans Peur, j’écrirai donc, moi.
Caboche tressaillit de joie. Non qu’il crût plus valable le traité parce qu’il serait de la main de Jean Sans Peur, mais ce qui lui était une rare sensation de puissance que de courber ainsi le redoutable féodal jusqu’à se faire scribe des volontés populaires. Et l’on vit ce spectacle étrange : le duc de Bourgogne s’assit à la table où des plumes, de l’encre, des feuilles de parchemin étaient disposées. Près du duc assis, Caboche debout appuya son poing à la table. Et il parla. À mesure qu’il dictait, Jean Sans Peur écrivait :
– D’abord, rétablissement de toutes les maîtrises et communautés de métiers. Rétablissement des dixeniers, cinquanteniers et quarteniers. Rétablissement de toutes congrégations.
– Ce sont les droits qui ont été abolis par le roi régnant, dit le scribe ; il est juste qu’ils soient rétablis.
– Ensuite, continua Caboche, il faudra aussi rétablir la prévôté des marchands, l’échevinage, son greffe, sa juridiction. Nous demandons que les rentes et deniers communs de la ville soient déclarés inaliénables et que le roi n’y puisse toucher sous aucun prétexte. Nous demandons que la juridiction qui est au prévôt soit transportée de droit à l’Hôtel de Ville.
– Tout cela est légitime, dit le scribe avec un sourire goguenard que Caboche saisit parfaitement.
– Nous demandons que tous métiers et confréries aient droit de se réunir sans aucune permission du roi ou de ses suppôts. Ces assemblées devront se tenir quand, où et comme il plaira aux corps de métiers.
« Nous demandons le droit de tendre les chaînes de nos rues, de nous armer, de choisir par élection nos prévôts et échevins. Nous demandons le droit d’acheter le sel où bon nous semble et au prix que nous voulons. Nous demandons le droit de ne rien payer au confesseur. Nous demandons que le luxe des femmes nobles soit réduit à de justes proportions. Nous voulons enfin que dans le conseil du roi nous puissions faire entrer des hommes que nous aurons choisis et qui seront nos porte-parole. Nous demandons que le roi ne puisse rien faire qui n’ait été ratifié par nos conseillers… que nos impôts surtout soit soumis à une vérification de ces mêmes conseillers…
Caboche s’arrêta. Le grondement de sa voix s’était accentué. Lui-même comprenait que des paroles définitives allaient sortir de ses lèvres brûlantes.
– C’est tout ! dit-il brusquement. C’est tout pour le moment, ajouta-t-il en lui-même.
Le scribe duc avait écrit avec une sorte de rage. Chaque parole de celui qui dictait était une offense mortelle pour la noblesse, un lambeau de privilège qui s’en allait au vent.
Jean Sans Peur signa. Il tendit le parchemin à Caboche qui le passa à un bourgeois, lequel savait lire et se mit en effet à relire à haute voix toute cette énumération. Quand ce fut fini, Caboche, une fois encore, demanda :
– Messeigneurs, êtes-vous décidés à nous donner ce que nous demandons ?
Et tous, d’une seule voix, répondirent encore :
– Nous ratifions !
Ils ratifiaient un projet de traité qui, tout compte fait, jetait les bases d’une monarchie constitutionnelle. Alors Caboche se tourna vers le duc de Bourgogne et, d’une voix grave, lui dit :
– Monseigneur, dès ce moment, vous êtes notre chef. Nous vous jurons obéissance jusqu’à extermination complète de nos ennemis communs. Quand vous nous donnerez le signal, nous serons prêts.
– C’est bien, dit Jean Sans Peur. Un de mes gentilshommes vous apportera le mot d’ordre.
– Lequel ? fit Caboche.
– Celui-ci, dit le duc de Bourgogne.
Et il désigna Courteheuse qui s’inclina.
– Messieurs les bourgeois, reprit Jean Sans Peur, je compte sur vous. Comptez sur moi !
C’était la fin de la conférence.
– Ouf ! songea le chevalier de Passavant. Il est temps que cela finisse. Je n’en puis plus de faim et de soif. Mais voici nos gens qui s’en vont. Il s’agit d’ouvrir l’œil.
Jean Sans Peur, le premier, avait monté l’escalier, suivi de la plupart de ses seigneurs.
Puis Caboche et ses bourgeois disparurent à leur tour.
Ocquetonville, Scas et Courteheuse formaient l’arrière-garde. Ocquetonville monta, puis Scas. Courteheuse jeta un dernier coup d’œil sur la salle et commença à monter aussi.
Dans la rotonde, les torches continuaient à brûler.
Cet escalier, en effet, aboutissait aux caves de la maison d’un bourgeois, lequel se chargeait de toute la mise en scène. Ce bourgeois attendait que ses hôtes fussent tous partis pour descendre éteindre les torches et fermer enfin la porte…
Vers la cinquième ou sixième marche, Courteheuse se sentit saisi par le bras. Quelqu’un était derrière lui. Et ce quelqu’un lui disait :
– Un mot, s’il vous plaît, sire de Courteheuse.
Courteheuse se retourna. Il vit un homme qui portait l’épée… l’un des gentilshommes du duc, sans doute. Dans l’ombre, il ne pouvait le distinguer.
– Que voulez-vous ? demanda Courteheuse.
– Vous parler. Et comme il est inutile que nos amis entendent ce que j’ai à vous dire, faites-moi l’honneur de redescendre ces quelques marches. Je vous retiendrai une ou deux minutes à peine.
Courteheuse jugea qu’il avait affaire à quelque ennemi qui voulait lui donner un rendez-vous sur le Pré-aux-Clercs. Rapidement il repassa dans sa tête la liste de ses ennemis, mais comme elle était nombreuse, il y renonça vite. D’autre part, il n’arrivait pas à distinguer les traits de cet ennemi. Mais comme à tout prendre c’était un gentilhomme qui, sûrement, était de la maison de Bourgogne, il n’hésita pas. Il commença donc à redescendre en disant :
– C’est à moi personnellement que vous en avez ?
– À vous-même !
– Courteheuse ! Courteheuse ! cria la voix de Scas. Viendras-tu, mort-diable ?
– Je vous rejoins ! cria Courteheuse. Allez toujours ! Vous voyez, monsieur, je suis attendu. Parlez donc vite, s’il vous plaît. Qu’avez-vous à me dire ?
Passavant découvrit son visage, sur lequel il avait ramené son manteau, et se plaça de façon à être éclairé en plein par la lumière des torches. Courteheuse pâlit et murmura sourdement :
– Le chevalier de Passavant !
En même temps, il leva les yeux vers le haut de l’escalier, comme pour demander du secours.
Passavant se débarrassa de son manteau, tira sa longue rapière, et d’une voix qui résonna étrangement :
– Guines ! Guines ! tu es mort de ma main. Courteheuse, es-tu là ?
– J’y suis ! dit Courteheuse.
– Courteheuse, tu mourras de ma main !
En prononçant ces mots, d’un bond, il se plaça entre l’escalier et Courteheuse. Et il tomba en garde. Courteheuse était un chien enragé. Il suffisait de le démuseler pour qu’il se jetât sur les gens. Corps et âme au duc de Bourgogne, il avait pour lui, en mainte rencontre, risqué sa peau ; pour lui, il avait accompli plus d’une prouesse au détour des rues sombres.
Courteheuse, moralement lâche, avait donc du moins cette intrépidité physique de l’homme qui, continuellement, joue sa vie contre une chance de fortune.
– Très bien, dit-il, vous voulez me tuer ?
– Comme j’ai tué Guines. Comme je tuerai Scas et Ocquetonville.
– Et pourquoi me tueriez-vous, voyons ? Dites-moi cela, que j’aie au moins la conscience tranquille avant de m’en aller retrouver mon brave Guines dans un monde qui est évidemment meilleur que celui-ci, puisque vous ne vous y trouvez pas… pas encore !
– Monsieur, dit Passavant avec son sourire tout hérissé d’ironie, soyez sûr que le jour où je me trouverai dans ce monde meilleur, ce n’est pas vous qui m’en aurez montré le chemin. Soyez sûr que si je vous y rencontre, je m’arrangerai de façon à vous écarter de ma route.
Il achevait à peine ce mot que Courteheuse, se ruant sur lui l’épée au poing, lui porta un furieux coup de pointe, sans le prévenir, sans aucun de ces préliminaires qui alors préparaient le combat. Le chevalier para d’un violent coup de fouet et éclata de rire :
– Ah ! ah ! je vous aime mieux ainsi ! Je vous retrouve ! Le coup de traîtrise vous va à merveille !
Courteheuse ne disait plus rien. Pâle de rage, les dents serrées, il portait dans les yeux la volonté de tuer ; il attaquait avec une calme assurance, car il demeurait maître de sa pensée et de son bras ; coup sur coup, il se fendait ; d’un bond, il se plaçait à droite de Passavant, puis à gauche ; il se jetait à plat ventre, et de sa dague, par-dessous, essayait de l’atteindre. Mais il avait affaire à un adversaire habitué aux ténèbres. Ses innombrables duels avec le geôlier de la Huidelonne avaient donné à Passavant l’habitude de toutes les feintes qu’on peut imaginer en escomptant la protection de l’obscurité. Le chevalier ne bougeait pas de sa place. Il coupait toute retraite vers l’escalier, et c’était pour lui le point essentiel.
Dans cette salle obscure, dans ce souterrain sur lequel la galerie dégorgeait des flots de ténèbres que les torches repoussaient à grand’peine, ce furent pendant quelques minutes le cliquetis des aciers, les éclairs jaillissant des lames entrechoquées, le tourbillon des deux hommes tantôt enlacés en un corps à corps farouche, tantôt arrêtés, haletants, à quelques pas l’un de l’autre…
Courteheuse, après une dernière attaque où il mit toute sa science, commença à reculer. Il était hors d’haleine. Les yeux sortaient de la tête. De pâle qu’il était, il était devenu livide.
– À mon tour ! dit froidement le chevalier.
Et il avança d’un pas pour préparer l’attaque… À cet instant, il sentit que son bras faiblissait, la rapière lui devint terriblement lourde, il sentit qu’elle allait lui échapper, ses doigts raidis se crispèrent ; en même temps, la même faiblesse mortelle descendit à ses jambes…
C’était la faim, c’était la soif, c’était le contre-choc de l’épouvante, c’était toute cette énorme fatigue de l’horrible marche à travers les ténèbres.
Passavant comprit qu’il allait mourir.
Il avait fait un pas en avant. Il en fit deux en arrière, en chancelant. Courteheuse eut un rugissement de joie féroce et, se jetant sur l’adversaire mourant, se fendit à fond, d’un terrible coup droit…
– Mort ! hurla-t-il dans un cri furieux.
Passavant était tombé sur un genou.
Mais il n’était pas atteint ! C’était la faiblesse qui l’avait terrassé au moment où l’épée de Courteheuse arrivait sur lui. L’épée passa par-dessus sa tête.
– Vivant ! râla le chevalier. Prenez garde, monsieur, je vous tue !
C’était sublime, cet avertissement. Mais Courteheuse n’en fut pas touché. Voyant que son adversaire n’était pas blessé, il leva son épée et se pencha pour le clouer sur le sable. Dans le même instant, il s’abattit en arrière, les bras en croix, sans un cri, sans un soupir… De bas en haut, rassemblant ses dernières forces, Passavant venait de lui traverser la poitrine à l’endroit du cœur… Et alors, se relevant péniblement, il contempla un instant le cadavre et répéta le mot de Courteheuse :
– Mort !…
Une minute, le silence dans la sombre rotonde fut effrayant. Penché sur le cadavre, le chevalier murmura :
– Mort de ma main. Mort comme Guines. Frappé au cœur comme Guines. Mort sans un soupir, comme Guines…
– Par l’enfer ! Par les griffes de Satan ! Par le nombril du pape ! As-tu juré de nous faire damner ? Viendras-tu, Courteheuse ?
C’était la voix d’Ocquetonville. Passavant releva la tête vers l’escalier, eut un étrange sourire, et cria :
– Me voici ! Je vous rejoins !…
– Nous partons, dit Ocquetonville. Rendez-vous à l’Hôtel !
– Je viens ! dit Passavant.
Rapidement, il s’empara du chaperon de Courteheuse et s’en coiffa. Puis il saisit son manteau et s’en couvrit. Alors, montant l’escalier d’un pas paisible, il se vit dans une cave où un homme lui montra un autre escalier, en lui disant :
– Hâtez-vous, mon gentilhomme. Vos compagnons, las de vous attendre, sont dans la rue.
– Le rendez-vous est à l’hôtel de Bourgogne, n’est-ce pas ? fit Passavant avec le même sourire.
– Oui, seigneur.
Passavant monta et arriva dans une sorte d’arrière-boutique où attendait une vieille femme qu’en passant, il salua gracieusement, comme il eût fait pour la plus jolie fille.
– Pouvez-vous, lui demanda-t-il, me dire à quel jour nous sommes ? Je vous en serais reconnaissant.
– Bien volontiers, dit la femme étonnée de la question, mais charmée du salut et de l’exquise politesse qu’il y avait dans la voix de ce gentilhomme. Nous sommes à vendredi matin.
Passavant était entré dans les carrières en la nuit du lundi au mardi.
Il fit rapidement le compte et frémit.
– Comment suis-je encore vivant ? songea-t-il.
Il s’étonnait, il s’émerveillait d’être resté trois jours et trois nuits sans boire ni manger. Il ne savait pas ce que savait Saïtano. C’est que l’agonie de la faim et de la soif, si elle est la plus effroyable, est aussi la plus longue ; elle peut durer dix jours et au delà.
– Vous faut-il quelque chose, mon gentilhomme ? reprit la vieille femme.
Passavant restait là, honteux de ce qu’il avait à dire. Il se décida tout à coup.
– Eh bien, oui, dit-il en tremblant, un peu d’eau… si vous voulez bien…
– De l’eau ? Jésus ! Un flacon de bon vin, oui ! Pour un seigneur aussi aimable…
– Je vous en supplie, râla Passavant, un peu d’eau… vite ! oh ! vite !
Comme il arrive toujours, l’idée qu’il allait enfin boire déchaîna sa soif. Dans ces quelques secondes, il souffrit de la soif plus qu’il n’en avait souffert dans les galeries. Il eût tué. Il sentait sa tête s’égarer. La femme reparut portant un grand gobelet plein d’eau. Le chevalier le saisit avec fureur et le vida.
– Encore ! dit-il.
Cinq ou six gobelets d’eau furent apportés coup sur coup par la bonne vieille, émerveillée qu’un gentilhomme eût une si belle soif et qu’il se contentât de boire de l’eau.
Le chevalier se sentait ranimé. Il sourit à la vieille et la remercia avec une effusion qui l’étonna plus encore que le reste. Puis il sortit, et, bien qu’il eût été prévenu qu’on était au matin, éprouva une véritable stupeur à voir le grand jour.
Dans la rue, les passants allaient et venaient.
Mais d’Ocquetonville et sa bande avaient disparu.
Passavant regarda autour de lui et se rendit compte qu’il se trouvait au pied de la montagne Sainte-Geneviève, sur le versant opposé à l’abbaye de Cluny. Il calcula la distance qui séparait l’abbaye du lieu où il se trouvait, et demeura effaré de constater combien minime était cette distance. Pourtant, il avait marché, ah ! marché pendant des jours et des nuits ! Il frissonna de terreur. C’est alors seulement qu’il se rendit un compte exact de ce qu’était l’effroyable labyrinthe de ténèbres.
Passavant se secoua pour échapper à ces impressions rétrospectives. Il se mit en route.
VIII – LES GUÉRISSEURS DU ROI
Ce matin-là, un dimanche, dans un misérable cabaret de la rue des Francs-Bourgeois (ce qui signifiait rue des voleurs, des truands, des escarpes, si l’on veut) dans ce cabaret, donc, sombre, triste, nauséeux, Brancaillon, Bragaille, Bruscaille, inséparables dans l’infortune de leur fortune éclipsée, étaient assis sur un banc devant une table.
Les trois compères avaient la mine longue d’une aune. Ils étaient blêmes ; ils avaient maigri ; Brancaillon était, en grosseur, réduit aux proportions d’un homme ordinaire ; Bragaille avait l’allure d’un moine au sortir des grands jeûnes de carême ; quant à Bruscaille, c’était un squelette. Ils claquaient des dents et roulaient des yeux terribles vers la cuisine d’où s’échappaient des odeurs de basse catégorie, mais qui étaient pour eux d’ineffables parfums.
Et leurs costumes ! Ah ! certes, les trois séides de Jean Sans Peur n’étaient plus ces gentilshommes sinon brillants, du moins cossus, qu’ils étaient aux temps heureux et lointains où ils habitaient l’hôtel de Bourgogne.
À des prix misérables, pour avoir de quoi manger un jour ou deux, ils avaient vendu à la grande friperie qui sa casaque de buffle, qui son chaperon, qui ses belles bottes de cuir fauve. Ils étaient emmaillotés d’étranges oripeaux ; le dernier mendiant de la cour des Miracles leur eût fait l’aumône.
Ils grelottaient. Dehors, il faisait un froid noir. Le ciel, chargé de neige, leur était un muet anathème.
– J’ai froid ! dit Bruscaille en serrant les épaules.
– J’ai faim ! dit Bragaille en bâillant.
– J’ai soif ! dit Brancaillon en louchant vers une outre installée dans un coin.
Ils eussent pu intervertir les couplets de cette complainte. Faim, froid, soif, c’était toute leur vie depuis trois ou quatre jours. En effet, l’idée que Brancaillon avait émise et qui avait été si triomphalement adoptée n’avait donné que de piteux résultats. Marion Bonnecoste, que Brancaillon s’était vanté de mener au doigt et à l’œil, leur avait offert un gobelet d’hydromel et ensuite les avait jetés dehors en disant : « J’ai assez à faire d’assurer ma propre vie. Allez en paix, compères, allez ! »
Alors ils tentèrent différentes fortunes qui toutes se montrèrent aussi cruelles les unes que les autres. Brancaillon essaya de s’embaucher parmi les débardeurs et mariniers du fleuve ; mais, la Seine étant gelée, tout travail était suspendu ; Bragaille alla offrir ses services au bedeau de Saint-Jacques-de-la-Boucherie ; mais peut-être l’eau des bénitiers était-elle gelée elle-même, car ses offres furent repoussées avec perte et fracas ; nous n’avons jamais su d’ailleurs en quoi avaient bien pu consister ces offres. Bruscaille, de son côté, mit en mouvement les ressorts de son imagination et proposa tout simplement de s’embusquer la nuit pour détrousser le bourgeois ; mais, par ce temps de chien et de loup, le bourgeois lui-même était gelé sans doute ; ce fut en vain que leur longue, patiente et grelottante faction attendit au détour des rues la victime récalcitrante : nul ne sortait la nuit.
Nous retrouvons donc nos gaillards à demi-morts dans la salle de ce pauvre cabaret où, après une affreuse nuit passée à claquer des dents sous un auvent, ils venaient de s’introduire dans l’espoir de se réchauffer un peu. Après un long silence, Bragaille reprit dans un soupir :
– Pour le coup, nous sommes morts.
– Et dire, fit Bruscaille avec rage, dire que l’infernal sorcier ose nous appeler les trois vivants !
– Est-ce de la cervoise ? du vin ? de l’hypocras ? de l’hydromel ?
C’était le maître du cabaret qui parlait, les poings appuyés sur la table, et les examinait de cet air sérieux qu’on a dans les affaires.
– Voulez-vous manger ou boire ? ajouta-t-il.
– Les deux ! fit Bruscaille avec désinvolture, les deux ! Manger et boire, mon cher hôte, ce que vous voudrez… la moindre des choses.
– Oui, fit Brancaillon, une omelette, un pâté de coq de bruyère, un cuissot de chevreuil.
– Et à boire, que vous faut-il ?
– Peu de chose, dit Brancaillon en se passant la langue sur les lèvres, tandis que ses deux compagnons, étourdis de son audace, le contemplaient bouche-bée Mettez-nous tout simplement sur la table cette outre que je vois là, dans ce coin.
– Très bien ! dit le patron, et il se plongea dans un profond calcul.
Bruscaille tressaillit, se pencha à l’oreille de Bragaille, et murmura :
– Il a dit : très bien !…
– Oui, palpita Bragaille. Nous sommes sauvés.
– Très bien, reprit l’hôte en achevant son calcul. Cela fait six livres, deux sols, huit deniers.
– Quoi ? fit Bruscaille d’un air de stupéfaction indignée.
– Que nous raconte-t-il là ? dit de son côté Bragaille, avec une égale surprise.
– Je ne comprends pas, affirma Brancaillon.
– Très bien, dit simplement l’hôte.
Il n’avait pas besoin de plus amples explications. Il allongea le doigt vers une pancarte crasseuse clouée au mur, et se mit à sourire en disant :
– Savez-vous lire ?
– Eh ! drôle ! Il n’est pas question de lire, dit Brancaillon avec candeur et fermeté. Il est question de…
– Oui. Très bien. Donc vous ne savez pas lire. Ni moi non plus, mais je sais très bien ce qu’il y a là-dessus, vu que c’est moi-même qui l’ai fait écrire sous mes yeux, par maître Baluche établi dans la rue aux Écrivains. Il y a ceci : « Crédit est mort. »
Les trois compères se regardèrent comme si cette nouvelle les eût profondément étonnés et que cela leur parût chose invraisemblable. Puis Brancaillon, qui avait toujours des mots définitifs, prononça :
– Mais les morts ressuscitent. Nous avons vu cela deux fois !
De plus en plus souriant, l’hôte cessa de désigner la malheureuse pancarte, mais ce fut vers la porte que cette fois il allongea le doigt. Et il dit : Très bien !…
– Quoi ! qu’est-ce qui est très bien ? hurlèrent Bruscaille et Bragaille.
– Dehors ! dit l’hôte. Dehors ! Il me faut de la place pour ceux qui boivent, mangent, et paient.
À ce moment, dans l’encadrement d’une porte, au fond, se montrèrent deux ou trois hommes solides, tout prêts en apparence à prêter main-forte au cabaretier. Les trois pauvres diables sentaient bien que, dans l’état où ils se trouvaient, ils n’étaient pas de force à lutter.
Ils se levèrent donc, soupirant, reniflant, louchant et le dos voûté, la tête dans les épaules, se traînèrent vers cette porte extérieure que l’hôte leur désignait, qu’il leur ouvrit gracieusement, et qu’ils franchirent les larmes aux yeux.
– Très bien ! dit l’hôte en refermant la porte de son cabaret à cause du grand froid.
Bruscaille, Bragaille et Brancaillon s’enfuirent. Cet horrible « très bien » leur entrait dans les oreilles avec la méchanceté d’une vrille perforante.
Ils marchaient l’un derrière l’autre, lentement, par les rues désertes où de rares passants se montraient de loin en loin, tout courants et soufflant dans leurs doigts.
Brusquement, la neige se mit à tomber. Elle descendait en lourds flocons qui ne tourbillonnaient pas, mais s’affaissaient tout droit, lentement, comme une nuée de papillons blessés à mort. Cela tombait silencieusement, dans le silence des rues. En peu de minutes, Paris prit un étrange aspect de nécropole…
Où allaient-ils, les pauvres bougres, tandis que dans leurs maisons closes, les bourgeois se chauffaient, le dos au feu, le ventre à table, comme il est dit dans la chanson ? Où ils allaient, ils ne le savaient guère ! Bruscaille reniflait, pourtant, le nez tendu vers on ne savait quoi. Peut-être avait-il une idée arrêtée, ou peut-être tout simplement le hasard le conduisit-il.
Toujours est-il qu’après d’interminables marches et contremarches dans la neige toute blanche, toute immaculée, Bruscaille, soudain s’arrêta.
– Où diable sommes-nous ? fit Bruscaille d’un air innocent.
Les deux autres regardèrent, levèrent les yeux et reculèrent en frissonnant.
– L’hôtel de Bourgogne ! murmura Bragaille.
– Tiens ! C’est pourtant vrai, dit Bruscaille. Si nous y entrions ?
Ils se regardèrent. Ils étaient livides. Et cette fois la peur était peut-être dans leurs âmes. Longtemps, ils demeurèrent ainsi, en arrêt devant la grand’porte de la forteresse, immobiles, silencieux, grelottant sous la neige implacable qui tombait plus serrée, plus épaisse, plus morne… Une heure se passa peut-être, et alors Bruscaille reprit avec le calme du désespoir :
– Ce soir, nous serons morts de froid. Autant en finir tout de suite.
– Eh bien ! dit Bragaille farouche, entrons et faisons-nous pendre.
Brancaillon bâilla. C’était un cri de détresse. Bruscaille songeait.
– Peut-être, murmura-t-il. Qui sait ?… Oui, peut-être !… Écoutez, nous allons entrer. Nous verrons monseigneur. Une fois là, pas un mot, tous deux, pas un geste. Laissez-moi faire. Laissez-moi parler. Et alors… peut-être !
Brusquement, il ajouta :
– Ou pendu, ou sauvé. Entrons !
La grand’porte était fermée, bien que le pont-levis fût baissé. Brancaillon s’apprêtait à donner de la voix, lorsque deux nouveaux personnages entrèrent en scène. C’étaient deux moines qui, arrivant à grandes enjambées, tout couverts de neige, pareils à deux vivantes effigies de l’immortel Bonhomme Noël, se présentèrent devant l’hôtel et appelèrent à grands cris. La porte s’ouvrit. Les révérends pénétrèrent dans la cour avancée. Bruscaille, Bragaille et Brancaillon s’y glissèrent à leur suite, et se trouvèrent nez à nez avec le capitaine des gardes.
Ce digne soldat prit d’abord une physionomie des plus stupéfaites, tandis que les trois compères se confondaient en saluts ; puis cette stupeur fit place à l’indignation ; le capitaine fronça les sourcils et gronda :
– Comment, drôles, vous n’êtes pas morts et vous avez l’audace de vous présenter ici ?
– Mais, fit Bruscaille, puisque monseigneur a déclaré que nous sommes les trois vivants !
– Oui. Mais vous deviez être morts, sacripants !
– Étant les trois vivants, il est juste que nous venions nous mettre au service de monseigneur.
– Oui. Mais vous deviez être morts, comment se fait-il ?… Tout ceci n’est pas clair, ajouta le capitaine en jetant un regard soupçonneux sur nos trois pauvres bougres, comme s’il eût voulu s’assurer qu’ils étaient en chair et os. Arrivez, Monseigneur débrouillera la chose. Moi, je n’y comprends rien.
– C’est comme moi, dit Brancaillon.
Ils suivirent le capitaine qui fit un signe à une douzaine de gardes. Aussitôt, nos gaillards se trouvèrent encadrés de hallebardes, cadre d’un bel effet décoratif, certes, mais dont ils se fussent bien passés.
Quelques instants plus tard, les trois prisonniers volontaires se trouvaient dans l’antichambre qui précédait la salle des armes où le capitaine pénétra seul. Il reparut en disant :
– Attendez, Monseigneur est en conférence avec deux saints révérends, des personnages meilleurs à voir et à écouter que vous, méchants drôles, mauvais garçons !
C’était vrai. Jean Sans Peur conférait avec les deux moines qui venaient d’entrer dans l’hôtel. Ils s’appelaient l’un Pierre Tosant, et l’autre Martin Lancelot. C’étaient les deux ermites qui avaient été chargés de guérir le roi Charles VI en l’exorcisant.
Les deux ermites étaient debout, côte à côte. Le duc se promenait avec agitation.
– Notre mission est terminée, disait Tosant. À Dieu ne plaise que j’accuse ici le roi de mauvaise volonté. Le pauvre sire, au contraire, ne demandait qu’à se laisser faire.
– Il acceptait tout, ajouta Lancelot avec un soupir, et il eût bu…
– Il eût bu ! interrompit violemment Jean Sans Peur.
Les deux ermites échangèrent un regard de désolation.
Le duc, peu à peu, se calma.
– Nous avons été saisis, reprit Lancelot, saisis sans que rien ne pût justifier un acte de violence exercé contre deux envoyés de Dieu et du duc de Bourgogne. Les gardes de Sa Majesté, au moment même où, après avoir convenablement jeûné et prié, nous allions tenter le suprême exorcisme, se sont emparés de nous. Non sans bourrades dont je porte les marques, ils nous ont menés hors l’Hôtel Saint-Pol, et pour tout adieu, pour tout remerciement, leur capitaine, suppôt d’enfer, à coup sûr, nous a crié : Allez au diable !
– Et même, dit Tosant, il a juré que nous serions pendus si nous reparaissions jamais.
– Dites-moi comment les choses se sont passées, et soyez bref, ordonna Jean Sans Peur.
Tosant fit alors tomber son capuchon, et sa face maigre d’ermite habitué aux jeûnes et aux macérations apparut, fine et tourmentée ; une longue barbe blanche lui descendait jusque sur la poitrine ; il avait le regard d’un illuminé. Il se signa lentement et prononça :
– « In nomine patris, et filii, et… »
– Enfer et damnation ! gronda le duc. Gardez vos patenôtres pour une meilleure occasion, messire. Il s’agit ici de la santé du roi de France qu’il faut sauver de la folie, car le royaume en a grand besoin.
– À qui le dites-vous, monseigneur ! soupira Tosant. Notre pauvre ermitage a été trois fois pillé par ces païens d’Anglais, chose que ne fût pas arrivée si notre bon sire eût été en état de les pourchasser. Eh bien, donc, lorsque votre envoyé vint nous trouver et fit appel à notre science de l’exorcisme, nous fûmes, frère Lancelot et moi, saisis d’un saint enthousiasme pour la mission qui nous était confiée. Pour plus de sûreté, nous acceptâmes le flacon sauveur qu’il s’agissait de faire boire, et refusant les mules qu’on mettait à notre disposition, nous nous mîmes en route, marchant humblement à pied, et au bout de trois jours, nous étions à Paris, belle ville, certes, devant l’Hôtel Saint-Pol, magnifique forteresse, où, je dois le dire, nous fûmes accueillis avec respect.
Jean Sans Peur bouillait d’impatience. Mais, sans doute, il avait déjà pu apprécier l’humeur de Tosant et savait que rien ne l’empêcherait de dévider son écheveau. Il gardait donc un prudent silence. Tosant continua :
– Nous fûmes donc mis en présence du roi. Nous devions, pendant huit jours, réciter des prières et faire les gestes rituels qui chassent les démons. Le huitième jour, qui est celui-ci, nous devions couronner notre œuvre en faisant boire à notre sire cette liqueur qui, nous avait assuré votre envoyé, venait en droite ligne de Rome. Or, monseigneur, jusqu’à ce matin, tout marchait à souhait. Le roi était calme. Il riait de bon cœur. Il semblait heureux. Il revivait. Et ce fut ainsi tous les jours, toutes les nuits, sauf cette nuit où, dans une partie de son palais, retentirent soudain des grondements de bête sauvage, et où le roi, avec tous ses gardes, courut chez la demoiselle de Champdivers…
Jean Sans Peur devint livide.
– Passez, murmura-t-il, passez !…
Un profond soupir gonfla sa poitrine. Il murmura le nom d’Isabeau, et un éclair de haine jaillit de ses yeux. L’ermite récitait une prière à voix basse, puis il reprit :
– Nos gestes d’exorcisme eurent donc le plus heureux effet sur Sa Majesté. Ce matin, frère Lancelot et moi, nous dîmes chacun notre messe. Nous implorâmes le Très Haut. Puis, étant encore à jeun, nous gratifiâmes le roi de quelques nouveaux gestes[2]. Enfin, le frère Lancelot tira de sa cassette le précieux flacon, en versa le contenu dans une coupe d’or, et je dis au roi : « Sire, cette liqueur vient de Rome. » Lancelot ajouta : « Et peut-être même de Jérusalem. « Croix-Dieu, nous répondit dévotement le roi, en ce cas, elle a fort voyagé et vient de lieux saints que je voudrais bien voir. » « Sire, dit frère Lancelot, il faut la boire et vous serez guéri. » « Est-ce du bon vin ? Voilà ce que nous dit le roi, car il aime le mot pour rire. Nous nous mîmes à rire avec lui de bon cœur et le roi saisit la coupe pour boire.
– Ah ! ah ! fit Jean Sans Peur, sombre, haletant, la sueur au front.
Ici, les deux ermites multiplièrent les signes de croix et commencèrent une série de prières en se donnant la réplique. Leur profonde sincérité était évidente. Leurs esprits transposés dans l’état d’extase presque continuelle ne saisissaient que peu de choses des réalités de la vie.
– Le roi allait boire lorsque tout à coup entra la diablesse…
– La diablesse ? dit Jean Sans Peur qui tressaillit.
– L’envoyée de Belzébuth venue tout exprès pour empêcher la guérison du roi !
– Mais qui ? hurla le duc de Bourgogne…
– La demoiselle de Champdivers ! dit Lancelot en se signant avec précipitation.
– Malédiction ! murmura sourdement Jean Sans Peur.
L’amour et la rage se livrèrent une rude bataille dans son cœur. Il la maudissait, et, si elle avait été là, il fût tombé à ses pieds.
– Elle entra, continua Tosant, courut jusqu’au roi, lui arracha la coupe et la vida dans les cendres du foyer. Le roi la regarda faire sans un mot de révolte. Elle l’eût tué qu’il n’eût pas bougé. Il souriait, Monseigneur, il n’y a qu’un moyen d’exorciser notre sire, c’est de la délivrer de ce démon… de…
– Assez ! gronda Jean de Bourgogne. Pas un mot sur elle, si vous tenez à la vie !
Tosant et Lancelot se regardèrent, effarés. Ils se disaient : « Monseigneur de Bourgogne aurait bien besoin d’être exorcisé, lui aussi. La diablesse les tient tous. »
– Continuez, reprit Jean Sans Peur en se calmant.
– Eh bien, pour finir, la demoiselle ayant vidé la coupe dans les cendres, comme je le disais, s’en vint vers nous, et, à voix basse, nous dit : – Ce que vous vouliez faire est horrible. – Comment ? s’écria le frère Lancelot. – Taisez-vous ! dit-elle. Remerciez Dieu que je ne veuille pas avoir votre mort sur la conscience, et que je ne dénonce pas votre forfait. Je vais vous faire chasser. Allez disparaissez, et ne revenez plus jamais… » Alors, monseigneur, comme nous demeurions muets, frappés de stupeur et d’horreur, elle revint au roi et lui dit : « Sire, je vous prie de faire sortir tout de suite ces deux hommes de l’Hôtel Saint-Pol. » Et le roi, qui a donné son âme à cette dia… à cette demoiselle, dis-je, le roi lui dit : « Puisque vous le désirez, qu’il en soit ainsi ! » Tout aussitôt, il appela à grands cris son capitaine, lequel, comme je vous le disais, nous fit saisir par ses gens d’armes. C’est ainsi, monseigneur, que nous avons été expulsés de l’Hôtel Saint-Pol, où nous étions venus sur votre ordre pour exorciser, sauver, guérir notre sire le roi.
Ayant achevé cette péroraison d’une voix rapide et nasillarde, l’ermite ramena son capuchon sur son visage et se croisa les bras. Lancelot l’imita.
Jean Sans Peur songeait. Maintenant, c’était d’un pas lent et fatigué qu’il parcourait la grande salle des armes. Il songeait. Et dans sa tête retentissait avec fracas le nom d’Odette. Il murmurait :
– Me voici donc encore arrêté par la fatalité. Tout était prêt. Je n’avais qu’à donner le signal à Caboche. La ville se soulevait. Et, tandis que la meute immense se déchaînait sur les Armagnacs, moi, je marchais sur l’Hôtel Saint-Pol… où il n’y avait plus de roi… Il faut reculer encore.
Il s’arrêta, tout pâle, le menton dans une de ses mains, les yeux fermés.
– Et qui sait, poursuivit-il, qui sait si demain, ce soir, on ne découvrira pas que l’assassin du duc d’Orléans, c’est moi !… Et alors…
Il frémissait d’épouvante. Il est certain que, malgré sa puissance et son audace, la découverte qu’il redoutait lui eût été, à ce moment, fatale. Sans aucun doute, il eût été arrêté, livré au bourreau…
– Odette ! Odette ! cria-t-il en lui-même. Ce n’est donc plus seulement mon amour qui veut que je te prenne dans mes serres et t’emporte dans le vol de ma passion ! Odette, tu es donc, toi aussi, un obstacle sur la route du trône ! Odette, c’est donc aussi mon rêve d’ambition qui… Eh bien ! par le ciel !… Messire, dit-il en revenant sur les ermites, acceptez jusqu’à demain l’hospitalité dans mon hôtel, puis vous reprendrez la route de votre ermitage.
Les deux personnages s’inclinèrent.
Jean Sans Peur appela. Le gouverneur de l’hôtel et le capitaine des gardes entrèrent ensemble.
– Qu’on donne à ces deux révérends les meilleurs appartements, ordonna le duc ; qu’on les traite honorablement, qu’on leur fasse bonne cuisine surtout, car ils ont jeûné à notre service. Allez, messires, et puisse l’hospitalité de l’hôtel de Bourgogne vous faire oublier celle de l’Hôtel Saint-Pol !
Les deux moines suivirent le gouverneur. Alors le capitaine des gardes s’avança sur le duc, et d’une voix narquoise :
– Monseigneur, dit-il, il y a là, dans l’antichambre, trois autres ermites qui veulent vous voir.
– Trois ermites ? fit Jean Sans Peur étonné.
IX – L’ERMITAGE DE BRUSCAILLE ET Cie
Le duc de Bourgogne ayant donné l’ordre d’introduire ces saints personnages, le brave capitaine, de plus en plus goguenard, s’en fut les chercher et les poussa devant lui à grandes bourrades. Ils entrèrent par rang de taille, tâchant de prendre la même allure dégagée, conquérante que jadis, au temps de leur splendeur. Mais ils étaient si blêmes, si minables, si dépenaillés que le duc, d’abord, ne les reconnut pas. Puis, fronçant les sourcils, il gronda en fixant tour à tour chacun des trois ermites :
– Bruscaille !…
– Oui, monseigneur, et ce n’est pas ma faute si je ne suis pas mort !
– Bragaille !…
– Ressuscité bien malgré moi, monseigneur !
– Brancaillon !…
– J’avais soif, monseigneur, alors…
– Comment se fait-il que vous ne soyez pas morts ?
Brancaillon avança le pied et, avec sa majestueuse tranquillité, répondit :
– C’est que monseigneur nous a affirmé que nous étions les trois vivants. Alors…
Bragaille lui bourra les côtes : il était convenu que Bruscaille seul parlerait. Brancaillon rentra dans le rang. Le duc, l’un après l’autre, les saisit entre le pouce et l’index, d’un air très dégoûté.
– Capitaine, dit-il, regardez-moi ces mauvais garçons. D’où sortent-ils ? En quels bouges ont-ils été se rouler ? Sont-ils assez ignobles ? Et ils ont l’audace de se présenter ainsi à l’hôtel de Bourgogne !
Ils jubilaient tous trois. Ils s’attendaient à une plus terrible réception. Ils devinaient dans les injures que leur octroyait leur maître une joie secrète mais réelle. Faut-il le dire ? Oui, sans doute, car les personnages tout d’une pièce en beauté ou en laideur sont du domaine du rêve. Jean sans Peur eut une minute bienfaisante. Sa joie de revoir ces trois animaux domestiques fut exempte de tout calcul. Morts, il n’eût plus pensé à eux. Les retrouvant vivants, il s’avisa qu’il les avait regrettés et que leurs faces patibulaires, leurs gestes de matamores, leurs attitudes exagérément dévouées avaient manqué à sa vie ordinaire pendant ces quelques jours. Quand il les eut suffisamment injuriés, tournés, retournés, bourrés de coups, quand il se furent remis en ligne, la main à la garde absente d’une épée imaginaire, il s’assit comme un juge dans un grand fauteuil, allongea les jambes et se versa dans sa vaste coupe d’or une rasade d’hypocras sur laquelle les trois compères louchèrent fortement. Puis il dit :
– Racontez-moi comment vous vous êtes évadés du cachot de l’hôtel de Bourgogne.
– En dormant, monseigneur !
Ce fut au tour de Jean sans Peur d’être étonné : le mot lui parut tellement ironique. Pourtant, Brancaillon l’avait prononcé dans la sincérité de son âme.
– C’est bon ! dit brusquement le duc. Dites-moi ce qui vous est arrivé. Ne mentez pas.
Le moment était venu pour Bruscaille de déployer toute son ingéniosité de mensonge.
– Monseigneur, dit-il, pour vous mettre à même d’apprécier, je dois reprendre les choses au début.
– Ah ! fit Jean sans Peur, tâche d’être plus bref que les ermites !
– Les ermites ? fit Bruscaille interloqué.
– Eh, oui ! s’écria le capitaine avec un gros rire, les ermites ! Et vous aussi, n’êtes-vous pas des ermites ?
Jean sans Peur tressaillit. Il eut pour les trois compères un étrange regard qui contenait une idée.
– Des ermites, murmura-t-il. Pourquoi pas ?… Allons, raconte, Bruscaille, et sois bref.
– Eh bien, monseigneur, c’est difficile à croire, c’est terrible à dire, mais l’homme à qui nous avons eu affaire est mort ou vivant à son gré. Voilà où gît toute la diablerie qui nous a attiré votre magnanime colère.
Jean sans Peur pâlit un peu. Le capitaine se signa et dit :
– Le fait est que j’ai vu mort dans son sac le sire de Passavant, bien mort, je le jure !
– Brancaillon l’avait assommé d’un seul coup de poing, affirma Bruscaille en levant la main.
– Après ? dit Jean sans Peur.
– Après, nous portâmes donc le sac au bord de l’eau, selon les ordres. Une pierre au cou, une pierre aux pieds, nous le mîmes dans la barque. C’est ici, monseigneur, que commence notre mensonge. Nous n’avons pas jeté le cadavre dans l’eau. Mais nous avons une excuse : au moment où Bragaille et Brancaillon se baissaient pour le saisir et le précipiter, le cadavre se mit debout, oui, monseigneur, debout dans son sac, et je vous jure que j’aimerais mieux regarder en face la potence où je vais être accroché que de revoir ce sac debout, silencieux, fantôme qui nous glaçait d’horreur…
– Vous avez eu peur, dites-le ! ricana le capitaine, très peu rassuré, d’ailleurs.
– Peur ? Oui, par la Croix-Dieu ! Et vous-même, capitaine, tout brave que vous êtes, vous eussiez tremblé en voyant ce sac se déchirer de haut en bas… Le mort vivait, monseigneur, et je ne sais ce que vous auriez fait à notre place, mais nous, sans songer, nous piquâmes dans le fleuve. Quand nous fûmes au bord, nous regardâmes vers le milieu de la Seine : bah ! cadavre, sac, barque, tout avait disparu. C’est pour cela que nous avons été mis au cachot.
Le capitaine ne ricanait plus. Le duc était sombre. Sûr d’avoir produit son effet, Bruscaille reprit :
– Au cachot, monseigneur ne l’ignore pas peut-être, nous sommes tombés dans un profond sommeil. Quand nos yeux se sont ouverts, nous étions chez le sorcier du diable.
Les trois se mirent à trembler, et Brancaillon hurla :
– Nous sommes vivants !
– Sur la table, dit Bruscaille en grelottant, sur la table de mort, nous avons vu le mort. Et nous, monseigneur, nous étions des enfants enchaînés. Que voulait faire le démon ? Je l’ignore. Mais lorsqu’il a voulu faire la chose…
– La chose ? gronda Jean sans Peur tout pâle.
– Je ne sais laquelle ! Mais lorsqu’il a voulu la faire, le mort était vivant… Le chevalier de Passavant nous a délivrés. Voilà, monseigneur. Depuis, nous mourons de faim…
– Et de soif, dit Brancaillon.
– Tuez-nous, monseigneur. Nous aimons mieux cela que d’errer comme des loups. Vous le disiez : nous sommes trois bons vivants, et…
– Vous êtes, dit Jean sans Peur en se levant, vous êtes trois fieffés imposteurs. Qu’on les conduise aux fourches de l’arrière-cour !
En même temps, le duc dit quelques mots à l’oreille du capitaine qui disparut. Bruscaille, Bragaille et Brancaillon se regardaient piteusement. La fin de leur noble carrière était proche. Ce n’était pas sans regret, nous devons le dire, qu’ils s’apprêtaient à quitter cette vallée de douleurs où pourtant ils avaient trouvé quelques bons moments. Bruscaille pleurait, Bragaille soupirait. Brancaillon s’était mis à chanter à tue-tête, et, comme le duc s’éloignait, il remplit la coupe d’or et la vida d’un trait.
– Voilà du fameux, dit-il en suçant le bout de ses moustaches. Je consens à être pendu tous les matins si on veut m’en donner autant, et du pareil.
À ce moment, les gardes faisaient irruption dans la salle. Les trois pauvres diables furent entourés, poussés au dehors, conduits avec force horions jusqu’à l’arrière-cour où ils virent trois nœuds coulants accrochés aux fourches, et l’exécuteur du duc de Bourgogne qui, en sifflant un air joyeux, graissait convenablement les cordes.
– Haut et court ! cria le capitaine. Haut et court !
– Allons, dit le duc qui entrait dans la cour, qu’on fasse vite ! Ces dignes ermites consentent à confesser les trois drôles. J’accorde cinq minutes pour la confession.
Pierre Tosant et Martin Lancelot s’approchaient.
– Je n’ai rien à dire, fit brusquement Brancaillon.
Et il reprit sa chanson qui faisait rougir les deux révérends. Quant à Bragaille et à Bruscaille, de bonne volonté, ils commencèrent à se confesser, le premier parce qu’il croyait à l’efficacité de cette cérémonie, l’autre parce qu’il espérait retarder le moment fatal. Or, pensait-il, tant qu’on a les yeux ouverts, tant qu’on respire, fût-ce au bout d’une corde, il y a de la ressource. Le hasard est si capricieux !
Tosant eut donc Bruscaille. Lancelot prit Bragaille. Les cinq minutes s’écoulèrent, et le capitaine cria :
– C’est assez ! Qu’on leur mette la corde au cou !
– Mais, protesta Bruscaille, j’ai à peine commencé. Grâce à Monseigneur, j’en ai long à dire à ce saint homme. Je veux bien être pendu, mais je dois songer à mon âme, par les pieds fourchus de Satan !
Bref, cinq nouvelles minutes furent accordées, au bout desquelles, malgré les cris, les larmes, les supplications, l’exécuteur de l’hôtel leur passa le nœud coulant autour du cou.
À l’autre extrémité de chacune des trois cordes deux aides, deux solides gaillards s’apprêtaient à tirer pour guinder en l’air les condamnés. La terrible minute était arrivée. Brancaillon ne chantait plus. Bragaille récitait une dernière prière. Bruscaille grommelait des jurons. Tous trois étaient livides.
– Attention ! cria joyeusement l’exécuteur, de l’ensemble, et du cœur au travail. Une, deux, trois, tirez ! Tirez ferme !…
Les six aides, deux par deux à chaque corde, se mirent à tirer.
Les nœuds coulants se serrèrent. Brancaillon tira la langue, et Bruscaille, de son accent gouailleur, lui cria : « Pas encore, animal ! Tu auras le temps tout à l’heure. » Les aides tirèrent encore et les trois malheureux commencèrent à perdre pied… C’était la fin ; ils eurent le frisson de la mort et fermèrent les yeux.
– Arrêtez ! dit Jean sans Peur.
Les nœuds coulants se détendirent. Brancaillon murmura : « Pourquoi arrêter ? Je n’y comprends rien. » Bragaille palpitait. Bruscaille ouvrit un œil, regarda le duc et jubila : « Je le savais bien, moi ! »
– Voyons, dit le duc, vous repentez-vous ?
Un triple rugissement qui était une protestation fervente de dévouement lui répondit.
– Eh bien, reprit le duc, je consens à vous faire grâce de la vie, mais à une condition : vous vous ferez ermites.
– Ermites ! Frocards ! Évêques ! Papes ! Tout ce que vous voudrez, monseigneur !
Quelques minutes plus tard, les trois compères se retrouvaient dans les cuisines de l’hôtel.
– Qu’on leur donne à manger, avait dit le duc, qu’on les habille convenablement, qu’on les laisse dormir jusqu’à demain, et puis nous verrons.
– Voilà de généreux ordres et plaisants à entendre, murmurait Bruscaille. Mais pourquoi diable devons-nous nous faire ermites ?
Ce fut une ripaille monstrueuse, et il fallait être les gens qu’ils étaient pour passer avec une telle désinvolture de la potence à table. Pour finir, ils furent portés ivres-morts dans leur dortoir où, le lendemain matin, ils trouvèrent chacun un équipement complet qui ne laissa pas de les étonner.
– Qu’est-ce que cela ? fit tout à coup Bruscaille.
– Que signifient de telles hardes ? ajouta Bragaille.
– Du diable si j’y comprends goutte ! affirma Brancaillon.
Ces équipements dont nous parlons, c’étaient, en effet, des équipements de moines, y compris le froc à capuchon, la corde pour ceindre les reins, le chapelet.
– C’est vrai, reprit Bruscaille sérieusement étonné, nous devons nous faire ermites. Mais pourquoi ermites ?
Quoi qu’il en fût, ils commencèrent à revêtir les vêtements de dessous, que devait couvrir le froc.
– Oh ! fit soudain Brancaillon, une dague !
– Moi aussi ! dit Bragaille.
– Moi aussi ! fit Bruscaille. Ah ! ah ! nous ne serons donc qu’à moitié ermites ? De bonnes dagues, courtes, solides, faciles à la main… Allons, compères les beaux jours ne sont pas finis !
Il y eut un éclat de rire terrible. Ils se retrouvaient, les sacripants, prêts à en découdre, prêts à foncer sur l’ennemi qu’on leur désignerait. Et ce fut joyeusement qu’ils endossèrent les frocs sous lesquels se cachaient les dagues.
À ce moment, Tosant et Lancelot entrèrent dans le dortoir.
– Ventre du pape ! Venez-vous nous confesser encore ? cria Bruscaille.
– Non, mes frères, dit Tosant, nous venons vous apprendre le métier.
– Le métier ? Eh ! mort du diable, quel métier vaut le nôtre ?
– Le métier d’ermite, dit Lancelot. Il faut que vous appreniez à exorciser.
– Bah ! fit Bragaille goguenard en touchant sa dague, nous avons là de quoi exorciser tous les possédés de Paris. Laissez faire, mes révérends. Le métier, nous le connaissons, oui !
– Il faut que vous appreniez les paroles et les gestes. Écoutez bien, et retenez.
Malgré leur répugnance, les trois sacripants durent écouter la leçon qui leur fut faite, et qui dura jusqu’au soir, interrompue seulement par un plantureux dîner auquel Tosant et Lancelot prirent part.
Pendant ce temps, ceci est à noter, le duc de Bourgogne était à l’Hôtel Saint-Pol, en grande conférence avec la reine Isabeau de Bavière.
Sur le soir, donc, Jean sans Peur revint à son hôtel.
Il se fit amener Bruscaille, Bragaille et Brancaillon qu’escortaient toujours Tosant et Lancelot.
– Savent-ils le métier d’ermite ? demanda le duc.
– Presque aussi bien que nous, répondit Lancelot dont les idées n’étaient plus très nettes.
– Sont-ils capables d’exorciser le possédé qu’il s’agit d’arracher au diable ?
– Ils savent faire les gestes, dit Tosant. Mais quant aux paroles sacrées…
– Les paroles importent peu, gronda Jean sans Peur d’un accent terrible. S’ils savent les gestes…
Bruscaille écoutait avec une attention passionnée. La voix rauque, âpre et funèbre du maître lui donnait l’ardeur de la bataille.
– Les gestes, dit-il, nous les savons tous, monseigneur, oui… tous !
L’œil de Jean de Bourgogne se fit sanglant. Sourdement, il murmura :
– Tous ?…
– Oui, dit Bruscaille froidement. Et si les gestes de ces révérends ne suffisent pas pour exorciser le possédé en question, il en est un que nous savons, dès longtemps, monseigneur…
Il frappa sur sa dague et du regard, interrogea le maître. Jean sans Peur eut une courte hésitation, et enfin, dans un souffle :
– Oui ! dit-il.
Bruscaille, Bragaille et Brancaillon frémirent. Quelqu’un était condamné. Qui ?
– Monseigneur, dit Bruscaille, il nous reste à apprendre le nom du possédé…
– Vous le saurez, fit Jean sans Peur plus sombre. Le possédé demeure dans votre ermitage.
– Notre ermitage ?…
– Oui. L’ermitage que vous allez habiter. Venez. Je vais vous y conduire !
Six heures du soir venaient de sonner. La nuit était noire, mais les neiges accumulées sur les chaussées, accrochées à toutes les arêtes, réverbéraient des clartés blanches. Le froid était violent, l’air cinglait.
Or, par les rues, s’acheminait une bande que quelques bourgeois, à l’abri derrière leurs vitres épaisses, regardaient passer avec étonnement. C’étaient cinquante cavaliers marchant au pas, enveloppés jusqu’au nez de leurs manteaux fourrés sous lesquels les mêmes bourgeois, à certains mouvements pouvaient voir briller les cuirasses et les dagues. Les manteaux portaient sur l’épaule gauche la croix rouge de Saint-André, et les bourgeois pensaient :
– C’est Mgr le duc de Bourgogne qui s’en va faire visite à quelque haut baron…
C’était Jean sans Peur, en effet.
Il marchait à plus de vingt pas en avant de son escorte, afin qu’on ne l’entendît pas parler. Et il parlait à trois révérends qui, montés sur des mules, cheminaient près de lui.
C’était Jean sans Peur qui donnait ses dernières instructions à Bruscaille, Bragaille et Brancaillon.
On arriva à l’ermitage !
L’escorte mit pied à terre. Jean sans Peur donna du cor. Un pont-levis s’abaissa… le pont-levis de l’ermitage où Bruscaille, Bragaille et Brancaillon allaient faire les gestes d’exorcisme… le geste !
Cet ermitage, c’était l’Hôtel Saint-Pol.
X – DANS L’ERMITAGE
Lorsque Bruscaille se vit dans l’Hôtel Saint-Pol, il ne put s’empêcher de frémir. Il perdit la tête et, tout pâle, ne sachant plus ce qu’il faisait, saisit le duc de Bourgogne par le bras. Il paraît que Jean sans Peur se trouvait lui-même dans une peu ordinaire situation d’esprit, car il ne songea pas à relever cette étonnante familiarité.
– Ainsi, murmura Bruscaille, l’homme que nous devons…
– Exorciser ! interrompit vivement le duc.
– Oui, exorciser… Il habite donc l’hôtel du roi ?…
Jean de Bourgogne planta son regard dans les yeux du sacripant et répondit :
– C’est le roi !
Bruscaille ploya les épaules. Le coup était effroyable, même pour un gaillard qui, en plein estomac, avait reçu plus d’une proposition de ce genre. Un moment, il demeura tout étourdi. Jean sans Peur reprit :
– Songe que les cordes de la potence, là-bas, sont toutes graissées. Ainsi, choisis sans crainte, mon brave.
– Mon choix est tout fait, monseigneur ; nous exorciserons le roi, la reine, tout l’Hôtel Saint-Pol, si vous y tenez. Pendu là-bas, songeait-il, c’est tout de suite. Pendu ici, j’ai quelques jours devant moi. En quelques jours, tout peut arriver, même la mort de notre généreux maître.
– As-tu bien compris ta mission ?
– Ah ! monseigneur, vous voulez m’humilier !
– Te rappelles-tu bien tout ce que tu as à faire et à dire, et à quel moment vous aurez à agir ?
– Oui ! murmura sourdement Bruscaille d’un accent sauvage. Vous venez de nous donner la vie. Nous allons la risquer pour vous. N’en parlons plus et marchons.
À travers les jardins couverts de givre, on s’avança vers le palais du roi. Bientôt, on se heurta à une femme qu’escortaient deux hommes. La femme échangea quelques mots rapides avec Jean sans Peur, puis s’en alla.
Si Bruscaille avait pu voir le visage de cette femme, il eût reconnu Isabeau de Bavière !
– Suivez ces deux gentilshommes ! ordonna Jean sans Peur.
Et lui-même se recula, s’enfonça dans la nuit, disparut dans la direction du palais de la reine. Il est probable que les deux gentilshommes en question avaient dans la journée reçu des instructions détaillées.
– Venez, révérends ermites, dit l’un des gentilshommes.
Bragaille et Brancaillon se regardèrent avec un sursaut, puis :
– Ah ! oui, ermites ! dit Bragaille.
– Ventre du pape ! il me semble que cela se voit assez, dit de son côté Brancaillon.
On arriva au palais du roi. On traversa des antichambres remplies de gens d’armes qui s’inclinaient avec respect sur le passage des révérends.
Dans l’après-midi, le bruit s’était répandu que trois saints ermites allaient arriver pour remplacer les sieurs Tosant et Lancelot qui n’avaient rien fait de bon et qu’il avait fallu chasser. On disait des merveilles de ces trois nouveaux guérisseurs profondément versés dans l’art d’exorciser les possédés. C’est donc accompagnés par des regards de sympathie et de vénération que les trois drôles parvinrent jusqu’aux appartements où le roi, prévenu de la visite qu’il allait recevoir, les attendait, sans impatience, il faut le dire.
Le roi avait été préparé à cette visite par le prieur des Célestins, homme des plus vénérables en qui il avait toute confiance. Il est d’ailleurs à noter qu’avant de parler à Charles VI, ledit prieur avait longuement conféré avec Isabeau et Jean sans Peur.
Quoi qu’il en soit, Bruscaille, Bragaille et Brancaillon furent introduits dans une très belle salle où une vingtaine de gentilshommes, parmi lesquels se trouvait le duc de Berry, faisaient leur cour au roi.
– Messieurs, dit Charles VI en souriant, retirez-vous et cédez la place aux envoyés de Dieu.
Tous les regards convergèrent curieusement sur les ermites qui avaient eu soin de rabattre leurs capuchons sur leurs visages pour cacher leur émotion. On s’accorda à leur trouver une belle prestance.
Le duc de Berry reniflait, souriait de son sourire cauteleux, jetait un bizarre coup d’œil sur les ermites, et ruminait des pensées de soupçon.
– Hum ! songeait-il, je donnerais bien ma chaîne d’or pour savoir ce que la reine et mon cousin de Bourgogne pensent de ces drôles. Sire, dit-il, nous laissons Votre Majesté aux prises avec Dieu, que nous apportent ces saints personnages. Puissent-ils réussir mieux que Tosant et Lancelot !
La salle s’était vidée.
Il n’y avait plus en présence des ermites que le roi, une jeune fille et un grand gaillard dégingandé.
– Voici, murmura Bruscaille, voici celle dont je dois me défier, et à qui je dois dire…
Cette jeune fille, c’était Odette de Champdivers.
Cet être maigre, souple, haut sur pattes, c’était Jacquemin Gringonneur.
– Approchez-vous, mes révérends, approchez-vous, dit le roi.
Ils avancèrent à l’ordre comme ils faisaient dans l’hôtel de Bourgogne, sur une seule ligne, et d’un seul mouvement, saluèrent. Charles les considérait, émerveillé. Bruscaille gardait son sang-froid. Mais Bragaille et Brancaillon roulaient des yeux terribles. Ils étaient ahuris de stupeur et peut-être d’effroi. Le roi ! Ils se trouvaient devant le roi !
Odette, pâle et pensive, les regardait fixement, cherchant à résoudre le problème qui se dressait, se demandant si ces trois ermites n’étaient pas là pour poignarder le roi comme Tosant et Lancelot étaient venus pour l’empoisonner (sans le savoir, il est vrai, mais Odette ignorait quelle part de bonne foi il y avait eu dans la tentative des deux ermites qu’elle avait expulsés).
Gringonneur tournait autour de ces trois moines, les saluait jusqu’à terre par devant, leur tirait la langue par derrière, cherchait à soulever les frocs pour voir ce qui se cachait dessous.
– Ne touchez pas, vous ! tonitrua Brancaillon en assénant un coup sec sur le poignet de Gringonneur.
– Oh ! Oh ! fit Gringonneur en frottant son poignet, diable soit du révérend ! Vous avez la main aussi dure que pouvait l’avoir Ajax, fils de Télamon, saint ermite !
– Ajax ? fit Brancaillon en toisant le peintre, qu’il y vienne !
– Voyons, dit Charles, comment vous nomme-t-on, mes dignes frères ?
Ils s’inclinèrent en chœur et du même geste se frappèrent l’estomac (leçon de Tosant).
– Sire, c’est moi frère Bruscaille, le fameux Bruscaille (Gringonneur dressa les oreilles) qui a extirpé quinze démons du cœur ou du ventre de divers possédés.
– Bruscaille ! fit le roi en riant. À la bonne heure, voilà un nom. Et vous ?
– Sire, c’est moi frère Bragaille (Hein ? fit Gringonneur), le célèbre Bragaille qui a guéri treize déments rien qu’en leur mettant la main sur la tête.
– Bragaille ! s’écria Charles. Voilà qui est encore mieux. Et vous ?
– Sire, c’est moi frère Brancaillon (Plus de doute ! murmura Gringonneur), l’illustre Brancaillon qui assomme un bœuf… non, mort-diable ! qui vide une outre… Ah ! par les cornes ! par les tripes ! par les boyaux !…
Le pauvre Brancaillon n’était plus du tout au fait de sa leçon. Il s’arrêta, tout suant, tout effaré. Les deux autres étaient consternés. Le coup était manqué. À l’horizon de leur imagination, ils virent la potence. Mais tout aussitôt ils furent saisis d’une joyeuse stupeur. Le roi riait à cœur-joie. Loin de s’indigner de ces jurons intempestifs, le roi témoignait pour Brancaillon de la plus vive admiration et criait :
– Brancaillon ! Ah ! pour le coup, c’est un vrai nom d’ermite ! Mieux que les autres ! Bruscaille, c’est bien, Bragaille, c’est mieux, mais Brancaillon, par Notre-Dame ! Et ces oremus, ces prières ! Comment, dit-il ? Par les tripes ? Les tripes de qui, mon digne révérend ?
– Eh ! sire, les tripes du diable, si vous voulez, ou les boyaux du pape, à votre choix.
Le roi éclata. Il y avait longtemps qu’on ne l’avait entendu rire d’aussi bon cœur. Il criait :
– Voilà des ermites qui me plaisent. Ils me guériront, par les boyaux ! par les tripes !
– Sire, balbutia Bruscaille, nous vous guérirons avec les gestes.
– Les gestes ? Eh ! mon digne révérend, laissez-là vos gestes. J’ai eu assez de ceux de Tosant et de Lancelot. Faites-moi rire comme votre acolyte, c’est tout ce que je demande.
Brancaillon, fier de son succès, ouvrait déjà la bouche pour envoyer une nouvelle bordée de jurons. Bragaille lui marcha sur les pieds. Odette regardait et écoutait tout cela sérieusement. Quant à Gringonneur, à force de tourner autour des ermites, il finit par entr’ouvrir un froc.
– Ah ! ah ! dit-il. Je croyais bien vous reconnaître, mes révérends, pour vous avoir vus déjà.
– Nous ! s’écria Bruscaille indigné. Notre ermitage est près de Tours (leçon de Lancelot) et nous n’en sommes sortis que pour venir ici.
– Votre ermitage, damnés ruffians, est à la Truie pendue !…
Il y eut un silence. D’un charmant mouvement, Odette se plaça devant le roi comme pour le défendre. Gringonneur ricanait. Le roi était sombre.
– Sire, reprit le peintre, ces ermites portent sous le froc la casaque de cuir et la dague.
Charles se leva, la figure changée.
– Mon capitaine des gardes ! dit-il d’une voix rauque. Gringonneur allait s’élancer.
À ce moment, Bruscaille, rapidement, s’approcha d’Odette et, à voix basse, lui glissa ces mots :
– C’est le chevalier de Passavant qui nous envoie ! C’était le mot d’ordre…
Une des plus belles idées de Jean sans Peur…
Odette était là pour protéger le roi. Odette avait déjoué déjà Tosant et Lancelot, il fallait faire d’Odette une alliée des trois nouveaux ermites. Pâle de rage et de jalousie, le duc avait indiqué à Bruscaille le nom de Passavant comme seul capable d’inspirer à Odette les confiances nécessaires.
Or, il ne savait pas à quel point ce nom était admiré, vénéré par le formidable trio.
Ce fut avec ferveur que Bruscaille parla de Passavant. Il y avait une telle sincérité, une telle ardeur de dévouement dans son accent que, dans l’instant même, Odette fut convaincue.
– Sire, dit-elle d’une voix rapide et oppressée, je sais pourquoi ces hommes sont armés. Sire, je sais qu’ils sont là pour vous protéger, vous… et moi. Sire, ayez confiance. Je réponds d’eux !
Gringonneur fut stupéfait. Mais le roi leva la main :
– Il suffit, dit-il. Tout ce qui mérite votre confiance, mon enfant, mérite aussi la mienne. – Monsieur, dit-il au capitaine qui entrait en ce moment, veuillez donner des ordres pour que ces trois révérends soient logés dans mon palais. J’entends qu’on les respecte, et qu’ils ne manquent de rien. Comme ils semblent de joyeuse humeur, je veux qu’ils soient bien nourris, et à cet effet, on leur donnera des viandes de mes cuisines.
Brancaillon, radieux, mit un pied en avant et dit :
– Et les vins, Sire ?
– Pardieu, compère, des meilleurs ! des meilleurs !
– « Domine, salvum fac regem nostrum ! » chanta Bragaille enthousiasmé.
– « Salvum fac bonum vinum ! » hurla Brancaillon.
Dans les antichambres, on écoutait avec respect ces vociférations, et on se disait : « Voilà les ermites déjà à l’œuvre. Ils ne perdent pas de temps. Le roi, pour le coup, va guérir. »
Gringonneur s’était enfoui dans un fauteuil et, avec admiration, contemplait cette scène. Odette, cependant, avait entraîné Bruscaille à part.
– Vous l’avez vu ? demandait-elle, haletante.
– La preuve, dit sincèrement Bruscaille, c’est que je suis vivant… Et mes compagnons aussi. Sans lui, madame, nous serions morts déjà je ne sais combien de fois.
– Où est-il ? Que fait-il ?…
– Ce qu’il fait ? Sûrement, il rôde autour de l’Hôtel Saint-Pol.
– Où l’avez-vous vu ? Que vous a-t-il dit ? Parlez franchement et vous n’aurez pas à vous en repentir. Je veux tout savoir.
La pauvre Odette espérait que Bruscaille allait lui dire : « Il m’a parlé de vous. » Mais Bruscaille, si fin qu’il fût, ne pouvait lire dans la pensée d’Odette. Il était d’ailleurs fort préoccupé, ce digne sacripant. Il se sentait sur un terrain glissant. Le moindre mot pouvait faire découvrir la fourberie. En outre, une rude bataille se livrait dans son esprit. Il se fût fait tuer pour Passavant. S’il n’obéissait pas à Jean sans Peur, il était pendu.
– Madame, dit-il, nous avons vu le sire de Passavant il y a quelques jours. Nous allions mourir. Il nous a sauvés – sauvés de la mort la plus affreuse, ajouta-t-il en grelottant. Vous ne savez pas ce que c’est que la table de marbre. Et les escabeaux ! Dieu vous préserve de le savoir jamais, ma noble Dame. Mais enfin nous fûmes sauvés.
– Sauvés par lui…
– Oui, madame. Et il nous dit alors : « Vous êtes des drôles, des sacripants, des francs-bourgeois, des gens de sac et de corde… » Il nous en eût dit cent fois plus, madame, nous eussions tendu le dos. Quand il nous eut gratifié de force bourrades agrémentées de douces paroles, comme je viens de vous l’expliquer, il a ajouté : « Si vous voulez me faire plaisir, trouvez un moyen de pénétrer dans l’Hôtel Saint-Pol et d’y rester. Vous verrez le roi. Vous verrez la demoiselle de Champdivers. Vous ferez ce qu’elle vous dira de faire. Soyez bien armés pour pouvoir livrer bataille s’il le faut. »
– Oui, murmura Odette, peut-être faudra-t-il livrer bataille ! Peut-être en veut-on à la vie de ce pauvre sire, comme on en veut à la mienne, comme on en voulait à celle de mon malheureux…
Au souvenir du vieux Champdivers, elle se mit à trembler et des larmes coulèrent. Bruscaille la regarda et fut étonné de trouver une émotion dans son cœur qui n’avait jamais battu.
– Mort du diable, songea-t-il. Si le moment terrible arrive, nous daguerons de roi, puisqu’il le faut. Mais par l’enfer, que nul ne s’avise de toucher au sire de Passavant et à cette noble fille !… Madame, reprit-il, nous avons donc cherché le moyen d’entrer ici. Nous avons appris que Tosant et Lancelot avaient été chassés. Nous avons donc pensé que nous pourrions les remplacer, d’autant mieux qu’avant de nous faire truands, nous nous étions faits ermites pendant plusieurs années. On fait ce qu’on peut pour gagner sa pauvre vie. Je dois dire pourtant que le métier de coupe-bourse est plus agréable que celui d’ermite. Mais laissez faire, nous connaissons les paroles et les gestes…
– Les gestes ? demanda Odette, tandis que Bruscaille cherchait sa voie parmi ses mensonges qu’entre-croisaient des vérités.
– Les gestes qui exorcisent, dit-il. Nous les savons mieux que Tosant. Tenez, regardez !
Il fut certain pour Odette que ces trois étranges ermites connaissaient Passavant, qu’ils l’aimaient et l’admiraient, qu’ils avaient été envoyés par lui. Le reste n’avait que peu d’importance. Elle résolut donc de ne pas s’opposer à leurs pratiques d’exorcisme, de façon qu’aux yeux de tous ils fussent seulement des ermites venus pour tenter une fois de plus la guérison du roi.
Les gestes ! Déjà Bragaille et Brancaillon les avaient entrepris, Bruscaille, plein d’émulation et désireux surtout d’échapper aux précises questions d’Odette, courut se joindre à eux.
Gringonneur suivait la scène d’un regard curieux et soupçonneux.
XI – SURPRISE DE THIBAUD LE POINGRE
Maintenant que nous voici rassurés sur le sort de nos trois ermites, nous pouvons jeter un coup d’œil sur la situation de certains de nos personnages, et notamment sur celle du sieur Thibaud Le Poingre, que nous retrouvons en son auberge de la Truie pendue.
L’enseigne brisée par Gringonneur avait été réparée tant bien que mal et remise en place de sorte qu’on n’eût pu se douter de la bataille qui avait eu lieu chez Thibaud.
Vermeil et rieur, l’hôte de la Truie pendue continuait à exercer, avec sa malice et sa bonne humeur ordinaires, les charges de sa profession. Nous reprenons contact avec ce célèbre hôtelier le lendemain matin du jour où le chevalier de Passavant avait échappé au labyrinthe – et, par conséquent, la veille du jour où nous avons revu Bruscaille et Cie.
Ce matin-là, samedi, maître Thibaud Le Poingre s’activait comme d’habitude à la bonne tenue de son auberge, gourmandait joyeusement Lubin et Perrinet, et Pervenche et La Boulgreuse, buvait un coup de vin par-ci, jetait par-là un regard aux cuisines.
– Maître, fit un valet en s’approchant, voici un seigneur qui met pied à terre devant l’auberge.
– J’y vais !
Il se précipita vers la porte et se trouva nez à nez avec un grand gaillard à fortes moustaches noires qui jurait comme un païen.
– Thibaud ! criait-il, Thibaud du diable ! Faudra-t-il que mon cheval attende ton bon plaisir avant d’être conduit au râtelier ? Sache, manant, que cette noble bête vient de faire ses dix lieues d’une traite. Du diable si je ne meurs d’envie de te couper les oreilles !
Le fait est que ce pourfendeur avait une physionomie des moins rassurantes. Thibaud s’empressa de donner satisfaction à ce peu endurant seigneur qui, voyant son cheval aux mains du garçon d’écurie, entra en disant :
– À manger, mort-Dieu ! À boire, mort-diable ! Holà ! drôles ! que l’on quitte tout ouvrage pour venir me servir ! Et vous, maître Thibaud, savez-vous qui je suis ?
– Sans doute ! fit tranquillement Thibaud. Qui ne vous connaît ? Vous êtes le sire Tanneguy du Chatel, celui-là même qui faisait partie de la maison de Bourgogne.
– Tais-toi, drôle ! tonna le nouveau venu.
– Et que monseigneur Jean de Bourgogne…
– Te tairas-tu, manant !
– A fait gourmer par les sires de Scas, de Courteheuse, d’Ocquetonville et de Guines, acheva Thibaud Le Poingre dont la figure se rida d’innombrables sourires de malice.
On ne sait jusqu’où se fût portée la fureur du sire du Chatel si le même Thibaud, changeant soudain d’attitude et se courbant autant que lui permettait la majesté de son ventre, n’eût murmuré :
– Messire, on vient de parfaire en mes cuisines un pâté d’anguilles digne de Jupiter et de Juno, comme dirait mon compère Gringonneur. Ventre-Joye, mon capitaine, il n’est pas pour les damnés Bourguignons !
– Et pour qui, alors ? fit Tanneguy soudain apaisé.
– Pour vous, ou le diable m’emporte. On eût dit que je vous sentais venir. Lubin, ai-je dit ce matin, prépare-nous un pâté d’anguilles, tu sais, comme les aime le seigneur du Chatel qui s’y connaît !
Tanneguy du Chatel était à cette époque un homme de quarante ans, rude, violent et gourmand, l’attitude d’un tranche-montagne, au demeurant un vrai brave, très mêlé aux sanglantes querelles de son temps. Il était vindicatif, et Jean sans Peur s’en aperçut bien, plus tard, au pont de Montereau.
Ainsi que Thibaud venait de le rappeler, il avait été d’abord l’un des fidèles de Jean sans Peur. Que se passa-t-il ensuite entre eux ? Nous l’ignorons. Toujours est-il que Tanneguy se sépara du duc de Bourgogne sans pour cela devenir un ennemi. Mais un beau jour, ou plutôt une nuit, il fut attaqué par une bande qui le laissa pour mort. Tanneguy ne mourut pas. Il avait la peau dure. Mais il fut d’autant plus ulcéré que le bruit de l’algarade se répandit dans Paris. Or, en tête des assaillants, il avait parfaitement reconnu les compagnons ordinaires de Jean sans Peur.
Tanneguy se fit le serment de vengeance, et comme il était violent, incapable de tenir sa langue, commença la guerre en disant partout à haute voix tout le mal possible du duc de Bourgogne, ce qui était d’ailleurs une vraie preuve de courage, car à ce petit jeu il risquait tout bonnement sa vie.
Tandis, donc, que Thibaud Le Poingre bavardait, faisait l’éloge de son pâté d’anguilles et de nombreuses autres victuailles dont il comptait régaler son hôte, Tanneguy du Chatel dégrafait son ceinturon et son buffle, se débarrassait de son chaperon, enfin prenait toutes les dispositions nécessaires pour se livrer en toute conscience à une de ces plantureuses agapes telles qu’on les concevait en un temps où l’on mangeait comme on se battait – à outrance. Il s’assit donc à une table devant le fameux pâté d’anguilles, et, près d’attaquer :
– Asseyez-vous là, maître, vous me ferez raison.
– Oh ! oh ! dit Thibaud avec inquiétude. C’est trop d’honneur, capitaine !
– Soyez tranquille, dit Tanneguy, j’ai de quoi payer double écot. Ainsi…
La face de l’hôte rayonna. Il prit donc place vis-à-vis de Tanneguy, non sans admirer la condescendance de ce redoutable capitaine ; il se demandait pourquoi on lui faisait un tel honneur, mais il n’en perdit pour cela ni un coup de dent ni un coup de gosier.
Lorsque le dîner fut achevé, lorsqu’on eut placé devant le capitaine un flacon de vin d’Espagne, il mit ses coudes sur la table, se pencha vers Thibaud, et, à voix basse :
– Ainsi, vous n’aimez pas les Bourguignons ?
– Pour eux, tout au plus la friture de goujons. Mais quant au pâté d’anguilles…
– Parlez franchement… Détestez-vous les gens de Bourgogne ?
– Je les ai en horreur, assura Le Poingre, du même ton dont il eût dit à Scas : « Je tiens les Armagnacs en détestation. »
– Très bien, fit du Chatel. En ce cas, je puis me fier à vous. J’eusse pu jeter mon dévolu sur vingt de vos confrères, mais je me suis dit : Maître Thibaud est un brave homme qui ne me trahira pas. Et puis, c’est l’endroit de Paris où l’on mange les meilleurs pâtés.
Il faut avouer que Thibaud, pour le coup, fut touché. En effet, l’amour qu’il professait pour sa belle auberge et sa réputation était profond et sincère.
– Parlez, messire, dit-il. Ventre-Joye, il ne sera pas dit qu’un brave capitaine comme vous aura eu faim et soif à la Truie pendue. Quant à être trahi, soyez sans crainte. Ici on mange trop bien pour trahir.
Tanneguy fut rassuré. Se penchant donc davantage et baissant la voix :
– Maître Thibaud, dit-il, j’ai été avisé que les maudits Bourguignons me veulent attaquer dans mon logis. À peine suis-je remis de mes blessures dont ils m’ont couturé le corps que, déjà, ils songent à me meurtrir. Chez moi ! ajouta Tanneguy avec rage.
– Lubin ! cria Thibaud, un autre flacon !
– Je veux vivre, poursuivit du Chatel en se versant une rasade. D’abord, je trouve que la vie est bonne, moi. Ensuite, je veux me venger. J’attendrai mon heure. Elle viendra, soyez tranquille. En attendant, les Bourguignons tiennent le haut de la chaussée, et ne nous laissent que le ruisseau. J’ai donc résolu de ne pas les attendre en mon logis, et…
– De vous cacher ! fit étourdiment Thibaud.
– Maître, dit froidement du Chatel, les gens comme moi ne se cachent pas. Je vais me retirer pour quelques jours en embuscade dans votre auberge. C’est une ruse de guerre.
– Sans contredit ! Ruse de guerre… J’y suis, capitaine. Allez toujours.
– C’est tout. Avez-vous une belle et bonne chambre à me donner pour huit jours. Je paie d’avance, ajouta du Chatel en faisant sonner son escarcelle.
Thibaud se mit à réfléchir. Et, certes, la chose demandait réflexion.
– Une chambre, une belle et bonne chambre, bredouillait-il. Heu. Nous disons belle et bonne, et payée d’avance. Belle affaire, ventre-joye ! (Si les Bourguignons le savent, méditait-il, c’est la ruine, c’est la Truie pendue mise à feu et à sac, et moi pendu à la place de mon enseigne.) Sans aucun doute, capitaine. Mais vous avez dit ruse de guerre… (Si je refuse, il va m’étriper.) C’est donc que vous vous tiendrez coi dans votre chambre, sans vous montrer à âme qui vive ?
– C’est mon intérêt, affirma Tanneguy. Je vous promets que nul ne saura…
– Venez ! dit rapidement Thibaud après un nouveau coup d’œil vers la porte.
Il entraîna Tanneguy du Chatel au fond de la salle, où, derrière une porte, commençait l’escalier. Une fois à l’abri de cette porte, Thibaud se sentit rassuré et, sans savoir pourquoi, éclata de rire.
– Mort-Dieu ! fit-il. Ce n’est pas que j’aie peur… J’ai fait mes preuves. Je vais vous donner la chambre dont s’était emparé ce fameux truand, le sire de Passavant.
– Passavant ? fit Tanneguy.
– Oui. Celui qui a meurtri le duc d’Orléans. C’est moi qui l’ai arrêté.
– Ah ! ah ! Contez-moi cela. J’aime les beaux faits d’armes.
Thibaud commença à monter l’escalier. À chaque marche, il s’arrêtait pour gesticuler. Son visage ensoleillé riait. Il n’avait pas l’air de bien croire à ce qu’il racontait. Mais cela l’amusait tout de même de le raconter. Suant, soufflant, cramoisi, Thibaud raconta donc l’exploit. Homère eût dit qu’il le chantait.
– Oh ! C’est donc un bien rude batailleur ? fit du Chatel intéressé.
– C’est-à-dire que dix, vingt épées ne lui font pas peur. Je crois me connaître en bravoure, capitaine. Eh bien, je jure qu’après vous cet homme est le plus brave de Paris. C’est dommage, vraiment, qu’il soit sans sou ni maille et qu’il ait failli me ruiner. Voyant donc que les gens d’armes n’osaient pas monter pour le saisir, je fais signe à mon ami Gringonneur. Il me suit. Nous montons. Vous connaissez Gringonneur, n’est-ce pas ? Vous savez qu’il n’a peur de rien…
– Oui, il boit bien, dit Tanneguy. Moins bien que moi, toutefois, car je l’ai fait rouler sous la table.
– Intrépide comme moi, Gringonneur me suit. Les gens du guet se décident alors. Nous montons, tous, moi en tête, Gringonneur derrière moi, et nous arrivons à cette porte que vous voyez…
Ils étaient arrivés devant la porte de la chambre qu’avait occupée Passavant. Thibaud continua :
– Pour arrêter le truand, je n’avais d’autre arme qu’une toute petite lardoire. Gringonneur était là où vous êtes, son épée à la main. Derrière lui, l’escalier était plein de gens d’armes qui me disaient de faire attention et que j’allais me faire tuer. Comme bien vous pensez, je ne les écoutais pas. Je dis à Gringonneur : Y es-tu ? – Oui, me répondit-il.
– Alors, j’ouvre la porte toute grande…
Et Thibaud ouvrit la porte, d’un mouvement superbe.
– Et j’entre en criant de toutes mes forces…
Et Thibaud entra en criant en effet :
– Rends-toi, truand ! Pas de résistance inutile !
– Or çà, maître Thibaud, dit une voix paisible, devenez-vous enragé de venir ainsi réveiller les gens qui dorment tranquillement chez eux ? Fermez cette porte, je vous prie. Il fait assez froid, je pense !
La bouche ouverte, les yeux exorbités, les cheveux hérissés, Thibaud demeurait pétrifié au milieu de la chambre où il venait d’entrer. Il était devenu très pâle, c’est-à-dire que son visage avait pris les teintes de la rose au lieu de celles de la brique. Enfin, un soupir gonfla sa vaste poitrine, et il put balbutier :
– Le chevalier de Passavant !…
– Fermez donc la porte, par la Croix-Dieu !…
– Je rêve, je rêve ! bégayait Thibaud.
– C’est moi que vous empêchez de rêver. Maître Thibaud, je vous préviens que si cela continue, je quitterai votre auberge et irai m’installer ailleurs…
– Quoi ! C’est vous ! C’est bien vous que je vois !…
– Et qui voulez-vous que ce soit ? dit le chevalier qui éclata de rire et se souleva sur le coude.
Il était allongé sur le lit, tout habillé, et paraissait sortir d’un profond sommeil. À ce moment Tanneguy du Chatel, étant entré, referma la porte en disant :
– Monsieur le chevalier a tout à fait raison. Il fait froid, et vous êtes un drôle, maître Thibaud, de laisser ainsi les portes ouvertes.
En un clin d’œil, Passavant fut sur pied et, sans avoir l’air d’y toucher, alla décrocher sa rapière qu’il ceignit aussitôt. Puis, saluant Tanneguy :
– Monsieur, dit-il, vous êtes le bienvenu chez moi…
– Non, dit Tanneguy, chez moi !
– Monsieur, reprit le chevalier, saluant de plus belle, malgré la façon bizarre dont vous vous introduisez chez moi, faites-moi l’honneur de vous y asseoir un instant.
– Ne vous gênez donc pas, dit Tanneguy, prenez cet escabeau et, bien que je sois assez surpris de vous voir installé chez moi, reposez-vous-y tant qu’il vous plaira…
– Seigneur ! Seigneur ! Comment cela va-t-il finir ? gémit Thibaud en levant ses bras courts vers le plafond.
Le chevalier de Passavant se prit à sourire comme il souriait parfois quand la main lui démangeait. Tanneguy fronça les sourcils et se mit à tordre sa formidable moustache. Tous deux ensemble se tournèrent vers l’infortuné Thibaud.
– Suis-je chez moi ? demanda le chevalier.
– Sans doute !
– Suis-je chez moi ? gronda Tanneguy.
– C’est sûr !
– Je ne vois plus qu’une chose à faire, dit Tanneguy, c’est de prier monsieur de franchir la porte.
– Je ne vois plus qu’une chose à faire, dit Passavant, c’est de jeter monsieur par la fenêtre.
Les deux adversaires, un instant, se mesurèrent. Dans la même seconde, les fers virent le jour. Thibaud, rapide et subtil, fit une conversion oblique et disparut. Tanneguy et le chevalier tombèrent en garde. Les épées cliquetèrent. Presque aussitôt, ils se ruèrent l’un sur l’autre. Il y eut un corps à corps, puis tous deux ensemble rompirent : à cet instant l’épée de Tanneguy sauta et sa forte garde d’acier alla rudement heurter le coffre.
D’un bond, le chevalier avait sauté sur l’épée de Tanneguy, et, mettant le pied dessus :
– Vous êtes vaincu, monsieur.
– Je me rends à merci, dit Tanneguy dont le poignet endolori eût été incapable de soutenir encore la rapière.
– Eh ! mordieu, fit Passavant, ramassez votre épée… Vous êtes un brave… Recommençons.
Tanneguy jeta un regard sur le gentilhomme qui, selon les règles du temps, pouvait le tuer ou le rançonner à son gré, et qui lui faisait une si généreuse proposition. Il le vit jeune, beau, étincelant de bravoure, et si fin avec son sourire sceptique. Son cœur s’émut.
– Jeune homme, dit-il, vous avez vaincu une des meilleures lames de Paris. Vous avez la générosité de me rendre mon épée. C’est un procédé que je n’oublierai pas. Je suis votre ami, cornes du diable, et je vous aime, tout truand que vous êtes !
– Truand ? fit le chevalier étonné.
À ce moment, la tête effarée de Thibaud apparut. Les deux ennemis réconciliés éclatèrent de rire. Ce que voyant, Thibaud plissa sa figure qui devint un rire répété à mille éditions, et dit :
– Pour en revenir à ce que nous disions, mes braves gentilshommes, laissez-moi vous faire une proposition.
– Voyons, dit Passavant. Et si la chose est raisonnable…
– Elle l’est. Vous, capitaine, je vous ai promis cette chambre, ignorant que M. le chevalier m’avait fait l’honneur de la réintégrer sans m’en prévenir. Vous êtes donc d’autant plus chez vous que vous m’avez proposé de payer d’avance.
– Ah ! ah ! fit le chevalier. Voilà donc pourquoi…
– Et je suis prêt à payer ! dit Tanneguy en ouvrant son escarcelle.
– Vous, monsieur le chevalier, reprit Thibaud, vous me voulez couvrir de gloire et d’honneur en augmentant la note de vos dépenses chez moi. Vous êtes donc chez vous, je le confesse de tout mon cœur.
– C’est bon, c’est bon, grogna le chevalier. Ne parlons pas de note. Il a été convenu entre nous que nous en parlerions seulement le jour où j’aurai fait fortune.
– Ce qui ne saurait tarder, ventre-joye ! Mes gentilshommes, vous êtes tous deux poursuivis. Vous avez tous deux à vous cacher. Vous êtes tous deux chez vous. Eh bien, restez, tous deux, dans cette chambre si elle vous plaît et si vous vous plaisez l’un à l’autre.
Passavant et Tanneguy se regardèrent : ils ne se déplurent pas… Ils venaient de se battre, mais cela ne tirait pas à conséquence.
– La chose vous convient-elle, chevalier ? dit Tanneguy.
– Truand, rectifia froidement Passavant.
– Oh ! par le nombril du pape, truand ou chevalier, je vous tiens pour un digne gentilhomme. J’efface truand, si vous voulez.
– Je le veux, dit Passavant. Il est bon que chacun se dise ce qu’il est. Si j’étais truand, je ne voudrais pas d’autre appellation. Mais je ne le suis pas, je n’y puis rien. Vous m’appelleriez duc ou roi, je réclamerais – plus fort que pour truand, il est vrai. Ni duc, ni roi, ni truand, voyez comme c’est simple. Cela dit, les propositions de maître Thibaud me conviennent. Vous êtes mon hôte, monsieur !…
– Le sire Tanneguy du Chatel, dit le capitaine en s’inclinant.
– Je cours chercher à boire, cria Thibaud qui s’élança.
– Et du meilleur ! cria Passavant.
Cependant, le front de Tanneguy se rembrunissait.
– Chevalier, dit-il enfin, avant d’accepter l’hospitalité que nous nous offrons l’un à l’autre, une question, je vous prie : êtes-vous Armagnac ou Bourguignon ?
– Hein ?… Je suis Passavant, voilà tout.
– Oui. Mais tenez-vous pour Jean de Bourgogne ?
– C’est mon plus cher ennemi !
– Pour Ocquetonville ?
– Je dois le tuer.
– Pour Scas ?
– J’ai juré de le meurtrir.
– Pour Courteheuse ?
– Il est mort – mort de ma main.
– Pour Guines ?
– Je l’ai tué !
– Ah ! par Dieu, cria Tanneguy au comble de l’enthousiasme, il faut que je vous embrasse !
L’accolade eut lieu. À ce moment, Thibaud rentrait. À la vue de cette embrassade, tout se mit à rire en lui, les yeux, la face, le ventre ; il leva ses deux mains chargées chacune d’un flacon, et songea :
– Voilà pourtant deux hommes qui voulaient se pourfendre, il y a dix minutes ! Monsieur le chevalier, ajouta-t-il en disposant les flacons sur la table, une chose m’inquiète, je dois l’avouer…
– Avoue, mais avoue en termes brefs.
– Eh bien ! puisque… c’est vous… puisque vous avez… le seigneur duc d’Orléans… vous…
– Est-ce bientôt fini ? dit Passavant avec un sourire terrible, tandis qu’il pâlissait un peu.
– Eh bien… non, je ne peux pas. Rien, monseigneur… Je n’ai rien à dire.
Passavant marcha sur le malheureux Le Poingre, le saisit par l’oreille droite, et tira sa dague affilée, tranchante comme un couteau. Et d’un ton paisible :
– Avoue, ou je te la coupe !
– Seigneur ! cria Thibaud, on dit donc que c’est vous qui avez meurtri le duc !…
Passavant lâcha l’oreille. Il se tourna vers Tanneguy du Chatel qui écoutait, violemment intéressé, car Paris tout entier s’occupait du meurtre et commençait à trouver étrange que le meurtrier demeurât impuni.
– Capitaine, dit le chevalier, je connais les assassins. Ils mourront de ma main !
Ceci fut dit d’un ton qui fit tressaillir Tanneguy et frissonner Thibaud.
– Pardon ! murmura celui-ci en se courbant. Je ne suis qu’un bélître.
– Chevalier, dit Tanneguy avec émotion, vous avoir vu une fois suffit pour écarter de vous l’horrible accusation. Quant à moi, si on vous accuse en ma présence, je dirai que je n’ai vu personne d’aussi brave et d’aussi généreux que vous. Je vous jure que l’accusateur ne répétera pas deux fois son mensonge.
– Merci, dit le chevalier en tendant la main au capitaine. Quant à toi (Thibaud cacha ses deux oreilles et poussa un soupir de détresse), quand à toi… sers-nous à boire !
– À l’instant même ! cria Thibaud.
Il se mit à remplir les gobelets d’étain : tout en versant, il se reprit à soupirer et donna à sa mobile physionomie une mimique des plus inquiètes.
– Voyons, dit le chevalier, qu’y a-t-il encore ? Faut-il saisir l’oreille gauche ? Parle sans crainte.
– Monsieur le chevalier est trop généreux, dit finement Le Poingre, sans qu’on pût démêler si cette générosité qu’il vantait s’appliquait à la liberté de parler ou à la menace faite aux oreilles. Je parlerai donc. Certes, de savoir si j’hébergeais ou non le meurtrier que cherche le prévôt, ce m’était une inquiétude. Mais j’avoue que j’ai au fond du cœur une autre inquiétude autrement lancinante…
– Laquelle ? fit curieusement du Chatel.
Passavant haussa les épaules.
– Voilà, dit-il. Maître Thibaud veut savoir comment il m’a trouvé dormant sur le lit de cette chambre qu’il croyait vide depuis plusieurs jours.
– Ventre-joie, monseigneur ! Vous êtes donc sorcier ?
– Non, mais j’en ai fréquenté un, et cela me fait même songer… mais revenons à vous, notre hôte. Qu’y a-t-il donc d’inquiétant en tout ceci ?
– Eh bien ! fit Thibaud, je ne sais pas comment vous êtes entré, voilà ! Si on entre dans mon auberge aussi facilement sans que je le sache, je ne vais plus dormir tranquille. Les portes ferment bien, pourtant.
– Mais, dit froidement le chevalier, je ne suis pas rentré par la porte.
– Et par où ? fit Thibaud ébahi.
– Par où je suis sorti, donc : par la fenêtre. Que voulez-vous ? C’est une habitude chez moi. J’entre, je sors par les fenêtres. C’est plus commode et moins ennuyeux que par la porte.
On ne sait si cette explication put satisfaire l’aubergiste de la « Truie-Pendue ». Il parut toutefois s’en contenter, et, saluant ses hôtes avec cette aimable et respectueuse familiarité dont il avait le secret, s’en fut surveiller ses cuisines.
C’est ainsi que Tanneguy du Chatel, fameux capitaine de ces temps, se trouva installé en l’auberge de Thibaud Le Poingre, et lia amitié avec le chevalier de Passavant.
XII – LE TÉMOIN
Cette amitié ne fit que croître et embellir dans le courant de cette journée qu’ils passèrent en tête à tête. Sur les instances de Tanneguy, le chevalier raconta une partie de ses aventures, et notamment comment il avait occis Guines et Courteheuse.
– Le plus beau, continua le chevalier, c’est ma rencontre avec vous. Voyez… En sortant des maudites caves où le sorcier m’avait conduit, j’étais faible, j’avais faim et soif, je mourais de froid. À la nuit, j’ai pu me traîner jusqu’à cette auberge. Le croirez-vous ? Parce que j’avais l’escarcelle vide, ma tête était vide aussi, et je ne trouvai rien à raconter au maître de céans. Ayant donc remarqué que la fenêtre de ma chambre était entrouverte, je me hissai tant bien que mal jusqu’à l’enseigne, de là jusqu’à la fenêtre elle-même ; je me jetai sur le lit, et, ma foi, je me suis endormi d’un sommeil qui durerait encore si les clameurs de Thibaud ne m’eussent réveillé. N’est-ce pas admirable que, dans la situation où je me trouvais, je me sois rencontré avec un homme tel que vous, capable d’assurer mon gîte et ma pitance ?
Ceci se passait le soir après un succulent et plantureux dîner.
– Vous oubliez, dit Tanneguy, que je vous dois la vie.
En même temps, il décrocha son escarcelle et la vida sur la table.
– Tiens ! fit Passavant, alors c’est la vie ou la bourse ? Au fait, un truand…
– Partageons, dit le sire du Chatel.
Passavant eut un geste comme pour repousser les pièces d’or que le capitaine avançait de son côté. Mais un regard qu’il jeta sur Tanneguy le fit tressaillir.
– Eh bien ! oui, dit-il. Partageons ! Mais, ajouta-t-il en riant, si Thibaud sait ma richesse, il va me harceler. Qu’il vienne ! Ma foi, je suis bien capable de lui jeter à la tête ces choses brillantes.
– Ne faites pas cela ! cria joyeusement Tanneguy. Thibaud perdrait toute l’estime qu’il a pour vous.
Ce fut donc en devisant de ces choses et autres que se passa cette journée. Passavant, de nouveau, se trouvait riche, et, s’il faut tout dire, il éprouvait quelque soulagement à se sentir l’escarcelle moins plate. Un deuxième lit fut dressé dans la chambre. Tanneguy du Chatel et le chevalier de Passavant dormirent à poings fermés.
Le lendemain fut encore une journée de récits héroïques, de confidences et surtout de substantielle ripaille, en sorte que Passavant se trouva tout à fait remis de son long jeûne dans les galeries qu’il appelait son carême noir. Sur le soir, il s’équipa de pied en cap, s’arma en guerre.
– Où allez-vous ? demanda Tanneguy. Est-ce Ocquetonville, ou Scas, que cette nuit vous allez occire ? J’en suis, mort-diable ! Laissez-m’en au moins un.
– Non, dit Passavant. Scas et Ocquetonville peuvent dormir tout leur soûl, et vous aussi. Je vais tout simplement chez quelqu’un à qui j’ai promis de couper les oreilles et la langue.
– Tout simplement ! fit Tanneguy ébahi. Peste ! je ne voudrais pas avoir excité chez vous cette simplicité. Mais je devine… Vous allez chez cet infâme sorcier… Je vous accompagne.
Passavant secoua la tête et déclara qu’il irait seul. Du Chatel n’insista pas. Mais, lorsque le chevalier eut descendu l’escalier, il boucla sa rapière, sortit à son tour, et de loin suivit son jeune ami.
– Je ne me reconnais plus, songeait le capitaine tout en piétinant dans la neige. Autrefois, j’avais le cœur plus dur, il me semble. Il est vrai que ce jeune homme a une manière d’agir et de parler qui m’a tout à fait touché.
Bref, le brave capitaine, à la suite de Passavant, arriva dans la Cité, et s’arrêta devant la porte de Saïtano. Et il commença tranquillement à monter sa faction, décidé, si le chevalier tardait trop, à entrer de force.
Quant à Passavant, il avait heurté le marteau. Il avait vu s’ouvrir le judas et répondu à la voix qui lui demandait ce qu’il voulait :
– Je viens de la part de la reine.
La porte s’était aussitôt ouverte, et Passavant s’était trouvé nez à nez avec Gérande qui tressaillit et poussa un léger cri. Puis, prenant son parti de l’aventure, elle le conduisit dans la deuxième salle où Saïtano, penché sur une table, s’absorbait dans un mystérieux travail devant des éprouvettes et des cornues. Le savant n’entendit pas entrer. Passavant, d’un geste impérieux, renvoya Gérande et s’assit dans un fauteuil. Puis, paisiblement, il tira sa dague et se mit à en essayer le fil sur le cuir de sa ceinture.
Saïtano, au bout de quelques minutes, versa le contenu d’une éprouvette dans un flacon que remplissait déjà à demi un autre liquide. Il plaça le flacon devant une lampe, l’examina un instant, le flaira, en versa une goutte dans sa main, et goûta.
Puis il poussa un soupir, marmotta de vagues paroles, et se retourna.
Il vit Passavant dans le fauteuil, affilant sa dague.
Saïtano ne fit pas un geste, ne dit pas un mot. Il demeura pensif, méditant sur l’aventure, l’esprit emporté vers de lointaines spéculations inaccessibles à la plupart des hommes. L’étonnement n’eut que peu de part dans cet état d’esprit. Passavant affilait la lame coupante et ne semblait nullement s’inquiéter du sorcier. Finalement, il se leva. Saïtano fut debout au même instant, et dit :
– Avant de me couper les oreilles et la langue, pouvez-vous patienter quelques minutes ?
– Écoutez, mon maître, dit froidement Passavant, je ne suis pas pressé. J’attendrai donc, non pas quelques minutes, mais une heure entière. Seulement, je dois vous prévenir que vous n’éviterez pas le châtiment, Quoi que vous disiez, je suis résolu à ne pas vous épargner. Sur ce, allez, je vous écoute.
– Asseyez-vous, dit Saïtano avec une sorte de tristesse.
– Je veux bien, dit Passavant.
Tous deux reprirent leurs places. Le chevalier garda sa dague à la main. Il avait l’œil et l’oreille aux aguets, s’attendant à quelques nouvelle trahison, et décidé à égorger le sorcier à la moindre alerte. Saïtano l’examinait furtivement ; parfois un soupir gonflait sa maigre poitrine. Il murmura :
– Pouvez-vous me dire comment vous êtes sorti des carrières ?
– C’est bien simple, dit Passavant. Quelqu’un a pris ma place et je suis sorti.
– Quelqu’un ?
– Oui, le sire de Courteheuse. Je me suis heurté à lui dans une cave en rotonde. Je l’ai tué. C’était son tour, paraît-il. J’ai tué Courteheuse, et je suis sorti. Par exemple, je dois dire que j’avais faim et soif. Vous m’aviez prévenu : ceux qui s’égarent dans les carrières y meurent de faim, de soif, et d’épouvante. Aucune de ces horreurs ne m’a manqué. Pourquoi m’avez-vous infligé un pareil supplice ?
Saïtano eut un geste vague et murmura :
– Ce fut en effet stupide. Je voulais me débarrasser de vous. Je craignais que vous ne fussiez un sérieux obstacle à ma recherche du Grand Œuvre, et je ne voyais aucun moyen de vous supprimer.
Il y eut un silence, pendant lequel Saïtano oublia peut-être jusqu’à la présence de cet homme, qui devait être alors un implacable ennemi et qui ne ferait aucune grâce.
– Enfin, reprit le chevalier, vous avez voulu trois fois me tuer.
– Une fois ! rectifia froidement le sorcier. Une seule fois : lorsque je vous ai conduit au labyrinthe.
– Bon, fit Passavant narquois, les deux fois où vous m’avez mis sur la table de marbre, vous vouliez donc…
– Vous ressusciter ! affirma Saïtano d’un accent de terrible sincérité.
– Vous dites ?…
– Vous ressusciter… C’est cela que je voulais vous dire en vous demandant quelques minutes de patience. Après, vous me tuerez, si vous voulez. Vous tuerez le Grand Œuvre. Vous tuerez la vie. Écoutez…
Passavant leva les yeux sur le sorcier. Une inexprimable émotion s’empara de lui à la vue de Saïtano qu’il reconnut à peine. Le visage maigre, tourmenté, ricaneur, le visage démoniaque s’était transfiguré. La flamme de l’orgueil illuminait le front. La passion de la recherche et de la découverte scientifique incendiait le regard.
– Un homme de santé moyenne vit à peu près soixante à soixante-dix ans. Il faut en retrancher environ vingt ans qui sont pris par le sommeil. La digestion quotidienne et les maladies absorbent environ dix ans. Il reste donc à peine trente à trente-cinq ans d’existence effective à un homme. Beaucoup plus de la moitié de ce temps, pour l’immense majorité des hommes, est dépensé stupidement en travail, monstrueuse obligation qui fait de l’être humain un pauvre animal courbé sur des besognes toutes infâmes. Sur les trente-cinq ans qui lui restent, l’homme en gaspille donc une vingtaine et peut-être plus pour assurer son gîte et sa nourriture. Au total, une quinzaine d’années pour « vivre »… Je vous le demande, est-ce la vie ?
– Du diable, fit Passavant, si j’ai jamais songé à de tels calculs. Pourtant, maître, je vous signale que parmi les années à retrancher de la vie, vous devez compter aussi celles qu’on passe dans les fosses d’une Huidelonne, ou les nuits perdues dans vos carrières…
Saïtano n’entendit pas. Il s’était enfoncé dans ses rêveries…
– Ce que je veux, dit-il, c’est la vie, toute la vie, l’éternité devant moi ! Au lieu des quinze misérables années d’existence réelle que l’homme parvient à s’assurer à grand-peine quand il vit sa vie normale, quand il n’a pas de maladies, quand il est aidé par les hasards favorables, je veux devant moi l’infini du temps, l’infini libre, déchargé de cet horrible poids qui est la crainte de la mort et qui écrase notre existence ! Ce que pourrait devenir un homme au bout de seulement quelques siècles de vie, à quelle beauté atteindrait sa pensée, et quelle perfection son corps même pourrait ambitionner, à quelle somme immense de bonheur il pourrait prétendre, c’est ce qu’il est inutile de calculer. Mais qu’un homme ait devant lui le temps sans limites, que sa patience puisse se dire éternelle, et à quel problème dès lors ne pourra-t-il pas s’attaquer ! Quel est l’obstacle de la nature dont il ne triomphera pas ? L’homme actuel ne perçoit qu’une infiniment petite partie de ce que donne aux sens la nature. Il perfectionnera ses yeux et il verra des magies éblouissantes de couleurs intermédiaires que son regard est maintenant inapte à saisir. Il fera de son oreille un monde, et les musiques dont il pourra se repaître pourront contenir des centaines de gammes entre chacun des sept misérables tons qui sont toute sa gamme actuelle. Il saisira des variétés de parfums inconnus. Il se découvrira des sens nouveaux qu’il n’a pas le temps maintenant de développer. Parvenu à l’apogée de sa propre gloire et de son propre bonheur, il s’élancera à la conquête de l’espace, changera de planète, volera d’univers en univers, éteindra dans son infime intelligence la nature entière, et il dira alors : il y a un Dieu, et c’est moi !…
Saïtano étincelait.
Brusquement, il baissa la tête, se tordit les mains et bégaya :
– Que faire ? Que faire en si peu de temps ? Alors qu’il y a dans le cerveau humain de fabuleux trésors de sensations qu’il faut découvrir, se contenter de ces quelques infiniment pauvres impressions qu’on ose appeler amour, joie, délire… allons donc ! Il faut vivre ! Il faut découvrir l’homme ! Il faut lever l’un après l’autre ces voiles épais qui couvrent sa vue, son oreille, tous ses sens… Il faut le temps ! Il faut l’éternité !…
Passavant frémissait et frissonnait.
Ce fut étrange. Doucement, il rengaina sa dague.
Saïtano l’avait-il donc subjugué, conquis, émerveillé ?… Non. Ne faisons pas notre chevalier plus beau qu’il n’était. Tout simplement, il songeait :
– C’est un fou. Comment oserais-je faire du mal à un pauvre fou ?
Avait-il raison ? Oui, sans doute. Ce n’était pas un homme de rêve que notre pauvre chevalier. Seulement, son cœur venait de parler. Et qui sait si ce n’est pas là la suprême science ?
Quant à Saïtano, peu à peu, il se calmait. Il avait dédaigné de remarquer le geste magnanime du chevalier. Il se pencha sur lui, et d’une voix extraordinairement douce :
– Mon enfant, vous me plaisez. Nul ne m’a plu autant que vous. Je vois en vous un être exceptionnel puisque vous avez pu me charmer moi-même. Vos projets à mon égard importent peu. Ne me tuez pas, c’est tout. Le reste est peu de chose. Si vous me mutilez, comme vous en avez l’intention, je souffrirai et ma souffrance ne vous donnera aucune satisfaction… votre cœur n’est pas fait pour se plaire à des douleurs. Je vous parle comme à l’un des meilleurs êtres que j’aie connus au monde.
– Mais alors, s’écria naturellement le chevalier, pourquoi diable avez-vous essayé de me tuer ? Je ne parle pas des carrières, mais de la table de marbre !…
Saïtano répondit :
– Je voulais vous ressusciter. Comprenez-vous ? Mais comprenez donc que je poursuis la découverte sublime qui fera de l’homme le maître du temps et de l’espace ! Mais saisissez donc que je tente la grande, la merveilleuse expérience ! Vous ne savez pas ce qu’on peut faire avec la transfusion du sang ! Les pauvres expériences tentées par Nicolas Flamel avec des animaux ont donné des résultats capables d’affoler la raison humaine. Or j’ai volé les formules de Nicolas Flamel. Comme lui, j’ai fait de l’or, j’ai fait des diamants. Comme lui, j’ai, par des transfusions de sang, de nerfs, de muscles, de cerveaux, obtenu la transformation des bêtes. Vous ne savez pas ! vous ne savez pas que la vie, en apparence éteinte, peut se rallumer, que du sang vivant versé dans les veines vidées d’un cadavre peut faire revivre ce cadavre !… Et alors… ne voyez-vous pas que c’est la fenêtre ouverte sur le mystère du Grand Œuvre ! Ne comprenez-vous pas que si j’étais parvenu à faire palpiter votre cœur, « à vous, mort », c’était la définitive preuve que l’homme peut faire la vie !…
Le sorcier s’arrêta pour respirer longuement, puis continua avec la même fougue furieuse :
– Faire de la vie ! Suspendre la mort ! Écoutez, écoutez ! Déjà j’ai composé l’élixir sacré capable de remettre en mouvement le balancier arrêté, le cœur qui règle le grand mécanisme. Oui, vous dis-je ! Cet élixir, cette liqueur qui est déjà dans mes mains une arme terrible, je l’ai composée, moi, Saïtano, et je l’ai éprouvée sur un cadavre qui s’est remis à vivre : le cadavre de Laurence d’Ambrun !
Le chevalier de Passavant fut aussitôt debout, très pâle, frémissant.
– Sorcier, gronda-t-il sourdement, tu as dit le cadavre de Laurence d’Ambrun !
– Eh oui ! Laurence d’Ambrun ! Celle-là même que vous appeliez votre sœur ! Celle-là même que votre généreuse mère avait accueillie en son logis ! Celle-là même à qui vous avez continué cette hospitalité. Je l’ai vue morte… et je l’ai vue revivre !
Une secrète terreur commençait à s’infiltrer dans l’esprit du jeune homme. Et en même temps, un ardent désir d’en savoir plus long le tourmentait. Il cria :
– Parleras-tu, cette fois ? Diras-tu cette fois la vérité ?
– Oui, par le ciel ! Toute la vérité que je pourrai dire en ce moment, je la dirai. Car je vois bien que le destin ne vous a pas marqué pour la grande expérience, je vois que vous êtes suscité par les puissances contre le seul homme qui m’ait inspiré une haine véritable.
– Quel homme ? fit Passavant étonné.
– Jean de Bourgogne !
– Ah ! ah ! En effet, maître, cette fois vous pourriez avoir raison. Je hais cet homme.
– Et si vous saviez toutes les raisons que vous avez de le haïr… Écoutez, vous aimiez Laurence d’Ambrun comme une sœur… Eh bien, c’est Jean de Bourgogne qui a poignardé Laurence d’Ambrun.
– Pourquoi ? Pourquoi ? Qu’y avait-il de commun entre elle et Jean Sans Peur ?
– Ce qu’il y avait de commun ! cria Saïtano.
Il s’arrêta soudain au moment où il allait dire : Laurence d’Ambrun, c’était l’amante de Jean Sans Peur. Roselys, c’était la fille de Jean Sans Peur.
Froidement, après deux minutes de réflexion, il reprit :
– Je le sais, mais je ne puis le dire. Un autre vous le dira peut-être. Moi, je ne puis et ne dois vous assurer que d’une chose : c’est que la reine Isabeau est venue ici chercher un poison pour tuer Laurence d’Ambrun et que je lui ai donné, moi, la liqueur de vie que j’ai composée. Je sais et puis dire que Jean de Bourgogne a poignardé Laurence – et qu’elle n’est pas morte parce qu’elle avait bu ma liqueur.
– Jean Sans Peur ! Isabeau de Bavière ! murmura Passavant. Je vous haïssais d’instinct. Voilà donc d’où me venaient ces pensées de défiance que vous m’inspiriez… Où est-elle, maintenant ? Vous savez tout cela !
– Je le sais. Mais je ne puis le dire…
– Enfer ! Veux-tu donc…
– Je veux, interrompit Saïtano avec une sorte de majesté, je veux que vous restiez ce que le destin a voulu que vous fussiez : « le témoin ! »
– Le témoin ?…
– Oui… le témoin de ce qui se passa au logis Passavant la nuit où vous fûtes amené ici et déposé sur cette table de marbre. Vous êtes le témoin, le terrible témoin qui peut, d’un mot, tuer le puissant duc. Écoutez, je ne veux pas contrarier le destin, moi. D’ailleurs, que suis-je ? Un homme ? Non. Je suis la science. Mais c’est vous que le destin a désigné pour arrêter Jean de Bourgogne dans son vol audacieux et lui briser les reins. Je ne dirai rien de plus.
– Tu parleras ! cria Passavant chez qui la colère commençait à bouillonner.
Saïtano, sans répondre, prit le chevalier par la main, le conduisit dans la troisième salle jusque devant l’armoire de fer. Il l’ouvrit. Elle contenait trois tablettes superposées. Le rez-de-chaussée était occupé par un coffre en fer. Les trois étages étaient habités par d’innombrables flacons. Passavant regardait avec une indicible curiosité, et l’angoisse étreignait sa gorge.
Saïtano parla ainsi :
– Je ne veux pas vous dire de quoi vous avez été le témoin, je ne veux pas vous dire ce qu’est devenue Laurence d’Ambrun, je ne veux pas vous dire ce qu’est devenue Roselys que vous cherchez. Il y a une destinée. Il y a une mathématique du destin. Je ne suis pas un homme. Je suis la science. Je n’ai pas le temps, ni la volonté de me mêler à l’histoire des hommes : je suis à la recherche du Grand Œuvre et ceci explique ma vie, mes mensonges, mes réticences. Je ne veux pas me mêler de corriger la destinée, ni d’entraver sa mathématique. Si le destin doit vous instruire, vous serez instruit. Ne me demandez donc pas plus que je vous donne. Ce que je puis vous donner, le voici. Retenez-le. Car votre vie est là ! D’abord, vous êtes le témoin, le terrible témoin redouté de Jean Sans Peur. Ensuite, Laurence d’Ambrun et Roselys sont vivantes. C’est tout. Ne demandez pas plus !
Le chevalier écoutait avec une ferveur qui l’étonnait lui-même.
Saïtano leva la main et désigna la tablette supérieure.
– Là, dit-il, sont les poisons. Tenez, voyez ce tout petit flacon : avec une seule goutte sur la langue, vous pouvez foudroyer un homme. En voici d’autres qui procurent de longues agonies, de façon que le meurtrier ait le temps de gagner au large. Mais ce sont là des jeux enfantins. Voyez ce liquide incolore comme de l’eau ; il est également sans saveur et sans odeur. Vous pouvez en faire boire à celui que vous voulez tuer. Il croira avoir bu de l’eau. Il n’éprouvera aucun malaise. Il vous quittera en parfaite santé. Vous entreprendrez alors quelque voyage et reviendrez au bout de trois ans pour apprendre que quinze jours avant votre arrivée, alors que vous étiez loin, votre cher ennemi est mort tout à coup d’une fièvre chaude. Que pensez-vous de cela ? ajouta Saïtano en regardant fixement le chevalier.
– Si j’ai un ennemi, dit froidement le chevalier, j’ai ma rapière et ma dague.
– Et si cet ennemi est tellement puissant que vous ne puissiez le frapper sans être certain d’être livré au bourreau ?
– Passez, maître. Ne vous inquiétez pas de ce qui, alors, regarderait le bourreau et moi.
Saïtano eut un étrange coup d’œil oblique sur le chevalier et continua :
– Laissons les poisons, et venons-en aux élixirs que recherchent avidement les seigneurs de la cour. Les voici en bon ordre au deuxième étage de ma maison de fer. Voici le plus important : il donne l’amour. Aimez-vous quelque fille à qui vous voulez inspirer une passion égale à la vôtre ? Voici, voici qui, mieux que les protestations, les paroles brûlantes, mieux que l’or même qui pourtant triomphe de bien des résistances, voici qui donnera à cette fille la fièvre d’amour que vous aviez rêvé. Voici ce qui la jettera dans vos bras. Quand vous voudrez être aimé, chevalier, venez à moi.
– Quand je voudrai être aimé, répondit Passavant, j’offrirai ma vie à celle qu’aura choisie mon cœur. Si elle refuse, je m’éloignerai. C’est tout.
C’était dit avec une froideur glaciale. Le sorcier garda un moment le silence, examinant le chevalier à la dérobée. Il haussa légèrement les épaules et du doigt toucha la première tablette de l’armoire. Son regard alors s’enflamma. Cette fois, il ne parlait plus pour le chevalier :
– Élixirs d’amour et poisons, ce sont des jeux… Voici mon œuvre, à moi ! Voici la liqueur qui donne la vie, celle-là même qui a permis à Laurence d’Ambrun d’être frappée d’un coup mortel sans mourir. Voici la liqueur qui me permet de transformer un cerveau, d’abolir ou de surexciter la mémoire, de modifier les sentiments, de faire d’un brave comme vous un lâche… Qu’en dites-vous ?
– Le jour où ce malheur m’arriverait, dit Passavant, j’espère qu’il me resterait encore assez de courage pour me tuer.
De nouveau, ce fut le silence dans la salle funèbre. Saïtano songeait :
– Il n’a pas même jeté un coup d’œil sur la table de marbre. Pourquoi un tel homme n’est-il pas mon ami ? Dans l’œuvre que j’ai entreprise, détendu, protégé par cette loyauté intrépide, par cette bravoure que rien n’abat, avec quel calme, quelle tranquillité j’eusse continué la grande recherche !
Il soupira. Passavant attendait paisiblement que le sorcier s’expliquât. Saïtano, peut-être, hésitait encore.
– Chevalier, dit-il enfin, et sa voix prit une inflexion de douceur qui étonnait chez cet homme, je vous ai mis sur la table de marbre, et vous m’avez deux fois vaincu. Je vous ai conduit dans les carrières pour vous y faire mourir de faim, de froid, d’épouvante. Vous étiez venu ici pour vous venger. Tout à l’heure vous m’avez cru fou et vous avez rengainé votre dague. Maintenant, me croyez-vous encore fou ?
– Non, dit Passavant.
– Pourquoi ne me tuez-vous pas ?
– Parce que je n’ai plus de colère contre vous. Je ne vous comprends pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne saisis pas exactement ce que vous voulez. Mais je vois que ce n’est pas la haine qui vous guide. Pourtant, à vous, savant illustre qui cherchez l’accomplissement d’un rêve sublime, je veux, moi, pauvre esprit incapable de m’élever à ces hauteurs de pensée, je veux dire une chose qui vous paraîtra sans doute bien misérable, mais qui me semble, à moi, très naturelle.
– Dites, fit avidement Saïtano.
– Ceci : pour achever votre expérience, vous deviez tuer les trois pauvres diables enchaînés sur ces escabeaux ? Cela ne peut faire de doute…
– C’est la vérité même, dit le sorcier en soupirant. Leur sang m’était nécessaire.
– Eh bien, que voulez-vous que fasse à Bruscaille, Bragaille et Brancaillon votre recherche de la vie éternelle ? Pourquoi un homme serait-il supprimé parce que les hommes doivent vivre ? Votre sublimité est criminelle au premier chef, mon maître.
Saïtano sourit. Il posa sa main sèche sur l’épaule de Passavant. Ce sourire faisait frissonner le chevalier…
– Vous êtes un enfant, un noble enfant, dit le sorcier. Vous ne savez pas que la guerre, la lutte sans pitié, c’est la loi primordiale de la brute humaine. C’est la loi même de l’affreuse nature. Il faut tuer pour vivre. Il n’y a pas un homme au monde qui n’ait plusieurs crimes à se reprocher. Il n’y pense pas, il les ignore parce que s’il a été criminel, ce fut pour assurer sa vie. Vous ne savez pas, vous ne pouvez savoir ce que l’obligation de défendre, sa vie engendre chez la brute – tigre ou homme – des pensées de mort. Les moins criminels sont ceux qui tuent avec une dague. Laissez-vous vivre, mon enfant, et ne cherchez pas à sonder l’effroyable mystère de la guerre que se font les hommes. Retenez seulement ceci : que vous deviez me tuer, et que vous ne me tuez pas !
Saïtano se redressa et jeta un long et indéfinissable regard sur le chevalier.
Puis il se baissa et ouvrit le coffre de fer qui se trouvait au rez-de-chaussée. Passavant regarda curieusement l’intérieur du coffre, où il vit des papiers en quantité et quelques petits coffrets. Saïtano saisit l’un de ces coffrets et le déposa sur la table de marbre à l’endroit même où s’était appuyée la tête du chevalier lorsqu’il avait été étendu sur la table.
Alors, dans le grand coffre, le sorcier prit un vieux parchemin plié, sali…
Saïtano était redevenu sombre. D’autres pensées montaient en lui avec une force irrésistible, pensées terribles sans doute, car le chevalier, tout à coup, vit son visage se contracter. Et, comme il considérait cette figure qui peu à peu se convulsait, Passavant, soudain, comme avait fait Jean Sans Peur, allongea le bras et avec un rire nerveux cria :
– Quoi ? Qu’est-ce ? Qu’avez-vous au visage ? Une main !…
– La main sanglante, dit Saïtano sans émotion.
– Quelle main ? bégaya le chevalier saisi par une sourde terreur. Quelle main ? Qu’est-ce que cela veut dire ? Oh ! la voici rouge, comme du sang !… La voici qui saigne !…
Saïtano haussa les épaules :
– J’ai tâché de dompter en moi la brute humaine. Il n’y a pas eu moyen. Je suis resté homme par certains bas instincts d’animalité. Cette main ?… C’est celle d’un homme qui m’a souffleté, voilà tout. Moi, Saïtano, roi de la science, moi qui vais sans doute trouver le Grand Œuvre, j’ai été frappé au visage, j’ai subi l’ignominie de cette insulte…
– Oui, murmura le chevalier. Mais comment la marque est-elle restée ? Ceci, vraiment, est du sortilège. Ceci, vraiment, m’épouvante… Ah ! la voici qui s’efface.
– Regardez, dit Saïtano en souriant. Regardez parmi ces liqueurs. Il en est que j’ai essayées sur moi-même !… J’ai été souffleté, vous dis-je. Or j’ai voulu que jamais l’oubli de l’horrible outrage ne puisse se faire dans mon cœur… Grâce à ces liquides corrosifs, j’ai pu…
– Disparue ! interrompit Passavant.
– Oui ! fit Saïtano avec un rire funèbre, disparue en apparence. Mais elle ne disparaîtra en réalité que le jour où vous…
– Moi ?… Par Satan, qu’ai-je affaire de cette main ?
Saïtano se tut. Mais bientôt il leva en l’air entre ses doigts le parchemin plié et sali qu’il avait pris dans le coffre.
– Ne parlons plus de moi, dit-il gravement. Parlons de vous. Écoutez. Avec toute votre attention, écoutez ce que je vais vous dire. Tôt ou tard, bientôt sans doute, vous allez vous heurter à Jean de Bourgogne…
– Oui ! dit Passavant avec un accent d’implacable résolution. Et je lui demanderai ce qu’il a fait de Laurence, de Roselys !
– Ceci ne me regarde pas. C’est l’œuvre de la destinée – de votre destinée. Mais retenez ceci : lorsque vous penserez que l’heure sera venue, n’hésitez pas, venez frapper à cette porte, et dites-moi : « Je réclame le parchemin où sont relatées les choses dont je fus le témoin… »
– Quelles choses ? murmura le chevalier dont la tête s’égarait. Quelles choses ? Pourquoi parler si mystérieusement ?
– Vous êtes le témoin ! C’est tout. Quand l’heure sera venue, demandez-moi ce parchemin… Maintenant, allez. N’oubliez pas que vous êtes le témoin. Moi je n’oublie pas que tout à l’heure vous avez rengainé la dague qui devait me tuer.
Saïtano referma le coffre, puis l’armoire de fer. Passavant s’enveloppa de son manteau, et tout étourdi de ce qu’il avait vu, étonné de ne se sentir aucune haine contre l’homme qui l’avait conduit dans les carrières, il se dirigea vers la porte qui donnait sur la rue. Saïtano prit dans ses mains le coffret qu’il avait déposé sur la table de marbre, et suivit le chevalier. Au moment où celui-ci allait franchir la porte, Saïtano lui remit le coffret.
– Qu’y a-t-il dans ce coffret ?
– La dot de Roselys ! répondit le sorcier.
Et la porte se referma. Passavant effaré entendit à l’intérieur un bruit de ferrures qu’on poussait.
– La dot de Roselys ! murmura-t-il en frémissant.
Soudain une sorte de colère s’empara de lui. Il se mit à frapper du poing sur la porte, en criant :
– Roselys ! Vous m’aviez promis de me conduire à elle ! Où est-elle ! Si vous êtes un homme, si vous avez un cœur comme je l’ai cru tout à l’heure, répondez ! Où est Roselys !…
Et Passavant entendit le sorcier Saïtano qui lui répondait :
– Allez à l’Hôtel Saint-Pol, et demandez Roselys à Odette de Champdivers…
Le chevalier fut secoué d’un long tressaillement ; puis la stupeur, la crainte l’immobilisèrent, des pensées étranges se levèrent dans son esprit. Il cherchait en vain à se calmer. Mais sans doute il fût resté longtemps devant cette porte, si une main lourde, tout à coup, ne se fût posée sur son épaule. Il se retourna en criant nerveusement :
– Qui va là ! Au large !…
– Eh ! par le diable, ne reconnaissez-vous pas Tanneguy du Chatel ?
– Vous !… Comment…
– Je vous ai suivi. J’attendais votre départ de cette maison diabolique. Je commençais même à trouver que vous étiez bien long, et j’allais heurter au marteau.
Passavant se taisait. Il était encore sous le coup de l’impression que lui avait causée l’étrange réponse de Saïtano.
– Venez, reprit Tanneguy du Chatel. Vous êtes sauf, c’est l’essentiel. Mais que diable tenez-vous dans vos mains ?… Un coffret ?…
– Oui, dit Passavant avec un rire bizarre, c’est la dot de Roselys.
– Roselys ? fit le capitaine effaré.
– Roselys que je dois aller demander à Odette de Champdivers…
– Du diable si…
– À l’Hôtel Saint-Pol ! acheva Passavant.
À ce mot, Tanneguy du Chatel se renfrogna.
– Mon jeune ami, grogna-t-il, vous vous êtes conduit envers moi en vrai chevalier et vous m’inspirez une amitié à laquelle je ne résiste pas. Cela vaut un conseil, je vais vous le donner.
– Non, vendez-le moi.
– Hein ?
– Oui. Une idée que j’ai. Je ne puis supporter qu’on me donne un conseil. Alors, vous comprenez, je vous l’achète, surtout s’il est bon.
Et Passavant, se prenant à rire du bout des dents, se mit en route, escorté de Tanneguy tout ébaubi.
– Quel diable d’homme êtes-vous ? fit le capitaine. Quoi qu’il en soit, voici le conseil : évitez de jamais entrer à l’Hôtel Saint-Pol.
– C’est ce qu’on m’a déjà dit. C’est ce que je me suis dit moi-même. Et pourtant, j’irai. Votre conseil ne vaut rien, mon cher, mais je prise la bonne intention qui l’a dicté. Allons.
La route se fit en silence. Lorsqu’ils eurent atteint l’auberge de Thibaud, lorsqu’ils furent enfermés dans la chambre qu’ils s’étaient disputée la rapière au poing et qu’ils partageaient fraternellement, le chevalier posa le fameux coffret sur la table et murmura :
– Dot de Roselys !…
Tanneguy du Chatel regardait curieusement. Il frappait du pied, tournait autour de la table, mâchait des jurons, et enfin, n’y tenant plus :
– Eh bien, ouvrez-le donc, mort au diable !
Passavant tressaillit, et parut revenir de très loin. Le coffret était fermé à clef, et Saïtano l’avait gardée, cette clef. Tanneguy introduisit la pointe de sa dague dans le joint du couvercle qui bientôt se leva. Le capitaine poussa un cri – un rugissement suivi d’un terrible juron. Passavant ne dit rien. Tous deux, un peu pâles, considéraient avec admiration, presque avec terreur, le contenu de ce coffret.
Il était plein de diamants !…
– Est-ce vrai ? murmura Passavant.
– Est-ce croyable ? fit du Chatel.
Ni l’un ni l’autre n’osait toucher à ces belles choses brillantes. Enfin, le chevalier s’y hasarda et, ayant longuement choisi, prit une bague ornée d’un fort beau diamant. Tanneguy, qui le regardait faire, s’écria :
– Prenez garde, mon jeune ami, prenez garde !…
– À quoi ? fit Passavant étonné.
– Eh ! tout cela vient du sorcier. Cela brûle, peut-être !
– Vous croyez ? dit le chevalier avec un sourire de malice.
– J’en suis sûr. On m’a raconté plus d’une histoire de ce genre. Le diable a plus d’un tour dans son sac. Il vous offre un diamant : vous le tournez et retournez dans vos doigts, vous admirez les jolies flammes qu’il jette, et tout à coup, le diamant se transforme en un charbon ardent ; votre main est brûlée, votre bras se dessèche…
– Ah ! fit Passavant, je remets donc dans le coffret cette bague que je voulais vous offrir.
Le capitaine devint très rouge et poussa un cri :
– Quoi ! balbutia-t-il, à moi ? Ce diamant ? Mais il vaut une fortune !
Et le brave Tanneguy tendait la main dans laquelle Passavant laissa tomber la bague en disant :
– Prenez garde d’avoir la main brûlée et le bras desséché !
– Bah ! Nous verrons bien ! grogna Tanneguy qui saisit avidement le bijou et se mit à l’admirer avec force exclamations.
Il y eut alors de nouvelles embrassades. Tanneguy se déclara désormais l’ami du chevalier envers et contre tous, et lui proposa de l’escorter à l’Hôtel Saint-Pol, dût-il y laisser sa peau. Puis il ajouta :
– Vous voilà riche, et je ne sais pas si le duc de Berry qui a volé les joyaux du feu roi Charles V possède autant de pierres précieuses (il exagérait de bonne foi, le brave capitaine), mais en raison même de cette richesse, laissez-moi vous donner…
– Un conseil ! dit le chevalier de son air naïf.
– Oui ! dit le capitaine étourdi. Le voici : Allez chez Éphraïm, le juif de la Cité, ou plutôt allons-y, et échangez ces pierres contre des écus d’or.
– Par le ciel, cette fois, le conseil est bon !
– Et payé d’avance ! fit le capitaine goguenard. Ainsi, nous irons ?
– Dès le jour venu !
XIII – L’EXORCISME
Le lendemain, au point du jour, comme la chose avait été convenue, Tanneguy du Chatel et le chevalier de Passavant sortirent de l’auberge de la « Truie-Pendue » ; le chevalier portait le coffret.
Pendant que le chevalier et le capitaine s’en vont chez le juif Éphraïm, nous prierons le lecteur de nous suivre à l’Hôtel Saint-Pol, où se préparait un historique événement que nous devons raconter. Le principal héros de cette aventure fut le sire de Bois-Redon.
Ce jour-là, c’était celui où Bruscaille, Bragaille et Brancaillon, où les ermites malgré eux furent introduits dans l’Hôtel Saint-Pol et commencèrent leurs gestes d’exorcisme.
C’est donc dans l’appartement royal que nous entrerons tout d’abord.
Nous y retrouvons les mêmes personnages que dans la scène que nous avons précédemment esquissée, moins Odette qui avait regagné son appartement – c’est-à-dire le roi, les trois ermites et Jacquemin Gringonneur. Nous avons laissé Bruscaille au moment où il venait de convaincre Odette qu’il était un envoyé de Passavant, et où il se rapprochait de ses acolytes pour jouer son rôle.
– Sire, dit-il, « in nomine patris »…
– Oui, dit Charles qui se signa dévotement. Mais j’aime mieux ce que raconte votre révérend frère Brancaillon. Il n’importe : commencez, messire.
– Bon ! Plaise à Votre Majesté de bien s’asseoir dans le fond de son fauteuil, la tête appuyée au dossier… oui, sire, et je supplie le roi de ne pas remuer.
– Suis-je ainsi bien placé ? fit docilement le roi.
– Exactement, oui, sire, ne remuez plus, fermez les yeux, et récitez douze « pater » de suite.
– Douze ! s’écria Gringonneur. Six de plus qu’avec Tosant. Pour le coup, sire ! vous êtes guéri !
– Et Tosant ne me faisait pas fermer les yeux, dit Charles.
– Ah ! par la jupe à Juno, vous voilà bien joli, mon roi ! Avec trois gaillards de cette trempe, moi, je deviendrais fou au bout de deux heures. C’est ce qui prouve que les fous, par un effet inverse, doivent recouvrer leur santé. Soyez tranquille, sire, du moment que Bruscaille s’en mêle, vous allez devenir aussi raisonnable que Mgr de Berry.
– Gringonneur, suis-je donc insensé, à ton avis ?
– Cela dépend des jours, sire. Aujourd’hui vous me paraissez assez fou.
Le roi ouvrit les yeux. Et déjà son regard se troublait. Déjà quelques tremblements convulsifs laissaient présager une crise prochaine. Il en était ainsi toutes les fois que, devant lui, on faisait allusion à sa folie, bien que lui-même, souvent, revînt sur ce sujet. Sans doute Gringonneur sentit venir l’orage car, changeant de ton, il informa gravement le roi qu’il se rendait aux cuisines.
– Sire, dit-il, ces trois vénérables ermites vont se fatiguer au service de Votre Majesté. Il est donc juste et même nécessaire de les réconforter par quelque victuaille de haut goût.
– Bien, dit le roi avec une évidente satisfaction. Va, et ne ménage rien.
– Et n’oublie pas la buvaille ! cria Brancaillon.
Le roi donc, étant assis dans son fauteuil, les yeux fermés, la tête appuyée au dossier, nos trois compères se mirent en ligne devant lui et étendirent leurs mains. Bruscaille prononça une longue invocation à la fin de laquelle le roi, d’une voix fervente, répondit : « Amen. »
Puis, se plaçant l’un derrière l’autre, les ermites, lentement, firent trois fois le tour du fauteuil en récitant une prière. Seul, Brancaillon, qui n’avait pas de mémoire, remplaça les verbes latins par un jargon de sa composition – et cependant il louchait vers la porte pour voir si la victuaille et la buvaille n’arrivaient pas. Ayant fini leurs évolutions, ils frappèrent trois fois dans leurs mains, et Bruscaille, d’une voix terrible, cria :
– Au nom de Dieu tout-puissant, démon qui habite ce corps, je t’ordonne d’en sortir à l’instant !
Bragaille répéta cet ordre d’une voix non moins redoutable. Mais Brancaillon, après avoir attendu une minute, au lieu de répéter à son tour, se contenta de dire :
– Il ne sort pas ! Ah ! par les boyaux du pape, si jamais je mets la main sur lui !…
– Imbécile ! grogna Bruscaille.
– Messire, dit Charles en entrouvrant un œil, j’ai fini mes douze « pater ».
Bruscaille et Bragaille se regardèrent. Ils n’avaient pas prévu ce genre d’observation.
– Ah ! fit Bruscaille, le roi a déjà fini ses douze « pater » ! Que faire ?
– Que faire, par la tête et le ventre ! gronda Bragaille.
– J’ai trouvé ! dit Brancaillon. Sire, vous avez fini vos douze « pater » ? Eh bien, recommencez-les !
Il y eut un cri de joie et de soulagement. Seul, Charles, à qui ses douze premiers « pater » paraissaient sans doute suffisants, jeta un regard de reproche à Brancaillon. Mais résigné et tenace comme tout malade qui veut et espère la guérison, il referma les yeux et recommença « in petto » sa monotone complainte.
Bruscaille, alors, se plaça derrière le fauteuil, et imposa les deux mains sur la tête du roi. En même temps, Bragaille se plaçait à gauche, face à Bruscaille, et imposa la main droite. Brancaillon, placé à droite, imposa la main gauche. Dans cette position, les trois ermites commencèrent un chant latin que Brancaillon, naturellement, remplaça par une chanson bachique. Puis, chacun des trois, à tour de rôle, intima au démon qui habitait le corps du roi l’ordre d’avoir à déguerpir.
Sans doute ledit démon avait l’oreille dure, ou bien il était d’humeur récalcitrante, car, pour la deuxième fois, Brancaillon s’écria :
– Il ne veut pas sortir, le mauvais bougre ! Ah ! si jamais je le tiens… je l’assomme !
Et il montra son poing.
Bruscaille, faisant le tour du fauteuil, se plaça devant le roi, allongea le bras jusqu’à toucher la poitrine du patient ; puis, ce bras, il le ramena à lui violemment comme s’il eût vraiment attiré un être ou un poids quelconque ; il recommença ce mouvement une centaine de fois avec une vitesse et une vigueur telles que bientôt il fut en nage. Il s’essuya le front et dit :
– Je suis à bout. À vous, révérend Bragaille, et tâchez de soutirer l’infâme drôle qui refuse de sortir.
Bragaille entreprit aussitôt le même geste, et toujours avec la même énergie, la même précipitation.
– À vous, messire Brancaillon ! dit-il enfin, essoufflé.
Brancaillon commença, avec une force non exempte de quelque élégance. Il allongeait le bras, et tirait. Bientôt ce fut aussi la langue qu’il tira. Bientôt commença la bordée de jurons ; d’une voix sourde d’abord, puis d’une voix de tonnerre, il invectiva le démon qui s’obstinait à ne pas sortir, cependant que les deux autres ermites nasillaient une oraison. Tout à coup le roi se leva, irrésistiblement attiré, et Brancaillon hurla :
– Victoire ! Je le tiens !
Charles poussa un cri. Brancaillon stupéfait recula, tout effaré…
– Triple bélître ! vociféraient Bruscaille et Bragaille. C’est notre bon sire que tu as saisi par la poitrine ! Ah ! le triste ermite qui ne sait pas exorciser !
Le roi lâché était retombé dans son fauteuil. Déjà Bruscaille préparait une nouvelle série de gestes, mais le pauvre Charles trouvait que la séance avait suffisamment duré.
– Assez, dit-il, assez, mes révérends. Allez vous refaire et vous reposer, Gringonneur vous tiendra compagnie, mais ne le poussez pas sur la boisson.
– Sire, dit Brancaillon je me charge de lui !
Il paraît que si Brancaillon se chargea de Gringonneur, ce dernier dut se charger de Brancaillon, Bragaille et Bruscaille, car la réfection des pauvres ermites dura jusque fort avant dans la nuit, et le lendemain matin, lorsqu’il se présentaient pour tenter un nouvel exorcisme, ils avaient la langue pâteuse et les idées obscures, ce qui n’empêcha nullement le roi de leur témoigner la plus grande confiance.
XIV – TRISTE AVENTURE DU SIRE DE BOIS-REDON
La nouvelle séance d’exorcisme commença donc. Et nous prévenons le lecteur que nous aurons à y revenir. Simultanément, se déroulait chez la reine Isabeau une scène d’un tout autre ordre. Or, c’est la combinaison de cette scène et de l’exorcisme qui valut au sire de Bois-Redon la fâcheuse aventure que nous devons raconter.
Ce matin-là, donc, Isabeau se leva de bonne humeur. Accompagnée de ses demoiselles d’honneur, sa première visite fut pour la tigresse Impéria, laquelle était soignée par le chef des gardiens des cages de Sa Majesté, homme fort versé dans l’art de guérir les blessures.
La tigresse était loin d’être guérie encore, car les crocs du chien Major étaient d’honnêtes crocs, ne faisant pas à demi leur besogne. Mais Impéria commençait à revenir à la vie. Ses blessures se fermaient. La tigresse reprenait son bel appétit.
Impéria fut, par les demoiselles d’honneur, comblée de caresses et de friandises.
Puis la reine tint sa cour dans le « chauffe-doux », vaste salle qui se chauffait au moyen de deux énormes poêles de faïence assez semblables à ceux dont on se sert encore dans les pays flamands.
Lorsque la reine eut fait ample distribution de sourires et gracieuses paroles, elle déclara qu’elle voulait être seule et rentra dans ses appartements. Les demoiselles d’honneur allèrent se confiner dans la partie du palais qui leur était réservée. Les gens d’armes prirent position dans la salle des gardes. Les gentilshommes et dames de la cour disparurent. La galerie, la salle de Théseus et celle de Mathebrune demeurèrent désertes. Bois-Redon fit sa ronde et vint au rapport.
– Que font les ermites ? demanda la reine.
– Ils exorcisent, répondit le colosse.
Cette réponse était sincère. Comme tout le monde à l’Hôtel Saint-Pol, le capitaine d’Isabeau était convaincu que nos trois sacripants étaient de véritables ermites, bien plus savants que Lancelot et Tosant en l’art d’extirper un démon. La reine regarda curieusement Bois-Redon qui se campa, bomba le torse et frisa sa petite moustache – imperceptible dans sa figure de poupée rosée.
– Ces ermites, reprit-elle au bout d’un silence, les connais-tu ?
– Moi ! s’écria Bois-Redon avec stupeur Madame, je ne connais pas de frocards, ajouta-t-il avec dégoût.
– Eh bien ! dit tranquillement Isabeau, il faut que tu connaisses ceux-ci.
Bois-Redon ouvrit des yeux énormes et la reine continua :
– Ce sont des braves qui mangent bien, boivent mieux, savent jouer aux cartes. Leur compagnie ne t’ennuie donc pas ; ce sont de joyeux compères, et puis, sûrement, ils vont exorciser le roi.
Bois-Redon baissa la tête, se gratta le bout du nez, et répéta machinalement :
– Exorciser le roi… Pourquoi, songea-t-il, la reine est-elle si contente de la guérison assurée du roi ? Il me semble jusqu’ici que…
– Tu vas donc aller trouver ces braves qui, d’ailleurs, t’attendent, et tu les aideras à exorciser le bon sire. À moins que tu ne l’exorcises à toi tout seul.
– Moi ! répéta Bois-Redon avec plus de stupeur et d’indignation encore.
– Toi. Écoute bien. Ces ermites sont envoyés par Jean de Bourgogne comme les deux premiers. Où Tosant et Lancelot n’ont pas réussi, ceux-ci peuvent encore échouer. Or, je ne veux pas, moi ! Je veux que cette fois, le roi soit réellement exorcisé. Et comme je me méfie de la science des ermites de Jean sans Peur, tu vas aller les aider, mais en prenant certaines précautions. Ainsi, tu ne te montreras pas. Tu vas être conduit dans une chambre du palais du roi par quelqu’un à moi. Là, tu attendras deux jours, trois jours, autant de jours qu’il faudra. Sois tranquille, on ne t’y laissera pas mourir de faim, et tu auras de mes nouvelles tous les matins. Seulement, tu seras prêt à toute heure, à toute minute du jour et de la nuit, prêt à exorciser le roi.
– À exorciser !… Moi !…
– Allons, ne fais pas la bête, dit sérieusement Isabeau.
Le colosse frissonna. Toutes les fois qu’Isabeau lui avait parlé de cette voix sérieuse, des choses terribles s’étaient préparées. Mais cette fois, l’étonnement l’empêcha de dériver à la terreur. On lui demandait d’exorciser ! Il ne put s’empêcher de rire. La reine le regarda de son œil inexprimablement clair.
– Tu surveilleras donc les ermites, reprit-elle, et au besoin, tu les aideras au moment voulu. Mais surtout, tu t’occuperas de la demoiselle de Champdivers…
Elle frissonna à son tour et pâlit. C’était ainsi toutes les fois qu’elle prononçait ce nom.
– La demoiselle ! murmura Bois-Redon. Diable ! Oh ! oh ! Je commence à comprendre…
Isabeau, le menton dans la main, les yeux perdus au loin, parlait d’un accent très doux et monotone :
– Tosant, disait-elle, Tosant et Lancelot étaient sur le point d’exorciser le roi. Tout serait fini maintenant. Le roi avait saisi la coupe, et il allait boire. C’était la guérison assurée. La demoiselle de Champdivers entra, s’empara de la coupe et la vida dans les cendres… Tout est à recommencer.
Sous la douceur de la voix grelottait la haine. Ces accents funèbres, ces inflexions caressantes comme l’étreinte d’un serpent qui bientôt va se resserrer et devenir mortelle, Bois-Redon les écoutait, les reconnaissait, et il tremblait en lui-même. Isabeau continuait :
– Les gens de Bourgogne ont essayé de sauver le roi en s’emparant de l’intrigante : ils ont tué Champdivers et la gouvernante, mais la demoiselle Odette est restée. J’ai continué la bataille, moi. J’ai envoyé ma tigresse contre l’intrigante. Impéria est revenue demi-morte, mais la demoiselle Odette est restée. Les ermites sont venus pour sauver le roi, mais la demoiselle Odette n’a pas voulu.
Elle leva vivement les yeux sur Bois-Redon et ajouta :
– Là où ont échoué les hommes de Jean sans Peur, là où a été vaincue Impéria, tu réussiras, toi.
Bois-Redon vacilla sur sa base.
Il avait tout à fait compris !…
On lui demandait de tuer Odette de Champdivers !…
– Oui, dit le capitaine en essuyant quelques gouttes de sueur sur son front.
– Il n’est plus question de l’enlever de l’Hôtel Saint-Pol pour la détenir en l’hôtel de Bourgogne. Il n’est plus question non plus d’éviter un meurtre dans le palais du roi. Bois-Redon, je te demande cette preuve de ton amour. Tu deviens mon chevalier. Je te lance contre la fée malfaisante qui veut ma mort. Va, mon chevalier ; va, mon capitaine ; va, mon cher amant ; va et délivre-moi ! Va, et frappe !
Elle continuait à parler doucement, sans éclat de voix. C’est avec des inflexions d’amour et de caresse qu’elle disait ces choses. Bois-Redon haletait. Il eut à ce moment tué tout ce qu’aurait voulu Isabeau.
Il ouvrit les bras d’un mouvement rude.
Isabeau se déroba, mais elle sourit, et ce sourire acheva de bouleverser Bois-Redon. Elle reprit :
– Donc, tu la frapperas. Tu la frapperas à mort. Que ce soit une bonne fois fini ! gronda-t-elle soudain furieuse et les yeux pleins d’éclairs. Que si les gens du palais foncent alors sur toi, ne t’inquiète pas, car…
– Ah ! par la mort du Christ ! cria Bois-Redon ivre de son amour et de la rage de tuer, qu’ils y viennent, ceux-là !… Une femme, par les plaies ! Une fille, par l’enfer ! J’aurais pu…
– Quoi ! Quoi donc ! rugit Isabeau.
– J’aurais pu hésiter ! hurla Bois-Redon déchaîné. Mais je n’hésite pas, reine ! Je vais la frapper, la tuer, et ce sera proprement fait, d’un seul coup en plein dans le cœur ! Et quant aux autres…
Il y eut un éclat de rire qui fit grelotter les vitraux dans leurs mailles de plomb.
– Viens, mon brave. Viens sauver ta reine, ton amante, et quant au roi, écoute…
Ils arrivaient dans la grande galerie déserte.
– Le roi ? songea-t-il en pâlissant. Tout ce qu’elle veut, oui, mais le roi !… Diable !…
– Les ermites, disait Isabeau, les ermites s’appellent Bruscaille, Bragaille et Brancaillon.
– Ah ! ah ! fit Bois-Redon les yeux écarquillés. Ces drôles…
– Ces ermites vont tenter l’exorcisme. Quand ? Demain ? Dans huit jours ? Tu le sauras. Tu te tiendras prêt à tout. Quand ils donneront le signal, quand on viendra te chercher, tu accourras, tu frapperas la demoiselle de Champdivers, d’abord… Et puis s’ils ont peur, s’ils hésitent…
– S’ils hésitent…
– Oui. Tu frapperas, toi !… Tu frapperas le roi !…
Isabeau leva les yeux sur le capitaine.
Elle le vit livide.
Elle comprit ce qui se passait dans l’âme de ce soldat dressé à considérer le roi comme la représentation de Dieu sur terre.
Isabeau leva les mains, les posa sur les épaules du géant, et gronda :
– Jure de frapper !…
Bois-Redon la vit contre lui. Le parfum de ses cheveux l’enivra. De nouveau, la passion se déchaîna, hurla en lui. Ses yeux s’ensanglantèrent. Sa tête tourna.
D’une étreinte furieuse, il saisit la reine dans ses bras et haleta :
– Jurez d’être toujours à moi !…
– Toujours ! dit-elle. À toi ! À toi seul désormais ! Tes jalousies, je les apaiserai. Ton amour, je l’élèverai si haut que nul ne pourra plus te porter ombrage… Allons, à ton tour, jure de frapper !… Elle d’abord… et puis le roi !…
– Le roi ! râla Bois-Redon fou d’amour, le roi de France, je le tuerai d’un coup ! d’un seul coup au cœur !…
Elle s’abandonna. L’étreinte du capitaine fut plus violente. Il la souleva jusqu’à lui, et ses lèvres, d’un rude baiser, cherchèrent les lèvres de la reine…
Au bas de l’escalier, il y eut un cri sourd…
* *
*
Nous avons dit que nous serions obligé de revenir à la séance d’exorcisme qui se poursuivait chez le roi Charles VI. Elle fut à peu près pareille à celle que nous avons essayé de décrire, avec cette différence, pourtant, que le prieur des Célestins fut d’abord présent à ces étranges exercices.
C’était un homme d’aspect plus guerrier que religieux, plus rude que vénérable. Il abordait la soixantaine, mais si sa barbe avait grisonné, il se tenait droit et ferme, et son regard brillant donnait à son visage une apparence de jeunesse. Le rôle qu’il joua dans ces aventures nous échappe. Nous savons seulement que Charles VI le tenait en singulière vénération. Il témoigna son respect et son amitié pour le prieur en comblant le couvent des Célestins de présents innombrables et riches. La célèbre chapelle fastueuse par son architecture et par les joyaux qu’elle contenait, fut presque entièrement l’œuvre de ce roi.
Comment et pourquoi le prieur fut-il amené, dans la grande tragédie de ces temps, à prendre parti pour Jean de Bourgogne et Isabeau de Bavière ? C’est ce que nous n’avons pu savoir.
Le premier était donc venu examiner les nouveaux ermites. Il les regardait faire, avec un sombre sourire de mépris. Parfois, d’un mot bref, il rectifiait un geste. Parfois aussi, il couvrait de sa voix psalmodiant une prière, la voix de Brancaillon psalmodiant des jurons.
– Eh bien, sire prieur, demanda Charles, que pensez-vous de ces guérisseurs ?
– À merveille, sire roi, ils s’en tirent à merveille.
– Surtout celui-là, hein ?
Il désignait Brancaillon.
– Oh ! celui-là mérite toute votre confiance, bien que les deux autres ne soient pas non plus à dédaigner, Sire, vous pouvez être tranquille. Jamais Votre Majesté n’aura mis son mal en meilleures mains.
– Je les aime, dit Charles. Ils m’ont fait rire. Surtout ce gros-là !
Le prieur, quelques instants, contempla d’un œil rêveur ce roi, ce pauvre roi bafoué, à qui l’on jouait la comédie. Peut-être songeait-il à ce qu’il y avait de vraiment hideux en cette comédie bientôt sanglante. Peut-être son intelligence, supérieure à celle de Jean sans Peur, s’indigna-t-elle qu’on bafouât la majesté royale en même temps que le roi. Il fronça ses sourcils touffus sous lesquels luisaient des yeux profonds. Mais, sans doute, la condamnation était irrémissible. Le prieur s’inclina devant le pauvre fou et insista :
– Sire roi, adieu. Je reviendrai. Mais Votre Majesté a-t-elle vraiment confiance ?
– Oui, dit le roi avec fermeté. Surtout en ce gros compère-là ! J’ai confiance parce qu’ils ont un talisman.
– Un talisman ? fit le prieur avec étonnement et inquiétude. Quel talisman ?
– Vous ne le saurez pas, messire ! Allez, et revenez-nous bientôt.
Le prieur se courba, fit le signe de croix, murmura une prière à l’intention de Sa Majesté, puis se retira en songeant :
– Un talisman ? Que peut être ce talisman ?… N’y pensons plus : quelque inspiration de sa folie, sans doute. Mais n’est-il pas terrible que nous soyons réduits à de tels expédients pour restaurer dans Paris et le royaume la véritable autorité monarchique ?
– Le talisman… songeait Charles VI en souriant. Eh ! n’est-ce pas un vrai talisman, puisque c’est Odette elle-même qui me répond d’eux ?…
Le prieur des Célestins, une fois parti, les trois ermites poussèrent un soupir de soulagement et voulurent reprendre avec une nouvelle ardeur les gestes d’exorcisme qui devaient faire sortir le démon de folie gîté quelque part dans le corps du roi.
Ceci pourra paraître assez étonnant, mais c’est au fond un phénomène naturel : ces drôles commençaient à se prendre au sérieux ; les gestes qui n’avaient aucun pouvoir sur le roi commençaient à influer sur eux-mêmes ! Ils en arrivaient à oublier qu’ils étaient là pour un geste définitif et terrible. Vaguement, ils pensaient qu’après tout, on avait vu d’autres miracles !
Le roi admira de bon cœur le zèle de ses guérisseurs, et finit par leur dire :
– Reposez-vous, mes révérends, reposez-vous, je le veux.
Brancaillon se mit à rire. Bruscaille et Bragaille se frottèrent les mains. Les sacripants savaient bien en quoi consistait le repos auquel les conviait le roi. En effet, dans un coin de la pièce, on avait apporté une table chargée de divers flacons : c’était Charles lui-même qui en avait ainsi décidé.
D’un même mouvement, ils se tournèrent vers la table, et le roi tout souriant se leva, s’approcha de cette table, et se mit à remplir lui-même trois grandes coupes d’argent.
– Asseyez-vous et buvez, dit le roi de France.
Bruscaille, Bragaille et Brancaillon, sans façon aucune, prirent place dans les fauteuils à coussins brochés d’or, saisirent chacun sa coupe d’argent et la vidèrent, Bruscaille les yeux levés au plafond, Bragaille, plus fin, les yeux à demi-clos, Brancaillon la main sur le cœur.
– On est bien ici, dit alors simplement Bragaille.
– Oui, fit Bruscaille toujours en éveil, mieux qu’en notre ermitage où, assis sur des pierres, nous buvons l’eau puisée à la source.
– C’est du fameux, dit Brancaillon ; il n’y en a pas de pareil à la Truie pendue…
Les sacripants se versèrent une dernière rasade, et, avec un soupir de regret, déposèrent leurs coupes. Sur un appel du roi, deux valets vinrent enlever la table, mais Charles saisit les trois coupes d’argent, en remit une à chacun des trois ermites, et leur dit :
– Vous les garderez en souvenir de moi. Même si vous ne me guérissez pas, je suis content de vous. Tosant et Lancelot étaient sévères et tristes. Vous m’avez fait rire, je vous tiens pour de bons et braves guérisseurs.
Ébahis, ils contemplaient les coupes et les retournaient dans leurs mains.
– Quoi ! bégaya Bragaille, ces belles choses pour nous !
– Ah ! sire, cria Bruscaille enthousiasmé, quel malheur qu’un aussi bon roi détienne des démons dans son ventre !
– J’ai une idée ! dit tout à coup Brancaillon.
– Allons, fit le roi, je dois maintenant recevoir mes gentilshommes. Retirez-vous. Vous reviendrez tantôt.
– Pourtant, dit Brancaillon dont le cerveau était un peu enfumé par les rasades, mon idée est bonne. Je suis sûr que le démon n’y résisterait pas et sortirait tout seul.
Le roi tressaillit. Ce mirage qui attire sans cesse le malade incurable se présenta à son imagination. Il y a quelque chose d’indestructible chez l’homme qui lutte contre un mal : c’est l’espoir de guérir.
– Qui sait ? murmura Charles. Est-ce un nouvel exorcisme ? demanda-t-il.
– Nouveau ? fit Brancaillon. Non, car je l’ai déjà essayé sur moi-même.
– Et il a réussi ? palpita le roi.
– Tout de suite ! dit Brancaillon avec un rire épais.
– Mes gentilshommes attendront ! fit le roi. Voyons votre exorcisme… Commencez !
Et Charles, avec empressement, reprit sa place dans son grand fauteuil. Bruscaille et Bragaille se regardaient, étonnés et méfiants. Bragaille marchait sur les pieds de Brancaillon. Mais celui-ci n’en avait cure. Le bon vin aidant, son exorcisme lui semblait de plus en plus merveilleux.
– Comment n’y ai-je pas songé plus tôt ? dit-il en se frappant le front.
– Eh bien, commencez donc ! dit le roi avec impatience.
– Sire… c’est une histoire ! Il faut que je vous la dise.
– Une histoire ! s’écria Bruscaille très inquiet. Une histoire n’est pas un exorcisme. Tu… vous nous la raconterez demain, révérend Brancaillon.
– Non, non, cria le roi, tout de suite !
– La voici ! dit le révérend Brancaillon.
Bruscaille et Bragaille échangèrent des signaux désespérés. Mais Brancaillon, superbe, se campa pour raconter, et le roi s’installa pour écouter.
– Il faut vous dire qu’en ce temps-là, j’étais amoureux de Marion Bonnecoste…
– Hein ! s’écria Bragaille indigné. Amoureux ! Un ermite !…
– Sire, dit précipitamment Bruscaille, avant d’être ermite, le révérend Brancaillon a porté la casaque et fait la guerre. C’est sûrement en ce temps que…
– Laissez, laissez, dit le roi en riant. Continue, mon brave. C’est toi qui me guériras.
– Là ! fit Brancaillon radieux. Donc, j’étais amoureux. Connaissez-vous Marion Bonnecoste, sire ?… Non ?… C’est étonnant, tout le monde la connaît, à Paris. Eh bien, c’est, ou plutôt c’était une bien belle fille, des yeux noirs, des lèvres rouges, une brave fille, sire, contre laquelle il n’y a rien à dire, si ce n’est que l’autre jour elle n’a pas voulu nous…
Ici, Bragaille marcha sur le pied de Brancaillon, mais cette fois si vigoureusement que le digne narrateur jeta un cri et comprit qu’il s’engageait dans une passe dangereuse.
– Bref, reprit-il, un jour, ou plutôt un soir, je me trouvai, je ne sais comment, tout triste et malade. J’avais des visions biscornues. Des diables me frôlaient, me touchaient de leurs doigts velus ; je les entendais ricaner en voltigeant autour de ma tête…
– Oh ! murmura le roi profondément attentif à l’énumération de ces symptômes, c’est tout comme moi !
– Tout à coup, continua Brancaillon, je sentis que l’un de ces démons s’était venu loger dans mon corps. Je l’entendis fort bien me crier des injures. Je retournai donc au cabaret d’où je sortais quand m’arriva cette pénible aventure et je me remis à boire dans l’espoir de noyer le diable. Mais le drôle était entêté. Plus je buvais, plus il se montrait insolent. Bientôt je me rendis compte que, sournoisement, il devait absorber mon vin au fur et à mesure que je buvais. Je sortis donc du cabaret, moitié pour ces motifs et moitié parce qu’on me jeta dehors sous le prétexte que je n’avais pas de quoi payer. Et cependant le démon qui m’avait choisi pour logis se remuait en moi au point que je pouvais à peine me tenir debout. Alors, j’allai chez Marion Bonnecoste…
Brancaillon s’arrêta net et rougit. Oui, il rougit, le pauvre hère, et demeura fort embarrassé.
– Allons-nous-en, dit Bruscaille, tu nous raconteras la fin une autre fois.
Mais le roi n’avait pas rougi, lui ! Le roi voulait guérir ! Le roi, comme tous les malades à cervelle détraquée, ne demandait qu’à croire ! Il intima à l’ermite l’ordre de continuer.
Et Brancaillon, se déchargeant de tout scrupule par un haussement de ces larges épaules :
– Sire, par où diable pouvait sortir le démon qui me tourmentait, sinon par la bouche ?
– C’est juste, par Notre-Dame !…
– Eh bien ! Marion me prit dans ses bras, la bonne fille, et, je suis bien forcé de le dire, je sentis ses lèvres sur les miennes. Or, qu’arriva-t-il ? Je me le demande encore ! Peut-être le démon fut-il étouffé parce qu’il manquait d’air ? Peut-être était-ce là un exorcisme intolérable pour lui ? Ce qui est sûr, c’est que je me trouvai parfaitement guéri, en suite de quoi, comme de juste, j’allai me confesser.
– Ah ! ah ! fit le roi toujours attentif, et que vous dit votre confesseur ?
– C’était un saint homme, et très savant, sire. Il me dit que l’exorcisme que j’avais employé était excellent.
– Oui, dit le sire pensif, j’ai souvent entendu parler d’un exorcisme qui consiste à faire aspirer par la bouche le démon de folie qui ne veut pas sortir.
– C’est cela, s’écria Brancaillon, c’est tout à fait cela ! Seulement, ce digne confesseur ajouta que j’aurais dû, pour le salut de mon âme, faire exécuter l’exorcisme par ma propre femme, c’est-à-dire celle qui m’était unie par les liens sacrés du mariage. J’eus beau lui objecter que je n’étais pas marié… Il n’en voulut pas démordre et soutint que j’avais risqué l’éternelle damnation…
Le roi tressaillit.
Il est certain que sur cet esprit la crainte de la damnation exerçait une influence décisive.
– Il faudrait donc… murmura-t-il avec une évidente répulsion.
Et il se tut. Brancaillon, rondement, ajouta :
– Il faudrait, sire, que Sa Majesté la reine, qui vous est unie par le mariage, consentît à aspirer le démon. Je vous réponds de la réussite. Quoi de plus facile ?…
Le fou se leva tout agité. Il se prit à arpenter la pièce de ce pas inégal, tantôt morne et lent, tantôt précipité, qu’il avait lorsque se préparait une de ses affreuses crises.
– La reine ! balbutia-il. La reine ! Consentira-t-elle seulement ?… Elle ne m’aime pas !… Que lui importe ce que je puis souffrir ? La reine ! ajouta-t-il sourdement avec une colère, croissante. Qui sait si elle ne s’est pas écartée de moi pour éviter que, par cet exorcisme… Ah ! par Notre-Dame ! je veux…
Ses yeux devenaient hagards. Ses lèvres commençaient à se plisser nerveusement.
Il eut un strident éclat de rire, puis un sanglot déchira sa gorge.
Stupéfaits et tremblants, les trois ermites assistaient, immobiles, silencieux, à ce terrible spectacle.
Ils n’avaient vu jusque-là dans le roi qu’un homme affable, docile, patient, écoutant avec une étrange politesse les fantaisies les plus extraordinaires, se prêtant de bonne grâce à toutes les grimaces de leurs exorcismes. Le fou se montrait !… La démence éveillée allait se déchaîner !…
Brusquement, il revint sur Brancaillon et gronda :
– Tu dis donc que la reine… tu dis la reine, n’est-ce pas ?… Parle donc, stupide ermite !…
– La reine, bégaya Brancaillon effaré, terrifié, oui, sire, la reine.
– Il suffit ! dit Charles avec une majesté tragique. Je vais… holà ! mon capitaine !…
Le capitaine des gardes du roi entra. Un coup d’œil lui suffit pour voir ce qui se préparait. Il jeta un regard de travers aux ermites consternés et, s’avançant rapidement sur Charles :
– Sire, dit-il, voulez-vous qu’on aille chercher la demoiselle de Champdivers ?
Souvent ce nom seul calmait le fou. En pleine crise, même, dès qu’Odette apparaissait, dès qu’elle mettait sa main sur le front du roi, tout s’apaisait en lui. Mais, cette fois, il se mit à hurler :
– L’ermite a dit : la reine !… Je veux aller chez la reine !… Capitaine, prenez douze gardes avec vous et suivez-moi. Vous allez voir la reine me guérir !…
Il eut un éclat de rire d’une poignante tristesse, et s’élança. Strict observateur des consignes qu’il recevait, le capitaine, à la tête de douze hommes d’armes, suivit le roi qui, prenant de l’avance, traversa en courant les jardins déserts, et arriva en présence du palais d’Isabeau.
D’un bond, tout hagard, tout haletant, il pénétra dans le grand vestibule du rez-de-chaussée, leva les yeux et un cri monta jusqu’à ses lèvres.
Il s’arrêta court.
Là-haut, dans la galerie, au bord du large escalier, Isabeau de Bavière et Bois-Redon étaient d’abord demeurés frappés de stupeur. Ce fut avec une sorte de lenteur tragique qu’ils s’écartèrent l’un de l’autre. La figure convulsée, Isabeau attendait. Le meurtre luisait dans son regard. Impassible, indifférent, si on peut dire, Bois-Redon se disait que le moment d’en finir était sans doute arrivé.
Charles VI était-il certain de la fidélité d’Isabeau ? Le contraire paraît prouvé. Il y avait longtemps qu’il vivait séparé de la reine. Dans ses heures d’accalmie et de demi-raison, il la méprisait et la redoutait. Il la soupçonnait. Et son soupçon était presque une certitude.
Mais jamais il n’y avait eu flagrant délit…
Cette fois, il tenait « la preuve ».
Il se mit lentement à monter l’escalier.
La reine le vit si pâle, si calme, si farouchement résolu, que la terreur, en un instant, fit irruption et submergea son cœur. Elle ne sut plus où elle était, ni qu’elle était la reine. Elle comprit seulement que des choses terribles allaient se passer, il fallait se défendre. Il fallait, d’un seul bond d’esprit, se ruer à la résolution suprême. Elle se pencha sur Bois-Redon et gronda :
– Tue-le !…
Bois-Redon, effroyablement pâle, commença à descendre l’escalier.
À ce moment, le capitaine des gardes parut dans le vestibule escorté de ses douze hommes d’armes.
L’instant fut sinistre.
Bois-Redon s’arrêta ; il avait aux lèvres le pâle, l’indéfinissable sourire du vaincu qui va mourir.
– Lâche ! rugit Isabeau. Va donc ! Mais va donc !…
Ces mots, elle crut les crier. Elle les cria en elle-même. Aucun son autre qu’une sorte de gémissement ne se fit entendre.
Déjà le capitaine était au milieu de l’escalier, près du roi, devinant tout d’un coup d’œil, et il dit :
– Sire de Bois-Redon, où allez-vous ?
C’était la porte ouverte à de possibles explications capables d’amener une détente et une entente. Le roi se tourna vers son capitaine. Il bégaya on ne sait quoi. Mais le geste suppléa à la parole. Il étendit vers Bois-Redon une main qui tremblait convulsivement. Et alors son capitaine prononça :
– Sire de Bois-Redon, au nom du roi mon maître, rendez-moi votre épée.
Bois-Redon obéit sans un mot, dégrafa la dague et l’épée, les remit au capitaine qui les donna à un de ses hommes. Le roi monta. Son capitaine suivit avec les gens d’armes au milieu desquels se trouvait Bois-Redon.
Arrivé dans la galerie, le roi s’arrêta près d’Isabeau. Ils se regardèrent. Elle se raidit, s’immobilisa, se pétrifia, comprenant qu’au premier mot, qu’au premier geste, elle était arrêtée, à moins que le roi ne l’abattît d’un coup de poignard.
Encore une fois, le capitaine des gardes tenta la détente. Il dit :
– Majesté, en quel cachot faut-il conduire ce gentilhomme ?
Le roi se tourna vers le capitaine, le toisa de la tête aux pieds, et bredouilla :
– Gentilhomme ?…
– Majesté, répéta le capitaine, où faut-il conduire Bois-Redon ? Dans les prisons du palais ?
Le roi éclata de rire. Ce fut terrible. Isabeau se mordit les lèvres pour ne pas crier.
– Aux Fourches ! À la hart ! Comme un manant ! Comme un coupe-bourse ! Comme un truand ! Un voleur pris sur le fait ! Aux fourches ! À la potence !…
– Le procès, sire ! Il faut le procès !…
– Il n’y a pas de procès pour le voleur pris sur le fait ! En route ! Aux Fourches ! En route, ou je vous fais pendre, vous, pour crime de rébellion !…
Isabeau ferma les yeux.
Le roi marcha sur elle, la toucha au bras, frissonna, et, avec une funèbre douceur, murmura :
– Venez, madame.
Elle chancela. Tout de suite, elle comprit ce que voulait le roi. Elle essaya de résister et balbutia :
– Venir ? Où cela, sire ?… Je suis fatiguée… laissez-moi rentrer en mon appartement.
– Venez, répéta le roi avec la même douceur.
– Où ? cria-t-elle. Où voulez-vous que je vienne ?
– Voir pendre votre amant, dit-le roi.
Elle recula. Elle frémit. Elle sentit grelotter son cœur. Un sanglot monta à sa gorge… C’était une femme exaspérée par les passions de l’amour et de l’ambition, mais c’était une femme. Aimait-elle Bois-Redon ? Pourquoi pas ? C’est probable. Si fort, si robuste, si obéissant, si stupide, elle avait dû finir par éprouver pour lui plus que de l’affection comme on en a pour le chien familier. C’était son arme d’attaque et de défense. Près de lui, cent fois, elle s’était hasardée la nuit hors de l’Hôtel Saint-Pol. Près de lui, sans autre escorte, elle se sentait infiniment rassurée. Oui, un peu plus que sa tigresse, elle devait l’aimer.
– Sire roi, dit-elle dans un râle d’horreur, de tels spectacles, vous le savez bien, me font mal. Je n’irai pas !
Un peu plus, le roi se rapprocha d’elle et, la figure dans la figure, lui parla :
– Madame, votre amant va être pendu. Vous serez là. Vous le verrez mourir. Si vous ne venez pas, je vous jure que je vous fais arrêter à l’instant, et que je réclame contre vous le châtiment des adultères. Attachée nue sur un âne, la tête vers la queue de la bête, vous serez, madame, promenée, à travers la Ville, la Cité, l’Université et l’exécuteur des hautes œuvres vous fouettera. Allons, madame, évitez ce scandale à la royauté de France que vous avez suffisamment déshonorée. Venez-vous ?
– Je viens ! dit Isabeau dans un souffle.
– Capitaine, dit le roi, donnez la main à Madame la reine ; elle veut voir pendre le truand.
C’était la dernière insulte. Le roi et la reine paraissant ensemble, le roi seul devait et pouvait donner la main. Le capitaine ferma les yeux et tendit son poing, persuadé que la reine refuserait de s’y appuyer, mais il sentit presque aussitôt sur ce poing le contact d’une main légère et glacée. Il ouvrit les yeux et vit Isabeau souriante !…
Elle s’était domptée ! Ce qu’il pouvait y avoir d’imprécations et de résolutions mortelles dans son cœur, nul ne l’a jamais su. Mais ce grelottement convulsif qui l’avait saisie avait disparu ; mais son visage s’était calmé ; mais un sourire immobile détendait ses lèvres !…
Isabeau descendit l’escalier d’un pas ferme, appuyée au poing du capitaine, et près d’elle marchait le roi. Puis venait le groupe des hommes d’armes entourant Bois-Redon. On sortit du palais. Le cortège se dirigea vers ces terrains incultes qui avoisinaient la tour Huidelonne.
Les gens de l’Hôtel Saint-Pol, en quelques minutes, comprirent le drame. Au bout d’un quart d’heure, il y avait trois ou quatre mille spectateurs aux abords de la Huidelonne : gentilshommes des palais, gardes, arbalétriers, archers, officiers, dames, valets de tout grade, une foule silencieuse, frappée de stupeur.
L’exécuteur de l’Hôtel Saint-Pol prévenu en hâte, de par les ordres du roi, accourait, flanqué de ses aides portant une belle corde qui n’avait guère servi qu’une douzaine de fois, ainsi que l’assura le bourreau au condamné. Au premier rang de ce peuple accouru se tenait le roi et, près de lui s’était placée la reine.
Et Bois-Redon ?…
Il dit seulement :
– J’eusse mieux aimé être décapité. La hache est plus noble que la corde, mort-diable !
– Oui, dit l’exécuteur, mais avec la corde, c’est tôt fait. Votre Seigneurie désire-t-elle un confesseur ?
– Tu m’y fais penser ! cria Bois-Redon. Qu’allais-je faire !… Me laisser pendre sans confession ? Notre-Dame et les saints m’eussent repoussé avec horreur ! Je veux un confesseur.
Ce désir fut transmis au roi. C’était chose inéluctable. Non seulement les condamnés avaient le droit de se confesser tout leur soûl, mais encore on les confessait de force quand, d’aventure, ils préféraient passer « ad patres » en se privant de cette formalité suprême.
– Un confesseur ? fit le roi. C’est juste. Ce Bois-Redon n’était pas un païen, après tout. Je vais donc lui donner un confesseur – et un bon – dont il n’aura pas à se plaindre.
Il dit quelques mots à l’oreille d’un gentilhomme qui se trouvait près de lui, et qui partit en courant.
La foule attendit, toujours silencieuse. Le roi considérait Bois-Redon avec un sombre regard. La reine, toute raide, figée, toujours souriante, regardait sans voir. Nous devons la peindre telle qu’elle était. Vingt fois, dans ces quelques minutes où il attendait sans impatience le confesseur annoncé, Bois-Redon tourna vers elle son regard de chien fidèle qui mendiait une suprême caresse. Pas une fois, l’œil d’Isabeau ne se reposa sur son amant. Non qu’elle craignait que son regard à elle ne fût saisi par le roi ou par cette foule… Simplement, Bois-Redon n’existait plus pour elle.
Il y eut tout à coup un mouvement d’agitation dans la foule, et on vit s’approcher de la potence un moine colossal, au capuchon rabattu sur les yeux.
Tout le monde fit cette remarque plaisante qu’à un géant tel que Bois-Redon il ne fallait pas moins qu’un géant tel que ce confesseur.
Le religieux s’était approché du condamné, et il y eut quelques pourparlers à voix basse. Tout à coup, il y eut un bruit de dispute. Des jurons éclatèrent : un formidable duo de jurons frénétiques, le confesseur donnant la réplique au confessé.
– Je n’en veux pas ! hurlait Bois-Redon. Nombril du pape ! Je ne veux pas être confessé par Brancaillon !… Au large, mauvais garçon, va-t’en au diable !
– Eh ! bélître, qu’est-ce que cela peut te faire ? rugissait le confesseur. Par les tripes et les boyaux, par les cornes, par le pied fourchu ! je confesse aussi bien qu’un autre !
– Au feu ! vociférait Bois-Redon. À la hart ! Au truand ! C’est Brancaillon, vous dis-je ! Foudre et tonnerre ! Sang du Christ ! Va-t-on me faire confesser par Brancaillon !
– Ah ! misérable, grognait le confesseur, tu insultes Brancaillon ! Ah ! Par les ongles de Belzébuth ! Par le Ventre-Dieu ! Par les flammes ! Par la gorge de Marion ! Tu vas voir ce qu’il en coûte !…
Et l’on vit le confesseur retrousser ses larges manches de son froc et lever un poing formidable. Bois-Redon, de son côté, se mit en garde, les deux poings en position…
Les deux colosses allaient se ruer l’un sur l’autre.
Ils allaient s’assommer !
À ce moment, les rangs de la foule s’écartèrent. Une houle de dégoût, de mépris, de terreur fit osciller toutes ces têtes empanachées. Un homme s’avançait, vêtu de noir sous le vaste manteau rouge dont il s’enveloppait. On lui ouvrait le chemin. Nul ne tenait à être frôlé par cette apparition.
Il y eut de sourds jurons, il y eut des signes de croix. On grondait :
– Pourquoi le sorcier de la Cité a-t-il libre accès dans l’Hôtel Saint-Pol ?
Saïtano s’avança rapidement et se plaça entre Brancaillon et Bois-Redon…
XV – LES MYSTÈRES DU GRAND ŒUVRE
Le sorcier regarda un instant Brancaillon, et le poing du géant, levé pour assommer son adversaire, aussitôt retomba. L’ermite recula effaré, se couvrit le visage de son capuchon et murmura :
– Je suis vivant, maître, je suis vivant !
Son pauvre esprit sombra dans l’épouvante. Saïtano l’eût renversé en le touchant du bout du doigt.
– Va-t’en, dit-il.
– Tout de suite ! fit Brancaillon enchanté.
Et il s’en alla, trébuchant, tandis que le roi et les gentilshommes qui l’entouraient éclataient de rire.
– Allons, cria Charles avec une gaieté fébrile, voici notre ermite qui ne veut pas confesser le brave capitaine des gardes de Madame la reine. Sorcier, voudrais-tu donc te charger de la besogne ?
Saïtano s’inclina, plia en deux sa longue échine, et se redressant, d’un ton sinistrement jovial :
– S’il plaît à Votre Majesté…
– Mais je ne veux pas, moi ! dit sourdement Bois-Redon.
La reine, qui avait d’abord paru se désintéresser du sort de son capitaine, assistait maintenant à cette scène avec une profonde attention. D’étranges pensées montaient lentement dans son esprit, et y érigeaient des images qui surexcitaient en elle un funèbre intérêt. Elle ne quittait pas Saïtano des yeux, et un espoir imperceptible, éloigné encore comme une pâle étoile perdue au fond des nuées, la faisait palpiter.
– Sire, dit Saïtano du même accent bizarre et jovial, Votre Majesté m’a déjà vu à l’œuvre. Vous savez que je puis calmer les appréhensions de cet homme qui va mourir… Mourir, entendez-vous ? C’est chose assez grave, il me semble. Laissez-moi au moins lui faire la mort plus douce.
– Soit ! dit le roi en détournant la tête. Je veux bien qu’il s’en aille de ce monde, car il a cruellement offensé… la reine ! Mais je ne tiens pas à le faire souffrir.
– Passions ! rugit en lui-même Saïtano. Pauvres minuscules passions qui, de votre souffle si léger, causez de tels bouleversements parmi les hommes ! Vie imbécile ! Vie stupide ! Inanité, vanité effroyable de cette vie sans but ! – Que c’est pauvre ! Et quel hideux désordre ! ajouta-t-il tout haut dans un strident éclat de rire.
Nul ne comprit ces exclamations.
Le roi seul, le fou les écouta gravement, et, sans savoir pourquoi, approuva d’un signe de tête.
Saïtano s’approcha vers Bois-Redon. Le capitaine cria :
« Arrière ! Va-t’en au diable ! » Et, se tournant vers l’exécuteur :
– Allons, fais ton office. Par Notre-Dame, faut-il tant de façons pour attacher une cravate de chanvre au cou d’un gentilhomme ?…
– Écoutez, murmura le sorcier à voix basse, je vous suis envoyé par la reine.
Bois-Redon tressaillit. Une légère rougeur se plaqua sur son visage de poupée jusque-là livide.
– La reine ? balbutia-t-il avec ferveur, comme il eût dit : « La vierge puissante ! La reine des cieux ! »
– Voulez-vous donc la désespérer ? reprit rapidement Saïtano.
– Moi ! fit le colosse avec stupeur. Moi qui meurs pour elle ! Moi qui consentirais à subir dix fois le supplice qu’on va m’infliger !…
– Eh bien ! si vous voulez qu’elle vous garde un souvenir d’amour dans son cœur, buvez ceci !
En même temps, d’un geste rapide, Saïtano sortit de dessous son manteau un minuscule flacon. Le condamné le saisit, le tourna dans ses doigts avec de la curiosité, de l’effroi et un vague espoir…
– Cette liqueur, fit-il en tremblant, c’est donc…
– Un élixir qui vous fera vivant ! dit Saïtano avec un frémissement d’ardeur. Vivant dans le cœur de la reine ajouta-t-il en se reprenant.
– Il suffit, dit Bois-Redon.
Et il jeta un long regard à Isabeau, comme pour fixer son image dans son esprit jusque par delà la mort.
– Sorcier, continua-t-il d’une voix calme, apaisée déjà par l’approche de la mort, sorcier, je t’ai redouté, je t’ai méprisé, je t’ai haï pour tes accointances avec l’enfer. Mais si ce que tu dis est vrai, si cet élixir peut me faire vivre dans le cœur de la reine lorsque je ne serai plus, sorcier, à ma dernière minute, je te bénis…
Et il but lentement le contenu du flacon qu’il garda ensuite dans sa main convulsivement fermée, comme le suprême talisman capable de lui assurer dans la tombe l’amour fidèle de celle que si fidèlement il avait aimée. Alors l’exécuteur lui passa la corde au cou. Il fit un signe. Les aides tirèrent…
Bientôt se balança dans l’espace le corps du sire de Bois-Redon…
La foule attentive demeura autour du gibet, immobile et silencieuse, jusqu’à ce que tout fût fini. Alors, le roi eut un soupir. Il jeta à la reine un regard de travers, un regard tout chargé de menace. Puis, des yeux, il chercha le sorcier pour lui demander ce qu’il avait fait boire au condamné. Mais le sorcier avait disparu. Charles VI, alors, se tourna vers son capitaine des gardes.
– Monsieur, lui dit-il, vous escorterez Madame la reine jusqu’à son palais dont vous ferez garder toutes les portes. Le capitaine de ses gardes étant mort, c’est à nous d’assurer sa sécurité.
Il y eut un mouvement de stupeur. Cet ordre, malgré les derniers mots, équivalait à une arrestation. Puis cette stupeur vite effacée fit place au respect. On s’empressa autour du roi. On se murmurait que Charles revenu à la raison reprenait le pouvoir effectif. Devant l’acte qui signalait ce retour à la santé et à la puissance, il y eut des frémissements de terreur. Il y avait là quatre ou cinq cents gentilshommes, tous plus ou moins dévoués à la reine. Tous, c’est à la reine qu’ils avaient porté leurs hommages et demandé des faveurs. Bien peu d’entre eux fréquentaient le palais de Charles VI. Mais lorsque le roi eût donné à haute voix cet ordre qui était une sorte de coup d’État, c’est vers lui que se porta la foule.
La reine partit seule, escortée… entourée plutôt par les gardes, et un indicible sourire de mépris crispa ses lèvres pâles. De la Huidelonne, alors, partit un éclat de rire. Il y avait là quelqu’un qui regardait, riait, et murmurait :
– Reconnaissance humaine, amour des hommes, affections, dévouements, je vous reconnais !
Le roi s’en alla vers son palais, escorté d’enthousiasme, étonné de toute cette faveur qui lui revenait si subitement. Il voyait autour de lui tant de visages joyeux qu’il finit par en éprouver une inquiétude et hâta le pas. Alors, l’enthousiasme éclata. On cria. On se bouscula pour suivre le roi. La clameur du dévouement humain en admiration devant la force monta dans les jardins de l’Hôtel Saint-Pol :
– Le roi est guéri ! Vive le roi !…
Or, comme tout ce peuple de grands seigneurs arrivait devant le palais du roi en vociférant sa joie, son affection, son dévouement, son admiration, tous les sentiments purs et sans taches que fait fleurir la mendicité, suprême escorte du pouvoir, tout à coup les cris redoublèrent :
– Voici le sauveur ! Voici le guérisseur du roi !
Il était là, arrêté devant l’entrée du palais, méditant encore sur sa rencontre avec le sorcier de la Cité, se demandant quel malheur allait sortir de là. Il se vit entouré de gens qui voulaient absolument toucher son froc.
– Que diable me veulent-ils ? grogna Brancaillon. Tâchons de gagner au large.
Mais il demeura cloué sur place, les yeux arrondis, la bouche fendue d’une oreille à l’autre, par un large sourire de joyeux étonnement, et il tendait les deux mains en disant :
– Oh ! si c’est cela qui vous tient, ne vous gênez pas, mes frères ! Donnez ! Donnez toujours !…
Un seigneur avait commencé en offrant à l’ermite une pièce d’or. Et comme le roi avait eu un geste de satisfaction, un autre avait mis deux pièces dans la main large ouverte de Brancaillon. Puis un autre, puis il y eut foule. Les uns donnaient de l’argent, d’autres des bijoux. Des dames arrachèrent leurs colliers. Brancaillon ébloui retroussa son froc, le tendit en forme de panier, et les présents se mirent à pleuvoir. L’ermite, effaré d’abord, se mit à rire, puis à pleurer. Jamais il n’eût supposé qu’une telle fortune existât au monde.
– Est-ce que ce serait vraiment un guérisseur ? songeait le roi ébranlé dans le scepticisme que les allures de Brancaillon assez étrange pour un ermite lui avaient inspiré.
Bref, le sacripant fit son entrée dans le palais, portant dans son froc retroussé une véritable fortune qu’il laissa tomber aux pieds de Bruscaille et de Bragaille. Les deux compères poussèrent une sourde exclamation, puis, sans perdre de temps, Bragaille courut fermer les portes, tandis que Bruscaille faisait le partage du butin ; ils avaient des figures de loups, avec des yeux luisants et mauvais.
Cependant, le sire de Bois-Redon était resté solitaire, là-bas, dans l’ombre de la Huidelonne. L’aigre bise de l’hiver le balançait doucement. Quelquefois, il tournait, d’un lent mouvement de giration qui se déroulait ensuite. Il était là, à quelques pieds au-dessus du sol, bien tranquille au bout de sa corde, et, somme toute, il ne faisait pas trop mauvaise figure, si ce n’est que sa face était violette et qu’il tirait la langue.
En haut, tout en haut de la Huidelonne, impassibles, une douzaine de corbeaux, sur la crête de la tour, regardaient, immobiles, la tête de travers pour mieux voir. Ils s’intéressaient fort à la situation du capitaine.
Un des corbeaux tendit le cou et croassa en battant des ailes. D’autres se mirent à croasser. Que pouvaient-ils bien se raconter ? De loin, des clochers voisins, d’autres corbeaux arrivaient, lourds et joyeux, et se posaient sur le sommet de la Huidelonne, minuscules taches noires sur la bordure d’hermine de la neige. L’un d’eux, un vieux vénérable, se mis soudain à piétiner, puis, ouvrant ses larges ailes, se laissa tomber dans le vide, et son vol noir traça dans les brumes un vaste cercle ; au même instant, avec des cris de victoire, toute l’armée se jeta dans le vide, les cercles noirs se multiplièrent et formèrent une spirale descendante… Cela descendait vers la chose que l’aigre bise d’hiver, au bout d’une corde, balançait doucement, et Bois-Redon ne s’en apercevait pas, il ne s’apercevait plus de rien au monde…
Soudain, les cris de victoire devinrent des cris de colère. La spirale descendante se fit spirale remontante, et bientôt, toute la bande, posée à nouveau sur les crêtes de la Huidelonne, se mit à jacasser et à invectiver le malencontreux personnage qui l’avait dérangée.
Ce personnage, c’était le geôlier de la Huidelonne.
À ce moment, il y avait un peu plus d’une demi-heure que Bois-Redon avait été guindé, la hart au col. Le geôlier, ayant menacé les corbeaux de son bâton et les ayant mis en déroute, inspecta longuement les environs d’un œil méfiant. Il redoutait d’autres corbeaux à deux pieds et sans plumes.
Voyant que tout était paisible, c’est-à-dire désert, il fit un signe, et l’homme au manteau rouge sortit de la Huidelonne, s’approcha, examina Bois-Redon d’un regard d’une intense luminosité, puis, lestement, il se mit à grimper aux montants de bois du gibet, sans dire un mot.
Le geôlier se plaça au-dessous du cadavre…
Saïtano se plaça à cheval sur la poutre de traverse où était vissée la poulie de la corde, tira sa dague et trancha la corde.
Bois-Redon tomba dans les bras du geôlier qui l’emporta, et ce groupe s’engloutit dans la Huidelonne bientôt suivi par le sorcier. Le cadavre fut déposé sur le lit de sangle du geôlier. Saïtano se pencha. Il frémissait. Rapidement il dénoua le nœud coulant et jeta le tronçon de corde.
Puis, dans la bouche, jusqu’à la dernière goutte, il versa le contenu d’un flacon plus grand que celui qu’il avait présenté à Bois-Redon au pied de la potence.
Alors il se recula, contempla une minute le cadavre, sortit de la salle avec le geôlier, ferma la porte à clef et mit cette clef dans son escarcelle d’où, en même temps, il tira douze pièces d’or. Le geôlier les prit d’un geste indifférent.
– Si tu es chassé, dit Saïtano, tu viendras chez moi. Tu y seras tout au moins aussi heureux qu’ici.
– Croyez-vous ?… Au surplus, si on s’aperçoit de ce que je viens de faire, je ne serai pas chassé, mais pendu. Ainsi, soyez sans inquiétude sur mon sort.
Saïtano jeta un regard pensif sur cette magnifique brute qui, paisiblement, disait ces choses formidables.
– Tu me promets de ne pas essayer d’entrer dans cette chambre ? reprit-il.
– Il n’y a qu’une clef, vous l’emportez…
Le sorcier hocha la tête, s’enveloppa de son manteau, sortit de la Huidelonne, et se dirigea droit sur le palais de la reine. En voyant le poste d’archers qui gardait la grande porte, il eut un ricanement silencieux. Les gardes ne s’opposèrent pas à son entrée dans le palais. Bientôt, Saïtano parvint aux appartements de la reine.
Il paraît qu’il était attendu, car dès qu’il eut été aperçu par l’huissier de la salle de Mathebrune, il fut introduit dans le parloir particulier où il trouva Isabeau nonchalamment étendue sur une sorte de canapé, tandis qu’une de ses demoiselles d’honneur lui lisait un roman de chevalerie, et que trois autres faisaient de la tapisserie.
Saïtano admira la force d’âme de cette femme qu’il croyait trouver en proie à une crise de fureur ou de désespoir. La reine renvoya les demoiselles d’honneur, et alors, se soulevant :
– Qu’avez-vous fait boire à Bois-Redon ? demanda-t-elle avidement.
– Un simple élixir destiné à lui éviter les angoisses de l’agonie. Il a pu mourir sans peur de la mort.
Elle se laissa retomber et murmura :
– Ah !… ce n’est que cela ?
– C’est beaucoup. J’ai pensé qu’il vous serait agréable d’apprendre que votre capitaine est mort sans horreur.
– Bois-Redon n’avait pas peur de la mort, dit Isabeau d’un ton farouche.
Il y eut quelques minutes de silence. Le sorcier préparait ce qu’il avait à dire, ce qu’il était venu dire.
Isabeau songeait…
– Ainsi, dit tout à coup Saïtano, Tosant et Lancelot sont partis sans avoir fait boire au roi Charles l’élixir que si soigneusement j’avais préparé. C’est dommage, ajouta-t-il gravement. J’eusse été curieux de voir les effets de cette liqueur. Il y eût eu d’abord un accès de démence furieuse pendant laquelle…
– Assez ! gronda Isabeau. L’Ange veillait. C’est tout…
– Vous voulez dire Odette de Champdivers. Elle veillait oui. Vous eussiez dû prévoir cela. Elle veille encore, soyez-en sûre. Tant qu’elle sera là…
– Odette de Champdivers ne peut être longtemps encore la gardienne du fou, car elle va mourir.
– Bon ! Jean Sans Peur a envoyé contre elle quatre hommes qui passaient pour braves, et ils ont fui…
– C’est vrai, dit la reine en jouant avec les cordelettes de sa robe de lin blanc.
– Vous avez envoyé contre elle votre tigresse Impéria, et la tigresse a fui.
– C’est vrai, dit la reine qui souriait étrangement.
– Vous avez envoyé Bois-Redon contre elle, et Bois-Redon est mort.
– C’est vrai, répéta la reine avec douceur.
– Madame, si les gens du duc de Bourgogne ont fui, si Impéria fut vaincue, si Bois-Redon est mort, qui donc va maintenant affronter l’invincible faiblesse d’Odette ?
– J’irai moi-même, dit la reine.
– Vous irez la tuer vous-même ?
– J’irai la tuer moi-même. Crois-tu que cette fois la faiblesse de l’Ange sera encore invincible ?
– Oui, dit Saïtano.
La reine se leva aussi : le masque d’indifférence, qu’elle avait jusque-là gardé, tomba. Elle saisit un bras de Saïtano, l’étreignit violemment et gronda :
– Tu sais quelque chose ?
– Oui, madame, et c’est cela que je suis venu vous dire. Heureux que le hasard m’ait poussé dans l’Hôtel Saint-Pol assez à temps pour rendre au brave Bois-Redon un dernier service. Je dis donc, madame, que vous risquez d’être vaincue vous aussi par Odette de Champdivers parce que si elle veille sur le roi, elle, un homme veille sur elle, et celui-là, je le crois vraiment invincible…
– Un homme ? fit Isabeau dont les soupçons se réveillèrent. Jean Sans Peur ?
– Non, madame. Celui dont je vous parle va venir au palais du roi. Il veut voir Odette de Champdivers. Il veut lui demander, à elle !… ce qu’est devenue Roselys. Vous voyez que pour vous le danger se complique ; cet homme, c’est le chevalier de Passavant.
Isabeau jeta un cri au sens duquel Saïtano ne put se méprendre ; c’était un cri de joie et de résurrection.
– Sans doute, vous êtes étonnée, madame, continua le sorcier. Lorsque j’ai emmené ce jeune homme, il était condamné à mort – condamné par vous. Je le conduisis dans, les carrières. Nul n’en est jamais sorti, à moins d’être guidé par quelque mystérieuse Ariane. Or il n’y a pas d’Ariane dans ces sombres demeures. Passavant n’avait aucun guide. Et il est sorti, madame !
Isabeau palpitait.
– L’avez-vous donc vu ? murmura-t-elle.
– Je l’ai vu. Je sais qu’il doit venir au palais du roi. Lui-même me l’a dit. Il viendra !
– Pour voir Odette ! gronda la reine. Eh bien, soit ! Il ne la verra pas ! Ou, s’il la voit, je serai là, moi ! Et devant lui… qu’il la défende, s’il peut ! Qu’il porte la main sur moi, s’il ose !…
Saïtano s’inclina profondément devant la reine. Il la voyait à bout d’émotion. L’amour et la haine, la rage, la jalousie, la joie de savoir le chevalier vivant, la fureur de se savoir dédaignée, ces sentiments divers s’entre-choquaient dans sa pensée, – et, impuissante à garder cette attitude d’indifférence qu’elle avait adoptée, elle ordonna d’un geste à Saïtano de se retirer.
– Madame, dit le sorcier toujours incliné, je crois que je viens de vous rendre un signalé service. Je vous prie humblement de me le payer à sa valeur.
– Comment ? fit Isabeau étonnée, – car jamais Saïtano ne lui avait demandé d’argent.
– Donnez-moi, dit le sorcier, donnez-moi un laissez-passer pour que je puisse sortir ce soir à la nuit de l’Hôtel Saint-Pol. Ajoutez qu’on laisse passer aussi celui qui m’accompagnera portant un fardeau sur ses épaules.
– Soit ! dit Isabeau avec amertume. Je suis encore reine et je puis donner le laissez-passer dont tu as besoin. Mais je suis prisonnière aussi ! Reste à savoir si les gardes de l’Hôtel Saint-Pol tiendront ma signature pour valable…
– Madame, dit doucement Saïtano, vous possédez en blanc des ordres signés par le roi Charles…
Isabeau tressaillit. Tout autre que le sorcier eût sans doute payé de sa vie d’aussi audacieuses paroles. Mais il y avait pour lui des grâces d’État. La reine passa dans son appartement et, revenant au bout de quelques minutes, tendit à Saïtano un parchemin qu’il lut et fit ensuite disparaître sous son manteau.
Saïtano, ayant remercié la reine comme il convenait, sortit du palais et gagna la tour Huidelonne où il s’enferma avec le geôlier. Il est à remarquer qu’en cette journée, le sorcier n’entra pas un instant dans la salle où se trouvait le cadavre de Bois-Redon. Ce qu’il fit en ce jour, à quoi il occupa son temps dans cette tour, c’est ce qui nous échappe. Le soir vint. Vers cinq heures, la nuit était noire. Mais Saïtano attendit encore. Il attendit jusqu’à l’heure probable où les rues de Paris seraient désertes.
Ce fut donc seulement vers neuf heures qu’il entra dans la salle où Bois-Redon, les yeux ouverts et fixes, dormait le seul sommeil paisible que tôt ou tard connaît enfin chaque créature.
Le geôlier enveloppa le cadavre d’un vaste manteau et, le traînant jusqu’à la porte extérieure de la tour, le déposa dans une petite charrette aux brancards de laquelle il s’attela.
À travers les neiges se mit à rouler la petite charrette, laissant derrière elle le double sillon de ses roues ; Saïtano marchait devant, d’un pas égal, et il marmottait de certaines choses incompréhensibles. Arrivé à la grand’porte de l’Hôtel Saint-Pol, il montra son laissez-passer, et le chef de poste, en jurant, se plaignit que pour un misérable suppôt d’enfer, on fût obligé de baisser le pont-levis à l’heure de dormir.
Saïtano se trouva dans la rue et, alors, se plaça derrière la charrette, indiquant parfois d’un mot bref au geôlier le chemin qu’il fallait suivre. Ce groupe allait lentement par les ténèbres ; le geôlier se taisait ; Saïtano marchait tête basse en ruminant ses pensées ; seul, le cadavre, de temps à autre, cahoté et se heurtant aux parois, interrompit ce silence. On arriva dans la Cité. On s’arrêta devant la maison du sorcier. Le corps de Bois-Redon, à nouveau, fut traîné, et enfin, se trouva reposer tranquillement sur la table de marbre.
Le geôlier s’en alla, taciturne, indifférent. Saïtano referma sa porte, la verrouilla, la cadenassa, alluma le flambeau à triple cire, le posa sur la table près de la tête de Bois-Redon.
Puis, il ouvrit l’armoire de fer, et dans le grand coffre du rez-de-chaussée, prit quelques manuscrits qu’il déposa sur la table. Ils étaient écrits d’une large écriture régulière. Mais entre les lignes, et dans les marges, de nombreuses annotations couraient, d’une écriture hérissée et sèche.
Les caractères puissants étaient de Nicolas Flamel.
Les caractères maigres étaient de Saïtano.
Le savant se mit relire, suivant du bout de son doigt maigre son écriture à lui, enchevêtrée dans celle de Flamel. Il lisait avidement. Et pourtant, ces manuscrits, il les savait par cœur. Parfois, il redressait la tête, et écoutait attentivement, lorsque l’horloge du Palais de la Cité, logis royal alors au même titre que le Louvre et l’Hôtel Saint-Pol, jetait dans le gouffre du vaste silence d’hiver ses appels de tristesse énorme. Il comptait les heures, puis se remettait à lire.
Trois fois encore, il se leva, et à chaque fois, de l’armoire de fer, apporta un flacon. De chacun de ces trois flacons, il versa dans une coupe une trentaine de gouttes, et il agita le mélange sur lequel il versa un peu d’eau. Puis, d’un geste distrait, il repoussa les manuscrits, et se remit à contempler Bois-Redon. Un ricanement secoua le sorcier qui murmura :
– Je le vois encore, quand, sur ses épaules, il m’apporta l’enfant. Il le déposa là sur cette table et s’en alla en me jetant un regard de malédiction. L’enfant est devenu l’invincible chevalier… et Bois-Redon est maintenant sur la table. Rassure-toi, ajouta-t-il en posant la main sur le front glacé du cadavre, le scalpel ne te menace pas, toi. Tu n’es pas destiné à la grande tentative de la transfusion de sang vivant. Tout ce que je te demande, c’est un signe, si faible qu’il soit, une preuve que l’élixir de vie a pu lutter contre la mort. Cadavre, tu n’es qu’un champ de bataille…
Il se tut subitement et, l’oreille tendue vers le vaste silence, écouta.
– Non, murmura-t-il. Ce n’est pas l’heure encore. Les heures sont lentes à s’écouler ce soir. Minuit ne viendra donc pas !… Minuit, c’est l’heure favorable.
Il se mit à marcher lentement et sans bruit dans la salle, sans plus jeter un coup d’œil ni au cadavre, ni aux manuscrits, ni au mélange qu’il avait préparé dans la coupe. Il marmottait ses réflexions, comme font les solitaires, – comme si l’homme éprouvait l’impérieux besoin de se prendre soi-même à témoin de son effort.
– Le vulgaire, disait-il, croit que les heures sont indifférentes, toutes pareilles les unes aux autres, simples relais dans la marche du temps. Minuit est pourtant une heure étrange. Une heure ? Un instant, un laps de temps inimaginablement bref où s’accomplit un phénomène énorme : le passage d’un jour à un autre ! Voici un jour qui tombe dans le néant, et en voici un autre qui se lève. Ils se poussent sans trêve depuis les lointains commencements des temps, comme les vagues de l’océan… une qui se brise sur le rivage, et en même temps l’autre qui est là qui se gonfle, toute prête à se briser. Minuit ! Minuit, c’est la seconde du mystère. C’est donc à cette heure que doit s’accomplir tout ce qui est mystère…
Tout à coup, il frissonna.
L’horloge du palais de la Cité, de sa voix d’inexprimable solennité, parlait aux Parisiens. Et, cette fois, elle leur disait : C’est minuit ! Rapidement, Saïtano saisit la coupe, desserra les mâchoires de Bois-Redon et versa dans la bouche le mélange qu’il avait préparé. Puis il laissa retomber sur les dalles la coupe qui roula avec un bruit sonore. Et il demeura penché sur le cadavre, immobile, raidi, les cheveux Hérissés, les yeux exorbités, pantelants sous l’effroyable étreinte de cette angoisse que cause « l’attente »…
Une minute s’écoula… puis une autre… puis d’autres encore…
Saïtano demeurait dans la même position.
Il râlait. La douleur de l’« attente » portée à son paroxysme le faisait trembler jusque dans les profondeurs de l’être. Ses yeux fous demeuraient rivés aux yeux grands ouverts du cadavre. La sueur, à grosses gouttes, roulait sur son maigre visage…
Enfin, un soupir de désespoir gonfla sa poitrine. Il recula en bégayant :
– Rien !…
Non, rien. Dans l’apparence immobile du cadavre, rien n’avait donné le faible signe attendu.
Bois-Redon était mort.
Saïtano se tordit les mains. Il se mit à rugir des imprécations. Il tomba sur ses genoux, sanglotant, hurlant, se roula sur les dalles contre lesquelles il frappa sa tête – et alors, à ce bruit de funèbre douleur, à ces cris de désespérance inapaisable, la porte s’ouvrit. Gérande parut. Elle jeta un coup d’œil de mépris sur le savant abîmé dans le vertige de l’affreuse déception – puis ce regard rebondit sur le cadavre de Bois-Redon, et alors, Gérande poussa une déchirante clameur d’épouvante.
Ce fut un tel cri d’horreur que Saïtano se redressa d’un bond, s’avança sur Gérande et, d’une voix sauvage, hurla :
– Que veux-tu ? Que fais-tu ici ? Dehors ! Va-t-en !
Gérande ne s’en allait pas, n’entendait pas peut-être. De sa main tendue, elle désignait le cadavre de la table, cadavre elle-même en apparence, avec son visage décomposé, ses yeux ternes, sa bouche tordue.
– Quoi ! rugit Saïtano. Qu’y a-t-il ?
Elle ne répondit pas, demeura toute raide, avec le même geste de montrer la table. Saïtano se retourna, fut secoué d’un violent frisson, et d’un bond il fut à la table, en proie cette fois au délire de la joie et du mystère…
Bois-Redon palpitait !…
Des secousses nerveuses agitaient ses membres !…
Sa main droite faisait un évident effort pour se lever… les yeux ouverts jusque-là s’étaient fermés… un frisson courait à fleur de peau sur le visage… Tous les signes de la vie étaient là, visibles, indéniables, et Saïtano, un moment, ferma lui-même les yeux, comme ébloui par quelque étincelante fulguration de vérité…
La vie ! oui, la vie, s’agitait dans ce cadavre !…
Quelques minutes, Saïtano fut réduit à l’impuissance, la pensée sombrée dans l’effroi de son propre ouvrage, puis, par un titanesque effort de volonté, il parvint à se calmer. Lorsqu’il eut reconquis le sang-froid nécessaire, il courut à l’armoire, saisit une minuscule fiole, la déboucha avec précaution et en versa une goutte, une seule, sur la langue de Bois-Redon.
L’effet fut prodigieux…
Bois-Redon se raidit, se souleva en arc, posé sur la tête et les pieds, et quelque chose comme un son vague râla dans sa gorge.
– Il parle ! gronda Saïtano affolé. Il veut parler ! Il va parler !…
Brusquement, le corps s’affaissa, redevint cadavre absolument immobile. Mais les lèvres continuaient à s’agiter. Les yeux étaient fermés, le visage rigide. Seules, dans cette face pétrifiée, les lèvres, gardant une apparence de vie fantastique, tentaient le mystérieux effort de formuler les verbes d’au-delà…
– Parle ! rugit Saïtano. Parle donc ! M’entends-tu ? Me comprends-tu ? Sais-tu qui tu es ?…
– Je… suis…
Étaient-ce des mots ? C’étaient des tronçons de sons formant des embryons de paroles, cela ne ressemblait à rien de ce que Saïtano avait entendu de par le monde, c’étaient des sons morts, si on peut dire, c’était le reflet lointain, l’indescriptible et si peu humain reflet de la parole humaine…
Mais Saïtano entendit, lui ! Saïtano comprit !… Il se pencha, colla son oreille à la bouche du cadavre. Et le cadavre parlait !… Il tentait de parler !…
– Je… suis… oh !… je… suis…
– Qu’es-tu ? Qui es-tu ? dit Saïtano avec un suprême accent de volonté.
– Oh ! laissez-moi !… Ne voyez-vous pas que… depuis ce matin… je suis… mort !…
– Mort ! râla Saïtano, les cheveux hérissés.
Derrière lui, il y eut un bruit sourd. C’était Gérande qui s’affaissait, tombait en arrière, assommée par l’épouvante. Saïtano n’y prit pas garde. Sur la bouche de Bois-Redon, les sons étrangement inhumains se précipitaient maintenant avec une sorte de mystérieuse furie.
– Laissez-moi !… Vous voyez bien !… Mort !… Je suis mort… Laissez-moi dans la mort !…
Saïtano, figé, la pensée exténuée d’horreur, écoutait. Peu à peu, ces sons se firent moins sensibles, ils s’atténuèrent, se perdirent en un murmure, en nous ne savons quoi que le mot murmure rend très mal, et il y eut une minute où ce ne fut pas encore du silence, sans que les sons inexprimablement hors de toute idée de son eussent cessé de se faire entendre…
Et puis enfin, le silence vint.
Les lèvres de Bois-Redon demeurèrent à jamais scellées, sous un vague sourire de mystère que contemplait Saïtano.
Le sorcier demeura là, luttant contre le furieux assaut des centaines de sentiments déchaînés en lui ; il resta immobile, insensible, les yeux rivés sur ce sourire qui s’affaiblissait et disparut enfin…
Le sorcier, lentement, se redressa, et regarda autour de lui, stupéfait des clartés qui l’enveloppaient.
Il faisait grand jour !
Alors Saïtano se mit à trembler. Cet homme qui avait disséqué de nombreux cadavres, qui avait passé des nuits et des nuits en tête à tête avec les morts, ce savant pour qui la mort n’était qu’un problème à résoudre, éprouva soudain une impression qu’il ne connaissait pas. Cela s’abattit sur lui à l’improviste. Il se sentit faible, désarmé, incapable de lutter contre cette impression que jamais il n’avait analysée.
C’était la peur ! C’était la redoutable décomposition des organismes de la pensée ! Peur !… Peu de gens peuvent se vanter d’avoir vraiment connu la peur, et de l’avoir supportée. Saïtano avait peur…
Il eut peur de ce mort qui avait parlé, proféré des verbes inhumains non destinés à des oreilles humaines.
Parlé ? Était-ce vrai ?… Oui, l’élixir avait arrêté l’anéantissement. Oui, Bois-Redon s’était trouvé suspendu au-dessus des gouffres de la mort, sans qu’il pût leur échapper… Mort, des sensations avaient survécu, et il avait parlé. Parlé du fond de la mort ! Parlé sans que la vie eût palpité en lui !…
Une terreur insensée s’infiltra jusqu’à l’âme de Saïtano. Lui, l’homme du mystère, comprit qu’il avait outrepassé les possibilités et côtoyé des mystères inaccessibles à l’intelligence humaine. Il se vit seul, et il eut l’ineffable horreur de la solitude. Il lui parut que mieux encore valait mourir, renoncer à son rêve d’éternité, que de rester seul en présence de ce cadavre. D’un effort furieux, d’une véritable secousse, il parvint à s’arracher de la place où il se trouvait, et fit quelques pas en trébuchant, surveillant Bois-Redon par-dessus son épaule, et il râla :
– Gérande !…
Que Gérande se montrât seulement, qu’il fût seulement une minute en présence d’un être humain vivant, et il était sûr d’échapper à l’intolérable étreinte de la peur qui lui incrustait ses griffes au cerveau.
– Gérande !…
Son propre cri, répété cette fois plus fort, le fit frissonner. Il s’avança encore vers la porte, vacillant sur ses jambes, tenant sa tête à deux mains ; soudain, il s’arrêta : son pied venait de heurter quelque chose ; tout de suite, il sut ce que c’était, mais il n’osait regarder ; il se mit à hurler :
– Gérande !…
Et il savait que Gérande était là, à ses pieds, en travers de la porte. Un espoir soudain le ranima : évanouie ? Oui, peut-être. Et il aurait tôt fait de la ranimer à la vie. Brusquement, il s’agenouilla. Un regard suffit à son œil expert : Gérande était morte, – morte de peur au moment où le cadavre de Bois-Redon s’était mis à parler. Son bras raidi s’allongeait encore vers la table comme pour dénoncer l’effroyable mystère.
Saïtano à genoux se pencha. De plus en plus, il se pencha sur Gérande morte. Il lui sembla que sa tête était pleine d’éclairs qui se croisaient, et de bruits pareils au fracas du tonnerre. Il se pencha encore, une force irrésistible, lentement, le courbait. Sa pensée se disloquait. Le sens des choses familières fuyait. Et d’autres sens s’éveillaient en lui, lointains encore, vagues et tremblotants comme des lumières qu’on allume tout au fond des nuits opaques… le sens des choses qu’il ignorait… des sens inconnus qui faisaient de lui un homme non semblable aux autres.
La force qui l’étreignait à la nuque le courba encore.
Il fut courbé jusqu’à toucher le corps de Gérande morte – morte de peur, – d’où jaillissaient les formidables effluves de la peur.
XVI – LE TRÉSOR DE PASSAVANT
Huit jours environ après que Tanguy du Chatel et le chevalier de Passavant eurent lié une de ces amitiés de fortune et d’improviste qui sont les meilleures, toujours les plus durables souvent, ces deux hommes, un matin, après dîner, le coude sur la table, les jambes allongées, achevaient de vider à petits coups un troisième cruchon de vin blanc placé entre eux. C’était du Chatel qui avait découvert ces cruchons en passant lui-même l’inspection des caves de Thibaud Le Poingre.
– Figurez-vous, dit-il, que ce ladre prétendait garder pour lui seul les trente ou quarante cruchons qui lui restent de ce vin. C’est, paraît-il, maître Froissart qui l’apporta de Champagne. Je vous dirai tout franc que, sans mépriser les vins rouges, je me sens un faible pour ces jolis blancs qui montent si facilement à la tête. Et vous, chevalier ? Qu’en dites-vous ?
– Je dis que nous mettons à mal le dernier cruchon. Qu’allez-vous devenir ?
– Oui, dit Tanneguy en hochant la tête. Nous avons tout bu, et Thibaud en fera une maladie.
– Bah ! Il se guérira avec ces bons gros vins rouges que vous dédaignez.
Tanneguy lampa une rasade, suça consciencieusement le bout de ses grosses moustaches, et reprit après un silence :
– N’était votre manie de vouloir pénétrer dans l’Hôtel Saint-Pol, je trouverais en ce moment que la vie a du bon. Nous faisons la nique aux enragés Bourguignons. Nous mangeons bien, nous buvons mieux, mais nous dormons mal. Ah ! notre ami, pourquoi diable passons-nous nos nuits à rôder autour de la forteresse du roi ?
– Mais, dit Passavant, puisque nous dormons le jour…
– Oui, oui, mais diable…
– Il faut que je retrouve Roselys.
– Mais qui est cette Roselys ? Et pourquoi la chercher ?
– Mais pour lui rendre sa dot, dit Passavant avec son sourire narquois. Or, je dois la demander à la demoiselle de Champdivers, laquelle est logée à l’Hôtel Saint-Pol. Est-ce que tout ceci ne vous paraît pas logique ?
– Sans doute, grogna Tanneguy, mais vous verrez que cette logique-là nous conduira à la potence.
Le chevalier avait placé tous les ducats qu’il avait reçus d’Éphraïm dans le coffre de bois qui était dans sa chambre. Mais il avait juré de ne pas y toucher et de rendre à Roselys sa dot.
Il avait, il est vrai, distrait deux diamants ; mais l’une de ces deux pierres avait été offerte à Tanneguy en récompense : Tanneguy, en effet, l’aidait à garder le trésor. L’autre… Le lendemain même du jour où s’était fait cet échange, le chevalier, toujours escorté de Tanneguy, était monté à cheval et avait pris le chemin de Pierrefonds, dans l’espoir d’obtenir de la duchesse d’Orléans le renseignement qu’elle avait promis au sujet de Roselys. La route avait été faite d’une traite. Au château du duc d’Orléans, une déception attendait Passavant : Valentine, en proie à une inguérissable tristesse, était partie sous bonne escorte, et il fut impossible au chevalier de savoir quel chemin elle avait pris.
– Au surplus, se dit-il, le sorcier m’a dit de demander Roselys à la demoiselle de Champdivers. C’est donc à l’Hôtel Saint-Pol qu’en réalité je dois me rendre.
Le même jour, après trois heures de repos accordées aux chevaux, nos deux aventuriers reprirent le chemin de Paris, mais cette fois, ils s’arrêtèrent à Dammartin, et entrèrent à l’auberge du Bienheureux Saint-Éloi où le chevalier n’eut pas l’air de reconnaître la jolie et généreuse jeune fille qui, de si délicate manière, avait refusé l’agrafe destinée à payer le dîner de Passavant, lors de son premier voyage.
Selon la formule de Tanneguy, les deux voyageurs mangèrent bien et burent mieux.
La jolie fille était là qui les servait, un peu dépitée de n’être pas reconnue. Du premier coup d’œil elle avait, elle, parfaitement reconnu son hôte, et, à sa mine un peu plus maigre, à ses habits un peu plus râpés, elle avait jugé qu’il n’avait pas dû faire fortune encore. Cependant, ni le dîner, ni les vins ne laissèrent à désirer. Quand ce fut fini, Tanneguy paya les deux écots.
Puis les deux cavaliers se remirent en selle, et la jolie fille vint, selon le charmant usage de ces temps, leur offrir le coup de l’étrier. Le soir tombait. Les abords de l’auberge commençaient à se noyer d’obscurité. La bise balayait le chemin.
Devant le perron du Bienheureux Saint-Éloi, le groupe se silhouettait vaguement. Un peu triste, la jolie fille remplit les deux gobelets. Tanneguy vida le sien et le rendit à l’hôtesse. Le chevalier vida aussi son gobelet, et alors laissa tomber au fond un objet qui résonna. L’hôtesse entendit ce bruit léger et prit les gobelets vides que lui tendait le chevalier penché sur l’encolure de son cheval.
La jolie fille était tout contre lui. Elle jeta un regard dans le fond du gobelet, et, aux lueurs mourantes du jour, vit briller le diamant – le dernier des diamants que le chevalier avait distraits de la dot de Roselys. Sur l’encolure de son cheval, Passavant se pencha davantage et embrassa l’hôtesse sur les deux joues.
– Ce diamant ? murmura-t-elle toute émue.
– Ce n’est pas moi qui vous le donne, fit-il avec son bon sourire, c’est le pauvre chevalier qui, là-bas, sur le plateau du Voliard, mangea de si bon appétit le dîner que vous lui aviez mis dans ses fontes…
– Et ces deux baisers ? dit-elle en riant.
– Oh ! ceux-là, c’est moi qui vous les donne, et de bon cœur, jolie hôtesse que je n’oublierai pas !
Les cavaliers piquèrent des deux, et quand ils eurent disparu, au fond de l’obscurité, la jolie fille était encore sur la route, ne regardant même pas ce beau diamant qu’elle tenait dans ses doigts…
Pendant les jours qui suivirent, Passavant essaya de pénétrer dans l’Hôtel Saint-Pol. Ce fut peine perdue. Il va sans dire qu’il ne pouvait se présenter tout bonnement à la grand-porte. Il savait à quoi s’en tenir sur les intentions d’Isabeau.
– Le moins qui puisse m’arriver, disait-il à Tanneguy, c’est d’être jeté dans les fossés de la Huidelonne, et pour le coup, il me serait difficile de remettre à Roselys le trésor qui lui appartient.
– Qui lui appartient… hum !… grognait Tanneguy, mais je vous approuve, de ne pas vous montrer le jour à l’Hôtel Saint-Pol.
Comme on l’a appris par l’entretien ci-dessus, c’est donc la nuit qu’eurent lieu ces diverses tentatives.
Mais revenons dans la chambre de l’auberge. Nos deux amis finissaient de vider le dernier cruchon lorsqu’on frappa à la porte. C’était maître Thibaud qui venait prévenir que des figures plus ou moins patibulaires avaient été vues autour de l’auberge. Le chevalier et Tanneguy se mirent en observation, et soit que des gens eussent été réellement apostés, soit que leur esprit eût été frappé, ils virent en effet, ou crurent voir à diverses reprises des hommes arrêtés devant l’auberge.
– C’est bien, dit Tanneguy. Nous changerons de gîte.
– Avant tout, fit le chevalier, il faut mettre le trésor à l’abri.
– Diable, oui ! Le trésor de la jolie invisible, de la petite fée qu’on a pétrie de roses et de lys ! Mais où, mon noble ami ? Où cacher la dot de Roselinde…
– Roselys, rectifia froidement le chevalier.
– J’y suis ! cria Tanneguy. Nous allons tout bonnement transporter chez moi les ducats d’Éphraïm. Mon logis n’est plus surveillé. On me croit hors de Paris. Nul ne s’avisera d’aller chercher là. Cela vous va-t-il ?
– Cela me va, mon brave capitaine. Holà ! Holà ! ! maître Thibaud !
– Holà ! hôtelier de l’enfer ! cria Tanneguy pour renchérir.
Thibaud accourut.
– Il faut que vous sachiez, maître Le Poingre, que votre auberge sera sans doute attaquée ce soir ou demain par les gens qui nous veulent la malemort. Mais ne craignez rien, nous serons là pour la défendre.
– En ce cas, dit Thibaud renfrogné, il n’en restera pas pierre sur pierre.
– J’y compte bien, dit Passavant glacial. En attendant, nous voulons mettre en lieu sûr ce trésor qui ne nous appartient pas. Vous allez donc charger ces quelques sacs sur l’une de vos mules que conduira ce drôle, comment l’appelez-vous ? Perrinet, – qui, et que nous escorterons, nous.
Et sans plus s’occuper du déménagement, certains d’ailleurs de la parfaite honnêteté de Thibaud, les deux amis s’occupèrent de s’équiper de pied en cap.
Quand ils descendirent dans la rue, la mule était là, toute chargée. Perrinet tenait le bridon, ne sachant pas d’ailleurs quelle charge précieuse il conduisait, vu que Thibaud, homme prudent, avait lui-même transporté et arrimé les sacs sur le bât. Seulement, en voyant partir ses deux hôtes qui lui promettaient d’être de retour au bout de deux heures pour défendre l’auberge :
– Eh ! songea Thibaud, s’ils pouvaient seulement avoir l’idée de rester en surveillance auprès du trésor. Mes chers seigneurs, dit-il, ne vous gênez pas. Je défendrai seul ma taverne, défendez ces beaux sacs.
– Non, non, par Notre-Dame ! Il ne sera pas dit que nous vous aurons laissé dans la peine !
La petite caravane se mit en route ; la rue était d’ailleurs parfaitement paisible ; si bien que le capitaine et le chevalier, ayant inspecté les environs, ne virent rien qui pût provoquer leurs soupçons.
Le logis de Tanneguy se trouvait rue Saint-Antoine. La route se fit donc rapidement et sans encombre. La mule fut déchargée par du Chatel et Passavant, les sacs transportés à l’intérieur, puis Perrinet s’en retourna, reconduisant l’animal, et se disant perplexe : Il me semble que ces sacs ont rendu un son étrange, comme qui dirait des chocs de pièces d’or. Est-ce que j’aurais manqué ma fortune ?
Il ne vit pas deux hommes qui, enveloppés de leurs manteaux jusqu’au nez, à cause du grand froid sans doute, s’étaient mis en surveillance devant le logis du Chatel. Bientôt l’un de ces deux espions s’éloigna rapidement, tandis que l’autre demeurait sur place.
Le logis du Chatel était une solide maison carrée, flanquée d’une tourelle à son angle d’ouest. Élevée de deux étages, coiffée d’une belle toiture à girouettes, ornée en façade de balcons gothiques, elle avait seigneuriale apparence.
Le sire du Chatel y vivait seul, en garçon qui n’aime guère encombrer son existence de femme et enfants ; bien entendu, nous ne parlons pas du personnel domestique composé de deux valets d’armes, d’une escorte de huit hommes de guerre, deux valets d’intérieur et trois femmes chargées des soins de cuisine et autres. Tout ce monde avait été provisoirement licencié, le capitaine ayant voulu persuader à ses ennemis qu’il était parti pour un long voyage. Le petit castel se trouvait donc vide.
Tanneguy se fit un plaisir de le faire visiter à son ami, depuis les greniers jusqu’à la salle d’honneur ornée de beaux meubles, jusqu’à la salle d’armes où était assemblée une éblouissante collection de haches, de masses, de piques, de hallebardes, enfin et surtout jusqu’aux caves qui étaient fort belles, fort bien pourvues, et où le fameux trésor fut enterré dans le sable du sol.
Cette visite, à laquelle Passavant se prêta avec sa politesse et sa bonne grâce louangeuse, demanda deux bonnes heures. Il va sans dire qu’il fallut goûter à quelques-uns des meilleurs vins de céans. Ensuite de quoi, nos deux amis songèrent à reprendre le chemin de la Truie pendue.
Comme ils allaient ouvrir la porte extérieure, – solide porte renforcée de clous curieusement travaillés et à tête énorme selon la mode – ils entendirent quelque tumulte dans la rue. Et presque aussitôt, une voix cria :
– Écartez-vous, drôles, manants ! Qu’on laisse la rue libre, il va pleuvoir des horions tout à l’heure !
– Oh ! fit Tanneguy, la voix d’Ocquetonville !
– Et celle de Scas ! ajouta le chevalier au moment où une autre voix se mit à brailler des ordres.
Ils se trouvaient dans un large vestibule dallé de marbre, encombré de coffres, de bahuts qui n’avaient pu trouver place dans les appartements. D’un regard, ils se comprirent, et se mirent à l’œuvre : en dix minutes, coffres et bahuts se trouvèrent entassés contre la porte et formèrent une puissante barricade.
– Là ! fit Tanneguy en essuyant son visage couvert de sueur. J’ai enfoncé pour ma part quelques entrées de forteresses, mais je crois que celle-ci m’eût donné du mal.
– Les fenêtres d’en-bas ? demanda Passavant.
– Bardées de fer épais, mon chevalier. Ils n’entreront pas par les fenêtres, je vous en réponds.
– Ah ! fit le chevalier, ce n’est pas comme moi…
Tanneguy demeura un instant effaré. Mais comme il commençait à s’habituer à ces réponses bizarres prononcées d’un ton froid et naïf, il suivit son ami qui montait au premier étage.
Passavant ouvrit une fenêtre et fit entendre un petit sifflement qui en disait long. Tanneguy se précipita, jeta un regard sur la rue et recula en disant : « Diable ! Diable !… »
– Oui, fit Passavant, je crois que ce n’est pas encore ce soir que nous pourrons entrer à l’Hôtel Saint-Pol.
– Ni demain, ajouta Tanneguy.
– Ni après, ni jamais, acheva Passavant. Ah ! mon pauvre capitaine, je crois que, pour moi, vous vous êtes fourvoyé dans un bien méchant guêpier.
– Pas du tout, c’est vous au contraire qui devez me maudire, puisque je vous ai attiré…
– Ne disons pas de sottises, interrompit le chevalier. Voyons, combien sont-ils ? D’après leur nombre, nous pourrons calculer les chances que nous avons de nous en tirer.
– Vous croyez ?…
– Oui. Je suis un bon calculateur.
Les deux amis, ensemble, se penchèrent à la fenêtre, et une clameur salua leur apparition. Un groupe de gens d’armes, qui portaient tous les insignes de Bourgogne, occupait la rue devant le logis de Tanneguy. Ils étaient armés de haches de guerre ; en outre, chacun portait sa dague et son épée. Plusieurs balançaient à leur poing une de ces masses garnies de pointes qui, du premier coup, vous défonçaient proprement un crâne.
– Les voilà ! Les voilà ! vociféra cette troupe.
– Rendez-vous, ruffians ! hurla Guillaume de Scas.
– Ohé, Tanneguy, cria Ocquetonville, je t’apporte ton reste !
– Monseigneur veut la peau du sire de Passavant pour s’en faire un cuir à son escabeau !
– Il sera plaisant de voir les deux truands s’embrasser dans la même chaudière à pourceaux !
– Quels cris ! dit Tanneguy un peu pâle. Nous sommes perdus, mon cher, ils sont trop.
– Ils sont vingt-trois, dit Passavant.
– Pardon, j’ai compté aussi, ils sont soixante !…
– Oui, mais Scas et Ocquetonville ne comptent pas, puisqu’ils doivent mourir de ma main.
– Ah ! fit du Chatel abasourdi, vous croyez ?
– Je suis sûr ! dit Passavant avec un sourire qui donna à Tanneguy un petit frisson à la nuque.
– Bon ! En ce cas, reste à cinquante-huit. De là à vingt-trois…
– Oui, capitaine, mais vous admettez bien qu’à la première rencontre, nous en tuerons six chacun ?
– Diable ! cria Tanneguy interloqué. Eh bien, oui ! reprit-il, six chacun ! Cela fait douze. Reste à quarante-six, il me semble !
– Sans doute, quarante-six. Nous sommes deux. Nous n’avons donc affaire qu’à vingt-trois chacun…
– Ah ! Ah ! C’est ce que vous appelez être bon calculateur ? fit du Chatel en ouvrant des yeux énormes.
– Aurais-je commis une erreur ? dit Passavant de son air poivre et sel. Nous disons vingt-trois, capitaine. Et comme chacun de nous vaut bien une douzaine de ces truands, il en résulte que nous avons seulement douze chances à peu près d’être tués. C’est peu de chose.
Il y avait on ne sait quoi de terrible dans ces fanfaronnades qui, venant d’un autre, eussent prêté à rire. Mais Passavant les disait d’un accent si formidablement paisible que Tanneguy se sentit transporté d’enthousiasme plus que par le plus beau discours ou la plus sublime exhortation. Il tira son épée, et vociféra :
– Bataille, par l’enfer ! Bataille !… Et si je meurs, chevalier, eh bien, ce me sera un rude honneur que d’être tué dans la société d’un compagnon tel que vous !…
– Tiens ! dit froidement Passavant, ils apportent une poutre. Pourquoi faire ?… Ah oui, pour enfoncer la porte !…
– Ma porte ! cria Tanneguy en qui se réveilla l’instinct du propriétaire. Une si belle porte en cœur de chêne tout sculpté, ornée de clous, et qui m’a coûté…
– Attendez, attendez, vous calculerez tout à l’heure…
Un coup sourd ébranla la porte, suivi d’exclamations furieuses, et Passavant continua :
– Décidément, ils entreront par la porte. Voyons, vous n’avez pas de poutre ici ? Non, évidemment… Et cependant, il nous faut démolir cette fenêtre, et vite !
La fenêtre en question donnait juste au-dessus de la porte. Tanneguy s’était élancé. Déjà il revenait avec deux énormes haches. Et tandis que la poutre, en bas, continuait à frapper des coups qui répercutaient dans tout le logis de sourds et lugubres échos, les deux assiégés démolissaient la fenêtre avec une telle ardeur qu’en quelques minutes, le bâti de chêne fut descellé et tomba dans la rue à grand fracas.
– Ma pauvre fenêtre ! grogna Tanneguy tout suant. Je l’ai bien payée quarante…
– Oh ! mais attendez donc, que diable ! Vous ferez le compte général quand le logis sera démoli.
À la chute de la fenêtre, les assiégeants avaient un instant reculé, hurlant une bordée d’injures, mais se demandant si les assiégés ne devenaient pas fous. Une large ouverture béait maintenant au-dessus de la porte. Les Bourguignons, le nez en l’air, regardaient et vociféraient.
– Bon ! cria Scas en éclatant de rire, les voici qui rebouchent leur trou, maintenant ! La peur les affole !…
– À la poutre ! hurla Ocquetonville.
Dans l’ouverture béante venait de s’encastrer un pesant bahut qui semblait la boucher. Ce bahut avait été poussé par Tanneguy et Passavant qui, l’oreille aux aguets, écoutaient…
Au premier coup qui, de nouveau, retentit sur la porte, ils se baissèrent ensemble, saisirent l’énorme meuble par en bas, et se raidirent.
– Attention ! dit Passavant.
– Pourvu que cela passe ! gronda Tanneguy.
– Cela passera, puisque nous avons démoli la fenêtre qui vous a coûté…
La poutre tonna sur la porte. Au même instant, d’un même, furieux effort, les deux assiégés soulevèrent par sa base le bahut qui bascula, oscilla une seconde sur l’appui et tomba…
Un long hurlement monta de la rue. Passavant se pencha et rentra aussitôt.
– Cinq, dit-il.
– Hors de combat ? haleta du Chatel.
– Assommés, écrasés, aplatis, je ne sais quoi, mais ils sont cinq qui se tortillent sur la chaussée comme des vers de terre. Continuons !
Dans la rue, les imprécations forcenées couvraient la plainte des cinq écrasés qu’on emportait hors de la zone dangereuse. La grosse poutre qui servait de bélier gisait abandonnée ; les assiégeants avaient reflué en désordre. Ocquetonville criait à tue-tête :
– Recommençons, mort-dieu ! Saisissez-moi cette poutre ! Ah ! chiens maudits, vous avez peur !…
– C’est cela, dit Passavant, recommençons.
En bas, une dizaine d’hommes soulevaient le bélier, le balançaient, et à toute volée le lançaient sur la porte.
– Hurrah ! Hurrah ! mugit la frénétique acclamation.
La porte était fendue, l’un des battants à demi disloqué. À ce moment, l’ouverture de la fenêtre se trouva bouchée par quelque chose de vaste et de luisant dont on voyait les sculptures ; une tête de démon tirait la langue aux gens de la rue ; c’était un coffre magnifique et pesant que les deux assiégés venaient de placer debout sur l’appui de la fenêtre, énorme projectile prêt à l’écrasement. Il y eut une débandade. De nouveau, la poutre fut abandonnée. Et encore retentirent, parmi les jurons, les ordres furieux de Scas et d’Ocquetonville.
Dix hommes s’avancèrent, non sans un vrai courage, car ils savaient ce qui les attendait ; ils soulevèrent le bélier, le précipitèrent sur la porte. Au même instant, le coffre s’abattit ; le tumulte des cris exaspérés couvrit le fracas, et on vit alors que trois des travailleurs gisaient inanimés parmi les débris du projectile ; mais la porte était à bas. Scas et Ocquetonville, les premiers, s’élancèrent, la hache au poing. Leur troupe les suivit en vociférant.
Puis il y eut une reculade soudaine : la porte était enfoncée, oui, mais derrière se dressait le rempart qu’avaient échafaudé les assiégés ; de la fenêtre pleuvaient les lourds escabeaux, les masses de fer ; pendant quelques minutes, il y eut une confusion de gestes affolés, un conflit de rumeurs violentes d’où jaillissaient des jurons, des hurlements de douleur, et brusquement la bataille cessa.
– L’assaut est repoussé, dit Passavant.
– Oui, fit Tanneguy, je commence à croire…
Ocquetonville se disposait pour une nouvelle attaque ainsi combinée : se ruer tous ensemble sur l’obstacle sans se soucier des projectiles de la fenêtre, démolir le rempart à coups de hache, – et monter !
À ce moment, le chevalier de Passavant parut à la fenêtre. Il était couvert de sueur. Dans la pâleur de son visage étincelaient ses yeux, et son sourire était effrayant à voir… Une bordée d’insultes l’accueillit, mais il leva la main et on se tut. Il y avait de la curiosité dans cette foule, il y avait de la terreur, et aussi peut-être de l’admiration parmi ces rudes hommes d’armes qui n’estimaient rien que la force et le courage. On vociféra donc des injures. Passavant fut comparé à un chien galeux, à un porc qu’on grille, et autres de ce genre, mais lorsqu’il leva la main, si calme et si flamboyant, tous se turent. Il cria :
– Sire de Scas ! Sire d’Ocquetonville !
– Qu’as-tu fait de Courteheuse ? rugit Ocquetonville.
– Ce que je ferai de vous, dit Passavant. Tôt ou tard, vous mourrez de ma main. Or, voici que je veux vous proposer. Je vais descendre dans la rue. Les braves qui vous accompagnent donneront leur parole de ne pas me charger. Et je me battrai contre vous deux…
– Pardon ! grogna Tanneguy, je veux ma part…
– Silence ! dit Passavant d’une voix si glaciale que Tanneguy recula. Ici, ce n’est pas moi qui parle. Scas ! Ocquetonville ! Seul contre moi, chacun de vous deux tombera…
– Chien maudit, vociféra Scas livide de fureur, te crois-tu donc invincible ?
– Descends ! brailla Ocquetonville. Descends que je t’étripe !…
– Tandis qu’à deux, continua le chevalier, vous pourrez peut-être vous débarrasser de moi…
– Peut-être ! hurlèrent les deux Bourguignons fous de rage.
– Acceptez-vous ?… Si oui, vous épargnez la vie de quelques-uns de ces braves. Écoutez, vous autres ! Nous soutiendrons le siège plusieurs jours. Nous avons des vivres. Vous avez vu ce que nous pouvons faire. La porte franchie, l’escalier vous arrêtera deux heures. Puis, il y a d’autres portes à prendre. Il y aura deux étages. Combien de vous vont laisser ici leurs os ? Songez-y et décidez vos maîtres à accepter ma proposition. S’ils refusent, je vous tiendrai, vous, pour des braves, condamnés à l’écrasement, mais eux je les tiendrai pour des lâches.
À ce mot, qui a aujourd’hui perdu presque toute sa valeur, on vit Ocquetonville délirant s’arracher les cheveux, on vit Scas s’élancer seul sur la porte et essayer de son épaule de démolir le rempart. Puis un tumulte encore s’éleva, et cessa. Passavant avait disparu de la fenêtre. Dans la rue s’établit un silence relatif. Les assiégeants se concertaient et délibéraient sur la proposition du chevalier.
– Par tous les diables, dit Tanneguy, croyez-vous donc que je vais vous laisser descendre seul ?
– Oui, s’ils acceptent. Taisez-vous, capitaine. C’est ici la seule et dernière chance qui me reste de tenir le serment fait sur la tête sanglante de Louis d’Orléans.
– Mais, par le tonnerre du ciel, vous serez tué ! Scas et Ocquetonville sont deux rudes lames !
– Taisez-vous. Je les tuerai !… Et ne voyez-vous pas qu’alors nous sommes saufs ? Les deux chefs morts, les autres n’oseront porter la main sur nous. Et enfin, mon brave ami, si je suis tué, il vous restera une ressource : à votre tour, vous descendrez, et…
– Ah ! voilà qui arrange les choses !
– Bon ! Les voici qui appellent, dit Passavant en se rapprochant de la fenêtre.
Le conciliabule était terminé. Les gens d’armes s’étaient massés en deux troupes qui, de chaque côté du logis de Tanneguy, barraient la rue, laissant entre elles un large espace vide. Derrière chacune de ces barrières, à perte de vue, une foule de populaire, moutonnante, silencieuse aux premiers rangs attentifs à tout ce qui allait se passer, mais de plus en plus agitée et bruyante dans les lointains, où l’on poussait, où l’on voulait voir coûte que coûte la bataille et le massacre.
Dans l’espace vide se tenaient Scas et Ocquetonville.
Tous deux avaient l’épée à la main.
– Nous acceptons le combat, dit Ocquetonville.
– L’un après l’autre, dit Scas.
– Messieurs, dit Passavant, ceci est de la générosité. Je ne l’accepte pas, moi. Je ne veux rien de vous. Donc, je vous combattrai tous deux ensemble, – ou je ne descends pas.
– Eh bien, soit ! fit Ocquetonville livide, descendez !
Le chevalier, aussitôt, descendit, suivi de Tanneguy qui répétait : « Attention, diable, attention ! » Le rempart fut démoli tout juste pour laisser place à un homme. Tanneguy voulait absolument sortir, mais Passavant le fit tenir tranquille avec son clair bon sens :
– Voyons, lui dit-il, si vous m’accompagnez, on pourra croire à une ruse de notre part ; de ce fait, la trêve jurée par les gens d’armes sera rompue, et nous serons massacrés.
– C’est juste, dit Tanneguy avec regret. Allez donc, et que Dieu vous garde !
Les deux amis s’embrassèrent. Puis le capitaine se précipita au premier étage pour assister au combat et Passavant, se glissant dans le passage qu’ils venaient de ménager, parut dans la rue. Il dégaina aussitôt, salua ses adversaires et tomba en garde.
– Enfin ! rugit Ocquetonville, nous le tenons donc enfin !…
Au même instant, les deux troupes rangées de chaque côté du logis se mirent en marche, resserrant l’étau en deux ou trois secondes, et Passavant se trouva enveloppé avant même qu’il eût tout à fait compris la trahison. Il faut dire que plusieurs de ces hommes refusèrent de marcher et se mirent à l’écart, prétextant la foi jurée. Ceux-là payèrent cher la façon dont ils comprenaient l’honneur : ils furent tout simplement pendus.
– Trahison ! Trahison ! hurla du Chatel en se jetant dans l’escalier en bonds insensés.
Mais si vite qu’il eût descendu l’escalier, lorsqu’il arriva dans la rue, il était trop tard : il vit son ami solidement ligoté, porté sur les épaules de cinq ou six hommes, tandis que le reste des gens d’armes entourait étroitement ce groupe en marche vers l’Hôtel Saint-Pol. Scas et Ocquetonville marchaient la dague au poing, le visage convulsé, de chaque côté du prisonnier. Et alors, ce fut pour Tanneguy la plus baroque des aventures que ce digne capitaine eût connues dans sa vie tumultueuse.
Lorsqu’il vit qu’on emmenait, ou plutôt qu’on emportait son ami, du Chatel se rua l’épée haute en hurlant :
– J’en suis ! Arrêtez-moi ! Ohé Scas ! Ohé Ocquetonville ! Bélîtres ! Ruffians ! Chiens de Bourgogne !
Il tomba ainsi sur les derniers rangs de la troupe en marche, mais on se contenta de le repousser à coups de pique. Il eut beau ajouter à la liste, pourtant très longue de ses jurons, des imprécations nouvelles, des anathèmes de son invention, des insultes effarantes, il eut beau même blesser quelques-uns des gardes, il ne fut pas arrêté : Scas et Ocquetonville, dans la joie de leur prise, l’avaient complètement oublié. Ce fut ainsi, hurlant, suant, se démenant, que le brave capitaine parvint jusqu’à la grand’porte de l’Hôtel Saint-Pol, et demeura tout ébahi en voyant qu’on relevait le pont-levis.
Eh bien, Tanneguy fut profondément humilié. De cette aventure, il demeura ulcéré beaucoup plus que des coups qu’il avait reçus certain soir des gens de Bourgogne. Il grinça des dents, jura que Jean sans Peur avait voulu le déshonorer, et se fit à lui-même de terribles serments de vengeance.
Puis il reprit tristement le chemin de la Truie pendue. La rue, déjà, avait repris son aspect accoutumé. D’abord, on était fort habitué à ce genre d’algarades. Ensuite, Paris était en proie à de sombres préoccupations dont nous aurons à parler. Il résultait de là que le siège du logis du Chatel, l’arrestation de Passavant n’avaient ému la rue qu’au moment même de l’action.
Tanneguy du Chatel arriva à l’auberge, et il faut dire que l’événement ne l’empêcha pas de dîner de bon appétit. Thibaud, qui le vit de méchante humeur, tourna longtemps autour de lui, puis, l’abordant enfin :
– Ne vous semble-t-il pas, capitaine, que vous êtes bien imprudent de dîner dans la grande salle et non dans votre chambre comme d’habitude ?
– Pourquoi imprudent ? grogna le capitaine.
– Mais vous m’avez dit… les gens de Bourgogne… vous savez bien ?
– Oui. Eh bien, ils ne veulent plus de ma peau ! dit rageusement le capitaine.
Le bon Thibaud ne comprit pas comment Tanneguy du Chatel était si furieux de ce que ses ennemis n’en voulussent plus à sa peau. Mais cette fureur était si visible qu’il tenta de détourner l’orage.
– J’espère, dit-il, qu’on en pourra bientôt dire autant de M. le chevalier de Passavant, ce digne gentilhomme !
– Eh bien, hurla Tanneguy, c’est ce qui vous trompe ! Sa peau, à lui, est en grand danger !
– J’espère qu’il ne lui est rien arrivé de fâcheux !
– Il est prisonnier dans l’Hôtel Saint-Pol ! vociféra le capitaine, qui se versa coup sur coup plusieurs rasades.
Thibaud pâlit et trembla pour son auberge. Si Passavant était arrêté, et qu’on lui donnât la question, n’avouerait-il pas qu’il avait longtemps logé à la Truie Pendue ? Cependant, le capitaine posait bruyamment son gobelet vide sur la table en criant :
– Ah ! par tous les diables d’enfer ! Je donnerais dix ans de ma vie pour pouvoir entrer à l’Hôtel Saint-Pol !…
Un buveur, attablé non loin, se leva alors, s’approcha en saluant, et murmura :
– Si au lieu de dix ans de votre vie, dont je n’ai que faire, vous voulez seulement me donner dix écus d’argent, je me charge, moi, de vous faire entrer dans l’Hôtel Saint-Pol !
– Dix écus d’or ! fit Tanneguy soudain dégrisé. Je donne dix écus d’or !
Et Tanneguy considéra l’homme qui venait ainsi se mettre à sa disposition. C’était un de ces êtres qui pullulaient dans Paris, la figure longue et maigre, la moustache en croc, la rapière immense et le manteau troué.
– Oh ! fit-il, est-ce toi qui me feras entrer dans la forteresse du roi ?
– Non, dit le personnage, mais je connais quelqu’un qui ne peut pas me refuser de m’aider à gagner ma pauvre vie et qui, lui, vous fera entrer où vous voudrez…
– Allons ! dit Tanneguy en se levant.
– Les écus d’abord ! dit l’homme.
Du Chatel monta à la chambre que si joyeusement il avait partagée avec Passavant, donna un soupir de regret aux souvenirs que cette chambre évoqua en lui, et redescendit avec les dix écus.
– C’est tout ce qui me reste, songea-t-il, mais je les reprendrai sur la dot de Roselys !…
Il se mit donc en route, escorté du personnage qui le guidait.
– Où me mènes-tu ? demanda-t-il.
– Dans la Cité, répondit l’homme.
– Hum !… Et qui es-tu ?… Que fais-tu ?…
L’homme eut un bizarre sourire et un regard de travers sur son compagnon. Tout en marchant, il expliqua :
– Qui je suis ? Du diable si je le sais, et mon nom je l’ai oublié, si tant est que j’en aie jamais eu un. Quant à mon état, je fais profession de jouer ma vie contre un peu d’or toutes les fois qu’il y a aux Fourches de la Grève un beau pendu, solide gaillard qui ne demandait qu’à vivre. Vous ne comprenez pas ?
– Non, par la damnation de ton âme, mais je suppose…
– Ne supposez rien. J’arrive à la nuit noire sur la Grève, escorté d’un ou deux compagnons qui sont mes aides et que je paie. Je décroche le pendu… et je le porte à l’homme de la Cité. Qu’en fait-il ? Je ne le sais, et ne veux point le savoir. Il paie largement, voilà tout.
– L’homme de la Cité ? fit Tanneguy avec une sourde inquiétude.
– Oui. Celui chez qui nous allons. Si quelqu’un au monde peut vous introduire dans l’Hôtel Saint-Pol, c’est lui, ou Dieu me damne.
– Mais s’il refuse ?
– Pas de danger ! Il a trop peur d’être dénoncé au prévôt ! Mais aussi pourquoi depuis plus de quinze jours ne m’a-t-il pas employé ? Vos écus m’eussent été inutiles. Nous y voici.
– Quoi ? fit Tanneguy.
– C’est ici, dit l’homme. Vous n’avez donc jamais ouï parler de Saïtano ?
– Le logis du sorcier ! murmura Tanneguy, qui venait de reconnaître la maison devant laquelle il avait attendu Passavant. Eh bien ! oui, celui-là me conduira !
XVII – DISPOSITIF DE COMBAT
Jean sans Peur attendait dans l’Hôtel Saint-Pol, près de la grand’porte. C’est là qu’il avait donné l’ordre d’amener le chevalier de Passavant. Cette fois, la capture était assurée. Depuis quelques jours, le chevalier était étroitement surveillé. Scas et Ocquetonville étaient prêts à agir. Ils venaient de lui mander que, dans la journée, Passavant serait pris. Jean de Bourgogne attendait. Il voyait à cette capture un profit immense, la fortune, la gloire, la puissance, et sa propre vie assurée.
Il faut l’indiquer ici en quelques mots :
Jean de Bourgogne était aux abois. La reine lui semblait condamnée à l’impuissance. Activement, les Armagnacs travaillaient contre lui à la cour et dans la ville. Presque ouvertement, il était accusé du meurtre de Louis d’Orléans. Le réseau des preuves se resserrait. L’inéluctable nécessité d’agir, d’agir vite ! s’imposait à cet homme, et il songeait :
– Passavant pris, c’est la condamnation et l’exécution de l’assassin du duc d’Orléans. C’est donc mon innocence établie avec éclat. Passavant pris et condamné, c’est la reine qui me revient et reprend confiance en moi, puisque je suis alors le seul homme qui puisse occuper sa pensée. Passavant livré par moi aux juges, c’est le roi qui me croit son sauveur. Passavant mort, c’est Odette qui se tourne vers moi…
Il eut une longue méditation, et murmura :
– Le sorcier a tenu ses promesses. Cette fille qui me haïssait n’a plus pour moi que des regards de tendresse à peine voilés… de la pitié, dirait-on parfois. Pourquoi la dernière promesse du sorcier ne se réaliserait-elle pas ?… Je n’ai qu’à dire à Odette : Je sais qui vous êtes… et Odette me suivra. Enfer ! Pourquoi ne l’ai-je pas dit encore ? Pourquoi la seule vue de cette enfant me fait-elle trembler ?…
Il cessa de regarder vers la rue Saint-Antoine et, se tournant du côté du palais du roi, jeta un long regard sur le vaste ensemble de l’Hôtel Saint-Pol. Passaient de nombreux gentilshommes dont les uns le saluaient avec déférence – et ceux-là étaient des partisans du duc de Berry – les autres le toisaient avec insolence – et c’étaient des Armagnacs. Mais il n’y avait pas un seul Bourguignon. Tous les gentilshommes de sa maison, et tous ceux qui, sans lui appartenir, lui étaient dévoués, étaient massés dans l’hôtel de Bourgogne, ou attendaient chez eux le mot d’ordre. Rien, dans l’Hôtel Saint-Pol, ne pouvait inspirer le moindre soupçon contre Jean sans Peur.
Les regards du duc de Bourgogne étaient fixés sur les fenêtres lointaines de l’aile que n’habitait pas le roi. Et derrière ces fenêtres, ce qu’il espérait entrevoir vaguement, silhouette imperceptible pour tout autre, c’était Odette de Champdivers. Une rumeur qui s’éleva derrière lui, soudain, le fit se retourner tout d’une pièce, et il tressaillit, et il eut un long soupir.
C’était Passavant !…
C’était la première victoire. Instantanément, Jean de Bourgogne reprit cette attitude d’assurance et d’orgueil qui faisait si redoutable son aspect. Passavant, porté sur les épaules des gens d’Ocquetonville, bien garrotté, désarmé, d’ailleurs, franchit la grand’porte en se disant avec une mélancolie narquoise :
– Bon ! Et moi qui, depuis huit jours, cherchais le moyen d’entrer à l’Hôtel Saint-Pol !…
On le déposa devant le duc de Bourgogne. On le délia. Il se secoua, se détira, sourit, et se tournant, la figure changée, vers Scas et Ocquetonville :
– N’oubliez pas ceci : Guines et Courteheuse vous attendent !
Les deux Bourguignons haussèrent les épaules, mais leurs cœurs tremblèrent. Scas s’avança vers son maître :
– Monseigneur, voici l’homme, pris en flagrant état de rébellion.
– C’est pour embellir son affaire devant l’Official, dit Ocquetonville.
Jean sans Peur et Passavant étaient face à face dans un grand cercle de gens d’armes. Le duc, une minute, considéra le jeune homme avec cette rudesse dédaigneuse qui faisait trembler tant de gens. Il dit :
– C’est vous qui avez tué Guines ?
– D’un coup au cœur, dit Passavant. Il est mort en brave.
– C’est vous qui avez tué Courteheuse ?
– D’un coup au cœur. Celui-là aussi est mort en brave. Mais ces deux-là…
Il se tourna vers Scas et Ocquetonville et les toisa :
– Ces deux-là mourront en lâches, mais ils mourront d’un coup au cœur, de la main qui a tué Guines et Courteheuse.
Les deux Bourguignons grincèrent des dents et s’avancèrent.
– Arrière ! commanda le duc. C’est vous… c’est vous qui avez tué mon bien-aimé cousin d’Orléans ?
Passavant se rapprocha de Jean de Bourgogne, et, dans la figure, lui parla à voix basse. On vit pâlir le duc. On vit ses mains trembler. On le vit jeter autour de lui des yeux hagards. Passavant disait :
– J’ai tué Guines devant le perron de l’hôtel Passavant où lui et les siens étaient venus me meurtrir. J’ai tué Courteheuse dans les caves où vous veniez, vous, de conspirer contre la vie du roi votre cousin et votre maître. N’ayez pas peur : je ne vous dénoncerai pas. Mais quant au noble duc d’Orléans, contre lequel vous me vouliez lancer, c’est vous qui l’avez tué. Je ne parle pas de ces gens qui sont ici. Ils ne furent que la hache qui frappe. Vous fûtes, vous, le bras du bourreau qui manie cette hache. Ne tremblez donc pas : je ne vous dénoncerai pas. Mais prenez garde ! Aussi vrai que je tuerai Scas et Ocquetonville d’un coup au cœur, je puis vous anéantir, vous… car vous le savez… il y a un témoin… et ce témoin de ce que vous avez fait jadis, ce témoin c’est moi !…
– Qu’on l’amène ! rugit Jean sans Peur.
– Où cela ? s’empressèrent Ocquetonville et Scas.
– Eh ! cria Passavant dans un éclat de rire, là même où monseigneur, voici de cela douze ans et plus, a fait jeter le témoin : à la Huidelonne !…
Jean sans Peur approuva d’un rude signe de tête, et le chevalier, entouré d’une vingtaine de gardes, se mit à marcher de bonne volonté. Il songeait : « Il paraît décidément que je suis le témoin. Mais je veux être écorché vif si je sais de quoi je suis le témoin ! » Quelques minutes plus tard, il était enfermé dans l’un de ces cachots souterrains du deuxième étage où le geôlier lui avait jadis assuré que les prisonniers vivaient rarement plus de six mois. Jean sans Peur l’avait suivi des yeux tant qu’il avait pu le voir.
À ce moment, le pont, qui avait été levé pour opposer un obstacle à toute bande qui eût tenté de délivrer le prisonnier, fut abaissé, la rue ayant repris tout de suite son aspect paisible.
– Le témoin ! songeait Jean sans Peur en s’essuyant le front. Le sorcier m’a autrefois prévenu. Il y a un témoin de ce qui s’est passé dans l’oratoire du logis Passavant. J’ai signé un acte de mariage, moi, l’époux de Marguerite de Hainaut !… C’est le sacrilège ! C’est la peine des sacrilèges ! La langue coupée, le poignet droit coupé, puis le bûcher ! Il y a un témoin !… Oui, ajouta-t-il avec un rire nerveux, mais qui croira la parole d’un assassin contre celle de Jean de Bourgogne ? Où sont les actes de mariage qui portent ma signature et celle de Laurence d’Ambrun ? Allons, allons… les actes, je les brûlai moi-même. Le témoin va mourir. Et quant à Laurence…
Il s’arrêta court, les yeux arrondis par la terreur, une sueur glacée à la racine des cheveux…
Là-bas, dans la rue, au delà de la grand-porte, au delà du pont-levis, une femme…
C’était celle-là même que, près de cette même porte, il avait failli un jour renverser…
C’était le spectre de Laurence d’Ambrun ! Que faisait-elle là ? Qu’attendait-elle ? Que regardait-elle ? Furieusement, Jean sans Peur s’avança vers les gens du poste et hurla :
– Cette femme !… Là !… Cette femme !… Arrêtez-là !
Mais avant que les archers fussent sortis du corps de garde, la femme avait repris son chemin, lentement, sans hâte, et s’était enfoncée dans l’une des ruelles qui venaient se dégorger sur la rue Saint-Antoine. Les archers qui s’étaient élancés battirent les environs et ramenèrent trois ou quatre malheureuses qui criaient et sanglotaient. Elles furent relâchées et la course affolée du lapin dans les fourrés peut seule donner une idée de la rapidité avec laquelle elles s’éloignèrent de la redoutable forteresse. Jean sans Peur, longtemps, médita sur cette vision ; puis enfin, haussant les épaules, il se dirigea vers le palais de la reine.
– Imaginations et folie, se dit-il. J’ai le cerveau troublé. Bientôt mon horizon va s’éclaircir. Encore un effort, et je suis le maître. Caboche attend. Mes gentilshommes sont prêts. Bruscaille, Bragaille et Brancaillon frapperont le fou. Allons ! Allons affronter cet autre spectre plus réel, plus redoutable, qu’on appelle Isabeau de Bavière.
Informée d’heure en heure de tout ce qui se passait dans l’Hôtel Saint-Pol et les palais par une véritable armée d’espions et d’espionnes, la reine savait déjà l’arrestation du chevalier de Passavant. Quant à savoir ce qu’elle en pensait et quel trouble cette nouvelle avait pu porter dans son esprit et dans son cœur, c’est ce qui eût été bien difficile. Devant ses gentilshommes et ses demoiselles d’honneur, assemblés dans la salle de Théseus, où ce jour-là elle tenait sa cour, elle accueillit le duc de Bourgogne avec son plus charmant sourire.
– Vous le voyez, mon cousin : nous mettons à profit la sécurité profonde où nous sommes grâce au zèle de notre bon sire et époux, qui a mis des gardes à toutes les portes de ce palais. Allons, faites comme nous, et jouez aux cartes… Prenez garde, ma chère de Puisieux, je tiens un roi dans mon jeu… Ah ! je le tiens !
Jean sans Peur ploya le genou devant la reine, puis, se relevant :
– Majesté, dit-il, pardonnez-moi pour aujourd’hui. J’ai d’autres jeux en tête…
Les gentilshommes et les dames, tout en feignant de s’intéresser à la partie de cartes où tous avaient engagé de l’or, écoutaient avec une prodigieuse attention ce qui se disait…
C’était un charmant et merveilleux spectacle que celui de cette assemblée. Dans la vaste salle aux splendides tapisseries dont la renommée est parvenue jusqu’à nos jours, dans cette salle élégante, somptueuse, où un feu d’énormes troncs de hêtre, se consumant au fond de la gigantesque cheminée, entretenait une douce chaleur, les personnages de cette scène étaient vêtus légèrement ; la soie, les dentelles formaient le fond de ces costumes aux couleurs éclatantes ; tous ces êtres, groupés harmonieusement çà et là, étaient jeunes, beaux et spirituels ; les femmes, jolies à faire rêver, habillées avec la plus audacieuse, mais aussi la plus élégante légèreté, jasaient, disaient des vers, se racontaient des nouvelles.
Jean sans Peur admira ce tableau, non qu’il fût d’humeur poète ou artiste, mais cette sérénité au milieu du drame fait de tant de drames lui donnait une haute idée du courage et de la force d’Isabeau. Et ce courage même, ce ne fut pas en connaisseur désintéressé qu’il l’admira, mais il se dit que si la reine était si calme à l’heure où sa liberté, sa vie même peut-être étaient en péril, c’est qu’elle avait de secrètes assurances de triomphe.
L’attitude d’Isabeau de Bavière était en effet digne d’admiration.
Mais bientôt ce fut pour elle-même que le duc de Bourgogne l’admira. Il retombait sous le charme étrange et puissant que dégageait la beauté de cette femme, semblable à quelques célèbres courtisanes privilégiées de la nature, à demi-déesses, gardèrent jusqu’à la fin les apparences de la jeunesse.
Parmi ces splendides costumes qui l’entouraient comme pour la mettre en valeur, Isabeau était simplement vêtue d’une sorte de longue tunique de lin blanc, très léger, très souple : toujours parée de bijoux, étincelante de pierreries comme une fée tentatrice, elle ne montrait ce jour-là que la blancheur rosée de ses bras et de sa gorge.
Il était impossible de la voir sans l’aimer. Elle provoquait l’hallucination. Elle apparaissait lointaine et supérieure, digne d’être adorée en secret, ce qui est la seule forme de l’adoration, car un geste ou un mot brisent le charme, et l’adoration devient alors simplement du désir. Or, tous ces jeunes hommes élégants et beaux qui l’entouraient l’adoraient véritablement et on pouvait s’étonner de ne pas les voir prosternés aux pieds de l’idole.
Voilà ce qui apparut à Jean sans Peur en ce jour où s’agitait le mystère de sa destinée de puissance. Odette de Champdivers et sa grâce naïve et son innocence immaculée disparurent aux horizons de ses sentiments. Il regarda ces femmes dont quelques-unes étaient célèbres par leur beauté, dont plusieurs l’aimaient ouvertement, et il se dit qu’elles étaient de simples fantômes. Il regarda ces gentilshommes dans les yeux desquels il put lire l’adoration, et il fut jaloux, et sa passion s’exalta.
En lui, le conquérant s’abolit ; le rude féodal qui se ruait à l’assaut du trône s’effaça ; il ne fut plus qu’une pauvre épave d’humanité que ballottait le flot de l’amour…
Pendant quelques minutes, il s’intéressa à la partie de cartes, se mêla aux entretiens, alla de groupe en groupe. Une dame qui tenait la partie adverse de la reine lui dit :
– Soyez avec moi, seigneur duc…
Et il vida son escarcelle devant la dame, sans compter, ivre, les tempes battant le rappel des passions qui affolent. Mais alors, la reine, gravement, lui dit :
– C’est avec moi que vous devez être, mon beau cousin…
Et comme son escarcelle était vide, brusquement, à deux mains, il brisa la splendide chaîne qu’il portait au cou, chaîne d’une fabuleuse richesse, toute étoilée de diamants, et la déposa dans le jeu de la reine. Il y eut un murmure. Isabeau sourit, prit la chaîne, rattacha les mailles brisées, et la mit à son cou. C’était d’une telle audace que Jean sans Peur vacilla, que les seigneurs et les dames du jeu de la reine pâlirent de terreur…
Elle se leva soudain.
À l’instant, tous furent debout, rangés en demi-cercle autour d’elle et courbés.
– Majesté, dit le duc de Bourgogne d’une voix rauque, je suis aux regrets de troubler cette réunion et le plaisir de la reine ; je venais solliciter une audience particulière, car il se passe des événements qui intéressent la sûreté de notre sire le roi…
Un regard d’Isabeau suffit à faire comprendre à ses courtisans qu’elle voulait être seule. En quelques instants, la salle de Théseus fut déserte ; mais la douce et lointaine musique continua de se faire entendre en sourdine.
– Je vous écoute, dit la reine.
Le duc fit un effort. Il passa ses mains sur son front brûlant comme pour tenter de chasser les pensées de passion qui l’obsédaient. Et rapidement, d’une voix hachée, il développa le plan :
– Reine, le jour approche. Dans tous les quartiers de Paris, des compagnies de bourgeois en armes sont prêts à tenir la rue au cri de : Vive Bourgogne ! Nous avons douze mille hommes d’armes. Nous avons douze cents seigneurs et leurs suites. Une nuit suffira à l’anéantissement de vos ennemis et des miens.
– Je sais cela, beau cousin. Continuez.
– Les trois hommes que j’ai placés près du roi agiront au premier signe. J’ai vu ce matin leur chef, nommé Bruscaille. Madame, ajouta Jean sans Peur d’une voix frémissante, le roi est condamné. Quand vous le voudrez, vous serez veuve. Ce sera en même temps que le massacre des gens d’Armagnac.
– Passez, mon cousin. Je sais cela…
Jean sans Peur se rapprocha, baissa la voix. Et pourtant, ce qu’il venait de dire, un mot entendu par une oreille ennemie le condamnait à mort. Dans ce qu’il allait dire, rien de dangereux pour lui ou la reine :
– Le meurtrier du duc d’Orléans est arrêté. Arrêté par des hommes à moi, portant mes insignes. Aucune accusation ne peut désormais nous atteindre. La confiance du monde de la cour et de la ville nous était nécessaire. Nous l’avons. Le signal d’agir sera donné le jour même où tombera la tête du meurtrier. Au coup de hache de l’exécuteur répondront les tocsins de toutes les paroisses.
Cette fois, la reine demeura muette. Jean sans Peur, qui la considérait ardemment, ne put saisir en elle ni un frisson ni un tressaillement. Plus bas encore, d’une voix plus ardente, il murmura :
– Ainsi le peuple de Paris ne demandera plus quel est le meurtrier ! Ainsi se terminera, pour lui et pour moi, le cauchemar de savoir vivant cet homme que vous… Ah ! par la damnation, je dirai donc pourtant ce que j’ai sur le cœur ! Cet homme, vous…
– Que ferez-vous d’Odette de Champdivers ? interrompit Isabeau d’un accent paisible.
Jean sans Peur eut un rauque soupir. Il s’arrêta, étourdi, fasciné. Toute la force d’Isabeau – la force de toute femme qui combat – venait de se manifester par un coup terrible, et toujours le même. Sans laisser au duc le temps de dire qu’elle aimait Passavant, elle le plaçait, elle, en présence d’une autre passion inavouée ; l’accusateur devenait accusé.
– Odette de Champdivers ! balbutia-t-il en reculant.
– Oui, dit la reine. Toute la question est là. Toute la question… Vous m’entendez, vous me comprenez. Traître à vos premiers engagements vis-à-vis de moi, meurtrier hier de votre cousin d’Orléans, meurtrier demain du roi de France, conspirateur, rêveur de puissance, impitoyable compétiteur décidé à ramasser dans des flots de sang une couronne que je vous offrais sans risques, hypocrite mendiant d’amour qui prenez ici le masque de la passion pour me cacher la vraie face de votre cœur, je vous, le déclare : ou vous êtes à moi tout entier, ou je vous abandonne. Vous vouliez parler… C’est moi qui parle. Vous me réservez la trahison suprême. Le roi assassiné, votre femme Marguerite morte par le poison, ou par la honte, ou par la douleur. Paris muselé. Armagnac anéanti. Bourgogne enfin maître du royaume et hissé sur le pavois par ses soudards sanglants, que devient Odette de Champdivers ? Que devient Isabeau de Bavière ? Que donnez-vous à l’une et à l’autre ? Je vais vous le dire. À l’intrigante qui a déjà fait de moi une prisonnière, vous offrez la couronne. Et à moi qui vous ai sauvé, élevé de marche en marche, vous offrez cette même coupe de poison que votre première amante, Laurence d’Ambrun, refusait de boire. Vous voyez, Jean de Bourgogne, je me dévoile à vous tout entière. Si je pensais à vous trahir, je vous cèlerais mes soupçons, mes certitudes, et si bien que vous me croiriez jusqu’au bout votre dupe. En ceci du moins, je suis loyale. Je vous parle avec toute la vérité de mon cœur, dût-elle nous tuer tous deux. Et voici ma volonté, duc : avant qu’on ne touche au roi, avant qu’on ne sonne le tocsin qui sera le signal du massacre d’Armagnac et de votre gloire, avant que ne tombe la tête de l’homme que vous venez de faire enfermer dans la Huidelonne, je veux être sûre de votre fidélité, moi. Je ne veux pas de serment. Je ne veux même pas de convention écrite comme celle que vous avez échangée avec ce manant, ce boucher, ce Caboche. Je veux un acte, un seul. Je veux la mort de celle que vous aimez. Odette vivante, je suis votre ennemie, duc. Je me retranche dans mes soupçons. Je vous suis pas à pas. Je vous dénonce. Je vous livre. Au moment même où vous allongerez la main pour saisir la couronne, vous trouverez le carcan de fer qu’on vous passera au cou. Odette morte, je suis votre, amante. Je suis votre femme. Je suis le génie qui vous conduit aux cimes éblouissantes où pas un pied de roi ne s’est encore posé. Jean de Bourgogne, parlez maintenant !
Stupéfait, hagard, fou de terreur, de rage, de passion, le duc de Bourgogne écoutait comme en rêve la musique monotone, effroyable et douce de cette voix qui parlait presque sans accent – sûrement sans menace. Pas de colère, pas de froideur affectée chez Isabeau.
À grand effort, le duc recouvra un peu de sang-froid et murmura :
– Ma décision est prise, je vais vous la dire…
Il mentait, et se mentait à lui-même. Il était incapable, en ce moment, de décider quoi que ce fût. Pourtant, au fond de lui-même, il se sentait un terrain de révolte. L’idée de braver Isabeau passa en éclair dans son esprit et s’évanouit :
– Odette de Champdivers !… commença-t-il d’une voix faible.
Et il se tut. Immobile, Isabeau attendait.
Il eut un accent de fureur. Il comprit qu’il allait briser la chaîne, qu’il se libérait d’Isabeau, et qu’il allait crier : Cette jeune fille que vous condamnez, je la sauverai, moi !…
Dans l’instant qui suivit, il s’abattit aux pieds de la reine, et râla :
– Qu’elle meure donc, puisque vous la condamnez !…
La beauté d’Isabeau triomphait. Le bouleversement, d’ailleurs, ne fut qu’apparent. En réalité, terreur, haine, fureur, révolte, ne furent chez Jean sans Peur que de stériles agitations d’âme, alors que dès l’instant où il était entré dans cette salle, il n’y avait eu pour lui de vivant au monde que la beauté d’Isabeau, et sa passion.
La reine regarda le puissant duc prosterné à ses pieds.
Elle ne triompha pas, elle ! Ce fut presque un sourire de tristesse et d’amertume qui vint crisper ses lèvres. Elle se pencha lentement, tendit ses deux mains au duc et le releva. Un instant, ils furent face à face. Isabeau vit Jean de Bourgogne flamboyant de décisions mortelles. Elle eut la sensation qu’en cette minute, il eût pour elle bouleversé le monde, déraciné son trône, noyé une ville dans le sang ; et alors, sur elle aussi, s’abattit le coup de passion. Elle l’aima violent et brutal et sanguinaire – sanglant dans son imagination. Elle le vit plus fort et, par conséquent, plus beau que tout et tous. Elle haleta. Vaguement, elle ouvrit les bras – et aussitôt elle se déroba : une autre image se dressait devant elle, et c’était Passavant… Jean sans Peur, étonné, tremblant, regardait plus loin qu’Isabeau, et se balbutiait, éperdu : « Quoi ! J’ai condamné Odette ! Quoi ! Elle va mourir !…
Ils s’écartèrent l’un de l’autre. Une minute leur suffit pour reprendre non leur sang-froid mais cette attitude de combattants alliés par quoi ils se retrouvaient en contact. Leur résolution à tous deux était prise.
– Vous avez dit : qu’elle meure ! Prenez garde, ceci est l’engagement même que je vous demande.
Isabeau, abattue par ses multiples efforts de volonté, parlait maintenant d’un accent nerveux, irrité.
– Je l’ai dit, répondit Jean sans Peur. Je le répète. Que cette fille meure… peu importe. C’est vous que j’aime. Depuis des ans, vainement je cherche à me tromper et à vous échapper. Je sais que je vous aime, et je l’ai toujours su. Je ne sais où je vais… Je vais là où vous m’entraînez, voilà tout. Votre rêve, c’est mon rêve. Ma puissance royale sera forte de votre puissance. Mon orgueil sera fait de votre amour. Ma gloire, c’est votre beauté. Qu’importe le reste ? Que cette fille m’ait attendri, que j’aie même cru l’aimer un jour, en quoi cela peut-il modifier ma destinée qui est la vôtre ? Qu’elle vive, si vous voulez. Qu’elle meure, si cela vous plaît. Moi je ne m’intéresse dans ce monde qu’à la vie d’Isabeau de Bavière, parce qu’elle est ma vie.
Longtemps, sans doute, il eût pu continuer sur ce thème, car le mensonge est fécond et verbeux. La sincérité trouve rarement un discours à son service.
– C’est bien, haleta Isabeau, n’en dites pas plus. Allez duc. Hâtez vos derniers préparatifs. Si vous êtes à moi, je suis à vous. Nulle puissance, donc, ne peut empêcher la définitive union à laquelle nous poussent nos destins. Allez… Et songez que la conquête du trône, c’est la conquête d’Isabeau.
Quelques instants plus tard, ils s’étaient séparés.
Jean sans Peur songeait : « Il faut qu’Odette me suive à l’hôtel de Bourgogne ! »
Isabeau murmurait : « Ce soir, je descendrai dans le cachot de Passavant !… Et pourtant, si Jean de Bourgogne est sincère ?… Sincère ou non, qu’il veuille ou non sauver l’intrigante, elle mourra ! »
En sortant du palais de la reine, le duc de Bourgogne marcha tout droit sur le palais du roi. Il ne prenait même pas la précaution de se cacher. Il savait d’ailleurs que toute précaution eût été inutile. Il savait que dans peu de minutes la reine serait avisée de ce qu’il faisait. Dehors, les dernières impressions qu’il gardait encore de la puissante beauté d’Isabeau s’effacèrent. Il lui semblait que cet air glacial qu’il aspirait avidement le dégrisait. Sa résolution de sauver Odette, de l’emmener sur-le-champ s’affermissait. Un autre plan de bataille s’échafaudait dans son esprit, et ses pensées évoluaient maintenant autour de la possibilité du meurtre de la reine survenant en même temps que l’assassinat du roi.
Lorsqu’il arriva dans les antichambres de Charles VI, il apprit que Sa Majesté se trouvait en conférence avec les trois ermites. Mais Jean sans Peur n’était pas de ceux que le roi pouvait consigner à sa porte : bientôt le duc fut admis dans la salle où, en effet, Bruscaille, Bragaille et Brancaillon continuaient en toute conscience à exorciser le fou.
À la vue de leur seigneur et maître, les trois sacripants frémirent.
– Attention ! se dit Bruscaille. Est-ce que le moment est venu de faire le geste ?
Ils se réfugièrent avec empressement dans un angle où ils s’immobilisèrent, attentifs, se demandant vaguement si derrière le duc n’allait pas entrer l’exécuteur qui leur eût fait signe.
Mais Jean sans Peur, sans jeter un regard sur eux, vint s’incliner devant le roi qui l’accueillit gracieusement.
– Voyez-vous ces trois hommes ? dit le pauvre fou. Eh bien, mon cousin, ils sont en train de me guérir, de me sauver la vie, et savez-vous comment ?
– Par la prière, sire.
– Non… par le rire. Ce gros, surtout ! Il s’appelle Brancaillon. Voyez le gaillard…
Brancaillon sa redressait, Bragaille invoquait les saints, Bruscaille gémissait en lui-même et se disait : « Cette fois, c’est fini. Le roi, que nous devons aider à mourir, déclare que nous le sauvons !… »
Jean sans Peur alla à eux, et ils grelottèrent.
– C’est bien, leur dit-il à voix basse. Vous faites à merveille votre office. Continuez… Continuez, ajouta-t-il tout haut, à prier pour Sa Majesté. Demain je vous enverrai un présent à chacun.
Les ermites respirèrent.
– Ainsi, monseigneur, dit timidement Bruscaille, tout va bien ? Nous devons faire rire Sa Majesté…
– Oui… Oui, jusqu’au moment proche… Soyez prêts !
– Nous le sommes ! gronda Bruscaille électrisé par le regard du maître.
– Sire, dit le duc en revenant au roi, les nouveaux guérisseurs du roi me semblent dignes de toute confiance. J’ai fort entendu parler d’eux et de leurs exploits. Leur prière vous guérira.
– Mais non, cousin. Par le rire, vous dis-je ! Vous ne connaissez pas ces drôles. Je les connais, moi – et le maître de mes caves les connaît aussi. Ah ! par Notre-Dame, quelles futailles il faudrait pour leur soif ! Mais parlez, mon noble cousin. Je vois à votre sévère figure que vous venez m’entretenir des affaires de l’État. Venez ça, maître Brancaillon, vous ne serez pas de trop, car je vous nomme conseiller.
– Sire, je n’y entends rien, balbutia Brancaillon qui s’approcha obliquement en surveillant le duc.
Mais Jean sans Peur leur gardait un visage impassible.
– Par la Pâques de Dieu, cria le roi, je veux que vous soyez mon conseiller. Parlez, maintenant, duc.
– C’est une heureuse nouvelle que j’apporte, dit Jean sans Peur.
– Ah ! fit amèrement le fou. Quelle heureuse nouvelle, voyons ? Est-ce que Madame la reine se met à aimer et honorer son époux ? (Jean sans Peur tressaillit). Est-ce que les seigneurs du royaume cessent de conspirer ma mort pour mettre à ma place un roi qui ne serait pas fou ? (Jean sans Peur pâlit). Les fous ! reprit Charles VI en se levant. Les déments ! Ils ont un roi qui les laisse vivre et ils en cherchent un plus raisonnable qui les… Voyons la nouvelle !
– Sire, dit le duc de Bourgogne, le meurtrier de notre aimé cousin est pris.
– Vraiment ? dit le fou avec un étrange regard en dessous. Le meurtrier ?
– Lui-même. Il a été pris, voici deux jours, en état de rébellion, et on l’a conduit à la Huidelonne.
Le roi demeura quelques instants méditatif, la tête baissée, cherchant quelque lueur à travers les obscures pensées de soupçon qui évoluaient dans son cerveau désemparé.
– Oui, dit-il enfin d’une voix morne, c’est là en effet une heureuse nouvelle. Mon frère d’Orléans ne m’aimait pas. Il était l’ami de mes ennemis. Mais enfin il n’y a jamais eu de preuve qu’il ait comploté ma mort, et, en somme, c’est suffisant pour établir une bonne fraternité. Je me réjouis donc de la capture de son meurtrier. Vous veillerez, duc, à ce que son procès soit rapidement instruit…
– Dans trois jours, sire, tout sera fini, dit le duc d’une voix qui vibra étrangement et alla faire tressaillir Bruscaille dans son coin.
– Trois jours, dit le roi, pensif. Les procès sont plus longs d’habitude. Mais enfin, contre celui qui a meurtri un frère de roi, on ne procédera jamais trop vite. Comment l’appelez-vous ?
– Le chevalier de Passavant.
– Ah ! murmura le roi. J’ai entendu ce nom. Mais où ? Mais quand ?
– Il sera condamné, continua Jean sans Peur. Les preuves abondent. S’il plaît au roi, l’exécution aura lieu dès le lendemain matin du jugement.
– Cela me plaît ainsi, dit le roi.
Jean sans Peur se retira, ayant eu la double habileté d’annoncer le premier l’arrestation de Passavant et de ne pas se vanter d’avoir lui-même préparé et mené à bonne fin cette arrestation – exploit que le procès devait mettre en suffisante valeur.
Le roi, enchanté de se retrouver seul avec ses ermites, leur fit signe d’approcher et leur dit :
– Allons, continuons nos exorcismes. Racontez-moi de ces bons fabliaux qui me font rire… Hé ?… Quoi ?… Je vous dis de me faire rire, bélîtres, je ne vous demande pas de pleurer !… Des larmes, ajouta Charles VI à mi-voix, il y en a vraiment trop dans le palais du roi.
Bruscaille semblait consterné, Bragaille mâchait des jurons, Brancaillon sanglotait. Les pauvres diables étaient démoralisés par la catastrophe qui s’abattait sur Passavant.
– Que signifie cela ? cria furieusement le fou. Quoi ! On se met à pleurer maintenant, quand je veux qu’on rie ? Suis-je, ou non, roi de France ?
– Ah ! sire, commença Bragaille, c’est affreux…
– Quoi ? Qu’y a-t-il d’affreux ? fit Charles VI déjà inquiet pour lui-même.
Brancaillon s’avança. Il allait entamer l’explication. Mais Bruscaille le devança rapidement. Il ne perdait pas facilement la tête, ce digne sacripant. Il calcula donc que Brancaillon, en avouant le motif de sa douleur, allait tout simplement établir leur complicité à tous trois avec le meurtrier du duc d’Orléans.
– Sire, dit-il avec précipitation, c’est une nouvelle manière que nous avons trouvée de vous faire rire…
– Ah ! fit Charles très étonné. Faire rire avec des pleurs, la méthode est nouvelle, en effet.
– Hé ! sire, dit Bruscaille, qui éclata en sanglots, il y a pleurs et pleurs. Il y a des larmes tristes. Il y en a qui font rire. Et quoi de plus risible, après tout, que la douleur ? Regardez, sire, voyez l’insigne grimace que nous faisons. Pleure, Bragaille ! Pleure, Brancaillon ! Pleurez donc, drôles, pour faire rire le roi ! Regardez-les, sire !
Le fait est que Brancaillon surtout faisait une merveilleuse grimace. Il n’avait pas une figure tragique. Pour sincère que fût sa douleur, elle prenait fatalement un masque bizarrement déformé.
Le roi regarda les trois ermites, et, en effet, éclata de rire.
Ils étaient en ligne devant le fou, se lamentant et pleurant tout leur saoul. Le fou riait convulsivement…
Tout en sanglotant, Bruscaille songeait : « Le moment approche où il faudra faire le grand geste d’exorcisme… le geste qui tue… » Pour qui eût pu saisir l’étrange conflit de sensations cruelles issues de cette scène, c’eût été là un spectacle sinistre. Et pendant ce temps, Jean sans Peur entrait chez Odette.
Depuis la disparition de Champdivers et de Margentine, elle vivait plus retirée dans ses appartements. Elle portait le deuil. Son âme était triste. Non seulement la mort (certaine à ses yeux) de ceux qu’elle avait aimés l’avait désemparée, mais encore la pauvre fille se sentait condamnée elle-même. Des terreurs palpitaient dans l’air qu’elle respirait.
Depuis le combat de la tigresse et du chien, elle vivait un effroyable cauchemar. Le chef des gardiens des fauves était bien venu s’agenouiller devant elle, et lui avait dit : « J’ai mérité la mort. Par ma négligence, la tigresse a pu s’échapper des cages, et si Dieu a voulu que vous fussiez sauvée, il n’en reste pas moins que, par ma faute, vous avez couru un terrible danger. Punissez-moi… Faites-moi pendre… La reine le veut ainsi… »
Odette avait renvoyé cet homme.
Mais l’explication, plausible après tout, ne l’avait pas convaincue. Elle s’attendait donc à la mort, mais elle ne songeait pas à fuir. La filiale affection qu’elle éprouvait pour le malheureux roi était, à cette époque de sa vie, son unique raison d’être.
Il y avait bien en elle un autre sentiment, mais celui-là était profondément caché dans son cœur.
Odette, donc, ce jour-là, dans ce petit salon où souvent Charles VI venait la voir, s’occupait de tapisserie au milieu de ses femmes. Dans la vaste embrasure de la fenêtre se tenaient quatre gens d’armes : c’était l’ordre du roi. Ainsi Odette se trouvait aussi prisonnière que pouvait l’être Isabeau.
Jean sans Peur, en entrant, marcha droit sur la jeune fille et s’inclina.
Il avait la tête en feu. Il lui semblait qu’il accomplissait une chose formidable. Il se maudissait d’être là, et il fût mort plutôt que de s’en aller.
– Madame, dit-il, aurez-vous assez de confiance en moi pour me parler seule à seul et renvoyer vos gens ? Ce que j’ai à vous dire est secret.
Odette de Champdivers se tourna vers les hommes d’armes de la fenêtre.
– Vous avez congé, dit-elle d’une voix qu’elle s’efforçait de rendre paisible.
Et, du même geste, elle renvoya aussi les femmes qui l’entouraient. Puis, d’instinct, comme pour être prête à tout événement, elle se leva.
– C’est mon père, songeait-elle avec amertume, et je dois me garder de lui comme d’un ennemi !
Un instant, ils se regardèrent. Ils étaient très pâles tous deux. La gorge sèche, les mains frémissantes, la pensée en délire, Jean sans Peur à voix basse, murmura :
– Madame, avant tout, un mot. Croyez-vous à l’intérêt immense que je vous porte ? Devinez-vous dans le cœur du duc de Bourgogne la volonté qu’il a de vous faire heureuse, puissante, respectée ?…
Odette leva sur cet homme, qu’elle savait être son père, son clair regard limpide, – et Jean sans Peur tressaillit en voyant dans ces yeux fiers cette lueur de tendresse qui l’avait affolé.
– Monseigneur, dit-elle, respectée, je crois l’être : puissante, je ne le désire pas ; heureuse, je ne crois pas que j’y sois destinée. Quant à l’intérêt que vous daignez me porter, oui, je vous crois…
– C’est tout, fit Jean sans Peur d’une voix fébrile. Si vous croyez à cela, vous m’écouterez. Un danger vous menace ; madame, il faut quitter l’Hôtel Saint-Pol et me suivre. À l’hôtel de Bourgogne, vous serez en sûreté. Nul n’osera ni ne pourra vous y atteindre. Ce n’est pas demain, ni ce soir qu’il faut fuir ce palais maudit ; c’est tout de suite. Me croyez-vous ? Oh ! dites que vous me croyez.
Odette, lentement et doucement, hocha la tête :
– Je sais que je suis menacée, je vous crois donc. Mais il y a dans ce palais un être qui est plus menacé encore que moi, qui a eu confiance en moi. Faible, triste abandonné, en butte aux ambitieux qui rôdent autour de lui attendant le moment de le dévorer. Il en appelle à ma faiblesse pour le protéger. Si je m’en vais, que lui restera-t-il ?
– Le roi ! gronda sourdement Jean sans Peur.
– Le roi, oui, monseigneur. Le roi qui n’a autour de lui que ces deux ou trois hommes qui le font parfois sourire, étranges ermites que j’ai cessé de soupçonner parce que je sais qui les envoie…
– Vous savez ! balbutia Jean sans Peur. – Elle sait que Bruscaille a été envoyé par moi, et pour cela, elle a confiance en eux ! songea-t-il, éperdu.
– Ce roi, donc, qui n’a près de lui que ces amuseurs, et son peintre de cartes, et moi qui réussis quelquefois à apaiser ses alarmes, je l’aime, monseigneur. Son cœur est bon. Et sa folie, ajouta-t-elle d’un accent de rêve, sa folie me paraît moins dangereuse que les hautes raisons d’État qui l’enveloppent. Non, monseigneur, je ne partirai pas.
– Vous ne me suivrez pas ! cria le duc avec une violence contenue.
Et la passion se déchaîna en lui. Mais, résolu cette fois à triompher, il garda l’attitude respectueuse qu’il avait prise dès son entrée.
– Sorcier ! gronda-t-il en lui-même, c’est maintenant que je vais voir la puissance des paroles que tu m’as enseignées.
– Madame, dit-il d’une voix ferme, puisque votre danger vous touche si peu, je vais vous dire, moi, qu’il me touche jusqu’au cœur…
– Jusqu’au cœur ? balbutia Odette en joignant les mains.
– Vous me suivrez. J’ai le droit de vous le commander. Car, écoutez : je sais qui vous êtes !…
L’effet produit par ces paroles stupéfia et bouleversa Jean sans Peur. Odette jeta un cri, pâlit, recula, revint sur le duc, et bégaya :
– Vous savez ce que je suis… pour vous ?… Vous le savez ?…
– Je le sais ! dit Jean sans Peur avec une sourde terreur.
– Il sait que je suis sa fille ! cria Odette au fond d’elle-même.
Et elle éclata en sanglots. Immobile de stupeur, Jean sans Peur assistait à cette étrange transformation de la jeune fille. Parfois, elle levait sur lui un regard craintif. Par instant, on eût dit qu’elle voulait se jeter dans ses bras et qu’elle n’osait pas. Dans l’âme de Jean de Bourgogne, l’amour grondait :
– Elle m’aime !… Elle est à moi !…
Par degrés, Odette de Champdivers se calma. Elle se rapprocha encore de son père, et, la tête basse, gardant ses mains jointes dans cette attitude qui lui était si naturelle, doucement elle parla :
– Puisque vous savez cela, je dois donc maintenant vous obéir. Tout me l’ordonne. C’est mon devoir et ma joie. Souvent, monseigneur, bien longtemps avant que je vous connusse, j’ai ardemment désiré de vous voir. Je vous attendais. Je savais qu’un jour ou l’autre vous m’apparaîtriez pour protéger ma vie et prendre sur moi les droits qui vous appartiennent… Oh ! je vous ai redouté, d’abord, et combien je m’en repens !… Moi, vous redouter ! Ah ! c’est que je ne savais pas alors… pardonnez-moi, voyez ma joie, voyez mon bonheur…
– Que dit-elle ? murmurait Jean sans Peur. Est-ce que je deviens insensé moi-même ? Ainsi, reprit-il avec une sorte de timidité qui charma Odette, vous consentez maintenant à me suivre ?
– Il le faut bien, dit-elle avec un sourire, puisque vous savez maintenant que vous avez le droit de me donner des ordres, et que j’ai le devoir de vous obéir !
– Par le Dieu vivant, songea le duc, c’est bien là un prodige de sorcellerie ! Mais dussé-je encourir le risque de me trouver face à face avec Satan, il ne sera pas dit que j’aurai reculé.
– Je vous suivrai parce que c’est mon devoir, continuait Odette. Je vous suivrai si vous m’en donnez l’ordre. Mais le roi, monseigneur… le roi…
– Le roi ! gronda Jean sans Peur, ce n’est pas au roi qu’il faut penser, c’est à vous… et à moi, mon enfant !
« Mon enfant ! » Le mot parut si juste, si vrai, il répondit si bien aux aspirations d’Odette que la jeune fille eut « vers le père » un mouvement non moins juste, non moins vrai…
Et l’effroyable malentendu poursuivit son développement normal et tragique.
À ce mouvement de pure affection, Jean sans Peur sentit sa tête s’égarer, sa pensée affolée se mit à évoluer parmi des tourbillons de passion.
– Le roi ! murmura-t-il d’une voix ardente et bégayante, il sera sauf, si tu veux. C’est toi désormais qui donnes des ordres. Si tu veux que le roi soit respecté, je courberai toutes les têtes devant lui. Je lui rendrai sa puissance. Je… mais non ! non ! C’est de nous qu’il s’agit… C’est de toi !…
Odette, d’abord, ne comprit pas ce bouleversement d’esprit. Étonnée plutôt qu’effrayée, elle écoutait, elle entendait, et ne saisissait pas le sens de ces paroles brûlantes. Mais Jean sans Peur, maintenant, se livrait tout entier, sans résistance, à la fièvre d’amour. Il saisit les mains de la jeune fille. Il râla :
– Cette reine qui veut te tuer, je la tuerai, moi ! Ce roi, ce pauvre fou, puisque tu daignes le sauver, nous le ferons vivre en quelque monastère où il sera certes plus heureux qu’en ce palais. Il y aura un roi, et ce sera moi ! Il y aura une reine, et ce sera toi !
L’épouvante, soudain, entra dans l’esprit d’Odette. Elle eut un faible cri :
– Reine ! Moi !…
– Toi ! rugit Jean sans Peur. Et qui donc tenterait de s’y opposer si je le veux ainsi ! Je suis maître de Paris. Dans une heure, si je veux, je serai maître de l’Hôtel Saint-Pol… Et toi la maîtresse !
– Seigneur ! cria Odette dans son cœur, mon père est frappé de la même démence que le roi ! Monseigneur, que dites-vous ! Revenez à vous !… Si on vous entendait…
– Oui, oui ! dit Jean sans Peur, enivré, tu crains pour moi. Eh bien, je t’obéis, je ne parle plus de ces choses. Je suis à toi, à toi seule. Et si tu veux, je renonce à mon ambition même. Nous quitterons Paris, nous irons habiter mon palais de Dijon. Et là, simple duc de Bourgogne, j’oublierai en te regardant que j’ai pu prétendre à dominer le monde. Viens, partons, le bonheur s’ouvre à nous, puisque je t’aime et que tu m’aimes !
D’une frénétique secousse, Odette s’arracha à l’étreinte qui peu à peu l’avait enlacée. D’un bond, elle se mit hors d’atteinte. Et frissonnante, frappée d’horreur, elle considéra le duc avec une si poignante douleur que l’homme, stupéfait, recula à son tour en murmurant :
– Ne craignez rien. Je vous ai fait peur ? C’est malgré moi.
– Qu’avez-vous dit ! murmura Odette d’une voix de terreur. Que vous m’aimez ! Vous ! Oh ! je devine quelque chose d’horrible ! Dites, parlez vite ! Quel sens donnez-vous à ce mot ?…
– Enfer ! rugit Jean sans Peur. Et quel sens veux-tu que je lui donne ! Je t’aime comme j’ai cru aimer la reine ! Comme, jadis, j’ai cru aimer Laurence d’Ambrun et d’autres ! Je t’aime ! Ce mot dit tout. Tu es présente dans mon cœur ; je pleure, moi ! Jean sans Peur, la nuit, quand il t’appelle en vain, pleure de savoir que tu n’es pas à lui ! Mais ces mauvais rêves sont finis, puisque tu m’aimes…
Odette, d’un mouvement d’inexprimable pudeur, couvrit son visage de ses deux mains, et murmura :
– Allez, monseigneur. Retirez-vous. Je vous le demande en grâce. Faites que je ne vous voie plus… je mourrais de honte et de désespoir.
– Quoi ? bégaya le duc. Que dites-vous ? Que se passe-t-il en vous ?…
Le visage toujours couvert de ses mains, toute droite, pareille à une apparition de rêve, elle reprit :
– Je supplierai le Dieu puissant de me laisser oublier les choses atroces que je viens d’entendre. Ah ! retirez-vous, monseigneur !
Jean sans Peur fit un pas et gronda :
– Damnation ! Je crois que cette petite fille se moque de moi !…
Elle recula avec un cri, mais sans découvrir ses yeux. Et c’était épouvantable, cette volonté formelle de ne plus « voir » l’homme qui avait prononcé les « choses atroces ». Elle cria :
– Retirez-vous ! ou je jure sur ce Dieu qui nous juge, je jure que j’appelle ! Et à tous, gentilshommes, gens d’armes, valets, je dis l’affreuse ignominie ! Je dis au risque de notre mort à tous deux, je dis qui vous êtes, qui je suis, et les hontes de vos paroles ! Allez ! Allez donc !…
D’un bond, Jean sans Peur fut sur la jeune fille, qui poussa un grand cri et s’abattit sur les genoux. Il se pencha, et la voix rude, les yeux sanglants, gronda :
– Tu me chasses après m’avoir affolé de ton faux amour d’enfer… C’est bien. Je m’en vais. Mais sache-le : tu seras à moi ! À mon tour de jurer ; eh bien, avant peu, tu connaîtras ma force et que nul ne résiste à Jean sans Peur ! Adieu : mais, sous peu, tu me reverras, et, quoi que tu fasses, tu seras à moi !
Il s’en alla à grands pas, ivre d’amour et de fureur. Elle roula sur le tapis, évanouie…
XVIII – ISABEAU
Lorsque le duc de Bourgogne fut parti, une tenture qui cachait l’entrée d’une petite salle voisine se leva, une femme entra, jeta un regard de banale pitié sur Odette, puis, s’assurant que Jean sans Peur était déjà loin et ne revenait pas, alla ouvrir les portes.
C’était l’une des suivantes d’Odette de Champdivers, jeune et belle fille qui était tenue en particulière affection par la maîtresse de céans. Elle appela. Les femmes entrèrent et s’empressèrent autour d’Odette. Quant à la suivante, elle sortit, gagna le palais de la reine, et, sur un mot de passe qu’elle prononça, fut aussitôt introduite auprès d’Isabeau. Une demi-heure plus tard, elle se retirait, et Odette, revenue à la vie, la voyait parmi les plus empressées à la servir.
Isabeau passa la journée seule dans le fond de son appartement.
Toutes ses pensées, tous ses frissons de rage, toutes ses attitudes de fureur, tous ses abattements succédant aux crises, tout en elle aboutissait à la même volonté :
– Il faut que je tue cette fille !
Sur le soir, Isabeau avait reconquis son calme habituel. Comme d’habitude, elle tint sa cour, et parut plus charmante avec ses yeux fiévreux, sa parole volubile, ses gestes las. Vers dix heures, elle se trouva seule, et bientôt tout parut dormir dans le palais.
C’est à ce moment qu’Isabeau, s’étant enveloppée d’un grand manteau, descendit le grand escalier, franchit les cours et les jardins déserts de l’Hôtel Saint-Pol, et arriva à la tour Huidelonne. Elle appela le geôlier, et, étant entrée, commença à descendre l’escalier des souterrains.
Le geôlier l’escortait, portant une torche. Sur l’ordre de la reine, il s’était muni des clefs des cachots.
– Où est-ce ? demanda Isabeau quand ils furent au premier étage.
– Plus bas, Majesté, répondit le geôlier.
Elle n’avait nullement dit ce qu’elle venait faire, ni qui elle voulait voir. Mais le geôlier ne s’y trompait pas. La reine, pour un motif qui lui échappait, voulait entrer dans le cachot de l’un des cinq ou six prisonniers d’État qui étaient enfermés là. Au moment de s’engager dans la nouvelle descente, Isabeau recula et frissonna.
– Comment peut-on vivre là ? murmura-t-elle.
– On n’y vit pas, Majesté, on y meurt. Ce n’est qu’une question de jours. Tenez, reine, voici un cachot où je n’ai vu personne rester plus de quatre mois.
– Qui est enfermé dans cette tombe ?
– Le sire de Passavant, répondit le geôlier d’une voix calme. Ce cachot a été spécialement choisi par messires de Scas et d’Ocquetonville. Mais je doute que le pauvre diable y demeure quatre mois…
Le geôlier avait prononcé ces mots d’une voix si bizarre que la reine tressaillit.
– Et pourquoi ? dit-elle d’un accent qu’elle fit indifférent. Serait-il moins capable qu’un autre de supporter la prison ?
– Je ne veux pas dire cela, Majesté. Seulement, il paraît que le prisonnier sera jugé et sans doute livré à l’exécuteur avant huit jours, ce qui abrégera son agonie. Ma foi, j’en suis content pour lui…
– Ouvre cette porte ! dit la reine d’une voix sèche.
Le geôlier s’inclina profondément.
– Majesté, dit-il avec humilité, la reine n’ignore pas sans doute que, sans un ordre signé du roi lui-même…
– Voici l’ordre !…
– La reine me pardonnera… C’est que je ne tiens pas à être pendu, moi !…
Et il introduisit la clef dans l’énorme serrure. À ce moment, la reine le toucha au bras, et d’un ton étrange :
– Tu ne tiens pas à être pendu ?
– Si peu que soit ma vie, j’y tiens, Majesté.
– Qu’as-tu fait du corps de Bois-Redon ?
Le geôlier se redressa d’un, sursaut. Mais reprenant aussitôt son sang-froid :
– J’avais la faiblesse d’aimer ce malheureux capitaine… La reine me pardonnera ?…
– Oui, parle sans crainte.
– Eh bien, j’ai voulu éviter au sire de Bois-Redon le désagrément réservé aux pendus…
– Le désagrément ?…
– Les corbeaux, dit le geôlier.
– Ah ! fit la reine en frissonnant. Et alors ?
– Alors, je l’ai décroché, j’ai creusé un trou au pied de la Huidelonne, et l’y ai enterré. Ensuite de quoi, à défaut d’un plus saint ou plus savant que moi, je lui ai octroyé une bonne prière.
La reine demeura quelques minutes pensive. Puis enfin, avec un étrange sourire :
– L’histoire que tu me racontes ne ressemble pas à celle que m’a dite Saïtano. Sais-tu bien, mon brave, que tu as mérité la corde ? Allons, c’est bien, ne tremble pas, je te pardonne, et d’avoir essayé de me tromper, et d’avoir livré au sorcier le corps de mon capitaine. Seulement, je compte sur ta reconnaissance. Allons, ouvre.
Le geôlier se hâta d’obéir, et à la lueur de la torche, la reine vit Passavant debout, accoté fort paisiblement à un angle de son cachot. Le chevalier, de son côté, reconnut Isabeau. Il s’avança vivement, saisit la torche des mains du geôlier, et la levant comme pour faire honneur à sa visiteuse :
– Merci, madame, dit-il, merci de la faveur grande que je reçois en ce moment.
Puis il planta la torche sur un support de fer fixé au mur et destiné à cet usage, et il s’inclina gracieusement devant la reine. D’un signe, Isabeau ordonna au geôlier de se retirer. L’homme obéit, et se tint derrière la porte, prêt en apparence à intervenir si besoin était. La reine considérait le prisonnier avec étonnement. Passavant supportait cet examen avec une placidité remarquable.
– J’admire votre courage, dit-elle enfin avec amertume. Où je comptais trouver un prisonnier abattu, prêt à tout accepter pour reconquérir la vie et la liberté, je vois un homme qui me brave… Ne protestez pas : vous me bravez de toute votre attitude tranquille, vous m’insultez de votre sourire, c’est de l’impudence.
– Non, madame, dit le chevalier. Le premier mot employé par vous était plus exact, c’est simplement le courage. Quant à braver la reine, peut-être cela même serait-il permis à un homme qui va mourir sans doute et qui par conséquent n’a plus rien à redouter des grands de ce monde, mais telle n’est pas ma pensée. J’attends avec respect les offres que la reine est venue me faire dans mon cachot.
– Et qui vous dit que j’ai des offres à vous faire ? gronda Isabeau.
– Ah ! pardon… En ce cas, la reine de France est descendue dans les souterrains de la Huidelonne uniquement pour se donner le plaisir de voir la figure d’un homme accusé, convaincu d’un presque régicide, et condamné d’avance au supplice… Eh bien, ceci n’est pas généreux, madame. Je savais bien que vous chercheriez à vous venger de l’insolence que j’ai eue de refuser la fortune offerte par vous, mais je vous croyais de taille à choisir une vengeance plus rude ou plus noble. Je m’étais trompé. Pardon, madame.
La reine se redressa, et d’un accent de suprême dédain, laissa tomber ces mots :
– Vous avez raison, je suis venue vous offrir la vie sauve, mais vous ne me paraissez pas vous faire une idée bien nette de votre position et de la grâce que je vous apportais.
Le chevalier se croisa les bras. La colère commençait à l’échauffer. Son attitude fut aussi dédaigneuse que celle de la reine, mais plus simple et à la fois plus narquoise. Et reprenant presque les termes mêmes dont s’était servie Isabeau :
– Et qui vous dit que je veuille de votre grâce ?
– Prenez garde ! dit-elle. Il est encore temps. Savez-vous…
– Je sais ! interrompit Passavant d’un accent de sombre résolution. Tenez, madame, vous me faites pitié. Vous êtes reine… Vous êtes la toute-puissance. Et, pour réduire un ennemi aussi infime que moi, vous êtes forcée d’avoir recours au mensonge. Vous pouviez, vous deviez m’écraser d’un geste. Et, pour m’anéantir, vous vous faites calomniatrice, vous me laissez accuser d’un meurtre qui a été commis par votre allié le duc de Bourgogne. Allons donc ! On m’avait tracé d’Isabeau un portrait tel que j’avais fini par la redouter…
– Tandis que maintenant ?… bégaya la reine livide de rage.
– Je la plains, dit Passavant. Je la juge un pauvre être qui ne sait ni ce qu’il veut, ni où il va, et que les passions poussent de leur souffle capricieux. Je vais peut-être mourir, madame, bien que ce ne soit pas bien sûr, mais une chose dont je suis certain, c’est que, dans mon supplice ordonné, préparé par vous, je souffrirai moins que vous au sein de vos fêtes. Que voulez-vous de moi ? reprit-il avec plus de force. Je vais vous le dire, moi, puisque vous n’osez pas, vous !
Isabeau était atterrée. Jamais on ne lui avait parlé avec un aussi complet oubli, non seulement de sa souveraineté, mais aussi de la puissance de sa beauté. Ce vague espoir qui l’avait soutenue dans sa lutte morale contre Jean sans Peur se brisait. L’impression qu’elle éprouva fut plus violente, plus funèbre que le jour où le roi lui avait dit : « Je veux que vous assistiez au supplice de votre amant ! » Tout s’effondrait donc ; par son espionne, elle savait que Jean sans Peur tentait de la trahir au moment même où il venait de lui jurer alliance et amour ; elle était prisonnière du roi. Et Passavant la bafouait.
– Voyons, dit-elle d’une voix de mortelle amertume, voyons jusqu’où ira votre insolence.
– Soyez tranquille, dit le chevalier tout hérissé, mon insolence ne dépassera pas les bornes que vous lui avez vous-même assignées.
– Eh bien, soit ! Dites-moi donc ce que je voulais de vous, puisque vous le savez !
– Je le sais parce que vous me l’avez dit. Vous êtes venue, madame, me proposer d’assassiner Odette de Champdivers parce que vous n’osez pas la tuer vous-même. Contre le meurtre de celle à qui j’ai donné mon cœur, à qui je rêve de donner mon sang, vous m’eussiez promis de m’associer à votre gloire, et vous m’eussiez ébloui de votre amour. Regardez-moi, madame. Je ne suis qu’un pauvre hère, comparé à vous. Je n’ai rien au monde, pas même ma maison. Je suis prisonnier dans ce cachot d’où je ne sortirai que pour m’entendre condamner au supplice des régicides. Eh bien, voici ma réponse : j’aime mieux mourir que de vous suivre. Si une pensée mauvaise s’élevait dans mon cœur contre celle que vous haïssez, vous, et que j’aime, moi, je m’arracherais le cœur. J’aime mieux l’étreinte du bourreau que la vôtre. Êtes-vous contente ? Si non, parlez, et j’ai d’autres réponses à vous fournir. Si oui, allez-vous-en et laissez-moi mourir en paix !
Sur ces mots, le chevalier de Passavant se tourna et alla s’accoter dans son angle obscur.
Hagarde, ivre de rage et peut-être d’amour, Isabeau marcha sur lui et, doucement, lui mit sa main sur l’épaule. Il tressaillit et, sans se retourner, gronda :
– Que voulez-vous encore ?
– Vous dire adieu, dit la reine. Vous ne savez peut-être pas ce qu’il y a dans cet adieu. Vous le saurez avant peu… avant trois jours. L’exécuteur des hautes œuvres vous le dira !
Il fit un bref signe de tête et s’immobilisa.
Elle recula lentement. Au milieu du cachot, elle comprit qu’elle allait éclater en sanglots, et que ce serait là la fin de tout ce qu’il y avait d’orgueil en elle. Un instant, elle eut un mouvement comme pour revenir sur Passavant, puis, d’un pas rapide, elle s’éloigna.
Le geôlier, devant elle, ferma la porte, et il l’escorta jusqu’au haut de l’escalier. Au grand air, la reine se calma. Pendant quelques minutes, elle demeura immobile au pied de la tour, noyée dans l’ombre, songeant à des choses qu’elle-même ne pouvait éclaircir. Enfin, elle redressa la tête :
– Toutes précautions sont-elles prises ? demanda-t-elle froidement.
– Quelles précautions ? demanda le geôlier étonné.
– Le prisonnier peut-il s’évader ?…
– S’évader ?… Non, madame. Il faudrait pour cela que la vieille tour fût renversée par quelque tempête, et encore le prisonnier serait-il enseveli sous ses décombres. Ou bien, il faudrait encore que moi-même lui ouvrant la porte, je le prenne par la main, et lui dise : Allez, vos malheurs sont finis ! Mais ceci est impossible, madame.
– Oui, dit Isabeau, c’est impossible. Quoi qu’il en soit, songe que si cet homme parvient à sortir de son cachot…
– Je serai pendu, je le sais !
– Non pas ! dit la reine. Tu subirais le supplice qui lui était réservé : celui des régicides.
Le geôlier pâlit. Déjà Isabeau s’en allait. Lentement, au fond des jardins pleins de neige, sa silhouette se fondit et finit par s’effacer.
– Le supplice des régicides ! gronda le geôlier. Diable ! La langue arrachée, le poignet droit coupé, la mort à petit feu sur un brasier… Diable !… Qui donc oserait affronter une telle mort ?
Isabeau regagna son palais, et rentra par une petite porte secrète devant laquelle il n’y avait pas de gardes. Sa colère était tombée. Elle se sentait seulement une grande lassitude. Elle fit appeler ses demoiselles d’honneur et s’entretint avec elles une partie de la nuit sans qu’à aucun moment, on pût la voir troublée.
En réalité, elle avait peur de se retrouver seule…
Le moment arriva pourtant où il lui fallut affronter la solitude, et alors, elle subit la crise contre laquelle depuis sa sortie de la Huidelonne, elle se débattait. Ce fut terrible. L’aube d’hiver la surprit frissonnante, abattue, prostrée sur ses coussins.
Toute cette journée, toute la nuit qui suivit, elle les passa encore seule, tantôt furieuse, tantôt sanglotante, quelquefois en proie à de sinistres accalmies et à d’autres moments déchaînée en des accès de délire.
Enfin, au bout de deux jours seulement, Isabeau se retrouva forte, impitoyable, prête à l’acte.
Elle se disait : Si Jean sans Peur est là et qu’il la veuille défendre, il y aura deux cadavres au lieu d’un… En ce troisième jour, c’était là sa seule pensée. Le chevalier de Passavant avait disparu de sa préoccupation.
Ce matin-là, elle fit venir les deux ou trois espionnes qu’elle entretenait auprès d’Odette, et leur donna ses instructions qui furent très simples : s’arranger pour qu’à midi la demoiselle de Champdivers se trouvât seule. Ensuite la reine se fit habiller. Il était neuf heures lorsqu’elle se trouva prête.
À ce moment, des cloches lointaines se mirent à sonner, auxquelles bientôt répondirent d’autres cloches. Des rumeurs s’élevèrent, puis s’affaissèrent, puis éclatèrent en tumultes pareils à des rafales de bruits indistincts. Dans l’Hôtel Saint-Pol, d’abord, ce fut un lourd silence. Mais brusquement il y eut de rapides allées et venues ; des cris d’appel fusèrent dans la rumeur éparse.
– Que se passe-t-il ? murmurait Isabeau, palpitante.
Elle écoutait sans comprendre. Elle appela le capitaine d’armes qui remplaçait Bois-Redon, et cet homme ne put lui fournir aucune explication. Deux heures s’écoulèrent. Isabeau allait d’une fenêtre à l’autre, essayant de voir et d’entendre ; mais elle ne voyait que les archers de l’Hôtel qui se massaient comme pour un combat ; elle n’entendait que ces vagues tumultes lointains que couvrait la voix des cloches.
Et toutes ces impressions glissaient sur elle.
Elle s’efforçait de s’intéresser à ce grand drame qu’elle devinait sans le comprendre, mais elle n’avait qu’une pensée très nette : Odette de Champdivers. L’heure d’agir était venue.
Isabeau assura à sa ceinture la courte dague que, comme beaucoup de dames, elle portait souvent. C’était une lame solide et aiguë, emmanchée d’or, dans un fourreau de velours parsemé de pierreries.
Elle se dirigea vers la porte.
Elle était pâle, mais jamais elle n’avait paru plus calme. Simplement, elle dit à ses demoiselles :
– Ces bruits m’inquiètent. Je vais moi-même chez le roi m’assurer que…
Elle n’acheva pas. Les demoiselles d’honneur se mirent en marche pour l’escorter.
– Restez, dit-elle. J’irai seule.
Elles se regardèrent, étonnées, mais obéirent. La reine sortit et gagna la grande galerie. À ce moment même, Jean sans Peur apparut au haut du grand escalier. Il était livide, convulsé. Un coup d’œil jeté sur la reine lui apprit ce qu’elle allait faire. Il alla à elle. Et tous deux comprirent qu’en cet instant, ils n’avaient guère le temps de ruser.
– Renvoyez tout ce monde ! dit le duc d’une voix rauque.
La reine se tourna vers son capitaine et lui jeta un ordre bref : en une minute, la grande galerie fut vide. Et alors, Jean sans Peur :
– Vous allez chez Odette ?…
– Oui, répondit Isabeau, les dents serrées.
Et sa main se crispa sur le manche de sa dague. Le duc de Bourgogne vacillait. Il pouvait se faire en ce moment que l’idée lui vint d’étrangler la reine. Mais sans doute lui aussi avait pris ses résolutions. Il posa sa main sur le bras d’Isabeau, et, tout grelottant, il dit :
– Je vous la livre…
Isabeau fut secouée d’un frénétique tressaillement. L’espoir envahit son cœur. Elle eut la sensation qu’elle pouvait encore se raccrocher à la vie, arriver peut-être à aimer Jean sans Peur comme elle l’aimait jadis…
– Prenez garde ! dit-elle d’une voix si farouche que le duc sentit en cette seconde que l’esprit d’Isabeau était arrivé au paroxysme de la haine.
– Je sais ! gronda-t-il. Vous pouvez vous défier de moi. J’ai tenté de vous trahir. J’ai essayé de convaincre cette fille et de l’emmener le jour même où je vous ai juré à vous que je vous appartenais. C’est fini. Et je vous répète : je vous la livre, tuez-la, ôtez-la de ma vie.
Il se tut un moment. Il claquait des dents. L’effort qu’il faisait pour prononcer l’irrémédiable condamnation d’Odette pouvait le tuer. D’un geste furieux, il chassa toute pitié. Il se gronda :
– M’arracher le cœur, s’il le faut, mais être le roi, le maître ! – À votre tour, continua-t-il. Vous avez essayé de me trahir le jour même où vous avez juré que vous étiez à moi. Vous êtes descendue dans les cachots de la Huidelonne. À votre tour, dis-je. Me livrez-vous Passavant ?
Elle sourit. Sur ce point du moins, elle était encore supérieure à Jean sans Peur. Il tremblait, lui, il défaillait à la pensée qu’Odette allait mourir. Mais elle, déjà, avait condamné Passavant.
– Qu’il meure, dit-elle froidement. Que m’importe, à moi ? Si jamais j’ai eu quelque pitié pour ce malheureux qui, après tout, me sauva la vie, cette pitié est morte. Ne doit-on pas lui faire son procès ?
Jean sans Peur entrouvrit lentement son manteau et de son vêtement fait d’une peau de bœuf non tannée qui lui servait de cuirasse, il tira un parchemin qu’il tendit à Isabeau. Il la considéra avidement tandis qu’elle lisait. Mais ce fut sans émotion qu’elle le parcourut. Elle le rendit ensuite au duc en disant :
– Tout est bien. Il n’y a plus rien de vivant entre vous et moi…
Le parchemin, c’était l’ordre d’exécuter ce même jour, à midi, en place de Grève, le chevalier de Passavant convaincu d’avoir assassiné le duc d’Orléans, frère du roi.
– Le procès est terminé, expliqua Jean sans Peur d’un accent de rage concentrée. Tout est terminé. Deux séances ont suffi pour convaincre cet homme, car les témoins abondaient. Dans une heure, il sera conduit sur la Grève. Et vous… oui, vous avez raison : il n’y a plus rien de vivant entre nous…
– Rien que le roi et Marguerite de Hainaut, dit froidement la reine.
– Au coup de midi, Bruscaille fera sur le roi le suprême geste d’exorcisme, et quant à Madame Marguerite…
Jean sans Peur acheva par un geste de dédain féroce.
– Le jour est venu, continua-t-il. J’ai donné le signal. Le peuple de Paris est tout entier dans les rues, et les gens de Caboche se font la main sur quelques officiers de gabelle et commis d’impôts. Tout à l’heure, au coup de midi, en même temps que la hache du bourreau abattra le poignet de Passavant, la vraie bataille commencera. Aujourd’hui, c’est l’extermination des Armagnacs, c’est la mort de tout ce que je hais : aujourd’hui Paris sera rouge de sang, et cela commencera par la mort de ce misérable Passavant…
En lui-même il ajouta : « l’homme que tu aimais ! pour qui tu voulais me trahir et me tuer ! »
Il s’exaltait. Ses yeux sanglants semblaient s’emplir de visions rouges. Le grand massacre, les flots de sang dans les rues de Paris, la mort de Passavant, le meurtre d’Odette, toutes les images funèbres couraient sur l’écran de son imagination affolée. Il était livide, convulsé, terrible… Isabeau l’admirait.
– Allez donc, dit-elle toute haletante au souffle ardent de la voix de Jean sans Peur, allez faire votre besogne. Moi je ferai la mienne ! Conduisez Passavant à l’échafaud. Moi je vais ôter Odette de Champdivers de votre vie et de la mienne, et notre route une fois déblayée, donnons-nous la main pour marcher à la conquête du monde…
Elle se détourna brusquement.
Elle commença à descendre le petit escalier qui aboutissait à la porte secrète, car les autres portes du palais étaient gardées par les gens du roi. Jean sans Peur se prit la tête à deux mains.
– Où va-t-elle ? râla-t-il. Est-ce vrai ? Odette va-t-elle mourir ?
Il se mit en marche, lui aussi, l’esprit bouleversé, l’âme pleine d’horreur, ballotté par des volontés contraires, et il suivit le même chemin que la reine. En franchissant la petite porte, il la vit qui marchait vers le palais du roi.
Jean sans Peur s’était arrêté. Il était hagard. Il était comme pétrifié. Un officier s’approcha de lui en courant et lui dit :
– Monseigneur, le prisonnier… le sire de Passavant…
– Eh bien ! hurla Jean sans Peur, qu’on le prenne et qu’on le conduise à la Grève !…
Il écarta violemment l’officier et se mit en route vers le palais du roi, où Isabeau venait d’entrer. Quelques pas plus loin, il se mit à courir. Sa poitrine était pleine de rugissements. Il lui semblait que jamais il n’atteindrait cette grand-porte qu’il voyait devant lui. Il écumait.
Il entra en tempête et se rua vers les appartements d’Odette.
La reine était entrée, elle, plus froidement. Elle rendait au passage les saluts aux saluts. Elle souriait aux gardes qui renversaient leurs piques pour lui faire honneur. Il y avait une stupeur à voir la reine venir seule dans le palais du roi. Mais elle ne voyait pas ces airs d’étonnement. Elle s’avançait d’un pas égal, et enfin elle parvint devant la porte de l’appartement d’Odette.
Aussitôt, sans hésiter, elle entra…
XIX – LE GEÔLIER
Le chevalier de Passavant, donc, avait été enfermé dans un cachot du deuxième sous-sol de la tour Huidelonne.
Le jour même, le prisonnier reçut deux visites (nous ne parlons pas de celle d’Isabeau qui eut lieu le soir très tard).
La première, toute naturelle et attendue par lui, ce fut celle de son geôlier qui lui apporta des vivres tels qu’ils pouvaient convenir à un dangereux prisonnier d’État.
– Vous voici donc revenu ? demanda cet homme, de sa voix indifférente.
– Est-ce que cela vous fâche ? dit Passavant. Ne suis-je pas un bon prisonnier, très doux, incapable d’une tentative d’évasion ?
– Hum ! fit le geôlier. Vous pourriez tenter de vous évader que cela ne vous servirait de rien. Je vous l’ai dit jadis : on ne sort de la Huidelonne que les pieds devants. Et puis, vous n’auriez pas le temps, croyez-moi. En écoutant de-ci de-là ce qu’on disait de vous, j’ai entendu qu’on va vous juger pour je ne sais quel crime, et que sous trois ou quatre jours vous serez livré à l’exécuteur.
– Ah !… c’est une consolation.
– Oui, mieux vaut le bourreau. Au moins c’est fait en peu de temps. L’agonie qui vous attendrait ici serait terrible, et elle durerait bien quelques mois.
Passavant se mit à rire.
– Bon, dit-il, si vite qu’on me livre à maître Capeluche, nous aurons bien le temps…
– Le temps de quoi ? fit le geôlier.
– Rien ! dit Passavant d’une voix sombre. Dites-moi, lorsque vous m’avez aidé à grimper à la fenêtre de la demoiselle de Champdivers… vous rappelez-vous ?
– Oui. S’il fallait vous aider encore, je recommencerais…
Passavant eut une sorte de grognement. Il reprit :
– Écoutez, il m’a semblé que vous aviez pour moi je ne sais quelle affection… est-ce vrai ?
– C’est vrai, dit le geôlier… plus que vous ne croyez. Pour vous, j’ai risqué la mort.
– Écoutez… Puisque vous avez risqué la mort pour moi, puisque vous prétendez que je vous ai inspiré un peu d’amitié, puisque vous m’avez dit votre vénération pour la demoiselle de Champdivers… c’est d’elle qu’il s’agit.
– Que voulez-vous ? dit le geôlier d’une voix sourde.
– Aidez-moi à fuir !
Le geôlier secoua la tête.
– Vous ne voulez pas ? dit Passavant.
– C’est impossible.
Ces deux hommes se regardèrent. Et tous deux avaient sans doute une arrière-pensée, car leurs regards étaient troubles. Le geôlier reprit :
– Impossible… à cause de la surveillance… et puis, tenez, je vais vous dire. J’ai prêté serment. Vous ne savez pas cela ? Eh bien, un geôlier, cela prête serment de ne pas favoriser l’évasion des prisonniers. Un serment… hum ! Croyez-vous à la damnation éternelle ?
– J’y crois, dit gravement le chevalier.
– Vous voyez bien !
– Qu’est-ce que je vois ?
– Que je ne peux pas vous faire fuir, puisque j’ai prêté serment dans la chapelle en présence d’un prêtre.
Quelques minutes, le chevalier demeura pensif. Puis, en lui-même, il murmura :
– Pauvre diable !… J’eusse pourtant bien voulu éviter mais puisqu’il n’y a pas moyen… Je vous disais donc, reprit-il, que nous aurions tout de même le temps…
– Oui, fit le geôlier d’un air étrange. Vous me disiez cela tout à l’heure. Et tout à l’heure comme maintenant, vous n’avez pas achevé de me dire de quoi nous aurions le temps…
Tout d’une voix, haletant, un faux rire aux lèvres, l’esprit bouleversé d’angoisse, Passavant prononça :
– Eh ! le temps de ferrailler un peu ensemble !
– Ah ! Ah ! C’est cela ?… Eh bien, vous me faites plaisir, mon gentilhomme !
– Pauvre diable ! murmura Passavant.
Et il essuya d’un revers de main un peu de sueur froide qui pointait à son front. Il considéra un instant la rude figure du geôlier, noyée d’ombre d’un côté, et il lui sembla voir sur ce visage une singulière expression de pitié, de sacrifice peut-être.
– Il le faut ! gronda-t-il. Ainsi, vous dites que cela vous ferait plaisir ?
– Sans doute, dit le geôlier avec une étrange bonhomie, sans doute. Je ne suis pas fâché de voir les progrès que vous avez pu faire. Ah ! ah ! mon chevalier, je suis votre maître ! C’est moi qui vous ai appris à tuer proprement un homme – d’un seul coup – droit au cœur !
Le chevalier tressaillit violemment.
– J’ai appris, continua le geôlier, que le coup vous a déjà servi et que les sires de Guines et de Courteheuse en ont su quelque chose. Que Dieu ait pitié de leurs âmes ! J’ai appris cela en écoutant le sire d’Ocquetonville. Est-ce vrai, mon gentilhomme ?
– C’est vrai ! dit sourdement le chevalier. C’est vous qui m’avez appris le coup.
– Il vous a servi, dit le geôlier d’un ton d’indifférence. Il pourra vous servir encore. Est-ce qu’on sait ?
De nouveau, un profond tressaillement agita le chevalier.
– Donc, poursuivit le geôlier, non seulement cela me fera plaisir de tâter encore votre fer, mais encore je m’en trouverai honoré. Tant que vous n’étiez que mon prisonnier, vous comprenez, vous n’aviez pas encore porté l’épée. Vous ne vous étiez pas mesuré avec des gentilshommes, des gens si au-dessus du pauvre hère que je suis. Mais maintenant, diable… vous allez m’anoblir !
Cette fois, ce fut une sorte d’ironie terrible que le chevalier crut distinguer dans la voix du geôlier.
– Eh bien ! dit-il, puisque la chose vous fait plaisir et vous honore, quand commençons-nous ?
Le geôlier se mit à réfléchir et dit lentement :
– J’apporterai deux épées, comme autrefois – deux épées démouchetées, cela va sans dire ! Avec votre adresse et la mienne, nous ne risquons pas de nous blesser sérieusement.
– Non, dit Passavant qui frissonna, nous ne le risquons pas.
– Je descendrai donc deux bonnes lames, solides, bien trempées. J’ai horreur de ces lames qui se ploient ou se brisent au premier coup.
– Quand ? haleta Passavant.
– Dès que ce sera possible ! dit le geôlier.
Et il se retira, tranquille et indifférent comme à son ordinaire, laissant son prisonnier dans un état d’agitation indicible. Le chevalier s’était accoté dans ce coin où Isabeau, plus tard, dans la soirée, devait le voir. Parfois, il frissonnait. Et parfois il murmurait :
– Pauvre diable !… Aurai-je bien ce courage ?… Il le faut ! Pour Odette… et pour Roselys !
Or le chevalier de Passavant en était ainsi à se débattre contre les sentiments divers qui l’assaillaient, et le geôlier était parti depuis plus de trois heures, lorsque la porte du cachot se rouvrit pour cette deuxième visite dont nous parlions.
Cette fois, le geôlier demeura dans le couloir.
À sa place, entrèrent quatre hommes portant des torches qui éclairèrent vivement l’intérieur. Puis, huit gardes bien armés vinrent se ranger aux murs, tandis que douze autres prenaient position dans le couloir. Enfin deux valets apportèrent une petite table noire et quatre escabeaux.
Lorsque tous ces préparatifs furent achevés, Passavant vit entrer Scas et Ocquetonville, puis trois ou quatre autres personnages de la maison de Bourgogne.
Tous ces gens étaient silencieux.
Un petit homme vêtu de noir et tout fluet entra en saluant et, s’asseyant au bout de la table, apprêta un écritoire, des plumes, et installa devant lui divers parchemins : c’était le greffier.
Enfin, trois hommes également vêtus de noir, graves et solennels, firent leur entrée dans le cachot et tout de suite prirent place à la table, sur les escabeaux qui avaient été préparés.
C’étaient les juges.
L’un d’eux, en bredouillant très vite, lut un papier qui établissait que, par l’énormité du crime, l’importance du personnage victime de ce crime, il était à craindre que le prisonnier ne pût être transporté au siège de l’Officialité ; que la légitime colère du peuple de Paris soustrairait sans aucun doute le scélérat au châtiment qui l’attendait, par une mort assurément méritée mais trop douce ; qu’en conséquence le procès se ferait dans le plus grand secret.
Le même papier concluait en ordonnant que le cachot du meurtrier fût pour la circonstance érigé en grand-chambre de justice. Passavant fit justement observer que les conseillers de la grand-chambre ne pourraient jamais entrer tous dans le cachot. Mais le juge, non moins justement, lui répondit qu’il n’avait pas voix sur ce chapitre.
– Après tout, cela m’est égal, dit Passavant en riant.
– Écrivez que cela lui est égal et qu’il a ri, dit gravement le juge.
Ce fut ainsi que commença le procès. À toutes les questions qui lui furent posées, Passavant répondit en se tournant vers Scas et Ocquetonville :
– Demandez à ces deux-là qui sont les meurtriers.
Ce jour-là, il fut établi que l’accusé s’était trouvé, d’après ses propres aveux, dans la rue Barbette, à l’heure même où le duc d’Orléans avait été tué.
Le lendemain, nouvelle visite, nouvelle séance ; les témoins déposèrent et furent unanimes : l’accusé avait été vu fuyant, couvert de sang ; Scas raconta que Passavant lui avait dit la haine qu’il nourrissait contre le malheureux duc ; Ocquetonville assura qu’il avait reçu les confidences de Guines et de Courteheuse ; ces pauvres gentilshommes, sortant d’un cabaret de la rue Barbette, avaient entendu les cris du duc d’Orléans, s’étaient élancés à son secours, mais étaient arrivés trop tard ; ils avaient pu cependant voir le meurtrier qui tenait encore la hache à la main, et avaient essayé de l’arrêter ; Passavant avait alors juré de se venger de ces deux vaillants seigneurs, et il avait tenu parole.
Le lendemain, troisième et dernière séance, très courte, qui fut consacrée à la lecture du jugement. Ensuite de quoi, le greffier annonça au condamné qu’il serait exécuté le jour suivant, sur l’heure de midi, en place de Grève.
Il faut remarquer que le geôlier fut présent à cette dernière séance, à laquelle parurent les juges et les gardes : mais les témoins ne revinrent pas.
Après la lecture du jugement, les juges se retirèrent, escortés par les gardes. Mais le greffier demeura un instant encore.
– Par grâce et compassion de notre bon sire le roi, dit-il, vous pouvez passer la nuit en prières dans la chapelle du couvent des Célestins. Le voulez-vous ?
Passavant, qui à ce moment regardait le geôlier, crut s’apercevoir que cet homme lui faisait signe de refuser. Ce n’était peut-être qu’une imagination, mais il répondit qu’il prierait tout aussi bien dans son cachot, réponse dont le greffier se montra satisfait.
Quelques instants plus tard, le condamné se retrouva seul. Le geôlier était parti, lui aussi, le laissant dans les ténèbres. Passavant commença à désespérer.
– Demain ! murmura-t-il. Demain, tout sera fini…
Le geôlier n’avait pas tenu sa promesse de venir se mesurer avec lui les épées à la main : c’était le seul espoir du prisonnier qui s’envolait. Maintenant, il était trop tard, sans doute…
– Eh bien ! tant mieux, après tout ! songea Passavant. Que ce pauvre diable vive sa vie ! N’eût-ce pas été pour moi une horrible chose que de conquérir à ce prix ma liberté ?
Ainsi, tantôt reportant son souvenir vers Odette, tantôt songeant à Roselys qu’il ne reverrait plus jamais, le jeune homme finit par s’endormir – quelques heures de lourd sommeil coupé de rêves sanglants. Lorsqu’il se réveilla, tout frissonnant, il se murmura :
– Est-ce encore la nuit ? Ou bien le jour a-t-il commencé ?… le jour où je dois mourir…
Il se disait cela. Mais, quoi qu’il fît, il n’arrivait pas à se convaincre que l’heure de la mort allait réellement sonner. Cela lui paraissait absurde. Son active imagination inventait des délais, des catastrophes qui le délivreraient, et tout à coup il entendit la porte s’ouvrir. Le vague et tenace espoir qui était au fond de sa pensée aussitôt s’évanouit.
– On vient me chercher, songea-t-il. Eh bien ! nous verrons. Il y a loin de l’Hôtel Saint-Pol à la place de Grève. Si je n’arrive pas à fuir, je me ferai tuer par les gardes. J’arracherai à l’un d’eux sa pique, sa dague, n’importe quel moyen de défense, et je mourrai les armes à la main, comme un vrai Passavant.
La porte s’ouvrit et se referma l’instant d’après.
C’était le geôlier.
– La dernière visite du geôlier, songea Passavant… Mais… que tient-il sous son bras ?… Des épées ?…
Le prisonnier se mit à palpiter. Oui, le geôlier venait de fixer la torche à la place habituelle et, se tournant vers Passavant, lui montrait deux épées.
Passavant fit un effort pour conserver son air d’indifférence.
– Est-ce le jour ? demanda-t-il d’une voix qui ne tremblait pas.
– C’est le jour, dit le geôlier. Il est bientôt onze heures du matin. Dans quelques minutes, les gardes viendront vous prendre.
– Mais ces épées ? fit Passavant.
– Eh bien, ne m’avez-vous pas promis de vous mesurer une dernière fois avec moi ? Nous avons le temps. Mais il faut que je vous demande aussi une faveur. Je vous ai dit que je serais fier de toucher l’épée d’un vrai gentilhomme… Or, qui fait le gentilhomme ? Le costume !…
– Le costume ! s’écria Passavant qui ne put s’empêcher de rire.
– Sans doute ! Eh bien, tel que vous êtes, tout déchiré, vous ne faites guère mine de gentilhomme. Aussi vous ai-je apporté un costume… et si vous vouliez…
Passavant frémit. Il devina ou crut deviner quelque secrète intention chez le geôlier. Cet homme voulait-il donc le sauver ? Lui apportait-il donc un costume pour le rendre méconnaissable et lui permettre de traverser sans encombre les jardins de l’Hôtel Saint-Pol ?
Il le regarda fixement. Mais le geôlier, froidement, lui montra le paquet, et grogna :
– Si vraiment vous voulez me faire plaisir, hâtez-vous. Tout à l’heure il sera trop tard.
Passavant ne se le fit pas dire deux fois. En moins de dix minutes, il eut opéré le changement et se trouva revêtu d’un fort beau costume qui lui seyait parfaitement.
– Cette dague à votre ceinture, dit le geôlier.
Et Passavant plaça à sa ceinture la forte dague que lui tendait le geôlier.
– Maintenant, votre épée !
Et le prisonnier ceignit l’épée, bonne lame solide qu’il eut soin de vérifier.
– Maintenant, votre escarcelle !
Et le geôlier attacha lui-même une escarcelle de cuir dans laquelle tintaient une douzaine d’écus d’or. Passavant, stupéfait et palpitant, se laissait faire.
– C’est, dit le geôlier, le dernier argent que m’aura fait gagner le sire de Bois-Redon. Vous ne comprenez pas, mais peu importe. Vous voici maintenant un vrai gentilhomme. Rien n’y manque, le costume, l’épée, la dague et l’escarcelle. Maintenant, l’honneur que vous me voulez faire sera complet. En garde, donc, en garde !…
Le geôlier tomba aussitôt dans la position de garde et, machinalement, le prisonnier l’imita.
– Voilà ! songea Passavant en touchant le fer de l’étrange adversaire, un coup droit à fond, droit au cœur… le coup qu’il m’a enseigné… et cet homme tombe. Alors, je lui prends ses clefs, je monte à la surface de la terre. Grâce au costume qu’il m’a apporté, nul ne me reconnaît. Grâce à l’or dont il m’a muni, je puis fuir… Oui. Je n’ai plus qu’un coup à porter…
– Défendez-vous, par les saints et les démons ! Défendez-vous donc !…
Le geôlier attaquait vivement. Passavant reculait.
Ce coup qu’il lui fallait porter, dix fois en quelques minutes, lui fut presque offert par le geôlier qui se découvrait, commettait d’étonnantes maladresses, et, d’une voix furieuse, répétait :
– Mais attaquez donc, mort-diable ! Tout à l’heure, il va être trop tard !
– Trop tard ? Pourquoi trop tard ?
– Pour fuir, donc !
Il y eut un bref silence. Le regard qu’échangèrent ces deux hommes fut un regard de véritable défi. Car le sacrifice et le dévouement ont leurs fureurs comme la colère et la haine. L’attitude du geôlier était d’une aveuglante clarté. Elle criait : « Tuez-moi et prenez les clefs pour fuir… »
– N’y a-t-il donc que ce seul moyen ? dit Passavant à haute voix.
Le geôlier comprit parfaitement de quoi il s’agissait.
– C’est le seul moyen, dit-il d’une voix calme. Et encore faut-il vous hâter.
Passavant rengaina son épée. Une puissante émotion lui étreignait le cœur. Ses yeux s’embuaient de larmes.
– Que faites-vous ? grogna le geôlier. En garde, en garde, ou je vous charge ! Mort-Dieu ! Et moi qui voulais voir vos progrès ! Voilà que vous ne voulez plus vous battre ? Je n’y comprends rien !
– Pardonnez-moi, dit le chevalier d’une voix tremblante. C’est vrai. J’ai fait cet affreux rêve que vous avez deviné : de conquérir la liberté en sacrifiant votre vie…
– Bah ! Bah ! Que vaut ma vie ? Je suis vieux. Quelques années de plus ou de moins, et puis, je vous assure, cette vie que vous voulez me ménager… à quoi sert-elle ? Je n’ai fait que du mal. J’en ferai encore si je vis. Un geôlier, c’est presque un bourreau. Je ne tiens pas à vivre plus longtemps. Il y a ce diable de serment que j’ai fait en présence du prêtre, sans quoi, je vous ouvrirais tout simplement la porte. Je ne peux pas. Et pourtant, vous devez vivre, vous. Il le faut, sinon pour vous-même, du moins pour elle !… Elle vous attend. Je le sais. Et je sais aussi ce qui la menace. Tenez, les clefs sont là, à ma ceinture. Ne faites pas l’enfant : un bon coup d’épée, et vous les prenez. Par exemple, je vous demande de ne pas manquer le coup.
Passavant avait écouté, tête basse. Le geôlier s’approcha de la porte, écouta un instant, puis revint en disant :
– Nous avons encore un petit quart d’heure…
– La dernière leçon, murmura Passavant. La dernière leçon d’armes, vous venez de me la donner. Je pense à ce qu’aurait été ma vie si je vous avais tué ; heureusement, cela n’est pas, cela n’eût pas été, « même pour elle »… Cela ne sera pas. Allons, geôlier, merci de m’avoir habillé de neuf pour aller à la place de Grève.
– Vous ne voulez pas fuir ? gronda le geôlier, sincèrement stupéfait.
Passavant fit un pas vers le geôlier et lui tendit la main.
– Quoi ? fit l’homme abasourdi. Moi ! Un manant ! Un geôlier !
Et il saisit la main du chevalier qu’il étreignit. De confuses idées passèrent dans sa tête. Il se dit que peut-être il était semblable à un autre homme, à un bourgeois, et même à un noble. Passavant souriait. Il n’était plus question de fuir. Tout cela s’était fait très simplement, et cette scène n’avait demandé que peu de minutes.
– Je vous tiens pour un brave à l’égal de n’importe quel haut baron, dit paisiblement Passavant. Vous avez voulu vous laisser tuer pour assurer ma fuite…
– En me donnant votre main, dit le geôlier avec la sincérité de son héréditaire humilité, en m’élevant ainsi au-dessus de ma condition, vous m’avez payé cela au delà. Je suis votre débiteur. Et je puis bien risquer maintenant…
Il s’arrêta, tout pâle.
– Risquer quoi ? palpita le chevalier qui se remit à trembler.
– Eh ! mort-diable, oui, je puis bien risquer mon âme !
– Allons ! dit Passavant en se dirigeant résolument à la porte.
Une seconde, le geôlier, le considéra avec étonnement.
– Il refuse de me tuer, songea-t-il, et il accepte que je perde mon âme par un parjure… Oh ! oh ! Le salut de l’âme est cependant chose plus grave que celui du corps, à ce que j’ai toujours ouï dire…
Quelques instants plus tard, tous deux se trouvaient hors du cachot que le geôlier, par geste machinal, referma avec autant de conscience que l’habitude. Ils montèrent, le chevalier frémissant, et le geôlier ruminant de vagues pensées où le salut de son âme tenait le premier rôle. Quand ils furent au rez-de-chaussée, le geôlier jeta un rapide coup d’œil au dehors.
– Il était temps, dit-il.
– Quoi ? fit Passavant.
– On vient vous chercher.
Le chevalier regarda, et au loin dans la direction du palais de Charles VI, vit venir une troupe d’archers. Mais maintenant, libre, de l’air et de l’espace devant lui, une bonne épée à la main, il ne craignait plus rien.
– Oui, dit-il froidement, il est temps, en effet. Partons. Vous venez avec moi ?
– Il le faut bien, grogna le geôlier. Si vous partez seul, vous allez sûrement vous heurter à ces gens. Il faut que je vous guide. Après quoi, ajouta-t-il avec un soupir, je reviendrais reprendre ma place, ici. Allons, où voulez-vous que je vous mène ?
– Au palais du roi, dit Passavant.
– J’en étais sûr ! songea le geôlier.
Ils se mirent en route, tournant d’abord le dos à la troupe qui venait, et se dirigeant vers la Bastille ; puis, longeant le chemin de ronde, ils gagnèrent cette petite porte par où Passavant était entré un soir. De là, par des chemins détournés, à travers les cours, ils marchèrent sur le palais du roi.
XX – LE PARCHEMIN
Nous devons maintenant revenir au moment où Tanneguy du Chatel arrivait en vue du logis de Saïtano. Le brave capitaine n’était pas sans éprouver quelque émotion à l’idée de pénétrer dans l’antre du sorcier, lieu maudit, à coup sûr, où l’on risquait de se trouver nez à nez avec quelque démon de la pire catégorie. L’homme qui s’était offert à le conduire n’avait pas sans doute de ces craintes, car il frappait déjà à la porte. Bientôt le judas s’entr’ouvrit. L’homme dit son nom à voix basse. Il y eut quelques pourparlers, puis la porte s’ouvrit, et Tanneguy entra à la suite de son compagnon. Saïtano jeta un regard sur le capitaine.
– Messire, dit le guide, je vous amène un seigneur qui a quelque chose d’important à vous demander. Je lui ai promis votre aide.
– Inutile ! dit le sorcier d’une voix basse. J’ai résolu de ne plus m’occuper de rien, ni de personne. Si vous voulez un philtre, ou des herbes, si vous cherchez l’amour ou la mort, si vous voulez guérir, si vous voulez donner la mauvaise fièvre à un ennemi, si vous cherchez un charme, enfin si vous avez besoin de n’importe quel sortilège, passez votre chemin. Ici, ce n’est plus la maison du sorcier.
– Oh ! Oh ! dit l’homme tout désappointé. Et que vais-je devenir, moi ?… Et que vous est-il arrivé, messire ? Vous êtes, sur ma parole, pâle comme un revenant de l’autre monde. Je ne reconnais ni vos yeux, ni votre voix. Est-ce que Satan vous abandonne ?
Saïtano jeta sur cet homme un étrange regard. Et il sourit.
– Tu l’as dit ! Satan n’est plus avec moi. Je pars, donc. D’ici huit jours, j’aurai quitté Paris. Ainsi, capitaine, reprit-il en s’adressant à Tanneguy, ne comptez pas sur ma pauvre science… Ma science est morte, et c’est miracle que moi-même je sois encore vivant.
– Sorcier, dit Tanneguy, je ne viens pas pour moi… je viens pour celui à qui vous avez remis la dot de Roselys.
L’attitude de Saïtano se modifia au même instant. Il s’avança rapidement sur Tanneguy.
– Passavant ? demanda-t-il avec un intérêt soudain surexcité.
– Lui-même. Il a confiance en vous. Il me l’a dit.
– Oui. Et que veut-il ? Parlez vite !
– C’est moi qui veux, et non lui. Passavant a été saisi dans mon logis même, en état de rébellion. De plus il est accusé du meurtre du duc d’Orléans. Son affaire est donc claire, si je ne trouve le moyen de le tirer des griffes de Jean sans Peur. Et Bourgogne, vous le savez peut-être, est un chien qui ne lâche pas facilement l’os qu’il ronge. Il faudra user de force et de ruse à la fois. Pour commencer, apprenez que mon jeune ami a été conduit à l’Hôtel Saint-Pol…
Saïtano écoutait avec une profonde attention. Tanneguy remarqua que les mains du sorcier tremblaient légèrement. De toute évidence, la nouvelle était importante pour lui.
– Cet homme, ajouta le capitaine, m’a assuré que seul vous pourriez me faire entrer dans l’Hôtel Saint-Pol. Est-ce vrai ? Parlez vite à votre tour.
– Il a dit vrai, fit Saïtano qui puisa dans son escarcelle et tendit au guide quelques pièces d’or. Tu as bien fait de m’amener le digne capitaine. Tiens, mon ami, voici ta récompense.
– Eh ! cria Tanneguy, j’ai déjà payé le drôle !
– C’est égal, dit l’homme en prenant, c’est égal… merci, maître.
– Qu’importe un peu d’or ? dit Saïtano. Tu as bien fait, mon ami. Maintenant, va-t’en ; laisse-moi avec ce seigneur.
L’homme salua en ricanant et se faufila dans la rue. Saïtano referma la porte et revint vers le capitaine.
– Ainsi, dit-il, le chevalier de Passavant est arrêté.
– Oui. Et on l’a conduit dans l’Hôtel Saint-Pol. Pouvez-vous réellement me faire entrer dans la forteresse ?
Saïtano, sans répondre, se mit à se promener lentement. Le capitaine le considérait, étonné, et commençait à maugréer quelques jurons contre l’insolence des sorciers…
– Voici exactement la situation, dit tout à coup Saïtano. Le chevalier de Passavant est à l’Hôtel Saint-Pol en danger de mort. Vous voulez le sauver, pour l’amitié que vous lui portez. Et moi, je veux le sauver pour la haine que je porte au duc de Bourgogne.
– Eh bien, dit Tanneguy, unissons cette haine et cette amitié. À nous deux, nous pourrons délivrer mon jeune ami – moi, avec la force de mon bras, vous, avec la force des démons.
Saïtano secoua la tête.
– Je puis, dit-il, vous introduire dans l’Hôtel Saint-Pol, mais qu’y ferez-vous ?
– Ce que je ferai, mort-dieu ! Je délivrerai Passavant…
– Je sais bien… Mais comment ?
– Comment !… fit Tanneguy interloqué. Mort du diable, je mettrai le feu, je tuerai, je…
– Oui… Mettrez-vous le feu aux quinze ou vingt bâtiments divers dont se compose l’Hôtel Saint-Pol ? Parviendrez-vous seulement à savoir où est enfermé votre ami ? Chacun des sept palais de l’enceinte a ses cachots, sans compter ceux de la tour Huidelonne. Et quand vous le saurez, tenterez-vous de corrompre des geôliers incorruptibles parce que leur peur de la potence et de l’enfer est plus forte que leur avarice ? Essayerez-vous de tuer à vous seul les gardes qu’on a placés autour du prisonnier, et cela sans donner l’alarme ?
Tanneguy du Chatel écoutait avec effarement. Il s’essuya le front et gronda :
– Par l’enfer, tout ceci n’est que trop vrai. Eh bien, je me ferai tuer en essayant de délivrer mon jeune ami, voilà tout. Au moins, il saura…
– Il ne saura rien, dit Saïtano. Il ne profitera pas de votre généreuse ardeur. Et vous, mon digne capitaine, vous aurez succombé dans une bagarre sans gloire, et votre mort sera inutile.
– Que faire, alors, que faire ? hurla Tanneguy.
– Vous tenir tranquille jusqu’au moment où je vous enverrai chercher. Je ne vous demande pas si vous êtes capable de donner au moment voulu votre vie pour votre ami. Avec le caractère que je vous vois, vous vous ferez tuer. Mais il faut que votre mort soit utile. Voici donc ce que je vous demande : êtes-vous capable d’attendre patiemment que je vous appelle ?
– Que ferai-je pendant ce temps ?
Le brave Tanneguy grondait. Mais Saïtano, avec son air paisible, s’était, du premier coup, imposé à lui. Vaguement, le rude homme d’armes pressentait qu’il y a peut-être d’autres forces que la force d’une épée.
– Eh bien, dit-il brusquement, j’attendrai.
– Où pourrai-je vous faire chercher ?
– Chez maître Thibaud Le Poingre, à l’auberge de la Truie Pendue. Vous ne connaissez pas ? Non, les gens comme vous ne doivent boire que de l’eau.
– Je connais, dit froidement Saïtano. Et je connais aussi votre logis de la rue Saint-Antoine, sire du Chatel, votre logis désert depuis que vous redoutez le coup de dague de Bourgogne. C’est là, voyez-vous, que vous devez m’attendre : l’auberge de Thibaud Le Poingre est trop loin de l’Hôtel Saint-Pol !
– Par Notre-Dame, vous avez raison ! s’écria le capitaine émerveillé. Mais dites donc, mon digne suppôt de Satan, je crois que vous avez dit que je redoutais le coup de dague…
– Des gens de Bourgogne, oui… Mais je n’ai pas dit que vous aviez peur.
Tanneguy regarda Saïtano dans les yeux, mais sans doute il vit bien que le sorcier ne songeait guère à se moquer de lui.
– C’est étrange, murmura-t-il, vous savez mieux que moi, et m’expliquez clairement ce que j’ai pensé de toute cette affaire ; c’est vrai, j’ai redouté, je redoute encore d’être rencontré par les damnés Bourguignons, et pourtant nul ne peut dire que j’ai peur. Au surplus, ajouta le capitaine en secouant la tête, tout cela tient à la sorcellerie.
– Allez, dit doucement Saïtano. Retirez-vous en votre castel de la rue Saint-Antoine, et attendez-moi là. Celui que je vous enverrai vous dira aussi ce que vous aurez à faire.
Et l’homme d’armes, qui ne s’était jamais senti la moindre disposition pour obéir à qui que ce fût, se courba sous cette parole douce, ou plutôt froide et sans accent.
Tanneguy du Chatel se retira donc et, suivant ponctuellement les instructions qu’il avait reçues, alla se poster en son hôtel. Ce n’était pas un mince sacrifice qu’il faisait à l’amitié. En somme, une faction de quelques jours dans l’auberge de la Truie pendue n’eût rien présenté de désagréable à son imagination. En tête à tête avec ces fameux vins blancs de Thibaud, il eût passé des heures sans trop d’ennui. Mais pour bien boire, il faut être au moins deux. Tanneguy n’eût pas manqué de compagnons qui lui eussent tenu tête. Au logis de la rue Saint-Antoine, c’était la solitude. Tanneguy ne savait pas boire seul.
Le premier jour, il essaya donc de lutter contre l’ennui en visitant ses caves qui étaient belles et bien ordonnées.
Mais le deuxième jour, il ne se sentit même plus cette noble soif qui fait les intrépides buveurs. Le jour suivant, l’ennui le dévorait.
Le lendemain matin, Tanneguy en vint à se dire que Saïtano s’était moqué de lui ; puis une idée terrible lui passa par la tête : le sorcier, d’accord avec Jean de Bourgogne, avait voulu l’écarter pour qu’aucun secours ne pût arriver à Passavant.
Du Chatel s’habilla donc de pied en cap, et, tout jurant, tout grondant, se disposa à courir au logis de la Cité dans l’intention de pourfendre le sorcier.
Des rumeurs venues de la rue, à ce moment, interrompirent ses jurons. Presque aussitôt, des cloches se mirent à mugir.
– Le tocsin ! dit le capitaine. Oh ! que se passe-t-il dans ce diable de Paris ?
Tanneguy écouta cette rumeur qui montait de la rue. Et il entendit des voix qui criaient tout ce que pouvait crier le peuple. Une rafale passa en lui apportant ce cri :
– Liberté ! Liberté pour le peuple !…
– Oh ! Oh ! fit le capitaine goguenard. Liberté ? Qu’est-ce que cela ?
Presque au même instant, une autre clameur s’éleva, puis s’éteignit.
– Bon ! dit Tanneguy qui avait entendu, ceux-ci crient contre les impôts. Eh bien, à la bonne heure, je comprends… Mais liberté ? Que diable cela peut-il signifier ?
Il se tut brusquement. Et cette fois il pâlit, car d’autres clameurs passaient, plus violentes, des voix plus impérieuses, des accents plus menaçants, et cette fois, on criait :
– Bourgogne ! Bourgogne ! Vive Bourgogne !…
– Armez-vous, bourgeois ! Tendez des chaînes !…
– Monseigneur de Bourgogne est avec le peuple ! Nous sommes sauvés !…
Tanneguy du Chatel avait, avec des meubles, bouché l’ouverture qu’il avait faite. Il avait aussi tant bien que mal rejoint les battants de sa porte à demi démolie. Il jeta un coup d’œil sur ces sommaires travaux qu’il avait effectués seul.
– C’est sûr ! songea-t-il. Les gens de Bourgogne vont faire quelque mauvais coup. Ces damnés ruffians viendront ici, je ne puis en douter. Je serai pris comme un renard et ne pourrai même pas me défendre puisqu’ils ont l’autre jour défoncé la porte.
La conclusion de ces peu agréables réflexions fut une bordée de jurons après laquelle le digne capitaine résolut de jouer un mauvais tour aux Bourguignons en décampant. En effet, il lui était venu une idée.
– Attendre ici le signal du sorcier, se disait-il, c’est vouloir me livrer aux brigands de Jean sans Peur. Mais si je m’en vais, et que ce brave suppôt du diable m’envoie ici l’homme dont il m’a parlé ?… Eh bien, je vais tout simplement aller m’installer chez le sorcier lui-même.
Content de cette résolution, Tanneguy du Chatel se mit aussitôt en route et descendit l’escalier, mais avant de gagner le large, il voulut faire une dernière visite à ses caves, d’abord parce qu’il avait grand’soif, et ensuite parce que son escarcelle était vide.
Sans la moindre hésitation, Tanneguy creusa le sol à l’endroit où il avait aidé le chevalier de Passavant à enterrer le trésor – la dot de Roselys.
Il y puisa tranquillement le nombre d’écus dont il pensait avoir besoin, – pas un de plus, pas un de moins. Puis, avec le plus grand soin, il recouvrit le trésor. Tanneguy du Chatel n’éprouva pas le moindre scrupule. Il n’eut même pas la pensée que ce qu’il faisait là n’était peut-être pas absolument légitime. Tanneguy, en puisant dans le trésor qui ne lui appartenait pas, n’eut ni réflexions, ni scrupules : il prit simplement ce dont il avait besoin. Il n’eût pas réfléchi davantage si, le trésor lui appartenant, il eût eu à donner pareille somme à son ami. Il eût donné sans réflexion ni scrupule : il prenait de même.
Une fois lesté, Tanneguy du Chatel quitta son logis. Il était à ce moment près de midi.
Cinq minutes après le départ du capitaine, un homme arriva en courant au logis de la rue Saint-Antoine : c’était l’envoyé de Saïtano.
Tanneguy, cependant, descendit la rue dans la direction de la Grève, se mêlant à la foule, et suivant les bandes plus ou moins armées.
Cette surexcitation du matin s’était calmée en apparence. On n’entendait plus les cloches.
Les bandes qui passaient ne criaient plus. Mais elles n’en paraissaient peut-être que plus redoutables, bien qu’elles fussent à peine armées de quelques pertuisanes.
Ces bandes étaient d’ailleurs composées presque entièrement de femmes et d’enfants. Mais ces femmes, presque toutes mal vêtues, avaient de ces visages qui font frissonner. Mais ces enfants hâves, maigres, beaucoup d’entre eux, pieds nus dans la neige, disaient aussi qu’une force mystérieuse se levait : cette force s’appelait la misère.
Où allaient ces bandes maintenant silencieuses ?
Sans doute elles ne le savaient pas elles-mêmes.
On avait entendu le tocsin ; on s’était assemblé, par rues, par quartiers ; on s’était mis en route, au hasard.
Mais il était évident que ces gens étaient soutenus par une idée ferme, et qu’ils avaient un mot d’ordre. L’idée et le mot d’ordre se confondaient dans un nom : Bourgogne !
Tanneguy, retroussant ses grosses moustaches et roulant des yeux, avançait lentement, la main à la garde de la rapière, prêt à mettre flamberge au vent.
Il atteignit la place de Grève.
Là, le spectacle changeait. Là, plus serrée, plus menaçante, une foule énorme attendait. Tous les regards convergeaient vers le centre de la place. Et Tanneguy, ayant lui aussi regardé de ce côté, vit qu’un échafaud tendu de noir se dressait entre le pilori et le gibet. Sur l’échafaud allaient et venaient l’exécuteur et ses aides.
Mais, en cet exécuteur, Tanneguy ne reconnut pas la silhouette farouche et colossale de maître Capeluche. Ce bourreau était maigre, mince, et se démenait fort en criant ses instructions aux aides qui achevaient de clouer la tenture.
À vingt pas en arrière de l’échafaud, dans la direction de la Seine, se dressait un bûcher.
– Que diable signifie tout cela ? gronda Tanneguy.
Un bourgeois qui se trouvait près de lui entendit la question et saisit la balle au bond ; la langue lui démangeait justement ; il était de l’immortelle race de gens qui veulent, coûte que coûte, expliquer au voisin le spectacle auquel ils assistent ensemble.
Ce bourgeois, donc, déposa sur le sol la pique qu’il tenait sur son épaule, s’appuya au manche, se donna un coup de poing sur la cuirasse, toussa, et dit :
– Comment ! Vous ne savez pas ce que cela signifie ? Au fait, vous arrivez peut-être ?
– Justement… et de loin.
– Bon. Laissez-moi d’abord vous donner un bon conseil, mon digne gentilhomme.
– Voyons le conseil.
– Eh bien, hâtez-vous de placer sur votre manteau une croix rouge de Saint-André, sans quoi, et bien que vous ayez une honnête figure, on pourrait croire… vous comprenez ?…
– Non, mort du diable ! Mais vous allez m’expliquer…
– Oui. Eh bien, cela pourrait donner à penser que vous êtes pour Armagnac.
– Ces chiens d’Armagnac ! dit Tanneguy goguenard.
– Ah ! je vois que vous êtes un bon ! Vive Bourgogne, n’est-ce pas ?
– Diable ! Je le crois bien ! D’autant que j’ai moi-même mille obligations à Jean de Bourgogne. Mais j’espère bien lui payer ma dette un jour ou l’autre.
– Aujourd’hui vous en aurez peut-être occasion. Mais pour en revenir à cet échafaud que vous voyez, on va d’abord, sur le coup de midi, trancher le poignet droit du condamné et lui couper la langue comme à un sacrilège.
– Oh ! oh ! fit Tanneguy, je ne voudrais pas être à sa place.
– Ni moi, dit le bourgeois en éclatant de rire. Ensuite, vous voyez bien, en arrière de l’échafaud, la confrérie des pénitents blancs ?
– Oui, je vois en effet quelques cagoules.
– Voyez-vous que quelques-uns de ces dignes pénitents tiennent une torche ?
– Oui, je vois la fumée des torches.
– Eh bien ! c’est pour allumer le bûcher. Dès qu’on aura arraché la langue du condamné, il sera attaché au bûcher et les pénitents blancs l’allumeront.
– Bon ! dit Tanneguy. Et comme le pauvre diable n’aura plus de langue, il ne pourra pas crier ni demander à boire s’il a trop chaud dans son brasier.
Le bourgeois, cette fois, fut pris d’un terrible accès de rire.
– À la bonne heure, finit-il par dire, vous avez le mot pour rire avec le bourgeois, vous !… Vous n’êtes pas de ces Armagnacs qui nous toisent et se croiraient déshonorés s’ils nous adressaient la parole ! Quant au brasier, vous vous trompez, mon gentilhomme. Ce ne sera pas un feu à brasier, vu que le condamné doit être brûlé à petit feu ; c’est dans la sentence qui a été criée.
– À petit feu ! frissonna Tanneguy. Le pauvre diable !
– Oui. Mais avouez que c’est un fier sacripant ! Et puis, ajouta le bourgeois à demi-voix, c’était, paraît-il, un ennemi de monseigneur de Bourgogne !
– Ah ! Et comment l’appelez-vous ?
– Qui ? Le condamné ?…
– Sans doute ! Je ne sais rien, puisque j’arrive…
– Ah ! oui, c’est vrai. Eh bien ! le condamné, c’est le sire de Passavant.
Tanneguy du Chatel gronda un sourd juron d’une voix qui avait les accents d’une plainte furieuse.
– Oh ! le bourgeois, voilà que vous ne riez plus. Et vous êtes blanc comme un mort… Qu’avez-vous donc, mon gentilhomme ?
– Rien, dit Tanneguy, cela va se passer.
– C’est comme ma femme. Ça la prend tout à coup, si bien qu’on croit qu’elle va mourir ; mais il n’y a pas de danger, ajouta le bourgeois avec un soupir, elle a vite fait de se remettre.
Le capitaine demeurait pétrifié, laissant le bourgeois continuer son bavardage qui lui parvenait comme de loin et dont il saisissait parfois quelques bribes. Il apprit ainsi que le chevalier de Passavant était condamné, que le procès, grâce à l’activité de Jean sans Peur, avait été rapidement instruit dans le plus grand secret, et que tout allait se terminer par une bonne exécution, malgré l’étrange incident dont tout Paris s’était occupé dans la matinée.
– Quoi donc ? demanda Tanneguy, qui parut alors reprendre intérêt à l’entretien.
– Eh bien ! ce matin, quand on a été chercher maître Capeluche, on l’a trouvé mourant dans son lit, par une mauvaise fièvre qu’il a, paraît-il, gagnée cette nuit même. Heureusement, Capeluche a désigné un de ses garçons comme très capable de le remplacer. C’est ce maigre efflanqué que vous voyez se démener sur l’échafaud.
Tanneguy fit signe au bourgeois qu’il en savait assez. Il s’avança de quelques pas, dans la direction de l’échafaud, et se trouva enveloppé de toutes parts, pris dans cette foule d’où montait un vaste murmure indistinct. Ce qu’éprouvait Tanneguy à ce moment, c’était de la rage. Il s’accusait de stupide confiance envers le sorcier.
– C’est clair. L’infernal suppôt m’a tenu trois jours éloigné de tout. En sorte que je n’ai rien su de ce qui se passait et n’ai rien pu tenter pour le pauvre chevalier.
Le capitaine forma aussitôt le projet de se rendre à l’instant dans la Cité, de pénétrer de gré ou de force dans le logis et d’étrangler Saïtano.
Mais une sorte de maladive curiosité l’arrêtait. Il éprouvait une insurmontable horreur à la pensée d’assister au supplice de son ami, et il lui sembla en même temps qu’il n’aurait jamais le courage de s’éloigner. Tout en se livrant à ces sombres pensées, tout en combinant des projets de vengeance contre Saïtano et Jean sans Peur, il avançait peu à peu, de sorte qu’il se trouva bientôt au premier rang de la foule.
Il n’était plus séparé de l’échafaud que par une barrière d’archers du guet.
Tanneguy du Chatel voulut alors reculer, fuir ; la vue du vaste échafaudage tendu de noir lui faisait mal, et les chants des moines, qui à ce moment même entonnaient une funèbre complainte, lui soulevaient le cœur – et pourtant Dieu sait si le cœur du capitaine était peu facile à émouvoir. Tanneguy voulut donc s’en aller et courir chez Saïtano pour lui faire payer sa trahison le plus cher possible. Mais il demeura sur place, tout raidi par l’horreur : midi sonnait à ce même moment, et c’était l’arrivée du condamné que saluaient les chants des moines ! En même temps, une clameur montait de la foule : Le voici ! Le voici !…
Tanneguy regarda au loin dans toutes les directions : il eut beau écarquiller les yeux, il ne vit pas arriver le condamné. Mais, certain que le malheureux chevalier allait, dans quelques instants, être traîné sur l’échafaud, toute sa pitié, toute son horreur, toute son amitié firent explosion en une crise de fureur, et Tanneguy se cria :
– Eh bien, non ! Moi vivant, il ne sera pas exécuté. Je mourrai avec lui, ou le délivrerai !
Vers le moment où Tanneguy du Chatel, dans la matinée, avait commencé à s’émouvoir des cris de ces bandes qui passaient sous les fenêtres de son logis, Saïtano pénétrait chez Ermine Valencienne. Il est nécessaire que nous suivions le sorcier depuis le soir où il avait reçu la visite de Tanneguy et appris ainsi l’arrestation du chevalier de Passavant.
Après le départ du capitaine, Saïtano demeura longtemps pensif, se demandant peut-être s’il y avait pour lui intérêt à tenter de sauver Passavant.
– Il était ma vengeance, murmura-t-il, à un moment. C’est lui qui devait frapper Jean sans Peur. Le voici aux mains d’Isabeau qui ne lui pardonnera pas d’aimer Odette de Champdivers, aux mains du terrible duc qui ne lui pardonnera pas de connaître le meurtrier d’Orléans. Ce jeune homme est perdu. Tout essai sera vain. Et pourtant… oui… ceci, peut-être !…
Le lendemain matin, Saïtano se rendit à l’Hôtel Saint-Pol où il resta plusieurs heures.
Quand il en sortit, il avait acquis la certitude que rien ne pouvait sauver Passavant. Il avait cependant une idée que nous allons voir se développer.
Rentré dans son logis, il alla ouvrir l’armoire de fer et, dans l’armoire, ce coffre où il cachait ses richesses. Parmi les parchemins qui s’y trouvaient, il prit celui qu’il avait montré au chevalier, puis il referma son armoire.
Il s’assit, déplia le parchemin et, hochant la tête :
– Voici l’arme qui, mieux qu’un coup de dague ou de hache, peut tuer Jean sans Peur. Accusation de sacrilège ! Ceci peut le faire condamner mieux que si Passavant avait prouvé la complicité de Bourgogne dans le meurtre du duc d’Orléans. Oui, c’est l’arme terrible. Mais qui peut la manier, du moment que Passavant n’est plus là ?… Qui donc, sinon Laurence d’Ambrun ?…
Il replia soigneusement le parchemin, le plaça dans son escarcelle et médita :
– Oui, Laurence d’Ambrun… la mère d’Odette de Champdivers !… Elle seule peut… Mais où est Laurence depuis qu’elle est devenue Trop-va-qui-dure ?… Si Gérande était là, elle saurait, elle !… Mais Gérande est morte, morte de peur, comme peut-être je mourrai moi-même, ajouta-t-il en frissonnant.
Quelques minutes plus tard, le sorcier quittait son logis où on ne le revit plus de plusieurs jours. Que fit-il pendant cette longue absence ? Où erra-t-il ?
Il fut vu, et malgré le manteau dont il s’enveloppait, reconnu dans la rue Trop-va-qui-dure. On le vit entrer dans la maison qu’avait habité une heure Jehanne Trop-va-qui-dure. Il demanda à divers voisins ce qu’était devenue cette Jehanne. Mais on ne put lui répondre. Il sut seulement que cette pauvre fille avait été expulsée de la rue par jalousie des ordinaires habitantes, soucieuses de s’épargner une redoutable concurrence.
Ce que fit ensuite le sorcier nous échappe. Sans doute sa sagacité et son esprit habitué aux déductions lui firent retrouver la piste qu’il cherchait, car, ainsi que nous le disions, nous le retrouvons entrant dans le logis d’Ermine Valencienne.
Et le logis d’Ermine Valencienne abritait Jehanne Trop-va-qui-dure, c’est-à-dire Laurence d’Ambrun, la mère d’Odette de Champdivers.
XXI – DANS LE PALAIS DU ROI
Bruscaille, Bragaille et Brancaillon occupaient une chambre commune située assez près de l’appartement royal pour que Charles VI pût, autant qu’il le voulait, communiquer avec ses ermites favoris. Car les trois drôles étaient grands favoris. Le fou ne pouvait plus se passer d’eux. D’ailleurs, il n’était plus question d’exorcisme. Ce prétexte même avait été abandonné. Le roi voulait qu’on le fît rire, et Brancaillon seul y réussissait.
Cependant les trois sacripants conservaient leurs robes de religieux et ne se faisaient pas faute de distribuer des bénédictions, qui en valaient bien d’autres, après tout.
Le jour où Tanneguy du Chatel s’arrêta au pied de l’échafaud dressé pour le chevalier de Passavant, le jour même où Saïtano entra dans le logis d’Ermine Valencienne, Bruscaille, Bragaille et Brancaillon étaient réunis dans leur chambre.
La table était dressée.
Comme à l’ordinaire, cette table, selon les ordres du roi, était magnifiquement servie. Un splendide repas attendait donc les trois drôles qui, à ce régime, étaient devenus gras et luisants comme de vrais moines. Et cependant, ce jour-là, aucun d’eux ne prenait place à la table.
Chose fabuleuse : Brancaillon n’avait pas faim.
Il est vrai qu’en revanche, il avait toujours soif, et plus soif même que d’habitude. De temps à autre, il saisissait au hasard le premier flacon ou le premier cruchon qui lui tombait sous la main.
Bragaille, de son côté, n’était pas sans témoigner quelque émotion qui se traduisait par des prières entremêlées de jurons.
Bruscaille seul conservait tout son sang-froid.
C’est que Bruscaille avait peut-être le cœur plus dur que les autres, ou bien il se rendait compte plus exactement de la situation. Il l’expliquait avec clarté à ses deux acolytes.
– Il n’y a pas à reculer, disait-il. Le jour est venu. L’heure va sonner. L’envoyé de notre maître et seigneur le duc m’a dit : au coup de midi. À midi donc, le roi sera exorcisé ; le geste, le dernier geste sera accompli, et le fou passera de ce monde dans un autre.
– Meurtrir un si bon roi ! gronda Bragaille.
– Et qui nous fait boire de si bon vin ! ajouta Brancaillon.
– Hé ! fit Bruscaille. Je sais bien que c’est dur… Mais, de par tous les diables, ce ne sera pas la première fois que nos dagues auront rendu service à Jean de Bourgogne !
Brancaillon lampa une forte rasade, et d’une voix sombre :
– Oui. Nous avons tué, c’est vrai, mais dague contre dague, en risquant notre peau. Et puis, les gens contre lesquels nous avons bataillé, nous ne les connaissions pas. Nous savions seulement que c’étaient des ennemis du maître qui nous habille, nous loge, nous nourrit, nous fournit les écus dont nous avons besoin. Mort-dieu, quand à nous trois nous attaquions un seigneur escorté de ses valets d’armes, quand je voyais luire les épées, quand je voyais qu’il y allait de ma vie, je n’avais pas honte, non, de me ruer, le fer au poing, sur celui qu’il fallait abattre. Je porte plus d’une blessure. C’est la guerre. Mais ce pauvre roi qui a mis en nous sa confiance, que nous allons égorger comme un mouton… cela me crève le cœur. Il sera assis dans son grand fauteuil. Il me dira : « Venez ça, révérend Brancaillon, faites-moi rire ! » Et moi je lui plongerai ceci dans la poitrine ? Non ! Qu’un autre le fasse. Moi, je ne peux pas !
Et Brancaillon, saisissant sa dague, jeta un regard sanglant sur ses deux compagnons. D’un étrange accent, il ajouta :
– Et même, je ne dis pas… que je vous laisserais faire !
Bruscaille et Bragaille se regardèrent ; leurs physionomies se firent terribles. Bragaille, d’une voix douce et féroce, prononça :
– Ah ! voici qui arrangerait bien des choses. Si Brancaillon se met devant le roi, nous serons forcés de le tuer, lui aussi, et ce sera justement la bataille dont il parlait…
– Eh bien, bataille, donc ! dit Brancaillon d’une voix basse et terrible. Je ne veux pas, moi, qu’on touche au roi ! Malheur à celui…
– Malheur ? dit Bragaille.
En un instant, ils eurent jeté bas le froc et se trouvèrent l’un devant l’autre, la dague levée. La collision était imminente. Bruscaille se jeta d’un bond entre eux, les repoussa rudement, et gronda :
– Bas les fers ! Écoutez-moi. Nous ne pouvons rien contre ce qui est, entendez-vous ? Le roi est condamné, il va mourir. Je frapperai, moi. Laissez faire. Brancaillon, tu fermeras les yeux, voilà tout. Ou bien, alors, c’est que, pour sauver ce fou, pour prolonger sa vie de quelques minutes seulement, tu nous condamneras à mort, tous les trois. Suppose que nous refusions d’exécuter l’ordre… nous serons aussitôt remplacés, le roi périra, et nous, imbéciles, nous serons roués vifs. Inutile de résister !
Frappé par ce raisonnement, Brancaillon rengaina sa dague.
– Eh bien, dit-il, en ce cas, nous devons fuir. Nous sommes assez riches pour nous passer désormais de Jean sans Peur. Partons. Si le roi meurt, au moins ne l’aurai-je pas sur la conscience.
– Fuir ! s’écria Bruscaille en haussant les épaules. J’y ai pensé avant toi. Car moi-même, ce n’est pas sans remords que je donnerai le coup mortel à… celui qui est condamné. Mais la fuite même nous est défendue. Savez-vous qui commande dans le palais du roi depuis une heure ? C’est Ocquetonville. Les gardes de Charles sont remplacés par des gens de Bourgogne. En réalité, le roi de France est prisonnier. Rien ne peut le sauver, – ni nous sauver.
Bragaille frémit. Brancaillon lui-même baissa la tête et murmura :
– Pauvre roi !…
Le petit œil gris de Bruscaille étincela : ces mots de Brancaillon, c’était la liberté d’agir.
– Bon ! dit-il. Nous n’avons plus qu’à attendre le coup de midi… Courage, compagnons ! Ce sera notre dernier fait d’armes. Demain, riches de ce qu’on nous a donné ici, riches de ce que nous donnera le duc… quoi ? qu’y a-t-il encore ?
Brancaillon levait la main. Et, le visage décomposé, il murmurait :
– Il y a qu’il me vient une idée… Moi qui ne comprends rien à ce qui se passe ici, je viens du moins de comprendre que nous sommes perdus, même si nous frappons le roi… surtout si nous le frappons !
Bragaille et Bruscaille ne dirent rien, mais leurs yeux parlaient pour eux. Brancaillon continua :
– Que la malédiction soit sur Jean de Bourgogne ! Ce qu’il a inventé est horrible. Puisque ses gens occupent le palais, puisque c’est Ocquetonville qui commande ici, pourquoi le roi Charles n’est-il pas tout simplement saisi et enfermé, ou même mis à mort par les Bourguignons ? Voyons, répondez ?
C’était si simple, si clair, d’une si implacable logique que Bruscaille et Bragaille ne trouvèrent aucune réponse à cette question précise, et se regardèrent avec terreur.
– Vous ne répondez pas ? fit Brancaillon. Je vais vous le dire, moi ! C’est qu’il ne faut pas que Jean de Bourgogne soit l’assassin du roi de France ! Me comprenez-vous ?… C’est qu’il veut être roi, lui ! C’est qu’il ne veut pas soulever le peuple par l’horreur de ce meurtre ! C’est qu’il veut pouvoir montrer à Paris les assassins de Charles !… Le roi mort, Jean sans Peur mettra la couronne sur sa tête et son premier acte sera de venger le défunt en envoyant au bûcher les régicides qui s’appellent Bruscaille, Bragaille et Brancaillon !…
Bragaille et Bruscaille demeurèrent stupéfaits, assommés par ce raisonnement terrible dans sa simplicité. Puis Bragaille murmura : Nous sommes perdus !… Et Bruscaille, se frappant le front :
– Comment n’ai-je pas songé à cela ?… Brancaillon, tu nous sauves !
– Et comment ? fit modestement le pauvre Brancaillon. Je ne comprends pas…
– Il ne comprend pas ! s’écria Bruscaille en levant les bras.
Et, s’emparant avec une tranquille mauvaise foi, du magnifique raisonnement de Brancaillon :
– Tu ne comprends pas, bélître, que si nous ne fuyons pas avant que le roi ne soit mis à mort, c’est nous qui serons jugés et exécutés ? Bouillis ! Étripés ! Roués ! Pendus ! Brûlés ! Tu ne comprends donc jamais rien ! Eh bien, reste, si tu veux. Moi je vais tâcher de fuir…
– Mais tu disais…
– Je disais que nous devons gagner au large ! Et vite ! Midi va sonner !…
En un clin d’œil, les frocs furent roulés et jetés dans un coin. Les trois estafiers apparurent vêtus de la casaque de cuir. Ils ceignirent de fortes et larges rapières pendues au mur. Rapidement, ils se partagèrent leur richesse en parts égales. Puis, Bruscaille, d’un ton bref :
– En route ! Dans quelques minutes, il va pleuvoir des horions !
À ce moment, la porte s’ouvrit, et Ocquetonville parut. Les trois demeurèrent pétrifiés.
– Pas prêts ? dit Ocquetonville en fronçant les sourcils.
– Prêts à tout ! gronda Bruscaille qui, le premier retrouva son sang-froid. Vous voyez, messire, nous attendons le coup de midi, et alors…
– Bien. Au fait, vous n’avez plus besoin des frocs, mes dignes ermites.
– Au contraire, ils nous gêneraient, dit Bragaille.
– Bon, reprit Ocquetonville. Écoutez bien, maintenant. Monseigneur veut qu’après ce que vous savez, on ne vous trouve pas dans Paris.
– Ah ! Ah ! fit Bruscaille en jetant un regard à ses deux compagnons.
– Et d’abord, continua Ocquetonville, voici pour assurer votre fuite.
En même temps, il déposa sur la table un sac qu’il éventra d’un coup de dague. Les pièces d’or et d’argent se répandirent sur la table.
– Partagez-vous cela, drôles ! dit Ocquetonville non sans quelque regret.
Le partage se fit à l’instant même sous la surveillance d’Ocquetonville. Les yeux de Bruscaille pétillaient. Bragaille murmurait : « Que disais-tu donc qu’il allait pleuvoir des horions ? C’est une pluie d’écus… » Quant à Brancaillon, il était sombre.
– Maintenant, voici la fin, reprit Ocquetonville. Vous descendrez par le petit escalier. Vous filerez à toutes jambes jusqu’à la poterne qui donne sur la Seine. Là vous trouverez un homme qui tiendra trois chevaux en main. Vous sauterez dessus. Vous sortirez par la porte Saint-Antoine, et vous irez vous faire pendre où vous voudrez.
– Amen, dit Bragaille.
– Monseigneur, dit à son tour Bruscaille, les ordres seront exécutés. Une demi-heure après l’action, nous serons hors Paris, et ce soir, nous aurons mis entre l’Hôtel Saint-Pol et nous assez de bonnes lieues pour que nul ne nous retrouve. Maintenant, nous avons à faire nos derniers préparatifs. Ainsi donc, si vous voulez nous laisser seuls…
– Je vous laisse, dit Ocquetonville. Mais malgré toute la confiance qu’il a en vous, monseigneur a pensé que peut-être vous auriez besoin d’un coup de main. Aussi, regardez…
Ocquetonville alla ouvrir une porte. Et dans la salle voisine, qui était la seule par où ils pussent sortir de leur chambre, ils virent une douzaine d’hommes d’armes, dont chacun tenait, suspendue à son poignet par une lanière de cuir, une masse de combat, boule de fer agrémentée de huit pointes.
Bruscaille jeta un coup d’œil à Ocquetonville, et, dans son regard, il crut lire une sauvage ironie… une irrévocable condamnation. Sans doute Bragaille et Brancaillon avaient compris aussi, car ils étaient livides.
– Nous sommes gardés à vue ! songea Bruscaille, les sourcils contractés par l’épouvante. Nous allons tuer le roi… et puis, on nous arrête !
Ocquetonville avait disparu. Un silence de mort pesait sur cette partie du palais. Les gens d’armes, immobiles, raidis par l’attente, écoutaient, la masse au poing. Bruscaille, Bragaille et Brancaillon, les cheveux hérissés, la suée de la terreur au front, restaient figés en des attitudes de condamnés attendant le coup mortel…
Soudain, dans ce silence effrayant, là-haut, les rouages du jacquemart se mirent à grincer… Brancaillon poussa un soupir terrible. Bragaille se signa… On put entendre le léger bruit que faisait le marteau en se levant, – et brusquement, ce marteau tomba sur la cloche qui rendit un son large : le premier coup de midi !…
Et à ce moment, on entendit une voix qui criait. La voix du roi ! La voix du fou ! Et cette voix appelait avec un étrange accent de gaieté sinistre :
– Holà ! Où sont mes trois révérends ? Je veux mes ermites ! Par Notre-Dame, je veux rire, moi !…
Le chef des gens d’armes s’avança sur Bruscaille, tandis que là-haut, le jacquemart, lentement, comptait les douze coups de midi, et qu’en bas, la voix du fou appelait ses assassins !…
– Vous entendez ? fit l’homme d’armes.
– Oui ! dit Bruscaille en claquant des dents. C’est midi !…
– Le roi vous appelle !… Allez !… Allez faire rire le roi !… Allez l’exorciser !…
Bruscaille eut un terrible éclat de rire, et d’un geste sauvage, tira sa dague. Il jeta un regard sur Bragaille et Brancaillon, et, d’une voix rauque, il dit : Allons !…
Bruscaille, Bragaille et Brancaillon, la dague au poing, marchèrent sur l’appartement de Charles VI…
À ce moment même, un long cri d’agonie, une déchirante clameur, retentit au loin, dans le palais, venu des appartements d’Odette de Champdivers.
Charles VI l’entendit, cette clameur ! Il se leva tout droit, les yeux exorbités, et à demi-penché, écoutant de tout son être, bégaya :
– On tue quelqu’un !… Qui vient-on tuer dans mon palais ?
Il fit quelques pas vers la porte… Cette porte s’ouvrit brusquement : les trois ermites apparurent.
XXII – MIDI
Souvent, lorsque le lecteur parcourt le récit de quelque « fait divers » sensationnel, il demeure étonné du nombre de figurants mis en scène par le hasard – personnages venus de divers horizons, comme conduits par une volonté inconnue, et se heurtant, s’enchevêtrant dans la même comédie ou le même drame.
Cette heure de midi, qui sonnait au jacquemart du palais de Charles VI, convoquait au nom du hasard, au nom de la profonde volonté du mystère qui régit la pauvre humanité, oui, « convoquait » de multiples personnages qui, vraiment, semblaient accourir à l’appel.
En étudiant l’étrange péripétie de cette journée, l’auteur de ce récit a éprouvé l’étonnement dont il parlait. Il a vu surgir de différents horizons des personnages qui sont venus se heurter au même centre d’action. Il s’est demandé pourquoi et de par quelle volonté, ce jour-là, en cette heure-là, Jean sans Peur, Charles VI, le chevalier de Passavant, le sorcier Saïtano, Isabeau de Bavière, Odette de Champdivers, Laurence d’Ambrun, sans compter les comparses, Ocquetonville, Scas, le trio Bruscaille, et d’autres, tant d’êtres divers et de vouloirs adverses furent conduits au même point – et, renonçant à trouver une satisfaisante réponse, il a dû se contenter de faire une rigoureuse analyse de l’action synthétique.
L’analyse a consisté à séparer les éléments divers de l’action, c’est-à-dire à présenter clairement au lecteur les marches et contremarches de chacun de ces multiples personnages.
C’est donc l’un après l’autre que nous suivrons ces figurants qui agissent à la même heure.
Isabeau de Bavière.
Nous l’avons vue entrer dans le palais du roi, calme, rigide, décidée à jouer toute son existence sur un seul coup, résolue à supprimer Odette ou à être elle-même tuée, parvenue en somme à cet état d’excitation nerveuse où tout s’abolit dans la raison, où la passion devient le seul guide des actes – guide aveugle, ivre, titubant et grimaçant qui se meut par bonds impulsifs.
À peine entrée dans le palais, Isabeau se heurta à Scas.
Tout de suite, elle soupçonna que Jean sans Peur avait aposté des gens pour veiller sur Odette.
– Que faites-vous ici ? dit-elle en grelottant de fureur.
– Eh ! madame, nous sommes ici trente Bourguignons, répondit Scas, et des meilleurs.
Et il cligna des yeux. Il considérait la reine comme complice de son maître, et, dans le feu de l’action, le brave sire de Scas perdait la notion du respect. Il se mit à rire.
– Que faites-vous dans le palais d’Odette de Champdivers ? gronda la reine, livide de rage.
– Le palais d’Odette de Champdivers ! répéta Scas, effaré.
Il ne comprenait pas. Mais il vit très bien que la reine était folle de fureur et qu’elle tourmentait le manche de sa dague. Il s’inclina et, d’une voix basse :
– Non, madame, le palais du roi. Nous tenons le roi. Nous l’enveloppons. Les principaux officiers sont gagnés et nous laissent maîtres du champ de bataille.
La reine eut un long soupir. Si cela était vrai, Jean sans Peur reprenait dans son esprit cette position de lutteur et de conquérant qu’elle avait admirée. Mais était-ce vrai ?
– Ne bougez pas d’ici, dit-elle.
Et elle fit quelques pas vers l’appartement d’Odette, surveillant Scas par-dessus son épaule.
– C’est l’ordre que j’ai reçu, répondit Scas.
La reine tressaillit de joie. Elle s’avança rapidement et entra dans le logis d’Odette. Toutes les portes étaient ouvertes, toutes les salles étaient désertes, comme le jour où Impéria avait été lâchée sur Odette. Maintenant, c’était Isabeau qui venait, autre tigresse, aussi implacable à coup sûr, et sans doute plus redoutable.
Odette, tout à coup, la vit devant elle, et du même coup comprit qu’elle venait la tuer.
La collision se produisit dans la grande salle d’honneur que Charles VI avait donnée à Odette pour qu’elle pût, comme la reine, comme toutes les grandes dames, organiser des fêtes de danse, de musique, cours d’amour, déguisements, récitations de poésies chevaleresques et autres divertissements tels qu’on les comprenait alors.
Mais, avec son tact sûr et sa modestie innée, Odette n’avait jamais employé cette salle, et même elle y entrait rarement, disant qu’elle était venue dans l’Hôtel Saint-Pol pour tâcher de guérir le roi, et non pour y tenir rang de princesse. Elle était là, ce jour, à cette heure, parce qu’étonnée de ne voir aucune de ses femmes répondre à ses appels, elle s’était mise à parcourir son logis.
Elle venait d’entrer dans cette salle de fêtes, large, vaste, ornée de tapisseries, lorsqu’elle vit la reine y pénétrer par la porte en vis-à-vis. La reine marcha sur elle… Odette, toute droite, regarda venir cette figure de crime qu’un sourire rendait plus cruelle.
Elle ne dit pas un mot. Vaguement, elle se demanda s’il y avait pour elle une chance de salut, un moyen de défense, et, comprenant que rien ne la pouvait sauver, elle attendit le coup mortel.
La reine parla d’une voix rauque et brisée. Elle parla, non parce qu’elle avait des désirs ou des pensées à exprimer mais parce que devant cette victime qui s’offrait sans lutte, elle éprouvait, comme tous les scélérats, l’instinctif besoin de s’exciter, de mettre la victime dans son tort. C’est ce que disent tous les assassins : « Si la victime n’avait pas fait ce geste, pas poussé ce cri, je l’eusse épargnée… »
– Nous voici une dernière fois face à face, dit-elle dans un grondement de sons à peine compréhensible ; une dernière fois, je vous demande : voulez-vous vous en aller ? Voulez-vous me laisser seule maîtresse chez moi ? Voulez-vous renoncer au roi ?
C’était la banale insulte. Odette refusa de la relever. Seulement, elle se redressa, croisa ses mains sur son sein et détourna la tête.
Isabeau tira sa dague. Elle trembla de la tête aux pieds. Son visage livide se plaqua de taches terreuses et ses yeux perdirent toute expression. Elle rugit :
– Veux-tu renoncer à Passavant ?…
C’était enfin le cri véritable de son cœur qui jaillissait. Peut-être fût-ce à ce moment seul qu’elle se comprit soi-même et mesura la force de sa haine. Ce mot aussi secoua Odette. Elle frémit. Un éclair illumina son âme et toute la vaillance féminine s’éveilla en elle. D’une voix très calme, très douce, elle répéta :
– Passavant ?…
– Oui ! râla Isabeau. Celui que toutes deux nous aimons !… Renonces-tu à lui ?…
Dans la salle voisine, un bruit de pas précipités. Isabeau, légèrement, tourna la tête, et par la porte restée grande ouverte vit Jean sans Peur. Odette, dans ce moment, de sa même voix de calme, grave et profonde de sincérité, disait :
– Comment pourrais-je renoncer à Passavant, madame, puisque je l’aime ?
Et elle jeta un léger cri. Ce mot « je l’aime » venait, des profondeurs de son cœur, de monter à ses lèvres malgré elle ; Odette ne savait pas qu’elle aimait le chevalier ; la lueur de la mort toute proche éclaira d’un dernier rayon l’image qui s’était érigée dans son âme ; et ce mot qu’elle prononça avec tant de conviction l’étonna, la ravit au point qu’elle ne vit pas luire l’acier… La dague d’Isabeau s’abattit rudement, d’un coup sûrement appliqué.
Odette tomba.
Il y eut le grand cri de détresse de la bête qui passe violemment de la vie à la mort. Dans le même instant, Jean sans Peur fut sur Isabeau de Bavière.
Jean sans Peur.
Il avait suivi la reine de loin, était entré derrière elle dans le palais, avait repoussé d’un geste le sire de Scas qui voulait lui parler, et s’était élancé vers l’appartement d’Odette. Au moment d’y entrer, il eut quelques minutes de lucidité. Il se dit que s’il tentait de sauver la jeune fille, la reine pouvait le perdre, appeler le roi, dénoncer le complot. Il eut même deux ou trois pas de retraite. Ce fut ce qui déchaîna de nouveau en lui la passion. D’un violent mouvement des épaules, il parut jeter bas le fardeau des ambitions. Tout disparut. Et puisque l’homme n’est jamais parfait, même dans la scélératesse, disons qu’en cet instant, une pensée pure fit une soudaine irruption dans l’âme de Jean sans Peur.
– Eh bien, se rugit-il, je renoncerai à elle ! Mais qu’elle ne meure pas !…
Il se rua. Il haletait. Il était échevelé, terrible. Il arriva par bonds insensés, et vit tomber Odette. Une effroyable douleur l’étreignit à la gorge. Sa pensée sombra. Il râla :
– Morte ?… Est-elle donc morte ?…
Isabeau, debout, toute raide, sa dague rouge à la main, d’une voix étrangement paisible, affreusement dure dans cette tranquillité même, répondit :
– Morte, soyez en sûr. Les coups que je donne, moi, ne pardonnent pas.
– Vous l’avez tuée ! dit Jean sans Peur d’une voix morne.
Il était rigide, les cheveux hérissés, les yeux bouffis comme par un afflux de larmes qui ne voulaient pas jaillir. Il s’étonnait vaguement de demeurer tranquille. Et il ne sentait pas qu’en lui, toutes les puissances de la fureur, de la douleur, de la rage, du désespoir, se condensaient comme ces nuages de tempête qui vont former de la foudre. Il ne songeait même pas à se pencher sur Odette. Ses yeux demeuraient fixés sur ce sein d’où coulait un mince filet de sang. Isabeau, avec un sourire féroce, répondit :
– Il n’y a plus rien de vivant entre nous, Jean de Bourgogne : j’ai tué celle que tu aimais !…
– Tu l’as tuée ! gronda Jean sans Peur. Eh bien…
Sa tête s’égara. Il fit quelques pas à droite, à gauche, en râlant, en sanglotant sans pleurer, en jetant des cris inarticulés, et tout à coup, revint à Isabeau.
Il venait de tirer son épée !…
Il répéta : « Puisque tu l’as tuée… eh bien… »
– Je suis morte, songea Isabeau.
La porte par où était entrée Odette, brusquement, s’ouvrit, battit, claqua ; un homme parut, la figure convulsée, flamboyant, terrible, – à peine reconnaissable. Mais tous deux, Isabeau et Jean sans Peur, le reconnurent à l’instant. Et ils vivaient une telle minute de démence et d’horreur qu’ils ne songèrent pas à s’étonner de voir là, sous leurs yeux, taché de sang, les vêtements en désordre comme s’il eût déjà livré bataille, l’homme qui, à cette heure de midi, eût dû se trouver sur l’échafaud de la place de Grève.
De leurs lèvres blanches de terreur jaillit le même cri :
– Passavant ! Passavant !…
– Passavant ! hurla le chevalier. Hardi ! Hardi ! Passavant le Hardi !…
Vit-il Odette étendue aux pieds d’Isabeau ? Se rendit-il compte de ce qui venait de se passer ?
Peut-être ne vit-il qu’Isabeau, d’abord, car l’épée à la main, il se rua sur elle.
D’un bond, la reine se mit hors d’atteinte et cria :
– Jean de Bourgogne ! J’ai tué celle que tu aimais !… Plus rien de vivant entre nous : à toi de tuer celui que j’aimais !…
Au même instant, Jean sans Peur fut devant le chevalier. Les deux épées se choquèrent…
Odette de Champdivers.
Sous le coup de dague, elle était tombée en jetant ce suprême cri d’appel que le roi Charles VI avait entendu à l’instant même où Bruscaille, Bragaille et Brancaillon pénétraient chez lui.
En une seconde, toute pensée s’abolit en elle.
Elle fut néant.
Mais cela dura quelques instants à peine. Au fond d’elle-même, elle eut la vague et confuse perception de sons affaiblis. Elle eut alors l’instinctif et puissant effort de la vie qui se défend, et elle tenta de comprendre ce que signifiaient ces sons…
Elle était immobile, inerte, la vie se retirait d’elle avec le mince filet de sang qui coulait de son sein. Mais le sens des choses s’éveillait après la rapide éclipse. Bientôt elle se rendit compte que ce qu’elle entendait, ces sons lointains, c’étaient les voix de deux hommes. Et elle s’efforça alors de comprendre ce qui se disait.
Elle n’y parvint pas. Elle sentit seulement que c’étaient des éclats de voix hostiles, des grondements ennemis, des sons qui se défiaient, – et un temps s’écoula pour Odette, sur cette sensation, un temps qu’elle eut évalué à une heure peut-être, si elle eût été capable de mesurer la fuite des minutes.
Brusquement, comme par la soudaine ouverture d’une fenêtre sur son cerveau, elle comprit.
Non pas ce qui se disait, mais la personnalité de ces voix. La physionomie des voix lui apparut. Elle eut un long frémissement d’amour et de terreur : l’une des deux voix évoqua Jean sans Peur, et l’autre, le chevalier de Passavant.
Qu’ils fussent là tous deux, en présence, échangeant des sons, elle ne s’en étonna pas…
Mais que ces sons qu’ils échangeaient fussent violemment adverses, précurseurs de mortelle bataille, elle en éprouva une épouvante qui, bientôt après, se transforma en horreur.
Alors, l’effort des puissances vitales, en elle, se centupla, et après une lutte qui lui fut d’une lenteur désespérante elle ouvrit les yeux, elle vit…
Elle vit Passavant, elle vit Jean sans Peur.
Ils étaient face à face.
Elle les vit dans un étincelant tourbillon des chocs d’acier.
Elle les saisit dans leur ruée l’un sur l’autre, exactement comme l’appareil photographique peut faire des gestes rapides en une immobilité instantanée.
Le terrible effort des puissances vitales condensées la souleva. Elle se mit sur les mains. Elle rampa vers la vision des gestes de bataille enchevêtrés parmi les éclairs des épées. Elle se souleva encore et enfin elle fut debout, les mains tendues…
L’effort se brisa soudain ; elle tomba en avant, les bras ouverts.
Ces bras s’abattirent sur deux épaules, elle sentit qu’elle enlaçait frénétiquement une tête et que, dans une explosion de douleur, d’horreur, d’amour, elle criait des paroles…
*
* *
Dans cet essai de restitution de l’état d’être au cours d’une agonie, nous avons nécessairement employé les mots qui s’adaptaient à l’idée qu’Odette pouvait se faire des choses en cet état, – notamment en ce qui concerne les durées. Pour elle, c’était « bientôt », ou « après », ou « minutes », ou « heure », ou « temps long ». Dans la réalité, ce fut comme une succession de décharges électriques dans sa sensation. Tout ce long effort, depuis le coup de dague, jusqu’au moment où Odette, debout, enfin, retomba les bras en avant et cria quelque chose en jaillissement de paroles affolées, demanda peut-être une quarantaine de secondes au plus.
Passavant.
Escorté du geôlier, il arriva en vue du palais du roi. Il se tourna un instant vers la Huidelonne et vit au loin la troupe d’archers qui atteignait la tour.
– Ils vous cherchent, dit le geôlier, pour vous conduire en place de Grève. Dans quelques instants, on saura votre évasion et ma fuite. Moi, ça m’est égal. Mais vous !…
– Eh bien, quoi, moi ? fit en souriant le chevalier.
Il respirait le bonheur. L’air libre lui fouettait le visage. Et cet air qu’avait respiré Odette l’enivrait.
– Ce n’est pas tant pour vous… reprit le geôlier en cherchant ses mots pour exprimer le fond de sa pensée.
Passavant eut un rire clair et sonore, le rire de bonheur, dans l’insouciante gaieté de la jeunesse.
– Mon brave maître-ès-armes, dit-il, vous maniez convenablement une épée, mais vous avez le tort de palabrer par paraboles. Vous n’êtes pas l’un des quatre évangélistes, je pense ?
– Je veux dire… bredouilla le colosse, que vous mourriez, vous, j’en aurais de la peine, c’est sûr, mais enfin, je m’en consolerais, que diable !… tandis que…
– Merci ! dit le rire du chevalier. Tandis que ?…
– Tandis que si elle meurt, elle, eh bien, jamais je ne m’en consolerais ! Tenez, je puis bien vous le dire, ce n’est pas pour vous que je vous ai donné la liberté, c’est pour elle…
– Ah ! palpita Passavant. Et pourquoi mourrait-elle ?
– Elle mourra si vous mourez. J’en suis sûr. Ne vous l’ai-je pas dit ? Quand elle venait me voir là-bas, dans mon enfer, sous toutes ses paroles, je sentais qu’elle parlait de vous. Il n’y a que vous au monde pour elle. Vous disparu, que voulez-vous qu’elle devienne ?
Passavant buvait ses paroles comme il buvait l’air pur, l’air de la vie, l’air enivrant de la liberté. Il fût resté là des heures à écouter la lourde voix du geôlier, ineffable musique.
– Si vous m’en croyez, continua le colosse de la Huidelonne, vous sortirez tout de suite de l’Hôtel Saint-Pol par un chemin que je sais, vous vous cacherez quelque part dans Paris, et…
– Silence ! gronda Passavant.
La reine !… Elle se glissait, solitaire et sombre, à vingt pas du massif épais derrière lequel ils s’étaient arrêtés. Elle disparut dans le palais du roi.
– Vous avez vu ? dit le geôlier. Si vous entrez, vous êtes perdu.
– Allons, fit Passavant.
Il allait s’élancer. Le geôlier le saisit par le bras, et souffla :
– Venez ! Ah ! venez !… Tenez, regardez qui vient là-bas…
– Jean de Bourgogne, murmura sourdement le chevalier.
– La mort ! dit le geôlier.
Jean sans Peur entra dans le palais. Le chevalier passa une main sur son front, et murmura :
– Ces figures qu’ils ont tous deux !… Il se prépare quelque chose de terrible… Isabeau, Jean sans Peur, Odette…
Il eut un brusque mouvement. Une soudaine sensation d’angoisse l’étreignit à la gorge, un de ces violents et rapides pressentiments qui s’abattent sur un homme aux heures de surexcitation nerveuse. Et, avec une foudroyante soudaineté, il « sentit » qu’Odette l’appelait… Il râla : « Elle est en danger !… » et s’élança.
Le geôlier le suivit.
D’une course rapide, Passavant atteignit l’entrée du palais, et s’y engouffra.
Toutes les précautions prises par Isabeau de Bavière pour isoler Odette, pour que cette partie du palais fût déserte et sans secours possible, ces précautions, la volonté mystérieuse du hasard sembla les avoir établies uniquement pour Passavant.
– Par ici ! dit le geôlier qui, dès qu’ils furent dans le palais, prit les devants et lui montra le chemin des appartements d’Odette…
– Halte ! gronda une voix. Arrière ! Oh ! Passavant !…
– Scas ! cria le chevalier.
Une seconde, Scas demeura hébété de stupeur. Il bégayait : Démon ! Démon !… Presque aussitôt, cette impression d’effarement terrifié disparut ; un éclair venait de luire : l’épée de Passavant !
– Défends-toi si tu peux ! cria le chevalier.
Au même instant, ils furent l’un sur l’autre, les deux fers cliquetèrent et d’une voix de tonnerre, Scas hurla : « Monseigneur ! Monseigneur ! Prenez garde !… »
Et il porta un furieux coup de pointe à Passavant qui bondit en arrière. Scas éclata de rire.
– À nous la petite Odette, grogna-t-il avec des intentions d’insulte plein la voix. Monsieur arrivera trop tard !
– J’arriverai ! rugit le chevalier.
Et il se fendit à fond. Scas tomba en arrière, les bras en croix, sans un soupir, sans une convulsion, frappé de mort foudroyante… Le chevalier se rua en avant, sautant par dessus le corps. Le geôlier se pencha, toucha Scas, le considéra une seconde et murmura avec un étrange sourire :
– Un seul coup, droit au cœur !…
– Hardi ! Hardi ! Passavant le Hardi ! hurlait le chevalier comme pour informer Odette du secours qui arrivait.
Il poussa une porte entrebâillée, d’un violent coup de pied, et, l’épée rouge à la main, marcha sur Jean sans Peur.
Il y eut, comme nous l’avons dit, quelques cris brefs, quelques exclamations inarticulées, et, tout de suite, la bataille commença entre Jean de Bourgogne et Passavant. Le duc était un rude ferrailleur, ferme comme un roc. Il subit sans broncher le furieux assaut du chevalier. Son œil sanglant cherchait le passage pour l’atteindre à la poitrine. La volonté de tuer était formelle dans ce regard. Une minute, ce fut un éblouissement d’éclair, un crépitant rappel de chocs d’acier. Passavant était un vivant tourbillon. Sans doute, dans un rapide coup d’œil de côté, il vit Odette étendue, car on l’entendit soudain sangloter, jeter des cris déchirants ; sa figure devint livide, et ce fut horrible, alors, cet homme qui se reculait pour l’élan, se précipitait comme un bélier, attaquait à droite, à gauche, cherchait à tuer, tout cela en sanglotant éperdument.
Devant ce furieux tourbillon, devant cette tempête d’où jaillissaient des fulgurations, Jean sans Peur recula ; bientôt, il fut acculé au mur…
À ce moment, Isabeau se mit en marche, la dague au poing ; elle vint, par derrière, sur le chevalier, et la dague qui avait tué Odette, elle la leva sur Hardi de Passavant. Elle gronda :
– Meurs ! Meurs avec celle que tu aimes !…
Et son bras demeura suspendu sans s’abattre. Un étau de fer serrait le poignet. Quelqu’un avait happé la reine et la tirait en arrière. Isabeau, écumante, se retourna et vit le geôlier impassible, vraiment impassible, et, chose stupéfiante, infiniment respectueux. Il poussa la reine dans l’angle opposé et dit :
– Majesté, laissez faire, ou je vous tue…
Dans cette seconde, Jean sans Peur, haletant, désemparé, fou de rage, vit qu’il allait mourir. Son épée sauta. Il vit le fer de Passavant se lever pour le coup suprême… et alors… Passavant demeuré figé, les yeux agrandis, l’esprit exorbité…
Les deux bras d’Odette venaient de l’enlacer au cou…
Odette criait. Dans une explosion de toutes les forces d’amour et de douleur condensées en elle, Odette criait ceci :
– Passavant ! Passavant ! Laisse-moi mourir, mais ne tue pas mon père.
Les trois ermites.
Comme on a vu, ils étaient entrés chez le roi, décidés à le tuer. Ocquetonville était là, derrière la porte, qui surveillait. Et il avait douze hommes d’armes avec lui. Les trois ermites étaient donc acculés au suprême geste d’exorcisme qui devait délivrer le roi de la folie, et de la vie. Bruscaille était terrible. Bragaille était ferme et se disait qu’après tout il n’était pas à son coup d’essai. Brancaillon pleurait…
Tous trois s’avancèrent. Le roi ne les reconnut pas tout d’abord à leurs physionomies convulsées. Puis, tout à coup :
– Oh ! pourquoi sans vos frocs qui vous vont si bien ?…
Il eut un cri d’épouvante :
– Pourquoi ces dagues ?
Ils ne répondirent pas. Bruscaille, le premier, leva la dague…
– Hardi ! Hardi ! Passavant le Hardi !…
La lointaine clameur les pétrifia. Ils s’arrêtèrent, haletants, l’oreille tendue.
– C’est lui ! dit Brancaillon.
– Que me voulez-vous ? râla le roi. À moi ! À moi ! On veut me tuer !…
– Hardi ! Hardi ! Passavant le Hardi ! répéta la clameur qui les avait immobilisés.
– C’est lui ! rugit Brancaillon. C’est lui ! Il nous appelle !
– Mort du diable ! vociféra Bragaille, quand il nous appelle, nous ne connaissons plus de maître !
– Allons ! hurla Bruscaille.
Ils firent demi-tour et s’élancèrent. Le fou les vit disparaître, vision enchevêtrée de gestes furieux, et il demeura pantelant, sous le coup d’effroi de ce cauchemar soudain apparu et plus soudainement évanoui.
En bonds rapides, les trois se ruèrent vers le point d’où était partie la clameur, c’est-à-dire qu’ils sortirent par la porte opposée à la salle où attendait Ocquetonville.
Bruscaille, Bragaille et Brancaillon atteignaient la salle d’honneur des appartements d’Odette. D’un coup d’œil, ils virent la scène. La forte rapière à la main droite, la dague au poing gauche, ils apparurent, formidable trio d’estafiers capable à ce moment de tenir tête à une armée.
Mort du roi fou.
Ocquetonville, cependant, écoutait. Il était revenu là, sans doute à la suite d’ordres reçus. L’oreille à la porte du roi, il écoutait la bataille que livrait le fou contre les trois assassins. Et sans doute ce qu’entendait Ocquetonville devait être terrible, car ce rude homme d’armes, ce spadassin habitué aux clameurs de détresse, frémissait et, de temps en temps, essuyait une petite suée froide qui lui glaçait le front. Parfois il se redressait et grognait :
– Mort-dieu, comme il se défend ! Il ne veut pas mourir, le bougre !…
Et puis il se remettait à écouter l’affreuse bataille.
Le fou se battait contre les trois ermites.
Il les avait reconnus au moment où ils s’étaient mis à fuir vers ce grand cri de Passavant qui les appelait. Il commença la bataille au moment où ils disparurent. Ce fut quand ils se furent élancés qu’il reconstitua leur volonté de meurtre. Ils n’étaient plus là et, alors seulement, il vit dans leurs yeux qu’ils venaient pour le tuer, il vit leurs mains armées de dagues, il comprit pourquoi ils ne portaient plus le froc d’ermite ; un instant, « il les regarda », tendit ses mains vers Brancaillon et murmura : « C’est pour me faire rire, n’est-ce pas ? »
La seconde d’après, l’épouvante l’empoigna, et il sombra dans la crise, gouffre de démence où sa pensée tomba en tournoyant comme un oiseau blessé.
Les yeux du fou s’exorbitèrent, ses traits convulsés formèrent un masque d’horreur, sa bouche écuma ; d’un bond terrible, il se mit hors d’atteinte des trois ermites, et il se ramassa dans un angle, la dague à la main, et dès lors il entra pleinement dans la réalité des images créées.
Il vit les assassins, au milieu de la salle, se concerter, se montrer la victime du doigt, avec une formidable tranquillité. Bruscaille disait :
– Le roi de France ne reconnaît pas en moi le fantôme de la forêt du Mans.
– Égorgeons-le, disait Bragaille, et puis nous le remettrons au maître des chimères.
– Je crois, disait Brancaillon, qu’il vaut mieux le tuer en le faisant rire.
– À moi ! hurla alors le roi. À moi ! Je suis le roi ! On égorge le roi ! À moi, capitaine ! gardes ! À moi, fantômes amis ! À moi, chimères de mes nuits ! Ha ! Truands ! Traîtres ! Qui vous paie ? Ha ! vous avez peur de frapper le roi ! Je suis le roi, le roi des batailles, vous allez voir !
Il se tut, haleta, médita un instant qu’il fallait profiter de leur hésitation, et soudain il se rua sur eux, la dague haute. Et ce fut effroyable. Les coups qu’il assénait dans le vide faisaient gicler le sang. En bondissements frénétiques, il parcourut la salle, renversant les tables, les fauteuils, frappant, vociférant ; Brancaillon l’étreignit par derrière ; mais, avec un rugissement de victoire, il se débarrassa de l’étreinte, se baissa, saisit le colosse par les pieds et le fit tournoyer, et Brancaillon riait d’un rire de tonnerre. Ce rire de plus en plus violent tordait les nerfs du roi. Il vociférait :
– Tourne ! Tourne dans la mort ! Ha ! Voici que tu n’as plus de tête ! Du sang ? Trop de sang ! Non ! Pas assez !
Brusquement, Brancaillon s’évanouit, se dissipa comme une fumée, et le roi poussa des cris déchirants parce que Bruscaille et Bragaille, paisiblement, se mettaient à lui ronger la poitrine. Tout à coup reparut Brancaillon qui, par une large et béante blessure à la gorge, lui versa des flammes.
– À moi ! On me brûle ! Oh ! c’est l’enfer !… À moi, fantôme ! Je vous dis qu’ils ont blessé le roi ! Le roi va mourir ! On tue le roi !…
Il trébucha parmi les débris de meubles effondrés, s’abattit dans un coin, et pantela quelques secondes, dans une sorte de silence. Alors il vit les trois assassins lever ensemble des dagues d’une longueur démesurée. Ils ne frappèrent pas. Mais les dagues, se tordant comme des serpents de feu, descendirent vers lui et enfin l’atteignirent, le pénétrèrent lentement. Et il jeta une dernière clameur :
– Je suis mort !…
Puis Ocquetonville n’entendit plus rien. Il écouta encore quelques minutes, et alors, se redressant lentement, tout pâle, il dit à ses hommes :
– C’est fait. Le roi est mort !
– Dieu ait son âme ! dit sincèrement l’un des gens d’armes.
Et tous se signèrent.
Doucement, Ocquetonville entrouvrit la porte et se hasarda à passer la tête. Il vit la salle encombrée de débris, la panoplie arrachée, une table, là-bas vers la fenêtre, les pieds en l’air, le grand bahut de gauche sur le flanc, un entassement de fauteuils vers le fond à droite, et un peu partout des morceaux de menus meubles fracassés… La bataille avait été rude.
Enfin, il découvrit le roi dans un fond obscur. Il était couché sur le côté gauche, inerte, un bras replié, l’autre allongé, la main crispée encore au manche de la dague. Inquiet, il murmura :
– Où sont-ils ?…
Où étaient les assassins ?… Au fond, face à lui, il vit tout à coup l’autre porte ouverte, et il tressaillit.
– Ah ! fit-il à mi-voix, ils ont deviné ce qui les attendait. Ils ont fui par là. Bah ! on les retrouvera. Toutes les issues de l’Hôtel Saint-Pol sont gardées.
Ocquetonville eut un mouvement comme pour entrer dans la salle. Puis il recula. Il n’osait pas !… Il frissonnait à la pensée de s’approcher de ce mort. Car ce mort, c’était encore la Majesté, la Puissance, la presque Divinité… C’était le Roi !… Doucement, comme il l’avait ouverte, il referma la porte… il la referma à clef. Et il dit :
– Allons annoncer à monseigneur que le roi est mort !
Si Ocquetonville était entré dans cette salle où l’on venait d’assassiner le roi de France, dix minutes plus tard environ, il eût vu un étrange spectacle : le roi assis sur le tapis, à l’endroit même où il était tombé, le roi manipulait activement sur ses genoux des carrés de carton armoriés et enluminés. D’une voix rapide, il murmurait : « Où est ce Gringonneur du diable ? Je veux voir Gringonneur. Je veux lui montrer ce coup superbe… »
Le roi jouait aux cartes.
XXIII – ROSELYS
Midi sonnait. Nous avons fixé le geste de chacun des figurants. Supposons maintenant tous ces figurants immobilisés en ce geste comme par un brusque arrêt du cinéma ; les gestes s’achèveront lorsque la bande se remettra à se dévider. Il faut pour cela que quelqu’un vienne actionner l’appareil.
Midi, lentement, tintait au jacquemart du logis royal, répété par les horloges des autres palais de l’Hôtel Saint-Pol, répété au loin par l’horloge fameuse du palais de la Cité, par les horloges aussi de quelques églises déjà munies de cet ornement.
Sur Paris, pesait un orageux silence du fond duquel, parfois, montaient des bouffées de rumeur.
La foule houleuse, sur la place de Grève, attendait le condamné. Sur l’échafaud, le remplaçant de maître Capeluche allait et venait, nerveux, impatient.
Au premier rang du populaire massé contre la barrière d’archers, Tanneguy du Chatel attendait aussi, roulant des pensées héroïques, rêvant de bousculer à lui seul tout ce peuple pour sauver son ami.
Dans la Cité, des groupes de mariniers et de bouchers, distribués par bandes disciplinées, attendaient, elles aussi, le signal de l’émeute que devait donner le gros bourdon de Notre-Dame.
Dans l’une des rues qui débouchaient sur le Val d’Amour, rue pleine de neige, enfouie dans le silence, en l’un de ces pauvres logis qu’habitaient des filles folles de leur corps, comme on disait alors, une scène venait de se dérouler, et nous devons la retracer.
Vers neuf heures du matin, Saïtano était entré dans cette rue, escorté d’un homme qui le suivait pas à pas. Le sorcier, en diverses maisons, entra, et s’enquit d’une femme qu’il dépeignit avec exactitude : il était sur la piste de Laurence d’Ambrun.
Ce fut ainsi qu’il parvint au logis d’Ermine Valencienne. Il pénétra dans la maison, entra chez Ermine, et quand il eut constaté que Laurence était là, il redescendit pour donner un ordre à son compagnon. Cet homme s’élança vers la rue Saint-Antoine et arriva bientôt au logis de Tanneguy du Chatel. On a vu qu’il ne trouva pas le capitaine…
Le sorcier était monté chez Ermine…
Laurence était là, ou plutôt, alors, Jehanne Trop-va-qui-dure. Elle tremblait devant Saïtano, comme une pauvre bête peut trembler devant le dompteur. Elle eût voulu fuir, et elle sentait bien qu’elle n’en eût pas eu la force, que le sorcier n’avait qu’à la toucher du doigt pour l’immobiliser.
Ermine murmura une prière, et, réconfortée sans doute, elle se plaça entre Saïtano et Laurence.
– Je sais qui vous êtes, dit-elle d’une voix ferme. Souvent, lorsque je vous voyais passer à la tombée de la nuit, dans votre manteau rouge, pareil à un spectre venu pour tourmenter les vivants, je m’enfuyais, et bien d’autres avec moi, et des hommes aussi. On connaît votre puissance. On sait que vous avez fait un charme contre le prévôt et l’Official. Sans quoi, vous laisserait-on aller et venir comme une menace toujours suspendue sur l’âme des chrétiens ? Maintenant je n’ai pas peur de vous, et je vous dis : Que voulez-vous à Jehanne ?… C’est mon amie. Elle m’a dit son histoire, et ce qu’elle a souffert près de vous. Quels sont vos projets ? Sûrement, Jehanne est une dame. D’abord, elle sait broder, lire, écrire. Ensuite, ce qu’elle dit, et sa voix, et ses manières, tout prouve qu’elle est de noblesse. Vous avez voulu en faire une fille… comme moi !… Pourquoi ?…
Ermine s’arrêta, étonnée d’en avoir tant dit en une seule fois, étonnée de son propre courage.
Saïtano l’écoutait, immobile, un vague sourire aux lèvres. Peut-être lui aussi admirait-il la vaillance d’Ermine.
– Sachez-le, reprit-elle toute frémissante, vous n’avez pas réussi. Jehanne n’a habité qu’une heure la rue Trop-va-qui-dure où vous l’aviez jetée. Depuis que je l’ai rencontrée, elle habite avec moi, près de moi, et elle m’a sauvée. Que lui voulez-vous, maintenant ?
– La sauver comme elle vous a sauvée, dit Saïtano. Lui rendre ses droits. Et pour cela, lui rendre la mémoire… la mémoire de ce qu’elle est.
– La mémoire ? balbutia Ermine.
– Vous ne comprendriez pas, et je n’ai pas le temps. Vous n’allez pas me gêner, j’espère ! Si vous voulez que votre amie soit sauvée, il faut me laisser seul avec elle.
– Non ! dit Ermine avec force.
Saïtano eut un geste d’impatience et grommela on ne sait quoi.
– Eh bien, dit-il, vous resterez. Asseyez-vous dans ce coin là-bas, et n’en bougez plus, ou je ne réponds pas de la mémoire de Laurence.
– La mémoire ? répéta Ermine. Laurence ?… Que va-t-il se passer ?…
– Ermine ! Ermine ! cria Laurence. Ne m’abandonne pas !
Saïtano, rudement, prit Ermine par le bras, la conduisit, la fit asseoir. Il gronda :
– Rappelez-vous bien ceci. Un mot, un geste de vous pendant que je parlerai à Laurence peuvent la tuer ou la rendre démente pour toujours. Ainsi, tenez-vous en paix, et si vous aimez cette malheureuse, remerciez Dieu que ses intérêts se confondent aujourd’hui avec les miens.
Grelottante de terreur, Ermine s’immobilisa. Le sorcier se tourna vers Jehanne, et, d’une voix forte, en marchant sur elle, il dit :
– Eh bien, Laurence d’Ambrun, que faites-vous ici, tandis que Roselys vous attend et vous appelle ?…
Ermine put alors constater que celle qu’elle appelait Jehanne, celle que le sorcier appelait Laurence d’Ambrun, semblait s’apaiser. La voix du sorcier paraissait avoir dissipé toute terreur. Paisible, étonnée seulement, Laurence considéra un instant le sorcier, et, d’une voix calme, répondit, comme si elle débitait une leçon :
– Mieux que personne, vous savez qui je suis. Mon nom est Jehanne. J’habite depuis des années la rue Trop-va-qui-dure. Dans le coffre de ma chambre sont mes ajustements et ma ceinture d’argent. Je vis seule. Demandez à tout le monde dans la rue, on vous dira que j’habite ce logis depuis douze ans.
– C’est faux ! murmura Ermine stupéfaite de ces « mensonges. »
Le sorcier s’approcha de Laurence, la toucha à la tête d’une lente pression renouvelée plusieurs fois, puis, lui prenant les deux mains :
– Regardez autour de vous, éveillez-vous ! Que voyez-vous ?… Où êtes-vous ?…
– Mais dans mon logis de la rue Trop-va-qui-dure !
– Vous êtes dans le logis Passavant, dit Saïtano d’une voix de rude autorité. Voyez ce qui est. Ne mentez pas !
– Je ne mens pas, bégaya Laurence. Je ne veux pas mentir.
Elle frissonnait maintenant. Ses dents claquaient. Ermine, épouvantée, ne songeait même plus à réciter ses prières. Saïtano, livide de l’effort qu’il faisait, le visage couvert de sueur, étreignit les mains de Laurence.
Et elle, alors, avec un cri de terreur :
– Oh ! mais nous sommes deux, ici !… Nous sommes deux en moi !… Il y a en moi l’âme de Jehanne… et l’âme de Laurence !…
– L’âme de Laurence seule ! gronda le sorcier. Jehanne est une imposture !…
– Double ! râlait Laurence. Je suis double !…
C’était vrai. L’effort de Saïtano avait été suffisant pour réveiller à demi la personnalité de Laurence et abolir à demi la personnalité de Jehanne. Sur l’écran de sa mémoire, une double image se projetait. Son cerveau devenait le champ de bataille où deux entités se prenaient corps à corps. Les souvenirs artificiels créés par Saïtano persistaient à ne pas mourir. Les souvenirs naturels s’éveillaient. Et ces deux états d’existence enchevêtrés vivaient l’un contre l’autre, cherchant à se détruire.
Celle en qui se livrait cette bataille de deux êtres dissemblables palpitait comme si vraiment elle eût été piétinée, foulée par deux ennemis. Saïtano la considérait avec l’intense curiosité du savant qui se trouve en présence d’un phénomène inconnu. Peut-être pendant quelques minutes oublia-t-il pourquoi il était venu, et ce qu’il attendait de Laurence.
– Double ? songeait-il. Sans doute… Et pourquoi pas ? Puisque la conscience de l’être humain réside uniquement dans la mémoire, puisque le souvenir est le seul élément de la vie de l’âme, si deux souvenirs peuvent cohabiter une âme, cette âme est double. Elle possède deux personnalités… Et qu’arriverait-il si je laissais cette femme en cet état ?
Mais sans doute, en ce jour, la science passait au second plan dans l’esprit du sorcier, car bientôt, il se reprit. Et tandis que Laurence se débattait sous l’assaut des deux êtres dont chacun voulait triompher, le sorcier, sans plus s’occuper d’elle, se mit à préparer dans un gobelet un mélange de trois flacons dont il versa des gouttes soigneusement dosées. Il est à supposer qu’il avait prévu une résistance dans la mémoire de Laurence puisqu’il avait emporté ces flacons.
– Buvez, dit-il tout à coup à Laurence.
Elle obéit aussitôt. Et alors, Saïtano répéta :
– Roselys vous attend. Roselys vous appelle. Laurence d’Ambrun, ne voulez-vous pas voir votre fille qui vous appelle ?… Votre fille !… Roselys !… Roselys !…
– Roselys ! interrogea Laurence.
Au loin, tout au loin, vers les plus lointains horizons de sa mémoire, se dressa une image pâle, faible, à peine perceptible, fantôme sans consistance, souvenir qui n’avait encore ni chair, ni os…
– Roselys ? murmurait Laurence avec étonnement.
Vraiment, elle s’écoutait prononcer ce nom, elle tâchait d’y découvrir une mélodie connue. Les alarmes que lui avait causées la dualité de sa mémoire s’apaisaient. Elle semblait surtout étonnée.
L’image formée dans les lointains de son souvenir se précisa, se rapprocha des premiers plans.
Saïtano, d’un accent plus rude, prononçait les paroles qui devaient provoquer la nouvelle association d’idées :
– C’est donc ici l’oratoire du logis Passavant… C’est ici qu’a été célébré le mariage de Laurence d’Ambrun avec Jean de Bourgogne. Qu’est devenu le prêtre qui consentit à la cérémonie sacrilège ? Il est mort, Laurence ! Et morts tous les témoins dont la présence achevait de vous persuader. Tous morts, excepté un !
Laurence écoutait avec une intense attention. Le prodigieux travail qui s’accomplissait en elle la faisait panteler comme si l’air eût manqué à ses poumons.
Il ne s’agissait pas de la faire passer de la folie à la raison… Laurence n’était pas folle.
Il s’agissait de la faire passer d’un état de mémoire à un autre ; le premier étant artificiel, et le second naturel. Les drogues du sorcier, ses passes magnétiques, ses pressions sur la tête et surtout en arrière dans la région du cervelet avaient accompli ce prodige de transformer la personnalité de Laurence – exactement comme il y a sûrement transformation de personnalité consciente en certains cas de folie ; mais Laurence n’était pas folle ! La physionomie des paroles demeurait toute puissante, et Saïtano répétait :
– C’est ici que la reine Isabeau de Bavière vous a fait boire le poison. C’est ici que vous avez été frappée du coup de poignard de votre amant Jean sans Peur. C’est ici que vous avez été séparée de Roselys. Où est maintenant votre fille ? Roselys vous appelle. Et vous, Laurence d’Ambrun, vous hésitez à rejoindre votre fille.
– Je n’hésite pas, râla Laurence en se tordant les mains. Je ne sais pas !…
– Mais vous savez maintenant que vous avez une fille ?
– Oui, oui ! haleta Laurence. Et je sais qu’elle s’appelle Roselys…
– Qu’est devenue Jehanne ? Dites-le franchement. Je vous ai sauvée déjà, je puis vous sauver encore. Répondez donc avec assurance et vérité. Il faut que je retrouve Jehanne de la rue Trop-va-qui-dure. Vous l’avez longtemps connue…
– Jamais ! dit Laurence avec force. Je le jure. Je n’ai jamais connu celle dont vous parlez.
Ermine poussa un cri de terreur folle et se laissa glisser à genoux, les yeux ardemment fixés sur une de ces pauvres images de la Vierge, telles que les enlumineurs populaires, aussi nombreux que nos imprimeurs, en vendaient alors pour des prix pourtant assez élevés.
– Ah ! gronda Saïtano ivre de joie, tu peux crier, maintenant !
C’était la joie du savant. Une minute, le sorcier demeura haletant, s’essuyant le front, et contemplant avec orgueil cette créature dont il avait pétri la conscience à son gré.
– Conscience humaine ! cria-t-il en lui-même. Génie, folie, grandeur d’âme, pauvreté d’esprit, pensée de crime ou de beauté, aspirations de cette larve qui rampe dans l’inconnu, tentatives dérisoires vers le bien ou vers le mal, vous n’êtes qu’une question de quantité. Le calcul des éléments qui composent un cerveau peut fixer avec certitude ce qui jaillira de là : pensée de lumière ou de ténèbre. Moi-même, savant qui crois savoir, sorcier triomphant, si tel lobe de mon cerveau s’était trouvé plus ample ou plus étroit d’une imperceptible fraction, je serais idiot. Haine, amour, affections, répulsions, vous n’êtes que des spasmodiques convulsions du ver cherchant inutilement parmi l’immensité des fanges un but qui n’existe pas…
Ermine priait à haute voix.
– Tais-toi, lui dit doucement le sorcier. Tu me gênes…
Laurence ne priait pas, ne criait pas. Elle considérait toutes choses autour d’elle avec une sorte de stupeur. Jehanne n’existait plus en elle… Saïtano la prit par une main et murmura :
– Savez-vous maintenant votre nom ?
Elle se prit à pleurer des larmes qui furent de plus en plus amères, et elle dit :
– Mon nom est malheur. Pourquoi m’avez-vous éveillée ? Sachant que je suis Laurence d’Ambrun, je sais aussi que ma fille est morte, et que ma vie est une morne plaine de désolation.
Elle sanglotait. Il lui semblait que tout était à recommencer dans son malheur, et que l’apaisement des ans n’existait plus pour elle. Et elle pleurait :
– Ma fille, ma petite Roselys, vous le savez qu’elle est morte… Pourquoi me…
Elle se tut. Et Saïtano, attentif, repris tout entier par la passion de son œuvre :
– Vous l’aimez donc bien, votre petite Roselys ?…
Laurence eut un cri déchirant – le cri même qu’elle eût pu avoir si, en cet instant même, Roselys fût morte sous ses yeux. C’était le chef-d’œuvre de Saïtano. Laurence aimait sa fille exactement comme douze ans auparavant.
Les longues années écoulées, pour Laurence comme pour tout être humain, devaient avoir effacé l’impression de douleur. Mais pour Laurence, en ce moment, cette impression était vivante, contemporaine de la mort de Roselys. Alors, le sorcier porta le dernier coup :
– Laurence, on vous a trompée. Roselys n’est pas morte. Roselys vous appelle. Elle est en danger.
– En danger ? Ma fille ? cria Laurence, oubliant que l’instant d’avant Roselys était morte.
– En danger, répéta fortement le sorcier. Voulez-vous la sauver ?
– Courons ! haleta Laurence.
– Un instant. Pour sauver Roselys, il faut frapper votre amant. Hésiterez-vous ?
– Donnez-moi une arme ! dit Laurence, d’un accent farouche.
– La voici ! dit le sorcier.
Laurence recula, étonnée. Elle frémissait. Elle voulait s’élancer, courir au secours de sa fille. Elle haïssait ce sorcier qui ne la conduisait pas à l’instant à Roselys. Elle lui demandait une arme pour sauver sa fille, et le maudit lui tendait un parchemin !…
– Ceci ? bégaya-t-elle. Qu’est-ce ? Un chiffon de papier ! Pour frapper Jean de Bourgogne ! Prenez garde, enfin ! Vous ne savez pas de quoi est capable une mère exaspérée !
– Je le sais ! dit Saïtano. Et c’est pourquoi j’ai confiance en vous. Écoutez, écoutez de toute votre force, de tout votre être, car les minutes sont comptées, et je n’ai pas le temps. Aujourd’hui, votre amant est le maître dans Paris et dans l’Hôtel Saint-Pol…
– Son rêve ! Son ancien rêve ! bégaya Laurence.
– Ah ! Vous êtes « vous » tout entière, puisque vous vous rappelez ceci ! Son rêve, oui ! Son rêve se réalise. Il est le maître. Ses bandes vont se déchaîner…
– Dans ; le carnage ! Dans le sang ! râla Laurence.
– Oui ! dit Saïtano étonné à son tour. Ceci, maintenant : Jean sans Peur a une complice…
– Isabeau ! cria Laurence, secouée de frissons. La reine Isabeau !
– Vous l’avez dit ! Ceci, maintenant : votre fille Roselys habite l’Hôtel Saint-Pol. Comment ? Pourquoi ? Plus tard vous le saurez. Elle est là, voilà tout. Isabeau la hait. Comprenez-vous ? Pour donner la couronne à Jean de Bourgogne, sa première condition est que Roselys soit sacrifiée.
– Courons ! hurla Laurence.
Saïtano la saisit par un poignet et la maintint.
– Que ferez-vous ? Atteindrez-vous Jean de Bourgogne au milieu de ses gens d’armes ? La dague dont vous le frapperiez traverserait-elle sa cuirasse ?…
– Maudits ! râla Laurence épuisée. Qu’ils soient maudits tous deux !… Venez… Si ma fille meurt, j’aurai du moins la consolation de mourir avec elle…
– Vous pouvez la sauver, vous sauver… avec ceci ! Lisez !…
Et cette fois, Laurence prit le parchemin. Ses yeux embués de larmes, lentement, déchiffrèrent l’écriture. Et alors, un long moment, elle demeura figée, morne, insensible, avec seulement le tremblement de ce parchemin au bout de ses doigts. Saïtano, avec une sorte de gravité, reprit :
– Jean sans Peur brûla les actes de mariage dans l’oratoire du logis Passavant, mais celui-ci lui échappa. Lorsque je vous trouvai, sanglante, je vous soulevai dans mes bras, et je vis ce parchemin que cachait un pli de votre robe. Voici donc l’acte de mariage qui vous unit à Jean de Bourgogne. Il est en règle. Il porte la signature du prêtre, la signature de l’époux et la vôtre, la signature des témoins… la signature de la reine ! Comprenez-vous qu’avec ce parchemin vous pouvez tuer Jean de Bourgogne ? L’époux de Marguerite de Hainaut, en signant cet acte, a commis un sacrilège qui est puni du même châtiment que le parricide ou le régicide. Êtes-vous prête ?
Laurence, avec une sorte de calme tragique, plia le parchemin et le mit dans son sein. Elle ne prononça pas un mot. Mais Saïtano vit qu’elle était prête.
– Venez, dit-il, venez sauver votre fille !
Aussitôt ils se mirent en route et gagnèrent l’Hôtel Saint-Pol. Le sorcier contourna les murs jusqu’à une poterne située en arrière de la Huidelonne. Là, il jeta un appel.
Une minute plus tard, ils étaient dans l’Hôtel Saint-Pol et à peu près par le même chemin qu’avaient suivi Passavant et le geôlier, ils s’approchèrent du palais du roi. Saïtano en connaissait les tours et détours, portes secrètes, passages réservés au roi. Il prit Laurence par la main et, rapidement, par des couloirs que peu de personnes connaissaient, la conduisit vers l’appartement d’Odette de Champdivers.
Dans la salle d’honneur.
À l’un des angles, une chose inouïe, impossible, et pourtant réelle : la reine de France prisonnière du geôlier de la Huidelonne ! Le premier personnage du royaume avant même le roi, la souveraine maîtresse de l’Hôtel Saint-Pol, l’idole à qui tout obéit, est tenue à l’épaule par la poigne de cet être si bas placé dans la hiérarchie sociale, si loin de ce qui compose alors la société, que c’est à peine s’il existe pour la reine. Il existe ! Et la reine, pâle comme une morte, sent sur son épaule l’étreinte furieuse de l’homme qui, tranquillement, lui dit avec respect :
– Ne bougez pas, ou je serai forcé de vous tuer…
Vers le milieu de la salle, trois hommes figés dans leur attitude de stupeur, qui regardent, écoutent, et n’arrivent pas à comprendre ce qu’ils voient, ce qu’ils entendent : Bruscaille, Bragaille et Brancaillon qui viennent d’entrer en tempête, et se sont arrêtés court devant l’étonnante vision.
À l’autre extrémité, Jean sans Peur et Passavant, face à face, pétrifiés tous deux par ce cri qu’Odette vient de jeter du fond de son agonie :
– Passavant, ne tue pas mon père !…
Le chevalier éprouva comme un bouleversement de son être. Le cri d’Odette le frappa jusqu’à l’âme. Il eut un regard pour Jean sans Peur… pour le père d’Odette !… et ses yeux se troublèrent ; il jeta son épée, d’un geste qui clairement voulait dire : « Tuez-moi ! Je ne frapperai pas le père de celle que j’aime. »
Lentement, doucement, il déposa Odette sur le tapis, et il s’agenouilla. Plus rien n’exista pour lui.
Le duc de Bourgogne regardait cela. Un tourbillon de pensées évolua dans son esprit. Un prodigieux étonnement le pétrifiait. Il eût pu aisément frapper le chevalier, mais son regard éperdu demeurait rivé sur Odette, sans qu’il se sentît la force d’un geste. Seulement, au fond de lui-même, il murmurait : « Ma fille ! C’est ma fille !… » Et tout à coup il eut un mouvement de recul terrifié, ses yeux agrandis se fixèrent sur une vision qui apparaissait, et il râla :
– Voici la mère !… Le spectre de la mère !…
– Roselys ! cria la voix déchirante de Laurence.
– La voici ! dit Saïtano. Et voici, ajouta-t-il en désignant le duc, voici celui qui l’a tuée !…
– Roselys ! répéta la voix de Passavant.
Laurence s’était jetée à genoux. Le chevalier se releva. Il ne pleurait pas. Il lui semblait même qu’il n’y avait pas de douleur en lui, que toute sa faculté de vivre et de penser se condensait en une unique sensation de stupeur. Cela dura deux secondes. Brusquement, il comprit, « il se comprit » ! Cela fut soudain comme un coup de foudre. Il se cria que toujours, en Odette, il avait aimé Roselys ; il se sanglota éperdument que dès le premier regard, là-bas, dans la Huidelonne, il avait non pas reconnu, mais « vu » Roselys dans Odette. Ses yeux sanglants firent le tour de la salle. Il râla :
– Son père ! Cet homme qui la tue, c’est son père ! Écoutez tous ! Jean de Bourgogne a tué sa fille !… Et moi, je n’ai pas le droit de la venger !…
Le reste se perdit dans un sanglot d’où jaillissaient des paroles informes.
Sans pensée, sans force, hébété d’épouvante, Jean de Bourgogne ne voyait plus que le spectre : Laurence ! Laurence vivante ! Laurence qu’il avait tuée et qui était là sous ses yeux, telle que jadis, à peine changée, embellie peut-être par la chevelure d’argent pur. Il regardait ce qui se passait comme à travers une glace qui l’empêchait d’approcher, comme en un rêve où les gestes ne sont pas saisis et compris tout de suite…
Laurence n’avait poussé qu’une clameur :
– Roselys !…
Et, s’étant agenouillée, elle avait pris sa fille dans ses bras. Quelques secondes, elle contempla le visage de la jeune fille, et, d’une voix étrange, incompréhensible, et que Passavant comprit seul, d’une voix tranquille, dans une sorte de grognement sublime, elle prononça quelque chose qui voulait dire : C’est elle ; c’est ma fille…
Jean sans Peur la vit qui semblait méditer un instant, et débattre avec elle-même sur ce qu’elle avait à faire. Et tout à coup il la vit, sans effort apparent, soulever la jeune fille dans ses bras. Elle se mit en marche. Saïtano l’escortait. Laurence se heurta au trio Bruscaille, et d’un accent de rudesse, commanda :
– Place !
Ils s’écartèrent.
Elle franchit la porte, accompagnée du sorcier, et portant dans ses bras Roselys blessée, morte peut-être, sûrement privée de tout sentiment. Isabeau fit un violent effort pour s’élancer. La poigne du geôlier la maintînt, écumante, folle de rage.
Passavant ramassa son épée. Il vit Bruscaille, Bragaille et Brancaillon, et, sans s’étonner de leur présence, leur dit :
– Suivez-moi !
Il se tourna vers le geôlier, et lui dit :
– Suis-moi !
Le geôlier lâcha la reine. Les quatre hommes se mirent à marcher près de Passavant.
– Scas ! Ocquetonville ! hurla Jean sans Peur.
– À nous ! cria Isabeau. Au secours de la reine !…
Plusieurs portes s’ouvrirent, dégorgeant des flots de gens d’armes. En un clin d’œil la salle fut envahie. Ocquetonville braillait des ordres : « Douze hommes autour de Sa Majesté ! Douze autour de Monseigneur ! Sus aux meurtriers !… »
– Arrêtez d’abord cette femme ! rugit la reine.
Laurence et Saïtano venaient de passer dans la salle voisine. La bande des gens d’armes se rua et se heurta à Passavant entouré du geôlier, de Bruscaille, Bragaille et Brancaillon.
– Sauvez-la ! Sauvez-les ! eut encore le temps de crier le chevalier en se tournant vers Saïtano. Nous autres, il faut que nous tenions ici cinq minutes !
Et il eut un dernier cri :
– Adieu, Laurence !… Adieu, Roselys !…
XXIV – L’ÉCHAFAUD
La bande hurlante des gardes arrêtée par le chevalier de Passavant, Saïtano conduisit Laurence dans le dédale du palais. Bientôt, ils se trouvèrent dans les jardins et atteignirent la poterne par laquelle ils étaient entrés dans l’Hôtel Saint-Pol.
– Ainsi Jean de Bourgogne m’échappe, grondait en lui-même le sorcier. Le parchemin que cette femme porte sur elle aura été inutile… cette fois, du moins ! Mais comment détourner de son cours le torrent d’amour d’une mère qui veut sauver sa fille ?…
Et levant un sombre regard sur Laurence, pour la première fois de sa vie, Saïtano sentit le frisson de l’admiration le secouer. Elle venait de parcourir un long chemin, portant sa fille dans ses bras, et elle ne semblait nullement fatiguée.
– Où est placé le centre de cette force incompréhensible ? songeait le savant. Quelle puissance inconnue permet à cette femme, en somme mal organisée pour l’effort physique, de déployer une telle résistance à l’énorme fatigue qu’elle doit éprouver ?
Laurence marchait d’un pas ferme, les yeux fixés devant elle.
Elle ne regardait pas sa fille. Elle la tenait doucement serrée dans ses bras, comme si elle eût craint de lui faire du mal. Où allait-elle ? Quel intérêt la guidait ? Elle semblait sûre de sa route. Elle ne faiblissait pas. À aucun moment, elle ne parut éprouver cette lassitude que prévoyait le sorcier. Et lui, bouleversé d’étonnement et d’admiration, la suivait dans la rue Saint-Antoine où elle venait de s’engager. Il la toucha au bras.
– Ne vaut-il pas mieux déposer cette enfant dans l’une de ces maisons ? dit-il.
Laurence ne répondit pas et continua de s’avancer d’un pas égal et ferme, sans hâte.
– Allons, reprit le sorcier, il serait bon de la mettre dans une litière, et nous la transporterons où vous voudrez…
Laurence ne parut pas avoir entendu…
– Écoutez ! dit rapidement Saïtano. La ville est en rumeur. Voyez ces bandes de gens armés qui vous regardent passer. On va s’étonner de vous voir porter cette morte…
– Morte ! râla Laurence d’une voix rauque. Qui dit que ma fille est morte…
– Soyez prudente ! dit Saïtano avec force. On va vous arrêter…
– Qui donc l’oserait ! dit Laurence.
Elle s’arrêta un instant. Elle considéra de ses yeux hagards ces bandes que lui signalait Saïtano, et qui, en effet, la considéraient avec étonnement. Elle parut les défier… défier la rue… défier Paris entier. Et il y avait une telle majesté dans l’expression de ce visage livide que Saïtano, avec une irrésistible force de conviction, dit à haute voix :
– Non ! nul n’osera se placer devant la mère qui emporte son enfant !…
Et Laurence continua de marcher. Et le double miracle s’accomplit.
Nul ne s’approcha de Laurence. Devant elle, les groupes s’ouvrirent. Des femmes comprirent sans doute ce que faisait cette femme qui passait, car elles se signèrent en pleurant. Et pas un instant Laurence ne faiblit… Elle marcha d’un pas raidi, égal et ferme, prenant garde seulement de ne pas lui faire mal en la serrant trop fort dans ses bras.
Ce fut ainsi qu’elle parvint devant un hôtel abandonné, aux portes disjointes ou abattues comme après un siège…
– Le logis Passavant ! dit Saïtano.
C’était au logis Passavant que son instinct l’avait conduite !… Là où s’était écoulée son enfance, là où elle avait été heureuse avec Roselys, Laurence d’Ambrun était revenue !…
Elle entra, monta l’escalier sans hésiter et gagna la chambre que jadis elle avait habitée. Le berceau de Roselys était là, toujours, mais couvert de poussière comme tous les meubles de la pièce.
Laurence déposa sa fille sur le lit.
Et debout, près de ce lit, sans larmes, pétrifiée, elle s’abîma dans sa douleur muette, s’enfonça lentement dans les gouffres du désespoir. Saïtano s’était élancé au dehors, vers la Cité. Il entra dans son logis et dans l’armoire de fer, qu’il ne songea pas à refermer, prit cinq ou six flacons. Puis il courut chez Ermine Valencienne et l’emmena avec lui. Lorsqu’il rentra dans la chambre de Laurence, il la vit toujours debout près du lit, les yeux sans larmes fixés sur le visage de Roselys. Parfois seulement, elle se penchait, écartait d’un doigt léger les cheveux blonds qui retombaient sur ce front si pur, et déposait un baiser, à peine un souffle, comme jadis, quand elle avait peur de la réveiller…
Saïtano s’approcha de Laurence et résolument la saisit par un bras.
– Que voulez-vous ? gronda Laurence. Prenez garde ? Laissez-moi veiller ma fille…
– Assez ! dit le savant d’un accent de suprême autorité. Voulez-vous qu’elle meure ? Voulez-vous qu’elle soit vivante ? Choisissez ! Si vous la voulez morte, je m’en vais. Si vous la voulez vivante, laissez-moi libre d’agir…
– Vivante ! râla Laurence. Vous demandez si je veux ma fille vivante !…
Elle se recula de deux pas, et s’agenouilla devant le sorcier, les mains jointes, comme dans son enfance elle s’agenouillait devant le Christ en croix. Et alors, alors seulement, les larmes jaillirent de ses yeux. Alors, elle eut des cris farouches et des supplications ardentes. Elle se prosterna. Elle criait :
– Qui êtes-vous ? Vous avez été le démon pour moi ! Soyez Dieu pour ma fille ! Pour le mal que vous m’avez fait, je vous bénirai ! Pour chaque minute de souffrance endurée près de vous pendant des ans et des ans, je vous adorerai ! Sauvez Roselys, sauvez ma fille, et tuez-moi ! ou faites de moi votre servante, votre très humble servante, qui passera le reste de sa vie à vous bénir…
– Debout ! gronda Saïtano. Il faut me laisser faire. Je puis sauver cette enfant. Je le veux. Mais prenez garde ! Il est temps. Il vous faut du courage.
– Que faut-il faire ? Dites ! Parlez ! Je suis prête à tout ! cria Laurence debout, obéissante, palpitante.
– Vous en aller, dit Saïtano. Votre amie est ici qui m’aidera.
– M’en aller ! rugit la mère. Êtes-vous fou ?
– Vous en aller ! répéta Saïtano avec force. Écoutez… avez-vous la force de m’écouter ? Êtes-vous en état de raison ?
Laurence d’Ambrun se raidit contre la douleur. Elle détourna ses yeux de Roselys. Elle tâcha d’obtenir de ses nerfs tendus à se briser que, pour quelques secondes, ils la laissassent en paix. Enfin, elle s’imposa le rude effort qu’il fallait pour écouter, et elle dit :
– Ma raison ? Ma pauvre raison ? Elle est si fluide, si ténue que je la sens m’échapper. Mais parlez. Je vous écoute. Soyez certain toutefois que vous ne me persuaderez pas que pour sauver ma fille, il me faille la quitter.
– Je vous félicite, dit gravement Saïtano. Vous êtes une vaillante, une intrépide lutteuse contre les pires forces ennemies de l’être humain, c’est-à-dire celles qu’il porte en lui-même. Maintenant, regardez. Voici votre amie. Avez-vous confiance en elle ?…
Ermine Valencienne s’avança, les yeux pleins de larmes, et murmura :
– Je donnerais ma vie pour vous éviter l’affreuse douleur où je vous vois…
– Pauvre enfant ! murmura Laurence. Noble cœur si pur, si chaste, fille à ceinture d’argent, plus chaste peut-être que je ne fus, moi !… oui, j’ai en vous la confiance que j’aurais en une sœur chérie…
– Tout va bien ! s’écria Saïtano avec une sorte de jovialité. Vous admettez donc que votre amie peut vous remplacer quelques heures au chevet de votre fille ?… Ceci maintenant : Roselys n’est pas morte. Je réponds de sa vie. Elle guérira de cette blessure.
Laurence tremblait convulsivement. Elle dévorait le sorcier du regard. Il lui apparaissait comme un être fabuleux et tout-puissant. Et Saïtano continuait :
– Ce n’est pas « maintenant » que votre fille est en danger de mort. C’est lorsque vous la verrez guérie, bien vivante, c’est alors seulement qu’elle échappera à votre amour maternel pour entrer lentement dans la mort.
– Que dites-vous ? bégaya Laurence.
– Je dis que Roselys guérie, Roselys vivante vous demandera celui qu’elle aime !…
– Celui qu’elle aime !… Roselys aime un homme ?…
– Elle aime celui qu’elle a aimé dans son enfance, le compagnon de toute sa vie ; absent ou présent, elle aime celui qui, jadis, la sauva de la Seine, et qui plus tard la sauva d’Isabeau…
– Hardy ! Hardy de Passavant ! cria Laurence en joignant les mains.
– Oui ! Et lorsqu’elle vous demandera celui qu’elle aime, lorsque vous serez forcée de lui dire que Passavant est mort, alors, vous verrez Roselys mourir peu à peu dans vos bras sans que vos baisers puissent la réchauffer.
De nouveau, Laurence dut faire le violent et sublime effort pour écarter de son cerveau les oiseaux de folie, pour ramasser tout son pouvoir de raison, demeurer calme, capable de pensée et d’action. Saïtano la surveillait avec une active attention et l’admirait plus encore que tout à l’heure dans la rue.
– Hardy est donc en danger de mort ? interrogea Laurence.
– Et seule vous pouvez le sauver !
Laurence jeta un regard oblique sur Roselys, n’osant pas affronter l’aventure de la regarder en plein. Et elle dit :
– Je suis prête. Où faut-il aller ? Que faut-il faire ?
– Jean sans Peur ! Jean sans Peur ! rugit en lui-même Saïtano, voici ton châtiment qui se met en marche ! Où vous devez aller ? reprit-il à haute voix. Je ne sais. Je dois rester ici. Je dois ici combattre corps à corps la mort assise au chevet de ce lit. Je dois faire vivre votre fille ! À vous de faire vivre Passavant ! Pour cela, il suffit de paralyser celui qui veut le tuer…
– Et qui veut tuer Hardy ? râla Laurence éperdue.
– Jean de Bourgogne !
Laurence baissa la tête… Une pâleur livide s’étendit sur ce visage que l’effort avait jusqu’ici enfiévré. Elle se mit à grelotter. Elle parut s’abandonner aux forces dissolvantes. Saïtano la saisit par les deux mains, se pencha sur elle, et, comme s’il eût lu dans la pensée de Laurence :
– Ne vous accusez pas ! dit-il d’une voix de volonté majestueuse. Ne dites pas que vous payez maintenant votre faute de jadis. Ce n’est pas vous qui avez commis la faute ; le criminel, c’est lui. Fourbe, lâche, sacrilège, c’est lui qui trompa votre candeur. Allez ! Soyez brave, soyez forte. Vous portez là, dans votre sein, l’arme qui peut tuer l’imposteur.
– Ce parchemin ? bégaya Laurence.
– L’acte de votre mariage avec Jean de Bourgogne, époux déjà de Marguerite de Hainaut. Allez à lui, bravement, saisissez-le au milieu de sa cour, accusez-le hautement de sacrilège et forfaiture, montrez la preuve, et vous verrez ses vassaux eux-mêmes s’emparer de lui et l’arrêter.
– Et Hardy ? frissonna Laurence.
– Jean sans Peur arrêté, la terrible accusation qu’il porte contre Hardy de Passavant tombe d’elle-même, elle tombe, dis-je ! Elle retombe sur Jean sans Peur ! Mais allez ! Il est temps !…
Laurence, alors, cessa de regarder Roselys, même de son mince filet de regard oblique ; elle sentait qu’un coup d’œil la riverait à sa fille et qu’elle ne pourrait plus s’en détacher. Elle sortit de la chambre, et aussitôt Saïtano se mit à l’œuvre.
Hors du logis Passavant, Laurence marcha, portée par le raisonnement qui demeurait ferme sous les afflux de douleur, comme une roche de granit sous les vagues de la marée qui déferle à grand fracas. Les flots s’élancent, se roulent, se gonflent et hurlent, mais la roche est là, inébranlable. Ainsi se lamentait la douleur de Laurence. Mais sous cette douleur, presque inconsciente, la raison demeurait ferme.
Laurence prit donc le chemin de l’Hôtel Saint-Pol.
Là était le centre d’action de Jean sans Peur. Là elle pourrait saisir l’ennemi et le dompter.
Elle déboucha sur la place de Grève, pleine de rumeurs, vaste conflit de mouvements houleux et de clameurs imprécises. Au centre, l’îlot noir se dressait, funèbre plate-forme sur laquelle se détachaient des formes grêles dans l’éloignement : le bourreau et ses aides sur l’échafaud.
*
* *
Il nous faut maintenant revenir à l’Hôtel Saint-Pol et rentrer dans cette salle d’honneur que quittaient Laurence, portant Roselys dans ses bras, et Saïtano. Passavant, au moment de l’irruption des gens d’armes appelés par Jean sans Peur et Isabeau de Bavière, s’était campé devant la porte que venait de franchir Laurence. Ils étaient cinq pour tenir tête à une quarantaine de solides batailleurs armés de haches, de masses et de lourdes épées à double tranchant.
– Il suffit de tenir ici quelques minutes, songeait Passavant.
C’est tout ce qu’il pensait. Sans doute Roselys était vivante en lui, sans doute son esprit divaguait confusément le long de ce double plan de prodigieux étonnement : qu’Odette, c’était Roselys ; et que Roselys était la fille de Jean sans Peur. Mais toute sa pensée active se condensa pendant deux ou trois secondes sur la nécessité de tenir là quelques minutes… de tenir sans frapper Jean sans Peur ! Allait-il mourir ? Roselys était-elle morte ? Si elle vivait encore, sortirait-elle de l’Hôtel Saint-Pol ? Et la reverrait-il jamais ? Aucune de ces questions ne se dressa en lui. Et deux secondes plus tard, la pensée même qu’il fallait tenir là s’abolit. Il ne pensa plus. Il fut pris dans la furie de la bataille. Il se battit. Ce fut tout…
La bataille se déchaîna instantanément.
Ocquetonville entra, avons-nous dit. D’un coup d’œil, il vit Isabeau. Il vit Passavant. Et il vit le duc de Bourgogne. D’un bond, il fut sur lui, et avec un rire de triomphe :
– Sire !…
– Sire ? gronda le duc haletant, oubliant tout.
– Oui ! Sire ! C’est vous qui êtes sire ! Le roi est mort !…
– Vive le roi, gronda la bande.
Isabeau frénétique, écumante, son regard de feu rivé sur Passavant, saisit Jean sans Peur par la main, et d’une voix puissante qui domina le tumulte, d’une voix de fièvre et d’enivrement, cria :
– Vive le roi !…
– En avant ! hurla Jean sans Peur. Le premier ordre du roi, le voici : saisissez ce rebelle et portez-le à l’échafaud de la Grève !…
Ceci demanda quelques instants. Près de la porte, déjà, on se battait. Il n’y avait, dans la confuse vision des gestes enchevêtrés, que les éclairs des formidables épées se levant à deux bras et retombant en coups sourds. Le premier tomba le geôlier. Il tomba, le crâne ouvert d’un coup de hache. Il s’abattit en travers de la porte, et il eut le temps, en cette inappréciable seconde, de voir Ocquetonville fendre le flot des assaillants et se placer devant Passavant.
Le geôlier mourut presque aussitôt. Il mourut avec un étrange sourire sur les lèvres, le même sourire qu’il avait eu pour dire sur le corps de Scas : « Un seul coup droit au cœur !… » Presque aussitôt s’abattit un corps sur le corps du geôlier : c’était Bruscaille. Un coup de masse l’atteignit à la tempe, et il s’abattit comme un bœuf. Au même instant, une épée le traversa de part en part… l’épée d’Ocquetonville qui, alors, se trouva face à face avec Passavant. Les deux épées, rouges toutes deux, se choquèrent, et une pluie de sang tomba.
– Vous êtes le dernier ! haleta Passavant.
Ocquetonville vociféra :
– Scas ! Guines ! Courteheuse ! Je vous venge !…
– Scas ! Guines ! Courteheuse ! cria Passavant, voici Ocquetonville qui vient à vous.
Et il allongea simplement le bras, comme si la mort d’Ocquetonville eût été chose inéluctable convenue entre lui et le Destin. Et la chose convenue s’accomplit. Emporté par son furieux élan. Ocquetonville s’enferra ; il tomba, le cœur crevé…
Alors, dans la salle, les hurlements devinrent tempête. Passavant jeta un coup d’œil par-dessus son épaule : Laurence et Saïtano n’étaient plus là. Sans doute ils étaient loin déjà, hors d’atteinte.
Un flot de sang tiède jaillit sur lui ; il en eut sur le visage, ses mains furent rouges, et dans une vision insaisissable de rapidité, il vit s’affaisser Bragaille, la gorge ouverte.
Près de lui, sur sa droite, il ne distinguait plus, dans l’affreuse confusion de ces visions, qu’un géant dont les bras, d’un geste automatique, se baissaient et se levaient pour se baisser encore ; au bout de ces bras, il y avait un de ces estramaçons de bataille qu’un colosse pouvait seul manier avec aisance. Et c’était Brancaillon qui, paisible, souriant, simplement heureux de se trouver près de Passavant, accomplissait avec candeur une effroyable besogne. Ce fut entre deux attaques foudroyantes que Passavant vit cela. Il eut un pâle sourire et poursuivit sa besogne à lui.
Lui, c’étaient des coups droits. Il ne connaissait que le coup droit, en cette épouvantable minute. Tout ce qu’il savait d’escrime sagace et voltigeante, il l’avait oublié. Ses bras plongeaient dans le tas de poitrines, et à chaque plongée il revenait d’un bond en arrière, l’épée ruisselante. Il ne disait pas un mot.
Autour de lui, la rafale des insultes mugissait. Des malédictions frénétiques se croisaient. Il n’entendait pas. Il frappait. Hagard, porté d’un coup d’aile hors des limites du raisonnement et des sensations, il n’était plus qu’une force en mouvement. Les dents serrées, les yeux exorbités, tout son être ramassé dans une formidable tension des nerfs, il fut si effrayant que des reculs désordonnés se produisirent.
Autour de Passavant, il y avait une douzaine de cadavres sur lesquels piétinaient furieusement les assaillants. Il jeta encore un regard par-dessus son épaule : plus de Laurence, plus de Roselys. Une vague pensée, dans un tantième de seconde inappréciable, lui formula qu’elles étaient bien sauvées, et ce fut d’une étrangeté extra humaine qu’en ce laps de temps si bref il songea doucement, avec une infinie douceur, à rejoindre Roselys. Aussitôt, ce fut fini. Il continua de frapper ; soudain, il s’arrêta net : Jean Sans Peur était devant lui ! Le père de Roselys !…
Jean Sans Peur avait vu tomber Ocquetonville.
Ce fut alors qu’à grand effort il se fraya passage parmi ses gens, se dirigeant sur le chevalier. Une sorte de rage le transportait. De ses quatre estafiers, confidents de ses pensées, exécuteurs de ses vengeances, le quatrième venait de tomber, d’un coup droit au cœur, comme les trois autres. C’était la rage, oui. Mais sous cette fureur à laquelle il s’excitait il y avait une joie sourde. Et, tandis qu’il marchait sur Passavant, Jean Sans Peur songeait :
– Maintenant, personne ne peut plus m’accuser du meurtre de Louis d’Orléans !…
Il atteignit Passavant au moment où une masse d’armes sifflant dans l’air à toute volée allait s’abattre sur le chevalier. La masse s’abattit, et Passavant demeura debout. Jean Sans Peur le vit qui baissait son épée… C’était Brancaillon qui avait reçu le coup.
Brancaillon avait vu venir la masse et s’était jeté en avant. C’est lui qui la reçut. Elle l’atteignit sur le côté gauche de la tête et ricocha sur l’épaule. Brancaillon tomba lourdement et demeura inerte…
Jean Sans Peur leva la main, d’un furieux geste d’autorité. Les épées, les masses, les haches s’abaissèrent. Les hurlements, les imprécations s’apaisèrent. La meute s’immobilisa, grondante encore, soufflant, haletant. Il n’y eut plus de distinct que les gémissements des blessés.
Passavant baissa la tête et vit Brancaillon à ses pieds, étendu tout raide.
Quelque chose comme un tressaillement profond le fit vaciller ; quelque chose comme une douleur lointaine embua ses yeux… et il redressa la tête. Cet adieu donné au pauvre Brancaillon avait duré une seconde – laps de temps énorme dans la tempête qui emportait l’esprit du chevalier.
– Eh bien ! gronda Jean Sans Peur, pourquoi ne me frappez-vous pas, moi aussi ?
– Parce qu’elle vous protège ! dit Passavant.
Jean Sans Peur le savait ! Père de Roselys, il était inviolable pour Passavant !
– Allons ! dit-il, c’est assez. Qu’on le saisisse !
Et il se plaça près de Passavant, jusqu’à le toucher, le réduisant ainsi à l’impuissance. Le chevalier n’eut même pas le temps de se remettre en position de bataille et de garde : vingt bras s’abattirent sur lui, les dagues se levèrent.
– Mort au premier qui le frappe ! hurla le duc.
Et il ajouta :
– Cet homme appartient à la justice royale. Condamné pour le meurtre de notre cousin le duc d’Orléans, c’est l’exécuteur royal qui seul peut le frapper. Il faut que le peuple de Paris voie mourir l’assassin. Gardes, conduisez-le à l’échafaud de la Grève !
Il était à ce moment environ une heure après midi.
Passavant, par les gens de Bourgogne, fut remis aux gardes qui, au nombre de soixante, se mirent en route pour la place de Grève ; au milieu d’eux marchait Passavant. Dès que le chevalier eut été emmené, Jean Sans Peur s’approcha d’Isabeau, et sans doute il prit avec elle les dernières résolutions, car, se tournant vers Robert de Mailly, il dit :
– Comte, prenez une suffisante escorte et allez à Notre-Dame où vous ferez sonner le gros bourdon.
Et alors Isabeau, au moment de sortir de cette salle pleine de blessés, de cadavres et de sang :
– Allez, sire ! Allez, et revenez vainqueur ! À 4 heures je vous attends dans la grande chapelle du palais où je vais faire rassembler le conseil et le chapitre des Célestins.
Elle sortit lentement, spectre sanglant qui semblait se mouvoir à l’aise parmi les cadavres.
Jean Sans Peur, une minute, demeura sur place, livide, vacillant, l’œil flamboyant et d’une voix d’orgueil inexprimable, il dit dans un profond soupir :
– Je suis roi !…
– Vive le roi !… vociféra la bande, les épées haut dressées.
– En avant ! gronda alors le duc. En avant pour l’extermination des Armagnacs !
Un instant plus tard, il n’y eut plus dans la salle que les cadavres étendus en des attitudes convulsées.
L’un de ces cadavres, alors fit un mouvement pour se soulever, et retomba pesamment. Il eut un grognement de jurons ; une nouvelle tentative le mit sur les genoux, puis, enfin, debout, appuyé au mur. C’était Brancaillon… Le coup de masse ne l’avait pas tué.
Brancaillon était demeuré étendu, à peu près assommé, le sentiment et la sensation abolis : ce fut son salut. Si un seul des gens de la bande avait soupçonné à ce moment qu’il vivait, Brancaillon eût été aussitôt achevé.
Évanoui, le colosse n’avait pas tardé à reprendre ses sens. Il avait entrouvert un œil, et, comme dans un rêve, il avait vu la reine et le duc échangeant de rapides paroles…
Quand il fut debout, Brancaillon chercha, dans sa pauvre tête bourdonnant, à rassembler quelques idées. Et voici la traduction approximative de ce qu’il parvint à penser :
– J’ai l’enfer dans le gosier, et il n’y a qu’un homme au monde capable d’étancher une telle soif, c’est le roi de France. Je vais aller le faire rire un peu, moyennant quoi je serai abreuvé d’innombrables vins de toutes couleurs… Ah ! par le diable !… Et pourquoi assemblerait-on dans la grande chapelle le conseil royal et le chapitre des frocards ?… Et pourquoi a-t-on crié « Vive le roi » ?… Qui est roi à cette heure ?… Est-ce que nous avons tué le pauvre sire ?… Que de sang, mort-dieu, que de sang !… Où est Passavant ?…
Il vacilla. Il se raccrocha frénétiquement aux montants de la porte, se frotta le front avec énergie, et regarda autour de lui.
– Voici Bruscaille, bégaya-t-il. Et voici Bragaille. Ho ! Dites donc, vous autres, vous rappelez-vous si nous avons tué le bon sire qui aimait, à rire ? Est-ce que notre seigneur maître le duc de Bourgogne est roi de France ?… Ils ne répondent pas, les ruffians !… Oh ! mais… ils sont morts !… Les pauvres bougres ! Que le diable les tienne en joie !… Seigneur, donnez-moi à boire !… Il faut que je boive !…
Pas à pas et se tenant aux murs, Brancaillon se mit en route. Bientôt, il se sentit plus ferme et la soif intense que lui donnait la perte du sang lui suggéra la seule idée nette et précise qu’il put formuler : arriver coûte que coûte dans l’appartement du roi où, sûrement, le bon sire lui donnerait à boire…
Bientôt aussi, toutes les idées qu’il avait ramassées dans la salle sanglante finirent par se classer dans sa tête. Il put se souvenir avec certitude qu’il n’avait pas frappé Charles VI. Dès lors, la pensée de ce Conseil royal qu’on devait réunir à 4 heures dans la grande chapelle s’imposa à lui.
Par le chemin qu’il avait parcouru avec Bruscaille et Bragaille lorsqu’ils avaient entendu le cri de Passavant, il se traîna jusqu’à la porte par où ils étaient sortis de l’appartement du roi, porte opposée à celle qu’avait fermée Ocquetonville, après avoir constaté que le fou était mort.
Brancaillon entra donc et fut frappé de l’énorme désordre qui régnait dans la salle.
– Oh ! grogna-t-il, c’est donc le jour de la destruction finale ? On s’est donc battu ici comme là-bas ?
Il chercha des yeux et tout à coup tressaillit.
Dans un recoin d’ombre, deux hommes assis sur le tapis, manipulaient activement des cartes : C’était Charles VI ; c’était Jacquemin Gringonneur…
Jacquemin Gringonneur tremblait, claquait des dents, suait la suée de l’épouvante et se disait :
– Je sens mes veines qui se glacent, ô Jupiter ! Ainsi devait frissonner ce misérable Thersyte, lorsqu’il entendait les clameurs des Troyens attaquant le camp des Grecs ! Par Vulcain, je suis tout de même par trop poltron !
– Joue, Gringonneur ! disait le roi. À toi, à toi. À quoi songes-tu, par Notre-Dame ?
Jacquemin abattait sa carte au hasard, et continuait son soliloque :
– Je tremble, je grelotte et pourtant je ne m’en vais pas. Ô puissance de l’amitié ! Ô Pylade et Oreste, Castor et Pollux, du haut de l’Olympe, vous devez me trouver sublime !
Et c’était vrai. Jacquemin Gringonneur, ce jour-là, fut sublime.
Il n’avait qu’une idée lucide : fuir ! fuir au plus tôt, par les voies les plus rapides ! fuir le massacre qui commençait (les bruits venus de l’appartement d’Odette), massacre qui, sûrement, ne l’épargnerait pas.
Entré dans l’Hôtel Saint-Pol pour faire sa cour quotidienne, il avait trouvé le roi jouant tout seul aux cartes dans un décor de choses brisées, évocateur de quelque bataille. Jacquemin avait voulu fuir. Mais le roi lui avait ordonné de s’asseoir sur le tapis, devant lui, et le peintre enlumineur avait obéi en soupirant : « Je suis mort ! »
De minute en minute, la volonté de fuir le pressait… « Si toutefois j’en ai encore la force », se disait-il. Et au fond de lui, une voix lui criait : « Reste, Gringonneur, reste avec ce pauvre sire que ses courtisans ont abandonné dans la male heure. Donne au monde cet exemple de fidélité. Sois plus brave que ta poltronnerie. Dompte les frissons de la carcasse. Et si ton roi, ton ami qui t’a enrichi, qui t’a fait une heureuse existence, qui n’a plus que toi au monde, si ton ami meurt, eh bien, meurs avec lui, près de lui. Charles t’a donné les lettres patentes qui te permettent de porter l’épée. Eh bien, pour une fois, la première et la dernière, sans doute, tu te serviras de cette épée !… »
C’est dans ces dispositions d’esprit que Brancaillon trouva Gringonneur.
– Ho ! fit Jacquemin, voici du renfort ; déjà, je me sens plus brave.
– Tiens ! dit tranquillement le roi, voici mon brave ermite. Mais… mais ne t’ai-je donc pas tué, quand, t’ayant saisi par les pieds, je te fis tournoyer ? Eh bien, je suis content de te voir vivant.
– Sire, dit Brancaillon, j’ai soif !
– Moi aussi ! ajouta Gringonneur émerveillé. Je me demandais aussi ce qui me tourmentait. C’était la soif !
Le roi se leva, passa dans sa chambre de réfection, revint les bras chargés de flacons, et reprit sa place en disant :
– Buvons et jouons.
C’était le roi de France ! Dans l’Hôtel Saint-Pol, dans son palais, dans Paris, le grand complot éclatait, la trahison se déchaînait, et l’esprit de carnage battait des ailes…
Gringonneur et Brancaillon étanchèrent leur soif, tandis que le fou, avec une fébrile activité, battait les cartes et murmurait des choses incompréhensibles. Ses pommettes étaient pourpres. Ses yeux flamboyaient. Et pourtant, la crise de démence commençait à s’apaiser sans doute, car parfois il laissait tomber les cartes, passait sa main grêle et jaune sur son front en feu, et une vague lueur s’allumait dans ses yeux.
Gringonneur ne s’enquit pas de savoir comment Brancaillon avait été blessé : le brave peintre redoutait d’apprendre d’une façon précise que le massacre était commencé. Mais de ses mains tremblantes il parvint à panser le géant qui, d’ailleurs, dès le troisième flacon, commença à se trouver plus solide.
– Jouons ! Jouons, reprenait fébrilement le roi fou.
Et alors Brancaillon :
– Sire, sur le coup de 4 heures, il va se jouer un jeu étrange dans la grande chapelle…
Gringonneur leva la tête et regarda fixement Brancaillon.
– Voici, dit le colosse avec sa formidable sérénité, voici ce que j’ai entendu… Écoutez, sire roi, écoutez, je crois que l’heure de bien jouer va venir… et l’heure de rire !
*
* *
Sur la place de Grève, une immense clameur salua l’arrivée du condamné. Les archers s’avançaient péniblement à travers l’énorme foule. Les huit sergents à verge qui marchaient en tête hurlaient : « Place ! Place à la justice royale ! »
– Voici le condamné ! Le meurtrier du sire d’Orléans ! criaient des bourgeois.
Mais d’autres en plus grand nombre murmuraient :
– Le condamné, oui, mais le meurtrier… qui le connaît ?
Ce sentiment que le condamné qui marchait à l’échafaud n’était pas le vrai meurtrier du duc d’Orléans était presque unanime dans la foule. Mais nul ne songeait d’ailleurs à s’indigner. La véritable pensée de tout ce peuple était qu’il voulait voir l’exécution.
Passavant marchait au milieu des gardes. Il n’était pas lié. En sortant de l’Hôtel Saint-Pol, l’archer qui se trouvait près de lui avait voulu le tenir par le bras. Passavant lui avait dit :
– Mon ami, je n’ai guère la possibilité de me sauver. Vous ne pouvez donc craindre aucune tentative. Je marcherai de bonne volonté. Mais si vous m’en croyez, si vous tenez à assister à mon supplice, je vous engage à ne pas me toucher.
Il paraît que ceci fut dit d’un ton si bizarre, et l’archer vit une telle résolution dans les yeux du condamné, qu’il le lâcha tout aussitôt.
On arriva sur la place de Grève.
Passavant, du premier coup d’œil, vit l’échafaud et frissonna. Le regret de la vie étreignit son cœur. Dans cette minute, il calcula si, par un moyen quelconque, il pourrait non, s’échapper, ce qui était impossible, mais provoquer une bagarre au cours de laquelle il se ferait tuer pour éviter le supplice. Mais bientôt il se rendit compte que cela même était impossible.
– Eh bien ! se dit-il, tâchons, jusqu’au bout, d’être le fils de Passavant le Brave.
Il n’avait pas peur de mourir. Mais l’idée de cette longue torture du bûcher à petit feu où il agoniserait lentement, mutilé déjà, la langue arrachée, le poignet coupé, faisait monter son cœur à la gorge, et il se demandait comment il allait supporter la chose.
Les abords de l’échafaud furent violemment dégagés par les archers de service sur la place, et il y eut dans la foule des grondements de colère. Passavant monta rapidement les marches qui conduisaient à la plate-forme. Il entrevit alors l’exécuteur qui lui tournait le dos et se baissait pour s’assurer une dernière fois que le tranchant de la hache était en bon état. Le condamné haussa les épaules. En une vague et rapide vision, les aides gesticulèrent dans le champ de sa vue. Puis son regard se porta sur l’immense foule, océan immobile maintenant, d’où montait le grand souffle de l’angoisse. Il crut entendre que les femmes plaignaient sa jeunesse. Il crut voir des visages sympathiques. Et il se raidit :
– Courage, par Dieu ! Il faut ici mourir en vrai Passavant. Mourir, ce n’est rien, mais souffrir… diable ! Aurais-je la force de ne pas crier ?… Allons, adieu, Odette… Roselys !
Et comme cette image évoquée menaçait de l’attendrir, à pleine voix, comme à la bataille, il cria :
– Hardi ! Hardi ! Passavant le Hardi !
– Me voici ! hurla une voix éclatante.
Et Passavant, au pied de l’échafaud, vit l’éclair d’une large épée qui se levait et s’abattait d’un formidable coup de revers, couchant deux archers ; dans la même seconde, il y eut le bondissement d’un homme qui se ruait sur l’escalier en vociférant : « Me voici ! Hardi ! Hardi !… »
– Tanneguy ! rugit le chevalier.
– Prends ceci ! gronda le capitaine.
Passavant saisit la dague que lui tendait Tanneguy du Chatel qui, livide, désordonné, furieux, tandis qu’un silence de mort pesait sur la foule pétrifiée de stupeur, hurlait :
– Hardi ! Venez-y, maintenant ! Nous sommes deux !
– Et celui-ci est avec vous ! fit une voix calme, sinistre, rocailleuse.
Et Passavant, les yeux hagards, l’esprit exorbité par les effrayantes secousses émotives de cet instant, vit le bourreau se placer près de lui, sa hache à la main.
Le bourreau !… C’était le chef des Écorcheurs. C’était Polifer. En un clin d’œil, il se débarrassa du surcot rouge et apparut vêtu de buffle. En ce même laps de temps, ses aides se rangèrent derrière lui, la dague au poing, et une trentaine d’êtres déguenillés, sauvages, figures de cauchemar, montant l’escalier, envahirent la plate-forme.
Il y eut dans la foule une terrible clameur :
– Les Écorcheurs ! Les Écorcheurs !…
Polifer leva sa hache, et, d’un cri puissant, répondit :
– Les Écorcheurs !
– En avant ! vociféra Tanneguy du Chatel.
– Hardi ! hurla le chevalier. Hardi ! Passavant le Hardi !
La bande tout entière se mit à descendre le large escalier, dévala comme un troupeau de sangliers, hérissé d’acier, monstrueuse bête pelotonnée, rugissante, qui fonça droit devant elle.
Passavant était en tête. Près de lui Tanneguy. Un peu en arrière, Polifer, d’une voix brève, criait des ordres à ses Écorcheurs et les rangeait en ordre de bataille. Sur la place le tumulte se déchaînait, comme si cet océan humain, une minute figé, se fût soulevé en vagues frénétiques. Au pied de l’échafaud, la bataille éperdue commençait…
À ce moment, le sourd mugissement d’une voix de bronze couvrit les vastes rumeurs…
À cet appel, qui avait on ne sait quoi de tragique et de désespéré, il y eut un bref silence, puis la clameur de la bataille rebondit en cris qui se répercutèrent sur toute la place, et de là, s’épandirent de rue en rue dans Paris convulsif : « Le signal ! Le signal ! »
C’était le signal de Jean sans Peur !
C’était la voix du gros bourdon de Notre-Dame. Deux fois, trois fois, elle jeta lentement son mugissement prolongé, puis ses appels se précipitèrent, et elle se mit à hurler dans les airs, appelant tous les esprits de carnage qui accouraient et tourbillonnaient dans un ciel morne.
– Qu’est cela ? cria Tanneguy tout en frappant à coups redoublés.
– Le signal de l’extermination des Armagnacs ! répondit Polifer.
– Malédiction ! clama le capitaine.
La bande se battait. La foule des bourgeois s’était disloquée en troupes qui se mettaient en marche vers des points déterminés. Un escadron d’hommes d’armes passa le long de la Seine, d’un trot pesant, dans un grondement de sabots, dans un fracas de cuirasses entrechoquées, oriflammes déployés, et cela hurlait :
– Bourgogne ! Bourgogne !
– Mort aux Armagnacs ! vociféraient les bourgeois.
Et plus loin, dans la Cité, une clameur sauvage et puissante balaya tous les bruits avec le souffle de ce cri forcené qu’elle jetait au monde :
– Liberté ! Liberté !…
Et c’étaient, là-bas, les gens de Caboche, à l’œuvre déjà, franchissant le pont, culbutant la garde prévôtale et marchant sur l’Hôtel Saint-Pol. Et ce monstre en marche faisait trembler Paris avec sa clameur :
– Liberté ! Liberté !…
Au pied de l’échafaud, la bataille devenait frénétique mêlée. Trois cents archers entouraient Passavant, Tanneguy et les Écorcheurs.
Là, ce fut un furieux enchevêtrement de gestes épileptiques, de bras qui se levaient pour assommer, égorger ; les visages n’étaient plus que des masques convulsés, les bouches tordues, les yeux flamboyants, des cris rauques se croisaient, les malédictions se heurtaient, les gémissements fusaient en plaintes déchirantes et Passavant, les mains rouges, le visage éclaboussé de rouge, les vêtements en lambeaux, Passavant, armé d’une épée ramassée sur le champ de bataille, d’instant en instant, portait devant lui son terrible coup droit – droit au cœur… un homme tombait, puis un autre… et son sourire narquois, un peu sceptique, semblait dire : « Allons, ce n’est pas cette fois encore que j’irai voir Passavant le Brave dans un monde où, sans doute, il n’est pas besoin de tant de sang pour conquérir le bonheur… » Et tout à coup, il se mit en marche en criant :
– Passavant ! Passavant le Hardi !
– Hardi ! hardi ! hurla Tanneguy. En avant !
La troupe des Écorcheurs, en bloc serré, s’avança. D’un furieux effort, elle pénétra dans la masse des archers. À gauche, à droite, en avant, les coups de masse pleuvaient. De la bande en marche surgissait l’ininterrompu jaillissement des éclairs d’acier, et des hommes tombaient sur des cadavres, se roulaient, puis demeuraient immobiles, et l’effroyable bête hérissée, grondante, sanglante, faisait sa trouée ; de part et d’autre, les archers lâchaient pied… Brusquement, le chevalier de Passavant se trouva dans la rue Saint-Antoine. Il n’y avait plus d’archers.
La rue n’était qu’un tumulte. Mais ces bandes qui passaient en vociférant ne s’inquiétaient pas de Passavant et de sa troupe. Elles avaient leur besogne tracée d’avance, et elles y allaient.
Un instant, Passavant et Tanneguy se regardèrent, si rouges, si déchirés, si hagards, qu’à peine ils se reconnurent. Et alors, ils s’embrassèrent.
– Vous êtes sauvé, dit Polifer en s’avançant.
– Grâce à vous dit Passavant en lui tendant la main. Mais comment…
– Oh ! c’est bien simple, dit le chef des Écorcheurs qui vit venir la question. Maître Capeluche est un ami à moi… Un ami… vous comprenez ? Il ne peut rien me refuser. Dès lors que j’ai su qu’on allait vous exécuter, j’ai été le trouver. Il ne voulait pas d’abord. Puis je l’ai convaincu. Bref, le brave Capeluche a été pris à temps de la fièvre nécessaire et m’a désigné comme le seul de ses aides capable de le remplacer. Voilà. Vous êtes sauvé. Il faut maintenant sortir de Paris. Où voulez-vous aller ?…
– À l’Hôtel Saint-Pol ! répondit Passavant d’une voix sombre.
XXV – LA DAME D’ORLÉANS
À l’hôtel d’Armagnac, ce jour-là, vers 11 heures, une cinquantaine de hauts seigneurs étaient assemblés dans la grande salle des armes. De quart d’heure en quart d’heure entrait une estafette qui venait rendre compte de ce qui se passait dans Paris. Le comte d’Armagnac, revêtu de son harnachement de guerre, mais la tête nue encore, recevait les messages et les commentait d’un mot rapide. Il était pâle de fureur. Sous ses gantelets, ses mains tremblaient légèrement. Parfois, un rauque soupir soulevait sa poitrine.
Autour de lui, les seigneurs, debout, tout harnachés, pareils à des statues, se tenaient immobiles ; derrière chacun d’eux, un valet d’armes portait le casque dont il allait le coiffer.
C’était une imposante et terrible assemblée.
Toute la haute noblesse du royaume était là, frémissante de colère : les noms les plus illustres, les hommes les plus braves, les chefs les plus redoutés.
Il y avait le comte de Namur, impétueux, bouillant, qui se rongeait les poings et mâchait de furieux jurons ; il y avait le sire de Coucy, formidable silhouette féodale ; il y avait le seigneur d’Albret et le duc de Bar, plus froids, livides de rage, silencieux et sombres ; il y avait le comte d’Alençon qui frappait du pied et jurait sourdement d’arracher le cœur de Jean sans Peur pour le faire manger par ses chiens ; il y avait le seigneur de la Trémoille qui souriait d’un hautain sourire ; Hélion de Lignac, Colin de Puisieux, Raoul de Brisac, et d’autres hauts barons, rudes figures balafrées d’entailles, statues de puissance, regards d’orgueil et de fureur…
Vers midi, une dernière estafette entra et parla à l’oreille du comte d’Armagnac. Il tressaillit violemment, un tremblement convulsif l’agita. Puis, par un effort de volonté, il se calma.
– Messieurs, dit froidement le comte d’Armagnac, le conseil est ouvert. Que chacun parle à son tour.
– Par la mort du Christ ! hurla le comte de Namur, il n’est besoin ni de paroles ni de conseils. Montons à cheval et marchons sur les Bourguignons !
Une acclamation accueillit ces paroles. Armagnac leva la main. Il eut un sourire livide.
– Noble seigneur de Namur, dit-il, et vous tous, ce serait, par Notre-Dame, trop facile, et trop agréable aussi : marcher au Bourguignon, tuer ou l’être, lui faire payer en tout cas sa victoire le plus cher possible, oui, seigneurs, ce serait plaisant à faire. Malheureusement, c’est difficile, et je dois vous rappeler avec exactitude la situation où nous sommes… Jusqu’à ce matin, nous avons ignoré le complot de Jean sans Peur. Quand je vous ai mandés ici, quand vous avez tous été assemblés, il était trop tard pour nous défendre. Les principales rues, les principales forteresses de Paris sont occupées. Déjà, il y a deux heures, quand vous êtes venus, il ne nous restait plus que la ressource de mourir avec gloire.
– Mais, observa le duc de Bar, nous avons décidé tout à l’heure de nous rendre à l’Hôtel Saint-Pol, de nous y retrancher avec la dame d’Orléans et d’y soutenir le siège. La forteresse royale peut tenir un an, pendant lequel toute la seigneurie de France se lèvera pour nous. Au pis-aller, nous aurons la gloire suprême de mourir en défendant le trône. Il y a un roi, messieurs. Allons défendre le roi !
Armagnac se leva. Il était effrayant à voir. Un frémissement parcourut l’assemblée, qui comprit que quelque chose de terrible allait se dire :
– Messieurs, dit Armagnac, le roi est mort.
Le silence de stupeur, de rage et peut-être d’effroi qui s’abattit sur ces braves et rudes hommes de guerre fut sinistre. Armagnac, de sa voix glaciale, continua :
– Le roi Charles, messieurs, vient d’être assassiné, égorgé dans son palais, il y a une demi-heure à peine. Dieu ait son âme !
Et tous ces hommes, oubliant qu’il était question pour eux de vie ou de mort, s’inclinèrent en murmurant avec une profonde ferveur :
– Dieu ait pitié de l’âme de Charles sixième…
Puis ils se redressèrent et se regardèrent, effarés. La nouvelle était effroyable, car elle présageait le triomphe absolu de Jean sans Peur.
– Seigneur, reprit le comte d’Armagnac, vous voyez que nous ne pouvons nous réfugier à l’Hôtel Saint-Pol. Nous n’avons pas le droit non plus de nous faire tuer dans les rues de Paris, car nous avons juré de rendre la dame d’Orléans saine et sauve en ses domaines, où elle veut se retirer. Voici donc ce qu’il faut faire. Nous ferons monter la noble veuve de notre malheureux ami dans une litière, et nous marcherons sur la porte Saint-Antoine, sans nous inquiéter de ceux de nous qui tomberont en route… Les survivants escorteront Mme Valentine jusqu’en son domaine…
Les Armagnacs se regardèrent silencieusement : il leur en coûtait de renoncer à combattre les Bourguignons, mais leur devoir était de sauver la veuve de celui qui avait été le chef de leur parti.
– La dame d’Orléans, reprit le comte, a voulu venir à Paris pour demander justice contre le vrai meurtrier de son noble époux. Notre honneur était de l’escorter et de la seconder. Aujourd’hui, seigneurs, le meurtrier triomphe… Tous, nous avons quelque obligation à Mme Valentine, outre que notre devoir de gentilshommes est de ne pas livrer une dame à ses ennemis. Messieurs, dans deux heures, plus tôt, peut-être, le nouveau roi cherchera à s’emparer de la malheureuse veuve. Quand nous aurons tous succombé autour d’elle, il ne lui restera plus à elle-même qu’à se tuer pour ne pas tomber aux mains de l’assassin de son mari. Mon avis est donc de renoncer dans Paris à une lutte dont l’issue ne peut être douteuse, de sauver coûte que coûte la dame d’Orléans, chef nominal, oriflamme et bannière de la seigneurie française, et de rassembler dans les plaines de Île de France assez de seigneurs dignes de ce nom pour assiéger l’homme qui doit son trône au meurtre, au mensonge, à la forfaiture. Dieu aidant, nous prendrons Paris, et nous remettrons sur le trône le fils de la race des Valois. J’ai dit. Que ceux qui tiennent pour un autre avis l’expliquent.
– Je me range à l’avis du noble comte d’Armagnac, dit le duc de Bar.
Aussitôt, tous les seigneurs présents crièrent qu’il n’y avait pas d’autre avis possible.
– Et puis, ajouta le comte de Namur avec un rire terrible, après tout, ce sera encore de la bataille. Par le Christ, j’espère bien que nous ne sortirons pas de Paris sans coup férir !
– Bataille ! Bataille ! cria tout d’une voix cette assemblée de braves.
C’étaient des braves. Surpris par l’explosion soudaine du complot, leur retraite hors de Paris ne peut nullement être assimilée à une fuite.
C’étaient de rudes seigneurs, impitoyables souvent pour le bourgeois et le manant, orgueilleux toujours ; ils avaient fait germer autour d’eux de vastes haines ; ils étaient la féodalité jalouse de ses droits, dure dans l’exercice de ses privilèges, féroces dans la répression – mais pas plus que quiconque détient le pouvoir : et c’étaient des braves. À grand fracas, ils descendirent dans la grande cour d’honneur de l’hôtel d’Armagnac. Ce fut, pendant quelques minutes, le long du large escalier de pierre, comme un énorme serpent à écailles d’acier qui se déroule.
Dans la cour, les chevaux caparaçonnés attendaient. Chaque cavalier montait sur des bancs de pierre pour se hisser en selle. Alors, ils couvrirent leurs têtes de leurs casques, dont ils rabattirent les visières. Les valets d’armes placèrent dans leurs mains recouvertes du gantelet d’acier un estramaçon de bataille.
Les Armagnacs se rangèrent par quatre sur quinze rangs de profondeur. Mais derrière chaque rang, c’est-à-dire derrière chaque seigneur, prit place un valet d’armes à cheval portant la lance et la masse. Et derrière chaque valet d’armes prit place un autre valet non combattant, porteur d’armes de rechange, et dont le rôle était d’aider le maître désarçonné à se relever, de le panser sommairement s’il était blessé. En sorte que ces quinze rangs de seigneurs en bataille formaient en réalité quarante-cinq rangs de quatre hommes.
Les bannières furent déployées, et, en tête, l’oriflamme d’Armagnac.
Par-dessus la cuirasse, tous les seigneurs portaient l’écharpe blanche, insigne de leur ralliement dans la mêlée.
Ainsi rangés, ils formaient une de ces formidables figurations guerrières dont nos déploiements de force modernes ne peuvent nous donner aucune idée. Dans la rue, on entendait les clameurs des bandes qui passaient :
– Bourgogne ! Bourgogne ! – Vive Bourgogne sauveur du peuple ! – Mort à Armagnac !…
Et parfois, un grondement terrible où éclatait le mot de tonnerre qui, de siècle en siècle, fait peur aux conducteurs de bétail humain :
– Liberté ! Liberté !…
Au-dessus de ces clameurs, dans les airs, s’enchevêtraient les appels éperdus des tocsins de toutes les églises. Et par-dessus même ces rumeurs de cloches, les graves, lents et terribles mugissements du gros bourdon de Notre-Dame épandaient de vastes ondulations d’épouvante et de menace.
Les Armagnacs rangés dans la cour, devant la grande porte de fer close et chaînée, ces guerriers vêtus d’acier écoutaient ces hurlements qui se battaient dans l’air. Ils demeuraient silencieux. Mais on eût entendu les frémissements de rage qui faisaient s’entre-choquer leurs cuirasses. Les chevaux piaffaient, inquiets, impatients, le nez tendu vers le carnage…
Une litière fermée s’avança.
Quelques instants plus tard, Armagnac parut, tête nue, marchant lentement, et donnant la main à Valentine d’Orléans, vêtue de grand deuil. Derrière eux, venaient la dame de Coucy et la dame de Puisieux. Puis les valets d’armes du comte portant son casque, son épée, sa lance.
Les seigneurs, rangés pour la bataille, frissonnèrent à la vue de celle qu’il fallait sauver. Un grand souffle d’héroïsme agita les panaches des cimiers. Des cris brefs, rauques, rudes, violents éclatèrent :
– Vive le roi ! – Vive la seigneurie de France ! – Vive Armagnac ! – Salut à la dame d’Orléans !…
Et tous, d’une même voix puissante, d’un seul cri tragique :
– Mort à Bourgogne !…
Valentine s’approcha de la litière, se tourna vers ses deux compagnes comme pour leur demander leur approbation, et elle dit :
– Découvrez la litière !…
Le comte d’Armagnac hésita à donner l’ordre.
– Nous voulons qu’on nous voie, dit Valentine. Nous voulons notre part du péril. Et si Dieu veut que je sois frappée en ce jour, béni soit l’acier qui m’atteindra… car rien ne m’est plus… plus ne m’est rien.
– Oui ! Oui ! vociféra l’escadron d’acier électrisé. À découvert ! Noël à la dame d’Orléans !…
En quelques instants, les valets eurent enlevé les mantelets, les rideaux de cuir épais. Valentine prit place dans le fond de la litière ainsi découverte, les dames de Coucy et de Puisieux s’assirent devant elle et lui faisant face, la figure pâle, mais le regard intrépide.
Le comte d’Armagnac s’était mis en selle. Son valet lui présenta le casque…
Alors se produisit l’incident qui montre ce qu’était cette noblesse à qui on peut tout reprocher, sauf d’avoir eu peur. Le valet d’armes, disons-nous, s’approcha du comte d’Armagnac et lui présenta le casque. Le comte le repoussa et cria :
– Tête nue ! Qu’on nous voie ! À découvert ! À découvert !
– Tête nue ! Tête nue ! hurla l’escadron d’acier.
En un clin d’œil, les casques furent arrachés et on les entendit tomber sur le sol, à grand fracas ; pendant quelques instants, il n’y eut que le roulement de ces casques que les guerriers rejetaient, et l’escadron entier apparut, tout en acier, avec ces têtes nues dont les traits se convulsaient, dont les regards jetaient des flammes. Seuls, les valets d’armes gardèrent leurs morions. Alors le comte d’Armagnac alla se placer à la tête de la troupe et cria :
– Qu’on ouvre les portes ! Qu’on baisse le pont-levis !…
On entendit le grincement des leviers, le raclement des chaînes ; cela dura quelques minutes, et, du dehors, soudain, entra dans l’hôtel la violente bouffée de la clameur populaire.
– Armagnac ! Armagnac ! vociféra l’escadron.
Tout s’ébranla. La litière était au milieu. Dès qu’on fut dans les rues, l’ordre primitif se modifia. Il n’y eut plus qu’un hérissement d’épées tout autour de la litière. L’escadron s’avança d’un seul bloc, dans le piaffement de ses chevaux, dans le bruit des aciers qui se heurtaient. Il s’avança, comme une formidable et lente machine de guerre s’adaptant à la largeur des rues, tantôt se resserrant et s’allongeant, tantôt s’élargissant et perdant de sa longueur. Il s’avança, balayant tout sur son passage par le seul aspect de sa force. Et ce fut ainsi, sans avoir rencontré d’adversaires, que les Armagnacs atteignirent la rue Saint-Antoine, et ils prirent aussitôt la direction de la porte Saint-Antoine, par où ils comptaient sortir de Paris.
Tout à coup, le comte d’Armagnac leva très haut son épée et cria : « Attention !… » Derrière lui, et jusqu’au bout de l’escadron, les seigneurs se dressaient sur leurs étriers pour essayer de voir au loin. La rue n’était qu’une houleuse confusion d’êtres enchevêtrés, un effroyable hérissement de piques, de pertuisanes, de bâtons même, une multitude de faces livides et flamboyantes, et sur cette vision une seule clameur formidable :
– Liberté ! Liberté !…
Au loin, c’était la masse confuse et désordonnée des bandes populaires poussées, repoussées par ses propres flux et reflux. Mais devant l’escadron d’Armagnac une troupe disciplinée, bien armée, composée d’un millier de combattants, barrait la route.
Chose étrange et véridique pourtant, il y avait dans cette troupe autant de femmes que d’hommes ; jeunes ou vieilles, belles ou laides, toutes, c’étaient des femmes du peuple, vêtues de haillons, décidées en ce jour à mourir ou à gagner la liberté ; elles avaient des physionomies farouches, et dès que l’escadron se heurta à leur troupe, par un rapide et violent mouvement, elles repoussèrent les hommes et se trouvèrent les premières devant Armagnac, sur cinq ou six rangs de profondeur, occupant toute la largeur de la rue et criant :
– Liberté ! Liberté !…
L’escadron prenait son élan pour faire sa trouée. Les épées se levaient. Les lances tombaient en garde… À la vue de ces femmes, le comte d’Armagnac leva l’épée et fit le signe d’arrêt. L’escadron s’immobilisa. Un indéfinissable étonnement entra dans l’âme du comte et il murmura :
– Des femmes !… Comment charger des femmes ?
Un instant, quelque chose comme un frisson remua son cœur : pour la première fois, il voyait sous ses yeux la misère du peuple ; ce fut peut-être de la pitié, mais l’orgueil aussitôt l’emporta. Il cria :
– Allons, femmes, laissez-nous passer !
Un hurlement de la foule répondit. Des cris se croisèrent, des ricanements, des menaces.
– Qu’est-ce qu’il dit, ce sacripant ? – Armagnac n’est plus le maître de la chaussée ! – Vive la liberté ! Hourrah ! Hourrah ! – Mort aux affameurs ! – Mort à la gabelle ! – Mort à la seigneurie ! – Mort aux Armagnacs !…
Bientôt ce fut la clameur de mort qui s’enfla, domina, balaya tous les autres cris. Et jusqu’au fond de la rue, au loin, très loin. Armagnac et ses seigneurs virent la houle de la foule se briser, se déchaîner ; cela déferla ; ce fut une vaste vision de visages convulsés, une énorme haine émiettée sur la multitude des physionomies fulgurantes, et ce leur fut l’inexprimable sensation qu’ils étaient des maudits, et cela exalta leur orgueil ; il n’y eut plus pour eux l’horreur de piétine, des femmes, et de l’escadron d’acier monta le terrible grondement de la bataille :
– En avant ! En avant !…
Soudain la foule reflua !…
Le bataillon serré des femmes s’ouvrit !…
Il ne s’ouvrit pas devant la menace de l’escadron d’acier. Et l’escadron, surpris par cette manœuvre imprévue, demeura figé dans son élan, redoutant le coup d’embuscade…
Mais non ! Ces femmes, ces malheureuses qui étaient la figuration vivante de tant de misère accumulée, ne méditaient aucun guet-apens. Elles se reculaient pour laisser passer. Un revirement brusque, inouï, incompréhensible d’abord, venait de se faire dans leurs esprits surchauffés. Et elles criaient :
– La dame d’Orléans ! C’est l’escorte de la dame d’Orléans ! – Noël à la bonne dame d’Orléans ! – Laissez passer la dame d’Orléans ! – Elle a sauvé mon mari ! – Elle a tiré mon fils du Châtelet ! – Elle nous a secourus dans la misère ! – Vive la dame d’Orléans ! – Honneur et respect à l’ange du peuple !…
Voilà les cris délirants qui se heurtaient. La pitié populaire sauvait l’épouse du grand féodal…
Le chemin était libre. L’escadron s’avança, franchit la barrière vivante qui s’était dressée devant lui et venait de s’ouvrir. Il s’enfonça dans la foule. Mais au bout de deux cents pas, ce n’étaient plus des femmes acclamant la duchesse d’Orléans, c’étaient des hommes qui refluaient à droite et à gauche en grondant.
Bientôt l’escadron tout entier, par devant, sur les flancs, par derrière, fut enveloppé de cette écume humaine qui déferlait, l’éclaboussait ; bientôt ce fut une formidable étreinte ; des estramaçons se levèrent et retombèrent sur des crânes ; d’en bas, des piques frappèrent les chevaux : la bataille allait devenir mêlée, la mêlée allait devenir effroyable tuerie ; deux seigneurs tombèrent ; autour de l’escadron, des hommes s’affaissaient, le sang jaillissait, l’écume humaine devenait rouge ; Armagnac, d’une voix de tonnerre qui gronda dans les tumultes croisés, lança un ordre :
– En avant ! Au trot ! En avant !…
La masse entière s’ébranla au trot, les chevaux hennirent, un effroyable rugissement monta de la rue, fait d’insultes, de gémissement, de cris féroces ; pesant et lourd, pareil à une immense machine aux engrenages d’acier, l’escadron, de son trot irrésistible, marcha en avant, broya l’obstacle de chair humaine, s’enfonça comme un coin dans le vaste hurlement de mort, et passa sur des monceaux de blessés, laissant l’Hôtel Saint-Pol sur sa droite, piquant droit sur la porte Saint-Antoine, droit sur une masse de cavalerie, sur une machine semblable à lui, sur deux mille Bourguignons qui venaient de déboucher et, de leur côté, fonçaient sur les Armagnacs en vociférant :
– Vive Jean, roi de France, et la Bourgogne !…
– Vive le roi !…
– Bourgogne ! Bourgogne !…
Entre la machine aux écharpes blanches et la machine aux croix rouges de Saint-André, se produisit la collision, dans un fracas de tonnerre ; il y eut un vaste choc de cuirasses, un retentissement de choses d’acier se heurtant en masse, puis un éparpillement de bruits sonores, lances brisées, épées qui se frappaient, puis un râle énorme d’angoisse formé du râle et de l’angoisse des milliers de poitrines, et les deux machines dévastatrices entrées l’une dans l’autre, indémêlables, se confondirent dans l’inexprimable étreinte des gestes furieux, dans le conflit des cris, des jurons, des malédictions, des plaintes rauques, des insultes sauvages… « Meurs, ruffians !… À toi, fils de chienne !… Traître, à ton roi !… Vive le roi !… France, France !… Bourgogne, Bourgogne !… Crève, truand !… Ton cœur aux pourceaux !… » Et les râles des mourants, les clameurs des blessés, l’horreur, l’épouvante, la haine hurlaient chacune leur hurlement ; des statues d’acier abattues roulaient l’une sur l’autre, sanglantes, cherchaient encore à s’assommer, à s’égorger, à s’étouffer ; le sang coulait par petits ruissellements, des flaques rouges se formaient, des chevaux éventrés frappaient le vide de leurs sabots et tâchaient de redresser pesamment leurs têtes aux yeux hagards, et il n’y eut plus sur la chaussée que des corps à corps furieux de blessés cherchant à s’achever l’un l’autre, dans l’air que des bondissements de chevaux qui reculaient et se ruaient dans leur élan, un fabuleux enchevêtrement d’éclairs d’acier, et sur tout cela, la morne clameur venue des lointains de Paris, couverte par le mugissement des cloches.
Plus de vingt seigneurs Armagnacs gisaient les bras en croix, immobiles, raides dans leurs vêtements d’acier ; presque tous les valets d’armes étaient tombés ; il restait environ quarante hommes, ducs, comtes, hauts barons, massés autour de la litière de la duchesse Valentine, éclaboussée de sang, la tête effroyable, frappant encore à coups redoublés et s’avançant d’une lente poussée vers la porte.
Les Bourguignons rugissaient leur joie et leur triomphe.
Le comte d’Armagnac vociférait : « En avant ! En avant ! Vers la porte !… » Et devant lui, Jean sans Peur, tête nue lui aussi, ayant déjà changé deux fois de cheval, Jean sans Peur, terrible, les yeux hors des orbites, les cheveux hérissés les narines aspirant le carnage, Jean sans Peur tonnait : « Tuez ! Tuez, Qu’il n’en reste pas un ! Tuez ! Hardi mes braves ! Hardi ! Hardi !… »
Les derniers Armagnacs étaient perdus. Enveloppés de toutes parts, ils allaient être écrasés contre la gigantesque porte fermée. Ils jetaient au vent leurs malédictions. Et Jean sans Peur rugissait : « Tuez ! Tuez ! Hardi !… »
– Hardi ! Passavant le Hardi ! tonna une clameur ! Passavant ! Passavant !…
– Hardi pour la dame d’Orléans !… Passavant ! Passavant !…
– Les Écorcheurs, vociférèrent les Bourguignons.
C’étaient les Écorcheurs ! Polifer était là, à la tête de sa bande et conduit par le chevalier de Passavant. Tanneguy du Chatel était là. Ils étaient partis de la place de Grève pour marcher sur l’Hôtel Saint-Pol. Là devait se trouver Roselys. « Si j’ai une chance de la retrouver, pensait Passavant, c’est à l’Hôtel Saint-Pol ! » – « Vous voulez vous faire tuer, lui disait froidement Polifer. Je vous accompagne jusqu’aux portes de la forteresse royale, mais pas plus loin. En route !… »
Ils étaient partis à quinze ou vingt, troupe serrée, ardente, farouche, que les bandes populaires laissaient passer, les unes parce que l’aspect de cette troupe traçait un sillon d’épouvante, les autres, en plus grand nombre, parce qu’ils pensaient que c’était un groupe de combattants affiliés. Or, la petite troupe, d’instant en instant, se grossissait ; les Écorcheurs apostés un peu partout par Polifer entre la porte Saint-Antoine et la place de Grève pour assurer sa retraite hors de Paris, venaient le rejoindre ; près de la porte même, le chef des Écorcheurs avait laissé une cinquantaine de ses hommes dont le mot d’ordre était d’égorger la garde et de manœuvrer le pont-levis au moment où Polifer se présenterait pour fuir.
Près de l’Hôtel Saint-Pol, Passavant et sa troupe furent heurtés par les Armagnacs en marche ; le chevalier vit la dame d’Orléans ; il comprit la suprême tentative du comte d’Armagnac ; il vit déboucher les Bourguignons dans la rue Saint-Antoine et il se dit : « Il faut que je sauve la dame d’Orléans !… »
Entre lui, Polifer et Tanneguy du Chatel, il y eut un bref colloque. Puis Polifer détacha un homme vers la bande postée à la porte Saint-Antoine.
Puis toute cette troupe armée d’épées, de piques, de dagues, de coutelas, fonça sur les Bourguignons, au cri de : « Passavant ! Hardi pour la dame d’Orléans !… »
XXVI – L’HÔTEL SAINT-POL
Il y avait quelqu’un qui regardait tout ce grand massacre comme on peut regarder les images forcenées d’un cauchemar : c’était Laurence d’Ambrun, la mère de Roselys, en marche pour sauver celui qu’aimait sa fille !… Laurence arrêtée place de Grève par la vue de l’échafaud, Laurence bientôt certaine que cet échafaud était là pour Hardy de Passavant avait assisté de loin à la fabuleuse tentative dès Écorcheurs.
Elle s’était mise en route vers l’échafaud, toute raide, sans voir, se frayant un chemin à travers l’énorme foule, ne se demandant nullement ce qu’elle voudrait ou pourrait faire, soutenue seulement par cette pensée obstinée qu’il lui fallait arriver à l’échafaud. Et elle n’en était plus séparée que par une vingtaine de pas lorsque les démons, figures d’un rêve impossible et pourtant réel, avaient envahi la plate-forme. Passavant était sauvé !…
Alors, elle avait tenté de le rejoindre. Palpitante, obstinée, silencieuse, elle était entrée dans la rue Saint-Antoine. À chaque minute elle se croyait sûre d’atteindre. Passavant et de lui crier :
– Où allez-vous ? Venez, venez avec moi, car Roselys vous attend !…
À chaque fois, une nouvelle vague déferlait et la rejetait loin de celui qu’au prix de sa vie elle eût voulu étreindre en ses bras, car cet homme représentait la vie de Roselys.
Par un phénomène très explicable, Laurence avait tout à fait oublié qu’elle avait vu le chevalier au logis d’Ermine. La transmutation de mémoire avait aboli tout ce qui, dans cet esprit, édifiait l’artificielle personnalité de Jehanne. Mais, du même coup, toute la mémoire de Laurence, tout son passé, toute sa vie s’étaient reconstitués.
Laurence, donc, en ces brûlantes minutes où à travers vents et marées, vents d’émeute, marées d’humanités déchaînées, cherchait à se rapprocher du chevalier ; Laurence, disons-nous, évoquait l’époque lointaine où, pareille à un oiseau blessé revenant à l’ancien nid, pâle, désespérée, elle avait regagné l’hôtel Passavant et avait dit à l’enfant : « Y a-t-il place encore pour moi en ce logis d’honneur et de probité ?… Elle revoyait Hardy l’accueillant comme une sœur bien-aimée. Elle le voyait lever ses grands yeux curieux sur Roselys et murmurer : « C’est votre fille, n’est-ce pas ? Elle est belle comme un ange du livre d’heures de madame ma mère. »
L’amour du chevalier de Passavant datait de cette lointaine minute, étoile tremblotante qui se perdait dans l’immensité des ciels qu’on nomme le Passé.
Laurence pleurait. Mais c’étaient des larmes plus douces. L’impérieux besoin de se dévouer pour Passavant se fortifiait en elle.
Que n’eût-elle pas donné pour lui offrir une marque éclatante de sa gratitude et de son amour maternel… oui, maternel, car le chevalier, dans son cœur, devenait son fils au même titre que Roselys était sa fille ! Elle les confondait dans la même expansion d’amour, elle les eût voulu tous deux ensemble dans ses bras, souriants, heureux, dût-elle mourir l’instant d’après…
Et cette adorable idylle de son cœur fleurissait dans le sang du vaste carnage, sous les rafales des clameurs, parmi les tumultueux tourbillons d’humanité emportée par la tempête.
En de soudaines visions qui s’échafaudaient et se démolissaient brusquement comme des images de rêves, s’édifiaient les ruées des bandes populaires par delà lesquelles Hardy de Passavant tantôt lui apparaissait, faible forme lointaine devinée par son cœur plutôt que vue par ses yeux, et tantôt sombrait entre deux hautes vagues d’émeute. Et c’était le fulgurant passage de l’escadron d’Armagnac étincelant d’acier.
Elle marchait, épave ballottée, rejetée d’un bord de rue sur l’autre ; elle rasa l’Hôtel Saint-Pol comme une mouette qui péniblement rase une falaise, et brusquement ce fut la formidable collision des Armagnacs et des Bourguignons. Elle était près d’atteindre Passavant. Et encore, Passavant lui échappait, bondissant vers elle ne savait quel but, au cri de : « Hardi pour la dame d’Orléans !… » Et Laurence, bloquée par la furieuse bataille, par l’inextricable enchevêtrement des chevaux, fixait son regard éperdu sur la porte Saint-Antoine en murmurant : « Oh ! il cherche à sortir de Paris ! Il va fuir ! Roselys le reverra-t-elle jamais ? »
– Passavant ! Passavant ! Mon fils ! appela-t-elle dans un grand cri.
Une clameur lui répondit et s’épandit, grondante, fusant soudain en un hurlement terrible des Bourguignons ; la porte l’énorme porte Saint-Antoine s’ouvrait. À grand fracas, le pont-levis s’abattait ! La bande des Écorcheurs avait massacré le poste tandis que Polifer, Passavant, Tanneguy du Chatel et une centaine de démons formaient devant Jean sans Peur et ses gens une infranchissable barrière. Les survivants des Armagnacs franchissaient la porte, entourant la litière de la dame d’Orléans saine et sauve, troupe grondante, sanglante, terrible encore, qui prit au pas la route du Nord…
– Victoire ! victoire ! hurlèrent les Bourguignons.
Mais Jean sans Peur, dressé sur ses étriers, regardait s’éloigner Armagnac et murmurait :
– Tant que cet homme vivra, je mettrai en doute ma victoire.
Et alors, d’un mouvement de rage convulsif, il détourna la tête, leva sa large épée sanglante et cria :
– À l’Hôtel Saint-Pol !…
Ce fut un cri d’orgueil et de triomphe. Il allait entrer en conquérant dans cet Hôtel Saint-Pol où il saisirait la couronne de Charles en attendant l’heure où, dans la cathédrale de Reims, il deviendrait l’oint du Seigneur. Et la foule de ses guerriers le comprit. Car tous, ivres de carnage, ivres des honneurs et des jouissances qui les attendaient, d’une même voix puissante, tragique à force de volonté furieuse, crièrent :
– Vive le roi !…
Dans ce moment, le regard de Jean sans Peur tomba sur le chevalier de Passavant !…
Jean sans Peur eut un étrange hochement de tête. Il lui sembla d’abord que, de voir là cet homme qu’on avait entraîné à l’échafaud, cela ne lui causait qu’un médiocre étonnement. Ce n’était qu’un incident au milieu des rêves tumultueux de cette journée. Puis, brusquement, s’abattit sur lui cet étonnement qu’il niait et qui le pétrifiait. Puis une rage spasmodique le secoua. Il allongea son bras tremblant vers le chevalier et gronda :
– Passavant ! L’infernal Passavant !…
Autour de lui, on vit son geste sans comprendre ce qu’il disait. Plus loin, les guerriers hurlaient :
– À l’Hôtel Saint-Pol ! Vive le roi de Francs et de Bourgogne !…
Un vaste mouvement se produisit. Les chevaliers bourguignons, d’une irrésistible impulsion, se mettaient en marche vers l’Hôtel Saint-Pol, poussant devant eux le chef, le maître, le roi ! leur roi, qu’ils eussent massacré s’il eût résisté à la furie d’impatience qui les affolait… poussant donc Jean sans Peur, et en avant de Jean sans Peur, une foule parmi laquelle Passavant, Tanneguy, Polifer et une cinquantaine d’Écorcheurs.
Tout s’engouffra dans l’Hôtel Saint-Pol.
Et alors s’éleva l’immense clameur de triomphe à laquelle succéda le hurlement de la furieuse impatience :
– À la chapelle ! À la chapelle du roi !…
Tout de suite, sur l’heure, il leur fallait la prise de possession, le geste, la cérémonie, le n’importe quoi qui certifiait la victoire, assurait la curée, réalisait la mise à sac, le partage des places, des emplois, des honneurs, de l’argent. Celui-ci se voyait connétable, celui-là était grand amiral. Chacun s’indiquait à soi-même sa part, et Jean sans Peur s’avançait, prisonnier de cette formidable armée d’appétits. La troupe entière mettait pied à terre, et, gesticulante, hurlante parmi les cris, les éclats de rire, les menaces, les jurons, avec des figures convulsées, marchait sur la grande chapelle du roi où Jean sans Peur, en présence des hommes et de Dieu, allait être hissé sur le pavois…
Tout ce monde, pêle-mêle, pénétra dans l’immense galerie des fêtes du roi, se dirigeant, disons-nous, sur la grande chapelle.
Or, si les Bourguignons se fussent comptés à ce moment, ils eussent constaté qu’ils n’étaient guère que deux cents autour de Jean sans Peur. Ils étaient partis deux mille de la Porte Saint-Antoine. Qu’étaient devenus les autres ? Avaient-ils été entraînés sur quelque point de Paris par les remous de la bataille ?…
Loin du palais du roi, vers la grand’porte de l’Hôtel Saint-Pol, on eût pu entendre une rumeur de combat, mais cette rumeur se perdait dans l’immense tumulte qui montait de Paris, et brusquement elle s’éteignit.
Jean sans Peur, donc, à cet instant où cessait ce bruit de lutte autour de la grande porte de la forteresse, entrait dans la galerie des fêtes, solennel et magnifique vaisseau long de cent cinquante pas, au fond duquel, sur une estrade, sous un dais de velours fleurdelysé d’or, se trouvait le trône du roi, siège d’apparat où Charles VI ne prenait place qu’en de rares cérémonies.
Parmi tant de choses terribles et étranges qui se déroulèrent en cette journée, cette entrée en cette galerie fut la plus étrange ; elle fut inexprimablement étrange.
Voici ce qu’il y avait dans cette foule qui avait été jetée jusque là :
Jean sans Peur et ses principaux vassaux ou partisans, tels que Robert de Mailly, Antoine de Brabant (son frère), le sire de Jacqueville, le seigneur de Châtillon, Villiers de l’Isle-Adam, Saveuse, et tant d’autres, en tout, avons-nous dit, environ deux cents Bourguignons, bardés d’acier, éclaboussés de sang, les cuirasses bosselées, les visages étincelants.
À trois pas de Jean sans Peur, entraîné par le même violent reflux, sachant qu’il allait mourir là, et cherchant encore Roselys, marchait Passavant.
Plus loin, c’était Tanneguy du Chatel. Ailleurs, c’était Polifer.
Environ cinquante Écorcheurs étaient là.
Enfin, près de mille bourgeois et hommes du peuple, des enfants, des femmes, déchirés, sanglants, éperdus de se trouver dans l’Hôtel Saint-Pol, marchaient sans savoir, ayant vaguement conscience qu’ils bouleversaient un monde, et « faisaient de l’Histoire ».
Et tous ces gens, chevaliers, artisans, grands seigneurs, bourgeois, hommes, femmes, s’avançaient pêle-mêle confondus hurlant, vivant chacun une de ces inoubliables minutes qui pèsent sur toute la vie. Les Bourguignons vociféraient :
– À la chapelle ! Vive le roi !…
– Vive le roi ! répétaient artisans et bourgeois sans trop savoir de quel roi il s’agissait.
Cette foule aux éléments si divers dont le contact, à chaque instant, pouvait faire explosion, cette foule composée d’ennemis qui voulaient se tuer, et de grands féodaux, et de manants, cette foule s’avançait en bloc serré dans la grande galerie des fêtes du roi.
Ce fut en bloc qu’elle parvint jusqu’au milieu de cette galerie.
En sorte que la moitié de l’immense salle fut, à un moment précis, emplie de gestes furieux, d’attitudes convulsives, de visages flamboyants, tandis que l’autre moitié, vers le trône, demeura encore déserte.
Ce fut à ce moment précis que Jean sans Peur s’arrêta livide d’épouvante. Sans qu’il en eût donné l’ordre, ses seigneurs s’arrêtèrent d’un même arrêt brusque, et, pétrifiés d’étonnement, ils écoutèrent.
Et ce fut cet arrêt immédiat, sans cause apparente, cette soudaine immobilité de toute une foule, pareille alors à un énorme et fantastique jouet mécanique dont le ressort vient de se briser net, ce fut une chose improbable, mystérieuse, et profondément émouvante… Que s’était-il passé ?…
Presque rien : un incident familier à la plupart des figurants de ce drame :
Une fanfare lointaine, dans le palais du roi, venait de se faire entendre…
Une fanfare composée sûrement d’une trentaine de trompettes, au moins ; car, stridente, déchirante, elle perçait si, nous pouvons dire, les voiles épais de tous les tumultes flottants…
Et c’était la fanfare de Charles VI…
C’était la marche de triomphe qui se jouait seulement aux jours solennels où Charles VI, en grande pompe, venait occuper ce trône qui, là, au fond de cette salle, semblait l’attendre ?
Jean sans Peur trembla convulsivement, leva son épée rouge et gronda :
– Par le tonnerre de Dieu, je…
Il n’acheva pas. Les deux portes monumentales, de chaque côté du trône, s’ouvrirent ! Un huissier, d’une voix tragique, lança le cri que voulait l’étiquette.
– Le roi !… Place au roi !…
La fanfare éclata plus stridente. Par la porte de droite, Charles VI entra et monta sur son trône en grand costume de cérémonie[3], suivi d’Isabeau de Bavière, défaillante, chancelante, écumante de rage et de terreur, suivi de ses gentilhommes en costume de cour, et tout ce monde brillant, somptueux, vision d’un splendide effet décoratif, prit place autour de l’estrade, tandis que par la porte de gauche entrait Savoisy portant le costume de capitaine des gardes, et suivi de toute la garde royale : archers, pertuisaniers, hallebardiers, piquiers, quatre compagnies complètes de deux cents hommes chacune, – des hommes rouges de sang, les vêtements déchirés, encore tout échauffés de la bataille soutenue à la grand’porte de l’Hôtel Saint-Pol où ils avaient coupé la colonne des Bourguignons, laissant entrer Jean sans Peur, et repoussant ensuite le reste.
C’était l’œuvre de Brancaillon !…
C’était l’œuvre de Gringonneur !…
Dans la rue Saint-Antoine, dans la marche à l’Hôtel Saint-Pol, Jean de Bourgogne avait pris les devants avec environ deux cents des siens et une foule populaire. Un vaste remous d’émeute avait, quelques minutes, arrêté le gros des forces bourguignonnes. Et quand ce gros s’était présenté au pont-levis, la garde royale était déjà là !…
Cette garde avait été assemblée par Savoisy, nommé sur l’heure capitaine général de l’Hôtel Saint-Pol. Les chefs qui avaient trahi furent remplacés. De tous les palais de l’Hôtel, sortirent des gentilshommes qui, voyant la tournure que prenait la chose, se rangèrent résolument autour du roi. Isabeau fut saisie et gardée à vue. Le coup de théâtre fut préparé en une heure, et lorsque Jean sans Peur crut entrer dans la forteresse où il allait être proclamé roi de France, il entrait dans une chambre de mine dont la mèche était allumée.
*
* *
L’entrée du roi, des gardes, l’envahissement de la salle, la mise en place de cet énorme et magnifique ensemble scénique demanda quelques secondes pendant lesquelles Jean de Bourgogne sentit que la folie allait l’envahir. Convulsé, hagard de terreur, d’étonnement, il bégaya :
– Vivant !… Charles est vivant !…
Puis, tout à coup, la fureur le fit grelotter. Il se tourna vers ses guerriers. Il allait jeter un ordre, – un ordre à lui : l’ordre d’attendre… Presque aussitôt, l’un des courtisans du roi s’approcha de Jean sans Peur et lui murmura :
– Monseigneur, vous êtes ici pour livrer au fou le meurtrier d’Orléans, qui a échappé à l’échafaud et provoqué une émeute contre le roi. Parlez, monseigneur. Dites cela, rien que cela. Toutes les portes de l’Hôtel Saint-Pol sont gardées, et il y a cinq mille archers en bataille, dans la grande cour. Parlez. C’est l’ordre de la reine.
Jean sans Peur, avec cette mobilité de sentiments qui était à la fois sa force et sa faiblesse, avec l’instantanéité du noyé qui saisit la corde qu’on lui jette, Jean sans Peur lança à Isabeau un regard éperdu qui voulait dire : J’ai compris !… Et il acheva de crier l’ordre :
– Qu’on saisisse cet homme, et qu’on le porte devant Sa Majesté le roi ! Vive le roi !…
– Vive le roi ! hurlèrent les Bourguignons qui, eux aussi, comprirent la manœuvre.
En un instant, Passavant fut traîné jusqu’au pied du trône.
Et Jean sans Peur, blême d’épouvante et de rage, l’esprit affolé, les pensées en déroute, s’avança lentement. Charles VI se leva…
Avait-il compris, lui ?… Qui sait ?… Peut-être !
Mais nul ne put jamais savoir si, en cette effrayante minute, le fou fut vraiment sage, ou si, simplement, il ne continua pas son rêve de fou…
Il se leva, et, un instant, par-dessus son épaule, jeta un sourire à deux êtres bizarres qui, par un caprice de démence, avaient pris place en arrière du trône :
Jacquemin Gringonneur et Brancaillon !…
L’un grelottant, tremblant sur ses jambes, invoquant Jupiter et les saints, sublime de courage en sa poltronnerie, car il s’attendait à périr ; l’autre, gigantesque, impassible et grognant :
– Sire, jamais, dans ma vie, je n’eus une telle soif. N’ayez pas peur, sire. Je suis là. À moi seul, je les étriperai s’ils bougent. Mais, seigneur, quelle soif !…
Et alors, dans cette seconde d’intense angoisse où se jouaient la vie de tant d’hommes, la vie d’une monarchie, le sort d’un royaume, la destinée d’un peuple, qui, dans cette seconde, on l’entendit qui disait dans le silence de mort :
– Tu boiras, mon brave révérend ermite, tu boiras, va !… Vin ou sang, tu auras à boire !
Et se tournant vers Jean sans Peur, le visage tout joyeux :
– Ainsi, mon digne cousin, ce truand que vous m’apportez a causé une émotion dans notre bonne ville, et vous l’avez saisi pour me l’apporter au péril de votre vie ?…
Le silence, disons-nous, était énorme : un de ces silences épouvantables qui s’abattent sur une foule et semblent peser sur les épaules comme si vraiment l’air chargé d’angoisse se faisait inexprimablement lourd. Jean sans Peur répondit :
– Oui, sire…
Passavant, très calme, tout droit, son sourire sceptique au coin des lèvres, ne bougea pas.
– Et cet homme, reprit Charles, c’est le meurtrier ?
– Le meurtrier de votre bien-aimé frère d’Orléans, oui, sire ! dit Jean sans Peur.
Le roi hocha la tête. Brancaillon jura sourdement. Gringonneur éternua de terreur. Tanneguy du Chatel se secoua furieusement au milieu des gardes. Jean sans Peur essaya de raffermir sa voix, et grelotta :
– Le meurtrier !…
Le silence devint lourd, l’angoisse palpita sur cette assemblée. Une voix prononça des mots… une voix d’une étrange solennité, une voix glaciale, terrible de calme. Elle disait :
– Jean de Bourgogne, vous mentez !…
Et Jean sans Peur éprouva une effroyable secousse qui acheva de détraquer son cerveau. On le vit se tourner lentement vers cette voix qui venait de proférer une telle insulte contre un tel personnage, on le vit esquisser un geste de lassitude, le geste d’un homme qui se trouve sous la poigne de la fatalité, on le vit essayer de reculer, et ceux qui étaient près de lui l’entendirent murmurer : « Le spectre !… »
Tous les regards se tournèrent sur Laurence.
Elle, s’avançait, et, sur son passage, on se reculait d’instinct pour lui faire place.
– Qui est cette femme ? demanda le roi.
– Sire, dit Passavant, d’une voix qui résonna en d’étranges vibrations, sire, cette femme, c’est la justice qui vient. Taisez-vous, sire, laissez parler la justice !
Et l’instant était si angoissant, si hors de toutes choses attendues, que nul, pas mêmes Charles VI, ne songea à s’étonner de l’audace du condamné parlant ainsi au roi de France.
Jean sans Peur reculait. Il se heurta à la cuirasse d’un de ses vassaux, tressaillit, frissonna, et attendit la venue du spectre, l’œil éteint maintenant, les cheveux hérissés, l’esprit sans pensée ou ne roulant que des pensées de cauchemar. Dans ce cerveau s’érigeait la folie…
Laurence d’Ambrun s’arrêta près de Jean sans Peur et dit :
– Jean de Bourgogne, vous savez qui est le meurtrier du duc d’Orléans. Dénoncez-le…
Jean sans Peur jeta autour de lui ce regard vide et morne des gens qui ne peuvent plus échapper à l’étreinte d’un malheur, et il bégaya :
– C’est Passavant…
Laurence tira de son sein un parchemin qu’elle déplia. Elle reprit :
– Jean de Bourgogne, vous mentez. Il faut ici dire le nom du meurtrier. Dites-le !…
– Non ! gronda le duc. Spectre, je te conjure de te retirer !…
– Le nom du meurtrier ! répéta Laurence.
– Je ne veux pas ! râla Jean sans Peur qu’on vit se débattre comme si vraiment une invisible main l’eût saisi à la gorge.
– Alors, dit Laurence, je vais vous lire ce qui est écrit sur ce parchemin. Écoutez, Jean de Bourgogne…
On vit Laurence d’Ambrun se rapprocher de Jean sans Peur. On entendit le murmure de sa voix qui lisait le parchemin. Mais nul ne put saisir un mot distinct. À mesure qu’elle lisait le parchemin… l’acte de mariage !… la preuve matérielle du sacrilège !… la preuve écrite et signée d’un crime plus terrible alors que le parricide et le régicide !… à mesure donc qu’elle lisait, on vit le duc de Bourgogne se courber comme sous une main invisible, on vit son front ruisseler de sueur, et ses yeux s’égarer, on le vit palpiter et panteler, on l’entendit demander grâce !…
Laurence d’Ambrun replia le parchemin et le mit dans son sein. Alors elle prononça :
– Jean de Bourgogne, voulez-vous que je relise à voix haute ?
– Grâce ! râla Jean sans Peur. Laurence, pardonne à celui qui t’aima !…
– Je ne lirai donc pas ! Mais vous, dites au roi le nom du meurtrier de son frère.
Jean sans Peur, d’un mouvement lent et raide, se tourna vers Charles VI. À coup sûr, il était fou en cette minute. L’arrivée du roi, la fanfare, l’invasion de la garde royale, l’écroulement subit de son rêve de puissance lui avaient déjà asséné un coup terrible. L’apparition du spectre avait désorganisé, émietté, balayé ce qu’il y avait encore en lui de volonté. La lecture de cet acte qu’il croyait anéanti depuis des ans acheva de l’affoler. Il éprouva le vertige de l’horreur. Il eut la sensation de tomber dans un gouffre. Les yeux morts, la voix pâteuse, le geste indécis, il murmura :
– Sire, le meurtrier de votre frère le duc d’Orléans…
– Eh bien ! hurla le roi. Parlez donc enfin, par Notre-Dame ! Qui est-ce ?…
– C’est moi !…
– Vous ! rugit Charles VI.
– Moi !…
À ce mot effrayant, il y eut d’abord comme un coup de silence, – la sensation inverse d’un coup de tonnerre. Puis, un vaste murmure qui se gonfla, monta, éclata, se déchaîna en clameurs furieuses. Et dans cette rumeur faite d’horreur, de terreur, de stupeur, grinça la voix du roi qui jetait l’ordre :
– Arrêtez-le ! Arrêtez le duc de Bourgogne !…
Il y eut une formidable poussée de la garde royale. Savoisy s’avançait, en hurlant :
– Votre épée, seigneur duc, votre épée !
En un instant, Jean sans Peur fut entouré par ses gentilshommes, disparut derrière un étincelant rempart de cuirasses, hérissé d’épées. Ce groupe, tout d’une pièce, se mit en route vers la porte, harcelé par les archers, grondant, frappant, faisant gicler le sang et, une minute plus tard, Jean sans Peur avait gagné la grande cour d’honneur de l’Hôtel Saint-Pol.
*
* *
Comment Jean sans Peur fut amené à s’avouer hautement coupable du meurtre, comment il fut poussé à cet acte de folie que l’histoire déclare incompréhensible et se contente d’attribuer au remords, nous avons tenté de l’expliquer.
Comment Jean sans Peur put sortir de l’Hôtel Saint-Pol, c’est un événement qui demeure encore mystérieux.
On dit pourtant qu’une rude bataille fut livrée par les deux cents Bourguignons à la grand’porte de l’Hôtel Saint-Pol ; on dit que cette bataille dura environ vingt minutes et que plus de cinquante Bourguignons y mordirent la poussière. On dit que les survivants, groupe farouche et redoutable encore, plaçant, au milieu d’eux leur duc insensible, inerte, incapable d’une volonté de défense, tentèrent un suprême assaut et qu’ils allaient tous être égorgés, lorsque la porte, enfin, s’ouvrit, et que le pont-levis s’abattit.
Les Bourguignons, poussant ensemble un rugissement de joie, se lancèrent sur la porte ouverte et disparurent dans la rue Saint-Antoine.
Dix minutes plus tard, Jean de Bourgogne, au milieu des siens, galopait sur la route de Dijon, abandonnant les émeutiers, Caboche et plus de deux mille Bourguignons qui se retirèrent comme ils purent. Il paraît que pendant plusieurs jours, éperdument, Jean sans Peur galopa, et que de minute en minute, il regardait derrière lui, et qu’à toutes les questions, à toutes les exhortations, à toutes les imprécations, il répondait seulement :
– Le spectre ! Voyez si le spectre ne nous suit pas !…
Mais qui ouvrit la grand’porte de l’Hôtel Saint-Pol ? Qui baissa le pont-levis ?…
On raconte qu’au plus fort de la bataille, alors qu’il n’y avait plus d’espoir pour les Bourguignons, trois hommes se jetèrent dans la mêlée : un colosse armé d’une hache, un capitaine qui portait de rudes coups de masse, et un jeune homme, un furieux, un démon devant qui tout pliait. Ces trois hommes, donc, chose fantastique, étaient escortés d’une femme qui passa au travers du carnage, sans un mot, sans un geste, comme si elle eût été invisible.
On dit que ces trois furieux, faisant une trouée de sang en travers des archers, ouvrirent la porte et manœuvrèrent le mécanisme du pont-levis.
On dit enfin qu’au moment où Jean sans Peur franchissait la porte, le capitaine des gardes, avec un gros d’archers, se rua sur le duc. Mais alors, le capitaine sentit une main de fer s’abattre sur son épaule, et il se trouva en présence du plus jeune des trois furieux qui le maintint rudement, et, souriant d’un étrange sourire, tout sanglant, tout hérissé, improbable vision, irréelle figure d’héroïsme et de force, d’une voix narquoise, prononça ces mots plus étranges encore :
– Laissez, monsieur ! Laissez passer !…
– Quoi ! vociféra le capitaine, laisser passer le meurtrier !…
– « Non ! Laissez passer le père de Roselys !… »
Notre récit s’arrête ici. Pour les cœurs sensibles qui ont pu s’intéresser à la jolie petite Roselys, ajoutons pourtant que la science du sorcier Saïtano triompha de la mort, et que, trois mois après ces quelques épisodes, dans l’église Saint Jacques-de-la-Boucherie, fut célébré le mariage de noble demoiselle Roselys d’Ambrun avec le chevalier Hardy de Passavant.
À ce mariage assista Laurence d’Ambrun rajeunie par le bonheur.
On y vit aussi le brave Tanneguy du Chatel, encore furieux d’avoir contribué au sauvetage de Jean sans Peur, et Brancaillon qui, de son côté, jamais ne put comprendre comment et pourquoi il s’était battu près de la grand’porte de l’Hôtel Saint-Pol pour favoriser la fuite du duc.
Tous nos lecteurs savent ce que devinrent Isabeau de Bavière, Charles VI et Jean sans Peur. C’est de l’Histoire.
FIN.
À propos de cette édition électronique
Texte libre de droits.
Corrections, édition, conversion informatique et publication par le groupe :
Ebooks libres et gratuits
http://fr.groups.yahoo.com/group/ebooksgratuits
Adresse
du site web du groupe :
http://www.ebooksgratuits.com/
—
Janvier 2010
—
– Élaboration de ce livre électronique :
Les membres de Ebooks libres et gratuits qui ont participé à l’élaboration de ce livre, sont : Jean-Yves, Jean-Marc, PatriceC, Coolmicro et Fred.
– Dispositions :
Les livres que nous mettons à votre disposition, sont des textes libres de droits, que vous pouvez utiliser librement, à une fin non commerciale et non professionnelle. Tout lien vers notre site est bienvenu…
– Qualité :
Les textes sont livrés tels quels sans garantie de leur intégrité parfaite par rapport à l'original. Nous rappelons que c'est un travail d'amateurs non rétribués et que nous essayons de promouvoir la culture littéraire avec de maigres moyens.
Votre aide est la bienvenue !
VOUS POUVEZ NOUS AIDER À FAIRE CONNAÎTRE CES CLASSIQUES LITTÉRAIRES.