
Michel Zévaco
LA COUR DES MIRACLES
1900-1901
– La Petite République Socialiste
1910 – Arthème Fayard, Le Livre populaire
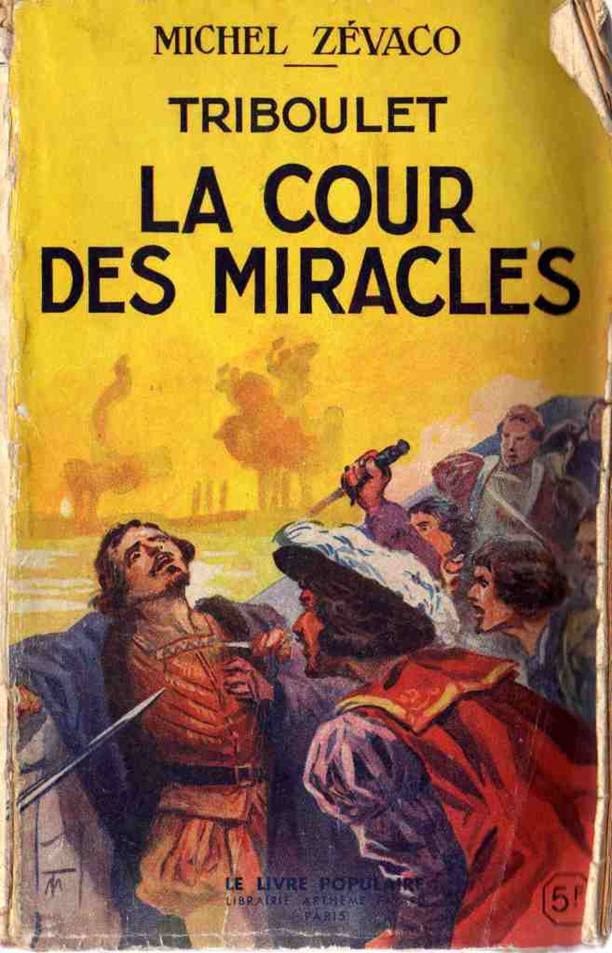
Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » – http://www.ebooksgratuits.com/
Table des matières
II UNE VICTOIRE DE FRANÇOIS Ier
VI LA RÉCOMPENSE D’ALAIS LE MAHU
VII LE TESTAMENT D’ÉTIENNE DOLET
XVIII LA MÈRE DE GILLETTE.. 235
XIX NOUVELLE APPARITION DE FRÈRE THIBAULT ET FRÈRE LUBIN
XXII LA RUE SAINT-ANTOINE.. 288
XXV LA BELLE FERRONNIÈRE.. 343
XXXIII JARNAC ET LA CHATAIGNERAIE
XXXVII UN SOIR DE PRINTEMPS. 563
XXXIX DU BOUFFON AU ROI DE FRANCE
À propos de cette édition électronique
Texte établi d’après l’édition Arthème Fayard Le Livre populaire 1956, version abrégée.
I
TRUANDS ET RIBAUDES[1]
À l’époque dont nous essayons de donner une idée par le caractère des personnages et les aventures possibles, les choses publiques s’entouraient de moins de mystère qu’aujourd’hui.
De nos jours une opération de police, une rafle, par exemple, demeure un secret tant qu’elle n’a pas été opérée.
Les truands de la Cour des Miracles étaient tous au courant de l’expédition qui se préparait contre eux, sorte de rafle énorme imaginée par Monclar sous l’inspiration d’Ignace de Loyola.
La seule chose qu’on ignorât parmi les truands, c’était le jour où l’attaque aurait lieu.
En attendant, la Cour des Miracles s’était préparée à soutenir un véritable siège.
Le roi d’Argot – le mendiant Tricot – avait fort habilement répandu le bruit que l’expédition n’aurait pas lieu, mais grâce aux conseils de Manfred et de Lanthenay, on avait agi comme si les gens du roi eussent été sur le point d’arriver.
C’est-à-dire qu’on avait entassé des provisions, et qu’on avait fortement barricadé les ruelles qui aboutissaient à la Cour des Miracles.
Tricot, d’abord opposé à toute résistance, avait feint de prendre au sérieux son rôle de général d’armée.
Ce soir-là, comme d’habitude, il avait placé des sentinelles avancées dans les rues qui avoisinaient le vaste quadrilatère. Seulement, ces sentinelles étaient des créatures à lui, et à chacune il avait donné pour mot d’ordre :
– Ne rien dire, et laisser passer !
Ces quelques explications données, revenons à Ragastens.
Le chevalier et Spadacape s’étaient rapidement éloignés de la rue Saint Denis, se dirigeant par le plus court vers la Cour des Miracles. Ragastens était soucieux.
Il fallait coûte que coûte arriver jusqu’à Manfred.
Or, il s’était heurté à de si étranges difficultés toutes les fois qu’il avait voulu entrer sur le territoire de l’Argot qu’il désespérait presque d’y pouvoir pénétrer.
– Monseigneur, dit Spadacape en souriant dans sa terrible moustache, savez-vous à quoi je pensais quand nous étions enfermés dans le caveau de l’enclos des Tuileries ?
– Non, mais je serais content que tu me le dises.
– Je pensais que si, par hasard, un des soldats avait eu soif, et qu’il eût voulu boire du vin de notre futaille…
– Je devine le reste : nous étions obligés d’en découdre. Mais pourquoi cette réminiscence ?
– Pour rien ; parce que je pensais que des gens qui ont soif sont capables de tout, même d’oublier une consigne.
– Je vois ce que tu veux dire. Mauvais moyen ! J’en ai essayé… Non, j’ai une autre idée qui réussira peut-être. Allons…
Bientôt, ils se trouvèrent dans le dédale d’infectes et sombres ruelles qui formait un inextricable réseau autour du domaine des truands.
L’idée de Ragastens était de raconter au premier truand qui voudrait l’empêcher de passer, ce qu’il venait d’apprendre de la bouche du roi lui-même, c’est-à-dire qu’à minuit, l’empire d’Argot allait être attaqué par toutes les forces de Monclar.
À son grand étonnement, il avançait sans encombre.
Tout à coup, il se trouva dans une ruelle au milieu de laquelle se dressait une barricade.
– Ah ! ah ! pensa-t-il paraît que nos gens étaient sur leurs gardes ! C’est ici que nous allons être arrêtés.
Un homme se dressa près de lui.
– Mon ami, dit Ragastens, il faut que je passe, il y va de notre vie à tous.
– Vous êtes de la cour ? fit l’homme, Passez.
C’était une des sentinelles de Tricot.
– De quelle cour veut-t-il parler ? se dit Ragastens.
Et il enjamba rapidement les obstacles accumulés dans cet endroit.
Sans plus se demander ce que signifiait cette extraordinaire facilité qui lui était donnée, surtout en un moment où plus que jamais les défiances des truands devaient être éveillées, Ragastens poursuivit son chemin.
Et ce lui fût une violente émotion que d’apercevoir au bout de la ruelle une vaste place éclairée par des feux.
Quelques secondes plus tard, il était dans la Cour des Miracles. Il s’arrêta d’abord pour s’orienter, s’il pouvait, et jeter un coup d’œil sur l’étrange spectacle qui se déroulait autour de lui.
Cinq ou six brasiers allumés de distance en distance brûlaient avec des flammes lourdes enveloppées de fumées ; par moments un coup de vent chassait la fumée, et alors les flammes éclairaient de reflets rouges les maisons qui bordaient le vaste quadrilatère, maisons lézardées, lépreuses, dont les fenêtres noires semblaient des yeux louches fixés sur la place.
Autour de chaque feu grouillait une vraie foule et autour de grandes tables, des hommes à figures sinistres, des femmes à physionomies fatiguées chantaient d’une voix éraillée et vidaient leurs gobelets d’étain, qu’au fur et à mesure les ribaudes remplissaient de vin.
D’autres, assis sur le sol détrempé, fourbissaient des rapières ou aiguisaient des poignards.
Quelques-uns chargeaient des arquebuses.
Ragastens et Spadacape passèrent au milieu de ces groupes sans que personne parût faire attention à eux.
En effet, du moment qu’ils étaient là, c’est qu’ils avaient dû donner de bonnes raisons aux sentinelles.
Ragastens examinait avec une avide attention ces groupes bizarres qui formaient, dans la lueur des brasiers un ensemble fantastique.
Il cherchait à reconnaître parmi ces sombres figures, parmi ces farouches physionomies, la figure ouverte, riante et énergique du jeune homme qu’il avait tiré du charnier de Montfaucon.
Mais arriverait-il à le reconnaître, même s’il le voyait ?
Au centre de la place, un groupe plus nombreux et plus intéressant attira son attention. Là, on ne buvait pas, on ne chantait pas. Et ce groupe, composé de deux à trois cents hommes, semblait, écouter avec attention quelqu’un qui parlait.
Ces hommes étaient tous armés solidement.
La plupart portaient des cuirasses.
Ils constituaient en somme la véritable armée de la Cour des Miracles.
Ragastens s’approcha, se faufila à travers les rangs serrés et parvint aux premières places.
Au centre de ce groupe, dans un assez large espace laissé vide, se dressait une sorte d’échafaud composé de planches posées sur des tonneaux vides.
Sur cet échafaud, il y avait une chaise, et sur la chaise un homme assis parlait à voix assez haute pour être entendu de tout le groupe. Ragastens le reconnut immédiatement. Cet homme, c’était Tricot.
Au silence attentif qui régnait autour de lui, Ragastens devina de quelle autorité jouissait ce brigand.
Auprès de l’échafaud, quelques hommes attendaient, peut-être pour parler à leur tour à cette espèce d’assemblée de notables ; car, à la Cour des Miracles comme partout ailleurs, on retrouvait une hiérarchie sociale, atténuée il est vrai par l’indépendance dont chaque membre de la confrérie pouvait se réclamer.
– Je me résume, disait Tricot, achevant une harangue commencée depuis quelques minutes. On ne nous attaquera pas ; on n’osera pas ! Nous avons des privilèges consacrés par l’usage de plusieurs siècles ; nous avons mieux encore, nous avons la force ! Donc, je dis que nous n’avons rien à craindre. Mais s’il est impossible que le grand prévôt ait perdu toute prudence au point de risquer une attaque violente contre le royaume d’Argot, comprenez aussi que vous ne devez pas vous livrer à des provocations dangereuses. Je propose donc que les barricades, qui sont une sorte d’insulte inutile adressée au grand prévôt, soient démolies à l’instant, et que chacun déposant ses armes rentre dormir tranquillement. J’ai dit.
Un murmure approbateur circula dans les rangs des truands, mais tel que pouvait être le murmure de loups assemblés, c’est-à-dire qu’on entendit un grondement qu’un profane eût pu prendre pour l’expression de la rage et non de la faveur.
Une voix jeune et forte domina tout à coup ce tumulte.
– Frères, disait-elle, le bon Tricot se trompe. Je jure que vous serez attaqués avant peu. Je propose au contraire de renforcer nos barricades. Ragastens fut secoué d’un profond tressaillement. Il se haussa sur la pointe des pieds et vit un jeune homme qui au pied de l’échafaud, appuyé sur sa rapière, parlait.
C’était Manfred.
Le cœur du chevalier se mit à battre.
Non, il n’était pas possible que cette figure franche, ouverte et hardie fût la figure du bandit que Tricot avait dépeint chez Monclar.
Emporté par un irrésistible élan de sympathie, Ragastens s’élança dans l’espace laissé vide et s’arrêta devant Manfred.
Il y eut un instant de silence et de stupeur.
Manfred, voyant deux hommes armés s’élancer vers lui, avait froncé les sourcils. Il allait crier « Trahison ! » lorsque le chevalier lui dit rapidement :
– Souvenez-vous de Montfaucon et de son charnier !
– Le chevalier de Ragastens ! s’écria Manfred dans une explosion de joie. Enfin, je vous vois, monsieur ! Enfin, je puis vous remercier !
Et il tendit les deux mains à Ragastens qui les serra avec une indicible émotion.
Mille pensées se pressaient dans la tête du chevalier.
Mille paroles voulaient sortir à la fois.
Il voulait lui parler de Béatrix, de Gillette, de lui-même, de l’Italie, lui poser les questions qu’il brûlait de lui adresser.
Mais il fallait avant tout sauver la situation.
– Monsieur, dit-il, avant toutes choses, faites changer à l’instant même toutes vos sentinelles.
– Pourquoi cela ?
– Si j’ai pu passer sans la moindre difficulté, c’est que d’autres pourront passer aussi…
– Vous avez raison. Nous sommes trahis !
Il dit quelques mots à Lanthenay qui s’élança aussitôt.
Cependant, cet incident avait provoqué une vive curiosité parmi les truands qui, d’abord tout prêts à se ruer sur les deux étrangers, se rassurèrent en voyant l’attitude de Manfred.
Tricot, assis au milieu de l’échafaud, ne pouvait voir le chevalier.
Et, tandis que Ragastens et Manfred échangeaient avec vivacité quelques paroles, le roi d’Argot recommençait à parler pour convaincre les truands.
– C’est notre frère Manfred qui se trompe, dit-il : je sais positivement que le grand prévôt n’a aucune intention mauvaise contre nous…
– C’est donc lui-même qui te l’a dit ! s’écria Manfred.
En même temps, il escalada l’échafaud et se dressa près de Tricot.
Celui-ci avait eu un frémissement de fureur.
– Tu insultes le roi d’Argot ! dit-il ; tu vas être jugé à l’instant.
Un silence glacial tomba sur le groupe des truands.
– C’est toi qui va être jugé ! riposta Manfred. Frères, j’accuse Tricot de trahison. Je l’accuse de s’être vendu au grand prévôt. Je l’accuse d’être d’accord avec ceux qui veulent notre destruction…
– C’est faux, hurla Tricot.
– Le jugement ! le jugement ! vociféra la foule.
– Il faut qu’il s’explique.
– Si Manfred a menti, il mourra !
En quelques secondes, la scène que nous venons de décrire avait changé d’aspect.
La justice des truands était expéditive. Il n’y avait point parmi eux de juge instructeur ni de tribunal régulier. Mais le dernier des piètres pouvait porter une accusation contre le plus redouté des massiers ou des suppôts, le massier ou le suppôt, le duc d’Égypte lui-même, et le roi d’Argot était tenu de s’expliquer séance tenante devant le tribunal.
Or, non loin de l’échafaud qui avait servi de trône à Tricot – trône sinistre et que par dérision philosophique on avait fait semblable aux échafauds des condamnés à mort, – non loin de ce trône, donc, s’élevait une potence.
Elle se composait d’une poutre grossière plantée en terre.
Au sommet, une autre poutre transversale était clouée.
Cela formait un L renversé.
Du bout du petit jambage de l’L, descendait une corde qui se terminait par un nœud coulant.
Juste au-dessous du nœud coulant, il y avait un escabeau à trois pieds.
Cette potence et ce trône étaient là l’un près de l’autre, en permanence. On se contentait seulement de renouveler la corde, de temps à autre.
Lorsque le tribunal avait condamné à mort un truand, un associé coupable de quelque méfait contre la confrérie, on le faisait monter sur l’escabeau, on lui passait le nœud autour du cou.
Puis l’un des assistants donnait un coup de pied dans l’escabeau qui se renversait, et le patient tombant dans le vide se trouvait pendu dans toutes les règles de l’art et selon les formules de la justice la plus expéditive.
En quelques secondes, disons-nous, la foule qui d’abord avait entouré le trône de Tricot entoura la potence.
Tricot vint de lui-même se placer devant ses juges.
Manfred, en sa qualité d’accusateur, se plaça près de Tricot.
À ce moment, onze heures sonnèrent à Saint-Eustache.
Tricot tressaillit.
– Que je gagne seulement une demi-heure, pensa-t-il, et que je puisse donner le signal, je suis sauvé.
Il jeta les yeux autour de lui.
Près de la potence, des arquebuses toutes chargées avaient été déposées pour servir en cas d’attaque.
Tricot les vit et eut un sourire.
On se rappelle qu’il devait tirer trois coups d’arquebuse pour dire à Monclar que les truands dormaient et qu’on pouvait envahir la Cour des Miracles.
– Parle ! dit rudement l’un des juges en s’adressant à Manfred, Tricot te répondra ensuite.
– Je répète ce que j’ai avancé. Tricot vous trahit. Les sentinelles qu’il avait posées lui-même étaient de connivence avec lui.
– La preuve ? hurla Tricot.
Lanthenay apparut.
– Je viens de faire remplacer toutes les sentinelles, dit-il ; j’ai fait lier celles que Tricot avait postées ; toutes ont avoué qu’elles avaient reçu pour mot d’ordre : Ne rien dire et laisser passer.
– Qu’as-tu à dire ? fit l’un des juges.
– Que les sentinelles ont été payées pour m’accuser, ou qu’elles n’ont pas compris l’ordre que j’avais donné.
– J’accuse Tricot d’avoir eu des entretiens avec le grand prévôt, dit fortement Manfred.
– Réponds ! dit un juge.
– Je réponds que c’est faux ! Si cela est vrai, c’est que quelqu’un m’aurait vu ?… Qui est ce quelqu’un ?
– Moi ! dit Ragastens.
Tricot devint livide. Il fixa sur le chevalier un regard hébété. Puis, faisant un effort, il murmura :
– Je ne vous connais pas…
– Qui est cet étranger ? Comment est-il parmi nous ? demanda un juge.
– Oui ! oui ! s’écria Tricot en reprenant tout son aplomb… Qu’il dise comment il a pu entrer parmi nous !
– C’est bien simple, répondit tranquillement le chevalier ; vos sentinelles m’ont laissé passer parce qu’elles avaient reçu l’ordre de laisser passer tout ce qui viendrait de la cour. On m’a pris pour un seigneur du roi…
À ces mots, il s’éleva une furieuse clameur, et Tricot vit se tendre vers lui les poings énormes des truands.
Mais tel était l’instinct de discipline chez ces natures primitives que pas un ne fit un pas : le tribunal n’avait pas encore statué.
– C’est un étranger ! hurla Tricot pour dominer le tumulte. Aurez-vous plus de confiance en cet homme, espion probable, qu’en moi que vous connaissez et aimez depuis vingt ans ?
Ragastens fit un pas et saisit le poignet de Tricot.
– Tu m’as appelé espion, dit-il de cette voix qui, chez lui, était l’indice d’une confiance illimitée en lui-même, tu vas demander pardon…
Tricot poussa un cri de douleur et essaya de se débattre.
La foule des truands, muette, attentive, regardait avidement.
Ragastens, immobile, presque souriant, tendit ses nerfs dans un effort prodigieux. Le brigand se débattit une seconde encore, puis, pantelant, blême de rage, tomba à genoux et râla :
– Pardon…
Il y eut des trépignements de joie terrible dans cette cohue que le spectacle de la force opposée à la force faisait palpiter.
– Noël ! Noël ! vociférèrent les ribaudes enthousiasmées.
Mais Manfred fit un geste.
Le silence se rétablit. Il parla :
– Frères, un jour j’ai été pris comme jeune loup par les renards du grand prévôt. Acculé au gibet de Montfaucon, je me suis réfugié dans le charnier. Savez-vous ce qu’a fait M. de Monclar ? Il a fermé la porte de fer et a placé douze gardes devant cette porte en ordonnant de me laisser mourir de faim…
Il nous serait difficile de donner une idée de la tempête que ces mots soulevèrent. Toutes les imprécations connues dans toutes les langues d’Europe se croisèrent et se heurtèrent à l’adresse du grand prévôt !…
– Je lui mangerai les tripes !…
– Je veux que son crâne me serve de gobelet !…
– Il faut le rôtir à petit feu !
Ces exclamations roulèrent furieusement au-dessus de ces mille têtes convulsées et féroces.
– Frères, reprit Manfred, un homme est alors arrivé. Il a mis en fuite les douze gardes du grand prévôt ; il a défoncé la porte de fer et m’a dit : « Tu es libre ! » Cet homme, le voici !
Il désignait Ragastens.
Les cris reprirent, mais le plus vieux des juges étendit les deux bras, et le silence se fit avec la brusquerie instantanée de tous les mouvements qui agitaient ces hommes.
– Honneur à ce noble étranger, s’écria le vieux truand, farouche et curieuse physionomie, avec sa grande barbe grise, ses cheveux épars ; glorifié soit-il ! Chez nous, chez nos enfants, et les enfants de nos enfants, jusqu’aux générations les plus reculées, le souvenir de sa hardiesse et de son courage demeurera en exemple. Qu’il parle ! Il nous fait honneur, en venant parmi nous.
Ragastens, embarrassé, se tourna vers Tricot :
– Avoue donc, maître fourbe…
– Avouer, c’est mourir, dit Tricot à voix basse. Monseigneur, sauvez-moi, par pitié !…
Ragastens se tourna alors vers l’étrange tribunal et voulut parler pour demander la grâce du roi d’Argot.
Malheureusement pour celui-ci, ses paroles avaient été entendues par quelques-uns des plus rapprochés.
– Il a avoué ! hurlèrent-ils À mort ! À mort !
En un instant, Tricot fut saisi et placé sur l’escabeau. Ragastens s’apprêta à défendre l’infortuné. Mais au moment où il allait tirer sa rapière, il se sentit saisi par le bras.
– Laissez faire, monsieur, dit Manfred. Autant vaudrait essayer d’arrêter un torrent… Voyez !… Et puis, le personnage n’en vaut pas la peine…
Or, tandis que Manfred parlait ainsi, une scène inouïe, affreuse, commençait à se dérouler. Une dizaine de truands, avons-nous dit, avaient saisi Tricot, l’avaient entraîné à la potence, l’avaient placé sur l’escabeau – sinistre marchepied de la mort – et s’apprêtaient à lui passer autour du cou le nœud coulant.
– Grâce ! Laissez-moi vivre ! râlait le malheureux.
À ce moment, une centaine de ribaudes se précipitèrent vers la potence en hurlant :
– Il ne faut pas qu’il meure de la mort des braves !
Elles saisirent l’ancien roi d’Argot et l’entraînèrent vers l’un des coins les plus obscurs de la Cour des Miracles.
Quel acte de justice sommaire, fruste et primitive, accomplirent ces Euménides aux cheveux flottants, impudiques avec leurs seins nus, hideuses et superbes ?
On entendit les clameurs d’épouvante de Tricot et les clameurs de rage des ribaudes…
Puis, la voix du roi d’Argot s’éteignit, sombra, pourrait-on dire.
Et quelques moments plus tard, on vit cinq ou six ribaudes sanglantes jeter au loin les membres d’un cadavre.
L’avaient-elles donc écartelé ?
S’étaient-elles attelées à ses quatre membres comme des juments qu’affolent les coups de fouet du bourreau ?
L’avaient-elles haché en quartiers ?
On ne sut jamais au juste.
Mais un truand, sorte de brute monstrueux, géant d’autant plus semblable à quelque antique cyclope qu’il était borgne, revint tranquillement vers la potence.
Il s’appelait Noël le Borgne.
À deux pas de la potence, l’étendard des truands était fiché en terre. Cet étendard se composait d’une lance au fer de laquelle était planté un quartier de charogne, quartier de cheval abattu ou de chien tué…
Or, Noël le Borgne saisit la lance, enleva le quartier, le remplaça par quelque chose qu’il cachait dans son manteau, puis remit l’étendard à sa place.
Un immense et féroce hurlement des ribaudes et des truands salua le nouvel étendard.
Ce quelque chose que Noël le Borgne avait planté au fer de la lance, c’était la tête de Tricot, roi d’Argot…
Ragastens avait pâli.
– Il est onze heures et demie, dit-il, venez, il est grand temps.
Manfred secoua la tête.
– Je reste, dit-il.
– Mais toutes les forces du grand prévôt vont attaquer…
– C’est pour cela que je reste.
– Vous êtes donc réellement des leurs ? Vous êtes donc bien vraiment un truand ?
– Je ne suis pas truand, répondit tranquillement Manfred, mais j’ai été élevé parmi ces malheureux ; je n’ai jamais vu que des sourires pour moi dans leurs yeux, et leurs mains violentes ont pris pour moi, lorsque j’étais enfant, l’habitude des caresses…
– Parlez ! parlez encore ! fit Ragastens.
– Ce sont des malheureux, continua le jeune homme, et je les aime comme ils m’ont aimé. Ils ont besoin de moi ce soir. Je mourrai avec eux, s’il le faut… Merci, monsieur, de votre bon avertissement… Je vous suis deux fois reconnaissant, s’il est possible… mais je reste…
– En ce cas, je reste aussi, dit Ragastens.
Manfred poussa un cri de joie.
– Avec une épée comme la vôtre, nous sommes sauvés, s’écria-t-il.
Et il appela Lanthenay.
– Frère, voici l’homme généreux dont je t’ai si souvent parlé…
Lanthenay jeta un regard d’admiration et de reconnaissance sur le chevalier auquel il tendit la main.
– Monsieur, dit-il, Vous êtes un héros. Grâce à vous, mon frère vit encore…
– Votre frère ? demanda vivement Ragastens.
– Oui, nous nous donnons ce nom, Manfred et moi, bien que nous ne soyons pas du même sang, au moins selon toutes probabilités.
Ragastens, d’un coup d’œil, avait étudié et jugé Lanthenay, c’est-à-dire l’homme que Tricot lui avait dépeint comme capable de tous les crimes.
Et l’impression de cet examen était que Tricot avait menti effrontément. Dans quel but ?
Les derniers mots de Lanthenay le firent tressaillir.
– Vous dites « selon toutes probabilités », fit-il ; excusez ma curiosité et ne l’attribuez qu’à la sympathie que vous m’inspirez tous les deux…
– Je parle ainsi, répondit Lanthenay, parce que ni Manfred, ni moi ne connaissons nos origines… Nous avons été élevés ensemble par une bohémienne de la Cour des Miracles, et voilà tout ce que nous savons de notre enfance.
Ragastens devint très pâle et son regard ardent s’attacha sur Manfred avec une curiosité passionnée.
– Et cette bohémienne ? demandait-il.
– Elle est parmi nous…
– Pourrai-je la voir… lui parler ?
– Sans doute, fit Manfred étonné. Mais, monsieur, ne me disiez-vous pas que nous serions attaqués à minuit ?
– Oui, oui, dit Ragastens.
Il essuya la sueur qui inondait son front, et fit effort pour s’arracher à ses pensées.
– Vous avez raison, reprit-il d’un ton ferme. Occupons-nous de la défense.
Manfred appela d’un geste quelques-uns des chefs les plus estimés pour leur courage et leur sang-froid.
Entouré de truands, de gens de sac et de corde, Ragastens éprouvait une gêne inexprimable à là pensée de tirer l’épée en l’honneur de ces brigands.
Mais cette gêne disparaissait dès que son regard s’arrêtait sur Manfred. Si ce jeune homme était son fils !
Et il se rappelait avec terreur les paroles de François Ier. L’expédition avait surtout pour but de s’emparer de Lanthenay et de Manfred.
Au point du jour, Manfred devait être pendu à la Croix du Trahoir.
Et si Manfred était bien son fils !
Un flot de sang vint battre les tempes de Ragastens. À ce moment, il se fût battu seul contre une armée pour sauver le jeune homme. Il n’y eut plus autour de lui ni truands ni ribaudes. Il n’y eut que son fils – peut-être ! – et il résolut de brûler Paris plutôt que de laisser Manfred tomber aux mains du roi et du grand prévôt.
Son regard perçant embrassa d’un coup la Cour des Miracles.
Trois ruelles s’y déversaient.
Elles étaient barricadées toutes les trois.
– Avez-vous des armes ? demanda-t-il.
– Près de trois cents arquebuses et autant de pistolets.
– Des munitions ?
– Une quantité.
– Des tireurs ?
– Tous ces hommes sont habitués à tirer l’arquebuse.
– Que peuvent faire les femmes ?
– Tout ce qu’on voudra.
– Bien, dit alors Ragastens. Cent hommes à cette rue (il désignait la ruelle Saint-Sauveur). Cent hommes à cet endroit (il montrait la ruelle de Montorgueil). Cent hommes devant cette rue (la ruelle aux Piètres)… En arrière de chaque groupe de tireurs, faites placer, de façon qu’elles soient à l’abri, une vingtaine de femmes avec des munitions. Elles rechargeront les arquebuses…
À mesure que Ragastens donnait ces indications, elles étaient aussitôt exécutées.
À ce moment même, on entendit sonner minuit à Saint-Eustache.
– Maintenant, continua Ragastens, derrière chaque groupe d’arquebusiers, faites placer cent hommes armés de pistolets. Si les arquebusiers sont obligés de céder, les pistolets entreront dans la mêlée.
Ces nouvelles dispositions furent prises en deux minutes.
– Enfin, acheva Ragastens, ici, au centre de la place, tout, ce que vous avez d’hommes disponibles… Ce sera ici une réserve de forces qui pourra se porter sur le point le plus menacé.
Le chevalier avait pris le seul dispositif qui présentât quelque chance de succès. Les chefs rassemblés autour de lui s’en rendirent compte, et adoptèrent sans contestation le plan de l’étranger.
– Maintenant, dit enfin Ragastens, écoutez-moi bien : le pauvre diable qui vient d’être si affreusement traité devait tirer trois coups d’arquebuse pour prévenir le grand prévôt que la Cour des Miracles était tranquille. Si ces trois coups ne sont pas tirés, il est très possible que l’attaque soit remise. Décidez ce que vous avez à faire.
– Je comprends, monsieur, votre légitime embarras, dit Manfred. Je parlerai donc en votre lieu et place. Frères, si nous ne tirons pas les trois coups de feu, nous serons surpris une nuit prochaine. Si nous donnons, au contraire, le signal, les gens du roi ne s’attendront à aucune résistance. Est-ce votre avis ?
Les chefs opinèrent gravement de la tête.
– Votre avis, monsieur ?’demanda Manfred à Ragastens.
– Mon enfant, dit celui-ci violemment ému, si j’étais à votre place, c’est ainsi que j’aurais parlé.
À ce mot « mon enfant », Manfred regarda Ragastens avec étonnement. Mais il l’attribua à un excès de politesse.
– Le sort en est donc jeté, dit-il d’une voix ferme. Lanthenay, place-toi à la ruelle Montorgueil. Moi, à la ruelle Saint-Sauveur. Toi, Cocardère, à la ruelle aux Piètres… Monsieur le chevalier, voulez-vous nous faire l’honneur de diriger d’ici les opérations ?
– Je préfère vous suivre, répondit Ragastens en s’efforçant de dominer son émotion.
– Venez donc ! Je vais donner le signal…
II
UNE VICTOIRE DE FRANÇOIS Ier
Pendant que dans la Cour des Miracles s’achevaient les préparatifs d’une résistance désespérée, d’autres événements s’accomplissaient.
On a vu que François Ier était venu avec M. de Monclar et une forte troupe, faire une perquisition dans l’enclos des Tuileries, et que, ayant constaté la disparition de Gillette et du chevalier de Ragastens, il était retourné au Louvre, décidé à prendre part à l’expédition contre les truands.
Or, dans la troupe que Monclar avait amenée à la maison de Madeleine Ferron, se trouvait un homme que nos lecteurs connaissent. C’était Alais Le Mahu.
Depuis qu’il avait aidé la duchesse d’Étampes à enlever Gillette, Alais Le Mahu avait fort réfléchi.
Et le résultat de ses réflexions avait été que, d’une part, il devait se méfier de la duchesse d’Étampes, et que, de l’autre, c’est sur lui que retomberait la fureur du roi s’il apprenait jamais la vérité.
Lorsqu’il connut la mort soudaine de la vieille Mme de Saint-Albans, les réflexions d’Alais Le Mahu redoublèrent d’intensité.
– Ma pauvre amie est morte, se dit-il en se donnant à lui-même le simulacre d’essuyer une larme absente. Nous sommes tous mortels, il est vrai. Mais cette chère amie était de santé robuste. Or, on dit qu’elle est morte d’une colique inopinée… Je me suis renseigné à la Bastille, et j’ai appris que la colique était survenue après un envoi de fruits… Qui avait envoyé les fruits ? Mystère… Mais j’ai dans l’idée que ce mystère pourrait bien s’appeler Mme d’Étampes. Or, moi, qui déteste les fruits et qui ne suis pas sujet aux coliques, on pourrait bien un de ces soirs, au détour de quelque rue sombre, me faire avaler six pouces d’acier. Merci bien, madame d’Étampes…
Poursuivant le cours de ses méditations, maître Alais avait ensuite ajouté, toujours se parlant à lui-même :
– Et si Sa Majesté finit par savoir comment s’appelle l’homme qui entraîna la jolie demoiselle ?… J’ai vu qu’on avait mis des cordes toutes neuves à toutes les potences de la ville. Malepeste ! Que la corde soit neuve ou vieille, mon cou n’a nul besoin d’une pareille cravate…
Et Alais Le Mahu avait décidé : 1° d’être sur ses gardes nuit et jour, 2° de tâcher de rendre au roi quelque signalé service.
Comme nous l’avons dit, il faisait partie de la troupe de Monclar en cette soirée où fut visitée la maison des Tuileries.
Lorsqu’on eut donné le signal du retour, Alais Le Mahu se demanda la cause de cette disparition soudaine des personnes qu’on voulait arrêter. Il voyait que François Ier attachait un prix extraordinaire à cette arrestation, et que son désappointement avait été vraiment étrange.
Quelles étaient ces personnes qu’on avait voulu arrêter ?
Le Mahu l’ignorait.
Mais il se dit que celui qui ferait l’arrestation deviendrait du coup un favori de Sa Majesté.
De tout cela, il résulta que Le Mahu, au lieu de suivre le roi et Monclar vers le Louvre, se cacha aux environs de l’enclos des Tuileries.
– Si ces gens sont réellement partis, je n’aurai rien perdu à attendre, dit-il. Mais comme on n’avait vu sortir personne, et qu’il est possible que personne en effet ne soit sorti, si je puis rapporter au roi quelque bonne nouvelle, j’aurai tout gagné à attendre. Attendons !
Alais Le Mahu, abrité derrière un massif de vieux arbres, se mit donc en devoir de monter une garde sérieuse et attentive.
Son attente fut assez longue, et il allait renoncer à sa faction lorsqu’il vit quelqu’un sortir de la maison. Ce quelqu’un, aux yeux d’un observateur quelconque, eût passé pour un jeune cavalier.
Il reconnut une femme.
C’était, en effet, Madeleine Ferron qui venait s’assurer, comme on l’a vu, que les environs étaient tranquilles.
Il s’apprêta à suivre le cavalier, ou la femme.
Mais elle rentra tout à coup dans la maison.
– Il faut attendre encore ! pensa Le Mahu. Toute la nichée doit être au nid, et je suis sûr qu’elle ne va pas tarder à s’envoler.
En effet, dix minutes plus tard, une lumière se montra.
– Voici nos gens ! murmura Le Mahu.
Il vit sortir le jeune cavalier, puis deux femmes et deux hommes.
À cinquante pas derrière Spadacape, qui formait l’arrière-garde de la petite troupe, Le Mahu se mit à marcher prudemment, se dissimulant le long des arbres tant qu’on fut loin des rues, et le long des maisons lorsqu’on fut en plein Paris, se jetant ventre à terre toutes les fois qu’il voyait s’arrêter la haute silhouette de Spadacape.
Lorsqu’on arriva rue Saint-Denis, Alais Le Mahu changea de tactique.
Il s’avança au milieu de la chaussée en chantant une chanson à boire.
Et il dépassa ainsi d’abord Spadacape, puis Ragastens escortant les deux femmes.
Le plan de Le Mahu était d’essayer de voir au moins l’un de ces visages. Il vit bien Spadacape et Ragastens…
Mais ils lui étaient complètement inconnus.
Quant aux deux femmes, elles étaient si bien encapuchonnées qu’il était impossible de distinguer leurs traits.
Un coup de vent décoiffa tout à coup les deux femmes, au moment où la petite troupe passait dans la zone de lumière qui sortait de la devanture d’un cabaret.
Le Mahu, qui entonnait à tue-tête le quatrième couplet de sa chanson à boire, s’arrêta court, saisi.
Déjà les deux femmes avaient replacé leurs capuchons.
Mais Le Mahu avait reconnu l’une d’elles.
Il se mit à tousser fortement, comme s’il eût voulu expliquer l’arrêt de son couplet, puis recommença à chanter, et bientôt disparut en avant.
– La petite duchesse ! dit-il en lui-même. C’est la petite duchesse ! Le joli petit oiselet que j’avais conduit en cette fort vilaine cage, par ordre de Mme d’Étampes ! Ah ! ça, elle s’est donc sauvée ? Morbleu ! voilà qui prend bonne tournure, il me semble !
Ayant dépassé à son tour Madeleine Ferron, Le Mahu se contenta de garder une avance suffisante pour ne pas perdre de vue ceux qu’il filait ainsi. Le mot filer n’est pas de l’époque, sans doute, mais il rend très bien le genre d’espionnage auquel se livrait Le Mahu.
Tout à coup, il les vit disparaître dans une grande belle maison d’aspect bourgeois et presque seigneurial.
Il revint alors sur ses pas, nota soigneusement la maison qui était d’ailleurs très facile à reconnaître.
– C’est ici le gîte définitif, murmura-t-il. Je comprends tout. L’homme qui accompagne les deux femmes est un parent, un frère peut-être de la petite duchesse de Fontainebleau. C’est lui qui l’a enlevée de la rue des Mauvais-Garçons, de chez la Margentine. Le roi l’a vue par hasard dans la maison des Tuileries. Mais il y avait une cachette dans la maison. Et maintenant, c’est ici qu’ils vont se cacher. Bonne chasse, par tous les diables !
Et Le Mahu, tout joyeux, prit grand train la direction du Louvre. Chemin faisant, le bandit réfléchissait à ce qu’il devait faire.
– Dois-je prévenir la duchesse d’Étampes ? Dois-je prévenir le roi ? Lequel des deux maîtres vais-je choisir ?
En arrivant au Louvre, Le Mahu était décidé à tout dire au roi. Sans compter qu’il saurait bien mettre à profit le moment de bonne humeur que la nouvelle apportée par lui procurerait au roi.
Le Mahu était officier subalterne.
Il discuta avec lui-même s’il demanderait une somme d’argent ou un grade. Il se décida pour l’argent.
On a pu voir déjà que Le Mahu était un esprit très pratique.
En arrivant au Louvre, il trouva qu’il se faisait un étrange remue-ménage. Plusieurs compagnies d’arquebusiers se rangeaient dans la grande cour à la lueur des falots que portaient des laquais.
Dans les écuries, on sellait les chevaux.
Un grand nombre de seigneurs de la cour étaient déjà à cheval en tenue de guerre, c’est-à-dire cuirassés, l’estramaçon battant les flancs de leurs montures.
Le grand prévôt, isolé, immobile, assistait sans mot dire à tous ces préparatifs.
Le Mahu se dirigea vivement vers les appartements du roi.
– Je veux parler à Sa Majesté, dit-il à Bassignac.
– Comme cela ? Sans demander audience ?
– C’est une nouvelle importante que j’apporte au roi.
– Dites-la moi et je la transmettrai à Sa Majesté.
– Non, dit-il. Je garde ma nouvelle.
Et Le Mahu tourna les talons.
Il se disait qu’il trouverait bien le moyen de parler au roi, qui devait monter à cheval pour assister à l’attaque de la Cour des Miracles…
– Donner ma nouvelle ! grondait-il. Je donnerais plutôt ma main au bourreau ! Alors, c’est moi qui aurais pris toute la peine, et c’est Bassignac qui en profiterait ? Car je connais le roi. Dès qu’il saura la chose, il jettera une chaîne d’or quelconque à celui qui l’aura prévenu et il ne pensera plus à lui !
Vers onze heures, il se fit un grand mouvement dans la cour du Louvre.
Les compagnies défilèrent silencieusement.
Chaque officier venait prendre les ordres de Monclar qui, penché sur le cou de son cheval, donnait à chacun des indications précises.
Le roi parut tout à coup, entouré d’une dizaine de ses favoris. Il se mit en selle.
Près de lui, le grand prévôt attendait.
– Quand vous voudrez, monsieur, dit le roi.
– Nous sommes prêts, sire.
Le roi fit un geste, et se mit en route, causant avec La Châtaigneraie qui était à côté de lui.
Le Mahu avait sauté sur son cheval, et pris la suite, à la queue de l’escorte des seigneurs.
Mais lorsqu’on eut franchi la porte du Louvre, il prit le trot, et s’avançant, s’arrêta à la hauteur du roi.
– Que veut cet homme ? dit François Ier.
– Sire, s’écria Le Mahu, j’apporte à Votre Majesté des nouvelles de l’enclos des Tuileries.
Le roi eut un tressaillement.
Il fit un geste, et ceux qui l’entouraient demeurèrent quelques pas en arrière.
– Viens ça, dit-il à Le Mahu.
Celui-ci se plaça près du roi.
– Parle, fit le roi d’un ton bref.
– Sire, dit Le Mahu, je sais où se trouve la duchesse de Fontainebleau.
– Qui es-tu ? dit François Ier en pâlissant.
– Un pauvre officier obscur, perdu au plus bas de l’échelle, sire !
Et il ajouta avec impudence :
– Mais j’espère que Votre Majesté daignera ne pas oublier le pauvre diable qui s’est dévoué…
Le roi regarda avec dégoût cet homme qui, avec une pareille grossièreté, réclamait sa récompense.
– Qu’as-tu fait ? demanda-t-il.
– Voici : lorsque tout le monde a eu quitté la maison de l’enclos des Tuileries, j’ai eu l’idée de rester, moi !
– Ah ! ah !… Et tu as vu quelque chose ?
– J’ai vu sortir de cette maison cinq personnes : trois femmes et deux hommes. L’une des trois femmes était déguisée en cavalier. De ces trois femmes, je n’en connais qu’une. Quant aux deux hommes, je ne les connais ni l’un ni l’autre.
– Et celle que tu connais ?
– Je la connais pour avoir eu l’honneur de l’apercevoir étant de garde à la porte de la grande salle des fêtes : c’est Mme la duchesse de Fontainebleau.
– Tu es sûr ?
– Aussi sûr que j’ai l’insigne faveur de me trouver près de Votre Majesté en ce moment, faveur qui comptera dans ma pauvre existence, quand bien même il conviendrait à Votre Majesté d’oublier…
– C’est bien, je n’oublierai pas… Continue.
– Eh bien, sire, lorsqu’ils ont quitté la maison des Tuileries, il m’est venu une autre idée : celle de les suivre. Et si Votre Majesté avait par hasard le désir de revoir d’ici une demi-heure Mme la duchesse de Fontainebleau, je me charge de l’y conduire.
Le roi se retourna alors sur sa selle.
– La Châtaigneraie, dit-il, envoie-moi M. de Monclar.
– Me voilà, sire, dit le grand prévôt qui chevauchait à deux ou trois rangs en arrière.
– Monclar, dit François Ier, vous ferez établir demain un bon de mille écus de six livres sur mon trésor, au nom de…
Et il interrogea Le Mahu d’un regard plein de cette insolence qu’il aimait à affecter parfois.
– Alais Le Mahu, officier aux arquebusiers de Sa Majesté, dit Le Mahu.
Monclar le regarda avec indifférence.
– Es-tu content ? reprit le roi.
– Votre Majesté me comble, fit le bandit.
Six mille livres étaient en effet pour lui une fortune inespérée. Mais au prix qu’attachait le roi au renseignement qu’il apportait, il put juger de sa véritable valeur et se promit de ne pas en rester là.
– Monclar, avait continué le roi, choisissez-moi une escorte d’une vingtaine d’hommes et continuez sans moi vers la Cour des Miracles.
Le grand prévôt s’inclina et fit demi-tour.
Deux minutes plus tard, une vingtaine de cavaliers vinrent se ranger derrière le roi qui, faisant signe à ses trois fidèles de le suivre, prit le trot en disant à Le Mahu :
– Marche devant !
Après un temps de trot de vingt minutes, la troupe, guidée par Alais Le Mahu, s’arrêta devant la maison.
III
LA GYPSIE
Cependant le grand prévôt avait pris la tête de là colonne qui marchait sur la Cour des Miracles.
Son plan d’attaque était fait depuis longtemps.
Ce plan, le voici dans toute sa simplicité :
Tricot donnait le signal que tout était paisible dans la Cour des Miracles et qu’on pouvait attaquer.
Dans chacune des trois rues qui aboutissaient au royaume d’Argot se trouvait établie une souricière, c’est-à-dire qu’un poste fort de trois cents hommes était dissimulé dans chacune de ces trois rues.
Au signal donné, Monclar entrait sans bruit dans la Cour des Miracles et en occupait le centre avec cinquante arquebusiers formés en carré.
Aussitôt, des soldats armés de torches pénétraient dans toutes les maisons et y mettaient le feu.
Les habitants sortaient, affolés.
Le carré d’arquebusiers commençait à faire feu dans toutes les directions, les truands se précipitaient en foule dans les trois rues et allaient se faire prendre dans les trois souricières.
L’incendie faisait place nette.
Et le lendemain commençait un procès monstre qui envoyait au gibet tous ceux qui auraient échappé à l’arquebusade.
Pour être juste, nous dirons que ce plan était dû en grande partie à l’imagination de M, de Loyola, qui devenait des plus fécondes dès qu’il s’agissait de tuer et d’incendier… bien entendu dans l’intention de sauver des âmes.
En cheminant, Monclar songeait.
Il pensait à Manfred et à Lanthenay.
Dire que le grand prévôt en était arrivé à haïr ces deux hommes qu’il ne connaissait pas serait peut-être exagéré. Monclar n’avait qu’une passion dans le cœur, et cette passion était une douleur rétrospective.
Le grand prévôt avait l’âme tournée vers le passé mystérieux qui jetait sur sa vie un voile de deuil.
Mais si Monclar ne haïssait pas les deux jeunes gens qu’il appelait des chefs de truands, il mettait son honneur à les pendre haut et court le plus tôt possible.
Monclar, s’il n’avait qu’une douleur dans le cœur, n’avait qu’une pensée dans l’esprit. Et cette pensée, c’était le respect absolu de l’autorité suprême. Dieu et ses représentants sur terre devaient commander en maîtres incontestés. Dieu était Dieu, et ses représentants, c’étaient les hommes comme Loyola, et les rois comme François Ier.
Toucher à Loyola, c’était toucher à Dieu.
Offenser le roi, c’était offenser Dieu.
Or, Manfred avait insulté le roi.
Lanthenay avait frappé Loyola.
Monclar ne comptait même pas, l’audace de Manfred sautant en croupe derrière lui et le menaçant, pour permettre à Lanthenay de fuir…
Il ne s’agissait là que de lui-même, et c’était peu.
Mais avoir touché au roi et à Loyola, c’était là pour Monclar le crime monstrueux pour lequel il n’y avait pas de rémission possible.
Monclar, dans ses longues méditations, lorsque solitaire au coin de sa vaste cheminée, il évoquait le fantôme de la jeune femme qu’il avait perdue, de l’enfant idolâtré qu’il avait perdu aussi, Monclar, dans ses moments terribles, conversait avec Dieu…
Il appelait le Tout-Puissant, celui qui était capable de faire des miracles et de ressusciter les morts.
Lui, grand prévôt, se chargeait de faire respecter Dieu et ses représentants.
« Mais en échange, Ô Seigneur, rendez-moi ma femme, rendez-moi mon fils, ou du moins, si votre serviteur est indigne d’un tel miracle, faites descendre un peu de votre paix auguste dans ce pauvre cœur torturé par la douleur… »
Voilà quel était le cri perpétuel qui montait du fond de cet esprit.
Comprend-on maintenant quelle froide résolution l’animait dans l’accomplissement de ses terribles fonctions ?
Comprend-on avec quelle implacable volonté il avait résolu de s’emparer de Manfred et de Lanthenay, oh ! Lanthenay surtout, Lanthenay qui non seulement avait insulté la majesté royale, mais encore avait porté la main sur un saint !…
Le supplice de ces deux hommes était, il n’en doutait pas, le prix de la paix enfin accordée à son cœur.
Pour Manfred, la pendaison suffirait. Peut-être irait-il jusqu’à l’estrapade, mais ce serait tout.
Mais quant à Lanthenay, il ne fallait rien moins que le bûcher. En effet, le feu purifie : Loyola le lui avait formellement affirmé.
Pendant que Monclar réfléchissait ainsi, et voyait déjà se dresser dans son imagination la flamme du bûcher qui monte haute et clair dans le ciel tandis que les foules épouvantées roulent autour du poteau de supplice, les capitaines de compagnie avaient pris position dans la ruelle Saint-Sauveur, la ruelle Montorgueil et la ruelle aux Piètres. Ces mouvements s’étaient accomplis dans le plus profond silence.
Le grand prévôt arrivé sur le champ de bataille ne songea plus qu’à assurer la victoire du roi et la destruction des truands.
Il visita successivement chacune des trois rues, s’assura que chacun avait bien compris ses instructions, et alla se poster lui-même dans la rue Saint-Sauveur.
Au signal de Tricot – trois coups d’arquebuse tirés à minuit – les trois troupes devaient entrer ensemble sur le terrain de la Cour des Miracles et l’opération que nous avons décrite ; plus haut devait commencer aussitôt.
Dès lors, il n’y eut plus qu’à attendre.
Les douze coups de minuit tintèrent gravement à Saint-Eustache…
Quelques minutes encore…
Puis, tout à coup, un coup d’arquebuse éclata dans le silence.
Un deuxième… un troisième… Monclar les compta.
– En avant ! dit-il alors au capitaine de la compagnie qui se trouvait près de lui.
La masse des arquebusiers s’ébranla.
Certain que cette barricade n’était gardée que par quelques hommes qui étaient de connivence avec Tricot, Monclar, arrêté au milieu de la rue, regardait tranquillement défiler les soldats.
Les arquebusiers n’étaient plus qu’à dix pas de l’obstacle.
À ce moment, une voix rude jeta un ordre bref.
La barricade parut s’enflammer comme un cratère éteint qui se mettrait soudain à cracher des laves incandescentes, et une formidable détonation ébranla les masures de la rue, faisant voler en éclats les vitraux des fenêtres fermées.
Dépeindre l’effarement, la stupeur et l’épouvante de la compagnie d’arquebusiers serait difficile. Plus de quarante morts ou blessés étaient tombés, parmi des hurlements et des imprécations. Au nombre des morts était le capitaine qui marchait en tête.
Les survivants reculèrent en désordre, entrechoquant leurs armes, se culbutant les uns les autres.
Monclar, un moment stupide d’étonnement, entendit au loin deux autres détonations sourdes ; c’étaient les truands de la ruelle aux Piètres et de la ruelle Montorgueil qui venaient de faire feu comme ceux de la ruelle Saint-Sauveur.
En toute hâte, il appela auprès de lui quelques-uns des seigneurs qui étaient venus, par distraction, assister au grand massacre de la Cour des Miracles.
Ensemble, ils barrèrent la rue et arrêtèrent les fuyards.
– En avant ! rugit Monclar. Si vous ne prenez pas la barricade d’assaut, vous allez vous faire tuer jusqu’au dernier dans ce boyau…
Ce raisonnement était le seul qui pût rendre courage aux arquebusiers.
Ils se retournèrent vers la barricade, mais au lieu d’y aller en rangs serrés comme la première fois, ils se disséminèrent en rasant les murs.
Ils étaient quatre cents environ.
Au pas de course, ils foncèrent sur la barricade.
Une deuxième détonation retentit, et des hommes tombèrent pour ne plus se relever.
– En avant ! hurla Monclar.
Les arquebusiers, en quelques secondes, furent sur la barricade, avec une grande clameur.
Mais alors, sur cette barricade, se dressèrent une foule de démons armés de lances, de hallebardes, de tronçons d’épées, de vieux estramaçons, et même de lardoires, de toutes sortes de coutelas bizarres.
Des plaintes, des cris de rage, des jurons en toutes les langues, des coups de pistolet et d’arquebuse, voilà ce qu’on entendit pendant près de vingt minutes.
Cependant les soldats du roi reculaient peu à peu.
Monclar, entouré de seigneurs, avait gardé son épée au fourreau, tandis que ceux qui l’entouraient s’escrimaient à outrance.
Le grand prévôt se trouvait maintenant tout près des truands qui bondissaient autour de lui.
Son attitude et, ses ordres donnèrent un peu de sang-froid aux soldats ; un effort suprême fut tenté, et ce fut au tour des truands de reculer.
Mais derrière eux, du fond de la Cour des Miracles, voici qu’une bande accourait, comme une trombe. Ils avancèrent en ordre serré, bien cuirassés, bien armés, jouant de l’estramaçon et du pistolet.
En quelques instants, la rue fut déblayée.
Monclar, demeuré l’un des derniers, la pâleur au front, la rage au cœur, allait s’enfuir à son tour.
À ce moment, un homme saisit la bride se son cheval et lui dit :
– Vous êtes pris, monsieur, rendez-vous !
Monclar se vit entouré de truands. Au loin, il entendit le roulement de la fuite de ses hommes.
Il leva les yeux vers le ciel comme pour y chercher Dieu qu’il avait imploré, puis il ramena son regard sur l’homme qui, à la tête de la bande de truands, avait mis en fuite les soldats du roi, l’homme dont il était le prisonnier…
Et il reconnut Lanthenay !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les truands célébrèrent leur victoire par de terribles clameurs. Les grands feux furent rallumés.
Autour, prirent place les blessés que déjà d’actives ribaudes pansaient et frottaient d’onguents.
Aux tables, maintenant, l’orgie se déchaînait.
Des tonneaux de vin étaient placés de distance en distance : ils se vidaient rapidement. À chaque table, chacun racontait maintenant les beaux coups qu’il avait donnés, les crânes qu’il avait pourfendus.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dans la ruelle aux Piètres et dans la ruelle Montorgueil, les événements s’étaient déroulés à peu près comme dans la ruelle Saint-Sauveur.
De longtemps, sans doute, on ne songerait à attaquer la Cour des Miracles.
Les truands s’énuméraient les uns aux autres les avantages que leur donnait cette victoire inespérée – due surtout à la découverte de la trahison de Tricot.
Ragastens n’avait pas tiré l’épée.
Il s’était contenté de se tenir constamment près de Manfred, prêt à le protéger au besoin de sa rapière, arme formidable dans ses mains.
Lorsque le grand prévôt fut conduit au milieu de la Cour des Miracles, il s’éleva parmi les truands une telle clameur que la ville entière parut en être ébranlée jusque dans ses assises.
Les massiers, les suppôts entourèrent aussitôt Monclar.
Sans cette précaution, le grand prévôt eût été à l’instant traité comme venait de l’être son agent Tricot.
Mais l’autorité des chefs était grande.
Devant leurs ordres répétés, les truands reculèrent en grondant, pareils à des dogues affamés à qui on arrache l’os qu’ils voulaient ronger.
Monclar fut enfermé dans la salle basse de l’une des maisons de la Cour des Miracles.
Et les chefs tinrent conseil pour savoir ce qu’on en ferait.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ragastens, aussitôt après l’action, avait demandé à Manfred :
– Cette bohémienne dont vous me parliez… cette…
– La Gypsie ? fit Manfred étonné.
– Oui. Vous avez dit que je pourrais la voir ?
– Sans aucun doute.
– Eh bien, je désire la voir…
Manfred, surpris de cette hâte, s’inclina pourtant et dit au chevalier qu’il était prêt à le conduire auprès de la vieille bohémienne.
– Allons donc, je vous prie, fit Ragastens avec une émotion qui surprit de plus en plus le jeune homme.
– Ah çà ! pensa-t-il, le chevalier connaît donc la vieille sorcière qui m’a élevé ? Ou s’il ne la connaît pas, que lui veut-il ?
Quelques instants plus tard, ils entraient dans le logis de la Gypsie.
– Mère, fit Manfred, voici un étranger qui désire vous voir. Recevez-le bien, je vous en prie, car je lui ai de grandes obligations.
– Qu’il soit le bienvenu, mon fils, dit la bohémienne.
Ragastens se tourna vers Manfred.
– Mon enfant, dit-il voulez-vous avoir la bonté de me laisser seul avec, cette femme ? Excusez-moi…
– Chevalier, répondit Manfred, j’ai pour vous une telle sympathie et une si grande reconnaissance que je considère vos désirs comme des ordres…
À ces mots, il s’inclina gracieusement, et Ragastens le regarda s’éloigner, admirant sa taille svelte, l’aisance de sa parole, l’intelligence qui brillait en ses yeux…
Lorsque Manfred eut disparu déjà depuis plus d’une minute, le chevalier poussa un soupir et s’adressa à la Gypsie.
Celle-ci semblait le considérer avec cette curiosité indifférente qu’on accorde à une personne qu’on voit pour la première fois.
– Je désire, dit-il, – et sa voix tremblait légèrement – vous poser quelques questions. Je vous demande de me répondre en toute franchise et vérité. Si vous êtes pauvre, je vous enrichirai…
– Parlez, seigneur, dit-elle sans que sa voix trahît la moindre émotion ou défiance, je répondrai de mon mieux…
– Ce jeune homme qui sort d’ici…
– Manfred ?
– Oui… Manfred ! Voulez-vous me dire où il est né ?
– En Italie, fit simplement la vieille.
Ragastens sentit son cœur battre à coups redoublés.
– Il n’en faut plus douter ! pensa-t-il. C’est mon fils ! Mon fils ! Ah ! que Béatrix va être heureuse !
Il reprit à haute voix :
– Où l’avez-vous trouvé ? Dans quel pays de l’Italie ?
– Trouvé, seigneur ?
– Oui, trouvé… ou recueilli… ou autre chose enfin !
– Je ne comprends pas, répondit la Gypsie d’un air de naïveté. Manfred n’est pas un enfant trouvé…
– Je m’exprime mal… Je voudrais savoir qui vous a remis cet enfant ?
– Personne !
Ragastens chercha à pénétrer la pensée de la bohémienne, mais celle-ci montrait un visage parfaitement calme.
Il reprit :
– Je vous répète que je vous enrichirai. Demandez-moi ce que vous voulez. D’avance, je vous l’accorde.
– Je vous remercie, seigneur, fit la Gypsie avec effusion. Il est certain qu’un peu d’argent serait le bienvenu dans ma pauvre demeure. Voulez-vous que je vous dise la bonne aventure ?
– Je veux simplement que vous me répondiez : Manfred est un enfant volé, n’est-ce pas ? Oh ! je ne cherche pas à savoir par qui…
– Vous vous trompez, seigneur…
– Mais enfin, qui est son père ? Le connaissez-vous ?
– Hélas ! Comment ne le connaîtrais-je pas ! s’écria la bohémienne avec une mélancolie admirablement jouée. Son père est un noble napolitain.
– Napolitain ! exclama Ragastens palpitant.
– Oui… J’étais jeune alors… J’étais jolie… je lui plus… je l’aimai… et de cet amour éphémère est né mon Manfred…
Ragastens tomba sur un siège. La déception était cruelle.
– Ainsi, balbutia-t-il, Manfred est votre fils ?
– Mon fils, oui, seigneur… Je l’ai appelé Manfred en souvenir de son père, qu’il n’a pas connu…
– Mais ce jeune homme, reprit vivement Ragastens se raccrochant à un dernier espoir, ce jeune homme dit que vous n’êtes pas sa mère…
– Je le lui ai laissé croire… pauvre enfant ! il est si intelligent, si fort au-dessus de ceux qui l’entourent qu’il a fini par se persuader qu’il a des parents illustres… Lui prouver qu’il est simplement le fils de la pauvre bohémienne, c’eût été lui briser le cœur… Il faut être mère, seigneur, pour concevoir des sacrifices pareils !…
La Gypsie essuya deux larmes qui coulaient de ses yeux.
– Ah ! reprit-elle tout à coup, ce n’est pas comme Lanthenay, par exemple ! Celui-là n’est pas mon fils, bien qu’il m’appelle aussi sa mère… Celui-là est vraiment un enfant recueilli… Son père était Parisien… Il est mort !
Ragastens fit un geste de la main comme pour dire qu’il en savait assez…
Il se leva alors, fouilla dans sa bourse, et tendit à la bohémienne une poignée de pièces d’or qu’elle prit en murmurant des bénédictions.
Nous laisserons Ragastens redescendre tout pensif dans la Cour des Miracles et s’approcher de Manfred avec qui il commença un entretien que nous aurons à relater.
Lorsque le chevalier fut sorti de chez elle, la Gypsie s’assit près d’un coin de table et se mit à songer.
– J’aurais pu, murmura-t-elle, dire la vérité au seigneur de Ragastens. Du coup, je faisais bien des gens heureux. Mais à quoi m’aurait servi, à moi, tant de bonheur dont j’aurais été cause ? Voyons un peu ce qui se passerait si je disais au chevalier : « Oui Manfred est votre fils ! C’est moi qui l’ai enlevé pour plaire à Mme Lucrèce Borgia. Mais elle est morte maintenant ! » Si je disais cela, il arriverait que, sous peu de temps, Manfred partirait avec son père. Or, qui me prouve qu’il ne chercherait pas à emmener Lanthenay et qu’il n’y réussirait pas ? Et que m’importe, après tout, que les gens soient heureux ou malheureux… Est-ce que quelqu’un s’inquiète de mon bonheur à moi ? Est-ce que personne a jamais songé aux larmes que j’ai répandues depuis que j’ai vu mon fils pendu sous mes yeux ?
La Gypsie mit sa tête dans ses deux mains.
Et cette évocation de son fils pendu la fit frissonner.
Elle murmura, les dents serrées :
– Emmener Lanthenay ! Qu’est-ce que je deviendrais, moi, du jour où je n’aurais plus sous ma main le fils de Monclar pour assurer ma vengeance.
Elle se leva, s’approcha de la fenêtre qui donnait sur la Cour des Miracles.
Au milieu de la cour, près d’un grand feu, elle vit les chefs assemblés. Parmi eux, Lanthenay.
Quant à Manfred, il s’était écarté en compagnie de Ragastens.
En reconnaissant Lanthenay, la Gypsie tressaillit, et un éclair de haine sauvage brûla dans son regard.
Pourtant, ce n’est pas Lanthenay qu’elle haïssait.
C’était au père de Lanthenay, au grand prévôt de Paris, au comte de Monclar que cette haine farouche s’adressait.
Pendant toute la bataille, la Gypsie était demeurée à sa fenêtre ouverte, écoutant les bruits, scrutant la nuit.
Elle ne doutait pas de l’issue du combat.
Les gens du roi, et Monclar avec eux, seraient vaincus.
C’était chez elle une conviction – une foi.
Il fallait que Monclar fût vaincu pour que la rage du grand prévôt s’accrût ! Il fallait que Monclar en arrivât à haïr son propre fils !
Lorsque ce fut fini et qu’elle sut que les troupes du roi étaient refoulées des trois côtés à la fois elle referma tranquillement sa fenêtre et dit :
– Je savais bien que les choses tourneraient ainsi !
Maintenant, elle examinait avec curiosité l’assemblée des chefs et trouvait bizarre que le conseil durât si longtemps.
– Est-ce que tout ne serait pas fini ? murmura-t-elle.
Et elle descendit et s’approcha du brasier près duquel se tenait le conseil en plein vent, selon les mœurs et habitudes de la Cour des Miracles.
C’était Lanthenay qui parlait à ce moment.
Et Lanthenay disait :
– Si nous le mettons à mort, comme on vous en donne l’avis, les plus grands malheurs sont à redouter. Croyez-moi, profitez au contraire de cet événement pour confirmer vos privilèges. Arrachez-lui la promesse formelle de ne plus rien tenter contre vous, et renvoyez-le. Croyez-vous que le roi laisserait sa mort impunie ? Dès demain la bataille serait à recommencer, et peut-être, cette fois, l’avantage des circonstances ne serait-il pas pour vous. Tandis que si vous le renvoyez vivant, sans lui avoir fait aucun mal, non seulement le roi y regardera à deux fois avant d’attaquer à nouveau des gens qui se défendent si bien, mais encore il aura pour votre générosité une sorte d’estime, sans compter la reconnaissance de votre prisonnier…
La Gypsie tressaillit. De qui était-il question ?
Elle toucha le bras d’un suppôt qui se trouvait près d’elle.
– Frère, dit-elle, de quel prisonnier s’agit-il ?
– Comment, vieille Gypsie, tu ne le sais pas !
– Je ne sais qu’une chose, c’est que mes chers enfants n’ont pas été tués ou blessés dans la bagarre ; c’est tout ce qu’il me faut, à moi !
– Oui, oui… on connaît ton affection pour nos frères Manfred et Lanthenay. Il est vrai, qu’ils en valent la peine. C’est grâce à eux que les gens du roi ont fui ! Lanthenay surtout !
– Ah !
– Oui ! C’est lui qui a fait le prisonnier.
– Et ce prisonnier ?
– C’est le grand prévôt.
– Le comte de Monclar ? balbutia la Gypsie.
– On discute sur son sort…
– Et où l’a-t-on mis ?
– Là ! fit le truand.
D’un geste, il désigna une masure.
– Pas de danger qu’il se sauve, au moins ?
Le truand éclata de rire.
– Il est dans la cave, lié avec des cordes solides, et la cave est fermée à double tour, dit-il.
– La précaution est bonne, dit la Gypsie, pour un prisonnier de cette importance.
Elle s’écarta doucement.
Monclar était prisonnier, et c’était grâce à Lanthenay !
Elle se dirigea droit vers la masure.
Devant une porte, elle vit Cocardère en faction.
– Lanthenay veut te parler, lui dit-elle. Je vais te remplacer.
– Bon ! fit Cocardère, voici la clef de la cave.
– Tu attendras que le conseil soit terminé. Il m’a recommandé que tu ne le déranges pas avant.
– Bien, bien…
Cocardère s’éloigna en sifflotant.
La Gypsie s’élança chez elle.
Quelques instants plus tard, elle revenait avec un paquet sous le bras, et une petite lampe.
Alors, elle ouvrit la porte de la cave, entra et referma.
Au bas de l’escalier, il y avait deux caves.
Dans la deuxième, elle vit Monclar étendu sur le sol, lié solidement, et bâillonné. D’un tour de main, elle défit le bâillon et coupa les cordes.
– Me reconnaissez-vous, monsieur le grand prévôt ?
– Oui ! Que me veux-tu ? dit-il, persuadé que la vieille était escortée de truands et qu’elle venait l’insulter.
– C’est Lanthenay qui vous a pris ? reprit-elle.
– Oui ! dit-il.
– En ce moment, le conseil des chefs est réuni pour statuer sur votre sort.
Monclar haussa les épaules et sourit dédaigneusement.
– Tous sont d’avis de vous renvoyer indemne… Un seul, vous entendez, un seul est d’avis qu’il faut vous mettre à mort. Malheureusement, son avis, à lui, vaut plus que celui de tous les autres. Il sera écouté…
– Ah ! Et quel est cet homme implacable ?
– Lanthenay.
– J’aurais dû m’en douter. Eh bien qu’ils fassent vite !…
– Je viens vous sauver…
– Et pourquoi me sauves-tu ?
– Nous n’avons pas le temps de nous expliquer. Plus tard, vous saurez. Seulement, je vous demande de ne pas oublier que Lanthenay voulait vous faire pendre, et que je vous sauve, moi !
– Sois tranquille, je n’oublierai ni l’un ni l’autre !
En parlant, la vieille avait défait son paquet.
Il contenait un ample manteau et une toque.
– Laissez votre épée, dit-elle. Elle pourrait vous trahir.
Monclar obéit, se couvrit de la toque et s’enveloppa du manteau.
– Venez dit la Gypsie lorsque ces préparatifs furent terminés.
Ils montèrent l’escalier.
La bohémienne referma la porte à double tour et mit la clef dans sa poche.
Elle se dirigea droit vers la ruelle Saint-Sauveur.
Au bout de la rue, la Gypsie s’arrêta.
– Allez, monseigneur, dit-elle.
– Et toi ?
– Moi ?… Je rentre chez moi, voilà tout.
– Mais on saura que c’est toi qui m’as délivré ?
– Peut-être !
– Alors, on te tuera. Viens, je me charge de te faire une existence plus heureuse que celle que tu as menée jusqu’à ce jour.
– Nul ne peut plus rien pour mon bonheur, fit-elle.
– Tu es donc bien malheureuse ?
– Autant qu’une créature humaine peut l’être.
– Étrange femme ! murmura le grand prévôt. N’est-ce pas toi qui m’as parlé un jour, comme je passais à cheval près de la rue Saint-Denis ?…
– Oui, monseigneur, c’est moi.
– Mais tu me disais alors que tu t’intéressais à ce Lanthenay…
– C’est vrai, et je m’intéresse encore à lui.
– Pourtant tu me sauves, alors que tu sais bien ce que je vais faire…
– Non, monseigneur, je ne le sais pas.
– Eh bien, il faudra bien qu’un jour ou l’autre Lanthenay tombe dans mes mains…
– C’est probable, monseigneur… Et après ?
– Après ? Je le ferai rouer vif. Il ne m’eût pas épargné, lui ! Tu me le disais tout à l’heure…
– Je le disais parce que c’est la vérité, Monseigneur.
– Ainsi donc, tu t’intéresses à Lanthenay et tu délivres celui qui le fera rouer ?
– N’y a-t-il donc qu’une manière de s’intéresser à quelqu’un ?
Le grand prévôt garda un instant le silence.
– Qu’est devenu Tricot ? demanda-t-il.
– Il est mort ; nos hommes l’ont tué parce qu’il trahissait.
– Qui les a prévenus ?
– Lanthenay, répondit la Gypsie.
– Tu ne mens pas ?…
La bohémienne tressaillit. Est-ce que Monclar la devinait ?
– Pourquoi mentirais-je ? fit-elle avec son calme.
– Que sais-je ?… Si tu hais ce Lanthenay…
– Je ne le hais pas. Il n’est rien pour moi. Et lors même que je le haïrais, je ne daignerais pas mentir. Lorsque je veux frapper quelqu’un, je le frappe moi-même. Et je vous jure, Monseigneur, que le coup est toujours bien appliqué.
– Je le crois ! dit Monclar en frissonnant.
Il reprit, après un court silence :
– Que veux-tu pour m’avoir délivré ?
– Je n’ai besoin de rien, monseigneur. Je vous ai délivré simplement parce que si mes hommes vous avaient tué, il en serait résulté de terribles calamités pour nous tous.
– Soit ! Adieu, alors…
– Au revoir, monseigneur…
Elle le regarda un instant s’éloigner d’un pas aussi tranquille que s’il n’eût pas couru dix minutes avant un terrible danger.
Alors elle rentra dans la Cour des Miracles.
Elle s’approcha du brasier, et, tranquillement, pénétra dans le cercle des truands qui discutaient le sort du grand prévôt.
Une sorte de respect superstitieux s’attachait à la Gypsie.
Elle passait pour avoir des accointances avec certains démons ; elle avait en outre la réputation de lire comme à livre ouvert dans les étoiles, « ce que la nuit des temps renferme dans ses voiles » – pour employer la somptueuse expression de La Fontaine. Plus d’un truand qui n’eût pas redouté de se colleter avec le guet et qui, au besoin, eût marché à la potence avec un sourire de bravade, frissonnait en rencontrant la Gypsie, par les nuits obscures, et se hâtait de toucher quelque amulette capable de conjurer le mauvais sort.
Aussi, lorsqu’elle pénétra dans le cercle des chefs et qu’elle leva ses deux bras maigres comme pour réclamer le silence, on se tut aussitôt.
– Frères, dit la Gypsie, vous discutez pour savoir si vous devez tuer le grand prévôt…
– Donne ton avis ! lui cria-t-on.
– Mon avis est inutile. Votre avis à tous est inutile. Le grand prévôt n’est plus dans la Cour des Miracles. Il s’est évadé…
Un grand cri de rage et de fureur s’éleva.
Plusieurs truands s’élancèrent vers la cave où Monclar avait été enfermé ; Ils revinrent au bout de quelques instants en disant que la Gypsie avait dit la vérité.
– Ne cherchez pas, reprit la bohémienne, comment la chose a pu se faire. C’est moi qui ai ouvert la porte au grand prévôt et qui l’ai conduit hors le territoire du royaume d’Égypte.
Un silence de stupéfaction accueillit ces paroles, et la Gypsie se hâta de continuer :
– En délivrant le grand prévôt, c’est nous tous que j’ai sauvé. Les esprits m’ont révélé que la mort du grand prévôt serait le signal d’un massacre général. Cependant, si j’ai eu tort, je me soumettrai à la peine que vous m’infligerez. Mais même si cette peine doit être la mort, je mourrai heureuse d’avoir sauvé mes frères.
Nul n’éleva donc la voix pour réclamer une punition contre la Gypsie.
Et celle-ci put se retirer tranquillement.
Mais comme elle allait remonter sans son taudis, elle vit Lanthenay qui s’approchait d’elle en hâte.
– Pourquoi avez-vous sauvé cet homme ? demanda-t-il.
– Mais toi-même, tout à l’heure, n’as-tu pas parlé dans le conseil pour que Monclar fût épargné ?… J’ai cru que je te serais agréable, mon fils…
– C’est possible… Allez, mère Gypsie, pardonnez-moi ma colère.
– Ai-je donc vraiment si mal fait ? demanda-t-elle. Et sa voix avait une singulière douceur d’affection.
– Ne comprenez-vous pas, répondit sourdement Lanthenay, ne comprenez-vous pas que si j’avais pris cet homme, c’est que, moyennant sa vie et sa liberté, je comptais lui arracher la vie et la liberté d’un autre !
– Ah ! malheureuse, je n’ai point songé à cela !
– N’y pensons plus… Le mal est fait… il est irrémédiable… Mais, vraiment, si tout autre que vous eût fait ce que vous venez de faire, je ne sais si j’aurais assez de puissance sur moi pour m’empêcher de le tuer…
La colère et le désespoir de Lanthenay était d’autant plus effrayants qu’il contenait sa voix pour ne pas épouvanter la vieille femme.
Un geste violent lui échappa, et il s’éloigna brusquement en s’écriant :
– Il faut que je sois maudit !
La Gypsie était demeurée à la même place.
– Maudit ? gronda-t-elle alors entre ses dents. Qui te dit que tu ne l’es pas !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le désespoir de Lanthenay fut immense.
Depuis l’avortement de la tentative insensée qu’il avait faite à la Conciergerie pour délivrer Étienne Dolet, il attendait avec une fébrile impatience que la Cour des Miracles fût attaquée.
Il était persuadé que le grand prévôt dirigerait en personne l’opération.
Son plan était simplement de s’emparer de Monclar.
Une fois le grand prévôt prisonnier il ne doutait pas qu’il pût lui arracher la liberté de Dolet.
On a vu que ce plan avait admirablement réussi dans la partie que Lanthenay pouvait à juste titre considérer comme la plus difficile.
Et on a vu comment, grâce à la Gypsie, il avait échoué dans la deuxième partie.
IV
BÉATRIX
Pendant que ces divers événements s’accomplissaient à la Cour des Miracles, le roi et son escorte, guidés par Alais Le Mahu, étaient arrivés devant la maison de la rue Saint-Denis où Madeleine Ferron avait conduit le chevalier de Ragastens.
Le roi mit pied à terre.
Les vingt cavaliers qui l’avaient suivi l’imitèrent, et l’officier qui les commandait prit aussitôt ses dispositions selon les indications que François Ier venait de lui donner. Le roi fit signe à La Châtaigneraie, à d’Essé et à Sansac de venir avec lui.
– Monsieur, dit-il à l’officier, si j’appelle, vous envahirez cette maison, et alors, n’hésitez pas, tuez tout ce qui voudrait vous faire obstacle, homme ou femme !
L’officier s’inclina en signe qu’il avait compris la consigne et qu’il était prêt à l’exécuter envers et contre tous. Alors le roi s’approcha de la porte. Elle était fermée.
– Forcez cette porte, dit-il à l’officier. Sans bruit.
Sur un signe de l’officier, un soldat s’approcha à son tour, introduisit son poignard dans la jointure de la serrure, et après dix minutes de travail silencieux, parvint enfin à ouvrir.
François Ier s’élança, suivi de ses trois compagnons.
Pour entrer dans la maison, il y avait une autre porte.
Elle fut ouverte par le même procédé.
Cependant, le silence qui régnait dans la maison ne laissait pas que d’inquiéter le roi.
Pourquoi tout était-il silencieux et obscur à l’intérieur ?
Tout à coup, comme il était à peu près au milieu de cet escalier, l’obscurité dans laquelle il se trouvait se dissipa.
Le roi porta vivement la main à son épée et leva les yeux. Car la lumière venait de haut.
Alors, il vit une femme qui tenait une lampe à la main et qui le regardait avec une dignité triste et sévère.
Il la reconnut aussitôt.
– Madame de Ragastens ! fit-il en se découvrant avec cette politesse qui l’abandonnait bien rarement.
Puis, souriant, et prenant déjà son parti, il s’écria :
– Eh ! madame, nous nous étions tout à l’heure quittés un peu en froid, et j’ai tenu à me réconcilier avec une personne aussi accomplie que vous paraissez l’être.
– Sire, dit Béatrix, je vous répéterai ce que je vous ai dit dans l’enclos des Tuileries : Soyez le bienvenu.
Le roi regarda autour de lui avec inquiétude.
Il s’attendait à une résistance, à des reproches, – car enfin il entrait dans cette maison comme un des truands que le grand prévôt combattait à cette heure, – et la parole de Béatrix lui faisait redouter quelque guet-apens.
François Ier avait la bravoure physique poussée à un degré extraordinaire.
– On va peut-être me poignarder, songea-t-il, mais, tant pis, la mort plutôt que le ridicule !
Et il monta lestement les quelques marches qui le séparaient de Béatrix.
– Aurais-je le plaisir de voir M. de Ragastens ? demanda-t-il en s’inclinant.
– M. le chevalier sera désespéré de ne pas s’être trouvé là pour répondre à l’honneur que lui fait Sa Majesté pour la deuxième fois…
En même temps, elle s’effaça pour laisser entrer le roi.
Elle vit son hésitation et comprit.
– Ne craignez rien, sire, dit-elle, il n’y a personne que moi dans cette maison…
Le roi rougit un peu et entra, immédiatement suivi de ses compagnons, dans une belle et vaste salle incomplètement meublée.
– Quoi, madame, s’écria-t-il alors, vous êtes seule ici, dites-vous ?
– Absolument seule, sire.
– Cependant, madame, on a vu entrer ici plusieurs personnes…
– Qui étaient présentes il n’y a pas plus d’un quart d’heure, sire. Mais en ce moment, malgré tout le regret que j’en éprouve, je suis seule à essayer de rendre au roi les honneurs qui lui sont dus…
– Où est M. de Ragastens ?
– Sire, dit Béatrix avec un calme qui imposa au roi une sorte de respectueuse admiration, je pourrais vous répondre que vous, le premier chevalier de France, vous interrogez en ce moment une femme venue en ce pays sur sa réputation de loyale hospitalité…
– Pardonnez-moi, madame, fit le roi frémissant. Mais il y va d’intérêts fort graves, je vous assure. Aussi, malgré le chagrin que j’en éprouve, je vous interroge comme maître de la suprême justice dans ce pays et vous somme de me répondre… Où est M. de Ragastens ?
– Puisque vous parlez en maître, sire, je répondrai contrainte ; M. de Ragastens est sorti pour conduire en lieu sûr une jeune fille à laquelle nous avons voué tous les deux une grande affection.
– De quoi se mêle ; éclata-t-il, ce petit aventurier qui n’est ni Français ni Italien et qui prétend nous donner des leçons !
Béatrix pâlit.
– Sire, dit-elle d’une voix étrangement ferme, le chevalier de Ragastens n’a jamais toléré que qui que ce fût au monde l’insultât impunément. Ce m’est un impérieux devoir de veiller à ce qu’il ne soit pas insulté en son absence. Mais comme je suis femme et que je n’ai aucun moyen d’empêcher quatre hommes d’être insolents je me retire pour ne pas en entendre davantage…
– Restez, madame, s’écria le roi. Vous venez de prononcer des paroles bien audacieuses ; mais selon vos propres expressions, vous êtes femme, et je n’userai pas, à Dieu ne plaise ! du droit de répression que je pourrais employer. Restez, je mesurerai mes paroles, et j’espère que vous ferez de même.
– Votre Majesté peut en être assurée, dit alors Béatrix. Le roi garda un instant le silence.
– Madame, reprit-il, tout à l’heure, dans l’enclos des Tuileries, je vous ai dit clairement que Gillette est ma fille… Me croyez-vous ?
– Je crois d’autant plus volontiers Votre Majesté que Gillette elle-même nous a raconté toute son histoire.
– Et sachant que Gillette est ma fille, sachant que je la cherche, le chevalier de Ragastens la soustrait, la cache, l’enlève !… Sans vouloir invoquer d’autres droits, je vous dirai, madame, que je n’ai pas agi ainsi à l’égard du chevalier lorsqu’il est venu me supplier de l’aider à retrouver son fils… votre fils, madame !
– Sire, le chevalier m’a dit la bienveillante réception que vous aviez bien voulu lui faire, et je vous garantis sa reconnaissance comme la mienne…
– Je n’en doute pas, madame ; mais le chevalier a une étrange façon de témoigner sa reconnaissance.
– M. de Ragastens a, tout à l’heure, demandé à Gillette si elle désirait être conduite au Louvre ; sur sa réponse affirmative, sire, le chevalier était tout prêt à vous ramener votre enfant…
– Et qu’a-t-elle dit ? fit le roi avidement.
– Qu’elle préférait mourir…
François Ier baissa la tête.
– Me hait-elle donc à ce point ! murmura-t-il.
Mais bientôt la colère l’emporta à nouveau.
– Soit, dit-il. Le chevalier de Ragastens a emmené ma fille. Mais moi, je désire savoir en quel lieu il l’a conduite.
– Je ne le sais pas, sire.
– Vous le savez, madame ! Ou plutôt, tout dans votre attitude, dans le son de votre voix, dans votre regard embarrassé, tout me prouve que vous vous jouez de moi. Je vous prie donc de me répondre avec exactitude, sans quoi…
– Sans quoi, sire ?…
– C’est à vous, à vous seule, madame, que je m’en prendrais ! Donc, vous m’affirmiez que le chevalier n’est pas ici ?
– Oui, sire !
– Qu’il a emmené Gillette ?
– Oui, sire !
– C’est bien. Il séquestre ma fille ; moi je séquestre sa femme. Veuillez vous préparer à nous suivre, madame.
– Quoi, sire, vous oseriez…
– J’oserai tout ! fit violemment le roi. Je vous arrête, madame. Lorsque le chevalier de Ragastens me rendra ma fille, je vous remettrai en liberté, cela, je le jure, – mais je jure également que le chevalier ne vous reverra pas avant que je n’aie revu Gillette…
– Sire, c’est un indigne abus de force !
– Non, madame, c’est de la clémence.
– Sire, je ne céderai qu’à la force, et nous verrons si, en France, quatre gentilshommes armés auront osé porter la main sur une femme.
– Qu’à cela ne tienne ! s’écria le roi au paroxysme de la fureur.
Et il fit un signe à ses gentilshommes qui sans hésitation, s’avancèrent sur Béatrix.
Celle-ci poussa un cri.
À ce moment, une porte s’ouvrit, et Gillette parut.
La jeune fille, blanche comme un lys, mais ferme, s’avança vers le roi stupéfait.
– Sire, dit-elle, me voici prête à vous suivre…
– Malheureuse enfant ! s’écria Béatrix.
– Hélas ! madame… je suis condamnée. Mon malheur se doublerait de la certitude que j’ai pu causer le vôtre. Sire, continua-t-elle, une première fois je me suis rendue à vous pour sauver un homme qui se dévouait pour moi. Cette fois-ci, j’ose penser que l’arrestation du chevalier de Ragastens ne suivra pas de près mon entrée au Louvre, comme l’arrestation d’Étienne Dolet…
– Mon enfant, dit le roi agité d’une foule de sentiments, l’arrestation de Dolet est un fait politique. Quant au chevalier, je vous jure qu’il ne sera pas inquiété…
– Adieu, madame, adieu, ma chère bienfaitrice ! s’écria Gillette en se jetant dans les bras de Béatrix.
– Sire, dit celle-ci, ce que vous faites ce soir est odieux. Prenez garde que quelque catastrophe ne vienne payer la mauvais action que vous commettez !
Le roi tressaillit.
Mais il se contenta de s’incliner froidement.
Puis, s’adressant à Gillette :
– Mon enfant, dit-il, vous avez contre moi d’injustes préventions. Je les ferai tomber à force d’affection, un jour prochain, j’espère… La Châtaigneraie, continua-t-il, offrez votre main à la duchesse de Fontainebleau.
La Châtaigneraie s’empressa d’obéir et saisit la main de Gillette, qui se laissa entraîner sans résistance.
Puis le roi salua profondément Béatrix.
– Madame, lui dit-il, je viens de promettre à cette enfant de ne pas inquiéter le chevalier de Ragastens ; je tiendrai ma parole, mais, croyez-moi, conseillez-lui de s’en retourner au plus tôt en Italie.
Il se retira alors en murmurant :
– Cette fois, on ne me l’enlèvera pas !
V
MONSIEUR FLEURIAL.
Le chevalier de Ragastens, en quittant la Gypsie, s’était approché de Manfred. Pendant la mêlée des truands et des gens du roi il avait étudié le jeune homme avec une curiosité passionnée, et il avait senti se fortifier en lui cette sympathie qui avait pris naissance au pied du gibet de Montfaucon.
– Il n’est pas mon fils, soit ! songeait-il. Mais si j’avais le bonheur de retrouver l’enfant que j’ai perdu, je ne le voudrais pas autrement que ce jeune homme…
Et maintenant, tout en causant, il l’examinait à la lueur du brasier, cherchant encore, se demandant confusément si la bohémienne n’avait pas menti.
Mais pourquoi aurait-elle menti ? La seule raison plausible d’un mensonge eût été la crainte de Lucrèce Borgia ou le désir de se ménager ses bonnes grâces. Or, Lucrèce Borgia était morte, et Ragastens avait offert une fortune à la Gypsie.
Donc elle ne mentait pas.
Pourtant, sur les traits fins et hardis du jeune homme, il semblait parfois à Ragastens qu’il démêlait quelque chose du profil si fier et si pur de Béatrix. Mais, aussitôt, il se disait que ce n’était là sans aucun doute qu’une illusion créée par son imagination tendue vers la recherche des ressemblances.
– Vous avez su ce que vous désiriez savoir, monsieur le chevalier ? avait demandé Manfred.
– Hélas ! oui fit Ragastens avec un soupir. Mais, dites-moi, n’avez-vous jamais entendu parler d’un enfant qui aurait été enlevé par des bohémiens et amené à la Cour des Miracles ?
– Les histoires de ce genre sont nombreuses ici, monsieur. Et moi-même, je suis très probablement un enfant volé… ou perdu.
– Ah ! Et avez-vous gardé quelque souvenir de votre enfance ?
– Des souvenirs bien vagues, de fugitives réminiscences qui m’échappent dès que j’essaie d’en former une image précise. Ainsi, tenez, il m’arrive souvent de rêver de l’Italie. Il y a des moments où il me semble que je vais pouvoir reconstituer un paysage familier… Je vois de hautes montagnes, un jardin somptueux, une belle maison… puis, dès que je veux étreindre ces fantômes, ils se dissipent et m’échappent…
Ragastens écoutait avec une avidité et une émotion extraordinaires.
– Ainsi, dit-il, vous croyez que cette bohémienne n’est peut-être pas votre mère ?
– Je ne crois rien, monsieur, je doute, voilà tout, La Gypsie n’a jamais eu envers moi l’attitude d’une mère. Ah ! si c’était Lanthenay, ce serait plus probable ! Elle a pour lui une profonde affection… mais, je vous prie, ne parlons pas de ces choses. Je vous avouerai que j’éprouve quelque chagrin à essayer de lire dans un passé qui demeurera pour moi un livre à jamais fermé…
– Qui sait ? murmura Ragastens. Vous avez raison, ajouta-t-il à haute voix ; ces regards en arrière sont pénibles pour un homme jeune, dans toute la force et l’ardeur de son printemps ; l’avenir vous sourit. Brave, chevaleresque, intelligent comme vous l’êtes…
Manfred l’interrompit par un hochement de tête.
– L’avenir, dit-il, m’apparaît aussi sombre que mon passé est obscur.
– Voilà de bien tristes pensées, à votre âge.
– Excusez-moi, monsieur. Je vous attriste vous-même, alors que je devrais m’efforcer de vous être agréable, vous qui venez de me rendre coup sur coup des services aussi importants !
– Non, non, fit vivement le chevalier. Je voudrais seulement savoir la cause de votre tristesse.
– Vous le voulez ?
– Je vous en prie, mon ami.
– C’est étrange, monsieur le chevalier, que vous m’inspiriez tant de confiance et de sympathie. J’éprouve, à m’ouvrir à vous que je connais à peine, la même consolation que lorsque je parle à Lanthenay, mon seul ami.
– Eh bien, s’écria Ragastens d’une voix émue, parlez donc à cœur ouvert.
– La cause de ma tristesse, chevalier, est bien simple : j’aime avec passion une jeune fille ; il est probable que je l’aime depuis longtemps, bien que je ne me sois avoué cet amour que depuis peu…
– Eh bien, fit en souriant le chevalier, je ne vois rien là de terrible.
– Vous allez voir. Cette jeune fille, c’est la fille du roi de France.
– Ah ! je comprends… vous redoutez de ne pouvoir combler le fossé qui vous sépare d’elle ?
– Non, ce n’est pas cela. Il y a là tout un drame que je vous conterai. Sachez seulement que le roi persécute Gillette…
– Elle s’appelle Gillette ?
– Et elle est plus jolie encore que ce joli nom.
– Mais comment le roi peut-il persécuter sa propre fille ?
– Il est poussé par un sentiment si étrange, si bas, si vil, si improbable et si contre nature qu’à peine on peut le concevoir. Il aime sa fille, vous entendez, il l’aime d’amour.
– C’est affreux, dit Ragastens sans trop d’étonnement ; car à force d’interroger Gillette, il avait fini par démêler à peu près la vérité.
– N’est-ce pas ? fit Manfred.
– Je comprends dès lors votre chagrin ; car sans doute vous ne trouvez pas le moyen d’arracher celle que vous aimez à ce père dénaturé…
– Heureusement, elle n’est plus en son pouvoir…
– Mais alors, qui vous empêche de la rejoindre ?
– Voilà mon tourment ! Gillette a disparu du Louvre, mystérieusement enlevée ; depuis, je la cherche ; mais jusqu’ici, acheva le jeune homme avec découragement, je l’ai cherchée en vain.
Ragastens le contempla un instant avec un sourire.
– Voulez-vous m’accompagner jusque chez moi ?
– Ce me sera un précieux devoir que de vous faire escorte, monsieur le chevalier.
– Vous me comprenez mal. Je vous demande de venir jusque dans ma maison.
– Quoi ! à cette heure ?
– Qu’importe l’heure ! Je vous présenterai à quelqu’un qui pourra peut-être vous donner des nouvelles de Mlle Gillette.
– Que dites-vous ! s’écria Manfred en pâlissant.
– La vérité…
– Ah ! monsieur, prenez garde de me ménager quelque désillusion trop cruelle…
– Je sais trop, dit gravement le chevalier, ce que c’est qu’une déception du cœur. Ne redoutez rien. Venez, et je crois que vous serez satisfait.
– Je vous crois, monsieur, je vous crois, fit Manfred avec agitation. Mais le trouble où vous me voyez ne vous surprendrait pas si vous saviez à quel désespoir succède la joie que vous me donnez… Mais j’y songe, reprit-il tout à coup, il faut que vous me permettiez d’amener quelqu’un avec moi…
– Votre ami Lanthenay ?
– Non ! Un homme que j’ai appris à aimer et à respecter… Celui qui a élevé Gillette et lui a servi de père… M. Fleurial.
– Quoi ! s’écria Ragastens, M. Fleurial est ici ?
– Vous le connaissez donc ? fit Manfred surpris.
– Non… mais j’ai fort entendu parler de lui par la personne même qui vous donnera des nouvelles de votre Gillette. Allez, mon ami, allez chercher M. Fleurial ; non seulement je vous permets de l’amener avec vous, mais sa présence est nécessaire.
Manfred s’élança.
– Ce n’est pas mon fils, soupira Ragastens. Mais en mérite-t-il moins le bonheur qu’il va éprouver dans quelques minutes… Plus je regarde et écoute ce jeune homme, plus je lui trouve de perfections. Allons, mon voyage n’aura pas été inutile, puisque j’aurai pu faire deux heureux… sans compter ce malheureux Fleurial que je ne m’attendais guère à trouver ici.
À ce moment, il vit revenir Manfred. Un homme vêtu de noir l’accompagnait.
– Monsieur le chevalier, dit Manfred, voici M. Fleurial. Comme je vous le disais, je le considère comme le véritable père de Gillette, et elle-même le considère comme tel.
Il lui tendit la main. Triboulet la serra en disant :
– Il y a donc de grands seigneurs qui s’occupent du bonheur des pauvres gens, alors qu’il est si facile et si agréable de les tourmenter ?
– Monsieur Fleurial, répondit Ragastens, je pourrais d’abord vous dire que je ne suis peut-être pas aussi grand seigneur que vous semblez le supposer ; j’aime mieux vous dire simplement qu’élevé moi-même à l’école du malheur, j’ai appris à respecter la douleur des autres et à la considérer d’un œil pitoyable…
– Monsieur, fit Triboulet, ému, qui que vous soyez, vous êtes un homme de cœur, et, par ma foi, laissez-moi vous regarder bien en face, car la chose est rare…
– Allons ! venez ! fit Ragastens en souriant.
Les trois hommes se mirent aussitôt en chemin, suivis de Spadacape.
– Vous dites donc, reprit Triboulet, que quelqu’un peut nous donner des nouvelles de Gillette ?
– Vous verrez, dit Ragastens.
Le reste de la route se fit en silence.
Ils arrivèrent rue Saint-Denis.
La porte de la cour qui entourait la maison était ouverte. Ragastens pâlit et s’élança vers la porte d’entrée, ouverte aussi !
– Oh ! gronda-t-il, un malheur est arrivé ici ! Béatrix ! Béatrix ! appela-t-il d’une voix angoissée, en se jetant dans l’escalier.
– Me voici ! répondit la voix de Béatrix.
Et elle apparut sur le palier, comme tout à l’heure elle était apparue au roi. Ragastens soupira, rassuré.
Manfred et Triboulet l’avaient suivi avec étonnement.
Tous trois entrèrent dans la salle où était entré François Ier.
– Chère amie, dit Ragastens, je vous présente M. Fleurial et M. Manfred.
Béatrix jeta un profond regard sur le jeune homme, puis ce regard se tourna vers le chevalier, avec une ardente et muette interrogation.
Ragastens, tristement, fit non de la tête.
– Est-ce notre fils ? avait demandé le regard de la mère.
Et, au signe négatif, ses yeux se voilèrent d’une larme.
Mais aussitôt, dans cette nature généreuse, son propre chagrin disparut ; elle ne songea qu’au chagrin de Triboulet et de Manfred.
Elle avait compris pourquoi Ragastens les avait amenés.
– Messieurs, dit-elle, je vous connais l’un et l’autre… Vous, monsieur Fleurial, vous êtes le meilleur et le plus dévoué des pères… Et vous, monsieur, Manfred, on m’a longuement parlé de vous, bien qu’on vous connaisse à peine…
– Madame… balbutia Triboulet, regardant autour de lui comme s’il se fût attendu à voir entrer Gillette.
Quant à Manfred, ce jeune homme qui était si ferme et si insoucieux devant les arquebuses des gens du roi, il tremblait et se sentait défaillir.
– Messieurs, reprit alors Béatrix, soyez courageux, soyez fermes, soyez hommes, car j’ai une triste nouvelle à vous apprendre…
– Gillette ! s’écria Ragastens.
– Enlevée !
– Gillette était donc ici ! s’écria Triboulet.
– Vous ne le saviez donc pas ?
– Hélas ! fit Ragastens, je leur en réservais la surprise.
– Madame ! madame ! fit à son tour Manfred, parlez, je vous en conjure ! Peut-être est-il temps encore de courir… Quand cela s’est-il fait ?
– Vers onze heures et demie, c’est-à-dire qu’il y a maintenant près de deux heures…
– Oh ! ces portes ouvertes ! s’écria Ragastens. Mais qui ? qui est venu ?
– Et qui serait-ce donc ? éclata Triboulet dont l’œil s’illumina d’un feu sombre. Qui, sinon le bandit qui s’embusque la nuit pour courir sus aux femmes, le lâche que son autorité et son pouvoir mettent à l’abri des vengeances d’une foule de pères, de frères ou de fiancés ! Qui, sinon le roi de France !
– C’est lui, en effet, qui est venu, dit Béatrix.
Alors, en quelques mots rapides, mais sans omettre aucun détail, elle raconta la scène à laquelle nous avons assisté dans le précédent chapitre.
– Espérez ! ajouta Béatrix. Le roi parlait vraiment comme un père… peut-être ne court-elle aucun danger…
– Ah ! madame, s’écria Triboulet, vous ne connaissez pas cet homme comme je le connais. Hypocrite, habile à prendre tous les masques, d’autant plus cruel qu’il croit n’avoir rien à redouter, tenace dans les passions qui se succèdent en lui, il est capable des pires crimes. Il doute en réalité que Gillette soit bien sa fille. Mais en eût-il la preuve indiscutable que je le crois capable de passer outre !
Manfred serrait nerveusement les poings.
Triboulet, cependant, s’enveloppait de son manteau.
– Pardonnez-moi, madame, dit-il de vous quitter aussi brusquement. J’eusse voulu savoir où et comment vous avez retrouvé mon enfant. J’eusse voulu surtout vous faire comprendre quelle reconnaissance déborde de mon cœur… Mais chaque seconde qui s’écoule rend plus effroyable le danger…
– Où cours-tu ? fit Manfred, les dents serrées, tutoyant pour la première fois celui qu’il appelait le père de Gillette.
– Au Louvre, mon fils, dit Triboulet.
– Je t’accompagne. À nous deux nous tuerons le tyran…
– Non, non ! fit vivement Triboulet. Il faut de la ruse et non de la force. La ruse, c’est mon arme, à moi. Quand l’heure sera venue, je ferai appel à la force de ton bras.
– M. Fleurial a raison, dit Ragastens en saisissant la main du jeune homme.
– Oh ! râla Manfred, ne rien pouvoir ! C’est à se briser la tête contre un mur !
– Adieu ! fit Triboulet. Que cette maison soit notre rendez-vous général. Manfred, ajoute-t-il en voyant que le jeune homme, allait malgré tout le suivre, il faut que tu restes. S’il n’y a plus personne, dans le cas où un malheur m’arriverait, que deviendrait-elle ? Et puis, je suis son père. J’ai le droit de marcher le premier… Reste, je te l’ordonne !
Triboulet s’élança et courut au Louvre, se dirigeant vers une petite porte qui s’ouvrait sur la berge de la Seine. Au moment où il y arrivait, il s’arrêta soudain.
Devant la petite porte, il venait de distinguer une voiture, une chaise de voyage. Et autour de la voiture s’agitaient confusément des ombres.
Triboulet demeura cloué sur place.
Gillette venait d’apparaître !
Une femme la soutenait, ou plutôt l’entraînait…
Le bouffon les vit monter dans la voiture dont les man-telets se baissèrent aussitôt.
Une voix ordonna :
– Route de Fontainebleau !…
Triboulet la reconnut.
C’était la voix du roi !
Et il l’aperçut, arrêté dans l’encadrement de la porte.
Le postillon fit claquer son fouet, les porteurs de torches s’élancèrent en avant, la voiture s’ébranla au galop, suivie de l’escorte… En un instant, toute la vision disparut dans les ténèbres…
Et Triboulet vit le roi qui rentrait dans le Louvre, la porte qui se refermait.
Tout cela avait duré deux ou trois secondes.
Alors, il s’élança à son tour.
Il était deux heures sonnées lorsqu’il arriva à la maison de la rue Saint-Denis.
Ragastens et Manfred étaient encore dans la salle où il les avait laissés.
– On l’entraîne à Fontainebleau ! s’écria Triboulet.
– Partons à Fontainebleau ! répondit Manfred.
– Partons ! dit Ragastens froidement.
– Quoi ! chevalier, vous consentiriez…
– Rien ne me retient plus à Paris, dit Ragastens. Je ne vous cacherai pas que je m’intéresse vivement à votre sort, et au vôtre, monsieur Fleurial. De plus, l’action du roi François Ier m’a révolté. Enfin, je m’étais attaché à cette jeune fille. Voilà plus de motifs qu’il n’en faut pour tirer l’épée en l’honneur de Mlle Gillette !…
– Nous sommes sauvés ! dit Manfred en saisissant la main de Fleurial.
VI
LA RÉCOMPENSE D’ALAIS LE MAHU
Le roi, en sortant de la rue Saint-Denis, était revenu directement au Louvre. Il avait voulu, faire le chemin à pied, pour honorer la jeune fille qu’il ramenait. Aussi, tous les seigneurs qui l’escortaient avaient-ils marché à pied, et les soldats, seuls, étaient restés à cheval.
En arrivant au Louvre, François Ier apprit que nombre de dames de la cour étaient réunies, attendant le résultat de l’expédition contre les truands.
Elles avaient trouvé la partie amusante, et avaient organisé une collation nocturne dont était Mme la duchesse d’Étampes.
Quant à Mme Diane de Poitiers, elle était retirée en ses appartements.
Le roi s’informa de la salle où étaient réunies les dames. Bassignac le guida.
François Ier avait pris la main de la duchesse de Fontainebleau, et, suivi des seigneurs qui l’avaient accompagné, il entra dans la salle de la collation.
Toutes les femmes présentes se levèrent.
Mais le roi, d’un geste affable, ordonna qu’on ne se dérangeât pas.
– À Dieu ne plaise, dit-il galamment, que je trouble les ébats d’une aussi charmante société. Je viens seulement vous confier pour une heure la duchesse de Fontainebleau qui nous revient après un voyage. Madame la duchesse d’Étampes, je la mets spécialement sous votre protection.
Le roi avait prononcé ces paroles sans malice aucune et sans y attacher aucun sens d’allusion.
Mais la duchesse devint livide. Elle crut que le roi avait su qu’elle avait enlevé Gillette.
– Je suis perdue, pensa-t-elle.
Ce qui ne l’empêcha pas de faire au roi sa plus belle révérence, et, se remettant aussitôt de son trouble, de faire à Gillette toutes sortes de caresses.
La duchesse avait jeté un coup d’œil machinal sur les seigneurs qui escortaient le roi.
Parmi eux, elle avait aperçu Alais Le Mahu.
– C’est lui qui m’a trahie ! se dit-elle.
Le roi cependant était sorti.
Il avait donné différents ordres, notamment de préparer à l’instant une voiture de voyage.
Gillette, demeurée avec les dames de la cour, avait, elle aussi, reconnu la duchesse d’Étampes. Elle frissonna d’horreur et reçut les caresses de cette femme avec une froideur si visible que la duchesse, voyant l’étonnement des dames qui l’entouraient, s’écria audacieusement :
– Mais, chère petite, on dirait que je vous inspire de l’effroi ?
– Non, madame ; si vous me voyez troublée, répondit Gillette, c’est que je pense encore à une femme qui vous ressemblait d’étrange façon et qui m’a conduite chez une folle pour m’y faire tuer…
– Oh ! mon Dieu !… chez une folle, s’écrièrent plusieurs femmes.
– Oui, dit Gillette ; une folle qui a nom Margentine et qui habite un taudis près la Cour des Miracles… Est-ce que vous la connaissez, madame ?…
La duchesse d’Étampes se mordit les lèvres et ne répondit pas.
Mais elle fut plus que jamais persuadée qu’Alais Le Mahu l’avait trahie. Son angoisse dura une heure, au bout de laquelle le roi reparut. Il venait en personne chercher la duchesse de Fontainebleau.
On a vu où il la conduisait.
Lorsque le roi revint, la duchesse d’Étampes se demanda si elle n’allait pas être arrêtée à l’instant et conduite en quelque bastille.
Mais, à son grand étonnement, le roi se montra d’une humeur charmante ; il daigna goûter à la collation des dames de la cour, s’assit près de la duchesse d’Étampes, et il fut évident aux yeux de tous que plus que jamais elle était en faveur.
Ce fut à ce moment qu’on annonça le retour de Monclar.
– Priez M. le grand prévôt de venir ici, fit le roi.
Et il ajouta :
– Mesdames, une nouvelle : la cour va voyager.
– Où allons-nous, sire ? demandèrent plusieurs qui aspiraient à l’honneur de remplacer la duchesse d’Étampes.
– À Fontainebleau. Nous partons demain.
Monclar, en entrant, interrompit les exclamations.
– Eh bien, Monclar, s’écria le roi, êtes-vous satisfait ? Avez-vous réduit en cendres la Cour des Miracles ?
– Sire, dit Monclar, je voudrais avoir l’honneur de m’entretenir un moment avec Sa Majesté…
François Ier jeta un regard autour de lui.
Les femmes, à grands froufrous de soies froissées, se levèrent, saluèrent cérémonieusement et se retirèrent.
– Parlez ! fit le roi lorsqu’il se vit seul avec Monclar.
– Sire, dit le grand prévôt, nous sommes battus.
– Vous plaisantez, monsieur ! s’écria François Ier.
– Je ne plaisante jamais, sire !
– En effet, je ne vous ai jamais vu rire. Mais aussi, ce que vous me dites est si extraordinaire.
– Sire, nous avons été trahis.
Le grand prévôt fit alors un récit complet de l’attaque, des dispositions qu’il avait prises et de ce qui s’en était suivi.
– Sire, dit Monclar en terminant, ce n’est que partie remise, j’espère ; car enfin il faut bien que force demeure à l’autorité du roi…
– Non, monsieur, répondit François Ier, c’est partie terminée. Pour obéir aux conseils d’un moine fanatique, vous m’avez jeté dans une aventure qui me couvre de ridicule. Battu par des truands ! Jour de Dieu ! c’est vraiment la peine d’avoir des régiments à notre disposition ! Vous voulez recommencer ? Et moi je ne veux pas ! C’est assez d’une leçon ! Que diable avions-nous besoin de forcer ce repaire ? Les rois, mes ancêtres, ont tous respecté les privilèges des mendiants. Pourquoi irais-je faire cette nouveauté ?
Parmi toutes les bonnes raisons que donnait le roi, il omettait la meilleure : c’est qu’il voulait quitter Paris pour aller à Fontainebleau.
– Sire, dit froidement Monclar, vous êtes le maître. Mais je demanderai simplement à Votre Majesté de quel moine elle a voulu parler tout à l’heure ?
– De M. de Loyola, dit sèchement François Ier. Nierez-vous que vous avez surtout voulu lui faire plaisir en attaquant la Cour des Miracles ?
– J’ai surtout voulu défendre l’autorité royale, sire !
– C’est possible, mon bon Monclar. Mettons que vous ayez eu raison. Mais vous n’avez pas réussi, n’en parlons plus.
Le grand prévôt se demandait d’où venait cette bienveillance extraordinaire du roi.
Il s’était attendu à un grand éclat de fureur. Et le grand éclat se résumait en une petite semonce politique.
– Que peut-il bien méditer ? se demanda-t-il.
– Monclar, reprit le roi après un silence, vous occupez-vous de retrouver la duchesse de Fontainebleau ?
– Oui, sire. Je crois être sur une bonne piste.
– Vraiment !…
– Tout au moins sur la piste des personnes qui ont fait sortir du Louvre la jeune duchesse de Fontainebleau.
– Eh bien, quand vous aurez trouvé, vous me le direz, fit tranquillement le roi. Quant à la duchesse, ne vous en inquiétez plus, elle est retrouvée. À propos, Monclar, je pars demain pour Fontainebleau. N’oubliez pas de m’envoyer tous les matins un courrier pour me tenir au courant de ce qui se passe dans Paris. Allez, mon cher Monclar… allez…
Le grand prévôt s’inclina et se retira en songeant : Les truands vainqueurs, la petite duchesse retrouvée sans mon aide, double défaite pour moi ! Le roi ne m’emmène pas à Fontainebleau. Je suis en disgrâce… Allons voir M. de Loyola !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le lendemain matin, Alais Le Mahu se leva tout joyeux et fit une toilette soignée, s’apprêtant à se rendre chez M. de Monclar pour avoir son bon de mille écus, et de là passer chez M. le trésorier du roi.
Les pensées de Le Mahu étaient couleur de rose.
Ayant achevé de s’apprêter, l’officier allait sortir et ouvrait sa porte lorsqu’il se trouva nez à nez avec une femme encapuchonnée qu’il crut reconnaître.
– Vous sortiez ? fit la femme.
– La duchesse d’Étampes ! s’écria intérieurement Le Mahu.
Et à haute voix, il ajouta :
– Excusez-moi, madame ; je sortais, en effet, et comme c’est pour le service du roi, il m’est impossible de retarder…
– Allons donc ! même pour moi ? s’écria la duchesse qui laissa tomber son capuchon.
En même temps, elle entra dans le logis, poussant devant elle Alais Le Mahu, et refermant la porte.
– Ah ! madame, s’écria l’officier, si j’avais su que, ce fût vous !… Vous savez bien que votre service passe avant celui du roi lui-même !… Mais daignez vous asseoir…
Rapidement, Le Mahu s’était assuré que sa dague était bien à sa ceinture.
– Or ça, dit la duchesse, expliquez-moi comment la jeune fille que nous avons conduite chez la folle est revenue cette nuit au Louvre.
– Madame, vous m’en voyez moi-même tout surpris.
– Vraiment, mon bon Le Mahu ?
– C’est comme j’ai l’honneur de vous l’affirmer.
– Vous mentez avec une rare impudence, mon cher.
– Je vous jure, madame…
– Tenez, je vais être plus franche que vous, moi. Sachez donc, mon brave, que cette nuit même, j’ai reçu la visite de M. le grand prévôt qui m’est venu voir en sortant de chez Sa Majesté.
Le Mahu pâlit et commença à se rapprocher doucement de la porte.
– Ne vous sauvez pas, dit la duchesse. Auriez-vous peur de moi, par hasard ?
– Oui, madame, répondit simplement Le Mahu.
La réponse était si imprévue que la duchesse, pour la première fois, regarda le brave d’un certain air d’intérêt.
– Et qui vous fait peur en moi ? fit-elle en souriant.
– En vous, madame, rien ! Mais j’ai appris certaine histoire de fruits que la pauvre Mme de Saint-Albans aurait mangés ; après quoi, elle aurait été prise de coliques !
– Vous perdez la tête, M. Le Mahu, fit la duchesse avec une sévérité qui rassura plutôt Le Mahu. Laissons de côté vos histoires de peur et de fruits. Si je vous voulais du mal, je vous aurais fait saisir cette nuit et jeter dans une oubliette…
– C’est juste ! pensa Le Mahu tout à fait rassuré.
– Donc, reprit la duchesse, M. de Monclar m’est venu voir et m’a appris une chose qui m’a fort donné à penser : c’est qu’il avait ordre du roi de faire établir pour vous un bon de mille écus sur le trésor… Ne perdons pas de temps en discours inutiles. Vous m’avez trahi, c’est bien : je ne vous en veux pas. Et je viens vous dire : Voulez-vous à son tour trahir le roi que vous avez servi cette nuit ? Voulez-vous à ses mille écus ajouter mille autres écus que vous gagnerez de mon côté ? Cela vous fera deux mille écus : une fortune.
Le Mahu avait écouté fort attentivement.
Il fut convaincu que la duchesse parlait de bonne foi.
– Que faut-il faire ? demanda-t-il froidement.
– D’abord me raconter comment les choses se sont passées cette nuit.
N’ayant plus aucune raison de mentir, Le Mahu fit des événements de la nuit un récit très sincère.
– J’aurais dû, ajouta-t-il en terminant, vous prévenir lorsque j’ai vu la duchesse de Fontainebleau… mais je suis si pauvre, madame…
– Oui, vous avez été du côté du maître le plus riche… Je vous répète que je ne vous en veux pas. Vous n’êtes qu’un instrument, et c’était à moi de m’assurer de votre fidélité en la payant convenablement.
– Parbleu ! madame, s’écria Le Mahu en s’épanouissant, vous parlez d’or !
– Donc, vous êtes résolu à faire ce que je veux… moyennant un honnête salaire, bien entendu ?
– Les mille livres en question…
– C’est cela même.
– J’attends vos ordres, madame. De quoi s’agit-il ?
– De nous emparer à nouveau de la petite duchesse.
– C’est difficile, madame.
– Bah ! j’ai un plan. Je ne vous demande pas de penser ; je ne vous demande que d’exécuter.
– Oui, comme un bon instrument ; cela me va tout à fait.
– Très bien. En ce cas, soyez à midi chez moi. Le roi quitte le Louvre à deux heures. Toute la cour se rend à Fontainebleau. Je suis du voyage.
– Mais moi, je suis attaché à mon poste, au Louvre.
– Ne vous inquiétez pas de cela : au moment voulu, vous recevrez l’ordre de venir à Fontainebleau ; j’ai déjà pris mes dispositions pour cela.
– Je serai chez vous à midi, madame, dit-il.
– Oui, ce ne sera pas de trop de deux heures pour causer, répondit la duchesse en se levant.
Elle fouilla dans son aumônière, en sortit une bourse à mailles de soie fine et la tendit à Le Mahu, en disant d’une voix très naturelle :
– Tenez, voici des arrhes…
Le Mahu, courbé en deux, saisit la bourse et la serra dans sa main. Au même instant, il poussa un léger cri. Il y avait sans doute une épingle dans la bourse… Et cette épingle l’avait piqué.
– À midi, n’oubliez pas ! fit la duchesse en se dirigeant, vers la porte, comme si elle n’eût pas entendu le cri de Le Mahu.
– À midi, madame… Comptez sur moi, dit-il.
La duchesse sortit.
Le Mahu demeura quelques instants pour lui laisser le temps de s’éloigner.
– Bonne affaire ! pensait-il. Cette bonne duchesse est moins terrible que je ne croyais. Il est vrai qu’elle a besoin de moi… Serais-je enfin sur le chemin de la fortune ?… À propos, voyons ce que contient la bourse…
Il reprit la bourse qu’il avait déposée sur la cheminée, et un autre cri lui échappa.
– Maudite épingle ! gronda-t-il avec un juron. Au diable soient les femmes qui oublient partout des épingles !…
Il ouvrit la bourse. Ce n’était pas de l’or qu’elle contenait.
C’était une pelote, une petite pelote hérissée de sept à huit pointes d’acier.
Le Mahu devint livide et une rauque exclamation d’épouvante lui échappa.
– Oh ! la scélérate ! Elle m’a empoisonné !… Mais malheur à elle ! Avant de mourir, je veux me venger !…
Il voulut s’élancer vers la porte.
Mais il s’arrêta soudain, le front mouillé d’une sueur glaciale, les dents serrées comme un étau ; tout se mit à tournoyer autour de lui ; un voile noir passa sur ses yeux. Il tomba sur ses genoux.
Un instant, il laboura le parquet de ses ongles… puis, tout à coup, il demeura à jamais immobile.
À peu près à l’heure où expirait l’infortuné Le Mahu, – mort au moment même où, pour la première fois de sa vie, il allait enfin toucher la belle somme de mille livres, – à peu près à cette heure-là, le comte de Monclar entrait dans la chambre où le révérend Ignace de Loyola gisait sur un lit.
Loyola ; en voyant entrer Monclar, eut un éclair de joie dans ses yeux abattus. Le moine était hors de danger. Il savait qu’il ne mourrait pas. Mais sa haine contre Lanthenay n’en était pas atténuée.
– Révérend père, dit Monclar en s’asseyant au chevet de Loyola, je suis tout à fait décidé… Vos conseils, vos sages avis m’inspirent. Je veux entrer dans le saint ordre que vous avez fondé pour la gloire de Jésus et la prospérité de l’Église…
– Bien, mon fils ! dit Loyola dans un souffle.
– Je vais donc quitter le monde, abandonner cette cour où tout est mensonge et perfidie… Peut-être enfin trouverai-je la paix au fond d’un monastère !… Je veux m’y retirer au plus tôt.
– Non ! fit Loyola.
– Comment, révérend père ?
– Je dis que vous ne devez pas entrer dans un couvent…
– C’est vous-même qui m’avez suggéré cette pensée !
– Non ! La pensée d’entrer dans notre ordre, mais pas de vous retirer au couvent. Il faut rester à la cour.
Loyola souffla un instant.
– Mon fils, reprit le moine, il y a deux manières de servir Dieu et l’Église. La première, c’est la plus facile. C’est celle que choisissent les cœurs pusillanimes qui se réfugient en Dieu au lieu de courir le monde pour combattre en son nom. Ceux-là entrent au monastère. Ils y vivent en paix ; ce sont des saints quelquefois, mais ce sont surtout des lâches…
Loyola parlait sans exaltation.
Et pourtant, il y avait une singulière énergie dans le ton de sa voix, bien qu’elle fût affaiblie par la souffrance.
– La deuxième manière, continua-t-il, convient aux âmes fortes, aux esprits bien trempés, aux cœurs qui ne tremblent pas. Un moine, mon fils, c’est un soldat. Soldat de Jésus ! Quel beau titre de gloire ! Cette manière, monsieur le comte, consiste à demeurer dans la vie laïque, à agir aux yeux du monde comme si on n’avait prononcé aucun vœu, et pourtant à faire converger tous ses actes, toutes ses pensées, toute sa force, toute son intelligence vers un but unique : la gloire de Jésus et la prospérité de l’Église…
– Mais, mon père, fit Monclar, cette manière-là, c’est celle de tous les bons chrétiens qui ont la foi vigoureuse.
– Vous me comprenez mal. Celui dont je parle, l’homme fort intelligent et supérieur qui demeure laïc et se dévoue à l’Église…
Loyola s’interrompit soudain, puis reprit :
– Entendez-vous, mon fils, ce que signifie ce terme : l’Église !
– L’Église, mon père… mais c’est l’ensemble des fidèles, c’est le troupeau que conduisent nos prêtres ; au-dessus des prêtres, il y a les évêques, puis les cardinaux, puis, tout près de Dieu, celui dont les pieds reposent sur la terre et dont la mitre touche au ciel : le Saint-Père !
– Vous avez raison jusqu’à un certain point. C’est là l’Église pour le vulgaire, pour le troupeau ainsi que vous dites. Mais vous, mon fils, vous n’êtes point du vulgaire. L’Église, c’est ce que vous venez de peindre, mais il y a quelque chose au-dessus des prêtres, au-dessus des évêques, des cardinaux et du pape lui-même.
– Quoi donc, révérend père ? demanda Monclar.
– Il y a nous ! répondit Loyola.
– Nous ?…
– Nous… c’est-à-dire les chevaliers de la Vierge, c’est-à-dire l’ordre de Jésus, la société sacrée, la compagnie toute-puissante devant laquelle rois, empereurs et pape même ont déjà courbé le front. Quant je dis l’Église, je veux dire : l’Ordre de Jésus.
Monclar s’était incliné.
– Je suis comme ébloui, mon père, fit-il d’une voix tremblante. Ah ! maintenant seulement, je comprends la sublime mission de force et de lutte que vous avez acceptée !
Loyola sourit.
Cet esprit austère du grand prévôt, si dur aux pauvres gens, si revêche, si inaccessible à la pitié, il le pétrissait à son gré.
– Je recevrai vos vœux, mon fils ; dès que je serai en état, je vous entendrai en confession, je vous révélerai ensuite la règle de notre ordre, et désormais vous en ferez partie. Mais, comme je vous le disais, ces vœux demeureront secrets ; pour tous, pour le roi lui-même, pour le monde entier excepté pour moi vous ne serez encore que le grand prévôt de François Ier. Mais pour moi, vous serez un membre de la société de Jésus, et pour Dieu, mon fils, vous serez un élu !
– Et que me faudra-t-il faire pour servir dignement l’Église, c’est-à-dire la puissante société dont je ferai partie ?
– J’ai jeté les yeux sur vous, mon fils ; j’ai vu votre foi véritable, votre haute intelligence, et vous ai réservé l’une des tâches les plus délicates, les plus dangereuses, les plus glorieuses aussi… Vous serez l’un de nos soldats d’élite, en mission chez l’ennemi…
– L’ennemi ! exclama sourdement Monclar.
Imperturbable, Loyola poursuivit :
– Je vous charge de surveiller le roi de France.
Sûr de son pouvoir, le moine reprit :
– C’est surtout la pensée du roi que je veux connaître.
– En quelle sorte d’affaire, mon père ?
– En toutes affaires, mon fils. Mais au fur et à mesure que les événements se produiront, je vous ferai connaître sur quel point spécial vous devez porter vos investigations. En attendant, notez tout ce que fait, tout ce que dit le roi ; ses actions les plus simples, ses paroles en apparence les plus indifférentes peuvent avoir pour moi une importance capitale… pour moi, je veux dire pour le bien de l’Église et la gloire de Jésus… Et tenez, voulez-vous que je vous donne un bon conseil ?
– Faites, mon père.
– Eh bien, tous les soirs, en rentrant chez vous, dans le secret de votre cabinet, écrivez tout ce que vous avez vu et entendu dans la journée. Car je n’ai pas besoin de vous dire que ce qui s’applique au roi s’applique aussi à divers seigneurs de moindre importance. En un mot, faites-vous l’historiographe de la cour de France. En vous livrant tous les soirs à ce petit travail, vous serez sûr de n’omettre aucun détail…
Monclar gardait le silence.
– Prenez le temps de réfléchir, mon fils, dit vivement Loyola. Quand vous sentirez que vous êtes à Dieu, dans huit jours, dans un mois, si vous voulez, prévenez-moi.
– Mon père, dit Monclar, quand voulez-vous que je commence ?
– Tout de suite, mon fils, dit gravement Loyola. Je vous entendrai en confession générale quand vous voudrez…
– À l’instant ! s’écria fiévreusement le grand prévôt.
– Soit ! fît Loyola.
Monclar s’agenouilla.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quand ce fut fini, et que Monclar se fût relevé, une expression plus sombre parut s’être étendue sur son visage.
– Vous prononcerez vos vœux dès que je pourrai me rendre en quelque église, dit Loyola. Mais dès ce moment, vous êtes à nous, mon fils. Je viens de répandre sur votre tête les paroles augustes et redoutables qui vous consacrent au Seigneur Si vous me trahissez, désormais, vous aurez trahi Dieu lui-même !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il y eut quelques minutes d’un silence solennel.
On eût dit que Loyola voulait laisser à Monclar le temps de bien se pénétrer des paroles menaçantes qu’il venait de prononcer.
Quant à Monclar, cette acceptation définitive d’un rôle odieux le laissait paisible. Il se disait seulement qu’il était dès lors plus fort que le roi de France lui-même.
Loyola reprit enfin :
– Maintenant, mon fils, dites-moi si vous avez réussi l’opération que vous avez entreprise contre les truands.
– Non, mon père.
– Ainsi, ce bandit, ce Lanthenay, nous échappe ?
– Pour le moment, oui.
– Pourtant, il me faut cet homme ! gronda-t-il.
– Patience, mon père, dit Monclar, je vous le promets.
– Bien, mon fils… J’ai foi en votre parole.
– Je vous jure que vous serez terriblement vengé.
Loyola fit signe qu’il attendrait avec confiance.
– Et Dolet ? reprit-il.
– L’official a commencé à instruire son procès.
– Il faut que cela soit activé. Je veux, avant de quitter la France, voir s’élever les flammes de son bûcher…
– Vous les verrez, mon père !… Vous n’avez pas d’autres ordres à me donner en ce moment ?…
– Non, mon fils… Allez, j’ai besoin de repos… Allez, et que Dieu vous inspire !…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tandis que le grand prévôt courbait la tête sous la redoutable bénédiction d’Ignace de Loyola et devenait associé laïque de la compagnie de Jésus, tout se préparait à la cour pour le départ à Fontainebleau.
Le matin, de bonne heure, le roi avait fait demander maître Rabelais.
On courut chercher l’illustre docteur dans l’appartement que lui avait fait assigner François Ier.
On ne le trouva.
Il fut bientôt évident que maître Rabelais s’était enfui.
Le roi envoya des cavaliers qui parcoururent les environs de Paris : les recherches furent vaines.
On sait comment et pourquoi Rabelais était parti.
On sait aussi pourquoi on ne trouva dans sa chambre ni la lettre qu’il avait écrite au roi ni le médicament qu’il avait préparé.
L’inquiétude de François Ier devint de l’anxiété. Il n’avait qu’une confiance limitée en ses médecins ordinaires, et la fuite de Rabelais lui était d’un triste augure.
Ce fut donc d’un air très sombre qu’il s’apprêta à quitter le Louvre.
Une autre chose qui surprit assez le roi, ce fut d’apprendre qu’Alais Le Mahu ne s’était pas présenté pour toucher son bon de mille écus.
Mais cette surprise n’alla pas jusqu’à l’inquiéter sur le sort de celui qui lui avait fait retrouver Gillette.
Nul ne s’occupa donc de ce qu’était devenu Alais Le Mahu. Et ce ne fut que quelques jours plus tard que sa logeuse découvrit son cadavre.
M. Gilles Le Mahu, en apprenant la mort de son frère, s’écria :
– Un beau chenapan de moins sur la terre ; il nous économise une corde !
Vers deux heures, le roi donna le signal du départ.
Il y avait dans la grande cour du Louvre une trentaine de carrosses, dans lesquels prirent place les femmes, princesses et dames d’honneur.
Quant aux fourgons qui emportaient les domestiques et les bagages, il y en avait plus de cent.
Les seigneurs de la cour devaient faire le voyage à cheval. Un régiment de cavaliers devait servir d’escorte.
Toute cette brillante cavalcade traversa Paris, fort admirée et fort acclamée par le peuple, rangé en files compactes, qui s’exténuait à crier :
– Vive le roi !
François Ier, à cheval, entouré de ses seigneurs, ne faisait nulle attention à cet enthousiasme.
Pourtant, lorsque, dans la foule, le roi apercevait quelque jolie fille qui s’extasiait, il daignait sourire.
Enfin, la cavalcade sortit de Paris et, au grand trot, prit le chemin de Fontainebleau, résidence royale.
VII
LE TESTAMENT D’ÉTIENNE DOLET
Le jour du jugement d’Étienne Dolet approchait. Il avait reçu à diverses reprises la visite de l’official qui l’avait longuement interrogé.
L’accusation portait sur deux points très précis.
Étienne Dolet, en premier lieu, était accusé d’avoir écrit qu’après la mort l’homme n’est plus rien.
Ensuite, il était accusé d’avoir imprimé des livres plus ou moins démoniaques, et surtout – horreur des abominations – d’avoir imprimé une bible en langue vulgaire.
En effet, la Bible imprimée en latin était un livre sacré. Mais le même livre, traduit en français, devenait un livre de perdition.
Sur le premier point, Dolet répondait :
– Je n’ai pas écrit que l’homme après la mort n’est plus rien ; j’ai traduit Platon qui dit cela. Plusieurs pères de l’Église ont traduit Platon ; j’ai fait comme eux ; mais je n’ai pas cru que j’avais le droit de le mutiler…
Sur le deuxième point, Dolet niait simplement.
Il avait obtenu du roi un privilège d’imprimeur.
Il savait à quoi l’obligeait ce privilège.
Et la vérité, c’est que Dolet eût plutôt renoncé à son privilège que de faire de la fraude.
Les livres trouvés chez lui y avaient été déposés par frères Thibaut et Lubin.
Nous ne fatiguerons pas nos lecteurs avec le récit des interrogatoires multiples qu’eut à subir cet infortuné. Disons simplement que l’official fut plus d’une fois embarrassé devant les réponses claires, simples et précises de l’accusé.
Enfin, Dolet apprit qu’il allait passer en jugement comme relaps, apostat, hérétique, et convaincu de connivence avec plusieurs démons.
Le jour où Gilles Le Mahu vint lui lire l’arrêt qui le traduisait devant le tribunal sous ces terribles inculpations, Dolet se dit :
– Je suis perdu !…
Depuis sa tentative d’évasion, il n’avait pas été changé de cachot. Maître Le Mahu, tout entouré de gardes qu’il fût, craignait que le prisonnier n’essayât encore quelque entreprise désespérée pendant le transfert.
Il l’avait donc laissé où il était.
Seulement, il avait quadruplé le nombre des gardiens qui se tenaient en permanence devant la porte du cachot.
En outre, trois soldats armés demeuraient nuit et jour dans le cachot, surveillant tous les mouvements de l’accusé, et toujours prêts à se jeter sur lui.
Il eut une botte de paille pour dormir. Il eut de l’eau à discrétion pour boire à sa soif. Quant à la nourriture, maître Le Mahu se montra généreux ; le prisonnier eut un pain tous les jours, et, de deux jours l’un, une soupe aux légumes.
La vérité nous oblige à ajouter que le pain était noir et que la soupe aux légumes se composait de beaucoup d’eau chaude avec très peu de légumes ; enfin qu’avec cette nourriture il y avait tout juste de quoi ne pas mourir de faim.
En revanche, sur l’ordre exprès de Loyola, le prisonnier avait permission d’écrire.
On espérait ainsi qu’il échapperait à sa plume quelque aveu, quelque phrase qui, convenablement présentée et commentée, pourrait au besoin passer pour avoir été directement inspirée par le démon.
Ce n’est pas, d’ailleurs, qu’on eût le moindre doute sur l’issue du procès : Dolet était condamné d’avance.
Mais enfin, il vaut mieux faire un procès convenable.
Nous pénétrerons dans le cachot de Dolet, en même temps que M. Gilles Le Mahu, gouverneur de la Conciergerie.
Il venait s’enquérir des réclamations que l’accusé pourrait avoir à formuler.
– Aucune ! répondit Dolet.
– Au fait, répondit Le Mahu avec un large sourire qui balafra sa figure rubiconde, vous avez du pain, de l’eau, de la paille, une nourriture saine, substantielle, abondante, un lit convenable, que faut-il de plus ? Mais je ne suis pas fâché de vous entendre dire à vous-même que vous n’avez rien à réclamer.
– Rien ! répéta Dolet.
– Je vous ferai remarquer, en outre, ajouta Le Mahu, que j’ai fait mettre dans votre cachot une table, un écritoire, du parchemin, et que vous pouvez écrire si bon vous semble…
– Je vous remercie. Quel jour passerai-je en jugement ?
– Mardi, jour désigné par l’official.
– Merci, dit encore Dolet.
On était au samedi.
– Puis-je, demanda le prisonnier, faire prévenir les miens que je serai jugé ce jour-là ?
– Écrivez toujours, fit avec empressement Le Mahu.
Dolet fit signe qu’il réfléchirait à la chose.
Comme tous les prisonniers qui n’ont aucune relation avec le dehors et sont murés vivants dans des tombeaux où les bruits de la vie n’arrivent jamais, il se croyait oublié de l’univers, hormis sa famille.
En réalité, il n’était bruit dans Paris que de son prochain jugement.
On savait que c’était là un grand savant.
Donc, Dolet ignorait tout ce bruit qui se faisait autour de son nom, et se tourmentait du moyen de prévenir les siens.
Il eût été facile à Gilles Le Mahu de le rassurer, au moins sur ce point.
Mais Gilles Le Mahu, en excellent geôlier, eût cru trahir ses devoirs en apportant à son prisonnier une consolation, si faible et si triste que fût cette consolation.
Et puis, il était venu surtout pour se mettre en appétit, parce que l’heure de son dîner approchait.
Nous avons dit quel jovial caractère c’était que le concierge de la Conciergerie. Il aimait à rire de bon cœur, et trouvait qu’on dînait mieux quand on avait bien ri.
Il avait raison.
Or, rien ne faisait rire Gilles Le Mahu autant que la figure soudain blafarde et bouleversée d’un malheureux à qui il annonçait quelque horrible nouvelle.
Aussi, fut-ce en pouffant d’avance et en faisant de grands efforts pour ne pas éclater de rire qu’il dit à son prisonnier :
– D’ailleurs, maître, si vous avez quelque chose à écrire, il faut vous hâter, car je doute que dans huit ou dix jours, vous puissiez tenir encore une plume…
– Pourquoi ? demanda Dolet avec indifférence.
– Pourquoi ? Est-ce qu’on écrit dans l’autre monde ?
Et, décidément, cette idée que les morts pourraient tenir une plume lui parut tellement drôle qu’il n’y put tenir.
Dolet, gravement, le regarda rire.
– Excusez-moi, fit Le Mahu en s’essuyant les yeux, c’est plus fort que moi.
– Ainsi, dit Dolet tranquillement, vous croyez que je serai condamné à mort ?
Le Mahu ouvrit de grands yeux, et peu s’en fallut qu’il n’éclatât encore.
– D’où sortez-vous ? fit-il. Mais vous serez si bien condamné que j’ai vu de mes propres yeux l’ordre au bourreau-juré d’avoir à se procurer un bon poteau, avec deux bonnes cordes de bois sec, des torches, enfin tout ce qu’il faut ! Oh ! ne craignez rien, vous serez traité comme un personnage de marque !
– Je serai donc brûlé ! s’écria Dolet qui ne put s’empêcher de frissonner.
– Brûlé ! brûlé ! fit Le Mahu qui vit qu’il en avait trop dit, c’est une façon de parler. Que diable, il ne faut pas désespérer encore. Et puis, en somme, ces fagots qu’on a commandés sont peut-être pour quelque condamné du Châtelet. Allons, bonne nuit !
Demeuré seul en son cachot – seul, car la présence des soldats armés ne comptait plus pour lui – Dolet, pensif, se mit à se promener de long en large. Il y avait des jours et des nuits qu’il se promenait ainsi, tantôt songeant à ce Loyola dont il était la victime innocente, tantôt pensant à ce roi si lâche qui le livrait, parfois arrêtant son esprit sur des problèmes de philosophie, mais toujours écartant de son mieux les images de sa femme et de sa fille. Car dès qu’il pensait à elles, il se sentait faiblir.
La mort ne l’effrayait pas.
Et quant à l’horrible souffrance du bûcher, il ne se disait peut-être pas avec la feinte sagesse du stoïcisme antique : « Douleur, tu n’es qu’un mot », mais il envisageait avec fermeté l’effroyable conjoncture.
Il vint s’asseoir à la petite table, sur un escabeau, et posa sa tête dans sa main.
– Je serai brûlé ! murmura-t-il.
Un frémissement le secoua.
– Eh quoi ! pensa-t-il, en admettant même que j’aie mérité la mort ne pourrait-on me faire mourir sans souffrance ? Pourquoi ceux qui se réclament d’un Dieu de bonté sont-ils féroces à ce point ? Quoi ! prendre un homme vivant et lui faire subir ce supplice de le placer sur un amas de bois et de mettre le feu aux fagots !
Sa main retomba sur la table et, machinalement, il saisit la plume.
Et ce fut sous l’impression des pensées qu’il venait d’agiter qu’il se mit à écrire :
« Ceci est ma dernière pensée.
« C’est le dernier effort d’un esprit qui va bientôt s’éteindre.
« Peut-être ces lignes tomberont-elles plus tard sous les yeux d’hommes justes.
« Peut-être ce papier va-t-il être détruit.
« Je ne veux songer qu’à la possibilité d’être lu plus tard.
« C’est donc du seuil de la tombe que je parle aux hommes, et j’ai pour tribune un bûcher.
« Je vais être brûlé ! Brûlé vif !
« Ce que ma chair va souffrir, je ne le sais.
« Je ne sais pas non plus quelles clameurs d’agonie s’échapperont de ma gorge alors que, délirant au milieu des tourbillons de flamme, je ne serai plus responsable de ma pensée.
« La vraie clameur du condamné est ici, sur ce parchemin.
« Voici donc ce que je souhaite :
« Je suis innocent de toute action mauvaise.
« Aussi loin que je regarde dans ma vie, avec le scrupule et l’angoisse d’un juge impartial, je n’y découvre aucun crime, aucune faute véritable.
« J’ai aimé les hommes, mes frères.
« J’ai tâché de leur montrer qu’il y a un flambeau pour les guider vers le bonheur à travers les ténèbres de la vie que nous vivons. Ce flambeau s’appelle : Science.
« J’ai fait en sorte de répandre le plus que j’ai pu de science, c’est-à-dire de lumière, afin de chasser le plus possible de ténèbres, c’est-à-dire d’ignorance.
« Je ne me suis pas détourné des moins fortunés que moi. Je n’ai pas montré un visage impitoyable aux fautes des autres.
« J’ai songé que le mot suprême de la sagesse humaine et l’aboutissement fatal de la science, de la pensée, de la vie, c’est l’indulgence.
« Une humanité où les hommes auraient pitié les uns des autres, où se développerait cette radieuse et magnifique pensée de fraternité que le Christ a entrevue, une humanité pareille aurait résolu le problème du paradis terrestre.
« Cependant, c’est la haine qui triomphe.
« Je ne veux ici accuser personne.
« Je dis seulement que l’esprit de domination engendre l’esprit de haine.
« Je dis que les dominateurs qui ont inventé le bûcher pour les hommes inaptes à la servitude sont l’obstacle qu’il faut écarter.
« Puisse-t-on me comprendre !
« Puisse l’humanité apprendre à pénétrer dans sa propre pensée !
« Puissent les hommes arriver un jour à penser librement, c’est-à-dire sans que leur croyance, leur foi, leur pensée leur ait été imposée.
« Puisse la science remettre au creuset de l’analyse les croyances humaines qui nous sont transmises par les siècles barbares !
« En formulant ces souhaits, je ne crois pas passer les limites du droit humain.
« Je ne me crois pas en faute.
« Pourtant, c’est pour penser ce que j’écris, c’est pour avoir aimé la science, la lumière, pour avoir été le frère de mes frères que je vais être brûlé.
« Je voudrais qu’un jour un monument s’élevât à l’endroit même où je vais souffrir, et que sur ce monument, les jours de fête, les hommes enfin délivrés apportent quelque modeste offrande de fleurs, et qu’enfin le souvenir des iniquités présentes fût perpétué par cette simple parole que quelqu’un redirait aux foules, d’année en année :
« Ici, on a brûlé un homme parce qu’il aimait ses frères et prêchait l’indulgence et proclamait le bienfait de la science.
« Cela se passait du temps où il y avait des rois comme François, et des saints comme Ignace de Loyola. »
« Voilà ce que je souhaite.
« En foi de quoi, libre d’esprit et sain de corps, j’ai signé. »
Dolet signa.
À quoi pensa-t-il en ces heures de détresse ?
Sans doute, malgré tous ses efforts, l’image de sa femme et de sa fille – bientôt veuve et orpheline – vint se présenter vivement à lui.
Car, à un moment, les soldats le virent vaguement tendre les bras comme vers une étreinte, et une larme obscurcit sa vue.
Dolet, alors, se leva brusquement. D’un pas agité, il se remit à marcher. Puis il se calma.
Il s’approcha de la table et chercha des yeux le parchemin sur lequel il venait d’écrire les lignes qu’on a lues.
Il ne vit plus le parchemin !…
Pendant qu’il se perdait en ses rêves, un des soldats avait doucement saisi le papier et l’avait remis aux gardiens qui stationnaient dans le couloir.
Maintenant, le parchemin était entre les mains de Gilles Le Mahu !…
VIII
FONTAINEBLEAU
Le matin du jour où François Ier quitta Paris avec sa cour, Manfred annonça à Lanthenay qu’il allait se rendre à Fontainebleau, et le mit au courant de tout ce qui lui était arrivé dans la nuit.
– Mais, ajouta-t-il, toi-même, tu vas essayer de sauver Dolet. Il faut que je sois à Paris ce jour-là. Je te laisse tout préparer à ta guise, me réservant pour l’action.
– Comment te préviendrai-je, frère ? dit Lanthenay.
– Écoute… de Paris à Fontainebleau, il n’y a en somme, pour un bon cavalier, qu’une étape, un peu rude, j’en conviens ; mais nous n’avons pas le choix des moyens… Si rien de pressé ne se produit, tu te contenteras de me faire prévenir à l’avance du jour où tu auras résolu d’agir. Si, au contraire, tu prévois la nécessité d’agir à l’improviste, tu m’envoies Cocardère à franc étrier, et nous revenons ensemble.
Lanthenay fit signe de la tête qu’il y comptait.
Les deux amis s’embrassèrent.
Puis Manfred s’en alla rejoindre le chevalier de Ragastens et Triboulet.
– Le roi part à deux heures, dit Ragastens. Je viens de l’apprendre.
Manfred pâlit. Il avait espéré que le roi demeurerait à Paris quelques jours encore.
– Ceci, reprit le chevalier, modifie quelque peu notre plan. Au lieu de partir ce matin, nous partirons dans l’après-midi.
– Pourquoi cela ? fit Manfred.
– Parce que notre arrivée dans Fontainebleau avant la cour ne manquerait pas d’éveiller des curiosités autour de nous, et que nous avons en somme besoin de passer inaperçus.
– Mais si nous arrivons après la cour, ne serons-nous pas menacés des curiosités que vous voulez éviter ?
– Certes… mais si nous arrivons en même temps ?
– Quoi !… Vous voulez voyager avec le roi !
– M. le chevalier a raison ! s’écria Triboulet.
– C’est le plus sûr moyen de n’être remarqué ni pendant notre voyage, ni à notre arrivée à Fontainebleau.
L’heure du départ fut donc calculée sur le départ de la cour.
Spadacape devait être du voyage.
La princesse Béatrix devait rester à Paris et réintégrer l’hôtel que Ragastens avait loué rue des Canettes.
Il n’y avait plus aucun motif, en effet, pour que l’hôtel fût surveillé. Et là, Béatrix trouverait maison montée, ses serviteurs et ses femmes.
Ces diverses dispositions s’exécutèrent et, à trois heures précises, Ragastens donnait le signal du départ, c’est-à-dire une heure après le départ de François Ier et de la cour.
Les quatre cavaliers sortirent de Paris et s’engagèrent sur la route de Melun.
Vers cinq heures, comme le jour baissait, Manfred qui trottait en tête aperçut l’arrière-garde de l’escorte royale.
Dès lors, ils se maintinrent à la même distance.
En se retournant à diverses reprises, il avait semblé à Ragastens qu’il apercevait derrière lui, sur la route, un cavalier qui trottait.
– Serions-nous espionnés ? songea-t-il.
Il s’arrêta et fit descendre son cheval dans le fossé du bas côté. Là il attendit.
Mais peut-être le cavalier inconnu avait-il remarqué cette manœuvre, ou peut-être avait-il brusquement changé de route. Car Ragastens attendit vainement.
Assez inquiet, il rejoignit ses amis au galop.
Mais comme à ce moment il se retourna encore, il vit le même cavalier qui suivait toujours.
– Nous verrons bien, pensa-t-il.
À six heures, on arriva à Lieusaint, village situé à mi-chemin entre Paris et Fontainebleau.
La cour devait y coucher, et des fourriers partis en avant-garde avaient préparé des logements pour tout ce monde.
Ragastens et ses amis trouvèrent l’hospitalité chez un fermier des environs qui, moyennant deux écus, consentit à les laisser coucher dans sa grange.
Le lendemain, de bonne heure, l’escorte se remit en route. Nos quatre amis reprirent leur poste en arrière de la colonne.
Au moment où on entrait dans les premiers bois qui annonçaient la forêt, Ragastens aperçut de nouveau le cavalier inconnu qui, mille pas en arrière, chevauchait paisiblement.
– Avez-vous remarqué l’homme qui nous suit ? demanda-t-il à ses compagnons.
Manfred et Triboulet se retournèrent et aperçurent à leur tour le cavalier.
– Un espion ! fit Triboulet.
– Je vais le charger, dit Manfred.
– Non… continuez la route. Je me charge de savoir à qui nous avons affaire, dit Ragastens.
Manfred, Spadacape et Triboulet, poursuivirent donc leur chemin, et Ragastens, sortant de la route, s’enfonça dans un taillis où il s’arrêta.
Cette fois, sa manœuvre lui réussit à souhait : au bout de dix minutes, il vit passer l’inconnu, monté sur un solide cheval et soigneusement enveloppé dans un ample manteau.
Ragastens attendit qu’il eût pris les devants.
Alors il quitta son taillis et, en quelques foulées, rejoignit l’inconnu.
Il s’arrêta botte à botte près de lui et salua poliment.
– Monsieur, demanda-t-il, rejoint sans doute la cour du roi François ?
L’inconnu jeta un rapide regard sur le chevalier et répondit :
– Et vous, monsieur de Ragastens ?
Ragastens tressaillit et fronça le sourcil.
Mais à ce moment, le cavalier releva la toque qui lui tombait sur les yeux, rabattit son manteau, et Ragastens reconnut une femme.
Cette femme, c’était la mystérieuse habitante de l’enclos des Tuileries, celle qui l’avait conduit rue Saint-Denis, celle que nous pouvons appeler par son nom : Madeleine Ferron.
– Vous, madame ! s’écria le chevalier.
– Moi-même ! répondit-elle avec une gaîté forcée qui serra le cœur de Ragastens. Je vais à Fontainebleau. Et vous ?
– J’y vais aussi, dit le chevalier étonné. Mais j’ai un motif sérieux de m’y rendre.
– Croyez-vous donc, chevalier, que j’y aille pour mon plaisir !
Et comme Ragastens, péniblement impressionné par le ton étrange qu’elle avait dans ses paroles, gardait le silence, elle continua :
– Mais n’admirez-vous pas comme nos destinées ont de singuliers points de contacts ? Voici la troisième fois que nous nous rencontrons.
– Il est vrai, madame, et les deux premières fois, la rencontre a été tout à mon avantage.
– Je suis plus heureuse que vous ne pouvez penser de vous avoir aidé. Mais à ce propos, dites-moi, vous êtes-vous bien trouvé de ma maison de la rue Saint-Denis ?
– Il nous y est arrivé une catastrophe, dit Ragastens.
Madeleine Ferron, surprise, interrogea le chevalier du regard.
Alors Ragastens raconta ce qui lui était arrivé : l’irruption du roi, l’enlèvement de Gillette.
– Nous avons sans doute été épiés pendant notre marche de la Tuilerie à la rue Saint-Denis, acheva-t-il.
Madeleine avait écouté avec attention.
– Et maintenant, dit-elle, vous allez essayer de sauver cette enfant ?
– Oui, madame.
– Eh bien, chevalier, si je ne me trompe, je crois que notre troisième rencontre ne vous aura pas été inutile. Ce que vous me dites bouleverse complètement un plan que j’avais formé. Adieu, chevalier, nous nous reverrons peut-être !…
En parlant ainsi, et avant que Ragastens eût eu le temps de demander une explication, l’étrange femme piqua des deux et disparut en avant.
Madeleine Ferron avait passé au galop devant le groupe formé par Spadacape, Triboulet et Manfred.
Spadacape s’était retourné avec inquiétude. Il se rassura en voyant arriver au petit trot Ragastens.
Madeleine Ferron s’était jetée sous bois, comme pour couper court et dépasser la longue colonne de cavaliers, de carrosses et de fourgons.
– Eh bien ? demanda Manfred, lorsque le chevalier eut rejoint.
– Eh bien, ce n’était pas un espion, c’était un ami.
– Un ami ? interrogea Manfred.
– Ma foi, je suis bien obligé de donner ce nom à cette femme…
– C’est une femme ?
– Oui et c’est la troisième fois que je la vois.
Ragastens raconta alors au jeune homme en quelles circonstances il avait vu deux fois la mystérieuse cavalière.
Manfred n’eut pas de peine à reconnaître, dans le portrait qu’en traça la chevalier, la femme qu’il avait sauvée au gibet de Montfaucon et qui elle-même l’avait sauvé à son tour en ouvrant si à propos la porte de l’enclos des Tuileries.
À son tour, il raconta cette double circonstance…
– Si ce n’est pas une amie, conclut-il, du moins cette femme ne nous veut pas de mal…
– Mais que peut-elle aller faire à Fontainebleau ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Madeleine Ferron, cependant, s’était arrêtée à l’une des premières maisons de l’entrée de la ville.
Dans cette maison était arrivé, la veille au soir, un homme que nos lecteurs ont pu entrevoir un instant.
Cet homme, c’était Jean le Piètre, – ce malheureux dont la silhouette nous est apparue dans la maison de la Maladre.
Jean le Piètre était parti de Paris deux ou trois heures avant le roi ; arrivé à Fontainebleau, il s’était enquis d’une maison à louer.
On lui avait montré, presque à l’entrée de la ville, une demeure d’aspect à demi bourgeois, comme les riches fermiers en élevaient.
Jean le Piètre avait aussitôt fait marché et payé ce qu’on avait voulu.
À peu près à l’heure où la cour devait arriver, il s’était avancé dans la forêt d’un millier de pas, sur la route de Melun.
Il s’était assis sur un tronc d’arbre renversé par quelque tourmente. Puis, les coudes sur les genoux et le menton dans les deux mains, il avait attendu, les yeux perdus sur cette route par où elle devait arriver.
Enfin, un galop retentit sur le sol.
Jean le Piètre se dressa comme mû par une étrange émotion et son regard se fit ardent.
Madeleine Ferron apparut. Elle avait coupé à travers la forêt et distancé l’escorte royale.
Elle aperçut Jean le Piètre et s’arrêta près de lui.
– Eh bien ? demanda-t-elle.
– La maison est prête, madame, répondit Jean le Piètre d’une voix où il y avait plus d’émotion encore que de respect.
Et on eût dit qu’il n’osait lever les yeux sur Madeleine.
– Où est la maison ? fit-elle.
– La quatrième à gauche en entrant dans la rue au bout de cette route. Mais je crains qu’elle ne soit pas digne…
Madeleine haussa les épaules.
– Hâte-toi de venir m’y rejoindre, dit-elle.
Quelques instants plus tard, elle s’arrêta devant la maison signalée, sauta à terre, attacha son cheval à un anneau et entra à l’intérieur sans avoir été remarquée par les voisins, tant elle avait agi avec précipitation.
Dix minutes après, Jean le Piètre arriva à son tour.
– Y a-t-il une écurie ? demanda-t-elle.
– Oui, madame : j’y ai placé le cheval.
– J’ai visité la maison, dit-elle.
Le regard de Jean le Piètre l’interrogea avec anxiété.
– C’est bien, dit-elle. Tu as fait pour le mieux. Mais toi, où coucheras-tu ?
– À l’écurie, répondit-il à voix basse.
À ce moment, on entendit un grand tumulte dans la rue. Madeleine s’approcha d’une fenêtre qu’elle entr’ouvrit assez pour pouvoir regarder au dehors sans être aperçue elle-même.
Il y avait grande rumeur. Les gens de Fontainebleau, en habits de dimanche, avaient envahi la rue.
Un homme vêtu de noir, entouré des principaux personnages de la petite cité, fort ému, en apparence, tenait à la main un rouleau de parchemin sur lequel était écrit un compliment qu’il devait lire à Sa Majesté.
Des clameurs de : Vive le Roi ! éclatèrent.
L’homme vêtu de noir et les notabilités se portèrent en avant.
Les premiers cavaliers de l’escorte royale apparaissaient.
Madeleine Ferron, derrière les vitraux de sa fenêtre, attendait, le visage impassible.
Dans la rue, maintenant, un grand silence s’était fait.
Sans doute l’homme noir lisait au roi son compliment de bienvenue.
Puis, tout à coup, les clameurs recommencèrent.
Enfin, le roi apparut, entouré de seigneurs.
– Jean ! fit Madeleine.
D’un bond, il fut près d’elle.
– Regarde cet homme…
– Je le vois…
– C’est le roi de France.
– Je sais, madame…
Le roi était passé. Le fourgon, puis encore des cavaliers défilaient.
Madeleine, pensive, était restée près de la fenêtre.
Dix minutes plus tard, elle vit passer Ragastens et ses trois compagnons.
– Tu vas suivre ces hommes, dit-elle, et tu reviendras me dire où ils sont descendus ; alors, nous aurons à causer.
Jean le Piètre s’élança au dehors. Une heure après, il était de retour.
– Les cavaliers sont à l’auberge du Grand-Charlemagne, rue des Fagots, dit-il.
– Bien ! fit Madeleine qui s’était assise.
Jean le Piètre demeurait debout devant elle.
Elle le regarda soudain en face. Il baissa les yeux.
– Tu disais donc que tu coucherais à l’écurie ? fit-elle.
– Pour ne pas vous gêner, madame, balbutia-t-il.
Elle lui jeta un autre regard qui le bouleversa. Puis elle reprit :
– Tu as bien remarqué l’homme que je t’ai montré ?
– Le roi : oui, madame.
– Si je te disais de le tuer, Jean, que ferais-tu !
– Je tuerais le roi, madame.
Et ardemment, il continua :
– Si vous me dites de tuer le roi, je tuerai le roi. Si vous me dites de tuer le pape, j’irai à Rome et je tuerai le pape. Si vous me dites de renier ma foi, de blasphémer le Seigneur, je renierai ma foi jusque sur le bûcher, et je blasphémerai Dieu jusque dans la torture. Mon roi, mon Dieu, c’est vous, madame ! Mais vous le savez ! Qu’ai-je besoin de vous le dire ! Je vous appartiens corps et âme… Pour une heure pareille à celle que j’ai passée près de vous, je consens à l’éternité de l’enfer… Et que serait d’ailleurs le paradis sans vous ! Oh ! cette nuit quand j’y songe !… Et j’y songe toujours ! Ce souvenir, c’est ma vie, maintenant. Il n’est pas un instant où je ne vois se dresser dans mon imagination l’image qui me poursuit… Et parfois, pour m’apaiser, je me lacère la poitrine à coups d’ongle… Oh ! madame… aurez-vous une fois encore pitié de moi ! Oh ! dites ! ne fût-ce qu’un mot ! Ne fût-ce que pour me laisser vivre avec un semblant d’illusion et une ombre d’espoir ! Dût cette illusion me conduire à de plus affreux tourments ! Dût cet espoir s’évanouir et ne me laisser que d’épouvantables souffrances de regret !
Madeleine écoutait cette passion qui débordait.
– Qui t’a défendu d’espérer ? fit-elle d’une voix caressante.
– Oh ! madame, bégaya-t-il éperdu, prenez garde de me rendre fou de joie !…
– Voyons ! Ai-je donc été si cruelle une première fois ?…
– Oui, c’est vrai ! fit-il, soudain assombri et désespéré. Mais vous ne saviez pas alors !
– Je ne savais pas… quoi ?…
Il baissa la tête et devint livide.
– Ton mal ? demanda-t-elle d’un ton si parfaitement indifférent qu’il en fut secoué d’un étonnement prodigieux, comme s’il eût vu quelque puissante reine jeter sa couronne dans un égout.
Et comme il demeurait stupide d’ébahissement et d’effroi, elle se leva et alla à lui.
Le sourire de ses lèvres avait disparu. Son regard, de caressant qu’il était s’était fait dur et mauvais.
– Oh ! madame, vous me faites peur, s’écria-t-il.
Elle lui saisit la main.
– Ton mal ! s’écria-t-elle, veux-tu savoir ? Veux-tu que je te dise, pauvre misérable ? Ton mal, c’est ce que je voulais en toi !
Il eut un cri d’épouvante et de détresse.
– Est-ce possible ? Je ne rêve pas ! C’est bien vous que j’entends !
– Ton mal !… Je voulais qu’un homme en fût atteint… Un homme que j’exècre, et contre qui j’ai rêvé d’effroyables supplices… Je voulais… mais peut-être n’ai-je pas réussi… Peut-être qu’il m’échappe, puisqu’il vole à de nouvelles amours…
– Cet homme ! cet homme ! gronda Jean le Piètre.
– C’est le roi de France !
Hébété, égaré, Jean la regarda avec des yeux stupides d’horreur.
– Je te dis que peut-être je n’ai pas réussi. Alors, je le frapperai autrement ! J’ai besoin d’un instrument docile, de quelqu’un qui soit mon esclave… Veux-tu être cet instrument, cet esclave ?
– Je le suis ! dit-il sourdement.
– Veux-tu haïr le roi comme je le hais ?
– Je le hais de toutes les puissances de mon être à partir de cet instant.
– Bien !… En revanche, Jean le Piètre, je serai à toi.
– Quand ! oh ! quand !…
– Quand il sera mort ! répondit-elle.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jean le Piètre s’enfuit comme un fou, et se réfugia au fond de l’écurie.
Là, la tête dans ses poings, il songea :
– Elle aime !… Jamais je n’ai souffert pareil tourment !… Elle aime le roi… Et il faut que cet amour soit bien puissant pour qu’elle ait osé concevoir et exécuter l’acte insensé qu’elle a commis !… Elle s’est empoisonnée pour empoisonner le roi !… Elle a détruit sa beauté pour détruire la vie de François !… Elle aime ! Et moi, misérable, que suis-je pour elle ?… Un vil instrument ! Elle l’a dit… Et j’ai consenti ! Oui, j’ai consenti, je consens encore ! Qu’importe que sa pensée s’envole vers un autre si elle est à moi ! Oh ! le délire de cette heure d’amour !… Et cet homme ! le roi qui passe avec son sourire superbe ! Il mourra ! Je le condamne ! Lors même qu’elle voudrait maintenant le sauver, il est trop tard ! Ma haine fera plus que tous les poisons…
Il se leva et tendit vaguement le poing crispé.
Il était effroyable à voir…
Par une lucarne, Madeleine Ferron ne le perdait pas de vue. Et à le voir si horrible, si terrible, elle eut un doux sourire sur ses lèvres pâles.
IX
UN COURRIER DE PARIS
Le château de Fontainebleau était appuyé à un parc immense dont on peut voir encore de beaux restes.
Ce parc était clos de hautes murailles.
Lorsque François Ier venait habiter le château, on plaçait des gardes tout le long de ces murailles, à l’intérieur.
Il y avait un garde à peu près tous les cent pas.
Triboulet était déjà venu deux fois à Fontainebleau avec le roi. Il n’ignorait aucun de ces détails.
Pourtant, c’est par le parc qu’il avait résolu de s’introduire dans le château. Il avait exposé son plan à Ragastens et à Manfred.
Entrer coûte que coûte dans le parc et tâcher de savoir en quel endroit du château se trouvait enfermée Gillette.
Une fois ce point acquis, il connaissait assez la disposition des logis et appartements pour pouvoir, par une nuit obscure, guider ses amis.
Alors, ils pénétreraient à eux quatre dans le château, décidés à tuer tout ce qui ferait obstacle, arriveraient à Gillette, et l’enlèveraient, puis ils partiraient pour l’Italie.
Dès le premier soir de l’arrivée, Triboulet, accompagné de ses trois amis, alla étudier les abords du château.
En passant devant la somptueuse façade, Ragastens et Manfred se rendirent très bien compte de l’impossibilité d’une attaque autrement que par le parc.
La cour était pleine d’hommes d’armes.
Du côté du parc, au contraire, tout était sombre et désert. Ils longèrent le mur.
De l’autre côté, ils entendaient parfois le cri de veille des sentinelles qui se répondaient l’une à l’autre.
Ils parvinrent au fond du parc. Là, par endroits, le mur était en mauvais état. Des pierres étaient tombées ; il y avait des trous.
Ils rentrèrent sans avoir, ce soir-là, rien pu tenter.
Le lendemain et les jours suivants se passèrent de même ; tous les soirs, au seul endroit que l’on pût escalader, il y avait une sentinelle.
Chacun des quatre songeait avec répugnance qu’il faudrait en arriver à tuer un homme inoffensif ou à renoncer à l’entreprise.
Dix mortelles journées s’écoulèrent ainsi.
Manfred se désespérait, et son désespoir l’affolait. Il parlait d’entrer au château en plein jour, de braver le roi, de le provoquer !…
Le soir du onzième jour, Ragastens et Triboulet conférèrent à voix basse.
– Il faut en finir ! dit Triboulet d’un air sombre.
– Je vous comprends… la sentinelle ?… Triboulet haussa les épaules.
– Puisqu’il n’y a pas moyen de faire autrement, dit-il.
– C’est donc moi qui m’en chargerai, dit Ragastens.
Il espérait qu’il pourrait tomber sur le soldat et le bâillonner assez vite pour l’empêcher de crier…
Pour la onzième fois, donc, les quatre compagnons revinrent au mur.
Il était environ dix heures du soir.
– Je monte, dit Ragastens à voix basse, en arrivant à l’endroit favorable. Dès que la chose sera faite, j’appellerai. Vous passerez l’un après l’autre, et après… nous verrons.
À ce moment le cri de veille retentit au loin. Il se répéta de proche en proche.
Et enfin, il fut redit par le soldat qui se trouvait en face de Ragastens, de l’autre côté du mur.
À la voix du soldat, Triboulet tressaillit.
Il s’élança, saisit la main de Ragastens.
– Attendez ! fit-il. C’est moi qui monte.
Dix secondes plus tard, il était au haut du mur, et faisait signe à ses amis de garder le plus profond silence.
Il voyait distinctement la sentinelle immobile, appuyée sur la hampe de sa hallebarde.
À voix basse, Triboulet appela :
– Ludwig !…
Le soldat sursauta.
– Qui m’appelle ? s’écria-t-il.
– Parle plus bas… approche-toi… là ! Ne reconnais-tu pas un ami ? Par la mort-dieu, je ne t’ai point oublié, moi !
– Monsieur Triboulet ! fit le soldat, reconnaissant la voix. Mais vous étiez à la Bastille, disait-on ?
– Ah ! ah ! Et qui disait cela, mon brave Ludwig ?
– Mais tout le monde. C’est M. de Montgomery qui vous arrêta et vous conduisit lui-même en la forteresse Saint-Antoine.
– Diable ! Eh bien, tu vois, si j’étais à la Bastille, j’en suis sorti.
– Vous en êtes sorti ! fit le Suisse ébahi.
– Tout exprès pour venir te demander si tu as toujours envie de revoir la montagne de la Jungfrau, d’aller écouter le « Ranz des Vaches », d’aller embrasser ta fiancée… ta… comment l’appelles-tu déjà ?
– Catherine ! dit le soldat attendri.
– Oui, Catherine. Eh bien, mon bon Ludwig, te souviens-tu de ce que je t’ai promis au Louvre ?
– Si je m’en souviens, par le diable ! Je ne pense qu’à cela, et vous m’avez mis la cervelle à l’envers… Mille écus !…
– De six livres parisis ! De quoi faire bâtir une métairie dans la vallée où tu es né, où tu épouseras ta Catherine, et où tu passeras ton heureuse existence à engendrer toute une nichée de petits Ludwig !
– Monsieur Triboulet, fit le soldat, vous venez encore me tenter !
– Mais pas du tout ! Je viens seulement te dire que je suis prêt à tenir ma promesse.
– Les mille écus !…
– Tu n’as qu’à venir les prendre.
– Où cela ?… s’écria le soldat, enflammé.
– À l’auberge du Grand-Charlemagne.
– Quand ?…
– Quand tu voudras.
– Ah ! vous êtes vraiment un bon homme de vous déranger tout exprès…
– Pour t’apporter la fortune, c’était chose promise !
– C’est vrai, mais je n’eus pas l’occasion de vous rendre le service que vous me demandiez, et je pouvais croire…
– Aussi, mon cher Ludwig, je vais te demander un autre service.
– Ah ! ah ! fit le Suisse désappointé.
– Beaucoup moins dangereux que le premier que tu consentais pourtant à me rendre… Cependant, je ne veux pas te violenter. Il ne manque pas de Suisses dans les gardes, qui ne demanderont pas mieux de gagner honnêtement mille livres en faisant une bonne action…
– Une bonne action qui pourra sans doute me conduire au gibet !
– Oui, si tu es maladroit et si tu manques d’argent. Mais tu es adroit, Ludwig, et tu auras de l’argent…
– Que faut-il faire ? demanda Ludwig.
– Simplement fermer les yeux et te boucher les oreilles pendant deux minutes…
– Vous voulez pénétrer en secret dans le château ?
– Oui !… Et puis te demander un renseignement que tu pourras peut-être me donner. Mais le renseignement est par-dessus le marché.
– Dites toujours.
– Tu as entendu parler d’une jeune fille que le roi a fait amener au château, la veille même du jour où il est arrivé lui-même…
– Vous voulez parler de Mme la duchesse de Fontainebleau ?
– Oui ! fit Triboulet ému.
– Pauvre demoiselle, elle a l’air bien triste !
– Oh ! s’écria Triboulet, tu l’as donc vue ?
– Deux fois, les deux jours où j’ai été mis en faction près du château ; elle est descendue dans le parc.
– Seule ? fit Triboulet haletant.
– Accompagnée de deux femmes.
– Et a-t-elle pénétré loin dans le parc ?
– Oh ! non !…
– Ludwig ! veux-tu gagner, non pas mille écus, mais le double ! le triple ; tout ce que je possède ! Veux-tu être riche comme un bourgeois ? Dis, le veux-tu ?
– Silence ! fit Ludwig à voix basse.
Triboulet entendit des pas qui s’approchaient.
C’était une ronde.
Il s’aplatit sur la muraille, le cœur tremblant à la pensée que Ludwig ferait tout ce qu’il voudrait.
La ronde conduite par un officier s’approcha ; l’officier échangea quelques mots avec Ludwig, puis s’en alla.
– Quand seras-tu encore de faction, Ludwig ?
– Après-demain.
– À cette même place ?
– Je puis m’arranger pour y être.
– Bon ! Te charges-tu, demain, de t’approcher de la duchesse de Fontainebleau ?
– Oui… Elle n’est pas fière ; il lui est arrivé déjà d’adresser la parole à des camarades.
– Eh bien ! dis-lui qu’elle se trouve après-demain dans le parc à l’heure de la faction.
– C’est-à-dire à dix heures du soir… Mais à quel endroit ?
– Près du grand bassin aux carpes. Acceptes-tu ?
– J’accepte !
– Répète un peu ce que je t’ai dit.
– Demain, je m’approche de la jeune duchesse, j’attire son attention, elle me parle, et je lui dis : « Demain, à dix heures du soir, M. Triboulet sera près du bassin aux carpes. » Ai-je bien compris ?
– Oui, mon brave Ludwig. Donc, à après-demain soir, dix heures, ici même.
– C’est entendu.
– Et après, tu fuis avec nous, et riche désormais, tu te sauves en Suisse…
– Ô ma Catherine ! soupira le Suisse. Triboulet se laissa glisser au bas du mur.
Ils rentrèrent à l’auberge du Grand-Charlemagne. Le lendemain, Spadacape se procura une chaise de voyage qu’il acheta. Le jour du lendemain fut un jour de fièvre.
Triboulet ne tenait pas en place, causait tout seul à haute voix, serrait la main de Ragastens.
Manfred paraissait plus calme, mais une profonde émotion l’agitait. À huit heures, il dit :
– Partons !
C’était un peu trop tôt. Mais Ragastens comprit que le jeune homme n’y tenait plus.
Tous les quatre s’équipèrent, s’armèrent en toute hâte et descendirent dans la rue. À ce moment, un cavalier apparut au tournant de la rue des Fagots.
En apercevant Manfred, il poussa une exclamation de joie, arrêta son cheval et sauta à terre.
Le cheval s’abattit alors ; il était fourbu et rendait le sang par les naseaux.
Manfred avait affreusement pâli.
Il venait de reconnaître Cocardère.
– Lanthenay ? interrogea-t-il anxieusement.
– C’est lui qui m’envoie. Tenez.
Il tendit un pli à Manfred.
Alors, tous ensemble, ils rentrèrent dans l’auberge. Manfred, lentement, ouvrit le pli, et lut :
« Midi.
« C’est pour demain matin, sept heures.
« On va brûler Dolet.
« Si je n’arrive pas à l’enlever pendant le trajet de la Conciergerie à la place de Grève… ô mon ami, mon frère… tu comprends !
« Je t’attends !… »
Silencieusement, Manfred tendit la lettre à Ragastens qui la lut, puis la fit lire à Triboulet.
Ragastens s’assit.
Quant à Triboulet, il était comme assommé.
– Mais, bégaya-t-il, les lèvres blanches, mais… tu peux partir… après !…
– Après ! fit Manfred avec une imprécation de désespoir ; après, il sera peut-être minuit, une heure… trop tard pour arriver à temps !
Brusquement, il se tourna vers Cocardère qui assistait à cette scène, sans comprendre ce qu’elle avait de poignant.
– Va à l’écurie, dit-il, et selle deux chevaux. Spadacape va t’indiquer les meilleurs. Hâte-toi !
Spadacape et Cocardère s’élancèrent.
Ragastens s’était levé et avait saisi la main de Manfred.
– Bien, mon enfant, dit-il simplement, en redonnant au jeune homme ce nom qui déjà, l’avait fait tressaillir.
– Nous restons à trois ! dit Ragastens en se tournant vers Triboulet. Mais sans vouloir déprécier l’aide de notre ami, j’affirme que nous réussirons à trois comme si nous eussions été quatre !
Manfred comprit l’intention du chevalier et, à son tour, lui serra la main.
À ce moment, Cocardère reparut.
– Tu n’es pas trop fatigué pour refaire le chemin ? demanda Manfred.
– Je suis éreinté, par la mort-dieu ! Mais pour ne pas être à Paris demain matin, il faudrait que je sois mort et enterré… Si vous pouviez voir la figure de Lanthenay, comme je l’ai vue ce matin !…
– Partons ! fit Manfred d’une voix rauque.
L’instant d’après, Ragastens, Triboulet et Spadacape entendirent le galop furieux de deux chevaux.
– Partons ! dit alors à son tour Triboulet.
Et ils se dirigèrent vers le parc du château.
Manfred et Cocardère galopaient côte à côte sur la route de Melun.
L’oreille aux aguets et la main prête, Cocardère causait.
– Comment as-tu fait pour nous trouver ? avait demandé Manfred.
– C’est une chance inespérée… Il faut vous dire qu’en arrivant à Fontainebleau, je n’avais guère la tête à moi ; cette course furieuse m’avait brisé. Donc, à la première maison, je m’arrête, et je regarde autour de moi. Personne. Je frappe à une maison de paysan. Et, comme me l’avait recommandé Lanthenay, je demande si on a vu un seigneur qui s’appelle le chevalier de Ragastens et si on sait où il loge. On me répond de m’adresser au château et on me ferme la porte au nez. Il paraît que je faisais peur… Je demeurais là, tout bête, ne sachant où aller, lorsque tout à coup, d’une maison voisine, sort une femme…
– Une femme ?
– Habillée en homme… Belle femme autant que j’ai pu voir.
– J’ai entendu que vous cherchiez M. de Ragastens, me dit-elle.
– Qui êtes-vous, madame ? lui dis-je, me méfiant.
Elle hausse les épaules et me dit :
– Oui ou non, cherchez-vous M. de Ragastens ?
– Oui, lui dis-je. Et c’est pressé.
– Eh bien, me dit-elle, allez rue des Fagots, près du château, et arrêtez-vous à l’auberge du Grand-Charlemagne.
– Là-dessus elle disparaît, acheva Cocardère, et moi, je pique des deux, demandant à mon pauvre cheval un dernier effort.
L’idée de Madeleine Ferron se présenta d’elle-même à Manfred. Quelle autre, en effet, que Madeleine pouvait s’intéresser au chevalier de Ragastens que nul ne connaissait à Fontainebleau ?
– Cette femme est donc notre bon génie ? se dit-il.
Ils traversèrent Melun comme des fantômes.
Hors de la ville, ils s’arrêtèrent une heure ; sans cette halte, les chevaux ne fussent pas arrivés à Paris.
Une pleine mesure d’avoine tirée des fontes fut placée devant chaque bête, et Cocardère profita de la halte pour dévorer une tranche de bœuf placée entre deux vastes tartines de pain. Quant à Manfred, il se contenta d’une lampée de liqueur.
Les deux cavaliers se remirent en selle et repartirent du même train.
À deux heures du matin, ils étaient aux portes de Paris.
– Fou que j’ai été ! gronda amèrement Manfred. Les portes sont fermées ! Je n’avais point songé à cela !
– Les portes ouvrent à cinq heures, dit Cocardère ; or la chose est pour sept heures seulement…
Manfred piétinait nerveusement autour de son cheval. Tout à coup il se décida.
– Suis-moi, dit-il à Cocardère.
Il alla frapper à la poterne, c’est-à-dire à la petite porte basse qui s’ouvrait près de la grande. Au bout de quelques instants, un soldat vint ouvrir.
– Mon ami, dit-il, j’ai un message pressé à communiquer à votre sergent.
– Venez, dit le soldat.
Ils traversèrent une salle basse aux voûtes surbaissées, dans laquelle il y avait quelques gardes, et entrèrent dans une deuxième pièce de plus grandes dimensions qui était le véritable poste.
Manfred vit tout de suite la porte qui ouvrait sur la rue, et fit un signe à Cocardère.
Celui-ci s’approcha de la porte.
– Voici le sergent, dit le soldat.
– Que me voulez-vous ? demanda le chef de poste.
– Vous dire que j’ai besoin d’entrer tout de suite à Paris, dit Manfred qui surveillait du coin de l’œil les mouvements de Cocardère.
– On n’entre pas à pareille heure, grommela le sergent. Garde, reconduisez ces deux hommes.
– En avant ! cria à ce moment Cocardère en ouvrant la porte toute grande et en se précipitant dans la rue.
Le sergent, comprenant qu’il était joué, essaya de barrer le passage à Manfred. Mais, d’un coup de poing, le jeune homme l’envoya rouler à trois pas, et s’élança à son tour.
L’instant d’après, il entendit deux ou trois coups d’arquebuse que les soldats du poste tirèrent au jugé, par acquit de conscience.
Une heure plus tard, Manfred et Cocardère arrivaient à la Cour des Miracles.
– Il est trois heures, dit Cocardère, je vais dormir jusqu’à six. Sans quoi, je serais inutile.
– Je te réveillerai, sois tranquille.
Et il se dirigea vers l’appartement qu’occupait Lanthenay, appartement dans lequel s’étaient réfugiées Julie et Avette, la femme et la fille d’Étienne Dolet.
Lanthenay poussa un cri de joie en apercevant son ami et le serra dans ses bras. D’un coup d’œil, il lui montra les deux malheureuses femmes qui pleuraient.
– Ils ont donc osé le condamner ! fit Manfred.
– Mais tout n’est pas perdu ! s’écria Lanthenay. Nous le sauverons !
– Certes !
– Ah ! monsieur ! s’écria Avette en joignant les mains. Mon pauvre père.
Quant à Julie, elle était comme prostrée.
– Nous tenterons l’impossible ! dit Manfred.
– Viens ! dit brusquement Lanthenay.
– Mon cœur se brise à les voir pleurer ! sanglota Lanthenay quand ils furent dehors. Viens… je vais te montrer les dispositions que j’ai prises afin que nous soyons bien d’accord dans l’action.
Dans la Cour des Miracles, les truands préparaient des armes pour le coup de main que l’on allait tenter.
Manfred et Lanthenay parvinrent à la Conciergerie.
– Où l’exécution doit-elle avoir lieu ? demanda Manfred.
– Tu vas voir. Nous voici à la Conciergerie. Le cortège sortira par cette porte. Prenons le chemin qu’il va suivre.
Ils franchirent le pont. À droite, ils tournèrent, tout de suite, et, en quelques pas, se trouvèrent sur la place de Grève.
Là, au centre de la place, trois ou quatre hommes s’occupaient à un singulier travail : ils paraissaient édifier avec beaucoup de soins une sorte de tour carrée.
Méthodiquement, les travailleurs nocturnes entassaient de longues pièces de bois sec.
Il y avait une rangée de bois, une rangée de fagots, puis une autre rangée de bois, ainsi de suite. Cette sorte de cube s’élevait autour d’un long poteau carré qui avait été profondément enfoncé en terre.
Ces hommes, qui travaillaient ainsi, étaient les aides du bourreau. Et ce qu’ils édifiaient, c’était un bûcher.
– C’est ici qu’on veut le brûler ? demanda Manfred.
– Tu vois ! dit Lanthenay. Viens, maintenant.
Il le ramena à l’entrée du pont.
– C’est là que nous nous placerons, reprit alors Lanthenay… Voici ce qui est convenu : au moment précis où le cortège débouchera du pont, nous nous ruerons sur l’escorte… Y eût-il cinq cents gardes, nous en viendrons à bout… Nous enlevons le prisonnier et nous nous réfugions dans la Cour des Miracles… Que dis-tu de ce plan ?
– C’est le seul qui paraisse raisonnable. La réussite me paraît indubitable.
– Tu crois ? fit Lanthenay.
– Certes !
– Ah ! si cela pouvait être, ami ! Notre rôle à nous deux, sera d’arriver jusqu’à Dolet sans nous inquiéter de ce qui se passera autour de nous… Ah ! voici nos gens qui commencent à prendre position… Je commence à croire que nous réussirons ! Je doutais ! Il me semblait que nul de ces hommes ne se dérangerait… Que te dirai-je ? J’en étais arrivé à penser que toi-même tu ne pourrais arriver à temps !
– Tu vois que je suis arrivé ! fit Manfred avec un sourire.
X
LA CONDAMNATION DE DOLET
Le procès d’Étienne Dolet, qui avait duré six jours, s’était terminé la veille à midi.
Le procès avait été conduit par Mathieu Orry, inquisiteur de la foi, et l’official Étienne Faye.
Mathieu Orry remplissait les fonctions d’accusateur.
Étienne Faye présidait, assisté d’assesseurs.
Étienne Dolet, debout devant le tribunal, les mains liées au dos, écoutait attentivement ce que disaient tantôt l’official Faye, tantôt l’accusateur Orry.
De temps à autre, il se tournait vers la foule et y cherchait des yeux quelqu’un qui avait suivi toutes les péripéties du procès.
C’était Lanthenay qui se rongeait de désespoir.
En effet, l’accusé était amené tous les jours dans la salle par un passage secret qui le faisait communiquer à la Conciergerie.
Il n’y avait donc eu aucun moyen de tenter d’enlever Dolet pendant le procès.
Ce jour-la, le dernier, vers onze heures du matin, Mathieu Orry et l’official se trouvaient embarrassés. Étienne Dolet persistait à ne pas avouer les crimes qu’on lui imputait.
Et la grande ressource de la question en chambre de torture leur échappait. François Ier s’y était opposé.
– Donc, disait Faye, vous dites que vous n’êtes point hérétique ?
– Je ne le suis pas.
– Il l’affirme, s’écriait Orry, mais n’a-t-il pas écrit que l’homme n’est rien après la mort ? C’est là une monstrueuse hérésie, et il n’est pas besoin d’autres preuves.
– J’ai traduit Platon, répondit Dolet. Contestez-vous le droit de traduire les anciens auteurs ? Proscrivez-vous l’étude du grec ?
– Vous avez imprimé des livres scandaleux, vous avez publié une Bible en langue vulgaire.
– Les livres dont vous parlez furent déposés dans mon imprimerie : si je les avais imprimés, on trouverait trace des épreuves.
– Avouez-vous, reprit Faye, que vous êtes schismatique ? Cela, vous ne pouvez le contester. Vous avez favorisé les défenseurs des erreurs nouvelles.
– Je n’en connais aucun ; comment les aurais-je favorisés ?
L’aveu de l’accusé était alors la pièce principale d’un procès.
Que Dolet persistât à nier, cela faisait sur la foule des assistants un prodigieux effet. Et comme la justice n’était pas étayée sur des forces matérielles aussi solides qu’aujourd’hui, il devenait difficile de condamner Dolet.
À ce moment, un homme s’avança vers l’official Faye.
C’était un moine.
Sa tête était couverte d’une cagoule noire.
Le moine se pencha vers l’official, tira un papier de sa poitrine, et le tendit à Faye en disant :
– Demandez à l’accusé si ce parchemin est bien de son écriture.
Faye parcourut rapidement le papier, puis le passa à Mathieu Orry qui le lut aussi.
– Abomination et sacrilège ! gronda Orry.
– Gardes, faites approcher le prisonnier, dit Faye.
Étienne Dolet s’approcha de lui-même et se pencha sur le parchemin.
– Est-ce vous, demanda Faye, qui avez écrit cela ?
– Oui, dit froidement Dolet.
Ce parchemin, c’était celui que Dolet avait écrit à la Conciergerie dans une heure de fièvre et que les soldats lui avaient enlevé pour le remettre à Gilles Le Manu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mathieu Orry se leva et donna lecture du document.
Puis il le commenta, on peut imaginer comment.
Le dernier passage surtout excita sa verve.
« Je voudrais qu’un jour un monument s’élevât à l’endroit même où je vais souffrir, et que sur ce monument les jours de fête, les hommes enfin délivrés apportent quelque modeste offrande de fleurs et qu’enfin le souvenir des iniquités présentes fût perpétué par cette simple parole qu’on redirait aux foules d’année en année :
« Ici on a brûlé un homme parce qu’il aimait ses frères et prêchait l’indulgence et proclamait le bienfait de la science.
« Cela se passait du temps où il y avait des rois comme François et des saints comme Ignace de Loyola. »
Il fut dès lors avéré d’une façon formelle que l’accusé prêchait la science, cause de tous les maléfices et source première de toutes les hérésies.
Le moine qui avait apporté le parchemin accusateur était retiré dans un coin.
Il vit l’official Faye se pencher vers ses assesseurs.
Ceux-ci approuvèrent de la tête.
L’official lut alors la sentence, qui déclarait Étienne Dolet mauvais, scandaleux, schismatique, hérétique, fauteur et défenseur d’hérésie et autres erreurs.
La sentence condamnait le savant à être brûlé en place publique.
Les gardes entraînèrent aussitôt Dolet.
Seule, une femme s’écria :
– C’est grand’pitié de brûler un homme si beau et qui parle si bien !
Cette femme fut arrêtée à l’instant. Et les siens ne purent jamais savoir ce qu’elle était devenue.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Après la condamnation, Lanthenay était sorti avec la foule, et, fou de désespoir, avait écrit quelques lignes pour Manfred.
Cocardère était aussitôt monté à cheval. On sait le reste.
Quant au moine à la cagoule noire, il avait attendu aussi la condamnation, puis il était sorti, était monté dans un carrosse, et s’était fait conduire à l’hôtel du grand prévôt.
En entrant dans le cabinet de Monclar, cet homme se débarrassa de sa cagoule.
– Quelle imprudence ! s’écria Monclar en l’apercevant. Si votre blessure se rouvrait, saint père !…
Loyola tressaillit et dit paisiblement :
– Vous me donnez là un nom qui ne s’accorde qu’au pape, mon fils.
– Dans mon esprit, je voulais rendre hommage à votre sainteté… mais dans le fait, pourquoi ne vous appelleriez-vous pas bientôt de ce nom ?
– Jamais ! dit tranquillement Loyola. Je perdrais la moitié de ma force si j’acceptais la tiare… Quant à ma blessure, rassurez-vous… Je viens vous apporter une bonne nouvelle : Dolet est condamné… Le reste vous regarde, en votre qualité de grand prévôt.
– Quand voulez-vous que s’élève le bûcher ?
– Demain, mon fils.
– Demain !
– Oui, Dolet a des amis audacieux ; tant que je n’aurai pas vu de mes yeux les flammes de son bûcher s’élever autour de lui, je ne serai pas tranquille.
– Ce que vous désirez, mon père, est en dehors des usages.
– Il faut surprendre l’ennemi. D’ailleurs, l’official n’a pas hésité à déclarer publiquement que le criminel expierait dès demain.
– Soit, mon père.
– Reste à savoir en quel endroit nous allons le brûler.
– Il y a la place de Grève…
– Oui, je sais. Place vaste et spacieuse, dit Loyola songeur.
La conférence dura une heure encore entre Monclar et Loyola ; ce qui fut résolu dans cet entretien, nous ne tarderons pas à le savoir[2].
XI
OÙ FUT ÉDIFIÉ LE BÛCHER
Nous revenons maintenant à Manfred et à Lanthenay que nous avons laissés arrêtés près du pont Saint-Michel.
Ce pont avait une porte à chacune de ses extrémités.
Ces deux portes n’étaient d’ailleurs que rarement fermées, excepté les jours où il y avait sédition en l’Université, et où on voulait empêcher les écoliers de se répandre par la ville.
Le jour se leva, blafard et sinistre.
Il était environ six heures.
Dolet devait sortir à sept heures de la Conciergerie pour être amené au lieu de son supplice, c’est-à-dire en place de Grève, comme cela avait été annoncé.
À six heures et demie deux cents cavaliers débouchèrent sous la porte et se rangèrent en bataille.
Derrière eux s’avancèrent trois petits canons de campagne.
– Le moment approche ! dit sourdement Lanthenay.
Cependant, des soldats, ostensiblement, chargèrent les canons et les pointèrent en trois directions différentes sur la foule.
Cette menaçante démonstration fut remarquée de tout le monde et accueillie par des cris de terreur. Seuls, les truands ne manifestèrent aucune surprise.
Seulement, ayant jeté un regard sur l’enfilade du pont, Manfred et Lanthenay constatèrent plusieurs choses qui leur donnèrent une vague inquiétude.
D’abord, toutes les boutiques du pont étaient fermées, ce qui n’arrivait jamais en pareille occurrence, les boutiquiers de Paris étant au contraire friands de ces spectacles.
En outre, Manfred et Lanthenay remarquèrent que le pont était couvert de soldats ; il y avait peut-être deux régiments massés dans l’étroit passage libre entre les deux rangées de boutiques.
Six autres canons parfaitement visibles achevaient de donner au pont l’aspect d’une forteresse qui se prépare à soutenir un assaut.
Le beffroi du Palais de Justice sonna sept heures.
À ce moment, la porte du pont fut fermée.
– Que se passe-t-il ? murmura Lanthenay devenu livide.
– Je viens de la place de Grève, haleta une voix près de lui.
Manfred et Lanthenay se retournèrent vivement.
L’homme qui venait de parler ainsi était Cocardère.
Et ces paroles pourtant si simples avaient résonné comme un glas.
À ce même instant précis, le glas se mit justement à tinter à Saint-Germain-l’Auxerrois et à Notre-Dame, puis à Saint-Eustache, puis aux autres églises, gagnant de proche en proche comme une voix de malheur qui se serait répercutée en échos de deuil…
Au loin, de l’autre côté de la Seine, on entendit le chant des centaines de moines qui, couverts de cagoules et le cierge à la main – cierges bientôt torches d’incendie !… – formaient le cortège du condamné.
– J’arrive de la place de Grève ! reprenait Cocardère, et savez-vous ce qui s’y passe ? Il y a un bûcher, mais autour du bûcher, ni le bourreau ni ses aides ! Ce n’est pas en Grève qu’on va le brûler.
Lanthenay jeta un cri déchirant.
Manfred rugit un terrible juron.
Il y eut parmi les truands un violent remous.
Et cette clameur, soudain, répétée par des voix furieuses, éclata, tonna :
– À la place Maubert ! À la place Maubert !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Des cris, des imprécations, se heurtèrent, se croisèrent…
Un millier de truands se ruèrent sur la porte du pont, et là, une effroyable mêlée commença, tandis que, de toutes parts, s’enfuyait une foule terrifiée.
Comment passer ?
Comment courir à son secours ?
La tête en feu, les cheveux hérissés, Lanthenay rugissait ces questions hachées de jurons où se déchaînait son désespoir.
Et, tout à coup, une idée traversa sa cervelle affolée.
– En avant ! hurla-t-il.
En quelques bonds, il avait dévalé la berge.
Il y avait des barques attachées par des cordas à des pieux fichés dans le sable. Il est sûr qu’il ne les vit pas.
Il entra dans l’eau !
Lanthenay perdit pied presque aussitôt et se mit à nager avec une telle furie qu’il coupait le courant presque en droite ligne.
Alors, ce fut un spectacle inouï, un spectacle de rêve ou de cauchemar.
Derrière Lanthenay, Manfred ; derrière Manfred, Cocardère et Fanfare, dix, vingt, cent, mille truands se jetèrent à l’eau, hurlant, vociférant, se poussant, se soutenant ; la Seine fut noire de toques, hérissée de fêtes furieuses, de poings qui brandissaient des poignards…
XII
LA PLACE MAUBERT
Oui ! c’était en place Maubert que les deux mille gardes de la prévôté, accompagnés de plus de cinq cents moines, conduisaient Étienne Dolet. C’est une pensée de génie qu’avait eue Loyola.
Le terrible moine s’était fait expliquer minutieusement l’attaque de la Cour des Miracles, et la résistance des truands, et leur victoire extraordinaire !
Et il avait résolu de prendre ses précautions pour que Dolet ne lui fût pas arraché au meilleur moment.
On a vu qu’il avait été trouver Monclar.
Il lui donna des conseils, ou plutôt ses ordres, qui se résumèrent en ces opérations très simples :
Répandre le bruit que Dolet serait brûlé en place de Grève, y faire édifier un bûcher pour mieux tromper Paris ; puis vers cinq heures du matin, édifier rapidement un bûcher place Maubert, et faire fermer les ponts en les gardant par des forces imposantes.
Tel avait été le plan de Loyola.
Nul ne fut mis dans le secret, et jusqu’au dernier moment Dolet lui-même crut qu’il serait conduit en Grève.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aussitôt après la sentence de condamnation lue par l’official Faye, Dolet avait été saisi par les gardes qui l’entouraient et ramené dans son cachot par le passage souterrain qui faisait communiquer la Conciergerie avec la maison de justice.
Vers sept heures du soir, Gilles Le Mahu pénétra dans le cachot et dit à Dolet qu’il serait fait droit à toutes ses demandes et requêtes.
– Voulez-vous, ajouta-t-il, que je vous fasse servir quelque bon repas, que vous arroserez d’une bouteille sortie de mes propres caves ?
Toute l’âme de Gilles Le Mahu tenait dans cette proposition. Il ne concevait pas qu’un homme sur le point de mourir pût souhaiter autre chose qu’un bon pâté et un flacon de bon vin d’Anjou.
Aussi fût ce avec une sincère surprise qu’il entendit Dolet lui répondre :
– Merci maître Le Mahu, mon pain me suffira.
– Que désirez-vous donc ?
– Que vous me laissiez dormir tranquille, car je suis fatigué.
Gilles Le Mahu se retira très étonné.
Étienne Dolet se jeta en effet sur sa botte de paille et ferma les yeux.
Dolet ne dormit pas.
Mais à cinq heures du matin, lorsque s’ouvrit la porte de son cachot et que reparut Gilles Le Mahu, Étienne Dolet, aussitôt sur pied, montra un visage serein.
Un prêtre accompagnait Gilles Le Mahu.
– Mon fils, dit cet homme, je viens vous apporter les consolations que notre religion de pardon, de douceur et de résignation réserve à tous ses enfants, même les plus pervers.
Il avait dit cela d’une voix glaciale.
– Monsieur, répondit Dolet, vous me voyez tout consolé ; je n’ai donc pas besoin de vos secours, dont pourtant je vous remercie en toute sincérité.
– Quoi, mon fils ! Vous ne voulez pas, au moment de paraître devant Dieu, confesser vos fautes, erreurs et péchés ?… Je vous apportais l’absolution.
– Je me suis absous moi-même, dit Dolet.
– Sacrilège !… Vous entendrez pourtant le divin sacrifice de la messe !
– Il faudra donc qu’on m’y porte !
Le prêtre fit le signe de la croix, qui était sans doute un signal convenu, car au même instant les gardes et les geôliers se jetèrent sur Dolet, le terrassèrent, le ligotèrent de cordelettes et l’emportèrent.
Dans la chapelle, où le condamné fut déposé, la messe funèbre commença…
Dies irae ! Dies illa !
Les moines, rangés autour de la chapelle, reprenaient le chœur menaçant que Dolet, enchaîné, entouré de gardes, entendait et traduisait en lui-même.
De profundis ad te clamavi !
Ce fut avec une sorte de sombre furie que l’officiant attaqua le chant des morts.
Près du condamné, un moine ne chantait pas.
Il regardait Dolet.
Et à travers les deux trous de la cagoule, le condamné voyait briller deux yeux noirs, – un regard spécial, un regard d’ironie, de force et de victoire.
Le supplice de cette messe funéraire prit fin.
On délia les jambes de Dolet.
Mais on resserra les liens qui attachaient ses mains.
Le cortège se forma.
Des confréries de pénitents noirs et blancs, en tête, portant de lourds crucifix, puis des théories de nonnes, puis des prêtres psalmodiant les prières des agonisants, puis des moines en quantité, tous couverts de cagoules et tous porteurs de gros cierges en cire.
Venait alors Dolet, entouré des moines.
Dolet marchait d’un pas très ferme.
Près de lui s’avançait le moine dont il avait remarqué le regard étrange.
À peine le cortège se fut-il mis en route que toutes les églises commencèrent à sonner le glas.
Dolet s’aperçut à peine qu’on se dirigeait vers la place Maubert et non vers la place de Grève.
Au loin, de l’autre côté du pont Saint-Michel, une sourde rumeur s’élevait.
Les gens de la Cité et de l’Université, à défaut de ceux de la ville, accouraient et se rangeaient le long des rues.
Le sentiment qui dominait cette foule était celui de la pitié. Mais d’imperceptibles mouvements de colère et d’indignation se manifestèrent.
Des hommes crièrent à voix haute qu’il était abominable de tuer un innocent et que son supplice retomberait sur l’official Faye, à qui on s’en prenait surtout de l’inique condamnation.
Le moine qui marchait près de Dolet vit ces larmes de la foule, et d’une voix pleine de cinglante ironie, murmura :
– Dolet pia turba dolet[3] !
Le condamné tressaillit ; il venait de reconnaître la voix de Loyola ! Il redressa la tête et répondit sans trembler :
– Sed Dolet ipse non dolet[4]. Ah ! c’est vous, monsieur de Loyola ? Eh bien, vous allez voir comment sait mourir un homme qui ne craint rien ; pas même vous en ce moment !
Bientôt on déboucha sur une étroite place autour de laquelle se massèrent les cavaliers, les soldats et les moines.
Ceux qui portaient des cierges entourèrent aussitôt le bûcher. On avait dressé une échelle pour arriver sur la plate-forme.
Le bourreau et ses aides s’approchèrent et voulurent saisir le condamné pour lui faire monter l’échelle.
– Arrête, bourreau, dit Dolet. Je ne veux pas être aidé.
En même temps Dolet monta les échelons, bien qu’il ne pût s’aider de ses mains attachées.
Arrivé sur la plate-forme, il se plaça contre le poteau.
Aussitôt, le bourreau l’y attacha solidement par une corde qui faisait plusieurs fois le tour du corps.
Dolet voulut commencer à parler.
Mais, sur un signe de Loyola, les moines entonnèrent le De Profundis d’une voix sauvage ; on ne peut entendre un mot de ce que disait l’infortuné savant.
Au même instant, le bourreau saisit une torche qu’un de ses aides venait d’allumer.
Mais Loyola la lui arracha des mains.
– Ainsi périssent les ennemis de Jésus ! cria-t-il furieusement.
Et il inclina sa torche vers les fagots secs qui formaient la base du bûcher.
En un clin d’œil, tous les cierges s’étaient baissés vers les fagots. Une fumée grise et odorante, comme la fumée qui s’élève des fours de boulanger, monta alors et enveloppa Dolet de ses tourbillons.
Quelques secondes encore, sa figure sereine apparut.
Soudain, les flammes montèrent, déchirèrent la fumée des zébrures écarlates : de larges flammes onduleuses, souples, se balançant au vent comme des drapeaux funestes et dardant vers le condamné des pointes qui semblaient siffler…
Une clameur, une immense et déchirante clameur de pitié monta de la foule…
Puis, tout à coup, ce fut une rumeur d’effroi ; des hurlements éclatèrent ; il y eut une fuite éperdue, et deux ou trois cents êtres hagards, échevelés, dégouttants d’eau, se ruèrent sur les cavaliers qui entouraient le bûcher, et, à leur tête, Lanthenay, Manfred, livides, forcenés !…
– Feu ! feu de toutes armes ! tonna Loyola.
Un homme à cheval commanda :
– Visez bien ! Feu !…
C’était Monclar.
Le tonnerre de deux cents arquebuses déchargées d’un coup roula sur ce quartier de Paris en même temps que le tonnerre des clameurs de la foule ; une cinquantaine de truands tombèrent ; parmi eux, Manfred, le bras fracassé.
– En avant ! hurla Lanthenay.
Une nouvelle décharge retentit lugubrement.
Des morts culbutèrent, des blessés se roulèrent avec d’énormes imprécations.
Cocardère et Fanfare toujours ensemble étaient tombés l’un près de l’autre.
– En avant ! hurlait Lanthenay sans s’apercevoir qu’ils n’étaient plus qu’une dizaine.
Ses yeux exorbités, fous, sanglants, s’étaient rivés à l’effroyable vision… là, à quelques pas de lui, par-dessus les têtes des moines et des soldats, la vision rouge, noire et grise, les flammes qui montaient, montaient en se tordant et en sifflant, montaient plus haut que le faîte des maisons voisines, le poteau calciné, l’immense brasier ardent qui s’écroulait en tisons écarlates, la fournaise monstrueuse au centre de laquelle un pauvre corps atroce à voir, convulsé, contourné sur lui-même, tordu, ratatiné, aminci, n’ayant plus figure d’homme, figure de quoi que ce soit de déjà vu, achevait de se consumer en grésillant !…
Tout à coup, la vision disparut…
Le bûcher s’écroula. Le poteau s’abattit…
C’était fini.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lanthenay, son poignard à la main, s’était rué.
Il allait droit devant lui, insensé, terrible, surhumain…
À chacun de ses pas, son bras se levait et s’abaissait dans un geste foudroyant, et un soldat tombait.
Il se frayait ainsi un chemin de sang vers Monclar qui, immobile sur son cheval, les yeux fixes, le voyait venir comme dans les cauchemars on voit venir la bête de l’Apocalypse.
Mais à chacun de ses gestes mortels, une sorte de grognement furieux déchirait sa gorge.
Il marchait à Monclar. Il le tenait.
Lanthenay atteignit le cheval de Monclar.
Il se ramassa sur lui-même.
Il prépara le bond prodigieux par lequel il allait se trouver poitrine à poitrine avec Monclar…
À ce moment, par derrière, une main sèche, violente et nerveuse s’appesantit sur sa nuque.
Cette main était celle d’une femme !
Et cette femme, c’était la Gypsie !
En un instant, vingt gardes furent sur Lanthenay.
La seconde d’après, il se trouva lié solidement.
XIII
APRÈS…
Monclar avait laissé tomber un regard sur la Gypsie.
C’était la deuxième fois que la vieille bohémienne sauvait le grand prévôt.
Et toujours elle le sauvait de Lanthenay.
Il se pencha vers elle.
– Que veux-tu ? demanda-t-il.
Dans son esprit, cela voulait dire :
– Quelle récompense désires-tu pour m’avoir sauvé ?
Elle répondit à voix basse :
– La grâce de cet homme !
Elle désignait Lanthenay.
Celui-ci ne l’avait pas aperçue encore. Il était entouré de soldats qui le liaient. En reconnaissant la voix de la bohémienne, il tourna vivement la tête vers elle.
Un soldat crut qu’il allait essayer une dernière tentative de résistance et lui asséna un formidable coup sur la tête.
Lanthenay tomba évanoui.
Mais avant de perdre connaissance, il avait eu cette pensée dernière :
– Pauvre Gypsie ! Bonne mère Gypsie ! Elle accourait me sauver !
Le grand prévôt avait froncé le sourcil. Il secoua la tête.
– Monseigneur, dit rapidement la Gypsie, je vous demande en grâce de vouloir bien me recevoir en votre hôtel.
– Soit. Viens ce soir à neuf heures.
– Je vous demande en grâce de ne rien ordonner contre Lanthenay avant de m’avoir entendue…
– Je t’accorde aussi cela.
Et entre les dents, il gronda :
– Il ne perdra rien pour attendre !
Satisfaite, la Gypsie s’était éloignée précipitamment.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lanthenay fut jeté sur une charrette, car on l’avait si étroitement lié qu’il lui eût été impossible de faire un pas.
Autour de la charrette, Monclar plaça deux cents cavaliers, l’estramaçon ou la lance au poing.
– À mon hôtel ! ordonna-t-il alors.
En effet, l’hôtel du grand prévôt était muni d’une demi-douzaine de cachots qui n’avaient rien à envier à ceux de la Conciergerie, du Châtelet ou de la Bastille.
Une heure plus tard, Lanthenay était enchaîné en l’un de ces cachots.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autour du tas de tisons noircis qui achevaient de se consumer tristement, il ne restait plus que les moines chantant les prières des morts, après avoir psalmodié les prières des agonisants. La foule avait pris la fuite au moment de l’arrivée des truands.
Manfred, on l’a vu, était tombé l’un des premiers, le bras fracassé. Il demeura évanoui pendant longtemps.
Lorsqu’il se réveilla dans une lueur de raison que lui laissa la fièvre, il se vit couché sur une paillasse, dans un triste et sombre taudis. Une femme le regardait.
– C’est vous qui m’avez sauvé ? demanda Manfred.
– Sauvé ? Je ne sais… C’est la Mésange et la Bigorne qui t’ont conduit ici…
– Qui êtes-vous ?
– Je suis Margentine ; vous ne savez pas ? Margentine la blonde…
Manfred ferma les yeux et se mit à murmurer des mots inintelligibles. Le délire le reprenait.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à Cocardère et Fanfare, ils avaient disparu.
Étaient-ils morts ? Ou seulement blessés ?…
Autour du brasier, la foule, maintenant, revenue de sa terreur, s’approchait et regardait silencieusement, avec une avide curiosité, ce tas de tisons et de cendres.
Du corps de Dolet, on ne voyait plus rien que quelques os qui se confondaient avec les tisons.
Il était alors environ trois heures de l’après-midi.
Les moines étaient toujours là.
Vers trois heures, donc, la foule se serrait autour des religieux. Une femme du peuple cria :
– Qu’on prenne au moins ses cendres et qu’on les enterre dignement en terre chrétienne !
Loyola entendit ces paroles, tressaillit, et parut sortir de la léthargie d’immobilité où il se trouvait depuis le matin. Il n’avait rien vu, rien entendu de l’attaque des truands.
Livide, sous sa cagoule, les yeux fixes, il n’avait pas perdu un détail du supplice, rêvant de supplices plus vastes, plus monstrueux.
Le cri de pitié de la femme le ramena à la réalité.
Il dit d’une voix forte :
Pas de faiblesse ! Pas de pardon pour l’impie et l’hérétique ! Mes frères, prenez ses cendres et vous les jetterez, vous les disperserez en quelque terrain vague !
De l’intérieur d’une charrette, le bourreau et ses aides sortirent une petite caisse en bois blanc et des pelles.
Deux moines saisirent les pelles. Les ossements du savant furent jetés dans la caisse que les deux moines, sans doute stylés à l’avance, emportèrent.
– Ainsi périssent les ennemis de Jésus ! cria encore Loyola.
Et sous cette voix menaçante la foule frémit et courba la tête.
– Amen ! répondit le chœur immense de 500 moines.
XIV
LA BOHÉMIENNE
En quittant Monclar, et en sortant de la place Maubert, la Gypsie s’était dirigée aussitôt vers la Cour des Miracles. Comme elle arrivait dans la rue des Mauvais-Garçons, elle vit devant elle deux hommes qui, sur une sorte de brancard improvisé, en portaient un troisième.
Près du brancard marchaient deux femmes qu’elle reconnut aussitôt pour deux ribaudes. Elle s’approcha, et, sur ce brancard, vit Manfred, blanc, les yeux fermés.
– Est-il mort ? demanda-t-elle.
– Oh ! non, évanoui seulement. Il a le bras cassé.
– Où le conduisez-vous ?
– Mais… nous allions chez vous, la Gypsie !
– Chez moi ! fit-elle d’une voix qui glaça les deux ribaudes… Je n’y serai plus ce soir ou demain… Et puis, croyez-moi, il ne serait pas en sûreté à la Cour des Miracles…
La Gypsie réfléchissait. Que se passait-il dans cette obscure conscience ? Était-ce un regard de pitié qui éclairait à ce moment ces yeux sauvages ?
– Conduisez-le chez Margentine ! dit-elle tout à coup.
– Chez la folle !… Ah çà, qu’avez-vous donc, la Gypsie ?…
– Croyez-moi, dit-elle, il faut qu’il soit chez Margentine… pour des choses… que vous ne savez pas… et que je sais, moi !
Les ribaudes se regardèrent, de plus en plus étonnées. Mais telle était l’autorité morale dont jouissait la Gypsie, telle était sa réputation de devineuse dans ce monde naïf et crédule, qu’elles ne firent plus d’objection.
Les deux hommes, à nouveau, soulevèrent le brancard et la bohémienne les vit entrer dans la maison de Margentine la Folle.
Arrivée chez elle, la Gypsie se mit à écrire assez longuement. Car elle savait lire, écrire et compter, sciences dont elle s’était d’ailleurs toujours gardée de se vanter.
Elle fit ce travail avec une tranquillité apparente qui eût stupéfié quiconque eût pu lire alors dans sa pensée.
Ayant achevé d’écrire, elle plia le parchemin, le cacheta, et se rendit en courant chez Margentine où elle vit Manfred installé sur une paillasse jetée par terre.
– Tu le soigneras ? demanda-t-elle.
– Oui, oui, fit Margentine ; il m’a défendue un jour que des hommes couraient après moi…
– Bien. As-tu besoin d’argent ?
Sans attendre sa réponse, elle mit quelques écus dans la main de Margentine. Puis elle reprit :
– Maintenant, veux-tu que je te dise, Margentine ? Eh bien, il te fera retrouver ta fille, si tu le gardes bien.
Margentine alla à la porte et plaça contre le battant une barre de fer.
– Qu’on vienne le toucher ! gronda-t-elle.
– Écoute ! continua la Gypsie, tu vois ceci ?
Elle montrait le pli cacheté.
– Eh bien, quand il sera guéri, mais pas avant, tu m’entends bien…
– Pas avant ! J’ai compris…
– Alors, tu lui remettras ce papier.
– Bon ! donnez !
Margentine prit le parchemin et alla l’enfouir dans une sorte de trou pratiqué dans le mur, qui servait d’armoire.
– Rappelle-toi, recommanda encore la Gypsie, pas avant qu’il ne soit guéri !
– Pas avant !…
– Bon ! songea la Gypsie, cela me donne plus de huit jours… plus de temps qu’il ne m’en faut.
Elle jeta sur Manfred délirant un dernier regard où perçait une aube d’émotion, puis elle sortit.
Rentrée chez elle, la Gypsie rassembla en un paquet un certain nombre d’objets précieux, notamment des bijoux, pour une somme assez considérable.
Elle mit dans une ceinture de cuir de l’or qu’elle tira d’une cachette, et ceignit la ceinture autour de ses reins, par-dessous les vêtements.
Elle songeait à Manfred, ou plutôt s’efforçait de songer à lui, grommelant des mots sans suite.
– Pouvais-je me douter que je m’attacherais à lui, et que j’en arriverais à souhaiter qu’il ne soit pas malheureux !… Oh ! ce Monclar ! comme il va souffrir !… Que Manfred, après tout, soit heureux… que m’importe !… Il ne peut plus maintenant m’enlever le fils du grand prévôt !… Va-t-il en verser des larmes !… Pourvu qu’il ne devienne pas fou !… Ou qu’il n’aille pas en mourir sur le coup !…
Lanthenay, coupable de rébellion, tentative d’enlèvement de Dolet à la Conciergerie, coupable d’avoir voulu tuer Ignace de Loyola, coupable d’avoir pénétré violemment dans le Louvre à la tête des truands, coupable de s’être rebellé contre l’autorité royale au moment de l’attaque de la Cour des Miracles, coupable enfin d’avoir conduit les truands contre Monclar sur le bûcher de Dolet, Lanthenay était perdu.
Il serait condamné après un semblant de procès.
Il serait pendu le surlendemain au plus tard.
Et elle, la Gypsie, assisterait au supplice.
Et lorsque Lanthenay aurait rendu le dernier soupir, elle se tournerait vers le comte de Monclar et lui dirait :
– Tu cherches ton fils depuis plus de vingt ans, tu le pleures… Regarde, le voici !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
À neuf heures du soir, la bohémienne se présenta à l’hôtel du grand prévôt. Sans doute des ordres avaient été donnés à son sujet, car elle fut aussitôt introduite.
On la conduisit dans le cabinet du comte de Monclar.
– Parle, dit-il avec une douceur qui ne lui était pas habituelle. Que me veux-tu ?
– Monseigneur, dit la Gypsie en faisant un violent effort pour ne pas trahir la haine qui débordait de son cœur, vous rappelez-vous que jadis, je suis venue vous demander une grâce ?
– Je me souviens, dit froidement Monclar.
– L’homme qu’on allait pendre, c’était mon fils… Vous souvenez-vous, Monseigneur ?
– Je me souviens, répéta Monclar.
– Oui, je sais que vous avez bonne mémoire, monseigneur.
– Peut-être l’as-tu meilleure encore que moi ! dit le grand prévôt d’une voix si profonde que la Gypsie tressaillit.
– Monseigneur, reprit-elle, j’ai bonne mémoire, en effet ! Car ce que j’ai souffert le jour où on a pendu mon fils, je l’ai souffert tous les jours, depuis l’affreuse matinée… Or, monseigneur, c’est si horrible qu’une nouvelle souffrance de ce genre me tuerait…
– Ah ! ah ! je te vois venir…
– Je vous ai deux fois sauvé la vie, monseigneur ; en échange, donnez-moi celle de Lanthenay…
– Mais je croyais que tu le haïssais…
– Moi, monseigneur ! Qui vous a dit cela ? qui a pu vous le faire croire ? J’ai besoin, il est vrai, de Lanthenay…
– Mais lorsque je suis tombé au pouvoir des truands, toi-même as pris soin de m’informer que Lanthenay voulait ma mort.
– Et qu’en est-il résulté ? demanda-t-elle avidement.
– Que je serai impitoyable comme il voulait l’être… Mais ceci ne m’explique pas ton attitude, qui me paraît étrange… Tu me dénonces Lanthenay, tu attires mon attention sur lui à plus d’une reprise, et tu viens me demander sa vie !
– Parce que j’ai besoin de lui, monseigneur ! Je ne l’aime ni ne le hais, je vous l’ai dit un soir… Mais j’ai besoin de lui… ne me le tuez pas…
– Et pourquoi as-tu besoin de lui ?… Parle sincèrement… Et je verrai, car je t’ai de grandes obligations.
– J’ai besoin de lui pour mener à bonne fin une œuvre de vengeance.
– Quelque truand que tu veux faire poignarder ?…
– On ne peut rien vous cacher, monseigneur ! Oui, il s’agit d’un truand, mais de l’espèce la plus vile, la plus hideuse !… Cet homme m’a fait un mal abominable… Et pour lui rendre dent pour dent, œil pour œil, selon la loi de Bohême, j’ai besoin de Lanthenay… Monseigneur, je savais qu’un jour ou l’autre, il tomberait en vos mains redoutables ! Et c’est pourquoi, je me suis préparé des droits à votre reconnaissance… Je vous ai sauvé… Sauvez-moi à votre tour en me laissant Lanthenay !
Le grand prévôt secoua la tête.
– Impossible ! dit-il sèchement.
– Impossible ! Ah ! ce même mot terrible que vous avez prononcé jadis ! Tenez, monseigneur, me voilà à vos pieds, comme alors ! Comme pour mon fils, je vous crie : Grâce ! pitié pour ce jeune homme !
La Gypsie s’était jetée à genoux.
– Il est si jeune, monseigneur ! Quoi ! Songez à cette chose affreuse : cet être jeune et beau, plein de vie, promis peut-être au bonheur d’une mère ou d’un père… On le saisirait, on lui passerait la corde au cou ! Et ce ne serait plus qu’un cadavre !… Songez au désespoir de son père, monseigneur !…
Le grand prévôt se leva :
– Assez ! dit-il. Après-demain, à l’aube, ce misérable aura payé tous ses crimes…
– Quoi ! dès après-demain !… Oh ! ce n’est pas possible, cela !… Et le procès, monseigneur ! Il faut bien qu’il y ait procès et condamnation !…
– Tu te trompes. Ce truand a été pris en flagrant délit. Il ne relève dès lors que de mon bon plaisir…
– Impitoyable ! Oh ! impitoyable !… Je ne trouverai donc pas de paroles pour toucher votre cœur !… Ah ! monseigneur, que j’aie au moins la triste consolation de lui faire un signe de pitié à ses derniers moments !… que je sache au moins le lieu et l’heure du supplice !…
– Soit : après-demain, huit heures du matin, à la Croix-du-Trahoir…
– Hélas ! rien ne peut donc le sauver !
– Rien au monde !…
– Une dernière fois, monseigneur, grâce pour cet infortuné jeune homme !
– Assez, te dis-je ! Relève-toi… et si tu n’as pas autre chose à me demander, va-t-en !
Elle se releva en essuyant ses yeux.
– Vous êtes terrible, dit-elle.
– Voyons, dit-il, que puis-je pour toi… en dehors de la grâce impossible que tu venais solliciter.
– Pour moi ? Rien, maintenant ! Adieu ! Rappelez-vous au moins que je vous ai supplié à deux genoux de gracier Lanthenay et de le laisser vivre… Car il est peut-être moins coupable que vous ne pensez… et peut-être… oui ! peut-être aurez-vous regret de l’avoir tué… oh ! monseigneur ! de l’avoir tué ! C’est vous qui le tuez… Vous pourriez d’un mot lui rendre la liberté…
– Allons ! tu recommences !… Va-t’en ! Et quant à sa culpabilité, ne t’en inquiète pas.
– Adieu, monseigneur.
Le grand prévôt fit un signe, et le laquais qui avait introduit la Gypsie la reconduisit.
– Vous n’avez donc pas réussi, ma pauvre femme ? dit cet homme qu’avait apitoyé le désespoir de la bohémienne.
– Hélas ! non… Vous avez vu…
– C’est qu’aussi ce truand est, paraît-il, un grand scélérat…
– Oh ! s’il, pouvait seulement s’échapper !…
– N’y comptez pas…
– Il est donc bien sévèrement gardé ?…
– Il a une chaîne à chacun de ses poignets et à chacune de ses chevilles ; il est dans un cachot qui se trouve à trente pieds sous sol ; il n’y a pas de soupirail à ce cachot… Rien ne peut le sauver… Allons, consolez-vous, que diable ! Ce n’est pas votre fils, après tout !
– Merci ! merci, mon brave homme ! murmura la bohémienne.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dehors, dans la rue noire et déserte, la joie furieuse de la Gypsie éclata en un rire funèbre, un rire de démente qui eût épouvanté le grand prévôt s’il l’eût entendu.
– Au moins, grondait-elle en marchant à grands pas, il ne pourra pas dire que je l’ai pas prévenu… Ah ! que j’ai eu peur tout à l’heure ! Cette grâce ! s’il me l’avait accordée !
Elle s’arrêta toute glacée à cette pensée.
– Mais non, reprit-elle, non, il ne pouvait pas faire grâce ! il est tel que je l’espérais… impitoyable… Impitoyable pour son fils ! Que va-t-il penser, que va-t-il dire quand il saura ! Pleurez, monsieur de Monclar, pleurez comme j’ai pleuré… Le voilà, votre fils ! Cet homme enchaîné dans un cachot – enchaîné par vous ! – cet homme qu’on va pendre – que vous allez pendre ! – c’est votre fils ! Ah ! ah ! je vous ai supplié de pardonner, je me suis traînée à vos pieds… Impitoyable ! C’est juste… c’est très bien… c’est admirable !
Puis elle continua :
– Voyons, voyons… il a dit après-demain matin, à la Croix-du-Trahoir ! Pourvu qu’il n’ait pas menti ! Cela m’est égal après tout. Dès demain matin, je m’installe devant la porte de Monclar et je n’en bouge plus ! Je serai là au bon moment… Que signifierait cette fête sans moi ! J’y serai, n’en doutez pas, Monsieur de Monclar !
XV
LE COMTE DE MONCLAR
Le grand prévôt fut sur pied de bonne heure, selon son habitude.
Il s’employa donc, dès son lever, à ses occupations ordinaires, c’est-à-dire qu’il reçut les rapports de ses agents, donna des ordres, dicta des lettres.
Vers neuf heures du matin, il reçut la visite du bourreau.
– Demain, à huit heures du matin, à la Croix-du-Trahoir, vous pendrez par le col le truand Lanthenay, détenu dans les cachots de mon hôtel… Allez !
Le bourreau s’inclina et sortit sans mot dire.
Alors, le grand prévôt regarda autour de lui. Il était seul. Un sombre ennui le dévorait de mélancolie. Il se leva, fit quelques pas, et s’approcha d’une fenêtre qui donnait sur la rue. Sur un vitrail, il appuya son front fiévreux.
– Cet homme va mourir, murmura-t-il. Je n’éprouve même plus de joie à la pensée de tuer un de ceux qui m’ont tué mon enfant… et elle ! Jadis, lorsque je pouvais faire pendre un de ces truands, une de ces Égyptiennes maudites, je ressentais une sorte d’affreux plaisir qui me déchirait et me délectait…
Maintenant, cette ressource m’échappe…
Et comme il n’arrivait pas à rafraîchir son front, il entr’ouvrit la fenêtre.
De l’autre côté de la rue, une femme, sous un auvent, causait avec un homme.
Monclar les reconnut tous les deux :
– La Gypsie ! Que fait-elle ici ? Et pourquoi parle-t-elle au bourreau ?
– A-t-elle essayé de corrompre le bourreau ? songea-t-il… Mais cet homme est incorruptible presque autant que moi-même. Il est de pierre. Rien ne le toucherait. Je lui aurais tout à l’heure donné l’ordre de pendre son frère, s’il en a un, qu’il se serait incliné avec la même indifférence, et demain, il aurait pendu son frère… Que fait là cette femme ? Qu’attend-elle ?
Cette insistance de la bohémienne le frappait. Il n’était pas éloigné de penser qu’elle avait un secret motif de haine contre Lanthenay.
– Mais alors, pourquoi est-elle venue me demander sa grâce ?
Dans le cabinet du grand prévôt, il y avait un crucifix suspendu à l’un des panneaux : un grand crucifix sur lequel un Christ d’argent massif penchait sa tête couronnée d’épines.
Au pied du crucifix, il y avait un prie-Dieu.
Monclar s’y jeta à genoux, enfouit son visage dans ses deux mains et pria.
On gratta à la porte. Monclar n’entendit pas.
– Dieu puissant ! murmurait-il, Dieu juste, Dieu bon, n’ai-je pas assez prié, n’ai-je pas assez souffert ?
La porte s’ouvrit. Loyola parut. Le moine, d’un geste, renvoya le laquais qui venait de lui ouvrir, puis referma doucement la porte et s’approcha de l’homme agenouillé.
– Seigneur ! Seigneur ! disait Monclar, n’aurez-vous donc pas pitié de moi ? Oh ! si je pouvais oublier ! Pourtant, Seigneur, j’ai tout fait pour vous être agréable… J’ai poursuivi d’une haine sans miséricorde les blasphémateurs et les hérétiques… J’ai été jusqu’à aliéner ma liberté et ma pensée en holocauste… Je ne suis plus que l’humble serviteur de la compagnie de Jésus… et pourtant, je ne retrouve pas la paix !
– Parce que vous ne croyez pas avec assez de ferveur ! dit durement Loyola.
D’un bond, le grand prévôt fut debout, les sourcils froncés… Il reconnut Loyola.
– Vous, mon père ! s’écria-t-il.
– Oui, mon fils. J’ai forcé vos gens à m’ouvrir cette porte ; la vérité m’oblige à confesser que j’ai dû employer la menace…
– Mon père, pour avoir introduit, fût-ce le roi, sans mon ordre, je les chasserais ; mais pour vous, mon père… attendez…
Il frappa. L’huissier et le laquais d’antichambre apparurent tremblants. Monclar leur jeta une bourse.
– Voici pour avoir obéi au révérend père qui me fait l’insigne honneur de me visiter ; quelque ordre qu’il donne, il est ici le maître ; entendez-vous !
Les deux valets se courbèrent, jetant sur Loyola un regard de crainte et d’admiration ; puis ils se retirèrent.
Loyola ne remercia pas le grand prévôt.
Il s’assit, tandis que le comte de Monclar demeurait debout, comme il eût fait devant le roi.
– Je vous disais donc, mon fils, que Dieu jusqu’ici n’a pas entendu vos prières, parce que vous manquez de foi… Jésus veut le sacrifice absolu, de notre chair et de notre pensée. Or, que lui offrez-vous ? Votre pensée va tout entière à ceux qu’autrefois vous avez chéris… Ce sont des affections humaines qui n’ont rien à voir avec l’amour de Jésus. Vous pleurez, mon fils, mais ce n’est pas sur l’iniquité des hommes qui blasphèment le nom du sacré cœur… Ce qui est en vous, c’est une douleur qui ne saurait être agréable à Dieu… Il faut vous donner tout entier. Jésus n’admet pas le partage. Il faut, dis-je, arracher de votre cœur toute pensée qui n’est pas à la gloire de la Société dont vous avez maintenant le bonheur d’être…
– J’y tâche, mon père… mais j’y tâche vainement.
– Rassurez-vous, la foi viendra, et avec la foi, la force ! Alors vous serez invincible. Alors, comme moi, vous détournerez votre âme de toute affection, de toute douleur, de toute joie, de toute émotion humaine… Alors, comme moi, vous jetterez sur ce pays de blasphème un regard de colère, et vous ne songerez qu’à venger Jésus… À propos… cet homme qui m’a frappé…
– Il est dans mes cachots, mon père ; demain, au point du jour, il expiera son crime.
– Il le faut ! Quiconque frappe un soldat de Jésus doit périr. Ainsi donc, rien ne peut sauver cet homme ?
– Rien, mon père… rien au monde !
– Je venais m’assurer de ce point important. Je venais aussi, mon fils, vous apporter mes félicitations. Vous serez une des colonnes les plus solides de notre ordre. Grâce à vous, l’impie qui corrompait ce pays a vécu… Demain, mon fils, je quitterai la France… N’oubliez pas que vous avez une mission de la plus haute importance… Je vais essayer de trouver dans les autres pays de l’Europe d’autres serviteurs de Dieu aussi fidèles que vous… mais j’en doute… Enfin, si déjà, par vous, nous tenons le roi de France, c’est déjà essentiel, car la France, mon fils, est notre pays d’élection. C’est ce pays que nous voulons conquérir…
– Je vous fais donc mes adieux, vénéré père…
– Non… pas encore, mon fils. Je veux, avant de partir, assister au supplice de ce misérable que vous avez si heureusement capturé. C’est une légère satisfaction que je m’accorde… un peu de repos dans ma vie de lutte sans trêves… Je tâcherai de voir cet homme avant qu’il n’aille au gibet. Peut-être pourrai-je en obtenir des renseignements précieux sur certains de ses compagnons.
Loyola se leva.
– À demain matin, en ce cas, mon père. Le supplice aura lieu à la Croix-du-Trahoir, à huit heures du matin.
Loyola fit un geste d’adieu et se retira, escorté jusqu’à la porte de l’hôtel par le grand prévôt.
Au moment où cette porte se refermait, Monclar constata que la Gypsie était toujours à la même place.
Et la même question, à nouveau, se posa dans son esprit :
– Que fait là cette femme ? Quelle secrète pensée la guide ? Ah çà ! Qu’est-ce que cela peut me faire, après tout ? Cette bohémienne veut absolument assister au supplice de ce truand… Pourquoi ? Peu m’importe… N’y pensons plus.
Plus la journée avançait, plus cela lui pesait de savoir que la Gypsie était là, immobile, les yeux fixés sur la porte de son hôtel. De temps à autre, il allait à la fenêtre pour voir si elle n’était point partie.
Il la voyait toujours à la même place.
Il eût pu la faire chasser.
Pour ne pas recourir à ce moyen, il se donna comme prétexte qu’en somme cette pauvre vieille lui avait sauvé la vie. Quel mal faisait-elle, d’ailleurs ?
Dans l’obscurité, Monclar cessa de la voir… mais il eut la perception nette qu’elle était toujours là…
Monclar s’installa comme pour passer la nuit à travailler. Cela lui arrivait souvent.
Et il se retrouva plusieurs heures après, n’ayant rien fait que de songer à la Gypsie.
Pas un instant, devant cette rêverie qui fut profonde, il ne pensa à Lanthenay.
Lanthenay ne comptait pas, n’existait pas. Mais la Gypsie prenait dans son esprit une importance énorme.
Minutieusement, il se retraçait les rares incidents où il s’était trouvé en contact avec elle et il cherchait à se rappeler avec précision ses paroles, ses gestes, sa physionomie, la signification de son regard.
Or, toutes ces choses se rattachaient, s’enchaînaient à deux faits :
Le premier… la bohémienne venant lui demander la grâce de son fils.
Le deuxième… la bohémienne le suppliant pour Lanthenay.
Quant au mystérieux rapport qui pouvait exister entre ces deux événements, il ne le saisissait pas.
Il se leva plein de colère et se mit à se promener avec agitation. Longtemps après, il se retrouva à sa table, réfléchissant toujours à la bohémienne.
Quatre heures du matin sonnèrent.
Il tressaillit et se leva en disant :
– Il faut que je descende voir cet homme dans son cachot…
XVI
LE FILS DU GRAND PRÉVÔT
Pendant ce temps, quelque chose de singulièrement important se passait dans l’esprit de Lanthenay. C’est donc à lui que nous allons maintenant nous attacher, sans quoi la suite de notre récit serait incompréhensible.
On a vu qu’au moment où, près du bûcher de Dolet, Lanthenay tournait la tête vers la Gypsie, un soldat lui avait asséné un coup violent, et qu’il était tombé évanoui.
On le jeta tout ligoté sur une charrette qui prit aussitôt le chemin de l’hôtel du grand prévôt.
Lanthenay revint à lui au moment même où on le faisait entrer dans la cour de l’hôtel dont la grande porte se referma.
Or, au moment où il ouvrait les yeux dans cette cour, il lui parut d’une façon précise, d’une façon évidente et irréfutable, il lui parut, disions-nous, qu’il se trouvait en présence d’un paysage familier.
On connaît la force irrésistible de ce singulier phénomène d’esprit qui s’appelle une association d’idées.
Lanthenay éprouva une de ces violentes surprises qui déroutent d’abord l’imagination et la laissent affolée.
Tout cela, d’ailleurs, dura une seconde.
– Je suis fou ! dit-il.
Les soldats qui étaient près de lui l’entendirent et se mirent à rire. Mais il n’y prêta aucune attention et referma brusquement les yeux.
– Voyons, réfléchit-il avec cette intensité et cette rapidité que l’esprit acquiert à certains moments de paroxysme, si je ne suis pas fou, si je ne suis pas le jouet d’un cauchemar ou d’une hallucination, il doit y avoir à ma gauche une porte à laquelle on accède par trois marches, et au-dessus de cette porte, une lanterne de fer…
La porte, les trois marches, la lanterne de fer lui apparurent. Lanthenay demeura comme épouvanté.
On le descendit dans le cachot, on l’enchaîna, on ferma la porte sans qu’il s’en fût aperçu.
Il fut comme hébété pendant quelques heures et ne se réveilla que lorsqu’il entendit la porte de son cachot s’ouvrir. Un geôlier lui apportait à manger.
– Mon ami, fit Lanthenay avec une anxiété qui faisait trembler sa voix, voulez-vous me rendre un immense service… Oh ! un service qui ne touche en rien votre consigne…
La voix de Lanthenay était suppliante.
Le geôlier hocha la tête et songea :
– Voilà donc ce terrible truand qui a tenu tête aux armées du roi ! Le voilà abattu, faible comme un enfant ! Ce que c’est qu’un bon cachot !
Et, à haute voix, il demanda rudement :
– Quel service ?
– Dites-moi seulement ceci… Est-ce que la porte qui est à gauche dans la cour, là-haut, ne communique pas avec un jardin ?
Le geôlier jeta un regard de défiance sur son prisonnier.
– Ne craignez rien ! s’écria celui-ci. Que pouvez-vous craindre !… Enchaîné comme je suis, je ne puis rien…
– C’est tout de même vrai… Oui, la porte communique avec le jardin de monseigneur le grand prévôt !
– Le jardin de monseigneur le grand prévôt… Dites-moi… oh ! dites-moi… est-ce qu’il n’y a pas dans ce jardin, de chaque côté de la porte, deux jeunes ormes ?
– Ma foi, il y a bien deux ormes… je ne sais s’ils sont jeunes.
– Encore une question, brave homme, une seule… Est-ce que, à partir de la porte, il n’y a pas une longue allée bordée de rosiers ?… Est-ce que cette allée n’aboutit pas à une petite terrasse qui surplombe les berges de la Seine ?…
– Tout cela est bien vrai, mais qu’est-ce que cela peut vous faire ?
Lanthenay poussa un cri déchirant et s’affaissa.
La commotion qu’il venait d’éprouver était si violente qu’une cervelle moins froide que la sienne n’y eût pas résisté.
Il ne savait plus s’il était arrêté, enchaîné, pourquoi…
Il n’y avait plus rien au monde que ce fait exorbitant :
C’est qu’il reconnaissait, comme s’il l’eût habité, l’intérieur de l’hôtel du grand prévôt !
Pourquoi ces souvenirs qui s’éveillaient en lui ?
Lanthenay essaya d’abord de se persuader qu’il se trouvait en présence d’une simple réminiscence.
– Voyons, je serai entré un jour ici… j’aurai traversé la cour… j’aurai franchi la porte à la lanterne de fer… j’aurai franchi le jardin dans toute sa longueur… Quand ai-je fait cela ? Je l’ai fait sûrement, puisque la seule vue de la cour m’a rappelé une foule de détails… Voyons… ne perdons pas la tête… Quand et à quelle occasion suis-je entré dans l’hôtel ?… Remontons le cours des années… Non… oh ! non… je ne retrouve pas ! Jamais je ne suis entré dans l’hôtel… jamais !… jamais !…
Il voulut prendre sa tête à deux mains, et s’aperçut alors qu’il était enchaîné. Il s’accroupit, ferma violemment les yeux… Pourtant il était dans la nuit noire… mais cette nuit même gênait son effort…
– Jamais je ne suis entré !… Voyons… peut-être quelqu’un qui est entré m’a-t-il exactement dépeint l’intérieur… et cette description m’est restée dans la tête ? Qui m’a dépeint ce que je vois ?… Qui ? Oh ! personne ! personne !
Il haletait, sentait craquer en lui ses nerfs…
– Si je remonte le cours des années, aussi loin que j’aille, je me vois à la Cour des Miracles… Là… peut-être quelque truand qui aura été arrêté m’aura raconté… Mais non ! Oh ! ces éclairs qui traversent mon cerveau ! Oh ! Est-ce que le truand m’aurait raconté ce que je vois ! Je vois ! Je vois !… L’escalier de pierre qui conduit là-haut… là… le vaste vestibule… puis le cabinet où travaille un homme jeune et souriant… puis la chambre où je suis… oh ! voyons… comment suis-je ?… je suis debout… près d’une jeune femme… et quelqu’un devant nous travaille… Qui est ce quelqu’un ?… Je vois !… c’est un peintre… il fait notre portrait… mon portrait à moi… et celui de la jeune femme… ma mère… ma mère !
Ce mot « ma mère ! » fît, pour ainsi dire, explosion dans la pensée de Lanthenay en même temps qu’il jaillissait de ses lèvres en une rauque clameur discordante.
Si rien n’avait été changé à la disposition de l’hôtel, il pouvait en retracer les moindres détails, depuis la grande salle de réception jusqu’à l’office, depuis la chambre où se trouvait son lit, un petit lit en forme de bateau, avec rideaux de mousseline, jusqu’aux écuries où il allait parfois regarder les chevaux, jusqu’au corps de garde où les soldats lui faisaient toucher les immenses hallebardes et le prenaient dans leurs bras…
Il avait habité l’hôtel. Sa première enfance s’y était écoulée. Il y était né !
Alors, la conclusion se dressa devant lui, effrayante, horrible :
C’est qu’il était le fils du grand prévôt !
Il essaya d’abord de se convaincre que cette conclusion n’était pas absolument rigoureuse. Il pouvait être né dans l’hôtel, au moment où il était habité par quelque autre.
Mais il était notoire que M. le comte de Monclar avait toujours occupé l’hôtel de la prévôté depuis qu’il avait été investi des terribles fonctions dont il s’acquittait avec une si froide et si constante cruauté.
Il était non moins notoire que M. de Monclar était grand prévôt depuis plus de trente ans.
Lanthenay, convaincu qu’il était bien le fils du grand prévôt, ne songea pas une minute que cela pouvait le sauver. Cette conviction ne lui apporta qu’une nouvelle douleur.
L’acharnement de Monclar avait tué Dolet.
Voilà, surtout, ce qui surnageait de sa méditation : il était le fils de l’assassin d’Étienne Dolet !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La nuit avançait.
Un peu de calme revenait lentement dans l’esprit du jeune homme.
Il n’avait pris aucune résolution en ce qui concernait Monclar.
Il n’était pas probable qu’il le revît, pensait-il.
Nous devons ajouter que Lanthenay ne savait pas son supplice si proche. Il s’attendait à passer en jugement et ignorait la résolution que le grand prévôt avait prise.
Toute cette partie de la nuit s’écoula donc sans qu’il eût arrêté son esprit sur son supplice.
Cela ne lui apparaissait que comme une chose vague et lointaine.
Il songeait seulement qu’il venait de retrouver son père, et que loin d’en éprouver une joie, il n’en ressentait qu’une sorte d’horreur dont il n’arrivait pas à triompher.
Ce fut à ce moment qu’il entendit le bruit des verrous de son cachot.
La porte s’ouvrit : M. de Monclar apparut.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le grand prévôt s’était levé de son fauteuil en disant :
– Il faut que je descende voir cet homme !
À ce moment-là, il était quatre heures du matin.
Il y avait au rez-de-chaussée, un corps de garde où dormaient quelques geôliers. C’est à cette salle que commençait l’escalier qui descendait vers les cachots.
– Venez m’ouvrir la porte du prisonnier, dit Monclar.
Le geôlier auquel il s’adressait prit les clefs.
– Monseigneur descend seul ? demanda-t-il.
– Oui, Pourquoi cette question ? fit le grand prévôt.
L’homme s’arrêta, embarrassé. Car ce lui était en effet une grande audace que d’interroger le grand prévôt, même quand la question lui était dictée par un bon sentiment.
– Monseigneur me pardonnera, bredouilla-t-il.
Au bas de l’escalier, il y avait un caveau en forme de rotonde. Autour de cette rotonde, cinq ou six portes massives, bardées de fer, munies de verrous énormes.
Le geôlier se dirigea vers l’une des portes.
Mais Monclar l’arrêta par le bras.
– Tu m’as posé une question, là-haut ? demanda-t-il.
Question bien simple pourtant et à laquelle, en tout autre moment, le comte de Monclar n’eût prêté qu’une médiocre attention… Mais il était dans une situation d’esprit telle que les choses les plus insignifiantes prenaient un relief extraordinaire.
– Oui, monseigneur, répondit le geôlier tremblant.
– Répète-la…
– Puisque monseigneur l’ordonne !… Je demandais à monseigneur s’il descendait seul dans le cachot du prisonnier.
– Seul !… Qu’entends-tu par là ?
– Je voulais savoir si monseigneur ne se ferait pas escorter de quelques gardes…
– Ah ! ah ! fit Monclar avec un sourire. Tu avais peur pour moi… Merci, mon brave !
– C’est que, monseigneur… fit le geôlier enhardi.
– Parle franchement, je te l’ordonne.
– Eh bien, monseigneur, le prisonnier est devenu fou !
– Fou !… Allons donc !…
– Oui, monseigneur, fou ! Tout ce qu’il y a de plus fou ! Et on dit que les fous acquièrent une force extraordinaire… je pouvais donc croire…
Monclar demeura un moment tout songeur.
– Et comment sais-tu que cet homme est devenu fou ? demanda-t-il alors. En quoi consiste sa folie ? A-t-il crié, menacé ?…
– Non, monseigneur…
– Alors ?…
– Alors, voilà, monseigneur. Lorsqu’il est arrivé, ou plutôt lorsqu’on l’a transporté dans l’hôtel, au moment où la charrette s’arrêtait dans la cour, il est revenu de son évanouissement, il a ouvert les yeux, regardé autour de lui… Les soldats qui l’entouraient l’ont vu pâlir comme s’il eût reçu sur la tête un autre coup aussi bien asséné que celui qui l’avait mis en cet état…
– Achève donc !
– Eh bien, les soldats l’ont donc vu pâlir, et l’ont entendu s’écrier : Je deviens fou :… Et il est certain qu’il avait l’air très singulier, monseigneur.
Monclar haussa les épaules.
– Mais ce n’est pas tout, monseigneur, fit le geôlier qui tenait à donner à son chef une preuve de sa sagacité et peut-être par la même occasion préparer son avancement.
– Qu’y a-t-il encore ?
– Ce qui me reste à dire est encore plus curieux, monseigneur… Vous saurez donc que vers la fin de la journée, je suis descendu voir le prisonnier. C’était l’heure où je devais lui porter à manger. Je me suis donc muni d’un pain réglementaire et d’une cruche d’eau et je suis descendu.
– Continue ! dit Monclar d’un ton bref.
– J’y arrive, monseigneur. Me voilà donc descendu. Je pose la cruche dans un coin, près du prisonnier. Bon. Je lui montre le pain. Bon. Je reprends ma lanterne et je me dispose à me retirer. Alors, monseigneur, voilà que le prisonnier, qui n’avait fait attention ni au pain ni à la cruche, ce qui est déjà mauvais signe pour un homme qui devait sans doute mourir de faim et de soif…
– Achève donc, imbécile !…
– Voilà donc que le prisonnier se met à me regarder… mais avec des yeux si doux, si implorants, si pleins de larmes que moi, qui ne me laisse pas facilement attendrir, je me suis senti tout bouleversé… C’est peut-être mal, monseigneur, de la part d’un geôlier…
– Non, fit doucement Monclar.
Et il dit ce « non » machinalement, sans savoir.
Et à peine l’eût-il dit qu’il en fut stupéfait.
C’était lui, lui Monclar, qui disait cela !
– Oh ! monseigneur ! s’écria le geôlier, voilà que vous parlez exactement comme lui… ou plutôt… c’est le son de la voix qui est tout pareil…
– Continue ! fit sourdement le grand prévôt.
– Alors, il me parle. Il me pose des questions.
– Une tentative d’embauchage ! songea le grand prévôt en revenant à lui. Il t’a parlé !… Tu ne lui as rien dit, j’espère !…
– Voilà, monseigneur !… Je lui ai répondu… mais je n’ai pas cru mal faire… Monseigneur va en juger.
– Tu sais pourtant que c’est défendu !
– Oui, monseigneur…
– Enfin, que t’a-t-il dit ?… Il t’a offert de l’argent…
– Eh bien, non, monseigneur ! Je me suis d’abord méfié, comme monseigneur peut croire. Mais j’ai bien vu tout de suite que le pauvre diable, loin de songer à fuir, avait complètement perdu la tête…
– Voyons donc ce qui t’a fait penser cela ?
– Il s’est mis à me poser des questions… des questions sans queue ni tête… s’il y avait bien deux ormes à l’entrée du jardin de monseigneur, si l’allée des rosiers aboutit bien à une terrasse au bord de l’eau, enfin, des choses pareilles qui n’ont aucun intérêt…
– C’est tout ? fit Monclar.
Cette pensée lui venait, très nette, que le prisonnier avait cherché à avoir un plan de l’hôtel pour le cas d’une évasion. Évasion impossible, il le savait bien !
– Mais l’espoir est si tenace au cœur des prisonniers ! pensa-t-il.
– C’est tout ce qu’il a demandé, monseigneur, reprit le geôlier ; mais dans tout cela, voyez-vous, ce qu’il y a eu de plus bizarre, c’est la façon dont il me parlait, et encore la façon dont il accueillait mes réponses. Quand je lui ai dit qu’il y avait deux ormes de chaque côté de la porte du jardin, il a paru tout à fait égaré, comme si je lui avais annoncé un événement extraordinaire. Vous voyez qu’il est fou, monseigneur… Faut-il aller chercher quelques gardes ?…
– N’est-il pas enchaîné ?…
– Oui, monseigneur.
– C’est bien… laisse-là tes clefs et la lanterne, et va-t’en.
Le geôlier se retira sans surprise.
Cependant, comme le geôlier commençait à remonter l’escalier, il le rappela d’un mot.
– À propos… fit-il.
– Monseigneur ? dit l’homme en s’arrêtant.
Monclar réfléchit quelques instants. Puis il dit :
– Non, rien… Va-t’en.
Cette fois, le geôlier disparut.
En rappelant cet homme, le comte de Monclar avait subitement songé à la Gypsie, et le mot qui lui était venu à l’esprit avait été celui-ci :
– Assure-toi donc si une sorte de vieille bohémienne qui a passé la journée sous un auvent en face de l’hôtel est toujours là…
Puis, non moins brusquement, il jugea la question inutile.
Pourquoi, à la suite des bavardages du geôlier, le grand prévôt, avait-il coup à coup pensé à la Gypsie ? Pourquoi, maintenant, les deux figures de la bohémienne et du prisonnier demeuraient-elles unies dans son esprit ?
Il se faisait dans la pensée de Monclar un travail qui l’étonnait. Qui se fût trouvé près de lui à ce moment l’eût entendu murmurer :
– Pourquoi la Gypsie est-elle si acharnée à la mort de cet homme ? Car voilà la lumineuse vérité ! Elle veut le voir mourir… Sa scène d’hier n’est qu’une comédie…
Il avait laissé la lanterne à terre, là où le geôlier l’avait posée. Les bras croisés, son menton dans une main, les yeux étrangement fixés sur la porte du cachot de Lanthenay, il rêvait profondément.
Il murmura encore ceci :
– Pourquoi cet homme a-t-il demandé ces détails sur l’hôtel ?… Ce ne peut être pour s’évader. Il est trop intelligent pour ne pas avoir vu tout de suite l’impossibilité de l’évasion…
Il y eut un grand quart d’heure de silence pesant, pendant lequel les pensées de Monclar évoluèrent, roulèrent comme des nuées d’orage, et enfin, la rêverie aboutit à cette question nouvelle qui fit frissonner le grand prévôt :
– Mais, au fait, comment connaît-il ces détails ?
Alors, lentement, il ramassa la lanterne, fit manœuvrer les verrous, ouvrit la porte et pénétra dans le cachot de Lanthenay…
Monclar dirigea le jet de lumière de sa lanterne sur le visage de Lanthenay et le regarda, nous pourrions dire l’étudia, avec une avidité telle que son cœur battait à grands coups.
Lanthenay, cependant, l’examinait ardemment.
Son premier regard fut un regard de haine absolue, de haine mortelle, de haine furieuse.
Et sa première parole fut :
– Assassin !
Monclar avait posé sa lanterne et s’était avancé de deux pas.
Le mot « assassin ! », il ne l’avait pas entendu.
Il s’approcha, disons-nous, et d’une voix sourde qui contenait un monde d’angoisse, il demanda :
– Ces questions que vous avez posées au geôlier… tout à l’heure…
Il s’arrêta, n’osant pas, ne sachant pas ce qu’il allait dire.
– Terreur et folie ! songeait Lanthenay. Est-ce que je ne rêve pas ! Est-ce que ma raison ne va pas sombrer ici !… Quoi ! C’est là mon père !… Mon père… Mon père qui vient voir si je suis bon à jeter au bourreau !
Un sanglot déchira sa gorge.
– Vous pleurez ! fit Monclar d’une voix dont la douceur l’épouvanta.
Ah çà ! que se passait-il donc ?
Et il se trouvait bouleversé par ce sanglot !
Lui !… Lui !…
Haletant, torturé, brisé par un sentiment pour lequel il n’y a pas d’expression, puisque ce sentiment ne répondait à rien de positif et de normal, le comte de Monclar reprit :
– Ces questions… ces questions posées au geôlier… dites… voulez-vous me les poser à moi…
Lanthenay demeura une longue minute sans répondre.
Ce n’est pas qu’il ne sût que dire…
Mais tant de choses se pressaient sur ses lèvres !…
Enfin, il parla :
– À vous !… oh ! ce ne sont pas des questions… À vous !… c’est une description que je veux faire !…
– Une description ! haleta Monclar.
– Là-haut… une chambre… une grande belle chambre tendue de vieilles tapisseries… L’une des tapisseries représente les quatre fils Aymon… Une autre représente Roland avec sa bonne épée… Les deux autres… oh !… les deux autres… je ne sais plus…
Hypnotisé, livide, secoué d’un tremblement convulsif, le front couvert de sueur, Monclar écoutait.
Lanthenay continua :
– Il y a de grands fauteuils en bois noir dont les bras sont figurés par des chimères et dont les dossiers portent un écusson… L’écusson… je le vois… non… je ne sais plus…
– Après ! Après ! râla Monclar, vacillant.
– Deux fenêtres… elles ouvrent sur un vaste jardin… elles sont ouvertes… le soleil entre à flots, avec des parfums de roses… car il y a dans le jardin toute une longue allée bordée de roses…
– Après ! oh !… après !…
– On a tiré l’un des fauteuils près de la deuxième fenêtre ; tout près… je dis bien… oui, la deuxième fenêtre… en entrant par le cabinet… En arrière du fauteuil tombe le rideau de la fenêtre… un rideau de soie brodée… sur le fauteuil est assise une femme… oh ! elle est jeune, si belle… si radieuse… Un peintre est là qui travaille à son portrait… Un homme est entré… il a baisé au front la jeune femme… et elle !… elle l’a regardé avec amour… puis l’homme a examiné le travail du peintre… il lui a fait des éloges en souriant… puis il est entré dans son cabinet… après avoir tapoté les joues de l’enfant… Et l’enfant s’appuie contre sa mère… et l’enfant… oh !… il sourit de toute son âme… il est heureux… heureux comme jamais, depuis, il ne l’a été… jamais !… Car il n’a plus que son père maintenant… Et alors… il avait sa mère… ma mère !
– Mon fils !
Ce mot sortit à grand’peine, comme un souffle, des lèvres tuméfiées de Monclar… Il voulut s’avancer, titubant, ivre, fou, en plein délire… Mais, au premier pas, il s’abattit comme une masse, blême, inanimé… mais le visage transfiguré, la bouche détendue en un sourire d’extase !…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lanthenay fit un surhumain effort pour aller plus loin que la longueur de ses chaînes.
Il gémissait comme un petit enfant qui pleure.
Et il répétait, sans savoir, sans s’entendre :
– Mon père… mon père…
En s’allongeant, en faisant saigner ses poignets et craquer ses muscles, il parvint à saisir Monclar et, violemment, avec un cri rauque, l’attira à lui, le mit sur ses genoux, l’enveloppa de ses bras chargés de chaînes, et la pluie chaude de ses larmes réveilla le grand prévôt !…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Mon père !… Mon père !…
– Mon enfant !… Mon fils !…
Pendant dix minutes, on n’entendit, dans le noir cachot, que le sublime concert de leurs gémissements, de leurs paroles bégayées, balbutiées, incohérentes, sans expression humaine…
Monclar regardait son fils comme il eût regardé quelque miraculeux phénomène.
– Laisse que je te voie, murmurait-il. As-tu toujours ce bon petit rire clair et joyeux ? Cela devait arriver, vois-tu !… Je savais que tu vivais… je pensais trop à toi… Et toi, as-tu quelquefois pensé à moi ? Comme tu es grand et fort ! C’est incroyable… Qui t’a élevé… voyons ! Je veux savoir… les braves gens qui t’ont élevé… Si ! Je veux faire leur fortune…
Lanthenay répondit machinalement :
– Une bohémienne de la Cour des Miracles… On l’appelle la Gypsie…
– La Gypsie ! rugit le grand prévôt.
Il bondit sur ses pieds, et, sans songer qu’il laissait son fils enchaîné, s’élança hors du cachot, monta l’escalier en quelques sauts, traversa en courant le corps de garde et la cour…
Une lumière aveuglante se faisait dans son esprit.
Il comprenait enfin le drame de sa vie !
– La Gypsie ! grondait-il. Oh ! pourvu qu’elle soit encore là !
Oui ! Elle était encore là !…
En un instant, il fut sur elle. Il la saisit violemment par le bras, l’entraîna sans prononcer une parole.
Et quand ils furent dans son cabinet :
– Alors, bohémienne, tu veux assister au supplice de Lanthenay ?
La Gypsie tressaillit. La voix altérée du grand prévôt, cette manière folle de venir la chercher, de l’entraîner, cette question étonnante, tout lui disait qu’elle était menacée d’une catastrophe.
– Monseigneur, dit-elle, attentive, je vous demande encore sa grâce…
– Sa grâce ! Il est trop tard ! Il m’échappe !
– Évadé ! gronda la bohémienne.
– Mieux qu’évadé ! Mort !
La Gypsie comprit dès lors, ou crut comprendre l’attitude du grand prévôt.
– Mort ; répéta-t-elle. Mort… comment ?
– Il s’est tué ! Je te dis qu’il m’échappe !
– Vous êtes sûr qu’il est bien mort ?
– Il est mort, te dis-je ! fit Monclar en pâlissant.
– Et rien ne pourrait le ranimer ?
– Rien ! Les médecins ont tout essayé…
La Gypsie éclata d’un rire funèbre. Farouche, elle marcha vers Monclar.
– Je rêvais, fit-elle d’une voix stridente, je rêvais d’une autre vengeance…
– Que veux-tu dire, vieille folle ?
– Ce n’est pas moi la folle ! continua-t-elle. Je rêvais mieux… Mais je sais me contenter ! Et vous dites donc qu’il est mort, monseigneur ?
Monclar fit un signe de tête affirmatif.
– C’est donc dans vos cachots qu’il est mort ?
– Oui ! Dans mes cachots.
– Arrêté par vous ?
– Par moi !
– Ah ! C’est donc vous qui l’avez tué ! Vous ! Vous !…
– Oui, c’est moi !
– Eh bien, misérable ! sache-le donc ! Ce jeune homme… ce Lanthenay ! Tu avais un fils, tu avais une femme !… Je vins te demander d’épargner la chair de ma chair ! Et tu fus impitoyable ! Ton fils ! c’est moi qui le volai ! Entends-tu ? C’est moi ! C’est moi qui l’élevai ! C’est moi qui en fis un truand ! C’est moi qui le désignai à tes coups ! Et ton fils, grand prévôt, c’est Lanthenay… Va l’embrasser et pleurer sur son cadavre !
– Sorcière d’enfer ! Ta vengeance t’échappe. Meurs de rage comme j’ai failli mourir de douleur ! Il est vivant. Il vivra !
La Gypsie ouvrit des yeux exorbités. Sa gorge voulut exhaler un cri… Elle n’en eût pas le temps. Elle tomba en arrière, tout d’une pièce, toute raidie…
Sans plus faire attention à elle, Monclar s’élança vers les cachots…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La bohémienne demeura évanouie quelques minutes.
Elle ne cria pas, ne dit pas un mot.
Chancelante, elle se dirigea vers la porte.
Était-elle prisonnière ? Non ! la porte était ouverte !
Elle descendit, traversa la cour, et comme on l’avait vu entrer avec le grand prévôt, comme aucun ordre n’avait été donné contre elle, on la laissa sortir sans difficulté.
Dans la rue, la Gypsie respira largement.
Elle se tourna vers l’hôtel, sur lequel elle darda un regard de haine. Son poing se tendit, menaçant. Elle murmura :
– Tout n’est pas fini encore !
Puis elle s’enfonça dans les profondeurs de Paris.
XVII
LE GRAND MAITRE
Le comte de Monclar était redescendu précipitamment au cachot de Lanthenay, répétant avec une obstination où il y avait sûrement un commencement de démence :
– Plus de doute ! c’est bien mon fils !
Il pleurait maintenant.
Il se jeta sur Lanthenay et lui dit :
– Viens !
Lanthenay lui montra ses chaînes.
– Triple fou ! J’ai fait enchaîner mon fils ! Et je ne pense même pas à le délivrer !
Remonter au corps de garde, prendre la clef des cadenas, redescendre en quelques bonds furieux, tout cela fut pour Monclar l’affaire de quelques secondes.
Alors, il essaya d’ouvrir les cadenas.
Mais sa main tremblait trop.
– Attends, attends, c’est la serrure qui est rouillée…
Et ce fut Lanthenay lui-même qui ouvrit les deux énormes cadenas.
Les chaînes s’affaissèrent à grand bruit, si bien que deux geôliers descendirent en toute hâte et apparurent à la porte du cachot.
Monclar les vit. Il marcha sur eux, sa dague à la main.
– Qui vous a appelés ! grogna-t-il. Le premier qui remue, je le tue comme un chien !
Les geôliers, épouvantés, effarés, disparurent. Alors Monclar revint à Lanthenay. Il prit ses mains :
– Tes pauvres mains… Tu as beaucoup souffert, dis ?
– Non, mon père, ce n’est rien…
– Et tes poignets ! Oh ! tout meurtris ! tout contusionnés !… Oh ! ces maudites chaînes…
– N’y pensons plus, père…
– Père !… Ah ! comme c’est bon de s’entendre appeler ainsi ! Il y a plus de vingt ans, sais-tu, que je n’ai entendu cela ! Et comme j’attendais ! comme je cherchais à m’imaginer ta voix !…
– Pauvre père !…
– Alors, voyons, dis-moi… tu pensais quelquefois à ton père ? Tu cherchais à te souvenir, dis ? Comme tu as dû souffrir…
– De cela, oui, j’ai souffert, dit Lanthenay. Et justement parce que je n’arrivais pas à me souvenir…
– Viens… Non… Restons encore ici… C’est ici que j’ai retrouvé mon fils ! Mon fils !… Seigneur ! Ai-je assez pleuré !… Alors tu n’arrivais pas…
– Parfois, des éclairs traversaient mon esprit… il me semblait que si j’avais pu trouver le bout du fil, j’aurais débrouillé l’écheveau de mes souvenirs… C’est ce qui m’est arrivé en entrant dans la cour de l’hôtel… mes souvenirs se sont éveillés l’un après l’autre… C’est la lanterne de fer… Parce que, un jour… vous souvenez-vous, père ? Un jour vous m’aviez donné… quoi… je ne me rappelle plus… quelque chose avec quoi je jouais… et qui alla s’accrocher à la lanterne.
– Je me souviens… un volant… avec des plumes rouges !
– Oh ! c’est cela !… je voyais bien quelque chose de rouge…
– Parle ! parle encore !…
– Ce fut un soldat qui décrocha mon volant… Et la lanterne m’était bien restée dans les yeux…
– Dire que l’an dernier, j’ai failli la faire ôter de là !
– J’aurais reconnu tout de même, père… il y avait d’autres indices…
– Pardieu ! tu aurais sûrement reconnu que ton vieux père était là ! Il le fallait, vois-tu… Mais comme tu parles bien ! Tu t’exprimes avec une aisance… une facilité…
– C’est votre indulgence paternelle.
– Non, non… certes… On dirait que tu as été instruit… Qui t’a instruit ? Quel homme vénérable et bon entre tous a pris soin de ton éducation ?… car ce n’est pas cette horrible sorcière…
Lanthenay, devint livide, sa joie tombée d’un coup. Il fut sur le point de dire le nom de Dolet ; mais cet esprit généreux gardait pour lui toutes ses douleurs…
D’ailleurs, Monclar, avec cette mobilité, avec cette volubilité fiévreuse qui se remarquaient dans ses paroles et ses gestes depuis qu’il était dans le cachot, s’écriait :
– Fou que je suis ! Je te garde là, dans cet infect cachot… Et tu dois mourir de faim… Viens, viens… je vais te faire préparer un souper réconfortant.
À ce moment, une ombre se dressa devant la porte du cachot. Et la voix de Loyola gronda :
– Eh bien ! que signifie ? Un grand prévôt qui fait évader un prisonnier ! Devenez-vous fou, comte de Monclar !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oui, c’était Loyola qui parlait ainsi.
L’heure du supplice de Lanthenay approchait, et le révérend venait offrir les consolations de la religion au prisonnier, ce qui était une grande marque de l’estime où il le tenait. Car il ne se fût pas dérangé pour d’autres prisonniers, eussent-ils été d’illustres seigneurs.
Mais Lanthenay lui avait tenu tête avec une audace qui l’avait déconcerté ; Lanthenay l’avait dangereusement blessé, lui qui se croyait invincible à l’épée.
De tout cela, il résultait que la haine de Loyola pour Lanthenay s’était décuplée.
Peut-être le haïssait-il plus qu’il n’avait haï Dolet.
À l’aube, donc, Ignace de Loyola était sorti en toute hâte du monastère où il s’était réfugié depuis son aventure du Trou-Punais, et avait pris le chemin de l’hôtel de la grande prévôté.
En arrivant à l’hôtel de la grande prévôté, Loyola vit des gardes et des domestiques rassemblés dans la cour et, à voix basse causant avec animation.
Dès qu’il apparut, les conversations cessèrent, et tous ces hommes prirent cette attitude humble et penchée, particulière aux laquais qui se trouvent soudain en présence d’un maître.
L’ordre donné par Monclar lui-même d’obéir, en toute occasion, au moine, le respect singulier que le grand prévôt lui avait témoigné, la peine qu’il avait prise de l’escorter lui-même jusqu’à la porte, d’autres indices encore avaient contribué à donner aux domestiques une haute idée de Loyola. Avec l’instinct spécial des serviteurs, ils devinaient en lui un redoutable personnage, si haut placé que le comte de Monclar, devant qui tremblaient la cour et la ville, tremblait à son tour en sa présence.
Loyola avait, du premier coup d’œil remarqué que quelque chose d’étrange avait dû arriver.
Il se dirigea vers le sergent qui commandait le poste.
– Que se passe-t-il, mon brave ? demanda-t-il.
– Mon père, fit le soldat d’un ton embarrassé, rien de bien grave…
– Où est M. le comte de Monclar ?
– Justement… c’est de cela que nous causions… Monseigneur le grand prévôt est dans les cachots, causant avec un prisonnier…
– Lanthenay ?…
– C’est cela, mon révérend…
– Eh bien, qu’y a-t-il d’extraordinaire ?
Le sergent se tut, n’osant répéter ce que les gardes et les domestiques étaient en train de se dire.
– Conduisez-moi auprès de M. le grand prévôt, fit brusquement Loyola.
– Tout de suite, mon révérend, dit le sergent qui n’était pas fâché d’aller voir ce qui se passait dans le cachot de Lanthenay.
Mais son espoir fut trompé. Car, à la dernière marche, le moine le renvoya d’un geste.
Loyola s’arrêta au pied de l’escalier.
Immobile, le cou penché vers la porte du cachot demeurée ouverte et vaguement éclairée par la lanterne de Monclar, le moine écouta…
Et quand il eut entendu ce que se disaient le père et le fils, quand il eut compris que Lanthenay lui échappait, le moine eut un effroyable sourire de haine.
En lui, l’ancien chevalier, le rude jouteur d’armes, l’impétueux manieur d’estramaçon disparurent : il ne demeura que le sombre rêveur de despotismes surhumains, le patient et sinistre théoricien qui avait inventé que la fin justifie les moyens…
D’un pas léger, il remonta au corps de garde, montra un papier au sergent, lui donna des ordres rapides et clairs…
Puis, avec son même sourire, il descendit.
À la voix de Loyola, Lanthenay tressaillit d’angoisse, une sueur perla à son front et, machinalement, il chercha à son côté son poignard absent.
Mais Monclar avait jeté un cri de joie.
– Mon père ! s’écria-t-il en s’avançant vers le moine, comme vous allez être heureux du bonheur qui m’arrive ! Ah ! soyez béni cent fois !… Car je n’en doute pas, c’est par l’intercession de vos prières que…
– Comte de Monclar, interrompit rudement Loyola, vous avez le délire ! Quoi ! c’est vous qui délivrez les rebelles ! Car cet homme, vous le savez, est rebelle, traître à son roi et à son Dieu ; il a tenté d’assassiner Sa Majesté en plein Louvre ! Et malheur à tout sujet français qui hésiterait à l’arrêter ! Malheur, acheva-t-il en haussant la voix, à tout serviteur du roi qui hésiterait à vous arrêter, vous-même, si vous vous faites le complice de l’hérétique, rebelle, truand, convaincu de crimes insupportables tels que d’avoir attenté à la Majesté royale.
– Mon père, dit Monclar, stupéfait, vous vous oubliez, il me semble… Je vais d’un mot, vous expliquer…
– Gardes ! tonna Loyola, au nom du roi que je représente ici, au nom de l’Église dont je suis le mandataire, faites votre devoir !
Loyola s’effaça. Le caveau apparut plein de gardes.
Éperdu, Monclar cria :
– Misérables ! oseriez-vous porter la main sur votre maître !
– Sergent ! gronda Loyola, si vous tenez à votre tête, obéissez !
Les gardes, qui avaient eu un instant d’hésitation, se jetèrent alors sur Monclar. En une seconde, celui-ci fut arraché du cachot dont la porte fut violemment refermée sur Lanthenay, ou moment où celui-ci s’élançait pour se porter au secours du grand prévôt.
– À moi ! hurla Monclar, à moi ! Lâches ! Misérables ! Mon enfant ! Ils me volent mon enfant !
Il voulut se jeter sur la porte.
Loyola fit un signe. Le grand prévôt fut saisi, enlevé…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lorsque Monclar revint à lui, il se vit dans son cabinet, assis dans son fauteuil.
Il passa ses deux mains sur son front, avec cette sensation précise qu’il venait de faire un horrible cauchemar… Oui ! ce devait être cela !
La bohémienne… la descente dans les cachots… les paroles de Lanthenay… l’arrivée de Loyola… un rêve, tout cela… un affreux rêve !…
Il s’était endormi à sa table de travail.
Ses yeux tombèrent sur le travail qu’il avait commencé :
« Sire,
« J’ai l’honneur de faire parvenir à Votre Majesté le détail des circonstances qui ont accompagné le supplice et la mort de l’hérétique Étienne Dolet, et je la prie de bien…
C’est tout ce qu’il avait écrit de son rapport.
Il prit alors sa tête dans ses deux poings, posa les deux coudes sur la table.
– Voyons, murmura-t-il, le sourcil froncé par l’effort de l’attention, je ne suis pas fou, n’est-ce pas ?… J’ai bien toute ma raison ?… Voici bien ma table… mon bureau… le rapport que j’ai commencé… je vois bien la phrase que je voulais écrire… je pourrais l’achever… j’ai bien toute ma lucidité… Que m’est-il arrivé ?…
Il reprit son lamentable monologue :
– Procédons avec ordre… ne laissons pas notre raison s’égarer… Je suis frappé par un immense malheur, je le sais… Je m’y connais… deux fois déjà j’ai éprouvé cette épouvantable angoisse à la gorge, ce grand vide à l’estomac, la sensation de cette main de fer agrippant mon cœur… Je sais !… Une première fois, lorsque mon enfant me fut volé… la deuxième fois, lorsqu’elle mourut dans mes bras… Où est le malheur ? Quelle catastrophe est encore venue me frapper ?… Tâchons de reconstituer la nuit… Voyons : hier le révérend Loyola… celui qui est maintenant mon maître… mon maître plus que le roi (il fut agité d’un long frisson en prononçant ces derniers mots) est venu… Il m’a dit qu’il voulait, avant le supplice, descendre interroger le prisonnier… Quel prisonnier ?… (quelque effort qu’il fît, Monclar n’arriva pas à dire le nom qui était sur ses lèvres)… C’est bien cela… Puis j’ai dîné… j’ai donné des ordres… je me suis installé dans mon cabinet, ici même… je voulais travailler… je n’ai pas pu… pourquoi ? Ah ! oui, à cause de cette bohémienne qui était là devant la porte de l’hôtel… ai-je dormi ? ai-je médité ? Je me souviens du trouble étrange qui m’agitait… l’attitude de la bohémienne faisait passer dans ma tête des pensées qui me stupéfiaient… Alors… je me souviens qu’il était quatre heures du matin… c’est cela… je suis descendu dans le cachot… Et je l’ai vu… lui !… Je lui ai parlé !…
Ces derniers mots achevèrent de déchirer le voile qui s’était appesanti sur l’esprit de Monclar.
Il se dressa tout debout, avec un cri terrible qui se termina par un sanglot suppliant :
– Mon enfant !… rendez-moi mon enfant ! Grâce, messieurs !… c’est mon fils !…
– C’est un rebelle ! dit une voix rude.
Monclar se retourna.
Dans un angle de son cabinet, debout, les bras croisés, funèbre dans sa robe monacale, il vit Loyola qui dardait sur lui un regard fixe à donner le vertige.
– Vous ! gronda le grand prévôt en faisant deux pas vers le moine.
– Moi, comte de Monclar !
– Vous !… c’est vous… vous qui m’arrachez le cœur ! Vous qui me volez mon fils ! Vous, tigre sans pitié ! Vous, exécrable imposteur… Vous que j’ai haï d’instinct dès la première seconde ! Vous, devant qui je me suis courbé tremblant, épouvanté par votre formidable puissance !… Vous, moine… Eh bien, à nous deux !…
– Vous me faites pitié, dit lentement Loyola.
Et Monclar marchait sur lui.
– Un pas encore, et je vous fais saisir, et je vous fais plonger dans un de vos cachots, et tout espoir de revoir votre fils sera à jamais perdu…
Il trembla sur ses genoux, ses mains se joignirent, ses yeux brûlèrent de larmes chaudes qui tombèrent avec une sorte de violence, et sa voix, sa voix faible et bégayante comme une voix d’enfant battu, proféra :
– Non, vénéré père… pardon ! Oh ! dites-moi seulement que je puis espérer le revoir ! Dites-moi qu’il ne va pas mourir !…
– Obéissez d’abord ! gronda le moine ! Asseyez-vous ! (Monclar obéit). Là, maintenant, sachez plusieurs choses : d’abord, il y a derrière chacune de ces portes dix gardes en armes qui accourront à mon premier appel… Êtes-vous décidé à m’écouter sans essayer d’une violence inutile ?
– Oui, mon père, balbutia Monclar.
– Bien ! maintenant, sachez que j’ai montré au chef de vos gardes le papier que vous avez bien voulu me donner du jour où vous vous êtes enrôlé dans notre ordre.
Monclar frémit.
– Ce papier, vous le savez, signé par vous, scellé de votre sceau, ordonne à tout agent du guet, garde prévôtal, geôlier de toute prison, et en général à tout suppôt de la force, de m’obéir en quelque circonstance que ce soit, quel que soit l’ordre qu’il me plaît de donner et ce, sous les peines de la hart.
Loyola, très calme, continua :
– Je vous rappelle aussi, pour simple mémoire, que vous vous êtes lié à la Société de Jésus par un engagement formel, bien et dûment signé et scellé, par lequel acte vous jurez obéissance passive, sans discussion ni en paroles ni en pensée, au grand-maître de la Société, fût-ce envers et contre vos amis, fût-ce envers et contre votre famille, votre pays, votre roi ! Il me suffirait donc : d’une part, donner l’ordre à vos gardes de vous tenir en vos cachots et ce en vertu de votre propre commandement ; d’autre part, envoyer au roi de France l’engagement par lequel vous jurez de trahir ses intérêts si l’intérêt supérieur de la Société l’exige. Je vous laisse, monsieur le grand prévôt, le soin de conclure.
Le comte de Monclar eût entendu son arrêt de mort qu’il n’eût pas été plus épouvanté.
Loyola se rapprocha alors du grand prévôt.
Il comprit qu’il le tenait sous sa domination.
– Qu’êtes-vous dans mes mains ? Un pauvre instrument. Vous ne devez avoir ni pensée personnelle ni affections, ni haines qui ne soient pour la gloire de la Société de Jésus à laquelle vous appartenez. Que je fasse un geste, que je dise un mot, et vous êtes précipité de la haute et brillante situation que vous occupez ; à mon, gré, vous êtes un puissant seigneur que chacun redoute, ou un criminel qu’attend le gibet… Soyez donc docile, soldat de Jésus, chevalier du Sacré-Cœur ; soyez obéissant ! ne discutez pas ! Ni vos paroles ni votre pensée ne doivent s’élever contre le commandement de votre maître ! Ne l’oubliez jamais : vous êtes dans mes mains perinde ac cadaver[5] !…
Loyola s’assit.
Un changement brusque se fit dans sa physionomie qui devint paternelle et bienveillante.
Il reprit doucement :
– Maintenant que vous êtes rentré dans la voie de la soumission absolue, la seule qui conduit au Seigneur, maintenant, mon fils, ouvrez-moi votre cœur…
Monclar voulut parler ; tout un plaidoyer se pressait sur ses lèvres ; il ne put qu’éclater en sanglots en balbutiant :
– C’est mon fils !… Oh ! vous le savez… ce fils que j’ai tant pleuré… ce fils… c’est lui !… Laissez-moi mon fils… C’est le désespoir qui m’a jeté à vos pieds… C’est la douleur qui m’a fait votre esclave… Et maintenant que je le retrouve… qu’est-ce que cela peut vous faire que j’aime mon enfant… Est-ce que cela m’empêchera d’être votre serviteur fidèle… Ô mon père… laissez-le-moi…
– Vous vous égarez encore dans une affection qui ne peut que vous éloigner de Jésus…
– Jésus !… Qu’est-ce donc alors que ce Dieu épouvantable qui empêche les pères d’aimer leurs enfants !… Est-ce possible cela !… Allons donc ! Vous mentez !…
– Je m’y attendais : la révolte engendre le blasphème… Adieu donc !
Loyola se leva.
Monclar tomba à genoux.
– Grâce ! râla-t-il ; grâce pour lui… et faites de moi ce que vous voudrez…
– Pas de grâce pour le criminel !
– C’est mon fils !…
– Pas de grâce pour qui se rebelle !
– C’est mon fils !…
– Pas de grâce pour qui frappe un soldat du Christ !
– C’est mon fils ! hurla Monclar toujours à genoux.
– Vous vous trompez !… Vous n’avez pas de fils… Ou plutôt, votre fils, et à la fois votre père, mère, famille, votre tout, c’est la Société de Jésus… L’homme dont vous parlez ne vous est rien !
– Atroce ! C’est atroce de torturer ainsi un cœur !
– Choisissez, monsieur de Monclar : soumettez-vous ou révoltez-vous ouvertement. Dans le premier cas, Lanthenay doit mourir ; dans le deuxième cas, je sais ce qu’il me reste à faire…
– Je ne me soumets pas ! rugit Monclar. Et toi, moine infernal, tu ne sortiras pas d’ici, vivant !
En parlant ainsi, le grand prévôt s’était relevé d’un bond et s’était placé entre la porte et Loyola.
Celui-ci, non moins prompt, avait mis entre lui et Monclar le grand bureau de travail.
Alors, Monclar éclata de rire.
– Je te tiens ! dit-il.
Loyola haussa les épaules.
– C’est bon ! grogna le grand prévôt. Hausse les épaules tant que tu voudras ; tu vas mourir ; je te hais ; ta religion, je la hais ; ton Dieu, je le hais ; ta société abominable, je la hais ; les théories monstrueuses, je les hais. Tu résumes à mes yeux tout ce qu’il y a d’horrible et d’abject dans l’abus de la force. Ah ! tu veux me tuer mon fils !… Eh bien, tu vas savoir de quoi un père est capable !
Loyola se vit perdu. Il tenta un effort.
– Je vous préviens, dit-il, que si je ne suis pas dehors dans une heure, un cavalier partira pour remettre au roi l’engagement que vous avez pris de l’espionner toujours et de le trahir au besoin.
– Tu es fou ! gronda Monclar. Que veux-tu que cela me fasse qu’on me pende ou qu’on me coupe le cou, si mon fils est sauvé !… Ces moines sont plaisants, sur ma foi ! Drôles ! vous vous croyez tout permis, et vous inventez de nouveaux supplices pour le cœur des pères ! Vous trouvez qu’on ne souffre pas assez par vous ! Vous jugez que vous n’avez pas assez accumulé d’impostures, assez répandu de sang, assez entassé de ruines ! Il vous faut encore entrer de vive force dans la conscience des hommes, tarir en eux la source de toute joie ! Il vous faut encore vous emparer des cœurs pour les broyer sous la formidable meule de votre tyrannie !… Et dans quel but ? Pour quels complots ? Pour établir je ne sais quel pouvoir invisible devant qui tremblerait l’univers !… Attends, attends, monstre ! Je vais toujours débarrasser la terre de ta présence ! Que chacun en fasse autant toutes les fois qu’il trouvera un moine sur son passage !… Qu’il ne perde pas son temps à discuter, à ergoter, à discourir… Qu’il l’écrase sans pitié, comme je vais t’écraser !…
Loyola, pendant ces paroles qu’il n’écoutait pas, avait rassemblé toute sa force de volonté dominatrice et d’imagination inventive.
Au moment où Monclar allait se jeter sur lui, un sourire de triomphe éclaira la figure du moine.
Il leva les bras et s’écria :
– Seigneur ! Seigneur ! Que ta volonté soit faite ! Si l’heure où je dois rentrer dans ton sein est venue, bénie soit cette heure !… Et malheur à ceux qui ne comprennent pas qu’Abraham put lier son fils sur l’autel de l’holocauste et saisir son couteau pour l’immoler ! Malheur à ceux qui ne se souviennent pas que tu envoyas dans le buisson un agneau pour remplacer le fils d’Abraham !…
Monclar s’arrêta court.
– Que dit-il ? murmura le grand prévôt.
– Il est perdu ! songea Loyola.
Et à haute voix, froidement :
– Frappez, monsieur, je ne me défends pas.
– Que disiez-vous ?
– Rien !… sinon qu’Abraham n’hésita pas à saisir le couteau pour immoler son fils !
– Mais Dieu, disiez-vous, envoya un agneau…
– Insensé ! tonna le moine, qui te dit qu’au moment suprême, l’agneau ne surgira pas dans le buisson ! Qui te dit que Dieu n’a pas voulu éprouver ta foi et ta fidélité, comme il éprouva la fidélité, la foi d’Abraham !… Qui te dit qu’il laissera s’accomplir l’épouvantable sacrifice ! Tu nous accuses, ô mon fils !… Crois-tu donc que nos entrailles, à nous, soient insensibles et que notre cœur ne batte pas !… Ne comprends-tu pas… Mais non… non ! Je ne veux rien dire… frappez !…
– Je vous en supplie, s’écria Monclar délirant, achevez !… oh ! s’il était possible que j’eusse compris !… Si ce que j’entrevois était une radieuse vérité !…
– Eh bien !… ne comprenez-vous pas, pauvre père affolé, qu’il faut à la foule des exemples salutaires… Ne comprenez-vous pas que pour Paris, pour le bien de la religion, Lanthenay doit aller au supplice !… Mais ne comprenez-vous pas aussi que tout est préparé pour le sauver, et qu’ainsi l’esprit d’autorité n’aura pas subi d’atteintes, en même temps que vous conservez votre fils, en même temps que vous conservez votre haute situation, votre pouvoir !…
L’arme que tenait Monclar lui échappa des mains.
– Ainsi, balbutia-t-il… mon fils sera sauvé !…
– J’en ai trop dit ! s’écria Loyola. J’ai enfreint pour vous la règle de notre ordre qui veut que le grand maître soit obéi sans qu’il ait à expliquer sa pensée…
Monclar s’inclina très bas.
Il avait cette conviction que Loyola avait voulu l’éprouver.
– Comment vous faire oublier mes paroles impies ? murmura-t-il.
– Quelles paroles, mon fils ? Je n’ai rien entendu… rien, vous dis-je !… sinon que vous vous soumettez !
– Oui, oui !… dit Monclar le front courbé.
– Il ne vous reste plus qu’à donner vous-même l’ordre de conduire au gibet le scélérat qui a frappé le Christ en me frappant !
Monclar frémit, secoué de la tête aux pieds.
– Et maintenant que le maître de la Société a parlé, l’homme ajoute… tout en réprouvant la faiblesse qu’il a pour vous : Soyez sans crainte ; votre fils ne sortira pas d’ici. J’ai tout prévu. Dans cinq minutes, il sera dans vos bras…
Monclar jeta une clameur de joie terrible.
– Mon père, dit-il, quand me demanderez-vous ma vie ?…
– Hâtez-vous, mon fils ! dit Loyola en souriant.
– Gardes ! appela Monclar d’une voix tonnante.
En même temps, il prit les mains de Loyola :
– Mon vénéré père ! supplia-t-il, vous me jurez qu’il, sera sauvé ?…
– Je vous le jure… votre fils sera sauvé.
– Vous me jurez, reprit Monclar frémissant, qu’il ne sortira même pas de l’hôtel ?
– Je vous jure que votre fils ne sortira pas d’ici !…
Mentalement, Loyola ajouta :
– Mais comme j’ignore si Lanthenay est le fils de Monclar, je ne suis pas tenu de me conformer à ce serment.
Cependant, les gardes, à l’appel du grand prévôt, avaient ouvert les deux portes du cabinet. Monclar vit alors que Loyola n’avait pas menti : il y avait dix gardes à chaque porte.
Le sergent, assez embarrassé, regardait alternativement le moine et le grand prévôt.
– Obéissez aux ordres du révérend père, dit Monclar.
– Saisissez-vous du prisonnier, commanda le moine.
Les gardes descendirent, étonnés.
Immédiatement derrière eux venait Monclar, blême et agité de frissons convulsifs, puis Loyola.
Dans la cour, le grand prévôt s’arrêta et interrogea le moine du regard.
– Patience ! dit Loyola.
Les gardes et les geôliers étaient descendus dans les cachots.
– Mon père, fit Monclar tremblant, l’épreuve n’a-t-elle pas assez duré ?…
– Patience !
– Ces misérables vont lui faire du mal…
– Non non… ne craignez rien…
– Oh !… tenez ! entendez-vous !… Je n’y puis tenir !… Assez !…
On entendait en effet le bruit d’une lutte.
Monclar s’élança.
Au même instant, les gardes apparurent, et, au milieu d’eux, Lanthenay, étroitement lié.
– Déliez-le ! rugit Monclar… ou plutôt… c’est moi qui vais le délier !…
– Gardes ! ordonna Loyola de sa voix glaciale, conduisez le prisonnier à la Croix-du-Trahoir !
Monclar se tourna vers lui, et, sur son visage bouleversé, il se contraignit à dessiner un sourire.
– C’est fini, n’est-ce pas vénéré père ? murmura-t-il.
– C’est fini, en effet, dit Loyola.
– Mon père ! mon père ! clama Lanthenay, me laisserez-vous supplicier ?…
– Mon fils ! Attends ! je suis à toi !…
Monclar se jeta sur les geôliers.
– Gardes, commanda Loyola, saisissez-vous de ce rebelle qui, après avoir feint un retour aux bons sentiments, méconnaît encore l’autorité royale et religieuse !
– Pardon, monseigneur ! dit le sergent en mettant la main au collet de Monclar.
– Misérable !… Lâche imposteur ! bégayait le grand prévôt.
Il se débattait, fonçait sur Loyola, entraînant avec lui les cinq ou six gardes qui le maintenaient.
La voix déjà lointaine de Lanthenay appela encore :
– À moi, père, à moi !…
– Grâce ! hurlait Monclar, grâce pour mon fils !…
– Vous voyez bien qu’il est devenu fou ! dit le sergent. Allons, allons, monseigneur !…
– Je ne veux pas ! je ne veux pas ! Oh ! c’est trop horrible ! À moi ! au secours !…
À terre, cherchant à se débarrasser de l’étreinte des gardes, Monclar ne dit plus rien. Il écumait…
Soudain, de ce groupe informe que Loyola contemplait d’un œil sombre, jaillit un éclat de rire !…
Et cet éclat de rire, funèbre, déchirant, c’était le comte de Monclar qui le poussait.
– Lâchez-le, maintenant ! commanda Loyola.
Les gardes obéirent. Tandis que Loyola rejoignait l’escorte qui entraînait Lanthenay, Monclar entrait dans le corps de garde, et poussait un cri de joie en apercevant la lanterne avec laquelle on descendait dans les cachots. Il s’en empara vivement.
Alors, sa lanterne éteinte à la main, il s’élança au dehors, traversa la cour et se perdit dans la rue.
Des gens qui le virent l’entendirent grommeler :
– Maintenant que j’ai une lanterne pour y voir clair, je finirai bien par trouver la porte de son cachot… Attends, mon fils, attends !… N’appelle pas ainsi… cela me fait trop de mal !…
XVIII
LA MÈRE DE GILLETTE
Pendant que se passaient, à l’hôtel du grand prévôt, les scènes que nous venons d’exposer, d’importants événements se déroulaient dans le taudis de Margentine.
Nous laisserons donc le comte de Monclar à sa folie, nous laisserons Lanthenay marcher vers la Croix-du-Trahoir où l’attendait le bourreau, étonné du retard qu’on mettait à lui amener sa proie, et nous conduirons nos lecteurs dans le triste logis de cette autre folle : Margentine la blonde.
Au moment de la décharge des arquebusiers massés autour du bûcher d’Étienne Dolet, Manfred avait reçu une balle dans le bras.
La blessure était d’autant moins dangereuse que la balle n’avait fait que traverser les chairs et qu’elle était sortie sans avoir atteint l’os.
Il en résultait que Manfred n’avait nullement le bras cassé comme l’avaient dit les deux compatissantes ribaudes qui, sur le conseil de la Gypsie, avaient amené le blessé chez Margentine.
Mais cette blessure, pour n’être pas dangereuse, n’en faisait pas moins souffrir le jeune homme, et on a vu qu’une fièvre suivie de délire s’était tout d’abord déclarée.
Heureusement, le blessé était doué d’un tempérament robuste. Sa jeunesse et sa vigueur ne tardèrent pas à avoir raison de la fièvre.
Nous le retrouverons la veille même du jour où viennent de se passer les faits que nous avons racontés.
C’était dans l’après-midi. Toute la journée de la veille et toute la nuit, Margentine avait soigné le jeune homme avec une intelligence remarquable chez cette folle.
Tant qu’il n’était pas question de sa fille, elle était capable de raisonner avec une certaine logique, et ses actes s’enchaînaient naturellement.
C’est ainsi que, dans les soins qu’elle donna à Manfred blessé, elle manifesta un véritable esprit de suite et de sagacité, renouvelant les compresses de vin aromatique en temps voulu, passant de temps à autre un linge mouillé sur les tempes, le front et les lèvres du jeune homme pour calmer l’accès de fièvre.
Ces soins avaient redoublé d’activité lorsque Margentine avait entendu Manfred, dans son délire, appeler Gillette à diverses reprises.
Tout d’abord, cette découverte faillit être fatale à Manfred.
– Que dit-il ? gronda Margentine. Il parle de Gillette ?
Et elle ajouta :
– Encore quelque intrigante qui prend le nom de ma fille !
Margentine médita un instant si elle ne punirait pas le jeune homme de se prêter à l’intrigue qu’elle supposait ourdie contre elle et sa fille.
Mais elle se rappela alors la visite de la Gypsie.
Or, la bohémienne lui avait dit :
– C’est lui qui te fera retrouver ta fille !…
Dès lors, Margentine ne douta plus que le blessé ne fût vivement intéressé à retrouver Gillette.
Après les premières heures de fièvre, Manfred était tombé dans un lourd sommeil ; il ne parlait plus ; si bien que Margentine, accablée de fatigue, finit par s’endormir elle-même sur son escabeau.
Vers les deux heures de l’après-midi, Manfred s’éveilla. Il jeta autour de lui ce regard étonné qui suit les crises de fièvre ; il se souvint vaguement qu’il avait déjà entrevu ce qu’il voyait dans un moment de lucidité. Près de lui, il aperçut Margentine endormie.
– La folle ! murmura-t-il.
Il voulut faire un mouvement comme pour se lever, la violente douleur qu’il ressentit au bras lui rappela alors tout ce qu’il venait de passer.
Comme dans une vision enflammée, il se revit près du pont Saint-Michel, attendant avec Lanthenay l’arrivée du cortège d’Étienne Dolet.
La pensée du violent désespoir qui devait accabler Lanthenay lui vint alors.
Qu’était devenu son ami ? Était-il tombé dans la ruelle, parmi les truands ? Vivait-il encore ?
Et en ce cas, quelle devait être sa tristesse !… Manfred imaginait son ami errant autour du bûcher éteint, n’osant s’arracher à l’horrible spectacle… puis il le voyait revenir à la Cour des Miracles, et il se représentait la scène déchirante : Lanthenay apprenant à Julie et à Avette que le supplice de Dolet était consommé !…
Alors, l’enchaînement des idées conduisit Manfred à se dire qu’il n’avait plus rien à faire à Paris. Il était venu pour aider Lanthenay à sauver Dolet… La fortune les avait trahis… Dolet était mort sur le bûcher.
Manfred éprouvait une insurmontable horreur à la pensée de demeurer plus longtemps dans la ville qui avait vu s’accomplir une pareille abomination.
Son plan fut vite fait : il irait trouver Lanthenay et l’arracherait à sa douleur.
Il l’emmènerait avec Avette, avec Julie.
Dès lors, son imagination le transporta à Fontainebleau.
Que se passait-il là-bas ? Le coup de main préparé par le vieux Fleurial avait-il réussi ?
Une terrible angoisse l’étreignit, et l’idée de rester enfermé dans ce taudis, immobile, impuissant, lui devint insupportable. Il rassembla toutes ses forces et parvint à se lever et à s’habiller.
Une fois debout, il s’aperçut qu’à part la cuisante douleur de son bras, il n’avait d’autre mal qu’une certaine faiblesse provoquée par la perte de sang.
Il regarda autour de lui pour voir s’il n’apercevait pas quelque flacon de cordial ou de vin.
Margentine dormait profondément.
– Pauvre femme ! murmura-t-il en contemplant un instant les traits tirés de la folle.
Et comme il ne trouvait pas ce qu’il cherchait, il aperçut dans une encoignure un trou, une sorte de petite armoire pratiquée dans le mur.
– Là, peut-être… pensa-t-il.
Il alla doucement à l’armoire et y plongea la main.
Cette main rencontra et froissa un papier.
Manfred saisit le papier et le considéra distraitement.
Tout à coup il tressaillit. Ce papier, parchemin plié et scellé en forme de lettre, portait une suscription.
Et cette suscription, c’était :
– Pour Manfred.
De quel Manfred s’agissait-il ? Lui, peut-être !
Manfred se décida alors à réveiller Margentine, qu’il toucha légèrement au bras.
La folle poussa un cri de surprise, puis se mit à rire.
– Te voilà donc guéri ? dit-elle.
– Oui, ma bonne Margentine. Mais, dis-moi, cette lettre ?…
– C’est pour toi.
– Qui te l’a remise ?
– La Gypsie, donc ! Elle m’a dit : « Tu lui donneras la lettre quand il sera guéri, dans huit jours, mais pas avant. »
– Ah ! Elle t’a dit cela, la Gypsie ?… Oui, mais je suis guéri.
Dès les premiers mots il pâlit et rougit coup sur coup, et Margentine remarqua que ses mains tremblaient.
Voici cette curieuse lettre que nous reproduisons tout entière, même en certains détails qui ne sont pas absolument utiles à notre récit.
Lettre de la Gypsie à Manfred
Maintenant que la chose ne peut plus me nuire, je vais te révéler en quel pays tu es né et comment s’appelle ton père. J’ai hésité avant de m’y décider, parce que j’avais juré sur Aldebaran, la grande étoile de ma destinée, de ne jamais te parler de cela.
Mais que veux-tu ? Peut-être bien que ma croyance à Aldebaran est morte dans mon cœur, comme y sont mortes bien d’autres croyances. Enfin, peut-être t’aurais-je révélé depuis longtemps ta naissance, – car je m’étais attachée à toi, et je te portais une sorte d’affection, – mais je craignais quelque chose que je n’ai pas besoin de t’expliquer.
Aujourd’hui cette crainte n’a plus raison d’être.
Aussi, lis-moi bien attentivement, car tu ne me reverras plus jamais, et les explications que je te donne ici contiennent des détails qui seront utiles pour te faire reconnaître de tes parents.
Voici donc, Manfred :
Il y aura bientôt vingt-deux ans, je traversais l’Italie du sud au nord avec une partie de ma tribu. Nous venions des lointains pays de l’Asie, de contrées dont je ne me souviens plus, et où habitaient les plus vieux de notre peuple. Et nous avions traversé l’Arabie, puis l’Égypte où nous avons longtemps séjourné, et où je me suis instruite en diverses sciences.
Toute notre tribu s’était embarquée à Alexandrie ; mais tandis qu’une partie montait sur un vaisseau qui se dirigeait vers l’Hellespont pour aller au pays des Turcs, l’autre, dont je faisais partie, voguait vers la Sicile.
De la Sicile, nous passâmes en Italie, et là, notre tribu se partagea en divers groupes qui prirent chacun une route différente.
Avec l’homme que j’avais choisi pour époux et mon fils, je remontai l’Italie dans toute sa longueur. Nous allâmes à Naples, de Naples à Rome, puis à Florence et à Mantoue. Je disais la bonne aventure. Mon homme tressait des ouvrages d’osier qu’il vendait bien. Moi-même, je gagnais beaucoup ; j’aimais mon fils jusqu’à l’adoration ; j’étais heureuse… oui, heureuse !
Je te raconte tout cela, Manfred, parce qu’en ce moment j’éprouve un triste plaisir à me reporter à cette époque où vivait mon fils.
Ce fils, Manfred, avait alors environ seize ans.
Il était fier et beau comme tu peux l’être toi-même.
Nous étions alors à Mantoue, comme je te l’ai dit. Nous y étions depuis un mois, et nous nous disposions à pousser plus loin notre destinée vagabonde, lorsque je fus frappée par un terrible malheur.
Mon fils, insulté, raillé dans la rue par un jeune seigneur, avait souffleté son insulteur. Aussitôt on l’avait arrêté. C’était, pour ce crime, au moins la prison perpétuelle, sinon la mort.
Affolée, je m’informai.
– Qui règne à Mantoue ? demandai-je.
On me répondit en riant :
– Le duc règne sur Mantoue, mais la signora Lucrèce Borgia règne sur le duc !
Je courus au palais ducal.
Ce ne fut qu’au bout de deux jours que je parvins à y entrer et à me faire conduire en présence de Lucrèce Borgia, cette célèbre femme dont tu as sans doute entendu parler.
Je me jetai aux pieds de la signora Lucrèce, et lui racontai ce qui venait d’arriver à mon fils. Je lui dis que si mon fils ne m’était pas rendu, je mourrais de chagrin ; enfin, je pleurai et suppliai à genoux pendant longtemps.
La signora Lucrèce m’avait d’abord écouté avec une indifférence hautaine.
Puis, peu à peu, elle avait paru s’intéresser à mon récit et à ma douleur. Elle m’avait examinée attentivement.
Elle renvoya les femmes qui l’entouraient, et mon cœur battit d’espoir.
– Tu aimes donc bien ton fils ?… me demanda-t-elle.
– C’est toute ma vie ! m’écriai-je en sanglotant.
– Tu sais qu’il sera sans doute condamné à mort ; un misérable bohémien qui se permet de souffleter un fils de noblesse… Oui, c’est la mort… mais si tu veux… tu peux le sauver.
J’écoutais, haletante d’angoisse.
– Si tu aimes ton fils, reprit-elle d’un air sombre, tu dois être disposée à tout pour le sauver ?
– À tout ! à tout ! signora…
Elle garda quelque temps le silence, m’étudiant avec attention, et sans doute elle reconnut ma sincérité et la passion maternelle qui me transportait, car elle finit par me dire :
– Eh bien, peut-être pourrons-nous nous entendre… Écoute-moi…
– J’écoute, signora, m’écriai-je, suspendue à ses lèvres.
La signora Lucrèce Borgia reprit :
– Connais-tu la ville de Monteforte ?
– Je ne la connais pas, mais je la connaîtrai s’il le faut.
– Je te donnerai d’ailleurs toutes les indications nécessaires. Tu vas donc te rendre à Monteforte… Il y a à peu près dix jours de voyage… autant pour revenir… dix jours pour séjourner là-bas… cela fait en tout trente jours… Il faut t’apprêter à partir au plus tôt…
– Je suis prête, signora ; je puis partir à l’instant même…
– Bien… as-tu quelqu’un qui puisse t’aider à une certaine action… où il faut d’ailleurs plus d’habileté que de force ?…
– J’ai ce qu’il faut, signora…
– En ce cas, tu peux partir dès aujourd’hui ; tu iras à pied, parce qu’il est nécessaire qu’en arrivant à Monteforte tu passes inaperçue…
– Et que ferai-je à Monteforte, signora ?
Lucrèce Borgia eut une dernière hésitation.
– Fiez-vous à moi, lui dis-je d’un ton ferme, j’accomplirai votre mission quelle qu’elle soit, car pour sauver mon fils, je suis capable de tout, même d’un crime !
Je prononçai à dessein ces paroles, car j’avais tout de suite deviné que c’était un crime qu’on allait me proposer.
En effet, ces paroles rassurèrent la signora.
Elle se rapprocha de moi et me dit à voix basse :
– Il y a à Monteforte un homme que je hais autant que tu peux aimer ton fils ; il y a à Monteforte une femme que je hais comme tu pourrais haïr le bourreau qui se saisirait de ton fils… C’est cet homme et cette femme que je veux frapper… Es-tu disposée à me seconder ?
– Disposée à tout, signora !
En parlant ainsi, Manfred, mes yeux s’attachaient sur la signora Lucrèce. Elle avait les traits réellement bouleversés par la haine…
Pourtant, je n’eus pas peur.
Au contraire, je me dis que cette femme si forte saurait tenir sa parole, et que si je l’aidais, elle sauverait mon fils. Elle parut contente de mon ardeur et me dit alors :
– Cet homme dont je te parle, c’est…
Elle hésita encore, et me dit :
– Si jamais tu me trahis…
– Si je vous trahis, signora, faites mourir mon fils, et ce sera ma propre mort !
– Bien… Cet homme, donc, c’est le chevalier de Ragastens, devenu comte Alma et seigneur de Monteforte. Cette femme, c’est sa femme, la princesse Béatrix. Ils habitent le palais comtal de Monteforte. Ils sont heureux, et je veux les frapper…
– Que faut-il faire ?… m’écriai-je. Je suis experte en l’art des poisons… et si vous voulez…
Elle haussa les épaules, et, d’une voix qui me fit frissonner, me répondit :
– Le poison ! Je crois aussi en connaître tous les secrets… mais le poison… c’est trop peu pour Béatrix ! trop peu pour Ragastens !
Alors, elle me dit :
– Écoute… Ce Ragastens a eu deux enfants… tous deux sont morts… Un troisième lui est né… C’est un fils… Et celui-là vivra, car il a hérité de toute la force de son père… Or, cet enfant, c’est leur adoration à tous deux ; ils ne vivent plus que pour lui… il est leur dieu.
– Je crois vous comprendre, signora… il faut tuer l’enfant ?
Je dis cela froidement, Manfred, et je te jure que pour sauver mon fils j’eusse tué l’enfant du comte Alma, si la signora Lucrèce m’en avait donné l’ordre.
Mais ce n’est pas cela qu’elle voulait.
– Ne m’interromps pas, me dit-elle. Tuer l’enfant, ce serait certes leur infliger une violente douleur… mais cette douleur, avec le temps, s’atténuerait… Ce qui est mort est bien mort, et on finit par l’oublier… Au contraire, si l’enfant est perdu pour eux, et si pourtant ils savent qu’il vit, conçois-tu dès lors l’existence infernale qu’ils mèneront ! La certitude que leur enfant emporté par des bohémiens, parcourt le monde, malheureux, battu, et qu’il meurt lentement… cette certitude peut les rendre fous…
Les vois-tu, le soir, s’asseyant à leur foyer désert et se disant : « En ce moment, notre enfant est martyrisé ! En quel endroit du monde ? Sous quel ciel ?… Voilà ce que nous ne saurons jamais ! » Oui, c’est là la punition que j’ai rêvée pour eux !
– Alors, il faut voler l’enfant ? demandai-je.
– Oui ; le voler, l’emporter, en faire un bohémien, un bandit qui finira un jour sur un échafaud !
– Je me charge de tout cela ! dis-je alors.
– Il faudra que tu me montres l’enfant.
– Comment saurez-vous que c’est bien lui ? Qui vous prouvera que je ne vous présente pas un autre enfant que j’aurai acheté…
– Ta question me plaît et me prouve que tu réussiras. Quant à reconnaître l’enfant de Ragastens, sois tranquille : je le connais. Je l’ai vu assez pour être sûre que tu ne pourras me tromper… Tu viendras donc me montrer l’enfant.
– Ici même ?
– Non : à Ferrare ; car je n’habite Mantoue que pour quelques jours. Si tu réussis, tu auras cinq cents ducats.
– L’or est une bonne chose, signora, mais si vous me rendez mon fils, je ne vous en demande pas davantage.
Ce fut sur ces mots que je pris congé de la signora Lucrèce.
Aussitôt je me mis en route, seule.
Car, pour une affaire de ce genre, je ne m’en fiais qu’à moi-même. Je donnai rendez-vous à mon homme à Marseille, en Provence, grande ville où nous devions facilement passer inaperçus dans la foule de gens que débarquent des navires venus de tous les points de l’horizon.
Je partis donc, et, au bout de huit jours, j’arrivai à Monteforte, ville magnifique par ses jardins et par son palais comtal. Elle est située dans les montagnes et d’un abord difficile.
Dès le soir même de mon arrivée, Manfred, j’avais réussi à pénétrer, secrètement dans les jardins du palais.
Et c’est là que je vis l’enfant que je devais voler.
Cet enfant, Manfred, c’était toi ! Tu avais trois ans ou à peu près…
Peut-être, sûrement même, tu vas me haïr pour la révélation que je te fais. Oui, tu vas me haïr. Mais ta haine, Manfred, m’est indifférente. Rien ne m’est plus dans ce monde, puisque j’ai perdu le fils pour lequel je consentis à me faire criminelle. À tout ce que j’ai souffert, je puis juger de ce qu’ont souffert tes parents.
Hais-moi donc, Manfred. Je le mérite…
Et pourtant, considère que rien ne m’oblige à t’écrire cette lettre et, que si je le voulais, jamais, tu ne saurais.
C’est, comme je te le disais, que j’ai fini par te prendre en affection, bien que tu ne t’en sois jamais aperçu. Aussi bien ne tenais-je pas à te montrer cette sorte de tendresse qui peu à peu entrait dans mon cœur. Est-ce que les femmes, peut-être, ne peuvent se passer d’aimer, et qu’il leur faut toujours un enfant à chérir ? Cela se peut bien. Toujours est-il qu’il y a des jours où j’en arrivais à me demander si tu n’étais pas mon fils…
C’est pourquoi je souhaite que tu sois désormais heureux. Ma punition, à moi, sera de songer que tu me hais !
Mais voilà que je m’attendris… Non, non… j’ai bien autre chose à faire.
Donc, comme je te l’ai dit, je parvins dès le premier jour à voir l’enfant, son père et sa mère, sans avoir été remarquée moi-même.
Le père et la mère adoraient réellement leur fils ! Je ne pus m’y tromper ; je savais cela, moi ! Mais je n’hésitai pas.
Maintenant, te dire comment je m’y suis prise pour enlever l’enfant, ce serait trop long ; il te suffira de savoir que je dus, pour arriver à mes fins, demander l’aide d’un jeune Napolitain qui se trouvait à Monteforte, et que, grâce à cette aide, le soir du cinquième jour, je sortis de Monteforte en t’emportant dans mes bras.
À peine arrivée à Ferrare, je te conduisis auprès de Lucrèce Borgia. Elle te contempla d’un œil rêveur et sombre, puis elle murmura :
– C’est bien lui !
Alors, elle me compta 800 ducats d’or et non pas 500 qu’elle m’avait promis. Deux heures plus tard, je serrais dans mes bras mon fils qu’elle avait fait transporter de Mantoue à Ferrare.
Il fut convenu que je t’emmènerai à Paris et que jamais plus je ne reviendrai en Italie. Lucrèce Borgia me dit qu’elle viendrait à Paris s’assurer que j’avais bien suivi ses instructions.
Je partis donc avec mon fils et toi ; j’arrivai à Marseille où je retrouvai mon homme ; puis, avec toutes sortes de détours, nous finîmes par arriver à Paris où nous nous installâmes dans la Cour des Miracles…
Quant à toi, Manfred, te dire que tu pleuras d’abord beaucoup en demandant ta mère, puis que tu finis par oublier complètement l’Italie, serait inutile.
Le reste, tu le sais…
Quant à ton père, le chevalier de Ragastens, et à ta mère, la princesse Béatrix, tu les as vus ces jours-ci, tu leur as parlé. Tu dois savoir où ils sont.
Manfred, je n’ai plus rien à te dire…
Je te fais mes adieux pour toujours. Si tu songes quelquefois à moi, hais-moi si tu veux, mais pense aussi que je n’exécutai jamais ma promesse de te martyriser… Jamais je ne consentis à te taire mal… et puis, songe aussi que la vieille femme qui t’écrit a beaucoup souffert… oui, beaucoup !
Adieu, Manfred !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telle fut l’étrange lettre dont Manfred, en tremblant, recommença plusieurs fois la lecture.
Elle prouvait que si la Gypsie avait commis un crime abominable, elle n’était peut-être pas pour cela entièrement pervertie. Les romanciers ont l’habitude de présenter des personnages qui sont tout à fait mauvais. En cela, ils se trompent : il n’y a rien d’absolu, pas plus dans l’esprit que dans le cœur des humains, et la vie se compose d’oppositions souvent incompréhensibles. N’avons-nous pas vu le grand prévôt se transformer sous nos yeux ?…
Manfred, en faisant cette lecture, était trop agité pour remarquer que pas une fois la Gypsie n’avait parlé de Lanthenay que cependant elle avait toujours semblé préférer à lui-même.
L’état d’esprit où se trouva le jeune homme après avoir lu et relu cette lettre fut une sorte de ravissement.
Il cherchait à se représenter la princesse Béatrix qu’il n’avait fait qu’entrevoir dans la maison de la rue Saint-Denis, mais dont la beauté et la dignité l’avaient vivement frappé.
Puis son imagination le ramenait auprès du chevalier de Ragastens, et il serrait ses mains avec force, tandis que ses yeux se mouillaient de larmes.
– Voilà donc, songeait-il, le sens des questions qu’il me posait dans la Cour des Miracles, la nuit de l’attaque ! Il cherchait son fils… Et ton fils était devant toi, ô mon père !…
À ce moment, la folle s’approcha de lui.
– Écoute-moi, dit-elle.
Manfred, arraché soudain à sa rêverie, tressaillit.
– Que me veux-tu ? demanda-t-il doucement.
– La Gypsie m’a dit que tu me ferais retrouver ma fille. Oh ! je n’ai pas oublié, c’est bien cela qu’elle a dit…
– Ta fille, pauvre femme !
– Oui, une petite fille, six ans à peu près, des cheveux blonds… tu l’as donc vue ?
Et Manfred, ému, se trouvait assez embarrassé lorsque des pas précipités retentirent, la porte s’ouvrit. Cocardère et Fanfare, toujours inséparables, apparurent.
– Enfin, on te retrouve ! s’écria Cocardère. Sais-tu ce qui se passe ?
– Comment le saurais-je ? Depuis hier, je me débats contre la fièvre…
– Eh bien, il se passe que Lanthenay va être pendu ! Es-tu en état de marcher ?…
– Allons ! gronda Manfred qui, à cet instant, eût oublié le monde entier.
Tous les trois s’élancèrent au dehors.
– Oh ! sanglota Margentine. Il s’en va !… Il ne reviendra plus !…
XIX
NOUVELLE APPARITION DE FRÈRE THIBAULT ET FRÈRE LUBIN
Nous prierons le lecteur de bien vouloir se reporter au moment où les truands, ayant franchi la Seine à la nage, essayaient de sauver Étienne Dolet.
On sait qu’ils furent accueillis par une forte arquebusade.
Au moment de la décharge, Cocardère vit tomber Fanfare qui était près de lui.
Fanfare gémissait sourdement.
Donc il n’était pas mort.
Cocardère le chargea sur ses épaules, car pour rien au monde il n’eût abandonné son compagnon. D’autre part, il ne voulait pas non plus abandonner Lanthenay et Manfred dans leur audacieuse tentative.
Le truand se proposait donc de mettre son ami à l’abri, puis de rejoindre aussitôt les assaillants.
Ayant chargé Fanfare sur ses épaules, il regarda autour de lui et aperçut quelques ribaudes qui lui faisaient signe d’un air très apitoyé.
Cocardère, sourit, attribuant à sa bonne mine et à ses moustaches conquérantes la pitié de ces femmes. Il se hâta d’entrer dans la pauvre maison où elles l’appelaient.
La porte refermée, Cocardère déposa le blessé sur un matelas et s’agenouilla près de lui pour juger de la gravité de son état.
Fanfare, qui revenait à lui, porta la main à sa tête. Cocardère se hâta de défaire le casque de fer de son ami.
Délivré de cette armure gênante, Fanfare respira plus librement, et ne tarda pas à se mettre sûr ses pieds. On s’aperçut alors qu’il n’avait d’autre mal qu’une contusion au crâne et qu il avait été simplement étourdi par le choc de la balle sur le fer.
– Courons ! dit alors Cocardère.
– Inutile ! fit l’une des ribaudes qui, penchée à la fenêtre, regardait ce qui se passait.
Cocardère se précipita à la fenêtre.
En effet, toute intervention était inutile !…
Il vit la rue jonchée de cadavres et de blessés ; des femmes enlevaient les blessés au risque de recevoir quelque balle. Là-bas, au bout de la rue, il vit Lanthenay entouré de gardes… Tout était fini !…
Cocardère tomba sur un escabeau en pleurant.
– Que veux-tu ? lui dit Fanfare qui, par nature, était plus philosophe, c’est son tour aujourd’hui… ce sera demain le nôtre !…
Mais Cocardère ne l’écoutait pas.
Il s’était remis à la fenêtre et examinait ce qui se passait vers le bûcher. Une heure, deux heures s’écoulèrent.
Peu à peu, il vit la foule, revenue de son alerte, se ramasser à nouveau autour du bûcher.
– Allons voir ! dit-il à Fanfare. Peut-être apprendrons-nous du nouveau !
Fanfare, ayant échangé son casque contre une toque qui lui fut prêtée par l’une des ribaudes, suivit son ami, et tous deux, étant descendus, allèrent se mêler à la foule.
C’est ainsi qu’ils assistèrent à toutes les péripéties de cet affreux spectacle.
– Allons nous-en ! dit Fanfare épouvanté.
– Attends…
C’était le moment où Loyola, répondant au cri pitoyable d’une femme, criait que les cendres du supplicié seraient jetées au vent. Des moines avaient saisi des pelles, et les ossements de l’infortuné Dolet avaient été placés dans une caisse pour être emportés.
Tout était fini, les moines s’étaient dispersés, chaque groupe regagnant son couvent…
– Allons ! dit Cocardère.
– Où cela ?…
Cocardère désigna à son ami deux moines qui emportaient la funèbre caisse.
– Suivons-les ! dit-il.
– Pourquoi faire ?… demanda Fanfare étonné…
– N’as-tu pas entendu que les ossements du malheureux vont être jetés en terrain perdu ?
– Oui ! Et après ?…
– Après ?… Tu ne trouves pas cela épouvantable, toi, cœur de bronze ! Tu ne trouves pas abominable cette persécution qui s’acharne sur les os du mort ! Tu ne trouves pas que les moines qui consentent à ce sinistre métier de bourreaux des morts méritent une correction !
– Ma foi, dit Fanfare, je n’y pensais pas, mais puisque tu le juges ainsi…
Tous les deux s’élancèrent, suivant les moines qui emportaient la caisse.
En route, lorsqu’ils furent assez loin du lieu du supplice, les moines se défirent de leurs cagoules. Cocardère et Fanfare reconnurent les deux porteurs.
– Frère Thibaut !…
– Et Frère Lubin !…
– La besogne convient à ces drôles ! reprit Cocardère.
– N’en dis pas de mal : nous avons mangé leurs écus.
Les deux truands suivirent de loin les moines, qui se dirigèrent non vers leur couvent, situé du côté de la Bastille, mais vers la montagne Sainte-Geneviève. Ils les virent entrer dans un monastère d’augustins.
– Attendons-les ! dit Cocardère.
– Attendons ! dit Fanfare avec résignation. L’attente fut longue. La journée se passa sans que les moines furent[6] ressortis. La nuit vint.
Vers dix heures, cependant, ils virent arriver un moine qui frappa à la porte du couvent et disparut à l’intérieur.
Ce moine, que Cocardère et Fanfare ne reconnurent pas, c’était Loyola : il sortait de chez le grand prévôt.
Fanfare pestait fort contre la faction que lui imposait son ami.
– Attendons jusqu’à minuit, dit Cocardère. Alors nous nous en irons, mais vraiment, je n’eusse pas été fâché de donner une leçon à ces misérables.
La persévérance de Cocardère devait avoir sa récompense.
Vers onze heures, la porte du couvent se rouvrait, et deux moines portant une caisse en sortirent. Cocardère et Fanfare les reconnurent sur-le-champ : c’étaient frère Thibaut et frère Lubin.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loyola, poussant jusqu’au bout la sinistre comédie qu’il avait imaginé, avait en effet donné l’ordre aux deux moines – ses créatures – de porter les cendres de Dolet dans le couvent où il s’était logé depuis qu’il avait quitté le Trou-Punais.
Par son ordre aussi, des chants liturgiques furent psalmodiés toute la journée sur ces pauvres restes du supplicié.
Enfin, lorsque Loyola rentra au couvent, il fit venir Lubin et Thibaut et leur dit que l’heure était venue de faire subir à l’hérétique l’injure posthume qu’il avait méditée.
– Quoi, mon révérend, en pleine nuit !… s’écria frère Thibaut, toujours prudent.
– Aimez-vous mieux besogner au jour et risquer d’ameuter contre vous quelque populace ? Car on ne respecte plus rien dans ce maudit Paris !
Les deux moines furent vivement frappés par cet argument et se déclarèrent prêts à obéir.
– Allez donc, mes frères, dit Loyola, et que Dieu vous conduise !
Frère Thibaut s’empara donc de la caisse et, suivi de frère Lubin, sortit du couvent.
Ils se dirigèrent vers un pré situé sur l’autre versant de la Montagne-Sainte-Geneviève, à peu près à l’endroit où fut bâti plus tard un couvent qui devait devenir la prison de Sainte-Pélagie.
Il y avait là alors une sorte de terrain vague, c’est-à-dire un pré banal non enclos de murs ou de palissades.
C’est dans ce terrain que Loyola avait donné l’ordre de jeter les cendres de Dolet.
Tant que les moines se trouvèrent en l’Université, ils marchèrent assez bravement. L’Université, en effet, pullulait de couvents et d’églises, et aussi de cabarets dont un certain nombre, par privilège, avaient permission de donner à boire aux écoliers jusqu’à une heure assez avancée de la nuit.
Quelques-uns de ces cabarets étant encore ouverts, les deux moines ne manquèrent pas d’aller y puiser le courage qui leur faisait défaut. Il va sans dire qu’ils furent accueillis par les quolibets des écoliers.
– Ohé, Thibaut de malheur ! que portes-tu dans cette caisse ?
– C’est son âme qu’il va vendre à Lucifer !
– Non ! c’est un trésor qu’il va enterrer !
Les moines ne répondaient rien, vidaient hâtivement un verre de vin et reprenaient leurs pérégrinations.
Ce fut ainsi que les cendres d’Étienne Dolet furent portées au lieu de leur éternel repos…
Après la dernière station des moines dans le dernier cabaret ouvert, la caisse était maculée de taches de vin, un écolier ivre ayant jugé à propos d’envoyer le contenu de son gobelet, à toute volée, sur frère Thibaut.
Les deux fossoyeurs improvisés titubaient légèrement en se dirigeant vers le pré, après avoir dépassé les dernières maisons de l’Université.
Les libations des deux moines leur avaient rendu quelque courage, courage tout relatif d’ailleurs et qui leur permettait tout juste de ne pas jeter leur caisse en un coin et de s’enfuir à toutes jambes.
Mais si Lubin et Thibaut redoutaient fort quelque diabolique apparition ou quelque attaque de maraudeurs, ils redoutaient encore plus la colère d’Ignace de Loyola.
Ils s’avançaient donc, se soutenant de leurs réflexions, s’encourageant mutuellement, s’arrêtant au moindre bruit pour s’arc-bouter l’un contre l’autre.
Enfin, ils arrivèrent au pré, but final de leur sinistre excursion.
Frère Thibaut déposa la caisse à terre.
Le sol de ce pré, continuellement ravagé par les courses des gamins, était pelé, galeux, et le gazon n’y poussait que par places ; c’était tout à fait ce qu’on appelle aujourd’hui un terrain vague.
– Ouf ! dit Thibaut, nous y voilà !
– En somme, nous n’avons pas fait de mauvaise rencontre, reprit Lubin.
– Oui, mon frère, mais il y a le retour !
– Espérons que quelque taverne sera encore ouverte. Avez-vous remarqué, mon digne frère, combien la peur est poivrée ?
– Hein ? fit Thibaut étonné.
– Je veux dire combien elle donne soif…
– Peuh !… Je vous avouerai que j’ai soif en tout temps… Mais si nous voulons, comme vous en émettiez l’espoir, trouver une taverne ouverte, il faut nous hâter de vider cette caisse…
– Comme une caisse d’ordures, selon l’expression du révérend Loyola !
Cependant frère Thibaut s’était agenouillé ; Lubin s’agenouilla près de lui, et tous deux combinèrent leurs efforts pour soulever le couvercle cloué de la caisse.
Ce fut à ce moment précis que les deux moines poussèrent ensemble une clameur de détresse, d’épouvante et de douleur.
Un formidable coup d’ils ne savaient quoi de dur et de noueux s’était abattu sur leurs échines.
Stupéfaits, effarés, terrifiés, Lubin et Thibaut furent debout d’un bond.
Un nouveau coup tomba sur leurs reins.
– Miséricorde ! vociféra Thibaut.
– Saints anges du ciel ! hurla Lubin.
Ces invocations, malgré toute leur ferveur, demeurèrent inutiles ; aucun ange ne vint leur manifester sa miséricorde. Au contraire, une main de fer avait harponné chacun des deux moines par un bras, et les coups s’étaient mis à pleuvoir drus comme grêle.
Lorsque Cocardère et Fanfare furent las de frapper, ils lâchèrent leurs victimes.
Retroussant leurs robes, les moines se mirent à courir, tels des cerfs aux abois, talonnés de près par leurs agresseurs, et attrapant encore par ci par là quelque coup de matraque.
Ce ne fut qu’au bout du pré et aux premières maisons de l’Université que Thibaut et Lubin se sentirent libérés ; mais ils n’en continuèrent pas moins à voler en bondissant vers le couvent où ils arrivèrent exténués, brisés, moulus, et où ils furent malades plus de trois mois, tant des coups qu’ils avaient reçus que de la peur qu’ils avaient éprouvée.
Cocardère et Fanfare étaient revenus vers la caisse.
Tous deux se mirent à creuser le sol avec leurs poignards. Au bout d’une heure de travail, ils avaient fait un trou d’une certaine profondeur, dans lequel ils déposèrent la funèbre caisse.
Puis, avec leurs mains, ils repoussèrent la terre dans le trou qu’ils comblèrent et piétinèrent de leur mieux.
Alors Cocardère eut une idée.
Il saisit les deux bâtons de cornouiller dont ils venaient de frotter les échines des moines, et, les attachant par une cordelette, il en fit une croix !…
Et cette croix, il la planta sur le pauvre petit tas de terre qui recouvrait les cendres d’Étienne Dolet…
Leur besogne accomplie, les deux truands s’inclinèrent – peut-être avec plus de compassion que de piété – et récitèrent tant bien que mal un Pater.
Puis ils s’en allèrent.
Ce fut ainsi que Dolet, qui n’eût peut-être pas voulu de croix sur sa tombe, en eut une tout de même ; et ce fut ainsi que ses restes furent enterrés chrétiennement, malgré la volonté des prêtres.
Quant à la croix, elle demeura longtemps sur le tumulus. Jamais on ne sut ce qu’elle faisait là, solitaire, au milieu de ce pré galeux.
Mais elle passa à l’état d’habitude, et fut respectée par les gamins, ordinaires habitants de ce terrain où ils prenaient leurs ébats.
On finit par supposer qu’elle symbolisait l’ex-voto de quelque âme en peine, et comme il faut que toute chose soit étiquetée et cataloguée, on l’appela simplement La Croix du Pré…
XX
LE GIBET DU TRAHOIR
Les deux truands étaient rentrés en toute hâte dans l’Université, puis dans la ville, et étaient enfin arrivés à la Cour des Miracles où ils dormirent jusqu’au matin.
Cocardère fut sur pied de bonne heure et réveilla son ami…
Lanthenay avait été arrêté.
Cocardère voulait savoir en quelle prison il avait été jeté. Il commença par s’enquérir de Manfred, et apprit que lui aussi avait disparu.
Il voulut se renseigner auprès de la Gypsie, mais nul ne savait où était la bohémienne.
Cocardère constata qu’avant bien longtemps on ne pourrait les jeter en une nouvelle aventure.
Avec Fanfare, il erra toute la matinée de la Conciergerie au Châtelet, du Châtelet à la Bastille, cherchant à savoir, déployant des prodiges de ruse pour interroger quelque geôlier.
Comme ils s’en revenaient, ils passèrent près de la Croix du Trahoir.
Il y avait là un des innombrables gibets dont les rues de Paris étaient alors hérissées.
Un aide du bourreau, grimpé sur une échelle, était occupé à accrocher au gibet une belle corde toute neuve.
– On va pendre, quelqu’un ! dit Fanfare avec indifférence.
Mais dans l’état d’esprit où il se trouvait, cette vue affecta péniblement Cocardère et excita sa curiosité. Il se plaça donc au premier rang des badauds, et, comme le valet du bourreau, descendu de son échelle, examinait son ouvrage avec une évidente satisfaction…
– Belle corde ! dit Cocardère.
– Toute neuve, dit le valet.
– Peste ! Celui à qui elle est destinée ne se plaindra pas !
Le valet se mit à rire et haussa les épaules.
– Vieille ou neuve, une corde est une corde !
– Et… à quand la fête, camarade ?
– Demain matin, répondit le valet, flatté d’être appelé camarade par un homme qui portait au côté une gigantesque rapière et avait à sa toque une plume qui tombait jusque dans le dos.
– Un gobelet d’hypocras ? proposa le truand.
Deux minutes plus tard, l’aide bourreau et les deux truands étaient attablés dans la plus proche taverne, devant une bonne mesure d’hypocras.
– Ainsi, vous allez le pendre haut et court ? demanda Cocardère.
– Qui ça ? fit l’aide bourreau.
– Mais l’homme de demain matin !
– Ah ! oui… eh bien, celui-là n’a pas volé sa corde…
– Diable ! Qu’a-t-il donc fait ?
– C’est un de ces démons qui ont attaqué les gardes de monseigneur le grand prévôt, un des plus féroces…
– Et comment s’appelle-t-il ? Excusez ma curiosité…
– Il n’y a pas de mal, dit le valet en vidant son gobelet. L’homme s’appelle Lanthenay…
– Lanthenay ! s’écria Fanfare en frappant violemment la table de son poing…
– Eh bien ! Qu’est-ce qui vous prend ? fit le valet.
Fanfare s’apprêtait à répondre, mais Cocardère lui marcha sur le pied et se hâta de reprendre :
– Ne faites pas attention, camarade. Mon ami a eu maille à partir un jour avec ce brigand, ce… comment l’appelez-vous ?
– Lanthenay.
– C’est justement cela. Eh bien, mon ami a donc été fort joliment rossé par ce Lanthenay ; dès lors, vous comprenez sa joie d’apprendre que le scélérat va être pendu… Encore un peu d’hypocras…
– Eh bien, dit le valet qui, en tendant son gobelet, éclata de rire, en votre honneur, je vous promets de bien soigner votre homme…
– Comment cela ? fit Cocardère en pâlissant.
– C’est bien simple : toutes les fois qu’un condamné nous est recommandé… vous comprenez ?
– Oui, oui, allez…
– Eh bien, nous nous arrangeons pour le faire souffrir un peu plus.
– Ah ! ah ! s’écria le truand dont le front se mouillait de sueur. Et comment faites-vous ?
– C’est une petite ruse de métier… Au moment où le condamné se balance au bout de sa corde, vous savez que nous nous accrochons à ses jambes… C’est une traction qui brise les os du cou… et alors… couic !
Il reprit :
– Alors, vous comprenez, si au lieu de tirer un bon coup bien sec, nous tirons mollement, dame ! le pendu meurt en douceur, et ça dure quelquefois plusieurs minutes…
– Horrible ! murmura Cocardère qui pourtant ne faisait pas profession d’avoir les nerfs bien délicats.
– Que dites-vous ?
– Je dis que c’est tout à fait amusant…
– Dame, dans notre métier, vous savez, on se distrait comme on peut.
– Et vous dites que ce Lanthenay sera pendu demain matin ?
– À sept heures ; si le cœur vous en dit, vous pourrez vous amuser un quart d’heure à regarder la chose.
– Nous n’y manquerons pas, diable ! Et en quelle prison l’a-t-on mis, ce scélérat ?
– Ah ! Voilà ce que j’ignore… On nous amène notre homme demain matin, voilà tout ce que je sais…
Et comme Cocardère se taisait, anéanti, l’aide du bourreau, mis en belle humeur par l’hypocras, continua :
– D’ailleurs, vous ne serez pas les seuls à vous réjouir du coup d’œil. Le brigand a été recommandé d’une manière toute spéciale à mon maître…
– Votre maître ?
– Oui… le bourreau juré. Il a reçu des ordres particuliers, non seulement du grand prévôt, mais encore de quelqu’un qui, paraît-il, est encore plus puissant…
– Je ne vois que le roi qui soit plus puissant que le grand prévôt.
– On voit bien, dit le valet dont la langue s’épaississait, que vous n’êtes pas comme nous au courant… et que vous ignorez ce qu’il faut redouter… le roi, c’est le roi… je ne dis pas non… mais pour nous, le grand prévôt est plus que le roi… et il y a quelqu’un qui est plus que le grand prévôt…
– Voilà qui est incroyable !
– Si vous aviez vu comme moi et mon maître le puissant comte de Monclar trembler devant ce moine, vous ne diriez pas cela !
– C’est donc un moine ?
– Oui… mais quant à vous dire son nom, ajouta l’homme en regardant autour de lui avec inquiétude, n’y comptez pas !… J’aimerais mieux avoir à mes trousses tous les diables d’enfer que de m’attirer la haine de ce révérend !
Et comme s’il eût été pris soudain d’une inexplicable terreur, le valet se hâta de vider son gobelet et, précipitamment, prit congé des deux truands. Quelques instants plus tard, Cocardère et Fanfare sortirent à leur tour.
– Qu’est-ce que tu dis de tout cela ? demanda le premier.
Fanfare hocha la tête :
– Je dis que notre pauvre Lanthenay est bien perdu…
– Ah ! si seulement nous avions huit jours devant nous !… Mais c’est demain ! demain matin !
Et Cocardère hâtait le pas, comme si un espoir l’eût poussé il ne savait où !
En arrivant à la Cour des Miracles, il eut pourtant une minute de joie. Une ribaude lui apprit que Manfred, blessé au bras, était soigné chez Margentine la folle.
– Celui-là du moins est sauvé !
Ils coururent chez Margentine où ils trouvèrent Manfred, comme nous l’avons raconté.
XXI
MAITRE LEDOUX
Il y avait autour du Petit Châtelet une foule de petites rues qui, croisées, enchevêtrées, formaient une sorte de toile à mailles serrées au milieu de laquelle la célèbre prison était placée comme une monstrueuse araignée.
L’une de ces ruelles s’appelait, nous ne savons pourquoi, la ruelle aux chats.
C’était la plus triste, la plus sombre, la plus déserte.
Cette précipitation due à une sourde terreur s’accentuait encore lorsque les mêmes passants arrivaient devant une maison située vers le milieu de la ruelle.
Cette maison, où nos lecteurs se souviendront peut-être d’avoir accompagné le révérend père Ignace de Loyola, était protégée par une solide porte toute ferrée sur laquelle s’ouvrait un judas défendu lui-même par une grille épaisse.
C’est là que demeurait le bourreau-juré de Paris, personnage considérable qui était en relations directes avec le grand prévôt et commandait à une véritable petite armée de valets, aides et ouvriers.
Il s’appelait Ledoux, nom qu’il portait avec modestie et qui lui convenait assez.
Les voisins, toutes les fois qu’ils voyaient s’ouvrir la porte de chêne bardée de fer, disaient entre eux :
– Qui va mourir aujourd’hui ?
On ne lui connaissait ni domestique, ni servante, ni femme, ni maîtresse, ni famille quelconque. Il était dans toute l’acception du mot, et dans son double sens, « un solitaire ».
Dans la nuit qui précéda la matinée où Lanthenay fut, comme nous l’avons vu, entraîné vers le gibet du Trahoir par les gardes qu’escorta Loyola, dans cette nuit-là, au moment où maître Ledoux s’apprêtait à se coucher, on heurta à la porte de chêne.
En entendant, le bourreau grogna quelques mots inintelligibles et parut hésiter s’il irait ouvrir. Tout de même, il se décida et alla tirer le judas.
Il vit trois hommes.
– Qui êtes-vous ? demanda-t-il.
– Trois truands de la Cour des Miracles, répondit hardiment l’un des trois hommes.
La réponse, en effet, ne laissa pas que d’étonner le bourreau. Cette franchise lui imposa un vague respect. Toutefois, il grommela :
– Vous êtes donc bien pressés de faire ma connaissance ! Allez, cela viendra bien assez tôt ! Que me voulez-vous ?
– Vous dire quelque chose qui vous intéresse au plus haut point… dans l’espoir que vous récompenserez notre zèle de quelques écus.
– Hum ! Et quelle est cette chose ?
– Nous ne pouvons la dire qu’après avoir discuté le paiement. Sachez seulement que vous êtes menacé de perdre votre fonction… Faute de savoir ce que nous avons appris par hasard, demain, Paris aura un autre bourreau.
Sans doute celui qui parlait ainsi savait l’effet que ces paroles produiraient sur maître Ledoux. Le bourreau, en effet, qui n’était ni coureur, ni buveur, ni paillard, qui avait réellement toutes les vertus qui constituent ce qu’on appelle un honnête homme, le bourreau, disons-nous, avait un point faible : il s’était pris de passion pour ses fonctions. Il caressait de la main sa collection de haches comme un avare peut caresser de l’or. Le jour où maître Ledoux ne serait plus bourreau-juré, il mourrait !… Lorsqu’il marchait dans le cortège d’un condamné, sa hache à l’épaule, et que, du coin de l’œil, il surveillait le frisson de terreur qui agitait la foule, il éprouvait au fond de lui-même une jubilation qui ne se traduisait par aucun signe extérieur, mais qui n’en était pas moins intense.
Les paroles prononcées par l’inconnu firent pâlir maître Ledoux.
Que risquait-il, après tout ? Il n’y avait rien à voler chez lui. Et puis la franchise, l’accent de sincérité de celui qui lui parlait l’avaient vivement impressionné.
– Entrez… dit-il.
Les trois hommes obéirent à l’invitation. Le bourreau referma sa porte et leur jeta encore un coup d’œil soupçonneux.
– Je vous préviens, dit-il, qu’il n’y a rien de bon à prendre chez moi, sinon quelque bon coup de dague au cas où vous seriez venus en de mauvaises intentions.
– Rassurez-vous, maître, répondit celui des trois qui avait jusqu’ici parlé, nous n’avons aucune mauvaise intention.
Le bourreau, alors, fit passer ses nocturnes visiteurs dans la grande salle où brûlait une torche de résine en guise de flambeau.
Ces trois truands, c’étaient Manfred, Cocardère et Fanfare.
Que venaient-ils faire chez le bourreau ?
Cocardère avait raconté à Manfred l’entretien qu’il avait eu avec le valet de maître Ledoux. Lorsqu’il fut question du moine, dont cet homme n’avait pas voulu dire le nom, Manfred devina aussitôt qu’il s’agissait de Loyola.
Il comprit dès lors que rien ne pouvait sauver son ami.
Mais telle était l’énergie de ce caractère qu’il n’en résolut pas moins de tenter quelque chose.
Quoi ? Il ne savait.
Le soir arriva.
Quelques heures, maintenant, séparaient Lanthenay du moment où il serait conduit au supplice…
Ce fut alors que Manfred songea au bourreau.
Oui, si quelqu’un au monde pouvait lui donner un renseignement positif, c’était le bourreau !…
Manfred ne perdit pas de temps à discuter cette pensée lorsqu’elle lui vint. Il en fit part à Cocardère et à Fanfare qui ne le quittaient pas.
Et ce fut ainsi que, vers le milieu de la nuit, tous les trois frappèrent à la porte de maître Ledoux.
À peine entré dans la grande salle, Manfred se tourna vers le bourreau.
– Maître, lui dit-il, je dois tout d’abord vous dire que j’ai menti pour vous obliger à nous ouvrir votre porte. Votre situation n’est pas menacée ; ou, si elle l’est, je l’ignore complètement…
– Que voulez-vous, alors ? grogna-t-il.
– Si vous aviez un cœur, je vous dirais que je viens essayer de le toucher… mais j’aime mieux en appeler à votre intérêt… Je puis, en deux heures, rassembler un millier d’écus. Je vous les offre.
– Pourquoi ?
– Pour savoir en quelle prison se trouve l’homme que vous devez pendre demain matin… c’est-à-dire tout à l’heure.
– Lanthenay ?
– Oui, Lanthenay.
Le bourreau demeura grave.
– Je n’ai pas besoin d’argent, dit-il sourdement ; je ne dépense pas le quart de ce que je gagne.
Manfred pâlit.
Il comprit que le bourreau était incorruptible.
– Ainsi, balbutia-t-il, vous ne consentiriez pas…
– Vous êtes un plaisant personnage, fit brusquement le bourreau. Vous cherchez à savoir où se trouve un homme qu’on va pendre. C’est pour tenter de le sauver. Et c’est à moi que vous vous adressez pour cela !
Manfred regarda le bourreau avec des yeux égarés.
Ledoux alla sans se hâter décrocher une de ses haches et dit :
– Quand vous seriez dix, je me chargerais de vous expédier tous. Et quand même vous seriez parvenu à me lier, quand vous me mettriez sur le chevalet, je ne parlerais pas si je veux me taire… Une seule fois je me suis laissé tenter par le gain ! Une seule fois je suis sorti de mon devoir !… Et j’en ai trop souffert pour que je recommence…
Et Manfred l’entendit qui murmurait :
– Oh ! mes nuits sans sommeil !… Oh !… le cauchemar de cette femme que j’ai pendue… sans en avoir le droit… puisqu’elle n’était pas condamnée !…
Si bas que ces mots eussent été prononcés, Manfred les entendit.
Un éclair illumina sa pensée et l’éblouit.
Dans une rapide vision, il revit la scène du gibet de Montfaucon, la lourde voiture qui marche devant lui, la femme qui se débat dans les bras du bourreau en jetant des cris d’horreur…
– Maître, dit-il à brûle-pourpoint, depuis quand n’avez-vous pas été à Montfaucon ?
– Qui parle de Montfaucon ici !…
– Moi ! dit Manfred. Moi qui me suis trouvé à Montfaucon par une glaciale soirée du début de l’hiver… Tenez, maître, il était à peu près cette heure-ci…
Le bourreau poussa un sourd grognement qui, chez lui, devait être sans doute une sorte de plainte. Il regarda Manfred d’un air effaré…
– La nuit était bien noire, reprit Manfred, mais j’ai de bons yeux… Une voiture arriva, montant péniblement la côte… elle s’arrêta enfin au pied du gibet… Un homme sortit de la voiture, traînant après lui une femme…
– Elle ! gronda le bourreau.
– En même temps, continua Manfred, le postillon de la voiture sauta à terre et reçut la femme dans ses bras… Alors, maître, savez-vous ce qu’il fit, ce postillon :
– Non, je ne le sais pas ! Je ne veux pas le savoir !…
– Il saisit la femme… une femme jeune, belle, digne de pitié… il la saisit rudement et l’entraîna…
– Taisez-vous !… Taisez-vous !…
– Il l’entraîna !… vous dis-je. L’infortunée suppliait, gémissait !… Mais l’infernal postillon était sans doute sans pitié, puisqu’il la porta jusqu’au gibet et qu’il lui passa la corde au cou !…
– Grâce ! bégaya le bourreau.
– Un instant plus tard, le corps de la malheureuse se balançait dans le vide !… Alors l’homme remonta dans la voiture, le postillon sur son siège, et la voiture s’éloigna dans la direction du village de Montmartre… Or, savez-vous qui était cet homme ?…
– Non ! je ne le sais pas ! hurla maître Ledoux.
– C’était Ferron, honnête bourgeois. Et la femme, c’était sa femme !… Et le postillon, savez-vous qui c’était ?…
– Non ! Non !… Je ne veux pas entendre !
– C’était vous, maître Ledoux ! C’était vous, bourreau-juré, qui commettiez un crime abominable, un monstrueux assassinat !…
Maître Ledoux tomba sur ses genoux.
– Grâce ! râla-t-il… Si vous saviez comme j’ai souffert depuis cette affreuse nuit !… Oui… C’est vrai ! Pour la première fois, je me laissai tenter… Stupide que j’étais !… Comme si j’étais capable de dépenser de l’or, moi !… Le présent que je reçus… présent royal !… Je ne sus qu’en faire !… C’était une boîte en argent ciselé… je la brisai à coups de hache… C’était aussi un collier de perles qui eût fait ma fortune… J’ai donné toutes les perles… Depuis, je ne dors plus. Dès que je ferme les yeux, je vois cette femme qui se balance au bout d’une corde, j’entends ses cris… Et pourtant, que de femmes, que d’hommes j’ai pendus dans ma vie sans en éprouver de remords !…
Alors Manfred se pencha vers lui :
– Et si je te rendais le sommeil ? Si je te rendais la paix de la conscience, que ferais-tu pour moi ?…
– Que voulez-vous dire ? balbutia le bourreau.
– Réponds d’abord : où est Lanthenay ?
– À l’hôtel de la grande prévôté ! dit maître Ledoux, inconscient à force de terreur.
– Maintenant, réponds encore : veux-tu m’aider à le sauver ?
Le bourreau se releva et secoua la tête avec angoisse :
– Si c’est à ce prix-là que vous devez me rendre mon bon sommeil de jadis, tout est inutile !
– Pourquoi ?…
– Parce que je ne puis rien ! Si je refuse de pendre Lanthenay, un aide s’en chargera à ma place…
– Oh ! rugit Manfred, n’existe-t-il donc aucun moyen au monde !…
– Écoutez, fit le bourreau… Vous me promettez de…
– Oui, te dis-je ? D’un seul mot, je puis t’enlever tes remords…
– Oh ! si cela était possible !…
– Cela sera, je le jure !…
– Eh bien ! je ferai l’impossible pour vous donner le temps d’agir… Comment je m’y prendrai ? Je n’en sais rien ! Mais je vous jure que l’exécution sera retardée jusqu’à 10 heures. C’est tout ce que je puis faire… et nul au monde n’en pourrait faire autant !
– Et tu te charges de dire à Lanthenay que je suis là, que je travaille à sa délivrance ?
– Je m’en charge ! dit résolument le bourreau. Et après un instant de silence, il ajouta avec une terrible anxiété :
– À votre tour, maintenant !
– Bourreau, dit Manfred, tu as un cœur puisque tu souffres, puisque tu pleures, puisque tu te repens ! Bien des hommes qui marchent dans la vie, honorés, respectés, n’en pourraient dire autant… Sois donc rassuré sur le sort de la malheureuse que tu pendis au gibet de Montfaucon… elle est vivante.
Rien ne saurait donner une idée du bouleversement qui se fit au visage de maître Ledoux.
– Vivante ! murmura-t-il, tandis qu’une buée humide voilait son regard sanglant.
– Oui, dit simplement Manfred, je suis arrivé à temps pour la sauver…
– Vous !…
– Moi.
– Vous l’avez sauvée…
– J’ai tranché la corde et ranimé la pauvre femme…
– Et vous êtes sûr qu’elle vit ?
– Très sûr ; je l’ai vue il y a quelques jours.
Le bourreau poussa un profond soupir, et tout ce que cette âme obscure pouvait contenir de joie et de reconnaissance remonta jusqu’à son visage et se traduisit par une sorte d’admiration farouche.
Au surplus, il ne manifesta par aucune parole les sentiments qui l’agitaient.
Mais il regardait Manfred avec une douceur qui contrastait violemment avec la bestialité de son visage.
Manfred ne voyait plus le bourreau.
Les bras croisés, la tête penchée, il méditait.
Toutefois, avant de se retirer, il essaya une dernière fois d’ébranler le bourreau.
– Ainsi, lui dit-il, en échange de ce que je vous apporte, vous ne pouvez que retarder l’heure de l’exécution ?
– Je ne puis que cela ! dit le bourreau. Et pourtant…
– Pourtant quoi ?
– Je donnerais dix ans de ma vie pour vous éviter un chagrin.
– Ce n’est pas votre vie que je veux… c’est celle de mon malheureux frère qu’il faut sauver !
– C’est votre frère ?
– Oui, mon frère !
Maître Ledoux fit quelques pas dans la vaste et sombre salle. Un travail énorme se faisait dans sa tête.
– Écoutez, dit-il brusquement en s’arrêtant devant Manfred… au lieu de reculer l’exécution jusqu’à 10 heures, je puis la reculer jusqu’au soir… cela vous donne toute la journée… Et puis… cela me permettra peut-être… J’ai déjà vu le cas une fois…
– Que voulez-vous dire ? demanda Manfred palpitant.
– Voyons… L’exécution n’aura lieu qu’à la nuit tombante ; cela, je m’en charge, et cela vous donne une chance de plus pour agir dans l’obscurité… Mais si vous ne réussissez pas… si… votre frère est pendu…
– Eh bien ? haleta Manfred.
– Eh bien ! ne vous éloignez pas du gibet… Attendez que les gardes soient partis… et alors… oui, alors dépendez-le !… Je tenterai ce miracle… mais souvenez-vous que je ne réponds de rien ! Souvenez-vous qu’à ce moment là toutes les chances sont pour que vous emportiez un cadavre !
Quelle redoutable épreuve voulait donc tenter maître Ledoux ?
Manfred fit un violent effort sur lui-même, parvint à se ressaisir, fit signe à ses compagnons de le suivre, et ayant jeté à maître Ledoux un regard de suprême recommandation, se hâta de s’éloigner de la maison maudite.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demeuré seul, maître Ledoux referma soigneusement sa porte et revint s’asseoir près de l’âtre.
Les coudes sur les genoux et la mâchoire dans les deux mains, le bourreau regardait fixement la flamme. Il était grave et sévère comme à son habitude. Il semblait qu’il n’y eût rien de changé en lui. Seulement, ses yeux, ordinairement ternes ou sanglants, brillaient de cet éclat spécial et velouté que les larmes donnent au regard.
De temps à autre, il grognait des phrases obscures.
– C’est rudement bon, tout de même… pouvoir regarder dans les coins noirs sans crainte de voir s’y dresser le spectre de la femme… pouvoir écouter le vent qui siffle dans cet âtre sans entendre les hurlements de la morte… pouvoir regarder et écouter dans moi-même.
Puis, après un long silence, il ajoutait, suivant sans doute à la piste sa pensée :
– Oui, certes… entre l’occiput et le maxillaire… Non, ce serait un vrai miracle…
Et encore ceci qu’il grommela longtemps après :
– Pourtant, je ne veux pas que ce jeune homme pleure !
Le bourreau se leva brusquement et se mit à se promener lentement, les mains au dos.
Il murmurait :
– Toute la question est de savoir si le corps peut demeurer suspendu en prenant comme point d’appui l’os occipital et l’os auxiliaire, sans briser les vertèbres… Il faut voir…
Il se dirigea vers la porte, et passa dans une pièce voisine en s’éclairant de la torche.
Dans un coin de cette pièce, un objet oblong était dressé debout contre le mur et enveloppé de serge.
Le bourreau lentement, avec méthode, fit tomber la serge, et l’objet apparut.
C’était un squelette complet.
Il était admirablement agencé, articulé, et il n’y manquait pas le plus petit os ; maître Ledoux avait passé de longs mois à exécuter ce travail qui eût fait honte aux travaux de ce genre qu’on exécute pour les musées d’anatomie. Cela avait été une grande distraction pour cet homme. Et une distraction non moins puissante avait été, pour lui, d’étudier à fond ce squelette.
Il essuya soigneusement un peu de poussière tombée sur le crâne et les omoplates.
Puis son doigt se posa sur les vertèbres du cou.
– Voilà ce qu’il ne faut pas briser ! grogna-t-il.
Il se perdit en une longue méditation, puis murmura :
– Pourtant, cela s’est vu ! La chose est arrivée à Gaspard le Flamand. Je m’en souviendrai toute la vie. C’était en l’an quinze cent douze, au mois d’avril, à Montfaucon même. Qu’est-ce qu’il avait fait, ce bon Gaspard ? Je ne sais plus, au fait ! Toujours est-il que par un joli matin d’avril, je le pendis bel et bien par le col. Or, qu’arriva-t-il ?… Il arriva que plus de huit minutes après la pendaison, comme je m’apprêtais à m’en aller, l’esprit en repos, un de mes valets – à telles enseignes que ce fut Nicolas Bigot – donc, Nicolas Bigot me saisit tout à coup par le bras et s’écria, blême d’épouvante, et les dents entre-choquées : « Maître, regardez donc Gaspard le Flamand ! » Je regardai le pendu, et vis qu’il avait les yeux grands ouverts, non pas par dilatation d’agonie, mais tranquillement et pleins de vie… et ces yeux-là me regardaient d’un air narquois… Quand il vit que je le fixais, le drôle s’empressa de les fermer… Je m’approchai et lui dit : « Ohé ! Tu n’es donc pas trépassé ? », question à laquelle il ne répondit rien, d’ailleurs… Je montai à l’échelle, et m’aperçus alors que le nœud n’avait pas glissé jusqu’au cou, et que le bon Gaspard demeurait suspendu dans le vide sans autre gêne que de ne pouvoir ouvrir la bouche, puisque la corde le maintenait par-dessous le maxillaire… La chose me surprit tellement que je pris sur moi de dépendre le pauvre diable et de lui donner la clef des champs…
Le bourreau ajouta alors :
– Ce qui est arrivé à Gaspard le Flamand par hasard ne peut-il arriver à un autre par ma volonté ?
Alors il se livra à un singulier travail.
Au-dessus du squelette, il planta un gros clou ; au clou, il accrocha une corde et fit le nœud coulant.
Il passa le nœud autour des os du cou.
Alors il plaça la corde du nœud en la serrant de façon qu’elle s’appuyât d’une part sur le menton et de l’autre sur l’os occipital. Puis il tira.
Le squelette se trouva pendu.
– Bon ! fit maître Ledoux ; voilà mon homme en posture ! Que dois-je faire à ce moment ! Je dois me suspendre à ses jambes et tirer dessus d’un fort coup bien sec… Que s’ensuit-il ?… Que les vertèbres du col sont brisées et que la mort survient aussitôt… Oui, mais si je ne donne pas la secousse ?…, Si je fais semblant de la donner ?… Les vertèbres demeurent intactes, et mon homme peut demeurer dans cette position assez longtemps… si toutefois il n’étouffe pas !… Recommençons !
À plus de dix reprises, maître Ledoux s’exerça à ce macabre et fantastique exercice.
Il dépendait le squelette, lui ôtait la corde.
Puis il replaçait le nœud et tirait sur la corde.
Il recommença ainsi jusqu’à ce que du premier coup, et sans hésiter, il fût arrivé à placer le nœud coulant à l’endroit précis qu’il s’était indiqué.
Alors maître Ledoux eut un large ricanement.
Il enveloppa son squelette avec beaucoup de soin et il songea à prendre quelque repos.
Mais au moment où il se dirigeait vers son lit, on frappa violemment à sa porte. Il alla ouvrir. C’était un de ses valets.
– Maître, il est temps ! dit cet homme.
– Quelle heure est-il donc ?…
– Six heures maître.
La nuit avait passé avec une rapidité dont maître Ledoux n’avait pas eu conscience.
– C’est bon, dit-il, j’y vais !…
XXII
LA RUE SAINT-ANTOINE
Nous avons vu le révérend Loyola s’élancer au moment où éclatait la folie du comte de Monclar, s’élancer, disons-nous, hors de l’hôtel de la grande prévôté pour rattraper les gardes qui emmenaient Lanthenay et assister au supplice du malheureux jeune homme.
Les mains étroitement liées, solidement maintenu par deux geôliers, entouré d’une vingtaine de gardes, Lanthenay marchait sans résistance.
L’infortuné ne comprenait rien à ce qui arrivait.
Son père l’avait reconnu !…
Son père avait témoigné, à le retrouver, une joie, une émotion puissantes…
Et son père le laissait emmener au gibet !…
Que se passait-il donc dans l’esprit du grand prévôt ?… Est-ce que son cœur s’était donc racorni à ce point dans l’exercice de ses fonctions, qu’il sacrifiât ainsi son fils !…
Certes, il avait haï le grand prévôt quand il ignorait qu’il était le fils du comte de Monclar…
Mais n’avait-il pas senti cette haine se fondre comme neige au soleil au moment où il avait été sûr d’avoir retrouvé son père ?
Et maintenant !…
Ce père ! Allait-il donc mourir en lui jetant une malédiction suprême ?
Comme il réfléchissait à ces choses, presque inconscient de sa marche au gibet, une voix près de lui raillant, comme cette même voix avait raillé tout à coup à l’oreille de Dolet marchant au bûcher :
– Êtes-vous prêt à mourir ?
Lanthenay reconnut Loyola.
– J’espère, reprit Loyola, que vous employez les cinq ou six minutes qui vous restent à vivre à vous réconcilier avec Dieu…
– Je vous engage, dit rudement Lanthenay, à me laisser mourir tranquille.
– Quoi ! pas un mot de repentir !… Ou tout au moins ne voulez-vous rien faire dire à personne ? Il y a pourtant des êtres que vous aimez… qui vous aiment…
Mais déjà Loyola se hâtait de continuer :
– Je suis sûr qu’il serait consolant pour votre pauvre père de recevoir vos adieux, que je me charge bien volontiers de lui transmettre…
– Mon père ! murmura Lanthenay devenu livide.
– Oui ! Votre père qui vous aime… il me l’a dit !… Votre père qui éprouve une bien vive douleur à vous sacrifier à son devoir…
– Ainsi, gronda Lanthenay, je meurs par la volonté du grand prévôt ?…
– Non par sa volonté, grand Dieu !… mais par son consentement… simplement par son consentement ! Ah ! c’est un magnifique exemple d’abnégation que donne là le comte de Monclar, votre père.
Lanthenay se taisait. Il étouffait de douleur.
– Eh bien, dites-lui donc… dites-lui à ce père si intrépide qui livre son fils au bourreau… dites-lui qu’à tous mes crimes j’en ajoute un dernier… celui de le haïr comme on hait le bourreau même, celui de le mépriser comme on méprise les valets du bourreau ! Dites-lui cela, à ce digne père, et espérons que cela lui donnera quelques nuits de bon sommeil…
– Votre volonté m’est sacrée, dit Loyola, car c’est la volonté d’un mourant. Mais Dieu m’est témoin que j’eusse voulu rapporter d’autres paroles à mon malheureux ami…
– C’est bien, dit Lanthenay d’un air sombre ; écartez-vous, maintenant. Ne demeurez pas à côté… ou je vous jure que dans l’impuissance où je suis de vous étrangler comme vous le méritez, je vous cracherai à la face devant tout ce peuple…
Loyola se recula de deux pas en disant à haute voix :
– Mon Dieu, pardonnez à cet infortuné, car il ne sait ce qu’il dit !
Et, dans la foule, on admira la magnanimité du moine.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lanthenay, dès lors, marcha la tête basse, absorbé en sa suprême méditation.
Tout à coup, il sentit qu’on s’arrêtait.
Il leva les yeux, regarda autour de lui, et vit le gibet.
Lanthenay sourit dédaigneusement. Devant la mort imminente, il reprenait toute sa liberté d’esprit. L’ombre de son père qui venait de l’obséder se dissipa.
Il s’avança vers le gibet et dit au bourreau :
– Tâche de faire vite et bien ! On dit que tu es fort habile ; je vais voir si ta réputation est juste.
À la surprise de tous les assistants, le bourreau répondit. Jamais maître Ledoux ne parlait au moment redoutable.
– Soyez tranquille, fit-il avec une sorte de joyeuse humeur ; je vais faire pour vous mieux que je n’ai jamais fait pour personne.
– Va donc, et fais vite !
À ce moment, les chants de deux ou trois religieux qu’on avait prévenus et qui se trouvaient au pied du gibet s’élevèrent.
Maître Ledoux s’approcha et arrangea vivement le col du pourpoint de Lanthenay. Pour procéder à cette opération, il s’était placé derrière Lanthenay.
Et Lanthenay fut secoué comme d’une secousse électrique lorsqu’il entendit une voix – la voix du bourreau ! – murmurer à son oreille :
– Ne vous étonnez de rien, et ouvrez l’œil ! Votre frère veille !…
En même temps, le bourreau se reculait, et s’adressant à son principal valet :
– Eh bien ! cria-t-il, qu’attends-tu, mauvais capon, pour éprouver la solidité de cette corde !…
Le valet, surpris – car cette formalité n’était pas dans les habitudes – n’en obéit pas moins avec promptitude.
Il se suspendit à la corde et tira dessus d’un coup sec et violent.
On entendit un craquement. Le poteau s’abattit !…
Le bourreau poussa une horrible imprécation.
Les chants des moines cessèrent…
Le cœur de Lanthenay palpitait à se briser.
– Tous ces poteaux des gibets de Paris sont pourris ! sacra le bourreau.
Loyola s’était approché et se penchait sur le poteau, examinant la cassure.
Il se releva en disant :
– Ce poteau n’était pas pourri… ce poteau a été scié…
– Est-ce possible ! s’écria le bourreau en s’approchant.
Mais déjà Loyola, s’adressant à la foule et paraissant y chercher des ennemis inconnus, s’écriait :
– Mais le condamné n’en sera pas moins supplicié. Toute force est vaine contre l’autorité de l’Église et l’autorité du roi !
Alors il se tourna vers maître Ledoux :
– Bourreau, conduisez le condamné au plus proche gibet.
– Impossible ! mon révérend.
– Impossible ! fit Loyola. Pourquoi donc ?
– Parce que j’ai reçu l’ordre de pendre le prisonnier à la Croix du Trahoir, et non ailleurs. Au surplus, mon révérend, l’accident sera vite réparé…
– Soit ! Combien de temps faut-il ?
– Oh ! la journée à peine. Dès ce soir, je pourrai reprendre l’entretien avec ce brave homme qui a l’air si contrarié du retard.
– Bourreau, reprit Loyola, êtes-vous prêt à m’obéir ? Regardez ceci…
Le moine montra à maître Ledoux un parchemin au sceau du grand prévôt.
– C’est bien, mon révérend, dit Ledoux, je suis prêt à vous obéir. Commandez.
– Vous ne pouvez pendre le prisonnier qu’ici même ?
– Oui, mon révérend. Parce que tel est l’ordre de mon chef direct.
– Soit ! vous allez rentrer chez vous et y attendre mes ordres. La personne qui viendra vous montrera le papier que vous venez de voir. Obéirez-vous ?
– J’y suis bien forcé, mon révérend, puisque monseigneur le grand prévôt l’ordonne.
– Bien. Dans une heure, vous aurez de mes nouvelles. Tâchez alors d’être prompt. Ou, pour mieux faire encore, attendez ici.
– J’attendrai, mon révérend, dit le bourreau étonné.
– Gardes, dit Loyola, surveillez attentivement le prisonnier pendant mon absence, et feu sur quiconque voudrait s’en approcher !
– Soyez tranquille, mon révérend père ! dit le sergent.
Loyola s’élança alors dans la direction de l’hôtel de la grande prévôté. Son plan était bien simple.
Il ferait signer à Monclar l’ordre de pendre Lanthenay à tout autre gibet que la Croix du Trahoir. Dans l’état où il se trouvait, le grand prévôt signerait tout ce qu’on voudrait. Alors Loyola ferait porter ou, mieux, porterait l’ordre lui-même, et Lanthenay serait pendu.
Ce n’était qu’un retard d’une heure au plus.
Ainsi raisonnait Ignace de Loyola en se dirigeant en toute hâte vers l’hôtel du grand prévôt.
Au moment où il passait devant une maison basse dont la porte était ouverte, il se sentit brusquement saisi par des bras vigoureux. Il voulut pousser un cri.
Mais il n’en eut pas le temps.
Un bâillon venait de lui être solidement appliqué sur la bouche. En même temps, le moine fut entraîné vers la porte ouverte et disparut avec ses agresseurs dans l’intérieur de la maison, tandis que la porte se refermait.
Deux ou trois voisins s’aperçurent bien de cet enlèvement si brutalement exécuté.
Mais, à cette époque, c’était là chose assez commune.
À peine le moine avait-il été entraîné dans la maison que la porte s’était aussitôt refermée, Loyola se trouva alors plongé dans une obscurité relative ; il se sentit poussé vers un escalier qui devait descendre dans des caves ; l’obscurité se faisait de plus en plus opaque ; au bas de l’escalier, Loyola fut violemment poussé dans un caveau dont la porte un instant ouverte se referma. Un instant plus tard, une lumière éclaira soudain ce caveau : quelqu’un venait d’entrer avec une torche.
Loyola se vit alors en présence de quatre hommes.
L’un deux lui enleva son bâillon en lui disant :
– Inutile de crier, monsieur, on ne vous entendrait pas… D’ailleurs, nous ne voulons pas vous faire du mal.
– Que me voulez-vous ? demanda le moine d’une voix calme.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trois de ces hommes étaient Manfred, Cocardère et Fanfare.
En quittant la maison du bourreau, dans la nuit, ils étaient revenus à la Cour des Miracles.
À la Cour des Miracles, les trois hommes passèrent le reste de la nuit à essayer de recruter des aides pour un coup de main. Mais la Cour des Miracles était en deuil.
Plus de trois cents hommes avaient été tués ou blessés place Maubert autour du bûcher de Dolet.
Lorsque le jour se leva, c’est à peine si une douzaine de truands avaient promis leur concours, et encore si mollement, avec tant de réticences, qu’à six heures du matin, Manfred, désespéré, partit accompagné seulement de Fanfare et de Cocardère.
– Connaissons-nous quelqu’un de sûr dans la rue Saint-Antoine ou dans la rue Saint-Denis ? demanda-t-il.
– Il y a Didier le bourrelier, dans la rue Saint-Antoine, dit Fanfare.
– Allons chez Didier…
Ce bourrelier, qui était aussi marchand de hardes diverses, habitait dans la rue Saint-Antoine une petite maison dont il était le propriétaire.
Il avait des accointances avec certains truands et mettait ses caves à leur disposition, moyennant une honnête rétribution, lorsqu’ils avaient des marchandises à cacher…
Manfred et ses deux compagnons, en arrivant chez Didier, le mirent au courant de la situation.
– La maison est à vous, répondit le bourrelier.
Le plan de Manfred était de se jeter tout à coup sur les gardes de Lanthenay. Pendant qu’il bataillerait avec Cocardère et Fanfare, Didier entraînerait Lanthenay dans sa maison où ils se réfugieraient tous.
Quant à la fuite, elle devenait dès lors aisée.
Derrière la maison du bourrelier, il y avait un jardin dont il ne s’agirait que d’enjamber le mur pour aller gagner une autre maison.
Ce genre d’attaque avait déjà réussi à Manfred, qui avait ainsi arraché deux ou trois truands à la potence.
Généralement, un homme conduit à la potence était escorté par sept ou huit sbires et les choses se passaient en douceur.
Ce plan ne put être exécuté.
Embusqués dans la boutique du bourrelier, Manfred, Cocardère et Fanfare attendaient le passage de Lanthenay.
Le supplice était pour sept heures.
Mais sans doute un événement imprévu avait retardé l’heure, car huit heures sonnaient à la chapelle Saint-Paul lorsque Cocardère s’écria :
– Les voilà !
C’était en effet l’escorte de Lanthenay.
Manfred étouffa un juron et devint très pâle.
Il y avait plus de trente gardes autour de Lanthenay.
Il n’y avait pas moyen, à trois, d’attaquer une force pareille, en plein jour, en présence de toute une population hostile au condamné.
Les trois compagnons sortirent de chez le bourrelier et se mirent à marcher machinalement parmi les gens du peuple qui suivaient l’escorte.
Ce fut ainsi qu’ils arrivèrent à la Croix du Trahoir.
Il y eut pour eux un moment d’anxiété terrible.
Mais lorsqu’ils virent s’abattre le poteau de la potence, ils comprirent que le bourreau tenait sa parole et reprirent courage. Ils avaient encore toute une journée pour agir !
Manfred assista sans l’entendre à la conversation qui eut lieu entre Loyola et le bourreau. Mais il vit le moine exhiber un papier et le bourreau courber respectueusement la tête.
Enfin, il vit Loyola s’élancer.
Il fit signe à Cocardère et à Fanfare de le suivre.
Devant la maison de Didier le bourrelier, ils se jetèrent sur lui et l’entraînèrent.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loyola examinait d’un air sombre les trois hommes qu’il avait devant lui.
Il espérait qu’il était tombé entre les mains de francs-bourgeois audacieux qui en voulaient à sa bourse.
Et il reprit :
– Est-ce de l’argent qu’il vous faut ?… En ce cas, dites vite la somme.
– Et comment l’aurions-nous ? demanda Manfred.
Loyola sourit. C’étaient décidément de simples voleurs.
– Faites-moi apporter de quoi écrire ; dans un instant je vais vous signer un bon sur la caisse du couvent des Augustins. Quelle somme ?
Manfred fit un signe à Didier, qui se précipita hors du caveau.
– Vous allez savoir ! dit-il à Loyola.
Au bout de quelques minutes, le bourrelier revint ; il traînait derrière lui une petite table ; sur la table, il plaça une écritoire, une plume et une feuille de parchemin.
– Écrivez, monsieur ! dit Manfred.
– Je suis prêt ! répondit Loyola, quelle que soit la somme ; mais j’espère que vous n’abuserez pas…
– Non, vous allez voir que cela ne vous coûtera pas trop cher.
Et Manfred dicta :
– Ordre à maître Ledoux, bourreau-juré de Paris…
– Que dites-vous ? s’écria le moine en posant la plume.
– Monsieur, dit froidement Manfred, pas d’inutile comédie entre nous ; vous en voulez mortellement à Lanthenay parce qu’il vous a blessé, parce qu’il a essayé de sauver le malheureux Dolet, votre victime, enfin, parce que ses instincts d’indépendance vous déplaisent, à vous l’homme de l’autorité violente et absolue !
– Vous vous trompez, mon fils… je ne suis pas l’homme de l’autorité violente, comme vous dites…
– Allons donc ! Regardez-moi, monsieur… vous ne me reconnaissez pas ?
– Je ne vous connais pas ! dit Loyola en regardant attentivement Manfred.
– Souvenez-vous de ce déjeuner que vous fîtes chez maître Rabelais, à Meudon, en compagnie de messire Calvin et d’un autre…
– Ah ! ah ! l’autre, c’était vous, jeune homme ! Je vous remets à présent.
– J’en suis très honoré, monsieur. Vous comprenez maintenant que je vous connais ! Je sais de quelles haines implacables vous nourrissez votre esprit ! C’est vous qui avez fomenté l’attaque contre la Cour des Miracles, c’est vous qui avez voulu la mort de Dolet ; c’est vous qui voulez la mort de Lanthenay…
– Soit ! Et après ?
– Après ? Vous allez écrire ce que je vais vous dicter.
– Et si je n’écris pas ?
– En ce cas, dans deux minutes vous serez mort. Vie pour vie, monsieur !
Loyola courba la tête et demeura pensif.
– Vous êtes bien jeune, dit-il enfin, et vous vous heurtez à plus fort que vous, je vous en préviens.
– Lanthenay est mon frère. Je suis décidé à tout pour le sauver.
– Même à un crime abominable perpétré sur un homme d’Église ?
– Oui, monsieur, dit Manfred très calme. Dépêchez-vous ; il ne vous reste qu’une minute. Écrivez… ajouta-t-il en se montant, écrivez, ou sangdieu je vous égorge comme j’égorgerais une bête malfaisante !…
Loyola prit la plume.
– Dictez ! fit-il d’un ton bref où Manfred démêla une sorte d’ironie. Dictez… mais c’est bien convenu, n’est-ce pas ? Vie pour vie, avez-vous dit ?
– Je le jure ! dit Manfred.
– C’est bien, je suis prêt.
Manfred, ivre de joie, dicta :
– « Ordre à Ledoux, bourreau-juré de Paris, de surseoir au supplice du condamné Lanthenay qui est gracié… Ordre au bourreau de remettre le condamné sain et sauf ès mains de ses gardes. »
Loyola signa.
– Ce n’est pas tout, dit alors Manfred. Écrivez, monsieur… non, pas sur le même parchemin… sur celui-ci…
La mine du moine se fit plus sérieuse.
Manfred dicta :
– « Ordre au sergent, chef des gardes de la prévôté chargés d’escorter le condamné Lanthenay, de le mettre en liberté séance tenante… »
– Mais je ne suis pas qualifié pour signer un ordre pareil ! s’écria Loyola.
– Écrivez toujours… et pas d’hésitation, monsieur !
Loyola jeta un coup d’œil sur Manfred. Il le vit tourmenter nerveusement le manche de son poignard.
Il eut un frémissement de fureur, écrivit et signa. Manfred relut soigneusement les deux parchemins et les mit dans son pourpoint.
– Je suis libre, n’est-ce pas ? demanda le moine.
– Tout à l’heure, monsieur ! Veuillez me remettre le papier que vous avez sur vous !
– Quel papier ! demanda Loyola en blêmissant.
– Pas de comédie, monsieur ! Je parle du papier que vous avez montré au bourreau et devant lequel il s’est incliné avec tant de respect.
– Ce papier est insignifiant pour vous, balbutia le moine.
– Raison de plus pour me le remettre… Allons, décidez-vous !… à moins que vous ne préfériez que je le prenne moi-même sur votre cadavre…
Le moine vit que toute résistance était inutile. Et comme il n’était pas homme à s’emporter en vaines récriminations, il sortit le parchemin et le tendit à Manfred en disant :
– Voilà ce que vous voulez, mon fils. Souvenez-vous que je me suis exécuté de bonne grâce… et que peut-être je ne suis pas l’ennemi de Lanthenay autant que vous paraissez le croire.
Mais Manfred n’écoutait plus.
Il avait déplié le parchemin et jeté un cri de joie.
C’était l’ordre, signé et scellé par le grand prévôt, qui enjoignait à tous gardes de la prévôté, agents du guet et de la force, d’obéir au révérend, porteur du parchemin !
XXIII
VOYAGE DE LOYOLA
Manfred glissa quelques mots à l’oreille de Cocardère et se précipita au dehors. Dans la rue, il se mit à courir comme un fou dans la direction de la Croix du Trahoir.
Comme il courait ainsi éperdument, il heurta un homme que des gamins suivaient à quelques pas.
L’homme roula à terre en criant :
– Vous avez beau faire ! Je le retrouverai maintenant !
Il ramassa une lanterne éteinte qu’il avait laissé tomber au choc et se mit à inspecter les maisons, en faisant le geste de les éclairer.
Manfred, à la voix de l’homme, s’était arrêté court.
Il se retourna et reconnut le grand prévôt.
Que faisait-il là avec sa lanterne ?
Pourquoi ces gamins le suivaient-ils curieusement ?
Manfred, stupéfait, se posa un instant ces questions, puis, remettant à plus tard l’éclaircissement de ce mystère, reprit sa course furieuse vers le gibet de la Croix du Trahoir.
Il y arriva pantelant, à demi suffoqué, en agitant son papier et en criant :
– Grâce ! Il y a grâce pour le condamné !
Le bourreau avait saisi le papier que lui tendait Manfred.
– Il y a grâce en bonne et due forme ! dit-il à haute voix.
Cette exclamation eût suffi pour lever les doutes du chef des gardes si ce sergent eût eu des doutes.
Il examina en connaisseur les deux parchemins appuyés par l’ordre signé du grand prévôt.
– C’est bien, dit-il enfin. Qu’on délie le condamné. Il est libre !
– Noël ! Noël ! hurla la foule.
– Explique-moi… dit Lanthenay.
– Viens ! viens ! murmura Manfred… Tout à l’heure, tu sauras…
Et il entraîna son ami, tandis que les gardes reprenaient le chemin de la prévôté, et le bourreau celui de la ruelle aux chats.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loyola, en voyant partir Manfred, avait refoulé une imprécation qui lui montait aux lèvres.
Les bras croisés sous son manteau, les poings serrés, le sourcil froncé, Loyola échafaudait déjà le plan d’une terrible vengeance.
Trois longues heures s’écoulèrent ainsi.
Ni Cocardère, ni Fanfare n’étaient sortis du caveau. Ils ne perdaient pas le moine de vue.
Un instant, Loyola avait calculé s’il pourrait venir à bout de ces deux hommes. Selon son habitude, toutes les fois qu’il sortait, il était couvert d’une cotte de mailles et portait sous sa robe un poignard.
Mais ses deux gardiens improvisés tenaient chacun à la main une forte dague et avaient l’air très déterminés.
De plus, Cocardère lui avait dit :
– Je vous préviens, mon révérend, que j’ai ordre de vous tuer proprement au premier geste suspect que vous feriez. Ainsi, tenez-vous en paix si vous désirez vous conserver au service de Dieu et au bonheur des hommes.
Cocardère avait appuyé ce remarquable discours d’un geste de sa dague qui n’avait pu laisser aucun doute au moine sur l’issue d’un combat.
Il avait donc pris le parti de se tenir immobile et silencieux, supposant que Manfred ne tarderait pas à revenir.
L’attente, comme nous l’avons dit, dura trois heures.
Au bout de ce temps, le moine entendit des pas qui descendaient l’escalier.
Bientôt Manfred et Lanthenay apparurent.
Manfred était radieux, et Loyola augura bien de cette joie manifeste du jeune homme. Mais Lanthenay était sombre, – plus sombre peut-être qu’au moment où il allait au gibet.
Cocardère et Fanfare avaient chaleureusement pressé la main de celui qu’ils avaient si heureusement contribué à sauver.
– Messieurs, dit Loyola en prenant les devants, j’espère que je suis libre maintenant ?
– Nous allons voir ! dit Manfred.
– Oseriez-vous fausser la parole que vous m’avez donnée ? Contre la vie de Lanthenay, vous m’avez juré de respecter la mienne…
Manfred regarda Lanthenay.
– Monsieur, dit alors celui-ci, d’une voix qu’il s’efforçait de rendre calme, c’est au serment de mon ami… mon frère… que vous devez de vivre. Si Manfred n’avait pas juré de respecter votre vie, comme vous dites, je vous tuerais à l’instant…
– Prenez garde que je porte une robe sacrée ! interrompit Loyola qu’épouvanta un geste de Lanthenay.
– Je vous tuerais, reprit celui-ci, comme un chien enragé, sans le moindre scrupule, et je croirais rendre ainsi un immense service à l’humanité.
Lanthenay était terrible en ce moment.
– Ne craignez rien, railla Manfred. : nous autres, truands, nous avons assez l’habitude de respecter la parole donnée. Vous avez vie sauve, puisque Lanthenay est vivant.
Lanthenay s’arrêta alors et essuya d’une main la sueur qui coulait sur son front.
– Oui, dit-il, vous avez vie sauve… Quant à votre liberté… nous allons en causer.
Loyola, sûr de ne pas être tué, eut un sourire diabolique.
– Vous êtes bien jeunes tous les deux, dit-il, et j’excuse le faux jugement que vous portez sur un homme qui devrait vous être respectable à plus d’un titre. Mais il ne me convient pas de discuter avec vous les actes de ma vie et les mobiles qui les inspirèrent. Dites-moi seulement ce que vous voulez faire de moi… Songez seulement que si vous êtes les plus forts aujourd’hui, il n’en sera pas toujours de même. Si vous me détenez prisonnier, le roi de France, dont je suis hôte, s’inquiétera de ma disparition et me fera rechercher. On finira par découvrir la vérité… C’est dans votre intérêt que je parle et non dans le mien, car j’ai depuis longtemps habitué mon esprit à la pensée des persécutions que je pourrais endurer au service de Dieu et de sa sainte Église…
– Ne parlons pas de persécutions, monsieur, dit Manfred ; ce chapitre entraînerait trop loin, s’il nous fallait dénombrer toutes celles que vous avez suscitées. Causons plutôt de nos affaires.
– Soit ! dit paisiblement Loyola.
– Nous aurons donc, reprit Manfred, à discuter de votre liberté, c’est-à-dire des conditions que nous mettons à cette liberté.
– Des conditions…
– Oui ; cela vous étonne ? Donc, nous aurons tous les deux à traiter cet intéressant sujet. Mais avant de l’aborder, voici mon frère Lanthenay qui a d’abord à vous entretenir d’un sujet qui lui tient à cœur…
Loyola fixa sur Lanthenay un regard interrogateur.
– Monsieur, dit alors celui-ci, vous rappelez-vous les paroles que vous m’avez dites ce matin ?
– Des paroles de consolation chrétienne, murmura vaguement Loyola.
– Non, des paroles de malédiction qui m’ont brûlé le cœur. Vous m’avez dit, monsieur, que j’allais au gibet par le consentement du comte de Monclar.
– Il est vrai…
– Or, je vous demande maintenant si vous n’avez pas menti ?
– L’homme de Dieu ne ment jamais.
– Faites bien attention, reprit Lanthenay avec un calme qui glaça le moine, faites bien attention que je vous demande la vérité absolue… je vous demande de parler du fond de votre conscience. Peut-être le comte de Monclar a-t-il été contraint à ce consentement ?… Dites… En ce cas, je vous connais assez maintenant pour savoir que vous avez pu jouer sur le mot consentement… Comment le grand prévôt a-t-il consenti ? Voilà ce que je veux savoir…
– Qui peut se flatter de connaître le vrai mobile des hommes ?
– Je vois que nous ne nous entendons pas. Je vais vous dire une chose, monsieur. Mon ami Manfred que voici s’est tout à l’heure heurté au comte de Monclar dans la rue…
Lanthenay s’arrêta pour respirer, comme s’il étouffait… Il reprit :
– Or, savez-vous ce que Manfred a constaté ?
– J’attends que vous me l’appreniez.
Lanthenay saisit le bras du moine…
– Le comte de Monclar est fou ! dit-il d’une voix rauque. Fou ! Entendez-vous cela ? Il cherche son fils ! Il l’appelle en pleurant… Pourquoi le comte de Monclar est-il devenu fou ? Parlez, monsieur ! Vous le savez…
– Vous m’étonnez ! dit Loyola.
– Pourquoi, au moment où j’ai été entraîné hors de son hôtel, mon père se débattait-il parmi des gardes ? Cela aussi, vous le savez ! Parlez ! Avoue donc que tu as affreusement menti, misérable ! Avoue donc que ta fourbe et ton audace avaient seules préparé mon supplice…
– Vous vous trompez, je vous l’affirme ! En ce moment, je n’aurais aucun intérêt à mentir… J’ai remarqué en effet d’étranges contradictions dans les ordres que le grand prévôt donnait à votre sujet… Je l’ai entendu moi-même ordonner de vous conduire au gibet… J’ai vu ensuite qu’il essayait de se jeter sur les gardes. Je suis parti à ce moment et n’en sais pas davantage. Vous m’ouvririez la poitrine pour fouiller mon cœur que vous n’y trouveriez pas le mensonge que vous cherchez.
Lanthenay se tourna vers Manfred.
Celui-ci haussa les épaules comme pour dire :
– Tu n’en tireras rien !
– Oh ! murmura Lanthenay, je donnerais vingt ans de ma vie pour savoir que mon père n’a pas consenti au supplice !
Loyola serra les lèvres.
– Bon ! pensa-t-il. Tu auras toujours cette souffrance-là dans le cœur. Pour le reste, nous verrons.
Lanthenay lâcha le bras du moine qu’il serrait violemment, et se recula de quelques pas, découragé.
– Puisque monsieur persiste à se taire, fit alors Manfred, nous allons régler la question de sa liberté…
Loyola tressaillit, mais ne dit pas un mot.
– Nous avons d’abord songé à vous lâcher sur le pavé de Paris après toutefois nous être mis hors de vos atteintes. Mais nous avons réfléchi que les Parisiens pourraient à bon droit nous maudire… D’autre part, n’étant pas doués comme vous et vos pareils d’une nature de tourmenteur, il nous répugne de vous garder en prison… Et puis vous auriez fini par pervertir, avec vos sermons, les braves gens que nous aurions commis à votre garde.
Loyola se taisait toujours. Manfred continua :
– Pour ménager les intérêts de tous, nous avons simplement résolu de vous conduire hors de Paris.
– Je suis prêt ! ne put s’empêcher de s’exclamer Loyola.
– Cocardère et Fanfare, que je vous présente ici, auront l’honneur de vous escorter…
– Me laisserez-vous au moins choisir la ville où je devrai être déposé ?
– Dites toujours… Où désirez-vous être conduit ? Je vous préviens qu’il faut que ce soit assez loin de Paris…
– La ville où je voudrais aller n’est pas très éloignée, il est vrai. Mais je pourrais vous jurer sur le crucifix de n’en pas sortir avant huit jours, ce qui, en somme, répondrait à votre plan…
– Eh bien… quelle est cette ville ?
– Fontainebleau ! dit Loyola, qui ignorait complètement que Manfred se fût préoccupé du départ du roi pour cette ville.
Manfred éclata de rire :
– Demandez-moi donc de vous conduire par la main jusqu’au roi de France, votre digne ami, auquel vous n’auriez plus qu’à demander ma tête !
– Le roi de France ! balbutia Loyola. Vous vous trompez… je voulais me retirer dans le monastère de cette ville.
Manfred regarda Cocardère par-dessus son épaule :
– Tu as remarqué un monastère à Fontainebleau ?
– Ma foi non…
– Vous voyez bien, monsieur… Impossible de vous conduire à Fontainebleau.
– Soit ! Choisissez vous-même la ville où vous prétendez me conduire. Une question seulement : quand devrai-je partir d’ici ?
– Mais à l’instant même !
– Soit ! fit encore Loyola, comme s’il eût consenti un sacrifice, mais en réalité avec une joie qui n’échappa pas à Manfred. Celui-ci continua :
– Il y a là-haut, devant la porte de cette maison, une chaise de voyage confortable à souhait et munie de mantelets fermant à clef. Je te préviens, Cocardère, qu’il y a dans le coffre du siège, un sac où tu trouveras de quoi pourvoir aux besoins du voyage…
– Bon ! fit Cocardère.
– Donc, voici ce qui va se passer : nous montons tous ; le révérend entre dans la voiture sans pousser un cri, car il sait bien qu’au premier appel, il recevrait dans la gorge trois pouces de cette lame… Ensuite, notre brave ami Fanfare y entre à son tour ; les mantelets sont fermés à clef ; Cocardère monte sur le siège et n’a plus qu’à fouetter les deux vigoureux normands qui vont avoir l’honneur de vous entraîner…
– Je suis disposé à obéir sans résistance. Vous abusez de votre force ; mais il ne sera pas dit que l’homme de Dieu aura opposé la force à la force. Dites-moi seulement en quel endroit vous me ferez déposer…
– Vous avez gardé votre secret tout à l’heure, dit gravement Manfred ; à mon tour, je garde le mien !…
Manfred sortit du caveau, suivi de Cocardère.
Il fut plus d’une heure absent. Sans doute, il donna à Cocardère des instructions détaillées.
Au bout de cette heure, Manfred apparut dans le caveau.
– Suivez-moi, monsieur, dit-il à Loyola.
– Puis-je savoir au moins combien de temps durera le voyage ?
– Peuh ! quelques heures… Venez, et songez qu’au premier geste, vous êtes mort…
Manfred monta. Derrière lui venait Loyola. Derrière le moine marchait Lanthenay, son poignard à la main. Fanfare fermait la marche.
Devant la porte du bourrelier stationnait, en effet, une chaise de voyage. Sur un signe de Manfred, Fanfare y prit place. Cocardère était déjà sur le siège.
En arrivant sur le pas de la porte, Loyola, encadré par Manfred et Lanthenay, jeta un rapide coup d’œil à droite et à gauche.
Mais la rue était déserte.
Loyola eut un frémissement de rage et monta dans la voiture en murmurant :
– Que Jésus vous maudisse !
– Bon voyage ! cria Manfred.
La voiture s’ébranla au grand trot de ses deux chevaux.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plongé dans la demi-obscurité de sa prison roulante, Loyola méditait sur ce qui lui arrivait. Non seulement il était joué, battu à plates coutures, mais encore le but principal de son voyage en France était manqué. Ce but était de placer, auprès du roi de France, un homme qui le mît au courant de tout ce que ferait et penserait le monarque.
Déjà l’esprit actif du chef des jésuites songeait à l’avenir. Déjà il dressait de nouvelles batteries.
Dès qu’on lui rendrait la liberté, il se dépouillerait de son froc, achèterait un cheval et courrait à franc étrier jusqu’à Fontainebleau.
Là, son premier soin serait de faire agréer par François Ier une de ses créatures comme grand prévôt de Paris, en remplacement du comte de Monclar.
Alors, il bouleverserait Paris jusqu’à ce qu’il eût mis la main sur Manfred et sur Lanthenay…
La nuit vint. Mais la voiture continua son chemin.
Pendant ce temps, Fanfare bâillait à se décrocher la mâchoire. Il tombait de sommeil et de faim, mais il n’osait s’endormir.
Enfin, n’y tenant plus, il frappa aux mantelets.
– Tout à l’heure ! répondit la voix de Cocardère. Patience, que diable !
Il était environ dix heures lorsque la voiture s’arrêta. Loyola attendit avec une avide anxiété.
– Ouvre ! cria Cocardère.
Fanfare obéit avec empressement.
– Quelle diable de commission nous a donnée là Manfred ! s’écria-t-il. Pour un vilain oiseau de cette espèce, est-il besoin de tant de façons ?… Je vais l’étrangler tout bonnement…
– Non pas ! Nous devons conduire le révérend père, nous le conduirons…
– Mais j’enrage de famine, moi !
– Sois tranquille, l’heure du dîner a sonné.
Loyola avait avidement regardé par le mantelet ouvert. À sa grande stupeur, et à son inquiétude plus grande encore, il constata que la voiture s’était arrêtée en pleine campagne sur une route absolument déserte et noire.
– Mais où me conduisez-vous donc ? gronda-t-il.
– Tenez, mon révérend, je ne veux pas vous faire chercher plus longtemps… je vous conduis en Bourgogne, à Dijon…
– À Dijon ! exclama le moine. Pourquoi Dijon ?
– Je l’ignore complètement, mon révérend père.
– Mais il nous faut quatre bonnes journées pour y arriver !
– À peu près…
– Où allons-nous passer la nuit ?
– Mais il me semble que vous serez très bien dans la voiture…
– Soit, pour moi qui suis habitué à la dure, mais vous, pauvres gens !…
– Ne vous inquiétez pas de cela, mon digne père.
Sous ces questions multiples, Loyola dissimulait la joie profonde qu’il éprouvait.
– Quatre jours pour aller à Dijon, autant pour revenir à Fontainebleau… Allons ! rien n’est perdu !…
Cependant Cocardère avait organisé un dîner sommaire.
Il avait commencé par passer à la tête des chevaux une musette remplie d’avoine ; au préalable, il avait dételé les deux normands et les avait fait boire à un ruisseau dont on entendait le murmure à dix pas de là ; en ayant fini avec les chevaux, Cocardère s’était occupé des hommes.
On mangea dans la voiture à la lueur d’une lanterne.
Loyola prit sa part du repas et dîna de fort bon appétit ; il se montra d’excellente humeur, et trouva moyen d’intéresser ses deux gardiens en leur faisant le récit des batailles auxquelles il avait assisté avant d’entrer dans les ordres.
Si bien, que Cocardère s’écria :
– Sang-dieu, mon père, quel beau truand vous auriez fait ! Et quel dommage que vous ayez mal tourné !
Loyola se mit à rire en buvant une rasade d’un excellent flacon que Fanfare venait de déboucher.
Enfin, ce fut presque avec une certaine cordialité que les deux compères souhaitèrent le bonsoir au révérend et descendirent de la voiture dont ils fermèrent soigneusement les mantelets. Ils se roulèrent alors dans des couvertures et dormirent consciencieusement.
Au soleil levant, la route fut reprise dans les mêmes conditions que la veille. Les journées passèrent en somme assez rapidement pour Loyola.
Cinq jours s’écoulèrent ainsi.
Le soir du cinquième jour, comme les trois hommes, devenus en apparence les meilleurs amis du monde, s’installaient pour dîner, Loyola demanda :
– Nous ne devons pas être loin de Dijon… nous y arriverions sûrement, si nous poursuivions.
Cocardère se mit à rire.
– Dijon ! Nous l’avons traversé aujourd’hui à midi.
Loyola pâlit, et, un instant, il fut sur le point de se départir du rôle de jovial compagnon qu’il avait pris.
Cocardère continuait déjà :
– C’est que je vais vous dire… Ce n’est pas à Dijon que nous devons vous conduire, mais bien à Lyon…
Un cri de rage faillit échapper au moine.
Mais il se contint et répondit d’une voix indifférente :
– Dijon ou Lyon… cela m’est égal.
– À la bonne heure ! fit joyeusement Fanfare. Il y a plaisir à escorter un aussi brave compagnon.
À Lyon, le moine apprit que ses deux gardiens devaient le conduire à Avignon…
Enfin, à Avignon, il lui fut révélé qu’on pousserait jusqu’à Marseille.
Tous ses plans s’écroulaient !
Vers le trentième jour, ou plutôt la trentième nuit, – car on n’ouvrait les mantelets que la nuit – Cocardère dit à Loyola :
– Nous sommes à Marseille, mon révérend.
Loyola pencha la tête et se vit dans une ruelle obscure et déserte.
– Je suis libre, n’est-ce pas ? gronda-t-il.
– Pas encore tout à fait, mon révérend, répondit doucement Cocardère.
– Misérables ! rugit le moine. Il ne sera pas dit que de grands desseins seront renversés par une aussi stupide fatalité ! Mourez donc tous les deux !
En disant ces mots, Loyola avait tiré de sa poitrine un fort poignard et avait bondit hors de la voiture, en portant un coup terrible de son arme à Cocardère…
Mais, à ce jeu-là, il avait affaire à fort partie.
Cocardère, d’un geste prompt comme la foudre, avait saisi le poignet de Loyola et l’avait tordu violemment.
Le moine tomba sur ses genoux en poussant un hurlement de douleur.
Au même instant, Fanfare s’était précipité sur lui.
Loyola se vit solidement maintenu.
– Pardieu, mon révérend, dit Cocardère, vous n’y allez pas de main morte ! Fi ! que faites-vous du commandement qui interdit aux hommes de Dieu de se servir de l’épée !
Loyola écumait.
Ils l’entraînèrent dans un sombre boyau au bout duquel on lui fit monter quelques marches.
En haut de l’escalier, un homme tenant une torche éclairait cette scène.
– Salut à maître Giovanni ! dit Cocardère.
– Salut aux compagnons de Paris ! répondit l’homme. J’ai été prévenu hier de votre prochaine arrivée. Je ne vous attendais que demain.
– Nous avons fait diligence.
Loyola fut poussé dans une pièce assez vaste.
Cocardère lui lia les mains et les pieds.
– Mais enfin ! hurla le moine, que voulez-vous donc faire de moi ?…
– Vous allez le savoir, mon révérend.
Il se tourna alors vers l’homme qu’il avait appelé maître Giovanni. Cet homme portait le costume de marin.
C’était un des innombrables affiliés de la Cour des Miracles, qui comptait partout des compagnons se reconnaissant par une sorte de franc-maçonnerie.
Maître Giovanni était patron d’un brick qui faisait les voyages de Smyrne et de la côte d’Asie.
– Maître Giovanni, demanda Cocardère, êtes-vous sur le point de faire campagne ?
– Mais… la Belle-Étoile appareillera dans six jours, au plus tard.
– Qu’est-ce que la Belle-Étoile ?
– Mon brick, donc !
Cocardère se tourna vers le moine :
– Donc, mon révérend, encore six jours de patience, et vous serez débarrassé de notre compagnie qui, décidément, n’a pas l’heur de vous plaire.
– Je ne comprends pas, murmura le moine dévoré d’inquiétude.
– C’est pourtant bien simple… Notre ami Giovanni que voilà est maître d’un fort beau brick…
– Après ? gronda le moine.
– Dame… ce brick qui, comme vous venez de l’entendre, s’appelle la Belle-Étoile, appareille dans six jours…
Loyola devenait livide. Il commençait à comprendre.
– Après ? grommela-t-il.
– Après ?… eh bien, dans six jours nous aurons l’honneur de vous conduire à la Belle-Étoile et de vous y déposer bien et dûment à fond de cale ; après quoi, mon révérend, il ne nous restera plus qu’à vous demander votre bénédiction, que vous ne nous refuserez pas, je l’espère.
Loyola fit sur lui-même un terrible effort :
– Et lorsque ce navire sera arrivé à sa destination, que fera-t-on de moi ?…
– Vous serez libre…
– Qu’entendez-vous par ce mot ?…
– Libre, mon révérend ! Libre comme l’oiseau dans l’air… libre d’aller où bon vous semblera…
– Est-ce définitif, cette fois ?
– Si ce n’était pas définitif, mon révérend, nous vous accompagnerions…
– C’est juste…
Loyola garda un moment un silence pensif.
Il fixa le marin et lui demanda :
– Et quel est le port où vous devez me relâcher ? Puis-je le savoir ?
– Oh ! ceci n’a pas d’importance, répondit Cocardère ; mon révérend, c’est à Smyrne, en Asie, que vous devez être libre.
– Smyrne ! balbutia le moine atterré.
Ce dernier coup le terrassait.
– Combien de temps faut-il à votre navire pour toucher Smyrne ?
– À toi, maître Giovanni ! dit Cocardère.
– Pour toucher Smyre, fit le patron de la Belle-Étoile… dame… avec nos relâches en Italie, en Algérie, en Tunisie…
Loyola frémissait d’épouvante.
– Oui, acheva Giovanni, je réponds d’être à Smyrne dans quatre mois au plus !
Loyola voulut pousser un cri. Ses yeux se strièrent de rouge. Il tournoya sur lui-même, et s’affaissa lourdement, évanoui, assommé sur le coup !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lorsque Loyola revint à lui, il employa tout ce qu’il avait de volonté puissante à se composer un maintien.
Mais si fort qu’il fût, il ne put retenir une larme brûlante, larme de haine et de rage qui tomba comme une goutte de fiel.
Tout un plan longuement combiné s’écroulait.
Il ne pourrait être de retour en France avant six mois au moins. Il baissa la tête, vaincu.
Et les trois hommes l’entendirent murmurer :
– Tout est perdu…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les choses se passèrent selon le programme tracé par Cocardère. Le soir du quatrième jour de son arrivée à Marseille, Loyola fut conduit à bord de la Belle-Étoile et enfermé dans un réduit d’où il ne pourrait plus sortir qu’au moment où le navire aurait perdu les côtes de vue.
La Belle-Étoile appareilla le lendemain.
Cocardère et Fanfare, de loin, virent ses voiles se gonfler peu à peu, puis le brick prendre son vol vers le large. Cocardère eut le mot qu’avait eu Manfred.
– Bon voyage ! cria-t-il.
Puis les deux compagnons montèrent à cheval et reprirent le chemin de Paris.
XXIV
LE FOU
Nous laisserons les deux truands s’en revenir à petites journées vers Paris, la conscience tranquille et le cœur satisfait, et nous reviendrons à un personnage que nos lecteurs n’ont certainement pas oublié : nous voulons parler de la Gypsie.
Après la scène émouvante et pour ainsi dire tragique qui s’était déroulée entre elle et le grand prévôt, la vieille bohémienne, atterrée, désespérée, le cœur ulcéré, l’âme éperdue de vengeance, avait quitté l’hôtel de la grande prévôté.
Dans l’obscurité confuse du jour naissant, elle avait montré le poing à l’hôtel, et, d’une voix pleine de sourdes menaces, avait murmuré :
– Tout n’est pas fini !
Elle avait passé des nuits et des nuits à ruminer le plan qui venait d’échouer si misérablement, mais elle ne renonçait pas.
En effet, cette vengeance, c’était sa vie même.
La haine absolue de la Gypsie contre le comte de Monclar venait de l’immense douleur qu’elle avait éprouvée en assistant au supplice de son fils. Que la bohémienne eût aimé alors ce fils d’une façon absolue, que l’amour maternel eût étouffé en elle tout autre sentiment, ceci est incontestable.
Or, peu à peu, avec les mois et les années, la Gypsie en était arrivée à oublier la cause même de sa haine, c’est-à-dire son fils !
Elle n’aimait plus ce fils mort depuis si longtemps ; ou du moins, elle n’arrivait plus, même par un effort de volonté, à se mettre dans la situation d’esprit d’une personne qui aime… mais sa haine contre le grand prévôt n’avait fait que croître et embellir…
Elle en était arrivée à considérer cette haine comme le but de sa vie, ou plutôt comme sa vie elle-même.
Bientôt, elle n’y tint plus, et par une sorte d’attraction fatale, elle sortit de chez elle et se dirigea vers l’hôtel du comte de Monclar.
Maintenant, elle se remémorait les scènes écoulées jadis, comme si elles se fussent passées à l’instant même.
Elle se voyait, plus de vingt-deux ans auparavant, guettant autour de l’hôtel, sans but fixe, sans pensée précise…
Pendant quelques jours, son objectif avait été de tuer le grand prévôt.
Et alors s’était passée la scène qui avait été le point de départ de tout son plan de vengeance.
Un matin – un mois environ après le supplice de son fils – la bohémienne était venue se poster devant la porte de l’hôtel.
Tout à coup, la porte de l’hôtel s’était ouverte.
Une belle chaise stationnait dans la rue, une chaise toute capitonnée de soie…
Et le grand prévôt était apparu !
La bohémienne, en le voyant, avait senti cette angoisse abominable que l’on éprouve devant certaines bêtes malfaisantes…
Or, près du grand prévôt, apparaissait une femme jeune, belle, radieusement belle, si évidemment et si absolument heureuse qu’elle semblait dégager de la lumière, de la joie et de l’amour…
Le grand prévôt, jeune alors, dans toute la force de sa mâle beauté, la couvait d’un regard si tendre, si plein de passion, que la Gypsie avait profondément tressailli devant la soudaine pensée qui venait de se lever en sa conscience tumultueuse.
Entre le grand prévôt et sa femme marchait un enfant…
La jeune femme le tenait par la main…
L’enfant paraissait quatre ans.
En réalité, c’est à peine s’il en avait trois.
C’était un bel enfant, magnifiquement habillé ; on sentait qu’il devait être idolâtré de son père et de sa mère…
L’enfant, avec des exclamations de joie, s’était élancé vers la chaise…
Mais le père l’avait pris dans ses bras… Il l’avait regardé quelques secondes d’un regard profond.
Dans ce regard, la Gypsie avait lu l’immense passion paternelle du comte de Monclar.
Dès lors, la bohémienne avait senti une joie âpre et douloureuse. Elle tenait sa vengeance !
Elle avait été frappée dans son amour de mère…
C’est dans son amour de père qu’elle frapperait le grand prévôt…
Alors elle avait combiné et mûri son terrible plan.
Huit jours après, le fils du grand prévôt était mystérieusement enlevé !
Fou de douleur, le comte mit sur pied toute la police de Paris, qui fut fouillé de fond en comble.
Un nouveau désastre, premier effet de la vengeance de Gypsie, allait l’atteindre :
Sa jeune femme, frappée au cœur par la perte de cet enfant qui était son adoration, mourait de langueur au bout de trois mois !
Lorsque sa femme fut morte, lorsqu’il fut bien certain qu’on ne retrouverait pas son fils, le grand prévôt espéra un moment qu’il mourrait lui-même.
La destinée lui fut cruelle. Il vécut !…
Peu à peu, son âme, à lui aussi, s’était ulcérée !
Il était devenu sombre, farouche, misanthrope, inflexible, dur aux malheureux qui lui tombaient sous la main, et surtout aux bohémiens, truands et habitants de la Cour des Miracles qu’il accusait sourdement d’avoir volé ou peut-être tué son fils…
Voilà les souvenirs impitoyables qui se dressaient dans l’esprit affolé de la Gypsie, au moment où nous la retrouvons et où elle se dirigeait vers cet hôtel qu’elle venait de quitter deux heures auparavant.
Et elle se rappelait aussi avec quelles minutieuses précautions elle avait élevé le fils du grand prévôt !…
Quelle patience il lui avait fallu pour effacer de ce jeune esprit la première impression d’enfance si forte et si durable.
Et plus tard, lorsqu’il était devenu adolescent, avec quelles lentes et infinies précautions elle lui avait appris à haïr le comte de Monclar !
Quels prodiges d’astuce, quels trésors d’habileté dépensés pour amener le père et le fils en contact ! Pour faire que chacun de ces contacts fût une nouvelle cause de haine dans le cœur de Lanthenay ! Pour faire enfin que le grand prévôt prit inéluctablement la résolution de tuer son fils !
Et tout cela en pure perte !
Comment le comte de Monclar savait-il que Lanthenay était son fils ?
Comment le savait-il au moment même où il allait faire conduire ce fils au gibet ?
– Oh ! grondait-elle en marchant, c’est une effroyable fatalité ! C’est à se briser la tête contre les murs de la maison maudite ! J’aurai donc travaillé en vain. Ma vengeance m’échappera donc à l’heure même où elle allait aboutir ! Oh ! non, non quand je devrais tous les deux les étrangler de ma main…
Comme elle arrivait rue Saint-Antoine, des gens rassemblés regardaient un spectacle qui devait être sans doute des plus intéressants.
Il y avait des gamins, des hommes, des femmes.
Les gamins riaient, et quelques-uns, sournoisement, ramassaient des pierres ; les femmes avaient l’air apitoyé ; les hommes paraissaient étonnés et presque effrayés.
La bohémienne allait passer outre, tout entière à sa pensée, peut-être sans avoir vu ce rassemblement, lorsqu’un mouvement se fit parmi ces gens, les rangs s’ouvrirent, et un homme parut…
Il se heurta presque à la Gypsie.
La bohémienne s’arrêta court, stupide d’étonnement.
Cet homme, c’était le grand prévôt… c’était le comte de Monclar !
Il tenait toujours à la main sa lanterne éteinte et grommelait :
– Je vous dis qu’il m’appelle… laissez-moi passer !
Quelques domestiques de l’hôtel suivaient pas à pas leur maître et essayaient parfois de le ramener en arrière.
Mais lui, actif, les écartait d’un geste et s’avançait rapidement.
La Gypsie était demeurée un instant étourdie devant ce lamentable spectacle.
Comme il passait près d’elle, elle l’entendit murmurer :
– Il a beau faire nuit, j’y vois clair tout de même… Attends, mon fils… je vais ouvrir les cadenas des chaînes…
Une révélation foudroyante se fit dans l’esprit de la bohémienne :
Le comte de Monclar lui échappait à tout jamais !
La folie le sauvait de la vengeance qu’elle rêvait !
Machinalement, elle se mit à le suivre.
Le fou, cependant, avait quitté la rue Saint-Antoine et s’était enfoncé en ce dédale de petites ruelles qui avoisinait la rue Saint-Denis.
Elle allait, courant quand il se mettait à courir, s’arrêtant quand il s’arrêtait, tâchant de reconstituer, d’après ses paroles, la vision exacte du dément, s’efforçant aussi de mettre un peu d’ordre et de calme dans sa propre pensée.
Il fallait qu’elle fît souffrir le comte de Monclar !
Et puisqu’elle ne pouvait plus le torturer dans son cœur, eh bien, elle le ferait souffrir dans son corps ! Elle condamnait à mort le grand prévôt.
Et elle se préparait à exécuter la sentence.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sa résolution prise, la bohémienne, frissonnante, s’approcha du comte de Monclar et le toucha au bras.
Mais elle se sentit violemment repoussée par l’un des domestiques qui suivaient le fou.
– Arrière, femme ! dit cet homme.
– Vous ne voulez donc pas qu’il soit sauvé ? dit-elle.
Le valet regarda plus attentivement la bohémienne et reconnut la vieille qui était entrée chez son maître.
– J’ai un moyen de le guérir, continua-t-elle.
– Il faut la laisser faire ! s’écria un autre valet. Cette vieille sorcière connaît les herbes qui guérissent…
– Certes ! affirma-t-elle.
Et, sans plus s’occuper des laquais et de la foule, elle s’approcha de nouveau du comte de Monclar et murmura à son oreille :
– Je sais où est votre fils… Il vous attend… venez…
Le fou s’était arrêté, indécis d’abord ; puis, souriant, il prit la main de la bohémienne :
– Vrai ? Tu sais où il est ?
– Je vous dis qu’il vous attend et qu’il m’a envoyée…
– Allons vite…
Elle garda dans sa main la main du grand prévôt et l’entraîna.
– Voyez ! voyez ! s’écria l’un des valets. Elle l’a déjà dompté… il la suit docilement.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lorsque la Gypsie arriva à la Cour des Miracles, les domestiques du comte de Monclar voulurent y entrer avec elle.
Mais on n’entrait pas si facilement dans le royaume d’Argot. La bohémienne n’eut qu’un signe à faire : les valets se virent entourés, bousculés, repoussés et finalement expulsés.
L’arrivée du grand prévôt à la Cour des Miracles en compagnie de la Gypsie fit sensation.
Une centaine de truands entourèrent aussitôt le fou.
Ils ne criaient pas… Mais leurs regards chargés de haine parlaient pour eux !
Quelques-uns tiraient déjà leurs poignards.
La Gypsie étendit le bras et plaça la main sur la tête du grand prévôt.
– Cet homme est à moi ! dit-elle de sa voix coupante.
Et elle ajouta aussitôt :
– D’ailleurs, rassurez-vous ! Cette fois, il ne nous échappera pas. J’en réponds !
Et ces paroles étaient accompagnées d’un tel sourire et d’un tel regard que les poignards rentrèrent dans leurs gaines…
Monclar était demeuré indifférent à cette scène, ne paraissant même pas se douter du lieu où il se trouvait.
Seulement, il répétait sans impatience, avec une morne obstination :
– Allons vite…
La bohémienne le reprit par la main et l’entraîna. Arrivée chez elle, la Gypsie ferma soigneusement la porte.
– Où est-il ? demanda Monclar.
– Tout à l’heure… Attendez…
– Oui, oui, j’attendrai…
Elle réfléchissait profondément. Tout ce qu’elle avait de volonté, d’énergie se concentrait sur ce point : tuer le grand prévôt.
Simplement, elle cherchait le genre de mort.
Ou, pour être plus exact, elle cherchait ce qui pourrait calmer cette sensation étrange, ce désir furieux de vengeance, persuadée que la mort du comte de Monclar la soulagerait aussitôt.
Alors elle eut cette idée que ce qui pourrait le mieux l’apaiser, ce serait de voir se balancer le grand prévôt au bout d’une corde, comme elle avait vu son fils.
Sans s’occuper du grand prévôt, elle se mit aussitôt à fouiller parmi ses hardes et ne tarda pas à trouver ce qu’il lui fallait, c’est-à-dire une bonne corde solide et suffisamment longue.
Puis elle se mit à inspecter les murs.
Elle aperçut un gros clou à crochet qui avait été planté jadis dans le mur, et grogna en souriant :
– Dirait-on pas qu’on l’a mis là exprès !…
Cependant, elle ne demeurait pas inactive et préparait le nœud coulant, s’assurant qu’il jouerait facilement, et mettant à cette besogne une tranquillité méticuleuse.
Enfin, elle grimpa sur un escabeau et passa le bout de la corde dans le crochet. Alors la corde pendit le long du mur.
Son plan était très simple.
Pousser le comte de Monclar au-dessous du nœud coulant, le lui passer au cou, puis tirer sur le bout de la corde jusqu’à ce que le grand prévôt fut soulevé au-dessus du plancher.
Celui-ci, repris par sa monomanie, s’était mis à fureter dans tous les coins de la pièce sans s’inquiéter de ce que faisait la bohémienne, et peut-être l’ayant complètement oubliée.
– Oh ! gronda la Gypsie en s’approchant de lui, si je pouvais réveiller sa raison, ne fût-ce que pour quelques minutes !
Et saisissant la main du grand prévôt :
– Écoutez-moi… Regardez-moi… me reconnaissez-vous, comte de Monclar ?
– Comte de Monclar ? interrogea le fou.
– Oui, vous êtes le comte de Monclar, grand prévôt de Paris !
– Ah ! oui…
– Et moi, je suis celle dont vous avez tué le fils… Rappelez-vous donc, voyons !
– Mon fils… Je le trouverai… il m’attend…
La bohémienne se mit à rire.
– Ton fils est mort ! dit-elle.
Le comte de Monclar poussa un terrible hurlement :
– Qui a dit qu’il est mort ? Je ne veux pas, moi ! Je ne veux pas qu’on le tue ! Arrêtez, misérables !…
La bohémienne s’était vivement reculée, prise d’épouvante. Elle n’en poursuivit pas moins de sa voix âpre :
– Et moi, je te dis qu’il est mort ! Ton fils est mort !
– Mort ! répéta le malheureux dont la fureur tomba soudain et qui se mit à trembler.
– Mort pendu ! Pendu au gibet ! C’est toi qui l’as condamné !…
Monclar porta les mains à ses tempes en feu :
– Non… non… pas moi ! C’est toi, prêtre ! c’est toi, moine d’enfer qui tues mon enfant ! Grâce ! Ne tuez pas mon fils !
L’infortuné râlait. Il était tombé à genoux. Et sa voix était à donner le frisson. Les paroles de la bohémienne le remettaient avec une atroce précision dans la scène même où son fils avait été entraîné.
La bohémienne délirait de joie furieuse.
La réalité dépassait son rêve !
Pendant quelques minutes, elle se tint silencieuse, uniquement occupée à regarder cette effroyable douleur et à s’en repaître.
Le grand prévôt se traînait sur les genoux, frappait le plancher de son front, et des cris inarticulés, des cris de bête égorgée venaient expirer sur ses lèvres tuméfiées.
Puis, avec la soudaineté déconcertante de la folie, une nouvelle révolution s’opéra tout à coup dans sa cervelle. Il cessa de sangloter, se releva et regarda autour de lui avec étonnement.
– C’est le moment d’en finir ! gronda la bohémienne.
Elle s’approcha du fou.
– Venez, dit-elle en lui prenant la main.
Le comte de Monclar la suivit docilement.
Elle le conduisit contre le mur, au-dessous du nœud coulant.
– Mon enfant ? interrogea-t-il, se souvenant vaguement de ce que cette femme lui avait promis.
– Ton enfant ! rugit-elle, il est mort ! C’est moi qui l’ai tué ! Meurs, toi aussi !
Au même instant, on frappa violemment à la porte qu’on essayait d’enfoncer.
La bohémienne n’entendait pas.
Délirante de haine, elle répéta :
– Meurs comme est mort ton fils que j’ai tué !
Le nœud coulant glissa autour du cou du grand prévôt ; mais, à ce moment, comme la Gypsie jetait un cri de triomphe, elle se sentit saisie elle-même à la gorge.
Le comte de Monclar lui incrustait ses dix doigts dans le cou.
Il grognait confusément :
– Ah ! c’est toi qui l’as tué… Ah ! c’est toi, sorcière…
La bohémienne donna une violence secousse… mais les doigts de fer demeurèrent plantés dans sa gorge où ils semblaient s’enfoncer lentement.
Elle râla, battit l’air de ses bras… ses yeux se convulsèrent… puis, tout à coup, sa tête retomba mollement sur ses épaules.
Le grand prévôt continuait à serrer, mais d’un geste sans colère maintenant… déjà il oubliait !
Et comme la porte battue à grands coups s’ouvrait enfin avec fracas, défoncée, il lâcha le cadavre de la bohémienne qui tomba lourdement à ses pieds, et il regarda les deux hommes qui, haletants, faisaient irruption dans le logis.
C’étaient Manfred et Lanthenay.
En un instant, celui-ci eut défait le nœud que la bohémienne avait passé au cou du comte de Monclar.
– Il était temps, dit Manfred.
Lanthenay, silencieux, contempla un instant le cadavre de la vieille bohémienne qui avait été sa mère.
Puis son regard remonta jusqu’au comte de Monclar. Et tout naturellement, comme si le fou pût le comprendre, il dit tristement :
– Venez, père…
Le fou n’entendit ou ne comprit pas ce nom.
L’effort qu’il avait fait pour étrangler la bohémienne avait brisé ses forces.
Il se laissa emmener avec une morne docilité.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maintenant, Manfred et Lanthenay se trouvaient dans une vaste chambre faiblement éclairée.
Car, bien qu’il fît grand jour, les rideaux et les volets tirés entretenaient dans cette chambre une obscurité que combattait seule la lueur d’un cierge de cire.
Ce cierge brûlait près d’un lit…
– Asseyez-vous, père, dit gravement Lanthenay.
Il conduisit le comte de Monclar à un fauteuil où il s’assit, tranquille, rêvant à des choses lointaines… très lointaines du spectacle qu’il avait sous les yeux et qu’il ne voyait pas…
Lanthenay, violemment ému, s’approcha du lit, tandis que Manfred, découvert et le front penché, se tenait debout près du comte de Monclar.
Près du chevet du lit, agenouillée, la figure cachée dans les deux mains, une jeune fille sanglotait doucement.
– Avette ! murmura Lanthenay d’une voix étranglée par l’émotion.
Alors, les yeux de Lanthenay se fixèrent sur le lit…
Sous le drap tiré se dessinait la forme d’un cadavre…
– Pauvre Julie ! murmura le jeune homme. Pauvre femme martyre ! Morte de la mort de celui que tu aimais ! Le bûcher d’Étienne Dolet a brûlé l’homme et tué la femme… Les monstres qui ont organisé ce forfait de supplicier le grand penseur au nom de leur Dieu, au nom de leur religion de crime et d’infamie, ne savent pas qu’ils t’ont assassinée du même coup ! Tu es morte de douleur, pauvre femme… mais déjà te voilà vengée… car l’un de ceux qui se sont acharnés contre l’homme que tu aimais est là, devant ton cadavre, cruellement puni… et c’était le moins coupable !
Avec un soupir étouffé, Lanthenay se tourna vers son père qui, souriant d’un sourire inconscient, tenait ses yeux attachés sur la pâle lueur du cierge qui éclairait le cadavre de la femme d’Étienne Dolet…
Alors Lanthenay se pencha vers Avette et la toucha à l’épaule.
– Avette, dit-il, il faut vous arracher à ce triste spectacle…
Elle secoua la tête.
– Cher bien-aimé, répondit-elle, laissez-moi encore auprès d’elle…
– Soit… nous resterons donc ici jusqu’à l’heure où il faudra nous séparer à jamais de cette pauvre dépouille…
Alors, à bout de forces, elle se laissa tomber dans les bras de son fiancé, toute secouée de sanglots, murmurant confusément des mots sans suite où revenait cette parole :
– Seule, maintenant ! Sans père ni mère… Morts tous deux ! Seule au monde !
– Je vous reste, moi, dit Lanthenay avec une grande douceur… Et puis, Avette… si vous n’avez plus de mère… si vous n’avez plus de père… peut-être aurez-vous quelqu’un à aimer comme un père… quelqu’un sur qui vous laisserez tomber la miséricorde et le pardon de votre regard… quelqu’un vers qui vous irez… comme les anges doivent aller vers les damnés…
Surprise, elle l’interrogea des yeux, n’osant, ne pouvant parler…
Et lui, tout en lui versant ces paroles mystérieuses dans l’oreille, l’avait lentement entraînée, conduite devant le fauteuil où était assis le fou… le comte de Monclar… celui qui avait présidé au supplice d’Étienne Dolet !
Elle le reconnut, poussa un cri d’horreur :
– L’assassin de mon père ! le grand prévôt de Paris ! Ici ! Près de cette morte ! près de cette victime !
Plus doucement encore, Lanthenay la ramena.
Et grave, avec une infinie tristesse, il prononça :
– Avette… cet homme est mon père !
Elle frissonna. Et le jeune homme continua :
– Oui, Avette… mon père ! Ceci vous sera expliqué… Il suffit que vous sachiez cette chose terrible… cet homme… un de ceux qui ont tué Étienne Dolet… eh bien ! c’est mon père… Avette… mon Avette… grâce pour lui… Je vous l’ai dit… ce fut le moins coupable… et c’est le plus cruellement puni… sa raison s’est effondrée… Mon pauvre père n’est plus qu’un corps sans âme…
Ce regard de pardon qu’avait sollicité Lanthenay, ange de miséricorde, elle le laissa tomber sur le malheureux… Elle s’approcha de lui. Sans répulsion, sans haine, elle prit ses deux mains.
Elle le baisa au front.
Et tandis que le grand prévôt de Paris souriait de son inconscient sourire, la fille d’Étienne Dolet murmura :
– Soyez pardonné… mon père !
XXV
LA BELLE FERRONNIÈRE
Nous nous transportons maintenant à Fontainebleau, dans cette maison que Jean le Piètre avait si hâtivement aménagée pour Madeleine Ferron.
Nous y arrivons à la nuit tombante.
Et nous pénétrons dans une chambre du premier étage.
Cette chambre est la reproduction exacte de la chambre où, au début de ce récit, nous avons introduit le lecteur, dans la petite maison d’amour de l’enclos des Tuileries.
Ce sont les mêmes tentures. Ce sont les mêmes meubles. La même immense glace se dresse, prête à refléter quelque douce scène de passion comme celles que vit jadis l’enclos des Tuileries… ou peut-être quelque terrible scène de meurtre, comme le meurtre de Ferron !
La Belle Ferronnière est là…
Et elle a revêtu le costume de soie, la robe lâche et flottante qui plaisait autrefois à son royal amant.
Au fond de la chambre, c’est comme là-bas, comme à Paris… un lit large, profond et bas… le lit des étreintes délirantes…
À demi renversée dans un vaste fauteuil, la Belle Ferronnière fixe, à travers ses paupières à demi closes, un regard incisif sur Jean le Piètre, qui, debout devant elle, la contemple avec une admiration furieuse.
L’infortuné tremble et grelotte.
Le mal qui l’a atteint a ravagé son organisme… Peut-être n’a-t-il plus que quelques jours à vivre. Mais l’indomptable passion qui brûle sa poitrine le soutient.
– Jean, mon cher Jean, murmura l’enchanteresse.
– Maîtresse ? interrogea-t-il.
– Racontez-moi bien comment les choses se sont passées…
Une expression de sombre souffrance s’étendit sur le visage blêmi du malheureux.
– Je vous ai tout dit !…
– Qu’importe !… Peut-être, d’ailleurs, as-tu oublié quelque détail qui m’intéressera…
– Je n’ai rien oublié, fit-il sourdement.
– Je le veux ! reprit-elle avec impatience. N’es-tu donc pas mon fidèle ?…
– Fidèle jusqu’à la mort ! haleta Jean le Piètre.
– Eh bien, obéis donc !…
– À quoi bon revenir sur ces choses qui me font souffrir cruellement !… Je n’aurai donc pas à souffrir assez tout à l’heure !…
– Je te dis, Jean, que cette nuit tes souffrances vont finir d’un coup !…
– Oh ! si cela était ! gronda-t-il, les dents serrées par l’angoisse…
– Tu disais donc, reprit Madeleine Ferron, que tu avais été dans la forêt ?
– Puisque vous l’ordonnez !… Oui, maîtresse, j’ai eu ce courage… j’ai fait ce que vous me disiez… mais je vous jure que j’aimerais mieux mourir mille morts que de recommencer à souffrir ainsi…
– Mon bon Jean !…
Elle lui sourit avec cette suprême coquetterie dont elle avait l’art. Bouleversé par ce sourire, le malheureux continua :
– Oui, j’ai été dans la forêt… Oui, j’ai attendu le passage de la chasse royale… Oui, j’ai vu le roi… Oui, je lui ai remis le billet que vous m’aviez donné…
– Et qu’a-t-il dit ?… L’a-t-il lu tout de suite ?…
– Oui !… fit Jean le Piètre en crispant les poings.
C’était vraiment une abominable torture de jalousie que Madeleine infligeait à cet homme. Mais elle ne s’en apercevait même pas. Toute à sa pensée, attentive, à la fois caressante, féline et dure, elle arrachait à Jean le Piètre des paroles qui lui brûlaient la gorge.
– Il a lu, reprit-elle. Mais quel air avait-il ? A-t-il souri ?…
– Oui !… il a souri…
– Je connais bien ce sourire, rêva tout haut la Belle Ferronnière ; sourire de roi qui croit que tout est à lui, sourire d’homme las de ses bonnes fortunes, et qui s’imagine faire l’aumône quand une femme s’offre à lui… Et qu’a-t-il dit ?
– Il a dit : C’est bien, j’y serai…
– L’heure approche, Jean !
L’homme frémit.
Elle se leva, alla à la cheminée, attisa le feu, comme si elle eût eu froid. Jean la regardait aller et venir avec des yeux hagards, et, en réalité, elle ne cherchait qu’à prendre les attitudes dignes d’affoler cet homme.
Alors, elle ouvrit un coffret sur une table et en tira un solide poignard.
– Tu vois ce joujou ? dit-elle.
Il fit un signe de tête.
– Eh bien, c’est lui qui me l’a donné… oui, un soir, j’ai vu ce poignard suspendu à sa ceinture, je le lui ai pris par caprice, et lui me dit de le garder et ajouta en souriant :
– « Peut-être vous servira-t-il un jour ! »
Elle se mit à rire doucement.
– Et voici que le poignard va servir ! dit-elle.
Elle alla à Jean le Piètre, lui mit l’arme dans la main, et devenue grave :
– Tu ne trembleras pas ?
– Non ! dit-il avec un accent de haine incurable, – la pire des haines, celle que fait naître la jalousie.
– Rappelle-toi que tu ne dois frapper que si j’appelle !… Obéiras-tu à cela ?
Il hésita une seconde et répondit :
– Je ne frapperai que si vous appelez…
Mais son hésitation avait suffi pour donner à Madeleine Ferron la certitude que Jean le Piètre frapperait, même si elle n’appelait pas.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quelle était donc la pensée intime de la Belle Ferronnière ? Si nous voulions obéir aux règles ordinaires de ce qu’on appelle un roman, il nous faudrait montrer ce personnage tout d’une pièce, poursuivant François Ier d’une haine mortelle jusqu’à ce que cette haine soit assouvie. Mais la vie n’est point si absolue.
Force nous est donc de déclarer que Madeleine Ferron haïssait bien le roi, mais qu’elle l’aimait peut-être plus encore qu’elle ne le haïssait, ou plutôt que sa haine n’était guère, au fond, que de l’amour aigri.
Qu’on ne se hâte pas d’en conclure qu’elle ne tenait pas à sa vengeance…
Elle voulait réellement tuer le roi. Elle souhaitait réellement le voir mourir de la mort terrible qu’elle avait imaginée.
Mais peut-être cherchait-elle, dans une dernière entrevue avec l’amant condamné, une volupté suprême.
Peut-être, aussi, voulait-elle s’assurer que François Ier était bien réellement atteint par l’affreuse maladie… par le poison mortel.
Elle s’était posé à elle-même ce dilemme :
Ou François est atteint par le mal, et il en mourra ; ou il n’est pas atteint, et je le ferai poignarder.
En réalité, elle ne s’avouait pas qu’elle avait un ardent désir de revoir son amant.
Quant au danger qu’elle pouvait courir, quant à la probabilité d’être tuée par l’amant ou d’être arrêtée et jetée en quelque oubliette, elle n’y avait pas songé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le roi François Ier avait bien reçu le billet de la Belle Ferronnière, et Jean le Piètre n’avait menti sur aucun point.
Le billet contenait ces mots :
« Une femme jeune et belle vous aime. Depuis votre arrivée à Fontainebleau, elle rêve du baiser que vous daignerez peut-être lui accorder. Ce soir, à dix heures, vous serez attendu. »
François Ier était dans toute l’acception du terme un « homme à femmes ». Il avait eu mille aventures de ce genre, et eût pu faire relier un volume in-folio de tous les billets doux qu’il avait reçus.
Celui-ci ne le surprit donc en aucune manière.
Il s’était contenté de caresser sa barbe grisonnante et avait murmuré :
– Quelque petite bourgeoise, sans doute…
Puis il avait demandé à Jean le Piètre des renseignements sur la maison où on l’attendait, et, finalement, avait répondu :
– Dis que j’irai…
Vers neuf heures, le roi avait revêtu le costume à demi bourgeois qu’il revêtait pour ces sortes d’équipées.
Puis il avait donné l’ordre à Bassignac, son valet de chambre, de lui aller chercher l’une des femmes de la duchesse de Fontainebleau.
C’était son habitude, depuis son arrivée à Fontainebleau. Bientôt l’une des dames d’honneur de la « petite duchesse » arriva.
– Que fait Mme la duchesse de Fontainebleau ? demanda le roi.
– Elle dort, sire.
– Depuis longtemps ?
– Mme la duchesse vient de se coucher il y a un quart d’heure…
– Qu’a-t-elle fait aujourd’hui ?
– Mme la duchesse n’a pas voulu quitter son appartement de la journée.
– Il faut pourtant qu’elle sorte, qu’elle se récrée…
– Nous avons vainement insisté, sire.
– Et qu’a-t-elle fait dans son appartement ?
– Rien, sire. Elle n’a voulu ni écouter la lecture, ni permettre qu’on lui parle…
– Et son rouet ?
– Ah ! j’oubliais, sire, dit la dame d’honneur d’un air pincé. Mme la duchesse a, en effet, filé du lin toute la sainte journée…
– Et qu’a-t-elle dit ?…
– Rien, sire.
– Elle n’a pas parlé de moi ?
– Non, sire ; ni de Votre Majesté ni de personne.
– Et vous dites qu’elle dort ?
– Ou du moins, sire, elle est dans son lit et a les yeux fermés.
– C’est bien, vous pouvez vous retirer…
La dame d’honneur fit la révérence et disparut.
Le roi, très sombre, demeura rêveur pendant quelques minutes. À quoi songeait-il ?
Il y eut dans ses yeux un éclair ; puis il haussa les épaules, et transformant tout à coup la physionomie de son visage avec cette facilité qui faisait de lui un comédien achevé, passa de sa chambre, où avait eu lieu cette conversation, dans son cabinet où l’attendaient quelques gentilshommes.
Il apparut souriant.
Et les gentilshommes se dirent entre eux :
– Sa Majesté est en bonne fortune…
Le roi fit signe à deux ou trois d’entre eux, honneur dont les autres se montrèrent fort jaloux, et, en cette compagnie, sortit du palais.
Il allait être dix heures.
Il faut rendre cette justice à François Ier que rarement il avait fait attendre une femme.
Commettre quelque bonne petite infamie dans le genre de celle qu’il avait commise envers Ferron, cela oui. Faire jeter dans un cachot quelque mari récalcitrant, oui encore ; écraser d’un mot de mépris la femme dont il avait assez, oui encore. Mais faire attendre la femme qui s’offrait… non !
Donc, il allait être dix heures, et le roi pressa le pas.
Parvenu devant la maison dont Jean le Piètre lui avait soigneusement indiqué l’emplacement, le roi renvoya son escorte.
Il n’avait pas peur. L’idée ne lui venait pas qu’on pût l’attirer un jour dans un guet-apens.
Il frappa à la porte, en caressant d’un geste qui lui était familier sa barbe où des fils d’argent se montraient.
La porte s’ouvrit à l’instant même, et François Ier sourit de cet empressement qui lui prouvait qu’on l’attendait avec impatience.
– Entrez, dit une voix féminine que le roi prit pour la voix de quelque soubrette.
En réalité, c’était Madeleine Ferron. Sans doute, elle avait craint que Jean le Piètre ne le frappât aussitôt ; elle avait vu arriver le roi, et était descendue aussitôt se poster derrière la porte.
Une fois le roi dans la maison, la porte se referma lourdement. François Ier se trouva plongé dans l’obscurité et tressaillit, pris d’une vague inquiétude. Madeleine Ferron, qui venait de lui prendre la main, perçut ce tressaillement.
– Auriez-vous peur ? dit-elle. Il est encore temps de reculer…
– Peur ! Quand on tient une main douce et parfumée comme celle-ci ! Par Notre-Dame, ma belle enfant, ce mystère me plaît, au contraire… Hâte-toi de me conduire auprès de ta maîtresse…
Madeleine Ferron ne dit plus rien, et entraînant doucement le roi, lui fit monter marche à marche un escalier plongé dans la plus complète obscurité.
– Si c’est le chemin du ciel, il est bien noir ! plaisanta le roi.
– Nous y voici… murmura Madeleine, vous n’avez qu’à ouvrir cette porte… tenez, voici le loquet.
Elle plaça la main de François Ier sur le loquet de sa chambre, et disparut silencieusement.
Le roi demeura un instant le cœur battant devant cette porte. Non qu’il eût peur… Au contraire, comme il l’avait dit, il adorait ces mystères qui donnaient du « montant » et un charme spécial à ces expéditions amoureuses. Et il songea :
– À en juger par ces précautions, je dois être tombé sur quelque bourgeoise bien timide qui en est à son premier rendez-vous. Jour de Dieu, la bonne aubaine !
Alors il ouvrit doucement la porte et entra.
La chambre était solitaire Elle était faiblement éclairée par la lueur d’un flambeau de cire odorante.
D’un coup d’œil circulaire, le roi embrassa l’élégant décor de meubles et de tentures où il se trouvait transporté.
– Décidément, songea-t-il en admirant en connaisseur, la dame de céans est peut-être plus experte que je ne croyais…
Mais, peu à peu, ses sourcils se froncèrent.
Lentement, pièce à pièce, il reconnaissait le décor.
Les parfums, tout d’abord, le frappèrent… les parfums favoris de celle qu’il avait aimée, puis le lit qu’il reconnut… puis les sièges… tous les détails d’ameublement… Il se crut le jouet d’une hallucination et pâlit.
Machinalement, il voulut rouvrir la porte par laquelle il était entré… et cette fois, il frissonna de terreur : cette porte était fermée !
François Ier avait la bravoure physique d’un reître. Mais ce silence profond, cette lueur triste du flambeau, cette reconstitution exacte de la chambre d’amour qu’il connaissait bien, tout cela produisit sur lui la sensation d’un cauchemar. Ses yeux hagards se fixèrent sur une tenture du fond de la chambre.
– C’est par là qu’elle entrait ! murmura-t-il en essuyant la sueur d’angoisse qui perlait à son front… Elle entrait toute blanche et rose dans sa robe flottante de soie légère… de soie bleue d’où ses bras de marbre sortaient nus… Elle entrait en disant : « Me voici, mon seigneur », et venait se suspendre à mon cou… Oh ! cette vision d’enfer ! Ah ! ça… où suis-je ? Est-ce elle qui va entrer ? Oh ! pourvu que ce ne soit pas elle ! pourvu que tout ceci ne soit qu’un rêve !
Au même moment, la tenture du fond se souleva et Madeleine Ferron parut. Instinctivement, le roi porta là main à son poignard.
Elle était vêtue de la robe même qu’il venait de décrire, et s’avançait, souriante, en disant de cette voix charmeuse qui bouleversait les sens des hommes :
– Me voici, mon cher seigneur !
François Ier, très pâle, recula d’un pas.
Mais une seconde plus tard, elle était contre lui. Elle nouait autour de son cou ses bras nus, ses beaux bras d’une impeccable pureté de ligne, et elle tendait vers lui ses lèvres humides, tandis que ses yeux pâmés d’amour plongeaient dans les yeux du roi. Et elle se collait à lui, l’enlaçait, l’échauffait de son haleine tiède.
– Comme tu as tardé à venir, méchant ! soupira-t-elle. Il y a si longtemps que je ne t’ai eu tout à moi comme en ce moment… Ah ! mon François, comme je t’aime !… Et toi… m’aimes-tu ?
Une étrange folie avait d’abord envahi l’esprit du roi…
Mais maintenant, la folie qui faisait battre ses tempes, c’était la folie d’amour. Madeleine l’avait reconquis de sa caresse enveloppante…
– Femme ou spectre, songea-t-il en frémissant, elle est adorable… et dût-elle m’entraîner en enfer, je suis à elle !
Pourtant les dernières paroles de la Belle Ferronnière brisèrent un peu le charme d’épouvante et de passion…
– C’est vous ! prononça-t-il sourdement. C’est bien vous ! Avez-vous donc oublié l’affreuse scène de la maison de la Maladre ?
Il fit un effort pour se dégager. Mais plus souple, plus féline, plus robuste encore, elle s’enlaça à lui plus étroitement.
– Tais-toi ! murmura-t-elle ; ce que j’ai fait, je l’ai fait par amour, ô mon François ! ce rêve me hante de mourir dans tes bras, d’expirer sous un de tes baisers… Écoute comme mon cœur palpite…
Il voulut lutter encore, fit appel à ce qu’il pouvait éveiller en lui-même de haine et de fureur…
– Vous m’avez tué ! gronda-t-il… Vous avez été pour moi la hideuse ribaude dont le baiser est mortel…
– Tais-toi ! Je t’aimais trop !
Cependant, elle l’étudiait attentivement ; elle détaillait son visage, ses yeux, sa bouche ; avide, elle cherchait à surprendre les traces visibles du poison… Oui, oui… il n’y avait pas de doute possible… le roi était empoisonné, le roi était condamné… le poignard de Jean le Piètre devenait inutile !
Ces marques affreuses, ces honteux stigmates d’un mal contre lequel on ne connaissait pas de remède, elle les voyait, délirante !
François Ier surprit dans ses yeux l’éclair de joie…
– Damnation ! rugit-il, tu as voulu t’assurer que ton œuvre était parfaite ! Tu as voulu voir si je suis bien condamné à la plus effroyable des morts ! Eh bien, ribaude, tu mourras avant moi !
Il fit un violent effort pour la repousser, pour saisir son poignard.
Mais déjà la passion le brûlait et le paralysait.
Il voulait tuer cette femme, et un furieux désir lui venait de l’étreindre une fois encore… Il leva le bras… le poignard jeta un éclair…
– Meurs ! râla-t-il, meurs comme une gueuse !
– Oui, bégaya-t-elle, tue-moi, mon François ! Tiens, tue-moi !
En même temps, elle se détacha de lui, et d’un geste rapide fit tomber sa robe ; elle apparut dans son éclatante nudité, le sein soulevé, les lèvres frémissantes, les bras tendus.
– Tue-moi donc, acheva-t-elle, mais tue-moi d’amour ! François Ier poussa un rauque soupir, jeta violemment le poignard qu’il tenait à la main, et tomba sur ses genoux, délirant lui-même, la tête en feu, brisé de désirs et de volupté.
Elle eut un léger cri de triomphe ; elle le saisit, le releva, sa bouche se colla à la sienne, et balbutia :
– Nous sommes damnés, soit ! Mais damnée avec toi, c’est le paradis… Ô mon François, avant de descendre à l’enfer… une nuit d’amour… une nuit de délices et de volupté surhumaine !
Et ce furent vraiment des heures d’ivresse insensée. François Ier et Madeleine Ferron éprouvèrent cette sensation qu’ils en étaient à leur premier rendez-vous. Mortellement atteints tous deux, frappés d’un mal dont le nom seul est un poison, ils eurent la nuit d’amour de deux nouveaux épousés…
Mais lorsque vers trois heures du matin, François s’apprêta à se retirer, ni l’un ni l’autre ne prononça la parole du charmant « revoir », si douce aux amoureux.
Ils demeurèrent pâles, sombres et glacés, vraiment pareils à deux damnés qui n’osent se regarder… Une étrange pudeur lui était venue à elle. Se voyant nue, elle rougit ! Et elle se hâta de se vêtir.
Alors, pendant cinq mortelles minutes, ils restèrent en présence l’un de l’autre, silencieux, absorbés par l’idée que la mort avait présidé à leurs violentes amours…
Une sorte de rage rétrospective montait en François Ier. En acceptant cette nuit d’amour, il s’était interdit toute représaille contre la Belle Ferronnière… ou du moins, toute représaille immédiate…
– Adieu ! fit-il tout à coup d’une voix sourde.
Ce fut là la fin des amours de François Ier et de la Belle Ferronnière.
Elle ne répondit pas, mais prit le flambeau pour accompagner le roi.
Elle ouvrit la porte. L’escalier fut vaguement éclairé.
Et dans le bas de l’escalier, enfoncé en une sombre encoignure, Jean le Piètre attendait, secoué de frissons de fureur, son poignard à la main.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Au moment où François Ier, renvoyant son escorte, s’était approché de la maison, Jean le Piètre, posté près de Madeleine Ferron, l’avait vu venir.
Il tenait encore à la main l’arme que la Belle Ferronnière venait de lui remettre.
À la vue du roi, Jean le Piètre parut reconquérir soudainement tout son calme.
Il se contenta de toucher du bout du doigt la pointe du poignard, comme pour l’éprouver.
Puis, d’une voix qui ne tremblait plus, il dit :
– Je vais ouvrir au roi…
Madeleine eut la perception très nette que François Ier allait être poignardé.
– Non, non, fit-elle vivement, je vais ouvrir moi-même.
L’homme eut un geste de contrariété, mais n’émit pas d’objections.
– Où attendrai-je ? demanda-t-il d’un ton bref.
– Viens !
Elle l’entraîna, le fit entrer dans une pièce voisine de la chambre, mais sans communication avec elle.
– D’ici, tu peux m’entendre crier, dit-elle à voix basse, et alors…
– Bien, interrompit Jean le Piètre d’un ton rude.
Alors elle descendit rapidement et se trouva contre la porte d’entrée à l’instant même où le roi frappait…
Jean le Piètre, l’oreille aux aguets, les entendit monter.
Il entendit la voix du roi qui plaisantait.
Lorsqu’ils arrivèrent au haut de l’escalier, il fut sur le point d’apparaître.
Il se contint.
– Tout à l’heure ! gronda-t-il.
Quelques minutes se passèrent.
Un profond silence régnait dans la maison.
Certain que Madeleine Ferron lui livrerait François Ier, il se disait :
– Plus que deux minutes à souffrir… une peut-être…
Et cependant, ces quelques instants qu’il passa là, lui parurent d’une longueur effroyable… Au bout d’une minute, il eut la sensation qu’il attendait depuis une heure.
– Sur le palier, je serai plus près, murmura-t-il.
Il s’y transporta aussitôt sans bruit, et se trouva devant la porte de la chambre.
Mais là, il comprit qu’il ne pouvait attendre plus longtemps… Il allongea la main vers le loquet.
À ce même instant, le loquet fit entendre un bruit sec, comme si de l’intérieur on essayait d’ouvrir.
Jean le Piètre demeura immobile, sa main étendue, sans respiration, comme foudroyé… puis son bras se leva…
Mais la porte ne s’ouvrit pas !
On a vu que le roi avait constaté qu’elle était fermée, et c’est lui qui venait d’agiter inutilement le loquet.
Une sueur froide inonda Jean le Piètre.
– Elle a fermé la porte à clef ! murmura-t-il.
Et tout aussitôt il reprit :
– Mais alors, comment vais-je entrer moi !…
Il demeura d’abord stupéfait, comme lorsqu’on constate une trahison à laquelle on ne s’attendait pas.
– Par l’autre porte, dit-il tout à coup. Doucement, Jean le Piètre essaya de l’ouvrir… Il étouffa un grondement de fureur.
Cette porte là aussi était fermée !… Alors, il revint sur le palier.
Il se mordait le poing jusqu’au sang pour ne pas crier.
Dans les hallucinations rapides qui se succédaient dans son cerveau, il se vit frappant d’abord Madeleine avant de frapper le roi.
Il colla son oreille à la porte…
Puis, peu à peu, il se laissa tomber sur les genoux, et ce fut ainsi, à genoux, l’oreille contre la porte, qu’il passa ces heures, qui, par un singulier phénomène inverse, lui parurent durer quelques minutes seulement.
Il n’entendit pas toutes leurs paroles…
Mais il les devina, il comprit les intonations, nota les soupirs… Ce fut horrible.
Tout à coup il comprit que c’était fini… que le roi allait sortir… En deux bonds, il fut au bas de l’escalier, et se blottit dans l’encoignure de la cage, redevenu très maître de lui.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le roi sortit le premier.
Madeleine suivit, son flambeau à la main.
D’un rapide regard elle s’assura que Jean le Piètre n’était pas sur le palier. Le roi commença à descendre.
Madeleine déposa le flambeau sur la plus haute marche, et descendant avec rapidité, passa devant le roi en murmurant :
– Je vais ouvrir.
Comme elle le frôlait, le roi eut, à son contact, un frisson qui était presque un frisson d’horreur. La fièvre d’amour tombée, le délire calmé, toute sa haine lui revenait contre la femme qui l’avait empoisonné…
Au moment où Madeleine dépassa le roi, elle aperçut Jean le Piètre raidi, dans l’attitude de l’assassinat.
Par un furieux effort de volonté, elle se força à ne pas le regarder, et à continuer de descendre comme si elle ne l’eût pas aperçu…
Maintenant elle était sûre que le roi était atteint par le mal.
Le coup de poignard supprimait sa vengeance. Ou du moins c’est ce qu’elle se dit. Et elle conclut : il ne faut pas qu’il meure ainsi ! juste au moment où le roi atteignait le bas de l’escalier et où Jean le Piètre, avec une sorte de hurlement étranglé, se ruait sur lui.
Le hurlement de rage se termina par un râle épouvantable.
Avant d’avoir pu abaisser son bras, Jean le Piètre était tombé, foudroyé, dans une large flaque de sang qui s’échappait de sa gorge entr’ouverte…
Madeleine, d’un geste foudroyant, lui avait planté dans la gorge une petite dague qu’elle tenait à la main, au moment même où le malheureux s’élançait…
Madeleine Ferron, éclaboussée de sang, livide, regarda un instant Jean le Piètre qui se débattait dans les soubresauts de l’agonie.
Il voulut se soulever, fixa sur elle un regard épouvantable, puis retomba inerte.
La Belle Ferronnière, souriant d’un sinistre sourire, se tourna vers François Ier qui, pâle de stupéfaction et de terreur, regardait sans comprendre.
– Sire, dit-elle, vous l’avez échappé belle…
Alors le regard du roi alla du cadavre à Madeleine, tous deux sanglants et livides…
Et il comprit que cet homme était là pour le tuer !
Il comprit qu’elle l’avait attiré vers l’assassinat et que, s’il échappait au poignard, c’est qu’elle était bien sûre qu’il n’échapperait pas au poison !
Et comme la Belle Ferronnière venait d’entr’ouvrir la porte, il se glissa au dehors et s’enfuit, bouleversé d’épouvante, les dents entre-choquées…
XXVI
DEUX CAVALIERS PASSAIENT
Au moment où le roi s’enfuyait ainsi, la sueur de l’angoisse au front, deux cavaliers arrivaient au grand trot par la route de Melun.
Ils passèrent devant la maison de la Belle Ferronnière comme le roi en sortait, si bien que François Ier se heurta presque contre l’un des chevaux.
– Au diable les bourgeois qui se promènent à pareille heure ! gronda-t-il.
Les deux cavaliers allaient poursuivre leur chemin après le léger temps d’arrêt provoqué par cet incident.
– Messieurs ! cria le roi, d’une voix si angoissée qu’ils arrêtèrent court.
– Qu’y a-t-il pour votre service, monsieur ? demanda celui des deux cavaliers qui avait déjà parlé.
Le roi s’approcha rapidement.
– Êtes-vous gentilshommes ? interrogea-t-il.
– Nous pouvons dire, en effet, que nous le sommes, mais qu’importe !
– Messieurs, je suis gentilhomme. Si vous l’êtes, vous me devez aide et assistance.
– Monsieur, dit alors l’autre cavalier, si vous avez besoin d’aide, nous vous aiderons sans que nous ayons besoin de connaître vos parchemins.
– Par Notre-Dame, c’est bien dit ! fit le roi en se remettant peu à peu. Eh bien, ayez l’obligeance de mettre pied à terre et de me suivre.
Les deux cavaliers eurent un instant d’hésitation.
Mais la demande avait été faite d’un tel ton d’angoisse qu’ils obéirent.
– Messieurs, reprit alors le roi, vous voyez cette maison, n’est-ce pas ? Eh bien, il vient de s’y commettre un crime horrible… On y a attiré, pour le tuer, un noble gentilhomme… et si on n’a pas réussi… c’est grâce à une circonstance providentielle… L’assassin est là, messieurs.
– Eh bien ? demandèrent les deux cavaliers.
– Il faut que l’assassin soit arrêté, messieurs… dans dix minutes, il aura pris la fuite sans aucun doute…
On remarquera que le roi disait il en parlant de Madeleine Ferron.
Il craignait en effet, de se voir refuser assistance s’il déclarait qu’il s’agissait d’une femme.
– En quoi pouvons-nous vous aider ? reprit l’un des deux cavaliers d’un ton assez rude. Où est le gentilhomme qu’on a voulu tuer ?
– C’est moi, messieurs.
– Eh bien, mais vous n’êtes pas blessé, il me semble ?…
– Non pas, par la mort-dieu, mais il s’en est fallu de peu. Voici donc ce que j’attends de vous, messieurs. Vous allez demeurer devant cette porte jusqu’à ce que je revienne avec les renforts nécessaires…
– Adieu, monsieur ! fit brusquement le cavalier. La besogne ne saurait nous convenir !
Et ils remontèrent sur leurs chevaux. Le roi crispa le poing avec fureur et fut sur le point de dire :
– Je suis le roi, obéissez !
Il se contint pourtant.
– Monsieur, dit le cavalier, si vous craigniez quoi que ce soit encore, nous sommes disposés à vous escorter jusqu’à votre maison…
Le roi était dans une de ces dispositions nerveuses où les plus braves avouent qu’ils ont eu peur, – et qu’ils ont peur encore. En outre, en se faisant accompagner, il espérait connaître les noms des deux gentilshommes auxquels il songeait déjà à faire payer cher leur refus.
– J’accepte, dit-il, et vous remercie de grand cœur.
– Marchez donc, en ce cas, et soyez tout à fait rassuré.
François Ier se dirigea directement vers le château.
Il ne tarda pas à arriver devant la grande porte et s’approcha du factionnaire. Celui-ci avait d’abord croisé la hallebarde en criant :
– Au large !
Mais, au même instant, il reconnut le roi et, avant que celui-ci eût pu dire un mot pour lui recommander le silence, le soldat avait pris une position respectueuse et crié de toute sa voix :
– Aux armes pour les honneurs au roi !
On entendit un tumulte, et aussitôt ses quarante hallebardiers du poste se rangeaient le long de la grille, tandis que six d’entre eux s’avançaient avec des torches, pour éclairer Sa Majesté.
Les deux cavaliers qui avaient escorté François Ier se regardèrent en murmurant :
– Le roi !
Celui-ci s’était tourné vers eux.
– Messieurs, dit-il en riant, voici mon incognito dévoilé… Suivez-moi, je veux vous remercier dignement… Mais, ajouta-t-il en fronçant le sourcil et en forçant la voix, je m’étonne que vous soyez encore à cheval et couverts !
Les deux cavaliers ne bronchèrent pas.
Ils ne se découvrirent pas !
Et comme le roi, furieux, allait donner un ordre à l’officier des hallebardiers, l’un des deux inconnus répondit d’une voix calme au fond de laquelle perçait une sourde irritation :
– Monsieur, nous vous avons rencontré par les chemins ; vous aviez peur, nous vous avons escorté ; vous voici chez vous… Adieu donc, et ne soyez pas en peine des remerciements que vous nous devez ; nous vous en tenons quitte.
Et les deux inconnus firent volte face, piquèrent, et disparurent dans la nuit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ces deux cavaliers que le roi ne reconnut pas, nos lecteurs les ont certainement reconnus : c’étaient Manfred et Lanthenay.
Ils arrivaient de Paris où, avant leur départ, s’était passée une scène que nous devons raconter.
Nous reprenons donc les événements au moment où Julie, la malheureuse femme de Dolet, morte de douleur, vient d’être enterrée.
Avette, forte et courageuse, a suivi le cercueil jusqu’au cimetière des Innocents.
Puis, malgré les instances de Lanthenay, la jeune fille a voulu rentrer dans cette maison de la rue Saint-Denis où chaque meuble lui parle de son père et de sa mère.
C’est là que nous retrouvons ces trois personnages.
Ce que craignait Lanthenay est arrivé.
À la vue des objets familiers qu’ont si souvent touchés les mains de ceux qui ne sont plus, Avette a été prise d’une crise de désespoir.
Mais enfin, les larmes qui ont pu couler l’ont calmée.
Maintenant, réfugiée dans la chambre de son père et de sa mère, elle pleure doucement.
Dans la pièce du rez-de-chaussée, dans cette pièce où, au début de ce récit, Étienne Dolet a reçu le roi François Ier, Manfred et Lanthenay devisent gravement.
– Que comptes-tu faire ? a demandé Manfred.
Lanthenay a esquissé un geste grave.
– Que faire ? murmura-t-il. Il faut que je sauve cette enfant de sa douleur… Il faut que j’essaye d’arracher le vieillard à la folie. Me voilà entre ma fiancée et mon père, désorganisé, découragé ; je vois l’avenir en noir…
– C’est que tu souffres. Il est nécessaire que tu t’arraches toi-même à tes désolantes pensées.
Et comme Lanthenay essayait d’un geste négatif, Manfred continua doucement :
– Frère, tu m’as assez souvent fait la morale pour qu’à mon tour je puisse t’en faire un peu. Il me semble que tu es injuste envers la destinée ; un double malheur t’a frappé : la mort de Dolet que tu considérais comme ton vrai père ; la folie du comte de Monclar… mais Avette te reste ! Et tu es sûr de son amour ; elle est là ; tandis que moi… mais justement, je pars pour Fontainebleau ; je suis sans nouvelles de là-bas ; c’est qu’on n’a pas dû réussir… Toi, frère, ta fiancée est à tes côtés ; moi, il faut que je conquière la mienne… J’ai besoin de toi, Lanthenay, il faut que tu viennes avec moi…
Manfred, en parlant ainsi, songeait surtout à emmener son ami loin de Paris.
– Si tu as besoin de moi, je suis prêt, dit Lanthenay, mais que ferais-je d’Avette ? Que ferais-je de mon père ? Que deviendront-ils pendant mon absence ? Je te soumets ces questions, frère.
– Je sais un endroit où ils seront en parfaite sûreté tous deux…
– Que veux-tu dire ?
– Tu le sauras. Mais réponds seulement : si je te prouve que le comte de Monclar et Avette n’auront rien à redouter pendant ton absence, consentiras-tu à me suivre ?
– Peux-tu en douter ! s’exclama Lanthenay.
– C’est tout ce qu’il me faut, dit Manfred. Attends-moi ici…
Aussitôt Manfred sortit et prit le chemin de Notre-Dame. Il ne tarda pas à arriver dans une petite rue – la rue des Canettes – où se trouvait l’hôtel qu’avait loué le chevalier de Ragastens.
On n’a pas oublié qu’au moment de son départ pour Fontainebleau, le chevalier avait conduit sa femme, la princesse Béatrix, dans cet hôtel, où il lui semblait qu’il n’y avait plus rien à craindre pour elle.
Manfred n’ignorait pas ce détail.
Or, depuis qu’il avait lu la lettre révélatrice de la Gypsie, le cœur de Manfred s’était, à chacune de ses pensées, élancé vers cet hôtel où se trouvait sa mère.
Mais la délivrance de Lanthenay avait pris toute son énergie, tous ses instants. Depuis trois jours, il s’était donné tout entier à son ami.
Maintenant que Lanthenay était sauvé, maintenant que la douloureuse scène de l’enterrement de Julie était terminée, Manfred partageait ses pensées entre ces deux figures de femmes :
Gillette ; la princesse Béatrix.
Ce fut donc le cœur en émoi, qu’il arriva rue des Canettes.
Il se trouva tout à coup la main sur le marteau de la grande porte de l’hôtel ; alors il fut pris d’une indicible émotion, reposa doucement le marteau et s’éloigna. Maintenant, il n’osait pas !
Il fit quelques pas dans la rue, puis revint tout à coup, et cette fois il n’hésita pas à frapper.
Un domestique entr’ouvrit la porte.
Sans lui donner le temps de questionner, Manfred lui dit :
– Annoncez à Mme la princesse, que quelqu’un venu de Fontainebleau, désire l’entretenir de la part de M. le chevalier de Ragastens.
– Attendez ici ! fit le valet après l’avoir dévisagé.
La princesse était bien gardée.
Manfred attendit, très ému.
Quelques minutes se passèrent, puis le même valet reparut et lui dit :
– Suivez-moi.
Un instant plus tard, Manfred était en présence de Béatrix. Il la contempla avidement, songeant :
– C’est là ma mère !
Béatrix était à cette époque, une femme de quarante-deux ans.
Mais elle avait gardé, comme il arrive à quelques femmes privilégiées, toute la robuste sveltesse, toute la souple élégance de sa jeunesse, alors qu’elle parcourait à cheval les routes d’Italie et qu’elle se mettait à la tête des guerriers de Monteforte, pour repousser l’armée de César Borgia.
Seulement, son regard avait perdu cet éclat ardent qui avait tant ébloui le chevalier de Ragastens à leur première rencontre.
Ce regard, maintenant, se voilait de mélancolie.
On voyait qu’elle avait beaucoup souffert et beaucoup pleuré.
Cependant Béatrix l’avait tout de suite reconnu.
– Vous venez de Fontainebleau ? demanda-t-elle.
– J’y étais il y a trois jours, madame.
Et Manfred avait l’air si bouleversé, que Béatrix, prise d’un pressentiment, s’écria :
– Il n’est rien arrivé au chevalier ?
– Rien, madame, rien ! Soyez rassurée… J’ai quitté M. le chevalier en parfaite santé et en bonne humeur…
La pensée de Béatrix se reporta alors tout entière sur ce jeune homme qui était devant elle. Elle étouffa un soupir. Un instant, elle avait espéré avoir retrouvé en lui ce fils qu’elle cherchait.
Un signe du chevalier de Ragastens lui avait fait comprendre qu’elle s’était trompée, on s’en souvient sans doute. Malgré cette déception, elle gardait à Manfred une sympathie irraisonnée et souhaitait ardemment qu’il fût heureux.
– Eh bien, monsieur, demanda-t-elle, avez-vous réussi dans votre entreprise ? Cette charmante Gillette… cette jeune fille que j’aimais déjà de tout mon cœur…
Manfred, depuis quelques instants, sentait ses pensées tourbillonner dans sa tête. Il écoutait la princesse sans l’entendre. Et elle, sans en savoir la cause, remarquait cette profonde émotion qui agitait le jeune homme.
Il n’y put tenir davantage.
– Tenez, madame, dit-il d’une voix altérée, ce que j’ai à vous dire est si étrange que je ne sais comment m’exprimer…
Et comme, interdite, elle gardait le silence, il eut une main tremblante, la tendit à Béatrix en disant :
– Lisez !
Béatrix fut secouée d’un tressaillement électrique.
Ses mains tremblèrent violemment en prenant la lettre qu’elle parcourut en pâlissant de plus en plus.
Enfin, elle murmura, en étouffant les soupirs qui l’oppressaient :
– Je le savais… je le savais…
Et elle tomba à la renverse.
Manfred jeta un cri de terreur, la saisit dans ses bras à temps pour l’empêcher de tomber.
– Madame ! oh ! madame ! balbutia-t-il.
Chose curieuse, et pourtant bien naturelle : il ne lui venait pas à l’esprit de dire « ma mère ».
Livide, Manfred songea qu’il venait de tuer sa mère. Il en est en effet des joies puissantes comme des douleurs : elles peuvent tuer, en dépit du banal proverbe qui veut qu’on ne meure pas de joie.
Manfred déposa Béatrix glacée sur un fauteuil, et, fou de désespoir, appela à l’aide. Deux femmes apparurent, et bientôt, grâce à leurs soins, la princesse ouvrit les yeux. Elle vit Manfred penché sur elle et murmura, ravie :
– Mon fils !
Alors seulement Manfred osa dire :
– Ma mère !
Et il se prit à pleurer longuement, comme pleurent les petits enfants.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les trois heures qui suivirent s’écoulèrent comme une minute ; il nous paraît inutile de détailler les innombrables questions que se posèrent réciproquement la mère et le fils, chacun d’eux oubliant souvent de répondre ; inutile aussi de décrire les touchantes effusions des deux êtres d’élite qui se découvraient, s’essayaient à se connaître, ou plutôt à se reconnaître.
Disons seulement que Manfred, au bout de ce temps, songea à Lanthenay et annonça à la princesse qu’il allait sortir. Béatrix pâlit :
– Si j’allais le perdre encore…
Mais Manfred la rassura d’un sourire et d’un mot.
– Je ne suis plus l’enfant qu’enlève une bohémienne, dit-il, et je suis de taille à me défendre… maintenant surtout ! Mort-dieu, ma mère, je plains les pauvres diables qui essayeraient de nous séparer !
Béatrix alors examina son fils pour la première fois.
Elle vit sa force, sa vigoureuse élégance, sa robuste beauté, et une flamme de fierté monta à son front. Tout lui parut admirable en lui, jusqu’à ce juron familier qui venait de lui échapper.
C’était bien le digne fils de Ragastens.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manfred ne fut guère absent que deux heures.
Quand il revint, il était accompagné de trois personnes.
– Ma mère, dit-il à la princesse, voici Lanthenay, mon ami, mon frère de tous les instants depuis mon enfance, celui qui m’a sauvé plusieurs fois la vie… Voici M. le comte de Monclar… Ce vieillard est le père de Lanthenay… Voici Mlle Avette Dolet, fiancée de mon ami… je la considère comme ma sœur…
Béatrix tendit la main à Lanthenay et baisa Avette au front.
Puis un long entretien s’engagea entre ces personnages, entretien auquel le comte de Monclar seul ne put prendre part.
Il fut résolu qu’Avette et le comte demeureraient dans l’hôtel, pendant que Manfred et Lanthenay prendraient le chemin de Fontainebleau.
Puis Lanthenay, Avette et le vieillard furent conduits à des chambres que Béatrix avait ordonné de leur préparer.
Que dirons-nous de plus ?
L’aube se levait, et ni Béatrix ni Manfred n’avaient songé à prendre de repos ; il leur semblait qu’ils n’arriveraient pas à épuiser tout ce qu’ils avaient à se dire.
Il fallut pourtant se séparer.
Après mille et mille recommandations, Manfred monta à cheval et, accompagné de Lanthenay, prit la route de Fontainebleau.
La première heure de trot se fit silencieusement, Manfred et Lanthenay se livrant chacun à leurs pensées… Pensées exclusivement riantes chez Manfred.
– Comment trouves-tu ma mère ? demanda-t-il à Lanthenay.
Lanthenay tressaillit, arraché soudain à ses pensées qui, elles, étaient toutes de tristesses.
– Ta mère ? fit-il… elle est telle que j’eusse souhaité la mienne. Ah ! tu es heureux, frère ! Tu as ta mère… moi, je n’ai que le portrait de la mienne. Tu as ton père… moi, je n’ai que l’ombre du mien.
Et comme Manfred regardait son ami d’un air étonné :
– Pardonne-moi mon amertume, reprit Lanthenay. Le malheur rend mauvais.
– Mauvais, toi !… Tu plaisantes… Mais tu dis que tu as le portrait de ta mère ?
– Oui, un fort beau portrait qui se trouvait à l’hôtel de la grande prévôté… J’y ai été hier, pendant que tu te rendais rue des Canettes.
– Imprudent !
Lanthenay haussa les épaules.
– Nul n’a fait attention à moi, dit-il. J’ai trouvé les domestiques en train de piller l’hôtel en douceur. La… maladie de leur maître les a rendus impudents : « Que voulez-vous, monsieur, m’a dit le majordome, il faut bien que nous soyons payés de nos gages, puisque nous ne savons pas si monseigneur reviendra jamais… » J’ai obtenu pour vingt ducats la permission d’emporter la toile, à condition de laisser le cadre… La toile est maintenant dans la maison du pauvre Dolet.
Et Lanthenay ajouta :
– C’est tout ce qui me reste de ma mère.
Ce fut en devisant de ces choses que les deux amis arrivèrent à Fontainebleau en pleine nuit et qu’ils eurent la rencontre que nous avons racontée.
Quelques minutes après avoir si vivement brûlé la politesse au roi, ils mettaient pied à terre devant l’auberge du Grand-Charlemagne.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le roi était demeuré stupéfait, et de la réponse des deux inconnus, et de leur brusque fuite. Il ne fallait pas songer à essayer de les retrouver.
– Qui diable peuvent être ces deux malandrins ? murmura-t-il.
– Malandrins est bien le mot, sire, dit une voix près de lui.
François Ier reconnut la voix et vit une ombre à ses côtés.
– La Châtaigneraie ! s’exclama le roi.
– Moi-même, sire.
– Et tu as vu ?
– Tout ! Je venais de rentrer au château, après… une excursion, et j’allais me retirer dans la belle chambre que le roi a bien voulu me donner, lorsque le bruit de leurs deux chevaux a attiré mon attention. Je suis donc resté près de la grille, j’ai vu arriver Sa Majesté, j’ai entendu le factionnaire crier maladroitement : Aux armes ! et j’ai tout vu, tout, sire.
La Châtaigneraie insistait sur ce mot « tout ».
– Que veux-tu dire ? demanda le roi.
– Je veux dire qu’à la lueur des torches, j’ai pu voir les deux malandrins comme Votre Majesté a justement appelé ces deux hommes ; j’ai pu voir leurs visages un seul instant, il est vrai, mais cet instant m’a suffi pour les reconnaître.
– Tu les connais ? fit vivement François.
– Votre Majesté les connaît aussi.
Tout en causant ainsi, le roi et son compagnon étaient entrés dans le palais, et François Ier avait gagné ses appartements.
– L’un de ces deux hommes, continua La Châtaigneraie, est celui qui nous a blessés tous les trois, Essé, Sansac et moi, et qui plus tard a si cruellement défiguré le pauvre Sansac que celui-ci n’ose plus sortir de son trou…
– Le truand Manfred ? exclama sourdement le roi.
– Oui, sire ! Le même qui a eu l’audace de tenir tête à Votre Majesté près de l’enclos du Trahoir, le même qui a eu l’audace plus grande de venir vous braver au Louvre. Et l’autre, c’est son damné compagnon, le truand Lanthenay !
– Eux à Fontainebleau !…
– Votre Majesté n’oublie pas sans doute que l’un de ces deux misérables ose lever les yeux jusqu’à Mme la duchesse de Fontainebleau !
Non, le roi ne l’oubliait pas…
– Viens ! dit-il à la Châtaigneraie.
Le roi descendit dans la cour d’honneur et entra au corps de garde.
– Monsieur, dit-il à l’officier, quelle consigne donnez-vous à vos factionnaires ?
– Mais, sire, la consigne ordinaire… rendre les honneurs…
– Il ne s’agit pas d’honneurs ! s’écria violemment le roi. Je vous parle de la consigne de défense…
– De défense ? balbutia l’officier.
– Oui ; que feriez-vous, monsieur, si des gens de mauvaise intention s’approchaient de la grille ?… Et il faut toujours soupçonner la mauvaise intention, monsieur ! Vous n’avez pas de consigne, je le vois… Ah ! je suis bien protégé, par ma foi !
– Pardon, sire ! Nul ne peut entrer au château sans avoir parlé à l’un des officiers de garde.
– C’est insuffisant. À partir de ce moment, tout individu, homme ou femme, de nuit ou de jour, qui s’approchera à vingt pas des grilles sera sommé de se retirer. S’il n’obéit pas à l’instant, on fera feu… Remplacez immédiatement les hallebardiers par des arquebusiers. Au lieu d’un factionnaire, vous en placerez deux à chaque porte ; ils auront l’arquebuse chargée et seront prêts à tirer sur quiconque s’approchera. Voilà la consigne, monsieur. Viens, La Châtaigneraie.
Le roi sortit du corps de garde, laissant l’officier tout interdit.
– Combien y a-t-il de postes ? demanda François à ses compagnons.
– Quatre, sire. Mais le plus important est celui qui fournit les sentinelles du parc.
– Voyons-les tous.
Guidé par la Châtaigneraie, le roi visita tous les corps de garde et donna partout les mêmes ordres, si bien que le bruit se répandit dans le château qu’on était menacé d’une attaque, sans qu’on pût préciser de quelle attaque il s’agissait.
Non content d’avoir visité les postes, le roi fit le tour du parc, s’arrêta devant chaque factionnaire, les encouragea, leur promit force ducats s’ils faisaient bonne garde, leur promit l’estrapade et l’écartèlement si leur vigilance était en défaut, et enfin, à peine rassuré par ces diverses mesures, rentra dans son appartement comme il faisait grand jour.
Tout cela parce que la Châtaigneraie avait murmuré ces deux noms à son oreille :
– Manfred, Lanthenay.
XXVII
LA MÈRE EN MARCHE
C’est dans le taudis de Margentine la folle que nous ramenons nos lecteurs.
Ceci se passait le lendemain du jour où Manfred, retrouvé par Cocardère, quittait brusquement Margentine pour essayer de sauver Lanthenay.
Margentine, après le départ de Manfred, avait été prise d’une de ces crises aiguës qui la jetaient à la rue échevelée, dépoitraillée, parcourant des quartiers entiers en appelant sa fille.
Elle était rentrée en son triste logis vers minuit, écrasée de fatigue, et s’était endormie jusqu’au jour.
Au moment où nous la retrouvons, elle était accroupie dans un angle, le regard vaguement fixé sur la porte, essayant de rassembler des bribes éparses de pensée et de souvenir.
– La bohémienne, grondait-elle, la bohémienne m’a dit que Manfred me fera retrouver ma petite fille ! Mais Manfred est parti… Me voilà encore sans enfant… Pauvre Margentine, tout le monde est acharné contre toi !…
Comme elle grommelait de sourdes imprécations, elle vit la porte s’ouvrir. Une femme entra.
Margentine qui, comme certains fous, avait la mémoire des physionomies très sûre, la reconnut aussitôt.
– La belle dame ! murmura-t-elle.
Celle qu’elle appelait « la belle dame » était la duchesse d’Étampes.
La duchesse était seule. Elle entra, souriante, en disant :
– Eh bien, ma chère Margentine, es-tu contente de me voir ? Me reconnais-tu ?
– Je vous reconnais, dit la folie.
– Tu me reconnais, reprit la duchesse en dissimulant un geste de contrariété ; tu sais donc en ce cas que je t’aime bien, et que je me suis toujours intéressée à ton bonheur ?
– Personne ne m’aime, dit Margentine d’une voix morne, et je ne tiens pas à ce qu’on m’aime. Je veux qu’on me laisse dans mon trou penser à mon aise. Je ne suis heureuse que lorsque je puis penser.
– À quoi penses-tu alors ?
– À des choses…
– Veux-tu que je te le dise, à quoi tu penses, pauvre femme, lorsque triste, seule, abandonnée du monde entier excepté de moi, tu rêves dans ton coin ?… Tu penses à ta jeunesse… tu songes au temps où tu étais plus belle encore que maintenant, car tu es toujours belle, sais-tu ?… Tu penses à la ville où tu as aimé, à l’homme à qui tu donnas ton cœur pour toujours. La ville s’appelle Blois, l’homme s’appelle François…
Margentine hocha la tête.
– Vous parlez bien, murmura-t-elle. Vous dites justement ce que je n’aurais pu dire moi-même…
– Et puis, continua la duchesse, tu penses aussi à l’ange perdu, au chérubin à la tête blonde dont les caresses te font encore sourire et pleurer quand tu les évoques…
– Elle mettait là ses deux petites menottes, fit Margentine ravie en montrant son cou. Si je m’en souviens, seigneur, doux Jésus ! Mais je ne vis que de cela, moi !… Et elle me serrait en riant. Je vois encore les deux petites fossettes de ses joues quand elle riait si gentiment, et ses dents… des petites perles, si vous saviez !…
La duchesse, maintenant, laissait parler Margentine.
Elle l’avait amenée au point où elle voulait.
Un à un les souvenirs de la pauvre folle s’éveillaient.
Et, comme toujours, cela se termina par une crise de sanglots.
– Je ne la verrai plus… c’est fini !… Vous m’aviez promis… la bohémienne aussi m’avait promis… mais je sens bien que c’est fini, et que plus jamais je ne reverrai ma Gillette…
La duchesse attendait cette explosion.
– Et moi, s’écria-t-elle, je t’affirme que tu reverras ta fille quand tu voudras !
– C’est pour me faire encore souffrir que vous me dites cela…
– Te faire souffrir, malheureuse ! À quoi cela me servirai-t-il ? Non… tu sais bien que je m’intéresse à toi ; j’ai eu pitié de ta douleur de mère… Ta fille, je l’ai cherchée, et je l’ai trouvée…
Margentine bondit.
– Oh ! si cela était ! fit-elle, les mains jointes.
– Cela est. Je te dis que ta fille, je l’ai retrouvée. Et je viens te dire où elle est…
– Oh ! madame… Écoutez, dit Margentine d’une voix brisée, je ne suis qu’une malheureuse ; quelques-uns même disent que je suis folle… Je n’ai que ma vie à donner… mais cette vie, je vous la donne. S’il faut mourir pour vous, je mourrai. S’il faut que quelqu’un s’arrache le cœur pour vous éviter un chagrin, je m’arracherai le cœur…
La duchesse d’Étampes n’eut pas un tressaillement de pitié. Son cœur demeura sec.
– Parlez ! s’écria Margentine… Où est-elle ?…
– Assez loin d’ici…
La folle saisit ardemment les mains de la duchesse.
– Que ce soit au bout du monde, et qu’il faille y aller pieds nus… qu’importe, j’arriverai…
– Ta fille est à Fontainebleau, dit la duchesse.
– Fontainebleau ? interrogea la folle.
– Oui, une ville… assez loin de Paris, comme je te l’ai dit…
Le cœur de Margentine battait à rompre.
– Par où passe-t-on ? reprit-elle fébrilement.
– Je te le dirai, je te donnerai toutes les indications. La folle allait et venait dans le taudis, avec une allure de lionne.
– Fontainebleau ! murmurait-elle… Je vais partir à l’instant… Adieu !…
– Et comment feras-tu pour la retrouver, si je ne te donnes pas toutes les indications ? s’écria la duchesse.
– Ah ! oui… parlez… je deviens folle à cette idée… Oh ! madame, comment se fait-il que vous soyez si bonne !… Ma fille ! dire que je sais où elle est !… Elle est à Fontainebleau, et je vais aller la retrouver…
– Écoute : voici d’abord un peu d’argent pour faire le chemin.
– Pas besoin d’argent… J’irai sur mes genoux, s’il le faut.
– Prends… tu arriveras plus vite.
– C’est vrai, en payant, j’arriverai plus vite.
Elle prit les cinq ou six pièces d’or que lui tendait la duchesse d’Étampes.
– En arrivant à Fontainebleau, continua celle-ci, tu demanderas où se trouve le château. Tu m’entends ?
– Si j’entends !… Ah bien, je me jetterais la tête contre un mur si j’oubliais un seul détail ! Je demanderai le château en arrivant à Fontainebleau… Après ?
– Sais-tu qui habite ce château ?
– Non ! Comment voulez-vous que je le sache, moi ! Mais parlez donc !…
– Eh ! bien, c’est François…
– François !…
– Oui… ton amant, le père de Gillette… Tu ne l’as jamais revu ?
– Jamais !
– Le reconnaîtrais-tu ?
– Ah ! oui ! fit-elle avec un accent de haine qui amena un sourire de satisfaction sur les lèvres de la duchesse.
– Même s’il a un peu vieilli ?
– Je le reconnaîtrai, vous dis-je !
– Sais-tu ce qu’il est, ton François ?
– Oh ! un grand personnage, je sais…
– Il est roi ! C’est le roi de France…
À la stupéfaction de la duchesse, la folle éclata de rire et battit des mains.
– Ah bien, il ne manquait plus que ça à ma Gillette ! Fille d’un roi !… Mais ce n’est pas étonnant, voyez-vous ! Elle serait reine elle-même que cela ne m’étonnerait pas du tout. Quant à François, ça m’est égal qu’il soit roi de France. Il peut bien être ce qu’il veut. Je lui dirai ce que j’ai à lui dire…
– Eh bien, écoute, ta Gillette est dans le château du roi de France. Tu n’as qu’à aller à Fontainebleau, comme je t’ai dit. Tu iras au château. Tu attendras devant les grilles… Sauras-tu attendre, au moins ?…
– Oui, oui ! J’aurai de la patience.
– Le roi sort presque tous les matins pour aller à la chasse… Alors, tu comprends, quand tu le verras sortir au milieu de son escorte, tu t’approcheras de lui, et le reste te regarde ! Si tu ne te fais pas rendre ta fille, c’est que tu auras été bien maladroite…
Margentine avait écouté ces paroles avec une attention profonde.
La duchesse lui indiqua alors le chemin qu’elle devait prendre, par quelle porte de Paris elle devait sortir. Puis elle se retira.
En toute hâte, Margentine s’habilla d’une robe de gros drap qu’elle mettait rarement, fit un petit paquet, et sortit à son tour.
La duchesse, postée dans un coin de la rue avec deux hommes qui l’avaient accompagnée, assista au départ de Margentine. Celle-ci, d’un bon pas, traversa Paris.
Une fois sur la route de Melun, elle activa sa marche.
Il était environ trois heures de l’après-midi lorsqu’elle était sortie de son taudis. Elle marcha d’une traite jusqu’à huit heures du soir.
À ce moment, elle entrait dans un village.
Un carrosse attelé de quatre chevaux conduit par deux postillons arrivait à fond de train, derrière elle, et faillit la renverser.
– Gare ! gare ! hurla le postillon de tête.
Margentine n’eut que le temps de se ranger et regarda un instant ce carrosse qui disparaissait dans la direction de Fontainebleau.
– Je voudrais bien être là-dedans, songea-t-elle. Je serais tôt arrivée.
Cette voiture était celle de la duchesse d’Étampes qui rentrait à Fontainebleau.
Quelle avait été la pensée qui avait poussé Anne, duchesse d’Étampes, à faire cette démarche auprès de Margentine ?
Pourquoi envoyait-elle la folle à Fontainebleau ?
Espérait-elle que la scène de cette pauvresse arrivant au château et réclamant pour sa fille celle qu’on appelait la « petite duchesse » rendrait Gillette à jamais ridicule ? Peut-être !
Ou peut-être aussi, avec cette confiance instinctive que toutes les femmes ont dans la force réellement énorme du sentiment maternel, peut-être espérait-elle que Margentine trouverait le moyen d’arracher Gillette à François Ier, ou tout au moins de la protéger contre son amour.
Car pour la duchesse d’Étampes, il n’y avait pas de doute possible : le roi aimait Gillette.
Tant que la jeune fille résisterait, cela irait encore à peu près…
Mais du jour où elle serait officiellement la maîtresse du roi, que deviendrait-elle, elle, la puissante favorite qui courbait sous sa domination jusqu’à Diane de Poitiers ?
Elle faillit s’arrêter à un parti violent : celui d’empoisonner Gillette.
Mais elle n’avait personne sous la main pour exécuter ce projet ; son complice Alais Le Mahu était mort ; elle l’avait elle-même assassiné.
Quant à ses gentilshommes ordinaires, elle n’avait en leur discrétion qu’une confiance relative.
Ce fut alors qu’elle songea à Margentine et qu’elle se demanda si la folle bien stylée ne pourrait pas jouer un rôle dans la comédie ou le drame qu’elle préparait.
La pensée lui était venue de dire à Margentine que Gillette était justement la fille qu’elle cherchait.
La duchesse d’Étampes n’en savait rien et croyait mentir. Il se trouva que son mensonge était une vérité : la vie a de ces quiproquos.
C’est son carrosse qui avait failli renverser Margentine.
Celle-ci, on l’a vu, s’était mise en route à pied. L’idée ne lui était pas venue qu’avec l’argent que lui avait laissé « la belle dame » elle pouvait fréter une voiture. Pour elle, pour cet esprit où la vie ne se reflétait qu’en images troubles, il n’y avait qu’un moyen d’aller d’un point à un autre : c’était de marcher tant qu’elle aurait la force de marcher.
Nous avons dit que sa première étape dura cinq heures.
Margentine, tourmentée du besoin d’avancer, traversa le village où elle venait d’arriver et essaya de continuer.
Mais elle dut s’arrêter devant la nuit comme devant un mur.
Alors elle rétrograda, rentra dans le village, pénétra dans une auberge, et montra une pièce d’or.
L’aubergiste s’empressa, dressa la table, servit un dîner comme pour une demi-douzaine de gentilshommes. La pièce d’or y passa, mais Margentine mangea un morceau de pain et but un verre d’eau, ne paraissant même pas avoir vu les pâtés et le poulet qu’une servante avait disposés devant elle.
– Où allez-vous comme ça ? lui avait demandé l’aubergiste.
– Où je vais ? Cette question ! Je vais retrouver ma fille, pardi.
Les gens de l’auberge se regardèrent en hochant la tête. La voyageuse, avec ses yeux hagards, ses gestes étranges, ne tarda pas à leur apparaître ce qu’elle était : une folle.
Margentine dut à cette circonstance de ne pas être entièrement détroussée par le rapace aubergiste : on craignait les fous comme des êtres spéciaux qui étaient plus ou moins en relations avec les esprits, les anges ou les démons, toutes sortes de puissances extra-terrestres dont il était mauvais de s’attirer la colère.
Au soleil levant, Margentine reprit sa route.
À un moment, une mendiante lui demanda l’aumône.
Margentine lui donna une des pièces d’or qu’elle portait. La mendiante, d’abord stupéfaite, la poursuivit de bénédictions exorbitantes.
La folle s’en alla en fredonnant sa cantilène favorite, – une vieille berceuse du vieux temps, naïve, enfantine :
Dans le champ du voisin,
J’ai cueilli des lys blancs.
Par moments, elle s’arrêtait et frappait dans ses mains, en disant :
– Qu’est-ce qu’elle va dire, mon Dieu ! qu’est-ce qu’elle va dire quand je vais la prendre dans mes bras pour la bercer comme je faisais pour l’endormir… Va-t-elle être heureuse !… Et moi donc !… Seigneur, qu’il fait bon ! Et qu’il fait beau ! Je n’ai jamais vu une aussi belle journée !…
Une rafale de neige l’enveloppait à cet instant.
Toutes les fois qu’elle rencontrait un paysan ou qu’elle passait devant une maison, elle demandait :
– Fontainebleau, est-ce loin, dites ?
On la renseignait.
La première fois qu’elle avait posé cette question, elle avait tremblé qu’on ne lui répondit :
– Fontainebleau ! Mais ça n’existe pas ! Il n’y a pas de Fontainebleau !
Maintenant, elle était sûre.
Elle marcha toute la journée ; la nuit venue, elle dut s’arrêter encore, et ce ne fut que le lendemain qu’elle arriva.
Un groupe de maisons lui était apparu, et à un homme qu’elle croisait, elle avait posé sa question habituelle :
– Fontainebleau, est-ce loin ?
L’homme avait allongé le bras vers les maisons, en disant :
– Fontainebleau ? Vous y êtes, c’est ça…
La folle demeura toute saisie. Elle s’était arrêtée, les mains jointes, les yeux dilatés d’étonnement.
Le long du chemin, elle avait eu cette impression sourde que jamais elle n’arriverait et que les gens se moquaient peut-être d’elle quand ils lui disaient :
– Dans quatre heures… dans deux heures, vous y êtes. Elle y était !
Et ce fut avec une sorte de timidité qu’elle entra dans la ville, une timidité qui la faisait marcher doucement, comme elle faisait quand elle entrait dans une église, à Paris, l’hiver, pour s’abriter contre le froid ou la pluie.
Quelques instants plus tard, elle arrivait devant le château.
Le château lui apparut comme un palais féerique.
– Dieu, que c’est beau ! murmura-t-elle avec une profonde et sincère admiration.
Elle s’approcha lentement des grilles, comme invinciblement attirée, hypnotisée.
– Au large ! cria soudain un arquebusier ; au large, la femme ! ou je fais feu !
XXVIII
LA FILLE DE MARGENTINE
Nous avons laissé François Ier au moment où, ayant visité les divers postes du château, il rentrait dans ses appartements.
La rencontre de Manfred et de Lanthenay avait fait oublier au roi la nuit extraordinaire qu’il avait passée chez Madeleine Ferron, nuit d’amour et de haine, de terreur et de passion, qui s’est terminée sur la tragique vision de cet homme tombant, la gorge ouverte.
Tous ces souvenirs revinrent frapper naturellement l’esprit de François au moment où il crut avoir pris de suffisantes précautions contre les deux truands.
– La Châtaigneraie, es-tu fatigué ? demanda-t-il.
– Oui, sire, s’il s’agit de moi-même ; non, s’il s’agit du service de Votre Majesté.
– Eh bien, puisque tu n’es pas fatigué, dit le roi qui n’avait voulu entendre que la deuxième partie de la réponse, tu vas te faire donner une escorte et aller fouiller la maison à la porte de laquelle tu m’as laissé cette nuit. Tu arrêteras toute personne qui se trouvera dans cette maison.
– Même si c’est une femme, sire ?
– Surtout si c’est une femme.
La Châtaigneraie s’éloigna en pestant fort contre la corvée que lui imposait son maître.
Quant à François Ier, il ordonna à son valet de chambre de faire prévenir la jeune duchesse de Fontainebleau qu’il comptait aller la voir, et commanda qu’on le laissât seul.
Selon son habitude, toutes les fois qu’il avait un grave sujet d’ennui, il se mit à se promener avec agitation.
Puis, brusquement, il s’arrêta devant un grand miroir où il pouvait se voir de la tête aux pieds.
Le miroir lui renvoya l’image d’un homme vigoureux, d’un athlète aux larges épaules massives, aux jambes fortement musclées, et il sourit.
Ayant constaté d’un coup d’œil qu’il pouvait encore, par la prestance, passer pour le premier gentilhomme du royaume, François Ier continua son inspection par l’examen du visage. Alors son sourire disparut.
Là, en effet, se multipliaient les signes d’une vieillesse prématurée. De grosses rides profondes traçaient des rigoles sur son front ; ses joues s’étaient alourdies ; il constata avec effroi que, depuis un mois environ, ses cheveux avaient blanchi, et que sa barbe grisonnait. Ses paupières se bordaient de rouge, et le regard devenait terne. Et enfin, parmi les signes impitoyables de la fatigue physique, se montraient les signes honteux du mal qui le rongeait.
– Je suis perdu ! murmura François Ier en se laissant tomber dans un fauteuil. Je suis perdu… et rien ne peut me sauver. Rabelais m’avait juré de me trouver un remède… mais Rabelais a disparu… Lâche comme tous ses pareils, il m’abandonne traîtreusement… il se parjure…
Le roi ne se disait pas qu’il avait, lui, parjuré sa parole en laissant supplicier Dolet qu’il avait juré de sauver. Il est d’ailleurs certain que si Rabelais avait connu la vérité, il serait accouru du fond de l’Italie où il s’était réfugié.
Mais Rabelais ne savait pas que Diane de Poitiers s’était emparée de la lettre qu’il avait écrite à François Ier et du médicament qu’il avait préparé.
– Quant à ces chirurgiens qui m’entourent, continua le roi, me livrer à eux serait hâter ma mort. Il n’y avait dans mon royaume qu’un homme capable de me sauver, et il s’est enfui ! Je suis bien perdu… Oh ! être roi et être terrassé par une femme !
Il s’arrêta sur ce mot, évoquant la nuit qu’il venait de passer dans les bras de Madeleine Ferron, et une bouffée de sang monta à son visage.
Mais aussitôt la haine parla en lui plus fort que le désir, et il murmura :
– Pourvu que La Châtaigneraie la trouve ! Par tous les diables, je veux qu’elle me précède en enfer !…
Ce dernier mot, encore, le fit tressaillir.
– L’enfer ! songea-t-il ; c’est bien là ce qui m’attend !
Il reprit sa promenade furieuse et gronda :
– Perdu et damné, soit ! Damné pour damné, il faut que je le sois à bon droit… Ces scrupules qui m’étourdissaient, ces voix qui faisaient vacarme en mon cœur, je les étoufferai… Il me reste peut-être un an… six mois à vivre… Je veux vivre ces journées, ces heures, ces minutes… je veux vivre ardemment, sans en perdre une seule… je veux mourir rassasié de volupté, dans une dernière convulsion de plaisir… Et, par la mort-dieu, ce sera encore une belle mort, digne de moi !
Maintenant, il allait et venait comme un fauve.
– Des scrupules ? continua-t-il en haussant ses larges épaules… Est-il sûr qu’elle est ma fille, d’abord ? Parce que cette folle a jeté par hasard un mot… Est-ce que je le sais, moi, si elle est ma fille !… Et puis… et puis, quand elle le serait ! L’infernale drôlesse de cette nuit, en achevant de m’empoisonner, n’a-t-elle pas dit que l’enfer m’attend !… À quoi bon hésiter, alors ?… Damné, soit !… Oh ! cette pureté immaculée, cette blancheur de lys, cette suave innocence… tout cela promis au délire de mon agonie ! Mourir ! Sentir peu à peu ce robuste corps tomber à la hideuse pourriture, voir l’abominable gangrène gagner mes jambes, mes bras, ma poitrine… sentir mon cœur s’effriter jusqu’à ce qu’il cesse de battre… Oui, oui ! tout cela va devenir une réalité… Que dis-je ? C’est déjà l’horrible réalité… Mais puisque je meurs, périsse avec moi le lys immaculé, et que mon agonie, brûlante au moins, se rafraîchisse au contact de cette pureté… Mourir… oh ! mourir, désespéré, dévoré par l’infâme lupus… mais mourir dans les bras de Gillette !…
Ainsi toute la pensée du roi mourant se concentrait sur trois objets qui se tenaient étroitement :
Madeleine, cause du mal ; le mal lui-même ; Gillette.
Pour la maladie, il n’y avait rien à faire ; il se savait condamné.
Pour Madeleine Ferron, il rêvait le supplice.
Pour Gillette, il rêvait de la sacrifier à son dernier délire.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
François Ier sortit de sa chambre et entra dans un vaste salon rempli de courtisans, comme la Châtaigneraie arrivait.
– Eh bien ? demanda-t-il.
– Nous avons fait buisson creux, sire.
– Oh ! la maudite ! gronda le roi.
– Nous avons fouillé la maison de fond en comble et n’avons trouvé… que le cadavre d’un homme, un fort vilain cadavre avec une gorge béante…
Le roi frissonna au souvenir de la scène qu’évoquaient ces paroles.
– C’est bien, dit-il. Montgomery ?
– Me voilà, sire ! dit le capitaine des gardes.
– Écoutez…
François Ier entraîna le capitaine dans l’embrasure d’une fenêtre, et lui donna ses ordres :
– Prenez cent hommes intelligents et sûrs, divisez-les en autant de compagnies qu’il y a d’auberges à Fontainebleau. À chacune de ces compagnies, désignez une auberge ; attendez la nuit ; et ce soir, vers dix heures, faites fouiller toutes les hôtelleries de la ville ; arrêtez sans explications toute personne étrangère à la ville, qui y sera arrivée depuis que j’y suis moi-même – vous entendez toute personne, homme ou femme…
– Je comprends, sire…
– Surtout les femmes ! ajouta le roi. En attendant, faites monter à cheval cinquante de vos meilleurs cavaliers et envoyez-les sur toutes les routes, et principalement celle de Paris. Donnez-leur mission d’arrêter tout homme ou toute femme s’éloignant de Fontainebleau… Avez-vous tout compris…
– Oui, sire. Mais si cependant Votre Majesté voulait me désigner avec plus de précision la personne qu’elle vise, peut-être pourrais-je agir plus sûrement.
François Ier hésita un instant.
– Connaissez-vous la dame Ferron ? dit-il.
– Je l’ai vue deux ou trois fois, sire.
– Il s’agit d’elle – d’elle surtout ! Mais il s’agit aussi de deux truands de Paris.
– Manfred et Lanthenay, sire ?
– C’est cela même. Vous êtes un bon serviteur, Montgomery. Allez, faites diligence… je compte sur vous…
– L’impossible sera fait, sire ! s’écria le capitaine des gardes qui s’élança rayonnant.
Les ordres que venait de donner le roi l’avaient quelque peu rasséréné. Il tourna vers ses gentilshommes silencieux un visage souriant.
Aussitôt, les mines inquiètes et assombries se changèrent en mines joyeuses, les conversations reprirent leur train, et le roi traversa les groupes en distribuant des paroles aimables.
Mais la joie devint de l’enthousiasme, lorsque François Ier, se tournant vers les gentilshommes avant de sortir, dit à haute voix :
– Messieurs, notre grand veneur nous annonce un dix-cors. Nous le courrons demain, s’il plaît à Dieu. Ainsi donc, que chacun s’apprête, car l’animal a déjà mis en défaut plus d’une meute, et ce sera une véritable victoire que de le forcer.
Des acclamations accueillirent cette nouvelle, tandis que le roi se dirigeait lentement vers les appartements de la duchesse de Fontainebleau.
Ces appartements, placés à l’aile gauche, du château, consistaient en une douzaine de vastes pièces très somptueuses.
Il y avait une belle antichambre, où douze hallebardiers, en costume d’apparat, montaient la garde pour faire honneur à la petite duchesse.
Il y avait un immense salon où se tenaient les dames d’honneur.
Il y avait une salle à manger d’un luxe grandiose, avec ses hauts dressoirs chargés de vaisselles précieuses, ses aiguières d’or, ses candélabres monstrueux.
Il y avait enfin une chambre à coucher dont le lit carré, élevé sur une estrade comme un trône, était un véritable monument et un chef-d’œuvre de sculpture.
Mais Gillette n’entrait jamais dans le beau salon d’honneur.
Mais elle mangeait, seule, dans une petite pièce du fond de l’appartement.
Et c’est dans cette pièce qu’elle dormait.
Elle avait exigé qu’on plaçât un fort verrou à la porte, menaçant de sauter par la fenêtre si on ne lui donnait pas satisfaction.
Chacune de ces exigences avait révolutionné le petit monde des dames d’honneur qui s’en étaient montrées fort scandalisées.
Gillette avait donc vécu dans cette chambre qui donnait sur le parc par une fenêtre unique.
Elle était en somme assez protégée contre les périls inconnus que devinait son instinct de jeune fille. Elle y avait fait apporter un rouet et filait pour se distraire.
Sa triste existence de recluse avait été des plus uniformes.
Le matin, au jour, elle se levait, s’habillait elle-même, et ne tirait le verrou qu’assez tard dans la matinée. Alors la première dame d’honneur venait lui demander ses ordres « pour se lever », paraissant ne pas vouloir remarquer qu’elle était déjà habillée. À quoi Gillette répondait également en demandant s’il s’agissait du lever du lendemain, auquel cas, ajoutait-elle, elle réfléchirait à la chose pendant la nuit.
À midi, nouvelle apparition de la dame d’honneur venant annoncer que « les viandes de Mme la duchesse étaient servies dans la salle à manger ». À quoi Gillette répondait en interpellant sa servante et en lui ordonnant de lui apporter son dîner.
Le soir, répétition de la même scène.
Dans la journée, la dame d’honneur venait régulièrement à la même heure demander à Mme la duchesse si elle désirait la lecture ou la conversation de ces dames.
Mme la duchesse répondait non moins régulièrement qu’elle avait des yeux pour lire, si l’envie lui en prenait, et que, quant à la conversation des dames de la cour, elle s’y ennuyait fort, parce qu’elle ne comprenait pas toujours.
La seule distraction de Gillette était de descendre dans le parc ; encore attendait-elle que le soir fût tombé.
Mais elle ne pouvait faire un pas sans être suivie, sous prétexte de la distraire ou de lui faire honneur.
Un soir, comme elle se promenait lentement dans une allée qui longeait la haute muraille du parc, l’un des factionnaires placés de distance en distance, la regarda si fixement que Gillette s’approcha de lui.
Plusieurs fois déjà, il lui était arrivé d’adresser quelques paroles à quelques-uns de ces soldats, et cela se terminait toujours par l’offrande d’une pièce d’argent.
Ce soir-là, donc, Gillette, ayant vu ce factionnaire qui la regardait et croyant qu’il avait peut-être quelque grâce à lui demander, s’approcha de lui.
– Vous désirez me parler, n’est-ce pas ? demanda-t-elle avec douceur.
Le factionnaire regarda rapidement autour de lui.
– M. Triboulet est à Fontainebleau, dit-il.
Gillette poussa un cri, et ses femmes s’élancèrent auprès d’elle au moment où le soldat allait peut-être ajouter quelque nouvelle révélation.
Gillette vit bien qu’il avait encore à parler.
Mais il était trop tard !
– Est-ce que cet homme s’est montré insolent ? s’écria la première dame d’honneur ; je vais faire appeler l’officier…
– Mais non, dit vivement Gillette, un faux mouvement que j’ai fait m’a fait craindre de tomber, voilà tout !
– Au reste, ajouta la duègne d’un air pincé, lorsqu’une grande dame condescend à converser familièrement, contre toute étiquette, avec de pareilles espèces, il faut s’attendre à tout…
Gillette s’était éloignée en jetant au soldat un regard d’intelligence.
Le lendemain, redescendue dans le parc, elle chercha vainement le factionnaire.
Les jours suivants, il en fut de même.
Gillette imagina qu’on s’était peut-être défié de ce soldat, et, pour endormir les soupçons, elle cessa de descendre au parc.
Il faut se représenter tout ce qui se cachait de désespoir sous sa feinte indifférence pour imaginer sa joie à apprendre qu’elle n’était pas abandonnée, qu’on la cherchait, qu’on s’occupait de sa délivrance…
Elle était dans cette situation d’esprit lorsqu’on vint lui annoncer la visite de Sa Majesté.
Gillette fut prise d’une mortelle angoisse et se sentit pâlir. Pour la première fois, elle se rendit dans le grand salon où se tenaient les dames d’honneur, qui, à son arrivée, se levèrent et firent la révérence.
Là, elle se rassura quelque peu.
Et elle s’assit près d’une fenêtre, laissant errer son regard sur cette ville de Fontainebleau, reportant sa pensée de Triboulet à Manfred, puis songeant à ce roi qui se prétendait son père et qu’elle redoutait comme un larron.
– Messieurs, le roi ! cria une voix dans l’antichambre.
François Ier entra.
Gillette avait jeté autour d’elle un regard de terreur en constatant que les femmes quittaient la salle, et que les portes se fermaient.
– Sire ! dit-elle d’une voix qui tremblait d’indignation plus encore que de crainte, faites ouvrir les portes, ou je crie et je fais un scandale tel que vous n’oserez plus jamais venir ici.
– Rassurez-vous, dit François Ier.
Il frappa sur une table. Un gentilhomme apparut.
– Pourquoi ferme-t-on les portes ? dit le roi. C’est inutile. Je n’ai que peu d’instants à passer auprès de Mme la duchesse.
Et, se tournant vers Gillette :
– Vous voyez, je vous obéis, Gillette. Mais pourquoi vous défier ainsi de moi ?
C’était la première fois que le roi l’appelait de ce nom de « Gillette ». Jusqu’ici, en lui parlant, il avait affecté de dire « mon enfant ».
Il reprit :
– Vous serez donc toujours mon ennemie ? Que vous ai-je fait, méchante ?
Gillette tressaillit d’horreur.
Le ton de François Ier était changé. Elle reconnaissait maintenant la voix de l’homme qui avait pénétré par violence dans la petite maison de l’enclos du Trahoir et avait essayé de l’enlever.
– Je venais, continua le roi, je venais m’enquérir de votre santé… Vous pâlissez, Gillette, vous maigrissez… Vous vous renfermez dans vos pensées… Quand vous me connaîtrez mieux, vous regretterez votre injustice à mon égard… En attendant, je voudrais vous distraire… Demain, il y aura chasse… Voulez-vous en être ?
– Je veux bien, sire ! dit Gillette.
François Ier demeura stupéfait.
– Vous acceptez ?
– Oui, sire. Je n’ai jamais vu de chasse, et cela me fera plaisir…
– Par Notre-Dame ! voilà le premier moment de joie que j’éprouve depuis bien longtemps ! Ainsi, pour tout de bon, vous acceptez ?
– Oui, sire !…
– Ah ! Gillette, murmura ardemment le roi en faisant un pas vers la jeune fille… si vous vouliez… si j’osais espérer… si cette acceptation inespérée était le début d’un revirement chez vous…
– Sire, dit Gillette à bout de forces, j’irai à votre chasse demain… Mais je vous en prie, d’ici là… laissez-moi…
– Soyez obéie, fit le roi qui tremblait autant qu’elle, mais non de la même émotion.
Il se retira, et Gillette courut se réfugier dans sa chambre.
Le roi, en rentrant chez lui, était rayonnant.
– Elle cède ! grondait-il. Jour de Dieu, la chose a été longue, mais enfin…
Le plan de François Ier était des plus simples.
Une fois en forêt, il s’arrangerait pour être seul avec Gillette. L’idée d’un viol brutal n’était pas pour l’effrayer.
Une seule chose, dans cette affaire, étonnait le roi et l’inquiétait presque. C’était la facilité avec laquelle Gillette, jusqu’alors si farouche, avait accepté la proposition d’assister à cette chasse.
Oui, Gillette avait accepté, – et même avec joie.
D’abord, il ne venait pas à la pensée de la pauvrette qu’elle pût avoir un danger quelconque à redouter ; un tête-à-tête avec le roi lui paraissait chose impossible dans une chasse à laquelle assisteraient peut-être deux ou trois cents personnes.
Ensuite, elle espérait, en traversant la ville, être aperçue de Triboulet, échanger un signe avec lui, peut-être pouvoir lui parler.
Il faut dire que si Gillette était libre dans son appartement, si elle pouvait descendre au parc, il lui était interdit de sortir des limites du château.
Donc, traverser Fontainebleau, même en nombreuse compagnie, était une chance dont il fallait profiter.
XXIX
LA CHASSE ROYALE
C’était vraiment un groupe fringant qui traversait la ville de Fontainebleau le lendemain matin, à la grande admiration des bourgeois qui, par des cris répétés de : Vive le roi ! traduisaient leur admiration enthousiaste.
Gillette, montée sur un cheval noir, peut-être trop vif pour elle – pourquoi lui avait-on fait monter ce cheval et qui en avait donné l’ordre ? – Gillette, jetant autour d’elle des regards inquiets, cherchant avidement le visage ami parmi les mille visages des rues et des fenêtres, Gillette, marchait aux côtés de la duchesse d’Étampes, et toutes deux étaient encadrées de gentilshommes, au nombre desquels Essé et La Châtaigneraie ne perdaient pas la jeune fille de vue.
Quant à Diane de Poitiers, elle caracolait en tête sur un fougueux étalon que bien des cavaliers réputés n’eussent pas osé enfourcher.
Catherine de Médicis, montant selon la nouvelle mode qu’elle avait inventée, c’est-à-dire la jambe droite appuyée sur un demi-arceau planté à l’arçon de la selle. Catherine chevauchait hardiment, heureuse de montrer le bas de sa jambe qu’elle avait fort belle, heureuse de montrer sa science de l’équitation, heureuse aussi d’échapper pour une matinée à l’insupportable mauvaise humeur de son mari le dauphin Henri, lequel d’ailleurs n’avait d’yeux que pour Diane de Poitiers.
Quant au roi, il était radieux. Sa haute taille dépassait la taille des gentilshommes qui l’entouraient.
Il portait beau, dans son pourpoint de velours cramoisi, serré par une ceinture d’or à laquelle pendait un couteau de chasse à manche d’or incrusté de pierreries.
Il parlait du cerf, il parlait des campagnes qu’il voulait entreprendre, il parlait haut, riait, complimentait des hobereaux dont les familles allaient se transmettre de génération en génération le mot aimable arraché au roi par sa bonne humeur ; car le roi, ce matin-là, eût complimenté l’univers entier.
On arriva en forêt.
L’événement désiré, souhaité ardemment par Gillette, ne s’était point produit ; elle n’avait pas aperçu le visage ami qu’elle avait tant cherché… Et déjà elle se repentait d’être venue.
Au carrefour, le cortège s’arrêta.
On fit un grand cercle autour du roi.
Les meutes encore accouplées s’alignaient hors du cercle. Les sonneurs de fanfares étaient rangés en bataille.
Sur un appel du roi, le grand veneur s’avança au rapport au milieu du cercle.
Le grand veneur salua d’abord le roi, puis, d’un geste moins profond, les chasseurs assemblés. Dans le grand silence qui s’était fait, il parla à voix haute et claire, comme un héraut d’armes.
Il résultait du rapport que l’animal avait été débusqué la veille près d’une mare qui se trouvait à cent pas de là, et que les voies partaient de cette mare pour aboutir à la grande hêtraie ; le dix-cors, flairant le danger, avait passé la nuit à brouiller ses pistes par des contre-voies, et il était maintenant embusqué au fond des hêtraies.
Le grand veneur se tut.
Le roi jeta un regard d’intelligence à La Châtaigneraie et à d’Essé qui ne le perdaient pas des yeux.
Puis, ayant remercié et félicité son grand veneur, il se tourna vers le peloton des sonneurs et fit un geste.
C’était le signal de la chasse. Les fanfares sonnèrent.
Les chiens, découplés en un instant, s’élancèrent en compagnie serrée, jappant sourdement, quêtant et flairant.
Puis, ce fut le galop rapide des chasseurs partis en peloton.
Or, au moment où François Ier s’élançait à son tour, avec, eût-on dit, une certaine hésitation, comme s’il eût tenu à se laisser dépasser, à ce moment, un cavalier qui avait assisté invisible, à toute la scène du rapport, caché qu’il était dans les fourrés environnants, se mit à galoper à la hauteur du roi, tout en se tenant hors de son regard et en se dissimulant avec soin.
Ce cavalier, svelte, adroit, maniant sa mouture à travers les arbres avec une prestesse extraordinaire, portait sur le visage un loup de velours noir.
Il n’était pas de la cour.
Ce n’était pas non plus l’un des gentilshommes du voisinage accourus à la chasse.
Et enfin, qui eût pu l’examiner de près, malgré sa course rapide, n’eût pas tardé à reconnaître que c’était une femme.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
À l’instant précis où les cors avaient sonné, La Châtaigneraie s’était approché du roi et avait demandé à voix basse :
– Vos derniers ordres, sire ?
– Dans une demi-heure, soyez au Rocher de l’Ermite.
Alors, La Châtaigneraie avait repris sa place auprès de la duchesse de Fontainebleau, tandis que d’Essé occupait l’attention de la duchesse d’Étampes.
Or, le Rocher de l’Ermite était loin de la hêtraie signalée au rapport du grand veneur.
Ce Rocher de l’Ermite, ainsi appelé parce que jadis quelque cénobite y avait probablement élu domicile, était en réalité un entassement de rochers.
Éboulées les unes sur les autres, ces roches verdies de mousses formaient diverses anfractuosités, dont l’une, assez vaste, avait dû être jadis la grotte de l’ermite en question.
C’est vers cette grotte que galopait François Ier après s’être isolé du reste de la chasse. Il était toujours escorté par son invisible compagnon, – par le cavalier, ou plutôt par la cavalière au loup noir.
On a vu que la duchesse d’Étampes s’était jusque-là tenue auprès de Gillette.
Avec son instinct de femme jalouse et sa connaissance parfaite des ruses amoureuses de François Ier, elle avait tout de suite compris que la chasse n’avait d’autre but que de rapprocher le roi de Gillette.
La jeune fille n’avait, il est vrai, répondu à aucune des avances de la duchesse, et celle-ci avait pris le parti de chevaucher près d’elle sans lui parler, mais décidée à ne pas la perdre de vue un seul instant.
Or, au moment même où la chasse commençait, d’Essé avait brusquement sauté à bas de son cheval, en disant :
– Ces écuyers du château sont décidément de vilains drôles… votre bête est mal sanglée, madame…
En même temps, d’Essé faisait le geste de ressangler le cheval de la duchesse d’Étampes qui était d’ailleurs parfaitement sanglé.
– Merci, mon cher, dit la duchesse.
Et elle excita sa monture pour rattraper Gillette.
Mais elle n’eut pas fait vingt pas que la selle chavira ; la duchesse n’eut que le temps de sauter légèrement à terre.
– Quel maladroit je fais ! s’écria d’Essé qui lui-même mit pied à terre, mais cette fois plus lentement, et qui, tout en prodiguant les exclamations de regret, s’employa à seller la bête de la duchesse.
Celle-ci fouettait nerveusement l’air du bout de sa cravache et ne disait mot. Elle suivait des yeux La Châtaigneraie et Gillette qui filaient à la suite des chasseurs.
D’Essé n’en finissait pas, multipliant les excuses sur sa maladresse. Enfin, le cheval se trouva sellé, cette fois solidement, et aidée par son compagnon, la duchesse d’Étampes se remit en selle.
Alors elle regarda d’Essé droit dans les yeux.
– Encore une fois merci, dit-elle. Vous êtes certain que je n’oublierai pas l’important service que vous venez de me rendre, et qu’avant peu ma reconnaissance saura vous atteindre.
– Bien faible service, madame, fit d’Essé en pâlissant ; en tout cas, je suis sûr d’avoir été agréable au roi, en vous évitant un accident.
Puis la duchesse partit à fond de train, tandis que d’Essé la suivait d’assez près en songeant :
– Elle siffle bien, la vipère ; et si le roi ne lui arrache les dents, je pourrais bien un de ces jours connaître sa morsure… Il faudrait que je me gare !
Pendant que d’Essé jouait ainsi son rôle dans le petit scénario que François Ier avait imaginé, La Châtaigneraie jouait le sien de son côté.
On avait donné à Gillette un cheval ombrageux ; et il ne fallait rien moins que l’habileté consommée et le sang-froid de La Châtaigneraie pour éviter un accident.
À chaque instant le gentilhomme saisissait la bride de Gillette et arrêtait le cheval pour le calmer. Il en résulta qu’ils se trouvèrent bientôt en arrière de la chasse.
– Rejoignons ! fit tout à coup La Châtaigneraie.
Gillette, préoccupée de n’avoir pas aperçu celui qu’elle avait cherché des yeux, Gillette, tout entière à ses pensées de tristesse, ne fit pas attention qu’à ce moment, ils se trouvaient à l’embranchement de plusieurs routes…
Quelle était la bonne ?
Sans doute celle qu’avait prise La Châtaigneraie, car il s’y était engagé sans hésitation, et lui qui jusqu’ici avait fait tous ses efforts pour calmer la monture de Gillette, se mit soudain à l’exciter.
On galopa ainsi pendant dix bonnes minutes. Les bruits de la chasse s’étaient éteints. Gillette n’entendait plus que le bruit de son cheval et de celui de son compagnon.
Elle voulut arrêter.
Mais soit hasard, soit maladresse, la cravache de La Châtaigneraie s’égara à ce moment sur la croupe du cheval noir qui bondit furieusement.
Cinq cents pas plus loin, Gillette parvint enfin à arrêter sa monture et mit pied à terre en déclarant qu’elle n’irait pas plus loin.
– Je suis à vos ordres, madame, dit La Châtaigneraie.
Et lui-même sauta à bas de son cheval.
En même temps, il cingla violemment la bête qui partit à fond de train, immédiatement suivie par la monture de Gillette.
Cela s’était fait si rapidement que la jeune fille n’avait pu surprendre la manœuvre.
La Châtaigneraie éclata de rire.
– Nous voilà donc démontés ! fit-il. Je ne suis pas en peine de mes deux fugitifs qui rejoindront certainement… mais vous, madame…
Gillette garda le silence.
– J’y pense ! s’écria tout à coup La Châtaigneraie en se frappant le front ; nous sommes à deux minutes de la grotte de l’Ermite… Madame la duchesse peut s’y réfugier, pendant que j’irai à la recherche… Je pense que ce plan vous agrée ?
– Il me convient tout à fait, dit vivement Gillette.
Elle songeait que, pendant une heure, elle serait seule.
Aussi ne fit-elle aucune difficulté pour suivre La Châtaigneraie qui, en effet, au bout de quelques minutes de marche, arriva devant les roches. Le gentilhomme s’arrêta.
– Madame, dit-il, vous voici devant la grotte de l’Ermite ; vous y serez en sûreté et à l’abri ; si vous voulez bien m’y autoriser, je vais m’éloigner pour aller chercher quelque moyen de vous ramener à Fontainebleau.
– Faites, monsieur, murmura Gillette.
– C’est ici que je vous retrouverai, madame ?
– Oui… j’attendrai ici…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avant de suivre Gillette dans la grotte de l’Ermite, quelques mots d’explication sur La Châtaigneraie.
Peut-être nos lecteurs n’ont-ils pas oublié la scène où François Ier avait promis Gillette pour femme à celui de ses trois gentilshommes favoris qui lui livrerait Manfred.
La Châtaigneraie, Sansac et Essé, décidés à unir leurs efforts, avaient tout simplement joué Gillette aux dés.
C’est La Châtaigneraie qui avait gagné.
On a vu que les trois favoris n’avaient nullement réussi à s’emparer de Manfred. Il en résultait qu’à moins de quelque gros service rendu au roi, La Châtaigneraie ne pouvait guère espérer devenir l’époux de Gillette.
Le gentilhomme s’était longtemps creusé le cerveau pour trouver quel éminent service il pourrait bien rendre au roi. Et il cherchait encore lorsque le roi, au matin, avant le départ pour la chasse, lui avait révélé son petit plan de viol.
La Châtaigneraie avait accepté son rôle avec enthousiasme. En effet, à Gillette devenue la maîtresse du roi, il faudrait un mari, – un mari dévoué, assez l’ami du royal amant pour ne pas gêner ses amours.
– Ce mari, ce sera moi, s’était dit le gentilhomme.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gillette, le cœur palpitant, s’assit sur un banc de mousse qu’on avait formé dans le fond de la grotte.
Plus rouée, elle se fût demandé pourquoi l’active surveillance dont elle était l’objet venait de cesser tout à coup. Elle songea seulement qu’un merveilleux hasard lui venait en aide.
Elle palpitait, disons-nous. Car maintenant la pensée de fuir lui venait, précise et nette. Son plan fut vite fait : s’en aller au hasard, droit devant elle, jusqu’à ce qu’elle trouvât une maison où elle pourrait demander l’hospitalité.
Cette décision prise avec la fougue d’une joie qui ne laissait place à aucune hésitation, Gillette attendit deux ou trois minutes pour donner à La Châtaigneraie le temps de s’éloigner.
Enfin, n’y tenant plus, elle s’élança légèrement vers l’ouverture de la grotte.
Mais comme elle allait atteindre cette ouverture, une ombre intercepta soudain le rayon de soleil, un homme parut. Gillette jeta un cri d’angoisse et de terreur.
Cet homme, c’était François Ier.
La jeune fille, d’un bond, avait reculé jusqu’au fond de la grotte.
– J’étais inquiet, balbutia le roi. J’espère qu’il ne vous est rien arrivé de grave ?
Il continuait à avancer.
Gillette se trouva tout à coup acculée au fond de la grotte. Elle se vit perdue.
Une inspiration soudaine, une de ces inspirations qu’enfantent les cerveaux surchauffés de fièvre dans les moments suprêmes, – et elle dit :
– Il ne m’est rien arrivé, mon père !
François Ier s’arrêta court.
Ce mot que Gillette prononçait pour la première fois, ce mot qu’il avait en vain sollicité, ce mot de père se dressait maintenant entre la jeune fille et lui.
Père !… Il était père de cette enfant qu’il venait violer !
Et elle, hardiment, le regardait en face, d’un regard clair qui était la plus terrible accusation.
La lutte, dans le cœur de François Ier, dura quelques minutes, mortelles minutes pendant lesquelles Gillette n’osa risquer un pas, de crainte de rompre cette sorte de charme qui semblait paralyser le roi.
Mais, brusquement, François Ier darda un regard enflammé sur la jeune fille. Tout scrupule s’évanouissait en lui. Toute crainte s’effondrait. Sa pensée ne lui fournit plus que des images de luxure. Et même cette certitude d’inceste le fouetta.
Et il gronda, hagard :
– Qui t’a dit que je suis ton père ?…
Au loin, Gillette perçut une galopade.
François Ier, lui, n’entendit pas.
Il saisit la jeune fille par les deux poignets :
– Ton père !… Es-tu folle !… Je suis ton roi, je suis ton amant… Je t’aime, ne le comprends-tu pas ?…
Elle se raidit pour éviter son haleine brûlante.
– Je t’aime… bégaya-t-il avec un rire épais… Tu m’aimes aussi, toi n’est-ce pas ?… Tu m’aimes… dis que tu m’aimes… dis-le !…
Ses lèvres, furieusement, cherchèrent le baiser…
– Le voilà !… Sain et sauf !… Vive le roi !
Ces cris éclatèrent tout à coup, au moment où Gillette éperdue, rassemblait le peu qui lui restait de forces pour repousser l’homme exaspéré de passion.
François Ier se retourna, livide de fureur.
Il vit la grotte pleine de monde.
En tête des chasseurs accourus, la duchesse d’Étampes, qui lui prenait la main en disant :
– Oui ! Dieu merci, sain et sauf !… Messieurs, vive le roi !
– Vive le roi ! acclamèrent les gentilshommes.
Au loin, vers les hêtraies, les cors sonnaient victorieusement l’hallali…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ce qui s’était passé :
La cavalière au loup noir avait, on l’a vu, galopé pendant quelques minutes à la hauteur du roi. Tout à coup, elle reconnut le chemin que suivait François Ier.
– Mais il va au Rocher de l’Ermite ! fit-elle en arrêtant son cheval.
Dès lors, les scènes qu’elle avait notées prirent toute leur signification : le roi demeurait en arrière, tandis que La Châtaigneraie entraînait Gillette.
Elle éclata de rire.
– Pauvre François ! murmura-t-elle, quel chagrin je vais lui faire en l’empêchant de commettre une infamie de plus !…
Elle se dressa sur ses étriers, écouta attentivement, et finit par entendre le son du cor dans les lointains de la forêt. Alors, elle lâcha bride et se lança dans un galop furieux…
Dix minutes plus tard, elle rejoignait la chasse, au moment même où la duchesse d’Étampes la rejoignait elle-même et constatait avec un sourire de rage l’absence de Gillette et du roi.
La cavalière aperçut la duchesse et s en approcha.
– Vous cherchez le roi, madame ? dit-elle, railleuse.
– Qui êtes-vous ?… demanda la duchesse étonnée.
– Que vous importe… Je suis une amie pour vous, puisque je viens vous dire que le roi se trouve en ce moment même à la grotte de l’Ermite, et qu’il n’y est pas seul.
En disant ces mots, la cavalière fit volte-face, et, s’éloignant rapidement, disparut dans la forêt.
À cent pas de là, elle ôta son loup, et la belle et sombre figure de Madeleine Ferron apparut.
La duchesse n’avait pas perdu une seconde. À peine eut-elle entendu parler de la grotte de l’Ermite, qu’elle s’était écriée :
– Sotte ! J’aurais dû y penser !… Messieurs ! messieurs !…
Aux cris de la duchesse, une vingtaine de cavaliers s’arrêtèrent et l’entourèrent.
– Messieurs, dit la Duchesse en feignant une vive émotion, on me prévient à l’instant que le roi, désarçonné de son cheval, s’est réfugié au Rocher de l’Ermite. Je redoute un malheur…
La duchesse partit à fond de train, suivie par le groupe de cavaliers.
Quant à la Belle Ferronnière, ayant constaté que la duchesse partait dans la direction de la grotte, elle reprit tranquillement le chemin de Fontainebleau.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le roi, avec cette prodigieuse facilité de dissimulation qui constituait en sa nature de primitif le côté civilisé, le roi, en apercevant la duchesse d’Étampes, refoula le mouvement de fureur qui déjà crispait ses poings, et s’écria gaiement :
– Eh oui, messieurs, sain et sauf ! Par Notre-Dame, votre roi en a vu bien d’autres !…
Il disait cela à tout hasard.
– Vive le roi ! répétèrent les courtisans.
– À cheval, messieurs, et finissons-en avec cet incident ridicule !
– Votre Majesté assistera-t-elle à l’hallali demanda la duchesse d’Étampes.
– Non… nous rentrons au palais.
– Cela fait deux hallalis de manques, François ! murmura Anne de façon que le roi seul l’entendît.
François Ier lui jeta un regard tel que d’Essé, qui surprit l’expression de ce regard, s’approcha de la duchesse et lui dit ironiquement :
– Je crois, madame, que si cela ne dépend que de Sa Majesté, la reconnaissance que vous avez bien voulu me promettre sera longue à m’atteindre.
– Nous verrons ! dit Anne d’un air de défi.
Et, se tournant vers Gillette qui, pâle et tremblante, faisait d’incroyables efforts pour se soutenir :
– Pauvre petite ! murmura-t-elle. Aurez-vous confiance en moi, maintenant ?… Mais voyons, vous sentez-vous de force à vous tenir à cheval ?… Je vous préviens qu’il serait très dangereux pour vous de ne pouvoir nous suivre… le roi voudrait sans doute, vous tenir compagnie…
– Je suis prête ! dit Gillette galvanisée.
Quelques instants plus tard, on se mettait en route pour Fontainebleau.
XXX
LA CONSIGNE DU ROI
Nous laisserons Diane de Poitiers continuer la chasse avec ardeur, sans s’inquiéter d’autre chose que de traquer le cerf : nous laisserons François Ier, escorté de sa petite troupe de gentilshommes, cheminer en causant bruyamment, et nous le précéderons à Fontainebleau.
Nous avons vu que Margentine était arrivée devant le château. Une sentinelle lui avait crié :
– Au large, ou je fais feu !…
La folle s’était arrêtée.
La duchesse lui avait recommandé la patience. Et Margentine avait promis. Elle se souvenait très bien.
Si bien, même, qu’elle demanda à un soldat qui passait :
– Est-ce que le roi doit aller à la chasse ?
– À la chasse ? Il y est, la belle blonde.
– Ah ! Il y est… Et savez-Vous si Gillette est avec lui ?
Le soldat demeura stupéfait. Il savait que Gillette était le nom de la duchesse de Fontainebleau, et il fut émerveillé que cette sorte de pauvresse parlât d’une personne qui passait aux yeux des uns pour la maîtresse de François Ier, aux yeux des autres pour sa fille.
Il bredouilla quelques mots et se hâta vers le château, de crainte d’être vu avec une personne aussi dénuée de respect pour ces êtres à demi fabuleux qui évoluaient dans le monde de la cour.
Tout à coup, derrière elle, elle entendit crier : « Vive le roi ! »
Elle se retourna soudain, pâlie et tremblante.
– Le roi ! murmura-t-elle. Le roi !… Lui ! François !
Un groupe de cavaliers s’avançait vers les grilles du château. Celui qui venait en tête, en avant de tous les autres de quelques pas, était un seigneur de haute mine, dont le pourpoint de velours cramoisi faisait valoir la taille.
Et les yeux de Margentine buvaient, pour ainsi dire, cette vision, avec un étonnement infini, tandis qu’il lui semblait que tout craquait en elle et qu’un prodigieux travail s’accomplissait dans sa tête !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Depuis les temps lointains où Margentine avait été abandonnée par son amant, depuis l’affreuse scène où, toute sanglante encore de ses couches, à demi morte, elle était apparue dans la salle de débauche où François riait et chantait près de la fille-mère agonisante, depuis cette heure maudite, jamais Margentine n’avait revu l’homme qu’elle avait tant aimé.
Que le roi eût changé, vieilli, il n’en demeurait pas moins le cavalier si fier, avec son sourire un peu ironique et ses yeux froids, qu’elle voyait venir jadis avec extase, quand, sur le seuil de la maison de Blois, elle interrogeait avidement la route.
Et elle le revit tel qu’elle le voyait alors.
Nous ne pouvons dire qu’elle le reconnut : de Blois à Fontainebleau, il n’y avait pas dans son esprit de solution de continuité.
Margentine, en se trouvant ramenée en une seconde à près de vingt ans en arrière, subit-elle une transformation qui atteignit jusqu’aux fibres les plus profondes de son être ?
Le roi passa à dix pas d’elle. Il ne la vit pas.
Mais elle le vit, elle !
Ses mains se joignirent avec force. Elle voulut crier. Elle comprit qu’elle n’arrivait qu’à bégayer…
Déjà il était passé…
Et alors, parmi quelques gentilshommes formant escorte, elle vit deux femmes…
Deux femmes qui cheminaient côte à côte…
L’une lui jeta un regard brûlant, puis ce regard se reporta sur sa compagne comme pour la lui désigner.
C’était la duchesse d’Étampes.
Et l’autre, c’était Gillette ! Gillette que Margentine ne reconnut pas…
Tout à coup, le cheval de la duchesse d’Étampes fit un écart, et en quelques bonds se trouva près de Margentine.
La duchesse, en se penchant comme pour flatter l’encolure de la bête et la calmer, laissa tomber quelques mots. Puis elle rejoignit en souriant, sans que personne se fût douté de sa manœuvre.
– Ta fille, ta Gillette, la voilà !…
Ces paroles tombèrent dans la pensée de Margentine comme des gouttes de plomb fondu.
Et ces paroles la galvanisèrent, la fouettèrent, la jetèrent, délirante, vers le groupe qui, à ce moment, franchissait les grilles du château.
– Au large ! hurla la sentinelle.
– Ma fille ! ma Gillette ! hurla la mère en bondissant.
Un coup de feu éclata.
Margentine, ensanglantée, tomba sur ses genoux, les bras tendus vers Gillette, puis se renversa inanimée.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un cri d’horreur avait retenti dans le groupe des gentilshommes du roi. L’un d’eux avait couru à la sentinelle.
– Qui t’a dit de tirer, misérable ?
– C’est la consigne du roi, répondit le soldat.
Le gentilhomme s’écarta prudemment, déjà inquiet de son mouvement d’indignation.
Mais le roi ne faisait pas attention à lui.
Il suivait des yeux Gillette qui, sautant à bas de sa monture, s’était élancée vers Margentine, et il disait à la duchesse d’Étampes :
– Chère amie, ramenez donc cette petite écervelée qui va se commettre…
Le roi avait-il reconnu Margentine ?
Pas encore !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gillette, disons-nous, se mit à courir vers Margentine, s’agenouilla près d’elle, et souleva sa tête pâle qui avait en ce moment un étrange caractère de beauté.
Alors, elle reconnut la folle du taudis de la rue des Mauvais-Garçons.
Elle se souvint de la terreur que cette femme lui avait inspirée, elle se rappela le masque empoisonné…
Une larme tomba de ses yeux, et elle murmura :
– Ce n’est pas ma mère !…
Au cri de Margentine, à cet appel puissant et vibrant, Gillette avait eu un instant cette précise et palpitante sensation que c’était sa mère qui l’appelait…
Et maintenant, sa déception était si amère que cela lui arrachait des larmes.
– Allons, venez, mon enfant… ce n’est pas là votre place.
Gillette leva les yeux et reconnut la duchesse d’Étampes. En même temps, elle vit qu’un certain nombre de gentilshommes s’étaient approchés et la regardaient avec étonnement. Le roi n’était pas parmi eux.
– Voici le chirurgien ! dit l’un des assistants.
Gillette se releva, laissant la place au chirurgien.
Une pitié émue, une pitié profonde lui venait pour cette pauvre femme qui l’avait appelée « sa fille ».
– Il faut transporter la blessée, nasilla doctoralement le chirurgien. Quelqu’un sait-il où elle habite ?
– Elle habite au château, dans mon appartement ! dit Gillette.
Ces paroles lui échappaient pour ainsi dire malgré elle ; elle les prononça avec impétuosité et, dès lors, il lui sembla qu’elle avait un énorme intérêt à faire transporter Margentine chez elle ; l’instant d’avant, elle n’eût pas compris cet intérêt.
Cependant, des soldats avaient apporté un brancard sur lequel on déposa Margentine.
– Que décidez-vous, madame ? demanda le chirurgien à la duchesse d’Étampes.
– Obéissez à Mlle de Fontainebleau, dit Anne avec un sourire.
Quelques minutes plus tard, Margentine reposait sur le lit de Gillette.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le roi, sans attendre la fin de cet incident, s’était retiré dans son appartement. Il était furieux, et une fois qu’il fût seul, sa rage put se donner libre cours.
– Elle me le payera cher ! grondait-il par moments.
La menace allait à la duchesse d’Étampes.
Tout à coup, il s’assit à sa table, saisit une plume et écrivit :
« Ordre à la dame Anne de Pisseleu, duchesse d’Étampes, de se retirer, dès les présentes reçues, dans ses terres, d’où elle ne pourra sortir sans notre congé et d’où elle ne reviendra que lorsqu’il nous plaira de l’appeler à notre cour. »
Il signa et appela Bassignac.
Le valet de chambre apparut.
– Fais-moi venir mon capitaine des gardes, dit le roi.
– M. de Montgomery est justement dans l’antichambre, sire ; mais Votre Majesté veut-elle recevoir Mme la duchesse d’Étampes ?
Le roi tressaillit.
– Elle ! fit-il rageusement. Qu’elle aille au diable ! Ou plutôt, non, fais-la entrer…
Un instant plus tard, la duchesse entra, souriante.
En même temps qu’elle, entrait Montgomery, mandé par François Ier.
Celui-ci tendit au capitaine le parchemin sur lequel il venait d’apposer son sceau.
– Montgomery, dit-il, lisez ce papier et chargez-vous d’en assurer l’exécution.
L’officier parcourut le parchemin d’un regard.
– Est-ce tout de suite, sire ? demanda-t-il.
– Tout à l’heure, répondit le roi, calmé par l’exécution qu’il venait de faire. Allez, et attendez le moment dans les antichambres.
Montgomery comprit, salua et sortit.
Anne avait jeté un coup d’œil perçant sur le parchemin. Et si elle ne parvint pas à le lire, du moins l’attitude du roi et le regard surpris de Montgomery lui laissèrent entrevoir la vérité.
Elle s’approcha du roi, et posant la main sur son bras :
– Vous m’en voulez donc bien, François ?
– Madame, dit froidement le roi, vous avez voulu me parler. J’ai consenti à vous donner audience… Mais hâtez-vous…
– Hâtez-vous ! s’écria la duchesse, car Montgomery attend avec impatience, n’est-ce pas, sire ? Est-ce pour me jeter en quelque oubliette ? Est-ce pour me conduire en exil ? Parlez donc, sire ! Parlez haut, comme je parle, afin qu’on sache bien qu’à la cour de France, le dévouement est à la merci d’un caprice royal, et que tel qui risque sa vie pour le roi sera peut-être demain proscrit ou exécuté !… Ah ! François ! Est-ce donc là le prix de ma fidèle et constante amitié ? Que me reprochez-vous ? De n’être plus belle, peut-être ! C’est là un grand malheur, en effet ; mais tout de même j’avais le droit d’espérer que mon affection, je n’ose plus dire mon amour, serait un jour récompensée autrement que par l’entremise d’un Montgomery ! Et cela à l’instant même où je venais rendre à mon roi un service… un nouveau service, sire !
Elle lança ces dernières paroles au roi comme une amorce, et feignit aussitôt une prompte retraite, – stratégie d’ailleurs commune à toutes les femmes.
– Adieu, sire, dit-elle d’une voix brisée comme si elle eût fait effort pour ne pas sangloter… Adieu, François !
Le roi la saisit par la main. Le mot de « nouveau service » lui avait fait dresser l’oreille, car jamais Anne ne s’était vantée à faux de lui être utile.
– Laissez-moi, sire ! dit-elle.
– Eh ! mort-dieu, madame, quelle mouche vous pique ? Où prenez-vous que vous soyez menacée ?
– sire… oseriez-vous reprendre à Montgomery le parchemin que vous lui avez remis, et me le faire lire ?
Tout en se débattant, la duchesse s’arrangeait de façon à tomber dans les bras du roi.
Anne était d’une remarquable beauté, et Diane seule pouvait rivaliser avec elle.
Un parfum grisant s’échappait de sa chevelure.
Elle offrait à ce moment, et dans sa perfection, le type de la femme capiteuse.
Il n’en fallait pas tant à François Ier.
– Voyons, bégaya-t-il, ne fais donc pas la méchante…
C’était l’aveu de la défaite !
– Ce parchemin, sire ! murmura la duchesse.
– Montgomery ! appela le roi.
Le capitaine des gardes entra.
– L’ordre que je vous ai remis… fit le roi.
– Le voilà, sire.
– Eh bien, détruisez-le. Je le révoque.
La duchesse allongea la main pour s’emparer du parchemin, mais déjà Montgomery l’avait jeté dans la cheminée, feignant de ne pas apercevoir le geste de la duchesse.
– Vous pouvez vous retirer, Montgomery, dit alors le roi, qui adressa à son capitaine un sourire qui eût fait pâlir d’envie les favoris du roi s’ils l’eussent pu voir.
– M. de Montgomery est vraiment un homme d’esprit, fit la duchesse.
– C’est un soldat dévoué, dit le roi ; je lui ferai un sort… Ce parchemin ne contenait rien d’intéressant pour vous ; mais puisqu’il vous inquiétait, je suis content qu’il n’en reste plus trace… Mais ne disiez-vous pas…
– Que je venais vous rendre un service ? Oui, sire, un service d’affection…
– Je n’ai jamais douté de votre affection, ma chère Anne…
– Sire, cette femme, cette pauvresse sur laquelle a tiré une de vos sentinelles…
Le roi fronça le sourcil.
– Eh bien, demanda-t-il, cette femme ?
– Elle a été transportée au château, sire…
– Au château ! s’écria le roi surpris.
– Dans l’appartement de la duchesse de Fontainebleau, sire. Et c’est là justement ce que je voulais vous apprendre ; la jeune duchesse a demandé, exigé que cette mendiante soit transportée chez elle. Or, je crois, sire, qu’elles se connaissent ; je crois… oui, je suis sûre que vous feriez bien d’aller voir cette femme…
– J’y vais à l’instant, s’écria François Ier.
– Allez donc, sire, et souvenez-vous au moins que c’est moi qui ai poussé le dévouement jusqu’à vous servir contre les intérêts même de mon cœur !
François Ier eut un moment d’émotion bien rare chez lui. Il saisit les deux mains de la duchesse et murmura :
– Au fond, je n’aime que vous !
Et il se hâta de courir vers l’appartement de Gillette.
C’était un maître coup d’audace et d’astuce féminines que venait d’exécuter la duchesse d’Étampes. Non seulement elle n’avait pas dit un mot de sa jalousie contre Gillette – jalousie que redoutait le roi, – mais encore, elle prenait position comme protectrice des amours de François et de Gillette.
Dès lors, plus d’inquiétude à son sujet dans l’esprit du roi. Dès lors elle devenait la maîtresse légitime, la maîtresse indulgente qui ferme les yeux sur un caprice parce qu’elle est assez forte pour cela !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Margentine avait été transportée dans cette petite chambre retirée que Gillette avait adoptée.
Le chirurgien du château, ayant découvert le buste de la blessée, examina la plaie qui se trouvait au-dessus du sein droit.
Les dames d’honneur s’étaient sauvées avec des mines de pudeur offensée. Gillette était restée.
Et même elle avait voulu aider le chirurgien.
– Soulevez un peu la tête… là… restez ainsi.
Gillette, obéissante, avait placé ses deux mains sous la tête de Margentine et la soutenait, tandis que le chirurgien lavait et pansait la blessure.
Ce fut à ce moment que Margentine rouvrit les yeux.
Son premier regard, avec un mélange de doute, d’étonnement infini et de ravissement, se fixa sur Gillette.
– Pauvre femme, dit celle-ci, comment vous sentez-vous ?
– Bien… très bien… dit Margentine. Jamais je n’ai été aussi bien…
Et elle continuait à dévorer Gillette du regard.
– Voilà qui est fait ! dit le chirurgien. Si on est tranquille, si on ne touche pas au pansement, je réponds d’une prompte guérison.
Il se retira.
Gillette, alors, regarda autour d’elle et vit qu’il n’y avait plus personne dans sa chambre.
Elle ferma la porte et vint s’asseoir près de Margentine.
– Où suis-je ici ? demanda Margentine.
– Dans le château de Fontainebleau.
Un frisson agita Margentine.
– Le château, murmura-t-elle. Ah ! oui… le château du roi de France, n’est-ce pas ?
– Oui, madame.
On eût dit que le coup de feu de la sentinelle avait tué la folie de Margentine.
Avec un émerveillement presque terrifié, elle constatait qu’elle raisonnait ; elle percevait la clarté, l’ordre et la logique de ses pensées ; elle comprenait qu’elle redevenait la directrice de sa mémoire.
Elle refit comme en un rêve rapide, son voyage de Paris à Fontainebleau ; elle se revit attendant le passage du roi – de son amant ! – et se répéta les paroles de la duchesse d’Étampes :
– Ta fille ! ta Gillette ! la voilà…
Mais par une sorte d’ombre portée, une partie des événements qui s’étaient passés pendant sa folie, lui demeuraient interceptés.
C’est ainsi qu’elle ne se rappelait nullement pourquoi elle avait eu l’idée de venir à Fontainebleau ; elle ne se rappelait pas davantage que cette belle jeune fille qui lui souriait était venue dans son taudis.
Elle reprit avec une timidité angoissée :
– Voulez-vous me dire votre nom ?
– Je m’appelle Gillette…
Les doigts de Margentine se crispèrent sur les couvertures du lit ; mais elle se contint.
– Gillette ! fit-elle avec une profonde douceur ; c’est un bien joli nom…
Gillette sourit.
– Pourquoi m’a-t-on transportée en ce beau château ?
– C’est moi qui l’ai voulu ainsi…
– C’est vous ? Ah ! au fait… cela ne m’étonne pas…
– Pourquoi cela ? fit Gillette en souriant.
– Parce que vous êtes bonne… et puis… parce qu’il fallait peut-être que les choses fussent ainsi…
Gillette ne comprit pas cette phrase obscure, qui, chez Margentine, traduisait des sentiments plus obscurs encore. D’ailleurs tout l’étonnait dans l’attitude et les paroles de la blessée.
Était-ce bien là cette même femme qui l’avait si durement traitée à Paris ? Quel revirement s’était opéré en elle ?
Et pourquoi, aussi, Margentine, tout à l’heure, avant le coup de feu, s’était-elle élancée vers elle, en criant :
– Ma fille ! Ma Gillette !
Cette femme lui apparaissait enveloppée de mystère.
Cependant Margentine lui demandait :
– On dit que le roi a une fille… comprenez-moi… une fille dont on ne connaît pas la mère… Est-ce vrai ?
La question fit pâlir Gillette. Ses yeux se voilèrent. Elle baissa la tête… Margentine la regardait avidement.
Elle reprit d’une voix haletante :
– Répondez-moi… oh ! croyez-le… soyez-en sûre… si je vous demande ces choses… Répondez-moi comme vous répondriez à une agonisante que vos paroles peuvent faire vivre ou tuer…
– Il est vrai, madame, dit alors Gillette… le roi a une fille ou, du moins, j’ai pu le croire puisque lui-même me l’a dit…
– Cette fille… c’est vous, n’est-ce pas ? c’est vous…
Un douloureux soupir échappa à la jeune fille qui dit :
– C’est moi, en effet… Fille de roi… hélas ! fille sans mère !
Margentine fut agitée d’un tremblement convulsif.
Et de ses yeux, des larmes lentes coulèrent.
– Madame ! Madame ! s’écria la jeune fille effrayée, vous sentez-vous plus mal ?
Margentine fit non de la tête.
Et d’une voix oppressée, elle murmura :
– Attendez… j’ai des choses à vous dire… il faut que je puisse parler…
Frémissante, Gillette attendit.
– Écoutez dit enfin Margentine… il faut que je vous dise… Il y a dans ma vie une longue période pleine de ténèbres, et je sens que j’essaierais en vain d’y jeter quelque lueur… Que s’est-il passé dans cette période ? Je ne sais… Combien de jours ou d’années cela a-t-il duré, je ne sais pas non plus… Il me semble que j’ai dormi longtemps… longtemps… et que je viens seulement de me réveiller… C’est à peine si je garde un souvenir vague de quelques événements… C’est ainsi qu’il me semble vous avoir vue… mais c’est une illusion, sans doute…
– Oui, une illusion ! dit Gillette avec compréhension.
Margentine continua :
– Mais, par exemple, tout ce qui s’est passé avant cette période obscure, je me le rappelle dans les moindres détails… Mes douleurs d’alors m’étreignent d’angoisse, comme si je venais de les éprouver… et mes joies sont si présentes à mon esprit que je me demande si des années se sont bien passées… Et tout cela se mêle dans ma tête…
– Reposez-vous, je vous en prie, interrompit Gillette effrayée par l’exaltation qu’elle devinait dans la pensée de Margentine.
– Me reposer ! s’écria ardemment celle-ci. Me reposer ! Mais cela me repose infiniment de vous parler… Et puis… vous ne savez pas… Oh ! si cela était possible ! Écoutez-moi… Vous êtes une pure jeune fille, et je ne devrais peut-être pas vous dire… peut-être allez-vous me blâmer… Si vous saviez comme mon cœur se serre à l’idée d’avoir honte devant vous ! Pourtant, il faut que je vous dise… J’étais jeune, alors ; j’étais belle ; et j’aimai de toute mon âme ce jeune cavalier qui me jurait de m’aimer toujours… Vous rougissez… Ah ! voilà ce que je redoutais… comment faire ?
– Non, non ! s’écria vivement Gillette bouleversée d’émotion. Parlez… ne faites pas attention…
– Eh bien, je devins mère… J’eus un enfant… et ce même jour… jour de malheur, jour de joie, j’appris l’infamie de l’homme que j’aimais…, je faillis mourir… puis je revins à la vie qui m’aurait paru radieuse si j’avais conservé mon enfant…
– Cet enfant mourut donc ? interrogea Gillette.
Margentine ne répondit pas. Elle n’entendit peut-être pas. Elle reprit avec une exaltation croissante :
– Savez-vous comment s’appelait cet homme ?
– Dites ! oh ! dites !
– Il s’appelait François et est devenu roi de France…
– Mon père ! murmura Gillette défaillante.
– Quant à mon enfant… vous ai-je dit que c’était une fille ? Vous ai-je dit que je me mis à l’adorer avec emportement, avec frénésie ? Écoutez… écoutez… ces choses se passaient à Blois…
– Blois ! s’exclama sourdement la jeune fille.
– Un jour… elle disparut… Comment ? Je ne sais… Plus tard, bien plus tard, je sus qu’on l’avait vue à Mantes…
– Mantes ! râla Gillette, pâle comme une morte…
– On me dit qu’un homme l’avait emmenée… un homme… un monstre difforme et contrefait… puis, je ne me souviens plus…
Un sourd gémissement de joie ineffable échappa à Gillette.
Elle voulut crier : Mère ! mère ! c’est moi ta fille ! et sa gorge ne rendit aucun son ; elle voulut tendre ses bras… mais elle sentit que la vie se dérobait d’elle et qu’elle tombait…
– Anges du ciel ! c’est elle ! c’est elle !
Avec un rugissement, Margentine avait bondi de sa couche et saisit sa fille dans ses bras.
La double exclamation de la jeune fille, son émotion croissante devant son récit, son attitude à ses derniers mots lui révélèrent que Gillette s’était reconnue dans ce récit entrecoupé.
Sous les caresses délirantes de sa mère Gillette rouvrit les yeux.
– Ma mère ! murmura-t-elle faiblement.
– C’est toi ! râlait Margentine en sanglotant et en riant, c’est donc toi ! Je n’étais pas sûre ! Faut-il que je sois mauvaise mère ! Comme tu es belle ! et grandie ! Seigneur ! Il y a donc bien longtemps ! Figure-toi, quand je songeais que je te retrouvais, je me disais que je te prendrais dans mes bras pour te bercer…
La scène qui suivit est de celles qui échappent à toute description.
Mais enfin, après tant d’effusions, Margentine voulut savoir comment et pourquoi Gillette connaissait son père, et comment elle se trouvait au château de Fontainebleau.
– Le roi… commença-t-elle.
Gillette frissonna :
– Oh ! mère, mère chérie, ne parlons pas de cet homme… il m’épouvante…
– Ainsi, gronda-t-elle, le mal qu’il a fait à la mère ne lui suffit pas… il faut encore…
À ce moment, à l’entrée de la chambre, plusieurs personnages, hommes et femmes apparurent.
Et l’un d’eux, s’avançant jusqu’au milieu de la chambre, s’écria rudement :
– Or ça, que signifie cette comédie ? que fait ici cette mendiante ?… Qu’on la saisisse et qu’on la jette hors du palais, sans autre châtiment, en raison de son état… Quant à vous, Gillette…
Il étendit la main, comme pour saisir Gillette.
Mais il s’arrêta tout à coup, blêmi, et se mit à reculer comme s’il eût vu un spectre.
Margentine s’était redressée.
D’un geste violent et doux, un geste de mère, elle avait repoussé sa fille derrière elle et elle grondait :
– Touche-la donc un peu… touche-la… et nous allons rire…
– La mère ! bégaya le roi.
Et ce mot, sur ses lèvres retroussées par un rictus d’épouvante, prenait une signification formidable. La mère !… cela voulait dire : le châtiment…
Parmi les gentilshommes que le roi avait amenés pour ne pas effaroucher Gillette en venant seul, plusieurs voulurent s’élancer sur l’insolente.
Le roi les arrêta d’un geste et dit – murmura plutôt :
– Retirez-vous, messieurs… Cette femme est ici à sa place… retirez-vous…
Étonnés, effarés, ils obéirent… ils reculèrent, s’en allèrent, suivis par le roi, écoutant avec stupéfaction les grondements de la mère pantelante et furieuse.
XXXI
AU GRAND-CHARLEMAGNE.
La veille au soir s’était déroulée, à l’auberge du Grand-Charlemagne, une scène qui trouve ici sa place naturelle. On a vu que, dans la matinée, avant d’aller trouver Gillette qu’il voulait entraîner à la chasse, François Ier avait donné des ordres à son capitaine des gardes, Montgomery.
Lorsque François Ier lui confia cette mission d’arrêter la Belle Ferronnière et les deux truands, Montgomery en comprit toute la gravité.
Son premier soin fut d’expédier sur toutes les routes de nombreuses estafettes ; en même temps, il prépara son expédition du soir en envoyant des espions dans les auberges de Fontainebleau.
Les estafettes revinrent bredouilles.
Et sur la fin de la journée, le capitaine fut convaincu que Madeleine Ferron était déjà bien loin de Fontainebleau.
Mais si, de ce côté-là, sa déception fut complète, il n’en fut pas de même en ce qui concernait les deux truands. L’un des espions, en effet, vint vers sept heures lui dire que des étrangers survenus depuis peu habitaient l’auberge du Grand-Charlemagne et que deux d’entre eux répondaient au signalement donné.
– Sur trois, songea-t-il, j’en offrirai deux au roi, et, si je ne me trompe, la capture des deux truands fera oublier la fuite de la Ferron.
Montgomery se frotta les mains.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vers neuf heures et demie, la ville de Fontainebleau fut sillonnée de patrouilles silencieuses. Chacune de ces patrouilles marchait droit sur l’auberge qui lui avait été désignée, entrait si l’auberge était ouverte, frappait au nom du roi si elle était fermée…
L’auberge du Grand-Charlemagne était située dans une ruelle peu fréquentée et d’assez mauvaise réputation, qu’on appelait la rue aux Fagots.
Malgré son titre pompeux, c’était une pauvre auberge qui recevait rarement des voyageurs et qui gagnait misérablement sa vie à vendre des cruches de bière aux soldats. En effet, elle n’était pas très loin du château.
En même temps que les autres groupes, Montgomery sortit du château à la tête d’une quarantaine de soldats bien armés et munis de tout ce qu’il faut pour enfoncer une porte ou bâillonner et ligoter un prisonnier.
Il ne tarda pas à atteindre la ruelle aux Fagots, et commença par barrer les deux extrémités de la rue au moyen de deux postes composés chacun de dix arquebusiers ; les postes reçurent l’ordre de tuer tout ce qui essaierait de passer.
Puis, avec les vingt estafiers qui lui restaient, le capitaine s’avança vers le Grand-Charlemagne.
Montgomery frappa.
À sa grande surprise, la porte s’ouvrit aussitôt.
– Diable ! songea le capitaine, voilà une porte qui s’ouvre bien facilement !… Est-ce que je vais, de ce côté-là aussi, faire buisson creux ?
Il avait laissé ses soldats dans la rue.
– Bonhomme, dit-il à l’aubergiste, vous avez ici des voyageurs ?
– Oui, monseigneur.
– Combien ? Parlez franchement, car il pourrait vous en coûter cher d’essayer de jouer avec la justice du roi.
– À Dieu ne plaise, monseigneur ! J’héberge en ce moment cinq étrangers.
– Bien, mon brave. Je viens ici pour arrêter ces étrangers au nom du roi ; mes soldats vont entrer, la chose se fera sans bruit ni scandale, vous n’aurez qu’à nous montrer la porte de leurs chambres.
– Je suis un fidèle sujet de Sa Majesté, fit l’aubergiste, j’obéirai, monseigneur.
– Un instant. Parmi les étrangers, il y en a deux arrivés depuis peu de jours, n’est-ce pas ?
– Oui, monseigneur, les deux plus jeunes.
– Auriez-vous, d’aventure, entendu leurs noms ?
– Oui, monseigneur.
– Dites-moi ces noms !
– J’ai entendu ces deux gentilshommes s’appeler entre eux ; l’un se nomme Manfred et l’autre Lanthenay.
– Aubergiste ! s’écria Montgomery rayonnant, je vous promets cinquante écus, et que le ciel me damne si je ne vous les apporte dès demain… Allons, conduisez-moi à la chambre de ces deux-là… les autres ne m’importent guère.
Le capitaine se tourna vers la porte restée entr’ouverte pour appeler ses soldats. À ce moment, une porte vitrée située au fond de la salle s’ouvrit, un homme parut, et une voix railleuse, nasillarde, ironique s’éleva :
– Ne vous donnez pas la peine de faire entrer vos soldats, monsieur de Montgomery, nous nous rendons au roi !
– Triboulet ! exclama sourdement Montgomery.
– Sorti tout exprès de la Bastille pour vous aider à exécuter les ordres du roi, mon cher !
– Triboulet ! répéta le capitaine anéanti.
– Tout prêt à rendre compte à Sa Majesté de l’habile prestesse avec laquelle vous m’avez conduit à la Bastille !
– Parlez plus bas ! murmura Montgomery en jetant vers ses soldats un regard de terreur.
– Ayez donc l’obligeance de fermer la porte si vous ne voulez pas qu’on entende que vous avez menti au roi en vous vantant de m’avoir arrêté et conduit à la Bastille !
Montgomery obéit avec une docilité stupéfiée, puis revint vers Triboulet.
– Mais j’y pense ! reprit celui-ci. Nous avons à causer, mon cher monsieur de Montgomery ! Or, il y a des soldats qui ont l’oreille fine… Je m’en suis assuré… Ne jugez-vous pas à propos de renvoyer cette troupe qui encombre inutilement la rue.
– Inutilement ! répéta Montgomery anéanti de stupeur.
– Dame ! Cela me paraît ainsi, puisque nous nous rendons de bonne volonté, mes amis et moi…
– Vos amis !…
– Sans doute… des amis bien chers, deux jeunes gens qui savent ce qu’on doit aux ordres de notre bon roi François de Valois ; car je puis vous affirmer que Manfred et Lanthenay ont été bien calomniés ; ils ne demandent qu’à aller en prison… à condition que j’y aille avec eux, et qu’avec eux je paraisse devant le roi, qui sera bien joyeux de me revoir, j’en suis sûr… J’ai voulu les détourner de ce projet, mais ils y ont mis un entêtement que je ne conçois pas… Voyons, mon cher capitaine, voulez-vous que je les appelle et qu’ensemble nous allions nous mettre au milieu de vos soldats ?… « Voici Triboulet ! crieront de leur plus belle voix Manfred et Lanthenay ; voici le fameux Triboulet qui vient de sortir de la Bastille où M. de Montgomery l’avait conduit ! » Car, Dieu merci, chacun sait combien il est facile de sortir de la Bastille.
Montgomery n’en écouta pas davantage.
Il sortit dans la rue en refermant soigneusement la porte, et donna l’ordre au sergent d’armes de relever les deux postes et de reconduire toute la troupe au château.
– Il n’y a personne dans cette auberge, acheva-t-il ; les oiseaux se sont envolés, mais je vais interroger l’aubergiste et j’aurai peut-être une indication.
Surpris et flatté que son chef daignât condescendre à des explications, le sergent se hâta de rassembler sa troupe, pendant que Montgomery rentrait dans l’auberge.
– Du vin d’Anjou, aubergiste ! commanda Triboulet.
Un large broc d’étain fut déposé sur la table par l’aubergiste qui, sur un signe de Triboulet, s’éclipsa aussitôt.
Triboulet remplit les deux gobelets.
– Si nous reprenions la conversation au point où nous l’avons laissée ? dit Triboulet.
– Où l’avons-nous laissée ? balbutia Montgomery.
– Ah ! capitaine, vous manquez de mémoire. Je vais donc vous aider… Voyons, s’il m’en souvient bien, vous me prîtes par le bras, vous me fîtes sortir du Louvre, et vous me demandâtes de vous appuyer auprès du roi, vous figurant que j’étais rentré en grâce et faveur.
– C’est la vérité ; où voulez-vous en venir ?
– À ceci : je vous faussai compagnie, ce dont je m’excuse de tout cœur ; lorsque vous rentrâtes dans le Louvre, le roi vous ordonna de me conduire séance tenante à la Bastille.
– Comment savez-vous cela ? fit Montgomery.
– Il suffit que je le sache, mon digne capitaine. Or, le lendemain matin, vous annonçâtes au roi que, grâce à votre diligence, j’étais bel et bien embastillé. Vous mentiez, mon cher, mais ce fut le commencement de votre fortune.
– C’est possible… Après ?
– Après ? Il en résulte ceci : que si vous arrêtiez mes jeunes amis, je me ferais arrêter en même temps, et que je dirais au roi : « Sire, une autre fois, choisissez mieux ceux qui doivent me conduire à la Bastille ». Vous voyez l’effet produit.
Montgomery frémit.
Il ne comprenait que trop bien que si pareil événement se produisait, ce serait pour lui-même une catastrophe dont il ne se relèverait pas, bien heureux encore d’en être quitte avec la perte de son grade et de son emploi et la disgrâce du roi.
– Oui, dit-il avec un soupir de rage, je suis forcé d’en convenir. Et aussi bien, vous voyez que je n’ai pas arrêté les deux truands que vous appelez vos amis.
– Ce soir, oui, mais une autre fois ?
– Je vous donne ma parole de…
– Bon pour vous, mon cher ; mais ne pourrait-il se faire que quelque autre officier, prévenu, ou pris d’une inspiration soudaine…
– Je me tairai…
– Je n’en doute pas ; mais les Latins, qui, comme vous le savez, étaient un peuple fort intelligent, avaient imaginé un proverbe… Verba volant, scripia manent.
– Ce qui veut dire ?
– Que les paroles s’envolent mais que les écrits restent.
– Vous voulez que j’écrive ?
– Tout simplement.
– Et si je refuse ?
– Alors, écoutez bien. Je suis vieux, je ne tiens pas du tout à ma vieille carcasse, et, au fond, il m’importe assez peu d’aller pourrir au fond de quelque cachot. Au contraire, j’ai un intérêt énorme à assurer la liberté de mes deux amis. Or, donc, si vous refusez d’écrire, je vais de ce pas au château, et je dis au premier officier que je rencontre : Je suis Triboulet, conduisez-moi au roi…
– Cela n’empêcherait pas l’arrestation des truands.
– C’est vrai, mais cela nous vengerait d’avance. Manfred et Lanthenay seraient arrêtés… peut-être, et s’ils y consentent ! Mais ce qui est sûr, c’est que le capitaine qui s’est joué de la crédulité du roi serait également arrêté, conduit à Paris sous bonne escorte, et jeté dans quelque bastille.
Montgomery frissonna.
– Écrivez donc ! reprit Triboulet en poussant devant le capitaine une feuille de parchemin et une plume qui, évidemment, avaient été préparées d’avance.
– Et si je te tue ! rugit tout à coup Montgomery.
En même temps, il repoussa violemment la table, tira sa dague et se précipita sur Triboulet.
Celui-ci fit un bond en arrière, et avant, que le capitaine eût pu l’atteindre, se trouva campé, l’épée à la main.
Montgomery savait que Triboulet était d’une force redoutable à l’escrime. Il n’en aurait pas moins essayé de frapper son adversaire si, à ce moment, plusieurs hommes ne fussent entrés dans la salle.
Montgomery reconnut deux d’entre eux : Manfred et Lanthenay.
Du reste, ils ne firent aucune démonstration contre le capitaine et parurent vouloir assister au combat en simples spectateurs. Mais Montgomery comprit que s’il blessait Triboulet, il ne sortirait pas vivant de cette auberge.
D’un geste furieux, il rengaina sa dague et alla reprendre sa place à la table en disant à Triboulet :
– Que faut-il écrire ?
Alors Manfred, Lanthenay, Spadacape et le chevalier de Ragastens s’assirent à l’autre bout de la salle.
Triboulet dicta et Montgomery écrivit :
« Ordre aux chefs de poste du château de Fontainebleau de « porter respect et déférence à mon bon ami Fleurial qu’on « appelle aussi Triboulet. »
La tournure ambiguë de cette phrase échappa à Montgomery, qui d’ailleurs n’était guère en état de réfléchir. Il signa. Triboulet s’empara du précieux papier en disant :
– Vous comprenez, mon cher… Avec un pareil viatique sur moi, je puis passer partout sans crainte.
– Soit ! fit Montgomery d’une voix étranglée par la fureur, mais votre triomphe sera de courte durée ; je me charge, avant huit jours…
– Oh ! avant huit jours, nous serons tous loin de Fontainebleau.
C’est ce que voulait savoir le capitaine.
– Puisses-tu dire vrai, vipère ! gronda-t-il en lui-même.
Et il sortit, accompagné jusqu’au seuil par Triboulet qui lui fit une profonde révérence.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le lendemain matin, Montgomery, posté dans l’antichambre du roi, attendit avec impatience que François Ier le fit appeler. Mais le roi était absorbé par une grave opération : sa toilette de chasse… Il partit pour la forêt sans demander à son capitaine aucune nouvelle de la double battue de la veille.
On a vu la scène qui eut lieu entre François Ier et la duchesse d’Étampes au retour de la chasse, on a vu que Montgomery avait su mériter de son roi un sourire qui l’avait quelque peu réconforté ; on a vu enfin que le roi s’était rendu chez Gillette, et ce qui s’en était suivi.
Ce fut à ce moment que François Ier se rappela les ordres qu’il avait donnés.
Il fit venir Montgomery et l’interrogea d’une voix si sombre que le capitaine, tremblant, songea que, décidément, il allait passer un mauvais quart d’heure.
Mais aussitôt, il se remit et, payant d’audace, se fiant sur le hasard et les revirements de la cour, il répondit :
– Sire, nous n’avons pu arrêter ni la dame Ferron ni les deux truands… La raison en est toute simple, sire, c’est que cette femme et ces deux hommes ont quitté Fontainebleau.
Et Montgomery se lança dans un grand luxe de détails imagina séance tenante une série de scènes qui intéressèrent fort le roi, et termina en disant :
– Nous avons arrêté hier et cette nuit une soixantaine de personnes qui sont au château, sire… Je vais, si le roi m’y autorise, faire relâcher ces gens, puisque les seuls qui intéressent Votre Majesté sont en fuite…
François Ier avait écouté d’un air sombre les explications de Montgomery. Il était évident que sa pensée était ailleurs.
Enfin, un soupir lui échappa.
Et se tournant vers Montgomery :
– Allez, monsieur. Renvoyez vos prisonniers ; et, puisque vous êtes sûr que les personnes en question ne sont plus à Fontainebleau, c’est que tout est pour le mieux ; n’en parlons plus.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
François Ier demeura enfermé chez lui pendant deux heures.
La soudaine apparition de Margentine se dressant entre Gillette et lui, le bravant du regard, le menaçant du geste, l’avait violemment frappé.
Au bout de deux heures, on vit François Ier sortir de son cabinet. Il paraissait sombre et préoccupé.
Il se dirigea vers l’appartement de la duchesse d’Étampes.
Qu’allait-il faire chez Anne ?
Allait-il lui demander la consolation ?
Peut-être l’astucieuse duchesse attendait-elle cette visite…
Elle avait fait une toilette savante.
Habillée, ou plutôt déshabillée avec un art consommé, elle s’apprêtait à une lutte suprême pour reconquérir la couronne.
La couronne !…
Et n’était-elle pas en effet presque reine ?
Ou bien y avait-il au fond de cette conscience quelque monstrueux espoir s’étayant sur des assassinats possibles ?…
Quoi qu’il en soit, lorsque François Ier entra chez la duchesse, il s’assit ou plutôt se laissa tomber dans un fauteuil, et, comme après Marignan, il murmura :
– Tout est perdu !
Mais cette fois, il n’osa ajouter :
– Hormis l’honneur !
Il n’avait fait attention ni à la capiteuse toilette d’Anne, ni à son sourire plein de promesses, et n’avait pas vu qu’elle s’était avancée vers lui en tendant ses lèvres.
– Il souffre donc bien ! pensa-t-elle.
Pour une femme comme la duchesse d’Étampes, le doute n’était pas possible.
Ce roi, ce grand coureur de femmes, ce grand trousseur de jupes, cet homme que la vieillesse marquait au front et que la maladie poussait à la tombe, ce roi qui avait passé sa vie à rire de l’amour et des femmes, ce reître qui n’avait jamais vu dans la femme qu’un instrument de passion, eh bien ! il était dompté par une petite fille sans malice…
Deux yeux bleus, deux yeux purs et profonds comme le joli ciel azuré de ce coin de France, avaient bouleversé ce sceptique.
Il tremblait, il soupirait, il pleurait.
Il aimait enfin !…
C’était le châtiment qui venait le surprendre à l’apogée de sa carrière de grand amoureux.
Pensive, la gorge serrée, Anne contempla le roi qui pleurait !…
Elle n’était plus la femme aimée ! Elle était déchue de cette souveraineté qu’elle avait exercée pendant des années sur le cœur du souverain.
Elle comprit que c’était la fin de sa carrière de femme.
Ce fut un drame qui se déroula silencieusement dans le secret de sa pensée.
Anne se résignait à l’abdication…
Elle abdiquait, oui ! Mais elle n’abdiquait que sa royauté d’amoureuse. Quant à sa royauté politique, quant à son influence sur l’esprit du roi, à défaut de son cœur, elle allait tenter un suprême effort pour la conserver…
Anne doucement, s’approcha de lui, se pencha, et le baisa au front.
Ce n’était plus un baiser d’amante. Il y avait quelque chose de maternel dans ce geste apitoyé, dans ce baiser consolateur.
Elle murmura :
– Tu souffres donc bien, mon pauvre François ?
Le roi de France cacha sa tête dans le sein de cette femme qui se penchait sur lui et se prit à sangloter.
Et c’était d’une habileté réellement admirable, c’était presque beau et presque grand, ce sacrifice de l’amante, cette transformation d’Anne, duchesse d’Étampes.
Sous ces caresses, le roi, peu à peu, reprenait possession de soi-même.
Alors elle demanda :
– Que s’est-il passé ?
Et, tout naturellement, comme s’il eût parlé à un vieil ami, il raconta la scène de Margentine se dressant entre Gillette et lui.
– Et c’est sa mère ?… demanda la duchesse.
– Oui ! fit le roi.
– Et vous aimez cette jeune fille, François ?…
– Oui ! répondit encore le roi.
La duchesse frissonna. Cette passion d’inceste ainsi proclamée l’étourdissait. Mais elle jugea qu’il fallait se grandir avec la situation. L’essentiel, pour le moment, était de ne faire aucune allusion au lien de parenté qui unissait le roi à Gillette.
Anne s’assit près du roi, posa sa main blanche sur son bras, et d’une voix qui tremblait un peu :
– C’est un caprice de votre cœur, n’est-ce pas ?…
– Oui, un caprice, s’écria le roi, se raccrochant à cette perche qu’on lui tendait ; un simple caprice, ma chère Anne. Quant à mon cœur, au fond, il demeure vôtre pour longtemps… pour toujours, je pense !
– Eh bien, mon roi, mon amant, soyons assez amis l’un de l’autre pour poser nettement la situation. Vous aimez cette Gillette… et je veux croire, je veux être sûre que vous continuez à m’aimer tout de même… Hélas ! une pauvre femme aimante comme moi ne peut donner une dernière preuve de son amour qu’en se dévouant…
– Chère Anne ! s’écria le roi réellement ému.
– Mais, reprit-elle, si je me dévoue, mon roi, si… je vous aide à vous faire aimer, que me restera-t-il à moi ? Bientôt je serai complètement oubliée, et moi qui étais la première à votre cour, je serai tellement la risée des rivales que j’ai écrasées qu’il ne me restera plus qu’une ressource : me retirer en mon château et, dans une vieillesse déshonorée, attendre dans les larmes une mort que j’appellerai… que je hâterai peut-être…
– Anne ! Anne ! je vous jure, je vous donne ma parole de roi que vous resterez à ma cour la première, la plus honorée…
Il eut le courage d’ajouter :
– La plus aimée !…
Elle reprit, comme songeuse et suivant une idée à la piste :
– Ainsi c’est cette Margentine qui est l’obstacle ?… Eh bien sire, il faut supprimer l’obstacle.
– C’est à quoi je pense, répondit François Ier d’une voix qui fit frissonner Anne, quelle que fût sa force d’âme.
– C’est un moyen… mais il est mauvais.
– De quel moyen parlez-vous ?
– De celui auquel vous pensez.
Ils se regardèrent et se virent pâles.
– Eh bien, oui ! fit violemment François Ier, puisque cette femme me gêne…
Il acheva d’un geste.
– Et je vous dis, François, que le moyen serait mauvais.
– Pourquoi ?
– Parce que, couvert du sang de Margentine, vous inspireriez à Gillette une horreur telle qu’elle en arriverait à se tuer elle-même plutôt que de tomber dans vos bras.
Le roi demeura une minute pensif.
– C’est maintenant, dit-il enfin, que je reconnais toute la force de votre dévouement, ma chère Anne… Vous avez mille fois raison. Mais alors, achevez votre œuvre, guidez-moi, conseillez-moi…
– Il faut les isoler, dit la duchesse ; songer à les séparer, ce serait folie ; mais les isoler est facile, et une fois qu’elles seront seules, qu’elles ne pourront plus compter sur la crainte d’un scandale…
– Oui, je comprends… mais comment les isoler ? Où les conduire ?… Hors du château ? Jamais !
– Il y a le pavillon des gardes au fond du parc. Je me charge de le faire aménager, et dès demain je les déciderai à s’y réfugier.
– Anne, tu me sauves la vie ! s’écria le roi sans songer que son exclamation était un vrai coup de poignard dans le cœur de la duchesse.
XXXII
LE PAVILLON DES GARDES.
Ce pavillon, dont la duchesse d’Étampes venait de parler à François, était situé très avant dans le parc, au milieu d’un massif de vieux arbres qui, pendant l’été, le couvraient d’une ombre impénétrable.
On allait rarement de ce côté. L’endroit était solitaire.
On avait fini, parmi les gens du château, par attacher des idées superstitieuses à ce pavillon, grâce à son isolement au fond du bosquet d’arbres.
Or, le soir du jour où la duchesse d’Étampes et François Ier eurent l’entrevue à laquelle nous avons assisté, un laquais du château entra tout à coup, pâle et tremblant, à l’office, où ses camarades prenaient leur repas.
Et il raconta qu’ayant eu une commission à porter à une des sentinelles postées contre le mur du fond du parc, il avait voulu couper court en revenant et, malgré la nuit, était passé devant le pavillon des gardes.
Or, à travers les jointures des persiennes du rez-de-chaussée, il avait vu de la lumière !
D’abord pris d’une folle envie de s’enfuir, cet homme assura qu’il avait eu ensuite le courage de s’approcher à pas de loup de la persienne éclairée vaguement, et qu’il avait vu une forme noire venant lentement à lui.
L’opinion générale fut que la vision signalée n’avait rien d’extraordinaire, et que c’était un fait connu que le pavillon des gardes était hanté.
Par qui ? Ou par quoi ?
C’est ce qu’on ne pouvait dire. D’ailleurs, on ne sait jamais par qui est hantée une maison hantée, parce que, si on le savait, ce ne serait plus une maison hantée, mais une maison habitée.
Cette théorie, que nous reproduisons sans en endosser la responsabilité, fut émise par l’un des officiers de la bouche royale, homme considérable et tout à fait digne d’être cru sur parole.
Il demeura donc acquis que le pavillon des gardes était actuellement la demeure d’une « forme noire », que, faute de lui pouvoir donner un nom plus précis, on appela la Dame en Noir, sans qu’on fût d’ailleurs tout à fait sûr que l’apparition était du sexe féminin.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nous avons trop de respect pour MM. les officiers de l’office royal pour élever le moindre doute sur l’existence de la Dame en Noir dont il est fait mention dans les « Mémoires du sieur Aubry de Ribécourt, officier de la bouche royale, concernant quelques faits et gestes s’étant produits en le château de Fontainebleau ». Et nous renvoyons aux dits Mémoires le lecteur récalcitrant qui refuserait d’adopter la légende de la Dame en Noir.
Mais comme, d’autre part, nous ne nous sommes pas contenté de compulser le manuscrit du sieur Aubry de Ribécourt (nous disons manuscrit, car ces Mémoires ne connurent point l’honneur de l’imprimerie), mais que nous avons cherché à contrôler ses assertions par celles d’autres manuscrits ou imprimés du temps, nous sommes en mesure de dévoiler le mystère de la Dame en Noir.
Nous prierons donc le lecteur curieux de dévoiler l’incognito de la dame en noir – s’il s’en trouve d’assez curieux pour cela – de vouloir bien revenir un instant avec nous au moment où François Ier étant sorti de la maison de la Belle Ferronnière, fit, avec Manfred et Lanthenay, la rencontre que nous avons narrée de notre mieux.
Qu’on se représente Madeleine Ferron, debout près du cadavre de Jean le Piètre qu’elle vient d’égorger pour sauver François Ier, – pour le conserver à sa vengeance.
Une fois que le roi fut parti, Madeleine se pencha sur le cadavre qu’elle considéra un instant avec une froide curiosité. Certaine que Jean le Piètre était bien mort, elle remonta dans la chambre du premier étage et entr’ouvrit la fenêtre pour essayer d’apercevoir une dernière fois son amant.
Elle distingua dans la nuit un groupe d’ombres confuses, entendit la voix du roi, et si elle ne comprit pas tout ce qu’il disait, elle en entendit assez pour deviner son projet.
– Oui, oui, murmura-t-elle, fais cerner cette maison, fais-la fouiller ! Tu ne m’y retrouveras pas… C’est ailleurs que tu dois me revoir, mon doux François.
Alors, rapidement, elle, s’habilla en cavalier, fit un paquet de quelques hardes, et entra dans l’une des pièces qui donnaient sur le derrière de la maison.
Il y avait là un jardin clos de murs peu élevés.
Madeleine jeta son paquet dans le jardin et sauta elle-même par la fenêtre, supposant que la porte d’entrée allait être forcée d’un moment à l’autre et qu’elle ne pourrait passer par là.
Une fois dans le jardin, elle franchit le mur au moyen d’une échelle, se trouva dans un étroit passage qui courait parmi les jardins d’alentour, et regagna la rue.
Elle s’était mise à marcher rapidement dans la direction du château.
Dix minutes plus tard, elle entendit le bruit d’un grand nombre de pas venant à sa rencontre, et elle se blottit dans l’encoignure d’une porte cochère.
De là, elle vit passer une vingtaine d’hommes qui marchaient en toute hâte sous la direction d’un cavalier ; c’était La Châtaigneraie qui allait fouiller la maison de la Belle Ferronnière, et qui passa à trois pas d’elle sans l’apercevoir.
Lorsque cette troupe se fut éloignée, Madeleine Ferron reprit sa marche.
Elle n’aboutit pas à la façade du château. Mais, le contournant par l’aile droite, elle se mit à longer le mur du parc et arriva enfin au point qu’elle s’était fixé.
Là, ayant attentivement considéré les environs, elle frappa deux fois dans ses mains.
Une corde lui fut aussitôt lancée de l’intérieur du parc.
Elle attacha d’abord son paquet au bout de la corde. Puis, à la force des poignets, se hissa elle-même le long de la corde. Parvenue sur la crête du mur, où elle s’assit à califourchon, elle tira à elle son paquet et le jeta dans le parc, puis, se suspendant par le bout des doigts, elle se laissa tomber et arriva légèrement à terre.
Un homme était là qui l’attendait.
– Fidèle au poste, dit-elle ; c’est bien.
– Depuis quatre nuits, madame, répondit l’homme.
– C’est parfait. Conduis-moi maintenant.
L’homme se mit à marcher silencieusement, suivi de Madeleine Ferron ; au bout d’un quart d’heure, il arriva devant un pavillon délabré.
C’était le pavillon des gardes. Il en ouvrit la porte et entra dans une salle du rez-de-chaussée.
Là, il alluma un flambeau que sans doute il avait dû apporter la veille ou le jour même.
Madeleine avait défait le paquet de hardes qu’elle avait apporté et en avait tiré une bourse pesante, dont elle sortit un nombre respectable de pièces d’or.
Elle les tendit à l’homme.
– Voici, dit-elle, un petit commencement ; mais rappelle-toi que si tu m’es fidèle jusqu’au bout, et surtout si tu es intelligent, ta fortune est faite.
– Quant à la fidélité, vous pouvez d’autant plus y compter que vous trahir serait me trahir moi-même, et par conséquent risquer à tout le moins la potence, ; quant à l’intelligence, je ferai de mon mieux… Mais venez que je vous montre votre logis.
L’homme ouvrit une porte et descendit un escalier qui aboutissait à une cave assez vaste et assez bien aérée.
– Voici, dit-il. J’ai descendu un des lits qui se trouvaient là-haut, et l’ai garni à peu près. Voici une table, un fauteuil, et quant aux vivres, toutes les nuits je vous apporterai ce qu’il faut.
– Et le cheval ? demanda Madeleine.
– En sortant par la petite porte du parc et en suivant le chemin, au bout de cinq cents pas, vous trouverez une ancienne hutte de bûcheron. J’y ai mis la bête ; vous n’aurez qu’à la seller ; cette cabane vous servira aussi pour attendre le moment propice pour rentrer dans le parc.
– Le roi va à la chasse bientôt ?
– Après-demain… ce sera une grande chasse à laquelle assistera toute la cour.
– Bien ; continue toutes les nuits à me renseigner sur ce qui se passe au château. Jusqu’ici je suis contente de toi. Va maintenant, car je suis fatiguée.
L’homme se retira.
Madeleine ferma soigneusement la porte du pavillon et descendit se coucher dans la cave, où elle ne tarda pas à s’endormir d’un sommeil paisible.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel était ce pavillon des gardes où la duchesse d’Étampes méditait de faire conduire Margentine et Gillette.
– Je me charge de les décider, avait-elle dit, et de faire aménager le pavillon.
En effet, dès que le roi l’eut quittée, elle se mit à l’œuvre. Et bientôt une dizaine d’ouvriers et de domestiques s’employèrent à nettoyer de fond en comble les pièces les mieux conservées du pavillon, qui furent aussitôt garnies de meubles et de tentures.
Dès le lendemain, le pavillon se trouva logeable, du moins dans la partie destinée à être habitée par Margentine et sa fille. Il restait à les décider.
– Ce sera difficile, songea la duchesse, mais avec de la patience on arrive à tout. Et puis, en somme, si la petite Gillette doit m’en vouloir, Margentine, au contraire, me doit de la reconnaissance, puisque je lui ai réellement fait retrouver sa fille.
Maintenant, quelle était au juste la pensée de la duchesse d’Étampes ?
Voulait-elle sérieusement aider le roi à triompher de Gillette ?
Ou plutôt n’avait-elle pas quelque espoir secret qu’au contraire la jeune fille résisterait plus facilement dans le pavillon des gardes ?
Elle n’eût pu le dire exactement.
Lorsqu’elle arriva dans l’appartement de la duchesse de Fontainebleau elle trouva Margentine dans un fauteuil. Malgré sa blessure, elle ne se couchait plus pour être toujours prête à défendre sa fille.
Gillette était assise près d’elle.
La mère et la fille, perdues dans une de ces longues et douces conversations qui étaient leur vie depuis qu’elles s’étaient retrouvées, ne virent point entrer la duchesse.
Elle avait entre-bâillé la porte de leur chambre, et si basse que fût leur voix, elle put entendre une partie de leur entretien.
– Et ce jeune homme, disait Margentine, tu dis qu’il s’appelle ?…
– Manfred, mère.
– Manfred… Manfred, fit Margentine songeuse ; c’est étrange, il me semble que je connais ce nom-là… bien mieux, il me semble le reconnaître lui-même au portrait que tu m’en as tracé… On dirait que je l’ai connu à une époque lointaine de ma vie.
Margentine, au temps de sa folie, habitait dans la rue des Mauvais-Garçons, c’est-à-dire sur les frontières de la Cour des Miracles.
Or, Manfred n’habitait-il pas la Cour des Miracles ?
Mais Gillette évitait avec une sorte de terreur de dire quoi que ce fût qui pût faire comprendre à sa mère qu’elle avait été folle.
– Ne vous tourmentez pas, chère mère, dit-elle. Et surtout, ne songez à rien de votre passé, puisque cela peut vous faire du mal.
– Pourquoi ne penserais-je pas au passé, ma chère enfant ? J’y songe au contraire autant que je puis. Je voudrais pouvoir combler ce trou qu’il y a dans ma mémoire ; je voudrais pouvoir joindre le présent à ma jeunesse et jeter un pont sur le fossé qui les sépare… Enfin, pour revenir à Manfred, je crois vraiment l’avoir connu. Où et quand ? Voilà ce que je ne puis dire…
– C’est une illusion, mère…
– C’est possible… Et tu dis qu’il t’a sauvée ? Oui tu m’as dit cela… Et tu l’aimes… Pauvre chérie, je comprends ce que tu dois souffrir, loin de lui… Mais toutes tes misères vont finir, va ! Je te tirerai d’ici, moi… n’aie pas peur.
– Je n’ai plus peur, ma mère… Tenez, même lorsque… le roi s’est présenté ici brusquement, je n’ai pas eu peur, tandis que je serais morte de terreur si j’avais été seule… comme là-bas…
– Oui ! Tu m’as dit… comme dans la grotte de l’Ermite… Oh ! l’infâme !
– Avec vous, je ne redoute plus rien.
– Et vous avez peut-être tort, mon enfant, dit la duchesse d’Étampes en s’avançant.
Et comme Gillette demeurait tout interdite, elle se hâta d’ajouter :
– Pardonnez-moi d’avoir surpris vos derniers mots et d’entrer en tiers dans votre conversation. Je viens en amie…
– Qui êtes-vous, madame ? demanda Margentine.
La duchesse, en voyant le regard clair et intelligent de Margentine, comprit la vérité. Elle n’était plus folle !
– Vraiment, fit-elle, regardez-moi bien… ne me reconnaissez-vous pas ?
– Madame ! implora Gillette.
– Laisse parler, ma fille ! interrompit Margentine. Il me semble que je vais enfin savoir… comprendre…
– Taisez-vous, par pitié ! supplia Gillette à voix basse.
– J’ai dit que je venais en amie, répondit Anne avec une fermeté voisine de la dureté ; il faut que je le prouve… Regardez-moi, Margentine… Tâchez de vous souvenir… voyons… Vous rappelez-vous Paris… la rue des Mauvais-Garçons ?…
– La rue des Mauvais-Garçons ! fit Margentine en prenant son front dans ses deux mains.
– Oui… c’est là que vous m’avez vue, Margentine.
– Vous m’appelez par mon nom comme s’il vous était familier… et pourtant… non… je ne me souviens pas vous avoir jamais vue… je ne me rappelle pas la rue des Mauvais-Garçons…
– Une petite rue étroite, bordée de masures dont les toits pointus, aux tuiles verdies, semblent des clous qui menacent le ciel… une chaussée défoncée avec un ruisseau au milieu… des boutiques sordides… des gamins mal vêtus, pieds nus…
– Oui… oui… il me semble que je vois mieux au fur et à mesure que vous parlez…
– Et dans cette rue, reprit la duchesse d’Étampes, une maison plus délabrée que les autres… un escalier en bois vermoulu que l’on monte en s’accrochant à une corde fixée à la muraille humide…
– Je vois, je vois ! s’écria Margentine palpitante.
– Oh ! madame, ce que vous faites-là est impitoyable ! dit Gillette.
La duchesse haussa les épaules et répondit :
– C’est pour vous sauver, mon enfant, comme je vous ai déjà sauvée à deux reprises différentes.
Et, s’adressant à Margentine :
– Au haut de l’escalier, une pièce obscure dont la fenêtre prend jour sur une cour étroite, triste, sans air…
– C’est là que je vivais ! cria Margentine.
– Oui, c’est là ! Et rappelez-vous… Un soir… c’était en hiver… quelqu’un est venu vous dire de descendre… et lorsque vous fûtes descendue, une dame poussa dans vos bras une jeune fille…
Gillette ne put retenir un gémissement.
– Une jeune fille, continua la duchesse, que vous avez saisie dans vos bras et emportée chez vous…
– Ô terreur ! murmura Gillette.
– Et c’était votre fille ! Votre fille que voilà ! Et la dame, c’était moi ! Moi qui avais arraché Gillette au Louvre et qui vous l’amenais… Vous rappelez-vous ?…
– Oh ! c’est insensé, ce qui se passe dans ma tête ! fit Margentine. Je vois la scène que vous dites… Je la vois comme si j’y étais… J’emporte la jeune fille… ma fille… ma Gillette… et je l’emporte avec haine… je l’emporte pour la faire souffrir ! Mais alors… Oh ! je comprends l’épouvantable vérité… j’étais folle !
– Mère ! mère chérie ! sanglota Gillette en se jetant au cou de sa mère. Ne pensez pas une chose aussi affreuse… Tout cela n’existe pas !
– Pauvre ange ! Comment, alors, n’ai-je pas compris que tu étais ma fille ?
– Vous ne m’avez pas torturée ! Vous ne m’avez pas haïe !…
– Tu me le jures ?
– Je vous le jure sur mon âme !
– Ah ! je sens mon cœur se dilater… C’eût été aussi par trop abominable qu’une mère martyrisât sa fille…
– Si je vous l’amenai alors, dit la duchesse d’Étampes, ce fut pour la sauver du roi…
– La sauver !
– Oui ! Ne savez-vous donc pas…
– Oui, oui… elle m’a tout dit, la pauvre petite…
– Eh bien, Margentine, écoutez encore… Qui est venu vous dire que Gillette était à Fontainebleau ? Qui est venu vous donner les moyens de faire la route ? Qui est venu vous dire comment vous deviez vous y prendre ?
– C’est vous, madame ! C’est vous !
– Enfin ! Vous, me reconnaissez donc !
– Si je ne vous reconnais pas, je comprends au moins que vous me dites la vérité.
– Si je viens maintenant vous dire que Gillette n’est pas en sûreté ici !
– Qu’on ose la toucher ! gronda Margentine.
– Pauvre femme ! On aura vite fait de se débarrasser de vous par le fer ou le poison !
Gillette jeta un cri d’épouvante et Margentine frissonna.
– Voulez-vous avoir confiance en moi ? Je vous promets, moi, de vous sauver toutes les deux. Ne me demandez pas pourquoi je veux vous sauver… Il suffit que je le veuille ! Voulez-vous avoir foi dans le secours que je vous apporte ?
– Parlez ! dirent à la fois Margentine et Gillette.
La duchesse d’Étampes comprit que sa cause était gagnée.
Gillette, en effet, tout en éprouvant une instinctive défiance contre elle, ne pouvait méconnaître qu’elle l’eût sauvée des griffes du roi.
Quant à Margentine, elle devinait dans la duchesse une femme, qui pouvait être une mortelle ennemie ou une alliée, mais qui, pour le moment, avait intérêt à défendre Gillette.
La duchesse reprit alors :
– Il ne faut pas rester ici… Évidemment le roi ne vous laissera pas sortir du château ; vous êtes ses prisonnières, du moins l’une de vous… Mais je puis obtenir facilement qu’on vous donne un autre logis…
– Qu’y gagnerons-nous ? fit Margentine.
– Vous n’y gagnerez rien si ce nouveau logis est situé dans le château… Mais s’il est dehors…
– En dehors ! N’avez-vous pas dit vous-même que nous sommes prisonnières !
– En effet ; aussi ne s’agit-il pas de vous faire franchir les limites du château ; mais dans ces limites il y a un grand parc, et, dans ce parc, plusieurs pavillons. Si l’un d’eux vous était assigné comme logement, je crois que vous pourriez mieux vous défendre et peut-être profiter d’une occasion…
Margentine et Gillette acceptèrent avec joie l’idée qu’elle leur suggérait, et, dès le même soir, elles étaient installées dans le pavillon des gardes.
XXXIII
JARNAC ET LA CHATAIGNERAIE
Dans son cabinet, le roi François Ier avait attendu le résultat de la démarche de la duchesse, comme si sa vie en eût dépendu.
La pensée que Gillette était sa fille ne le tourmentait plus. Il en avait pris son parti.
Lorsque la duchesse d’Étampes, vint lui annoncer que Margentine et Gillette allaient s’installer dans le pavillon des gardes, elle le trouva en conférence avec La Châtaigneraie. Le gentilhomme, par discrétion, se retira.
Mais le roi lui cria :
– Ne t’en va pas, reste dans l’antichambre… Eh bien ? demanda-t-il fiévreusement à la duchesse.
– Eh bien, sire, cela n’a pas été sans mal, mais nous avons la victoire.
– Vous êtes mon bon ange ! s’écria François Ier.
La duchesse sourit avec mélancolie.
– Quand la chose se fera-t-elle ? reprit-il.
– Je vais m’employer à ce que qu’elle se fasse dès aujourd’hui, sire.
Au sortir de la duchesse, La Châtaigneraie rentra dans le cabinet royal.
Il vit le roi tout joyeux, et jugea sans doute que le moment était arrivé pour lui poser une question.
– Je vois, sire, dit-il, que vous avez de bonnes nouvelles.
– Excellentes, ami, excellentes… Je renais… je respire à pleine poitrine…
– Sire, dit alors La Châtaigneraie, puisque Votre Majesté est si heureuse, elle devrait en profiter pour faire rayonner son bonheur autour d’elle.
– Que veux-tu dire ?
– Je veux dire, sire, que je sais quelqu’un qui a une supplique à vous adresser et qui n’ose pas. Si vous le permettez, je vais parler pour lui.
– Parle donc ! fit le roi en se jetant dans un fauteuil.
– Votre Majesté se souvient-elle de la promesse qu’elle fit un jour à trois de ses gentilshommes ?
– À quel sujet ?
– Au sujet de Mme la duchesse de Fontainebleau, sire.
La Châtaigneraie prononça cette phrase sur le ton le plus naturel et le plus indifférent. En réalité, il savait parfaitement l’effet qu’elle allait produire sur le roi.
– Je me souviens ! dit François Ier d’une voix brève.
– Eh bien, sire, je demande à Votre Majesté si elle se trouve toujours dans les mêmes intentions. Je précise : le roi voulait alors donner en mariage la jeune duchesse à l’un de ses trois favoris.
François Ier se demanda un instant si La Châtaigneraie ne devenait pas fou. Le gentilhomme était au courant de l’amour du roi, qui ne se gênait pas devant lui, pensait tout haut et le prenait pour confident.
La Châtaigneraie suivait d’un œil attentif la pensée royale.
– Sire, dit le gentilhomme en souriant, je fais d’abord observer à Votre Majesté que je ne parle pas pour moi, mais pour un de mes amis…
– D’Essé ?
– Je ne dis pas que c’est lui.
– Sansac, alors ?
– Je ne dis pas celui-là non plus. Mais laissez-moi achever, sire. Cet ami n’ignore nullement les sentiments dont Votre Majesté veut bien honorer la jeune duchesse.
– Alors, ton ami éprouve le besoin d’aller faire un tour à la Bastille ?
– Non, sire ; mon ami éprouve le besoin de donner à son roi une preuve de dévouement absolu…
– Explique-toi donc, mort-dieu !
– Eh ! sire, la chose est difficile après tout ! Et s’il s’agissait de moi, je me tairais, certes ! Eh bien, pour parler net et franc, mon ami m’a ouvert son cœur. Il m’a laissé entendre qu’il était disposé à accepter le titre d’époux sans en réclamer les droits… Je vois que Votre Majesté commence à comprendre, car elle sourit… Il est certain, sire, que la jeune duchesse aura avant peu besoin d’un défenseur… Il ne faudra pas qu’elle puisse être soupçonnée ! Il ne faudra pas qu’on puisse sourire quand elle passera… Et qui pourra renfoncer les calomnies dans la gorge des médisants, qui pourra faire se glacer les sourires sur les lèvres, sinon un homme à qui le titre d’époux en donnera le droit et qui appuiera ce titre par quelque bonne et solide épée ?
Le roi demeura pensif pendant quelques minutes.
– Tu as raison, dit-il enfin.
La Châtaigneraie tressaillit de joie.
– Que dois-je annoncer à mon ami ? demanda-t-il.
– Annonce-lui que le roi est content d’avoir un ami tel que lui et que son dévouement recevra une éclatante récompense. Maintenant, dis-moi, ton ami – s’appelle La Châtaigneraie ?
Le gentilhomme s’inclina profondément. Le roi lui frappa amicalement sur l’épaule :
– Dis-lui que je suis content de lui. Avant un mois, le titre de duc de Fontainebleau sera à lui…
La Châtaigneraie, pour cacher la joie, qui brilla dans ses yeux, s’inclina encore, se courba jusqu’à terre, pendant que le roi, avec un sourire de mépris, songeait :
– Ramasse !
La Châtaigneraie sortit de chez le roi rayonnant. Dans l’antichambre, il rencontra le capitaine des gardes Montgomery, qui lui prit le bras et lui dit :
– Je crois, cher ami, que nous avons à causer de choses très importantes et très pressées.
Montgomery avait, entre autres qualités, une science parfaite qu’il avait poussée aussi loin qu’il avait pu : la science d’écouter aux portes.
Il avait entendu l’entretien du roi et de La Châtaigneraie.
– De quoi s’agit-il ? demanda celui-ci.
– De votre mariage avec la duchesse de Fontainebleau, répondit avec impudence le capitaine des gardes.
La Châtaigneraie regarda Montgomery dans les yeux.
– Diable ! fit-il, vous êtes bien informé, mon cher, et je vous en fais compliment.
– Écoutez donc, on fait ce qu’on peut ; mon intérêt est de savoir ce qui se passe à la cour ; je tâche donc de le savoir de mon mieux.
– Oui, mais mon mariage avec la duchesse de Fontainebleau vient à peine d’être décidé, – et encore n’est-il pas sûr qu’il le soit.
– Allons causer plus loin, car il y a ici des oreilles indiscrètes… sans compter les miennes.
En effet, un gentilhomme de Mme Diane de Poitiers, Guy de Chabot de Jarnac, se promenait dans l’antichambre et paraissait assez curieux de savoir ce qui se disait entre La Châtaigneraie et Montgomery.
La Châtaigneraie réfléchit que le capitaine des gardes était en grande faveur. Il accepta donc le bras que lui offrait Montgomery, et ce fut ainsi, bras dessus bras dessous, qu’ils descendirent dans la cour d’honneur.
– Parlez, fit Montgomery.
– Vous disiez donc, cher ami, qu’il n’est pas tout à fait sûr que votre mariage avec la duchesse de Fontainebleau se fasse. Et vous aviez raison de le dire…
– Ah ! Ah !… Vous savez quelque chose, vous !… Il y a un obstacle, n’est-ce pas ?
– Vous rappelez-vous certain truand nommé Manfred ?
– Manfred ! fit La Châtaigneraie en pâlissant de fureur ; mais vous avez dit au roi que cet homme a quitté Fontainebleau !
– C’est la vérité… mais pensez-vous que cet homme renonce si facilement à la femme qu’il aime ?… Il me semble qu’il a donné déjà des preuves d’audace et de courage qui doivent vous le rendre redoutable.
– Tout cela n’est que trop vrai.
– Eh bien, voici où je voulais en venir. Je crois pouvoir vous affirmer que Manfred reviendra avant peu à Fontainebleau.
– Si seulement on savait où il se gîte !
– Voilà un point sur lequel je puis vous donner satisfaction. Connaissez-vous l’auberge du Grand-Charlemagne ?
– Rue aux Fagots ?
– C’est cela. Eh bien, allez au Grand-Charlemagne, mon cher, tâchez d’interroger habilement, de voir sans être vu, d’écouter enfin… et je crois que vous aurez rapidement des nouvelles de votre homme.
– Par le diable, Montgomery, vous êtes un véritable ami. Je hais cet homme plus que je ne saurais dire ; il m’a humilié deux fois, et si vraiment j’arrive à le tenir un jour au bout de mon épée, je vous en aurai une reconnaissance…
– Dont je compte bien user, mon cher… Je vous l’ai dit : nous avons besoin l’un de l’autre. Vous étiez trois auprès du roi. Il ne reste plus que vous et Essé. Sansac a disparu… Si je pouvais prendre sa place…
– Je comprends…
– Que faut-il pour cela ? Un mot dit adroitement et à propos…
– Comptez sur moi.
– Comme vous pouvez compter sur mon amitié.
Ils se serrèrent la main et se séparèrent.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
À quel mobile obéissait Montgomery en envoyant La Châtaigneraie à l’auberge du Grand-Charlemagne ? Simplement, il espérait que le spadassin qu’était La Châtaigneraie se rencontrerait avec Triboulet.
Or, si le gentilhomme en voulait fort au truand, il en voulait encore bien plus au bouffon. Il y avait entre eux une vieille inimitié, et Montgomery pensait que si La Châtaigneraie rencontrait Triboulet, il y avait des chances pour que celui-ci restât sur le carreau.
Le bouffon une fois tué, Montgomery se flattait d’obtenir facilement de la Châtaigneraie une discrétion absolue, en lui rendant quelque service important.
La Châtaigneraie, une fois seul, se dirigea séance tenante vers l’auberge du Grand-Charlemagne. Il entra dans l’auberge, s’assit à une table et commanda qu’on lui apportât du vin.
Mais il n’était pas plutôt assis qu’un gentilhomme entrait à son tour dans la salle et s’asseyait non loin de lui.
C’était Jarnac.
La Châtaigneraie fronça les sourcils. Il avait vu Jarnac le regarder avec impertinence dans l’antichambre royale.
Dans la cour d’honneur du château, Jarnac, descendu presque en même temps que lui, avait continué son manège.
Maintenant, il le suivait jusque dans cette auberge retirée…
L’intention de la provocation était évidente.
Cependant La Châtaigneraie se contint.
Mais, comme l’aubergiste remontait de sa cave avec la bouteille qu’avait demandée La Châtaigneraie, Jarnac se leva, saisit la bouteille des mains de l’aubergiste ébahi, et en brisa le goulot en disant :
– Apprends, manant, que lorsque je suis dans une taverne, c’est moi qu’on sert le premier… Va-t’en chercher d’autre vin pour monsieur, s’il en reste dans ta cave !
La Châtaigneraie se leva et marcha droit à Jarnac :
– C’est une querelle que monsieur est venu chercher ici ?
– Il paraît qu’il vous faut du temps pour comprendre, répondit Jarnac avec insolence.
– S’il me faut du temps pour comprendre, il m’en faudra peut-être moins pour vous mettre six pouces de fer dans le ventre !…
– Messieurs ! messieurs ! implora l’aubergiste.
– Tais-toi ivrogne ! fit Jarnac en écartant le pauvre diable d’un revers de main… Monsieur de La Châtaigneraie, ajouta-t-il en se mettant en garde, savez-vous où est en ce moment votre ami d’Essé ? Je vais vous le dire… Il est sur la pelouse du parc où je l’ai laissé pour mort, et comme vous iriez me dénoncer au roi, il faut que je vous tue, vous aussi…
– Misérable ! rugit La Châtaigneraie, si tu as tué d’Essé, tu ne vas pas tarder à l’aller rejoindre…
Tout en s’invectivant, les deux gentilshommes se portaient botte sur botte, et pour quiconque eût pu assister en impassible spectateur à ce duel, la scène eût été vraiment digne d’intérêt.
Pendant un long quart d’heure, les deux combattants ferraillèrent avec une égale ardeur, multipliant les coups compliqués de contres et de doublés.
Puis, d’un commun accord et sans qu’ils se le fussent dit, il y eut une trêve.
La Châtaigneraie surtout n’eût pas demandé mieux que d’en rester là.
Et peut-être allait-il faire une ouverture dans ce sens lorsque Jarnac se remit en garde, en disant :
– Quand vous voudrez…
La Châtaigneraie attaqua aussitôt et fondit sur son adversaire avec une fureur d’autant plus avivée qu’il avait été sur le point de capituler.
Jarnac ne rompit pas. Les deux épées se trouvèrent engagées jusqu’à la garde.
Tout à coup Jarnac se baissa avec une foudroyante rapidité. La Châtaigneraie crut qu’il le tenait et leva son épée pour le frapper de haut en bas.
Mais il n’eut pas le temps d’exécuter ce mouvement.
Il lâcha soudain l’arme et tomba comme une masse, en râlant et en rendant le sang par la bouche : Jarnac, en se baissant, avait tiré sa dague et en avait violemment frappé au ventre l’infortuné gentilhomme.
Jarnac le contempla un instant.
Puis il essuya tranquillement sa dague, rengaina son épée, et voyant dans un coin l’aubergiste blême de terreur, il alla à lui, le saisit par l’oreille et lui dit :
– Toi, si jamais tu dis un mot, je t’arrache les deux oreilles avant de t’éventrer à coups de dague.
Incapable de parler, l’aubergiste fit signe qu’il se tairait.
Sur ce, Jarnac sortit de l’auberge.
Jarnac ne fut pas plutôt sorti qu’un homme apparut par la porte vitrée et se pencha sur le blessé.
– Ne puis-je rien pour vous ? demanda-t-il.
La Châtaigneraie ouvrit les yeux.
Et une indéfinissable surprise se mêla sur son visage aux affres de la mort toute proche : il venait de reconnaître l’homme qui se penchait sur lui. C’était Triboulet.
– J’ai tout vu, reprit celui-ci. Vous vous êtes bravement battus tous deux, et j’ai vraiment regret que vous soyez en si triste état, bien que je n’aie pas toujours eu à me louer de votre amitié à mon égard. Si je puis vous être utile, disposez de moi, je vous prie, et oubliez que vous m’avez haï jadis.
La Châtaigneraie fit un effort pour parler.
Peut-être l’idée lui vint-elle de donner à son ancien ennemi une preuve de cette gratitude.
Car, rassemblant toutes ses forces, il essaya de prononcer une phrase. Mais le premier mot seul fut proféré :
– Gillette…
Au même moment, La Châtaigneraie se renversa, se raidit, un rauque soupir lui échappa, et ce fut tout…
Au nom de Gillette, Triboulet avait tressailli, s’était penché encore davantage, aspirant pour ainsi dire de ses yeux ardents la pensée du blessé.
Mais à l’instant où il espérait, avec un terrible battement de cœur, qu’il allait apprendre quelque nouvelle de sa fille, il s’aperçut qu’il ne tenait plus qu’un cadavre dans ses bras.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jarnac était rentré au château, et s’était rendu directement à l’appartement qu’occupait Diane de Poitiers.
Celle-ci l’interrogea du regard.
– C’est fait, répondit Jarnac.
– Vous êtes un héros… Racontez-moi cela…
– Oh ! ce fut bien simple. Je trouvai d’abord d’Essé et lui reprochai amèrement de porter un pourpoint cerise, en satin, alors que le mien est en velours noir. Il eut le mauvais goût de prendre mes reproches en mauvaise part, et trois minutes plus tard, par un contre de quarte suivi d’un coup droit en prime, je lui démontrai pour jamais qu’il avait eu tort de se fâcher. À l’heure qu’il est, le pauvret ne mettra plus de pourpoint cerise ou noir, velours ou satin.
Si impassible et si dure que fût en réalité Diane de Poitiers, elle ne put s’empêcher de frémir.
– Et l’autre ?…
– Pour La Châtaigneraie, continua alors Jarnac, la chose fut également expédiée au mieux, bien que l’adversaire fut plus sérieux. Je le trouvai dans une misérable taverne, et du diable si je sais ce qu’il y allait faire, car le vin y est détestable. Bref, je le trouvai là attablé, et comme l’aubergiste émettait l’exorbitante prétention de le servir avant moi, je me saisis de sa bouteille et j’en brisai le goulot. Ce pauvre La Châtaigneraie eut le tort de se fâcher, et je fus obligé de lui renfoncer sa colère dans le ventre, d’un bon coup de dague.
Diane de Poitiers demeura pensive.
– Vous êtes un terrible serviteur, dit-elle au bout de quelques instants de cette songerie spéciale qu’ont les criminels lorsqu’ils ont accompli l’acte irréparable.
Jarnac fixa froidement la maîtresse du dauphin Henri.
– Madame, dit-il, je ne vois pas trop ce qu’il y a de terrible en tout ceci. Convenons donc une bonne fois de nos pensées et de nos sentiments. Que suis-je, moi ? Un bras qui frappe, voilà tout. Mais vous, madame, vous êtes le cerveau qui médite et conçoit. Or, si la mort de La Châtaigneraie et de d’Essé sont choses terribles, cela ne me regarde pas, moi.
– Bien, bien, fit Diane de Poitiers en reprenant tout son sang-froid, je ne rejette pas ma part, croyez-le. J’ai mes nuits d’insomnie, comme vous avez peut-être les vôtres (Jarnac fit un signe de dénégation). Ce sera deux spectres de plus, voilà tout…
– Spectre de bas étage, ricana Jarnac ; simple canaille… tandis que le vrai spectre…
– Taisez-vous ! fit Diane de Poitiers, en regardant autour d’elle avec terreur.
– Le spectre royal, acheva Jarnac, eh bien, madame, quand voulez-vous qu’il vienne hanter vos nuits ?… Je suis pressé, moi ! Vous m’avez promis la connétablie lorsque vous serez reine. Mais pour que vous soyez reine, et pour que je sois, moi, connétable de France, il faut que le vieux roi s’en aille reposer ses os à Saint-Denis… Le terrain est déblayé, maintenant… Il n’y a plus qu’à donner le dernier coup.
– Je crois que vous avez raison… Il est temps d’agir.
– Si nous attendons que le roi revienne à Paris, tout est perdu, madame.
– Assez sur ce sujet, dit Diane de Poitiers d’une voix qui indiqua à son complice qu’elle venait de prendre une terrible résolution.
Jarnac comprit et s’inclina.
– Quand voulez-vous que nous prenions nos dernières dispositions ? murmura-t-il.
– Je vous préviendrai… En attendant, je puis vous dire l’endroit où la chose pourra avoir chance de se tenter avec succès…
Jarnac tendit avidement l’oreille.
– Je crois, acheva Diane de Poitiers, que vous ferez bien de surveiller de près le pavillon des gardes…
– Le pavillon des gardes !
– Oui, j’ai des raisons de penser qu’il ne tardera pas à y faire des visites nocturnes… et on pourrait profiter de l’une de ces visites…
– Il suffit, madame ! dit Jarnac en s’inclinant.
Puis il sortit.
Demeurée seule, Diane de Poitiers s’abîma dans une de ces rêveries sinistres où nous l’avons surprise déjà.
Au bout d’une heure de méditation, elle parut s’éveiller, se regarda dans un miroir, y étudia un instant le dessin d’un sourire, puis, appelant une de ses suivantes favorites, elle se rendit chez le dauphin Henri qu’elle trouva bâillant dans l’embrasure d’une fenêtre et tambourinant une marche sur un vitrail, tandis que sa femme, la jeune Catherine, entourée de toute une cour de dames et de gentilshommes, écoutait des ballades que le poète Clément Marot récitait de sa belle voix chaude.
À l’entrée de Diane de Poitiers, Catherine de Médicis prit son visage le plus riant, et d’un signe l’invita à s’asseoir près d’elle, honneur que Diane de Poitiers n’eût pu esquiver si le dauphin ne l’eût aperçue à ce moment et ne se fût écrié :
– Voici mon Égérie !… Venez ça, madame, que je vous dise combien je m’ennuie.
Et, sans plus faire attention ni à sa femme ni à Marot, ni au reste de cette brillante société, le dauphin avait saisi la main de Diane, et l’avait fait asseoir près de lui, assez loin du groupe formé par la cour de poésie que tenait Catherine.
– Vous vous ennuyez, Henri, dit Diane de Poitiers à voix basse ; j’en avais le pressentiment… car je suis accourue après un rêve que je viens de faire…
– Un rêve ? Racontez-le moi. J’adore les rêves, moi.
– Je vous voyais triste… mais d’une mortelle tristesse…
– Cela est assez mon air habituel.
– Oui, mais dans mon rêve, vous aviez un sujet réel d’être si triste.
– Voyons donc le rêve.
– Eh bien, je me promenais dans le parc ; il faisait nuit ; j’étais seule ; j’allais, me semblait-il, à un rendez-vous que vous m’aviez donné…
– Chère Diane !
– Tout à coup, cette idée de rendez-vous se précisa dans mon rêve. Il me parut que j’étais fort en retard, et je fis un effort pour me hâter vers le lieu du rendez-vous qui était, s’il m’en souvient bien, le pavillon des gardes… Mais plus je voulais me hâter, plus je me sentais comme paralysée…
– C’est l’effet ordinaire des cauchemars.
– Oui, mais voici où mon rêve se complique. Ne pouvant courir vers le pavillon des gardes, je vous appelai d’un grand cri, et je vous vis alors sortant d’entre les arbres, mais pâle et défait et sanglotant… Et passant près de moi, vous me dites : « Un grand malheur est arrivé, mon père est mort ! »
– Ah ! ah ! fit le dauphin en considérant sa maîtresse avec plus d’attention.
– À ce moment, poursuivit Diane de Poitiers, je vis venir plusieurs hommes portant un brancard sur lequel était couché le roi. Il avait à la poitrine une affreuse blessure par où tout son sang s’était échappé. Et l’un des hommes me parla comme vous m’aviez parlé, et me dit : « C’est un grand malheur ; on vient de tuer le roi ! »
– Ainsi, non seulement le roi était mort, mais il était mort assassiné ? demanda froidement le dauphin.
– Oui, Henri. Et je songeais dans mon rêve que vous étiez roi de France !
Le dauphin tressaillit.
– Mais, acheva Diane, je vous voyais si triste de cet accident, que je n’arrivais pas à me réjouir de votre élévation au trône… J’entendis crier autour de vous : « Vive le roi Henri ! » et c’est à ce moment que je me suis réveillée…
– C’est, en effet, un rêve bien étrange… On dit que les rêves précèdent parfois la vérité de bien près…
Diane de Poitiers garda le silence et prit un air songeur.
– Si le vôtre devait se réaliser bientôt, reprit Henri, ce serait certes un bien grand malheur… Mais que pouvons-nous contre les décrets du ciel ? Si Dieu m’appelait demain à monter sur le trône de France, je crois que je ferais de grandes choses. Je restaurerais la chevalerie qui s’en va… Je voudrais, par des tournois, me préparer à de grandes guerres où j’irais, secourant les peuples faibles contre les peuples forts… Oui, Diane, vous savez si je ronge mon frein et si je me morfonds dans l’inaction… Car mon père, jusqu’ici, m’a tenu à l’écart de son gouvernement. Ne croyez pas, au moins, que je souhaite la mort du roi… Dieu veuille au contraire prolonger ses jours aux dépens des miens, s’il le faut.
– Moi aussi, je souhaite, de tout mon cœur que mon rêve ne se réalise pas. Moi aussi, je suis prête à donner ma vie pour sauver celle du roi… Mais enfin, si le malheur se produisait… vous seriez roi, Henri !
– Roi ! c’est-à-dire le premier parmi les chevaliers français…
Le dauphin allait peut-être s’exprimer avec plus de précision ; mais il s’arrêta à temps.
Diane avait d’ailleurs touché le fond de sa pensée.
Elle savait que cette idée qu’il pourrait bientôt être roi par suite d’un « accident » survenu à François Ier allait germer dans son faible cerveau et y donner les fruits empoisonnés dont elle venait de jeter la semence.
Elle se leva et, sans affectation, alla se mêler au groupe qui entourait Catherine de Médicis.
– Qu’avez-vous donc comploté avec mon époux ? lui demanda celle-ci avec son plus charmant sourire.
– Monseigneur le dauphin m’a confié que s’il n’avait le bonheur de vous avoir près de lui, il serait mort d’ennui depuis longtemps, répondit Diane.
XXXIV
LA CHAMBRE VIDE.
C’était la duchesse d’Étampes qui avait voulu installer elle-même Gillette et Margentine dans leur nouveau logis.
Leur appartement comprenait quatre pièces sur les cinq du rez-de-chaussée.
La porte de l’escalier conduisant aux étages supérieurs avait été condamnée.
Deux chambres – une pour Margentine, une pour Gillette – se touchaient.
Une troisième devait servir de parloir ou salon. La quatrième était une salle à manger avec un âtre pour faire la cuisine.
Quant aux deux pièces du rez-de-chaussée qui n’avaient pas été aménagées, Margentine les visita aussi.
Dans la dernière, il y avait une porte.
– C’est la porte des caves, expliqua la duchesse ; mais on n’y descend plus depuis bien longtemps…
La duchesse ajouta :
– La servante qui vous sera attachée fera son affaire de la cuisine.
– Il n’est pas besoin de servante, dit Margentine.
– Qui donc s’occupera des soins de votre appartement ?
– Moi, dit Margentine ; je puis bien servir ma fille et moi-même, et je veux que nul n’entre ici.
– Sans doute, sans doute ! fit la duchesse qui, une heure plus tard, alla trouver le roi et lui dit :
– Elles sont dans le pavillon, et je me suis arrangée pour qu’il n’y ait même pas de servante chez elles. Les volets de la fenêtre de gauche sont disjoints… on peut facilement entrer par là, et on se trouve alors dans une pièce où il y a deux portes… L’une, celle qui est à gauche de la fenêtre, donne sur les caves ; mais l’autre, celle qui est en face de la fenêtre, donne sur la chambre occupée par la mère.
Cette première soirée fut un véritable enchantement pour Gillette et Margentine. Avec un peu d’imagination, elles pouvaient se croire libres en quelque maison de campagne isolée au fond des bois.
Margentine avait fermé porte et fenêtres.
Elle se sentait en parfaite sûreté.
Gillette prit le rouet.
Et Margentine la regarda faire avec une admiration extasiée.
– Comme tu as de jolies mains, dit-elle… Tes doigts sont fins et fuselés comme des doigts de princesse…
Gillette sourit.
– Quand je pense, reprit la mère, que j’ai pu vivre si longtemps sans toi ! Je crois bien que je mourrais sur le coup si on nous arrachait maintenant l’une à l’autre…
– Chère mère ! Ne pensons pas à des choses aussi cruelles… Pensons plutôt à préparer notre évasion d’ici… car nous sommes de vraies prisonnières.
– Il n’est que trop vrai… Écoute, dès demain, si je puis marcher, je sortirai…
– Oh ! non, pas dès demain, mère ! Il vous faut encore plusieurs jours de repos…
– Je crois que je pourrai dès demain. Je ne suis pas très forte, mais je suis habituée à la dure… J’étudierai les environs et…
– Écoutez donc, mère ! fit tout à coup Gillette à voix basse. N’avez-vous rien entendu ?… Là… dans cette pièce…
Margentine vit Gillette toute pâle.
– Je n’ai rien entendu, dit-elle. Rassure-toi, mon enfant… Je suis là !
– Oui, mère ! Et pourtant… Oh ! tenez ! sûrement on vient de marcher… là !
Cette fois, Margentine avait entendu elle aussi !
– Attends ici, dit-elle, en s’élançant vers la chambre où le bruit s’était produit.
Elle en ouvrit brusquement la porte et entra, un flambeau à la main. Un rapide regard la convainquit que cette pièce était vide.
Margentine pénétra alors dans la dernière pièce.
Elle était vide également.
Elle essaya d’ouvrir la porté de la cave, mais cette porte résista, et, à la poussière qui couvrait ses jointures, il était visible qu’elle n’avait pas été ouverte depuis longtemps. Quant à l’escalier qui conduisait à l’étage du haut, il était bouché.
– Nous nous sommes trompées, dit Margentine en revenant auprès de Gillette. Le vent aura secoué un volet…
La nuit se passa tranquillement, et, pendant la journée du lendemain, rien ne vint éveiller les soupçons des deux femmes.
À l’heure du dîner du soir, Margentine, comme la veille, ferma soigneusement la porte et enchaîna les volets des fenêtres. Au dehors, la nuit était noire.
Gaîment, elles se mirent à table.
Margentine était assise le dos tourné à la porte de la chambre vide… Face à elle, Gillette était donc tournée vers cette porte.
Les deux femmes se mirent à causer, comme la veille, de Manfred, de Triboulet et de la possibilité de les rejoindre. Tout à coup, comme la veille, Gillette tressaillit.
– Je vous assure, mère, dit-elle à voix basse, qu’on vient de marcher dans cette chambre…
– Petite peureuse ! répondit Margentine, convaincue qu’il ne pouvait y avoir personne qu’elles dans le pavillon. Rassure-toi donc, puisque je suis là !
Mais elle n’avait pas fini de parler que Gillette jeta un cri, se leva toute droite, blanche de terreur, et de son bras tremblant montra à sa mère la porte de la chambre.
Margentine se retourna, et elle aussi se leva, saisissant un couteau sur la table.
La porte venait de s’ouvrir.
Et une forme noire apparaissait, arrêtée dans l’encadrement. C’était une femme.
– Qui êtes-vous ? interrogea Margentine d’une voix ferme. Hâtez-vous de répondre… sinon, malheur à vous !
– Je ne suis pas une ennemie, répondit la dame en noir ; je suis, comme vous, une malheureuse qui a beaucoup souffert du fait de ceux qui vous font souffrir, Voulez-vous que nous causions ? Je vous jure qu’il n’en résultera aucun mal pour vous.
Margentine, cependant, gardait tout son sang-froid.
– Madame, dit-elle, je veux croire que vous ne nous voulez aucun mal ; mais, avant tout, expliquez-nous par où vous êtes entrée dans ce pavillon.
– Je n’y suis pas entrée, dit la dame en noir.
Et elle se hâta d’ajouter :
– Ne donnez à ces paroles aucun sens étrange ; elles signifient simplement que j’étais dans le pavillon avant vous.
– Où cela ?
– Dans les caves. Vous avez en vain essayé hier d’en ouvrir la porte, c’est que je l’avais fermée en dedans au moment ou Mlle Gillette a deviné ma présence. Dès hier, je voulais vous parler… je n’ai pas osé… Aujourd’hui il le fallait de toute nécessité, et pour diverses raisons dont la plus pressante est que, grâce à vous, je suis menacée de mourir de faim…
Elle prononça ces paroles avec une gaieté un peu fiévreuse. Puis s’adressant à Gillette :
– Voyons, mademoiselle, ne me reconnaissez-vous pas ? Rappelez-vous la maison de l’enclos des Tuileries… Rappelez-vous le soir où cette maison fut envahie par les gens du roi… C’est moi qui vous cachai, c’est moi qui vous conduisis rue Saint-Denis, vous, le chevalier de Ragastens et la princesse Béatrix.
– Oh ! je vous reconnais maintenant ! s’écria Gillette… Mère… sûrement, madame n’est pas une ennemie pour nous… Elle m’a sauvée.
Margentine s’avança vers Madeleine Ferron, que nos lecteurs ont certainement reconnue. Elle lui prit la main.
– Soyez bénie, madame, dit-elle d’une voix émue ; non seulement vous n’êtes pas une ennemie, mais vous êtes pour moi une amie bien chère, vous qui avez sauvé ma fille… Pardonnez-moi de vous avoir tout à l’heure menacée… Soyez la bienvenue… prenez place à notre table…
Déjà Gillette avait préparé une place pour la dame en noir qui s’assit et s’écria gaiement :
– Là ! le plus difficile est fait. Je redoutais fort de me présenter à vous, et je ne savais trop comment m’y prendre, car je craignais de vous épouvanter… Il l’a fallu cependant… Je n’avais plus de vivres et on ne pouvait plus m’en apporter… votre installation ici a contrarié bien des projets…
Le dîner terminé, Madeleine se leva et dit :
– Je veux d’abord vous montrer mon appartement. Ensuite, je répondrai aux interrogations que vous avez la politesse de ne pas m’adresser, mais que je devine dans vos regards. Venez…
Margentine et Gillette suivirent sans crainte la dame en noir. Avec elle, elles descendirent dans la cave, et elle leur montra le réduit où elle s’était installée.
– Mais c’est affreusement humide ici ! s’écria Gillette.
– En effet, dit simplement Madeleine.
Margentine remarqua alors que l’étrange femme toussait par moments d’une toux sèche, que ses yeux brillaient d’un éclat fiévreux, et que ses pommettes étaient très rouges.
– Il ne faut pas rester ici ! dit-elle, émue de pitié. Vous allez vous installer avec nous, là-haut… Et je vous soignerai, moi… Vous avez bien sauvé ma fille…
– Croyez-vous donc que je tienne beaucoup à la vie ?
Cette question, le ton dont elle fut faite frappèrent Margentine et Gillette.
– Si vous devez rester dans ce pavillon, s’écria celle-ci, je ne supporterai pas que vous habitiez cette cave… Pauvre femme ! Si vous saviez comme je vous plains… Et pourtant je ne connais pas vos tourments… mais là-bas, aux Tuileries, j’ai déjà eu cette sensation que vous étiez bien à plaindre…
– Et moi, dit sourdement Madeleine, j’ai eu dès lors cette impression que vous étiez un ange…
Puis, comme si elle eût craint de s’abandonner à l’émotion :
– Remontons ! dit-elle brusquement.
– Pas avant que vous n’ayez promis de venir habiter là-haut avec nous, dit fermement Gillette.
– Vous le voulez ? Eh bien, soit !
En elle-même, Madeleine ajouta :
– Au fait, cela vaudra peut-être mieux ainsi…
Lorsqu’elles furent remontées, Madeleine poursuivit :
– Voilà trois jours que j’habite cette cave. J’ai pu m’introduire à grand’peine dans le parc, et gagner ce pavillon, grâce à la complicité d’un domestique du château dont je me suis assuré le dévouement en le payant très cher. Car tout se paie, – surtout le dévouement !
Gillette écoutait avec une surprise mêlée d’effroi, cette femme qui parlait simplement des choses audacieuses qu’elle avait accomplies.
– Cet homme, continua Madeleine Ferron, devait tous les soirs m’apporter les vivres de chaque lendemain. Il a dû être bien étonné hier de ne pouvoir entrer, puisque vous aviez fermé la porte. Quant à moi, jugez des heures d’angoisse que j’ai passées dans ma cave lorsque j’ai entendu des allées et venues dans le pavillon… Enfin, je suis montée en haut de l’escalier, j’ai écouté et j’ai compris qu’on remettait le pavillon en état pour deux personnes qui allaient l’habiter par ordre du roi. Quelles pouvaient être ces deux personnes ? Comment ferais-je pour sortir ? Est-ce que je m’étais moi-même prise à mon piège ? Voilà les questions qui me tourmentaient… Mais hier, j’ai pu écouter votre entretien et j’ai été rassurée… Voilà mon histoire…
Il y eut quelques minutes de silence pénible au bout desquelles Madeleine reprit :
– Maintenant, vous vous demandez sans doute pourquoi je me suis introduite secrètement dans le parc, pourquoi je me cache dans ce pavillon, enfin qui je suis et ce que je viens faire au château de Fontainebleau ?
Appuyée contre sa mère, Gillette écoutait avec terreur et pitié. Pour Margentine, c’était l’étonnement qui la dominait.
– Écoutez, continua Madeleine Ferron, mon cœur est si gonflé d’amertume qu’il en éclate. J’ai si longtemps souffert en silence que le silence m’est devenu odieux, intolérable…
– Nous vous consolerons, dit doucement Gillette.
– Il n’est pas de consolation pour moi, répondit Madeleine en secouant la tête. Je suis perdue, je suis damnée… Corps et âme, tout en moi souffre les dernières convulsions d’une abominable agonie…
– Espérez ! espérez dit Gillette.
Et, entourant de ses bras le cou de Madeleine, elle voulut l’embrasser.
Mais Madeleine se leva, la repoussa presque avec violence, et devint toute pâle…
– Malheureuse enfant, dit-elle d’une voix sombre à Gillette interdite et tremblante, qu’alliez-vous faire ! Ne savez-vous pas qu’à me toucher on peut gagner la mort !
Margentine poussa un cri, saisit sa fille et la serra contre elle…
– Ne craigniez rien, reprit Madeleine en passant sa main sur son front couvert de sueur. Il suffit que vous me touchiez le moins possible… Où en étais-je ? Ah ! oui, je voulais vous, expliquer ce que je suis venue faire au château de Fontainebleau…
Elle garda un long silence, comme si maintenant elle eût hésité à parler.
– Écoutez, reprit-elle tout à coup, vous haïssez le roi de France, n’est-ce pas ?
– Je le redoute, voilà tout ! fit Gillette en frémissant.
– Et moi, je le hais, ajouta Margentine.
– Voilà par où nos destinées se touchent : nous avons un ennemi commun ; vous, vous ne cherchez qu’à vous défendre ; moi, je songe à l’attaquer… Pourquoi je hais le roi de France ? Sachez seulement qu’il m’a infligé la plus cruelle torture que puisse souffrir un cœur de femme, l’insulte la plus odieuse dont on puisse frapper Un esprit fier… J’ai résolu de me venger. Je le suis déjà. Je suis venue ici pour assister à ma vengeance. J’ai suivi le roi en son château pour le voir mourir.
– Le roi va donc mourir ?…
– Oui ! dit tranquillement Madeleine. Il est plus sûrement condamné que la malheureuse sur qui le bourreau porte la main, alors qu’il n’est plus de grâce possible et que la corde se balance au-dessus de la tête de l’infortunée…
Madeleine parlait avec une telle âpreté que Margentine et Gillette ne purent s’empêcher de frémir.
Comment savait-elle que le roi devait mourir ?
Elles n’osèrent pas le lui demander.
Et elles la contemplèrent avec une curiosité mêlée de pitié et d’effroi. Madeleine reprit :
– Maintenant, il faut que je sache certaines choses… Et d’abord, que s’est-il passé depuis l’aventure de la grotte de l’Ermite ? Je vous vois étonnée, mon enfant, de m’entendre parler de cet incident comme si je le connaissais parfaitement… Je le connais, puisque c’est moi qui ai conduit pour ainsi dire la duchesse d’Étampes à la grotte…
– Vous m’avez donc sauvée une deuxième fois ! Eh bien, depuis ce moment, il s’est passé pour moi un événement qui est le plus merveilleux de ma vie, j’ai retrouvé ma mère !…
Madeleine regarda attentivement Margentine.
– Vous voulez savoir comment ?… dit celle-ci.
– Oui… si cela ne vous ennuie pas…
– C’est la duchesse d’Étampes qui est venue me prévenir à Paris que ma fille se trouvait ici.
– Je comprends, je comprends… Maintenant, comment vous êtes-vous transportées dans ce pavillon ? Est-ce vous qui l’avez demandé au roi ? Est-ce lui, au contraire, qui vous y a obligées ?…
– Ni l’un ni l’autre. La duchesse d’Étampes nous a proposé de nous installer ici, et nous avons accepté, pensant que nous pourrions peut-être mieux nous défendre et préparer notre évasion.
– Ah ! c’est la duchesse d’Étampes, dit Madeleine. Et elle murmura :
– Cette fois, je ne comprends plus… à moins que… oui… tout est possible dans cette cour gangrenée, pourrie jusqu’à la moelle…
Elle reprit à haute voix :
– Écoutez, je vais réfléchir à notre situation. Quant à vous faire sortir d’ici, je vais l’essayer…
Gillette poussa un cri de joie.
– Oh ! ce sera difficile… mais non impossible. En attendant, veillez, soyez vigilantes, tenez-vous sur vos gardes nuit et jour…
Madeleine se leva.
– Voyons la porte, dit-elle.
Elle alla la visiter, la secoua, s’assura que les vis de la serrure tenaient bien, que la barre de fer qu’on mettait en travers n’était pas limée, que les crampons étaient solides.
– Tout va bien de ce côté ; ce n’est pas par là que viendra l’attaque.
Elle fit là même visite à toutes les fenêtres.
Ayant constaté que les volets en étaient également solides, elle demeura quelques minutes pensive. Tout à coup, elle eut un sourire ironique.
– J’ai trouvé, murmura-t-elle.
Et tout haut :
– Tenez, dit-elle, je crois que vous avez raison. Je ne puis demeurer dans cette cave où je toussais, où je souffrais inutilement. Et puisque vous le permettez, je vais m’installer près de vous, dans la chambre vide… Mademoiselle Gillette va se coucher et dormir bien tranquille. Je lui réponds qu’il n’arrivera rien cette nuit au moins. Quant à vous, madame, nous avons à causer… voulez-vous ?
– Mais, s’écria Gillette, comment allez-vous dormir vous-même ?… Oh ! ce canapé !
– Il fera admirablement mon affaire, dit Madeleine. Dans la chambre de Gillette, il y avait en effet un excellent canapé large et profond, sur lequel une personne pouvait dormir aussi bien que dans son lit.
– Voilà un canapé qui sera mieux dans la chambre vide que dans la chambre de cette enfant ! songea étrangement Madeleine.
À elles trois, elles le poussèrent dans la pièce voisine, celle qui attenait à la salle à manger.
Puis, Gillette, rêveuse, se retira dans sa chambre.
Margentine et Madeleine demeurèrent seules dans la salle à manger. Alors Madeleine alla examiner la porte qui séparait cette salle de la chambre vide.
La porte ne fermait qu’au loquet.
– Avez-vous remarqué ce détail ? demanda Madeleine.
– Non, car je m’étais assurée qu’il est impossible d’ouvrir la fenêtre de la chambre, et qu’on ne peut entrer que par là.
Les volets paraissaient tenir solidement, et en les secouant par le milieu, il semblait impossible d’ouvrir la fenêtre. Madeleine examina alors les gonds.
Avec un clou, elle gratta la pierre autour de ces gonds.
– Voyez ! dit-elle à Margentine.
– Oh ! les misérables !
Sous l’action du clou, la pierre s’effritait comme du plâtre. C’était du plâtre, en effet. On avait descellé les crampons des gonds, et on avait simplement bouché au plâtre les trous qu’on avait dissimulés ensuite en enduisant le plâtre de poussière.
– C’est par là que le larron devait entrer. Je vois la scène comme si j’y assistais. Il arrive par ce côté du parc, escorté de deux ou trois de ses séides ; en quelques minutes ils disloquent les gonds, retirent les volets et entrent. Alors, pendant que ses acolytes se jettent sur vous et vous tuent, au besoin, lui court à la chambre de Gillette… Demain matin, je reboucherai le trou que je viens de faire pour qu’on ne se doute pas que vous savez maintenant la vérité.
– Que faire ? Que faire ? Oh ! je ne dormirai plus ! Je veillerai devant la porte de ma fille ! Fussent-ils vingt ! Ils ne savent pas ce que c’est qu’une mère !…
– Ne craignez rien ! dit Madeleine.
– Comment ! que dites-vous là ?
– Je vous dis de ne plus rien craindre, car je suis là ! Je vous jure que l’infâme reculera devant moi plus facilement que devant un poignard.
– Je ne comprends pas…
– Ne vous inquiétez pas de cela. Rassurez-vous seulement, et dormez bien tranquille dans votre lit : le larron n’entrera pas… Cependant, pour plus de précautions, vous pourrez barricader la porte de séparation…
– Non ! non ! je ne ferai pas cela ! s’écria Margentine. Je veux être prête à vous porter secours… Oh ! vous prendriez donc tout le danger pour vous…
– Eh bien, soit ! dit Madeleine avec un sourire ému. À nous deux nous serons plus fortes pour défendre l’enfant…
Elles revinrent alors dans la salle à manger, et s’assirent, gardant le silence.
Chacune d’elles lisait dans les regards de l’autre la question qui était dans sa pensée.
Ce fut Madeleine Ferron qui osa.
– Ainsi, dit-elle, le roi sait, que Gillette est sa fille, et pourtant…
– Oui !
– C’est à confondre l’imagination… c’est à croire que l’infâme est atteint d’une sorte de folie qui l’empêche de ne plus rien reconnaître, lorsque sa passion se déchaîne…
– Vous le haïssez bien ?…
– Comme vous !
– Mais moi, dit Margentine, d’une voix sombre, j’ai des raisons…
– Je vais vous les dire : il vous est apparu un jour, au printemps de votre vie, alors que votre cœur s’ouvrait aux premières aspirations de l’amour… Alors, il vous a juré qu’il vous aimait et qu’il vous donnait sa vie…
– Oui, oui !… Oh ! comment savez-vous…
– Hélas !… Et alors, sous le feu de cette ardeur, sous ces regards brûlants et désespérés, peut-être devant la menace de se tuer, vous avez cédé, vous avez aimé, vous avez adoré avec passion l’homme qui dès l’instant où vous lui aviez appartenu, ne songeait plus qu’à la bonne plaisanterie qu’il pourrait vous faire, en vous abandonnant ! Est-ce bien cela ?…
– Mot pour mot ! s’écria Margentine, palpitante.
– Je reconstitue facilement votre histoire parce que c’est celle de beaucoup de malheureuses que cet homme a poussées au désespoir…
Margentine la regardait, tourmentée par le besoin de lui poser une question qu’elle n’osait formuler…
Enfin, se décidant :
– Cette histoire, fit-elle en hésitant, peut-être est-ce aussi la vôtre ?…
– Oui ! dit nettement Madeleine.
Madeleine reprit :
– Oui, c’est mon histoire, et comme toutes les histoires d’amour se terminent gaiement avec le roi, voici ce qu’il a imaginé pour égayer la mienne : il a remis à mon mari la clef de la maison où nous devions nous voir un soir et lui a indiqué l’heure du rendez-vous !…
– Horreur !
– Mon mari vint ! continua Madeleine en éclatant d’un rire nerveux, mais il se fit accompagner par le bourreau. Et si mes ossements ne reposent pas en ce moment dans le charnier de Montfaucon, c’est grâce à un hasard qui tient du miracle.
– Horreur ! répéta Margentine.
– Et vous ?… Qu’a-t-il imaginé pour vous quitter ?
– Ce fut atroce, murmura Margentine d’une voix sourde. Le soir où ma fille vint au monde… le soir où, presque mourante, j’agonisais sur ma couche, lui, dans une pièce voisine, se livrait à l’orgie… j’entends sa voix… je pus me lever… et lorsque j’ouvris la porte de la salle du festin, je le vis qui levait son verre en riant et qui embrassait une femme assise sur ses genoux…
– Oui, fit lentement Madeleine, ce n’est pas mal imaginé… Je le reconnais bien à ce coup.
Enfin Madeleine Ferron se leva et souhaita le bonsoir à Margentine.
– Dormez sans crainte, acheva-t-elle.
Alors elle se retira dans la chambre du canapé, tandis que Margentine passait dans la sienne.
Madeleine Ferron, cependant, descendit dans la cave.
Sur ses ordres, le valet du château, qu’elle avait soudoyé à prix d’or, avait placé dans cette cave tous les objets dont elle avait prévu qu’elle pourrait se servir.
C’est ainsi que, sur la petite table, il y avait des feuilles de papier, de l’encre, des plumes. Sur l’une de ces feuilles, Madeleine écrivit quelques mots, puis plia et cacheta.
Puis elle écrivit l’adresse suivante :
– Monsieur le chevalier de Ragastens, à l’auberge du Grand-Charlemagne.
Alors elle remonta et, entr’ouvrant doucement la fenêtre, examina les environs. Mais la nuit était trop profonde. À deux pas, on n’y voyait rien.
– Comment faire ?… murmura-t-elle.
Elle avait espéré que le domestique reviendrait errer autour du pavillon. Mais sans doute cet homme avait pris peur et il était peu probable qu’il se montrât.
– Il faut pourtant que cette lettre arrive ! songeait Madeleine.
Elle referma la fenêtre et entra dans la chambre de Margentine.
– Écoutez, dit-elle, pouvez-vous pendant une heure veiller seule ?
– Toute la nuit s’il le faut.
– Bien. Pendant mon absence, installez-vous donc dans ma chambre, près de la fenêtre. Si on vient, il suffira je pense, que vous fassiez du bruit, et au besoin que vous profériez quelque menace. Car je suis sûre que le larron compte vous surprendre pendant votre sommeil…
– Vous allez donc vous absenter ?
– Oui. Il faut que quelqu’un soit prévenu de ce qui se passe ici… quelqu’un qui peut vous être d’un grand secours…
– Allez donc ! et puissiez-vous réussir !…
Madeleine, alors, redescendit dans la cave, et, en quelques instants, se dépouillant de ses vêtements de femme, s’habilla en cavalier.
– Lorsque je reviendrai, dit-elle à Margentine, je frapperai trois coups espacés, sur le volet et je prononcerai votre nom et le mien à voix basse…
– Votre nom ! fit doucement Margentine ; vous ne me l’avez pas encore dit…
– Je m’appelle Madeleine…
– Madeleine… un nom que je n’oublierai jamais !
Madeleine déjà avait ouvert la fenêtre, scruté les alentours d’un coup d’œil perçant, puis elle avait légèrement sauté à terre et avait disparu dans l’ombre.
Margentine referma la fenêtre et attendit…
Madeleine Ferron s’était enfoncée dans un bouquet d’arbres.
Elle se dirigeait droit vers la petite porte dérobée par où elle était sortie une fois pour aller retrouver la chasse du roi.
Le jour, il n’y avait pas de factionnaire devant cette porte. En serait-il de même la nuit ?
Madeleine marchait rapidement. Tout à coup, il lui sembla entendre des pas derrière elle.
Elle se jeta brusquement derrière le tronc noueux d’un hêtre séculaire et attendit.
Deux secondes plus tard, une ombre se dressa près d’elle.
L’ombre paraissait hésiter, l’ayant perdue de vue.
À un moment, l’inconnu qui, de toute évidence, la cherchait, passa si près d’elle qu’il la toucha. Madeleine tressaillit. L’inconnu bondit…
Madeleine vit briller dans la nuit l’éclair d’un poignard… Elle se baissa vivement…
Le poignard s’enfonça profondément dans le tronc du hêtre.
– Malédiction ! gronda l’inconnu, qui en même temps mit l’épée à la main.
Prompte comme la foudre, Madeleine avait également tiré la sienne.
Elle ne disait pas un mot.
L’inconnu, de son côté, se taisait.
Soudain, les épées se touchèrent.
Madeleine, sans un battement de cœur, le front plissé dans l’effort violent qu’elle faisait pour distinguer son adversaire, para le coup qui lui était porté.
Au même instant, elle riposta au jugé par un coup droit… Le coup porta…
Elle sentit la lame pénétrer dans de l’étoffe, dans de la chair…
– Vous êtes touché ! ne put-elle s’empêcher de dire.
– Ce n’est pas lui ! répondit l’inconnu qui, aussitôt, bien que grièvement blessé selon toute probabilité, s’éloigna rapidement et s’effaça dans les ténèbres.
Alors seulement Madeleine sentit son cœur battre à grands coups.
Qui pouvait être cet homme ? À qui en voulait-il ?…
Sûrement, ce n’était pas à elle, d’après les paroles qu’avait prononcées cet homme.
Et l’idée que l’incident se rattachait à la situation de Gillette se présenta irrésistiblement à son cerveau.
Elle secoua la tête, comme pour se dire :
– Je verrai bien !
Puis elle se remit en route.
Un quart d’heure plus tard, elle arrivait à la petite porte dérobée. Elle s’était arrêtée derrière un massif d’arbustes d’où elle pouvait facilement inspecter le mur d’enceinte du parc.
Le long de ce mur se mouvaient lentement des ombres.
C’étaient des sentinelles. Madeleine eut une minute d’angoisse à la pensée qu’elle ne pourrait pas sortir.
Mais bientôt elle eut remarqué que la sentinelle placée devant la porte se promenait avec lenteur ; elle faisait une vingtaine de pas à droite de la porte, puis, revenant, parcourait à peu près le même espace sur la gauche.
En sorte qu’elle restait près d’une demi-minute le dos tourné à la porte.
Madeleine possédait une clef de la petite porte.
Elle lui avait été donnée par l’homme qui l’avait introduite dans le parc et de là dans le pavillon des gardes.
La manœuvre que médita Madeleine à ce moment était périlleuse. Mais elle était résolue à tout tenter pour arracher Gillette à François Ier. Et peut-être, dans cette résolution y avait-il encore un reste de jalousie amoureuse.
Le massif derrière lequel elle s’abritait se trouvait à cinq ou six pas de la porte. Elle attendit que la sentinelle fût passée devant cette porte et commença à s’éloigner en sa promenade somnolente.
Alors Madeleine s’avança vers la porte.
Elle n’y courut pas : elle y alla doucement, si doucement qu’il était difficile d’entendre le bruit de son pas léger.
Madeleine tenait à la main une courte dague, résolue à frapper s’il le fallait.
Elle avait atteint la porte et l’avait ouverte avant que le soldat se fût retourné.
Elle se glissa au dehors et referma sans bruit.
XXXV
DISPOSITIF DE COMBAT.
À ce moment, il était environ onze heures.
Madeleine Ferron se mit à marcher rapidement en longeant le mur du parc. Son idée était d’aller jusqu’à l’auberge du Grand-Charlemagne et de voir le chevalier de Ragastens.
La lettre qu’elle avait écrite devenait alors inutile. Elle voulut la déchirer pour en jeter les morceaux le long du chemin. Mais elle la chercha vainement : la lettre avait dû tomber pendant ce court duel avec l’inconnu qui l’avait attaquée.
Madeleine ne put retenir un blasphème.
Tout à coup, il lui sembla qu’à dix pas devant elle des ombres cherchaient à se dissimuler le long du mur d’enceinte.
S’étant arrêtée un instant, elle s’avança, intrépide.
L’instant d’après, elle reconnut que trois ou quatre hommes s’adossaient au mur, comme s’ils eussent espéré ne pas être vus.
Elle passa sans qu’on lui eût dit un mot.
– Sans doute des maraudeurs, songea-t-elle.
Mais, au même instant, elle pensa que des maraudeurs l’eussent attaquée ; une idée soudaine éclaira son cerveau, et elle revint brusquement sur ses pas.
Les inconnus étaient encore là, attendant sans doute qu’elle se fût éloignée.
En arrivant à leur hauteur, Madeleine, comme si elle se fût parlé à elle-même, se mit à dire :
– Il est décidément trop tard, je préviendrai demain M. de Ragastens.
Comme elle l’avait prévu, ou espéré, un mouvement se fit parmi ces hommes qui, après quelques mots changés à voix basse, s’élancèrent et l’entourèrent.
– N’ayez pas peur, monsieur, dit l’un deux… mais nous vous avons entendu prononcer un nom…
– Le vôtre, Monsieur le chevalier de Ragastens, dit Madeleine Ferron.
C’était en effet le chevalier.
Il reconnut à la voix Madeleine Ferron.
– C’est notre bonne protectrice ! s’écria-t-il. Vous me cherchiez donc, madame ?
– Oui… nous avons à causer, mais pas ici…
– Retournons à l’auberge, dit Ragastens.
– Ce sera encore un jour de perdu ! prononça une voix jeune dont l’accent fit tressaillir Madeleine, qui répondit :
– Un jour de perdu pour retrouver Gillette, n’est-ce pas, monsieur ? C’est d’elle que je viens vous parler…
– Allons !… s’écrièrent les hommes avec émotion. Ils se mirent en route silencieusement ; il était plus de minuit lorsqu’ils arrivèrent à l’auberge du Grand-Charlemagne. Quelques instants plus tard, ils étaient réunis dans la grande salle de l’auberge.
Le premier regard de Madeleine Ferron fut pour Manfred.
– Il faut, dit-elle, puisque je vous retrouve, que je vous remercie encore de m’avoir sauvé la vie…
– Vous avez sauvé la mienne, madame, dit Manfred en s’inclinant autant par politesse que pour échapper au regard pénétrant de cette femme.
En effet, ce regard lui disait clairement :
– Te rappelles-tu cette minute de délire où tu me proclamas ton amour !…
Manfred ne se la rappelait que trop. Et il eût donné une année de son existence pour effacer cette minute, où, par la pensée, par l’intention, il avait trahi sa bien-aimée Gillette.
La Belle Ferronnière comprit sans doute ce qui se passait dans le cœur du jeune homme, car elle détourna son regard qui fit le tour des assistants.
Il y avait Triboulet, Ragastens, Lanthenay, Spadacape et Manfred.
– Madame, dit alors Ragastens, vous nous avez promis de parler de Gillette. Pardonnez notre hâte à tous, et cette hâte vous la comprendrez lorsque vous saurez que M. Fleurial, ici présent, est le père de Gillette, et que mon cher fils, Manfred, est son fiancé…
Madeleine tressaillit :
– Vous dites que M. Manfred est votre fils ?…
– Oui, madame, dit Ragastens.
– Ah ! fit Madeleine, j’en suis bien heureuse…
Ni Ragastens ni Manfred ne comprirent cette étrange exclamation.
Au bout d’un instant, elle reprit :
– Et Gillette est fiancée à M. Manfred ?
– Ou du moins ces deux enfants s’adorent…
Et elle répéta :
– De cela aussi je suis heureuse. M. Manfred est un noble caractère, et Gillette est la fille la plus charmante que j’aie jamais vue…
– Vous l’avez donc vue ? s’écrièrent à la fois Triboulet et Manfred.
– Un peu de patience, dit-elle en souriant. Dans ce qu’a dit tout à l’heure M. de Ragastens, une chose m’a surtout étonnée… il a dit que M. Fleurial est le père de Gillette…
– Je le suis, madame, dit Triboulet d’une voix que l’émotion faisait trembler ; je le suis autant que peut être père un homme qui a recueilli une enfant, l’a élevée, l’a adorée, et a fait de son bonheur le but de son existence…
– Je comprends, fit Madeleine en hochant la tête. Chevalier, et vous, messieurs, j’ai vu Gillette… j’étais avec elle il y a à peine deux heures.
Tous ces hommes gardèrent un silence poignant.
– Soyez tout d’abord rassurés, prononça Madeleine : cette enfant a échappé à tous les dangers qui l’enveloppaient, je dis à tous, messieurs, et je n’ai pas besoin d’insister sur la nature de ces dangers, puisque Gillette se trouve dans la maison du roi de France…
– Sauvée ! murmura Triboulet dont les yeux se remplirent de larmes, tandis que Manfred, incapable de prononcer un mot, serrait à les briser une main de son père et une main de Lanthenay.
– Oui, ajouta gravement Madeleine, sauvée, mais non hors de danger, et si vous m’en croyez, il faut agir le plus tôt possible.
– Agir ! s’écria Triboulet avec désespoir… Mais comment ?… Depuis que nous sommes à Fontainebleau, dix tentatives ont échoué coup sur coup… Ce soir, nous étions résolus à sauter dans le parc, à tuer une sentinelle et à marcher sur le château…
– Où vous n’auriez pas trouvé celle que vous cherchez… Bénissez le hasard qui m’a placée sur la route de Gillette… Messieurs, apprenez d’abord que l’enfant n’est plus dans le château ; elle est avec sa mère dans un pavillon du parc.
– Avec sa mère !…
Cette exclamation leur échappa à tous.
– Sans doute ! fit Madeleine. Sa mère… Margentine…
– Margentine ! s’écria Manfred ! Ah ! je comprends maintenant ce que la pauvre folle voulait me dire pendant qu’elle soignait ma blessure !
– Margentine ! s’exclama à son tour Ragastens ; cette malheureuse à qui Gillette a été arrachée à temps !
– Messieurs, dit Madeleine Ferron, il y a là un mystère que je vais éclaircir d’un mot. La malheureuse Margentine m’a raconté sa lamentable histoire. Margentine, messieurs, a été folle ; elle ne l’est plus depuis qu’elle est auprès de sa fille. Margentine, qui est-ce ?… Une demoiselle de Blois qui a eu le malheur de rencontrer il y a dix-huit ans François de Valois… Vous devinez, messieurs, le drame qui précipita cette créature aimante dans la folie… Trahie par celui qu’elle adorait, bafouée, abandonnée dans une scène tragique, sa fille perdue, elle sombre dans la démence… et elle ne revient à la raison que pour retrouver son enfant menacée par le même homme qui l’a perdue, elle !
Ils se taisaient, violemment impressionnés par ce récit imprévu, débité d’une voix sombre, sans éclat, mais où perçait une haine incurable.
Elle reprit :
– Je ne vous dirai pas, messieurs, ce que je suis venue faire à Fontainebleau. Monsieur de Ragastens, je crois qu’à la suite de nos diverses rencontres, vous avez dû deviner mon secret.
– Non, madame, affirma Ragastens avec fermeté.
– Je vous crois… Qu’il vous suffise donc de savoir que nos intérêts sont communs, en ce sens que je hais François de Valois. J’ose à peine ajouter que peut-être aussi y a-t-il dans ma pensée une vive sympathie pour cet ange qui s’appelle Gillette…
« Quoi qu’il en soit, poursuivit-elle brusquement, comme pour échapper à l’émotion, j’ai réussi à m’introduire dans le parc et j’ai mis mon centre d’opération au pavillon des gardes ; c’est là que j’ai vu Gillette et sa mère…
Tous, ils regardaient avec une admiration stupéfaite cette femme qui, seule, avait réussi à faire ce qu’ils avaient tenté en vain.
Elle poursuivit :
– Quelqu’un de vous, messieurs, connaît-il le parc ?
– Moi, dit Triboulet ; je connais aussi bien le château que le parc.
– Vous savez donc la situation du pavillon des gardes par rapport à la petite porte dérobée ?
– J’irais les yeux fermés.
– En ce cas, voici ce que je vous propose. Trouvez-vous tous demain devant la petite porte dérobée. J’en ai la clef, je vous ouvrirai…
– Pourquoi ne pas y aller tout de suite ? fit Manfred.
– Pour deux raisons majeures : la première, c’est qu’il y a pour garder cette porte une sentinelle qui donnerait l’alarme si on n’arrivait pas à la tuer du premier coup de poignard.
– Cette sentinelle n’y sera donc pas demain ?
– Non, répondit froidement Madeleine.
Il y eut un frémissement parmi ces hommes habitués pourtant à l’effusion du sang, en une époque où une vie d’homme était tenue pour peu de chose.
– Il y a une deuxième raison, reprit Madeleine. Tout à l’heure, en traversant le parc, j’ai rencontré quelqu’un – qui ? je ne sais – mais quelqu’un qui, évidemment, surveillait le pavillon. Il y a donc des chances pour qu’il soit difficile à quatre hommes de passer dans le parc sans que l’éveil soit donné. Voici donc ce que je propose : demain, à une heure convenue… onze heures du soir par exemple ?…
– Onze heures… c’est entendu.
– À cette heure-là, vous arriverez à la petite porte. Alors, de deux choses l’une : ou j’ai amené avec moi Margentine et Gillette, j’ouvre, et l’évasion se fait sans difficulté, ou j’ai reconnu un danger grave à leur faire traverser le parc, et vous venez les chercher dans le pavillon. Il y a à peu près un quart d’heure de marche rapide de la porte au pavillon. Gillette et Margentine seront prêtes. Un quart d’heure pour revenir. En tout une demi-heure. Je n’ai pas besoin de vous dire que vous devez être bien armés et prêts à tout !
– Il n’y a pas d’autre plan possible, dit Ragastens résumant l’impression de ses compagnons… Une question, madame, voulez-vous ?
– Faites, chevalier.
– Fuirez-vous avec nous ?
– Non, dit-elle avec ce même accent de fermeté roide ; moi, je reste… il faut que je reste…
– Pourquoi ne pas fuir, madame ? insista Ragastens ému. Croyez-moi, la punition dont vous voulez sans doute frapper… quelqu’un…
– Ah ! vous voyez bien que vous savez mon secret !
– Non, mais je vois que vous préparez une vengeance. Laissez-moi vous dire que vous y risquez votre vie… Venez avec nous…
– Ma vie est plus que risquée ; elle est sacrifiée. Que je reste ou que je parte, avant peu je serai morte ; j’aime mieux mourir vengée… Un dernier mot avant de nous séparer, il serait prudent de ne point passer la journée de demain, ni même le reste de cette nuit dans cette auberge.
– Pourquoi ? demanda Triboulet… On est venu pour nous y arrêter, mais celui qui seul peut être chargé de la chose n’osera plus en tenter l’aventure, j’en réponds…
– Je ne comprends pas, dit Madeleine. En tout cas, voici ce qui est arrivé : il n’entrait pas dans mon plan, ce soir, de me rencontrer avec vous. J’avais préparé une lettre que j’espérais pouvoir vous faire parvenir. Cette lettre porte comme suscription : « Monsieur le Chevalier de Ragastens, à l’auberge du Grand-Charlemagne. » Quant à son contenu, le voici mot à mot : « Trouvez-vous demain soir, à onze heures, à la petite porte du parc. » Et j’avais signé : « Une amie de Gillette. » Cette lettre, si elle parvenait entre les mains du roi, serait toute une dénonciation… Or je viens de la perdre dans le parc.
– En ce cas, notre tentative de demain me paraît impossible.
– Pourquoi donc ? Le parc est immense. Il faut agir dès demain. Il faudrait un hasard extraordinaire pour que ce carré de papier, tombé dans l’herbe épaisse, soit trouvé avant huit jours, si jamais il est trouvé… Mais, enfin, pour plus de sûreté, ne restez pas ici… Et quant au reste, ne changeons rien.
– Vous avez raison, madame, dit Ragastens qui avait attentivement écouté ces explications. Nous allons quitter séance tenante l’auberge. Demain soir, à onze heures précises, nous serons à la porte dérobée.
– Adieu donc ! dit Madeleine.
Madeleine Ferron reprit d’un pas rapide le chemin du parc et arriva sans encombre à la petite porte. Là, elle recommença la manœuvre qui lui avait déjà réussi.
Mais comme elle refermait la porte et marchait vers le massif derrière lequel elle allait disparaître, la sentinelle se retourna et l’aperçut.
– Halte là ! cria-t-elle.
Madeleine réfléchit que si elle ne s’arrêtait pas, cet homme allait donner l’éveil. Elle s’arrêta donc et marcha droit à la sentinelle.
– Qui êtes-vous ? demanda le soldat.
– Officier du roi ! répondit-elle d’un ton rogue. Ne fais pas de bruit, imbécile ! Ne vois-tu pas que si je passe par la porte dérobée avec la clef de Sa Majesté, c’est que je ne dois pas être vu !
– Excusez, mon officier…
– Tu n’as rien vu, tu entends ! si du moins, tu tiens à ta peau !
– Je n’ai rien vu, mon officier.
– Ton nom ?…
– Guillaume le Picard…
– Bien… Je saurai si tu as fait ton devoir.
Elle s’éloigna tranquillement, tandis que la sentinelle reprenait sa morne promenade en grommelant dans sa barbe :
– Ces officiers sont toujours à courir la prétantaine… Heureusement que j’ai eu la bonne idée de ne pas donner mon nom !…
Madeleine arriva au pavillon des gardes sans autre rencontre. Elle frappa au volet les trois coups convenus, dit son nom à voix basse, prononça aussi celui de Margentine, la fenêtre s’ouvrit, et elle sauta lestement à l’intérieur.
– Demain, vous êtes sauvées, dit-elle à Margentine, et elle raconta alors ce qu’elle venait de faire.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Après le départ de Madeleine Ferron, il y avait eu conférence dans la salle du Grand-Charlemagne.
Triboulet était inquiet, nerveux.
– Je ne sais pourquoi, finit-il par dire, mais je me méfie de cette femme. Cette histoire de lettre perdue, surtout, me paraît terriblement louche.
– Si elle avait voulu nous trahir, dit Lanthenay, il lui était facile d’amener avec elle des gens qui eussent cerné l’auberge ; elle nous a au contraire priés de ne pas rester ici…
– Je réponds d’elle ! dit à son tour Manfred.
– Moi aussi, ajouta Ragastens.
Triboulet hocha la tête.
– Quoi qu’il en soit, dit-il, nous serons demain au rendez-vous. C’est une chance : il faut essayer d’en profiter… dussé-je, quant à moi, y périr ! Mais d’ici là, prenons nos précautions.
– La seule précaution à prendre, ce serait de quitter l’auberge à l’instant même. Mais aller frapper à une autre hôtellerie à pareille heure, ce serait peut-être faire bien du bruit et courir au devant du danger que nous voulons éviter.
Tout compte fait, on finit par convenir qu’il valait mieux rester au Grand-Charlemagne, avec cette précaution cependant qu’une faction serait montée à tour de rôle jusqu’au lendemain.
Les cinq compagnons, réfugiés au fond de l’auberge d’où ils ne sortirent pas, employèrent leur journée à préparer la suprême tentative.
Ragastens avait eu avec l’hôte une conférence d’où il résulta qu’une chaise de voyage attelée de deux vigoureux chevaux leur serait procurée pour le soir même.
Manfred, Lanthenay et Ragastens avaient leurs chevaux à l’écurie.
Quant à Spadacape, il ferait office de postillon.
Triboulet monterait le cheval du fidèle serviteur du chevalier.
À neuf heures, tout était prêt.
La chaise de voyage tout attelée était dans la cour de l’auberge. Les chevaux étaient sellés.
À neuf heures et demie, Ragastens donna le signal du départ.
Manfred se jeta dans les bras de son père, qui l’étreignit en lui disant :
– Courage ! Nous réussirons…
On se mit en route.
La voiture marchait au pas. Les quatre cavaliers suivaient. On atteignit sans encombre le chemin qui longeait le mur du parc.
À dix heures et demie précises, Spadacape s’arrêta à dix pas de la petite porte dérobée.
Les chevaux de selle furent alors attachés par les brides aux roues de la voiture. Ceux de la voiture eux-mêmes furent attachés à un arbre.
Puis, tous allèrent se poster devant là petite porte.
XXXVI
DÉLIRE D’AMOUR
On a vu que la duchesse d’Étampes avait prévenu François Ier que Margentine et Gillette étaient installées au pavillon des gardes.
Au moment où la duchesse sortait de chez le roi, Sansac se fit annoncer et fut aussitôt reçu.
Il arrivait de Paris à franc étrier, et il fallait qu’il eût à dire des choses bien graves pour qu’il se montrât en plein jour avec son visage affreusement balafré par un large sillon rougeâtre.
– Te voilà donc enfin ! s’écria le roi. Par Notre Dame ! si mes amis m’abandonnent je vais périr d’ennui.
Sansac regarda le roi.
Il le vit blêmi, maigri, les yeux cerclés de rouge ; des plaques livides tachaient son visage, et au coin de ses lèvres, on eût dit qu’une sorte de lèpre s’était déclarée.
– Pourtant, Votre Majesté a bonne mine, dit le gentilhomme.
– Laissons cela ! fit le roi en secouant la tête. Tu viens nous retrouver, et j’en suis bien heureux… Je vais faire prévenir La Châtaigneraie et d’Essé…
– Sire, dit Sansac, Votre Majesté me pardonnera. Je désire repartir de Fontainebleau le plus tôt possible. Je suis simplement venu annoncer au roi certaines choses assez étranges qui se passent à Paris…
– Parle, fit le roi étonné.
– Eh bien, sire, il y a deux jours, j’ai eu besoin de voir notre grand prévôt.
– Monclar ?
– Oui, sire. Et je me suis rendu le soir – car je ne sors plus que la nuit, comme les hiboux – je me suis rendu, donc, à l’hôtel de la grande prévôté. Or, savez-vous ce que j’y ai appris ? Que le comte de Monclar, subitement devenu fou, avait quitté l’hôtel et qu’on ne savait ce qu’il était devenu !
– Que m’apprends-tu là ! s’écria François Ier.
– La vérité, sire.
– Et je n’en suis pas informé ! Sans doute, c’est au dauphin qu’on a porté la nouvelle !
Le roi fit quelques pas dans son cabinet, le visage enflammé par un de ces accès de colère folle qui faisaient trembler le Louvre et Paris – et parfois la France entière.
– Nous allons voir, gronda-t-il, si je suis encore le roi… Sansac, tu vas partir pour Paris avec La Châtaigneraie et d’Essé… Je n’ai confiance qu’en vous trois. Je te nomme grand prévôt, entends-tu !
Sansac s’inclina sans joie. Pour ce gentilhomme, la vie avait fini du jour où il n’avait plus été le « beau Sansac »…
– Je te donne pleins pouvoirs, ajouta furieusement le roi qui, tout en parlant, s’était mis à écrire et remplissait divers parchemins. Tu prendras possession de la grande prévôté. Tu feras jeter à la Bastille mon grand chancelier et le gouverneur du Louvre… Ah ! nous allons voir… pars à l’instant… Montgomery !
Le capitaine des gardes apparut.
– Montgomery, dit le roi d’une voix rauque, rendez-vous à l’instant à l’appartement du dauphin, et de là à celui de Mme Diane…
– Sire ! voulut intervenir Sansac.
– La paix ! Vous arrêterez mon fils, Montgomery. Vous arrêterez Mme Diane… Allez… et voyez si La Châtaigneraie et d’Essé sont par là…
– Sire, dit Montgomery qui était un peu pâle, au moment où Votre Majesté m’a appelé, j’accourais justement vers elle pour lui dire… pour la prévenir…
– Dire quoi ! Voyons… parlez donc, monsieur !
– Sire, on vient de trouver sur la pelouse du parc, à cent pas de l’étang, le cadavre de M. d’Essé, la poitrine trouée de part en part…
– Quel est le misérable ?… rugit Sansac. Pardonnez, sire !
– On ne sait rien ! répondit Montgomery.
À ce moment, il se fit un grand bruit dans l’antichambre, et Bassignac, le valet de chambre, entra en criant :
– Sire ! Quelle affreuse nouvelle pour Votre Majesté ! M. de La Châtaigneraie est mort !
– Mort ! répéta sourdement le roi.
– Mort ! s’écrièrent Sansac et Montgomery, cette fois avec un commencement de terreur.
– Mort assassiné, reprit Bassignac ; on vient d’apporter au château le cadavre du malheureux gentilhomme, et les gens qui ont rempli ce funèbre office disent avoir trouvé le corps dans une rue écartée qui s’appelle la rue aux Fagots.
Montgomery tressaillit, pâlit, et murmura à part lui :
– Je donnerais ma tête à couper que l’assassin s’appelle Triboulet !
– C’est bien, Bassignac, dit le roi, laisse-nous !
Le valet de chambre se retira.
Montgomery attendait, avec le pressentiment que cette nouvelle modifierait peut-être les idées du roi.
Celui-ci, en effet, était comme foudroyé.
– Montgomery, dit le roi avec effort… ce que je vous ai dit…
– Je vais l’exécuter, sire ?
– Non ! mettez que je n’ai rien dit… Et que personne ne sache !
– Oh ! sire… Votre Majesté sait bien…
– Oui… vous êtes un fidèle… Allez, Montgomery.
Montgomery sortit.
Dès l’antichambre, le capitaine se demandait :
– Dois-je prévenir le dauphin… le roi de demain ?…
François Ier, demeuré seul avec Sansac, se leva et reprit sa promenade, mais, cette fois, lente et morne. Le gentilhomme remarqua alors combien le roi était affaissé, et quels terribles changements s’étaient faits en lui depuis qu’il avait quitté Paris…
– Dois-je partir, sire ? demanda-t-il.
– Non, répondit le roi d’une voix presque suppliante ; reste… je n’ai plus que toi à qui me fier ici !
Et ce qui acheva d’épouvanter François Ier, ce fut l’attitude même de Sansac, Autrefois, en semblable circonstance, le gentilhomme eût conseillé au roi la violence… Maintenant, il se taisait…
– Oh ! songea-t-il avec une profonde amertume. Il est donc bien vrai que je suis condamné !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ces nouvelles apportées coup sur coup, la folie du comte de Monclar, la mort de La Châtaigneraie et de d’Essé, avaient porté un coup terrible à François Ier.
Et dans cette âme gangrenée d’égoïsme comme le corps était gangrené par un mal incurable, il n’y eut pas un regret sincère donné au bon serviteur qu’avait été le grand prévôt, aux braves compagnons de plaisir et de péril qu’avaient été La Châtaigneraie et d’Essé.
Le roi ne pleura que sur lui-même.
Puis, peu à peu, comme il arrive parfois dans les tempéraments exorbités, sa douleur se transforma. Les images de ses compagnons flottèrent indécises, finirent par disparaître et furent remplacées par l’image de Gillette.
Quelques heures après la nouvelle des catastrophes, François Ier ne songeait plus qu’à s’emparer de Gillette.
Mais, au lieu d’y penser avec des hésitations comme il avait fait jusque-là, il y pensait avec fureur.
Il rêvait une mort monstrueuse…
Il éprouvait une joie funeste, avec des tremblements nerveux, à imaginer son propre cadavre étouffant en des bras glacés la jeune fille vaincue…
Dans le délire amoureux de François Ier, la Vie et la Mort, enlacées, enchevêtrées, formaient un étrange tableau dont le dessin macabre se traçait en lignes de feu dans son imagination surchauffée.
Puis ce fut la Belle Ferronnière qui passa devant ses yeux, provocante, lubrique, admirable de beauté en la nudité de son corps, mais un masque de squelette rongé grimaçait sur son visage.
Et toujours il en revenait à cette fantastique création de son délire :
Il était mort… mort d’amour… mort de volupté.
Et ses bras de cadavre enlaçaient dans une étreinte indéniable le corps de Gillette palpitant de vie et d’horreur.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
À l’heure du dîner, le roi annonça qu’il ne mangerait pas. Au moment de son coucher, il renvoya Bassignac qui, inquiet, s’assit dans l’antichambre et attendit…
Pendant de longues heures, le roi subit, chercha, créa la série turpide des tableaux qui l’enchantaient et le tuaient. C’était une agonie de volupté.
Bientôt de violentes lancinations attaquèrent le crâne. En même temps, les entrailles se tordirent sous l’effet du mal.
Minuit était sonné depuis longtemps déjà, et le roi se débattait encore silencieusement.
Cela dura deux heures encore…
Tout à coup, les douleurs des entrailles se calmèrent ; mais, aussitôt, il lui parut qu’on enfonçait des aiguilles de feu dans ses paupières. Il ferma les yeux, et ne s’en trouva pas soulagé…
Alors, les horreurs de la mort lui furent visibles comme si elle eût été toute proche. Il voulut se lever pour échapper aux fantômes de son délire. Il fit deux pas et tomba lourdement, avec un cri déchirant…
Il est trois heures après minuit.
– Le roi se meurt… Le roi va mourir !…
Dans le château, où des lumières vont et viennent, dont toutes les fenêtres sont éclairées, ce mot court de bouche en bouche.
Les habitants du château, réveillés en sursaut, attendent la fin de la crise…
Et les appartements de François Ier étaient déserts.
Seuls, Bassignac et Sansac, que le valet de chambre avait couru chercher, avaient pénétré dans le cabinet royal. Ils avaient porté le roi sur son lit, l’avaient déshabillé, et Bassignac s’était élancé au dehors en quête du chirurgien de François Ier.
Ce chirurgien, après l’avoir inutilement demandé partout, il finit par le trouver dans l’appartement du dauphin Henri.
Là, il y avait cohue.
Au premier rang des courtisans empressés à saluer le soleil levant, Montgomery racontait à voix basse au fils de François Ier une histoire qui devait sans doute l’intéresser beaucoup, car le dauphin écoutait avec une attention profonde.
Bassignac, ayant aperçu le chirurgien dans l’embrasure d’une fenêtre, traversa la cohue… En arrivant à la fenêtre, il s’aperçut que le chirurgien causait avec Mme Diane de Poitiers. Que pouvait-elle lui dire ?
Sans souci de l’étiquette, Bassignac tira le chirurgien par la manche.
– Que se passe-t-il, Bassignac ? fit Diane de Poitiers.
– Le roi est gravement indisposé ; ne le savez-vous donc pas, madame ? dit le valet de chambre.
– Oh ! mon Dieu !… mais il faut prévenir monseigneur le dauphin ! s’écria Diane qui s’éloigna aussitôt en jetant un regard au chirurgien.
Celui-ci suivit Bassignac.
Comme le valet de chambre partait en courant, il se heurta à Jarnac qui poussa un cri de douleur accompagné d’un juron. Bassignac était trop préoccupé pour s’arrêter.
Mais le chirurgien, lui, s’arrêta.
– Cet imbécile vous a heurté ? demanda-t-il.
– Oui, mort Dieu, et cela me brûle…
– Bon !… Je verrai tout à l’heure votre épaule. L’essentiel est que la compresse ne soit pas tombée…
Le chirurgien s’élança à son tour.
Jarnac entra dans l’appartement du dauphin et alla droit à Diane de Poitiers.
– Comment va votre épaule ? demanda celle-ci.
– Aussi bien que possible, bien que l’enragé qui m’a fourni ce coup d’épée, grâce à l’obscurité, n’ait pas ménagé le fer… mais j’aurai ma revanche lorsque j’aurai deviné à quel diable j’ai eu affaire ! En attendant, il s’agit d’autre chose… Tout à l’heure, dans l’espoir de retrouver une piste, je me suis, après que ma blessure eut été pansée, rendu avec une lumière à l’endroit où je me suis rencontré avec l’enragé en question… Savez-vous ce que j’ai trouvé dans l’herbe ?…
– Voyons ! fit Diane.
Jarnac lui tendit un carré de papier.
– J’ai eu la curiosité de l’ouvrir, acheva-t-il. Lisez, et vous verrez que c’est assez intéressant…
Diane de Poitiers ouvrit la lettre et la lut à diverses reprises.
– Qu’en dites-vous ? demanda Jarnac.
– Attendons ! reprit Diane… Le chirurgien va tout à l’heure m’apporter une réponse. D’après cette réponse, la lettre trouvée sera ou ne sera plus utile. En tout cas, elle est de bonne prise.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur son grand lit armorié, François Ier râlait.
L’idée de la mort avait pris en lui un développement monstrueux.
Mais elle n’arrivait pas à étouffer la passion qui délirait dans ce corps.
Les paroles qui lui échappaient dénonçaient ce double état d’âme et de corps.
– Mourir dans les bras de Gillette… mourir avec elle… Oh ! c’est affreux de mourir si jeune… mais je mourrai en l’étouffant de baisers…
– Sire ! sire ! chassez ces idées…
– Oh ! mes yeux… Ce sont mes yeux qui me brûlent ! Oh ! ces flammes qui me passent sur mes paupières !… Je suis sûr qu’un baiser de cette jeune fille les rafraîchirait…
– Buvez, sire, dit le chirurgien en présentant aux lèvres du roi une potion calmante.
Le roi but avec avidité.
– Ah ! c’est vous ! dit-il en saisissant la main du chirurgien. Où est Rabelais ? Je veux qu’on m’envoie Rabelais !…
– Mon illustre confrère n’est pas au château, sire ; mais je tâche à le remplacer autant qu’il est au pouvoir de ma faible science…
– Oui… oui… vous aussi vous êtes un savant…
Le roi, d’un signe renvoya Bassignac.
– Le roi va mieux ! dit le chirurgien.
Bassignac se hâta de sortir pour colporter cette nouvelle, jouissant d’avance de la consternation des courtisans.
– Va, toi aussi, dit François Ier à Sansac, doucement.
Sansac consulta le chirurgien d’un coup d’œil.
– Sa Majesté vient d’avoir une crise violente… la crise est montée à son point culminant, elle va maintenant redescendre par degrés. Je réponds des jours de Sa Majesté, si elle veut bien suivre mes prescriptions…
– Dieu sauve Sa Majesté ! murmura Sansac.
Et cet homme de fer sortit en pleurant. Car, à force de partager les plaisirs et les dangers du roi, il s’était attaché à lui profondément…
Le roi se tourna alors vers le chirurgien.
– Dites-moi mon état, fit-il avec une certaine fermeté.
– L’état de Votre Majesté n’est pas alarmant.
– Et moi, je vous dis que je suis condamné !… Peut-être ai-je encore trois mois à vivre… Mais à quoi bon !…
– Votre Majesté est robuste. Le sang peut se régénérer sous l’influence des herbes qui calment et purifient…
François Ier secoua la tête.
– Pourquoi mentez-vous ? dit-il rudement. Vous savez mieux que moi que le mal dont je suis atteint est incurable…
Le chirurgien garda le silence.
– Vous voyez bien ! s’écria le roi avec désespoir.
– Sire !… j’avoue que le mal de Votre Majesté est difficile à guérir… Mais ce n’est pas trois mois que vous pouvez vivre, si vous voulez…
– Six mois, n’est-ce pas ? fit le roi avec amertume. Cette fois encore, le chirurgien demeura silencieux.
– Écoutez, dit alors François Ier ; ces quelques misérables jours d’existence qui me restent, je n’en veux pas… Écoutez-moi… Taisez-vous… et obéissez… Je veux que d’ici à la pointe du jour, vous m’ayez composé une potion qui me rende toutes mes forces pour huit jours, pour moins même… Je veux, pendant ces heures suprêmes redevenir jeune, ardent, tel enfin que j’étais il y a vingt ans… le pouvez-vous ?
– Oui, sire… Mais si je vous donne cette potion, je vous tue !
– Composez-la toujours et apportez-la-moi… Je verrai…
– Sire, je répète à Votre Majesté qu’elle va au suicide…
– Taisez-vous, monsieur ! râla le roi. Que demain matin j’aie cette potion, il y va de votre vie !…
– Le roi l’ordonne ?…
– Oui ! Je vous l’ordonne !…
– C’est bien, soit… Vous serez obéi…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peut-être était-ce un honnête homme que ce chirurgien.
Peut-être simplement eut-il peur… mais il résolut de se taire et de tenter ensuite un suprême effort pour détourner François Ier de son funeste projet.
En sortant de chez le roi, il aperçut Diane de Poitiers qui l’attendait avec impatience.
– Eh bien ? demanda-t-elle.
– Sa Majesté a eu une crise, mais rien ne prouve que le roi soit en danger… Il sera sauvé s’il consent à prendre du repos… et surtout, ajouta-t-il, si… on écarte soigneusement de lui… la cause de l’excitation.
– Quelle cause ? fit Diane de Poitiers.
– Les femmes ! répondit celui-ci avec rudesse.
Il s’éloigna.
– Les femmes ! songea Diane… Et il peut être sauvé ! Oh ! la lettre !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le chirurgien s’était élancé vers son appartement, où un laboratoire était installé.
Nous avons dit que c’était peut-être un honnête homme.
L’idée de préparer la potion qu’il avait promise au roi le révoltait. Il s’assit dans un fauteuil, et, la tête dans les deux mains, se prit à réfléchir.
Au loin, à quelque beffroi, quatre heures du matin sonnèrent lentement.
À ce moment, on frappa à sa porte, et, s’imaginant qu’on venait le chercher pour courir chez le roi, il s’empressa d’ouvrir.
C’était Diane de Poitiers.
Elle entra et referma soigneusement la porte.
– Voyons, dit-elle, mettez-moi bien au courant…
– Je ne puis que vous répéter ce que je vous ai dit, madame. Le roi peut être sauvé… momentanément, du moins…
– Que faudrait-il pour cela ?
– Le repos le plus complet… vous m’entendez, madame ?… c’est-à-dire non seulement le repos du corps, mais celui de l’esprit. Et par repos, madame, je comprends seulement… le repos… des sens…
– Parlez librement, fit Diane de Poitiers ; les circonstances sont trop graves pour perdre du temps aux métaphores.
– Soit, madame. Je dis donc que le roi peut et doit se livrer à ses exercices ordinaires, même les plus violents. Au contraire, la chasse, les tournois, tout ce qui peut amener d’abondantes transpirations et dompter les sens ne peut que lui être favorable. Mais il faut qu’il cesse d’une façon absolue tout commerce féminin ; il faut même qu’il chasse tout à fait de son esprit toute pensée amoureuse… moyennant quoi…
– Achevez…
– En suivant ces prescriptions avec rigueur, et en se soumettant à une médication raisonnable, Sa Majesté peut vivre encore cinq ou six ans…
– Cinq ou six ans ! répéta Diane de Poitiers.
– Et peut-être même, conclut le chirurgien, pourrait-on enrayer le mal grâce à l’extrême vigueur du roi… Malheureusement son tempérament, d’une ardeur démesurée, a maîtrisé sa volonté. Loin de rechercher le calme qui peut le sauver, le roi m’a commandé de lui faire une potion excitante…
– Excitante ? interrogea Diane.
– Une potion qui, pour quelques jours, lui rendrait toutes les facultés de la jeunesse…
– Cette potion… pouvez-vous la composer ?
– Je le puis, madame, mais je ne le ferai pas !
– Pourquoi ?
– Parce que je tuerais le roi avec un philtre de ce genre aussi sûrement qu’avec une balle de mousquet dans la tête ou un coup de poignard dans la poitrine…
– Je comprends, maître ; mais il vous est bien difficile de résister ouvertement aux ordres de Sa Majesté…
– Aussi, madame, ne résisterai-je pas ouvertement. Je préparerai pour Sa Majesté une potion calmante, et je lui dirai que c’est le philtre qu’elle m’a demandé…
– Et lorsque le roi s’apercevra que vous l’avez trompé, vous serez arrêté et jeté dans quelque basse fosse…
Le chirurgien pâlit.
Diane de Poitiers se leva et alla à lui.
– Il faut composer ce philtre, dit-elle froidement.
– Madame, que me demandez-vous là !…
– Écoutez-moi bien, maître ; les minutes sont précieuses. Il y a dans ce couloir, derrière cette porte, deux hommes qui vont entrer, si j’appelle… Voyez plutôt…
Diane alla vivement ouvrir la porte. Dans le corridor, le chirurgien aperçut en effet deux hommes.
Ils étaient masqués, et il ne put les reconnaître. Mais, à leurs costumes, il jugea que c’étaient des gentilshommes.
Diane referma la porte.
– Savez-vous ce qui arrivera si j’appelle, maître ?
– Je ne m’en doute pas, madame, fit le médecin qui, de pâle, était devenu blême.
– Eh bien, ces deux hommes entreront et vous poignarderont sans pitié. Vous avez une minute pour vous décider. Ou vous répondez de composer le philtre, ou sinon j’appelle…
Le chirurgien hésita environ douze secondes, laps de temps énorme, si l’on réfléchit qu’il tenait Diane de Poitiers pour incapable de faire une menace vaine et si l’on songe qu’elle avait déjà travaillé l’esprit du malheureux dans l’appartement du dauphin.
– Madame, balbutia-t-il, je ferai la potion.
– Bien maître, c’est tout ce que je vous demande. Maintenant, rassurez-vous. Votre conscience sera à l’abri de tout reproche. C’est à moi, à moi seule que vous remettrez votre philtre. Quant au roi, vous ferez comme vous avez dit : vous lui apporterez la potion calmante. Veillez seulement à ce que les deux flacons soient identiques. Si, au moment où vous apporterez au roi votre potion, il se trouve quelque personne auprès de Sa Majesté, il sera bon que cette personne sache que cette potion est inoffensive. Moyennant la bonne exécution de toutes ces prescriptions, comme vous dites, vous serez, maître, nommé chirurgien de Sa Majesté Henri II, roi de France. Vos appointements seront doublés, et des titres de noblesse vous seront acquis. Cela vous paraît-il suffisant ?
Le chirurgien s’inclina en tremblant.
– Finissons-en, maître. Combien de temps vous faut-il pour préparer vos deux potions… la bonne et la mauvaise ?…
– Environ deux heures, madame.
– Prenez-en trois. À huit heures, je serai ici. Je pense que nous sommes d’accord sur tous les points ?…
– Oui, madame !…
– À huit heures ! dit Diane de Poitiers d’un ton de voix qui fit frémir l’infortuné médecin.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un peu après huit heures, le chirurgien se dirigea vers l’appartement du roi.
Comme il allait pénétrer dans l’antichambre, une femme sortit d’une chambre voisine et le saisit par le bras.
C’était la duchesse d’Étampes.
– Vous allez porter au roi la potion qu’il vous a demandée ?… dit-elle à voix basse.
– Madame…
– J’ai tout entendu, cette nuit, lorsque Sa Majesté vous a parlé ! Avez-vous songé, monsieur, qu’obéir au roi c’est le tuer ?…
– Madame, dit le chirurgien en baissant la tête, la potion que j’apporte est inoffensive…
– Comment cela ?…
– Je ne puis m’expliquer davantage, madame, mais je vous jure sur le salut de mon âme que je porte au roi une potion calmante et non le philtre qu’il m’a demandé.
– Vous êtes un brave homme, vous ! s’écria la duchesse qui embrassa sur les deux joues le médecin affairé.
– Le roi ne mourra pas ! songeait la duchesse en regagnant ses appartements. Ah ! ma chère Diane, rira bien qui rira la dernière !…
– Comment le roi a-t-il passé le reste de la nuit ? demanda alors le chirurgien à Bassignac.
– Sa Majesté n’a pas tardé à s’endormir, dit-il.
– C’est l’effet de la potion que je lui ai fait prendre…
– Mais le sommeil a été coupé de cauchemars, à en juger par les paroles incohérentes qui échappaient à Sa Majesté…
– Nous allons voir cela…
Et le chirurgien voulut passer outre.
– Maître ! fit Bassignac d’un voix suppliante.
– Que voulez-vous, mon ami ?…
– Est-il dans votre intention d’obéir à Sa Majesté…
Le médecin poussa un soupir et son visage s’assombrit.
Tout à coup, il montra à Bassignac le flacon qu’il apportait :
– Vous voyez ce flacon, n’est-ce pas ?
– Oui ! fit ardemment le valet de chambre.
Le chirurgien regarda anxieusement autour de lui.
– Écoutez-moi bien, fit-il brusquement en se penchant vers Bassignac. Tant que le roi ne boira que du contenu de ce flacon, je réponds de sa vie, vous m’entendez ?
– J’entends… Oh ! soyez béni !
– Mais, ajouta le médecin d’une voix si basse qu’à peine elle était intelligible, si le flacon est changé, je ne réponds plus de rien…
Et laissant Bassignac frissonnant d’espoir et de terreur, il entra dans la chambre du roi.
XXXVII
LE PHILTRE
François Ier était réveillé. Un grand abattement se lisait sur ses traits fatigués. Seuls, les yeux brillaient d’un feu étrange.
– Eh bien, monsieur, s’écria François Ier, avez-vous réussi à me composer cette potion ?
Le médecin déposa sur une table, au milieu de la chambre, le flacon qu’il avait apporté.
– Sire, balbutia-t-il, le philtre que me demandait Votre Majesté est bien connu, et sa composition, importée en France par des Asiatiques, ne peut être ignorée par un médecin…
– Il suffit, maître, dit le roi dont le regard s’enflamma.
– Si votre Majesté daignait le permettre…
– Non, maître, non !… Je sais ce que vous pouvez avoir à me dire… Toute parole est désormais inutile… Votre office est rempli, vous pouvez vous retirer…
– J’ose espérer que le mal qui peut arriver ne retombera pas sur moi ! dit le médecin qui, s’étant incliné, se retira.
Maintenant, les antichambres étaient pleines de monde.
La nouvelle que le roi allait mieux, et qu’il pouvait guérir, avait fait le vide autour du dauphin Henri et ramené auprès du vieux roi la foule des courtisans.
Seul dans sa chambre, François Ier demeura quelques minutes songeur, les yeux fixés sur le plafond.
Bassignac entra et lui dit que Mme Diane de Poitiers demandait instamment à être introduite près du roi.
François Ier avait pour Diane une singulière estime.
Cependant cette femme le trahissait : elle voulait le tuer.
Il ne le savait pas.
Diane de Poitiers ne haïssait pas François Ier. Mais elle haïssait celui qui occupait la place d’Henri II Car elle pensait fermement que le couronnement du dauphin se compléterait par son propre couronnement.
– Sire, dit-elle de sa voix un peu masculine, lorsque François Ier eut donné l’ordre de l’introduire, je vois avec bonheur qu’on nous avait fait un faux rapport.
– Quel rapport, ma chère Diane ?
– On nous disait que Votre Majesté souffrait d’un mal inguérissable…
Le roi devint livide à ce coup si rude.
– Et que la crise de cette nuit menaçait de l’emporter, acheva Diane implacable. Je vois, se hâta-t-elle d’ajouter, qu’il n’en est rien et que, par la merci de Dieu, le roi sera encore longtemps.
– Le roi se meurt, interrompit François Ier.
– Sire ! sire ! que dites-vous là ?… Je suis convaincue que vous souffrez seulement d’un peu d’ennui, et qu’il suffirait de quelque amusement pour vous arracher aux pensées qui vous attristent… Permettez-moi, sire, de parler en toute franchise…
– Parlez, ma chère amie…
– Eh bien ! depuis notre arrivée à Fontainebleau, Votre Majesté ne s’entoure que de visages graves et austères… Plus de fêtes, plus de tournois… C’est à peine si la chasse vient rompre la rude monotonie de ses journées… Eh ! sire, nous ne sommes pas au camp !… Rappelez auprès de vous les poètes que vous avez éloignés, les troubadours dont les récits nous charmaient jadis, composez-vous une cour qui soit comme un parterre de fleurs. Il ne manque pas de jeunes et charmantes femmes dont le spectacle égaiera les esprits moroses de Votre Majesté… Et tenez, sire, j’y pense… Sans aller plus loin… pourquoi avoir chassé du château et relégué au fond du parc cette si jolie Gillette que nous aimons tous…
Le roi buvait ces paroles et s’en enivrait comme d’un poison délicieux.
Au nom de Gillette, un long frisson l’avait agité.
Diane put, d’un coup d’œil, mesurer toute l’étendue des ravages que la passion peut causer dans un cœur qui a passé l’âge d’aimer et s’obstine à l’amour…
Tout à coup elle frappa dans ses mains :
– Mais ceci me rappelle un incident assez curieux que je veux rapporter à Votre Majesté pour la distraire…
– Vous êtes une enchanteresse, Diane, et sous vos paroles, je me sens revivre !
– Votre Majesté, heureusement, n’a pas besoin qu’on l’aide à vivre…
– Voyons l’incident… À qui se rapporte-t-il ?
– Mais… à la jeune duchesse de Fontainebleau…
Les yeux du roi flamboyèrent.
– Un jardinier, continua Diane, a trouvé dans le parc une lettre singulière qui est signée : Une amie de Gillette… Cette lettre est adressée à un monsieur… de… j’ai oublié… Mais, tenez, sire, voici la lettre…
Diane tendit au roi un carré de papier qu’il se mit à lire et relire.
Par discrétion, sans doute, et pour laisser le roi méditer à son aise, Diane, pendant que le roi lisait, avait reculé, glissé jusqu’à la table sur laquelle le médecin avait déposé la potion.
Le roi, ayant lu la lettre, leva enfin les yeux sur Diane de Poitiers.
– Je vous remercie, ma chère Diane, dit-il.
– Et de quoi, sire ?
– De vos bonnes paroles et de la lettre que vous m’apportez…
– Oh ! Mon Dieu, aurait-elle donc une importance quelconque ?
– Une importance considérable, Diane. Veuillez me laisser… Mais avant de vous retirer, rendez-moi un dernier service… Apportez-moi cette bouteille qui est là près de vous, sur la table… Ne la voyez-vous pas ?
– Pardon, sire… je ne la voyais pas, en effet.
Diane saisit le flacon et l’apporta au roi.
Le roi considéra d’un œil sombre la bouteille toute semblable à celle que le chirurgien avait déposé sur la table.
– Ceci contient la vie, ceci contient la mort murmura-t-il.
Et d’un geste brusque, remplissant un gobelet d’argent, il le vida d’un trait.
Puis il appela Montgomery.
Le capitaine des gardes se présenta aussitôt.
– Prenez vingt hommes sûrs, dit le roi, rendez-vous à l’auberge du Grand-Charlemagne, et arrêtez le chevalier de Ragastens, qui s’y trouve. S’il est en compagnie d’autres personnes, arrêtez aussi ces personnes. Faites vite !
Montgomery s’inclina et disparut.
– Bassignac ! appela le roi.
– Me voilà, sire !…
– Aide-moi à m’habiller…
Tout en commençant à vêtir le roi, Bassignac jeta un coup d’œil sur le flacon de la potion et reconnut celui que le chirurgien lui avait montré.
– Voilà qui va bien, murmura entre ses dents le vieux serviteur.
– Que dis-tu ? interrogea le roi.
– Je dis que Votre Majesté a commencé à boire sa potion, et que j’en suis heureux…
– Pourquoi cela ? fit le roi.
– Parce que la potion est calmante, j’en ai la certitude, et Votre Majesté peut la boire sans crainte.
Ces paroles qui, dans l’esprit du valet de chambre se rapportaient à la courte conversation qu’il avait eue avec le chirurgien, ne furent pas comprises par François Ier.
– Tu as raison, dit-il d’une voix sombre ; c’est ce philtre qui doit apaiser les esprits en révolte dans mon corps. Remplis-moi mon gobelet…
Bassignac se hâta d’obéir.
Le roi but d’un trait, comme tout à l’heure, avec une sorte de désespoir farouche.
– Je bois de la mort ! songea-t-il.
Le premier effet immédiat du philtre fut un bien-être général qui se répandit parmi ses membres brisés de fatigue. Cette âcre et froide sueur qui surtout l’incommodait s’arrêta. Les sourdes douleurs qui persistaient dans les entrailles disparurent.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montgomery, cependant, était sorti des appartements royaux en proie à un trouble voisin de l’affolement. Il songeait :
– Que se passe-t-il ?… La Châtaigneraie est tué au Grand-Charlemagne, cela ne fait pas de doute pour moi… Tué par Triboulet, c’est sûr. Je vois la scène comme si j’y étais. Et maintenant, le roi m’envoie à l’auberge de la rue aux Fagots pour y arrêter le sieur de Ragastens, l’un des étrangers qui m’ont été signalés, un ami de Triboulet !… Le damné bouffon va causer ma perte au moment où ma fortune s’établissait…
Tout en réfléchissant, Montgomery était descendu dans la cour du château et avait donné des ordres à l’un de ses officiers.
Bientôt cet officier vint lui dire que les vingt hommes demandés étaient prêts.
– Eh bien, suivez-moi ! fit le capitaine.
Il se mit en marche vers la rue aux Fagots.
– Je suis perdu ! murmura-t-il. Si je vais au Grand-Charlemagne, je suis forcé d’arrêter Triboulet. Le bouffon est amené au roi. Et ma faveur, étayée sur un mensonge, s’écroule en même temps que ce mensonge…
– Où allons-nous, monsieur ? lui demanda à ce moment l’officier.
– Nous allons rue aux Fagots.
Et aussitôt il regretta cette réponse.
– Peut-être procéder à une arrestation ?… continua l’officier.
– Oui, une arrestation dans une auberge.
– Laquelle ? Il y a deux auberges dans la rue aux Fagots… Le Grand-Charlemagne et le Soleil-d’Or.
– Eh bien, monsieur, c’est au Soleil-d’Or que nous allons ! fit Montgomery, inspiré par une idée soudaine.
On arriva dans la rue aux Fagots et, sur un signe de Montgomery, la petite troupe s’arrêta devant l’auberge du Soleil-d’Or.
Montgomery entra dans la grande salle.
L’officier plaça des soldats à toutes les issues, puis vint retrouver le capitaine devant qui l’aubergiste et sa femme, tremblants, faisaient force salutations.
– Monsieur, dit Montgomery à l’officier, vous allez vous faire ouvrir les portes de toutes les chambres de l’hôtellerie et m’amener toutes les personnes que vous trouverez dans ces chambres.
Vingt minutes plus tard, les cinq à six voyageurs de l’auberge étaient rassemblés devant le capitaine des gardes.
Tout innocents qu’ils fussent, ces voyageurs tremblaient à qui mieux mieux, pendant que Montgomery les passait en revue sans daigner leur adresser une parole.
Enfin, le capitaine prononça ces mots qui furent accueillis par un soupir de soulagement :
– La personne que nous cherchons n’est pas ici !…
Et s’adressant à l’hôte :
– Vous n’avez pas eu depuis trois jours un voyageur jeune, trente ans à peu près, moustache et cheveux blonds, pourpoint violet, plume blanche à la toque !
– Non, monseigneur, répondit l’hôte courbé jusqu’à terre. Jamais pareil voyageur n’a paru dans mon hôtellerie. D’ailleurs, monseigneur peut s’informer, le Soleil-d’Or a bonne réputation et…
– C’est bien, c’est bien, l’hôte ! fit Montgomery d’un ton rude. En tout cas, nous avons l’œil sur vous, et une autre fois vous ne vous en tirerez pas à si bon compte !
L’hôtelier, abasourdi, leva son bonnet et cria d’une voix étranglée :
– Vive le roi !…
Rentré au château de Fontainebleau, Montgomery se présenta devant le roi, escorté par l’officier qui l’avait accompagné.
– Sire, dit-il, nous avons fait dans l’auberge en question une exacte perquisition, et nous n’y avons pas trouve la personne que m’avait signalée Votre Majesté.
– Je joue de malheur en ce moment, fit le roi.
Le roi ne fut pas contrarié de ce nouvel échec comme Montgomery le redoutait ou feignait de le redouter.
Il était absorbé par ses pensées qui toutes convergeaient à Gillette et à la lettre que lui avait remise Diane de Poitiers. Elle était ainsi conçue :
– Trouvez-vous demain soir à onze heures à la petite porte du parc.
– Demain soir, murmurait le roi, c’est-à-dire ce soir, si, comme cela est probable, la lettre a été perdue hier. Et c’était signé : « Une amie de Gillette. » Qui peut bien être cette amie de Gillette ? Pourquoi écrivait-elle au chevalier de Ragastens ?… Que se trame-t-il ?…
Pendant une heure, le roi réfléchit à cette singulière lettre. Puis, tout à coup, il ordonna à son valet de chambre d’envoyer chercher Sansac.
À ce moment, le roi sentait une extrême vigueur circuler dans ses veines.
C’était donc bien réellement un philtre d’amour, une boisson de jouvence qu’avait absorbée le roi.
Les couleurs lui étaient revenues.
Et ses yeux, bien qu’ayant perdu leur funeste éclat de fièvre, brillaient comme si vraiment il eût été rajeuni de plusieurs années.
Sansac, qu’il avait mandé, arriva et poussa un cri de joyeuse surprise.
– Par la mort-dieu, il semble que Votre Majesté soit ressuscitée ! ne put-il s’empêcher de dire.
– Ressuscité est bien le mot, dit le roi.
Un immense espoir lui venait. Et à se sentir si fort, il en arrivait à croire qu’il vaincrait le mal.
– Viens, dit-il à Sansac, je veux un peu respirer l’air pur de cette matinée. Nous irons jusqu’à l’étang, veux-tu ?
– Je suis aux ordres de Votre Majesté.
– Oui, mais je ne veux pas qu’on nous suive. Tu feras savoir que je veux être seul avec toi dans le parc.
François Ier passa alors dans son antichambre et dans les salons bondés de courtisans.
De violentes acclamations de : « Vive le roi ! » retentirent. Il y eut un bel élan d’enthousiasme.
– Les aurais-je calomniés ? songea François Ier, déjà tout prêt à se convaincre de la sincérité de cette joie et de ce dévouement qui se lisaient sur tous ces visages.
Et il traversa les groupes, distribuant les bonnes paroles et les sourires, tandis que Sansac répétait à Montgomery que le roi voulait être seul dans le parc.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le parc immense et désert était d’une jolie fraîcheur, avec ses jeunes verdures encore frêles et ses premiers chants d’oiseaux.
François Ier marchait silencieusement, escorté par Sansac qui respectait sa rêverie.
Tout à coup, il s’arrêta, caché parmi des touffes de lilas qui n’avait pas encore fleuri, mais dont les grappes de bourgeons semblaient prêtes à éclater en floraisons parfumées.
Il fit signe à Sansac de s’arrêter aussi et de ne faire aucun bruit. Alors il écarta doucement les touffes épaisses du bouquet d’arbustes, et Sansac aperçut une maison d’aspect délabré…
C’était le pavillon des gardes.
Le roi palpitait.
– Tout ce que j’aime est là ! murmura-t-il, Soudain, il pâlit et saisit la main de Sansac.
Dans l’encadrement de l’une des croisées du rez-de-chaussée apparaissait une figure de jeune fille qui, elle aussi, semblait interroger anxieusement le ciel bleu et attendre quelque événement d’où dépendait sa vie.
– Elle ! gronda sourdement le roi.
C’était en effet Gillette.
Mais la jeune fille ne tarda pas à disparaître, et les doigts crispés sur la main de Sansac se détendirent peu à peu.
– Ainsi, demanda Sansac, Votre Majesté aime toujours cette jeune fille ?
– Toujours, ami ! Plus follement que jamais !… Cet amour me torture et me désespère… mais c’est fini…
Sansac regarda fixement François Ier.
– Le roi est le maître ! prononça-t-il.
– Oui, mort-dieu, je suis le maître… Je te dis que c’est fini, Sansac ! Ce soir, nous l’enlevons, tu entends ?
– Bien, sire, dit froidement Sansac. À quelle heure ?
– Lorsque la nuit commencera à tomber.
XXXVII
UN SOIR DE PRINTEMPS
Entre Margentine et Madeleine Ferron, il avait été convenu que Gillette ne serait mise au courant de ce qui se préparait que tout à fait au dernier moment.
La journée se passa donc pour là jeune fille dans une tranquillité relative.
Cependant, sur le soir, l’attitude nerveuse de Margentine commença à l’inquiéter.
– Qu’avez-vous donc, mère ? demanda-elle.
Margentine répondit par d’évasives paroles. Madeleine, qui toute la journée était restée enfermée dans sa chambre, se montra à ce moment.
Elle était plus pâle qu’à son ordinaire, et Gillette ne put s’empêcher de le lui dire.
– Chère enfant, dit Madeleine, ne vous inquiétez pas de moi !
Elle l’attira vers la fenêtre ouverte, et toutes deux s’accoudèrent un instant.
– Quel beau soir ! murmura Madeleine Ferron. Comme on voudrait pouvoir aimer librement et laisser battre son cœur… tandis que…
– Que voulez-vous dire, madame ?… Oh ! parlez… je sens que vous avez au fond du cœur, une immense amertume et je voudrais tant vous consoler !…
– Pauvre petite ! Vous oubliez vos chagrins qui sont réels pour essayer de consoler mes lubies… Croyez-moi mon enfant, je n’ai guère besoin d’être consolée… j’en ai fini avec les amertumes et les dégoûts de la vie… Vous, au contraire, si jeune, toute vibrante d’espoir et d’amour… ne rougissez pas ma fille… l’amour est une noble chose…
Elle ajouta avec un soupir étouffé :
– Le tout est d’être aimée !… Mais vous, vous l’êtes sûrement…
– Comment le savez-vous, madame ?
– Je le sais. Hélas ! j’ai trop l’expérience de ces choses pour pouvoir m’y tromper. Vous êtes aimée, n’en doutez pas…
À ce moment Margentine les appela.
On ferma la croisée et on se mit à table avec cette gaieté contrainte des personnes qui ont à se cacher quelque inquiétude.
Madeleine se pencha vers Margentine.
– Bientôt neuf heures, murmura-t-elle. Il est temps de la prévenir. Moi je vais voir si rien d’inquiétant ne se passe aux alentours.
Elle se leva, s’enveloppa d’une mante et sortit.
Gillette était demeurée rêveuse ; sa pensée était évidemment bien loin de ce pavillon où elle était enfermée.
Cette pensée s’envolait vers la petite maison du Trahoir d’où, par un soir de printemps, pareil à celui-ci, elle avait pour la première fois remarqué ce jeune homme qui la regardait d’un regard si tendre et si ardent à la fois.
– À quoi songes-tu ? demanda Margentine en souriant. Veux-tu que je le dise ? Tu songes à ton amoureux…
– Oui, mère, dit-elle simplement.
Et ses yeux se voilèrent.
– Il est bien loin, dit-elle avec un soupir. Il ne sait pas que je suis ici. Et qui sait s’il pense à moi !
– À quoi veux-tu qu’il pense ? fit naïvement Margentine. Mais tu dis qu’il est bien loin d’ici… Peut-être n’est-il pas aussi loin que tu le crois.
– Que dites-vous, mère ! s’écria Gillette en pâlissant.
Margentine lui prit les deux mains.
– Écoute, mon enfant, dit-elle… L’heure de te désoler est passée ; le moment est venu d’espérer… Que dirais-tu si je t’affirmais que Manfred est à Fontainebleau.
– Oh ! est-ce possible ?
– Que diras-tu si, étant entré dans le parc, il venait te chercher ?…
– Quand ? Oh ! dites-moi quand ?…
– Ce soir, ma fille, ce soir ! Dans deux heures, peut-être avant, il frappera à cette porte…
À ce moment un heurt se fit entendre à la porte. Gillette poussa un cri déchirant, bondit à la porte, tira violemment le verrou que Margentine avait poussé.
– C’est lui ! c’est lui ! cria-t-elle avant que Margentine eût pu faire un geste pour l’arrêter.
La porte ouverte, deux hommes entrèrent.
Gillette recula, cette fois avec un cri d’horreur.
Le premier de ces deux hommes, c’était le roi !…
Margentine, avec une sorte de hurlement sauvage, s’était jetée sur François Ier.
Mais au moment où elle allait l’atteindre, elle sentit à sa tête un coup violent ; il lui sembla que le sol s’effondrait, et elle tomba à la renverse, évanouie, perdant le sang par la blessure que Sansac venait de lui faire en lui assénant un terrible coup sur la nuque.
– Mère ! à moi, mère !…
Gillette voulut crier encore, voulut se débattre…
Mais un bâillon étouffa sa voix, et deux bras vigoureux la saisirent, la réduisirent à l’impuissance, l’emportèrent…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Madeleine Ferron était sortie pour inspecter les environs.
Elle s’écarta assez loin, sonda les bouquets d’arbres, examina les coins sombres, tout cela, dans la direction de la petite porte, – c’est-à-dire dans une direction presque opposée à celle du château.
– Tout va bien, murmura-t-elle enfin ; la rencontre de la nuit dernière n’est qu’un accident ; on ne se méfie de rien ; dans deux heures, Gillette sera sauve, et le roi François m’appartient dès lors… Un peu de patience, Majesté, nous mourrons ensemble !
Convaincue que tout était paisible et que rien n’empêcherait la fuite préparée, Madeleine revint au pavillon.
Elle vit la porte ouverte.
– Un malheur est arrivé ! se dit-elle.
En deux bonds, elle fut à l’intérieur et vit Margentine évanouie, étendue à terre. Gillette avait disparu.
Un terrible blasphème monta aux lèvres de Madeleine. En toute hâte, elle se mit à bassiner d’eau fraîche les tempes de Margentine.
– Ma fille ! put-elle murmurer.
– Que s’est-il passé ? interrogea Madeleine.
– Le roi ! répondit Margentine.
– Il l’a enlevée ?
– Oui !
Devant cette catastrophe imprévue, Madeleine Ferron garda cet étrange sang-froid qu’elle avait en toutes circonstances depuis la nuit tragique où son mari l’avait entraînée au gibet de Montfaucon.
Elle se releva lentement et calcula :
– Il est neuf heures et demie. Ils doivent venir à onze. Mais il faut compter avec l’impatience de l’amour et de l’affection paternelle réunies en Manfred et en Fleurial. Dans une demi-heure, ils seront au rendez-vous…
Tout en monologuant ainsi, elle préparait une compresse composée de vin sucré et d’huile.
Elle l’appliqua sur la blessure et posa un bandage avec une adresse qu’un chirurgien eût admirée.
Cette fois, Margentine revint tout à fait à la vie.
– Ce ne sera rien, dit Madeleine… Eh bien ! où courez-vous ? ajouta-t-elle en se plaçant devant la pauvre mère qui se jetait vers la porte.
– Laissez-moi passer ! gronda Margentine.
– Jamais ! Vous vous feriez tuer inutilement.
– Laissez-moi passer, ou c’est vous que je vais tuer !
– Me tuer ! s’écria Madeleine. Ah ! vous ne savez pas le service que vous me rendriez-là ! Mais il ne s’agit pas de moi. Je vous empêche de faire une folie qui vous perdrait, vous et votre fille… Voulez-vous perdre Gillette ? Qu’allez-vous faire ? Vous heurter à des hommes armés qui vous saisiront et vous jetteront dans un cachot… Et vous aurez donné l’éveil au ravisseur ; vous aurez hâté la perte de votre enfant… Voulez-vous m’écouter ? Voulez-vous sauver Gillette ?
Ces paroles prononcées avec force firent impression sur l’esprit de Margentine.
– Écoutez-moi, dit-elle en revenant à Margentine, avez-vous confiance en moi ?
– Oui ! car j’ai compris la haine que vous avez au cœur, et j’ai compris aussi que pour satisfaire cette haine, vous devez sauver mon enfant.
– Vous avez raison, dit froidement Madeleine. Ma haine contre François vous répond du zèle que je mettrai à sauver votre fille, et je n’ai pas besoin d’invoquer l’affection qu’elle commençait à m’inspirer…
– Pardonnez-moi ! dit Margentine en se jetant dans les bras de Madeleine, la douleur me rend injuste. Parlez.
– Il est temps que je me sépare de vous, murmura Madeleine, car vous auriez fini, à vous deux, par me réconcilier avec la vie… et il eût été trop tard… N’en parlons plus… Vous savez que le rendez-vous avec Manfred est pour onze heures… Vous sentez-vous la force de marcher jusqu’à la petite porte ?
– Jusqu’à Paris, s’il le faut !
– Nous allons sortir toutes les deux et nous rendre au point de rendez-vous. Je me charge d’ouvrir la porte dérobée. Vous sortirez…
– Pendant que ma fille… oh ! jamais !
– C’est donc que vous voulez tout compromettre ? Je vais introduire cinq hommes braves, énergiques, bien armés. Votre présence, pauvre femme nerveuse, blessée, qu’il faudrait protéger, serait un gros obstacle…
– C’est vrai ! fit Margentine en se tordant les mains.
– Attendez-moi ici, dit Madeleine, qui s’élança vers sa chambre.
Quelques minutes plus tard, Margentine la vit reparaître vêtue en cavalier.
Elle portait à la ceinture, outre une épée, une dague, – arme redoutable dans ses mains.
C’était la dague que lui avait donnée François Ier.
C’était avec cette arme qu’elle avait poignardé Ferron, puis, plus tard, Jean le Piètre.
– Je vous disais que j’allais introduire cinq hommes bien armés dans le parc, dit-elle en souriant ; avec moi, cela fera six. Or, que ne peuvent pas six hommes déterminés, prêts à mourir ! Si vous saviez la force que cela donne, d’être prêt à mourir ! Suivez-moi. Votre blessure ?
– Je ne la sens pas !
Madeleine sortit, suivie de Margentine.
Elle prit aussitôt le chemin de la petite porte dérobée.
Elle tenait son poignard à la main.
Dix heures venaient de sonner lorsqu’elle arriva à ce bouquet d’arbres d’où, la nuit précédente, elle avait examiné les allées et venues de la sentinelle.
– Ne bougez pas d’ici ! souffla-t-elle à Margentine.
Alors Madeleine marcha droit à la sentinelle, non seulement sans prendre de précaution pour ne pas être vue, mais en exagérant le bruit de ses pas.
– Halte-là ! cria le soldat.
– Officier ! répondit Madeleine, comme elle avait répondu la veille.
Et elle continua à marcher sur la sentinelle qui, la prenant en effet pour un jeune officier chargé de lui transmettre quelque consigne, la laissa s’approcher.
Mais comme elle arrivait sur lui, il eut sans doute des doutes, car il essaya de croiser sa hallebarde.
– Mon ami, dit Madeleine en écartant d’un geste la lance de l’arme, que diriez-vous si je vous proposais mille livres…
– Je dirais que c’est sans doute pour trahir ma consigne. Passez au large, mon officier…
– Je vous propose mille livres pour vous taire pendant une heure, quoi qu’il arrive.
– Au large ! répondit le soldat. Ou je vous arrête, tout officier que vous êtes !
– Je voulais employer un autre moyen, gronda Madeleine, mais puisque tu le veux… tiens !
Elle avait bondi sur le soldat et, avant que celui-ci eût pu faire un geste ou pousser un cri, lui avait enfoncé son poignard dans la gorge.
Le soldat tomba lourdement.
– Tant pis ! murmura Madeleine un peu pâle… Au reste, il en reviendra peut-être !
Et elle se dirigea vers la porte.
À ce moment, au loin, elle entrevit une lumière qui se balançait et s’avançait vers elle.
En même temps, le cri de veille retentit.
– Si le cri de veille n’est pas répété ici, songea Madeleine avec angoisse, tout est perdu ! Et là-bas… c’est une ronde qui vient ! Si cette ronde ne trouve pas de sentinelle devant la porte…
Quelques secondes se passèrent…
Le cri fut jeté par le factionnaire le plus rapproché de la porte, c’est-à-dire à deux cents pas sur la gauche.
Madeleine n’hésita pas… Elle se tourna vers la sentinelle de droite, invisible dans l’ombre, et cria :
– Sentinelle, garde à vous !
L’instant d’après, elle entendit le soldat répéter le cri qui alla s’éloignant et s’affaiblissant, faisant le tour du parc.
– Et d’un ! murmura Madeleine.
La petite lumière se rapprochait de plus en plus.
C’était évidemment une ronde.
Dans quelques minutes, elle serait là ! Elle verrait le cadavre du soldat tué… L’éveil serait donné…
Tout à coup, Madeleine se pencha vers le corps, le saisit par les pieds, et se mit à le traîner vers le bouquet d’arbres où elle avait laissé Margentine.
Là, en un tour de main, elle enleva le manteau de nuit de la sentinelle et s’en enveloppa.
Puis elle se coiffa de la lourde toque.
Enfin, elle saisit la hallebarde, et, revenant à la porte, se mit à se promener lentement, sans s’en écarter trop.
Deux minutes plus tard, la ronde fut sur elle.
– Veillez bien ! cria le sergent en passant. Et ne vous éloignez pas de la porte…
Madeleine poussa un grognement quelconque, en même temps qu’un soupir de soulagement.
Bientôt la lumière de la lanterne disparut dans l’éloignement. Alors Madeleine courut chercher Margentine, l’entraîna vivement par la main et ouvrit la porte.
Du premier coup d’œil, elle vit la voiture.
Au même instant, elle fut entourée par les cinq hommes.
– En voici toujours une ! dit-elle avec une gaîté qui, dans un pareil moment, était presque sinistre. Quant à l’autre, il faut la conquérir !
Madeleine avait entraîné Margentine jusqu’à la voiture.
– Gillette ! murmurèrent deux voix anxieuses.
– Silence ! fit Madeleine, ou je ne réponds plus de rien.
Et ces hommes stupéfaits, obéirent.
– Entrez là ! dit Madeleine à Margentine en l’entraînant à la voiture. Vous me jurez d’y rester tranquille ?
– J’attendrai ici ! dit Margentine avec fermeté.
Et, épuisée par la perte de sang et la souffrance de sa blessure, elle se laissa tomber à bout de forces sur l’un des coussins de la voiture.
– Entrons ! dit Madeleine, en se dirigeant vers la porte. Ils entrèrent, le cœur battant d’émotion. Elle, tranquillement, referma la porte.
– Prenez la clef, chevalier, ajouta-t-elle en tendant à Ragastens le clef de la petite porte. C’est par là que vous sortirez. Moi, comme vous savez, je reste… Maintenant, suivez-moi.
Ils obéirent silencieusement.
– Qu’a-t-elle pu faire de la sentinelle qui devait être en faction devant la porte ? murmurait Ragastens.
Et comme il se posait cette question, son pied heurta un corps. Il se pencha vivement, toucha quelque chose de tiède et d’humide.
Alors, il se releva en tressaillant et vit que sa main était rouge de sang.
– La sentinelle ! murmura-t-il dans un sursaut d’horreur.
Comme ils approchaient du pavillon des gardes, Madeleine s’arrêta tout à coup et leur fit signe de s’arrêter également. Un homme s’approchait du pavillon.
Il y entra, Madeleine ayant laissé la porte entr’ouverte en sortant avec Margentine.
Cet homme, c’était Sansac.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sansac, on l’a vu, avait accompagné le roi lorsque celui-ci était venu au pavillon. Ils étaient seuls, n’ayant ou ne croyant affaire qu’à deux femmes.
– Charge-toi de la mère, avait dit François Ier, moi, je me charge de la fille…
L’expédition avait réussi au mieux des désirs du roi. Alors Sansac avait escorté le larron jusqu’au château. En arrivant au château, le roi monta de la même allure à ses appartements.
– Retourne là-bas, dit-il à Sansac. Il est inutile que la mère se mette à réveiller le château avec ses cris…
– Et si elle veut crier, sire ?…
– Eh bien… arrange-toi !
Il eut un geste sinistre.
Sansac partit au pas de course.
Le roi entra dans sa chambre, dont il ouvrit la porte d’un violent coup de pied. Il jeta la jeune fille sur son lit.
– Bassignac ! appela-t-il d’une voix rauque.
Le valet de chambre apparut à l’instant.
– Sire ?…
– Tout le monde dort, n’est-ce pas ?…
– Oui, sire !
– Je veux que tout le monde dorme, entends-tu ?
Il y avait dans sa voix un commencement de folie et de délire.
– Oui, sire ! fit Bassignac.
– Préviens Montgomery. Qu’il monte la faction devant l’antichambre ; que personne n’approche de mes appartements…
– Oui, sire !…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sansac s’était mis à courir vers le pavillon des gardes. Il comptait y trouver encore Margentine évanouie, et délibérait avec lui-même s’il se contenterait de la bâillonner, ou s’il la tuerait.
– Le roi ne veut pas qu’elle crie, finit-il par dire : il n’y a que les morts qui ne disent plus rien !
Froidement, il tira sa dague et en tâta la pointe sur son genou.
On n’entendait aucun bruit. Sous la porte entr’ouverte, Sansac voyait le même rais de lumière paisible.
Le gentilhomme entra. Du premier coup d’œil, il vit que Margentine n’était plus là.
– Elle se sera traînée dans la pièce voisine, se dit-il.
Il visita successivement les trois pièces et, ne trouvant personne, revint dans la première, et s’avança vers la porte en maugréant :
– Au diable la donzelle ! Comment la trouver dans le parc ? Il y fait noir comme au four de messer Satanas… Oh ! oh ! serait-ce justement M. Satan ?
En effet, au moment où il arrivait au seuil de la porte, une ombre s’était dressée devant lui, puis une autre… Sansac compta six hommes qui silencieusement entrèrent et refermèrent la porte.
– Qui êtes-vous ? demanda Sansac d’une voix ferme.
L’un des hommes fit un pas en avant des autres, en disant :
– Cet homme m’appartient. Que nul ne bouge… Monsieur, ajouta-t-il en s’adressant à Sansac, n’êtes-vous pas un de ces lâches qui, certain soir de l’hiver dernier, se mirent à quatre pour enlever une jeune fille près de la Croix-du-Trahoir ?…
– Enfer ! vociféra Sansac, c’est le truand !
– Ah ! ah ! Tu me reconnais ! Moi je t’ai reconnu tout de suite au coup dont je t’ai cravaché le visage pour que tu portes à jamais la marque de mon mépris… Défends-toi !…
Et Manfred, laissant glisser son manteau, tomba en garde, l’épée à la main.
Sansac, livide de fureur, avait dégainé de son côté, en grondant :
– Voilà assez longtemps que je te cherche, truand !…
Les deux fers s’étaient choqués et les adversaires se portaient botte sur botte.
– Que venais-tu chercher ici ? reprit Manfred ; encore quelque fille à larronner ? Car vous n’êtes braves qu’avec les femmes, messieurs de la cour, et encore vous vous y mettez à plusieurs !…
– C’est comme vous autres, truands. Vous venez à six pour assassiner un homme. Mais l’homme ne se laissera pas faire sans vous écorcher un peu !…
– Rangez-vous, messieurs ! cria Manfred à ses compagnons. Il ne faut pas que le larron s’imagine qu’on lui a fait l’honneur de venir à six pour lui. Un seul de nous suffit pour quatre des leurs !
– Prends garde, mon enfant ! s’écria anxieusement le chevalier de Ragastens.
En effet, non seulement Sansac se défendait habilement, mais encore il attaquait avec un terrible sang-froid.
Une goutte de sang apparut tout à coup sur la main de Manfred ; il venait d’être touché.
– C’est pour te mettre en goût ! ricana Sansac.
D’un geste prompt comme la foudre, Manfred changea son épée de main, prit sa garde à gauche, et soudain, liant la lame de son adversaire, il le poussa violemment jusqu’au mur, puis se ramassa, puis se détendit, bondit, son épée fila, s’enfonçant dans la poitrine de son adversaire, et alla se briser contre le mur…
Sansac demeura debout quelques secondes, les yeux exorbités, la bouche rouge d’une écume de sang.
Puis, sans un cri, avec seulement un soupir d’une tristesse infinie, il glissa le long du mur et tomba lourdement sur le flanc : il était mort…
– Causons maintenant, dit Manfred en se tournant vers ses compagnons sans plus s’inquiéter de Sansac.
Il avait seulement échangé son épée brisée contre celle du mort.
– Messieurs, dit Madeleine Ferron, je vous ai amenés ici afin que nous puissions tranquillement prendre nos mesures. Gillette et Margentine sa mère étaient dans ce pavillon, il y a deux heures à peine. Mon plan était de les conduire toutes deux jusqu’à la porte dérobée. Je suis sortie pour m’assurer que ce plan était réalisable. Lorsque je suis rentrée, Gillette avait disparu.
Un rauque juron échappa à Manfred.
– Patience, mon fils, dit le chevalier.
– Messieurs, reprit Madeleine, je trouvai Margentine évanouie. Je la ranimai. Elle me dit qu’en mon absence le roi était venu et avait emporté sa fille. Quant à elle, un coup qu’on lui avait porté à la tête l’avait étendue sur le carreau. Voici donc la situation. Gillette est en ce moment au château. Mais où ?
Une sorte de gémissement, plus terrible qu’une menace de mort, monta aux lèvres de Manfred.
Avec le calme et le sang-froid d’un chirurgien qui dissèque un cadavre, Madeleine Ferron continua :
– Remarquez, messieurs, que le roi a d’abord donné un appartement à Gillette dans le château. Puis, jugeant qu’il lui serait plus facile de la vaincre dans ce pavillon, il l’y a fait conduire. Et enfin, ce soir, exaspéré sans doute par je ne sais quel délire – je connais le roi, messieurs ! – poussé par une de ces idées qui le bouleversent tout à coup, il vient, il saisit la jeune fille, et l’emporte. Je vous le dis : elle ne peut-être en ce moment que dans l’appartement du roi…
– Marchons ! dit Manfred.
Fleurial s’écria :
– Je passe devant ; je connais l’appartement, moi !
Lorsque la masse du château se dégagea de l’ombre et leur apparut, d’un mouvement instinctif, ils se serrèrent en peloton… Quelques minutes plus tard, ils bondissaient dans les escaliers.
Soudain, d’un geste, Triboulet les arrêta.
– C’est là ! dit-il à haute voix, comme si toute précaution eût été désormais inutile.
Il montrait un large couloir au bout duquel se trouvait une porte fermée, la porte des appartements royaux…
Deux secondes plus tard, ils furent sur la porte, que Ragastens ouvrit d’un geste violent. Au-delà c’était l’antichambre.
Dans cette antichambre, Montgomery causait à voix basse avec trois officiers. Au long des banquettes, quatre laquais à demi endormis, et au fond, devant une porte, deux hallebardiers gigantesques.
Ragastens, en ouvrant, vit tout cela d’un coup d’œil. Ses compagnons se ruèrent. Et lui referma la porte devant laquelle il se plaça.
– Holà ! avait hurlé Montgomery. Alerte !
Les envahisseurs s’étaient arrêtés l’espace d’un éclair, semblables à des sangliers qui choisissent le chien qu’ils vont éventrer.
Madeleine, du premier coup de poignard, avait abattu l’un des hallebardiers géants, et elle attaquait l’autre.
Manfred et Lanthenay avaient bondi sur les trois officiers.
Ceux-ci avaient dégainé. Mais ni Manfred ni Lanthenay ne tirèrent leurs épées : ils foncèrent furieusement, poignard au poing. En deux secondes, ils furent tout sanglants des coups de pointe qu’ils reçurent, mais trois corps se tordaient dans les convulsions de l’agonie.
Madeleine Ferron, au même moment, poussa un terrible rire : elle venait de se glisser sous la hallebarde du géant et elle lui ouvrait le ventre, d’un coup de poignard.
Les quatre domestiques, à genoux, ivres de terreur, avaient tendu leurs mains à Spadacape pour être liés.
Quant à Montgomery, à l’instant de la porte ouverte, il avait crié « alerte ! » et avait voulu se jeter au dehors.
Devant la porte, il trouva Ragastens.
– Place ! grogna-t-il.
À ce moment, il sentit sur son dos un poids étrange : Triboulet sautait sur lui et, livide, le visage en sueur, la bouche tordue par le rire de la bataille, lui disait :
– Monsieur de Montgomery, votre humble serviteur !…
Il avait incrusté ses dix doigts dans la gorge du capitaine qui, au bout de quelques secondes, s’abattit, peut-être mort, peut-être évanoui seulement.
– À moi ! à moi !
Le cri lamentable de la jeune fille aux abois fusa dans la nuit. Ils se jetèrent sur la porte…
– À moi, mère ! à moi !
– Te tairas-tu !
Le cri d’épouvante et le grondement rauque de l’hystérique en délire se succédèrent.
Alors, voyant la place nette, ils se jetèrent sur la porte qu’ils ébranlèrent.
Une clameur de rage désespérée :
– Fermée ! Malédiction d’enfer ! Fermée !…
– À moi Manfred ! à moi, mon amant !
Le gémissement de Gillette fut quelque chose de tragique, une de ces voix comme on en entend dans les rêves, une voix qui venait de quelque empyrée de l’épouvante…
Manfred, comme un bélier, de son épaule, frappait à coups redoublés…
Et à chaque coup, un halètement sauvage grondait dans sa poitrine en fournaise.
– À moi !… À moi, Manfred !
À cette minute, elle oubliait père, mère, tout ! l’homme aimé seul la pouvait sauver !…
Le bruit de la lutte atroce allait en s’apaisant, derrière la porte. Le cri était d’agonie. Le grondement du fauve en rut, du roi qui n’entendait rien, retentit victorieux.
– Tu es à moi ! Je t’ai !…
Ragastens poussa un cri :
– La banquette !…
Tous les six se ruèrent sur la longue, lourde et énorme banquette de chêne.
Par quelle non croyable force la soulevèrent-ils, l’emportèrent-ils, catapulte tonnante qui, du premier coup, furieusement assénée, fracassa, émietta la lourde porte ?…
Puis il y eut l’infernal bondissement des six qui, pêle-mêle, sanglants, n’ayant plus face humaine, firent irruption.
Debout derrière des fauteuils entassés, Gillette, en arrêt, se défendait encore !
Au même instant, Manfred fut sur elle…
Elle eut un sourire d’extase, d’orgueil, de joie surhumaine, et ferma les yeux, évanouie de bonheur d’être si brusquement rassurée.
Il l’empoigna, la jeta sur son épaule, avec le grognement bref de l’homme qui remet à plus tard de s’émouvoir ; d’une main, il la contenait, de l’autre, il brandissait son poignard… Hébété, stupide d’un étonnement sans nom, le roi bégayait des appels qu’il croyait déchirants et qui franchissaient à peine le bord de ses lèvres.
Manfred s’était élancé vers l’antichambre.
Les cinq l’entouraient en courant…
L’antichambre franchie, ils se jetèrent dans le couloir.
Des cris éclataient maintenant.
– C’est chez Sa Majesté ! criaient des voix.
Cinq, dix, vingt gentilshommes apparurent, la plupart à peine vêtus.
Les six foncèrent.
Ragastens s’était mis en tête.
Sa lourde épée jetait dans le clair-obscur du couloir ses flamboiements.
Il frappait comme avec une cravache, et dans sa main, la rapière sifflait, fouettait, des cris féroces retentissaient.
Et le couloir, sur l’espace d’une douzaine de pas, jusqu’au haut de l’escalier qui conduisait au parc, devint une piste sanglante.
Les six étaient tous blessés.
Mais des cadavres gisaient çà et là…
Derrière eux, le hurlement de délire du roi revenu de sa stupeur éclata :
– Arrête ! Arrête !… Tue !… Tue !…
Livide et rugissant, François Ier accourait, un poignard à la main.
Et lorsqu’il arriva au haut de l’escalier, une vision d’enfer emplit son regard :
Manfred, en bonds frénétiques, descendait l’escalier.
Sur ses épaules, Gillette… Autour de lui, quatre hommes, quatre démons.
Et la foule des courtisans qu’ils avaient franchie, trouée comme un boulet, maintenant, voltigeait, hurlante, autour d’un être fabuleux qui sur la première marche, à lui seul, avec un formidable moulinet d’où giclait un rire plus formidable, contenait la meute !…
– Triboulet !… Triboulet !… Triboulet !…
Le triple cri où il y avait de l’épouvante superstitieuse, de l’horreur, de la haine, de la joie féroce, le triple cri écuma sur les lèvres de François Ier.
– Triboulet ! répéta le délire hurlant des courtisans qui, à peine réveillés, crurent entendre, à ce nom, la trompette du jugement dernier…
Quoi ! Triboulet n’était pas mort !
Quoi ! Son cadavre sortait de la Bastille où l’on savait bien que le bouffon avait lentement crevé au fond d’une basse fosse !
Était-ce un vertige ? une hallucination’?…
– Triboulet ! oui, Triboulet ! éclata le bouffon. Triboulet, sire !… Triboulet, messieurs les seigneurs ! Bonjour, Majesté ! Bonsoir, pourriture ! Bas les pattes, chiens ! Gare au fouet du bouffon !…
XXXIX
DU BOUFFON AU ROI DE FRANCE
La cohue des assaillants riposta par un hurlement de rage, et dix épées pointèrent à la fois sur Triboulet. Une le toucha au front, une autre à l’épaule.
Il descendit deux marches, se couvrant d’un large moulinet, flamboyante barrière infranchissable pour les assaillants qui, pressés, serrés, se gênaient, se portaient obstacle, tandis que, seul, il emplissait la largeur de l’escalier par l’éclair ininterrompu de sa lourde rapière sifflante…
La manœuvre était audacieuse jusqu’à la folie.
Triboulet le savait.
Il mourrait ! Oui ! Il mourrait accablé, écrasé, percé de cent coups… mais ses compagnons auraient le temps de mettre Gillette en sûreté !…
Lentement, il descendit les marches, une à une.
Deux ou trois minutes étaient déjà gagnées.
Il tenait toujours bon, et sa voix railleuse, âpre, cinglait, fouettait les assaillants :
– À vous, Monsieur de Brissac… êtes-vous toujours le premier cocu de France ?… Tiens ! ce cher marquis de Fleury… comment va votre aimable sœur, depuis que Sa Majesté l’a engrossie ?… Patience, Monsieur de Ce !… le Dauphin, à qui vous offrez votre, femme depuis cinq ans, se laissera émouvoir à la longue !…
Il ruisselait de sang. Le sang qu’il perdait par le front, surtout, l’incommodait, l’aveuglait…
Il voulut s’essuyer de sa main gauche.
Cette main était rouge elle-même, et lorsqu’il la retira de son visage, ce visage apparut comme le masque de la Mort Rouge, si horrible, si étincelant, si formidable, qu’il y eut dans la meute un frisson d’horreur et un recul…
Triboulet descendit encore quelques marches.
Maintenant, il était presque à la dernière marche.
D’un bond, il eût pu sauter dans le parc, se perdre dans la nuit, se sauver… Il demeura…
– C’est le démon, vociféraient les courtisans affolés.
– Allons donc ! ricana Triboulet, un démon pour vous ? Vous vous vantez ! Valetaille, c’est un bouffon… Attention, laissez passer François de Valois qui veut me voir de près…
En effet, à ce moment, François Ier, écartant la cohue, descendait, la main crispée sur son poignard, ivre de rage.
– Prenez garde, sire ! supplièrent les courtisans tout en lui livrant passage.
En quelques instants, le roi et le bouffon se trouvèrent face à face, et il y eut comme une trêve, – un arrêt brusque parmi les assaillants.
Le roi jeta une sorte de grognement que nul ne comprit. Mais Triboulet comprit !…
Le grognement, voix effroyable, sans expression ni sens, appelait la fille de François Ier – la fille de Triboulet !
– Gillette ! Où est Gillette ?… rugissait le roi.
– Merde ! tonna le bouffon dans un si formidable grondement qu’il sembla qu’on eût entendu la foudre.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Livide, le roi leva son poignard.
Mais, avant que l’arme ne se fût abattue, le bouffon, grandissant sa taille déjetée, d’un geste de tempête, lança son épée à toute volée sur la foule des courtisans entassés derrière François…
Avant que l’arme ne se fût abattue, la main du bouffon, toute grande ouverte, s’abattit, claqua, retentit sur le visage du roi, d’un si terrible soufflet qu’il sembla à la foule des courtisans que les murailles du château s’écroulaient pour cacher au monde l’effroyable éclat de ce sacrilège.
Sur Triboulet maintenant désarmé, la ruée de l’escalier noir de gens affolés fut un spectacle de délire…
Il était debout, sanglant, sublime. Il avait croisé les bras.
Le mascaret humain dévala sur lui. Cent poignards jetèrent des lueurs d’éclairs. Triboulet tomba.
Plus de vingt coups de poignard le trouèrent, le percèrent à la gorge, à la poitrine, aux épaules, au ventre…
Sa bouche, crispée par l’agonie cracha violemment…
Les visages penchés sur lui reçurent la tragique et rouge insulte… Il mourut… au moment où ses lèvres apaisées cherchaient, dans un frémissement suprême, à murmurer :
– Adieu, Gillette… ma fille…
Ce fut ainsi que sa pauvre âme héroïque s’exhala en même temps que le nom de celle qui avait été tout son amour, toute sa vie…
XL
UN JOUR D’ÉTÉ
On a vu que Manfred, emportant Gillette sur ses épaules, descendit l’escalier, entouré de Ragastens, Lanthenay, Spadacape et Madeleine Ferron qui, dans une épique ruée, s’étaient frayé un passage à travers les courtisans réveillés et accourus au bruit de la lutte dans l’antichambre.
Ils atteignirent donc le parc qu’ils traversèrent de biais en courant, conduits par Madeleine Ferron…
Celle-ci, au bout d’une vingtaine de pas, s’arrêta.
– Adieu ! dit-elle à Ragastens. Adieu à jamais !…
– Venez ! venez ! supplia le chevalier.
– Partez ! Si vous vous arrêtez, vous vous perdez, vous et vos compagnons : ma destinée est liée à celle du roi. Je reste, quand bien même je devrais être foudroyée à l’instant. Partez ! Adieu !
Le chevalier comprit que rien au monde ne pourrait ébranler une telle résolution.
– Écoutez, dit-il rapidement. Je comprends votre projet. Si vous réussissez, si vous êtes saine et sauve, venez vous réfugier en Italie, à Monteforte… Maintenant, adieu, pauvre femme ! Victime de votre haine… de votre amour !
Quelques minutes plus tard, ils atteignirent tous la chaise du voyage. Manfred jetait Gillette évanouie dans les bras de Margentine, et Spadacape prenait place sur le siège. Ils s’apprêtaient à sauter sur leurs chevaux et à fuir.
À ce moment, Ragastens saisit le bras de Manfred.
– Fleurial ! dit-il.
Triboulet n’était pas avec eux !
L’abandonner ? Fuir sans lui ?… La pensée ne leur en vint pas. Haletants et hagards, tous les trois rentrèrent dans le parc.
Spadacape était resté sur le siège de la voiture.
Ivre de joie, Margentine ranimait Gillette de ses caresses.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Madeleine Ferron, ayant dit adieu à Ragastens, s’était glissée vers le château. Elle avait vu, elle, que Triboulet s’était arrêté et elle avait deviné son projet.
Qu’allait-elle faire elle-même ? Elle ne savait pas au juste.
Elle voulait surtout, avant tout, voir la figure du roi à qui on venait d’arracher Gillette…
Elle se glissa d’arbre en arbre et arriva ainsi, guidée par le tumulte, devant l’escalier qu’elle venait de descendre avec Manfred et ses compagnons. Elle y arriva au moment où se levait la main sanglante de Triboulet pour retomber sur le visage de François Ier.
Dans une vision d’horreur, elle eut ce spectacle inouï du bouffon souffletant le roi de son mot énorme, le souffletant de sa main, et tombant ensuite sous les coups, de poignard…
Alors, elle entendit la voix de François Ier hurler :
– Dans le parc ! Ils sont dans le parc ! Cherchez !
Madeleine alors se jeta en courant du côté de la porte dérobée. Elle eut l’intuition que Ragastens et ses amis voudraient attendre Fleurial, et elle voulait les prévenir.
À quelques pas de la porte, elle les rencontra qui entraient dans le parc.
– C’est inutile, dit-elle froidement : Il est mort !
– Fleurial… firent les trois hommes dans une même exclamation douloureuse.
– Il est mort, vous dis-je ! Je l’ai vu tomber sous dix poignards… Fuyez !
Des cris retentissaient dans le parc.
Les sentinelles se répondaient l’une à l’autre.
Des lumières couraient…
– Mort ! sanglota Manfred. Mort pour elle ! Mort pour nous ! Pauvre Triboulet… Habit de bouffon, cœur de héros…
– Alerte ! dit Lanthenay.
– Fuyez ! fuyez ! répétait Madeleine.
Ragastens et Lanthenay entraînèrent Manfred.
Une minute plus tard, ils étaient à cheval, autour de la voiture qui partait à fond de train et bientôt roulait sur la route de Paris.
Quant à Madeleine Ferron, elle était restée dans le parc.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comment échappa-t-elle à la battue qui fut organisée ?
Tous les pavillons qui s’élevaient dans le parc furent soigneusement fouillés de fond en comble, y compris le pavillon des gardes.
Mais enfin, on finit par s’apercevoir au bout de deux heures que la petite porte dérobée était ouverte.
Les sentinelles voisines, interrogées, ne surent que répondre. Ces deux malheureux furent jetés en prison.
On retrouva alors le cadavre de la sentinelle que Madeleine Ferron avait poignardée.
La conclusion générale fut que les truands – car nul ne songeait à la Belle Ferronnière – avaient fui par la porte trouvée ouverte. Ils étaient sans doute déjà bien loin.
Le roi, d’ailleurs, ne donna aucun ordre à ce sujet.
Lorsqu’il avait vu tomber Triboulet, il était lentement remonté à son appartement.
Les personnes qui virent François Ier à ce moment-là certifièrent plus tard que le roi, en ces quelques minutes, avait vieilli de dix ans.
La foudroyante excitation produite par le philtre d’amour était en effet tombée tout d’un coup. Les forces qu’avait avivées le breuvage, le roi les avait pour ainsi dire gaspillées dans ces quelques minutes de rage poussée à son paroxysme.
Il apparut à tous que le soufflet de Triboulet avait tué le roi aussi sûrement que les poignards avaient tué le bouffon.
Lorsqu’on vint annoncer à François Ier que toute recherche avait été vaine et que les truands avaient probablement fui par la petite porte dérobée, il ne dit rien ; mais un profond soupir gonfla sa poitrine, il rentra dans son appartement.
Au moment où il franchissait l’antichambre, deux femmes le regardèrent passer ; l’une avec une sombre joie, l’autre avec un désespoir intense.
La première était Diane de Poitiers ; l’autre la duchesse d’Étampes. Le roi disparu, elles échangèrent un long regard. Puis la duchesse d’Étampes fit un mouvement pour se retirer.
– Où allez-vous, ma chère Anne ? demanda Diane de Poitiers avec un sourire de triomphe.
– Je vais, ma chère Diane, donner l’ordre à mes gens de préparer mon départ pour ma terre…
– J’allais vous donner ce conseil, fit Diane…
Une larme de désespoir monta aux yeux de la duchesse d’Étampes.
Quant au roi, il fit venir le premier officier de sa maison et lui dit :
– Monsieur, je m’ennuie à Fontainebleau. Prenez vos mesures pour que dès demain nous puissions partir pour Rambouillet.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nous ne suivrons pas le chevalier de Ragastens et ses compagnons dans leur voyage à Paris où ils ne séjournèrent que quelques heures pour repartir aussitôt dans la direction de l’Italie.
Nous dirons seulement que la mort de Fleurial fut cachée à Gillette le plus longtemps possible.
Le jour vint cependant où la princesse Béatrix dut lui avouer la vérité. Gillette faillit mourir de douleur.
Mais elle était bien jeune…
Mais elle voyait Manfred si désespéré de son désespoir, si triste de sa tristesse, que, peu à peu, elle essaya tout au moins de dissimuler sa désolation…
Puis cette grande douleur s’effaça lentement – comme s’effacent toutes les grandes douleurs humaines – le temps et l’amour, ces deux grands consolateurs, apaisèrent l’âme endeuillée de Gillette.
Dans Monteforte, jolie ville d’Italie où ils s’étaient réfugiés, le chevalier de Ragastens avait fait élever au milieu d’un jardin un monument de marbre blanc à la mémoire de Triboulet et d’Étienne Dolet.
Deux familles nouvelles s’étaient fondées dans ce coin paisible et riant.
Le 15 juin de l’année où se passèrent les derniers événements que nous avons racontés, un double mariage unit Manfred et Gillette, Lanthenay et Avette.
Cette cérémonie de joie, dans la radieuse journée d’été où elle s’accomplit, fut comme voilée de mélancolie… Les deux jeunes femmes, chacune de son côté, murmurèrent :
– Oh ! mon père, que n’es-tu là !…
Quant au comte de Monclar, il ne recouvra jamais la raison. Les terribles événements qu’avait inspirés et dirigés Ignace de Loyola avaient pour toujours jeté sur ce cerveau la nuit de la folie. Mais cette folie était douce.
Il s’était épris d’une singulière affection pour Avette, qui l’entourait de soins touchants.
Et pour qui eût su quelle part l’ancien grand prévôt avait prise au supplice d’Étienne Dolet, c’eût été un spectacle d’une indicible émotion que de voir la fille du supplicié sourire avec une si belle tendresse au bourreau de son père…
Il est vrai que ce bourreau était le père de son mari !
XLI
RAMBOUILLET
Les voyageurs que leur caprice, leurs affaires ou simplement le hasard amènent à Rambouillet vont presque tous visiter le vieux château classé parmi les monuments historiques de France.
Là, comme dans tous les « monuments historiques », il y a un gardien, qui commence par promener ses clients de passage à travers les vastes salons qui évoquent des visions de fêtes où des marquises poudrées font vis-à-vis à des marquis galants en des pavanes à révérences ; il n’a garde de vous faire grâce d’un trumeau, d’un feston, d’une astragale. Puis enfin, il vous conduit à un couloir écarté qui aboutit à une cour isolée et on se croit tout à coup transporté bien loin du château.
La pièce où nous venons d’entrer est de médiocre dimension. Elle donne sur le parc. Elle est nue.
Elle est triste, d’une pesante tristesse qu’on cherche vainement à secouer.
Et le gardien vous dit :
– C’est là qu’est mort le roi François Ier…
Puis, quand son petit effet est produit, quand il voit ses auditeurs impressionnés à son gré, le brave gardien ajoute :
– Chose étrange, François Ier voulut être transporté dans cette pièce écartée pour y mourir… il ne voulut pas rester dans sa chambre, il ne voulut pas que son agonie fût entourée de soins et de sympathies : on ne sait pourquoi, mais il se fit transporter ici… et il voulut y être seul !
Et dans l’imagination du visiteur s’éveille cette funèbre vision du vieux roi qui veut mourir seul, loin de son appartement, loin de son fils, loin de ses amis, loin de tout.
Pourquoi !…
C’est cette curieuse et mystérieuse particularité que nous allons éclairer et qui servira d’épilogue à notre récit.
Ceci se passait environ vingt jours après la mort tragique de Triboulet.
Dans la chambre de la tour mystérieuse et lointaine où personne ne pénètre, deux femmes causaient à voix basse.
C’étaient Madeleine Ferron et Diane de Poitiers.
Madeleine a suivi la cour à Rambouillet. Elle suit sans déviation la ligne qu’elle s’est tracée. Elle est comme l’ombre funèbre qui marche dans le sillon du roi… Comment a-t-elle pu s’introduire au château ? Par quel effort d’imagination, par quelle patiente étude a-t-elle pu deviner la pensée secrète de Diane de Poitiers ?
Peu importe !… Ce qui importe, c’est qu’elle est apparue un soir à Diane, qu’elle lui a longuement parlé, et que de cette femme supérieure en intrigue politique, elle a fait sa comparse, – disons mieux : sa complice.
La chambre de la tour mystérieuse, Madeleine l’a transformée comme elle avait transformé la chambre où elle avait attiré le roi dans la maison de Fontainebleau. Là aussi, on retrouve le même lit large et profond, la même glace immense, les mêmes tentures de soie, les mêmes fauteuils qui, pendant si longtemps, avaient été familiers au roi de France. Quiconque entre là se trouve transporté comme par magie dans la maison de l’enclos des Tuileries, dans la chambre d’amour qui fut le témoin des caresses prodiguées à François Ier par la prestigieuse magicienne de passion.
L’entretien entre Madeleine Ferron et Diane de Poitiers a duré plus d’une heure.
Enfin, Madeleine remet à Diane une lettre ; puis les deux femmes, debout, échangent un dernier regard de curiosité et d’horreur. C’est qu’à ce moment elles se font peur ; c’est qu’elles frissonnent de s’être si bien et si complètement devinées ; c’est qu’elles incarnent deux fantômes aussi terribles et sinistres l’un que l’autre : Diane incarne l’Ambition, et Madeleine incarne la Mort… Et elles se touchent, et il semble tout naturel qu’elles aient fini par prendre contact… Est-ce que la Mort ne trouve pas dans l’Ambition sa plus fidèle servante ? Est-ce que l’Ambition peut faire un pas qui ne soit guidé par la Mort ?…
Il y a entre elles une minute de silence effrayant… puis elles se séparèrent.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ce jour-là, donc, Diane de Poitiers, en quittant Madeleine Ferron, se rendit dans l’appartement du dauphin et lui dit :
– C’est pour bientôt !…
Henri, fils de François Ier, tressaillit et devint blafard… il s’appuya au bras de Montgomery que Triboulet n’avait pas, paraît-il, tout à fait étranglé, puisque le capitaine des gardes était là, plus en faveur que jamais, auprès du dauphin, ne quittant plus ses appartements et cherchant à assurer sa fortune sous le futur roi, servant la mortelle intrigue qui donnait la couronne au dauphin, avant de servir lui-même d’instrument à la destinée justicière qui devait faire de lui le meurtrier d’Henri II.
Diane de Poitiers ne s’arrêta pas chez le dauphin.
Elle parvint jusqu’aux appartements du roi. Bassignac, – dernier fidèle de François Ier, – montait la faction dans la vaste antichambre déserte et désolée. À ce moment, le chirurgien sortit de la chambre du roi.
– Eh bien ? lui demanda Diane.
– Madame, il y a encore de l’espoir… mais…
– Mais ?… interrogea-t-elle, palpitante.
– Une nuit d’amour, une seule… et le roi mourra !
Le chirurgien se retira en hâte, blême d’avoir dit ce qu’il venait de dire.
– Bassignac, dit Diane, je veux voir le roi.
– Mais Sa Majesté dort, madame. Le chirurgien vient de me l’assurer.
– Affaire d’État ! dit rudement Diane, qui doucement ouvrit la porte, tandis que le serviteur reculait épouvanté.
Diane s’arrêta sur le seuil, le roi dormait d’un sommeil, agité. Lentement, comme une ombre, elle se glissa jusqu’à son lit… Sur le drap, elle plaça, la lettre que venait de lui remettre Madeleine Ferron… puis recula, silencieuse, comme doivent reculer les grands criminels devant leur victime, regagna la porte, s’effaça, disparut…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le roi dort…
Un léger râle sort de ses lèvres tuméfiées, presque noires, crevées de fièvre. Son front et ses pommettes sont d’un rose vif, tandis que les replis au nez et au menton sont d’une pâleur de cire. Sa poitrine découverte est plaquée de taches livides, et aux deux coins de la bouche, il semble que des mouches vénéneuses aient laissé la trace purulente de leur passage ; des érosions humides autour des paupières achèvent de donner à ce masque on ne sait quelle apparence putride.
Des songes funestes traversent le sommeil de François Ier. Il murmure des lambeaux de phrases où reviennent les noms d’Étienne Dolet, de Triboulet et de Gillette. Et un long frisson le secoue tout entier lorsqu’il prononce ce dernier nom…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vers six heures, le roi s’éveilla.
Sa main, à son premier mouvement, toucha la lettre… Il l’ouvrit précipitamment et lut :
« François… ô François… ô mon bien-aimé François… « celle qui a vécu d’amour pour toi, celle qui se meurt « d’amour… celle qui veut mourir d’amour sous tes derniers « baisers t’attend dans la tour… Viens, ô mon bien-aimé, viens « m’aimer une fois encore… puis, tu me tueras si tu veux… »
Le roi passa sa main sur ses yeux, puis relut.
– Cette lettre ! gronda-t-il, d’où vient cette lettre ?… Est-ce la suite de mes abominables cauchemars ? Oh ! ces rêves affreux où des femmes nues s’offrent, impudiques, au délire de mes baisers !… Et quand je veux les étreindre, il n’y a plus rien !… Oui… je dois rêver… Et pourtant non… Cette lettre !… je la touche, je la vois, je la lis ! Enfer ! Je reconnais ton écriture, ribaude damnée ! Et tes paroles versent en moi des laves de passion !… Ah ! tu es venue ! Ah ! tu t’es glissée jusqu’ici !… Ah ! tu veux… Eh bien, oui, j’irai… je saisirai le monstre et je l’étranglerai… je déchirerai de mes dents sa gorge palpitante… oui… je veux… attends, Madeleine… attends… je viens te tuer.
En même temps, le roi rejeta violemment ses couvertures et commença à s’habiller, – seul, pour la première fois de sa vie. Ses yeux maintenant flamboyaient ; un double délire s’emparait de lui, et, malgré son épuisement, lui permettait de se tenir debout… délire érotique, délire de haine, – amour et fureur fermentaient ensemble dans sa tête surchauffée. Il grognait des choses sans nom.
– Gillette, attends-moi… enfin ! tu es à moi… Oh ! cette lettre !… C’est toi qui l’as apportée, Satan !… Ribaude, meurs donc, empoisonneuse !
En quelques minutes, il fut prêt, et, à sa ceinture, il passa un poignard solide, la lame nue.
Au bruit qu’il fit, Bassignac entra et leva les bras au ciel.
– Sire ! Sire ! supplia-t-il…
– Tais-toi ! je veux aller à la tour.
Il voulut se mettre en marche, mais il tomba épuisé sur un fauteuil…
Un juron de fureur fit trembler le vieux valet de chambre.
– Que se passe-t-il ? demandèrent plusieurs voix… En tête des nouveaux arrivants, Diane de Poitiers, attentive, l’esprit tendu.
– À la tour ! grondait le roi. Qu’on me porte à la tour !…
– Il faut satisfaire Sa Majesté ! s’écria Diane.
Sur un signe d’elle, quatre vigoureux laquais soulevèrent le fauteuil et emportèrent le roi soudain apaisé.
Quand il fut devant la porte, il put se soulever, se mit debout et se tourna vers ceux qui l’avaient suivi :
– Que personne n’entre !… sous peine de mort ! Ce qui va se passer là ne regarde que moi…
Courtisans et laquais reculèrent…
Le roi entra et ferma la porte à clef…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alors Diane de Poitiers, ayant vu entrer François Ier dans la chambre de la tour, courut à l’appartement du dauphin Henri, noir de monde, et, par un coup d’audace extraordinaire, remplaçant la formule consacrée, elle s’écria d’une voix triomphale :
– Messieurs, le roi va mourir… Vive le roi !
Et la foule énorme des courtisans, courbés autour du dauphin blafard, cria frénétiquement :
– Vive le roi !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Là-bas, François Ier avait tout de suite saisi son poignard. Il s’avança en grondant. Il la cherchait dans la demi-obscurité. Cela dura une minute… et déjà les parfums d’amour déchaînaient en lui une tempête de volupté… Puis, hagard, délirant, comme emporté par le vertige d’un songe d’agonie, il reconnut le grand lit, le large lit, l’autel d’amour… Et alors, il la vit !… Elle était nue… elle était splendide, elle vibrait, palpitait, les bras tendus vers lui…
Et il jeta son poignard… Il arracha ses vêtements…
Elle avait sauté près de lui, elle l’aidait… et ils roulèrent sur le lit, dans une étreinte furieuse, reconquis tout entiers l’un par l’autre, oubliant leur haine, oubliant qu’ils étaient empoisonnés, ne voyant pas les pustules qui s’ouvraient, hideuses fleurs du mal, sur leurs lèvres et leurs seins !…
Leurs rauques soupirs emplirent la chambre d’un balbutiement de mort et de délices… leurs haleines fétides se confondirent…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les heures sonnèrent… les heures passèrent… La nuit était profonde… Ils n’avaient pas allumé de flambeau…
François Ier, dans un dernier spasme, râlait… hoquetait…
Madeleine le toucha : ses extrémités étaient glacées…
Elle comprit qu’il allait mourir…
Et alors, leur passion à tous deux s’évanouit, balayée par le souffle glacial de la mort… Et il n’y eut plus de vivant en eux que leur haine insondable…
Elle se coucha tout entière sur lui comme pour l’étouffer sous une caresse effroyable…
Sa gorge pantelante s’offrit au baiser de l’amant en agonie…
– Ô mon bien-aimé, gronda-t-elle, aime-moi encore ! encore !…
Alors, lui, dans l’infernale vision de son agonie, entrevit la femme couchée sur lui… cette gorge s’offrant à ses lèvres…
Dans l’effort énorme de son agonie, il ouvrit la bouche toute grande, et férocement, avec une déchirante clameur de volupté, de rage et de mort, planta ses dents dans la gorge de neige, d’un coup de croc formidable.
Un jet de sang les inonda.
Elle poussa un faible soupir et se raidit dans la mort.
Les yeux fous de François Ier contemplèrent le cadavre. Un éclat de rire grinça sur sa bouche rouge de sang, il la saisit à pleins bras… Cela dura une seconde, et ce fut dans l’effort de ce rire et de cette étreinte funèbres qu’il se raidit à son tour en la paix éternelle de la mort consolatrice.
FIN
À propos de cette édition électronique
Texte libre de droits.
Corrections, édition, conversion informatique et publication par le groupe :
Ebooks libres et gratuits
http://fr.groups.yahoo.com/group/ebooksgratuits
Adresse du site web du groupe :
http://www.ebooksgratuits.com/
—
Juin 2007
—
– Élaboration de ce livre électronique :
Les membres de Ebooks libres et gratuits qui ont participé à l’élaboration de ce livre, sont : Gilbert, Véronique, Coolmicro et Fred
– Dispositions :
Les livres que nous mettons à votre disposition, sont des textes libres de droits, que vous pouvez utiliser librement, à une fin non commerciale et non professionnelle. Tout lien vers notre site est bienvenu…
– Qualité :
Les textes sont livrés tels quels sans garantie de leur intégrité parfaite par rapport à l'original. Nous rappelons que c'est un travail d'amateurs non rétribués et que nous essayons de promouvoir la culture littéraire avec de maigres moyens.
Votre aide est la bienvenue !
VOUS POUVEZ NOUS AIDER À FAIRE CONNAÎTRE CES CLASSIQUES LITTÉRAIRES.
[1] L’épisode qui précède cet ouvrage a pour titre : TRIBOULET.
[2] La plupart des historiens placent la date de la condamnation de Dolet au mois d’août. Quelques-uns la placent au mois de janvier, et bien que cette opinion soit la moins accréditée, nous l’avons adoptée de préférence, en raison de certains indices.
[3] Loyola fait ici un atroce calembour : dolet, en latin, signifie : gémit, plaint, – Dolet pia turba dolet veut donc dire : la foule pieuse plaint Dolet.
[4] Mais Dolet lui-même ne plaint pas Dolet.
[5] Tel qu’un cadavre.
[6] Sic, fussent aurait été plus approprié. (Note du correcteur – ELG.)