
VIDOCQ
MÉMOIRES DE VIDOCQ,
CHEF DE LA POLICE DE SÛRETÉ
JUSQU’EN 1827
Aujourd’hui
propriétaire et fabricant
de papier à Saint-Mandé
TOME DEUXIÈME
(1828)
Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » – http://www.ebooksgratuits.com/
Table des matières
Un receleur. – Dénonciation. – Premiers rapports avec la police. – Départ de Lyon. – La méprise.
Séjour à Arras. – Travestissements. – Le faux Autrichien. – Départ. – Séjour à Rouen. – Arrestation.
Le camp de Boulogne. – La rencontre. – Les recruteurs sous l’ancien régime. – M. Belle-Rose.
À propos de cette édition électronique
CHAPITRE XV.
Un receleur. – Dénonciation. – Premiers rapports avec la police. – Départ de Lyon. – La méprise.
D’après les dangers que je courais en restant avec Roman et sa troupe, on peut se faire une idée de la joie que je ressentis de les avoir quittés. Il était évident que le gouvernement, une fois solidement assis, prendrait les mesures les plus efficaces pour la sûreté de l’intérieur. Les débris de ces bandes qui, sous le nom de Chevaliers du Soleil ou de Compagnie de Jésus, devaient leur formation à l’espoir d’une réaction politique, ajournée indéfiniment, ne pouvaient manquer d’être anéantis, aussitôt qu’on le voudrait. Le seul prétexte honnête de leur brigandage, le royalisme, n’existait plus, et quoique les Hiver, les Leprêtre, les Boulanger, les Bastide, les Jausion, et autres fils de famille, se fissent encore une gloire d’attaquer les courriers, parce qu’ils y trouvaient leur profit, il commençait à n’être plus du bon ton de prouver que l’on pensait bien en s’appropriant par un coup de main l’argent de l’état. Tous ces incroyables, à qui il avait semblé piquant d’entraver, le pistolet au poing, la circulation des dépêches et la concentration du produit des impôts, rentraient dans leurs foyers, ceux qui en avaient, ou tâchaient de se faire oublier ailleurs, loin du théâtre de leurs exploits. En définitive, l’ordre se rétablissait, et l’on touchait au terme où des brigands, quelque fût leur couleur ou leur motif, ne jouiraient plus de la moindre considération. J’aurais eu le désir, dans de telles circonstances, de m’enrôler dans une bande de voleurs, que, abstraction faite de l’infamie que je ne redoutais plus, je m’en fusse bien gardé, par la certitude d’arriver promptement à l’échafaud. Mais une autre pensée m’animait, je voulais fuir, à quelque prix que ce fut, les occasions et les voies du crime ; je voulais rester libre. J’ignorais comment ce vœu se réaliserait ; n’importe, mon parti était pris : j’avais fait, comme on dit, une croix sur le bagne. Pressé que j’étais de m’en éloigner de plus en plus, je me dirigeai sur Lyon, évitant les grandes routes jusqu’aux environs d’Orange ; là, je trouvai des rouliers provençaux, dont le chargement m’eut bientôt révélé qu’ils allaient suivre le même chemin que moi. Je liai conversation avec eux, et comme ils me paraissaient d’assez bonnes gens, je n’hésitai pas à leur dire que j’étais déserteur, et qu’ils me rendraient un très grand service, si, pour m’aider à mettre en défaut la vigilance des gendarmes, ils consentaient à m’impatroniser parmi eux. Cette proposition ne leur causa aucune espèce de surprise : il semblait qu’ils se fussent attendus que je réclamerais l’abri de leur inviolabilité. À cette époque, et surtout dans le midi, il n’était pas rare de rencontrer des braves, qui, pour fuir leurs drapeaux, s’en remettaient ainsi prudemment à la garde de Dieu. Il était donc tout naturel que l’on fût disposé à m’en croire sur parole. Les rouliers me firent bon accueil ; quelque argent que je laissai voir à dessein acheva de les intéresser à mon sort. Il fut convenu que je passerais pour le fils du maître des voitures qui composaient le convoi. En conséquence, on m’affubla d’une blouse ; et comme j’étais censé faire mon premier voyage, on me décora de rubans et de bouquets, joyeux insignes qui, dans chaque auberge, me valurent les félicitations de tout le monde.
Nouveau Jean de Paris, je m’acquittai assez bien de mon rôle ; mais les largesses nécessaires pour le soutenir convenablement portèrent à ma bourse de si rudes atteintes, qu’en arrivant à la Guillotière, où je me séparai de mes gens, il me restait en tout vingt-huit sous. Avec de si minces ressources, il n’y avait pas à songer aux hôtels de la place des Terreaux. Après avoir erré quelque temps dans les rues sales et noires de la seconde ville de France, je remarquai, rue des Quatre-Chapeaux, une espèce de taverne, où je pensais que l’on pourrait me servir un souper proportionné à l’état de mes finances. Je ne m’étais pas trompé : le souper fut médiocre, et trop tôt terminé. Rester sur son appétit est déjà un désagrément ; ne savoir où trouver un gîte en est un autre. Quand j’eus essuyé mon couteau, qui pourtant n’était pas trop gras, je m’attristai par l’idée que j’allais être réduit à passer la nuit à la belle étoile, lorsqu’à une table, voisine de la mienne, j’entendis parler cet allemand corrompu, qui est usité dans quelques cantons des Pays-Bas, et que je comprenais parfaitement. Les interlocuteurs étaient un homme et une femme déjà sur le retour ; je les reconnus pour des Juifs. Instruit qu’à Lyon, comme dans beaucoup d’autres villes, les gens de cette caste tiennent des maisons garnies, où l’on admet volontiers les voyageurs en contrebande, je leur demandai s’ils ne pourraient pas m’indiquer une auberge. Je ne pouvais mieux m’adresser : le Juif et sa femme étaient des logeurs. Ils offrirent de devenir mes hôtes, et je les accompagnai chez eux, rue Thomassin. Six lits garnissaient le local dans lequel on m’installa ; aucun d’eux n’était occupé, et pourtant il était dix heures ; je crus que je n’aurais pas de camarades de chambrée, et je m’endormis dans cette persuasion.
À mon réveil, des mots d’une langue qui m’était familière, viennent jusqu’à moi.
– « Voilà six plombes et une mèche qui crossent, dit une voix qui ne m’était pas inconnue ;… tu pionces encore. (Voilà six heures et demie qui sonnent ; tu dors encore.)
– » Je crois bien ;… nous avons voulu maquiller à la sargue chez un orphelin, mais le pautre était chaud ; j’ai vu le moment où il faudrait jouer du vingt-deux ;… et alors il y aurait eu du raisinet. (Nous avons voulu voler cette nuit chez un orfèvre, mais le bourgeois était sur ses gardes ; j’ai vu le moment où il faudrait jouer du poignard ; et alors il y aurait eu du sang !)
– » Ah ! ah ! tu as peur d’aller à l’abbaye de Monte-à-regret… Mais en goupinant comme çà, on n’affure pas d’auber. (Ah ! ah ! tu as peur d’aller à la guillotine… Mais en travaillant de la sorte, on n’attrape pas d’argent.)
– » J’aimerais mieux faire suer le chêne sur le grand trimard, que d’écorner les boucards : on a toujours les lièges sur le dos. (J’aimerais mieux assassiner sur la grande route que de forcer des boutiques ;… on a toujours les gendarmes sur le dos.)
– » Enfin, vous n’avez rien grinchi… Il y avait pourtant de belles foufières, des coucous, des brides d’Orient. Le guinal n’aura rien à mettre au fourgat. (Enfin, vous n’avez rien pris… Il y avait pourtant de belles tabatières, des montres, des chaînes d’or. Le Juif n’aura rien à recéler.)
– » Non. Le carouble s’est esquinté dans la serrante ; le rifflard a battu morasse, et il a fallu se donner de l’air. (Non. La fausse clef s’est cassée dans la serrure ; le bourgeois a crié au secours, et il a fallu se sauver.)
– » Hé ! les autres, dit un troisième interlocuteur, ne balancez donc pas tant le chiffon rouge ; il y a là un chêne qui peut prêter loche. (Ne remuez pas tant la langue ; il y a là un homme qui peut prêter l’oreille.)
L’avis était tardif : cependant on se tut. J’entr’ouvris les yeux pour voir la figure de mes compagnons de chambrée, mais mon lit étant le plus bas de tous, je ne pus rien apercevoir. Je restais immobile pour faire croire à mon sommeil, lorsqu’un des causeurs s’étant levé, je reconnus un évadé du bagne de Toulon, Neveu, parti quelques jours avant moi. Son camarade saute du lit,… c’est Cadet-Paul, autre évadé ;… un troisième, un quatrième individu se mettent sur leur séant, ce sont aussi des forçats.
Il y avait de quoi se croire encore à la salle n° 3. Enfin, je quitte à mon tour le grabat ; à peine ai-je mis le pied sur le carreau, qu’un cri général s’élève : « C’est Vidocq ! ! ! On s’empresse ; on me félicite. L’un des voleurs du garde-meuble, Charles Deschamps, qui s’était sauvé peu de jours après moi, me dit que tout le bagne était dans l’admiration de mon audace et de mes succès. Neuf heures sonnent : on m’emmène déjeûner aux Brotaux, où je trouve les frères Quinet, Bonnefoi, Robineau, Métral, Lemat, tous fameux dans le midi. On m’accable de prévenances, on me procure de l’argent, des habits, et jusqu’à une maîtresse.
J’étais là, comme on voit, dans la même position qu’à Nantes. Je ne me souciais pas plus qu’en Bretagne, d’exercer le métier de mes amis, mais je devais recevoir de ma mère un secours pécuniaire, et il fallait vivre en attendant. J’imaginai que je parviendrais à me faire nourrir quelque temps sans travailler. Je me proposais rigoureusement de n’être qu’en subsistance parmi les voleurs ; mais l’homme propose, et Dieu dispose. Les évadés, mécontents de ce que, tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre, j’évitais de concourir aux vols qu’ils commettaient chaque jour, me firent dénoncer sous main pour se débarrasser d’un témoin importun, et qui pouvait devenir dangereux. Ils présumaient bien que je parviendrais à m’échapper, mais ils comptaient qu’une fois reconnu par la police, et n’ayant plus d’autre refuge que leur bande, je me déciderais à prendre parti avec eux. Dans cette circonstance, comme dans toutes celles du même genre où je me suis trouvé, si l’on tenait tant à m’embaucher, c’est que l’on avait une haute opinion de mon intelligence, de mon adresse, et surtout de ma force, qualité précieuse dans une profession où le profit est trop souvent rapproché du péril.
Arrêté, passage Saint-Côme, chez Adèle Buffin, je fus conduit à la prison de Roanne. Des les premiers mots de mon interrogatoire, je reconnus que j’avais été vendu. Dans la fureur où me jeta cette découverte, je pris un parti violent, qui fut en quelque sorte mon début dans une carrière tout à fait nouvelle pour moi. J’écrivis à M. Dubois, commissaire général de police, pour lui demander à l’entretenir en particulier. Le même soir, on me conduisit dans son cabinet. Après lui avoir expliqué ma position, je lui proposai de le mettre sur les traces des frères Quinet, alors poursuivis pour avoir assassiné la femme d’un maçon de la rue Belle-Cordière. J’offris en outre de donner les moyens de se saisir de tous les individus logés tant chez le Juif que chez Caffin, menuisier, rue Écorche-Bœuf. Je ne mettais à ce service d’autre prix que la liberté de quitter Lyon. M. Dubois devait avoir été plus d’une fois dupe de pareilles propositions ; je vis qu’il hésitait à s’en rapporter à moi. « Vous doutez de ma bonne foi, lui dis-je, la suspecteriez-vous encore, si m’étant échappé dans le trajet pour retourner à la prison, je revenais me constituer votre prisonnier ? – Non, me répondit-il. – Eh bien ! vous me reverrez bientôt, pourvu que vous consentiez à ne faire à mes surveillants aucune recommandation particulière. » Il accéda à ma demande : l’on m’emmena. Arrivé au coin de la rue de la Lanterne, je renverse les deux estafiers qui me tenaient sous les bras, et je regagne à toutes jambes l’Hôtel de Ville, où je retrouve M. Dubois. Cette prompte apparition le surprit beaucoup ; mais, certain dès lors qu’il pouvait compter sur moi, il permit que je me retirasse en liberté.
Le lendemain, je vis le Juif, qu’on nommait Vidal ; il m’annonça que nos amis étaient allés loger à la Croix-Rousse, dans une maison qu’il m’indiqua. Je m’y rendis. On connaissait mon évasion, mais, comme on était loin de soupçonner mes relations avec le commissaire général de police, et qu’on ne supposait pas que j’eusse deviné d’où partait le coup qui m’avait frappé, on me fit un accueil fort amical. Dans la conversation, je recueillis sur les frères Quinet des détails que je transmis la même nuit à M. Dubois, qui, bien convaincu de ma sincérité, me mit en rapport avec M. Garnier, secrétaire général de police, aujourd’hui commissaire à Paris. Je donnai à ce fonctionnaire tous les renseignements nécessaires, et je dois dire qu’il opéra de son côté avec beaucoup de tact et d’activité.
Deux jours avant qu’on effectuât, d’après mes indications, une descente chez Vidal, je me fis arrêter de nouveau. On me reconduisit dans la prison de Roanne, où arrivèrent le lendemain Vidal lui-même, Caffin, Neveu, Cadet-Paul, Deschamps, et plusieurs autres qu’on avait pris du même coup de filet ; je restai d’abord sans communication avec eux, parce que j’avais jugé convenable de me faire mettre au secret. Quand j’en sortis, au bout de quelques jours, pour être réuni aux autres prisonniers, je feignis une grande surprise de trouver là tout mon monde. Personne ne paraissait avoir la moindre idée du rôle que j’avais joué dans les arrestations. Neveu, seul, me regardait avec une espèce de défiance ; je lui en demandai la cause ; il m’avoua qu’à la manière dont on l’avait fouillé et interrogé, il ne pouvait s’empêcher de croire que j’étais le dénonciateur. Je jouai l’indignation, et, dans la crainte que cette opinion ne prît de la consistance, je réunis les prisonniers, je leur fis part des soupçons de Neveu, en leur demandant s’ils me croyaient capable de vendre mes camarades ; tous répondirent négativement, et Neveu se vit contraint de me faire des excuses. Il était bien important pour moi que ces soupçons se dissipassent ainsi, car j’étais réservé à une mort certaine s’ils se fussent confirmés. On avait vu à Roanne plusieurs exemples de cette justice distributive que les détenus exerçaient entre eux. Un nommé Moissel, soupçonné d’avoir fait des révélations, relativement à un vol de vases sacrés, avait été assommé dans les cours, sans qu’on pût jamais découvrir avec certitude quel était l’assassin. Plus récemment, un autre individu, accusé d’une indiscrétion du même genre, avait été trouvé un matin pendu avec un lien de paille aux barreaux d’une fenêtre ; les recherches n’avaient pas eu plus de succès.
Sur ces entrefaites, M. Dubois me manda à son cabinet, où, pour écarter tout soupçon, on me conduisit avec d’autres détenus, comme s’il se fût agi d’un interrogatoire. J’entrai le premier : le commissaire général me dit qu’il venait d’arriver à Lyon plusieurs voleurs de Paris, fort adroits, et d’autant plus dangereux, que, munis de papiers en règle, ils pouvaient attendre en toute sécurité l’occasion de faire quelque coup, pour disparaître aussitôt après : c’étaient Jallier dit Boubance, Bouthey dit Cadet, Garard, Buchard, Mollin dit le Chapellier, Marquis dit Main-d’Or, et quelques autres moins fameux. Ces noms, sous lesquels ils me furent désignés, m’étaient alors tout à fait inconnus ; je le déclarai à M. Dubois, en ajoutant qu’il était possible qu’ils fussent faux. Il voulait me faire relâcher immédiatement, pour qu’en voyant ces individus dans quelque lieu public, je pusse m’assurer s’ils ne m’avaient jamais passé sous les yeux ; mais je lui fis observer qu’une mise en liberté aussi brusque ne manquerait pas de me compromettre vis-à-vis des détenus, dans le cas où le bien du service exigerait qu’on m’écrouât de nouveau. La réflexion parut juste, et il fut convenu qu’on aviserait au moyen de me faire sortir le lendemain sans inconvénient.
Neveu, qui se trouvait parmi les détenus extraits en même temps que moi pour subir l’interrogatoire, me succéda dans le cabinet du commissaire général. Après quelques instants, je l’en vis sortir fort échauffé : je lui demandai ce qui lui était advenu.
« – Croirais-tu, me dit-il, que le curieux m’a demandé si je voulais macaroner des pègres de la grande vergne, qui viennent d’arriver ici ?… S’il n’y a que moi pour les enflaquer, ils pourront bien décarer de belle. (Croirais-tu que le commissaire m’a demandé si je voulais faire découvrir des voleurs qui viennent d’arriver de Paris ? S’il n’y a que moi pour les faire arrêter, ils sont bien sûrs de se sauver.)
» – Je ne te croyais pas si Job, repris-je, songeant rapidement au moyen de tirer parti de cette circonstance… J’ai promis de reconobrer tous les grinchisseurs, et de les faire arquepincer. (Je ne te croyais pas si niais… Moi, j’ai promis de reconnaître tous les voleurs, et de les faire arrêter.)
» – Comment ! tu te ferais cuisinier ;… d’ailleurs tu ne les conobres pas. (Comment ! tu te ferais mouchard ;… d’ailleurs tu ne les connais pas.)
» – Qu’importe ?… on me laissera fourmiller dans la vergne, et je trouverai bien moyen de me cavaler, tandis que tu seras encore avec le chat. (Qu’importe ? on me laissera courir la ville, et je trouverai bien moyen de m’évader, tandis que toi tu resteras avec le geôlier.) »
Neveu fut frappé de cette idée ; il témoignait un vif regret d’avoir repoussé les offres du commissaire général ; et comme je ne pouvais me passer de lui pour aller à la découverte, je le pressai fortement de revenir sur sa première décision ; il y consentit, et M. Dubois, que j’avais prévenu, nous fît conduire tous deux un soir, à la porte du grand théâtre, puis aux Célestins, où Neveu me signala tous nos hommes. Nous nous retirâmes ensuite, escortés par les agents de police, qui nous serraient de fort près. Pour le succès de mon plan et pour ne pas me rendre suspect, il fallait pourtant faire une tentative, qui confirmât au moins l’espoir que j’avais donné à mon compagnon ; je lui fis part de mon projet : en passant rue Mercière, nous entrâmes brusquement dans un passage, dont je tirai la porte sur nous, et pendant que les agents couraient à l’autre issue, nous sortîmes tranquillement par où nous étions entrés. Lorsqu’ils revinrent, tout honteux de leur gaucherie, nous étions déjà loin.
Deux jours après, Neveu, dont on n’avait plus besoin, et qui ne pouvait plus me soupçonner, fut arrêté de nouveau. Pour moi, connaissant alors les voleurs qu’on voulait découvrir, je les signalai aux agents de police, dans l’église de Saint-Nizier, où ils s’étaient réunis un dimanche, dans l’espoir de faire quelque coup à la sortie du salut. Ne pouvant plus être utile à l’autorité, je quittai ensuite Lyon pour me rendre à Paris, où, grâce à M. Dubois, j’étais sûr d’arriver sans être inquiété.
Je partis en diligence par la route de la Bourgogne ; on ne voyageait alors que de jour. À Lucy-le-Bois, où j’avais couché comme tous les voyageurs, on m’oublia au moment du départ, et lorsque je m’éveillai, la voiture était partie depuis plus de deux heures ; j’espérais la rejoindre à la faveur des inégalités de la route, qui est très montueuse dans ces cantons ; mais, en approchant Saint-Brice, je pus me convaincre qu’elle avait trop d’avance sur moi pour qu’il me fût possible de la rattraper ; je ralentis alors le pas. Un individu qui cheminait dans la même direction, me voyant tout en nage, me regarda avec attention, et me demanda si je venais de Lucy-le-Bois ; je lui dis qu’effectivement j’en venais, et la conversation en resta là. Cet homme s’arrêta à Saint-Brice, tandis que je poussai jusqu’à Auxerre. Excédé de fatigue, j’entrai dans une auberge, où, après avoir dîné, je m’empressai de demander un lit.
Je dormais depuis quelques heures, lorsque je fus réveillé par un grand bruit qui se faisait à ma porte. On frappait à coups redoublés ; je me lève demi habillé ; j’ouvre, et mes yeux encore troublés par le sommeil entrevoient des écharpes tricolores, des culottes jaunes et des parements rouges. C’est le commissaire de police flanqué d’un maréchal-des-logis et de deux gendarmes ; à cet aspect, je ne suis pas maître d’une première émotion : « Voyez comme il pâlit, dit-on à mes côtés… Il n’y a pas de doute, c’est lui. » Je lève les yeux, je reconnais l’homme qui m’avait parlé à Saint-Brice, mais rien ne m’expliquait encore le motif de cette subite invasion.
– « Procédons méthodiquement, dit le commissaire… : cinq pieds cinq pouces,… c’est bien çà,… cheveux blonds,… sourcils et barbe idem,… front ordinaire,… yeux gris,… nez fort,… bouche moyenne,… menton rond,… visage plein,… teint coloré,… assez forte corpulence. »
– C’est lui, s’écrient le maréchal-des-logis, les deux gendarmes et l’homme de Saint-Brice.
– « Oui, c’est bien lui, dit à son tour le commissaire… Redingote bleue,… culotte de casimir gris,… gilet blanc,… cravate noire. C’était à peu près mon costume. »
– « Eh bien ! ne l’avais-je pas dit, observe avec une satisfaction marquée l’officieux guide des sbires… c’est un des voleurs ! »
Le signalement s’accordait parfaitement avec le mien, Pourtant je n’avais rien volé ; mais dans ma situation, je ne devais pas moins en concevoir des inquiétudes. Peut-être n’était-ce qu’une méprise ; peut-être aussi… l’assistance s’agitait, transportée de joie. « Paix donc s’écria le commissaire, puis tournant le feuillet, il continua. On le reconnaîtra facilement à son accent italien très prononcé… Il a de plus le pouce de la main droite fortement endommagé par un coup de feu. » Je parlai devant eux ; je montrai ma main droite, elle était en fort bon état. Tous les assistants se regardèrent ; l’homme de Saint-Brice, surtout, parut singulièrement déconcerté ; pour moi, je me sentais débarrassé d’un poids énorme. Le commissaire, que je questionnai à mon tour, m’apprit que la nuit précédente un vol considérable avait été commis à Saint-Brice. Un des individus soupçonnés d’y avoir participé portait des vêtements semblables aux miens, et il y avait identité de signalement. C’était à ce concours de circonstances, à cet étrange jeu du hasard qu’était due la désagréable visite que je venais de recevoir. On me fit des excuses que j’accueillis de bonne grâce, fort heureux d’en être quitte à si bon marché ; toutefois, dans la crainte de quelque nouvelle catastrophe, je montai le soir même dans une patache qui me transporta à Paris, d’où je filai aussitôt sur Arras.
CHAPITRE XVI.
Séjour à Arras. – Travestissements. – Le faux Autrichien. – Départ. – Séjour à Rouen. – Arrestation.
Plusieurs raisons que l’on devine ne permettaient pas que je me rendisse directement à la maison paternelle : je descendis chez une de mes tantes, qui m’apprit la mort de mon père. Cette triste nouvelle me fut bientôt confirmée par ma mère, qui me reçut avec une tendresse bien faite pour contraster avec les traitements affreux que j’avais éprouvés dans les deux années qui venaient de s’écouler. Elle ne désirait rien tant que de me conserver près d’elle ; mais il fallait que je restasse constamment caché ; je m’y résignai : pendant trois mois, je ne quittai pas la maison. Au bout de ce temps, la captivité commençant à me peser, je m’avisai de sortir, tantôt sous un déguisement, tantôt sous un autre. Je pensais n’avoir pas été reconnu, lorsque tout à coup le bruit se répandit que j’étais dans, la ville ; toute la police se mit en quête pour m’arrêter ; à chaque instant on faisait des visites chez ma mère, mais toujours sans découvrir ma cachette : ce n’est pas qu’elle ne fût assez vaste, puisqu’elle avait dix pieds de long sur six de large ; mais je l’avais si adroitement dissimulée, qu’une personne qui plus tard acheta la maison, l’habita près de quatre ans sans soupçonner l’existence de cette pièce ; et probablement elle l’ignorerait encore, si je ne la lui eusse pas révélée.
Fort de cette retraite, hors de laquelle je croyais qu’il serait difficile de me surprendre, je repris bientôt le cours de mes excursions. Un jour de mardi gras, je poussai même l’imprudence jusqu’à paraître au bal Saint-Jacques, au milieu de plus de deux cents personnes. J’étais en costume de marquis ; une femme avec laquelle j’avais eu des liaisons m’ayant reconnu, fit part de sa découverte à une autre femme, qui croyait avoir eu à se plaindre de moi, de sorte qu’en moins d’un quart d’heure tout le monde su sous quels habits Vidocq était caché. Le bruit en vint aux oreilles de deux sergents de ville, Delrue et Carpentier, qui faisaient un service de police au bal. Le premier, s’approchant de moi, me dit à voix basse qu’il désirait me parler en particulier. Un esclandre eût été fort dangereux ; je sortis. Arrivé dans la cour, Delrue me demanda mon nom. Je ne fus pas embarrassé pour lui en donner un autre que le mien, en lui proposant avec politesse de me démasquer s’il l’exigeait. « Je ne l’exige pas, me dit-il ; cependant je ne serais pas fâché de vous voir. – En ce cas, répondis-je, ayez la complaisance de dénouer les cordons de mon masque, qui se sont mêlés… » Plein de confiance, Delrue passe derrière moi ; au même instant, je le renverse par un brusque mouvement d’arrière corps ; un coup de poing envoie rouler son accolyte à terre. Sans attendre qu’ils se relèvent, je fuis à toutes jambes dans la direction des remparts, comptant les escalader et gagner la campagne ; mais à peine ai-je fait quelques pas, que, sans m’en douter, je me trouve engagé dans un cul-de-sac, qui avait cessé d’être une rue depuis que j’avais quitté Arras.
Pendant que je me fourvoyais de la sorte, un bruit de souliers ferrés m’annonça que les deux sergents s’étaient mis à ma poursuite ; bientôt je les vis arriver sur moi sabre en main. J’étais sans armes… Je saisis la grosse clef de la maison, comme si c’eût été un pistolet ; et, faisant mine de les coucher en joue, je les force à me livrer passage. « Passe tin quemin, François, me dit Carpentier d’une voix altérée ;… n’va mie faire de bêtises ». Je ne me le fis pas dire deux fois : en quelques minutes je fus dans mon réduit.
L’aventure s’ébruita, malgré les efforts que firent, pour la tenir secrète, les deux sergents qu’elle couvrit de ridicule. Ce qu’il y eut de fâcheux pour moi, c’est que les autorités redoublèrent de surveillance, à tel point qu’il me devint tout-à-fait impossible de sortir. Je restai ainsi claquemuré pendant deux mois, qui me semblèrent deux siècles. Ne pouvant plus alors y tenir, je me décidai à quitter Arras : on me fit une pacotille de dentelles, et, par une belle nuit, je m’éloignai, muni d’un passe-port qu’un nommé Blondel, l’un de mes amis, m’avait prêté ; le signalement ne pouvait pas m’aller, mais faute de mieux, il fallait bien que je m’en accommodasse ; au surplus, on ne me fit en route aucune objection.
Je vins à Paris, où, tout en m’occupant du placement de mes marchandises, je faisais indirectement quelques démarches, afin de voir s’il ne serait pas possible d’obtenir la révision de mon procès. J’appris qu’il fallait, au préalable, se constituer prisonnier ; mais je ne pus jamais me résoudre à me mettre de nouveau en contact avec des scélérats que j’appréciais trop bien. Ce n’était pas la restreinte qui me faisait horreur ; j’aurais volontiers consenti à être enfermé seul entre quatre murs ; ce qui le prouve, c’est que je demandai alors au ministère à finir mon temps à Arras, dans la prison des fous ; mais la supplique resta sans réponse.
Cependant mes dentelles étaient vendues, mais avec trop peu de bénéfice pour que je pusse songer à me faire de ce commerce un moyen d’existence. Un commis voyageur, qui logeait rue Saint-Martin, dans le même hôtel que moi, et auquel je touchai quelques mots de ma position, me proposa de me faire entrer chez une marchande de nouveautés qui courait les foires. La place me fut effectivement donnée, mais je ne l’occupai que dix mois : quelques désagréments de service me forcèrent à la quitter pour revenir encore une fois à Arras.
Je ne tardai pas à reprendre le cours de mes excursions semi-nocturnes. Dans la maison d’une jeune personne à laquelle je rendais quelques soins, venait très fréquemment la fille d’un gendarme. Je songeai à tirer parti de cette circonstance, pour être informé à l’avance de tout ce qui se tramerait contre moi. La fille du gendarme ne me connaissait pas ; mais comme dans Arras, j’étais le sujet presque habituel des entretiens, il n’était pas extraordinaire qu’elle parlât de moi, et souvent, en des termes fort singuliers. « Oh ! me dit-elle un jour, on finira par l’attraper, ce coquin-là ; il y a d’abord notre lieutenant (M. Dumortier, aujourd’hui commissaire de police à Abbeville) qui lui en veut trop pour ne pas venir à bout de le pincer ; je gage qu’il donnerait de bien bon cœur un jour de sa paie pour le tenir. – Si j’étais à la place de votre lieutenant, et que j’eusse bien envie de prendre Vidocq, repartis-je, il me semble qu’il ne m’échapperait pas.
– » À vous, comme aux autres ;… il est toujours armé jusqu’aux dents. Vous savez bien qu’on dit qu’il a tiré deux coups de pistolets à M. Delrue et à M. Carpentier… Et puis ce n’est pas tout, est-ce qu’il ne se change pas à volonté en botte de foin.
– » En botte de foin ? m’écriai-je, tout surpris de la nouvelle faculté qu’on m’accordait… en botte de foin ?… mais comment ?
– » Oui, monsieur… Mon père le poursuivait un jour ; au moment de lui mettre la main sur le collet, il ne saisit qu’une botte de foin… Il n’y a pas à dire, toute la brigade a vu la botte de foin, qui a été brûlée dans la cour du quartier. »
Je ne revenais pas de cette histoire. On m’expliqua depuis que les agents de l’autorité, ne pouvant venir à bout de se saisir de moi, l’avaient répandue et accréditée en désespoir de cause, parmi les superstitieux Artésiens. C’est par le même motif, qu’ils insinuaient obligeamment que j’étais la doublure de certain loup-garou, dont les apparitions très problématiques glaçaient d’effroi les fortes têtes du pays. Heureusement ces terreurs n’étaient pas partagées par quelques jolies femmes à qui j’inspirais de l’intérêt, et si le démon de la jalousie ne se fût tout à coup emparé de l’une d’entre elles, les autorités ne se seraient peut-être pas de long-temps occupées de moi. Dans son dépit, elle fut indiscrète, et la police, qui ne savait trop ce que j’étais devenu, acquit encore une fois la certitude que j’habitais Arras.
Un soir que, sans défiance et seulement armé d’un bâton, je revenais de la rue d’Amiens, en traversant le pont situé au bout de la rue des Goguets, je fus assailli par sept à huit individus. C’étaient des sergents de ville déguisés ; ils me saisirent par mes vêtements ; et déjà ils se croyaient assurés de leur capture, lorsque, me débarrassant par une vigoureuse secousse, je franchis le parapet et me jetai dans la rivière. On était en décembre ; les eaux étaient hautes, le courant très rapide ; aucun des agents n’eut la fantaisie de me suivre ; ils supposaient d’ailleurs qu’en allant m’attendre sur le bord, je ne leur échapperais pas ; mais un égout que je remontai me fournit l’occasion de déconcerter leur prévoyance, et ils m’attendaient encore, que déjà j’étais installé dans la maison de ma mère.
Chaque jour je courais de nouveaux dangers, et chaque jour la nécessité la plus pressante me suggérait de nouveaux expédients de salut. Cependant, à la longue, suivant ma coutume, je me lassai d’une liberté que le besoin de me cacher rendait illusoire. Des religieuses de la rue de… m’avaient quelque temps hébergé. Je résolus de renoncer à leur hospitalité, et je rêvai en même temps au moyen de me montrer en public sans inconvénient. Quelques milliers de prisonniers autrichiens étaient alors entassés dans la citadelle d’Arras, d’où ils sortaient pour travailler chez les bourgeois, ou dans les campagnes environnantes ; il me vint à l’idée que la présence de ces étrangers pourrait m’être utile. Comme je parlais allemand, je liai conversation avec l’un d’entre eux, et je réussis à lui inspirer assez de confiance pour qu’il me confessât qu’il était dans l’intention de s’évader… Ce projet était favorable à mes vues ; ce prisonnier était embarrassé de ses vêtements de Kaiserlick ; je lui offris les miens en échange, et, moyennant quelque argent que je lui donnai, il se trouva trop heureux de me céder ses papiers. Dès ce moment, je fus Autrichien aux yeux des Autrichiens eux-mêmes, qui, appartenant à différents corps, ne se connaissaient pas entre eux.
Sous ce nouveau travestissement, je me liai avec une jeune veuve qui avait un établissement de mercerie dans la rue de… ; elle me trouvait de l’intelligence ; elle voulut que je m’installasse chez elle ; et bientôt nous courûmes ensemble les foires et les marchés. Il était évident que je ne pouvais la seconder qu’en me faisant comprendre des acheteurs. Je me forgeai un baragouin semi tudesque, semi français ; que l’on entendait à merveille, et qui me devint si familier, qu’insensiblement j’oubliai presque que je savais une autre langue. Du reste, l’illusion était si complète, qu’après quatre mois de cohabitation, la veuve ne soupçonnait pas le moins du monde que le soi-disant Kaiserlick était un de ses amis d’enfance. Cependant elle me traitait si bien, qu’il me devint impossible de la tromper plus long-temps : un jour je me risquai à lui dire enfin qui j’étais, et jamais femme, je crois, ne fut plus étonnée. Mais, loin de me nuire dans son esprit, la confidence ne fit en quelque sorte que rendre notre liaison plus intime, tant les femmes sont éprises parfois de ce qui s’offre à elles sous les apparences du mystère ou de l’aventureux ! et puis n’éprouvent-elles pas toujours du charme à connaître un mauvais sujet ? Qui, mieux que moi, a pu se convaincre que souvent elles sont la providence des forçats évadés et des condamnés fugitifs ?
Onze mois s’écoulèrent sans que rien vînt troubler ma sécurité. L’habitude qu’on avait pris de me voir dans la ville, mes fréquentes rencontres avec des agents de police, qui n’avaient même pas fait attention à moi, tout semblait annoncer la continuation de ce bien-être, lorsqu’un jour que nous venions de nous mettre à table dans l’arrière-boutique, trois figures de gendarmes se montrent, à travers une porte vitrée ; j’allais servir le potage ; la cuillère me tombe des mains. Mais, revenant bientôt de la stupéfaction où m’avait jeté cette incursion inattendue, je m’élance vers la porte, je mets le verrou, puis sautant par une croisée, je monte au grenier, d’où, gagnant par les toits la maison voisine, je descends précipitamment l’escalier qui doit me conduire dans la rue. Arrivé à la porte, elle est gardée par deux gendarmes… Heureusement ce sont des nouveaux venus qui ne connaissent aucune de mes physionomies. « Montez donc, leur dis-je, le brigadier tient l’homme, mais il se débat… Montez, vous donnerez un coup de main ;… moi je vais chercher la garde. » Les deux gendarmes se hâtent de monter et je disparais.
Il était évident qu’on m’avait vendu à la police ; mon amie d’enfance était incapable d’une pareille noirceur, mais elle avait sans doute commis quelque indiscrétion. Maintenant qu’on avait l’éveil sur moi, devais-je rester à Arras ? il eût fallu me condamner à ne plus sortir de ma cachette. Je ne pus me résigner à une vie si misérable, et je pris la résolution d’abandonner définitivement la ville. La mercière voulut à toute force me suivre : elle avait des moyens de transport ; ses marchandises furent promptement emballées. Nous partîmes ensemble ; et comme cela se pratique presque toujours en pareil cas, la police fut informée la dernière de la disparition d’une femme dont il ne lui était pas permis d’ignorer les démarches. D’après une vieille idée, on présuma que nous gagnerions la Belgique, comme si la Belgique eût encore été un pays de refuge ; et tandis qu’on se mettait à notre poursuite dans la direction de l’ancienne frontière, nous nous avancions tranquillement vers la Normandie par des chemins de traverse, que ma compagne avait appris à connaître dans ses explorations mercantiles.
C’était à Rouen que nous avions projeté de fixer notre séjour. Arrivé dans cette ville, j’avais sur moi le passe-port de Blondel, que je m’étais procuré à Arras ; le signalement qu’il me donnait était si différent du mien, qu’il était indispensable de me mettre un peu mieux en règle.
Pour y parvenir, il fallait tromper une police devenue d’autant plus vigilante et ombrageuse, que les communications des émigrés en Angleterre se faisaient par le littoral de la Normandie. Voici comment je m’y pris. Je me rendis à l’Hôtel de Ville, où je fis viser mon passe-port pour le Havre. Un visa s’obtient d’ordinaire assez facilement ; il suffit que le passe-port ne soit pas périmé ; le mien ne l’était pas. La formalité remplie, je sors ; deux minutes après, je rentre dans le bureau, je m’informe si l’on n’a pas trouvé un portefeuille… personne ne peut m’en donner des nouvelles ; alors je suis désespéré ; des affaires pressantes m’appellent au Havre ; je dois partir le soir même et je n’ai plus de passe-port.
« N’est-ce que cela ? me dit un employé… Avec le registre des visas, on va vous donner un passe-port par duplicata. » C’était ce que je voulais ; le nom de Blondel me fut conservé, mais du moins, cette fois, il s’appliquait à mon signalement. Pour compléter l’effet de ma ruse, non seulement je partis pour le Havre, ainsi que je l’avais annoncé, mais encore je fis réclamer par les petites affiches le portefeuille, qui n’était sorti de mes mains que pour passer dans celles de ma compagne.
Au moyen de ce petit tour d’adresse, ma réhabilitation était complète. Muni d’excellents papiers, il ne me restait plus qu’à faire une fin honnête ; j’y songeai sérieusement. En conséquence, je pris, rue Martainville, un magasin de mercerie et de bonneterie, où nous faisions de si bonnes affaires, que ma mère, à qui j’avais fait sous main tenir de mes nouvelles, se décida à venir nous joindre. Pendant un an, je fus réellement heureux ; mon commerce prenait de la consistance, mes relations s’étendaient, le crédit se fondait, et plus d’une maison de banque de Rouen se rappelle peut-être encore le temps où la signature de Blondel était en faveur sur la place ; enfin, après tant d’orages, je me croyais arrivé au port, quand un incident que je n’avais pu prévoir fit commencer pour moi une nouvelle série de vicissitudes… La mercière avec laquelle je vivais, cette femme qui m’avait donné les plus fortes preuves de dévouement et d’amour, ne s’avisa-t-elle pas de brûler d’autres feux que ceux que j’avais allumés dans son cœur. J’aurais voulu pouvoir me dissimuler cette infidélité, mais le délit était flagrant ; il ne restait pas même à la coupable la ressource de ces dénégations bien soutenues, à l’abri desquelles un mari commode peut se figurer qu’il ignore.
Autrefois, je n’eusse pas subi un tel affront sans me livrer à toute la fougue de ma colère :… comme l’on change avec le temps ! Témoin de mon malheur, je signifiai froidement l’arrêt d’une séparation que je résolus aussitôt : prières, supplications, promesses d’une meilleure conduite, rien ne put me fléchir : je fus inexorable… J’aurais pu pardonner sans doute, ne fut-ce que par reconnaissance ; mais qui me répondait que celle qui avait été ma bienfaitrice romprait avec mon rival ? et ne devais-je pas craindre que dans un moment d’épanchement, elle ne me compromît par quelque confidence ? Nous fîmes donc par moitié le partage de nos marchandises ; mon associée me quitta ; depuis, je n’ai plus entendu parler d’elle.
Dégoûté du séjour de Rouen par cette aventure, qui avait fait du bruit, je repris le métier de marchand forain ; mes tournées comprenaient les arrondissements de Mantes, Saint-Germain et Versailles, où je me formai en peu de temps une excellente clientèle ; mes bénéfices devinrent assez considérables pour que je pusse louer à Versailles, rue de la Fontaine, un magasin avec un pied-à-terre, que ma mère habitait pendant mes voyages. Ma conduite était alors exempte de tous reproches ; j’étais généralement estimé dans le cercle que je parcourais ; enfin, je croyais avoir lassé cette fatalité qui me rejetait sans cesse dans les voies du déshonneur, dont tous mes efforts tendaient à m’éloigner, quand, dénoncé par un camarade d’enfance, qui se vengeait ainsi de quelques démêlés que nous avions eus ensemble, je fus arrêté à mon retour de la foire de Mantes. Quoique je soutinsse opiniâtrement que je n’étais pas Vidocq, mais Blondel, comme l’indiquait mon passe-port, on me transféra à Saint-Denis, d’où je devais être dirigé sur Douai. Aux soins extraordinaires qu’on prit pour empêcher mon évasion, je vis que j’étais recommandé ; un coup d’œil que je jetai sur la feuille de la gendarmerie me révéla même une précaution d’un genre tout particulier : voici comment j’y étais désigné.
SURVEILLANCE SPÉCIALE.
« Vidocq (Eugène-François), condamné à mort par contumace. Cet homme est excessivement entreprenant et dangereux. »
Ainsi, pour tenir en haleine la vigilance de mes gardiens, on me représentait comme un grand criminel. Je partis de Saint-Denis, en charrette, garrotté de manière à ne pouvoir faire un mouvement, et jusqu’à Louvres l’escorte ne cessa d’avoir les yeux sur moi ; ces dispositions annonçaient des rigueurs qu’il m’importait de prévenir ; je retrouvai toute cette énergie à laquelle j’avais déjà dû tant de fois la liberté.
On nous avait déposés dans le clocher de Louvres, transformé en prison ; je fis apporter deux matelas, une couverture et des draps, qui, coupés et tressés, devaient nous servir à descendre dans le cimetière ; un barreau fut scié avec les couteaux de trois déserteurs enfermés avec nous ; et à deux heures du matin, je me risquai le premier. Parvenu à l’extrémité de la corde, je m’aperçus qu’il s’en fallait de près de quinze pieds qu’elle n’atteignît le sol : il n’y avait pas à hésiter ; je me laissai tomber. Mais, comme dans ma chute sous les remparts de Lille, je me foulai le pied gauche, et il me devint presque impossible de marcher ; j’essayais néanmoins de franchir les murs du cimetière, lorsque j’entendis tourner doucement la clef dans la serrure. C’était le geôlier et son chien, qui n’avaient pas meilleur nez l’un que l’autre : d’abord le geôlier passa sous la corde sans la voir, et le mâtin près d’une fosse où je m’étais tapis, sans me sentir. Leur ronde faite, ils se retirèrent ; je pensais que mes compagnons suivraient mon exemple ; mais personne ne venant, j’escaladai l’enceinte ; me voilà dans la campagne. La douleur de mon pied devient de plus en plus aiguë… Cependant je brave la souffrance ; le courage me rend des forces, et je m’éloigne assez rapidement. J’avais à peu près parcouru un quart de lieue ; tout à coup j’entends sonner le tocsin ; on était alors à la mi-mai. Aux premières lueurs du jour, je vois quelques paysans armés sortir de leurs habitations pour se répandre dans la plaine ; probablement ils ignoraient de quoi il s’agissait ; mais ma jambe éclopée était un indice qui devait me rendre suspect ; j’étais un visage inconnu ; il était évident que les premiers qui me rencontreraient voudraient, à tout événement, s’assurer de ma personne… Valide, j’eusse déconcerté toutes les poursuites ; il n’y avait plus qu’à me laisser empoigner, et je n’avais pas fait deux cents pas, que, rejoint par les gendarmes, qui parcouraient la campagne, je fus appréhendé au corps, et ramené dans le maudit clocher.
La triste issue de cette tentative ne me découragea pas. À Bapaume, on nous avait mis à la citadelle, dans une ancienne salle de police, placée sous la surveillance d’un poste de conscrits du 30e de ligne ; une seule sentinelle nous gardait ; elle était au bas de la fenêtre, et assez rapprochée des prisonniers pour qu’ils pussent entrer en conversation avec elle ; c’est ce que je fis. Le soldat à qui je m’adressai me parut d’assez bonne composition ; j’imaginai qu’il me serait aisé de le corrompre… Je lui offris cinquante francs pour nous laisser évader pendant sa faction. Il refusa d’abord, mais, au ton de sa voix et à certain clignotement de ses yeux, je crus m’apercevoir qu’il était impatient de tenir la somme ; seulement il n’osait pas. Afin de l’enhardir, j’augmentai la dose, je lui montrai trois louis, et il me répondit qu’il était prêt à nous seconder ; en même temps, il m’apprit que son tour reviendrait de minuit à deux heures. Nos conventions faites, je mis la main à l’œuvre ; la muraille fut percée de manière à nous livrer passage ; nous n’attendions plus que le moment opportun pour sortir. Enfin, minuit sonne, le soldat vient m’annoncer qu’il est là ; je lui donne les trois louis, et j’active les dispositions nécessaires. Quand tout est prêt, j’appelle : Est-il temps ? dis-je à la sentinelle. « – Oui, dépêchez-vous », me répondit-elle, après avoir un instant hésité. Je trouve singulier qu’elle ne m’ait pas répondu de suite ; je crois entrevoir quelque chose de louche dans cette conduite ; je prête l’oreille, il me semble entendre marcher ; à la clarté de la lune, j’aperçois aussi l’ombre de plusieurs hommes sur les glacis ; plus de doute, nous sommes trahis. Cependant, il peut se faire que j’aie trop précipité mon jugement ; pour m’en assurer, je prends de la paille, je fais à la hâte un mannequin, que j’habille ; je le présente à l’issue que nous avions pratiquée ; au même instant, un coup de sabre à pourfendre une enclume m’apprend que je l’ai échappé belle, et me confirme de plus en plus dans cette opinion, qu’il ne faut pas toujours se fier aux conscrits. Soudain la prison est envahie par les gendarmes ; on dresse un procès-verbal, on nous interroge, on veut tout savoir ; je déclare que j’ai donné trois louis ; le conscrit nie ; je persiste dans ma déclaration ; on le fouille, et l’argent se retrouve dans ses souliers ; on le met au cachot.
Quant à nous, on nous fit de terribles menaces, mais comme on ne pouvait pas nous punir, on se contenta de doubler nos gardes… Il n’y avait plus moyen de s’échapper, à moins d’une de ces occasions que j’épiais sans cesse ; elle se présenta plus tôt que je ne l’aurais espéré. Le lendemain était le jour de notre départ ; nous étions descendus dans la cour de la caserne ; il y régnait une grande confusion, causée par la présence simultanée d’un nouveau transport de condamnés et d’un détachement de conscrits des Ardennes, qui se rendaient au camp de Boulogne. Les adjudants disputaient le terrain aux gendarmes pour former les pelotons et faire l’appel. Pendant que chacun comptait ses hommes, je me glisse furtivement dans la civière d’une voiture de bagage qui se disposait à sortir de la cour… Je traversai ainsi la ville, immobile, et me faisant petit autant que je le pouvais, afin de n’être pas découvert. Une fois hors des remparts, il ne me restait plus qu’à m’esquiver ; je saisis le moment où le charretier, toujours altéré, comme les gens de son espèce, était entré dans un bouchon pour se rafraîchir ; et tandis que ses chevaux l’attendaient sur la route, j’allégeai sa voiture d’un poids dont il ne la supposait pas chargée. J’allai aussitôt me cacher dans un champ de colza ; et quand la nuit fut venue, je m’orientai.
CHAPITRE XVII.
Le camp de Boulogne. – La rencontre. – Les recruteurs sous l’ancien régime. – M. Belle-Rose.
Je me dirigeai à travers la Picardie sur Boulogne. À cette époque, Napoléon avait renoncé à son projet d’une descente en Angleterre ; il était allé faire la guerre à l’Autriche avec sa grande armée ; mais il avait encore laissé sur les bords de la Manche de nombreux bataillons. Il y avait dans les deux camps, celui de gauche et celui de droite, des dépôts de presque tous les corps et des soldats de tous les pays de l’Europe, des Italiens, des Allemands, des Piémontais, des Hollandais, des Suisses, et jusqu’à des Irlandais.
Les uniformes étaient très variés ; leur diversité pouvait être favorable pour me cacher… Cependant je crus que ce serait mal me déguiser que d’emprunter l’habit militaire. Je songeai un instant à me faire soldat en réalité. Mais, pour entrer dans un régiment, il eût fallu avoir des papiers ; et je n’en avais pas. Je renonçai donc à mon projet. Cependant le séjour à Boulogne était dangereux, tant que je n’aurais pas trouvé à me fourrer quelque part.
Un jour que j’étais plus embarrassé de ma personne et plus inquiet que de coutume, je rencontrai sur la place de la haute ville un sergent de l’artillerie de marine, que j’avais eu l’occasion de voir à Paris ; comme moi, il était Artésien ; mais, embarqué presque enfant sur un vaisseau de l’état, il avait passé la plus grande partie de sa vie aux colonies ; depuis, il n’était pas revenu au pays, et il ne savait rien de ma mésaventure. Seulement il me regardait comme un bon vivant ; et quelques affaires de cabaret, dans lesquelles je l’avais soutenu avec énergie, lui avaient donné une haute opinion de ma bravoure.
« Te voilà, me dit-il, Roger-Bontemps ; et que fais-tu donc à Boulogne ? – Ce que j’y fais ? Pays, je cherche à m’employer à la suite de l’armée. – Ah ! tu cours après un emploi ; sais-tu que c’est diablement difficile de se placer aujourd’hui ; tiens, si tu veux suivre un conseil… Mais, écoute, ce n’est pas ici que l’on peut s’expliquer à son aise ; entrons chez Galand. » Nous nous dirigeâmes vers une espèce de rogomiste, dont le modeste établissement était situé à l’un des angles de la place. « Ah ! bonjour, Parisien, dit le sergent au cantinier. – Bonjour, père Dufailli, que peut-on vous offrir ? une potée ; du doux ou du rude ? – Vingt-cinq dieu ! papa Galand, nous prenez-vous pour des rafalés ? C’est la fine rémoulade qu’il nous faut, et du vin à trente, entendez-vous ? » Puis il s’adressa à moi : « N’est-il pas vrai, mon vieux, que les amis des amis sont toujours des amis. Tope là », ajouta-t-il en me frappant dans la main ; et il m’entraîna dans un cabinet où M. Galand recevait les pratiques de prédilection.
J’avais grand appétit, et je ne vis pas sans une bien vive satisfaction les apprêts d’un repas dont j’allais prendre ma part. Une femme de vingt-cinq à trente ans, de la taille, de la figure, et de l’humeur de ces filles qui peuvent faire le bonheur de tout un corps de garde, vint nous mettre le couvert : c’était une petite Liégeoise bien vive, bien enjouée, baragouinant son patois, et débitant à tout propos de grosses polissonneries, qui provoquaient le rire du sergent, charmé qu’elle eût autant d’esprit. « C’est la belle-sœur de notre hôte, me dit-il ; j’espère qu’elle en a des bossoirs ; c’est gras comme une pelotte, rond comme une bouée ; aussi est-ce un plaisir. » En même temps Dufailli, arrondissant la forme de ses mains, lui faisait des agaceries de matelot, tantôt l’attirant sur ses genoux (car il était assis), tantôt appliquant sur sa joue luisante un de ces baisers retentissants, qui révèlent un amour sans discrétion.
J’avoue que je ne voyais pas sans peine ce manège, qui ralentissait le service lorsque mademoiselle Jeannette (c’était le nom de la belle-sœur de M. Galand) s’étant brusquement échappée des bras de mon Amphitryon, revint avec une moitié de dinde fortement assaisonnée de moutarde, et deux bouteilles qu’elle plaça devant nous.
« À la bonne heure ! s’écria le sergent ; voilà de quoi chiquer les vivres et pomper les huiles, et je vais m’en acquitter du bon coin. Après çà, nous verrons, car, dans la cassine, tout est à notre discrétion ; je n’ai qu’à faire signe. N’est-il pas vrai, mademoiselle Jeannette ? Oui, mon camarade, continua-t-il, je suis le patron de céans. »
Je le félicitai sur tant de bonheur ; et nous commençâmes l’un et l’autre à manger et à boire largement. Il y avait long-temps que je ne m’étais trouvé à pareille fête ; je me lestai d’importance. Force bouteilles furent vidées ; nous allions, je crois, déboucher la septième, lorsque le sergent sortit, probablement pour satisfaire un besoin, et rentra presque aussitôt, ramenant avec lui deux nouveaux convives ; c’étaient un fourrier et un sergent-major. « Vingt-cinq dieu ! j’aime la société, s’écria Dufailli ; aussi, Pays, viens-je de faire deux recrues : je m’y entends à recruter ; demandez plutôt à ces Messieurs.
» Oh, c’est vrai, répartit le fourrier, à lui le coq, le papa Dufailli, pour inventer des emblèmes et embêter le conscrit : quand j’y pense, fallait-il que je fusse loff pour donner dans un godan pareil ! – Ah ! tu t’en souviens encore ? – Oui, oui, notre ancien, je m’en souviens, et le major aussi, puisque vous avez eu le toupet de l’engager en qualité de notaire du régiment.
– » Eh bien ! n’a-t-il pas fait son chemin ? et, mille noms d’une pipe ! ne vaut-il pas mieux être le premier comptable d’une compagnie de canonniers, que de gratter le papier dans une étude ? Qu’en dis-tu, fourrier ? – Je suis de votre avis ; pourtant… – Pourtant, pourtant, tu me diras peut-être, toi, que tu étais plus heureux, quand, dès le patron minet, il te fallait empoigner l’arrosoir, et te morfondre à jeter du ratafia de grenouilles sur tes tulipes. Nous allions nous embarquer à Brest sur l’Invincible ; tu ne voulais partir que comme jardinier fleuriste du bord : allons t’ai-je dit, va pour jardinier fleuriste ; le capitaine aime les fleurs, chacun son goût, mais aussi chacun son métier ; j’ai fait le mien. Il me semble que je te vois encore : étais-tu emprunté, lorsqu’au lieu de t’employer à cultiver des plantes marines, comme tu t’y attendais, on t’envoya faire la manœuvre de haubans sur du trente-six, et lorsqu’il te fallut mettre le feu au mortier sur la bombarde ! c’était là le bouquet ! Mais ne parlons plus de ça, et buvons un coup. Allons, Pays, verse donc à boire aux camarades. »
Je me mis en train d’emplir les verres. « Tu vois, me dit le sergent, qu’ils ne m’en veulent plus : aussi à nous trois maintenant ne faisons-nous plus qu’une paire d’amis. Ce n’est pas l’embarras, je les ai fait joliment donner dans le panneau ; mais tout çà n’est rien ; nous autres recruteurs de la marine, nous ne sommes que de la Saint-Jean auprès des recruteurs d’autrefois ; vous êtes encore des blancs-becs, et vous n’avez pas connu Belle-Rose ; c’est celui-là qui avait le truque. Tel que vous me voyez, je n’étais pas trop niolle, et cependant il m’emmaillota le mieux du monde. Je crois que je vous ai déjà conté çà, mais, à tout hasard, je vais le répéter pour le Pays.
» Dans l’ancien régime, voyez-vous, nous avions des colonies, l’île de France, Bourbon, la Martinique, la Guadeloupe, le Sénégal, la Guyane, la Louisiane, Saint-Domingue, etc. À présent, çà fait brosse ; nous n’avons plus que l’île d’Oléron ; c’est un peu plus que rien, ou, comme dit cet autre, c’est un pied à terre, en attendant le reste. La descente aurait pu nous rendre tout çà. Mais bah ! la descente, il n’y faut plus songer, c’est une affaire faite : la flottille pourrira dans le port et puis on fera du feu avec la défroque. Mais je m’aperçois que je cours une bordée et que je vais à la dérive ; en avant donc Belle-Rose ! car je crois que c’est de Belle-Rose que je vous parlais.
» Comme je vous le disais c’était un gaillard qui avait le fil ; et puis dans ce temps là les jeunes gens n’étaient pas si allurés qu’aujourd’hui.
» J’avais quitté Arras à quatorze ans, et j’étais depuis six mois à Paris en apprentissage chez un armurier, quand un matin le patron me chargea de porter au colonel des carabiniers, qui demeurait à la Place Royale, une paire de pistolets qu’il lui avait remis en état. Je m’acquittai assez lestement de la commission ; malheureusement ces maudits pistolets devaient faire rentrer dix-huit francs à la boutique ; le colonel me compta l’argent et me donna la pièce. Jusque là c’était à merveille ; mais ne voilà-t-il pas, qu’en traversant la rue du Pélican, j’entends frapper à un carreau. Je m’imagine que c’est quelqu’un de connaissance, je lève le nez, qu’est-ce que je vois ? une madame de Pompadour qui, ses appas à l’air, se carrait derrière une vitre plus claire que les autres ; et qui, par un signe de la tête, accompagné d’un aimable sourire, m’engageait à monter. On eût dit d’une miniature mouvante dans son cadre. Une gorge magnifique, une peau blanche comme de la neige, une poitrine large, et par-dessus le marché une figure ravissante, il n’en fallait pas tant pour me mettre en feu ; j’enfile l’allée, je monte l’escalier quatre à quatre, on m’introduit près de la princesse : c’était une divinité ! – Approche, mon miston, me dit-elle, en me frappant légèrement sur la joue, tu vas me faire ton petit cadeau, n’est-ce pas ?
» Je fouille alors en tremblant dans ma poche, et j’en tire la pièce que le colonel m’avait donnée. – Dis donc petit, continua-t-elle, je crois, ma foi de Dieu, que t’es Picard. Eh bien ! je suis ta payse : oh ! tu paieras bien un verre de vin à ta payse !
» La demande était faite de si bonne grâce ! je n’eus pas la force de refuser ; les dix huit francs du colonel furent entamés. Un verre de vin en amène un autre, et puis deux, et puis trois et puis quatre, si bien que je m’enivrai de boisson et de volupté. Enfin la nuit arriva, et, je ne sais comment cela se fit, mais je m’éveillai dans la rue, sur un banc de pierre, à la porte de l’hôtel des Fermes…
» Ma surprise fut grande, en regardant autour de moi ; elle fut plus grande encore quand je vis le fond de ma bourse :… les oiseaux étaient dénichés…
» Quel moyen de rentrer chez mon bourgeois ? Où aller coucher ? Je pris le parti de me promener en attendant le jour ; je n’avais point d’autre but que de tuer le temps, ou plutôt de m’étourdir sur les suites d’une première faute. Je tournai machinalement mes pas du côté du marché des Innocents. Fiez-vous donc aux payses ! me disais-je en moi-même ; me voilà dans de beaux draps ! encore s’il me restait quelque argent…
» J’avoue que, dans ce moment, il me passa de drôles d’idées par la tête… J’avais vu souvent affiché sur les murs de Paris : Portefeuille perdu, avec mille, deux mille et trois mille francs de récompense à qui le rapporterait. Est-ce que je ne m’imaginai pas que j’allais trouver un de ces portefeuilles ; et dévisageant les pavés un à un, marchant comme un homme qui cherche quelque chose ; j’étais très sérieusement préoccupé de la possibilité d’une si bonne aubaine, lorsque je fus tiré de ma rêverie par un coup de poing qui m’arriva dans le dos. – Eh bien ! Cadet, que fais-tu donc par ici si matin ? – Ah ! c’est toi, Fanfan, et par quel hasard dans ce quartier à cette heure ?
» Fanfan était un apprenti pâtissier, dont j’avais fait la connaissance aux Porcherons ; en un instant, il m’eut appris que depuis six semaines il avait déserté le four, qu’il avait une maîtresse qui fournissait aux appointements, et que, pour le quart d’heure, il se trouvait sans asile, parce qu’il avait pris fantaisie au monsieur de sa particulière de coucher avec elle. Au surplus, ajouta-t-il, je m’en bats l’œil ; si je passe la nuit à la Souricière, le matin je reviens au gîte, et je me rattrape dans la journée. Fanfan le pâtissier me paraissait un garçon dégourdi ; je supposais qu’il pourrait m’indiquer quelque expédient pour me tirer d’affaire ; je lui peignis mon embarras.
– » Ce n’est que ça, me dit-il ; viens me rejoindre à midi au cabaret de la barrière des Sergents ; je te donnerai peut-être un bon conseil : dans tous les cas, nous déjeûnerons ensemble.
» Je fus exact au rendez-vous. Fanfan ne se fit pas attendre ; il était arrivé avant moi : aussitôt que j’entrai, on me conduisit dans un cabinet où je le trouvai en face d’une cloyère d’huîtres, attablé entre deux femelles, dont l’une, en m’apercevant, partit d’un grand éclat de rire. – Et qu’a-t-elle donc celle-là, s’écria Fanfan ? – Eh ! Dieu me pardonne, c’est le pays ! – C’est la payse ! dis-je à mon tour, un peu confus. – Oui, mon minet, c’est la payse. Je voulus me plaindre du méchant tour qu’elle m’avait joué la veille ; mais, en embrassant Fanfan, qu’elle appelait son lapin, elle se prit à rire encore plus fort, et je vis que ce qu’il y avait de mieux à faire, était de prendre mon parti en brave.
» – Eh bien ! me dit Fanfan, en me versant un verre de vin blanc, et m’allongeant une douzaine d’huîtres, tu vois qu’il ne faut jamais désespérer de la Providence ; les pieds de cochon sont sur le gril : aimes-tu les pieds de cochon ? Je n’avais pas eu le temps de répondre à sa question, que déjà ils étaient servis. L’appétit avec lequel je dévorais était tellement affirmatif, que Fanfan n’eut plus besoin de m’interroger sur mon goût. Bientôt le Chablis m’eut mis en gaieté ; j’oubliai les désagréments que pourrait me causer le mécontentement de mon bourgeois, et comme la compagne de ma payse m’avait donné dans l’œil, je me lançai à lui faire ma déclaration. Foi de Dufailli ! elle était gentille à croquer ; elle me rendit la main.
– » Tu m’aimes donc bien, me dit Fanchette, c’était le nom de la péronnelle. – Si je vous aime ! – Eh bien ! si tu veux, nous nous marierons ensemble. – C’est ça, dit Fanfan, mariez-vous ; pour commencer, nous allons faire la noce. Je te marie, Cadet, entends-tu ? Allons, embrassez-vous ; et en même temps, il nous empoigna tous deux par la tête pour rapprocher nos deux visages. – Pauvre chéri, s’écria Fanchette, en me donnant un second baiser, sans l’aide de mon ami ; sois tranquille, je te mettrai au pas.
» J’étais aux anges ; je passai une journée délicieuse. Le soir, j’allai coucher avec Fanchette ; et, sans vanité, elle s’y prit si bien qu’elle eût tout lieu d’être satisfaite de moi.
» Mon éducation fut bientôt faite. Fanchette était toute fière d’avoir rencontré un élève qui profitait si bien de ses leçons ; aussi me récompensait-elle généreusement.
» À cette époque, les notables venaient de s’assembler. Les notables étaient de bons pigeons ; Fanchette les plumait, et nous les mangions en commun. Chaque jour c’étaient des bombances à n’en plus finir. Nous ont-ils fait faire des gueuletons, ces notables, nous en ont-ils fait faire ! Sans compter que j’avais toujours le gousset garni !
» Fanchette et moi nous ne nous refusions rien : mais que les instants du bonheur sont courts !… Oh ! oui, très courts !
» Un mois de cette bonne vie s’était à peine écoulé, que Fanchette et ma payse furent arrêtées et conduites à la Force. Qu’avaient-elles fait ? je n’en sais rien ; mais comme les mauvaises langues parlaient du saut d’une montre à répétition, moi, qui ne me souciais pas de faire connaissance avec M. le lieutenant général de police, je jugeai prudent de ne pas m’en informer.
» Cette arrestation était un coup que nous n’avions pas prévu ; Fanfan et moi, nous en fûmes attérés. Fanchette était si bonne enfant ! Et puis, maintenant que devenir, plus de ressources, me disais-je ; la marmite est renversée ; adieu les huîtres, adieu le Chablis, adieu les petits soins. N’aurait-il pas mieux valu rester à mon étau ? De son côté, Fanfan se reprochait d’avoir renoncé à ses brioches.
» Nous nous avancions ainsi tristement sur le quai de la Ferraille, lorsque nous fûmes tout à coup réveillés par le bruit d’une musique militaire, deux clarinettes, une grosse caisse et des cymbales. La foule s’était rassemblée autour de cet orchestre porté sur une charrette, au-dessus de laquelle flottaient un drapeau et des panaches de toutes les couleurs. Je crois qu’on jouait l’air, Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille ? Quand les musiciens eurent fini, les tambours battirent un banc ; un monsieur galonné sur toutes les coutures se leva et prit la parole, en montrant au public une grande pancarte sur laquelle était représenté un soldat en uniforme. – Par l’autorisation de Sa Majesté, dit-il, je viens ici pour expliquer aux sujets du roi de France les avantages qu’il leur fait en les admettant dans ses colonies. Jeunes gens qui m’entourez, vous n’êtes pas sans avoir entendu parler du pays de Cocagne ; c’est dans l’Inde qu’il faut aller pour le trouver ce fortuné pays ; c’est là que l’on a de tout à gogo.
» Souhaitez-vous de l’or, des perles, des diamants ? les chemins en sont pavés ; il n’y a qu’à se baisser pour en prendre, et encore ne vous baissez-vous pas, les Sauvages les ramassent pour vous.
» Aimez-vous les femmes ? il y en a pour tous les goûts : vous avez d’abord les négresses, qui appartiennent à tout le monde ; viennent ensuite les créoles, qui sont blanches comme vous et moi, et qui aiment les blancs à la fureur, ce qui est bien naturel dans un pays où il n’y a que des noirs ; et remarquez bien qu’il n’est pas une d’elles qui ne soit riche comme un Crésus, ce qui, soit dit entre nous, est fort avantageux pour le mariage.
» Avez-vous la passion du vin ? c’est comme les femmes, il y en a de toutes les couleurs, du malaga, du bordeaux, du champagne, etc. Par exemple, vous ne devez pas vous attendre à rencontrer souvent du bourgogne ; je ne veux pas vous tromper, il ne supporte pas la mer, mais demandez de tous les autres crus du globe, à six blancs la bouteille, vu la concurrence, on sera trop heureux de vous en abreuver. Oui, messieurs, à six blancs, et cela ne vous surprendra pas quand vous saurez que, quelquefois cent, deux cents, trois cents navires tous chargés de vins, sont arrivés en même temps dans un seul port. Peignez-vous alors l’embarras des capitaines : pressés de s’en retourner, ils déposent leur cargaison à terre, en faisant annoncer que ce sera leur rendre service de venir puiser gratis à même les tonneaux.
» Ce n’est pas tout : croyez-vous que ce ne soit pas une grande douceur que d’avoir sans cesse le sucre sous sa main ?
» Je ne vous parle pas du café, des limons, des grenades, des oranges, des ananas, et de mille fruits délicieux qui viennent là sans culture comme dans le Paradis terrestre ; je ne dis rien non plus de ces liqueurs des Îles, dont on fait tant de cas, et qui sont si agréables, que, sauf votre respect, il semble, en les buvant, que le bon Dieu et les anges vous pissent dans la bouche.
» Si je m’adressais à des femmes ou à des enfants, je pourrais leur vanter toutes ces friandises ; mais je m’explique devant des hommes.
» Fils de famille, je n’ignore pas les efforts que font ordinairement les parents pour détourner les jeunes gens de la voie qui doit les conduire à la fortune ; mais soyez plus raisonnables que les papas et surtout que les mamans.
» Ne les écoutez pas, quand ils vous diront que les Sauvages mangent les Européens à la croque-au-sel : tout cela était bon au temps de Christophe Colomb, ou de Robinson Crusoé.
» Ne les écoutez pas, quand ils vous feront un monstre de la fièvre jaune ; la fièvre jaune ? eh ! messieurs, si elle était aussi terrible qu’on le prétend, il n’y aurait que des hôpitaux dans le pays : et Dieu sait qu’il n’y en a pas un seul ?
» Sans doute on vous fera encore peur du climat, je suis trop franc pour ne pas en convenir : le climat est très chaud, mais la nature s’est montrée si prodigue de rafraîchissements, qu’en vérité il faut y faire attention pour s’en apercevoir.
» On vous effraiera de la piqûre des maringouins, de la morsure des serpents à sonnettes. Rassurez-vous ; n’avez-vous pas vos esclaves toujours prêts à chasser les uns ? quant aux autres, ne font-ils pas du bruit tout exprès pour vous avertir ?
» On vous fera des contes sur les naufrages. Apprenez que j’ai traversé les mers cinquante sept fois ; que j’ai vu et revu le bon homme tropique ; que je me soucie d’aller d’un pôle à l’autre comme d’avaler un verre d’eau, et que sur l’Océan où il n’y a ni trains de bois, ni nourrices, je me crois plus en sûreté à bord d’un vaisseau de 74, que dans les casemates du coche d’Auxerre, ou sur la galiote qui va de Paris à Saint-Cloud. En voilà bien assez pour dissiper vos craintes. Je pourrais ajouter au tableau de ces agréments ; … je pourrais vous entretenir de la chasse, de la pêche : figurez-vous des forêts où le gibier est si confiant, qu’il ne songe pas même à prendre la fuite, et si timide, qu’il suffit de crier un peu fort pour le faire tomber ; imaginez des fleuves et des lacs où le poisson est si abondant, qu’il les fait déborder. Tout cela est merveilleux, tout cela est vrai.
» J’allais oublier de vous parler des chevaux : des chevaux, messieurs, on ne fait pas un pas sans en rencontrer par milliers ;… on dirait des troupeaux de moutons ; seulement ils sont plus gros : êtes-vous amateurs ? voulez-vous monter ? vous prenez une corde dans votre poche ; il est bon qu’elle soit un peu longue ; vous avez la précaution d’y faire un nœud coulant ; vous saisissez l’instant où les animaux sont à paître, alors ils ne se doutent de rien ; vous vous approchez doucement, vous faites votre choix, et quand votre choix est fait, vous lancez la corde ; le cheval est à vous, il ne vous reste plus qu’à l’enfourcher ou à l’emmener à la longe, si vous le jugez à propos : car notez bien qu’ici chacun est libre de ses actions.
» Oui, messieurs, je le répète, tout cela est vrai, très vrai, excessivement vrai : la preuve, c’est que le roi de France, Sa Majesté Louis XVI, qui pourrait presque m’entendre de son palais, m’autorise à vous offrir de sa part tant de bienfaits. Oserais-je vous mentir si près de lui ?
» Le roi veut vous vêtir, le roi veut vous nourrir, il veut vous combler de richesses ; en retour, il n’exige presque rien de vous : point de travail, bonne paie ; bonne nourriture, se lever et se coucher à volonté, l’exercice une fois par mois, la parade à la Saint-Louis ; pour celle-là, par exemple, je ne vous dissimule pas que vous ne pouvez pas vous en dispenser, à moins que vous n’en ayez obtenu la permission, et on ne la refuse jamais. Ces obligations remplies, tout votre temps est à vous. Que voulez-vous de plus ? un bon engagement ? vous l’aurez ; mais dépêchez-vous, je vous en préviens ; demain peut-être il ne sera plus temps ; les vaisseaux sont en partance, on n’attend plus que le vent pour mettre à la voile… Accourez donc, Parisiens, accourez. Si, par hasard, vous vous ennuyez d’être bien, vous aurez des congés quand vous voudrez : une barque est toujours dans le port, prête à ramener en Europe ceux qui ont la maladie du pays ; elle ne fait que ça. Que ceux qui désirent avoir d’autres détails viennent me trouver ; je n’ai pas besoin de leur dire mon nom, je suis assez connu ; ma demeure est à quatre pas d’ici, au premier réverbère, maison du marchand de vin. Vous demanderez M. Belle-Rose.
Ma situation me rendit si attentif à ce discours, que je le retins mot pour mot, et quoiqu’il y ait bientôt vingt ans que je l’ai entendu, je ne pense pas en avoir omis une syllabe.
Il ne fit pas moins d’impression sur Fanfan. Nous étions à nous consulter, lorsqu’un grand escogriffe, dont nous ne nous occupions pas le moins du monde, appliqua une calotte à Fanfan, et fit rouler son chapeau par terre. – Je t’apprendrai, lui dit-il, Malpot, à me regarder de travers. Fanfan était tout étourdi du coup ; je voulus prendre sa défense ; l’escogriffe leva à son tour la main sur moi ; bientôt nous fûmes entourés ; la rixe devenait sérieuse, le public prenait ses places ; c’était à qui serait aux premières. Tout à coup un individu perce la foule ; c’était M. Belle-Rose : – Eh bien ! qu’est-ce qu’il y a ? dit-il ; et en désignant Fanfan, qui pleurait, je crois que monsieur a reçu un soufflet : cela ne peut pas s’arranger ; mais monsieur est brave, je lis ça dans ses yeux ; cela s’arrangera. Fanfan voulut démontrer qu’il n’avait pas tort, et ensuite qu’il n’avait pas reçu de soufflet. – C’est égal, mon ami, répliqua Belle-Rose ; il faut absolument s’allonger. – Certainement, dit l’escogriffe, cela ne se passera pas comme ça. Monsieur m’a insulté, il m’en rendra raison ; il faut qu’il y en ait un des deux qui reste sur la place.
» – Eh bien ! soit, l’on vous rendra raison, répondit Belle-Rose ; je réponds de ces messieurs : votre heure ? – La vôtre ? – Cinq heures du matin, derrière l’archevêché. J’apporterai des fleurets.
» La parole était donnée, l’escogriffe se retira, et Belle-Rose frappant sur le ventre de Fanfan, à l’endroit du gilet où l’on met l’argent, y fit résonner quelques pièces, derniers débris de notre splendeur éclipsée : – Vraiment, mon enfant, je m’intéresse à vous, lui dit-il, vous allez venir avec moi ; monsieur n’est pas de trop, ajouta-t-il en me frappant aussi sur le ventre, comme il avait fait à Fanfan.
» M. Belle-Rose nous conduisit dans la rue de la Juiverie, jusqu’à la porte d’un marchand de vin, où il nous fit entrer. – Je n’entrerai pas avec vous, nous dit-il ; un homme comme moi doit garder le décorum ; je vais me débarrasser de mon uniforme, et je vous rejoins dans la minute. Demandez du cachet rouge et trois verres. M. Belle-Rose nous quitta. Du cachet rouge, répéta-t-il en se retournant, du cachet rouge.
» Nous exécutâmes ponctuellement les ordres de M. Belle-Rose, qui ne tarda pas à revenir, et que nous reçûmes chapeau bas. – Ah çà ! mes enfants, nous dit-il, couvrez-vous ; entre nous, pas de cérémonies ; je vais m’asseoir ; où est mon verre ? le premier venu, je le saisis à la première capucine, (il l’avale d’un trait). J’avais diablement soif ; j’ai de la poussière plein la gorge.
» Tout en parlant, M. Belle-Rose lampa un second coup ; puis, s’étant essuyé le front avec son mouchoir, il se mit les deux coudes sur la table, et prit un air mystérieux qui commença à nous inquiéter.
» – Ah çà ! mes bons amis, c’est donc demain que nous allons en découdre. Savez-vous, dit-il à Fanfan, qui n’était rien moins que rassuré, que vous avez affaire à forte partie, une des premières lames de France : il pelotte Saint-Georges. – Il pelotte Saint-Georges ! répétait Fanfan d’un ton piteux en me regardant. – Ah mon Dieu oui, il pelotte Saint-Georges ; ce n’est pas tout, il est de mon devoir de vous avertir qu’il a la main extrêmement malheureuse. – Et moi donc ! dit Fanfan. – Quoi ! vous aussi ? – Parbleu ! je crois bien, puisque, quand j’étais chez mon bourgeois, il ne se passait pas de jour que je ne cassasse quelque chose, ne fût-ce qu’une assiette. – Vous n’y êtes pas, mon garçon, reprit Belle-Rose : on dit d’un homme qu’il a la main malheureuse, quand il ne peut pas se battre sans tuer son homme.
» L’explication était très claire ; Fanfan tremblait de tous ses membres ; la sueur coulait de son front à grosses gouttes ; des nuages blancs et bleus se promenaient sur ses joues rosacées d’apprenti pâtissier, sa face s’alongeait, il avait le cœur gros, il suffoquait ; enfin il laissa échapper un énorme soupir.
– Bravo ! s’écria Belle-Rose, en lui prenant la main dans la sienne ; j’aime les gens qui n’ont pas peur… N’est-ce pas que vous n’avez pas peur ? Puis, frappant sur la table : Garçon ! une bouteille, du même, entends-tu ? c’est monsieur qui régale… Levez-vous donc un peu, mon ami, fendez-vous, relevez-vous, alongez le bras, pliez la saignée, effacez-vous ; c’est ça. Superbe, superbe, délicieux ! Et pendant ce temps, M. Belle-Rose vidait son verre. Foi de Belle-Rose, je veux faire de vous un tireur. Savez-vous que vous êtes bien pris ; vous seriez très bien sous les armes, et il y en a plus de quatre parmi les maîtres qui n’avaient pas autant de dispositions que vous. Que c’est dommage que vous n’ayez pas été montré. Mais non, c’est impossible ; vous avez fréquenté les salles. – Oh ! je vous jure que non, répondit Fanfan. – Avouez que vous vous êtes battu. – Jamais. – Pas de modestie ; à quoi sert de cacher votre jeu ? est-ce que je ne vois pas bien… – Je vous proteste, m’écriai-je alors, qu’il n’a jamais tenu un fleuret de sa vie. – Puisque monsieur l’atteste, il faut bien que je m’en rapporte : mais, tenez, vous êtes deux malins, ce n’est pas aux vieux singes qu’on enseigne à faire des grimaces : confessez-moi la vérité, ne craignez-vous pas que j’aille vous trahir ? ne suis-je plus votre ami ? Si vous n’avez pas de confiance en moi, il vaut autant que je me retire. Adieu messieurs, continua Belle-Rose d’un air courroucé, en s’avançant vers la porte, comme pour sortir.
» – Ah ! monsieur Belle-Rose, ne nous abandonnez pas, s’écria Fanfan ; demandez plutôt à Cadet si je vous ai menti : je suis pâtissier de mon état ; est-ce de ma faute si j’ai des dispositions ? j’ai tenu le rouleau, mais… – Je me doutais bien, dit Belle-Rose, que vous aviez tenu quelque chose. J’aime la sincérité ; la sincérité, vous l’avez ; c’est la principale des vertus pour l’état militaire ; avec celle-là l’on va loin ; je suis sûr que vous ferez un fameux soldat. Mais pour le moment, ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Garçon, une bouteille de vin. Puisque vous ne vous êtes jamais battu, le diable m’emporte si j’en crois rien… et après une minute de silence : c’est égal ; mon bonheur à moi, c’est de rendre service à la jeunesse : je veux vous enseigner un coup, un seul coup. (Fanfan ouvrait de grands yeux.) Vous me promettez bien de ne le montrer à qui que ce soit. – Je le jure, dit Fanfan. – Eh bien, vous serez le premier à qui j’aurai dit mon secret. Faut-il que je vous aime ! un coup auquel il n’y a pas de parade ! un coup que je gardais pour moi seul. N’importe, demain il fera jour, je vous initierai.
» Dès ce moment Fanfan parut moins consterné, il se confondit en remercîments envers M. Belle-Rose, qu’il regardait comme un sauveur ; on but encore quelques rasades au milieu des protestations d’intérêt d’une part, et de reconnaissance de l’autre ; enfin, comme il se faisait tard, M. Belle-Rose prit congé de nous, mais en homme qui connaît son monde. Avant de nous quitter, il eut l’attention de nous indiquer un endroit où nous pourrions aller nous reposer. Présentez-vous de ma part, nous dit-il, au Griffon, rue de la Mortellerie ; recommandez-vous de moi, dormez tranquilles, et vous verrez que tout se passera bien. Fanfan ne se fit pas tirer l’oreille pour payer l’écot ; au revoir, nous dit Belle-Rose, je vendrai vous réveiller.
» Nous allâmes frapper à la porte du Griffon, où l’on nous donna à coucher. Fanfan ne put fermer l’œil : peut-être était-il impatient de connaître le coup que M. Belle-Rose devait lui montrer ; peut-être était-il effrayé ; c’était plutôt ça.
» À la petite pointe du jour, la clef tourne dans la serrure : quelqu’un entre, c’est M. Belle-Rose. Morbleu ! est-ce qu’on dort les uns sans les autres ? branle-bas général partout, s’écrie-t-il. En un instant nous sommes sur pied. Quand nous fûmes prêts, il disparut un moment avec Fanfan, et bientôt après ils revinrent ensemble. – Partons, dit Belle-Rose ; surtout pas de bêtises ; vous n’avez rien à faire, quarte bandée, et il s’enfilera de lui-même.
» Fanfan, malgré la leçon, n’était pas à la noce : arrivé sur le terrain, il était plus mort que vif ; notre adversaire et son témoin étaient déjà au poste. – C’est ici qu’on va s’aligner, dit Belle-Rose, en prenant les fleurets qu’il m’avait remis, et dont il fit sauter les boutons ; puis, mesurant les lames : – Il n’y en aura pas un qui en ait dans le ventre six pouces de plus que l’autre. Allons ! prenez moi çà, M. Fanfan, continua-t-il, en présentant les fleurets en croix.
» Fanfan hésite ; cependant, sur une seconde invitation, il saisit la monture, mais si gauchement qu’elle lui échappe. – Ce n’est rien, dit Belle-Rose en ramassant le fleuret qu’il remet à la main de Fanfan, après l’avoir placé vis-à-vis de son adversaire. Allons ! en garde ! on va voir qui est-ce qui empoignera les zharicots.
» – Un moment, s’écrie le témoin de ce dernier, j’ai une question à faire auparavant. Monsieur, dit-il en s’adressant à Fanfan, qui pouvait à peine se soutenir, n’est ni prévôt ni maître ? – Qu’est-ce que c’est ? répond Fanfan du ton d’un homme qui se meurt. – D’après les lois du duel, reprit le témoin, mon devoir m’oblige à vous sommer de déclarer sur l’honneur si vous êtes prévôt ou maître ? Fanfan garde le silence et adresse un regard à M. Belle-Rose, comme pour l’interroger sur ce qu’il doit dire. – Parlez donc, lui dit encore le témoin. – Je suis,… je suis,… je ne suis qu’apprenti, balbutia Fanfan. – Apprenti, on dit amateur, observa Belle-Rose. – En ce cas, continua le témoin, monsieur l’amateur va se déshabiller, car c’est à sa peau que nous en voulons. – C’est juste, dit Belle-Rose, je n’y songeais pas ; on se déshabillera : vite, vite, M. Fanfan, habit et chemise bas.
» Fanfan faisait une fichue mine ; les manches de son pourpoint n’avaient jamais été si étroites : il se déboutonnait par en bas et se reboutonnait par en haut. Quand il fut débarrassé de son gilet, il ne put jamais venir à bout de dénouer les cordons du col de sa chemise, il fallut les couper ; enfin, sauf la culotte, le voilà nu comme un ver. Belle-Rose lui redonne le fleuret : – Allons ! mon ami, lui dit-il, en garde ! – Défends-toi, lui crie son adversaire ; les fers sont croisés, la lame de Fanfan frémit et s’agite : l’autre lame est immobile ; il semble que Fanfan va s’évanouir. – C’en est assez, s’écrient tout-à-coup Belle-Rose et le témoin, en se jetant sur les fleurets ; c’en est assez, vous êtes deux braves ; nous ne souffrirons pas que vous vous égorgiez ; que la paix soit faite, embrassez-vous, et qu’il n’en soit plus question. Sacredieu ! il ne faut pas tuer tout ce qui est gras… Mais c’est un intrépide ce jeune homme. Appaisez-vous donc, M. Fanfan.
» Fanfan commença à respirer ; il se remit tout-à-fait quand on lui eut prouvé qu’il avait montré du courage ; son adversaire fit pour la frime quelques difficultés de consentir à un arrangement ; mais à la fin il se radoucit ; on s’embrassa ; et il fut convenu que la réconciliation s’achèverait en déjeûnant au parvis Notre-Dame, à la buvette des chantres : c’était là qu’il y avait du bon vin !
» Quand nous arrivâmes, le couvert était mis, le déjeûner prêt : on nous attendait.
» Avant de nous attabler, M. Belle-Rose prit Fanfan et moi en particulier. – Eh bien ! mes amis, nous dit-il, vous savez à présent ce que c’est qu’un duel ; ce n’est pas la mer à boire ; je suis content de vous, mon cher Fanfan, vous vous en êtes tiré comme un ange. Mais il faut être loyal jusqu’au bout : vous comprenez ce que parler veut dire ; il ne faut pas souffrir que ce soit lui qui paie.
» À ces mots le front de Fanfan se rembrunit, car il connaissait le fond de notre bourse. – Eh ! mon Dieu, laissez bouillir le mouton, ajouta Belle-Rose, qui s’aperçut de son embarras, si vous n’êtes pas en argent, je réponds pour le reste ; tenez, en voulez-vous de l’argent ? voulez-vous trente francs ? en voulez-vous soixante ? entre amis, on ne se gêne pas ; et là-dessus il tira de sa poche douze écus de six livres : à vous deux, dit-il, ils sont tous à la vache, cela porte bonheur.
» Fanfan balançait : – Acceptez, vous rendrez quand vous pourrez. À cette condition, on ne risque rien d’emprunter. Je poussai le coude à Fanfan, comme pour lui dire : prends toujours. Il comprit le signe, et nous empochâmes les écus, touchés du bon cœur de M. Belle-Rose.
» Il allait bientôt nous en cuire. Ce que c’est quand on n’a pas d’expérience. Oh ! il avait du service M. Belle-Rose !
» Le déjeuner se passa fort gaiement : on parla beaucoup de l’avarice des parents, de la ladrerie des maîtres d’apprentissage, du bonheur d’être indépendant, des immenses richesses que l’on amasse dans l’Inde : les noms du Cap, de Chandernagor, de Calcutta, de Pondichéry, de Tipoo-Saïb, furent adroitement jetés dans la conversation ; on cita des exemples de fortunes colossales faites par des jeunes gens que M. Belle-Rose avait récemment engagés. – Ce n’est pas pour me vanter, dit-il, mais je n’ai pas la main malheureuse ; c’est moi qui ai engagé le petit Martin, eh bien ! maintenant, c’est un Nabab ; il roule sur l’or et sur l’argent. Je gagerais qu’il est fier ; s’il me revoyait, je suis sûr qu’il ne me reconnaîtrait plus. Oh ! j’ai fait diablement des ingrats dans ma vie ! Que voulez-vous ? c’est la destinée de l’homme !
» La séance fut longue… Au dessert, M. Belle-Rose remit sur le tapis les beaux fruits des Antilles ; quand on but des vins fins : – Vive le vin du Cap ; c’est celui-là qui est exquis, s’écriait-il ; au café, il s’extasiait sur le Martinique ; on apporta du Coignac : Oh ! oh ! dit-il, en faisant la grimace, ça ne vaut pas le tafia, et encore moins l’excellent rhum de la Jamaïque ; on lui versa du parfait-amour : Çà se laisse boire, observa Belle-Rose, mais ce n’est encore que de la petite bierre auprès des liqueurs de la célèbre madame Anfous.
» M. Belle-Rose s’était placé entre Fanfan et moi. Tout le temps du repas il eut soin de nous. C’était toujours la même chanson : videz donc vos verres, et il les remplissait sans cesse. – Qui m’a bâti des poules mouillées de votre espèce ? disait-il d’autres fois ; allons ! un peu d’émulation, voyez-moi, comme j’avale çà.
» Ces apostrophes et bien d’autres produisirent leur effet. Fanfan et moi, nous étions ce qu’on appelle bien pansés, lui surtout. – M. Belle-Rose, c’est-il encore bien loin les colonies, Chambernagor, Sering-a-patame ? c’est-il encore bien loin ? répétait-il de temps à autre, et il se croyait embarqué, tant il était dans les branguesindes. – Patience ! lui répondit enfin Belle-Rose, nous arriverons : en attendant, je vais vous conter une petite histoire. Un jour que j’étais en faction à la porte du gouverneur… – Un jour qu’il était gouverneur, redisait après lui Fanfan. – Taisez-vous donc, lui dit Belle-Rose, en lui mettant la main sur la bouche, c’est quand je n’étais encore que soldat, poursuivit-il. J’étais tranquillement assis devant ma guérite, me reposant sur un sopha, lorsque mon nègre, qui portait mon fusil… Il est bon que vous sachiez que dans les colonies, chaque soldat a son esclave mâle et femelle ; c’est comme qui dirait ici un domestique des deux sexes, à part que vous en faites tout ce que vous voulez, et que s’ils ne vont pas à votre fantaisie, vous avez sur eux droit de vie et de mort, c’est-à-dire que vous pouvez les tuer comme on tue une mouche. Pour la femme, ça vous regarde encore, vous vous en servez à votre idée… j’étais donc en faction, comme je vous disais tout à l’heure ; mon nègre portait mon fusil…
» M. Belle-Rose à peine achevait de prononcer ces mots, qu’un soldat en grande tenue entra dans la salle où nous étions, et lui remit une lettre qu’il ouvrit avec précipitation : C’est du ministre de la marine, dit-il ; M. de Sartine m’écrit que le service du roi m’appelle à Surinam. Eh bien ! va pour Surinam. Diable, ajouta-t-il en s’adressant à Fanfan et à moi, voilà pourtant qui est embarrassant ; je ne comptai pas vous quitter sitôt ; mais, comme dit cet autre, qui compte sans son hôte compte deux fois ; enfin, c’est égal.
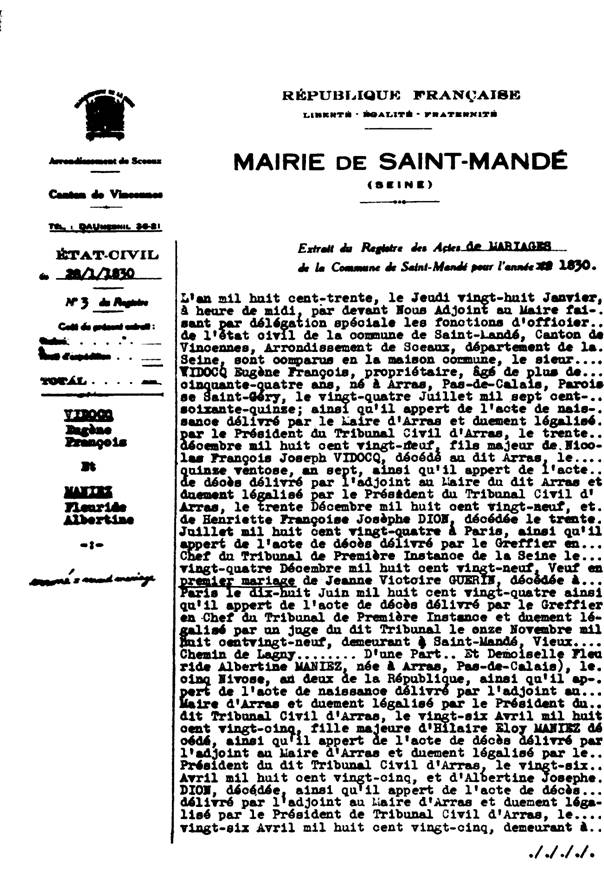
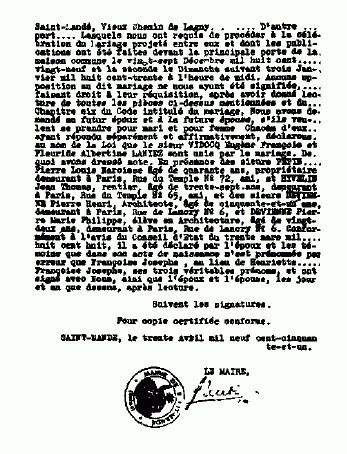
» M. Belle-Rose, prenant alors son verre, de la main droite, frappait à coups redoublés sur la table. Pendant que les autres convives s’esquivaient un à un, enfin une fille de service accourut. – La carte, et faites venir le bourgeois. Le bourgeois arrive en effet, avec une note de la dépense. – C’est étonnant ! comme cela se monte ! observa Belle-Rose, cent quatre-vingt-dix livres douze sols, six deniers ! Ah ! pour le coup, M. Nivet, vous voulez nous écorcher tout vifs ? Voilà d’abord un article que je ne vous passerai pas : quatre citrons vingt-quatre sols. Il n’y en a eu que trois ; première réduction. Peste, papa Nivet, je ne suis plus surpris si vous faites vos orges. Sept demi-tasses ; c’est joli ; il paraît qu’il fait bon vérifier : nous n’étions que six. Je suis sûr que je vais encore découvrir quelque erreur… Asperges, dix-huit livres ; c’est trop fort. – En avril ! dit M. Nivet, de la primeur ! – C’est juste, continuons : petits pois, artichaux, poisson. Le poisson d’avril n’est pas plus cher que l’autre, voyons un peu les fraises… vingt-quatre livres… il n’y a rien à dire… Quant au vin, c’est raisonnable… À présent, c’est à l’addition que je vous attends : pose zéro, retiens un, et trois de retenus… Le total est exact, les 12 sols sont à rabattre, puis les 6 deniers, reste 190 livres. Me trouvez-vous bon pour la somme, papa Nivet ?… – Oh ! oh ! répondit le traiteur, hier oui, aujourd’hui non ;… crédit sur terre tant que vous voudrez, mais une fois que vous serez dans le sabot, où voulez-vous que j’aille vous chercher ? à Surinam ? au Diable les pratiques d’outre-mer !… Je vous préviens que c’est de l’argent qu’il me faut, et vous ne sortirez pas d’ici sans m’avoir satisfait. D’ailleurs, je vais envoyer chercher le guet, et nous verrons…
» M. Nivet sortit fort courroucé en apparence.
» – Il est homme à le faire, nous dit Belle-Rose ; mais il me vient une idée, aux grands maux les grands remèdes. Sans doute que vous ne vous souciez pas plus que moi d’être conduits à M. Lenoir, entre quatre chandelles. Le roi donne 100 francs par homme qui s’engage ; vous êtes deux, cela fait 200 francs,… vous signez votre enrôlement, je cours toucher les fonds, je reviens et je vous délivre. Qu’en dites-vous ?
» Fanfan et moi nous gardions le silence. – Quoi ! vous hésitez ? j’avais meilleure opinion de vous, moi qui me serais mis en quatre… et puis, en vous engageant vous ne faites pas un si mauvais marché… Dieu ! que je voudrais avoir votre âge, et savoir ce que je sais !… Quand on est jeune il y a toujours de la ressource. Allons ! continua-t-il en nous présentant du papier, voilà le moment de battre monnaie, mettez votre nom au bas de cette feuille.
» Les instances de M. Belle-Rose étaient si pressantes, et nous avions une telle appréhension du guet, que nous signâmes. – C’est heureux, s’écria-t-il. À présent, je vais payer ; si vous êtes fâchés, il sera toujours temps, il n’y aura rien de fait, pourvu cependant que vous rendiez les espèces ; mais nous n’en viendrons pas là… Patience, mes bons amis, je serai promptement de retour.
» M. Belle-Rose sortit aussitôt, et bientôt après nous le vîmes revenir. – La consigne est levée, à présent, nous dit-il, libre à nous d’évacuer la place ou de rester ;… mais vous n’avez pas encore vu madame Belle-Rose, je veux vous faire faire connaissance avec elle ; c’est ça une femme ! de l’esprit jusqu’au bout des ongles.
» M. Belle-Rose nous conduisit chez lui ; son logement n’était pas des plus brillants : deux chambres sur le derrière d’une maison d’assez mince apparence, à quelque distance de l’arche Marion. Madame Belle-Rose était dans un alcove au fond de la seconde pièce, la tête ex-haussée par une pile d’oreillers. Près de son lit étaient deux béquilles, et non loin de là, une table de nuit, sur laquelle étaient un crachoir, une tabatière en coquillage, un gobelet d’argent et une bouteille d’eau de vie en vuidange. Madame Belle-Rose pouvait avoir de quarante-cinq à cinquante ans ; elle était dans un négligé galant, une fontange et un peignoir garnis de malines. Son visage lui faisait honneur. Au moment où nous parûmes, elle fut saisie d’une quinte de toux. – Attendez qu’elle ait fini, nous dit M. Belle-Rose. Enfin, la toux se calma. – Tu peux parler, ma mignonne ? – Oui mon minet, répondit-elle. – Eh bien ! tu vas me faire l’amitié de dire à ces messieurs quelle fortune on fait, dans les colonies. – Immense, M. Belle-Rose, immense ! – Quels partis on y trouve pour le mariage. – Quels partis ? superbes, M. Belle-Rose, superbes ! la plus mince héritière a des millions de piastres. – Quelle vie on y fait ? – Une vie de chanoine, M. Belle-Rose.
» – Vous l’entendez, dit le mari, je ne le lui fais pas dire.
» La farce était jouée. M. Belle-Rose nous offrit de nous rafraîchir d’un coup de rhum : nous trinquâmes avec son épouse, en buvant à sa santé, et elle but à notre bon voyage. – Car je pense bien, ajouta-t-elle, que ces messieurs sont des nôtres. Cher ami, dit-elle à Fanfan, vous avez une figure comme on les aime dans ce pays-là : épaules carrées, poitrine large, jambe faite au tour, nez à la Bourbon. Puis, en s’adressant à moi : – Et vous aussi ; oh ! vous êtes des gaillards bien membrés… – Et des gaillards qui ne se laisseront pas marcher sur le pied, reprit Belle-Rose ; monsieur, tel que tu le vois, a fait ses preuves ce matin. – Ah ! monsieur a fait ses preuves, je lui en fais mon compliment, approchez donc, mon pauvre Jésus, que je vous baise ; j’ai toujours aimé les jeunes gens, c’est ma passion à moi ; chacun la sienne. Tu n’es pas jaloux, Belle-Rose, n’est-ce pas ? – Jaloux ! et de quoi ? monsieur s’est conduit comme un Bayard : aussi j’en informerai le corps ; le colonel le saura ; c’est de l’avancement tout de suite, caporal au moins, si on ne le fait pas officier ;… Hein ! quand vous aurez l’épaulette, vous redresserez-vous ! Fanfan ne se sentait pas de joie. Quant à moi, sûr de n’être pas moins brave que lui, je me disais : S’il avance, je ne reculerai pas. Nous étions tous deux assez contents.
» – Je dois vous avertir d’une chose, poursuivit le recruteur : recommandés comme vous l’êtes, il est impossible que vous ne fassiez pas des jaloux ; d’abord, il y a partout des envieux, dans les régiments comme ailleurs,… mais souvenez-vous que si l’on vous manque d’une syllabe, c’est à moi qu’ils auront affaire… Une fois que j’ai pris quelqu’un sous ma protection… enfin, suffit. Écrivez-moi. – Comment ! dit Fanfan, vous ne partez donc pas avec nous ? – Non, répondit Belle-Rose, à mon grand regret ; le ministre a encore besoin de moi : je vous rejoindrai à Brest. Demain, à huit heures, je vous attends ici, pas plus tard ; aujourd’hui je n’ai pas le loisir de rester plus long-temps avec vous ; il faut que le service se fasse ; à demain.
» Nous prîmes congé de madame Belle-Rose, qui voulut aussi m’embrasser. Le lendemain nous accourûmes à sept heures et demie, réveillés par les punaises qui logeaient avec nous au Griffon. – Vivent les gens qui sont exacts ! s’écria Belle-Rose, en nous voyant ; moi je le suis aussi. Puis, prenant le ton sévère : Si vous avez des amis et des connaissances, il vous reste la journée pour leur faire vos adieux. Actuellement, voici votre feuille de route : il vous revient trois sous par lieue et le logement, place au feu et à la chandelle. Vous pouvez brûler des étapes tant qu’il vous plaira, çà ne me regarde pas ; mais n’oubliez pas surtout que si l’on vous rencontre demain soir dans Paris, c’est la maréchaussée qui vous conduira à votre destination.
» Cette menace cassa bras et jambes à Fanfan ainsi qu’à moi. Le vin était tiré, il fallait le boire : nous primes notre parti. De Paris à Brest, il y a un fameux ruban de queue ; malgré les ampoules, nous faisions nos dix lieues par jour. Enfin nous arrivâmes ; et ce ne fut pas sans avoir mille fois maudit Belle-Rose. Un mois après, nous fûmes embarqués. Dix ans après, jour pour jour, je passai caporal d’emblée, et Fanfan devint appointé ; il est crevé à Saint-Domingue pendant l’expédition de Leclerc ; c’est le pian des Nègres qui l’a emporté : c’était un fameux lapin. Quant à moi, j’ai encore bon pied bon œil ; le coffre est solide, et s’il n’y a pas d’avarie, je me fais fort de vous enterrer tous. J’ai essuyé bien des traverses dans ma vie ; j’ai été trimballé d’une colonie à l’autre ; j’ai roulé ma bosse partout, je n’en ai pas amassé davantage ; c’est égal, les enfants de la joie ne périront pas… Et puis, quand il n’y en a plus il y en a encore », poursuivit le sergent Dufailli, en frappant sur les poches de son uniforme râpé, et en relevant son gilet pour nous montrer une ceinture de cuir qui crevait de plénitude. « Je dis qu’il y en a du beurre à la cambuse, et du jaune, sans compter qu’avant peu les Anglais nous feront le prêt. La compagnie des Indes me doit encore un décompte ; c’est quelque trois mâts qui me l’apporte. – En attendant, il fait bon avec vous, père Dufailli, dit le fourrier. – Très bon, répéta le sergent-major. – Oui, très bon, pensai-je tout bas, en me promettant bien de cultiver une connaissance que le hasard me rendait si à propos.
CHAPITRE XIX
Continuation de la même journée. – La Contemporaine. – Un adjudant de place. – Les filles de la mère Thomas. – Le lion d’argent. – Le capitaine Paulet et son lieutenant. – Les corsaires. – Le bombardement. – Le départ de lord Landerdale. – La comédienne travestie. – Le bourreau des crânes. – Neuvième Henri et ses demoiselles. – Je m’embarque. – Combat naval. – Le second de Paulet est tué. – Prise d’un brick de guerre. – Mon sosie ; je change de nom. – Mort de Dufailli. – Le jour des rois. – Une frégate coulée. – Je veux sauver deux amants. – Une tempête. – Les femmes des pêcheurs.
Tout en faisant la scène du recruteur, le père Dufailli avait bu presque à chaque phrase. Il était d’opinion que les paroles coulent mieux quand elles sont humectées ; il aurait pu tout aussi bien les tremper avec de l’eau, mais il en avait horreur, depuis, disait-il, qu’il était tombé à la mer : c’était en 1789 que cet accident lui était arrivé. Aussi advint-il que, moitié parlant, moitié buvant, il s’enivra sans s’en apercevoir. Enfin il vint un moment où il fut saisi d’une incroyable difficulté de s’exprimer : il avait ce qu’on appelle la langue épaisse. Ce fut alors que le fourrier et le sergent-major songèrent à se retirer.
Dufailli et moi nous restâmes seuls ; il s’endormit, se pencha sur la table, et se mit à ronfler, pendant qu’en digérant de sang-froid, j’étais livré à mes réflexions. Trois heures s’étaient écoulées, et il n’avait pas achevé son somme. Quand il se réveilla, il fut tout surpris de voir quelqu’un auprès de lui ; il ne m’aperçut d’abord qu’à travers un épais brouillard, qui ne lui permit pas de distinguer mes traits ; insensiblement cette vapeur se dissipa, et il me reconnut ; c’était tout ce qu’il pouvait. Il se leva en chancelant, se fit apporter un bol de café noir, dans lequel il renversa une salière, avala ce liquide à petites gorgées et, ayant passé son demi-espadon, il se pendit à mon bras, en m’entraînant vers la porte ; mon appui lui était on ne peut plus nécessaire : il était la vigne qui s’attache à l’ormeau. « Tu vas me remorquer, me dit-il, et moi je te piloterai. Vois-tu le télégraphe, qu’est-ce qu’il dit avec ses bras en l’air ? il signale que le Dufailli est vent dessus vent dedans ;… le Dufailli, mille Dieu ! navire de trois cents tonneaux au moins. Ne t’inquiète pas, il ne perd pas le nord Dufailli. » – En même temps, sans me quitter le bras, il retira son chapeau, et le posant sur le bout de son doigt, il le fit pirouetter. « Voilà,… ma boussole ; attention ! Je retiens la corne du côté de la cocarde ; … le cap sur la rue des Prêcheurs ; en avant, marche ! » commanda Dufailli, et nous prîmes ensemble le chemin de la basse ville, après qu’il se fût recoiffé en tapageur.
Dufailli m’avait promis un conseil, mais il n’était guères en état de me le donner. J’aurais bien désiré qu’il recouvrât sa raison ; malheureusement le grand air et le mouvement avaient produit sur lui un effet tout contraire. En descendant la grande rue, il nous fallut entrer dans cette multitude de cabarets dont le séjour de l’armée l’avait peuplée ; partout nous faisions une station plus ou moins longue, que j’avais soin d’abréger le plus possible ; chaque bouchon, selon l’expression de Dufailli, était une relâche qu’il était indispensable de visiter, et chaque relâche augmentait la charge qu’il avait déjà tant de peine à porter. – « Je suis soul comme un gredin, me disait-il par intervalles, et pourtant je ne suis pas un gredin, car il n’y a que les gredins qui se soûlent, n’est-ce pas, mon ami ? »
Vingt fois je fus tenté de l’abandonner, mais Dufailli à jeun pouvait être ma providence ; je me rappelai sa ceinture pleine, et pour le perdre de vue, je comprenais trop bien qu’il avait d’autres ressources que sa paie de sergent. Parvenu en face de l’église, sur la place d’Alton, il lui prit la fantaisie de faire cirer ses souliers. « À la cire française, dit-il, en posant le pied sur la sellette : c’est de l’œuf, entends-tu ? – Suffit, mon officier, répondit l’artiste. » À ce moment, Dufailli perdit l’équilibre ; je crus qu’il allait tomber, et m’approchai pour le soutenir. « Eh ! pays, n’as-tu pas peur, parce qu’il y a du roulis ? j’ai le pied marin. » En attendant, le pinceau, remué avec agilité, donnait un nouveau lustre à sa chaussure. Quand elle fut complètement barbouillée de noir : – « Et le coup de fion, dit Dufailli, c’est-il pour demain ? » En même temps il offrait un sou pour salaire. – « Vous ne me faites pas riche, mon sergent. – Je crois qu’il raisonne : prends garde que je te f… ma botte… » Dufailli fait le geste ; mais, dans ce mouvement, son chapeau ébranlé tombe à terre ; chassé par le vent, il roule sur le pavé ; le décrotteur court après et le lui rapporte.
« Il ne vaut pas deux liards, s’écrie Dufailli ; n’importe, tu es un bon enfant. » Puis, fouillant dans sa poche, il en ramène une poignée de guinées : « Tiens, voilà pour boire à ma santé. – Merci, mon colonel, » dit alors le décrotteur, qui proportionnait les titres à la générosité.
« Actuellement, me dit Dufailli, qui semblait peu à peu reprendre ses esprits, il faut que je te mène dans les bons endroits. » J’étais décidé à l’accompagner partout ou il irait ; je venais d’être témoin de sa libéralité, et je n’ignorais pas que les ivrognes sont gens les plus reconnaissants du monde envers les personnes qui se dévouent à leur faire compagnie. Je me laissai donc piloter suivant son désir, et nous arrivâmes dans la rue des Prêcheurs. À la porte d’une maison neuve d’une construction assez élégante, était une sentinelle et plusieurs soldats de planton : « C’est là, me dit-il. – Quoi ! c’est là ? est-ce que vous me conduisez à l’état-major ? – L’état-major, tu veux rire ; je te dis que c’est là la belle blonde, Magdelaine ; ou, pour mieux dire, madame quarante mille hommes, comme on l’appelle ici. – Impossible, pays, vous vous trompez. – Je n’ai pas la berlue peut-être, ne vois-je pas le factionnaire ? » Dufailli s’avança aussitôt, et demande si l’on peut entrer. – « Retirez-vous, lui répond brusquement un maréchal-des-logis de dragons, vous savez bien que ce n’est pas votre jour. » – Dufailli insiste. – Retirez-vous, vous dis-je, reprend le sous-officier, où je vous conduis à la place. » Cette menace me fit trembler.
L’obstination de Dufailli pouvait me perdre ; cependant il n’eût pas été prudent de lui communiquer mes craintes ; ce n’était d’ailleurs pas le lieu : je me bornai à lui faire quelques observations qu’il rétorquait toujours, il ne connaissait rien. – « Je me f… de la consigne, le soleil luit pour tout le monde : liberté, égalité ou la mort, » répétait-il, en se tordant pour échapper aux efforts que je faisais afin de le retenir. – Égalité, te dis-je » ; et, dans une attitude renversée, il me regardait sous le nez avec cette fixité stupide de l’homme que l’excès des liqueurs fermentées a réduit à l’état de la brute.
Je désespérais d’en venir à bout, lorsqu’à ce cri : Aux armes, suivi de cet avis : « Canonnier, sauvez-vous, voilà l’adjudant, voilà Bévignac », il se redresse tout à coup. Une douche qui descend de cinquante pieds, sur la tête d’un maniaque, n’a pas un effet si rapide, pour le rendre à son bon sens. Ce nom de Bévignac fit une singulière impression sur les militaires qui formaient tapisserie devant le rez-de-chaussée de l’habitation occupée par la belle blonde. Ils s’entre-regardaient les uns les autres sans oser, pour ainsi dire, respirer, tant ils étaient terrifiés. L’adjudant, qui était un grand homme sec, déjà sur le retour, se mit à les compter en gesticulant avec sa canne ; jamais je n’avais vu de visage plus courroucé ; sur cette face maigre et allongée, qu’accompagnaient deux ailes de pigeon sans poudre, il y avait quelque chose qui indiquait que, par habitude, M. Bévignac était en révolte ouverte contre l’indiscipline. Chez lui la colère était passée à l’état chronique ; ses yeux étaient pleins de sang ; une horrible contraction de sa mâchoire annonça qu’il allait parler. – « Trou dé dious ! tout est tranquille ! vous savez l’ordre, rien qui les officiers, trou dé dious ! et chaque son tour. » Puis, nous apercevant, et avançant sur nous la canne levée : – « Eh ! qu’est-ce qu’il fait ici ce sergent des biguernaux ? » J’imaginai qu’il voulait nous frapper. – « Allons ! c’est rien, poursuivit-il, je vois qué tu es ivre, s’adressant à Dufailli ; un coup de boisson, c’est pardonnable, mais va té coucher, et qué jé té rencontré plus. – Oui mon commandant, » répondit Dufailli, à l’exhortation, et nous redescendîmes la rue des Prêcheurs.
Je n’ai pas besoin de dire quelle était la profession de la belle blonde, je l’ai suffisamment indiquée. Magdelaine la Picarde était une grande fille, âgée de vingt-trois ans environ, remarquable par la fraîcheur de son teint autant que par la beauté de ses formes ; elle se faisait gloire de n’appartenir à personne, et par principe de conscience, elle croyait se devoir tout entière à l’armée et à l’armée tout entière : fifre ou maréchal d’empire, tout ce qui portait l’uniforme était également bien accueilli chez elle ; mais elle professait un grand mépris pour ce qu’elle appelait les péquins. Il n’y avait pas un bourgeois qui pût se vanter d’avoir eu part à ses faveurs ; elle ne faisait même pas grand cas des marins, qu’elle qualifiait de culs goudronnés, et qu’elle rançonnait à plaisir, parce qu’elle ne pouvait pas se décider à les regarder comme des soldats : aussi disait-elle plaisamment qu’elle avait la marine pour entreteneur, et la ligne pour amant. Cette fille, que j’eus l’occasion de visiter plus tard, fit long-temps les délices des camps, sans que sa santé en fût altérée ; on la supposait riche. Mais, soit que Magdelaine, comme j’ai pu m’en convaincre, ne fût pas intéressée, soit que, comme dit le proverbe, ce qui vient de la flûte s’en retourne au tambour, Magdelaine mourut en 1812 à l’hôpital d’Ardres, pauvre, mais fidèle à ses drapeaux ; deux ans de plus, et comme une autre fille très connue dans Paris, depuis le désastre de Waterloo, elle aurait eu la douleur de se dire la veuve de la grande armée.
Le souvenir de Magdelaine vit encore disséminé sur tous les points de la France, je dirais même de l’Europe, parmi les débris de nos vieilles phalanges. Elle était la Contemporaine de ce temps-là, et si je n’avais pas la certitude qu’elle n’est plus, je croirais la retrouver dans la Contemporaine de ce temps-ci. Toutefois, je ferai observer que Magdelaine, bien qu’elle eût les traits un peu hommasses, n’avait rien d’ignoble dans la figure ; la nuance de ses cheveux n’était pas de ce blond fade qui frise la filasse ; les reflets dorés de ses tresses étaient en parfaite harmonie avec le bleu tendre de ses yeux ; son nez ne se dessinait point disgracieusement dans la courbe anguleuse de la proéminence aquiline. Il y avait du messalin dans sa bouche, mais aussi quelque chose de gracieux et de franc ; et puis, Magdelaine ne faisait que son métier ; elle n’écrivait pas, et ne connaissait de la police que les sergents de ville ou les gardes de nuit, à qui elle payait à boire pour son repos.
La satisfaction que j’éprouve, après plus de vingt ans, à tracer le portrait de Magdelaine, m’a fait un instant oublier Dufailli. Il est bien difficile de déraciner une idée d’un cerveau troublé par les fumées du vin. Dufailli avait fourré dans sa tête de terminer la journée chez les filles ; il n’en voulut pas démordre. À peine avions-nous fait quelques pas, que, regardant derrière lui. « Il est filé, me dit-il, allons ! viens ici, et, abandonnant mon bras, il monta trois marches pour heurter à une petite porte, qui, après quelques minutes, s’entr’ouvrit afin de livrer passage à un visage de vieille femme. – Qui demandez-vous ? – Qui nous demandons, répondit Dufailli ; et nom d’un nom ! vous ne reconnaissez plus les amis ? – Ah ! c’est vous, papa Dufailli ; il n’y a plus de place. – Il n’y a plus de place pour les amis ! ! ! tu veux rire, la mère, c’est un plan que tu nous tires là. – Non, foi d’honnête femme ; tu sais bien, vieux coquin, que je ne demanderais pas mieux ; mais j’ai Thérèse, mon aînée, qui est en occupation avec le capitaine des guides-interprètes, et Pauline, la cadette, avec le général Chamberlhac ; repassez dans un quart d’heure mes enfants. Vous serez bien sages, n’est-ce pas ? – À qui dites-vous ça ? est-ce que nous avons l’air de tapageurs ? – Je ne dis pas, mes enfants ; mais, voyez-vous, la maison est tranquille ; jamais plus de bruit que vous n’en entendez ; aussi c’est tous gens comme il faut qui viennent ici : le général en chef, le commissaire-ordonnateur, le munitionnaire général ; ce ne sont pas les pratiques qui manquent, Dieu merci ! j’aurais cinquante filles que je n’en serais pas embarrassée. – C’est ça une bonne mère, s’écria Dufailli. Ah çà ! maman Thomas, reprit-il, en se posant sur l’œil une pièce d’or, tu n’y songes pas, de vouloir nous faire droguer pendant un quart d’heure ; est-ce qu’il n’y aurait pas quelque petit coin ? – Toujours farceur comme à son ordinaire, papa Dufailli ; il n’y a pas mèche à lui refuser : allons ! vite, vite, entrez qu’on ne vous voie pas ; cachez-vous là, mes enfants, et motus. »
Madame Thomas nous avait mis en entrepôt derrière un vieux paravent, dans une salle basse, qu’il était indispensable de traverser pour sortir. Nous n’eûmes pas le temps de perdre patience : mademoiselle Pauline vint nous trouver la première ; après avoir reconduit le général, elle dit quelques paroles à l’oreille de sa mère, et s’attabla avec nous autour d’un flacon de vin du Rhin.
Pauline n’avait pas encore atteint sa quinzième année, et déjà elle avait le teint plombé, le regard impudique, le langage ordurier, la voix rauque, et le dégoûtant fumet de nos courtisanes de carrefour. Cette ruine précoce m’était destinée ; ce fut à moi qu’elle prodigua ses caresses. Thérèse était mieux assortie au front chauve de mon compagnon, à qui il tardait qu’elle fût libre ; enfin, un mouvement rapide de bottes à la hussarde, garnies de leurs éperons, annonça que le cavalier prenait congé de sa belle. Dufailli, trop empressé, se lève brusquement de son siège, mais ses jambes se sont embarrassées dans son demi-espadon ; il tombe, entraînant avec lui le paravent, la table, les bouteilles et les verres. « Excusez, mon capitaine, dit-il, en cherchant à se remettre debout ; c’est la faute de la muraille. – Oh ! il n’y a pas d’indiscrétion, » repartit l’officier, qui, bien qu’un peu confus, se prêtait de bonne grâce à le relever, pendant que Pauline, Thérèse et leur mère, étaient saisies d’un rire inextinguible. Dufailli une fois sur ses pieds, le capitaine se retira, et comme la chute n’avait occasionné ni contusion ni blessure, rien n’empêcha de nous livrer à la gaîté. Je jetterai un voile sur le reste des événements de cette soirée : nous étions dans un des bons endroits que connaissait Dufailli, tout s’y passa comme dans un mauvais lieu. Plus d’un de mes lecteurs sait à quoi s’en tenir ; qu’il me suffise de leur apprendre qu’à une heure du matin j’étais enseveli dans le plus profond sommeil, lorsque je fus subitement réveillé par un épouvantable vacarme. Sans soupçonner ce que ce pouvait être, je m’habillai en toute hâte, et bientôt les cris à la garde, à l’assassin, poussés par la mère Thomas, m’avertirent que le danger approchait de nous. J’étais sans armes ; je courus aussitôt à la chambre de Dufailli, pour lui demander son briquet, dont j’étais assuré de faire un meilleur usage que lui. Il était temps, le gîte venait d’être envahi par cinq ou six matelots de la garde, qui, le sabre en main, accouraient tumultueusement pour nous remplacer. Ces messieurs ne s’étaient promis ni plus ni moins que de nous faire sauter par la fenêtre ; et comme ils menaçaient, en outre, de mettre tout à feu et à sang dans la maison, madame Thomas, de sa voix aiguë, sonnait à tue tête un tocsin d’alarme qui mit tout le quartier en émoi. Quoique je ne fusse pas homme à m’effrayer facilement, j’avoue que je ne pus me défendre d’un mouvement de crainte. La scène quelle qu’elle fût, pouvait avoir pour moi un dénouement très fâcheux.
Toutefois, j’étais résolu à faire bonne contenance. Pauline voulait à toute force que je m’enfermasse avec elle. « Mets le verrou, me disait-elle, mets le verrou, je t’en supplie. » Mais le galetas dans lequel nous étions n’était pas inexpugnable ; je pouvais y être bloqué ; je préférai défendre les approches de la place, plutôt que de m’exposer à y être pris comme un rat dans la souricière. Malgré les efforts de Pauline pour me retenir, je tentai une sortie. Bientôt je fus aux prises avec deux des assaillants : je fonçai sur eux, le long d’un étroit corridor, et j’y allais avec tant d’impétuosité, qu’avant qu’ils se fussent reconnus, acculés, en rompant précipitamment, à la dernière marche d’une espèce d’échelle de meunier par laquelle ils étaient montés, ils firent la culbute en arrière et dégringolèrent jusqu’en bas, où ils s’arrêtèrent moulus et brisés. Alors Pauline, sa sœur, et. Dufailli, pour rendre la victoire plus décisive, lancèrent sur eux tout ce qui leur tomba sous la main, des chaises, des pots de chambre, une table de nuit, un vieux dévidoir et divers autres ustensiles de ménage. À chaque projectile qui leur arrivait, mes adversaires, étendus sur le carreau, poussaient des cris de douleur et de rage. En un instant l’escalier fut encombré. Ce tapage nocturne ne pouvait manquer de donner l’éveil dans la place : des gardes de nuit, des agents de police et des patrouilles s’introduisirent dans le domicile de madame Thomas. Il y avait, je crois, plus de cinquante hommes sous les armes ; il se faisait un tumulte épouvantable. Madame Thomas essayait de démontrer que sa maison était tranquille ; on ne l’écoutait pas ; et ces mots, dont quelques-uns étaient très significatifs : « Emmenez cette femme ! allons, coquine, suis-nous… allez chercher une civière… empoignez-moi tout ça, » nous arrivaient du rez-de-chaussée. « Rafle générale, rafle générale, et désarmez-les. Je vous apprendrai, tas dé canaille, à faire du train. » Ces paroles, prononcées avec l’accent provençal et entremêlées de quelques interjections occitaniques, qui, de même que l’ail et le piment, sont des fruits du pays, nous firent assez connaître que l’adjudant Bévignac était à la tête de l’expédition. Dufailli ne se souciait pas de tomber en son pouvoir. Quant moi, on sait que j’avais d’excellentes raisons pour vouloir lui échapper. « À l’escalier, bloquez lé passage, à l’escalier, trou dé dious, commandait Bévignac. Mais pendant qu’il s’époumonait de la sorte, j’avais eu le temps d’attacher un drap à la croisée, et les obstacles qui nous séparaient de la force armée, n’avaient pas encore disparu, que Pauline, Thérèse, Dufailli et moi, étions déjà hors d’atteinte. Cette menace : « Ne vous inquiétez pas, je vous repêcherai, » que nous entendîmes de loin, ne fit qu’exciter notre hilarité ; le danger était passé.
Nous délibérâmes où nous irions achever la nuit ; Thérèse et Pauline proposèrent de sortir de la ville et de faire une excursion pastorale dans la campagne, où il y a toujours des lits pour tout le monde. « Non, non, dit Dufailli, au plus près, au Lion d’argent, chez Boutrois ». Il fut convenu que l’on se réfugierait dans cet hôtel. M. Boutrois, bien qu’il fût heure indue, nous ouvrit avec une cordialité enchanteresse. « Eh bien ! dit-il à Dufailli, j’ai appris que vous aviez touché votre part des prises ; c’est fort bien fait à vous de venir nous voir ; j’ai de l’excellent Bordeaux. Ces dames souhaitent-elles quelque chose ? Une chambre à deux lits, je vois çà. » En même temps M. Boutrois, armé d’un trousseau de clefs et la chandelle à la main, se mit en devoir de nous conduire à la chambre qu’il nous destinait. « Vous serez là comme chez vous. D’abord, on ne viendra pas vous troubler ; quand on donne la pâtée au commandant d’armes, au chef militaire de la marine et à notre commissaire général de police, vous sentez qu’on n’oserait pas… Par exemple, ajouta-t-il, il y a madame Boutrois qui ne plaisante pas ; aussi me garderai-je bien de lui dire que vous n’êtes pas seuls ; c’est une bonne femme madame Boutrois, mais les mœurs ; voyez-vous, les mœurs ! sur cet article elle n’entend pas raison ; elle est stricte. Des femmes ici ! si elle le soupçonnait seulement, elle croirait que tout est perdu : avec ça qu’elle a des filles ! Eh ! mon Dieu, ne faut-il pas vivre avec les vivants ? Je suis philosophe moi, pourvu qu’il n’y ait pas de scandale… Et quand il y en aurait ; … chacun se divertit à sa manière, l’essentiel est que ça ne porte préjudice à personne. »
M. Boutrois nous débita encore bon nombre de maximes de cette force, après quoi il nous déclara que sa cave était bien fournie, et qu’elle était toute à notre service. « Quant à la crémaillère, ajouta-t-il, à l’heure qu’il est, elle est un peu froide, mais que votre seigneurie donne ses ordres, et en deux coups de temps tout sera prêt. » Dufailli demanda du bordeaux et du feu, quoiqu’il fît assez chaud pour que l’on pût s’en passer.
On apporta le bordeaux ; cinq ou six grosses bûches furent jetées dans le foyer, et une ample collation s’étala devant nous ; une volaille froide occupait le centre de la table, et formait la pièce de résistance d’un repas improvisé, où tout avait été calculé pour un énorme appétit. Dufailli voulait que rien ne nous manquât, et M. Boutrois, certain d’être bien payé, était de son avis. Thérèse et sa sœur dévoraient tout des yeux ; pour moi, je n’étais pas non plus en trop mauvaise disposition.
Pendant que je découpais la volaille, Dufailli dégustait le bordeaux. « Délicieux ! délicieux ! » répétait-il, en le savourant en gourmet ; puis il se mit à boire à grand verre, et à peine avions-nous commencé à manger, qu’un sommeil invincible le cloua dans son fauteuil, où il ronfla jusqu’au dessert comme un bienheureux. Alors il se réveille : « Diable, dit-il, il vente grand frais ; où suis-je donc ? Est-ce qu’il gèlerait par hasard ? Je suis tout je ne sais comment ? – Oh ! il a plus de la moitié de son pain de cuit, s’écria Pauline, qui me tenait tête ni plus ni moins qu’un sapeur de la garde. – Il est mort dans le dos le papa, dit à son tour Thérèse, en ouvrant une espèce de bonbonnière d’écaille, dans laquelle était du tabac ; une prise, mon ancien, çà vous éclaircira la vue. » Dufailli accepta la prise ; et si je mentionne cette circonstance, très peu importante en elle-même, c’est que j’oubliais de dire que la sœur de Pauline avait déjà dépassé la trentaine, et que de ce seul fait qu’elle reniflait du tabac comme un greffier ou comme un clerc de commissaire, on peut, aisément tirer la conséquence qu’elle n’était plus de la première jeunesse.
Quoi qu’il en soit, Dufailli en faisait ses choux gras. « Je l’aime la petite, s’écria-t-il quelquefois ; c’est une bonne enfant. – Oh ! tu ne m’apprends rien de neuf, lui répondait Thérèse, depuis qu’il y a une péniche dans la rade, il n’est pas un équipage que je n’aie passé en revue, et je défie qu’un matelot puisse me dire plus haut que mon nom ; quand on sait se faire respecter… – L’enfant dit vrai, reprenait Dufailli, je l’aime, moi, parce qu’elle est franche ; aussi prétends-je lui faire un sort. – Ah ! ah ! ah ! un sort, s’écria Pauline en riant ; puis s’adressant à moi, et toi, m’en feras-tu un de sort ? »
La conversation allait se continuer sur ce pied, lorsque nous entendîmes venir du côté du port une troupe d’hommes bottés qui faisaient grand bruit en marchant. « Vive le capitaine Paulet ! criaient-ils, vive le capitaine ! » Bientôt cette troupe s’arrêta devant l’hôtel. « Eh ! père Boutrois, père Boutrois », appelait-on coup sur coup et en même temps. Les uns essayaient d’ébranler la porte, d’autres secouaient le marteau d’une force incroyable, ceux-ci se pendaient au cordon de la sonnette, ceux-là lançaient des pierres dans les volets.
À ce carillon, je tressaillis, j’imaginais que notre asile allait être violé de nouveau ; Pauline et sa sœur n’étaient pas trop rassurées ; enfin l’on descend l’escalier quatre à quatre, la porte s’ouvre, il semble que ce soit une digue qui vient de se briser. Le torrent se précipite, un mélange confus de voix articule des sons auxquels nous ne comprenons rien. « Pierre, Paul, Jenny, Elisa, toute la maison ; ma femme, lève-toi. Ah ! mon Dieu ! ils dorment comme des souches. » On eût dit que le feu était à la maison. Bientôt nous entendîmes aller et venir les portes ; c’est un mouvement, un bruit inconcevables, c’est une servante qui se plaint en termes grossiers d’une familiarité indécente, ce sont des éclats d’un rire bruyant ; des bouteilles s’entrechoquent. Les plats, les assiettes, les verres remués précipitamment, le tournebroche qu’on remonte, concourent à ce charivari ; l’argenterie résonne, et des jurons anglais et français, jetés pêle-mêle au milieu du vacarme, font retentir les airs. « Pays, me dit Dufailli, c’est de la joie, ou je ne m’y connais pas. Qu’ont-ils donc ces mâtins-là, qu’ont-ils donc ? Est-ce qu’ils ont enlevé les gallions d’Espagne ? ce n’est pas la route pourtant ! »
Dufailli se creusait l’esprit pour trouver la cause de cette allégresse, sur laquelle je ne pouvais lui donner aucun éclaircissement, quand M. Boutrois, la face toute radieuse, entra pour nous demander du feu. « Vous ne savez pas, nous dit-il, la Revanche vient de rentrer dans le port. Notre Paulet a encore fait des siennes : a-t-il du bonheur !… une capture de trois millions sous le canon de Douvres. – Trois millions ! s’écria Dufailli, et je n’y étais pas ! – Dis donc, ma sœur, trois millions ! s’écria de son côté Pauline, en bondissant comme un jeune chevreau. – Trois millions ! répéta Thérèse ; Dieu ! que je suis contente ! allons-nous en avoir ! – Voilà bien les femmes, reprit Dufailli, l’intérêt avant tout ; et songez donc plutôt à votre mère, dans ce moment peut-être, elle est à l’ombre. – La mère Thomas, une vieille,… je n’ose pas répéter ici la qualification que lui donna Thérèse. – C’est joli ! observa M. Boutrois, une fille ! tes père et mère honorera, afin de vivre longuement. – Je n’en puis pas revenir, trois millions, disait Dufailli ; contez-nous donc ça, papa Boutrois… Notre hôte s’excusa sur ce qu’il n’en avait pas le loisir ; d’ailleurs, ajouta-t-il, je ne sais pas, et je suis pressé. »
Le tintamarre se continue ; je reconnais que l’on range des chaises ; un instant après, le silence qui se fit m’annonça que les mâchoires étaient occupées. Il était vraisemblable que la suspension du tapage serait de quelques heures ; je proposai alors à la société de se mettre dans le portefeuille ; chacun fut de mon avis, nous nous couchâmes pour la seconde fois, et comme nous touchions aux approches du jour ; pour ne pas être incommodés par la lumière, et récupérer à notre aise le temps perdu, nous eûmes la précaution de tirer le rideau… Le lecteur ne trouvera pas mauvais que la cotonnade flambée qui devait prolonger pour nous la durée de cette nuit orageuse, dérobe à ses regards les actes clandestins d’une orgie dont il ne tardera pas à connaître le dénouement.
Tout ce que je puis dire, c’est que notre réveil était moins éloigné que je ne le pensais ; les marins mangent vite et boivent long-temps. Des chants à faire frémir les vitres vinrent tout à coup interrompre notre repos ; quarante voix discordantes entre elles répétaient en chœur, le refrain fameux de l’hymne de Roland. « Au Diable les chanteurs ! s’écria Dufailli, je faisais le plus beau rêve ;… j’étais à Toulon : y es-tu allé à Toulon, pays ? – Je répondis à Dufailli, que je connaissais Toulon, mais que je ne voyais pas quel rapport il pouvait y avoir entre le plus beau rêve et cette ville. – J’étais forçat, reprit-il, je venais de m’évader. » Dufailli s’aperçoit que le récit de ce songe fait sur moi une impression pénible, que je n’étais pas le maître de dissimuler. « Eh ! bien, qu’as-tu donc, pays ? n’est-ce pas un rêve que je te raconte ? je venais de m’évader ; ce n’est pas un mauvais rêve, je crois, pour un forçat ; mais ce n’est pas tout, je m’étais enrôlé parmi des corsaires, et j’avais de l’or gros comme moi. »
Quoique je n’aie jamais été superstitieux, j’avoue que je pris le rêve de Dufailli pour une prédiction sur mon avenir ; c’était peut-être un avis du ciel pour me dicter une détermination. Cependant, disais-je en moi-même, jusqu’à présent, je ne vaux guère la peine que le ciel s’occupe de moi, et je ne vois pas non plus qu’il s’en soit trop occupé. Bientôt, je fis une autre réflexion ; il me passa par la tête, que le vieux sergent pourrait bien avoir voulu faire une allusion. Cette idée m’attrista ; je me levai, Dufailli s’aperçut que je prenais un air plus sombre que de coutume. « Eh ! qu’as-tu donc, pays ? s’écria-t-il ; il est triste comme un bonnet de nuit. – Est-ce que par hasard on t’aurait vendu des pois qui ne veulent pas cuire ? me dit Pauline en me saisissant brusquement par le bras, comme pour me tirer de ma rêverie. – Est-il maussade, observa Thérèse. – Taisez-vous, reprit Dufailli ; vous parlerez quand on vous le permettra ; en attendant, dormez ; dormez esclaves, répéta-t-il, et ne bougez pas ; nous allons revenir. »
Aussitôt il me fit signe de le suivre ; j’obéis, et il me conduisit dans une salle basse, où était le capitaine Paulet, avec les hommes de son équipage, la plupart ivres d’enthousiasme et de vin. Dès que nous parûmes, ce ne fut qu’un cri : « Voilà Dufailli ! voilà Dufailli ! – Honneur à l’ancien, dit Paulet ; puis, offrant à mon compagnon un siège à côté de lui : Pose toi là, mon vieux : on a bien raison de dire que la providence est grande. M. Boutrois, appelait-il, M. Boutrois, du bichops, comme s’il en pleuvait ; va ! il n’y aura pas de misère après ce temps-ci, reprit Paulet, en pressant la main de Dufailli. » Depuis un moment Paulet ne cessait pas d’avoir les yeux sur moi. « Il me semble que je te connais, me dit-il ; tu as déjà porté le hulot, mon cadet. »
Je lui répondis que j’avais été embarqué sur le corsaire le Barras, mais que quant à lui, je pensais ne l’avoir jamais vu. – « En ce cas nous ferons connaissance ; je ne sais, ajouta-t-il, mais tu m’as encore l’air d’un bon chien ; d’un chien à tout faire, comme on dit. Eh ! les autres, n’est-ce pas qu’il a l’air d’un bon chien ? j’aime des trognes comme ça. Assieds-toi à ma droite, main fieux, queu carrure ! en a-t-il des épaules ! Ce blondin fera encore un fameux péqueux de rougets (pêcheur d’Anglais.) » En achevant de prononcer ces mots, Paulet me coiffa de son bonnet rouge. « Il ne lui sied point mal, à cet éfant, » remarqua-t-il avec un accent picard, dans lequel il y avait beaucoup de bienveillance.
Je vis tout d’un coup que le capitaine ne serait pas fâché de me compter parmi les siens. Dufailli, qui n’avait pas encore perdu l’usage de la parole, m’exhorta vivement à profiter de l’occasion ; c’était le bon conseil qu’il avait promis de me donner, je le suivis. Il fut convenu que je ferais la course et que, dès le lendemain, on me présenterait à l’armateur, M. Choisnard, qui m’avancerait quelqu’argent.
Il ne faut pas demander si je fus fêté par mes nouveaux camarades ; le capitaine leur avait ouvert un crédit de mille écus dans l’hôtel, et plusieurs d’entre eux avaient en ville des réserves dans lesquelles ils allèrent puiser. Je n’avais pas encore vu pareille profusion. Rien de trop cher ni de trop recherché pour des corsaires. M. Boutrois, pour les satisfaire, fut obligé de mettre à contribution la ville et les environs ; peut-être même dépêcha-t-il des courriers, afin d’alimenter cette bombance, dont la durée ne devait pas se borner à un jour. Nous étions le lundi, mon compagnon n’était pas dégrisé le dimanche suivant. Quant à moi, mon estomac répondait de ma tête, elle ne reçut pas le moindre échec.
Dufailli avait oublié la promesse que nous avions faite à nos particulières ; je l’en fis souvenir, et, quittant un instant la société, je me rendis auprès d’elles, présumant bien qu’elles s’impatientaient de ne pas nous voir revenir. Pauline était seule ; sa sœur était allée s’informer de ce qu’était devenue sa mère : elle rentra bientôt. – « Ah ! malheureuses que nous sommes, s’écria-t-elle en se jetant sur le lit, avec un mouvement de désespoir. – Eh ! bien, qu’y a-t-il donc ? lui dis-je. – Nous sommes perdues, me répondit-elle, le visage inondé de larmes : on en a transporté deux à l’hôpital ; ils ont les reins cassés ; un garde de nuit a été blessé, et le commandant de place vient de faire fermer la maison. Qu’allons-nous devenir ? où trouver un asile ? – Un asile, lui dis-je, on vous en trouvera toujours un ; mais la mère, où est-elle ? » Thérèse m’apprit que sa mère, d’abord emmenée au violon, venait d’être conduite à la prison de la ville, et qu’il était bruit qu’elle n’en serait pas quitte à bon marché.
Cette nouvelle me donna de sérieuses inquiétudes : la mère Thomas allait être interrogée, peut-être avait-elle déjà comparu au bureau de la place, ou chez le commissaire-général de police : sans doute qu’elle aurait nommé ou qu’elle nommerait Dufailli. Dufailli compromis, je l’étais aussi ; il était urgent de prévenir le coup. Je redescendis en toute hâte pour me concerter avec mon sergent, sur le parti à prendre. Heureusement, il n’était pas encore hors d’état d’entendre raison : je ne lui parlai que du danger qui le menaçait ; il me comprit, et, tirant de sa ceinture une vingtaine de guinées : « Voilà, me dit-il, de quoi m’assurer du silence de la mère Thomas ; Puis, appelant un domestique de l’hôtel, il lui remit la somme, en lui recommandant de la faire tenir sur-le-champ à la prisonnière. « C’est le fils du concierge, me dit Dufailli ; il a les pieds blancs, il passe partout, et avec çà, c’est un garçon discret. »
Le commissionnaire fut promptement de retour ; il nous raconta que la mère Thomas, interrogée deux fois, n’avait nommé personne ; qu’elle avait accepté avec reconnaissance la gratification, et qu’elle était bien résolue, la tête sur le billot, à ne rien dire qui pût nous porter préjudice ; ainsi, il devint clair pour moi que je n’avais rien à craindre de ce côté. « Et les filles, qu’en ferons-nous, dis-je à Dufailli ? – Les filles, il n’y a qu’à les emballer pour Dunkerque, je fais les frais du voyage. » Aussitôt nous montons ensemble pour signifier l’ordre de ce départ. D’abord, elles parurent étonnées ; cependant, après quelques raisonnements pour leur prouver qu’il était de leur intérêt de ne pas rester plus long-temps à Boulogne ; elles se décidèrent à nous faire leurs adieux. Dès le soir même elles se mirent en route. La séparation s’opéra sans efforts ; Dufailli avait largement financé ; et puis, il y avait de l’espoir que nous nous reverrions : deux montagnes ne se rencontrent pas… on sait le reste du proverbe. En effet, nous devions les retrouver plus tard, dans un musicos qu’achalandait la grande renommée du célèbre Jean-Bart, dont une descendante, au sein de sa patrie même, se consacrait aux plaisirs des émules de son aïeul.
La mère Thomas recouvra sa liberté, après une détention de six mois. Pauline et sa sœur, ramenées dans le giron maternel, par l’amour du sol natal, reprirent leur train de vie habituel. J’ignore si elles ont fait fortune ; ce ne serait pas impossible. Mais faute de renseignements, je termine ici leur histoire, et je continue la mienne.
Paulet et les siens s’étaient à peine aperçus de notre absence ; que déjà nous étions de retour, l’on chanta, l’on but, l’on mangea, alternativement, et tout à la fois, sans désemparer, jusqu’à minuit, confondant ainsi tous les repas dans un seul. Paulet et Fleuriot, son second, étaient les héros de la fête : au physique comme au moral, ils étaient les véritables antipodes l’un de l’autre. Le premier était un gros homme court, râblé, carré ; il avait un cou de taureau, des épaules larges, une face rebondie, et dans ses traits quelque chose du lion ; son regard était toujours ou terrible ou affectueux ; dans le combat, il était sans pitié, partout ailleurs il était humain, compatissant. Au moment d’un abordage, c’était un démon ; au sein de sa famille, près de sa femme et de ses enfants, sauf quelque reste de brusquerie, il avait la douceur d’un ange ; enfin c’était un bon fermier, simple, naïf et rond comme un patriarche, impossible de reconnaître le corsaire ; une fois embarqué, il changeait tout à coup de mœurs et de langage, il devenait rustre et grossier outre mesure, son commandement était celui d’un despote d’Orient, bref et sans réplique ; il avait un bras et une volonté de fer, malheur à qui lui résistait. Paulet était intrépide et bon homme, sensible et brutal, personne plus que lui n’avait de la franchise et de la loyauté.
Le lieutenant de Paulet était un des êtres les plus singuliers que j’eusse rencontrés : doué d’une constitution des plus robustes, très jeune encore, il l’avait usée dans des excès de tous genres ; c’était un de ces libertins qui, à force de prendre par anticipation des à-compte sur la vie, dévorent leur capital en herbe. Une tête ardente, des passions vives, une imagination exaltée, l’avaient de bonne heure poussé en avant. Il ne touchait pas à sa vingtième année et le délâbrement de sa poitrine, accompagné d’un dépérissement général, l’avaient contraint de quitter l’arme de l’artillerie dans laquelle il était entré à dix-huit ans ; maintenant, ce pauvre garçon n’avait plus que le souffle, il était effrayant de maigreur ; deux grands yeux, dont la noirceur faisait ressortir la pâleur mélancolique de son teint, étaient en apparence tout ce qui avait survécu dans ce cadavre, où respirait cependant une âme de feu. Fleuriot n’ignorait pas que ses jours étaient comptés. Les oracles de la faculté lui avaient annoncé son arrêt de mort, et la certitude de sa fin prochaine lui avait suggéré une étrange résolution : voici ce qu’il me conta à ce sujet. « Je servais, me dit-il, dans le cinquième d’artillerie légère, où j’étais entré comme enrôlé volontaire. Le régiment tenait garnison à Metz : les femmes, le manège, les travaux de nuit au polygone, m’avaient mis sur les dents ; j’étais sec comme un parchemin. Un matin on sonne le bouteselle ; nous partons ; je tombe malade en route, on me donne un billet d’hôpital, et, peu de jours après, les médecins voyant que je crache le sang en abondance, déclarent que mes poumons sont hors d’état de s’accommoder plus long-temps des mouvements du cheval : en conséquence, on décide que je serai envoyé dans l’artillerie à pied ; et à peine suis-je rétabli, que la mutation proposée par les docteurs est effectuée. Je quitte un calibre pour l’autre, le petit pour le gros, le six pour le douze, l’éperon pour la guêtre ; je n’avais plus à panser le poulet-dinde, mais il fallait faire valser la demoiselle sur la plate-forme, embarrer, débarrer à la chèvre, rouler la brouette, piocher à l’épaulement, endosser la bricolle, et, pis que cela, me coller sur l’échine la valise de La Ramée, cette éternelle peau de veau, qui a tué à elle seule plus de conscrits que le canon de Marengo. La peau de veau me donna comme on dit, le coup de bas ; il n’y avait plus moyen d’y résister. Je me présente à la réforme, je suis admis ; il ne s’agissait plus que de passer l’inspection du général ; c’était ce gueusard de Sarrazin ; il vint à moi : – Je parie qu’il est encore poitrinaire celui-là ; n’est-ce pas que tu es poitrinaire ? – Phtysiaque du second degré, répond le major. – C’est ça, je m’en doutais ; je le disais, ils le seront tous, épaules rapprochées, poitrine étroite, taille effilée, visage émacié. Voyons tes jambes ; il y a quatre campagnes là dedans, continua le général, en me frappant sur le mollet : maintenant que veux-tu ? ton congé ? tu ne l’auras pas. D’ailleurs, ajouta-t-il, il n’y a de mort que celui qui s’arrête : vas ton train… à un autre… Je voulus parler… À un autre, répéta le général, et tais-toi.
» L’inspection terminée, j’allai me jeter sur le lit de camp. Pendant que j’étais étendu sur la plume de cinq pieds, réfléchissant à la dureté du général, il me vint à la pensée que peut-être je le trouverais plus traitable, si je lui étais recommandé par un de ses confrères. Mon père avait été lié avec le général Legrand ; ce dernier était au camp d’Ambleteuse ; je songeai à m’en faire un protecteur. Je le vis. Il me reçut comme le fils d’un ancien ami, et me donna une lettre pour Sarrazin, chez qui il me fit accompagner par un de ses aides de camp. La recommandation était pressante, je me croyais certain du succès. Nous arrivons ensemble au camp de gauche, nous nous informons de la demeure du général, un soldat nous l’enseigne, et nous voici à la porte d’une baraque délabrée, que rien ne signale comme la résidence du chef ; point de sentinelle, point d’inscription, pas même de guérite. Je heurte avec la monture de mon sabre : Entrez, nous crie-t-on, avec l’accent et le ton de la mauvaise humeur, une ficelle que je tire soulève un loquet de bois, et le premier objet qui frappe nos regards en pénétrant dans cet asile, c’est une couverture de laine dans laquelle, couchés côte à côte sur un peu de paille, sont enveloppés le général et son nègre. Ce fut dans cette situation qu’ils nous donnèrent audience. Sarrazin prit la lettre, et, après l’avoir lue sans se déranger, il dit à l’aide de camp : – Le général Legrand s’intéresse à ce jeune homme, eh bien ! que désire-t-il ? que je le réforme ? il n’y pense pas. – Puis, s’adressant à moi : – Tu en seras bien plus gras quand je t’aurai réformé ! oh ! tu as une belle perspective dans tes foyers : si tu es riche, mourir à petit feu par le supplice des petits soins ; si tu es pauvre, ajouter à la misère de tes parents, et finir dans un hospice : je suis médecin, moi, c’est un boulet qu’il te faut, la guérison au bout ; si tu ne l’attrapes pas, le sac sera ton affaire, ou bien la marche et l’exercice te remettront, c’est encore une chance. Au surplus, fais comme moi, bois du chenic, cela vaut mieux que des juleps ou du petit-lait. En même temps il étendit le bras, saisit par le cou une énorme dame-jeanne qui était auprès de lui, et emplit une canette qu’il me présenta ; j’eus beau m’en défendre, il me fallut avaler une grande partie du liquide qu’elle contenait ; l’aide de camp ne put pas non plus se dérober à cette étrange politesse : le général but après nous, son nègre, à qui il passa la canette, acheva ce qui restait.
» Il n’y avait plus d’espoir de faire révoquer la décision de laquelle j’avais appelé ; nous nous retirâmes très mécontents. L’aide de camp regagna Ambleteuse, et moi le fort Châtillon, où je rentrai plus mort que vif. Dès ce moment, je fus en proie à cette tristesse apathique qui absorbe toutes les facultés ; alors j’obtins une exemption de service ; nuit et jour je restais couché sur le ventre, indifférent à tout ce qui se passait autour de moi, et je crois que je serais encore dans cette position, si, par une nuit d’hiver, les Anglais ne se fussent avisés de vouloir incendier la flottille. Une fatigue inconcevable, quoique je ne fisse rien, m’avait conduit à un pénible sommeil. Tout à coup je suis réveillé en sursaut par une détonation ; je me lève, et, à travers les carreaux d’une petite fenêtre, j’aperçois mille feux qui se croisent dans les airs. Ici ce sont des traînées immenses comme l’arc-en-ciel ; ailleurs des étoiles qui semblent bondir en rugissant. L’idée qui me vint d’abord fut celle d’un feu d’artifice. Cependant un bruit pareil à celui des torrents qui se précipitent en cascades du haut des rochers, me causa une sorte de frémissement ; par intervalles, les ténèbres faisaient place à cette lumière rougeâtre, qui doit être le jour des enfers ; la terre était comme embrasée. J’étais déjà agité par la fièvre, je m’imagine que mon cerveau grossit. On bat la générale ; j’entends crier aux armes ! et de la plante des pieds aux cheveux, la terreur me galope ; un véritable délire s’empare de moi. Je saute sur mes bottes, j’essaie de les mettre ; impossible, elles sont trop étroites ; mes jambes sont engagées dans les tiges, je veux les retirer, je ne puis pas en venir à bout. Durant ces efforts, chaque seconde accroît ma peur : enfin tous les camarades sont habillés ; le silence qui règne autour de moi m’avertit que je suis seul, et tandis que de toutes parts on court aux pièces, sans m’inquiéter de l’incommodité de ma chaussure, je fuis en toute hâte à travers la campagne, emportant mes vêtements sous mon bras.
» Le lendemain, je reparus au milieu de tout mon monde, que je retrouvai vivant. Honteux d’une poltronnerie dont je m’étonnais moi-même, j’avais fabriqué un conte qui, si on eût pu le croire, m’aurait fait la réputation d’un intrépide. Malheureusement on ne donna pas dans le paquet aussi facilement que je l’avais imaginé ; personne ne fut la dupe de mon mensonge ; c’était à qui me lancerait des sarcasmes et des brocards ; je crevais dans ma peau, de dépit et de rage, dans toute autre circonstance, je me serais battu contre toute la compagnie ; mais j’étais dans l’abattement, et ce ne fut que la nuit suivante que je recouvrai un peu d’énergie.
» Les Anglais avaient recommencé à bombarder la ville ; ils étaient très près de terre, leurs paroles venaient jusqu’à nous, et les projectiles des mille bouches de la côte, lancés de trop haut, ne pouvaient plus que les dépasser. On envoya sur la grève des batteries mobiles, qui, pour se rapprocher d’eux le plus possible, devaient suivre le flux et reflux. J’étais premier servant d’une pièce de douze ; parvenus à la dernière limite des flots, nous nous arrêtons. Au même instant, on dirige sur nous une grêle de boulets ; des obus éclatent sous nos caissons, d’autres sous le ventre des chevaux. Il est évident que malgré l’obscurité, nous sommes devenus un point de mire des Anglais. Il s’agit de riposter, on ordonne de changer d’encastrement, la manœuvre s’exécute ; le caporal de ma pièce, presqu’aussi troublé que je l’étais la veille, veut s’assurer si les tourillons sont passés dans l’encastrement de tir, il y pose une main ; soudain il jette un cri de douleur que répètent tous les échos du rivage ; ses doigts se sont aplatis sous vingt quintaux de bronze ; on s’efforce de les dégager, la masse qui les comprime ne pèse plus sur eux, qu’il se sent encore retenu ; il s’évanouit, quelques gouttes de chenaps me servent à le ranimer, et je m’offre à le ramener au camp ; sans doute on crut que c’était un prétexte pour m’éloigner.
» Le caporal et moi nous cheminions ensemble : au moment d’entrer dans le parc, que nous devions traverser, une fusée incendiaire tombe entre deux caissons pleins de poudre ; le péril est imminent ; quelques secondes encore, le parc va sauter. En gagnant au large, je puis trouver un abri ; mais je ne sais quel changement s’est opéré en moi, la mort n’a plus rien qui m’effraie ; plus prompt que l’éclair, je m’élance sur le tube de métal, d’où s’échappent le bitume et la roche enflammés : je veux étouffer le projectile, mais, ne pouvant y parvenir, je le saisis, l’emporte au loin, et le dépose à terre, dans l’instant même où les grenades qu’il renferme éclatent et déchirent la tôle avec fracas.
» Il existait un témoin de cette action : mes mains, mon visage, mes vêtements brûlés, les flancs déjà charbonnés d’un caisson, tout déposait de mon courage. J’aurais été fier sans un souvenir ; je n’étais que satisfait : mes camarades ne m’accableraient plus de leurs grossières plaisanteries. Nous nous remettons en route. À peine avons-nous fait quelques pas, l’atmosphère est en feu, sept incendies sont allumés à la fois, le foyer de cette vive et terrible lumière est sur le port ; les ardoises pétillent à mesure que les toits sont embrasés ; on croirait entendre la fusillade ; des détachements, trompés par cet effet, dont ils ignorent la cause, circulent dans tous les sens pour chercher l’ennemi. Plus près de nous, à quelque distance des chantiers de la marine, des tourbillons de fumée et de flamme s’élèvent d’un chaume, dont les ardents débris se dispersent au gré des vents ; des cris plaintifs viennent jusqu’à nous, c’est la voix d’un enfant ; je frémis ; il n’est plus temps peut-être ; je me dévoue, l’enfant est sauvé, et je le rends à sa mère, qui, s’étant écartée un moment, accourait éplorée pour le secourir.
» Mon honneur était suffisamment réparé : on n’eût plus osé me taxer de lâcheté ; je revins à la batterie, où je reçus les félicitations de tout le monde. Un chef de bataillon qui nous commandait alla jusqu’à me promettre la croix, qu’il n’avait pu obtenir pour lui-même, parce que, depuis trente ans qu’il servait, il avait eu le malheur de se trouver toujours derrière le canon, et jamais en face. Je me doutais bien que je ne serais pas décoré avant lui, et grâces à ses recommandations, je ne le fus pas non plus. Quoi qu’il en soit, j’étais en train de m’illustrer, toutes les occasions étaient pour moi. Il y avait entre la France et l’Angleterre des pourparlers pour la paix. Lord Lauderdale était à Paris en qualité de plénipotentiaire, quand le télégraphe y annonça le bombardement de Boulogne ; c’était le second acte de celui de Copenhague. À cette nouvelle, l’Empereur, indigné d’un redoublement d’hostilités sans motif, mande le lord, lui reproche la perfidie de son cabinet, et lui enjoint de partir sur-le-champ. Quinze heures après, Lauderdale descend ici au Canon d’Or. C’est un Anglais, le peuple exaspéré veut se venger sur lui ; on s’attroupe, on s’ameute, on se presse sur son passage, et quand il paraît, sans respect pour l’uniforme des deux officiers qui sont sa sauve-garde, de toutes parts on fait pleuvoir sur lui des pierres et de la boue. Pâle, tremblant, défait, le lord s’attend à être sacrifié ; mais, le sabre au poing, je me fais jour jusqu’à lui : Malheur à qui le frapperait ! m’écriai-je alors. Je harangue, j’écarte la foule, et nous arrivons sur le port, où, sans être exposé à d’autres insultes, il s’embarque sur un bâtiment parlementaire. Il fut bientôt à bord de l’escadre anglaise, qui, le soir même, continua de bombarder la ville. La nuit suivante, nous étions encore sur le sable. À une heure du matin, les Anglais, après avoir lancé quelques congrèves[1], suspendent leur feu : j’étais excédé de fatigue, je m’étends sur un affût, et je m’endors. J’ignore combien de temps se prolongea mon sommeil, mais quand je m’éveillai, j’étais dans l’eau jusqu’au cou, tout mon sang était glacé, mes membres engourdis, ma vue, comme ma mémoire, s’était égarée. Boulogne avait changé de place, et je prenais les feux de la flottille pour ceux de l’ennemi. C’était là le commencement d’une maladie fort longue, pendant laquelle je refusai opiniâtrement d’entrer à l’hôpital. Enfin l’époque de la convalescence arriva ; mais comme j’étais trop lent à me rétablir, on me proposa de nouveau pour la réforme, et cette fois je fus congédié malgré moi, car j’étais maintenant de l’avis du général Sarrazin.
» Je ne voulais plus mourir dans mon lit, et m’appliquant le sens de ces paroles, il n’y a de mort que celui qui s’arrête, pour ne pas m’arrêter, je me jetai dans une carrière où, sans travaux trop pénibles, il y a de l’activité de toute espèce. Persuadé qu’il me restait peu de temps à vivre, je pris la résolution de bien l’employer : je me fis corsaire ; que risquais-je ? je ne pouvais qu’être tué, et alors je perdais peu de chose ; en attendant, je ne manque de rien, émotions de tous les genres, périls, plaisirs, enfin je ne m’arrête pas. »
Le lecteur sait, à présent quels hommes étaient le capitaine Paulet et son second. À peine restait-il le souffle à ce dernier, et au combat, comme partout, il était le boute-en-train. Parfois semblait-il absorbé dans de sombres pensées, il s’en arrachait par une brusque secousse, sa tête donnait l’impulsion à ses nerfs, et il devenait d’une turbulence qui ne connaissait pas de bornes : point d’extravagance, point de saillie singulière dont il ne fût capable ; dans cette excitation factice, tout lui était possible, il eût tenté d’escalader le ciel. Je ne puis pas dire toutes les folies qu’il fit dans le premier banquet auquel Dufailli m’avait présenté ; tantôt il proposait un divertissement, tantôt un autre ; enfin le spectacle lui passa par l’esprit : « Que donne-t-on aujourd’hui ? Misanthropie et Repentir. J’aime mieux les Deux Frères. Camarades ! qui de vous veut pleurer ? Le capitaine pleure tous les ans à sa fête. Nous autres garçons, nous n’avons pas de ces joies-là. Ce que c’est quand on est père de famille ! Allez-vous quelquefois à la comédie, notre supérieur ? il faut voir çà, il y aura foule. Tout beau monde, des pêcheuses de crevettes en robes de soie ; c’est la noblesse du pays. Ô Dieu ! le ciel est poignardé ! des manchettes à des cochons. N’importe, il faut la comédie à ces dames ; encore, si elles entendaient le français ? le français ! ah bien oui ! allez donc vous y faire mordre ; je me souviens du dernier bal ; des particulières, quand on les invite à danser, qui vous répondent, je suis reteinte. – Ah çà ! auras-tu bientôt fini d’écorner le pays ? dit Paulet à son lieutenant, qu’aucun des corsaires n’avait interrompu. – Capitaine, reprit celui-ci, j’ai fait ma motion ; personne ne dit mot, personne ne veut pleurer ; au revoir, je vais pleurer tout seul. »
Fleuriot sortit aussitôt ; alors le capitaine commença de nous faire son éloge : « C’est un cerveau brûlé, dit-il, mais pour la bravoure, il n’y a pas son pareil sous la calotte des cieux. » Puis il poursuivit en nous racontant comment il devait à la témérité de Fleuriot la riche capture qu’il venait de faire. Le récit était animé et piquant, malgré les cuirs dont l’assaisonnait Paulet, qui avait une habitude bien bizarre, celle de fausser la liaison en prodiguant le t toutes les fois qu’il était avec ses compagnons de bord, et l’s lorsque, dans les relations civiles, ou dans les jours de fête, il se croyait obligé à plus d’urbanité : ce fut avec force t qu’il fit la description presque burlesque d’un combat dans lequel, suivant sa coutume, il avait avec la barre du cabestan assommé une douzaine d’Anglais. La soirée s’avançait ; Paulet, qui n’avait pas encore revu sa femme et ses enfants, allait se retirer, lorsque revint Fleuriot ; il n’était pas seul : « Capitaine, dit-il, en entrant, comment trouvez-vous le gentil matelot que je viens d’engager ? j’espère que le bonnet rouge n’a jamais coiffé un plus joli visage ? – C’est vrai, répondit Paulet, mais est-ce un mousse que tu m’amènes-là ? il n’a pas de barbe… eh ! parbleu, ajouta-t-il, en élevant la voix avec surprise, c’est une femme ! » Puis continuant avec un étonnement encore plus marqué : « Je ne me trompe pas, c’est la Saint ***[2]. – Oui, reprit Fleuriot, c’est Elisa, l’aimable moitié du directeur de la troupe qui fait les délices de Boulogne, elle vient avec nous se réjouir de notre bonheur. – Madame parmi des corsaires, je lui en fais mon compliment, poursuivit le capitaine, en lançant à la comédienne travestie ce regard du mépris qui n’est que trop expressif ; elle va entendre de belles choses ; il faut avoir le diable au corps ; une femme ! – Allons donc ! notre chef, s’écria Fleuriot, ne dirait-on pas que des corsaires sont des cannibales ; ils ne la mangeront pas. D’ailleurs, vous savez le refrain :
Elle aime à rire, elle aime à boire,
Elle aime à chanter comme nous
» Quel mal y a-t-il à ça ? – Aucun, mais la saison est propice pour la course, tout mon équipage est en parfaite santé, et il n’y a pas besoin ici de madame pour qu’il se porte bien. » À ces mots, prononcés avec humeur, Elisa baissa la vue. « Chère enfant, ne rougissez pas, dit Fleuriot, le capitaine plaisante… – Non, morbleu ! je ne plaisante pas, je me souviens de la Saint-Napoléon, où tout l’état-major, à commencer par le maréchal Brune, était à pied ; il n’y eut pas de petite guerre ce jour-là : madame sait pourquoi, ne me forcez pas à en dire davantage. »
Élisa, que ce langage humiliait, n’était pas à se repentir d’avoir accompagné Fleuriot : dans le trouble qui l’agitait, elle essaya de justifier son apparition au Lion d’argent, avec cette douceur de ton, ces manières gracieuses, cette aménité de physionomie, que des mœurs très licencieuses semblent exclure : elle parla d’admiration, de gloire, de vaillance, d’héroïsme, et, afin de prendre Paulet par les sentiments, elle fit un appel à sa galanterie, en le qualifiant de chevalier français. La flatterie a toujours plus ou moins d’empire sur les âmes ; Paulet devint presque poli, les s lui revinrent à la bouche avec autant de profusion que s’il eût été endimanché ; il s’excusa du mieux qu’il put, obtint son pardon d’Elisa, et prit congé de ses convives, en leur recommandant de s’amuser : sans doute, ils ne s’ennuyèrent pas. Quant à moi, il me fut impossible de rester éveillé ; je gagnai donc mon lit, où je ne vis et n’entendis rien. Le lendemain, j’étais frais et gaillard… Fleuriot me conduisit chez l’armateur, qui, sur ma bonne mine, me fit l’avance de quelques pièces de cinq francs. Sept jours après, huit d’entre nos camarades étaient entrés à l’hôpital… Le nom de là comédienne Saint *** avait disparu de l’affiche. On dit qu’afin de se mettre promptement en lieu sûr, elle avait profité de la chaise de poste d’un colonel, qui, tourmenté du besoin de jouer jusqu’aux plumets de son régiment, avait fait tout exprès le voyage de Paris.
J’attendais avec impatience le moment de nous embarquer. Les pièces de cinq francs de M. Choisnard étaient comptées, et si elles me faisaient vivre, elles ne me mettaient guère à même de faire figure ; d’un autre côté, tant j’étais à terre, j’avais à redouter quelque fâcheuse rencontre : Boulogne était infesté d’un grand nombre de mauvais garnements. Les Mansui, les Tribout, les Salé, tenaient des jeux sur le port, où ils dépouillaient les conscrits, sous la direction d’un autre bandit, le nommé Canivet, qui, à la face de l’armée et de ses chefs, osait s’intituler le bourreau des crânes. Il me semble encore voir cette légende sur son bonnet de police, où étaient figurés une tête de mort, des fleurets et des ossements en sautoir. Canivet était comme le fermier ou plutôt le suzerain de petit paquet, des dés, etc. C’était de lui que relevaient une foule de maîtres, prévôts, bâtonistes, tireurs de savattes et autres praticiens, qui lui payaient tribut pour avoir le droit d’exercer le métier d’escroc ; il les surveillait sans cesse, et quand il les soupçonnait de quelqu’infidélité, d’ordinaire il les punissait par des coups d’épée. J’imaginais que dans cette lie, il était impossible qu’il n’y eût pas quelque échappé des bagnes ; je craignais une reconnaissance, et mes appréhensions étaient d’autant plus fondées, que j’avais entendu dire que plusieurs forçats libérés avaient été placés, soit dans le corps des sapeurs, soit dans celui des ouvriers militaires de la marine. Depuis quelque temps, on ne parlait que de meurtres, d’assassinats, de vols, et tous ces crimes présentaient les caractères auxquels on peut reconnaître l’œuvre de scélérats exercés ; peut-être dans le nombre des brigands s’en trouvait-il quelques-uns de ceux avec qui j’avais été lié à Toulon. Il m’importait de les fuir, car, mis de nouveau en contact avec eux, j’aurais eu bien de la peine à éviter d’être compromis. On sait que les voleurs sont comme les filles : quand on se propose d’échapper à leur société et à leurs vices, tous se liguent pour empêcher la conversion ; tous revendiquent le camarade qui renonce au mal, et c’est pour eux une espèce de gloire de le retenir dans l’état abject dont ils ne veulent ni sortir, ni laisser sortir les autres. Je me rappelais mes dénonciateurs de Lyon, et les motifs qui les avaient portés à me faire arrêter. Comme l’expérience était récente, je fus disposé tout naturellement à en faire mon profit et à me mettre sur mes gardes : en conséquence, je me montrais dans les rues le plus rarement possible ; je passais presque tout mon temps à la basse ville, chez une madame Henri, qui prenait des corsaires en pension, et leur faisait crédit sur la perspective de leurs parts de prises. Madame Henri, dans la supposition où elle aurait été mariée, était une fort jolie veuve encore très avenante, bien qu’elle approchât de ses trente-six ans ; elle avait auprès d’elle deux filles charmantes, qui, sans cesser d’être sages, avaient la bonté de donner des espérances à tout beau garçon que la fortune favorisait. Quiconque dépensait son or dans la maison était le bien venu ; mais celui qui dépensait le plus était toujours le plus avant dans les bonnes grâces de la mère et des filles, aussi long-temps qu’il dépensait. La main de ces demoiselles avait été promise vingt fois, vingt fois peut-être elles avaient été fiancées, et leur réputation de vertu n’en avait reçu aucun échec. Elles étaient libres dans leurs paroles ; dans leur conduite elles étaient réservées, et quoiqu’elles ne se fissent pas blanches de leur innocence, personne ne pouvait se vanter de leur avoir fait faire un faux pas. Cependant, combien de héros de la mer avaient subi l’influence de leurs attraits ! combien de soupirants, trompés par des agaceries sans conséquence, s’étaient flattés d’une prédilection qui devait les conduire au bonheur ! et puis, comment ne pas se méprendre sur les véritables sentiments de ces chastes personnes, dont l’amabilité constante avait toujours l’air d’une préférence ? Le matador d’aujourd’hui était fêté, choyé ; on lui prodiguait mille petits soins, on lui permettait certaines privautés, un baiser, par exemple, pris à la dérobée ; on l’encourageait par des œillades, on lui donnait des conseils d’économie, en poussant adroitement à la consommation ; on réglait l’emploi de son argent, et si les fonds baissaient, ce qui avait lieu ordinairement à son insu, ce n’était que par l’offre généreuse d’un prêt qu’il apprenait la pénurie de ses finances ; jamais on ne l’éconduisait : sans témoigner ni indifférence ni tiédeur, on attendait que la nécessité et l’amour le fissent voler à de nouveaux périls. Mais à peine le navire qui emportait l’amant avait-il mis à la voile, et voguait-il vers les chances heureuses sur lesquelles étaient hypothéqués un hymen éventuel et une somme légère que l’on avait pris l’engagement de rendre au centuple, que déjà il était remplacé par quelqu’autre fortuné mortel ; si bien que dans la maison de madame Henri, les adorateurs faisaient la navette, et que ses deux demoiselles étaient comme deux citadelles qui, toujours investies, toujours près de se rendre, en apparence, ne succombaient jamais. Quand l’un levait le siège, l’autre le reprenait ; il y avait de l’illusion pour tout le monde, et il n’y avait que de l’illusion. Cécile, l’une des filles de madame Henri, avait pourtant dépassé sa vingtième année ; elle était enjouée, rieuse à l’excès, écoutait tout sans rougir, jusqu’à la gravelure, et ne se fâchait qu’à l’attouchement. Hortense, sa sœur, ne s’en fâchait même pas ; elle était plus jeune, et son caractère était plus naïf ; parfois elle disait des choses… mais il semblait que du miel et de l’eau de fleur d’orange coulaient dans les veines de ces deux enfants, tant, en toute occasion, elles étaient douces et calmes. Dans leur cœur, il n’y avait rien d’inflammable, et quoiqu’elles ne se signassent pas pour un propos leste, ou qu’elles ne s’étonnassent pas du geste un peu trop familier d’un matelot, elles n’en méritaient pas moins, assure-t-on, le surnom qu’on a donné à la bergère de Vaucouleurs, ainsi qu’à une petite ville de la Picardie.
Ce fut au foyer de cette famille si recommandable, que je vins m’asseoir pendant un mois avec une assiduité dont je m’étonnais moi-même, partageant mes heures entre le piquet, la gandriole et la petite bière : cet état d’une inaction qui me pesait, cessa enfin. Paulet voulut reprendre le cours de ses exploits habituels : nous nous mîmes en chasse ; mais les nuits n’étaient plus assez obscures, et les jours étaient devenus trop longs : toutes nos captures se réduisirent à quelques misérables bateaux de charbon, et à un sloop de peu de valeur, sur lequel nous trouvâmes je ne sais plus quel lord, qui, dans l’espoir de recouvrer de l’appétit, avait entrepris avec son cuisinier une promenade maritime. On l’envoya dépenser ses revenus et manger des truites à Verdun.
La morte-saison approchait, et nous n’avions presque pas fait de butin. Le capitaine était taciturne et triste comme un bonnet de nuit ; Fleuriot se désespérait, il jurait, il tempêtait du matin au soir ; du soir au matin il était dans un véritable accès de rage ; tous les hommes de l’équipage, suivant une expression fort usitée parmi les gens du peuple, se mangeaient les sangs… Je crois qu’avec des dispositions semblables, nous aurions attaqué un vaisseau à trois ponts. Il était minuit : sortis d’une petite anse auprès de Dunkerque, nous nous dirigions vers les côtes d’Angleterre ; tout à coup la lune, apparaissant à travers une clairière de nuages, répand sa lumière sur les flots du détroit ; à peu de distance, des voiles blanchissent ; c’est un brick de guerre qui sillonne la vague luisante ; Paulet l’a reconnu : « Mes enfants, nous crie-t-il, il est à nous, tout le monde à plat ventre, et je vous réponds du poste. » En un instant il nous eut conduits à l’abordage. Les Anglais se défendaient avec fureur ; une lutte terrible s’engagea sur leur pont. Fleuriot, qui, selon sa coutume, y était monté le premier, tomba au nombre des morts : Paulet fut blessé ; mais il se vengea, et vengea son second : il assomma tout autour de lui ; jamais je n’avais vu une boucherie pareille. En moins de dix minutes, nous fûmes les maîtres du bord, et le pavillon aux trois couleurs fut hissé à la place du pavillon rouge. Douze des nôtres avaient succombé dans cette action, où de part et d’autre fut déployé un égal acharnement.
Entre ceux qui avaient péri, était un nommé Lebel, dont la ressemblance avec moi était si frappante, que journellement elle donnait lieu aux plus singulières méprises. Je me rappelai que mon Sosie avait des papiers fort en règle. Parbleu ! ruminai-je en moi-même, l’occasion est belle ; on ne sait pas ce qui peut arriver : Lebel va être jeté aux poissons ; il n’a pas besoin de passe-port, et le sien m’irait à merveille.
L’idée me paraissait excellente : je ne craignais qu’une chose, c’était que Lebel n’eût déposé son portefeuille dans les bureaux de l’armateur. Je fus au comble de la joie, en le palpant sur sa poitrine ; aussitôt je m’en emparai sans être vu de personne, et quand on eut lancé à la mer les sacs de sable, dans lesquels, pour mieux les retenir à fond, on avait placé les cadavres, je me sentis soulagé d’un grand poids, en songeant que désormais j’étais débarrassé de ce Vidocq qui m’avait joué tant de mauvais tours.
Cependant, je n’étais pas encore complètement rassuré ; Dufailli, qui était notre capitaine d’armes, connaissait mon nom. Cette circonstance me contrariait : pour n’avoir rien à redouter de lui, je résolus de le déterminer à me garder le secret, en lui faisant une fausse confidence. Inutile précaution : j’appelle Dufailli, je le cherche sur le brick, il n’y était pas ; je vais à bord de la Revanche, je cherche, j’appelle encore, point de réponse ; je descends dans la soute aux poudres, pas de Dufailli. Qu’est-il devenu ? Je monte à la cambuse : auprès d’un baril de genièvre et de quelques bouteilles, j’aperçois un corps étendu : c’est lui ; je le secoue, je le retourne… il est noir… il est mort.
Telle fut la fin de mon protecteur, une congestion cérébrale, une apoplexie foudroyante ou une asphyxie, causée par l’ivresse, avait terminé sa carrière. Depuis qu’il existait des sergents d’artillerie de marine, on n’en citait pas un qui eût bu avec autant de persévérance. Un seul trait le caractérisera : ce prince des ivrognes le racontait comme le plus beau de sa vie. C’était le jour des Rois, Dufailli avait attrapé la fève : pour honorer sa royauté, ses camarades le font asseoir sur une civière portée par quatre canonniers ; c’était le pavois sur lequel on l’élevait. À chaque brancard pendaient des bidons d’eau-de-vie provenant de la distribution du matin ; juché sur cette espèce de palanquin improvisé, Dufailli faisait une pose devant chaque baraque du camp, où il buvait et faisait boire aux acclamations d’usage. Ces stations furent si souvent réitérées, qu’à la fin la tête lui tourna, et que sa majesté éphémère, introduite dans une escouade, avala, presque sans la mâcher, une livre de lard qu’elle prit pour du fromage de Gruyère : la substance était indigeste, Dufailli, rentré dans sa baraque, se jette sur son lit ; il éprouve des soulèvements de cœur, il veut réprimer ces mouvements expansifs, l’éruption a lieu, la crise passe, il s’endort, et n’est tiré de sa léthargie profonde que par le grognement d’un chien et les coups de griffes d’un chat, qui, postés à proximité du cratère, se disputaient… Ô dignité de l’homme, qu’étais-tu devenue ? À ce hideux tableau, qui ne reconnaîtrait que nul, plus que Dufailli, n’était fait pour donner des leçons de tempérance aux enfants des Spartiates ?
Je me suis arrêté un instant pour donner un dernier coup de pinceau à mon pays ; il n’est plus, que Dieu lui fasse paix ! Je reviens à bord du brick, où Paulet m’avait laissé avec le capitaine de prise et cinq hommes de l’équipage de la Revanche. À peine avions-nous fermé les écoutilles pour nous assurer de nos prisonniers, que nous nous rapprochâmes de la côte afin de la longer le plus possible jusqu’à Boulogne ; mais quelques coups de canon, tirés par les Anglais avant l’abordage, avaient appelé dans notre direction une de leurs frégates. Elle força de voiles pour nous canonner, et bientôt elle fut si près de nous, que ses boulets nous dépassèrent ; elle nous suivit ainsi jusqu’à la hauteur de Calais. Alors la mer devenant houleuse, et un vent impétueux chassant au rivage, nous crûmes qu’elle s’éloignerait, dans la crainte de se briser sur des récifs ; elle n’était déjà plus maîtresse de ses manœuvres ; poussée vers la terre, elle eut à lutter à la fois contre tous les éléments déchaînés : s’échouer était pour elle l’unique moyen de salut, il ne fut pas tenté. En un clin d’œil, la frégate fut précipitée sous les feux croisés des batteries de la côte de fer, de la jetée, du fort Rouge : de partout on faisait pleuvoir sur elle des bombes, des boulets ramés et des obus. Au milieu du bruit effroyable de mille détonations, un cri de détresse se fait entendre, et la frégate s’abîme dans les flots, sans qu’il soit possible de lui porter secours.
Une heure après, le jour parut ; de loin en loin ; soulevés par les vagues, flottaient quelques débris. Un homme et une femme s’étaient attachés sur un mât, ils agitaient un mouchoir ; nous allions doubler le cap Grenet lorsque nous aperçûmes leurs signaux. Il me semblait que nous pouvions sauver ces malheureux ; j’en fis la proposition au capitaine de prises, et sur son refus de mettre la chaloupe à notre disposition, dans l’élan d’une pitié que je n’avais pas encore ressentie, je me laissai emporter à la menace de lui faire sauter la cervelle. « Allons donc ! me dit-il avec un sourire dédaigneux, et en haussant les épaules, le capitaine Paulet a plus d’humanité que toi, il les a vus, et ne bouge pas : c’est qu’il n’y a rien à faire. Ils sont là-bas, nous sommes ici, avec le gros temps, chacun pour soi ; nous avons fait assez de perte comme ça, quand il n’y aurait que Fleuriot. »
Cette réponse me rendit à mon sang-froid, et me fit comprendre que nous courions nous-mêmes un danger plus grand que je ne le supposais : en effet, les vagues s’amoncelaient ; au-dessus ; se jouant les guoilans et les mauves qui mêlaient leurs cris aigus au sifflement de l’aquilon ; à l’horizon, de plus en plus obscurci, se projetaient de longues bandes noires et rouges ; l’aspect du ciel était affreux, tout annonçait une tempête. Heureusement Paulet avait habilement calculé le temps et les distances ; nous manquâmes la passe de Boulogne, mais, non loin de là, au Portel, nous trouvâmes un refuge et la sécurité du rivage. En débarquant dans cet endroit, nous vîmes couchés sur la grève les deux infortunés que j’aurais si bien voulu secourir ; le reflux les avait apportés sans vie sur la terre étrangère, où nous devions leur donner la sépulture : c’étaient peut-être deux amans. Je fus touché de leur sort, mais d’autres soins m’arrachèrent à mes regrets. Toute la population du village, femmes, enfants, vieillards, était accourue sur la côte. Les familles de cent cinquante pêcheurs se livraient au désespoir, à la vue de frêles embarcations que foudroyaient six vaisseaux de ligne anglais, dont les masses solides affrontaient la mer en courroux. Chaque spectateur, avec une anxiété qu’il est plus aisé de concevoir que de décrire, ne suivait des yeux que la barque à laquelle il s’intéressait, et, selon qu’elle était submergée ou se trouvait hors de péril, c’étaient des cris, des pleurs, des lamentations, ou des transports d’une joie extravagante. Des femmes, des filles, des mères, des épouses, s’arrachaient les cheveux, déchiraient leurs vêtements, se roulaient par terre, en vomissant des imprécations et des blasphèmes ; d’autres, sans croire insulter à tant de douleur, et sans songer à remercier le ciel, vers lequel l’instant d’auparavant elles levaient des mains suppliantes, dansaient, chantaient, et, le visage encore inondé de pleurs, manifestaient tous les symptômes de l’allégresse la plus vive, les vœux les plus fervents, le patronage du bienheureux saint Nicolas, l’efficacité de son intercession, tout était oublié. Peut-être un jour plus tard, allait-on s’en souvenir, peut-être devait-il y avoir un peu de compassion pour le prochain, mais pendant la tempête l’égoïsme était là… On me l’avait dit : chacun pour soi.
CHAPITRE XX
Je suis admis dans l’artillerie de marine. – Je deviens caporal. – Sept prisonniers de guerre. – Sociétés secrètes de l’armée les olympiens. – Duels singuliers. – Rencontre d’un forçat. – Le comte de L***, mouchard politique. – Il disparaît. – L’incendiaire. – On me promet de l’avancement. – Je suis trahi. – Encore une fois la prison. – Licenciement de l’armée de la Lune. – le soldat gracié. – Un de mes compagnons est passé par les armes. – Le bandit piémontais. – Le sorcier du camp. – Quatre assassins mis en liberté. – Je m’évade.
Dès le soir même je retournai à Boulogne, où j’appris que, d’après un ordre du général en chef, tous les individus qui, dans chaque corps, étaient signalés comme mauvais sujets, devaient être immédiatement arrêtés et embarqués à bord des bâtiments armés en course. C’était une espèce de presse qu’on allait exercer pour purger l’armée, et mettre un terme à sa démoralisation, qui commençait à devenir alarmante. Ainsi, désormais il n’y avait plus moyen de m’isoler qu’en quittant la Revanche, sur laquelle, pour réparer les pertes du dernier combat, l’armateur ne manquerait pas d’envoyer quelques-uns de ces hommes dont le général jugeait à propos de se défaire. Puisque Canivet et ses affidés ne devaient plus reparaître dans les camps, je crus qu’il n’y avait plus aucun inconvénient à me faire soldat. Muni des papiers de Lebel, je m’enrôlai dans une compagnie de canonniers de marine, qui faisait alors le service de la côte ; et comme Lebel avait autrefois été caporal dans cette arme, j’obtins ce grade à la première vacance, c’est-à-dire quinze jours après mon admission. Une conduite régulière et la parfaite intelligence des manœuvres, que je connaissais comme un artilleur de la vieille roche, me valurent promptement la bienveillance de mes chefs. Une circonstance qui aurait dû me la faire perdre acheva de me concilier leur estime.
J’étais de garde au fort de l’Eure ; c’était pendant les grandes marées, il faisait un temps affreux : des montagnes d’eau balayaient la plate-forme avec une telle violence, que les pièces de trente-six n’étaient plus immobiles dans leurs embrasures ; à chaque renouvellement de la lame, on eût dit que le fort entier allait être emporté. Tant que la Manche ne serait pas plus calme, il était plus qu’évident qu’aucun navire ne se montrerait : la nuit venue, je supprimai donc les sentinelles, permettant ainsi aux soldats du poste que je commandais de goûter les douceurs du lit de camp jusqu’au lendemain. Je veillais pour eux, ou plutôt je ne dormais pas, parce que je n’avais pas besoin de sommeil, lorsque sur les trois heures du matin, quelques mots que je reconnais pour de l’anglais, frappent mon oreille, en même temps que l’on heurte à la porte placée au bas de l’escalier qui conduit à la batterie. Je crus que nous étions surpris : aussitôt j’éveille tout le monde ; je fais charger les armes, et déjà je m’apprête à vendre chèrement ma vie quand, à travers la porte, j’entends la voix et les gémissements d’une femme qui implore notre assistance. Bientôt je distingue clairement ces paroles françaises : « Ouvrez, nous sommes des naufragés. » – J’hésite un moment ; cependant, après avoir pris mes précautions, pour immoler le premier qui se présenterait avec des intentions hostiles, j’ouvre, et je vois entrer une femme, un enfant et cinq matelots, qui étaient plus morts que vifs. Mon premier soin fut de les faire réchauffer ; ils étaient mouillés jusqu’aux os et transis de froid. Mes canonniers et moi, nous leur prêtâmes des chemises et des vêtements, et dès qu’ils se furent un peu remis, ils me racontèrent l’accident qui nous procurait l’honneur de leur visite. Partis de la Havane sur un trois-mâts, et à la veille de terminer une heureuse traversée, ils étaient venus se briser contre le môle de pierre qui nous renfermait, et n’avaient échappé à la mort qu’en se précipitant des hunes sur la batterie. Dix-neuf de leurs compagnons de voyage, parmi lesquels le capitaine, avaient été engloutis dans les flots.
La mer nous tint encore bloqués huit jours, sans que l’on osât envoyer une chaloupe pour nous relever. Au bout de ce temps, je fus ramené à terre avec mes naufragés, que je conduisis moi-même chez le chef militaire de la marine, qui me félicita comme si je les eusse fait prisonniers. Si c’était là une brillante capture, c’était bien le cas de dire qu’elle ne m’avait coûté qu’une peur. Quoi qu’il en soit, dans la compagnie, elle fit concevoir la plus haute opinion de moi.
Je continuai à remplir mes devoirs avec une exactitude exemplaire ; trois mois s’écoulèrent, et je ne méritais que des éloges ; je me proposais d’en mériter toujours ; mais une carrière aventureuse ne cesse pas de l’être tout d’un coup. Une fatale propension à laquelle j’obéissais malgré moi, et souvent à mon insu, me rapprochait constamment des personnes ou des objets qui devaient le plus s’opposer à ce que je maîtrisasse ma destinée : ce fut à cette singulière propension, que, sans être agrégé aux sociétés secrètes de l’armée, je dus d’être initié à leurs mystères.
C’est à Boulogne que ces sociétés prirent naissance. La première de toutes, quoi qu’en ait pu dire M. Nodier, dans son histoire des philadelphes[3], fut celle des olympiens, dont le fondateur apparent fut un nommé Crombet de Namur ; elle ne se composa d’abord que d’aspirants et d’enseignes de la marine, mais elle ne tarda pas à prendre de l’accroissement, et l’on y admit les militaires de toutes les armes, principalement de l’artillerie.
Crombet, qui était fort jeune, (il n’était qu’aspirant de première classe), se démit de son titre de chef des olympiens, et rentra dans les rangs des frères, qui élurent un vénérable, et se constituèrent avec des formes maçonniques. La société n’avait pas encore de but politique, ou du moins si elle en avait un, il n’était connu que des membres influents. Le but avoué était l’avancement mutuel : l’olympien qui s’élevait devait concourir de tout son pouvoir à l’élévation des olympiens qui étaient dans des grades inférieurs. Pour être reçu, si l’on appartenait à la marine, il fallait être au moins aspirant de seconde classe, et au plus capitaine de vaisseau ; si l’on servait dans les troupes de terre, la limite allait du colonel à l’adjudant-sous-officier exclusivement. Je n’ai pas entendu dire que dans leurs réunions, les olympiens aient jamais agité des questions qui eussent trait à la conduite du gouvernement, mais on y proclamait l’égalité, la fraternité, et l’on y prononçait des discours qui contrastaient beaucoup avec les doctrines impériales.
À Boulogne, les olympiens se rassemblaient habituellement chez une Mme Hervieux, qui tenait une espèce de café borgne peu fréquenté. C’était là qu’ils tenaient leurs séances, et qu’ils faisaient leurs réceptions, dans une salle qui leur était consacrée.
Il y avait à l’École militaire, ainsi qu’à l’École polytechnique, des loges qui étaient affiliées aux olympiens. En général, l’initiation se réduisait à des mots de passe, à des signes et à des attouchements que l’on enseignait aux récipiendaires ; mais les véritables adeptes savaient et voulaient autre chose. Le symbole de la société expliquait assez les intentions de ces derniers ; un bras armé d’un poignard sortait de la nue ; au-dessous l’on voyait un buste renversé : c’était celui de César. Ce symbole, dont le sens se révèle de lui-même, était empreint sur le sceau des diplômes. Ce sceau avait été modelé en relief par un canonnier nommé Beaugrand ou Belgrand, employé à la direction de l’artillerie ; on en avait ensuite obtenu le creux en cuivre au moyen de la fonte rectifiée par la ciselure.
Pour être reçu olympien, il fallait avoir fait preuve de courage, de talent et de discrétion. Les militaires d’un mérite distingué étaient ceux que l’on cherchait à enrôler de préférence. On faisait en sorte, autant que possible, d’attirer dans la société les fils des patriotes qui avaient protesté contre l’érection du trône impérial, ou qui avaient été persécutés. Sous l’empire, il suffisait d’appartenir à une famille de mécontents, pour se trouver dans la catégorie des admissibles.
Les chefs véritables de cette association étaient dans l’ombre, et ne communiquaient pas leurs projets. Ils complotaient le renversement du despotisme, mais ils ne mettaient personne dans leur confidence. Il fallait que les hommes au moyen desquels ils espéraient que ce résultat s’accomplirait, fussent des conjurés à leur insu. Personne ne devait leur proposer de conspirer, mais ils devaient en trouver la force et la volonté dans leur propre situation. C’est en vertu de cette combinaison que les olympiens finirent par se recruter jusque dans les derniers rangs des armées tant de terre que de mer.
Un sous-officier ou un soldat marquait-il, par son instruction, par l’énergie de son caractère, par sa fermeté, par son esprit d’indépendance, les olympiens l’attiraient à eux, et bientôt il entrait dans cette confraternité, où l’on s’engageait, sous la foi du serment, à se donner les uns aux autres aide et protection. L’appui réciproque que l’on se promettait semblait être le seul lien de la société ; mais au fond il y avait une préméditation cachée. On savait, d’après une longue expérience, que sur cent individus admis, à peine dix obtiendraient un avancement proportionné à leur mérite : ainsi, sur cent individus, il était probable qu’avant peu d’années on compterait quatre-vingt-dix ennemis de l’ordre de choses dans lequel il leur avait été impossible de se caser. C’était le comble de l’adresse d’avoir classé de la sorte, sous une dénomination commune, des hommes entre lesquels on était certain qu’il y aurait plus tard l’affinité du mécontentement, des hommes qui seraient irrités, et qui, fatigués de l’injustice, ne manqueraient pas de saisir avec empressement l’occasion de se venger. Ainsi se trouvait fomentée une ligue qui, pour s’ignorer elle-même, n’en avait pas moins une existence moins réelle. Les éléments d’une conspiration étaient rapprochés : ils se perfectionnaient, se développaient de plus en plus ; mais il ne devait point y avoir de conspirateurs tant que cette conspiration n’éclaterait pas ; on attendait le moment propice.
Les olympiens précédèrent de plusieurs années les philadelphes, avec lesquels ils se confondirent plus tard. L’origine de leur société est un peu antérieure à l’époque du sacre de Napoléon. On assure qu’ils se réunirent pour la première fois à l’occasion de la disgrâce de l’amiral Truguet, destitué parce qu’il avait voté contre le consulat à vie. Après la condamnation de Moreau, la société, constituée sur des bases plus larges, compta un grand nombre de Bretons et de Francs-Comtois. Parmi ces derniers, était Oudet, qui puisa chez les olympiens la première idée de la philadelphie.
Les olympiens existèrent près de deux années sans que le gouvernement parût s’en inquiéter. Enfin, en 1806, M. Devilliers, commissaire-général de police à Boulogne, écrivit à Fouché pour lui dénoncer leurs rassemblements ; il ne les signalait pas comme dangereux, mais il croyait de son devoir de les faire surveiller, et il n’avait près de lui aucun agent à qui il pût confier une pareille tâche ; il priait, en conséquence, le ministre d’envoyer à Boulogne un de ces mouchards exercés que la police politique a toujours sous la main. Le ministre répondit au commissaire-général, qu’il le remerciait beaucoup de son zèle pour le service de l’Empereur, mais que depuis long-temps on avait l’œil sur les olympiens, ainsi que sur plusieurs autres sociétés du même genre ; que le gouvernement était assez fort pour ne pas les craindre dans le cas où elles conspireraient ; que, d’ailleurs, il ne pouvait plus y avoir que des trames d’idéologues, dont l’Empereur ne se souciait nullement, et que, selon toute apparence, les olympiens étaient des rêveurs, et leur réunion une de ces puérilités maçonniques inventées pour amuser des niais.
Cette sécurité de Fouché n’était pas réelle, car à peine eut-il reçu l’avis qui lui avait été transmis par M. Devilliers, qu’il manda dans son cabinet le jeune comte de L…, qui était initié aux secrets de presque toutes les sociétés de l’Europe. « L’on m’écrit de Boulogne, lui dit-il, qu’il vient de se former dans l’armée une espèce de société secrète sous le titre d’olympiens : on ne me fait pas connaître le but de l’association, mais on m’annonce qu’elle a des ramifications très étendues… Peut-être se rattache-t-elle aux conciliabules qui se tiennent chez Bernadotte ou chez la Staël. Je sais bien ce qui se passe ici : Garat, qui me croit son ami, et qui a la bonhomie de supposer que je suis encore patriote, ni plus ni moins qu’en 93, me raconte tout. Il y a des jacobins qui imaginent que je regrette la république, et que je pourrais travailler à la rétablir : ce sont des sots que j’exile ou que je place, suivant que cela me convient… Truguet, Rousselin, Ginguené ne font pas un pas, ne disent pas un mot que je n’en sois aussitôt averti… Ce sont des gens peu redoutables, comme toute la clique de Moreau ; ils bavardent beaucoup et agissent peu. Cependant, depuis quelque temps, ils semblent vouloir se faire un parti dans l’armée ; il m’importe de savoir ce qu’ils veulent ; les olympiens sont peut-être une de leurs créations. Il serait bien utile que vous vous fissiez recevoir olympien ; vous me révéleriez les mystères de ces messieurs, et alors je verrais quelles mesures il faut prendre. »
Le comte de L*** répondit à Fouché que la mission qu’il lui proposait était délicate ; que les olympiens ne faisaient probablement aucune réception sans avoir pris auparavant des informations sur le compte du récipiendaire ; qu’en outre, on ne pouvait pas être admis, si l’on n’appartenait pas à l’armée. Fouché réfléchit un instant sur ces obstacles, puis, prenant la parole : « J’ai, dit-il, découvert un moyen de vous faire initier promptement. Vous vous rendrez à Gênes : là vous trouverez un détachement de conscrits liguriens qui doivent incessamment être dirigés sur Boulogne, pour y être incorporés dans le huitième régiment d’artillerie à pied. Parmi eux est un comte Boccardi, que sa famille a vainement cherché à faire remplacer… Vous offrez de partir à la place du noble Génois ; et, pour lever à cet égard toute espèce de difficultés, je vous fais remettre un certificat constatant que vous avez, sous le nom de Bertrand, satisfait aux lois sur la conscription. Au moyen de cette pièce, vous êtes agréé, et vous partez avec le détachement. Arrivé à Boulogne, vous aurez affaire à un colonel[4] fanatique de maçonnerie, d’illuminisme, d’hermétisme, etc. Vous vous ferez reconnaître, et comme vous êtes dans les hauts grades, il ne manquera pas de vous protéger. Vous pourrez alors lui faire, au sujet de votre origine, toutes les ouvertures que vous jugerez à propos. Ces confidences auront d’abord pour effet d’atténuer l’espèce de défaveur qui s’attache toujours à la qualité de remplaçant ; elles vous attireront ensuite la considération des autres chefs. Mais ils est indispensable que l’on croie qu’il y a eu pour vous nécessité de vous faire soldat. Sous votre véritable nom, vous étiez en butte à des persécutions de la part de l’Empereur : c’est pour échapper à la proscription que vous vous êtes caché dans un régiment. Voilà votre histoire : elle circulera dans les camps, et l’on ne doutera pas que vous ne soyez une victime et un ennemi du système impérial… Je n’ai pas besoin d’entrer dans de plus longs détails… Le reste s’effectuera tout seul… Au surplus, je m’en remets entièrement à votre sagacité. »
Muni de ces instructions, le comte de L*** partit pour l’Italie, et bientôt après il revint en France avec les conscrits liguriens. Le colonel Aubry l’accueillit comme un frère que l’on revoit après une longue absence. Il le dispensa des manœuvres et de l’exercice, assembla la loge du régiment pour le recevoir et le fêter, lui fit mille politesses, l’autorisa à se mettre en bourgeois, et le traita, en un mot, avec la plus grande distinction.
En peu de jours, toute l’armée sut que M. Bertrand était un personnage : on ne pouvait pas lui donner les épaulettes ; on le nomma sergent, et les officiers, oubliant pour lui seul qu’il était sur les degrés inférieurs de la hiérarchie militaire, n’hésitèrent pas à l’admettre dans leur intimité. M. Bertrand était devenu véritablement l’oracle du corps ; il avait de l’esprit, une instruction très variée, et l’on était disposé à le trouver plus instruit et plus spirituel encore qu’il ne l’était. Quoi qu’il en fut, il ne tarda pas à se lier avec plusieurs olympiens, qui tinrent à singulier honneur de le présenter à leurs frères. M. Bertrand fut initié, et dès qu’il eut réussi à se mettre en communication avec les sommités de l’Olympe, il adressa des rapports au ministre de la police.
Ce que je viens de raconter de la société des olympiens et de M. Bertrand, je le tiens de M. Bertrand lui-même, et pour légitimer la vérité de mon récit, il ne sera peut-être pas superflu de dire par quelles circonstances il fut amené à me faire confidence de la mission dont il était chargé et à me révéler des particularités dont il est fait mention ici pour la première fois.
Rien de plus fréquent à Boulogne que le duel, dont la funeste manie avait gagné jusqu’aux paisibles Néerlandais de la flottille sous les ordres de l’amiral Werhwel. Il y avait surtout, non loin du camp de gauche, au pied d’une colline, un petit bois dans le voisinage duquel on ne passait jamais, quelle que fut l’heure du jour, sans voir sur la lisière une douzaine d’individus engagés dans ce qu’on appelle une affaire d’honneur. C’est dans cet endroit qu’une amazone célèbre, la demoiselle Div…, tomba sous le fer d’un ancien amant, le colonel Camb…, qui ne l’ayant pas reconnue sous des habits d’homme, avait accepté d’elle une provocation à un combat singulier. La demoiselle Div…, qu’il avait abandonnée pour une autre, avait voulu périr de sa main.
Un jour que, de l’extrémité du plateau que peuplait la longue file des baraques du camp de gauche, j’abaissais mon regard sur le théâtre de cette scène sanglante, j’aperçus à quelque distance du petit bois deux hommes dont l’un marchait sur l’autre, qui battait en retraite à travers la plaine ; à leurs pantalons blancs, je reconnus les champions pour Hollandais ; je m’arrêtai un instant à les considérer. Bientôt l’assaillant rétrograde à son tour ; enfin se faisant mutuellement peur, ils rétrogradèrent en même temps, en agitant leurs sabres, puis l’un d’eux venant à s’enhardir, lança son briquet à son adversaire, et le poursuivit jusqu’à la berge d’un fossé, que cet adversaire ne put franchir. Alors chacun d’eux renonçant à se servir de son sabre, même comme projectile, un combat à coups de poing s’engagea entre ces hommes qui vidèrent ainsi leur querelle. Je m’amusais de ce duel grotesque, quand je vis tout près d’une ferme où nous allions quelquefois manger du codiau (espèce de bouillie blanche faite avec de la farine et des œufs), deux individus qui, débarrassés de leurs habits, se préparaient à mettre l’épée à la main, en présence de leurs témoins, qui étaient d’un côté un maréchal-des-logis du dixième régiment de dragons, et de l’autre, un fourrier de l’artillerie. Bientôt les fers se croisèrent ; le plus petit des combattants, était un sergent des canonniers ; il rompait avec une intrépidité sans égale ; enfin après avoir parcouru de la sorte une cinquantaine de pas, je crus qu’il allait être percé de part en part, lorsque tout à coup il disparut comme si la terre se fut entr’ouverte sous lui ; aussitôt un grand éclat de rire se fit entendre. Après ce premier mouvement d’une gaieté bruyante, les assistants se rapprochèrent, je les vis se baisser. Poussé par un sentiment de curiosité, je me dirigeai vers eux, et j’arrivai fort à propos pour les aider à retirer d’un trou pratiqué pour l’écoulement d’une auge à pourceaux, le pauvre diable dont la disparition subite m’avait frappé d’étonnement. Il était presque asphyxié, et tout couvert de fange des pieds à la tête ; le grand air lui rendit assez vite l’usage de ses sens, mais il n’osait respirer, il craignait d’ouvrir la bouche et les yeux, tant le liquide dans lequel il avait été plongé était infect. Dans cette fâcheuse situation, les premières paroles qu’il entendit furent des plaisanteries : je me sentis révolté de ce manque de générosité, et cédant à ma trop juste indignation, je lançai à l’antagoniste de la victime ce coup d’œil provocateur qui, de soldat à soldat, n’a pas besoin d’être interprété. « Il suffit, me dit-il, je t’attends de pied ferme. » À peine suis-je en garde, que sur ce bras qui oppose un fleuret à celui que j’ai ramassé, je remarque un tatouage qu’il me semble reconnaître : c’était la figure d’une ancre, dont la branche était entourée des replis d’un serpent. « Je vois la queue, m’écriai-je, gare à la tête ; et en donnant cet avertissement, je me fendis sur mon homme que j’atteignis au téton droit. – Je suis blessé, dit-il alors, est-ce au premier sang ? – Oui, au premier sang, lui répondis-je. » et sans plus attendre, je me mis en devoir de déchirer ma chemise, pour panser sa blessure. Il fallut lui découvrir la poitrine ; j’avais deviné la place de la tête du serpent, qui venait comme lui mordre l’extrémité du sein ; c’était là que j’avais visé.
En voyant que j’examinais alternativement ce signe et les traits de son visage, mon adversaire ne laissait pas de concevoir de l’inquiétude ; je m’empressai de le rassurer, par ces paroles : que je lui dis à l’oreille : « Je sais qui tu es ; mais ne crains rien, je suis discret. » – Je te connais aussi, me répondit-il, en me serrant la main, et je me tairai. » Celui qui me promettait ainsi son silence, était un forçat évadé du bagne de Toulon. Il m’indiqua son nom d’emprunt, et m’apprit qu’il était maréchal-des-logis-chef au 10e de dragons, où il éclipsait par son luxe tous les officiers du régiment.
Tandis qu’avait lieu cette reconnaissance, l’individu dont j’avais pris la défense, en véritable redresseur de torts, essayait de laver, dans un ruisseau, le plus gros de la souillure dont il était couvert ; il revint promptement auprès de nous : tout le monde était plus calme ; il ne fut plus question du différend, et l’envie de rire avait fait place à un désir sincère de réconciliation.
Le maréchal-des-logis-chef, que je n’avais blessé que très légèrement, proposa de signer la paix au Canon d’or, où il y avait toujours d’excellentes matelottes, et des canards plumés d’avance. Il nous y paya un déjeûner de prince, qui se prolongea jusqu’au souper, dont sa partie adverse fit les frais.
La journée complète on se sépara. Le maréchal-des-logis-chef me fit promettre de le revoir, et le sergent ne fut pas content que je ne l’eusse accompagné chez lui.
Ce sergent était M. Bertrand ; il occupait dans la haute ville, un logement d’officier supérieur ; dès que nous y fûmes seuls, il me témoigna sa reconnaissance avec toute la chaleur dont est capable, après boire, un poltron que l’on a sauvé d’un grand danger : il me fit des offres de service de toute espèce, et comme je n’en acceptais aucune : « Vous croyez peut-être, me dit-il, que je ne puis rien ; il n’est point de petit protecteur, mon camarade ; si je ne suis que sous-officier, c’est que je ne veux pas être autre chose ; je n’ai point d’ambition, et tous les olympiens sont comme moi ; ils font peu de cas d’une misérable distinction de grade. » – Je lui demandai ce qu’étaient les olympiens. – « Ce sont, me répondit-il, des gens qui adorent la liberté et préconisent l’égalité : voudriez-vous être olympien ? pour peu que cela vous tente, je me charge de vous faire recevoir. »
Je remerciai M. Bertrand, et j’ajoutai que je ne voyais pas trop la nécessité de m’enrôler dans une société sur laquelle devait tôt ou tard se porter l’attention de la police. – « Vous avez raison, reprit-il, en me marquant un véritable intérêt, ne vous faites pas recevoir, car tout cela finira mal. » Et alors il commença à me donner sur les olympiens les détails que j’ai consignés dans ces mémoires ; puis comme il était encore sous l’influence confidentielle et singulièrement expansive du champagne, dont nous nous étions abreuvés : il me révéla sous le sceau du secret, la mission qu’il était venu remplir à Boulogne.
Après cette première entrevue, je continuai de voir M. Bertrand, qui resta encore quelque temps à son poste d’observateur. Enfin, l’époque arriva où, suffisamment instruit, il demanda et obtint un congé d’un mois : il allait, disait-il, recueillir une succession considérable ; mais le mois expiré, M. Bertrand ne revint pas ; le bruit se répandit qu’il avait emporté une somme de douze mille francs que lui avait confiée le colonel Aubry, à qui il devait ramener un équipage et des chevaux : une autre somme destinée à des emplettes pour le compte du régiment, était passée de la même manière dans l’actif de M. Bertrand. On sut qu’à Paris, il était descendu rue Notre-Dame-des-Victoires, à l’hôtel de Milan, où il avait exploité à outrance un crédit imaginaire.
Toutes ces particularités constituaient une mystification, dont les dupes n’osèrent pas même se plaindre sérieusement. Seulement il fut constaté que M. Bertrand avait disparu : on le jugea, et comme déserteur il fut condamné à cinq ans de travaux publics. Peu de temps après, arriva l’ordre d’arrêter les principaux d’entre les olympiens, et de dissoudre leur société. Mais cet ordre ne put être exécuté qu’en partie : les chefs, avertis que le gouvernement allait sévir contre eux, et les jeter dans les cachots de Vincennes, ou de toute autre prison d’État, préférèrent la mort à une si misérable existence. Cinq suicides eurent lieu le même jour. Un sergent-major du vingt-cinquième de ligne et deux sergents d’un autre corps, se firent sauter la cervelle. Un capitaine qui, la veille, avait reçu son brevet de chef de bataillon, se coupa la gorge avec un rasoir… Il était logé au Lion d’argent ; l’aubergiste, M. Boutrois, étonné de ce que, suivant sa coutume, il ne descendait pas pour déjeuner avec les autres officiers, frappe à la porte de sa chambre : le capitaine était alors placé au-dessus d’une cuvette qu’il avait disposée pour recevoir son sang ; il remet précipitamment sa cravate, ouvre, essaie de parler, et tombe mort. Un officier de marine qui montait une prame chargée de poudre, y mit le feu, ce qui entraîna l’explosion de la prame voisine. La terre trembla à plusieurs lieues à la ronde ; toutes les vitres de la basse ville furent brisées ; les façades de plusieurs maisons sur le port s’écroulèrent ; des débris de gréement, des mâtures brisées, des lambeaux de cadavres furent jetés à plus de dix-huit cents toises. Les équipages des deux bâtiments périrent… Un seul homme fut sauvé, comme par miracle : c’était un matelot qui était dans les hunes ; le mât avec lequel il fut emporté jusque dans la nue, retomba perpendiculairement dans la vase du bassin, qui était à sec, et s’y planta à une profondeur de plus de dix pieds. On trouva le matelot vivant ; mais dès ce moment il eut perdu l’ouïe et la parole, qu’il ne recouvra jamais.
À Boulogne, on fut surpris de la coïncidence de ces événements. Des médecins prétendirent que cette simultanéité de suicides avait été déterminée par une disposition résultant d’un état particulier de l’atmosphère. Ils invoquaient à l’appui de leur opinion une observation faite à Vienne en Autriche, où, l’été précédent, grand nombre de jeunes filles, entraînées comme par une sorte de frénésie, s’étaient précipitées le même jour.
Quelques personnes croyaient expliquer ce qu’il y avait d’extraordinaire dans cette circonstance, en disant que rarement un suicide, quand il est ébruité, n’est pas accompagné de deux ou trois autres. En résumé, le public sut d’autant moins à quoi s’en tenir, que la police, qui craignait de laisser apercevoir tout ce qui pouvait caractériser l’opposition au régime impérial, faisait, à dessein, circuler les bruits les plus étranges ; les précautions furent si bien prises qu’à cette occasion le nom d’olympien ne fut pas même prononcé une seule fois dans les camps ; cependant la cause de tant d’aventures tragiques était dans les dénonciations de M. Bertrand. Sans doute il fut récompensé, j’ignore de quelle manière ; mais ce qui me paraît probable, c’est que la haute police, satisfaite de ses services, dut continuer de l’employer, puisque, quelques années plus tard, on le rencontra en Espagne, dans le régiment d’Isembourg, où devenu lieutenant, il n’était pas regardé comme un moins bon gentilhomme que les Montmorenci, les Saint-Simon, et autres rejetons de quelques-unes des plus illustres maisons de France qui avaient été placés dans ce corps.
Peu de temps après la disparition de M. Bertrand, la compagnie dont je faisais partie fut détachée à Saint-Léonard, petit village à une lieue de Boulogne. Là notre tâche se bornait à la garde d’une poudrière, dans laquelle avait été emmagasinée une grande quantité de munitions de guerre. Le service n’était pas pénible, mais le poste était réputé dangereux : plusieurs factionnaires y avaient été assassinés, et l’on croyait que les Anglais avaient résolu de faire sauter ce dépôt. Quelques tentatives du même genre, qui avaient eu lieu dans les dunes sur divers points, ne laissaient aucun doute à cet égard. Nous avions donc des raisons assez fortes pour déployer une continuelle vigilance.
Une nuit que c’était mon tour de garde, nous sommes subitement réveillés par un coup de fusil : aussitôt tout le poste est sur pied ; je m’empresse, suivant l’usage, d’aller relever la sentinelle : c’était un conscrit dont la bravoure ne m’inspirait pas une grande confiance ; je l’interroge ; et, d’après ses réponses, je conclus qu’il s’est effrayé sans motif. Je visite les dehors de la poudrière, qui était une vieille église ; je fais fouiller les approches : on n’aperçoit rien, aucun vestige de pas d’homme. Persuadé alors que c’était une fausse alerte, je réprimande le conscrit, et le menace de la salle de police. Cependant, de retour au corps de garde, je lui fais de nouvelles questions, et le ton affirmatif avec lequel il proteste qu’il a vu quelqu’un, les détails qu’il me donne, commencent à me faire croire qu’il ne s’est point laissé aller à une vaine terreur ; il me vient des pressentiments ; je sors, et me dirige une seconde fois vers la poudrière, dont je trouve la porte entre-baillée ; je la pousse, et, de l’entrée, mes regards sont frappés des faibles reflets d’une lumière qui se projette entre deux hautes rangées de caisses à cartouches. J’enfile précipitamment cette espèce de corridor ; parvenu à l’extrémité, je vois… une lampe allumée sous une des caisses qui débordait les autres ; la flamme touche au sapin, et déjà se répand une odeur de résine. Il n’y a pas un instant à perdre ; sans hésiter je renverse la lampe, je retourne la caisse, et avec mon urine j’éteins les restes de l’incendie. L’obscurité la plus complète me garantissait que j’avais coupé court à l’embrasement. Mais je ne fus pas sans inquiétude tant que l’odeur ne se fut pas entièrement dissipée. J’attendis ce moment pour me retirer. Quel était l’incendiaire ? je l’ignorais, seulement il s’élevait de fortes présomptions dans mon esprit ; je soupçonnais le garde-magasin, et afin de connaître la vérité, je me rendis sur-le-champ à son domicile. Sa femme y était seule ; elle me dit que, retenu à Boulogne pour des affaires, il y avait couché, et qu’il rentrerait le lendemain matin. Je demandai les clefs de la poudrière ; il les avait emportées. L’enlèvement des clefs acheva de me convaincre qu’il était coupable. Toutefois, avant de faire mon rapport, je revins à dix heures pour m’assurer s’il était de retour ; il n’avait pas encore reparu.
Un inventaire auquel on procéda dans la même journée, prouva que le garde devait avoir le plus grand intérêt à anéantir le dépôt qui lui était confié : c’était l’unique moyen de couvrir les vols considérables qu’il avait commis. Quarante jours se passèrent sans qu’on sût ce que cet homme était devenu. Des moissonneurs trouvèrent son cadavre dans un champ de blé ; un pistolet était près de lui.
C’était ma présence d’esprit qui avait prévenu l’explosion de la poudrière : j’en fus récompensé par de l’avancement ; je devins sergent, et le général en chef, qui voulut me voir, promit de me recommander à la bienveillance du ministre. Comme je me croyais le pied à l’étrier, et que je désirais faire mon chemin, je m’appliquais surtout à faire perdre à Lebel toutes les mauvaises habitudes de Vidocq, et si la nécessité d’assister aux distributions de vivres, ne m’avait de temps à autre appelé à Boulogne, j’aurais été un sujet accompli ; mais à chaque fois que je venais en ville, je devais une visite au maréchal-des-logis-chef des dragons, contre lequel j’avais pris le parti de M. Bertrand, non qu’il l’exigeât ; mais je sentais la nécessité de le ménager : alors c’était un jour entier consacré à la ribotte, et malgré moi je dérogeais à mes projets de réforme.
À l’aide de la supposition d’un oncle sénateur, dont la succession, disait-il, lui était assurée, mon ancien collègue du bagne menait une vie fort agréable ; le crédit dont il jouissait en sa qualité de fils de famille était en quelque sorte illimité. Point de richard boulonnais qui ne tînt à honneur d’attirer chez lui un personnage d’une si haute distinction. Les papas les plus ambitieux ne souhaitaient rien tant que de l’avoir pour gendre, et parmi les demoiselles, c’était à qui réussirait à fixer son choix ; aussi avait-il le privilège de puiser à volonté dans la bourse des uns, et de tout obtenir de la complaisance des autres. Il avait un train de colonel, des chiens, des chevaux, des domestiques : il affectait le ton et les manières d’un grand seigneur, et possédait au suprême degré l’art de jeter de la poudre aux yeux et de se faire valoir. C’était au point que les officiers eux-mêmes, qui d’ordinaire sont si bêtement jaloux des prérogatives de l’épaulette, trouvaient très naturel qu’il les éclipsât. Ailleurs qu’à Boulogne, cet aventurier eût tardé d’autant moins à être reconnu pour un chevalier d’industrie, qu’il n’avait, pour ainsi dire, reçu aucune éducation ; mais, dans une cité où la bourgeoisie, de création toute récente, n’avait pu encore adopter de la bonne compagnie que le costume, il lui était facile d’en imposer.
Fessard était le véritable nom du maréchal-des-logis-chef, que l’on ne connaissait dans le bagne que sous celui d’Hippolyte ; il était, je crois, de la Basse-Normandie : avec tous les dehors de la franchise, une physionomie ouverte et l’air évaporé d’un jeune étourdi, il avait ce caractère cauteleux que la médisance attribue aux habitants de Domfront ; c’était, en un mot, un garçon retors, et pourvu de toutes les rubriques propres à inspirer de la confiance. Un pouce de terre dans son pays lui aurait fourni l’occasion de mille procès, et serait devenu son point de départ pour arriver à la fortune en ruinant le voisin ; mais Hippolyte ne possédait rien au monde ; et, ne pouvant se faire plaideur, il s’était fait escroc, puis faussaire, puis… on va voir ; je n’anticiperai pas sur les événements.
Chaque fois que je venais en ville, Hippolyte me payait à dîner. Un jour, entre la poire et le fromage, il me dit : « Sais-tu que je t’admire ; vivre en ermite à la campagne, se mettre à la portion congrue, et n’avoir pour tout potage que vingt-deux sous par jour ; je ne conçois pas que l’on puisse se condamner à des privations pareilles ; quant à moi, j’aimerais mieux mourir. Mais tu fais tes chopins (coups) à la sourdine, et tu n’es pas sans avoir quelque ressource. » Je lui répondis que ma solde me suffisait, que d’ailleurs j’étais nourri, habillé, et que je ne manquais de rien. « À la bonne heure, reprit-il ; cependant il y a ici des grinchisseurs, et tu as sans doute entendu parler de l’armée de la Lune ; il faut te faire affilier ; si tu veux, je t’assignerai un arrondissement : tu exploiteras les environs de Saint-Léonard. »
J’étais instruit que l’armée de la Lune était une association de malfaiteurs, dont les chefs s’étaient jusque-là dérobés aux investigations de la police. Ces brigands, qui avaient organisé l’assassinat et le vol dans un rayon de plus de dix lieues, appartenaient à tous les régiments. La nuit, ils rôdaient dans les camps ou s’embusquaient sur les routes, faisant de fausses rondes et de fausses patrouilles, et arrêtant quiconque présentait l’espoir du plus léger butin. Afin de n’éprouver aucun obstacle dans la circulation, ils avaient à leur disposition des uniformes de tous les grades. Au besoin, ils étaient capitaines, colonels, généraux, et ils faisaient à propos usage des mots d’ordre et de ralliement, dont quelques affidés, employés probablement à l’état-major, avaient soin de leur communiquer la série par quinzaine.
D’après ce que je savais, la proposition d’Hippolyte était bien faite pour m’effrayer : ou il était un des chefs de l’armée de la Lune, ou il était un des agents secrets envoyés par la police pour préparer le licenciement de cette armée, peut-être était-il l’un et l’autre… Ma situation vis-à-vis de lui était embarrassante… Le fil de ma destinée allait se nouer encore… je ne pouvais plus, comme à Lyon, me tirer d’affaire en dénonçant le provocateur. À quoi m’eût servi la dénonciation dans le cas où Hippolyte aurait été un agent ? Je me bornai donc à rejeter sa proposition, en lui déclarant avec fermeté que j’étais résolu à rester honnête homme. « Tu ne vois pas que je plaisante, me dit-il, et tu prends la chose au sérieux : je voulais seulement te sonder. Je suis charmé, mon camarade, de te trouver dans de tels sentiments. C’est tout comme moi, ajouta-t-il ; je suis rentré dans le bon chemin ; le Diable à présent ne m’en ferait pas sortir. » Puis, la conversation changeant d’objet, il ne fut plus question de l’armée de la Lune.
Huit jours après l’entrevue pendant laquelle Hippolyte m’avait fait une ouverture si promptement rétractée, mon capitaine, en passant l’inspection des armes, me condamna à vingt-quatre heures de salle de police, pour une tache qu’il prétendait avoir aperçu dans mon fourniment. Cette maudite tache, j’eus beau me crever les yeux pour la découvrir, je ne pus jamais en venir à bout. Quoi qu’il en soit, je me rendis à la garde du camp sans me plaindre : vingt-quatre heures, c’est sitôt écoulé ! C’était le lendemain à midi que devait expirer ma peine… À cinq heures du matin, j’entends le trot des chevaux, et bientôt après le dialogue suivant s’établit : « Qui vive ? – France. – Quel régiment ? – Corps impérial de la gendarmerie. » À ce mot de gendarmerie, j’éprouvai un frémissement involontaire. Tout à coup la porte s’ouvre, et l’on appelle Vidocq. Jamais ce nom, tombé à l’improviste au milieu d’une troupe de scélérats, ne les a plus consternés que je ne le fus en ce moment. « Allons, suis-nous, » me cria le brigadier ; et, pour être sûr que je ne m’échapperai pas, il prend la précaution de m’attacher. On me conduisit aussitôt à la prison, où je me fis donner un lit à la pistole. J’y trouvai nombreuse et bonne compagnie. « Ne le disais-je pas ? s’écrie, en me voyant entrer, un soldat de l’artillerie, qu’à son accent je reconnais pour Piémontais ; tout le camp va arriver ici… En voilà encore un d’enflaqué ; je parie ma tête à couper que c’est ce gueux de maréchal-des-logis-chef de dragons qui lui a joué le tour. On ne lui cassera pas la gueule à ce brigand-là ! – Et va donc le chercher, ton maréchal-des-logis-chef, interrompit un second prisonnier, qui me parut aussi être du nombre des nouveaux venus ; s’il a marché toujours, il est bien loin à présent, depuis la semaine dernière qu’il a levé le pied. Tout de même, avouez, camarades, que c’est un fin matois. En moins de trois mois, quarante mille francs de dettes dans la ville. C’est-il ça du bonheur ! Et les enfants qu’il a faits… Pour ceux-là je ne voudrais pas être obligé de les reconnaître… Six demoiselles enceintes, des premières bourgeoises ! ! ! Elles croyaient tenir le bon Dieu par les pieds… les voilà bien loties !… – Oh ! oui, dit un porte-clefs qui s’occupait de préparer mon coucher ; il a fait bien du dégât, ce monsieur ; aussi gare à lui, s’il se laisse mettre le grappin dessus : on l’a porté déserteur. On le rattrapera. – Prends garde de le perdre, repartis-je ; on le rattrapera comme on a rattrapé M. Bertrand. – Et quand on le rattraperait, reprit le Piémontais, ça m’empêcherait-il d’aller me faire guillotiner à Turin ? D’ailleurs, je le répète ! je parierais bien ma tête à couper… – Eh ! que veut-il donc, le boudsarone, avec sa tête à couper ? s’écria un quatrième interlocuteur ; nous sommes enfoncés ; il n’y a plus à y revenir. Eh bien ! n’importe par qui ! » Ce dernier avait raison. D’ailleurs, il était tout à fait superflu de s’égarer dans le champ des conjectures, et il fallait être aveugle pour ne pas reconnaître dans Hippolyte l’auteur de notre arrestation. Quant à moi, je ne pouvais pas m’y tromper, puisqu’à Boulogne il était le seul qui sût que je fusse un évadé du bagne.
Plusieurs militaires de différentes armes vinrent contre leur gré compléter une chambrée, dans laquelle étaient réunis les principaux chefs de l’armée de la Lune. Rarement la prison d’une petite ville présente un plus curieux assemblage de délinquants : le prévôt, c’est-à-dire l’ancien de la salle, nommé Lelièvre, était un pauvre diable de soldat qui, condamné à mort depuis trois ans, avait sans cesse en perspective la possibilité de l’expiration du sursis en vertu duquel il vivait encore. L’empereur, à la clémence de qui il avait été recommandé, lui avait fait grâce ; mais comme ce pardon n’avait point été constaté, et que l’avis officiel indispensable pour qu’il reçût son effet n’avait pas été transmis au grand-juge, Lelièvre continuait à être retenu prisonnier ; tout ce que l’on avait osé en faveur de ce malheureux, c’était de suspendre l’exécution jusqu’au moment où se présenterait une occasion d’appeler une seconde fois sur lui l’attention de l’empereur. Dans cet état, où son sort était fort incertain, Lelièvre flottait entre l’espoir de la liberté et la crainte de la mort : il s’endormait avec l’un et s’éveillait avec l’autre. Tous les soirs il se croyait à la veille de sortir, et tous les matins il s’attendait à être fusillé ; tantôt gai jusqu’à la folie, tantôt sombre et rêveur, il n’avait jamais un instant de calme parfait. Faisait-il sa partie à la drogue ou au mariage, tout à coup il s’interrompait au milieu de son jeu, jetait les cartes, se frappait le front avec les poings, faisait cinq ou six sauts, en se démenant comme un possédé, puis finissait par se jeter sur son grabat, où, couché sur le ventre, il restait des heures entières dans l’abattement. L’hôpital était la maison de plaisance de Lelièvre, et s’il s’ennuyait par trop, il allait y chercher les consolations de sœur Alexandrine, qui avait toutes les dévotions du cœur, et sympathisait avec toutes les infortunes. Cette fille si compatissante s’intéressait vivement au prisonnier, et il le méritait, car Lelièvre n’était point un criminel, mais une victime, et l’arrêt porté contre lui était l’effet injuste de cette conviction trop souvent imposée aux Conseils de guerre, que, dût périr l’innocent, quand il y a urgence de réprimer certains désordres, la conscience et l’humanité des juges doivent se taire devant la nécessité de faire un exemple. Lelièvre était du très petit nombre de ces hommes qui, bronzés contre le vice, peuvent sans danger pour leur moralité rester en contact avec ce qu’il y a de plus impur. Il s’acquittait des fonctions de prévôt avec autant d’équité que s’il eût été revêtu d’une magistrature réelle : jamais il ne rançonnait un arrivant ; se bornant à lui expliquer la règle de ses devoirs de détenu, il tâchait de lui rendre plus supportables les premiers instants de sa captivité, et faisait en quelque sorte plutôt les honneurs de la prison, qu’il n’en exerçait l’autorité.
Un autre caractère s’attirait le respect et l’affection des prisonniers, Christiern, que nous nommions le Danois, ne parlait pas français, il ne comprenait que par signes, mais son intelligence semblait deviner la pensée ; il était triste, méditatif, bienveillant ; dans ses traits, il y avait un mélange de noblesse, de candeur et de mélancolie, qui séduisait et touchait en même temps. Il portait l’habit de matelot, mais les boucles flottantes et artistement arrangées de sa longue chevelure noire, l’éclatante blancheur de son linge, la délicatesse de son teint et de ses manières, la beauté de ses mains, tout annonçait en lui un homme d’une condition plus relevée. Quoique le sourire fût souvent sur ses lèvres, Christiern paraissait en proie à un profond chagrin, mais il le renfermait en lui, et personne ne savait même pour quelle cause il était détenu. Un jour cependant on l’appelle ; il était occupé à tracer sur la vitre avec un silex le dessin d’une marine, c’était là sa seule distraction ; quelquefois c’était le portrait d’une femme dont il aimait à reproduire la ressemblance. Nous le vîmes sortir ; bientôt après on le ramena, et à peine le guichet se fut-il refermé sur lui, que tirant d’un petit sac de cuir un livre de prières, il y lut avec ferveur. Le soir il s’endormit comme de coutume jusqu’au lendemain, que le son du tambour nous avertit qu’un détachement pénétrait dans la cour de la prison ; alors il s’habilla précipitamment, donna sa montre et son argent à Lelièvre, qui était son camarade de lit ; puis, ayant baisé à plusieurs reprises un petit Christ, qu’il portait habituellement sur la poitrine, il serra la main à chacun de nous. Le concierge, qui avait assisté à cette scène, était vivement ému. Lorsque Christiern fut parti : « On va le fusiller, nous dit-il, toute la troupe est assemblée : ainsi dans un quart d’heure tous ses maux seront finis. Voyez un peu ce que c’est quand on n’est pas heureux. Ce matelot, que vous avez pris pour un Danois, est né natif de Dunkerque ; son véritable nom est Vandermot ; il servait sur la corvette l’Hirondelle, quand il fut fait prisonnier par les Anglais ; jeté à bord des pontons, comme tant d’autres, il était fatigué de respirer un air infect, et de crever de faim, lorsqu’on lui offrit de le tirer de ce tombeau s’il consentait à s’embarquer sur un bâtiment de la compagnie des Indes. Vandermot accepta, au retour le bâtiment fut capturé par un corsaire. Vandermot fut conduit ici avec le reste de l’équipage. Il devait être transféré à Valenciennes mais, au moment du départ, un interprète l’interroge, et l’on s’aperçoit à ses réponses qu’il n’est pas familiarisé avec la langue anglaise : aussitôt des soupçons s’élèvent, il déclare qu’il est sujet du roi de Danemarck, mais comme il ne peut fournir aucune preuve à l’appui de cette déclaration, on décide qu’il restera sous ma garde jusqu’à ce que le fait soit éclairci. Quelques mois s’écoulent : on ne songeait plus vraisemblablement à Vandermot : une femme, accompagnée de deux enfants, se présente à la geôle ; elle demande Christiern ; – Mon mari ! s’écrie-t-elle, en le voyant. – Mes enfants, ma femme ! et il se précipite dans leurs bras. – Que vous êtes imprudent ? dis-je tout bas à l’oreille de Christiern. Si je n’étais pas seul ! – Je lui promis d’être discret, il n’était plus temps : dans la joie de recevoir de ses nouvelles, sa femme, à qui il avait écrit, et qui le croyait mort, avait montré sa lettre à ses voisins, et déjà parmi eux des officieux l’avaient dénoncé : les misérables ! ce sont eux aujourd’hui qui l’envoient à la mort. Pour quelques vieux pierriers dont était armé le navire qu’il montait, un navire qui a amené sans combattre, on le traite comme s’il avait porté les armes contre sa patrie. Convenez que les lois sont injustes. Oh ! oui, les lois sont injustes, répétèrent plusieurs des assistants, que je vis se grouper autour d’un lit pour jouer aux cartes, et boire du chenic. – À la ronde, mon père en aura, dit l’un d’eux en faisant passer le verre. – Allons donc ! dit un second, qui remarquait l’air de consternation de Lelièvre, dont il secoua le bras, ne va-t-il pas se désoler celui-là ? aujourd’hui son tour, demain le nôtre. »
Ce colloque, atrocement prolongé, dégénéra en horribles plaisanteries ; enfin le son du tambour et des fifres, que l’écho de la rive répétait sur plusieurs points, nous indiqua que les détachements des divers corps se mettaient en marche pour regagner le camp. Un morne silence régna dans la prison pendant quelques minutes ; nous pensions tous que Christiern avait subi son sort ; mais au moment où, les yeux couverts du fatal bandeau, il venait de s’agenouiller, un aide-de-camp était accouru, et avait révoqué le signal donné à la mousqueterie. Le patient avait revu la lumière ; il allait être rendu à sa femme et à ses enfants, et c’était au maréchal Brune, qui avait accédé à leurs prières, qu’il était redevable du bienfait de la vie. Christiern, ramené sous les verrous, ne se possédait pas de joie ; on lui avait donné l’assurance qu’il recouvrerait promptement sa liberté. L’empereur était supplié de lui accorder sa grâce, et la demande, faite au nom du maréchal lui-même, était si généreusement motivée, qu’il était impossible de douter du succès.
Le retour de Christiern était un événement dont nous ne manquâmes pas de le féliciter : on but à la santé du revenant, et l’arrivée de six nouveaux prisonniers, qui payèrent leur bienvenue avec une grande libéralité, fut un sujet de plus de réjouissance. Ces derniers, que j’avais connus la plupart pour avoir fait partie de l’équipage de Paulet, venaient subir une détention de quelques jours, punition qui leur avait été infligée parce que, laissés à bord d’une prise, ils avaient, au mépris des lois de la guerre, dépouillé un capitaine anglais. Comme ils n’avaient pas été contraints à restituer, ils apportaient avec eux des guinées, qu’ils dépensaient rondement. Nous étions tous satisfaits : le geôlier, qui recueillait jusqu’aux moindres gouttes de cette pluie d’or, était si content de ses hôtes nouveaux, qu’il se relâchait à plaisir de sa surveillance. Cependant, il y avait dans notre salle trois individus condamnés à la peine capitale, Lelièvre, Christiern et le Piémontais Orsino, ancien chef de barbets, qui, ayant rencontré, près d’Alexandrie, un détachement de conscrits dirigés sur la France, s’était glissé dans leurs rangs, où il avait pris la place et le nom d’un déserteur de bonne volonté. Orsino, depuis qu’il était sous les drapeaux, avait tenu une conduite irréprochable ; mais il s’était perdu par une indiscrétion : sa tête avait été mise à prix dans son pays, et c’était à Turin qu’elle devait tomber. Cinq autres prisonniers étaient sous le poids de graves accusations. C’étaient d’abord quatre marins de la garde, deux Corses et deux Provençaux, à qui l’on imputait l’assassinat d’une paysanne dont ils avaient volé la croix d’or et les boucles d’argent. Le cinquième avait, ainsi qu’eux, fait partie de l’armée de la Lune ; on lui attribuait d’étranges facultés : au dire des soldats, il avait la puissance de se rendre invisible ; il se métamorphosait aussi comme il lui plaisait, et avait en outre le don de l’omniprésence ; enfin c’était un sorcier, et tout cela parce qu’il était bossu ad libitum, facétieux, caustique, grand conteur, et qu’ayant escamoté sur les places, il exécutait assez adroitement quelques tours de gibecière. Avec de tels pensionnaires, peu de geôliers n’eussent pas pris des précautions extraordinaires ; le nôtre ne nous considérait que comme d’excellentes pratiques, il fraternisait avec nous. Puisque, moyennant salaire, il pourvoyait à tous nos besoins, il ne pouvait pas se figurer que nous voulussions le quitter, et jusqu’à un certain point il avait raison ; car Lelièvre et Christiern n’avaient pas la moindre envie de s’évader ; Orsino était résigné ; les marins de la garde ne se doutaient pas même que l’on pût leur faire un mauvais parti, le sorcier comptait sur l’insuffisance de preuves, et les corsaires, toujours en goguette, n’engendraient pas la mélancolie. J’étais le seul à nourrir des projets ; mais, justement pour ne pas me laisser pénétrer, j’affectais d’être sans souci, si bien qu’il semblait que la prison fût mon élément, et que chacun était induit à présumer que je m’y trouvais comme le poisson dans l’eau. Je ne m’y grisai pourtant qu’une seule fois, ce fut en l’honneur du retour de Christiern. La nuit tout le monde ronflait, sur les deux heures du matin, j’éprouve une soif ardente, j’avais le feu dans le corps ; je me lève et à demi éveillé je me dirige vers la croisée : je veux boire ; infernale méprise ! Je m’aperçois qu’au lieu de puiser au bidon, c’est dans le baquet que j’ai puisé mon gogueneau ; je suis empoisonné. Au jour, je n’étais pas encore parvenu à réprimer les plus épouvantables contractions d’estomac ; un porte-clefs entre pour annoncer que l’on va faire la corvée : c’est une occasion de prendre le grand air, et cela contribuera peut-être à me remettre le cœur ; je m’offre à la place d’un corsaire, dont je revêts les habits ; et, en traversant la cour, je rencontre un sous-officier de ma connaissance, qui arrivait la capote sur le bras. Il m’annonça qu’ayant fait du bruit au spectacle, et condamné à un mois de prison, il venait de lui-même se faire écrouer. « En ce cas, lui dis-je, tu vas commencer tes fonctions dès à présent ; voici le baquet. » Le sous-officier était accommodant ; il ne se fit pas tirer l’oreille ; et pendant qu’il faisait la corvée, je passai roide devant la sentinelle, qui ne fit pas attention à moi.
Sorti du château, je pris aussitôt mon essor vers la campagne, et ne m’arrêtai qu’au pont de brique, dans un petit ravin, où je réfléchis un instant aux moyens de déjouer les poursuites ; j’eus d’abord la fantaisie de me rendre à Calais, mais ma mauvaise étoile m’inspira de revenir à Arras. Dès le soir même, j’allai coucher dans une espèce de ferme qui était un relais de mareyeurs. L’un d’eux, qui était parti de Boulogne trois heures après moi, m’apprit que toute la ville était plongée dans la tristesse par l’exécution de Christiern. « On ne parle que de ça, me dit-il ; on s’attendait que l’Empereur lui ferait grâce, mais le télégraphe a répondu qu’il fallait le fusiller… Il l’avait déjà échappé belle ; aujourd’hui on lui a fait son affaire. C’était une pitié de lui entendre demander pardon ! pardon ! en essayant de se relever, après la première décharge ; et les cris des chiens qui se trouvaient derrière, et qui avaient attrapé des balles ! il y avait de quoi arracher l’âme, mais ils ne l’ont pas moins achevé à bout portant ; c’est-il ça, une destinée ! »
Quoique la nouvelle que me donnait le mareyeur m’affligeât, je ne pus pas m’empêcher de penser que la mort de Christiern faisait diversion à mon évasion, et comme rien de ce qu’il me disait ne m’indiquait qu’on se fût aperçu que je manquais à l’appel, j’en conçus une très grande sécurité. J’arrivai à Béthune sans accident ; je voulus aller y loger chez une ancienne connaissance de régiment. Je fus fort bien accueilli, mais, quelque prudent que l’on soit, il y a toujours des imprévisions. J’avais préféré à l’auberge l’hospitalité d’un ami : j’étais venu me brûler à la chandelle, car l’ami s’était marié récemment, et le frère de sa femme était du nombre de ces réfractaires dont le cœur, insensible à la gloire, ne palpitait que pour la paix. Il s’ensuivait tout naturellement que le domicile que j’avais choisi, et même celui de tous les parents du jeune homme, était fréquemment visité par messieurs les gendarmes. Ces derniers envahirent la demeure de mon ami long-temps avant le jour ; sans respecter mon sommeil, ils me sommèrent d’exhiber mes papiers. À défaut de passe-port que je pusse leur montrer, j’essayai de leur donner quelques explications ; c’était peine perdue. Le brigadier, qui depuis un instant me considérait avec une attention toute particulière, s’écria tout à coup : « Je ne me trompe pas, c’est bien lui, j’ai vu ce drôle à Arras : c’est Vidocq ! » Il fallut me lever, et un quart d’heure après j’étais installé dans la prison de Béthune.
Peut-être qu’avant d’aller plus loin le lecteur ne sera pas fâché d’apprendre ce que devinrent les camarades de captivité que j’avais laissés à Boulogne ; je puis dès à présent satisfaire leur curiosité, du moins à l’égard de quelques-uns. On a vu que Christiern avait été fusillé ; c’était un excellent sujet. Lelièvre, qui était également un brave homme, continua d’espérer et de craindre jusqu’en 1811, que le typhus mit un terme à cette alternative. Les quatre matelots de la garde étaient des assassins : par une belle nuit ils furent mis en liberté, et envoyés en Prusse, où deux d’entre eux reçurent la croix d’honneur sous les murs de Dantzick ; quant au sorcier, il fut aussi relaxé sans jugement. En 1814, il se nommait Collinet, et était devenu quartier-maître d’un régiment westphalien, dont il avait imaginé de sauver la caisse à son profit. Cet aventurier, pressé de placer son argent, se dirigeait à tire d’ailes sur la Bourgogne, lorsqu’aux environs de Fontainebleau, il tomba au milieu d’un pulk de cosaques, à qui il fut obligé de rendre ses comptes ; ce fut son dernier jour, ils le tuèrent à coups de lance.
Mon séjour à Béthune ne fut pas long : dès le lendemain de mon arrestation, on me mit en route pour Douai, où je fus conduit sous bonne escorte.
CHAPITRE XXI
On me ramène à Douai. – Recours en grâce. – Ma femme se marie. – Le plongeon dans la Scarpe. – Je voyage en officier. – La lecture des dépêches. – Séjour à Paris. – Un nouveau nom. – La femme qui me convient. – Je suis marchand forain. – Le commissaire de Melun. – Exécution d’Herbaux. – Je dénonce un voleur ; il me dénonce. – La chaîne à Auxerre. – Je m’établis dans la capitale. – Deux échappés du bagne. – Encore ma femme. – Un recel.
À peine avais-je mis le pied dans le préau, que le procureur-général Rauson, que mes évasions réitérées avaient irrité contre moi, parut à la grille, en s’écriant : « Eh bien ! Vidocq est arrivé ? Lui a-t-on mis les fers ? – Eh ! monsieur, lui dis-je, que vous ai-je donc fait pour me vouloir tant de mal ? Parce que je me suis évadé plusieurs fois ? est-ce donc un si grand crime ? Ai-je abusé de cette liberté qui a tant de prix à mes yeux ? Lorsqu’on m’a repris, n’étais-je pas toujours occupé de me créer des moyens honnêtes d’existence ? Oh ! je suis moins coupable que malheureux ! Ayez pitié de moi, ayez pitié de ma pauvre mère ; s’il faut que je retourne au bagne, elle en mourra ! »
Ces paroles et l’accent de vérité avec lequel je les prononçai, firent quelque impression sur M. Rauson : il revint le soir, me questionna longuement sur la manière dont j’avais vécu depuis ma sortie de Toulon, et comme à l’appui de ce que je disais, je lui offrais des preuves irrécusables, il commença à me témoigner quelque bienveillance. « Que ne formez-vous, me dit-il, une demande en grâce, ou tout au moins en commutation de peine ? Je vous recommanderai au grand juge. » Je remerciai le magistrat de ce qu’il voulait bien faire pour moi ; et, le même jour, un avocat de Douai, M. Thomas, qui me portait un véritable intérêt, vint me faire signer une supplique qu’il avait eu la bonté de rédiger.
J’étais dans l’attente de la réponse, lorsqu’un matin on me fit appeler au greffe : je croyais que c’était la décision du ministre qu’on allait me transmettre. Impatient de la connaître, je suivis le porte-clefs avec la prestesse d’un homme qui court au-devant d’une bonne nouvelle. Je comptais voir le procureur-général, c’est ma femme qui s’offre à mes regards ; deux inconnus l’accompagnent. Je cherche à deviner quel peut être l’objet de cette visite, lorsque, du ton le plus dégagé, Mme Vidocq me dit : « Je viens vous faire signifier le jugement qui prononce notre divorce : comme je vais me remarier, il m’a fallu remplir cette formalité. Au surplus, voici l’huissier qui va vous donner lecture de l’acte. »
Sauf ma mise en liberté, on ne pouvait rien m’annoncer de plus agréable que la dissolution de ce mariage ; j’étais à jamais débarrassé d’un être que je détestais. Je ne sais plus si je fus le maître de contenir ma joie, mais à coup sûr ma physionomie dut l’exprimer, et si, comme j’ai de fortes raisons de le croire, mon successeur était présent, il put se retirer convaincu que je ne lui enviais nullement le trésor qu’il allait posséder.
Ma détention à Douai se prolongeait horriblement. J’étais à l’ombre depuis cinq grands mois, et rien n’arrivait de Paris. M. le procureur général m’avait témoigné beaucoup d’intérêt, mais l’infortune rend défiant, et je commençai à craindre qu’il m’eût leurré d’un vain espoir, afin de me détourner de m’enfuir jusqu’au moment du départ de la chaîne : frappé de cette idée, je revins avec ardeur à mes projets d’évasion.
Le concierge, le nommé Wettu, me regardant d’avance comme amnistié, avait pour moi quelques égards ; nous dînions même fréquemment tête à tête dans une petite chambre, dont l’unique croisée donnait sur la Scarpe. Il me sembla qu’au moyen de cette ouverture, qu’on avait négligé de griller, sur la fin du repas, un jour ou l’autre, il me serait facile de lui brûler la politesse ; seulement il était essentiel de m’assurer d’un déguisement, à la faveur duquel, une fois sorti, je pourrais me dérober aux recherches. Je mis quelques amis dans ma confidence, et ils tinrent à ma disposition une petite tenue d’officier d’artillerie légère, dont je me promettais bien de faire usage à la première occasion. Un dimanche soir, j’étais à table avec le concierge et l’huissier Hurtrel ; le Beaune avait mis ces messieurs en gaieté ; j’en avais fait vernir force bouteilles. « Savez-vous, mon gaillard, me dit Hurtrel, qu’il n’aurait pas fait bon vous mettre ici, il y a sept ans. Une fenêtre sans barreaux ! Peste ! je ne m’y serais pas fié. – Allons donc, papa Hurtrel, il faudrait être de liège, lui répliquai-je, pour se risquer à faire le plongeon de si haut ; la Scarpe est bien profonde pour quelqu’un qui ne sait pas nager. – C’est vrai, observa le concierge » ; et la conversation en resta là ; mais mon parti était pris. Bientôt il survint du monde, le concierge se mit à jouer, et au moment où il était le plus occupé de sa partie, je me précipitai dans la rivière.
Au bruit de ma chute, toute la société courut à la fenêtre, tandis que Wettu appelait à grands cris la garde et les porte-clefs pour se mettre à ma poursuite. Heureusement le crépuscule permettait à peine de distinguer les objets ; mon chapeau, que j’avais d’ailleurs jeté à dessein sur la rive, fit croire que j’étais immédiatement sorti de la rivière, pendant que je continuai à nager dans la direction de la porte d’eau, sous laquelle je passai avec d’autant plus de peine, que j’étais transi de froid, et que mes forces commençaient à s’épuiser. Une fois hors la ville, je gagnai la terre ; mes vêtements, trempés d’eau, pesaient plus de cent livres ; je n’en pris pas moins ma course, et ne m’arrêtai qu’au village de Blangy, situé à deux lieues d’Arras. Il était quatre heures du matin ; un boulanger qui chauffait son four, fit sécher mes habits, et me fournit quelques aliments. Dès que je fus restauré, je me remis en route, et me dirigeai vers Duisans, où restait la veuve d’un ancien capitaine de mes amis. C’était chez elle qu’un exprès devait m’apporter l’uniforme que l’on s’était procuré pour moi à Douai. Je ne l’eus pas plutôt reçu, que je me rendis à Hersin, où je ne me cachai que peu de jours chez un de mes cousins. Des avis, qui me parvinrent fort à propos, m’engagèrent à déguerpir : je sus que la police, convaincue que j’étais dans le pays, allait ordonner une battue ; elle était même sur la voie de ma retraite ; résolu à lui échapper, je ne l’attendis pas.
Il était clair que Paris seul pouvait m’offrir un refuge : mais pour aller à Paris, il était nécessaire de revenir sur Arras, et si je passais dans cette ville, j’étais infailliblement reconnu. J’avisai donc au moyen d’éluder la difficulté : la prudence me suggéra de monter dans la carriole d’osier de mon cousin, qui avait un excellent cheval, et était le premier homme du monde pour la connaissance des chemins de traverse. Il me répondit, sur sa réputation de parfait conducteur, de me faire tourner les remparts de ma cité natale ; il ne m’en fallait pas davantage, mon travestissement devant faire le reste. Je n’étais plus Vidocq, à moins qu’on n’y regardât de trop près ; aussi en arrivant au pont de Gy, vis-je sans trop d’effroi, huit chevaux de gendarmes attachés à la porte d’une auberge. J’avoue que je me fusse bien passé de la rencontre, mais elle se présentait face à face, et ce n’était qu’en l’affrontant qu’elle pouvait cesser d’être périlleuse. « Allons ! dis-je à mon cousin, c’est ici qu’il faut payer de toupet ; pied à terre, et vite, vite, fais-toi servir quelque chose. Aussitôt il descend et se présente dans l’auberge avec cette allure d’un luron dégourdi, qui ne redoute pas l’œil de la brigade. – Eh bien ! lui dirent les gendarmes, est-ce ton cousin Vidocq que tu conduis ? – Peut-être, répondit-il en riant, regardez-y. » Un gendarme s’approcha en effet de la carriole, mais plutôt par un simple mouvement de curiosité que poussé par un soupçon. À la vue de mon uniforme, il porta respectueusement la main au chapeau. « Salut, capitaine » me dit-il, et bientôt après il monta à cheval avec ses camarades. « bon voyage, leur cria mon cousin, en faisant claquer son fouet ; si vous l’empoignez, vous nous l’écrirez. – Va ton train, reprit le maréchal-des-logis qui commandait le peloton, nous savons le gîte, et le mot d’ordre est Hersin : demain, à cette heure, il sera coffré. »
Nous continuâmes notre route fort paisiblement ; cependant il me vint une crainte : des insignes militaires pouvaient m’exposer à quelques chicanes qui auraient pour moi un résultat désagréable. La guerre de Prusse était commencée, et l’on voyait peu d’officiers à l’intérieur, à moins qu’ils n’y fussent ramenés par quelque blessure. Je me décidai à porter le bras en écharpe : c’était à Iéna que j’avais été mis hors de combat, et si l’on m’interrogeait, j’étais prêt à donner sur cette journée, non seulement tous les détails que j’avais lus dans les bulletins, mais encore tous ceux que j’avais pu recueillir, en entendant une foule de récits vrais ou mensongers faits par des témoins, oculaires ou non. Au total, j’étais ferré sur ma bataille d’Iéna, et je pouvais en parler à tout venant avec connaissance de cause : personne n’en savait plus long que moi : je m’acquittai parfaitement de mon rôle à Beaumont, où la lassitude du cheval, qui avait fait trente-cinq lieues en un jour et demi, nous obligea de faire halte. J’avais déjà pris langue dans l’auberge, lorsque je vis un maréchal-des-logis de gendarmes aller droit à un officier de dragons, et l’inviter à exhiber ses papiers. Je m’approchai à mon tour du maréchal-des-logis et je le questionnai sur le motif de cette précaution. « Je lui ai demandé sa feuille de route, me répondit-il, parce que quand tout le monde est à l’armée, ce n’est pas en France qu’est la place d’un officier valide. – Vous avez raison mon camarade ! » lui dis-je, il faut que le service se fasse ; et en même temps, pour qu’il ne lui prît pas la fantaisie de s’assurer si j’étais en règle, je l’invitai à dîner avec moi. Pendant le repas, je gagnai tellement sa confiance, qu’il me pria, quand je serais à Paris, de m’occuper de lui faire obtenir son changement de résidence. Je promis tout, et il était content ; car, afin de le servir, je devais user de mon crédit, qui était très grand, et de celui des autres, qui l’était encore davantage. En général, on n’est pas chiche de ce qu’on n’a pas. Quoi qu’il en soit, les flacons se vidaient avec rapidité, et mon convive, dans l’enthousiasme d’une protection qui lui venait si à propos, commençait à me tenir de ces discours sans suite, précurseurs de l’ivresse, lorsqu’un gendarme lui remit un paquet de dépêches. Il rompit les bandes d’une main incertaine, et voulut essayer de lire, mais ses yeux obscurcis ayant rendu inutile toute tentative de ce genre, il me pria de le suppléer dans ses fonctions ; j’ouvre une lettre, et les premiers mots qui frappent mes regards sont ceux-ci : Brigade d’Arras. Je parcours de la vue, c’était l’avis de mon passage à Beaumont ; on ajoutait que je devais avoir pris la diligence du Lion d’argent. Malgré mon trouble, je lus le signalement en le dénaturant : « Bon ! bon ! dit le très sobre et très vigilant maréchal-des-logis, la voiture ne passe que demain matin, on s’en occupera », et il voulut recommencer à boire sur de nouveaux frais, mais ses forces trompèrent son courage ; on fut obligé de l’emporter dans son lit, au grand scandale de toute l’assistance, qui répétait avec indignation : « Un maréchal-des-logis ! un homme gradé ! se mettre dans des états pareils ! »
On pense bien que je n’attendis pas le réveil de l’homme gradé ; à cinq heures, je pris place dans la diligence de Beaumont, qui le même jour me conduisit sans encombre à Paris, où ma mère, qui n’avait pas cessé d’habiter Versailles, vint me rejoindre. Nous demeurâmes ensemble quelques mois dans le faubourg Saint-Denis, où nous ne voyions personne, à l’exception d’un bijoutier, nommé Jacquelin, que je dus, jusqu’à un certain point, mettre dans ma confidence, parce qu’à Rouen il m’avait connu sous le nom de Blondel. Ce fut chez Jacquelin que je rencontrai une dame de B…, qui tient le premier rang dans les affections de ma vie. Madame de B…, ou Annette, car c’est ainsi que je l’appelais, était une assez jolie femme, que son mari avait abandonnée par suite de mauvaises affaires. Il s’était enfui en Hollande, et depuis long-temps il ne lui donnait plus de ses nouvelles. Annette était donc entièrement libre ; elle me plut ; j’aimai son esprit, son intelligence, son bon cœur ; j’osai le lui dire ; elle vit d’abord, sans trop de peine, mes assiduités, et bientôt nous ne pûmes plus exister l’un sans l’autre. Annette vint demeurer avec moi ; et, comme je reprenais l’état de marchand de nouveautés ambulant, il fut décidé qu’elle m’accompagnerait dans mes courses. La première tournée que nous fîmes ensemble fut des plus heureuses. Seulement, à l’instant où je quittais Melun, l’aubergiste chez lequel j’étais descendu m’avertit que le commissaire de police avait témoigné quelque regret de n’avoir pas examiné mes papiers, mais que ce qui était différé n’était pas perdu, et qu’à mon prochain passage, il se proposait de me faire une visite. L’avis me surprit ; il fallut que j’eusse été déjà désigné comme suspect. Aller plus loin, c’était peut-être me compromettre : je rabattis aussitôt sur Paris, me promettant bien de ne plus faire d’excursion tant que je n’aurais pas réussi à rendre moins défavorables les chances qui se réunissaient contre moi.
Parti de très grand matin, j’arrive de bonne heure au faubourg Saint-Marceau : à mon entrée, j’entends des colporteurs hurler cette finale : qui condamne deux particuliers très connus à être fait mourir aujourd’hui en place de Grève. J’écoute : il me semble que le nom d’Herbaux a résonné à mon oreille ; Herbaux, l’auteur du faux qui a causé tous mes malheurs ! J’écoute plus attentivement encore, mais avec un saisissement involontaire, et cette fois le crieur, dont je me suis approché, répète la sentence avec des variantes : Voici l’arrêt du tribunal criminel du département de la Seine, qui condamne à la peine de mort les nommés Armand Saint-Léger, ancien marin, né à Bayonne, et César Herbaux, forçat libéré, né à Lille, atteints et convaincus d’assassinat, etc.
Il n’y avait plus à en douter : le misérable qui m’avait perdu allait porter sa tête sur l’échafaud. L’avouerai-je ? ce fut une impression de joie que je ressentis, et pourtant je frémissais. Tourmenté de nouveau dans mon existence, agité d’inquiétudes sans cesse renaissantes, j’eusse voulu anéantir cette population des prisons et des bagnes, qui, après m’avoir lancé dans l’abîme, pouvait m’y maintenir par ses cruelles révélations. On ne s’étonnera donc pas de l’empressement avec lequel je courus au Palais de Justice, afin de m’assurer par moi-même de la vérité : il n’était pas encore midi, et j’eus toutes les peines du monde à arriver jusqu’à la grille, auprès de laquelle je pris position, en attendant l’instant fatal.
Quatre heures sonnent enfin. Le guichet s’ouvre : un homme paraît le premier dans la charrette… ; c’est Herbaux. La figure couverte d’une pâleur mortelle, il affiche une fermeté que dément l’agitation convulsive de ses traits. Il affecte de parler à son compagnon, qui déjà est hors d’état de l’entendre. Au signal du départ, Herbaux, d’un front qu’il s’efforce de rendre audacieux, promène ses regards sur la foule ; ses yeux rencontrent les miens… Il fait un mouvement ; son teint s’anime… Le cortège a passé. Je restai aussi immobile que les faisceaux de bronze auxquels je m’étais attaché, et je me serais sans doute encore long-temps oublié dans cette attitude, si un inspecteur du Palais ne m’eût enjoint de me retirer. Vingt minutes après, une voiture chargée d’un panier rouge, et escortée par un gendarme, traversa au trot le Pont-au-Change, se dirigeant vers le cimetière des condamnés. Alors, le cœur serré, je m’éloignai, et regagnai le logis en faisant les plus tristes réflexions.
J’ai appris depuis que, pendant sa détention à Bicêtre, Herbaux avait exprimé le regret de m’avoir fait condamner innocent. Le crime qui avait conduit ce scélérat à l’échafaud était un assassinat commis de complicité avec Saint-Léger sur une dame de la place Dauphine. Ces deux misérables s’étaient introduits chez leur victime, sous le prétexte de lui donner des nouvelles de son fils, qu’ils avaient vu, disaient-ils, à l’armée.
Quoiqu’en définitive l’exécution d’Herbaux ne dût avoir aucune influence directe sur ma position, elle me consterna : j’étais épouvanté de m’être trouvé en contact avec des brigands, destinés au bourreau ; mes souvenirs me ravalaient à mes propres yeux ; je rougissais en quelque sorte en face de moi-même ; j’aurais souhaité perdre la mémoire, et mener une démarcation impénétrable entre le passé et le présent, car, je ne le voyais que trop, l’avenir était dans la dépendance du passé, et j’étais d’autant plus malheureux qu’une police à qui il n’est pas toujours donné d’agir avec discernement, ne me permettait pas de m’oublier. Je me voyais de nouveau à la veille d’être traqué comme une bête fauve. La persuasion qu’il me serait interdit de devenir honnête homme me livrait presque au désespoir : j’étais silencieux, morose, découragé. Annette s’en aperçut ; elle demanda à me consoler ; elle proposait de se dévouer pour moi ; elle me pressait de questions ; mon secret m’échappa : je n’ai jamais eu lieu de m’en repentir. L’activité, le zèle et la présence d’esprit de cette femme me devinrent très utiles. J’avais besoin d’un passe-port ; elle détermina Jacquelin à me prêter le sien ; et, pour me mettre à même d’en faire usage, celui-ci me donna, sur sa famille et sur ses relations, les renseignements les plus complets. Muni de ces instructions, je me remis en voyage, et parcourus toute la Basse-Bourgogne. Presque partout il me fallut montrer que j’étais en règle : si l’on eût comparé l’homme avec le signalement, il eût été facile de découvrir la fraude ; mais nulle part on ne me fit d’observation ; et, pendant plus d’un an, à quelques alertes près qui ne valent pas la peine d’être ici mentionnées, le nom de Jacquelin me porta bonheur.
Un jour que j’avais déballé à Auxerre, en me promenant tranquillement sur le port, je rencontrai le nommé Paquay, voleur de profession, que j’avais vu à Bicêtre, où il subissait une détention de six années. Il m’eût été fort agréable de l’éviter, mais il m’accosta presque à l’improviste ; et, dès les premières paroles qu’il m’adressa, je pus me convaincre qu’il ne serait pas prudent d’essayer de le méconnaître. Il était très curieux de savoir ce que je faisais ; et comme j’entrevis dans sa conversation qu’il se proposait de m’associer à des vols, j’imaginai, pour me débarrasser de lui, de parler de la police d’Auxerre, que je lui représentai comme très vigilante, et par conséquent très redoutable. Je crus observer que l’avis faisait impression ; je chargeai le tableau, jusqu’à ce qu’enfin, après m’avoir écouté avec une très inquiète attention, il s’écria tout à coup : « Diable ! il paraît qu’il ne fait pas bon ici ; le coche part dans deux heures ; si tu veux, nous détalerons. – C’est cela, lui répondis-je ; s’il s’agit de filer, je suis ton homme. » Puis, sur ce, je le quittai, après avoir promis de le rejoindre aussitôt que j’aurais terminé quelques préparatifs qui me restaient à faire. C’est une si pitoyable condition que celle du forçat évadé, que, s’il ne veut pas être dénoncé, ou être impliqué dans quelque attentat, il est toujours réduit à prendre l’initiative, c’est-à-dire à se faire dénonciateur. Rendu à l’auberge, j’écrivis donc la lettre suivante au lieutenant de gendarmerie, que je savais être à la piste des auteurs d’un vol récemment commis dans les bureaux de la diligence.
« MONSIEUR,
Une personne qui ne veut pas être connue, vous prévient que l’un des auteurs du vol commis dans les bureaux des messageries de votre ville, va partir, à six heures, par le coche, pour se rendre à Joigny, où l’attendent probablement ses complices. Afin de ne pas le manquer, et de l’arrêter en temps utile, il serait bon que deux gendarmes déguisés montassent avec lui dans le coche ; il est important que l’on s’y prenne avec prudence, et qu’on ne perde pas de vue l’individu, car c’est un homme fort adroit. »
Cette missive était accompagnée d’un signalement si minutieusement tracé, qu’il était impossible de s’y méprendre. L’instant du départ arrivé, je me rends sur les quais en prenant des chemins détournés, et de la fenêtre d’un cabaret, où je m’étais posté, j’aperçois Paquay qui entre dans le coche : bientôt après s’embarquent les deux gendarmes, que je reconnais à certaine encolure que l’on conçoit, mais qu’on ne saurait analyser. Par intervalles, ils se passent mutuellement un papier sur lequel ils jettent les yeux ; enfin leurs regards s’arrêtent sur mon homme, dont le costume, contre l’habitude des voleurs, était une mauvaise enseigne. Le coche démarre, et je le vois s’éloigner avec d’autant plus de plaisir, qu’il emporte tout à la fois Paquay, ses propositions et même ses révélations, si, comme je n’en doutais pas, il avait eu la fantaisie d’en faire.
Le surlendemain de cette aventure, tandis que j’étais en train de faire l’inventaire de mes marchandises, j’entends un bruit extraordinaire, je mets la tête à la fenêtre : c’est la chaîne, que conduisent Thiéry et ses argouzins ! À cet aspect si terrible et si dangereux pour moi, je me retire brusquement, mais dans mon trouble je casse un carreau ; soudain tous les regards se portent de ce côté ; j’aurais voulu être aux entrailles de la terre. Ce n’est pas tout, pour mettre le comble à mon inquiétude, quelqu’un ouvre ma porte, c’est l’aubergiste du Faisan, Madame Gelat. « Venez donc, M. Jacquelin, venez donc voir passer la chaîne, me crie-t-elle !… Oh ! il y a long-temps qu’on n’en a pas vu une si belle !… ils sont au moins cent cinquante, et de fameux gaillards encore !… Entendez-vous comme ils chantent ? » Je remerciai mon hôtesse de son attention, et, feignant d’être occupé, je lui dis que je descendrais dans un moment. « Oh ! ne vous pressez pas, me répondit-elle, vous avez le temps,… ils couchent ici dans nos écuries. Et puis, si vous souhaitez causer avec leur chef, on va lui donner la chambre à côté de la vôtre. » Le lieutenant Thiéry, mon voisin ! À cette nouvelle, je ne sais pas ce qui se passa dans moi ; mais je pense que si Madame Gelat m’eût observé, elle aurait vu mon visage pâlir et tous mes membres s’agiter comme par une espèce de tressaillement. Le lieutenant Thiéry, mon voisin ! Il pouvait me reconnaître, me signaler, un geste, un rien pouvait me trahir : aussi me donnais-je bien garde de me montrer. La nécessité d’achever mon inventaire légitimait mon manque de curiosité. Je passai une nuit affreuse. Enfin, à quatre heures du matin, le départ de l’infernal cortège me fut annoncé par le cliquetis des fers : je respirai.
Il n’a pas souffert celui qui n’a pas connu des transes pareilles à celles dans lesquelles me jeta la présence de cette troupe de bandits et de leurs gardiens. Reprendre des fers que j’avais brisés au prix de tant d’efforts, cette idée me poursuivait sans cesse : mon secret, je ne le possédais pas seul, il y avait des forçats par le monde, si je les fuyais, je les voyais prêts à me livrer : mon repos, mon existence étaient menacés partout, et toujours. Un coup d’œil, le nom d’un commissaire, l’apparition d’un gendarme, la lecture d’un arrêt, tout devait exciter et entretenir mes alarmes. Que de fois j’ai maudit les pervers qui, trompant ma jeunesse, avaient souri à l’élan désordonné de mes passions, et ce tribunal qui, par une condamnation injuste, m’avait précipité dans un gouffre dont je ne pouvais plus secouer la souillure, et ces institutions qui ferment la porte au repentir !… J’étais hors de la société, et pourtant je ne demandais qu’à lui donner des garanties ; je lui en avais donné, j’en atteste ma conduite invariable à la suite de chacune de mes évasions, mes habitudes d’ordre, et ma fidélité scrupuleuse à remplir tous mes engagements.
Maintenant il s’élevait dans mon esprit quelques craintes au sujet de ce Paquay, dont j’avais provoqué l’arrestation ; en y réfléchissant, il me sembla que dans cette circonstance j’avais agi bien légèrement ; j’avais le pressentiment de quelque malheur : ce pressentiment se réalisa. Paquay, conduit à Paris, puis ramené à Auxerre pour une confrontation, apprit que j’étais encore dans la ville ; il m’avait toujours soupçonné de l’avoir dénoncé, il prit sa revanche. Il raconta au geôlier tout ce qu’il savait sur mon compte. Celui-ci fit son rapport à l’autorité, mais ma réputation de probité était si bien établie dans Auxerre, où je faisais des séjours de trois mois, que, pour éviter un éclat fâcheux, un magistrat dont je tairai le nom me fit appeler et m’avertit de ce qui se passait. Je n’eus pas besoin de lui confesser la vérité, mon trouble la lui révéla tout entière ; je n’eus que la force de lui dire : « Ah ! monsieur ! je voulais être honnête homme ! » Sans me répondre, il sortit et me laissa seul ; je compris son généreux silence. En un quart d’heure j’eus perdu de vue Auxerre, et, de ma retraite, j’écrivis à Annette, pour l’instruire de cette nouvelle catastrophe. Afin de détourner les soupçons, je lui recommandai de rester encore une quinzaine de jours au Faisan, et de dire à tout le monde que j’étais allé à Rouen pour y faire des emplettes, ce terme expiré, Annette devait me rejoindre à Paris ; elle y arriva en effet le jour que je lui avais indiqué. Elle m’apprit que le lendemain de mon départ, des gendarmes déguisés s’étaient présentés à mon magasin pour m’arrêter, et que ne m’ayant pas trouvé, ils avaient dit qu’on ne s’en tiendrait pas là, et qu’on finirait par me découvrir.
Ainsi on allait continuer les recherches : c’était là un contre-temps qui dérangeait tous mes projets : signalé sous le nom de Jacquelin, je me vis réduit à le quitter et à renoncer encore une fois à l’industrie que je m’étais créée.
Il n’y avait plus de passe-port, quelque bon qu’il fût, qui pût me mettre à l’abri dans les cantons que je parcourais d’ordinaire ; et dans ceux où l’on ne m’avait jamais vu, il était vraisemblable que mon apparition insolite éveillerait des soupçons. La conjoncture devenait terriblement critique. Quel parti prendre ? c’était là mon unique préoccupation, lorsque le hasard me procura la connaissance d’un marchand tailleur de la cour Saint-Martin : il désirait vendre son fonds. J’en traitai avec lui, persuadé que je ne serais nulle part plus en sûreté qu’au cœur d’une capitale, où il est si aisé de se perdre dans la foule. En effet, il s’écoula près de huit mois sans que rien vînt troubler la tranquillité dont nous jouissions, ma mère, Annette et moi. Mon établissement prospérait : chaque jour il prenait de l’accroissement. Je ne me bornais plus, comme mon prédécesseur, à la confection des habits ; je faisais aussi le commerce des draps, et j’étais peut-être sur le chemin de la fortune, quand tout pour un matin, mes tribulations recommencèrent.
J’étais dans mon magasin ; un commissionnaire se présente et me dit que l’on m’attend chez un traiteur de la rue Aumaire ; je présume qu’il s’agit de quelque marché à conclure, je me rends aussitôt dans l’endroit indiqué. On m’introduit dans un cabinet, et j’y trouve deux échappés du bagne de Brest : l’un d’eux était ce Blondy, qu’on a vu diriger la malheureuse évasion de Pont-à-Luzen : « Nous sommes ici depuis dix jours, me dit-il, et nous n’avons pas le sou. Hier, nous t’avons aperçu dans un magasin ; nous avons appris qu’il était à toi, et ça m’a fait plaisir, je l’ai dit à l’ami… Maintenant nous ne sommes plus si inquiets, car on te connaît, tu n’es pas homme à laisser des camarades dans l’embarras.
L’idée de me voir à la merci de deux bandits que je savais capables de tout, même de me vendre à la police, ne fût-ce que pour me faire pièce, quitte à se perdre eux-mêmes, était accablante. Je ne laissai pas d’exprimer combien j’étais satisfait de me trouver avec eux ; j’ajoutai que n’étant pas riche, je regrettais de ne pouvoir disposer en leur faveur que de cinquante francs : ils parurent se contenter de cette somme, et, en me quittant, il m’annoncèrent qu’ils étaient dans l’intention de se rendre à Châlons-sur-Marne, où ils avaient, disaient-ils, des affaires. J’eusse été trop heureux qu’ils se fussent pour toujours éloignés de Paris, mais, en me faisant leurs adieux, ils me promettaient de revenir bientôt, et je restais effrayé de leur prochain retour. N’allaient-ils pas me considérer comme leur vache à lait, et mettre un prix à leur discrétion ? Ne seraient-ils pas insatiables… ? Qui me répondrait que leurs exigences se borneraient à la possibilité ? Je me voyais déjà le banquier de ces messieurs et de beaucoup d’autres, car il était à présumer que, suivant la coutume usitée parmi les voleurs, si je me lassais de les satisfaire, ils me repasseraient à leurs connaissances pour me rançonner sur de nouveaux frais ; je ne pouvais être bien avec eux que jusqu’au premier refus ; parvenu à ce terme, il était hors de doute qu’ils me joueraient quelque méchant tour. Avec de tels garnements à mes trousses, on comprendra que je n’étais pas à mon aise ! Il s’en fallait que ma situation fût plaisante, elle fut encore empirée par une bien funeste rencontre.
On se souvient, ou on ne se souvient pas, que ma femme, après son divorce, avait convolé à de secondes noces : je la croyais dans le département du Pas-de-Calais, tout occupée de faire son bonheur et celui de son nouveau mari, lorsque dans la rue du Petit-Carreau, je me trouvai nez à nez avec elle ; impossible de l’éviter, elle m’avait reconnu. Je lui parlai donc, et, sans lui rappeler ses torts à mon égard, comme le délâbrement de sa toilette me montrait de reste qu’elle n’était pas des plus heureuses, je lui donnai quelque argent. Peut-être imagina-t-elle alors que c’était là une générosité intéressée, cependant il n’en était rien. Il ne m’était pas même venu à la pensée que l’ex-dame Vidocq pût me dénoncer. À la vérité en me remémoriant plus tard nos anciens démêlés, je jugeai que mon cœur m’avait tout-à-fait conseillé dans le sens de la prudence ; je m’applaudis alors de ce que j’avais fait, et il me parut très convenable que cette femme, dans sa détresse, pût compter sur moi pour quelques secours ; détenu ou éloigné de Paris, je n’étais plus à même de soulager sa misère. Ce devait être pour elle une considération qui devait la déterminer à garder le silence, je le crus du moins ; on verra plus tard si je m’étais trompé.
L’entretien de mon ex-femme était une charge à laquelle je m’étais résigné, mais cette charge, je n’en connaissais pas tout le poids. Une quinzaine s’était écoulée depuis notre entrevue ; un matin, on me fait prier de passer rue de l’Échiquier : je m’y rends, et au fond d’une cour, dans un rez-de-chaussée assez propre quoique médiocrement meublé, je revois non seulement ma femme, mais encore, ses nièces et leur père, le terroriste Chevalier, qui venait de subir une détention de six mois, pour vol d’argenterie : un coup d’œil suffit pour me convaincre que c’était une famille qui me tombait sur les bras. Tous ces gens-là étaient dans le plus absolu dénuement ; je les détestais, je les maudissais, et pourtant je n’avais rien de mieux à faire que de leur tendre la main. Je me saignai pour eux. Les réduire au désespoir, c’eût été me perdre, et plutôt que de revenir en la puissance des argouzins, j’étais résolu à faire le sacrifice de mon dernier sou.
À cette époque, il semblait que le monde entier se fût ligué contre moi ; à chaque instant il me fallait dénouer les cordons de ma bourse, et pour qui ? pour des êtres qui, regardant ma libéralité comme obligatoire, étaient prêts à me trahir aussitôt que je ne leur paraîtrais plus une ressource assurée. Quand je rentrai de chez ma femme, j’eus encore une preuve du malheur attaché à la condition de forçat évadé, Annette et ma mère étaient en pleurs. En mon absence, deux hommes ivres m’avaient demandé, et sur la réponse que je n’y étais pas, ils s’étaient répandus en invectives et en menaces, qui ne me laissaient aucun doute sur la perfidie de leurs intentions. Au portrait que me fit Annette de ces deux individus, il me fut aisé de reconnaître Blondy et son camarade Duluc. Je n’eus pas la peine de deviner leurs noms ; d’ailleurs ils avaient donné une adresse avec injonction formelle d’y porter quarante francs, c’était plus qu’il ne fallait pour me mettre sur la voie ; car, à Paris, il n’y avait qu’eux capables de m’intimer un pareil ordre. Je fus obéissant, très obéissant ; seulement, en payant ma contribution à ces deux coquins, je ne pus m’empêcher de leur faire observer qu’ils avaient agi fort inconsidérément. « Voyez le beau coup que vous avez fait, leur dis-je, on ne savait rien à la cassine et vous avez mangé le morceau ! (vous avez tout dit) ma femme, qui a l’établissement en son nom, va peut-être vouloir me mettre à la porte, et alors il me faudra gratter les pavés (vivre dans la misère). – Tu viendras grinchir (voler) avec nous, me répondirent les deux brigands. »
J’essayai de leur démontrer qu’il vaut infiniment mieux devoir son existence au travail que d’avoir sans cesse à redouter l’action d’une police, qui, tôt ou tard, enveloppe les malfaiteurs dans ses filets. J’ajoutai que souvent un crime conduit à un autre ; que tel croit risquer le carcan, qui court tout droit à la guillotine, et la conclusion de mon discours fut qu’ils feraient sagement de renoncer à la périlleuse carrière qu’ils avaient embrassée.
« Pas mal ! s’écria Blondy, quand j’eus achevé ma mercuriale… Pas mal ! Pourrais-tu pas en attendant nous indiquer quelque cambriole à rincer (quelque chambre à dévaliser) ? C’est que, vois-tu, nous sommes comme Arlequin, nous avons plus besoin d’argent que d’avis. » Et ils me quittèrent en me riant au nez. Je les rappelai pour leur protester de mon dévouement, et les priai de ne plus reparaître à la maison. « Si ce n’est que çà, me dit Duluc, on s’en abstiendra. – Eh ! oui, l’on s’en abstiendra, répéta Blondy, puisque çà déplaît à madame. »
Ce dernier ne s’abstint pas long-temps. Dès le surlendemain, à la tombée de la nuit, il se présenta à mon magasin, et demanda à me parler en particulier. Je le fis monter dans ma chambre. « Nous sommes seuls » me dit-il, en faisant d’un coup d’œil la revue du local ; et quand il se crut assuré qu’il n’y avait pas de témoins, il tira de sa poche onze couverts d’argent et deux montres d’or, qu’il posa sur le guéridon : « Quatre cents balles (francs) tout cela… ce n’est pas cher… les bogues d’orient et la blanquette (les montres d’or et l’argenterie). Allons, aboule du carle (compte-moi de l’argent). – Quatre cents balles, répondis-je tout troublé par une aussi brusque sommation, je ne les ai pas. – Peu m’importe. Va bloquir (vendre). – Mais si l’on veut savoir… ! – Arrange-toi ; il me faut du poussier (de la monnaie), ou si tu aimes mieux, je t’enverrai des chalands de la préfecture… Tu entends ce que parler veut dire… Du poussier, et pas tant de façons. »
Je ne l’entendais que trop bien… Je me voyais déjà dénoncé, privé de l’état que je m’étais fait, reconduit au bagne… Les quatre cents francs furent comptés.
CHAPITRE XXII
Encore un brigand. – Ma carriole d’osier. – Arrestation des deux forçats. – Découverte épouvantable. – Saint-Germain veut m’embaucher pour un vol. – J’offre de servir la police. – Perplexités horribles. – On veut me prendre au chaud du lit. – Ma cachette. – Aventure comique. – Travestissements sur travestissements. – Chevalier m’a dénoncé. – Annette au dépôt de la Préfecture. – Je me prépare à quitter Paris. – Deux faux monnoyeurs. – On me saisit en chemise. – Je suis conduit à Bicêtre.
Me voilà recéleur ! J’étais criminel malgré moi ; mais enfin je l’étais, puisque je prêtais les mains au crime : on ne conçoit pas d’enfer pareil à celui dans lequel je vivais. Sans cesse j’étais agité ; remords et crainte, tout venait m’assaillir à la fois ; la nuit, le jour, à chaque instant, j’étais sur le qui vive. Je ne dormais plus, je n’avais plus d’appétit, le soin de mes affaires ne m’occupait plus, tout m’était odieux. Tout ! non, j’avais près de moi Annette et ma mère. Mais ne me faudrait-il pas les abandonner ?… Tantôt, je frémissais à cette réminiscence de mes appréhensions, ma demeure se transformait en un abominable repaire, tantôt elle était envahie par la police, et la perquisition mettait au grand jour les preuves d’un méfait qui allait attirer sur moi la vindicte des lois. Harcelé par la famille Chevalier, qui me dévorait ; tourmenté par Blondy, qui ne se lassait pas de me soutirer de l’argent ; épouvanté de ce qu’il y avait d’horrible et d’incurable dans ma position, honteux d’être tyrannisé par les plus viles créatures que la terre eût porté, irrité de ne pouvoir briser cette chaîne morale qui me liait irrévocablement à l’opprobre du genre humain, je me sentis poussé au désespoir, et pendant huit jours je roulai dans ma tête les plus sinistres projets. Blondy, l’exécrable Blondy, était celui surtout contre qui se tournait toute ma rage. Je l’aurais étranglé de bon cœur, et pourtant je l’accueillais encore, je le ménageais. Emporté, violent comme je l’étais, tant de patience était un miracle, c’était Annette qui me le commandait. Oh ! que je faisais alors des vœux bien sincères pour que, dans une des excursions fréquentes que faisait Blondy, quelque bon gendarme pût lui mettre la main sur le collet ! Je me flattais que c’était là un événement très prochain, mais chaque fois qu’une absence un peu plus longue que de coutume me faisait présumer que j’étais enfin délivré de ce scélérat, il reparaissait, et avec lui revenaient tous mes soucis.
Un jour, je le vis arriver avec Duluc et un ex-employé des droits réunis, nommé Saint-Germain, que j’avais connu à Rouen, où, comme tant d’autres, il ne jouissait que provisoirement de la réputation d’honnête homme. Saint-Germain, pour qui j’étais le négociant Blondel, fut fort étonné de la rencontre ; mais il suffit de deux mots de Blondy pour lui donner la clef de toute mon histoire : j’étais un fieffé coquin ; la confiance prit la place de l’étonnement, et Saint-Germain, qui, à mon aspect, avait d’abord froncé le sourcil, se dérida. Blondy m’apprit qu’ils allaient partir tous trois pour les environs de Senlis, et me pria de lui prêter la carriole d’osier dont je me servais pour courir les foires. Heureux d’être débarrassé de ces garnements à ce prix, je m’empressai de leur donner une lettre pour la personne qui la remisait. On leur livra la voiture avec les harnais ; ils se mirent en route, et je restai dix jours sans recevoir de leurs nouvelles : ce fut Saint-Germain qui m’en apporta. Un matin, il entra chez moi ; il avait l’air effaré et paraissait excédé de fatigue. « Eh bien ! me dit-il, les camarades sont arrêtés. – Arrêtés ! » m’écriai-je, dans le transport d’une joie que je ne pus contenir ; mais, reprenant aussitôt mon sang-froid, je demandai des détails, en affectant d’être consterné. Saint-Germain me raconta fort brièvement comme quoi Blondy et Duluc avaient été arrêtés, uniquement parce qu’ils voyageaient sans papiers ; je ne crus rien de ce qu’il disait, et je ne doutai pas qu’ils n’eussent fait quelque coup. Ce qui me confirma dans mes soupçons, c’est qu’à la proposition que je fis de leur envoyer de l’argent, Saint-Germain répondit qu’ils n’en avaient que faire. En s’éloignant de Paris, ils possédaient cinquante francs à eux trois ; certes, avec une somme aussi modique, il leur aurait été bien difficile de faire des économies ; comment advenait-il qu’ils ne fussent pas encore au dépourvu ? la première idée qui me vint fut qu’ils avaient commis quelque vol considérable, dont ils ne se souciaient pas de me faire confidence ; je découvris bientôt qu’il s’agissait d’un attentat beaucoup plus grave.
Deux jours après le retour de Saint-Germain, il me prit la fantaisie d’aller voir ma carriole, qu’il avait ramenée : je remarquai d’abord qu’on en avait changé la plaque. En visitant l’intérieur, j’aperçus sur la doublure de coutil blanc et bleu des taches rouges fraîchement lavées ; puis, ayant ouvert le coffre pour prendre la clef d’écrou, je le trouvai rempli de sang, comme si l’on y eût déposé un cadavre. Tout était éclairci, la vérité s’annonçait plus épouvantable encore que mes conjectures ; je n’hésitai pas : plus intéressé peut-être que les auteurs du meurtre, à en faire disparaître les traces, la nuit suivante je conduisis la voiture sur les bords de la Seine ; parvenu au-dessus de Bercy, dans un lieu isolé, je mis le feu à de la paille et à du bois sec dont je l’avais bourrée, et je ne me retirai que lorsqu’elle eut été réduite en cendres.
Saint-Germain, à qui je communiquai le lendemain mes remarques, sans lui dire toutefois que j’eusse brûlé ma carriole, m’avoua enfin que le cadavre d’un roulier assassiné par Blondy, entre Louvres et Dammartin, y avait été caché jusqu’à ce qu’on eût trouvé l’occasion de le jeter dans un puits. Cet homme, l’un des plus audacieux scélérats que j’aie rencontrés, parlait de ce forfait comme s’il se fût entretenu de l’action la plus innocente : c’était le rire sur les lèvres et du ton le plus détaché, qu’il en énumérait jusqu’aux moindres circonstances. Il me faisait horreur, je l’écoutais dans une sorte de stupéfaction ; quand je l’entendis me déclarer qu’il lui fallait l’empreinte des serrures d’un appartement dont je connaissais le locataire, mes terreurs furent à leur comble. Je voulus lui faire quelques observations. « Et que ça me fait à moi ? me répondit-il, en affaires comme en affaires ; parce que tu le connais !… raison de plus : tu sais les êtres, tu me conduiras et nous partagerons… Allons ! ajouta-t-il, il n’y a pas à tortiller, il me faut l’empreinte. Je feignis de me rendre à son éloquence. « Des scrupuleux comme ça !… tais-toi donc ! reprit Saint-Germain, tu me fais suer (l’expression dont il se servit était un peu moins congrue). Enfin, à présent c’est dit, nous sommes de moitié. » Grand Dieu ! quelle association ! ce n’était guère la peine de me réjouir de la mésaventure de Blondy : je tombais véritablement de fièvre en chaud mal. Blondy pouvait encore céder à certaines considérations, Saint-Germain jamais, et il était bien plus impérieux dans ses exigences. Exposé à me voir compromis d’un instant à l’autre, je me déterminai à faire une démarche auprès de M. Henry, chef de la division de sûreté à la préfecture de police : j’allai le voir ; et après lui avoir dévoilé ma situation, je lui déclarai que si l’on voulait tolérer mon séjour à Paris, je donnerais des renseignements précieux sur un grand nombre de forçats évadés, dont je connaissais la retraite et les projets.
M. Henry me reçut avec assez de bienveillance ; mais, après avoir réfléchi un moment à ce que je lui disais, il me répondit qu’il ne pouvait prendre aucun engagement vis-à-vis de moi. « Cela ne doit point vous empêcher de me faire des révélations, continua-t-il, on jugera alors à quel point elles sont méritoires, et peut-être… – Ah ! Monsieur, point de peut-être, ce serait risquer ma vie : vous n’ignorez pas de quoi sont capables les individus que je désire vous signaler, et si je dois être reconduit au bagne après que quelque partie d’une instruction juridique aura constaté que j’ai eu des rapports avec la police, je suis un homme mort. – En ce cas, n’en parlons plus. » Et il me laissa partir sans même me demander mon nom.
J’avais l’âme navrée de l’insuccès de cette tentative. Saint-Germain ne pouvait manquer de revenir : il allait me sommer de lui tenir ma parole ; je ne savais plus que faire : devais-je avertir la personne que nous étions convenus de dévaliser ensemble ? S’il eût été possible de me dispenser d’accompagner Saint-Germain, il aurait été moins dangereux de donner un pareil avis ; mais j’avais promis de l’assister, il n’y avait pas d’apparence que je pusse, sous aucun prétexte, me dégager de ma promesse ; je l’attendais comme on attend un arrêt de mort. Une semaine, deux semaines, trois semaines se passèrent dans ces perplexités. Au bout de ce temps je commençai à respirer ; après deux mois je fus tranquillisé tout à fait ; je croyais que, comme ses deux camarades, il s’était fait arrêter quelque part. Annette, je m’en souviendrai toujours, fit une neuvaine, et brûla au moins une douzaine de cierges, à leur intention. « Mon Dieu ! s’écriait-elle quelquefois, faites-moi la grâce qu’ils restent où ils sont ! » La tourmente avait été de longue durée ; les instants de calme furent bien courts, ils précédèrent la catastrophe qui devait décider de mon existence.
Le 3 mai 1809, au point du jour, je suis éveillé par quelques coups frappés à la porte de mon magasin ; je descends pour voir de quoi il s’agit, et je me dispose à ouvrir, lorsque j’entends un colloque à voix basse : « C’est un homme vigoureux, disent les interlocuteurs, prenons nos précautions ! » Plus de doute sur le motif de cette visite matinale ; je remonte à la hâte dans ma chambre ; Annette est instruite de ce qui se passe ; elle ouvre la fenêtre, et, tandis qu’elle entame la conversation avec les agents, m’esquivant en chemise par une issue qui donne sur le carré, je gagne rapidement les étages supérieurs. Au quatrième, je vois une porte entre ouverte, et m’introduis : je regarde ; j’écoute : je suis seul. Dans un renfoncement au-dessous du lambris, se trouve un lit caché par un lambeau de damas cramoisi en forme de rideau : pressé par la circonstance, et certain que déjà l’escalier est gardé, je me jette sous les matelas ; mais à peine m’y suis-je blotti, quelqu’un entre ; on parle, je reconnais la voix, c’est celle d’un jeune homme nommé Fossé, dont le père, monteur en cuivre, était couché dans la pièce contiguë ; un dialogue s’établit :
SCÈNE PREMIÈRE
Le Père, la Mère, le Fils.
Le fils. « Vous ne savez pas, papa ? on cherche le tailleur ;… on veut l’arrêter ; toute la maison est en l’air… Entendez-vous la sonnette ?… Tiens, tiens, les voilà qui sonnent chez l’horloger.
La mère. » Laisse-les sonner, ne te mêle pas de ça ; les affaires des autres ne nous regardent pas : (à son mari.) allons mon homme, habille-toi donc, ils n’auraient qu’à venir.
Le père. » (Bâillant ; il est à présumer qu’en même temps il se frottait le front). Le diable les emporte ! et qu’est-ce qu’ils veulent donc au tailleur ?
Le fils. » Je ne sais pas, papa ; mais ils sont joliment du monde, et des mouchards, et des gendarmes, qui mènent le commissaire avec eux.
Le père. » C’est pt’être rien du tout seulement.
La mère. » Et qu’est-ce qu’il peut avoir fait ? Un tailleur !
Le père. » Qu’est-ce qu’il peut avoir fait ? il peut avoir fait ;… ah ! j’y suis… ! puisqu’il vend du drap ; il aura fait des habits avec des marchandises anglaises.
La mère. » Il aura, comme on dit, employé des denrées coloniales ; tu me fais rire, toi : est-ce qu’on l’arrêterait pour ça ?
Le père. » Je le crois bien qu’on l’arrêterait pour ça, et le blocus continental, c’est-il pour des prunes qu’on l’a décrété ?
Le fils. » Le blocus continental ! qu’est-ce que ça veut dire papa… ? ça va-t-il sur l’eau ?
La mère. » Ah ! oui, dis-nous donc ce que ça veut dire, et mets-nous ça au plus juste ?
Le père. » Ça veut dire que le tailleur va pt’être bien être bloqué.
La mère. » Oh ! mon Dieu ! le pauvre homme ! je suis sûre qu’ils vont l’emmener… des criminels comme ça, qui ne sont pas coupables, si ça ne dépendait que de moi… je crois que je les cacherais dans ma chemise.
Le père. » Sais-tu qui fait du volume, le tailleur ? c’est un fameux corps !
La mère. » C’est égal, je le cacherais tout de même. Je voudrais qu’il vienne ici. Tu te souviens de ce déserteur ?…
Le père. » Chut ! chut ! les voilà qui montent. »
SCÈNE DEUXIÈME
Les précédents, le commissaire, des gendarmes, des mouchards.
Dans ce moment, le commissaire et ses estafiers, après avoir parcouru la maison du haut en bas, arrivent sur le palier du quatrième.
Le commissaire. « Ah ! la porte est ouverte. Je vous demande pardon du dérangement, mais c’est dans l’intérêt de la société… Vous avez pour voisin un grand scélérat, un homme capable de tuer père et mère.
La femme. » Quoi, monsieur Vidocq ?
Le commissaire. » Oui, Vidocq, madame, et je vous enjoins, dans le cas où vous ou votre mari lui auriez donné asile, de me le déclarer sans délai.
La femme. » Ah ! monsieur le commissaire, vous pouvez chercher partout, si ça vous fait plaisir,… nous, donner asile à quelqu’un !…
Le commissaire. » D’abord, cela vous regarde, la loi est excessivement sévère ! c’est un article sur lequel elle ne plaisante pas, et vous vous exposeriez à des peines très graves ; pour un condamné à la peine capitale, il n’y va rien moins que de…
Le mari (vivement). » Nous ne craignons rien, monsieur le commissaire.
Le commissaire. » Je le crois,… je m’en rapporte parfaitement à vous. Cependant pour n’avoir rien à me reprocher, vous me permettrez de faire ici une petite perquisition, c’est une simple formalité d’usage. (S’adressant à sa suite.) Messieurs, les issues sont bien gardées ? »
Après une visite assez minutieuse de la pièce du fond, le commissaire revient dans celle où je suis. – Et dans ce lit ? dit-il, en levant le lambeau de damas cramoisi, pendant que du côté des pieds, je sentais remuer un des coins du matelas, que l’on laissa retomber nonchalamment. – Pas plus de Vidocq que sur la main. Allons ! il se sera rendu invisible, reprit le commissaire, il faut y renoncer. » On n’imaginerait jamais de quel énorme poids ces paroles me soulagèrent. Enfin toute la bande des alguasils se retira ; la femme du monteur en cuivre les accompagna avec force politesses, et je me trouvais seul avec le père, le fils et une petite fille, qui ne me croyaient pas si près d’eux. Je les entendis me plaindre. Mais bientôt madame Fossé accourut en montant l’escalier quatre à quatre ; elle était tout essoufflée ; j’eus encore la venette[5].
SCÈNE TROISIÈME
Le mari, la femme et le fils.
La femme. « Oh ! mon Dieu ! mon Dieu ! Combien qu’il y a de monde d’amassé dans la rue… Allez ! on en dit de belles sur le compte de M. Vidocq, j’espère qu’on en dégoise, et de toutes les couleurs. Tout de même, il faut qu’il y ait quelque chose de vrai ; il n’y a jamais de feu sans fumée… Je sais bien toujours que c’était un fier faigniant que ton monsieur Vidocq : pour un maître tailleur, il avait plus souvent les bras que les jambes croisées.
Le mari. » Te voilà encore comme les autres à faire des suppositions : vois-tu comme t’es mauvaise langue ;… d’ailleurs, il n’y a qu’un mot qui serve, ça ne nous regarde pas. Je suppose encore que ça nous regarderait ; eh bien ! de quoi qu’ils l’accusent, qu’est-ce qu’ils chantent ? je ne suis pas curieux…
La femme. » Qu’est-ce qu’ils chantent, ça fait trembler seulement rien que d’y penser… Quand on dit d’un homme qu’il a été condamné à être fait mourir pour assassinat. Je voudrais que t’entendes le petit tailleur de dessus de la place.
Le mari. » Bah ! jalousie de métier.
La femme. » Et la portière du n° 27, qui dit comme ça qu’elle est bien sûre qu’elle l’a vu sortir tous les soirs avec un gros bâton, si bien déguisé qu’elle ne le reconnaissait pas.
Le mari. » La portière dit ça ?
La femme. » Et qu’il allait attendre le monde dans les Champs-Élysées.
Le mari. » Faut-il que tu sois bête !
La femme. » Ah ! faut-il que je sois bête ! le rogomiste est p’t-être bête aussi, quand il dit que c’est tous voleurs qui viennent là-dedans, et qu’il a vu M. Vidocq avec des visages qui avaient mauvaise mine.
Le mari. » Eh bien ! qui avaient mauvaise mine, après…
La femme. » Après, après, toujours est-il que le commissaire a dit à l’épicier que c’est rien qui vaille,… et pire que ça, puisqu’il a ajouté que c’était un grand coupable, que la justice ne pouvait venir à bout de rattraper.
Le mari. » Et tu la gobes… t’es joliment encore de ton pays ;… tu crois le commissaire, toi, tu ne vois pas que c’est un quart qu’il bat ; et puis, tiens, on ne me mettra jamais dans la tête que M. Vidocq soit un malhonnête homme, il m’est avis, au contraire, que c’est un bon enfant, un homme rangé. Au surplus, qu’il soit ce qu’il voudra, ça nous regarde pas, mêlons-nous de notre ouvrage ; voilà l’heure qui s’avance,… il faut valser. Allons, preste au travail ! »
La séance est levée : le père, la mère, le fils et une petite fille, toute la famille Fossé part, et je reste sous clef, réfléchissant aux insinuations perfides de la police, qui, pour me priver de l’assistance des voisins, s’attachait à me représenter comme un infâme scélérat. J’ai vu souvent depuis employer cette tactique, dont le succès se fonde toujours sur d’atroces calomnies, tactique révoltante, en ce qu’elle est injuste ; tactique maladroite, en ce qu’elle produit un effet tout contraire à celui qu’on en attend, puisque alors les personnes qui eussent prêté main-forte pour l’arrestation d’un voleur, peuvent en être empêchées par la crainte de lutter contre un homme que le sentiment de son crime et la perspective de l’échafaud doivent pousser au désespoir.
Il y avait près de deux heures que j’étais enfermé : il ne se faisait aucun bruit dans la maison, ni dans la rue ; les groupes s’étaient dispersés ; je commençais à me rassurer, lorsqu’une circonstance bien ridicule vint compliquer ma situation. Un besoin des plus pressants s’annonçait par des coliques d’une telle violence, que, ne voyant dans la chambre aucun vase approprié à la nécessité, je me trouvai dans le plus cruel embarras ; à force de fureter dans tous les coins et recoins, j’aperçois enfin une marmite en fonte… Il était temps, je la découvre, et… à peine ai-je terminé, que j’entends fourrer une clef dans la serrure ; je replace précipitamment le couvercle, et vite je me glisse de nouveau dans ma retraite : on entre, c’est la femme Fossé avec sa fille ; un instant après viennent le père et le fils.
SCÈNE DERNIÈRE
Le père, la mère, les enfants et moi.
Le père. « Eh bien ! ce restant de soupe d’hier n’est pas encore réchauffé ?
La mère. » Il n’est pas arrivé qu’il crie déjà : on va le mettre sur le feu, ton restant de soupe ;… avec lui, on dirait que la foire est sur le pont.
Le père. » Est-ce que tu crois qu’ils n’ont pas faim, ces enfants ?
La mère. » Eh mon Dieu ! on ne peut pas aller plus vite que les violons ;… ils attendront ; ils feront comme moi : tu ferais bien mieux de souffler, que de bougonner.
Le père (soufflant). » Elle est donc gelée ta marmite ?… ah je crois qu’elle chante,… entends-tu ?
La mère. » Non ; mais je sens…, ce n’est pas possible autrement, il y a quelqu’un…
Le père. » C’est les choux d’hier ;… c’est pt’être bien toi… ? François rit, je parie que c’est lui… ?
Le fils. » Voilà comme il est papa, il inculpe tout le monde.
Le père. » C’est que vois-tu, comme on connaît les singes on les adore ; je sais que tu es un cadet sujet à caution. Oh Dieu ! que ça pue ! ah çà ? crois-tu être dans une écurie ? (haussant le ton) ? Est-ce dans une écurie que tu crois être (s’adressant à sa femme) ? Voyons, si c’est toi, dis-le moi ?
La mère. » Est-il drôle, à présent ? il veut toujours que ce soit moi… ; c’est qu’elle ne se passe pas cette odeur.
Le père. » C’est de plus fort en plus fort.
La petite fille. » Maman, ça bout.
La mère. » Maudit couvercle ! je me suis brûlée.
Tous ensemble. » Ô Dieu ! quelle infection !
La mère. » C’est une peste : on n’y tient pas… Fossé ouvre donc la fenêtre.
Le père. » Vous le voyez, madame, c’est encore un des tours de votre fils.
Le fils. » Papa, je te jure que non.
Le père. » Tais-toi, fichu paresseux… la preuve n’est pas convaincante… ? monsieur ne peut pas aller au cinquième… ; il serait trop fatigué de monter un étage… ; il se foulerait la rate…, tu plains donc bien tes pas… ; sois tranquille, je te corrigerai.
Le fils. Mais papa…
Le père. » Ne me raisonne pas…, tu vois ce manche à balai…, il ne tient à rien que je te le casse sur le dos : avance ici que je te donne ta danse… avance, te dis-je ? je t’apprendrai… Ah ! tu me nies…
Le fils (pleurant). » Mais, oui, puisque ce n’est pas moi.
Le père. » Tu es capable de tout :… comme dit cet autre, tous menteurs, tous voleurs.
La mère. » Pourquoi ne pas dire la vérité ?
Le père. » Oh non ! il aimera mieux que je lui fiche une paye…, d’aussi bien, il va l’avoir… Ah ! tu veux que je te donne la tournée ? ma femme, ferme la fenêtre, à cause des voisins.
La mère. » Gare à toi ! François, ça se gâte…, gare à toi ! »
Nul doute, l’action va s’engager ; sans hésiter, je soulève matelas, draps, couverture, et écartant brusquement le lambeau de damas, je me montre à la famille stupéfaite de mon apparition. On imaginerait difficilement à quel point ces braves gens furent surpris. Pendant qu’ils s’entre-regardent sans mot dire, j’entreprends de leur raconter le plus brièvement possible comme quoi je m’étais introduit chez eux ; comme quoi je m’étais caché sous les matelas, comme quoi… Il est inutile de dire que l’on rit beaucoup de l’aventure de la marmite, et qu’il ne fut plus question de battre personne. Le mari et la femme s’étonnaient que je n’eusse pas été étouffé dans ma cachette ; ils me plaignirent, et, avec une cordialité dont les exemples ne sont pas rares parmi les gens du peuple, ils m’offrirent des rafraîchissements, qui étaient bien nécessaires après une matinée si laborieuse.
On doit penser que je fus sur les épines, aussi long-temps que cette scène n’eut pas touché au dénouement… Je suais à grosses gouttes ; dans tout autre moment, je m’en fusse amusé ; mais je songeais aux suites de la découverte inévitable qui se préparait, et personne moins que moi n’était en état d’apprécier tout ce qu’il y avait de burlesque dans la situation… Me croyant perdu, j’aurais pu hâter l’instant fatal ; c’eût été couper court à mes perplexités : une réflexion sur la mobilité des circonstances m’inspira de voir venir : je savais par plus d’une expérience qu’elles déconcertent quelquefois les plans les mieux conçus, comme aussi elles triomphent des cas les plus désespérés.
D’après l’accueil que me faisait la famille Fossé, il était probable que je n’aurais pas à me repentir d’avoir attendu l’événement : toutefois je n’étais pas pleinement rassuré ; cette famille n’était pas heureuse ; et ne pouvait-il pas se faire que cette première impression de bienveillance et de compassion, dont ne se défendent pas toujours les hommes les plus pervers, fit place à l’espoir d’obtenir quelque récompense en me livrant à la police ? et puis, en supposant même que mes hôtes fussent ce qu’on appelle francs du collier, étais-je à l’abri d’une indiscrétion ? Sans être doué d’une grande perspicacité, Fossé devina le secret de mes inquiétudes, qu’il réussit à dissiper par des protestations dont la sincérité ne devait pas se démentir.
Ce fut lui qui se chargea de veiller à ma sûreté ; il commença par pousser des reconnaissances à la suite desquelles il m’informa que les agents de police, persuadés que je n’avais pas quitté le quartier, s’étaient établis en permanence dans la maison et dans les rues adjacentes ; il m’apprit aussi qu’il était question de faire une seconde visite chez tous les locataires. De tous ces rapports, je conclus qu’il était urgent de déguerpir, car il était vraisemblable que cette fois l’on fouillerait à fond les logements.
La famille Fossé, comme la plupart des ouvriers de Paris, était dans l’usage d’aller souper chez un marchand de vin du voisinage, où elle portait ses provisions ; il fut convenu que j’attendrais ce moment pour sortir avec elle. Jusqu’à la nuit, j’avais le temps de prendre mes mesures : je m’occupai d’abord à faire parvenir de mes nouvelles à Annette : ce fut Fossé qui organisa le message. Il eût été de la dernière imprudence qu’il se mît en communication directe avec elle. Voici ce qu’il fit : il se rendit dans la rue de Grammont, où il acheta un pâté, dans lequel il glissa le billet qu’on va lire :
« Je suis en sûreté. Tiens-toi sur tes gardes : ne te fie à personne. Ne te laisse pas prendre à des promesses qu’on n’a ni l’intention ni le pouvoir de tenir. Renferme-toi dans ces quatre mots, je ne sais pas. Fais la bête, c’est le meilleur moyen de me prouver que tu as de l’esprit. Je ne peux pas te donner de rendez-vous, mais quand tu sortiras, prends toujours la rue Saint-Martin et les boulevards. Surtout ne te retourne pas, je réponds de tout. »
Le pâté confié à un commissionnaire de la place Vendôme, et adressé à madame Vidocq, tomba, ainsi que je l’avais prévu, dans les mains des agents qui en permirent la remise, après avoir pris connaissance de la dépêche ; ainsi je me trouvais avoir atteint deux buts à la fois, celui de les tromper, en leur persuadant que je n’étais plus dans le quartier, et celui de rassurer Annette, en lui faisant savoir que j’étais hors de danger. L’expédient m’avait réussi ; enhardi par ce premier succès, je fus un peu plus calme pour effectuer les préparatifs de ma retraite. Quelqu’argent que j’avais pris à tout hasard sur ma table de nuit, servit à me procurer un pantalon, des bas, des souliers, une blouse ainsi qu’un bonnet de coton bleu destiné à compléter mon déguisement. Quand l’heure du souper fut venue, je sortis de la chambre avec toute la famille, portant sur ma tête, par surcroît de précautions, une énorme platée de haricots et de mouton, dont l’appétissant fumet expliquait assez quel était le but de notre excursion. Le cœur ne m’en battit pas moins en me trouvant face à face, sur le carré du second, avec un agent que je n’avais pas d’abord aperçu, caché dans une encoignure. « Soufflez votre chandelle, cria-t-il brusquement à Fossé. – Et pourquoi ? répliqua celui-ci, qui n’avait pris de la lumière que pour ne pas éveiller les soupçons. – Allons ! pas tant de raisons, reprit le mouchard, » et il souffla lui-même la chandelle. Je l’aurais volontiers embrassé ! Dans l’allée, nous tombâmes encore sur plusieurs de ses confrères qui, plus polis que lui, se rangèrent pour nous livrer passage. Enfin nous étions dehors. Lorsque nous eûmes détourné l’angle de la place, Fossé prit le plat, et nous nous séparâmes. Afin de ne pas attirer l’attention, je marchai fort lentement jusqu’à la rue des Fontaines : une fois là, je ne m’amusai pas, comme disent les Allemands, à compter les boutons de mon habit, je pris ma course dans la direction du boulevard du Temple, et fendant l’air, j’étais arrivé à la rue de Bondy, qu’il ne m’était pas encore venu à l’idée de me demander où j’allais.
Cependant il ne suffisait pas d’avoir échappé à une première perquisition, les recherches pouvaient devenir des plus actives. Il m’importait de dérouter la police, dont les nombreux limiers ne manqueraient pas, suivant l’usage, de tout négliger pour ne s’occuper que de moi. Dans cette conjoncture très critique, je résolus d’utiliser pour mon salut les individus que je regardais comme mes dénonciateurs. C’étaient les Chevalier, que j’avais vus la veille, et qui dans la conversation que j’avais eue avec eux, avaient laissé échapper quelques-uns de ces mots qu’on ne s’explique qu’après coup : convaincu que je n’avais plus aucun ménagement à garder vis-à-vis de ces misérables, je résolus de me venger d’eux, en même temps que je les forcerais à rendre gorge autant qu’il dépendrait de moi. C’était à une condition tacite que je les avais obligés, ils avaient violé la foi des traités, contrairement à leur intérêt même, ils avaient fait le mal, je me proposais de les punir d’avoir méconnu leur intérêt.
Le chemin n’est pas trop long du boulevard à la rue de l’Échiquier ; je tombai comme une bombe au domicile des Chevalier, dont la surprise en me voyant libre, confirma tous mes soupçons. Chevalier imagina d’abord un prétexte pour sortir ; mais, fermant la porte à double tour, et mettant la clef dans ma poche, je sautai sur un couteau de table, et dis à mon beau-frère que s’il poussait un cri, c’était fait de lui et des siens. Cette menace ne pouvait manquer de produire son effet ; j’étais au milieu d’un monde qui me connaissait, et que devait épouvanter la violence de mon désespoir. Les femmes restèrent plus mortes que vives, et Chevalier, pétrifié, immobile comme la fontaine de grès sur laquelle il s’appuyait, me demanda, d’une voix éteinte, ce que j’exigeais de lui : « Tu vas le savoir, » lui répondis-je.
Je débutai par la réclamation d’un habit complet que je lui avais fourni le mois d’auparavant, il me le rendit ; je me fis donner en outre une chemise, des bottes et un chapeau ; tous ces objets avaient été achetés de mes deniers, c’était une restitution qui m’était faite. Chevalier s’exécuta en rechignant ; je crus lire dans ses yeux qu’il méditait quelque projet, peut-être avait-il à sa disposition un moyen de faire savoir aux voisins l’embarras dans lequel le jetait ma présence : la prudence me prescrivit d’assurer ma retraite en cas d’une perquisition nocturne. Une fenêtre donnant sur un jardin était fermée par deux barreaux de fer, j’ordonnai à Chevalier d’en enlever un, et comme, en dépit de mes instructions, il s’y prenait avec une excessive maladresse, je me mis moi-même à l’ouvrage, sans qu’il s’aperçût que le couteau qui lui avait tant inspiré d’effroi était passé de mes mains dans les siennes. L’opération terminée, je ressaisis cette arme. « Maintenant, lui dis-je, ainsi qu’aux femmes, qui étaient terrifiées, vous pouvez aller vous coucher. » Quant à moi, je n’étais guère en train de dormir ; je me jetai sur une chaise, où je passai une nuit fort agitée. Toutes les vicissitudes de ma vie me revinrent successivement à l’esprit ; je ne doutais pas qu’il n’y eût une malédiction sur moi ;… en vain fuyais-je le crime, le crime venait me chercher, et cette fatalité contre laquelle je me roidissais avec toute l’énergie de mon caractère, semblait prendre plaisir à bouleverser mes plans de conduite en me mettant incessamment aux prises avec l’infamie et la plus impérieuse nécessité.
Au point du jour je fis lever Chevalier, et lui demandai s’il était en fonds. Sur sa réponse, qu’il ne possédait que quelques pièces de monnaie, je lui fis l’injonction de se munir de quatre couverts d’argent qu’il devait à ma libéralité, de prendre son permis de séjour et de me suivre. Je n’avais pas précisément besoin de lui, mais il eût été dangereux de le laisser au logis, car il aurait pu donner l’éveil à la police et la diriger sur mes traces avant que j’eusse pu prendre mes dimensions. Chevalier obéit. Je redoutais moins les femmes : comme j’emmenais avec moi un otage précieux, et que d’ailleurs elles ne partageaient pas tout à fait les sentiments de ce dernier, je me contentai, en partant, de les enfermer à double tour, et par les rues les plus désertes de la capitale, même en plein midi, nous gagnâmes les Champs-Élysées. Il était quatre heures du matin ; nous ne rencontrâmes personne. C’était moi qui portais les couverts ; je me serais bien gardé de les laisser à mon compagnon, il fallait que je pusse disparaître sans inconvénient, s’il lui était arrivé de s’insurger ou de faire un esclandre. Heureusement, il fut fort docile ; au surplus, j’avais sur moi le terrible couteau, et chevalier, qui ne raisonnait pas, était persuadé qu’au moindre mouvement qu’il ferait, je le lui plongerais dans le cœur : cette terreur salutaire, qu’il éprouvait d’autant plus vivement qu’il n’était pas irréprochable, me répondait de lui.
Nous nous promenâmes long-temps aux alentours de Chaillot ; Chevalier, qui ne prévoyait pas comment tout cela finirait, marchait machinalement à mes côtés ; il était anéanti et comme frappé d’idiotisme. À huit heures, je le fis monter dans un fiacre et le conduisis au passage du bois de Boulogne, où il engagea en ma présence, et sous son nom, les quatre couverts, sur lesquels on lui prêta cent francs. Je m’emparai de cette somme ; et, satisfait d’avoir si à propos recouvré en masse ce qu’il m’avait extorqué en détail, je remontai avec lui dans la voiture, que je fis arrêter sur la place de la Concorde. Là, je descendis, mais après lui avoir fait cette recommandation : « Souviens-toi d’être plus circonspect que jamais ; si je suis arrêté, quel que soit l’auteur de mon arrestation, prends garde à toi. » J’intimai au cocher de le mener grand train, rue de l’Échiquier, n° 23 ; et pour être certain qu’il ne prenait pas une autre direction, je restai un instant à l’examiner ; ensuite de quoi je me rendis en cabriolet, chez un fripier de la Croix-Rouge, qui me donna des habits d’ouvrier en échange des miens. Sous ce nouveau costume, je m’acheminai vers l’esplanade des Invalides, pour m’informer s’il y aurait possibilité d’acheter un uniforme de cet établissement. Une jambe de bois, que je questionnai sans affectation, m’indiqua, rue Saint-Dominique, un brocanteur chez qui je trouverais l’équipement complet. Ce brocanteur était, à ce qu’il paraît, assez bavard de son naturel. « Je ne suis pas curieux, me dit-il (c’est le préambule ordinaire de toutes les demandes indiscrètes) : vous avez tous vos membres, sans doute l’uniforme n’est pas pour vous. – Pardon, lui répondis-je ; et comme il manifestait de l’étonnement, j’ajoutai que je devais jouer la comédie. – Et dans quelle pièce ? – Dans l’Amour filial. »
Le marché conclu, j’allai aussitôt à Passy, où, chez un logeur qui était dans mes intérêts, je me hâtai d’effectuer la métamorphose. Il ne fallut pas cinq minutes pour faire de moi le plus manchot des invalides ; mon bras rapproché vers le défaut de ma poitrine et tenu adhérent au torse par une sangle et par la ceinture de ma culotte, dans laquelle il était engagé, avait entièrement disparu : quelques chiffons introduits dans la partie supérieure d’une des manches, dont l’extrémité venait se rattacher sur le devant du frac, jouaient le moignon à s’y méprendre, et portaient l’illusion au plus haut degré : une pommade dont je me servis pour teindre en noir mes cheveux et mes favoris, acheva de me rendre méconnaissable. Sous ce travestissement, j’étais tellement sûr de déconcerter le savoir physiognomonique des observateurs de la rue de Jérusalem et autres, que dès le soir même, j’osai me montrer dans le quartier Saint-Martin. J’appris que la police, non-seulement occupait toujours mon logement, mais encore qu’on y faisait l’inventaire des marchandises et du mobilier. Au nombre des agents que je vis allant et venant, il fut aisé de me convaincre que les recherches se poursuivaient avec un redoublement d’activité bien extraordinaire pour cette époque où la vigilante administration n’était pas trop zélée toutes les fois qu’il ne s’agissait pas d’arrestations politiques. Effrayé d’un semblable appareil d’investigations, tout autre que moi aurait jugé prudent de s’éloigner de Paris sans délai, au moins pour quelque temps. Il eût été convenable de laisser passer l’orage ; mais je ne pouvais me décider à abandonner Annette au milieu des tribulations que lui causait son attachement pour moi. Dans cette occasion, elle eut beaucoup à souffrir ; enfermée au dépôt de la préfecture, elle y resta vingt-cinq jours au secret, d’où on ne la tirait que pour lui faire la menace de la faire pourrir à Saint-Lazare, si elle s’obstinait à ne pas vouloir indiquer le lieu de ma retraite. Le poignard sur le sein, Annette n’aurait pas parlé. Qu’on juge si j’étais chagrin de la savoir dans une si déplorable situation ; je ne pouvais pas la délivrer : dès qu’il dépendit de moi, je m’empressai de la secourir. Un ami à qui j’avais prêté quelques centaines de francs, me les ayant rendus, je lui fis tenir une partie de cette somme ; et, plein de l’espoir que sa détention finirait bientôt, puisque après tout on n’avait à lui reprocher que d’avoir vécu avec un forçat évadé, je me disposai à quitter Paris, me réservant, si elle n’était pas élargie avant mon départ, de lui faire connaître plus tard sur quel point je me serais dirigé.
Je logeais rue Tiquetonne, chez un mégissier, nommé Bouhin, qui s’engagea, moyennant rétribution, à prendre pour lui, un passe-port qu’il me céderait. Son signalement et le mien étaient exactement conformes : comme moi, il était blond, avait les yeux bleus, le teint coloré, et, par un singulier hasard, sa lèvre supérieure droite était marquée d’une légère cicatrice ; seulement sa taille était plus petite que la mienne ; mais pour se grandir et atteindre ma hauteur, avant de se présenter sous la toise du commissaire, il devait mettre deux ou trois jeux de cartes dans ses souliers. Bouhin recourut en effet à cet expédient, et bien qu’au besoin je pusse user de l’étrange faculté de me rapetisser à volonté de quatre à cinq pouces, le passe-port qu’il me vendit me dispensait de cette réduction. Pourvu de cette pièce, je m’applaudissais d’une ressemblance qui garantissait ma liberté, lorsque Bouhin (j’étais installé dans son domicile depuis huit jours) me confia un secret qui me fit trembler : cet homme fabriquait habituellement de la fausse monnaie, et pour me donner un échantillon de son savoir-faire, il coula devant moi huit pièces de cinq francs, que sa femme passa dans la même journée. On ne devine que trop tout ce qu’il y avait d’alarmant pour moi dans la confidence de Bouhin.
D’abord j’en tirai la conséquence que vraisemblablement, d’un instant à l’autre, son passe-port serait une très mauvaise recommandation aux yeux de la gendarmerie ; car, d’après le métier qu’il faisait, Bouhin devait tôt ou tard se trouver sous le coup d’un mandat d’amener ; partant, l’argent que je lui avais donné était furieusement aventuré, et il s’en fallait qu’il y eût de l’avantage à être pris pour lui. Ce n’était pas tout : vu cet état de suspicion qui, dans les préventions du juge et du public, est toujours inséparable de la condition de forçat évadé, n’était-il pas présumable que Bouhin, traduit comme faux monnayeur, je serais considéré comme son complice ? La justice a commis tant d’erreurs ! condamné une première fois quoique innocent, qui me garantissait que je ne le serais pas une seconde ? Le crime, qui m’avait été à tort imputé, par cela seul qu’il me constituait faussaire, rentrait nominalement dans l’espèce de celui dont Bouhin se rendait coupable. Je me voyais succombant sous une masse de présomptions et d’apparences telles, peut-être, que mon avocat, honteux de prendre ma défense, se croirait réduit à implorer pour moi la pitié de mes juges. J’entendais prononcer mon arrêt de mort. Mes appréhensions redoublèrent, quand je sus que Bouhin avait un associé : c’était un médecin nommé Terrier, qui venait fréquemment à la maison. Cet homme avait un visage patibulaire ; il me semblait qu’à la seule inspection de sa figure, toutes les polices du monde dussent se mettre à ses trousses ; sans le connaître, je me serais fait l’idée qu’en le suivant il était presque impossible de ne pas remonter à la source de quelque attentat. En un mot il était une fâcheuse enseigne pour tout endroit dans lequel on le voyait entrer. Persuadé que ses visites porteraient malheur au logis, j’engageai Bouhin à renoncer à une industrie aussi chanceuse que celle qu’il exerçait ; les meilleures raisons ne purent rien sur son esprit ; tout ce que j’obtins à force de supplications, fut que, pour éviter de donner lieu à une perquisition qui certainement me livrerait à la police, il suspendrait et la fabrication, et l’émission des pièces aussi long-temps que je resterais chez lui, ce qui n’empêcha pas que deux jours après je le surprisse à travailler encore au grand œuvre. Cette fois je jugeai à propos de m’adresser à son collaborateur ; je lui représentai sous les couleurs les plus vives les dangers auxquels ils s’exposaient. « Je vois, me répondit le médecin, que vous êtes encore un peureux comme il y en a tant. Quand on nous découvrirait, qu’est-ce qu’il en serait ? il y en a bien d’autres qui ont fait le trébuchet sur la place de Grève ; et puis nous n’en sommes pas là : voilà quinze ans que j’ai pris messieurs de la chambre pour mes changeurs, et personne ne s’est jamais douté de rien : ça ira tant que ça ira : au surplus, mon camarade, ajouta-t-il avec humeur, si j’ai un conseil à vous donner, c’est de vous mêler de vos affaires. »
À la tournure que prenait la discussion, je vis qu’il était superflu de la continuer, et que je ferais sagement de me tenir sur mes gardes : je sentis plus que jamais la nécessité de quitter Paris le plus tôt possible. On était au mardi ; j’aurais voulu partir dès le lendemain ; mais averti qu’Annette serait mise en liberté à la fin de la semaine, je me proposais de différer mon départ jusqu’à sa sortie, lorsque le vendredi, sur les trois heures du matin, j’entendis frapper légèrement à la porte de la rue : la nature du coup, l’heure, la circonstance, tout me fait pressentir que l’on vient m’arrêter : sans rien dire à Bouhin, je sors sur le carré ; je monte : parvenu au haut de l’escalier, je saisis la gouttière, je grimpe sur le toit, et vais me blottir derrière un tuyau de cheminée.
Mes pressentiments ne m’avaient pas trompé : en un instant la maison fut remplie d’agents de police, qui furetèrent partout. Surpris de ne pas me trouver, et avertis sans doute par mes vêtements laissés auprès de mon lit, que je m’étais enfui en chemise, ce qui ne me permettait pas d’aller bien loin, ils induisirent que je ne pouvais pas avoir pris la voie ordinaire. À défaut de cavaliers que l’on pût envoyer à ma poursuite, on manda des couvreurs, qui explorèrent toute la toiture, où je fus trouvé et saisi, sans que la nature du terrain me permît de tenter une résistance qui n’aurait abouti qu’à un saut des plus périlleux. À quelques gourmades près, que je reçus des agents, mon arrestation n’offrit rien de remarquable : conduit à la préfecture, je fus interrogé par M. Henry, qui, se rappelant parfaitement la démarche que j’avais faite quelques mois auparavant, me promit de faire tout ce qui dépendrait de lui pour adoucir ma position ; on ne m’en transféra pas moins à la Force, et de là à Bicêtre, où je devais attendre le prochain départ de la chaîne.
CHAPITRE XXIII
On me propose de m’évader. – Nouvelle démarche auprès de M. Henry. – Mon pacte avec la police. – Découvertes importantes. – Coco-Lacour. – Une bande de voleurs. – Les inspecteurs sous clef. – La marchande d’asticots et les assassins. – Une fausse évasion.
Je commençais à me dégoûter des évasions et de l’espèce de liberté qu’elles procurent : je ne me souciais pas de retourner au bagne ; mais, à tout prendre, je préférais encore le séjour de Toulon à celui de Paris, s’il m’eût fallu continuer de recevoir la loi d’êtres semblables aux Chevalier, aux Blondy, aux Duluc, aux Saint-Germain. J’étais dans ces dispositions, au milieu de bon nombre de ces piliers de galères, que je n’avais que trop bien eu l’occasion de connaître, lorsque plusieurs d’entre eux me proposèrent de les aider à tenter une fugue par la cour des Bons Pauvres. Autrefois le projet m’eût souri ; je ne le rejetai pas, mais j’en fis la critique en homme qui a étudié les localités, et de manière à me conserver cette prépondérance que me valaient mes succès réels, et ceux que l’on m’attribuait, je pourrais dire aussi ceux que je m’attribuais moi-même ; car dès qu’on vit avec des coquins, il y a toujours avantage à passer pour le plus scélérat et le plus adroit : telle était aussi ma réputation très bien établie. Partout où l’on comptait quatre condamnés, il y en avait au moins trois qui avaient entendu parler de moi ; pas de fait extraordinaire depuis qu’il existait des galériens, qu’on ne rattachât à mon nom. J’étais le général à qui l’on fait honneur de toutes les actions des soldats : on ne citait pas les places que j’avais emportées d’assaut, mais il n’y avait pas de geôlier dont je ne pusse tromper la vigilance, pas de fers que je ne vinsse à bout de rompre, pas de muraille que je ne réussisse à percer. Je n’étais pas moins renommé par mon courage et mon habileté, et l’on avait l’opinion que j’étais capable de me dévouer en cas de besoin. À Brest, à Toulon, à Rochefort, à Anvers, partout enfin, j’étais considéré parmi les voleurs comme le plus rusé et le plus intrépide. Les plus malins briguaient mon amitié, parce qu’ils pensaient qu’il y avait encore quelque chose à apprendre avec moi, et les plus novices recueillaient mes paroles comme des instructions dont ils pourraient faire leur profit. À Bicêtre, j’avais véritablement une cour, on se pressait autour de ma personne, on m’entourait, c’était des prévenances, des égards, dont on se ferait difficilement une idée… Mais maintenant toute cette gloire des prisons m’était odieuse ; plus je lisais dans l’âme des malfaiteurs, plus ils se mettaient à découvert devant moi, plus je me sentais porté à plaindre la société de nourrir dans son sein une engeance pareille. Je n’éprouvais plus ce sentiment de la communauté du malheur qui m’avait autrefois inspiré ; de cruelles expériences et la maturité de l’âge m’avaient révélé le besoin de me distinguer de ce peuple de brigands, dont je méprisais les secours et l’abominable langage. Décidé, quoi qu’il en pût advenir, à prendre parti contre eux dans l’intérêt des honnêtes gens, j’écrivis à M. Henry pour lui offrir de nouveau mes services, sans autre condition que de ne pas être reconduit au bagne, me résignant à finir mon temps dans quelque prison que ce fût.
Ma lettre indiquait avec tant de précision l’espèce de renseignements que je pourrais donner, que M. Henry en fut frappé ; une seule considération l’arrêtait, c’était l’exemple de plusieurs individus prévenus ou condamnés, qui, après avoir pris l’engagement de guider la police dans ses recherches, ne lui avaient donné que des avis insignifiants, ou bien encore avaient fini eux-mêmes par se faire prendre en flagrant délit. À cette considération si puissante, j’opposai la cause de ma condamnation[6], la régularité de ma conduite toutes les fois que j’avais été libre, la constance de mes efforts pour me procurer une existence honnête ; enfin j’exhibai ma correspondance, mes livres, ma comptabilité, et j’invoquai le témoignage de toutes les personnes avec lesquelles je m’étais trouvé en relation d’affaires, et spécialement celui de mes créanciers, qui tous avaient la plus grande confiance en moi.
Les faits que j’alléguais militaient puissamment en ma faveur : M. Henry soumit ma demande au préfet de police M. Pasquier qui décida qu’elle serait accueillie. Après un séjour de deux mois à Bicêtre, je fus transféré à la Force ; et, pour éviter de m’y rendre suspect, on affecta de répandre parmi les prisonniers que j’étais retenu comme impliqué dans une fort mauvaise affaire dont l’instruction allait commencer. Cette précaution, jointe à ma renommée, me mit tout-à-fait en bonne odeur. Pas de détenu qui osât révoquer en doute la gravité du cas qui m’était imputé. Puisque j’avais montré tant d’audace et de persévérance pour me soustraire à une condamnation de huit ans de fers, il fallait bien que j’eusse la conscience chargée de quelque grand crime, capable si jamais j’en étais reconnu l’auteur, de me faire monter sur l’échafaud. On disait donc tout bas et même tout haut, à la Force, en parlant de moi : « C’est un escarpe (un assassin) » ; et comme dans le lieu où j’étais, un assassin inspire d’ordinaire une grande confiance, je me gardais bien de réfuter une erreur si utile à mes projets. J’étais alors loin de prévoir qu’une imposture que je laissais volontairement s’accréditer, se perpétuerait au-delà de la circonstance, et qu’un jour, en publiant mes Mémoires, il ne serait pas superflu de dire que je n’ai jamais commis d’assassinat. Depuis qu’il est question de moi dans le public, on lui a tant débité de contes absurdes sur ce qui m’était personnel ! quels mensonges n’ont pas inventés pour me diffamer des agents intéressés à me représenter comme un vil scélérat ! Tantôt j’avais été marqué et condamné aux travaux forcés à perpétuité ; tantôt l’on ne m’avait sauvé de la guillotine qu’à condition de livrer à la police un certain nombre d’individus par mois, et aussitôt qu’il en manquait un seul, le marché devenait résiliable ; c’est pourquoi, affirmait-on, à défaut de véritables délinquants, j’en amenais de ma façon. N’est-on pas allé jusqu’à m’accuser d’avoir, au café Lamblin, introduit un couvert d’argent dans la poche d’un étudiant ? J’aurai plus tard l’occasion de revenir sur quelques-unes de ces calomnies dans plusieurs chapitres des volumes suivants, où je mettrai au grand jour les moyens de la police, son action, ses mystères ; enfin tout ce qui m’a été dévoilé,… tout ce que j’ai su.
L’engagement que j’avais pris n’était pas aussi facile à remplir que l’on pourrait le croire. À la vérité, j’avais connu une foule de malfaiteurs, mais, incessamment décimée par les excès de tous genres, par la justice, par l’affreux régime des bagnes et des prisons, par la misère, cette hideuse génération avait passé avec une inconcevable rapidité ; une génération nouvelle occupait la scène, et j’ignorais jusqu’aux noms des individus qui la composaient : je n’étais pas même au fait des notabilités. Une multitude de voleurs exploitaient alors la capitale, et il m’aurait été impossible de fournir la plus mince indication sur les principaux d’entre eux ; il n’y avait que ma vieille renommée qui pût me mettre à même d’avoir des intelligences dans l’état-major de ces Bédouins de notre civilisation ; elle me servit, je ne dirai pas au-delà, mais autant que je pouvais le désirer. Il n’arrivait pas un voleur à la Force qu’il ne s’empressât de rechercher ma compagnie ; ne m’eût-il jamais vu, pour se donner du relief aux yeux des camarades, il tenait à amour-propre de paraître avoir été lié avec moi. Je caressais cette singulière vanité ; par ce moyen, je me glissai insensiblement sur la voie des découvertes ; les renseignements me vinrent en abondance, et je n’éprouvai plus d’obstacles à m’acquitter de ma mission.
Pour donner la mesure de l’influence que j’exerçais sur l’esprit des prisonniers, il me suffira de dire que je leur inoculais à volonté mes opinions, mes affections, mes ressentiments ; ils ne pensaient et ne juraient que par moi : leur arrivait-il de prendre en grippe un de nos co-détenus, parce qu’ils croyaient voir en lui ce qu’on appelle un mouton, je n’avais qu’à répondre de lui, il était réhabilité sur-le-champ. J’étais à la fois un protecteur puissant et un garant de la franchise quand elle était suspectée. Le premier dont je me rendis ainsi caution était un jeune homme que l’on accusait d’avoir servi la police, en qualité d’agent secret. On prétendait qu’il avait été à la solde de l’inspecteur général Veyrat, et l’on ajoutait qu’allant au rapport chez ce chef, il avait enlevé le panier à l’argenterie… Voler chez l’inspecteur, ce n’était pas là le mal, mais aller au rapport !… Tel était pourtant le crime énorme imputé à Coco Lacour, aujourd’hui mon successeur. Menacé par toute la prison, chassé, rebuté, maltraité, n’osant plus même mettre le pied dans les cours, où il aurait été infailliblement assommé, Coco vint solliciter ma protection, et pour mieux me disposer en sa faveur, il commença par me faire des confidences dont je sus tirer parti. D’abord j’employai mon crédit à lui faire faire sa paix avec les détenus, qui abandonnèrent leurs projets de vengeance ; on ne pouvait lui rendre un plus signalé service. Coco, autant par reconnaissance que par désir de parler, n’eût bientôt plus rien de caché pour moi. Un jour, il venait de paraître devant le juge d’instruction : « Ma foi, dit-il à son retour, je joue de bonheur,… aucun des plaignants ne m’a reconnu : cependant, je ne me regarde pas comme sauvé ; il y a par le monde un diable de portier à qui j’ai volé une montre d’argent : comme j’ai été obligé de causer long-temps avec lui, mes traits ont dû se graver dans sa mémoire ; et s’il était appelé, il pourrait bien se faire qu’il y eût du déchet à la confrontation ; d’ailleurs, ajouta-t-il, par état, les portiers sont physionomistes. » L’observation était juste ; mais je fis observer à Coco qu’il n’était pas présumable que l’on découvrît cet homme, et que vraisemblablement il ne se présenterait jamais de lui-même, puisque jusqu’alors il avait négligé de le faire ; afin de le confirmer dans cette opinion, je lui parlai de l’insouciance ou de la paresse de certaines gens, qui n’aiment pas à se déplacer. Ce que je dis du déplacement amena Coco à nommer le quartier dans lequel habitait le propriétaire de la montre : s’il m’avait indiqué la rue et le numéro, je n’aurais eu plus rien à désirer. Je me gardai bien de demander un renseignement si complet, c’eût été me trahir ; et puis la donnée pour l’investigation me semblait suffisante : je l’adressai à M. Henry, qui mit en campagne ses explorateurs. Le résultat des recherches fut tel que je l’avais prévu ; on déterra le portier, et Coco, confronté avec lui, fut accablé par l’évidence. Le tribunal le condamna à deux ans de prison.
À cette époque, il existait à Paris une bande de forçats évadés, qui commettaient journellement des vols, sans qu’il y eût espoir de mettre un terme à leurs brigandages. Plusieurs d’entre eux avaient été arrêtés et absous faute de preuves : opiniâtrement retranchés dans la dénégation, ils bravaient depuis long-temps la justice, qui ne pouvait leur opposer ni le flagrant délit ni des pièces de conviction ; pour les surprendre nantis il aurait fallu connaître leur domicile, et ils étaient si habiles à le cacher, qu’on n’était jamais parvenu à le découvrir. Au nombre de ces individus était un nommé France, dit Tormel, qui en arrivant à la Force, n’eut rien de plus pressé que de me faire demander dix francs pour passer à la pistole : j’étais tout aussi pressé de les lui envoyer. Dès lors il vint me rejoindre, et comme il était touché du procédé, il n’hésita pas à me donner toute sa confiance. Au moment de son arrestation, il avait soustrait deux billets de mille francs aux recherches des agents de police, il me les remit, en me priant de lui avancer de l’argent au fur et à mesure de ses besoins. « Tu ne me connais pas, me dit-il, mais les billets répondent ; je te les confie, parce que je sais qu’ils sont mieux dans tes mains que dans les miennes : plus tard nous les changerons, aujourd’hui ça serait louche, il vaut mieux attendre. » Je fus de l’avis de France, et, suivant qu’il le désirait, je lui promis d’être son banquier : je ne risquais rien.
Arrêté pour vol avec effraction, chez un marchand de parapluies du passage Feydeau, France avait été interrogé plusieurs fois, et constamment il avait déclaré n’avoir point de domicile. Pourtant la police était instruite qu’il en avait un ; et elle était d’autant plus intéressée à le connaître, qu’elle avait presque la certitude d’y trouver des instruments à voleurs, ainsi qu’un dépôt d’objets volés. C’eût été là une découverte de la plus haute importance, puisqu’alors on aurait eu des preuves matérielles. M. Henry me fit dire qu’il comptait sur moi pour arriver à ce résultat : je manœuvrai en conséquence, et je sus bientôt qu’au moment de son arrestation, France occupait, au coin de la rue Montmartre et de la rue Notre-Dame-des-Victoires, un appartement loué au nom d’une receleuse appelée Joséphine Bertrand.
Ces renseignements étaient positifs ; mais il était difficile d’en faire usage sans me compromettre vis-à-vis de France, qui, ne s’étant ouvert qu’à moi seul, ne pourrait soupçonner que moi de l’avoir trahi : je réussis cependant, et il se doutait si peu que j’eusse abusé de son secret, qu’il me racontait toutes ses inquiétudes, à mesure que se poursuivait l’exécution du plan que j’avais concerté avec M. Henry. Du reste, la police s’était arrangée de telle sorte, qu’elle semblait n’être guidée que par le hasard : voici comment elle s’y prit.
Elle mit dans ses intérêts un des locataires de la maison qu’avait habitée France ; ce locataire fit remarquer au propriétaire que depuis environ trois semaines on n’apercevait plus aucun mouvement dans l’appartement de Madame Bertrand : c’était donner l’éveil et ouvrir le champ aux conjectures. On se souvint d’un individu qui allait et venait habituellement dans cet appartement ; on s’étonna de ne plus le rencontrer ; on parla de son absence, le mot de disparition fut prononcé, d’où la nécessité de faire intervenir le commissaire, puis l’ouverture en présence de témoins ; puis la découverte d’un grand nombre d’objets volés dans le quartier, et, enfin, la saisie des instruments dont on s’était servi pour consommer les vols. Il s’agissait maintenant de savoir ce qu’était devenue Joséphine Bertrand : on alla chez les personnes qu’elle avait indiquées pour les informations lorsqu’elle était venue louer, mais on ne put rien apprendre sur le compte de cette femme ; seulement on sut qu’une fille Lambert, qui lui avait succédé dans le logement de la rue Montmartre, venait d’être arrêtée ; et comme cette fille était connue pour la maîtresse de France, on en avait conclu que les deux individus devaient avoir un gîte commun. France fut en conséquence conduit sur les lieux : reconnu par tous les voisins, il prétendit qu’il y avait méprise de leur part ; mais les jurés devant qui il fut amené en décidèrent autrement, et il fut condamné à huit ans de fers.
France une fois convaincu, on put aisément se porter sur les traces de ses affiliés : deux des principaux étaient les nommés Fossard et Legagneur. On se fût emparé d’eux, mais la lâcheté et la maladresse des agents les firent échapper aux recherches que je dirigeais. Le premier était un homme d’autant plus dangereux, qu’il excellait dans la fabrication des fausses clefs. Depuis quinze mois, il semblait défier la police, lorsqu’un jour j’appris qu’il demeurait chez un perruquier Vieille rue du Temple, en face de l’égout. L’arrêter hors de chez lui était chose à peu près impossible, attendu qu’il était fort habile à se déguiser, et qu’il devinait un agent de plus de deux cents pas ; d’un autre côté, il valait bien mieux le saisir au milieu de l’attirail de sa profession et des produits de ses labeurs. Mais l’expédition présentait des obstacles ; Fossard, quand on frappait à la porte, ne répondait jamais, et il était probable qu’en cas de surprise, il s’était ménagé une issue et des facilités pour gagner les toits. Il me parut que le seul moyen de s’emparer de lui, c’était de profiter de son absence pour s’introduire et s’embusquer dans son logement. M. Henry fut de mon avis : on fit crocheter la porte en présence d’un commissaire, et trois agents se placèrent dans un cabinet contigu à l’alcôve. Près de soixante et douze heures se passèrent sans que personne arrivât : à la fin du troisième jour, les agents, dont les provisions étaient épuisées, allaient se retirer, lorsqu’ils entendirent mettre une clef dans la serrure : c’était Fossard qui rentrait. Aussitôt deux des agents, conformément aux ordres qu’il avaient reçus, s’élancent du cabinet et se précipitent sur lui ; mais Fossard s’armant d’un couteau qu’ils avaient oublié sur la table, leur fit une si grande peur, qu’ils lui ouvrirent eux-mêmes la porte que leur camarade avait fermée ; après les avoir mis à son tour sous clef, Fossard descendit tranquillement l’escalier, laissant aux trois agents tout le loisir nécessaire pour rédiger un rapport auquel il ne manquait rien, si ce n’est la circonstance du couteau, que l’on se garda bien de mentionner. On verra dans la suite de ces Mémoires comment, en 1814, je parvins à arrêter Fossard ; et les particularités de cette expédition ne sont pas les moins curieuses de ce récit.
Avant d’être transféré à la Conciergerie, France, qui n’avait pas cessé de croire à mon dévouement, m’avait recommandé l’un de ses amis intimes : c’était Legagneur, forçat évadé, arrêté rue de la Mortellerie, au moment où il exécutait un vol à l’aide de fausses clefs, cet homme privé de ressources par suite du départ de son camarade, songea à retirer de l’argent qu’il avait déposé chez un receleur de la rue Saint-Dominique, au Gros-Caillou. Annette, qui venait me voir très assidûment à la Force, et me secondait quelquefois avec beaucoup d’adresse dans mes recherches, fut chargée de la commission ; mais, soit méfiance, soit volonté de s’approprier le dépôt, le receleur accueillit fort mal la messagère, et comme elle insistait, il alla jusqu’à la menacer de la faire arrêter. Annette revint nous annoncer qu’elle avait échoué dans sa démarche. À cette nouvelle, Legagneur voulait dénoncer le receleur : cette résolution n’était que l’effet d’un premier mouvement de colère. Devenu plus calme, Legagneur jugea plus convenable d’ajourner sa vengeance, et surtout de se la rendre profitable. « Si je le dénonce, me dit-il, non seulement il ne m’en reviendra rien, mais il peut se faire qu’on ne le trouve pas en défaut, j’aime mieux attendre à ma sortie, je saurai bien le faire chanter (contribuer). »
Legagneur n’ayant plus d’espoir en son receleur, se détermina à écrire à deux de ses complices, Marguerit et Victor Desbois, qui étaient des voleurs en renom : convaincu de cette vérité bien ancienne, que les petits présents entretiennent l’amitié, en échange des secours qu’il demandait, il leur envoya quelques empreintes de serrures qu’il avait prises pour son usage particulier. Legagneur eut encore recours à l’intermédiaire d’Annette ; elle trouva les deux amis rue des Deux-Ponts, dans un misérable entresol, espèce de taudis où ils ne se rendaient jamais sans avoir pris auparavant toutes leurs précautions. Ce n’était pas là leur demeure. Annette, à qui j’avais recommandé de faire tout ce qui dépendrait d’elle pour la connaître, eut le bon esprit de ne pas les perdre de vue. Elle les suivit pendant deux jours sous des déguisements différents, et, le troisième, elle put m’affirmer qu’ils couchaient petite rue Saint-Jean, dans une maison ayant issue sur des jardins. M. Henry, à qui je ne laissai pas ignorer cette circonstance, prescrivit toutes les mesures qu’exigeait la nature de la localité, mais ses agents ne furent ni plus braves ni plus adroits que ceux à qui Fossard avait échappé. Les deux voleurs se sauvèrent par les jardins, et ce ne fut que plus tard que l’on parvint à les arrêter rue Saint-Hyacinthe-Saint-Michel.
Legagneur ayant été à son tour conduit à la Conciergerie, fut remplacé dans ma chambre par le fils d’un marchand de vin de Versailles, le nommé Robin, qui, lié avec tous les escrocs de la capitale, me donna par forme de conversation, les renseignements les plus complets, tant sur leurs antécédents que sur leur position actuelle et leurs projets. Ce fut lui qui me signala comme forçat évadé le prisonnier Mardargent, qui n’était retenu que comme déserteur. Celui-ci avait été condamné à vingt-quatre ans de fers. Il avait vécu dans le bagne ; à l’aide de mes notes et de mes souvenirs, nous fûmes promptement en pays de connaissance ; il crut, et il ne se trompait pas, que je serais joyeux de retrouver d’anciens compagnons d’infortune ; il m’en indiqua plusieurs parmi les détenus, et je fus assez heureux pour faire réintégrer aux galères bon nombre de ces individus, que la justice, à défaut de preuves suffisantes, aurait peut-être lancés de nouveau dans la circulation sociale. Jamais on n’avait fait de plus importantes découvertes que celles qui marquèrent mon début dans la police : à peine m’étais-je enrôlé dans cette administration, et déjà j’avais fait beaucoup pour la sûreté de la capitale et même pour celle de la France entière. Raconter tous mes succès en ce genre, ce serait abuser de la patience des lecteurs ; cependant je ne crois pas devoir passer sous silence une aventure qui précéda de peu de mois ma sortie de prison.
Une après-midi, il se manifesta quelque tumulte dans la cour ; il s’y livrait un furieux combat à coups de poings. À pareille heure, c’était un événement fort ordinaire, mais cette fois il y avait autant à s’en étonner que d’un duel entre Oreste et Pilade. Les deux champions, Blignon et Charpentier, dit Chante-à-l’heure, étaient connus pour vivre dans cette intimité révoltante qui n’a pas même d’excuse dans la plus rigoureuse claustration. Une rixe violente s’était engagée entre eux ; on prétendait que la jalousie les avait désunis : quoi qu’il en soit, lorsque l’action eut cessé, Chante-à-l’heure, couvert de contusions, entra à la cantine pour se faire bassiner ; je faisais alors ma partie de piquet. Chante-à-l’heure, irrité de sa défaite, ne se possédait plus ; bientôt l’eau-de-vie du pansement qu’il buvait sans s’en apercevoir, l’animant encore, il se trouva dans cette situation d’esprit où les épanchements deviennent un besoin.
– « Mon ami, me dit-il, car tu es mon ami, toi…, vois-tu comme il m’a arrangé, ce gueux de Blignon ?… mais il ne le portera pas en paradis !…
– » Laisse tout cela, lui répartis-je, il est plus fort que toi,… il faut prendre ton parti. Quand tu te ferais assommer une seconde fois ?
– » Oh ! ce n’est pas ça que je veux dire !… Si je voulais, il ne battrait plus personne, ni moi, ni d’autres. On sait ce que l’on sait !…
– » Eh ! que sais-tu ? m’écriai-je, frappé du ton dont il avait prononcé ces derniers mots.
– » Oui, oui, reprit Chante-à-l’heure, toujours plus exaspéré, il a bien fait de me pousser à bout ; je n’aurais qu’à jaspiner (jaser)… Il serait bientôt fauché (guillotiné).
– » Eh ! tais-toi donc, lui dis-je en affectant d’être incrédule ; vous êtes tous taillés sur le même patron ; quand vous en voulez à quelqu’un, on dirait qu’il n’y a qu’à souffler sur sa tête pour la faire tomber.
– » Tu crois ça, s’écria Chante-à-l’heure, en frappant du poing sur la table ; et si je te disais qu’il a escarpé une largue (assassiné une femme) !
– » Pas si haut, Chante-à-l’heure, pas si haut, lui dis-je, en me mettant mystérieusement un doigt sur la bouche. Tu sais bien qu’à la Lorcefée (la Force) les murs ont des oreilles. Il ne s’agit pas de servir de belle (dénoncer à faux) un camarade.
– » Qu’appelles-tu servir de belle, répliqua-t-il, plus irrité à mesure que je feignais de vouloir l’empêcher de parler, quand je te dis qu’il ne tient qu’à moi de lui donner un redoublement de fièvre (révéler un nouveau fait à charge).
– » Tout cela est bon, repris-je, mais pour faire mettre un homme sur la planche au pain (traduire devant la cour d’assises), il faut des preuves !
– » Des preuves, est-ce que le boulanger (le diable) en manque jamais ?… Écoute… tu connais bien la marchande d’asticots qui se tient au bas du pont Notre-Dame ?
– » Une ancienne ogresse (femme qui loue des effets aux filles), la maîtresse de Chatonnet, la femme du bossu. – Tout juste ! – Eh bien ! il y a trois mois que Blignon et moi nous étions à bouffarder tranquillement dans un estaminet de la rue Planche-Mibray, lorsqu’elle vint nous y trouver. « Il y a gras, nous dit-elle, et pas loin d’ici, rue de la Sonnerie ! Puisque vous êtes de bons enfants, je veux vous l’enseigner. C’est une vieille femme qui reçoit de l’argent pour beaucoup de monde ; il y a des jours qu’elle a quinze et vingt mille francs, or ou billets ; comme elle rentre souvent à la sorgue (à la nuit), il faudrait lui couper le cou et la f… à la rivière, après avoir poissé ses philippes (pris son argent). » D’abord qu’elle nous a fait la proposition, nous ne voulions pas en entendre parler, parce que nous ne faisons pas l’escarpe (l’assassinat), mais cette emblémeuse nous a tant tourmentés, en nous répétant qu’il y avait gras (beaucoup d’argent), et que d’ailleurs il n’y avait pas grand mal à étourdir (tuer) une vieille femme, que nous nous sommes laissés aller. On tomba d’accord que la marchande d’asticots nous avertirait du jour et du moment favorables. Ça me contrariait pourtant de m’enflaquer là-dedans, parce que, vois-tu, quand on n’est pas habitué à faire la chose, ça fait toujours un effet. Enfin, n’importe, tout était convenu, lorsque le lendemain, aux Quatre-Cheminées, près de Sèvres, nous avons rencontré Voivenel avec un autre grinche (voleur). Blignon leur a parlé de l’affaire, mais en témoignant qu’il avait de la répugnance pour le crime. Alors ils proposèrent de nous donner un coup de main, si toutefois nous y consentions. – Volontiers, répondit Blignon, quand il y en a pour deux, il y en a pour quatre. Voilà donc qu’est décidé, ils devaient être de mèche (de complicité) avec nous. Depuis ce jour le camarade de Voivenel était toujours sur notre dos ; il n’aspirait qu’au moment. Enfin la marchande d’asticots nous fait prévenir ; c’était le 30 décembre. Il faisait du brouillard. C’est pour aujourd’hui, me dit Blignon. Vous me croirez si vous le voulez, foi de grinche, j’avais envie de ne pas y aller, mais entraîné, je suivis la vieille avec les autres, et, le soir, au moment où, sa recette terminée, elle sortait de chez un M. Rousset, loueur de carrosses, dans le cul-de-sac de la Pompe, nous l’avons expédiée. C’est l’ami de Voivenel qui l’a chourinée (frappée à coups de couteau), pendant que Blignon, après l’avoir entortillée dans son mantelet, la tenait par-derrière. Il n’y a que moi qui ne m’en suis pas mêlé, mais j’ai tout vu puisqu’ils m’avaient planté à faire le gaf (le guet), et j’en sais assez pour faire gerber à la passe (guillotiner) ce gueux de Blignon. »
Chante-à-l’heure me raconta en détail et avec une rare insensibilité toutes les circonstances de ce meurtre. J’entendis jusqu’au bout ce récit abominable, faisant à chaque instant d’incroyables efforts pour cacher mon indignation : chaque parole qu’il prononçait était de nature à faire dresser les cheveux de l’homme le moins susceptible d’émotions. Quand ce scélérat eut achevé de me retracer avec une horrible fidélité les angoisses de la victime, je l’engageai de nouveau à ne pas perdre son ami Blignon ; mais, en même temps, je jetai habilement de l’huile sur le feu, que je semblais vouloir éteindre. Je me proposais d’amener Chante-à-l’heure à faire de sang-froid à l’autorité l’horrible révélation à laquelle l’avait poussé la colère. Je désirais en outre pouvoir fournir à la justice les moyens de conviction qui lui étaient nécessaires pour frapper les assassins. Il y avait beaucoup à éclaircir. Peut-être Chante-à-l’heure ne m’avait-il fait qu’une fable qui lui aurait été suggérée par le vin et l’esprit de vengeance. Quoi qu’il en soit, je fis à M. Henry un rapport, dans lequel je lui exposais mes doutes, et bientôt il me fit savoir que le crime que je lui dénonçais n’était que trop réel. M. Henry m’engageait en même temps à faire en sorte de lui procurer des renseignements précis sur toutes les circonstances qui avaient précédé et suivi l’assassinat, et dès le lendemain je dressai mes batteries pour les obtenir. Il était difficile de faire arrêter les complices sans que l’on pût soupçonner d’où partait le coup ; dans cette occasion comme dans beaucoup d’autres, le hasard se mit de moitié avec moi. Le jour venu, j’allai éveiller Chante-à-l’heure qui, encore malade de la veille, ne put se lever ; je m’assis sur son lit, et lui parlai de l’état complet d’ivresse dans lequel je l’avais vu, ainsi que des indiscrétions qu’il avait commises : le reproche parut l’étonner ; je lui répétai un ou deux mots de l’entretien que j’avais eu avec lui, sa surprise redoubla ; alors il me protesta qu’il était impossible qu’il eut tenu un pareil langage, et soit qu’effectivement il eut perdu la mémoire, soit qu’il se défiât de moi, il essaya de me persuader qu’il n’avait pas le moindre souvenir de ce qui s’était passé. Qu’il mentît ou non, je saisis cette assertion avec avidité, et j’en profitai pour dire à Chante-à-l’heure qu’il ne s’était pas borné à me raconter confidentiellement toutes les circonstances de l’assassinat, mais encore qu’il les avait exposées à haute voix dans le chauffoir, en présence de plusieurs détenus qui avaient tout aussi bien entendu que moi. – « Ah ! malheureux que je suis, s’écria-t-il, en montrant la plus grande affliction : qu’ai-je fait ? À présent comment me tirer de là ? – Rien de plus aisé, lui répondis-je, si l’on te questionne au sujet de la scène d’hier, tu diras : ma foi, quand je suis ivre, je suis capable de tout, surtout si j’en veux à quelqu’un, je ne sais pas ce que je n’inventerais pas. »
Chante-à-l’heure prit le conseil pour argent comptant. Le même jour, un nommé Pinson qui passait pour un mouton fut conduit de la Force à la préfecture de police : cette translation ne pouvait s’effectuer plus à propos ; je m’empressai de l’annoncer à Chante-à-l’heure, en ajoutant que tous les prisonniers pensaient que Pinson n’était extrait que parce qu’il allait faire quelques révélations. À cette nouvelle, il parut consterné. « Était-il dans le chauffoir ? me demanda-t-il aussitôt ; je lui dis que je n’y avais pas fait attention. » Alors il me communiqua plus franchement ses alarmes, et j’obtins de lui de nouveaux renseignements qui, transmis sur-le-champ à M. Henry, firent tomber sous la main de la police tous les complices de l’assassinat, parmi lesquels la marchande d’asticots et son mari. Les uns et les autres furent mis au secret ; Blignon et Chante-à-l’heure, dans le bâtiment neuf ; la marchande d’asticots, son mari, Voivenel et le quatrième assassin dans l’infirmerie, où ils restèrent très long-temps. La procédure s’instruisit, et je ne m’en occupai plus : elle n’eut aucun résultat, parce qu’elle avait été mal commencée dès le principe ; les accusés furent absous.
Mon séjour, tant à Bicêtre qu’à la Force, embrasse une durée de vingt et un mois, pendant laquelle il ne se passa pas de jours que je ne rendisse quelque important service ; je crois que j’aurais été un mouton perpétuel, tant on était loin de supposer la moindre connivence entre les agents de l’autorité et moi. Les concierges et les gardiens ne se doutaient même pas de la mission qui m’était confiée. Adoré des voleurs, estimé des bandits les plus déterminés, car ces gens-là ont aussi un sentiment qu’ils appellent de l’estime, je pouvais compter en tout temps sur leur dévouement : tous se seraient fait hacher pour moi ; ce qui le prouve c’est qu’à Bicêtre le nommé Mardargent, dont j’ai déjà parlé, s’est battu plusieurs fois contre des prisonniers qui avaient osé dire que je n’étais sorti de la Force que pour servir la police. Coco-Latour et Goreau, détenus dans la même maison comme voleurs incorrigibles, ne prirent pas ma défense avec moins de générosité. Alors, peut-être, auraient-ils eu quelque raison de me taxer d’ingratitude puisque je ne les ai pas plus ménagés que les autres, mais le devoir commandait ; qu’ils reçoivent aujourd’hui le tribut de ma reconnaissance, ils ont plus concouru qu’ils ne pensent aux avantages que la société a pu retirer de mes services.
M. Henry ne laissa pas ignorer au préfet de police les nombreuses découvertes qui étaient dues à ma sagacité. Ce fonctionnaire, à qui il me représenta comme un homme sur qui l’on pouvait compter, consentit enfin à mettre un terme à ma détention. Toutes les mesures furent prises pour que l’on ne crût pas que j’eusse recouvré ma liberté. On vint me chercher à la Force, et l’on m’emmena sans négliger aucune des précautions les plus rigoureuses : on me mit les menottes, et je montai dans la cariole d’osier, mais il était convenu que je m’évaderais en route ; et en effet je m’évadai. Le même soir toute la police était à ma recherche. Cette évasion fit grand bruit, surtout à la Force, où mes amis la célébrèrent par des réjouissances : ils burent à ma santé et me souhaitèrent un bon voyage !
CHAPITRE XXIV
M. Henry surnommé l’Ange malin. – MM. Bertaux et Parisot. – Un mot sur la Police. – Ma première capture. – Boubin et Terrier sont arrêtés d’après mes indications.
Les noms de M. le baron Pasquier et de M. Henry ne s’effaceront jamais de mon souvenir. Ces deux hommes généreux furent mes libérateurs ! Combien je leur dois d’actions de grâces ! ils m’ont rendu plus que la vie ; pour eux je la sacrifierais mille fois, et je pense que l’on me croira quand on saura que souvent je l’exposai pour obtenir d’eux une parole, un regard de satisfaction.
Je respire, je circule librement, je ne redoute plus rien : devenu agent secret, j’ai maintenant des devoirs tracés, et c’est le respectable M. Henry qui se charge de m’en instruire : car c’est sur lui que repose presque toute la sûreté de la capitale. Prévenir les crimes, découvrir les malfaiteurs, et les livrer à l’autorité, c’est à ces points principaux que l’on doit rapporter les fonctions qui m’étaient confiées. La tâche était difficile à remplir. M. Henry prit le soin de guider mes premiers pas ; il m’aplanit les difficultés, et si par la suite j’ai acquis quelque célébrité dans la police, je l’ai due à ses conseils, ainsi qu’aux leçons qu’il m’a données… Doué d’un caractère froid et réfléchi, M. Henry possédait au plus haut degré ce tact d’observation qui fait démêler la culpabilité sous les apparences les plus innocentes ; il avait une mémoire prodigieuse, et une étonnante pénétration : rien ne lui échappait ; ajoutez à cela qu’il était excellent physionomiste. Les voleurs ne l’appelaient que l’Ange malin, et à tous égards il méritait ce surnom ; car chez lui l’aménité était la compagne de la ruse. Rarement un grand criminel, interrogé par lui, sortait de son cabinet sans avoir avoué son crime, ou donné à son insu quelques indices qui laissaient l’espoir de le convaincre. Chez M. Henry, il y avait une sorte d’instinct qui le conduisait à la découverte de la vérité ; ce n’était pas de l’acquis, et quiconque aurait voulu prendre sa manière pour arriver au même résultat, se serait fourvoyé ; car sa manière n’en était pas une ; elle changeait avec les circonstances : personne plus que lui n’était attaché à son état : il couchait comme on dit dans l’ouvrage, et était à toute heure à la disposition du public. On n’était pas obligé alors de ne venir dans les bureaux qu’à midi, et de faire souvent antichambre pendant des quarts de journées, ainsi que cela se pratique aujourd’hui. Passionné pour le travail, il n’était rebuté par aucune espèce de fatigue ; aussi après trente-cinq ans de service, est-il sorti de l’administration accablé d’infirmités. J’ai vu quelquefois ce chef passer deux ou trois nuits par semaine, et la plupart du temps pour méditer sur les instructions qu’il allait me donner, et pour parvenir à la prompte répression des crimes de tout genre. Les maladies, il en a eu de très graves, n’interrompaient presque pas ses labeurs : c’était dans son cabinet qu’il se faisait traiter : enfin c’était un homme comme il y en a peu : peut-être même comme il n’y en a point. Son nom seul faisait trembler les voleurs, et quand ils étaient amenés devant lui, tant audacieux fussent-ils, presque toujours ils se troublaient, ils se coupaient dans leurs réponses ; car tous étaient persuadés qu’il lisait dans leur intérieur.
Une remarque que j’ai souvent eu l’occasion de faire, c’est que les hommes capables sont toujours les mieux secondés ; serait-ce en vertu de ce vieux proverbe, qui se ressemble s’assemble ? Je n’en sais rien ; mais ce que je n’ai pas oublié, c’est que M. Henry avait des collaborateurs dignes de lui : de ce nombre était M. Bertaux, interrogateur d’un grand mérite : il avait un talent particulier pour saisir une affaire, quelle qu’elle fût : ses trophées sont dans les dossiers de la préfecture. Près de lui, j’aime à mentionner le chef des prisons, M. Parisot, qui suppléait M. Henry avec une grande habileté. Enfin, MM. Henry, Bertaux et Parisot formaient un véritable triumvirat qui conspirait sans cesse contre le brigandage : l’extirper de Paris, et procurer aux habitants de cette immense cité une sécurité à toute épreuve, tel était leur but, telle était leur unique pensée, et les effets répondaient pleinement à leur attente. Il est vrai qu’à cette époque, il existait entre les chefs de la police une franchise, un accord, une cordialité qui ont disparu depuis cinq à six ans. Aujourd’hui, chefs ou employés, tous sont dans la défiance les uns des autres ; tous se craignent réciproquement ; c’est un état d’hostilités continuelles ; chacun dans son confrère redoute un dénonciateur, il n’y a plus de convergence, plus d’harmonie entre les divers rouages de l’administration : et d’où cela vient-il ? de ce qu’il n’y a plus d’attributions distinctes et parfaitement définies ; de ce que personne, à commencer par les sommités, ne se trouve à sa place. D’ordinaire à son avènement, le préfet lui-même était étranger à la police ; et c’est dans l’emploi le plus éminent qu’il vient y faire son apprentissage : il traîne à sa suite une multitude de protégés, dont le moindre défaut est de n’avoir aucune qualité spéciale ; mais qui, faute de mieux, savent le flatter et empêcher la vérité d’arriver jusqu’à lui. C’est ainsi que tantôt sous une direction, tantôt sous une autre, j’ai vu s’organiser, ou plutôt se désorganiser la police : chaque mutation de préfet y introduisait des novices, et faisait éliminer quelques sujets expérimentés. Je dirai plus tard quelles sont les conséquences de ces changements, qui ne sont commandés que par le besoin de donner des appointements aux créatures du dernier venu. En attendant, je vais reprendre le fil de ma narration.
Dès que je fus installé en qualité d’agent secret, je me mis à battre le pavé, afin de me reconnaître, et de me mettre à même de travailler utilement. Ces courses, dans lesquelles je fis un grand nombre d’observations, me prirent une vingtaine de jours, pendant lesquels je ne fis que me préparer à agir : j’étudiais le terrain. Un matin, je fus mandé par le chef de la division : il s’agissait de découvrir un nommé Watrin, prévenu d’avoir fabriqué et mis en circulation de la fausse monnaie et des billets de banque. Watrin avait déjà été arrêté par les inspecteurs de police ; mais suivant leur usage, ils n’avaient pas su le garder. M. Henry me donna toutes les indications qu’il jugeait propres à me mettre sur ses traces ; malheureusement ces indications n’étaient que de simples données sur ses anciennes habitudes ; tous les endroits qu’il avait fréquentés m’étaient signalés ; mais il n’était pas vraisemblable qu’il y vînt de sitôt, puisque dans sa position, la prudence lui prescrivait de fuir tous les lieux où il était connu. Il ne me restait donc que l’espoir de parvenir jusqu’à lui par quelque voie détournée ; lorsque j’appris que dans une maison garnie où il avait logé, sur le boulevard du Mont-Parnasse, il avait laissé des effets. On présumait que tôt ou tard il se présenterait pour les réclamer ou tout au moins qu’il les ferait réclamer par une autre personne : c’était aussi mon avis. En conséquence, je dirigeai sur ce point toutes mes recherches, et après avoir pris connaissance du manoir, je m’embusquai nuit et jour à proximité, afin de surveiller les allant et les venant. Cette surveillance durait déjà depuis près d’une semaine ; enfin las de ne rien apercevoir, j’imaginai de mettre dans mes intérêts le maître de la maison, et de louer chez lui un appartement où je m’établis avec Annette, ma présence ne pouvait paraître suspecte. J’occupais ce poste depuis une quinzaine, quand un soir, vers les onze heures, je fus averti que Watrin venait de se présenter, accompagné d’un autre individu. Légèrement indisposé, je m’étais couché plus tôt que de coutume : je me lève précipitamment, je descends l’escalier quatre à quatre ; mais quelque diligence que je fisse, je ne pus atteindre que le camarade de Watrin. Je n’avais pas le droit de l’arrêter ; mais je pressentais qu’en l’intimidant, je pourrais obtenir de lui quelques renseignements ; je le saisis, je le menace, bientôt il me déclare en tremblant qu’il est cordonnier, et que Watrin demeure avec lui, rue des Mauvais-Garçons-Saint-Germain, n° 4 ; il ne m’en fallait pas davantage. Je n’avais passé qu’une mauvaise redingote sur ma chemise : sans prendre d’autres vêtements, je cours à l’adresse qui m’était donnée, et j’arrive devant la maison au moment où quelqu’un va sortir, persuadé que c’est Watrin, je veux le saisir, il m’échappe, je m’élance après lui dans l’escalier ; mais au moment de l’atteindre, un coup de pied qu’il m’envoie dans la poitrine me précipite de vingt marches ; je m’élance de nouveau, et d’une telle vitesse que pour se dérober à la poursuite, il est obligé de s’introduire chez lui par une croisée du carré : alors heurtant à sa porte, je le somme d’ouvrir, il s’y refuse. Annette m’avait suivi, je lui ordonne d’aller chercher la garde, et tandis qu’elle se dispose à m’obéir, je simule le bruit d’un homme qui descend. Watrin trompé par cette feinte, veut s’assurer si effectivement je m’éloigne, il met la tête à la croisée : c’était là ce que je demandais, aussitôt je le prends aux cheveux ; il m’empoigne de la même manière, et une lutte s’engage. Cramponné au mur de refend qui nous sépare, il m’oppose une résistance opiniâtre ; cependant je sens qu’il faiblit ; je rassemble toutes mes forces pour une dernière secousse ; déjà il n’a plus que les pieds dans sa chambre, encore un effort et il est à moi ; je le tire avec vigueur, et il tombe dans le corridor. Lui arracher le tranchet dont il était armé, l’attacher, et l’entraîner dehors fut l’affaire d’un instant : accompagné seulement d’Annette, je le conduisis à la préfecture, où je reçus d’abord les félicitations de M. Henry, et ensuite celles du préfet de police, qui m’accorda une récompense pécuniaire. Watrin était un homme d’une adresse rare, il exerçait une profession grossière, et pourtant il s’était adonné à des contre-façons qui exigent une grande délicatesse de main. Condamné à mort il obtint un sursis à l’heure même où il devait être conduit au supplice ; l’échafaud était dressé, on le démonta et les amateurs en furent pour un déplacement inutile : tout Paris s’en souvient. Le bruit s’était répandu qu’il allait faire des révélations, mais, comme il n’avait rien à dire, quelques jours après la sentence reçut son exécution.
Watrin était ma première capture : elle était importante ; le succès de ce début éveilla la jalousie des officiers de paix et des agents sous leurs ordres ; les uns et les autres se déchaînèrent contre moi ; mais ce fut vainement. Ils ne me pardonnaient pas d’être plus adroit qu’eux ; les chefs m’en savaient au contraire beaucoup de gré. Je redoublai de zèle pour mériter de plus en plus la confiance de ces derniers.
Vers cette époque, un grand nombre de pièces de cinq francs fausses avaient été jetées dans la circulation du commerce. On m’en montra plusieurs ; en les examinant, il me sembla reconnaître le faire de mon dénonciateur Bouhin et de son ami le docteur Terrier. Je résolus de m’assurer de la vérité : en conséquence je me mis à épier les démarches de ces deux individus ; mais comme je ne pouvais les suivre de trop près, attendu qu’ils me connaissaient, et que je leur aurais inspiré de la défiance, il m’était difficile d’obtenir les lumières dont j’avais besoin. Toutefois, à force de persévérance, je parvins à acquérir la certitude que je ne m’étais pas trompé, et les deux faux-monnoyeurs furent arrêtés au moment de la fabrication : quelque temps après ils furent condamnés à mort et exécutés. On a répété dans le public d’après un bruit accrédité par les inspecteurs de police, que le médecin Terrier avait été entraîné par moi, et que je lui avais en quelque sorte mis à la main les instruments de son crime. Que le lecteur se rappelle la réponse qu’il me fit lorsque, chez Bouhin, j’essayai de le déterminer à renoncer à sa coupable industrie, et il jugera si Terrier était homme à se laisser entraîner.
CHAPITRE XXV
Je revois Saint-Germain. – Il me propose l’assassinat de deux vieillards. – Les voleurs de réverbères. – Le petit-fils de Cartouche. – Discours sur les agents provocateurs. – Grandes perplexités. – Annette me seconde encore. – Tentative de vol chez un banquier de la rue Hauteville. – Je suis tué. – Arrestation de Saint-Germain et de Boudin, son complice. – Portraits de ces deux assassins.
Dans une capitale aussi populeuse que Paris, les mauvais lieux sont d’ordinaire en assez grand nombre ; c’est là que tous les hommes tarés se donnent rendez-vous : afin de les rencontrer et de les surveiller, je fréquentais assiduement les endroits mal famés, m’y présentant tantôt sous un nom, tantôt sous un autre, et changeant très souvent de costume comme une personne qui a besoin de se dérober à l’œil de la police. Tous les voleurs que je voyais habituellement auraient juré que j’étais un des leurs. Persuadés que j’étais fugitif, ils se seraient mis en quatre pour me cacher, car non-seulement ils avaient en moi pleine et entière confiance, mais encore ils m’affectionnaient ; aussi m’instruisaient-ils de leurs projets, et s’ils ne me proposaient pas de m’y associer, c’est qu’ils craignaient de me compromettre, attendu ma position de forçat évadé. Tous n’avaient pourtant pas cette délicatesse, on va le voir.
Il y avait quelques mois que je me livrais à mes investigations secrètes, lorsque le hasard me fit rencontrer ce Saint-Germain dont les visites m’avaient consterné tant de fois. Il était avec un nommé Boudin, que j’avais vu restaurateur, rue des Prouvaires, et que je connaissais comme on connaît un hôte chez qui l’on va de temps à autre prendre sa réfection en payant. Boudin n’eût pas de peine à me remettre, il m’aborda même avec une espèce de familiarité, à laquelle j’affectais de ne pas répondre : « Vous ai-je donc fait quelque chose, me dit-il, pour que vous ayiez l’air de ne pas vouloir me parler ? – Non ; mais j’ai appris que vous avez été mouchard. – Ce n’est que ça, eh bien ! oui, je l’ai été mouchard ; mais lorsque vous en saurez la raison, je suis sûr que vous ne m’en voudrez pas.
– » Certainement, me dit Saint-Germain, tu ne lui en voudras pas : Boudin est un bon garçon, et je réponds de lui comme de moi. Dans la vie il y a souvent des passes qu’on ne peut pas prévoir ; si Boudin a accepté la place dont tu parles, ce n’a été que pour sauver son frère ; au surplus, tu dois savoir que s’il avait de mauvais principes, je ne serais pas son ami. » Je trouvai la garantie de Saint-Germain excellente, et je ne fis plus aucune difficulté de parler à Boudin.
Il était bien naturel que Saint-Germain me racontât ce qu’il était devenu depuis sa dernière disparition, qui m’avait fait tant de plaisir. Après m’avoir complimenté sur mon évasion, il m’apprit que depuis que j’avais été arrêté, il avait recouvré son emploi, mais qu’il n’avait pas tardé à le perdre de nouveau, et qu’il se trouvait encore une fois réduit aux expédients. Je le priai de me donner des nouvelles de Blondy et de Duluc. – « Mon ami, dit-il, les deux qui ont escarpé le roulier avec moi, on les a fauchés à Beauvais. » Quand il m’annonça que ces deux scélérats avaient enfin porté la peine de leurs crimes, je n’éprouvai qu’un seul regret, c’est que la tête de leur complice ne fût pas tombée sur le même échafaud.
Après que nous eûmes vidé ensemble plusieurs bouteilles de vin, nous nous séparâmes. En me quittant, Saint-Germain ayant remarqué que j’étais assez mesquinement vêtu, me demanda ce que je faisais, et comme je lui dis que je ne faisais rien, il me promit de songer à moi, si jamais il se présentait une bonne occasion. Je lui fis observer que, sortant rarement dans la crainte d’être arrêté, il pourrait bien se faire que nous ne nous rencontrassions pas de sitôt. – « Tu me verras quand tu voudras, me dit-il, j’exige même que tu viennes me voir ? » Quand je le lui eus promis, il me remit son adresse, sans s’informer de la mienne.
Saint-Germain n’était plus un être aussi redoutable pour moi, je me croyais même intéressé à ne le plus perdre de vue ; car si je devais m’attacher à surveiller les malfaiteurs, personne plus que lui n’était signalé à mon attention. Je concevais enfin l’espoir de purger la société d’un pareil monstre. En attendant, je faisais la guerre à toute la tourbe des coquins qui infestaient la capitale. Il y eut un moment où les vols de tous genres se multiplièrent d’une manière effrayante : on n’entendait parler que de rampes enlevées, de devantures forcées, de plombs dérobés ; plus de vingt réverbères furent pris successivement, rue Fontaine-au-Roi, sans que l’on pût atteindre les voleurs qui étaient venus les décrocher. Pendant un mois consécutif, des inspecteurs avaient été aux aguets afin de les surprendre, et la première nuit qu’ils suspendirent leur surveillance, les réverbères disparurent encore : c’était comme un défi porté à la police. Je l’acceptai pour mon compte, et, au grand désappointement de tous les Argus du quai du Nord, en peu de temps je parvins à livrer à la justice ces effrontés voleurs, qui furent tous envoyés aux galères. L’un d’entre eux se nommait Cartouche : j’ignore s’il avait subi l’influence du nom, ou s’il exerçait un talent de famille : peut-être était-il un descendant du célèbre Cartouche ? Je laisse aux généalogistes le soin de décider la question.
Chaque jour je faisais de nouvelles découvertes ; on ne voyait entrer dans les prisons que des gens qui y étaient envoyés d’après mes indications, et pourtant aucun d’eux n’avait même la pensée de m’accuser de l’avoir fait écrouer. Je m’arrangeai si bien, qu’au dedans comme au-dehors, rien ne transpirait ; les voleurs de ma connaissance me tenaient pour le meilleur de leurs camarades, les autres s’estimaient heureux de pouvoir m’initier à leurs secrets, soit pour le plaisir de s’entretenir avec moi, soit aussi parfois pour me consulter. C’était notamment hors barrière que je rencontrais tout ce monde. Un jour que je parcourais les boulevards extérieurs, je fus accosté par Saint-Germain, Boudin était encore avec lui. Ils m’invitèrent à dîner ; j’acceptai, et au dessert, ils me firent l’honneur de me proposer d’être le troisième dans un assassinat. Il s’agissait d’expédier deux vieillards qui demeuraient ensemble dans la maison que Boudin avait habitée rue des Prouvaires. Tout en frémissant de la confidence que me firent ces scélérats, je bénis le pouvoir invisible qui les avait poussés vers moi : j’hésitai d’abord à entrer dans le complot, mais à la fin je feignis de me rendre à leurs vives et pressantes sollicitations, et il fut convenu qu’on attendrait le moment favorable pour mettre à exécution cet abominable projet. Cette résolution prise, je dis au revoir à Saint-Germain ainsi qu’à son compagnon ; et, décidé à prévenir le crime, je me hâtai de faire un rapport à M. Henry, qui me manda aussitôt, afin d’obtenir de plus amples détails au sujet de la révélation que je venais de lui faire. Son intention était de s’assurer si j’avais été réellement sollicité, ou si, par un dévouement mal entendu, je n’aurais pas eu recours à des provocations. Je lui protestai que je n’avais pris aucune espèce d’initiative, et comme il crut reconnaître la vérité de cette déclaration, il m’annonça qu’il était satisfait ; ce qui ne l’empêcha pas de me faire sur les agents provocateurs un discours dont je fus pénétré jusqu’au fond de l’âme. Que ne l’ont-ils entendu comme moi, ces misérables qui, depuis la restauration, ont fait tant de victimes, l’ère renaissante de la légitimité n’aurait pas, dans quelques circonstances, rappelé les jours sanglants d’une autre époque ? « Retenez bien, me dit M. Henry, en terminant, que le plus grand fléau dans les sociétés est l’homme qui provoque. Quand il n’y a point de provocateurs, ce sont les forts qui commettent les crimes, parce que ce ne sont que les forts qui les conçoivent. Des êtres faibles peuvent être entraînés, excités ; pour les précipiter dans l’abîme, il suffit souvent de chercher un mobile dans leurs passions ou dans leur amour-propre : mais celui qui tente ce moyen de les faire succomber est un monstre ! C’est lui qui est le coupable, et c’est lui que le glaive devrait frapper. En police, ajouta-t-il, il vaut mieux ne pas faire d’affaire que d’en créer. »
Quoique la leçon ne me fût pas nécessaire, je remerciai M. Henry, qui me recommanda de m’attacher aux pas des deux assassins et de ne rien négliger pour les empêcher d’arriver à l’exécution. « La police, me dit-il encore, est instituée autant pour réprimer les malfaiteurs que pour les empêcher de faire le mal, et il vaut toujours mieux avant qu’après. » Conformément aux instructions que m’avait donné M. Henry, je ne laissai pas passer un jour sans voir Saint-Germain et son ami Boudin. Comme le coup qu’ils avaient projeté devait leur procurer assez d’argent, j’en conclus qu’il ne leur semblerait pas extraordinaire que je montrasse un peu d’impatience. « Eh bien ! à quand la fameuse affaire ? leur disais-je chaque fois que nous étions ensemble ? – À quand ? me répondait Saint-Germain, la poire n’est pas mûre : lorsqu’il sera temps, ajoutait-il, en me désignant Boudin, voilà l’ami qui vous avertira. » Déjà plusieurs réunions avaient eu lieu, et rien ne se décidait ; j’adressai encore la question d’usage. « Ah ! cette fois, me répondit Saint-Germain, c’est pour demain, nous t’attendons pour délibérer. »
Le rendez-vous fut donné hors de Paris ; je n’eus garde d’y manquer ; Saint-Germain ne fut pas moins exact. « Écoute, me dit-il, nous avons réfléchi à l’affaire, elle ne peut s’exécuter quant à présent, mais nous en avons une autre à te proposer, et je te préviens d’avance qu’il faut y mettre de la franchise et répondre oui ou non. Avant de nous occuper de l’objet qui nous amène ici, je te dois une confidence qui nous a été faite hier : le nommé Carré, qui t’a connu à la Force, prétend que tu n’en es sorti qu’à la condition de servir la police, et que tu es un agent secret. »
À ces mots d’agent secret, je me sentis comme suffoqué ; mais bientôt je me fus remis, et il faut bien que rien n’ait parut extérieurement, puisque Saint-Germain qui m’observait attendit que je lui donnasse une explication. Cette présence d’esprit qui ne m’abandonne jamais me la fit trouver sur-le-champ. « Je ne suis pas surpris, lui dis-je, que l’on m’ait représenté comme un agent secret, je sais la source d’un pareil conte. Tu n’ignores pas que je devais être transféré à Bicêtre ; chemin faisant, je me suis évadé, et je suis resté à Paris, faute de pouvoir aller ailleurs. Il faut vivre où l’on a des ressources. Malheureusement je suis obligé de me cacher ; c’est en me déguisant que j’échappe aux recherches, mais il est toujours quelques individus qui me reconnaissent, ceux, par exemple, avec lesquels j’ai vécu dans une certaine intimité. Parmi ces derniers, ne peut-il pas s’en trouver qui, soit dessein de me nuire, soit motif d’intérêt, jugent à propos de me faire arrêter ? Eh bien ! pour leur en ôter l’envie, toutes les fois que je les ai crus capables de me dénoncer, je leur ai dit que j’étais attaché à la police.
– » Voilà qui est bien, reprit Saint-Germain, je te crois ; et pour te donner une preuve de la confiance que j’ai en toi, je vais te faire connaître ce que nous devons faire ce soir. Au coin de la rue d’Enghien et de la rue d’Hauteville, il demeure un banquier dont la maison donne sur un assez vaste jardin, qui peut favoriser notre expédition et notre fuite. Aujourd’hui le banquier est absent, et la caisse, dans laquelle il y a beaucoup d’or et d’argent, ainsi que des billets de banque, n’est gardée que par deux personnes ; nous sommes déterminés à nous en emparer dès ce soir même. Jusqu’à présent, nous ne sommes que trois pour exécuter le coup, il faut que tu sois le quatrième. Nous avons compté sur toi ; si tu refuses, tu nous confirmeras dans l’opinion que tu es un mouchard. »
Comme j’ignorais l’arrière-pensée de Saint-Germain, j’acceptai avec empressement : Boudin et lui parurent contents de moi. Bientôt je vis arriver le troisième, que je ne connaissais pas, c’était un cocher de cabriolet, nommé Debenne ; il était père de famille, et s’était laissé entraîner par ces misérables. L’on se mit à causer de choses et d’autres ; quant à moi, j’avais déjà prémédité comment je m’y prendrais pour les faire arrêter sur le fait, mais quel ne fut pas mon étonnement, lorsqu’au moment de payer l’écot, j’entendis Saint-Germain nous adresser la parole en ces termes : « Mes amis, quand il s’agit de jouer sa tête, on doit y regarder de près ; c’est aujourd’hui que nous allons faire cette partie que je ne veux pas perdre ; pour que la chance soit de notre côté, voici ce que j’ai décidé, et je suis sûr que vous applaudirez tous à la mesure : c’est vers minuit que nous devons nous introduire tous quatre dans la maison en question ; Boudin et moi nous nous chargeons de l’intérieur ; quant à vous deux, vous resterez dans le jardin, prêts à nous seconder en cas de surprise. Cette opération, si elle réussit, comme je pense, doit nous donner de quoi vivre tranquilles pendant quelque temps ; mais il importe pour notre sûreté réciproque que nous ne nous quittions plus jusqu’à l’heure de l’exécution. »
Cette finale, que je feignis de ne pas avoir bien entendue, fut répétée. Pour cette fois, me disais-je, je ne sais pas trop comment je me tirerai d’affaire : quel moyen employer ? Saint-Germain était un homme d’une témérité rare, avide d’argent, et toujours prêt à verser beaucoup de sang pour s’en procurer. Il n’était pas encore dix heures du matin, l’intervalle jusqu’à minuit était assez long ; j’espérais que pendant le temps qui nous restait à attendre, il se présenterait une occasion de me dérober adroitement, et d’avertir la police. Quoi qu’il dût en arriver, j’adhérai à la proposition de Saint-Germain, et ne fis pas la moindre objection contre une précaution, qui était bien la meilleure garantie que l’on pût avoir de la discrétion de chacun. Quand il vit que nous étions de son avis, Saint-Germain, qui, par ses qualités énergiques et sa conception, était véritablement le chef du complot, nous adressa des paroles de satisfaction. « Je suis bien aise, nous dit-il, de vous trouver dans ces sentiments ; de mon côté, je ferai tout ce qui dépendra de moi pour mériter d’être long-temps votre ami. »
Il était convenu que nous irions tous ensemble chez lui, à l’entrée de la rue Saint-Antoine ; un fiacre nous conduisit jusqu’à sa porte. Arrivés là, nous montâmes dans sa chambre, où il devait nous tenir en charte privée jusqu’à l’instant du départ. Confiné entre quatre murailles, face à face avec ces brigands, je ne savais à quel saint me vouer : inventer un prétexte pour sortir était impossible, Saint-Germain m’eût deviné de suite, et au moindre soupçon, il était capable de me faire sauter la cervelle. Que devenir ? je pris mon parti, et me résignai à l’événement, quel qu’il fut ; il n’y avait rien de mieux à faire que d’aider de bonne grâce aux apprêts du crime : ils commencèrent aussitôt. Des pistolets sont apportés sur la table pour être déchargés et rechargés : on les examine ; Saint-Germain en remarque une paire qui lui semble hors d’état de faire le service : il la met de côté. « Pendant que vous allez démonter les batteries, nous dit-il, je vais aller changer ces pieds de cochon. » Et il se dispose à sortir. – « Un moment, lui fis-je observer, d’après notre convention personne ne doit quitter ce lieu sans être accompagné. – C’est vrai, me répond-il, j’aime que l’on soit fidèle à ses engagements ; aussi, viens avec moi. – Mais ces messieurs ? – Nous les enfermerons à double tour. » Ce qui fut dit fut fait : j’accompagne Saint-Germain ; nous achetons des balles, de la poudre et des pierres ; les mauvais pistolets sont échangés contre d’autres, et nous rentrons. Alors on achève des préparatifs qui me font frémir : le calme de Boudin, aiguisant sur un grès deux couteaux de table, était horrible à voir.
Cependant le temps s’écoulait, il était une heure, et aucun expédient de salut ne s’était présenté. Je bâille, je m’étends, je simule l’ennui, et, passant dans une pièce voisine de celle où nous étions, je vais me jeter sur un lit comme pour me reposer : après quelques minutes, je parais encore plus fatigué de cette inaction, et je m’aperçois que les autres ne le sont pas moins que moi. « Si nous buvions ? me dit Saint-Germain. – Admirable idée, m’écriai-je en sautant d’aise, j’ai justement chez moi un panier d’excellent vin de Bourgogne ; si vous voulez nous allons l’envoyer chercher. » Tout le monde fut d’avis qu’il ne pourrait arriver plus à point, et Saint-Germain dépêcha son portier vers Annette, à qui il était recommandé de venir avec la provision. On tomba d’accord de ne rien dire devant elle, et tandis que l’on se promet de faire honneur à ma largesse, je me jette une seconde fois sur le lit, et je trace au crayon ces lignes : « Sortie d’ici, déguise toi, et ne nous quitte plus, Saint-Germain, Boudin, ni moi ; prends garde surtout d’être remarquée : aie bien soin de ramasser tout ce que je laisserai tomber, et de le porter là-bas. » Quoique très courte, l’instruction était suffisante : Annette en avait déjà reçu de semblables, j’étais sûr qu’elle en comprendrait tout le sens.
Annette ne tarda pas à paraître avec le panier de vin. Son aspect fit renaître la gaieté ; chacun la complimenta ; quant à moi, pour lui faire fête, j’attendis qu’elle se disposât à repartir, et alors en l’embrassant je lui glissai le billet.
Nous fîmes un dîner copieux, après lequel j’ouvris l’avis d’aller seul avec Saint-Germain reconnaître les lieux, et en examiner de jour la disposition, afin de parer à tout en cas d’accident. Cette prudence était naturelle, Saint-Germain ne s’en étonna pas ; seulement j’avais proposé de prendre un fiacre, et il jugea plus convenable d’aller à pied. Parvenu à l’endroit qu’il me désigna comme le plus favorable à l’escalade, je le remarquai assez bien pour l’indiquer de manière à ce qu’on ne s’y méprît pas. La reconnaissance effectuée, Saint-Germain me dit qu’il nous fallait du crêpe noir pour nous couvrir la figure : nous nous dirigeons vers le Palais Royal, afin d’en acheter, et tandis qu’il entre dans une boutique, je prétexte un besoin, et vais m’enfermer dans un cabinet d’aisance, où j’eus le temps d’écrire tous les renseignements qui pouvaient mettre la police à même de prévenir le crime.
Saint-Germain, qui n’avait pas cessé de me garder à vue autant que possible, me conduisit ensuite dans un estaminet, où nous bûmes quelques bouteilles de bière. Sur le point de rentrer au repaire, j’aperçois Annette qui épiait mon retour : tout autre que moi ne l’aurait pas reconnue sous son déguisement. Certain qu’elle m’a vu, près de franchir le seuil, je laisse tomber le papier et m’abandonne à mon sort.
Il m’est impossible de rendre toutes les terreurs auxquelles je fus en proie, en attendant le moment de l’expédition. Malgré les avertissements que j’avais donnés, je craignais que les mesures ne fussent tardives, et alors le crime était consommé : pouvais-je seul entreprendre d’arrêter Saint-Germain et ses complices ? Je l’eusse tenté sans succès ; et puis, qui me répondait que, l’attentat commis, je ne serais pas jugé et puni comme l’un des fauteurs ? Il m’était revenu que dans maintes circonstances, la police avait abandonné ses agents ; et que dans d’autres elle n’avait pu empêcher les tribunaux de les confondre avec les coupables. J’étais dans ces transes cruelles, lorsque Saint-Germain me chargea d’accompagner Debenne, dont le cabriolet destiné à recevoir les sacs d’or et d’argent, devait stationner au coin de la rue. Nous descendons ; en sortant je revois encore Annette, qui me fait signe qu’elle s’est acquittée de mon message. Au même instant Debenne me demande où sera le rendez-vous ; je ne sais quel bon génie me suggéra alors la pensée de sauver ce malheureux ; j’avais observé qu’il n’était pas foncièrement méchant, et il me semblait plutôt poussé vers l’abîme par le besoin et par des conseils perfides, que par la funeste propension au crime. Je lui assignai donc son poste à un autre endroit que celui qui m’avait été indiqué, et je rejoignis Saint-Germain et Boudin, à l’angle du boulevard Saint-Denis. Il n’était encore que dix heures et demie ; je leur dis que le cabriolet ne serait prêt que dans une heure, que j’avais donné la consigne à Debenne, qu’il se placerait au coin de la rue du Faubourg-Poissonnière, et qu’il accourrait à un signal convenu ; je leur fis entendre que trop près du lieu où nous devions agir, la présence d’un cabriolet pouvant éveiller des soupçons, j’avais jugé plus convenable de le tenir à distance : et ils approuvèrent cette précaution.
Onze heures, sonnent : nous buvons la goutte dans le Faubourg-Saint-Denis, et nous nous dirigeons vers l’habitation du banquier. Boudin et son complice marchaient la pipe à la bouche ; leur tranquillité m’effrayait. Enfin, nous sommes au pied du poteau qui doit servir d’échelle. Saint-Germain me demande mes pistolets ; à ce moment je crus qu’il m’avait deviné, et qu’il voulait m’arracher la vie : je les lui remets ; je m’étais trompé : il ouvre le bassinet, change l’amorce, et me les rend. Après avoir fait une opération semblable aux siens et à ceux de Boudin, il donne l’exemple de grimper au poteau, et tous deux, sans discontinuer de fumer, s’élancent dans le jardin. Il faut les suivre ; parvenu, en tremblant, au sommet du mur, toutes mes appréhensions se renouvellent : la police a-t-elle eu le temps de dresser son embuscade ? Saint-Germain ne l’aurait-il pas devancée ? Telles étaient les questions que je m’adressais à moi-même, tels étaient mes doutes ; enfin, dans cette terrible incertitude, je prends une résolution, celle d’empêcher le crime, dussé-je succomber dans une lutte inégale, lorsque Saint-Germain, me voyant encore à cheval sur le chaperon, et s’impatientant de ma lenteur, me crie : « Allons donc ! descends. » À peine il achevait ces mots, qu’il est tout à coup assailli par un grand nombre d’hommes, Boudin et lui font une vigoureuse résistance. On fait feu de part et d’autre, les balles sifflent, et, après un combat de quelques minutes, on s’empare des deux assassins. Plusieurs agents furent blessés dans cette action ; Saint-Germain et son accolyte le furent aussi. Simple spectateur de l’engagement, je ne devais avoir éprouvé aucun accident fâcheux ; cependant pour soutenir mon rôle jusqu’au bout, je tombai sur le champ de bataille comme si j’eusse été mortellement frappé : l’instant d’après on m’enveloppa dans une couverture, et je fus ainsi transporté dans une chambre où étaient Boudin et Saint-Germain : ce dernier parut vivement touché de ma mort ; il répandit des larmes, et il fallut employer la force pour l’empêcher de se précipiter sur ce qu’il croyait n’être plus qu’un cadavre.
Saint-Germain était un homme de cinq pieds huit pouces, dont les muscles étaient vigoureusement tracés ; il avait une tête énorme et de petits yeux, un peu couverts, comme ceux des oiseaux de nuit ; son visage, profondément sillonné par la petite vérole, était fort laid, et pourtant il ne laissait pas que d’être agréable, parce qu’on y découvrait de l’esprit et de la vivacité : en détaillant ses traits, on lui trouvait quelque chose de la hyène ou du loup, surtout si l’on faisait attention à la largeur de ses mâchoires, dont les saillies étaient des plus prononcées. Tout ce qui était de l’instinct des animaux de proie prédominait dans cette organisation ; il aimait la chasse avec fureur, et la vue du sang le réjouissait ; ses autres passions étaient le jeu, les femmes et la bonne chair. Comme il avait le ton et les manières de la bonne compagnie, qu’il s’exprimait avec facilité, et était presque toujours vêtu avec élégance, on pouvait dire qu’il était un brigand bien élevé ; quand il y était intéressé, personne n’avait plus d’aménité et de liant que lui : dans toute autre circonstance, il était dur et brutal. À quarante-cinq ans, il avait vraisemblablement commis plus d’un meurtre, et il n’en était pas moins joyeux compagnon lorsqu’il se trouvait avec des gens de son espèce. Son camarade Boudin était d’une bien plus petite stature : il avait à peine cinq pieds deux pouces ; il était gros et maigre ; avec un teint livide, il avait l’œil noir et vif, quoique très enfoncé. L’habitude de manier le couteau de cuisine, et de couper des viandes, l’avait rendu féroce. Il avait les jambes arquées : c’est une difformité que j’ai observée chez plusieurs assassins de profession, et chez quelques autres individus réputés méchants.
Je ne me souviens pas qu’aucun événement de ma vie m’ait procuré plus de joie que la capture de ces scélérats : je m’applaudissais d’avoir délivré la société de deux monstres, en même temps que je m’estimais heureux d’avoir dérobé au sort qui leur était réservé, le cocher Debenne, qu’ils eussent entraîné avec eux. Cependant tout ce que j’éprouvais de contentement n’était que relatif à ma situation, et je n’en gémissais pas moins de cette fatalité qui me plaçait sans cesse dans l’alternative de monter sur l’échafaud ou d’y faire monter les autres.
La qualité d’agent secret préservait, il est vrai, ma liberté, je ne courais plus les mêmes dangers auxquels un forçat évadé est exposé, je n’avais plus les mêmes craintes ; mais tant que je n’étais pas gracié, cette liberté dont je jouissais n’était qu’un état précaire, puisqu’à la volonté de mes chefs, elle pouvait m’être ravie d’un instant à l’autre. D’un autre côté, je n’ignorais pas quel mépris s’attache au ministère que je remplissais. Pour ne pas me dégoûter de mes fonctions et des devoirs qui m’étaient prescrits, j’eus besoin de les raisonner, et dans ce mépris qui planait sur moi, je ne vis plus que l’effet d’un préjugé. Ne me dévouais-je pas chaque jour dans l’intérêt de la société ? C’était le parti des honnêtes gens que je prenais contre les artisans du mal, et l’on me méprisait !… J’allais chercher le crime dans l’ombre, je déjouais des trames homicides, et l’on me méprisait !… Harcelant les brigands jusque sur le théâtre de leurs forfaits, je leur arrachais le poignard dont ils s’étaient armés, je bravais leur vengeance, et l’on me méprisait !… Dans un rôle différent, mais plus près du glaive de Thémis, il y avait de l’honneur à provoquer sans périls la vindicte des lois, et l’on me méprisait !… Ma raison l’emporta, et j’osai affronter l’ingratitude, l’iniquité de l’opinion.
CHAPITRE XXVI
Je hante les mauvais lieux. – Les inspecteurs me trahissent. – Découverte d’un recéleur. – Je l’arrête. – Stratagème employé pour le convaincre. – Il est condamné.
Les voleurs, un instant effrayés par quelques arrestations que j’avais fait effectuer coup sur coup, ne tardèrent pas à reparaître plus nombreux et plus audacieux peut-être qu’auparavant. Parmi eux étaient plusieurs forçats évadés, qui, ayant perfectionné dans les bagnes un savoir-faire très dangereux, étaient venus l’exercer dans Paris, où leur présence répandait la terreur. La police résolut de mettre un terme aux expéditions de ces bandits. Je fus en conséquence chargé de les pourchasser, et je reçus l’ordre de me concerter à l’avance avec les officiers de paix et de sûreté, toutes les fois que je serais à portée de leur faire opérer une capture : on voit quelle était ma tâche, je me mis à parcourir tous les mauvais lieux de l’intérieur et des environs. En peu de jours je parvins à connaître tous les repaires où je pourrais rencontrer les malfaiteurs : la barrière de la Courtille, celles du Combat et de Ménilmontant étaient les endroits où ils se rassemblaient de préférence. C’était là leur quartier-général, ils y étaient constamment en force, et malheur à l’agent qui serait venu les y trouver, n’importe pour quel motif : ils l’auraient infailliblement assommé ; les gendarmes n’osaient même plus s’y montrer, tant cette réunion de mauvais sujets était imposante. Moins timide, je n’hésitai pas à me risquer au milieu de cette tourbe de misérables, je les fréquentais, je fraternisais avec eux, et j’eus bientôt l’avantage d’être regardé par eux comme un des leurs. C’est en buvant dans la compagnie de ces messieurs, que j’apprenais les crimes qu’ils avaient commis ou ceux qu’ils préméditaient ; je les circonvenais avant tant d’adresse, qu’ils ne faisaient pas difficulté de me découvrir leur demeure ou celle des femmes avec lesquelles ils vivaient en concubinage. Je puis dire que je leur inspirais une confiance sans bornes, et si quelqu’un d’entre eux, plus avisé que ses confrères, se fût permis d’exprimer sur mon compte le moindre soupçon, je ne doute pas qu’ils ne l’en eussent puni à l’instant même. Aussi obtins-je d’eux tous les renseignements dont j’avais besoin, de telle sorte que quand je donnais le signal d’une arrestation, il était presque certain que les individus seraient pris ou en flagrant délit ou nantis d’objets volés qui légitimeraient leur condamnation.
Mes explorations intra muros n’étaient pas moins fructueuses : je hantais successivement tous les tripots des environs du Palais-Royal, l’hôtel d’Angleterre, les boulevards du Temple, les rues de la Vannerie, de la Mortellerie, de la Planche-Mibray, le marché Saint-Jacques, la Petite-Chaise, les rues de la Juiverie, de la Calandre, le Châtelet, la place Maubert et toute la Cité. Il ne se passait pas de jour que je ne fisse les plus importantes découvertes ; point de crimes commis ou à commettre dont toutes les circonstances ne me fussent révélées ; j’étais partout, je savais tout, et l’autorité, quand je l’appelais à intervenir, n’était jamais trompée par mes indications. M. Henry s’étonnait de mon activité et de mon omniprésence : il m’en félicita, tandis que plusieurs officiers de paix et des agents subalternes ne rougirent pas de s’en plaindre. Les inspecteurs, peu habitués à passer plusieurs nuits par semaine, trouvaient trop pénible le service en quelque sorte permanent, que je leur occasionnais ; ils murmuraient. Quelques-uns même furent assez indiscrets, ou assez lâches, pour trahir l’incognito à la faveur duquel je manœuvrais si utilement. Cette conduite leur attira des réprimandes sévères, mais ils n’en furent ni plus circonspects, ni plus dévoués.
Il n’était guère possible de vivre presque constamment parmi les malfaiteurs, sans qu’ils me proposassent de m’associer à leurs coups ; je ne refusais jamais, mais à l’approche de l’exécution, j’inventais toujours un prétexte pour ne pas aller au rendez-vous. Les voleurs sont en général des êtres si stupides, qu’il n’y avait pas d’excuse absurde que je ne pusse leur faire admettre ; j’affirmerai même que souvent, pour les tromper, il n’a pas fallu me mettre en frais de ruse. Une fois arrêtés, ils n’en voyaient pas plus clair ; au surplus, en les supposant moins bêtes, les mesures avaient été prises de telle façon qu’il ne pouvait pas leur venir à la pensée de me suspecter. J’en ai vu s’échapper au moment de l’arrestation et accourir à l’endroit où ils savaient me rencontrer, pour me donner la fâcheuse nouvelle de la prise de leurs camarades.
Rien de plus aisé quand on est bien avec les voleurs, que d’arriver à connaître les recéleurs ; je parvins à en découvrir plusieurs, et les indices que je donnai pour les convaincre furent si positifs, qu’il ne manquèrent pas de suivre leur clientèle dans les bagnes. On ne lira peut-être pas sans intérêt, le récit des moyens que j’employai pour délivrer la capitale de l’un de ces hommes dangereux.
Depuis plusieurs années, on était sur sa piste, et l’on n’avait pas encore réussi à le prendre en flagrant délit. De fréquentes perquisitions faites à son domicile n’avaient produit aucun résultat, pas la moindre marchandise qui pût fournir une preuve contre lui : pourtant on était assuré qu’il achetait aux voleurs, et plusieurs d’entre eux, qui étaient loin de me croire attaché à la police, me l’avaient indiqué comme un homme solide, à qui l’on pouvait se confier. Les renseignements sur son compte ne manquaient pas ; mais il fallait le saisir nanti d’objets volés. M. Henry avait tout mis en œuvre pour parvenir à ce but : soit maladresse de la part des agents, soit adresse de la part du recéleur, on avait toujours échoué. On voulut savoir si je serais plus heureux ; je tentai l’entreprise, et voici ce que je fis : posté à quelque distance de la demeure du recéleur, je le guettai sortir. Il se montre enfin, dès qu’il est dehors, je le suis quelques pas dans la rue, et l’accoste tout à coup en l’appelant d’un autre nom que le sien ; il affirme que je me trompe, je soutiens le contraire ; il persiste à dire que je suis dans l’erreur, je lui déclare à mon tour que je le reconnais parfaitement pour un individu qui, depuis long-temps, est l’objet des recherches de la police de Paris et des départements. « Mais vous vous méprenez, me dit-il, je m’appelle un tel, et je demeure à tel endroit. – Je n’en crois rien. – Ah ! pour le coup, c’est trop fort, voulez-vous que je vous le prouve ? Et je consens à ce qu’il demande, sous la condition qu’il m’accompagnera au poste le plus voisin. « Volontiers, » me dit-il. Aussitôt nous nous acheminons ensemble vers un corps-de-garde, nous entrons ; je l’invite à m’exhiber ses papiers : il n’en a pas. Je demande alors qu’on le fouille, et l’on trouve sur lui trois montres et vingt-cinq doubles napoléons, que je mets en dépôt en attendant qu’il soit conduit chez le commissaire. Un mouchoir enveloppait ces objets, je m’en empare ; et après m’être déguisé en commissionnaire, je cours à la maison du recéleur : sa femme y était avec quelques autres personnes ; elle ne me connaissait pas, je lui dis que je désire lui parler en particulier : et quand je suis seul avec elle, je tire de ma poche le mouchoir, et le lui présente comme un signe de reconnaissance. Elle ignore encore quel est le motif de ma visite, et pourtant ses traits se décomposent ; elle se trouble : « Je ne vous apporte pas une trop bonne nouvelle, lui dis-je : votre mari vient d’être arrêté, on le retient au poste où l’on a saisi tout ce qu’il avait sur lui, et, d’après quelques mots échappés aux mouchards, il craint d’avoir été vendu ; c’est pourquoi il vous prie de déménager tout de suite ce que vous savez bien, si vous le souhaitez je vous donnerai un coup de main ; mais je vous préviens qu’il n’y a pas de temps à perdre. »
L’avis était pressant ; la vue du mouchoir et la description des objets auxquels il avait servi d’enveloppe, ne laissait aucun doute sur la vérité du message. La femme du recéleur donna à plein collier dans le piège que je lui tendais. Elle me chargea d’aller chercher trois fiacres, et de revenir aussitôt. Je sortis pour m’acquitter de la commission ; mais, chemin faisant, je donnai à l’un de mes affidés l’ordre de ne pas perdre de vue les voitures, et de les faire arrêter dès qu’il en recevrait le signal. Les fiacres sont à la porte ; je remonte au logis, et déjà le déménagement se prépare : la maison est encombrée d’objets de tous genres, pendules, candélabres, vases étrusques, draps, casimirs, toile, mousseline, etc. Toutes ces marchandises étaient extraites d’un cabinet dont l’entrée était masquée par une grande armoire si bien adaptée, qu’il aurait été impossible de s’apercevoir de la fraude. J’aidai au chargement, et quand il fut terminé, l’armoire ayant été remise en place, la femme du recéleur me pria de la suivre ; je fis ce qu’elle désirait, et dès qu’elle fut dans l’un des fiacres prête à se mettre en route, je levai une des glaces, et soudain nous fûmes entourés. Les deux époux, traduits devant la cour d’assises, succombèrent sous le poids d’une accusation à l’appui de laquelle il existait une masse formidable de témoignages matériels irrécusables.
Peut-être blâmera-t-on le stratagème auquel j’ai recouru, afin de débarrasser Paris d’un recéleur qui était un véritable fléau pour cette capitale. Que l’on approuve ou non, j’ai la conscience d’avoir fait mon devoir ; d’ailleurs, lorsqu’il s’agit d’atteindre des scélérats qui sont en guerre ouverte avec la société, tous les moyens sont bons, sauf la provocation.
CHAPITRE XXVII
La bande de Gueuvive. – Une fille me met sur les traces du chef. – Je dîne avec les voleurs. – L’un d’eux me donne à coucher. – Je passe pour un forçat évadé. – J’entre dans un complot contre moi-même. – Je m’attends à ma porte. – Un vol, rue Cassette. – Grande surprise. – Gueuvive et quatre des siens sont arrêtés. – La fille Cornevin me désigne les autres. – Une fournée de dix-huit.
À peu près vers le temps où je fis succomber le recéleur, une espèce de bande s’était formée dans le faubourg Saint-Germain, qu’elle exploitait de préférence aux autres quartiers de Paris. Elle se composait d’individus qui paraissaient dans la dépendance d’un chef, nommé Gueuvive, dit Constantin, dit Antin, par abréviation ; car parmi les voleurs, de même que parmi les souteneurs de filles, les claqueurs et les escrocs, c’est un usage de ne se faire appeler que par la dernière syllabe du prénom.
Gueuvive, ou Antin, était un ancien maître d’armes, qui, après avoir fait le métier de spadassin, aux gages des courtisanes du plus bas étage, accomplissait dans l’état de voleur, les vicissitudes de la vie de mauvais sujet. Il était, assurait-on, capable de tout, et bien qu’on ne pût pas prouver qu’il eût commis des meurtres, on ne doutait pas qu’au besoin il n’hésitât pas à verser le sang. Sa maîtresse avait été assassinée dans les Champs-Élysées, et on l’avait fortement soupçonné d’être l’auteur de ce crime. Quoi qu’il en soit, Gueuvive était un homme très entreprenant, d’une audace à toute épreuve, et d’une effronterie extraordinaire ; du moins ses camarades le tenaient pour tel, et il jouissait parmi eux d’une sorte de célébrité.
Depuis long-temps la police avait l’œil fixé sur Gueuvive et sur ses complices ; mais elle n’avait pu les atteindre, et chaque jour quelque nouvel attentat contre la propriété, annonçait qu’ils n’étaient pas oisifs. Enfin, on résolut bien sérieusement de mettre un terme aux méfaits de ces brigands, je reçus en conséquence l’ordre de me porter à leur recherche, et de tâcher de les prendre, comme on dit, la main dans le sac. On insistait principalement sur ce dernier point, qui était de la plus haute importance. Je m’affublai donc d’un costume convenable, et le soir même, je me mis en campagne dans le faubourg Saint-Germain, dont je parcourus les mauvais lieux. À minuit, j’entre chez un nommé Boucher, rue Neuve-Guillemain, je prends un petit verre avec des filles publiques, et tandis que je suis dans leur compagnie, j’entends, à une table voisine de la mienne, résonner le nom de Constantin ; j’imagine d’abord qu’il est présent, je questionne adroitement une fille. « Il n’est pas là, me dit-elle, mais il y vient tous les jours avec ses amis. » Au ton dont elle me parla, je crus m’apercevoir qu’elle était très au fait des habitudes des ces messieurs : je l’engageai à souper avec moi, dans l’espoir de la faire jaser ; elle accepta, et lorsqu’elle fut passablement animée par l’effet des liqueurs fermentées, elle s’expliqua d’autant plus ouvertement, que mon costume, mes gestes et surtout mon langage la confirmaient dans l’idée que j’étais un ami (voleur). Nous passâmes une partie de la nuit ensemble, et je ne me retirai que lorsqu’elle m’eut instruit des endroits que fréquentait Gueuvive.
Le lendemain, à midi je me rendis chez Boucher. J’y retrouvai ma particulière de la veille ; à peine suis-je entré, elle me reconnaît. « Te voilà, me dit-elle, si tu veux parler à Gueuvive, il est ici. » Et elle m’indiqua un individu de 28 à 30 ans, vêtu assez proprement, quoique en veste ; il avait environ cinq pieds six pouces, une assez jolie figure, des cheveux noirs, de beaux favoris, de belles dents ; c’était bien ainsi qu’on me l’avait dépeint. Sans hésiter, je l’accoste, en le priant de me donner une pipe de tabac ; il m’examine, me demande si j’ai été militaire ; je lui réponds que j’ai servi dans les hussards, et bientôt, le verre à la main, nous entamons une conversation sur les armées.
Tout en buvant, le temps se passe, on parle de dîner, Gueuvive me dit qu’il a arrangé une partie, et que si je veux en être, je lui ferai plaisir. Ce n’était pas le cas de refuser, je me rends sans plus de façons à son invitation, et nous allons à la barrière du Maine, où l’attendaient quatre de ses amis. En arrivant, nous nous mîmes à table ; aucun des convives ne me connaissait ; j’étais pour eux un visage nouveau ; aussi fut-on assez circonspect. Néanmoins, quelques mots d’argot, lâchés par intervalles, ne tardèrent pas à m’apprendre que tous les membres de cette aimable compagnie étaient des ouvriers (voleurs).
Ils voulurent savoir ce que je faisais ; je leur bâtis un conte à ma manière, et d’après ce que je leur dis, ils crurent non-seulement que je venais de la province, mais encore que j’étais un voleur qui cherchait à s’accrocher à quelque chose. Je ne m’expliquai pas positivement à cet égard, mais affectant certaines manières qui trahissent la profession, je leur laissai entrevoir que j’étais assez embarrassé de ma personne.
Le vin ne fut pas épargné, il délia toutes les langues, si bien qu’avant la fin du repas, je sus la demeure de Gueuvive, celle de Joubert, son digne acolyte, ainsi que les noms de plusieurs de leurs camarades. Au moment de nous séparer, je fis entendre que je ne savais trop où aller coucher ; Joubert offrit de m’emmener chez lui, et il me conduisit rue Saint-Jacques, n° 99, où il occupait une chambre au second étage sur le derrière ; là, je partageai avec lui le lit de sa maîtresse, la fille Cornevin.
L’entretien fut long : avant de nous endormir Joubert m’accablait de questions. Il tenait absolument à connaître quels étaient mes moyens d’existence, il s’enquérait si j’avais des papiers, sa curiosité était inépuisable : pour la satisfaire, j’éludais ou je mentais, mais en cherchant toujours à lui faire concevoir que j’étais un confrère. Enfin il me dit, comme s’il m’avait deviné : « Ne battez plus, vous êtes un grinche. (Ne dissimulez plus, vous êtes un voleur.). » Je parus ne pas comprendre ces paroles, il me les expliqua en français ; et ayant l’air de prendre la mouche, je lui répondis qu’il se trompait, que s’il prétendait me plaisanter de la sorte, je serais obligé de me retirer. Joubert se tut, et il ne fut plus question de rien jusqu’au lendemain dix heures, que Gueuvive vint nous réveiller.
Il fut convenu que nous irions déjeûner à la Glacière. Nous partîmes. Chemin faisant, Gueuvive me prit à part et me dit : « Écoute, je vois que tu es un bon garçon, je veux te rendre service ; ne sois pas si dissimulé, dis-moi qui tu es et d’où tu sors ? » Quelques demi-confidences lui ayant donné à penser que je pourrais bien être un échappé du bagne de Toulon, il me recommanda d’être discret avec ses camarades : « Ce sont, ajouta-t-il, les meilleurs enfants du monde, mais un peu bavards.
– » Oh ! je suis sur mes gardes, lui répliquai-je ; et puis je ne crois pas moisir à Paris, il y a trop de mouchards pour que j’y sois en sûreté.
– » C’est vrai, me dit-il, mais si tu n’es pas connu de Vidocq, tu n’as rien à craindre, surtout avec moi, qui flaire ces gredins-là comme les corbeaux sentent la poudre.
– » Quant à moi, repris-je, je ne suis pas si malin. Cependant si j’étais en présence de Vidocq, d’après la description qu’on m’en a faite, ses traits sont si bien gravés dans ma tête, qu’il me semble que je le reconnaîtrais tout de suite.
– » Tais-toi donc, on voit bien que tu ne connais pas le pèlerin ! Figure-toi qu’il se change à volonté : le matin, par exemple, il sera habillé comme te voilà ; à midi, ce n’est plus ça ; le soir c’est encore autre chose. Pas plus tard qu’hier, ne l’ai-je pas rencontré en général ?… mais je n’ai pas été dupe du déguisement ; d’ailleurs, il a beau faire, lui comme les autres, je les devine au premier coup d’œil, et si tous mes amis étaient comme moi, il y a long-temps qu’il aurait sauté le pas.
– » Bah ! lui fis-je observer, tous les Parisiens en disent autant, et il est toujours là.
– » Tu as raison, me dit-il ; mais pour te prouver que je ne suis pas comme ces badauds, si tu veux m’accompagner, dès ce soir nous irons l’attendre à sa porte, et nous lui ferons son affaire. »
J’étais bien aise de savoir s’il savait effectivement ma demeure ; je lui promis de le seconder, et, vers la brune, il fut convenu que chacun de nous mettrait dans son mouchoir dix pièces de deux sous en cuivre, afin d’en administrer quelques bons coups à ce gueux de Vidocq, lorsqu’il entrerait chez lui ou en sortirait.
Les mouchoirs sont préparés, et nous nous mettons en route ; Constantin était déjà un peu dans le train, il nous conduisit rue Neuve-Saint-François, tout juste devant la maison n° 14, où je demeurais en effet. Je ne concevais pas comment il s’était procuré mon adresse ; j’avoue que cette circonstance m’inquiéta et que dès lors il me sembla bien étrange qu’il ne me connût pas physiquement. Nous fîmes plusieurs heures de faction, et Vidocq, comme on le pense bien, ne parut pas. Constantin était on ne peut plus contrarié de ce contre-temps. « Il nous échappe aujourd’hui, me dit-il, mais je te jure que je le rencontrerai, et il me paiera cher la garde qu’il nous a fait monter. »
À minuit, nous nous retirâmes, en remettant la partie au lendemain. Il était assez piquant de me voir mettre en réquisition pour coopérer à un guet-apens dirigé contre moi. Constantin me sut beaucoup de gré de ma bonne volonté : dès ce moment, il n’eut plus de secret pour moi ; il projetait de commettre un vol rue Cassette, il me proposa d’en être ; je lui promis d’y participer, mais en même temps je lui déclarai que je ne pouvais ni ne voulais sortir la nuit sans papiers. « Eh bien ! me dit-il, tu nous attendras à la chambre. »
Enfin le vol eut lieu, et comme l’obscurité était grande, Constantin et ses compagnons, qui voulaient voir clair en marchant, eurent la hardiesse de décrocher un réverbère, que l’un d’eux portait devant le cortège. En rentrant, ils plantèrent ce fanal au milieu de la chambre, et se mirent à faire la revue du butin. Ils étaient au comble de la joie, en contemplant les résultats de leur expédition ; mais à peine cinquante minutes s’étaient écoulées depuis leur retour, qu’on frappe à la porte, les voleurs étonnés se regardent les uns les autres sans répondre. C’était une surprise que je leur avais ménagée. On frappe encore ; Constantin alors, commandant par un signe le silence, dit à voix basse : « C’est la police, j’en suis sûr. » Soudain, je me lève et me glisse sous un lit : les coups redoublent, on est forcé d’ouvrir.
Au même instant, un essaim d’inspecteurs envahit la chambre, on arrête Constantin et quatre autres voleurs ; on fait une perquisition générale : on visite le lit dans lequel est la maîtresse de Joubert, on sonde même le dessous de la couchette avec une canne, et l’on ne me trouve pas. Je m’y attendais.
Le commissaire de police dresse un procès-verbal, on inventorie les marchandises volées, et on les emballe pour la préfecture avec les cinq voleurs.
L’opération terminée, je sortis de ma cachette ; j’étais alors avec la fille Cornevin, qui, ne pouvant assez s’étonner de mon bonheur auquel elle ne comprenait rien, m’engagea à rester chez elle : « Y songez-vous ? lui répondis-je ; la police n’aurait qu’à revenir ! » et je la quittai, en lui promettant de la rejoindre à l’Estrapade.
J’allai chez moi prendre du repos, et à l’heure indiquée, je fus exact au rendez-vous. La fille Cornevin m’y attendait. C’était sur elle que je comptais pour obtenir la liste complète de tous les amis de Joubert et de Constantin : comme j’étais bon enfant avec elle, elle me mit promptement en rapport avec eux, et en moins de quinze jours, grâce à un auxiliaire que je lançai dans la troupe, je réussis à les faire arrêter les mains pleines ; ils étaient au nombre de dix-huit : ainsi que Constantin, il furent tous condamnés aux galères.
Au moment du départ de la chaîne, Constantin, m’ayant aperçu, devint furieux ; il voulut se répandre en invectives contre moi ; mais, sans m’offenser de ses grossières apostrophes, je m’approchai de lui et lui dis avec sang-froid, qu’il était bien surprenant qu’un homme tel que lui, qui connaissait Vidocq, et jouissait de la précieuse faculté de sentir un mouchard d’aussi loin que les corbeaux sentent la poudre, se fût laissé dindonner de la sorte.
Atterré, confondu par cette foudroyante réplique, Constantin baissa les yeux et se tut.
CHAPITRE XXVIII
Les agents de police pris parmi les forçats libérés, les voleurs, les filles publiques et les souteneurs. – Le vol toléré. – Mollesse des inspecteurs. – Coalition des mouchards. – Ils me dénoncent. – Destruction de trois classes de voleurs. – Formation d’une bande de nouvelle espèce. – Les frères Delzève. – Comment découverts. – Arrestation de Delzève jeune. – Les étrennes d’un préfet de police. – Je m’affranchis du joug des officiers de paix et des inspecteurs. – On en veut à mes jours. – Quelques anecdotes.
Je n’étais pas le seul agent secret de la police de sûreté : un Juif nommé Gaffré m’était adjoint. Il avait été employé avant moi, mais comme ses principes n’étaient pas les miens, nous ne fûmes pas long-temps d’accord. Je m’aperçus qu’il avait une mauvaise conduite, j’en avertis le chef de division, qui, ayant reconnu la vérité de mon rapport, l’expulsa et lui donna l’ordre de quitter Paris. Quelques individus sans autre aptitude au métier que cette espèce de rouerie que l’on acquiert dans les prisons, étaient également attachés à la police de sûreté, mais ils n’avaient point de traitement fixe, et n’étaient rétribués que par capture. Ces derniers étaient des condamnés libérés. Il y avait aussi des voleurs en exercice, dont on tolérait la présence à Paris, à la condition de faire arrêter les malfaiteurs qu’ils parviendraient à découvrir : souvent, quand ils ne pouvaient mieux faire, il leur arrivait de livrer leurs camarades. Après les voleurs tolérés, venaient en troisième ou en quatrième ligne, toute cette multitude de méchants garnements qui vivaient avec des filles publiques mal famées. Cette caste ignoble donnait parfois des renseignements fort utiles pour arrêter les filous et les escrocs ; d’ordinaire, ils étaient prêts à fournir toute espèce d’indications pour obtenir la liberté de leurs maîtresses, lorsqu’elles étaient détenues. On tirait encore parti des femmes qui vivaient avec ces voleurs connus et incorrigibles qu’on envoyait de temps en temps faire un tour à Bicêtre : c’était là le rebut de l’espèce humaine, et pourtant il avait été jusqu’alors indispensable de s’en servir ; car une expérience malheureusement trop longue avait démontré que l’on ne pouvait compter ni sur le zèle ni sur l’intelligence des inspecteurs. L’intention de l’administration n’était pas d’employer à la recherche des voleurs des hommes non soudoyés, mais elle était bien aise de profiter de la bonne volonté de ceux qui, par un intérêt quelconque, ne se dévouaient à la police que sous la réserve qu’ils resteraient derrière le rideau et jouiraient de certaines immunités. M. Henry avait compris depuis long-temps combien il était dangereux de faire usage de ces couteaux à deux tranchants ; depuis long-temps il avait songé à s’en délivrer, et c’était dans cette vue qu’il m’avait enrôlé dans la police, qu’il voulait purger de tous les hommes dont le penchant au vol était bien avéré. Il est des cures que les médecins n’opèrent qu’en faisant usage du poison : il peut se faire que la lèpre sociale ne puisse se guérir que par des moyens analogues ; mais ici le poison avait été administré à trop forte dose : ce qui le prouve, c’est que presque tous les agents secrets de cette époque ont été arrêtés par moi en flagrant délit, et que la plupart sont encore dans les bagnes.
Lorsque j’entrai à la police, tous ces agents secrets des deux sexes durent naturellement se liguer contre moi ; prévoyant que leur règne allait finir, ils firent tout ce qui dépendait d’eux pour le prolonger. Je passais pour inflexible et impartial ; je ne voulais pas ce qu’ils appelaient prendre des deux mains, il était juste qu’ils se déclarassent mes ennemis. Ils n’épargnèrent pas les attaques pour me faire succomber : inutiles efforts ! je résistai à la tempête, comme ces vieux chênes dont la tête se courbe à peine, malgré la violence de l’ouragan.
Chaque jour j’étais dénoncé, mais la voix de mes calomniateurs était impuissante. M. Henry, qui avait l’oreille du préfet, lui répondait de mes actions, et il fut décidé que toute dénonciation dirigée contre moi me serait immédiatement communiquée, et qu’il me serait permis de la réfuter par écrit. Cette marque de confiance me fit plaisir, et sans me rendre ni plus dévoué ni plus attaché à mes devoirs, elle me prouva du moins que mes chefs savaient me rendre justice, et rien au monde n’aurait été capable de me faire déroger au plan de conduite que je m’étais tracé.
En toutes choses, pour réussir, il faut un peu d’enthousiasme. Je n’espérais pas rendre honorable la qualité d’agent secret ; mais je me flattais d’en remplir les fonctions avec honneur. Je voulais que l’on me jugeât intègre, incorruptible, intrépide, infatigable ; j’aspirais aussi à paraître en toute occasion capable et intelligent : le succès de mes opérations contribua à donner de moi cette opinion. Bientôt M. Henry ne fit plus rien sans me consulter ; nous passions ensemble les nuits à combiner des moyens de répression, qui devinrent si efficaces, qu’en peu de temps le nombre des plaintes en vol fut considérablement diminué : c’est que le nombre des voleurs de tout genre s’était réduit en proportion. Je puis même dire qu’il y eut un moment où les voleurs d’argenterie dans l’intérieur des maisons, ceux qui dévalisent les voitures et chaises de poste, ainsi que les filous faisant la montre et la bourse, ne donnaient plus signe de vie. Plus tard, il devait s’en former une génération nouvelle, mais pour la dextérité il était impossible qu’elle égalât jamais les Bombance, les Marquis, les Boucault, les Compère, les Bouthey, les Pranger, les Dorlé, les La Rose, les Gavard, les Martin, et autres rusés coquins, que j’ai réduits à l’inaction. Je n’étais pas décidé à laisser à leurs successeurs le loisir d’acquérir une si rare habileté.
Depuis environ six mois, je marchais seul, sans autres auxiliaires que quelques femmes publiques, qui s’étaient dévouées, lorsqu’une circonstance imprévue vint me faire sortir de la dépendance des officiers de paix, qui jusqu’alors avaient su adroitement faire rejaillir sur eux le mérite de mes découvertes. Cette circonstance eut l’avantage pour moi de mettre en évidence la mollesse et l’ineptie des inspecteurs, qui s’étaient plaint avec tant d’amertume de ce que je leur donnais trop d’occupations. Pour arriver au fait, je vais reprendre la narration de plus haut.
En 1810, des vols d’un genre nouveau et d’une hardiesse inconcevable vinrent tout à coup donner l’éveil à la police sur l’existence d’une bande de malfaiteurs d’une nouvelle espèce.
La presque totalité des vols avait été commise à l’aide d’escalade et d’effraction ; des appartements situés au premier et même au deuxième étage avaient été dévalisés par ces voleurs extraordinaires, qui jusqu’alors ne s’étaient attaqués qu’aux maisons riches : il était même aisé de remarquer que ces coquins s’y prenaient de manière à indiquer qu’ils avaient une parfaite connaissance des localités.
Tous mes efforts pour découvrir ces adroits voleurs étaient restés sans succès, lorsqu’un vol dont l’exécution semblait présenter d’insurmontables obstacles fut commis rue Saint-Claude, près celle de Bourbon-Villeneuve, dans un appartement au deuxième au-dessus de l’entresol, dans la maison même où demeurait le commissaire de police du quartier. La corde de la lanterne suspendue à la porte de ce fonctionnaire avait servi d’échelle.
Une musette (petit sac de toile dans lequel on donne l’avoine aux chevaux stationnaires) avait été laissée sur le lieu du crime ; ce qui fit présumer que les voleurs pouvaient être des cochers de fiacre, ou tout au moins que des fiacres avaient aidé à l’expédition.
M. Henry m’engagea à prendre des renseignements sur les cochers, et je parvins à savoir que la musette avait appartenu à un nommé Husson, conduisant le fiacre n° 712 ; je fis mon rapport, Husson fut arrêté, et par lui on eut des notions sur deux frères nommés Delzève, dont l’aîné ne tarda pas non plus à être sous la main de la police : ce dernier, interrogé par M. Henry, fut amené à faire quelques révélations importantes, qui firent arrêter le nommé Métral, employé en qualité de frotteur dans la maison de l’impératrice Joséphine. Ce dernier était signalé comme le recéleur de la bande, composée presqu’en entier de Savoyards, nés dans le département du Léman. La continuation de mes recherches me conduisit à m’assurer de la personne des frères Pissard, de Grenier, de Lebrun, de Piessard, de Mabou, dit l’Apothicaire, de Serassé, de Durand, enfin de vingt-deux, qui plus tard furent tous condamnés aux fers.
Ces voleurs étaient pour la plupart commissionnaires, frotteurs ou cochers, c’est-à-dire qu’ils appartenaient à une classe d’individus dans laquelle la probité était une tradition, et qui de temps immémorial était réputée honnête parmi les Parisiens ; tous dans leur quartier étaient regardés comme des hommes éprouvés, incapables de convoiter même le bien d’autrui, et cette considération qu’on leur accordait les rendait d’autant plus redoutables que les personnes qui les employaient, soit à scier le bois, soit à tout autre ouvrage, étaient sans défiance à leur égard, et les laissaient s’introduire partout. Quand on sut qu’ils étaient impliqués dans une affaire criminelle, à peine osait-on croire qu’ils fussent coupables ; moi-même je balançai quelque temps à le supposer. Cependant, il fallut se rendre à l’évidence des faits, et la vieille renommée des Savoyards, dans une capitale où elle était restée intacte durant des siècles, s’évanouit sans retour.
Dans le courant de 1812, j’avais livré à la justice les principaux membres de la bande. Cependant Delzève jeune n’avait pas encore été atteint, et continuait de se dérober aux investigations de la police, lorsque, le 31 décembre, M. Henry me dit : « Je crois que si nous nous y prenions bien, nous viendrions à bout d’arrêter l’Écrevisse (surnom de Delzève) ; voici le jour de l’an, il ne peut manquer d’aller voir la blanchisseuse qui lui a si souvent donné asile, ainsi qu’à son frère : j’ai le pressentiment qu’il y viendra, soit ce soir, soit dans la nuit, soit enfin demain dans la matinée. »
Je fus de l’avis de M. Henry, et il m’ordonna en conséquence d’aller, avec trois inspecteurs, me placer en surveillance à proximité du domicile de la blanchisseuse, qui restait rue des Grésillons, faubourg Saint-Honoré, à la Petite-Pologne.
Je reçus cet ordre avec cette satisfaction qui m’a constamment présagé la réussite. Accompagné des trois inspecteurs, je me rends à sept heures du soir au lieu indiqué. Il faisait un froid excessif ; la terre était couverte de neige, l’hiver n’avait pas encore été si rigoureux.
Nous nous postons aux aguets : après plusieurs heures, les inspecteurs transis et ne pouvant plus résister, me proposent de quitter la station ; j’étais moi-même à moitié gelé, n’ayant pour me garantir qu’un vêtement fort léger de commissionnaire ; je fis d’abord quelques observations, et quoiqu’il m’eût été fort agréable de me retirer, il fut convenu que nous resterions jusqu’à minuit. À peine cette heure fixée pour notre départ a-t-elle sonné, ils me somment de tenir ma promesse, et nous voilà abandonnant un poste qu’il nous était prescrit de garder jusqu’au jour.
Nous nous dirigeons vers le Palais-Royal, un café est encore ouvert ; nous entrons pour nous réchauffer, et après avoir pris un bol de vin chaud, nous nous séparons, chacun dans l’intention de gagner notre logis. Tout en m’acheminant vers le mien, je réfléchis à ce que je venais de faire : « Eh quoi ! me disais-je, oublier si vite les instructions qui m’ont été données ! » tromper de la sorte la confiance du chef, c’est une lâcheté impardonnable ! Ma conduite me semblait, non-seulement répréhensible, mais encore je pensais qu’elle méritait la punition la plus sévère. J’étais au désespoir d’avoir suivi l’impulsion des inspecteurs : décidé à réparer ma faute, je prends le parti de retourner seul au poste qui m’était assigné, bien résolu à y passer la nuit, dussé-je mourir sur place. Je reviens donc à la Pologne, et me blottis dans un coin pour ne pas être aperçu par Delzève, dans le cas où il lui prendrait fantaisie de venir.
Il y avait une heure et demie que j’étais dans cette position ; mon sang se congelait ; je sentais faiblir mon courage ; tout à coup il me vient une idée lumineuse : non loin de là est un dépôt de fumier et d’autres immondices, dont la vapeur révèle un état de fermentation : ce dépôt est ce que l’on nomme la voirie ; j’y cours, et après avoir creusé dans un endroit une fosse assez profonde pour y descendre jusqu’à hauteur de la ceinture, je m’enfonce dans le trou, où une douce chaleur rétablit la circulation dans mes veines.
À cinq heures du matin, je n’avais pas quitté ma retraite, où, sauf l’odeur, j’étais assez bien. Enfin la porte de la maison qui m’était signalée s’ouvre pour donner passage à une femme qui ne la referme pas. Aussitôt, sans faire de bruit, je m’échappe de la voirie, et peu d’instants après j’entre dans la cour ; j’examine, mais je ne vois de lumière nulle part.
Je savais que les associés de Delzève avaient une manière de s’appeler en sifflant ; leur coup de sifflet qui était celui des cochers, m’était connu ; je l’imite, et à la deuxième fois j’entends crier : « Qui appelle ?
– » C’est le Chauffeur (cocher de qui Delzève avait appris à conduire) qui siffle l’Écrevisse.
– » Est-ce toi ? me crie encore la même voix (c’était Delzève).
– » Oui, c’est le Chauffeur qui te demande, descends.
– » J’y vais, attends-moi une minute.
– » Il fait trop froid, lui répliquai-je ; je vais t’attendre chez le rogomiste du coin, dépêche-toi, entends-tu ? »
Le rogomiste avait déjà ouvert : on sait qu’un premier jour de l’an, ils ont des pratiques matinales. Quoi qu’il en fût, je n’étais pas tenté de boire. Afin de tromper Delzève par une feinte, j’ouvre la porte de l’allée, et l’ayant laissée bruyamment retomber sans sortir, je vais me cacher sous un escalier dans la cour. Bientôt après Delzève descend, je l’aperçois : marchant alors droit à lui, je le saisis au collet, et lui mettant le pistolet sur la poitrine, je lui notifie qu’il est mon prisonnier. « Suis-moi, lui dis-je, et songe bien qu’au moindre geste, je te casse un membre : au surplus, je ne suis pas seul. »
Muet de stupéfaction, Delzève ne répond mot et me suit machinalement ; je lui ordonne de me remettre ses bretelles, il obéit ; dès ce moment je fus maître de lui, il ne pouvait plus me résister ni fuir.
Je me hâtai de l’emmener. L’horloge frappait six heures comme nous entrions dans la rue du Rocher, un fiacre vint à passer, je lui fis signe d’arrêter ; l’état où le cocher me voyait dut lui inspirer quelque crainte pour la propreté de sa voiture ; mais j’offris de lui payer double course ; et, séduit par l’appât du gain, il consentit à nous recevoir. Nous voici donc roulant sur le pavé de Paris. Pour être plus en sûreté, je garrotte mon compagnon, qui, ayant repris ses sens, pouvait avoir le désir de s’insurger ; j’aurais pu, comptant sur ma force, ne pas employer ce moyen, mais comme je me proposais de le confesser, je ne voulais pas me brouiller avec lui, et des voies de fait, lors même qu’il les aurait provoquées par une rébellion, auraient eu infailliblement ce résultat.
Delzève réduit à l’impossibilité de s’évader, je tâchai de lui faire entendre raison ; afin de l’amadouer, je lui offre de se rafraîchir, il accepte ; le cocher nous procure du vin, et sans avoir de but fixe, nous continuons de nous promener en buvant.
Il était encore de bonne heure : persuadé qu’il y aurait quelque avantage pour moi à prolonger le tête-à-tête, je propose à Delzève de l’emmener déjeûner dans un endroit où nous trouverons des cabinets particuliers. Il était alors tout-à-fait apaisé et paraissait sans rancune ; il ne repousse pas l’invitation, et je le conduis au Cadran bleu. Mais avant d’y arriver, il m’avait déjà donné de précieux renseignements sur bon nombre de ses affidés, encore libres dans Paris, et j’étais convaincu qu’à table il se déboutonnerait complètement. Je lui fis entendre que le seul moyen de se rendre intéressant aux yeux de la justice, était de faire des révélations ; et afin de fortifier sa résolution, je lui décochai quelques arguments d’une certaine philosophie que j’ai toujours employée avec succès pour la consolation des prévenus ; enfin, il était parfaitement disposé quand la voiture s’arrêta à la porte du restaurateur. Je le fis aussitôt monter devant moi, et au moment de faire ma carte, je lui dis que, désirant pouvoir manger avec tranquillité, je le priais de me permettre de l’attacher à ma manière. Je consentais à lui laisser dans toute sa plénitude le jeu des bras et de la fourchette, à table on ne saurait désirer d’autre liberté. Il ne s’offensa point de la précaution, et voici ce que je fis : avec les deux serviettes, je lui liai chaque jambe aux pieds de sa chaise, à trois ou quatre pouces du parquet, ce qui l’empêchait de tenter de se mettre debout, sans risquer de se briser la tête.
Il déjeûna avec beaucoup d’appétit, et me promit de répéter en présence de M. Henry tout ce qu’il m’avait confessé. À midi, nous prîmes le café : Delzève était en pointe de vin, et nous repartîmes en fiacre, tout à fait réconciliés et bons amis : dix minutes après, nous étions à la préfecture. M. Henry était alors entouré de ses officiers de paix, qui lui faisaient leur cour du jour de l’an. J’entre et lui adresse ce salut : « J’ai l’honneur de vous souhaiter la bonne et heureuse année, accompagné du fameux Delzève.
» Voilà ce qu’on appelle des étrennes, me dit M. Henry, en apercevant le prisonnier. » Puis s’adressant aux officiers de paix et de sûreté : « Il serait à désirer, messieurs, que chacun de vous en eût de semblables à offrir à M. le Préfet. » Immédiatement après, il me remit l’ordre de conduire Delzève au dépôt, et me dit avec bonté : « Vidocq, allez vous reposer, je suis content de vous. »
L’arrestation de Delzève me valut d’éclatants témoignages de satisfaction ; mais en même temps elle ne fit qu’augmenter la haine que me vouaient les officiers de paix, et leurs agents. Un seul, M. Thibaut, ne cessa de me rendre justice.
Faisant chorus avec les voleurs, et les malveillants, tous les employés qui n’étaient pas heureux en police, jetaient feu et flamme contre moi : à les entendre, c’était un scandale, une abomination, d’utiliser mon zèle pour purger la société des malfaiteurs qui troublent son repos. J’avais été un voleur célèbre, il n’y avait sorte de crimes que je n’eusse commis : tels étaient les bruits qu’ils se plaisaient à accréditer. Peut-être en croyaient-ils une partie ; les voleurs du moins étaient persuadés que j’avais, comme eux, exercé le métier ; en le disant ils étaient de bonne foi. Avant de tomber dans mes filets, il fallait bien qu’ils pussent supposer que j’étais un des leurs ; une fois pris, ils me regardaient comme un faux frère ; mais je n’en étais pas moins, à leurs yeux, un grinche de la haute pègre (voleur du grand genre) ; seulement je volais avec impunité, parce que la police avait besoin de moi : c’était là le conte que l’on faisait dans les prisons. Les officiers de paix et les agents en sous-ordre n’étaient pas fâchés de le répandre comme une vérité, et puis peut-être, en devenant l’écho des misérables qui avaient à se plaindre de moi, ne présumaient-ils pas mentir autant qu’ils le faisaient ; car, en ne se donnant pas la peine de vérifier mes antécédents, jusqu’à un certain point, ils étaient excusables de penser que j’avais été voleur, puisque de temps immémorial, tous les agents secrets avaient exercé cette noble profession. Ils savaient qu’ainsi avaient commencé les Goupil, les Compère, les Florentin, les Lévesque, les Coco-Lacour, les Bourdarie, les Cadet Herriez, les Henri Lami, les César Viocque, les Bouthey, les Gaffré, les Manigant, enfin tous ceux qui m’avaient précédé ou qui m’étaient adjoints ; ils avaient vu la plupart de ces agents tomber en récidive, et comme je leur semblais, avec raison, beaucoup plus rusé, beaucoup plus actif, beaucoup plus entreprenant qu’eux, ils en conclurent que si j’étais le plus adroit des mouchards, c’est que j’avais été le plus adroit des voleurs. Cette erreur de raisonnement, je la leur pardonne ; il n’en est pas de même de cette assertion, intentionnellement calomnieuse, que je volais tous les jours.
M. Henry, frappé de l’absurdité d’une pareille imputation, leur répondit par cette observation : « S’il est vrai, leur dit-il, que Vidocq commette journellement des vols, c’est une raison de plus pour vous accuser d’incapacité : il est seul, vous êtes nombreux, vous êtes instruits qu’il vole, comment se fait-il que vous ne le preniez pas sur le fait ? seul il est parvenu à saisir en flagrant délit plusieurs de vos collègues, et vous ne pouvez, à vous tous, lui rendre la pareille ! ! ! »
Les inspecteurs auraient été fort embarrassés de répondre, ils se turent ; mais comme il était trop évident que l’inimitié qu’ils me portaient irait toujours croissant, le préfet de police prit le parti de me rendre indépendant. Dès ce moment, je fus libre d’agir comme je le jugerais convenable au bien du service, je ne reçus plus d’ordre direct que de M. Henry, et ne fus astreint à rendre compte de mes opérations qu’à lui seul.
J’eusse redoublé de zèle, s’il eût été possible. M. Henry ne craignait pas que mon dévouement se ralentît ; mais comme déjà il se trouvait des gens qui en voulaient à mes jours, il me donna un auxiliaire qui fut chargé de me suivre à distance, et de veiller sur moi, afin de prévenir les coups qu’on aurait eu l’intention de me porter dans l’ombre. L’isolement dans lequel on m’avait placé favorisa singulièrement mes succès ; j’arrêtai une multitude de voleurs qui auraient encore long-temps échappé aux recherches, si je n’eusse pas été affranchi de la tutelle des officiers de paix et du cortège des inspecteurs ; mais plus souvent en action, je finis aussi par être plus connu. Les voleurs jurèrent de se défaire de moi : maintes fois je faillis tomber sous leurs coups ; ma force physique, et, j’ose dire, mon courage, me firent sortir victorieux des guets-apens les mieux combinés. Plusieurs tentatives, dans lesquelles les assaillants furent toujours maltraités, leur apprirent que j’étais décidé à vendre chèrement ma vie.
CHAPITRE XXIX
Je cherche deux grinches fameux. – La maîtresse de piano ou encore une mère des voleurs. – Une métamorphose, ce n’est pas la dernière. – Quelques scènes d’hospitalité. – La fabrique de fausses clefs. – Combinaison pour un coup de filet superbe. – Perfidie d’un agent. – La mèche est éventée. – La mère Noël se vole et m’accuse de l’avoir volée. – Mon innocence reconnue. – La calomniatrice à Saint-Lazare.
Il est bien rare qu’un forçat s’évade avec l’intention de s’amender ; le plus souvent il ne se propose que de gagner la capitale, afin d’y exercer la funeste habileté qu’il a pu acquérir dans les bagnes, qui, ainsi que la plupart de nos prisons, sont des écoles où l’on se perfectionne dans l’art de s’approprier le bien d’autrui. Presque tous les grands voleurs ne sont devenus experts qu’après avoir séjourné aux galères plus ou moins de temps. Quelques-uns ont subi cinq ou six condamnations avant d’être des grinches en renom ; tels étaient le fameux Victor Desbois et son camarade Mongenet, dit le Tambour, qui, dans diverses apparitions à Paris, ont commis un grand nombre de ces vols que le peuple aime à raconter comme preuve d’adresse et d’audace.
Ces deux hommes qui, depuis plusieurs années, étaient de tous les départs de la chaîne, et parvenaient toujours à s’échapper, étaient encore une fois à Paris : la police en fut informée, et je reçus l’ordre de me mettre à leur recherche. Tout faisait présumer qu’ils avaient des accointances avec d’autres condamnés, non moins dangereux. On soupçonnait une maîtresse de piano, dont le fils, le nommé Noël, dit aux besicles, était un célèbre brigand, de donner par fois asile à ces derniers. Madame Noël était une femme bien élevée ; elle était excellente musicienne, et, dans la classe moyenne des bourgeois qui l’appelaient à donner des leçons à leurs demoiselles, elle passait pour une artiste distinguée. Elle courait le cachet dans le Marais et dans le quartier Saint-Denis, où l’élégance de ses manières, la pureté de son langage, une légère recherche dans le costume, et certains airs de cette grandeur qui ne s’efface pas tout-à-fait par des revers de fortune, laissaient croire qu’elle pouvait appartenir à l’une de ces nombreuses familles auxquelles la révolution n’avait plus laissé que de la morgue et des regrets. À la voir et à l’entendre, quand on ne la connaissait pas, Madame Noël était une petite femme fort intéressante ; bien plus, il y avait quelque chose de touchant dans son existence ; c’était un mystère, on ne savait ce qu’était devenu son mari. Quelques personnes assuraient qu’elle était tombée de bonne heure dans le veuvage ; d’autres qu’elle avait été délaissée ; on prétendait aussi qu’elle était une victime de la séduction. J’ignore laquelle de ces conjectures se rapprochait le plus de la vérité, mais ce que je sais bien, c’est que Madame Noël était une petite brune, dont l’œil vif et le regard lutin, se conciliaient cependant avec des apparences de douceur que semblaient confirmer l’amabilité de son sourire et le son de sa voix, dans laquelle il y avait beaucoup de charme. Il y avait de l’ange et du démon dans cette figure, mais plus du démon que de l’ange ; car les années avaient développé les traits qui caractérisent les mauvaises pensées.
Madame Noël était obligeante et bonne, mais c’était uniquement pour les individus qui avaient eu quelque démêlé avec la justice ; elle les accueillait comme la mère d’un soldat accueille les camarades de son fils. Pour être bien venu auprès d’elle, il suffisait d’être du même régiment que Noël aux besicles, et alors, autant par amour pour lui que par goût peut-être, elle aimait à rendre service ; aussi était-elle regardée comme la mère des voleurs, c’était chez elle qu’ils descendaient ; c’était elle qui pourvoyait à tous leurs besoins ; elle poussait la complaisance jusqu’à leur chercher de l’ouvrage, et quand un passe-port était indispensable pour leur sûreté, elle n’était pas tranquille qu’elle n’eût réussi à le leur procurer. Madame Noël avait beaucoup d’amies parmi les personnes de son sexe ; c’était d’ordinaire au nom de l’une d’elles que le passe-port était pris ; à peine était-il délivré, une bonne lessive d’acide muriatique oxygéné faisait disparaître l’écriture, et le signalement du monsieur, ainsi que le nom qu’il lui convenait de prendre, remplaçaient le signalement féminin. Madame Noël avait même d’habitude sous sa main une raisonnable provision de ces passeports lavés, qui étaient comme des chevaux à toute selle.
Tous les galériens étaient les enfants de Madame Noël, seulement elle choyait plus particulièrement ceux qui s’étaient trouvés en relation avec son fils : elle avait pour eux un dévouement sans bornes ; sa maison était ouverte à tous les évadés dont elle était le rendez-vous ; et il faut bien que parmi ces gens-là il y ait de la reconnaissance, puisque la police était informée qu’ils venaient souvent chez la mère Noël pour le seul plaisir de la voir : elle était la confidente de tous leurs projets, de toutes leurs aventures, de toutes leurs alarmes : enfin ils se confiaient à elle sans restriction, et ils étaient certains de sa fidélité.
La mère Noël ne m’avait jamais vu, mes traits lui étaient tout-à-fait inconnus, bien que souvent elle eût entendu prononcer mon nom. Il ne m’était donc pas difficile de me présenter à elle sans lui inspirer de craintes, mais l’amener à m’indiquer la retraite des hommes qu’il m’importait de découvrir, était le but que je me proposais, et je présumais que je n’y parviendrais pas sans beaucoup d’adresse. D’abord, je résolus de me faire passer pour un évadé ; mais il était nécessaire d’emprunter le nom d’un voleur que son fils ou les camarades de son fils lui eussent peint sous des rapports avantageux. Un peu de ressemblance était en outre indispensable : je cherchai si dans le nombre des forçats de ma connaissance il n’en existait pas un qui eût été lié avec Noël aux besicles, et je n’en découvris aucun qui fût à peu près de mon âge, ou dont le signalement eût quelque analogie avec le mien. Enfin, à force de me mettre l’esprit à la torture et de solliciter ma mémoire, je me souvins d’un nommé Germain, dit Royer, dit Capitaine, qui avait été dans l’intimité de Noël, et quoiqu’il ne me ressemblât pas le moins du monde, il fut le personnage que je me proposai de représenter.
Germain, ainsi que moi, s’était plusieurs fois échappé des bagnes, c’était là tout ce qu’il y avait de commun entre nous ; il avait à peu-près mon âge, mais il était plus petit que moi : il avait les cheveux bruns, les miens étaient blonds ; il était maigre, et je ne manquais pas d’embonpoint ; son teint était basané, j’avais la peau très blanche et le teint fort clair ; ajoutez à cela que Germain était pourvu d’un nez excessivement long, qu’il prenait une grande quantité de tabac, et qu’il avait constamment au dehors comme au-dedans des narines obstruées par une roupie considérable, ce qui lui donnait une voix nasillarde.
J’avais fort à faire pour jouer le personnage de Germain. La difficulté ne m’effraya pas : mes cheveux, coupés à la manière du bagne, furent teints en noir ainsi que ma barbe, après que je l’eus laissée croître pendant huit jours ; afin de me brunir le visage, je le lavai avec une décoction de brou de noix ; et pour compléter l’imitation, je simulai la roupie en me garnissant le dessous du nez d’une espèce de couche de café rendue adhérente au moyen de la gomme arabique ; cet agrément n’était pas superflu, car il contribuait à me donner l’accent nasillard de Germain. Mes pieds furent également arrangés avec beaucoup d’art : je me fis venir des ampoules, en me frottant d’une espèce de composition dont on m’avait communiqué la recette à Brest. Je dessinai les stigmates des fers ; et quand toute cette toilette fut terminée, je pris l’accoutrement qui convient à la position. Je n’avais rien négligé pour donner de la vraisemblance à la métamorphose, ni les souliers ni la chemise marqués des terribles lettres G. A. L. : le costume était parfait, il n’y manquait que quelques centaines de ces insectes qui peuplent les solitudes de la pauvreté et qui furent je crois, avec les sauterelles et les crapauds, une des sept plaies de la vieille Égypte ; je m’en procurai à prix d’argent ; et dès qu’ils se furent acclimatés, ce qui est l’affaire d’une minute, je me dirigeai vers la demeure de la mère Noël, qui restait rue Tiquetonne.
J’arrive, je frappe ; elle ouvre, un coup-d’œil la met au fait ; elle me fait entrer, je vois que je suis seul avec elle, je vais lui dire qui je suis. « Ah ! mon pauvre garçon, s’écria-t-elle, on n’a pas besoin de demander d’où vous venez ; je suis sûre que vous avez faim ? – Ah ! oui, bien faim, lui répondis-je, il y a vingt-quatre heures que je n’ai rien pris. » Aussitôt, sans attendre d’explication, elle sort et revient avec une assiette de charcuterie et une bouteille de vin qu’elle dépose devant moi. Je ne mange pas, je dévore, je m’étouffais pour aller plus vite ; tout avait disparu, qu’entre une bouchée et l’autre je n’avais pas placé un mot. La mère Noël était enchantée de mon appétit ; quand la table fut rase, elle m’apporta la goutte. « Ah ! maman, lui dis-je, en me jetant à son cou pour l’embrasser, vous me rendez la vie, Noël m’avait bien dit que vous étiez bonne. » Et je partis de là pour lui raconter que j’avais quitté son fils depuis dix-huit jours, et pour lui donner des nouvelles de tous les condamnés auxquels elle s’intéressait. Les détails dans lesquels j’entrais étaient si vrais et si connus, qu’il ne pouvait lui venir à l’idée que je fusse un imposteur.
« Vous n’êtes pas sans avoir entendu parler de moi, continuai-je, j’ai essuyé beaucoup de traverses, on me nomme Germain, dit Capitaine, vous devez me connaître de nom ? – « Oui, oui, mon ami, me dit-elle, je ne connais que vous, ô mon Dieu, mon fils et ses amis m’ont assez entretenu de vos malheurs ; soyez le bienvenu, mon cher Capitaine. Mais grand Dieu ! comme vous êtes fait ; vous ne pouvez pas rester dans l’état où je vous vois. Il paraît même que vous êtes incommodé par un vilain bétail qui vous tourmente : attendez, je vais vous faire changer de linge et faire en sorte de vous vêtir plus convenablement. »
J’exprimai ma reconnaissance à la mère Noël, et quand je crus pouvoir le faire sans inconvénient, je m’informai de ce qu’étaient devenus Victor Desbois et son camarade Mongenet. « Desbois et le Tambour, ah ! mon cher, ne m’en parlez pas, me répondit-elle, ce coquin de Vidocq leur a causé bien de la peine : depuis qu’un nommé Joseph (Joseph Longueville, ancien inspecteur de police), dont ils ont fait deux fois la rencontre dans cette rue, leur a dit qu’il venait dans ce quartier, pour ne pas tomber sous sa coupe ils ont été contraints d’évacuer.
– » Quoi ! ils ne sont plus dans Paris, m’écriai-je, un peu désappointé.
– » Oh ! ils ne sont pas loin, reprit la mère Noël, ils n’ont pas quitté les environs de la grande vergne, j’ai même encore l’avantage de les voir de loin en loin, j’espère bien qu’ils ne tarderont pas à me faire une petite visite. Je crois qu’ils seront bien aises de vous trouver ici.
– » Oh ! je vous assure, lui dis-je, qu’ils n’en seront pas plus satisfaits que moi, et si vous pouviez leur écrire, je suis bien certain qu’ils s’empresseraient de m’appeler auprès d’eux.
– » Si je savais où ils sont, reprit Madame Noël, j’irais moi-même les chercher pour vous faire plaisir ; mais j’ignore leur retraite, et ce que nous avons de mieux à faire, c’est de prendre patience et de les attendre. »
En ma qualité d’arrivant, j’excitais toute la sollicitude de la mère Noël, elle ne s’occupait que de moi.
« Êtes-vous connu de Vidocq et de ses deux chiens, Lévesque et Compère ? me demanda-t-elle.
– » Hélas ! oui, répondis-je, ils m’ont déjà arrêté deux fois.
– » En ce cas, prenez garde, Vidocq est souvent déguisé ; il revêt tous les costumes pour arrêter les malheureux comme vous. »
Nous causions depuis environ deux heures, lorsque Madame Noël offrit de me faire prendre un bain de pieds ; j’acceptai, il fut bientôt prêt. Quand je me déchaussai, elle faillit se trouver mal. « Que je vous plains, me dit-elle dans un accès de sa sensibilité maternelle, combien vous devez souffrir ; mais aussi pourquoi ne pas l’avoir dit tout de suite, me mériteriez-vous pas d’être grondé ? » Et tout en m’adressant des reproches, elle se mit en devoir de me visiter les pieds ; puis, après avoir percé chaque ampoule, elle y passa de la laine, et m’oignit avec une pommade dont elle m’assura que l’effet serait des plus prompts. Il y avait quelque chose d’antique dans les soins de cette touchante hospitalité, seulement ce qui manquait à la poésie de l’action, c’est que je fusse quelque illustre voyageur, et la mère Noël une noble étrangère. Le pansement terminé, elle m’apporta du linge blanc, et comme elle songeait à tout, elle me remit en même temps un rasoir en me recommandant de me faire la barbe. « Je verrai ensuite, ajouta-t-elle, à vous acheter des vêtements d’ouvrier au Temple, c’est le vestiaire général des gens dans la débine. Enfin, n’importe, le hasard vaut souvent du neuf. »
Dès que je fus approprié, la mère Noël me conduisit dans le dortoir : c’était une pièce qui servait aussi d’atelier pour la fabrication des fausses-clefs ; l’entrée en était masquée par des robes pendues à un portemanteau. « Voilà, me dit-elle, un lit dans lequel vos amis ont couché plus de quatre fois : il n’y a pas de danger que la police vous déterre ici ; vous pouvez dormir sur l’une et l’autre oreille.
– Ce n’est pas sans faute, répondis-je ; » et je sollicitai d’elle la permission de prendre quelque repos : elle me laissa seul. Trois heures après, je fus censé m’être éveillé ; je me levai et la conversation recommença. Il fallait être ferré pour tenir tête à la mère Noël : pas une habitude des bagnes qu’elle ne connût sur le bout du doigt : elle avait retenu non seulement les noms de tous les voleurs qu’elle avait vus ; mais encore elle était instruite des moindres particularités de la vie de la plupart des autres ; et elle racontait avec enthousiasme l’histoire des plus fameux, notamment celle de son fils, pour qui elle avait presque autant de vénération que d’amour.
« Ce cher fils, vous seriez donc bien contente de le revoir ? lui dis-je.
– » Oh ! oui, bien contente.
– » Eh bien ! c’est un bonheur dont je crois que vous jouirez bientôt, Noël a tout disposé pour une évasion, à présent il n’attend plus que le moment propice. »
Madame Noël était heureuse de l’espoir d’embrasser son fils ; elle versait des larmes d’attendrissement. J’avoue que j’étais moi-même vivement ému ; c’était au point que je mis un instant en délibération si, pour cette fois, je ne transigerais pas avec mes devoirs d’agent secret ; mais en réfléchissant aux crimes que la famille Noël avait commis, en songeant surtout à l’intérêt de la société, je restai ferme et inébranlable dans ma résolution de poursuivre mon entreprise jusqu’au bout.
Dans le cours de notre conversation, la mère Noël me demanda si j’avais quelque affaire en vue (un projet de vol), et après avoir offert de m’en procurer une, dans le cas où je n’en aurais pas, elle me questionna pour savoir si j’étais habile à fabriquer les clefs ; je lui répondis que j’étais aussi adroit que Fossard. « S’il en est ainsi, me dit-elle, je suis tranquille, vous serez bientôt remonté, et elle ajouta, puisque vous êtes adroit, je vais acheter chez le quincaillier une clef que vous ajusterez à mon verrou de sûreté, afin de la garder sur vous de manière à pouvoir entrer et sortir quand il vous plaira. »
Je lui témoignai combien j’étais pénétré de son obligeance ; et comme il se faisait tard, j’allai me coucher en songeant au moyen de me tirer de ce guêpier sans courir le risque d’être assassiné, si par hasard les coquins que je cherchais y venaient avant que j’eusse pris mes mesures.
Je ne dormis pas, et me levai aussitôt que j’entendis la mère Noël allumer son feu : elle trouva que j’étais matinal, et me dit qu’elle allait me chercher ce dont j’avais besoin. Un instant après, elle m’apporta une clef non évidée, me donna des limes avec un petit étau que je fixai au pied du lit, et dès que je fus pourvu de ces outils, je me mis à l’œuvre, en présence de mon hôtesse, qui voyant que je m’y connaissais, me fit compliment sur mon travail ; ce qu’elle admirait le plus, c’était la manière expéditive dont je m’y prenais ; en effet, en moins de quatre heures j’eus fait une clef très ouvragée ; je l’essayai, elle ouvrait presque dans la perfection, quelques coups de lime en firent un chef-d’œuvre ; et, comme les autres, je me trouvai maître de m’introduire au logis quand bon me semblerait.
J’étais le pensionnaire de Madame Noël. Après le dîner, je lui dis que j’avais envie de faire un tour à la brune, afin de m’assurer si une affaire que j’avais en vue était encore faisable, elle approuva mon idée, mais en me recommandant de bien faire attention à moi. « Ce brigand de Vidocq, observa-t-elle, est bien à craindre, et si j’étais à votre place, avant de rien entreprendre, j’aimerais mieux attendre que mes pieds fussent guéris. – Oh ! je n’irai pas loin, lui répondis-je, et je ne tarderai pas à être de retour. » L’assurance que je reviendrais promptement parut la tirer d’inquiétude. « Eh ! bien allez », me dit-elle, et je sortis en boitant.
Jusque-là tout s’arrangeait au gré de mes désirs ; on ne pouvait être plus avant dans les bonnes grâces de la mère Noël : mais en restant dans sa maison, qui me répondait que je n’y serais pas assommé ? Deux ou trois forçats ne pouvaient-ils pas venir à la fois, me reconnaître et me faire un mauvais parti ? Alors, adieu les combinaisons, il fallait donc sans perdre le fruit des amitiés de la mère Noël, me prémunir contre un pareil danger ; il eût été trop imprudent de lui laisser soupçonner que j’avais des raisons d’éviter les regards de ses habitués : en conséquence, je tâchai de l’amener à m’éconduire elle-même, c’est-à-dire à me conseiller dans mon intérêt de ne plus coucher chez elle.
J’avais remarqué que la femme Noël était très liée avec une fruitière qui habitait dans la maison ; je détachai à cette femme le nommé Manceau, l’un de mes affidés que je chargeai de lui demander secrètement et avec maladresse des renseignements sur le compte de Madame Noël. J’avais dicté les questions, et j’étais d’autant plus certain que la fruitière ne manquerait pas de divulguer la démarche, que j’avais prescrit à mon affidé de lui recommander la discrétion.
L’événement prouva que je ne m’étais pas trompé, mon agent n’eut pas plutôt rempli sa mission que la fruitière s’empressa d’aller rendre compte de ce qui s’était passé à la mère Noël, qui, à son tour, ne perdit pas de temps pour me faire part de la confidence. Postée en vedette sur le pas de la maison de l’officieuse voisine, d’aussi loin qu’elle m’aperçut, elle vint droit à moi, et sans préambule, elle m’invita à la suivre ; je rebroussai chemin, et quand nous fûmes sur la place des Victoires, elle s’arrêta, regarda autour d’elle, et après s’être assurée que personne ne nous avait remarqués, elle s’approcha de moi, et me raconta ce qu’elle avait appris. « Ainsi, dit-elle en finissant, vous voyez, mon pauvre Germain, qu’il ne serait pas prudent à vous de coucher à la maison, vous ferez même bien de vous abstenir d’y venir dans le jour. » La mère Noël ne se doutait guère que ce contre-temps dont elle se montrait véritablement affligée, était mon ouvrage. Afin de détourner de plus en plus les soupçons, je feignis d’être encore plus chagrin qu’elle, je maudis, avec accompagnement de deux ou trois jurons, ce gueux de Vidocq, qui ne nous laissait point de repos ; je pestai contre la nécessité où il me réduisait d’aller chercher un gîte hors de Paris, et je pris congé de la mère Noël, qui, en me souhaitant bonne chance et un prompt retour, me glissa dans la main une pièce de trente sous.
Je savais que Desbois et Mongenet étaient attendus ; j’étais en outre informé qu’il y avait des allants et des venants qui hantaient le logis, que la mère Noël y fût ou qu’elle n’y fût pas ; c’était même assez ordinairement pendant qu’elle donnait des leçons en ville. Il m’importait de connaître tous ces abonnés… Pour y parvenir, je fis déguiser quelques auxiliaires, et les apostai au coin de la rue, où, confondus avec les commissionnaires, leur présence ne pouvait être suspecte.
Ces précautions prises, pour me donner toutes les apparences de la crainte je laissai s’écouler deux jours sans aller voir la mère Noël. Ce délai expiré, je me rendis un soir chez elle, accompagné d’un jeune homme que je présentai comme le frère d’une femme avec laquelle j’avais vécu, et qui m’ayant rencontré par hasard, au moment où je me disposais à sortir de Paris, m’avait donné asile. Le jeune homme était un agent secret ; j’eus soin de dire à la mère Noël qu’il avait toute ma confiance, qu’elle pouvait le considérer comme un second moi-même, et que comme il n’était pas connu des mouchards, je l’avais choisi pour en faire mon messager auprès d’elle, toutes les fois que je ne jugerais pas prudent de me montrer. « Désormais, ajoutai-je, c’est lui qui sera notre intermédiaire, il viendra tous les deux ou trois jours afin d’avoir de vos nouvelles et de celles de nos amis.
– » Ma foi, me dit la mère Noël, vous avez bien perdu, vingt minutes plus tôt vous auriez vu ici une femme qui vous connaît bien.
– » Et qui donc ?
– » La sœur de Marguerit.
– » C’est juste, elle m’a vu souvent avec son frère.
– » Aussi, quand je lui ai parlé de vous, vous a-t-elle dépeint trait pour trait ; un maigriot, m’a-t-elle dit, qui a toujours du tabac plein le nez. »
Madame Noël regrettait beaucoup que je ne fusse pas arrivé avant le départ de la sœur de Marguerit, mais pas autant sans doute que je m’applaudissais d’avoir échappé à une entrevue qui aurait déjoué tous mes projets : car si cette femme connaissait Germain, elle connaissait aussi Vidocq, et il était impossible qu’elle prît l’un pour l’autre, la différence était si grande ! Quoique je me fusse grimé de manière à faire illusion, la ressemblance, si parfaite dans la description, n’était pas à l’épreuve d’un examen approfondi, et surtout des souvenirs de l’intimité. La mère Noël me donna donc un avertissement très utile, en me racontant qu’elle avait assez souvent la visite de la sœur de Marguerit. Dès lors je me promis bien que cette fille ne me verrait jamais en face, et, pour éviter de me trouver avec elle, toutes les fois que je devais venir, je me faisais précéder de mon prétendu beau-frère, qui, lorsqu’elle n’y était pas, avait ordre de me le faire savoir, en appliquant du bout du doigt un pain à cacheter sur la vitre. À ce signal, j’accourais, et mon aide-de-camp allait se mettre aux aguets dans les environs, afin de m’épargner toute surprise désagréable. Non loin de là étaient d’autres auxiliaires à qui j’avais remis la clef de la mère Noël, pour qu’ils fussent prêts à me secourir en cas de danger ; car, d’un instant à l’autre, il pouvait se faire que je tombasse à l’improviste au milieu des évadés, ou que les évadés m’ayant reconnu tombassent sur moi, et alors un coup de poing lancé dans un carreau de l’une des croisées, devait indiquer que j’avais besoin de renfort pour égaliser la partie.
On voit que toutes mes mesures étaient prises. Le dénouement approchait ; nous étions au mardi ; une lettre des hommes que je cherchais annonça leur arrivée pour le vendredi suivant. Le vendredi devait être pour eux un jour néfaste. Dès le matin, j’allai m’établir dans un cabaret du voisinage, et afin de ne pas leur fournir une occasion de m’observer, dans la supposition où, suivant leur usage, ils passeraient et repasseraient dans la rue avant d’entrer au domicile de la mère Noël, j’y envoyai mon prétendu beau-frère, qui revint bientôt après me dire que la sœur de Marguerit n’y était pas, et que je pouvais me présenter en toute sûreté. « Tu ne me trompes pas ? » observai-je à cet agent dont la voix me parut sensiblement altérée ; aussitôt je le regardai de cet œil qui plonge jusqu’au fond de l’âme, et je crus remarquer dans les muscles de son visage quelques-unes de ces contractions encore mal arrêtées qui dénotent un individu qui se compose pour mentir ; enfin, un je ne sais quoi semblait m’indiquer que j’avais affaire à un traître. C’était la première impression qui me frappait comme un jet de lumière : nous étions dans un cabinet particulier ; sans balancer, je saisis mon homme au collet, et lui dis, en présence de ses camarades, que j’étais instruit de sa perfidie, et que si, à l’instant même, il ne me l’avouait pas, ç’en était fait de lui. Épouvanté, il balbutia quelques mots d’excuse, et en tombant à mes genoux, il confessa qu’il avait tout dit à la mère Noël.
Cette indiscrétion, si je ne l’avais pas devinée, m’aurait peut-être coûté la vie : cependant je n’écoutai pas mon ressentiment personnel, ce n’était que dans l’intérêt de la société que j’étais fâché d’échouer si près du port. Le traître Manceau fut arrêté, et tout jeune qu’il était, comme il avait de vieux péchés à expier, on l’envoya à Bicêtre, et ensuite à l’île d’Oléron, où il a fini sa carrière.
On se doute bien que les évadés ne revinrent plus dans la rue Tiquetonne, mais ils n’en furent pas moins arrêtés peu de temps après.
La mère Noël ne me pardonnait pas le mauvais tour que je lui avais joué ; afin de prendre sa revanche, elle imagina, tout pour un jour, de faire disparaître de chez elle la presque totalité de ses effets, et quand elle eut opéré cet enlèvement, elle sortit sans fermer sa porte, et revint en criant qu’elle était volée. Les voisins sont pris à témoins, une déclaration est faite chez le commissaire, et la mère Noël me désigne comme le voleur, attendu, assurait-elle, que j’avais eu une clef de sa chambre. L’accusation était grave : elle fut envoyée sur-le-champ à la préfecture de police, et le lendemain j’en reçus communication. Ma justification n’était pas difficile. M. le préfet ainsi que M. Henry virent de suite l’imposture, et les perquisitions qu’ils ordonnèrent furent si bien dirigées, que les effets soustraits par la mère Noël furent tous retrouvés. On eut la preuve qu’elle m’avait calomnié, et pour lui donner le temps de s’en repentir, on l’enferma six mois à Saint-Lazare.
Telles furent l’issue et la suite d’une entreprise dans laquelle je n’avais pourtant pas manqué de prévoyance ; j’ai souvent réussi avec des combinaisons moins faites pour conduire au succès.
CHAPITRE XXX
Les officiers de paix envoyés à la poursuite d’un voleur célèbre. – Ils ne parviennent pas à le découvrir. – Grande colère de l’un d’entre eux. – Je promets de nouvelles étrennes au préfet. – Les rideaux jaunes et la bossue. – Je suis un bon bourgeois. – Un commissionnaire me fait aller. – La caisse de la préfecture de police. – Me voici charbonnier. – Les terreurs d’un marchand de vin et de madame son épouse. – Le petit Normand qui pleure. – Le danger de donner de l’eau de Cologne. – Enlèvement de mademoiselle Tonneau. – Une perquisition. – Le voleur me prend pour son compère. – Inutilité des serrures. – Le saut par la croisée. – La glissade, et les coutures rompues.
On a vu quels désagréments m’a causé l’infidélité d’un agent : je savais depuis long-temps qu’il n’est de secret bien gardé que celui qu’on ne confie pas ; mais la triste expérience qu’il m’avait fallu faire me convainquit de plus en plus de la nécessité d’opérer seul toutes les fois que je le pourrais, et c’est ce que je fis, ainsi qu’on va le voir, dans une occasion très importante.
Après avoir subi plusieurs condamnations, deux évadés des îles, les nommés Goreau et Florentin, dit Chatelain, dont j’ai déjà parlé, étaient détenus à Bicêtre comme voleurs incorrigibles. Las du séjour dans ces cabanons, où l’on est comme enterré vivant, ils firent parvenir à M. Henry une lettre dans laquelle ils offraient de fournir des indices, au moyen desquels il serait possible de se saisir de plusieurs de leurs camarades qui commettaient journellement des vols dans Paris. Le nommé Fossard, condamné à perpétuité, et plusieurs fois évadé des bagnes, était celui qu’ils désignaient comme le plus adroit de tous, en même temps qu’ils le représentaient comme le plus dangereux. « Il était, écrivaient-ils, d’une intrépidité sans égale, et il ne fallait l’aborder qu’avec des précautions, attendu que, toujours armé jusqu’aux dents, il avait formé la résolution de brûler la cervelle à l’agent de police qui serait assez hardi pour vouloir l’arrêter. »
Les chefs supérieurs de l’administration ne demandaient pas mieux que de délivrer la capitale d’un garnement pareil : leur première idée fut de m’employer à le découvrir ; mais les donneurs d’avis ayant fait observer à M. Henry que j’étais trop connu de Fossard et de sa concubine pour ne pas faire manquer une opération si délicate, dans le cas où l’on m’en chargerait, il fut décidé que l’on recourrait au ministère des officiers de paix. On mit donc à leur disposition les renseignements propres à les diriger dans leurs recherches ; mais, soit qu’ils ne fussent pas heureux, soit qu’ils ne se souciassent pas de rencontrer Fossard, qui était armé jusqu’aux dents, ce dernier continua ses exploits, et les nombreuses plaintes auxquelles son activité donna lieu annoncèrent que, malgré leur zèle apparent, ces messieurs, suivant leur coutume, faisaient plus de bruit que de besogne.
Il en résulta que le préfet, qui aimait que l’on fit plus de besogne que de bruit, les manda un jour, et leur adressa des reproches qui durent être assez sévères, à en juger par le mécontentement qu’en cette occasion ils ne purent s’empêcher de manifester.
On venait justement de leur laver la tête, lorsqu’il m’arriva, sur le marché Saint-Jean, de faire la rencontre de M. Yvrier, l’un d’entre eux : je le salue ; il vient à moi, et, presque bouffi de colère, il m’aborde en me disant : « Ah ! vous voilà, monsieur le grand faiseur, vous êtes la cause que nous venons de recevoir des réprimandes au sujet d’un nommé Fossard, forçat évadé, que l’on prétend être à Paris. À entendre M. le préfet, on croirait que dans l’administration il n’est que vous qui soyez capable de quelque chose. Si Vidocq, nous a-t-il dit, eût été envoyé à sa poursuite, nul doute qu’il ne fût depuis long-temps arrêté. Allons, voyons, M. Vidocq, tâchez un peu de le trouver, vous qui êtes si adroit, prouvez que vous avez autant de malice que l’on vous en attribue. »
M. Yvrier était un vieillard, et j’eus besoin de respecter son âge pour ne pas rétorquer avec humeur son impertinente apostrophe. Quoique je me sentisse piqué du ton d’aigreur qu’il prenait en me parlant, je ne me fâchai point, et me contentai de lui répondre que pour le moment je n’avais guère le loisir de m’occuper de Fossard ; que c’était une capture que je réservais pour le premier janvier, afin de l’offrir en étrennes à M. le préfet, comme l’année d’auparavant j’avais offert le fameux Delzève.
« Allez votre train, reprit M. Yvrier, irrité de ce persiflage, la suite nous montrera qui vous êtes ; un présomptueux, un faiseur d’embarras. » Et il me quitta en murmurant entre ses dents quelques autres qualifications que je ne compris pas.
Après cette scène, j’allai au bureau de M. Henry, à qui je la racontai. « Ah ! ils sont courroucés, me dit-il en riant ; tant mieux ! c’est une preuve qu’ils reconnaissent votre habileté : ces messieurs, je le vois, ajouta M. Henry, sont comme les eunuques du sérail, parce qu’ils ne peuvent rien faire, ils ne veulent pas que les autres fassent. » Il me donna ensuite l’indication suivante :
Fossard demeure à Paris, dans une rue qui conduit de la halle au boulevard, c’est-à-dire à partir de la rue Comtesse-d’Artois jusqu’à la rue Poissonnière, en passant par la rue Montorgueil, et le Petit-Carreau ; on ignore à quel étage il habite ; mais on reconnaîtra les croisées de son appartement à des rideaux jaunes en soie, et à d’autres rideaux en mousseline brodée. Dans la même maison, reste une petite bossue, couturière de son état, et amie de la fille qui vit avec Fossard.
Le renseignement, ainsi qu’on le voit, n’était pas tellement précis que l’on pût aller droit au but.
Une femme bossue et des rideaux jaunes, avec accompagnement d’autres rideaux de mousseline brodée, n’étaient certes pas faciles à trouver sur un espace aussi vaste que celui que je devais explorer. Sans doute le concours de ces trois circonstances devait s’y présenter plus d’une fois. Combien de bossues, tant vieilles que jeunes, ne compte-t-on pas dans Paris ; et puis des rideaux jaunes, qui pourrait les nombrer ? En résumé, les données étaient assez vagues : cependant il fallait résoudre le problème. J’essayai si, à force de recherches, mon bon génie ne me ferait pas mettre le doigt sur le bon endroit.
Je ne savais pas par où commencer ; toutefois, comme je prévoyais que dans mes courses, c’était principalement à des femmes du peuple, c’est-à-dire à des commères, filles ou non, que j’allais avoir affaire, je fus bientôt fixé sur l’espèce de déguisement qu’il me convenait de prendre. Il était évident que j’avais besoin de l’air d’un monsieur bien respectable. En conséquence, au moyen de quelques rides factices, de la queue, du crêpé à frimas, de la grande canne à pomme d’or, du chapeau à trois cornes, des boucles, de la culotte et de l’habit à l’avenant, je me métamorphosai en un de ces bons bourgeois de soixante ans, que toutes les vieilles filles trouvent bien conservé : j’avais tout à fait l’aspect et la mise d’un de ces richards du Marais, dont la face rougeaude et engageante accuse l’aisance, et la velléité de faire le bonheur de quelque infortunée sur le retour. J’étais bien sûr que toutes les bossues auraient voulu de moi, et puis j’avais la mine d’un si brave homme, qu’il était impossible que l’on ne se fît pas scrupule de me tromper.
Travesti de la sorte, je me mis à parcourir les rues, le nez en l’air, en prenant note de tous les rideaux de la couleur qui m’était signalée. J’étais si occupé de ce recensement, que je n’entendais ni ne voyais rien autour de moi. Si j’eusse été un peu moins cossu, on m’eût pris pour un métaphysicien, ou peut-être pour un poète qui cherche un hémistiche dans la région des cheminées : vingt fois je faillis être écrasé par des cabriolets ; de tous côtés j’entendais crier gare ! gare ! et en me retournant, je me trouvais sous la roue, ou bien encore j’embrassais un cheval ; quelquefois aussi, pendant que j’essuyais l’écume dont ma manche était couverte, un coup de fouet m’arrivait à la figure, ou, quand le cocher était moins brutal, c’étaient des gentillesses de la nature de celle-ci : Ôte-toi donc, vieux sourdieau ; on alla même, je m’en souviens, jusqu’à m’appeler vieux lampion.
Ce n’était pas l’affaire d’un jour, que cette revue des rideaux jaunes ; j’en inscrivis plus de cent cinquante sur mon carnet, j’espère qu’il y avait du choix. Maintenant, n’avais-je pas travaillé, comme on dit, pour le roi de Prusse ? ne se pouvait-il pas que les rideaux derrière lesquels se cachait Fossard, eussent été envoyés chez le dégraisseur, et remplacés par des rideaux blancs, verts ou rouges ? n’importe, si le hasard pouvait m’être contraire, il pouvait aussi m’être favorable. Je pris donc courage, et quoiqu’il soit pénible pour un sexagénaire de monter et de descendre cent cinquante escaliers, c’est-à-dire de passer et de repasser devant environ sept cent cinquante étages ; de dévider plus de trente mille marches, ou deux fois la hauteur du Chimboraçao, comme je me sentais bonnes jambes et longue haleine, j’entrepris cette tâche, soutenu par un espoir du même genre que celui qui faisait voguer les Argonautes à la conquête de la Toison d’or. C’était ma bossue que je cherchais : dans ces ascensions, sur combien de carrés n’ai-je pas fait sentinelle pendant des heures entières, dans la persuasion que mon heureuse étoile me la montrerait ? L’héroïque don Quichotte n’était pas plus ardent à la poursuite de Dulcinée ; je frappais chez toutes les couturières, je les examinais toutes les unes après les autres : point de bossues, toutes étaient faites à ravir ; ou si, par cas fortuit, elles avaient une bosse, ce n’était point une déviation de la colonne vertébrale, mais l’une de ces exubérances qui peuvent se résoudre à la Maternité, ou partout ailleurs, sans le secours de l’orthopédie.
Plusieurs jours se passèrent ainsi, sans que je rencontrasse l’ombre de mon objet ; je faisais un métier d’enfer, tous les soirs j’étais échiné, et il fallait recommencer tous les matins. Encore si j’avais osé faire des questions, peut-être quelque âme charitable m’eût-elle mis sur la voie ; mais je craignais de me brûler à la chandelle : enfin, fatigué de ce manège, j’avisai à un autre moyen.
J’avais remarqué que les bossues sont en général babillardes et curieuses ; presque toujours ce sont elles qui font les propos du quartier, et quand elles ne les font pas, elles les enregistrent pour les besoins de la médisance ; rien ne doit se passer qu’elles n’en soient averties. Partant de cette donnée, je fus induit à en conclure que, sous le prétexte de faire sa petite provision, l’inconnue qui m’avait déjà fait faire tant de pas, ne devait pas plus que les autres, négliger de venir tailler la bavette obligée près de la laitière, du boulanger, de la fruitière, de la mercière ou de l’épicier. Je résolus en conséquence de me mettre en croisière à portée du plus grand nombre possible de ces organes du cancan ; et comme il n’est pas de bossue qui, dans la convoitise d’un mari, ne s’attache à faire parade de tous les mérites de la ménagère, je me persuadai que la mienne se levant matin, je devais, pour la voir, arriver de bonne heure sur le théâtre de mes observations : j’y vins dès le point du jour.
J’employai la première séance à m’orienter : à quelle laitière une bossue devait-elle donner la préférence ? nul doute, y eût-il un peu plus de chemin à faire, que ce fût à la plus bavarde et à la mieux achalandée. Celle du coin de la rue Thévenot me parut réunir cette double condition : il y avait autour d’elle des petits pots pour tout le monde, et au milieu d’un cercle très bien garni, elle ne cessait pas de parler et de servir ; les pratiques y faisaient la queue, et vraisemblablement aussi elle faisait la queue aux pratiques ; mais ce n’était pas ce qui m’inquiétait ; l’important pour moi, c’est que j’avais reconnu un point de réunion, et je me promis bien de ne pas le perdre de vue.
J’en étais à ma seconde séance ; aux aguets comme la veille, j’attendais avec impatience l’arrivée de quelque Ésope femelle, il ne venait que de jeunes filles, bonnes ou grisettes à la tournure dégagée, à la taille svelte, au gentil corsage, pas une d’elles qui ne fût droite comme un I ; j’en étais au désespoir… Enfin mon astre paraît à l’horizon ; c’est le prototype, la Vénus des bossues. Dieu ! qu’elle était jolie, et que la partie la plus sensible de son signalement était admirablement tournée ; je ne me lassais point de contempler cette saillie que les naturalistes auraient dû, je crois, prendre en considération, pour compter une race de plus dans l’espèce humaine ; il me semblait voir une de ces fées du moyen âge, pour lesquelles une difformité était un charme de plus. Cet être surnaturel, ou plutôt extra-naturel, s’approcha de la laitière, et après avoir causé quelque temps, comme je m’y étais attendu, elle prit sa crème ; c’était du moins ce qu’elle demandait ; ensuite elle entra chez l’épicier, puis elle s’arrêta un moment vers la tripière, qui lui donna du mou, probablement pour son chat ; puis, ses emplettes terminées, elle enfila, dans la rue du Petit-Carreau, l’allée d’une maison dont le rez-de-chaussée était occupé par un marchand boisselier. Aussitôt mes regards se portèrent sur les croisées ; mais ces rideaux jaunes après lesquels je soupirais, je ne les aperçus pas. Cependant, faisant cette réflexion, qui s’était déjà présentée à mon esprit, que des rideaux, quelle qu’en soit la nuance, n’ont pas l’inamovibilité d’une bosse de première origine, je projetai de ne pas me retirer sans avoir eu un entretien avec le petit prodige dont l’aspect m’avait tant réjoui. Je me figurais malgré mon désappointement sur l’une des circonstances capitales d’après lesquelles je devais me guider, que cet entretien me fournirait quelques lumières.
Je pris le parti de monter : parvenu à l’entresol, je m’informe à quel étage demeure une petite dame tant soit peu bossue. « C’est de la couturière que vous voulez parler, me dit-on, en me riant au nez. – Oui, c’est la couturière que je demande, une personne qui a une épaule un peu hasardée. » On rit de nouveau, et l’on m’indique le troisième sur le devant. Bien que les voisins fussent très obligeants, je fus sur le point de me fâcher de leur hilarité goguenarde : c’était une véritable impolitesse ; mais ma tolérance était si grande que je leur pardonnai volontiers de la trouver comique, et puis n’étais-je pas un bon homme ? je restai dans mon rôle. On m’avait désigné la porte, je frappe, on m’ouvre : c’est la bossue, et après les excuses d’usage sur l’importunité de la visite, je la prie de vouloir bien m’accorder un instant d’audience ; ajoutant que j’avais à l’entretenir d’une affaire qui m’était personnelle.
– « Mademoiselle, lui dis-je avec une espèce de solennité, après qu’elle m’eut fait prendre un siège en face d’elle, vous ignorez le motif qui m’amène près de vous, mais quand vous en serez instruite, peut-être que ma démarche vous inspirera quelque intérêt. »
La bossue imaginait que j’allais lui faire une déclaration ; le rouge lui montait au visage, et son regard s’animait, bien qu’elle s’efforçât de baisser la vue : je continuai :
– « Sans doute vous allez vous étonner qu’à mon âge on puisse être épris comme à vingt ans.
– » Eh ! monsieur, vous êtes encore vert, me dit l’aimable bossue, dont je ne voulais pas plus long-temps prolonger l’erreur.
– » Je me porte assez bien, repris-je, mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Vous savez que dans Paris il n’est pas rare qu’un homme et une femme vivent ensemble sans être mariés.
– » Pour qui me prenez-vous ? monsieur, me faire une proposition pareille ? s’écria la bossue, sans attendre que j’eusse achevé ma phrase. La méprise me fit sourire. « Je ne viens point vous faire de proposition, repartis-je ; seulement je désire que vous ayez la bonté de me donner quelques renseignements sur une jeune dame qui, m’a-t-on dit, habite dans cette maison avec un monsieur qu’elle fait passer pour son mari. – Je ne connais pas cela, répondit sèchement la bossue. Alors je lui donnai grosso modo le signalement de Fossard et de la demoiselle Tonneau, sa maîtresse. – Ah ! j’y suis, me dit-elle, un homme de votre taille et de votre corpulence à peu près ayant environ de trente à trente-deux ans, beau cavalier ; la dame, une brune piquante, beaux yeux, belles dents, grande bouche, des cils superbes, une petite moustache ; un nez retroussé, et avec tout cela une apparence de douceur et de modestie. C’est bien ici qu’ils ont demeuré, mais ils sont déménagés depuis peu de temps. » Je la priai de me donner leur nouvelle adresse, et sur sa réponse qu’elle ne la savait pas, je la suppliai en pleurant de m’aider à retrouver une malheureuse créature que j’aimais encore malgré sa perfidie.
La couturière était sensible aux larmes que je répandais ; je la vis tout émue, je chauffai de plus en plus le pathétique. « Ah ! son infidélité me causera la mort ; ayez pitié d’un pauvre mari, je vous en conjure ; ne me cachez pas sa retraite, je vous devrai plus que la vie. »
Les bossues sont compatissantes ; de plus, un mari est à leurs yeux un si précieux trésor ; tant qu’elles ne l’ont pas en leur possession, elles ne conçoivent pas que l’on puisse devenir infidèle : aussi ma couturière avait-elle l’adultère en horreur ; elle me plaignit bien sincèrement, et me protesta qu’elle désirerait m’être utile. « Malheureusement, ajouta-t-elle, leur déménagement ayant été fait par des commissionnaires étrangers au quartier, j’ignore complètement où ils sont passés et ce qu’ils sont devenus, mais si vous voulez voir le propriétaire ? » La bonne foi de cette femme était manifeste. J’allai voir le propriétaire ; mais tout ce qu’il put me dire, c’est qu’on lui avait payé son terme, et qu’on n’était pas venu aux renseignements.
À part la certitude d’avoir découvert l’ancien logement de Fossard, je n’étais guère plus avancé qu’auparavant. Néanmoins je ne voulus pas abandonner la partie sans avoir épuisé tous les moyens d’enquête. D’ordinaire, d’un quartier à l’autre, les commissionnaires se connaissent ; je questionnai ceux de la rue du Petit-Carreau, à qui je me représentai comme un mari trompé, et l’un d’eux me désigna l’un de ses confrères qui avait coopéré à la translation du mobilier de mon rival.
Je vis l’individu qui m’était indiqué, et je lui contai ma prétendue histoire : il m’écouta ; mais c’était un malin, il avait l’intention de me faire aller. Je feignis de ne pas m’en apercevoir, et pour le récompenser de m’avoir promis qu’il me conduirait le lendemain à l’endroit où Fossard était emménagé, je lui donnai deux pièces de cinq francs, qui furent dépensées le même jour, à la Courtille, avec une fille de joie.
Cette première entrevue eut lieu le surlendemain de Noël (27 décembre). Nous devions nous revoir le 28. Pour être en mesure au 1er janvier, il n’y avait pas de temps à perdre. Je fus exact au rendez-vous ; le commissionnaire, que j’avais fait suivre par des agents, n’eut garde d’y manquer. Quelques pièces de cinq francs passèrent encore de ma bourse dans la sienne ; je dus aussi lui payer à déjeûner ; enfin il se décida à se mettre en route, et nous arrivâmes tout près d’une jolie maison, située au coin de la rue Duphot et de celle Saint-Honoré. « C’est ici, me dit-il ; nous allons voir chez le marchand de vin du bas, s’ils y sont toujours. » Il souhaitait que je le régalasse une dernière fois. Je ne me fis pas tirer l’oreille ; j’entrai, nous vidâmes ensemble une bouteille de beaune, et quand nous l’eûmes achevée, je me retirai avec la certitude d’avoir enfin trouvé le gîte de ma prétendue épouse et de son séducteur. Je n’avais plus que faire de mon guide ; je le congédiai, en lui témoignant toute ma reconnaissance ; et pour m’assurer que, dans l’espoir de recevoir des deux mains, il ne me trahirait pas, je recommandai aux agents de le veiller de près, et surtout de l’empêcher de revenir chez le marchand de vin. Autant que je m’en souviens, afin de lui en ôter la fantaisie, on le mit à l’ombre : dans ce temps-là, on n’y regardait pas de si près ; et puis soyons plus francs : ce fut moi qui le fis coffrer ; c’était une juste représaille. « Mon ami, lui dis-je, j’ai remis à la police, un billet de cinq cents francs, destiné à récompenser celui qui me ferait retrouver ma femme. C’est à vous qu’il appartient, aussi vais-je vous donner une petite lettre pour aller le toucher. » Je lui donnai en effet la petite lettre qu’il porta à M. Henry. « Conduisez monsieur à la caisse, commanda ce dernier à un garçon de bureau ; et la caisse était la chambre Sylvestre, c’est-à-dire le dépôt, où mon commissionnaire eut le temps de revenir de sa joie.
Il ne m’était pas encore bien démontré que ce fût la demeure de Fossard qui m’avait été indiquée. Cependant je rendis compte à l’autorité de ce qui s’était passé, et, à toute échéance, je fus immédiatement pourvu du mandat nécessaire pour effectuer l’arrestation. Alors le richard du Marais se changea tout à coup en charbonnier, et dans cette tenue, sous laquelle ni ma mère ni les employés de la préfecture qui me voyaient le plus fréquemment, ne surent pas me deviner, je m’occupai à étudier le terrain sur lequel j’étais appelé à manœuvrer.
Les amis de Fossard, c’est-à-dire ses dénonciateurs, avaient recommandé de prévenir les agents chargés de l’arrêter, qu’il avait toujours sur lui un poignard et des pistolets, dont un à deux coups était caché dans un mouchoir de batiste, qu’il tenait constamment à la main. Cet avis nécessitait des précautions ; d’ailleurs, d’après le caractère connu de Fossard, on était convaincu que, pour se soustraire à une condamnation pire que la mort, un meurtre ne lui coûterait rien. Je voulais faire en sorte de ne pas être victime, et il me sembla qu’un moyen de diminuer considérablement le danger était de s’entendre à l’avance avec le marchand de vin dont Fossard était le locataire. Ce marchand de vin était un brave homme[7], mais la police a si mauvaise renommée, qu’il n’est pas toujours aisé de déterminer les honnêtes gens à lui prêter assistance. Je résolus de m’assurer de sa coopération en le liant par son propre intérêt. J’avais déjà fait quelques séances chez lui sous mes deux déguisements, et j’avais eu tout le loisir de prendre connaissance des localités, et de me mettre au courant du personnel de la boutique ; j’y revins sous mes habits ordinaires, et, m’adressant au bourgeois, je lui dis que je désirais lui parler en particulier. Il entra avec moi dans un cabinet, et là je lui tins à peu près ce discours : « Je suis chargé de vous avertir de la part de la police que vous devez être volé, le voleur qui a préparé le coup, et qui peut-être doit l’exécuter lui-même, loge dans votre maison, la femme qui vit avec lui vient même quelquefois s’installer dans votre comptoir, auprès de votre épouse, et c’est en causant avec elle, qu’elle est parvenue à se procurer l’empreinte de la clef qui sert à ouvrir la porte par laquelle on doit s’introduire. Tout a été prévu : le ressort de la sonnette destinée à vous avertir, sera coupé avec des cisailles, pendant que la porte sera encore entre-bâillée. Une fois dedans, on montera rapidement à votre chambre, et si l’on redoute le moins du monde votre réveil, comme vous avez affaire à un scélérat consommé, je n’ai pas besoin de vous expliquer le reste. – On nous escofiera, dit le marchand de vin effrayé ; et il appela aussitôt sa femme pour lui faire part de la nouvelle. – Eh bien ! ma chère amie, fiez-vous donc au monde ! cette madame Hazard, à qui l’on donnerait le bon Dieu sans confession, est-ce qu’elle ne veut pas nous faire couper le cou ? Cette nuit même, on doit venir nous égorger. – Non, non, dormez tranquilles, repris-je, ce n’est pas pour cette nuit : la recette ne serait pas assez bonne ; on attend que les Rois soient passés ; mais si vous êtes discrets, et que vous consentiez à me seconder, nous y mettrons bon ordre. »
Madame Hazard était la demoiselle Tonneau, qui avait pris ce nom, le seul sous lequel Fossard fût connu dans la maison ; j’engageai le marchand de vin et sa femme, qui étaient épouvantés de ma confidence, à accueillir les locataires dont je leur avait révélé le projet, avec la même bienveillance que de coutume. Il ne faut pas demander s’ils furent tout disposés à me servir. Il fut convenu entre nous que, pour voir passer Fossard et être plus à même d’épier l’occasion de le saisir, je me cacherais dans une petite pièce au bas d’un escalier.
Le 29 décembre, de grand matin, je vins m’établir à ce poste ; il faisait un froid excessif ; la faction fut longue, et d’autant plus pénible que nous étions sans feu : immobile et l’œil collé contre un trou pratiqué dans le volet, il s’en fallait que je fusse à mon aise. Enfin, vers les trois heures, il sort, je le suis : c’est bien lui ; jusqu’alors il m’était resté quelques doutes. Certain de l’identité, je veux sur-le-champ mettre le mandat à exécution, mais l’agent qui m’accompagne prétend avoir aperçu le terrible pistolet : afin de vérifier le fait, je précipite ma marche, je dépasse Fossard, et, revenant sur mes pas, j’ai le regret de voir que l’agent ne s’est pas trompé. Tenter l’arrestation, c’eût été s’exposer, et peut-être inutilement. Je me décidai donc à remettre la partie, et en me rappelant que quinze jours auparavant, je m’étais flatté de ne livrer Fossard que le 1er janvier, je fus presque satisfait de ce retard ; jusque-là je ne devais point me relâcher de ma surveillance.
Le 31 décembre, à onze heures, au moment où toutes mes batteries étaient dressées, Fossard rentre ; il est sans défiance, il monte l’escalier en fredonnant ; vingt minutes après, la disparition de la lumière indique qu’il est couché : voici le moment propice. Le commissaire et des gendarmes avertis par mes soins, attendaient au plus prochain corps-de-garde que je les fisse appeler ; ils s’introduisent sans bruit, et aussitôt commence une délibération sur les moyens de s’emparer de Fossard, sans courir le risque d’être tué ou blessé ; car on était persuadé qu’à moins d’une surprise, ce brigand se défendrait en déterminé.
Ma première pensée fut de ne pas agir avant le jour. J’étais informé que la compagne de Fossard descendait de très bonne heure pour aller chercher du lait ; on se fût alors saisi de cette femme, et après lui avoir enlevé sa clef, on serait entré à l’improviste dans la chambre de son amant ; mais ne pouvait-il pas arriver que, contre son habitude, celui-ci sortît le premier ? cette réflexion me conduisit à imaginer un autre expédient.
La marchande de vin, pour qui, suivant ce que j’avais appris, M. Hazard était plein de prévenances, avait près d’elle un de ses neveux : c’était un enfant de dix ans, assez intelligent pour son âge, et d’autant plus précoce dans le désir de gagner de l’argent, qu’il était Normand. Je lui promis une récompense, à condition que sous prétexte d’indisposition de sa tante, il irait prier madame Hazard de lui donner de l’eau de Cologne. J’exerçai le petit bonhomme à prendre le ton pieux qui convient en pareille circonstance, et quand je fus content de lui, je me mis en devoir de distribuer les rôles. Le dénouement approchait : je fis déchausser tout mon monde, et je me déchaussai moi-même, afin de ne pas être entendu en montant. Le petit bonhomme était en chemise ; il sonne, on ne répond pas ; il sonne encore : « Qui est là ? demanda-t-on. – C’est moi, madame Hazard ; c’est Louis ; ma tante se trouve mal et vous prie de lui donner un peu d’eau de Cologne : elle se meurt ! j’ai de la lumière. »
La porte s’ouvre ; mais à peine la fille Tonneau se présente, deux gendarmes vigoureux l’entraînent en lui posant une serviette sur la bouche pour l’empêcher de crier. Au même instant, plus rapide que le lion qui se jette sur sa proie, je m’élance sur Fossard, stupéfait de l’événement, et déjà lié, garrotté dans son lit ; il est mon prisonnier, qu’il n’a pas eu le temps de faire un seul geste, de proférer un seul mot : son étonnement fut si grand, qu’il fut près d’une heure avant de pouvoir articuler quelques paroles. Quand on eut apporté de la lumière, et qu’il vit mon visage noirci, et mes vêtements de charbonnier, il éprouva un tel redoublement de terreur que je pense qu’il se crut au pouvoir du Diable. Revenu à lui, il songea à ses armes, ses pistolets, son poignard, qui étaient sur la table de nuit, son regard se porta de ce côté, il fit un soubresaut, mais ce fut tout : réduit à l’impuissance de nuire, il fut souple et se contenta de ronger son frein.
Perquisition fut faite au domicile de ce brigand, réputé si redoutable, on y trouva une grande quantité de bijoux, des diamants et une somme de huit à dix mille francs. Pendant que l’on procédait à la recherche, Fossard ayant repris ses esprits me confia que sous le marbre du somno, il y avait encore dix billets de mille francs : « Prends-les, me dit-il, nous partagerons ou plutôt tu garderas pour toi ce que tu voudras. » Je pris en effet les billets comme il le désirait. Nous montâmes en fiacre et bientôt nous arrivâmes au bureau de M. Henry, où les objets trouvés chez M. Fossard furent déposés. On les inventoria de nouveau ; lorsqu’on vint au dernier article : « Il ne nous reste plus qu’à clore le procès-verbal, dit le commissaire, qui m’avait accompagné pour la régularité de l’expédition. – Un moment, m’écriai-je, voici encore dix mille francs que m’a remis le prisonnier. » Et j’exhibai la somme, au grand regret de Fossard, qui me lança un de ces coups d’œil dont le sens est : voilà un tour que je ne te pardonnerai pas.
Fossard débuta de bonne heure dans la carrière du crime. Il appartenait à une famille honnête, et avait même reçu une assez bonne éducation. Ses parents firent tout ce qui dépendait d’eux pour l’empêcher de s’abandonner à ses inclinations vicieuses. Malgré leurs conseils, il se jeta à corps perdu dans la société des mauvais sujets. Il commença par voler des objets de peu de valeur ; mais bientôt ayant pris goût à ce dangereux métier et rougissant sans doute d’être confondu avec les voleurs ordinaires, il adopta ce que ces messieurs appellent un genre distingué. Le fameux Victor Desbois et Noël aux besicles, que l’on compte encore aujourd’hui parmi les notabilités du bagne de Brest, étaient ses associés : ils commirent ensemble les vols qui ont motivé leur condamnation à perpétuité. Noël, à qui son talent de musicien et sa qualité de professeur de piano, donnaient accès dans une foule de maisons riches, y prenait des empreintes, et Fossard se chargeait ensuite de fabriquer les clefs. C’était un art dans lequel il eût défié les Georget, et tous les serruriers mécaniciens du globe. Point d’obstacles qu’il ne vînt à bout de vaincre : les serrures les plus compliquées, les secrets les plus ingénieux et les plus difficiles à pénétrer ne lui résistaient pas long-temps.
On conçoit quel parti devait tirer d’une si pernicieuse habileté, un homme qui avait en outre tout ce qu’il faut pour s’insinuer dans la compagnie des honnêtes gens et y faire des dupes ; ajoutez qu’il avait un caractère dissimulé et froid, et qu’il alliait le courage à la persévérance. Ses camarades le regardaient comme le prince des voleurs ; et de fait, parmi les grinches de la haute pègre, c’est-à-dire, dans la haute aristocratie des larrons, je n’ai connu que Cognard, le prétendu Pontis, comte de Sainte-Hélène, et Jossas, dont il est parlé dans le premier volume de ces Mémoires, qui puissent lui être comparés.
Depuis que je l’ai fait réintégrer au bagne, Fossard a fait de nombreuses tentatives pour s’évader. Des forçats libérés qui l’ont vu récemment, m’ont assuré qu’il n’aspirait à la liberté que pour avoir le plaisir de se venger de moi. Il s’est, dit-on, promis de me tuer. Si l’accomplissement de ce dessein dépendait de lui, je suis sûr qu’il tiendrait parole, ne fût-ce que pour donner une preuve d’intrépidité. Deux faits que je vais rapporter donneront une idée de l’homme.
Un jour Fossard était en train de commettre un vol dans un appartement situé à un deuxième étage : ses camarades qui faisaient le guet à l’extérieur, eurent la maladresse de laisser monter le propriétaire, qu’ils n’avaient sans doute pas reconnu : celui-ci met la clef dans la serrure, ouvre, traverse plusieurs pièces, arrive dans un cabinet et voit le voleur en besogne : il veut le saisir ; mais Fossard se mettant en défense, lui échappe ; une croisée est ouverte devant lui, il s’élance, tombe dans la rue sans se faire de mal, et disparaît comme l’éclair.
Une autre fois, pendant qu’il s’évade, il est surpris sur les toits de Bicêtre ; on lui tire des coups de fusil ; Fossard, que rien ne saurait déconcerter, continue de marcher sans ralentir ni presser le pas, et parvenu au bord du côté de la campagne, il se laisse glisser. Il y avait de quoi se rompre le cou cent fois, il n’eut pas la moindre blessure, seulement la commotion fut si forte que tous ses vêtements éclatèrent.
CHAPITRE XXXI
Une rafle à la Courtille. – La Croix-Blanche. – il est avéré que je suis un mouchard. – Opinion du peuple sur mes agents. – Précis sur la brigade de sûreté. – 772 arrestations. – Conversion d’un grand pécheur. – Biographie de Coco-Lacour. – M. Delavau et le trou madame. – Enterrinement de mes lettres de grâce. – Coup-d’œil sur la suite de ces mémoires. – Je puis parler, je parlerai.
À l’époque de l’arrestation de Fossard, la brigade de sûreté existait déjà, et depuis 1812, époque à laquelle elle fut créée, je n’étais plus agent secret. Le nom de Vidocq était devenu populaire, et beaucoup de gens pouvaient l’appliquer à une figure qui était la mienne. La première expédition qui m’avait mis en évidence, avait été dirigée contre les principaux lieux de rassemblement de la Courtille. Un jour M. Henry ayant exprimé l’intention d’y faire une rafle chez Dénoyez, c’est-à-dire, dans la guinguette la plus fréquentée par les tapageurs et les mauvais sujets de toute espèce, M. Yvrier, l’un des officiers de paix présents, observa que pour exécuter cette mesure, ce ne serait pas assez d’un bataillon. « Un bataillon, m’écriai-je aussitôt, et pourquoi pas la grande armée ? Quant à moi, continuai-je, qu’on me donne huit hommes et je réponds du succès. » On a vu que M. Yvrier est fort irritable de son naturel, il se fâcha tout rouge, et prétendit que je n’avais que du babil.
Quoi qu’il en soit, je maintins ma proposition, et l’on me donna l’ordre d’agir. La croisade que j’allais entreprendre était dirigée contre des voleurs, des évadés, et bon nombre de déserteurs des bataillons coloniaux. Après avoir fait ample provision de menottes, je partis avec deux auxiliaires et huit gendarmes. Arrivé chez Dénoyez, suivi de deux de ces derniers, j’entre dans la salle ; j’invite les musiciens à faire silence, ils obéissent ; mais bientôt se fait entendre une rumeur à laquelle succède le cri réitéré de à la porte, à la porte. Il n’y a pas de temps à perdre, il faut imposer aux vociférateurs, avant qu’ils s’échauffent au point d’en venir à des voies de fait. Sur-le-champ j’exhibe mon mandat et au nom de la loi, je somme tout le monde de sortir, les femmes exceptées. On fit quelque difficulté d’obtempérer à l’injonction ; cependant au bout de quelques minutes, les plus mutins se résignèrent, et l’on se mit en train d’évacuer. Alors je me postai au passage, et dès que je reconnaissais un ou plusieurs des individus que l’on cherchait, avec de la craie blanche je les marquais d’une croix sur le dos : c’était un signe pour les désigner aux gendarmes qui les attendant à l’extérieur, les arrêtaient, et les attachaient au fur et à mesure qu’ils sortaient. On se saisit de la sorte de trente-deux de ces misérables, dont on forma un cordon qui fut conduit au plus prochain corps de garde, et de là à la préfecture de police.
La hardiesse de ce coup de main fit du bruit parmi le peuple qui fréquente les barrières ; en peu de temps il fut avéré pour tous les escrocs et autres méchants garnements qu’il y avait par le monde un mouchard qui s’appelait Vidocq. Les plus crânes d’entre eux se promirent de me tuer à la première rencontre. Quelques-uns tentèrent l’aventure ; mais ils furent repoussés avec perte, et les échecs qu’ils éprouvèrent me firent une telle renommée de terreur, qu’à la longue elle rejaillit sur tout les individus de ma brigade : il n’y avait pas de criquet parmi eux qui ne passât pour un Alcide : c’était au point qu’oubliant de qui il s’agissait je me sentais presque le frisson, lorsque des gens du peuple sans me connaître, s’entretenaient en ma présence, ou de mes agents ou de moi. Nous étions tous des colosses : le vieux de la montagne inspirait moins d’effroi, les séides n’étaient ni plus dévoués, ni plus terribles. Nous cassions bras et jambes ; rien ne nous résistait ; et nous étions partout. J’étais invulnérable ; d’autres prétendaient que j’étais cuirassé des pieds à la tête, ce qui revient au même quand on n’est pas réputé peureux.
La formation de la brigade suivit de fort près l’expédition de la Courtille. J’eus d’abord quatre agents, puis six, puis dix, puis douze. En 1817 je n’en avais pas davantage, et cependant avec cette poignée de monde, du 1er janvier au 31 décembre, j’effectuai sept cent soixante-douze arrestations et trente-neuf perquisitions ou saisies d’objets volés[8].
Du moment où les voleurs surent que je devais être appelé aux fonctions d’agent principal de la police de sûreté, ils se crurent perdus. Ce qui les inquiétait le plus, c’était de me voir entouré d’hommes qui, ayant vécu et travaillé avec eux, les connaissaient tous. Les captures que je fis en 1813 n’étaient pas encore aussi nombreuses qu’en 1817, mais elles le furent assez pour augmenter leurs alarmes. En 1814 et 1815, un essaim de voleurs parisiens, libérés des pontons anglais, où ils étaient prisonniers, revint dans la capitale, où ils ne tardèrent pas à reprendre leur premier métier : ceux-là ne m’avaient jamais vu, je ne les avais pas vus non plus, et ils se flattaient d’échapper facilement à ma surveillance ; aussi à leur début furent-ils d’une activité et d’une audace prodigieuses. En une nuit seulement, il y eut au faubourg Saint-Germain dix vols avec escalade et effraction ; pendant plus de six semaines, on n’entendit parler que de hauts faits de ce genre. M. Henry, désespéré de ne trouver aucun moyen de réprimer ce brigandage, était constamment aux aguets, et je ne découvrais rien. Enfin, après bien des veilles, un ancien voleur que j’arrêtai, me fournit quelques indices, et en moins de deux mois, je parvins à mettre sous la main de la justice une bande de vingt-deux voleurs, une de vingt-huit, une troisième de dix-huit, et quelques autres de douze, de dix, de huit, sans compter les isolés, et bon nombre de recéleurs qui allèrent grossir la population des bagnes. Ce fut à cette époque que l’on m’autorisa à recruter ma brigade de quatre nouveaux agents, pris parmi les voleurs qui avaient eu l’avantage de connaître les nouveaux débarqués avant leur départ.
Trois de ces vétérans, les nommés Goreau, Florentin, et Coco-Lacour, depuis long-temps détenus à Bicêtre, demandaient avec instance à être employés, ils se disaient tout-à-fait convertis, et juraient de vivre désormais honnêtement du produit de leur travail, c’est-à-dire du traitement que leur allouerait la police. Ils étaient entrés dès l’enfance dans la carrière du crime ; je pensais que s’ils étaient fermement décidés à changer de conduite, personne ne serait plus à même qu’eux de rendre d’importants services ; j’appuyai donc leur demande, et bien que, pour les retenir, on m’opposât la crainte des récidives, auxquelles les deux derniers surtout étaient sujets, à force de sollicitations et de démarches, motivées sur l’utilité dont ils pouvaient être, j’obtins qu’ils fussent mis en liberté. Coco-Lacour, contre lequel on était le plus prévenu, parce qu’étant agent secret, on lui avait imputé à tort ou à raison, l’enlèvement de l’argenterie de l’inspecteur général Veyrat, est le seul qui ne m’ait pas donné lieu de me repentir d’avoir en quelque sorte répondu de lui. Les deux autres me forcèrent bientôt à les expulser : j’ai su depuis qu’ils avaient subi une nouvelle condamnation à Bordeaux. Quant à Coco, il me parut qu’il tiendrait parole et je ne me trompai pas. Comme il avait beaucoup d’intelligence et un commencement d’instruction, je le distinguai et j’en fis mon secrétaire. Plus tard, à l’occasion de quelques remontrances que je lui fis, il donna sa démission, avec deux de ses camarades, Decostard, dit Procureur, et un nommé Chrétien. Aujourd’hui que Coco-Lacour est à la tête de la police de sûreté, en attendant qu’il publie ses mémoires, peut-être sera-t-il intéressant de montrer par quelles vicissitudes il a dû passer avant d’arriver au poste que j’ai occupé si long-temps. Il y a dans sa vie bien des motifs d’être indulgent à son égard, et dans son amendement radical sous les rapports capitaux de puissantes raisons de ne jamais désespérer qu’un homme perverti vienne enfin à résipiscence. Les documents d’après lesquels je vais esquisser les principaux traits de l’histoire de mon successeur sont des plus authentiques. Voici d’abord quelles traces de son existence, il a laissées à la préfecture de police ; j’ouvre les registres de sûreté, et je transcris :
« Lacour, Marie-Barthélemy, âgé de onze ans, demeurant rue du Lycée, écroué à la Force le 9 ventôse an IX, comme prévenu de tentative de vol ; et onze jours après, condamné à un mois de prison par le tribunal correctionnel.
» Le même, arrêté le 2 prairial suivant, et reconduit de nouveau à La Force, comme prévenu de vol de dentelles dans une boutique. Mis en liberté ledit jour par l’officier de police judiciaire du 2e arrondissement.
» Le même, enfermé à Bicêtre le 23 thermidor an X, par ordre de M. le préfet ; mis en liberté le 28 pluviôse an XI, et conduit à la préfecture.
» Le même, entré à Bicêtre le 6 germinal an XI, par ordre du préfet ; remis à la gendarmerie le 22 floréal suivant, pour être conduit au Havre.
» Le même, âgé de dix-sept ans, filou connu, déjà plusieurs fois arrêté comme tel, enrôlé volontairement à Bicêtre, en juillet 1807, pour servir dans les troupes coloniales ; remis le 31 dudit mois à la gendarmerie pour être conduit à sa destination. Évadé de l’île de Ré dans la même année.
» Le même Lacour dit Coco, (Barthélemy) ou Louis, Barthélemy, âgé de 21 ans, né à Paris, commissionnaire en bijoux, demeurant faubourg Saint-Antoine, n° 297. Conduit à la Force le 1er décembre 1809, comme prévenu de vol ; condamné à deux ans de prison par jugement du tribunal correctionnel le 18 janvier 1810, conduit ensuite au ministère de la marine comme déserteur.
» Le même, conduit à Bicêtre le 22 janvier 1812, comme voleur incorrigible. Conduit à la préfecture le 3 juillet 1816. »
Lacour dans sa jeunesse a offert un bien triste exemple des dangers d’une mauvaise éducation. Tout ce que je sais de lui depuis sa libération semble démontrer qu’il était né avec un excellent naturel. Malheureusement, il appartenait à des parents pauvres. Son père, tailleur et portier dans la rue du Lycée, ne s’occupa pas trop de lui pendant ces premières années d’où dépend souvent la destinée des hommes. Je crois même que Coco resta orphelin en bas-âge. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’il grandit, pour ainsi dire, sur les genoux de ses voisines, les courtisanes et les modistes du palais Égalité ; comme elles le trouvaient gentil, elle lui prodiguaient des douceurs et des caresses, et lui inculquaient en même temps ce qu’elles appellent de la malice. Ce furent ces dames qui prirent soin de son enfance ; constamment elles l’attiraient auprès d’elles : il était leur récréation, leur bijou, et lorsque les devoirs de l’état ne leur laissaient pas le loisir de tant d’innocence, le petit Coco allait dans le jardin se mêler à ces groupes de polissons qui, entre le bouchon et la toupie, tiennent l’école mutuelle des tours de passe-passe. Éduqué par des filles, instruit par des apprentis filous, il n’est pas besoin de dire de quels genres étaient les progrès qu’il fit. La route qu’il suivait était semée d’écueils. Une femme qui se croyait sans doute appelée à lui imprimer une meilleure direction, le recueillit chez elle : c’était la Maréchal, qui tenait une maison de prostitution, place des Italiens. Là Coco fut très bien nourri, mais sa complaisance était la seule des qualités morales que son hôtesse prît à tâche de développer. Il devint très complaisant : il était au service de tout le monde, et s’accommodait à tous les besoins de l’établissement dont les moindres détails lui étaient familiers. Cependant le jeune Lacour avait ses jours et ses heures de sortie, il sut, à ce qu’il paraît, les employer, puisque avant sa douzième année il était cité comme l’un des plus adroits voleurs de dentelles, et qu’un peu plus tard ses arrestations successives lui assignèrent le premier rang parmi les voleurs au bonjour, dits les chevaliers grimpants. Quatre ou cinq ans de séjour à Bicêtre où, par mesure administrative, il fut enfermé comme voleur dangereux et incorrigible, ne le corrigèrent pas ; mais là du moins, il apprit l’état de bonnetier, et reçut quelque instruction. Insinuant, flexible, pourvu d’une voix douce et d’un visage efféminé sans être joli, il plut à M. Mulner qui, condamné à seize ans de travaux forcés, avait obtenu la faveur d’attendre à Bicêtre l’expiration de sa peine. Ce prisonnier, qui était le frère d’un banquier d’Anvers, ne manquait pas de connaissances : afin de se procurer une distraction, il fit de Coco son élève, et il est à présumer qu’il le poussa avec amour, puisque en très peu de temps Coco fut en état de parler et d’écrire sa langue à peu près correctement. Les bonnes grâces de M. Mulner ne furent pas l’unique avantage que Lacour dut à un extérieur agréable. Durant toute sa captivité, une nommée Élisa l’Allemande, qui était éprise de lui, ne cessa pas de lui prodiguer des secours : cette fille qui lui sauva véritablement la vie, n’a, dit-on, éprouvé de sa part que de l’ingratitude.
Lacour est un homme dont la taille n’excède pas cinq pieds deux pouces, il est blond et chauve, a le front étroit, on pourrait dire humilié, l’œil bleu mais terne, les traits fatigués, et le nez légèrement aviné à son extrémité : c’est la seule portion de sa figure sur laquelle la pâleur ne soit pas empreinte. Il aime à l’excès la parure et les bijoux, et fait un grand étalage de chaînes et de breloques ; dans son langage il affectionne aussi beaucoup les expressions les plus recherchées dont il affecte de se servir à tout propos. Personne n’est plus poli que lui, ni plus humble ; mais au premier coup d’œil on s’aperçoit que ce ne sont pas là les manières de la bonne compagnie : ce sont les traditions du beau monde, telles qu’elles peuvent encore arriver dans les prisons, et dans les endroits que Lacour a dû fréquenter. Il a toute la souplesse des reins qu’il faut pour se maintenir dans les emplois, et de plus, une étonnante facilité de génuflexion. Tartuffe, avec qui il a, du reste, quelque ressemblance, ne s’en acquitterait pas mieux.
Lacour, devenu mon secrétaire, ne put jamais comprendre que, pour le decorum de la place qu’il occupait, sa compagne successivement fruitière et blanchisseuse, depuis qu’elle n’était plus autre chose, ne ferait pas mal de choisir une industrie un peu plus relevée. Une discussion s’éleva entre nous à ce sujet, et plutôt que de me céder, il préféra abandonner le poste. Il se fit marchand colporteur et vendit des mouchoirs dans les rues. Mais bientôt, rapporte la chronique, il se donna à la congrégation, et s’enrôla sous la bannière des jésuites : dès lors il fut en odeur de sainteté auprès de MM. Duplessis et Delavau. Lacour a toute la dévotion qui devait le rendre recommandable à leurs yeux. Un fait que je puis attester, c’est qu’à l’époque de son mariage, son confesseur, qui tenait les cas réservés, lui ayant infligé une pénitence des plus rigoureuses, il l’accomplit dans toute son étendue. Pendant un mois, se levant à l’aube du jour, il alla les pieds nus de la rue Sainte-Anne au Calvaire, seul endroit où il lui fût encore permis de rencontrer sa femme, qui était aussi en expiation.
Après l’avènement de M. Delavau, Lacour eut un redoublement de ferveur ; il demeurait alors rue Zacharie, et bien que l’église Saint-Séverin fût sa paroisse, pour entendre la messe il se rendait tous les dimanches à Notre-Dame, où le hasard le plaçait toujours près ou en face du nouveau préfet et de sa famille. On ne peut que savoir gré à Lacour d’avoir fait un si complet retour sur lui-même ; seulement il est à regretter qu’il ne s’y soit pas pris vingt ans plus tôt : mieux vaut tard que jamais.
Lacour a des mœurs fort douces, et s’il ne lui arrivait pas parfois de boire outre mesure, on ne lui connaîtrait d’autre passion que celle de la pêche : c’est aux environs du pont Neuf qu’il jette sa ligne ; de temps à autre il consacre encore quelques heures à ce silencieux exercice ; près de lui est assez habituellement une femme, occupée de lui tendre le ver : c’est Madame Lacour, habile autrefois à présenter de plus séduisantes amorces. Lacour se livrait à cet innocent plaisir, dont il partage le goût avec Sa Majesté Britannique et le poète Coupigny, lorsque les honneurs vinrent le chercher : les envoyés de M. Delavau le trouvèrent sous l’arche Marion : ils le prirent à sa ligne, comme les envoyés du sénat romain prirent Cincinnatus à sa charrue. Il y a toujours dans la vie des grands hommes des rapports sous lesquels on peut les comparer ; peut-être Madame Cincinnatus vendait-elle aussi des effets aux filles de son temps. C’est aujourd’hui le commerce de la légitime moitié de Coco-Lacour : mais c’en est assez sur le compte de mon successeur ; je reviens à l’historique de la brigade de sûreté.
Ce fut dans le cours des années 1823 et 1824 qu’elle prit son plus grand accroissement : le nombre des agents dont elle se composait fut alors, sur la proposition de M. Parisot, porté à vingt et même à vingt-huit, en y comprenant huit individus alimentés du produit des jeux que le préfet autorisait à tenir sur la voie publique[9]. C’était avec un personnel si mince qu’il fallait surveiller plus de douze cents libérés des fers, de la réclusion ou des prisons ; exécuter annuellement de quatre à cinq cents mandats, tant du préfet que de l’autorité judiciaire ; se procurer des renseignements, entreprendre des recherches et des démarches de toute espèce, faire les rondes de nuit si multipliées et si pénibles pendant l’hiver ; assister les commissaires de police dans les perquisitions ou dans l’exécution des commissions rogatoires, explorer les diverses réunions publiques, au dedans comme au dehors ; se porter à la sortie des spectacles, aux boulevards, aux barrières, et dans tous les autres lieux, rendez-vous ordinaires des voleurs et des filous. Quelle activité ne devaient pas déployer vingt-huit hommes pour suffire à tant de détails, sur un si vaste espace et sur tant de points à la fois. Mes agents avaient le talent de se multiplier, et moi celui de faire naître et d’entretenir chez eux l’émulation du zèle et du dévouement : je leur donnai l’exemple. Point d’occasion périlleuse où je n’aie payé de ma personne, et si les criminels les plus redoutables ont été arrêtés par mes soins, sans vouloir tirer gloire de ce que j’ai fait, je puis dire que les plus hardis ont été saisis par moi. Agent principal de la police particulière de sûreté, j’aurais pu, en ma qualité de chef, me confiner, rue Sainte-Anne, en mon bureau ; mais, plus activement, et surtout plus utilement occupé, je n’y venais que pour donner mes instructions de la journée, pour recevoir les rapports, ou pour entendre les personnes qui, ayant à se plaindre de vols, espéraient que je leur en ferais découvrir les auteurs.
Jusqu’à l’heure de ma retraite, la police de sûreté, la seule nécessaire, celle qui devrait absorber la majeure partie des fonds accordés par le budget, parce que c’est à elle principalement qu’ils sont affectés, la police de sûreté, dis-je, n’a jamais employé plus de trente hommes, ni coûté plus de 50.000 francs par an, sur lesquels il m’en était alloué cinq.
Tels ont été, en dernier lieu, l’effectif et la dépense de la brigade de sûreté : avec un si petit nombre d’auxiliaires, et les moyens les plus économiques, j’ai maintenu la sécurité au sein d’une capitale peuplée de près d’un million d’habitants ; j’ai anéanti toutes les associations de malfaiteurs, je les ai empêchées de se reproduire, et depuis un an que j’ai quitté la police, s’il ne s’en est pas formé de nouvelles, bien que les vols se soient multipliés, c’est que tous les grands maîtres ont été relégués dans les bagnes, lorsque j’avais la mission de les poursuivre, et le pouvoir de les réprimer.
Avant moi, les étrangers et les provinciaux regardaient Paris comme un repaire, où jour et nuit il fallait être constamment sur le qui vive ; où tout arrivant, bien qu’il fût sur ses gardes, était certain de payer sa bienvenue. Depuis moi, il n’est pas de département où, année commune, il ne se soit commis plus de crimes, et des crimes plus horribles que dans le département de la Seine : il n’en est pas non plus où moins de coupables soient restés ignorés, où moins d’attentats aient été impunis. À la vérité, depuis 1814 la continuelle vigilance de la garde nationale avait puissamment contribué à ces résultats. Nulle part cette vigilance des citoyens armés n’était plus nécessaire, plus imposante ; mais l’on conviendra aussi qu’au moment où le licenciement forcé de nos troupes et la désertion des soldats étrangers déversaient dans nos cités, et plus particulièrement dans la métropole, une multitude de mauvais sujets, d’aventuriers, et de nécessiteux de toutes les nations, malgré la présence de la garde nationale, il dût encore beaucoup rester à faire, soit à la brigade de sûreté, soit à son chef. Aussi avons-nous fait beaucoup, et si j’aime à payer aux gardes nationaux le tribut d’éloges qu’ils méritent ; si, éclairé par l’expérience de ce que j’ai vu durant leur existence et depuis l’ordonnance de dissolution, je déclare que sans eux Paris ne saurait offrir aucune sécurité, c’est que toujours j’ai trouvé chez eux une intelligence, une volonté d’assistance, un concert de dévouement au bien public que je n’ai jamais rencontrés ni parmi les soldats ni parmi les gendarmes, dont le zèle ne se manifeste, la plupart du temps, que par des actes de brutalité, après que le danger est passé. J’ai créé pour la police de sûreté actuelle une infinité de précédents, et les traditions de ma manière n’y seront pas de sitôt oubliées ; mais quelle que soit l’habileté de mon successeur, aussi long-temps que Paris restera privé de sa garde civique, on ne parviendra pas à réduire à l’inaction les malfaiteurs dont une génération nouvelle s’élève, du moment qu’on ne peut plus les surveiller à toutes les heures et sur tous les points à la fois. Le chef de la police de sûreté ne peut être partout, et chacun de ses agents n’a pas cent bras comme Briarée. En parcourant les colonnes des journaux, on est effrayé de l’énorme quantité de vols avec effraction qui se commettent chaque nuit, et pourtant les journaux en ignorent plus des neuf dixièmes. Il semble qu’une colonie de forçats soit venue récemment s’établir sur les bords de la Seine. Le marchand même, dans les rues les plus passagères et les plus populeuses, n’ose plus dormir ; le Parisien appréhende de quitter son logis pour la plus petite excursion à la campagne ; on n’entend plus parler que d’escalades, de portes ouvertes à l’aide de fausses clefs, d’appartements dévalisés, etc., et pourtant nous sommes encore dans la saison la plus favorable aux malheureux : que sera-ce donc quand l’hiver fera sentir ses rigueurs, et que, par l’interruption des travaux, la misère atteindra un plus grand nombre d’individus ? car en dépit des assertions de quelques procureurs du Roi, qui veulent à toute force ignorer ce qui se passe autour d’eux, la misère doit enfanter des crimes ; et la misère, dans un état social mal combiné, n’est pas un fléau dont on puisse se préserver toujours, même quand on est laborieux. Les moralistes d’un temps où les hommes étaient clair-semés ont pu dire que les paresseux seuls sont exposés à mourir de faim ; aujourd’hui tout est changé, et si l’on observe, on ne tarde pas à se convaincre, non seulement qu’il n’y a pas de l’ouvrage pour tout le monde, mais encore que dans le salaire de certains labeurs, il n’y a pas de quoi satisfaire aux premiers besoins. Si les circonstances se présentent aussi graves que l’on peut les prévoir, quand le commerce est languissant, que l’industrie s’évertue en vain à chercher un écoulement à ses produits, et qu’elle s’appauvrit à mesure qu’elle crée, comment remédier à un mal si grand ? Sans doute il vaudrait mieux soulager les nécessiteux, que de songer à réprimer leur désespoir ; mais, dans l’impuissance de faire mieux, et si près de la crise, ne doit-on pas, avant tout, fortifier les garanties de l’ordre public ? et quelle garantie est préférable à la présence continuelle d’une garde bourgeoise, qui veille et agit sans cesse sous les auspices de la légalité et de l’honneur ? Suppléera-t-on à une institution si noble, si généreuse par une police élastique, dont les cadres puissent s’étendre ou se restreindre à volonté ? ou mettra-t-on sur pied des légions d’agents pour les congédier aussitôt que l’on croira pouvoir se passer de leurs services. Il faudrait ignorer que la police de sûreté s’est recrutée jusqu’à ce jour dans les prisons et dans les bagnes, qui sont comme l’école normale des mouchards à voleurs et la pépinière d’où on doit les tirer. Employez de tels gens en grand nombre, et essayez de les renvoyer après qu’ils auront acquis la connaissance des moyens de police, ils reviendront à leur premier métier, avec quelques chances de succès de plus. Toutes les éliminations, lorsque j’ai jugé à propos d’en opérer parmi mes auxiliaires, m’ont démontré la vérité d’une semblable assertion. Ce n’est pas que des membres de ma brigade, et elle était toute composée d’individus ayant subi des condamnations, ne soient devenus incapables d’une action contraire à la probité ; j’en citerais plusieurs à qui je n’aurais pas hésité à confier des sommes considérable sans en exiger de reçu ; sans même les compter, mais ceux qui s’étaient amendés de la sorte étaient toujours en minorité : ce qui ne veut pas dire (sauf la profession) qu’il y eût là moins d’honnêtes gens, proportion gardée, que dans d’autres classes auxquelles il est honorable d’appartenir. J’ai vu parmi les notaires, parmi les agents de change, parmi les banquiers, des détenteurs infidèles, accepter presque gaîment l’infamie dont ils s’étaient couverts. J’ai vu un de mes subordonnés, forçat libéré, se brûler la cervelle, parce qu’il avait eu le malheur de perdre au jeu la somme de cinq cents francs, dont il n’était que le dépositaire. Consignerait-on beaucoup de pareils suicides dans les annales de la Bourse, et pourtant !… mais il ne s’agit point ici de faire l’apologie de la brigade de sûreté sous un point de vue étranger à son service. C’était l’inconvénient d’un personnel considérable de mouchards que je me proposais de prouver, et cet inconvénient ressort de tout ce que j’ai dit, même abstraction faite du danger qu’il y a pour la moralité du peuple, à le laisser se familiariser avec cette idée que toute condamnation est un noviciat ou un acheminement à une existence assurée, et que la police n’est autre chose que les invalides des galères.
C’est à partir de la formation de la brigade de sûreté qu’aura commencé véritablement l’intérêt de ces Mémoires. Peut-être trouvera-t-on que j’ai trop long-temps entretenu le public de ce qui ne m’était que personnel, mais il fallait bien que l’on sût par quelles vicissitudes j’ai dû passer pour devenir cet Hercule à qui il était réservé de purger la terre d’épouvantables monstres et de balayer l’étable d’Augias. Je ne suis pas arrivé en un jour ; j’ai fourni une longue carrière d’observations et de pénibles expériences. Bientôt, et j’ai déjà donné quelques échantillons de mon savoir-faire, je raconterai mes travaux, les efforts que j’ai dû entreprendre, les périls que j’ai affrontés, les ruses, les stratagèmes auxquels j’ai eu recours pour remplir ma mission dans toute son étendue, et faire de Paris la résidence la plus sûre du monde. Je dévoilerai les expédients des voleurs, les signes auxquels on peut les reconnaître. Je décrirai leurs mœurs, leurs habitudes ; je révélerai leur langage et leur costume, suivant la spécialité de chacun ; car les voleurs, selon le fait dont ils sont coutumiers, ont aussi un costume qui leur est propre. Je proposerai des mesures infaillibles pour anéantir l’escroquerie et paralyser la funeste habileté de tous ces faiseurs d’affaires, chevaliers d’industrie, faux courtiers, faux négociants, etc., qui, malgré Sainte-Pélagie, et justement en raison du maintien inutile et barbare de la contrainte par corps, enlèvent chaque jour des millions au commerce. Je dirai les manèges et la tactique de tous ces fripons pour faire des dupes. Je ferai plus, je désignerai les principaux d’entre eux, en leur imprimant sur le front un sceau qui les fera reconnaître. Je classerai les différentes espèces de malfaiteurs, depuis l’assassin jusqu’au filou, et les formerai en catégories plus utiles que les catégories de La Bourdonnaie, à l’usage des proscripteurs de 1815, puisque du moins elles auront l’avantage de faire distinguer à la première vue les êtres et les lieux auxquels la méfiance doit s’attacher. Je mettrai sous les yeux de l’honnête homme tous les pièges qu’on peut lui tendre, et je signalerai au criminaliste des diverses échappatoires au moyen desquels les coupables ne réussissent que trop souvent à mettre en défaut la sagacité des juges.
Je mettrai au grand jour les vices de notre instruction criminelle et ceux plus grands encore de notre système de pénalité, si absurde dans plusieurs de ses parties. Je demanderai des changements, des révisions, et l’on accordera ce que j’aurai demandé, parce que la raison, de quelque part qu’elle vienne, finit toujours par être entendue. Je présenterai d’importantes améliorations dans le régime des prisons et des bagnes ; et, comme je suis plus touché qu’aucun autre des souffrances de mes anciens compagnons de misère, condamnés ou libérés, je mettrai le doigt sur la plaie, et serai peut-être assez heureux pour offrir au législateur philanthrope les seules données d’après lesquelles il est possible d’apporter à leur sort un adoucissement qui ne soit point illusoire. Dans des tableaux aussi variés que neufs, je présenterai les traits originaux de plusieurs classes de la société qui se dérobent encore à la civilisation, ou plutôt qui sont sorties de son sein pour vivre à côté d’elle, avec tout ce qu’elle a de hideux. Je reproduirai avec fidélité la physionomie de ces castes de parias, et je ferai en sorte que la nécessité de quelques institutions propres à épurer, ainsi qu’à régulariser les mœurs d’une portion du peuple, résulte de ce qu’ayant été plus à portée de les étudier que personne, j’ai pu en donner une connaissance plus parfaite. Je satisferai la curiosité, sous plus d’un rapport ; mais ce n’est pas là le dernier but que je me propose, il faut que la corruption en soit diminuée, que les atteintes à la propriété soient plus rares, que la prostitution cesse d’être une conséquence forcée de certains malheurs de position, et que des dépravations si honteuses, que ceux qui s’y abandonnent ont été mis hors la loi pour la peine qu’elle devrait infliger, comme pour la protection qu’elle réserve à chacun, disparaissent enfin ou ne soient plus, par leur impudente publicité, un perpétuel sujet de scandale pour l’homme qui comprend le vœu de la nature et sait le respecter. Ici, le mal vient de haut ; pour l’extirper, c’est aux sommités sociales qu’il est besoin de s’attaquer. De grands personnages sont entachés de cette lèpre, qui dans ces derniers temps, a fait d’effrayants progrès. À l’aspect des noms vénérés inscrits sur la liste de ces modernes Sardanapales, on ne peut s’empêcher de gémir sur les faiblesses de l’humanité, et cette liste ne mentionne encore que ceux qui ont été réduits à faire ou à laisser intervenir la police à propos des désagréments qu’ils s’étaient attirés par leur turpitude.
L’on a répandu dans le public que je ne parlerais pas de la police politique ; je parlerai de toutes les polices possibles, depuis celle des jésuites jusqu’à celle de la Cour ; depuis la police des filles (bureau des mœurs) jusqu’à la police diplomatique (espionnage pour le compte des trois puissances, la Russie, l’Angleterre et l’Autriche) ; je montrerai tous les rouages grands et petits de ces machines qui sont toujours montées non en vue du bien général, mais pour le service de celui qui y introduit la goutte d’huile, c’est-à-dire pour le compte du premier venu s’il dispose des deniers du trésor ; car qui dit police politique dit institution créée et maintenue par le désir de s’enrichir aux dépens d’un gouvernement dont on entretient les alarmes ; qui dit police politique dit aussi besoin d’être inscrit au budget pour des dépenses secrètes, besoin d’assigner une destination occulte à des fonds visiblement et souvent illégalement perçus (l’impôt sur les filles et mille autres tributs de détails), besoin pour certains administrateurs de se rendre indispensables, importants, en faisant croire à des dangers pour l’État ; besoin enfin de concussions au profit d’un vil ramas d’aventuriers, d’intrigants, de joueurs, de banqueroutiers, de délateurs, etc. Peut-être serai-je assez heureux pour démontrer l’inutilité de ces agents perpétuels destinés à prévenir des attentats qui ne se répètent que de loin en loin, des crimes qu’ils n’ont jamais prévus, des complots qu’ils n’ont jamais déjoués lorsqu’ils étaient réels, ou lorsqu’ils n’en avaient pas eux-mêmes ourdi la trame. Je m’expliquerai sur toutes ces choses sans ménagements, sans crainte, sans passion ; je dirai toute la vérité, soit que je parle comme témoin, soit que je parle comme acteur.
J’ai toujours eu un profond mépris pour les mouchards politiques, par deux motifs : c’est que, ne remplissant pas leur mission, ils sont des fripons, et la remplissant, dès qu’ils arrivent à des personnalités, ils sont des scélérats. Cependant, par ma position, je me suis trouvé en relation avec la plupart de ces espions gagés ; ils m’étaient tous connus directement ou indirectement, je les nommerai tous,… je le puis, je n’ai point partagé leur infamie ; seulement j’ai vu la mine et la contre-mine d’un peu plus près qu’un autre. Je sais quels ressorts les polices et les contre-polices mettent en jeu. J’ai appris et j’enseignerai comment on peut se garantir de leur action : comment on peut se jouer d’elles, les dérouter dans leurs combinaisons perfides ou malveillantes, et même quelquefois les mystifier. J’ai tout observé, tout entendu, rien ne m’est échappé, et ceux qui m’ont mis à même de tout observer et de tout entendre, n’étaient pas de faux-frères, puisque j’étais à la tête d’une des fractions de la police, et qu’ils pouvaient avoir l’opinion que j’étais un des leurs : ne puisions-nous pas à la même caisse ?
L’on me croira ou l’on ne me croira pas, mais jusqu’ici j’ai fait quelques aveux assez humiliants pour que l’on ne doute pas que si j’eusse été dévoué à la police politique, je ne le confessasse sans détours. Les journaux, qui ne sont pas toujours bien informés, ont prétendu que l’on m’avait aperçu dans divers rassemblements ; que j’avais été d’expédition avec ma brigade pendant les troubles de juin, pendant les missions, à l’enterrement du général Foy, à l’anniversaire de la mort du jeune Lallemand, aux écoles de droit et de médecine, lorsqu’il s’agissait de faire triompher les doctrines de la congrégation. On aurait pu m’apercevoir partout où il y avait foule ; mais qu’aurait-il été juste d’en conclure ? que je cherchais les voleurs et les filous où il est probable qu’ils viendraient travailler. Je surveillais les coupeurs de bourses, partisans ou non de la Charte, mais je défie qu’aucun empoigné pour cri qualifié séditieux ait pu reconnaître dans l’empoigneur l’un de mes agents. Il n’y a point d’échange possible entre le mouchard politique et le mouchard à voleurs. Leurs attributions sont distinctes : l’un n’a besoin que du courage nécessaire pour arrêter d’honnêtes gens, qui d’ordinaire ne font point de résistance. Le courage de l’autre est tout différent, les coquins ne sont pas si dociles. Un bruit qui dans le temps prit quelque consistance, c’est que, reconnu par un porteur d’eau, au milieu d’un groupe d’étudiants qui ne voulaient pas des leçons de M. le professeur Récamier, j’avais failli être assommé par eux. Je déclare ici que ce bruit n’avait aucun fondement. Un mouchard fut effectivement signalé, menacé et même maltraité ; ce n’était pas moi, et j’avoue que je n’en fus pas fâché ; mais je me fusse trouvé en présence des jeunes gens qui lui firent cette avanie, je n’aurais pas balancé à leur décliner mon nom ; ils auraient bientôt compris que Vidocq ne pouvait avoir rien à démêler avec des fils de famille, qui ne faisaient ni la bourse ni la montre. Si je fusse venu parmi eux, je me serais conduit de façon à ne m’attirer aucune espèce de désagréments, et il aurait été évident pour tous que ma mission ne consistait pas à tourmenter des individus déjà trop exaspérés. L’homme qui se sauva dans une allée pour se dérober à leur courroux était le nommé Godin, officier de paix. Au surplus, je le répète, ni les cris séditieux, ni les autres délits d’opinion n’étaient de ma compétence, et eût-on proféré, moi présent, la plus insurrectionnelle de toutes les acclamations, je ne me serais pas cru obligé de m’en apercevoir. La police politique se passe de troupes régulières, elle a toujours pour les grandes occasions des volontaires, soldés ou non, prêts à seconder ses desseins ; en 1793, elle déchaîna les septembriseurs, ils sortaient de dessous terre, ils y rentrèrent après les massacres. Les briseurs de vitres, qui, en 1827, préludèrent au carnage de la rue Saint-Denis, n’étaient pas, je le pense, de la brigade de sûreté. J’en appelle à M. Delavau, j’en appelle au directeur Franchet : les condamnés libérés ne sont pas ce qu’il y a de pire dans Paris, et dans plus d’une circonstance on a pu acquérir la preuve qu’ils ne se plient pas à tout ce qu’on peut exiger d’eux. Mon rôle, en matière de police politique, s’est borné à l’exécution de quelques mandats du procureur du roi et des ministres, mais ces mandats eussent été exécutés sans moi, et ils présentaient d’ailleurs toutes les conditions de la légalité. Et puis aucune puissance humaine, aucun appât de récompense, ne m’aurait déterminé à agir conformément à des principes et à des sentiments qui ne sont pas les miens ; l’on restera convaincu de ma véracité en ce point, lorsqu’on saura pour quel motif je me suis volontairement démis de l’emploi que j’occupais depuis quinze ans ; lorsqu’on connaîtra la source et le pourquoi de ce conte ridicule, d’après lequel j’aurais été pendu à Vienne pour avoir tenté d’assassiner le fils de Napoléon ; lorsque j’aurai dit à quelle trame jésuitique se rattache le fait controuvé de l’arrestation d’un voleur, qui aurait été saisi récemment derrière ma voiture, au moment où je passais place Baudoyer.
En composant ces Mémoires, je m’étais d’abord résigné à des ménagements et à des restrictions que prescrivait ma situation personnelle. C’était là de la prudence. Quoique gracié depuis 1818, je n’étais pas hors de l’atteinte des rigueurs administratives : les lettres de pardon que j’ai obtenues, à défaut d’une révision qui m’eût fait absoudre, n’étaient pas entérinées ; et il pouvait arriver que l’autorité, encore maîtresse d’user envers moi du plus ample arbitraire, me fit repentir de révélations qui n’excèdent pas les limites de notre liberté constitutionnelle. Maintenant qu’en son audience solennelle du 1er juillet dernier, la cour de Douai a proclamé que les droits qui m’avaient été ravis par une erreur de la justice, m’étaient enfin rendus, je n’omettrai rien, je ne déguiserai rien de ce qu’il convient de dire, et ce sera encore dans l’intérêt de l’État et du public que je serai indiscret : cette intention ressortira de toutes les pages qui vont suivre. Afin de la remplir de manière à ne rien laisser à désirer, et de ne tromper sous aucun rapport l’attente générale, je me suis imposé une tâche bien pénible pour un homme plus habitué à agir qu’à raconter, celle de refondre la plus grande partie de ces Mémoires. Ils étaient terminés, j’aurais pu les donner tels qu’ils étaient, mais, outre l’inconvénient d’une funeste circonspection, le lecteur aurait pu y reconnaître les traces d’une influence étrangère, qu’il m’avait fallu subir à mon insu. En défiance contre moi-même, et peu fait aux exigences du monde littéraire, je m’étais soumis à la révision et aux conseils d’un soi-disant homme de lettres. Malheureusement, dans ce censeur, dont j’étais loin de soupçonner le mandat clandestin, j’ai rencontré celui qui, moyennant une prime, s’était chargé de dénaturer mon manuscrit, et de ne me présenter que sous des couleurs odieuses, afin de déconsidérer ma voix et d’ôter toute importance à ce que je me proposais de dire. Un accident des plus graves, la fracture de mon bras droit dont j’ai failli subir l’amputation, était une circonstance favorable à l’accomplissement d’un pareil projet. Aussi s’est-on hâté de mettre à profit le temps pendant lequel j’étais en proie à d’horribles souffrances. Déjà le premier volume et partie du second étaient imprimés lorsque toute cette intrigue s’est découverte. Pour la déjouer complètement, j’aurais pu recommencer sur de nouveaux frais mais jusqu’alors il ne s’agissait que de mes propres aventures, et bien qu’on m’y montre constamment sous le jour le plus défavorable, j’ai espéré, qu’en dépit de l’expression et du mauvais arrangement, puisque, en dernière analyse, les faits s’y trouvent, on saurait les ramener à leur juste valeur et en tirer des conséquences plus justes. Toute cette portion du récit qui n’est relative qu’à ma vie privée, je l’ai laissée subsister ; j’étais bien le maître de souscrire à un sacrifice d’amour-propre : ce sacrifice, je l’ai fait, au risque d’être taxé d’impudeur pour une confession dont on a dissimulé ou perverti les motifs ; il marque la limite entre ce que je devais conserver et ce que je devais détruire. Depuis mon admission parmi les corsaires de Boulogne, on s’apercevra facilement que c’est moi seul qui tiens la plume. Cette prose est celle que M. le baron Pasquier avait la bonté d’approuver, pour laquelle il avait même une prédilection qu’il ne cachait pas. J’aurais dû me souvenir des éloges qu’il donnait à la rédaction des rapports que je lui adressais : quoi qu’il en soit, j’ai réparé le mal autant qu’il était en mon pouvoir, et malgré le surcroît d’occupation qui résulte pour moi de la direction d’un grand établissement industriel que je viens de former, résolu à ce que mes Mémoires soient véritablement la police dévoilée et mise à nu, je n’ai pas hésité à y reprendre en sous-œuvre tout ce qui est relatif à cette police. La nécessité d’un pareil travail a dû occasionner des retards, mais elle les justifie en même temps, et le public n’y perdra rien. Plutôt, Vidocq sous le coup d’une condamnation, n’eût parlé qu’avec une certaine réserve, aujourd’hui, c’est Vidocq, citoyen libre, qui s’explique avec franchise.