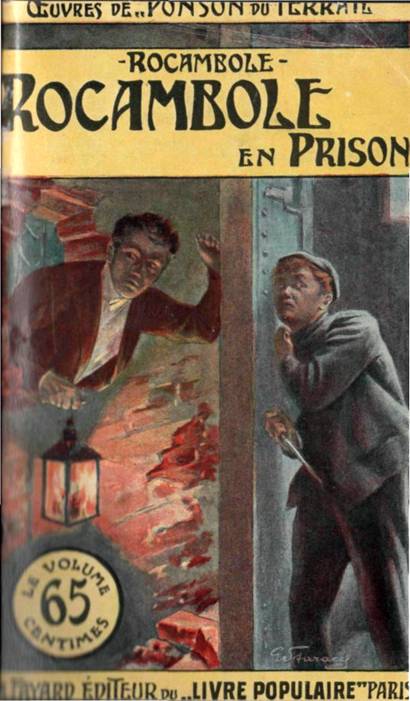Pierre Alexis Ponson du Terrail
ROCAMBOLE EN PRISON
Publication originale, sous le titre Les Démolitions de Paris – La Petite Presse – 21 février au 12 juin 1869 – 122 épisodes, en deux parties : Les Amours du Limousin et La Captivité du maître.
Texte établi d’après l’édition Arthème Fayard – février 1910 – le Livre populaire n° 18, XIVe aventure de Rocambole publiée dans cette collection.
Table des matières
À propos de cette édition électronique
LES AMOURS DU LIMOUSIN
I
Le chantier était désert.
Au milieu des décombres de la maison démolie, au travers des pierres neuves récemment taillées pour la maison à reconstruire, flambait le feu de bivouac allumé par l’invalide, gardien du chantier et des matériaux.
La nuit était sombre, les bruits de la grande ville s’éteignaient, et la dernière voiture de bal était rentrée.
Car cela se passait, il y a quelques jours à peine, au milieu du Paris moderne, à deux pas du boulevard et de la colonne Vendôme, et sur l’emplacement de cette maison où Tahan étalait ses richesses artistiques et Basset ses écrins de perles fines et de diamants.
Avait-on mis Paris à feu et à sang ? Quelque horde barbare venue du Nord avait-elle conquis la reine des cités et semé sur son passage la misère et la désolation ? Cette lueur rougeâtre, qui se projetait sur un amas de décombres, était-elle le feu de nuit des vainqueurs ?
C’est l’image de la désolation et son chaos !
Un peu plus loin le calme enfiévré de Paris qui dort après une nuit de plaisir.
La horde barbare qui avait fait un monceau de ruines de la rue de la Paix, n’était autre qu’une troupe et de maçons et de Limousins inoffensifs.
Paris était conquis par le Limousin, et la rue Turbigo passait.
Si le jour eût paru, on eût pu voir une longue brèche partant du boulevard des Capucines et se prolongeant jusqu’à la rue de Choiseul.
D’un côté, les vieilles maisons tombaient en poussière ; de l’autre, s’élevaient des constructions nouvelles qui montaient peu à peu, hérissées d’échafaudages supportant une légion d’ouvriers de toute sorte.
Mais à cette heure, on eût dit un champ de bataille après l’enterrement des morts.
Partout le silence et l’obscurité, partout des décombres ; et en travers de cette ville saccagée, deux hommes qui veillaient auprès d’un feu allumé avec des poutres vermoulues et des persiennes en morceaux.
L’un de ces deux hommes était un invalide ; l’autre un pauvre diable de maçon, qui s’était couché devant le feu, roulé dans un lambeau de vieille couverture.
L’invalide était un soldat de Crimée, à qui les Russes avaient pris une jambe, dont la moustache était noire encore et le visage empreint d’une fière mélancolie.
On eût dit le dieu Mars condamné à un repos éternel.
Le maçon était un jeune homme ; il n’avait guère que vingt ans, avec cela de longs cheveux châtains, des yeux bleus et un visage ouvert et doux qui n’était pas sans énergie.
Bien qu’il eût travaillé tout le jour de son rude labeur, et qu’il dût être brisé de fatigue, il ne dormait pas.
Il se tournait et se retournait dans sa couverture, levant parfois la tête, et cherchant du regard dans l’espace et les ténèbres un objet et un point de repère mystérieux.
Puis un gros soupir lui échappait ; ses yeux se fermaient, mais le sommeil ne venait pas.
– Hé ! Limousin, lui dit l’invalide qui retira un moment de sa bouche le brûle-gueule qu’il fumait, sais-tu que tu es un singulier garçon ?
Le jeune homme tressaillit.
– Pourquoi donc ça, mon ancien ? dit-il, en se soulevant à demi et regardant l’invalide.
– Tes camarades s’en vont chaque soir, reprit le soldat amputé, les uns tirent vers les Batignolles, les autres vers La Chapelle ou Belleville, chacun regagne son garni…
– Et moi je reste ici, n’est-ce pas ?
– Comme si le patron avait besoin de toi pour garder le chantier ! Est-ce que je ne suffis pas, moi qu’on paye pour cela ?
– Si je reste ici, dit le maçon, c’est que, comme mes camarades, je n’ai pas de garni.
– Tu ne touches donc pas ta paye comme les autres ?
– Si fait.
– Alors tu es un mange-tout, un ivrogne ?
– Non, mon ancien.
– Peut-être envoies-tu ton argent à ta mère ?
– Je lui en envoie la moitié, et il m’en reste bien assez pour vivre et avoir un garni comme les autres ; mais je préfère coucher au grand air.
– Il ne fait pas chaud, pourtant !
– Je ne dis pas. Mais je ne crains pas le froid.
– Bon ! fit l’invalide ; mais, alors pourquoi ne dors-tu pas ? Voici huit ou dix nuits que nous passons ensemble, et à peine si tu fermes l’œil une couple d’heures.
– C’est que je n’ai pas sommeil, dit le Limousin avec un nouveau soupir.
– Tu as quelque chagrin, mon garçon ?
– Peut-être bien, mon ancien.
– Serait-on amoureux ?
À cette question, le Limousin fit un véritable soubresaut :
– Qui vous a dit cela ? dit-il brusquement.
L’invalide se prit à sourire :
– Comme tu peux le voir, dit-il, je ne suis pas encore un vieux de la vieille ; je n’avais que vingt-six ans quand les Russes m’ont carotté une jambe. Il y a quatorze ans de cela ! et je n’en ai pas quarante, par conséquent.
– Bon, fit le Limousin.
– L’amour, ça m’a connu comme un autre, continua l’invalide, et ça me connaît même encore à l’occasion.
– Ah ! ah ! dit le maçon en souriant.
– Je suis même de bon conseil, au besoin, et, puisque tu ne dors pas, mon garçon, jase-moi donc ta petite affaire… on ne sait… je te donnerai peut-être un coup de main…
Le Limousin soupira encore :
– Voyez-vous, mon ancien, dit-il, quand un ver de terre est amoureux d’une étoile, il n’y a rien à faire.
– Tu parles comme le magister de mon village, dit l’invalide en riant. Tu es donc le ver de terre ?
– Oui.
– Et l’étoile, où est-elle ?
– Là haut.
Ce disant, le Limousin étendit la main vers une des maisons de la rue Louis-le-Grand que la rue Turbigo en passant avait laissée debout et dont les fenêtres s’ouvraient sur le chantier.
– En effet, dit l’invalide, ce n’est pas dans ce quartier-là que des gens comme toi et comme moi peuvent aisément trouver une particulière. Mais, bast ! on ne sait pas… et pour parler comme toi, je te dirai qu’il y a des chenilles qui deviennent papillons et qui s’envolent alors vers les étoiles.
Le Limousin eut un nouveau soupir :
– Oh ! dit-il, même quand j’aurai des ailes, elle est encore trop haut.
– C’est donc une femme de haute volée ?
– C’est une princesse, peut-être. Chaque jour, à deux heures, quand il fait soleil, je m’en vais là-bas, dans un coin du chantier, je grimpe sur un tas de bois, je glisse un regard à travers les planches, et je la vois qui monte dans une belle voiture pour aller à la promenade.
– Elle est seule ?
– Non, il y a deux hommes avec elle.
Elle a l’air de les détester et de les craindre, et il y a des moments où il me semble que si je sautais par dessus les planches avec mon marteau, et que, montant dans la voiture, je vinsse à les assommer, elle serait bien contente.
– Tu es fou, mon garçon !
– Ça n’empêche pas qu’elle m’a souri un jour.
– À toi ?
– Mais, oui…
– À travers les planches ?
– Non, quand nous démolissions la maison, j’étais en train de jeter par terre l’ouverture d’une croisée en face de la sienne, et j’avais suspendu ma besogne pour la contempler.
Elle était accoudée à sa fenêtre, regardant par-dessus les toits, et elle avait comme un air d’hirondelle mise en cage et qui voudrait s’envoler.
Tout à coup, elle s’aperçut que je la regardais et elle m’adressa un sourire.
La voix du Limousin était émue, et à la lueur du brasier, l’invalide vit une larme qui coulait sur sa joue.
– Hé ! mon pauvre Limousin, dit le soldat, j’ai bien peur que tu ne perdes la tête ; mais enfin, continue, je te l’ai dit, je suis de bon conseil.
Et l’invalide attendit la suite des confidences amoureuses du pauvre Limousin.
II
Le Limousin poursuivit :
– Je ne suis un pas malin, mais je ne suis pas non plus innocent au point de croire qu’une belle demoiselle comme ça peut sourire à un pauvre maçon, si elle n’a pas besoin de lui.
– Ah ! tu crois qu’elle a besoin de toi ? dit l’invalide.
– Puisque je vous dis qu’elle est prisonnière.
– Je crois que tu es fou, Limousin. Les prisonnières ne quittent pas leur prison.
– Oh ! ça dépend.
– Et on ne les promène pas en voiture.
– Puisque que ceux qui la gardent sont avec elle.
– J’en ai vu de toutes les couleurs, murmura l’invalide en frisant sa moustache ; un zouave, ça connaît tout. Mais celle-là est la plus forte que j’aie jamais entendue.
– Mon vieux, reprit le Limousin, écoutez-moi donc jusqu’au bout, et vous verrez…
– Parle !
– Vous pensez bien que je n’ai pas réfléchi tout de suite.
La première fois que j’ai vu la demoiselle à sa fenêtre, je suis tombé amoureux, ni plus ni moins que si j’avais reçu un coup de merlin sur la tête.
C’était un samedi.
J’ai manqué me jeter en bas des échafaudages, et le maître compagnon m’a dit vingt fois, ce jour-là, que si je n’allais pas plus fort à l’ouvrage, on me renverrait du chantier.
Mais le lendemain, c’était un dimanche, le premier dimanche du mois, le dimanche de paye, par conséquent.
J’avais si bien perdu la tête, que je m’en suis allé avec mon argent chez un marchand d’habits, qui est tout auprès d’ici, sur la place Gaillon, et qu’il m’a habillé comme un bourgeois pour dix-neuf francs dix sous.
Je m’en suis venu rôder alors autour du chantier ; mais ce n’était pas pour l’ouvrage ni pour les camarades, qui s’en allaient tous aux barrières ; c’était pour tâcher de voir la belle demoiselle et me rendre compte de ce qu’elle pouvait être.
La maison où elle demeure est la dernière de la rue Louis-le-Grand avant la tranchée, comme vous pouvez le voir.
– Après ? dit l’invalide.
– Elle demeure au troisième et elle occupe tout l’appartement dont les principales fenêtres donnent sur la rue. Je m’imagine que celle où je l’ai vue et où je la revois quelquefois est celle d’un cabinet de toilette.
– C’est quelque grande cocotte, dit naïvement le soldat de Crimée.
Le Limousin eut un geste d’indignation.
– Ne te fâche pas, dit l’invalide. Mettons que ça soit une princesse et conte-moi ton affaire jusqu’au bout.
Le Limousin reprit :
– Vous pensez bien que, si fou que je fusse, je n’allais pas de but en blanc monter dans la maison, sonner aux portes et dire : C’est moi le maçon qui aime la belle demoiselle blonde.
– Ah ! elle est blonde ? dit l’invalide.
– Comme une Anglaise qu’elle est.
– Voilà que c’est une Anglaise, à présent !
– Oui, mon ancien.
– Alors nous l’appellerons miss. Continue.
– En face de la maison, il y a un petit caboulot qu’on a ouvert quand les démolitions ont commencé ; nous y trouvons la goutte le matin et nos patrons y déjeunent. C’est là que l’Auvergnat traite ses affaires. Connaissez-vous l’Auvergnat, mon ancien ?
– Non.
– C’est un gros homme qui ne sait ni lire ni écrire, qui a des bagues plein les doigts et des diamants à sa chemise ; il a une veste bleue et un chapeau de paille, et c’est lui qui achète les démolitions pour les revendre. Il a des chantiers à la barrière du Trône, où on trouverait des milliers de portes et de croisées d’occasion, des moellons et de la pierre à rebâtir Paris, et où les petits entrepreneurs et les architectes qui travaillent dans la banlieue achètent tous leurs matériaux.
Mais le dimanche, le caboulot est désert.
J’allai donc m’y installer. Je bus une goutte, puis une chopine, puis je mangeai un morceau de fromage, et je ne perdis pas de vue un seul moment la porte de la maison.
Il y a un écriteau jaune sur la porte avec des mots anglais.
On m’a expliqué que cela voulait dire appartements garnis.
L’Anglaise était en meublé. Mais elle avait tout un étage.
Tandis que je regardais toujours la porte, il y avait un grand diable d’homme qui se promenait sur le trottoir, comme s’il avait attendu quelqu’un, mais en réalité pour observer tous les gens qui entraient et sortaient.
C’est un rousse, que je me dis.
Le concierge de la maison est un soiffeur. Il n’y a pas un marchand de vin du quartier qui n’ait sa visite le matin avant huit heures.
Comme je regardais toujours les fenêtres du troisième en mangeant mon pain et mon fromage, il entra.
– Là ! mon vieux, lui dis-je, voulez-vous boire un coup ? J’ai touché ma paye, c’est moi qui régale.
Le pipelet ne se le fit pas répéter. Il s’assit avec moi, comme si nous nous étions toujours connus.
J’avais mon idée, je voulais le faire jaser.
Au troisième verre de vin, je lui dis : Vous avez une maison conséquente, n’est-ce pas ?
– Oui, me répondit-il, mais nous avons deux étages non meublés, et ce n’est pas toujours agréable.
– Pourquoi donc ?
– Parce qu’il nous arrive souvent un tas d’histoires avec les étrangers ; nous avons en ce moment une Anglaise…
Je devins de toutes les couleurs, mais il ne s’en aperçut pas, et continua :
– Il paraît que c’est une jeune fille de la haute, la fille d’un lord, qui s’est sauvée. Elle est descendue ici avec une femme de chambre et deux domestiques, tous Anglais.
À peine installée, elle a fait venir une voiture et s’est mise à courir Paris. Elle cherchait quelqu’un.
Le soir, comme elle rentrait, deux hommes se sont présentés et ont demandé à lui parler.
Les deux hommes se sont établis chez elle, ont renvoyé les domestiques et lui en ont donné d’autres. Elle ne peut plus faire un pas sans eux. Deux ou trois fois elle a essayé de me parler dans l’escalier, mais il y a toujours un des deux hommes avec elle.
Ils la mènent au bois, au spectacle, mais ils ne la quittent pas plus que leur ombre.
C’était là tout ce que savait le pipelet.
Il paraît que les Anglais ne font pas le dimanche comme nous, ils ne sortent pas ce jour-là. Je passai donc la journée dans le caboulot sans l’avoir même aperçue.
Le lendemain, il fallut reprendre le bourgeron et revenir au chantier.
Comme je me mettais à la besogne, la fenêtre s’ouvrit et je la vis.
Elle paraissait me chercher des yeux.
Enfin, elle m’aperçut et se mit encore à sourire.
Cette fois, on eût entendu battre mon cœur du boulevard des Capucines.
Personne ne faisait attention à nous.
Et comme je la regardais toujours, elle mit son doigt sur ses lèvres pour me recommander la discrétion, et, en même temps, elle laissa glisser de ses doigts un papier qui descendit à travers l’espace en tourbillonnant sur lui-même et alla tomber derrière un tas de planches.
Elle me fit un dernier signe qui voulait dire :
– Ce papier est pour vous.
Puis elle ferma sa fenêtre et disparut.
J’étais loin du tas de planches, et je ne pouvais pas y aller sans être vu par les camarades ; mais le repas du matin était proche, et, quelque impatient que je fusse, j’attendis…
– Et puis ? fit l’invalide.
– Et puis vous aller voir que je n’ai pas de chance, ni elle non plus, murmura le Limousin en poussant un gros soupir…
III
Le soldat de Crimée avait fini par s’intéresser si fort au récit du Limousin qu’il avait négligé de mettre du bois dans le brasier.
Le feu s’éteignait peu à peu, et le pittoresque fouillis de matériaux et d’échafaudages rentrait peu à peu dans les ténèbres.
Le Limousin continua :
– Je me disais : Dans un quart d’heure nous irons tous déjeuner ; alors je passerai derrière les planches et je prendrai le papier.
Je commençais à comprendre, du reste que la belle Anglaise avait besoin de moi, et qu’elle ne savait comment me le faire savoir.
Mais, patatras ! voilà que tout d’un coup un monsieur entre dans le chantier et demande à parler au maître compagnon.
Moi, ne me défiant de rien, je le regarde.
C’était un homme d’âge et qui paraissait respectable.
J’ai cru que c’était le propriétaire du terrain ou bien un architecte de la Ville.
Le maître compagnon, en le voyant, se dérange aussitôt et va à sa rencontre.
Alors un camarade l’entend qui disait :
– Monsieur, je suis le locataire de l’appartement qui est là-haut, au troisième. J’ai laissé tomber par la fenêtre un papier d’une certaine importance. Je vous demande la permission d’aller le chercher.
Et voilà que mon homme s’en va droit au tas de planches, ramasse le papier et le met dans sa poche.
Tout cela s’est fait si vite que je n’y ai vu que du feu et que notre homme était déjà hors du chantier que je n’avais pas eu le temps de faire ouf !
– Ça fait, dit l’invalide, que tu n’as pas su ce que le billet contenait ?
– Non.
– Et elle, l’as-tu revue ?
– Oui, tous les matins elle ouvre sa fenêtre, me regarde et semble attendre quelque chose.
– C’est-à-dire qu’elle ne sait pas que tu n’as pas eu le billet ?
– Ça, c’est vrai, et elle est triste !… triste, que c’est à vous fendre l’âme.
– Et tu n’as pas essayé de pénétrer dans la maison ?
– Non.
– Tonnerre ! dit l’invalide, nous étions plus hardis que ça dans les zouaves.
– Que feriez-vous donc à ma place, mon ancien.
– J’entrerais par la porte.
– Et l’homme qui se promène sur le trottoir ?
– Je lui tordrais le cou.
– Et le pipelet ?
– Je lui paierais à boire.
– Et les deux hommes qui sont là-haut et couchent dans l’appartement ?
– Je leur passerais sur le corps.
Le Limousin secoua la tête.
– Ce n’est pas mon idée, dit-il.
– C’est que tu n’es pas un vieux de la vieille comme moi, mon garçon.
Le Limousin eut un fin sourire.
– Je n’ai pas été soldat, cela est vrai, dit-il ; mais je me ferais tuer bien volontiers pour elle, et je ne tiens pas à ma peau…
– Alors, risque-la…
– Non, ce n’est pas mon idée.
– Pourquoi ?
– Quand j’arriverais jusqu’à elle en bousculant tout je ne la délivrerais pas tout de même : au contraire. Et je veux la délivrer.
– Et comment feras-tu ?
– Je vous ai dit que j’avais mon idée.
– Bon ! voyons ça.
– Il n’y a que huit jours à attendre.
– Ah ! il faut attendre huit jours ?
– Oui, le temps qu’on ait monté le deuxième étage sur la maison que nous reconstruisons. Mais vous savez, ça va vite, une fois qu’on a pris la pierre, comme on dit ; le plus long, c’est la limousinade : les caves, les voûtes, tout ce qui est moellon, quoi ! Mais une fois qu’on prend la pierre qui arrive toute taillée, toute numérotée, et qu’on monte à la vapeur, ce n’est rien du tout.
– Je sais cela, dit l’invalide ; mais quand le deuxième étage sera monté, que feras-tu ?
– Le plancher hourdé, je me trouverai presque de plain-pied avec sa fenêtre ; ce sera comme quand je l’ai vue la première fois.
– Alors vous pourrez parler ?
– Ce n’est pas ça. Entre cette maison que nous reconstruisons et la sienne, il n’y aura qu’une cour de six mètres.
– Bon.
– J’attendrai une nuit bien sombre et le moment où je serai seul avec vous.
– Et puis ?
– Je poserai une planche de la maison neuve à sa maison, et je passerai.
– Eh ! dit l’invalide, tu es plus hardi que je ne pensais, mon garçon !
– Vous sentez bien que lorsqu’on est sur le bâtiment depuis l’âge de dix ans, on marche sur les échafaudages à cent pieds de haut sans que la tête vous tourne. J’arriverai donc à la fenêtre, je frapperai doucement. Si on vient m’ouvrir, je lui dis : « Fiez-vous à moi. »
Et je la prends dans mes bras, et je l’emporte ; et les deux hommes qui la gardent n’ont pas eu le temps de se réveiller que l’oiseau s’est envolé de sa cage.
C’est-y ça, mon ancien ?
– Tu n’es pas bête, pour un Limousin, dit l’invalide.
– Vous devinez maintenant pourquoi, au lieu de m’en aller comme les camarades à six heures, je reste et je couche au chantier.
– Parbleu !
– Vous ne me trahirez pas, au moins ?
– Je suis soldat, répondit l’invalide, non seulement je ne te trahirai pas, mais je t’aiderai, si je puis.
Et l’invalide tendit sa main à l’ouvrier.
Le feu s’était éteint. Mais les premières clartés de l’aube glissaient sous le ciel pâle de novembre, et les pierrots commençaient à s’éveiller sous les toits.
L’invalide, levant la tête, jeta les yeux dans la direction que lui indiquait le doigt du Limousin et aperçut la fenêtre dont celui-ci lui avait parlé.
Tout à coup cette fenêtre s’ouvrit.
Une tête pâle, enfiévrée, apparut alors, et l’invalide jeta un cri d’admiration.
L’Anglaise exposait son front brûlant au vent frais du matin.
– Qu’elle est belle ! dit le soldat amputé.
L’Anglaise ne le regardait pas, ou plutôt ne les avait point aperçus.
– Sais-tu au moins comment elle s’appelle ? demanda l’ancien zouave.
– Le pipelet m’a dit son petit nom.
– Ah !
– Elle se nomme miss Ellen.
Et comme le Limousin parlait ainsi, l’Anglaise abaissa les yeux vers le chantier, tressaillit en apercevant le pauvre maçon, et, une fois encore, elle se prit à lui sourire, comme si elle eût deviné en lui son libérateur.
IV
Miss Ellen !
Oui, c’était bien elle ; la fille de lord Palmure, naguère l’implacable ennemie de l’homme gris, c’est-à-dire de Rocambole, maintenant son amante dévouée.
Ceux qui ont suivi les derniers événements dont Londres avait été le théâtre, se souviennent certainement de ce piège tendu par l’altière jeune fille à cet homme qu’elle croyait haïr et qu’elle aimait.
Ils n’ont pu oublier cette scène de désespoir suprême pendant laquelle miss Ellen cherchait à faire à Rocambole un rempart de son corps, et implorant la pitié de cet homme sans entrailles, de ce prêtre vindicatif et farouche qu’on appelait le révérend Patterson.
Miss Ellen s’était aperçue tout à coup qu’elle aimait cet homme qu’elle venait de livrer à ses ennemis. Et l’homme gris lui avait dit en souriant :
– Vous m’avez perdu, mais à présent vous me sauverez, miss Ellen !
Et alors, comme le révérend faisait signe aux policemen d’emmener leur prisonnier, celui-ci s’était mis à parler français, une langue que miss Ellen possédait parfaitement.
– Miss Ellen, lui avait-il dit, nous allons être séparés, mais notre séparation sera courte. Je serai libre quand je le voudrai. Aussi, ne songez pas à moi, mais à la cause que vous combattiez naguère, et à laquelle maintenant, je le sais, vous appartenez corps et âme, comme vous m’appartenez.
Ne demandez rien à votre père, qui, du reste, va vous maudire, ne cherchez pas à me faire sortir de prison : mais partez, quittez Londres, quittez l’Angleterre ; allez-vous-en à Paris, cherchez-y un homme qui s’appelle Milon, une femme qui a nom Vanda, et dites-leur :
« Venez avez moi, le maître a besoin de vous. Cela suffira. »
Et comme miss Ellen le regardait, éperdue, atterrée, il ajouta :
– À Londres, on m’appelait l’homme gris, mais à Paris, je me nomme Rocambole !
Et Rocambole avait été en prison du pas d’un triomphateur, laissant miss Ellen folle de douleur, mais lui appartenant désormais corps et âme, comme il venait de le dire.
Sortie du souterrain, elle était remontée dans son hôtel.
Lord Palmure était absent.
Désormais miss Ellen était Irlandaise. Désormais elle appartenait à la grande cause des Fénians, que Rocambole avait servie, et elle cessait, pour ainsi dire, d’être la fille de son père.
Aussi n’avait-elle pas même songé à le revoir.
Profitant de l’absence du noble lord, elle avait réuni à la hâte quelques vêtements, quelques bijoux et tout l’argent qu’elle avait eu sous la main.
Miss Ellen avait deux serviteurs dévoués, une femme de chambre, appelée Katt, et un valet.
Elle les avait emmenés avec elle.
L’homme gris n’était pas encore arrivé à Newgate que miss Ellen venait à Charing-Cross, montait dans le train express de Folkestone et quittait Londres avec ses deux serviteurs.
Le soir, elle débarquait à Boulogne, prenait le train de marée et arrivait à Paris vers minuit.
Miss Ellen, comme toutes les Anglaises riches qui voyagent, connaissait Paris.
Rocambole n’avait pas eu le temps de lui donner d’autres renseignements ; il n’avait pu prononcer que les noms de Milon et de Vanda, mais cela lui suffisait.
Miss Ellen serait la digne compagne de l’homme gris, elle trouverait.
Elle se fit conduire, en arrivant, rue Louis-le-Grand, dans une maison qu’elle avait habitée déjà avec son père, un hiver qu’ils étaient venus à Paris.
La dame qui tenait l’appartement meublé la reconnut et lui fit un excellent accueil.
Miss Ellen s’installa donc avec sa femme de chambre et son domestique.
Le lendemain matin, après quelques heures d’un sommeil agité et fiévreux, elle se mit en campagne.
Milon est un nom assez commun ; il y a des Milon par centaines à Paris, et l’almanach du commerce en contient une vraie collection.
Miss Ellen se dit :
– J’aborderai quiconque se nomme ainsi et je lui dirai : Connaissez-vous le maître ?
C’était naïf à première vue, mais peut-être était-ce, en réalité, le meilleur moyen.
Et miss Ellen se mit à l’œuvre.
Elle épuisa la liste des Milon de l’almanach.
Aucun de ceux-là n’avait entendu parler d’un homme appelé Rocambole.
Le soir, miss Ellen eut une idée tout à fait anglaise. Elle rédigea une petite note ainsi conçue :
« M. Milon et madame Vanda, tous deux amis de M. R…, sont priés de passer sans retard, rue Louis-le-Grand, n°…, pour une affaire de la plus haute importance. »
Cette note était destinée aux journaux.
Malheureusement miss Ellen n’eut pas le temps de l’envoyer.
Comme, brisée de fatigue, elle prenait à la hâte quelque nourriture, un bruit se fit dans son antichambre et elle entendit un domestique qui parlementait, en anglais, avec un visiteur.
Puis la femme de chambre lui apporta une carte sur laquelle on lisait :
Sir James Wood, esq.,
Oxfort street.
Miss Ellen allait répondre qu’elle ne pouvait recevoir ce gentleman, qui lui était parfaitement inconnu.
Mais sir James Wood, ayant poussé la femme de chambre, entra résolument dans le boudoir de miss Ellen.
En même temps, la jeune fille aperçut deux autres hommes qui lui étaient pareillement inconnus et qui se tenaient dans la pièce voisine.
Alors elle pâlit et devina un malheur.
Néanmoins, elle regarda sir James Wood avec hauteur et lui dit :
– Que voulez-vous donc, monsieur, et de quel droit forcez-vous ainsi ma porte ?
– Oh ! excusez-moi, miss Ellen, répondit-il, je suis un gentleman et n’outrepasse jamais mon droit. Je suis en règle.
– Plaît-il ?
– J’ai un passe-port visé par l’ambassade d’Angleterre à Paris.
– Que m’importe ?
– Et un ordre du préfet de police qui m’autorise à requérir la force armée au besoin.
– Monsieur.
– Enfin, j’ai l’honneur d’appartenir à la police de la métropole et je suis détective.
Miss Ellen recula épouvantée.
– Je vois, dit froidement cet homme, que vous commencez à comprendre pourquoi je suis ici. C’est lord Palmure, votre noble père, et le révérend Patterson, son ami, qui m’envoient.
Miss Ellen jeta un cri !…
V
Sir James Wood, le détective, était un homme d’environ quarante-cinq ans, aux favoris un peu grisonnants, aux cheveux blonds et aux yeux bleus.
Il avait de belles dents, un visage coloré, un grand flegme dans toute sa personne, et son langage et ses manières étaient ceux d’un parfait gentleman.
Il s’exprimait avec le plus grand calme et ne sortait pas des bornes d’un respect excessif.
– Miss Ellen, dit-il, je vous supplie de m’excuser tout d’abord et de m’écouter ensuite avec patience. Je vous ai dit qui j’étais ; je fais mon devoir, rien de plus, rien de moins.
Je suis parti de Londres avec des ordres formels, muni de pouvoirs réguliers.
Je n’irai pas plus loin que les ordres que j’ai reçus ; je n’outrepasserai pas mes pouvoirs.
– Monsieur, répondit miss Ellen, qui avait peu à peu reconquis son sang-froid et sa présence d’esprit, je vous prie de vouloir bien vous expliquer.
– Je suis à vos ordres, miss Ellen.
– On vous a donné des instructions me concernant ?
– Oui.
– Qui donc ?
– Lord Palmure, votre noble père.
– Quelles sont ces instructions ?
– Votre attitude, votre conduite, miss Ellen, peuvent les modifier.
– Ah !
– Lord Palmure sait pourquoi vous avez quitté Londres.
– Bien.
– Il désire que vous y reveniez.
– Après ?
– Mais il désire plus encore que vous ne soyez pas mise en contact avec les misérables que vous êtes venue chercher à Paris.
– Et puis.
– Les ordres que j’ai reçus étaient donc la conséquence de ce double désir.
– Voyons ces ordres ?
– Je les ai exécutés en partie. Je suis allé à l’ambassade d’Angleterre, et, muni d’une lettre de lord Palmure, approuvée par l’ambassade, j’ai sollicité du préfet de Police de Paris un mandat d’arrestation que j’ai obtenu.
– Vous venez m’arrêter ? s’écria miss Ellen, qui fit de nouveau un pas en arrière.
– Cela dépend de vous, miss Ellen.
– De moi !
– Oui, le Parlement est à la fin de sa session ; dans quinze jours ses membres seront libres, et lord Palmure pourra quitter Londres, passer le détroit et venir chercher sa fille à Paris.
– Et… d’ici là ?
– J’ai à vous donner à choisir : ou vous laisser en France dans une maison de santé, ou demeurer libre sous ma surveillance. Dans ce dernier cas, je congédierai vos deux domestiques et les remplacerai par d’autres, j’habiterai, moi et mon collègue, cette maison, et vous ne pourrez en sortir qu’accompagnée par lui ou par moi. Du reste, soyez tranquille, miss Ellen, ajouta-t-il avec un sourire, nous sommes gens de bonne compagnie et nous ne vous ferons pas rougir. Vous irez au bois tous les jours, si bon vous semble, au spectacle tous les soirs.
Lord Palmure vous ouvre un crédit sur la maison Rothschild, de Paris, et vous pourrez satisfaire tous vos caprices.
– En vérité ! dit miss Ellen avec amertume. Et si je refusais ?
– Nous aurions la douleur, mon collègue et moi, de vous conduire ce soir même dans une maison de santé, où vous seriez l’objet d’une surveillance particulière.
Le flegme de sir James Wood ne laissait pas d’illusion à miss Ellen.
Évidemment cet homme ferait ce qu’il disait, et rien au monde ne le pourrait détourner de ce qu’il appelait son devoir.
Entre deux maux, miss Ellen, qui était une femme de résolution, devait choisir le moindre.
Dans une maison de santé, elle était tout de bon prisonnière ; sous la surveillance de sir James Wood, elle avait au moins quelque chance de s’échapper.
Paris est la terre classique du hasard, et le hasard sera toujours le père de l’occasion.
Elle parut réfléchir un moment.
Puis, regardant le gentleman :
– Eh bien ! soit, monsieur, dit-elle, j’accepte.
À partir de ce jour, la vie de miss Ellen avait été de tous points comme le Limousin l’avait naïvement décrite à son compagnon de nuit l’invalide.
Les deux détectives ne la quittaient pas une minute pendant le jour.
La nuit, ils se faisaient dresser un lit de camp à la porte de la jeune fille, si bien qu’elle n’aurait pu sortir de sa chambre sans les éveiller.
Cependant, un moment, elle avait espéré sa délivrance.
Elle avait surpris le pauvre maçon qui la contemplait avec extase, et la pensée de faire de cet homme un naïf instrument lui était venue aussitôt.
Le billet qu’elle avait laissé tomber derrière un amas de planches était ainsi conçu :
« J’ai un grand service à vous demander et je vous récompenserai généreusement si vous pouvez me le rendre. Quand vous aurez lu ces mots, levez la tête, et si vous êtes décidé à me servir, ôtez votre casquette deux fois de suite. Alors je vous ferai parvenir mes instructions. »
Malheureusement l’œil de lynx de sir James Wood avait surpris la chute du billet, et son collègue, cinq minutes après, entrait dans le chantier et s’en emparait avant que le pauvre Limousin eût pu en prendre connaissance.
Ce jour-là, le détective dit à la jeune fille :
– Miss Ellen, si vous recommenciez, j’aurais la douleur de vous conduire dans la maison de santé dont je vous ai menacée.
Et dès lors il ne fut plus permis à miss Ellen de se mettre à la fenêtre pendant le jour, c’est-à-dire tant que les maçons étaient au chantier.
Si cette fenêtre s’ouvrait et que la jeune file parût, le détective était derrière elle.
Les maçons arrivaient à six heures du matin et s’en allaient à sept heures du soir.
Alors l’invalide prenait possession du chantier ; mais sir James Wood ne se méfiait pas de lui, car il avait fort bien remarqué que c’était au jeune maçon que miss Ellen avait songé à s’adresser.
Or, huit jours s’étaient écoulés depuis la tentative infructueuse du billet, quand miss Ellen, un matin, ouvrant sa fenêtre, aperçut le Limousin assis auprès de l’invalide dans le chantier.
Comme l’heure où les maçons arrivaient était loin encore, sir James Wood, pensant que miss Ellen dormait, était au lit dans la pièce voisine.
Miss Ellen tressaillit en voyant le Limousin ; l’espoir revint à son cœur.
Et prenant un petit carnet, elle en arracha un feuillet et écrivit un second billet conçu dans les mêmes termes que le premier.
Cette fois le billet parvint à son adresse.
Le Limousin savait lire.
Il ôta sa casquette deux fois de suite, et miss Ellen disparut aussitôt de la croisée.
VI
Miss Ellen referma la fenêtre et se remit au lit.
Elle savait maintenant une chose : c’est que le Limousin couchait dans le chantier au lieu de s’en aller le soir, comme les autres maçons.
Sir James Wood s’est levé bien avant l’ouverture du chantier, mais il ne soupçonne rien.
Miss Ellen restait au lit et paraissait résignée à sa captivité.
Elle alla au bois comme à l’ordinaire, rentra pour l’heure du dîner, toujours accompagnée de ses deux gardiens, et profita du moment où sir James Wood la laissait seule afin qu’elle pût se déshabiller, pour écrire cet autre billet qui était plus explicite que le premier.
« Vous est-il possible de parvenir jusqu’à moi, soit à l’aide d’une échelle, soit en grimpant le long d’un tuyau de conduite ? Vous êtes le seul homme que je connaisse à Paris, et je suis prisonnière. Si vous le pouvez, écrivez-le-moi ; cette nuit je laisserai pendre un fil après lequel vous attacherez votre réponse. Je vous le répète, vous serez généreusement récompensé. »
Elle cacha ce billet dans son corsage et attendit le soir patiemment.
Sir James Wood, une fois la nuit venue, ne se méfiait plus du chantier.
Quelquefois même, il confiait la garde de miss Ellen à son camarade et allait faire un petit tour de boulevard. Miss Ellen, après dîner, se mettait à un piano et gagnait ainsi dix heures, moment où elle se mettait au lit.
Jamais les heures ne lui avaient paru plus longues que ce soir-là.
Enfin, sir James Wood sortit, après avoir installé l’autre détective dans l’antichambre, et miss Ellen s’enferma chez elle.
Elle s’enveloppa d’un peignoir, éteignit sa bougie, ouvrit sa fenêtre sans bruit et se pencha sur le chantier.
Comme la nuit précédente, deux hommes causaient à voix basse auprès du feu de nuit.
C’étaient l’invalide et le Limousin.
Celui-ci n’eut pas besoin de lever la tête, car il avait constamment les yeux fixés sur la fenêtre.
La nuit était assez claire, du reste, et le Limousin, voyant apparaître l’Anglaise, se leva et vint se placer verticalement au-dessous de la croisée.
Alors miss Ellen lâcha son billet et disparut de nouveau.
Le Limousin le ramassa, revint auprès du feu et le lut. Puis, il le montra à l’invalide.
– C’est bien drôle tout de même qu’elle soit prisonnière : prisonnière de qui ? est-ce d’un mari jaloux ?
– Oh ! fit le naïf Limousin, qui eut un battement de cœur et un rugissement de colère dans la voix.
Tout maçon a un crayon qui lui sert à tracer des lignes sur la pierre ou à faire ses calculs.
Le Limousin n’avait pas de papier ; mais il alla chercher dans un coin du chantier une planchette de trois pouces de long sur quatre de large, et qui n’était autre chose qu’un fragment de plinthe peinte en gris. Puis, avec son gros crayon bleu il écrivit dessus :
« Nous n’avons pas au chantier d’échelle assez longue ; mais si vous pouvez attendre six jours, je pénétrerai jusqu’à vous, et si vous le voulez, je vous délivrerai. »
Cela fait, il alla se replacer sous la fenêtre.
Miss Ellen, abritée derrière ses vitres, l’avait vu écrire sur la planchette.
Elle s’était procuré dans la journée un peloton de ficelle rouge qu’elle se mit alors à débrouiller et qu’elle laissa pendre par un bout dans le chantier.
L’intelligent Limousin y attacha solidement la planchette et miss Ellen tira à elle.
Deux minutes après, la planchette redescendit.
Miss Ellen avait ajouté un mot :
« J’attendrai. »
Quel moyen le Limousin employerait-il pour la délivrer ?
Elle ne le savait pas, mais elle avait foi en lui.
Le lendemain, comme elle déjeunait tête à tête avec James Wood, elle lui dit :
– Dans combien de jours estimez-vous que mon père arrivera ?
– J’ai reçu une lettre de lui ce matin.
– Ah !
– Lord Palmure sera ici dans treize jours.
– Pourquoi donc, au lieu de venir me chercher, ne vous a-t-il pas confié le soin de me ramener en Angleterre ?
Une ombre de sourire glissa sur les lèvres de sir James Wood.
– Mais, dit-il, lord Palmure n’a nullement l’intention de vous ramener en Angleterre.
– Ah ! vraiment ?
– Il ne veut pas s’exposer à vous voir passer ouvertement aux Fénians.
– Ah ! ah !
– Et il compte vous emmener passer l’hiver en Italie.
– C’est bien, dit miss Ellen, je comprends.
Et elle n’adressa plus la parole à sir James Wood.
Les jours s’écoulèrent.
De temps en temps, la pauvre prisonnière jetait un regard furtif dans le chantier.
La maison neuve était sortie de terre et montait rapidement.
Au bout de cinq jours, elle était arrivée au second étage.
Par une nuit sombre, miss Ellen se remit à sa fenêtre.
Le Limousin prit sa planchette et vint se poser au-dessous.
Miss Ellen laissa pendre le peloton de ficelle, et la planchette monta.
Le Limousin avait écrit dessus :
– Demain, à minuit, je serai chez vous.
Et miss Ellen rejeta la planchette et se mit au lit pleine d’espoir.
La nuit lui parut longue, la journée plus longue encore, cependant elle dissimula merveilleusement son impatience et sir James Wood ne se douta de rien.
Le soir venu, miss Ellen se retira chez elle et se mit au lit.
À onze heures, sir James Wood rentra de sa petite promenade.
Il ne pénétrait jamais la nuit dans la chambre de miss Ellen, mais il s’était ménagé un petit jour dans la porte, et, par ce jour, il pouvait suivre, au besoin, tons les mouvements de la jeune fille.
Sir James Wood aperçut la jeune miss, qui semblait dormir, grâce à un splendide clair de lune dont les rayons pénétraient dans la chambre et s’ébattaient sur la courtine du lit.
Sir James Wood prit possession de son lit de camp, qui se trouvait placé en travers de la porte.
Puis, un quart d’heure après, miss Ellen, qui ne dormait pas, entendit un ronflement sonore.
C’était sir James qui dormait réellement.
Alors, miss Ellen se glissa hors de son lit, s’enveloppa d’un peignoir, alla ouvrir la fenêtre et attendit.
Aux rayons de la lune, elle vit le Limousin debout sur le plancher du troisième étage de la maison neuve.
L’invalide était avec lui.
Tous deux tiraient à eux une longue planche et la faisaient glisser sur l’entablement d’une croisée, qui était placée vis-à-vis de celle de miss Ellen et tout à fait de niveau avec elle.
Alors, miss Ellen commença à comprendre, car la planche glissait sans bruit et son extrémité vint se poser sur l’entablement de sa propre croisée.
Alors encore, miss Ellen eut peur et ferma instinctivement les yeux : le Limousin venait de s’aventurer bravement sur le pont aérien, qui n’avait pas un pied de large.
VII
Comme il l’avait dit, le Limousin n’était pas depuis l’âge de dix ans dans le bâtiment pour manquer d’équilibre et avoir le vertige.
Il passa lestement au-dessus de l’abîme et posa le pied sur l’entablement de la croisée de miss Ellen, qui venait de s’ouvrir.
Alors, deux petites mains le saisirent et l’attirèrent.
Puis une voix douce et harmonieuse lui dit tout bas :
– Ne faites pas de bruit, ou nous sommes perdus !
La chambre était sans lumière ; mais la lune y versait sa blanche clarté, et le pauvre Limousin voyait miss Ellen et la contemplait avec extase, comme si on eût été en plein jour.
C’était un rêve pour lui !
Un rêve étrange, bizarre, un rêve céleste que se trouver ainsi, lui, le pauvre enfant des montagnes de la Creuse et du Limousin, le maçon aux habits couverts de plâtre, dans ce boudoir de jeune file vêtue de soie et dont les deux mains mignonnes, blanches et parfumées, pressaient sa main calleuse, dont la voix tremblante murmurait à son oreille, à son oreille enivrée : « Ne faites pas de bruit », l’associant ainsi à son péril et l’élevant par là même jusqu’à elle.
Miss Ellen avait connaissance sans doute de ce petit trou que sir James avait percé dans la porte, afin de la pouvoir surveiller à toute heure, car elle entraîna le jeune ouvrier à l’autre bout de la chambre, en un coin où ils ne pouvaient être vus.
Et alors, lui tenant toujours les mains, elle approcha ses lèvres de son oreille et lui dit :
– Je ne vous connais pas, mais j’ai confiance en vous.
– Moi non plus, mademoiselle, répondit le naïf garçon, moi non plus je ne vous connais pas ; mais vous pouvez faire un signe et je me jette par la fenêtre, ou bien je m’en retournerai par où je suis venu.
– C’est-à-dire que vous m’êtes dévoué ?
– La dernière goutte de mon sang vous appartient.
– J’espère bien, dit-elle toujours émue et cependant souriante, j’espère bien que vous ne verserez jamais votre sang pour moi. Mais j’ai l’espoir aussi que vous pourrez me rendre un grand service.
– Parlez, mademoiselle, je suis prêt.
– En deux mots, dit miss Ellen, car nous n’avons pas de temps à perdre, je vais vous mettre au courant de la situation. Je suis la fille d’un lord anglais ; je me suis sauvée de chez mon père pour remplir un devoir impérieux, un devoir sacré.
– Sans cela, dit le Limousin, qui attachait sur elle un regard plein d’admiration et d’enthousiasme, vous ne vous seriez pas sauvée, j’en suis bien sûr.
Miss Ellen poursuivit :
– Je viens à Paris pour y chercher un homme que je ne connais pas, dont j’ignore le domicile et qu’il faut à tout prix que je retrouve. Cet homme se nomme Milon.
– Milon ! exclama le Limousin.
– Oui. Vous connaissez quelqu’un de ce nom ?
– Notre entrepreneur de maçonnerie, notre patron, comme nous disons, s’appelle Milon.
– Ô mon Dieu ! murmura miss Ellen, si c’était lui !
– Comment est-il, celui que vous cherchez ? demanda le Limousin.
– Je vous l’ai dit, je ne le connais pas… je ne l’ai jamais vu !…
– Savez-vous s’il est jeune ou vieux ?
– Pas davantage.
– Notre patron, poursuivit le Limousin, est un grand et gros homme, qui a les cheveux blancs et qui est bon comme du bon pain.
– Tout ce que je puis vous dire, reprit miss Ellen, c’est qu’il doit connaître une femme appelée Vanda.
– Bon !
– Et un homme appelé Rocambole.
– Cela me suffit, dit le Limousin. Ce matin même, j’irai trouver le patron et je lui dirai : Connaissez-vous M. Rocambole et Mme Vanda ? S’il me dit oui, c’est que c’est lui. Et la nuit prochaine, je viens vous le dire.
– Mais, dit miss Ellen, je voudrais sortir d’ici, pouvez-vous m’emmener ?
– Je ne demande pas mieux, dit le Limousin, dont un frisson parcourait le corps. Seulement, il faut que je repasse seul sur le bâtiment.
– Pourquoi ?
– Pour mettre une planche plus large.
– Oh ! dit miss Ellen, je suis courageuse et j’ai le pied sûr.
– Oui, dit le Limousin, mais la planche n’est pas assez forte, elle casserait sous le poids de nos deux corps.
Miss Ellen se mit à réfléchir.
– Au fait, dit-elle, mieux vaut attendre à la nuit prochaine. D’abord, vous verrez si le Milon dont vous parlez est celui que je cherche.
– Pour ça, oui.
– Ensuite, vous me chercherez loin d’ici, dans un quartier éloigné de Paris, un petit logement, et vous me procurerez les vêtements d’une femme du peuple. Voilà de l’argent.
Et elle mit une bourse dans la main du Limousin rougissant.
– J’exécuterai vos ordres, mademoiselle, dit-il, et demain, à pareille heure, tenez-vous prête. J’aurai une planche deux fois plus large et deux fois plus forte. Vous pourrez passer sans danger.
– Vous êtes un brave garçon et un noble cœur, dit miss Ellen.
Et la fille du pair d’Angleterre tendit la main au pauvre maçon, qui prit respectueusement cette main et la baisa.
Puis il s’élança sur le pont aérien et franchit de nouveau l’abîme.
Alors, miss Ellen se mit à genoux et remercia Dieu.
Elle avait enfin trouvé un libérateur.
Cependant, elle n’entendait plus les ronflements sonores de sir James Wood.
Mais elle avait parlé si bas qu’il était peu probable que le détective eût entendu sa conversation avec le maçon et eût même soupçonné cette nocturne entrevue.
Néanmoins, miss Ellen passa une nuit d’angoisse et ne se trouva rassurée que le lendemain, lorsqu’elle vit sir James Wood.
L’Anglais était calme et indifférent, et il lui dit :
– Vous n’avez plus que douze jours à supporter ma présence, miss Ellen, prenez patience !
– Moins que cela peut-être, pensa la jeune fille qui se prit à songer au Limousin.
VIII
Le Limousin avait donc regagné le bâtiment neuf.
L’invalide l’attendait et il l’aida à retirer la planche qui lui avait servi de pont.
– Eh bien ! que te voulait-elle ? demanda le soldat.
Le Limousin lui raconta son entrevue avec la jeune fille.
– Et que comptes-tu faire ? dit encore l’invalide.
– Pardine ! répondit le Limousin, c’est bien simple, j’irai trouver le patron.
– Et puis ?
– Et je lui dirai : Est-ce que vous connaissez Rocambole ?
– Je ne suis pas de cet avis, lui dit l’invalide.
– Pourquoi, mon ancien ?
– Je suis un homme d’expérience, je te l’ai dit, et j’estime qu’il ne faut jamais aller trop vite.
– Allez, mon ancien, expliquez-vous.
– Suppose une chose, reprit l’invalide : c’est que ton patron, M. Milon, l’entrepreneur de maçonnerie, ne soit pas celui que cherche ton Anglaise.
– Bon !
– Il voudra savoir pourquoi tu lui as fait cette question, et tu lui conteras la chose.
– Naturellement.
– Le patron est un homme d’âge ; les gens d’âge ne comprennent pas grand’chose à l’amour ; mais, en revanche, ils sont près de leurs intérêts. Comprends-tu, toi ?
– Non, mon ancien.
– Ton patron, dans tout ce que tu lui auras dit, ne verra qu’une chose.
– Laquelle ?
– C’est que tu t’amuses, la nuit, à passer de sa construction dans une maison habitée, sur une planche ; que la police peut trouver la plaisanterie mauvaise, que le propriétaire de la maison habitée peut se plaindre, et que M. Milon, homme patenté, peut avoir des difficultés avec l’autorité à cause de toi.
– Diable ! fit le Limousin, vous avez peut-être raison, mon ancien.
– Alors, poursuivit l’invalide, que fera-t-il ? Il te mettra à la porte du chantier, et tu ne pourras pas sauver l’Anglaise.
– Mais alors, mon ancien, dit le Limousin, frappé de la justesse de ce raisonnement, que feriez-vous à ma place ?
– Demain, je ne dirais rien au patron.
– Bon !
– Mais je m’occuperais de trouver une chambre quelque part pour la demoiselle, une chambre et des habits, car elle pense bien qu’elle ne peut pas être habillée comme une duchesse, si elle s’en va aux barrières.
– Et puis ?
– Et puis, la nuit prochaine, je lui ferais prendre l’air ; et ce ne serait que lorsqu’elle serait hors du chantier et en sûreté, que j’irais demander au patron s’il ne connaît pas ce monsieur… Comment l’appelle-t-on ?… Rocambole ?
– Fort bien, dit le Limousin. Vous parlez d’or, mon ancien, et je ferai comme vous dites.
Et l’invalide et le Limousin allèrent achever leur nuit auprès du feu allumé dans le chantier.
Quand le jour parut, l’invalide éveilla le Limousin, qui avait fini par s’endormir, et lui dit :
– Il m’est venu une idée.
– Voyons ça ?
– J’ai une sœur au Gros-Caillou, dans le passage de l’Alma ; elle est blanchisseuse, c’est une brave femme, qui m’est toute dévouée et qui fera ce que je voudrai.
– Bon !
– Elle logera ton Anglaise. J’irai lui parler aujourd’hui. Tu n’as plus à t’inquiéter de rien. Je t’apporterai même une robe et un bonnet pour la demoiselle.
– Ah ! mon ancien, murmura le Limousin, vous êtes un vrai camarade, vous !
– Je l’ai toujours été, dit l’invalide avec simplicité.
*
* *
La journée s’écoula.
Le Limousin était dévoré d’impatience ; mais il n’osait plus lever les yeux vers la croisée de miss Ellen, tant il avait peur que son projet ne fût deviné, soit par ses camarades du chantier, soit par les gens qui gardaient à vue la jeune Anglaise.
Seulement, en allant et venant, il finit par trouver une planche d’échafaudage qui avait deux pouces d’épaisseur et trois pieds de large.
Cette planche faisait partie d’un échafaudage qui fut démoli le soir, et le Limousin la rangea lui-même contre un mur.
La nuit vint, les ouvriers quittèrent le chantier et l’invalide arriva.
Il portait un petit paquet sous le bras, auquel personne ne fit attention.
Quand il se trouva seul avec le Limousin, il lui dit :
– J’ai vu ma sœur : elle t’attend avec l’Anglaise, et elle m’a donné des habits convenables que voilà.
Et il montra le paquet.
Tous deux allumèrent le feu de nuit et attendirent.
La veille, il faisait clair de lune ; ce soir-là, le temps était couvert et l’obscurité complète.
– J’aime autant ça, murmura l’invalide. Il y a toujours des flâneurs de nuit qui fument leur cigare aux fenêtres. On ne te verra pas.
La soirée passa, comme avait passé la journée ; le brouhaha des voitures, les rumeurs du boulevard s’éteignirent peu à peu.
Une lumière brillait à la fenêtre de miss Ellen.
Le Limousin disait tout bas à l’invalide, qui était monté avec lui dans le bâtiment en construction :
– Tant que je verrai cette lumière, je ne bougerai pas.
– Pourquoi ?
– Parce qu’elle n’est peut-être pas seule. Quand la lumière s’éteindra, nous poserons la planche.
Comme il disait cela, la lumière s’éteignit.
– Attendons encore un peu, dit le Limousin.
Quelques minutes après, la fenêtre s’entr’ouvrit.
– Ah ! voilà le moment, dit le Limousin, qui pensa que miss Ellen était prête.
Et l’invalide et lui poussèrent la planche, dont le bord alla s’appuyer sur l’entablement de la croisée.
Alors le Limousin prit le paquet de hardes apporté par l’invalide et s’aventura sur le pont improvisé.
Mais, comme il était parvenu au milieu du trajet, la fenêtre de miss Ellen s’ouvrit toute grande ; une forme humaine se montra, non point une femme, mais un homme ; et cet homme, saisissant la planche par le bout appuyé sur la fenêtre, la souleva d’une main vigoureuse et la repoussa…
L’invalide entendit un cri terrible, et le malheureux Limousin fut précipité dans l’espace !…
IX
Depuis deux ou trois ans, le côté gauche des Champs-Élysées, en haut du rond-point, a complètement changé d’aspect.
L’ancien village de Chaillot a disparu, et le magnifique hôtel de la duchesse d’Albe, qui avait un parc de plusieurs hectares, a fait place à des terrains encore nus, mais qui, demain, seront couverts par une ville toute neuve.
Çà et là se dresse une construction à peine achevée ; la rue de Morny prolongée n’est bornée que par des terrains à vendre qui, pour la plupart, appartiennent à l’Assistance publique.
Quelques entrepreneurs hardis commencent à bâtir, mais les maisons ne sortent pas encore du sol.
À minuit, ce quartier est désert : on n’y rencontre même pas une voiture de place.
Pourtant les Champs-Élysées sont à deux pas, et, sur l’autre côté, le faubourg Saint-Honoré est plein de bruit et de lumière.
La plaine de Chaillot demeure une vaste solitude, et le passant qui aurait l’imprudence de s’y attarder, courrait grand risque d’y être dévalisé par quelque palefrenier anglais devenu pickpocket à ses moments perdus.
Cependant, ce soir-là, à peu près à l’heure où le malheureux Limousin se trouvait précipité dans l’espace d’une hauteur du troisième étage, la rue de Morny prolongée vit un petit coupé de maître s’arrêter à l’angle des Champs-Élysées.
Le coupé était brun, attelé d’un beau trotteur et conduit par un tout jeune cocher.
Un jeune homme ouvrit la portière et descendit.
Le cocher jeta un regard quelque peu étonné autour de lui, comme s’il eût cherché des yeux la maison absente dans laquelle son maître allait faire une visite nocturne.
Le jeune homme, qui était enveloppé dans un grand manteau imperméable, dont il avait relevé le col, car une petite pluie fine et serrée commençait à tomber, le jeune homme, disons-nous, alluma son cigare, puis il dit au cocher :
– Tu peux rentrer.
– Je n’attends pas monsieur ?
– Non. Va-t’en.
Le cocher tourna bride ; mais en même temps il tourna la tête, curieux sans doute de savoir où son maître pouvait aller à pareille heure.
Mais le jeune homme, qui, sans doute, n’était pas d’humeur à satisfaire cette curiosité, attendit fort tranquillement à la même place que le coupé qu’il venait de quitter eût descendu les Champs-Élysées et dépassé le rond-point.
Alors il se mit en marche d’un pas rigide, longeant cette rue sans maisons et se dirigeant vers le Trocadéro récemment nivelé.
Quand il eut dépassé la rue François Ier, également sans maisons, à ce point de jonction, il s’arrêta de nouveau.
Un bruit était parvenu à son oreille ; deux hommes marchaient derrière lui en causant à mi-voix.
Le jeune homme s’effaça contre une des palissades qui servaient de clôture aux terrains à vendre et attendit.
À mesure qu’ils approchaient, les deux hommes se détachaient plus nettement dans l’obscurité, et bientôt il fut aisé de voir qu’il s’en trouvait un qui était d’une stature colossale.
– Ce doit être Milon, pensa le jeune homme.
Les deux hommes n’étaient plus qu’à quelque distance de lui.
L’un disait :
– Alors, patron, il ne faudra pas vous déranger cette nuit.
– Non.
– Sous aucun prétexte ?
– À moins que l’Anglais qui est déjà venu hier soir ne revienne.
– C’est toujours au même endroit que vous allez ?
– Toujours.
– Alors, je puis m’en aller, patron ?
– Oui. Bonsoir.
– Bonsoir patron.
Et le plus petit des deux hommes tourna les talons et redescendit du côté des Champs-Élysées, tandis que le colosse continuait sa route.
Mais alors le jeune homme quitta sa retraite improvisée et fit un pas vers lui.
– Qui est là ? dit le colosse.
– Est-ce toi, Milon ?
– Oui, monsieur ; ah ! pardon, je ne vous reconnaissais pas, monsieur Marmouset.
– Il fait assez noir pour que tu sois excusable.
Et Marmouset, car c’était bien l’ancien élève de Rocambole, tendit la main à Milon, ce vieux serviteur fidèle du maître.
– Vous le voyez, dit Milon, je suis exact à notre rendez-vous mensuel.
– Moi aussi, dit Marmouset.
– Et, continua Milon, je suis bien sûr que personne ne manquera.
– Excepté Vanda peut-être.
– Pourquoi ?
– Je l’ai envoyée en Angleterre.
Marmouset passa son bras sous celui de Milon.
– Elle le retrouvera peut-être, ajouta-t-il.
Milon secoua la tête. Puis, d’une voix émue :
– Ah ! dit-il, j’ai bien peur que le maître ne soit mort.
Marmouset haussa les épaules :
– Tu disais la même chose il y a quatre ans, quand le maître était dans l’Inde.
– C’est vrai.
– Et le maître est revenu.
– C’est encore vrai. Mais vous savez le proverbe : « Tant va la cruche à l’eau…
– Qu’elle se brise », n’est-ce pas ?
– Oui, dit Marmouset ; mais, outre que tu n’es pas respectueux en comparant Rocambole à une cruche…
– Excusez-moi, balbutia Milon tout confus, j’aurai beau faire, je ne serai jamais qu’une bête.
– Tu oublies que ce diable d’homme joue avec la mort le sourire aux lèvres ? acheva Marmouset.
– Avec tout cela nous sommes sans nouvelles ?
– Oui.
– Et depuis plus de six mois.
– C’est encore vrai.
– Il n’y a pas loin pourtant de Londres à Paris… et si le maître ne nous donne pas signe de vie…
– C’est qu’il a ses raisons pour cela, dit Marmouset. Mais tu parlais tout à l’heure d’un Anglais…
– Ah oui, dit Milon.
– Qu’est-ce que cela ?
– Je vais vous le dire.
Ils avaient continué à marcher, et, s’arrêtant tout à coup devant un terrain clos, Milon passa la main entre deux planches et pratiqua une brèche.
– Nous ne sommes pas les premiers, dit-il.
Et il entra dans le terrain.
Marmouset le suivit, disant :
– Voyons, qu’est-ce que cet Anglais ?
X
Milon replaça la planche qu’il avait dérangée.
Puis, cela fait, comme Marmouset marchait à côté de lui :
– Il y a huit jours, dit-il, un Anglais est venu chez moi.
Ce n’était pas un milord, ni un gentleman, ni un homme bien mis, oh ! non.
C’était un pauvre diable qui marchait sur des bottes éculées, avait un méchant chapeau et pas de linge sous sa redingote boutonnée jusqu’au menton.
J’ai pensé que c’était un mendiant, et j’ai voulu lui donner cent sous.
Il les a repoussés en me disant :
– Ce n’est pas pour cela que je viens.
Comme il se donnait un mal affreux pour parler français, je lui ai parlé anglais.
Alors il m’a raconté qu’il avait été volé à son arrivée à Paris et qu’il avait perdu une lettre et d’autres paquets.
Que la lettre était une lettre de crédit sur un monsieur Milon à Paris, et qu’elle lui avait été donnée par l’homme gris.
Connaissez-vous quelqu’un de ce nom ?
– Non, dit Marmouset.
– Ni moi non plus. Cependant…
– Eh bien ?
– Quand ce pauvre diable a été parti, j’ai pensé au maître, lequel pourrait bien ne faire qu’un seul avec l’homme gris.
– Qui te fait supposer pareille chose ?
– Voici : le pauvre diable d’Anglais m’a dit que l’homme gris était un Français et que ce Français rêvait la liberté de l’Irlande ; que c’était un homme très fort et que tout ce qu’il entreprenait réussissait. Cela ressemble pleinement au maître, ça, hein ?
– Continue, dit Marmouset devenu pensif.
– L’Anglais, poursuivit Milon, pensait bien que la lettre de crédit était signée d’un autre nom. Mais l’homme gris la lui avait donnée cachetée. Ensuite je n’étais pas le premier à qui il racontait cette histoire, car il ne se rappelait que le nom écrit sur l’enveloppe et non point l’adresse. Il s’était donc mis à visiter tous les gens qui portaient le nom de Milon, et généralement, à cause de ses haillons, il s’était fait mettre à la porte. Je vous avoue, acheva Milon, que je l’ai pris, moi aussi, pour un aventurier et un de ces racoleurs anglais qui abondent dans le quartier des Champs-Élysées.
C’était un samedi, jour de paye, j’avais dix personnes qui m’attendaient dans mon bureau ; je lui ai mis dix francs dans la main en lui disant :
– Je n’ai pas le temps de recevoir aujourd’hui, mais revenez me voir.
– Et est-il revenu ?
– Hélas ! non, soupira Milon. J’ai fait la leçon à ma servante, à mon contre-maître, à tout le monde ; la consigne est donnée que, si l’Anglais revient, on le gardera et qu’on viendra me prévenir, n’importe où je serai.
– Même où nous allons ?
– Oui.
– Tu as bien fait, dit Marmouset. Quelque chose me dit que cet homme venait de la part du maître.
– Mais, dit Milon avec un soupir, s’il ne revient pas ?
– Nous le chercherons.
– Paris est grand… Trouvez donc une aiguille dans une botte de foin !
– Bah ! il n’y a pas tant d’Anglais que cela à Paris, surtout d’Anglais en haillons.
Le terrain sur lequel ils marchaient était encombré de matériaux de démolitions, au milieu desquels Milon passait en homme qui est du bâtiment.
Il y avait eu là, et très récemment sans doute, une de ces maisons de l’ancien Chaillot qu’on avait rasée pour faire surgir à sa place, au premier jour, une de ces belles constructions où des loyers de six mille francs représentent un appartement fort ordinaire.
Mais, en attendant, la vieille maison avait disparu, et la nouvelle n’existait pas encore.
Où diable Milon conduisait-il Marmouset ?
Ou plutôt, en quel endroit allaient-ils tous deux ? car Marmouset connaissait parfaitement le chemin.
Au bout du terrain, il y avait un amas de pierres de taille, et, derrière ces pierres, quelques planches couvraient une manière de puits.
On avait rasé la maison, mais on n’avait pas détruit les caves encore.
Les planches avaient été dérangées, et Milon fit pour la seconde fois cette observation :
– Nous n’arrivons pas les premiers.
– Qu’importe ? dit Marmouset.
Alors Milon tira de sa poche une bougie et un rat de cave, qu’il alluma.
Puis il posa le pied sur la première marche d’un escalier qui s’enfonçait sous terre.
Marmouset le suivait toujours.
À la trentième marche, ils se trouvèrent dans une sorte de corridor voûté.
Une lumière brilla dans l’éloignement.
– Qui donc a pu venir avant nous ? demanda Marmouset.
– Peut-être bien la Mort des braves.
– Ah !
– Il demeure dans le quartier. À moins que ce ne soit Jean le Bourreau.
– Demeure-t-il aussi par ici ?
– Oui, il est établi boucher à Passy, comme vous savez.
– Ah ! c’est juste.
Milon éteignit son rat de cave, devenu inutile, car la lumière qui brillait dans le lointain le guidait, et ils arrivèrent ainsi à une porte sur laquelle ils frappèrent trois petits coups.
Aussitôt cette porte s’ouvrit, et les deux visiteurs nocturnes se trouvèrent en présence d’un vieillard de haute stature, dont les cheveux et la barbe étaient entièrement blancs.
XI
L’homme à la barbe blanche qui venait d’ouvrir, n’était autre que notre ancienne connaissance Jean le Bourreau, le paria du bagne, que Rocambole avait réconcilié avec la société et avec lui-même, car longtemps il s’était fait horreur.
Il était le premier au rendez-vous, et ce rendez-vous avait lieu dans la cave d’une maison démolie, au milieu de ce quartier désert que nous venons de décrire. Pourquoi ! dans quel but ?
C’est ce que nous allons dire en peu de mots.
On doit se souvenir qu’à son retour des Indes, Rocambole avait emmené ses compagnons à Londres ; puis, le trésor du major enlevé, cette campagne aventureuse terminée, alors qu’on l’attendait à bord pour retourner en France, il avait manqué à l’appel.
Un mot de lui parvenu à ses compagnons leur disait :
– Partez sans moi, je vous rejoindrai !
Il y avait de cela plus d’un an, et le maître n’avait pas reparu.
Chaque mois, tous ceux qui lui avaient obéi, tous ceux qui auraient versé avec joie la dernière goutte de leur sang pour lui, se réunissaient tantôt dans un coin, tantôt dans un autre, sous la présidence de Milon et de Marmouset.
Chacun espérait, en y venant, apprendre quelque chose, avoir enfin des nouvelles du maître.
Les uns avaient voyagé, les autres avaient couru Paris en tous sens.
D’ailleurs, les compagnons de Rocambole n’étaient plus un amas de pauvres diables luttant avec les nécessités de la vie, en guerre clandestine avec la société, obligés de cacher soigneusement un passé ténébreux. Cet homme infatigable, avant de les abandonner, avait complété son œuvre ; il avait fait à chacun sa place au soleil.
Jean le Bourreau était redevenu boucher ; il avait un étal à Passy, dans la Grande-Rue, était du Conseil des prud’hommes et jouissait de l’estime générale.
Milon, commandité par Marmouset, devenu millionnaire par la mort de Gypsy la Bohémienne, Milon s’était fait entrepreneur. Il démolissait et reconstruisait des maisons, et il avait sous ses ordres une armée de quinze cents ouvriers.
La Mort des Braves s’était fait menuisier, et Marmouset avait payé son fonds.
La Camarde, cette ancienne maîtresse du Pâtissier, cette sinistre cabaretière de l’Arlequin, tenait à présent un beau débit de vins et liqueurs sur le boulevard de Sébastopol, et la Pie-Borgne était devenue marchande de pruneaux à l’entrée de la rue de la Paix.
Tous enfin avaient du travail, étaient dans l’aisance, vivaient honnêtement et conservaient au plus profond de leur cœur le respect et l’amour de cet homme qui, bandit lui-même en sa jeunesse, s’était régénéré par le repentir et leur avait tendu la main.
Rien n’était bizarre, du reste, comme ces réunions mystérieuses où chacun arrivait avec le costume de sa profession, où la robe de soie de Vanda frôlait le tablier de cretonne bleue de la Camarde, et l’habit élégant de Marmouset, le gros paletot pelucheux de Milon ou la veste tricotée de Jean le boucher.
Ces dissemblances avaient même un peu ému la police.
Ce jour-là, les amis de Rocambole s’étaient réunis chez la Camarde.
Un sergent de ville curieux avait adressé un rapport au commissaire de police du quartier.
Le commissaire, qui connaissait Milon, l’avait fait venir pour lui demander des explications.
Milon lui avait répondu qu’ils étaient d’anciens amis et qu’ils banquetaient une fois par mois.
Cette explication avait satisfait le commissaire, mais Milon avait dit à Marmouset :
– Je ne veux pas que la police se mêle de nos affaires. La prochaine fois, je vous indiquerai un endroit où elle ne viendra certainement pas.
Et c’était pour cela que la cave de la maison démolie dans le quartier de Chaillot avait été choisie pour ce nouveau rendez-vous.
Seulement, la nuit précédente, Milon y avait fait transporter par deux de ses ouvriers, dont il était sûr, un panier de vin et une pipe d’eau-de-vie.
Donc, Jean le Bourreau avait été le premier au rendez-vous.
Puis étaient venus Marmouset et Milon, et, après eux, la Mort des braves, et dix autres encore.
Et tous s’étaient regardés tristement.
Personne n’avait de nouvelles du maître.
– Sommes-nous tous là ? demanda Marmouset.
– Vanda n’y est pas, répondit Milon.
– Elle ne viendra probablement point, je te l’ai dit, reprit Marmouset.
Mais, comme il parlait ainsi, la porte s’ouvrit brusquement et il y eut un cri de joie parmi les assistants.
Vanda apparut sur le seuil.
Elle était en robe de voyage, enveloppée dans une vaste pelisse fourrée.
– J’arrive de Londres, dit-elle, et je vous apporte des nouvelles de Rocambole.
Ce fut un cri d’enthousiasme parmi les compagnons du maître…
– Où est-il ? continua Vanda, hélas ! je n’en sais rien, mais je puis vous affirmer qu’il n’est pas mort.
– Tu ne l’as donc pas vu ? s’écria Marmouset.
– Non, mais j’ai suivi ses traces pas à pas jusqu’à il y a environ quinze jours.
– Et alors ?
– Alors, plus rien, disparu de nouveau.
– Oh ! dit Milon, c’est qu’alors il lui est arrivé un malheur.
– Non, dit Vanda avec conviction. Rocambole était victorieux de ses ennemis à l’heure même où je perdais sa trace.
– Quels ennemis avait-il donc à Londres ? Était-ce le major indien ? demanda Milon.
– Non, dit Vanda. Les nouveaux ennemis de Rocambole, ou plutôt ceux à qui il a déclaré une guerre sans merci, ce sont les oppresseurs de l’Irlande et de la foi catholique. Rocambole s’est mis à la tête des fenians de Londres, qui l’appellent l’homme gris.
– L’homme gris ! s’écria Milon, ils l’appellent l’homme gris ?
– Oui.
– Ah ! c’était donc bien à moi qu’en avait le pauvre Anglais que j’ai presque mis à la porte ! murmura le colosse avec un accent de désespoir.
– Parle, dit Marmouset à Vanda, dis-nous d’où tu viens et ce que tu as appris.
XII
Vanda arrivait de Londres, en effet.
Elle n’avait pas même passé avenue Marignan, où elle habitait toujours son petit hôtel ; elle était venue directement en voiture de la gare du chemin de fer à l’entrée de la rue de Morny.
Là, elle avait renvoyé le véhicule et continué son chemin à pied.
Le silence s’était fait autour d’elle.
On attendait avec anxiété les révélations qu’elle venait de promettre.
– Rocambole, dit-elle, emprisonné lors de notre départ, se fit relâcher le lendemain sous caution.
Puis il disparut de Londres pendant quelques jours, et il fut impossible à la police anglaise de retrouver ses traces.
– Et ces traces, vous les avez retrouvées, vous ? demanda Milon.
– Oui.
– À Londres ?
– À Londres, dit Vanda. J’avais successivement, en huit jours, habité tous les hôtels français, depuis Sablonière jusqu’à Sauton hôtel.
– Non, me dis-je un jour, ce n’est pas là que je le retrouverai.
Et je m’en allai dans le quartier des docks, vers Saint George street.
Au lieu de me loger dans un hôtel, je louai un boarding, au coin de Old Gravel-Lane.
Je parle anglais comme une Anglaise, et je me déguisai en femme du peuple.
Le jour, je courais les rues ; le soir j’entrais dans les publics-houses et les tavernes.
J’habitais au deuxième étage.
Au-dessus de moi il y avait une famille composée du père et de sa fille.
Le père était un homme silencieux et sombre ; la fille, une belle créature qui relevait d’une longue et douloureuse maladie.
Je la voyais passer souvent devant ma porte, que je laissais ouverte à cause de la chaleur, et j’avais fini par lui sourire.
Nous fîmes connaissance.
– Vous ayez donc été bien malade ? lui dis-je un jour.
– J’ai cru mourir, me répondit-elle ; c’est un envoyé de Dieu qui m’a sauvée.
– Un médecin ?
– Oui.
– Anglais ?
– On ne sait pas. Il y en a qui disent que c’est un Anglais ; tout ce que je sais, c’est qu’on l’appelle l’homme gris.
– Ah !
Elle me raconta alors que le médecin mystérieux l’avait conduite dans une maison de Hampsteadt, où il l’avait soumise à un traitement par les émanations du goudron.
Puis elle ajouta :
– Nous avons son portrait, mon père et moi.
– Où est-il ?
– Là-haut, dans notre logis.
– Voulez-vous me le montrer ?
– Oh ! de grand cœur.
Je la suivis, elle me fit pénétrer dans sa chambre. Je jetai les yeux sur un portrait, une petite photographie assez mauvaise, et je poussai un cri de joie.
J’avais reconnu Rocambole.
À partir de ce moment, et grâce aux indications que m’ont fournies le père et la fille, je l’ai suivi, pour ainsi dire, pas à pas. J’ai retrouvé presque tous les hommes qui l’ont servi et dont il s’était fait une petite armée. J’ai vu quel était son but, la lutte qu’il avait engagée, les victoires qu’il avait remportées.
Il y a trois semaines, il a embarqué pour la France un enfant irlandais en qui les fenians voient leur chef futur. Avec cet enfant est parti un autre homme appelé Shoking, lequel doit être à Paris et qui certainement possède tous les secrets de l’homme gris.
– C’est peut-être mon Anglais, dit Milon.
– Cet homme et l’enfant partis, poursuivit Vanda, Rocambole est demeuré à Londres.
Un soir, il s’est embarqué dans un canot, au bas du pont de Westminster.
À partir de ce moment on ne l’a plus revu.
Il avait annoncé, du reste, que peut-être il ne reviendrait pas.
Dès lors, tous mes efforts pour retrouver sa trace ont été inutiles.
– Il est mort ! murmura Milon.
Marmouset haussa les épaules.
– Rocambole ne meurt pas, dit-il.
– J’ai aussi cette conviction ! dit Vanda. Seulement, où est-il ?
– Peut-être est-il revenu à Paris ? hasarda la Camarde.
– C’est ce que je me dis quelquefois, fit Jean le Bourreau.
– S’il était à Paris, nous l’aurions vu, dit Marmouset.
L’espoir revenait au cœur de Milon.
– Ah ! dit-il, je me souviens que lorsque nous nous désespérions, il y a quatre ans, un homme me frappa sur l’épaule dans la rue et me dit :
– Imbécile ; il n’y a que les hommes dont la tâche est remplie qui meurent.
Je me retournai. C’était lui.
– Eh bien ! dit Marmouset, pareille chose vous arrivera au premier jour.
– Je le crois, dit Vanda.
– Je l’espère, murmura Milon.
– Car, reprit Marmouset, la dernière tâche que s’est imposée Rocambole n’est point accomplie encore.
La loyale Angleterre continue à opprimer l’Irlande, à persécuter les prêtres catholiques et à refuser aux enfants de la pauvre Erin des pommes de terre et du pain.
– C’est vrai, dit Vanda.
– Donc, Rocambole n’est pas mort.
– Qui sait même s’il n’a pas besoin de nous ? reprit Milon. Oh ! si je pouvais retrouver l’Anglais !
Comme Milon parlait ainsi, on entendit un bruit dans l’éloignement.
Des pas retentissaient dans les couloirs sombres des caves.
– Qui donc attendons-nous encore ? demanda Marmouset.
– Personne, répondit Jean le Bourreau, nous sommes au complet.
– Mon Dieu ! s’écria Vanda, si c’était lui ! si c’était Rocambole !
Et tous les cœurs battirent, et tous les regards se dirigèrent anxieux vers la porte…
XIII
Il y eut une minute d’angoisse suprême.
Puis la porte s’ouvrit, et un homme parut.
Mais cet homme n’était point Rocambole, et il y eut un cri unanime de désappointement et de déception.
Cet homme, c’était le contre-maître de Milon, celui qui l’avait accompagné une heure auparavant jusqu’à la rue de Morny, et à qui l’entrepreneur avait dit :
– Tu ne viendras me déranger sous aucun prétexte, à moins toutefois que tu ne voies revenir l’Anglais.
Aussi Milon s’écria-t-il :
– Tu as vu l’Anglais ?
– Non, patron, répondit cet homme, qui se nommait Polydore.
– Alors, pourquoi viens-tu ?
– Parce qu’il est arrivé un grand malheur !
– Un malheur ?
– Oui.
– Tonnerre ! fit Milon, qu’est-ce qu’il y a donc ?
– Vous savez qu’un de nos Limousins couche dans le chantier de la rue Louis-le-Grand ?
– Non, je ne le savais pas… Mais… continue.
Et Milon, regardant Marmouset :
– Je vous demande pardon, dit-il, cet imbécile vient me parler ici de mes affaires particulières.
– Allez, dit Marmouset.
– Le Limousin est tombé d’un échafaudage… L’a-t-on jeté en bas ?… Je ne sais pas… Tout ce que je puis vous dire, c’est qu’il est mourant et qu’on a eu de la peine à le transporter au poste de la rue Port-Mahon.
C’est là que je l’ai trouvé.
Allez chercher le patron, m’a-t-il dit, avant que je meure, car je crois bien que j’ai mon compte. Dites-lui que, s’il est le Milon qui connaît Rocambole, j’ai un grand secret à lui confier avant de m’en aller dans l’autre monde.
– Ah ! dit Milon, qui fit un bond vers la porte, il a dit cela ?
– Oui, patron.
– Alors, j’y vais.
– J’ai une voiture dans la rue, à l’entrée du terrain, continua le contremaître Polydore, et une voiture qui marche bien.
Milon allait franchir le seuil de la porte en disant : Nous allons peut-être avoir des nouvelles du maître, lorsque Marmouset le suivit :
– Je vais avec toi, dit-il.
Et, se tournant vers les autres compagnons de Rocambole :
– Attendez-nous ici, ajouta-t-il. Milon ou moi nous reviendrons avant une heure.
Et Milon et Marmouset partirent à la suite du contremaître Polydore.
En moins d’un quart d’heure, la voiture de place amenée par ce dernier eut franchi la distance qui sépare le haut des Champs-Élysées de la rue du Port-Mahon.
Il y avait là un poste de police, et c’était dans ce poste qu’on avait transporté le Limousin, grâce à l’invalide, qui, témoin de sa chute, avait couru y demander du secours.
Le Limousin était dans un état déplorable.
Il avait une épaule démise et trois côtes enfoncées.
Un tas de sable sur lequel il était tombé avait amorti sa chute, et c’était par miracle qu’il ne s’était pas tué sur le coup.
Un médecin du quartier appelé en toute hâte ne répondit pas de sa vie.
Il pouvait s’être produit des lésions internes dont on n’avait pas encore connaissance et qui détermineraient peut-être la mort.
– Je sais bien que je n’en reviendrai pas ; mais j’ai deux frères qui prendront soin de notre vieille mère au pays.
Tout ce que je demande, c’est que le patron soit bien celui que miss Ellen cherchait.
L’invalide essuyait de temps en temps une larme qui roulait sur sa joue martiale et il regardait le médecin qui ne voulait toujours pas se prononcer.
Enfin, Milon et Marmouset arrivèrent.
Le Limousin rayonna en voyant l’entrepreneur ; son visage s’éclaira d’une joie céleste :
– Ah ! dit-il, je savais bien que c’était vous qu’elle cherchait.
– Qui donc ? demanda le bon Milon, ému jusqu’aux larmes du piteux état de son ouvrier.
– L’Anglaise.
– Quelle Anglaise ?
– Celle qui est prisonnière là-haut, dans une maison de la rue Louis-le-Grand et que j’ai voulu sauver.
Et comme Milon le regardait avec avidité, le Limousin poursuivit :
– Écoutez-moi vite, patron, car je pourrais bien mourir tout d’un coup.
Mais l’invalide l’arrêta.
– Je sais la chose comme toi, dit-il. Laisse-moi la dire ; si je me trompe, tu me corrigeras. Mais il ne faut pas parler.
Alors, Marmouset, Milon et l’invalide demeurèrent seuls au chevet du moribond, car le médecin eut la discrétion de se retirer dans la première pièce du poste.
L’invalide prit alors la parole.
Il avait eu les confidences du Limousin, il l’avait aidé dans sa funeste expédition, et ce fut avec la plus grande clarté qu’il raconta à l’entrepreneur tout ce qui s’était passé.
Milon ne comprenait pas beaucoup ce que cette Anglaise lui voulait.
Mais Marmouset ne perdait pas un mot du récit de l’invalide, et, quand celui-ci eut fini et que le Limousin eut murmuré : Tout cela est vrai, – il fit appeler le médecin et lui dit :
– Pensez-vous, monsieur, que ce jeune homme puisse être transporté hors d’ici ?
– Pas avant demain, répondit le médecin.
– C’est bien, dit Marmouset qui recommanda le Limousin au chef du poste.
Puis il fit un signe à l’invalide :
– Venez avec nous, dit-il.
Au chantier où cela s’est passé. Je veux me faire montrer la fenêtre.
Et Marmouset, précédé par l’invalide, prit le chemin du chantier.
XIV
Milon avait vu souvent Marmouset à l’œuvre, et c’était l’homme en qui il avait le plus de confiance, après Rocambole, bien entendu.
Il le suivit donc, persuadé que le jeune homme allait faire de bonne besogne.
L’invalide les précédait, et il ouvrit la porte en planches grossièrement assemblées qui fermait le chantier.
– Montrez-moi d’abord la fenêtre, dit Marmouset.
– La voilà, dit l’invalide ; et voici la planche qui s’est brisée en tombant.
Marmouset monta ensuite dans la maison en construction ; il examina attentivement la distance qui séparait les deux fenêtres, et, prenant un carnet, il écrivit dessus quelques mots.
Puis il rejoignit Milon.
– Maintenant, lui dit-il, écoute-moi bien.
– Parlez, dit Milon.
– Tu vas t’en retourner là-bas.
– À la rue de Morny ?
– Oui.
– Et tu diras aux camarades que tu ne peux rien leur dire pour le moment, mais qu’on peut avoir besoin d’eux d’un instant à l’autre.
– Et vous ? dit Milon.
– Moi, je vais rester ici.
– Dans le chantier ?
– Je vais d’abord faire un tour dans le quartier, et puis je reviendrai. Dis à l’invalide, toi qui es le maître ici, qu’il peut m’obéir aveuglément.
– Ah ! mon ancien, dit Milon, je suis l’entrepreneur, mais monsieur que voilà est l’architecte ; comprenez-vous ?
– Comme qui dirait, dit l’invalide, que vous êtes le colonel, mais que monsieur est le général. Respect à la hiérarchie. On obéira à monsieur.
– C’est bien, dit Marmouset. Tu peux t’en aller, Milon.
Milon avait fini par obéir à Marmouset comme il obéissait à Rocambole, militairement.
Demeuré seul avec l’invalide, Marmouset lui frappa sur l’épaule.
– Venez avec moi, dit-il.
L’invalide le suivit.
Ils quittèrent le chantier et entrèrent dans la rue Louis-le-Grand.
– C’est bien là, dit Marmouset, la porte de la maison où demeurait l’Anglaise ?
– Oui, certes.
Marmouset inscrivit le numéro sur son calepin.
– Mais, monsieur, dit l’invalide, il est probable qu’elle n’a pas déménagé cette nuit et qu’elle y demeure encore.
– C’est là ce que vous allez m’aider à savoir.
– Voulez-vous que j’aille sonner et que je demande au portier ?
– Non, dit Marmouset, qui ne put s’empêcher de sourire de cette naïveté. Allons chez moi, d’abord.
– Chez vous ?
– Oui, je demeure à deux pas d’ici, à l’entrée de la rue Auber.
En effet, depuis quelques mois, Marmouset habitait un premier étage dans cette nouvelle rue dont les splendeurs modernes éclipsent la splendeur ancienne de la Chaussée-d’Antin, reléguée maintenant au second plan.
Ce fut là qu’il conduisit l’invalide.
Le valet de chambre qui vint ouvrir à son maître fut quelque peu étonné de le voir rentrer en pleine nuit suivi d’un homme à jambe de bois ; mais, au lieu de satisfaire sa curiosité, Marmouset l’envoya se coucher.
L’invalide, en pénétrant dans cet appartement où régnait un luxe de bon goût, était peut-être tout aussi étonné que le domestique, et se demandait sans doute pourquoi on l’amenait en pareil lieu.
Mais le soldat est sobre de paroles ; il n’interroge pas.
D’ailleurs Milon lui avait dit qu’il devait obéir à Marmouset.
Cela lui suffisait.
Marmouset le conduisit dans son cabinet de travail.
– Mon brave, lui dit-il, vous voyez ce plateau à trois flacons, sur cette table ?
– Oui, monsieur.
– Les trois flacons contiennent du kirsch, du rhum et de l’eau-de-vie. Vous choisirez.
– Oh ! fit l’invalide.
– On dort bien sur ce divan…
– Mais… monsieur…
– Et je vais vous donner une robe de chambre qui vous enveloppera jusqu’aux chevilles.
– Oh ! dit l’invalide, je n’ai pas besoin de robe de chambre.
– C’est possible, mais il faut bien que je remplace votre uniforme par quelque chose.
– Mon uniforme ?
– Oui, j’en ai besoin.
– Pourquoi donc faire ?
– Pour aller garder le chantier cette nuit.
L’invalide eut un geste d’étonnement.
– Écoutez-moi bien, reprit Marmouset.
Et il versa un verre de rhum à l’invalide, qui le regarda et attendit.
– À votre santé, dit Marmouset.
Puis il continua :
– Vous pensez bien que ce n’est pas la jeune Anglaise qui a soulevé la planche et fait culbuter le pauvre Limousin.
– Oh ! pour ça, non.
– C’est donc un des deux hommes qui la gardaient ?
– Très certainement.
– Et comme vous avez aidé le Limousin, ces hommes doivent vous avoir remarqué.
– Bon !
– Et ils se méfient de vous.
– Eh bien ?
– Mais demain matin, au petit jour, en voyant un autre invalide, ils penseront qu’on vous a remplacé et ils ne se méfieront plus du nouveau.
– Et… ce nouveau ?
– Ce sera moi.
– Tout cela est très bien, dit le soldat amputé, mais vous êtes tout jeune, monsieur.
– Qu’est-ce que cela fait ?
– Et vous avez tous vos membres.
– Je vais me séparer d’un de mes bras, dit Marmouset en riant.
– Plaît-il ?
– Tenez, dit encore Marmouset, déshabillez-vous auprès du feu, je vais vous donner un pantalon et une robe de chambre en échange de votre uniforme.
L’invalide obéit encore.
– Maintenant, dit Marmouset, vous allez voir.
Et il passa dans son cabinet de toilette.
Dix minutes après il en sortit, et l’invalide jeta un cri de surprise.
Marmouset avait de grosses moustaches grises, des cheveux blancs, et il paraissait amputé du bras gauche.
L’invalide ne le reconnut qu’à la voix.
– Bon ! dit-il, la moustache, les cheveux, ça s’explique encore ; mais le bras…
– Mon bras est collé au long de mon corps, et je me suis fait un moignon avec du son.
Puis il ajouta en souriant :
– Je vous avouerai qu’avant d’être architecte, j’ai été comédien.
Et Marmouset laissa l’invalide installé chez lui, et il sortit affublé de son uniforme et prit la route du chantier.
– Allons voir, se dit-il, si les gens de la police anglaise sont plus forts que nous.
XV
Marmouset ainsi déguisé ne s’amusa point à rallumer le feu que l’invalide véritable entretenait toute la nuit fort consciencieusement.
Au lieu de demeurer en bas, dans le chantier, il monta dans la maison en construction, se coucha sur le plancher, en face de la croisée de miss Ellen et attendit.
Marmouset faisait un calcul assez juste :
– Évidemment, les hommes ou l’homme qui avaient jeté le maçon en bas, ne manqueraient pas, en admettant qu’ils eussent quitté la maison, d’y revenir.
Marmouset voulait les voir.
La nuit était sombre, et par conséquent, outre qu’il ne serait pas aperçu, lui, il avait la chance de les voir s’ils pénétraient dans la chambre avec une lumière.
Cependant Marmouset attendit longtemps.
Ce ne fut que vers quatre heures du matin qu’il entendit d’abord un petit bruit.
On venait d’ouvrir la croisée.
En même temps, un homme se pencha en dehors, regarda, prêta l’oreille et finit par se retourner vers une autre personne qui se trouvait derrière lui.
Bien qu’il parlât à voix basse, Marmouset, qui avait l’oreille fine, entendit ces mots prononcés en anglais.
– Personne ! l’invalide s’en est allé.
– Et le maçon ? demanda une autre voix.
– On l’a emporté.
– Pensez-vous qu’il n’ait rien dit ?
– Certainement non. On aura mis sa chute sur le compte d’un accident.
– C’est égal, reprit la deuxième voix, nous ferons bien de quitter la maison.
– Nous n’avons plus rien à y faire, puisque l’oiseau est en cage, mais je ne crains rien ; d’ailleurs, si j’étais obligé de dire la vérité, je le dirais au préfet de police qui, du reste, m’a donné des pouvoirs étendus.
– Bon ! pensa Marmouset, qui ne perdait pas un mot de cette conversation, il fait bon de savoir l’anglais, et je sais maintenant, à qui j’ai affaire. Ces messieurs sont des détectives de Londres et ils ont mission de ramener la demoiselle.
– Je voudrais bien les voir en plein jour, et s’ils voulaient me faire plaisir, ils allumeraient une lampe.
Mais sir James Wood et son compagnon, car c’étaient eux, ne donnèrent point cette satisfaction à Marmouset ; ils disparurent de la fenêtre, qu’ils refermèrent, et tout rentra dans le silence.
Marmouset attendit encore.
Quand les premières clartés du jour pénétrèrent au travers du brouillard jaunâtre qui pesait sur Paris, Marmouset quitta son poste d’observation, redescendit dans le chantier et ralluma le feu.
Puis, retrouvant dans la poche de la capote de l’invalide sa pipe et son tabac, il se mit à fumer.
Les ouvriers n’arrivaient qu’à sept heures.
De temps en temps Marmouset levait la tête vers la maison mystérieuse ; mais la croisée demeurait close.
À travers la palissade de planches, son regard pénétrait dans la rue Louis-le-Grand et il surveillait la porte de la maison.
Personne ne sortait.
Enfin cette porte s’ouvrit, et Marmouset vit apparaître le portier, un balai sur l’épaule.
Le portier donna deux coups de balai sur le trottoir, puis il traversa la rue et entra dans le cabaret dont le Limousin avait parlé à l’invalide.
Alors Marmouset quitta son poste. Il sortit du chantier, traversa la rue à son tour et entra dans le cabaret en disant :
– Brrr ! il ne fait pas chaud ce matin. Donnez-moi une goutte de mêlé, patron.
Le portier, qui était déjà accoudé sur le comptoir, leva la tête et regarda le prétendu invalide :
– Tiens ! dit-il, ce n’est plus le même.
– Qu’est-ce qu’il y a pour votre service, mon brave ? demanda Marmouset.
– Vous êtes l’invalide du chantier ?
– Oui.
– Mais vous n’êtes pas celui d’avant-hier ?
– Non. J’ai remplacé mon camarade hier soir.
Parce qu’il était malade.
– Alors c’est vous qui avez passé la nuit ?
– Oui.
– On a fait un joli sabbat dans votre chantier : c’était pire que dans ma maison.
Marmouset ne sourcilla pas.
– Qu’est-ce qu’il s’est donc passé ? demanda le portier, qui était loquace au dernier point.
– C’est un maçon qui s’était endormi dans le bâtiment et qui est tombé du troisième étage.
– C’est donc ça que j’ai entendu crier.
– Oui.
– Est-ce qu’il s’est tué ?
– À peu près ; il n’est pas encore mort, mais il n’en vaut guère mieux.
– Quand j’ai entendu tout ce vacarme, poursuivit le portier, j’ai voulu me lever, mais ma femme m’en a empêché.
– Vous avez été réveillé en sursaut ?
– Oh ! non, nous ne dormions pas, nous avons des meublés dans la maison, et pour le quart d’heure, des locataires qui nous scient joliment.
– Bah ! fit Marmouset.
– Deux Anglais et une jeune fille.
– Une Anglaise !
– Oui.
– Ils rentrent tard ?
– À toute heure de la nuit. Par exemple, hier soir, la jeune fille n’est pas rentrée.
– Oh ! oh !
– À trois heures, elle est montée en voiture avec les deux Anglais pour aller au bois.
– Et elle n’est pas revenue ?
– Non.
– Ni les Anglais ?
– Pardon ; ils sont revenus tous les deux.
– Ah !
– Et même je crois qu’ils ont passé la nuit à faire leurs paquets, car ce matin je leur ai tiré le cordon avant le jour.
– Alors ils sont partis ?
– Oui.
Marmouset savait ce qu’il voulait savoir.
Miss Ellen avait disparu et les deux Anglais aussi.
Comment les retrouver ?
XVI
Qu’était devenue miss Ellen, et comment son évasion si bien combinée avait-elle échoué ?
Pour le savoir, il faut nous reporter à l’autre nuit, celle où le Limousin, s’aventurant sur la planche, était arrivé presque dans la chambre de la pauvre Anglaise.
Sir James Wood était un détective de premier mérite.
Il savait lire au fond des cœurs ; et, quelque effort que miss Ellen eût fait pour cacher ses secrètes espérances, il les avait devinées.
Miss Ellen, s’informant de l’époque où son père viendrait en France, avait commis une première faute.
Le calme qu’elle montrait depuis deux jours avait achevé d’éveiller les soupçons du détective.
Sir James Wood avait, on le sait, percé un trou imperceptible dans la porte.
Grâce à ce trou, il pouvait voir ce qui se passait dans la chambre de miss Ellen.
Miss Ellen avait bien remarqué le trou, mais elle avait, rassurée du reste par les ronflements de sir James, pris la précaution d’entraîner le Limousin dans un coin de la chambre, hors du rayon visuel que le trou pouvait donner.
Seulement miss Ellen n’avait pas songé qu’il y avait une armoire à glace dans sa chambre, que les rayons de la lune permettaient à cette glace de réfléchir son image et celle du Limousin, et qu’elle était placée en face du trou.
Sir James Wood avait ronflé tout éveillé et n’avait pas perdu un seul des mouvements, ni aucune des paroles, quoique prononcées à voix basse, de sa prisonnière et de son futur libérateur.
Il est même probable que si le Limousin eût consenti à emmener miss Ellen cette nuit-là, sir James Wood, enfonçant la porte d’un coup d’épaule, se fût élancé à leur poursuite. Mais le Limousin s’était en allé seul.
Dès lors sir James Wood eut le temps de réfléchir et de prendre ses précautions.
Le lendemain, à l’heure du bois, sir James était aux ordres de miss Ellen.
La jeune fille monta en voiture sans défiance, et la promenade commença.
Sir James était un parfait gentleman, du reste, et on aurait pu le prendre pour l’oncle ou le père de la jeune Anglaise, dont la beauté faisait, du reste, sensation.
Comme les jours précédents, sa calèche fit le tour du lac ; mais là, sir James donna l’ordre au cocher de se diriger vers le cèdre.
– Où voulez-vous donc aller ? demanda miss Ellen, étonnée de ce changement de programme.
– Miss Ellen, répondit sir James avec son flegme habituel, j’ai quelques petites affaires personnelles à Paris, et vous me pardonnerez de les faire tout en vous accompagnant.
– Mais nous allons à Boulogne !
– Précisément.
Miss Ellen le regarda.
L’Anglais était calme, son œil bleu sans rayons, son visage aussi muet que la tête de pierre d’un sphinx.
– Allons ! murmura la jeune fille, qui ne voulait pas le contrarier de peur qu’il n’eût le moindre soupçon.
Arrivée au cèdre, la calèche descendit rapidement vers Boulogne.
Quand on fut hors du bois, miss Ellen aperçut l’autre détective se promenant dans la Grande-Rue, auprès d’une voiture arrêtée qui paraissait stationner la depuis quelques minutes seulement.
Sir James donna l’ordre d’arrêter.
Alors une vague inquiétude s’empara de miss Ellen. Elle regarda sir James.
Un sourire glissait sur les lèvres de l’homme de police.
– Il fait froid, dit-il, et le temps est à la pluie ; nous allons monter dans ce coupé.
– Mais…
– Prenez ma main, dit-il, et ne me résistez pas, miss Ellen.
Il y avait dans sa voix un accent d’autorité qui révolta la patricienne.
– Ah ! dit-elle, vous m’avez tendu un piège.
– Nullement, miss Ellen. En voiture nous causerons.
La Grande-Rue était déserte ; les douaniers de la grille étaient loin, et miss Ellen se trouvait à la merci de ses deux gardiens.
Elle obéit et monta dans le coupé.
Alors sir James s’assit auprès d’elle et leva les glaces.
L’autre détective fit un signe au cocher, et, tandis que la calèche s’en allait à vide, le coupé partit comme l’éclair.
Alors sir James dit à miss Ellen :
– Vous m’avez forcé à agir ainsi, et il n’eût dépendu que de vous que nous attendissions l’arrivée du noble lord votre père. Mais vous avez cherché à nous échapper, miss Ellen, et il faut bien que je prenne mes précautions.
Miss Ellen avait pâli.
Sir James continua :
– Le Limousin du chantier vous attendra vainement la nuit prochaine, miss Ellen.
Elle jeta un cri.
– Ah ! misérable !
– Un vilain mot que vous dites là, miss Ellen, je suis un honnête détective, qui fait son métier avec conscience.
– Et où me conduisez-vous donc ?
– Dans une maison de santé !
Miss Ellen jeta un nouveau, cri et voulut ouvrir la portière.
Sir James se mit à rire.
– Les portières sont fermées à clef, dit-il.
Elle voulut baisser les glaces, mais un ressort invisible les maintenait.
Elle essaya de regarder au travers.
Les glaces étaient dépolies.
Alors elle fut en proie à une colère de lionne prise au piège. Si elle avait eu une arme sur elle, elle aurait poignardé sir James Wood.
Le détective était toujours calme et souriant :
– Vous ne verrez pas si vite, dit-il, les gens que vous cherchez.
– Vous êtes un misérable ! répéta miss Ellen.
Sir James ne répondit pas.
Le coupé roulait grand train, et la route macadamisée avait succédé au pavé bruyant.
Miss Ellen essayait vainement de savoir où on la conduisait.
Les glaces dépolies du coupé ne lui permettait pas de voir en dehors.
Comme elle continuait à accabler sir James de son mépris furieux et d’épithètes injurieuses, il avait tiré de sa poche un numéro du Times et s’était mis à lire tranquillement.
Enfin le coupé s’arrêta un moment… puis il roula sous une voûte sonore.
– Nous voici arrivés, dit sir James.
Et avec son flegme habituel, il remit son journal dans sa poche.
XVII
Le second détective était sans doute monté à côté du cocher, car il descendit du siège et vint ouvrir la portière.
– Prenez ma main, répéta courtoisement sir James.
Miss Ellen mit pied à terre.
Alors elle regarda autour d’elle.
Le coupé venait de rouler sous une voûte, et derrière lui une porte cochère s’était refermée avec grand fracas.
Miss Ellen se trouvait dans une cour entourée de trois côtés par de hautes murailles et, du quatrième côté, bornée par un grand bâtiment carré qui ressemblait à une prison et dont toutes les fenêtres étaient garnies d’épais barreaux de fer.
Un homme, qui portait un uniforme gris et bleu et une casquette cirée, était venu à sir James et le saluait respectueusement.
– Le directeur est-il visible ? demanda le détective.
– Oui, monsieur, répondit cet homme, qui portait un trousseau de clefs à la main.
Puis il ajouta :
– Mylord est sans doute la personne que M. le Directeur attend.
Sir James s’inclina, et l’homme entra dans la maison, laissant les nouveaux venus dans la cour.
Miss Ellen promenait autour d’elle un œil morne et farouche.
Sir James lui dit :
– Miss Ellen, vous devinez où vous êtes.
– Je suis dans une prison, répondit-elle.
– Non, dans une maison de fous.
Elle frissonna.
– Mais vous n’y resterez que deux jours, fit le détective. Car lord Palmure viendra vous y chercher le soir même de son arrivée.
– Mais je ne suis pas folle ! s’écria-t-elle.
– Non, mais nous ne sommes pas en Angleterre, ici, où il y a des prisons non moins variées que confortables, depuis Newgate jusqu’à Bath square, en passant par White-Cross.
Quand nous autres, étrangers, nous demandons à la police française de vouloir bien se charger provisoirement d’un prisonnier, elle nous désigne soit une prison, soit une autre. Auriez-vous préféré Saint-Lazare ?
Ce nom arracha un geste d’horreur à miss Ellen.
Sir James poursuivit tranquillement :
– J’avais songé d’abord à une maison de santé ordinaire, mais une énergique et intelligente personne comme vous s’évaderait trop facilement d’un pareil endroit. Et puis un médecin n’ose pas prendre une responsabilité semblable.
– C’est-à-dire, fit miss Ellen avec dédain, que vous n’avez pas trouvé en lui un complice assez sûr pour vos infamies.
Sir James haussa les épaules.
– Pas de ces vilains mots, miss Ellen, répéta-t-il : d’ailleurs, je vais vous débarrasser de ma présence.
L’homme au trousseau de clefs revint :
– M. le directeur attend mylord, fit-il.
Sir James se pencha vers miss Ellen :
– Je vous jure, dit-il, que vous serez traitée ici avec les plus grands égards, si toutefois vous ne faites pas trop de résistance.
– Et si je résistais ? demanda-t-elle.
En parlant ainsi, la hautaine jeune fille semblait vouloir pulvériser le détective de son regard.
– On vous donnerait une douche.
Miss Ellen frissonna de nouveau.
Un souvenir rapide, un sourire effrayant et sinistre, venait de traverser son esprit.
Elle se rappelait avoir visité Bedlam, la célèbre maison d’aliénés de l’Angleterre, et avoir vu des malheureux qui se mettaient à genoux et se tordaient les mains, suppliant qu’on leur fît grâce de ce supplice épouvantable.
Sir James profita de ce mouvement d’effroi pour ajouter :
– Miss Ellen, j’ai un ordre d’arrestation parfaitement en règle, et tout ce que vous pourriez dire au directeur, en lui prouvant que vous n’êtes pas folle, ne servirait à rien.
Le directeur n’est pas un médecin, c’est un geôlier. Il exécute purement et simplement les ordres reçus.
Et il força miss Ellen à s’appuyer sur son bras, et tous deux suivirent l’homme au trousseau de clefs.
Le cabinet du directeur était au rez-de-chaussée, dans un corridor du premier bâtiment, car la maison paraissait composée de plusieurs corps de logis reliés entre eux par des cours intérieures.
C’était une pièce vaste et froide, aux tentures sombres. Un homme de cinquante ans, grand, maigre, livide d’aspect, se leva d’un bureau devant lequel il était assis, et salua.
– Monsieur le directeur, dit sir James, je vous amène la jeune lady dont j’ai eu l’honneur de vous entretenir par lettre en vous faisant parvenir l’ordre de la préfecture de Police et le visa de l’ambassade d’Angleterre.
– On a préparé une chambre à mademoiselle, répondit le directeur, qui regarda miss Ellen avec un œil sans chaleur.
Miss Ellen comprit que cet homme était un verrou incarné.
En même temps le directeur tira à lui un gland de sonnette qui pendait au-dessus de son bureau.
Aussitôt deux infirmiers entrèrent.
– Conduisez mademoiselle au numéro 13, dit-il.
– Monsieur, dit-elle, est-ce comme folle qu’on m’enferme ici ?
– Probablement, répondit-il, puisque vous êtes dans une maison de fous.
Cet homme était plus flegmatique encore que sir James Wood.
Miss Ellen, comprit qu’elle n’avait rien à attendre de lui, et accablant le détective d’un dernier regard de mépris, elle suivit les infirmiers.
*
* *
Quelques minutes après, sir James Wood et son compagnon remontaient en voiture.
– Où allons-nous ? demandait celui-ci.
– Rue Louis-le-Grand.
– Chercher les hardes de miss Ellen ?
– D’abord. On les lui enverra dans la soirée. Et puis nous allons attendre le maçon.
– Je suppose qu’on ne lui ouvrira pas la fenêtre ?
– Au contraire.
– Plaît-il ? dit le second détective.
– Cet homme s’est mêlé de ce qui ne le regardait pas, dit froidement sir James Wood, il est juste qu’il soit puni.
Et ce fut ainsi que le sort du malheureux Limousin avait été résolu.
Dans quelle maison de santé, dans quel quartier se trouvait miss Ellen ?
Voilà ce que Marmouset ne savait pas, et ce qu’il voulait savoir à tout prix.
XVIII
Marmouset, après avoir acquis la conviction que sir James Wood et le second détective avaient quitté la maison de la rue Louis-le-Grand et que miss Ellen n’y était pas rentrée la veille, Marmouset, disons-nous, reprit le chemin de chez lui.
Il n’était pas encore sept heures du matin.
Dans les maisons à petits locataires on est matinal ; mais rue Auber, où il n’y a que de grands appartements, les concierges dorment la grasse matinée.
Marmouset jeta son nom en passant devant la loge, et le concierge, encore endormi, n’ouvrit pas même les yeux ; sans cela, il eût trouvé au moins étrange le déguisement de son locataire.
L’invalide avait bu deux ou trois verres de rhum et dormait du sommeil du juste.
Marmouset attendit d’avoir changé de vêtements pour l’éveiller.
– Hé ! camarade, lui dit-il alors, vous avez eu plus chaud que moi ici.
– Il est vrai, dit l’invalide en ouvrant les yeux.
– Reprenez votre uniforme, mon brave, dit Marmouset et puis vous me rendrez un petit service.
En même temps Marmouset se plaça devant une table et écrivit ces mots à Milon :
« J’ai besoin de toi. Viens tout de suite. »
Puis, fermant ce billet, il le remit à l’invalide, qui avait de nouveau endossé sa capote.
– Évidemment, lui dit-il, vous rentrez au Gros-Caillou ?
– Oui, monsieur.
– Cela ne vous allongera pas beaucoup de passer par la rue de Marignan, et vous me ferez plaisir de porter ce mot à l’entrepreneur.
– Oh ! je sais où il demeure, dit l’invalide en prenant le billet.
– Maintenant, dit encore Marmouset, je vais vous demander votre parole d’honneur de soldat, mon ami, que vous ne parlerez plus à personne de ce qui s’est passé la nuit dernière, ni de la petite Anglaise, ni de moi qui vous ai emprunté votre uniforme. Si je vous la demande, c’est parce que de grands intérêts sont en jeu, qu’une indiscrétion pourrait les compromettre.
L’invalide donna sa parole d’autant plus volontiers qu’il s’intéressait à miss Ellen, qu’il aimait le pauvre Limousin, son compagnon de nuit, et que Marmouset lui allait, comme on dit.
Marmouset lui mit une dizaine de louis dans la main.
Le soldat voulut refuser. Mais le jeune homme lui dit avec une bonhomie charmante :
– Je suis quatre ou cinq fois millionnaire. Prenez ; c’est pour vos camarades de là-bas comme pour vous.
L’invalide s’en alla sans perdre une minute trouver Milon et lui remit la lettre.
Milon se jeta dans une voiture de place et accourut rue Auber.
– Mon ami, lui dit alors Marmouset, écoute-moi bien. L’Anglaise a disparu.
– Elle n’est plus rue Louis-Le-Grand ?
– Non.
– Depuis quand ?
– Depuis hier.
– Alors elle n’était pas là quand on a fait faire la culbute à mon pauvre Limousin ?
– Non.
– Et savez-vous où elle est ?
– Si je le savais, je ne te ferais pas venir pour que tu m’aides à la chercher.
– Autant trouver une aiguille dans une botte de foin.
Marmouset eut un sourire :
– Mon bon Milon, tu seras toujours un peu simple. Rocambole parvenait quelquefois à t’ouvrir l’esprit. Mais Rocambole n’est plus là…
– Je redeviens tout à fait bête ; c’est vrai, dit Milon.
– Pourtant, suis bien mon raisonnement.
– Parlez…
– Cette Anglaise, qui est venue à Paris pour y chercher un certain Milon et une certaine Vanda, venait évidemment de la part de Rocambole, lequel est peut-être en péril et a besoin de nous.
– Certainement elle venait de sa part, ça n’est pas douteux, dit Milon.
– Donc, il faut la retrouver, l’arracher aux gens qui l’ont fait disparaître, et savoir ce que nous veut Rocambole.
– Mais comment la retrouver ?
– Dans les pays de frontière, poursuivit Marmouset, on pince les contrebandiers en épiant leurs chiens.
– Bon !
– Miss Ellen, – puisqu’elle se nomme ainsi, – ne fait pas la contrebande et n’a sans doute pas de chien, mais elle est suivie, gardée à vue par ces deux hommes, qui évidemment sont des ennemis de Rocambole, puisqu’ils veulent l’empêcher de se rencontrer avec toi et Vanda.
– Après ? fit Milon.
– Donc, reprit Marmouset, ce sont ces deux hommes qu’il faut retrouver d’abord.
– Mais où ?
– Quand nous saurons où ils sont, nous aurons miss Ellen.
– Mais les deux hommes ?…
– Sont évidemment des gens de la haute police anglaise, ce qu’on appelle des détectives.
– Eh bien ?
– Et rien n’est plus facile que de les retrouver, eux.
– Mais comment ?
– As-tu de l’argent chez toi en ce moment ?
– Il m’est rentré cent mille francs hier matin.
– Où sont-ils ?
– Dans une caisse.
– La caisse que tu as achetée à Londres ?
– Oui.
– J’ai la pareille. Eh bien ! je te volerai demain tes cent mille francs.
– Plaît-il ? dit Milon stupéfait.
– Aucun serrurier français ne pourrait forcer cette caisse, n’est-ce pas ?
– Certainement non.
– Il n’y a qu’un voleur anglais qui ait pu se procurer les empreintes nécessaires à fabriquer les clefs qui la ferment. Comprends-tu ?
– Pas encore, dit Milon.
– C’est pourtant bien simple. Tu es volé, tu t’adresses à la Préfecture. Les agents français acquièrent la conviction que tu as été volé par un Anglais ; et ils s’adressent aux deux détectives qui se trouvent en ce moment à Paris pour les aider à trouver le voleur.
– Mais les agents français savent-ils que les détectives sont ici ?
– J’en ai la certitude, et je vais te le prouver.
– Ah !
– Ensuite je t’expliquerai le petit plan que je viens d’imaginer et que Rocambole lui-même ne désapprouverait pas.
Sur ces mots, Marmouset alluma un cigare, et Milon devint de plus en plus attentif.
XIX
Marmouset reprit :
– En rapprochant le récit que nous a fait l’invalide, parlant pour le Limousin, de ce que je devine, voici ce qui a pu se passer :
Miss Ellen, que nous envoie Rocambole, est arrivée à Paris.
À peine débarquée, elle s’est mise en campagne pour nous retrouver ; mais les détectives sont arrivés et se sont constitués ses gardiens.
Or, mon ami, voilà où j’acquiers la certitude que la police française s’est mêlée de cette affaire. La loi anglaise ne peut rien en France, et il aurait suffi que miss Ellen se plaçât sous la protection du commissaire de police du quartier pour qu’elle fût débarrassée de ses deux drôles.
– Pourquoi donc ne l’a-t-elle pas fait ?
– Parce que les deux détectives avaient pris les devants.
– Comment cela ?
– Ils ont dû aller à l’ambassade anglaise, laquelle les aura recommandés à la Préfecture de police.
– Et la préfecture de police ?
– Leur aura donné un ordre d’arrestation avec la faculté de ne pas s’en servir, si cela n’était pas nécessaire.
– Ah ! je comprends, dit Milon.
– Donc, suis bien mon raisonnement. Tu as cent mille francs dans ta caisse.
– Bon !
– Je te les vole.
– Ce qui n’est pas dangereux, dit Milon en riant.
– Tu vas porter plainte et la police se met en campagne.
– Et puis ?
– Dès la première investigation, elle reconnaît que le voleur ne peut être qu’un Anglais.
– À quoi voit-elle cela ?
– Ne t’en préoccupe pas, c’est mon affaire.
– Fort bien.
– La police songe alors aux deux détectives qui ont probablement enfermé miss Ellen, et elle se met en rapport avec eux.
– Ah ! ah !
– Dès lors, je me fais chasser par eux, et tandis qu’ils me prennent pour le gibier, je deviens réellement le chasseur, et nous retrouvons miss Ellen.
Milon regarda Marmouset avec une naïve admiration :
– Il y a des moments, dit-il, où je vous prendrais volontiers pour le maître lui-même.
Marmouset se prit à sourire :
– Il est probable, dit-il, que si Rocambole n’avait pas trouvé de l’étoffe chez moi, il ne m’aurait pas fait son élève, et, d’un affreux voyou que j’étais, il n’aurait pas fait un parfait gentleman.
– Cela est vrai, fit Milon. Mais…
– Mais, quoi ?
– Vous me volez mes cent mille francs, et on vous arrête.
– Cela dépendra.
– Comment vous justifierez-vous ?
– D’abord, on ne m’arrêtera pas.
– Ah !
– Et puis, si on m’arrêtait, je saurais bien me tirer d’affaire, sois tranquille.
– Alors, c’est bon, dit Milon, faisons comme il vous plaira.
– À quelle heure es-tu chez toi, toujours ?
– À midi, c’est le moment où mes maîtres compagnons viennent prendre mes ordres.
– C’est bon, rentre chez toi et attends-moi.
Et Milon, docile, Milon le colosse s’en alla.
*
* *
Comme on a pu le voir, Milon était revenu à son ancien métier ; car, on se souvient qu’après la mort de sa maîtresse, la mère d’Antoinette et de Madeleine, et avant que M. de Monfort l’envoyât au bagne, il s’était fait maçon.
Marmouset l’avait commandité, et en attendant qu’un ordre de ce maître mystérieux qu’on appelait Rocambole lui donnât une autre mission, il occupait des centaines d’ouvriers et faisait tout doucement fortune.
Milon habitait rue de Marignan, à deux pas de l’hôtel de Vanda.
La maison, à de certaines heures, avait toute l’animation d’une vaste administration, les jours de paye surtout.
Les ouvriers du bâtiment, maçons, tailleurs de pierre, ravaleurs, menuisiers, couvreurs, charpentiers et serruriers s’y croisaient sans relâche.
Le vieux colosse était là, actif, bienveillant, juste surtout, écoutant les réclamations, donnant des ordres à ses contremaîtres, et, du fond de son bureau, faisant marcher vingt constructions différentes.
Or, ce jour-là était précisément un samedi, le premier samedi du mois, et Milon réglait ses comptes d’ouvriers, lorsque, au moment où midi sonnait, une voiture s’arrêta à la porte.
C’était une voiture de grande remise, louée à la journée, et de laquelle les ouvriers qui, en attendant leur tour, s’étaient approchés de la fenêtre du bureau de Milon, virent descendre un personnage singulier.
Était-ce un jeune homme ou un vieillard ? Nul n’aurait pu le dire.
C’était un homme au visage coloré, aux favoris d’un rouge ardent, au front un peu chauve et qui était affligé d’un pénible embonpoint.
Il portait un habit bleu et un pantalon trop étroit ; son cou disparaissait dans un large faux-col roide comme du parchemin.
D’énormes breloques étaient suspendues à son gilet, et il avait de gros diamants à sa chemise.
Enfin, il s’appuyait péniblement sur une canne à pomme d’or et était coiffé d’un de ces grands chapeaux à forme droite qu’on ne fabrique qu’en Angleterre.
– Maître Milon ? demanda-t-il à la servante qui vint lui ouvrir.
On l’introduisit dans le bureau.
Milon le regarda avec étonnement.
– Mossié, dit le personnage, je avé l’honneur de vous salouer, je été lord Candaule, pair d’Angleterre, et je été descendu à Meurice hôtel.
Milon tressaillit et salua.
– Le docteur de moâ, poursuivit mylord, il ordonnait le séjour de Paris pour la santé de moâ, et je volé construire une maison pour moâ dans les Champs-Élysées.
Milon se leva, ouvrit une porte qui donnait dans une pièce où était la caisse, et il y fit entrer le nouveau venu.
Alors, quand la porte se fut refermée, l’Anglais se mit à rire :
– Tu ne me reconnais donc pas ? fit-il sans aucun accent anglais cette fois.
– Marmouset ! exclama Milon.
– Pardieu !
– Oh ! le diable lui-même…
– Tu penses bien, dit Marmouset, riant toujours, que ce n’est pas la peine d’être l’élève de Rocambole pour ne pas savoir se grimer et se déguiser.
– Comment ! c’est vous ?
– C’est moi.
– Et vous venez me voler ?
– Non, pas encore. Je viens préparer mon vol.
– Ah !
– Seulement, je voulais être vu, et c’est pour cela que j’ai choisi l’heure où tu as beaucoup de monde.
– Maintenant, causons…
Et Marmouset que, selon l’expression de Milon, le diable lui-même n’aurait pas reconnu, s’assit tranquillement en face de Milon stupéfait.
XX
– Montre-moi ta caisse, dit alors Marmouset.
Milon tira une clef de sa poche et ouvrit d’abord une porte qui se trouvait dans le mur.
Cette porte ouverte, Marmouset aperçut un placard, et, dans ce placard, une caisse d’origine anglaise.
Elle sortait des ateliers de William S. Helley, coffretier-serrurier dans Hosborne street, au n° 152, à Londres.
De la hauteur d’une armoire à glace ordinaire, elle pouvait peser mille kilogrammes et était à l’épreuve du fer et du feu.
Comme les caisses françaises, elle n’avait point un clavier de lettres ; une simple serrure constituait sa fermeture.
On voyait au milieu une petite ouverture hexagone de la dimension d’un pois ; c’était le passage de la clef.
Seulement, une fois dans la serrure, cette clef devait tourner tantôt à gauche, tantôt à droite, pendant un certain nombre de fois, et le possesseur seul de la clef avait dans sa tête ce chiffre-là.
Milon prit sa clef, qui ne le quittait jamais et faisait partie d’un petit trousseau qu’il portait suspendu à son cou par une chaîne d’acier.
– Ouvre-moi la caisse, dit encore Marmouset.
Milon obéit.
– Où sont tes cent mille francs ?
– Dans le portefeuille.
– Fort bien. Retire la clef et laisse ta caisse ouverte.
– Et puis ?
– Maintenant, ferme la porte du placard.
Milon obéit encore.
Alors, Marmouset examina cette seconde serrure et dit :
– Celle-là n’est pas méchante. On l’ouvrirait avec une paille.
– Mais, enfin, demanda Milon, que comptez-vous faire ?
– Je vais sortir d’ici d’abord.
– Bon !
– Tu me reconduiras, et, devant tout le monde, tu me diras : Mylord, j’aurai l’honneur de vous recevoir à quatre heures.
– Fort bien.
– Quand je serai parti, tu recommanderas à ta servante de m’introduire dans ton cabinet aussitôt que je me présenterai. Naturellement, j’arriverai un peu avant quatre heures, et tu t’arrangeras de façon à être en retard. Il faut qu’on puisse constater que j’ai passé trois quarts d’heure dans ton cabinet.
– Mais, quand j’arriverai ?
– Moi, je serai parti, en disant que j’avais un rendez-vous pressé, et que je ne puis attendre plus longtemps.
Tu entreras dans ton cabinet, tu trouveras ton placard foncé et ta caisse ouverte.
– Tout cela est très bien, dit Milon… mais après ?
– D’abord, tu ne rentreras pas tout seul. Tu reviendras avec un de tes contremaîtres ; un de ceux qui sont dans la pièce voisine en ce moment. Le vol constaté, tu prendras ta course vers l’hôtel Meurice, où, naturellement, tu n’as jamais vu lord Candaule ; puis chez le commissaire, et enfin à la préfecture, où tu dénonceras mon signalement exact au chef de la Sûreté.
– Et… enfin ?
– Enfin tu ne t’occuperas plus de rien. Tu penses bien que tes cent mille francs ne seront pas perdus, ajouta Marmouset en souriant.
Milon le reconduisit avec force révérences.
En traversant le bureau, Marmouset avait repris son baragouin anglo-français, et Milon lui dit :
– Si vous voulez vous donner la peine, mylord, de revenir à quatre heures, je serai tout entier à votre disposition, et nous irons voir le terrain à vendre dont je viens de vous parler.
– Aoh ! fit Marmouset. Combien de temps faut-il à vous pour bâtir une maison à moâ ?
– Trois mois.
– Trop de temps ! dit l’Anglais.
– On peut y arriver en deux mois et demi.
– Et plus vite encore ?
– Alors, il faudrait travailler la nuit à la lumière électrique.
– Aoh ! electric-light. Je voulais, moâ.
– Mais c’est très cher.
– Aoh ! je payerai beaucoup de bank-notes, moâ !…
Et Marmouset partit.
– Patron, dit alors un des contremaîtres, on fera de jolis bénéfices avec ce client-là, hein ?
– Nous prendrons une revanche de Waterloo, répondit Milon avec son gros rire.
Et Milon acheva de régler ses comptes, congédia ses ouvriers et monta dans son cabriolet pour aller visiter les chantiers.
En parlant, il n’eut garde de recommander à sa servante d’introduire l’Anglais aussitôt qu’il se présenterait.
*
* *
Cependant, le plan de Marmouset devait être légèrement modifié par un événement tout à fait imprévu.
Au moment où Milon s’en allait, un homme cheminait tristement sur le trottoir, de l’autre côté de la rue.
Milon l’aperçut, et l’émotion qu’il éprouva fut telle, qu’il retint si brusquement son cheval, que l’animal se cabra à demi.
Le colosse passa les rênes à son petit domestique et s’élança à terre.
L’homme qu’il avait aperçu, c’était cet Anglais en haillons qui s’était présenté chez lui déjà en lui parlant de l’homme gris.
– Ah ! enfin ! je vous retrouve ! s’écria Milon en lui saisissant vivement les mains.
– Oui, monsieur, répondit Shoking, car c’était bien notre ancien ami de Londres, le fidèle compagnon du mystérieux homme gris.
Milon parlait assez bien l’anglais, et ce fut dans cette langue qu’il continua :
– Vous reveniez chez moi ?
– Oui, je suis très misérable, dit Shoking, et, faute de retrouver la lettre que j’avais pour vous et qu’on m’a volée, nous sommes, moi, la femme et l’enfant avec qui je suis venu en France, dans la plus profonde détresse.
– Vous n’avez plus besoin de lettre, dit Milon. Ma bourse vous est ouverte.
Shoking le regarda avec une sorte de déférence.
– Vous m’étiez envoyé par l’homme gris ?
– Oui.
– Eh bien ! c’est mon ami intime.
– Ah ! fit Shoking.
– Mais, reprit Milon, qui songea soudain à miss Ellen, dites-moi, puisque vous avez vécu avec l’homme gris, si vous avez connu une jeune fille anglaise du nom de miss Ellen ?
– Miss Ellen ! s’écria Shoking.
Et Milon le vit pâlir, tandis qu’un regard plein de haine jaillissait de ses yeux.
– Oui, miss Ellen, répéta Milon.
– C’est la plus mortelle ennemie de l’homme gris ! s’écria Shoking.
Et Milon recula abasourdi, murmurant :
– Et nous qui voulions la délivrer.
XXI
La rue Marignan est solitaire comme toutes les rues nouvelles du quartier des Champs-Élysées. Milon et Shoking étaient donc sur le trottoir absolument aussi isolés que s’ils se fussent trouvés en tête-à-tête dans le bureau de l’entrepreneur.
– Vraiment ? reprit Milon, qui parvint à dompter l’émotion qui s’était emparée de lui, vous dites que cette miss Ellen est la mortelle ennemie de Rocambole – pardon, de l’homme gris ?
– Oui.
– Quelle preuve pouvez-vous m’en donner ?
– Venez avec moi, dit Shoking. Jenny et son fils vous répéteront mes paroles.
– Qu’est-ce que Jenny ?
– La mère de Ralph.
– Et Ralph ? demanda Milon.
– C’est l’enfant qui sera un jour le chef de l’Irlande régénérée.
– Et ils sont en France ?
– Ils sont à Paris. C’est moi qui les ai amenés. L’homme gris nous avait donné de l’argent quand nous sommes partis, et puis une lettre de crédit sur vous. Huit jours après notre arrivée, on nous a volés.
– Et vous n’avez pas porté plainte ?
Un sourire triste passa sur les lèvres de Shoking.
– Ceux qui nous ont volés, dit-il, sont plus puissants que nous, et la loi ne les atteint pas.
– En France, dit Milon, la loi atteint tout le monde.
Shoking secoua la tête.
– Ceux-là ne sont pas Français, du reste ; ce sont nos ennemis de Londres qui nous ont suivis, et l’homme gris n’est plus là pour nous protéger.
– Et où sont cette femme et cet enfant ?
– Ils habitent avec moi une mansarde à deux pas de l’hôpital de Lourcine, dans le plus pauvre quartier de Paris, le faubourg Saint-Marcel.
– Tiens, dit Milon, j’ai précisément un chantier par là ; allons les voir, je ferai d’une pierre deux coups.
Puis, revenant toujours à son idée :
– Ainsi vous dites que miss Ellen était l’ennemie de l’homme gris ?
– L’ennemie acharnée, mortelle, et j’ai bien peur que mon pauvre maître ne se soit enterré avec elle.
– Comment cela ?
– Il prétendait qu’il forcerait miss Ellen à l’aimer.
– Ah ! dit Milon, qui songea à ce don merveilleux de fascination que possédait Rocambole.
Mais ces derniers mots de Shoking ne pouvaient pas modifier l’impression première ressentie par Milon.
– Attendez-moi là, dans ma voiture, dit-il à Shoking, je rentre une minute chez moi, et puis je vous rejoins et nous irons ensemble voir la mère et l’enfant.
Comme Milon n’était qu’à quelques pas de sa maison, il y retourna à pied, remonta dans son bureau et écrivit la lettre suivante :
« Le vol est inutile. Nous n’avons plus à nous occuper de miss Ellen. J’ai revu l’Anglais qui venait au nom de l’homme gris. Il m’affirme que miss Ellen est une ennemie et non une amie, et qu’elle est acharnée à la perte de Rocambole.
« Au lieu de vous en aller, attendez-moi, je vais jusqu’à la rue de Lourcine, et je reviens.
« MILON. »
Puis il remit cette lettre à sa servante et lui dit :
– Quand le milord viendra, tu l’introduiras dans mon cabinet.
– Oui, patron.
– Et tu lui remettras cette lettre en le priant de m’attendre.
– Oui, patron, répéta la servante en prenant la lettre.
– Plus souvent, murmura le naïf Milon, que nous porterons secours aux ennemis du maître !
Et il s’en alla rejoindre Shoking.
*
* *
À quatre heures moins un quart, une voiture s’arrêta devant la maison de Milon.
Le mylord anglais, – c’est-à-dire Marmouset, – en descendit.
La servante lui remit la lettre ; puis elle l’introduisit avec force révérences dans le cabinet du patron.
Marmouset ouvrit la lettre et la lut.
– Ma foi ! murmura-t-il, décidément, Milon a raison quand il dit lui-même qu’il est un peu naïf.
Et s’asseyant devant le bureau de l’entrepreneur, Marmouset prit une plume et écrivit :
« Tu es un niais. Si Miss Ellen était une amie de Rocambole, il fallait la délivrer.
« Si elle est une ennemie, il faut la délivrer d’autant plus et s’en servir au besoin comme d’un instrument.
« Par conséquent, j’emporte les cent mille francs, et je t’engage à ne pas perdre une minute pour aller faire ta déclaration à la police. »
Cette lettre écrite, Marmouset poussa le verrou de la porte, afin de n’être pas dérangé.
Puis il tira de sa poche un rossignol et un ciseau à froid.
– Voyons, se dit-il en souriant, si je me souviens encore de mon ancien métier.
Et il se dirigea vers le placard qui renfermait la caisse.
En un tour de main, le placard fut forcé.
Milon, on s’en souvient, avait laissé la caisse ouverte.
Marmouset prit le portefeuille et le fit disparaître dans une des poches de son waterproof.
Après quoi, il referma la porte du placard, et comme la serrure ne fonctionnait plus, il mit une chaise devant.
Il attendit encore environ un quart d’heure.
– Maintenant, filons, se dit-il.
Et il sortit du cabinet la lettre à la main.
La servante était au rez-de-chaussée de la maison, et n’avait rien entendu du bruit que Marmouset avait été obligé de faire pour forcer le placard.
– Aoh ! lui dit-il, votre maître manquait complètement d’éducation en faisant attendre un lord comme moâ. Vous lui remettre cette lettre de moâ.
Et prenant un air majestueux et blessé, il mit deux louis dans la main de la servante un peu étonnée, se dirigea vers la porte et remonta dans sa voiture.
Tout cela fut fait très rapidement, et le fiacre qui avait amené milord était déjà loin, que la pauvre servante n’était pas encore revenue de sa surprise.
Marmouset se fit conduire aux Champs-Élysées, s’arrêta au coin de la rue de Morny, paya le cocher et descendit.
Puis il gagna à pied les terrains vagues dans lesquels se trouvait l’entrée de cette cave qui avait servi de lieu de réunion aux compagnons de Rocambole la nuit précédente. Il avait relevé le col de son waterproof, de sorte qu’il n’attira point l’attention des rares passants qu’il rencontra.
Il entra dans les terrains vagues, gagna l’escalier de la cave et s’y engouffra.
Marmouset allait changer de costume, se dépouiller de ses favoris roux et de son gros ventre et reprendre son apparence ordinaire.
Son cocher, qui avait un mot d’ordre sans doute, l’attendait au Trocadéro.
Marmouset, après cette nouvelle métamorphose, sortit de la cave, reprit la rue de Morny, gagna le Trocadéro, remonta dans son coupé et retourna tranquillement chez lui, rue Auber, en se disant :
– Mais si miss Ellen est notre ennemie, raison de plus pour la retrouver ! Décidément, je ne ferai jamais rien de ce pauvre Milon.
XXII
Cependant Milon avait suivi Shoking.
Le trajet de la rue de Marignan à la rue de Lourcine, considérable autrefois, est relativement court maintenant par le boulevard des Invalides et le boulevard Montparnasse, qui s’appelle boulevard de Port-Royal, dans son prolongement à travers le faubourg Saint-Marcel et le quartier des Gobelins.
Au bout de cette dernière avenue, on prend la rue Pascal, on longe l’hôpital et on tombe dans l’antique rue du Champ-de-l’Alouette.
Ce fut là que Shoking conduisit Milon.
Là aussi on commence à pressentir un Paris nouveau ; mais un Paris encore informe, un champ de bataille plutôt qu’une ville, un monde qui sort du chaos.
La pioche des démolisseurs a déjà bouleversé ce vieux faubourg misérable et peu pittoresque du reste ; puis, après les démolisseurs, modernes Vandales, sont venus les Limousins reconstructeurs.
Mais ni les uns ni les autres n’ont achevé leur œuvre.
La vieille maison tombe çà et là par lambeaux ; la nouvelle sort à peine de terre.
C’est le manteau d’Arlequin en pierres et en gravats. Comme dans Chaillot métamorphosé, il y a beaucoup de terrains vagues à côté de maisons toutes neuves, et la pierre de taille qui monte au soleil a pour voisine encore la vieille baraque aux murs vermoulus, aux allées noires, aux cinq étages écrasés, ventrus, hideux, à la cour sans air et sans lumière de cinq pieds carrés, entre les pavés de laquelle pousse verte, humide et drue une herbe de cimetière.
Vers le milieu de la rue, sur la gauche, en entrant par la rue Pascal, il y avait une de ces maisons-là.
En face était un chantier de construction.
Devant le chantier un écriteau, et sur cet écriteau ces mots :
Milon, entrepreneur de maçonnerie.
– C’est ici, dit Shoking en montant l’allée noire de la vieille maison.
– En face de mon chantier, dit Milon.
– C’est parce que j’ai vu votre nom là, reprit Shoking, que j’ai pu me procurer votre adresse. Puis, comme vous m’aviez mal reçu, je n’osais plus revenir. Seulement, Jenny et moi, nous espérions toujours que vous viendriez visiter vos travaux et que vous auriez pitié de nous.
– Hélas ! dit Milon, j’ai tant de constructions en train dans Paris, que je ne puis les surveiller toutes et que je me repose pour les plus éloignées sur mes contremaîtres. Je suis pourtant venu ici l’autre jour.
– Je ne vous ai pas vu, dit Shoking. Depuis huit jours, du reste, j’avais trouvé un peu d’ouvrage. J’étais entré comme palefrenier chez un marchand de chevaux, du boulevard de l’Hôpital. Mais il a vendu la moitié de son écurie et il n’a plus besoin de moi.
Tandis que Milon et Shoking échangeaient ces quelques mots, deux hommes avaient passé et repassé plusieurs fois devant le chantier, et semblaient s’intéresser quelque peu à ce que pouvaient faire ensemble le pauvre Shoking en haillons et M. Milon, le riche entrepreneur.
Ces deux hommes n’avaient rien d’extraordinaire à première vue, et ils paraissaient même être de simples flâneurs du quartier, se promenant pour prendre l’air et rendre hommage au génie de M. le Préfet de la Seine.
Mais ils parlaient bas, et, à un moment donné, Shoking, auprès duquel ils passaient, tressaillit.
Il avait cru surprendre un mot d’anglais.
Ce geste de surprise de Shoking ne leur échappa probablement pas, car ils s’éloignèrent aussitôt.
– Qu’avez-vous donc ? demanda Milon.
– Il me semble que ce sont des Anglais, dit Shoking.
– Ce n’est guère le quartier pourtant.
– Méfions-nous-en…
– Pourquoi ?
– Parce que très certainement la police de Londres, qui nous a fait voler à notre arrivée à Paris, ne nous perd pas de vue.
Milon haussa les épaules.
– S’ils font les méchants avec nous, dit-il, je les ferai assommer par mes Limousins. Allons voir la mère et l’enfant.
Et tous deux s’engouffrèrent dans l’allée noire de la vieille maison ; mais les deux hommes qui parlaient anglais étaient demeurés au coin de la rue Pascal, et ils les avaient vus entrer.
Shoking n’avait point chargé le tableau de la maison où Jenny, Ralph et lui se trouvaient depuis leur arrivée à Paris.
Une pauvre chambre sans meubles, sans cheminée, ouvrant sur les toits par une tabatière, était tout leur logis.
La mère et l’enfant couchaient sur un grabat, Shoking s’accommodait d’un tas de paille.
Il y avait un morceau de pain et une cruche d’eau sur une table boiteuse.
Milon fut frappé de ce dénûment profond, en même temps que de la beauté un peu souffrante et du grand air de résignation et de dignité de l’Irlandaise.
Shoking sauta au cou de Jenny :
– Nous sommes sauvés, dit-il, voilà M. Milon, l’ami de l’homme gris, notre père.
Milon se prit à caresser l’enfant, qui le regardait avec ses grands yeux un peu étonnés.
– Mes amis, dit-il, vous ne resterez pas ici un jour de plus. Ma maison est grande, et vous y vivrez avec moi jusqu’à ce que le maître nous ait donné de ses nouvelles et m’ait transmis des ordres à votre égard.
Et comme les inquiétudes de Milon à propos de Rocambole le reprenaient, il se prit à la questionner.
Le récit de Jenny fut en tout semblable à celui de Shoking, et il se trouva que leur version coïncidait avec celle de Vanda, qui revenait de Londres.
Puis, Shoking lui raconta alors que, débarqués à Paris avec des lettres et de l’argent, ils avaient été volés.
Par qui ? Ils ne l’avaient pas su d’abord ; mais le maître de l’hôtel garni dans lequel ils étaient descendus s’était parfaitement souvenu qu’un autre Anglais avait occupé une chambre voisine sur leur carré et était parti précipitamment le jour du vol.
– Le mal n’est pas grand, leur dit Milon, puisque vous m’avez retrouvé et que j’ai de l’argent.
Alors il convint avec Shoking, à qui il remit une dizaine de louis, que celui-ci irait acheter des vêtements convenables pour eux trois, qu’il prendrait une voiture et se ferait conduire rue de Marignan, avec Ralph et Jenny.
Et, se souvenant de Marmouset, qui devait venir chez lui à quatre heures, et qui, certainement, pensait-il, renoncerait à voler les cent mille francs après avoir lu sa lettre, il les quitta et regagna son cabriolet.
Les deux hommes qui parlaient anglais étaient toujours dans la rue.
Ils regardèrent Milon s’éloigner, et Milon ne les vit pas.
Alors l’un des deux murmura :
– Il faut pourtant que nous sachions ce que ce gros homme est allé faire là-haut.
XXIII
Ces deux hommes qui parlaient anglais et qui avaient examiné Milon et Shoking avec tant d’attention, n’étaient autres que sir James Wood et son collègue, l’autre détective.
– Vous voyez, Edward, lui dit sir James Wood, que nous n’avons pas perdu notre temps depuis hier, puisque nous avons mis en sûreté miss Ellen et que nous avons retrouvé les traces de Shoking, de l’Irlandaise et de son fils.
– Assurément non, répondit le second détective ; seulement je me demande ce que nous allons faire à présent.
– Que voulez-vous dire ?
– Nous avions mission de nous assurer de la personne de miss Ellen.
– Sans doute.
– Mais quelle est notre mission vis-à-vis de ces trois mendiants ?
Sir James Wood se prit à sourire :
– Jusqu’à présent, dit-il, j’ai été la tête qui pense et vous étiez simplement le bras qui agit. Mais vous m’avez donné depuis quinze jours assez de marques de sagacité et de prudence pour que je vous initie au but véritable de notre voyage en France.
– Je vous écoute, dit le second détective.
– Ne restons pas ici, reprit sir James. Bien que le quartier soit peu fréquenté, il est inutile d’attirer l’attention. Promenons-nous de long en large, sans toutefois perdre de vue cette maison.
Et sir James montrait la masure où se trouvaient Shoking, Ralph et Jenny.
Puis, prenant son compagnon par le bras :
– Nous sommes envoyés à Paris, non seulement par lord Palmure, mais encore par le révérend Patterson, qui, vous le savez, est le chef occulte de la religion anglicane.
– Ah ! fit Edward.
– Jamais l’Irlande ne s’est autant remuée qu’en ce moment, et le fénianisme a pris des proportions telles que l’Angleterre commence à trembler, poursuivit James.
– Mais ces Irlandais qui sont là-haut sont donc des fénians ?
– Oui.
– Et… miss Ellen ?
– Miss Ellen est la fille de lord Palmure ; mais elle s’est prise d’un fol amour pour un Français connu à Londres, sous le nom de l’homme gris, et c’est lui qui l’a envoyée en France pour y chercher du secours, car il est en prison à Londres, lui, et on ne peut arriver à lui faire son procès. Nous avions donc pour mission d’abord de retrouver miss Ellen et d’empêcher à tout prix qu’elle ne se mît en relation avec les personnes qu’elle venait chercher.
– Et ces personnes, les connaissez-vous ?
– Non, mais je les connaîtrai.
– Fort bien.
– Maintenant, parlons des Irlandais.
– Ceux-là ne me paraissent pas bien redoutables.
– Vous vous trompez, Edward.
– Vraiment ?
– Ce mendiant du nom de Shoking, était à Londres le bras droit de l’homme gris.
– Et la femme ?
– La femme est veuve du frère puîné de lord Palmure, qui est mort pour l’Irlande.
– Oh ! oh !
– Et son fils cet enfant de dix ans que vous avez aperçu, n’est autre que le chef futur des fenians.
– Eh bien ! que devons-nous faire ? Les arrêter ?
– Cela est impossible pour le moment.
– Les enlever alors ?
– Peut-être…
– Mais comment ?
– Vous allez voir. Le mendiant Shoking était sans ressources ce matin même encore. On lui a fait voler ses papiers à son arrivée en France, et avec eux une lettre de crédit sur un certain Milon, entrepreneur.
– Mais c’est l’homme que nous venons de voir ?
– Justement.
– Comment se sont-ils retrouvés ?
– Shoking se sera souvenu du nom. L’entrepreneur est venu ici pour s’assurer sans doute qu’il n’avait pas affaire à un aventurier.
– Bon !
– L’Irlandaise et son fils lui auront fait un récit conforme à celui de Shoking et il aura donné de l’argent. Peut-être même va-t-il vouloir les emmener chez lui.
– Et nous le laisserons faire ?
– Je vous l’ai dit, nous n’avons de mandat d’arrestation que pour miss Ellen, mais nous pouvons enlever l’enfant. Le révérend Patterson et Lord Palmure, avec qui j’ai eu un long entretien à mon départ, de Londres, m’ont promis une somme de dix mille livres sterling si je ramenais le petit Irlandais.
– Et savez-vous ce qu’on en veut faire ?
– Je l’ignore.
– Le faire disparaître à jamais, sans doute.
– C’est probable. Il y a donc cinq mille livres pour vous, mon cher Edward, si nous ramenons le petit Irlandais à Londres.
– Mais, dit encore le second détective, alléché par la promesse des cinq mille livres, il me semble que nous pourrions agir tout de suite ?
– Cela dépend. Shoking va probablement sortir.
– Bon !
– L’Irlandaise et son fils resteront seuls.
– Et alors ?…
– Attendez, dit sir James, il faut que je vous fasse une confession.
– Parlez…
– Je n’ai pas toujours été détective.
– Ah !
– J’ai été fénian, moi aussi.
– Vous !
– Et je me suis vendu à l’Angleterre. Que voulez-vous ? dit l’homme de police avec cynisme, je ne suis pas un homme de principes, moi.
– Ce qui fait que vous êtes initié aux pratiques du fénianisme ?
– Et que je sais les signes mystérieux à l’aide desquels ils se reconnaissent entre eux.
Comme sir James Wood parlait ainsi, ils aperçurent Shoking qui sortait de la maison.
– Mon cher Edward, dit alors le détective, il faut suivre cet homme.
– Lui parlerai-je ?
– Certainement, et vous lui direz que, l’ayant reconnu pour un Anglais et le voyant misérable, vous voulez le secourir. Vous tâcherez de l’emmener de l’autre côté de la Seine, sous prétexte de lui donner de l’argent. Mais enfin, quoi qu’il arrive, gardez-le une heure. C’est plus de temps qu’il ne m’en faut.
– Et vous, qu’allez-vous faire ?
– Je vais redevenir fénian et monter chez l’Irlandaise.
Shoking se dirigeait vers la rue Pascal.
Les deux détectives se séparèrent.
Edward se mit à suivre Shoking.
Quant à sir James, il s’engouffra dans l’allée noire de la vieille maison.
– Il me faut l’enfant, murmura-t-il.
XXIV
Nous connaissons de longue date le bon Shoking, et nous savons que la fortune bonne ou mauvaise avait sur son humeur et son caractère une notable influence.
Shoking pauvre, misérable, était un garçon judicieux, prudent, plein de sagacité.
Avait-il en poche quelque argent, ces précieuses qualités s’émoussaient sensiblement.
On se rappelle encore combien Shoking, métamorphosé en lord, avait été naïf à Londres ; et combien de gaucheries il eût faites sans la surveillance rigoureuse de l’homme gris.
Depuis qu’il était à Paris, Shoking avait fait des prodiges pour faire vivre Jenny l’Irlandaise et son fils, et retrouver Milon, le correspondant de Rocambole.
Baragouinant à peine quelques mots de français, il était parvenu à trouver de l’ouvrage et il avait soutenu avec la misère un duel.
Son but atteint, Milon retrouvé, sa poche, vide naguère, remplie de louis, Shoking redevint subitement un imbécile.
Une heure auparavant, il avait regardé avec défiance ces deux hommes qui rôdaient, en parlant anglais, dans la rue du Champ-de-l’Alouette ; et s’il était sorti comme il était rentré, c’est-à-dire sans un sou dans sa poche, il n’aurait pas manqué de regarder autour de lui et de voir si les deux personnages n’y étaient plus.
Mais Shoking avait de l’argent.
Il sortit donc sans même retourner la tête et se dirigea vers la rue Pascal.
Le détective Edward le suivit à distance.
Où allait Shoking ?
Il descendait vers les beaux quartiers ; il allait se vêtir convenablement et acheter des habits pour Jenny et pour son fils.
Or, un homme qui est vaniteux comme Shoking ne s’amuse pas à aller à pied quand il peut aller en voiture.
Au bout de la rue passait un omnibus.
Shoking grimpa sur l’impériale et se promit de prendre un fiacre au retour.
Deux minutes après l’omnibus s’arrêta pour prendre un voyageur qui avait fait un signe, et Shoking vit monter à côté de lui le détective.
Chose bizarre ! il ne le reconnut pas et ne fit même pas attention à lui.
Ce ne fut que lorsque le conducteur monta sur l’impériale en faisant entendre d’une voix nasillarde son fameux : places, s’il vous plaît ! que Shoking tressaillit.
Avec un accent fortement anglais, le détective avait demandé une correspondance.
À quoi le conducteur répondit qu’on n’en donnait pas à l’impériale.
– Aoh ! fit le détective, je croyais qu’on donnait toujours des correspondances.
– Nô ! répondit Shoking.
Alors le détective le regarda d’un air étonné.
– Vous, Anglais, aoh ! fit-il.
– Yes, répondit Shoking.
Et Shoking ne reconnut pas en lui l’un des deux hommes qui rôdaient tout à l’heure dans la rue du Champ-de-l’Alouette.
Le détective était mis comme un gentleman.
À Londres, il n’eût pas même regardé Shoking ; mais en ce moment l’esprit de nationalité parut l’emporter sur sa fierté.
Il se mit à causer avec Shoking.
– Vous êtes ici depuis longtemps, sir ? lui demanda-t-il.
– Depuis un mois, répondit Shoking.
Le détective jeta sur son accoutrement misérable un regard de compassion.
– Vous êtes venu conduire des chevaux, peut-être ?
– Non, dit Shoking.
– Chercher de la besogne ?
– Non, dit encore notre ami Shoking, que la compassion de son national parut choquer.
– Je suis riche, continua le détective, et je n’ai jamais laissé un compatriote dans l’embarras. Voici ma carte.
– Merci, gentleman, répondit Shoking, qui mit la carte dans sa poche.
L’omnibus s’arrêta dans la rue de Vaugirard à l’Odéon.
Shoking descendit ; le détective descendit pareillement.
Puis, tandis que l’omnibus s’éloignait, il frappa sur l’épaule de Shoking :
– Mon cher compatriote, dit-il, un fils de la libre Angleterre ne saurait en rencontrer un autre sur le sol étranger sans lui faire raison d’un verre de porto ou de xérès. Me refuserez-vous ?
– Assurément non, répondit Shoking.
Le détective le prit par le bras.
– Entrons là, dit-il.
Et il mit la main sur le bouton de la porte du café Tabouret.
Quelques étudiants, qui se trouvaient dans le café, regardèrent curieusement cet homme bien mis et cet homme en haillons qui entraient bras dessus bras dessous.
Mais, avec un flegme tout britannique, Shoking et le détective allèrent s’asseoir à une table, dans un coin, et le second demanda une bouteille de porto.
Le porto n’est pas un vin à la mode en France ; mais on en fabrique a Cette et à Montpellier et le café Tabouret en a.
Le porto versé, le détective renouvela ses offres de service.
Shoking ne dit ni oui ni non.
Seulement un sourire mystérieux passa sur ses lèvres.
– Peut-être, reprit le détective, luncheriez-vous volontiers ?
– Oh ! yes, dit Shoking, le lunch me convient beaucoup.
Le détective appela le garçon et lui demanda une bouteille de bordeaux, du jambon, du roatsbeef froid et des sardines.
Shoking se mit à manger et à boire comme quatre ; mais Shoking était un rude buveur, on ne le couchait pas facilement sous la table.
Son sourire mystérieux prenait peu à peu des proportions plus vastes.
– Excusez-moi, gentleman, dit-il quand il n’eut plus ni faim ni soif : mais j’ai des affaires très pressées, et je vais être au regret de vous quitter.
Ce disant, il appela le garçon.
– Que faites-vous ? demanda le détective étonné.
– Je paye, dit froidement Shoking.
Et il tira sa poignée d’or de sa poche et mit, à la grande stupéfaction du garçon, un louis sur la table.
Et comme le détective paraissait non moins stupéfait, Shoking, qui avait prémédité depuis un quart d’heure cette petite scène, dit en souriant :
– L’habit ne fait pas le moine, gentleman. Je suis un lord excentrique ; je voyage pour étudier les mœurs des différents pays, et quand vous m’avez trouvé, je venais de parcourir le faubourg Saint-Marcel. Très curieux, très curieux, ce faubourg ; il ressemble à Spitheafield de Londres.
– Mais, dit le détective qui parut instantanément saisi de respect, Votre Seigneurie daignera-t-elle au moins m’apprendre son nom ?
– Je m’appelle lord Vilmot, répondit Shoking, dont la nature fanfaronne et vaniteuse avait tout à coup repris le dessus.
Et il se leva avec la dignité d’un vrai lord quittant son siège au Parlement.
XXV
Sir James Wood avait dit à son confrère le détective qu’une heure lui suffisait pour enlever l’enfant et le mettre en lieu sûr.
Or il y avait bien plus d’une heure que Shoking et lui lunchaient.
Le détective Edward pensa qu’il pouvait donc laisser aller Shoking où bon lui semblait.
Shoking triomphant lui tendit la main d’un air protecteur.
– Venez donc me voir à mon hôtel un de ces soirs et prendre le thé, lui dit-il.
– Ce sera beaucoup d’honneur pour moi, dit le détective.
– J’habite hôtel de la Paix, place Vendôme, poursuivit Shoking. Excusez-moi, je n’ai pas de cartes sur moi.
Shoking était ravi d’avoir jeté de la poudre aux yeux.
– Adieu, sir, dit-il encore.
– Au revoir, milord, répondit le détective.
Ils se quittèrent à la porte du café Tabouret.
Le détective parut vouloir suivre la rue de Vaugirard, et Shoking descendit vers le carrefour de l’Odéon.
Shoking était un peu gris, mais gris à la façon des Anglais, qui ont une si grande habitude de l’ivresse et une peur si salutaire de la cour de police, qu’ils marchent droit et, par un effort de volonté suprême, ne battent jamais les murs.
Il arriva donc sans encombre au carrefour de l’Odéon.
C’est le quartier par excellence des marchands d’habits.
On trouve chez eux du vieux et du presque neuf.
Shoking entra dans une boutique, s’exprima de son mieux en montrant trois louis et fut servi à souhait.
Pour soixante francs, il eut habit et pantalon noirs, bottes, chapeau, pardessus et en outre une chemise blanche.
Il était entré mendiant, il sortit gentleman.
Un gentleman ne saurait se passer de gants.
Shoking entra chez une mercière et se paya une paire de gants peau de chien, du plus beau rouge sang-de-bœuf.
Alors seulement il songea à Jenny et à son fils.
– Diable ! se dit-il, mais je ne me connais guère en nippes de femme. J’aurais mieux fait d’emmener Jenny avec moi.
Et il se mit à tenir le haut du pavé, en jetant un regard complaisant dans toutes les glaces qui se trouvaient sur son chemin, et il arriva de nouveau ainsi dans la rue de Vaugirard.
En la traversant, il entra dans le Luxembourg.
La première personne qu’il aperçut dans le jardin fut le détective Edward.
Celui-ci avait acheté un journal, s’était assis sur un banc et paraissait plongé dans sa lecture.
Shoking eut un nouvel accès de vanité.
Il s’approcha du détective.
Sir Edward ne leva même pas la tête.
Alors Shoking toussa.
Le détective quitta son journal et il eut un petit mouvement de surprise.
– Sir, dit Shoking, vous n’allez peut-être pas me reconnaître.
– Ah ! milord, est-ce possible !
– En vous quittant, dit Shoking je me suis jeté dans une voiture et je suis allé changer de vêtements à mon hôtel.
Maintenant je vais assister à la séance du Sénat.
Le détective salua.
– Mais auparavant, poursuivit Shoking, trop ivre déjà pour n’avoir pas soif, nous allons boire une nouvelle bouteille de porto.
– Je n’ai rien à refuser à Votre Seigneurie ; et même, continua Edward, bien que je ne sois qu’un simple gentleman, tout au plus esquire, je supplierai Votre Seigneurie de me laisser payer cette fois.
– Je vous le promets, dit Shoking toujours protecteur.
Et ils retournèrent au café Tabouret, où Shoking n’était pas fâché de montrer une pelure nouvelle.
Le détective pensait :
– On ne sait ce qui peut arriver. Sir James n’a peut-être pas fini sa besogne. Autant amuser cet imbécile un bout de temps.
Et ils s’attablèrent.
Shoking était déjà gris, nous l’avons dit. Il fit honneur à la bouteille de porto du détective ; puis, toujours magnifique, il en demanda une seconde et une troisième.
Mais il ne l’acheva pas et roula sous la table.
Alors le détective s’approcha du comptoir et expliqua à la dame, en fort bon français, que Shoking était un Anglais excentrique, très riche et pas mal ivrogne, comme on pouvait le voir, et qu’on n’avait qu’à le porter sur un banc du Luxembourg, où il cuverait tranquillement son vin ; ce qui fut exécuté sur-le-champ par deux garçons et sous ses yeux.
*
* *
Les ivrognes de profession ont l’ivresse courte.
Trois ou quatre heures après, Shoking s’éveilla et ouvrit les yeux.
Il rassembla ses souvenirs et la mémoire lui revint.
– Double brute que je suis ! se dit-il.
Et il songea à Jenny et à Ralph qui l’attendaient, et à Milon qui lui avait donné rendez-vous dans la soirée.
Qu’était devenu le gentleman Edward ?
Shoking ne se le demanda même pas.
Il prit ses jambes à son cou, traversa le jardin en courant, car on allait fermer les grilles, et se trouva sur le boulevard d’Enfer.
Une chose consolait Shoking de sa mésaventure, – l’absence de l’homme gris, le seul homme qu’il eût craint dans sa vie et devant lequel il eût jamais rougi de son intempérance.
Shoking se jeta dans une voiture et indiqua au cocher la rue du Champ-de-l’Alouette.
– Bah ! se dit-il tandis que le véhicule se mettait en chemin, il n’y a pas grand mal à tout cela. Je vais garder la voiture, j’y ferai monter Jenny et son fils ; nous irons ensemble acheter des habits et nous nous ferons conduire ensuite chez Milon.
Un quart d’heure après, le fiacre s’arrêtait à la porte de la pauvre maison où ils occupaient une mansarde depuis trois semaines.
Shoking monta lestement l’escalier.
Au dernier étage il s’arrêta stupéfait : la porte était ouverte et la mansarde était vide.
En même temps une voisine, une petite ouvrière qui demeurait sur le carré, dit à Shoking :
– Votre femme et votre enfant sont partis.
– Partis ! exclama Shoking.
– Oui.
– Mais quand ? mais comment ? pourquoi ? balbutia-t-il.
– C’est un de vos compatriotes qui est venu les chercher.
– Un Anglais ?
– Oui.
Shoking sentit ses cheveux se hérisser et la sueur perler à son front.
Et, se souvenant pour la première fois alors de ces deux hommes qui rôdaient autour de la maison quand il était venu avec Milon, et songeant au gentleman qui l’avait grisé, Shoking jeta un cri de terreur et s’élança dans l’escalier comme un homme qui a subitement perdu la raison.
XXVI
Cependant Milon, en rentrant chez lui, avait trouvé la lettre de Marmouset au lieu de le rencontrer lui-même.
Il avait lu cette lettre avant de monter dans son bureau, ce qui fit qu’il put réfléchir quelques minutes.
– Marmouset a raison, pensa-t-il.
Dès lors il fallait constater le vol et faire grand tapage.
Milon n’avait pas revu ses contremaîtres, à qui il avait donné rendez-vous, ce qui fit que, n’ayant pas été contre-mandés, ils arrivèrent à l’heure dite, c’est-à-dire comme quatre heures sonnaient.
Milon s’était arrêté au rez-de-chaussée de la maison et paraissait s’étonner beaucoup de la lettre de l’Anglais et de son impatience.
La servante lui disait qu’elle avait essayé vainement de le retenir.
Enfin, les deux contremaîtres étant arrivés, Milon leur dit :
– Un drôle d’homme que cet Anglais ! parce que je suis en retard d’un quart d’heure, il dit que je lui manque de respect.
– Il ne reviendra pas…
– Je m’en moque, dit encore Milon ; j’ai plus d’affaires que je n’en peux faire.
Et il ajouta :
– Je vous avais fait venir pour voir le terrain dont je lui avais parlé ; ça fait que je n’ai plus besoin de vous. Ah ! si fait ! montez tout de même…
Milon, comme on le voit, voulait jouer sa petite scène avec le plus de naturel possible.
– Je vais vous donner les plans du rez-de-chaussée de la maison de la rue Réaumur, dit-il.
Les deux contremaîtres le suivirent. Milon gravit l’escalier, traversa le premier bureau, poussa la porte de la caisse et jeta un cri.
Ce cri fut si naturellement poussé que les deux maîtres compagnons accoururent.
Milon était bouche béante, bras ballants, stupéfait devant sa caisse ouverte.
– Volé ! dit-il enfin. Il m’a volé cent mille francs !
Son air lamentable fut si naturel que les deux contremaîtres ne soupçonnèrent pas un seul instant la vérité.
La servante était accourue au cri de son maître. À la vue de la caisse ouverte, elle s’écria :
– Eh bien ! il est joli son milord ! Ce n’est qu’un filou !
Milon s’élança au dehors.
– Depuis quand est-il parti ? disait-il.
– Depuis un quart d’heure.
– Par où ?
– Il était en voiture et il est remonté vers les Champs-Élysées.
– En fiacre ?
– Oui, mais je n’ai pas regardé le numéro, je n’ai remarqué que le cocher.
– Le reconnaîtrais-tu ?
– Pardine !
Milon se précipita au dehors. La servante et les deux contremaîtres le suivaient.
La journée avait été belle, et les voitures retour du bois étaient pressées dans les Champs-Élysées comme un troupeau de moutons.
– Une aiguille dans une botte de foin ! murmura Milon qui parut pris d’un vrai désespoir.
– Patron ! dit un des contremaîtres, il faut aller chez le commissaire ; c’est le plus court.
– Oui, dit Milon, et vous allez venir avec moi tous les trois.
Le commissaire de police du quartier a son bureau rue de Ponthieu.
C’est là que Milon, ses deux contremaîtres et sa servante se présentèrent.
Milon était, du reste, personnellement connu de ce magistrat.
Il fit sa déclaration : ses contremaîtres, sa servante donnèrent le signalement exact du prétendu lord, et le commissaire leur dit :
– Je vais transmettre votre plainte à la préfecture.
En ce moment, je crois qu’on a sous la main un ou deux agents de police anglais.
– Ah ! fit Milon étonné.
– Mais, ajouta le magistrat, la police anglaise ne se fait pas gratuitement.
– Ah ! répondit Milon, je donnerai vingt-cinq mille francs s’il le faut.
Le commissaire ne se contenta point de sa déposition verbale, il commença une enquête et se transporta chez Milon ; la serrure de la caisse ne portait aucune trace d’effraction.
Par conséquent, le voleur l’avait ouverte avec une clef et une clef fabriquée en Angleterre comme la caisse.
– Il est probable, dit le commissaire de police en se retirant, que vous serez invité à passer dès demain matin à la préfecture.
– J’irai, dit Milon.
Et il s’enferma dans son bureau, comme un homme qui ne prend pas facilement son parti d’avoir été volé.
Mais, une fois seul, le calme revint sur son visage bouleversé, et ses bonnes grosses lèvres s’arquèrent en un sourire qui visait à la malice.
– On dit toujours que je suis un imbécile, murmura-t-il, et il y a même des jours où je le crois, mais il n’est pas moins vrai que j’ai enfoncé aujourd’hui un commissaire, ni plus ni moins que si j’étais Rocambole lui-même.
Et Milon, fort satisfait, se mit à faire ses comptes.
Tout à coup on frappa vivement à la porte, et la servante entra.
– Ah ! patron, dit-elle, en voilà bien d’une autre !
– Qu’est-ce qu’il y a ? demanda Milon.
– Un autre Anglais qui se présente.
– Un autre ?
– Oui.
– Ah ! c’est juste, dit Milon, qui pensa à Shoking. Un pauvre diable.
– Mais non, il est mis comme un bourgeois.
– Avec une femme et un petit garçon ?
– Non, il est seul, il pleure, et il a l’air comme un fou. C’est encore une couleur, patron, méfiez-vous !
Milon descendit.
Il aperçut Shoking, tout de noir vêtu, qui s’était laissé tomber sur un banc dans le vestibule et qui pleurait à chaudes larmes :
– Ah ! disait-il en anglais, Jenny est partie, et Ralph aussi…
– Que chantes-tu là ? demanda Milon.
Et il se fit raconter ce qui s’était passé.
Shoking ne savait que deux choses ; la première, c’est qu’il avait été grisé par un gentleman ;
La seconde, c’est que l’Irlandaise et son fils avaient disparu, emmenés par un autre Anglais.
– Ah ! ma foi ! pensa Milon, ceci est beaucoup trop compliqué pour moi. Il n’y a que Marmouset qui puisse éclaircir cette affaire.
Il laissa Shoking chez lui, le recommandant à sa servante, se jeta dans une voiture et se fit conduire rue Auber.
Marmouset, redevenu lui-même, venait de rentrer.
Il écouta jusqu’au bout et sans mot dire le récit de Milon.
Puis, quand Milon eut fini, un sourire lui vint aux lèvres.
– Et te voilà bien embarrassé ? dit-il.
– Dame !
– Les gens qui ont enlevé la mère et l’enfant, cela est certain, reprit Marmouset, sont les mêmes qui ont fait disparaître miss Ellen.
– Vous croyez ?
– J’en suis sûr. Et comme nous sommes en train de leur tendre un piège, acheva froidement Marmouset, cela ne nous coûtera pas plus, quand nous les tiendrons, de leur reprendre l’Irlandaise et son fils en même temps que miss Ellen.
– Vrai, s’écria Milon, vous avez le génie du maître, Marmouset.
– Je ne sais pas, répondit modestement l’élève de Rocambole, mais je suis au moins un peu plus fort que toi, qui te noyes toujours dans un verre d’eau.
XXVII
Qu’étaient devenus Ralph et Jenny ?
Sir James Wood avait fait sa confession à son collègue Edward le détective, – il avait été fénian.
Peut-être même était-il le premier traître de cette secte mystérieuse et redoutable, si menaçante pour l’Angleterre et pour l’orgueil britannique.
Réfugié dans un coin de l’Irlande, il était ensuite parti pour l’Amérique.
C’était ici sans doute qu’il était parvenu à faire perdre ses traces à ses anciens amis, car à Londres personne ne l’avait reconnu.
Or, sir James Wood comptait sur la toute-puissance de ce signe maçonnique qui permet aux fénians de se reconnaître entre eux.
Avant de quitter Londres et de venir en France rechercher miss Ellen d’abord, et ensuite cet enfant qui était l’espoir de l’Irlande, il avait eu plusieurs conférences soit avec lord Palmure, soit même avec le révérend Patterson, cet homme qui mettait le fanatisme religieux de la partie dans la guerre qu’il avait déclarée aux Irlandais.
Sir James était au courant de tout ce qui s’était passé à Londres, par conséquent.
Ce n’était que peu à peu, du reste, qu’il avait fait des confidences à son collègue, et il ne lui avait même pas tout dit. Or il y avait plus de huit jours que sir James préparait l’enlèvement du petit Irlandais, à l’insu du détective Edward.
On se souvient que, tant qu’il s’était constitué le gardien de miss Ellen, rue Louis-le-Grand, il ne la quittait jamais pendant le jour.
Mais le soir, il se départait volontiers de la surveillance, confiait la garde de la prisonnière à son collègue et sortait de neuf à onze heures.
On lui avait donné, à la préfecture de police de Paris, un homme qui devait le piloter et se mettre à sa disposition quand il en aurait besoin.
L’ambassade anglaise n’avait, du reste, pas fait mystère du but que le détective poursuivait.
Il venait à Paris non seulement pour y chercher une jeune fille en puissance de père, mais pour y surveiller des fénians.
S’il pouvait arrêter l’une et compter sur le secours de l’autorité, il ne pouvait pas arrêter les autres, mais il avait le droit de suivre leurs traces.
Or, dans l’homme qu’on lui avait donné, sir James avait rencontré un garçon habile, intelligent, véritable enfant de Paris, et qui en connaissait tous les mystères.
Paris n’est pas comme Londres, où le beau et le laid se coudoyent, où le brok street, ruelle des voleurs, touche à Piccadilly et à Haymarkett, le beau quartier.
Les Limousins ont envahi la rue de Choiseul et les abords de la place Vendôme, ils ont jeté bas des maisons encore neuves, mais ils n’ont pas découvert sur ce point le plus petit mystère.
Ce Paris-là était trop neuf encore.
Sir James avait besoin d’un quartier excentrique, où la surveillance de la police fût moins grande, la population plus habituée au tapage.
Emportez un enfant dans vos bras sur le boulevard des Italiens, et qu’il crie et se débatte, vous ne ferez pas cent pas devant vous.
On vous arrêtera, on vous questionnera, on prendra fait et cause pour l’enfant.
Que cela se passe à l’extrémité du boulevard du Prince-Eugène, dans le quartier de la Roquette, nul ne fera attention à vous.
Sir James était méthodique comme un Anglais.
Avant de se mettre à la recherche de Jenny et de son fils, dont il avait perdu les traces depuis le jour où il les avait fait voler, sir James s’était posé cette question :
– Quand je les aurai retrouvés, qu’en ferai-je ?
Il n’avait rien à attendre de l’autorité française.
À la requête de l’ambassade, la France voulait bien donner une hospitalité provisoire dans une de ses prisons à la fille d’un lord en rupture d’obéissance…
Mais la France ne voulait pas se faire la geôlière des fénians.
Aussi sir James s’était dit :
– C’est à moi tout seul à inventer une prison dans Paris, à l’insu de l’autorité.
Chaque soir donc, pendant huit ou dix jours, il avait rejoint l’homme de police français mis à sa disposition au café du Helder.
Puis ils allaient courir les quartiers éloignés où la pioche des démolisseurs a mis à découvert une foule de maisons du moyen âge, machinées comme des théâtres de féeries.
Sans doute qu’un beau soir sir James avait trouvé ce qu’il cherchait, car il dit à son collègue Edward :
– Maintenant, nous pouvons nous mettre à la recherche de l’Irlandaise et de son fils.
Trois jours après, sir James et son collègue erraient, comme on l’a vu, dans la rue du Champ-de-l’Alouette, et tandis que le second suivait Shoking à distance, sir James s’engouffrait dans l’allée noire de la vieille maison.
Le détective avait imaginé une petite fable à laquelle il était impossible que Jenny ne se laissât pas prendre.
Il savait, en outre, une chose, c’est que Shoking, l’ami, le compagnon des deux exilés, n’était cependant pas fénian.
Shoking s’était lancé dans le mouvement Irlandais, à la suite de l’homme gris et par pure admiration pour lui.
Mais Shoking était Anglais, non Irlandais, et tout ce qu’il avait fait jusque-là était pure chevalerie de sa part.
Et Jenny n’avait à Paris d’autre ami que Shoking ; le jour où un fénian lui apparaîtrait, il aurait évidemment sur elle plus d’influence que lui.
Sir James monta donc le petit escalier sombre et tortueux auquel une corde servait de rampe.
Au troisième étage, il rencontra une jeune fille et lui dit en bon français :
– Ma belle enfant, à quel étage demeurent les Anglais ?
– Tout en haut, monsieur, répondit-elle, la porte à droite sur le carré.
– Merci bien.
Et sir James continua de monter.
La porte de la mansarde était ouverte.
Jenny tenait son fils sur ses genoux.
En voyant approcher sir James, elle eut un premier mouvement d’effroi.
Mais sir James lui fit aussitôt le signe mystérieux.
Alors l’Irlandaise se leva et vint à lui :
– Frère, dit-elle, sois le bienvenu.
– Ma sœur, répondit sir James dans le patois irlandais qui fait le désespoir des habitants de Londres, il y a longtemps que je te cherchais.
– Moi ? fit Jenny.
– Toi et notre chef.
Et sur ces mots, sir James fléchit un genou devant l’enfant étonné et lui baisa la main.
Puis, d’une voix grave et triste :
– Un de nos frères se meurt dans cette grande ville où nous sommes venus chercher un refuge contre nos persécuteurs ; or ce frère implore la faveur de voir, avant de rendre le dernier soupir, CELUI en qui l’Irlande a mis l’espoir de ses destinées.
Lui refuseras-tu cette consolation ?
Jenny hésita un moment.
– Non, frère, dit-elle enfin, je suis prête à te suivre…
XXVIII
Sir James Wood, le traître, l’Irlandais qui avait vendu à l’Angleterre le secret de ses frères, avait une petite histoire toute prête pour achever d’abuser Jenny.
– Ma sœur, lui dit-il, il n’y a que quelques heures que je suis parvenu à retrouver vos traces dans Paris, où je suis venu tout exprès pour vous chercher.
Jenny le regarda :
– Qui donc vous envoyait ? dit-elle.
– Deux hommes qui sont là-bas et dont l’un se nomme l’abbé Samuel.
Ce dernier nom eût ôté à la pauvre Irlandaise toute hésitation, si elle en avait eu encore. Mais le signe maçonnique des fénians était là pour la rassurer, et, nous le répétons, sir James Wood était peut-être le premier initié qui eût trahi.
– Depuis huit jours, continua sir James, je vous cherche.
– Vraiment ? dit-elle.
– Et je vous cherche, d’abord parce que j’ai ordre de vous retrouver, ensuite parce que, je vous le répète, une de nos sœurs va mourir et demande la bénédiction de notre maître futur.
Et de nouveau il adressa un respectueux regard à l’enfant de Jenny.
– Où est-elle donc, notre sœur ? demanda Jenny.
– Loin d’ici, il nous faudra près d’une heure de voiture pour arriver.
– Pouvons-nous être de retour avant la nuit ?
– Oui, certes, dit James.
Un pâle sourire vint aux lèvres de Jenny :
– Vous vous étonnez peut-être de ma question ? fit-elle.
Sir James eut un geste discret.
– Écoutez-moi, reprit l’Irlandaise, vous venez à moi de la part de l’abbé Samuel, n’est-ce pas ?
– Oui.
– Et de la part d’un autre homme encore ?
– Oui, ma sœur.
– Me diriez-vous son nom, à celui-là ?
– Il n’en a pas. On l’appelle l’homme gris.
Jenny tendit la main à sir James.
– Frère, dit-elle, si tous les deux vous envoient, je puis vous suivre, et ne dois rien vous cacher. Quand nous avons quitté Londres, l’homme gris nous a donné un guide et un compagnon…
– Shoking, dit sir James.
– Vous le connaissez ?
– Oui, et je croyais le trouver ici.
– Il est parti, mais il rentrera bientôt.
– Hélas ! dit sir James, si notre pauvre sœur n’était pas à l’agonie…
– C’est juste, dit l’Irlandaise. D’ailleurs, quand Shoking à de l’argent dans sa poche, il n’est jamais pressé de rentrer. Je vous dirai le reste de notre histoire en chemin.
– Je cours chercher une voiture, dit sir James.
Et il s’élança vers l’escalier.
Jenny jeta un châle sur ses épaules, et prenant son fils par la main :
– Viens ! dit-elle.
Mais l’enfant ne bougea.
Et comme la mère s’étonnait de cette résistance :
– J’ai peur, dit-il.
– Pourquoi donc as-tu peur, mon enfant ?
– N’allons pas avec cet homme, dit-il.
– Mais cet homme est un de nos frères.
– Non, dit-il encore, maman, n’y allons pas.
Et il avait des larmes dans les yeux en parlant ainsi.
Mais Jenny avait foi dans l’homme qui lui avait fait le signe mystérieux des fénians.
– Un homme ne doit pas avoir peur, dit-elle, et tu es un homme !
L’enfant se redressa avec fierté.
– Puisque tu le veux, dit-il, allons ! Mais tu verras qu’il nous arrivera malheur !
Jenny haussa imperceptiblement les épaules.
Dès lors son fils la suivit sans résistance et sans mot dire.
Sir James les attendait à la porte avec un fiacre à quatre places.
Ils y montèrent.
Alors Jenny dit au détective :
– Quand nous sommes arrivés à Paris, nous avions de l’argent, et, en outre, une lettre de crédit sur un homme qui est l’ami de l’homme gris. On nous a volé la lettre et l’argent, et nous sommes devenus bien misérables.
Mais, pendant que vous nous cherchiez, Shoking a battu le pavé de Paris en tous les sens, il a retrouvé l’homme sur qui nous avions une lettre de crédit, et celui-ci l’a cru sur parole : Il est venu à la maison, il nous a donné de l’argent, et il nous attend chez lui ce soir. C’est pour cela qu’il faut que nous revenions avant la nuit.
– Vous ne ferez que les deux chemins, dit sir James, et je vous ramènerai.
Tandis qu’ils causaient ainsi, le fiacre roulait.
En montant, sir James avait donné au cocher la marche à suivre.
Le fiacre gagna donc le boulevard d’Enfer, prit ensuite le boulevard Saint-Michel, traversa la Cité, arriva au boulevard Sébastopol, et s’engagea dans la rue Turbigo, une grande artère toute neuve qui arrive à la place du Château-d’Eau.
Jenny regardait de temps à autre par la portière.
– Est-ce encore bien loin ? demanda-t-elle.
– Non, dit sir James.
Le fiacre s’engagea sur le boulevard du Prince-Eugène.
Les maisons neuves qui le bordent auraient rassuré Jenny, si elle avait eu encore la moindre défiance.
Au delà du canal se trouve une église neuve, Saint-Ambroise.
Un peu plus loin est une mairie.
Tant qu’on longe le boulevard, on se croirait dans une grande ville qui date d’hier.
Le boulevard du Prince-Eugène est une route magnifique qui recouvre et dérobe à la vue les hideuses rues de ce vieux quartier de la Roquette et du faubourg Saint-Antoine.
On aperçoit bien ça et là une étroite ruelle, un passage sans vie et sans lumière, mais il a si vite disparu !
Un peu avant la mairie, on trouve une rue qui se nomme la rue du Chemin-Vert.
Le fiacre y entra.
Au bout de cette rue qui se nommait jadis la rue des Amandiers, se trouve l’avenue Parmentier, une avenue sans maisons, ou à peu près, et à gauche une sorte d’esplanade que bordent de petites ruelles et des maisons hautes et noires.
Le fiacre s’arrêta.
– Attendez-nous ici, dit sir James au cocher, à qui il donna cent sous.
– Nous descendrons ? dit Jenny.
– Oui, mais c’est à deux pas, répondit le détective.
Il voulut prendre l’enfant par la main ; mais celui-ci se jeta contre sa mère.
Alors sir James lui dit dans ce patois irlandais qui était si doux aux oreilles de l’enfant :
– Tu as donc peur de moi ?
L’enfant fut désarmé.
Et il prit la main du détective, qui les entraîna, lui et sa mère, et leur fit traverser l’esplanade, tournant ainsi le dos à l’avenue Parmentier.
XXIX
Cette esplanade déserte que longeaient sir James, Ralph et Jenny datait d’hier.
C’était l’emplacement des anciens abattoirs Ménilmontant, repoussés, comme les autres, au delà des fortifications.
Depuis qu’on avait rasé l’édifice, le quartier était devenu solitaire.
On ne voyait plus, à trois heures du matin, les cabarets ouverts ; on n’entendait plus rouler les voitures de bouchers partant comme l’éclair.
La nuit tout dormait. Le jour, la solitude régnait dans toutes ces ruelles qui mènent à l’hospice des incurables d’un côté et à la rue de la Roquette de l’autre.
Derrière l’avenue Parmentier, il y a un passage, une cité misérable, une impasse plutôt, qu’on appelle le passage des Amandiers.
Les Limousins n’y sont pas venus encore.
Les maisons sont hautes, les allées noires, les cours étroites.
Une population d’ouvriers travaillant au dehors vient y coucher chaque soir.
En plein jour on n’y rencontre guère qu’une femme ayant un nourrisson à la mamelle ou une nichée d’enfants jouant au seuil des portes.
Vers le milieu, à gauche, en entrant par la rue du Chemin-Vert, il y avait une maison plus haute, plus noire, plus enfumée que toutes les autres.
Un charbonnier occupait le rez-de-chaussée ; le premier et le second n’étaient pas loués ; les autres étages étaient habités par des ouvriers qui s’en allaient le matin pour ne revenir que le soir.
À partir de huit heures, le charbonnier était l’unique créature humaine qui vécût dans ce bouge.
Ce fut là que sir James entra.
Jenny avait vu les plus pauvres quartiers de Londres, elle avait habité Dudley street, où la misère a l’aspect le plus hideux du monde.
Elle entra donc sans hésitation ni répugnance, sur les pas de sir James, dans l’étroite allée de la maison.
En passant, sir James frappa à la porte du charbonnier.
Celui-ci, le visage barbouillé, apparut aussitôt.
C’était un homme de quarante ans environ, au front bas, à l’œil sournois, aux épaules herculéennes.
Il avait un mauvais sourire aux lèvres et quelque chose de féroce et de stupide à la fois dans l’ensemble de la physionomie.
Il était veuf.
Sa femme était morte mystérieusement, et d’étranges rumeurs avaient circulé dans le voisinage : on disait qu’il l’avait étranglée.
Mais une enquête judiciaire n’avait pas abouti, et Chapparot, – c’était son nom, – mis en état d’arrestation tout d’abord, avait été relâché.
Il avait une fille de quinze ans qu’il accablait de coups et de mauvais traitements.
Un beau jour, sa mère morte, la pauvre enfant s’était enfuie, et on ne savait ce qu’elle était devenue.
Chapparot ne s’était pas plus préoccupé de sa fille qu’il n’avait pleuré sa femme.
Il était travailleur et avare.
On disait même qu’il avait un gros sac d’écus, avec lequel il s’en retournerait en Auvergne au premier jour. En attendant, on le craignait, et personne ne s’avisait de lui chercher querelle.
Les bonnes femmes qui venaient chez lui chercher du charbon ou de la braise osaient à peine franchir le seuil de sa boutique.
Cet homme ne parlait pas, ne buvait pas, n’avait pas d’amis et était la terreur du quartier, bien qu’il ne cherchât jamais querelle à personne.
L’homme de police qu’on avait donné à sir James pour le piloter dans Paris avait dit un soir au détective :
– Vous m’avez demandé un homme résolu et capable de tout ?
– Oui, avait répondu sir James.
– J’ai votre affaire, venez avec moi.
Sir James, ce soir-là, avait endossé un paletot d’ouvrier par-dessus une blouse, coiffé une casquette, noirci ses favoris, qui étaient trop blonds, et il avait suivi l’homme de police.
Celui-ci l’avait conduit chez un marchand de vins du passage Saint-Pierre et lui avait montré Chapparot, qui mangeait un morceau de lard et buvait une chopine dans un coin.
– Voilà votre homme, avait-il dit ; moi je ne puis me mêler de rien et je m’en vais.
Chapparot, sans doute, était prévenu, car il avait fait bon accueil au détective.
Celui-ci s’était assis à sa table, avait demandé du vin ; puis, tandis que le cabaretier tournait le dos, il avait furtivement montré une poignée d’or au fils de l’Auvergne.
À partir de ce moment, Chapparot avait appartenu corps et âme à sir James Wood.
Ils s’étaient revus plusieurs fois, tantôt dans un cabaret, tantôt dans l’autre, et, un soir, après six heures, le détective s’était furtivement introduit dans la boutique du charbonnier.
Donc, en arrivant avec Jenny et son fils, sir James se glissa dans l’allée au lieu d’entrer par la boutique, et il frappa à une porte que Chapparot ouvrit aussitôt.
Un rapide coup d’œil fut échangé entre eux.
Puis le charbonnier fit un signe qui voulait dire :
– Suivez-moi.
Sir James tenait toujours l’enfant par la main.
Jenny le suivait.
La boutique dans laquelle ils entrèrent était un étroit boyau tout en longueur.
Elle était séparée d’une petite cour sans air et sans lumière, où, même en plein jour, régnait une demi-obscurité. De l’autre côté de la cour, il y avait une autre boutique, un hangar plutôt, sous lequel le charbonnier empilait le bois qui lui venait du chantier.
Il fit traverser cette cour à ses visiteurs, et ils entrèrent sous le hangar.
Jenny s’attendait toujours à voir un lit et sur ce lit une agonisante.
Quant à l’enfant, il avait plusieurs fois hésité. Mais sir James l’entraînait et faisait de temps en temps retentir à ses oreilles quelques mots de patois irlandais.
Et l’enfant rassuré continuait à le suivre.
Au fond du hangar, Chapparot ouvrit une porte. Alors sir James se trouva à l’entrée d’une troisième pièce, plongée dans l’obscurité.
Le charbonnier alluma une chandelle et entra le premier. Ils étaient dans une cave au niveau du sol.
La clarté de la chandelle était vacillante et un vent, humide la courbait sur la palette de fer dans laquelle elle était plantée.
En même temps sir James sentit un sol en planches et qui sonnait le creux sous ses pieds.
La chandelle éclairait si peu qu’on ne voyait pas le fond de la cave.
Le charbonnier marchait devant.
Après lui venaient sir James et l’enfant.
Puis Jenny fermait la marche.
Tout à coup le charbonnier s’arrêta.
En même temps l’enfant étonné le vit se baisser, comme s’il cherchait quelque chose à terre.
Puis il entendit un bruit sec.
Puis un grand cri…
Puis quelque chose comme la chute d’un corps dans un puits.
Et l’enfant éperdu, tournant la tête, ne vit plus sa mère.
Jenny avait disparu.
L’Irlandaise avait senti tout à coup le sol manquer sous ses pieds, et, une planche qui faisait la bascule cédant sous son poids, elle était tombée dans la citerne de la maison.
XXX
L’enfant terrifié crut d’abord à un accident.
– Maman ! où est maman ? s’écria-t-il en voulant revenir en arrière.
Le mouvement des bascules avait été si rapide que la planche qui avait cédé sous les pieds de la malheureuse Irlandaise était remontée presque aussitôt, et l’enfant n’avait rien vu.
Et comme il voulait s’élancer en répétant :
– Maman ! maman !
Sir James Wood le retint d’une main vigoureuse, tandis que le charbonnier riait de son mauvais rire.
L’enfant se remit à crier et à se débattre.
Sir James lui mit une main sur la bouche, disant :
– Tais-toi ou je te tue !
L’enfant mordit cette main avec fureur.
Sir James jeta un cri de douleur et lâcha l’enfant.
Mais le charbonnier le prit au passage, et lui serra le cou de manière à l’empêcher de pousser même un gémissement.
Les deux misérables avaient entendu quelques plaintes sous leurs pieds et le clapotement de l’eau pendant quelques secondes.
Puis les plaintes s’étaient éteintes, et aussi le clapotement.
– Je crois qu’elle a son compte, avait dit le charbonnier en riant.
Et il serrait si fort le cou de Ralph, que le pauvre enfant tirait la langue et était devenu d’un rouge livide.
– Prends garde de l’étrangler, imbécile, dit sir James, cet enfant vaut cent mille francs pour moi.
L’enfant, à demi étranglé, se débattait toujours.
– Alors dit le charbonnier, mettez-lui votre mouchoir dans la bouche.
– Le voilà, dit sir James, qui secouait sa main d’où le sang sortait.
Les deux misérables bâillonnèrent l’enfant. Puis le charbonnier lui jeta un sac à charbon sur la tête et l’emporta dans le hangar.
– Qu’allons-nous en faire ? dit-il.
Ralph ne comprenait pas le français, la langue dans laquelle sir James parlait au charbonnier.
Réduit à l’impuissance, bâillonné, couvert par le sac dont la poussière noire l’aveuglait, il n’était plus dans les mains de ces hommes qu’un colis inerte.
– Crois-tu que la mère se soit noyée ? demanda sir James à Chapparot.
– J’en suis bien sûr, dit le charbonnier, il y a dix pieds d’eau dans la citerne. Et du petit, que voulez-vous en faire ?
– Il faut que tu me le gardes.
– Jusqu’à quand ?
– Jusqu’à demain.
– Faudra-t-il lui donner à manger ?
– Oui, s’il ne crie pas.
– Oh ! Je vais le mettre dans un endroit où il peut bien crier tout à son aise ; personne ne l’entendra.
Et comme il avait toujours Ralph dans ses bras, il fit signe à sir James de soulever une plaque de tôle munie d’un anneau qui se trouvait dans un coin du hangar.
Sir James obéit.
La plaque recouvrait les premières marches d’un escalier qui descendait dans les caves de la maison.
– Je vais toujours le laisser bâillonné, dit le charbonnier, qui s’engagea, l’enfant sur ses épaules, dans l’escalier, ajoutant :
– Attendez-moi ici.
Cinq minutes après, Chapparot remonta seul.
– Je l’ai enfermé dans un caveau, dit-il, dont les murs ont quatre pieds de large. Il n’y a pas un cabanon à Mazas qui soit plus solide.
En même temps il tendit la main à sir James :
– Mon argent ? dit-il.
– En voilà la moitié, répondit sir James.
Et il lui mit un rouleau d’or dans la main.
– Pourquoi ne me donnez-vous pas tout ? fit le charbonnier d’un ton hargneux.
– Afin que tu veilles sur le petit et que tu ne le laisses pas s’échapper.
– Oh ! soyez tranquille.
– Je viendrai le chercher demain, ajouta sir James, et tu auras le reste de ton argent.
– Soit, dit le charbonnier en soupirant.
Et ils quittèrent le hangar, retraversèrent la cour et entrèrent dans la boutique.
Puis sir James sortit par la porte de l’allée.
– À demain, dit-il.
Et il regagna le fiacre qui l’attendait toujours à l’angle de l’avenue Parmentier et de la rue du Chemin-Vert.
*
* *
Une heure après, sir James Wood, mis avec toute la recherche prétentieuse d’un gentleman d’outre-Manche, entrait dans un bureau télégraphique, rue Lafayette, et transmettait le télégramme suivant :
Au révérend Patterson,
92, Oxfort street,
London.
« Ralph est avec moi. Faut-il partir ? Répondez sur-le-champ.
« SIR JAMES. »
La dépêche expédiée, sir James alla tranquillement dîner au café Anglais.
C’était là que le détective Edward devait le rejoindre.
Mais le détective se fit attendre, sir James avait achevé son repas et huit heures sonnaient lorsque Edward arriva.
– Eh bien ? dit-il.
– C’est fait, répondit sir James.
– Vous avez l’enfant ?
– Oui.
– Où est-il ?
– En lieu sûr, fit sir James avec un sourire.
– Moi, dit Edward, j’ai passé à notre hôtel, et je vous apporte une lettre et un télégramme.
– Voyons ?
Et sir James tendit la main aux deux missives.
Le télégramme qu’il ouvrit tout d’abord, était la réponse du révérend Patterson.
Il était ainsi conçu :
« Écrivez lettre. Donnez détails et attendez de nouveaux ordres ».
– Comme il lui plaira, murmura sir James.
Et il ouvrit la lettre, qui portait cet en-tête :
Préfecture de police
Cabinet du chef de là sûreté.
« Venez demain matin à neuf heures à mon bureau, disait le chef de la sûreté à sir James, j’ai une proposition à vous faire et un petit service à vous demander. »
– Je me doute de quoi il s’agit, dit Edward, qui prit connaissance de la lettre.
– Ah !
– Il se commet beaucoup de vols à Paris en ce moment, et il y a, dit-on, une bande de pickpockets nouvellement débarquée. On veut nous utiliser.
– Avec plaisir, dit sir James, s’il y a de l’argent au bout.
– Alors nous irons là-bas à neuf heures ?
– Certainement, répondit sir James.
Et il demanda tranquillement du café et des cigares.
Le souvenir de la malheureuse Irlandaise ne le tourmentait point, comme on le voit !…
XXXI
Le lendemain, un peu avant neuf heures, sir James se présenta à la préfecture de police, et entra par le quai des Orfèvres.
Il y a là une station de voitures, et une dizaine de fiacres attendaient à la suite une pratique encore absente.
Cependant l’un de ces fiacres n’était pas vide, et même on en avait baissé les stores.
Pourquoi ?
Milon et Marmouset se trouvaient dedans.
Arrivés à huit heures et demie, ils avaient monté dans le véhicule, en disant au cocher :
– Nous attendons quelqu’un, restez-la et laissez votre cheval le nez dans sa musette.
Le cocher, ayant regardé l’heure, n’avait fait aucune observation, et la voiture habitée était demeurée au milieu des voitures vides.
Milon et Marmouset avaient baissé les stores ; puis, les yeux fixés au travers, sur la petite cour au bout de laquelle se trouve un des escaliers de la préfecture, ils avaient attendu, causant tout bas :
– Tu penses bien, disait Marmouset, qu’un Anglais se reconnaît à Paris. Ils ont beau faire, ils ont une tournure qui permet de les éventer.
– Alors vous voulez le voir ?
– Naturellement.
– Et pourquoi ne voulez-vous pas que je monte chez le chef de la sûreté auparavant ?
– Pour deux motifs.
– Ah !
– D’abord parce que tu reconnaîtras peut-être en lui un des deux Anglais qui rôdaient hier rue du Champ-de-l’Alouette et que nous soupçonnons être ceux qui ont enlevé l’Irlandaise et son fils.
– Ah ! je comprends.
– Ensuite, parce que j’aime autant qu’il arrive le premier…
– Pourquoi ? demanda vivement Milon.
Marmouset se prit à sourire.
– Parce qu’on lui expliquera ce qui s’est passé et qu’il sera au courant. Contente-toi de cette explication, car si j’allais plus loin, tu te mettrais inutilement l’esprit à la torture.
– Comme vous voudrez, dit Milon résigné.
Et comme ils causaient ainsi, une voiture qui descendait du Pont-Neuf s’arrêta à l’entrée de la rue de Jérusalem.
Un homme en descendit et dit quelques mots à son cocher.
– Ce doit être lui, dit Marmouset.
Milon regarda cet homme.
– Ah ! pour sûr, dit-il, c’est un de ceux d’hier.
– Fort bien ; à présent, écoute.
– Parlez, dit Milon, tandis que sir James, car c’était lui, en effet, se dirigeait vers l’escalier de la préfecture.
– Tu vas monter dans quelques minutes.
– Oui, dit Milon.
– Et que le détective se charge ou non de retrouver ton voleur, tu t’arrangeras de façon à descendre avec lui.
– Pourquoi ?
– Parce qu’il faut que tu sois bien sûr que l’homme qui vient d’entrer ne va pas à la préfecture pour autre chose et que c’est celui que la police va mettre à mes trousses.
– Bon, je comprends ; et puis ?
– Et puis tu t’en iras tranquillement chez toi.
– Et vous ?
– Oh ! moi, j’entreprendrai une petite campagne et je commencerai par suivre mon homme.
– Mais, dit Milon, j’ai idée qu’il ne se chargera pas de mon affaire.
– Pourquoi ?
– Parce que je m’appelle Milon, qu’il doit être un de ceux qui ont volé la lettre de crédit et les papiers de Shoking, et que par conséquent… il ne voudra pas se trouver en rapport avec moi.
– Tu te trompes !
– Ah !
Milon ne fit plus d’objection. Il sortit du fiacre et monta.
Alors Marmouset appela le cocher et lui montrant la voiture que sir James avait quittée et qui s’était remisée de l’autre côté de la rue, il lui dit :
– Pensez-vous que votre cheval soit aussi bon que celui-là ?
– Je le parierai quand on voudra.
– Ce n’est pas nécessaire, dit Marmouset ; mais il s’agit de le suivre quand il partira. Il y a un louis de pourboire.
– Fameux ! dit le cocher.
Et il monta sur son siège.
Pendant ce temps, sir James entrait chez le chef de la Sûreté.
– Mon cher monsieur, lui disait celui-ci, il s’agit d’un vol commis par un de vos compatriotes.
– Ah ! lui dit sir James, il y a une bande de pickpockets à Paris.
Je sais cela. Le vol est-il considérable ?
– Cent mille francs.
Sir James était un homme positif.
– Que donnez-vous pour les retrouver ? demanda-t-il.
– Le quart.
– C’est-à-dire vingt-cinq mille francs ?
– Oui.
– C’est une petite affaire, dit sir James assez dédaigneusement ; mais vous avez été trop aimable avec moi pour que je ne cherche pas à vous être utile à mon tour.
Le commissaire de police du quartier des Champs-Élysées avait transmis une note très détaillée sur la manière dont le vol avait été accompli.
Au nom de Milon, sir James ne sourcilla pas.
Quand Milon entra, il le regarda avec cet œil indifférent d’un gentleman qui voit un autre gentleman pour la première fois.
Milon fut tout aussi calme, et sir James demeura convaincu que Milon ignorait encore l’enlèvement de l’Irlandaise et de son fils et que la perte de son argent le préoccupait exclusivement.
Le détective lui fit mille questions, se fit donner le signalement exact du voleur et la carte que celui-ci avait laissée.
Puis il dit à Milon :
– Retournez chez vous, monsieur, et ne vous préoccupez pas. Dans trois jours vous aurez votre argent.
– Ai-je besoin de vous revoir ? demanda Milon.
– Non.
– Puis-je aller chez vous ?
– Inutile. Quand j’aurai mis la main sur le voleur, je vous jetterai un mot à la poste, et vous donnerai rendez-vous ici.
Sir James parlait avec assurance, et Milon parut tout joyeux.
Comme le lui avait recommandé Marmouset, il ne sortit qu’avec sir James de chez le chef de la Sûreté, et il descendit avec lui sur le quai, où ils se séparèrent, Milon s’en allant à pied, et le détective remontant dans sa voiture.
Alors Marmouset dit au cocher :
– En route, mon garçon ; il y a, je te le répète, un louis de pourboire.
La voiture de sir James n’avait pas d’œil-de-bœuf, ce qui fit que le détective ne put regarder en arrière. D’ailleurs, il ne soupçonna pas un seul instant qu’on pût le suivre.
L’Anglais remonta sur le Pont-Neuf, le traversa, prit le quai, et descendit vers la rue de Rivoli.
La voiture s’arrêta à l’entrée de l’hôtel du Louvre.
Sir James descendit, paya et renvoya le cocher.
– Bon ! pensa alors Marmouset, dont le fiacre s’était arrêté à quelque distance, nous allons maintenant lui faire le coup du portefeuille.
Et il tira de sa poche un carnet qu’il laissa tomber dans le ruisseau.
Puis le reprenant tout mouillé, il se dirigea vers le bureau de l’hôtel.
– Voilà un tour que les Anglais, si malins qu’ils soient, ne connaissent pas…
XXXII
Le coup du portefeuille a été inventé, non par les voleurs, mais par les chanteurs.
Inutile de dire que nous ne voulons parler ni des artistes lyriques, ni de ceux qui disent agréablement la chansonnette, ni même des pauvres diables qui chantent dans les rues pour quelques sous.
Le chanteur devrait plutôt et plus logiquement s’appeler l’homme qui fait chanter.
Qu’est-ce que faire chanter ?
Une chose bien simple, en vérité, – s’emparer du secret d’autrui, et rançonner autrui ensuite.
De même qu’il y a des bandes de voleurs, il y a des associations de chanteurs.
Elles ont leurs chefs, leurs soldats, leurs dignitaires et leurs simples associés. Elles obéissent à des ordres secrets, à des mots de passe mystérieux.
La grosse affaire du chanteur, son commerce le plus considérable est, évidemment, la spéculation sur les intrigues amoureuses.
Il y a un chanteur, souvent plusieurs, dans chaque quartier, quelquefois dans chaque rue un peu aristocratique.
Rue Trois-Étoiles, au numéro 7, et au premier étage, M. Six-Étoiles habite un somptueux appartement.
Il est riche, il est vieux, il est laid.
En revanche, il a une femme jeune et jolie.
Un chanteur qui demeure dans l’hôtel garni d’en face a souvent vu à la fenêtre le couple disparate.
– Voilà qui n’est pas raisonnable, se dit-il. Il y a quelque chose là-dessous.
Le chanteur a flairé une affaire.
Dès lors il épie.
Mme Six-Étoiles se lève de bonne heure, elle est pieuse, elle va à la messe tous les matins.
Le chanteur la suit.
Saint-Vincent-de-Paul est la paroisse de madame.
À huit heures, madame entre par la grande porte, son livre de messe à la main.
Peu après, le chanteur entre à son tour dans l’église.
Ô surprise !
L’église est presque déserte. Une trentaine de personnes tout au plus écoutent dans une chapelle latérale une messe basse.
Mais Mme Six-Étoiles a disparu.
Où est-elle ?
Le chanteur sort, non pas désappointé, mais ravi.
Le lendemain, à la même heure, il est à Saint-Vincent-de-Paul, non devant la grande porte, mais au bout de l’église, près de celle qui donne sur la rue Fénelon.
Mme Six-Étoiles sort furtivement de l’église.
Où va-t-elle ?
Le chanteur le saura.
Il y a une station de voitures non loin de là.
Mme Six-Étoiles monte dans un fiacre ; elle dit au cocher, à mi-voix et baissant son voile, le nom d’une rue.
Le fiacre part.
Le chanteur ne court pas après, mais il a entendu le nom de la rue et le numéro indiqué.
Le lendemain il est dans cette rue, en flâneur, en Parisien qui baye aux corneilles.
À huit heures trois quarts, un fiacre s’arrête à la porte, une femme en descend. C’est elle.
Elle entre furtivement dans la maison, passe devant le concierge sans demander, et monte l’escalier d’un pas leste.
Le chanteur est fixé.
Madame a un amant.
Un autre chanteur se charge de savoir quel est l’amant ? Une fois qu’il a son nom, les deux associés s’entendent.
Un matin, l’amant reçoit une lettre dans laquelle on le menace de tout dire au mari.
Le soir, la femme reçoit une lettre semblablement. Elle perd la tête. On lui demande six mille francs pour garder le silence.
Elle ne les a pas.
Si l’amant est riche, il paye. S’il ne peut se procurer la somme demandée, madame met en gages ses diamants au mont-de-piété.
Et tous deux se croient sauvés.
Six mois après, on leur redemande de l’argent et puis de l’argent encore, et cela durera jusqu’à ce que le mari meure, ou bien que la femme se décide à aller faire sa confession à la préfecture de police, où son secret sera gardé, car la police de Paris est la plus discrète du monde.
Il arrive aussi qu’un chanteur qui se promène aux Champs-Élysées, au Bois, dans un quartier désert, le matin ou le soir, voit un monsieur qui descend d’une voiture et s’en va à pied.
La voiture contient une femme.
Le chanteur est fixé : c’était un rendez-vous d’amour.
Il laisse le monsieur s’en aller, mais il suit la voiture.
Elle quitte les Champs-Élysées, entre dans le faubourg Saint-Honoré, traverse la place Beauvau, prend la rue Cambacérès et s’arrête devant une maison de belle apparence.
La femme descend, paye la voiture et rentre chez elle avec tranquillité.
Quelle est-elle ? comment savoir son nom ? à quel étage habite-t-elle ?
Le chanteur ne le sait pas ; mais, grâce au coup du portefeuille, il va le savoir.
Il a un joli carnet en cuir de Russie dans sa poche, il le trempe dans le ruisseau de façon qu’il soit un peu maculé ; puis le tenant à la main, il entre dans la maison et va droit à la loge du concierge.
– Excusez-moi, dit-il, une dame est entrée ici, il y a une minute.
– Oui, dit le concierge.
– Tandis qu’elle payait la voiture, elle a laissé tomber ceci.
– C’est la baronne de X…, au premier, dit le concierge.
– Je vais lui restituer son bien, dit le chanteur.
Et il monte, ne s’arrête pas au premier, enfile l’escalier jusqu’au dernier étage, remet le carnet dans sa poche et redescend tranquillement.
À partir de ce moment, Mme la baronne de X… est chantée.
Dans huit jours, on saura le nom et l’adresse du monsieur qui redescend à pied les Champs-Élysées ; huit jours plus tard, on saura si le baron de X… est jaloux.
Or, Marmouset, pour en revenir à notre récit, eut recours au coup de portefeuille.
Pourquoi ?
D’abord il voulait savoir le nom que le détective portait à l’hôtel.
Ensuite, il n’était pas fâché de jeter un coup d’œil sur le logis de sir James.
L’hôtel du Louvre, chacun sait cela, est deux fois grand comme un ministère.
Mais il y a un chasseur à la porte, qui dévisage les gens qui entrent et qui sortent.
Marmouset s’adressa à lui.
Il lui montra le portefeuille et lui dépeignit le gentleman.
– C’est un Anglais, sir James Wood, au premier, escalier L…, chambre 18, répondit le chasseur.
Marmouset n’était point vêtu en gentleman ; il avait même endossé un vieux paletot et coiffé un chapeau tout bosselé qui lui donnaient l’air d’un pauvre diable.
Le chasseur le laissa monter en se disant :
– Il aura une bonne pièce. Tant mieux pour lui !
Et Marmouset se trouva ainsi dans l’hôtel du Louvre, grâce au coup du portefeuille.
XXXIII
Il est difficile au premier venu, nous l’avons dit, de pénétrer dans l’hôtel du Louvre sans être plus ou moins examiné par le chasseur de la porte.
Mais une fois qu’on a traversé la cour et enfilé un escalier quelconque, personne ne fait plus attention à vous.
Comme le Grand-Hôtel, l’hôtel du Louvre est une ruche immense, sans cesse bourdonnante, dans les mille cellules et les nombreux corridors de laquelle se presse une population hétéroclite et hétérogène, un mélange prodigieux d’Anglais, de Français, d’Allemands, de Russes et de Turcs, et toutes les variétés de la domesticité, depuis le moujik jusqu’au groom anglais, depuis le cocher de grande remise jusqu’à l’humble commissionnaire en veste de velours bleu, depuis le valet richement harnaché d’or d’un fastueux dentiste jusqu’au porteur en livrée des magasins de nouveautés.
Une fois dans l’escalier, Marmouset se dit :
– Ne nous pressons pas, j’ai le temps d’étudier mon homme.
Il avait, comme on le pense bien, remis son portefeuille dans sa poche et ne songeait nullement à aller frapper à la porte du numéro 18, la chambre occupée par le détective.
Marmouset se mit donc à flâner dans les couloirs, ne perdant jamais de vue la porte n° 18, sur laquelle il aperçut la clef, et il se fit le raisonnement suivant :
– Sir James ne rentre pas pour longtemps, il est même probable qu’il va ressortir ; sans cela, il n’aurait pas laissé la clef au dehors. Peut-être attend-il quelqu’un ?
Et Marmouset, allant et venant de long en large, attendit pareillement.
Il ne s’était pas trompé.
Le détective Edward arriva quelques minutes après si James.
Un coup d’œil suffit à Marmouset pour reconnaître en lui le second personnage dont lui avait parlé le concierge de la rue Louis-le-Grand.
Edward ne se donna pas le temps de frapper ; il tourna la clef et entra.
Quand la porte se fut refermée, Marmouset tira de se poche un singulier appareil.
C’était un tube en caoutchouc, long de deux mètres environ, de l’épaisseur d’un cordon de sonnette et de couleur grise.
Les murs du corridor étaient peints en gris.
Ceux qui ont parcouru l’hôtel du Louvre ont remarqué des banquettes placées le long des murs de distance en distance.
Les gens qui montent à l’étage supérieur s’y reposent un moment. Les commissionnaires y attendent les réponses aux lettres qu’ils ont apportées.
Marmouset trouva justement une banquette à droite de la porte de sir James.
Et profitant d’un moment où le corridor était à peu près désert et où personne ne faisait attention à lui, il fourra dans la serrure, sans toucher à la clef et sans faire le moindre bruit, un des bouts du tube en caoutchouc.
Ce bout s’arrondissait ou plutôt s’évasait comme la gueule d’un tromblon.
Cela fait, Marmouset s’assit sur la banquette, posa sa tête sur sa main et se courba à demi laissant arriver à son oreille l’autre extrémité du tube qui courait le long du mur et se confondait avec lui.
Puis, à l’aide de cet appareil acoustique improvisé, il écouta.
Naturellement sir James et Edward parlaient anglais.
Edward disait :
– Vous venez de là-bas ?
– J’arrive à l’instant.
– Qu’est-ce que cette affaire ?
– Un vol de cent mille francs.
– Au préjudice de qui ?
– Oh ! dit sir James en riant, vous ne le devineriez jamais.
– Plaît-il ?
– C’est l’homme d’hier, l’entrepreneur, le correspondant de l’homme gris.
– Milon ?
– Justement.
– Vous l’avez vu ?
– Nous nous sommes rencontrés dans le cabinet du chef de la Sûreté.
– Et vous avez refusé de vous mêler de cette affaire ?
– Au contraire, j’ai accepté.
– Mais…
– Je sais ce que vous allez me dire, dit sir James, nous jouons un jeu dangereux, car enfin il est probable que ce Milon et Shoking se mettront à la recherche de l’Irlandaise et de son fils.
– Naturellement.
– Et comme vous avez été en rapport avec le premier, il vous reconnaîtra.
– Sans doute.
– Oui, mais il ne m’a pas vu, moi.
– Alors je ne mêlerai pas de ce vol ?
– Au contraire, nous chercherons chacun de notre côté, mais on ne nous verra plus ensemble et vous ne paraîtrez pas. Vous ferez même bien, Edward, de quitter l’hôtel du Louvre et d’aller au Grand-Hôtel.
– Sir James, dit Edward, je crois que nous ferions mieux, à présent que l’Irlandaise est morte et que nous avons l’enfant, de retourner à Londres.
– C’est impossible, puisque dans sa dépêche le révérend Patterson me demande une lettre et attend cette lettre pour me transmettre ses ordres.
– Et cette lettre, l’avez-vous écrite ?
– Elle est partie ce matin.
– Eh bien ! dit encore Edward, elle sera à Londres ce soir.
– Oui.
– Supposez que le révérend vous envoie un télégramme avec le seul mot : Partez.
– Nous partirons.
– Et nous laisserons là le vol ?
– Non, dit sir James, car je crois que nous trouverons le voleur d’ici ce soir.
– En vérité !
– Et je suis à peu près certain de savoir qui il est.
– Bah !
– C’est le pickpocket que nous avons employé pour voler Shoking, je le jurerais.
– Qui vous le fait croire ?
– Il a volé Shoking. Il a pris connaissance de la lettre de l’homme gris à Milon. Nous l’avons payé, et il a dit qu’il repartait ; mais il n’est point parti. L’autre jour je l’ai aperçu sur le boulevard.
– Ah !
– Et il m’a évité. La lettre de l’homme gris l’a donc mis sur la voie. Il a travaillé pour son compte !
– Et vous croyez le trouver ?
– Oh ! certainement.
– Et si c’est lui, vous le ferez arrêter ?
– Non, mais je lui ferai rendre l’argent.
– Diable ! pensait Marmouset, qui ne perdait pas un mot de cette conversation, grâce à son tube de caoutchouc, ceci dérange un peu mes projets. Enfin, ils ont l’enfant, c’est toujours un premier point éclairci.
– Et miss Ellen ? demanda Edward.
– Eh bien ? dit sir James, elle est toujours à Saint-Lazare.
Cette fois Marmouset tressaillit.
– Je sais la moitié de ce que je voulais savoir, murmura-t-il.
Et il tira à lui son tube de caoutchouc, le mit dans sa poche, quitta la banquette et se remit à flâner dans le corridor.
Quelques minutes après, la porte de sir James s’ouvrit, et celui-ci parut avec Edward, qui portait une petite valise à la main et allait sans doute quitter l’hôtel du Louvre pour le Grand-Hôtel.
Marmouset accourut.
– Ces messieurs ont besoin d’un commissionnaire, dit-il.
Et il s’empara de la valise avec empressement.
XXXIV
Malgré son flair ordinaire d’homme de police, sir James ne se défia pas un instant de Marmouset.
Marmouset avait du reste cet air mêlé de candeur et de rêverie du Parisien des rues qui cherche à se rendre utile, et il n’avait besoin, pour cela, que de se souvenir de sa première jeunesse.
Le détective Edward laissa donc sa valise aux mains de Marmouset, qui se mit à marcher en avant, mais pas assez pour qu’un seul mot de la conversation des deux Anglais pût lui échapper.
Sir James était tête nue, du reste, ce qui prouvait qu’il n’accompagnait son collègue Edward que jusqu’au bout du corridor.
– Quand vous verrai-je ? dit celui-ci.
– Ce soir.
– Où ?
– Vous entrerez au café Anglais vers sept heures.
– Fort bien.
– Vous ne me parlerez pas, mais vous me regarderez. Si j’ai des huîtres devant moi, c’est que les cent mille francs sont retrouvés.
– À merveille !
– Alors vous pourrez me parler, car je n’aurai plus rien à faire avec l’homme aux cent mille francs. J’espère avoir une dépêche dans la soirée, du reste. Adieu.
Et sir James serra la main d’Edward et retourna vers sa chambre.
Marmouset n’avait pas même détourné la tête, mais il avait tout entendu.
Quand il fut en bas de l’escalier, Edward marchant toujours sur ses talons, il fit signe à une voiture qui venait d’amener un voyageur et était prête à s’en retourner.
Le cocher vint se ranger sous le péristyle.
Marmouset ouvrit la portière, mit la valise dans la voiture, et dit :
– Où va monsieur ?
– Au Grand-Hôtel.
Marmouset referma la portière ; puis, le plus naturellement du monde, il grimpa à côté du cocher.
Edward, habitué à l’obséquiosité de tous les gens qu’on rencontre dans les hôtels, ne s’étonna point.
Le fiacre traversa Paris et arriva au Grand-Hôtel.
Marmouset descendit lestement, s’empara de nouveau de la valise, entra de nouveau dans le bureau comme un homme qui a une grande habitude de l’établissement, et dit :
– Une chambre pour mylord ?
– Mon ami, dit Edward en souriant, je ne suis pas lord.
– Tiens ! fit naïvement Marmouset, monsieur est Anglais, pourtant ?
– Sans doute.
– Tous les Anglais ne sont donc pas lords ?
– Non, je ne suis qu’esquire, moi.
– Voilà un drôle de mot que jamais je ne saurai prononcer, dit Marmouset.
L’employé de bureau disait en même temps :
– Conduisez mylord au premier, escalier C…, chambre 21.
Marmouset remit la valise à un garçon ; puis, sa casquette à la main, il attendit son pourboire.
Edward lui donna quarante sous, et Marmouset s’en alla, répétant tout bas :
– Escalier C…, au premier, chambre 21.
La rue Auber passe, comme on sait, derrière le Grand-Hôtel.
Marmouset courut chez lui.
Il était sorti le matin dans un accoutrement qui avait quelque peu étonné son valet de chambre et son portier, ou plutôt son concierge, car la rue Auber est trop aristocratique pour avoir des portiers, et elle vise même aux suisses.
Mais un homme qui, comme Marmouset, a deux ou trois cent mille francs de rentes, possède de beaux chevaux et mène la vie fastueuse des clubs et des coulisses, a bien le droit d’être excentrique.
Marmouset avait dit un mot à son valet de chambre, qui avait mis le concierge au courant.
Il était amoureux d’une petite ouvrière du faubourg du Temple, et se donnait à elle pour un compagnon menuisier, en attendant qu’il la mît dans un huit-ressorts.
Marmouset rentra donc tranquillement chez lui et changea de vêtements. Puis il sonna son groom :
– Mets Lisbeth à la charrette anglaise, lui dit-il, cours rue Marignan et amène-moi Milon.
Comme cela avait été convenu entre eux une heure auparavant, le bon Milon avait pu monter chez lui et attendre les ordres de Marmouset.
Le groom partit.
Quelques minutes après on sonna, et le valet de chambre introduisit une femme dans le cabinet de Marmouset.
C’était Vanda.
– J’allais vous écrire, dit Marmouset.
– Alors j’ai bien fait de venir.
– Oui, car j’ai besoin de vous.
Vanda s’assit et attendit.
– Je sais où est miss Ellen, reprit Marmouset.
– Ah !
– Elle est à Saint-Lazare.
Vanda se prit à sourire.
– Je m’en doutais, fit-elle.
– Et j’ai compté sur vous.
– Pour l’en faire sortir ?
– Oui et non. Cela dépendra.
– De quoi ?
– Du jugement que vous porterez sur elle. D’après le pauvre diable de maçon qui s’est cassé bras et jambes, miss Ellen aime le maître.
– Bon !
– D’après l’Anglais Shoking et vous-même, elle est sa plus mortelle ennemie.
– Eh bien ?
– Vous la verrez, vous causerez avec elle…, et ce que vous déciderez, nous le ferons.
– C’est bien, dit Vanda.
– Vous pensez, continua Marmouset, que je ne me suis même pas préoccupé du moyen de vous faire entrer à Saint-Lazare.
– J’en ai un tout trouvé.
– Ah !
– Quand faut-il y aller ?
– Mais le plus tôt possible… aujourd’hui.
– Non, dit Vanda, pas avant demain.
– Pourquoi ?
– Parce que la personne dont je prendrai la place n’arrivera à Paris que ce soir par le dernier train.
– Que voulez-vous dire ?
– Il y a une légère mutation dans le personnel des prisons en ce moment. Je ne parle pas des détenus, mais des gardiens. Or, dit Vanda, une jeune religieuse que je protège et qui était à Lyon, vient à Paris. Elle descendra chez moi ce soir.
– Très bien.
– Et demain, à sa place, j’entrerai à Saint-Lazare.
– Mais se prêtera-t-elle à cette supercherie ? demanda Marmouset.
– Quand je vous aurai, dit son histoire, vous verrez qu’elle n’a rien à me refuser.
Et Vanda se prit à sourire, ajoutant :
– Ma liaison avec elle n’est pas née d’hier. Elle remonte au temps où j’étais entrée à Saint-Lazare pour faire évader Antoinette Miller.
– Voyons, dit Marmouset, je vous écoute. Nous avons le temps, du reste, car Milon ne sera pas ici avant une demi-heure.
XXXV
– Mon ami, dit alors Vanda, il y a de cela près de six ans.
Tandis que j’étais à Saint-Lazare avec Antoinette Miller, elle par son angélique et doux visage, moi par mon allure un peu décidée, nous avions attiré l’attention d’une jeune sœur qu’on appelait Marie. Elle croyait à notre innocence ; elle n’avait jamais douté un moment de la vertu d’Antoinette. Bref, elle nous avait prises en grande amitié.
Vous savez comment Antoinette est sortit de Saint-Lazare ?
– Oui, dit Marmouset, morte en apparence.
– Morte pour tous, excepté pour Rocambole, moi et quelques autres.
Puis nous nous évadâmes, la belle Marion et moi, après avoir bâillonné la sœur Léocadie.
Plus d’une année s’écoula, poursuivit Vanda ; Antoinette ressuscitée s’était mariée, et le maître était parti pour d’autres aventures ; j’avais un peu oublié Saint-Lazare et son triste personnel, lorsqu’un matin, passant, devant l’église Saint-Laurent, je fus abordée par une religieuse qui me salua.
C’était sœur Marie la jeune religieuse qui nous avait témoigné de la sympathie.
– Oh ! madame, me dit-elle, vous ne me refuserez pas de me dire la vérité ?
Elle me prit les mains avec effusion.
– Un bruit court à Saint-Lazare, poursuivit-elle, c’est que Mlle Antoinette n’était pas morte.
– Vous l’avez pourtant vue dans la bière.
– Oui, dit-elle, et cependant.
– Cependant, lui dis-je tout bas, venez me voir le jour où vous sortirez, et je vous dirai tout.
Elle sortait une fois par semaine et n’y manqua pas.
Un matin, je la vis arriver ; alors je ne fis plus mystère ni de la résurrection d’Antoinette, ni de notre évasion.
Elle vint me voir souvent, et je finis par me lier avec elle.
Chaque fois je lui donnais une certaine somme pour la distribuer aux pauvres détenues.
Un jour elle me dit :
– L’asile Sainte-Anne ne suffit pas. Si j’avais de l’argent je voudrais fonder un établissement semblable, mais loin de Paris, bien loin, afin que les malheureuses qui viendraient frapper à notre porte n’eussent jamais la pensée de revenir dans ce pays de perdition.
– Eh bien ! lui dis-je, je vous trouverai de l’argent.
J’en parlerai à Rocambole.
Je vous demandai de l’argent aussi, à vous, Marmouset.
– Oui, je sais bien, dit Marmouset, je vous ai donné cent mille francs pour un hospice.
– C’était pour la maison de refuge de Sainte-Marie.
– Où cela ?
– Près de Lyon.
– Elle n’est donc plus dans le service administratif des prisons ?
– Oui et non. La maison est une entreprise particulière, et cependant soumise au règlement des prisons et à la surveillance de l’autorité.
Quand une détenue se conduit bien et qu’elle n’a plus que peu de temps à faire, elle obtient d’aller finir sa captivité chez sœur Marie ; souvent elle y reste, une fois libérée.
Or, tous les deux ou trois ans, sœur Marie vient elle-même ou elle envoie une de ses sœurs en bonnes œuvres visiter Saint-Lazare ; elle interroge les misères, elle sonde la profondeur des infortunes, elle frappe sur les cœurs pour voir s’ils sont susceptibles de repentir, et elle finit par obtenir la permission d’emmener avec elle quatre, cinq, quelquefois dix détenues, voleuses ou femmes de mauvaise vie. La sœur Marie arrive ce soir, elle m’a écrit, et j’irai la recevoir à la gare.
– Fort bien, dit Marmouset ; mais comment entrerez vous à sa place à Saint-Lazare ?
– J’entrerai avec elle.
– Comme une de ses sœurs ?
– Comme son amie.
– Mais vous n’êtes pas religieuse ?
– Non certes.
– Et sœur Marie se prêtera-t-elle à un déguisement qui est un sacrilège à ses yeux, ou tout au moins une profanation ?
– J’ai mon idée, dit Vanda. Qu’il vous suffise de savoir que demain je serai à Saint-Lazare. Ainsi donnez-moi vos instructions.
– Elles se résument en un mot : savoir.
– Oui, savoir si miss Ellen est l’ennemie acharnée du maître ou si elle est devenue son amie ?
– Justement.
– Et puis ?
– Dans le premier cas, nous la laisserons à Saint-Lazare.
– Dans le second nous la ferons sortir.
– Oh ! mon ami, dit Vanda en souriant, je sais la peine que nous avons eue à faire sortir Antoinette.
– Aussi, dit Marmouset en riant, n’est-ce pas ainsi que je procéderai.
– Que ferez-vous ?
– Ceux qui l’ont mise à Saint-Lazare l’en feront sortir.
– Comment ?
– Mais tout naturellement. Écoutez-moi bien : Un homme est venu à Paris ; cet homme est un détective, il se nomme sir James Wood, je sais son nom depuis ce matin. Il a été le geôlier de miss Ellen tant que la jeune fille n’a pas cherché à lui échapper.
Après sa tentative d’évasion de la maison de la rue Louis-le-Grand, sir James, qui avait autre chose à faire à Paris, et à qui son gouvernement avait donné des pouvoirs étendus, sir James, dis-je, sera allé trouver le préfet de police et le chef de la sûreté, et aura obtenu d’eux qu’on lui gardât miss Ellen quelques jours dans une des pistoles de Saint-Lazare.
Comprenez-vous ?
– Parfaitement, dit Vanda. Alors, rien ne presse.
– Au contraire.
– Ah !
– Sir James est sur le point de retourner en Angleterre, et si je ne m’assure de sa personne d’ici à demain…
– Comment ferez-vous ?
Marmouset raconta alors à Vanda l’idée qui lui était venue de se déguiser en Anglais, de voler cent mille francs à Milon, et de mettre sir James sur la trace du voleur imaginaire.
– Tout cela, dit-il, est assez ingénieux, mais le hasard nous donnerait tort, si nous ne brusquions les événements.
– Que voulez-vous dire ?
– Sir James croit que le voleur est le pickpocket qu’il a employé pour voler les papiers de Shoking, ce qui fait qu’il va s’égarer dès le début de ses recherches, et que s’il reçoit la dépêche qu’il attend de Londres, il renoncera à poursuivre le voleur, et partira, emmenant l’enfant et miss Ellen.
– Vous êtes sûr qu’il a volé l’enfant ?
– Tout ce qu’il y a de plus sûr.
– Et savez-vous où il l’a mis ?
– Non, mais je le saurai.
Comme Marmouset disait cela, on frappa à la porte de son cabinet, et Milon entra.
Il était suivi de Shoking qui tournait et retournait son chapeau dans ses mains, d’un air consterné.
– Ne te désole pas, lui dit Marmouset, on retrouvera la mère et l’enfant.
– L’enfant, oui, dit Shoking d’une voix lamentable ; mais la mère, la pauvre Jenny, pourvu qu’ils ne l’aient pas tuée ?…
Milon, Marmouset et Vanda tressaillirent et se regardèrent.
XXXVI
Quel avait été le résultat du conciliabule de Marmouset, Milon et Vanda ?
C’est ce que nous verrons en suivant désormais sir James Wood.
Le détective croyait avoir de bonnes raisons pour soupçonner que le voleur des cent mille francs était le même homme qu’il avait employé quelques semaines auparavant à voler les papiers de Shoking.
Les gens de police et les voleurs de Londres se connaissent presque tous.
Un homme de l’importance de sir James connaissait non seulement les différents pickpockets qui, las des brouillards, passaient le détroit pour s’en aller opérer sur le continent, mais il savait encore quelle était leur spécialité.
Celui-ci dévalisait le comptoir d’un magasin de dentelles ; cet autre ne volait que dans les omnibus ; tel autre fréquentait les églises ; un quatrième travaillait au spectacle.
Il s’en était suivi pour sir James une petite nomenclature, très exacte, dans laquelle chaque voleur était désigné par sa profession.
Il connaissait à Paris le dentellier, le voyageur, le dévot et le dilettante.
Il y avait encore le serrurier.
Le serrurier, qui de son vrai nom se nommait Smith, avait été employé à Londres dans une fabrique de coffre-forts, et c’était en exerçant cet honnête métier qu’il avait appris sa coupable profession.
Et le serrurier était précisément l’homme qu’avait employé sir James Wood.
Cet homme avait dit qu’il repartait ; mais sir James l’avait aperçu la veille même du vol, rôdant aux environs du Grand-Hôtel.
Donc, pour sir James, un seul homme avait pu ouvrir sans effraction la caisse de l’entrepreneur Milon, et cet homme, c’était le serrurier.
Sir James était un détective habile, cela est incontestable, mais il n’était pas sorcier. Or, un sorcier seul aurait pu deviner que Milon s’était volé lui-même ou à peu près, et que ce vol qu’on lui signalait, à lui sir James, cachait un piège habilement tendu.
Lorsque sir James était arrivé à Paris et qu’il s’était mis en rapport avec le serrurier, il lui avait dit :
– Je ne suis pas au service de la police française, tu n’as par conséquent rien à craindre de moi. Tout au contraire, je vais t’employer et je te payerai bien.
Entre le voleur anglais et l’agent de police de Londres il n’y a aucune animosité.
Sans cesse en lutte, ils rivalisent d’adresse, de ruse, d’habileté, et le vaincu pardonne à son vainqueur aisément.
Tout autre que sir James se fût donné la peine de courir à la Préfecture et de faire rechercher Smith, dit le Serrurier.
Le procédé, si simple en apparence, eût fait perdre trop de temps ; et sir James s’attendait à recevoir, d’un moment à l’autre, l’ordre de retourner à Londres.
Or, il y a à Paris un journal appelé la Gazette des Étrangers, qui se distribue dans les hôtels et que les étrangers lisent régulièrement tous les jours.
Sir James prit une voiture, courut au bureau du journal, et paya cent sous la ligne l’annonce que voici :
« Le célèbre serrurier anglais S…, de passage à Paris en ce moment, est prié de se présenter à l’hôtel du Louvre, chambre 18, chez J. W., esq. »
On allait mettre sous presse.
Une heure après le journal avait paru.
Deux heures plus tard, Smith, dit le Serrurier, arrivait.
Sir James le reçut avec un sourire.
– Je craignais que tu ne fusses parti, dit-il.
– Oh ! non, dit Smith en riant, les affaires sont meilleures à Paris qu’à Londres.
– Vraiment ? et qu’as-tu fait ?
– Je me suis associé avec deux camarades.
– Bon !
– Et nous avons déjà un joli petit magot.
– Y compris les cent mille francs que tu as volés à l’entrepreneur Milon.
À ces paroles, Smith ouvrit des grands yeux, il eût même un air si étonné que sir James ne put s’y tromper.
Ce n’était pas lui qui avait commis le vol.
Cependant le détective lui fit mille questions, le tourna et le retourna et ne put obtenir de lui autre chose que d’énergiques dénégations.
Alors sir James lui raconta dans tous ses détails l’histoire du vol, telle qu’il la tenait du chef de la Sûreté et de Milon lui-même.
– Patron, dit alors Smith, je ne puis rien vous dire tant que je n’ai pas vu la serrure.
– Ah !
– Mais je parierais qu’on se moque de vous.
– Qui donc ?
– Je ne sais pas. Mais si la caisse a été trouvée ouverte comme vous me le dites, il n’y a que deux hommes qui eussent été capables de faire le coup.
– Qui donc ?
– Moi d’abord, et je vous répète que ce n’est pas moi.
– Et puis ?
– Et un autre Anglais qu’on appelle John et qui n’est pas à Paris, j’en suis sûr.
– Cependant la caisse a été ouverte.
– Je ne dis pas non… Mais pas comme vous le dites. Si je la voyais ?
– Rien n’est plus facile, dit sir James.
Il prit une plume et écrivit à Milon les lignes suivantes :
« Monsieur,
« Je suis sur les traces de votre voleur. Mais j’ai besoin de voir votre caisse. Ce soir, à onze heures, je serai chez vous avec un de mes collègues. Il est indispensable pour des motifs que je vous expliquerai de vive voix, que vous soyez seul et que personne de votre entourage ne nous voie ni entrer ni sortir. »
La lettre écrite, sir James la fit porter par un commissionnaire de l’hôtel, puis il dit à Smith :
– Trouve-toi ce soir aux Champs-Élysées, au coin de la rue Marignan, vers six heures et demie, et attends-moi.
– J’y serai, répondit Smith.
Et il s’en alla.
Pourtant quand le serrurier fut parti, ses paroles revinrent en mémoire à sir James : « On se moque de vous ! »
Qui donc pourrait se moquer de lui ?
Était-ce Milon ? était-ce cet imbécile de Shoking ?
C’était invraisemblable, d’autant plus que le vol avait été commis à l’heure même où lui, sir James, enlevait l’Irlandaise et son fils.
Le détective eut peur un moment, cependant.
Pendant quelques minutes, il délibéra si, au lieu de s’occuper de cette affaire, il ne partirait pas le soir même pour Londres, emmenant Ralph et miss Ellen.
Il était même décidé à prendre ce dernier parti, lorsque une dépêche lui arriva.
Elle venait de Londres :
« Restez huit jours encore. On instruit procès homme gris. Condamnation certaine, lettre demain.
« PATTERSON. »
Cette dépêche fit réfléchir sir James.
– Après tout, dit-il, je ne puis pas rester ici à ne rien faire. Si on n’avait pas volé Milon, il ne serait pas allé à la Préfecture ; Smith se trompe donc, le voleur dont il parle doit être à Paris.
Et il mit la dépêche dans sa poche et sortit tranquillement pour tuer le temps jusqu’au soir.
Il revint dîner à l’hôtel du Louvre.
Le commissionnaire avait rapporté la réponse de Milon, conçue en trois mots :
« Je vous attendrai ! »
Et sir James demeura résolu à conduire Smith chez Milon.
XXXVII
Environ deux heures après son installation au Grand-Hôtel, ce même jour-là, le détective Edward avait fait, selon l’habitude d’un parfait gentleman, une seconde toilette pour déjeuner, et il s’apprêtait à descendre dans la somptueuse salle à manger de l’établissement, quand deux petits coups discrets furent frappés à sa porte.
Il alla ouvrir et se trouva en présence d’un laquais de fort bonne mine :
– Monsieur, lui dit cet homme, je viens de la part de mon maître.
– Comment le nommez-vous ?
– Monsieur Peytavin.
– Je ne le connais pas, dit Edward.
– Mon maître sait parfaitement qu’il n’est pas connu de monsieur, mais il m’a dit de dire à monsieur qu’il habitait à deux pas d’ici, au numéro 1, rue Auber, qu’il avait trois cents mille livres de rente, et qu’il serait fort heureux de causer avec monsieur pendant dix minutes.
Et le laquais tendit une carte qui portait, en effet, le vrai nom de Marmouset.
Cependant le détective, eut un moment d’hésitation.
– Monsieur, dit encore le laquais, mon maître a ajouté : « Sir Edward ne se doute pas que nous avons un ami commun en Angleterre, et c’est pour avoir des nouvelles de cet ami que je lui serais reconnaissant d’accepter à déjeuner chez moi. »
La rue Auber est une des plus belles rues du Paris actuel ; elle est à deux pas du Grand-Hôtel ; il était midi ; on envoyait à sir Edward un laquais galonné. Tout cela était peut-être un peu mystérieux, mais n’avait rien d’effrayant.
Sir Edward, puisque le laquais lui donnait le titre de baronnet, ne protesta point d’avantage contre l’invitation.
– Je vous suis, dit-il au laquais.
Et il prit son chapeau et son waterproof, et au lieu de descendre à la salle à manger, il sortit du Grand-Hôtel et suivit le laquais.
La maison où demeurait Marmouset était de splendide apparence. Vestibule, escalier en marbre, tapis moelleux sous les pieds, un seul appartement par étage et portes à deux vantaux.
– Qu’est-ce que peut bien me vouloir ce monsieur que je ne connais pas ? se disait Edward en montant l’escalier.
Marmouset habitait l’entre-sol.
Un groom vint ouvrir au coup de sonnette du laquais, et le détective fut introduit dans un appartement qui était digne, par son luxueux mobilier, du luxe extérieur de la maison.
À gauche de l’antichambre, par la porte entr’ouverte, on apercevait la salle à manger meublée en ébène et dans laquelle une table toute servie attestait que le laquais n’avait point menti et qu’on attendait sir Edward à déjeuner.
Le laquais ouvrit une porte en face de la salle à manger et introduisit sir Edward dans le fumoir en disant :
– Monsieur va venir.
Edward entra.
À peine était-il assis qu’une portière se souleva et qu’un gentleman s’offrit à ses regards.
C’était Marmouset.
Le détective ouvrit de grands yeux.
– Vous ne me reconnaissez peut-être pas ? dit Marmouset en riant.
– Mais… attendez… il me semble… balbutia le détective stupéfait.
– Je suis votre commissionnaire de ce matin.
Le détective recula, ahuri.
– Cher monsieur, continua Marmouset, Londres n’a pas le monopole des excentriques, Paris en possède aussi, et j’en suis un.
Les Anglais viennent nous étudier sur place ; je les étudie pareillement.
Il m’a pris fantaisie, ce matin, de jouer le rôle d’un commissionnaire. Il est vrai de vous dire que j’avais fait un pari et que, grâce à vous, je l’ai gagné. Mais je vous conterai tout cela en présence de la personne avec qui j’ai parié et qui est un ami commun.
– Un ami à vous ? fit Edward de plus en plus étonné.
– À moi et à vous.
– Ah !
– Un Anglais…
Comme Marmouset disait cela, la porte s’ouvrit et le laquais annonça :
« Lord Wilmot ! »
Le détective jeta un cri.
Shoking, redevenu lord Wilmot, Shoking, tout de noir vêtu, ayant cravate blanche, gilet en cœur et boutons de diamants à sa chemise, entra avec l’aisance un peu raide d’un lord véritable.
Sir Edward était pâle et s’apercevait qu’on lui avait tendu un piège.
En même temps Marmouset prit sur la tablette de la cheminée un revolver, que le détective n’avait pas aperçu.
– Cher monsieur, dit-il en armant le revolver, cet instrument ne fait aucun bruit ; il est d’invention américaine ; c’est un revolver à vent et il chasse six balles avec autant de vigueur qu’une arme à feu. C’est vous dire que si vous vouliez faire avec nous le moindre tapage, la moindre résistance, nous vous enverrions dans l’autre monde, sans que les domestiques songeassent à quitter l’office, ni le concierge de la maison à interrompre un seul instant la lecture de son journal.
– Mais, monsieur, balbutia le détective, qui cherchait à se donner de l’assurance, si c’est une plaisanterie, elle est médiocre.
– Ce n’est point une plaisanterie, dit Marmouset. Vous connaissez lord Wilmot ?
– Et effet…
– Lord Wilmot m’a prié de le faire déjeuner avec vous.
– Alors pourquoi parlez-vous de… ce revolver ? demanda le détective, qui reprenait peu à peu son sang-froid.
– Pour le cas où vous refuseriez mon invitation.
– Je n’en ai nulle envie.
– Alors déjeunons, dit Marmouset.
Il fit signe à Shoking.
Shoking prit le détective par le bras et lui dit :
– Venez donc, mon cher.
Shoking était vigoureux. Edward ne se fut pas débarrassé facilement de son étreinte.
En outre, Marmouset marchait derrière eux, et le détective avait vu dans son regard qu’il était un homme à lui envoyer deux balles dans le dos, s’il essayait de vouloir se sauver. Enfin le grand laquais s’était placé dans l’antichambre devant la porte.
– Je suis pris comme un renard, pensa Edward, il n’y a pas moyen de résister.
Et il se laissa conduire dans la salle à manger et s’assit de bonne grâce à côté de Shoking et en face de Marmouset, qui plaça son revolver à côté de lui.
Le déjeuner était servi à la russe, et point n’était besoin qu’un domestique demeurât dans la salle à manger.
Marmouset fit un signe au laquais, qui sortit et ferma la porte.
Alors, regardant le détective :
– Nous pouvons causer maintenant, dit-il et jouer cartes sur tables.
Edward le regardait toujours avec égarement.
Marmouset reprit :
– D’un mot je vais vous mettre au courant de la situation.
Vous êtes venu à Paris avec sir James Wood.
Edward ne répondit pas.
– Vous aviez un double but : ramener miss Palmure en Angleterre.
– C’était notre but unique.
Marmouset haussa les épaules.
– Et enlever un enfant irlandais que Shoking…
Shoking fit la grimace.
– Que lord Wilmot, se reprit Marmouset en souriant, avait amené avec lui. Hier vous avez grisé lord Wilmot, et l’enfant a disparu.
Or, écoutez-moi, cher monsieur. Des gens qui, comme nous, en plein midi, rue Auber, à deux pas du boulevard, dans une maison où il y a trente locataires, confisquent un homme comme nous venons de vous confisquer, vont jusqu’au bout, s’il le faut.
Il s’agit pour vous de sortir d’ici avec cent mille francs dans votre poche, ou de passer de cette vie-ci dans l’autre. Choisissez !
Et Marmouset se mit à jouer négligemment avec son revolver.
XXXVIII
Le chiffre de cent mille francs, énoncé par Marmouset, avait produit assez bon effet sur le détective.
Cependant Marmouset ne s’en tint pas à la promesse. Il tira de sa poche un portefeuille, et de ce portefeuille un titre de chèque de la banque anglaise, qu’il mit sous les yeux d’Edward.
Celui-ci se disait :
– Je me suis conduit avec une déplorable légèreté ; mais qu’y faire ? Il est évident que je suis à la merci de ces deux hommes et qu’il va falloir en passer par ce qu’ils voudront.
Quand on joue, comme ils le disent, un pareil jeu, au milieu de Paris civilisé, on est capable d’assassiner un citoyen de la libre Angleterre en plein jour.
Marmouset reprit :
– J’ai calculé que, pour prix de vos deux missions, et en cas de réussite, on vous donnerait la moitié de la somme que je vous propose. Mais je suis assez riche pour ne pas regarder à cinquante mille francs de plus ou de moins.
Un éclair de cupidité brilla dans les yeux du détective.
– À la bonne heure, dit Marmouset avec courtoisie, je vois que vous êtes un homme sans préjugés et que nous allons pouvoir nous entendre.
Nous savons où vit miss Ellen et nous n’avons nul besoin de vous pour la faire sortir de prison. Edward eut un nouveau geste de surprise.
– Mais nous ne savons pas ce qu’est devenu l’enfant.
– Ni moi, dit Edward.
– Ah ! cher monsieur, dit Marmouset, prenez garde ! vous allez brouiller les cartes.
– Je vous jure…
– Ne jurez rien, dit froidement Marmouset, et dites-vous qu’en sortant d’ici vous emporterez un chèque de cent mille francs sur la Banque de Londres.
– Monsieur, répondit le détective Edward, je n’ai rien à vous cacher de ce que je sais, mais je ne puis vous dire, même en présence d’une menace de mort, ce que je ne sais pas.
Marmouset haussa les épaules.
Edward continua :
– Sir James a emmené la mère et l’enfant, tandis que je grisais lord Wilmot.
– Mais vous avez revu sir James le soir ?
– Sans doute.
– Et il ne vous a pas dit ce qu’il avait fait d’eux ?
– Il les avait mis en sûreté.
– Où ?
– Dans un quartier éloigné, sous la garde d’un charbonnier nommé Chapparot.
– Et vous ne savez pas le nom du quartier ?
– Non.
– Ni celui de la rue ?
– Pas davantage.
– Mon cher monsieur, dit Marmouset avec calme, regardez la pendule : il est midi vingt-cinq minutes ; si, à midi et demie, je ne sais pas où est l’enfant, je vous loge une balle entre les deux yeux.
Edward avait la sueur au front, et il était pâle.
– Monsieur, dit-il, je suis avec sir James sur un pied d’infériorité. J’ai une partie de ses secrets, mais je ne les ai pas tous.
– Ah !
– Je vous jure qu’il ne m’a pas dit où il avait mis l’enfant.
– Vous n’avez plus que trois minutes, dit Marmouset, qui jouait avec le cylindre du revolver avec un calme effrayant.
– Mais, reprit sir Edward, je vais vous dire un secret sur sir James qui vous prouvera ma sincérité, et dont la possession le mettra en vos mains pieds et poings liés.
Marmouset commençait à croire à cette sincérité dont parlait le détective.
Il était près de midi et demie, et il était évident que si cet homme ne disait pas où était l’enfant, c’est qu’il ne le savait pas.
– Parlez, dit Marmouset, je vous donne quelques minutes encore.
– Sir James, reprit Edward, ne s’est emparé de la mère et de l’enfant ni par les menaces ni par la violence.
– Comment donc a-t-il fait ?
– Il les a simplement priés de le suivre.
– Et ils l’ont suivi ?
– Tout naturellement.
– C’est impossible ! s’écria Shoking. Jenny savait que nous étions entourés d’ennemis et elle se défiait.
– Oui, mais elle ne pouvait se défier d’un frère.
– Hein ? dit Marmouset.
– D’un homme affilié comme elle aux fénians.
– Que voulez-vous dire ? s’écria Shoking.
– La vérité, dit Edward. Sir James est un fénian vendu à l’Angleterre, et c’est avec le signe maçonnique de la grande famille irlandaise qu’il a surpris la bonne foi de Jenny.
– Est-ce là votre secret ?
– Oui.
Marmouset demeura pensif un moment :
– Il est évident, dit-il enfin, que du moment où vous m’avez fait semblable révélation sur sir James Wood, et, à moins que vous ne m’ayez menti, vous ne pouvez plus espérer avoir avec lui des relations amicales.
– Je ne suis pas un ami de sir James Wood, dit Edward, je suis détective comme lui, avec cette différence qu’il est attaché à la police politique, et que moi je ne m’occupe indirectement que d’affaires particulières. Sir James me payait, vous me payez plus cher, je vais là où me conduit mon intérêt. Je vous en ai trop dit maintenant pour ne pas vous servir, je ne sais pas où est l’enfant, mais je le saurai.
Marmouset se reprit à sourire.
– Non, monsieur, dit-il, je n’ai aucune raison pour ne pas croire à votre sincérité, mais j’ai l’habitude de faire mes affaires tout seul.
Vous avez pu en juger ce matin.
Donc, vous me permettrez de prendre mes petites précautions et de vérifier l’exactitude de vos assertions.
– Rien ne vous sera plus facile, dit Edward.
– Oui, à la condition que vous resterez ici.
– Je le veux bien.
– Alors déjeunons et nous verrons après.
Et Marmouset remit son pistolet dans sa poche.
Puis il sonna et demanda de l’encre et une plume.
– Je vais toujours vous donner votre chèque, dit-il.
Et de sa plus belle écriture, Marmouset inscrivit le chiffre de cent mille francs en toutes lettres, signa, détacha le chèque, et nota sur la souche le nom d’Edward et la somme.
Puis, cela fait, il demanda le café.
Toute cette scène avait eu lieu sans bruit, sans esclandre, avec une parfaite courtoisie.
Le café pris, et le chèque passé des mains de Marmouset dans celles du détective, l’élève de Rocambole lui dit :
– Maintenant, veuillez me suivre.
Edward obéit.
Ils passèrent de la salle à manger dans le fumoir et de cette seconde pièce dans une troisième, qui était le cabinet de toilette du jeune homme.
Elle prenait le jour par en haut, et n’avait pas d’autre fenêtre.
– Cher monsieur, dit alors Marmouset, je vais vous laisser ici à la garde de votre ami lord Wilmot et d’une autre personne. Vous êtes mon prisonnier jusqu’à l’heure où j’aurai retrouvé l’enfant et délivré miss Ellen.
Je me connais assez en hommes pour avoir la presque certitude que vous m’avez dit la vérité ; néanmoins, comme il pourrait se faire que vous eussiez cherché à gagner du temps et à m’enfoncer, – pardon du mot, – vous trouverez bon que je prenne mes précautions.
– Faites tout ce que vous voudrez, dit Edward avec tranquillité.
Marmouset appela le laquais qui était allé chercher Edward au Grand-Hôtel.
C’était un robuste gaillard qui eût assommé le détective à coups de poings.
– Tu vois monsieur ? dit Marmouset.
Le laquais s’inclina.
– Si monsieur essaye de sortir d’ici, tu prendras les embrasses des rideaux et tu lui attacheras les pieds et les mains.
– Bon ! fit le laquais.
– S’il crie, tu lui enfonceras un mouchoir dans la bouche et tu le bâillonneras.
Le laquais fit encore un signe affirmatif.
– Je vous ai dit la vérité, dit Edward en souriant, et vous en aurez la preuve.
– Je vais la chercher, répliqua Marmouset.
Et il sortit, laissant à la garde de Shoking et du laquais le détective, qui caressait du bout des doigts, au fond de sa poche, le chèque qui représentait une fortune pour lui.
XXXIX
À six heures du soir, sir James Wood revenait du rendez-vous qu’il avait donné à Smith, dit le Serrurier.
Celui-ci se promenait de long en large à l’entrée de la rue de Marignan.
Il était venu à pied.
Sir James arriva en voiture.
Comme la voiture s’arrêtait, Smith s’approcha.
– Patron, dit-il, est-ce que vous êtes bien pressé ?
– Pourquoi ? demanda sir James.
– Parce que j’aurais voulu causer un brin auparavant.
– Monte, dit sir James, le cocher attendra, pour repartir, que nous lui fassions signe.
Smith monta dans le fiacre, qui demeura stationnaire.
– Voyons ? fit sir James, qu’as-tu à me dire ?
– John, le seul homme qui, après moi, puisse ouvrir sans la forcer une caisse de fabrique anglaise, n’est pas à Paris.
– Oui, tu m’as dit cela ce matin.
– J’en ai la preuve ce soir.
– Comment ?
– J’ai lu dans le Times que John avait été arrêté à Londres et qu’il était en ce moment à Newgate, où il attendait les prochaines assises.
– Est-ce tout ce que tu as à me dire ?
– Oui, patron.
– Eh bien ! allons, en ce cas.
– À votre place, je n’en ferais rien…
– Bah ! fit sir James.
– Je vous assure qu’on se moque de vous.
Sir James Wood haussa les épaules.
– Qu’ai-je à craindre ? dit-il, je suis un délégué de la police anglaise, un citoyen de la Grande-Bretagne : j’ai en poche une lettre de mon ambassadeur…
Smith sifflota entre ses dents.
Sir James ajouta :
– Je me suis trop avancé, du reste, pour reculer.
Et baissant une des glaces, il donna au cocher le numéro de la maison de Milon.
La maison, comme la rue, à cette heure tardive, était silencieuse et plongée dans une demi-obscurité.
Les Champs-Élysées, bruyants le jour, pleins de vie et de lumière, sont déserts le soir, en hiver surtout.
À la porte, Smith dit encore :
– À votre place, je m’en irais sans sonner.
– Tu es fou, dit sir James.
Et, descendant de voiture, il saisit le bouton de cuivre du timbre.
La porte s’ouvrit aussitôt, et derrière, un flambeau à la main apparut Milon.
Le colosse avait sa physionomie la plus naïve et la plus ingénue.
Sir James, en le voyant, regarda Smith d’un air qui voulait dire :
– Es-tu simple ? ne vois-tu pas que ce brave homme n’est occupé que de son argent ?
Milon dit, après avoir salué le détective.
– Je vous attendais, monsieur, avec une certaine impatience.
– Vraiment ? dit sir James.
– Figurez-vous qu’un de mes contremaîtres sort d’ici.
– Ah !
– Et il m’a juré avoir aperçu dans une voiture de maître revenant du Bois l’homme qui m’a volé.
– Ne serait-ce pas monsieur ? dit sir James.
Et il montra Smith, qui fit un geste de surprise.
– Oh ! non, dit Milon en souriant, il n’y a même pas la moindre ressemblance.
– Vous êtes seul ?
– Tout seul, j’ai envoyé ma bonne se coucher.
Sir James eut un geste de satisfaction.
Milon reprit :
– J’attendais cependant trois personnes ce soir, un pauvre diable, sa femme et son enfant, mais ils ne sont pas venus.
– Pourquoi ? demanda flegmatiquement le détective.
– Ils auront peut-être remis à demain.
– Bon ! pensa sir James, il ne sait rien de l’enlèvement de Ralph.
En échangeant ces quelques mots, ils étaient entrés dans le vestibule et Milon avait refermé la porte.
– Ne vous étonnez pas, reprit sir James, que je vous aie demandé à être seul. Nous autres gens de police anglais, nous procédons toujours avec un certain mystère et nous nous trouvons très bien de cette habitude.
– Chacun doit savoir son métier, répondit Milon avec un gros rire ; moi, je sais bâtir des maisons ; vous, vous savez retrouver les voleurs.
– Je vous amène, dit sir James, un de mes collègues qui, à la simple inspection de votre caisse, nous dira comment on a pu l’ouvrir.
– Je vais vous la montrer, dit Milon.
Et il se dirigea vers l’escalier.
Sir James et Smith le suivirent, et celui-ci dit en anglais :
– Je commence à ne plus rien comprendre à tout ce que vous m’avez dit.
Milon ne se retourna pas. Ils montaient.
Arrivés au premier étage, le colosse fit traverser son bureau à ses visiteurs nocturnes, puis il les introduisit dans cette pièce où se trouvait la caisse.
Le placard était ouvert et la caisse aussi.
– Vous pensez, dit Milon, que j’ai voulu laisser les choses dans leur état primitif.
Sir James fit un signe de tête approbateur.
– Seulement j’ai déménagé mon argent ailleurs.
Smith lui prit le flambeau des mains, et se mit à examiner la caisse.
– Donnez-moi la clef, dit-il.
Milon prit la clef, à son cou et la tendit au pickpocket.
Celui-ci la mit dans la serrure.
– Sur quelles lettres fermiez-vous ? demanda Smith.
– U, x, s et c, répondit Milon.
Smith fit jouer la clef. Il ferma la caisse, il la rouvrit ; puis, hochant la tête :
– C’est incompréhensible, dit-il.
– Comment cela ? dit naïvement Milon.
Smith le regarda.
– Vous ne seriez pas somnambule, par hasard ?
– Pas que je sache, dit Milon.
– Je le croirais volontiers, cependant.
– Par exemple !
– Votre caisse n’a pu être ouverte qu’avec votre propre clef.
– Je ne la quitte ni jour ni nuit.
– Alors, vous avez eu une nuit de somnambulisme et vous vous êtes volé vous-même.
Milon eut un geste de dénégation.
– Ou bien, dit froidement Smith, vous vous moquez de nous ?
Mais comme il disait cela, Smith entendit un léger bruit derrière lui.
Sir James, qui l’entendit pareillement, se retourna vivement.
La porte venait de s’ouvrir, et un homme, que sir James reconnut sur-le-champ, entra d’un pas tranquille.
Cet homme, c’était le commissionnaire qui, le matin, s’était emparé de la valise d’Edward à l’hôtel du Louvre. Seulement il avait changé de toilette et était mis comme un gentleman.
Alors sir James pâlit légèrement et devina que Smith avait raison tout à l’heure en disant qu’ils étaient tombés dans un piège.
Marmouset regarda sir James en souriant et lui dit :
– La police anglaise a une grande réputation, cher monsieur, mais j’ai bien peur qu’elle ne la perde aujourd’hui.
Et, Marmouset s’effaçant, sir James aperçut derrière lui trois autres personnages : Jean le Boucher, la Mort des Braves et Shoking !
Shoking souriait pareillement et disait :
– À nous deux, voleur d’enfant !…
XL
Sir James Wood, Irlandais doublé d’Américain, était un homme froidement audacieux.
D’un coup d’œil il avait jugé la situation.
La caisse forcée était un piège qu’on lui avait habilement tendu.
Marmouset, son commissionnaire du matin, vêtu en gentleman le soir, Shoking, Milon et les deux autres personnages qui apparaissaient derrière eux, étaient ces amis mystérieux vers lesquels l’homme gris avait tourné les yeux du fond de sa prison.
Le message confié à Miss Ellen était parvenu à son adresse.
Comment ?
Sir James Wood ne chercha point à le savoir, il n’avait pas le temps de raisonner ; il lui fallait tenir tête à l’orage, et l’orage, il le sentait, était menaçant.
Pourtant son visage demeura impassible, pas un muscle ne tressaillit, pas un geste d’effroi ne lui échappa.
Il eut même aux lèvres un demi-sourire et parut chercher des yeux quel était le chef de cette petite coalition.
Marmouset ne lui laissa pas cette peine longtemps.
– Sir James Wood, dit-il, vous êtes trop intelligent pour ne pas comprendre.
Sir James fit un geste de tête.
– Vous êtes en notre pouvoir, continua Marmouset.
Smith jetait autour de lui des regards effarés.
Sir James lui fit un signe qui voulait dire :
– Ne crains rien, nous nous en tirerons.
Marmouset reprit :
– Nous sommes dans un quartier désert. Les fenêtres de cette maison donnent sur un jardin ; vainement essayeriez-vous de crier, on ne viendrait pas à votre secours.
– Je ne sais, dit sir James.
Et il ne manifestait aucune émotion.
– Vous devinez, n’est-ce pas ? poursuivit Marmouset, ce que nous attendons de vous.
– Je ne devine jamais rien, répondit le détective.
– Bien. Alors nous allons vous aider.
– Comme il vous plaira.
– Vous vous étiez constitué le gardien de miss Ellen Palmure ?
– Parfaitement.
– Et pourtant elle a disparu. Qu’en avez-vous fait ?
– C’est mon secret.
– Le hasard m’ayant appris où elle était, dit Marmouset, je ne vous ferai pas de querelle à son endroit.
– Puisque vous le savez, il est parfaitement inutile de me le demander.
– Vous avez conduit miss Ellen dans une maison de fous d’abord. Puis vous avez demandé à Londres de nouvelles instructions, que vous avez portées à la préfecture de police, et là, le chef de la sûreté, pressé par l’ambassade d’une part, fort, d’autre part, du consentement que lord Palmure envoyait par écrit, a ordonné qu’elle serait transférée à Saint-Lazare.
– Tout cela est exact, dit sir James.
– Mais, dit Marmouset, il vous suffit d’écrire un mot, et miss Ellen sera relâchée.
– Ces mots, je ne les écrirai pas, dit sir James.
– En vérité !
– Je ne me fais pas d’illusions, poursuivit le détective. Vous ne m’avez pas attiré ici pour me laisser aller librement ensuite. Il est même possible que vous m’assassiniez. Seulement, je dois vous prévenir que je serai vengé.
– Ah ! dit Marmouset avec un sourire.
– Vous pensez bien, continua sir James en désignant Milon, que ce matin, en voyant monsieur dans le cabinet du chef de la sûreté, j’ai deviné.
Monsieur était l’homme que cherchait miss Ellen, et je n’ai pas cru au vol un seul instant.
– Ah ! ah !
– Je suis venu en France muni de pouvoirs réguliers, et la police française me doit aide et protection. Le chef de la sûreté est donc prévenu.
Trois agents sont embusqués au coin des Champs-Élysées, trois autres à l’autre bout de la rue, ils m’ont vu entrer ici. Maintenant, si vous voulez m’assassiner, dit froidement sir James, hâtez-vous, car dans un quart d’heure ils viendront à mon aide et me redemanderont mort ou vif.
Milon eut un geste d’inquiétude.
Mais Marmouset se prit à rire :
– Vous êtes un homme de sang-froid, sir James, dit-il, et vous avez imaginé habilement ce petit roman ; car c’est un roman…
– Vous croyez ?
– Je le crois et le prouve.
– Voyons ?
– Vous êtes sorti ce matin avec Milon de chez le chef de la sûreté.
– Cela est vrai.
– Vous n’avez donc pas pu lui communiquer vos soupçons. D’ailleurs, vous n’aviez pas de soupçons.
– J’ai revu le chef de la sûreté dans la journée.
– Non, sir James, car je vous ai fait suivre et je vais vous dire l’emploi de votre temps depuis ce matin.
– Vous me ferez plaisir, ricana sir James.
Mais Marmouset reprit :
– Nous n’avons pas le temps de nous amuser à des niaiseries. J’ai un moyen de faire sortir miss Ellen de Saint-Lazare. Laissons donc miss Ellen et parlons de l’Irlandaise Jenny et de son fils.
Nous ne savons ce que vous en avez fait, sir James, et il faut nous le dire.
Sir James haussa les épaules.
– Vous ne le saurez pas, dit-il.
– Bah ! reprit Marmouset, nous savons bien des choses déjà. D’abord celle-ci : vous êtes fenian apostat, vendu à l’Angleterre.
Cette fois, sir James perdit un peu de son assurance, et on le vit légèrement pâlir.
– Or, poursuivit Marmouset, vous savez quel sort épouvantable est réservé au fenian qui trahit ses frères. Les lois mystérieuses qui régissent l’association disent ceci : « Le frère qui aura trahi sera poursuivi et amené devant un tribunal qui le condamnera à mort. On commencera par lui couper la langue, puis les mains et les pieds, et on lui crèvera les yeux ; puis, on le laissera mourir de faim. » Est-ce cela, sir James ?
Très exactement, dit le détective.
– Or, poursuivit Marmouset, nous avons les moyens de vous envoyer en Irlande, comme un colis de messageries, et de vous livrer à ceux que vous avez trahis. Refuserez-vous encore de nous dire où est l’Irlandaise et son enfant !
– Je refuse, dit sir James, et je refuse parce que la conséquence de ma trahison, conséquence logique et bien humaine, vous en conviendrez, est une haine violente pour mes anciens amis.
– Vous êtes un homme bien trempé, sir James. Mais peut-être nous passerons-nous encore de vous, car nous savons un nom : Chapparot.
– Sir James tressaillit, et Marmouset le remarqua.
– Chapparot ! s’écria Jean le Boucher ; je le connais ! c’est un charbonnier. Si c’est lui ?…
Sir James avait retrouvé son impassibilité première, mais pas assez vite pour que Marmouset n’eût saisi l’émotion imperceptible qu’il avait éprouvée.
Et se tournant vers ses compagnons, Marmouset leur dit :
– Nous allons causer là-bas ; venez. Sir James, voici votre prison.
Et ils se dirigèrent vers la porte.
Sir James et Smith ne bougèrent.
– Ils croient m’effrayer, dit sir James quand la porte se fut refermée, mais ils n’y parviendront pas.
– En attendant, nous sommes prisonniers… dit Smith.
Et il montra les fenêtres cadenassées.
– Qu’est-ce que cela pour toi ? N’as-tu pas tes outils ?
– Pardine !
Mais comme Smith disait cela, il trébucha et jeta un cri.
– Hein ? fit sir James.
Et il trébucha à son tour.
Alors ces deux hommes de sang-froid jusqu’alors, se regardèrent avec une mystérieuse épouvante.
Le parquet, machiné sans doute dans la journée comme un plancher de théâtre, descendait lentement sous eux, grâce à un ressort qu’on avait fait mouvoir dans la pièce voisine.
Le sol descendait, et les fenêtres, les portes semblaient monter lentement au fur et à mesure.
Et le sol descendait toujours, et sir James et Smith, le serrurier comprirent avec terreur qu’ils allaient s’abîmer dans quelque profondeur inconnue…
XLI
Tandis que sir James Wood et Smith, dit le Serrurier, se trouvaient au pouvoir de Marmouset et des autres amis de l’homme gris, d’autres événements s’étaient accomplis dans le passage des Amandiers, où le détective après avoir noyé la mère, avait laissé l’enfant prisonnier à la garde du charbonnier Chapparot.
La citerne dont le farouche Auvergnat avait fait un instrument de mort mérite une description toute particulière, comme on va voir.
Le passage des Amandiers, dans lequel on entre par la rue du même nom, forme un coude et ses maisons du côté gauche se trouvent adossées aux maisons de la rue.
Entre les maisons de la rue et celle du passage, il y a plusieurs cours communes.
La citerne dont nous parlons était dans le même cas.
Autrefois un tonnelier avait habité la maison du côté du passage, et cette citerne lui servait à faire tremper ses douves et ses cercles.
Du côté de la rue il y avait eu un charron qui se servait de la citerne dans un but à peu près semblable.
Charron et tonnelier avaient, chacun de son côté, leur puisard particulier.
Mais quand on avait démoli l’abattoir Popincourt, le charron, pour qui les bouchers étaient une forte clientèle, avait donné congé et il était allé s’établir aux nouvelles barrières.
Le tonnelier était mort, et la citerne était demeurée sans autre destination que celle du réservoir où s’accumulaient tout l’hiver les eaux pluviales.
Chapparot avait loué la cour dans laquelle se trouvait un des deux puisards et comme il savait que la boutique du charron était inoccupée, il n’avait pas hésité à disposer une planche en bascule pour que la malheureuse Irlandaise s’y noyât.
Mais la Providence, que l’on s’obstine à nier, veille sans cesse sur les faibles et les protège contre les forts.
Chapparot et sir James avaient entendu un cri terrible au moment où la planche basculait sous les pieds de Jenny, puis quelques gémissements étouffés, un clapotement de quelques minutes, puis rien…
Cependant Jenny ne s’était pas noyée.
La nature met au cœur des mères une énergie sans égale.
Après avoir fait un plongeon, Jenny remonta à la surface, et ses vêtements arrondis comme une ceinture de sauvetage, l’y soutinrent.
Et Jenny ne cria pas, n’appela pas au secours ; elle écouta.
Elle entendit la voix de son fils disant :
– Maman ! rendez-moi maman !
Puis son fils ne dit plus rien et sir James Wood eut un éclat de rire.
Ce fut rapide comme l’éclair, instantané comme une décharge électrique. Jenny comprit tout.
On avait voulu la noyer pour s’emparer de son fils, et si elle bougeait, un de ces deux hommes descendrait dans la citerne pour l’achever.
Ce n’était pourtant pas l’amour de la vie qui réduisait Jenny au silence.
Mais elle songeait à son fils ; et comme l’espérance ne meurt qu’avec la vie, Jenny se rappela que déjà, on l’avait séparée de son enfant et que, cependant, son enfant lui avait été rendu.
L’eau était glacée, l’atmosphère fétide et asphyxiante.
Jenny eut cependant l’héroïsme de ne pas faire un mouvement.
Ses vêtements s’imprégnaient d’eau et s’alourdissaient peu à peu.
Jenny sentait qu’elle s’enfonçait par degrés.
Comme toutes les filles de pêcheurs, elle savait nager, elle aurait donc pu se soutenir plus longtemps ; mais ses bourreaux qu’elle sentait marcher au-dessus de sa tête l’eussent entendue.
Cela dura trois minutes peut-être, mais ces trois minutes furent un siècle d’agonie.
Enfin Chapparot et sir James Wood s’éloignèrent.
Alors l’amour maternel et l’instinct de la conversation se réunirent chez l’Irlandaise et amenèrent un suprême effort.
Elle se mit à nager vigoureusement.
Était-elle dans un puits ou dans un canal ? elle ne le savait pas, car d’épaisses ténèbres l’enveloppaient.
Ses mains étendues rencontrèrent un mur ; elle se tourna d’un autre côté et se remit à nager.
Tout à coup il lui sembla que l’obscurité était moins grande et qu’un faible rayon de clarté brillait devant elle.
Elle nagea encore et se trouva dans le deuxième puisard, celui du charron.
Celui-là était couvert avec des planches comme l’autre, mais il se trouvait dans la boutique, même et non pas dans une cave.
La boutique était vide, les portes en étaient fermées, mais au-dessus des portes il y avait une imposte vitrée qui laissait passer la clarté du jour, et ce jour, arrivant jusqu’aux planches mal jointes qui recouvraient le puisard, laissait tomber un dernier rayon au travers sur l’eau dormante de la citerne.
Et Jenny, levant la tête, vit le jour, et l’espoir lui revint au cœur, plus tenace, et ses forces épuisées se ranimèrent. Elle nageait sur place, de façon à se soutenir le plus longtemps possible.
Peu à peu ses yeux se faisaient à l’obscurité, et elle était parvenue à mesurer du regard, grâce au faible rayon de lumière, la distance qui séparait le niveau de l’eau de la voûte de la citerne.
Puis elle fit tout le tour de la citerne, promenant une de ses mains sur les parois lisses et dépourvues de la moindre aspérité.
Et pendant cette recherche infructueuse, la malheureuse, alourdie par ses vêtements qui, moyen de salut d’abord, allaient finir par l’entraîner au fond de l’eau, sentait ses forces la trahir insensiblement.
Mais comme elle luttait en désespérée contre cette mort lente et qui semblait inévitable, elle se heurta à un corps dur qui parut fixe devant elle.
Elle étendit de nouveau ses mains et saisit une planche, une vieille planche pourrie qui flottait sur l’eau.
Et elle s’y cramponna, comme le matelot naufragé se cramponne à une épave de son navire brisé.
Tout à coup elle perçut un bruit au-dessus de sa tête, le bruit d’une porte qu’on ouvre.
Jenny, couchée sur la planche, crut un moment que c’était sir James et le charbonnier qui revenaient ; mais elle entendit presque aussitôt une voix jeune et sonore qui chantait le Pied qui remue, cette délicieuse fantaisie si poétique qui a longtemps abruti les Parisiens.
Un homme était entré dans la boutique du charron, et cet homme, Jenny ne s’y trompa point, n’était ni Chapparot, ni sir James.
Et alors l’Irlandaise épuisée se mit à crier.
Soudain la voix se tut, et le Pied qui remue ne remua plus du tout.
Jenny cria de plus belle.
Alors les planches qui recouvraient le puisard furent soulevées et une tête d’homme apparut à la pauvre Irlandaise, en même temps que le jour descendait à flots dans la citerne.
Le hasard lui envoyait un libérateur !…
Quel était-il ?
C’est ce que nous allons dire…
XLII
La maison dont le charron avait habité le rez-de-chaussée et qui avait déjà la citerne commune avec celle du passage, avait, en outre des jours de souffrance qui s’ouvraient sur la cour de Chapparot, trois ou quatre petites meurtrières grillées qui donnaient de la clarté dans l’escalier.
Chapparot, qui savait que cette maison était, comme la sienne, à peu près déserte pendant la journée, ne se méfiait nullement de ces petites lucarnes.
D’ailleurs, il ne savait pas qu’au dernier étage l’escalier finissait par une sorte d’échelle de meunier, conduisant à un grenier, et que la meurtrière la plus élevée servait de croisée à ce grenier.
Or, il y avait précisément dans ledit grenier un type assez curieux et dont Chapparot aurait dû se méfier.
C’était un jeune homme, un véritable gamin de Paris, nommé Polyte.
Polyte avait été singe d’imprimerie à huit ans, apprenti menuisier à douze, machiniste de théâtre à quinze, puis chanteur de café-concert, puis comédien de banlieue et, en dernier lieu, secrétaire du commissaire de police de Belleville.
Comme on va le voir, il avait fait tous les métiers et n’avait réussi à rien.
Le commissaire de police, son dernier patron, l’avait trouvé trop artiste, et le directeur du théâtre de Mont-rouge lui avait dit :
– Mon garçon, vous ne ferez jamais un comédien !
Au café-concert, où il avait chanté le Pied qui remue, on l’avait sifflé.
Le menuisier qui l’avait recueilli à sa sortie de l’imprimerie l’avait mis à la porte avec une correction autre que des taloches.
Enfin, dans l’imprimerie où il avait fait ses débuts, on l’envoyait chercher le feuilleton de l’auteur en vogue, et Polydore ne revenait pas et perdait le feuilleton en route.
Malgré tout cela, Polydore avait fait son chemin ; il cultivait le calembour, était lié avec tous les cabotins du boulevard Eugène, comme on dit au faubourg, tournait souvent la tête à une figurante, achetait ses habits au Temple et avait, pour nous servir de l’expression populaire, ses hauts et ses bas.
Pour le moment, Polyte était dans la débine et il était venu loger chez sa mère, qui était en ce moment portière de la maison jadis habitée par le charron.
Polyte avait entendu raconter l’histoire nébuleuse du charbonnier Chapparot, qu’on accusait d’avoir assassiné sa femme.
Et comme Polyte n’avait rien à faire, il s’était dit :
– Je vais faire de la police pour mon compte et travailler le charbonnier.
Fumant sa pipe, chantant le Pied qui remue, il s’était établi dans ce grenier, dont la fenêtre donnait sur la petite cour du charbonnier.
Celui-ci, de temps en temps, traversait cette cour.
Alors Polyte cessait de chanter, puis à l’aide d’un morceau de glace cassée, qu’il posait incliné au bord de sa fenêtre, il regardait tous à son aise l’Auvergnat, sans être vu de lui.
L’homme qui se croit seul laisse tomber le masque d’hypocrisie qu’il met ordinairement sur sa figure quand on le regarde.
Chapparot, persuadé que nul ne le voyait, laissait reprendre à sa physionomie son aspect farouche et sombre.
– Il marque mal, pensait l’ancien secrétaire du commissaire de police.
Et il continuait à l’épier.
Il avait découvert le cabaret où Chapparot s’en allait le soir manger un peu de pain et de fromage et boire une chopine pour son souper.
Polyte s’en fit l’habitué.
Chose bizarre ! le charbonnier ne le connaissait pas, et ne l’avait même jamais vu.
Aussi le coudoya-t-il plusieurs soirs de suite dans la salle basse du marchand de vin sans faire attention à lui.
Et le soir où sir James vint causer avec Chapparot, Polyte était dans le cabaret.
L’intimité du grossier Auvergnat et du gentleman lui parut louche.
Jusque-là Polyte s’était simplement amusé.
Maintenant, il flairait une affaire.
L’affaire, comme on va le voir, était bien simple.
Polyte s’était dit :
– Le commissaire m’a renvoyé parce que j’étais feignant. Je ne le blâme pas, car il avait raison ; mais si, un matin, j’allais le trouver et lui disais : J’ai découvert un joli petit crime, et je viens vous prier de faire valoir mes droits à une petite prime que la préfecture accorde volontiers en pareil cas, il serait enchanté de me rendre ce service, car au fond il m’aimait assez et me trouvait une jolie voix.
Chacun son faible, et un commissaire de police a bien le droit d’aimer la musique.
Or, pour Polyte, un homme aussi mal famé que Chapparot, causant avec un monsieur comme sir James, c’était l’indice d’un crime commis ou à commettre.
Et, à partir de ce moment, Polyte ne quitta plus le charbonnier des yeux.
Dans la nuit qui suivit l’entretien, il demeura tantôt collé à la grille de la meurtrière qui donnait sur la cour, tantôt hissé jusqu’à une autre fenêtre en tabatière du grenier, qui avait vue sur l’esplanade des anciens abattoirs.
La nuit s’écoula, puis la matinée.
Polyte s’en alla flâner dans le passage, où il y avait une boutique de blanchisseuses, et, tout en ayant l’air de lorgner ces demoiselles, il ne perdit pas de vue le charbonnier et crut remarquer que celui-ci éprouvait une sorte d’inquiétude vague et que ses regards se tournaient sans cesse vers l’entrée du passage.
Polyte remonta à son observatoire et se mit à la tabatière.
Vers trois heures, il vit un fiacre s’arrêter à l’angle de l’avenue Parmentier et de la rue du Chemin-Vert. Puis, trois personnes en descendirent.
Polyte reconnut le gentleman qui avait eu un mystérieux entretien avec Chapparot.
La femme et l’enfant lui étaient inconnus.
Comme tous trois entraient dans le passage, Polyte fit volte-face.
Il quitta la tabatière et revint à la fenêtre grillée qui donnait sur la petite cour.
Puis, les yeux fixés sur son morceau de glace cassée, il attendit.
La porte de la boutique du charbonnier qui s’ouvrait sur la cour s’ouvrit, et Polyte vit Chapparot la traverser, suivi du gentleman, de la femme et de l’enfant.
– Tout cela est bien drôle ! se dit-il.
Puis il eut un souvenir et une inspiration.
Ce souvenir était celui-ci.
Quand il était gamin, il jouait avec les enfants du charron, et il avait souvent remarqué la sonorité de la citerne, dont les parois formaient écho et renvoyaient distinctement au charron le bruit et la voix du tonnelier qui chantait, dans la cave, en cerclant ses tonneaux.
Et ce souvenir amena l’inspiration et conduisit Polyte à se dire :
– Ils sont dans la cave, je vais pouvoir écouter ce qu’ils disent.
Alors le gamin sortit de son grenier, et, à cheval sur la rampe, se laissa glisser jusqu’en bas.
Sa mère était sortie, et il n’y avait personne dans la loge.
La boutique était à louer, et elle avait une petite porte donnant sur l’allée de la maison, et dont la clef demeurait chez le concierge.
Polyte s’empara de cette clef.
C’était plus fort que lui, même en faisant de la police, Polyte chantait le Pied qui remue.
Mais cette fois ce fut à dessein.
– S’ils sont dans la cave, se dit-il, ils m’entendront chanter, et s’ils méditent un mauvais coup, ils n’oseront pas l’accomplir.
Seulement, Polyte n’avait pas calculé que le mauvais coup s’était fait tandis qu’il se rendait à son grenier, et lorsqu’il arriva dans la boutique, sir James et le charbonnier avaient déjà quitté le théâtre de leurs exploits sinistres.
Mais Polyte entendit les cris de Jenny qui se décidait à appeler au secours.
Et alors il se pencha sur les planches qui recouvraient la citerne, les souleva et plongea un regard investigateur dans les profondeurs ténébreuses de ce cloaque.
XLIII
Les forces de Jenny commençaient à s’épuiser ; mais l’apparition de cette tête d’homme penchée sur l’orifice de la citerne lui rendit le courage et l’espoir.
Jenny ne savait que quelques mots de français.
Cependant elle articula nettement un sauvez-moi ! que Polyte entendit fort bien.
– Soutenez-vous une minute encore, répondit Polyte.
Et il disparut.
Jenny comprit qu’il allait chercher du secours.
Le secours n’était pas loin, du reste, et il consistait en un objet matériel.
Cet objet était une longue échelle qui se trouvait rangée contre le mur dans l’escalier.
D’un coup d’œil Polyte jugea qu’elle serait assez longue.
Et, la chargeant sur son épaule, il revint dans la boutique et la plongea dans la citerne.
L’échelle toucha le fond et ressortit encore dans la boutique d’environ trois pieds.
Alors Polyte descendit.
Déjà Jenny s’était cramponnée à l’échelle libératrice, mais ces vêtements étaient si lourds, ses forces si épuisées, qu’elle n’aurait pu parvenir à remonter toute seule, si Polyte ne l’avait prise à bras le corps.
Polyte était à la fois un mauvais sujet et un bon garçon ; en ce moment, il oublia Chapparot, et le commissaire, et son petit plan machiavélique.
Il ne vit devant lui qu’une pauvre créature épuisée, mourante, qui réclamait tous ses soins.
Et il la transporta dans sa loge.
Sa mère, une vraie portière, bavardait sans doute dans le voisinage et ne se pressait pas de rentrer.
Mais Polyte n’y songea pas un instant.
Il se hâta de déshabiller Jenny, de la pousser auprès du feu et de lui jeter sur les épaules les couvertures du lit de sa mère.
L’Irlandaise grelottait, mais elle ne pensait guère à elle, la malheureuse ! et murmurait le nom de son fils en se tordant les mains de désespoir.
Polyte comprit ; et, à tout hasard, pour la rassurer, il lui dit :
– Ne craignez rien, votre fils n’est pas en danger ; d’ailleurs, je le sauverai, comme je vous ai sauvée !…
Jenny n’avait pas redouté un seul instant, du reste, qu’on tuât l’enfant. Elle savait trop quel prix lord Palmure, son mortel ennemi, attachait à son existence et quels efforts il avait faits pour s’en emparer.
Ces paroles dites au hasard par Polyte et plus encore la pantomime expressive du jeune homme lui rendirent donc un peu de calme.
En même temps Polyte commençait à réfléchir.
– Ma mère va revenir, pensait-il, et si elle trouve cette femme ici, ce seront des si et des mais et des questions qui n’en finiront plus ; et dans une heure tout le quartier saura l’aventure. Il faut que je l’emmène hors d’ici.
Alors Polyte songea à son grenier.
Et, prenant la main de Jenny, il lui dit :
– Si vous ne voulez pas qu’il arrive malheur à votre enfant, suivez-moi !
Elle se leva docile.
Alors il fit un paquet des vêtements qu’elle avait quittés et les poussa sous le lit.
La loge était sombre, et il était probable que la portière ne s’apercevrait pas de ce remue-ménage.
Polyte remit, du reste, un peu d’ordre dans le coucher.
Puis, cela fait, il prit l’Irlandaise par la main et la conduisit à son grenier.
Dans l’escalier, ils ne rencontrèrent personne.
Une fois dans le grenier, Polyte mit un doigt sur sa bouche et dit à l’Irlandaise :
– Si vous voulez que je sauve votre fils, il faut rester ici et ne pas bouger.
Et il lui indiqua le grabat qui lui servait de lit.
L’Irlandaise eut un geste de soumission.
Alors Polyte sortit, tira, la porte après lui, donna un tour de clef pour être plus sûr que l’Irlandaise ne s’en irait pas, et descendit.
À mesure que le sang-froid lui revenait, Polyte sentait revenir aussi ses petits projets d’ambition.
Seulement, il avait besoin de réfléchir, de s’orienter, de se faire un plan de conduite.
Arrivé dans la rue, il jeta un coup d’œil au coin de l’avenue Parmentier.
Le fiacre qui avait amené sir James, Jenny et son fils, avait disparu.
Polyte en conclut que sir James était parti.
Il entra donc dans le passage et se mit à flâner comme à l’ordinaire devant la boutique des blanchisseuses.
Chapparot était sur le seuil de sa porte.
L’Auvergnat paraissait fort tranquille, et une joie mal dissimulée éclatait sur son visage.
Plusieurs fois de suite il entra dans la boutique, alla jusqu’au fond, puis revint précipitamment.
Ce manège intrigua Polyte.
Le charbonnier, après avoir noyé la mère, avait-il donc tué l’enfant ?
Ou bien, le gentleman l’avait-il emmené avec lui ?
C’était là un terrible problème que Polyte n’osait résoudre.
Mais l’obstination du charbonnier à revenir au seuil de sa porte, comme s’il n’eût osé pénétrer dans la cour, semblait indiquer un dénouement fatal.
Polyte retourna rue des Amandiers.
Il grimpa jusqu’à moitié de l’escalier de sa maison, et, par une des fenêtres, il regarda dans la petite cour.
La cour était déserte.
Alors Polyte eut une idée hardie, presque sublime.
– J’ai traversé le canal Saint-Martin en hiver, se dit-il. Je n’ai pas peur de l’eau d’une citerne.
Et il se glissa de nouveau dans la boutique autrefois occupée par le charron.
Polyte avait compris tout de suite une chose, c’est que l’Irlandaise avait été précipitée dans la citerne par le trou qui existait dans la cave du charbonnier.
L’échelle plongeait toujours dans l’eau.
Polyte poussa la porte qui donnait dans l’allée, se déshabilla et, tout nu, se risqua sur l’échelle.
L’eau était froide.
Polyte se jeta bravement à la nage et attira l’échelle à lui.
L’échelle se mit à flotter.
Alors le gamin, avec un instinct merveilleux, se dirigea vers l’autre extrémité de la citerne, et retirant l’échelle à demi, il lui fit prendre un point d’appui sur le sol, qui était une couche de ciment, et l’appuya de l’autre bout contre une des parois.
L’échelle se trouva posée horizontalement, comme un plan très incliné.
Polyte se mit alors à grimper d’un échelon à l’autre, jusqu’à ce que ses mains, cessant de rencontrer la voûte en maçonnerie, heurtassent la planche qui avait tourné sous les pieds de l’Irlandaise.
Puis, se levant, il souleva cette planche avec ses épaules et se trouva la moitié du corps hors de l’abîme. L’obscurité qui régnait dans la cave était plus grande que celle de la citerne, laquelle recevait un demi-rayon de jour du côté de la boutique du charron. Mais les souvenirs d’enfance de Polyte le guidaient, et il se rappela que le tonnelier avait coutume de laisser, tout auprès de la citerne, dans un trou pratiqué dans le mur, une large palette en fer, sur laquelle était plantée une chandelle et auprès une poignée d’allumettes.
– Ce sont là des habitudes, pensa-t-il, que les locataires se transmettent.
Et après avoir un moment tâtonné, il trouva le trou dans le mur et y mit la main.
Ce n’était pas la même sans doute, mais enfin il y avait une palette.
Et tout à côté Polyte sentit des allumettes sous ses doigts.
Il en prit une et la frotta contre le mur.
Et comme la lumière se faisait dans les ténèbres, Polyte se dit encore :
– Le charbonnier paraissait tout à l’heure avoir trop de mal à quitter le seuil de sa porte, je crois que je puis être tranquille.
Et il alluma la chandelle.
XLIV
La chandelle allumée, Polyte s’orienta avec ce sang-froid qui caractérise le vrai Parisien.
Tout nu, ruisselant d’eau, grelottant, il était aussi à l’aise, malgré cela, que s’il eût été sur le boulevard du Prince-Eugène, à la porte d’un petit théâtre, les mains dans ses poches et lorgnant les femmes.
– Quand on veut bien voir, pensait-il, il ne faut pas se presser. Et, en effet, avant de pousser plus loin ses investigations, il se mit à examiner le mécanisme ingénieux de la trappe dont Jenny avait été la victime.
C’était fort simple, du reste.
La planche avait été sciée de manière à ne plus reposer sur les solives du plancher.
Puis, avec deux clous, on avait fait une sorte d’essieu sur lequel la planche avait tourné quand l’Irlandaise avait mis le pied dessus.
Tout à l’entour, Polyte chercha vainement les traces d’une lutte.
Alors il devint évident pour lui que la mère seule avait été la victime d’un guet-apens.
Qu’était devenu l’enfant ?
Polyte se pencha néanmoins sur la citerne, le bras étendu et armé de la chandelle.
L’eau était calme et aucun corps ne flottait à sa surface.
De deux choses l’une :
Ou le gentleman avait emmené l’enfant.
Ou bien le charbonnier s’était constitué son gardien et son geôlier.
Dans cette dernière hypothèse, Polyte se mit à chercher ; derrière un amas de bois et de charbons, il trouva l’entrée de la cave souterraine.
Polyte descendit.
Au bout de vingt marches il se trouva dans un couloir, s’arrêta et prêta l’oreille.
Il croyait avoir entendu des gémissements étouffés.
Le couloir aboutissait à la porte d’un caveau.
Polyte s’approcha.
Les gémissements devinrent plus distincts.
Il n’y avait plus de doute pour lui. L’enfant était enfermé dans ce caveau.
Notre héros examina la porte, les gonds, la serrure. Tout cela était d’une solidité à toute épreuve, et il ne fallait pas songer à délivrer le prisonnier séance tenante.
Mais Polyte savait ce qu’il devait savoir.
Les gémissements attestaient que l’enfant était vivant.
– Bon ! se dit-il, je reviendrai ce soir, quand le charbonnier ira souper, et j’aurai ce qu’il faut pour desceller les gonds de la porte.
Et Polyte remonta.
Mais, comme il arrivait au haut de l’escalier, il entendit du bruit.
Soudain il souffla sa chandelle et demeura dans les ténèbres.
Le bruit qu’il avait entendu n’était pas une illusion, du reste.
C’était le charbonnier qui entrait dans la première cave.
Chapparot entrait à tâtons, mais il s’était approché du trou pratiqué dans le mur, et il cherchait la chandelle.
Polyte ne perdit pas la tête.
Il se glissa derrière un amas de bois et demeura immobile.
Peu après, le charbonnier qui cherchait toujours, lâcha un gros juron et murmura :
– Je crois que je perds la tête depuis tout à l’heure.
Et il sortit de la cave, rebroussa chemin vers la cour en ajoutant :
– J’aurai laissé la chandelle dans la boutique.
Alors Polyte courut vers le trou et y remit la palette en fer.
Un autre que lui se serait sauvé à toutes jambes ; mais Polyte resta et il attendit.
Du moment où le charbonnier croyait avoir laissé sa chandelle dans la boutique, c’est qu’il allait revenir.
Polyte se blottit de nouveau derrière le tas de bois.
La planche qui recouvrait la citerne, après avoir livré passage au jeune homme, avait repris sa position naturelle, et il était probable que le charbonnier ne se douterait de rien, pourvu qu’il ne vît pas Polyte.
Quelques minutes s’écoulèrent.
Puis les pas de Chapparot se firent entendre de nouveau dans la cour et la porte de la cave se rouvrit.
Le charbonnier pestait et jurait.
– Qu’est-ce que j’ai donc fait de ma chandelle ? disait-il.
Et il avait d’une main, cette fois, une de ces bougies grosses comme une ficelle, arrangées en pelote et qu’on a surnommées des rats de cave.
De l’autre main, il portait un panier.
Polyte retenait son haleine et il s’était si bien caché derrière le tas de bois, dont les rondins, symétriquement rangés les uns sur les autres, lui formaient des meurtrières à travers lesquelles il pouvait voir, – il s’était si bien caché, disons-nous, que le charbonnier aurait cherché longtemps avant de le trouver.
Mais Chapparot se croyait seul, et machinalement, il se tourna vers le trou.
La chandelle y était.
– Tonnerre ! dit-il, je crois que je deviens fou ! Tout à l’heure je l’ai cherchée sans pouvoir la trouver, et la voilà ! Cet Anglais m’a jeté un sort, pas possible !
Et il se mit à rire d’un gros rire ; puis, parlant tout haut comme un homme qui a besoin de s’étourdir avec le bruit de sa voix :
– Pourvu que son argent ne soit pas ensorcelé aussi !
Ce disant, il posa son panier à terre, s’assit sur un vieux tonneau renversé, mit sa chandelle auprès de lui et tira de sa poche une grosse bourse de cuir.
La bourse était pleine de pièces d’or.
L’Auvergnat se plut un moment à les faire sauter dans sa main, afin d’entendre le cliquetis des pièces d’or.
Puis, non content encore, il la vida sur la futaille.
Après quoi il se mit à compter son trésor pièce à pièce, et le remit enfin dans la bourse.
– Voilà toujours mille balles, dit-il ; mais c’est les mille autres que je voudrais voir. Enfin, il a dit qu’il reviendrait demain chercher l’enfant ; je vais, en attendant, lui donner à manger, à ce môme, car s’il mourait de faim, l’Anglais serait capable de ne pas payer.
Polyte ne perdait pas un mot de ce monologue.
Chapparot se dirigea vers l’escalier qui descendait au caveau converti en prison.
Alors Polyte le vit passer la main sous une poutre et y prendre une clef.
C’était la clef du caveau sans doute.
– Bon ! pensa Polyte, nous n’aurons pas besoin d’apporter des outils, et je pourrai délivrer le petit tout de suite.
Le charbonnier descendit.
Polyte entendit distinctement le bruit de ses pas dans le corridor souterrain, puis celui de la clef tournant dans la serrure et son pêne rouillé grinçant dans la gâche, et alors les gémissements redoublèrent un moment.
Puis ils furent suivis d’un cri de douleur.
Le brutal Auvergnat avait sans doute donné un coup de pied à l’enfant pour le faire taire.
Ensuite Polyte entendit refermer la porte, et peu après, le pas lourd du fils du Cantal retentit dans l’escalier.
– Ouf ! pensait Polyte, j’ai hâte qu’il soit parti.
Mais le charbonnier, au lieu de traverser la cave et de gagner la cour, s’arrêta auprès de la planche qui recouvrait l’orifice de la citerne.
– Elle doit flotter sur l’eau, se disait le charbonnier, faisant sans doute allusion à l’Irlandaise, qu’il croyait morte. Voyons voir…
Et il se pencha pour lever la planche.
Alors Polyte sentit quelques gouttes de sueur perler à ses tempes.
Le charbonnier n’allait-il pas apercevoir l’échelle et comprendre que quelqu’un était venu par ce singulier chemin ?
XLV
Polyte était un garçon de sang-froid ; et s’il n’était pas inaccessible à une première émotion, au moins il savait la réprimer promptement.
La trappe était placée entre lui et la porte de la cour. Toute retraite lui était donc fermée, à moins qu’il ne passât sur le corps du charbonnier.
Polyte songea à se défendre.
Il s’empara d’un rondin de bois, qui avait un mètre de long et était gros à proportion, et il s’en fit une massue.
Si le charbonnier venait à le découvrir, il avait de quoi lui répondre.
Mais au moment de soulever la trappe, Chapparot hésita et se redressa brusquement.
– Tonnerre du sort ! dit-il, c’est drôle comme ça me fait de l’effet.
Il se baissa de nouveau, passa un doigt dans l’anneau qui servait à soulever la planche, tira à lui, laissa retomber.
Puis, se redressant une seconde fois :
– Ah ! feignant que je suis ! fit-il !
Et il recula d’un pas.
– C’est le remords qui l’étrangle ! pensait Polyte.
Cependant, on n’est pas Auvergnat sans être tenace. Chapparot revint une troisième fois à la charge, se disant tout haut des injures à lui-même.
Mais une troisième fois le cœur lui manqua.
– C’est drôle, disait-il, mais ça me fait de l’effet, comme pour ma femme. Quand je l’ai tuée, quand elle a été morte, je n’ai pu la regarder et s’ils avaient été moins bêtes, ils me prenaient marron et m’envoyaient me faire faucher à deux pas d’ici, place de la Roquette.
On le voit, bien qu’il fût un notable commerçant, un boutiquier patenté, le charbonnier Chapparot savait assez bien l’argot.
Pour lui, les juges étaient des curieux, et être pris marron équivalait à dire : pris sur le fait et arrêté séance tenante.
Polyte, abrité derrière la pile de rondins, ne perdait ni un mot ni un geste du charbonnier.
Les coquins, taciturnes d’ordinaire et se faisant une loi de peu parler, se dédommagent amplement quand ils sont seuls ou se croient seuls.
Ils s’adressent alors de véritables discours, dans lesquels ils s’administrent le blâme ou la louange.
Chapparot se racontait à lui-même ses petits péchés, et il était à cent lieues de supposer que des oreilles humaines l’entendaient.
– Après ça, se dit-il encore, c’est peut-être parce que j’ai l’estomac vide. Je me pocharderai un brin ce soir, et j’aurai plus de courage.
Cette transaction passée avec lui-même, Chapparot s’éloigna de la trappe, au grand contentement de Polyte.
Polyte était courageux. Tout véritable enfant de Paris a ses ruses.
Il se serait fort bravement défendu au besoin, quoique le charbonnier eût des épaules énormes et des bras musculeux à tuer un bœuf d’un coup de poing.
Mais Polyte était tout nu.
Or, un homme nu et qui n’a pas une bonne paire de chaussures aux pieds perd la moitié de son assurance et un quart de sa force.
Notre héros respira donc plus à l’aise quand il vit le charbonnier remettre sa chandelle dans le trou du mur et l’éteindre ; puis s’en aller et traverser la cour d’un pas qui manquait évidemment de résolution.
Alors, le gamin n’hésita pas.
Il chercha la trappe à tâtons, se posa dessus, la fit basculer et retomba dans la citerne comme y était tombée l’Irlandaise.
Puis, nageant d’une main, il déplaça l’échelle, la fit flotter de nouveau et se dirigea vers l’orifice de la citerne qui était demeuré ouvert.
En cet endroit, il y avait une différence de niveau, et Polyte s’aperçut que l’eau était moins profonde et que, grâce à sa taille élancée, il pouvait se tenir debout et avoir la tête hors de l’eau.
Il put donc à son aise replacer l’échelle comme la première fois et remonter dans la boutique du charron.
Il était transi de froid.
Depuis que la boutique était vide, la mère de Polyte avait l’habitude d’y faire sécher son linge.
Elle avait tendu une corde entre deux murs, et sur cette corde se trouvait une paire de draps.
Polyte les prit et s’enveloppa dedans pour se sécher.
Puis il s’habilla sans bruit, ne mit pas ses souliers et alla coller son œil d’abord et son oreille ensuite à la porte qui donnait sur l’allée.
La mère était rentrée et préparait son dîner. On entendait bruire sur le fourneau allumé à la porte une casserole pleine de graisse et l’odeur de roussi prit Polyte à la gorge.
– Diable d’oignon ! se dit-il, j’en ai pour un bout de temps, et je ne veux pas que ma mère me voie.
En effet, il était peu probable que la portière quittât sa loge tandis qu’elle préparait son souper.
Polyte grelottait. De plus, le bain de pied qu’il avait pris lui avait donné un appétit d’enfer.
L’odeur des oignons qui mijotaient dans la casserole lui fit prendre une grande résolution.
– Après cela, se dit-il, qui sait ? On a vu des portières garder un secret toute une soirée. Je vais tâcher d’entortiller maman.
Et il ouvrit bravement la porte et se trouva face à face avec sa mère, qui eut un geste d’étonnement.
Polyte lui mit la main sur la bouche :
– Maman, dit-il, ne criez pas et soyez sérieuse une fois dans votre vie.
– Polisson ! dit la portière révoltée.
Il la poussa dans le fond de la loge et lui dit :
– Voulez-vous que notre fortune soit faite ? Ça dépend de vous.
– Qu’est-ce que tu chantes-la, dit la bonne femme, habituée aux illusions toujours nouvelles de son fils.
– Je ne chante que des choses raisonnables, maman.
– Mais d’où viens-tu ?
– Je vous le dirai.
Et Polyte tira sur lui la porte de la boutique, la ferma et mit la clef dans sa poche.
– Jésus Dieu ! murmurait la bonne femme, mon fils est toqué.
– Mère, dit Polyte gravement, je serai commissaire de police au premier matin.
La portière haussa les épaules.
– Et on me donnera une jolie prime.
– Mais…
– Il n’y a pas de mais. Ça sera comme ça, si vous êtes bien gentille.
La mère regardait son fils avec stupeur.
Polyte continua :
– Qu’est-ce que vous faites donc cuire là ?
– Du lard et des oignons.
– C’est-y cuit ?
– À peu près. Mais ce n’est pas de ça qu’il s’agit.
– Au contraire. C’est un moyen.
– Pour devenir commissaire ?
– Oui, maman.
– Mais, drôle, me diras-tu ce que tu es allé faire dans la boutique ?
– Ça ne vous regarde pas !
– Mauvais garnement, c’est comme ça que tu parles à ta mère ?
– Assez causé, maman. Donnez-moi un litre de vin. Tiens, en voilà un.
Et Polyte prit une bouteille sur la table.
– Donnez-moi du pain. Bon. Et puis ça…
Et il enleva la casserole de dessus le fourneau.
La portière voulut crier, mais Polyte lui dit :
– Si vous faites du bruit, je ne serai pas commissaire.
Et, le pain sous le bras, la casserole fumante d’une main, la bouteille de l’autre, Polyte s’élança dans l’escalier, disant à sa mère :
– Je ne fais que les deux chemins, je monte à mon grenier et je redescends.
Et, tout en montant, il se disait :
– Après le bain qu’elle a pris, la pauvre femme tortillera volontiers un morceau. C’est sûr !…
XLVI
Mais la mère Vincent, – c’était le nom de la mère de Polyte, – n’était pas femme à laisser ainsi son dîner s’envoler et prendre la route du ciel.
Elle s’élança dans l’escalier et cela si rapidement, elle monta les marches avec une telle vitesse, qu’elle arriva au dernier palier juste au moment où Polyte rentrait dans le grenier, son butin à la main.
Alors la portière jeta un cri en se trouvant en la présence d’une femme encore jeune et belle et qui la regardait avec un étonnement plein d’inquiétude.
Et la mère Vincent crut comprendre, tout en ne comprenant pas du tout.
Et elle s’écria :
– Ah ! vagabond ! ah ! mauvais sujet ! on t’en fichera du lard aux oignons, un litre à seize et un pain blanc pour nourrir tes donzelles !
Mais Polyte déposa la casserole, le pain et le vin sur une table qui se trouvait dans un coin du grenier ; puis, fermant la porte et prenant littéralement sa mère à la gorge :
– Mais puisque vous êtes venue jusqu’ici, dit-il, taisez-vous donc, maman, et écoutez !
Il y avait dans la voix, dans le geste de son fils une telle autorité que la portière se tut et, bouche béante, le regarda.
– Vous voyez cette femme ! dit alors Polyte, en lui désignant Jenny toute tremblante.
– Oui ; eh bien ?
– Sans moi, elle serait morte.
– Que veux-tu dire ?
– Vous savez le charbonnier du passage, Chapparot ?…
– Oui, qui a tué sa femme ?…
– Juste, maman. Eh bien ! il a jeté cette femme dans la citerne, où je l’ai repêchée il y a une heure.
Les cheveux dénoués de l’Irlandaise étaient encore imprégnés d’eau, et il suffit d’un regard à la portière pour juger que son fils ne mentait pas.
La mère Vincent était criarde, cancanière ; mais, comme son fils, elle avait bon cœur.
Une fois qu’elle fut bien convaincue qu’elle n’avait point affaire à quelque drôlesse de petit théâtre, à quelque fille ramassée on ne sait où par son mauvais sujet de fils, et que celui-ci lui disait la vérité, elle s’apitoya sur le sort de l’Irlandaise et écouta le récit de Polyte dans tous ses détails.
Et Polyte disait à l’Irlandaise que son fils était vivant et qu’il lui rendrait dans quelques heures.
Et la mère Vincent forçait l’Irlandaise à manger et à boire, et Jenny, songeant à son fils, que Polyte promettait de lui rendre, pleurait de joie.
– Voyons, maman, dit alors Polyte, faut pas faire les enfants, ni vous, ni moi. Faut avoir du vice.
La portière le regarda.
– Vous pensez bien que si Chapparot le charbonnier a jeté cette femme qu’il ne connaissait pas dans la citerne, c’est qu’on lui avait donné de l’argent pour faire le coup. Il a de l’or plein ses poches.
– Ah ! la canaille dit la portière.
– Par conséquent, poursuivit Polyte, il n’est pas seul à en vouloir à cette femme ; il faut se méfier.
– Ça, bien sûr, dit la mère Vincent.
– J’irais bien trouver le commissaire tout de suite ; mais si Chapparot voyait arriver les sergents de ville, il serait capable d’étrangler le petit.
La portière et Jenny frissonnèrent.
– Il faut donc que cette femme reste ici jusqu’à ce que nous ayons son fils.
– Oui, oui.
– Que vous en ayez bien soin…
– Oh ! tu peux y compter.
– Et que personne ne la voie.
– Bien sûr.
– Ensuite, faut que vous me promettiez de tenir votre langue, mais là, sérieusement.
– Je te le promets.
– Et de ne pas aller chez les voisines.
– Je ne bougerai pas.
– Si c’est comme ça, dit Polyte, tout ira bien. Voici qu’il est six heures et il fait nuit. C’est le moment où Chapparot ferme sa boutique et s’en va manger un morceau chez le mannezingue. Nous en profiterons.
Et Polyte laissa l’Irlandaise aux soins de sa mère et redégringola l’escalier, à cheval sur la rampe.
Quand il fut dehors, il s’en retourna flâner dans le passage. Les petites blanchisseuses avaient fini par le remarquer, et l’une d’elles qu’on appelait Pauline lui jeta une tendre œillade.
Chapparot était toujours sur sa porte et, cette fois, moins préoccupé sans doute, il regarda Polyte et fronça le sourcil.
Non point qu’il eût la moindre idée que le jeune homme s’occupait de lui et l’espionnait.
Mais Chapparot éprouva un moment de colère en le voyant passer et repasser devant la boutique des blanchisseuses.
C’est que cette brute humaine, cet homme farouche qui avait tué sa femme, chassé sa fille et qui vivait sous le poids d’une animadversion générale, cet homme était jaloux.
– Jaloux de quoi ?
Les chansons et les éclats de rire des petites blanchisseuses l’avaient longtemps agacé ; puis il s’était mis à les regarder et il y en avait une, cette même Pauline qui faisait les doux yeux à Polyte, qui l’avait fait tressaillir des pieds à la tête.
Chapparot était un homme établi ; il avait de l’argent ; la petite blanchisseuse n’avait probablement pas le sou.
Il était veuf, et rien ne l’empêchait de se remarier et d’épouser une jeunesse.
Chapparot s’était dit cela un matin, et quand un sac de charbon ou une voie d’eau sur l’épaule il passait devant la porte des blanchisseuses il jetait à la petite Pauline un regard de sinistre convoitise et songeait à en faire madame Chapparot.
Or, il arriva, ce soir-là, que Polyte, qui paraissait occupé exclusivement des blanchisseuses, alors qu’en réalité il attendait que le charbonnier s’en allât, il arriva, disons-nous, que Polyte excita tout à coup l’attention et la jalousie de l’Auvergnat.
Pauline vint sur le pas de la porte pour vider un baquet plein de savonnage.
Polyte fit un pas en arrière.
– Ah ! monsieur Polyte, dit l’espiègle, vous n’aimez pas vous mouiller les pieds, ça se voit.
– Tiens ! dit Polyte, qui n’avait jamais boudé à une jolie fille, vous me connaissez ?
– Pardine !
– Et d’où me connaissez-vous ?
– Vous avez joué la comédie aux Délass’-Com’, n’est-ce pas ?
– C’est vrai.
– Et vous étiez joliment drôle, allez !
Polyte se trouva flatté.
– Est-ce que vous ne pourriez pas me donner un billet de théâtre un de ces jours ? dit encore Pauline.
– Certainement, mam’zelle.
– Vous serez le roi des hommes. Merci d’avance ! Chut ! la patronne regarde par ici… Mais si vous voulez me voir, ce soir, à neuf heures…
– Où donc çà ?
– À l’entrée du passage. J’y serai. Nous rigolerons un brin.
Et Pauline rentra dans la boutique.
Chapparot était pâle de fureur. Il avait fermé sa boutique, mais il ne s’en allait pas.
– Hé ! vieux coquin, pensa Polyte, il me semble que tu me regardes ?
Et il s’en alla pour ne pas éveiller plus longtemps l’attention du charbonnier.
Alors, celui-ci se mit en route à son tour.
La nuit était venue, l’esplanade des abattoirs était déserte.
Polyte s’y engagea le premier.
– Quand je te verrai tranquillement attablé chez le mannezingue, pensait-il, je reviendrai.
Mais, comme Polyte, usant des ruses familières aux gens de police, qui, au lieu de suivre un homme, le filent, c’est-à-dire passent devant ; comme Polyte, disons-nous, traversait l’esplanade, il entendit courir derrière lui.
Et, se retournant, il aperçut Chapparot qui se ruait sur lui et le prit à la gorge, lui disant avec un accent de fureur concentrée :
– Ah ! tu te mêles de ce qui ne te regarde pas, gringalet !
Et le charbonnier attacha ses deux mains comme un étau de fer au cou de Polyte suffoqué…
XLVII
Les paroles que prononçait Chapparot donnèrent le change à Polyte, déjà surpris par cette brusque agression.
Il ne put pas supposer que le charbonnier faisait allusion aux blanchisseuses, et crut, au contraire, qu’il savait ce qui s’était passé.
– Ah ! canaille ! dit-il d’une voix étranglée, tu me lâcheras ou je t’envoie à l’échafaud.
Chapparot jeta un cri de rage et cessa de serrer le cou de Polyte.
Celui-ci profita de ce moment de répit pour continuer.
– Tu as assassiné ta femme, j’en ai la preuve.
Chapparot eut un éclat de rire féroce.
– Je sais bien que vous dites tous ça dans le quartier ; mais je me moque de vous.
– Et l’Anglaise que tu as jetée dans la citerne… ajouta Polyte, qui pensait que pour échapper au charbonnier il devait lui inspirer une terreur profonde.
Mais Polyte se trompait.
Chapparot était une de ces naturels violentes, féroces, brutales, qui s’exaltent dans le crime et qui se voyant découvertes, perdent toute mesure et renversent tout obstacle.
– Ah ! tu sais cela aussi ? dit-il.
Et il se rua de nouveau sur Polyte, le reprit à la gorge et engagea avec lui une lutte corps à corps.
Cela se passait, avons-nous dit, au milieu de cette esplanade où étaient naguère les abattoirs Ménilmontant.
Au nord, la rue Saint-Maur, qui n’a plus qu’un côté ; au sud, l’avenue Parmentier, qui n’a plus que quelques maisons isolées les unes des autres ; à l’est, la rue des Amandiers, prolongeant celle de Chemin-Vert ; à l’ouest, la rue Saint-Ambroise.
La nuit était venue, comme elle vient en hiver, tout d’un coup, accompagnée d’un de ces brouillards humides qui rendent le pavé gras et font rentrer les Parisiens au plus vite.
Chapparot et Polyte étaient seuls.
Polyte appela bien une ou deux fois au secours, car le charbonnier l’étranglait ; mais ces plaintes étouffées ne furent entendues de personne.
Polyte était jeune, Polyte était vigoureux ; mais Polyte n’avait pas la force herculéenne de l’Auvergnat.
Il lutta en désespéré ; mais le charbonnier finit par lui passer la jambe et le renversa.
Puis lui appuyant un genou sur la poitrine :
– Ah ! dit-il, tu sais trop de choses !…
Et il lui donna un coup de couteau qu’il portait toujours dans sa poche et qu’il avait tiré et ouvert rapidement.
Polyte poussa un gémissement étouffé et ne bougea plus.
Alors le charbonnier se redressa, les yeux injectés de sang et stupides, la sueur au front.
Polyte gisait inanimé devant lui.
Chapparot crut l’avoir tué.
Il eut un rire féroce, voisin de la folie, un rire à faire trembler les bêtes fauves.
– Je vais bien, dit-il, deux femmes et un homme, et de trois ! Il avait raison, ce garçon, je finirai par être fauché !…
Il fit un pas de retraite, et sentit que ses jambes chancelaient.
Alors il s’arrêta, promenant un œil ardent autour de lui, mais n’osant plus regarder sa victime.
Les assassins ont parfois de ces hébétements subits, et peut-être que Chapparot fût resté là longtemps attaché au théâtre de son dernier crime par une force inconnue, s’il n’eût entendu en ce moment un bruit de voix et de pas.
C’étaient des ouvriers qui remontaient la rue du Chemin-Vert et qui rentraient chez eux.
Alors Chapparot prit la fuite et courut à perdre haleine jusqu’à la rue Saint-Ambroise.
Une fois là, il descendit sur le boulevard du Prince-Eugène, se dirigea vers le canal, et, pendant une heure environ, il erra de droite et de gauche, tantôt marchant d’un pas précipité, tantôt s’arrêtant, tantôt se traînant, comme un ivrogne qui bat les murs.
Les dernières paroles retentissaient toujours à son oreille affolée.
Chapparot avait peur de la guillotine.
Cependant la pluie qui commençait à se dégager du brouillard et le vent froid de la nuit lui rendirent un peu de calme.
– Après ça, se dit-il, personne ne m’a vu ; qui peut dire que c’est moi ?
Dans la statistique criminelle, on a remarqué trois choses :
La première, c’est que l’assassin, son crime commis, songe tout de suite à se ménager un alibi ;
La seconde, c’est qu’il est pris d’une soif ardente et ne manque jamais d’aller s’étancher dans le cabaret le plus voisin ;
La troisième, enfin, c’est qu’après l’étourdissement de la boisson, il lui faut l’étourdissement du mauvais lieu.
Chapparot prit donc enfin tout naturellement le chemin du marchand de vin chez lequel il prenait ses repas.
C’était l’heure où les clients étaient nombreux et où les conversations étaient animées.
Chapparot entra, cherchant à paraître calme, et comme il était sombre et taciturne d’ordinaire et inspirait à tout le monde une répulsion mêlée de terreur, personne ne lui adressa la parole.
Il alla s’asseoir dans un coin, à une table vacante.
Le garçon du mannezingue lui apporta son ordinaire, c’est-à-dire sa soupe et son morceau de bœuf, sa chopine de vin et son fromage.
L’inattention générale acheva de calmer le charbonnier. Il mangea comme à l’ordinaire, il but sa chopine, et puis il demanda de l’eau-de-vie.
On lui apporta une petite fiole qui coûtait trois sous et contenait environ un décilitre, ce qu’on nomme vulgairement un poisson.
Dans l’état de surexcitation où il était, le charbonnier était plus accessible à l’ivresse qu’à l’ordinaire.
Le poisson avalé, il en demanda un second et le but pareillement. Il était dix heures du soir, quand il songea enfin à sortir, ou plutôt quand on songea à le mettre dehors, car l’établissement fermait à dix heures.
Il s’en alla en titubant, et comme il n’avait plus ses idées bien nettes il reprit machinalement le chemin qu’il suivait d’ordinaire.
Il dépassa donc le canal, tourna à gauche devant l’église Saint-Ambroise et prit la rue de ce nom.
Mais quand il fut à l’esplanade, il fit un brusque détour. De même qu’il n’avait pas osé soulever la planche de la citerne, de peur de voir le corps de l’Irlandaise flotter sur l’eau, de même il n’aurait voulu, pour rien au monde, passer auprès du corps de ce jeune homme qu’il supposait avoir tué d’un coup de couteau.
Il se rabattit donc sur l’avenue Parmentier et la suivit jusqu’à la rue des Amandiers.
Puis il suivit cette dernière voie jusqu’au passage dans lequel il avait sa boutique.
Malgré son ivresse, Chapparot se répétait mentalement de minute en minute :
– Qui peut dire que c’est moi ? D’ailleurs, j’ai passé ma soirée chez le mannezingue ; il y avait du monde, et j’aurai des témoins, au besoin.
Mais comme il entrait dans le passage, comme déjà il cherchait, dans sa poche la clef de l’allée de la maison, il s’arrêta et ses cheveux se hérissèrent.
La clarté d’une lumière passait à travers les vitres noircies de l’imposte de la boutique au-dessous de la porte.
Il y avait du monde chez lui…
Alors Chapparot s’imagina que la police, déjà prévenue de son nouveau crime, faisait une descente dans sa boutique, et qu’on venait l’arrêter…
Et l’épouvante qui s’empara de lui fut si grande en ce moment, qu’il rebroussa chemin et prit la fuite à toutes jambes.
*
* *
Chapparot avait-il deviné juste ?
Qui donc s’était introduit à cette heure avancée dans la boutique du charbonnier ?
C’est ce que nous allons vous dire.
XLVIII
Les petites blanchisseuses causaient entre elles, tandis que le malheureux Polyte s’en allait et devenait quelques minutes plus tard la victime du féroce Chapparot.
– Toi ! Pauline ? disait la grande Marguerite que dans l’atelier, on appelait reine Margot, voilà que tu vas te payer un amoureux, toi aussi ?
– Pourquoi donc pas ? répondit la petite fille.
– Il n’y a plus d’enfants, dit Pélagie la rousse.
– Voilà que j’ai dix-sept ans, mesdemoiselles, dit Pauline, qui se dressa sur la pointe du pied pour paraître plus grande.
– Et pas de corset, ajouta la reine Margot.
– Tu es bien avec lui, hein ? reprit la rousse Pélagie, faisant allusion à Polyte.
– C’est la première fois que je lui parle.
– Des nèfles ! dit Madeleine, une petite bossue qui était jolie et avait l’esprit méchant des êtres contrefaits.
– C’est la vérité, mesdemoiselles, affirma Pauline.
– Et pourquoi lui as-tu parlé ?
– Pour lui demander des billets de théâtre.
– Des billets de quoi ?
– Des billets pour Belleville ou les Délass’, ou l’Ambigu, dit Pauline.
– C’est donc un cabotin ? fit dédaigneusement Madeleine la bossue.
– C’est un acteur, mademoiselle.
– C’est la même chose.
– Ah ! mais non, dit Pauline avec vivacité.
– Et quelle différence fais-tu entre un acteur et un cabot ? demanda Pélagie la rousse.
– On applaudit l’acteur.
– Et le cabot ?
– On lui jette des pommes cuites.
– Dieu de Dieu ! fit la bossue, mon fer à repasser s’en trouve mal d’entendre mam’selle Pauline parler comme ça des acteurs et des théâtres ; c’est quelque chose de propre que le monsieur de tout à l’heure, je le connais bien, moi, sa mère est portière dans la rue.
– Ton père est bien savetier en plein air riposta Pauline.
– Paix donc, mesdemoiselles ! dit sévèrement la maîtresse blanchisseuse qui intervint dans le débat qui tournait à l’aigre.
Pélagie la rousse se pencha à l’oreille de Pauline :
– Si tu voulais faire rager Madeleine, dit-elle, je te donnerais bien un moyen.
– Dis vite ! car cette bossue m’insupporte.
– Demande-lui donc si son futur est toujours marchand de quatre saisons. Je te dirai pourquoi ça l’embête.
– Pourquoi ?
– Parce qu’il a été condamné pour vol et qu’il est encore à Poissy.
– Ah ! si c’est ça, dit Pauline qui avait bon cœur, non, je ne dirai rien. Elle est assez malheureuse comme ça… pauvre fille !
La grande Marguerite, la reine Margot, reposa son fer un moment et dit :
– Avec ça, ma petite, si tu écoutes le cabot, tu manques ton avenir !
– Vous dites ? fit Pauline.
– Tu pourrais être établie dans un mois si tu le voulais, et être la femme d’un homme patenté…
– Qu’est-ce qu’elle dit donc ? reprit la petite blanchisseuse.
– Et t’appeler Mme Chapparot, dit Pélagie.
– Un joli nom ! dit la bossue.
Pauline partit d’un éclat de rire.
– Merci bien, dit-elle. C’est comme le sire de Framboisy, cet homme-là ; il tue ses femmes quand il en a assez.
– Il a de l’argent, dit la bossue.
– Je n’y tiens pas à l’argent, moi. Est-ce que chaque jour n’amène pas son pain ? Et puis, une blanchisseuse qui est toujours dans l’eau et un charbonnier qui ne se lave la figure que tous les dimanches, ça va-t-il ensemble ?
– Je ne sais pas, dit Pélagie, devenue sérieuse, car le nom de Chapparot avait jeté un froid, je ne sais pas pourquoi, mais j’aime autant que ce soit de toi que de moi qu’il soit amoureux, le charbonnier.
– Pourquoi donc ? fit la bossue.
– Il a des moments où il regarde Pauline qu’on en sue dans le dos.
– Cette bêtise !
– C’est égal, reprit Pélagie, je te vais donner un bon conseil, Pauline.
– Voyons ça ?
– Tu es libre d’avoir un amoureux. C’est ton affaire ! mais méfie-toi de Chapparot.
– Et pourquoi donc ? Est-ce que ça le regarde ?
– Non, mais un jour il lui marchera sur le pied et lui tombera dessus à coups de poing.
– Ça c’est sûr, dit Madeleine la bossue.
– Si tu avais vu tout à l’heure, quand tu causais à ce jeune homme, avec quels yeux il vous regardait, dit la reine Margot.
– Bah ! dit Pauline en riant, M. Hippolyte est vigoureux et adroit ; il tirerait la savate que ça ne m’étonnerait pas…
– Oui, dit Madeleine à mi-voix, mais le charbonnier joue du couteau.
Pauline tressaillit et ne répondit pas.
À partir même de ce moment elle tomba en une rêverie profonde.
À sept heures et demie, la journée terminée, les petites blanchisseuses soupèrent.
Alors Pauline dit à la patronne :
– Madame, je ne travaillerai pas ce soir.
– Pourquoi donc ça, paresseuse ?
– Parce que, voyez-vous, ma mère était un peu malade, ce matin, quand j’ai quitté la maison, et je crois bien qu’elle ne sera pas allée au Cirque, où elle est ouvreuse.
Si elle y est, je reviendrai faire une demi-veillée.
Et Pauline, son repas terminé, prit son panier à son bras, souhaita le bonsoir à ses camarades d’atelier et s’en alla.
Elle avait dit la vérité, du reste. Sa mère était vieille, à moitié infirme et ne remplissait que fort difficilement son métier d’ouvreuse de loges.
Mais ce que Pauline n’avait pas dit, c’est qu’après avoir vu sa mère, si toutefois celle-ci avait manqué au théâtre, elle comptait bien ressortir sous le prétexte de retourner travailler et aller au rendez-vous qu’elle avait donné à Polyte.
Pauline partit donc.
Elle vivait avec sa mère, qui était veuve, dans un petit appartement composé de deux pièces, au rez-de-chaussée d’une maison qui faisait l’angle de la rue Saint-Ambroise et de l’avenue Parmentier, – maison qui n’avait pas de concierge et dont chaque locataire ouvrait la porte en pesant sur un loquet dissimulé assez adroitement.
Son plus court chemin était donc de traverser l’Esplanade, ce qu’elle se mit en devoir de faire, tout en couvrant sa tête nue d’un mouchoir, tant le brouillard était humide.
Pauline avait hâte de voir sa mère, mais elle avait hâte plus encore de revoir le brave Polyte et de jaser un brin avec lui.
Polyte lui plaisait ; un acteur est une sorte de demi-dieu pour une grisette ; ensuite ce que lui avaient dit ces demoiselles la tourmentait.
Chapparot était capable de tout, elle le savait, et pour rien au monde elle n’aurait voulu que Polyte eût une querelle avec l’Auvergnat.
Elle comptait donc l’avertir et lui dire que, s’il voulait bien s’occuper d’elle, il le fit avec précaution et ne vint plus flâner dans le passage.
Et tout en se disant cela, la petite trottait menu sur l’esplanade détrempée par les dernières pluies, et fermait à demi les yeux pour n’être pas aveuglée par le brouillard, lorsque tout à coup elle heurta à un obstacle et trébucha. Et comme elle reprenait son équilibre et baissait les yeux, elle poussa un cri.
L’obstacle que ses pieds avaient rencontré était un corps humain.
Un homme gisait immobile sur le sol.
Était-il mort ? Était-ce un ivrogne ?
Toute autre femme se fût sauvée ; Pauline se baissa et, à travers l’obscurité, elle s’efforça de voir si elle avait affaire à un mort ou à un vivant.
Et soudain elle poussa un nouveau cri, – mais un cri de douleur autant que d’épouvante.
Elle avait reconnu dans ce corps inerte Polyte, qui lui parlait deux heures auparavant et avait accepté son rendez-vous !…
XLIX
La petite Pauline s’était courbée sur Polyte, et, tout à coup, elle poussa un nouveau cri.
Sa main était humide, humide de sang.
Là où quelquefois les hommes perdent la tête, certaines femmes sont pleines de présence d’esprit.
La jeune fille n’appela point à son aide ; elle ne prit pas la fuite, elle n’abandonna point Polyte pour aller chercher du secours.
Elle passa, au contraire, sa main sur le cœur de Polyte et sentit que ce cœur battait.
Polyte n’était pas mort.
Si la vérité se dressait tout à coup devant elle ; si Polyte était là, gisant ensanglanté, c’est qu’il s’était battu avec Chapparot. Il n’en pouvait être autrement.
Et alors Pauline eut peur, non pour elle, mais pour Polyte, et elle eût été tentée de courir chercher du monde que la crainte du charbonnier l’en eût empêchée.
Le cœur de Polyte battait, donc Polyte vivait et n’était qu’évanoui.
La petite blanchisseuse se pencha sur lui de nouveau, elle colla ses lèvres sur les lèvres entr’ouvertes du jeune homme et se mit à lui souffler doucement dans la bouche.
En même temps elle lui frappait dans les mains.
Tout à coup elle eut une inspiration, ou plutôt un souvenir lui passa par l’esprit.
La maîtresse blanchisseuse nourrissait ses ouvrières pour les deux repas de midi et du soir, mais chacune d’elle apportait son premier déjeuner.
Pauline, le matin, avait acheté deux oranges sur une charrette à bras, au coin de la rue Saint-Maur.
Elle en avait mangé une ; mais l’autre était encore dans son panier.
Les oranges à un sou pièce qu’on vend au coin des rues de Paris peuvent en remontrer pour l’aigreur aux limons d’Espagne et aux citrons d’Italie.
Pauline chercha l’orange, la mordit à belles dents, et l’ayant ouverte ainsi, elle s’en servit comme d’une éponge pour frotter successivement les tempes, les lèvres et les narines de Polyte.
Le jus acidulé de l’orange fit en ce moment l’office du vinaigre.
Polyte poussa un soupir, puis il fit un mouvement, et Pauline eut un cri de joie.
Puis encore il ouvrit les yeux et murmura : Où suis-je !
Et alors il sentit deux lèvres brûlantes sur ses lèvres, et une voix émue et douce lui répondit :
– N’ayez pas peur, monsieur Polyte, c’est moi… votre petite amie… Pauline la blanchisseuse.
Le couteau de Chapparot, visant au ventre, car les gens qui jouent du couteau ne frappent jamais ailleurs et savent que, presque toujours, une blessure en cet endroit est mortelle, – le couteau de Chapparot, disons-nous, avait rencontré un corps dur qui l’avait fait dévier.
Le corps dur était un porte-monnaie placé dans la poche du pantalon, à la hauteur de l’aine, et rempli de menue monnaie et de gros sous.
Le coup avait dévié ; la pointe du couteau glissant sur la cuisse avait simplement produit une large entaille sans profondeur, d’où le sang s’était échappé assez abondamment.
Mais aucune veine, aucune artère n’avait été coupée. Seulement la pointe du couteau avait atteint un muscle, et la douleur avait été si vive que Polyte s’était évanoui.
Comme on le pense bien, une fois revenu à lui, il se retrouva bientôt sur ses pieds.
– Ô mon Dieu ! disait Pauline toute tremblante, et dire que je suis cause de tout cela, moi !…
– Vous ! fit Polyte abasourdi.
Il tenait dans ses mains les mains de la jeune fille et il la regardait avec reconnaissance.
– C’est bien Chapparot qui vous a frappé ? dit-elle.
– Oui, c’est lui.
– Le misérable !
– Mais ce n’est pas vous…
– C’est rapport à moi, dit Pauline, qu’il vous a cherché querelle.
– Oh !
– Il est amoureux de moi, ce misérable…
Ces derniers mots firent tout comprendre à Polyte. Le charbonnier s’était rué sur lui, non parce qu’il l’avait espionné, mais parce qu’il avait parlé à Pauline.
– Mais vous êtes couvert de sang ! s’écria la jeune fille.
– Tiens, c’est vrai, dit Polyte.
– Souffrez-vous beaucoup ?
– Non.
– Essayez de marcher… là… Appuyez-vous sur moi… Très bien… Je demeure à deux pas d’ici… Ma mère n’y est pas… Venez…
Polyte se laissa faire ; appuyé sur l’épaule de Pauline, il fit quelques pas sans trop de douleur, et, l’air froid de la nuit achevant de le ranimer et de lui rendre ses forces, il fit sans trop de difficulté le chemin qui séparait l’endroit où l’avait trouvé la petite blanchisseuse de la maison qu’elle habitait au coin de la rue Saint-Ambroise.
– Pas de lumière chez nous, dit-elle quand elle ne fut plus qu’à quelques pas, ma mère est à son théâtre.
Ils entrèrent, Pauline avait fait jouer le loquet dissimulé dans la porte.
– Donnez-moi la main, dit-elle alors en attirant le jeune homme dans l’allée noire.
La mère et la fille avaient chacune une clef du logis.
Pauline ouvrit donc la porte et se procura de la lumière, tandis que Polyte se laissait tomber sur une chaise à laquelle il venait de se heurter.
Une fois qu’elle eut allumé une chandelle, Pauline regarda Polyte.
Le jeune homme était un peu pâle, mais il ne paraissait pas dangereusement blessé.
Le logis se composait de deux pièces, deux petites chambres, dont l’une servait de cuisine.
Polyte passa dans l’autre, ôta son pantalon et vérifia sa blessure.
Elle était insignifiante.
Pauline lui apporta un morceau de linge et du vinaigre, et il put ainsi poser dessus une sorte de pansement provisoire.
– Ah ! dit-il en souriant, je crois que j’en suis quitte pour la peur. Mais il doit croire qu’il m’a tué.
Et, songeant au charbonnier, Polyte se souvint.
Il se souvint de l’Irlandaise qu’il avait confiée à sa mère. Il se souvint de l’enfant prisonnier dans la cave, et son énergie lui revint.
– Il faut aller chez le commissaire, disait la jeune fille pendant ce temps. On l’arrêtera, on le mettra en prison, et nous en serons débarrassés. Car, voyez-vous, monsieur Polyte, ajouta-t-elle, il vous a manqué aujourd’hui, mais il recommencera demain et finira par vous tuer. C’est une bête brute, cet homme.
Et elle regardait tendrement le jeune homme, et des larmes roulaient dans ses yeux ; elle avait joint ses petites mains toutes tremblantes, et sa voix était si émue que Polyte comprit qu’il ne tenait qu’à lui d’avoir la plus jolie maîtresse qu’il eût jamais rêvée.
Mais Polyte, en même temps, retrouvait son sang-froid.
Et comme il n’avait pas été impunément secrétaire d’un commissaire de police, il se disait :
– Chapparot avait de l’argent sur lui ; Chapparot croit m’avoir tué. Il passera la nuit à courir les cabarets et les mauvais lieux comme tous les assassins ; s’il rentre chez lui, ce ne sera pas avant le jour. J’ai le temps de délivrer l’enfant.
Alors, il prit la main de Pauline et il dit :
– Mademoiselle, vous êtes aussi bonne que vous êtes jolie, et je suis sûr que vous êtes courageuse.
– Quand il le faut, répondit-elle en rougissant.
– Vous allez venir avec moi.
– Chez le commissaire ?
– Oh ! non, dit-il.
– Où donc, alors ?
– Dans la maison de Chapparot.
Pauline eut un geste d’effroi.
– Soyez tranquille, dit Polyte, il n’y sera pas.
– Mais que voulez-vous donc aller faire chez lui ? s’écria-t-elle en le regardant avec stupeur.
– Délivrer un enfant condamné peut-être à mourir de faim.
Pauline, frissonnant, regarda Polyte, et sembla se demander si la blessure qu’il avait reçue, le sang qu’il avait perdu, ne lui avaient pas troublé la raison.
L
Polyte devina les réflexions de la petite blanchisseuse et se prit à sourire :
– Ma bonne amie, lui dit-il, j’ai toute ma raison et je vais vous le prouver.
– Ah ! dit-elle, le regardant toujours avec une vague inquiétude.
Alors, Polyte lui raconta ce qui s’était passé dans la journée, et comment il avait sauvé miraculeusement la pauvre Irlandaise d’une mort certaine.
Puis il ajouta :
– Si vous doutez encore, venez chez nous et vous la verrez, ma mère est auprès d’elle.
– Je vous crois, dit Pauline.
Puis, la jeune fille eut un mouvement de dépit.
– Alors, dit-elle, c’était pour observer Chapparot que vous veniez dans ce passage ?
– Et un peu pour vous aussi, dit galamment Polyte.
– Oh ! la couleur !
– Vrai ! dit Polyte, et si vous voulez être ma petite femme, je vous aimerai bien, et de fainéant que j’étais, je deviendrai travailleur.
– Nous verrons cela, dit Pauline en rougissant un peu.
– Mais, poursuivit Polyte, pour le moment, songeons à ce pauvre petit, qui est enfermé dans une cave.
– Vous voulez le délivrer ? dit Pauline avec un accent d’effroi.
– Sans doute.
– Mais comment ?
Pauline joignit les mains :
– Vous êtes fou, dit-elle.
– Fou ! pourquoi donc ?
– Vous voulez donc que Chapparot vous assassine pour de bon !
– Je n’ai pas peur de lui en ce moment.
– Ah !
– Il ne reviendra pas chez lui cette nuit.
– Qu’en savez-vous ?
– Il croit m’avoir tué.
– Eh bien ?
– Et les gens qui ont commis un crime, surtout quand ce sont des brutes comme Chapparot, ne rentrent pas coucher dans leur lit.
– Où voulez-vous donc qu’il aille ?
– Il passera la nuit à boire.
– Vous croyez ?
Et Pauline tremblait toujours à la seule pensée de s’introduire dans la maison où le terrible charbonnier avait sa boutique.
Mais Polyte lui dit :
– Au reste, puisque vous avez peur, je n’ai nul besoin que vous veniez avec moi ; seulement, vous pouvez me renseigner sur une chose.
– Laquelle ?
– Pensez-vous que les locataires de la maison soient rentrés ?
– Ils sont rentrés et couchés. Ce sont des ouvriers qui se lèvent de grand matin et se mettent au lit de bonne heure.
– Il n’y a pas concierge dans la maison ?
– Non.
– Alors chacun a sa clef ?
– Non, il y a un loquet à la porte comme ici.
– Je m’en doutais, fit Polyte, mais je voulais m’en assurer.
– Mais, dit Pauline, quand bien même vous entreriez dans la maison, comment feriez-vous pour pénétrer dans la boutique.
– C’est le plus simple, dit Polyte. Quand le charbonnier est parti, je l’ai vu mettre la clef de la porte de l’allée sous une planche qui lui sert de paillasson.
– C’est vrai, dit Pauline, je l’ai vu souvent faire la même chose.
– Eh bien ! reprit Polyte, adieu, mademoiselle, merci de vos bons soins, et permettez-moi de revenir vous voir demain pour vous remercier.
Et Polyte, encore faible, encore chancelant, voulut faire un pas vers la porte.
Mais Pauline lui passa gravement ses bras autour du cou.
– Vous êtes fou, dit-elle, si vous avez pensé que je vous laisserais aller tout seul.
– Comment ! vous viendriez avec moi ?
– Mais certainement.
– Vous avez bien peur de Chapparot pourtant !
– Pour vous, oui ; mais pour moi, non. Et puis, s’il vous arrive malheur, il m’arrivera malheur aussi. Allons-y donc gaiement.
– Une vraie petite femme ! s’écria Polyte enthousiasmé.
Et il embrassa Pauline, et tous deux sortirent.
Le sang qu’il avait perdu avait singulièrement affaibli Polyte.
Il marchait un peu comme un homme ivre ; mais Pauline le soutenait, et ils traversèrent ainsi l’esplanade.
À l’entrée du passage, Polyte s’arrêta et regarda autour de lui. La rue des Amandiers était déserte et le quartier silencieux.
Cependant, le jeune homme éprouva à son tour un petit mouvement d’hésitation.
– Mademoiselle Pauline, dit-il, véritablement ce que j’ai à faire est si simple, que je n’ai pas besoin de vous. Vous devriez m’attendre ici.
– Ah ! mais non, dit-elle, je vais avec vous.
– Vous y tenez absolument ?
– Mais dame ! fit-elle ingénument, puisque je dois être votre petite femme !
– Vous êtes un amour, dit Polyte en l’embrassant. Allons !
Et ils se dirigèrent vers la maison de l’Auvergnat.
Comme l’avait dit Polyte, l’expédition était des plus simples.
Il chercha avec la main la petite plaque ronde dissimulée dans la porte et qui faisait mouvoir le loquet, et la porte s’ouvrit.
Le cœur de Pauline battait bien un peu, mais elle était avec lui et l’amour rend les femmes courageuses.
Polyte trouva sous la planche la clef de la porte de l’allée, et ils pénétrèrent facilement dans la boutique.
Le vrai Parisien a toujours des allumettes dans sa poche.
Polyte en avait par conséquent, et il en frotta une avec son ongle.
L’allumette jeta une lueur rapide et fugitive autour d’eux et leur permit d’apercevoir une chandelle sur un sac de charbon.
Polyte approcha l’allumette de la chandelle et se procura ainsi de la lumière.
Ce fut sans doute en ce moment que Chapparot ivre revint, aperçut une lumière, s’imagina que la justice faisait une descente chez lui et prit la fuite.
– Et si les locataires nous voient traverser la cour ? dit encore Pauline toute tremblante.
– Vous dites qu’ils sont couchés ?
– Je le crois.
– J’aimerais mieux aller sans lumière, dit Polyte ; mais ce n’est pas possible, car je ne connais pas assez bien les lieux et vous pourriez tomber dans la citerne.
La porte qui s’ouvrait de la boutique dans la cour était fermée en dedans par un simple verrou que Polyte força.
La cave demeurait ouverte, le charbonnier ayant seul la jouissance de la cour.
Polyte montra la planche à bascule qui recouvrait la citerne à Pauline, tout émue, puis il prit la clef qu’il avait vu Chapparot mettre sur la poutre, et ils descendirent, dans la seconde cave.
L’enfant gémissait toujours.
Au moment où la porte de sa prison s’ouvrit, il se retourna et essaya de se débarrasser de ses liens, en même temps qu’un cri d’effroi lui échappait.
Mais Pauline le prit dans ses bras en disant :
– Pauvre petit !
Et, au son de cette voix ferme et franche, l’enfant cessa de se plaindre, et, tandis que Polyte le débarrassait de ses liens, il regardait Pauline et semblait comprendre que le ciel lui envoyait des libérateurs.
Un quart d’heure après, Ralph était dans les bras de Jenny l’Irlandaise.
Mais alors Polyte, épuisé, se laissait tomber sur une chaise, fermait les yeux et s’évanouissait devant sa vieille mère éperdue…
LI
Donc Chapparot s’était enfui.
De dix heures du soir à quatre ou cinq heures du matin, que devint-il ?
Nul n’aurait pu le dire.
Seulement, un peu avant le jour, nous l’eussions retrouvé rue de Lyon, marchant d’un pas inégal, la tête penchée, le visage farouche.
Chapparot, bien convaincu que la justice était sur ses traces, trouvait l’air de Paris malsain.
Il y avait un train du matin qui partait pour Lyon, à cinq heures quarante-cinq minutes.
Chapparot s’était dit :
– Je prendrai ce train jusqu’à Montereau ; là je descendrai et je filerai sur la ligne de Mulhouse, et je puis être la nuit prochaine en Suisse. Ils n’auront pas ma sorbonne…
Et le charbonnier, songeant ainsi, prenait sa tête à deux mains et semblait se vouloir assurer qu’elle tenait encore sur ses épaules.
Or, nous le savons, Chapparot avait de l’argent, un rouleau de cinquante louis que M. James lui avait mis dans la main comme acompte.
Un Auvergnat qui a mille francs sur lui peut faire le tour du monde.
Chapparot s’en allait donc prendre un billet de troisième pour Melun, pressé qu’il était de dérouter les recherches de la police et de lui faire perdre ses traces.
Il arriva dans la gare, où il y avait très peu de voyageurs, voulut se diriger vers le guichet des billets et s’arrêta brusquement sous l’horloge.
Chapparot venait d’apercevoir deux gendarmes installés aux deux côtés du guichet et qui paraissaient examiner attentivement chaque personne qui prenait son billet.
Chapparot n’eut pas même l’ombre d’un doute.
Les gendarmes étaient là avec mission de l’arrêter, et au lieu d’avancer vers le guichet, il battit précipitamment en retraita et sortit de la gare.
Il redescendit rue de Lyon, non sans jeter un regard louche à la prison de Mazas, qui est voisine de l’embarcadère, et, comme les gens timorés sont en proie à une soif inextinguible, il entra chez le premier marchand de vin qu’il trouva ouvert.
Un groupe d’hommes, des ouvriers du chemin de fer pour la plupart, entouraient le comptoir et causaient avec animation.
– Qu’est-ce qu’il faut vous servir ? demanda le garçon marchand de vin.
– Un cuivre, répondit Chapparot d’un ton farouche.
Un cuivre, c’est un verre d’absinthe.
Et, tandis qu’on le servait, il écouta ce que disaient ces hommes, et, dès les premiers mots, il tressaillit et dressa l’oreille.
– Avec tout cela, disait le marchand de vin, on ne l’a pas arrêté ?
– Bah ! il sera pincé avant ce soir.
– Pas sûr.
Un facteur du chemin de fer se mit à sourire :
– Ça n’est plus comme dans le temps d’autrefois, dit-il ; on ne se cache pas comme on veut, à Paris ; la police a le nez partout, et elle vous trouve les voleurs et les assassins, comme un chien de chasse, des perdreaux dans une luzerne.
– Le jeune homme est-il mort ?
– Pas encore, mais il n’en vaut guère mieux.
– Pauvre garçon !
– C’est tout de même un fameux brigand, l’autre !
– Peuh ! dit un philosophe, paraît qu’il avait soiffé, un pochard, c’est capable de tout.
Chapparot écoutait, et la sueur perlait à son front ; néanmoins, il n’osait sortir trop précipitamment, de peur d’attirer l’attention sur lui.
Il buvait donc à petits coups son verre d’absinthe, et les ouvriers continuaient à s’entretenir d’un assassinat qui avait fait grand bruit, paraît-il, dans le quartier.
Pour Chapparot, la chose était claire ; le jeune homme dont on parlait, c’était Polyte ; l’assassin qu’on recherchait, c’était lui.
Un des ouvriers du chemin de fer, dit encore :
– Il ne partira toujours pas par chez nous, il y a des gendarmes au guichet.
– Mais le reconnaîtront-ils ?
– Je le reconnaîtrais bien, moi, si je le voyais.
À ces derniers mots, Chapparot regarda l’homme qui parlait ainsi et se dit :
– Je vois pourtant cet homme-là pour la première fois.
Le marchand de vin ajouta :
– Il a logé ici, il y est venu souvent ; je n’aurais jamais cru qu’il fût capable d’un coup pareil.
Chapparot regarda le marchand de vin, comme il avait regardé l’ouvrier.
– Je ne suis jamais venu ici, pensa-t-il, ce n’est donc pas de moi qu’il s’agit !
Or, comme il avait fini son verre d’absinthe, il dit au marchand de vin en posant trois sous sur le comptoir :
– Il y a donc du nouveau par ici, ce matin ?
– Il y a, répondit un des ouvriers, qu’un Piémontais qui travaillait dans le passage d’Orient, à deux pas d’ici, a assassiné son camarade de garni, cette nuit, et qu’il a filé, emportant une centaine de francs que le pauvre jeune homme s’était mis de côté.
Chapparot respira bruyamment.
L’ouvrier continua :
– On croit qu’il n’a pas quitté le quartier, et c’est probable, car il aura songé à filer par le chemin de fer.
Ce n’était donc pas pour Chapparot que les gendarmes stationnaient auprès du guichet, dans la gare de Lyon !
Et Chapparot sortit du cabaret et il remonta vers la gare.
Mais un quart d’heure s’était écoulé depuis qu’il était sorti, et un coup de sifflet lui apprit que le train partait. Il était trop tard.
Un employé de service qui l’avait vu arriver en courant lui dit :
– Vous avez le temps d’attendre, mon brave homme, il n’y a plus de train qu’à onze heures quarante du matin.
Mais Chapparot ne se trouva désappointé qu’à demi, et il quitta la gare en se disant :
– J’ai la venette trop vive. Qui sait si seulement on me cherche ?
Il s’en revint donc vers la Bastille et prit le boulevard Richard-Lenoir, c’est-à-dire le bord du canal.
En suivant ce chemin, il se rapprochait de son quartier.
La peur, qui étreignait Chapparot naguère, avait fait place à un autre sentiment.
Il voulait savoir si on avait trouvé le cadavre de la victime et si on parlait de lui ; car enfin, il pouvait se faire que ce ne fût pas la justice qui se fût introduite chez lui la nuit précédente.
De marchand de vin en marchand de vin, le charbonnier arriva au boulevard du Prince-Eugène.
Partout, il buvait une goutte ; partout, il écoutait ce qu’on disait.
Chacun parlait de ses affaires, mais Chapparot n’entendait rien qui pût lui faire supposer que son crime était découvert.
Il arriva ainsi jusqu’à Ba-Ta-Clan.
Tout auprès de cet établissement pittoresque il y a un fruitier qui donne à boire.
Chapparot entra chez lui.
Le fruitier le connaissait et lui fit bon accueil.
Chapparot était déjà à moitié ivre, et l’ivresse lui donnait du courage.
Comme la boutique du fruitier était très fréquentée, le charbonnier en conclut que personne dans le quartier ne savait rien.
Et, sortant de ce dernier cabaret, Chapparot remonta vers la rue Saint-Ambroise.
Auprès de l’église il y a un perruquier, dont l’établissement est un foyer à cancans et où se débitent toutes les nouvelles du quartier.
De plus en plus enhardi, Chapparot entra chez le perruquier et demanda qu’on lui fît la barbe.
Le perruquier, tout en lui rasant le menton, lui parla de mille choses ; mais il ne fut question ni d’assassinat, ni de cadavre trouvé sur l’esplanade, qui était à deux pas de là.
Alors Chapparot se dit :
– Puisque je suis venu jusqu’ici, autant aller faire un tour à la maison.
Et il prit le chemin du passage des Amandiers.
LII
Après avoir eu si peur, Chapparot était devenu tout à fait brave. Il entrait même dans un accès de crânerie.
Il traversa l’esplanade.
– Je veux voir s’il y a du sang, se disait-il.
Mais la terre, détrempée par le brouillard de la nuit, ne portait aucune trace de sang, et le corps de Polyte, – car Chapparot croyait bien l’avoir tué, – avait disparu.
Le charbonnier se dirigea en droite ligne vers le passage.
Il y avait un marchand de vin à l’entrée, à gauche.
Chapparot passa devant, puis revint sur ses pas, puis passa devant une fois encore.
À la fin, le marchand de vin lui cria :
– Hé ! Chapparot ?
Le charbonnier s’arrêta.
– Apportez-moi donc un sac de charbon ! lui dit le marchand de vin.
Alors Chapparot s’approcha.
– Vous avez donc fait la noce hier soir ? demanda le mannezingue.
– Pourquoi ça ? fit Chapparot.
Et il regardait son interlocuteur avec inquiétude.
– J’ai frappé à votre porte ce matin, reprit le débitant.
– Ah !
– Et vous n’avez pas répondu…
– C’est vrai, dit Chapparot, j’ai trouvé des pays hier soir, nous avons bu un coup ensemble et j’étais un peu chaviré en rentrant.
– Ça arrive aux plus malins, dit le marchand de vin avec indifférence.
Chapparot lui dit :
– Je vais vous chercher votre charbon.
Et il se dirigea vers sa boutique.
En passant, il jeta un coup d’œil dans celle des blanchisseuses.
La petite Pauline était à son ouvrage, comme d’ordinaire.
Chapparot eut un battement de cœur, puis il se retourna brusquement et regarda sa propre boutique.
La porte en était fermée.
Cela lui donna du courage.
Il se glissa dans l’allée, mit la main sous la planche et y trouva la clef.
Quelques femmes, quelques enfants, qui se trouvaient au seuil des maisons, l’avaient regardé comme les autres jours, avec la même indifférence.
Chapparot était, du reste, coutumier du fait.
Il se grisait souvent depuis la mort de sa femme, et, dans ce cas-là, sa boutique était fermée bien après le lever du soleil.
Il trouva donc la clef, ouvrit la porte qui mettait en communication sa boutique avec l’allée et entra.
La boutique ne portait les traces d’aucun désordre. On n’avait rien pris, rien dérangé.
– Mais ce n’est donc pas la justice qui est venue chez moi cette nuit ! pensa Chapparot.
Et il se prit à songer.
Chapparot avait rarement de l’argent chez lui. Quand il avait amassé quelques sous, il les portait à la Caisse d’épargne et ne gardait pas plus d’une centaine de francs.
Le charbonnier se souvint qu’il avait laissé une somme à peu près pareille et en toutes sortes de monnaies dans un tiroir qui fermait à clef.
Il visita le tiroir extérieurement et constata qu’il n’avait pas été forcé.
Il l’ouvrit ensuite et retrouva son argent.
Qui donc s’était introduit chez lui, si ce n’était la justice ou bien des voleurs ?
Alors Chapparot songea à l’enfant qu’il avait enfermé dans un caveau.
L’enfant était-il parvenu à se délivrer ? C’était peu probable, car il était solidement attaché, et, d’ailleurs, la serrure était bonne.
Mais, en même temps, il songea à sir James.
Le détective lui avait confié Ralph pour vingt-quatre heures, mais il pouvait se faire qu’il eût changé d’avis et que, ayant besoin de l’enfant et ne trouvant pas le charbonnier, il eût cherché et trouvé les moyens de pénétrer dans la boutique.
Pour s’en assurer, Chapparot prit sa chandelle et se dirigea vers la petite cour qui conduisait à la cave de la citerne et ensuite à la cave souterraine.
Dans cette première, rien n’était dérangé.
Seulement, ayant passé la main sur la poutre pour y chercher la clef du caveau, Chapparot ne la trouva pas.
Alors il descendit précipitamment dans le couloir souterrain et s’arrêta ensuite stupéfait.
La porte du caveau était grande ouverte, le caveau était vide et l’enfant avait disparu.
Chapparot jeta un cri de rage.
Pour lui, la chose était maintenant évidente, c’était sir James qui était venu chercher l’enfant.
Seulement, pour les coquins, tout homme est encore plus coquin qu’eux.
– Ah ! le brigand ! murmura Chapparot ; c’est pourtant pour ne pas me donner les autres mille francs qu’il m’a fait ce tour-là !
Il n’eut pas un seul instant la pensée qu’une autre personne que l’Anglais fût venue délivrer le fils de l’Irlandaise. Mais, outre la perte probable de son second billet de mille francs, une chose l’inquiétait de plus en plus :
Qu’était devenu Polyte ?
Était-il mort ou vivant ?
S’il était mort, d’où venait que personne ne s’en était ému ?
Et si, ce que Chapparot commençait à admettre, le jeune homme, simplement blessé, était revenu à lui et s’était traîné quelque part, comment se faisait-il qu’il n’avait pas porté plainte au commissaire et que lui, Chapparot, n’était nullement surveillé ?
Car, enfin, Chapparot n’avait point perdu la mémoire.
Il se souvenait parfaitement qu’au moment où il avait pris Polyte à la gorge, celui-ci l’avait non seulement accusé d’avoir assassiné sa femme, mais encore d’avoir jeté l’Anglaise dans la citerne.
Comment ce jeune homme savait-il cela ?
Chapparot se posa toutes ces questions sans pouvoir en résoudre aucune.
Sans cesse partagé entre la peur d’être arrêté et le désir de rester tranquillement chez lui, en proie, par conséquent, à une hésitation perpétuelle, le charbonnier finit par demeurer toute la journée à sa boutique.
Nul ne s’occupa de lui dans le passage.
Comme à l’ordinaire, il alla chez les pratiques, portant du charbon aux unes, de l’eau aux autres.
Comme à l’ordinaire aussi, il jeta de tendres regards du côté de la Boutique des blanchisseuses, et mam’zelle Pauline ne fit aucune attention à lui et ne quitta pas son ouvrage des yeux.
La journée s’écoula.
Chapparot s’en retourna prendre son repas du soir chez le marchand de vin, où il fut accueilli comme de coutume.
Alors il s’en revint au logis et se mit au lit, murmurant :
– Le plus clair de tout cela, c’est que je suis floué de mille francs.
À trois heures du matin, Chapparot dormait profondément lorsqu’il fut éveillé en sursaut.
On frappait rudement à la porte.
– Ah ! cette fois, murmura-t-il, je suis pincé ! J’aurais dû m’en méfier.
Cependant il se leva, et, d’une voix étranglée, il demanda qui frappait.
– Moi, répondit une voix.
– Qui, toi ?
– Jean, le boucher de Passy.
Chapparot respira. Il connaissait le boucher de Passy pour l’avoir rencontré souvent autrefois au cabaret, s’être lié avec lui, et avoir fini par lui emprunter une somme de 800 francs, dont il lui servait l’intérêt.
Chapparot ouvrit.
Alors Jean le Boucher, – Jean le Bourreau, comme on l’appelait jadis au bagne, – entra dans la boutique, et lui dit :
– Je viens chercher l’enfant et sa mère.
– Hein ? dit Chapparot.
– L’enfant irlandais et la femme irlandaise qu’on t’a confiés, acheva Jean avec le calme et l’assurance d’un homme qui sait parfaitement ce qu’il demande.
LIII
Jean le Boucher n’était pas seul.
Il était suivi d’un jeune homme à petites moustaches noires qui referma la porte que le charbonnier venait d’ouvrir, de telle façon qu’ils se trouvèrent seuls tous les trois dans la boutique.
Chapparot était devenu très pâle en entendant parler de l’Irlandaise.
Cependant il balbutia :
– Je ne sais pas ce que vous voulez dire, je n’ai vu ni Irlandaise ni Irlandais.
Alors le jeune homme aux moustaches noires se mit à rire :
– Nous te connaissons, mon bonhomme, dit-il, tu vas voir…
Et il tira de sa poche un revolver.
Chapparot avait bien un couteau ; mais une balle va toujours plus loin.
– Ce que je te montre là, dit Marmouset, car on a deviné que c’était lui, n’est que pour te bien faire comprendre qu’il ne faut pas faire le méchant avec nous. Mais ce n’est pas mon seul argument. Regarde !
Marmouset s’était assis devant la table graisseuse sur laquelle Chapparot prenait son repas du matin.
Il avait posé le revolver à côté de lui.
Il déboutonna sa redingote, tira un portefeuille de sa poche et l’ouvrit.
Des billets de mille francs s’en échappèrent et tombèrent sur la table.
L’œil du charbonnier étincela.
Cet homme, qui tenait autant de la brute que de l’espèce humaine, avait avant tout la soif de l’or.
Avec de l’or on l’eût conduit au bout du monde.
Quand il vit les billets, il ne songea plus qu’à une chose, c’est que l’Anglais lui volait mille francs, puisqu’il avait emmené l’enfant sans achever de le payer.
Marmouset devina ce qui se passait dans l’âme de Chapparot.
– Si tu veux de l’argent, dit-il, il faut parler. Voilà d’abord mille francs.
Et il poussa un des billets en avant des autres.
Chapparot étendit la main convulsivement.
– Un instant ! dit Marmouset, il faut nous dire auparavant ce que tu as fait de l’enfant.
– Ma foi ! répondit le charbonnier dont l’œil brûlant de convoitise était rivé au billet de banque, puisque vous savez de quoi il retourne, je vais tout vous dire. Je crois que l’Anglais m’a floué.
– Ah !
– Il m’avait promis deux mille francs.
– Et il ne te les a pas donnés ?
– Il m’en a donné la moitié. Je ne devais avoir l’autre que lorsqu’il reviendrait chercher l’enfant.
– Eh bien ?
– Eh bien ! il est revenu l’autre nuit, pendant que je n’y étais pas ; il a repris l’enfant, et j’y suis de mon billet de mille.
Le charbonnier parlait avec une naïveté féroce qui frappa Marmouset.
Évidemment cet homme disait vrai, ou plutôt croyait dire vrai.
– Quelle heure était-il, selon toi, poursuivit Marmouset, quand l’Anglais est revenu ?
– Entre dix et onze heures du soir.
– Hier ?
– Oui.
– Cela est impossible, dit froidement Marmouset qui savait, ce que la veille au soir, sir James avait fait de sa soirée.
Chapparot eut alors un air tout à fait abasourdi.
– Que voulez-vous donc, fit-il, qui soit venu chercher l’enfant ?
– Je ne sais pas, mais ce n’est pas l’Anglais dont tu parles. Et la mère, où est-elle ?
Chapparot tressaillit, mais il ne répondit pas.
– Parle, dit Marmouset d’un ton d’autorité, et le billet de mille est à toi.
Chapparot le regardait avec des yeux enflammés.
Cependant deux opinions se combattaient en lui :
L’une était que Marmouset était un homme de la police et qu’il lui tendait un piège ;
L’autre, que cet enfant dont il était question devait valoir beaucoup d’argent, puisqu’on se battait pour lui à coups de mille francs.
La cupidité de Chapparot triompha de la prudence ; l’ombre de l’échafaud entrevue un moment par son esprit troublé, s’effaça, et l’appât du gain lui délia la langue.
– La mère, dit-il, je l’ai tuée.
Jean le Boucher eut un geste d’horreur.
Mais Marmouset ne sourcilla pas et conserva ce sang-froid terrible qu’il avait hérité de Rocambole.
– Et comment l’as-tu tuée ? dit-il.
En parlant ainsi, il poussa tout à fait le billet de mille francs, et le charbonnier mit sa large main dessus.
– Je l’ai noyée.
– Dans le canal ?
– Non, dans une citerne.
– Où est-elle ?
– Si vous voulez venir avec moi, je vais vous y conduire.
– Allons, dit Marmouset, et rappelle-toi que si tu fais mine de t’échapper, je t’envoie une balle dans la tête.
Chapparot fit un signe qu’il n’en avait nulle envie.
Mais il mit le billet de mille francs dans sa poche.
Marmouset ne fit aucune opposition.
Alors l’Auvergnat raconta en quelques mots et avec un cynisme effrayant ce qui s’était passé dans la cave, et comment l’Irlandaise, en posant le pied sur la planche à bascule, avait été précipitée dans la citerne.
– Allons voir l’endroit répliqua Marmouset.
Chapparot alluma la chandelle à palette de fer et ouvrit ensuite la porte de la cave.
– Conduis-nous, et souviens-toi de ce que je t’ai dit, fit Marmouset.
Ils arrivèrent dans la cave.
Mais là, Chapparot fut repris de cette étrange émotion qui s’était emparée de lui la veille, quand il avait voulu soulever la planche et regarder dans la citerne.
Cet homme tuait, mais quand il avait tué, il n’osait plus se trouver face à face avec sa victime.
– Ah ! regardez si vous voulez, dit-il, mais moi je ne veux pas.
Il était devenu tout pâle, et un tremblement convulsif lui parcourait tout le corps.
Marmouset lui prit la chandelle des mains ; puis, sur un signe qu’il fit à Jean le Boucher, celui-ci souleva la planche.
Marmouset se pencha.
– Elle doit flotter sur l’eau, disait Chapparot d’une voix étranglée.
– Je ne vois rien, dit Marmouset ; ah si ! je vois une échelle !
– Une échelle ?
– Oui.
– Et pas de femme ?
– Aucune femme, rien.
Le courage revint à Chapparot. Il osa s’approcher de la citerne, se baissa timidement d’abord, puis s’enhardit et finit par se convaincre, grâce à la chandelle dont Marmouset dirigeait les rayonnements dans tous les sens, au-dessous du plancher de la cave, qu’aucun cadavre ne surnageait.
En revanche, une échelle flottait.
– C’est drôle, dit Chapparot, il n’y avait pas d’échelle dans la citerne. Qui donc est descendu dedans ?
– Tu crois donc que quelqu’un est descendu ?
– Oui, dit Chapparot.
Il y avait une longue perche dans la cave, et au bout de cette perche un crochet.
Chapparot la prit, la plongea dans la citerne, attira et saisit l’échelle par un bout et la hissa hors de la citerne.
– Le bois n’est pas pourri, dit-il ; il n’y a pas longtemps qu’elle est dans l’eau.
Puis il avisa une marque noire faite sur un des montants.
Cette marque était un chiffre grossièrement entrelacé et obtenu avec un fer rougi.
– C’est la marque du charron, dit-il.
– Quel charron ?
– Celui qui avait la boutique de la maison voisine et avec qui la citerne était commune. On sera venu par là pour chercher l’enfant, et c’est bien sûr maintenant que la mère s’est sauvée.
Marmouset ouvrit de nouveau son portefeuille.
– Il y a un second billet de mille pour toi, dit-il, si tu parles clairement.
Cette fois Chapparot triompha tout à fait de son émotion et il retrouva son cynisme. Marmouset attendait !…
LIV
Chapparot était une de ces natures aux appétits féroces, à l’instinct bestial, qui semblent avoir été créées pour le mal.
Il aimait l’argent ; il avait des passions brutales que rien n’arrêtait, pas même la peur de l’échafaud.
Mais, par cela même, il avait une certaine dose d’intelligence ou plutôt de sagacité qui n’excluait pas l’esprit d’analyse.
L’échelle pêchée dans la citerne et qui portait le chiffre du charron était pour lui toute une révélation.
Marmouset et Jean le Boucher, le voyant pensif, attendirent patiemment le fruit de ses réflexions.
– Écoutez-moi bien, dit enfin Chapparot.
Et il regarda ces deux hommes, non plus comme des ennemis au pouvoir absolu desquels il était tombé, mais comme des associés qui allaient lui payer son dividende social en beaux deniers comptant.
– Parle, dit Marmouset.
– Quand nous sommes venus ici, dit Chapparot, l’Anglais, la femme et son fils, l’Anglais qui avait visité la cave auparavant, marchait le premier, donnant la main au petit et il a eu bien soin de ne pas mettre le pied sur la planche.
Moi, j’étais derrière, et la femme marchait après lui.
Je l’ai un peu poussée, elle a mis le pied sur la planche et elle est tombée en jetant un grand cri.
– Et puis ? demanda Marmouset.
– Et puis nous avons entendu un clapotement sous nos pieds.
– Et plus rien ?
– Plus rien, à telle enseigne que nous avons pensé qu’elle s’était noyée tout de suite.
– Mais, reprit Chapparot, c’était le petit qui criait, et nous l’avons emporté.
– Sans vous assurer que la mère était morte ?
– Ma foi, oui ! dit Chapparot tranquillement.
– Après ?
– Après, dame ! je suis revenu… et je me suis mis à chercher une chandelle que je mettais ordinairement dans ce trou.
Et Chapparot montra le trou pratiqué dans le mur.
– Ah ! fit Marmouset, et alors ?…
– Alors je n’ai plus trouvé la chandelle. J’ai pensé que, dans la bagarre, j’avais un peu perdu la tête, et je m’en suis retourné à la boutique.
– Et la chandelle n’y était pas ?
– Non. J’ai pris mes allumettes, je suis revenu… et j’ai trouvé ma chandelle dans le trou.
Alors je suis descendu porter à manger au petit que j’avais enfermé en bas, dans un caveau. Puis, je suis remonté et j’ai voulu regarder dans la citerne, mais le cœur m’a manqué.
– Eh bien ! dit Marmouset, qu’est-ce que ça prouve ?
– Attendez donc ! je puis bien ne vous rien cacher, puisque vous casquez de l’argent. Faut donc vous dire que j’ai un coup de soleil pour une petite qui est blanchisseuse dans le passage.
Ça n’est pas défendu, n’est-ce pas ?
– Non, dit Marmouset.
– J’avais déjà vu plusieurs fois un grand flandrin qui lui faisait de l’œil et lui parlait. Ça m’a monté la tête. Quand il est sorti du passage, je l’ai suivi.
– Ah ! ah !
– Et je lui ai tombé dessus à coups de poing, à coups de pied, je crois même que je lui ai donné un coup de couteau.
– Mais, fit Jean le Boucher, tout cela ne nous dit pas…
Chapparot continua :
– Comme je sautais dessus, il m’a appelé assassin. J’ai cru qu’il parlait de ma femme, qu’on dit que j’ai escoffiée. Mais non, c’était de l’Anglaise, à preuve qu’il m’a dit que je l’avais jetée dans la citerne.
– Ah ! il a dit cela !
– Alors j’ai tout à fait perdu la tête, je lui ai planté mon couteau dans le ventre et je me suis sauvé.
– Et qu’avez-vous fait ensuite ?
– Ce qu’on fait toujours après un mauvais coup : j’ai mangé, j’ai bu et je me suis promené ; et puis, je suis revenu et j’ai vu de la lumière dans ma boutique. Je me suis imaginé que la police était chez moi et je me suis sauvé de nouveau.
– Et alors ?
– Alors j’ai fait ce qu’on fait encore et toujours dans ces moments-là : je suis allé de mannezingue en mannezingue jusqu’à minuit, buvant ici de l’absinthe, là de l’eau-de-vie, et quand les mannezingues ont été fermés, je suis allé voir les dames. Bast ! j’avais de l’argent. Le matin, j’ai voulu filer, mais j’ai eu l’idée qu’on ne me cherchait peut-être pas, et je suis revenu, et personne ne m’a rien dit.
Quand j’ai vu ça, je me suis souvenu de la lumière et j’ai imaginé que c’était l’Anglais qui était revenu et avait emmené le petit, en me flouant de mes mille francs. Les Anglais, tous canailles ! Ils vous font voir le tour en un rien de temps.
Pendant ce long récit, Jean le Boucher, impatient, avait voulu parler plusieurs fois, mais Marmouset lui avait fermé la bouche.
Chapparot reprit :
– Faut croire, maintenant, que je m’étais trompé, et je vais vous dire mon idée.
– Voyons ?
– La citerne est commune entre les deux maisons, celle où nous sommes et une autre qui est dans la rue des Amandiers.
– Ah ! fit Marmouset.
– Chacune a son puisard. Vous connaissez celle-ci ; il y en a une autre dans la boutique du charron.
Le charron a donné congé et la boutique est à louer.
– Fort bien. Et puis ?
– Je me figure donc que la femme, en tombant à l’eau, a perdu connaissance.
– C’est possible.
– Puis, quand elle est revenue à elle, l’Anglais et moi nous étions partis. Alors, elle se sera mise à crier, et on l’aura entendue de la boutique du charron.
– Mais puisque la boutique est à louer ?
– Ça ne fait rien. Il y avait peut-être quelqu’un dedans à ce moment-là.
– Eh bien ?
– On aura repêché l’Anglaise au moyen de cette échelle.
– C’est probable, fit Marmouset ; mais l’enfant ?
– Je vous ai dit que ma chandelle avait disparu un moment, et puis que je l’avais retrouvée.
– Oui.
– Je suppose que c’est le grand flandrin qui a repêché l’Anglaise.
– Bon !
– Et puis qu’il sera venu dans la cave ici, en traversant la citerne à la nage et en se servant de l’échelle pour monter.
– Fort bien, et puis ?
– Quand je suis venu, il se sera caché et aura éteint précipitamment la chandelle ; puis il se sera dissimulé derrière un tas de bois.
On le voit, Chapparot reconstruisait assez bien la vérité.
– Continuez, dit Marmouset.
– C’est alors que je me suis en allé chercher des allumettes, dit Chapparot.
– Et pendant ce temps il aura replacé la chandelle.
– Oui, et il se sera caché encore une fois. Seulement, comme je suis descendu porter à manger à l’enfant, il aura vu où je mettais la clef du caveau.
– Je commence à comprendre, dit Marmouset.
– Et puis il se sera en allé par où il était venu ; mais c’est lui qui, quelques heures plus tard, sera revenu chercher l’enfant.
– Mais puisque vous dites l’avoir tué ?
– Je l’ai cru ; mais si je l’avais tué, on l’aurait trouvé, et ça aurait amené du grabuge. Mon couteau aura glissé entre deux côtes.
– Ah !
Comme Chapparot terminait ce récit, on entendit un grand bruit au delà de la cour.
On frappait à la porte de sa boutique et une voix disait :
– Au nom de la loi, ouvrez !
Et Chapparot jeta un cri, et sentit ses cheveux se hérisser.
LV
Qui donc frappait au nom de la loi ?
Évidemment ce ne pouvait être que le commissaire de police, et nous allons voir comment il avait été prévenu.
On s’en souvient, quand Polyte eut rendu l’enfant à sa mère, il s’affaissa sur une chaise et perdit connaissance.
Alors sa mère jeta un cri et se précipita sur lui.
Mais Pauline se remit :
– Ne craignez rien, madame, dit-elle ; sa blessure est légère.
– Il est donc blessé ? s’écria la portière.
– Oui.
– Comment ? par qui ? Ah ! mon Dieu !
– C’est le charbonnier qui lui a donné un coup de couteau.
L’Irlandaise n’entendait que quelques mots de français ; mais la pantomime que Pauline ajoutait à son récit était si expressive, que rien ne lui échappa.
On coucha Polyte, on le déshabilla, on lui fit respirer du vinaigre, ce sel anglais des pauvres gens, et il ne tarda pas à rouvrir les yeux.
Alors un sourire éclaira son visage pâle :
– C’est bon tout de même, dit-il, de faire son devoir une fois dans sa vie.
Il regarda sa mère anxieuse et les yeux pleins de larmes, il vit l’Irlandaise qui pressait son fils sur son cœur, il leva sur la petite blanchisseuse un regard de reconnaissance et, prenant la main de la petite fille, il la mit dans la main de sa mère en lui disant :
– Regarde-la bien ; sans elle, je serais peut-être mort.
Une bourgeoise aurait accueilli la grisette avec une froide réserve ; mais la mère de Polyte était du peuple, et le peuple a de nobles sentiments.
Elle prit la jeune fille dans ses bras et lui dit :
– Je ne sais pas qui tu es, mais je me doute bien que tu es la bonne amie de mon garçon, et tu es gentille à croquer, mon petit amour, et aussi vrai que je m’appelle la mère Vincent, s’il veut t’épouser, ce n’est pas moi qui refuserai mon consentement.
– Hé, dit Polyte, à qui sa bonne humeur de gamin de Paris revint, te voilà Mme Vincent, Pauline. C’est comme si le maire avec son écharpe et le curé avec son étole y avaient passé.
Cette première émotion calmée, Polyte dit à sa mère :
– Maintenant, maman, il s’agit d’être sérieux – et de ne pas faire des bêtises, hein ? c’est grave, ce que je vous dis là.
– Je te promets que je tiendrai ma langue, répondit la portière.
– Bien vrai ?
– Foi de mère Vincent. Veux-tu que je le jure sur la mémoire de ton pauvre père ?
– Non, je vous crois, maman.
Alors Polyte organisa un véritable plan de campagne.
Il était évident que Chapparot, croyant l’avoir tué, ne rentrerait pas cette nuit-là.
Et Polyte disait :
– Ce n’est pas la peine de mettre la police sur pied par avance, il vaut mieux attendre qu’il revienne.
Pauline partagea cet avis.
La mère Vincent reconduisit la jeune fille chez sa mère, et quand elle quitta Polyte, il fut convenu qu’elle irait dès le lendemain matin à sa boutique, comme à l’ordinaire, et ne soufflerait mot de rien à ses camarades de l’atelier.
La mère de Pauline, qui était ouvreuse dans un théâtre, n’était pas rentrée encore.
Pauline n’eut donc aucune explication à lui donner.
La nuit s’écoula. Le lendemain, vers neuf heures du matin. Polyte, tout à fait remis, reçut la visite de Pauline.
Sa patronne avait envoyé la jeune fille porter un paquet de linge, et elle en avait profité pour entrer chez la mère Vincent.
Pauline venait de lui apprendre que Chapparot était revenu.
Polyte répondit :
– C’est bien, on le pincera ce soir.
En effet, vers six heures, comme le charbonnier s’en allait à son cabaret prendre son repas, Polyte alla chez son ancien patron, le commissaire de Belleville, qui avait eu de l’avancement et qu’on avait envoyé dans Paris, rue du Chemin-Vert.
Le commissaire avait renvoyé Polyte parce qu’il était paresseux ; mais il avait eu plusieurs fois l’occasion d’apprécier son intelligence et sa sagacité.
Or, Polyte lui venait faire une déposition si nette et si précise que le commissaire ne douta pas une minute de l’exactitude scrupuleuse de ses renseignements.
Après quoi il donna des ordres en conséquence.
À partir de ce moment le charbonnier fut surveillé. On le suivit quand il alla prendre son repas ; on le vit rentrer chez lui, et si son arrestation n’avait pas été opérée immédiatement, c’est que Polyte avait demandé qu’elle se fit la nuit, afin que ni lui ni Pauline, décidés qu’ils étaient à se marier, ne fussent compromis par un esclandre.
Donc, tandis que Chapparot racontait naïvement ses forfaits, les fameux mots « Ouvrez, au nom de la loi ! » s’étaient fait entendre.
Et Chapparot était devenu tout tremblant, levant sur ces deux hommes qu’il considérait déjà comme ses deux complices, un regard suppliant.
Mais Marmouset changea soudain d’attitude et dit sèchement :
– Eh bien ! tu ne vas pas attendre que le commissaire fasse enfoncer la porte ? tu vas aller ouvrir, j’imagine ?
– Mais, balbutia Chapparot, on vient m’arrêter !
– C’est probable.
– Sauvez-moi, vous !
Marmouset se mit à rire.
– Mon bonhomme, dit-il, ce n’est pas nous qui avons averti la police ; nous avons coutume de faire nous-mêmes nos petites affaires ; mais du moment où un autre t’a dénoncé, si on vient te pincer, ce n’est pas nous qui nous y opposerons.
Et comme on frappait, pour la seconde fois, Jean le Boucher alla ouvrir.
Le commissaire, ceint de son écharpe, entra suivi de deux agents et d’un troisième personnage que Chapparot reconnut.
C’était Polyte.
Le commissaire alla droit au charbonnier et lui dit :
– Au nom de la loi, je vous arrête !
Chapparot, le féroce Auvergnat, était tellement anéanti par cette apparition qu’il ne songea même pas à opposer la moindre résistance.
Les deux agents s’emparèrent de lui et le fouillèrent.
Il avait un couteau sur lui, on le lui prit.
Alors le commissaire, regardant Marmouset et Jean le Boucher :
– Qui êtes-vous donc, messieurs ? fit-il vivement.
Jean répondit le premier :
– Je m’appelle Jean et je suis boucher à Passy, rue du Télégraphe.
– Et vous, monsieur ? fit poliment le commissaire en s’adressant à Marmouset.
– Monsieur le commissaire, répondit ce dernier, je suis M. Peytavin, rentier, demeurant rue Auber, n° 1.
Et il tira sa carte de sa poche.
– Ah ! fit le commissaire étonné, pourquoi donc êtes-vous ici ?
– Monsieur le commissaire, répondit Marmouset, nous sommes venus demander à cet homme des nouvelles d’une femme qu’il a tenté d’assassiner et d’un enfant qu’il a séquestré.
Mais comme Marmouset disait cela, Polyte s’écria :
– Rassurez-vous monsieur, la mère et l’enfant se portent bien, et je puis vous en donner des nouvelles.
Alors Marmouset regarda Polyte, qui souriait et dont le regard brillait d’intelligence.
LVI
Il y eut un petit moment de silence et presque d’hésitation.
Le Parisien est sobre de paroles ; de plus, il comprend à demi-mot.
Marmouset était, comme Polyte, un enfant de Paris.
Tous deux se voyaient pour la première fois, mais tous deux se comprirent d’un regard, comme des gens qui se connaissent de longue date.
Marmouset se revoyait dans Polyte, tel qu’il était à dix-huit ans.
Polyte devinait dans ce gandin qui semblait sortir du club un enfant des faubourgs.
Le regard qu’ils échangèrent voulait dire :
– Soyons prudent devant le quart d’œil.
Alors Marmouset dit au commissaire :
– Monsieur, voilà un homme qui aura sans doute à répondre de plusieurs crimes devant vous ; c’est son affaire et non la mienne. Seulement, permettez-moi d’éclairer d’un mot la situation.
Marmouset parlait avec une certaine autorité qui impressionna le magistrat.
– Je vous écoute, monsieur, dit-il.
– Il y a à Paris, dit Marmouset, un agent de police anglais, un détective, qui suit pas à pas, depuis une quinzaine de jours, de pauvres Irlandais accusés de fénianisme.
Le commissaire eut un geste qui voulait dire :
« La France n’est pas chargée de faire les affaires de l’Angleterre. »
Marmouset comprit le geste du commissaire et continua :
– L’Irlande sera toujours sympathique à la France, comme la Pologne, comme toutes les nations opprimées. Les Irlandais dont j’ai l’honneur de vous parler étaient venus en France avec une lettre de crédit sur moi.
Le détective qui les suivait avait, de son gouvernement, la mission de faire disparaître l’homme et la femme et de ramener en Angleterre un enfant à la possession duquel les Anglais attachent une certaine importance.
– Monsieur, dit le commissaire, je sais cela. On m’a transmis une note de la préfecture dans laquelle on me met en garde, car le détective dont vous parlez et qui se nomme, je crois, sir James Wood, avait sollicité l’intervention de la police, intervention qui lui a été refusée, par la raison toute simple que les fenians sont des hommes politiques et non des malfaiteurs.
Je sais donc cela, mais cela uniquement.
– Alors, reprit Marmouset, permettez-moi de continuer.
– Parlez, monsieur.
– Le détective a éloigné l’homme qui accompagnait la mère et l’enfant, puis il a enlevé ces derniers et les a amenés ici, chez cet homme que vous venez arrêter.
– Alors c’est la femme qui a été jetée dans la citerne ?
– Précisément.
– Et l’enfant ?
– L’enfant, dit Polyte, je l’ai délivré et je l’ai rendu à sa mère.
Chapparot était atterré.
– Monsieur, dit le commissaire, si votre témoignage est nécessaire à la justice, elle vous appellera. Pour le moment, vous pouvez vous retirer.
Le charbonnier avait perdu sa sauvage énergie, il sentait qu’il était perdu.
Cependant, quand les agents voulurent s’emparer de lui, il essaya d’opposer une résistance désespérée ; mais malgré sa force herculéenne, les agents le terrassèrent et lui mirent les menottes.
Alors il regarda Polyte avec une expression de haine farouche et lui dit :
– Si on ne me fauche pas, nous nous reverrons !
*
* *
Une heure après, Marmouset, Milon, Shoking et Jean le Boucher étaient réunis dans le grenier qui servait d’asile à l’Irlandaise et à son fils.
Pauline, la petite blanchisseuse, s’y trouvait aussi avec la mère Vincent et Polyte qui leur faisait, avec simplicité, le récit de son héroïque conduite.
Jenny, en voyant Shoking, avait été complètement rassurée.
– Ma chère, disait l’ex-mendiant de Londres, maintenant que nous voilà sous la protection des amis de l’homme gris, nous n’avons plus rien à craindre.
– Oui ! répondit Marmouset, mais l’homme gris, c’est-à-dire Rocambole, a besoin de nous.
– Oh ! dit Shoking, c’est miss Ellen qui dit cela, mais miss Ellen est son ennemie.
– Elle l’était, dit Marmouset.
– Elle l’est toujours !
– Qui sait ? dit encore Marmouset.
Puis, regardant Polyte :
– Tu es un brave garçon, dit-il, un garçon intelligent et de cœur.
Polyte s’inclina avec la dignité d’un homme qui sent ses mérites.
– Tu as donc droit à une récompense pour les services que tu nous as rendus.
Polyte eut un geste de fière abnégation.
– Que veux-tu être ? dit encore Marmouset.
Polyte ne répondit rien, mais il regarda tour à tour sa mère et Pauline, la jolie petite blanchisseuse.
– Mon garçon, dit la mère Vincent, serait bien content si on pouvait lui faire avoir une petite place.
– Oh ! de douze cent francs, dit Polyte.
– Moi, dit Pauline, je me mettrais à mon compte, je louerais une petite boutique, nous nous marierons, et nous serions heureux comme des cousins de l’Empereur.
Marmouset se mit à sourire.
– Et dans quel quartier t’établirais-tu volontiers, ma petite ?
– Par là-bas, vers le boulevard du Temple, le quartier est meilleur.
– Vous aurez votre boutique, mademoiselle.
– Et mon fils sa place ? fit la portière.
– Il l’a, dit Marmouset, j’ai besoin d’un secrétaire : je le prends.
Polyte eut un cri de joie, et la petite blanchisseuse se jeta à son cou.
– À cent louis de traitement, ajouta Marmouset.
– Mère, dit Polyte, pince-moi le bras, j’ai peur de rêver.
– Et, dit Marmouset, comme on ne se marie pas sans argent, mes enfants, laissez-moi vous faire mon cadeau de noce.
Il ouvrit son portefeuille, en tira six billets de mille francs et les tendit à Pauline.
Pauline, rougissant, eut un geste de refus.
– Prends, mon enfant, dit Marmouset, je suis riche, riche de l’héritage d’une pauvre fille qui m’aimait et qui m’a laissé une grande fortune, à la condition que je l’emploierais à faire du bien.
– Arrange-toi de façon à te marier vite, car j’ai besoin de mon secrétaire, et je vais partir pour Londres au premier jour.
– Ah ! mon Dieu ! murmura Pauline, qui entrevoyait une séparation.
– Et tu emmèneras ta femme, ce sera votre voyage de lune de miel. Vous vous établirez au retour.
Pauline se jeta de nouveau au cou de Polyte :
– Ah ! dit-elle, j’ai eu une fière chance de te parler hier, mon bon petit homme !… il y a si longtemps que je t’aimais !
LVII
Revenons maintenant à un personnage de notre histoire que nous avons depuis longtemps perdu de vue.
Nous voulons parler de miss Ellen.
Miss Ellen était à Saint-Lazare.
Comment la fille d’un lord d’Angleterre était-elle confondue avec des filles perdues et des voleuses ?
C’est ce que nous allons expliquer.
Miss Ellen avait été conduite d’abord dans une maison de fous, aux environs de Boulogne, on s’en souvient.
Cette maison n’était pas une maison municipale et elle était dirigée par un médecin indépendant de l’administration.
Cet homme avait consenti, moyennant une somme d’argent relativement considérable, à garder miss Ellen pendant huit jours.
Ce laps de temps paraissait plus que suffisant à sir James Wood, qui attendait l’arrivée de lord Palmure d’un jour à l’autre.
Mais lord Palmure n’arrivait pas et les huit jours s’étaient écoulés.
Le médecin aurait bien gardé miss Ellen huit jours de plus, mais un événement indépendant de sa volonté était venu s’y opposer.
Un jeune docteur attaché à son établissement avait plusieurs fois visité la pauvre fille, causé avec elle et acquis la certitude qu’elle jouissait de la plénitude de sa raison.
Alors il était allé trouver le directeur et lui avait tenu ce langage :
– Vous retenez chez vous une Anglaise qui n’est pas folle ; si d’ici demain vous ne lui avez pas rendu la liberté, ce n’est pas à la police que je m’adresserai, mais aux journaux, et par suite, à l’opinion publique.
Le médecin aliéniste n’était pas très scrupuleux, mais il avait peur du scandale.
Il avait donc écrit en toute hâte à sir James Wood. Celui-ci, fort embarrassé, s’était adressé de nouveau à l’ambassade, et l’ambassade avait insisté auprès de la préfecture de police pour qu’elle donnât à la jeune fille mineure et en puissance paternelle un asile provisoire.
La préfecture n’avait à offrir à sir James Wood d’autre asile que Saint-Lazare.
Par exemple, on avait eu des égards pour miss Ellen.
On l’avait conduite le soir, en voiture fermée, et personne ne l’avait vue entrer.
Puis on lui avait donné une chambre pour elle seule, dans le corridor des sœurs, et attaché à sa personne deux condamnées qui la servaient.
Enfin, on avait évité qu’elle eût le moindre contact avec les femmes de mauvaise vie et les voleuses.
Mais elle était prisonnière et si bien gardée que, dès le premier jour, elle avait renoncé à l’espoir d’une évasion.
Alors une profonde tristesse, un désespoir muet s’étaient emparés d’elle.
Elle songeait à l’homme gris, qui était aux mains de ses juges et à qui l’Angleterre ne pardonnerait pas.
Elle était sans nouvelles du Limousin, le seul homme qui eût un moment ranimé son espérance.
Le pauvre garçon était-il venu la chercher, comme c’était convenu la veille de son enlèvement ?
Avait-il parlé à Milon l’entrepreneur, et ce Milon était-il bien celui qui devait venir à son aide et que l’homme gris attendait à Londres ?
Miss Ellen se posait ces questions nuit et jour dans sa prison, et ne pouvait les résoudre.
Elle ne voyait personne que les deux condamnées qui la servaient et elle n’osait leur faire la moindre question.
Un soir, cependant, comme on lui apportait son repas, une de ces femmes lui dit :
– Vous aurez une visite aujourd’hui, mademoiselle.
– Une visite ? fit miss Ellen.
– Oui, la visite de sœur Ursule.
– Qu’est-ce que sœur Ursule ?
– C’est un ange de bonté et de charité, répondit la condamnée. Ah ! si j’étais assez heureuse pour être au nombre de celles qu’elle emmènera !…
Et la condamnée raconta à miss Ellen cette touchante histoire que Vanda avait dite à Marmouset, et lui parla longuement de cette maison de refuge établie par la jeune religieuse aux environs de Lyon.
– Et sœur Ursule viendra me voir ? demanda miss Ellen.
– Oui ; elle en a obtenu la permission de la supérieure.
Miss Ellen senti un vague espoir naître dans son âme ; non l’espoir de la liberté, mais l’espoir que sœur Ursule se chargerait peut-être de retrouver Milon et de lui faire savoir que l’homme gris était en péril.
Une heure après, en effet, la porte de sa cellule s’ouvrit et deux femmes, au lieu d’une, entrèrent.
Ces deux femmes portaient la robe noire et grise des sœurs des prisons.
L’une, la plus jeune, avait la beauté angélique et le doux sourire des femmes qui ont voué leur vie à la charité.
L’autre qui avait un peu plus de trente ans, était une beauté mâle, hardie, et avait de grands yeux noirs qui contrastaient étrangement avec ses cheveux blonds.
La sœur qui veillait dans le corridor referma la triple serrure de la porte, et les deux femmes restèrent seules avec miss Ellen, qui, étonnée et tremblante, n’avait pas dit encore un mot.
Alors la femme blonde aux yeux noirs adressa la parole à miss Ellen en anglais.
La pauvre fille tressaillit et sentit une larme rouler dans ses yeux.
Il est si doux pour ceux qui sont loin de leur patrie d’entendre le langage maternel !
– Miss Ellen, dit cette femme, la religieuse qui m’accompagne ne sait pas l’anglais. Si je vous parle dans cette langue, c’est qu’elle ne doit point savoir ce que je vais vous dire. Ne trahissez pas votre émotion, demeurez calme, si vous le pouvez, et écoutez-moi… Je viens vous sauver… Je viens de la part de l’homme gris…
Miss Ellen fut héroïque, son cœur n’éclata point ; aucun cri ne jaillit sur ses lèvres.
Elle répondit :
– Alors, madame, si vous venez de sa part, vous devez savoir qu’il a connu, qu’il court peut-être encore un grand danger ?
– Un danger de mort, dit la femme blonde.
Une pâleur mortelle se répandit sur le visage de miss Ellen.
La femme blonde ne s’y trompa pas :
– Elle l’aime ! pensa-t-elle.
Puis tout haut :
– Mais vous êtes l’ennemie mortelle de l’homme gris ! dit-elle.
– Je l’étais, madame.
– Et… vous ne l’êtes plus ?
Elle baissa la tête.
– Je l’aime ! dit-elle, je l’aime depuis le moment suprême où je l’ai trahi, livré à ses bourreaux…
Et miss Ellen raconta en peu de mots, mais avec un accent dont la sincérité ne pouvait être mise en doute, le piège qu’elle avait tendu à cet homme qu’elle croyait haïr, et le revirement inattendu qui s’était opéré dans son âme bouleversée quand elle l’avait vu aux mains des policemen.
La femme blonde l’écoutait.
Quand elle eut fini, elle lui dit :
– C’est bien, je vous crois. Nous sauverons l’homme gris. Demain soir, Milon, d’autres amis, vous et moi, nous partons pour Londres.
– Mais… madame, dit miss Ellen, qui êtes-vous ?
– Je me nomme Vanda… et, avant vous, j’aimais… l’homme gris, répondit la femme blonde, qui baissa la tête à son tour.
– Ah ! dit miss Ellen qui eut un éclair de jalousie dans le regard.
Mais un sourire glissa sur les lèvres de Vanda.
– Ne soyez pas jalouse, dit-elle. C’est vous qu’il doit aimer…
– Mais, madame, dit encore miss Ellen, comment voulez-vous que je parte ? Je suis prisonnière !
– Je vous apporte la délivrance, répondit Vanda.
LVIII
Quel moyen Vanda comptait-elle employer pour délivrer miss Ellen ?
C’est ce que nous allons voir, en nous reportant au moment même où sir James Wood et Smith dit le Serrurier avaient senti le plancher s’effondrer sous eux dans la maison de Milon, et où ils étaient descendus dans des profondeurs mystérieuses et pleines de ténèbres.
Le plancher était descendu pendant près de quatre minutes, et ce laps de temps avait été un siècle d’angoisses pour ces deux hommes qui, après avoir jeté un cri, étaient demeurés la bouche béante et la gorge crispée.
Enfin un bruit sec, puis une secousse leur avaient appris que le plancher s’arrêtait.
Mais où étaient-ils ?
Une obscurité profonde les environnait, et pendant quelques secondes ni l’un ni l’autre n’osa prononcer une parole.
Enfin, cependant, sir James Wood poussa un vigoureux Goddam, auquel Smith répondit par ces mots :
– Je le jure par saint George, le patron de la libre Angleterre, ceci ne se passe qu’au théâtre d’Adelphi.
Sir James et Smith se cherchèrent dans l’obscurité et se prirent la main.
– Mais enfin, dit le détective, où sommes-nous ?
– Probablement dans une cave.
Smith avait la philosophie du voleur anglais, qui s’attend toujours à retourner au moulin, et il s’accommodait vite des situations les plus étranges.
– Nous pouvons toujours savoir où nous sommes ! dit-il.
– Comment cela ? répondit sir James. Je n’y vois goutte.
– Vous, mais j’ai trouvé le moyen d’y voir, moi.
Et Smith tira de sa poche une petite boîte de bougies.
Soudain un éclair brilla et sir James put voir son compagnon de captivité.
– Donnons-nous le temps de regarder, dit Smith ; après celle-là, une autre.
À la troisième allumette, sir James et Smith étaient fixés.
Ils étaient dans une sorte de puits sans eau, de quatre pied carrés, et à une profondeur de quinze ou vingt mètres au-dessus du sol, si on en jugeait par l’élévation probable de ce puits, c’est-à-dire du plancher de la caisse de Milon, car ils eurent beau regarder, la clarté vacillante des allumettes ne parvenait pas à percer les ténèbres qu’ils avaient au-dessus de leurs têtes.
Ce puits était en maçonnerie toute neuve. Smith frappa du poing sur les parois.
Puis il secoua la tête et dit :
– Ce ne sont pas ces murs-là que nous percerons jamais. Et si nous sortons d’ici, c’est qu’on viendra nous y chercher.
Ils étaient, en effet, dans un puits, et ce puits, Milon l’avait fait creuser pour y essayer un appareil tout nouveau et qui est appelé à jouer un rôle important dans les constructions de l’avenir.
Cet appareil est un ascenseur et il est destiné à remplacer l’escalier.
Il avait suffi de sept à huit heures de travail pendant la nuit précédente, pour mobiliser une partie du plancher de la pièce où Milon avait sa caisse et mettre en état de fonctionner l’ascenseur en miniature que l’entrepreneur voulait essayer.
C’était encore là une idée de Marmouset.
Smith et sir James avaient en poche leur boîte d’allumettes bougies et ils finirent par se rendre compte du mécanisme dont ils étaient les victimes.
Peu à peu le détective avait repris son sang-froid.
– Ah çà ! dit-il enfin, que penses-tu, mon garçon, que ces misérables veulent faire de nous ?
– Je n’en sais rien, répondit Smith.
Ils pouvaient nous tuer et nous jeter morts dans ce puits.
– C’est vrai, et s’ils ne l’ont pas fait…
– C’est qu’ils avaient leurs raisons, dit sir James, et qu’ils espèrent se servir de moi.
Sir James n’acheva pas. Le sol éprouva une nouvelle secousse : lui et le détective trébuchèrent.
– Bon ! dit le pickpocket, est-ce que nous allons descendre encore ?
– Non, répondit sir James, je crois que nous remontons.
En effet, l’ascenseur s’était remis en mouvement, et plaçant sa main contre le mur, sir James sentit le mur fuir peu à peu, et il comprit qu’ils remontaient.
– Ils ont voulu nous effrayer, dit-il alors.
Smith enflamma une nouvelle allumette, mais le mouvement de l’ascenseur avait été si rapide qu’elle s’éteignit.
Presque aussitôt après, les deux prisonniers, levant la tête, virent une clarté au-dessus d’eux.
C’était une lumière qui brillait tout en haut du mur.
En même temps ils aperçurent Marmouset penché sur l’abîme et tenant une lampe à la main.
L’ascenseur montait toujours et il arriva enfin à trois pieds du plancher de la caisse.
Alors Marmouset tendit la main à Smith :
– Viens, toi, dit-il.
Et il le hissa sur la partie du plancher qui était dormante au lieu d’être mobile.
Sir James allait suivre Smith ; mais soudain Marmouset pressa un ressort et le plancher redescendit.
Le détective jeta un cri.
Alors Marmouset lui dit en riant :
– Vous pensez bien, mon gentleman, que nous n’avons aucune raison de garder en notre pouvoir ce garçon ; aussi allons-nous lui rendre sa liberté.
Sir James, ivre de rage, redescendit au fond du puits, et Marmouset disparut avec sa lampe.
Malgré son flegme britannique, le détective ne put s’empêcher d’éprouver une violente colère qui fit place ensuite à un profond abattement.
Après avoir crié, le détective, voyant que personne ne répondait à ses cris, se tut et tomba en un silence farouche.
Les heures s’écoulaient.
Souvent il semblait à sir James que le sol de l’ascenseur sur lequel il était devenait mobile de nouveau.
Illusion !
Souvent aussi il croyait entendre des bruits au-dessus de sa tête.
Illusion encore !
Alors sir James eut tout à coup une idée épouvantable.
– Ces hommes m’ont dit, pensa-t-il, qu’ils savaient où était miss Ellen, et il en est un qui a prétendu connaître le charbonnier.
Ils n’ont donc pas besoin de mes révélations désormais.
Et s’ils n’ont plus besoin de moi, qui sait si je ne suis pas enseveli tout vivant ?
Cette pensée prenait dans l’esprit de sir James une consistance effrayante à mesure que les heures succédaient aux heures.
Le détective avait sur lui une montre.
Il était dans les ténèbres, et, par conséquent, il lui était impossible de la consulter.
Néanmoins il la tira et l’appliqua contre son oreille.
La montre s’était arrêtée.
Et sir James fit ce calcul bien simple :
Sa montre, qu’il avait remontée la veille à six heures du soir, avait dû marcher, non pas vingt-quatre heures, mais vingt-sept ou trente, comme cela arrive ordinairement.
Il y avait donc, puisqu’elle était arrêtée, cinq ou six heures qu’il était dans le puits.
Et ce calcul fait, le détective se livra à un autre.
– En admettant qu’on veuille me laisser mourir ici, mon agonie sera longue, et j’ai le temps de voir ma montre s’arrêter une fois encore.
Et il se mit à la remonter.
Les heures passèrent encore.
Aucun bruit, aucune voix humaine n’arrivaient à sir James.
Si encore Smith fût resté avec lui ! on souffre moins à deux ; mais on avait rendu la liberté à Smith et il était seul.
Alors l’ancien fénian, l’homme qui avait trahi ses frères et vendu l’Irlande à l’Angleterre, sentit tout à coup ses cheveux se hérisser et se trouva en proie à un nouveau supplice…
Il avait faim !…
LIX
Les pauvres gens, l’ouvrier accablé de chômage, le marin perdu sur les mers, le soldat qui a fait campagne, ont eu faim plus d’une fois ; et pour eux, peut-être, la faim est moins horrible.
Mais un homme comme sir James, un Anglais rose et gras, habitué à manger des roatsbeefs saignants et à boire du porter, avoir faim était un supplice nouveau et sans nom.
Quand il était venu rue de Marignan, il venait de faire un copieux dîner.
Or sir James ne déjeunait jamais avant onze heures du matin et rarement il se mettait à table poussé par le besoin.
Cet épouvantable tiraillement d’estomac qu’il éprouvait tout à coup n’était-il pas une preuve que la journée était déjà très avancée ?
Il y avait peut-être quinze heures, peut-être vingt, que le détective était enseveli tout vivant au fond de ce puits.
Et la fièvre le gagna, et avec la fièvre le délire, et dans le délire il eut une vision épouvantable.
Les murs de granit de ce puits qui lui servait de prison devenaient transparents comme du verre, et tout à l’entour, il voyait une foule de haillons, une foule hâve et triste qui lui montrait le poing et lui criait :
– Tu nous poursuivais, tu nous traquais comme des bêtes fauves, nous qui avions faim ! aie donc faim à ton tour !
Et les Irlandais, – car c’étaient des Irlandais que sir James croyait voir, – passaient et repassaient devant lui et semblaient se repaître de ses tortures.
Sir James se reprit à crier.
Alors la vision s’effaça et la raison lui revint.
Mais quelle raison ! La faim le torturait, et l’obscurité dans laquelle il était plongé ajoutait à l’horreur de sa situation.
Et les heures se passaient, et le sol ne remuait plus sous ses pieds, et aucun bruit ne lui parvenait.
Enfin, cependant, il éprouva tout à coup une légère oscillation.
Alors d’assis qu’il était, il bondit et se retrouva sur ses pieds.
Cette fois, ce n’était pas une illusion. Le sol de l’ascenseur s’était mis en mouvement.
Il appuya sa main sur le mur, et le mur fila sous sa main.
Sir James remontait.
Au bout de quelques secondes, il leva la tête, et ce fut avec une joie d’enfant qu’il vit briller tout en haut du puits une lumière.
L’ascenseur montait toujours, et bientôt le détective reconnut l’homme qui tenait une lampe à la main et semblait éclairer son ascension.
C’était encore Marmouset.
Mais, cette fois, le détective le regarda avec joie, comme il aurait regardé un ami, tant l’horreur de l’isolement l’avait dominé.
Il voyait donc enfin un visage humain ; il allait donc enfin entendre la voix d’un homme !
Tout à coup l’ascenseur s’arrêta.
Sir James put alors constater qu’il était à quatre mètres plus bas que le plancher de la caisse de Milon, c’est-à-dire l’orifice du puits.
Et Marmouset lui dit d’une voix railleuse :
– Gentleman, je suis bien votre serviteur.
Sir James lava ses yeux sur lui.
– Monsieur, dit-il d’une voix embarrassée, vous avez fait de moi votre prisonnier un peu trop longtemps.
– Vous trouvez ? fit Marmouset.
– En Angleterre, les prisonniers mangent deux fois par jour.
– Et depuis trente-six heures vous n’avez pas mangé, vous ?
– Aussi je meurs de faim.
– Monsieur, reprit Marmouset, vous m’excuserez quand vous saurez les nombreuses préoccupations qui m’ont accablé depuis que j’ai eu l’honneur de vous voir.
– Mais, dit sir James avec impatience, votre machine s’est arrêtée, elle ne monte plus.
– À quoi bon ? Elle est montée juste assez pour que nous puissions causer.
Sir James eut un nouveau mouvement de colère.
– Vous voulez donc me garder ici ? s’écria-t-il.
– À moins que je ne reçoive de nouveaux ordres.
– Des ordres de qui ?
– Des ordres qui me viendront par le câble électrique de l’autre côté de la Manche.
Sir James frissonna.
– Je vous disais donc, poursuivit Marmouset, que j’ai fait depuis trente-six heures beaucoup de choses, qui m’ont forcé de vous perdre de vue et de vous oublier même un peu.
Sir James était au pouvoir de Marmouset, il se résigna à l’écouter.
– D’abord, continua celui-ci, j’ai délivré Ralph et sa mère.
Le détective eut un geste de surprise et presque d’incrédulité.
– Car la mère n’est point morte. Vous l’avez, en effet, jetée dans une citerne ; mais elle ne s’est pas noyée.
Et Marmouset raconta fort simplement à sir James ce qu’il était advenu de la mère et de l’enfant.
Sir James eût rugi de fureur la veille ; mais il était trop abattu maintenant pour accueillir cette nouvelle de la délivrance de la mère et de l’enfant autrement que comme une chose indifférente.
Marmouset continua :
– Ensuite j’ai expédié un télégramme en Angleterre.
– Ah ! fit sir James.
– Dans ce télégramme, adressé à l’abbé Samuel, un homme dont nous a parlé miss Ellen, – car il faut vous dire que si miss Ellen est encore à Saint-Lazare, du moins nous sommes en rapport avec elle, – dans ce télégramme je transmettais votre signalement, je vous désignais comme un ancien fénian et je demandais ce qu’il fallait faire de vous.
La réponse s’est fait attendre ; mais enfin la voici :
Et Marmouset déplia un papier et lut :
« Le comité secret a reconnu dans l’homme désigné un certain Williams Hoog qui avait disparu depuis cinq ans et qu’on croyait mort.
Faites de lui ce que vous voudrez, à moins que vous ne le renvoyiez en Angleterre, où une mort épouvantable sera son châtiment.
L’homme gris toujours en prison. Accourez. »
Marmouset remit le papier dans sa poche.
Puis d’une voix brève et qu’on sentait traduire une volonté inflexible :
– Sir James, dit-il, si on vous remet aux mains de vos anciens frères les fénians, vous savez quel sort vous attend !
– Tuez-moi donc ici, dit sir James d’une voix sourde.
– J’allais vous proposer de mourir dans ce puits.
En ce moment les tortures de sir James furent si grandes qu’il s’écria :
– Tuez-moi, mais donnez-moi à manger.
– Non pas, dit Marmouset, vous êtes condamné à mourir de faim.
La faim ne torturait pas seule le malheureux détective.
Il avait aussi une soif ardente.
– Donnez-moi au moins un verre d’eau, dit-il.
– Je vous donnerai à boire et à manger, dit Marmouset, si vous voulez faire ce que je vais vous demander.
– Ah ! parlez !
– Je savais bien que je viendrais à bout de vous, dit Marmouset, et que vous finiriez par devenir docile.
La faim a raison de tout, même d’un détective à la solde de la libre Angleterre.
Attendez-moi…
Et Marmouset disparut de l’orifice du puits, et sir James se retrouva dans l’obscurité.
LX
Deux minutes s’écoulèrent.
Deux siècles d’angoisse pour sir James.
Enfin Marmouset revint.
Il avait toujours son flambeau d’une main, et de l’autre il portait un de ces petits buvards qui renferment tout ce qu’il faut pour écrire.
– Cher monsieur, dit-il alors en posant sa lampe au bord du puisard de façon à éclairer la tête de sir James de haut en bas et à ne perdre aucune impression sur son visage, nous allons peut-être pouvoir nous entendre.
Alors il prit une chaise et la lui tendit en se baissant.
– Asseyez-vous d’abord, dit-il.
– Bon ! fit sir James de plus en plus anxieux.
– Et maintenant, laissez-moi vous passer cette table.
Et il lui descendit en effet un guéridon par le même procédé.
– À présent, dit-il, il ne vous manque plus que ceci et une lampe.
Et il jeta pareillement le buvard.
– Mais donnez-moi donc à boire ! supplia sir James.
– Tout à l’heure, si nous nous entendons.
L’industrie moderne a inventé une lampe à gaz qui brûle dans toutes les positions et peut se porter renversée au besoin.
Il est vrai qu’elle donne une clarté qui fait mal aux yeux et qu’elle sent horriblement mauvais.
Mais, dame ! les inventeurs font ce qu’ils peuvent.
Ce fut une lampe comme cela que Marmouset envoya rejoindre, tout allumée, au bout d’une ficelle, la chaise, la table et le buvard.
– À boire, monsieur ? à boire ! répétait sir James, qui semblait avoir du feu dans la gorge.
– Vous allez boire dans cinq minutes si nous parvenons à nous entendre.
– Mais que voulez-vous donc de moi ?
– Dix lignes de votre écriture.
– Adressées à qui ?
– Au chef de la Sûreté.
Malgré la soif et la faim qui le torturaient, sir James eut un reste d’héroïsme.
– Ah ! oui, dit-il, je sais ce que vous me demandez.
– Vous êtes trop intelligent pour ne point le deviner.
– Vous voulez que j’écrive au chef de la sûreté pour qu’il fasse mettre miss Ellen en liberté ?
– Justement.
– Eh bien ! non, dit sir James, j’aime mieux mourir de faim.
– Comme il vous plaira, dit Marmouset.
Sir James entendit un éclat de rire, puis le bruit sec d’un ressort et l’ascenseur redescendit au fond du puits.
Seulement sir James n’était plus plongé dans les ténèbres : il y voyait, grâce à la lampe que lui avait descendue Marmouset, et il pouvait s’asseoir au lieu de s’accroupir sur le sol.
Ce fut alors une lutte suprême chez cet homme à qui la mort apparaissait sous la plus épouvantable des formes, entre l’instinct de la conservation et l’instinct de son devoir.
Sir James était un coquin, un traître ; mais comme tous les misérables, il avait un point d’honneur bizarre et qui reposait sur un immense orgueil.
Sir James était flatté de servir l’aristocratie anglaise contre ces mendiants à qui il avait donné le nom de frères et pour qui, jadis, il avait combattu.
Mais cette lutte ne pouvait être ni longue, ni douteuse.
Sir James sentait ses boyaux se tordre et sa gorge aride brûler.
– Ah ! s’écria-t-il enfin, je ne veux pas mourir !
Et il appela :
– Monsieur, monsieur, au nom du ciel !
Mais sa voix se perdit sans écho au fond du puits et nul ne lui répondit.
Il cria plus fort, il prit la chaise et se mit à frapper avec ses pieds sur la table.
Ce tapage demeura sans résultat.
Mais, tout à coup, il remarqua que la ficelle au bout de laquelle Marmouset lui avait descendu la lampe y était toujours adhérente et quelle remontait vers l’orifice du puisard.
La ficelle s’était allongée à mesure que la lampe descendait.
Alors sir James saisit cette ficelle et la secoua violemment. Sans doute qu’elle correspondait à quelque timbre placé dans le haut de la maison, car soudain, l’ascenseur s’ébranla et se remit à monter.
Puis il s’arrêta juste au même endroit, et Marmouset reparut à l’orifice du puisard.
– Puisque vous remontez, dit-il, c’est que vous devenez raisonnable.
– À boire ! répéta sir James. Je ferai tout ce que vous voudrez.
– Faites d’abord ce que je veux, et je vous promets qu’on vous servira tout à l’heure à souper aussi confortablement que chez Brébant ou au café Anglais.
Sir James était vaincu. Il s’assit devant la table et prit la plume.
– Permettez, dit Marmouset, je vais dicter :
« Mon cher directeur du service de sûreté, je reçois une dépêche de Londres qui me force à partir à l’instant même. Je vous envoie mon collègue le détective Edward, à qui vous pouvez confier miss Ellen Palmure. »
Sir James, malgré ses tortures, ne put réprimer un geste de surprise.
– Ah ! dame dit Marmouset qui devina le geste, vous pensez bien que votre collègue Edward n’a pas les scrupules aussi tenaces que vous ; il sert qui le paie et, croyez-moi, nous payons bien !
Sir James écrivit, puis il signa.
Alors Marmouset pressa de nouveau le ressort et l’ascenseur monta jusqu’au niveau du sol de la chambre.
En même temps, Milon parut, apportant une manne pleine de victuailles, qu’il posa sur la table.
Sir James se précipita sur une carafe et la porta à ses lèvres.
Puis, quand il eut bu à longs traits, il s’empara d’un morceau de pain.
– Ne vous pressez pas, vous vous étrangleriez, dit Marmouset avec un sourire. Je vous souhaite un bon appétit.
Et il poussa le ressort une fois de plus, et l’ascenseur redescendit, emportant les vivres dont sir James avait si grand besoin, et sir James ne protesta seulement pas d’un signe ou d’une exclamation.
Il mangeait…
*
* *
Milon et Marmouset se trouvaient seuls alors.
Marmouset avait saisi la lettre écrite par sir James au chef de la sûreté.
– Maintenant, dit-il en la montrant à Milon, nous pourrons partir demain.
– Et nous emmènerons miss Ellen !
– Naturellement. Tu penses qu’avec ce papier, on va nous la rendre.
– Mais…, sir James ?
– Nous l’emmènerons aussi.
– Pour qu’il nous trahisse là-bas ?
Marmouset se prit à sourire :
– Une fois à Londres, je ne le crains plus.
– Ah ! fit Milon, qui avait toujours la compréhension lente.
– Signalé aux fénians comme un traître, il serait assuré de périr d’une façon épouvantable. Pour que nous lui gardions le secret, il nous servira non pas fidèlement, mais avec passion.
– Je le veux bien, dit Milon ; mais avant que nous soyons en Angleterre il peut nous échapper.
– Pas avant demain, toujours.
– Il est certain qu’il ne sortira pas tout seul du puits.
– Et il en sortira non pas comme un homme, mais comme un colis.
– Hein ? fit Milon.
– Mais, cher imbécile, répondit Marmouset en riant, si tu comprenais, on ne pourrait pas te faire de temps en temps des surprises.
Et il alla ouvrir une fenêtre et ajouta :
– Voici le jour. Appelle Edward le détective. Il faut qu’il porte cette lettre à la préfecture et que miss Ellen soit sortie de Saint-Lazare aujourd’hui même avant midi.
LXI
L’hospice Saint-Louis est le moins triste assurément de tous les hospices de Paris.
À deux pas du canal Saint-Martin, au milieu de ce faubourg du Temple si gaiement et si rondement chanté par Paul de Kock, le peintre inimitable des grisettes et des titis, il a des arbres devant sa porte, des arbres dans sa cour, et le soleil y entre à flots par toutes les croisées.
C’était à Saint-Louis qu’on avait transporté le malheureux Limousin, après la chute effroyable qu’il avait faite.
Comme l’avait dit le médecin qui avait fait le premier pansement, l’état du pauvre ouvrier maçon était grave, mais il n’était pas désespéré.
Pendant huit jours, il avait été cependant entre la vie et la mort ; mais, ce temps écoulé, la vie avait repris le dessus, grâce à ce puissant auxiliaire qu’on appelle la jeunesse.
Et puis il était si bien soigné par les bonnes sœurs et par les internes !
Les unes et les autres l’avaient pris en affection dès le premier jour.
Un interne, jeune homme de vingt-quatre ans, avait été son confident jusqu’à un certain point !
L’interne avait raconté à ses collègues que cet ouvrier vulgaire était une manière de héros de roman.
Un maçon qui risque sa vie pour une demoiselle de haute naissance, peste !
Cela ne se voit pas tous les jours à Paris où, cependant, il n’y a pas mal de maçons depuis quelque temps.
Ensuite, on venait voir le Limousin.
Milon d’abord.
Ce bon Milon avait voulu qu’on lui donnât tous les soins possibles et qu’on n’épargnât rien.
– C’est moi qui paye, avait-il dit.
Puis, après Milon, qui venait tous les deux jours, c’étaient les camarades du chantier qui arrivaient les dimanches, et l’invalide, son ancien confident, et Marmouset lui-même, vêtu en gandin et le lorgnon dans l’œil.
Il n’en fallait pas davantage pour que le Limousin pût devenir en quelque sorte le héros du moment parmi les malades de Saint-Louis.
Mais ce fut bien autre chose quand on apprit, un matin, que deux belles dames se présentaient au parloir pour venir voir le maçon.
Quand elles traversèrent les longs corridors et les salles de la maison de souffrance, les sœurs elles-mêmes, les saintes filles, furent prises d’un mouvement de curiosité, les internes eurent un petit battement de cœur, les malades se soulevèrent sur leur lit.
Les deux femmes étaient jeunes et belles toutes deux, bien que l’une parût avoir quelques années de plus que sa compagne.
Elles se firent indiquer le lit du Limousin et s’en approchèrent.
Le Limousin avait entendu un certain remue-ménage, et s’était dressé sur son lit.
Quand il aperçut de loin les deux femmes, bien que la distance ne lui permît pas encore de savoir qui elles étaient, il eut comme un vague pressentiment ; ses tempes se mouillèrent et son cœur battit.
Les deux femmes arrivèrent auprès de lui.
Alors la plus jeune leva son voile.
Le Limousin jeta un cri.
Il avait reconnu miss Ellen.
Miss Ellen lui prit la main et lui dit :
– Mon ami, ne m’en veuillez pas si je ne suis pas venue plus tôt ; mais j’étais prisonnière ce matin, encore, et ma première visite est pour vous.
Le pauvre garçon, sans voix, sans haleine, la contemplait avec extase.
– Mon ami, dit miss Ellen, je vais quitter la France ; mais j’y reviendrai, croyez-moi, et nous nous reverrons.
Et puis, soyez tranquille, je ne vous oublierai pas.
– Et aucun de nous non plus, dit l’autre femme, qui n’était autre que Vanda.
Alors miss Ellen s’assit auprès du lit et, tenant toujours la main du Limousin :
– Avez-vous encore des parents ? demanda-t-elle.
– Oui, mademoiselle, j’ai ma pauvre vieille mère à qui j’envoyais la moitié de ma paye, quand je travaillais, répondit enfin le Limousin d’une voix tremblante ; mais M. Milon, mon excellent patron, m’a dit que si je venais à mourir, il en prendrait soin.
– D’abord vous ne mourrez pas, mon ami, reprit miss Ellen avec sa voix enchanteresse.
Ensuite, je ne veux pas que personne que moi, pour qui vous avez failli mourir, assure à votre mère une vieillesse heureuse. Que fait votre mère ?
– Elle ne peut plus travailler, madame.
– Si on lui donnait une maison, quelques soins, une femme pour la servir…
– Ah ! mademoiselle ! dit le Limousin les larmes aux yeux.
Miss Ellen tira de son sein un mignon portefeuille en cuir de Russie.
– Tenez, dit-elle, prenez cela. Il y a, dans ce portefeuille, vingt mille francs… pour votre mère.
Une larme roula dans les yeux du maçon, s’en échappa et coula lentement sur sa joue.
Miss Ellen devina ce qui se passait dans l’âme de cet homme du peuple qui avait osé lever les yeux jusqu’à elle.
– Mon ami, lui dit-elle encore, vous ne pouvez m’en vouloir d’assurer la paix de la vieillesse de votre mère ; mais ma dette envers vous n’est point acquittée encore…
Et elle lui tendit ses deux belles mains.
Le Limousin les prit dans sa main calleuse et tout frémissant, les approcha de ses lèvres et les baisa.
*
* *
Pendant que miss Ellen faisait ses adieux au Limousin, Marmouset et Milon préparaient leur départ pour Londres.
Ils avaient fait jouer l’ascenseur, et sir James Wood était remonté du fond de son puits.
– Gentleman, lui dit Marmouset, je vous ai montré la dépêche de l’abbé Samuel. Les fenians vous ont condamné à mort, et je suis libre de faire de vous ce que je voudrai. Mais ne craignez rien, il dépend de vous de vivre vieux.
Sir James le regarda.
– On fait grâce aux traîtres quelquefois, quand ils consentent à se rendre utiles. Or, poursuivit Marmouset, je vous promets votre grâce, si vous servez désormais ceux que vous avez trahis.
Le détective eut un geste de rage.
– Sir James, dit encore Marmouset, ce soir vous aurez quitté Paris, et demain matin nous serons à Londres.
Puis, lui montrant une caisse longue de deux mètres et haute d’un mètre et demi :
– Vous voyez cela ? dit-il.
– Oui, dit sir James.
– Vous ferez le voyage dans cette caisse.
Et comme le détective faisait un pas en arrière :
– Vous pensez bien, ajouta Marmouset, que je ne veux pas que vous puissiez nous échapper avant que nous ayons touché le sol de l’Angleterre.
En même temps, il fit un signe à Milon.
Milon ouvrit un placard et y prit une bouteille et un verre.
Marmouset déboucha la bouteille, versa, dans le verre, deux doigts de son contenu, une liqueur verte comme de l’absinthe étendue d’eau.
– Buvez cela, dit-il.
– Mais… dit sir James.
– Buvez !
– Et qui me dit que vous ne me versez pas du poison ?
– C’est simplement un narcotique.
– Qui me le prouvera ?
– Ceci.
Et Marmouset tira de sa poche un revolver qu’il braqua sur sir James.
– Si vous ne buvez pas cela, dit-il, je vous casse la tête.
Sir James comprit au regard froid et résolu de Marmouset qu’il n’y avait pas à hésiter.
Il prit le verre et le vida d’un trait.
Soudain un froid mortel l’envahit, ses paupières s’appesantirent, sa tête bourdonna ; il se laissa tomber anéanti sur un siège, et, quelques minutes après, il était plongé dans un profond sommeil.
– À présent, dit Marmouset, songeons à aller délivrer Rocambole !
LES SOUTERRAINS DE NEWGATE
I
Il y avait un mois environ que l’homme gris était tombé aux mains des policemen amenés par le révérend Patterson dans ce souterrain où miss Ellen l’avait attiré ; un mois jour pour jour.
On se souvient des dernières paroles prononcées par lui, au moment où miss Ellen, désespérée, se tordant les mains, avait supplié vainement le révérend Patterson de lui rendre la liberté.
– À Paris, Milon et les siens ! avait-il dit.
Et l’homme gris s’était laissé conduire tranquillement en prison.
L’Anglais est calme, silencieux ; il ne se porte pas avec empressement sur le passage des prisonniers.
Homme d’affaires avant tout, il s’occupe de ses affaires, laissant aux lords et à l’aristocratie le soin de la politique.
L’homme gris avait donc traversé Londres avec son escorte de policemen sans qu’on fît grande attention à lui.
Il était arrivé à Newgate et avait trouvé la petite place déserte.
En passant, il avait jeté un coup d’œil sur cette fenêtre de laquelle il avait tiré avec un fusil à vent sur la corde du pauvre Irlandais et l’avait ainsi sauvé d’une mort certaine.
Cependant, quand le guichet de Newgate se fut ouvert, l’homme gris s’aperçut qu’il y avait un personnel complet sur pied.
– Oh ! oh ! se dit-il, on m’attendait, je le vois. Le révérend Patterson ne néglige pas les détails.
Le bon gouverneur, qui riait toujours, même quand il conduisait un condamné à mort dans la chambre des derniers apprêts, était là en grand uniforme, et une formidable rangée de gardiens s’était étalée le long des murs.
L’homme gris salua le gouverneur, comme une ancienne connaissance.
– Ici ! par saint George ! dit celui-ci en le reconnaissant, vous m’avez joué un joli tour, mon cher !
– Moi ! dit l’homme gris en souriant.
– Pardieu ! vous êtes ce gentleman français qui est venu visiter Newgate deux jours avant l’exécution de John Colden.
– Cela est vrai, dit l’homme gris.
– Et vous pensez bien que je ne suis plus votre dupe. Vous avez puissamment aidé à son sauvetage miraculeux.
– J’en conviens, dit l’homme gris.
– Ah ! mon gaillard, poursuivit le gouverneur, on ne vous sauvera pas aussi facilement.
L’homme gris eut un sourire silencieux.
– Et nous veillerons sur vous de près.
– Vous ferez bien, Votre Honneur.
– Car enfin, ajouta le gouverneur, il paraît que vous êtes un des principaux chefs de ces fénians qui donnent tant de chagrin à l’Angleterre ?
– Cela se peut, dit l’homme gris avec calme.
– Et je crois pouvoir vous dire que vous serez pendu d’ici à trois semaines ou un mois au plus tard.
– Je remercie Votre Honneur du pronostic.
Le sourire n’avait pas abandonné un seul instant les lèvres du gouverneur pendant qu’il parlait ainsi.
Cet homme était jovial de nature, et Newgate, avec ses tours sombres et ses fenêtres grillées, lui paraissait être le séjour le plus enchanteur qui fût au monde.
– Cependant, reprit-il en frappant sur l’épaule de l’homme gris, j’ai une nouvelle à vous donner qui ne vous déplaira pas, j’en suis sûr.
– Vraiment ?
– Vous êtes ici tout à fait à ma discrétion.
– Bon !
– Je ne dois compte à personne de ma façon de traiter les prisonniers, et j’ai la faculté d’adoucir pour eux le régime de la prison, quand ils m’intéressent.
– Ah ! ah ! dit l’homme gris.
– Vous êtes un parfait gentleman, poursuivit le gouverneur, un homme d’éducation, comme nous disons nous autres Anglais, et je ne veux pas qu’il vous reste une impression désagréable de votre séjour ici.
– Vous êtes mille fois trop bon.
– Non, d’honneur ! mon cher, vous me plaisez fort ; d’ailleurs j’ai toujours aimé les Français.
L’homme gris salua.
– Comme je vous l’ai dit, je ne crois pas que vous puissiez vous faire beaucoup d’illusions : avant un mois vous serez pendu.
– Je ne dis pas non, Votre Honneur.
– Mais puisqu’il ne vous reste plus qu’un mois à vivre, je ne veux pas qu’il soit mêlé pour vous d’amertume, et je m’efforcerai de vous être agréable.
L’homme gris salua de nouveau.
– D’abord, vous ne serez pas mal dans votre cellule.
– Ah !
– On vous donnera un de vos compagnons, un Irlandais fénian comme vous. Cela vous fera une société.
– Mille grâces, Votre Honneur.
– Ensuite, vous serez bien nourri, chauffé et éclairé jusqu’à neuf heures du soir. Si quelques livres pouvaient vous être agréables…
– Mais volontiers, mylord.
L’homme gris appelait « mylord » le gouverneur, ce qui acheva de le flatter.
– Je ne suis pas lord, dit-il, mais il ne serait pas impossible que Sa Très Gracieuse Majesté la reine Victoria me créât baronnet un jour ou l’autre pour mes bons services.
– J’en suis très persuadé, mylord.
– Donc ! on vous donnera des livres et des journaux.
– Pourrai-je écrire ?
– Sans aucun doute.
– Et je ne serai pas seul ?
– Je vous le répète, on vous donnera un compagnon.
Sur ces derniers mots, le gouverneur fit un signe.
Alors deux des gardiens ouvrirent la fameuse porte basse qui sépare le greffe de l’intérieur de la prison et dont les barreaux de fer ont l’épaisseur du bras.
Puis ils conduisirent l’homme gris au rez-de-chaussée, dans une cellule dont la fenêtre donnait sur un des préaux.
Au bruit de la porte qui s’ouvrait, un homme qui était couché sur l’un des deux lits de cette cellule se leva à demi et regarda le prisonnier d’un air farouche.
C’était un homme de trente ans, à la barbe longue, au visage maigre, aux yeux ardents.
– Barnett, lui dit un de ses gardiens, vous ne serez plus seul à l’avenir.
– Cela m’importe peu ! dit-il.
Et il retomba dans son mutisme, et ne regarda plus l’homme gris.
Mais quand les gardiens furent partis, il se retourna et leva de nouveau les yeux sur son compagnon de captivité.
L’homme gris le salua :
– Vous paraissez fort triste ici, mon cher ?
– On le serait à moins, repartit l’Irlandais.
– Êtes-vous ici pour longtemps ?
– Je serai pendu le 17 du mois prochain.
– Quel crime avez-vous commis ?
L’Irlandais se servit alors du signe de croix maçonnique usité parmi les fénians.
– Ah ! dit l’homme gris.
Et il répondit par un autre signe.
Alors le visage de l’Irlandais s’éclaira.
Mais l’homme gris lui fit un autre signe et l’Irlandais ne parut pas le comprendre.
Et l’homme gris, impassible, se dit :
– Ces pauvres Anglais ! Ils sont décidément moins forts que nous. Ils m’ont mis avec un brave homme qui n’a d’autre mission que de me faire jaser et qui n’est pas fénian. À Paris, nous appelons cela un mouton.
Puis il prit la main de l’Irlandais, leva un doigt vers le ciel qu’on entrevoyait au travers des barreaux de la croisée et murmura :
– Il faut souffrir pour notre mère l’Irlande !
Et en disant cela, l’homme gris pensait :
– Ce n’est pas encore avec ce gaillard-là que la libre Angleterre sondera les mystères du fénianisme, foi de Rocambole, qui est mon vrai nom !…
II
Sir Robert M…, le gouverneur de Newgate, avait tenu parole à l’homme gris.
Il lui avait envoyé des livres, et quand l’heure du repas arriva, on lui servit, à lui et au prétendu fénian irlandais, un souper assez confortable.
Ce jour-là, Rocambole parla peu.
À peine dit-il quelques mots à son compagnon de captivité.
Et bien avant l’heure où on éteignait le gaz, il se mit au lit.
Le lendemain, sir Robert M… vint en personne le visiter.
– Eh bien ? lui dit-il, comment vous trouvez-vous ici ?
– Fort bien, dit Rocambole en souriant.
– Êtes-vous content des livres que je vous ai envoyés ? les derniers romans de Dickens, par exemple ?
– Très content, Votre Honneur. Dickens est mon romancier favori.
– Voulez-vous des journaux ?
– Oh ! non, dit Rocambole, à moins que vous n’ayez la bonté de me faire donner des journaux français.
– Rien n’est plus facile. Quels journaux voulez-vous ? Je les ferai prendre chez Mitchell, le grand libraire de Piccadilly.
– Les premiers venus, les Débats, le Siècle, le Moniteur.
– Vous les aurez ce soir.
– Votre Honneur est mille fois trop bon pour moi.
Sir Robert M… regarda Rocambole avec une sorte de compassion.
– Quel âge avez-vous donc ? dit-il.
– Trente-neuf ans, répliqua le prisonnier.
– Vous en portez trente à peine.
Un sourire glissa sur les lèvres de notre héros.
– J’ai pourtant eu, dit-il, une vie quelque peu agitée.
– Quelle singulière idée, aussi, pour un gentleman comme vous, reprit le bon gouverneur, d’aller s’affilier à ces va-nu-pieds qu’on nomme les fénians !
Et, parlant ainsi, il regarda l’Irlandais.
Le mouton était dans son rôle. Il serra les poings et grommela quelques paroles inintelligibles en regardant de travers le gouverneur.
– Mylord, répondit Rocambole sans cesser de sourire, je suis devenu fénian parce que ma nature me porte à me ranger toujours du côté du faible contre le fort.
Sir Robert M… s’en alla.
Rocambole reprit sa lecture et ne parla pas au mouton. Celui-ci fit cependant mille questions.
Quelquefois, il obtenait un monosyllabe ; le plus souvent Rocambole paraissait ne pas entendre.
Trois ou quatre jours s’écoulèrent ainsi.
Chaque matin, sir Robert M… venait visiter son prisonnier et lui apportait les journaux français.
Puis il échangeait un regard furtif avec le mouton.
Ce mouton avait la mine désolée d’un juge d’instruction qui trouve un criminel de tempérament et qui les connaît toutes, selon la pittoresque expression parisienne.
Chaque fois, Rocambole, qui semblait pressé de lire les journaux, surprenait ce double regard.
Et le gouverneur parti, il retombait dans son mutisme, au grand désespoir du faux fenian.
Au bout de huit jours, Rocambole, qui lisait toujours fort attentivement les journaux, trouva dans le Siècle l’entrefilet suivant :
« On lit dans la Gazette des étrangers :
« Depuis quelques jours, le monde qui va au Bois et fait de deux à quatre heures le tour du lac, remarque dans une Victoria très correctement tenue et attelée de deux cobs alezan brûlé, une délicieuse jeune fille blonde qu’on dit être Anglaise…
« Elle est accompagnée par deux gentlemen dont l’un est un homme de cinquante ans.
« On a cru d’abord que c’était le père de la belle miss.
« Mais, à la froideur qu’elle lui témoigne, froideur mêlée de dédain, on est forcé de renoncer à cette hypothèse.
« Le comte de M…, ce jeune excentrique que tout Paris connaît, prétend même que la belle Anglaise est prisonnière, et que les deux hommes qui l’accompagnent ne sont autres que des détectives envoyés de Londres.
« Espérons que le comte de M…, qui paraît sérieusement épris de la belle Anglaise, pénétrera ce mystère. »
Quand il eut lu ce mystérieux article, Rocambole tomba en une rêverie profonde.
La belle Anglaise dont on parlait, n’était-ce pas miss Ellen !
Et si c’était cela, ne se pouvait-il pas que le comte de M… eût deviné la vérité, et que dès son arrivée à Paris, miss Ellen eût été suivie par des hommes expédiés par le révérend Patterson et lord Palmure ?
Or Rocambole avait fait ce raisonnement :
– Les fénians que j’ai servis sont incapables d’une sérieuse initiative pour me délivrer ; je ne suis pas Irlandais.
Il faut donc que je compte sur mes amis bien plus que sur les fénians.
Or, mes amis, c’est Milon, c’est Marmouset, c’est Vanda et les autres.
J’ai envoyé miss Ellen à Paris en lui disant : Cherchez Milon.
Si miss Ellen est prisonnière, Milon ne saura rien et il ne viendra pas.
Il faut donc que je trouve un moyen de prévenir Milon.
En faisant cette réflexion, Rocambole regardait le faux fénian.
Alors il lui passa par la tête une de ces idées hardies qui lui étaient familières, du reste.
– On a mis cet homme ici pour me surveiller : j’en veux faire mon ami, et quand il sera mon ami, il deviendra dans mes mains un instrument facile et qui me servira.
En pensant ainsi, Rocambole songeait à ce don merveilleux de fascination qu’il possédait et qui lui asservissait les hommes aussi bien que les femmes.
Il serra donc son journal et se prit à le regarder.
Jamais l’Irlandais n’avait été regardé ainsi ; au bout de quelques secondes, il se sentit mal à l’aise.
Alors Rocambole lui dit :
– Comment te nommes-tu ?
– Barnett.
– Où es-tu né ?
– À Dublin.
– Quand t’a-t-on arrêté !
– Lors de l’évasion du colonel Stephen.
– Tiens ! dit Rocambole, j’y étais et je ne me souviens pas de toi !
Une légère rougeur monta au front de l’Irlandais.
Rocambole poursuivit :
– Tu sais que c’est aujourd’hui le 11 du mois ?
– Eh bien !
– Et comme, m’as-tu dit, tu dois être pendu, le 17, tu n’as plus que six jours à vivre.
L’Irlandais baissa la tête.
– Je suis résigné, dit-il.
Mais alors Rocambole attacha sur lui un regard si pénétrant que le faux fénian se mit à trembler.
– Tu sais bien, dit-il, que tu ne mourras pas.
– Qui donc me sauvera ? dit Barnett.
– Personne.
– Alors je mourrai.
– Pour mourir, il faut être condamné.
Et le regard ardent de Rocambole pesait toujours sur cet homme.
– Mon camarade, dit alors Rocambole, tu n’es pas même condamné à la prison. On t’a mis ici pour me surveiller, et tu n’es pas fénian.
Que se passa-t-il alors ?
Rien ou presque rien. Mais le regard de Rocambole opéra un miracle.
Après avoir frissonné, Barnett sentit son cœur déchiré par le repentir.
Et comme Rocambole lui tendait la main et lui disait :
– Veux-tu être mon ami ?
Le faux fénian tomba à genoux devant lui et s’écria :
– Je ne sais pas qui vous êtes, mais je sais que je vous appartiens désormais et je vous serai fidèle comme un chien.
– Tu n’as pas fait un vilain rêve, dit Rocambole en souriant, tu le verras quand nous serons hors d’ici.
– Vous espérez donc en sortir ? fit Barnett d’une voix anxieuse.
– Parbleu ! répondit Rocambole.
III
Trois ou quatre jours après, le gouverneur sir Robert M…, las de venir visiter en pure perte son prisonnier, car, le mouton lui faisait toujours signe qu’il n’en pouvait rien tirer, sir Robert M…, disons-nous, au lieu de venir lui-même, envoya un guichetier porter ses compliments et les journaux français du jour à Rocambole. Cependant, comme ce guichetier était dans la confidence, y avait ordre d’adresser à Barnett un coup d’œil furtif.
Ô miracle !
Cette fois Barnett cligna de l’œil, ce qui voulait dire :
– J’ai enfin du nouveau.
Barnett avait du nouveau, en effet ; car il avait passé à l’ennemi, c’est-à-dire à Rocambole, avec armes et bagages, ou plutôt avec tout le dévouement que cet homme étrange savait inspirer.
Or, la veille, le Journal des Débats publiait le curieux fait divers que voici :
« Les Anglais ne se contentent pas de faire de l’excentricité chez eux, ils viennent encore en faire chez nous.
Voici une nouvelle, que nous donnons cependant sous toutes réserves, bien que nous ayons lieu de nous croire parfaitement informés.
Une belle jeune fille, altière en son attitude, entière dans son caractère, ayant du sang de pair d’Angleterre dans les veines, elle se nomme, dit-on, miss Ellen P…, – a passé récemment le détroit sans le consentement de sa famille, et suivie de deux domestiques.
Que venait-elle faire à Paris ? c’est ce qu’on ne sait pas au juste.
Elle est descendue dans une maison meublée très confortable des environs du boulevard des Italiens, et on a pu la voir pendant quelques jours faire, chaque soir, à quatre heures, une promenade autour du lac.
Mais il paraît que cette équipée n’était pas du goût de sa famille.
En France, un père aurait couru après sa fille.
En Angleterre, les choses se passent autrement.
Lord P…, le père de miss Ellen, qui siège à la Chambre haute, n’a pas cru devoir se soustraire aux fatigues de la session.
Au lieu de venir chercher sa fille à Paris, il a envoyé deux détectives.
Les détectives, parfaits gentlemen du reste, avaient pour mission de trouver miss Ellen, et ils l’ont trouvée.
Ensuite ils étaient munis de pouvoirs étendus et parfaitement réguliers qu’on leur avait donnés à l’ambassade.
Ils se sont donc assurés de la personne de miss Ellen.
Mais ne croyez pas qu’ils l’aient ramenée en Angleterre.
Non, lord P… juge que ce petit scandale a besoin d’être oublié.
Il se propose, la session du Parlement achevée, de venir à Paris, d’y prendre sa fille et de la conduire en Italie.
Il a donc chargé les deux détectives de surveiller la belle excentrique, de la conduire au spectacle, au Bois, à la promenade, partout, mais à la condition qu’elle ne communiquera avec personne.
Car, on le pense bien, il y a un amour mystérieux au fond de cette petite histoire, un amour qui déplaît sans doute au noble lord. »
Après la lecture de cet article, Rocambole ne pouvait plus douter.
Miss Ellen était venue à Paris, mais elle n’avait pas trouvé Milon.
Donc Milon ne savait rien.
Comment le prévenir ? comment faire arriver jusqu’à lui une phrase de ce genre : « Quitter Paris, arriver à Londres ; j’ai besoin de toi. »
Rocambole était demeuré pensif une partie de la journée, puis il avait trouvé sans doute une solution, car il avait adressé la parole à Barnett, disant :
– Écoute-moi bien, camarade.
– Parlez, avait répondu l’Irlandais.
– On t’a mis ici pour me surveiller et obtenir mes secrets.
– Ah ! maître, dit Barnett, c’est mal à vous de me faire encore ce reproche ; ne me suis-je pas repenti ?
– C’est vrai ; mais tu ne sais pas où j’en veux venir.
Barnett le regarda.
– Chaque matin, poursuivit Rocambole, le gouverneur vient ici et te regarde du coin de l’œil.
– C’est vrai.
– Il espère toujours que tu auras quelque chose à lui dire.
– Et jusqu’à présent il est volé, dit Barnett.
– Il l’a été tout naturellement d’abord, puisque je me méfiais de toi.
– Et il l’est tout naturellement encore aujourd’hui puisque je suis à vous corps et âme.
– Eh bien ! il faut me trahir, Barnett.
– Plaît-il ? dit l’Irlandais qui eut un geste d’étonnement ; vous trahir, moi ?
– C’est une manière de parler.
– Ah !
– Il faut que tu me serves.
– Je suis prêt.
– Demain matin, quand le gouverneur ou un guichetier quelconque viendra, tu feras signe que tu veux parler et que tu as quelque chose à dire.
– Bon ! et le gouverneur me fera venir chez lui ?
– C’est probable.
– Alors, que lui dirai-je ?
– Tu le sauras demain.
Rocambole avait donc passé le reste de la soirée et une partie de la nuit à réfléchir.
Le lendemain, au lieu du gouverneur, c’était le guichetier qui était venu.
Mais Barnett lui avait fait un signe, et le guichetier s’en était allé tout joyeux.
Alors Rocambole avait dit à l’Irlandais :
– Le gouverneur va t’envoyer chercher, cela va sans dire.
– Je le crois.
– Fais donc bien attention à mes paroles.
– Parlez, maître.
– Tu lui diras : « L’homme gris m’a fait une confidence.
« Il m’a dit que les fénians avaient un nouveau quartier général, lequel se trouvait à Paris. »
– Bon ! je lui dirai cela.
– » Et qu’ils avaient là-bas un chef nommé Rocambole. »
– Un drôle de nom ! fit Barnett.
– Alors, poursuivit Rocambole en souriant, tu ajouteras qu’il y aurait un moyen bien simple de s’emparer de cet homme, qui est, paraît-il, un des plus habiles parmi les chefs fénians.
– Et ce moyen ?
– Ce serait l’annonce dans les journaux que Rocambole est tombé aux mains de la police anglaise et qu’il est enfermé à Newgate.
– Mais, dit Barnett, puisque cet homme est en France, dites-vous ?
– Eh bien ?
– Il y restera.
– Tu feras comprendre le contraire au gouverneur.
– Comment cela ?
– Rocambole a fui l’Angleterre parce qu’il ne s’y trouvait plus en sûreté.
– Fort bien.
– Il lit dans les journaux qu’on l’a arrêté et enfermé à Newgate. Donc la police, qui croit le tenir, ne le cherchera plus, et il peut revenir tranquillement à Londres.
– Ah ! je comprends.
Rocambole n’eut pas le temps d’en dire davantage.
La porte de la cellule s’ouvrit et le guichetier reparut :
– Barnett, dit-il, vous avez adressé une supplique à la reine, à l’effet d’obtenir une commutation de peine.
Votre supplique a été accueillie.
Barnett, qui n’avait jamais été condamné à mort, remplit sa mission en conscience et poussa un cri de joie.
– Suivez-moi, lui dit le guichetier.
– Où cela ?
– Chez le gouverneur, qui vous lira les lettres de commutation.
Barnett suivit le guichetier.
– Pourvu qu’ils ne sachent pas que c’est moi qui suis Rocambole ! pensa l’homme gris demeuré seul.
IV
On avait donc conduit Barnett, le faux fénian, chez sir Robert M…, le gouverneur de Newgate. Celui-ci l’attendait avec impatience.
– Eh bien ! dit-il, il a donc parlé enfin ?
– Oui, Votre Honneur.
Barnett était intelligent ; il avait saisi à merveille la leçon de Rocambole, et il répéta textuellement à sir Robert ce que Rocambole lui avait dit.
– Eh ! eh ! dit le gouverneur, voilà une révélation qui vaut de l’or ; tu seras récompensé.
– Je l’espère bien, dit Barnett, car enfin, moi qui suis policeman et non voleur, je ne puis pas jouer le rôle de prisonnier et de condamné à mort pour les beaux yeux de Sa Majesté la reine Victoria.
Sir Robert M… fit reconduire Barnett dans sa prison.
Puis il envoya chercheur un cab, monta dedans en toute hâte et dit au cocher :
– À Elgin-Crescent !
Il n’était pas encore dix heures du matin, et sir Robert M… était certain de trouver le révérend Patterson encore chez lui.
Le chef occulte de la religion anglicane, l’homme qui est au chef de l’archevêché de Cantorbéry ce que le général des jésuites est au pape, le révérend Patterson enfin était chez lui, en effet, assis devant une table encombrée de lettres, de papiers et de livres, quand sir Robert M… entra.
En voyant le gouverneur de Newgate, le révérend comprit qu’il s’agissait de choses graves.
– Mon Dieu ! dit-il, est-ce que vous venez m’annoncer l’évasion de l’homme gris ?
Sir Robert M… avait le sourire aux lèvres ; mais comme il souriait perpétuellement, cela ne prouvait absolument rien, et il pouvait venir tout aussi bien, avec ce visage placide, apporter la nouvelle d’une catastrophe.
Heureusement sir Robert M… répondit aussitôt :
– Que Votre Honneur se rassure, l’homme gris est toujours sous clef.
– Ah ! dit le révérend, il y a des nuits que je m’éveille en sursaut et la sueur au front.
– Vous rêvez qu’il s’évade ?
– Oui.
– On ne s’évade pas de Newgate.
– On s’en évade la corde au cou, dit avec aigreur le révérend Patterson, qui faisait allusion par ces mots au miraculeux sauvetage de John Colden l’Irlandais.
Mais la sérénité de sir Robert M… n’en fut point troublée.
– Oh ! Votre Honneur, dit-il, une fois que j’ai remis un condamné à Calcraft, cela ne me regarde plus.
– Enfin, que venez-vous m’apprendre ?
– Notre homme a parlé.
– Bon ! a-t-il dit son vrai nom ?
– Pas encore.
– Qu’a-t-il dit alors ?
– Il a confié à Barnett que le chef fénian le plus habile après lui était à Paris, où il organisait une tentative mystérieuse.
– Et comment se nomme ce chef ?
– Rocambole.
– Singulier nom !
– Alors, dit encore sir Robert M…, Barnett, qui est un policeman intelligent, m’a donné une bien belle idée.
– Voyons ?
– Rocambole a quitté Londres, se croyant poursuivi.
– Après ?
– On annonce dans le Morning Post et le Times que le fameux chef fénian Rocambole a été arrêté et qu’il est écroué à Newgate.
– Bon ! et puis ?
– Alors le vrai Rocambole se dit : Je n’ai plus rien à craindre ; et il revient à Londres où l’on met aussitôt la main sur lui.
– L’idée est assez ingénieuse, en effet, dit le révérend Patterson.
– Alors vous pensez qu’il faut l’appliquer ?
– Non, pas encore ; je réfléchirai.
– Ah !
– Voyez-vous, mon cher, poursuivit le révérend Patterson, le fénianisme en lui-même ne m’occupe que d’une façon secondaire.
Sir Robert M… regarda le révérend Patterson avec étonnement.
– Si j’ai conduit avec tant de zèle et d’habileté, poursuivit celui-ci, l’arrestation de l’homme gris, c’est qu’il est plus dangereux pour nous, c’est-à-dire pour la religion anglicane, que tous les fénians réunis, car il s’était fait le bras droit de l’abbé Samuel, et l’abbé Samuel, vous le savez…
– Oui, c’est un apôtre catholique dont le peuple de Londres est enthousiasmé.
– Justement.
– Mais enfin, puisque nous tenons l’homme gris…
– Nous le tenons ; mais le lord chief-justice ne veut pas qu’il soit jugé que nous ne sachions son vrai nom.
– Je suis convaincu, dit sir Robert M…, que nous le saurons quand nous aurons sous la main ce Rocambole dont il parle.
– Soit, dit le révérend Patterson, mais attendez à ce soir pour envoyer une annonce aux journaux.
Et il congédia sir Robert M… et fit sa toilette de ville à la hâte.
Le révérend courut au télégraphe et il expédia la dépêche suivante :
« Sir James Wood,
« Hôtel du Louvre,
Paris.
« Avez-vous connaissance d’un chef fénian appelé Rocambole et qui doit être à Paris ?
« PATTERSON. »
Le révérend attendit toute la journée la réponse de sir James Wood.
Mais cette réponse ne vint pas.
Il y avait à cela une raison toute simple.
Sir James était aux mains de Marmouset depuis vingt-quatre heures.
Las d’attendre, le révérend Patterson courut chez lord Palmure.
Le pair d’Angleterre allait, comme chaque soir, se rendre au Parlement.
– Avez-vous reçu une dépêche de sir James ? demanda le révérend.
– Aucune.
Le révérend raconta à lord Palmure la visite de sir Robert M…
Après avoir un moment réfléchi, le noble lord émit cette opinion, que sir James ne répondait pas parce qu’il était à la recherche de ce fénian qu’on disait se nommer Rocambole.
Le révérend partagea l’avis de lord Palmure et il écrivit à sir Robert M… qu’il pouvait envoyer une note aux journaux.
Sir Robert M… était un lettré ; il avait même composé dans sa jeunesse un roman intitulé Miss Elmina.
Il tailla donc sa plume et, de sa belle écriture, il traça les lignes suivantes :
« L’homme qui a donné le plus de souci au gouvernement de Sa Majesté la reine depuis quelques mois, le fénian Rocambole, vient d’être arrêté à Dublin, et il va être transféré en Angleterre, où il sera probablement écroué à Newgate, en attendant l’heure de son jugement. »
Puis il fit trois copies de cet article, envoya la première au Times, la seconde au Morning Post et la troisième à l’Evening Star.
Et il se frotta les mains, ne se doutant guère qu’il avait dit la vérité et que Rocambole était bien réellement écroué à Newgate.
Seulement le bon gouverneur était tombé dans le piège que Rocambole lui avait tendu !…
V
Comme on a pu le voir, le piège tendu par Rocambole devait fonctionner merveilleusement.
Le jour même où on renvoyait aux journaux de Londres le fait divers rédigé par sir Robert M…, la police de Scotland-Yard était sur pied.
Sir Richard Maine, le métropolitain de la police de Londres, venait de mourir.
Son successeur n’était point désigné encore ; mais les différents chefs de service qu’il avait eus sous ses ordres brûlaient de le remplacer, et ils allaient rivaliser de zèle, d’habileté et de dévouement.
Quarante-huit heures s’étaient écoulées depuis le moment où le révérend Patterson, qui, du fond de sa maisonnette d’Elgin-Crescent, dirigeait tout le mouvement, avait expédié un télégramme à sir James Wood le détective.
Pourquoi sir James ne répondait-il pas ?
Le révérend Patterson se le demandait en vain, et son inquiétude était extrême lorsque, enfin, il reçut la dépêche suivante :
« Boulogne, 7 heures du matin.
« Rocambole parti pour Londres à minuit, via Calais.
« Teint pâle, moustaches noires ; une femme l’accompagne.
« Blonde, avec des yeux noirs.
« J’attends vos ordres, hôtel d’Espagne. »
Le révérend Patterson répondit :
« Bien. Et miss Ellen ? »
À quoi une heure après sir James, ou plutôt celui qui empruntait son nom, répondit :
« Miss Ellen toujours gardée à vue. Pas d’inquiétude. »
Muni de ces renseignements, le révérend Patterson s’en alla à Scotland-Yard.
Le chef de service à qui la conduite de cette affaire avait été confiée se nommait Philippe.
C’était un homme habile et dévoré d’ambition.
Il jura au révérend qu’avant quarante-huit heures le chef fénian serait en son pouvoir.
Le révérend monta dans un cab et se fit conduire à Newgate.
– Eh bien ! dit sir Robert M…, pensez-vous que mes annonces aient produit quelque effet ?
– Un effet immédiat.
– Vraiment ?
– Voyez plutôt.
Et le révérend mit sous les yeux de sir Robert le télégramme qu’il attribuait à sir James Wood.
– Alors vous pensez que ce Rocambole est à Londres ?
– Il doit y être. Sir James Wood est, du reste, un homme sage et réfléchi qui ne s’expose jamais à se tromper.
Sir Robert M… garda un moment le silence.
Puis après quelques minutes :
– L’homme que j’ai mis avec l’homme gris, dit-il, est pareillement un homme précieux.
– Ah !
– Il a si bien capté la confiance du prisonnier que celui-ci n’a plus de secrets pour lui.
– Que lui a-t-il donc confié ?
– Une chose qui, à mon sens, est excessivement importante.
– Voyons ?
L’homme gris lui a dit : « Si Rocambole était à Londres, si je pouvais seulement lui parler une minute, l’Irlande serait victorieuse. »
– En vérité ! ricana le révérend.
– » Et je ne serai pas pendu, » a-t-il ajouté.
– Ah ! il a dit cela ?
– Oui, dit sir Robert M… ; aussi ai-je une bien belle idée, Votre Honneur, comme vous allez le voir.
– Je vous écoute, mon cher.
– Je vais faire changer de cellule à l’homme gris.
– Bon !
– On le transférera, lui et Barnett, dans une salle plus vaste où il y aura trois lits au lieu de deux.
– Et puis ?
– Et puis, dame ! quand on aura arrêté ce Rocambole et que nous le tiendrons, nous comblerons les vœux de l’homme gris, nous les mettrons ensemble.
– Pour la plus grande gloire de l’Irlande ? ricana le révérend Patterson.
– Non ; pour savoir, par M. Barnett, ce grand secret ; car, ajouta sir Robert M…, vous pensez bien que si l’homme gris désire voir Rocambole, il admet cette hypothèse, que Rocambole libre, s’introduisant comme un visiteur à Newgate, pourra lui parler et s’en aller ensuite.
– Cela est assez vraisemblable.
– Or, acheva sir Robert M…, deux prisonniers ne sont pas plus difficile à garder qu’un seul ; par conséquent, nous garderons aussi bien le second que le premier.
– Votre idée est excellente, dit le révérend Patterson. Tenez-vous donc prêt à tout événement.
Ce devait être, pour le révérend, la journée aux télégrammes.
À cinq heures du soir, il en reçut encore un.
Celui-là était signé « Edward, détective ».
Le révérend savait qu’Edward était le collègue qu’avait emmené sir James Wood.
La dépêche d’Edward était ainsi conçue :
« J’ai suivi, par ordre de sir James, l’homme auquel vous vous intéressez. Il s’arrête à Douvres vingt-quatre heures. La personne qui l’accompagne et lui doivent prendre demain soir l’express de sept heures.
« Les suivre, mais ne pas les arrêter tout de suite. Expliquerai pourquoi.
« EDWARD. »
Et le révérend Patterson, ayant pris connaissance de cette dépêche, murmura :
– Décidément, ce sir James Wood est un habile homme !
*
* *
Après le départ du révérend Patterson, le bon gouverneur de Newgate, le jovial Robert M…, n’avait pas perdu une minute.
– Je vais, s’était-il dit, faire transférer dès demain matin mes deux prisonniers dans la cellule à trois lits.
Et comme, depuis que Barnett avait parlé, sir Robert s’était remis à visiter son prisonnier, il l’alla voir.
Il avait trouvé depuis deux jours un excellent moyen de converser avec Barnett et d’apprendre ce que l’homme gris lui disait, sans éveiller les soupçons de ce dernier.
On venait, chaque jour, à midi, chercher le prisonnier, en lui mettant les fers aux pieds et aux mains, et on le conduisait dans le parloir vitré, où il trouvait un solicitor chargé de le défendre devant les assises.
Pendant ce temps, sir Robert M… allait voir Barnett.
Il fit donc une nouvelle visite aux deux prisonniers.
Alors sir Robert M…, lorsque le révérend fut parti :
– Gentleman, lui dit-il, comment vous trouvez-vous ici ?
– Assez bien, Votre Honneur.
– Non, dit sir Robert M… ; cette cellule est humide.
– Je ne m’en suis pas aperçu, Votre Honneur.
– C’est égal, dit sir Robert M…, je vous ferai mettre dans une autre, plus grande, plus spacieuse, et où l’on va trois au besoin.
Rocambole tressaillit.
– Me séparerez-vous donc de Barnett ? demanda-t-il.
– Nullement, mon cher, et même, le cas échéant vous aurez un nouveau compagnon.
– En vérité ! dit l’homme gris.
– Un homme dont vous avez peut-être entendu parler.
– Ah ! bah !
– Il s’appelle Rocambole.
L’homme gris ne sourcilla pas.
– Votre Honneur se trompe, dit-il, voilà un nom que j’entends pour la première fois.
Mais il avait su, en parlant ainsi, trahir un certain trouble et le bon sir Robert M…, s’en alla ravi. Et quand le gouverneur fut parti, Barnett regarda l’homme gris.
– Ah ! cette fois, dit-il, je n’y comprends plus rien.
– Tu comprendras quand il en sera temps, dit-il.
Et l’homme gris se posa mentalement cette question :
– Est-ce Marmouset, est-ce Milon qui s’est fait arrêter ? Je ne sais pas, mais enfin c’est l’un ou l’autre…
Allons, je vais avoir de leurs nouvelles.
Rocambole se trompait bien un peu, mais si peu, qu’il nous faut faire maintenant un pas en arrière pour expliquer les télégrammes dont le révérend Patterson et sir Robert M… étaient les dupes.
VI
Marmouset, quand il s’était emparé de sir James Wood et l’avait gardé au fond d’un puits, avait pris des précautions pour que sa disparition ne fût remarquée par personne.
Le détective Edward était devenu l’homme de Marmouset ; mais, pour les gens de l’hôtel du Louvre, il était toujours l’ami de sir James.
Edward s’était donc présenté régulièrement deux fois par jour à l’hôtel du Louvre pour prendre les lettres et les dépêches de son compagnon, lequel, disait-il, avait fait une absence qui ne se prolongerait pas au delà de deux ou trois jours.
En outre, le détective Edward s’était emparé de la correspondance de sir James avec le révérend Patterson.
Par cette correspondance, Marmouset s’était trouvé tout d’un coup fixé sur le sort de Rocambole.
L’homme gris était à Newgate, on le jugerait très certainement, et on ne manquerait pas de le condamner à mort. Les circonstances atténuantes n’existent pas en Angleterre, du reste.
Mais pour le juger, s’il fallait croire ce que disait le révérend Patterson, il était nécessaire de dissiper les ténèbres dont s’enveloppait ce personnage mystérieux et de savoir son vrai nom et sa nationalité.
Toutes choses qu’on n’avait pas pénétrées jusqu’alors.
Donc, Marmouset et ses compagnons allaient partir, quand le détective Edward alla une dernière fois à l’hôtel du Louvre.
Comme on le pense bien, Marmouset emmenait avec lui trop de monde pour qu’il ne fût pas nécessaire de se diviser en route.
Milon, la Mort-des-Braves et Polyte avaient pris le train-omnibus de Boulogne.
Ils emportaient avec eux une grande caisse dans laquelle se trouvait sir James Wood plongé en léthargie.
Marmouset, miss Ellen et Vanda devaient prendre l’express, ce qu’on appelle train de marée.
Miss Ellen avait caché son opulente chevelure dans le petit bonnet de femme de chambre, et elle comptait beaucoup sur ce déguisement pour rentrer incognito à Londres.
Le départ avait lieu de chez Marmouset.
Au moment où ils allaient monter en voiture, le détective Edward arriva.
Rendez-vous lui avait été donné à la gare ; pour qu’il revînt rue Aubert, il fallait quelque chose d’extraordinaire.
Et, en effet, il tendit à Marmouset une dépêche qu’il venait de trouver à l’hôtel du Louvre et qui était adressée à sir James Wood. C’était celle du révérend Patterson.
« Avez-vous connaissance d’un chef fénian appelé Rocambole et qui doit être à Paris ? »
– Voilà qui est bizarre, murmura Marmouset.
Et il tendit la dépêche à Vanda, puis à miss Ellen ; tous trois se regardaient.
Enfin, après un moment de silence, Marmouset dit :
– Plus que jamais il faut partir.
Et ils se rendirent à la gare et s’installèrent dans un coupé, les deux hommes et les deux femmes, afin de pouvoir causer librement.
– Voulez-vous mon opinion ? dit alors Marmouset.
– Parlez, dit Vanda.
– Il y a du Rocambole lui-même dans cette dépêche.
– Comment cela ?
– Dame ! vous pensez bien que Rocambole, depuis qu’il est à Newgate, a bien pu compter un peu sur nous, mais qu’il a compté sur lui aussi ?
S’il faut en croire la correspondance du révérend Patterson, les Anglais cherchent le vrai nom de l’homme gris et ne le jugeront que lorsqu’ils l’auront trouvé.
Or, Rocambole doit avoir jasé à dessein dans sa prison, ou subi des interrogatoires dans lesquels il aura achevé de dérouter le juge chargé de l’instruction de son affaire.
– Ah ! tu crois ?
– Et si le révérend Patterson parle de Rocambole, c’est que l’homme gris en a parlé le premier.
– Dans quel but ?
– Je ne sais pas. Seulement, il est de principe au whist ou au domino de rendre sa couleur à son partner, sans connaître son jeu.
Nous ne savons pas quel est le plan du maître, mais il ne faut pas l’entraver.
Cinq heures après, Marmouset et ses compagnons arrivaient à Boulogne.
On était alors en hiver et la mer était très mauvaise.
– Nous allons coucher ici, dit Marmouset, nous ne partirons que demain matin.
– Pourquoi ? demanda Vanda.
– Parce que je ne serais pas fâché de tâter un peu le révérend Patterson avec une dépêche.
– Ah !
– Que nous soyons à Londres à dix heures du matin où à quatre heures du soir, peu importe ! Il n’y a pas de temps perdu.
– Mais il n’y en a pas à perdre non plus, dit miss Ellen à Marmouset avec un sourire.
– Oh ! rassurez-vous, mademoiselle, dit-il, nous le sauverons.
Milon les attendait à la gare.
– Le bateau chauffe, dit-il.
– Oui, mais nous ne partons pas ce soir.
– Ah ! pourquoi donc ?
– Tu le sauras demain.
Ils descendirent à l’hôtel d’Espagne, dont les fenêtres donnent sur la mer.
Marmouset dormit peu cette nuit-là. Il réfléchit beaucoup en revanche, et se dit :
– J’ai la conviction maintenant que Rocambole se moque de ses geôliers.
Au petit jour, il descendit dans la salle commune de l’hôtel et y trouva Milon.
Milon lisait les journaux anglais arrivés par le packett du matin.
Tout à coup Marmouset le vit pâlir.
– Qu’as-tu donc ? dit-il.
– Lisez, balbutia Milon d’une voix étranglée.
Et il tendit le Times à Marmouset en mettant le doigt sur le fameux entrefilet rédigé par sir Robert M…, le jovial gouverneur de Newgate.
« L’homme qui a donné le plus de souci au gouvernement de S. M. la reine depuis quelques mois, le fenian Rocambole, vient d’être arrêté à Dublin…
Marmouset eut un cri de joie.
– Es-tu bête ! dit-il.
– Bête ! dit Milon stupéfait.
– Sans doute. Voilà la preuve de ce que je soupçonnais…
– Comment ?
– Rocambole joue la police, et la police anglaise, persuadée que ce Rocambole est un ami de l’homme gris, annonce son arrestation. Or, comme Rocambole est à Newgate depuis quinze jours, on n’a pas pu l’arrêter à Dublin.
Donc, cet article est une note de police, à moins que Rocambole lui-même n’en soit l’auteur.
– Oh !
– Et cela pourrait être aussi, ajouta Marmouset.
– Mais… dans quel but ?
– Dans le but de nous avertir, au cas où miss Ellen ne nous aurait pas trouvés, qu’il a besoin de nous.
Et Marmouset reprit son chapeau.
– Viens avec moi, dit-il.
– Où cela ?
– Au télégraphe.
– Pourquoi faire ?
– Nous allons expédier une dépêche au révérend Patterson.
– Au nom de qui !
– Au nom de sir James, donc ! Du reste, Edward est descendu à l’hôtel d’Espagne sous ce nom.
– À quoi bon cette dépêche ?
– À ceci que le révérend Patterson nous répondra dans le cas où on aurait réellement arrêté un homme qui prendrait le nom de Rocambole.
Et, au télégraphe, Marmouset écrivit :
« Boulogne, 7 heures du matin.
« Rocambole parti pour Londres à minuit, via Calais. Teint pâle, moustaches noires. Une femme voyage avec lui. »
– Mais, s’écria Milon, c’est votre portrait que vous faites là, il me semble !
– J’ai mes raisons, dit Marmouset.
Et il attendit la réponse du révérend Patterson.
VII
Marmouset n’attendit pas longtemps.
Il n’était pas de retour à l’hôtel d’Espagne qu’un télégramme arriva à l’adresse de sir James Wood.
Le détective Edward le reçut.
Le révérend Patterson disait laconiquement : « C’est bien. Et miss Ellen ? »
Alors Marmouset regarda Milon.
– Tu sais bien, dit-il en lui montrant le télégramme, que Rocambole se moque d’eux.
– Je commence à le croire, en effet, dit Milon, mais…
– Mais quoi ?
– Il y a une chose que je ne comprends toujours pas.
– Laquelle ?
– Pourquoi donnez-vous votre signalement ?
– Afin qu’on puisse m’arrêter plus facilement.
– Vous voulez donc vous faire arrêter ?
– Oui, à Londres.
– Dans quel but ?
– Dans le but d’aller à Newgate.
– Pour voir Rocambole ?
– Naturellement, et prendre ses ordres, car si la note des journaux, comme il faut bien le croire, du reste, émane de lui, c’est qu’il a bien pensé que nous devinerions son idée et que nous ferions l’impossible pour arriver jusqu’à lui.
– Ah ! dit Milon, ce n’est pas d’entrer à Newgate qui est difficile.
– C’est d’en sortir.
– Justement.
– J’en sortirai cependant, et on me fera mille excuses, encore.
– Comment ferez-vous ?
– Je me ferai réclamer par l’ambassade de France.
Puis Marmouset ajouta avec un sourire :
– Mon premier passé est si loin que je n’ai pas peur d’en voir apparaître la moindre trace. Voici six ans, tout à l’heure que je vis au grand soleil de la vie parisienne.
– Ça, c’est vrai, dit Milon.
– Pour le monde, je ne m’appelle pas Marmouset, mais M. Félix Peytavin, un homme élégant qui est du Club, a de beaux chevaux, joue gros jeu, possède trois ou quatre cent mille livres de rentes et duquel répondrait au besoin toute la fashion.
– Cela est vrai encore, ajouta Milon.
– Or, poursuivit Marmouset, je suis personnellement lié avec le jeune marquis de C…, premier secrétaire de l’ambassade française à Londres.
– Bon ! dit le colosse.
– Tu me laisseras arrêter.
– Et puis ?
– Peut-être est-il nécessaire que je passe au moins deux jours à Newgate.
– Et après ces deux jours ?
– Après, tu iras à l’ambassade et tu porteras une lettre que je vais écrire, et une autre au marquis de C…
Ce colloque entre Marmouset et Milon avait lieu, non plus dans la salle commune de l’hôtel d’Espagne, mais dans la chambre où Marmouset avait passé la nuit.
Marmouset s’assit donc devant une table, prit la plume et écrivit la lettre suivante :
« Mon cher marquis,
« Il paraît que notre beau pays de France n’est pas le seul à avoir son criminel introuvable, son Jud fantastique.
« L’Angleterre a aussi le sien.
« De temps en temps, un agent de police idiot ou un gendarme stupide mettent la main sur un pauvre homme, s’obstinent à le prendre pour ce même Jud, qui n’a jamais existé probablement, et le fourrent en prison.
« Voilà mon histoire sur le sol de la libre Angleterre, mon cher marquis.
« Un policeman croit voir en moi un de ces fenians imaginaires qui troublent le sommeil des vénérables personnages qui siègent à la Chambre des lords.
« J’ai beau montrer mes papiers, mes titres, mes lettres, il ne veut rien entendre et m’appelle du singulier nom de Rocambole.
« À peine ai-je le temps de vous écrire ces lignes, que je confie à mon valet de chambre éploré, et je suis contraint d’aller coucher à Newgate.
« Le policeman en question fait même si bien les choses, qu’il m’assure que je serai pendu d’ici à trois semaines.
« Heureusement que vous êtes à Londres et que vous réclamerez le propriétaire de Miss Arabelle, la jument qui, vous le savez, a gagné le derby de Chantilly cette année.
« Votre
« FÉLIX PEYTAVIN. »
– Serre cette lettre, dit Marmouset, qui, avant de la fermer, en donna connaissance à Milon, et prends aussi cette autre.
– Fort bien.
– Deux jours après mon incarcération, on se présentera à l’ambassade.
– Mais il faut tout prévoir, dit Milon.
– Quoi donc ?
– Il faut prévoir le cas où le marquis ne serait pas à Londres.
– Il y est.
– Vous en êtes sûr ?
– Je lui ai serré la main il y a trois jours, au club, et il partait le soir même pour retourner à son poste.
– Alors c’est bien.
Le rôle de Milon ainsi tracé, Marmouset appela le détective Edward.
Il lui donna le modèle de deux dépêches.
L’une était signée par James Wood, et c’était celle que le révérend Patterson reçut datée de Boulogne, indiquant que miss Ellen était toujours gardée.
L’autre, au propre nom d’Edward, devait être expédiée de Douvres par lui.
– Je ne comprends pas bien celle-là, dit le détective.
– C’est bien simple pourtant, dit Marmouset. Après une dépêche de ce matin, le révérend a dû prévenir la police.
– Fort bien !
– Et il y a des policemen dans toutes les gares.
– Bon !
– Si je veux avoir quarante-huit heures de liberté à Londres, il faut donc qu’on m’attende à Douvres, tandis que j’arriverai par le train de Folkestone que je vais prendre dans une heure.
– À merveille ! je comprends.
– Maintenant, écoutez-moi.
– J’attends, dit sir Edward.
– Vous allez donc passer par Calais, descendre à Douvres, expédier de là ce deuxième télégramme ; puis vous partirez pour Londres aussitôt, et à peine arrivé vous vous présenterez chez le révérend Patterson.
– Que lui dirai-je ?
– Que vous m’avez laissé à Douvres, surveillé par deux policemen, et que vous venez prendre ses ordres.
– Et où vous retrouverai-je ?
– Demain soir à Evans Taverne, dans Covent Garden.
– J’y serai, dit sir Edward qui alla prendre le train de Calais.
Quant à Marmouset et à ses compagnons, ils s’embarquèrent sur le paquebot de midi, et, deux heures après, ils étaient en route pour Londres.
L’audace, le sang-froid de Marmouset avaient rempli de confiance le cœur de miss Ellen.
Elle aussi murmurait :
– Oh ! nous le sauverons !…
VIII
Donc, tandis que le détective Edward partait pour Calais, d’où il devait se rendre à Londres, Marmouset s’était embarqué avec Vanda et miss Ellen à Boulogne, était débarqué à Folkestone et avait aussitôt repris le train de Londres.
Milon avait expédié ses autres compagnons par un précédant paquebot.
On le sait, Milon, Marmouset et Vanda connaissaient Londres admirablement et tous trois parlaient anglais.
À partir du moment où ils avaient mis le pied sur le paquebot, il avait été convenu que Vanda et miss Ellen d’une part, Marmouset et Milon de l’autre, ne se parleraient plus et qu’ils voyageraient en deux groupes.
À Folkestone, Vanda et miss Ellen qui passait pour sa femme de chambre et qui s’était si bien embéguinée sous une coiffe normande que lord Palmure lui-même n’eût pu reconnaître sa fille, Vanda et miss Ellen, disons-nous, montèrent dans le compartiment réservé aux dames.
Milon, en quittant Boulogne, avait bravement endossé une belle livrée.
Quand ils arrivèrent à Londres, Vanda et miss Ellen descendirent à la gare de Cannons’street ; Marmouset et Milon demeurèrent dans le train, qui repassa la Tamise deux fois avant d’arriver à Charing-Cross.
Vanda devait aller loger dans une maison de famille située dans la Cité, auprès du Post Office.
Marmouset et Milon, au contraire, s’en allèrent dans le Strand, à l’hôtel des Trois-Couronnes.
En débarquant sur le quai de la gare, Marmouset avait compilé sept ou huit policemen.
– C’est pour nous, avait-il dit à Milon.
– Déjà ?
Et Milon avait eu un geste d’effroi.
Mais Marmouset avait un air si britannique, il donna des ordres à Milon en anglais si pur, qu’en dépit de ses moustaches noires, les policemen le prirent pour un parfait gentleman des environs de Londres.
D’ailleurs, l’homme qu’ils avaient mission de rechercher ne voyageait-il pas avec une femme ?
Marmouset poussa même l’aplomb jusqu’à s’adresser à l’un d’eux pour le prier de lui faire avancer un cab.
– Ah çà ! maintenant, dit Milon, quand ils furent installés dans le parloir des Trois-Couronnes, qu’allons-nous faire ?
– Souper, dit Marmouset.
– Et puis ?
– Et puis nous coucher.
– Et demain ?
– Demain, nous nous promènerons ; nous lirons les gazettes ; nous regarderons les femmes qui se promènent dans les parcs.
– Nous n’irons pas voir Vanda ?
– Non, pas avant d’avoir revu Edward.
– Ah ! c’est juste. Vous lui avez donné rendez-vous à Evans Tavern demain soir ?
– Oui, fit Marmouset. Et tant que je ne l’aurai pas vu, mous ne pouvons rien faire.
– Pas même réveiller ce pauvre sir James Wood, qui dort depuis deux jours au fond d’une caisse, et que nous avons nourri, à Boulogne, en lui introduisant du bouillon par le nez.
– Oh ! si fait, dit Marmouset, nous pouvons le faire revenir à lui ! ce soir même.
– Et qu’en ferons-nous ?
– Nous lui donnerons la liberté provisoirement.
– Oui, dit Milon, pour qu’il nous trahisse.
– Il aurait pu nous trahir à Paris ; mais… à Londres… la chose est tout à fait impossible.
– Pourquoi ?
– Parce qu’il est maintenant, grâce à la lettre que j’ai écrite à l’abbé Samuel, complètement à la merci des fenians.
Comme Marmouset disait cela, un homme entra dans le parloir.
C’était un gentleman qui paraissait arriver de voyage.
– Dieu vous garde, gentleman ! dit-il.
Et il vint s’asseoir à la table sur laquelle on avait servi aux deux Français du roastbeef et un pot de pale ale.
Marmouset n’était pas fénian, comme on le pense bien, mais il avait écrit à l’abbé Samuel en prenant le titre d’ami de l’homme gris.
Le gentleman qui vint s’asseoir auprès de lui prit alors la parole en français.
– Vous êtes celui que l’abbé Samuel attend, n’est-ce pas ?
– Peut-être ! dit Marmouset.
Le gentleman tira de sa poche un papier.
C’était une lettre du prêtre irlandais.
– Fort bien ! dit Marmouset.
– Vous pensez bien que nous vous attendons avec impatience, reprit le gentleman.
Un de nous était à Cannons’street, l’autre à London-Bridge, moi à Charing-Cross.
Si on n’a pas visité vos bagages à la douane de cette dernière gare, c’est que l’un des nôtres est parmi les douaniers.
– Ah ! ah ! dit Marmouset.
Puis regardant le gentleman :
– Vous êtes des gens bien informés, dit-il.
– Nous avions envoyé deux des nôtres, l’un à Calais, l’autre à Boulogne. Une dépêche, en termes incompréhensibles pour d’autres que pour nous, nous a informés que vous nous ameniez le traître, plongé en léthargie dans une caisse.
– C’est parfaitement exact.
– Et je viens le chercher.
Marmouset fronça le sourcil.
– L’abbé Samuel ne compte-t-il donc pas tenir la parole qu’il m’a donnée ? fit-il.
– L’abbé Samuel n’a jamais manqué à sa parole.
– Alors, que voulez-vous faire de sir James ?
– Nous assurer de lui ; mais, soyez tranquille ; on ne lui fera aucun mal.
– Et le tiendra-t-on à ma disposition ?
– Parfaitement.
– C’est bien, dit Marmouset. Permettez-nous de souper, puis nous monterons dans notre chambre, où nous vous livrerons notre prisonnier.
– Avez-vous un moyen prompt de l’arracher à sa léthargie ?
– Ce sera l’affaire d’une minute.
Marmouset et Milon soupèrent en compagnie du gentleman.
Ils avaient causé si familièrement tous trois que les gens de l’hôtel des Trois-Couronnes s’imaginèrent que le troisième voyageur connaissait les deux premiers de longue date et qu’ils ne firent aucune difficulté de donner, à celui-ci une chambre voisine de celle de Marmouset.
Alors le fenian rejoignit Marmouset et s’enferma avec lui et Milon.
La fameuse caisse dans laquelle on avait ménagé des trous pour que sir James Wood ne fût pas asphyxié, fut ouverte.
Le détective était à l’état de cadavre.
Milon, qui était robuste, le prit dans sas bras et le porta sur un lit.
Puis Marmouset déboucha une petite fiole et versa quelques gouttes d’une liqueur verte qu’elle contenait sur les lèvres serrées du prétendu mort.
Soudain un tressaillement parcourut ce corps inerte jusque-là ; les yeux s’écarquillèrent violemment et les lèvres s’ouvrirent.
Marmouset versa quelques gouttes encore qui pénétrèrent dans la bouche.
Et aussitôt sir James se leva.
Puis regardant le gentleman, il jeta un cri d’effroi.
– Ah ! fit celui-ci avec flegme, je vois que tu me reconnais…
Sir James s’était pris à trembler de tous ses membres.
IX
Marmouset dit alors à sir James :
– Ne craignez rien, vous êtes en nos mains, et depuis qu’un homme qui se nommait Rocambole m’a appris à ne jamais violer mon serment, je l’ai toujours fidèlement tenu.
Je vous ai promis de vous protéger, à la condition que vous nous serviriez.
Si vous ne cherchez pas à vous soustraire à nos engagements, il ne vous arrivera aucun mal. N’est-ce pas, gentleman ?
– Assurément non, dit le fénian.
Et Marmouset regarda le gentleman.
– Je vous confie à monsieur, poursuivit Marmouset, parce que j’ai besoin de toute ma liberté d’action ; mais monsieur me jure que pas un cheveu ne tombera de votre tête si vous ne cherchez à nous nuire.
Sir James Wood regardait le fénian et continuait à trembler.
Marmouset acheva :
– Monsieur sait bien que c’est au nom de l’homme gris que je vous ai fait cette promesse.
– C’est vrai, fit le fénian, et la promesse sera tenue.
Puis, regardant à son tour Marmouset :
– Que désirez-vous que nous fassions, monsieur ? dit-il.
– Monsieur, répondit Marmouset, je laisse à sir James le choix : ou de rester ici prisonnier sur parole… ou de vous suivre…
– Je préfère rester ici, balbutia le détective.
– Monsieur, dit le gentleman, voulez-vous me permettre d’émettre mon sentiment ?
– Parlez…
– Laissez monsieur en nos mains jusqu’à ce que l’homme gris soit en liberté.
– C’est pareillement mon avis, dit Milon.
Alors sir James se jeta aux pieds de Marmouset :
– Monsieur… par pitié… dit-il, ne me laissez pas aux mains des fénians…
– Puisque nous ne te ferons aucun mal ! dit le fénian.
Et comme sir James baissait la tête :
– Tu me connais, pourtant, dit le gentleman.
Sir James ne répondit pas.
– Et tu sais que je tiens parole.
Puis le gentleman se dirigea vers la fenêtre.
– James, dit-il, encore, je n’ai qu’à me pencher dans la rue, à donner un coup de sifflet et six hommes seront ici en un clin d’œil, et ton châtiment commencera. Je te le répète, si tu veux me suivre de bonne volonté, nous tiendrons fidèlement la promesse que monsieur t’a faite.
– Allez, sir James, dit Marmouset d’un ton solennel ; au nom de l’homme gris, je vous jure que vous ne courez aucun danger.
Et sir James fut contraint de suivre le gentleman.
Quand ils furent partis, Milon dit à Marmouset :
– C’est égal, nous eussions mieux fait de laisser sir James à Paris.
– Et pourquoi cela ?
– Un de mes contremaîtres lui aurait descendu à manger chaque jour dans le puits, et nous aurions été tranquilles.
– Oui, mais ici il nous servira.
Milon haussa les épaules.
– Voilà qui n’est pas sûr, dit-il.
– Il sait bien que dans le cas contraire, il est condamné à mourir.
Milon ne se trouva pas convaincu.
– Et qui vous dit, reprit-il, qu’il ne fera pas le sacrifice de sa vie un beau matin ?
– Dans quel but ?
– Dans le but de se venger.
Marmouset tressaillit.
– Voyez-vous, ajouta Milon, j’ai été au bagne, moi, et j’y ai connu des natures incorrigibles et qui dominent la peur de la mort.
– Quoi qu’il en soit, fit Marmouset, nous n’avons pas à le craindre pour le moment. Songeons à l’homme gris, c’est-à-dire à Rocambole, notre maître.
*
* *
Marmouset et Milon se mirent donc au lit et dormirent la grasse matinée, descendirent vers midi et déjeunèrent, puis ils allèrent se promener.
Un petit billet leur était parvenu dans la matinée. Il était de Vanda.
Vanda écrivait :
« Nous sommes très confortablement, ma femme de chambre et moi, et nous attendons patiemment tes ordres, puisque c’est toi qui diriges notre expédition. »
Marmouset avait répondu ce mot.
« Attendez ! »
Milon et lui ne se quittèrent pas de la journée ; puis, le soir venu, ils allèrent à Evans Tavern.
Le détective Edward s’y trouvait déjà.
Tous trois s’assirent à une table, demandèrent de la bière et se mirent à causer à voix basse.
– Eh bien ? fit Marmouset.
– Eh bien ! dit Edward, vous avez deviné.
– Ah !
– L’homme gris s’est moqué de la police, de la pairie et du clergé.
– Vraiment ? dit Marmouset avec un sourire.
– On lui a mis dans sa prison, poursuivit Edward, ce que vous appelez, vous autres, un mouton.
– Bon !
– Il aura très probablement ensorcelé le mouton.
– Cela ne m’étonne pas, dit Milon, qui se souvint de l’étrange don de fascination que possédait Rocambole.
– Et le mouton est avec lui.
– Quelle preuve en avez-vous ?
– Ce monsieur a raconté que l’homme gris lui avait confié qu’il comptait beaucoup pour sa délivrance sur un chef fénian qui se trouvait à Paris.
– Et qui se nommait Rocambole ?
– Justement.
– Pauvre gens ! dit Marmouset en souriant.
– Puis, c’est lui, le mouton, continua Edward, qui leur a donné l’idée de faire l’article des journaux.
– Ah ! ah ! Et que vous a dit le révérend Patterson ?
– Il est pressé de voir arrêter Rocambole.
– Fort bien.
– D’autant mieux, ajouta Edward, qu’on compte bien le mettre dans la même cellule que l’homme gris.
Cette fois Marmouset partit d’un éclat de rire.
Puis il dit à Milon :
– Tu peux ce soir aller trouver Vanda.
– Ah !
– Et lui dire que je me fais arrêter demain matin.
– J’y vais, dit Milon. Où vous retrouverai-je ?
– À l’hôtel des Trois-Couronnes.
Et Marmouset dit à Edward :
– Cela ne m’avancerait pas à grand’chose d’entrer à Newgate ce soir, il faut nous arranger pour me faire arrêter demain matin.
– Où cela ?
– À l’hôtel, dans mon lit.
– Entrer à Newgate n’est rien, dit Edward, mais… en sortir ?
– Oh ! répondit Marmouset, ne vous inquiétez pas, j’ai mon affaire.
– Vous avez le moyen d’en sortir ?
– Avec les excuses de Leurs Seigneuries. Milon a ses instructions à ce sujet.
Puis il ajouta :
– Et maintenant, quittez-moi, et envoyez un petit billet au révérend Patterson pour lui apprendre que vous avez l’œil sur Rocambole.
Que diable ! murmura Marmouset d’un ton moqueur, il faut bien que le chef des détectives anglicans passe enfin une bonne nuit !…
Le détective s’en alla et Marmouset fut tranquillement se coucher.
X
On avait donc installé l’homme gris et son compagnon de captivité, Barnett, dans une cellule plus grande et plus spacieuse.
Sir Robert M…, le joyeux gouverneur de Newgate, ne manqua pas, dès le matin, de faire sa visite quotidienne au prisonnier.
– Eh ! gentleman, lui dit-il, j’ai une bonne nouvelle à vous donner.
– Ah ! fit l’homme gris.
– Vous aurez un nouveau compagnon aujourd’hui.
– Vraiment ? dit le prisonnier.
– C’est comme j’ai l’honneur de vous le dire.
– Eh bien, Votre Honneur, dit l’homme gris, voilà le cas ou jamais de couronner toutes vos bontés pour moi.
– Que désirez-vous ?
– Si nous sommes trois, faites-nous donner des cartes, nous jouerons au whist.
Sir Robert M… se mit à rire.
– À moins que votre nouveau venu ne soit le dernier des ignorants, il doit jouer le roi des jeux.
– Vous devez le savoir, gentleman.
– Moi ?
– Oui, car vous connaissez beaucoup la personne qui va venir.
– Allons donc !
– C’est votre ami Rocambole.
– J’ai déjà eu l’honneur de dire à Votre Seigneurie que ce nom m’était parfaitement inconnu.
Sir Robert M… le regarda d’un air qui aurait pu se traduire par ce mot :
– Farceur !
Puis il ajouta :
– C’est qu’alors nous avons été mal renseignés.
– Par qui ?
– Par les deux détectives que nous avons envoyés en France.
L’homme gris ne fit pas d’autre question.
Sir Robert M… causait volontiers. Aussi reprit-il :
– Quand je vous annonce l’arrivée d’un compagnon pour aujourd’hui, je me trompe peut-être.
– Ah ! fit l’homme gris.
– Il est possible que ce ne soit que pour demain.
– Où donc l’avez-vous mis ?
– Nulle part encore. Je l’attends.
– Mais il est arrêté ?
– Il doit l’être.
– Et vous ne l’avez pas encore vu ?
– Non.
L’homme gris soupira.
– Tant pis, dit-il, car vous m’eussiez donné son signalement ; après tout, il est possible que je le connaisse.
– Ah ! ah !
– Et qu’il ait changé de nom… comme moi…
Et l’homme gris souriait avec une bonhomie charmante.
– Je n’ai pas vu mon futur prisonnier, répondit sir Robert M… ; mais on m’a transmis son signalement.
– Voyons ?
– C’est un homme de taille moyenne, jeune, vingt-sept ou huit ans.
– Fort bien.
– Brun, avec de petites moustaches noires.
– Et puis ?
– Il voyage avec une femme.
– Et c’est tout ?
– Tout absolument.
– Votre Honneur ne m’apprend pas grand’chose.
– Du reste, vous le verrez. Au revoir, gentleman.
– Longue vie à Votre Seigneurie ! répondit l’homme gris.
Et le bon gouverneur s’en alla.
L’homme gris regarda alors Barnett et se mit à rire.
– Vous connaissez parfaitement, je le vois, dit l’Irlandais, celui qui va venir.
– Parbleu !
– Mais ce n’est pas Rocambole ?
– Non, car Rocambole c’est moi.
L’Irlandais jeta un cri.
– Mon bon ami, dit l’homme gris, si on t’avait dit, il y a huit jours, que du fond de ma prison je correspondrais, au moyen des journaux, avec mes amis, l’aurais-tu cru ?
– Non, certes.
– Eh bien ! cela est pourtant, et je dois rendre à la police, cette justice qu’elle a fait mes petites affaires avec un zèle admirable.
– Seulement, observa Barnett, je ne comprends pas très bien de quelles affaires il s’agit.
– Alors, suis mon raisonnement. On m’arrête, me voilà en prison et dans l’impossibilité de m’évader, à moins que je n’aie des amis au dehors.
– Bon !
– Il est en France des hommes qui peuvent me venir en aide, qui verseront, pour moi, jusqu’à la dernière goutte de leur sang, mais qui ne savent même pas que je suis en prison.
Alors, que fais-je ? J’invente un homme qui peut donner sur moi des éclaircissements.
La police tombe dans le piège et se charge d’annoncer à mes amis ma captivité.
Naturellement, mes amis viennent à Londres.
– Mais, dit encore Barnett, s’ils se font arrêter, ils ne pourront plus rien pour vous.
– Tu te trompes encore…
– Ah !
– Ce jeune homme aux moustaches noires, dont parle notre bon gouverneur…
– Eh bien ?
– C’est mon ami, mon fils adoptif, quelque chose comme un autre moi-même. Il est donc tout naturel qu’il ait compris que la note des journaux était mon œuvre. Et le voilà à Londres, où on l’arrêtera, et on l’amène ici, où il vient s’entendre avec moi et prendre mes ordres.
– Mais comment sortira-t-il ?
– Ne t’inquiète pas de lui.
Comme Rocambole disait cela, on entendit dans le corridor les pas lourds et mesurés des gardiens.
Puis les verrous de la porte grincèrent, la grosse clef tourna dans la serrure, et sir Robert M… parut.
Derrière lui deux gardiens conduisaient un homme déjà revêtu du costume de la prison.
L’homme gris ne sourcilla pas.
Il regarda le nouveau venu avec une parfaite indifférence.
Marmouset, car c’était lui, ne broncha pas davantage.
En vain sir Robert M… épia-t-il un geste, un regard, un signe furtif de reconnaissance.
Les deux prisonniers parurent complètement étrangers l’un à l’autre.
Barnett regarda le gouverneur.
Son regard semblait dire…
– Je crois bien qu’on s’est moqué de Votre Honneur.
Sir Robert M… ne riait plus.
Et s’adressant à l’homme gris, il lui dit :
– Voici l’homme dont je vous ai parlé. C’est un français du nom de Rocambole.
L’homme gris eut un sourire :
– Vous avez un singulier nom, monsieur, dit-il au nouveau venu.
Marmouset s’inclina.
– Et vous, monsieur, dit-il, comment vous nommez-vous !
– L’homme gris.
– Un nom tout aussi singulier, monsieur.
Et les deux prisonniers se saluèrent comme de parfaits gentlemen qu’ils étaient.
Alors sir Robert M… fit un signe à Barnett.
Ce signe voulait dire :
– Plus que jamais, observe et écoute.
Barnett cligna de l’œil.
– Soyez tranquille ! fit-il.
Sir Robert M… s’en alla.
Mais quand la porte de la cellule fut refermée, Marmouset et Rocambole ne changèrent pas d’attitude.
Ils continuèrent à se regarder avec indifférence, à telle enseigne que Barnett se dit :
– Ah çà ! mais ils ne se connaissent donc pas ?…
XI
Il y a, à Londres, un système de glaces-réflecteurs très curieux.
La Cité, qui est le quartier des affaires par excellence, est abondamment pourvue de ces miroirs vigilants.
Placés à l’extérieur des maisons, mais au niveau du sol, ils sont disposés de telle manière que le policeman qui, la nuit veille dans chaque rue, voit du dehors tout ce qui se passe au dedans et rend toute tentative de vol impossible.
Marmouset et Rocambole, en se retrouvant face à face, avaient eu la même idée, et même compliquée, comme on va le voir.
Un inventeur, ou plutôt un innovateur, M. Hudson, a remis à la mode, en Amérique, un procédé d’acoustique qui ressemble par ses résultats au miroir réflecteur.
Une succession de tuyaux disposés de certaine façon et adroitement dissimulés dans le plafond ou le plancher d’une salle, permettent à la voix de parcourir, distincte et sonore, une grande distance, à l’insu de celui qui parle.
Rocambole et Marmouset ne s’étaient pas regardés mais ils s’étaient compris.
On avait bien mis avec eux un homme dont sir Robert M… se croyait sûr et qui, par conséquent, était chargé de les espionner.
Mais était-ce suffisant ?
Cette cellule, ou plutôt cette chambre spacieuse, aérée, dans laquelle on avait transféré l’homme gris à la dernière heure, n’était-elle pas pourvue d’un réflecteur invisible et d’un appareil acoustique parfaitement dissimulé ?
Sans échanger autre chose que des regards indifférents, le maître et le disciple s’étaient compris.
Barnett, lui-même, fut dupe de ce manège, à tel point qu’il adressa la parole à l’homme gris en patois Irlandais, et lui dit :
– Mais, on s’est donc trompé ?
– Oui, dit l’homme gris.
– Ce n’est pas Rocambole ?
– Aucunement.
– Alors vous ne le connaissez pas ?
– Je ne l’ai jamais vu.
Marmouset, de son côté, ne sourcillait pas et ne paraissait pas comprendre un mot de leur conversation.
Cela dura une heure environ.
Enfin Barnett dit à Marmouset :
– Gentleman, vous ne paraissez pas vous amuser beaucoup de notre compagnie.
– Mon ami, répliqua Marmouset, on ne s’amuse jamais beaucoup en prison.
– Cela est vrai, gentleman.
– Surtout quand on n’est coupable d’aucun délit et qu’on se trouve la victime d’une erreur.
– Mais vous n’êtes donc pas ce Rocambole dont on parle tant ?
Marmouset se prit à sourire.
– J’ai entendu prononcer ce nom pour la première fois ce matin, dit-il.
Marmouset avait conquis du premier coup la confiance de Barnett.
Barnett demeurait convaincu que l’homme gris et lui ne se connaissaient pas.
– Alors, reprit Barnett, comment se fait-il que vous soyez ici ?
– Rien n’est plus extraordinaire.
– Ah !
– Je suis Français, comme vous pouvez le voir à mon accent.
– Rocambole est un nom français, du reste.
– Soit, je suis un gentleman de Paris et je ne m’appelle pas plus Rocambole que vous-même. Je suis membre d’un club de la high life, je suis riche et je fais courir.
– On voit bien, en effet, dit Barnett naïvement, que vous êtes un homme de haute vie, et non un pauvre diable comme moi.
Marmouset poursuivit :
– Je suis venu faire un voyage à Londres pour mon plaisir.
Je n’ai jamais eu d’affaires, je suis descendu dans le Strand, à l’hôtel des Trois-Couronnes, tout à côté de la gare de Charing-Cross.
– Connu ! dit Barnett.
– Après une journée et une nuit de voyage, poursuivit Marmouset, j’étais tout tranquillement couché, quand la porte de ma chambre s’est ouverte, des policemen sont montés, m’ont forcé à m’habiller, me saluant de ce nom bizarre de Rocambole que j’entendais pour la première fois, et m’ont arrêté et conduit ici.
– Vous n’avez donc pas de papiers ?
– J’avais dix lettres pour une, à mon vrai nom, dans mon portefeuille ; mais on n’a pas voulu les voir.
Barnett était de plus en plus convaincu que Marmouset disait la vérité.
– Et, fit-il, vous ne connaissez peut-être, personne à Londres ?
– Peu de monde.
– Enfin, vous pouvez vous faire réclamer ?
– C’est-à-dire, répondit Marmouset, que je suis l’ami intime du premier secrétaire de l’ambassade française et que je suis bien sûr de sortir d’ici.
– Et même, aujourd’hui, dit Barnett.
– Non.
– L’ambassade n’a pourtant qu’à dire un mot.
– Sans doute ; mais l’ambassade ne sera prévenue que demain.
– Pourquoi ?
– Parce que, j’ai envoyé hier, en arrivant, mon valet de chambre hors de Londres. Il est parti pour Liverpool, où il va porter mes compliments à un gentleman de mes amis, et lui annoncer ma prochaine visite.
– Eh bien ?
– Mon valet de chambre a dû arriver ce matin à Liverpool.
– Bon !
– Il en repartira ce soir et ne sera à Londres que demain matin. Alors il ira à l’hôtel, ne me trouvera plus, s’informera, et comme c’est un vieux serviteur qui est au courant de toutes mes relations, il ne manquera pas de courir à l’ambassade.
Et Marmouset acheva en souriant :
– Vous voyez que je suis bien tranquille ; car enfin une mauvaise nuit est bientôt passée.
– Cela est vrai.
Pendant cette conversation, l’homme gris, couché sur son lit, parcourait tranquillement les journaux, mais il n’avait pas perdu un mot de ce qu’avait dit Marmouset, et Marmouset lui avait fait savoir le plus important.
En effet, pour lui, ce que Marmouset avait dit à Barnett pouvait se traduire ainsi :
– Je suis ici pour quarante-huit heures. Nous avons donc tout le temps de trouver un moyen de nous entendre. Par conséquent, ne nous pressons pas.
À midi, on apporta leur repas aux prisonniers.
L’homme gris n’avait pas quitté son lit.
Les deux gardiens ordinaires étaient suivis d’un troisième personnage, qui n’était autre que le gardien chef.
Celui-là était un homme habile, observateur, rusé, et qui justifiait l’expression de voir courir l’air.
Il assista au repas des trois prisonniers et ne put saisir ni un regard, ni un geste, qui trahit Rocambole et Marmouset.
Comme il allait se retirer, l’homme gris lui dit :
– Master Dixon, vous vous êtes toujours conduit avec moi en gentleman.
Master Dixon salua.
– Oserais-je vous demander un petit service ?
– Si les règlements ne s’y opposent pas, certainement, répondit le gardien en chef.
– Je voudrais bien avoir un jeu de cartes.
Et se tournant vers Marmouset :
– Monsieur, dit-il, jouez-vous le whist ?
– Oui, monsieur, et avec plaisir.
– Et toi, Barnett ?
– Moi aussi.
– Je vais demander au gouverneur la permission de vous apporter des cartes, dit le gardien chef.
Et il sortit.
XII
Marmouset et Rocambole, tout en échangeant ces quelques mots, ne s’étaient pas regardés davantage.
Mais ils s’étaient parfaitement compris.
Le whist allait être le prétexte qu’ils cherchaient pour causer à leur aise.
Une demi-heure après, le gardien chef master Dixon revint.
Il apportait des cartes.
Sir Robert M… avait dit :
– Il ne faut rien leur refuser, et il faut savoir décidément à quoi nous en tenir. Se connaissent-ils ou ne se connaissent-ils pas ?
– Là est toute la question, avait répondu master Dixon.
Puis le gouverneur avait ajouté :
– Il faut m’amener Barnett.
– Oui, Votre Honneur.
Et arrivé dans la cellule, master Dixon posa les cartes sur la table et dit :
– Gentlemen, voilà bien le jeu de whist, mais comment jouerez-vous ?
– À trois, dit Marmouset.
– Vous n’allez être que deux.
– Comment cela ?
– Barnett, dit master Dixon, sa seigneurie le gouverneur a permis que votre frère vous visitât. Il est au parloir et vous attend.
Barnett se leva tout joyeux et fut aussi prudent que Marmouset et Rocambole.
Barnett n’avait pas de frère ; mais il comprenait que le gouverneur le voulait voir.
Il suivit donc le gardien en chef.
Sir Robert M… attendait le prétendu mouton dans son cabinet, mais il n’y était pas seul.
Un autre personnage que Barnett voyait pour la première fois s’y trouvait.
C’était le révérend Patterson.
– Eh bien ? demanda sir Robert M… à Barnett, as-tu quelque chose à nous apprendre ?
– Pas aujourd’hui.
– Cependant l’homme gris et Rocambole sont tête à tête.
– Oui, dit Barnett, mais…
– Mais quoi ?
– Je crois que la police s’est trompée.
– Plaît-il ?
– Rocambole n’est pas Rocambole.
– Allons donc !
Barnett raconta ce que le nouveau prisonnier lui avait dit.
Mais le révérend Patterson haussa les épaules.
– Comédie que tout cela, fit-il.
– Cependant, Votre Honneur, dit Barnett, il y a un moyen bien simple de savoir la vérité.
– Quel est-il ?
– C’est d’envoyer à l’ambassade de France.
– C’est juste, dit sir Robert M…
– Oui, mais t’a-t-il dit son vrai nom ? demanda le révérend à Barnett.
– Non, Votre Honneur.…
– Il faudrait le savoir…
– Oh ! dit Barnett, faites-moi reconduire en prison, je le saurai dans une heure.
– Mon cher, dit le révérend s’adressant au gouverneur, songez que les deux plus habiles détectives de Londres, sir James Wood et Edward, nous affirment que cet homme est Rocambole.
– Sans doute, fit sir Robert M…
– Et que si nous faisons à l’ambassade une démarche précipitée, nous pouvons avoir des désagréments.
– Je ne dis pas non.
– Il prétend, n’est-ce pas, continua le révérend, que son valet de chambre est allé à Liverpool ?
– Oui.
– Et qu’il reviendra demain ?
– Oui, Votre Honneur.
– Eh bien ! attendons à demain. D’ici là, si c’est véritablement le chef fénian Rocambole, il se trahira peut-être.
Barnett avait un air tout à fait ingénu ; et sir Robert M… eût juré sur la corde de son ami Calcraft, le bourreau de Londres, que cet homme lui était dévoué corps et âme.
– Mon cher, dit encore le révérend, il se peut que ces gens là se méfient de Barnett.
– Oh ! je ne crois pas, dit l’Irlandais.
– Vous auriez dû faire placer un appareil Hudson dans la cellule où vous les avez enfermés.
– C’est juste, dit sir Robert M…, je n’y ai nullement songé.
– D’autant plus, dit Barnett, que je ne sais pas assez bien le français pour comprendre très facilement.
Et Barnett fut reconduit dans la prison.
L’homme gris se faisait des réussites avec le jeu de cartes, et Marmouset avait, à son tour, pris un journal.
– Eh bien, dit ce dernier à Barnett, avez-vous vu votre frère ?
– Oui, monsieur, et j’en suis bien content.
Puis Barnett adressa la parole à l’homme gris dans le patois irlandais, qui fait le désespoir du peuple de Londres.
– Ah ! lui dit-il, le gouverneur est joliment heureux.
– Vraiment ?
– Je lui ai raconté ce que m’avait dit le gentleman, qui, je le vois bien, n’est pas celui que nous attendions.
– Et qu’a-t-il dit, le bon sir Robert M… ?
– Il y avait là un autre gentleman, déjà vieux, grand, sec, et qui paraît être un ecclésiastique.
– Bon ! dit l’homme gris, c’est le révérend Patterson.
– Tous deux paraissent inquiets de n’avoir pas fait poser dans la cellule un appareil… Je ne sais pas ce que c’est…
– Un appareil Hudson ?
– Oui, c’est le mot dont ils se sont servis.
Cette fois, Rocambole respira, et Marmouset fit un léger mouvement.
– Ils n’ont pas parlé de réflecteur ?
– Non.
– Et ils veulent savoir mon vrai nom ? fit Marmouset.
À cette question, il y eut, comme on dit, un effet de théâtre.
Marmouset parlait tout à coup le patois irlandais.
Barnett jeta un cri et regarda le nouveau prisonnier d’un air stupéfait.
Alors, Rocambole se mit à rire :
– Imbécile ! dit-il.
– Moi… imbécile ? et pourquoi ? dit Barnett.
– Parce que je suis bien Rocambole, dit froidement Marmouset.
– Vous !
– Parbleu !
– Alors, tout ce que vous m’aviez dit ?…
– Nous avions peur de l’appareil Hudson.
– Mais qu’est-ce que cela ? demanda encore Barnett.
– Des tuyaux de caoutchouc placés sous le parquet ou dans les murs, et qui permettent aux gens qui sont dehors d’entendre ce qui se dit en dedans.
– Ah ! je comprends, dit Barnett.
– Et, reprit Marmouset, tu crois que personne à Newgate ne sait le patois irlandais ?
– Personne.
– Et toi, sais-tu le français ?
– À peu près.
– Eh bien ! nous allons voir si tu nous comprends.
Et Rocambole dit à Marmouset :
– Savasavant haivhaven savin save avestransave ave l’havetrouvelave dave avestevisave have couven ne ave ?
– Mais qu’est-ce que cela ? demanda Barnett tout ahuri, ce n’est pas du français ?
– Non, c’est du javanais, et bien que les Anglais soient maîtres des Indes, je les défie d’en comprendre un mot.
– Où se parle donc cette langue ?
– À la Maison-d’Or tous les soirs, et à Newgate aujourd’hui, répondit Rocambole.
Et il dit à Marmouset :
– Maintenant, mon fils, nous pouvons jaser tranquillement.
– Ç’avest mavon aviavisave, répliqua Marmouset.
Ce qui voulait dire textuellement :
– C’est mon avis.
XIII
Le javanais n’est pas une langue, ce n’est pas un patois, ce n’est pas même un argot.
C’est du français pur et simple, mais du français dans lequel chaque syllabe est précédée et suivie des mots ave, ava ou avi.
De telle façon que pour dire « je lis la vie de César » on prononce :
Jave lavi vavie deve çavésavar.
Sir Robert M… et le révérend Patterson auraient bien pu écouter à la porte de la cellule, qu’ils n’auraient pas compris un mot à cette conversation qui stupéfiait l’Irlandais Barnett.
Il est vrai que si l’un ou l’autre avait eu l’idée de demander par le fil électrique une petite dame de Paris en lui promettant pour la peine un huit-ressorts, elle aurait traduit à merveille ce que Rocambole et Marmouset disaient entre eux.
– Voyons, demandait le maître, comment avez-vous su que j’étais détenu ?
– Par miss Ellen.
– Vous avez donc vu miss Ellen ?
– Elle est avec nous.
– Mais on la surveillait ?
– C’est vrai.
– On l’a même mise en prison ?
– C’est encore vrai.
– Eh bien ! alors ?
– Alors, nous l’avons délivrée. C’est bien simple.
Puis Marmouset ajouta avec un sourire modeste :
– Je crois, du reste, que nous avons le temps de causer.
– Oh ! certainement, dit Rocambole.
– Alors, maître, je vais vous raconter en détail les aventures de miss Ellen et les nôtres.
– Parle !
Marmouset avait le récit clair, rapide, mais il n’oubliait rien.
Au bout de deux heures, Rocambole était au courant de tout ce qui s’était passé à Paris, depuis la chute de Marmouset et jusqu’au miraculeux sauvetage de l’Irlandaise Jenny et de son fils.
– Qu’avez-vous fait de ceux-ci ? demanda alors Rocambole.
– Ah ! dame ! répondit Marmouset, nous n’avons pas osé les ramener à Londres.
– Vous avez bien fait.
– Il nous fallait des ordres de vous et nous n’en avions pas. Jenny et Ralph sont dans la maison de Milon sous la garde de Shoking.
– Fort bien. Et miss Ellen ?
– Elle est avec Vanda. Maintenant, maître, poursuivit Marmouset, vous pensez que je ne moisirai pas ici.
– Ni moi non plus, dit Rocambole, qui eut un sourire mystérieux.
– Ah ! j’espère bien que nous vous délivrerons.
– Et, dit Rocambole, si vous n’y réussissez pas ?…
– Dame…
– Eh bien ! je me délivrerai moi-même ; mais continue. Ton valet de chambre, c’est Milon, n’est-ce pas ?
– Naturellement.
– Et il n’est pas à Liverpool ?
– Non, mais il attend vingt-quatre heures pour se présenter à l’ambassade.
– Je ne me repens pas de t’avoir élevé, dit Rocambole en souriant, tu es intelligent.
Marmouset salua.
– Maintenant, reprit le maître, écoute-moi bien.
– J’attends, dit Marmouset.
– Je commence à me trouver un peu trop chevaleresque.
– Ah !
– Je me suis dévoué corps et âme aux Irlandais, et j’ai sauvé leur chef futur. Si je suis en prison, c’est que je l’ai bien voulu, mais les fenians ne savent pas cela.
Or, ces gens, pleins d’audace quand il s’agit de délivrer un de leurs frères, sont pas mal ingrats.
– En vérité ?
– C’était un homme en qui ils avaient foi qu’ils prenaient pour chef et qui les avait habitués à le voir sortir des plus mauvais pas.
Quand ils désespéraient, ils les ranimaient d’un mot. Quand une cause leur semblait perdue, il leur démontrait qu’elle était gagnée.
Pendant trois mois, l’homme gris a tenu l’Angleterre toute entière en échec.
– Eh bien ? fit Marmouset.
– Eh bien ! Un jour, il m’a convenu de donner tête baissée dans un piège, parce que je voulais me faire une amie de ma mortelle ennemie, miss Ellen.
– Bon ! fit Marmouset.
– L’homme gris a été comme un fénian vulgaire ; on l’a mis à Newgate, et il n’a point renversé les murs de cette prison d’un coup d’épaule.
Il semble résigné au sort qui l’attend, et, dès lors, son prestige est tombé.
Seul, l’abbé Samuel peut-être essaye de me secourir ; mais les autres m’ont abandonné. Je ne m’en plains pas, les hommes sont ainsi. Ils abandonnent celui qui ne leur peut plus être utile.
– Mais nous ne vous abandonnerons pas, nous, cher maître, dit Marmouset.
– Je le sais, et c’est pour cela que je vous ai envoyé miss Ellen.
Puis Rocambole ajouta :
– Cependant, je veux soumettre les fénians à une dernière épreuve.
– Ah !
– S’ils me reviennent, je les servirai.
– Et s’ils vous abandonnent ?
– Eh bien ! nous chercherons d’autres victimes plus dignes de notre dévouement.
– Et quelle est cette épreuve ?
– Tu sortiras d’ici demain.
– C’est probable.
– Et tu emporteras les excuses de sir Robert M… ?
– De sir Robert M…, du révérend Patterson et du lord chief justice.
– En Angleterre, ce n’est pas comme en France, poursuivit Rocambole. Quand la justice s’est trompée, quand elle a emprisonné un homme abusivement, elle lui doit une indemnité.
– Je sais cela.
Et cette indemnité est proportionnée au rang de l’homme emprisonné. Tu es membre d’un club célèbre à Paris, tu es riche, tu es considéré. Tu demanderas cent mille livres sterling et la Cour t’en accordera la moitié.
– Vraiment ?
– En même temps, tous ceux qui t’auront malmené seront condamnés à une amende. Comprends-tu ?
– Pas encore.
– Tu feras alors le gentilhomme et tu renonceras à l’indemnité et au bénéfice des amendes, à la condition qu’on te permettra de faire visiter à ta femme le cachot dans lequel on t’aura enfermé, et de revoir tes compagnons de captivité.
– Bon !
– Seulement, dans l’intervalle de ta sortie d’ici et de cette visite, tu iras trouver l’abbé Samuel.
– Après ?
– Tu lui demanderas d’assembler une réunion de fénians et de leur proposer ma délivrance.
– Et si les fénians refusent ?
Un sourire glissa sur les lèvres de Rocambole.
– Quand tu reviendras ici, je laisserai tomber dans ta poche une boulette de papier. Cette boulette contiendra mes instructions.
Comme Rocambole achevait ces deniers mots, la porte de la cellule s’ouvrit, et sir Robert M… en personne se montra aux trois prisonniers.
– Continuons donc à parler javanais, dit Rocambole, il faut bien nous amuser un peu…
Sir Robert M… s’était arrêté tout ahuri sur le seuil.
XIV
Sir Robert M… regardait tour à tour le vrai ou le faux Rocambole, et il prêtait une oreille attentive à cette langue étrange dont il ne comprenait pas le premier mot. L’homme gris et Marmouset continuaient à causer en javanais.
Cependant, en prisonniers bien élevés, ils s’étaient levés avec empressement et avaient porté la main à leur bonnet.
– Ah ! gentleman, s’écria enfin sir Robert M…, je vous y prends à la fin.
– Comment cela, Votre Honneur ? demanda l’homme gris en souriant.
– Vous ne direz plus que vous ne connaissez pas le prisonnier ?
Et il désignait Marmouset.
– Excusez-moi, répondit Rocambole, je ne le connaissais pas ce matin.
– En vérité !
– Maintenant, nous avons fait connaissance et nous sommes bons amis.
Sir Robert haussa les épaules.
– Mais, Votre Honneur, nous nous comprenons fort bien, monsieur et moi.
– Langage de convention ?
– Du tout, Votre Honneur. Nous parlons une langue orientale, le javanais.
Sir Robert M…, était un bon Anglais, très fier du lion britannique, de la marine britannique, des possessions britanniques, et il était excessivement ferré sur tout ce qui concernait les Anglais dans l’Inde.
À ce nom de Java, il poussa un cri.
– Oh ! dit-il, nous allons bien voir.
– Plaît-il ? fit l’homme gris.
– Auriez-vous un Javanais ici ? demanda Marmouset.
Sir Robert M… se tourna vers le guichetier qui l’accompagnait, et qui, comme lui, s’était arrêté stupéfait au seuil de la cellule.
– Master Dixon, lui dit-il, allez me chercher Dick !
– Qu’est-ce que Dick ? demanda l’homme gris.
– Un matelot qui a passé dix ans dans l’Inde.
– Ah ! ah !
– Et qui est ici pour un vol insignifiant.
– L’homme est imparfait, dit Rocambole.
Puis, souriant toujours, il ajouta :
– Votre Honneur me permettra bien un moment, n’est-ce pas, de continuer ma conversation avec ce gentleman ?
– En javanais ?
– Naturellement, car nous sommes en train de nous raconter une foule de petits secrets.
Et l’homme gris dit à Marmouset :
– Tu vas voir que nous allons bientôt nous amuser.
– Comment cela ?
– Je vais parler à Dick le véritable javanais.
Tu penses bien que je n’ai pas vécu deux ans dans l’Inde, à la Cour de mon pauvre nabab, sans apprendre tous les idiomes indous.
– C’est juste ; mais moi ?
– Eh bien ! toi, tu te renfermeras dans un silence prudent.
Marmouset riait, comme riait Rocambole.
Il n’y avait que l’Irlandais Barnett qui était aussi ahuri que le gouverneur.
Master Dixon amena Dick.
C’était un matelot de vingt-huit ans, à la figure intelligente, au regard quelque peu sournois, et qui paraissait se soucier comme d’une guigne d’être enfermé à Newgate.
– Dick, lui dit sir Robert, qui prit son air le plus majestueux, savez-vous l’indou ?
– Comme l’anglais, Votre Honneur.
– Et le javanais ?
– Parfaitement.
– Eh bien, il s’agit de comprendre ce que disent ces deux gentlemen.
Dick regarda tour à tour Marmouset et Rocambole.
Rocambole lui dit :
– Te plaisais-tu beaucoup dans l’Inde ?
– Non, répondit Dick.
– Pourquoi ?
– Parce que je suis né voleur et non matelot, et que les voleurs indiens sont bien plus habiles que nous.
– Que dites-vous donc ? fit sir Robert M…
– Votre Honneur, répondit Dick, le gentleman me demande si je me plaisais dans l’Inde ?
– Alors, tu comprends ce qu’il dit ?
– Parfaitement.
– Tu peux t’en aller, Dick.
Et sir Robert M… fit un signe à master Dixon, qui emmena le prisonnier.
Alors le gouverneur dit à Rocambole :
– Vous feriez beaucoup mieux, gentleman, de faire des aveux.
– Ah ! ah !
– De nous dire votre véritable nom, de façon que vous puissiez passer devant le jury.
– Et me voir condamner à mort, n’est-ce pas ?
– Qui sait ? fit sir Robert M… avec son gros rire, la clémence de la reine s’étendra peut-être sur vous.
– La clémence de la reine ?
– Oui.
– Bon ! je connais cela. La reine fait grâce ?
– Très souvent.
– Mais le secrétaire d’État au département de la justice ne ratifie pas l’acte de clémence, et on est pendu tout de même. Merci bien, Votre Honneur !
Sir Robert M… dit encore :
– Vous êtes dans votre droit de défendre votre vie comme vous l’entendez. Bonsoir, gentleman.
– Hé ! monsieur le gouverneur ! dit Marmouset.
– Qu’est-ce donc ? demanda sir Robert.
– M’accorderez-vous une minute ?
– Parlez.
– Votre Honneur est convaincu que je me nomme Rocambole ?
– J’en doutais ce matin.
– Ah !
– Mais ce soir je ne doute plus.
– Fort bien. Alors Votre Honneur me permettra une supposition.
– Voyons ?
– Admettons un moment que je ne sois pas Rocambole.
– Soit, admettons-le.
– Que, tout au contraire, je sois un parfait gentleman français ?
– Eh bien ?
– Qui n’a commis ni crime ni délit, qui voyageait en Angleterre pour son plaisir, et que son ambassadeur réclame et fait mettre en liberté.
– Oh ! je n’ai pas peur de cela.
– Soit. Mais enfin, puisque nous supposons.
– Eh bien, gentleman, après ? dit le gouverneur.
– Un joli procès, Votre Honneur.
– Peuh !
– De beaux dommages-intérêts, qui seront supportés moitié par le lord-chief et moitié par vous.
– Mais non pas, dit sir Robert M… vivement, je suis geôlier, moi, et pas autre chose.
– Vous vous trompez, monsieur le gouverneur ; car en acceptant la garde d’un prisonnier sans vous être assuré de son identité…
– Oh ! je suis parfaitement convaincu.
– Qui vivra verra ! dit Marmouset en riant d’un air si franc et si moqueur que sir Robert M… sentit une petite sueur froide perler à son front.
– Oui, nous verrons bien ! dit-il brusquement.
Et il s’en alla, tandis que Rocambole et Marmouset continuaient à rire de bon cœur.
XV
Sir Robert M… parti, Rocambole dit à Barnett :
– Tu es toujours fort étonné ?
– Assurément, gentleman.
– Eh bien ! tu le seras bien davantage dans deux heures d’ici.
– Vraiment ?
– Car on va nous séparer.
Barnett étouffa un cri ; et il regarda Rocambole avec la tristesse d’un chien fidèle qu’on sépare de son maître.
– Mais sois tranquille, mon pauvre Barnett, nous nous reverrons.
Barnett leva les yeux au ciel.
– Si Calcraft le permet, dit-il.
– Ah çà ! fit Rocambole, serais-tu véritablement condamné à mort ?
– Nullement, gentleman. Mais… c’est vous qui le serez…
– Ne t’inquiète pas de moi, mon ami. Vois comme je suis tranquille.
– En effet, dit Barnett, vous paraissez vous moquer de Calcraft comme de sir Robert M…
– Exactement la même chose.
– Vous êtes bien heureux, gentleman.
– Mais, dis-moi, reprit Rocambole, pour combien de temps es-tu encore ici ?
– Je puis m’en aller demain.
– Ah !
– J’avais fait mon temps, quand on m’a mis auprès de vous pour vous espionner.
– Je m’en doutais.
– Et on m’avait promis une prime.
– De combien ?
– De cinquante livres.
– Tu en auras deux cents quand tu sortiras.
– Oh ! dit Barnett d’un cri de doute, qui donc me les comptera ?
– Moi, dit Marmouset.
– Vous allez donc sortir, vous autres ?
– Pas aujourd’hui, mais demain.
– Mais, dit Barnett, qui leva de nouveau sur Rocambole un œil dévoué, je ne tiens pas à m’en, aller, moi.
– Mais tu t’en iras, mon pauvre garçon.
– Et pourquoi ?
– Parce que, maintenant, on n’a plus besoin de toi.
Tu ne sais pas le javanais.
Et Rocambole et Marmouset se prirent à rire de nouveau.
– On n’a jamais vu à Newgate des prisonniers aussi gais, murmura Barnett.
– Or, poursuivit Marmouset, puisque nous allons être séparés et qu’on va te rendre la liberté, il faut que nous puissions nous retrouver.
– C’est juste, dit Barnett.
– D’abord pour qu’on te donne tes deux cents livres.
– Moi, dit Barnett, pour que vous me preniez à votre service et que je sois au nombre de ceux qui tenteront de délivrer le maître.
– Pour l’un et pour l’autre. Où donc te retrouverai-je ?
– Quand on m’a arrêté, je logeais dans Old Franck Lane.
– À quel numéro ?
– Au n° 7.
– Et tu allais le soir à la taverne tenue par master Wanstoone ? dit Rocambole.
– Oui, gentleman.
– Eh bien ! dit Marmouset, sois-y dans trois jours, à huit heures du soir.
– J’y serai.
Comme Barnett prenait ce rendez-vous, la porte de sa cellule s’ouvrit de nouveau.
Master Dixon, le gardien-chef, parut.
– Hé ! Barnett ! dit-il.
– Voilà, monsieur, dit l’Irlandais.
– On vous demande au parloir.
– Encore son frère assurément, ricana Rocambole.
Master Dixon regarda l’homme gris de travers.
Alors Barnett fut pris d’un moment d’irritation, et il serra la main de l’homme gris.
– Au revoir, dit-il.
Puis il suivit le gardien-chef en essuyant une larme.
Quand il fut dans le corridor, master Dixon lui dit :
– Je vais te conduire au greffe.
– Pourquoi faire ?
– Tu signeras ta levée d’écrou, tu reprendras tes vêtements, et tu t’en iras.
– Mais, dit Barnett, je suis donc libre ?
– Oui, et on n’a plus besoin de toi.
– Alors on me comptera la prime qu’on m’a promise.
– Non.
– Pourquoi donc ?
– Parce que tu n’as été d’aucune utilité.
Barnett ne répondit rien ; mais il se jura de servir l’homme gris et de lui appartenir corps et âme.
*
* *
Tandis que Barnett s’en allait, sir Robert M… ne perdait pas son temps.
Il s’était jeté dans un cab et s’était fait conduire en toute hâte chez le révérend Patterson.
Celui-ci, en le voyant entrer, devina de graves événements.
– Ils se connaissent ! dit sir Robert M…
– Je n’en ai jamais douté, répondit le révérend.
– Et ils parlent entre eux une singulière langue.
– Laquelle ?
– Le javanais.
– Ah ! ah !
– Et je me demande, fit sir Robert M… comment ils l’ont apprise.
– Eh ! c’est bien simple, dit le révérend, les fénians ont de nombreuses ramifications dans l’Inde.
– Vous croyez ?
– Nana Saïb en avait plusieurs dans son armée. Vous pensez bien que ces gens-là sont les mortels ennemis de l’Angleterre.
– Naturellement.
– Et qu’ils vont partout où l’Angleterre a des ennemis.
– Oui, dit sir Robert M… Mais à présent nous les tenons, et nous saurons le vrai nom de l’homme gris.
– Vous savez le javanais ?
– J’ai un de mes prisonniers, un matelot, qui le sait, avec une forte prime…
– Mais ils ne parleront pas devant lui…
– Ils parleront quand ils se croiront seuls, vous oubliez l’appareil mécanique Hudson.
– Comment le ferez-vous poser dans leur cachot sans qu’ils s’en aperçoivent ?
– On le pose à l’heure même dans une autre cellule.
– Ah !
– Et ils y seront transférés ce soir.
– Ne se douteront-ils de rien ?
– Je ne le crois pas. J’ai fait rendre la liberté à Barnett.
Dès lors la cellule est trop grande pour deux prisonniers.
– Parfait ! dit le révérend.
Et cependant, quand sir Robert M… fut parti, le front assombri du révérend ne se dérida point.
– Voilà qui est bizarre, murmurait-il. J’ai transmis depuis hier deux dépêches à sir James Wood avec ordre de revenir et de ramener miss Ellen, et sir James Wood ne me répond pas…
Que lui est-il donc arrivé ?…
XVI
Sir Robert M…, radieux, était retourné à Newgate. En quittant la prison, il avait donné ses ordres, et un appareil Hudson avait été posé par une dizaine d’ouvriers dans la cellule voisine de celle qui renfermait Marmouset et Rocambole.
Rien n’est plus simple, du reste, que cet appareil : longue suite de tuyaux en caoutchouc qui se rejoignent et aboutissent à un entonnoir renversé placé dans la pièce où on doit entendre ce qui se dit au point de départ, malgré une distance considérable. On avait fait passer l’appareil dans le tuyau du gaz, ce qui faisait qu’il était impossible de le voir.
L’entonnoir se trouvait dans le cabinet même du directeur.
Et sir Robert M… assista à la fin du travail en se frottant les mains et se disant :
– Enfin ! je tiens mes deux drôles.
Cependant une pensée mélancolique vint tout à coup attrister sa joie.
Il se souvint des paroles de Marmouset lui disant :
« – Supposons que je ne sois pas Rocambole… »
Sir Robert M… connaissait parfaitement la loi anglaise et savait qu’elle ne plaisante pas quand il s’agit de réparer les torts faits à des particuliers.
Et Marmouset lui avait dit une chose tout à fait raisonnable :
« – Si cela était, vous seriez responsable tout comme un autre, puisque vous auriez écroué un homme sous un nom qui n’est pas le sien et sans vous assurer de son identité… »
Et sir Robert M… eut un peu de mélancolie à cette pensée ; car enfin tout est possible, même l’impossible.
Et puis sir Robert M… était père de famille. Il n’était pas riche, il avait besoin de son traitement.
Cependant une autre pensée, ou plutôt une autre réflexion, venait aussitôt à son idée.
– La preuve, se disait-il, que cet homme est bien Rocambole et qu’il est le complice de l’homme gris, c’est qu’ils causent entre eux dans une langue qu’ils croient incompréhensible.
S’ils n’avaient pas de secrets à se confier, ils causeraient en anglais ou en français.
Il faisait toutes ces réflexions tout en assistant à la pose de l’appareil Hudson.
Quand ce fut fini, il se fit suivre du gardien chef et fit une nouvelle visite à ses deux personnes.
– Votre Honneur est vraiment bien bon, lui dit Rocambole avec une pointe de raillerie, de nous visiter ainsi deux ou trois fois par jour.
– Quand je vois M. le Gouverneur, dit à son tour Marmouset, je me sens tout réjoui.
– Ah ! ah ! dit sir Robert M…
– Il est certain, reprit Rocambole, qu’un visage aussi parfaitement réjoui que celui de Votre Honneur est fait pour reposer la vue des pauvres prisonniers comme nous.
– Hélas ! mes amis, dit sir Robert M…, je vous apporte une nouvelle désagréable.
– Vraiment ?
– Vous étiez bien ici ?
– Admirablement.
– Je vais être obligé de vous changer de cellule.
– Et pourquoi cela, Votre Honneur ?
– Parce que celle-ci est trop grande, maintenant que vous n’êtes plus que deux.
– Comment ? fit Rocambole, l’Irlandais ne va pas revenir ?
– Non.
– Ah bah !
– Sa peine a été commuée, vous le savez.
– Bon !
– Et on l’a transféré à Bath-square.
Rocambole ne sourcilla pas, bien qu’il fût certain que sir Robert M… mentait.
– Mais, au moins, dit-il, remplacez-vous notre jeu de whist par un jeu d’échecs ?
– Si cela peut vous être agréable, dit sir Robert.
Et regardant Marmouset :
– Jouez-vous aux échecs, gentleman ?
– Sans doute, répondit Marmouset. Mais… je crains de ne pouvoir faire longtemps la partie du gentleman.
– Et pourquoi cela ?
– Mais, cher monsieur, parce que je sortirai d’ici demain matin.
– Bah ! dit sir Robert qui essaya un sourire et n’obtint qu’une grimace. Vous m’avez déjà fait cette plaisanterie-là.
– Vous verrez qu’elle est sérieuse.
– Oh ! dit le gouverneur, nous verrons bien.
Et il s’en alla, laissant retentir un gros sourire, mais, au fond, très ému de l’insouciance de Marmouset.
Une demi-heure après, les deux prisonniers avaient été transférés dans l’autre cellule.
Alors sir Robert M… fit venir Dick le matelot.
– Dans combien de mois sortirons-nous d’ici ? lui dit-il.
– Dans trois mois.
– Si je suis content de toi, j’obtiendrai qu’on réduise ta prison à six semaines.
– En vérité, Votre Honneur…
– Et quand tu t’en iras, on te donnera vingt-cinq livres de prime.
– Que faut-il donc faire pour mériter ainsi les bontés de Votre Honneur ?
– T’asseoir là dans ce fauteuil.
– Et puis ? dit Dick étonné.
– Et appuyer ton oreille à cet entonnoir.
– M’y voilà.
– Entends-tu quelque chose ?
– Oui, des voix humaines.
– Écoute bien.
– J’entends fort distinctement.
– Que disent-elles ?
– Mais je ne comprends pas.
– Hein ?
– Je reconnais la voix des deux prisonniers avec qui vous m’avez confronté ce matin.
– Ah !
– Mais ils ne parlent plus la même langue.
Sir Robert M… jeta un cri de rage.
– Écoute bien, dit-il ensuite, il peut se faire que la distance…
– Oh ! non, non, Votre Honneur, je les entends aussi nettement que s’ils étaient auprès de moi.
– Vraiment ?
– Mais, je le répète à Votre Honneur, je ne comprends pas un mot de ce qu’ils disent.
– Voilà qui est trop fort ! s’écria sir Robert M… Dans quelle langue peuvent-ils bien parler ?
– Je ne sais pas, mais ils ont l’air de bien bonne humeur.
– Enfin, penses-tu que ce soit une langue orientale ?
– C’est possible. Tenez, Votre Honneur, écoutez vous-même.
Sir Robert M… s’approcha de l’appareil et prêta l’oreille à son tour.
Rocambole et Marmouset étaient en effet de fort belle humeur, et deux ou trois éclats de rire moqueurs parvinrent à sir Robert M…
Mais de leur conversation pas un mot intelligible.
Ils s’étaient remis à parler javanais.
Non pas la langue qu’on parle dans l’île de Java, mais le javanais de Paris qui tombe en cascades rieuses des lèvres des petites dames.
Alors sir Robert M… murmura :
– Oui, ce doit être une langue orientale… Oh ! ces hommes !
Puis il se frappa le front et se leva vivement comme un homme à qui il vient une bien belle idée !…
XVII
Au sud de Whitehall, tout auprès de Scotland Yard, se trouve un établissement qui porte ce nom quelque peu compliqué :
The royal united service institution Museum
Ce qui peut se traduire ainsi :
Service de l’union royale du Musée
C’est un établissement multiple dont une section est consacrée aux manuscrits et à l’étude de toutes les langues. On trouve là des professeurs qui parlent couramment le sanscrit et d’autres qui lisent les hiéroglyphes les plus indéchiffrables.
Il n’y a pas un idiome, un dialecte, une langue morte ou vivante qui ne soit compris ou commenté au The Royal Museum.
En France on n’apprend guère que le français. En Angleterre on apprend tout.
Les Anglais qui voyagent perpétuellement veulent être compris sur tous les points du globe.
L’idée sublime qui venait de traverser le cerveau du sous-gouverneur de Newgate, sir Robert M…, était cependant bien simple et elle aurait dû lui venir plus tôt.
– Je vais courir au Muséum, se dit-il, et je demanderai tous les professeurs de langues orientales.
Il renvoya donc Dick dans sa prison, monta dans un cab.
Le concierge du Muséum est un personnage très important, quelque chose comme un gouverneur.
Sir Robert M… s’adressa à lui.
Le concierge-gouverneur eut un sourire majestueux.
– Ces gens-là, dit-il faisant allusion aux deux prisonniers, parleraient l’égyptien du temps des Pharaons, que nous avons des gentlemen qui les comprendraient.
Venez avec moi, sir, et nous choisirons ensemble les personnes dont vous avez besoin.
Une demi-heure après, sir Robert M… emmenait avec lui deux gentlemen qui avaient consacré leur jeunesse à l’étude des langues sémitiques et des langues orientales, et il les introduisait dans son cabinet.
Il était alors huit heures du soir.
Le premier gentleman se plaça contre l’appareil Hudson et prêta l’oreille.
Sir Robert M… suivait anxieusement les impressions de sa physionomie.
Or, au bout de quelques minutes, cette physionomie exprima un mouvement mêlé de stupeur.
– Quel jargon parlent-ils donc là ? dit-il enfin.
– Comment ! s’écria sir Robert M…, vous ne comprenez pas ?
– Je ne comprends pas un mot.
Le professeur de langue sémitique remplaça auprès de l’appareil le professeur de langues orientales.
– Je ne comprends pas davantage, dit-il.
Sir Robert M… s’arrachait les cheveux de désespoir.
Enfin le premier gentleman émit cet avis que les deux prisonniers pourraient bien parler un jargon océanien, quelque chose comme la langue des îles Sandwich.
Le second prétendit que certaines consonances lui avaient paru se rapprocher du patois que parlent les nègres de l’intérieur de l’Afrique.
Ce n’était pas la spécialité de ces messieurs ; mais il y avait au Muséum un ancien midshipman qui avait été prisonnier au Congo et avait ensuite parcouru tous les archipels de l’Océanie.
Or, ce langage bizarre que parlaient Rocambole et Marmouset prenait à leurs yeux les proportions d’un phénomène scientifique.
Ils s’empressèrent donc d’envoyer chercher le midshipman, dont ils indiquèrent le nom et l’adresse à un des gardiens de Newgate, qui partit aussitôt.
Le midshipman n’était plus au Muséum ; il habitait même à la campagne, sur la route de Hampsteadt.
Près de trois heures s’écoulèrent avant qu’il arrivât.
Mais les deux prisonniers ne paraissaient pas avoir envie de dormir.
Leurs voix bruyantes et leurs éclats de rire arrivaient à chaque instant aux oreilles consternées de sir Robert M…
Enfin, l’ancien midshipman parut.
Ses deux confrères du Muséum lui expliquèrent la situation en deux mots.
Il se plaça à son tour devant l’appareil, appuya son oreille à l’entonnoir et écouta.
– Mais ce n’est pas une langue humaine, cela ! s’écria-t-il enfin.
– Commuent, dit un des gentlemen, ce n’est pas un jargon océanien ?
– Non.
– Ni un patois nègre ?
– Pas davantage.
Le problème paraissait insoluble, et sir Robert M… ne parlait de rien moins que de sauver son honneur par un suicide, lorsque le professeur des langues sémitiques eut une inspiration.
– Vous dites que les prisonniers sont Français dit-il.
– Je le crois, du moins.
– Avez-vous entendu parler d’une langue que parlent les voleurs et qui se nomme l’argot ?
– Oui, certes.
– Eh bien ! c’est de l’argot.
– Et qui donc, s’écria sir Robert M…, peut comprendre l’argot en Angleterre ?
– Bah ! dit le gentleman, vous avez bien un autre prisonnier français quelque part ?
Sir Robert M… manda Master Dixon, le gardien chef, et le consulta.
Dixon affirma qu’il y avait un Français à Newgate et que ce Français était un filou qui avait longtemps exercé son industrie à Paris.
Sir Robert M… l’envoya chercher.
– Sais-tu l’argot ? lui dit-il.
– Mieux que l’anglais, répondit le filou.
– Alors mets-toi là et écoute.
Le filou obéit.
– Ce n’est pas de l’argot, dit-il enfin.
– Qu’est-ce donc ?
– C’est du javanais.
Les deux gentlemen haussèrent les épaules.
– Le javanais de la Maison d’Or, dit encore le filou.
– Qu’est-ce que cela ?
– Une langue qu’on parle à Paris.
– Et que tu comprends ?
– Non, il n’y a que les femmes à huit ressorts et les gentilshommes qui font courir leurs chevaux et leurs créanciers qui parlent ce langage.
– Alors, comment faire ? s’écria sir Robert M…, dont le désespoir était sans limite.
– Une chose bien simple, répondit le Français.
– Quoi donc ?
– Faire venir une petite dame de Paris qui sera dans la débine et lui promettre une jolie somme.
– Mais il faut trois jours pour cela !
– Ou bien encore pour demander par le télégraphe les lumières de M. Victor Noir, rédacteur en chef de la « Gazette de Java » dont les bureaux sont sur le boulevard Montmartre.
– Comment ! exclamèrent les trois savants, il se publie un journal dans cette langue !
– Un journal qui a soixante mille abonnés, répondit sans rire le prisonnier, qui était un loustic de première force.
– C’est à devenir fou ! murmurait le bon gouverneur de Newgate.
Et, comme il disait cela, master Dixon entra tout effaré.
– Ah ! Seigneur Dieu ! reprit-il, par saint George, monsieur, quelle sottise avons-nous donc faite ?
– Hein ! dit sir Robert M… ahuri.
– Nous avons emprisonné sous le nom de Rocambole l’ami intime du premier secrétaire de l’ambassade française, lequel secrétaire vient d’entrer à Newgate comme un ouragan et demande une éclatante réparation…
Sir Robert M… poussa un cri sourd et se laissa tomber sur un siège, foudroyé par ce dernier coup du sort !…
XVIII
C’était bien, en effet, le premier secrétaire d’ambassade, à qui Marmouset avait écrit, qui se présentait à Newgate à cette heure matinale.
Il pouvait être alors quatre heures du matin.
À Londres, on vit la nuit presque autant que le jour.
C’est le soir que siège le Parlement.
C’est à minuit que le peuple envahit les tavernes et que les gens de haute vie fréquentent les clubs.
Fidèle aux instructions de Marmouset, Milon ne s’était présenté que fort tard, le soir, à l’ambassade de France.
Le premier secrétaire était au bal.
– Je l’attendrai, avait dit Milon.
À deux heures du matin, un huissier avait dit au colosse :
– Si vous voulez absolument voir M. le premier secrétaire, allez dans Pal Mal au West-India Club, vous l’y trouverez.
Milon avait couru à West-India.
Un des laquais du club lui dit qu’en effet le premier secrétaire de l’ambassade de France faisait partie du club, mais qu’il n’y venait jamais avant deux ou trois heures du matin.
Milon attendit patiemment.
Enfin, le haut personnage arriva.
Alors Milon lui remit la lettre de Marmouset et joua son rôle en conscience.
Marmouset était depuis six ans si honorablement connu dans le monde élégant de Paris, que la pensée m’aurait pu venir à personne qu’il se fût fait mettre à Newgate en vue de quelque projet ténébreux.
Le premier secrétaire témoigna donc une véritable indignation.
Il demanda sa voiture sur-le-champ, fit monter Milon à côté de lui et se rendit en toute hâte à Newgate.
À pareille heure on ne pénètre pas dans une prison.
Mais le premier secrétaire parla si haut, avec une telle autorité, menaçant de l’intervention de l’ambassadeur, que le portier-consigne se décida à aller chercher master Dixon, le gardien chef.
Celui-ci accourut.
– Vous avez un Français ici ? dit le secrétaire.
– Nous en avons plusieurs.
– Mais vous en avez un qui a été arrêté dans le Strand, à l’hôtel des Trois-Couronnes ?
– Oui, c’est un malfaiteur des plus dangereux.
Le premier secrétaire se mit à rire.
– Un homme du nom de Rocambole ?
– Vous êtes un niais ! répliqua le premier secrétaire.
L’homme qu’on a arrêté et que vous détenez en prison est un parfait gentleman de mes amis, dont je réponds complètement, et que vous allez faire sortir sur-le-champ.
– Mais, monsieur, avait dit master Dixon tout bouleversé, je ne suis pas le gouverneur.
– Eh bien ! allez chercher le gouverneur.
– À cette heure ?
– Mais sans doute. S’il est couché, il se lèvera. Faut-il vous répéter que je suis le premier secrétaire de l’ambassade de France !
Master Dixon, pris d’une salutaire terreur, était arrivé en toute hâte, comme on l’a vu, dans le cabinet de sir Robert M…
Et sir Robert M… s’était laissé tomber comme foudroyé sur un siège.
Mais, le premier secrétaire ayant suivi le gardien chef, il était entré presque aussitôt.
Alors le bon et jovial gouverneur, qui, certes, ne riait pas en ce moment, s’était levé en balbutiant et baissant les yeux sous le regard irrité du premier secrétaire d’ambassade.
– Monsieur le gouverneur, avait dit celui-ci, sans faire attention aux trois savants, je viens vous prier de faire mettre en liberté, sur-le-champ, un de mes bons amis qui est ici la victime d’une erreur.
– Monsieur, balbutia sir Robert M… d’une voix étouffée, n’auriez-vous pas été plutôt induit en erreur vous-même ?
Le premier secrétaire haussa les épaules.
– On m’a amené ici un Français du nom de Rocambole, poursuivit sir Robert M…
– Mais, mon cher monsieur, dit froidement le secrétaire d’ambassade, si vous croyez qu’il y a une erreur de ma part et non une bévue de la police, il y a un moyen bien simple d’éclaircir la chose.
– Lequel ? dit le gouverneur, qui perdait littéralement la tête.
– C’est de me montrer votre prisonnier.
Sir Robert M… se rattacha à un dernier espoir.
Il était impossible qu’un homme si haut placé que le secrétaire d’ambassade connût un malfaiteur.
Or, pour sir Robert M…, un homme qui parlait une langue mystérieuse et s’entretenait pendant toute la nuit avec un bandit comme l’homme gris, ne pouvait être qu’un malfaiteur qui, peut-être, avait volé les papiers d’un gentleman, et se réclamait, au nom de ce gentleman, à l’ambassade de France.
Sir Robert M… accepta donc avec empressement la proposition qui lui était faite.
– Venez ! monsieur, venez ! dit-il.
Et il se précipita le premier hors de son cabinet.
Master Dixon ouvrit la formidable porte de fer qui sépare le greffe et les appartements du gouverneur de l’intérieur proprement dit de la prison.
Les deux professeurs de langues orientales et le midshipman qui avait vécu parmi les sauvages de l’Océanie suivirent sir Robert M… et le premier secrétaire de l’ambassade.
Milon demeura au greffe.
Il y avait une émotion terrible et suprême que redoutait le colosse.
Il craignait de voir Rocambole et de se trahir.
Marmouset lui avait bien recommandé de ne pas se montrer.
Quand la porte de la cellule où le vrai et le faux Rocambole étaient enfermés se fut ouverte, Marmouset jeta un cri de joie.
Et se levant de son lit, sur lequel il était couché tout vêtu, il se précipita vers le premier secrétaire.
– Oh ! cher ami, dit celui-ci, en vérité, je suis indigné de ce qui vous arrive.
– Ah ! dit Marmouset en riant, je ne me suis pas trop ennuyé.
Rocambole était impassible.
– Et puis, dit Rocambole, ce brave homme et moi, nous nous sommes un peu moqués de sir Robert M…
– Vous vous êtes moqués de moi ?… balbutia le gentleman.
– Eh ! sans doute, cher monsieur.
Sir Marmouset, regardant Rocambole, dit encore :
– Monsieur est Français. Pourquoi est-il ici ? Je l’ignore. Vous avez absolument voulu que je fusse son ami et complice. Alors je lui ai proposé une petite comédie, et il m’a donné la réplique.
Monsieur est un gentleman et un homme d’éducation.
Il a peut-être commis des crimes, mais il parle merveilleusement le javanais.
– Une langue infernale ! dit sir Robert M…
– Une langue charmante, dont je vous donnerai la clef, mon cher gouverneur.
Mais le premier secrétaire d’ambassade fit, sur ces mots, un geste d’adieu à Rocambole, et dit à Marmouset :
– Mon cher ami, venez ; on vous doit une réparation, et je vous jure qu’elle sera éclatante !…
*
* *
Une demi-heure après, Marmouset quittait Newgate, laissant sir Robert M… en proie aux plus vives angoisses.
Car enfin Marmouset pouvait demander une forte indemnité, et le jury ne se priverait pas de se montrer sévère envers un gouverneur aussi léger dans sa conduite.
Et sir Robert M… n’était pas riche…
Et il était père de famille.
Quant à Rocambole, il s’était couché tranquillement et n’avait pas tardé à s’endormir.
XIX
Transportons-nous maintenant dans la Cité et dans une maison de Sermon Lane.
Cette même maison où nous avons vu naguère l’homme gris surprendre miss Ellen au moment où elle s’affublait de la robe et du capuchon noir des « Sœurs de la dernière heure. »
Londres, nous l’avons dit, possède une institution admirable entre tant d’autres.
Des femmes de la plus haute noblesse se sont liées par un vœu ; elles ont formé une association, et, tirées au sort chaque fois, elles vont porter aux condamnés à mort les consolations de la religion, et prient avec eux pendant la nuit qui précède leur supplice.
On se souvient encore qu’une nuit le sort ayant désigné miss Ellen, et la jeune fille ayant reçu le pli mystérieux marqué dans le coin d’une croix noire, elle s’était arrachée à son lit, vêtue à la hâte, était montée en voiture et avait couru à Sermon Lane.
C’est une ruelle, on le sait, qui descend infecte et noire des hauteurs de la Cité jusqu’à la Tamise.
Dans cette ruelle, au troisième étage d’une maison plus que modeste, miss Ellen avait alors une chambre dans laquelle elle renfermait son costume de « dame des prisons » ou « de la dernière heure » car le peuple de Londres leur donne les deux noms.
Miss Ellen était partie précipitamment de Londres, elle n’avait donc pas prévenu de son absence la présidente de l’œuvre, qui avait, on s’en souvient encore, ses bureaux dans la rue Pater-Noster.
Par conséquent elle avait conservé sa petite chambre de Sermon Lane.
Or, le lendemain matin de son retour à Londres, miss Ellen, qui était descendue avec Vanda dans un hôtel modeste, auprès de la poste, dit à sa compagne :
– Madame, nous n’allons pas rester ici, moi du moins.
– Pourquoi donc ? demanda Vanda.
– Parce que je me défie de la police et du révérend Patterson, et que j’aime autant me servir de mes armes.
– De quelles armes parlez-vous ! dit Vanda étonnée.
Miss Ellen eut un sourire.
– Vous connaissez la vie anglaise et l’Angleterre, dit-elle, mais pas comme moi.
– Que voulez-vous dire ?
– L’Angleterre est la terre des inviolabilités par excellence, il est des maisons, dans lesquelles la police n’a pas le droit de pénétrer, des costumes sous lesquels on peut circuler librement.
– Un élève de Christ-Hospital est inviolable, par exemple, dit encore miss Ellen.
– Bon !
– Le policeman qui oserait arrêter une dame des prisons ne sortirait pas vivant de la rue où il aurait commis ce forfait.
La populace le mettrait en pièces.
– Eh bien ?
– Eh bien ! dit miss Ellen, je suis sœur des prisons.
– Vous ?
– Moi, et par conséquent, je vais revêtir mon costume.
– Mais où cela ?
– À deux pas d’ici, dans le Sermon Lane. Voulez-vous m’accompagner ?
Vanda suivit miss Ellen.
La jeune fille la conduisit dans cette chambre que nous connaissons.
– Ici, dit-elle je brave la haine du révérend Patterson.
– Et le courroux de votre père ? dit Vanda.
– Oh ! fit miss Ellen qui eut un superbe sourire, avec mon père le dernier mot n’est pas dit.
– Ah !
– Mon père m’idolâtrait ; il m’idolâtre encore, j’en suis sûre.
– Et il doit être bien malheureux.
– J’en suis très persuadée, mais je le convertirai à mes idées.
– Vous oserez revoir votre père ?
– Sans doute, et j’irai en plein jour chez lui.
– Et s’il vous retient ?
– Revêtue de cet habit je vous le répète, je suis inviolable.
Puis miss Ellen ajouta après un silence.
– J’aime l’homme gris à présent ; je l’ai perdu, je le sauverai.
Il y avait une énergie sauvage ; une conviction profonde dans l’accent de la jeune fille.
– J’ai accepté tout d’abord votre plan et celui de vos amis, dit-elle ensuite, mais que ce plan vienne à échouer, et vous verrez…
Vanda retourna à son hôtel.
Miss Ellen demeura installée dans la chambre de Sermon Lane.
Une petite servante Irlandaise qu’elle s’était procurée lui apportait ses repas de la maison voisine.
Deux jours s’écoulèrent.
Milon était venu annoncer à Vanda que Marmouset était à Newgate.
Vanda avait porté elle-même cette nouvelle à miss Ellen.
Enfin, le surlendemain, Marmouset se présenta lui-même à l’hôtel de Vanda.
Celle-ci eut un cri de joie en le voyant.
Marmouset avait aux lèvres un sourire qui disait clairement que la campagne avait été bonne.
– As-tu vu le maître ? demanda Vanda.
– Pardieu !
– As-tu pu lui parler ?
– J’ai passé deux nuits et un jour avec lui.
– As-tu ses instructions ?
– Ses instructions complètes. Où est miss Ellen ?
Vanda mit Marmouset au courant.
– Eh bien ! dit celui-ci, allons dans Sermon Lane.
Et tous deux rejoignirent miss Ellen.
La belle patricienne eut un moment de violente émotion.
Elle voulut apprendre de la bouche de Marmouset mille détails sur cet homme qu’elle adorait après l’avoir haï.
Lui avait-il parlé d’elle ? Était-il ému en prononçant son nom ?
Et l’atmosphère pesante de Newgate, la maison aux murs sinistres, n’avait-elle pas brisé sa vaillante énergie ?
Marmouset répondait en souriant :
– Nous le sauverons, miss Ellen, nous le sauverons !
Alors Marmouset confia aux deux femmes qu’il avait mission de voir l’abbé Samuel. Mais où le trouver ?
Depuis l’arrestation de l’homme gris, le jeune prêtre qu’on avait essayé de compromettre, se cachait.
– Je sais où vous le trouverez, dit miss Ellen.
– Ah !
– Allez-vous-en dans le Southwark.
– Bon !
– Entrez à l’église Saint-George, adressez la parole au sacristain et dites-lui :
– C’est l’espoir de l’Irlande qui m’envoie.
Vous pouvez lui parler français, vous achèveriez ainsi de gagner sa confiance.
– Et il me dira où est l’abbé Samuel ?
– C’est probable, surtout si vous lui parlez de l’homme gris.
– J’y vais à l’instant même, dit Marmouset, car nous n’avons plus de temps à perdre maintenant, d’autant plus que l’homme gris demande une réunion des principaux chefs fénians.
– Allez, dit miss Ellen, qui avait retrouvé tout son calme, moi aussi je vous dis avec confiance : Nous le sauverons !
– Comme elle l’aime ! murmura Vanda. Ô la jeunesse !
XX
Londres était si embrumé, ce jour-là, qu’on eût dit que la capitale du spleen y mettait de la coquetterie.
Dès midi, les magasins avaient eu recours à l’hydrogène, cette doublure fort réussie du soleil anglais.
Le brouillard était rouge et si épais que les cabs ne circulaient plus.
– Quel chien de pays ! murmurait Milon, qui marchait cependant d’un pas rapide et côte à côte avec Marmouset.
Quand on pense qu’à Paris il fait un soleil magnifique et que les arbres des Tuileries commencent à bourgeonner !
– Viens donc, philosophe, répondit Marmouset. Tu te plaindras du brouillard un autre jour. Nous n’avons pas le temps aujourd’hui de disputer sur la température.
Ils arrivaient au pont de Westminster.
Le brouillard obscurcissait le ciel, rendait la Tamise invisible.
On aurait pu croire qu’ils marchaient dans un nuage.
Les piles du pont elles-mêmes étaient devenues invisibles.
Quand ils furent de l’autre côté, Marmouset hésita un moment :
– Nous voici bien dans le Southwark, dit-il ; mais quel est le plus court chemin pour arriver à l’église Saint-George ?
– Bridge road, répondit Milon, qui savait Londres par cœur.
Ils se remirent en route, et un quart d’heure après, ils arrivaient devant la cathédrale des catholiques de Londres.
Miss Ellen avait parfaitement indiqué à Marmouset le moyen de pénétrer dans l’église.
Il fallait tourner la grand’porte, traverser le cimetière et aller frapper à la porte du chœur.
Ce qu’ils firent.
Il s’écoula quelques minutes avant qu’on répondit.
Puis enfin le vieux sacristain à barbe blanche vint ouvrir.
Il avait une lampe à la main.
À la vue de ces deux hommes qu’il ne connaissait pas, il fit un pas en arrière et eut un geste de crainte.
– Que voulez-vous ? dit-il.
– C’est l’Espoir de l’Irlande qui nous envoie, répondit Marmouset, se conformant aux instructions de miss Ellen.
– Je ne sais pas ce que vous voulez dire, répliqua le sacristain en mauvais français.
– Nous voulons parler à l’abbé Samuel.
– Il n’est pas ici.
Marmouset et Milon étaient entrés dans le chœur.
– Si vous voulez voir l’abbé Samuel, dit encore le vieillard, allez à Saint-Gilles.
Mais Marmouset avait deviné que le vieillard mentait :
– Prends garde, vieillard, dit-il, en refusant de nous conduire à l’abbé Samuel, tu causes peut-être un grand préjudice à l’Irlande.
– Êtes-vous donc Irlandais ? fit le soupçonneux vieillard.
– Nous sommes des amis de l’Irlande.
– Ou de l’Angleterre. Allez ! dit le vieillard, quand on a arrêté l’abbé Samuel pour le mettre en prison, on lui a pareillement dit…
– Nous venons de France, dit Marmouset, et nous avons vu Ralph et Jenny.
À ces noms, le vieillard fit un pas en arrière.
– Veux-tu que je te les dépeigne ? dit encore Marmouset.
Jenny est grande, brune, elle a les yeux bleus et elle est plus belle que toutes les ladies du West-End.
– Après ? dit le sacristain.
– Ralph à dix ans, il est déjà fier comme son père, sir Edward Palmure.
– Et vous les avez vu ? demanda le sacristain.
– Ils sont chez moi, dit Milon.
– Où cela ?
– À Paris.
Cependant le vieillard ne se rendait pas encore.
– Je vous crois, dit-il, mais je ne sais pas où est l’abbé Samuel.
– Ah ! connais-tu l’homme gris ?
À ce nom le sacristain tressaillit.
– Oui, dit Milon. Et Shoking, le connais-tu ?
Ce nom dérida le sacristain.
– Prouvez-moi que vous connaissez Shoking, dit-il.
– C’est facile. Shoking n’est plus à Londres.
– C’est vrai.
– Il est en France avec Ralph et Jenny.
– C’est vrai encore. Mais la police anglaise sait tant de choses !…
– Tu te défies donc toujours ?
Le sacristain eut un sourire :
– L’Irlande est persécutée, dit-il, c’est notre excuse, si nous avons peur.
– Eh bien, dit Marmouset, puisque tu ne veux pas nous dire où est l’abbé Samuel, peux-tu au moins te charger d’un message pour lui ?
– Si je le vois, oui.
– Supposons que tu le verras…
– Dites alors.
– Si tu vois l’abbé Samuel, remets-lui ceci.
Et Marmouset tira de sa poche un petit papier plié en quatre.
Ce papier n’était autre qu’un billet écrit à l’abbé Samuel par l’homme gris lui-même.
Et Marmouset ajouta :
– C’est de la part de l’homme gris.
– Ah ! dit le sacristain qui prit le billet.
Mais sa défiance n’était point désarmée.
– Revenez demain, dit-il, ou ce soir. Peut-être aurai-je vu l’abbé Samuel.
– C’est bien, dit Marmouset. Viens, Milon.
– Comment ? dit le colosse, nous nous en allons ?
– Sans doute.
– Mais si l’abbé Samuel était ici ?
– Viens donc !
Et Marmouset entraîna Milon hors de l’église, au grand contentement du sacristain, qui se hâta de refermer la porte.
– Mais, dit alors Milon, si nous avions insisté ?… Tenez, j’aurais pris le sacristain à la gorge, moi et vous ?…
– Moi, j’aurais souillé l’église, n’est-ce pas ?
– Oui.
– Tu es un imbécile !
– Plaît-il ?
– Viens t’asseoir là, dit encore Marmouset.
Et il s’assit, sur le mur de clôture du cimetière.
– Maintenant, lève les yeux en l’air.
– Bon !
– Vois-tu le clocher ?
– Non ! il est perdu dans le brouillard.
– Regarde bien, que vois-tu ?
– Tiens : une lueur qui monte, dit Milon.
– Ah !
– On dirait une étoile.
– C’est une lampe qui monte dans le clocher et que tu aperçois à travers les meurtrières.
– Eh bien ?
– L’abbé Samuel est là haut.
– Vous croyez ?
– Et le sacristain il porte le billet de l’homme gris. Attendons un moment encore.
– Pourquoi ?
– Tu vas voir.
La clarté qui perçait le brouillard était devenue fixe en ce moment.
Tout à coup elle redescendit, mais non plus lentement. Cette fois, on eût dit une étoile se détachant du ciel.
– Le bonhomme a retrouvé ses jambes de vingt ans, dit Marmouset.
– Comment cela ?
– Il redescend en courant.
– Pourquoi ?
– Mais pour essayer de nous rejoindre. Tu vas voir.
En effet, un instant après la petite porte du chœur se rouvrit, et le vieux sacristain s’élança dans le cimetière.
XXI
Le vieux sacristain était, en effet, monté au clocher, et il avait poussé une petite porte dissimulée dans la muraille si habilement, que trois personnes seulement en connaissaient l’existence, le sacristain, le curé de l’église et l’abbé Samuel.
En Angleterre, les persécutions dont le catholicisme est victime ne datent pas d’hier et n’ont pas eu le fenianisme pour point de départ.
Il y a cinquante ans, un prêtre catholique, naturellement Irlandais, et curé de Saint-George, était poursuivi à outrance pour avoir, dans un de ses sermons, attaqué le primat de la Grande-Bretagne, l’archevêque de Cantorbéry.
Le pauvre prêtre était attaché à son église comme le capitaine à son vaisseau.
Il ne voulait pas fuir.
Pendant deux mois il se tint caché sous les murailles de Saint-Gilles, de l’autre côté de la Tamise.
Mais les Irlandais mirent ces deux mois à profit.
Chaque nuit deux ouvriers travaillaient mystérieusement dans le clocher et creusaient dans l’épaisseur du mur une espèce de cellule, large de quatre pieds.
Quand la cellule fut creusée, lorsque son entrée fut habilement dissimulée par une pierre semblable aux autres et tournant sur ses gonds invisibles, le prêtre revint dans son église.
Les policemen faisaient bonne garde à l’entour ; vingt fois ils envahirent l’église, espérant trouver le curé et le conduire en prison.
Le curé était invisible.
Tout le jour, il était caché dans la cellule mystérieuse ; la nuit il descendait prier dans l’église et, bien avant la première aube, il disait sa messe.
Or, depuis cinquante ans, la chambre secrète du clocher n’avait servi qu’une seule fois, et encore pendant quelques jours seulement, lorsqu’un soir l’abbé Samuel se glissa dans l’église et monta précipitamment chez le sacristain.
– Il faut me cacher, lui dit-il.
– Vous êtes donc poursuivi ? demanda le vieillard.
– Oui, on a fouillé dans mes papiers en mon absence, et on a trouvé plusieurs lettres de l’homme gris qui se trouve arrêté depuis hier.
En effet, à la pressante sollicitation du révérend Patterson, le lord chief-justice avait ordonné l’arrestation de l’abbé Samuel, qui n’avait eu que le temps de se réfugier à Saint-George.
Depuis lors on le recherchait si activement qu’il lui avait été impossible de réunir une seule fois les principaux chefs irlandais.
Cependant ses lettres lui parvenaient, et la dépêche de Marmouset, dépêche à laquelle il avait répondu, lui était arrivée par l’intermédiaire d’un agent du télégraphe qui était lui-même fénian.
Or donc, si le sacristain s’était montré si défiant à l’endroit de Marmouset et de Milon, c’est qu’ils n’étaient pas les premiers à venir demander l’abbé Samuel.
La police, qui continuait à rechercher activement l’abbé Samuel, avait employé tous les moyens ; elle s’était présentée sous tous les prétextes et sous tous les déguisements.
La perspicacité du bonhomme avait fait échouer ses efforts jusqu’à présent.
Cependant, l’accent de sincérité de Marmouset et de Milon avait frappé le vieillard.
Il s’était donc chargé de faire parvenir à l’abbé Samuel le billet que Marmouset lui avait remis.
Et, ce billet à la main, il était monté précipitamment dans le clocher, avait poussé un ressort et s’était trouvé dans la cellule où l’abbé Samuel priait en ce moment.
À peine le jeune prêtre eut-il jeté les yeux sur le billet et reconnu l’écriture de l’homme gris, qu’il s’écria :
– Qui donc a apporté cela ?
– Deux hommes.
– Où sont-ils ?
– Je les ai renvoyés.
– Y a-t-il longtemps ?
– Non, à l’instant même.
– Cours après eux, tâche de les rejoindre, ce sont des amis, avait encore dit l’abbé Samuel.
Et le sacristain, on l’a vu, avait dégringolé l’escalier du clocher et s’était élancé dans le cimetière, espérant retrouver les deux visiteurs, soit sur la place de l’Église, soit dans quelque rue voisine.
Comme le brouillard était très épais, il passait tout auprès de Marmouset sans le voir, quand celui-ci l’arrêta en lui saisissant le bras.
– Ah ! c’est vous ? fit le vieillard.
– Nous-mêmes.
– Je vous cherchais.
– Et nous, dit Marmouset, nous étions bien sûrs que vous nous courriez après.
– Venez, dit le sacristain.
Et il reprit le chemin de la petite porte du chœur, qu’il avait laissée entrouverte.
Marmouset et Milon le suivirent.
Quelques minutes après, ils se trouvaient en présence de l’abbé Samuel.
– Mon père, lui dit Marmouset, le billet que je vous ai fait tenir a dû vous l’apprendre, je sors de Newgate.
– Où vous avez vu l’homme gris ? fit vivement le jeune prêtre.
– J’ai passé deux jours avec lui.
L’abbé Samuel passa la main sur son front :
– Ah ! dit-il, c’est un grand, malheur qu’il soit à Newgate.
– Il en sortira.
Le prêtre leva les yeux au ciel.
– Hélas ! dit-il, vous ne connaissez pas les Irlandais, mon frère.
– Que voulez-vous dire ? fit Marmouset.
– Pendant quelques mois, reprit l’abbé Samuel, l’homme gris a été notre chef à tous. Partout nous avons triomphé, partout nous avons été victorieux.
Si bons chrétiens que soient nos frères d’Irlande, ils sont superstitieux.
– Ah !
– Et ils avaient fini par croire que l’homme gris avait un pouvoir surnaturel.
– Qui sait ? dit encore Milon.
L’abbé Samuel secoua la tête.
– Hélas ! dit-il, l’événement a prouvé le contraire. Il a été pris. Dès lors son prestige est tombé.
– Alors on ne croit plus à lui ?
– Non.
– Et personne ne songe à tenter quelque chose pour le sauver ?
– Personne.
Un fin sourire glissa sur les lèvres de Marmouset.
– Si l’homme gris a été pris, dit-il, c’est qu’il l’a bien voulu.
– Que dites-vous ?
– La vérité.
L’abbé Samuel fit un pas en arrière, tant ces paroles l’étonnaient.
– Il a été pris, poursuivit Marmouset, parce qu’il avait une grande idée que sa captivité seule pouvait réaliser.
– Je ne vous comprends pas, monsieur.
– Écoutez-moi, monsieur l’abbé. Quels sont vos deux plus mortels ennemis, en Angleterre ?
– Nous en avons trois.
– Nommez-les.
– Le révérend Patterson, chef occulte de la religion réformée.
– Et puis ?
– Et puis lord Palmure.
– Et enfin ?
– Enfin la fille de lord Palmure, miss Ellen.
– Vous vous trompez, monsieur l’abbé, dit froidement Marmouset.
– Plaît-il ?
– Miss Ellen n’est plus votre ennemie.
– Oh ! que dites-vous là ?
– Je dis la vérité, monsieur l’abbé. Miss Ellen est redevenue Irlandaise de cœur et d’âme.
L’abbé Samuel étouffa un cri.
XXII
Marmouset avait frappé un grand coup sur l’esprit de l’abbé Samuel en lui apprenant la conversion de miss Ellen aux idées irlandaises.
Néanmoins, cela paraissait si extraordinaire, si invraisemblable, que le jeune prêtre lui dit :
– Êtes-vous sûr, monsieur, que l’homme gris ne s’est pas trompé ?
– Sur quoi ?
– Miss Ellen a l’audace, la force, la ruse ; elle joue la passion en comédienne consommée…
– Oui, mais elle a été vaincue par l’homme gris.
– Et elle l’aime ?
– Elle l’a aimé du jour où il a été prisonnier.
Dans les deux jours qu’il avait passés en prison avec Rocambole, Marmouset avait eu le temps d’apprendre de lui tout ce qui s’était passé à Londres depuis six mois.
Il raconta donc à l’abbé Samuel comment miss Ellen avait tendu un piège à l’homme gris, piège dans lequel celui-ci avait volontairement donné tête baissée.
Et la réaction subite qui s’était opérée chez la fière patricienne, et son amour et son désespoir.
Puis il raconta encore le voyage de miss Ellen en France, et la façon dont lui, Marmouset, l’avait délivrée de sir James Wood.
Quand il eut terminé cet étrange récit, l’abbé Samuel lui dit :
– Je vous crois, moi.
– Mais les autres ne me croiront pas, voulez-vous dire ?
– Je le crains.
– Et si miss Ellen elle-même.
– Ah ! vous avez raison, dit l’abbé Samuel, je réunirai cette nuit même les principaux chefs.
– En quel endroit ?
– Connaissez-vous Londres ?
– Assez.
– Il y a un quartier qu’on nomme le Wapping.
– Connu ! dit Marmouset.
– Et un square appelé Well-Close…
– Je le connais aussi.
– Eh bien ! que miss Ellen s’y trouve ce soir, un peu avant minuit.
– Seule ?
– Oh ! non, car elle pourrait être insultée par quelque fille de bas étage ; accompagnez-la.
– Et puis ?
– Faites-la asseoir sur un banc au milieu du square, et attendez.
– C’est bien, dit Marmouset, nous y serons.
Puis, après un moment de réflexion, l’abbé Samuel dit encore :
– Savez-vous ce qui a achevé de ruiner le prestige de l’homme gris ?
– Non.
– C’est qu’on le croyait Irlandais.
– Et qu’on a appris qu’il était Français ?
– Justement.
– Dévouez-vous donc à un peuple et à une idée ! murmura Marmouset avec dédain.
Puis, froissé dans son orgueil, il regarda le prêtre et lui dit :
– Écoutez-moi une minute encore, monsieur.
– Parlez…
– L’homme gris, qui, pour nous, a un autre nom, vous a paru extraordinaire, merveilleux, n’est-ce pas ?
– Cela est vrai.
– Je sais ce qu’il a fait ici : et je puis vous affirmer que cela n’a rien d’important.
– Oh ! dit l’abbé Samuel.
– Nous lui avons vu faire bien autre chose, nous, ses compagnons, et je puis vous affirmer une chose…
– Laquelle ?
– C’est que s’il voulait sortir de Newgate ce soir et tout seul, il en sortirait.
Le prêtre eut un geste qui voulait dire :
– Alors pourquoi nous demande-t-il secours ?
Marmouset devina la pensée de l’abbé Samuel et répondit :
– Les hommes supérieurs ont leurs faiblesses. L’homme gris a été un grand coupable ; c’est maintenant un grand pénitent, et il a mis tout son génie étrange au service de toutes les causes qui lui paraissent nobles et dignes d’intérêt.
C’est ainsi qu’un jour il vous a vu apparaître dans une taverne, comme un ange parmi des démons, et qu’il est devenu fénian.
Délivrez-le, et il vous rendra de bien autres services encore.
– Ah ! je ne demande pas mieux, moi, dit l’abbé Samuel.
– Abandonnez-le, poursuivit Marmouset, il se tirera d’affaire, soyez tranquille.
– Et nous donc ! sommes-nous venus à Londres pour rien ? exclama le bon Milon, que le flegme de l’abbé Samuel irritait.
– Mais alors, acheva Marmouset, il vous abandonnera à son tour.
– Hélas ! dit le pauvre prêtre, pourquoi donc n’est-il pas Irlandais ? À l’heure qu’il est, on eût incendié Newgate pour le délivrer. Ah ! monsieur, si je pouvais disposer de ces hommes à ma guise, il y a longtemps que l’homme gris serait revenu parmi nous.
Marmouset se prit à sourire.
– Monsieur l’abbé, dit-il, vous êtes un apôtre, je le sais, et l’homme gris n’a jamais douté de vous.
– Ah ! certes !
– Aussi ne vous inquiétez pas de lui outre mesure. Si les fénians l’abandonnent, nous ses amis, nous lui ouvrirons toutes grandes les portes de Newgate. Comme vous le disait mon compagnon, nous ne sommes pas venus de Paris pour autre chose.
– À ce soir donc, dit l’abbé Samuel.
– À ce soir.
Marmouset et Milon firent un pas de retraite.
– Ah ! dit encore le prêtre, j’oubliais…
– Quoi donc ?
– Vous n’êtes pas fénian, vous ?
– Ma foi ! non.
– Vous ne pouvez, par conséquent, pénétrer dans notre réunion.
– Alors, miss Ellen ira seule ?
– Non, puisque je viendrai la chercher sur le banc de Well-Close square.
– C’est juste. À ce soir.
Et Marmouset et Milon s’en allèrent.
Milon, en traversant le cimetière de l’église, prononçait des mots inintelligibles, mais qui trahissaient une sourde exaspération.
– Qu’as-tu donc ? dit Marmouset en riant.
– J’ai que le maître est toujours victime de son cœur et de ses élans généreux.
– Naturellement.
– Et ces gens-là ne valent pas la peine…
– Tais-toi ! Ne les jugeons point par avance… Qui sait ?
– Oh ! fit Milon, c’est tout vu. Ils enverront promener miss Ellen.
– Eh bien ! nous délivrerons le maître, nous.
– Avez-vous déjà un plan ?
– Parbleu ! dit Marmouset. Et dès ce soir je me mets à l’œuvre.
– Dès ce soir ?
– Sans doute.
– Mais puisque vous accompagnez miss Ellen ?
– À minuit.
– Alors, auparavant… ?
– Auparavant je vais dresser mes petites batteries. Viens, nous en causerons en route.
Ils sortirent du cimetière et remontèrent vers le pont de Westminster.
XXIII
Le brouillard était toujours d’une intensité excessive.
On n’y voyait pas à trois pas de distance.
Cependant, il n’était pas encore quatre heures de l’après-midi.
Marmouset et Milon s’en revinrent donc à pied, après avoir traversé de nouveau la Tamise sur le pont de Westminster.
Et tout en cheminant ils causaient :
– Voyons, disait Marmouset, récapitulons un peu. Combien sommes-nous ?
– Où cela ?
– À Londres.
– Vous voulez parlez de nous et des gens que nous avons amenés ?
– Oui.
– Il y a d’abord nous quatre, vous, moi, Vanda et miss Ellen.
– Les femmes ne comptent pas.
– Alors, nous deux.
– Après ?
– La Mort-des-Braves, Jean le Boucher.
– Quatre.
– Polyte.
– Cinq.
– Sir James Wood.
– Il ne compte pas non plus.
– Edward.
– Ah ! il compte, celui-là : six.
– Pourquoi ces calculs ? demanda Milon.
Marmouset continua sans répondre à cette question :
– Rocambole m’a donné une liste de quatre personnes qui lui sont particulièrement dévouées à Londres.
– Bon ! fit Milon.
– Enfin, au besoin, nous ferons venir Shoking.
– Mais…
– Tu veux toujours savoir les choses trop longtemps à l’avance, dit Marmouset en souriant.
– Mais… pourtant.
– Qu’il te suffise pour le moment d’apprendre que tu vas changer de profession.
Milon ouvrit de grands yeux.
– Tu étais entrepreneur à Paris ?
– Sans doute.
– Tu vas être, à Londres, marchand de denrées coloniales.
– Quelle drôle d’idée !
– Épicier, si tu veux.
– Ah çà ! dit Milon qui avait ses petits moments d’impatience, je crois que vous vous moquez de moi, Marmouset.
– Bah !
– Je permets bien cela au maître…
– Mais tu ne me le permets pas ?
– Dame, fit Milon.
– Eh bien, rassure-toi, je ne me moque pas de toi.
– Cependant, observa Milon, je ne vois pas quel rapport il y a entre la profession d’épicier et le but de notre voyage à Londres.
– Tu le verras.
– Mais quand ?
– Dans une heure.
Tout auprès de Scotland-Yard, Marmouset fit entrer Milon dans un public-house.
– J’ai soif, dit-il.
Puis, au lieu d’entrer dans le box des gentlemen, il passa tout droit dans cette petite pièce qui est au fond de tous les public-houses et qu’on appelle le parloir.
Là seulement on trouve à s’asseoir.
Marmouset demanda une bouteille de porto et tandis qu’on le servait, il tira de sa poche un numéro du Times paru la veille au soir.
Milon, de plus en plus étonné le regardait faire.
Marmouset chercha à la quatrième page et mit le doigt sur une annonce qu’il plaça sous les yeux de Milon :
Great attraction !
« Master Love, négociant en denrées coloniales, Old-Bailey, n° 3, a l’honneur de prévenir le public qu’ayant fait sa fortune et désirant vivre tranquille dans son cottage de Greenwich, il est dans l’intention de vendre sa maison de commerce.
« Bonne clientèle de premier choix.
« Des fenêtres de la boutique, on voit pendre, la maison faisant face à la porte de Newgate devant laquelle on dresse le gibet. Great attraction ! On peut louer deux fenêtres. Master Love fait savoir qu’il traitera directement avec les personnes qui se présenteront. »
– Je le vois bien, dit Milon, mais…
Marmouset haussa les épaules.
– Ne sois donc pas si pressé, dit-il, tu devrais déjà comprendre, ce me semble, qu’il y a un intérêt quelconque pour nous à posséder un fonds de commerce en face de Newgate.
– Cela est juste.
– Nous ferons la connaissance du personnel de la prison, c’est toujours cela.
Milon n’insista pas.
La bouteille de vin vidée, Milon et Marmouset se remirent en route et remontèrent vers Trafalgar square.
Il y a une bonne trotte de Trafalgar à Old Bailey.
Il faut longer tout le Strand, ensuite Fleet street, traverser la longue rue de Farrigdon, dans laquelle se trouve l’imprimerie du Times.
En entrant dans Old Bailey, Marmouset montra une maison à Milon.
– Est-ce que c’est cela ? demanda Milon.
– Non, c’est la maison de M. Ranis, un riche banquier.
– Eh bien ?
– Vois-tu cette fenêtre au premier étage ?
– Oui.
– Eh bien ! Rocambole, de cette fenêtre, a coupé la corde d’un pendu avec une balle chassée par un fusil à vent.
– Quand cela ?
– Il y a trois mois.
Le magasin d’épicerie de master Love était tout à côté de la maison de M. Ranis.
C’était un tout petit magasin occupant le rez-de-chaussée d’une maison de triste apparence et dont la vieille architecture contrastait péniblement avec les constructions voisines.
– Cette maison, dit-il, a deux cents ans d’existence.
– C’est une masure, dit Milon, qui avait sur la construction des idées nouvelles.
– Nous trouverons, quand elle nous appartiendra, que c’est un vrai bijou.
– Par exemple !
– Quelquefois, le vieux vaut mieux que le neuf, dit sentencieusement Marmouset.
Et ils entrèrent dans la boutique où master Love, un petit homme grisonnant et fort laid, en dépit de son nom qui veut dire amour, trônait majestueusement derrière un comptoir de chêne noirci et au milieu de tous les produits que l’épicerie, toujours solennelle, a baptisés du nom de denrées coloniales.
En voyant entrer les deux gentlemen, master Love se leva avec empressement et vint à leur rencontre.
– My dear, lui dit Marmouset, vous désirez vendre votre fonds ?
– Yes, sir, répondit master Love.
– Combien ?
– Deux mille cinq cents livres.
Un sourire vint aux lèvres de Marmouset, qui dit en français à Milon :
– Cela vaut mille écus, et il en demande plus de soixante mille francs. Pas juif du tout, l’Anglais !
Puis tout haut :
– Êtes-vous donc locataire de toute la maison ?
– Yes, dit master Love.
Marmouset ouvrit sa redingote, tira de sa poche un portefeuille bourré de bank-notes et dit :
– J’offre deux mille livres et je paie comptant, mais à une condition.
– Laquelle ? demanda master Love, qui eut un éblouissement.
XXIV
Marmouset reprit en montrant Milon :
– Monsieur est mon parent, et je le veux établir.
– Fort bien, dit master Love.
– Or, je quitte l’Angleterre dès demain, et je veux, avant de partir, avoir la satisfaction de le voir établi. Par conséquent, je vous offre deux mille livres, à la condition que vous vous en irez à l’instant même avec votre femme.
– Je suis veuf, dit master Love.
– Et votre commis ?
– Je n’en ai pas.
– Alors vous êtes donc tout seul ?
– Absolument.
– Peste ! dit Marmouset en souriant, votre commerce ne me paraît pas si étendu, puisque vous faites votre besogne tout seul.
– Oh ! dit master Love en clignant de l’œil, ce n’est pas l’épicerie qui va le mieux ici…
– Qu’est-ce donc ?
– Les fenêtres.
– Ah ! oui, les fenêtres pour les exécutions ?
– Justement. Vous les louerez chaque fois dix livres.
Le marché ainsi conclu, master Love quitta son tablier, mit son habit, prit son chapeau, et suivit Marmouset chez un homme de loi qui, séance tenante, rédigea un acte de vente.
Une heure après, master Love prenait le penny-boat pour se rendre à Greenwich, et Milon s’installait dans la boutique de denrées coloniales d’Old Bailey.
En même temps Marmouset commandait chez un fabricant d’enseignes de la Cité une grande pancarte qu’on lui tirait tout de suite et sur laquelle on lisait :
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
LE MAGASIN EST FERMÉ POUR CAUSE DE RÉPARATIONS
Puis il colla l’affiche sur la porte, Milon mit les volets et Marmouset lui dit :
– Allons-nous-en !
– Où allons-nous ?
– Dans Sermon Lane, à deux pas d’ici, voir miss Ellen.
– Et après ?
– Après nous irons faire un tour dans la rue Pater-Noster, qui est celle des libraires de la Cité.
– Je veux être pendu, murmurait Milon en suivant Marmouset, si je comprends un mot à tout cela !
– Miss Ellen, dit Marmouset à la jeune fille, il y aura ce soir dans Well-Close square me grande réunion de fénians.
– Ah ! dit-elle avec joie.
– Et on vous y attend.
– Et il faudra bien, dit-elle, qu’ils me promettent de sauver l’homme gris.
Alors Marmouset lui raconta son entretien avec l’abbé Samuel.
Un sourire lui vint aux lèvres :
– Ces gens-là sont stupides ! dit-elle. Si un homme n’est pas éternellement victorieux, ils n’ont plus foi en lui.
– Du reste, dit Marmouset, si les fénians nous abandonnent, nous nous passerons d’eux.
– Certainement oui, dit-elle, et quand je devrais aller trouver mon père.
– Votre père ?
– Oh ! fit miss Ellen, je ferai de mon père ce que je voudrai, le jour où je le voudrai.
– À ce soir, miss Ellen !
– À ce soir.
– Je viendrai vous prendre ici à onze heures.
– Je serai prête.
Marmouset et Milon s’en allaient.
– Que diable allons-nous faire dans la rue Pater-Noster ! se demandait Milon.
Il le sut bientôt.
Dans cette rue il y a une boutique de libraire dans chaque maison.
Le plus achalandé de ces libraires se nomme M. Simouns.
Il a une fort belle collection de plans et de cartes, d’ouvrages historiques dont l’impression remonte à une époque déjà reculée.
Marmouset entra chez lui et lui dit :
– Je désirerais, monsieur, avoir un plan de la Cité au seizième siècle.
– Monsieur, répondit M. Simouns, le plan que vous me demandez est très rare. Il ne s’en trouve à ma connaissance, que deux exemplaires. L’un est au Muséum, l’autre est en ma possession.
– Et vous ne voulez pas vous en défaire ?
– J’en ai refusé cent livres.
– Je suis prêt à le payer cent cinquante.
Et Marmouset, une fois encore, ouvrit son portefeuille.
M. Simouns salua.
Puis il chercha dans ses rayons et mit la main sur le plan géographique, qui était divisé en petites feuilles collées sur toile et se fermait comme un livre.
– Tenez, monsieur, dit-il, vous allez voir combien cet ouvrage est précieux.
Et il étala le plan sur une table.
– Il a été dressé par ordre de Charles II à sa restauration, poursuivit le libraire.
– Je sais cela, monsieur.
– À la suite d’une conspiration qui n’avait pour but rien moins que de miner la ville de Londres tout entière, et de l’envoyer dans les airs à l’aide de quelques milliers de tonneaux de poudre.
– Je sais parfaitement cela, dit Marmouset, et c’est parce que je m’occupe d’un grand ouvrage historique…
– Tenez, monsieur, poursuivit M. Simouns, voyez ces lignes rouges.
– Bien.
– Elles indiquent les souterrains qui furent creusés à cette époque.
– Ah ! fort bien.
– Mais, reprit Marmouset, ces souterrains ont été comblés ?
– À peu près. Cependant j’ai la presque certitude qu’il en existe encore plusieurs.
– Où cela ?
– Principalement aux environs de Newgate.
– Ah ! vraiment ?
Ce libraire, qui était un érudit et en tirait quelque vanité, mit son doigt sur une des rues indiquées sur le plan.
– Tenez, dit-il, voilà Old Bailey.
– Bon !
– Vers le milieu, il y a une masure, une vieille maison qui fait face à Newgate.
– Eh bien ?
– Elle remonte au quatorzième siècle.
– J’irai la voir, dit Marmouset. Je veux faire mon ouvrage très consciencieusement.
– Je suis à peu près certain, poursuivit le libraire, que dans les caves de cette maison on retrouverait la trace des souterrains indiqués sur ce plan.
– C’est bien possible, dit Marmouset avec indifférence.
Et il prit le plan, qu’il paya en belles bank-notes toutes neuves.
Cette fois, comme ils sortaient de chez M. Simouns, et qu’ils descendaient la rue Pater-Noster, Milon murmura :
– Ah ! je commence à comprendre !
– C’est bien heureux… dit Marmouset en souriant.
XXV
Marmouset et Milon revinrent donc dans Old Bailey et prirent possession de leur nouvelle propriété.
Alors Marmouset regarda Milon en souriant :
– Ton vendeur, dit-il, comptait beaucoup sur le revenu de ses fenêtres pour les jours d’exécution.
– Je le vois bien, répondit Milon, qui jeta un coup d’œil dédaigneux sur les marchandises qui se trouvaient dans le magasin ; tout ce qu’il y a ici est avarié et ne vaut pas cinq cent franc.
– C’est une maison qu’il faut relever, mon ami.
– Hein ? fit Milon.
– Il faut acheter d’abord de la belle et bonne marchandise.
– Ah !
– Installer une jolie femme au comptoir.
– Plaît-il ?
– Avoir deux commis et un teneur de livres.
– Ah çà ! fit Milon stupéfait, vous voulez donc que je devienne sérieusement épicier ?
– Très sérieusement.
– Mais pourquoi ?
– Parce que nous avons besoin de tout notre personnel.
– La Mort-des-Braves et Jean seront commis.
– Bon !
– Polyte, notre nouvelle connaissance, sera teneur de livres.
– Et puis ?
– Sa petite femme Pauline, qui est fort gentille, ma foi ! tiendra le comptoir.
Tout à l’heure, je croyais comprendre, pourtant, murmura le bon Milon.
– Et maintenant tu ne comprends plus ?
– Oh ! mais là… plus du tout.
Marmouset haussa les épaules :
– Il faut toujours te mettre les points sur les i, dit-il.
– Cela m’est plus commode, toujours.
– Eh bien ! écoute. Le libraire nous a dit que cette maison, – et certes le brave homme ignorait qu’elle fût à nous, – avait dû être dans un temps le point de départ des souterrains creusés, lors de la conspiration des poudres.
– Oui, dit Milon.
– Ces souterrains aboutissaient probablement dans les caves.
– Eh bien ?
– Mais ils ont été comblés au moins à leur orifice.
– Après ?
– Il faudra donc, notre plan à la main, retrouver l’entrée d’abord.
– Bon ! dit le colosse.
– Et la déblayer.
– C’est juste.
– Or, pour cela, il faut des bras et des outils.
– C’est vrai.
– Or, que penserais-tu si nous aillions faire venir de braves ouvriers de Londres, terrassiers de leur état, que nous mettrions à cette besogne et qui, le soir, raconteraient dans les tavernes la singulière besogne dont on les a chargés ?
– C’est impossible, cela !
– Il faut donc, alors, que nous ayons nos ouvriers à nous.
– Vous avez raison.
– Et nos ouvriers sont la Mort-des-Braves, Jean le Boucher, Polyte et toi. Sais-tu que quatre hommes font de la besogne, la pioche à la main ?
– Excusez-moi, dit Milon, mais je ne suis qu’une brute, j’aurais dû comprendre ça tout de suite.
– Le jour, continua Marmouset, ils seront épiciers, et la nuit ils seront mineurs.
– Pardon, un mot encore, dit le colosse.
– Parle.
– En admettant que ces souterrains existent, pensez-vous qu’il y en ait un qui pénètre dans Newgate ?
Marmouset déplia de nouveau le plan qu’il venait d’acheter et le posa sur une table.
Puis il mit son doigt sur une des petites lignes rouges que le libraire disait indiquer les souterrains en question.
Et Milon vit que ce filet s’éloignait en droite ligne de la maison et se dirigeait à travers Old Bailey vers Newgate.
– Ah ! fort bien, dit-il encore, mais… Newgate est grand.
– Oui, certes.
– Où aboutit le souterrain et à quelle profondeur est-il ? Voilà ce que nous ne savons pas.
– Voilà ce que nous saurons.
– Quand ?
– Mais d’ici à deux jours.
– Comment cela ?
– Ah ! mon ami, dit Marmouset avec un léger mouvement d’impatience, il faut tout t’expliquer d’avance. Nous avons bien autre chose à faire ce soir.
Milon courba la tête, résigné.
Il était habitué, du reste, à ces façons de Marmouset, qui avait hérité des brusqueries et des franchises de Rocambole.
Marmouset consulta sa montre.
– Il est huit heures du soir, dit-il. C’est à onze heures que j’irais chercher miss Ellen. Allons dîner à Evans-Tavern. Puis tu te mettras en quête de nos compagnons.
– Ils sont descendus dans Haymarket et dans Liviston square.
– Ah !
– La Mort-des-Braves et Jean sont dans un boxeding où descendent les marchands de chevaux français.
– Et Polyte ?
– Polyte et sa femme sont à Sablonnière hôtel.
– Alors, dit Marmouset, allons dîner à Sablonnière ; c’est à eux d’abord que j’en ai.
*
* *
Pendant que Marmouset et Milon dînaient et convoquaient leurs compagnons de route pour le lendemain, Vanda était auprès de miss Ellen.
La jeune fille s’apprêtait à aller à la réunion des fénians.
Elle regardait Vanda en souriant et lui disait :
– Comme on change pourtant, madame.
– Quelquefois, en effet, miss Ellen.
– Il y a deux mois, le seul nom d’Irlandais révoltait tout mon sang.
– En vérité !
– Je regardais tous ces gens-là comme une vermine humaine, comme une lèpre vivante dont il fallait à tout prix débarrasser l’Angleterre.
– Et maintenant ?
– Maintenant, les Irlandais sont mes frères.
– Du reste, observa Vanda, n’êtes-vous pas, miss Ellen, d’origine irlandaise ?
– Certainement, répondit la jeune fille ; mais l’Angleterre nous avait adoptés, et mon père et moi l’avions, en revanche, considérée comme notre véritable patrie.
– Et il a suffi de l’homme gris ?…
– Oh ! dit miss Ellen avec enthousiasme ; puisque vous le connaissez, vous devez savoir avec quelle éloquence sa voix pénètre au fond des cœurs.
– Je le sais, dit Vanda, qui étouffa un soupir.
– Quand nous l’aurons sauvé, reprit miss Ellen, quand il sera libre, si vous saviez comme je serais fière de marcher à ses côtés dans le chemin qu’il s’est tracé, la liberté de l’Irlande !
– Comme elle l’aime ! pensait Vanda.
Et celle qui, elle aussi, avait tant aimé Rocambole, essuya furtivement une larme.
En ce moment on frappa à la porte de la chambrette, et Marmouset parut.
– Miss Ellen, dit-il, êtes-vous prête ?
– Oui ! répondit miss Ellen qui avait revêtu son costume de sœur des prisons.
XXVI
Le Wapping s’éveillait, et minuit allait sonner.
Ce quartier de Londres, que nous avons décrit si minutieusement autrefois, est un de ceux où la vie nocturne a le plus de racines.
À huit heures du soir, le passant ne rencontre plus dans les rues que de braves gens qui rentrent précipitamment chez eux pour dormir trois ou quatre heures.
Les magasins sont fermés, les public-houses déserts ; les enfants ont cessé de jouer dans les squares et ne se vautrent plus dans les ruisseaux.
À dix heures, un silence de mort règne partout, depuis les docks jusqu’à la rue Saint-George, depuis la Tour de Londres jusqu’à la Tamise.
Le Wapping est alors une véritable nécropole.
Mais tout à coup, un peu après onze heures, un murmure, vague d’abord, se fait entendre.
Une fenêtre s’ouvre ça et là.
Çà et là une lumière brille derrière les volets d’une boutique ou les persiennes d’une croisée.
Les établissements de nuit s’ouvrent un à un.
Une foule silencieuse descend dans la rue ; puis, à mesure qu’elle grossit, cette foule commence à murmurer à mi-voix d’abord, plus haut ensuite.
Est-ce une émeute qui gronde ?
Nullement, c’est le Wapping qui s’éveille, c’est la vie nocturne qui commence.
Les matelots envahissent les tavernes, et aussi les voleurs, les pickpockets et toute cette population sans aveu qui grouille dans l’East End.
Les belles de nuit accostent sans pudeur les passants ; les tables se dressent aux coins des rues, dans les carrefours, sur les places, sous le porche des temples, partout.
On soupe, on boit, on se querelle, mais à voix basse, afin de ne pas mécontenter le policeman qui se promène çà et là grave et silencieux.
– Ne dormez pas, si tel est votre bon plaisir, dit la loi anglaise, mais ne troublez pas le sommeil de votre voisin.
Elle dit aux filles de joie :
– La libre Angleterre n’admet pas le vice, elle ne l’élève pas à la hauteur d’une institution, elle ne veut pas vous connaître. En plein jour votre vue pourrait choquer les femmes honnêtes, les jeunes filles qui ont un fiancé, les mères de famille et les épouses chastes.
Mais la nuit vous ne les rencontrerez pas.
Faites donc ce que vous voudrez, pourvu que cela se passe convenablement et sans bruit.
Or donc, ce principe étant admis que la femme honnête ne circule pas la nuit dans les rues de Londres, la fille perdue est chez elle.
Elle peut rire, si son rire n’est pas trop bruyant, et tenir à ceux qu’elle rencontre les propos les plus cyniques…
Le policeman qui passe les entend et se prend à sourire.
Le policeman, du reste, est bon diable.
Toujours calme, toujours flegmatique, il ne se mêle que de ce qui le regarde et a le plus grand respect de la liberté individuelle.
Une femme honnête ne peut sortir, à pied, passé huit heures du soir, traverser les rues de Londres sans courir le risque d’être insultée.
Mais, à minuit, le risque devient certitude.
Il y avait dans Well-Close square une vingtaine de filles qui se querellaient à mi-voix, quand miss Ellen et Marmouset arrivèrent.
Mais miss Ellen avait revêtu le costume de dames des prisons, et, dès lors, elle n’avait rien à craindre.
La dame des prisons inspire un respect fanatique au peuple de Londres.
Quand on la voit passer avec une robe grise dont la cagoule lui couvre entièrement le visage, la foule s’écarte avec respect et le rire cynique de la fille de joie s’éteint.
Quelle est celle, du reste, de ces malheureuses qui n’ait un peu donné son âme et son cœur à quelque misérable comme elle, que la potence attend ?
Quelle est celle qui ne se souvient pas que durant la dernière nuit de cet homme qu’elle a aimé, une dame des prisons est venue le consoler et lui parler de la miséricorde infime de Dieu ?
Miss Ellen s’avança donc dans Weil-Close square, et le silence s’y fit tout à coup, comme par enchantement.
Les matelots cessèrent de chanter, leurs dignes compagnes de se quereller, et chacun s’écarta avec respect.
Marmouset était enveloppé dans un de ces manteaux ou plaids qu’on appelle macfarlanes, et il en avait relevé le collet, de sorte qu’on ne voyait guère que le haut de son visage.
Il conduisit miss Ellen vers le milieu du square, la fit asseoir sur un banc et s’assit auprès d’elle.
– L’abbé Samuel, dit-il, ne peut tarder à venir.
Et, en effet, comme il disait cela, une ombre qui se tenait immobile sous l’auvent d’une porte s’agita alors et se mit en marche.
Un homme s’avançait vers le banc où miss Ellen était assise.
Cependant, à deux pas de distance, il s’arrêta hésitant.
Le capuchon de miss Ellen ne lui permettait pas de reconnaître la jeune fille et il avait peur sans doute de se tromper.
Mais Marmouset fit un pas à sa rencontre.
– Êtes-vous l’abbé Samuel ? dit-il tout bas.
– Oui ; et vous êtes-vous le Français ?
– Oui, dit Marmouset à son tour, voilà celle que vous attendez.
Alors l’abbé Samuel qui était enveloppé d’un manteau couleur muraille, s’approcha de la jeune fille.
– Nous avons le temps, dit-il, attendons, miss Ellen.
– Cependant il est minuit, dit la jeune fille.
– Oui, mais le feu vert ne brille pas encore.
– De quel feu parlez-vous ?
Il étendit la main vers un coin de la place et montra le toit d’une maison.
– Tout à l’heure, dit-il, une flamme verte apparaîtra sur ce toit l’espace d’une seconde.
– Est-ce un signal ?
– Oui.
– Et nous attendons que cette flamme apparaisse ?
– Nous n’avons pas attendu longtemps, dit la jeune fille.
En effet, au même moment, une flamme verte couronna le toit, brilla quelques secondes et s’éteignit.
– Maintenant, dit l’abbé Samuel, venez, miss Ellen.
Puis, s’adressant à Marmouset :
– Quant à vous, monsieur, dit-il, où nous retrouverons-nous ?
– Ici, dit Marmouset.
– Peut-être nous ferons-nous attendre longtemps.
– Oh ! répondit Marmouset, j’ai des cigares. Et puis l’homme gris m’a donné de la besogne.
– Ah !
– Je dois aller au bal Wilson chercher des amis à lui, entre autres un matelot nommé William et une fille du nom de Betzy.
Je vous demande une heure.
– Allez, dit l’abbé Samuel.
Et marchant à côté de la sœur des prisons, il ajouta :
– Votre habit me sert d’égide, miss Ellen.
– Ah ! fit la pauvre fille.
– J’ai fait des miracles pour arriver jusqu’ici sans être arrêté. Mais à présent je ne crains plus rien. Quel est le policeman qui oserait s’approcher d’un homme qui accompagne une sœur des prisons ?
Miss Ellen prit le bras du prêtre, et ils parvinrent bientôt dans le dédale des petites rues qui avoisinent Well-Close square.
XXVII
Tandis que miss Ellen s’éloignait au bras de l’abbé Samuel, Marmouset se mettait à la recherche de William le matelot, l’homme que Betsy aimait avec fanatisme, l’hercule enfin qui s’était mesuré avec l’homme gris et avait été vaincu par lui.
William était un hôte habituel des mauvais lieux du Wapping.
On le trouvait dans la taverne du Cheval Noir, à partir de minuit, ou, avant cette heure-là, au bal Wilson. Puis, à quatre ou cinq heures du matin, Betsy et lui s’en allaient manger des huîtres et des coquillages dans la rue de la Poissonnerie, tout auprès du monument, comme les Anglais appellent la colonne commémorative du grand incendie de Londres.
Pourquoi Marmouset voulait-il trouver William ?
C’est ce que sa conversation avec lui nous apprendra.
Marmouset s’en alla donc au bal Wilson.
Il y avait à la porte deux Irlandaises en haillons et belles comme des anges, qui, voyant un homme bien mis, un gentleman, s’accrochèrent à lui aussitôt.
– Paye-nous un verre de sherry, dit l’une.
– Volontiers, dit Marmouset.
Et il entra dans le bal, flanqué des deux Irlandaises.
Puis, quand il les eut fait asseoir dans une petite salle où on servait des grogs au gin, du sherry et du porter, il leur dit :
– Est-ce que vous connaissez William ?
– Quel William ? Est-ce le William qui est l’amant de Betsy, dit l’une.
– Ou bien William le pickpocket ? dit l’autre.
– C’est l’amant de Betsy.
– Le matelot ?
– Précisément.
– Un drôle de matelot ! dit Anne Justin, la première des deux Irlandaises. Voici trois ans qu’il n’a pris la mer, et c’est Betsy qui le nourrit.
– Est-ce que tu veux lui chercher querelle, mon amour ? demanda l’autre. Aussi vrai que je m’appelle Débora, tu aurais tort.
– Oh ! fit Anne Justin, on ne peut pas savoir, ma chère.
– Oh ! dit Débora, monsieur est gentleman et il a les mains trop fines pour lutter avec William.
– Te souviens-tu du Français ?
– Quel Français ? dit Marmouset, qui prit un air naïf.
Anne Justin reprit :
– Figure-toi, mon petit, que, voici sept ou huit mois, William était à la taverne du Black-Horse.
– Bon ! dit Marmouset.
– Betsy lui avait cherché querelle et il était de mauvaise humeur.
Il se mit à provoquer tout le monde selon son habitude, et personne d’abord ne lui répondit, car William assommait un bœuf d’un coup de poing.
– Ah ! vraiment ?
– Mais il y avait dans un coin un Français, qui ne soufflait mot, et qu’on appelait l’homme gris, à cause de son habit.
– Drôle de nom ! dit flegmativement Marmouset.
– C’était un homme dans ton genre, poursuivit Anne Justin, ni grand, ni petit, avec une jolie figure un peu pâle et de beaux yeux gris qui vous brûlaient quand ils se fixaient sur vous.
– Et qu’arriva-t-il alors ?
– Le Français se leva et dit à William : Je suis ton homme.
– Ah ! ah !
William se mit à rire.
– Alors je vais t’écraser entre deux doigts, dit-il.
Mais le Français le prit par le milieu du corps, l’enleva comme il eût fait d’une plume et le terrassa en dix secondes.
Jamais personne, avant lui, n’avait tombé William.
– Et personne ne l’a tombé depuis, dit Débora. Aussi crois-moi, gentleman, ne tente pas l’aventure.
– Mais, dit Marmouset, je ne veux pas me battre avec lui.
– Que lui veux-tu donc ?
– J’ai à lui parler de la part d’un de ses amis.
– Ah ! c’est différent.
– Savez-vous où il est ?
– S’il n’est pas ici, certainement tu le trouveras au Black-Horse.
– Tiens ! le voilà, dit Débora.
En effet, un homme entrait en ce moment.
Marmouset le regarda avec curiosité.
William était un homme trapu, au cou de taureau, aux épaules herculéennes, aux bras couverts d’un duvet rouge, rugueux et fourni comme le poil d’un singe.
Sa figure était bestiale, mais il avait l’œil intelligent, et ses grosses lèvres indiquaient une franchise brutale et une certaine loyauté.
– Qui parle de moi ? dit-il en entrant et regardant les deux Irlandaises.
– Moi, dit Marmouset.
William le regarda.
Par extraordinaire le matelot n’était pas encore gris.
– Qui es-tu, toi ? dit-il.
– Tu ne me connais pas, dit Marmouset, mais je viens te voir de la part d’un homme que tu connais.
– Et qui se nomme ?
Marmouset se leva, approcha ses lèvres de l’oreille de William et dit tout bas :
– L’homme gris.
William eut un geste de surprise.
– Sortons d’ici, lui dit Marmouset.
Et il donna deux shillings aux Irlandaises en leur disant adieu.
Puis il prit William et l’entraîna hors du bal Wilson.
– Ah ! disait le matelot, tu viens de la part de l’homme gris, gentleman ?
– Oui, mon cher.
– Un rude homme, l’homme gris, le seul qui m’ait jamais tombé.
– Et tu ne lui as pas gardé rancune ?
– Ah ! mais non ; c’est même, entre nous, à la vie, à la mort.
– Vrai ?
– Et si jamais il a besoin de moi…
– Il a besoin de toi, William, et c’est pour cela qu’il m’envoie te trouver.
– Eh bien ! parle, dit William, et s’il faut assommer quelqu’un pour lui faire plaisir…
– Non.
– Que faut-il donc faire ?
– L’homme gris est à Newgate.
– Ah ! diable !
– Et il te prie de faire ce que je te demanderai, comme si c’était lui qui te le demandât.
– Mais que veux-tu donc que je fasse ?
– Viens luncher avec moi demain, je te le dirai.
– Et où cela ?
– Dans Old Bailey, chez un épicier qui me loge.
– Master Love ?
– Non, son successeur.
– J’irai, dit William.
Marmouset tira sa montre.
Il y avait déjà près d’une heure qu’il avait quitté miss Ellen.
– Excuse-moi, dit-il, on m’attend.
Et il quitta William pour retourner dans Well-Close square.
XXVIII
Donc miss Ellen et l’abbé Samuel, quittant Well-Close square s’étaient enfoncés dans le dédale de petites rues qui l’avoisinent.
Ils traversèrent ainsi Saint-George street, arrivèrent dans Pannington street, et là, l’abbé Samuel s’arrêta.
Miss Ellen vit alors devant elle une maison haute de quatre étages, qui n’avait que deux fenêtres sur la façade et paraissait habitée par des ouvriers et le monde le plus chétif.
Du linge et des loques pendant aux fenêtres, suspendues sur des cordes.
À travers les vitres de papier huilé brûlaient des lampes fumeuses.
Une petite porte bâtarde, la seule qui donnât accès dans cette maison, s’ouvrit quand l’abbé Samuel eut appuyé son doigt sur une virole de cuivre.
Miss Ellen se trouva alors au seuil d’une allée noire, d’où s’échappait un air froid.
Mais la patricienne ne recula point.
Pour sauver l’homme gris, elle eût pénétré dans le plus infect des bouges, elle eût bu des verres de gin avec des filles perdues.
– Venez, miss Ellen, reprit l’abbé Samuel, et marchez sans crainte.
– Je ne crains rien, répondit-elle.
Au fond de l’allée, il y avait une autre porte.
L’abbé Samuel frappa deux coups précipités, puis un troisième plus lentement, espacé.
Alors, cette porte s’ouvrit.
Une faible clarté frappa miss Ellen au visage.
Elle se voyait à l’entrée d’une cave dans laquelle on descendait par quelques marches usées, et qu’éclairait une lampe suspendue à la voûte.
L’abbé Samuel descendit le premier.
Au bas de l’escalier, qui avait dix-sept marches, on trouvait un second couloir pareillement éclairé.
Au bout de ce couloir, on apercevait une troisième porte, et, derrière cette porte, on entendait des voix confuses.
Alors, l’abbé Samuel dit à miss Ellen :
– Les fénians sont là.
– Bien, dit la jeune fille.
– Et vous pensez qu’ils ne vous attendent pas ?
– Ah !
– Il faut donc que je vous précède et que vous restiez ici.
L’abbé Samuel laissa donc miss Ellen dans le couloir et frappa sur la troisième porte.
Une voix dit au travers :
– Qui es-tu, toi qui viens à cette heure ?
– Un frère, répondit l’abbé Samuel.
– Entre, en ce cas.
Et la porte s’ouvrit.
Cette porte donnait sur une petite salle souterraine qui n’était autre, du reste, qu’une cave.
Il y avait au milieu une table et, assis sur des bancs, autour de cette table, une douzaine d’hommes qui se levèrent avec respect en reconnaissant l’abbé Samuel.
C’étaient les principaux chefs fénians.
L’un d’eux vint au-devant du jeune prêtre et lui dit :
– Mon père, vous nous avez convoqués, et nous sommes venus.
– Je vous ai convoqués pour vous parler de notre mère l’Irlande et de ceux qui l’ont servie fidèlement.
L’abbé Samuel fit un signe et tout le monde se rassit.
Lui seul demeura debout.
– Mes frères, reprit-il, il est un homme qui a voué sa vie et son sang à l’Irlande.
– Comme nous tous ! dirent plusieurs voix.
– Mais vous êtes des Irlandais, vous !
– Et cet homme dont vous parlez ?…
– Il est Français.
Les fénians froncèrent le sourcil ; l’abbé Samuel entendit même de légers murmures.
– Ah ! dit un des chefs, est-ce que vous venez encore nous parler de l’homme gris ?
– Oui, mes frères.
– L’homme gris n’est pas Irlandais.
– Mais a plus fait pour l’Irlande que beaucoup d’entre nous.
– Oh ! fit un sceptique, qu’a-t-il donc tant fait ?
– Il a sauvé John Colden.
– Et puis ?
– Il a sauvé celui que nous considérons comme notre chef futur.
– Mais il s’est laissé prendre à un piège grossier, ricana un des fénians.
– Vous vous trompez, mes frères.
– Enfin, est-il à Newgate, oui ou non ?
– Il y est.
– Vous voyez bien, alors !
– Mais il y est volontairement.
– Ah ! ah ! ricanèrent les fénians.
– Et c’est par dévouement pour vous et pour conquérir à votre cause notre plus mortelle ennemie qu’il s’est fait arrêter.
L’abbé Samuel partait avec un accent de conviction profonde qui finit par impressionner l’auditoire.
– Vous connaissez tous l’origine de cet enfant qui nous commandera un jour, poursuivit le jeune prêtre.
– Oui, oui.
– C’est le neveu de lord Palmure.
– Notre ennemi implacable, dit un des chefs.
– Oh ! fit un autre, moins implacable et moins terrible que sa fille miss Ellen.
– J’attendais cet aveu pour m’expliquer, dit froidement l’abbé Samuel.
Et comme on le regardait avec étonnement :
– Miss Ellen Palmure, dit-il, n’est plus l’ennemie de l’Irlande.
– Que dites-vous, mon père ?
– Miss Ellen est la fille respectueuse et dévouée de notre chère patrie.
– C’est impossible.
– Vous savez qui je suis, reprit le jeune prêtre et nul parmi vous n’oserait affirmer que j’aie jamais menti.
– Certes non, mon père.
– Eh bien ! au nom de notre mère l’Irlande, je vous jure que miss Ellen est avec nous.
Et, parlant ainsi, l’abbé Samuel rouvrit la porte et dit :
– Venez, miss Ellen, venez confirmer à ces hommes mes paroles.
Miss Ellen entra.
Elle portait haut la tête recouverte du capuchon de laine grise.
Un murmure d’étonnement courut parmi les fénians.
– Dites à ces hommes que je leur ai dit la vérité, miss Ellen, continua l’abbé Samuel.
Alors miss Ellen rejeta son capuchon en arrière, et tous la reconnurent.
– Quelle est belle ! murmurèrent plusieurs d’entre eux.
Miss Ellen était pâle, mais la résolution brillait dans ses yeux.
– Mes amis, dit-elle, j’ai poursuivi mes frères, j’ai été leur ennemie acharnée, mortelle. Un homme m’a convertie à votre foi, et cet homme va payer ma conversion de sa vie. Ne le sauverez-vous donc pas ?
Et alors miss Ellen raconta à ces hommes, muets de surprise et pénétrés de respect, sa longue lutte avec l’homme gris, – lutte dans laquelle elle avait été vaincue et elle s’écria :
– Je l’aime ! je l’aime ! et je vous supplie à mains jointes de me venir en aide.
Elle parlait avec des larmes dans la voix, avec des éclairs dans les yeux, avec une éloquence fougueuse et sauvage qui finit par enthousiasmer tous ces hommes.
Et l’un d’eux vint à elle et lui prit les mains.
– Miss Ellen, dit-il, au nom de notre mère l’Irlande, je te jure que nous le sauverons !
– Nous le jurons ! répétèrent les autres fénians, dussions-nous prendre Newgate d’assaut.
– J’ai foi en vous ! dit miss Ellen.
Et elle s’agenouilla devant l’abbé Samuel et lui dit :
– Mon père ! au nom de l’Irlande, pardonnez-moi.
– Ma fille, répondit gravement le prêtre, au nom de notre patrie, au nom de nos frères, je vous pardonne.
XXIX
Le lendemain matin, la boutique de denrées coloniales vendue à Marmouset la veille par master Love, lequel était parti sur-le-champ, son argent en poche, pour aller planter ses choux dans son cottage de Greenwich, cette boutique, disons-nous, s’ouvrit comme à l’ordinaire, vers neuf heures du matin.
Le brouillard faisait relâche, et il y avait même dans le ciel gris comme une pâle clarté qu’on pouvait prendre pour la photographie d’un rayon de soleil.
Des ouvriers avaient travaillé la nuit à repeindre la devanture.
Quand les habitants d’Old Bailey s’éveillèrent, car le Londonien n’est pas matinal, ils virent la boutique extra-flambante, un gros homme en habit noir avec un tablier blanc sur le ventre, majestueusement appuyé contre la porte, et en dedans trois commis et une jolie dame de comptoir.
La dame de comptoir mettait les écritures en ordre, les trois commis allaient et venaient, et le maître épicier, Milon, ne bougeait pas plus qu’une de ces statues qui décorent tous les coins de la cathédrale de Saint-Paul.
À Paris, il y eût eu rassemblement devant la porte et, pendant une heure, tous les habitants du quartier eussent défilé devant la boutique, examiné les commis, lorgné la jolie dame de comptoir.
À Londres, on ne se dérange pas pour si peu.
C’est à peine si le marchand de poissons et le publicain qui étaient les plus proches voisins de l’épicier, échangèrent ces quelques mots :
– Voisin, il paraît que master Love a vendu.
– Oui, voisin.
– Et que l’acquéreur a pris possession.
– Comme vous voyez.
Et le poissonnier avait étalé ses langoustes et ses saumons, tandis que le publicain rangeait ses pots d’étain sur un comptoir de même métal.
Milon, toujours sur sa porte, ne bougeait.
Il avait les yeux tournés du côté de Kent street et paraissait attendre quelqu’un.
Enfin un cab monta rapidement Old Bailey et vint s’arrêter devant la boutique.
Milon parut tout joyeux.
Un homme descendit du cab et entra.
C’était Marmouset.
Marmouset s’était tout à fait anglaisé depuis sa sortie de prison.
Il portait un de ces costumes de fantaisie, jaquette, gilet, pantalon et guêtres de même étoffe que les Londoniens appellent une suite et par-dessus un macfarlane.
Son chapeau à bords étroits et haut de forme était tout à fait britannique.
Il avait, en outre, coupé ses moustaches et gardé ses favoris.
Et comme il parlait un anglais fort pur, personne n’aurait pu dire que ce gentilhomme n’était pas un enfant des Trois-Royaumes.
Donc Marmouset entra, après avoir payé le cabman et renvoyé le cab.
Et comme il n’y avait pas d’étrangers dans la boutique, il dit en français :
– Bonjour, mes enfants !
– Ah ! dit Milon, je vous attendais avec impatience.
– Et tu m’as attendu toute la nuit ?
– Cela est vrai.
– Ce qui ne t’a pas empêché de travailler, je le vois.
– Non, mais je commençais à être inquiet.
– À mon sujet ?
– Je ne savais pas ce qui s’était passé hier là-bas.
– Je vais te le dire : ils ont promis de le sauver.
– Ah ! dit Milon joyeux.
– Et j’ai rendez-vous ici avec un des chefs.
– À quelle heure ?
– Mais… dans la matinée…
Comme Marmouset disait cela, un homme entra dans la boutique.
C’était un pauvre diable tout déguenillé et qui demanda un hareng, tout en posant un penny sur le comptoir.
Milon fit un signe, et la Mort des braves, un de ses commis, se mit en devoir de servir ce premier chaland, qui paraissait être un Irlandais.
Alors celui-ci regarda Marmouset.
Marmouset tressaillit et fit un pas vers lui.
– Miss Ellen ! dit cet homme.
– L’homme gris, répondit Marmouset.
– C’est bien moi que vous attendez, dit l’homme au hareng.
Et il se dirigea vers un coin de la boutique, afin de pouvoir parler librement.
Marmouset le suivit.
L’Irlandais lui dit alors :
– Je suis envoyé par les chefs fénians.
– Fort bien, dit Marmouset.
– Après le départ de miss Ellen, nous avons tenu conseil, et il a été décidé que nous sauverions l’homme gris.
– Comment ?
– Voilà ce que nous me pouvons vous dire.
– Ah !
– Pour deux raisons.
Marmouset attendit.
– La première, dit le chef fénian, c’est que nous n’avons pas encore définitivement arrêté notre plan.
– C’est différent.
– La seconde, c’est que ni vous ni ceux que vous avez amenés avec vous ne sont fénians.
– Qu’importe ? dit Marmouset.
– Cela importe beaucoup, dit l’Irlandais. Les statuts secrets du fénianisme nous défendent d’employer comme instruments ou comme associés des gens qui n’ont pas le même but politique que nous.
– Mais l’homme gris ?
– Il est fénian.
– Mais nous sommes ses amis ?
– Eh bien ! dit froidement l’Irlandais, nous aurons la plaisir de vous le rendre.
Et sur ces mots, il sortit.
Marmouset fronça le sourcil.
Milon s’approcha de lui :
– Eh bien ! demanda-t-il, que vous a-t-il dit ?
– Ils veulent sauver le maître.
– Bon !
– Mais ils veulent le sauver sans nous.
– Ah ! mais non, dit Milon. Nous ne sommes pas venus à Londres pour rien.
– Certainement, dit Marmouset. Aussi…
– Aussi ? dit Milon.
– Nous allons, de notre côté faire notre petit travail.
– Mais, dame !
– Seulement, il ne faut pas perdre de temps.
– Ah ! dit Milon en serrant ses poings énormes, ils m’embêtent tous ces fénians !
– Et moi, donc ! fit Marmouset.
– Et je voudrais bien qu’ils arrivassent après nous, continua Milon.
– À l’œuvre donc ! reprit Marmouset.
– Comment, nous allons commencer en plein jour ?
– Non, mais nous allons faire un petit tour dans les caves de la maison.
– Ah !
– Et rechercher l’entrée des souterrains.
– Ça va, dit Milon.
Il alluma une chandelle posée sur une large palette de fer, en même temps que Marmouset tirait de sa poche le fameux plan de Londres qu’il avait acheté cent cinquante livres chez M. Simouns, le libraire de la rue Pater-Noster.
Puis Milon poussa une porte au fond de la boutique, et Marmouset le suivit.
XXX
Marmouset avait, la veille, donné des instructions minutieuses à Milon sur ce qu’il avait à faire en son absence. Milon avait acheté des bêches, des tarières, des ciseaux à tailler la pierre, puis il avait fait mettre ces outils dans une caisse et les avait apportés dans la boutique.
Marmouset les trouva au bas de l’escalier de la cave. Master Love, qui avait habité la maison pendant près de quinze ans, n’avait jamais eu connaissance ni du plan de Londres au dix-septième siècle, ni de la conspiration des poudres.
La cave de la maison ressemblait à toutes les autres et elle était encombrée de futailles vides ou pleines et de différentes marchandises.
– Voyons, dit Marmouset, orientons-nous un peu à présent.
Milon posa la lampe sur un tonneau renversé et Marmouset étala son plan.
Puis il chercha l’emplacement de la maison où ils étaient et mit le doigt sur un filet rouge qui était bien celui, à croire le plan, qui partait de la cave.
Alors il prit la chandelle et se mit à faire le tour de la cave.
Elle n’avait qu’une porte, celle par laquelle Milon et lui étaient entrés.
– Je ne vois rien, dit Milon.
– Parce que l’entrée du souterrain indiqué a été murée, dit Marmouset.
Et il donna la chandelle au colosse.
Puis il prit un marteau, et se mit à frapper de petits coups sur le mur, de distance en distance.
Partout le mur était plein et rendait un son mat.
Il était revêtu, du reste, d’un enduit noirâtre qui tombait en lambeaux humides.
Marmouset changea d’outil.
Il quitta le marteau pour prendre une espèce de racloire avec laquelle il se mit à gratter le mur.
Tout à coup la racloire grinça comme si elle eût rencontré un corps métallique.
Milon approcha une chandelle.
Il y avait un clou planté dans la maçonnerie, et c’était sur ce clou que la racloire avait porté.
Marmouset quitta la racloire et reprit le marteau.
Puis il se mit à frapper sur un clou.
Le clou s’ébranla, et une brique du mur tomba avec lui.
Alors apparut une cavité, dans laquelle Marmouset put passer la main.
Le bras suivit la main jusqu’à l’épaule.
Mais la main ne trouva que le vide.
– Vite ! s’écria Marmouset, prends ta pioche, et à l’œuvre.
Et, retirant sa main, il s’empara du marteau dont il se servait tout à l’heure.
Le mur ainsi vigoureusement attaqué, les briques se détachèrent tour à tour et bientôt un trou béant apparut aux yeux des deux travailleurs.
Un trou assez grand pour laisser passer le corps d’un homme.
– Donne-moi ta chandelle, dit encore Marmouset.
Et la chandelle d’une main, le marteau de l’autre, il se lança en avant.
Mais il n’alla pas loin.
Le mur dans lequel il avait fait brèche séparait la cave d’un second caveau plus étroit, plus bas de voûte et qui paraissait sans issue.
– Nous ne sommes pas plus avancés, dit Milon qui avait suivi Marmouset.
– Nous verrons bien, répondit celui-ci.
Et il recommença avec son marteau l’expérience qu’il avait tentée sur les murs de la première cave.
Les murs sonnèrent plein tout d’abord : puis, à un certain endroit, ils résonnèrent comme un tambour.
– C’est là, dit Marmouset.
Et il regarda Milon d’un air de triomphe.
Milon attaqua le mur avec sa pioche.
Le plâtre qui servait d’enduit se détacha et tomba par lambeau, et la pioche rendit de nouveau un son métallique.
Le mur cachait une porte de fer, et les efforts de Milon se brisèrent contre cette porte.
– J’en étais bien sûr, dit Marmouset, qui reprit sa racloire.
En quelques minutes il eut mis la porte de fer à découvert.
Cette porte, haute d’un mètre trente ou quarante millimètres, n’avait ni serrure ni gonds apparents.
Et comme Milon s’escrimait dessus avec la pioche et frappait en pure perte, Marmouset l’arrêta.
– N’allons pas plus loin pour le moment, dit-il ; au son qu’elle rend, je devine quelle a six pouces d’épaisseur. Mais nous l’avons trouvée, c’est l’essentiel.
– Et vous croyez que c’est la porte du souterrain ?
– Parbleu !
– Alors qu’allons-nous faire ?
– Rien pour le moment. Nous verrons ce soir. Viens !
Et Marmouset battit en retraite le premier, ajoutant :
– Je suis sûr maintenant d’une chose. Les souterrains ne sont pas comblés.
– Ah ! dit Milon.
– Et nous sauverons Rocambole, avant même que les fénians se soient mis à l’œuvre.
Et tous deux repassèrent dans la première cave.
XXXI
Traversons maintenant la petite place si irrégulière de Old Bailey et entrons dans Newgate.
Sir Robert M…, le bon et jovial gouverneur, ne riait plus depuis la veille.
Sir Robert M… était un homme anéanti.
Après le départ de Marmouset et du premier secrétaire de l’ambassade de France, il avait été tellement ému, que, un moment, sa femme et ses deux filles avaient craint pour sa raison.
C’est que la loi anglaise ne couvre pas d’inviolabilité les fonctionnaires qui se trompent.
Le policeman qui arrête un citoyen paisible et le prend pour un malfaiteur s’expose à des dommages-intérêts considérables.
À plus forte raison le gouverneur d’une prison, qui se méprend aussi grossièrement que s’était mépris ce pauvre sir Robert M…
Marmouset était capable de lui demander un million d’indemnité, et ce qu’il y avait d’épouvantable, c’est que la justice accueillerait cette prétention, au moins en partie, et sir Robert M…, en songeant à cela, sentait ses cheveux se hérisser, et il se voyait complètement ruiné et forcé peut-être d’abandonner sa position de gouverneur.
Le soir de ce jour néfaste, il s’était mis à pleurer comme un enfant.
La nuit avait été sans sommeil pour lui.
Dès le matin, chaque coup de cloche annonçant que quelqu’un voulait pénétrer dans Newgate bouleversait le pauvre homme à ce point qu’il croyait voir entrer un solicitor muni d’une requête, et lui venant donner assignation à comparaître devant le tribunal, au nom du gentleman injustement emprisonné.
La matinée s’était pourtant écoulée et sir Robert n’avait rien vu venir.
Alors il avait eu une idée insensée.
Il s’en était allé voir l’homme gris et lui avait dit :
– J’étais plein de bonté pour vous, gentleman, et vous m’en avez récompensé par la plus noire ingratitude.
À quoi l’homme gris, c’est-à-dire Rocambole, s’était mis à rire.
– Gentleman, poursuivit sir Robert M… avec cette langue infernale que vous parliez, vous avez encouragé mon erreur.
– Mylord, répondit Rocambole, je vous ai pourtant bien prévenu que je ne connaissais pas ce gentleman.
– C’est vrai, et je n’ai pas voulu vous croire, mon Dieu ! soupira sir Robert M…
– Ah ! dame ! poursuivit Rocambole, ma situation n’est pas très belle, j’en conviens, mais je ne voudrais pas être à votre place non plus.
– Croyez-vous donc que ce gentleman donnera suite à ses menaces ?
– J’en suis sûr.
– Seigneur Dieu !
– Et vous êtes un homme ruiné par avance.
Sir Robert M… avait des larmes dans les yeux.
– Cependant, reprit Rocambole, je vais vous donner un conseil.
– Parlez, parlez vite.
– Le gentilhomme est fort riche…
– Raison de plus pour qu’il ne cherche pas à me ruiner.
– Il est excentrique.
– Ah !
– Je suis persuadé qu’avant de vous actionner en justice, il vous viendra voir.
– Eh bien ?
– Et qu’il vous demandera quelque chose d’extraordinaire.
– Mais quoi donc ?
– Je n’en sais rien ; mais c’est ma conviction.
– Et alors ?
– Alors, faites ce qu’il vous demandera, vous le désarmerez peut-être…
– Ah ! dit sir Robert, vous croyez ?
– Dans votre position, mylord, il faut essayer de tout, répondit flegmatiquement Rocambole.
Sir Robert M… poussa un profond soupir.
– Je vous remercie, dit-il, et même je vous demande pardon des paroles qui me sont échappées tout à l’heure.
Puis il fit un pas de retraite, et se retournant :
– Vous n’avez besoin de rien, gentleman ?
– Pardon, fit Rocambole en souriant.
– Parlez.
– Vous avez oublié sans doute, mylord, de m’envoyer des journaux ce matin.
– Ah ! c’est juste.
– Et s’il vous plaisait de me faire donner le Times ou l’Evening Star…
– Je vais vous les envoyer tous les deux.
– Ensuite, Mylord, dit encore Rocambole, je désirerais vous faire une question.
– Je vous écoute.
– Quand me juge-t-on ?
– Je l’ignore.
– Mais enfin, on me jugera ?
– Oui, aussitôt qu’on sera fixé sur votre identité et votre vrai nom.
Rocambole éclata de rire :
– Alors, dit-il, je crois que je serai longtemps le protégé de Votre Honneur.
Sir Robert M… s’en alla un peu réconforté par les paroles de son prisonnier.
Il entra dans son appartement et demanda si personne n’était venu !
– Personne ! lui répondit-on.
Sir Robert M… respira et manifesta même l’intention de déjeuner.
Nous l’avons dit précédemment, le logement du gouverneur, à Newgate, est situé sur la rue Old Bailey.
C’est une maison dans une maison, c’est-à-dire qu’il y a entre le greffe, qui fait partie de ses appartements, et la prison proprement dite une muraille épaisse dans laquelle s’ouvre une porte de fer basse et garnie de barreaux énormes.
Le gouverneur peut entrer et sortir à toute heure sans avoir à franchir cette porte, et il peut recevoir chez lui autant de visiteurs qu’il lui plaît.
Il a même une entrée particulière qui se trouve entre les deux fameuses portes que le peuple de Londres a surnommées l’entrée et la sortie.
Le prisonnier pénètre dans la prison par l’une, et quand il en sort par l’autre, c’est pour trouver de plain-pied la plate-forme de la potence.
Sir Robert M… se mit donc à table.
Mais il avait à peine la bouche pleine qu’un coup de sonnette, retentissant à la porte du milieu, le fit tressaillir.
Il cessa de manger et regarda sa femme et ses filles avec épouvante.
Une seconde après, un domestique lui apporta une carte sur un plateau.
Sir Robert M… prit cette carte, y jeta les yeux et pâlit ; il avait lu :
FÉLIX PEYTAVIN
gentleman français
Strand, hôtel des Trois-Couronnes,
Et le domestique lui dit :
– Ce gentleman insiste beaucoup pour voir Votre Honneur.
– Ah ! mes enfants ! soupira sir Robert M… en regardant ses filles les yeux pleins de larmes, c’est peut-être la ruine qui entre sous notre toit.
XXXII
Marmouset entra.
Il avait aux lèvres une sorte de sourire qui n’annonçait rien de bon.
On vient facilement à bout d’un homme irrité, mais un homme calme et parfaitement maître de lui, c’est une autre affaire.
Sir Robert M…, rouge comme un coquelicot et la sueur au front, lui offrit un siège.
Puis, espérant l’attendrir, il lui présenta mistress Robert, sa femme, et ses deux filles, Lucy et Mary.
– Mon cher monsieur, dit Marmouset, vous avez sans nul doute deviné le motif de ma visite.
– Mais, dit sir Robert, je ne sais pas… je suppose… enfin… parlez, gentleman.
– Cher monsieur, poursuivit Marmouset, je viens de chez le solicitor Staggs, lequel, vous le savez, est le plus habile solicitor de Londres.
À ce nom, sir Robert M… se prit à frissonner.
M. Staggs était bien connu à Londres.
C’était le plus charmant des gens de loi, le plus habile, le plus retors, le plus tenace.
Quand M. Staggs tenait un homme, c’était un homme perdu.
Sa fortune, sa considération y passaient.
« Dieu vous garde d’être jamais traîné en justice par Staggs ! » disait le peuple de Londres.
Sir Robert M… se sentit défaillir.
– J’ai confié mon affaire à M. Staggs, dit Marmouset, il la trouve excellente.
Sir Robert M…, plus mort que vif, épongeait la sueur qui coulait de son front.
Quant à sa femme et à ses deux filles, elles s’étaient retirées dans l’embrasure d’une fenêtre et y pleuraient silencieusement, depuis qu’elles avaient entendu ce terrible nom de Staggs.
Marmouset poursuivit :
– M. Staggs trouve donc mon affaire excellente. Il est d’avis de vous traduire, non pas devant le jury, qui se bornerait à m’accorder une grosse indemnité…
– Que veut-il donc faire ? demanda sir Robert éperdu.
– Il veut vous traduire devant le banc de la reine.
– Juste ciel !
Et sir Robert M… joignit les mains et leva les yeux au ciel.
– M. Staggs prétend – et vous m’accorderez qu’il s’y connaît – que le banc de la reine, non seulement vous condamnera à vingt-cinq ou trente mille livres sterling d’indemnité, mais encore qu’il prononcera votre destitution de gouverneur de Newgate.
Cette fois sir Robert M… oublia toute dignité. Il tomba aux genoux de Marmouset.
– Monsieur, lui dit-il, je sais que je vous ai gravement offensé et que votre colère est juste ; mais si vous n’avez pitié de moi, prenez au moins pitié de ma pauvre femme et de mes malheureux enfants.
– Hélas ! monsieur, dit Marmouset, je ne suis point aussi féroce que M. Staggs, mais cependant vous avouerez qu’il est fort dur pour un galant homme, pour un parfait gentleman qui vient à Londres par pure fantaisie, d’être arrêté, emprisonné, jeté dans un cachot, maltraité par des guichetiers ignorants.
– Tout ce que vous dites là est vrai, murmura sir Robert, qui versait des larmes de crocodile.
– Et vous conviendrez que j’ai droit à une réparation ?
– Oh ! certainement, pleura sir Robert.
– Vous pensez bien que je vous suis venu voir sans en parler à M. Staggs.
– Ah ! vous avez bien fait, monsieur. C’est un homme sans entrailles, ce Staggs. Il vous en eût empêché.
– Cela est certain.
– Et je n’aurais pas pu vous montrer ma pauvre femme et mes malheureux enfants, continua sir Robert, qui espérait toujours attendrir Marmouset.
– Mais enfin, cher monsieur, dit celui-ci, vous conviendrez que j’ai droit à une réparation ?
– Oh ! certainement.
– Et je ne demande pas mieux que de m’arranger à l’amiable.
Sir Robert respira plus librement.
– Voyons, continua Marmouset, quelle est la réparation que vous m’offrez ?
Sir Robert soupira ; mais il parut faire un violent, un suprême et douloureux effort.
– Je ne suis pas riche, dit-il.
– Mais enfin ?…
– Et si je vous donne cinq mille livres, c’est tout ce que je possède. Vous emporterez la dot de ma pauvre fille, monsieur.
Marmouset se mit à rire.
– Mais cinq mille livres sterling, dit-il, c’est cent vingt-cinq mille francs ?
– Oui, monsieur.
– Écrivez à Paris et demandez le chiffre de ma fortune, on vous dira que j’ai trois cent mille livres de rente.
– Oh ! monsieur, dit alors mistress Robert, qui intervint et joignit les mains, vous êtes très riche et vous voulez ruiner des malheureux comme nous ?
– Il le faudra bien, madame ! répondit Marmouset, si l’honorable sir Robert ne veut pas m’offrir la réparation que je lui demande.
– Mais je vous offre toute ma fortune, monsieur, dit sir Robert avec un sanglot.
– Et, dit Marmouset, si je voulais une réparation morale ?
Sir Robert jeta un cri.
– Ah ! monsieur, dit-il, je savais bien qu’un parfait gentleman comme vous ne devait pas être âpre à l’argent comme un homme de loi.
– Cela dépend.
– Dites, monsieur, poursuivis sir Robert, que désirez-vous ? parlez… voulez-vous que je vous écrive une lettre d’excuse dans le Times ?
– Non.
– Que je vous fasse des excuses publiquement devant tout le personnel de la prison ?
– Non, dit encore Marmouset.
– Qu’exigez-vous donc, mon Dieu ? exclama sir Robert, qui fut pris d’une épouvante nouvelle.
– Monsieur, dit Marmouset, je ne suis pas Anglais, mais je suis excentrique.
– Ah !
– Et j’ai la plus singulière des fantaisies.
– Parlez, monsieur, parlez !
– Depuis qu’on est venu m’arrêter dans mon hôtel des Trois-Couronnes, je ne me trouve plus en sûreté dans Londres.
– Oh ! monsieur.
– Ma femme, car j’ai une femme, monsieur, a les mêmes terreurs que moi.
– Voulez-vous que je demande pour vous une escorte de policemen ?
– Non, dit Marmouset. Je veux une chose bien plus simple.
– Ah ! vraiment !
– Je veux que vous nous preniez en pension, ma femme et moi.
– Ici ?
– Sans doute.
Sir Robert M… recula stupéfait.
– Oh ! acheva Marmouset, ma femme est une femme du meilleur monde ; elle est bonne musicienne et je suis persuadé que ces demoiselles seront enchantées de l’avoir pour compagne pendant huit jours.
– Mais elle s’ennuiera horriblement ici ! monsieur. Nous sommes dans une prison ! observa mistress Robert.
– Il lui sera loisible de sortir pendant le jour, je suppose ?
– Oh ! certainement.
– Elle n’a peur que la nuit.
Sir Robert et sa femme se regardaient comme des gens qui ont couru un immense danger et s’aperçoivent qu’ils en sont quittes pour la peur.
– Mais avec le plus grand plaisir ! s’écria sir Robert M…
Le front de Marmouset s’éclaira.
XXXIII
Sir Robert M… poursuivit :
– Nous sommes fort grandement logés. Outre le parloir où nous sommes, ma chambre, celle de ma femme et les chambres de ces demoiselles, il y a encore un petit salon et deux chambres que nous n’occupons pas.
– Et qui sont très confortables, dit mistress Robert.
– Nous nous en arrangerons, dit Marmouset ; au reste, ce n’est que pour six ou huit jours, car nous allons bientôt rentrer en France.
– Si vous le voulez, continua sir Robert M…, heureux d’en être quitte à si bon marché, nous adopterons les heures françaises pour les repas.
– Non ! non ! dit Marmouset, ma femme et moi nous adorons la vie anglaise. Mais, mon cher monsieur, là ne se borneront pas mes exigences.
– Ah ! mon Dieu !
Et sir Robert sentit de nouveau perler à son front quelques gouttes de sueur.
– Je vous l’ai dit, je suis excentrique.
Le bon gouverneur, qui ne riait plus depuis deux jours, regarda Marmouset.
– J’ai une passion, dit Marmouset.
Les jeunes misses baissèrent les yeux et mistress Robert parut fort inquiète à son tour.
– J’adore les échecs, et il me faut un partenaire chaque soir.
– Ah ! dit sir Robert, si ce n’est que cela, je suis de première force à ce jeu, et je serai votre partenaire tous les soirs.
– Non, dit Marmouset, ce n’est pas ce que je veux.
– Mais qu’est-ce donc ?
– J’ai passé ma jeunesse aux Indes, dit Marmouset.
– Bon !
– Aux Indes, on joue une partie très curieuse que les bonzes et les brahmines ont inventée.
– Je ne la connais pas, murmura sir Robert en soupirant.
– Mais vous avez parmi vos prisonniers un homme qui a pareillement vécu aux Indes !
– Ah !
– Et qui se dit de première force à ce jeu !
– Et… cet homme ?
– C’est le prisonnier avec lequel vous m’avez enfermé.
– L’homme gris !
– Oui, Votre Honneur.
– Mais, monsieur…
– C’est un parfait gentleman, dit Marmouset.
– Assurément.
– Et qui se montrera plein de retenue et de courtoisie devant ces dames.
– Comment ! exclama sir Robert M…, vous voulez que je le fasse venir ici ?
– Tous les soirs, pour faire ma partie.
– Mais les règlements…
– Ah ! pardon, dit Marmouset, vous pensez bien que si nous invoquons les règlements, je vais vous parler de M. Staggs.
Sir Robert frissonna.
– Il vous est loisible, poursuivit Marmouset, d’établir à la porte une escouade de policemen.
– Oh ! dit sir Robert, que le prisonnier soit ici ou dans son cachot, peu importe, je ne crains pas qu’il s’évade.
– À présent, dit Marmouset en se levant, vous savez à quelles conditions je consentirai à ne pas vous actionner devant le banc de la reine ?
Sir Robert et sa femme échangèrent un nouveau regard, et ce regard voulait dire :
– Après tout, mieux vaut encore enfreindre les règlements et s’exposer à une réprimande du lord chief-justice que de perdre notre fortune et notre position.
Et sir Robert dit à Marmouset :
– Monsieur, vos désirs seront accomplis. Le prisonnier viendra faire votre partie.
– Fort bien.
Et Marmouset ajouta :
– Je ne vous prendrai pas en traître, monsieur. D’ici à huit jours, je ne reverrai pas M. Staggs, et je vais même lui écrire un mot pour lui annoncer que je m’absente momentanément et le prier d’attendre mon retour pour s’occuper de mon affaire.
– Comment ! monsieur, vous ne retirerez pas votre plainte ?
– Je la retirerai la veille de mon départ seulement. Mais vous avez ma parole. Si vous tenez vos engagements, je ne manquerai pas aux miens.
– Comme il vous plaira ! dit sir Robert qui comprenait après tout que ce gentleman excentrique voulait avoir ses garanties.
Marmouset se leva, s’approcha de mistress Robert, qui avait essuyé ses larmes, et lui dit :
– J’aurai l’honneur, madame, de vous présenter ma femme demain.
– Vous ne viendrez donc pas ce soir ? demanda sir Robert.
– Non, nous allons à Greenwich manger du poisson et nous y coucherons.
Sir Robert voulut reconduire Marmouset jusqu’à la porte de Newgate, et il lui fit mille politesses.
Puis, quand celui-ci se fut jeté dans son cab, il remonta auprès de sa femme et se jeta dans ses bras.
– Ah ! ma chère, dit-il, j’ai cru que nous étions perdus.
Et il y eut entre le père, la mère et les filles une petite scène de famille tout à fait attendrissante…
*
* *
Pendant ce temps, Marmouset courut à l’hôtel dans lequel Vanda était descendue.
– Ma bonne amie, lui dit-il, vous voilà ma femme pour huit jours.
– Comment cela ?
– Vous êtes Mme Peytavin…
– Bon !
– Vous quittez votre hôtel demain et nous allons prendre pension dans une famille anglaise.
– Bah !
– La famille de sir Robert M…
– Mais c’est le gouverneur de Newgate ?
– Justement.
– Et c’est chez lui ?…
– Il nous prend en pension vous et moi.
– Mais…
– Et il nous fera passer nos soirées avec un homme de votre connaissance.
Vanda devint toute pâle.
– Rocambole fera ma partie d’échecs tous les soirs.
Vanda étouffa un cri.
Alors Marmouset lui raconta ce qui s’était passé entre sir Robert M. et lui.
– Mais, dit Vanda, à quoi cela nous avancera-t-il ?
– Nous enlèverons Rocambole un soir.
– Comment ?
– J’ai mon idée, dit Marmouset.
Et il quitta Vanda et se fit conduire dans Osborn street, au numéro 90, où il y a un célèbre serrurier qui a inventé les serrures les plus compliquées, les plus à l’abri des voleurs et du feu.
Et, en entrant dans la boutique, Marmouset se dit :
– Je trouverai bien ici le moyen d’ouvrir la fameuse porte de fer qui ferme les souterrains qui, si j’en crois mon plan de Londres au dix-septième siècle, doivent aboutir sous l’appartement même du bon et naïf gouverneur de Newgate.
XXXIV
Marmouset entra donc chez le fameux serrurier d’Osborn street.
Il se fit montrer toutes sortes de serrures, de clefs forées, tréflées, à pompe, à losange, n’arrêtant son choix sur aucune.
Puis enfin, il finit par dire :
– J’ai lu dans un vieux bouquin qu’au XVIIe siècle on employait à Londres un système de serrure fort curieux.
– On en a employé plusieurs, dit le serrurier, qui était un homme érudit.
– Il y en avait un dont la serrure n’était pas apparente.
– Ah ! je sais ce que vous voulez dire, fit le serrurier. J’ai dans mon magasin une porte en fer qui est ainsi disposée.
– Voyons-la, dit Marmouset.
Ils montèrent au premier étage.
– C’est là, dit le serrurier, ce que j’appelle mon musée des antiques.
La Société royale du Muséum vient quelquefois me visiter et m’a même fait quelques acquisitions.
– Ah ! vraiment ?
– Tenez, voilà une porte fort curieuse.
Et le serrurier montra à Marmouset une plaque de fer haute d’un mètre, large de quatre-vingts centimètres, cuivrée par un côté et couverte de sculptures en relief obtenues au marteau.
À première vue, cette plaque de fer n’avait pas de serrure.
– Vous ne voyez rien ? dit le serrurier.
– Absolument rien.
– Regardez bien.
– J’ai beau regarder…
Alors le serrurier prit un marteau et se mit à frapper tout en haut de la plaque, auprès de la partie cintrée.
Le choc du marteau produisit une secousse, et cette secousse fit sortir sur trois côtés, de l’épaisseur même de la feuillure, trois verrous qui semblaient chercher leurs gâches.
– Oh ! c’est merveilleux ! dit Marmouset.
– Avant de vous expliquer ce mécanisme, reprit le complaisant serrurier, il faut que je vous raconte l’histoire de cette porte.
– Allez, dit Marmouset.
Il alluma un cigare, s’assit et attendit.
– Il y a cent cinquante ans, poursuivit le serrurier, Londres a été enveloppé par une vaste conspiration. Les partisans des derniers Stuarts avaient songé à renverser la maison de Hanovre et à faire sauter, à l’aide de la mine, une portion de la Cité.
– En vérité !
– La conspiration fut déjouée. On trouva une quantité considérable de souterrains creusés par les conspirateurs et fermés par des portes de fer semblables à celle-là.
Ce fer, merveilleusement forgé et trempé, résistait à tous les chocs, et il eût été impossible de briser ces portes dans lesquelles, comme vous voyez, on ne trouvait pas trace de serrures, si un des conspirateurs, à qui on avait promis sa grâce, n’eût livré le secret.
Marmouset se disait, tandis que le serrurier parlait :
– Rocambole m’avait bien indiqué… c’était ici que je devais trouver ce que je cherche.
Le serrurier poursuivit :
– Ce système de gonds et de gâches invisibles avait un but.
– Ah !
– Les conspirateurs étaient nombreux ; il eût été difficile, sinon impossible de donner à chacun une clef qui ouvrit toutes ces portes, ou plutôt de faire à chaque porte la même serrure.
On essaya ce système de fermeture au marteau.
Quand on avait frappé un certain nombre de coups, la porte se trouvait fermée.
– Oui, mais comment l’ouvrait-on ?
– De la même manière.
– Bah !
– Seulement, au lieu de frapper par en haut, on frappait par en bas.
Et le serrurier reprit son marteau et frappa à la partie opposée.
Les trois pênes rentrèrent aussitôt dans l’épaisseur du fer.
– Merveilleux, dit encore Marmouset.
Puis, d’un air tout à fait confidentiel :
– Cher monsieur, dit-il, je suis attaché à la Bibliothèque impériale de France.
Le serrurier salua.
– Je suis venu à Londres, aux frais de mon gouvernement, à la seule fin d’écrire sur place un grand ouvrage sur cette même conspiration des Poudres dont vous venez de me parler.
– Ah ! fort bien, dit le serrurier.
– Et on m’avait dit que vous possédiez cette porte, j’ai voulu la voir. Aussi, soyez tranquille, je parlerai de vous dans mon ouvrage.
Le serrurier parut très flatté.
Quant à Marmouset, comme il savait ce qu’il voulait savoir et ce que Rocambole n’avait pu lui dire, il prit congé du serrurier, le remerciant encore, et il remonta dans son cab.
Une demi-heure après il était de retour dans Old-Bailey et entrait dans la boutique de Milon.
Le personnel du nouvel épicier s’était augmenté d’un commis.
Ce commis, c’était le matelot William, l’homme qui n’avait jamais trouvé qu’un maître, l’homme gris.
William avait revêtu le tablier de garçon épicier depuis le matin.
Marmouset lui avait dit :
– Il s’agit de délivrer l’homme gris. Nous y travaillons, veux-tu être des nôtres ?
À quoi William avait répondu :
– Je serai des vôtres jusqu’à la mort.
– C’est bien ; reste avec nous. Quand le moment d’agir sera venu, on te le dira.
Et William s’était installé chez Milon.
Or, Milon vit revenir Marmouset triomphant.
– Prends la chandelle, lui dit celui-ci.
– Bon ! dit Milon, nous allons à la cave ?
– Oui.
– Avez-vous trouvé le moyen d’ouvrir la porte ?
– Naturellement.
Ils descendirent, pénétrèrent dans la première cave, puis dans la seconde, par la brèche qu’ils avaient pratiquée, et Marmouset, prenant la chandelle des mains de Milon, se mit à examiner la porte.
Elle était cintrée et paraissait en tout semblable à celle que Marmouset avait vue chez le serrurier d’Osborn street.
– Mais je ne vois pas de serrure ! dit Milon.
– Tu vas voir pourtant qu’elle s’ouvre, dit Marmouset.
Et il lui rendit la chandelle.
Puis il prit un gros marteau et se mit à frapper coup sur coup dans la partie basse.
Soudain un bruit se fit entendre.
– On dirait un verrou qui court ! murmura Milon.
Marmouset frappa un dernier coup.
Puis il donna une poussée vigoureuse à la porte, qui tourna sur ses gonds invisibles.
Alors l’entrée d’un souterrain étroit et tortueux apparut à leurs yeux.
Marmouset reprit le flambeau à palette de fer des mains de Milon.
– Suis-moi, dit-il, je commence à croire que nous aurons délivré Rocambole avant que les fénians aient songé à prendre un parti.
Et, le premier, il s’aventura dans le souterrain.
XXXV
Le boyau souterrain dans lequel Marmouset et Milon s’étaient engagés était creusé à même le sol, comme on dit.
C’est-à-dire que ceux qui l’avaient pratiqué n’avaient pas perdu leur temps à édifier des voûtes en maçonnerie ; aussi, au bout de vingt pas, nos deux explorateurs furent-ils arrêtés par un éboulement qui s’était produit à une époque difficile à déterminer.
– Hé ! dit Marmouset, nous nous sommes vantés trop tôt. Nous aurons besoin de la pioche et de la pelle.
Ils rebroussèrent chemin et vinrent dans la première cave chercher les outils, que Milon y avait entassés.
Puis ils retournèrent attaquer l’éboulement.
Il était peu considérable, du reste, et en quelques coups de pioche la solution de continuité fut détruite et ils se frayèrent un nouveau passage.
Cent pas plus loin, ils trouvèrent une porte en tout semblable à la première.
Marmouset l’ouvrit par le même procédé qu’il avait vu employer au serrurier et qu’il avait employé déjà.
La porte ouverte, ils se trouvèrent, non plus à l’entrée d’une galerie unique, mais au seuil d’une sorte de petite salle circulaire.
On avait étayé les terres avec une grossière charpente, et le sol boueux annonçait que des infiltrations nombreuses se produisaient en cet endroit.
Trois galeries venaient aboutir à cette salle.
– Ah ! diable ! dit Milon, nous voici plus embarrassés que jamais. Laquelle prendre ?
– Voyons le plan, répondit Marmouset.
Et il étala le plan sur ses genoux, après s’être accroupi sur le sol, et Milon se pencha auprès de lui la chandelle à la main.
Le plan n’indiquait pas cette bifurcation.
Marmouset parut réfléchir un moment.
Puis, regardant Milon :
– Nous sommes venus en droite ligne jusqu’ici n’est-ce pas ?
– Je le crois.
– Eh bien ! suivons la galerie du milieu.
– Pourquoi ?
– Parce que pour aller dans Newgate, nous devons traverser Old-Bailey.
– C’est juste.
Ils se remirent en marche ; mais au bout de quelques pas, un nouvel éboulement les arrêta.
Cette fois, après quelques coups de pioche, Marmouset se retourna vers son compagnon :
– Il y a là, dit-il, un travail de plusieurs heures.
– Ah ! fit Milon, alors…
– Alors nous allons appeler nos amis.
– Tout de suite ?
– Non.
Marmouset consulta sa montre.
– Il est quatre heures, dit-il.
– Eh bien ?
– Dans deux heures il fera nuit et la Cité, si encombrée en ce moment, sera déserte.
– Bon !
– Les boutiques ferment de bonne heure, tu fermeras la tienne, et nous aurons tout le loisir de travailler à notre aise.
Puis, se grattant l’oreille :
– Mais pourquoi n’explorons-nous pas, dit-il, les autres galeries ?
– Comme tu voudras. Seulement il est probable que nous serons arrêtés pas les mêmes obstacles.
Ils revinrent dans la petite salle circulaire et prirent alors la galerie qui paraissait infléchir à droite.
– Oh ! oh ! murmura Marmouset qui marchait toujours le premier, qu’est-ce que cela ?
Et il s’arrêta.
– Qu’est-ce ? demanda Milon.
– N’entends-tu pas une sorte de bruit sourd et continu ?
Milon prêta l’oreille.
– Bah ! dit-il, c’est le roulement des voitures qui passent au-dessus de nous.
– Je ne crois pas…
Et Marmouset, rendant la chandelle à Milon, se coucha à plat ventre et appuya son oreille contre le sol.
Puis, se relevant :
– Je ne crois pas que ce soit le roulement des voitures, dit-il.
Mais avançons toujours ; nous verrons bien.
Au bout de trente pas encore, il s’arrêta :
– Ne remarques-tu pas que le sol s’abaisse toujours un peu devant nous ?
– Mais c’est vrai, dit Milon, nous sommes sur une pente.
– Ce qui justifie mon opinion.
– Ah !
– La Cité est sur une colline, n’est-ce pas ?
– Sans doute.
– Toutes les eaux qui vont à la Tamise suivent par conséquent une déclivité plus ou moins grande ?
– Naturellement, dit Milon.
– Eh bien ! sais-tu quel est ce bruit que nous entendons et qui devient plus perceptible à mesure que nous approchons ?
– Non.
– C’est la Tamise, à laquelle ce souterrain aboutit.
– Oh ! par exemple !
– Avançons toujours, tu verras…
La pente devenait de plus en plus rapide et le bruit plus strident.
Bientôt il ressembla à un roulement de tonnerre.
Tout à coup la flamme de la chandelle vacilla.
– Tiens, vois-tu ? dit Marmouset.
– Quoi donc ?
– Un courant d’air.
Et il abrita la chandelle avec une de ses mains.
– Il y a des courants d’air partout, dit encore Milon.
– Soit, mais celui qui nous frappe au visage est un air frais et qui vient du dehors.
– Alors, puisque nous voilà fixés, rebroussons chemin.
– Du tout.
– Pourquoi donc ?
– J’ai mon idée, dit Marmouset, je veux savoir où aboutit le souterrain.
– À la Tamise, comme vous voyez, et nous tournons le dos à notre but.
– Imbécile ! dit Marmouset.
– Plaît-il ?
– Supposons que nous ayons délivré Rocambole.
– Nous n’avons plus besoin du souterrain.
– Au contraire, nous lui faisons faire ce chemin-ci et nous le menons tout droit à la Tamise, où une barque nous attend.
– Tiens, c’est vrai, dit Milon.
Et ils avancèrent encore.
Mais soudain le courant d’air fut si violent que la chandelle s’éteignit…
XXXVI
– Ah ! diable ! fit alors Milon, comment allons-nous faire maintenant ?
Marmouset, qu’il ne voyait plus, lui répondit par un éclat de rire.
– Tu te noierais volontiers dans un verre d’eau, toi dit-il.
– Je n’ai pas d’allumettes, dit Milon.
– Mais moi j’en ai.
Et Marmouset fit jaillir soudain une étincelle d’une allumette-bougie qu’il frotta avec son ongle.
En même temps Milon le vit tirer de sa poche une petite lanterne à trois faces.
– J’avais prévu le cas où nous trouverions un courant d’air, fit tranquillement Marmouset.
Et il alluma la lanterne dont il referma le verre aussitôt.
– Maintenant, en route ! dit-il.
Et il reprit ses outils sur son épaule et se remit en marche.
À mesure qu’ils avançaient, le bruit devenait plus strident et le courant d’air plus violent.
En même temps la pente avait acquis une grande rapidité.
Bientôt un vent frais, humide, imprégné de cette odeur goudronnée que distille le brouillard de Londres les frappa au visage.
Ils marchèrent sept à huit minutes encore et, tout à coup, ils aperçurent un point lumineux dans le lointain.
Le souterrain allait s’élargissant, et la voûte s’élevait au fur et à mesure.
– Qu’est-ce donc que cette lumière ? murmura Marmouset.
Elle ne peut pourtant pas brûler depuis le dix-septième siècle !
– Nous allons nous jeter dans quelque endroit fréquenté par les hommes, dit Milon.
– Bah !
– Si nous rebroussions chemin…
– Allons donc, dit Marmouset, aurais-tu peur ?
– Pour moi, jamais ! répliqua le colosse.
– Alors, c’est pour moi ?
– Non, mais si nous allions nous trahir…
– Avançons toujours… s’il y a du danger, nous reviendrons sur nos pas.
À mesure qu’ils marchaient, la lumière grandissait, et tout à coup il sembla à Marmouset qu’elle était entourée d’une glace et qu’elle reflétait.
– Bon ! fit-il, je sais ce que c’est.
– Qu’est-ce donc ? demanda Milon.
Ce que nous voyons, c’est la Tamise. Le souterrain aboutit à fleur d’eau.
– Mais l’eau n’est pas lumineuse ?
– C’est la lueur d’un réverbère qui se réfléchit dedans.
– Vous croyez ?
– J’en suis sûr.
Marmouset fit trente pas encore, et l’événement lui donna raison.
Le souterrain s’ouvrait sur la Tamise et c’était bien la réverbération d’un bec de gaz que Milon et lui avaient vue.
La nuit était claire, le brouillard s’était dissipé.
Mais, on le sait, Londres n’a pas de quais ou presque pas.
La partie de la ville que l’on appelle l’agglomération a commencé sous le West-End en amont de Lambeth-palace, la construction des siens ; mais la ville de Londres proprement dite, la Cité, ne paraît nullement pressée de faire les siens.
Marmouset sortit du souterrain et se trouva sur une petite grève étroite.
Milon l’avait suivi.
Tous deux alors purent se rendre compte du lieu où ils étaient.
À leur droite ils avaient le pont de Black-Friars ; à leur gauche, en aval, le pont de Londres ; en face d’eux, la rive méridionale sur laquelle s’étendent le Southwark et le Borough.
– C’est tout ce que je voulais savoir, dit Marmouset. Allons-nous-en !
Et ils rentrèrent dans le souterrain, où ils avaient laissé leur lanterne.
– Nous avons fait un bout de chemin dit alors Milon.
– Mais oui, répondit Marmouset.
– Nous avons passé sous Fleet street et suivi Farringdon road.
– Justement…
– Il y a plus d’une heure que nous marchons.
– Eh bien ! dit encore Marmouset, jouons des guibolles, comme je disais dans mon enfance.
Ils n’avaient cheminé en venant qu’avec précaution et en s’arrêtant de temps à autre.
Maintenant qu’ils étaient sûrs de leur route, ils firent le double de chemin dans le même laps de temps.
Quand ils furent dans la petite salle circulaire, Marmouset tira sa montre.
– Cinq heures et demie, dit-il.
– On doit nous croire morts, là-haut, dit Milon, faisant allusion à leurs compagnons restés dans la boutique d’épicerie.
– Ce n’est pas ce que je veux dire.
– Ah ! fit Milon étonné.
– Nous avons encore une demi-heure à nous.
– Pourquoi faire ?
– Mais, pour explorer l’autre route et nous convaincre que ce n’est pas celle que nous devons suivre.
– Allons ! dit Milon.
Et ils pénétrèrent dans le boyau souterrain de gauche.
Celui-ci faisait un coude et paraissait se diriger vers le nord-ouest.
Il montait, au lieu de descendre.
À cent pas de la salle circulaire ils trouvèrent une porte de fer.
Marmouset l’ouvrit à coups de marteau.
Puis ils avancèrent encore.
– Ah çà ! dit tout à coup Milon, nous allons cependant vers la Tamise, cette fois ?
– Non !
– Cependant j’entends un bruit sourd.
– Moi aussi.
– Alors c’est le bruit des voitures.
– Non pas, dit Marmouset, et nous pouvons nous en retourner. Je sais ce que je voulais savoir.
– Ah ! qu’est-ce donc ?
– Nous laissons Old Bailey à notre droite.
– Bon !
– Et nous sommes sous le Metropolitan-railways, autrement dit Le chemin de fer de Chatham. C’est un convoi qui passe.
En effet, le bruit cessa tout à coup. Le convoi s’était éloigné.
– En es-tu sûr maintenant ? dit encore Marmouset.
– Très sûr.
– Eh bien ! allons-nous-en.
– Et ils revinrent une fois encore sur leurs pas.
Un quart d’heure après, ils reparaissaient dans la boutique.
– Mes enfants, dit alors Marmouset aux vieux compagnons de Rocambole, nous allons fermer la boutique et passer à un autre exercice.
– Ah ! ah ! dit la Mort-des-Braves.
– Il y a de l’ouvrage pour toute la nuit, ajouta Milon.
– Et pour d’autres nuits encore, peut-être, acheva Marmouset.
XXXVII
Le lendemain matin, un cab s’arrêta à la porte de Newgate.
La porte du milieu, celle qui donnait accès dans le logis proprement dit du gouverneur.
Deux personnes en descendirent.
Marmouset et Vanda.
Mistress Robert M… était à la fenêtre, abritée derrière les persiennes, et elle les aperçut tous deux au moment où ils sonnaient à la porte.
Vanda avait la tournure élégante et la démarche hautaine d’une femme du meilleur monde.
Les jeunes misses, qui étaient derrière leur mère, ne purent s’empêcher de murmurer :
– Maman, qu’elle est belle !…
Quant à sir Robert M…, il était en grand uniforme pour recevoir dignement ses hôtes.
Sir Robert avait beaucoup réfléchi depuis la veille.
Un Anglais comprendra toujours l’excentricité.
Après le départ de Marmouset, le bon gouverneur s’était posé cette question :
– N’est-ce pas un piège qu’on me tend ?
Mais il est tellement invraisemblable qu’un homme qui était l’ami du premier secrétaire de l’ambassade française eût la moindre accointance sérieuse avec les fénians, que sir Robert eut honte de sa défiance.
Ensuite, il n’avait vraiment pas le choix.
Marmouset avait parlé de M. Staggs.
Si M. Staggs mettait jamais le nez dans les affaires de sir Robert M…, celui-ci pouvait se considérer comme un homme perdu.
Sa réputation de probité, son bonheur, sa fortune, sa propriété, tout y passerait.
En mettant les choses au pire, en admettant que le gentleman français eût de mystérieuses relations avec l’homme gris, que risquait sir M… ?
Tout au plus une réprimande du lord chief-justice.
Si le prisonnier – chose impossible ! – s’évadait ?
Sir Robert M… pouvait être destitué ; mais on ne lui prendrait pas sa fortune, et, quoi qu’il en eût dit, le gouverneur de Newgate avait de bonnes petites économies bien rondelettes.
Donc sir Robert s’était dit :
– Il faut donc en passer par où le Français veut ; mais je prendrai mes précautions.
Et il s’en était allé trouver, dès le matin, son prisonnier l’homme gris.
Rocambole l’avait regardé du coin de l’œil, et s’était dit :
– Je vois ce que c’est. Tu as reçu hier la visite de Marmouset. Tu as le trac, mon bonhomme !
– Gentleman, dit alors sir Robert M…, vous m’accorderez cette justice que je vous ai toujours témoigné des égards ?
Rocambole s’inclina.
– J’ai adouci pour vous, autant que possible, le régime de la prison.
– Tout cela est vrai, mylord.
– Je vous ai fait donner des journaux.
– Parfaitement.
– Je vous ai même permis d’écrire.
– Tout cela est vrai, milord.
– Vous m’accorderez, poursuivit sir Robert, que si vous êtes ici, ce n’est pas ma faute et que j’y suis pour rien.
– Assurément non.
– Par conséquent, vous ne sauriez avoir aucun motif de haine contre moi.
– Mais je suis plein de reconnaissance pour vous, mylord.
– Vrai ?
– Et si jamais je suis libre !…
Sir Robert secoua la tête.
– Vous n’avez pas besoin d’être libre pour me prouver votre reconnaissance.
– En vérité !
– Et je vous avouerai même naïvement que je viens faire appel à vos bonnes dispositions pour moi.
– Parlez ! mylord, parlez ! dit Rocambole avec empressement.
Alors, sir Robert raconta à l’homme gris, dans tous ses détails, la visite de Marmouset et les conditions singulières qu’il lui avait imposées pour retirer sa plainte des mains de M. Staggs.
Rocambole se mit à sourire.
– Mylord, dit-il, je savais cela.
– Vous le saviez ?
– Je vais être franc avec vous, mylord.
– Parlez !…
– M. Félix Peytavin, c’est le nom du Français, n’est-ce pas ? s’est montré mécontent quand vous nous avez transférés dans une autre cellule.
« – Je me vengerai, » m’a-t-il dit.
Et il m’a raconté le projet qu’il va, je le vois, mettre à exécution.
– La vengeance n’est pas bien cruelle, dit sir Robert M…
– Elle l’eût été, si vous ne m’aviez comblé de vos bontés, mylord.
– Que voulez-vous dire ?
– Le Français n’est pas mon ami, après tout, dit Rocambole, et vous avez été très bon pour moi.
– Bon ! après ?
– Il se propose de recommencer ce que, en France, on nomme une scie.
– Je ne comprends pas.
– C’est-à-dire qu’il veut, chaque soir, pendant huit jours, en jouant au whist avec moi, parler cette langue bizarre qui vous a tant horripilé.
– Ah ! vraiment.
– Et vous faire croire que nous avons des intelligences. Mais, rassurez-vous, milord, il n’a pas mes secrets.
Et Rocambole se mit à rire.
– Donc, poursuivit-il, ne vous alarmez pas, et tenez-vous heureux d’être quitte à si bon marché de cette aventure que M. Staggs saurait mettre à profit.
Sir Robert M… frissonna au nom de M. Staggs.
– Gentleman, dit-il alors, en obéissant au caprice de M. Peytavin, je viole les règlements de la prison !
– Peuh ! dit l’homme gris.
– Je viens donc faire appel à votre honneur.
– Ah ! fit Rocambole.
– Vous serez jugé au premier jour.
– Eh bien !
– Je viens vous supplier de ne point parler à l’audience, quand on vous interrogera, de cette particularité que je vous aurai fait venir chez moi.
– Je vous jure, mylord, mais…
– Mais quoi ? demanda, sir Robert M… inquiet.
– Serez-vous aussi sûr de la discrétion de vos employés ?
– Il y en a deux dont je réponds, et ce sont eux qui viendront vous chercher.
– Alors, c’est différent, mylord, et vous pouvez compter sur moi.
Sir Robert M… avait quitté l’homme gris, tout à fait rassuré, et il retourna chez lui faire un bout de toilette et donner ses ordres pour que le gentleman français et sa femme fussent reçus convenablement.
Donc, il était dix heures du matin, quand sir Robert M… alla recevoir Marmouset et Vanda et leur témoigner un respectueux empressement.
– Eh bien ! lui dit Marmouset en riant, l’ombre de M. Staggs n’a-t-elle pas troublé votre sommeil ?
Sir Robert M… tressaillit. Néanmoins, le sourire n’abandonna point ses lèvres et il offrit galamment la main à Vanda.
XXXVIII
Comme on le pense bien, Marmouset n’avait pas passé la nuit dans son lit.
Personne même ne s’était couché dans la boutique d’épiceries d’Old Bailey.
À six heures, Milon avait fermé sa devanture.
La Cité reste déserte à partir de cette heure.
À l’exception des concierges de ces ruches gigantesques appelées des maisons à bureaux et des policemen qui veillent toute la nuit, il ne reste personne dans ce quartier qui, pendant le jour, est le plus populeux de Londres.
Aussi, trouve-t-on parfaitement naturel que le petit commerce de détail imite le grand commerce et ferme ses portes.
La boutique close, Marmouset harangua ses compagnons.
Il y avait là cinq hommes déterminés et une femme.
Pauline, car c’était elle, eut pour mission de demeurer dans la boutique sans lumière, d’écouter le moindre bruit, de monter au premier étage et de regarder discrètement derrière les jalousies, si elle entendait quelque rumeur insolite.
Auquel cas elle descendrait dans la cave.
Milon est Marmouset montrèrent eux-mêmes le chemin.
Ils descendirent dans la cave et se munirent de tous les outils préparés par Milon.
Puis ils passèrent dans le caveau, entrèrent dans la galerie et ne s’arrêtèrent qu’à cette salle circulaire où trois souterrains aboutissaient.
Marmouset avait planté un pieu dans la première cave et après ce pieu il avait attaché le bout d’un peloton de ficelle.
Puis, à mesure qu’il marchait, il déroulait le peloton.
Milon, qui croyait toujours comprendre et ne comprenait jamais, dit alors :
– Ah ! je sais ce que c’est.
– Tu crois ?
– Oui, c’est comme à Rome… dans les Catacombes… si on n’a pas un bout de fil, on se perd.
– Eh bien ! tu n’y es pas, dit Marmouset.
– Mais…
– Tu n’y es pas. Voilà tout.
– Alors ?
– Je te l’expliquerai plus tard…
Milon avait coutume de respecter les réticences de l’élève de Rocambole.
Il s’inclina.
On avança ainsi jusqu’à cet éboulement qui les avait arrêtés quelques heures auparavant.
– Allons ! mes enfants, dit Marmouset, à l’œuvre ! et ne perdons pas de temps.
Les terres éboulées étaient friables et faciles à entamer.
La Mort-des-Braves, qu’on avait longtemps employé à des ouvrages de terrassement à Paris, attaqua l’éboulement le premier.
– Bah ! dit-il au troisième coup de pioche, à moins qu’il n’y en ait une lieue comme ça, nous n’en aurons pas pour longtemps.
Mais il y en avait long, par exemple.
Comme ils ne pouvaient traverser que deux de front, ils se relayaient de quart d’heure en quart d’heure.
D’heure en heure, Marmouset quittait son compagnon et remontait dans la boutique.
La petite Pauline, toujours aux aguets, n’avait rien signalé d’extraordinaire.
Enfin, après quatre heures d’un travail opiniâtre, on trouva l’autre côté du souterrain.
Les compagnons de Rocambole poussèrent un cri de joie ; mais Milon, essuyant la sueur qui découlait de son front, secoua la tête et murmura :
– Si nous en trouvons encore beaucoup comme ça, nous en aurons pour huit jours.
Et il regarda Marmouset.
Marmouset était calme.
– Tiens cela, dit-il à Milon.
Et il lui mit dans la main le peloton de fil.
Puis il fit signe à Polyte de prendre une des lanternes et de l’éclairer.
Milon ne comprenait pas.
Marmouset tira alors un mètre de sa poche, un mètre de charpentier ou de menuisier, et il l’ouvrit.
Milon ouvrit de grands yeux.
Marmouset se mit à mesurer le fil déjà tendu, s’éloignant de Milon, par conséquent, et retournant à petits pas dans la cave.
Alors le colosse regarda la Mort-des-Braves, son vieux compagnon.
– Ah ! mon pauvre ami, dit-il, je n’ai vraiment pas de chance. Voici que Marmouset me traite absolument comme me traiterait le maître. Il a toujours l’air de me dire que je suis une bête !
Et le bon Milon soupira.
Il faut dire, du reste, que les autres n’avaient pas compris davantage.
Polyte lui-même, qui cependant était un gamin de Paris, ne comprit qu’à moitié ; car, lorsqu’ils furent descendus dans la première cave, il dit :
– Vous voulez vous rendre compte du chemin que nous avons fait ?
– Oui, d’abord !
– Et puis ?
– Et puis, tu vas voir !
Marmouset s’assit sur une futaille.
– J’ai compté six cent dix-huit mètres, dit-il.
– Bon !
– Nous allons remonter dans la boutique. Il doit y avoir de la ficelle encore.
– Parbleu ! répondit Polyte. Un épicier, ça vend de tout.
Ils remontèrent à bas bruit.
Alors l’étonnement de Polyte fut presque aussi grand que celui de Milon, lorsque, ayant posé sa lanterne sur le comptoir et ayant apporté un autre peloton de ficelle à Marmouset, il vit celui-ci mesurer soixante-dix-huit mètres de ficelle et couper au soixante-dix-huitième.
– Maintenant, nous allons voir, dit Marmouset.
Et il éteignit la lanterne et tous trois se retrouvèrent dans l’obscurité.
Le silence le plus profond régnait dans Old Bailey.
Marmouset entr’ouvrit la porte basse pratiquée dans la devanture.
Puis il prêta l’oreille.
En ce moment on entendit retentir dans le lointain un pas lent et mesuré.
– C’est le watchman, dit Marmouset.
– Qu’est-ce que c’est que ça ? fit Polyte.
– Le gardien de nuit de chaque quartier.
Et il repoussa doucement la petite porte et attendit.
Le pas approcha, puis il passa devant la boutique, puis s’éloigna, descendant vers Fleet street.
– Vite ! dit Marmouset, nous avons cinq minutes devant nous avant qu’il revienne.
C’est plus qu’il ne nous en faut !
Polyte, qui n’aurait pas été un gamin de Paris s’il n’avait pas eu le mot pour rire, dit alors :
– J’ai vu bien des mélodrames, au boulevard, mais aucun qui eût autant de ficelles que celui-ci.
XXXIX
Marmouset mit un bout de la ficelle dans la main de Polyte.
Puis, tenant l’autre, il entr’ouvrit de nouveau la petite porte et se glissa dans la rue.
Puis il marcha en droite ligne sur la prison de Newgate, qui était juste en face.
Il ne s’arrêta que lorsque la ficelle fut tendue.
Il était alors à dix ou douze pas du mur d’enceinte.
Marmouset laissa tomber la ficelle et continua son chemin en comptant les pas.
– Onze ! dit-il au moment où il touchait le mur de sa main.
Alors il se replia en courant sur la boutique.
– Commences-tu à comprendre ? dit-il à Polyte.
– Parfaitement, répondit celui-ci.
Ils tirèrent la ficelle, pour ne la point laisser dans la rue, et Marmouset dit encore :
– Maintenant, redescendons.
Ils rallumèrent la lanterne et reprirent le chemin de la cave.
Milon, tant que la ficelle que Marmouset lui avait mise dans la main était demeurée tendue, Milon, disons-nous, n’avait pas sourcillé.
Mais tout à coup, la ficelle était devenue lâche, et il avait compris que Marmouset ne tenait plus l’autre extrémité.
Il fut sur le point de retourner dans la première cave, lui aussi, pour savoir ce qui s’y passait.
Mais la Mort-des-Braves l’arrêta.
– Marmouset nous a dit de rester ici, fit-il, et de l’attendre pour aller en avant.
Milon poussa encore un soupir et ne souffla plus mot.
Enfin Marmouset et Polyte revinrent.
– À présent, dit le premier, avançons.
Et il prit une des lanternes et fraya la route.
Le souterrain se prolongeait une dizaine de pas à peine ; puis, tout à coup, on trouvait une nouvelle salle souterraine de quinze mètres de superficie environ.
Seulement on n’y voyait pas d’ouverture et aucun autre boyau souterrain ne paraissait y aboutir.
– Nous voilà bien avancés ! dit encore Milon.
Marmouset haussa les épaules.
Puis, passant sa lanterne à Polyte et prenant une pioche, il se mit à faire le tour de la salle en frappant de petits coups sur les parois.
Aux premiers regards, cette rotonde était creusée à même la terre.
Mais la pioche, détachant une sorte d’enduit, mit à découvert une voûte et des murs en maçonnerie.
Marmouset frappait toujours de petits coups.
– Il cherche un creux, dit Milon, qui comprenait cette fois.
Tout à coup la pioche rendit un son métallique.
– Bon ! dit Marmouset, nous y sommes. Il y a une porte là.
Il se mit à entamer l’enduit avec précaution et presque sans bruit.
Puis il fit signe à la Mort-des-Braves et au matelot William de l’imiter.
Ce fut un travail d’une heure.
Au bout de ce temps, il eut dégagé complètement l’embrasure d’une porte.
Cette porte était en tout semblable à celles qu’on avait rencontrées déjà.
Elle était en tôle repoussée, cintrée par le haut, et n’avait pas la moindre serrure apparente.
– Oh ! fit Milon en riant, nous avons le moyen de l’ouvrir. N’est-ce pas, Marmouset ?
– Oui, répondit celui-ci, mais nous ne l’ouvrirons pas.
– Pourquoi donc ça ?
– Parce que c’est inutile pour cette nuit. Nous avons assez travaillé comme ça.
Milon tira sa montre.
– Comment ! dit-il, il n’est pas minuit !
– C’est que nous avons fait en six heures la besogne de douze, voilà tout.
Et, partant de la porte qu’il venait de mettre à découvert, Marmouset se remit à compter les pas, traversant la salle circulaire et rebroussant chemin dans le boyau souterrain jusqu’à l’endroit où l’éboulement s’était produit.
Milon et les autres l’avaient suivi.
Alors, Marmouset s’arrêta :
– Il y a quatorze pas de l’endroit d’où nous venons, ici, dit-il.
– Quatorze, compta Polyte.
– Et d’ici à la cave, qui est située juste au-dessous de la boutique, il y a soixante-dix-huit mètres, dit encore Marmouset, ce qui, à mon compte, fait un total de quatre-vingt-huit mètres environ.
– Eh bien ? dit Milon.
– De la porte de la boutique à la muraille de Newgate, continua Marmouset, j’ai compté soixante-dix-huit mètres et onze pas. Il y a donc gros à parier que la porte que nous venons de découvrir, en admettant que le souterrain soit percé en droite ligne, est située sous le logement même du gouverneur de la prison.
– Ah ! ah !
– Il est donc inutile, pour le moment du moins, d’aller plus avant.
– Voilà ce que je ne comprends pas, dit Milon.
– C’est bien simple, pourtant.
– Ah !
– Ne t’avais-je pas dit que demain, Vanda et moi, nous allions visiter Newgate ?
– Sans doute.
– Si le gouverneur a connaissance des souterrains, il ne manquera pas de me les montrer.
– Alors, il ouvrira cette porte ?
– Mais non ; car si elle était dissimulée de ce côté, elle doit l’être aussi de l’autre.
– Alors, il ne pourra rien vous montrer ?…
– Voilà ce que nous verrons. En attendant, allons nous coucher.
Et Marmouset donna le signal de la retraite.
*
* *
Le lendemain matin, avant de quitter Old Bailey, Marmouset fit un signe à Polyte :
– Tu dois être brave ? dit-il.
– Comme tout le monde.
– Alors, tu n’as pas peur de te trouver seul dans un souterrain ?
– Je coucherais dans un cimetière, au besoin.
– Écoute bien, alors, ce que je vais te dire. Tu vas descendre dans le souterrain et tu iras t’établir dans la dernière salle que nous avons découverte.
Tu lâcheras de ne pas t’endormir et tu prêteras l’oreille.
– J’entendrai donc du bruit ?
– Cela peut être. Alors, tu chercheras à te rendre compte de ce que tu auras entendu.
– Parfaitement.
Et tandis que Polyte descendait à la cave, Marmouset s’en alla prendre Vanda pour la conduire à Newgate, où nous allons les retrouver tous deux.
XL
Mistress Robert M… et ses filles trouvèrent Vanda charmante.
Mais leur sympathie se changea en enthousiasme lorsque la jeune femme eut passé au cou de Lucy Robert, l’aînée des deux sœurs, un collier de grosses perles qu’elle portait, et que la jeune fille avait naïvement admiré.
Après le déjeuner du matin, l’intimité la plus parfaite régnait entre le gouverneur et sa famille et les hôtes un peu forcés qu’ils avaient.
Sir Robert M… n’était ni un joueur de whist ni un amateur passionné du billard, bien qu’il en eût un chez lui ; mais il jouait bien aux échecs.
Marmouset, pour achever de faire sa conquête, lui proposa une partie et le laissa gagner.
Mistress Robert et ses filles firent de la musique avec Vanda, qui était excellente pianiste.
Et l’on gagna ainsi l’heure du lunch.
Ce fut alors que Marmouset dit à sir Robert :
– Vous savez qu’il est une chose convenue dans mon programme ?
– Laquelle ?
– C’est que vous montrerez Newgate en détail à Mme Peytavin, qui est friande de ces émotions-là.
– Très volontiers, dit sir Robert, qui avait, du reste, un grand plaisir à montrer sa prison et ses prisonniers aux visiteurs. Seulement, je vous demande une grâce, gentleman.
– Parlez…
– Il a été convenu entre nous que ce mystérieux prisonnier, qu’on nomme l’homme gris, viendrait faire ce soir votre partie d’échecs ?
– Oui, ce soir, et tous les soirs de mon séjour ici.
– Bon ! dit sir Robert. J’ai pris mes précautions pour cela, et il n’y a que deux de mes gardiens, dont je suis parfaitement sûr du reste, qui sauront qu’il quittera son cachot une heure ou deux par soirée.
– Eh bien ?
– Pour tout le reste de mon personnel, l’homme gris est un secret.
– Ah ! ah !
– Et j’ai l’ordre formel du lord chief-justice de ne le laisser voir à personne.
– Alors, pour le moment, vous ne nous montrerez pas l’homme gris ?
– Non.
– Mais nous verrons les autres ?
– Certainement ! Vous verrez tout, d’ailleurs, depuis la cage aux oiseaux jusqu’aux anciennes oubliettes.
– Ah ! il y a donc des oubliettes à Newgate ? dit Marmouset impassible.
– Oui ! nous en possédons deux.
– Ce que vous me dites là m’étonne fort, mylord.
– Pourquoi ?
– Mais parce que j’ai lu, dans l’histoire d’Angleterre, que Newgate avait été construit en 1780 seulement.
– Oui, certes, mais sur l’emplacement d’une autre prison, qui fut brûlée à cette époque.
– Ah ! c’est différent, car je ne m’expliquais pas que dans les siècles derniers on se servît encore de pareils supplices.
– Aussi, ces oubliettes, n’ont-elles jamais servi qu’une fois.
– Comment cela ?
– Elles ont servi de refuge aux conspirateurs des Poudres.
– J’ai entendu parler, en effet, de cette conspiration, mais vaguement.
– Oh ! dit sir Robert M…, c’est une longue et nébuleuse histoire, que je n’entreprendrai pas de vous raconter. Mais nous pouvons commencer par les oubliettes notre visite de Newgate.
– Pourquoi par les oubliettes ?
– Parce qu’elles ne sont pas dans l’intérieur de la prison proprement dite.
– Ah !
– Elles sont sous nos pieds.
– Là ?
– Oui, dit sir Robert, dans mon propre logement.
– En vérité !
– J’ai, pour mes besoins particuliers, une cave, dit sir Robert.
– Et c’est dans cette cave… ?
– … Que s’ouvrent les deux oubliettes dont je vous parle. Seulement, de peur qu’un domestique maladroit ne vînt à y tomber, on a construit une margelle à l’entour, comme on fait pour un puits.
– Du reste, dit Marmouset, une oubliette n’est autre chose qu’un puits.
– Celles-là ont soixante-dix pieds de profondeur. On peut y descendre avec une corde. J’y suis descendu une fois, moi qui vous parle.
– Et qu’avez-vous vu, une fois en bas ?
– L’entrée d’un des souterrains creusés au temps de la conspiration des Poudres.
– Diable ! dit Marmouset en riant, mais alors, on peut s’évader de Newgate !
Sir Robert tressaillit.
– Ah ! non, dit-il ; d’abord ces oubliettes sont sous mon logis et non sous la prison.
Ensuite, ce souterrain est muré.
– Ah ! c’est différent.
– J’ai eu même un jour une singulière fantaisie, moi qui vous parle.
– Ah ! vraiment !
– Je suis descendu avec un maçon et j’ai voulu lui faire démolir le mur construit à l’entrée du souterrain.
– Et il n’a pu en venir à bout ?
– Au contraire. Seulement, derrière le mur, nous avons trouvé une porte.
Marmouset tressaillit à son tour.
– Une porte en fer, continua sir Robert M…, que jamais nous n’avons pu ni ébranler, ni jeter bas, ni ouvrir.
– Vous n’avez pas fait venir un serrurier ?
– J’en ai fait venir six.
– Et ils n’ont pu forcer la serrure ?
– Ils n’ont même pas trouvé la serrure.
– Après, qu’avez-vous fait ?
– J’y ai renoncé et me suis contenté de faire reconstruire le mur, tel qu’il était auparavant.
– Alors, on ne voit plus la porte ?
– Si, j’ai fait laisser un trou d’un pied carré dans le mur.
– Dans quel but ?
– Dans le but unique de constater l’existence de cette porte.
– Eh bien ! dit Marmouset, commençons alors, si vous le voulez, par les oubliettes.
– Comme vous voudrez, dit sir Robert M…
Un quart d’heure après, sir Robert M…, précédé par deux gardiens, qui portaient des flambeaux, faisait à ses hôtes les honneurs des caves de Newgate.
Marmouset disait tout bas à Vanda :
– J’aime autant que vous ne voyiez pas l’homme gris.
– Pourquoi ?
– J’aurais peur que vous n’éprouviez une émotion qui vous trahit.
– Bah ! dit Vanda, je suis forte, quand il le faut. Tu verras, ce soir.
– Et, s’il allait se trahir, lui !
Vanda secoua la tête.
– Non, dit-elle, ce n’est plus moi qu’il aime.
Et elle ajouta, avec un sourire résigné :
– C’est miss Ellen.
Les caves de Newgate n’avaient rien de curieux. Un plancher recouvrait l’orifice des oubliettes.
– Quelle est celle au pied de laquelle on trouve la porte ? demanda Marmouset.
– Celle-ci, dit sir Robert M…, voulez-vous y descendre ?
– Oh ! pas moi, fit Vanda.
– Mais moi, j’y descendrai, dit Marmouset.
Et sir Robert donna l’ordre à l’un des gardiens de fixer à un anneau de fer scellé dans la margelle une échelle de corde qui se trouvait dans la cave.
XLI
L’échelle attachée, Marmouset dit au gouverneur :
– Cela n’a plus rien de bien curieux pour vous, n’est-ce pas ?
– Assurément non, répondit sir Robert.
– Je vous dispense donc de me suivre.
– Mais…
– Donnez-moi seulement de quoi y voir.
Et Marmouset prit des mains de l’un des gardiens la lanterne qu’il portait ; puis il mit le pied sur l’échelle, après avoir enjambé la margelle de l’oubliette.
Marmouset était leste et adroit comme un enfant de Paris ; il avait été fumiste dans sa première jeunesse, il savait marcher sur le bord d’un toit ; à plus forte raison, se laisser glisser au bout d’une corde.
Descendre échelon par échelon lui parut oiseux.
– Ce sera bon pour remonter ! se dit-il.
Et il se laissa couler le long de la double corde, se maintenant d’une main et tenant de l’autre la lanterne.
Aussi, en quelques secondes, eut-il touché le fond du puits.
Alors, il leva la tête et vit sir Robert M… qui se penchait sur la margelle.
– Examinez bien la porte, lui criait le bon gouverneur.
– Mais puisque vous l’avez murée !
– Non, pas tout entière.
– Ah !
– On a laissé un trou dans le mur. Passez-y votre lanterne. Bon ! c’est bien cela…
– Ce brave homme, murmurait Marmouset en souriant, est d’une complaisance extrême.
Et il posa sa lanterne sur le bord de la brèche pratiquée dans le mur et de l’autre côté de laquelle on apercevait la porte de fer forgé.
– La voyez-vous ? cria encore sir Robert.
– Oui, oui ! elle est très curieuse comme travail.
– N’est-ce pas ? et elle a la sonorité de l’airain. Frappez donc dessus !
– Mais cet homme est mon complice sans s’en douter ! pensa encore Marmouset.
Et passant le poing à travers la brèche, il frappa trois coups qui retentirent bruyamment.
– C’est là ce que je voulais, se dit Marmouset.
Et il remonta presque aussi lestement qu’il était descendu.
– Et l’autre oubliette, a-t-elle une porte ? demanda-t-il.
– Non, aucune.
– Ah ! Eh bien ! milord, voyons la prison proprement dite maintenant.
Marmouset se disait en remontant des caves au rez-de-chaussée :
– Nous jouerions joliment de malheur si la porte sur laquelle j’ai frappé trois coups n’était pas celle que je crois.
Vanda marchait auprès de lui.
Sir Robert M… avait retrouvé toute sa belle humeur. Il avait un si grand plaisir à montrer sa prison en détail ! Pour lui, Newgate était une prison modèle, un amour de prison, à ce point, disait-il, que lorsqu’un prisonnier s’en allait, c’était toujours les larmes aux yeux.
À quoi Marmouset lui dit en riant :
– Il regrette d’autant plus Newgate que généralement il en sort pour être pendu.
– Oh ! pas toujours, dit sir Robert M…
Vanda parut s’intéresser vivement à tout ce qu’elle voyait ; mais elle ne cherchait cependant qu’une chose du regard à mesure qu’ils parcouraient les longs corridors sur lesquels donnaient les portes des cellules ; c’était la porte de la cellule occupée par Rocambole.
Tout à coup, Marmouset lui toucha légèrement l’épaule :
– C’est là, dit-il.
Vanda tressaillit, mais son visage ne trahit aucune émotion.
D’ailleurs, sir Robert M… n’avait vu ni le geste ni entendu les paroles de Marmouset.
En une heure et demie on a visité tout Newgate.
Sir Robert M… ne leur fit grâce de rien, du reste, depuis la cage aux oiseaux jusqu’à la salle de la cour d’assises, depuis le bureau du greffe, où l’on conserve le masque en plâtre des suppliciés, jusqu’à la cuisine, qui est la dernière station que fait le condamné à mort en quittant la prison pour aller au supplice.
À quatre heures, Marmouset et Vanda étaient de retour au logis du gouverneur, – et Marmouset, confiant à mistress Robert et à ses filles celle qu’il leur avait donnée comme sa femme, prétextait le besoin d’une course importante et sortait de Newgate.
Milon était sur la porte de sa boutique de l’autre côté d’Old-Bailey.
Marmouset lui fit un signe et continua à descendre vers Fleet street.
Milon quitta nonchalamment le seuil de la boutique et prit la même direction.
Au coin de Fleet street, ils jugèrent qu’ils étaient assez loin de Newgate pour s’aborder sans être vus par un gardien ou une personne quelconque appartenant au service de la prison.
– Eh bien ? dit Milon, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?
– C’est à toi que j’ai la même question à faire.
– Mais depuis que vous êtes partis, ce matin, tout est dans le même état.
– Ah ! dit Marmouset qui fronça le sourcil. Et Polyte ?
– Il est toujours à l’endroit où vous l’avez placé.
– Et tu ne l’as pas revu depuis ce matin ?
– C’est-à-dire que je suis descendu vers deux heures.
– Bon !
– Et que je lui ai porté de quoi luncher.
– Et tu ne l’as pas revu depuis ?
– Non.
Le front assombri de Marmouset se dérida.
– Alors, retournons chez toi, dit-il. Seulement, laisse-moi prendre mes précautions.
Un cab passait à vide.
Marmouset appela le cabman et passa.
– Va m’attendre, dit-il à Milon.
Grâce au cab, Marmouset put se glisser dans la boutique d’épicerie sans être vu de Newgate.
Mineurs pendant la nuit, les compagnons de Milon étaient sérieusement épiciers pendant le jour.
Ils allaient et venaient par la boutique, servaient les clients et obéissaient à Pauline, la jolie dame de comptoir.
Marmouset et Milon prirent le chemin de la cave.
– Je ne sais pas pourquoi, disait Milon, vous avez mis Polyte en sentinelle là-bas. Que voulez-vous qu’il entende ?
Marmouset ne répondit pas.
Comme ils traversaient la petite salle souterraine et s’apprêtaient à entrer dans le dernier boyau qui conduisait à la porte de fer mise à découvert, ils virent Polyte qui accourait à leur rencontre.
Grâce à la lanterne que portait Milon, Polyte avait reconnu Marmouset, qu’il considérait comme son chef de file.
– Eh bien ? dit celui-ci.
– Nous ne sommes pas seuls dans ces souterrains ! dit Polyte ému.
– Ah bah !
– Il y a du monde de l’autre côté de la porte de fer.
– Qu’en sais-tu ?
– J’ai entendu frapper trois coups.
– Rassure-toi, c’est moi qui les ai frappés.
– Vous !
– Oui, j’étais de l’autre côté.
– Par où avez-vous donc passé ? demanda Milon non moins étonné.
– Par le chemin que Rocambole suivra demain répondit Marmouset. L’heure de la délivrance approche !
XLII
Il était dix heures du soir quand la table de thé réunit le gouverneur de Newgate, sa famille et ses hôtes.
Sir Robert avait été de fort bonne humeur durant toute la journée.
Mais, vers le soir, son front s’était assombri.
La cause de cette tristesse subite, c’était l’homme gris.
Car enfin, il allait falloir s’exécuter, c’est-à-dire faire venir le dangereux prisonnier chez lui, le mettre en contact avec sa femme et ses filles.
Après le dîner, sir Robert s’était esquivé un moment sous le prétexte de faire une ronde à l’intérieur de la prison.
Et il s’était fait ouvrir la cellule du prisonnier.
Rocambole, toujours calme, l’avait salué avec son aménité ordinaire.
– Vous paraissez souffrant, milord ? lui avait-il dit.
– Non, mais inquiet, gentleman.
– Et pourquoi cela, milord ?
– Je me défie de vous.
– Par exemple !
– Si vous alliez, ce soir, manquer de convenance chez moi !
– Ah ! milord, votre supposition est injurieuse.
– Non que vous soyez un homme parfaitement bien élevé, je le reconnais, mais pour me jouer quelque vilain tour.
– Ah ! milord !
– Vous me jurez que vous serez raisonnable ?
– Je vous le jure.
Et sir Robert s’en était allé un peu soulagé ; mais son anxiété l’avait repris bientôt. Et, une fois encore, la pensée d’une complicité mystérieuse entre l’homme gris et son hôte lui était revenue.
Donc à dix heures, on prenait le thé chez le gouverneur, lorsque Marmouset dit à sir Robert :
– Et le prisonnier ?
– On va l’amener, répondit sir Robert avec un soupir. J’ai voulu seulement attendre que les gardiens eussent fini leur service.
– Vous avez bien fait, dit Marmouset.
Sir Robert sonna.
– Dites au gardien chef Wilson, dit-il, qu’il peut exécuter les ordres que je lui ai donnés.
Le domestique sortit.
Il s’écoula environ dix minutes, puis la porte du parloir s’ouvrit.
Marmouset regardait Vanda.
Vanda fut sublime de calme et d’impassibilité ; elle regarda l’homme qui entrait avec une parfaite indifférence, mélangée cependant d’une certaine émotion.
Et l’homme qui entrait, pourtant, c’était Rocambole.
Le gardien qui l’avait amené était resté dans l’autre chambre.
L’homme gris salua avec une aisance parfaite.
En dépit du costume de toile grise des prisonniers, il apparut aux dames comme un gentleman accompli.
– Madame, dit Marmouset à Vanda, voilà ce pauvre Français qui m’a servi de compagnon de captivité.
Sir Robert était fort ému.
– Mon ami, reprit Marmouset, je vous ai fait venir à la seule fin de jouer avec vous cette fameuse partie d’échecs dont vous m’avez parlé.
– Je le sais, dit Rocambole.
– Ah !
– Son Honneur m’en a prévenu ce matin. Et Rocambole salua sir Robert.
L’émotion de celui-ci était si grande que pour la dissimuler il alla chercher lui-même le jeu et disposa l’échiquier.
Marmouset lui dit en riant :
– Je suis un peu vindicatif, sir Robert.
– Oh ! fit le gouverneur, qui essaya de rire et qui ne put y parvenir.
– Il paraît que nous vous avons horripilé, ce gentleman et moi, en parlant javanais ?
– C’est une singulière langue, en effet.
– Eh bien ! dit Marmouset, nous allons vous l’apprendre.
– Me l’apprendre ! continua le bon gouverneur.
– Oui ; écoutez-moi bien.
– Comment, vous allez encore parler cet affreux jargon ?
Rocambole regarda sir Robert en souriant et d’une façon qui voulait dire :
– Je vous ai prévenu ce matin. C’est une toquade.
– Père, dit miss Lucy, une des filles du gouverneur, madame va nous faire un peu de musique, pendant que ces gentlemen joueront aux échecs.
Vanda se leva et se mit au piano.
En même temps Rocambole et Marmouset s’assirent face à face, l’échiquier posé entre eux.
Et Marmouset, tout en rangeant ses pièces, se mit à parler javanais, tandis que Vanda exécutait des variations brillantes qui couvraient à demi le bruit de sa voix.
– Maître, dit alors Marmouset, tout est prêt.
– Comment l’entends-tu ?
– Il dépend de vous d’être délivré la nuit prochaine.
– Par les fénians ?
– Non, par nous.
– Explique-toi.
– J’ai fait ce que vous m’avez dit. Milon, et moi nous avons acheté une boutique dans Old Bailey.
– Fort bien.
– Nous nous sommes procuré le plan dont vous m’aviez parlé.
– Et vous avez retrouvé l’entrée des souterrains.
– Parfaitement.
Alors Marmouset raconta à Rocambole, parlant toujours javanais du reste, ce que lui, Milon et leurs compagnons avaient fait.
Il n’omit aucun détail, pas même celui de sa descente dans l’oubliette et des trois coups frappés sur la porte de fer et entendus par Polyte.
Et Marmouset ajouta :
– J’ai à mes ordres un petit bateau à vapeur qui se tiendra tout près de l’orifice du souterrain qui aboutit à la Tamise.
– Fort bien, répondit Rocambole. Mais les fénians…
– Je n’en ai plus entendu parler.
– Ils travaillent pourtant à me sauver.
– C’est probable. Mais nous arriverons avant eux.
– Voilà ce que je ne veux pas.
– Pourquoi ?
– Je voudrais leur voir tenter quelque chose.
– À quoi bon ?
– Pour savoir si, une fois libre, je dois les servir encore ou les abandonner.
– Oh ! dit Marmouset, nous avons bien d’autres choses à faire à Paris !
– C’est possible ; mais tu n’iras pas contre ma volonté.
– Assurément non, maître.
– Donc, écoute ce que je vais te dire.
– Parlez, dit Marmouset avec soumission.
*
* *
Sir Robert examinait l’homme gris et Marmouset avec inquiétude.
– Ah ! pensait-il, si ce maudit Français restait un mois ici, je crois que mes cheveux deviendraient blancs comme neige.
XLIII
Pendant que Marmouset et Vanda s’installaient chez le gouverneur de Newgate, miss Ellen, toujours sous le costume des dames des prisons, demeurait dans la chambrette de Sermon Lane.
Marmouset l’était venu voir le matin et lui avait dit :
– Je ne sais pas ce que font les fénians, mais je puis vous affirmer que nous le sauverons, nous.
– Et comment ?
Marmouset avait alors développé son plan et miss Ellen l’avait approuvé de tous points.
Puis il lui avait appris que le soir il verrait Rocambole et il lui avait promis de revenir le lendemain.
Le lendemain, en effet, un peu après cinq heures, Marmouset arriva.
Miss Ellen l’attendait avec impatience.
Mais elle tressaillit et se sentit défaillir en voyant le jeune homme sombre et triste.
– Mon Dieu ! dit-elle, il est arrivé un malheur, pour sûr ?
– Non, dit Marmouset, mais il peut en arriver un.
– Que voulez-vous dire ?
– Tout est prêt pour la délivrance. Le souterrain est déblayé, nos compagnons sont résolus. J’ai sous la main un bateau à vapeur qui, avant le jour, nous aura conduits hors de la Tamise, en pleine mer, au delà du canon anglais.
– Bon.
– Eh bien ! IL ne veut pas.
– Qui ? lui ?
Marmouset fit un signe de tête affirmatif.
– Il ne veut pas être délivré ?
– Non.
– Mais pourquoi ? demanda miss Ellen stupéfaite.
– Il veut que les fénians tentent quelque chose.
– Certainement ils tiendront la parole qu’ils m’ont donnée.
– Oui, mais quand ?
– Voilà ce que l’abbé Samuel n’a pu me dire.
– Et ce qu’il faut savoir, dit Marmouset, car dussions-nous enlever Rocambole de force…
– Venez avec moi, dit miss Ellen.
– Où ? demanda Marmouset.
– À Saint-George : nous y trouverons l’abbé Samuel.
Et la pauvre jeune fille jeta sur ses épaules un manteau à capuchon.
– Vous ne craignez donc pas de sortir en plein jour ?
– Aucunement. Mon costume me rend inviolable.
Miss Ellen et Marmouset quittèrent Sermon Lane, montèrent dans un cab et se firent conduire dans le Southwark.
Un pâle rayon de soleil glissait au travers des nuages gris, et le cimetière qui entoure l’église Saint-George commençait à se couvrir d’une verdure hâtive.
Le printemps approchait.
Marmouset et miss Ellen traversèrent le cimetière et allèrent frapper à la petite porte du chœur.
Le vieux sacristain vint ouvrir.
Il témoigna d’abord quelque étonnement à la vue de miss Ellen.
Saint-George était une église et non une prison.
Mais il reconnut Marmouset.
– L’abbé Samuel est-il là-haut ? demanda celui-ci en montrant le clocher.
– Oui, mais il n’est pas seul.
– Ah !
– Il est avec les quatre chefs.
Miss Ellen et Marmouset échangèrent un regard joyeux.
– Je ne sais pas si je dois vous laisser monter ? fit le sacristain hésitant.
– Dans tous les cas, mon ami, allez le prévenir que miss Ellen veut le voir.
Le sacristain monta aussi vite que le lui permirent ses jambes chancelantes.
Puis, au bout de quelques minutes, il redescendit en disant :
– Venez, on vous attend.
Miss Ellen et Marmouset gravirent rapidement l’escalier du clocher et pénétrèrent dans la chambre secrète.
L’abbé Samuel était là avec les quatre chefs fénians.
– Ma sœur, dit le prêtre, avez-vous donc à nous dire des choses importantes ?
– Mon père, répondit miss Ellen, je viens savoir quand et comment on délivrera l’homme gris.
Elle prononça ses mots avec anxiété ; mais les quatre chefs demeurèrent impassibles…
– Ma sœur, répondit l’un d’eux, nous n’avons qu’une parole.
– Ah ! dit miss Ellen qui respira.
– L’homme gris sera sauvé.
– Mais, comment ?
– C’est un secret que nous ne pouvons révéler.
– Et quand le sauverez-vous ?
– Peut-être demain, peut-être dans huit jours, quand nous serons prêts.
Miss Ellen regarda Marmouset avec désespoir.
– Attendons alors, dit celui-ci qui parut subitement résigné.
Et ils s’en allèrent.
Comme ils sortaient du cimetière, Marmouset dit à miss Ellen :
– Mon parti est pris.
– Ah !
– Je sauverai Rocambole malgré lui.
– Vous ne croyez donc pas à la promesse des fenians ?
– Si, j’y crois. Mais ces gens-là n’en finissent pas, et le temps nous presse.
Et comme si un nouvel événement eût voulu justifier les paroles de Marmouset, au moment où la jeune fille et lui remontaient dans le cab, un homme s’approcha d’eux.
Cet homme était le détective Edward.
– Ah ! lui dit Marmouset, d’où venez-vous donc ?
– Je vous suivais.
– Eh bien ?
– J’ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre.
– Qu’est-ce donc encore ? s’écria miss Ellen éperdue.
– Le lord chief-justice, poussé par le révérend Patterson, vient de prendre une détermination.
– Laquelle ?
– L’homme gris sera jugé demain.
Marmouset et miss Ellen pâlirent.
– Et il est probable qu’il sera exécuté vingt-quatre heures après.
Miss Ellen jeta un cri sourd.
– Eh bien ! dit Marmouset, nous avons quarante-huit heures devant nous, c’est plus qu’il ne nous en faut.
– Et s’il ne veut pas, lui ? dit miss Ellen d’une voix étouffée.
– Nous l’enlèverons de force, dit Marmouset.
Et il monta dans le cab après y avoir fait asseoir miss Ellen.
– Courage ! murmura-t-il, courage !
Et le cab reprit le chemin de Sermon Lane.
XLIV
Marmouset reconduisit miss Ellen.
Puis il revint dans Old Bailey.
Milon était fort anxieux, car il n’avait pas vu Marmouset depuis la veille, c’est-à-dire depuis que celui-ci avait pu causer avec Rocambole et prendre ses ordres.
Marmouset lui dit :
– Nous n’avons pas le temps de flâner maintenant, il faut agir et promptement.
– Je crois que les fénians se remuent depuis quelques heures, répondit Milon.
– Ah !
– Cette nuit, à plusieurs reprises, j’ai vu des Irlandais en haillons rôder autour de Newgate.
– Eh bien ! dit Marmouset, s’ils veulent sauver l’homme gris, qu’ils le sauvent tout de suite.
– Pourquoi ?
– Mais parce que nous le sauverons la nuit prochaine et malgré lui.
– Comment, malgré lui ?
– Oui ! fit Marmouset avec un sourire. Le maître a une toquade, il veut que les fénians aient la bosse de la reconnaissance. Il veut être sauvé par eux.
– Tonnerre ! dit Milon en serrant ses poings, que veut-il donc que nous soyons venus faire à Londres, alors ?
– Tu sais qu’on le juge demain !
Milon frissonna.
– Mais demain nous serons en route pour la France, ajouta Marmouset. As-tu vu le capitaine du steamer ?
– Oui ! il est tout prêt.
– Tu le reverras ce soir, entre quatre et cinq heures et tu l’avertiras qu’une jeune dame se présentera à son bord.
– Miss Ellen ?
– Naturellement.
– À quelle heure !
– À minuit. Et à partir de ce moment, il devra se tenir sous petite vapeur auprès de Temple-Bar et tout prêt à partir aussitôt que nous serons embarqués.
– Mais, dit Milon, êtes-vous bien sûr, maintenant que nous pourrons réussir cette nuit ?
– Incontestablement. Descendons dans le souterrain et emmenons avec nous William qui est fort comme un Turc.
– Allons, dit Milon, qui alluma la lanterne.
Les autres compagnons de Marmouset, bien qu’ils n’eussent pas entendu les paroles qu’il échangeait à voix basse avec Milon, comprenaient que l’heure était solennelle, et aucun d’eux ne fit la moindre question.
Milon fit un signe au matelot William.
William le suivit sans objection.
Quand ils furent dans la cave, Marmouset y prit un marteau.
Puis ils continuèrent leur chemin à travers ce souterrain qu’ils avaient si péniblement déblayé la veille et l’avant-veille, et ils arrivèrent ainsi jusqu’à cette dernière porte de fer derrière laquelle Polyte avait entendu fort distinctement les trois coups frappés par Marmouset.
Alors Marmouset prit le marteau, et en quelques coups il eut ouvert la porte.
Alors apparut le mur de brique, et dans ce mur le trou que sir Robert M… avait ménagé pour que, du fond de l’oubliette, on pût, une lampe à la main, admirer le travail de cette porte qu’il n’avait jamais pu ouvrir.
– Tu n’es pas un maçon pour rien, dit alors Marmouset à Milon. Que penses-tu de ce mur ?
– D’abord, qu’il est très mince.
– Et qu’on peut le démolir facilement ?
– Il n’y a pas besoin de le démolir. Vous allez voir…
Et Milon donna un coup d’épaule dans la cloison de brique qui trembla.
– Attends, dit William, je vais t’aider.
Et à son tour il se rua sur la cloison, arc-boutant ses pieds énormes contre les montants en pierre qui encadraient la porte.
Ce fut l’histoire d’une seconde.
Le mur s’écroula. Le chemin de l’oubliette était ouvert. Marmouset y pénétra encore le premier.
– Regarde bien où nous sommes, dit-il.
– Pardi ! répondit Milon, nous sommes dans un puits.
– Mais ce puits a un orifice.
– Cela va sans dire.
– Et il a six mètres de profondeur.
– Bon !
– Il faut donc trouver une échelle de six mètres.
– L’échelle est facile à trouver, dit Milon, mais… il y a une difficulté, néanmoins.
– Laquelle ?
– Comment la dresser ? Nous n’avons pas assez de place entre cette brèche que nous venons de faire et le pavé du puits.
– J’ai prévu l’objection.
– Ah !
– Et j’ai commandé dans Osborn-street, à un charpentier, une échelle qui se démonte en cinq morceaux.
– C’est différent.
– Tu poses ton premier morceau. Arrivé au dernier échelon, tu ajoutes le second tronçon qu’on te passe ; puis le troisième.
– Compris, dit Milon.
– À présent, poursuivit Marmouset, qui parlait en anglais pour être mieux compris de William, écoutez-moi bien.
– Parlez, dit Milon.
– Tu iras chercher l’échelle ce soir.
– Bon !
– À onze heures vous descendrez tous ici. Vous serez armés d’un poignard et d’un revolver.
– Et la petite femme ?
– Vous l’amènerez ici, et elle attendra.
L’échelle dressée, tu monteras le premier, et les autres te suivront.
– Fort bien.
– Quand vous serez en haut, vous vous trouverez dans une cave.
Elle est fermée à clef, mais la Mort-des-Braves a été serrurier, n’est-ce pas ?
– Oui.
– Il fera sauter la serrure. La porte ouverte, vous trouverez un escalier, vous le gravirez et vous vous trouverez dans la cuisine du gouverneur. Vous n’y rencontrerez qu’une servante, renversez-la à terre et bâillonnez-la.
La cuisine est voisine de la salle à manger ; vous pénétrez dans cette pièce.
– Et puis ?
– Et là vous entendrez un bruit de voix à travers une porte ; alors vous attendrez.
– Quoi donc ?
– Un signal que je vous donnerai en temps et lieu.
– Et si nous rencontrons d’autres personnes que les servantes ?
– S’il le faut, vous tuerez, dit froidement Marmouset, mais pas avec vos revolvers, avec vos poignards.
– C’est l’arme vraie, dit Milon ; le revolver est un bavard qui fait souvent plus de bruit que de besogne.
– Vous avez bien compris, n’est-ce pas ?
– Parfaitement, dit William.
– Admirablement compris, répéta Milon.
– Eh bien ! dit Marmouset, tu iras chercher l’échelle et tu feras la leçon aux autres.
XLV
Miss Ellen n’avait pas revu Marmouset depuis le matin.
Mais, en la quittant, le jeune homme lui avait dit :
– Je vous répète que nous sauverons le maître malgré lui, et cela la nuit prochaine.
– Que dois-je donc faire, moi, d’ici là ? avait demandé la jeune fille.
– Attendre.
– J’attendrai.
– Ce soir, vers huit heures, avait ajouté Marmouset, Milon viendra vous chercher.
– Et je le suivrai ?
– Oui.
– Où me conduira-t-il ?
– À bord d’un steamer qui chauffe sur la Tamise.
Miss Ellen avait eu un battement de cœur.
– Et ce steamer, ajouta Marmouset, nous conduira tous en France.
Et miss Ellen avait attendu.
Le soir, en effet, elle avait vu venir Milon à l’heure indiquée.
Milon était joyeux.
– Ah ! miss, lui dit-il, tandis que la jeune fille s’appuyait sur son bras et qu’ils parcouraient les rues désertes de la Cité, nous n’avons plus besoin des fénians à présent, et j’en suis joliment content.
– En vérité ! dit-elle.
– J’aurais été un peu humilié que le maître fût délivré par d’autres que par nous, continua Milon.
– Qui sait ? fit miss Ellen, les fénians travaillent de leur côté, ce n’est pas douteux… et ils arriveront peut-être avant nous.
– Oh ! pour ça, non.
– Qu’importe, dit-elle avec un accent de dévouement et d’amour, qu’importe que ce soit vous ou eux, pourvu qu’il soit libre enfin ?
– Nous avons notre petit amour-propre, dit le bon Milon.
Miss Ellen eut un sourire mélancolique.
– Pensez-vous, dit-elle, que je n’ai pas mon orgueil, moi ?
– Cela est certain, miss Ellen.
– Eh bien ! cet orgueil, je vous l’ai sacrifié.
Et comme Milon la regardait avec étonnement, miss Ellen continua :
– Les fénians travaillent à je ne sais quel plan mystérieux ; vous autres, poursuivit miss Ellen, vous avez creusé un souterrain.
Moi seule, je n’ai rien fait encore ; mais que les fénians échouent, que votre plan avorte, et c’est moi qui alors le sauverai.
– Vous ! dit Milon d’un air de doute.
– Je me nomme miss Ellen Palmure, dit la jeune fille, je suis la fille d’un pair d’Angleterre, et je saurai bien, s’il le faut, aller me jeter aux pieds de la reine et obtenir la grâce de celui a qui j’ai donné ma vie et mon cœur tout entier.
Ses yeux brillaient d’un sombre enthousiasme tandis qu’elle parlait ainsi.
– Mais nous n’aurons pas besoin de cela, dit Milon.
Miss Ellen, je vous le répète, dans quelques heures le maître sera parmi nous.
– Dieu vous entende ! murmura la jeune fille.
Et ils continuèrent à marcher.
Ils arrivèrent ainsi au bas de Sermon Lane et suivirent le bord de la Tamise.
Le brouillard avait reconquis son domaine et le fleuve avait disparu sous sa couche épaisse.
Mais on entendait le clapotis des flots qui rongeaient, la rive en passant, et un plus loin, la respiration haletante d’une machine à vapeur.
C’était le steamer qui chauffait.
Milon mit deux doigts sur sa bouche et fit entendra un coup de sifflet.
– Attendons, dit-il.
Peu après, miss Ellen entendit un bruit d’avirons qui battaient l’eau et semblaient s’approcher du bord.
Puis, quelques secondes s’écoulèrent et, perçant le brouillard, une barque vint heurter le bord et fit jaillir un flot d’écume autour d’elle.
Alors Milon dit à l’homme qui se dressa du fond de la barque :
– Viens-tu du Shocking !
– Yes ! répondit le matelot.
– Embarquez, miss Ellen, dit Milon.
Et il fit monter la jeune fille dans la barque.
Puis il ajouta :
– C’est Marmouset qui a baptisé le steamer : il se nomme Shocking. Le capitaine est un ami de William. Il nous est dévoué.
Le matelot qui conduisait l’embarcation poussa au large, et miss Ellen vit bientôt le steamer se détacher en noir sur le fond rouge du brouillard.
Dix minutes après, elle était à bord.
– À bientôt, miss Ellen, lui dit Milon ; il est huit heures, à minuit nous serons tous réunis.
Et il redescendit dans la barque et dit au matelot :
– Mets-moi sous le pont de Waterloo.
La barque remonta la Tamise à force de rames et eut bientôt abordé à l’endroit indiqué par Milon.
Alors celui-ci sauta à terre et remonta vers le Strand.
Il appela un cab qui passait à vide, sauta dedans et se fit conduire dans Osborn street.
C’était là qu’était le charpentier que lui avait indiqué Marmouset et qui avait construit l’échelle se démontant en quatre morceaux.
Et une heure après, muni de l’échelle, Milon était de retour dans Old Bailey.
XLVI
Milon retrouva ses compagnons en émoi.
Ils avaient fermé la boutique depuis longtemps, mais ils étaient tous réunis et, sans lumière, ils avaient laissé entre-bâillée la petite porte basse.
– Ah ! dit la Mort-des-Braves, nous t’attendons avec une vive impatience, Milon.
– Qu’est-ce qu’il y a donc ? fit celui-ci.
– Depuis que tu es parti, il s’est passé de drôles de choses ici !
– Hein ?
– Je vais vous dire ça, moi, fit Polyte.
– Parle, dit Milon.
– Figurez-vous, reprit Polyte, que depuis l’entrée de la nuit nous avons vu circuler sur la place des gens de mauvaise mine.
– Des Irlandais ?
– Probablement.
Ils étaient deux par deux, ou trois par trois, et ils se suivaient à distance.
– Et puis ?
– Tout à coup, nous en avons vu un qui conduisait une charrette de brasseur.
– Bon !
– Il s’est arrêté un moment devant Newgate, entre les deux portes.
– Ah !
– Alors deux autres hommes qui se trouvaient sous une des deux portes se sont approchés.
– Et ils lui ont parlé ?
– Et ils l’ont aidé à débarquer une futaille qu’ils ont placé contre le mur.
– Et qu’en ont-ils fait ensuite ?
– Rien. Ils sont montés dans la voiture du brasseur et ils se sont éloignés.
– Mais la futaille ?…
– Elle est toujours là-bas.
– Au pied du mur ?
– Oui. Venez donc la voir, dit Polyte.
– Un moment, dit Milon, laissons passer les policemen.
En effet, on entendait dans le haut d’Old Bailey les pas lents et mesurés de deux gardiens de nuit qui cheminaient en tâtant les portes pour voir si elles étaient bien fermées.
Les policemen passèrent.
Alors Milon dit à Polyte :
– Viens, allons voir, maintenant.
Et ils se glissèrent dans Old Bailey et s’approchèrent du mur de Newgate.
– Voilà le baril, dit Polyte.
Milon vit alors un grand tonneau qui pouvait contenir un muid de vin et qui était hermétiquement clos.
– Qu’est-ce qu’il peut donc y avoir là dedans ? dit Milon.
– Ma foi, répondit Polyte, je n’en sais rien.
Milon essaya de remuer le baril.
– Trop lourd, dit-il.
– J’ai dans mon idée, reprit Polyte, que c’est de la poudre.
Milon tressaillit.
– Pourquoi donc faire ? dit-il.
– Pour faire sauter Newgate.
Milon haussa les épaules.
– Et qui veux-tu qui fasse sauter, Newgate ? dit-il.
– Les fénians.
– Pour délivrer Rocambole ?
– Oui.
– Imbécile ! S’ils faisaient sauter la prison ils tueraient du même coup celui qu’ils veulent sauver.
– C’est juste, dit Polyte. C’est égal, faisons donc le tour de la prison.
Ils se mirent en marche. Cent pas plus loin, le long du mur d’enceinte, il y avait un autre baril semblable au premier.
– Sais-tu ce que c’est ça ? fit Milon.
– Non, dit Polyte.
– C’est du gin volé. Les voleurs l’ont laissé ici et viendront le reprendre demain matin.
– Je ne crois pas, dit Polyte, et je persiste dans mon opinion.
– Que c’est de la poudre ?
– Oui.
– Eh bien ! quand Newgate sautera, nous n’y serons plus.
– C’est égal, dit Polyte, je serais d’avis de prévenir Marmouset.
– Comment ? Sous quel prétexte veux-tu maintenant que nous entrions dans Newgate ?
– C’est vrai, soupira Polyte.
– Il faut, au contraire, reprit Milon, mener les choses rondement.
– Comment cela ?
– Et ne pas perdre une minute. Si les fénians veulent faire sauter la prison, il faut arriver avant eux. Et notre amour-propre, donc !
Ce disant, Milon battit en retraite et Polyte le suivit.
Ils revinrent dans la boutique.
– Quel heure est-il ? demanda Milon.
– Dix heures un quart.
– Nous n’avons plus que trois quarts d’heure. Ce n’est pas de trop. Allons, mes enfants ! à l’œuvre !
La petite porte de la boutique fut fermée soigneusement et alors on ralluma les lampes.
– Tout est prêt en bas, dit la Mort-des-Braves.
– Descendons l’échelle, fit Milon.
Chacun se chargea d’un tronçon et on descendit dans la cave.
Pauline suivait son mari.
Dans la cave, Milon distribua des armes à ses compagnons.
Puis on prit le chemin du souterrain.
Arrivés à la porte de fer, Milon dit à la jeune femme :
– Vous n’êtes pas poltronne, au moins ?
– Je suis enfant de Paris ! répondit l’ancienne petite blanchisseuse.
– Mais c’est que vous allez rester seule ici.
– Cela m’est égal, si j’ai de la lumière.
– Et vous nous attendrez peut-être une heure.
– J’attendrai ! dit-elle.
Et elle embrassa Polyte.
Alors Milon fit dresser un premier tronçon de l’échelle dans l’oubliette et monta.
Puis on lui passa le second, qu’il ajusta, et il monta encore.
Au bout d’un quart d’heure il était au haut de l’oubliette et faisait sauter la planche qui en recouvrait l’orifice.
Alors ses compagnons montèrent un à un, le poignard aux dents, le revolver au poing, et Pauline, la courageuse petite femme, demeura seule dans le souterrain.
XLVII
Cependant Marmouset était rentré à Newgate bien avant la nuit.
Il avait retrouvé Vanda faisant de la musique avec les filles de sir Robert, tandis que mistress Robert M… brodait au métier, comme les femmes anglaises de la classe bourgeoise.
Sir Robert était absent de son logis.
Mais il était dans l’intérieur de la prison.
Il ne revint qu’à l’heure du repas du soir.
Marmouset le trouva pâle et soucieux.
– Oh ! oh ! sir Robert, lui dit-il, vous paraissez légèrement préoccupé ce soir ?
– Je le suis en effet, gentleman.
– Que vous arrive-t-il ?
– Je vous dirai cela après souper.
– Ah !
– Les mauvaises nouvelles gagnent toujours à être reculées…
Marmouset ne sourcilla pas.
Il devinait sans doute la mauvaise nouvelle dont le bon gouverneur voulait l’entretenir.
Alors il n’insista pas.
Le repas du soir eut lieu comme de coutume.
Après, et sous le prétexte de fumer un cigare, sir Robert, emmena Marmouset dans son cabinet.
– Voyons cette mauvaise nouvelle dont vous me menacez ? dit Marmouset.
– Eh bien ! je crains que vous ne puissiez plus faire votre partie d’échecs avec l’homme gris.
– Ah bah ! fit Marmouset.
– J’ai reçu, il y a quelques heures, poursuivit sir Robert, une communication du lord chief-justice.
– Bon ! et cette communication…
– M’annonçait qu’on jugerait le pauvre diable demain matin.
– Oh ! mon Dieu ! s’écria Marmouset, qui joua un étonnement profond et douloureux.
– On renonce à savoir son vrai nom.
– Et puis ?
– Sa condamnation n’est pas douteuse comme bien vous pensez.
– Hélas ! j’en ai peur.
– Et il sera pendu après-demain matin, c’est presque certain.
– Eh bien ! dit Marmouset avec un calme sévère, je ferai ma partie deux soirées encore.
– Comment ! vous oseriez…
– Mais sans doute.
– Songez donc qu’il faut que j’aille faire une visite au pauvre diable ce soir, et que je lui apprenne…
– Vous la lui ferez demain.
– Non, la loi s’y oppose.
– Ah ! vraiment ?
– Et il faut que ce soir, avant minuit…
– Eh bien ! ce soir quand ma partie d’échecs sera finie, vous lui direz tout.
Et Marmouset avait un sang-froid tel, que sir Robert se demandait s’il était en présence d’un tigre ou d’un homme.
Marmouset devina sa pensée :
– Milord, dit-il, il est temps que je joue avec vous cartes sur table.
– Que voulez-vous dire ?
– Vous m’avez pris pour un gentleman excentrique…
– Dame !
– Je le suis peut-être, mais je suis un joueur d’échecs forcené.
– Bon !
– À Paris je bats tout le monde. À Londres, l’an dernier, je ne trouvais plus d’adversaire au club de West India. Mais j’en ai trouvé un à Pétersbourg, et vous l’avouerai-je ? moi, le vainqueur sempiternel, j’ai été battu.
– En vérité ! fit sir Robert M…
– Le général Ugetoff m’a constamment gagné en me disant : « Tant que vous n’aurez pas appris la partie indienne, le jeu des brahmanes, vous serez indigne de jouer avec moi. »
– Eh bien ? fit sir Robert.
– Eh bien ! l’homme gris, vous le savez, sait cette partie.
– En effet.
– Il me l’a enseignée hier soir, mais j’ai besoin d’une leçon encore.
– Et après ?
– Après je serai de force à me mesurer avec le général Ugetoff, qui m’a gagné un million de roubles l’autre année.
– Un million de roubles !
– Oui, quelque chose comme quatre millions de francs. Commencez-vous à comprendre ?
– Non, dit naïvement sir Robert.
– Pendant ma captivité à Newgate, reprit Marmouset, en causant de choses et d’autres, ce malheureux m’a juré qu’il connaissait la partie indienne.
Alors, comme mes quatre millions me tiennent au cœur, poursuivit Marmouset, je me suis dit : « Si le gouverneur de Newgate me laisse jouer avec lui, le général sera battu, et je rentrerai dans mon argent.
– Ah ! je comprends, enfin ! dit sir Robert, dont le visage s’illumina et qui, dès lors, repoussa complètement le soupçon qui l’assaillait depuis l’entrée de Marmouset à Newgate.
– Vous le voyez, poursuivit Marmouset, il ne s’agit plus pour moi d’une fantaisie, d’une excentricité, mais bien de quatre millions. Si je laisse pendre l’homme gris avant qu’il n’ait livré le dernier mot de son secret, mes quatre millions sont perdus.
– C’est juste, soupira sir Robert.
– Et je serai alors obligé de me rejeter sur l’indemnité que M. Staggs me promet de me faire avoir.
Sir Robert M… eut un cri d’angoisse.
– Oh ! dit-il, vous ne ferez pas cela, gentleman !
– Alors faites que j’aie ma dernière leçon.
Sir Robert M… se grattait l’oreille et il était devenu rouge comme une pivoine.
– Songez, dit froidement Marmouset, que si vous me refusez, dès demain matin je vais trouver M. Staggs.
Sir Robert M… chancela…
XLVIII
Le bon gouverneur était sous le poids d’une véritable oppression.
Jamais peut-être il ne s’était trouvé en situation aussi délicate.
Pour bien prouver à Marmouset sa sincérité, il lui montra le pli que lui avait envoyé le lord chief-justice.
– Voyez, dit-il, quelle position vous me faites… Si je ne vous satisfais pas…
– Je vous ruine, dit froidement Marmouset.
– Si je vous satisfais, je désobéis à la justice et à la loi.
– En quoi ?
– En ce que je dois avertir le prisonnier avant minuit.
– Nous aurons fini notre partie à onze heures.
– Mais cette soirée qu’il consacrera naïvement à jouer aux échecs, le malheureux l’eût passée avec son avocat.
– Puisque vous dites qu’il sera condamné !
– Et si le lord chief-justice apprend jamais la vérité, je serai destitué !
– Non, dit Marmouset.
– Oh ! fit sir Robert d’un air de douleur.
– Vous serez félicité, au contraire !
– Par exemple !
– Et je parierais pour une gratification de deux mille livres qui vous sera offerte.
– Voilà que je ne comprends plus, murmura sir Robert ahuri.
– Vous me dites, n’est-ce pas ? qu’on juge l’homme gris sans avoir pu découvrir son nom.
– Oui.
– Supposez que demain, à l’audience, vous vous présentiez et appreniez ce nom à la cour d’assises.
– Comment l’apprendrais-je aux autres, puisque je ne le sais pas moi-même ?
– Je vous le dirai.
– Vous ?
– Moi.
– Vous le savez donc ? exclama sir Robert.
Marmouset tira sa montre.
– Il est neuf heures, dit-il.
– Eh bien ?
– Vous allez faire venir mon partenaire à dix heures précises.
– Soit.
– À onze heures moins un quart votre femme et vos filles se retireront dans leurs chambres.
– Comme chaque soir.
– Nous resterons donc seuls ici : vous, l’homme gris ma femme et moi.
– Et puis ?
– À onze heures un quart, j’appellerai l’homme gris par son véritable nom.
– Et s’il le nie ?
– Je vous jure qu’il ne le niera pas.
– Qu’en savez-vous ?
– Quand j’étais en prison avec lui, il m’a dit : « Je n’ai d’autre intérêt à cacher mon nom que celui de reculer mon jugement. »
Mais si une fois j’étais jugé, je le dirais à mes juges.
– Oh ! fit sir Robert, est-ce vrai ce que vous me dites là, gentleman ?
– Très vrai, milord.
– Vous ne vous moquez pas de moi ?
– Un homme qui court après quatre millions ne se moque jamais de personne.
L’observation parut juste à sir Robert.
– Ainsi donc faites venir le prisonnier, dit Marmouset. Si demain vous étiez réprimandé, vous fermeriez la bouche au lord chief-justice en lui apprenant que, dans un haut intérêt de la justice, vous avez cru devoir sauter à pieds joints par-dessus les règlements de la prison.
Sir Robert, ravi, revint dans le parloir avec Marmouset, débita quelques banalités à Vanda, et, au bout d’une demi-heure, se leva, disant :
– Gentleman, je vais aller chercher votre partenaire.
En même temps il lui fit un signe qui voulait dire :
– Surtout que ces dames ne sachent rien !
– Soyez tranquille ! répondit Marmouset par un clignement d’yeux.
Alors, quand sir Robert M… fut parti, Marmouset et Vanda échangèrent quelques mots, non en français, non en anglais, mais en langue russe.
Marmouset raconta rapidement à Vanda ce qui s’était passé durant le jour.
Vanda pâlit en apprenant que le jugement était fixé au lendemain.
Mais Marmouset lui dit :
– Tout est prêt pour ce soir.
– Et si le maître ne veut pas nous suivre ?
– Oh ! il faudra bien qu’il nous suive !
– Qui sait ?
– Refuser, d’ailleurs, serait se perdre et nous perdre avec lui.
Vanda hocha la tête :
– Je ne sais pas, dit-elle, mais j’ai été tout le jour d’une tristesse mortelle.
– Bah !
– J’ai de sombres pressentiments.
Marmouset haussa les épaules.
– C’est le climat de Londres qui en est cause, dit-il.
– Et le thé que nous buvons à pleines tasses.
– Mais si notre projet allait échouer ?…
– Eh bien ! les fénians travaillent de leur côté. Avez-vous votre poignard, Vanda ?
– Il ne me quitte jamais.
– C’est bien, dit Marmouset. À la grâce de Dieu, maintenant !
Et comme il disait cela, la porte s’ouvrit, et sir Robert M… entra avec Rocambole, toujours vêtu du triste costume des prisonniers de Newgate.
XLIX
Rocambole était aussi calme, aussi tranquille que s’il se fût encore appelé le major Avatar et qu’il fût monté à son club, sur le boulevard, à Paris, pour y faire sa partie de whist.
Marmouset était non moins calme que lui.
Seule, Vanda avait sur son visage une tristesse qui frappa Rocambole.
Quant à sir Robert, il regardait son prisonnier avec l’avidité d’un savant en train de déchiffrer un hiéroglyphe.
Vanda et les filles du gouverneur se remirent au piano.
Sir Robert s’assit derrière le fauteuil de Marmouset, à seule fin de ne pas perdre de vue le visage de son prisonnier placé vis-à-vis, et la partie commença.
Pendant un quart d’heure, les deux partenaires ne parurent occupés que de leur jeu.
Mais enfin Marmouset dit à Rocambole :
– J’ai du nouveau, maître.
– Je m’en suis douté : Vanda est triste.
– Comment ! dit sir Robert, vous allez encore parler votre affreux jargon ?
Marmouset se prit à sourire.
– Votre Seigneurie se trompe, dit-il.
– Cependant, vous parlez javanais ?…
– Oui, mais cette fois…
– Cette fois ?
– C’est le javanais de Java.
– À quoi bon, dit sir Robert, puisque vous avez renoncé à vous moquer de moi ?
– Parce que le javanais véritable est la langue sacrée des échecs.
– Ah ! fit sir Robert.
Et il eut un geste qui voulait dire :
– Au fait ! je suis résigné. C’est la dernière soirée, et tout à l’heure je saurai le grand mystère.
– Et qu’est-il donc arrivé ? demanda Rocambole parlant javanais de nouveau.
– J’ai vu les quatre chefs fénians et l’abbé Samuel.
– Ah ! ils travaillent à me sauver ?
– Oui ! mais ils n’ont pu me dire quand et comment.
– Peu importe !
– Cela m’importe beaucoup, maître.
– Pourquoi cela ?
– Parce que nous nous croisons les bras pendant ce temps-là.
Rocambole eut son sourire mystérieux.
– Sais-tu une chose ? dit-il.
– Parlez, maître !
– Je suppose que les fénians échouent.
– Bon !
– Et vous aussi…
– Oh ! par exemple !
– Après avoir laissé tout le monde s’occuper de mes affaires, je m’en occuperai moi-même.
– Que voulez-vous dire ?
– Je me sauverai tout seul.
– Et quand cela ?
– Dans trois jours.
En ce moment le quart avant onze heures sonna à la pendule.
Mistress Robert et ses filles se levèrent pour se retirer.
– Il sera trop tard, maître, dit alors Marmouset.
– Et pourquoi sera-t-il trop tard ?
– Parce que vous serez jugé demain.
Rocambole tressaillit.
– Et pendu après-demain.
– Ah ! dit Rocambole.
Un léger frémissement de narines fut la seule chose qui trahît l’émotion qu’il éprouva en ce moment.
– Maintenant, reprit froidement Marmouset, il faut vous résigner, maître. Pour la première fois, nous vous avons désobéi.
Rocambole eut un éclair dans les yeux.
– Dans un quart d’heure nos compagnons seront ici.
– Dis-tu vrai ?
– Et si vous ne nous suivez de bonne volonté, nous vous enlèverons de vive force.
Rocambole soupira :
– Vous êtes de braves cœurs, dit-il, et je vous pardonne votre désobéissance.
Sir Robert M…, qui ne pouvait comprendre un mot à ce qu’ils disaient, regardait, lui, aussi, la pendule avec anxiété.
Il attendait le moment où il apprendrait le véritable nom de l’homme gris.
Enfin onze heures sonnèrent.
Alors Marmouset reprit la parole en anglais, et, s’adressant à Rocambole :
– N’est-ce pas, gentleman, que si on devait vous juger sans avoir appris votre vrai nom, vous n’en feriez plus mystère ?
– Certainement non.
Sir Robert, eut un cri de joie.
– Eh bien ! dit-il brutalement, vous pouvez parler.
– Pourquoi cela, mylord ?
– Parce qu’on vous jugera sans le savoir.
– Vous voulez me faire parler, mylord.
– Non, dit sir Robert. Tenez, voici le pli du lord chief justice.
Rocambole ne toucha point à la dépêche ministérielle. Mais il dit froidement :
– Eh bien ! quand me juge-t-on ?
– Demain.
– Et, à votre estime, quand serai-je pendu ?
– Après-demain.
– Alors vous voulez savoir mon nom ?
– Je vous supplie à genoux de me le dire.
– Eh bien ! je m’appelle Rocambole !
– Rocambole ! c’est donc vous ?
– C’est moi !
Et comme Rocambole continuait à rire, un bruit sourd se fit dans l’antichambre, et on entendit un cri de détresse, puis la chute d’un corps, puis plus rien…
Sir Robert M…, effaré, se leva et voulut courir vers la porte.
Mais Marmouset se plaça tout à coup devant lui, et tirant un poignard il le lui mit sur la gorge et lui dit froidement :
– Si vous faites un pas, si vous poussez un cri, vous êtes mort !…
L
Sir Robert M… ne s’était jamais trouvé à pareille fête, ou, pour mieux dire, à pareil désagrément.
Il devint rouge d’abord, pâle ensuite ; les veines de son cou se gonflèrent et ses yeux s’arrondirent silencieusement dans leur orbite.
Tour à tour, pendant une minute, il regarda Rocambole, Vanda et Marmouset.
Tous trois étaient graves, presque solennels.
En même temps le bruit augmentait et devenait reconnaissable.
Une troupe d’hommes cheminait dans la pièce voisine et presque aussitôt la porte devant laquelle Marmouset s’était placé s’ouvrit à deux battants.
Alors un voile se déchira dans l’esprit du trop naïf et trop crédule gouverneur. Il comprit tout.
L’homme gris, qu’il se nommât Rocambole ou non, avait un complice, et ce complice, c’était Marmouset, lequel s’était moqué de l’ambassade française, aussi bien que de lui, sir Robert.
Et ces deux hommes avaient des amis.
Ces amis, sir Robert les voyait apparaître, enfin.
Milon et Polyte, la Mort-des-Braves, Jean le boucher et William, le poignard aux dents, le pistolet, au poing, venaient d’entrer par cette porte violemment ouverte.
Sir Robert M… avait été soldat dans sa jeunesse ; mais trente ans de la vie de Londres avaient fait de lui un bourgeois inoffensif et timide.
Quand il vit tous ces hommes armés, son épouvante fut si grande qu’il tomba à genoux, les mains jointes.
– Au nom du ciel, fit-il, prenez pitié de moi !
Marmouset se mit à rire…
– On ne veut pas vous tuer, si vous êtes sage, dit-il.
Le pauvre gouverneur eut un geste qui voulait dire :
– Vous ferez de moi tout ce que vous voudrez.
Rocambole serrait les mains de Milon et de ses autres libérateurs.
– Êtes-vous donc arrivés ici sans difficulté ? disait-il.
– Nous n’avons rencontré que deux petits obstacles.
– Ah !
– Une servante qui voulait crier et que nous avons bâillonnée.
– Et puis ?
– Et puis, dit Milon, un gardien qui était là dans l’antichambre. C’est William qui a été obligé de le tuer.
Marmouset semblait avoir conservé, même en présence de Rocambole, le commandement de l’expédition.
Il s’adressa à sir Robert et lui dit :
– Mon pauvre ami, je suis désolé de reconnaître si mal votre hospitalité, mais la nécessité fait loi.
Il faut donc que vous vous résigniez, sous peine de mort, d’abord à vous laisser mettre un bâillon dans la bouche, ensuite à vous laisser lier les mains et les pieds.
Sir Robert M… avait des larmes dans les yeux.
– Et moi, murmura-t-il d’un ton de reproche, moi qui vous avais pris pour un parfait gentleman !
– Je le suis à mes yeux, dit Marmouset.
Et il prit au cou de Vanda silencieuse un foulard qu’il se mit à rouler en corde.
Puis il le présenta galamment au pauvre gouverneur.
– Allons, cher ami, dit-il, prenez-moi donc ça avec les dents.
Sir Robert M… fit signe qu’il voulait dire un mot encore.
– Soit, fit Marmouset, parlez…
– Vous ne ferez pas de mal à ma femme et à mes enfants, au moins ? dit-il d’une voix entrecoupée de sanglots.
– Pas plus qu’à vous, cher ami.
– Vous ne voulez rien voler ici ?
– Fi ! monsieur, dit Marmouset, pour qui nous prenez-vous ? Nous sommes des conspirateurs, mais non des voleurs.
Sir Robert eut un geste de résignation.
Il se laissa bâillonner, puis garrotter et on le coucha délicatement sur le parquet.
– À présent, dit Marmouset, filons !
– Le steamer est donc prêt ? demanda Rocambole.
– Il chauffe devant l’orifice du souterrain qui aboutit à la Tamise.
– Et… miss Ellen ?
La voix du maître tremblait légèrement en prononçant ce nom.
– Miss Ellen est à bord du steamer.
– Ah !
Et Rocambole fit un pas vers la porte.
Puis il se retourna et regarda Vanda.
– Qu’as-tu donc, toi ? fit-il.
Vanda était pâle et triste, Vanda semblait en proie à une vague et mystérieuse épouvante.
Elle était demeurée assise en son fauteuil et n’en bougeait pas.
– Mais qu’a-t-elle donc ? fit à son tour Marmouset.
– J’ai peur, dit Vanda.
– Peur de quoi ?
– Je ne sais… mais j’ai peur…
– Le maître est pourtant avec nous, dit Marmouset.
– Allons, viens !
Vanda se leva avec effort.
Ses jambes fléchissaient sous elle ; elle marchait comme une personne frappée de la foudre.
Rocambole tressaillit.
– C’est bizarre ! murmura-t-il.
– C’est un effet nerveux ! dit Marmouset.
Et il prit Vanda par le bras et l’entraîna.
Tout à coup, et comme ils arrivaient dans la cuisine où la servante était bâillonnée, Vanda s’arrêta encore.
– N’allons pas plus loin, dit-elle.
– Elle est folle ! murmura Marmouset.
– Il est trop tard pour reculer maintenant, dit Rocambole, également impressionné par l’accent prophétique de la jeune femme.
– J’ai peur… j’ai peur… répéta-t-elle.
Et ses dents s’entre-choquaient violemment.
LI
Milon et Rocambole se regardaient silencieusement.
Enfin Rocambole s’écria :
– Mais pourquoi donc a-t-elle peur ?
– Je ne sais pas, dit Marmouset.
– Un pressentiment ! murmura Vanda.
– Nous ne pouvons pourtant pas demeurer ici, maintenant, fit Marmouset.
Rocambole eut un soupir.
– Vanda est Russe, dit-il, elle croit à la destinée.
– Allons ! dit Vanda, et Dieu nous protège !
Ils descendirent dans la cour, où ils avaient laissé une lanterne allumée.
– Mes enfants, dit alors Rocambole, je suis toujours votre capitaine. Par conséquent, je mettrai le dernier le pied sur l’échelle.
– Vous descendrez avant moi, maître, dit Marmouset.
– Et pourquoi cela ?
– Parce que le remords pourrait vous prendre, du moment où ce ne sont pas les fénians qui vous délivrent.
Rocambole haussa les épaules.
– Tu es un niais ! dit-il.
Et il mit le pied sur l’échelle après Milon, qui était déjà descendu au fond de l’oubliette.
Ils descendirent ainsi un à un.
Quand ils furent tous dans le souterrain, Milon respira bruyamment.
– Maintenant ! dit-il, les fénians peuvent mettre le feu à leur poudre.
Rocambole tressaillit.
– De quelle poudre veut-on parler ? dit-il.
– Que dis-tu ? s’écria Marmouset.
– Les fénians voulaient vous délivrer cette nuit, maître.
– Comment le sais-tu ?
– Polyte et moi, nous avons vu les barils.
– Des barils de poudre ?
– Oui, contre le mur de Newgate. Mais quand Newgate sautera, nous serons loin.
Vanda répétait :
– J’ai peur, j’ai peur…
Ils étaient arrivés dans la salle circulaire, où ils avaient laissé Pauline.
La petite femme était un peu pâle, et son isolement momentané avait surexcité ses nerfs à un tel point qu’elle jeta un cri en voyant Polyte et, se suspendant à son cou, elle lui dit :
– Viens, partons, partons vite !
– Ah ! dame dit Milon, il n’y a pas de temps à perdre.
Et regardant Marmouset en lui montrant un des trois souterrains qui aboutissaient à la salle circulaire :
– C’est bien celui-ci qu’il faut prendre ?
– Oui.
– C’est celui qui aboutit à la Tamise ? demanda Rocambole.
– Oui, maître.
Mais soudain le sol mugit et trembla sous leurs pieds, une détonation épouvantable se fit entendre et ils furent tous jetés violemment à terre.
– Ah ! voilà le malheur que je pressentais ! dit Vanda en tombant.
– La poudre ! la poudre des fénians ! hurla Milon.
Derrière eux, la galerie souterraine qu’ils venaient de parcourir s’écroulait avec fracas.
– Fuyons ! il en est temps encore ! s’écria Marmouset.
Et il voulut entraîner Rocambole dans la nouvelle galerie qui aboutissait à la Tamise.
Les autres s’étaient relevés.
Cependant la terre tremblait toujours sous leurs pieds, et les éboulements continuaient.
– Ah ! dit Rocambole, qui se redressa, lui aussi, l’œil en feu et le front calme, est-ce donc ma dernière heure qui sonne ?
– Non, non ! dit Marmouset. Le chemin est libre, fuyons !
– Nous sommes perdus ! s’écria Vanda. Au nom du ciel ! n’allons pas plus loin !…
– Marchons ! dit au contraire Marmouset.
– Marchons ! répéta Rocambole.
– Ah ! les gredins de fénians ! hurlait Milon.
Ils firent environ une trentaine de pas dans la nouvelle galerie.
Mais tout à coup une nouvelle détonation se fit entendre.
Vanda jeta un cri suprême et tomba sur ses genoux.
Les compagnons de Rocambole se regardèrent avec une morne épouvante.
Seul, le maître demeura calme et le front haut.
La galerie qui menait à la Tamise s’écroulait à son tour, et sans doute elle allait engloutir tout vivants Rocambole et ses imprudents compagnons.
À propos de cette édition électronique
Texte libre de droits.
Corrections, édition, conversion informatique et publication par le groupe :
Ebooks libres et gratuits
http://fr.groups.yahoo.com/group/ebooksgratuits
Adresse
du site web du groupe :
http://www.ebooksgratuits.com/
—
Septembre 2011
—
– Élaboration de ce livre électronique :
Les membres de Ebooks libres et gratuits qui ont participé à l’élaboration de ce livre, sont : Christian, Jean-Marc, BertrandG, PatriceC, Coolmicro.
– Dispositions :
Les livres que nous mettons à votre disposition, sont des textes libres de droits, que vous pouvez utiliser librement, à une fin non commerciale et non professionnelle. Tout lien vers notre site est bienvenu…
– Qualité :
Les textes sont livrés tels quels sans garantie de leur intégrité parfaite par rapport à l'original. Nous rappelons que c'est un travail d'amateurs non rétribués et que nous essayons de promouvoir la culture littéraire avec de maigres moyens.
Votre aide est la bienvenue !
VOUS POUVEZ NOUS AIDER À FAIRE CONNAÎTRE CES CLASSIQUES LITTÉRAIRES.