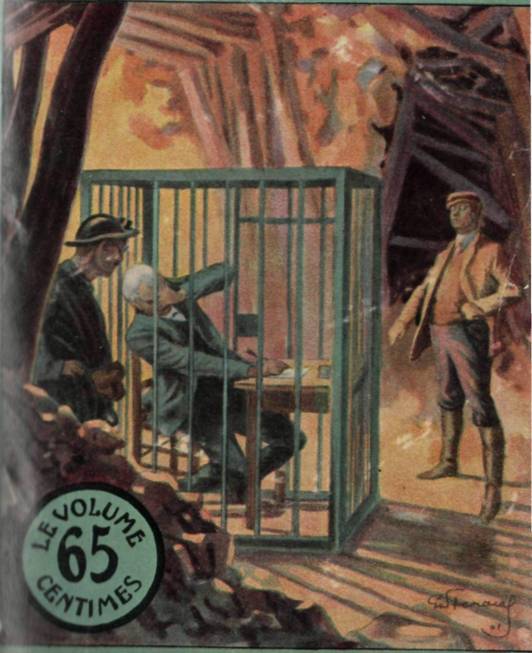
Pierre Alexis Ponson du Terrail
ROCAMBOLE
LA CORDE DU PENDU
Tome I – LA CORDE DU PENDU
Texte établi d’après l’édition Arthème Fayard – mars 1910 –
le Livre populaire n°19, XVe aventure de Rocambole publiée dans
cette collection.
Publication originale dans La Petite Presse – 29 mars au 18 juillet 1870
– 112 épisodes, en deux parties : Le Fou de Bedlam et L’Homme en
gris.
Table des matières
XVI Journal d’un fou de Bedlam I
XVII Journal d’un fou de Bedlam II
XVIII Journal d’un fou de Bedlam III
XIX Journal d’un fou de Bedlam IV (Suite) et V.
XX Journal d’un fou de Bedlam VI
XXI Journal d’un fou de Bedlam VII
XXII Journal d’un fou de Bedlam VIII
XXIII Journal d’un fou de Bedlam IX
XXIV Journal d’un fou de Bedlam X
XXV Journal d’un fou de Bedlam XI
XXVI Journal d’un fou de Bedlam XII
XXVII Journal d’un fou de Bedlam XIII
XXVIII Journal d’un fou de Bedlam XIV
XXIX Journal d’un fou de Bedlam XV
XXX Journal d’un fou de Bedlam XVI
XXXI Journal d’un fou de Bedlam XVII
XXXII Journal d’un fou de Bedlam XVIII
XXXIII Journal d’un fou de Bedlam XIX
XXXIV Journal d’un fou de Bedlam XX
XXXV Journal d’un fou de Bedlam XXI
XXXVI Journal d’un fou de Bedlam XXII
XXXVII Journal d’un fou de Bedlam XXIII
XXXVIII Journal d’un fou de Bedlam XXIV
XXXIX Journal d’un fou de Bedlam XXV
XL Journal d’un fou de Bedlam XXVI
XLI Journal d’un fou de Bedlam XXVII
XLII Journal d’un fou de Bedlam XXVIII
XLIII Journal d’un fou de Bedlam XXIX
XLIV Journal d’un fou de Bedlam XXX
XLV Journal d’un fou de Bedlam XXXI
XLVI Journal d’un fou de Bedlam XXXII
XLVII Journal d’un fou de Bedlam XXXIII
XLVIII Journal d’un fou de Bedlam XXXIV
XLIX Journal d’un fou de Bedlam XXXV
L Journal d’un fou de Bedlam XXXVI
LI Journal d’un fou de Bedlam XXXVII
LII Journal d’un fou de Bedlam XXXVIII
LIII Journal d’un fou de Bedlam XXXIX
LIV Journal d’un fou de Bedlam XL
À propos de cette édition électronique
LA CORDE DU PENDU
I
L’écroulement du souterrain durait toujours.
La voûte de la galerie se détachait par fragments de blocs énormes.
Le sol continuait à mugir et à trembler.
On eût dit un de ces tremblements de terre qui ébranlent les cités du nouveau monde.
Vanda était tombée à genoux et priait.
Pauline, suspendue au cou de Polyte, lui disait :
– Au moins, nous mourrons ensemble !
Milon hurlait de fureur et brandissait ses poings énormes en répétant :
– Ah ! les gredins de fénians ! les propres à rien ! les canailles !
Marmouset, lui, regardait le maître.
Le maître était calme, debout, le front haut.
Il semblait attendre la fin de ce cataclysme avec la tranquillité d’un homme qui se sait au-dessus de la mort.
Enfin, l’ébranlement s’apaisa.
Le bruit cessa tout à coup et les blocs de roche cessèrent de tomber.
– En avant ! dit alors Rocambole.
Vanda se redressa, l’œil en feu.
– Ah ! dit-elle, nous sommes sauvés !
– Pas encore, répondit-il. Mais marchons toujours.
Le souterrain était obstrué de blocs de roche énormes.
Cependant, Rocambole, armé d’une pioche, se fraya le premier un passage au milieu de ces décombres.
Ses compagnons, rassurés, le suivaient.
Ils firent ainsi une centaine de pas.
Tout à coup, Rocambole s’arrêta.
Au milieu de la galerie, un objet volumineux venait d’attirer son attention.
Cet objet était un tonneau.
Et ce tonneau était rempli de poudre.
Il était facile de s’en convaincre en voyant une mèche soufrée qui dépassait la bonde d’un demi-pied.
Que faisait là ce tonneau ?
Qui donc l’avait apporté ?
Les fénians connaissaient-ils donc aussi ce passage ?
Marmouset s’était pareillement approché.
Et, comme le maître, il regardait avec étonnement le baril et semblait se poser les mêmes questions.
Vanda et les autres se trouvaient à une certaine distance.
Rocambole dit enfin :
– Il est impossible que les fénians aient apporté cela ici.
– Qui voulez-vous que ce soit, alors, maître ? demanda Marmouset.
Rocambole tournait et retournait autour du tonneau.
Enfin, son front plissé se dérida ; un sourire revint à ses lèvres.
– Mes enfants, dit-il, nous n’étions pas nés le jour où ce baril a été transporté ici.
– En vérité ! murmura Marmouset.
– Cette poudre a deux cents ans, continua Rocambole.
– Est-ce possible ?
– Voyez le tonneau, examinez-le. Le bois en est vermoulu et se déchiquette sous le doigt.
– C’est vrai, dit Marmouset.
– Ne touche pas à la mèche, dit encore le maître, car elle est tellement sèche qu’elle tomberait en poussière.
– Et, dit Polyte, qui n’avait pas fait des études bien approfondies sur la matière, c’est de la poudre, je crois, qui n’est pas méchante.
– Tu crois ?
Et Rocambole regarda en souriant le gamin de Paris.
– Dame ! fit Polyte, une poudre si vieille doit être éventée.
– Tu te trompes.
– Ah !
– Elle est dix fois plus violente que de la poudre neuve.
– Bigre ! alors, il faut faire attention.
– À quoi ?
– À ne pas y mettre le feu.
– Et pourquoi cela ?
– Mais, dame ! après ce qui vient de nous arriver !
– Laissons là cette poudre et marchons toujours, dit Rocambole.
Et il continua son chemin.
Le souterrain allait toujours en s’abaissant, et le sol fuyait sous les pieds.
C’était là une preuve qu’on approchait de plus en plus de la Tamise.
Mais, tout à coup, Rocambole s’arrêta de nouveau.
– Ah ! dit-il, voilà ce que je craignais.
Le souterrain était fermé par un bloc de rochers qui s’était détaché de la voûte et remplissait l’office d’une porte.
– Prisonniers ! murmura Vanda, que son épouvante reprit.
Rocambole ne répondit pas.
Il voyait sa dernière espérance s’évanouir.
La route était barrée.
Revenir en arrière serait tout aussi impossible.
C’était s’exposer, du reste, à tomber aux mains des policemen, qui, dans quelques minutes peut-être, la première stupeur passée, envahiraient les souterrains découverts tout à coup et que la génération actuelle avait ignorés.
– Allons ! dit Rocambole après un moment de silence, il faut vaincre ou mourir.
– Je suis bien fort, dit Milon, mais ce n’est pas moi qui me chargerais de pousser ce caillou-là.
– Si on pouvait le saper, dit Marmouset.
– Avec quoi ? Nous n’avons pas les outils nécessaires.
– C’est vrai.
– Et puis, c’est de la roche dure…
– Ah ! dit encore Vanda, je le sens bien, nous mourrons ici.
– Peut-être… dit Rocambole.
Pauline s’était de nouveau jetée au cou de Polyte.
Et Polyte lui disait :
– Ne pleure pas ; tout n’est pas désespéré encore. Regarde cet homme comme il est calme…
En effet, Rocambole était aussi tranquille en ce moment que s’il se fût encore trouvé dans le salon du gouverneur de Newgate.
– Marmouset, dit-il enfin, et toi, Milon, écoutez-moi bien.
– Parlez, maître.
– N’entendez-vous pas un bruit sourd ?
– Oui.
– C’est la Tamise, qui n’est plus qu’à une faible distance de nous.
– Bon ! fit Milon.
– Examinez maintenant la voûte de cette galerie. Elle est taillée dans le roc vif.
– Oui, dit Marmouset, et c’est une roche vive qui nous défend d’aller plus loin.
– Attendez donc, fit Rocambole. Vous avez manié souvent, l’un et l’autre, des armes à feu.
– Parbleu ! dit Marmouset.
– Eh bien ! suivez mon raisonnement. Supposons deux choses : la première, que cette galerie est tout près de la Tamise.
– Ceci est sûr, dit Milon.
– Supposons encore qu’elle est comme un canon de fusil.
– Bon ! fit Marmouset.
– Et que cette roche que nous avons devant nous et qui nous ferme le chemin, est un projectile.
– Après ? dit Milon.
– Nous avons la poudre, continua Rocambole.
– Vous voulez faire sauter le rocher ?
– Non pas, mais le projeter en avant.
– Ah !
– Et le chasser jusqu’au bout de la galerie, où il rencontrera la Tamise.
– Cela me paraît difficile, dit Marmouset.
– Pourquoi ?
– Parce que la poudre, ne rencontrant point de tube en arrière, n’aura pas de point d’appui, et tout ce que nous aurons gagné à cet effet sera de produire un nouvel écroulement dans la galerie qui nous ensevelira cette fois.
– Marmouset a raison, dit Vanda.
– Il a tort, dit froidement Rocambole.
Alors, on se regarda avec anxiété.
Mais lui, toujours calme, toujours froid, regarda Marmouset et lui dit :
– C’est la force de résistance qui te manque, n’est-ce pas ?
– Oui, la force de résistance que la poudre rencontre au tonnerre, et qui lui permet de produire son expansion en avant.
– Eh bien ! rien n’est plus simple à obtenir.
– Ah !
– Milon, toi et moi, nous allons pousser le baril devant nous, et nous le coucherons contre le rocher, la mèche en arrière, bien entendu.
– Et puis ? demanda Marmouset.
– Puis, nous coulerons les uns après les autres tous les blocs plus petits qui obstruent la galerie.
– Et nous élèverons une sorte de muraille derrière le tonneau, n’est-ce pas, maître ? fit Milon.
– Précisément, et nous ferons cette muraille six fois plus épaisse que la roche qu’il s’agit de pousser.
– Et combien d’heures estimez-vous que va nous coûter un pareil travail ?
– Six heures au moins.
– Mais, dit Vanda, avant six heures, avant une heure peut-être nous serons perdus !
– Et pourquoi cela ?
– Parce que les policemen et les soldats vont envahir les souterrains.
Rocambole haussa les épaules.
– D’abord, dit-il, l’écroulement complet de la salle circulaire que nous avons laissée derrière nous nous protège. Ensuite, il est probable qu’on nous croira morts.
– Un bout de temps, six heures ! dit Milon.
Rocambole se prit à sourire.
– Tu trouves que c’est long ?
– Dame !
– Eh bien ! suppose que la muraille qu’il s’agit d’édifier est construite.
– Bon !
– Et qu’il ne nous reste plus qu’à mettre le feu au baril.
– Eh bien ?
– Il nous faudrait encore attendre sept ou huit heures.
Et comme on le regardait et que personne ne paraissait comprendre :
– Le bruit sourd que nous entendons, dit-il, nous prouve que nous sommes près de la Tamise.
– Oui, dit Milon.
– Et c’est l’heure de la marée ; il faut donc attendre que la Tamise ait baissé.
– Pourquoi ?
– Parce que le bloc de roche, au lieu d’être poussé en avant, rencontrerait une force de résistance invincible dans la colonne d’air que le fleuve emprisonnera, tant qu’il ne sera pas descendu au-dessous de l’orifice du souterrain.
– Tout cela est fort juste, dit Marmouset. Mais j’ai encore une objection à faire.
– Voyons ?
– Comment mettrons-nous le feu au baril, quand nous l’aurons emprisonné entre le bloc de roche et la muraille que nous allons élever ?
– Au moyen de la mèche, que nous laisserons passer entre les pierres.
– Mais elle sera trop courte.
– Nous l’allongerons avec nos chemises coupées en lanières.
– Pas assez pour que celui qui se dévouera…
– Cela ne te regarde pas, dit Rocambole.
– Hein ? fit Marmouset.
– Un seul homme mettra le feu, et cet homme c’est moi !
– Qui ? Vous ! exclamèrent à la fois Milon, Vanda et Marmouset.
– Moi, répéta-t-il tranquillement avec un sourire hautain aux lèvres. Vous m’appelez le maître ; quand j’ordonne, vous devez obéir !… À l’œuvre !…
II
Le maître avait parlé.
Il fallait obéir.
D’ailleurs, l’heure du péril était loin encore.
Marmouset dit à l’oreille de Milon :
– Construisons toujours la muraille, nous verrons après.
– Ça y est, dit Milon.
Et on se mit à l’œuvre.
En outre de Marmouset, de Milon, de Vanda, de Polyte et de Pauline, il y avait encore trois personnes dans le souterrain.
L’une était le matelot William celui que jadis l’homme gris avait terrassé.
Puis, la Mort-des-Braves, et enfin Jean le Boucher, que jadis on appelait, au bagne, Jean le Bourreau.
Ceux-là n’eussent même pas osé discuter un ordre du maître.
Rocambole leur fit un signe.
Tous trois revinrent en arrière pour y prendre le baril de poudre.
Milon les suivit.
Le baril était lourd ; mais poussé, traîné, porté par les quatre hommes, il fut arraché à la place qu’il occupait depuis deux cents ans.
Puis on le posa contre la roche, sur le flanc, la mèche en arrière.
– À la muraille, maintenant ! dit Rocambole.
Et il regarda sa montre.
Tous avaient des torches.
– Qu’on les épargne, dit Rocambole, une seule suffit !
Chacun souffla sa torche, excepté lui.
– Le maître a de la précaution, murmura Milon.
– Sans doute, répondit Marmouset à voix basse. Nous sommes ici pour sept ou huit heures peut-être, et si nous brûlions toutes nos torches à la fois, nous courrions grand risque de demeurer dans les ténèbres.
On se mit donc à la besogne.
Les blocs de roche furent apportés, un à un.
Avec la pioche dont il était armé, Rocambole les équarrissait au besoin et faisait l’office du maçon.
Le mur montait peu à peu.
Quand il fut à deux pieds du sol, on prit la mèche avec soin et on l’allongea en y ajoutant la chemise de Milon taillée en minces lanières.
Puis on la fit passer sur le mur et déborder au dehors.
Avec la pioche, Rocambole cassait de petits morceaux de roche qu’il disposait tout alentour, de façon à faire une sorte de lumière semblable à celle d’un canon.
Quand la mèche fut ainsi protégée, on continua la muraille.
Chacun, hommes et femmes, apportait sa pierre, et le mur montait, montait toujours.
Quatre heures après, il avait atteint le sommet de la voûte.
Le baril de poudre se trouvait alors emprisonné entre le mur et le bloc de roche.
Le mur avait dix ou douze pieds d’épaisseur.
Selon les calculs de Rocambole, il devait avoir une force de résistance triple de celle de la roche.
Alors, le maître tira sa montre.
– Est-ce le moment ? demanda Milon.
– Non, pas encore, dit Rocambole.
– Il y a pourtant joliment longtemps que nous travaillons !
– Quatre heures seulement.
– Ah !
– Et la marée n’est pas redescendue encore !
Milon soupira, puis, au bout d’un instant de silence :
– Combien de temps encore ? fit-il.
– Trois heures.
– Ah ! bien alors, les policemen ont le temps de venir.
– Espérons qu’ils ne viendront pas, dit Rocambole avec calme.
Et il s’assit sur un bloc de roche qui n’avait pas trouvé son emploi.
Et comme ses compagnons l’entouraient :
– Écoutez-moi bien, maintenant, dit-il.
On eût entendu voler une mouche dans le souterrain.
Rocambole poursuivit :
– Je crois fermement à notre délivrance. Cependant, je puis me tromper dans mes calculs.
– Je ne le pense pas, dit Marmouset.
– Moi non plus, mais enfin, il faut tout supposer.
– Bon ! murmura Milon.
– Si nous ne pouvons projeter le rocher en avant, il faut nous attendre à un nouvel écroulement.
– Et alors, dit Vanda, nous serions tous ensevelis et écrasés ?
– Peut-être oui, peut-être non.
Et Rocambole, le sourire aux lèvres, poursuivit :
– Quand l’heure de mettre le feu à la mèche sera venue, vous vous en irez tous à l’autre extrémité du souterrain et ne vous arrêterez que dans cette salle circulaire où cette jeune fille nous attendait.
Et il désigna Pauline d’un geste.
– Mais vous, maître ?
– Il ne s’agit pas de moi, dit Rocambole. Je parle, écoutez.
Il prononça ces mots d’un ton impérieux et tous courbèrent la tête.
– L’explosion aura lieu, continua-t-il. Alors, de deux choses l’une : ou la roche sera violemment chassée en avant, comme un boulet de canon…
– Ou nous serons tous écrasés, dit Marmouset.
– Pas vous, mais moi.
– Maître, dit Vanda, voilà précisément ce que nous ne voulons pas.
– Et c’est ce que je veux, moi !
– Il y a pourtant une chose bien simple, murmura Milon.
– Laquelle ?
– C’est de tirer au sort qui mettra le feu.
– Tu as raison en apparence, dit Rocambole.
– Ah !
– Mais tu as tort en réalité.
– Et pourquoi cela ? demanda Milon.
– Parce que si l’écroulement se fait, toute fuite pour ceux qui seront dans la salle circulaire deviendra impossible.
– Eh bien ?
– Et qu’ils tomberont aux mains des policemen.
– Bon ! après ?
– Et que, si je suis parmi eux, je serai pendu. Or, mourir pour mourir, j’aime mieux mourir ici.
Cela était tellement logique que personne ne répliqua.
– Vous autres, au contraire, poursuivit Rocambole, vous n’êtes ni incriminés, ni coupables ; en admettant même que vous soyez mis en prison, vous serez relâchés.
– Qui sait ? fit encore Milon.
– Je connais la loi anglaise, dit Rocambole, et suis sûr de ce que je dis.
– Eh ! s’écria Vanda, que nous importent la vie et la liberté si vous mourez, maître ?
– Vous continuerez mon œuvre, dit froidement Rocambole.
Milon se méprit à ces paroles :
– Ah ! non, par exemple, dit-il, en voilà assez comme ça pour les fénians, des gredins qui sont cause…
– Tais-toi !
Et Rocambole eut un geste impérieux.
Puis, s’adressant à Vanda :
– Écoute-moi bien, toi, dit-il.
– Parlez, maître !
– Si l’hypothèse que je viens d’admettre devenait une réalité, si j’étais enseveli, vous autres écroués d’abord, puis mis en liberté ensuite, tu te mettrais à la recherche de miss Ellen.
– Elle nous attend sur le navire.
– Soit. Mais enfin tu la retrouverais où qu’elle fût ?
– Sans doute. Et puis ?
– Et vous iriez ensemble à Rotherhithe, de l’autre côté de la Tamise, tout près du tunnel.
– Après ? fit encore Vanda.
– Vous entreriez dans Adam street, une ruelle étroite et sombre, et vous chercheriez la maison qui porte le numéro 17.
– Bon ! dit Vanda.
– Au troisième étage de cette maison demeure une vieille femme qu’on appelle Betzy-Justice. Tu lui montrerais ceci.
Et Rocambole prit à son cou une petite médaille d’argent qui était suspendue par un fil de soie.
– Et puis ? dit encore Vanda.
– Alors Betzy-Justice te donnera des papiers.
– Et ces papiers, je les lirai ?
– Oui, et ils t’apprendront à qui toi et nos compagnons avez affaire.
– C’est bien, dit Vanda.
Rocambole consulta sa montre de nouveau.
– Quel jour sommes-nous ? demanda-t-il ?
– Le 14, répondit Marmouset.
Le maître parut réfléchir.
– Je me suis trompé, dit-il enfin ; la marée avance d’une heure aujourd’hui.
– Ah !
– À l’heure qu’il est, l’orifice de la galerie doit être libre.
– Alors le moment est venu ? demanda Vanda en tremblant.
– Dans dix minutes.
Milon se jeta alors aux genoux de Rocambole :
– Maître, dit-il, au nom de Dieu, accordez-moi une grâce.
– Parle.
– Laissez-moi rester avec vous.
– Soit, dit Rocambole.
Milon poussa un cri de joie.
Alors le maître prit Vanda dans ses bras et l’y serra fortement ; puis il embrassa successivement chacun de ses compagnons et dit :
– Éloignez-vous !
Et ils obéirent.
Vanda se retournait à chaque pas, tout en obéissant.
– Plus vite ! cria Rocambole.
Puis, quand ils eurent disparu dans l’éloignement, il regarda Milon :
– Es-tu prêt ? dit-il.
– Toujours, répondit le colosse.
– Tu n’as aucune répugnance à t’en aller dans l’éternité ?
– Avec vous, aucune.
– C’est bien. En route, alors !
Et Rocambole approcha sa torche de l’extrémité de la mèche et y mit le feu.
Puis, les bras croisés sur la poitrine, il attendit.
Milon était aussi impassible que lui.
Et la mèche brûlait lentement, et elle atteignit le mur qui la séparait encore du baril…
III
Vanda s’était retournée bien souvent, et elle marchait la dernière, tandis que les compagnons de Rocambole s’éloignaient du baril de poudre et gagnaient la salle circulaire.
– Plus vite ! avait crié le maître, plus vite !
Marmouset, qui marchait en tête ; avait précipité sa marche.
Et tous arrivèrent ainsi à la salle circulaire.
Alors Marmouset dit à Vanda :
– Nous sommes à quatre cents mètres de distance du baril ; mais comme le souterrain est percé en droite ligne, nous pourrons voir l’explosion.
En même temps, il passait derrière lui la torche qu’il tenait à la main.
Alors on put voir Rocambole et Milon dans le lointain, grâce à la clarté de la torche qu’ils avaient gardée.
Le maître et Milon étaient l’un près de l’autre, immobiles, attendant l’explosion.
Vanda frissonnait de tous ses membres.
Non pour elle, car elle avait prouvé son héroïsme et son mépris de la vie.
Mais pour Rocambole, à l’amour de qui elle avait renoncé et que, cependant, elle aimait toujours.
Deux minutes s’écoulèrent.
– C’est long ! disaient les autres.
– Non, répondit Marmouset, il faut donner à la mèche le temps de brûler.
Puis il ajouta :
– Couchez-vous tous à terre.
– Pourquoi ? demanda la Mort-des-Braves.
– Parce l’explosion vous y couchera tout à l’heure, et que si vous attendez ce moment, vous risquez de vous casser une jambe ou un bras.
Tous obéirent, excepté Vanda.
– Moi, je veux voir ! dit-elle.
Et elle avait toujours les yeux fixés sur Milon et Rocambole, qui lui apparaissaient dans l’éloignement, au milieu du cercle de lumière décrit par la torche, comme des êtres microscopiques.
– Eh ! bien ! moi aussi, dit Marmouset.
Et, comme Vanda, il demeura debout.
Tout à coup, la mèche enflammée se trouva en contact avec le baril.
Jamais plus épouvantable coup de tonnerre ne se fit entendre.
Et l’ébranlement fut tel que Vanda et Marmouset furent jetés la face contre terre.
Mais ils demeurèrent les yeux ouverts.
Ô miracle !
À la place de la torche que tenait Rocambole et qui s’était brusquement éteinte, une lumière blanche, ronde comme la lune, se montra à l’extrémité du souterrain.
Le baril de poudre, avait, du même coup, rejeté la muraille en arrière et la roche en avant.
Le maître ne s’était point trompé dans ses calculs. La galerie avait joué le rôle d’un canon.
Cette lumière qui brillait, dans le lointain, c’était le jour, le jour au bord de la Tamise.
Au même instant, deux ombres s’agitèrent sur le sol.
C’étaient Milon et Rocambole qui, jetés violemment à terre par la secousse, se redressaient.
La voix du maître parvint aux oreilles de Marmouset et de Vanda.
– En avant ! criait-il, en avant !
Et on les vit, Milon et lui, qui s’élançaient vers le point lumineux, c’est-à-dire vers l’orifice de la galerie.
Les autres compagnons de Marmouset et de Vanda s’étaient pareillement relevés.
– En avant ! répéta Marmouset.
Et tous se mirent à venir sur les pas de Rocambole et de Milon.
Mais, tout à coup, un nouveau bruit se fit, un fracas plutôt.
La lumière blanche disparut…
Le sol trembla comme tout à l’heure, et Marmouset, qui marchait le premier, s’arrêta la sueur au front.
C’était la voûte de la galerie qui s’effondrait, et un nouveau bloc de roche fermait le souterrain une seconde fois.
Cette fois, une épouvante indescriptible s’empara des compagnons du maître.
Les torches étaient éteintes, et les ténèbres enveloppaient Marmouset, Vanda et ceux qui les suivaient.
Le sol tremblait sous leurs pieds ; des craquements sourds retentissaient à une faible distance.
– Nous sommes perdus ! dit Vanda.
– Qui sait ? fit Marmouset.
Sa torche était éteinte ; mais il l’avait toujours dans la main.
– Il faut y voir tout d’abord, dit-il.
Et il tira de sa poche un briquet avec lequel la torche fut rallumée.
Les craquements avaient cessé ; le sol ne crépitait plus sous leurs pieds, et tout était rentré dans le silence.
– En avant ! répétait Marmouset.
– En avant ! dit Vanda.
Polyte portait dans ses bras sa chère Pauline, qui s’était évanouie de frayeur.
Marmouset, sa torche à la main, tenait toujours la tête de la petite troupe.
On arriva ainsi à l’endroit où le baril avait pris feu ; on passa sur les débris de la muraille.
On put voir la paroi de la galerie entamée par le frottement de la roche.
– Plus loin encore ! disait Marmouset.
Et il marchait toujours.
Enfin, ils arrivèrent à l’endroit où la lumière du ciel avait subitement disparu.
Une énorme roche, plus grosse encore que la première, s’était détachée de la voûte et, muraille infranchissable, fermait la galerie.
Marmouset et Vanda se regardèrent.
Ils se regardèrent, pâles, muets, frissonnants.
La même question venait sur leurs lèvres, et ni l’un ni l’autre n’osait la faire.
Qu’était devenu le maître ?
Avait-il été écrasé ?
Ou bien la roche était-elle tombée derrière lui, le séparant ainsi de ses compagnons, mais lui donnant le temps de gagner la Tamise ?
Enfin, Vanda prononça un mot, un mot unique :
– Espérons ! dit-elle.
– Espérons ! répéta Marmouset.
Et alors ils regardèrent leurs compagnons, qui paraissaient frappés de stupeur.
– Mes amis, dit enfin Marmouset, il ne faut plus songer à aller en avant ; vous le voyez, la route est barrée.
– Eh bien ! dit Jean le Boucher, retournons en arrière, et si les policemen nous rencontrent, on verra…
Vanda ne prononçait plus un mot.
Elle était comme anéantie par cette nouvelle catastrophe, et un doute affreux l’étreignait.
Rocambole était-il mort ou vivant ?
La Mort-des-Braves dit à son tour :
– Ce n’est pas douteux, le maître et Milon ont pu se sauver.
Marmouset ne répondit pas.
Ils rebroussèrent chemin et arrivèrent dans la salle circulaire. Là, Marmouset s’arrêta.
– Il s’agit de tenir conseil sur ce que nous avons à faire, dit-il.
Et il montrait du doigt la galerie par laquelle, quelques heures auparavant, ils avaient gagné le souterrain de Newgate.
– Nous savons où cela conduit, dit-il.
– Merci bien, dit le matelot William, vous voulez donc aller vous livrer aux policemen ?
– Nous ne risquons pas grand’chose à cela.
– Nous risquons d’aller au Moulin, d’abord.
– Je me ferai bien mettre en liberté.
– Vous, peut-être, mais moi… qui suis Anglais ?
Polyte avait déposé Pauline à terre. La jeune fille commençait à revenir à elle et demandait ce qui s’était passé.
Polyte ralluma sa torche à la torche de Marmouset.
– Je vais faire un bout de chemin en avant, dit-il.
Et il s’engagea dans la galerie.
Mais il n’eut pas fait cinquante pas qu’il rebroussa chemin et vint rejoindre ses compagnons.
– C’est pas la peine de vous fouler la rate, dit-il.
– Hein ? dit Marmouset.
– Nous n’avons rien à craindre des policemen.
– Que veux-tu dire ?
– Qu’un autre éboulement s’est fait dans cette galerie et qu’elle est fermée aussi.
– Ah !
– Ce qui fait que nous sommes prisonniers ici.
– Prisonniers, dit la Mort-des-Braves et condamnés à mourir de faim.
Marmouset haussa les épaules.
– Bah ! dit-il, ce ne serait pas la peine d’avoir une étoile pour ne point s’y fier.
Tout le monde le regarda.
– Voici une autre galerie que nous n’avons pas explorée, dit-il.
– C’est vrai, fit Vanda.
– Qui sait où elle mène ?
– Voyons toujours…
Et Marmouset s’engagea dans la troisième galerie.
Celle-ci, au lieu de suivre un plan incliné, montait au contraire peu à peu.
Marmouset se retourna vers ses compagnons :
– Nous allons peut-être nous trouver tout à l’heure au niveau du sol, dit-il.
– Marchons toujours, dit la Mort-des-Braves.
Mais tout à coup Marmouset éteignit vivement sa torche.
– Silence ! dit-il à voix basse.
Puis il s’arrêta en disant :
– Que personne ne bouge !
Au milieu du silence qui régnait dans ces catacombes, un bruit était parvenu tout à coup aux oreilles de Marmouset.
Ce n’était plus un craquement sourd et lointain, ça n’était pas non plus un mugissement du sol ébranlé.
C’était le murmure de deux voix humaines.
Étaient-ce les policemen ?
Ou bien quelques fénians qui cherchaient celui qu’ils avaient promis de délivrer ?
Et comme Marmouset se posait cette question et recommandait le silence à ses compagnons, une lumière brilla dans l’éloignement.
Puis un homme se montra, portant une lanterne à la main.
Et Marmouset reconnut cet homme et dit :
– C’est Shoking ! Nous sommes sauvés !
IV
Marmouset ne se trompait pas.
C’était bien Shoking.
Shoking qui cheminait une lanterne à la main, côte à côte d’un homme que Marmouset reconnut pareillement.
C’était le chef fénian qui avait promis de sauver l’homme gris.
Et Marmouset, se tournant vers la petite troupe qui s’était arrêtée comme lui :
– Nous pouvons avancer, dit-il. Ce sont des amis.
Shoking les eut bientôt aperçus à son tour.
Et reconnaissant Marmouset, il poussa un cri de joie et vint se jeter dans ses bras.
– Ah ! dit-il, il y a bien longtemps que nous vous cherchons.
– C’est vrai, dit le fénian.
– Et nous avions bien peur que vous ne fussiez ensevelis, poursuivit Shoking.
En même temps, il cherchait des yeux Rocambole, et ne le voyant pas :
– Mais où est l’homme gris ? s’écria-t-il.
Marmouset secoua la tête.
Shoking jeta un nouveau cri.
– Mort ? dit-il.
– Nous espérons encore le contraire, murmura Marmouset.
– Comment ? Que voulez-vous dire ?
Et Shoking, au comble de l’anxiété, regardait Marmouset.
Celui-ci, en deux mots, lui raconta ce qui s’était passé.
Alors un sourire revint aux lèvres de Shoking.
– Je suis rassuré, dit-il.
Et comme Vanda, Marmouset et les autres le regardaient, il ajouta :
– J’ai été le compagnon du maître, et du moment où vous ne l’avez pas vu mort, je suis bien sûr qu’il se sera tiré d’affaire.
La confiance de Shoking gagna tout le monde, excepté Vanda.
Vanda était agitée par les plus sinistres pressentiments.
– Enfin, dit Marmouset, comment êtes-vous ici ?
– Nous vous cherchions, dit le chef fénian.
– Ah !
– Vous avez devancé mes plans, et s’il était arrivé un malheur, il ne faudrait vous en prendre qu’à vous, dit encore cet homme avec un flegme tout britannique.
Marmouset se redressa d’un air hautain.
– Vous croyez ? dit-il.
– Sans doute, dit le fénian toujours calme. Si vous n’aviez pas douté de notre parole… vous n’auriez pas agi…
– Ah ! dit Shoking qui intervint, ce n’est ni l’heure ni le moment de nous quereller ; il faut sortir d’ici, car les éboulements peuvent recommencer.
– Mais par où êtes-vous venus ? demanda Marmouset.
– Par une troisième issue.
Shoking connaissait donc les autres.
Et comme Marmouset faisait un geste de surprise, le bon Shoking ajouta :
– Les fénians connaissaient aussi bien que vous l’existence du souterrain.
– En vérité !
– Et ils comptaient faire sauter une partie de Newgate, si vous ne vous étiez pas tant pressés.
– Mais enfin, demanda Marmouset, quel était leur plan ?
– Je vais vous le dire, répondit le chef fénian. Nous avions placé six barils de poudre.
– Bon !
– Trois dans les souterrains, trois contre le mur même de la prison.
– Et puis ?
– On a mis le feu à ceux des souterrains.
Ceux-là étaient destinés à faire écrouler une partie des maisons d’Old Bailey.
– Dans quel but ?
– Dans le but d’amener un tel désordre que, le mur de Newgate s’écroulant à son tour, on pût sauver l’homme gris. Un seul de ces barils a pris feu.
– Et ceux qui étaient contre le mur de la prison ?
– Quand nous avons su que l’homme gris et vous étiez dans les souterrains, nous en avons arraché la mèche.
– Mais alors Old Bailey s’est écroulé ?
– Non.
– Comment cela ?
– Il n’y a qu’une maison de Sermon Lane qui s’est écroulée, et le fracas a été tel qu’on n’a pas encore pu savoir ce qui avait déterminé cet éboulement épouvantable.
– Alors la prison de Newgate est debout ?
– Oui, on a délivré le gouverneur, qui a raconté votre évasion.
On est descendu dans les souterrains, mais il a fallu rebrousser chemin.
– Pourquoi ?
– D’abord, parce que les éboulements continuaient ; ensuite, parce que la voie que vous aviez suivie était barrée.
– Ah ! c’est juste, dit Marmouset qui se souvint que Polyte n’avait pu aller plus loin.
Puis il ajouta :
– Mais enfin, vous êtes venus par une autre route, vous autres ?
– Sans doute.
– Alors nous pouvons sortir ?
– Quand vous voudrez, dit Shoking ; suivez-moi.
Et il rebroussa chemin.
La petite troupe le suivit.
Au bout d’un quart d’heure de marche, ils se trouvaient au bas d’un escalier.
– Ah ! dit Marmouset, où cela conduit-il ?
– Dans la cave d’un public-house.
– Tenu par un des nôtres, dit le chef fénian.
– Et où est situé ce public-house ?
– Dans Farringdon street.
– Ce qui fait que nous sommes maintenant à l’est de Newgate ?
– Oui.
Shoking marcha le premier.
Vanda ferma la marche.
On eût dit qu’elle laissait son âme tout entière dans le souterrain, et de temps à autre, tout en marchant, elle détournait la tête et murmurait :
– Peut-être, à cette heure, est-il enseveli sanglant et respirant encore sous quelque éclat de rocher.
L’escalier avait trente marches.
À la trentième, la tête touchait une trappe.
La trappe soulevée, Marmouset, qui suivait Shoking, se trouva dans la salle basse du public-house, et tout le monde suivit Marmouset.
Les volets de la devanture étaient fermés.
On était en pleine nuit.
Le publicain avait renvoyé ses pratiques et il était seul.
Lui aussi, il chercha des yeux l’homme gris et ne le vit pas.
Marmouset dit alors à Shoking :
– Nous sommes donc dans Farringdon street ?
– Oui.
– Au-dessus ou au-dessous de Fleet street ?
– Au-dessous.
– Par conséquent, tout près de la Tamise ?
– Certainement.
– Eh bien ! il faut vous mettre aussitôt à la recherche du maître.
– Ce sera d’autant plus facile, dit Shoking, que j’ai un bateau auprès de Temple Bar.
– Partons alors, dit Marmouset.
– Je vais avec vous, dit Vanda.
– Et moi aussi…
– Et moi aussi… dirent tous les autres.
– Non, dit Marmouset avec un accent d’autorité. Vous allez rester ici vous autres, et vous attendrez que nous revenions.
En l’absence du maître, Marmouset était toujours obéi.
Polyte, lui, n’était pas fâché de ne point faire partie de cette nouvelle expédition, car Pauline était brisée de fatigue et d’émotion.
Marmouset, Shoking et Vanda sortirent donc du public-house et se trouvèrent dans cette large voie qui s’appelle d’abord la rue et ensuite la route de Ferringdon…
La nuit était brumeuse.
Cependant un rayon de lune parvenait à déchirer le brouillard.
C’était ce qui expliquait cette clarté blanche que Marmouset et ses compagnons avaient aperçue un moment après l’explosion, par l’orifice dégagé du souterrain.
Vanda et ses deux compagnons descendirent donc au bord de la Tamise.
Le bateau de Shoking s’y trouvait amarré.
Ils y montèrent et Shoking prit les avirons.
– Puisque les fénians connaissaient le souterrain, dit alors Marmouset, vous devez savoir, vous, où est l’orifice de la galerie qui aboutit à la Tamise ?
– Nous gouvernons droit dessus.
– Est-ce loin ? demanda Vanda palpitante.
– Nous y serons dans dix minutes.
Et Shoking se mit à ramer vigoureusement.
Enfin la barque qui avait un moment pris le large se rapprocha peu à peu de la berge, et Shoking, relevant les avirons, laissa dériver.
La barque heurta un amas de broussailles.
– C’est là, dit Shoking.
Marmouset qui avait les yeux perçants, examinait les broussailles, et tout à coup, regardant Vanda :
– Il est évident, dit-il, qu’aucun homme n’a passé au travers.
– Mon Dieu !
– Le maître et Milon ne sont pas sortis du souterrain.
– Ah ! dit Vanda avec un sanglot, ils sont morts…
Marmouset ne répondit pas.
Mais il écarta les broussailles, mit à nu une large crevasse, et sauta lestement hors de la barque.
– As-tu gardé la lanterne ? demanda-t-il à Shoking.
– Oui, répondit Shoking. Mais nous ne l’allumerons que lorsque nous serons dedans.
Et ils pénétrèrent tous trois dans le souterrain.
Alors Shoking se mit en devoir de rallumer sa lanterne. Mais à peine une clarté douteuse eut-elle brillé dans le souterrain, que Vanda et Marmouset jetèrent un cri d’épouvante…
V
On eût pu croire, à ce cri d’épouvante, poussé simultanément par Vanda, Marmouset et Shoking, que tous trois se trouvaient en présence des cadavres mutilés de Rocambole et de Milon.
Il n’en était rien cependant.
Ce qui les avait glacés d’effroi, c’était un énorme rocher qui fermait l’entrée de la galerie.
Or ce rocher ne pouvait être celui que, de la salle circulaire, Marmouset et ses compagnons avaient vu tomber derrière Rocambole et Milon.
C’en était un autre.
Il fallait donc supposer que les éboulements commencés derrière les fugitifs avaient continué devant eux et qu’ils avaient été écrasés.
Il y avait une manière certaine de s’en convaincre du reste.
Marmouset, par l’inspection des broussailles, croyait être certain, que ni Rocambole ni Milon n’avaient eu le temps de sortir de la galerie.
M’ais il y avait un autre moyen de contrôle bien autrement éloquent.
À l’heure de la marée haute, les eaux de la Tamise envahissaient le souterrain sur un parcours de plusieurs centaines de pas.
En se retirant, elle déposait une sorte de limon qui aurait nécessairement gardé l’empreinte des pieds de Milon et de Rocambole.
Or Marmouset, promenant la lanterne sur le sol, eut beau chercher, il ne trouva rien.
En outre, le rocher détaché de la voûte était sec, preuve qu’il était tombé depuis que l’eau s’était retirée.
Vanda, Marmouset et Shoking se regardaient donc avec une épouvante indicible.
Le doute n’était plus possible.
Ou Rocambole et Milon avaient été écrasés pendant qu’ils fuyaient.
Ou bien ils se trouvaient emprisonnés entre deux blocs de roche.
Cette dernière hypothèse était la suprême espérance que Vanda pût avoir encore.
Et elle regardait Marmouset, se tordait les mains de désespoir et murmurait :
– Que faire ? que faire ?
– Je ne sais, répondit Marmouset.
Alors il eut une inspiration.
Il remit la lanterne à Shoking, s’approcha du bloc de roche, se coucha presque dessus et y appuya son oreille.
Vanda le regardait faire sans comprendre.
Marmouset écoutait…
Il écoutait, sachant que certaines pierres d’essence calcaire ont une sonorité prodigieuse.
Cette expérience ressemblait quelque peu à celle du médecin penché sur un homme qui ne donne plus signe de vie, et cherchant à surprendre un dernier battement de cœur.
Mais tout à coup le visage de Marmouset s’éclaira.
– J’entends quelque chose, dit-il.
– Quoi donc ? fit Vanda d’une voix étranglée.
Et elle se précipita vers lui.
Un bruit sourd, lointain, qui ressemble à la fois à l’écoulement goutte à goutte d’une source et à la voix humaine.
Vanda appuya à son tour l’oreille contre le rocher.
– Moi aussi, dit-elle, j’entends quelque chose.
– Ah !
– Et, ajouta-t-elle avec un geste de joie, ce n’est pas le bruit d’une eau qui coule.
– En êtes-vous sûre ?
– Oui, c’est une voix humaine. Attendez… attendez…
Et Vanda écoutait toujours.
– Oui, dit-elle encore, ce n’est pas une voix, c’est deux. Elles se rapprochent. Ah !…
Et Vanda eut un cri de joie.
– Qu’est-ce encore ? fit Marmouset.
– C’est bien leur voix à tous deux ; l’une claire et sonore, l’autre grave et basse.
Et Vanda se mit à crier :
– Maître ! maître !
– Silence ! dit Marmouset.
Et comme elle le regardait :
– Laissez-moi m’expliquer, dit-il, et ne criez pas inutilement.
– Inutilement ?
Et Vanda, folle de joie, regardait Marmouset et semblait se demander si lui-même n’avait pas perdu l’esprit.
– En effet, reprit celui-ci, vous avez raison.
– Ah ! c’est bien des voix que nous avons entendues.
– Oui.
– Et ces voix…
– Ce sont les leurs. Comme vous, je les ai reconnues.
– Eh bien ? pourquoi ne voulez-vous pas alors que je les appelle… pour qu’ils sachent…
– Ils ne sauront rien.
– Ah !
– Ils ne vous entendront pas.
– Nous les entendons bien, nous.
Marmouset se prit à sourire.
– Ceci, dit-il, n’est pas la même chose.
– Pourquoi donc ?
– Parce que dans le souterrain, entre les deux blocs de roche, il y a une sonorité qui ne saurait exister ici à cause du voisinage du grand air.
La raison était sans réplique.
Marmouset poursuivit :
– Le bruit qui nous parvient est un bruit de voix ; ils causent. S’ils étaient blessés, ils gémiraient.
– C’est juste, dit Vanda.
– Ils sont donc sains et saufs…
– Oui, mais ils sont prisonniers, et ils finiront par mourir de faim.
– Nous les délivrerons ! dit froidement Marmouset.
– Comment ?
– Oh ! reprit le jeune homme, vous pensez bien qu’il ne faut plus songer à employer la poudre.
– Certes, non.
– Il ne faut pas songer davantage à saper ce rocher avec des outils quelconques.
– Que faire alors ?
– Allons-nous-en, regagnons le bateau, prenons le large de la Tamise, et je vous le dirai.
Marmouset s’exprimait avec tant de calme que Vanda eut confiance.
Quant à Shoking, comme ils s’exprimaient en français, il n’avait pas compris grand’chose.
Tout ce qu’il savait, c’est que le maître et Milon étaient vivants, puisqu’on les entendait parler à travers le rocher.
Marmouset regagna le bateau et Vanda le suivit.
Shoking reprit les avirons, et Marmouset lui dit en anglais :
– Pousse au large et maintiens-toi bien en ligne directe de la galerie.
– Pour cela, dit Shoking, il faut d’abord que je remonte le courant.
– Soit, dit Marmouset.
– Puis je me laisserai dériver perpendiculairement sur l’orifice du souterrain.
– C’est bien cela, dit encore Marmouset.
Et debout, à l’arrière de la barque, il attacha son regard sur la rive gauche de la Tamise.
Vanda le regardait sans comprendre.
La barque remonta jusqu’au point des Moines-Noirs.
Puis Shoking la laissa dériver.
Marmouset ne perdait pas de vue les maisons noires et enfumées qui bordent la Tamise en cet endroit.
Tout à coup il parut en fixer une.
– C’est là ! dit-il.
– Quoi donc ? dit Vanda.
Mais Marmouset, au lieu de répondre à Vanda, dit à Shoking :
– Tu peux regagner le large.
– Ah ! fit Shoking.
Et les avirons retombèrent à l’eau.
Cinq minutes après, Marmouset mettait pied à terre et regagnait Farringdon street.
– Mais où allons nous ? demanda encore Vanda.
– Venez toujours, vous verrez.
La première rue qu’on trouve perpendiculaire à Farringdon, quand on a quitté le bord de la Tamise, se nomme Carl street.
Thames street est sa continuation vers l’est.
Marmouset marchait d’un pas rapide et Vanda avait peine à le suivre.
Il fit quelques pas dans Carl street et s’arrêta devant une maison plus haute que les autres.
C’était celle qu’il avait remarquée du milieu de la Tamise.
– Maintenant, dit-il à Vanda, écoutez-moi bien.
– Parlez…
– À moins que je ne me trompe dans mes calculs, cette maison est juste au-dessus de la galerie souterraine.
– Vous croyez ?
– Et elle se trouve entre les deux rochers qui emprisonnent Rocambole et Milon.
– Eh bien ?
– Attendez… dit encore Marmouset.
Et il s’approcha de la porte de cette maison, et tenant toujours à la main la lanterne de Shoking, il examina cette porte.
– J’en étais sûr, dit-il enfin.
– Sûr de quoi ? fit encore Vanda.
– Cette maison est celle d’un chef fénian qu’on appelle Farlane.
Tenez, son nom est sur la porte :
Farlane et C°.
– Et c’est un fénian ?
– Oui.
Vanda regarda Marmouset d’un air qui voulait dire :
– Ah çà ! vous êtes donc sorcier ?
Marmouset se prit à sourire.
– Écoutez-moi, dit-il.
Et il éteignit la lanterne de Shoking.
VI
À présent, reportons-nous au moment où l’explosion venait d’avoir lieu.
La secousse avait été si forte que Rocambole et Milon, projetés en arrière, étaient tombés la face contre terre.
Mais ils se soulevèrent presque aussitôt.
– Victoire ! s’écria Rocambole, la voie est libre.
En effet, on apercevait un coin du ciel dans l’éloignement.
Et il se retourna dans la direction de la salle circulaire, criant :
– Suivez-moi ! suivez-moi !
Et il se mit à courir.
Milon était auprès de lui.
Ils firent ainsi une vingtaine de pas.
Tout à coup, un fracas épouvantable retentit derrière eux.
Rocambole jeta un cri et se retourna.
Le premier éboulement venait de se produire, le séparant ainsi de ses compagnons.
Mais Rocambole ne perdit point la tête.
– En avant ! répéta-t-il, s’adressant à Milon. Sortons d’abord. Quand nous serons en plein air, nous trouverons bien un moyen de les délivrer.
– En avant ! dit Milon.
Et il continua à courir auprès du maître.
Soudain, un nouveau bruit, plus épouvantable encore que le premier, se fit entendre.
Cette fois, la lumière vers laquelle ils couraient disparut et les ténèbres les enveloppèrent.
La secousse fut même si forte que de nouveau Rocambole et Milon tombèrent la face contre terre.
Le sol mugissait sous eux.
Aux éboulements gigantesques succédaient des éboulements partiels. Des pierres tombaient ça et là, et l’une d’elles faillit atteindre Rocambole à la tête.
Cependant le maître n’avait point été écrasé.
Et, au milieu des ténèbres, la voix affolée de Milon se fit entendre :
– Maître ! maître ! dit-il, où êtes-vous ?
– Ici, dit Rocambole.
– Blessé ?
– Non.
– Moi non plus.
– Ne bougeons pas, dit Rocambole, attendons…
Enfin, l’éboulement général cessa ; les pierres ne tombaient plus. Alors Rocambole se redressa.
Et il entendit Milon qui murmurait :
– C’est égal, nous avons une fameuse chance.
Rocambole n’avait pas lâché sa torche. Seulement, elle était éteinte.
Mais Marmouset, en distribuant des torches à sa petite troupe, avait donné à chacun une boîte d’allumettes-bougies, et Rocambole avait la sienne.
– Maître, dit Milon, est-ce que je puis me lever, à présent ?
– Oui, mais ne bouge pas de place. Attends.
Et Rocambole chercha ses allumettes et alluma sa torche. Alors Milon put se convaincre qu’il était sain et sauf.
– Une fameuse chance ! répéta-t-il.
– Pas si grande que tu le crois, dit Rocambole.
Et, sa torche à la main, il marcha jusqu’à l’éboulement. Le souterrain était de nouveau fermé par un bloc énorme qui s’était, en tombant, écrasé par les coins et fermait la galerie aussi hermétiquement qu’une muraille élevée de main d’homme.
– Tu le vois, dit Rocambole, nous ne sommes pas plus avancés qu’il y a une heure.
– Revenons sur nos pas, alors, dit Milon.
Ils rebroussèrent chemin et se trouvèrent bientôt en présence de l’autre éboulement qui s’était produit derrière eux.
– Tu le vois, dit Rocambole, nous ne sommes pas encore plus avancés.
– Mais alors, dit Milon frémissant, nous sommes prisonniers ?
– Non, nous sommes enterrés tout vivants.
– Et ni outils, ni poudre ! geignit Milon.
Rocambole était un peu pâle, mais sa physionomie n’avait rien perdu de son calme habituel.
– Mon bon ami, dit-il, au lieu de nous désoler, il faut réfléchir froidement.
Milon le regarda.
– Notre situation n’est pas brillante, poursuivit Rocambole ; mais enfin elle n’est pas désespérée.
– Ah ! vous croyez ?
Et Milon attacha sur le maître un regard plein d’espoir.
– Écoute-moi bien, poursuivit Rocambole : il est probable que Marmouset et les autres n’auront pas été ensevelis.
– Soit. Mais ils sont prisonniers comme nous.
– Avec la chance d’être délivrés.
– Par qui ?
– Par les policemen qui doivent être à ma recherche.
– Bon ! mais alors on les conduira en prison ?
– D’abord. Mais on ne tardera pas à les relâcher.
– Vous croyez ?
– J’en suis sûr.
– Et alors ?
– Alors Marmouset, qui est, tu le sais, un garçon de ressource, et Vanda qui donnerait tout son sang pour moi, Marmouset et Vanda, dis-je, songeront à nous et s’occuperont de venir à notre secours.
– Soit, dit Milon, mais il s’écoulera un fameux bout de temps d’ici-là !
– Je ne dis pas non.
– Deux jours, peut-être…
– Et même trois, dit Rocambole.
– Nous avons le temps de mourir de faim !
– Un homme peut, à la rigueur, passer quatre jours sans manger, dit Rocambole.
Il s’assit tranquillement sur un bloc de rocher.
Milon n’était pas aussi calme que le maître.
Il allait et venait par le souterrain, comme une bête fauve qui fait sans relâche le tour de sa cage.
– Ne te désole donc point par avance, lui dit Rocambole, tu n’as pas encore faim, je suppose.
– Oh ! non, dit Milon, mais j’ai soif.
– Dans quatre ou cinq heures, tu pourras boire.
– Comment cela ?
– Au retour de la marée, la Tamise envahira de nouveau la galerie.
– Bon !
– Et nous jouerions de malheur si nous ne découvrions pas quelque infiltration.
– De l’eau salée…
– Mais non, de l’eau douce.
– Cependant, puisque la Tamise est soumise à la marée…
– Cela ne fait rien. La mer repousse la rivière, mais la rivière n’a pas le temps de se mélanger avec elle.
– Ah ! dit Milon.
– Viens donc t’asseoir ici, près de moi, poursuivit Rocambole.
Milon obéit.
– Et comme les paroles n’ont pas de couleur, ajouta le maître, je ne vois pas la nécessité de brûler inutilement notre torche, dont nous aurons certainement besoin plus tard.
Et Rocambole éteignit la torche. Puis il continua :
– Sais-tu pourquoi je ne me désespère pas, moi ?
– Oh ! vous, maître, dit Milon, vous êtes toujours impassible comme la destinée.
– Ce n’est pas cela, dit Rocambole.
– Qu’est-ce donc ?
– Je me figure que tant que j’aurai quelque chose à faire, la Providence veillera sur moi et me tirera d’affaire.
– Vraiment ? fit Milon. Mais alors, maître, vous ne vous reposerez jamais ?
– Non, dit Rocambole.
– Il me semble pourtant, dit Milon, que le moment serait venu pour vous de revenir à Paris et d’y vivre tranquille.
– J’ai affaire ici.
– Ah ! oui. Toujours les fénians.
– Non.
– Ma parole ! dit Milon, ce n’est pourtant pas un pays engageant que l’Angleterre.
– Cela dépend, dit Rocambole. Et puis, je te le répète, j’y ai un nouveau devoir à remplir.
– Et il n’est pas question de ces gredins de fénians ?
– En aucune façon.
Milon ne répondit rien. Il paraissait attendre que Rocambole s’expliquât. Celui-ci garda un moment le silence. Puis tout à coup :
– Crois-tu à la corde de pendu, toi ? dit-il.
– Comment cela ?
– On dit que la corde d’un pendu porte bonheur.
– On le dit, fit Milon, mais je n’y crois guère… et vous ?
– Nous verrons bien si elle nous tire d’ici.
– Hein ! dit Milon, vous avez donc de la corde de pendu ?
– Oui.
– Dans votre poche ?
– Dans ma poche.
– Alors, nous verrons bien, comme vous dites.
Et Milon attendit de nouveau.
– Et, acheva Rocambole, comme nous avons le temps et que nous ne sommes pas au bout de notre captivité, je vais te raconter une histoire.
– Une histoire de corde ?
– L’histoire de la corde et celle du pendu qui m’a nommé son exécuteur testamentaire, dit Rocambole.
– Parlez, maître, je suis tout oreilles.
VII
Rocambole dit alors :
– Tu te souviens de la façon dont notre amitié a commencé ?
Nous étions compagnons de chaîne.
Un jour tu me parlas de ces deux orphelins pour l’amour de qui tu étais au bagne…
– Oui, oui, dit Milon, et c’est depuis que vous avez sauvé mes pauvres enfants, que je vous suis dévoué comme un chien fidèle.
– Eh bien ! pareille chose m’est arrivée une seconde fois.
– Comment cela ?
– Seulement ce n’était plus au bagne de Toulon, mais dans la prison de Newgate.
– Ah !
– Et l’homme avec qui je me suis lié est mort.
– Il a été pendu ?
– Hélas ! oui.
Et Rocambole soupira.
– Écoute, reprit-il. Je venais d’être arrêté et je n’avais opposé d’ailleurs aucune résistance. J’avais mes raisons pour cela, car j’eusse pu m’évader avant même que les portes de Newgate ne se fussent refermées sur moi.
On ne me conduisit pas tout de suite à Newgate, du reste.
On me mena tout d’abord chez le magistrat de police de Drury Lane.
Le magistrat m’interrogea pour la forme et me fit écrouer dans la prison qui sert de dépôt et qui se trouve placée au-dessous de son prétoire.
Chaque matin, une voiture cellulaire fait le tour des cours de police, enlève les prisonniers arrêtés pendant la nuit et les dirige soit sur Newgate, soit sur Bath square ou toute autre prison centrale.
Je passai donc six heures dans le cachot de la cour de police de Drury Lane.
Dans ce même cachot, il y avait une femme en haillons, déjà vieille, mais dont le visage conservait les traces d’une rare beauté.
Quand j’entrai, elle me regarda avec défiance d’abord, puis avec curiosité.
Enfin, son regard ayant rencontré le mien, elle éprouva sans doute le charme mystérieux que mon regard exerce sur certaines personnes, car elle me dit :
– Je crois que vous êtes l’homme que je cherche.
Et comme je la regardais avec étonnement :
– Êtes-vous arrêté pour un grand crime ? me demanda-t-elle.
– Je suis fénian, répondis-je.
Elle tressaillit, et un rayon de joie éclaira son visage.
– Ah ! fit-elle ; alors vous irez à Newgate demain.
– Incontestablement.
– J’avais donc bien raison de dire que vous étiez l’homme que je cherche depuis si longtemps.
– Je la regardais toujours, cherchant à deviner le sens de ses paroles.
Elle continua :
– Je me nomme Betzy-Justice, je suis Écossaise.
– Fort bien. Après ?
– Voici un mois que je me fais arrêter chaque soir pour ivrognerie. Je ne suis pas ivre, comme bien vous le pensez…
– Alors ?…
– Mais je feins de l’être. On me conduit chez un magistrat de police, on m’enferme jusqu’au lendemain, et le lendemain le magistrat me condamne à 2 shillings d’amende et on me rend ma liberté.
– Pourquoi donc alors, demandai-je, si vous n’êtes pas ivre… feignez-vous de l’être ?
– Pour me faire arrêter, et cela tantôt dans un quartier, tantôt dans un autre. À cette heure, j’ai fait presque toutes les prisons des cours de police de Londres.
– Mais pourquoi ?
– Parce que je cherche un homme en qui je puisse avoir confiance, un homme qui aille à Newgate.
– En quoi cet homme peut-il vous servir ?
Elle me regarda encore.
– Vous avez l’air honnête et bon, me dit-elle. Comment vous appelez-vous ?
– L’homme gris, répondis-je.
Ce nom lui arracha un cri.
– Ah ! dit-elle, c’est vous qu’on appelle l’homme gris ?
– Oui.
– Et vous vous êtes laissé arrêter ?
– Oui.
– Mais vous sortirez de prison quand vous voudrez ?
– Peut-être…
– Oh ! c’est sûr, dit-elle. J’ai entendu parler de vous, et ce que vous voulez, vous le faites.
– En attendant, dis-je en souriant, je vais aller à Newgate.
– Oh ! puisque vous êtes l’homme gris, poursuivit-elle, je puis tout vous dire.
– Parlez…
– Mon mari est en prison.
– À Newgate ?
– Oui. Et il est condamné à être pendu, le 7 du mois prochain.
– Quel crime a-t-il commis ?
– Il a tué un lord.
– Dans quel but ?
– Ah ! dit Betzy-Justice, ceci serait une histoire trop longue à vous raconter. Nous n’aurions pas le temps. Mais, puisque vous allez à Newgate, il vous dira tout, lui.
– Soit. Et vous voulez me charger d’un message pour lui ?
– Oui.
– Donnez, alors.
– Oh ! ce n’est pas une lettre. On vous la prendrait au greffe, du reste. C’est une simple parole.
– Dites.
– Vous trouverez bien le moyen de le voir à Newgate, mon pauvre homme ; il est condamné à mort, mais il se promène tous les jours dans le préau avec les autres prisonniers.
– Eh bien ! que lui dirai-je ?
– Vous lui direz : « J’ai vu Betzy, votre femme. Mourez en paix, elle a les papiers. »
– Et c’est tout ?
– C’est tout, dit Betzy.
En même temps, elle essuya une larme.
Mais j’eus beau la questionner, elle ne voulut rien me dire de plus.
Le lendemain matin, au point du jour, on vint me chercher pour me conduire à Newgate.
Pendant trois jours, je fus tenu au secret, et il me fut impossible de voir le condamné à mort.
Enfin, le régime dont j’étais l’objet fit place à des procédés plus doux.
On espérait avoir de moi des aveux.
Je laissai entendre que si on me traitait avec douceur, je parlerais.
Dès lors, on fit à peu près tout ce que je voulais, et je pus, comme les autres prisonniers, descendre au préau deux fois par jour.
La première fois que j’y parus, je ne parlai à personne, mais je cherchai des yeux le condamné à mort.
Il se promenait tout seul dans un coin, la tête penchée sur sa poitrine, les bras emprisonnés dans la camisole de force.
Je l’examinai attentivement.
C’était un homme d’environ soixante ans.
Petit, trapu, les épaules larges, la tête carrée supportée par un cou de taureau cet homme devait être d’une force herculéenne.
Sa barbe était rouge, ses cheveux déjà gris.
Je passai près de lui et il me regarda.
Son regard contrastait singulièrement avec l’aspect presque repoussant de sa personne.
C’était un regard limpide, doux, loyal.
Cet homme avait tué.
Mais certainement il n’avait pas tué pour voler.
Le lendemain, je descendis au préau à la même heure.
Le condamné à mort s’y trouvait déjà.
J’allai droit à lui.
Il s’arrêta brusquement et leva sur moi ce regard honnête et presque timide qui m’avait frappé.
– C’est vous, lui dis-je, qui avez tué un lord ?
– Oui.
Et il me répondit ce mot unique avec une simplicité qui me confirma dans mon opinion.
Il avait accompli ou cru accomplir un devoir.
– N’êtes-vous pas le mari de Betzy-Justice ? lui demandai-je encore.
Il tressaillit et me regarda plus attentivement.
– Vous la connaissez ? dit-il enfin.
– Oui, j’ai passé une nuit avec elle dans la prison de Drury-Lane.
– Ah ! fit-il.
Et il me regarda d’un air soupçonneux.
– Elle m’a chargé d’un message pour vous.
– En vérité !
Et son regard était toujours plein de défiance.
– Je vois que vous ne me connaissez pas, lui dis-je.
– Qui donc êtes-vous ?
– Je me nomme l’homme gris.
Il fit un pas en arrière.
– Vous ! vous ! dit-il.
Et son visage perdit son expression de défiance et s’éclaira subitement.
– Oui, repris-je, je suis l’homme gris, et Betzy m’a dit de vous dire qu’elle avait les papiers.
Il jeta un cri.
Un cri de joie suprême, un cri qui aurait pu faire croire que je lui apportais sa grâce.
– Ah ! dit-il, dominant enfin l’émotion qui s’était emparée de lui, ah ! je puis mourir tranquille maintenant.
Et il me regarda encore.
– Mais, dit-il, puisque vous êtes l’homme gris, si vous êtes ici, c’est que cela vous plaît ?
– Peut-être.
– Et assurément vous sortirez quand bon vous semblera ?
– C’est probable.
Il hésita un moment.
– Ah ! me dit-il enfin, si j’osais… car c’est une femme courageuse, il est vrai, mais c’est une femme, ma pauvre Betzy, et qui sait si toute seule elle pourra mener notre œuvre à bonne fin ?
À mon tour je le regardai avec étonnement.
– Il faudra que je vous dise tout, reprit-il. Je suis sûr que vous vous intéresserez à notre affaire.
Il eut un sourire triste et ajouta :
– Un homme comme vous, ça peut tout… et, du reste, je vous léguerai ma corde, et elle vous portera bonheur.
À cet endroit de son récit, Rocambole s’arrêta un moment.
– Ma parole ! dit Milon, je ne pense plus que nous sommes enfermés entre deux rochers avec la moitié de la ville de Londres sur les épaules. Continuez, maître…
VIII
Rocambole poursuivit :
– Ce jour-là, le condamné à mort ne voulut pas s’expliquer davantage.
– L’histoire que je veux vous raconter est trop longue, me dit-il, l’heure de rentrer dans ma cellule est, du reste, sonnée. Mais demain…
– Demain, lui dis-je, je trouverai le moyen de passer plusieurs heures avec vous.
Il me regarda avec étonnement.
– Au fait, dit-il enfin, ce serait impossible pour un autre, mais, pour vous, il n’y a rien d’impossible, du moment où vous êtes l’homme gris.
Et il rentra dans son cachot, tandis que je regagnais ma cellule.
Une idée m’était venue.
Au moment où l’un des gardiens allait m’enfermer, je lui dis :
– Veuillez dire au gouverneur que je désire lui parler.
Le gardien s’acquitta du message et, un quart d’heure après, le gouverneur entrait dans ma cellule.
Tu as vu le bonhomme, et tu sais s’il est naïf.
– Oh ! très naïf, dit Milon.
Sir Robert arriva donc la lèvre souriante, l’œil caressant, persuadé que j’allais lui faire des révélations.
Car il ne suffisait pas à la libre Angleterre d’avoir mis la main sur l’homme qui paraissait être un des chefs du fénianisme et le plus dangereux de tous, sans doute, il lui fallait pénétrer le mystère dont cet homme s’enveloppait.
– Monsieur le gouverneur, dis-je alors à sir Robert, je désire causer avec vous.
– Ah ! fit-il d’un ton joyeux, je savais bien que nous finirions par devenir raisonnable.
– Je n’ai jamais cessé de l’être.
– Ah ! par exemple !
Il y avait deux chaises dans ma cellule ; il en prit une et s’assit familièrement auprès de moi.
– Voyons, mon ami, mon cher ami, me dit-il ; qu’avez-vous à me dire ?
– Mon cher gouverneur, j’ai à vous faire une question, d’abord.
– Parlez.
– Si je suis condamné à mort, serai-je pendu ?
– Hélas ! je le crains, mon ami. La potence est le seul mode de supplice usité en Angleterre.
– Bon ! Et vous pensez que je serai condamné ?
– À moins que vous ne fassiez des aveux qui vous attirent l’indulgence de vos juges.
– C’est à quoi je songe.
– Ah ! je le savais bien.
Et le bonhomme eut un cri de joie.
– Mais, poursuivis-je en souriant, j’ai besoin, auparavant, d’être fixé sur certaines choses.
– Lesquelles ?
– Je vais vous le dire. Je n’ai aucune peur de la mort.
– Cependant…
– Surtout de la mort par strangulation. J’ai même entendu dire…
– Ah ! oui, fit-il en clignant de l’œil, je sais…, un préjugé populaire… Mais ne craignez rien, mon ami, mon cher ami. Il faut voir le visage du supplicié, quand on lui ôte le bonnet noir ; il est tuméfié, bleuâtre, horrible à voir ! Et la langue !… Oh ! c’est épouvantable !
– En vérité ?
– C’est comme j’ai l’honneur de vous le dire, mon cher ami. Croyez-moi, faites des révélations.
– Attendez donc, lui dis-je.
– Plus vos révélations seront spontanées, poursuivit-il, et plus vos juges…
– Je sais cela, mais, je vous le répète, je n’ai aucune peur de la mort par strangulation.
– Vous avez tort.
– En France, où on a la guillotine, c’est différent !… Oh ! voilà une mort qui me fait peur !… Aussi j’avouerais tout de suite.
– On ne peut pas changer pour vous les coutumes, me dit-il. Mais je vous affirme que la pendaison est quelque chose d’horrible.
– Peuh !
– Tenez, poursuivit sir Robert M…, nous avons ici, en ce moment, un condamné à mort.
– Je le sais…
– Si vous saviez quelle épouvante emplit son âme !
– Mais il m’a paru cependant assez tranquille…
– Vous êtes dans l’erreur… Ah ! si vous passiez seulement deux ou trois heures en tête à tête avec lui !
– Croyez-vous que son épouvante me gagnerait ?
– J’en suis sûr.
– Vraiment ?
– Et si la fantaisie vous en prend…
– Hé ! hé ! cela me séduit assez.
– Tenez, poursuivit sir Robert M…, je vais faire pour vous une chose inouïe…
– Bah !
– Mais que j’ai le droit de faire après tout.
– Quoi donc ?
– Je vais vous faire partager, cette nuit même, le cachot du condamné à mort.
– Ah ! vous feriez cela ?
– Certainement. Et je veux que demain vous me fassiez appeler en toute hâte.
– Pourquoi faire ?
– Mais pour me faire des révélations et fléchir vos juges.
– Eh bien ! répondis-je, si tel est votre bon plaisir, je n’y vois pas le moindre inconvénient.
Il se leva tout joyeux.
– Je vais donner des ordres en conséquence, me dit-il.
Et il me serra la main et m’appela de nouveau son cher ami.
Puis il s’en alla, ne se doutant pas, le cher homme, qu’il m’avait offert spontanément ce que j’allais lui demander.
On m’apporta ce jour-là, comme de coutume, un plantureux dîner.
Puis le guichetier qui me servait me dit en clignant de l’œil :
– Il paraît que Votre Seigneurie est excentrique ?
Excentrique est un mot qui renferme à lui seul le plus bel éloge qu’on puisse faire d’un Anglais de pur sang.
– Heu ! heu ! répondis-je.
– Votre Seigneurie a fantaisie de coucher avec le condamné à mort ?
– Oui, mon ami.
– Sir Robert M…, notre bien-aimé directeur, poursuivit le guichetier, m’a donné des ordres.
– Ah ! ah !
– Et si Votre Seigneurie le permet, je vais la conduire.
Je fis un signe de tête affirmatif, et le guichetier, aussi naïf que son chef, me fit quitter ma cellule qui était au premier étage, descendre ensuite au rez-de-chaussée, et ouvrit devant moi la porte du cachot où le mari de Betzy-Justice était enfermé.
Au bruit, le malheureux se leva.
Je posai un doigt sur mes lèvres pour lui recommander le silence.
Il me fit un petit signe d’intelligence qui me prouva qu’il avait compris.
Du reste, il avait deviné qu’on allait lui donner un compagnon, car on avait apporté une heure avant dans le cachot un lit de sangle, un matelas et une couverture.
Bientôt nous nous trouvâmes seuls.
– Eh bien ! lui dis-je, vous le voyez, j’ai tenu ma parole, et nous avons toute la nuit pour causer.
– Vous faites ce que vous voulez, me répondit-il avec une naïve admiration.
– Maintenant, lui dis-je, conte-moi ton histoire.
Comme tu le penses bien, nous ne dormîmes pas de la nuit.
Le lendemain, au point du jour, la porte du cachot s’ouvrit.
Le guichetier venait me chercher.
– Sir Robert M… vous attend, me dit-il.
Je fis un signe d’adieu à mon compagnon.
– Mais cette histoire qu’il vous a racontée, maître ? interrompit Milon.
– Tu la sauras tout à l’heure. Parlons du gouverneur d’abord.
Et Rocambole, après un repos, continua :
– On me conduisit donc chez sir Robert.
J’étais pâle, comme on l’est après une nuit d’insomnie.
– Eh bien ! me dit-il tout joyeux, traiterez-vous encore la potence aussi légèrement ?
– Peuh ! répondis-je, elle ne me fait pas encore peur.
– Est-ce possible ?
– C’est comme j’ai l’honneur de vous le dire.
– Alors vous ne voulez pas parler ?
– Pas encore.
Il se mordit les lèvres, mais il ne se fâcha point.
– Oh ! dit-il, je vous convertirai, vous verrez ça.
– Est-ce que vous allez me faire coucher encore dans le cachot du condamné à mort ?
– Je ferai mieux…
– Ah bah ! Et que ferez-vous donc ?
– Je vous ferai assister à son supplice…
Et comme je le regardais étonné :
– Il y a un mois, me dit-il, la chose aurait été difficile, sinon impossible…
– Bah !
– Mais aujourd’hui qu’on exécute dans l’intérieur de la prison…
– Vous me donnerez une fenêtre sur le spectacle ?…
– Précisément.
Rocambole allait continuer son récit, quand Milon l’interrompit encore :
– Maître ! maître ! dit-il avec un accent d’effroi…
– Qu’est-ce donc ?
– Regardez…
Et Rocambole, enveloppé d’épaisses ténèbres, aperçut tout à coup deux points lumineux, semblables à des lucioles, qui venaient de s’allumer dans cette opaque obscurité, à quelque distance de Milon et de lui.
IX
Milon était brave, on le sait.
Mais Milon était comme tous les esprits un peu étroits, il n’affrontait volontiers que les périls dont il se rendait compte.
Il avait peur de l’inconnu.
Qu’était-ce que ces deux points lumineux qui brillaient dans les ténèbres ?
Milon se le demandait, et c’est pour cela qu’il avait peur.
Rocambole se leva et fit quelques pas en avant.
Les deux points lumineux ne changèrent point de place.
Alors Rocambole frappa deux coups dans sa main.
Soudain, les deux points lumineux disparurent.
– Imbécile ! dit alors Rocambole.
– Hein ? fit Milon qui sentait diminuer son oppression.
– Sais-tu ce que c’est ?
– Non.
– C’est un chat.
– Suis-je bête ! dit Milon.
– Et, puisqu’un chat a pénétré ici, dit Rocambole, c’est qu’il y a une issue quelconque.
– Vous croyez ?
– Dame ! et une issue par laquelle nous pourrons sortir, nous.
– À moins, dit Milon, que le chat n’ait été emprisonné au même temps que nous.
– C’est impossible.
– Pourquoi ? demanda encore Milon.
– Mais parce que nous l’aurions vu plus tôt.
– Ah ! c’est juste.
– Et puis, reprit Rocambole, comment veux-tu que ce chat se fût trouvé dans les souterrains ?
– Nous y sommes bien, nous !
– Oui, parce que nous avons trouvé l’entrée qui était murée depuis de longues années.
– Alors…
– Alors je vais l’expliquer ce qui a dû se passer.
– Voyons ? fit Milon.
– Ce chat était dans quelque cave au-dessus de nous, lors de l’explosion.
– Bon !
– L’explosion a dû amener quelque crevasse, quelque effondrement qui lui a permis d’arriver jusqu’ici, à la suite sans doute du violent effroi qu’il aura éprouvé.
– Ah ! c’est possible.
– Donc, reprit Rocambole, nous allons bien voir si nous ne pourrions pas nous en aller par où il est venu.
Et sur ces mots, le maître ralluma la torche.
– À présent, cherchons, dit-il.
Et il se mit à explorer leur étroite prison.
Deux blocs, on le sait, fermaient la galerie.
Rocambole se dirigea vers celui qui était tombé derrière eux.
C’était dans cette direction que les deux points lumineux avaient disparu.
Le roc offrait une sorte de saillie sur laquelle le chat s’était sans doute arrêté.
Rocambole monta sur cette saillie, puis il leva la tête.
Alors il vit un trou béant dans la voûte de la galerie.
– Monte, dit-il à Milon.
Milon arriva sur la saillie.
– Prends la torche, dit encore Rocambole. Tu me la passeras tout à l’heure.
Et il grimpa sur les épaules du colosse avec la légèreté d’un clown, et la moitié de son corps disparut dans le trou.
– À présent, passe-moi la torche, dit-il encore.
Milon obéit.
Rocambole regarda alors au-dessus de sa tête, puis devant lui.
Il avait devant lui une nouvelle excavation qui se prolongeait dans le même sens que la galerie.
– Tiens-toi bien ! cria-t-il à Milon.
Et il jeta sa torche devant lui.
Puis, s’accrochant à une saillie du rocher, il donna un coup de talon sur les épaules de Milon, afin de prendre son élan.
Et alors il se trouva dans l’excavation supérieure.
La torche ne s’était point éteinte en tombant.
Rocambole la ramassa.
– Attends-moi, dit-il à Milon, je vais à la découverte.
Et il s’avança, marchant avec précaution et regardant à ses pieds.
Une seconde d’examen lui suffit pour voir où il était.
Il se trouvait dans une de ces longues caves que les brasseurs de Londres possèdent au bord de la Tamise.
Le sol de cette cave s’était effondré au moment de l’explosion, et cette crevasse, par laquelle Rocambole venait de passer, n’existait certainement pas auparavant.
Il était même probable que le brasseur à qui appartenait cette cave ne se doutait pas qu’elle reposait elle-même sur un souterrain.
Rocambole revint sur ses pas.
Puis il s’assit au bord de la crevasse et laissa pendre ses jambes.
– Sers-toi de mon pied, dit-il à Milon, et monte.
Le géant, qui était demeuré immobile sur la saillie du rocher, se cramponna à une des jambes de Rocambole, et celui-ci le hissa, déployant cette force musculaire qu’il cachait sous son apparence délicate et presque frêle.
Alors, une fois que Milon fut auprès de lui, Rocambole lui dit :
– Maintenant, allons en avant, nous finirons bien par trouver une porte.
La cave formait un boyau étroit. Au bout de quelques pas, ils trouvèrent une rangée de tonneaux.
– Marchons toujours, dit Rocambole.
– Attendez, fit Milon.
– Qu’est-ce ?
– J’entends un bruit sourd…
Rocambole s’arrêta.
– Oui, dit-il, c’est la Tamise.
Et ils avancèrent encore, marchant entre deux rangées de tonneaux ; bientôt ils respirèrent un air plus vif, et ils comprirent que cet air venait du dehors.
Le mur décrivait une légère courbe.
Tout à coup Rocambole vit luire devant lui une lueur indécise et blafarde.
– Je vois le ciel, dit-il, ou tout au moins le brouillard.
Ils avancèrent encore.
Alors Rocambole éteignit la torche.
– Que faites-vous maître ? demanda Milon.
– Je suis prudent, répondit Rocambole.
– Ah !
– Nous sommes dans une cave qui sert d’entrepôt.
– Bon !
– Et cette cave a une porte qui est ouverte et que tu vois devant nous à trente pas, et à travers laquelle on entrevoit le ciel.
– Eh bien ?
– Eh bien ! nous n’avons plus besoin de torche, et il est inutile qu’on nous aperçoive du dehors.
– C’est juste.
Rocambole marchait toujours.
Enfin ils arrivèrent à cette porte, dont les deux battants étaient ouverts.
Quelques lumières brillaient çà et là à travers le brouillard.
La Tamise grondait en bas.
Rocambole s’arrêta au seuil de la porte et dit :
– Cette porte est une fenêtre.
– Tiens ! c’est vrai, dit Milon.
En effet, on apercevait le sol à vingt pieds au-dessous et au delà de la Tamise.
La porte de la cave était, en effet, une fenêtre qui se trouvait à la hauteur du premier étage d’une maison dont les assises étaient au niveau du lit de la rivière.
La Cité de Londres n’a pas de quais.
À la marée basse, la Tamise laisse en se retirant un espace à découvert, dont la largeur varie entre dix et quinze pieds.
À la marée haute, elle couvre cet espace et vient battre les murs des maisons, converties pour la plupart en entrepôts.
– Que faire ? dit Milon.
– Si tu veux te rompre le cou, tu n’as qu’à sauter d’ici.
– Mais, dit le colosse, en cherchant bien, peut-être trouverions-nous une corde.
– À quoi bon ? dit Rocambole.
– Mais…
– Quelle heure est-il ?
Milon avait sa montre, une belle montre à répétition. Il la fit sonner.
– Trois heures du matin, dit-il.
– Eh bien ! dans une heure, dit Rocambole, la marée sera montée.
– Vous croyez ?
– Elle baignera le pied de la maison, et alors nous nous jetterons à la nage.
Milon soupira.
Cette dernière heure qui le séparait de la liberté lui paraissait longue.
Rocambole se prit à sourire.
– Tout à l’heure, dit-il, nous étions emprisonnés dans un souterrain avec la perspective de mourir de faim. À présent, nous touchons à la liberté, nous aspirons le grand air, et tu n’es pas content.
– Vous avez raison, maître, dit Milon. Je suis une brute !
– Et pour que le temps ne te paraisse pas trop long, reprit Rocambole, je vais continuer mon histoire.
– Vous allez me dire le secret du mari de Betzy-Justice ?
– Non, pas encore.
– Ah !
– Je vais d’abord te raconter son exécution.
– Vous y avez donc assisté ?
– Sans doute.
Et Rocambole s’assit au bord de cette croisée qui ouvrait sur la Tamise, laquelle refoulée par la marée, commençait à monter…
X
– Le bon gouverneur, sir Robert M…, poursuivit Rocambole, ne perdait pas l’espoir de m’arracher des aveux.
Aussi redoublait-il avec moi de petits soins et d’amabilité.
Chaque jour, je pouvais voir le condamné à mort et lui prodiguer des consolations.
Chaque jour aussi, sir Robert M… me disait :
– N’est-ce pas que c’est affreux, un homme qui va mourir ?
Les jours s’écoulaient.
Un soir, sir Robert M… entra dans ma chambre et me dit :
– Vous savez que c’est pour demain ?
– Quoi donc ?
– L’exécution du condamné.
– Ah ! le pauvre homme !
– Voulez-vous toujours y assister ?
– Toujours.
– Alors, il faut que vous changiez de cellule.
– Ah !
– Et que vous descendiez au rez-de-chaussée.
– Comme il vous plaira.
– Si même…
Et sir Robert parut hésiter et me regarda d’un air indécis.
– Achevez, lui dis-je.
– Si même vous voulez passer la nuit avec lui…
– Oh ! bien volontiers…
– Je suis convaincu que votre conversion ne résistera pas à cette dernière épreuve.
– La vue du triste spectacle ?
– D’abord. Mais aussi les angoisses du malheureux qui n’a plus que quelques heures à vivre.
– Cela est possible, dis-je froidement.
– Oh ! je suis bien sûr, dit sir Robert M…, souriant toujours, que vous seriez pris d’une épouvante salutaire.
– Je ne demande pas mieux.
– Et que vous vous attirerez la bienveillance de vos juges par des aveux bien francs, bien complets.
– Je ne répondis rien.
Il reprit :
– Du reste, vous ne serez pas seul avec le condamné.
– Vraiment ?
– Deux dames des prisons y passeront la nuit en prière. Vous verrez comme c’est lugubre.
– Mais, dis-je à sir Robert, les règlements ne s’opposent donc pas à cela ?
– Au contraire, répondit-il.
– Bah !
– La loi permet que le condamné passe la dernière nuit avec un parent, un ami, ou même un simple prisonnier de bonne volonté.
– Eh bien ! je serai ce prisonnier-là.
– Attendez donc, poursuivit sir Robert, il y a encore une particularité que vous ignorez bien certainement et que je vais vous apprendre.
– Voyons ?
– Le corps du supplicié appartient à Calcraft, qui le vend ordinairement aux chirurgiens.
– Je sais cela.
– Sa défroque appartient encore à Calcraft.
– Bon !
– Mais la loi veut que la corde soit la propriété du supplicié.
– En vérité !
– Et il a le droit de la léguer à qui bon lui semble.
– Et la corde de pendu porte bonheur ?
– On le dit.
– Ce qui fait que si le condamné me léguait cette corde, j’aurais quelque chance de ne point être pendu à mon tour…
– Surtout si vous faites des aveux, dit sir Robert…
Je me mis à rire.
« Je ne crois pas beaucoup à la vertu de la corde du pendu, reprit sir Robert ; mais enfin si le condamné vous fait son héritier, je n’y vois aucun inconvénient, et je tiendrai même la main à ce qu’elle vous soit remise. »
– Vous êtes le plus aimable des gouverneurs, lui dis-je.
Il soupira.
– Vrai ! répondit-il, si vous faites des aveux, je vous aimerai comme mon fils.
Et il me quitta.
Une heure après, on me conduisit dans le cachot du condamné à mort.
Les dames des prisons s’y trouvaient déjà.
Le mari de Betzy-Justice me reçut en souriant.
– C’est pour demain, me dit-il.
– N’as-tu donc pas peur de la mort ? lui demandai-je.
– Non.
Et il leva la main vers la fenêtre du cachot, à travers les barreaux de laquelle on apercevait un coin du ciel.
– Quand un homme meurt pour avoir fait son devoir, dit-il, il meurt tranquille.
– Tu n’as plus rien à me dire ?
– Plus rien. Vous, savez tout. Ah ! pardon, je vous lègue ma corde, vous savez, c’est mon droit.
– Oui, le gouverneur me l’a dit.
– Ah !
– Et il est même enchanté de me voir ton héritier.
Le condamné se prit à sourire.
– Pauvre homme ! dit-il, faisant allusion au gouverneur, il n’est pas de force à lutter avec vous.
La nuit se passa.
Les dames des prisons ne cessèrent de prier, et le condamné et moi nous causâmes à voix basse.
À cinq heures du matin, la porte du cachot s’ouvrit.
Un des guichetiers amenait au condamné le chapelain qui devait l’exhorter à mourir.
Les dames des prisons sortirent.
J’embrassai le condamné une dernière fois.
– Souvenez-vous de ce que vous m’avez promis, me dit-il.
– Mourez en paix, lui dis-je.
Et je sortis à mon tour.
Le guichetier m’emmena et me dit :
– J’ai ordre de vous conduire dans une cellule dont la fenêtre donne sur la cour de l’exécution.
– Fort bien, répondis-je.
La cellule annoncée était vaste et percée d’une fenêtre plus grande que les autres.
Il suffisait de monter sur un escabeau pour atteindre cette fenêtre.
Ce fut ce que je fis.
Alors je pus voir la potence dressée.
Il était six heures du matin et le jour naissait, ou plutôt des lueurs indécises traversaient çà et là le brouillard.
Des ombres confuses s’agitaient dans la rue autour de l’échafaud.
Le jour grandit peu à peu, et je distinguai des soldats d’abord, puis sir Robert M… en grand uniforme.
Sir Robert avait le sourire aux lèvres.
Quand il me vit, il m’envoya un petit salut de la main.
Puis il poussa la courtoisie jusqu’à venir sous la fenêtre.
– Vous verrez merveilleusement bien de là, me dit-il.
– Je le crois, répondis-je. Mais qu’est-ce que tous ces hommes vêtus de noir que je vois là-bas.
– Ce sont les jurés qui ont condamné le malheureux et que la loi oblige à assister à l’exécution.
– Fort bien. Et cet autre groupe qui se tient à l’écart ?
– Ce sont les reporters des divers journaux.
– Ah ! merci.
– Excusez-moi, dit sir Robert, mais il faut que je dise un mot à Calcraft.
Et il me quitta.
J’attendis avec anxiété le moment suprême.
Cet homme qui m’était inconnu trois semaines auparavant, je l’aimais à présent que je connaissais son secret ; et la pensée qu’il allait mourir m’étreignait le cœur.
À sept heures moins le quart Calcraft et ses aides arrivèrent, montèrent sur l’échafaud, graissèrent la corde, s’assurèrent que la trappe jouait bien et redescendirent.
À sept heures précises, une porte s’ouvrit au fond du préau et le condamné parut.
Il était pâle, mais il marchait avec assurance et la tête haute.
Quand il fut sur l’échafaud, il me chercha des yeux et finit par m’apercevoir.
Nos regards se rencontrèrent.
– Souvenez-vous ! me cria-t-il encore.
– Mourez en paix ! répondis-je pour la seconde fois.
On lui passa le bonnet de laine noire, puis Calcraft lui mit la corde au cou.
Une seconde après, il était lancé dans l’éternité.
Quand les spectateurs furent partis, sir Robert M… s’empressa de me venir voir.
– Eh bien ? me dit-il.
– Eh bien ! lui dis-je, j’ai tout vu.
– Et… quelle impression cela vous a-t-il faite ?
– Aucune.
Et je me mis à rire.
– Vous ne voulez donc pas avouer ? s’écria-t-il avec un accent de dépit.
– Je verrai plus tard, lui répondis-je.
À ces mots, Rocambole se leva.
– Ah ! dit-il, voici la Tamise dans son plein. Veux-tu que nous nous jetions à l’eau ?
– Mais, dit Milon, la corde…
– Je l’ai.
– Où est-elle ?
– Autour de mes reins.
– Et vous ne me dites pas quel était ce secret que le mari de Betzy-Justice vous avait confié avant de mourir ?
– Plus tard, dit Rocambole.
– Ah ! fit Milon avec dépit.
– Pour le moment, il faut songer à n’être pas surpris ici par le jour.
– Mais où irons-nous ?
– Je ne sais pas ; nous verrons. Allons ! suis-moi !
Et Rocambole, prenant son élan, se jeta dans la Tamise, qui battait avec fureur les murs des maisons riveraines.
Milon le suivit.
Tous deux disparurent un moment sous les flots, mais ils remontèrent à la surface et se mirent à nager tranquillement dans la direction du pont de Londres.
XI
Revenons maintenant à Marmouset, que nous avons laissé avec Shoking et Vanda à la porte d’une maison de Carl street.
Marmouset, qui avait montré l’inscription qui était sur la porte.
Farlane & C°.
Marmouset, disons-nous, regarda ses deux compagnons.
– Puisque vous ne comprenez pas encore, dit-il, écoutez-moi.
– Parlez, dit Vanda, toujours anxieuse.
– Cette maison, je vous l’ai dit, doit être, si je ne me trompe, juste au-dessus de la galerie souterraine, et entre les deux éboulements que nous avons constatés.
– Eh bien ? fit Vanda.
– Eh bien ! reprit Marmouset, elle appartient à un fénian, ce qui est un grand point.
– Comment ?
– Attendez. Évidemment, cette maison a une cave, et quand nous serons descendus dans cette cave, nous trouverons un trou qui nous permettra d’arriver sous la galerie.
– Et de délivrer l’homme gris, dit Shoking.
– Oui, tout cela est fort bien, dit Vanda, mais êtes-vous sûr, Marmouset… ?
– Que la maison est verticalement au-dessus de la galerie souterraine ?
– Oui.
– J’en suis sûr.
– Comment pouvez-vous le savoir ?
Marmouset eut un sourire.
– Vous savez bien, dit-il, que j’ai fait des études d’ingénieur et que je passe même pour très fort en mathématiques.
– Ah ! c’est juste.
– J’ai calculé la distance, la situation de la maison par rapport à la galerie, et je crois mes calculs exacts.
– Dieu le veuille !
– Je crois même pouvoir affirmer que nous aurons un trou de quinze à dix-huit pieds de profondeur à percer.
– Alors, dit Shoking, il s’agit d’entrer dans la maison et de s’adresser tout de suite à master Farlane.
– Non, dit Marmouset.
– Et pourquoi cela ? fit Vanda.
– Parce que Farlane ne nous connaît pas, que nous ne sommes pas fénians et ne pouvons lui faire le signe mystérieux que les fénians ont accepté comme signe de ralliement.
– Alors ?
– Alors, dit Marmouset, Shoking va retourner dans Farringdon street.
– Bon ! fit Shoking.
– Et il préviendra le chef fénian, qui s’empressera de le suivre et viendra ici nous mettre en rapport avec M. Farlane.
– J’y cours, dit Shoking.
– Et nous vous attendons ici, dit Marmouset.
Shoking partit.
Vanda et Marmouset demeurèrent dans la rue, immobiles, les yeux fixés sur cette maison dont la porte était close, mais qui s’ouvrirait devant eux aussitôt que le chef fénian arriverait.
Ils n’attendirent pas longtemps.
Shoking avait de bonnes jambes et, à l’occasion, il savait les pendre à son cou.
Un quart d’heure après, il était de retour.
Le chef fénian l’accompagnait.
Shoking avait sans doute mis celui-ci au courant, car ils arrivèrent tous les deux avec des outils propres à creuser la terre et à faire, au besoin, une tranchée dans le roc.
Le chef fénian salua Vanda et Marmouset.
Puis, au lieu de soulever le marteau, il se mit à tambouriner sur la porte avec ses doigts, d’une façon toute particulière.
Quelques minutes s’écoulèrent.
Rien ne bougeait dans la maison, et aucune lumière n’apparaissait.
– On dort bien là dedans, fit Marmouset qui s’impatientait.
– Patience ! dit le chef fénian.
Il tambourina une seconde fois, mais d’une façon toute différente de la première.
Ni bruit, ni lumière.
– Mais cette maison est donc déserte ? exclama Vanda.
– Non, répondit le chef fénian.
Et il tambourina une troisième fois, et toujours sur un rythme différent.
Soudain une lumière apparut au-dessus de l’imposte de la porte.
Puis on entendit un pas lent et mesuré à l’intérieur du corridor.
Et enfin la porte s’ouvrit.
Marmouset et Vanda virent alors un homme de petite taille, mais trapu, vigoureux, la tête enfoncée dans les épaules, portant des cheveux et une barbe incultes de couleur rousse, qui arrivait à demi vêtu et portait une lanterne à la main.
C’était master Farlane.
Le chef lui fit un signe rapide.
Farlane répondit par le même signe, et son regard, soupçonneux d’abord quand il avait aperçu Marmouset et Vanda, se rasséréna aussitôt.
Tous les quatre entrèrent dans la maison et Farlane ferma la porte.
Puis il regarda le chef fénian.
– Eh bien ! dit-il, l’explosion a-t-elle donné un bon résultat ?
Comme il faisait cette question en patois irlandais Vanda, Marmouset et même Shoking ne comprirent pas.
– Non, dit le chef fénian.
– Cependant, reprit Farlane, j’ai cru que la moitié de Londres s’écroulait.
– Ta maison a-t-elle été secouée ?…
– Comme par un tremblement de terre.
– Vraiment ?
– Et j’aurais des crevasses dans mes caves que cela ne m’étonnerait pas.
– C’est précisément pour descendre dans les caves que nous venons.
Farlane regarda curieusement les visiteurs.
– Nous t’expliquerons tout cela, dit le chef, mais descendons dans les caves d’abord.
– Que voulez-vous faire de ces outils ?
– Tu le verras.
Bien qu’il fût un haut dignitaire dans le fénianisme, Farlane était sans doute le subordonné de celui que Shoking était allé chercher dans Farringdon street, car il n’insista point et ne fit aucune nouvelle question.
Mais il ouvrit une porte du vestibule, et, cette porte ouverte, Marmouset et Vanda, qui marchaient derrière lui, aperçurent l’escalier qui descendait dans les caves.
Le chef fénian fermait la marche.
On descendit une vingtaine de marches environ.
Puis on se trouva en face d’une nouvelle porte.
Cette porte donnait sur une longue galerie assez étroite.
Une bouffée d’air frappa Marmouset et Vanda au visage.
En même temps, ils aperçurent une double rangée de tonneaux.
Alors le chef fénian dit à Marmouset :
– À présent, orientez-vous, et voyez si vos calculs sont exacts.
Marmouset prit la lanterne que portait Farlane.
– Attendez-moi ici, dit-il.
Et il s’avança tout seul dams la direction d’où venait l’air humide et froid.
La galerie descendait insensiblement en décrivant une ligne courbe.
Au bout de quelques pas, Marmouset vit une lueur blanchâtre dans l’éloignement. Il chemina encore et reconnut qu’il apercevait les premières lueurs du matin et que la cave aboutissait à la Tamise.
Le fleuve était alors dans toute sa croissance, et la marée qui venait du large le repoussait vers les ponts de Londres.
– C’est bien ce que je pensais, se dit Marmouset.
Et il revint sur ses pas.
Vanda, les deux fénians et Shoking étaient demeurés au seuil de la porte.
Mais cette porte ouvrait au milieu de la galerie, et la galerie se prolongeait au nord.
– Par ici, dit Marmouset.
Et, marchant toujours le premier, il arriva jusqu’à un endroit où le sol était tout crevassé.
– J’en étais sûr, dit Farlane, c’est l’explosion.
Marmouset posa la lanterne au bord de la crevasse et s’aventura dans ce gouffre dont il ne pouvait sonder la profondeur. Heureusement ses pieds rencontrèrent un point d’appui.
– Passez-moi la lanterne, dit-il alors.
Et il leva les mains au-dessus de sa tête.
On lui donna la lanterne et il disparut.
Vanda et ses compagnons se trouvèrent alors dans les ténèbres.
Mais cinq minutes après la lumière reparut et Marmouset revint. Son visage était radieux.
– Le maître est sauvé ! dit-il.
– Sauvé ! s’écria Vanda.
– En êtes-vous bien sûr ? demanda Shoking.
– Sauvés tous les deux, lui et Milon ! dit Marmouset.
– Mais où sont-ils ?
– Ils ont passé par ici.
– Qu’en savez-vous ? demanda encore Shoking.
– Oh ! dit Marmouset, suivez-moi, vous allez voir.
Et rasant le sol avec sa lanterne, il se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur la rivière.
Le sol était humide par places.
– Tenez ! tenez ! dit Marmouset.
Et il montra l’empreinte des deux pieds humides.
On arriva ainsi jusqu’à la fenêtre.
Le fleuve grondait en bas.
– Comprenez-vous, maintenant ? dit Marmouset.
Et il étendit la main vers les flots bouillonnants de la Tamise et ajouta :
– Vous savez s’ils sont bons nageurs tous les deux, n’est-ce pas ?
Vanda était tombée à genoux et remerciait Dieu !
XII
Huit jours s’étaient écoulés.
Nous eussions retrouvé Vanda et Marmouset au premier étage d’une maison de Saint-George street, dans le Wapping. Il était presque nuit et Londres allumait ses réverbères.
Vanda et Marmouset causaient à mi-voix, assis auprès de la fenêtre, jetant de temps à autre un regard dans la rue et paraissant attendre quelqu’un.
– Enfin, disait Vanda, toutes nos recherches, tous nos efforts ont été inutiles depuis huit jours. Qu’est devenu Rocambole ? Oh ! il est mort, sans doute.
– Cela est impossible, dit Marmouset. Si Milon et lui s’étaient noyés, on aurait repêché leurs cadavres.
– Qui sait ?
– J’ai vu tous les noyés qu’on a retirés du fleuve, et puis, dit Marmouset, vous savez bien qu’ils sont bons nageurs tous les deux.
– Que sont-ils donc devenus ?
– Mystère ! dit Marmouset.
– Les fénians ont cherché l’homme gris partout.
– Je ne dis pas non.
– Miss Ellen, qui est venue ce matin encore, nous a affirmé que la police anglaise ne l’avait pas repris. Mais miss Ellen en est-elle sûre ?
– Oui, certes, dit Marmouset.
– Comment ?
– Elle a fait sa paix avec lord Palmure, son père.
– Bien. Mais…
– Lord Palmure s’intéresse maintenant à l’homme gris autant qu’il le haïssait, et lord Palmure est pair d’Angleterre, et il a le droit de se faire ouvrir les prisons et de voir les prisonniers qu’elles contiennent.
– Ce que vous dites là, Marmouset, devrait me rassurer, et cependant…
– Cependant vos alarmes sont plus poignantes que jamais ?
– Oui.
– Pourquoi ?
– Parce que je songe au révérend Patterson, le plus implacable ennemi de l’homme gris.
Marmouset haussa les épaules.
– Patterson n’est pas de force avec Rocambole, dit-il.
– Enfin, murmura Vanda, comment Rocambole n’a-t-il pas cherché à nous rejoindre ? Nous croit-il donc ensevelis dans le souterrain ?
Marmouset ne répondit pas tout d’abord.
Puis soudain, relevant la tête :
– Ma chère amie, dit-il, le maître a peut-être quitté Londres, mais nous, nous sommes bien coupables.
– Coupables ? fit Vanda étonnée.
– Nous avons manqué de mémoire.
– Comment cela ?
– Ne vous souvenez-vous donc pas qu’au moment où il allait mettre le feu au baril de poudre, Rocambole nous dit : « Il faut tout prévoir. Il est possible que je succombe, il est possible que nous soyons tout à l’heure à jamais séparés, et alors vous continuerez mon œuvre… »
– Oui, dit Vanda, le maître nous dit cela, en effet, et il nous enjoignit, s’il périssait, d’aller dans Rothnite, de l’autre côté du tunnel, et d’y rechercher une vieille femme du nom de Betzy-Justice.
– Précisément. Eh bien ! nous n’en avons rien fait.
– Parce que nous espérions, parce que nous espérons encore que le maître n’est pas mort.
– Soit, mais c’est par là que nous aurions dû commencer nos recherches, néanmoins.
– Pourquoi ?
– Parce que le maître est sans doute déjà allé chez cette femme.
– Ah ! dit Vanda, si vous pouviez dire vrai ?
– Qui sait ?
– Mais alors, partons, partons tout de suite !
– Non, il faut attendre maintenant.
– Attendre quoi ?
– La visite de Farlane, qui doit venir nous rendre compte des recherches continuées par les fénians.
Et comme Marmouset disait cela, il eut un geste de satisfaction.
– Tenez, fit-il, le voilà !
– Farlane ?
– Oui, il traverse la rue.
– Seul ?
– Non, il est avec Shoking.
En effet, peu après ses pas retentirent dans l’escalier, puis on frappa à la porte et Marmouset courut ouvrir.
Farlane le fénian et notre vieil ami Shoking entrèrent. Tous deux avaient la mine triste, abattue.
– Eh bien ? fit Marmouset.
– Rien, dit Farlane.
– Absolument rien ! murmura Shoking.
– C’est que nous finissons par où nous aurions dû commencer, dit Marmouset.
– Que voulez-vous dire ? fit Shoking.
– Sais-tu où est Adam street ?
– Certainement, répondit Shoking, c’est dans Rothnite.
– Eh bien ! va nous chercher un cab.
Shoking ne se le fit pas répéter, et dégringola l’escalier en courant.
Vanda avait jeté un châle sur ses épaules.
Pendant ce temps, Marmouset, disait à Farlane :
– Attendez à demain pour mettre de nouveau les hommes dont vous disposez en campagne.
– Pourquoi ? demanda le fénian.
– Parce que demain peut-être aurons-nous un point de départ certain pour continuer nos recherches.
– Comme il vous plaira, dit Farlane avec un flegme tout britannique.
Cinq minutes après, Shoking revint.
– Le cab est en bas, dit-il.
Marmouset tendit la main au fénian.
– À demain ! dit-il.
– À demain de bonne heure ! répondit Farlane.
Et il s’en alla.
– Allons vite, dit alors Marmouset.
– Est-ce que vous ne m’emmenez pas avec vous ? demanda Shoking.
– Viens si tu veux.
Vanda et Marmouset montèrent dans le cab.
Shoking monta à côté du cabman, et celui-ci rendit la main à son cheval.
Le cab descendit rapidement Saint-George street, passa auprès de la tour de Londres, entra dans Thames street, gagna le pont de Londres, arriva sur la rive droite et se dirigea vers Rothnite. Arrivé près de Rothnite-Church, c’est-à-dire à l’église de Rothnite, Marmouset cria au cabman d’arrêter.
Puis il mit pied à terre.
Shoking avait déjà ouvert la portière.
Marmouset lui dit :
– Nous sommes dans un quartier misérable, aux rues étroites. Il est inutile de poursuivre notre chemin en voiture et d’éveiller l’attention.
Et Marmouset paya le cabman et le renvoya.
Puis tous trois continuèrent leur chemin à pied.
D’ailleurs, Adam street, une pauvre ruelle entre toutes, était à deux pas.
Marmouset se souvenait du numéro que lui avait donné Rocambole, et il se trouva bientôt au seuil de la maison désignée.
C’était une pauvre maison à trois étages, de morne apparence.
On y entrait par une allée étroite et sombre, dans le milieu de laquelle était percé un judas qui donnait dans la boutique d’un marchand de poissons.
Celui-ci, entendant marcher, mit la tête à ce judas.
– Où allez-vous ? demanda-t-il.
– N’est-ce pas ici que demeure Betzy-Justice ? fit Marmouset.
– Oui, au troisième. Il n’y a qu’une porte.
– Savez-vous si elle est chez elle ?
– Oh ! certainement. Elle est au lit depuis le jour où on a pendu son mari.
Ils montèrent.
Marmouset frappa. La clef était sur la porte.
– Entrez ! dit une voix affaiblie de l’intérieur.
Betzy-Justice était étendue sur un grabat et dans un état de faiblesse extrême.
À la vue de ces trois inconnus elle jeta un cri d’effroi.
– Ah ! dit-elle, est-ce que vous venez me chercher, moi aussi, pour me mettre en prison comme mon pauvre Tom, et me pendre ensuite comme vous l’avez pendu ? Oh ! ce ne serait pas la peine, dit-elle, car je vais mourir !
– Ma chère, répondit Marmouset, nous ne sommes pas des gens de la justice, mais des amis.
– Ah ! ne me trompez-vous point ? dit la vieille.
Et elle écarta de ses doigts amaigris la broussaille de cheveux gris qui lui couvrait le front.
– Ne me trompez-vous point ? répéta-t-elle.
– Non, nous sommes les amis de l’homme gris.
Ce nom arracha un cri de joie à la vieille.
– De l’homme gris ! dit-elle, l’homme gris ?
– Oui.
– Il n’est donc plus en prison ?
À cette question, Marmouset et Vanda se regardèrent avec une morne stupeur.
Leur dernière espérance s’évanouissait.
Betzy-Justice n’avait pas vu l’homme gris, et il y avait huit jours que l’homme gris et Milon avaient quitté le souterrain de Newgate.
– Ah ! s’écria Vanda avec un sanglot dans la voix, je vous le disais bien, il est mort !
Betzy se dressa sur son lit de misère :
– Qui donc est mort ? s’écria-t-elle.
Et elle attacha sur les trois personnes ses yeux enflammés par la fièvre et les larmes.
XIII
Betzy-Justice continuait à regarder ces trois personnages.
Il y eut un moment de silence après l’exclamation de Vanda.
Puis Betzy se redressa et d’une voix enfiévrée :
– Non, dit-elle, vous vous trompez… cela ne peut être… l’homme gris n’est pas mort !
– Il faut bien l’espérer, dit Marmouset.
Vanda secoua la tête et ne répondit pas.
– L’homme gris a promis à mon pauvre Tom qu’il ferait justice, et l’homme gris n’a pu mourir avant d’avoir tenu sa parole. D’ailleurs, ajouta-t-elle, l’homme gris n’est pas un homme comme les autres.
– Ça c’est vrai, dit Shoking qui, lui aussi, se reprit à espérer.
– L’homme gris ne peut mourir, dit encore Betzy.
Et puis, les regardant toujours :
– Que veniez-vous donc faire ici ?
– Chercher l’homme gris.
– Et vous dites que vous êtes ses amis !
– Oui.
Et comme elle les regardait d’un air de doute, Marmouset ajouta :
– Quand nous nous sommes séparés, l’homme gris nous a dit : « Il est possible que nous ne nous revoyions pas. »
– Ah ! il vous a dit cela ?
– Oui, et il nous a commandé de venir vous trouver.
– Moi ?
– Et de vous prier de nous remettre les papiers.
Betzy les regarda avec défiance.
– Non, non ! dit-elle enfin. Vous ne venez peut-être pas de sa part.
– Je vous jure que si, ma chère, dit Shoking.
– Et moi je ne vous crois pas.
Marmouset prit dans ses mains les mains de la vieille femme et lui dit :
– Regardez-moi bien, ai-je l’air d’un homme qui ment ?
– Je n’en sais rien.
– Songez, reprit Marmouset, que si l’homme gris est mort, et que vous refusiez de vous confier à nous…
– Je ne songe qu’à une chose, dit Betzy.
– Laquelle ?
– C’est que mon pauvre Tom, quand il est allé en prison, m’a dit de ne confier les papiers à personne.
– Pas même à l’homme gris !
– Oh ! si.
– Puisque c’est lui qui nous envoie !
– Prouvez-le-moi ?
Et cette femme que le chagrin et la misère avaient mise aux portes du tombeau, et qui n’avait peut-être plus que quelques heures à vivre, cette femme, disons-nous, parut décidée à ne point se dessaisir des documents mystérieux qui se trouvaient en sa possession.
– Ma chère, dit alors Shoking, ne me connaissez-vous donc pas, moi ?
– Non, dit-elle. Cependant il me semble que je vous ai vu quelque part.
– Je me nomme Shoking.
Ce nom parut éveiller un souvenir dans l’esprit de Betzy-Justice.
– Ah ! oui, dit-elle, Shoking le mendiant ?
– Précisément.
– Nous avons passé une nuit ensemble au work-house de Mail-Road.
– C’est vrai, dit Shoking.
– Mais cela ne me prouve pas que vous veniez de la part de l’homme gris.
– Je suis son ami.
– Qui me le prouvera ?
– Voyons, dit Shoking qui était patient comme un véritable Anglais qu’il était, connaissez-vous dans Londres un homme en qui vous ayez une confiance absolue ?
– Oui, je connais un prêtre catholique.
– L’abbé Samuel, peut-être ?
– Vous le connaissez ?
Et Betzy regarda Shoking avec une attention pleine de ténacité.
– Non seulement je le connais, dit Shoking, mais je puis vous affirmer qu’il témoignera, si je le veux, que je viens de la part de l’homme gris.
– Eh bien ! dit Betzy, que l’abbé Samuel vienne ici et qu’il me dise que je peux vous remettre les papiers.
– Et vous nous les donnerez ?
– Oui.
Shoking consulta Marmouset du regard.
Marmouset répondit :
– Le maître nous a donné un ordre et nous devons l’exécuter. J’ai la conviction que le maître est vivant.
– Moi aussi, dit Shoking.
– Dieu vous entende ! murmura Vanda.
– Mais nous devons agir comme s’il était mort.
– C’est mon avis, dit encore Shoking.
– Mais, reprit Marmouset, où trouver cet abbé Samuel ?
– Je m’en charge, dit Shoking. Et si vous voulez m’attendre ici…
– Ici ?
– Oui ; en prenant un cab, je serai de retour avant une heure.
– Soit, dit Marmouset.
– Que l’abbé Samuel me dise que je puis avoir confiance en vous, et je vous donnerai les papiers, dit Betzy.
Marmouset regardait cette chambre délabrée qui n’avait d’autres meubles que le lit de bois blanc sur lequel Betzy était couchée, deux chaises boiteuses et une table.
Betzy crut comprendre ce regard.
– Ah ! dit-elle, vous cherchez où j’ai pu mettre les papiers, n’est-ce pas ?
Elle eut un rire nerveux et ajouta :
– Ils ne sont pas ici, croyez-le bien… Ils sont hors de cette maison…
– Ah ! fit Marmouset.
– Et si vraiment vous venez de la part de l’homme gris…
– Nous vous le prouverons tout à l’heure, ma chère, dit Shoking.
Et il gagna la porte, tandis que Vanda et Marmouset s’asseyaient au chevet de la vieille femme.
* *
*
Shoking était un enfant de Londres, et il savait la grande ville par cœur.
Une fois hors d’Adam street, il retourna vers Rothnite-Church, où il savait qu’il trouverait au fond d’une cour une station de voitures.
Il trouva en effet un cab et monta dedans, disant au cocher :
– Saint-George-Church !
– Dans le Southwark ? dit le cocher.
– Oui. Et il y a six pence de pourboire si tu me mènes rondement.
Le cabman rendit la main à son trotteur irlandais.
Vingt minutes après, le cab s’arrêtait devant la grille du cimetière qui entoure l’église catholique.
Shoking traversa le cimetière.
Puis, au lieu d’entrer dans l’église par la grande porte, il se dirigea vers la petite porte du chœur.
Rien n’était changé dans Saint-George-Church.
C’était toujours le même gardien à barbe blanche qui venait ouvrir quand on frappait d’une certaine façon.
Shoking frappa.
Le bonhomme vint ouvrir.
En voyant Shoking, il eut un éclair de joie dans ses yeux presque éteints.
– Ah ! dit-il, il y a longtemps qu’on ne vous a vu, mon cher ami !
– J’ai fait une absence, dit Shoking.
– En vérité ?
– Je suis allé en France.
– Ah ! fort bien.
– Et je voudrais voir l’abbé Samuel. Est-il là-haut ?
Et Shoking désignait du regard la porte du clocher.
– Oui, dit le vieillard d’un clignement d’yeux.
Shoking monta dans le clocher et frappa à cette porte perdue dans la muraille qui ouvrait sur la chambre secrète dans laquelle l’abbé Samuel, l’homme gris et tous ceux que le révérend Patterson poursuivait de sa haine implacable avaient successivement trouvé un asile.
L’abbé Samuel était en prière.
Il vint ouvrir à Shoking et eut, comme le sacristain, un geste de surprise joyeuse.
– Monsieur, lui dit Shoking, vous savez si j’étais l’ami de l’homme gris, ou plutôt son serviteur dévoué ?
– Certainement, dit l’abbé Samuel.
– Êtes-vous prêt à l’attester ?
– Mais sans doute.
– Alors je vous supplie de venir avec moi.
– Où cela ?
– Dans Rothnite, Adam street.
– Bon ! dit l’abbé Samuel, je sais ce que vous voulez.
– Ah !
– Vous êtes allé demander des papiers à la veuve d’un supplicié ?
– Oui.
– Qu’on nomme Betzy-Justice ?
– C’est bien son nom.
– Et elle ne veut pas croire que vous venez de la part de l’homme gris ?
– Elle ne le croira que si vous le lui affirmez.
– Eh bien ! dit le prêtre, allons, je suis prêt à vous suivre.
Alors Shoking regarda l’abbé Samuel :
– Monsieur, dit-il, vous connaissez donc l’histoire de ces papiers ?
– Oui.
– Qui vous l’a racontée ?
– L’homme gris lui-même.
Shoking jeta un cri :
– Ah ! s’il en est ainsi, dit-il, je bénis le ciel, car l’homme gris que nous avons cru mort est bien vivant !
L’abbé Samuel ne répondit pas.
XIV
Et comme ils traversaient le cimetière, Shoking prit vivement les mains de l’abbé Samuel.
– Ah ! fit-il, dites-moi que vous l’avez vu ?
– Qui ?
– L’homme gris.
– Sans doute, je l’ai vu.
– Quand ? hier, aujourd’hui ? demanda Shoking d’une voix étranglée par l’émotion.
– Non, dit l’abbé Samuel, je l’ai vu à Newgate, il y a une quinzaine de jours.
Shoking jeta un cri de surprise.
– Ah ! fit-il, s’il en est ainsi, vous ne savez rien.
Le prêtre le regarda d’un air étonné.
– Vous ne savez donc pas, poursuivit Shoking, que l’homme gris n’est plus à Newgate ?
– Si, je le sais.
– Alors vous savez où il est ?
Et Shoking se reprit à espérer.
– Non, dit l’abbé Samuel.
– Nous le croyons mort, nous.
– Ah ! dit le prêtre.
Et il demeura impassible.
– Oh ! s’écria Shoking, vous savez des choses que nous ne savons pas.
– Peut-être bien…
Shoking ne dit plus rien. Mais il fit à part lui cette réflexion :
« Je suis bien sûr maintenant que l’homme gris n’est pas mort.
Seulement, il a très certainement des raisons pour ne pas reparaître.
Et ces raisons, l’abbé Samuel les connaît aussi. »
Dès lors Shoking garda un silence plein de réserve.
Ils sortirent du cimetière et montèrent dans le cab qui attendait Shoking sur le square.
– Rothnite-Church ! dit celui-ci.
Le cab partit.
Arrivé à l’église de Rothnite, l’abbé Samuel et lui mirent pied à terre et renvoyèrent le cab.
Puis ils continuèrent leur chemin à pied et gagnèrent Adam street.
Marmouset était au seuil de la porte.
– Ah ! venez vite, dit-il, venez vite.
– Qu’est-ce qu’il y a donc encore ? demanda Shoking.
– Il y a que la vieille femme va mourir.
– Betzy ?
– Après ton départ, dit Marmouset, elle a été prise d’une crise nerveuse, puis une grande faiblesse s’en est suivie, et maintenant c’est à peine si elle respire. Il n’est que temps qu’elle voie monsieur.
Et Marmouset salua l’abbé Samuel.
– Rassurez-vous, monsieur, dit celui-ci en français. Je connais Betzy et je l’ai vue plusieurs fois en cet état, surtout depuis la mort de son mari.
Ils montèrent.
Vanda était toujours au chevet de la vieille femme, qui haletait sur son lit.
Quand Betzy-Justice vit apparaître l’abbé Samuel, son visage se transfigura et un rayon de joie brilla dans son regard.
– Ah ! dit-elle, j’ai cru que j’allais mourir avant votre arrivée.
L’abbé Samuel lui prit la main :
– Il faut avoir du courage, Betzy, dit-il.
– Ah ! j’en ai, dit-elle, et puis il ne faut pas que ce pauvre Tom soit mort inutilement.
Et elle regarda Shoking, ajoutant :
– Vous connaissez donc cet homme ?
– Oui, dit l’abbé Samuel.
– C’est un ami de l’homme gris ?
– Oui.
– Et ils viennent de sa part ?
– Oui, répéta le prêtre catholique.
– Alors je puis leur dire où sont les papiers ?
– Certainement.
Betzy fit un effort suprême et, une fois encore, elle parvint à se dresser sur son lit.
– Alors, dit-elle, écoutez-moi…, écoutez-moi bien.
Tous quatre entouraient le lit de la vieille femme, dont la voix allait toujours s’affaiblissant.
– Vous connaissez l’église de Rothnite ? dit-elle.
– Oui, répondit l’abbé Samuel.
– Elle est entourée d’un cimetière.
– Comme toutes les églises de Londres.
– Eh bien ! il y a dans le cimetière de Rothnite une tombe qui porte un nom pour toute inscription : Robert.
– Après ? fit Shoking.
– Cette tombe est surmontée d’une croix de fer, continua Betzy-Justice. Elles sont rares les croix de fer dans le pauvre cimetière de Rothnite, et vous trouverez facilement la tombe dont je vous parle.
– Et les papiers sont dans la tombe ?
– Oui.
– C’est bien, dit Marmouset, nous allons y aller.
– Mais, dit encore Betzy, vous ne le pourrez pas, le cimetière et l’église sont fermés la nuit.
– Nous passerons par-dessus les grilles.
– C’est inutile, dit Shoking.
– Que veux-tu dire ?
Et Marmouset regarda Shoking avec curiosité.
– Je veux dire, répondit Shoking, que j’ai un moyen de pénétrer dans le cimetière sans rien briser ni enfoncer aucune porte.
L’abbé Samuel fit un signe de tête qui voulait dire :
– Moi aussi.
– Allons, en ce cas, dit Marmouset.
– Mais, dit Vanda, on ne peut laisser cette pauvre femme seule ; je vais rester auprès d’elle.
– Oh ! fit Betzy d’une voix triste, vous n’y resterez pas longtemps, je crois bien que c’est fini cette fois ; mais je ne voudrais pas mourir avant de savoir si vous avez les papiers.
– Nous reviendrons aussitôt que nous les aurons, répondit l’abbé Samuel.
Et il sortit le premier.
Marmouset et Shoking le suivirent.
Quand ils furent dans la rue, le prêtre dit à Marmouset :
– Il est une chose que vous ne savez pas, que vous ne pouvez pas savoir, mais que l’homme gris sait bien.
– Ah !
– C’est que le cimetière de Rothnite a servi plus d’une fois de rendez-vous aux fénians.
– Vraiment ?
– Et nous allons prendre le même chemin qu’eux pour y pénétrer.
– Vous me parlez de l’homme gris ? dit Marmouset.
– Sans doute.
– Savez-vous ce qu’il est devenu ?
– Il s’est échappé de Newgate.
– Oui. Mais après ?
– Après… dame !…
Et le prêtre parut embarrassé.
Marmouset secoua la tête :
– J’ai bien peur qu’il ne soit mort, dit-il.
– Non, dit l’abbé Samuel.
– Vous croyez qu’il n’est pas mort ?
– Oui.
– Vous en êtes… certain ?
– Peut-être…
– Et… vous… l’avez vu ?
– Non, mais je vous affirme qu’il est vivant.
– Et moi je le crois, dit Shoking.
Marmouset sentait son cœur battre très violemment.
– Oh ! monsieur, dit-il, de grâce, si vous avez quelque nouvelle récente de celui que vous appelez l’homme gris et que nous appelons le maître, nous…
– Monsieur, répondit l’abbé Samuel, je ne puis parler. Qu’il vous suffise de savoir que l’homme gris est vivant, bien portant, et que vous le reverrez un jour.
Marmouset n’insista pas.
Rocambole vivait !
Et puis Marmouset se souvenait.
Il se souvenait que, trois ou quatre années auparavant, le maître avait subitement disparu, puis qu’il était revenu de la même façon.
L’abbé Samuel et ses deux compagnons, tout en causant ainsi, arrivèrent sur la petite place de Rothnite-Church.
Il y avait là un public-house qui fermait de bonne heure chaque soir, mais à travers les volets duquel on voyait filtrer un filet de lumière bien avant dans la nuit.
Shoking frappa d’une certaine façon.
Un bruit se fit à l’intérieur.
Mais la porte du public-house ne s’ouvrit pas.
Alors Shoking se retourna vers l’abbé Samuel.
– Le publicain attend le mot d’ordre, dit-il, et ce mot, je ne le sais pas.
– Attendez…
Et l’abbé Samuel, approchant ses lèvres d’une fente de la devanture, prononça quelques paroles en patois irlandais.
La porte s’ouvrit alors.
Le publicain, un Irlandais de pure race, fit un geste d’étonnement en apercevant l’abbé Samuel.
– Il n’y a pourtant pas de réunion aujourd’hui ! dit-il, faisant allusion sans doute aux assemblées mystérieuses des fénians.
– Non, dit l’abbé, mais nous avons affaire dans le cimetière.
– Ah !
Le publicain connaissait Shoking ; mais il voyait Marmouset pour la première fois.
Et comme il le regardait avec une extrême curiosité, l’abbé Samuel lui dit :
– Ce gentleman est l’ami de l’homme gris.
Le publicain salua avec respect.
Puis il alluma une lanterne à la lampe qui brûlait sur le comptoir, et dit :
– Puisque vous avez affaire dans le cimetière, venez.
Et il souleva la trappe qui se trouvait au milieu du public-house, laquelle trappe recouvrait une échelle de meunier qui plongeait dans la cave de son établissement.
XV
Une fois dans la cave, l’abbé Samuel prit la lanterne des mains du publicain.
– Nous n’avons plus besoin de toi, dit-il.
– Je puis remonter ?
– Oui.
– Vous n’attendez personne ?
– Personne absolument.
Le publicain gravit de nouveau les degrés de l’échelle, laissant Shoking, Marmouset et l’abbé Samuel dans la cave.
Alors le fénian promena sa main sur la paroi humide de la muraille, cherchant un ressort sans doute.
Et tout à coup une porte, si habilement dissimulée qu’on la confondait avec le mur, s’ouvrit.
– Voilà notre chemin, dit le prêtre.
La porte démasquait un étroit corridor souterrain.
Tous trois s’y engagèrent l’un après l’autre.
Marmouset cheminait le dernier, tandis que l’abbé Samuel éclairait la marche avec la lanterne qu’il avait prise au publicain.
Le souterrain était comme un boyau d’égout, se prolongeait sur un parcours de trente mètres environ et aboutissait à un petit escalier de six marches.
Cet escalier aboutissait lui-même à une porte qui était simplement poussée, car elle céda sous la main de l’abbé Samuel.
Alors le prêtre éteignit la lanterne.
– Que faites-vous donc ? demanda Marmouset.
– Je suis prudent.
– Mais où sommes-nous donc ici ?
– Dans un caveau de famille.
– Ah ! vraiment ?
– Tenez, dit encore l’abbé Samuel, maintenant que la lanterne est éteinte, regardez devant vous.
– Bon !
– N’apercevez-vous rien ?
– Il me semble que je vois un coin du ciel, au travers d’une fenêtre.
– Non pas d’une fenêtre, mais d’une porte.
En effet, le caveau dans lequel ils venaient de pénétrer par ce singulier chemin avait une porte qui donnait sur le cimetière.
L’abbé Samuel tira un verrou et cette porte s’ouvrit.
– Je sais où est la tombe, dit encore le prêtre irlandais.
Et il sortit le premier du caveau.
La nuit était noire et le brouillard épais.
– Suivez-moi, dit encore l’abbé Samuel, et marchez avec précaution ; il ne faut pas, autant que possible, marcher sur les tombes, c’est une profanation.
Malgré l’obscurité, le prêtre s’orientait assez bien.
– Ah ! dit Marmouset tout bas, vous savez où est la tombe ?
– Oui, je me rappelle avoir remarqué la croix de fer et l’inscription.
– Saviez-vous aussi qu’elle contenait des papiers ?
– Non ; et cependant…
– Cependant ? fit Marmouset.
– Je sais vaguement ce que renferment ces papiers ?
– Ah !
– Il y a trois mois, poursuivit l’abbé Samuel, un homme vint un jour à l’église Saint-George et demanda à me parler.
– Quel était cet homme ?
– C’était Tom, le mari de Betzy.
– Il n’était donc point encore en prison ?
– Non. Tom me raconta son histoire et me supplia de m’intéresser à lui.
Je pouvais tout, me disait-il, et si je prenais sa cause en main, il la considérait comme gagnée.
Malheureusement Tom était Écossais, protestant, et non affilié au fénianisme.
J’étais sûr d’avance que nos frères refuseraient de le servir et je le lui dis.
Il ne voulut pas en entendre davantage et s’en alla, en me faisant de la main un geste d’adieu désespéré.
Deux jours après, Tom assassinait lord Evandale.
– Mais, dit Marmouset, ne lui aviez-vous donc pas parlé de l’homme gris ?
– En aucune façon.
– Alors, comment l’homme gris a-t-il pu savoir ?
– Ils se sont vus à Newgate.
– Ah ! c’est juste.
Et Marmouset ajouta en manière d’aparté :
– Je reconnais bien là le maître et sa nature chevaleresque : pour que Rocambole ait accepté l’héritage de Tom le supplicié, il faut que cette cause soit juste.
L’abbé Samuel s’arrêta.
– C’est ici, dit-il.
La nuit était trop noire pour qu’on pût déchiffrer l’inscription, mais on voyait fort distinctement la croix de fer.
– J’ai un briquet dans ma poche, dit Shoking.
– À quoi bon ?
– Pour bien voir si c’est le nom qu’a dit Betzy qui est écrit là-dessus.
– Inutile. Je suis sûr que cette tombe est celle qu’elle a désignée.
C’était une simple pierre couchée dans l’herbe.
– Nous n’avons pas d’outils pour la soulever, dit Marmouset.
– Nous n’en avons pas besoin, répondit l’abbé Samuel.
– Ah ! vous croyez ?
– Voyez plutôt.
Et le prêtre prit la pierre à deux mains et la souleva facilement, tant elle était légère.
La pierre recouvrait une fosse dont les parois étaient en maçonnerie.
Au fond de la fosse, on apercevait une bière.
Shoking ne put se défendre d’un mouvement d’effroi.
– Tu as peur ? dit Marmouset.
– Un peu, répondit Shoking.
– Pourquoi ?
– Parce que bien certainement les papiers sont dans la bière.
– C’est probable.
– Oh ! dit Shoking qui se trouva en présence d’un cadavre, ce n’est pas drôle.
Marmouset descendit dans la fosse.
Il n’y voyait guère, mais le toucher suppléait pour lui à la vue.
Il promena ses mains sur le cercueil et rencontra une vis, puis deux, puis quatre.
À Londres, on ne cloue pas les cercueils, on les visse.
Alors Marmouset tira de sa poche un couteau à plusieurs lames.
L’une de ces lames était ronde par le bout et pouvait, au besoin, servir de tournevis.
Shoking se tenait un peu à l’écart.
L’abbé Samuel, debout au bord de la fosse, prêtait l’oreille au moindre bruit.
Le cimetière n’avait pourtant pas de gardien, non plus que l’église qui se trouvait au milieu, mais plusieurs maisons du voisinage prenaient vue sur lui ; et puis il pouvait se faire que quelque fénian eût fantaisie d’y pénétrer par le même chemin.
Heureusement l’opération ne fut pas longue.
En moins de dix minutes Marmouset eut enlevé les quatre vis du cercueil.
– C’est fait, dit-il.
Shoking recula encore et détourna la tête.
Marmouset souleva alors le couvercle du cercueil.
– Ah ! dit-il, tu peux revenir, Shoking.
– Hein ? fit Shoking d’une voix tremblante.
– Le cercueil est vide.
– Vide ?
L’abbé Samuel et Shoking s’étaient penchés au bord de la fosse.
– Pas de cadavre ! dit encore Marmouset.
– Et pas de papiers ?
– Ah ! si, je crois que c’est ça.
Et Marmouset trouva, en effet, dans un coin du cercueil veuf de son cadavre, un paquet recouvert avec de la toile cirée et fermé par cinq cachets de cire noire.
Et il jeta le paquet à l’abbé Samuel.
Puis il replaça le couvercle.
Et sautant ensuite hors de la fosse, il aida l’abbé Samuel à remettre en place la pierre et la croix de fer.
L’abbé Samuel se remit à guider la marche.
Quelques minutes après, ils étaient dans le public-house, gagnaient le dehors et se dirigeaient rapidement vers Adam street.
Quand ils arrivèrent chez Betzy, la pauvre femme agonisait.
Un dernier éclair de vie s’alluma dans son œil en voyant reparaître l’abbé Samuel.
– Voici les papiers, dit le prêtre.
– Oui, murmura-t-elle d’une voix éteinte, c’est bien cela. Ah ! je peux mourir maintenant.
Ce furent ses dernières paroles.
Sa respiration s’embarrassa, ses yeux se vitrèrent, elle eut quelques mouvements convulsifs.
Puis un dernier souffle s’exhala de sa poitrine.
Betzy-Justice était morte, tandis que le prêtre catholique lui donnait l’absolution.
Et les trois hommes et Vanda passèrent la nuit auprès du cadavre de Betzy-Justice.
Et Marmouset, ayant ouvert le paquet de toile cirée, y trouva un volumineux manuscrit en anglais et portant le titre bizarre :
Journal d’un fou de Bedlam.
Et Marmouset fit, à haute voix, la lecture du manuscrit.
XVI
Journal d’un fou de Bedlam
I
Les monts Cheviot séparent le comté écossais de Roxburgh du comté anglais de Northumberland.
Leur cime est couronnée de neiges éternelles.
D’épaisses forêts couvrent leurs pentes abruptes et dans les vallées poussent de verts pâturages.
À trois lieues du bourg de Castleton, suspendu sur un rocher comme une aire d’aigle et dominant un paysage d’une mélancolie âpre et sauvage, s’élève le manoir de Pembleton.
Pembleton-Castle, comme on dit dans le pays.
Il a huit tours massives, aux poivrières pointues, des murs épais comme ceux d’une forteresse.
Il domine huit lieues de pays du côté de l’Écosse, bien qu’il soit bâti sur la terre anglaise.
Au moyen âge, les sires de Pembleton étaient Écossais et marchaient sous la bannière des Robert Bruce et des Wallace.
Lord Pembleton siège au Parlement dans la chambre haute, mais il a néanmoins conservé le titre de baron écossais, et il en est très fier.
Lord Evandale Pembleton n’avait que trois ans quand son père mourut au combat de Navarin, où la France et l’Angleterre réunies chassèrent la flotte turque des eaux de la Grèce.
Il avait un frère de dix-huit mois.
Lorsque lady Pembleton apprit l’épouvantable malheur qui la frappait, elle quitta précipitamment Londres, où elle passait la saison dans son bel hôtel du West-End, pour se réfugier en toute hâte, avec ses deux enfants, au manoir de Pembleton. Vêtue de noir des pieds à la tête, elle s’enferma dans cette vieille forteresse que le noble lord son époux avait délaissée, comme ses aïeux, du reste, depuis trois quarts de siècle.
En bas, dans la plaine, s’élevait un joli castel tout moderne, entouré d’une ceinture de prairies, une demeure princière, entre toutes, dans laquelle lord Pembleton passait l’automne et la saison des chasses, et qu’il avait peuplée de merveilles artistiques et de toutes les richesses de luxe moderne.
C’était New-Pembleton, le nouveau Pembleton.
Le château succédant au manoir.
Et cependant ce ne fut pas à New-Pembleton que se réfugia lady Evandale.
Ce fut à Pembleton-Castle, à Old Pembleton, le vieux Pembleton, comme on appelait encore le manoir écossais.
Pourquoi ?
On était alors en 1828, c’est-à-dire en plein dix-neuvième siècle, et le temps était passé où les hauts barons se déclaraient réciproquement la guerre.
La noblesse était devenue l’aristocratie, les hauts barons n’étaient plus que de grands seigneurs, et le calme le plus profond régnait dans les trois royaumes devenus le Royaume Uni.
Cependant lady Evandale, en arrivant à Pembleton-Castle, donna des ordres bizarres.
Elle fit baisser le pont-levis, ce qui n’était pas arrivé depuis plusieurs siècles.
Elle fit un appel à tous les paysans du voisinage qui étaient encore ses vassaux, et elle peupla le manoir d’une véritable armée.
Puis, comme jadis, Jeanne de Montfort montrait son fils aux nobles bretons, elle prit son fils aîné dans ses bras – ce fils qui n’avait que trois ans – elle le montra à ses fidèles Écossais accourus à sa voix, et elle leur fit jurer de veiller sur lui.
Et les montagnards jurèrent avec enthousiasme.
Quel mystérieux et terrible danger menaçait donc cet enfant qui devait s’aller asseoir un jour à la chambre des lords ?
Un seul homme le savait peut-être, partageant ainsi le secret de lady Pembleton.
Cet homme était un jeune Écossais du nom de Tom, le frère de lait de lady Pembleton, laquelle était jeune et belle, et n’avait pas encore atteint sa vingt-quatrième année le jour où elle devint veuve.
Aussi Tom, dès le premier jour, s’installa dans la chambre où couchait l’enfant et y passa la nuit dans un fauteuil, ayant à la portée de sa main sa carabine de chasseur.
Et il en fut de même des nuits suivantes.
Et pendant ces mêmes nuits, les Écossais veillaient, se promenant sur les remparts du vieux castel, et avaient soin, dès que le crépuscule arrivait, de hisser le pont-levis.
Lady Pembleton se promenait au milieu d’eux, tantôt inquiète, tantôt paraissant plus rassurée, mais toujours mélancolique et comme poursuivie par quelque affreux souvenir.
Trois mois s’écoulèrent.
Pendant ces trois mois, au grand ébahissement de la contrée, Pembleton-Castle tint véritablement garnison.
Les bruits les plus étranges coururent alors.
La mort de lord Evandale avait troublé la raison de la pauvre veuve.
Nature exaltée déjà par la lecture des romans de Walter Scott et des poèmes de Byron, lady Eveline Pembleton était devenue tout à fait folle.
Elle se croyait en plein moyen âge, au temps des luttes héroïques des clans écossais contre les barons anglais, et elle voulait défendre son fils contre des ennemis imaginaires.
Les bons Écossais appelés à son aide, et qui n’avaient eu garde de refuser leurs services, commençaient à partager cette croyance.
Un seul homme disait que lady Pembleton n’était pas folle et qu’elle avait de bonnes raisons pour agir ainsi.
Cet homme, c’était Tom.
Mais Tom ne s’expliquait pas davantage et gardait fidèlement son secret.
Enfin, au bout de trois mois, lady Pembleton renvoya ses Écossais, fit abaisser le pont-levis de Old-Pembleton, demanda ses voitures de promenade, et quittant avec ses nombreux domestiques le manoir féodal, elle redescendit à New-Pembleton, la seigneuriale demeure, et s’y installa avec ses deux enfants.
Les gentilshommes fermiers des environs, les bourgeois des petites villes voisines ne manquèrent pas de dire alors que la belle veuve était revenue à la raison.
Le motif unique, cependant, de ce changement complet d’existence, reposait sur un message que lady Pembleton avait reçu de Londres :
« Sir Arthur s’est embarqué ce matin pour les Indes. »
Qu’était-ce que sir Arthur ?
Le frère puîné de lord Evandale.
Était-ce donc contre lui que lady Pembleton avait pris des précautions aussi singulières ?
Quelques jours après son retour à New-Pembleton, lady Eveline reçut la visite de deux gentlemen.
C’était lord Ascott et son fils, le baronnet sir James.
Lord Ascott et sir James étaient le père et le frère de lady Eveline.
Le père revenait d’Italie, où il avait passé deux années pour soigner une maladie de poitrine ; le fils, midshipman dans l’armée navale des Indes, était en congé.
Tous deux s’étaient trouvés à Londres, au moment où la conduite excentrique de lady Pembleton avait fait quelque bruit, et, persuadés que la pauvre femme était folle, ils étaient partis en toute hâte.
Lady Eveline les reçut en grand deuil.
Elle était fort triste, elle fondit même en larmes en les revoyant ; mais rien dans ses manières, ni dans sa conduite, ne les confirmait dans cette opinion qu’ils s’étaient faite sur le dérangement de ses facultés mentales.
Lady Pembleton était parfaitement raisonnable.
Cependant les deux gentlemen crurent devoir lui demander des explications.
Lady Eveline refusa de s’expliquer.
Alors lord Ascott fit appel à son autorité paternelle et il tint à sa fille un langage sévère.
Lady Eveline persista dans son refus.
Lord Ascott s’emporta.
Il alla même jusqu’à dire que la famille de lord Pembleton parlait de la faire interdire et de lui retirer la tutelle et l’éducation de ses enfants.
Lady Eveline fondit en larmes.
Enfin elle se jeta aux genoux de son père et lui dit :
– Milord, je sais que je vous dois obéissance, mais je sais aussi que les aveux que je vais vous faire vous briseront le cœur. Épargnez-les-moi, je vous en supplie.
Lord Ascott fut inflexible.
Alors lady Eveline le conduisit dans sa chambre, ouvrit un meuble d’où elle retira un petit cahier de papier couvert d’une écriture à moitié illisible, et dont chaque page portait les traces d’une larme.
– Tenez, mon père, dit-elle, voilà le journal de ma vie. Lisez…
Et elle prit la fuite, laissant lord Ascott en possession du cahier.
Une heure après, le vieux gentilhomme rejoignit sa fille ; il était d’une pâleur mortelle.
Et prenant sa fille dans ses bras, il la tint longtemps serrée sur son cœur.
Et mêlant ses larmes aux larmes de la jeune femme, il lui dit.
– Je suis trop vieux, moi… mais ton frère te vengera.
Quel était donc l’aveu épouvantable que lady Eveline n’avait osé faire de vive voix à lord Ascott, son vieux père ?
C’est ce que nous allons vous dire, en traduisant fidèlement le manuscrit de la veuve de lord Evandale Pembleton, commodore de la marine royale anglaise, tué à Navarin, en combattant sous le drapeau de la civilisation, aux prises avec la barbarie.
XVII
Journal d’un fou de Bedlam
II
La famille Dunderry, dont le chef porte le nom de lord Ascott, est de pure source normande.
Depuis que le duc Guillaume le Bâtard devint le roi Guillaume le Conquérant, les Dunderry se sont toujours alliés aux plus hautes maisons de l’aristocratie anglaise.
Miss Eveline, fille de lord Ascott, avait seize ans lorsque son père chercha à la marier.
Certes, les partis ne manquaient pas, et les plus beaux noms du Royaume-Uni se disputaient l’honneur d’une telle alliance, mais miss Eveline était fiancée depuis longtemps, selon la mode anglaise, à lord Pembleton.
Le manoir d’Ascott et celui de Pembleton le Vieux perchés chacun sur un des escarpements des monts Cheviot, se regardaient depuis des siècles à trois lieues de distance.
Lord Ascott, le père de miss Eveline, et feu lord Pembleton, père du lord actuel, avaient été liés depuis leur enfance ; et quand miss Eveline avait eu dix ans et sir Evandale Pembleton dix-huit, on les fiança.
Puis, sir Evandale s’embarqua pour les Indes, où il servait dans la marine royale.
Les deux familles n’en demeurèrent pas moins très unies.
Il n’y avait pas de semaine, en hiver, que lord Ascott et sa fille ne fissent visite à lord Pembleton, qu’une cruelle maladie, la goutte, clouait dans son fauteuil.
Miss Eveline et sir George Pembleton, frère cadet de lord Evandale, se donnaient le nom de frère et de sœur, et faisaient ensemble de longues promenades à cheval.
Cinq ans se passèrent.
Miss Eveline éprouvait un charme extrême à se trouver avec sir George, et sir George se surprenait à souhaiter que le navire que montait son frère aîné fût jeté à la côte, par une nuit de tempête, et se perdit corps et biens.
Un matin, les deux jeunes gens s’avouèrent qu’ils s’aimaient.
Alors miss Eveline épouvantée dit à sir George :
– Malheureux ! mais je suis la fiancée de votre frère.
– Hélas ! je le sais, répondit le jeune homme. Aussi ai-je pris une grande résolution.
Et comme elle le regardait avec angoisse :
– Alors même, poursuit-il, que mon frère consentirait à me céder son droit, nos deux familles ne consentiraient jamais à notre union. Je suis cadet, déshérité par conséquent des biens et des titres de ma maison.
Et il soupira.
Miss Eveline baissait la tête, et de grosses larmes roulaient dans ses yeux.
Sir George continua :
– Je partirai aujourd’hui même.
– Et où irez-vous ? demanda-t-elle toute tremblante.
– À Londres d’abord.
– Et puis ?
– Et puis j’irai rejoindre mon frère aux Indes.
Miss Eveline avait la pitié et la dignité des femmes de race ; elle courba la tête, tendit la main à sir George et lui dit :
– Adieu… adieu pour toujours…
Sir George avait alors dix-neuf ans, l’âge des dévouements chevaleresques.
Il partit.
Six mois après, lord Pembleton mourut, et son fils, sir Evandale, hérita de ses grands biens, de son titre et de son siège à la chambre haute.
Mais on ne revient pas des Indes en un jour, et il y avait près d’un an que sir George était parti, quand lord Evandale arriva.
Miss Eveline avait d’abord pris, au fond de son cœur, la résolution de se jeter aux genoux de lord Evandale, de lui tout avouer et de le supplier de renoncer à sa main.
Mais cette résolution tomba devant la volonté inflexible de lord Ascott.
Jour pour jour, un an après les funérailles du père de sir Evandale, miss Eveline devint lady Pembleton.
Le temps efface bien des douleurs, cicatrise bien des plaies.
Lady Pembleton songeait bien encore de temps à autre à sir George, le pauvre cadet, servant dans l’armée des Indes.
Mais lord Evandale était si bon pour elle, il lui témoignait tant de respect et d’amour !
Et puis lady Pembleton était devenue mère, et la maternité est un sentiment qui finit par dominer tous les autres.
À mesure que le temps s’écoulait, l’image de sir George s’effaçait.
L’absent commençait à avoir tort, et lord Evandale touchait à l’heure où sa femme lui rendrait amour pour amour.
Mais la fatalité devait en disposer autrement.
Tout en siégeant à la chambre haute, tout en devenant lord, le chef de la maison du Pembleton avait conservé son grade dans la marine royale.
Il avait fait rapidement son chemin, et il était commodore.
Un jour, il reçut de l’Amirauté l’ordre de reprendre la mer.
Où allait-il ?
Il ne le saurait qu’en ouvrant les instructions cachetées qu’on lui remit ; et ces instructions, il ne devait les ouvrir qu’en vue de l’île Madère.
Les femmes de marins sont faites, dès l’enfance, à ces séparations cruelles, dont la durée est toujours incertaine.
Lady Evandale se résigna, et le commodore partit.
On était alors en plein été, et la saison, comme disent les Anglais, était dans toute sa splendeur.
Naturellement, lady Pembleton avait quitté son magnifique château des monts Cheviot, pour venir habiter son hôtel du West-end, à Londres, dans Kensington-Road.
Kensington-Road est une large avenue, parallèle à Hyde-Park, et que bordent les demeures seigneuriales des grandes familles de Londres.
Chacune de ces demeures a un jardin, qui n’est séparé de Hyde-Park que par une grille, et chaque propriétaire a une clef qui ouvre cette grille et lui donne accès sur le jardin public.
Lady Pembleton était donc à Londres.
Mais, son mari parti, on ne l’avait plus vue nulle part.
Elle vivait enfermée, s’occupant de son fils, qui avait alors près de deux ans, lisant avec avidité les journaux qui pouvaient lui donner des nouvelles du Minotaure.
C’était le navire que montait lord Evandale.
Elle vivait seule, soupirant après le retour de l’absent.
Mais la solitude est mauvaise conseillère.
Plus d’une fois lady Pembleton s’était surprise à songer à sir George que, naguère, elle avait à peu près oublié.
Or, un soir, lady Eveline était assise auprès d’une fenêtre au rez-de-chaussée de son hôtel.
C’était un dimanche.
Le dimanche est un triste jour à Londres.
La journée avait été brûlante ; la soirée était fraîche, et la pauvre femme respirait avec une joie mélancolique le parfum des premières brises.
Il faisait nuit, le jardin était désert.
Au delà du jardin, on apercevait Hyde-Park, et le jardin public était désert aussi.
Tout à coup lady Eveline vit une ombre s’agiter dans l’éloignement.
C’était un homme qui s’était dressé au bord de la petite rivière qu’on nomme la Serpentine, et qui marchait droit à la grille du jardin de l’hôtel Pembleton.
Lady Eveline regarda curieusement cet homme.
Mais la nuit était obscure.
Quel ne fut pas son étonnement et ensuite sa frayeur quand elle vit cet homme sortir une clef de sa poche et ouvrir la grille !
Elle jeta un cri quand cet homme entra dans le jardin.
Mais ce cri ne mit point en fuite le visiteur nocturne.
Il marcha droit à la fenêtre.
Alors lady Eveline se rejeta vivement en arrière et courut saisir un cordon de sonnette qu’elle secoua violemment.
Au bruit personne ne vint.
L’homme enjamba la fenêtre et sauta dans la chambre.
Folle d’épouvante, lady Eveline s’élança vers la porte ; mais, en ce moment, une main vigoureuse la saisit et une voix qui la bouleversa lui dit :
– Eveline, ne me reconnaissez-vous donc point ?
Elle se retourna, folle, hébétée, stupide.
– Sir George ! murmura-t-elle.
– Oui, c’est moi.
Et le frère puîné de lord Evandale se jeta aux genoux de la jeune femme paralysée par la terreur.
XVIII
Journal d’un fou de Bedlam
III
C’était bien, en effet, sir George Pembleton, le frère de son mari, que lady Eveline avait devant elle.
Et cet homme avait osé pénétrer chez elle par la fenêtre, comme un voleur ou un assassin !
– Monsieur, dit-elle avec effroi, comment êtes-vous ici ?
Il se jeta à ses genoux :
– Eveline, dit-il, chère Eveline, ne me condamnez point sans m’avoir entendu.
Sa voix émue, son attitude suppliante rassurèrent un peu lady Eveline.
– George, dit-elle, d’où venez-vous ?
– Je reviens des Indes en droite ligne, dit-il.
– Vous avez donc quitté le service ?
– Non, j’ai obtenu un congé. Et c’est pour vous que je reviens.
– Pour moi !
Et elle le regarda, et son épouvante la reprit :
– George, dit-elle encore, osez-vous donc me tenir un pareil langage ?
– Eveline, je vous aime…
– Taisez-vous !
– Eveline, depuis trois ans, ma vie est un combat de chaque heure, de chaque minute, un supplice sans nom, une torture éternelle !
– Mais, malheureux ! oubliez-vous donc que je suis la femme de votre frère ?
– Mon frère est loin d’ici.
Elle jeta un cri de terreur.
– Oh ! vous le savez ? fit-elle.
– Nos deux navires se sont croisés en vue des côtes du Finistère.
– Et vous osez… ?
– Et je viens pour vous… rien que pour vous…
Lady Eveline attachait sur cet homme un œil affolé.
Certes, ce n’était plus le loyal et timide adolescent qui jadis avait dit à la jeune miss Eveline un adieu qu’il croyait éternel.
Sir George était maintenant un homme, et un homme au regard sombre et résolu ; un homme qu’on devinait capable de tout.
Lady Eveline, malgré son épouvante, ne désespérait pas cependant de fléchir cet homme et de le rappeler au sentiment du devoir.
– George, dit-elle, vous êtes le frère d’Evandale et je suis sa femme.
– Je hais Evandale, répondit-il.
– Mais vous m’aimez encore, dites-vous ?
– Toutes les flammes de l’enfer sont allumées dans mon cœur, répondit-il avec exaltation.
– Eh bien ! puisque vous m’aimez, respectez-moi, sortez d’ici et ne revenez que demain, en plein jour, par la grande porte de cet hôtel qui est la demeure de votre frère.
Il eut un rire sauvage.
– Non, non, dit-il. Ce n’est point pour me faire chasser par vos laquais que je suis venu.
Lady Eveline sentait la rougeur et la honte monter à son front.
Et comme il lui avait pris les mains, elle se dégagea et courut à l’autre bout de la chambre en criant :
– Sortez ! sortez, je le veux !
Il lui répondit par un éclat de rire.
– Sortez ! répéta-t-elle.
– Non, je vous aime !
– Sortez, ou j’appelle mes gens !
Il continuait à rire, et il fit un pas vers elle.
Alors elle s’élança de nouveau vers le gland de sonnette qui pendait au long de la glace de la cheminée, et elle le secoua avec fureur.
Mais la sonnette ne résonna point.
– Vous pouvez sonner tant que vous voudrez, dit-il. Le cordon est coupé.
Elle jeta un nouveau cri.
– À moi ! à moi ! dit-elle.
George fit un pas encore.
– Au secours ! s’écria lady Eveline.
– Vos gens sont sortis. Nous sommes seuls dans l’hôtel, dit-il.
Elle se précipita vers la porte et essaya de l’ouvrir.
– La porte est fermée, dit tranquillement sir George.
Enfin, elle songea à sauter par la fenêtre dans le jardin.
Mais il se plaça devant elle.
– Vous ne sortirez pas ! dit-il.
Et comme elle jetait un suprême cri d’épouvante et d’horreur, et qu’en joignant et tordant ses mains elle demandait grâce, il la prit dans ses bras et lui mit sur les lèvres un baiser brûlant.
Lord Evandale était en Océanie.
Le Minotaure faisait route pour Melbourne, une des deux capitales de l’Australie.
Chaque fois que le navire faisait escale, le noble lord écrivait à sa femme des lettres pleines de tendresse.
Parfois même il songeait à donner sa démission et à revenir en Angleterre.
Mais le soldat ne déserte pas à la veille d’une bataille, et lord Evandale n’abandonna point son navire.
Le Minotaure passa deux années en Australie, donnant la chasse aux pirates.
Ce ne fut que trente et un mois après son départ, que le commodore fut rappelé à Londres.
Quand il revint, lady Eveline alla à sa rencontre ; elle tenait ses deux enfants par la main.
Le second était né après le départ de lord Evandale.
La jeune femme était pâle et triste ; elle semblait vieillie de six ans.
Que s’était-il passé durant la longue absence de lord Evandale ?
Il ne pouvait le deviner, il ne le sut jamais.
Lady Eveline vivait loin du monde et passait presque toute l’année à Pembleton.
Depuis la nuit fatale que nous avons racontée, on n’avait pas revu sir George.
Lord Evandale ne soupçonna même pas qu’il avait un moment quitté les Indes pour revenir en Europe.
Effrayé de la pâleur de sa femme et de l’état de dépérissement où elle se trouvait, lord Evandale avait consulté toutes les célébrités médicales de Londres.
Les médecins prétendaient qu’elle était en proie à une maladie de langueur, et ils conseillèrent un voyage en Italie.
Lady Eveline partit avec son mari.
Elle passa un mois à Naples et à Rome, et revint plus souffrante, plus découragée, plus désintéressée de la vie.
Deux êtres parvenaient seuls à lui arracher un sourire :
L’un était son frère de lait, Tom ;
L’autre, son fils aîné, celui qui succéderait un jour aux dignités et à l’immense fortune de lord Evandale.
Quant à son autre fils, elle ne pouvait le contempler sans que des larmes de honte emplissent ses yeux.
Comme ils revenaient d’Italie, l’intervention anglo-française en faveur de la Grèce insurgée fut déclarée.
Lord Evandale reçut l’ordre de rejoindre son navire, et, une fois encore, lady Eveline se trouva seule.
Un soir, elle se promenait dans Hyde-Park, tenant son fils aîné par la main.
La nuit approchait.
Suivie à distance par deux laquais à sa livrée, lady Eveline suivait sans défiance le bord de la Serpentine.
Tout à coup deux hommes du peuple, deux roughs, comme on dit à Londres, se dressèrent devant elle.
Lady Eveline se retourna vivement et appela ses deux laquais.
Mais ceux-ci avaient disparu.
En même temps, un des deux roughs se jeta sur elle, lui mit la main sur la bouche pour l’empêcher de crier.
L’autre s’empara de l’enfant et prit la fuite.
* *
*
Une heure après, on rapportait à son hôtel lady Eveline, qu’on avait trouvée évanouie sur le bord de la Serpentine.
Quant à son fils, il avait disparu.
XIX
Journal d’un fou de Bedlam
IV (Suite) et V.
Heureusement, auprès de lady Eveline, seule et affolée, il y avait un homme, et un homme de résolution.
C’était Tom.
Tom ne perdait point la tête.
Tom devina tout de suite pourquoi on avait volé l’enfant.
À Londres, on vole les enfants, comme on fait le mouchoir, comme on brise le carreau d’un bijoutier.
C’est même un commerce assez lucratif.
Telle mendiante qui a bien du mal à gagner sa vie, ferait des affaires d’or si elle avait un enfant dans ses bras quand elle implore la charité publique.
Et puis il y a les nourrisseuses d’enfants qui ont depuis longtemps fait disparaître au fond de la Tamise les pauvres petites créatures qu’on leur avait confiées.
Un beau jour, les parents de ces enfants d’amour viennent les réclamer.
Les enfants sont morts ; il faut bien les remplacer.
Et puis encore il y a les bohémiens, les saltimbanques, les comédiens ambulants qui cherchent des enfants et les volent avec une dextérité remarquable.
Mais Tom ne pensa ni aux mendiants, ni aux nourrisseuses, ni aux saltimbanques.
Et Tom se dit :
– Le voleur, c’est sir Arthur-George Pembleton, officier de la marine royale.
Il y avait longtemps que sir George n’avait paru à Londres, ostensiblement, du moins.
Lady Eveline ne l’avait point revu depuis la nuit fatale.
Mais Tom, un soir, avait vu rôder un homme dans Hyde-Park, et cet homme, bien qu’il fût vêtu comme un rough, Tom l’avait reconnu.
C’était sir George.
Tom se mit donc à la recherche de sir George, sûr que l’enfant était en son pouvoir.
Tom était Écossais, mais il avait passé son enfance à Londres, et il savait par cœur tous les mystères de la grande ville.
Aussi eut-il bien vite retrouvé sir George.
Celui-ci s’était caché dans une ruelle du Wapping, sur les confins de White-Chapelle, dans une maison haute et noire où ne logeaient que les gens du peuple.
Tom tomba chez lui comme la foudre, un matin, quand le gentleman était encore au lit.
Tom avait deux pistolets à la main.
Sir George était sans armes.
Tom lui mit un pistolet sur le front et lui dit :
– Si vous ne me rendez pas l’enfant, je vous tue !
Sir George feignit d’abord une grande surprise.
– De quel enfant parles-tu, misérable ? dit-il.
– Du fils aîné de lady Eveline.
Sir George protesta.
Il n’avait pas vu le fils de lady Eveline ; il ne savait ce que Tom voulait dire.
Mais Tom ajouta :
– Je vous donne cinq minutes. Si dans cinq minutes vous ne m’avez pas rendu l’enfant, vous êtes un homme mort.
Il y avait tant de froide résolution dans le regard de l’Écossais, que sir George eut peur.
Il avoua tout.
L’enfant volé avait été remis à des saltimbanques, qui devaient l’élever dans leur métier.
Tom trouverait ces saltimbanques dans Mail en Road, tout auprès de la Work-house.
Mais Tom dit à sir George :
– Je vous crois. Seulement, je veux que vous veniez avec moi.
Et je vous tue comme un chien, si vous cherchez à m’échapper.
Et il força sir George à s’habiller.
Sir George avait dit vrai.
Les saltimbanques étaient dans Mail en Road, et l’enfant se trouvait en leur possession.
Ce jour-là, sir George disparut encore, et plusieurs mois s’écoulèrent sans qu’on le revît.
Pourquoi sir George avait-il enlevé l’enfant de lady Eveline ?
Sir George était un misérable ; il haïssait son frère lord Pembleton, il haïssait lady Eveline qu’il avait tant aimée, mais il adorait cet enfant qui venait de naître, le second fils de lady Eveline, qui était l’enfant du crime, son fils à lui.
Or, en faisant disparaître le fils aîné, celui qui succéderait à lord Evandale dans ses biens et ses titres, n’était-ce pas assurer ces mêmes titres et ces mêmes biens au fils cadet, c’est-à-dire à son fils à lui, sir George ?
Dès lors, Tom veilla nuit et jour sur l’enfant.
Lady Eveline ne sortait plus seule. Tom était sans cesse auprès d’elle.
Puis arriva la nouvelle de la mort de lord Evandale Pembleton.
Alors, on le sait, lady Eveline se réfugia en toute hâte dans son château des monts Cheviot, elle s’y entoura d’une garnison nombreuse, et ne consentit à redescendre à New-Pembleton que lorsqu’elle apprit que sir Arthur-George Pembleton était de nouveau embarqué pour les Indes.
Tel était le secret épouvantable que lady Eveline avait confessé par écrit et mis ensuite sous les yeux de son père, lord Ascott.
Lord Ascott l’avait prise dans ses bras et lui avait dit :
– Ton frère te vengera !
En effet, trois mois après, sir James quitta l’Angleterre et retourna aux Indes.
Sir George était à Calcutta quand sir James y arriva.
Il dansait dans les salons du gouverneur et paraissait l’homme le plus gai du monde.
Sir. James vint à lui et le salua.
Sir James était le frère de lady Eveline, et sir George et lui avaient été liés pendant leur enfance.
Sir James n’était encore que midshipman, sir George était lieutenant de vaisseau.
Sir James lui dit :
– J’arrive de Londres et j’ai un message pour vous. Tout à l’heure, quand on dansera, veuillez me suivre sur la terrasse qui donne sur la mer.
– J’irai, répondit sir George.
Et il alla danser avec la fille d’un nabab qui était aussi belle que son père était riche.
Un quart d’heure plus tard, les deux jeunes gens se rencontraient de nouveau.
Cette fois, ils étaient sur une des terrasses du palais, et ils se trouvaient seuls.
Alors sir James regarda fixement sir George et lui dit :
– Je sais tout.
Sir George tressaillit.
– Que savez-vous ? fit-il.
– Vous avez trahi votre frère.
– Que vous importe ?
– Vous avez déshonoré ma sœur.
Sir George haussa les épaules.
– Et il me faut tout votre sang, ajouta sir James.
– Je suis à vos ordres, répondit tranquillement le frère de lord Evandale.
– Je l’espère bien, répondit sir James ; mais il faut songer que vous êtes mon supérieur, et que je ne puis me battre sans enfreindre les lois martiales.
– Oh ! qu’à cela ne tienne, répondit sir George, je me charge d’aplanir cette difficulté.
– Ah !
– L’amiral qui commande l’escadre d’évolution mouillée dans le port vous autorisera, sur ma demande, à vous battre avec moi.
– Pardon, dit sir James, vous oubliez que des liens de parenté ou tout au moins d’alliance nous unissent.
– Eh bien ?
– Et je ne veux pas que notre rencontre puisse laisser planer un soupçon sur ma sœur.
– Eh bien ! dit sir George, nous nous battrons sans témoins.
– J’allais vous le proposer.
– Ah ! très bien.
– J’allais faire mieux…
– Voyons !
– Il y a une forêt aux portes de la ville ?
– Oui.
– Une forêt peuplée de tigres ?
– Comme toutes les forêts de l’Inde.
– Nous nous y rendrons demain, chacun de notre côté, au coucher du soleil.
– Après ?
– Et les tigres feront disparaître le cadavre de celui qui aura succombé.
– Accepté, dit sir George.
* *
*
Le lendemain soir, en effet, sir James et sir George se rencontraient dans la forêt.
Que se passa-t-il entre eux ?
Nul ne le sait.
Mais sir James revint seul à Calcutta, comme les premières étoiles s’allumaient dans le ciel indien.
Et sir James adressa au vieux lord Ascott une dépêche ainsi conçue :
« Notre honneur est sauf. Elle est vengée ! »
Le lendemain, des chasseurs trouvèrent à la lisière de la forêt un lambeau de cadavre à demi dévoré par les tigres, et que recouvrait encore un lambeau d’uniforme.
Et le bruit se répandit que sir George Pembleton, victime de sa passion pour la chasse, avait eu une fin horrible.
Tom et lady Eveline étaient, ou du moins croyaient être tranquilles désormais.
XX
Journal d’un fou de Bedlam
VI
Franchissons maintenant un espace de cinq années.
Nous sommes en avril 1834.
Deux personnages causent à voix basse dans une des salles voûtées de Old-Pembleton.
Le vieux manoir a revu des jours de splendeur et des jours de deuil, depuis cinq années.
Une seconde fois, New-Plembleton, la moderne demeure, le castel du grand seigneur, s’est vu délaissé pour Old-Pembleton, le manoir des hauts barons féodaux.
Pourquoi ?
Écoutons la conversation de ces deux personnes qui causent au coin du feu, dans une des salles basses du château.
– Je vous répète, moi, Tom, que notre maîtresse a eu tort de revenir à Old-Pembleton.
– Je ne dis ni oui, ni non, moi, ma chère Betzy.
– Et pourquoi êtes-vous ainsi indécis, Tom, dans votre manière de voir ?
– Betzy, ma chère, aussi vrai que vous êtes ma femme depuis bientôt trois années, je vous répète que je ne sais encore si lady Eveline, notre noble et bonne maîtresse, a eu tort ou raison de quitter Londres d’abord, New-Pembleton ensuite, pour venir ici. Cependant, en homme judicieux que je suis, je pencherais volontiers à croire qu’elle a eu raison.
– Ah ! vraiment ?
– Tout bien réfléchi, oui, ma chère Betzy.
– Moi, dit Betzy-Justice, la jeune femme de Tom, car ils étaient jeunes tous deux à cette époque, j’incline volontiers à penser le contraire.
– Sur quoi basez-vous votre opinion, Betzy ?
– Sur ceci, que la santé de milady va s’altérant tous les jours.
– Et vous croyez ?…
– L’air âpre et vif de la montagne ne lui vaut rien.
– Ah !
– Elle est attaquée d’une maladie de poitrine, et le climat qui lui serait nécessaire est loin de ressembler a celui-ci.
– Betzy, ma chère, répondit Tom, il y a du vrai dans ce que vous dites là. Mais je tiens à mon opinion, moi aussi, car décidément j’ai une opinion, maintenant.
– En vérité, Tom ?
– Oui, certes.
– Expliquez-vous donc, alors, Tom.
– Lady Eveline, voici trois années, me fit appeler un matin et me dit : – Tom, il faut que je te consulte, car tu es de bon conseil.
– Parlez, Lina, lui répondis-je.
Car tu le sais, Betzy, ma chère, je suis le frère de lait de milady et j’ai gardé de notre enfance l’habitude de l’appeler par l’abréviation de son petit nom.
Milady reprit :
– Depuis un mois, je fais des rêves épouvantables.
– Vraiment ? lui dis-je.
– Ou plutôt je fais le même rêve.
– Ah !
– Mais il est effrayant.
J’attendais que milady s’expliquât et je gardais respectueusement le silence.
Elle reprit :
– Mon rêve a trois parties. Dans la première, je me trouve à New-Pembleton et je me promène dans le parc, en tenant mon fils aîné par la main.
– Sir William ? lui dis-je.
– Précisément.
– Mon cher Tom, interrompit Betzy, laissez-moi vous faire une question.
– Parlez, ma chère.
Le feu lord, que je n’ai point connu, se nommait Evandale, n’est-ce pas ?
– Oui.
– Et son père portait le même nom ?
– Comme vous le dites, Betzy.
– Je croyais donc que le nom d’Evandale, poursuivit Betzy, était comme héréditaire dans la famille…
– À peu près.
– Et se transmettait de fils aîné en fils aîné ?
– Cela a été longtemps la tradition.
– Alors, reprit Betzy, pourquoi monseigneur, comme nous appelons le jeune lord, se nomme-t-il William, tandis que c’est son frère cadet qui porte le nom d’Evandale ?
– Je vais vous l’expliquer, Betzy.
– Parlez, Tom, je vous écoute.
– Sir lord Evandale, avait un ami d’enfance qui devint son compagnon d’armes. Tous deux servaient à bord du même navire et avaient le même grade. Cet ami se nommait sir William Dickson.
– Fort bien.
– Et lord Evandale voulait qu’il fût le parrain de son fils.
– Ce qui fait que monseigneur s’appelle William ?
– Oui, mais on n’a pas voulu perdre, dans la famille, le nom d’Evandale.
– Et on l’a donné au second fils ?
– Comme vous le dites, Betzy.
– Ma curiosité est satisfaite, Tom. Vous pouvez continuer votre récit.
Tom poursuivit :
– Lady Eveline me dit donc : Dans la première partie de mon rêve je me promène dans le parc de New-Pembleton. Je tiens William par la main.
Tout à coup il me semble que William devient pâle et transparent comme une ombre ; et puis, soudain, son visage disparaît dans un épais brouillard.
Puis le brouillard se dissipe peu à peu… et alors, oh ! c’est affreux, Tom, mon fils, dont je n’ai point quitté la main, m’apparaît de nouveau.
Mais il a changé de figure.
Ce n’est plus William, c’est Evandale.
Et pourtant, c’était William qui était auprès de moi, et je n’ai cessé de serrer convulsivement sa main dans la mienne.
– Voilà qui est bizarre, Lina, lui dis-je. Heureusement ce n’est qu’un rêve.
– Attendez, Tom, poursuivit milady. Généralement, à la suite de cette métamorphose étrange, je m’éveille en sursaut et je pousse un cri.
Souvent je me lève, et, passant dans la chambre voisine, je vais contempler mon cher petit William qui dort paisiblement.
Alors, rassurée, je me recouche et ne tarde pas à me rendormir.
– Et vous rêvez de nouveau, Lina ?
– Oui, Tom. C’est la seconde partie de mon rêve qui commence.
– Je vous écoute, Lina.
– J’ai cessé d’appartenir au monde des vivants pour devenir portrait de famille.
Je suis peinte en pied et vêtue de deuil, je ne suis plus une femme, je suis une toile enfermée dans un cadre, mais une toile qui pense, voit et se souvient.
On m’a placée dans la salle des Ancêtres à Old-Pembleton.
En face de moi, est feu lord Evandale, mon noble époux.
Comme moi, il est devenu portrait de famille.
Mais, comme moi, il voit et pense, et nous causons tout bas durant la nuit.
Les fenêtres de la Salle des Ancêtres sont grand ouvertes, la lune inonde la campagne de ses rayons, et nous pouvons voir là-bas, dans la plaine, les murailles blanches de New-Pembleton et les arbres verts de son parc.
Un homme se promène au clair de lune.
Il donne le bras à une femme qui nous est inconnue ; plusieurs gentlemen les accompagnent.
Et les gentlemen appellent l’homme milord et la femme milady.
– Et cet homme est lord William ; sans doute ?
– Non, c’est Evandale.
– Sir Evandale devenu lord ?
– Oui.
– Mais alors…
– Alors, poursuivit milady, feu lord Evandale et moi, qui ne sommes plus que des portraits de famille, nous nous regardons tristement et des larmes véritables nous viennent dans nos yeux peints.
– Mais, pour que sir Evandale soit lord, il faut…
Je m’arrêtai, n’osant en dire davantage.
– Il faut que William soit mort, n’est-ce pas ? me dit-elle.
– Oui, Lina.
– Vous vous trompez, Tom.
– Est-ce possible ?
– William est vivant.
– Oh ! par exemple !
Milady essuya alors une larme et reprit :
– Tout à coup, la lune disparaît et les ténèbres envahissent la salle des Ancêtres.
J’entends feu lord Evandale qui sanglote.
Puis il se fait un grand bruit, comme un coup de tonnerre, puis un éclair qui brûle nos yeux.
C’est la troisième partie de mon rêve qui commence.
Et milady, en parlant ainsi, se mit à fondre en larmes.
– Écoute, Tom, écoute encore, me dit-elle…
Je la regardais muet et saisi d’un douloureux étonnement.
XXI
Journal d’un fou de Bedlam
VII
Milady poursuivit :
– Les cimes neigeuses des monts Cheviots, la plaine verte au milieu de laquelle se dresse New-Pembleton, – tout cela vient de disparaître.
Feu lord Evandale et moi nous nous sommes pourtant toujours dans nos cadres, accrochés aux murs enfumés de la salle des Ancêtres, mais nous avons la faculté de voir à distance.
Nous sommes en plein jour.
Le soleil de midi éclaire une savane aride, un paysage désolé.
Des hommes demi-nus, ruisselants de sueur, travaillent péniblement sous ce ciel ardent, demandant à la terre ingrate un produit qu’elle se refuse presque à leur donner.
Ces hommes sont des convicts, c’est-à-dire des condamnés.
Ils ont été transportés loin de l’Angleterre, sur le sol australien, pour y expier leurs crimes.
Et parmi eux, cependant, il est un innocent.
Un innocent qui lève parfois les yeux au ciel et semble le prendre à témoin de ses souffrances non méritées.
Et milady, essuyant une nouvelle larme, me dit :
– Et sais-tu quel est cet homme ?
– Non, milady.
– C’est mon fils.
– Lord William ?
– Oui.
– Oh ! Lina, m’écriai-je, votre imagination alarmée vous égare. Comment cela pourrait-il jamais arriver ?
– Je n’en sais rien.
– Oubliez-vous donc, milady, que nous n’avions qu’un seul homme à craindre, et que cet homme est mort ?
– Qui sait ?
– Vous savez bien que sir James, votre frère l’a tué ?
– Non, dit milady, les choses ne se sont point passées comme tu le crois.
– Que voulez-vous dire, Lina ?
– Que James, mon frère, et le misérable qui avait nom sir George, se sont battus, en effet, dans une forêt, aux environs de Calcutta.
– Et sir James a tué sir George ?
– Non. Sir James lui a cassé la cuisse d’un coup de pistolet.
– Oui ; mais sir George est tombé et n’a pu se relever.
– Soit. Mais sir James s’est éloigné, le laissant vivant.
– Oh ! milady, repris-je, vous savez bien qu’un homme qui a la cuisse cassée en pleine forêt indienne n’en sort plus. Les tigres se chargent de l’achever. Ne vous souvenez-vous pas, du reste, que toutes les gazettes ont annoncé alors que le corps de sir George avait été trouvé à demi dévoré ?
– Oui, dit encore milady, on a trouvé un cadavre défiguré, recouvert d’un lambeau d’uniforme ; mais était-ce bien sir George ?
– Lina, m’écriai-je, vous cédez à de folles terreurs ! Je vous jure que sir George est mort.
Elle secoua la tête et me dit :
– N’importe ! je veux quitter New-Pembleton.
– Et où voulez-vous aller ?
– Là-haut.
– Au vieux manoir ?
– Oui.
– Je n’ai pas insisté, Betzy, ma chère, acheva Tom. Ce que milady veut, je le veux ; et c’est pour cela que nous sommes ici.
Betzy soupira.
– Oui, dit-elle, nous sommes ici, et la santé de milady va s’affaiblissant tous les jours.
– Cela est vrai.
– Et les médecins disent qu’elle est atteinte d’une maladie mortelle.
– Qui sait ? fit Tom.
Betzy secoua la tête.
– Je suis allé voir John Pembrock, dit encore Tom.
– Qu’est-ce que cela ?
– John Pembrock est un Écossais qui habite Perth, où il jouit d’une grande réputation comme médecin.
– Et John Pembrock viendra visiter milady.
– Je l’attends d’une heure à l’autre.
– Ah !
– C’est un singulier homme que John Pembrock poursuivit Tom. Il est riche, ce qui est rare pour un Écossais, et il ne se dérange jamais pour de l’argent.
– Bon !
– Mais il vient soigner les malades dont ses confrères désespèrent, et il est rare qu’il ne les sauve pas.
Comme Tom disait cela, un bruit se fit entendre.
C’était la cloche qui se trouvait au dehors du pont-levis de Old-Pembleton que la main d’un visiteur agitait.
Car chaque soir on relevait le pont-levis, et le vieux manoir redevenait forteresse, comme aux temps féodaux.
Tom se leva précipitamment et sortit de la salle basse.
Sur le seuil, il rencontra Paddy.
Paddy était un vieux valet qui avait vu naître miss Eveline Ascott et ne l’avait jamais quittée.
– Tom, dit-il, il y a là porte deux hommes, un piéton et un cavalier.
– Que demandent-ils ?
– Ils veulent entrer.
– Ont-ils dit leurs noms ?
– Le cavalier dit qu’il vient de Perth.
– Et le piéton ne dit rien.
Tom traversa la grande salle, le vestibule, la cour, et arriva en courant jusqu’à la poterne du pont-levis.
Il faisait un froid vif et le ciel était pluvieux.
Avant de manœuvrer les chaînes du pont-levis, Tom ouvrit un guichet et regarda.
Le cavalier attendait avec calme de l’autre côté du fossé.
Tom reconnut John Pembrock.
– Ah ! dit-il, je vous attendais.
Puis, avisant le piéton :
– Et cet homme, dit-il, est-il avec vous ! Le connaissez-vous ?
– Cet homme, répondit John Pembrock, est un pauvre Indien qui m’a demandé l’aumône sur la route et à qui j’ai promis l’hospitalité.
Tom fronça le sourcil.
– Il n’y a pourtant pas beaucoup d’Indiens à Londres, dit-il, et je n’en ai jamais vu dans nos montagnes. Milady n’a pas coutume de recevoir les gens qu’elle ne connaît pas ; je vais lui donner une couronne, et il s’en ira coucher en bas, au village.
– Vous ne ferez pas cela, Tom, dit John Pembrock.
– Et pourquoi cela, monsieur ? demanda Tom.
– Parce que cet homme est las, qu’il a peine à se soutenir sur ses jambes, et qu’il paraît mourir d’inanition.
– Il se réconfortera au village. Ce n’est pas une couronne, c’est une guinée que je lui donnerai.
– Tom, dit John Pembrock, je vous supplie d’avoir de l’humanité.
– Monsieur, répondit Tom, j’ai fait un serment à milady.
– Lequel ?
– Je lui ai juré de ne laisser pénétrer dans Old-Pembleton que des gens que je connaîtrai.
– Ainsi, dit John Pembrock, vous refusez l’hospitalité à ce malheureux ?
– Je ne puis faire autrement.
Ce disant, Tom fouilla dans sa poche et lança à travers le guichet une pièce d’or qui vint tomber aux pieds du mendiant.
John Pembrock était une manière de géant, et rappelait par sa stature herculéenne ces montagnards écossais chantés par Walter Scott.
Il se pencha sur sa selle, enleva l’Indien dans ses bras, le posa devant lui et tourna bride subitement en disant :
– Vous êtes un méchant homme.
Et rebroussant chemin, il mit son cheval au galop, avant même que Tom, stupéfait, eût eu le temps de répondre.
Tom manœuvra les chaînes du pont-levis : le pont-levis s’abaissa.
Tom s’élança au dehors et se mit à courir sur les pas de John Pembrock, lui criant :
– Arrêtez ! arrêtez !
Mais John Pembrock ne répondit pas.
Les quatre sabots du cheval retentissaient sur la pente abrupte qui descendait au village.
Tom ne se découragea point.
Il descendit au village, il entra dans l’auberge.
L’Indien, un pauvre mendiant, était assis au coin du feu.
Mais John Pembrock avait disparu.
Il était parti en disant à l’hôtelier :
– Si Tom, l’intendant de lady Pembleton, vient ici et qu’il demande après moi, vous lui direz que je n’aime pas les gens qui manquent d’humanité, et que je ne me dérange jamais pour eux.
John Pembrock avait repris la route de Perth.
Tom remonta tristement à Old-Pembleton.
Quand il y arriva, un sinistre pressentiment lui serra le cœur.
Il monta à la chambre de milady.
Milady était étendue sur son lit et paraissait dormir.
Tom l’appela doucement d’abord, puis plus fort.
Milady ne s’éveilla point.
Alors il la toucha et jeta soudain un cri d’horreur.
Milady ne dormait point…
Milady était morte !
XXII
Journal d’un fou de Bedlam
VIII
Dix ans s’étaient écoulés.
Il y avait dix ans que lady Eveline était allée rejoindre son époux, lord Evandale Pembleton, dans un monde meilleur.
Deux jeunes gentlemen à cheval suivaient côte à côte, un matin, la grande avenue de vieux ormes de New-Pembleton.
C’étaient les deux orphelins.
Lord William Pembleton, cet enfant que sa mère et le fidèle Tom avaient gardé avec tant de sollicitude, était maintenant un beau jeune homme, de dix-neuf ans, grand, svelte, et cependant robuste.
Son frère, au contraire, bien qu’il eût à peine deux ans de moins, était frêle, délicat, de taille chétive.
Lord William avait un visage ouvert et franc, un œil limpide, une bouche sans cesse souriante.
Sir Evandale, son frère, avait le visage anguleux, les lèvres minces, le regard fuyant.
Le premier était un type de noblesse et de loyauté.
Le second avait quelque chose de bas, de rusé, d’envieux.
Tous d’eux, montant de superbes poneys d’Écosse, étaient vêtus de l’habit rouge des chasseurs de renards, et ils allaient rejoindre en forêt une troupe de joyeux compagnons.
Comme ils arrivaient au bas de l’avenue et allaient franchir la grille du parc qui s’ouvrait sur la grande route, un homme se dressa devant eux.
Cet homme était un mendiant.
Et ce mendiant avait le teint cuivré des Indiens.
C’était un Indien, en effet, un fils de la race cuivrée que les Anglais ont asservie.
Peut-être cet homme avait-il été roi dans son pays ; maintenant il mendiait.
C’était un vieillard.
De rares cheveux blancs s’échappaient de son bonnet de laine grise ; une longue barbe inculte tombait sur sa poitrine.
– Mes beaux seigneurs, dit-il en levant vers les deux gentlemen ses mains suppliantes, n’oubliez pas le pauvre Indien !
Lord William lui jeta une guinée.
– Va-t’en ! dit-il.
L’Indien ramassa la guinée et disparut derrière une broussaille.
– Milord, dit sir Evandale, vous avez de brutales façons de faire la charité.
– Ah ! vous trouvez, mon frère ? dit le jeune lord.
– Pourquoi chassez-vous ce mendiant ?
– Parce que cet homme est la cause de la mort de notre mère, répondit le jeune lord.
– Comment cela peut-il être, milord ?
– Tom ne vous a donc jamais conté cette histoire ?
– Jamais.
Lord William soupira :
– Eh bien ! fit-il, je vais vous la dire, moi.
Et comme ils étaient arrivés sur la grande route, ils mirent leurs chevaux côte à côte et prirent le galop.
– Mon cher Evandale, dit alors lord William, notre mère était très malade et les médecins désespéraient de la guérison.
Tom s’en alla voir un médecin écossais qui habitait la ville de Perth.
– John Pembrock, n’est-ce pas ?
– Précisément.
– Et John Pembrock ne fut pas plus heureux que les autres médecins sans doute ?
– John Pembrock se fit décrire la maladie par Tom.
– Bon ! Et John Pembrock ne vint pas ?
– Au contraire, il se présenta un soir au pont-levis de Old-Pembleton. Mais il n’était pas seul.
– Ah !
– Un homme l’accompagnait, et cet homme c’était ce mendiant que nous venons de voir.
Or, mon ami, poursuivit lord William, il faut vous dire que notre mère, depuis longues années, était poursuivie par de mystérieuses et inexplicables terreurs. Tom n’a jamais voulu s’expliquer franchement avec moi là-dessus.
Notre mère s’était donc réfugiée à Old-Pembleton, et chaque soir on hissait le pont-levis, et on ne laissait plus entrer personne.
Tom refusa donc d’ouvrir au mendiant. Il ne voulait laisser pénétrer dans le château que John Pembrock, le médecin qui avait promis de guérir notre mère.
Mais John Pembrock était un excentrique.
Voyant que Tom ne voulait pas laisser entrer le mendiant, il refusa lui-même de pénétrer dans le château.
– Vraiment ?
– Et il s’en alla. Le lendemain, notre pauvre mère était morte.
– Eh bien ! dit sir Evandale, ce John Pembrock était un misérable ; mais le pauvre diable n’est, après tout, que la cause bien innocente…
– Soit, dit lord William, mais sa vue me serre toujours le cœur.
– Vous le rencontrez donc souvent ?
– Très souvent. Il est sans cesse par les chemins.
– Et comment se fait-il que cet homme, né à quatre mille lieues d’ici, se soit établi dans nos montagnes ?
– Voilà ce que je ne saurais vous dire.
– Tom doit le savoir.
– Pas plus que moi, pas plus que les gens de la contrée.
Ce mendiant, qu’on nomme Nizam, passe ses nuits dans les bois, ses journées aux portes du village ou des châteaux.
On ne lui connaît aucun métier.
– D’ailleurs, observa sir Evandale, il est bien vieux.
– Il est vieux, mais il est robuste encore et pourrait certainement exercer une profession quelconque.
– J’ai fait une singulière remarque tout à l’heure, milord, dit sir Evandale.
– Laquelle, mon frère ?
– Vous lui avez jeté une guinée ?
– Oui.
– Il n’est certes pas habitué à pareille aubaine ?
– Assurément non, et il ne récolte d’ordinaire qu’un demi-penny chaque fois qu’il tend la main. Eh bien ! qu’avez-vous remarqué ?
– Il vous a lancé un regard de haine en s’en allant.
– Oh ! il est méchant.
– Tandis qu’il m’a regardé tout autrement, moi, poursuivit sir Evandale.
– En vérité !
– Il m’a regardé affectueusement.
– Bah !
– Et comme avec émotion.
– Eh bien ! dit lord William en riant, c’est que vous avez le don de lui plaire, tandis que je lui déplais, moi.
Sir Evandale eut un mauvais sourire sous ses lèvres minces.
– Après cela, dit-il, vous avez des compensations, milord.
– Lesquelles ?
– Si le mendiant a une préférence pour moi, il est d’autres personnes qui passeraient leur vie à genoux devant vous, et qui ne peuvent dissimuler l’aversion qu’ils éprouvent contre moi.
Lord William haussa les épaules :
– Je parie, dit-il, que vous voulez parler de ce pauvre Tom ?
– De Tom et de sa femme Betzy.
– Vous croyez qu’ils ne vous aiment pas ?
– Assurément.
– Quelle idée bizarre !
– Je le leur rends bien, du reste.
– Mon frère !
– Et, poursuivit sir Evandale, si au lieu d’être un pauvre cadet, j’étais comme vous lord Pembleton, seigneur des monts et de la plaine, du vieux manoir et du jeune château, si je devais m’asseoir dans un an à la chambre haute…
– Eh bien ! que feriez-vous ? demanda lord William.
– Je chasserais de ma présence Tom et sa femme.
– Et vous auriez tort, dit sévèrement lord William.
Sir Evandale ne répondit pas.
– Tom est le frère de lait de notre mère, dit encore lord William. Ne l’oubliez pas, Evandale.
Et, dès lors, les deux frères galopèrent sans échanger un mot de plus.
Bientôt ils entrèrent dans la forêt.
Et, comme ils suivaient une des allées qui la perçaient d’outre en outre, ils aperçurent, à deux ou trois cents pas devant eux, une troupe de cavaliers également vêtus de rouge, et, parmi eux, la robe blanche d’une amazone.
Et le cœur de lord William se prit à battre d’émotion à cette vue, tandis que sir Evandale lui jetait, à la dérobée, un regard plein de haine et d’envie.
– Voilà miss Anna ! dit lord William.
Et il poussa son cheval, qui reprit le galop.
XXIII
Journal d’un fou de Bedlam
IX
Miss Anna chevauchait au milieu d’une troupe de cavaliers empressés.
Toute la fine fleur du comté était là, et chacun soupirait en regardant miss Anna.
Miss Anna était fort belle. Elle avait dix-huit ans, et, chose très rare pour une Anglaise, elle était fort riche.
Celui qui l’épouserait aurait non seulement une créature céleste, mais encore une des plus opulentes héritières du Royaume-Uni.
Elle était la fille de sir Archibald Carton, baronnet et membre de la Chambre des communes.
Sir Archibald, cadet de famille, s’en était allé aux Indes dans sa jeunesse et n’avait pas craint de faire du commerce, bien qu’il appartînt à l’aristocratie.
Il avait fait une fortune immense, avait épousé la fille d’un nabab, et n’avait eu qu’un enfant de cette union, miss Anna.
Le château de sir Archibald, situé dans la plaine, était distant de trois mille anglais de celui de lord William.
Lord William et sir Archibald se visitèrent.
Lord William était amoureux de miss Anna.
Miss Anna rougissait en regardant sir William.
Un jour, il y avait six mois, lord William s’en était allé trouver sir Archibald et lui avait dit :
– J’aime miss Anna et je sollicite l’honneur de devenir son époux.
À quoi sir Archibald avait répondu :
– Je crois m’être aperçu que ma fille vous aime, elle aussi ; et pour mon compte, je me trouve très honoré de votre demande.
Lord William avait eu un cri de joie.
Mais, se prenant à sourire, sir Archibald avait ajouté :
– Ne vous réjouissez pas si vite, milord ; les choses iront plus lentement que vous ne le supposez.
Lord William avait regardé sir Archibald avec étonnement.
Celui-ci poursuivit :
– J’ai épousé une Indienne ; et ma femme, que j’ai eu la douleur de perdre il y a longtemps déjà, était la fille du nabab Moussamy, le plus riche nabab du Punjaub.
– Eh bien ! fit lord William.
– Ma fille est son héritière.
– Bon !
– Et, à ce titre, je ne la puis marier sans le consentement du nabab.
Lord William fronçait le sourcil.
– Mais, avait dit encore sir Archibald, rassurez-vous. Le vieux nabab adore sa petite-fille.
– Ah !
– Et ce que miss Anna veut, il le veut. Or donc, si miss Anna…
À son tour, lord William s’était pris à rougir comme une jeune fille.
Lord William savait que miss Anna l’aimait.
L’entretien du noble lord et du baronnet, et celui qui avait eu lieu entre le père et la fille, avaient été tenus secrets.
On avait même écrit en grand mystère au nabab.
Quelques gentlemen des environs continuaient donc à faire de doux rêves à l’endroit de miss Anna.
Miss Anna, du reste, était de toutes les fêtes.
Intrépide écuyère, elle suivait les chasses de renards, sautant les haies et les fossés.
Sir Archibald était lui-même chasseur passionné ; et, deux fois par semaine, il conviait ses voisins à assister aux prouesses de son magnifique équipage.
C’était donc un rendez-vous de chasse ordinaire, auquel allèrent, ce matin-là, lord William et son frère sir Evandale. Quand le premier eut aperçu miss Anna galopant au milieu de son escorte de gentlemen, il pressa son cheval.
Sir Evandale, demeuré un pas en arrière, lui jeta un regard plein de haine.
La jeune miss était rayonnante.
Quand elle vit lord William, elle rougit.
Puis, lui tendant la main :
– Milord, dit-elle, je crois que mon père à de bonnes nouvelles à vous donner.
Lord William rougit.
Et comme on le regardait avec une curiosité envieuse sir Archibald s’avança vers lui :
– Milord, lui dit-il à son tour, la réponse que nous attendions des Indes est arrivée.
De rouge qu’il était, lord William devint subitement pâle.
Sir Archibald poursuivit :
– Le nabab Moussamy consent au mariage de miss Anna.
Et sir Archibald, regardant les gentlemen qui l’entouraient, ajouta :
– Messieurs, j’ai l’honneur de vous annoncer le prochain mariage de miss Anna, ma fille, avec lord William Pembleton.
Beaucoup de ceux qui entendirent ces paroles se mordirent les lèvres.
Il y eut en ce moment bien des soupirs secrets, bien des colères étouffées.
Mais celui qui pâlit le plus, celui qui souffrit le plus cruellement, ce fut sir Evandale.
Cependant son visage demeura calme et la vive émotion intérieure qu’il éprouva ne se manifesta au dehors que par un léger frémissement des lèvres et des narines.
Tout à coup, sir Archibald, s’adressant directement à lui :
– Sir Evandale, dit-il, j’ai pareillement une bonne nouvelle à vous donner.
– À moi ? dit sir Evandale en tressaillant.
– À vous.
– Oh ! par exemple !
– N’avez-vous pas demandé du service dans l’armée des Indes ?
– En effet, dit Evandale.
– Eh bien ! votre nomination de capitaine de cipayes m’est parvenue ce matin.
– Et vous pouvez remercier sir Archibald, mon frère, dit lord William.
– Ah ! fit sir Evandale.
– Car sir Archibald, poursuivit lord William, vous a chaudement appuyé et fait appuyer à Londres.
Et comme lord William prenait pour de la joie l’émotion de son frère, il ajouta :
– Mais vous ne partirez pas tout de suite, n’est-ce pas ?
– Vous êtes le chef de notre maison, répondit ironiquement sir Evandale, c’est à vous d’ordonner, à moi d’obéir.
– Eh bien ! fit lord William en souriant, je vous ordonne de rester quelques jours encore auprès de moi et d’assister à mon mariage.
– Vous serez obéi, murmura sir Evandale avec un accent farouche.
– Allons, voilà qui est bien, dit sir Archibald, et maintenant, en chasse, messieurs !
* *
*
Le renard était sur pied, les chiens hurlaient, les chevaux galopaient et le son du cor retentissait par la plaine.
Cependant un gentleman n’avait point suivi la chasse.
Il s’était arrêté au bord d’un petit bois, puis, attachant, son cheval à un arbre, il s’était assis sur l’herbe.
Ce gentleman versait des larmes de rage :
– Fatalité ! disait-il, injustice du sort ! comme lui je suis le fils de mon père et de ma mère ; le même sang coule dans nos veines ; et cependant à lui la fortune, le rang, les dignités, à lui miss Anna !
Quant à moi, une épaulette dans l’armée des Indes, c’est tout ce qu’il me faut.
Dérision !
Oh ! cet homme qui est mon frère, je le hais, je le hais !
Sir Evandale prononça ces derniers mots tout haut.
Il se croyait seul.
Cependant le feuillage d’un arbre s’entr’ouvrit et une tête bronzée apparut à sir Evandale.
– L’Indien ! murmura celui-ci.
– Oui, l’Indien, dit une voix ironique et sourde, l’Indien qui est ton ami et qui vient t’offrir ses services, comme toi, il hait lord William d’une haine féroce et mortelle.
XXIV
Journal d’un fou de Bedlam
X
Sir Evandale regardait l’Indien avec un étonnement qui n’était pas absolument dépourvu d’effroi.
L’Indien était vieux, si l’on s’en rapportait à ses cheveux blancs.
Cependant les traits de son visage étaient jeunes encore, et, chose étrange, sans la couleur bronzée de son visage, on eût juré un Européen, tant ses traits avaient de finesse et s’éloignaient du type de la race rouge.
Il n’était pas beau à voir, du reste, car si les signes du visage étaient corrects, ce même visage n’en était pas moins couturé par différentes cicatrices, d’aspect bizarre.
Quand l’Indien s’en allait par les chemins en demandant la charité, il relevait parfois les manches de son vêtement et entr’ouvrait sa chemise.
Et soit qu’on vit apparaître les bras ou la poitrine, on éprouvait un sentiment d’horreur.
Le corps de cet homme était couvert de blessures horribles, cicatrisées, il est vrai, mais cependant toujours hideuses, car la peau qui les recouvrait était demeurée transparente comme de la pelure d’oignon.
Quelquefois, l’Indien, qu’on appelait Nizam, pour attendrir les passants, leur racontait son histoire.
Il avait été surpris par une tigresse dans une pagode au moment où il faisait dévotement sa prière, emporté par elle dans les jungles, et livré en pâture à ses petits.
Comment avait-il échappé à cette bande de tigres ?
Nizam racontait alors une étrange histoire.
Au moment où les jeunes tigres le déchiraient de leurs griffes et, sous les yeux de leur mère, jouaient avec son corps pantelant, mais encore plein de vie ; tandis que, résigné comme tous les gens de sa race, il attendait la mort épouvantable qui lui était réservée, un bruit semblable au roulement du tonnerre s’était fait entendre.
Les tigres, abandonnant leur proie, s’étaient consultés du regard.
La mère avait paru inquiète.
Le bruit continuait. La terre tremblait, comme si une armée de géants eût été en marche.
Alors la tigresse fit entendre un cri rauque, donnant ainsi le signal du départ.
Et elle prit la fuite avec ses petits, abandonnant le malheureux Indien encore vivant.
Mais Nizam n’était point sauvé pour cela.
Ce bruit formidable, qui grandissait sans cesse comme un roulement de tonnerre qui s’approche, il l’avait reconnu.
C’était une troupe d’éléphants qui traversaient les jungles.
Et Nizam se dit :
– Les tigres m’ont fait grâce, mais les éléphants passeront sur moi sans me voir et m’écraseront sous leurs pieds.
Nizam se trompait ; il calomniait les éléphants.
Ceux-ci voyageaient au nombre de plus de deux cents. D’où venaient-ils ? où allaient-ils ?
Il présuma que c’était une émigration et non une marche guerrière, car les éléphants emmenaient leurs femelles et leurs petits, et au milieu d’eux de vieux éléphants qui avaient les oreilles toutes blanches.
Un chef marchait en tête, à plus de cent pas en avant de la colonne.
C’était un éléphant blanc.
L’éléphant sacré pour les Indiens.
Nizam l’aperçut.
Et comme Nizam était un serviteur pieux du dieu Wichnou, il pensa que le dieu Wichnou envoyait l’animal sacré à son aide.
Et Nizam ne se trompait pas.
Quand il fut auprès de lui, l’éléphant s’arrêta, abaissa sa trompe, l’enroula autour du corps de l’Indien et la posa doucement sur son cou.
Puis il continua sa marche, toujours suivi de la redoutable armée.
Les éléphants sortirent des jungles et arrivèrent dans une vaste plaine cultivée, au milieu de laquelle était un village indien.
Alors l’éléphant blanc déposa Nizam au bord d’un champ de riz et sembla lui dire, en le regardant de cet œil humain qu’ont ceux de sa race :
– Ici, tu es sous la protection des hommes, tes frères, et tu n’as plus rien à craindre des tigres.
C’était ainsi que Nizam avait été sauvé. Ses blessures s’étaient cicatrisées une à une ; mais la peau n’était pas revenue, et avait été remplacée par une membrane visqueuse qui permettait de voir les muscles et les veines des membres.
Pourquoi Nizam avait-il quitté l’Inde ?
Pourquoi, venu à Londres, avait-il abandonné cette ville pour venir vivre en mendiant dans le comté de Northumberland ?
Il ne le disait pas.
Et tel était l’homme qui apparaissait tout à coup à sir Evandale, pris d’un sombre accès de haine et d’envie.
Nizam se laissa glisser au bas de l’arbre dans lequel il s’était blotti, et il vint s’asseoir auprès de sir Evandale.
Celui-ci, nous l’avons dit, le regardait avec un étonnement mêlé d’effroi.
L’Indien devina ce sentiment et dit au jeune homme :
– Ne craignez rien de moi. Je vous suis plus attaché que la liane ne l’est au tronc d’arbre autour duquel elle s’enroule.
Et comme sir Evandale le regardait toujours :
– Je vous aime comme un chien, comme un esclave, poursuivit l’Indien ému, et tout mon sang vous appartient.
– Vraiment ? dit sir Evandale.
– Je vous aime, poursuivit l’Indien, et je voudrais vous faire lord.
– Oh ! oh !
– C’est comme je vous le dis.
Sir Evandale soupira.
– Malheureusement, dit-il, cela est impossible.
– Il n’y a rien d’impossible, dit sentencieusement l’Indien.
– Mais… mon pauvre ami…
– Sir Evandale, reprit l’indien avec gravité, êtes-vous pressé de rejoindre la chasse ?
– Non.
– Vous plait-il de m’écouter ?
– Parle, si tel est ton bon plaisir.
– Sir Evandale, vous aimez miss Anna.
Le jeune homme tressaillit.
– Qu’en sais-tu ? fit-il.
– Sir Evandale, poursuivit Nizam, quand vous levez les yeux, vous apercevez sur la montagne les tours massives de Pembleton le Vieux.
– Après ?
– Quand vous les abaissez vers la plaine, vous contemplez les tourelles de New-Pembleton.
– Et puis ?
– Et puis votre regard embrasse les dix lieues carrées de prairies, de champs cultivés et de bois qui entourent les deux manoirs, et vous soupirez…
Sir Evandale soupira en effet.
– Et alors, reprit l’Indien, vous vous dites : Si j’étais né le premier, tout cela serait à moi.
– Il est vrai, murmura sir Evandale d’un air sombre.
– Et quand on vous donne le simple titre de gentleman, vous entendez appeler votre frère milord…
– Eh bien ! que veux-tu que j’y fasse ?
– Il faut être lord à votre tour.
– Mais…
– Et si je le veux, vous le serez.
– Toi !
Et sir Evandale regarda ce mendiant avec un air de doute ironique.
– Ne riez pas, dit Nizam.
Sir Evandale le regardait toujours.
Alors Nizam redressa sa grande taille voûtée, et son œil ardent eut une flamme qui brûla les yeux de sir Evandale.
– Dans le pays où nous sommes, je tends la main aux passants, dit-il, et on me considère comme un objet d’horreur et de pitié tout à la fois, mais si je voulais…
– Eh bien ! que ferais-tu ?
– Je ferais de vous lord Pembleton, dit froidement l’Indien.
– Ah ! dit sir Evandale frémissant.
– Écoutez-moi, poursuivit l’Indien.
Et il vint s’asseoir auprès du frère déshérité de lord William Pembleton, le haut et puissant seigneur.
XXV
Journal d’un fou de Bedlam
XI
Nizam s’était donc familièrement assis auprès de sir George Evandale, et il osa même lui prendre la main.
– Quel âge aviez-vous, lui dit-il, quand vous avez perdu votre mère ?
– J’avais sept ans, dit sir Evandale.
– Vous étiez donc trop jeune pour qu’on pût vous confier un secret.
Ce mot fit tressaillir sir Evandale.
Il regarda de nouveau l’Indien.
– Car j’ai un secret à vous confier, poursuivit celui-ci.
– Un secret ?
– Oui, un secret qui touche votre… naissance…
– Mais, dit sir Evandale avec un accent hautain, ma naissance n’a rien de mystérieux, que je sache ?
– Oui et non.
Et le mendiant attacha sur le jeune gentilhomme un regard qui devint tout à coup dominateur, et sous le froid duquel sir George se sentit humble et soumis en présence de ce vagabond.
– Dites-moi, poursuivit Nizam, avez-vous jamais entendu parler de votre oncle sir George-Arthur Pembleton ?
– Rarement, dit sir Evandale.
– Mais enfin, on vous en a parlé quelquefois ?
– Oui.
– Qui donc ?
– Les serviteurs de ma maison.
– Et votre mère ?
– Jamais.
– Ah ! dit Nizam, qui eut un rire infernal aux lèvres, elle ne parlait jamais de lui ?
– Je me souviens même, poursuivit sir Evandale, qu’un jour elle s’est presque évanouie parce qu’un domestique avait prononcé ce nom devant elle.
– Elle ne se fût pas évanouie autrefois, dit Nizam, d’une voix sourdement ironique.
Sir Evandale tressaillit de nouveau.
– Que veux-tu dire, mendiant ? fit-il.
Nizam souriait toujours.
– Ne m’écrasez pas de votre mépris, sir Evandale, dit-il. Je suis puissant, moi le mendiant, et, je vous l’ai dit, si vous m’écoutez, je vous ferai lord et je vous marierai à miss Anna, la riche héritière.
Un frisson d’orgueil parcourut les veines de sir Evandale :
– Continue ! dit-il.
Nizam poursuivit :
– Il doit y avoir un homme à New-Pembleton qui ne parle jamais non plus de sir George. C’est Tom.
– Tom ! exclama sir Evandale, oh ! je le hais !
– Et vous avez raison.
– Je le hais, parce qu’il n’aime que mon frère aîné, lord William, ajouta sir Evandale.
– Si vous saviez autre chose encore, votre haine se décuplerait, ajouta l’Indien.
– Quoi donc ?
– Oh ! je vous dirai cela plus tard. Mais ce n’est pas de Tom qu’il s’agit en ce moment.
– Et de qui donc ?
– De sir George.
– Eh bien, parle…
– Sir George, il y a vingt-deux ans, poursuivit Nizam, était comme vous un pauvre cadet. Tandis que son frère serait lord, épouserait mis Eveline Ascott, posséderait une immense fortune, il était destiné, lui, à servir obscurément dans la marine.
– Comme moi dans l’armée des Indes, soupira sir Evandale.
– Cependant sir George aimait mis Eveline.
Sir Evandale fit un brusque mouvement.
– Et miss Eveline l’aimait.
– Tu mens !
– Je n’ai jamais menti, dit froidement l’Indien.
Et de nouveau il courba sir Evandale sous un regard dominateur.
Et alors, le mendiant, avec une autorité de gestes et de langage qu’on n’eût pas soupçonné chez lui naguère, en le voyant tendre la main sur les grandes routes, le mendiant raconta à sir Evandale les amours mystérieuses de miss Eveline et de sir George, puis le retour de celui-ci, et enfin cette nuit terrible pendant laquelle lady Pembleton trahit, malgré elle, tous ses devoirs.
Sir Evandale l’écoutait la sueur au front.
Et quand l’Indien eut fini, il lui dit :
– Mais alors, sir George était… ?
– Votre père, dit froidement l’Indien.
– Mon père !
– Et il avait rêvé, lui aussi, de vous faire lord.
– Et sir George… est mort…, n’est-ce pas ?
– Pour tout le monde, oui.
– Que veux-tu dire ?
– Pour moi, non.
– Sir George n’est pas mort ?
– Il est vivant, vous dis-je.
– Vivant !
– Oui, et je vais vous le prouver.
Sur ces derniers mots, Nizam se leva.
– Attendez-moi ici, dit-il, je reviens dans quelques minutes.
Et il disparut à travers les arbres du bois.
Nizam courut à un ruisseau qui coulait sous la futaie ; il se pencha sur le bord à plat ventre, puis il trempa son visage dans l’eau à plusieurs reprises.
Et au bout de quelques minutes, il revint.
Sir Evandale jeta alors un cri d’étonnement.
La couleur cuivrée du visage de Nizam avait disparu.
Nizam était blanc comme un Européen, comme un Anglais.
Et comme sir Evandale le regardait avec stupeur, Nizam lui dit :
– Sir George, c’est moi !
– Vous, vous ! exclama le jeune gentilhomme.
– Moi, ton père ! dit le faux Indien.
Et il prit sir Evandale dans ses bras et le couvrit de baisers furieux.
* *
*
Cet homme que depuis dix ans, dans le pays, on appelait Nizam l’Indien, était bien en effet sir George-Arthur Pembleton.
C’était lui que sir James Ascott avait laissé, la cuisse brisée d’un coup de feu, au milieu d’une forêt de l’Inde peuplée de tigres.
Et dans l’histoire que Nizam racontait, il n’y avait de faux qu’une chose, son enlèvement par une tigresse dans la pagode de Wichnou.
Le reste était vrai.
C’est-à-dire qu’attirés par ses plaintes et l’odeur du sang, après que sir James avait été parti, une bande de tigres avaient fondu sur lui ; mais elle n’avait pas eu le temps de le dévorer.
La troupe d’éléphants avait mis les tigres en fuite.
Abandonné par l’éléphant blanc qui l’avait porté hors de la forêt, au bord d’un champ de riz, sir George y était demeuré plusieurs heures évanoui.
Revenu enfin à lui, il s’était, tout sanglant, traîné jusqu’à la case d’un vieil Indien.
Cet Indien était un brahmine.
Le brahmine vit un événement miraculeux dans le sauvetage accompli par l’éléphant blanc, et il n’hésita pas à déclarer à sir George que c’était Wichnou lui-même qui, par un de ces avatars qui lui étaient familiers, s’était incarné dans un éléphant blanc à la seule fin de l’arracher à la mort.
Et il eut d’autant moins de peine à persuader sir George, que celui-ci ne voulut plus reparaître à Calcutta, et s’arrangeait bien de la perspective de passer pour mort.
Un cipaye qui venait marauder dans le village la nuit avait été étranglé par les Indiens.
Son corps, déchiqueté par les oiseaux de proie, gisait dans un champ voisin.
Le brahmine l’affubla des effets de sir George et le porta au bord de la forêt.
Dès lors, pour toute l’armée anglaise, sir George fut un homme mort.
Et comme Nizam arrivait à cet endroit de son récit, sir Evandale l’interrompit :
– Mais, dit-il, quel intérêt aviez-vous donc à passer pour mort ?
Un sourire vint aux lèvres du faux Indien.
– Je vais te le dire, mon enfant, répondit-il.
Et, de nouveau, il embrassa sir Evandale.
XXVI
Journal d’un fou de Bedlam
XII
Le faux Indien poursuivit :
– Ma convalescence fut longue.
Je passai près de deux mois caché dans la case du brahmine, me guérissant lentement de mes horribles blessures.
Les tigres m’avaient défiguré.
Et j’aurais fort bien pu m’aller promener au milieu de l’armée anglaise que pas un de mes anciens amis ne m’aurait reconnu.
Mais tel n’était point mon projet.
Je n’avais plus qu’une préoccupation, une idée fixe.
Je voulais revenir en Angleterre.
Je voulais revoir, non lady Eveline, mais le fils de nos amours, l’enfant que j’idolâtrais… toi, enfin.
Le faux Indien parlait avec tant d’émotion que sir Evandale ne s’y pouvait tromper.
Nizam et sir George ne faisaient qu’un.
Et sir George était bien son père.
Le brahmine, à qui je confiai une partie de mon secret, m’apprit à donner à mon visage une teinte cuivrée, à l’aide d’une décoction de certaines plantes.
Je teignis mes sourcils en rouge ; je me fis sur les bras certains tatouages, et je finis par ressembler à certains Indiens qui ont du sang européen dans les veines et qui, sous leur peau rouge, ont conservé la finesse des traits des hommes blancs.
Ainsi métamorphosé, je vins à Calcutta.
Personne ne m’y reconnut.
Je savais la langue indienne. J’allai me loger dans un faubourg de la ville noire, qui est le quartier des indigènes, tandis que la ville blanche est celui des Européens.
J’étais sans argent, il fallait vivre d’abord, et ensuite amasser un petit pécule qui me permit de payer mon passage.
Mes horribles blessures devinrent un objet de curiosité.
Et mon histoire, habilement arrangée, fut le boniment qui présida à mon exhibition.
Au bout de six mois, j’avais assez d’argent pour revenir en Europe.
Je m’embarquai aussitôt, et, six mois après, j’arrivais à Londres, car j’avais fait le grand tour, au lieu de passer par la mer Rouge et Suez.
Pendant plusieurs mois, j’allai dans les parcs, dans les squares, aux environs de l’hôtel Pembleton.
Quelquefois j’étais assez heureux pour t’apercevoir, conduit à là promenade par un laquais.
Ici sir Evandale interrompit brusquement Nizam.
– Attendez donc ! fit-il.
– Quoi donc ? demanda Nizam.
– Un souvenir de mon enfance qui me revient.
– Parle, dit le faux Indien en souriant.
– Je pouvais avoir quatre ans, reprit sir Evandale, et on m’avait conduit, par un bel après-midi d’hiver, dans Hyde-Park, au bord de la Serpentine dont la surface était gelée.
Plusieurs enfants de mon âge s’amusaient à glisser sur cette glace, et je me rappelle qu’il y avait un homme de couleur rouge qui se tenait à distance et nous regardait.
– C’était moi, dit simplement Nizam.
– Oh ! oui, c’était vous, reprit sir Evandale, je vous reconnais à votre regard.
– C’était toi que je contemplais.
– Ah !
– Mais continue. Ne te rappelles-tu pas autre chose !
– Oh ! si fait. Tout à coup, la glace se rompit et un des enfants tomba dans la rivière en jetant un cri.
Aussitôt l’homme à la figure rouge sauta dans la rivière et ramena le petit garçon sain et sauf sur la berge aux applaudissements de la foule.
– Et puis ?
– Et puis cet homme disparut.
– Et tu ne l’as revu qu’ici ? dit Nizam.
– Sans le reconnaître, puisque votre histoire a seule évoqué ce souvenir de ma première enfance.
– Alors je continue, dit Nizam.
Et sir George devenu Nizam reprit en effet son récit.
– Lady Eveline, dit-il, quitta Londres de nouveau pour venir s’établir à Old-Pembleton.
Alors, dominé par le besoin, de la voir furtivement quelquefois, j’entrepris, moi aussi, ce long voyage.
Mes ressources étaient épuisées, et je tendais la main sur les chemins et dans les rues.
Mais on ne pénétrait pas dans Old-Pembleton.
Lady Eveline et ce maudit Tom en avait fait une véritable forteresse.
Je rôdai plusieurs jours inutilement alentour, et le désespoir s’emparait de moi, quand un soir, par une nuit froide, j’entendis le galop d’un cheval qui montait les rampes abruptes de Old-Pembleton.
Le cavalier passa auprès de moi.
Je tendis la main.
Il me donna une couronne et me dit :
– Tu as bien froid, n’est-ce pas ?
– J’ai froid et j’ai faim, répondis-je.
– Viens avec moi, et tu trouveras un bon souper auprès d’un bon feu.
– Où donc ? demandai-je.
– Là-haut.
Et il me montrait les tours de Old-Pembleton.
– Vous vous méprenez, lui dis-je.
– Comment cela ?
– Les portes de ce château ne s’ouvrent jamais.
Il se mit à rire.
– Viens avec moi, me dit-il. Aussi vrai que je me nomme John Pembrock, le médecin de la ville de Perth, elles s’ouvriront.
Je le suivis. Mais Tom ne voulut pas me laisser entrer.
Alors fou de colère, John Pembrock me prit sur son cheval, rebroussa chemin, et me dit en descendant au village :
– Ces gens-là ont manqué d’humanité. Tant pis pour eux !
En effet, le lendemain, j’appris que ta mère était morte.
– Et depuis lors, demanda sir Evandale, vous êtes toujours resté dans le pays ?
– Toujours.
– Mendiant ?
– Et me trouvant heureux et fier de ma pauvreté, chaque fois que je pouvais t’apercevoir.
– Ainsi donc, murmura sir Evandale, vous êtes sir George Pembleton ?
– Oui.
– Et vous êtes… mon père ?
– Oui, dit le faux Indien dont les yeux étaient humides.
– Eh bien ! mon père, dit sir Evandale, venez avec moi. Je vais aux Indes, vous y retournerez et nous y vivrons heureux, et j’entourerai de soins votre vieillesse.
Sir Evandale, à son tour, parlait avec émotion.
Nizam le reprit dans ses bras.
– Tu n’iras pas aux Indes ! dit-il.
– Où voulez-vous donc que j’aille ?
– Tu resteras ici.
– Pour voir le bonheur de ce frère que je hais ?
– Non, pour prendre sa place.
Sir Evandale jeta un cri.
Nizam poursuivit avec une sorte d’exaltation :
– Tu seras lord !
– Moi !
– Tu épouseras miss Anna !
– Mais alors, mon père, dit le jeune homme frémissant, il faut pour cela que lord William meure.
– Peut-être.
– Et lord William est plein de force, de jeunesse et de santé.
– Peuh ! dit Nizam, la vie humaine est si peu de chose !
Sir Evandale eut un geste d’effroi.
– Oh ! dit-il, songeriez-vous donc, mon père, à tuer lord William ?
– Que t’importe ?
– Non, non, dit vivement le jeune homme, je ne veux pas.
Nizam parut réfléchir.
Puis, regardant sir Evandale :
– Et bien ! dit-il, supposons une chose.
– Voyons ?
– Supposons que tout le monde croie lord William mort, et que cependant il soit vivant.
– Mais cela est impossible !
– Tout est possible à un homme comme moi, répondit Nizam.
– Et lord William passant pour mort serait vivant ?
– Oui.
– Et je serais lord ?
– Tu seras lord.
– Et j’épouserais miss Anna ?
– Tu épouseras miss Anna.
– Mais vous promettez que lord William ne mourra pas ?
– Je te le jure.
Nizam parlait d’une voix solennelle.
– Oh ! dit sir Evandale, il me semble que j’ai le vertige.
– Lord Pembleton, dit Nizam, je te salue !
Et l’Indien disparut dans les broussailles voisines, laissant sir Evandale seul et frappé de stupeur.
XXVII
Journal d’un fou de Bedlam
XIII
Sir Evandale ne revit plus Nizam de la journée.
Le soir, le jeune gentilhomme s’en revint tout pensif et tout triste à New-Pembleton.
Lord William venait d’arriver.
– Qu’êtes-vous donc devenu, mon frère ? lui demanda-t-il.
– J’ai perdu la chasse, répondit sir Evandale.
– Vraiment ?
– Et comme le temps était beau et que je suis un admirateur passionné de la nature, j’ai suivi pendant longtemps un chemin bordé de haies qui courait au milieu des prairies et je ne me suis pas aperçu que je m’éloignais considérablement du château.
– Enfin vous voilà, dit lord William joyeux. Ah ! j’ai beaucoup de choses à vous dire, mon frère.
– À moi ? fit sir Evandale en tressaillant.
– À vous.
– Ah ! dit le jeune homme.
Et il attendit.
– D’abord, reprit lord William, je vous dirai que je suis l’homme le plus heureux du monde.
– En vérité !
– Dans trois semaines, miss Anna sera devenu lady Pembleton.
– Je vous en fais mon compliment, murmura sir Evandale d’un air contraint.
– Ensuite, nous avons beaucoup parlé de vous, le père de miss Anna et moi.
– À quel propos ? demanda sir Evandale.
– Mon cher frère, reprit le jeune lord, j’ai horreur de la loi anglaise qui établit le droit d’aînesse.
– Ah ! dit sir Evandale.
Et il eut un sourire ironique.
Lors William poursuivit :
– Je suis l’aîné. À moi le titre, à moi les terres, les seigneuries, le siège au Parlement.
– À moi, rien, dit sir Evandale d’un ton résigné.
– Et cela m’indigne.
– Ah ! ah ! dit encore sir Evandale.
– Malheureusement, la loi ne me permettrait pas de renoncer à mes avantages et de partager avec vous.
– Je ne vous demande rien, milord, dit sèchement sir Evandale.
– Attendez donc, mon frère.
Et lord William sourit affectueusement.
Sir Evandale le regardait.
– Le père de miss Anna et moi nous avons eu une belle idée, mon frère.
– Ah !
– Vous savez que miss Anna est la petite-fille d’un rajah de l’Inde.
– En effet.
– Un rajah fabuleusement riche.
– Eh bien ?
– Et qui a un frère, rajah comme lui, et aussi riche que lui.
Sir Evandale regardait toujours sir William.
– Ce frère a une fille, poursuivit lord William, une fille unique qui aura une dot royale.
– Eh bien ?
– Et le père de miss Anna vous donnera des lettres de recommandation pour les deux rajahs.
– Bon !
– Et il ne tiendra qu’à vous, j’en suis sûr, d’épouser la belle Daï-Natha ?
– Ah ! elle se nomme Daï-Natha ?
– Oui, mon frère, et elle est fort belle, dit-on.
– Je vous remercie mille fois de songer ainsi à mon avenir, dit sir Evandale.
Il y avait dans sa voix une sourde ironie.
Mais lord William ne s’en aperçut pas.
Et quand il fut seul, sir Evandale murmura :
– Ce n’est pas la fille du rajah que je veux, c’est miss Anna ; ce n’est pas des champs de riz et des plantations d’indigo que j’ambitionne, je veux ces gras pâturages qui entourent New-Pembleton, et le siège que tu possèdes au Parlement, lord William !
Cependant deux jours s’écoulèrent.
Sir Evandale se promenait dans les environs, tantôt à pied, tantôt à cheval.
Il était retourné plusieurs fois à cette lisière du bois où Nizam lui avait raconté son histoire.
Il avait parcouru les chemins de traverse et les grandes routes.
Partout il s’attendait à voir le faux Indien se dresser inopinément devant lui.
Mais Nizam était invisible.
Le soir du troisième jour, comme sir Evandale revenait découragé à New-Pembleton, il aperçut Tom dans la cour du château.
Tom était en habit de voyage et il s’apprêtait à monter à cheval.
Lord William s’entretenait avec lui à voix basse.
– Où va Tom ? demanda sir Evandale en s’approchant.
– Tom va à Londres, répondit lord William.
– Pourquoi faire ?
– Pour toucher une somme importante que j’ai en dépôt chez un de mes banquiers.
– Ah ! dit sir Evandale.
Tom partit. Il devait aller à cheval jusqu’à la station prochaine, où il prendrait le train express d’Édimbourg à Londres.
Lord William passa alors son bras sous celui de sir Evandale et lui dit :
– La loi anglaise me force à demeurer détenteur de tous les biens meubles et immeubles de la famille ; mais je puis disposer du numéraire dans une certaine mesure.
Or, je viens de rentrer en possession de vingt mille livres sterling que je croyais perdues. Permettez-moi de vous les donner.
– Mon frère… balbutia sir Evandale.
– Prenez ! dit lord William.
Et il lui tendit un portefeuille gonflé de traites, de chèques et de bank-notes.
* *
*
La nuit était venue.
Comme on était au milieu de l’été, la journée avait été brûlante.
Aussi aspirait-on avec avidité un faible souffle de brise qui agitait les feuilles des arbres et rafraîchissait un peu l’atmosphère.
Sir Evandale était rentré dans sa chambre.
Il s’était même mis au lit.
Mais il ne dormait pas.
La fenêtre était demeurée ouverte.
Tout à coup, une ombre s’agita dans le feuillage d’un arbre qui avoisinait cette fenêtre.
Sir Evandale tressaillit et sauta lestement à bas de son lit.
Le feuillage s’entr’ouvrit.
Puis, agile comme un singe, un homme sauta sur l’entablement de la fenêtre.
Cet homme, c’était Nizam.
– Me voilà, dit-il.
– Ah ! dit sir Evandale, voici trois jours que je vous cherche.
– J’avais quitté le pays, répondit Nizam.
– Où étiez-vous donc allé ?
– À Londres.
– En vérité ?
– Et je suis revenu ce soir.
– Qu’êtes-vous donc allé faire à Londres ?
– Je suis allé chercher des amis dont j’ai besoin…
Sir Evandale tressaillit de nouveau.
– Ah !
– Dont j’ai besoin pour qu’ils m’aident à te faire lord.
– Je serai donc vraiment lord ?
Et la voix de sir Evandale tremblait d’émotion.
– Tu seras lord.
– Et… bientôt ?
– Avant un mois.
– Mais vous ne tuerez pas lord William, au moins ?
– Non.
– Vous me le jurez ?
– Je te le jure.
– C’est bien, dit sir Evandale en poussant un soupir.
Puis il reprit :
– Mais on le croira mort ?
– Oui.
– Que ferez-vous donc de lui ?
– Tu veux savoir trop de choses, dit Nizam. Plus tard… Plus tard !
Puis, tout à coup, regardant sir Evandale :
– N’as-tu pas un peu d’argent, quelques économies ? car il me faut de l’argent… il m’en faut !
– J’en ai, dit sir Evandale.
Il ouvrit un petit meuble et en tira le portefeuille que lui avait remis sir William :
– Tenez ! dit-il.
Nizam ouvrit le portefeuille et y prit deux bank-notes de cent livres.
– J’en ai assez pour le moment. S’il le faut, je t’en redemanderai, dit-il.
Et il fit un pas vers la croisée, puis se retournant :
– Tom est-il parti ?
– Oui, ce soir.
– Alors, dit Nizam, dont les yeux étincelèrent, le moment est venu. Nous pouvons agir.
Il enjamba la croisée, et se retournant encore :
– Tu seras lord, dit-il.
Et il disparut.
XXVIII
Journal d’un fou de Bedlam
XIV
La chaleur était accablante.
On était au milieu du jour, et le soleil dardait sur la terre embrasée ses rayons perpendiculaires.
La campagne était silencieuse.
Les oiseaux avaient cessé de chanter.
Les laboureurs avaient quitté leur charrue et les bestiaux étaient rentrés.
On eût pu se croire sous l’équateur.
Cependant une troupe d’hommes marchait.
Elle marchait péniblement sur une route poudreuse.
Ces hommes, enchaînés deux à deux, les pieds nus, la tête rasée, vêtus de haillons sordides, étaient des galériens.
Condamnés dans les différents comtés de l’Écosse, réunis ensuite à la prison d’Édimbourg, ils étaient enfin dirigés par étapes, sous la conduite de deux gardiens, vers le port de Liverpool, où on devait les embarquer pour l’Australie.
Ils marchaient lentement, ruisselant de sueur.
Les uns gémissaient.
Les autres blasphémaient.
Parfois il s’en trouvait un qui, accablé de fatigue, refusait d’avancer.
Alors l’un des deux gardiens levait son bâton et frappait.
Le malheureux poussait un cri de douleur et se remettait en route.
– Lieutenant Percy, dit un des gardiens à son camarade, lequel était évidemment son supérieur dans la triste armée de la chiourme, car il avait une broderie sur la manche de son uniforme, lieutenant Percy, est-ce que nous ne ferons pas bientôt une petite halte ?
– Si fait, répondit, le lieutenant. Vous êtes las, John ?
– J’ai les pieds enflés.
– Moi, je meurs de soif.
– Et dire qu’il n’y a pas une goutte d’eau dans ce maudit pays !
– C’est que, répondit le lieutenant Percy avec philosophie, la neige que vous voyez en haut des montagnes n’est pas encore fondue.
– Et il est probable qu’elle ne fondra jamais, répondit le gardien John.
– Ce qui fait, dit encore Percy, qu’il ne faut pas compter sur elle.
– C’est mon opinion. Mais on doit trouver bientôt un village, un bourg, une auberge…
– À deux lieues d’ici, il y a le bourg de Pembleton.
– Ah ! c’est long, deux lieues.
– Nous nous arrêterons auparavant, John.
– Où cela, lieutenant ?
– Voyez-vous un signe noir à l’horizon ?
– Oui. C’est une forêt.
– Une forêt au bord de laquelle coule une petite rivière.
– Bon. Et nous y ferons halte ?
– Sans doute. Nous nous y reposerons même jusqu’à ce soir.
– Au lieu de gagner le bourg de Pembleton ?
– Oui.
– Vous avez là une singulière fantaisie, lieutenant ?
– J’ai la fantaisie de gagner cent livres sterling et de vous en faire gagner cinquante, John.
Le garde-chiourme, stupéfait, regarda le lieutenant Percy.
– Est-ce que le soleil vous frappe sur la tête ? dit-il enfin.
– Pourquoi me demandez-vous cela ?
– Eh bien ! continua John, vous moquez-vous de moi, lieutenant ?
– Pas le moins du monde, John.
– Et comment gagnerez-vous cent livres !
– C’est mon secret.
– Ah !
– Et vous en aurez cinquante.
– Moi ?
– Oui, mon ami ; mais pour cela il faut faire ce que je vous dirai.
– Parlez, dit John. Cinquante livres ! ce que nous ne gagnons pas dans une année.
– Cinquante livres sterling, répéta le lieutenant Percy.
– Mais…
Le lieutenant cligna de l’œil.
– Vous êtes trop pressé de savoir, John… patience !
Et le lieutenant Percy ne prononça plus un mot.
Les galériens avaient aperçu la forêt, eux aussi.
– Tas de chiens que vous êtes, leur dit le lieutenant, cessez de tirer la langue et ayez un peu de courage encore. Dans un quart d’heure nous nous reposerons, et il y aura de l’eau pour vous désaltérer.
Cette promesse ranima ces malheureux.
Ils étaient au nombre de huit, enchaînés deux pax deux.
Derrière la petite troupe marchait un mulet qu’un troisième gardien conduisait par la bride.
Et sur la monture il y avait un homme couché.
Cet homme, qui avait à peine vingt ans, était un pauvre diable de galérien qui avait été pris en route dans l’hôpital de la prison de Perth.
Il avait le visage couvert d’une lèpre affreuse et était un objet d’horreur, même pour ces hommes dégradés qui étaient ses compagnons d’infortune.
Quand on faisait halte, le mulet demeurait en arrière, car le bruit s’était répandu que le mal du pauvre diable était contagieux.
Le gardien mettait des gants pour lui donner à boire et à manger.
Du reste, ce malheureux était aux trois quarts idiot, et ne parlait pas.
Quel crime avait-il commis ?
On ne le savait pas.
Tout ce qu’on savait, c’est qu’il était condamné à la déportation perpétuelle.
Les galériens arrivèrent enfin à la lisière de la forêt.
– Halte ! commanda le lieutenant Percy.
Mais, au lieu de s’arrêter, les galériens se précipitèrent vers la rivière, au fond du lit de laquelle coulait encore un filet d’eau.
Puis ils burent avidement.
Le lieutenant Percy leur distribua quelques grossiers aliments et leur dit :
– Si vous avez sommeil, vous pouvez dormir. Nous resterons ici jusqu’au soir.
Et les infortunés se couchèrent deux par deux sur l’herbe à l’ombre des arbres, et, une demi-heure après, tous dormaient.
Mais le lieutenant Percy et son second, le garde-chiourme John, ne dormaient pas.
Assis à distance respectueuse de cette vermine humaine, comme ils disaient, ils causaient à voix basse.
– Oui, John, mon ami, il y a cent cinquante livres à gagner au bord de ce bois, cent pour moi, cinquante pour vous, disait le lieutenant Percy.
– Comment cela ?
– Écoutez-moi. Avez-vous remarqué que lorsque nous nous sommes arrêtés à Perth pour y prendre le condamné qui ne peut pas marcher, le geôlier de la prison m’a remis une petite boîte de fer-blanc ?
– Que vous portez en bandoulière ?
– La voilà.
– Bon ! dit John. Eh bien ?
– Savez-vous ce qu’elle contient ?
– Ma foi, non, et je n’ai même jamais osé vous le demander.
– Cette boîte contient une vipère bleue.
– Qu’est-ce que cela ?
– Un reptile de l’Inde long comme le petit doigt.
– Et dont la morsure est mortelle ?
– Non. Mais le venin de ce reptile a une singulière et terrible propriété.
– Ah !
– Il fait enfler le visage, le tuméfie au bout de quelques heures et rend idiot celui à qui le reptile l’a inoculé par sa morsure.
– Mais alors, dit John, ce malheureux qu’on porte sur le mulet a été mordu par cette vipère ?
– Oui.
– Comment cela est-il arrivé ?
– C’est le gardien qui l’a glissée dans son lit l’avant-veille du jour où vous deviez l’emmener. C’était alors un vigoureux garçon, sain de corps et d’esprit ; maintenant, c’est un pauvre idiot, épouvantable à voir.
– Mais, dit John, pourquoi le geôlier de la prison de Perth a-t-il commis cette méchante action ?
– Pour gagner cent livres, lui aussi.
– Je ne comprends pas.
Le lieutenant Percy se prit à sourire.
– Il y a de par le monde, dit-il, un homme assez riche pour acheter tous les chiourmes de la libre Angleterre.
– Ah ! Et… cet homme…
– Chut ! dit le lieutenant Percy, je vous en dirai plus long tout à l’heure…
Et il se leva.
Un homme couché dans l’herbe à quelques pas, et dont personne n’avait soupçonné la présence, levait la tête en ce moment et faisait un signe mystérieux au lieutenant Percy.
Cet homme, c’était l’Indien Nizam.
XXIX
Journal d’un fou de Bedlam
XV
L’Indien Nizam se dressa tout debout, regarda les galériens qui dormaient, et s’avança avec précaution.
Puis il regarda les deux chiourmes et, s’adressant à Percy :
– C’est vous qui êtes le lieutenant ? dit-il.
– Le lieutenant Percy. Oui.
– Je suis celui que vous attendez, moi.
– Je l’avais deviné, dit le chiourme.
– M’apportez-vous l’animal ?
– Oui, il est là, dans cette boîte.
Et le lieutenant Percy tendit la boîte à Nizam.
Celui-ci tira de sa poche un petit portefeuille tout graisseux et y prit, deux bank-notes de vingt-cinq livres chacune.
– Voilà cinquante livres, dit-il, à compte sur les cent cinquante.
– Bien, dit le chiourme ; à présent, j’attends vos ordres.
– Vous passerez le reste de la nuit ici, dit Nizam.
– Bon !
– Ensuite, demain, vous ferez halte au bourg de Pembleton.
Le lieutenant Percy s’inclina.
– Là, vous feindrez d’être malade et direz à vos galériens que vous ne pouvez continuer votre route.
– Combien de temps dois-je donc rester à Pembleton ?
– Voilà ce que je ne sais pas encore, dit Nizam ; cela dépendra des événements. Du reste, les malheureux que vous conduisez ne sont pas pressés, j’imagine.
– Oh ! non.
– Et s’ils trouvent à boire et à manger dans le bourg de Pembleton, ils y resteront volontiers une couple de jours.
– Très certainement, dit Percy. Par le temps caniculaire qu’il fait, du reste, les brigands ne marchent qu’à coups de bâton.
– Écoutez encore, reprit Nizam, il y a tout en haut de Pembleton, et auprès même d’une des grilles du parc du château, une auberge qui a pour enseigne : Au Ver luisant.
– C’est là que nous devons nous arrêter ?
– Oui. L’hôtelier est un homme à moi. Il logera vos prisonniers dans une cave et vous donnera le reste de son auberge pour vous, vos compagnons et le malheureux idiot que vous faites porter là sur un mulet.
– Parfait, dit le lieutenant Percy. Et puis ?
– Et puis, je vous le répète, dit Nizam, vous attendrez de moi de nouvelles instructions.
Et Nizam s’empara de la boîte de fer-blanc et laissa les deux chiourmes.
Les galériens ne s’étaient pas réveillés.
Quant à celui que la vipère bleue avait mordu, il était couché sur l’herbe auprès du mulet et poussait des cris inarticulés.
Nizam disparut au travers des arbres.
Quoique vieux, il était agile, et quand il fut hors de vue, il se mit à courir.
Il sautait les fossés, franchissait les broussailles d’un bond.
On eût dit un chevreuil poursuivi par une meute ardente.
Et il arriva ainsi jusqu’à un mur assez haut.
Ce mur était la clôture du parc de New-Pembleton.
Mais comme ce parc avait plusieurs lieues de tour, le château était encore assez loin.
Nizam escalada le mur et sauta dans le parc.
Puis il continua sa route en courant.
Au bout d’un quart d’heure, il s’arrêta pour reprendre un moment haleine.
Puis il fit quelques pas encore et s’arrêta de nouveau.
Évidemment Nizam cherchait quelque chose ou attendait un signal.
Et, tout à coup, il se jeta dans une broussaille et se coucha à plat ventre.
La broussaille était auprès d’une de ces routes sablées que les Anglais tracent circulairement dans leurs jardins et dans leurs parcs.
Nizam prêtait l’oreille à un bruit lointain.
Le bruit se rapprocha et devint plus distinct.
C’était le trot de plusieurs chevaux et le grincement des roues d’une voiture sur le sable.
Immobile, retenant son haleine, Nizam regardait au travers de la broussaille.
Et il vit une grande calèche découverte traînée par quatre chevaux, précédée par un piqueur et suivie par deux laquais vêtus de rouge, montés sur de vigoureux poneys d’Écosse.
La calèche passa tout près de Nizam.
Nizam put voir lord William assis en face de sir Archibald et de sa fille miss Anna.
L’Indien demeura couché jusqu’à ce que la calèche se fût éloignée.
Alors il se releva et reprit sa course vers le château.
Déjà les tourelles blanches, aux fenêtres encadrées de brique, apparaissaient au travers des arbres, et les blanches statues disséminées sur la pelouse tranchaient sur le vert sombre du feuillage aux yeux de Nizam, lorsqu’il s’arrêta encore.
Un jeune homme était assis devant le château, sur un banc, et lisait.
Nizam cessa de courir.
Il se prit à marcher péniblement, comme un homme accablé de fatigue.
Puis il alla droit au jeune homme qui lisait.
Sir Evandale leva la tête.
– La charité, s’il vous plaît ? demanda Nizam en tendant la main.
Sir Evandale lui donna une couronne.
Nizam jeta un regard furtif autour de lui.
– Je crois que nous sommes seuls ? dit-il tout bas.
– Oui. Tout le monde fait sa sieste au château.
– Alors, nous pouvons causer.
Et le faux mendiant continua à se tenir respectueusement debout devant le jeune gentilhomme.
– Que venez-vous m’apprendre ? demande alors sir Evandale.
– Que tout est prêt.
Sir Evandale tressaillit.
– Les galériens sont arrivés…
– Ah !
– Et la vipère aussi.
Ce disant, Nizam entr’ouvrit la méchante houppelande dont il était couvert et montra la boîte de fer-blanc suspendue à son cou.
– Sir George, dit alors sir Evandale ému, je vous somme de me refaire le serment que vous m’avez déjà fait.
– Plaît-il ? fit Nizam.
– Jurez-moi que la morsure de cette vipère n’est point mortelle.
– Je te le jure, dit Nizam ; mais si mon serment ne te suffit pas, va-t’en demain au bourg de Pembleton.
– Et puis ?
– Et puis, demande à voir les galériens et on te montrera celui que la vipère bleue a mordu, tu verras qu’il est plein de vie.
– C’est bien, je vous crois.
– Maintenant, reprit Nizam, voici le cas de nous souvenir du proverbe : Aide-toi, le ciel t’aidera !
– Vous voulez dire l’enfer, ricana sir Evandale.
– Va pour l’enfer, répondit Nizam.
– Qu’attendez-vous de moi ?
– Écoute, ton frère est allé reconduire sir Archibald et miss Anna ?
– Oui.
– Quand reviendra-t-il ?
– Il dînera chez eux et ne reviendra que fort tard.
– Est-il possible d’aller de ta chambre dans la sienne sans être rencontré ?
– Oui, en passant par la bibliothèque du château.
– Alors attends-moi ce soir dans ta chambre.
– À quelle heure ?
– À huit heures du soir, quand la nuit sera venue.
– Et c’est par le même chemin que vous viendrez ?
– Oui, par l’arbre qui me sert d’escalier.
Sir Evandale fit un signe d’assentiment.
Nizam s’éloigna.
* *
*
Le soir, en effet, sir Evandale était dans la chambre, dont il avait laissé la fenêtre ouverte.
Le feuillage de l’arbre s’entr’ouvrit, et Nizam sauta lestement sur l’entablement de la croisée et de l’entablement dans la chambre.
– Lord William n’est pas rentré encore ? demanda-t-il.
– Non.
– Alors, allons !
Sir Evandale était un peu pâle et sa voix tremblait.
Un moment même il murmura :
– Ah ! je ne veux pas !
– Imbécile, répondit Nizam, tu n’aimes donc plus miss Anna ?
Ces paroles mordirent sir Evandale au cœur.
– Allons ! dit-il d’une voix sourde.
Et il ouvrit une porte qui donnait dans une galerie convertie en bibliothèque.
Au bout de cette galerie, il y avait une autre porte qui ouvrait sur la chambre du jeune lord.
Et les deux misérables se glissèrent sans bruit dans la chambre.
Puis sir Evandale souleva un peu la courtine du lit.
Alors Nizam approcha la boîte de fer-blanc et l’ouvrit.
Un sifflement se fit entendre.
La vipère se glissa dans le lit, et la courtine retomba sur elle.
Et, quelques minutes après, Nizam se sauva en disant :
– À demain !
Et sir Evandale, la sueur au front, murmura :
– Je serai lord !…
XXX
Journal d’un fou de Bedlam
XVI
Deux heures après la disparition de Nizam, lord William rentrait à New-Pembleton.
Sir Evandale l’attendait dans le grand salon du rez-de-chaussée.
Lord William rayonnait.
– Ah mon cher frère, dit-il en lui sautant au cou, je suis en vérité le plus heureux des hommes !
– J’en suis ravi, mon frère, dit sir Evandale avec une pointe d’ironie.
– Miss Anna m’aime, poursuivit lord William.
Sir Evandale ne répondit pas.
Le jeune lord continua d’un ton enthousiaste :
– Elle m’aime, et elle m’a fait ses confidences ce soir.
– Vraiment ! dit sir Evandale.
– Sir Archibald nous avait laissés seuls, poursuivit lord William, et nous étions sous un berceau de verdure, dans le parc de leur habitation.
Miss Anna a placé sa petite main dans la mienne, poursuivit lord William et elle m’a dit alors :
– Je veux vous parler.
Et comme je la regardais avec étonnement, presque avec inquiétude :
Milord, a-t-elle continué, je ne veux pas devenir votre femme sans que vous ayez lu au fond de mon cœur. Milord, je vous aime, non parce que vous êtes un gentilhomme de haute race, non parce que vous siégerez au Parlement. Je vous aime pour vous, uniquement pour vous, parce que vous êtes bon, parce que le son de votre voix remplit mon âme d’une douce extase.
Et comme je portais sa main à mes lèvres et la couvrait de baisers, miss Anna poursuivit :
– Je veux vous dire aussi, milord, que je n’ai jamais fait aucun des petits calculs honteux de mon père.
– Quels calculs ? demandai-je un peu étonné.
– Mon père, poursuivit miss Anna, est fort riche, mais il est de petite noblesse, à peine esquire.
– Oh ! qu’importe !
– Et il est excessivement flatté de l’honneur de votre alliance. Tandis que moi…
Elle s’arrêta rougissante.
– Achevez, miss Anna, lui dis-je.
– Tandis que moi, poursuivit-elle, je voudrais que vous fussiez pauvre, d’origine obscure…
– Chère Anna !
Et je l’ai serrée dans mes bras.
– Ah ! mon cher frère, ajouta lord William, comme les quinze jours qui me séparent encore de mon bonheur vont me paraître longs…
Sir Evandale était muet.
– Pardonnez-moi, ajouta lord William. Les hommes heureux sont égoïstes ; ils ne savent parler que d’eux. Mais vous, mon cher frère, vous serez heureux aussi, et si j’en crois sir Archibald, la femme que nous vous destinons…
– Ah ! ne parlons pas de cela, mon frère, dit sèchement sir Evandale, il n’y a aucune comparaison à établir entre nous.
– Comment cela ? demanda sir William.
– Sans doute. Vous aimez miss Anna.
– Oh ! de toute mon âme.
– Puis-je savoir, si belle qu’elle soit, si j’aimerai jamais la fille du nabab ?
Et sir Evandale soupira.
Lord William eut alors comme un remords de lui avoir parlé de son bonheur.
– Mon cher frère, lui dit-il, je vais me coucher. Les douces émotions de la journée m’ont brisé. Bonsoir, et encore une fois pardonnez-moi.
– Je vais vous accompagner jusqu’à votre chambre, dit sir Evandale.
Et il reconduisit lord William.
Les fenêtres de la chambre à coucher du jeune lord étaient grand ouvertes.
Sir Evandale voulut les fermer.
– Oh ! laissez-les ainsi, dit sir William.
– Vous ne craignez donc pas l’air de la nuit ?
– Non. Au contraire, j’ai toujours trop chaud. Nous avons un été brûlant, mon frère.
– Alors, bonne nuit, dit sir Evandale.
Et il se retira.
Mais en sortant, il avait jeté un regard furtif vers le lit.
La courtine était en ordre et rien ne trahissait la présence du reptile qui s’était endormi sans doute dans quelque pli des draps.
* *
*
Une heure après, le valet de chambre de lord William, qui couchait dans la pièce voisine, entendit un grand cri.
Un cri d’angoisse, un cri de douleur.
Ce cri partait de la chambre de lord William.
Le valet se leva en toute hâte et passa chez son maître.
Il vit alors le jeune lord debout, au milieu de la chambre, tenant dans sa main crispée la vipère qu’il avait étouffée.
Mais le reptile l’avait cruellement mordu au visage auparavant, et quelques gouttes de sang découlaient le long de sa joue.
Lord William était comme fou.
Il jeta enfin la vipère, et le valet mit le pied dessus et l’écrasa.
Puis il appela au secours.
Les domestiques accoururent, et avec eux sir Evandale.
Lord William continuait à pousser des cris et disait :
– Je suis un homme perdu !
On courut chercher le médecin du bourg.
Celui-ci arriva en toute hâte et déclara que la morsure de la vipère était venimeuse, mais non mortelle.
Il lava la plaie, la cautérisa et fit recoucher lord William.
Sir Evandale, pendant ce temps-la, se lamentait et attribuait l’événement à l’imprudence de lord William, qui s’était mis au lit la fenêtre ouverte.
Une fièvre ardente s’était emparée de ce dernier.
Bientôt cette fièvre se compliqua d’un accès de folie, et il ne prononça plus que des paroles incohérentes.
Son visage enflait à vue d’œil et devenait noir.
Cependant, il eut encore un éclair de raison, et il prononça le nom de miss Anna.
– Qu’on prévienne miss Anna et sir Archibald ! ordonna sir Evandale.
Un domestique partit à cheval.
Au point du jour, sir Archibald et miss Anna arrivaient.
La jeune fille poussa un cri d’horreur.
Lord William était méconnaissable.
La tête, enflée, n’avait plus visage humain ; la peau des joues se détachait par lambeaux, la langue était tuméfiée, les lèvres violettes, les yeux éteints.
Le médecin commença à hocher la tête et à déclarer que lord William était perdu.
* *
*
Sir Evandale avait quitté la chambre du malade.
Peut-être était-il sous l’influence du remords.
Il courait tête nue devant lui, allant à l’aventure, lorsque Nizam bondit tout à coup hors d’une broussaille. Nizam avait un sourire hideux aux lèvres.
– Eh bien ? fit-il.
– Vous m’avez trompé, dit sir Evandale.
– Comment cela ? demanda Nizam.
– Lord William va mourir.
– Je te jure qu’il ne mourra pas.
– Cependant… le médecin…
– Le médecin est un âne, dit froidement Nizam ; maintenant, prends garde de te trahir, car tu es bouleversé par l’épouvante, et écoute-moi, si tu veux être lord, si tu veux épouser miss Anna.
Ce nom rendit tout son sang-froid à sir Evandale.
– Parlez, dit-il.
Alors Nizam tira une bougie de sa poche.
– Prends cela ! dit-il.
– Pourquoi faire ?
– Ce soir tu la mettras dans ton bougeoir.
– Bon ! Et puis ?
– Et puis tu iras tenir compagnie à sir Archibald et à sa fille qui voudront, très certainement, passer la nuit dans la chambre de lord William. Et tu poseras ton bougeoir sur la cheminée.
– Je ne comprends pas…
– Tu n’as pas besoin de comprendre, dit Nizam en riant. Tu verras… Au revoir…
Et l’Indien disparut au travers des arbres.
XXXI
Journal d’un fou de Bedlam
XVII
La journée fut terrible.
Lord William fut en proie à une fièvre ardente d’abord, puis la fièvre fit place à un abattement profond.
Il avait les yeux fermés, respirait à peine et, quand vint le soir, son visage n’était plus reconnaissable.
On avait télégraphié à Londres pour appeler les plus célèbres médecins de l’Angleterre.
Mais arriveraient-ils à temps ?
Sir Archibald et sa fille s’étaient installés auprès du malade.
Miss Anna pleurait à chaudes larmes.
Sir Evandale avait, lui aussi, fort bien joué son rôle.
Il avait témoigné une très grande douleur et refusé de prendre aucune nourriture.
Sir Archibald lui avait plusieurs fois tendu la main, et miss Anna s’était même jetée dans ses bras en l’appelant « mon cher frère. »
Vers le soir, lord William parut un moment sortir de sa torpeur.
Il prononça même quelques mots qui semblaient dénoter que la raison lui revenait.
L’espoir revint au cœur de miss Anna.
En même temps, sir Evandale fronça plusieurs fois le sourcil.
Il ne savait plus trop, si lord William revenait à la raison, comment Nizam tiendrait sa promesse.
Enfin, après un repas pris à la hâte et du bout des dents, sir Archibald et sa fille s’installèrent pour la nuit dans la chambre de lord William.
Peu après, sir Evandale les rejoignit.
Le jeune gentilhomme avait son bougeoir à la main et il le posa sans affectation sur la cheminée.
Une heure s’était à peine écoulée, que sir Evandale commença à deviner les projets de Nizam.
Une odeur singulière et fétide s’était répandue dans la chambre.
Était-ce lord William qui répandait cette odeur et, vivant encore, entrait en décomposition cadavérique ?
Sir Archibald et miss Anna le pensèrent ; mais ils restèrent bravement à leur poste.
Sir Evandale, lui, comprit que c’était sa bougie qui brûlait.
Et bientôt il se sentit la tête lourde et un violent besoin de dormir.
Cependant, il lutta contre ce sommeil léthargique le plus longtemps possible, et il eut le temps de voir sir Archibald et sa fille fermer les yeux presque en même temps, et un peu après eux, le valet de chambre de lord William, qui était demeuré dans la chambre pour servir son maître et lui donner les potions prescrites par le médecin, s’endormit pareillement.
À son tour, sir Evandale ferma les yeux.
Mais, presque aussitôt après, il éprouva une brusque secousse, suivie d’une étrange sensation de fraîcheur.
Et, ouvrant aussitôt les yeux, il sentit son visage tout mouillé.
Sir Evandale n’était plus dans la chambre de lord William.
Il se trouvait dans la sienne, couché tout vêtu sur son lit.
Un homme était auprès de lui.
Cet homme, on le devine, c’était Nizam.
Nizam lui passait sur le visage une éponge imbibée de vinaigre anglais.
Et sir Evandale, regardant l’Indien, lui dit :
– Que s’est-il donc passé ?
– Lève-toi, dit Nizam.
Sir Evandale se dressa sur son lit et sauta ensuite lestement à terre.
Il n’éprouvait plus qu’une légère lourdeur de tête.
– Viens avec moi, lui dit Nizam.
Et il ouvrit cette porte qui donnait sur la galerie convertie en bibliothèque, laquelle conduisait, on le sait, à la chambre de lord William.
Nizam entra le premier dans cette chambre.
– Regarde, dit-il.
Miss Anna, sir Archibald, le valet de chambre dormaient profondément.
Lord William, immobile sur son lit, ne donnait plus signe de vie.
– Oh ! fit Nizam, nous pouvons parler. Le bruit du canon ne les réveillerait pas, et si nous restions longtemps ici, tu t’endormirais de nouveau.
– Ah ! dit sir Evandale, vous m’avez trompé, mon frère est mort.
– Non, il dort.
– Vous ne me trompez pas ?
– Approche-toi et mets la main sur son cœur.
Sir Evandale obéit.
Le cœur de lord William battait.
Alors sir Evandale regarda Nizam :
– Eh bien ? fit-il.
– Regarde encore.
Et l’Indien lui montra dans un coin de la chambre quelque chose que, tout d’abord, sir Evandale n’avait point aperçu.
Ce quelque chose avait la forme d’un corps humain recouvert par une draperie.
Nizam souleva cette draperie, et sir Evandale jeta un cri d’horreur.
Il avait devant lui un cadavre.
Mais un cadavre hideux et dont le visage méconnaissable aussi ressemblait maintenant à celui de lord William.
Nizam souriait.
– Crois-tu qu’on les prendra l’un pour l’autre, maintenant ? dit-il.
– C’est-à-dire, répondit sir Evandale, que s’ils étaient couchés côte à côte, je ne pourrais dire lequel est mon frère.
– Ah ! tu vois bien.
– Mais… Il est mort celui-là ?
– C’est le galérien qu’on portait sur un mulet.
– Et il est mort ?
– Oui.
– Vous voyez donc bien, dit sir Evandale un peu ému, que la morsure de la vipère bleue est mortelle.
– Tu te trompes.
– Ah !
– Percy et moi nous l’avons tué.
– Comment !
– On lui a versé deux gouttes d’acide prussique dans un verre d’eau.
Sir Evandale regardait toujours attentivement son frère endormi et le galérien mort.
– Allons ! dit Nizam, aide-moi.
Et il s’approcha du lit, découvrit lord William, le prit à bras le corps et le posa tout endormi sur le parquet.
Puis, sir Evandale et lui prirent le cadavre et le couchèrent dans le lit.
– Et maintenant, dit sir Evandale, qu’allez-vous faire de mon frère ?
– Tu vas m’aider à le transporter hors du château.
– Comment ?
– Nous allons le porter dans ta chambre, d’abord.
– Bon !
– Deux hommes ont posé une échelle contre la fenêtre et m’attendent au bas.
– Quels sont ces deux hommes ?
– Le lieutenant Percy et le garde-chiourme John.
– Mais, dit encore sir Evandale, une fois hors de cette atmosphère, il s’éveillera ?
– Sans doute !
– Et alors…
– Ne t’ai-je pas dit qu’il serait fou pendant plusieurs semaines ?
– C’est juste.
– Et dans plusieurs semaines, ajouta Nizam en riant, il sera loin de l’Angleterre, et quand la raison reviendra il fera route pour l’Australie.
– Et je serai lord, moi ?
– Tu seras lord.
Et Nizam, disant cela, chargea sur ses épaules lord William endormi et reprit le chemin de la galerie.
Sir Evandale le suivit.
La bougie était aux trois quarts consumée, mais elle brûlait encore.
XXXII
Journal d’un fou de Bedlam
XVIII
Sir Evandale revint dans la chambre de lord William.
La bougie brûlait encore.
Le jeune gentilhomme s’assit dans le fauteuil où il s’était endormi quelques heures auparavant.
– À présent, pensa-t-il, peu m’importe de redormir et même le plus longtemps possible.
J’aime autant que sir Archibald et sa fille s’éveillent avant moi.
En effet, si sûr de lui qu’il pût être, sir Evandale redoutait quelque peu le réveil de ces personnages que la baguette d’une fée avait tout à coup privés de sentiment.
Qu’arriverait-il quand on constaterait que lord William ou plutôt l’homme qui lui avait été substitué était mort ?
Sir Evandale ne tarda pas à se rendormir sous l’influence des émanations narcotiques de la bougie.
Mais, la bougie éteinte, l’atmosphère se dégagea peu à peu, et sir Archibald, au bout d’une heure, s’éveilla à demi.
Seulement il suffoquait, il manquait d’air.
L’odeur fétide avait survécu à la bougie.
Sir Archibald fit un violent effort, se leva en chancelant, se traîna vers l’une des croisées et donna un coup de poing au travers des carreaux.
Une vitre vola en éclats.
En même temps, une bouffée d’air pur entra dans la chambre.
Ce fut instantané et magique.
Miss Anna s’éveilla, le valet de chambre aussi.
Seul, sir Evandale dormait encore.
Un demi-jour régnait dans la chambre.
Les premières clartés de l’aube luttaient avec la clarté d’une veilleuse placée sous un verre dépoli.
Miss Anna, stupéfaite, regardait son père.
Sir Archibald alla ouvrir les deux fenêtres.
Puis il revint vers sa fille.
Mais celle-ci jeta un cri terrible.
Une main sortait du lit.
Elle avait pris cette main et l’avait rejetée aussitôt.
Cette main était glacée.
Sir Archibald se pencha sur le cadavre.
– Mort ! dit-il avec stupeur.
Le cri de miss Anna avait éveillé sir Evandale.
Il se leva, étira les bras, promena un regard stupide autour de lui et murmura :
– Que se passe-t-il donc ?
– Votre frère est mort, dit sir Archibald. Il est mort pendant que nous dormions…
* *
*
Il se trouve toujours, à point nommé, un médecin pour expliquer à sa manière les choses les moins explicables.
Une heure après l’étrange réveil des hôtes du château, une des célébrités médicales qu’on avait appelées par le télégraphe arriva de Londres.
Ce prince de la science n’hésita pas à déclarer que le jeune lord Pembleton avait succombé à un empoisonnement particulier auquel il donna un nom latin.
Et il prétendit que le sommeil qui s’était emparé des personnes qui se trouvaient dans la chambre était dû aux exhalaisons morbides que lord William exhalait même de son vivant, la décomposition ayant précédé la mort.
Sir Evandale témoigna la plus violente douleur.
Il se frappait la tête contre le mur ; il voulait mourir à son tour. On eut toutes les peines du monde à le calmer.
Et le soir de ce jour, allant dans la campagne, à moitié fou, en apparence du moins, il arriva sur un petit monticule que contournait la grande route.
Un spectacle bizarre attira ses regards.
Une troupe d’hommes enchaînés gravissait péniblement la colline.
Devant elle, marchait le lieutenant Percy et le garde-chiourme John.
Derrière venait un mulet, sur lequel on avait couché un pauvre idiot qui n’avait plus visage humain.
Sir Evandale tressaillit.
Un pâtre, assis à quelques pas, vint auprès de la route pour voir les galériens de plus près.
Et, regardant sir Evandale, il lui dit :
– Ce sont des galériens, ils sont bien malheureux ; mais le plus malheureux de tous, ce n’est pas ceux qui marchent, milord, c’est celui qu’on a couché sur le mulet, car il est fou.
Sir Evandale jeta une pièce d’or au pâtre et prit la fuite.
Et comme il descendait la colline, une voix railleuse lui cria :
– Milord, j’ai tenu une partie de mes promesses…
Sir Evandale se retourna.
Il vit un homme accroupi derrière une broussaille, un homme qui, lui aussi, avait vu passer les galériens.
Cet homme, c’était Nizam.
Et comme le jeune homme, pâle et la sueur en front, demeurait cloué au sol, Nizam bondit jusqu’à lui.
– Tu es lord aujourd’hui, dit-il, dans six mois tu auras épousé miss Anna.
Et Nizam disparut encore.
* *
*
Six mois après, en effet, miss Anna, pressée par son père, quitta le deuil de son fiancé lord William.
Sir Archibald tenait à marier sa fille à un lord.
Elle devint lady Evandale.
Le jour même, un homme qui était arrivé trop tard pour les funérailles de son maître, déclara à lord Evandale qu’il quittait son service.
Cet homme, c’était Tom.
Tom ne voulait pas servir le fils du crime.
Tom pleurait toujours lord William.
Le même soir, lord Evandale, après avoir conduit sa jeune femme dans la chambre nuptiale, descendit furtivement dans le parc.
Nizam, le faux Indien, Nizam qui s’était appelé sir George Pembleton autrefois, avait donné rendez-vous à son fils pour le féliciter.
Le rendez-vous était au pied même de cet arbre où Nizam avait attendu tant de fois sir Evandale.
Et sir Evandale devenu lord s’y rendit.
La lune éclairait le paysage.
Comme il approchait, lord Evandale aperçut Nizam.
Mais Nizam n’était point debout comme à l’ordinaire.
Nizam était couché.
Et Nizam paraissait dormir.
Lord Evandale l’appela.
Nizam ne répondit point.
Alors le jeune homme s’approcha et poussa un cri d’horreur.
Nizam était mort.
Nizam avait encore un couteau planté dans le cœur.
Et lord Evandale, ayant arraché l’arme meurtrière de la plaie béante, la reconnut.
C’était le couteau de chasse de Tom, le mari de Betzy.
XXXIII
Journal d’un fou de Bedlam
XIX
Qu’était devenu Tom ?
C’était le matin même du jour où lord Evandale épousa miss Anna, la fille de sir Archibald, que Tom annonça à son jeune maître qu’il quittait son service.
Tom, on le sait, était à Londres quand eut lieu le fatal événement que nous venons de raconter.
Tom revint, pleura son maître et le crut réellement mort.
Lord Evandale paraissait même regretter si profondément son frère que Tom ne soupçonna pas un seul instant la vérité.
Cependant, un soir, quelque temps après son retour, Tom fut témoin invisible d’une chose étrange.
S’étant mis une nuit à la fenêtre de sa chambre qui donnait sur le parc, il vit un homme se glisser au travers des arbres.
Cet homme, c’était Nizam l’Indien.
Tom s’apprêtait à descendre pour chasser le mendiant, quand une porte du château s’ouvrit et un autre homme se glissa furtivement dans le parc.
Il faisait clair de lune et on y voyait comme en plein jour.
Tom reconnut dans la personne qui venait de sortir du château lord Evandale lui-même.
Tom le suivit des yeux.
Le jeune lord rejoignit l’Indien.
Et celui-ci le prit familièrement par le bras.
Ce fut pour le vieux serviteur toute une révélation.
Il ne devina point la vérité tout entière, mais il en devina une partie.
Nizam était Indien ; Nizam avait dû fournir la vipère bleue.
Et Nizam était le complice de lord Evandale.
Lord Evandale avait assassiné son frère.
Tom alors se mit à épier l’Indien.
Ce qu’il voulait, c’était la preuve du crime.
Cette preuve obtenue, Tom vengeait le malheureux lord William.
Cependant le frère de lait de lady Eveline ne soupçonnait point encore la véritable identité de Nizam.
Jusqu’alors, du reste, il s’était peu préoccupé du mendiant.
À partir de ce jour, Tom veilla.
Une nuit, à huit jours de distance, il suivit lord Evandale qui avait un nouveau rendez-vous avec Nizam.
À son tour, blotti dans une broussaille, Tom entendit lord Evandale et Nizam causer.
Et quand ils se furent éloignés, Tom se releva, la sueur au front.
Il savait maintenant qui était Nizam.
Nizam était le père de lord Evandale, c’est-à-dire sir George Pembleton.
Sir George dont avait été dressé l’extrait mortuaire à Calcutta, il y avait plus de quinze ans.
Tom ne pouvait plus douter de la complicité de lord Evandale, mais il y avait cependant une chose qu’il ne savait pas.
C’était que lord William n’était point mort.
Or, donc, le jour où lord Evandale allait épouser miss Anna, Tom et Betzy quittaient son service.
Ils partirent en plein jour, dans un break de chasse, pour aller prendre à la station voisine le train de Londres.
Le domestique du château qui les conduisit les vit même prendre place dans le convoi.
Lord Evandale était donc persuadé qu’ils étaient partis.
Cependant Tom n’était point allé loin.
Il était descendu à la station voisine, et laissant Betzy continuer sa route vers Londres, il était demeuré caché dans un fossé jusqu’à la nuit.
Tom avait surpris la veille un rendez-vous, donné à Nizam par sir Evandale.
Tom se glissa dans le parc quand la nuit fut venue.
Puis il alla se blottir dans un buisson auprès de l’arbre où le faux Indien attendait souvent lord Evandale.
Les heures s’écoulaient.
Le château était encore plein de lumière et de bruit, et les nombreux invités n’étaient point partis encore.
Cependant Nizam arriva.
Il était pressé sans doute de voir son fils, car, s’étant assis au pied de l’arbre, il attachait sur le château un regard impatient.
Tout à coup un homme bondit auprès de lui.
C’était Tom.
Tom était armé d’un couteau.
Nizam était sans armes.
Tom le prit à la gorge.
Nizam voulut jeter un cri.
– Si tu appelles, tu es mort, dit-il.
L’Indien se débattait.
Tom lui dit :
– Je sais qui tu es. Tu ne te nommes pas Nizam. Tu es sir George Pembleton.
L’Indien eut un ricanement féroce.
– Ah ! tu m’as reconnu ? dit-il.
– Oui, et je sais que tu as tué lord William.
– Non, dit sir George.
– Misérable ! oses-tu donc nier ton crime ?
– Je ne nie pas, répondit Nizam. Je dis la vérité. Je n’ai pas assassiné lord William.
– C’est toi qui as apporté la vipère bleue ?
– Oui.
– C’est toi qui l’as glissée dans le lit de lord William ?
– Oui, dit encore Nizam.
– Et tu oses te défendre ?
– Je n’ai pas assassiné lord William.
– Infâme !
– Lord William n’est pas mort.
Tom jeta un cri et son émotion fut si grande qu’il faillit lâcher l’Indien.
– Lord William n’est pas mort, répéta Nizam. Mais quand tu sauras ce qu’il est devenu, tu regretteras qu’il soit encore au nombre des vivants.
Tom avait renversé Nizam sous lui.
Et lui appuyant son genou sur la poitrine, la pointe de son couteau sur la gorge, il lui dit :
– Parleras-tu, misérable ?
– Ah ! tu veux savoir ?
– Oui.
– Et si je te dis où est lord William, me feras-tu grâce ?
– Non.
– Eh bien ! dit Nizam, je te dirai ce qu’il est devenu et ce sera ma vengeance !
Et Nizam, ricanant, l’écume à la bouche, raconta à Tom comment le forçat mort avait été substitué au noble lord vivant.
Et quand il eut fini son récit, il ajouta avec un éclat de rire diabolique :
– Mais il ne te sert de rien de savoir que lord William vit, car tu ne le retrouveras pas.
Mêlé aux convicts du nouveau monde, il traîne parmi eux une vie misérable, sous le nom du forçat dont il a pris la place.
– Quel est ce nom ? demanda Tom.
– Tu ne le sauras pas.
– Parle ! ou je te tue !
– Non, dit Nizam qui cherchait à gagner du temps, car il espérait toujours que lord Evandale viendrait.
– Parle ! répéta Tom.
– Non, non, je ne veux pas !
– Eh bien, meurs ! dit Tom.
Et il lui plongea son couteau dans la poitrine.
Nizam mourut sans pousser un cri.
Alors Tom se releva :
– Je ne sais pas quel nom porte mon malheureux maître, murmura-t-il, mais qu’importe ? La terre a beau être grande, Dieu m’aidera et je le retrouverai.
Et laissant son couteau dans la poitrine de Nizam, Tom prit la fuite.
XXXIV
Journal d’un fou de Bedlam
XX
Tom se mit donc à la recherche du malheureux lord William.
Mais le monde est grand ; et chercher un homme par le monde, quand on ne sait pas sous quel nom il se cache, est chose difficile, sinon impossible.
Tom se mit cependant à l’œuvre.
Il commença par rejoindre sa femme à Londres, et lui fit part des révélations suprêmes de Nizam.
Betzy était une femme de sens et d’intelligence.
Elle écouta Tom jusqu’au bout.
Puis, lorsqu’il eut terminé son récit, elle lui dit :
– Mon ami, il est deux choses qu’il faudrait savoir tout d’abord.
– Lesquelles ? demanda Tom.
– D’abord, le nom du lieutenant qui conduisait le convoi des galériens.
– Et puis ?
– Et puis de quelle ville d’Écosse venait le malheureux qui est maintenant enterré dans le cimetière du bourg de Pembleton, sous le nom de lord William.
– Tu as raison, dit Tom.
Il avait beaucoup de connaissances à Londres.
Entre autres un détective fameux auquel Scotland yard, c’est-à-dire la préfecture de police de Londres, avait confié les missions les plus délicates.
Tom alla le trouver.
Il lui confia le secret de l’existence de lord William.
En même temps, il lui mit dans la main un chèque de trois cents livres.
Le détective demanda huit jours.
Au bout de ce temps, il fit parvenir cette note au fidèle Tom.
« Un lieutenant de chiourme a passé, il y a sept mois, par le bourg de Pembleton.
« Il se nommait Percy et se rendait à Liverpool, où il conduisait un convoi de galériens.
« Il est probable qu’il s’est embarqué avec eux. »
Tom prit le chemin de fer et s’en alla à Liverpool.
Là, en compulsant les registres de la marine, il trouva, en effet, le nom de Percy, suivi de la qualification de lieutenant.
Percy s’était embarqué pour la Nouvelle-Zélande avec ses prisonniers.
Tom hésita alors.
S’embarquerait-il, lui aussi, ou bien auparavant, chercherait-il à savoir le nom de ce galérien qu’on avait substitué à lord William ?
Il s’arrêta enfin à ce dernier parti.
Tom prit la route de l’Écosse.
Il alla à Édimbourg, puis à Glascow, prenant des renseignements avec une adresse et une prudence inouïes.
Enfin il arriva dans la petite ville de Perth.
Là, on lui parla d’un événement mystérieux et inexplicable.
Un jeune homme du nom de Walter Bruce avait été condamné pour vol avec effraction à cinq années de déportation.
Ce jeune homme, détenu dans la prison de Perth, s’était couché un soir fort bien portant.
Le lendemain il s’était éveillé en jetant des cris affreux.
Il était fou furieux et son visage était devenu noir.
À ce portrait, Tom crut reconnaître le malheureux dont il cherchait le nom.
Mais son espérance devint une certitude lorsqu’on eut ajouté que le chiourme, en passant, l’avait emmené, si malade qu’il fût.
Et comme il ne pouvait marcher, on l’avait placé sur le mulet des bagages.
Tom vérifia les dates et acquit la conviction que le départ de Walter Bruce, de la ville de Perth, avait eu lieu cinq jours avant la mort de lord William.
Il s’agissait, maintenant, de retrouver Walter Bruce.
Tom revint à Londres.
Le fidèle serviteur n’était pas riche.
Quelques centaines de livres sterling, péniblement amassées au service de la famille Pembleton, étaient toute sa fortune.
Betzy lui dit :
– Je suis encore jeune, je suis forte. Je travaillerai. Emporte l’argent.
Huit jours après, Tom s’embarquait pour la Nouvelle-Zélande.
Il avait douze cents livres en chèques et bank-notes dans une ceinture de cuir.
Les premiers mois de la traversée furent heureux.
Le navire qui portait Tom doubla sans encombre la pointe méridionale de l’Amérique et entra dans les eaux du Pacifique.
Un mois après il fit naufrage.
Il alla se heurter, par une nuit sombre et brumeuse, sur un rocher à fleur d’eau.
Une voie d’eau se déclara, et les pompes furent impuissantes à le sauver.
Au moment de couler à pic, le capitaine fit mettre les embarcations à la mer, et les passagers et les matelots s’y entassèrent tant bien que mal.
Alors commença pour le pauvre Tom une série d’aventures épouvantables.
Pendant dix-sept jours, le radeau qui le portait erra sur l’immensité des eaux, sans direction, sans boussole.
Les provisions s’épuisèrent, la famine vint ; on s’égorgea pour se manger.
Le vingtième jour, la terre apparut.
Les malheureux firent des efforts inouïs et abordèrent enfin dans une île sauvage.
Les habitants de cette île étaient des nègres anthropophages.
Tom et ceux de ses compagnons d’infortune qui avaient survécu furent emmenés par les cannibales dans l’intérieur des terres.
Tom était d’une maigreur extrême.
Ce triste privilège lui sauva la vie.
Ses compagnons furent mangés.
Quant à lui, on essaya de l’engraisser, et comme on n’y pouvait parvenir, on le laissa vivre.
Il passa cinq ans au milieu des nègres, en butte aux plus mauvais traitements.
Enfin, un jour, un navire anglais relâcha dans cette île maudite.
Des nègres qui vinrent à bord vendre des fruits, du poisson et de l’huile de phoque, racontèrent qu’ils avaient un blanc parmi eux.
Le capitaine envoya des hommes à terre qui emmenèrent le pauvre Tom.
Le navire faisait voile pour l’Australie et devait toucher à la Nouvelle-Zélande.
Tom reprit courage.
Les nègres lui avaient laissé sa ceinture. Il avait donc encore de l’argent.
Un mois après, Tom, qui n’était plus qu’un fantôme, arriva à Aukland.
Il écrivit à sa femme, qui sans doute le croyait mort.
Puis il se mit de nouveau à la recherche de lord William, ou plutôt du convict Walter Bruce.
Après plusieurs jours de recherches inutiles, Tom apprit qu’une cinquantaine de déportés, qui avaient fini leur temps, avaient été dirigés sur l’Australie.
Walter Bruce était-il parmi eux ?
Tom n’en savait rien.
Mais il se mit néanmoins en route, et il s’embarqua pour Melbourne.
Là, il commença ses investigations.
Il parcourut les cabarets, interrogea les matelots, questionna les convicts.
Personne ne pouvait lui donner des nouvelles de Walter Bruce.
Mais Tom ne se décourageait point.
Il avait quitté Melbourne pour Sydney, et il était logé dans une misérable hôtellerie quand il fit connaissance d’un Allemand qui se nommait Frantz Hauser.
Frantz était fort misérable.
Soupçonnant quelque argent à Tom, il lui demanda un secours, ajoutant qu’il avait été condamné injustement il y avait sept ou huit ans et transporté à la Nouvelle-Zélande.
– Avez-vous connu un déporté du nom de Walter Bruce ? demanda Tom.
– Oui, certes, répondit Frantz, nous l’avions surnommé Milord.
Tom jeta un cri et prit vivement les mains de Frantz en lui disant :
– Parlez ! parlez ! dites-moi tout ce que vous savez sur lui !
XXXV
Journal d’un fou de Bedlam
XXI
L’Allemand Frantz Hauser regarda Tom avec étonnement.
– Oui, dit-il, j’ai connu un convict qui se nommait ou plutôt qu’on nommait Walter Bruce.
– Il répudiait ce nom, n’est-ce pas ?
– Oui, et il disait qu’il était lord ; aussi l’appelions-nous milord, mais par dérision, car nous savions bien…
– Vous ne saviez rien, dit Tom brusquement.
Frantz le regarda.
– Celui à qui vous donniez le nom de Walter Bruce était bien lord, en effet, poursuivit Tom ; mais peu importe ! Où l’avez-vous rencontré ?
– Nous avons fait ensemble quatre ans de servitude pénale.
– Où cela ?
– À la Nouvelle-Zélande, je vous l’ai dit.
– Et vous vous êtes séparés ?
– Oui.
– Pourquoi ?
– Mon temps était fini. On m’a rendu ma liberté et on m’a donné à choisir, retourner en Europe ou venir ici.
– Et Walter Bruce ?
– Il doit avoir fini son temps aussi.
– Alors il est retourné en Europe ?
– Je ne crois pas.
– Ah ! fit Tom haletant.
– Je ne réponds pas, poursuivit Frantz, de l’exactitude absolue des renseignements que je vais vous donner. Cependant, écoutez toujours.
– Parlez, dit Tom, dont le cœur battait à rompre.
– Il y a fort peu de convicts qui retournent en Europe leur temps fini ; la plupart demandent à rester en Australie.
Les uns se font bergers, les autres travaillent aux mines ; quelques-uns finissent même par faire fortune.
– Eh bien ? fit Tom.
– Il y a six mois, poursuivit Frantz, j’étais à Melbourne et il y avait une grande foire de bestiaux.
Les bœufs et les moutons arrivaient par centaines et toute la ville était pleine de fermiers.
Je crois bien avoir vu ce jour-là, au milieu de la forêt, un homme qui ressemblait à Walter Bruce ; j’ai même cherché à le joindre ; mais la foule était si compacte que je l’ai bientôt perdu de vue.
– Eh bien ! reprit Tom, en admettant que ce fût bien Walter Bruce que vous ayez vu, quelle conclusion en tireriez-vous ?
– Celle-ci, que Walter Bruce est berger chez quelque fermier éleveur de bétail.
– En Australie ?
– Sans doute.
– Mais dans quelle partie ? l’Australie est grande comme un continent.
– Oui, dit Frantz, mais il faut vous dire qu’à Melbourne il ne vient ordinairement que des troupeaux de l’ouest.
– C’est bien, dit Tom, je chercherai.
– Ce Walter Bruce était donc votre ami ? fit l’Allemand.
– C’était mon maître.
– Hein ? dit Frantz.
– Mon maître, un noble lord de la libre Angleterre, dit encore Tom.
– Comment un lord a-t-il pu être déporté ?
– Oh ! dit Tom, ceci est une trop longue histoire que je ne puis raconter aujourd’hui.
– Ah !
– Mais je vous ferai une proposition.
– Parlez.
– Vous êtes misérable ?
– Je meurs de faim.
– Eh bien ! voulez-vous gagner dix livres par mois ?
Les yeux du convict s’allumèrent.
– Dix livres ! s’exclama-t-il.
– Oui.
– Que faut-il faire pour cela ?
– Il faut m’accompagner et chercher avec moi Walter Bruce.
– Oh ! je veux bien, dit l’Allemand.
– Et si nous le retrouvons, poursuivit Tom, vous aurez cinquante livres de gratification.
– Puisqu’il en est ainsi, fit l’Allemand, je suis prêt à vous suivre au bout du monde.
* *
*
Dès le lendemain, Tom et Frantz Hauser s’embarquèrent à Sydney pour Melbourne.
Justement il y avait une foire de bestiaux le surlendemain de leur arrivée.
Tom et son compagnon demeurèrent dans la ville.
Ils attendirent le jour de la foire, qui devait se prolonger pendant toute la semaine.
Tom parcourut toutes les auberges, il chercha dans toutes les rues.
Mais nulle part il ne trouva Walter Bruce.
Cependant Frantz retrouva, lui, un ancien convict devenu berger et qui avait connu Walter Bruce.
Il lui en demanda des nouvelles.
– Oh ! dit le convict, il y a des hommes qui ont du bonheur.
– Que veux-tu dire ?
– Et Walter Bruce est de ce nombre.
Tom assistait à l’entretien ; mais ne soufflait mot. Son cœur battait à rompre sa poitrine.
– Walter Bruce est donc heureux ? demanda Frantz.
– Très heureux.
– Où est-il ?
– À cent lieues d’ici, dans le nord-ouest.
– Tu l’as vu ?
– Il y a six mois.
– Et que fait-il ?
– Il était berger comme moi quand il est revenu de la Nouvelle-Zélande.
– Et maintenant ?
– Maintenant il est fermier et il possède un troupeau à lui.
– Comment a-t-il donc fait pour en arriver là ? demanda encore l’Allemand.
– Il a su plaire à la fille d’un riche fermier et il l’a épousée. Le fermier est mort peu de temps après, et Walter Bruce est riche, car sa femme était fille unique.
– Et tu peux nous indiquer au juste l’endroit où il est ? demanda encore Frantz.
– Je puis faire mieux, dit le berger.
– Ah !
– Je suis sur une propriété qui n’est distante de la sienne que de quelques milles.
– Bon !
– Je m’en retourne demain, car mes bestiaux sont vendus. Venez avec moi.
– Et tu nous conduiras chez Walter Bruce ?
– Oui.
Tom se sentait mourir de bonheur.
Dès le lendemain il se mit en route avec Frantz et le convict devenu berger.
On voyage lentement en Australie.
Les routes, mal tracées, sont sillonnées par des chariots traînés par des bœufs.
Il fallut dix jours aux voyageurs pour franchir les cent lieues qui séparaient Melbourne du pâturage sur lequel Walter Bruce était établi.
Le berger, en arrivant, conduisit Tom à l’habitation de son maître.
– Demain seulement, dit-il, je vous amènerai chez Walter Bruce, car nous ne pourrions aujourd’hui y arriver de jour. Et le pays est infesté de nègres voleurs.
Tom attendit donc le lendemain.
Mais, dès le point du jour, il se mit en route.
Vers six heures du matin, le convict lui dit :
– Nous sommes encore loin de l’habitation, mais nous foulons déjà les terres de la ferme.
Enfin, vers midi, Tom aperçut une coquette maison blanche s’élevant au milieu de grands arbres.
– C’est là ! dit le convict.
Tom sentit ses yeux s’emplir de larmes.
Et puis il se fit cette question :
– Voudra-t-il revenir en Europe maintenant ?…
Et ce fut en chancelant, et pleurant comme un enfant, que Tom continua son chemin vers la maison qui, de loin, ressemblait à un nid de tourtereaux.
XXXVI
Journal d’un fou de Bedlam
XXII
Rien n’était propre et coquet comme cette habitation perdue au milieu d’un océan de verdure.
Les bâtiments d’exploitation, les écuries, les étables étaient entourés de hautes murailles toutes blanches.
La maison de maître était au milieu, avec un jardin pour ceinture.
Tom et ses compagnons restèrent dans la cour principale.
Un petit mulâtre s’y trouvait.
L’ancien convict lui dit :
– Bonjour, Nathan.
– Bonjour, Tobby, répondit le petit mulâtre.
– Voici deux amis à moi, continua le berger, qui viennent rendre visite à M. Bruce.
– M. Bruce n’est pas à l’habitation, répondit le petit nègre.
Tom pâlit.
– Où est-il donc ? fit Frantz Hauser.
– Oh ! rassurez-vous, il n’est pas en voyage.
– Ah !
– Il est allé visiter un de ses troupeaux qui est parqué à un mille d’ici.
– Et il rentrera bientôt ?
– Certainement, il ne peut tarder.
– Nous l’attendrons, dit Tom.
– Mais mistress Bruce est à la maison, dit encore le petit nègre, entrez.
Tom hésitait.
– Venez donc, dit l’ancien convict.
Et il passa le premier.
Quelques serviteurs étaient éparpillés dans les cours et le jardin.
La porte de l’habitation était grande ouverte.
Tom vit devant lui un large vestibule plein de fleurs, au bout duquel se développait la volute d’un élégant escalier.
Au bruit de leurs pas, une porte s’ouvrit à droite sous le vestibule.
Une jeune femme leur apparut alors.
Elle avait dans ses bras un enfant à qui elle donnait le sein.
Derrière elle une jolie petite fille de quatre ans se montrait toute rougissante et levant sur les visiteurs de grands yeux étonnés.
Mistress Bruce, car c’était elle, connaissait Tobby.
– Bonjour, Tobby, lui dit-elle.
– Bonjour, madame, répondit le convict.
– Vous vouliez voir M. Walter ?
Et, tout en posant cette question, elle jetait un regard curieux sur Frantz Hauser et sur Tom.
– Madame, répondit Tobby en montrant Tom, voici un gentleman qui a beaucoup connu votre mari.
La jeune femme tressaillit, une vive émotion s’empara d’elle, et elle murmura :
– Où donc cela ?
– En Angleterre, dit Tom vivement.
L’émotion de la jeune femme allait toujours croissant.
– En Angleterre ? fit-elle.
– Oui, madame.
– Et… à Perth ?
– Oh ! non…, à Pembleton Castle.
Et Tom parlait avec des larmes plein les yeux.
La jeune femme le regardait toujours.
– Qui donc êtes-vous ? fit-elle enfin.
– Je me nomme Tom.
Elle jeta un cri.
– Tom ! dit-elle, vous vous nommez Tom ?
– Oui, madame.
– Ah ! mon Dieu !
Et elle chancelait et un tremblement nerveux s’était emparé de tout son corps.
Tom reprit :
– Oui, madame, je me nomme Tom, et je vois à votre émotion que sir Walter vous a souvent parlé de moi.
– Il m’en parle tous les jours encore, répondit-elle.
Et comme elle disait cela, on entendit retentir dans la cour le pas d’un cheval.
Tom se précipita au dehors.
C’était M. Bruce qui arrivait.
Tom s’approcha.
Lui aussi tremblait de tous ses membres, et ses jambes refusèrent de le porter plus longtemps.
Il fallut que Tobby le convict le soutînt.
M. Walter était un beau jeune homme de vingt-sept ou vingt-huit ans, et son visage, bruni par le soleil, ne portait plus aucune trace des hideuses morsures de la vipère bleue.
Il regarda Tom et ne le reconnut pas tout d’abord.
Tom avait maintenant les cheveux tout blancs.
– Quel est cet homme ? demanda M. Walter en mettant pied à terre.
– Mon maître, mon bon maître, s’écria Tom, ne me reconnaissez-vous pas ?
M. Bruce jeta un cri.
– Tom ! fit-il.
– Ah ! milord, dit Tom d’une voix brisée, je savais bien que je finirais pas vous retrouver…
M. Bruce prit Tom dans ses bras et l’y tint longtemps serré.
Puis, avisant Frantz Hauser et Tobby, il leur tendit à chacun la main.
Et un triste sourire effleurant ses lèvres :
– Quand je vous disais que j’étais lord, fit-il, vous ne vouliez pourtant pas me croire !
Il dit à sa femme :
– Chère Lucy, emmenez donc ces braves gens à la salle à manger et faites-leur servir des rafraîchissements et une collation. Moi, j’ai hâte de me trouver seul avec mon cher Tom.
Et il prit le vieux serviteur par le bras et entra dans-la maison.
Tom tremblait toujours et il fondait en larmes.
Et lorsqu’ils furent seuls, M. Bruce l’embrassa de nouveau et lui dit :
– Tu me cherchais donc ?
– Il y a six ans que j’ai quitté l’Angleterre, répondit Tom, et sans ces maudits sauvages…
– Quels sauvages ?
– Oh ! milord, répondit Tom, mes souffrances ne sont rien auprès de celles que vous avez endurées.
– Tom, dit M. Bruce, avant de vous dire mon histoire, je veux savoir la vôtre.
M. Walter parlait avec autorité.
– Je vous obéirai, milord, répondit Tom.
Et il raconta comment il avait quitté l’Angleterre pour se mettre à la recherche de l’infortuné lord William.
– Tom, dit alors M. Bruce, il y a une chose que je n’ai jamais pu m’expliquer.
– Laquelle, milord ?
– J’ai perdu la mémoire pendant plus d’une année et j’ai été fou, m’a-t-on dit.
– Ah ! fit Tom.
– Le dernier événement de mon ancienne vie dont je me souvienne est celui-ci. Je venais de me mettre au lit, dans ma chambre de New-Pembleton, lorsque je jetai un grand cri. Quelque chose de froid se promenait sur ma figure et j’éprouvais une vive douleur.
– Et puis ?
– Je ne me rappelle rien de plus, après cela.
– Ah ! fit Tom.
– Un matin, je me suis comme éveillé d’un long rêve. J’avais une chaîne rivée à la cheville et je travaillais dans une mine d’argent.
De hideux compagnons m’entouraient.
Je me mis à vous appeler, Tom.
– Ô mon Dieu ! fit le vieux serviteur en levant les yeux au ciel.
– Mes compagnons se mirent à rire.
– Ignorez-vous donc qui je suis ? m’écriai-je.
– Tu es Walter Bruce, me répondit-on.
– Vous vous trompez, répondis-je. Je me nomme lord William Pembleton.
Mes compagnons de servitude rirent de plus belle.
Et comme je m’indignais, un surveillant s’approcha et me dit :
– Est-ce que tu vas redevenir fou, par hasard ?
– Fou ! m’écriai-je.
Il me tourna le dos, et comme j’avais suspendu mon travail, je reçus le soir six coups de corde.
Pendant huit jours, je criai, je m’indignai, j’en appelai à la justice des hommes et à celle de Dieu.
Efforts inutiles !
Ceux à qui je racontais que j’étais lord, me répondaient que j’étais Walter Bruce, natif de Perth, en Écosse, et que j’avais été condamné à cinq ans de servitude pénale.
Ici, M. Bruce s’arrêta un moment, comme accablé sous le poids de ses souvenirs.
Tom pleurait toujours…
XXXVII
Journal d’un fou de Bedlam
XXIII
Enfin M. Bruce reprit :
– J’étais pourtant bien sûr de mon identité.
Les souvenirs de ma jeunesse me revenaient en foule, et tout à coup mon cœur se prit à battre et mes lèvres murmurèrent un nom :
« Miss Arma ! »
Après mille efforts, je parvins jusqu’au commandant militaire de notre colonie pénitentiaire et le suppliai de m’écouter.
Il y consentit.
Je voulus alors lui raconter que je n’étais pas Walter Bruce, mais bien lord William.
Il m’écouta froidement, sans m’interrompre.
Puis il chercha mon dossier, le lut et me répondit :
– Vous vous nommez bien Walter Bruce, vous êtes âgé de vingt ans. La cour criminelle de Perth vous a condamné à la déportation.
Tandis que vous étiez détenu dans la prison de Perth, vous avez été atteint d’une maladie étrange, et votre visage s’est défiguré à ce point qu’on a pu croire que vous étiez perdu.
En même temps, vous êtes devenu fou.
Votre folie a duré plusieurs mois.
Il a fallu vous transporter de Perth à Liverpool sur un mulet car vous étiez dans l’impossibilité de marcher.
– Embarqué sur un transport de la marine royale, votre folie a continué.
Ce n’est qu’en arrivant ici que la lèpre qui couvrait votre visage s’est détachée.
Alors, vous êtes devenu plus calme, et on a pu croire que votre folie était dissipée.
J’étais atterré en entendant ces paroles.
Cependant j’eus de tels élans de franchise, un tel accent de vérité, je lui parlai si bien de mes relations d’autrefois, je coordonnai si parfaitement mes souvenirs, que sa conviction en fut ébranlée.
– Eh bien ! me dit-il, je consens à écrire en Angleterre et à demander de nouveaux renseignements.
Pendant un an j’eus un grand espoir.
Vous deviez me chercher, Tom, je le sentais.
Il était impossible que mon frère ne se fût pas ému de ma disparition.
Tom ne répondit pas.
– Un an après, le commandant me fit appeler.
– Eh bien ! me dit-il, êtes-vous devenu plus raisonnable ?
Cette question me fit froid au cœur.
– J’ai écrit en Angleterre, me dit-il.
– Et on vous a répondu ?
– Oui.
Il me tendit alors une lettre.
Elle était signée lord Evandale Pembleton.
Et c’était bien la signature de sir Evandale, mon frère.
Il écrivait au gouverneur de la Nouvelle-Zélande :
« Monsieur le gouverneur.
« J’ai eu, en effet, un frère aîné, lord William.
« Lord William est mort à New-Pembleton, il y a aujourd’hui deux années.
« Il a succombé à la morsure d’un reptile venimeux.
« Je vous adresse son acte mortuaire dressé par le shériff du comté et signé de noms trop honorables pour qu’on puisse mettre en doute l’authenticité de ce document.
« Mon beau-père, sir Archibald M…, me donne le conseil d’adresser une plainte au lord chief-justice, afin que le misérable qui ose usurper le nom de mon malheureux frère soit châtié. »
– Eh bien ! me dit le commandant, persistez-vous encore dans vos assertions ?
Je ne répondis pas et baissai la tête.
J’avais compris.
– Ah ! fit Tom.
– Mon frère m’avait pris mon titre, ma fortune et ma fiancée.
Par quel moyen était-il arrivé à son but ?
Voilà ce que j’ignore et ignorerai probablement toujours, ajouta M. Bruce avec un soupir.
– Je le sais, moi, dit Tom.
– Tu le sais ?
– Oui.
Et Tom, essuyant ses larmes, reprit :
– Vous souvenez-vous du mendiant Nizam ?
– Le vieil Indien ?
– Oui. Ce misérable…
– Eh bien ?
– Eh bien ! Nizam a été le complice de votre frère.
– Qu’avais-je donc fait à ce malheureux ?
Tom eut un rire amer :
– Savez-vous donc quel était cet homme ? dit-il.
– Non.
– C’était sir Georges Pembleton, le misérable qui avait trahi votre noble père et déshonoré lady Eveline, votre mère.
– Ah ! fit M. Bruce pâlissant.
– Bon chien chasse de race, dit encore Tom. Sir Evandale est son digne fils.
Et alors Tom raconta à M. Bruce ce qui s’était passé et ce que nous savons déjà.
– Mais, dit M. Bruce, lorsque tu eus tué ce misérable, pourquoi n’as-tu rien dit à mon frère ?
– Je voulais vous retrouver auparavant.
– Et il a épousé miss Anna ?
– Je suis parti de New-Pembleton le jour du mariage.
Alors Tom fit le récit de la triste odyssée et de son séjour chez les nègres cannibales.
Et quand il eut fini :
– Je le vois, dit M. Bruce, quand le gouverneur de la Nouvelle-Zélande a écrit en Angleterre, tu l’avais déjà quittée.
– Oui.
M. Bruce demeura un moment silencieux.
Puis il reprit.
– À partir du jour où le gouverneur m’avait communiqué la lettre de sir Evandale, je me résignai.
Mes compagnons d’infamie continuaient à m’appeler milord par dérision. Mais moi, je ne me vantai plus d’appartenir à la haute aristocratie anglaise.
Les années passèrent.
Un beau jour, on m’apprit que j’avais subi ma peine et que j’étais libre.
– Bruce, me dit le gouverneur en me remettant un petit pécule, le fruit de mon dur labeur de cinq années, Bruce, vous avez à choisir : ou être rapatrié en Angleterre, ou rester ici, ou bien encore être conduit en Australie, où vous trouverez du travail.
J’optai pour ce dernier parti.
On m’embarqua pour Melbourne.
J’y arrivai un jour de foire.
Un fermier du nord-ouest m’engagea comme berger et m’emmena dans son habitation.
C’était le père de miss Lucy.
Les souffrances, la rude vie que j’avais menée, le contact des êtres dépravés qui m’entouraient, n’avaient pu effacer chez moi ma distinction native.
Ici, mon ami, se place un roman d’amour trop long à te raconter.
J’avais oublié miss Anna.
Je commençais à soupirer en voyant miss Lucy.
– Et vous l’aimâtes ?
– Comme elle m’aima et comme elle m’aime.
Au bout de deux ans, j’avais conquis la confiance et les bonnes grâces du fermier.
Il me prit un peu à part et me dit :
– Vous aimez ma fille et elle vous aime. Soyez donc unis. En Angleterre, un pareil mariage serait monstrueux. Mais en Australie on est indulgent. Et puis, vous m’avez raconté votre histoire, et j’y crois.
– Et c’est ainsi, acheva M. Bruce, que je suis devenu le mari de miss Lucy, que j’ai succédé à son père et que je suis heureux.
– Mais, milord, s’écria Tom, vous n’allez pas rester ici, maintenant ?
– Si, mon ami.
– Vous renonceriez à revendiquer vos droits ?
– À quoi bon ? fit celui qui s’était nommé lord William, et qui n’était plus que sir Bruce, le fermier australien.
– Mais c’est impossible !
– Je suis heureux, répéta le jeune homme.
Et comme il disait cela, sa belle jeune femme entra, tenant un de ses enfants par la main et portant l’autre suspendu à son sein.
– Regarde… dit M. Bruce à Tom ; que me manque-t-il donc ?
XXXVIII
Journal d’un fou de Bedlam
XXIV
Tom passa plusieurs mois à l’habitation, priant et suppliant chaque jour M. Bruce de se souvenir qu’il s’appelait lord William de son vrai nom.
– Revenez en Angleterre, milord, disait-il, il faut que vous repreniez votre nom et que vous entriez en maître dans le château de vos ancêtres.
Mais M. Bruce répondait :
– Non, mon ami, je suis heureux ici, et j’y resterai.
Tom se désespérait.
– Écris à ta femme de venir nous rejoindre, disait encore M. Bruce.
Mais Tom ne renonçait pas à convaincre son ancien maître.
– Il faut que vous reveniez en Angleterre, disait-il, il le faut.
Et M. Bruce lui disait encore :
– Écoute-moi bien, mon pauvre Tom.
– Parlez, maître.
– Je suppose que je suive tes conseils.
– Ah ! vous les suivrez ?
– Nous revenons en Angleterre.
– Bon.
– Et nous nous présentons à mon frère.
– Il faudra bien qu’il vous reconnaisse !
– Non seulement il s’y refusera, mais il m’accusera d’être un imposteur.
– Oh ! nous lui prouverons bien…
– Que veux-tu que je lui prouve ? J’ai maintenant un état civil.
Je suis Walter Bruce, un convict libéré, et pas autre chose.
– Ah ! disait encore Tom, qui ne voulait pas se rendre à ce raisonnement, si sir Evandale refuse de vous reconnaître, il y a quelqu’un qui vous reconnaîtra sûrement.
– Qui donc ?
– Miss Anna.
Un nuage passait alors sur le front de lord William.
Et il disait encore :
– Non. Je n’aime plus miss Anna, du reste, j’aime ma femme.
Tom paraissait vaincu et ne disait plus rien.
Mais le lendemain il revenait à la charge.
Enfin, un événement, inattendu lui donna la victoire.
En Australie, les fortunes se font rapidement.
Elles sont quelquefois détruites plus rapidement encore.
Le vieux monde a créé là un peuple tout neuf.
Un peuple d’aventuriers, de criminels repentis et ayant subi leur châtiment.
On y a hâte de faire son chemin, et l’activité humaine y est sans limites.
Galérien de bord, convict ensuite, puis libéré, l’homme travaille aux mines et y fait sa fortune très vite ; ou bien il se fait berger, et pour peu qu’il soit actif et intelligent, il a bientôt franchi la ligne de démarcation qui sépare l’ouvrier du patron, le pâtre gagé du fermier propriétaire de troupeaux.
La fortune de ce dernier est excessivement incertaine et soumise à des bouleversements subits.
La veille, le fermier s’est couché riche. Il a cent mille moutons qui broutent les herbes salées, dix-huit lieues carrées de pays qu’il a choisies pour domaine, car l’Angleterre concède la possession du sol à quiconque a su le conquérir.
Le lendemain, il s’éveille ruiné.
Comment s’est accompli ce phénomène ?
L’Australie est infestée de nègres fugitifs qui ont quitté les colonies, où ils étaient esclaves, pour venir vivre de vol, de brigandage et d’incendie dans cette île grande comme un continent.
L’autorité a même créé contre eux une légion de nègres soumis, qu’on appelle la gendarmerie noire.
Cette troupe, quoique très redoutée et rendant de grands services, est néanmoins impuissante à protéger les colons de l’intérieur.
Les nègres marrons, comme on appelle les insoumis, se contentent ordinairement de voler quelques bestiaux.
Mais s’ils croient avoir à se plaindre gravement d’un fermier, alors ils organisent contre lui une véritable expédition.
Une nuit l’habitation est cernée.
Elle a pourtant de hautes murailles le long desquelles règne un fossé profond.
Elle est défendue par cent cinquante serviteurs, tous dévoués à celui qui est devenu leur maître.
Un troupeau de chiens énormes à demi sauvages fait bonne garde dans les cours et aux portes des étables.
Mais les nègres arrivent par centaines.
Quelquefois même par milliers.
Et si l’habitation est éloignée de toute autre, si de prompts secours n’arrivent pas, le fermier est perdu.
Il est vrai que les nègres lui laisseront quelquefois la vie sauve, mais ils mettront le feu à la maison, à ses bâtiments, couperont les arbres, empoisonneront les fontaines, tueront le bétail qu’ils ne pourront pas emporter.
Alors tout sera à recommencer.
La terre, en Australie, n’a de valeur que par les bras qui la cultivent et les troupeaux qui broutent son herbe salée.
Les serviteurs disparus, les troupeaux dispersés, le fermier n’est plus qu’un pauvre diable.
Un pareil malheur devait arriver à Walter Bruce.
Il avait pourtant toujours vécu avec les nègres en assez bonne intelligence.
Quand ils rôdaient autour de son habitation, il leur envoyait du pain, de la viande et de l’eau-de-vie.
Et les nègres respectaient ses troupeaux et l’appelaient même le bon blanc.
Mais un roman d’amour vint gâter toutes ces bonnes dispositions.
Il arriva que le chef d’une bande redoutable de ces bandits, nommé Kukuren, devint amoureux d’une jeune mulâtresse qui était servante à l’habitation.
Il l’aima et osa même venir la demander en mariage à M. Bruce.
Celui-ci lui répondit :
– Adresse-toi à elle. Si elle veut te suivre, je ne m’y opposerai pas.
Le chef fut repoussé.
La mulâtresse avait horreur des nègres marrons.
Il jura de se venger.
Quelques jours après, par une nuit sombre, il pénétra en escaladant les murailles dans l’habitation, arriva jusqu’à la chambre de sa bien-aimée et l’enleva.
Mais la mulâtresse jeta des cris.
Un des bergers du fermier s’arma d’un fusil, se mit à une fenêtre, vit un nègre qui s’enfuyait, l’ajusta et fit feu.
Le nègre tomba, mortellement atteint.
Et comme le nègre c’était Kukuren, un chef puissant, M. Bruce comprit qu’il était perdu.
En effet, dès la nuit suivante, l’habitation fut assiégée par une nuée de ces misérables que les fermiers australiens ont surnommé les démons noirs.
Ce fut un siège, et une bataille.
M. Bruce se défendit vaillamment.
Mais ses serviteurs tombèrent un à un sous les flèches empoisonnées des nègres.
En même temps ceux-ci mirent le feu à l’habitation.
Barricadé avec sa femme, ses enfants et une poignée de serviteurs, M. Bruce se défendait encore, lorsque enfin la gendarmerie noire arriva.
Les nègres prirent la fuite.
M. Bruce eut la vie sauve.
Mais il était désormais ruiné.
Tom avait conservé cette fameuse ceinture que les cannibales n’avaient pas songé à lui enlever.
Tom avait encore sept ou huit cents livres.
C’était plus qu’il n’en fallait pour revenir en Europe.
Et Tom, regardant son maître, lui dit avec un accent de triomphe :
– Ah ! il faudra bien, maintenant, que vous consentiez à redevenir lord Pembleton !
– Hélas ! répondit M. Bruce, si j’étais seul, je resterais ici, et j’essayerais de reconstituer ma fortune ; mais j’ai une femme et des enfants, et la misère m’effraye pour eux.
– Enfin ! s’écria Tom.
* *
*
Un mois après, Walter Bruce, sa femme, ses deux enfants et Tom s’embarquaient à Melbourne, sur un navire qui faisait voile pour l’Angleterre.
Huit jours auparavant, Tom avait écrit à Betzy :
– Nous arrivons enfin. Dans six mois, lord William sera à Londres !
Et Tom quitta l’Australie le cœur plein d’espoir, tandis que Walter Bruce versait des larmes et songeait à cette habitation perdue dans le désert des prairies, sous le toit de laquelle il avait vécu heureux si longtemps.
XXXIX
Journal d’un fou de Bedlam
XXV
Retournons à Londres, maintenant.
Nous sommes en plein été.
C’est-à-dire pendant la saison.
Londres, si brumeux en hiver, a ses jours d’été pleins de soleil et d’air pur.
Alors la coupole de ses édifices resplendit de mille rayons : ses rues sont joyeuses, ses parcs et ses squares sont remplis d’une foule qui paraît heureuse de vivre.
Hyde-Park surtout est superbe en ces moments-là.
Les équipages, les cavaliers, les piétons se croisent dans tous les sens.
Bien après le coucher du soleil, Hyde-Park est encore rempli par la foule.
Tendres fiancés roucoulant tout bas la romance éternelle du premier amour, enfants bruyants jouant aux bords de la Serpentine, vieillards rajeunis par le soleil et femmes vaporeuses rêvant du ciel d’Italie et des lointains bleus que baigne la Méditerranée.
Tout cela va et vient, circule, aspire à pleins poumons la brise du soir qui succède à une chaleur brûlante. Tout cela paraît heureux.
Il est huit heures du soir ; un dernier rayon du jour glisse encore sur le feuillage sombre des grands arbres.
Une jeune femme, tenant un enfant par la main et suivie de deux grands laquais, se promène au bord de la rivière.
C’est celle qui se nommait jadis miss Anna et qui a nom aujourd’hui lady Evandale Pembleton.
L’enfant qu’elle mène par la main est son fils.
Depuis quelques minutes cependant, lady Pembleton paraît inquiète.
Elle a remarqué qu’un homme la suivait à distance.
Quel est cet homme ?
Elle l’ignore.
Ou du moins elle n’a pu le voir d’assez près.
Cependant, sa mise et sa tournure sont celles d’un gentleman.
En outre, il a les cheveux tout blancs.
Mais son obstination à suivre la jeune femme a fini par effrayer celle-ci.
Tout à coup le gentleman paraît prendre son parti.
Et, devançant les deux laquais, il s’approche de lady Pembleton, le chapeau à la main.
Lady Pembleton a, tout d’abord, un geste d’effroi.
Mais le gentleman lui dit :
– Milady, ne me reconnaissez-vous pas ?
Et lady Pembleton jette un cri.
– Tom ! dit-elle.
– Oui, milady.
– Tom ! le serviteur fidèle du pauvre lord William.
– Lui-même, milady.
– Je vous croyais mort.
– Vous le voyez, milady, je suis vivant, bien vivant, dit Tom.
Lady Pembleton le regarda avec une sorte de stupeur.
Tom reprend :
– Milady, j’arrive d’Australie.
– Ah ! vraiment ? dit-elle.
– Et j’arrive tout exprès pour vous voir.
– Moi.
– Vous, milady.
– Ce n’est donc point le hasard qui nous met en présence ?
– Non, milady ; il y a huit jours déjà que je rôde aux environs de votre hôtel.
– Pourquoi n’être point entré ?
– Parce que je voulais vous voir seul à seul, milady.
– Ah !
Et lady Pembleton redevient inquiète.
– Milady, reprend Tom, nul ne doit entendre ce que je veux vous dire.
– Votre ton mystérieux m’effraye, Tom.
– Il faut absolument que je cause avec vous quelques minutes, milady.
– Eh bien ! marchez à côté de moi, Tom, et parlez. Nous sommes presque seuls en ce moment et personne ne nous entendra.
– Milady, j’ai un secret à vous confier.
– Un secret !
– Un secret qui vous eût comblé de joie il y a quelques années.
– Ah !
– Et qui, maintenant, va remplir votre cœur d’une douloureuse tristesse.
– Vous m’effrayez, Tom.
– Milady, poursuit Tom, je vous l’ai dit, j’arrive d’Australie.
– Eh bien ?
– J’ai rencontré là-bas un homme qui se souvenait de vous, qui songeait à vous bien souvent.
– Qui donc peut songer à moi en Australie ? demanda lady Pembleton impassible.
– Il se nomme Walter Bruce.
– Ce nom m’est inconnu, Tom.
– Soit, milady ; mais avant de porter ce nom, il en avait un autre.
– Lequel ?
– Il se nommait lord William Pembleton.
Lady Pembleton jette un cri.
Puis elle regarde Tom avec stupeur !
– Êtes-vous fou ? dit-elle.
– Non, milady, je ne suis pas fou.
– Vous savez pourtant bien que lord William est mort ?
– Je l’ai cru comme vous, milady.
– Et moi je l’ai vu mort, Tom.
– Ce n’est pas lord William que vous avez vu mort, milady.
– Ah !
– C’était un galérien nommé Walter Bruce.
– Ah ! mon pauvre Tom, dit alors lady Pembleton, je vois bien que le chagrin que vous avez éprouvé de la mort de votre pauvre maître a dérangé votre cerveau.
– Non, milady, je n’ai pas le cerveau dérangé ; non, milady, je ne suis point fou.
– Cependant…
– Et je vous supplie de m’écouter…
Lady Pembleton réprime un geste d’impatience.
Puis elle regarde autour d’elle.
Ils sont seuls.
Les deux laquais, voyant la noble dame causer familièrement avec le gentleman, se tiennent respectueusement à distance.
– Soit, dit-elle enfin, parlez.
– Milady, je vous le répète, lord William n’est pas mort.
Lady Pembleton ne répond pas.
– Oh ! reprend Tom, vous me croirez quand vous saurez tout.
Et Tom raconte à lady Pembleton tout ce qu’il sait, tout ce qu’il a vu, tout ce qu’il a fait.
Lady Pembleton, cependant, paraît incrédule.
– Ah ! dit alors Tom avec un accent de triomphe, quand vous l’aurez vu, il faudra bien que vous le reconnaissiez.
– Quand je l’aurai vu ?
– Oui.
– Mais il n’est donc pas en Australie ?
– Il est à Londres.
Lady Pembleton devient toute pâle.
– À Londres ! il est à Londres, cet homme ?
– Cet homme que vous aimiez, que vous avez pleuré !
– Et je le verrai ?
– Vous le verrez.
Et comme Tom parle ainsi, ils se trouvent tous deux à un détour de la rivière.
Un banc est adossé à un saule.
Sur ce banc est un homme, jeune encore, quoique son visage porte les traces de longues souffrances.
Et voyant approcher lady Pembleton, cet homme se lève.
– Miss Anna, dit-il.
Lady Pembleton tressaille.
– Le voilà, dit Tom.
Lady Pembleton contemple froidement Walter Bruce.
Puis, se tournant vers Tom :
– Mon pauvre ami, dit-elle, cet homme ressemble vaguement à lord William, en effet, mais ce n’est pas lui. Lord William est mort.
Walter Bruce jette un cri et s’enfuit.
Et Tom l’entend s’écrier :
– Pourquoi donc suis-je vivant ? Je savais bien qu’elle ne me reconnaîtrait pas !
XL
Journal d’un fou de Bedlam
XXVI
Dans la cité, auprès de Saint-Paul, il y a une rue qu’on nomme Pater-Noster street.
C’est la rue des libraires.
Mais les libraires n’en forment pas uniquement la population.
Il y a un peu de tout : des ouvriers et des négociants, des petits rentiers et de pauvres employés.
Et je trouve dans Pater-Noster, au n° 17, un solicitor.
Le solicitor, à Londres, est un avoué-avocat.
Il étudie les causes et il les plaide ensuite.
Le solicitor gagne beaucoup d’argent.
D’abord il se fait payer cher, – ensuite il éternise les procès.
Le client entré riche chez lui, en sort ruiné le plus souvent.
Seulement, il a fini par gagner son procès.
Il y avait donc à Londres, dans Pater-Noster, au n° 17, un solicitor.
Ce solicitor avait nom M. Simouns.
La basoche anglaise lui rendait hommage.
C’était un homme d’un grand talent.
Chacune de ses paroles valait une guinée au bas mot, et pour un solicitor, il était vraiment expéditif.
M. Simouns était un homme jeune encore.
Grand, légèrement obèse, les cheveux rares sur les tempes, absents sur le crâne, le visage encadré par de beaux favoris châtains, les lèvres minces, l’œil d’un bleu pâle, le teint rosé, le menton creusé d’une fossette.
Tel était M. Simouns.
Il avait de la bonhomie et de la majesté tout à la fois.
Un bourg l’avait porté à la Chambre des communes, mais M. Simouns avait décliné cet honneur.
– Je n’ai pas assez de fortune encore, avait-il dit, pour consacrer mon temps aux affaires publiques.
M. Simouns vous menait quelquefois une affaire très rondement. Les échos de la cour de Drury-Lane retentissaient encore des sons harmonieux de son éloquence à la fois pathétique et violente.
M. Simouns avait défendu un Irlandais compromis dans les derniers événements du fénianisme, et il l’avait fait acquitter.
Ce qui avait surtout ému et charmé le peuple de Londres, c’est que l’Irlandais n’avait pas dix pence dans sa poche et que M. Simouns avait plaidé pour rien.
Il est vrai qu’en bon Anglais qu’il était, M. Simouns savait ce que vaut la réclame.
Or donc, un matin, M. Simouns arriva dans Pater-Noster.
À Londres, tout homme d’affaires ou de loi qui se respecte, a ses bureaux, son étude, son cabinet dans une rue populeuse et commerçante, mais il demeure à la campagne.
Il habite, à deux ou trois lieues du centre, quelque jolie maison avec un jardin donnant lui-même sur un square.
M. Simouns arrivait dans Pater-Noster à onze heures et retournait chez lui pour dîner.
Donc, M. Simouns descendit de son cab, et il allait pénétrer dans une petite allée assez noire, assez humide, qui donnait accès dans sa maison, lorsqu’un homme, qui paraissait l’attendre depuis longtemps déjà fit un pas vers lui, ôta son chapeau et dit poliment :
– Pardon, monsieur Simouns.
L’homme était proprement vêtu.
M. Simouns le regarda.
Et son regard semblait dire :
– Il me semble que j’ai déjà vu ce gaillard-là. Mais où ?
– Vous ne me reconnaissez pas, je le vois, monsieur Simouns, dit cet homme.
– En effet… cependant… Il me semble…
– Il y a près de dix ans que nous ne nous sommes vus.
– Oh ! alors…
L’inconnu poursuivit :
– J’étais déjà un client de votre cabinet, quand vous n’en étiez encore que le maître clerc.
– En vérité ! fit M. Simouns.
– J’étais chez lord Pembleton et je me nomme Tom ; c’est moi qui venais vous apporter les affaires de mon noble maître.
– Ah ! fort bien, dit M. Simouns, je me souviens maintenant. Oui, oui, je vous reconnais.
– Monsieur Simouns, je désirerais vous entretenir un moment d’une affaire excessivement importante.
– Montez dans mon cabinet, en ce cas.
Et M. Simouns précéda Tom, qui le suivit.
Tom ne souffla pas mot jusqu’au moment où il fut installé dans le cabinet particulier du solicitor.
– Êtes-vous toujours au service de la noble famille Pembleton ? demanda alors M. Simouns.
– Oui et non, répondit Tom.
M. Simouns le regarda.
– J’ai quitté le service de sir Evandale, poursuivit Tom, mais je suis toujours le serviteur de lord William.
Comme il était notoire pour tout le Royaume-Uni que lord William était mort et que sir Evandale avait succédé à son frère, M. Simouns regarda Tom et se demanda s’il n’avait pas affaire à un fou.
Mais Tom parlait avec conviction, et il n’y avait aucun indice de folie ni dans son regard, ni dans son attitude, ni dans l’accent de sa voix.
– Pardon, fit M. Simouns, il faut vous expliquer plus clairement, mon ami.
– C’est ce que je vais faire, si vous voulez bien m’écouter.
– Parlez !
Le solicitor est un homme patient par nature et par état. Esprit pratique avant tout, il sait que, dans le récit le plus désordonné, le plus embrouillé d’un client, il y a toujours un côté qui peut être utile à la défense, et que les meilleures causes ne sont pas celles qui semblent les plus claires.
– Monsieur Simouns, dit alors Tom, M. Goldery, votre estimable prédécesseur, était fort dévoué à lord Evandale Pembleton, le père de lord William. C’était un très honnête homme, M. Goldery.
– Et je me vante d’être aussi honnête que lui, dit M. Simouns avec calme.
– C’est parce que j’en suis persuadé, poursuivit Tom, que je suis venu vous voir.
– Je vous écoute, parlez, répéta M. Simouns.
Un homme de loi est une manière de confesseur ; on doit lui tout dire, et il doit tout entendre.
Tom ne passa rien sous silence.
Il raconta l’histoire de sir George Pembleton, le crime abominable dont il s’était rendu coupable.
Ce crime, on le sait, avait eu pour conséquence la naissance de sir Evandale.
Tom raconta donc tout ce qui s’était passé : les alarmes de lady Eveline, l’enfance de lord William et de son frère sir Evandale, enfin le drame mystérieux et terrible qui s’était accompli à New-Pembleton, et qui avait eu pour résultat la substitution du galérien Walter Bruce mort à lord William vivant.
Puis, quand il eut fini, il regarda M. Simouns.
Celui-ci lui dit :
– Tout ce que vous venez de me raconter est vrai sans doute, mais excessivement invraisemblable. Maintenant, admettons que je le tienne pour vrai, en quoi puis-je vous servir ?
– Vous pouvez soutenir les prétentions de lord William.
– Quelles prétentions ?
Et M. Simouns eut un sourire qui fit frissonner Tom.
– Mais, dit le pauvre homme, c’est bien simple pourtant. Lord William, n’étant pas mort, entend rentrer dans la possession de son nom, de ses titres et de son immense fortune.
– Voilà qui est impossible.
– Et pourquoi cela ?
– Parce qu’aux yeux de la loi lord William est mort et que son acte de décès est en règle.
– Mais en prouvant la substitution… ?
– Comment le pouvez-vous ?
– En racontant ce qui s’est passé.
M. Simouns haussa les épaules.
– On ne vous croira pas.
– Cependant…
– Un seul homme pourrait offrir un témoignage de quelque valeur dans cette affaire, poursuivit M. Simouns.
– Quel est cet homme ?
– C’est le lieutenant de chiourme qui s’est rendu le complice de sir George Pembleton.
– Oh ! dit Tom, je le trouverai, cet homme.
– Mais ce témoignage, il ne le donnera pas.
– Il faudra bien qu’il parle !
M. Simouns haussa les épaules.
Puis, après un moment de réflexion, il ajouta :
– Avant tout, il faut être pratique. À votre tour, écoutez-moi, monsieur Tom.
– Parlez, dit Tom, qui semblait plein de foi dans la justice de sa cause.
XLI
Journal d’un fou de Bedlam
XXVII
M. Simouns reprit donc :
– Celui que vous appelez votre maître et qui peut bien, après tout, être réellement lord William, a été convict, me dites-vous ?
– Oui, monsieur, répondit Tom.
– Il y a près de dix années, selon vous, qu’il aurait quitté l’Angleterre ?
– À peu près.
– Par conséquent, il est méconnaissable pour quiconque n’a pas intérêt à le reconnaître ?
– Hélas !
– Donc votre maître se présentera à lord Evandale et lord Evandale haussera les épaules. Il sera reçu de la même manière, sans doute, par la femme du lord.
– S’il faut tout vous dire, monsieur, fit Tom vivement, mon maître a déjà vu lady Pembleton.
– Ah !
– Et elle ne l’a pas reconnu.
– Raison de plus, poursuivit M. Simouns, pour que vous acceptiez mes propositions.
– Parlez, monsieur.
– Il m’est facile de deviner que votre maître et vous revenez d’Australie presque sans ressources.
Tom ne répondit pas.
– Lord Evandale est fabuleusement riche. On l’amènerait, j’en suis certain, à une transaction.
– De quelle transaction voulez-vous parler ? fit Tom avec vivacité.
– D’une transaction comme celle-ci, par exemple, répliqua M. Simouns.
Lord William consentirait à conserver le nom de Walter Bruce, à retourner en Australie…
– Mais…
– Et lord Evandale lui donnerait trente, quarante, cinquante mille livres.
– Vous êtes fou, monsieur Simouns, dit Tom froidement.
– Ah ! vous croyez ?
– Mon maître ne veut renoncer à aucun de ses droits.
– Il veut être lord ?
– Oui.
– Et rentrer dans la possession pleine et entière de sa fortune ?
– Certainement.
– C’est vous qui êtes fou, et lui encore plus fou que vous, monsieur Tom, dit le solicitor.
– Oh ! monsieur…
– Et je vais vous le prouver, poursuivit M. Simouns. Un seul homme, je vous l’ai dit, le lieutenant de chiourme Percy, pourrait rendre un témoignage digne de foi.
– Je trouverai cet homme, je vous le jure ! dit Tom.
– Mais, je vous le répète, cet homme se gardera bien d’éventer la vérité…
– Oh ! il faudra…
– Et, le fit-il, continua M. Simouns, cela ne nous avancerait pas à grand’chose.
– Pourquoi ?
– Parce que le témoignage d’un chiourme, c’est-à-dire d’un homme aussi bas placé dans l’échelle sociale, n’inspire qu’une médiocre confiance ; et, je vous le répète, ajouta M. Simouns, cet homme est le seul qui pourrait, à la rigueur, quelque chose.
– Je le retrouverai, répéta Tom.
– Maintenant, dit encore le solicitor, en supposant que vous retrouviez le lieutenant Percy et qu’il consente à parler, vous supposez, n’est-ce pas, que tout est pour le mieux ?
– Dame ?
– Vous êtes tout à fait dans l’erreur.
– Ah ! fit Tom.
– Le lord chief-justice ne se mêlera point à la chose, Lord Evandale est pair ; il siège au Parlement ; il faut, pour le poursuivre, une autorisation de la Chambre haute. La Chambre y consentira-t-elle ? Il est peu probable.
Vous n’aurez donc alors contre lord Evandale que le recours d’un procès.
Et, vous le savez, monsieur Tom, les procès coûtent cher en Angleterre. Pour mon compte, dit M. Simouns, je ne me chargerais pas d’entreprendre celui-là qu’on ne me versât un cautionnement de dix mille livres.
– Dix mille livres ! exclama Tom.
– Pour le moins.
– Deux cent cinquante mille francs de France !
– Et encore, ajouta M. Simouns, je ne rentrerais peut-être pas dans les déboursés de la procédure.
– Mais c’est épouvantable qu’il faille tant d’argent pour reprendre ce qui vous appartient ! dit Tom.
– Je ne dis pas non, mais cela est ainsi.
– Mais alors…
– Alors, croyez-moi, votre maître fera bien de se résigner.
– À quoi ?
– À une transaction.
– Jamais ! dit Tom.
– Comme vous voudrez, fit M. Simouns. Seulement prenez garde…
Tom le regarda.
– Lord Evandale, poursuivit M. Simouns, est dans une situation que je considère comme inexpugnable.
– Bon ! fit Tom.
– Si tout ce que vous m’avez dit est vrai, c’est un homme peu scrupuleux.
– Eh bien ?
– Et si vous voulez faire du scandale, il ne reculera devant rien.
– Nous sommes sur le sol de la libre Angleterre ! dit Tom avec fierté.
M. Simouns haussa les épaules.
Tom se leva et dit à M. Simouns :
– Je le vois, monsieur, je m’étais fait une illusion en comptant sur votre appui.
– Monsieur Tom, répondit le solicitor, je suis encore à votre disposition et à celle de lord William pour amener lord Evandale à une transaction.
– Nous ne voulons pas de transaction, fit Tom avec colère. Adieu, monsieur Simouns.
– Au revoir, monsieur Tom.
Et le solicitor reconduisit Tom jusqu’à la porte de son cabinet.
– Nous nous reverrons, lui dit-il.
– Je ne crois pas, monsieur.
– Et moi j’en suis sûr.
Tom partit.
Il descendit Pater-Noster, puis Sermon-Lane et arriva au bord de la Tamise.
Là il prit le penny-boat de Sprinfields, et passa de l’autre côté dans le Borough.
Puis, une fois sur la rive droite du fleuve, il prit à pied le chemin d’une rue, bien connue des lecteurs de cette histoire, Adam street.
C’était dans Adam street que demeurait Betzy, la femme de Tom.
C’était dans la même maison que Tom avait logé lord William, sa femme et ses deux enfants, à leur retour d’Australie.
Tom était désespéré.
Il n’entra point tout d’abord chez lord William. Il monta tout droit chez sa femme.
– Eh bien ? demanda-t-elle.
Tom secoua la tête.
– Ces gens de loi n’ont pas d’entrailles, dit-il.
Et il lui raconta son entretien avec M. Simouns.
– Cet homme a raison jusqu’à un certain point, lui dit Betzy ; mais j’ai un autre espoir, moi.
– Lequel ?
– Tout à l’heure, reprit Betzy d’un ton de mystère, je suis sortie pour aller au marché.
– Bon ! fit Tom.
– Et je me suis croisée avec une femme à pied, le visage couvert d’un voile épais et qui semblait chercher quelque chose.
– Et cette femme… ?
– Elle a la tournure et la démarche de miss Anna.
– De lady Pembleton ?
– Oui.
Tom tressaillit.
– Et je crois bien, ajouta Betzy, qu’elle cherche à voir lord William.
Ce disant, Betzy s’approcha de la fenêtre et regarda dans la rue.
Puis, tout à coup :
– Tiens, dit-elle, la voilà… regarde !…
Tom s’approcha vivement de la fenêtre, et à son tour il regarda dans la rue.
XLII
Journal d’un fou de Bedlam
XXVIII
Tom regarda, lui aussi, dans la rue.
En effet, on voyait une femme qui errait, les yeux levés, et semblait chercher quelque chose.
– Oui, dit-il, c’est elle, c’est bien elle !
Tout à coup cette femme traversa la rue et s’engouffra dans l’allée étroite de la maison.
Alors Tom dit à sa femme :
– Attends-moi, je vais à sa rencontre.
Et il se précipita dans l’escalier.
La femme qui montait et Tom qui descendait se rencontrèrent sur le palier du second étage.
– Milady ? dit Tom tout bas.
La femme releva son voile.
– Je vous cherchais, dit-elle.
Et elle parut toute tremblante et comme honteuse d’avoir pénétré dans ce bouge.
Milady Pembleton, car c’était elle, prit alors le bras de Tom et lui dit tout bas :
– Je suis venue à l’insu de lord Evandale.
– Ah ! fit Tom.
– Je voudrais revoir celui que vous dites être Lord William.
– Il est ici, dit Tom.
– Dans cette maison ?
– Tenez, voilà la porte du logis qu’il habite.
– Et… il est… seul ?
– Non, dit Tom, il est avec sa femme et ses enfants.
– Ses enfants-… ? sa femme ?
Elle prononça ces mots avec un accent étrange.
L’émotion qui l’agitait parut se calmer subitement.
– Je veux le voir seul à seul, dit-elle.
– Eh bien ! dit Tom, montez au-dessus chez moi. Betzy et moi nous sortirons et je vous enverrai milord.
Lady Pembleton eût voulu s’en aller peut-être en ce moment, et elle se repentait certainement de sa démarche.
Mais il était trop tard.
Tom la prit par le bras et la fit monter.
Puis il alla chercher lord William.
Lord William fut profondément ému en apprenant que lady Pembleton le venait voir.
– Elle ne m’a pas reconnu l’autre jour, disait-il, mais certes elle me reconnaîtra aujourd’hui.
Ses jambes fléchissaient sous lui quand il entra dans la chambre de Tom.
Celui-ci fit un signe à sa femme, et tous deux sortirent.
Lady Pembleton était demeurée debout, son voile baissé.
Quand Tom et Betzy furent sortis, elle le releva.
Tous deux, lord William et elle, se contemplèrent un moment en silence.
Tous deux hésitaient à parler.
Enfin lady Pembleton fit un effort suprême et dit :
– Monsieur, j’ai absolument voulu vous revoir.
– Vous me reconnaissez, milady, je le vois bien, dit lord William.
Elle ne répondit pas à cette question et dit encore :
– Nous sommes bien seuls ici, n’est-ce pas, monsieur ?
– Absolument seuls.
– Personne ne peut nous entendre ?
– Personne.
– J’ai voulu vous voir, reprit-elle, pour me mettre entièrement à votre service.
– Ah ! fit-il en tressaillant.
– Monsieur, continua lady Pembleton, j’ai vu lord William mort, et cependant vous me dites qu’il est vivant.
– C’est moi.
– Soit, dit-elle, admettons-le.
– Que voulez-vous dire, milady ?
– Je vous supplie, dit-elle humblement, de m’écouter jusqu’au bout.
– Parlez !
– Je vous ai donc cru mort, et Dieu sait si je vous ai pleuré.
En parlant ainsi, elle avait des larmes dans les yeux.
– Je vous ai pleuré, reprit-elle, et durant plusieurs mois, j’ai refusé d’entendre parler d’une autre union. Je voulais vivre et mourir fiancée à un mort. Mais mon père me tourmentait, lord Evandale m’aimait. J’ai courbé la tête ; vaincue, j’ai obéi à mon père.
– Après ? fit lord William.
– J’ai fini par aimer cet homme que je n’avais d’abord épousé que par soumission. Il m’a rendue mère, et j’étais la plus heureuse des femmes quand vous êtes tout à coup apparu dans ma vie, vous que je croyais mort. Vous me voyez à votre merci, monsieur. Je viens vous supplier de ne pas faire de scandale, de ne pas troubler la paix dont je jouis, de ne pas engager une lutte inutile, insensée.
– Mais, milady, dit sir William, votre époux m’a dépouillé.
– Nous sommes prêts tous les deux à faire des sacrifices.
– Plaît-il ? fit lord William avec hauteur.
– Il vous sera bien difficile, sinon impossible, de prouver que lord William n’est pas mort.
– Oh ! je le prouverai, dit lord William.
– Alors, à votre tour, vous dépouillerez votre frère et vous couvrirez de honte le nom de Pembleton.
– Pourquoi donc, milady, puisque vous parlez ainsi, fit lord William avec amertume, êtes-vous venue ici ?
– Pour vous proposer une transaction.
– Voyons ?
– Vous quitterez Londres, vous retournerez en Australie, vous garderez ce nom de Walter Bruce, qui est le vôtre maintenant.
– Et que me donnerez-vous en échange ? demanda lord William avec ironie.
– Autant d’or que vous voudrez.
Lord William se prit à sourire.
– Ce que vous me demandez là est impossible, dit-il.
Elle ne se déconcerta point.
– Qu’exigez-vous donc ? fit-elle.
– À votre tour, écoutez-moi, milady.
Lady Pembleton attendit.
– J’ai autant que vous le souci de l’honneur du nom de Plembleton, milady. Vous me proposez une transaction, je vous en offre une autre.
– Voyons ? dit-elle.
– Un homme dont l’identité n’a point été établie, sir George, mon oncle, connu jadis sous le nom de Nizam, a été la cause première de tous mes malheurs. Pourquoi ne serait-il point le seul coupable ?
– Je ne comprends pas, dit-elle.
– Pourquoi sir Evandale, mon frère, ne reconnaîtrait-il pas qu’il a été trompé par cet homme ?
– Et puis ?
– Et ne me reconnaîtrait-il pas, moi, pour son frère ? Nous partagerions la fortune. Il garderait le titre de lord ; mais je veux être Pembleton.
– Ce que vous demandez là est impossible, monsieur.
– Ah ! vous croyez ?
– Oui, dit lady Pembleton sourdement. Le droit d’aînesse existe en Angleterre.
Lord William eut un mouvement de colère.
– Prenez garde, milady, dit-il.
– Monsieur, répliqua lady Pembleton avec un accent glacé, vous dites être lord William ?
– Oh ! vous le savez bien.
– Il vous faudra le prouver.
– Je le prouverai, milady.
– Alors, dit-elle, ce jour-là, lord Evandale vous rendra vos titres, votre nom et votre fortune.
Et elle fit un pas vers la porte.
Lord William fit un geste pour la retenir.
Mais elle ouvrit la porte et dit :
– Si vous étiez le vrai William, celui qui m’aimait et que j’ai tant aimé, vous m’eussiez tenu un autre langage.
Adieu, monsieur, nous ne nous reverrons que devant la justice.
Et elle sortit majestueusement et la tête haute.
Lord William poussa un cri sourd.
– Et cependant, fit-il, accablé et cachant sa tête dans ses mains, elle m’a reconnu !
XLIII
Journal d’un fou de Bedlam
XXIX
Le soir même de ce jour, trois personnes tenaient conseil dans l’hôtel Pembleton.
Les trois personnes étaient lord Evandale, lady Pembleton sa femme, et sir Archibald, son beau-père.
Sir Archibald n’était plus ce gentilhomme magnifique, affectueux et courtois que nous avons connu au début de cette histoire.
Il est des hommes que la prospérité rend meilleurs, d’autres qui deviennent méchants avec le succès.
Sir Archibald était de ce nombre.
Petit gentleman d’origine, à peine esquire, il avait, comme on le sait, fait fortune aux Indes.
De retour en Angleterre, cet homme n’avait plus eu qu’un but, marier sa fille à un grand personnage.
Lord William avait été le premier but de ses intrigues.
Lord William disparu, il avait songé à lord Evandale.
Le récit que lady Pembleton avait fait à lord William était vrai de point en point.
Longtemps elle avait pleuré son fiancé, longtemps elle avait résisté.
Mais enfin il avait fallu céder.
Miss Anna était devenue lady Pembleton.
Puis elle avait aimé son mari, et la naissance de ses enfants avait fini par lui faire oublier l’infortuné lord William, que, du reste, elle croyait mort.
Trois ans après, le convict Walter Bruce était parvenu, on s’en souvient, à intéresser à son sort le gouverneur de la colonie pénitentiaire d’Aukland.
Celui-ci avait écrit en Angleterre.
Lord Evandale était alors absent de Londres, et ce fut lady Pembleton elle-même qui reçut la fameuse lettre qui lui révélait l’existence de lord William.
Ce fut pour elle un coup de foudre.
Elle se jeta dans les bras de son père.
Sir Archibald lui dit :
– Lord William est mort ; et l’homme qui fait écrire est un imposteur ; mais songez bien à ce que je vais vous dire : lord William serait-il vivant, il doit être mort pour vous.
Vous êtes lady Pembleton, et votre époux n’a pas, ne peut pas avoir de frère.
Lord Evandale, de retour à Londres, avait commencé par crier, par s’indigner.
Cependant lady Pembleton avait fini par lui arracher l’aveu de son crime.
Lord Evandale avait supprimé son frère, non par cupidité, mais par amour pour miss Anna.
Et lady Pembleton pardonna à sir Evandale, et la jeune fille aimante et naïve d’autrefois devint, sous la double influence de son père et de son mari, la froide et hautaine grande dame que nous venons de voir pénétrer furtivement dans le misérable logis de lord William.
Ce soir là donc, sir Archibald et lord Evandale, après avoir attendu lady Pembleton avec impatience, l’accablèrent de questions.
– Est-il vraiment méconnaissable ? demanda sir Archibald.
– J’eusse passé toute ma vie auprès de lui sans le reconnaître, répondit lady Pembleton.
– Et il n’accepte pas nos propositions ! fit lord Evandale.
– Il les refuse.
Sir Archibald se prit à sourire.
– Ce sera, dit-il, un procès scandaleux ; mais nous en sortirons à notre honneur.
– D’abord, reprit lord Evandale, pour soutenir un procès semblable, il faut beaucoup d’argent.
– Et non seulement il n’en a pas, dit lady Pembleton, mais il m’a même paru dans le plus profond dénûment.
– Il faut cependant prendre un parti, dit sir Archibald.
– Lequel ?
– Il faut que cet homme quitte Londres.
– Comment l’y contraindre ?
– Je ne sais pas, mais nous trouverons bien un moyen…
Comme sir Archibald disait cela, un laquais apporta une lettre sur un plateau de vermeil et le présenta à lord Evandale.
Le jeune lord prit cette lettre et lut :
LE RÉVÉREND PATTERSON
– Que peut me vouloir ce prêtre ? dit-il.
– Milord, répondit le laquais, ce personnage insiste beaucoup pour voir Votre Seigneurie.
– Faites entrer, dit lord Evandale.
Une minute après, le révérend Patterson parut.
C’était bien le même homme, calme, froid, implacable, un fanatique avec lequel l’homme gris avait soutenu une lutte sans trêve ni merci, et qui poursuivait de sa haine le clergé catholique de Londres.
Le révérend Patterson entra, salua lord Evandale, et comme sir Archibald et sa fille allaient le laisser seul avec le noble lord, il leur dit :
– Oh ! vous pouvez rester, milady, et vous, monsieur. Il est même nécessaire que vous assistiez à mon entretien avec milord.
Lord Evandale regardait le révérend Patterson avec curiosité.
– Parlez, monsieur, lui dit-il.
– Milord, reprit le révérend Patterson, je suis le chef de la Mission évangélique de la Nouvelle-Angleterre…
– Ah ! fit lord Evandale.
– Les apôtres qui vont porter la lumière de la foi aux sauvages de la Nouvelle-Calédonie et de la Nouvelle-Zélande.
– Fort bien, monsieur, dit lord Evandale.
– Mais une pareille œuvre, poursuivit le révérend Patterson, ne saurait s’accomplir sans d’immenses sacrifices ; et si riche que soit déjà l’association que je préside, elle a néanmoins besoin du concours des fidèles.
Lord Evandale se méprit.
– Je vois ce que c’est, mon révérend, dit lord Evandale, vous venez me demander ma souscription. Je suis heureux de m’inscrire pour cinq cents livres.
Un sourire vint aux lèvres du révérend Patterson.
– Cinq cents livres, dit-il, ce serait beaucoup pour un autre que vous, milord.
– Alors, inscrivez-moi pour mille.
– Oh ! milord, quand vous saurez quel est le service que je veux vous rendre…
Sir Evandale tressaillit.
– Que voulez-vous dire ! fit-il.
– Milord, reprit le révérend, je vous l’ai dit, l’œuvre que je préside a des missionnaires partout.
– Bon !
– Nous en avons à Aukland.
– Eh bien ?
– Et l’un de ceux-là est de retour en Angleterre.
– En quoi cela peut il m’intéresser ?
– En ce que ce même missionnaire a beaucoup connu un ancien convict du nom de Walter Bruce.
Lord Evandale pâlit.
Lady Pembleton et son père se regardèrent avec inquiétude.
– En vérité ! fit lord Evandale.
– Je puis même ajouter que ce Walter Bruce, libéré, est à Londres.
– Ah !
– Et qu’il prétend se nommer, de son vrai nom, lord William Pembleton.
– Cet homme est un imposteur ! s’écria lord Evandale.
– C’est tout à fait mon avis, dit froidement le révérend Patterson.
Et il regarda fixement lord Evandale, et il eut aux lèvres un sourire qu’on aurait pu traduire ainsi.
– Je sais aussi bien que vous à quoi m’en tenir là-dessus, et vous ferez bien de jouer avec moi cartes sur table.
Lord Evandale comprit ce sourire et il attendit.
Le révérend Patterson ajouta :
– Que cet homme soit ou non lord William, il peut vous occasionner de très grands embarras.
– Peuh ! fit lord Evandale.
– Et ces embarras, je veux vous les éviter, moi.
– Ah ! vraiment ?
– Si toutefois nous parvenons à nous entendre.
– Parlez, dit lord Evandale.
XLIV
Journal d’un fou de Bedlam
XXX
Que se passa-t-il entre le révérend Patterson, sir Archibald, lord et lady Evandale Pembleton ?
Nul ne le sait au juste.
Mais le lendemain de ce jour, Tom reçut un singulier billet.
Un billet sans signature ainsi conçu :
« Une personne qui ne peut se faire connaître, mais qui sait le dévouement profond qu’il a pour lord W…, prévient M. Tom que le lieutenant de chiourme Percy est retiré à Perth, en Écosse, sa ville natale.
« Percy vit misérablement de quelques guinées que lui donne annuellement le gouvernement de S. M. la reine.
« Il est devenu aveugle et vit avec sa fille qui le nourrit de par son labeur.
« Il ne faudrait pas grand argent pour le décider à parler. »
Tom porta ce billet à lord William.
Lord William fronça le sourcil.
– Mon ami, dit-il, je crains un piège. N’y va pas.
– Un piège ? fit Tom étonné.
– J’ai bien vu que miss Anna me reconnaissait, poursuivit lord William.
– Eh bien ?
– Et non seulement cette femme ne m’aime plus, mais encore elle est devenue la complice de son mari. Elle est venue ici pour m’engager à partir. J’ai résisté. Elle agit.
– Mais dans quel but me ferait-on courir à Perth, si je ne devais pas y trouver le lieutenant Percy ?
– Dans le but de nous séparer.
– Vous avez peut-être raison, dit Tom. Au lieu d’y aller, je vais écrire.
Tom connaissait du monde à Perth, entre autres un vieux gentleman qui avait fait longtemps le commerce des chevaux des îles Shetland.
Il s’en alla au télégraphe et lui transcrivit cette dépêche :
« Mon vieil ami.
« Perth est une toute petite ville, et tout le monde doit s’y connaître.
« Vous m’obligerez de me dire s’il s’y trouve un ancien lieutenant de chiourme nommé Percy.
« Réponse payée.
« TOM.
« Ancien intendant de lord Pembleton.
« 17, Adam street, Spithfields, Londres. ».
Puis Tom attendit.
Vers le soir, la réponse arriva :
« Mon cher monsieur Tom.
« Le lieutenant Percy habite Perth, mais il est assez gravement malade.
« Votre dévoué.
« JOHN MURPHY, esq. »
Tom alla montrer la dépêche à lord William.
Celui-ci lui dit :
– Si peu d’argent qu’il faille pour décider Percy à dire la vérité, il en faut néanmoins.
– Il me reste cent livres, dit Tom.
– Ce n’est point assez.
– Je partirai néanmoins, milord, j’ai des amis à Perth et je trouverai facilement de l’argent, répondit le fidèle Écossais.
Et Tom fit ses préparatifs de départ.
Mais comme il allait quitter lord William, un inconnu se présenta dans Adam street et demanda à lui parler.
Cet homme était petit, déjà vieux, rigoureusement vêtu de noir, et respirant dans toute sa personne le parfum désagréable d’un homme de loi.
Il salua Tom et lui dit :
– Monsieur, je m’appelle Edward Cokeries, et je suis bien votre serviteur.
– Je suis le vôtre, répondit Tom, mais je vous avouerai que je n’ai pas l’honneur de vous connaître.
– Je suis clerc chez M. Simouns, le solliciter de Pater-Noster street.
– Ah ! c’est différent, dit Tom.
Et il pensa que M. Simouns avait réfléchi, et peut-être trouvé le moyen de rendre à lord William son nom et sa fortune.
Edward Cokeries poursuivit :
– Je travaille dans une petite pièce attenant au cabinet de M. Simouns.
– Ah !
– Et quand la porte est entr’ouverte, j’entends tout ce qui se passe chez lui.
– Bon ! fit Tom.
– Hier matin, vous êtes venu chez M. Simouns ?
– En effet, monsieur.
– Et j’ai entendu votre conversation.
Tom eut un accès de défiance :
– Ce n’est donc pas M. Simouns qui vous envoie ? fit-il.
– Attendez, dit le clerc, laissez-moi aller jusqu’au bout, monsieur Tom.
– Soit, parlez…
– Voici vingt ans que je travaille, poursuivit Edward Cokeries, et j’ai quelques économies. Mon rêve serait d’acheter la charge de M. Simouns, qui est fort riche et veut se retirer. Mais il me manque 3.000 livres, c’est-à-dire 75.000 francs en monnaie française.
– Si vous avez compté sur moi, dit Tom en souriant tristement, vous vous êtes trompé.
– Pas autant que vous le supposez, monsieur Tom.
Le clerc avait un air si mystérieux que Tom le regarda plus attentivement.
– Je vous l’ai dit, reprit Edward Cokeries, j’ai quelques économies.
– Fort bien.
– Quelque chose comme 10 à 12.000 livres sterling, et je les mettrais volontiers à la disposition de lord William.
– En vérité ! exclama Tom.
– En outre, poursuivit le clerc, j’ai une connaissance approfondie des lois et je me fais fort de gagner le procès.
– Serait-ce possible ?
– Hier encore, j’hésitais à vous venir voir. Mais j’ai pris mon parti, et me voilà.
Tom rayonnait.
– C’est moi qui vous ai écrit…
– La lettre sans signature ?
– Oui.
– Alors, il est vrai que le lieutenant Percy est à Perth !
– Vous devez en avoir la preuve.
– En effet, on m’a répondu de Perth dans ce sens.
– Et vous partez ?
– À l’instant.
– Mais quelle somme emportez-vous ?
– Deux cents livres.
– Ce n’est point assez.
– Mais dame ! fit Tom naïvement, j’emporte tout ce que j’ai.
– Voici un chèque de mille livres, dit le clerc ; seulement, je mets à mes avances une condition.
– Parlez !
– Le procès gagné, je veux cinquante mille livres.
– Vous les aurez, dit Tom.
Et il prit le chèque.
– Monsieur, dit Edward Cokeries, allez à Perth et ramenez le lieutenant Percy, je réponds de tout.
Lord William, muet de surprise, avait assisté à cet entretien.
– Monsieur, dit Tom au clerc, puis-je vous écrire en arrivant à Perth ?
– C’est complètement inutile.
Et le clerc salua et s’en alla.
– Ah ! mon bon maître, dit Tom, vous voyez bien que l’heure du triomphe n’est pas loin !
– Qui sait ? dit lord William d’un air de doute.
Tom courut au chemin de fer et prit le train d’Édimbourg.
Il était alors huit heures du soir.
Tom se trouvait seul avec un gentleman dans son wagon.
Le gentleman avait un air honnête et franc.
Il fumait et offrit un cigare à Tom.
Tom l’accepta.
Il se mit à fumer et ne tarda pas à s’endormir d’un profond sommeil.
XLV
Journal d’un fou de Bedlam
XXXI
Le cigare que le gentleman avait offert à Tom était sans doute imprégné d’un puissant narcotique, car Tom dormit lourdement durant plusieurs heures.
Quand il revint à lui il se trouva dans une obscurité complète.
En même temps, il voulut faire un mouvement et se sentit garrotté.
On lui avait attaché les jambes et lié les mains derrière le dos.
Comme il n’entendait aucun bruit, il en conclut que le train ne marchait plus.
Mais bientôt, ses yeux commençant à se faire à l’obscurité, il reconnut qu’il n’était plus dans un train du chemin de fer dans lequel il s’était endormi.
Où donc était-il ?
Il se mit à crier.
Personne ne répondit.
Il essaya de se lever et retomba.
Il était dans un sol humide, dans quelque cachot sans doute.
Cependant, ce sol n’était point fait de terre.
Tom devina soudain une partie de la vérité.
Il était tombé dans un piège, et les gens qui l’avaient garrotté avaient eu pour but de le séparer de lord William.
Tom était un homme énergique.
Dans les moments les plus critiques de son existence, il n’avait jamais perdu complètement la tête.
Tom se mit donc à réfléchir et cessa de crier.
À force de regarder, il lui sembla qu’un rayon de clarté brillait près de lui.
C’était comme un filet de lumière passant au travers d’une fente.
Mais cette clarté s’éteignit.
En même temps, il éprouva comme une légère oscillation.
Tom se retourna sur le dos, et ses mains liées tâtèrent le sol sur lequel il se trouvait.
Il reconnut un parquet ou du moins un sol en planches.
En même temps aussi il respira une forte odeur de goudron.
Puis les oscillations furent plus fortes.
Alors Tom comprit.
Il était dans la cale d’une embarcation quelconque, canot ou navire.
Quelques minutes s’écoulèrent.
Tom entendit tout à coup marcher au-dessus de sa tête.
Et le filet de lumière reparut.
Des pas pressés se firent entendre, puis des voix, puis des oscillations se succédèrent.
Et enfin un dernier bruit lui parvint, qui ne lui laissa plus le moindre doute sur sa situation.
Ce bruit, c’était la respiration haletante d’une machine à vapeur qui se remettait en mouvement.
Et avec ce bruit le mouvement d’une hélice se fit tout à coup sentir.
Tom était à bord d’un navire à vapeur, lui qui s’était endormi dans un wagon de chemin de fer.
Où allait ce navire ?
Tom ne le savait pas.
Aux mains de qui était-il tombé ?
Il n’aurait pu le dire.
Cependant le nom de lord Evandale vint à ses lèvres.
Alors Tom se reprit à crier.
Pendant longtemps on ne lui répondit pas.
Le navire venait sans doute de lever l’ancre, et les matelots, les gens du bord, occupés à l’appareillage, n’avaient nul souci de lui.
La machine faisait un bruit d’enfer ; l’hélice précipitait ses rotations.
Tom criait toujours.
Enfin, les pas qu’il avait déjà entendus retentirent de nouveau.
Cette fois, une porte s’ouvrit et un flot de lumière frappa Tom au visage.
En même temps un homme lui apparut.
Cet homme portait un chapeau ciré et une vareuse bleue.
– C’est toi qui fais tout ce vacarme ? dit-il en regardant Tom.
– Où suis-je ? demanda celui-ci. Pourquoi suis-je lié comme un malfaiteur ?
Le matelot se mit à rire.
– Va le demander au commandant, dit-il. Moi, je n’en sais rien. Seulement, si tu cries, je te donnerai vingt cinq coups de corde. Te voilà prévenu.
Tom ne céda point à la colère qui l’oppressait.
– Mon ami, dit-il avec douceur, je ne tiens pas à recevoir des coups de corde et je me tiendrai tranquille.
– À la bonne heure ! fit le matelot se radoucissant à son tour.
– Mais, poursuivit Tom, ne pouvez-vous me dire où je suis ?
– À fond de cale.
– Sur quel navire ?
– À bord du Régent, steamer transatlantique.
– Et où allons-nous ?
– En Amérique.
– Mais enfin, dit Tom, comment suis-je ici ?
– Je n’en sais rien.
Et le matelot s’en alla.
Quelques heures après, il revint et apporta à Tom un peu de nourriture et un quart de vin.
Puis il lui délia les mains, afin que le malheureux pût manger.
Tom était en proie à un violent désespoir.
Le navire marchait à toute vapeur et fuyait les côtes anglaises.
La journée s’écoula, puis la nuit, puis une autre journée encore.
Deux fois par vingt-quatre heures le même matelot apportait à manger à Tom, lui déliait les mains ; puis, son repas terminé, il le garrottait de nouveau.
Enfin, au bout de trois jours, le matelot lui dit :
– J’ai de nouveaux ordres du commandant.
– Ah !
– Le commandant juge inutile de te laisser plus longtemps à fond de cale.
– Vraiment ?
– Il m’a donné l’ordre de te délier et de te conduire sur le pont. Il n’y a plus de danger maintenant.
– Que voulez-vous dire ? demanda Tom.
– Nous sommes à cent lieues des côtes d’Angleterre, poursuivit le matelot ; et il n’est plus à craindre que tu te sauves à la nage.
– Ah ! fit Tom.
Et il se laissa délier les pieds et les mains et se trouva libre de ses mouvements.
Le matelot le conduisit sur le pont.
Tom se dit :
– Je suis à bord d’un navire de l’État. Le commandant est un officier et ce doit être un galant homme. Je vais m’adresser à lui. Il est impossible qu’il ne m’écoute pas, qu’il ne reconnaisse pas que je suis la victime soit d’une erreur, soit d’un guet-apens.
Alors il me fera rapatrier par le premier navire que nous rencontrerons.
Et Tom attendit une occasion de se trouver en présence du commandant.
Les gens de l’équipage le considéraient avec étonnement, mais aucun ne lui parlait.
Enfin, quelques heures après, comme il était presque nuit, le commandant parut sur le pont.
Tom alla vers lui et le salua.
Mais dès les premiers mots qu’il prononça, le commandant lui dit sèchement :
– Je n’ai pas d’explications à vous donner. J’ai reçu des ordres vous concernant, je les exécute.
Et il lui tourna le dos.
Tom voulut alors s’adresser au second.
Il fut plus mal reçu encore.
Le second lui dit durement :
– Si vous vous plaignez, je vous ferai mettre aux fers.
Alors Tom se dit :
– Je vois bien que je ne puis compter que sur moi.
Et avec ce flegme imperturbable qui caractérise les Anglais, il attendit une occasion de recouvrer sa liberté.
Cette occasion se fit attendre plusieurs jours ; mais, enfin, elle se présenta, comme on va le voir, et Tom avait eu raison de ne pas désespérer.
XLVI
Journal d’un fou de Bedlam
XXXII
Le Régent, grand steamer transatlantique, faisait route pour Buenos-Ayres.
Le quinzième jour de la traversée, il se trouva par le travers du pic de Ténériffe.
Le soleil s’était couché dans une auréole de pourpre, le ciel était d’un bleu sombre.
Cependant quelques nuages grisâtres couraient à l’horizon, vers le sud-ouest, et le vent avait fraîchi tout à coup.
Le commandant, qui était un vieux marin, après avoir successivement braqué sa lunette sur les quatre points cardinaux, avait quelque peu froncé le sourcil.
Mais il n’avait pas dit un mot.
Tom, qui avait paru se résigner à son sort mystérieux, jouissait maintenant à bord de toute sa liberté.
Il était libre de rester sur le pont, et on lui permettait de causer avec les matelots.
Tom ne demandait plus à quitter le navire et à être rapatrié.
Mais il observait tout ce qui se passait et explorait sans cesse l’horizon du regard, espérant toujours y voir poindre une voile.
L’attitude soucieuse du commandant ne lui échappa point ce jour-là.
Toute la journée, il avait examiné le pic qui se dressait majestueux à l’horizon.
Comme la nuit approchait, le commandant donna l’ordre de stopper.
Tom eut un frisson de joie.
Le vent faiblissait de plus en plus, la mer se soulevait, les nuages se couronnaient d’écume ; les petits nuages grossissaient peu à peu.
– Nous allons avoir un fameux grain, murmuraient les matelots.
La nuit vint.
Avec la nuit la tempête.
Une tempête terrible, épouvantable.
Le steamer se mit à danser au sommet des vagues comme une coquille de noix.
En même temps, l’obscurité augmentait.
Mais Tom savait que le pic de Ténériffe n’était pas à plus de deux lieues.
Enfin, comme la tempête était dans toute son horreur, comme l’équipage du steamer obéissait comme un seul homme à la voix tonnante du commandant, tandis que les mâts craquaient sous l’effort du vent, un cri se fit entendre :
« Un homme à la mer ! »
Cet homme était-il tombé à l’eau par accident, avait-il été enlevé par une lame, ou bien s’était-il volontairement précipité dans les flots ?
Personne en ce moment n’aurait pu le dire.
Quel était cet homme ?
Était-ce un matelot ou un passager ?
On ne chercha pas même à le savoir.
Ce ne fut qu’au matin, quand le jour vint, que la tempête se fut apaisée et que le commandant du steamer put constater les avaries de la nuit, qu’on vint lui dire que l’homme tombé à la mer était Tom.
Le commandant haussa les épaules.
Le pauvre diable a voulu se sauver, pensa-t-il ; mais nous étions trop loin de terre. Il se sera noyé.
Et l’officier écrivit sur son livre de bord :
« Cette nuit, le nommé Tom, que je transportais en Amérique, par ordre et pour le compte de la Mission évangélique, dont le siège est à Londres, a été enlevé par une lame et s’est noyé. »
Puis le steamer continua sa route.
Le commandant se trompait. Tom ne s’était point noyé. Tom était un vigoureux nageur.
Tantôt au sommet des vagues tantôt plongé dans des abîmes incommensurables, Tom avait nagé sans relâche. Puis il avait rencontré une épave.
L’épave avait été son salut.
C’était une planche de deux pieds de large sur quatre de long.
Accroché à cette planche, Tom avait nagé encore, nagé toujours, jusqu’à ce que, épuisé, il eût atteint les derniers contreforts du pic.
Le gentleman qui lui avait offert un cigare en wagon, au départ de Londres, les gens qui s’étaient emparés de lui endormi et l’avaient transporté à bord du Régent avaient omis un détail.
Ils lui avaient laissé cette vieille ceinture de cuir dans laquelle le vieil Écossais renfermait son argent, cette même ceinture qui n’avait pas tenté davantage, autrefois, les sauvages de l’Océanie.
Tom avait donc de l’argent.
Le soleil le trouva évanoui au bord de la mer à une faible distance du petit bourg de Laguna.
Un pêcheur qui venait visiter ses filets avariés par la tempête lui prodigua ses soins et le rappela à la vie.
Tom, revenu à lui, raconta qu’il avait été enlevé par une lame du pont du steamer le Régent.
Le pêcheur le conduisit à Laguna.
Comme Santa-Cruz, la capitale de l’île, Laguna possède beaucoup d’Anglais.
Tom se fit conduire chez le consul et demanda à être rapatrié.
Il lui fallut attendre pour cela qu’un navire vint à passer.
Enfin, au bout de huit jours, un trois-mâts norvégien relâcha à Santa-Cruz.
Tom s’embarqua, non pour l’Angleterre, mais pour l’Écosse.
Il mit près d’un mois à faire la traversée.
Mais il avait écrit de Ténériffe deux lettres, l’une à sa femme Betzy, l’autre à lord William.
Il leur racontait dans quel piège il était tombé, les engageait à quitter Adam street, à se cacher dans Londres, et à ne rien faire avant qu’il fût de retour.
En même temps il les priait de lui répondre à Barth, poste restante.
Et, dans sa mésaventure, Tom n’avait deviné qu’une partie de la vérité.
Il était convaincu que le clerc Edward Cokeries était de bonne foi, et que le gentleman qui lui avait écrit de Perth pour lui confirmer l’existence du lieutenant Percy était bien sir John Murphy, qu’il avait connu autrefois.
Son enlèvement, il l’attribuait à lord Evandale.
Tom mit donc le pied sur la terre d’Écosse et ne s’arrêta qu’à Perth.
Il courut, en arrivant, à la poste, où il espérait trouver des lettres de lord William ou de Betzy.
Ni l’un ni l’autre ne lui avaient écrit.
Alors, il se rendit au domicile du vieux gentleman.
Mais là, à son grand étonnement, il apprit que le gentleman avait quitté Perth depuis de longues années.
Ce n’était donc pas lui qui lui avait écrit.
Tom ne se découragea point.
Il se mit à la recherche du lieutenant Percy.
Mais nulle part, à Perth, on n’avait entendu parler de cet homme.
On ne l’y avait jamais vu.
Personne ne le connaissait.
Alors, Tom se souvint des répugnances de lord William lorsqu’il lui avait montré le billet sans signature qui lui révélait l’existence du lieutenant Percy à Perth.
Le pauvre vieux serviteur reprit donc la route de Londres.
En arrivant, il courut dans Adam street.
Mais là, une nouvelle surprise, plus navrante encore que les autres, l’attendait.
Lord William et sa famille avaient disparu depuis un mois.
Betzy était partie avec eux.
Où étaient-ils allés ?
Nul ne pouvait le lui dire.
Tom calcula le temps écoulé.
Il y avait près de trois mois qu’il avait quitté Londres.
Mais Tom, on le sait, ne se décourageait jamais complètement.
– Il faudra que je les retrouve ! se dit-il.
Et il se mit à l’œuvre.
XLVII
Journal d’un fou de Bedlam
XXXIII
Tom était arrivé à Londres le soir.
À cette heure, les bureaux de banque et de commerce étaient fermés. Les études de gens de loi aussi.
Tom fut obligé d’attendre au lendemain.
Le lendemain, dès neuf heures, il était chez M. Simouns.
Le solicitor ouvrit de grands yeux en l’écoutant.
– Je n’ai jamais eu de clerc du nom d’Edward Cokeries, lui dit-il.
Quant à votre femme, quant à lord William, je n’en ai pas même entendu parler.
Tout ce que vous me racontez, du reste, est moins extraordinaire que vous ne pensez.
Et comme, à ces paroles, Tom stupéfait le regardait, M. Simouns ajouta :
– Vous auriez dû suivre mon conseil. Nous fussions arrivés à une transaction avec lord Evandale.
– Mais, dit Tom, le misérable a peut-être fait assassiner son frère.
– Ce n’est pas probable.
– Pourtant…
– Lord William, sa femme et ses enfants ont disparu, me dites-vous ?
– Oui, répondit Tom.
– Et votre femme aussi ?
– Oui.
– Eh bien ! on n’assassine pas cinq personnes.
– Que sont-elles devenues, alors ?
M. Simouns eut pitié du désespoir de Tom.
– Écoutez, lui dit-il, j’ai pour habitude de ne me mêler que des choses de ma profession ; cependant, il y a un tel accent de vérité dans vos paroles, je suis si convaincu maintenant que lord William est bien vivant, que je veux prendre votre cause et la sienne en main.
Je ne m’expliquerai pas davantage ; mais revenez ce soir, et nous verrons…
Tom passa le reste de journée à errer dans Londres, cherchant toujours, mais inutilement.
Chercher dans Londres un homme disparu, c’est revenir au vieux proverbe qui dit que c’est peine inutile que de chercher une aiguille dans une botte de foin.
Le soir, à six heures, Tom revint dans Pater-Noster.
Les clercs étaient partis.
Mais M. Simouns attendait Tom.
– Vous n’avez rien trouvé ? lui dit-il.
– Hélas ! non, répondit Tom.
– Je suis plus heureux que vous, moi.
Tom poussa un cri de joie.
– Oh ! dit M. Simouns, ne vous réjouissez pas si site, mon pauvre Tom.
– Ils sont… morts ?…
– Non, mais ils ont été victimes d’une machination infernale. Savez-vous où est lord William ?
– Parlez, dit Tom anxieux.
– Il est à Bedlam.
Tom jeta un cri.
M. Simouns reprit :
– Il y a à Londres un détective fort habile qu’on appelle Rogers.
J’emploie quelquefois cet homme, et j’étais bien sûr qu’en m’adressant à lui je saurais ce que lord William, sa famille et votre femme étaient devenus.
J’ai donc fait venir Rogers ce matin, après votre départ.
Rogers m’a dit :
– L’affaire dont vous me parlez m’a passé par les mains. Je n’ai pas voulu m’en charger, mais je puis vous dire tout ce qui s’est passé.
Et voici ce que Rogers m’a raconté, poursuivit M. Simouns le solicitor.
Le lendemain de votre départ de Londres, lord William a reçu de vous un télégramme.
– De moi ? exclama Tom.
– Un faux télégramme, bien entendu.
– Ah !
– Vous écriviez à lord William : « Trouvé Percy. Cokeries ira vous voir, faites ce qu’il vous dira. »
Le même jour, Cokeries s’est présenté.
Il a fait rédiger à lord William un long mémoire fort diffus et muni çà et là d’une phrase incohérente, sous prétexte de formules judiciaires.
Puis, il l’a engagé à porter lui-même ce mémoire au parquet du lord chief-justice.
Deux jours après, lord William a reçu une lettre de vous.
– Mais je n’ai pas pu écrire ! s’écria Tom.
– Vous n’avez pas écrit, mais on a imité votre écriture à s’y méprendre.
– Et que me faisait-on dire dans cette lettre ?
– Vous annonciez que Percy, déjà aveugle, était malade, et que vous demeuriez auprès de lui jusqu’à ce qu’il fût rétabli.
– Après ? fit Tom.
– Huit jours après, lord William a reçu l’invitation de se rendre, sous le nom de Walter Bruce, bien entendu, au parquet du lord chief-justice.
Il est parti tout joyeux.
Le soir, il n’est pas revenu.
Et, comme sa femme et la vôtre commençaient à se montrer inquiètes, une lettre est arrivée.
Elle portait la signature de lord William.
Mais, comme pour vous, on avait imité son écriture à ce point que sa femme s’y est trompée.
Lord William écrivait que le lord chief-justice n’avait pas hésité une minute à admettre son identité à lui lord William, et qu’il avait mandé à sa barre lord Evandale.
Que, ce dernier s’étant présenté, il avait été confronté avec son frère et tout avoué.
Cependant, le lord chief-justice avait reculé devant l’énormité du scandale et la dure nécessité de traduire en justice un membre du Parlement, et que, sur ses instances, une transaction était intervenue entre les deux frères.
Lord William serait mis en possession d’une somme de deux cent cinquante mille livres sterling, de l’hôtel que la famille Pembleton possédait à Paris, dans le faubourg Saint-Honoré, et qu’il consentirait à habiter la France.
Lord William partait donc pour Folkestone, où il allait attendre sa femme et ses enfants.
En même temps il priait Betzy de se rendre à Perth, d’aller retrouver Tom, de lui faire part de la transaction intervenue et de le ramener à Londres d’abord, puis de partir avec lui pour la France.
À la lettre était jointe une bank-note de cent livres.
Mme Bruce ne douta pas un seul instant de l’authenticité de cette lettre.
Elle paya ses dettes dans Adam street, envoya chercher un cab et se fit conduire au railway du Sud.
Depuis lors on ne l’a revue, ni elle, ni ses enfants.
– Mais, dit Tom, lord William… qu’est-il devenu ?
– Le lord chief-justice n’a pas cru un mot du mémoire.
– Ah !
– En même temps, il a reçu une plainte de lord Evandale, qui disait être la victime d’un abominable chantage exercé par un ancien convict.
Tandis que Mme Bruce s’en allait à Folkestone, où elle croyait le trouver, lord William était soumis à l’examen de deux médecins aliénistes, qui n’hésitaient pas à déclarer qu’il était fou.
– Et… alors ? demanda Tom en tremblant.
– Et alors on l’a enfermé à Bedlam, où il est encore.
– Mais, ma femme… ?
– Votre femme est partie pour l’Écosse le même jour.
Elle était dans le wagon des femmes.
À la première station, une dame fort respectable a prétendu qu’on l’avait volée.
Les autres voyageuses se sont récriées.
Un inspecteur de police est venu. On a fouillé tout le monde et on a retrouvé dans la poche de Betzy le porte-monnaie de la vieille dame.
Betzy a été arrêtée et conduite en prison.
Tom eut un accès de désespoir.
– Oh ! dit-il, nous sommes perdus !
– Non, pas encore, dit M. Simouns.
Tom le regarda avidement.
XLVIII
Journal d’un fou de Bedlam
XXXIV
M. Simouns parut se recueillir un instant.
Tom le regardait avec avidité et se suspendait pour ainsi dire à ses lèvres.
Enfin, il reprit :
– Vous avez cherché partout le lieutenant Percy ?
– Hélas ! oui, et tout me porte à croire qu’il est mort.
– Vous vous trompez.
– Le croyez-vous donc vivant ? s’écria Tom.
– J’en ai la certitude.
– Ah !
– Et la preuve.
L’espoir revint au cœur de Tom.
– Écoutez, poursuivit M. Simouns, tandis que vous cherchiez, je cherchais aussi.
– Et vous avez trouvé ?
– Le lieutenant Percy vit toujours ; non seulement il n’est point aveugle, ni malade, mais il jouit de toutes ses facultés.
– Et il est à Londres ?
– Oui.
Et, parlant ainsi, M. Simouns poussa le bouton d’ivoire d’une sonnette électrique.
Un clerc parut.
– Prenez ma voiture, lui dit M. Simouns, et courez à Dover-Hill. Vous me ramènerez l’homme qui est venu ici hier.
Le clerc partit.
Alors M. Simouns reprit :
– Vous vous abandonniez au désespoir tout à l’heure, mon cher Tom. Maintenant, il ne faut pas vous livrer à une joie immodérée.
– Cependant…
– Écoutez-moi jusqu’au bout. Le lieutenant Percy est donc à Londres ; il parlera, moyennant une somme d’argent que je lui ai promise. Il fera mieux encore, même.
– Que fera-t-il ?
– Il fera intervenir les deux autres gardes-chiourmes qui étaient avec lui et ont trempé dans la substitution du forçat mort à lord William vivant.
– Oh ! mais alors… fit Tom joyeux.
– Attendez. Ces trois hommes ont quitté le service et ils ont une petite position. Mais quand ils auront parlé, non seulement ils perdront leur pension, mais encore ils tomberont aux mains de la justice.
– Ah ! fit Tom.
– Et ils seront condamnés pour le moins à la déportation.
– Mais s’ils s’attendent à un pareil sort, ils ne voudront rien dire, observa Tom qui avait repris peu à peu son sang-froid.
– J’ai trouvé un moyen de les faire parler et de les soustraire à la vindicte de la loi.
– Quel est-il ? demanda Tom.
– Nous leur donnerons à chacun quinze cents livres ; c’est le prix qu’ils mettent à leurs révélations.
– Bon !
– Ils quitteront l’Angleterre, passeront le détroit et iront en France. Il n’y a pas d’extradition pour ces sortes de crimes.
– Mais alors ils ne diront rien…
– Au contraire, ils parleront.
Tom ne comprenait pas.
– À Paris, poursuivit M. Simouns, ils se présenteront chez l’ambassadeur britannique, et ils lui révéleront ce qui s’est passé ; ils ajouteront même certains détails relatifs au geôlier de la prison de Perth, qui est encore en fonctions et qui a été le plus coupable dans toute cette affaire.
Cet homme, arrêté, pris à l’improviste, avouera tout.
– Mais alors, dit Tom, celui-ci sera condamné.
– Et il le mérite, car, je vous le répète, il a été le plus coupable, et c’est lui qui a servi d’intermédiaire entre les gardes-chiourmes et le faux Indien Nizam.
– Alors, le procès est gagné d’avance, fit Tom joyeux.
– Oh ! pas encore, dit M. Simouns.
– Pourtant.
– Attendez donc, reprit l’homme de loi. En Angleterre, toutes les fois qu’un intérêt privé est en jeu, la justice ne poursuit pas directement.
– Eh bien ! dit Tom, nous poursuivrons, nous.
– Oui, mais vous oubliez que lord Evandale est maintenant un homme puissant, et qu’il aura autant de partisans que d’ennemis, si cette affaire arrive au grand jour de la justice.
– Qu’importe, si nous avons les preuves authentiques de son infamie ?
– Tant que vous voudrez, répondit M. Simouns ; mais s’il se trouve des solicitors pour plaider le pour, il en est d’autres qui plaideront le contre. Et qui vous dit que le lord chief-justice, qui a fait enfermer lord William comme fou, voudra revenir sur son opinion. Qui vous assure que la justice anglaise osera mettre en lumière un pareil scandale.
Tom baissa la tête.
– Alors, dit-il, à quoi bon les déclarations du lieutenant Percy et de ses complices ?
– À ceci, répondit M. Simouns : nous obtiendrons une transaction.
– Laquelle ?
– Celle-là même que nos adversaires proposaient dans cette lettre faussement attribuée à lord William.
– Deux cent cinquante mille livres ?
– Oui, et l’hôtel Pembleton du faubourg Saint-Honoré à Paris.
– Mais comment y arriverons-nous ?
– Armés de ces papiers, nous irons trouver lord Evandale, vous et moi.
– Bon ! et puis ?
– Lord Evandale reculera devant la crainte du procès. Il n’a qu’un mot à dire pour faire mettre lord William en liberté.
– Et puis ?
– Lord William quittera Londres et se rendra à Paris, et là, l’échange aura lieu.
– Quel échange ?
– L’échange des deux cent cinquante mille livres et des titres de propriété de l’hôtel Pembleton contre la déclaration du lieutenant Percy et de ses complices, légalisée par l’ambassade anglaise.
Cependant, Tom ne se rendait pas encore.
Il lui semblait dur d’abandonner ainsi ses droits et lord William pour une somme d’argent, si considérable qu’elle fût.
Mais M. Simouns lui dit encore :
– Réfléchissez à toutes les difficultés, à toutes les lenteurs d’un semblable procès.
– C’est vrai, dit Tom.
– Il s’écoulera plusieurs années avant que nous ayons épuisé toutes les juridictions.
– Qu’importe, dit Tom, si nous touchons au but ?
– Et pendant ce temps, continua M. Simouns, la femme et les enfants de lord William seront dans une misère profonde, et lord William, enfermé avec des fous, finira par le devenir lui-même.
Cette dernière raison alléguée par M. Simouns triompha des derniers scrupules de Tom.
– Enfin, acheva M. Simouns, je ne vous cache pas que je veux bien avancer sept ou huit mille livres sterling pour cette affaire, mais que je reculerais devant une somme plus considérable, et pour soutenir le procès, il faut au moins vingt-cinq mille livres.
– Eh bien ! dit Tom, qu’il soit fait ainsi que vous le désirez.
– À la bonne heure ! répondit M. Simouns.
En ce moment, la porte s’ouvrit et le lieutenant Percy entra.
Tom l’examina curieusement.
C’était un homme encore jeune et vigoureux, et qui paraissait doué d’une grande énergie.
– Tout est convenu avec monsieur, lui dit M. Simouns en lui montrant Tom.
Le lieutenant salua.
– Vous partez ce soir pour Paris.
– Comme il vous plaira, monsieur.
– Voici cinq cents livres pour vous et vos compagnons. Le reste vous sera compté à Paris, à l’hôtel de l’ambassade.
Et M. Simouns prit son livre de chèques et donna un bon sur la Banque de cinq cents livres, que le lieutenant Percy mit tranquillement dans sa poche.
XLIX
Journal d’un fou de Bedlam
XXXV
– Allez faire vos préparatifs de départ, dit alors M. Simouns au lieutenant Percy. Quand vous serez à Paris, vous m’enverrez une dépêche en me donnant l’adresse de l’hôtel dans lequel vous et vos compagnons serez descendus.
– Faudra-t-il nous présenter à l’ambassade tout de suite ?
– Non, vous attendrez que monsieur vous rejoigne.
Et M. Simouns montra Tom.
Le lieutenant se leva et partit.
Alors, demeuré seul avec M. Simouns, Tom lui dit :
– Et ma pauvre femme qui est en prison ?
– Elle en sortira avant huit jours.
– Comment cela ?
– Je la ferai mettre en liberté sous caution.
– Ah ! dit Tom, mais si elle quitte l’Angleterre, la caution sera perdue.
– C’est une somme que nous ajouterons aux frais que lord William me remboursera.
Tom inclina la tête.
Puis, après un silence, il dit encore :
– Mais ne m’avez-vous pas dit que la femme et les enfants de lord William avaient disparu ?
– Oui.
– Peut-être leur est-il arrivé malheur ?
– Je l’ai craint comme vous. Mais…
– Mais ? fit Tom vivement.
– Je suis à peu près rassuré maintenant.
– Comment cela ?
– J’ai mis à leur recherche le détective dont je vous ai parlé.
– Ah !
– Et il m’a envoyé ce matin un télégramme de Brighton.
Ce télégramme, le voilà.
Et M. Simouns prit sur son bureau un papier qu’il mit sous les yeux de Tom.
Tom lut :
M. Simouns, Pater-Noster street, London.
« Ayez bon espoir. Je suis sur la bonne piste.
« ROGERS. »
– Ainsi, vous pensez qu’il les retrouvera ?
– Oui certes.
Tom se leva.
– Je reviendrai demain, dit-il.
– Non pas, dit M. Simouns, il ne faut pas que vous reveniez ici.
– Pourquoi ?
– Parce que nos adversaires vous croient mort, et qu’ils ne doivent savoir que vous êtes vivant que le jour que vous serez armé du témoignage écrit des gardes-chiourme ; or, en venant ici, vous pouvez être rencontré.
Où êtes-vous logé ?
– Nulle part encore.
– Il faut chercher un quartier éloigné, dans l’East-End, du côté de Mail en Road, par exemple.
– Bon ! mais quand partirai-je pour Paris !
– Aussitôt que nous aurons des nouvelles positives de Mme Bruce et de ses enfants.
– Et lord William, ne le verrai-je pas avant mon départ ?
– C’est impossible. D’abord, on ne pénètre pas facilement à Bedlam.
– Oh ! cependant, on donne des permissions.
– Oui, mais quand on saurait qu’un homme a visité Walter Bruce, on soupçonnerait que c’est vous, et, je vous le répète, vous êtes mort pour lord Evandale jusqu’au moment décisif.
Tom s’inclina.
– Mais où vous reverrai-je ? dit-il.
– Demain, entre dix et onze heures, répondit le solicitor, je passerai en cab dans Mail en Road.
À la hauteur du work-house, je m’arrêterai et mettrai pied à terre. Soyez dans les environs.
– Fort bien, dit Tom.
Et il partit.
Il suivit le conseil de M. Simouns et s’en alla loger auprès de Mail en Road.
Le lendemain, à l’heure dite, il était devant le work-house, arpentant le trottoir et lorgnant tons les cabs qui passaient.
Enfin, une de ces voitures s’arrêta et un homme en descendit.
C’était le solicitor.
– Mme Bruce est retrouvée, lui dit-il.
Tom eut un cri de joie.
– Tenez, dit M. Simouns, lisez.
Et il lui tendit une lettre.
Cette lettre était du détective Rogers.
« Monsieur, écrivait l’homme de police, j’aime mieux vous faire attendre quelques heures et confier mon message à la poste, de préférence au télégraphe.
« Je vous écris de chez Mme Bruce.
« Elle est à Brighton, dans un petit cottage au bord de la mer.
« La pauvre femme ne sait absolument rien. Elle croit son mari à Paris.
« Voici ce qui lui est arrivé.
« Vous savez qu’elle est partie de Londres, il y a trois mois, pour aller rejoindre son mari à Folkestone.
« L’écriture de M. Bruce avait été si merveilleusement imitée qu’elle n’a pas eu le moindre soupçon.
« Un homme l’attendait à la gare de Folkestone.
« Ce n’était pas M. Bruce, comme vous le pensez bien, mais un gentleman qui disait venir de sa part.
« Il avait une autre lettre également signée Walter Bruce et que la pauvre femme a crue être de son mari.
« M. Bruce lui disait que certaines combinaisons étaient changées ; qu’il partait seul pour Paris, où elle ne viendrait le rejoindre que dans quelques semaines.
« Il la priait, en conséquence, de se fier aveuglément à l’honorable gentleman qu’il lui envoyait.
Mme Bruce crut à cette seconde lettre, comme elle avait cru à la première.
« Elle suivit le gentleman, qui la conduisit à Brighton, et l’installa dans le cottage où je l’ai trouvée ce matin.
« Tous les quinze jours, elle reçoit une prétendue lettre de son mari, lequel recule toujours son départ pour Paris, sous différents prétextes.
« À chacune de ses lettres, du reste, est joint un envoi d’argent.
« Je n’ai pas cru devoir désillusionner madame Bruce.
« Je me suis borné à lui dire que je venais de votre part, car elle sait que vous vous êtes occupé d’une transaction entre son mari et lord Evandale.
« Je crois même qu’il serait bon de ne rien lui apprendre avant que cette transaction ait aboutit et que M. Bruce ait été mis en liberté.
« Du reste, j’attends vos ordres.
« Votre respectueux,
« ROGERS. »
Tom rendit cette lettre à M. Simouns.
– Eh bien ? dit-il.
– Eh bien ! j’ai envoyé un télégramme à Rogers, lui disant :
« Vous avez bien fait. Ne dites rien. »
– Bon ! Et qu’allons-nous faire ?
– Vous allez partir pour Paris aujourd’hui même. Voici une lettre de crédit sur la maison Shamphry et C°, rue de la Victoire.
Tom prit la traite.
– Pardon, monsieur Simouns, dit-il encore.
– Qu’est-ce ? demanda le solicitor.
– Lord William sait-il quelque chose ?
– Absolument rien.
– Il doit être réduit au plus violent désespoir.
– Sans doute, mais mieux vaut encore ne rien lui dire.
– Pourquoi ?
– Parce que nous pourrions donner l’éveil à lord Evandale.
– Soit ! dit Tom en baissant la tête.
M. Simouns reprit :
– Ainsi vous allez partir aujourd’hui ?
– Oui, monsieur.
– Vous serez à Paris demain matin, et vous-vous mettrez aussitôt en rapport avec le lieutenant Percy. Il vient de me télégraphier que lui et ses compagnons sont descendus à l’hôtel de Champagne, rue Montmartre.
– Bon !
– Et vous les conduirez à l’ambassade.
Puis, aussitôt que le procès-verbal aura été dressé et légalisé, vous m’écrivez.
– Et puis ?
– Et puis, dame ! j’irai voir lord Evandale.
Tom s’inclina et salua M. Simouns, qui remonta dans son cab.
Une heure après, Tom prenait l’express du Sud-Railway et était en route pour Paris.
Quarante-huit heures plus tard, M. Simouns recevait de France le télégramme suivant :
« Déclaration faite. Ambassadeur convaincu. Pièce légalisée.
« Pars ce soir. À Londres demain.
« TOM. »
– Hé ! hé ! murmura M. Simouns, je commence à croire que lord Evandale fera bien de transiger.
L
Journal d’un fou de Bedlam
XXXVI
Huit jours s’étaient écoulés.
Tom était revenu le matin même de France.
Deux personnes l’attendaient à la gare, M. Simouns et Betzy.
Betzy, mise en liberté sous caution, était revenue à Londres.
Tom était radieux.
Il rapportait une déclaration signée par le lieutenant Percy et les deux autres gardes-chiourme.
L’ambassadeur avait légalisé la pièce.
– Maintenant, dit M. Simouns, nous pouvons marcher.
Je vais écrire à lord Evandale pour le prier de me recevoir.
Tom, qui avait passé la nuit en chemin de fer, prit un peu de repos.
Puis, à deux heures, comme c’était convenu, il alla prendre M. Simouns dans un cab.
Tous deux se rendirent dans le West-End.
– Je crois, dit M. Simouns, quand ils furent à la porte de lord Evandale, je crois qu’il est inutile, au moins pour le moment, que vous entriez avec moi.
– Pourquoi cela ? dit Tom.
– Parce que, répondit M. Simouns, vous auriez peut-être vis-à-vis de lui un mouvement d’indignation qui compromettrait tout. Si j’ai besoin de vous, je vous ferai appeler.
– Comme vous voudrez, répondit Tom.
M. Simouns entra donc seul chez lord Evandale.
Le noble personnage l’attendait dans son cabinet.
Il ne savait pas ce que le solicitor pouvait avoir à lui dire.
Mais comme celui-ci s’était longtemps occupé des affaires de la famille Pembleton, il supposait que c’était une question d’intérêt quelconque qui l’amenait.
M. Simouns demeura debout devant lui.
– De quoi s’agit-il, monsieur Simouns ? demanda lord Evandale.
– Milord, répondit le solicitor, je me présente comme l’avoué du frère de Votre Seigneurie.
– Quel frère ?
Et lord Evandale se mit à rire.
– Votre frère aîné, lord William Pembleton, répliqua M. Simouns gravement…
– Monsieur, répondit lord Evandale, mon frère est mort voici près de dix ans.
– C’est ce que tout le monde croit.
– Et c’est la vérité, monsieur.
– Milord, dit froidement M. Simouns, il y a deux hommes que tout le monde croit morts aussi, et qui sont vivants.
– En vérité !
– Le premier se nomme Tom.
Lord Evandale tressaillit.
– Et… le second ? fit-il.
– C’est le lieutenant de chiourme Percy.
– Je ne connais pas cet homme.
– C’est pourtant lui, dit M. Simouns toujours impassible, qui a aidé sir George Pembleton, votre père, à substituer le cadavre du galérien Edward Bruce au corps de lord William vivant.
– Monsieur, dit lord Evandale, puisque vous êtes si bien renseigné, nous allons causer à cœur ouvert.
– Je l’espère, milord.
– Il y a un adroit bandit, poursuivit lord Evandale, qui se nomme bien réellement Walter Bruce ; cet homme a imaginé, pour me soutirer quelque argent, de prétendre qu’il n’était autre que lord William, mon malheureux frère, mort de piqûre d’un reptile.
– Et… cet homme ?…
– Je me suis borné à le dénoncer à la justice.
– Je sais cela.
– Et je crois que la justice, usant d’indulgence, l’a fait enfermer à Bedlam.
– Vous n’en êtes pas sûr, milord ?
– Oh ! pas plus sûr que cela, après tout.
– Mais cet homme avait une femme et des enfants ?
– C’est possible.
– Et c’est par votre ordre…
– Ah ! pardon, fit lord Evandale avec hauteur, il me semble que vous vous permettez de m’interroger.
– Milord, fit M. Simouns, excusez-moi, mais il faut bien que je vous prouve que je suis plus au courant de cette affaire que vous ne le supposez…
– Soit, parlez…
– Un jour, il y a trois mois, la femme de Walter Bruce, appelons-le ainsi, a reçu une lettre signée de son mari, lettre fausse, du reste, dans laquelle il était question d’une transaction.
– Avec qui ?
– Avec vous, mylord.
– Ah ! voyons.
– Lord William consentait à ne revendiquer ni son nom, ni son titre, à quitter l’Angleterre et à recevoir en échange deux cent cinquante mille livres.
– Fort bien.
– Cette transaction était raisonnable, et je viens, à mon tour, vous la proposer, milord.
Ce disant, M. Simouns étala un papier sur une table et ajouta :
– Quand Votre Seigneurie aura pris connaissance de ce document, elle n’hésitera pas…
Lord Evandale prit le papier et le lut.
M. Simouns, qui le regardait du coin de l’œil, le vit pâlir à mesure qu’il lisait.
Puis lord Evandale eut un mouvement de colère et il froissa le papier.
– Oh ! dit tranquillement M. Simouns, vous pouvez jeter cette pièce au feu, si bon vous semble, milord. C’est une simple copie. Le document authentique, légalisé par l’ambassade britannique, est sous clef dans mon étude.
Lord Evandale parut réfléchir alors.
– Eh bien ! dit-il enfin, si je consentais à ce que vous me demandez, quelle serait ma garantie ?
– On vous rendrait ce document dont vous venez de prendre connaissance, et qui est la seule pièce sérieuse du procès à soutenir.
– Fort bien. Mais Walter Bruce est à Bedlam…
– Oh ! il est facile à Votre Seigneurie de l’en faire sortir.
– Vous croyez ?
– Que Votre Seigneurie écrive seulement deux lignes au lord chief-justice, et Walter Bruce sera libre.
– Et il quittera Londres ?
– Sur-le-champ.
– Et en échange de l’hôtel de Paris et les deux cent cinquante mille livres, on me rendra cette pièce ?
– Milord, dit M. Simouns, je suis un homme connu pour ma probité à Londres. Je n’ai jamais donné ma parole sans la tenir.
– C’est bien, dit lord Evandale. Demain, à pareille heure, je serai chez vous et il sera fait comme vous le désirez.
M. Simouns salua lord Evandale et se retira.
Tom était resté dans le cab.
– Eh bien ! lui dit M. Simouns ! la cause est gagnée.
– Il consent à tout ?
– À tout absolument.
– Et lord William sortira de Bedlam ?
– Il sera libre demain. Du reste, venez demain à deux heures, tout sera fini.
Tom et M. Simouns se séparèrent à Leicester square.
M. Simouns retourna à son étude.
Tom rejoignit Betzy, qui avait pris un modeste logement garni dans Drury-Lane.
Tout bon Anglais qui a le cœur joyeux remercie la Providence du bonheur qu’elle lui envoie, le verre à la main.
Les efforts de Tom étaient enfin couronnés de succès.
Il passa le reste de la journée avec Betzy, et ils errèrent de taverne en taverne jusqu’à minuit, buvant du porter, du sherry, du gin et de l’eau-de-vie.
Ils se couchèrent ivres morts.
Néanmoins, le lendemain, Tom s’éveilla comme à l’ordinaire, la tête calme et l’esprit ouvert.
Il attendit deux heures avec impatience.
Puis, quand deux heures sonnèrent, il sauta dans un cab et se fit conduire à Pater-Noster street.
Mais comme il entrait dans cette rue, ordinairement tranquille, il vit une foule compacte qui encombrait les abords de la maison de M. Simouns.
Tom descendit de voiture et s’approcha.
La foule était silencieuse et paraissait consternée.
Tom voulut pénétrer jusqu’à la porte de la maison, criant : Place ! place !
Mais il n’y put parvenir.
– Ah çà ! dit-il alors en regardant un des roughs qui se trouvaient là, que se passe-t-il donc ?
– Il est arrivé un grand malheur, répondit l’homme du peuple.
Tom tressaillit, et une sueur froide coula soudain le long de ses tempes.
LI
Journal d’un fou de Bedlam
XXXVII
– Mais qu’est-il donc arrivé ? demanda Tom anxieux.
– Un grand malheur, monsieur.
– Quel malheur ?
– M. Simouns est mort.
Tom jeta un cri.
En ce moment, un jeune homme fendit la foule et s’approcha de Tom.
Tom le reconnut.
C’était ce même clerc de M. Simouns que le solicitor avait envoyé chercher le lieutenant Percy, quelques jours auparavant.
– Ah ! monsieur Tom, dit-il les larmes aux yeux, quel malheur ! monsieur Tom, quel malheur !
Tom était stupide.
– Mais cela est impossible ! dit-il enfin.
– Oh ! je suis comme vous, monsieur ; je ne voulais pas le croire il y a une heure. Mais je l’ai vu mort, bien mort…
Et alors le clerc raconta à Tom que M. Simouns était rentré chez lui, la veille au soir, fort bien portant et de joyeuse humeur.
Il avait soupé comme à son habitude et s’était mis au lit un peu avant minuit.
Le lendemain matin, à huit heures, comme il tardait à sonner son valet de chambre, Mme Simouns, inquiète, était allée frapper à sa porte.
Puis, comme on ne répondait pas, elle était entrée.
M. Simouns était couché sur son lit et il était mort.
Un médecin, appelé en toute hâte, avait constaté qu’il venait de succomber à une congestion cérébrale déterminée par une cause inconnue.
Tom, pendant le récit du clerc, avait fait appel à tout son courage, à toute son énergie.
– Mais, dit-il enfin, c’est bien ici qu’il est mort ?
– Non, monsieur, il est mort à son domicile hors de Londres.
– Alors, pourquoi tout ce monde ?
– Parce que la justice est ici.
– Et pourquoi la justice est-elle ici ?
– Oh ! elle y est depuis ce matin, monsieur. Il n’y avait pas une heure que la mort de mon pauvre patron était connue, que les juges sont arrivés.
– Mais que viennent-ils donc faire ?
– Ils viennent apposer les scellés sur les papiers de M. Simouns.
Cette réponse fut un nouveau coup de foudre pour Tom. Parmi les papiers de M. Simouns se trouvait évidemment la fameuse déclaration du lieutenant Percy, visée par l’ambassade d’Angleterre à Paris, l’unique pièce au moyen de laquelle on pût amener lord Evandale à composition.
Et Tom connaissait les lenteurs de la justice anglaise.
Il savait, que lorsqu’elle met les scellés sur quelque chose, ils y restent longtemps.
Il finit par fendre la foule et entrer dans la maison sur les pas du clerc.
Le cabinet du solicitor était déjà fermé avec des empreintes à la cire. Et, bien qu’il fût plus de deux heures, lord Evandale n’avait point paru.
Tom passa tout le jour à errer dans Pater-Noster.
Il attendit toujours lord Evandale.
Mais lord Evandale ne parut pas.
Tom était fixé.
M. Simouns n’était pas mort de sa belle mort.
Il avait été frappé par cette main mystérieuse qui avait écrit les lettres faussement attribuées à lord William. Et Tom se trouvait seul désormais en présence de pareils adversaires.
Mais, nous l’avons dit, Tom était un homme de robuste énergie.
Il ne se décourageait jamais complètement, et il avait la patience des trappeurs du nouveau monde.
Il attendit quinze jours caché avec Betzy dans un faubourg de Londres.
Au bout de ce temps, l’étude de M. Simouns reprit ses travaux.
Ce même clerc qui avait appris à Tom la mort de son patron fut nommé, par ordonnance royale, solicitor à la place de M. Simouns. Tom alla le trouver.
Le clerc était au courant de l’affaire.
– M. Simouns est mort, dit-il ; mais me voici solicitor, et je continuerai son œuvre. Je vais obtenir la levée des scellés, et quand nous aurons retrouvé la fameuse pièce, nous mettrons lord Evandale en demeure de s’exécuter.
Au bout de huit jours, le nouveau solicitor obtint la levée des scellés.
Mais, hélas ! une nouvelle déception, plus terrible que les autres, attendait Tom.
Les scellés levés, on eut beau fouiller dans les papiers de M. Simouns.
La fameuse pièce avait disparu.
Une main criminelle l’avait détournée sans doute le jour où la justice s’était transportée dans l’étude de Pater-Noster street.
Le nouveau solicitor ne se découragea point cependant. Il dit à Tom :
– Le lieutenant Percy est bien à Paris, n’est-ce pas ?
– Je le crois.
– Eh bien ! il faut aller à Paris et obtenir de lui, fût-ce à prix d’argent, une nouvelle déclaration.
Toujours infatigable, Tom partit.
Le lendemain, il était à Paris et courait au domicile du lieutenant.
Là, nouveau coup de foudre.
Le lieutenant était mort depuis huit jours.
En rentrant chez lui, le soir, il avait été écrasé par une charrette de la voirie.
Tom rechercha les deux autres gardes-chiourme ; mais il les rechercha en vain.
Alors, fou de colère et de douleur, il s’écria :
– Eh bien ! c’est moi qui ferai justice.
Et Tom repartit pour Londres.
* *
*
Le soir du jour où Tom était revenu, lord Evandale sortit du Parlement, où il avait siégé.
Il était alors près de minuit.
Au lieu de remonter dans son carrosse et de rentrer chez lui, lord Evandale renvoya ses gens, il revint à pied dans Pall-Mall, où il avait son club.
Sir Evandale passa une partie de la nuit à jouer au pharaon. Ce ne fut que vers trois heures du matin qu’il se décida à regagner son hôtel.
– Ah ! milord, lui dit le baronnet sir Charles M… est-ce que vous allez à pied ?
– Oui, certes, répondit lord Evandale.
– N’avez-vous pas peur des étrangleurs ?
– En aucune façon. Il n’y a jamais eu d’étrangleurs à Londres.
– Oh ! par exemple !
– Je ne crains rien, ajouta lord Evandale.
Et il sortit.
Comme il s’éloignait du club d’un pas rapide, il entendit marcher derrière lui.
Il se retourna et vit un homme qui le suivait.
Lord Evandale pressa le pas.
L’homme en fit autant.
Lord Evandale arriva dans Trafalgar square.
Au pied de la statue de Nelson il s’arrêta.
Alors, l’inconnu vint à lui.
– Deux mots, milord ? dit cet homme.
Lord Evandale tressaillit.
– Que me voulez-vous ? fit-il.
L’inconnu fit un pas encore.
– Ne me reconnaissez-vous pas, milord ?
– Non, dit sèchement lord Evandale.
– Je m’appelle Tom.
– Ah ! eh bien ?
– Je viens vous demander s’il vous plaît de rendre enfin la liberté à lord William.
Lord Evandale se mit à rire :
– Vous êtes fou ! dit-il.
– Milord, reprit Tom d’une voix tremblante de fureur, prenez garde !
– Arrière ! dit lord Evandale.
Et apercevant des policemen à quelque distance, il appela à son aide.
– Les policemen viendront trop tard, dit Tom.
Et tirant de dessous son manteau un long couteau, il le plongea tout entier dans la poitrine de lord Evandale, qui tomba en poussant un cri.
Les policemen accoururent et s’emparèrent de Tom.
Mais lord Evandale était mort, et lord William était vengé !…
LII
Journal d’un fou de Bedlam
XXXVIII
Betzy était sans doute dans la confidence des projets de Tom et elle n’avait mis aucune opposition à sa résolution, car elle ne s’inquiéta point de ne pas le voir revenir ce soir-là.
Le lendemain, elle alla rôder aux alentours de l’hôtel de lord Evandale.
La cour était encombrée de monde.
Betzy se mêla à la foule et écouta ce qu’on disait.
On disait que le noble lord avait été frappé d’un coup de couteau comme il traversait Trafalgar square, à quatre heures du matin.
Par qui ? Selon les uns, c’était par un fénian.
Lord Evandale avait fait à la Chambre, deux jours auparavant, un discours très violent contre l’Irlande.
Selon les autres, le crime avait eu le vol pour mobile.
Personne ne prononçait le nom de Tom.
Mais comme tout le monde était d’accord sur l’arrestation de l’assassin, Betzy fut fixée sur le sort de Tom.
Betzy était une femme courageuse.
– Tom est en prison, se dit-elle, qu’importe ? je continuerai son œuvre.
Betzy, du reste, se faisait des illusions.
Elle pensait que, lord Evandale mort, lady Pembleton se souviendrait qu’elle avait aimé lord William et qu’elle s’empresserait de consentir à la transaction.
Betzy attendit donc quelques jours.
Les funérailles du défunt eurent lieu en grande pompe. Les journaux en parlèrent, comme ils avaient parlé de sa mort.
Mais aucun ne parla des anciens rapports de l’assassin avec sa victime.
Au bout de huit jours, Betzy se présenta à l’hôtel de Pembleton.
Lady Anna consentit à la recevoir. Betzy lui dit alors :
– Le misérable qui avait abusé de votre confiance, milady, a expié son crime. Refuserez-vous, maintenant, de reconnaître lord William ?
Lady Pembleton ne répondit pas.
Elle se borna à agiter un gland de sonnette.
Deux hommes entrèrent, – sir Archibald et un inconnu.
Cet inconnu n’était autre que le révérend Patterson.
– Mon père, dit lady Pembleton, faites donc chasser cette misérable folle !
Betzy eut un accès d’indignation :
– Ah ! milady, fit-elle, jusqu’à présent, je vous avais crue l’esclave de lord Evandale, mais je vois bien que vous étiez sa complice.
Sir Archibald appela ses valets.
Ceux-ci s’emparèrent de Betzy et la jetèrent dehors.
Betzy se mit à crier.
Deux policemen du quartier la saisirent et la conduisirent à la station de police la plus voisine.
Là, Betzy voulut tout raconter au magistrat qui l’interrogea. Mais le magistrat lui ferma la bouche et donna ordre de la conduire en prison.
Alors, Betzy comprit qu’elle était perdue.
Mais elle avait l’âpre et sauvage énergie de Tom, son mari.
– Puisque je dois rester en prison, se dit-elle, autant vaut que je voie lord William.
Betzy passa trois jours dans la prison de la station de police. Au bout de ces trois jours, elle donnait de tels signes d’aliénation mentale, riant à gorge déployée, chantant du matin au soir, que le magistrat déclara qu’elle était folle et la fit conduire à Bedlam.
C’était ce que Betzy voulait.
Walter Bruce, c’est-à-dire William, s’y trouvait toujours.
Le secrétaire de Bedlam savait bien qu’il devait garder lord William à perpétuité, et il avait des ordres mystérieux pour le trouver fou à lier.
Mais on avait sans doute jugé inutile de l’instruire des motifs qu’on avait eus de faire arrêter Betzy.
Betzy ne fut donc pas surveillée, et elle put voir lord William Celui-ci n’avait nullement perdu la raison ; mais il se mourait lentement de douleur.
Oh ! certes, il ne songeait plus à reconquérir son nom et sa fortune, à cette heure.
Lord William n’avait plus qu’une idée fixe : être rendu à sa famille, revoir sa femme et ses enfants, et retourner avec eux en Australie.
Il avait rédigé un long mémoire où il relatait tout ce qu’il savait de sa lamentable histoire.
Les confidences de Betzy complétèrent ce document.
Or, le hasard, qui se plaît souvent à déjouer les plans les mieux combinés des hommes, le hasard vint tout à coup en aide à lord William et à la malheureuse Betzy.
Un jour, on amena à Bedlam un nouveau pensionnaire.
Betzy l’eut à peine envisagé qu’elle le reconnut.
C’était ce petit homme déjà vieux qui s’était présenté chez Tom, quelques mois auparavant, sous le nom d’Edward Cokeries, se donnant pour un clerc de M. Simouns. Cet homme, on s’en souvient, avait été l’instrument de lord Evandale ou plutôt, du révérend Patterson ; et on a deviné sans doute que c’était lui qui avait si bien imité l’écriture de lord William et transmis à Tom la fausse dépêche de John Murphy, datée de Perth, en Écosse.
Edward Cokeries était fou, réellement fou, et sa folie avait une cause bizarre.
Le lendemain du jour où Tom avait assassiné lord Evandale, il s’était présenté à l’hôtel Pembleton.
Là, il avait appris que lord Evandale était mort.
Edward Cokeries était devenu fou subitement.
C’était ce jour-là même que le noble lord devait lui payer une somme de deux mille livres pour prix de sa trahison.
On avait reconduit l’homme de loi chez lui.
Il avait femme et enfants.
Pendant quelques jours, on l’avait gardé enfermé dans sa maison. Mais il y avait donné de telles marques de démence furieuse que les voisins épouvantés avaient demandé son incarcération.
On l’avait conduit à Bedlam.
Or, une commotion violente avait ôté la raison à Edward Cokeries.
Une autre émotion non moins grande venait la lui rendre.
À la vue de Betzy et de lord William, Edward Cokeries jeta un cri. Il n’était plus fou.
Et comme la raison lui était revenue, la mémoire lui revint aussi, et avec elle le repentir.
Un soir, dans un coin du préau, il se jeta aux genoux de lord William et lui demanda pardon, s’accusant de tous les crimes, et avouant qu’il avait été l’instrument de lord Evandale et du révérend Patterson.
C’était lui qui avait fait enlever Tom en chemin de fer.
Lui qui avait fait disparaître le lieutenant Percy.
Lui encore qui avait volé dans l’étude de M. Simouns, tandis qu’on y apposait les scellés, cette fameuse déclaration du garde-chiourme visée par l’ambassade d’Angleterre.
Mais cette pièce, il ne l’avait point rendue à lord Evandale. Il avait voulu la conserver comme un otage, jusqu’à ce que le noble lord lui eût payé en trois fois la somme de huit mille livres, prix stipulé entre eux.
En apprenant la mort du lord, Edward Cokeries avait pensé qu’il ne serait pas payé et le désespoir l’avait rendu fou.
Et quand il eut fait tous ces aveux, Edward Cokeries dit encore :
– Maintenant, milord, si jamais je puis sortir d’ici, je travaillerai à réparer le mal que j’ai fait.
Lord William avait secoué la tête :
– On ne sort pas de Bedlam, avait-il dit.
Et Betzy avait répondu :
– Qui sait ?
La courageuse femme avait trouvé un moyen d’évasion, et elle songeait à le mettre à exécution, comme on va le voir.
LIII
Journal d’un fou de Bedlam
XXXIX
Lord William et Edward Cokeries avaient donc avidement regardé Betzy. Betzy leur dit :
– J’ai trouvé le moyen de sortir d’ici.
– Comment, sortir ? demanda lord William d’un air de doute.
– Oh ! pas vous, dit-elle, mais moi… Et, pourvu que je sorte, tout ira bien, dit la courageuse femme.
– Que ferez-vous donc ? demanda lord William.
– D’abord, monsieur me dira où il a caché le fameux papier.
– Bon ! fit Edward Cokeries.
– Quand je serai hors d’ici, j’irai donc chercher le papier.
– Et puis ?
– Et puis je le porterai au successeur de M. Simouns.
– Mais comment sortirez-vous, Betzy ?
– Oh ! très facilement, comme vous allez voir.
– Parlez.
– Vous savez qu’il y a à Londres une association de dames charitables qui ont pris le nom de dames des prisons ?
– Oui, fit lord William d’un signe de tête.
– Non seulement elles assistent les condamnés à mort, mais encore elles vont voir les prisonniers qui sont malades.
– Il en vient journellement ici, dit lord William.
– Elles sont masquées, ou plutôt elles portent sur la tête une sorte de cagoule qui ne laisse voir de tout le visage que les yeux.
– Eh bien ?
– Une de ces dames est venue hier voir un pauvre fou qui est très malade.
En traversant la prison et en passant près de moi, elle m’a regardée et m’a dit :
– Bonjour, Betzy !
J’ai fait un geste de surprise.
– Vous me connaissez donc, madame ? ai-je demandé.
– Oui, vous êtes la femme de Tom.
Et comme ma surprise augmentait, elle a ajouté :
– Et vous n’êtes pas plus folle que moi.
– Mais, ai-je balbutié, comment savez-vous ?…
– J’ai visité votre mari à Newgate, et il m’a tout raconté.
– Ah !
– Malheureusement, je ne puis pas faire grand’chose pour vous, mais ce que je puis faire, je le ferai.
Je continuais à la regarder avec étonnement.
– Écoutez, me dit-elle, vous voudriez bien sortir d’ici, n’est-ce pas ?
– Oh ! oui, madame.
– Eh bien ! je puis vous faire sortir.
– Comment ?
– N’occupez-vous pas une chambre toute seule ?
– En effet.
– Dès ce soir, mettez-vous au lit, refusez de manger et plaignez-vous d’être malade.
– Je le ferai, madame.
– Dans deux jours je viendrai vous voir. Je ne serai pas seule ; une autre dame des prisons m’accompagnera ; soyez sans crainte, je me charge du reste.
Et elle s’est éloignée.
– Tout cela, fit lord William, ne me dit pas comment vous sortirez d’ici, Betzy.
– Je le devine, milord.
– Ah !
– L’une des deux sœurs me prêtera son costume.
– Mais alors elle restera à votre place ?
– Sans doute.
– Comment donc sortira-t-elle à son tour ?
– En se faisant reconnaître, probablement.
– Mais elle compromettra l’œuvre des dames des prisons tout entière.
Betzy eut un geste qui pouvait se traduire ainsi :
– Je vous assure bien que cela m’importe peu.
– Maintenant, dit Betzy, s’adressant à Edward Cokeries, où est le papier ?
– Écoutez, répondit l’homme de loi, je demeure dans Old-Grand-Lane.
– Fort bien, dit Betzy.
– Au troisième étage de la maison qui porte le numéro 7. Vous direz à ma femme que vous venez de ma part, et si elle ne veut pas vous croire vous lui remettrez cet anneau.
Edward Cokeries tira de son doigt une alliance en or qu’il remit à Betzy. Betzy la passa au sien.
– Après ? dit-elle.
– C’est un pauvre logis que le nôtre, poursuivit Edward Cokeries, et les meubles y sont rares. Il y a pourtant sur la cheminée de notre chambre à coucher un buste de duc de Wellington en plâtre.
– Bon !
– Le buste est creux, comme bien vous pensez.
– Et je trouverai les papiers dedans ?
– Oui.
– C’est bien, fit Betzy. Il faudra bien, du reste, que votre femme me croie, quand elle saura que vous n’êtes plus fou.
Betzy exécuta à la lettre la première partie de son programme. Elle feignit d’être malade et ne voulut pas manger le soir. Elle se mit au lit de bonne heure.
Le lendemain, elle refusa toute nourriture.
Lord William lui avait remis son manuscrit – ce manuscrit dans lequel il racontait sa lamentable histoire – et elle l’avait caché sous son oreiller.
Pendant deux jours, Betzy ne voulut prendre que quelques cuillerées de bouillon.
Le troisième jour, les dames des prisons arrivèrent vers le soir. L’une avait un petit paquet sous son bras.
Quand elles furent seules dans la chambre de Betzy, elles fermèrent la porte au verrou.
Alors la première, celle qui avait déjà parlé à la femme de Tom, déplia le paquet.
Il contenait une robe et un capuchon semblables à ceux qu’elle partait elle-même.
– Vite, dit-elle, levez-vous et habillez-vous.
Betzy obéit.
Bedlam est tout un monde. Les fous, les gardiens, les infirmiers, les médecins, vont, viennent et se croisent dans des corridors multiples.
Les dames des prisons étaient entrées deux dans la cellule de Betzy.
Elles en sortirent trois et nul n’y prit garde.
– Suivez-moi, dit alors la mystérieuse libératrice à Betzy.
L’autre dame les quitta et s’en alla toute seule par un autre chemin.
Betzy et sa protectrice longèrent le corridor, descendirent du premier étage au rez-de-chaussée, traversèrent vingt salles différentes et arrivèrent enfin à la porte. Le portier chef leur ouvrit et les salua au passage.
Quand elles furent dans la rue, la dame des prisons mit une bourse dans les mains de Betzy.
– Maintenant, dit-elle, vous êtes libre. Adieu…
Betzy lui prit la main et la supplia de lui dire son nom. La dame résista.
– Adieu, répéta-t-elle.
Et elle s’éloigna rapidement.
Betzy ne perdit pas une minute.
Elle se rendit dans Old-Grand-Lane, gardant le costume de dames des prisons qu’on lui avait fait revêtir.
Elle trouva la femme d’Edward Cokeries, qui, en voyant l’anneau de son mari, s’empressa de lui remettre les papiers cachés dans le buste.
Alors Betzy retourna dans Adam street et y reprit ses habits ordinaires.
Puis elle attendit le lendemain avec impatience.
Le lendemain elle courut chez le successeur de M. Simouns. Elle s’attendait, la pauvre femme, à être reçue avec cordialité. Il n’en fut rien.
– Ma chère, lui dit le jeune solicitor, depuis que nous ne nous sommes vus, il s’est passé bien des choses.
– Que voulez-vous dire ? fit Betzy étonnée.
– D’abord, votre mari a assassiné lord Evandale.
– C’est un misérable de moins, dit Betzy.
– D’accord. Mais nous avons affaire à des ennemis bien autrement redoutables que lord Evandale.
– À qui donc ?
– À la société des Missions étrangères tout entière.
– Eh bien ?
– Et on ne se heurte pas à de pareilles gens.
– Pourquoi ?
– Mais parce qu’on serait brisé comme verre.
Et le jeune solicitor, baissant la voix, ajouta :
– Je vais vous donner un bon conseil. Si vous voulez sauver votre mari du sort qu’il l’attend, allez porter ces papiers à lady Pembleton.
Peut-être, en vous voyant désarmée, demandera-t-elle la grâce de Tom.
Et le jeune solicitor congédia Betzy.
Betzy s’en alla la mort dans l’âme.
– Oh ! dit-elle, ils peuvent tuer mon pauvre Tom, mais ils n’auront pas les preuves de l’infamie de lord Evandale, et peut-être que quelque jour il se trouvera un homme courageux qui prendra en main la cause des opprimés et livrera la guerre aux oppresseurs.
Et Betzy songea alors à cacher les papiers de telle sorte que les amis de lady Pembleton ne pussent les trouver.
LIV
Journal d’un fou de Bedlam
XL
À Londres on vit beaucoup la nuit.
Betzy était rentrée bien souvent après minuit dans son pauvre logis d’Adam street.
Bien souvent aussi, passant devant Rothrite church, il lui avait semblé voir des ombres s’agiter dans le cimetière qui entoure la chapelle.
Betzy n’était pas superstitieuse.
Elle ne croyait pas aux revenants.
Aussi avait-elle deviné que ces ombres étaient vivantes et non point à l’état de fantôme.
Ce n’étaient ni des djinns, ni des farfadets, ni des âmes en peine sortant de leur tombe.
C’étaient des hommes, – et des hommes qui avaient un but mystérieux, en s’introduisant ainsi dans ce cimetière.
Une nuit, Betzy s’était accroupie contre les grilles et elle y était demeurée immobile.
La nuit était noire, le brouillard épais.
Deux hommes passèrent tout près d’elle sans la voir.
Les deux hommes causaient, et Betzy entendit leur conversation.
– Ne te trompes-tu pas de tombe ! disait l’un.
– Non, non, répondit l’autre.
– C’est que, reprit le premier, il ne faudrait pas que notre vaillant ami, qui, de son vivant, était bon catholique, reposât plus longtemps dans une tombe protestante, au milieu d’hérétiques.
– Non, non, dit le second ; viens, je vais te montrer son tombeau.
Betzy comprit qu’il était question d’une exhumation ; et elle sut dès lors quels étaient ces hommes qui se réunissaient quelquefois dans le cimetière de Rothrite.
Ces hommes étaient des fénians.
Un des leurs était mort dans le quartier et on l’avait enterré en cet endroit.
Mais ses amis, ses coreligionnaires voulaient enlever nuitamment sa dépouille, sans doute pour la transporter dans le cimetière Saint-George, qui est une église catholique comme chacun sait.
Betzy était Écossaise, anglicane par conséquent.
Et cependant elle s’intéressa singulièrement à cette exhumation.
Immobile auprès de la grille, perçant le brouillard de son regard ardent, elle vit ouvrir la fosse et enlever le corps.
Ce ne fut que lorsque les deux hommes se furent éloignés avec leur triste fardeau, que Betzy regagna son logis d’Adam street. Mais elle ne dormit pas, et attendit le jour avec impatience.
Aux premiers rayons de l’aube, Betzy se dirigeait vers la chapelle et entrait dans le cimetière.
Les environs étaient déserts encore.
Betzy était vêtue de noir, et on aurait pu croire qu’elle allait pleurer sur la tombe d’une personne aimée.
Ce n’était point cependant le motif qui amenait l’Écossaise dans le cimetière.
Betzy voulait voir dès ce jour cette tombe qui était maintenant veuve de son cadavre.
Elle se mit donc à suivre la trace des pas que les deux fénians avaient laissée sur l’herbe haute et drue.
Elle arriva à la tombe, que surmontait une croix de fer, et s’agenouilla auprès.
Puis, jetant autour d’elle un rapide et furtif regard, elle reconnut qu’elle était seule et que personne ne pouvait la voir.
Alors elle s’assura que la pierre qui recouvrait la fosse vide pouvait être soulevée facilement.
– On ne viendra pas les chercher là, murmura-t-elle.
Betzy, en parlant ainsi, faisait allusion au manuscrit de lord William et à la déclaration du lieutenant Percy.
* *
*
Les dernières pages du manuscrit étaient tracées d’une autre main.
Lord William, à l’aide des documents que lui avait fournis Betzy, avait raconté son histoire et les événements qui avaient suivi son incarcération à Bedlam.
Mais après l’avoir emporté, Betzy l’avait complété par le récit des événements postérieurs.
Là s’arrêtait le Journal d’un fou de Bedlam. La déclaration du lieutenant Percy y était annexée au moyen d’une épingle.
Alors Vanda et Marmouset se regardèrent.
– Eh bien ? fit Vanda.
– Nous n’en savons pas davantage, mais nous en savons assez, dit Marmouset.
– Tom est mort, Betzy est morte…
– Oui. Mais lord William est vivant et sa famille aussi.
L’abbé Samuel n’avait pas encore prononcé une parole.
– Ce que le manuscrit ne nous dit pas, dit-il alors, je vais vous le dire, moi.
– Ah ! dit Marmouset en le regardant.
– Il peut y avoir six mois que Betzy a caché les papiers dans la tombe vide où vous les avez trouvés.
C’est donc six mois de son existence, les six derniers, hélas ! que je vais vous raconter.
– Parlez, monsieur l’abbé, fit Vanda.
Et tous trois, Marmouset, Vanda et Shoking, regardèrent l’abbé Samuel. Celui-ci reprit :
– Betzy s’était cachée avec soin tant qu’elle avait eu les papiers en sa possession.
On la recherchait dans Londres pour la ramener à Bedlam ; et si elle était revenue à Adam street, c’était précisément pour donner le change à ses persécuteurs, qui ne supposeraient certainement pas qu’elle était rentrée tranquillement chez elle.
Pendant trois mois, on la chercha donc partout ailleurs que dans Adam street.
Betzy ne sortait que le soir.
Alors elle courait dans les rues de Londres et se faisait arrêter sous un autre nom que le sien, pour vagabondage ou ivrognerie.
Elle passait les nuits dans les diverses stations de police, et elle avait un but en agissant ainsi.
Elle espérait toujours rencontrer quelque voleur que l’on conduirait à Newgate le lendemain et qui se chargerait d’apprendre à Tom, dont la mise en jugement traînait en longueur, qu’elle avait retrouvé les papiers.
Ce fut ainsi qu’elle rencontra l’homme gris.
Dès lors, Betzy fut plus tranquille. Tom était averti. Qui pouvait dire que Tom ne parviendrait pas à s’évader.
– Hélas ! interrompit Vanda, le malheureux a été pendu.
– Oui, dit l’abbé Samuel, vous continuerez son œuvre.
– Et l’œuvre est difficile, observa Vanda.
– Non certes, dit Marmouset, n’avons-nous pas la déclaration du lieutenant Percy ?
– Soit, dit Vanda.
– N’avons-nous pas beaucoup d’argent pour soutenir le procès ?
– En effet, dit Shoking, et dans la libre Angleterre, on fait tout ce qu’on veut avec de l’argent.
– Mais, dit l’abbé Samuel, il faudrait auparavant faire mettre lord William en liberté.
– Et c’est difficile, dit Vanda.
– Difficile, soit, mais non impossible, répliqua Marmouset. Demain j’irai voir le successeur de M. Simouns, et, comme le dit Shoking, avec de l’argent on fait bien des choses.
– Même quand on a à lutter avec la société des Missionnaires évangéliques, ajouta l’abbé Samuel.
Comme ils causaient ainsi tous les quatre, un rayon de jour blafard pénétra dans la mansarde et vint se jouer sur le visage pâli de la pauvre morte…
Vanda s’était mise à genoux et récitait les prières des morts.
(Fin du Journal d’un fou de Bedlam.)
À propos de cette édition électronique
Texte libre de droits.
Corrections, édition, conversion informatique et publication par le groupe :
Ebooks libres et gratuits
http://fr.groups.yahoo.com/group/ebooksgratuits
Adresse
du site web du groupe :
http://www.ebooksgratuits.com/
—
Septembre 2011
—
– Élaboration de ce livre électronique :
Les membres de Ebooks libres et gratuits qui ont participé à l’élaboration de ce livre, sont : Christian, Jean-Marc, BertrandG, PatriceC, Coolmicro.
– Dispositions :
Les livres que nous mettons à votre disposition, sont des textes libres de droits, que vous pouvez utiliser librement, à une fin non commerciale et non professionnelle. Tout lien vers notre site est bienvenu…
– Qualité :
Les textes sont livrés tels quels sans garantie de leur intégrité parfaite par rapport à l'original. Nous rappelons que c'est un travail d'amateurs non rétribués et que nous essayons de promouvoir la culture littéraire avec de maigres moyens.
Votre aide est la bienvenue !
VOUS POUVEZ NOUS AIDER À FAIRE CONNAÎTRE CES CLASSIQUES LITTÉRAIRES.