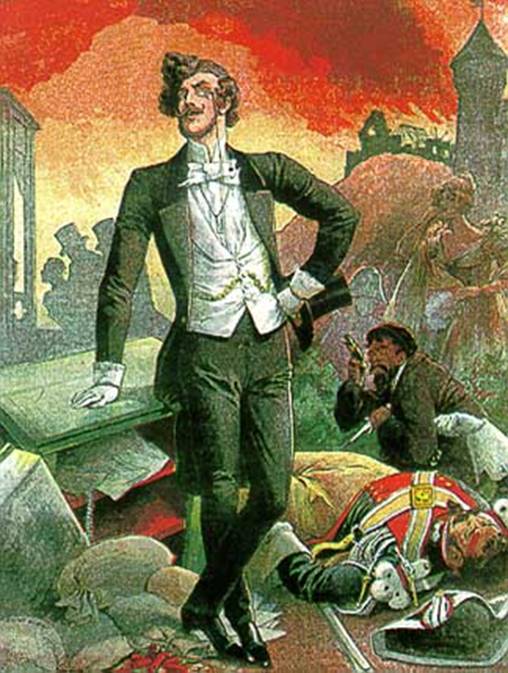
Pierre Alexis Ponson du Terrail
LE DERNIER MOT DE ROCAMBOLE
Tome II
LES MILLIONS DE LA BOHÉMIENNE
La Petite Presse – 21 août 1866 au 8 août 1867 – 350
épisodes
E. Dentu Le Dernier Mot de Rocambole (5 volumes) 1866 – 1867
Table des matières
À propos de cette édition électronique
LE FILS DE MILADY
I
Par une de ces splendides journées de février dont Paris a le secret, la foule des équipages et des cavaliers était grande vers deux heures de l’après-midi, au bois de Boulogne.
C’est l’endroit où ce monde de sportsmen et de gens à chevaux se reconnaît et s’observe, se salue ou échange un simple regard.
Le gandin ralentit son trotteur pour jeter une œillade à mademoiselle Cerisette qui sort pour la première fois en demi-daumont, le banquier surveille Coralie à qui il donne cinq mille francs par mois et qu’il soupçonne de ne venir aussi assidûment au Bois, chaque jour, que pour y rencontrer le petit vicomte R… qui croque son dernier oncle et monte son dernier cheval.
Enfin mademoiselle de Saint-Euverte qui s’appelait autrefois Joséphine, à qui la fuite de monsieur D… a fait des loisirs, cherche à les utiliser et couche en joue un Américain du Sud.
C’est, en un mot, le monde le plus élégant, le plus mêlé qu’on puisse voir.
Et ce monde-là, le jour dont nous parlons, paraissait fort ému, fort agité et semblait s’entretenir par groupes, et d’une voiture à l’autre, d’un événement considérable.
L’Europe entière était en paix, cependant, aucune révolution n’avait eu lieu et on ne parlait même pas de quelque désastre financier important.
Non, c’était plus et moins que tout cela.
On venait de voir Aspasie.
Aspasie s’était montrée dans son coupé bien attelé de ses deux admirables trotteurs irlandais dont le prince russe K… avait offert cent mille francs, et qu’elle avait refusé de vendre.
Qu’est-ce que Aspasie ?
Pour dire la vraie vérité, Aspasie s’appelait peut-être Caroline.
Mais Caroline est un nom de bourgeois et Aspasie avait pour métier de ruiner des fils de croisés et des barons autrichiens.
Aspasie était une femme de trente-deux ans, blonde et presque rousse, possédant un esprit d’enfer, renommée jadis pour son insensibilité, et que la mort du petit duc napolitain Galipieri, qui s’était battu pour elle, avait mise à la mode sept ou huit ans auparavant.
Aspasie avait eu un salon, un vrai salon. Elle avait possédé les plus beaux diamants, les plus beaux chevaux, le plus coquet petit hôtel des Champs-Élysées.
Elle avait reçu des artistes, des gens de lettres, des sénateurs et des princes.
Pendant sept ou huit ans on avait vanté son esprit mordant, sa beauté originale, son manque de cœur absolu et compté les désespoirs qu’elle avait semés sur son chemin.
Puis, un matin ou un soir on ne savait pas au juste, Aspasie avait disparu.
Elle avait tout vendu, chevaux, hôtel, mobilier, dentelles et diamants.
Le petit X…, qui avait fait à la Bourse une fortune scandaleuse et la croquait à ses pieds, avait failli se brûler la cervelle de désespoir.
Personne n’avait su ce qu’était devenue Aspasie.
Le bruit avait couru cependant, que ce bloc de glace avait fondu au soleil, que ce cœur de bronze s’était ému, que cette femme qui faisait litière de l’honneur des familles et s’était constituée le minotaure de l’adolescence dorée, s’était prise à aimer…
Qu’elle aimait follement, avec passion, avec furie, comme une tigresse et non comme une femme.
Il y avait un an de cela, et pendant un an on n’avait vu Aspasie nulle part, ni aux premières représentations, ni aux courses, ni au Bois.
Cependant quelques jeunes gens affirmaient qu’elle n’avait pas quitté Paris.
Qu’elle vivait enfermée dans une petite maison de la place Vintimille, quartier tranquille et retiré entre tous ; ne sortait que le soir, dans une voiture sans luxe, avec un de ces voiles masques récemment inventés et qui dépistent si bien les curieux.
Si on ne la voyait pas autour du lac, du moins on prétendait l’avoir rencontrée en compagnie d’un jeune homme irréprochable de manières et de tenue, dans les allées désertes du bois de Vincennes.
Les dames du monde dans lequel vivait autrefois Aspasie étaient divisées d’opinion.
Les unes, les plus damnées, celles qui avaient si bien accroché leur cœur un peu partout qu’il n’était plus qu’une loque, disaient avec un sentiment d’envie :
– Elle est bien heureuse !
Les autres, les jeunes, les effrontées et les naïves murmuraient avec dédain :
– On n’aurait jamais cru cela !… c’est une femme à la mer !
Puis tout le monde ayant dit son mot, le silence s’était fait.
Au bout d’un an, on se souvenait à peine d’Aspasie, lorsque tout à coup, Aspasie avait reparu.
On l’avait vue, on la voyait…
Car elle était là, à deux heures de l’après-midi, par ce temps printanier, dans ce même coupé brun sur les panneaux duquel on avait fait peindre, en guise d’armoiries, une salamandre en camaïeu.
Elle était là, promenant sur la foule son regard calme et fier.
Deux jeunes gens qui trottaient côte à côte dans l’allée des cavaliers s’arrêtèrent stupéfaits.
– Ce n’est pas possible, dit l’un d’eux.
– Je crois rêver, murmura l’autre.
– C’est pourtant bien Aspasie.
– Parbleu !
– D’où sort-elle ?
– Je l’ai crue morte !
– Moi aussi.
Et comme ils échangeaient toutes ces exclamations, échangées déjà par mille autres personnes, Aspasie les aperçut et leur fit un salut amical du bout de ses doigts mignons merveilleusement gantés.
Le salut était une invitation que tous deux comprirent parfaitement.
Ils s’approchèrent.
– Bonjour, dit Aspasie en se penchant à la portière du coupé.
– Voyons, chère, dit l’un d’eux, est-ce vous ? est-ce votre ombre ?
– C’est moi.
– Vivante !
– Mais sans doute…
Et elle leur montra ses dents éblouissantes en un sourire.
– D’où venez-vous ?
– Dieu seul le sait !
Elle eut dans l’œil un éclair.
– Aspasie, dit le premier des jeunes gens, savez-vous tout ce qu’on a dit de vous, en votre absence ?
– Non, mais peu m’importe.
– On a prétendu que votre cœur avait parlé.
– C’est vrai, dit-elle simplement.
– Vous avez aimé ?
– Avec frénésie.
– Et… vous aimez… toujours ?
– Je hais !
Elle prononça ces mots d’une voix sourde.
Les deux jeunes gens se regardèrent.
Aspasie avait une flamme sombre dans ses grands yeux bleus.
– Baron, dit-elle, s’adressant au premier, m’aimez-vous toujours ?
– Sans doute, répondit-il d’un ton léger.
– Et vous, marquis ?
Elle s’adressait au second, qui était un tout jeune homme.
– Ordonnez, répliqua ce dernier, j’obéirai.
– Venez me voir tous les deux, ce soir.
– Hein ! tous les deux, fit le baron un peu ébahi.
– Vrai.
– C’est bizarre !…
– Non. Vous verrez… je suis rentrée chez moi, avenue de Marignan… On dîne à sept heures… venez.
Et elle leur donna la main.
– Mais pourquoi tous deux ? fit à son tour le marquis d’un ton boudeur.
– Je cherche un vengeur ! répondit Aspasie, d’un ton qui les fit frissonner.
II
Dix heures venaient de sonner à la pendule rocaille du boudoir d’Aspasie.
Et ils étaient là, tous les deux, le cigare aux lèvres, digérant un dîner délicat, et prêts à entendre la confession de la pécheresse, ce marquis de vingt ans et ce baron de trente.
Deux fils de famille qui menaient la haute vie par tous les bouts et abusaient de tout, en attendant de ne plus pouvoir jouir de rien.
Le premier s’appelait Albert de Rouquerolles ; il était marquis authentique, avait hérité de quatre-vingt mille livres de rente en terre et vendait une ou deux fermes chaque mois.
Le second portait un nom célèbre dans la finance, il s’appelait le baron de Walleinstein.
Il était riche encore et devenait économe sur le tard.
Comme ils se rendaient, quelques heures auparavant, chez Aspasie, il avait dit à son ami Albert de Rouquerolles avec un abandon charmant :
– Il appert pour moi de ce qu’elle nous a dit, que cette chère Aspasie est libre. Nous tirera-t-elle au sort ? je ne sais. Mais comme tu es mon ami, je souhaite que tu ne sois point l’élu de son caprice.
– Pourquoi donc ? demanda le marquis.
– Parce qu’elle te ruinera en deux ans.
– Et toi ?
– Oh ! moi, j’ai passé l’âge… Elle aura beau croquer, elle n’entamera rien…
– Bah ! fit le marquis d’un air de doute.
Et ils étaient rentrés chez Aspasie qui avait racheté son hôtel et l’avait meublé de nouveau.
Ils avaient dîné tête à tête avec elle, et maintenant ils attendaient qu’elle se prononçât.
– Chère, disait le marquis, en amour toutes les armes sont loyales, même la trahison.
– Voilà un joli paradoxe, mon bon, répliqua Aspasie qui s’était pelotonnée comme une jolie chatte dans sa bergère et faisait danser au bout de son pied d’enfant une mule de soie cramoisie.
– Je m’explique, reprit le marquis. Mon ami Walleinstein est devenu mon rival, par le seul fait de votre invitation.
– Bon !
– Or, comme il m’a fait ses confidences, je vais le trahir.
– C’est admirable, dit Aspasie.
– À ton aise ! dit le baron avec flegme.
– Voyons la trahison ? reprit la pécheresse.
– Marquis, m’a-t-il dit tout à l’heure, laisse-moi Aspasie. Elle te ruinerait… tandis que moi… je suis un vieux renard… j’ai de l’expérience…
Aspasie haussa les épaules et interrompit le marquis d’un geste.
– Mes chers bons, dit-elle, j’ai cent vingt mille livres de rente.
– Qu’est-ce que cela prouve ? dit froidement le baron.
– Tout et rien, répondit Aspasie. Rien, si nous partons de ce principe que l’eau doit aller toujours à la rivière.
Tout, si je ne suis plus l’Aspasie d’autrefois et si je mets mon amour à un autre prix.
– J’avoue que je ne comprends plus, dit le baron.
– Je jette ma langue au chat, murmura le marquis.
– Ne vous ai-je pas dit tantôt que je cherchais un vengeur ?
– Ah ! c’est juste !
Aspasie cessa de sourire, fronça ses sourcils olympiens, et sa voix harmonieuse eut tout à coup un accent rude et sauvage.
– Écoutez-moi, dit-elle. J’ai aimé une fois en ma vie, moi qu’on accusait de n’avoir pas de cœur. J’ai aimé avec passion, avec fureur. J’ai fui le monde, je me suis cloîtrée, jalouse de mon bonheur, ivre de ma félicité.
Si l’homme que j’aimais l’avait voulu, je me serais tuée en souriant.
Lui, rien que lui, toujours lui !
Eh bien ! cet homme m’a trahie, cet homme a cessé de m’aimer… cet homme en aime une autre…
– Il est fou ! dit le baron. Il n’y a qu’une vraie femme à Paris, et cette femme, c’est toi.
– Je l’ai cru longtemps, dit modestement Aspasie. Il paraît que je me trompais, puisqu’il y a une femme outre moi dont il est éperdument épris et qu’il va épouser.
– Il se marie !
– Oui.
– Alors, dit le baron avec un sourire, pardonnez-lui. Il est fou.
– Lui pardonner ! dit Aspasie, jamais.
– Eh bien !… alors…
– Mais vous ne comprenez donc point encore ?
– Ma foi non.
– Comment ! reprit Aspasie avec un accent de haine si profonde que les deux jeunes gens se regardèrent enfin avec gravité, comment ! vous ne devinez pas que celui de vous deux qui viendra ici demain soir en me disant : je l’ai tué ! deviendra chez moi le seigneur et maître ?
– Ah çà ! ma chère, dit le baron, qui était un homme de grand sang-froid, dans quel roman as-tu lu que de notre temps, en l’an de grâce 186., on avait de ces mœurs espagnoles ?
– Mille pardons, dit Aspasie, avec dédain, je vois que je me suis trompée.
– Mais non, dit le marquis.
L’adolescent levait sur Aspasie le regard enthousiaste de ses vingt ans.
Et puis il avait quelques gouttes de sang batailleur dans les veines.
Un Rouquerolles s’était battu treize fois en duel sous Louis XIII, le même jour, et le lendemain de l’exécution de Montmorency-Boutteville.
Un autre, sous la Restauration, – son oncle, croyons-nous, – avait fait des hécatombes de colonels de la garde mis en demi-solde.
Ce Rouquerolles-là, donc, cet adolescent qui se ruinait grand train, sentit un flot de sang monter de son cœur à son cerveau, et il dit à Aspasie :
– Walleinstein est un gros Allemand panaché de juif. Il est noble de par les écus de ses aïeux les banquiers. C’est un garçon positif qui ne comprend rien aux sentiments chevaleresques.
– Mon bon, répondit Walleinstein, j’ai trente et un ans, je suis à mon aise, j’aime le bon vin, les belles filles et les bons cigares ; mais j’estime que pour satisfaire de semblables appétits il est de première nécessité d’avoir un bon estomac et une santé parfaite.
Ensuite, je tiens à mon physique. Ce n’est pas précisément celui d’un Adonis, mais tel qu’il est, il a son petit succès.
Or, une balle qui me crèverait un œil, ou un coup d’épée qui me percerait un poumon, dérangerait tous mes plans et détruirait l’harmonie de mon existence.
En ce moment, Aspasie, que j’ai connue une fille de sens et d’esprit, aurait bien plus besoin d’une consultation du docteur Blanche que d’un amoureux ; si le goût te prend de te faire tuer pour elle, ne te gêne pas.
Si tu as le bonheur de tuer ce monsieur en question, gêne-toi moins encore. Je suis un homme calme comme tu dis et je sais attendre.
Aspasie redeviendra raisonnable un jour ou l’autre, et elle sait bien que je ne laisse pas protester ma parole plus que mes lettres de change.
Sur ces mots, le baron Walleinstein se leva, mit son paletot, enroula un foulard autour de son cou, alluma un nouveau cigare et tendit la main à Aspasie :
– Adieu, chère, dit-il.
– Au revoir, juif immonde ! dit-elle en riant.
Et elle demeura tête à tête avec le marquis.
– Mon cher, dit-elle alors, savez-vous que la besogne est rude ?…
– Tant mieux !
– Cet homme que j’ai aimé, cet homme que je hais et dont j’ai juré la mort…
– Eh bien ?
– Il est le meilleur élève de Gâtechair.
– Que m’importe !
– Il tire le pistolet merveilleusement.
– Je vous aime… murmura le marquis en se mettant aux genoux d’Aspasie.
Son nom ?
– Je vous l’enverrai.
– Pourquoi ne point me le dire tout de suite ?
– C’est une idée à moi… Où irez-vous en me quittant ?
– Je ne sais pas.
– Êtes-vous toujours du Club des Asperges ?
– Toujours.
– Allez-y et attendez…
Et Aspasie congédia le marquis.
Celui-ci s’en alla en soupirant.
Quelques heures avaient suffi pour le rendre amoureux fou !
III
– Mon ami, disait Lucien à son ami Paul de Vergis, aussi loin que peuvent remonter mes souvenirs, je me vois, à l’âge de quatre ou cinq ans, dans un grand château fort triste et dans un pays que j’ai vainement cherché, devenu homme, durant les quatre années que j’ai passées à voyager.
Cependant, il me semble que ce devait être en Angleterre ou en Écosse.
Je me souviens de ma mère.
Elle était si jeune et si belle qu’on eût dit ma sœur aînée.
Comment en ai-je été séparé ? Est-ce de son plein gré ?
Voilà ce que je ne sais pas, ce que je ne saurai probablement jamais.
Je crois me souvenir encore que ma mère pleurait quelquefois en me prenant dans ses bras.
Pourquoi ?
Encore un mystère dont je n’aurai jamais la clé.
– Mais enfin, mon bon Lucien, dit Paul de Vergis, tu dois te souvenir de ce qui s’est passé lorsque tu as été séparé de ta mère ?
– Non, car après m’être endormi dans ses bras, je me suis réveillé sur les genoux d’une vieille femme, dans une chaise de poste qui courait un train d’enfer.
À partir de ce moment, ma vie a été un roman véritable, mon cher Paul.
– Comment cela ?
– Les enfants ont bientôt séché leurs larmes. Après avoir redemandé ma mère pendant quelques heures, quelques jours même, je cessai de pleurer.
La vieille dame m’accablait de caresses et me comblait de friandises.
Ici il se fait une lacune dans mes souvenirs.
Je me revois, quelques années après, dans un pensionnat de jeunes gens, confié à un vieux brave homme de professeur qui m’aimait comme son fils.
Je suis resté chez lui jusqu’à l’âge de seize ans.
Mes questions réitérées sur ma mère, sur ma famille, demeurèrent longtemps sans réponse.
Enfin, un jour, M. Berthoud, c’était le nom du brave homme, me dit :
– Mon cher enfant, je ne sais absolument rien de ce que vous me demandez.
Vous m’avez été confié par un homme encore jeune qui avait un accent allemand assez prononcé. Il m’a payé une année de pension d’avance, en me disant que je ne devais rien épargner pour votre éducation.
L’année suivante, j’ai reçu par la poste cinq mille francs et un billet sans signature.
Ces cinq mille francs, disait le billet, étaient destinés à payer votre seconde année.
À mesure que vous grandissiez, la pension, régulièrement payée par la même voie, devenait plus forte.
C’est ainsi que vous avez appris l’escrime, l’équitation, les langues vivantes, la musique et le dessin.
Maintenant, il y a trois mois, j’ai reçu une lettre de la même écriture que celle qui accompagnait chaque année l’envoi de votre pension.
Dans cette lettre, on m’annonce que vos protecteurs mystérieux vont prendre une autre détermination à votre égard.
Quelle est-elle ?
Je l’ignore.
Il disait vrai, le pauvre vieux brave homme, ainsi que j’ai pu m’en convaincre par la stupéfaction qui se peignit sur son visage quelques jours après, lorsqu’il eut ouvert devant moi la lettre attendue.
Cette lettre était conçue en ces termes :
« Lucien a terminé ses études. D’après les renseignements recueillis, son éducation est accomplie, et c’est un jeune homme raisonnable.
« M. Berthoud est prié de lui rendre la liberté.
« Ci-joint le premier trimestre de la pension qui lui sera servie. »
À la lettre était jointe une traite de mille livres sterling sur la maison de banque Davis-Humphry et C°.
J’avais cent mille livres de rente et ma dix-septième année n’était pas encore accomplie.
– Et tu n’es pas devenu fou ? demanda M. Paul de Vergis.
– Mon Dieu ! non. Or, écoute encore. Mon pauvre vieux professeur avait une fille de quatorze ans, qu’il idolâtrait et dont je commençais à être amoureux.
Marie Berthoud était déjà jolie comme un cœur et bonne et charmante !
Je sautai au cou du vieux brave homme et je lui dis :
– J’aime Marie, je l’épouserai et vous vivrez avec nous, et vous partagerez ma fortune.
Mais l’honnête homme me répondit en souriant :
– On ne se marie pas à seize ans, mon fils ; d’ailleurs Marie est encore une enfant. Entre dans la vie, achève de t’instruire, apprends à connaître les hommes… peut-être nous oublieras-tu bientôt, au milieu du tourbillon où ta fortune va te jeter, peut-être te souviendras-tu de nous quelquefois.
– Oh ! murmurai-je en l’embrassant encore.
Je priai, je suppliai, je pleurai, l’intègre professeur se montra inflexible.
Cependant, comme je paraissais en proie à un véritable désespoir, il consentit à me faire une promesse.
– Attendons six ans, me dit-il ; dans six ans, tu auras vingt-trois ans, et Marie en aura vingt. Si tu l’aimes toujours, nous verrons.
– Tu devines le reste, n’est-ce pas, mon cher Paul ? poursuivit Lucien.
Je voyageai deux années, en compagnie d’un jeune professeur.
Au retour je montai ma maison, je me fis recevoir au Club des Viveurs sous le nom de Lucien de Haas, un nom hollandais qui me dispensait d’avouer que j’ignorais mon vrai nom, et que j’étais sans doute un pauvre bâtard.
Le correspondant mystérieux du vieux Berthoud s’adressait maintenant directement à moi, et il avait triplé ma pension.
Ce n’était plus mille livres sterling que je recevais chaque trimestre, mais trois mille.
Mon bonheur eût été complet si, à mon retour d’Égypte, le dernier pays que j’avais visité, j’eusse retrouvé mon vieux professeur et sa jolie fille.
Mais le pensionnat avait été vendu, puis démoli pour laisser passer la rue Lafayette.
Toutes mes recherches furent infructueuses.
Un ancien camarade de pension que je rencontrai m’affirma que le vieux Berthoud était mort et que sa fille était mariée à un professeur dans un lycée de province.
Le voyage et le temps effacent bien des choses et atténuent la violence de bien des sentiments.
J’aimais encore un peu Marie, mais la pensée qu’elle n’était plus libre m’aida à me consoler.
Je me lançai dans le tourbillon.
J’ai fait des folies, j’ai eu des chevaux de sang, des maîtresses de prix, j’ai joué des sommes considérables.
Enfin, il y a un an, je me suis embarqué dans une liaison à demi romanesque que j’ai prise un moment pour de l’amour.
– Il y a un an ? dit Paul de Vergis.
– À peu près.
– C’est donc pour cela que tu as disparu un beau matin ?
– Oui, mon ami.
– Que ton existence est devenue mystérieuse et qu’on ne t’a plus vu nulle part ?
– C’est pour cela.
– Eh bien ! tu es heureux ?…
– Oh ! oui, mais pas de cette liaison.
– Je ne te comprends plus.
– D’abord, j’ai rompu…
– Ah !
– Mais j’ai fait convenablement les choses, en gentilhomme que je dois être, en gentleman que je suis à coup sûr.
– Tu as fait des rentes ?
– J’ai envoyé cent mille francs sous enveloppe, avec une lettre d’adieu.
– C’est parfait, mais pourquoi cette rupture ?
– Tu ne devines pas ?
– Non.
– Mais parce que j’ai retrouvé Marie Berthoud.
Mon premier, mon seul amour.
– Veuve ?
– Pas du tout, elle n’a jamais été mariée, son père n’est pas mort, Marie a vingt et un ans, elle est belle comme les anges, elle m’aime, et nous nous marions dans huit jours à l’église Saint-Eugène, sa paroisse. Comprends-tu ?
– Mais comment l’as-tu retrouvée ?
– Oh ! c’est toute une histoire, et si tu veux la savoir, prends un cigare sur la cheminée et écoute : l’histoire est longue.
– Voyons ? dit M. Paul de Vergis en se renversant dans son fauteuil.
IV
Avant de transcrire le récit de Lucien, dit Lucien de Haas, qu’il nous soit permis d’esquisser son portrait en quelques lignes et de dire deux mots de sa vie.
Lucien avait vingt-quatre ans.
C’était un grand jeune homme au teint mat et blanc, aux cheveux noirs et aux yeux bleus.
Un sourire mélancolique aux lèvres, une taille svelte et bien prise, un pied mignon, une main aristocratique faisaient de lui un véritable héros de roman.
Lucien avait bien dit à M. Paul de Vergis, un jeune officier avec lequel il s’était lié depuis quelques années, son enfance, son éducation, ses folies de jeunesse et son amour pour la fille du pauvre professeur.
Mais il ne lui avait point dit qu’il était généreux et serviable au possible, qu’il faisait beaucoup de bien, et avait sauvé l’honneur à un de ses amis en lui ouvrant sa bourse et l’y laissant puiser à pleines mains.
Ce qu’il n’avait point dit encore, c’est que, dans le monde, il avait eu des succès fous et qu’il aurait pu épouser une des plus riches héritières de Paris, s’il l’avait voulu.
Ce qu’il taisait enfin, c’est qu’il était d’une bravoure chevaleresque, et qu’en Allemagne, un jour où deux officiers autrichiens s’étaient permis des propos inconvenants à l’endroit de la France, il avait provoqué tout le régiment et s’était battu avec six le même jour.
Mais Lucien était un homme doux et modeste, et il parlait généralement peu de lui.
– Mon cher ami, dit-il alors, quand M. de Vergis eut allumé son cigare et pris l’attitude d’un auditeur attentif, pour arriver à la rencontre que j’ai faite de Marie Berthoud, il faut bien que je te parle quelque peu d’abord de cette liaison que je viens de rompre.
– Voyons ? dit M. de Vergis.
– Tu as entendu parler d’Aspasie ?…
– Aspasie !
– Oui.
– Comment, c’est elle ?
– Oui, dit Lucien en souriant.
– Le Minotaure, comme on l’appelait ?
– Justement.
– Alors c’est toi qui ?…
– C’est moi qui l’ai enlevée, un soir, à ce monde bruyant dont elle était tour à tour l’admiration et l’effroi. Ou plutôt, non, c’est elle qui m’a enlevé…
– Ah ! ah ! fit l’officier en riant.
– Cette femme qui se vantait de n’avoir jamais aimé et qui comptait avec complaisance ceux de ses adorateurs qui s’étaient brûlé la cervelle de désespoir, se prit tout à coup pour moi d’une belle passion…
– J’ignorais que ce fût pour toi, observa M. de Vergis ; mais tout Paris a su comme moi qu’Aspasie était devenue folle d’amour.
– Nous avons vécu un an, reprit Lucien, sans nous quitter une heure ; puis la lassitude est venue. Ces amours fiévreux, impossibles, que le souvenir d’un passé multiple assombrit à toute heure, finissent par être un accouplement monstrueux et infernal.
Un matin, je me suis éveillé non seulement n’aimant plus Aspasie, mais l’ayant en horreur.
Je crois qu’elle aussi, dans cette retraite volontaire à laquelle elle s’était condamnée, regrettait le passé et cette vie bruyante et vide qu’elle avait menée si longtemps.
Un matin donc, je m’échappai de cette maison de la place de Vintimille, où nous vivions cachés tous deux.
J’avais besoin d’air, je voulais être seul.
Le temps était beau, les pavés secs. Je marchais tout droit devant moi.
Je descendis ainsi toute la rue de Clichy, puis celle de la Chaussée-d’Antin.
Je traversai les boulevards et suivis la rue de la Paix jusqu’aux Tuileries.
Quelques enfants jouaient déjà sous les arbres veufs de leurs feuilles.
Ça et là l’éternel troupier marivaudait avec la bonne d’enfants.
Auprès de la terrasse des Feuillants quelques vieillards se chauffaient au soleil.
Tout à coup, j’eus un éblouissement, mes jambes fléchirent, je m’arrêtai, tant mon émotion était grande.
Un vieillard marchait péniblement en s’aidant d’une canne et s’appuyant sur le bras d’une jeune femme.
Le vieillard était mis avec décence, mais son habit noir montrait la corde et son chapeau rougissait légèrement sur les bords.
Une robe de laine, un pauvre petit châle bien simple, un chapeau de velours épinglé noir sans aucune fleur était tout l’accoutrement de la jeune femme.
Mais je les avais reconnus.
C’était le vieux Berthoud !
C’était Marie !
Et je m’élançai vers eux, et j’étreignis le vieillard dans mes bras en lui disant :
– Mais vous ne savez donc pas que je vous ai pleuré comme mort !
Il avait été aussi ému que moi, et il fut contraint de s’asseoir.
– Je ne suis pas mort, me dit-il, mais j’ai été bien malade à la suite de tous mes malheurs.
Je regardai Marie.
Marie baissait les yeux.
Alors, ils me racontèrent simplement toute leur vie depuis cinq années.
M. Berthoud avait perdu dans la faillite d’une maison de banque tout son petit avoir. Il avait vu ses élèves s’en aller un à un, et il s’était trouvé contraint de vendre.
Pendant un an ou deux encore, il avait donné des leçons comme répétiteur.
Puis, atteint d’une ophthalmie, il avait été condamné à un repos forcé.
Ils habitaient à deux pas, rue de la Sourdière, une ruelle sans air et sans soleil, dans une vieille maison, deux pauvres mansardes.
De quoi vivaient-ils ?
Les yeux rougis et le doigt piqué de Marie se chargèrent de me répondre.
La pauvre enfant tirait l’aiguille quinze heures par jour pour gagner vingt-cinq sous.
– Mais votre mari, vous a donc abandonnée, m’écriai-je.
– Mon mari ! dit-elle en jetant un cri, mais je n’en ai pas ! je n’ai jamais quitté mon père.
Je la pris dans mes bras, je lui mis un baiser au front et répondis :
– Tu te trompes, tu en as un, et ce mari c’est moi.
Puis, m’agenouillant devant mon vieux maître :
– Mon père, lui dis-je, avez-vous donc oublié votre promesse ?
– Je devine le reste, interrompit Paul de Vergis. Tu te maries…
– Dans huit jours.
– Veux-tu que je sois ton témoin ?
– C’était pour te le demander, que j’ai pris le prétexte de te retenir pour déjeuner ce matin.
– Avec qui le serai-je ?
– Ah ! voilà, dit Paul, je ne sais pas ou plutôt, je n’ose pas… croire…
– Encore un mystère !
– Hélas ! dit Lucien avec un sourire mélancolique toujours.
– Qu’est-ce encore, voyons ?
– Figure-toi que j’imagine avoir découvert un de mes protecteurs inconnus.
– Ah ! ah !
– C’est un Allemand, – et je te l’ai dit, ce fut un Allemand qui me conduisit dans la pension Berthoud. On l’appelle le major Hoff.
Depuis quand est-il à Paris ? Je ne sais pas !
Mais il y a bien trois ou quatre ans que je le rencontre sur mon chemin.
Quelquefois, il me regarde avec des yeux attendris, et une voix secrète me dit que je ne lui suis point étranger.
– Ne lui as-tu donc jamais parlé ?
– Si, mais il m’a répondu sèchement ; durement même et avec une brusquerie qui m’a paru forcée.
– D’où tu as conclu que le major Hoff et l’Allemand pourraient bien n’être qu’une seule et même personne ?
– Justement.
– Et tu voudrais qu’il te servît de témoin.
– Oui.
– Où le rencontre-t-on ?
– Il est du Club des Asperges . Mais il y a si longtemps que je n’y suis allé.
– Eh bien ! nous irons ce soir, si tu veux. Je tiens à le voir, ce major allemand.
– Soit, répondit Lucien. À ce soir.
Comme le jeune officier, M. Paul de Vergis, se levait, prenait son chapeau et s’apprêtait à quitter son ami, un violent coup de sonnette se fit entendre dans l’antichambre.
Lucien regarda la pendule qui marquait midi moins un quart.
– Je ne reçois pourtant jamais de visite aussi matin, murmura-t-il.
Et comme il faisait cette réflexion, la porte du fumoir s’ouvrit.
V
Le nouveau venu auquel la porte, en s’ouvrant, livra passage, était un homme d’environ soixante ans.
Sa mise décente et modeste annonçait un employé. Il portait sous le bras un portefeuille et un petit coffre.
– M. Lucien de Haas ? dit-il, en regardant les deux jeunes gens.
– C’est moi, répondit Lucien.
– Monsieur, reprit le vieillard, je suis l’un des caissiers de la maison Davis-Humphry et C°.
– Oh ! fit Lucien un peu étonné, car il avait touché, il n’y avait pas huit jours, le trimestre de sa pension.
– Je suis chargé de vous remettre cent mille francs et ce coffret, dit le caissier.
Et il posa le coffre et le portefeuille sur un guéridon.
Le coffre était recouvert d’une gaine de chagrin.
Dans le portefeuille se trouvait une lettre cachetée, que Lucien s’empressa d’ouvrir.
La lettre renfermait la clé du coffre.
En outre, il s’y trouvait une demi-feuille de ce papier de fabrique anglaise qui exhale un parfum pénétrant. Elle était couverte de trois lignes d’une écriture fine, allongée, trahissant une main de femme.
« Mon fils,
« Offrez de ma part, avec mes souhaits ardents pour votre bonheur, cette parure à votre fiancée.
« Votre mère. »
C’était tout.
Lucien passa la main sur son front.
– Et pas de nom ! murmura-t-il.
Puis en soupirant, il ouvrit le coffret, et son ami, M. Paul de Vergis, et lui, reculèrent éblouis, en apercevant une rivière de diamants d’une valeur telle qu’une princesse seule en pouvait rêver une semblable.
Cela valait un million au moins.
Mais Lucien continua à soupirer et une larme brilla dans ses yeux.
– Ma mère vit donc encore, dit-il… elle existe !… et elle se dérobe à ma tendresse !… ô mon Dieu ! qu’ai-je donc fait pour mériter un pareil sort ?
Puis, il eut un moment d’exaltation et saisit la main du caissier qui faisait mine de se retirer discrètement.
– Monsieur, lui dit-il, un mot, je vous prie.
Le caissier s’arrêta étonné.
– Vous pouvez parler devant monsieur, continua Lucien. C’est mon ami, et je n’ai pas de secrets pour lui.
– Mais, monsieur, balbutia le caissier, que voulez-vous que je vous dise ?
– Depuis combien de temps êtes-vous dans la maison de banque Davis ?
– Depuis quarante ans, monsieur.
– Ah ! murmura Lucien avec un soupir de soulagement, alors vous savez tout.
– Mais quoi donc, monsieur ?
– Vous me direz tout ! continua Lucien avec exaltation.
– Encore une fois, monsieur, dit le caissier, je ne vous comprends pas.
– Écoutez. Vous allez me comprendre. Tous les trois mois, vous avez à mon crédit une somme importante.
– Oui, monsieur.
– D’où vient cette somme ?
– Elle est versée à notre succursale de Londres.
– Par qui ?
– Je ne sais pas.
– Mais à Londres, on doit le savoir.
– J’en doute, dit le caissier.
– Vos patrons le savent à coup sûr…
– Monsieur, répondit le caissier, il est une seule chose que je puis vous dire, car elle me revient aujourd’hui en mémoire.
– Parlez, dit avidement Lucien.
– J’étais, il y a vingt ans, employé dans la maison de Londres.
Un homme que je reconnaîtrais, j’en suis sûr, si jamais je le retrouvais, se présenta et versa une somme considérable dont il fit deux parts.
L’une était destinée à un enfant du nom de Lucien qu’on élevait en France, l’autre devait être touchée à Londres même par un homme qui portait un nom indien, Ali-Remjeh.
En effet, celui-ci se présenta le lendemain.
L’année suivante le même personnage apporta une somme identique ; le même Indien se présenta le lendemain.
– Et l’année d’après, demanda Lucien dont la voix tremblait d’émotion.
– L’année d’après, je n’étais plus à Londres. Mes chefs m’avaient donné l’emploi que j’occupe dans la maison de Paris.
– Et c’est là tout ce que vous savez ?
– Tout absolument. Je vous le jure.
Lucien demeura pensif et triste un moment.
– Monsieur, dit-il enfin, si je vous montrais un jour l’homme que je soupçonne être celui qui venait verser les fonds qui m’étaient destinés et que vous le reconnaissiez, hésiteriez-vous à me dire : « C’est lui ? »
– Je n’ai fait aucun serment qui me lie à ce sujet, monsieur, répliqua le caissier.
– Ainsi je pourrais compter sur vous ?
– Sans doute.
– Ah ! murmura Lucien, si c’était le major Hoff, il faudrait bien qu’il me dise où est ma mère !
Le caissier partit, non sans avoir laissé son nom et l’adresse de son domicile particulier à Lucien.
Puis les deux jeunes gens causèrent quelques minutes encore et se séparèrent en se donnant rendez-vous pour le soir, au Club des Asperges .
* *
*
Le rendez-vous était pour dix heures et demie.
Mais Lucien n’arriva qu’à minuit.
La cause de ce retard était bien naturelle, du reste.
Il avait dîné et passé la soirée avec le vieux Berthoud et sa fille, et les deux amoureux s’étaient oubliés à faire des rêves de bonheur.
Lucien entra dans le fumoir.
Il était membre du Club des Asperges depuis trois années.
On le savait riche, il était jeune et charmant.
C’était plus qu’il n’en fallait pour qu’il eût beaucoup d’amis.
Cependant lorsqu’il entra, s’il eût été moins préoccupé de son bonheur et en même temps du major Hoff, qu’il chercha des yeux, il eût remarqué que son arrivée était accueillie d’une façon singulière.
Son ami M. Paul de Vergis lui tendit la main avec une certaine expression de tristesse.
Personne ne se dérangea pour lui.
Toute l’attention paraissait concentrée sur un membre du club, le jeune marquis de Rouquerolles, qui pérorait bruyamment et tenait des discours étranges.
Un peu étonné, Lucien prêta l’oreille aux paroles de M. de Rouquerolles.
Celui-ci disait :
– Vraiment, messieurs, ces choses-là n’arrivent qu’à Paris. Un beau jour, un homme se produit dans le monde. Ses mains ruissellent d’un or mystérieux, il s’est fabriqué un nom, n’en ayant jamais eu, il a l’aplomb des aventuriers et les manières aisées que donnent certaines fréquentations.
Il monte ses écuries, il fait courir, on le reçoit, on l’accueille et l’on devient son ami sans plus de façons.
Lucien avait tressailli à ces dernières paroles.
– Maintenant, mes bons amis, poursuivit le marquis de Rouquerolles, si un beau matin on vient vous dire : ce monsieur est un filou, ou un escroc… ou le fils d’une courtisane célèbre… l’or qu’il dépense est l’or de sa honte… que répondrez-vous ?
– Tu vas bien loin, Rouquerolles, dit un jeune homme.
– Tant pis ! répondit le marquis épris des charmes d’Aspasie, le rôle d’exécuteur est quelquefois très honorable.
Lucien était un peu pâle.
Cependant il demeura calme et dit avec douceur en regardant le marquis :
– Qui donc voulez-vous exécuter, Rouquerolles ?
– Un homme qui porte un nom d’emprunt.
– Il y en a beaucoup comme cela dans le monde.
– Un homme qui ne saurait indiquer la source de sa fortune.
Lucien eut un léger frémissement. Mais il se contint encore.
– Un homme enfin, acheva le marquis, que je suppose être le fils d’une courtisane, et s’il ne me prouve pas le contraire…
Lucien se leva à ces derniers mots. Mais il ne prononça pas un mot et attendit.
Seulement, son attitude était effrayante, et tous ceux qui l’entouraient et avaient entendu les dernières paroles de Rouquerolles, comprirent qu’un drame terrible allait se jouer.
VI
Pendant quelques secondes, on eût entendu voler une mouche dans le salon.
Un silence de mort s’était fait.
M. de Rouquerolles le rompit le premier.
– Je n’accuse pas, dit-il, sans donner à ceux que j’accuse le droit de se défendre.
– Qui donc accusez-vous ? demanda Lucien.
– Vous, dit froidement le marquis.
Ce fut l’étincelle qui met le feu à la mine et amène aussitôt l’explosion.
– Marquis, dit Lucien, il me faut tout votre sang, et je vous tuerai demain.
– C’est votre droit, répondit le marquis.
– Mais, reprit Lucien, auparavant, je veux que vous posiez nettement votre accusation.
– Vous y tenez ? fit M. de Rouquerolles avec une raillerie écrasante.
– Oui.
– Vous vous appelez non Lucien de Haas, mais Lucien tout court.
– Après ?
– Vous n’avez pas d’autre nom.
– Après ?
– Vous êtes bâtard…
– Vous n’en savez rien, ni moi non plus.
– Vous êtes le fils de quelque femme perdue…
– Assez ! s’écria Lucien.
Et il bondit vers le marquis et le frappa au visage.
Puis se tournant vers les assistants douloureusement émus :
– Messieurs, dit-il, cet homme qui, hier encore, se disait mon ami, à qui je n’ai fait aucun mal, vient de commenter lâchement le secret de ma naissance.
Un pareil outrage ne se lave qu’avec du sang. C’est affaire à moi et non à d’autres.
Mais j’ai vécu parmi vous, et depuis que vous me connaissez, quelqu’un peut-il me reprocher une action quelconque qui ne soit pas celle d’un galant homme ? Non, n’est-ce pas ?
– Assurément non, murmurèrent plusieurs voix.
– Je te tiens pour le plus loyal et le meilleur des hommes, dit Paul de Vergis. On t’a insulté, je serai ton témoin. Quel est mon second, messieurs ?
Mais alors, il se passa une chose inouïe.
Personne ne répondit : Moi ! Personne ne s’offrit pour assister Lucien sur le terrain.
Et le malheureux jeune homme jeta un cri et appuya ses deux mains convulsives sur sa poitrine, comme s’il eût été frappé à mort.
– Ma mère ! murmura-t-il, ma mère ! vous que je ne connais pas, mais que je revois belle, souriante et majestueuse comme une fille de roi, dans mes souvenirs d’enfant, ma mère ! il ne se présentera donc personne pour voir votre fils vous venger ?
Et comme il disait cela, un nouveau personnage entra dans le fumoir.
C’était un homme de trente-huit à quarante ans, d’une beauté pâle et triste, portant des moustaches, et ayant une redingote à brandebourgs boutonnée militairement.
– Bon ! murmura quelqu’un, en voici bien d’une autre. Les morts reviennent.
– Et les vivants arrivent de voyage, répondit l’homme aux brandebourgs.
Ce personnage, sur qui venait de se concentrer l’attention générale, avait été, sept ou huit mois auparavant, le héros et la victime momentanée d’une singulière méprise.
On le nommait le major Avatar.
Officier russe, longtemps prisonnier de Schamyl au Caucase, le major avait été présenté au Club des Asperges par le marquis de B…
Pendant plusieurs semaines, l’hôte forcé de l’émir de Circassie avait été le lion de Paris.
On avait écouté et redit avec enthousiasme les récits de sa captivité, on s’était raconté ses aventures romanesques.
Puis, un matin, le major Avatar avait été arrêté et le bruit s’était répandu que l’officier russe n’était autre qu’un forçat célèbre du nom de Rocambole, évadé quelques mois auparavant du bagne de Toulon.
Paris avait été en grand émoi pendant plusieurs jours. Puis la lumière s’était faite.
Une grande dame, une femme célèbre jadis sous le nom de Baccarat, avait déclaré que le major Avatar ne ressemblait nullement à Rocambole.
La parole de la comtesse Artoff n’était mise en doute par personne.
Le major Avatar s’était trouvé réhabilité, et plus que jamais le Club des Asperges s’était montré fier de le posséder dans son sein.
C’était donc le major Avatar qui arrivait.
– Messieurs, dit-il froidement, que se passe-t-il donc parmi vous ? Il me semble que l’on est un peu agité ici.
– Major, dit M. Paul de Vergis, je vais vous mettre au courant d’un seul mot. Mon ami M. Lucien de Haas a donné un soufflet au marquis de Rouquerolles.
– Bien.
– Je suis l’un des témoins de Lucien.
– Et vous en cherchez un second ?
– Justement.
– Ne cherchez plus, dit le major Avatar. J’accepte la mission.
Lucien s’avança vers lui les mains tendues.
– Monsieur, cria M. de Rouquerolles, dans ma famille on n’a jamais dormi sur un soufflet en guise d’oreiller. Il fait un beau clair de lune au Bois. Qu’en pensez-vous ?
– Je suis à vos ordres, dit Lucien.
– À l’épée, jusqu’à ce que mort s’en suive, poursuivit M. de Rouquerolles.
– Je l’entends bien ainsi, répondit Lucien.
* *
*
Dix minutes après M. de Rouquerolles et deux de ses amis montaient en voiture.
Lucien, M. de Vergis et le major Avatar les imitaient et les deux adversaires roulaient vers le Bois avec leurs témoins respectifs.
– Mais quel a donc été le point de départ de la querelle ? demanda le major Avatar, c’est-à-dire Rocambole, car c’était bien lui.
– Le marquis a insulté ma mère, répondit Lucien.
Rocambole avait ce tact exquis que donne l’habitude de la haute vie.
En demander plus long eût été une insulte.
– C’est bien, dit-il, je vous comprends.
M. de Vergis demeurait rue du Colysée.
On passa chez lui pour y prendre des épées.
À deux heures du matin on arrivait au Bois, par la grande grille de l’avenue de l’Impératrice, la seule qui ne ferme pas la nuit.
À pareille heure, le Bois est désert, les gardiens sont couchés, et pour peu qu’il fasse un beau clair de lune, l’esplanade qui s’étend au nord du premier lac est l’endroit le plus commode pour un duel.
Ce fut là que les fiacres s’arrêtèrent.
L’irritation des deux adversaires était telle qu’il ne fallait pas songer à prolonger les préliminaires.
On tira les épées au sort.
Le sort fut favorable à M. de Rouquerolles.
C’est-à-dire qu’il devait se battre avec ses épées.
Le froid était si piquant qu’il fut convenu qu’on se battrait en redingote.
– Allez, messieurs, dit le major Avatar.
Lucien et M. de Rouquerolles s’attaquèrent avec fureur.
Tous deux étaient braves, tous deux tiraient merveilleusement bien.
Pendant deux minutes, on n’entendit que le cliquetis du fer froissant le fer ; puis, tout à coup, Lucien adressa la parole au marquis :
– Monsieur, lui dit-il, dans quelques secondes l’un de nous sera mort ; me refuserez-vous, à ce moment suprême, de me dire quel mobile a pu vous déterminer ainsi ?
– Aspasie m’a promis de m’aimer, si je vous tuais, répondit le marquis.
Et il se fendit, et son épée disparut dans la poitrine de Lucien.
Mais Lucien ne tomba point ; Lucien ne laissa point échapper son épée, et comme M. de Rouquerolles se mettait vivement en garde, Lucien murmura :
– Aspasie n’aura pas à tenir sa promesse, à moins qu’elle ne vous pleure.
Il se fendit à son tour, et le marquis jeta un cri et tomba roide mort.
Alors Lucien s’affaissa lentement sur lui-même en vomissant une gorgée de sang.
VII
Avant d’aller plus loin et pour la plus complète intelligence de notre récit, disons tout de suite comment le major Avatar s’était trouvé, à point nommé, au Club des Asperges pour servir de témoin à M. Lucien de Haas.
Pour cela il faut nous reporter au moment où, se disant médecin, Rocambole était entré dans le château de Rochebrune, sur les pas de Jacquot.
Jacquot s’était empressé de conduire Rocambole auprès du vieux Bob mourant.
On avait couché l’intendant tout vêtu sur le même lit qu’avait occupé milady pendant la nuit.
Son habit rouge, le masque de cire et les chaînes qui gisaient à terre, objet de l’étonnement de Jacquot, de Marianne la cuisinière et du valet de chambre Saturnin, lesquels ne pouvaient comprendre pourquoi Bob s’était habillé ainsi, donnèrent au contraire à Rocambole, qui avait le récit de Vanda présent à l’esprit, le mot de l’énigme.
Bob était le spectre qui était apparu à Vanda croyant avoir affaire à milady.
La blessure de Bob s’expliquait tout aussi naturellement.
Milady avait découvert qu’elle était mystifiée, et la balle qui avait frappé le prétendu spectre avait été dirigée par elle ou par le mystérieux compagnon que Jacquot avait vu partir avec elle le matin.
Dès lors Rocambole se dit :
– Cet homme qui jouait un pareil rôle et ordonnait, au nom de la tombe, de restituer la fortune volée, est demeuré fidèle aux héritiers spoliés, c’est-à-dire à Gipsy.
Cet homme me dira tout et je pourrai continuer son œuvre.
Rocambole avait observé tout cela en un clin d’œil, et avant même que Bob eût tourné vers lui son œil mourant.
Il ne mentait d’ailleurs qu’à moitié en se disant médecin, car il avait hérité d’une partie des connaissances chirurgicales de sir Williams, son premier maître, et il savait, au besoin, débrider une plaie et pratiquer une amputation.
Il examina le blessé, sonda le trou de la balle et demeura impassible.
– Est-ce qu’il mourra, monsieur ? demanda Jacquot.
– Je ne sais pas, répondit brusquement Rocambole, mais il faut me donner les objets nécessaires à un premier pansement.
Après nous verrons…
Bob avait repris connaissance, les dernières paroles de Rocambole allumèrent un éclair d’espérance dans ses yeux vitreux.
Était-ce l’amour instinctif de la vie qui se réveillait en ce moment ?
Était-ce un désir de vengeance ?
Peut-être l’un et l’autre, car il se prit à regarder Rocambole avec cette avidité anxieuse de l’homme qui attend sa destinée d’un mot.
Rocambole se fit apporter une aiguière d’eau froide, lava la plaie, ouvrit une petite trousse de voyage qu’il avait toujours sur lui et pratiqua l’extraction de la balle.
Puis, il appliqua un premier pansement et dit alors à Jacquot et aux autres domestiques :
– J’ai besoin d’être seul avec le malade.
Tous trois sortirent.
Alors Rocambole alla fermer la porte au verrou et revint s’asseoir au chevet de Bob.
Bob balbutia quelques mots à peine articulés.
– Je crois que je vais mourir, disait-il.
– Votre blessure est grave, dit Rocambole, je n’affirmerais pas qu’elle ne fût pas mortelle, mais vous avez encore une heure ou deux à vivre, bien certainement.
L’œil de Bob continuait à rayonner.
Rocambole comprit qu’il fallait aller vite en besogne et ne pas se laisser distancer par la mort.
Ce qu’il voulait, c’étaient des révélations, et, pour les obtenir, il fallait au plus vite gagner la confiance de Bob.
Aussi lui dit-il en anglais :
– Je vous apporte des nouvelles de Gipsy la bohémienne, monsieur Bob.
À ces mots résonnant dans sa langue maternelle, à ce nom, retentissant tout à coup à son oreille, Bob se dressa, par un effort suprême, sur son séant et regarda Rocambole d’un air effaré.
– Gipsy… balbutia-t-il, Gipsy !
– Oui, la nièce de miss Ellen.
– Miss Ellen ! continua Bob frissonnant, qui parle de miss Ellen ?
– Moi.
– Qui donc êtes-vous ? murmura le vieil intendant.
– Un homme qui veut, comme vous, forcer les voleurs à restituer.
– Ah ! vous connaissez donc Gipsy ?
– Je l’ai sauvée, il y a quinze jours, des mains des Étrangleurs.
À ce mot d’Étrangleurs, Bob devint affreusement pâle :
– Taisez-vous !… ne me parlez pas d’eux ! fit-il avec fureur.
Puis, il eut un accès de défiance subite :
– Oh ! je ne vous crois pas, dit-il.
– Vous ne… me croyez pas ?…
– Non.
– Pourquoi ? demanda Rocambole avec douceur.
– Parce que c’est milady qui vous envoie. Vous voulez savoir… vous ne saurez rien…
Rocambole prit la main du vieillard :
– Vous ne voulez donc pas que je continue votre œuvre ? lui dit-il.
Bob secoua la tête :
– Milady et ses complices tiennent le monde, dit-il. Franz est avec elle… Franz l’assassin !…
Il eut un éclat de rire sardonique et ajouta :
– Le major Hoff, comme on l’appelle !
Ce nom tomba dans l’oreille de Rocambole pour n’en plus sortir.
– Monsieur Bob, dit encore Rocambole avec douceur, vous me croyez donc un complice de milady ?
– Oui.
– Et si je vous prouvais le contraire ?…
Bob le regarda avec un reste de défiance. Cependant une lueur d’espoir brilla dans son œil.
– Un homme et une femme ont passé la nuit ici, avant-hier.
Bob tressaillit.
– Vous savez cela ? dit-il.
– C’est la femme qui m’a tout dit… et c’est pour cela que je suis venu…
Le regard de Bob cessa d’être défiant.
Mais il se fixa sur le visage hardi et résolu de Rocambole, comme s’il eût voulu contrôler l’énergie et la force d’âme qu’il annonçait.
– Pourquoi vous intéressez-vous à Gipsy ? demanda-t-il.
Rocambole comprit qu’il fallait faire un mensonge.
– Parce que je l’aime, murmura-t-il.
Ce mot détourna les dernières défiances de Bob.
– Je vous crois, dit-il, mais aurez-vous la force de lutter contre milady ?
– Oui.
L’accent de Rocambole était résolu. Son œil brillait d’une énergie sombre et continue.
Bob avait foi en lui.
– Je vais mourir, murmura-t-il, et je n’aurais pas le temps de parler… mais j’ai écrit… toute l’histoire de miss Ellen…
– Où est-elle ?
– Dans une chambre… là-haut… sous la dalle du foyer…
La voix du mourant s’éteignait ; son regard s’obscurcissait. Le délire était proche…
Rocambole courut à un cordon de sonnette qu’il secoua violemment.
Jacquot parut.
– Tu vas me conduire dans la chambre où couchait M. Bob, dit Rocambole au petit groom.
Bob rouvrit les yeux et son regard se fixant sur Jacquot confirma l’ordre que Rocambole donnait.
– Venez, monsieur le médecin, répondit Jacquot.
Rocambole le suivit.
VIII
Rocambole suivit donc Jacquot et arriva au deuxième étage du château.
La chambre que l’intendant Bob avait occupée durant six ans était une sorte de capharnaüm dans lequel personne ne pénétrait d’ordinaire et où régnait un désordre indescriptible.
Mais les indications qu’il avait données à Rocambole étaient trop précises pour que celui-ci s’amusât à fouiller les meubles et les placards.
Il alla droit à la cheminée et se baissa pour examiner la plaque de marbre.
À première vue, elle était parfaitement scellée et encastrée dans le parquet.
Néanmoins, après un minutieux examen, Rocambole trouva une fente dans l’un des angles, assez large pour laisser passer une lame de couteau.
Jacquot se tenait derrière Rocambole, immobile et se demandant ce que celui-ci allait faire.
Mais Rocambole commença par se tourner vers lui et le fixer avec ce regard d’autorité sous le poids duquel tout le monde se courbait.
– Comment te nomme-t-on ? dit-il.
– Jacquot, pour vous servir, monsieur.
– Es-tu de ce pays-ci ?
– Oh ! non, monsieur, je suis de Compiègne.
– Depuis combien de temps sers-tu dans cette maison ?
– Environ deux ans, monsieur.
– Tu vas te trouver sans place…
– Oh ! monsieur, fit Jacquot d’un ton pleureur, c’est-y Dieu possible, ce que vous dites-là ?…
– C’est la vérité, dit froidement Rocambole. Bob va mourir, et milady ne reviendra jamais au château.
– Vous croyez, monsieur ?
– J’en suis sûr.
– Qu’est-ce que vous me dites donc là, monsieur ? Je serais donc sans place ?
– Non, dit Rocambole, car j’ai besoin d’un domestique et je te prends à mon service.
Jacquot fit un bond de joie.
– Je t’emmènerai à Paris, poursuivit Rocambole.
– Ah ! monsieur…
– Mais à une condition.
– Oh ! tout ce que vous voudrez… D’ailleurs, je sais bien mon service.
– Ce n’est pas pour cela que je te prends.
– Pourquoi donc ? demanda Jacquot.
– Pour que, si nous rencontrons milady, tu me la désignes du doigt et me dises : c’est elle.
– C’est bien facile, dit naïvement Jacquot.
– Maintenant, as-tu un couteau ?
Le petit groom tira de sa poche un fort bel eustache à manche de corne et le tendit à Rocambole.
Celui-ci le prit et ajouta :
– A-t-on prévenu la justice ?
– Pour dire la vérité vraie, monsieur, personne n’y a encore songé.
– Eh bien ! descends aux cuisines et dis que le médecin craindrait que son malade ne mourût, si on allait chercher les gendarmes et le juge de paix trop vite.
– Oh ! monsieur, répondit Jacquot, il n’y a pas de danger qu’ils arrivent sitôt que ça : le chef-lieu de canton est à trois lieues d’ici et la commune la plus proche à deux lieues.
– N’importe, va toujours…
Jacquot s’en alla, laissant Rocambole seul dans la chambre de Bob.
Alors Rocambole s’agenouilla devant la plaque de marbre, ouvrit le couteau et en introduisit la pointe dans la fente qu’il avait remarquée.
Puis il exerça une pesée, mais inutilement.
Il pensa alors que la fente devait cacher un ressort, et il se mit à promener la pointe du couteau dans toute sa longueur.
En effet, il rencontra peu à peu un obstacle, quelque chose comme une vis creuse, et il appuya fortement.
Soudain la plaque de marbre bascula et s’ouvrit absolument comme le couvercle d’une boîte à surprise.
Alors Rocambole vit une petite cachette d’un pied de profondeur et dans cette cachette une boîte en fer dont il s’empara.
À son peu de pesanteur, il comprit qu’elle ne renfermait guère que le manuscrit dont lui avait parlé Bob.
Elle était fermée, et il paraissait difficile d’en forcer la serrure.
Rocambole ne perdit point de temps.
Il mit la boîte en fer dans la poche de son vaste paletot d’hiver, referma la plaque de marbre dont le ressort joua de nouveau, et redescendit au premier étage.
Bob agonisait.
Cependant, en voyant rentrer Rocambole, il eut un éclair de raison et le délire l’abandonna un moment.
Rocambole lui montra la boîte.
Un rayon de joie brilla dans l’œil du mourant.
Puis, il eut la force de porter la main à son cou. Après quoi il retomba sur son oreiller, poussa un profond soupir et mourut.
Mais Rocambole avait compris.
Bob portait au cou un petit cordon de soie auquel était suspendue une clé.
C’était la clé de la boîte de fer, et Rocambole la détacha. Puis il abaissa la paupière du mort et sonna.
Les domestiques arrivèrent et un regard jeté sur le lit leur fit comprendre que l’éternité venait de s’ouvrir pour le vieil intendant.
* *
*
Rocambole avait un passe-port parfaitement en règle, au nom du major Avatar.
Au lieu de quitter le château, immédiatement après la mort de Bob, il attendit, au contraire, l’arrivée de la justice, qui, vers le soir, se transporta au château.
Sa déposition fut d’une netteté parfaite.
Il était descendu à la station voisine pour satisfaire sa curiosité d’archéologue, car on lui avait signalé le manoir de Rochebrune comme un spécimen assez pur de l’architecture féodale.
Il s’était donc dirigé vers Rochebrune, et il avait trouvé à la porte un rassemblement de passants et de domestiques en grand émoi.
Comme il était un peu médecin, il avait cru devoir donner des soins au malade.
Malheureusement, la blessure était mortelle et la science impuissante.
Le major Avatar fut complimenté par le juge de paix qui se livra à une enquête.
Procès-verbal fut dressé de la fuite de milady, sur laquelle planaient les suppositions les plus graves, car Bob n’avait fait aucune révélation avant de mourir.
Enfin, on apposa les scellés sur toutes les chambres du château, et on déclara au major Avatar qu’il était libre de se retirer.
Rocambole quitta donc le château, vers huit heures du soir, en compagnie de Jacquot.
Le train de Paris passait à dix heures.
Jacquot fut installé dans un wagon ordinaire.
Rocambole prit un coupé pour lui seul.
Alors seulement, quand la locomotive eut repris sa course bruyante, Rocambole ouvrit la boîte de fer.
La boîte renfermait un petit cahier jauni, couvert d’une écriture serrée, mais très lisible.
Il était écrit en anglais.
Sous le cahier, il y avait un médaillon.
Ce médaillon renfermait un portrait de femme, ou plutôt de jeune fille, d’une incomparable beauté.
Dans un angle, on avait écrit en caractères microscopiques :
Miss Ellen Perkins, à seize ans.
Rocambole examina longtemps cette miniature, puis il déplia le cahier et lut :
HISTOIRE D’UNE PARRICIDE
IX
Le manuscrit de Bob était ainsi conçu :
Le Christmas de l’année 183… fut remarquable, même à Londres, par le brouillard intense et rougeâtre qui régna pendant deux jours, enveloppant les édifices, noyant les maisons, interceptant la circulation des voitures et forçant les policemen à échanger leur bâton contre une torche, qui fut, du reste, insuffisante à guider les passants attardés.
Dès cinq heures, la veille, tous les comptoirs, tous les magasins avaient été fermés dans la cité.
Les commis s’étaient retirés en souhaitant joyeux Noël à leurs patrons, et les patrons s’étaient dirigés vers leur demeure où le pudding et les gâteaux étaient prêts.
La Noël est, de toutes les fêtes, celle que les Anglais accueillent avec le plus d’empressement. C’est la fête de famille par excellence.
On ne va pas, durant le Christmas, chercher des plaisirs et des jouissances au dehors. Les théâtres font relâche, les rues sont désertes. Chacun reste chez soi.
Personne donc ne s’aperçut tout d’abord de ce brouillard, sans précédent peut-être, qui s’appesantissait sur Londres avec une instantanéité prodigieuse.
Vers neuf heures du soir, les cabs cessèrent de rouler : les passants, désespérant de pouvoir continuer leur chemin, se réfugièrent dans les public-houses encore ouverts et attendirent que le brouillard se dissipât un peu.
Mais le brouillard, au lieu de diminuer, allait s’épaississant toujours.
Seule, une jeune fille, bravant cet océan de brume, allait toujours droit devant elle, marchant d’un pas rapide, les mains en avant pour se garantir de quelque choc inattendu.
Un moment, cependant, elle s’arrêta devant la porte entr’ouverte d’un public-house et entra.
Les établissements de ce genre ne sont fréquentés que par le bas peuple.
Rarement un homme comme il faut ose s’y risquer.
Une lady, ou simplement la femme d’un bourgeois, n’en franchirait pas le seuil pour une couronne, fût-ce celle d’un empire.
Pourtant la jeune fille entra.
– Monsieur, dit-elle au tavernier, pourriez-vous me dire où je suis ?
– Vous êtes dans Charing-Cross, lui répondit cet homme, qui se prit à l’examiner avec une attention un peu étonnée.
En effet, la jeune fille, dont la beauté fière et hardie révélait du reste une patricienne, était vêtue comme le sont les jeunes miss qu’on rencontre dans le parc de Saint-James, à Covent-Garden ou à Drury-Lane.
– Merci, dit-elle. Je trouverai bien mon chemin.
Et elle fit un pas pour sortir.
Mais, en ce moment, un homme qui était assis dans le fond de la salle se leva, vint à elle et lui dit :
– Miss, le brouillard n’a point de secrets pour moi. Où que soit votre demeure, je me fais fort de vous y conduire.
La jeune fille regarda cet homme.
Il y a des sympathies instantanées, des attractions dont il est impossible de se rendre compte.
Quand elle eut regardé cet homme, la jeune Anglaise tressaillit.
Peut-être cet homme qui lui était inconnu avait-il obéi à un sentiment de même nature en quittant la table et venant faire ses offres de service.
C’était un homme d’environ trente ans, au visage bruni, aux yeux noirs et fascinateurs, aux dents aiguës et blanches comme celles des carnassiers.
Sa taille était à peine au-dessus de la moyenne.
Son costume, des plus simples, était celui d’un patron de barque ou d’un chef de timonerie, et se composait d’une vareuse et d’un petit chapeau ciré.
La patricienne, cependant, baissa les yeux sous son regard et elle balbutia quelques mots de refus.
Mais cet homme lui prit le bras et lui dit avec un ton d’autorité subite.
– Allons ! venez… je vais vous conduire…
Et il l’entraîna hors du public-house.
Chose bizarre ! la jeune fille s’était prise à trembler et pourtant elle ne chercha point à se dégager de l’étreinte de cet homme.
Elle était déjà au milieu du brouillard ; déjà la lueur du public-house s’effaçait, que la jeune fille n’avait pas encore songé à jeter un cri.
– Où demeurez-vous ? reprit-il.
– Dans Piccadilly.
– Venez…
– Mais, monsieur…
– Miss, dit cet homme étrange, vous pouvez vous fier à moi. Je suis un ami…
Sa voix était devenue harmonieuse et douce comme un chant, et la jeune fille tressaillit de plus belle.
– Un ami sûr et fidèle, acheva cet homme.
– Comment seriez-vous mon ami, monsieur, dit-elle en tremblant de plus en plus. Vous ne me connaissez pas !
– C’est possible, mais quand je vous ai vue entrer dans le public-house, il s’est passé en moi quelque chose d’indéfinissable et j’ai compris que sur un mot de vous je serai votre esclave à toujours.
– Monsieur…
L’homme à la vareuse osa lui serrer la main sous son bras.
– Je vous répète, dit-il, que je suis votre ami.
La jeune fille poussa un soupir et murmura :
– Aussi vrai que je m’appelle miss Ellen, je n’ai pas d’amis. Je suis une pauvre déshéritée.
– Une déshéritée, vous ?
– Oui, dit-elle, touchée de l’accent de douloureuse surprise avec lequel il avait fait cette question.
– Vous, reprit-il, si jeune, la fille d’un pair peut-être… vous… déshéritée ?
– Moi, dit-elle.
Cet homme bizarre s’arrêta tout à coup :
– Vous vous nommez miss Ellen ? dit-il.
– Oui.
– Dites-moi franchement pour qui vous me prenez, moi.
– Je ne sais pas, balbutia-t-elle.
– Me croiriez-vous un obscur matelot ?
Et sa main fine et petite caressa la main de miss Ellen, comme pour lui prouver qu’il n’avait jamais eu de profession ouvrière.
Elle tressaillait plus fort.
– Je vous dirai plus tard qui je suis, fit-il, mais je peux beaucoup…
– Je vous crois, dit-elle avec conviction.
– Vous êtes déshéritée, dites-vous ?
– Oui.
– Pourquoi ?
– Parce que je suis la cadette, que ma mère a été légère, que mon père ne m’aime pas et qu’il a en vertu des lois qui régissent la noblesse anglaise, assuré son immense fortune à mon cousin qui est fiancé à ma sœur.
– Ah ! vraiment ? fit l’inconnu, qui eut dans la voix comme un rugissement étouffé.
– C’est la vérité, murmura miss Ellen.
– Et vous subissez cette position humiliante ?
– Il faut bien accepter ce qu’on ne peut empêcher.
– Et s’il vous arrivait un ami du ciel ?…
– Du ciel ou de l’enfer, murmura miss Ellen, qui sentait s’éveiller en elle une haine subite et dont les instincts se révoltèrent.
L’inconnu lui prit la main :
– Regardez-moi bien, dit-il.
Ils étaient alors sous un bec de gaz, qui perçait assez vigoureusement le brouillard pour éclairer le visage du conducteur de miss Ellen.
– Miss Ellen, dit encore cet homme étrange, je vous aime…
– Oh ! fit-elle d’une voix étouffée…
– Je vous aime… et je vous veux riche… et je veux abaisser ceux qui vous ont foulée aux pieds… Quel est le nom de votre père, miss Ellen ?
– Le commodore Perkins.
– C’est bien, dit l’inconnu, vous entendrez parler de moi…
Nous voici dans Piccadilly : appelez ce policeman dont vous apercevez la torche dans le brouillard, il vous remettra dans votre chemin.
Au revoir, miss Ellen… au revoir… je vous aime.
Et il osa la prendre par la taille et lui mettre aux lèvres un baiser brûlant.
Miss Ellen jeta un cri…
Mais déjà l’homme avait disparu dans la brume épaisse que la lumière du gaz était impuissante à dissiper.
X
Quelles furent les suites de cette rencontre ? continuait le manuscrit de Bob.
Ce fut et ce sera toujours sans doute un mystère.
Mais à quelques mois de là, on eût retrouvé miss Ellen dans un vieil hôtel de Glasgow, en Écosse, auprès de son père, le commodore Perkins.
Le commodore était presque un vieillard.
Il s’était marié aux environs de la cinquantaine, avec une jeune femme qui était morte presque subitement en donnant le jour à sa seconde fille, c’est-à-dire à miss Ellen.
L’aînée se nommait miss Anna.
Le vieil officier l’adorait. Il aimait peu miss Ellen. Il éprouvait même pour elle une sorte d’aversion.
Quelques personnes, mal intentionnées sans doute, avaient prétendu que miss Ellen était un enfant de l’amour et que le commodore était étranger à sa naissance.
Donc, quelques mois après cette étrange rencontre qu’elle avait faite dans les rues de Londres, la veille du Christmas, nous eussions retrouvé miss Ellen à Glasgow.
Le commodore était Écossais d’origine.
Tant qu’il avait été en activité de service, il avait habité, durant ses congés, un hôtel dans Piccadilly, à Londres.
Mais, depuis cinq mois qu’il était à la retraite, il était venu à Glasgow habiter la vieille maison paternelle.
L’époque du mariage de miss Anna approchait.
Son cousin, lord Evandah, en était fort épris, et il avait tant tourmenté le vieux commodore que celui-ci, bien que miss Anna n’eût que dix-sept ans, avait consenti à abréger le temps fixé d’une année.
Miss Anna était partie pour Londres avec son fiancé et sa dame de compagnie pour faire les emplettes de sa corbeille de mariage.
Miss Ellen était demeurée seule auprès de son père.
Miss Ellen était bien changée.
Ses fraîches couleurs avaient fait place à une pâleur morbide, ses yeux étaient cernés ; elle marchait avec peine, se plaignait de vives souffrances, et en avait pris prétexte pour ne plus s’habiller.
Sans cesse enveloppée dans une ample robe de chambre, elle passait ses journées couchée sur une bergère, dans la grande salle de cette vaste et triste demeure où le commodore s’était confiné.
Du reste, le commodore Perkins s’occupait fort peu de miss Ellen, lui demandait à peine de ses nouvelles une fois chaque jour, et ne songeait qu’à l’arrivée du courrier de Londres qui lui apportait chaque jour une lettre de sa chère miss Anna.
Le domestique du commodore était peu nombreux.
Il se composait d’un intendant nommé Bob et de sa femme, d’un valet de chambre appelé Franz, qui était d’origine allemande, et de quelques serviteurs subalternes qui ne quittaient point les cuisines et n’arrivaient jamais jusqu’aux maîtres.
Franz paraissait fort dévoué à miss Ellen.
Cependant il n’était au service du commodore que depuis quelques mois.
Son arrivée avait même suivi de peu de jours la rencontre que miss Ellen avait faite de l’inconnu dans le public-house.
Franz partait chaque jour, à la même heure, et se rendait à la poste-restante d’où il rapportait souvent une lettre qu’il remettait en cachette à miss Ellen.
Quelquefois, en lisant ces lettres, miss Ellen pleurait abondamment.
Un soir, le commodore s’était assoupi dans un grand fauteuil au coin de la cheminée.
Miss Ellen souffrait plus que de coutume.
Elle voulut quitter sa bergère, mais ses forces la trahirent et elle ne put que jeter un cri.
À ce cri, le commodore s’éveilla.
– Qu’avez-vous donc, ma chère ? dit-il d’un ton de mauvaise humeur.
– Rien… balbutia-t-elle. Une douleur au cœur… peut-être… et un nouveau cri lui échappa.
Le commodore tira un cordon de sonnette.
Franz entra.
Il échangea avec sa jeune maîtresse un coup d’œil rapide, et sans doute qu’elle comprit l’éloquence de son regard, car elle eut l’héroïsme d’étouffer un cri et de ramener sur son visage un calme menteur.
– Votre sœur se marie dans un mois, dit brusquement le commodore. Tâchez de ne pas être malade, à cette époque.
– Je tâcherai, murmura miss Ellen.
Mais elle jeta, à la dérobée, un regard de haine à son père.
Celui-ci se leva, prit sa canne et son chapeau et dit encore d’un ton dur :
– Il est tard… je vous engage à rentrer dans votre chambre et à passer une bonne nuit.
Miss Ellen ne répondit pas.
Le commodore sortit du salon et regagna son appartement.
Mais à peine eut-il laissé sa fille seule que celle-ci se mit à pousser des cris.
Franz revint.
– Mettez votre mouchoir dans votre bouche, lui dit-il, et mordez-le… ou nous sommes perdus…
Ces paroles firent éprouver à miss Ellen une telle épouvante qu’elle cessa de crier, regarda Franz d’un œil hébété et lui dit :
– Crois-tu donc que l’heure approche ?
Franz fit un signe affirmatif.
– Mon Dieu ! murmura-t-elle affolée… et lui… qui ne vient pas !…
– Il sera ici avant trois jours.
Et Franz prit miss Ellen dans ses bras.
Elle poussa un nouveau cri. Mais ce fut le dernier. Elle avait mis son mouchoir dans sa bouche et le mordait avec fureur.
Franz l’emporta comme il eût fait d’un enfant.
– Votre chambre est trop près de celle de votre père, dit-il. Je vais vous transporter au second étage.
* *
*
Le commodore Perkins avait, comme on a pu le voir, une haine instinctive pour miss Ellen.
Cependant à de certaines heures, quand l’expression de cette haine était allée trop loin, il se calmait et avait honte de sa conduite.
Ce soir-là, quand il se fut mis au lit, il se souvint d’avoir rudoyé la jeune fille et il en eut des remords.
Au bout d’une heure qu’il eut éteint la bougie, il n’avait point encore fermé l’œil.
Tout à coup il lui sembla que des plaintes étouffées arrivaient jusqu’à lui.
Le commodore se dressa sur son séant.
Les plaintes étaient plus distinctes.
Il se leva, passa sa robe de chambre, alluma un flambeau et se dirigea vers la chambre de miss Ellen.
La chambre était vide.
Les plaintes paraissaient venir de l’étage supérieur.
Le commodore, la sueur au front, gagna l’escalier, arriva dans un corridor et toujours guidé par ces cris étouffés qui venaient mourir à son oreille, il s’approcha d’une porte qui était entr’ouverte et par laquelle s’échappait un filet de lumière.
Puis il poussa cette porte…
Alors il eut sous les yeux un étrange spectacle.
Miss Ellen se tordait sur un lit sans autre assistance que Franz, dans les suprêmes douleurs de la maternité.
Et le commodore jeta un cri terrible et tomba à la renverse en murmurant :
– Misérable !
* *
*
Comme Rocambole arrivait à cet endroit du récit de Bob, le train entrait dans la gare de Paris. Il était minuit.
Rocambole remit à plus tard la suite de sa lecture et fourra le manuscrit dans sa poche.
Puis, en sortant de la gare, il monta dans une voiture de place et se fit conduire rue Saint-Lazare.
C’était là qu’il avait loué, au nom du major Avatar, un petit appartement.
Jacquot avait grimpé à côté du cocher.
Rocambole arriva chez lui.
Mais il ne se mit point au lit, il ne continua point la lecture du manuscrit qu’il serra précieusement dans le tiroir d’un secrétaire.
Tout au contraire, il se débarrassa de ses habits de voyage et fit une toilette de ville en se disant :
– Je crois bien que Bob, en mourant, a désigné Franz sous le nom du major Hoff.
Or, le major Hoff est du Club des Asperges dont je fais partie.
Allons-y !
XI
On sait ce qui s’était passé.
Rocambole, redevenu le major Avatar, était entré au Club des Asperges , cherchant des yeux ce mystérieux personnage qu’on appelait le major Hoff et qu’il se souvenait avoir vu.
Mais le major n’y était pas.
En revanche, Rocambole avait assisté aux dernières phases de la querelle de Lucien avec le marquis de Rouquerolles, consenti à servir de témoin au premier, et il était parti pour le bois de Boulogne.
Le marquis, nous l’avons dit, était tombé raide mort, l’épée de Lucien avait rencontré le cœur.
Mais Lucien s’était affaissé sur lui-même, en vomissant une gorgée de sang.
Lucien paraissait dans un état désespéré.
Tandis que les témoins du marquis cherchaient en vain à rappeler ce dernier à la vie, Rocambole et M. de Vergis avaient pris Lucien dans leurs bras et l’avaient transporté dans le fiacre qui les avait amenés.
– Au pas ! dit Rocambole au cocher.
Puis se tournant vers M. de Vergis.
– Nous allons chez lui, n’est-ce pas ?
– Non, dit le jeune officier, chez moi, rue du Colysée…, c’est plus près.
Lucien respirait encore, et il n’avait point perdu connaissance.
– Je crois que je suis frappé à mort, dit-il.
– Monsieur, lui répondit Rocambole avec émotion, on meurt tout de suite d’un coup d’épée… ou on n’en meurt pas… ne parlez point… et espérez…
M. de Vergis pleurait et tenait les mains de son malheureux ami.
Le trajet fut long, car il était nécessaire, ainsi que l’avait recommandé Rocambole, d’aller au pas.
Il parut plus long encore à ce dernier.
Rocambole était sous le poids d’une émotion subite, inattendue et presque inexplicable.
Ce jeune homme à qui il avait servi de témoin, par pure complaisance, qui lui était inconnu deux heures auparavant, ce jeune homme qui peut-être allait mourir avant le lever du soleil, lui inspirait une vive sympathie.
Pourquoi ?
Le cœur humain est plein de ces mystères.
On arriva rue du Colysée.
M. de Vergis habitait un charmant petit entresol dans un vieil hôtel, entre cour et jardin.
Son valet de chambre qui, sur son ordre, avait attendu descendit en toute hâte apportant un fauteuil.
On y plaça le blessé.
Puis Rocambole et M. de Vergis le portèrent, montant lentement l’escalier, et s’arrêtant chaque fois que le sang s’échappait de la bouche de Lucien.
Enfin on arriva dans l’appartement et Lucien fut placé sur le lit de son ami.
M. de Vergis dit au valet :
– Prends le fiacre qui est resté à la porte et cours chercher le docteur P… qui demeure au coin de la rue d’Angoulême.
Rocambole déshabilla le blessé.
Il était un peu chirurgien, comme on sait, et il avait vu et reçu tant de coups d’épée en sa vie, qu’il s’y connaissait.
Avant l’arrivée du médecin qui se fit un peu attendre, du reste, Rocambole avait examiné la blessure et reconnu qu’elle n’était pas mortelle.
L’épée avait glissé sur une côte, opérant une large déchirure et provoquant une hémorragie violente, mais aucun organe essentiel ne se trouvait lésé.
M. de Vergis attendait avec une anxiété mortelle que Rocambole se prononçât.
Par contre, le blessé était calme.
– Monsieur, lui dit Rocambole, ou je me trompe fort, ou je puis vous prédire que vous serez sur pied avant un mois.
– Merci, dit Lucien, sur les lèvres de qui glissa un sourire de gratitude.
Le médecin arriva et confirma de tous points le diagnostic de Rocambole.
Ce dernier ne voulut point se retirer.
Nous l’avons dit, Lucien lui inspirait une sympathie mystérieuse.
Il s’arrangea dans un fauteuil pour passer le reste de la nuit au chevet du blessé.
Le médecin avait pareillement interdit au blessé de prononcer un mot.
Quant à M. de Vergis, il était trop l’ami de Lucien pour donner au major Avatar le moindre renseignement sur les causes du duel.
Les bruits qui avaient couru sur la naissance de Lucien ne s’étaient déjà que trop propagés.
Le jeune officier se borna donc à dire à Rocambole que son malheureux ami était sur le point de se marier, et qu’il ne savait comment annoncer cette fatale nouvelle à sa fiancée.
Le blessé s’était assoupi, après avoir eu quelques minutes de fièvre.
– Savez-vous où demeure la jeune fille qu’il doit épouser ? demanda Rocambole.
– Oui.
– Eh bien ! vous me le direz, je me charge de tout.
Le reste de la nuit s’écoula, le jour vint, et avec les premiers rayons de soleil, le blessé s’éveilla.
Rocambole était toujours à son chevet, le regardant et paraissant abîmé en une sorte de contemplation.
Lucien avait la pâleur morte d’une femme.
– À qui donc ressemble-t-il ? murmurait à part lui Rocambole. Je suis pourtant bien certain de l’avoir vu hier pour la première fois… mais il a, avec quelqu’un que j’ai connu… homme ou femme… une ressemblance singulière.
Lucien, d’un sourire, le remercia de sa sollicitude.
– Monsieur, lui dit Rocambole, vous avez passé une bonne nuit, et je vous le répète, votre état n’inspire aucune inquiétude grave ; je puis donc me retirer, je viendrai prendre de vos nouvelles ce soir.
Et Rocambole s’en alla.
M. de Vergis l’accompagna jusque dans l’antichambre et lui donna l’adresse de Marie Berthoud.
La jeune fille et son père demeuraient toujours rue de la Sourdière.
Seulement, lorsque Lucien les avait retrouvés, il avait voulu qu’ils descendissent au premier étage, où il leur avait meublé un appartement convenable.
– Puisque je me suis embarqué dans cette aventure, murmura Rocambole, allons jusqu’au bout. Après, nous nous occuperons des affaires de Gipsy et de miss Cécilia.
Et, au lieu de rentrer chez lui, il s’en alla à pied par les boulevards et la rue de Rivoli, fumant un cigare, et respirant le grand air du matin.
Et, tout en marchant, Rocambole se répétait cette question singulière :
– Mais à qui donc ressemble ce jeune homme ?
Il arriva rue d’Alger, prit la rue Saint-Honoré qui n’était encore envahie que par les balayeurs, les hôtes ordinaires du matin, et il s’apprêtait à entrer rue de la Sourdière, lorsque tout à coup il s’arrêta et éprouva même une subite émotion.
Un homme entrait, comme lui, dans la rue de la Sourdière, marchant avec lenteur et paraissant chercher un numéro.
Cet homme, Rocambole le reconnut sur-le-champ.
C’était bien le personnage qu’au Club des Asperges on désignait sous le nom du major Hoff.
Rocambole l’avait vu autrefois, avant la fin tragique du vicomte Karl de Morlux.
Que venait faire cet homme dans la rue de la Sourdière à cette heure matinale ?
Il passa sans voir Rocambole, tant il paraissait préoccupé.
Du reste, il portait à la main un petit paquet, assez semblable à une boîte enveloppée dans du papier.
Rocambole le vit s’arrêter à la porte de la maison du numéro 17.
C’était précisément la maison habitée par la fiancée de Lucien de Haas.
Il hésita un moment, puis s’engouffra dans l’allée humide et sombre de la maison.
Alors Rocambole traversa la rue et passa rapidement devant la porte.
Le major Hoff causait avec la concierge et lui disait :
– N’est-ce pas ici que demeure Mlle Marie Berthoud ?
– Oui, monsieur.
– Avec son père ?
– Précisément.
– Voilà pour elle, dit le major.
Et il posa le paquet sur la table de sa loge, tandis que Rocambole passait rapidement devant la porte.
XII
– Que peut avoir de commun le major Hoff avec Mlle Marie Berthoud, la fiancée de Lucien de Haas ?
Telle était la question que se posait Rocambole, qui s’était effacé dans l’ombre d’une allée voisine.
Le major Hoff, qui, si on en croyait le manuscrit de Bob, n’était autre que Franz qui avait jadis aidé à la délivrance de miss Ellen, à Glasgow, – le major Hoff, disons-nous, ne s’arrêta que quelques minutes dans la loge de la concierge.
Cependant il eut le temps de lui adresser cette question que Rocambole entendit parfaitement.
– À quelle heure sort mademoiselle Berthoud ?
– Monsieur, répondit la concierge, depuis que Mademoiselle a une bonne et qu’elle est pour se marier, elle ne sort plus le matin, comme elle faisait autrefois pour chercher de l’ouvrage ou en rapporter à son magasin.
– Ah ! fit le major. Mais ne va-t-elle pas tous les jours se promener aux Tuileries avec son père ?
– Quand il fait beau, oui, monsieur.
– C’est bien, voilà pour vous…
Et le major jeta un louis sur la table.
La concierge salua jusqu’à terre.
– Il est inutile, n’est-ce pas, ajouta le major, de vous prier de ne point parler de tout cela à Mlle Berthoud ?
La concierge fit un signe d’intelligence et le major sortit.
Il passa près de Rocambole sans le voir.
Rocambole avait entendu les quelques mots échangés entre la concierge et le major.
– Je trouverai Mlle Berthoud dans une heure aussi bien qu’à présent, se dit-il, le plus important est de suivre le major.
Et il le suivit en effet.
Le major prit la rue Saint-Hyacinthe, celle du Marché-Saint-Honoré où se trouve une station de voitures et monta dans un fiacre en disant au cocher :
– Au Grand-Hôtel !
C’était tout ce que voulait savoir Rocambole.
Si le major, ce qui était probable, n’habitait pas au Grand-Hôtel, du moins il allait y voir quelqu’un.
Or, ce quelqu’un pourrait bien être milady.
En effet puisque, selon toute apparence la châtelaine de Rochebrune avait eu Franz pour complice dans le meurtre de l’intendant Bob, – selon toute apparence aussi, puisque Franz était à Paris, milady s’y trouvait.
Rocambole se faisait toutes ces réflexions et les résolvait une à une, tout en prenant, à pied, la rue Neuve-des-Capucines qui, on le sait, aboutit au boulevard non loin du Grand-Hôtel.
Seulement, il en revenait toujours à celle-là dont il ne trouvait pas la solution immédiate :
– Que pouvait avoir de commun le major Hoff avec Mlle Marie Berthoud ?
Et, tout à coup, Rocambole tressaillit et une grande lumière se fit dans son esprit.
Si l’on en croyait le manuscrit de Bob, miss Ellen, c’est-à-dire milady avait eu un enfant.
Cet enfant n’était-il pas M. Lucien de Haas ?
Rocambole sentit quelques gouttes de sueur perler à son front.
Il songeait à Lucien si brave, si bon, si sympathique et qui était peut-être le fils de ce monstre qui avait assassiné son père et sa sœur et dépouillé la malheureuse Gipsy.
Et, malgré lui, un rapprochement se fit dans son esprit :
Il compara milady à l’infâme vicomte Karl de Morlux, Lucien à ce brave et loyal Agénor qui était devenu l’heureux époux d’Antoinette.
Et Rocambole qui avait songé un moment à pénétrer dans le Grand-Hôtel, à suivre si obstinément le major Hoff et à chercher milady, Rocambole rebroussa chemin, ou plutôt il traversa le boulevard et prit la rue Caumartin pour se rendre chez lui, rue Saint-Lazare.
Il voulait éclaircir un dernier doute ; il voulait avoir le cœur net de cette vague ressemblance que Lucien lui paraissait avoir avec quelqu’un qu’il avait déjà vu.
Le major Avatar s’était, nous l’avons dit, installé à son retour de Londres, dans un petit appartement de la rue Saint-Lazare.
Il avait pris un valet de chambre.
Ce valet de chambre, un vieillard, n’était autre que Milon.
Milon avait revêtu une belle livrée en drap bleu, toute chamarrée d’or, et il avait une mine superbe dans son antichambre.
Le petit Jacquot l’admirait naïvement et s’étonnait cependant que son nouveau maître l’eût pris à son service puisqu’il n’avait pas de chevaux.
– Il faut prendre patience, mon garçon, M. le major est en train de monter ses écuries.
Rocambole, en entrant chez lui, trouva donc Milon qui l’attendait.
Milon lui dit :
– Vanda est venue.
– Ah ! fit Rocambole. Quand donc ?
– Il y a dix minutes. Elle ne reviendra pas aujourd’hui, mais elle pense pouvoir s’échapper vers minuit, heure où sir James Nively doit être présenté dans un club. Elle m’a remis ce billet pour vous.
Rocambole ouvrit le billet et lut :
« Mon maître adoré,
« La passion de sir James prend des proportions qui commencent à m’inquiéter, cependant il ne sort pas encore des bornes du respect. Il est toujours mystérieux et persiste à ne pas savoir ce que c’est que Gipsy, mais il faudra bien qu’il parle.
« Hier soir, il a reçu une lettre portant des timbres bizarres, et qu’on lui renvoyait de Londres.
« C’est, sans doute, un ordre venu de l’Inde.
« Il s’est empressé d’enfermer cette lettre dans son portefeuille qu’il a toujours sur lui.
« Et toi, maître, que sais-tu ?
« À ce soir, minuit.
« Ton esclave,
« VANDA. »
Rocambole brûla ce billet en entrant dans son cabinet.
Puis il ouvrit le tiroir de son secrétaire dans lequel il avait mis, en arrivant, la boîte de fer qui renfermait le manuscrit et le portrait.
Il s’empara du portrait, le regarda et étouffa un cri.
Miss Ellen à quatorze ans avait une ressemblance frappante avec Lucien.
Lucien, pour qui Rocambole avait éprouvé une de ces sympathies irrésistibles qui sont un des grands secrets de la nature.
Lucien, qui certainement était le fils de milady.
Et Rocambole comprit pourquoi le major Hoff s’était informé des habitudes de Mlle Marie Berthoud et avait voulu savoir si elle allait toujours se promener aux Tuileries avec son vieux père.
Milady, qui, sans doute, avait fait élever son fils loin d’elle, voulait voir sa fiancée…
Rocambole sonna Milon…
– Tu vas me faire habiller ce jeune garçon que j’ai ramené. Tu le conduiras dans une maison de confection, et tu le déguiseras autant que possible en étudiant ou en collégien.
– Bien, fit Milon qui avait pris l’habitude de ne jamais discuter les ordres de Rocambole, quelque étranges qu’ils fussent. Et puis ?
– Et puis, tu le ramèneras ici, où il attendra que j’aie besoin de lui.
Milon sortit.
Rocambole replaça le médaillon dans la boîte de fer, tira de celle-ci le manuscrit de Bob et reprit la sombre histoire de miss Ellen à l’endroit où il l’avait laissée.
XIII
Bob continuait ainsi son récit :
« Huit jours plus tard, le commodore Perkins entra dans la chambre de sa fille.
Le vieillard avait le front sévère et chargé de nuages ; cependant, à son geste et à sa démarche, il était facile de voir qu’il s’était juré d’être calme et de ne point sortir des bornes d’une froide modération.
C’était la première fois qu’il mettait le pied dans la chambre de sa fille depuis sa délivrance.
Miss Ellen se dressa avec peine sur son séant en le voyant entrer.
– Miss Ellen, dit le vieillard, je ne viens vous faire aucun reproche. Votre conduite ne me touche qu’en ceci : que vous portez mon nom et que je ne veux pas que ce nom soit déshonoré.
Miss Ellen ne répondit pas.
– Vous avez commis une faute. Quel est votre complice, je ne veux pas le savoir. Encore moins, je songe à une réparation. Il n’est jamais entré dans mes idées que vous vous marierez.
Par conséquent, je viens vous donner à choisir :
Ou entrer dans un couvent,
Ou partir sous la conduite de Bob, mon intendant, qui vous conduira en France.
Dans le premier cas, je me chargerai de votre enfant et le ferai élever modestement, comme il convient à l’enfant qui n’aura jamais de nom.
Dans le second cas, vous changerez de nom. Je me suis procuré des actes authentiques, vous désignant sous le nom d’Ellen Percy, orpheline.
Bob vous conduira en France, dans le pays que vous aurez choisi pour votre résidence, et vous y remettra cent mille francs.
Avec cette somme vous élèverez votre enfant à votre guise.
Miss Ellen tendit vers son père ses mains suppliantes.
Mais son père la repoussa.
Puis il dit encore :
– Le médecin qui vous soigne, et qui m’a juré le secret sur la tête de sa femme et de ses enfants, m’affirme que dans quatre ou cinq jours vous pourrez vous mettre en route.
Je vous en donne huit, mais pas une heure de plus, car votre sœur arrivera avec son fiancé, et je ne veux pas que ma maison soit souillée plus longtemps par votre présence.
– Mon père ! dit encore miss Ellen, qui essaya de fléchir le vieillard.
– Je ne suis pas votre père ! dit le commodore.
Ces mots produisirent sur miss Ellen une révolution complète.
Elle se dressa haletante, l’œil en feu ; elle enveloppa le vieillard d’un regard de haine :
– Ah ! dit-elle, n’insultez pas ma mère ! je vous le défends !
Et elle retomba sans force, les lèvres frangées d’écume, sur son oreiller.
Le vieillard sortit en ricanant.
Alors miss Ellen se prit à fondre en larmes.
Franz entra.
L’enfant vagissait dans un berceau auprès du lit de sa jeune mère.
Franz prit l’enfant et le lui tendit.
Miss Ellen prit son fils dans ses bras et l’y serra avec fureur.
– Oh ! murmura-t-elle, je hais cet homme qui me renie pour sa fille, de toutes les forces de mon âme. Je hais cette sœur à qui on me sacrifie… Je hais…
– Ne haïssez plus personne, miss Ellen ! dit alors une voix grave et douce sur le seuil.
Miss Ellen tourna la tête et jeta un cri.
Un cri de joie, un cri de lionne qui retrouve au désert le lion dont elle a reçu les caresses et qu’elle croyait tombé sous la balle des chasseurs.
Un homme venait d’entrer, et Franz s’était empressé de fermer la porte au verrou.
Cet homme qui apparaissait tout à coup à miss Ellen comme un sauveur, comme une providence, c’était celui qu’elle avait rencontré par une soirée de brouillard la veille du Christmas.
Miss Ellen lui tendit les bras et l’enlaça avec transport.
Puis cet homme se dégagea, prit l’enfant et le couvrit de caresses en l’appelant :
« Mon fils ! »
Et miss Ellen ne pleurait plus. Miss Ellen souriait… et elle contemplait avec orgueil cet homme à qui elle devait les joies et les tourments de la maternité.
– Ah ! disait-elle, tu viens me chercher, n’est-ce pas ? tu viens m’arracher aux brutalités de cet homme qui me renie pour sa fille ?
– Je viens te venger, répondit-il.
Elle se redressa écumante, l’œil plein de haine :
– Oui… dit-elle, oui… venge-moi !
Cet homme fit un signe à Franz et Franz sortit.
Comme l’Allemand franchissait le seuil de la chambre, il lui dit :
– Prends bien garde que le commodore ne revienne… et s’il revenait…
– Oh ! dit Franz avec un sourire, et dans les mains duquel on vit briller un poignard, ne craignez rien… il n’arriverait pas vivant !
Franz sorti, l’inconnu ferma la porte.
– Ah ! dit-il en s’asseyant sur le bord du lit de miss Ellen et lui prenant la main, tu veux que je te venge ?
– Oui.
– Tu hais le commodore ?
– Comme on hait l’homme qui a insulté votre mère.
– Et ta sœur miss Anna ?
– Comme on abhorre ceux qui vous dépouillent.
Cet homme fronça le sourcil.
Il était beau, en ce moment, d’une beauté sauvage et cruelle.
– Mais tu ne sais donc pas qui je suis ? dit-il.
– Je sais que tu es beau, je sais que tu es fort, je sais que je frissonne sous ton regard et que je palpite au son de ta voix, je sais que je t’aime comme une esclave et que je vivrais heureuse, enchaînée à tes pieds, répondit-elle avec enthousiasme.
– Miss Ellen, dit-il encore, je ne suis pas Anglais.
– Que m’importe ! je hais ce pays où les lois permettent à un père de dépouiller sa fille.
– Je ne suis pas chrétien.
– Que m’importe encore ! blasphéma miss Ellen.
– As-tu entendu parler de cette secte mystérieuse qui règne dans l’ombre aux Indes, sous le nom d’Étrangleurs ? poursuivit l’inconnu.
– Oui, dit miss Ellen.
– Cette secte, véritable gouvernement des ténèbres, dicte les lois à la compagnie des Indes, condamne sans appel et sème l’épouvante, la désolation et la mort autour d’elle.
– Je le sais, dit miss Ellen.
– Elle redresse quand elle veut, des torts et des injustices, poursuivit-il.
Elle fait riche l’enfant spolié, elle tue le spoliateur.
– Mais, en fais-tu donc partie ? demanda miss Ellen le regardant.
– Je suis son chef suprême, répondit-il.
– Oh ! s’écria la jeune mère avec une sombre admiration, il n’en pouvait être autrement. Un homme comme toi ne saurait obéir, il est fait pour commander.
Et lui jetant ses deux bras autour du cou :
– Parle, dit-elle, ordonne, maître, je t’obéirai.
– Prends garde, fit-il encore, prends garde, miss Ellen ; si tu m’acceptes pour vengeur, il faudra m’obéir… m’obéir jusqu’au bout.
– Va, dit-elle en le regardant avec fierté, va… je n’ai pas peur… tu es mon seigneur et maître… et je suis prête à obéir.
– Qu’il soit fait comme tu le veux, dit-il, je me nomme Ali-Remjeh.
* *
*
Que se passa-t-il alors entre Ali-Remjeh, le chef des Étrangleurs, et miss Ellen, la fille maudite ?
Sans doute, Bob ne le sut jamais au juste, car il avait espacé son manuscrit de plusieurs lignes de points.
Rocambole demeura un moment pensif.
Puis il tourna le feuillet et continua.
XIV
Vingt-quatre heures après, disait encore le manuscrit, le commodore Perkins lisait avec ravissement une lettre dans laquelle sa bien-aimée fille Anna lui annonçait son prochain retour, et il exprimait à Bob le désir que miss Ellen partît au plus vite, ne s’apercevant pas du regard de haine dont l’enveloppait son fidèle serviteur.
– Bob, dit encore le vieillard, je n’ai pas vu ta femme aujourd’hui.
Bob tressaillit et son regard lança des flammes.
– Mylord, dit-il, ma femme est partie ce matin pour un petit voyage. Elle est allée recueillir la succession d’un vieil oncle qu’elle avait à Édimbourg et qui vient de mourir.
– Mais elle reviendra bientôt, n’est-ce pas ? demanda le commodore d’une voix affectueuse.
Cette question fut dans l’esprit de Bob la condamnation du commodore Perkins.
La nuit était venue depuis longtemps et le salon était plongé dans une demi-obscurité.
Le feu seul flambait dans la cheminée, et on n’avait point allumé les lampes placées sur la cheminée.
– Mylord, dit Bob, un étranger s’est présenté tout à l’heure et demande à être introduit près de Votre Seigneurie.
– Un étranger ? fit le commodore surpris.
– Il arrive de Londres et se dit porteur de nouvelles de miss Anna.
– Qu’il entre ! qu’il entre ! dit le vieillard avec empressement.
Bob alla ouvrir la porte et l’étranger entra.
Le commodore vit alors un homme de trente-deux à trente-six ans, dont le regard clair et brillant le fit tressaillir.
Le commodore avait longtemps servi dans les mers indiennes et il reconnaissait, à première vue, en dépit de la couleur blanche, un homme de sang anglo-indien.
Or, le commodore avait conservé tous les préjugés des vieux Anglais, et il ne faisait pas plus de cas d’un Anglo-Indien que d’un mulâtre.
L’étranger introduit, Bob était sorti discrètement.
– Mylord, dit l’étranger en regardant fixement le commodore, j’ai à entretenir Votre Seigneurie un peu longuement.
– Vous venez de la part de ma fille ! dit le commodore.
– Oui et non… dit l’étranger.
– Ah ! fit le commodore dont l’œil exprima une certaine inquiétude.
– Mylord, reprit l’inconnu, Votre Seigneurie a longtemps commandé aux Indes ?
– Sans doute.
– Alors elle doit avoir quelque respect pour les serviteurs de la déesse Kâli ?
À ces mots, le commodore se leva vivement de son siège et fit un pas en arrière.
– Autrement dit les Étrangleurs, ajouta Ali-Remjeh, car c’était lui.
Le commodore fixa sur lui un regard de mépris.
– Je sais, dit-il, que ces hommes sont des misérables.
– Soit, dit Ali-Remjeh, mais lorsqu’ils ont reçu un ordre, ils l’exécutent.
– Ah ! dit le vieillard toujours dédaigneux.
– Vous savez encore, poursuivit Ali-Remjeh, que la déesse Kâli a des caprices, entre autres celui de vouloir qu’on lui consacre chaque année un certain nombre de jeunes filles anglaises ?
Le commodore frissonna.
– Ces jeunes filles, continua Ali-Remjeh, une fois marquées d’un signe indélébile, doivent demeurer vierges, et le mariage leur est à tout jamais interdit.
– Mais pourquoi donc venez-vous me dire tout cela, vous ? fit le commodore, qui fut pris d’un subit effroi en songeant à sa fille miss Anna.
– Parce que, dit Ali-Remjeh, la déesse Kâli a songé à vous.
– À moi ?
Et les cheveux du commodore se hérissèrent.
– Vous avez deux filles, miss Anna et miss Ellen ?
Le commodore eut un moment d’espoir.
– Et… dit-il, vous avez songé… à… miss Ellen ?
– Non, à miss Anna.
Le commodore jeta un cri.
Un cri de fureur, d’indignation et d’épouvante tout à la fois.
– Sortez, misérable, sortez ! dit-il.
Ali-Remjeh ne bougea pas.
– Je vous apprends, dit-il, la volonté de la déesse, à qui il plaît que miss Anna demeure vierge et que miss Ellen se marie et apporte en dot à son époux son immense fortune.
– Jamais ! jamais ! s’écria le vieillard.
Et son vieux courage se réveilla, il eut un moment d’énergie et de jeunesse, et courut à un cordon de sonnette qu’il secoua violemment en appelant :
– Bob ! Bob ! à moi ! Bob !
Et tandis que la sonnette retentissait, il regardait Ali-Remjeh d’un œil de défi en lui disant :
– Un homme comme moi, le commodore Perkins, n’a jamais tremblé devant une horde d’assassins. Arrière, hors d’ici, misérable !
La porte s’ouvrit.
Mais ce ne fut point Bob qui entra. Ce fut Franz.
Franz tenait à la main une espèce de lasso qu’il développa subitement sur un signe d’Ali-Remjeh.
Le lasso siffla, fendit l’air, vint s’enrouler autour du cou du commodore, le secoua violemment et l’abattit sur le parquet.
Alors, Ali-Remjeh se jeta sur lui et lui mit un genou sur la poitrine et un poignard sur la gorge.
– Si tu cries, dit-il, je te tue !
Le commodore était vieux, et comme tous les vieillards, il tenait à la vie.
Il eut peur et n’appela plus au secours.
– Un verre d’eau ! demanda Ali-Remjeh à Franz.
L’Allemand s’approcha d’une console et y prit une carafe et un gobelet qu’il emplit et apporta à l’Anglo-Indien.
Celui-ci tout en maintenant le commodore immobile sous lui, tira de sa poche un petit flacon qu’il déboucha et versa quelques gouttes de son contenu, une liqueur bleuâtre, dans le verre d’eau.
Alors, jetant son poignard, il prit le vieillard à la gorge et le serra si fort que le malheureux ouvrit un moment la bouche, et Franz, qui s’était emparé du gobelet, y versa le breuvage tout entier.
Ce fut instantané, foudroyant.
Le vieillard fit un soubresaut si violent qu’il renversa Ali-Remjeh.
Puis il retomba immobile et comme mort…
Il venait d’être frappé d’une paralysie absolue, grâce à quelqu’un de ces poisons végétaux si terribles que connaissent seuls les Indiens.
Alors, Franz le prit à bras le corps et le porta dans son fauteuil où il l’étendit dans l’attitude d’un homme frappé d’une attaque d’apoplexie foudroyante. Pendant ce temps, Ali-Remjeh, s’emparant d’une clé que le vieillard portait à son cou, ouvrait un coffre-fort dans lequel il avait renfermé ses papiers les plus précieux ; et, après quelques minutes de recherches, il trouvait un large pli cacheté et scellé aux armes du commodore.
C’était le testament par lequel le vieillard spoliait miss Ellen et laissait toute sa fortune à miss Anna.
Ali-Remjeh l’ouvrit, le lut et dit en riant :
– En l’absence du testament, il faudra partager. Mais nous verrons à ce que la part de miss Anna nous revienne un jour.
Et il approcha le testament de la bougie qu’il avait allumée et le brûla.
* *
*
Le lendemain matin, miss Ellen expédiait à sa sœur, miss Anna, la dépêche télégraphique suivante :
« Folle de douleur – notre père trouvé mort dans son fauteuil – arrive au plus vite pour les funérailles.
« Ta sœur,
« ELLEN. »
– Je commence à comprendre, murmura Rocambole, et il poursuivit sa lecture :
XV
Miss Anna et son fiancé arrivèrent au bout de trois jours.
Miss Ellen vêtue de noir les reçut au seuil de la chambre mortuaire.
Elle manifestait une grande douleur.
Miss Anna et son fiancé trouvèrent le commodore étendu sans vie sur un lit de parade.
Tous les médecins de Glasgow avaient été d’un avis conforme.
Le commodore avait succombé à une attaque d’apoplexie foudroyante.
Miss Anna voulait faire embaumer son père ; mais miss Ellen s’y opposa en disant que le commodore avait souvent manifesté le désir que son corps fût laissé en repos après sa mort.
Les funérailles furent commandées avec grande pompe.
Ce fut le fiancé de miss Anna qui y présida.
Par ses soins les dépouilles du défunt furent placées dans un triple cercueil de chêne, de plomb et d’argent massif.
Puis le cercueil fut recouvert d’un drap noir semé de larmes d’argent et sur lequel on plaça l’écusson, les insignes et les décorations du commodore.
Puis encore on plaça le cercueil dans une chambre convertie en chapelle ardente.
Alors seulement le fiancé de miss Anna crut pouvoir prendre quelque repos.
Miss Anna pleurait son père et miss Ellen sanglotait.
On eût dit que la douleur de la déshéritée était plus grande que celle de la fille qui s’attendait à recueillir la succession tout entière.
La nuit qui devait précéder les funérailles était venue.
Un ministre presbytérien priait auprès du cercueil dans la chapelle ardente et le dernier coup de minuit venait de sonner à la plus proche église.
Le ministre était pourtant un homme sobre et pieux ; il avait passé bien des nuits auprès des morts, et jamais ses paupières ne s’étaient alourdies.
Cependant, tout à coup, le livre qu’il avait à la main lui échappa, ses yeux se fermèrent et il s’endormit.
Alors deux hommes entrèrent, apportant sur leurs épaules un objet assez lourd qu’il était facile de reconnaître pour une figure de cire.
Cette figure dont les traits imitaient à s’y méprendre les traits du défunt, était revêtue d’un habit rouge comme celui du commodore.
Placée à côté du vrai corps, sur le même lit de parade, elle eût fait illusion.
Les deux hommes qui l’avaient apportée la placèrent dans un coin, puis poussèrent du pied le ministre qui ne s’éveilla point.
Et s’étant enfermés dans la chapelle ardente, ils se mirent en devoir de débarrasser le cercueil du drap mortuaire et de le dévisser.
Quand les trois couvercles eurent été successivement enlevés, ils prirent à bras le corps le vrai commodore, le retirèrent du cercueil et mirent à sa place la figure de cire.
Ces deux hommes étaient Bob et Franz.
Al-Remjeh avait disparu.
Franz, qui avait un moment tenu le commodore dans ses bras, dit à Bob :
– Il n’est que temps. Le cœur commence à battre, il va revenir à lui et il eût fait un joli vacarme dans le cercueil.
– Il pourra faire du bruit tout à son aise là où nous le transporterons, répondit Bob en ricanant.
La maison de Glasgow habitée par le commodore et ses filles était de construction féodale.
Les Perkins d’un autre âge l’avaient fait construire à une époque où toute habitation noble devait avoir sa prison et ses oubliettes.
Miss Ellen et Franz, ou plutôt Ali-Remjeh, avaient découvert au fond des caves un souterrain dans lequel on descendait par cent marches de pierre.
Au fond de ce souterrain était un cachot de six pieds carrés.
Ce fut là que Franz et Bob transportèrent le commodore encore en léthargie, mais prêt à revenir à lui.
Et quand ses yeux se rouvrirent, quand il eut recouvré l’usage de ses sens, le malheureux vieillard se vit dans cet affreux réduit.
Il avait des chaînes aux pieds et aux mains et il était attaché par la ceinture à un énorme anneau fixé dans le mur.
D’abord le vieillard se crut le jouet de quelque horrible rêve.
Mais le poids de ses chaînes l’eut bien vite rappelé au sentiment de la réalité.
Alors il se mit à crier.
Ses cris demeurèrent sans écho. Les murs de son cachot étaient trop épais pour les laisser passer au dehors.
Il hurla. Ses hurlements s’éteignirent.
Enfin, au bout de quelques heures, un homme entra, apportant une cruche d’eau et du pain.
Cet homme c’était Franz.
Franz posa ces tristes aliments auprès du prisonnier et lui dit :
– De la part de ta fille bien-aimée, miss Ellen.
Et pendant six années le vieillard vécut là, dans ce cachot, sans autre geôlier que Franz qui lui apprenait successivement, avec une joie féroce, les bonheurs de miss Ellen et les infortunes de miss Anna.
Enfin, un soir, Franz eut pitié de lui et l’étrangla.
* *
*
Maintenant qu’étaient devenues miss Ellen et miss Anna ?
Cette dernière savait que son père avait fait un testament en sa faveur.
Mais on eut beau chercher le testament, on ne le trouva point.
Et miss Ellen hérita de la moitié de l’héritage de son père qui laissait une fortune immense.
Six mois après les funérailles de la figure de cire, qu’on avait mise à découvert, au cimetière, l’espace de quelques secondes, pour obéir à l’usage et que tous les assistants avaient prise pour le vrai corps du commodore, – six mois après ces funérailles, miss Anna épousa son fiancé.
Mais, chose étrange, le lendemain même de ses noces, en s’éveillant, le jeune époux jeta un cri de surprise et d’effroi.
La poitrine nue de miss Anna endormie était tatouée de signes mystérieux et bizarres.
Les Étrangleurs l’avaient marquée pendant son sommeil.
Le soir, le mari de miss Anna étant sorti pendant quelques heures dans les rues de Glasgow, fut étranglé dans un carrefour, et si lestement qu’il n’eut même pas le temps de crier.
Miss Anna était veuve après vingt-quatre heures de mariage.
Les terribles stigmates qu’elle avait sur la poitrine n’étaient plus un mystère pour elle.
Les Étrangleurs qui avaient tué son mari, la condamnaient à ne jamais devenir mère.
Et cependant, au bout de quelques mois, elle sentit ses entrailles s’agiter.
Miss Anna était grosse d’un enfant qu’elle mit au monde dans l’ombre et que, pour le soustraire au sort qui l’attendait, elle fit élever par un bohémien du nom de Faro.
Longtemps, elle parvint à défier la vigilance des Étrangleurs.
Puis un jour, dans une fête publique, elle se trahit en s’évanouissant dans sa voiture, tandis qu’une petite bohémienne dansait.
Quelques jours après, miss Anna fut étranglée, pendant qu’elle pressait sa fille dans ses bras.
Son immense fortune revint alors à miss Ellen qui, du reste, n’habitait plus l’Angleterre depuis le jour où Franz avait étranglé le vieux commodore.
* *
*
Là finissait le manuscrit de Bob, laissant comme on voit quelques points obscurs, tels que le motif qui avait déterminé milady à faire élever son fils loin d’elle.
Mais Rocambole comptait sur sa sagacité ordinaire pour les éclaircir.
Midi sonnait comme il achevait sa lecture.
Un rayon de soleil s’ébattait sur le parquet et sur les murs de son cabinet.
– Par un temps pareil, murmura Rocambole, Marie Berthoud accompagnera bien certainement son vieux père aux Tuileries…
Et milady pourrait bien avoir envie de voir à la dérobée sa future belle-fille.
Sur ces mots, Rocambole sonna Milon.
XVI
La rue de la Sourdière est rarement visitée par le soleil.
Cependant vers midi, par les belles journées, quand tout Paris est inondé de lumière, un rayon du roi des astres se glisse parfois jusqu’à elle en ricochant sur les toits voisins.
De toutes les rues de Paris c’est peut-être la plus triste car la tristesse gît surtout dans le contraste.
Au milieu d’un quartier animé, bruyant, la rue de la Sourdière a l’air d’une voie de nécropole.
Il n’y passe pas dix voitures par jour.
Les piétons y sont tout aussi rares.
Un côté de la rue a des fenêtres grillées au rez-de-chaussée.
Le trottoir est absent presque partout.
Quelques misérables boutiques s’espacent çà et là.
On y voit une ou deux maisons d’aspect honnête et mélancolique comme des maisons d’une ville de province.
Or, c’était dans une de ces maisons qu’habitait Mlle Marie Berthoud, la fiancée de Lucien.
Elle vivait là, depuis plusieurs années, avec son vieux père, heureuse peut-être de ce silence et de cet isolement qui régnaient autour d’elle, lorsqu’elle avait retrouvé l’ami de son enfance.
Les déshérités de ce monde aiment à vivre dans le recueillement.
Moins il leur vient du bruit du dehors, et moins ils s’aperçoivent de leur infortune.
Lorsque Lucien les avait retrouvés, quand il était monté à ce cinquième étage où le père et la fille occupaient deux pièces mansardées avec un carreau rouge pour parquet, son cœur s’était serré et des larmes lui étaient venues aux yeux.
– Vous ne resterez pas ici plus longtemps, s’était-il écrié. Je vais vous chercher un joli appartement où vous demeurerez jusqu’à ce que nous soyons mariés.
Mais Marie résista.
Elle tenait à son quartier, à cette chère rue où elle avait passé de longues veilles et où, depuis plusieurs années, été comme hiver, on avait pu voir la lueur de la lampe laborieuse, bien après minuit, à travers les rideaux blancs de sa fenêtre.
Pour tout concilier, Lucien avait loué l’appartement du premier étage qui venait d’être remis à neuf et était assez grand.
Puis il l’avait meublé convenablement et le jour où le vieux professeur, tout ému, y fut installé, Lucien lui dit : « Mon père, dans un mois je serai l’époux de Marie, et nous aurons un charmant petit hôtel à Neuilly ou à Auteuil, vous demeurerez avec nous, et nous laisserons cette affreuse rue, n’est-ce pas ? »
C’est donc dans cet appartement du premier étage que nous allons pénétrer.
Il était midi.
Marie et son père avaient achevé leur déjeuner.
Le vieillard s’était assis auprès de la fenêtre qui était ouverte, et il humait ce rayon de soleil unique dont nous avons parlé et qui faisait, par les beaux jours, son apparition vers midi.
Marie, dans la chambre voisine, achevait sa toilette, une toilette bien simple et qui n’était certes pas celle d’une jeune fille qui allait devenir la femme d’un homme aussi riche que Lucien.
Lucien était parti la veille au soir en disant à Marie :
– Demain, j’irai me promener aux Tuileries à l’heure où vous y allez habituellement.
Si, par impossible, le temps était mauvais, s’il pleuvait, j’irais directement chez vous vers deux heures.
Mais comme le temps était beau, comme la jeune fille ignorait l’affreux événement de la nuit et que Rocambole qui s’était chargé de le lui apprendre, avait ajourné ce pénible message, Marie faisait sa toilette avec empressement et songeait qu’elle verrait Lucien deux heures plus tôt.
Marie était une grande et belle jeune fille, aux cheveux châtain clair, aux yeux bleus, au sourire mélancolique sans tristesse.
Elle avait une main charmante, un petit pied, une taille bien prise.
Les privations et le travail de la jeunesse n’avaient point altéré son caractère enjoué, mais elle avait perdu la fraîcheur de son teint, devenu de cette pâleur mate et distinguée dont s’enorgueillissent les Parisiennes de race.
Tandis qu’elle achevait sa toilette, la sonnette se fit entendre.
La femme de ménage alla ouvrir et la concierge entra.
Elle tenait à la main cette petite caisse que le major Hoff avait placée le matin sur la table de la loge.
Marie accourut.
– Qui donc vous a remis cela ? demanda-t-elle.
– Un commissionnaire, qui s’en est allé en disant que sa course était payée.
Et la concierge, qui voulait honnêtement gagner les quarante francs du major Hoff, s’en alla sans donner plus ample explication.
La veille, Lucien n’avait point apporté les diamants envoyés par cette mère mystérieuse qui veillait sur lui de loin et paraissait vouloir demeurer inconnue.
Il n’avait même pas parlé à sa fiancée de ce royal cadeau et sa raison en était qu’il avait l’espoir de retrouver le major Hoff, de lui arracher son secret, de parvenir jusqu’à sa mère et de dire ensuite à Marie :
– Viens, allons nous jeter dans ses bras !
Marie ignorait donc que Lucien fût ou se crût sur les traces de sa mère et, par conséquent, elle n’avait point encore reçu les diamants qui lui étaient destinés.
Aussi fut-elle fort surprise de recevoir cette boîte enveloppée dans du papier de soie.
Elle crut, cependant, que c’était un envoi de Lucien.
Le coffret était en bois de sandal.
La clé du fermoir se trouvait attachée à une faveur rose qui faisait le tour de la boîte.
Marie, toute tremblante d’émotion, prit cette clé, la mit dans la serrure et ouvrit.
La boîte était pleine de dentelles d’un grand prix, mais dont la couleur un peu jaunie annonçait l’ancienneté.
C’était, évidemment, ce qu’on appelle des dentelles de famille.
Une lettre qui portait pour inscription « À mademoiselle Marie Berthoud » était placée en évidence dans un coin de la boîte.
L’écriture de cette adresse n’était pas celle de Lucien. Marie se prit à trembler plus fort :
– Père ! père ! appela-t-elle, viens donc voir !
Et tandis que le vieux professeur accourait, elle brisa d’une main fiévreuse le cachet de cire parfumée de la lettre. Elle était ainsi conçue :
« Ma fille,
« Permettez-moi de donner ce nom à celle qui va devenir l’ange tutélaire de mon fils bien-aimé.
« Je suis à Paris depuis quelques heures seulement. Il y a trois jours encore, je n’espérais pas y venir.
« Un homme dont je suis sûr s’était chargé pour mon fils d’une parure en diamants qui vous était destinée.
« Mon fils vous l’a-t-il déjà offerte ou la réserve-t-il pour sa corbeille de mariage ?
« Je l’ignore.
« Laissez-moi aujourd’hui, mon enfant, vous envoyer mes dentelles de jeune fille que je voudrais voir à votre robe de mariée.
« Hélas ! je ne sais encore s’il me sera permis de lui ouvrir les bras, et cependant j’en ai le doux espoir.
« Mais, en attendant que cette espérance se réalise, je voudrais voir celle que mon fils a choisie.
« Mes informations m’apprennent que vous allez chaque jour vous promener aux Tuileries avec votre excellent père.
« N’y manquez pas une seule fois, ma chère enfant ; peut-être aujourd’hui, peut-être demain, assise sur une chaise, un masque d’indifférence cruelle sur le visage, comprimant les battements de son cœur, la mère de votre Lucien vous verra passer. »
La lettre était signée :
ELLEN.
Marie, chancelante, tendit la lettre à son père et murmura :
– Ô mon Dieu ! pourvu que Lucien ne meure pas de joie !…
Puis elle sauta au cou du vieillard :
– Viens, père, dit-elle, viens, je suis prête !
Et le vieillard et la jeune fille sortirent, appuyés au bras l’un de l’autre.
Quand ils tournèrent l’angle de la rue de la Sourdière, ils passèrent auprès d’un fiacre qui stationnait devant l’église Saint-Roch et n’y prirent garde.
Les stores en étaient baissés.
Mais, au moment où ils entraient dans la rue du Dauphin pour gagner la grille des Tuileries, un des stores se souleva un peu.
XVII
Quelques minutes après que Marie Berthoud et son père eurent tourné l’angle de la rue du Dauphin, la portière de ce fiacre mystérieux qui stationnait stores baissés devant l’église Saint-Roch s’ouvrit, et deux hommes ou plutôt un homme et un tout jeune homme en descendirent.
Ce dernier était revêtu d’un uniforme de collégien, portait un petit képi galonné et par-dessus l’uniforme un caban à capuchon.
Il eût été bien difficile de reconnaître en lui Jacquot, le petit groom du château de Rochebrune.
D’autant plus difficile, même, que le col du caban boutonné sous le menton ne laissait voir que le haut du visage.
Le personnage qui l’accompagnait, on l’a deviné déjà, n’était autre que Rocambole.
Mais Rocambole si bien métamorphosé que ses disciples eux-mêmes ne l’eussent point reconnu.
Il s’était affublé d’une ample redingote noisette, à collet comme les carricks d’autrefois, d’une perruque et d’une barbe blonde assez épaisses et assez touffues pour cacher entièrement sa chevelure noire et les fines moustaches du major Avatar.
Une paire de lunettes vertes, une lorgnette de courses portée en bandoulière, et un de ces parapluies énormes rouge et bleu qu’on ne trouve plus que de l’autre côté de la Manche, complétaient ce déguisement.
On eût juré que Rocambole était un brave Anglais de la Cité, ambitionnant à peine le titre de gentleman, et qui venait à Paris pour la première fois.
Ils descendirent donc tous deux du fiacre aux stores baissés.
Mais Rocambole, au lieu de payer le cocher, lui dit avec cet accent britannique qu’il possédait si naturel quand il le voulait :
– Vôs attendre moâ et bon pourboire !
Puis il prit Jacquot par le bras et ils se dirigèrent vers cette grille des Tuileries que Marie Berthoud et son père venaient de franchir.
Rocambole regardait par-dessus ses lunettes et son œil perçant eut bientôt découvert Marie Berthoud et son père qui se promenaient dans la grande allée des Tuileries.
– Restons ici, dit-il à Jacquot.
Et ils s’accoudèrent à la balustrade de la terrasse des Feuillants.
Rocambole surveillait attentivement les deux grilles, celle de la rue de Castiglione et celle qui s’ouvre presque en face de la rue du 29 Juillet.
Le temps était superbe et l’air presque printanier.
Le beau monde affluait aux Tuileries.
Rocambole se disait :
– Si milady vient avec le major Hoff, je n’aurai pas besoin de Jacquot. Mais il est possible qu’elle vienne seule ; et alors comment la reconnaître ?
Rocambole ne se trompait pas.
Tout à coup Jacquot lui poussa le bras en disant :
– La voilà !
En effet, une femme vêtue de noir, mais d’une élégance exquise, et dont la démarche trahissait une origine toute patricienne, entra par la grille de la rue du 29 Juillet.
Toute son attention était si bien concentrée sur le jardin qu’elle passa auprès de Rocambole et de Jacquot sans même s’apercevoir qu’elle était le but de leurs regards.
Rocambole ne put réprimer un geste d’admiration.
Milady avait bien quarante ans, mais elle était si belle, en sa pâleur nerveuse, elle avait l’œil si brillant, les lèvres si rouges, la taille si svelte et si souple qu’on eût hésité à affirmer qu’elle avait dépassé la trentaine.
Plus que jamais elle ressemblait à Lucien.
– Oui, pensa Rocambole, c’est bien elle.
Milady était seule, elle était venue sans le major Hoff.
Un moment, elle s’arrêta sur la terrasse des Feuillants et parut hésiter.
Mais bientôt son regard se fixa sur deux promeneurs.
C’étaient Marie et son père.
Puisque milady venait aux Tuileries pour voir Marie Berthoud, c’est que la jeune fille lui était inconnue.
Mais il est facile de comprendre qu’une jeune fille sur le bras de laquelle s’appuie un vieillard est aisée à reconnaître.
Aussi, milady n’eût-elle pas hésité à se dire « c’est elle ! » alors même qu’elle n’eût pas éprouvé un battement de cœur.
Rocambole devina son agitation, d’autant mieux qu’avant de descendre de la terrasse dans le jardin, milady rabattit son voile sur son visage.
Ce voile était assez épais pour dissimuler ses traits et cacher au besoin cette émotion qu’elle venait d’éprouver.
Marie Berthoud, après une promenade de quelques minutes, ramena son père vers le premier rang de chaises exposées au soleil, auprès de la grande allée.
Puis elle jeta un regard timide autour d’elle.
Milady, elle aussi, était allée s’asseoir à peu de distance ; seulement elle s’était placée auprès d’un arbre qui la masquait presque tout entière.
Elle pouvait écouter la conversation de Marie Berthoud et la voir tout à son aise.
Marie, au contraire, ne la voyait pas.
Quand elles furent ainsi placées, Rocambole reprit le bras de Jacquot et lui dit :
– Allons-nous-en !
Ils regagnèrent la rue du Dauphin et retrouvèrent le fiacre devant Saint-Roch.
– Où faut-il conduire mylord ? demanda le cocher.
– Moâ le dire à vô tout de suite ! répondit Rocambole.
Et il remonta dans le fiacre.
Alors une nouvelle métamorphose s’opéra, à l’abri des stores parfaitement baissés.
La perruque et la barbe blonde tombèrent, et l’ample redingote noisette, en s’ouvrant, laissa voir la redingote magyare du major Avatar.
Rocambole baissa la glace de devant du store, passa le bras et tendit un louis au cocher en lui disant :
– Rue Saint-Lazare.
Puis s’adressant à Jacquot :
– Tu vas rentrer et m’attendre.
En même temps, il ouvrit la portière et sauta si lestement sur le pavé que le cocher n’eut pas le temps de le voir.
En quelques enjambées, le major Avatar fut dans le jardin des Tuileries et s’approcha de Marie Berthoud.
La jeune fille avait concentré ses regards sur la grille par laquelle Lucien entrait ordinairement.
Lucien était en retard. Marie était inquiète.
Elle se leva étonnée en voyant le major s’approcher d’elle, son chapeau à la main.
– N’est-ce pas à Mademoiselle Berthoud que j’ai l’honneur de parler ? demanda-t-il.
– Oui, monsieur, répondit la jeune fille en tremblant.
– Je suis un ami de Lucien…
Marie tressaillit.
– Il va venir, dit-elle… et… si vous avez à le voir ?…
– Il ne viendra pas, mademoiselle, répondit Rocambole. C’est lui qui m’envoie.
– Il ne viendra pas ! dit Marie effrayée. Mon Dieu !
– Un petit accident… une égratignure… à la suite d’une querelle cette nuit… au club…
Marie jeta un cri.
– Blessé, dit-elle, mort peut-être !
– Non, mais blessé…
Marie jeta un nouveau cri.
Et, à ce cri, un autre cri répondit.
La femme vêtue de noir et cachée derrière l’arbre, milady, venait de s’évanouir !
XVIII
Revenons à Vanda, que nous avons à peine entrevue depuis son retour à Paris.
Comme on le sait, le baronnet sir James Nively, ce chef mystérieux des Étrangleurs qui un jour avait repris le pouvoir des mains inhabiles de sir George Stowe, – sir James Nively, disons-nous, s’était violemment épris d’elle en la voyant.
Vanda avait joué à merveille son rôle de femme trahie et ne vivait plus que pour la vengeance.
Sir Nively, qui avait d’excellentes raisons pour venir à Paris, car, à tout prix, il voulait retrouver Gipsy, enlevée par Rocambole, avait donc accueilli avec empressement ce départ de Londres.
On sait comment, arrêtés dans leur route, ils avaient passé une nuit au château de Rochebrune.
Mais Vanda seule avait soulevé un coin du voile mystérieux qui pesait sur le vieux manoir.
Sir Nively avait passé toute une nuit à Rochebrune sans se douter qu’il était sous le toit de la femme que les Étrangleurs servaient avec un zèle fanatique.
Arrivé à Paris, sir James était d’abord descendu à l’hôtel du Louvre.
Mais si splendide que soit cet établissement, il lui paraissait indigne de la femme qu’il aimait déjà avec ce sombre enthousiasme particulier aux hommes de l’Extrême-Orient.
Dès le lendemain, sir James Nively, qui possédait des ressources mystérieuses incalculables sans doute, avait acheté un petit hôtel entre cour et jardin, tout meublé.
Il y avait conduit Vanda.
Puis, se mettant à ses genoux :
– Voilà votre palais, ô ma fée !
Et Vanda, armant ses lèvres de son sourire le plus fascinateur, lui avait répondu :
– Vous m’aimez donc bien ?
– Mon rêve est d’être votre esclave, répondit-il.
– Soit, répondit-elle. Mais écoutez mes conditions.
Il demeura à genoux :
– Parlez, dit-il.
– Je ne vous aimerai que le jour où je serai vengée.
Elle lui tendit la main.
– Ce jour-là, dit-elle, c’est moi qui serai votre esclave. Mais, d’ici-là, considérez-moi comme une sœur, et rien de plus.
– Je vous le jure, répondit l’amoureux baronnet.
Vanda était donc à Paris depuis trois jours.
Si le baronnet restait dans les limites les plus strictes du programme indiqué par elle, il se montrait néanmoins jaloux déjà comme un amant heureux.
Elle n’avait pu s’échapper qu’une fois, et c’était le jour de son arrivée où nous l’avons vue venir rue Serpente, dans cette vieille maison dont la mère de Noël était concierge.
Pendant les deux jours qui suivirent, sir James Nively ne la quitta pas.
Vanda lui dit le matin du deuxième jour :
– Mais, mon ami, vous m’avez promis de me venger et vous savez que c’est à ce prix que je mets mon amour. Si vous passez votre temps à mes genoux comment retrouverons-nous ce misérable qui a enlevé Gipsy ?
Sir James eut un sourire mystérieux :
– Mon amie, dit-il, je dispose de forces occultes qui travaillent sans relâche, tandis que moi j’ai l’air de sommeiller.
Il y a des hommes qui m’obéissent et mourraient sur un signe de moi, qui se feront les instruments dociles de ma volonté et de votre vengeance.
– Mais quand ? demanda Vanda, qui parut accueillir cette révélation avec un profond étonnement.
– Dans deux ou trois jours, je les attends.
– C’est bien long ! soupira Vanda.
Tandis qu’elle paraissait tout entière absorbée par ses projets de vengeance, un valet entra apportant une lettre sur un plateau.
Sir James tressaillit à la vue des timbres bizarres qui couvraient l’enveloppe.
Il lui échappa même un geste de surprise, mais ce fut tout.
Il ouvrit la lettre, la lut et la mit dans sa poche sans faire part à Vanda de ce qu’elle contenait.
Seulement, au bout de quelques minutes, il dit négligemment :
– Il faut que je sorte. Je vais chez mes banquiers MM. Davis-Humphry et C°.
Vanda n’avait vu qu’une chose, c’est que la lettre était écrite en langue indoue.
Or, cette lettre que sir James Nively, venait de recevoir et qui était datée de Calcutta était ainsi conçue :
« Ali-Remjeh permet à miss Ellen de se faire connaître à son fils. Sir James Nively, l’exécuteur en Europe des volontés suprêmes du grand chef, est chargé de le lui annoncer. »
À peine sir James était-il parti que Vanda se jetait dans une voiture de place et se faisait conduire rue Saint-Lazare, où elle espérait trouver Rocambole.
Mais Rocambole, comme on le sait, n’y était pas, et Vanda avait écrit ce billet que Milon lui remit et dans lequel elle lui annonçait sa visite probable pour minuit.
Elle était de retour dans le petit hôtel acheté par sir James avant que celui-ci ne fût rentré.
Sir James n’avait jamais correspondu avec milady que par la maison de banque anglo-française Davis-Humphry et C°.
La succursale française de cette maison avait, nous l’avons déjà dit, ses bureaux rue de la Victoire.
Sir James s’y rendit et laissa un mot ainsi conçu :
« Le mandataire d’Ali-Remjeh désire voir le major Hoff.
« Réponse et indication de rendez-vous avenue Gabriel, aux Champs-Élysées.
« Sir JAMES NIVELY, esquire. »
Moins d’une heure après, sir James reçut cette réponse :
« Le major Hoff attendra entre onze heures et minuit sir James Nively, boulevard des Capucines, au Club des Asperges . »
Or, cette lettre arriva dix minutes avant le retour de sir James.
Un domestique non initié encore aux habitudes mystérieuses de sir James apporta cette lettre à Vanda, qui rentrait à l’instant même.
Vanda jeta la lettre sur un guéridon en disant :
– C’est pour monsieur.
Mais à peine le domestique fut-il parti, qu’elle reprit la lettre, s’empara d’un couteau à fruits qui se trouvait sur le guéridon et en exposa la lame à la flamme de la cheminée.
Puis quand cette lame fut chaude, elle la passa entre le cachet de cire rouge et l’enveloppe et le cachet se détacha sans se briser.
Alors Vanda ouvrit la lettre qui était écrite en anglais, la lut, la replaça dans son enveloppe, et par le même procédé recacheta cette dernière.
Quelques minutes après, sir James entra et trouva la réponse du major Hoff.
Le soir, à onze heures moins un quart, sir James sortit de nouveau, annonçant à Vanda qu’il ne rentrerait que fort tard dans la nuit.
Vanda courut chez Rocambole qui l’attendait.
Elle avait si bien retenu le contenu de la lettre du major Hoff qu’elle put le répéter mot à mot.
– C’est bien, dit Rocambole. Maintenant, je crois que nous les avons tous sous la main et nous allons dresser un plan de campagne.
Vanda s’assit auprès de lui et attendit que Rocambole s’expliquât.
XIX
Tandis que Rocambole exposait des plans à Vanda, une scène toute différente avait lieu dans un endroit de Paris bien éloigné de la rue Saint-Lazare, situé à l’extrémité nord-est de l’ancien faubourg de la Villette et qui porte le nom de Carrières d’Amérique.
Quand la grande ville commence à s’apaiser, que les voitures suspendues roulent seules sur le boulevard, que les magasins se ferment et que le Paris des travailleurs songe au repos, les Carrières d’Amérique, vrais repaires de sauvages à la porte de la civilisation, se peuplent peu à peu de leurs hôtes accoutumés.
Là le voleur qui fuit la police, le repris de justice en rupture de ban, le vagabond sans feu ni lieu, la courtisane des rues qui n’a pas de chez elle, trouvent un refuge pour la nuit.
L’été, le fond des puits est frais.
L’hiver, le dessus des fours à plâtre répand une douce chaleur.
On trouve l’un et l’autre aux Carrières d’Amérique.
Ce soir-là, – minuit approchait, – la réunion était nombreuse et choisie sur le four du milieu, celui qui avait reçu la dénomination pompeuse d’Eldorado.
Il y a trois fours célèbres aux Carrières d’Amérique.
Le premier s’appelle l’Hôtel des Petits-Oignons.
Le second a été baptisé l’Auberge des Innocents.
Le troisième est l’Eldorado.
L’Hôtel des Petits-Oignons est fréquenté par les vagabonds qui n’ont pas encore leurs diplômes de malfaiteurs.
Quelques filles douteuses qui abordent la carrière du vice d’un pas mal affermi encore s’y risquent quelquefois.
Les voleurs y sont rares.
L’Auberge des Innocents est une atroce antithèse.
On n’y reçoit que les gens qui ont subi au moins trois condamnations.
Un homme qui n’a fait que six mois de prison en est exclu.
Le vice a ses aristocraties, tout aussi bien que la vertu.
L’Eldorado justifie son nom badin, c’est le rendez-vous des loustics, des libres penseurs, des chanteurs ambulants et des danseuses de carrefours.
On y parle des nouveautés de toutes sortes qui se révèlent chaque jour dans Paris.
Les chiffonniers y sont très bien vus. On y applaudit les saltimbanques. Le titi y raconte la dernière féerie de Bobinot.
Le monsieur qui a mis sa jolie figure en loterie daigne s’y montrer quelquefois.
À l’Hôtel des Petits-Oignons, le voleur dort un œil ouvert, l’oreille tendue aux bruits lointains, prêt à détaler si une ronde de police vient à passer.
À l’Auberge des Innocents, on cause à voix basse et on se raconte de sinistres histoires, quand on ne médite pas quelque crime.
À l’Eldorado, on fait salon.
C’est l’hôtel Rambouillet de la guenille, l’Académie de la hotte et du crochet, la cour du Bel air de la fange.
On y passe les nuits comme à la maison d’Or.
On y boit du vin bleu et de l’eau-de-vie de grain avec autant d’entrain que du vin de Champagne ; on y tourne le madrigal entre deux chiques à l’adresse d’une Chloris de carrefour échappée de Saint-Lazare.
Or, donc, cette nuit-là, l’Eldorado était en grande liesse.
Un chiffonnier, qui avait autrefois rédigé le Moniteur des loques, journal satirique et littéraire, se livrait à une critique acerbe du dernier drame de l’Ambigu.
Mademoiselle Nora Pitanchel, ex-figurante du théâtre de Montrouge, faisait un cours de vertu à l’usage de tout le monde, et racontait l’histoire d’une demi-douzaine de princes russes qui étaient morts d’amour pour elle.
Un sceptique, le vieux marchand de coco que le percement du boulevard du Prince-Eugène avait ruiné et réduit au vagabondage, interrompit une des histoires de Nora Pitanchel par cette question à brûle-pourpoint :
– Tu crois donc à l’amour, toi ?
– Mais pas à la gloire, répondit Nora.
Une jeune fille, une nouvelle venue, encore jolie, encore un peu timide, leva la tête à ces mots et dit :
– Je sais bien des gens qui aiment pour le plaisir d’aimer.
– Oh ! c’te farce ! fit le marchand de coco. Où as-tu pêché ça, Zélie ?
– Si je vous racontais mon histoire avec Gustave, répondit Zélie, vous ne la croiriez pas ; pourtant nous nous aimions bien, allez ! mais Gustave est bloqué et vous ne pourriez pas y aller voir.
– Alors, qu’est-ce que tu nous chantes ?
– Mais vous pouvez aller dans la maison dont on m’a mise à la porte ce matin, parce que je devais un mois de loyer de mon cabinet, à preuve qu’on m’a gardé mes nippes.
– Eh bien ! qu’est-ce qu’on y voit dans cette maison ? demanda Nora Pitanchel.
– On y voit un garçon de dix-huit ans qui est amoureux d’une belle fille comme les amours et qui est folle. Oh ! mais, folle !…
Elle ne veut souffrir personne auprès d’elle, si ce n’est lui… Et puis elle pleure, et elle rit… et tout ça presque à la fois…
– Et c’est pour ça que l’autre l’aime ?
– Je ne sais pas ; mais ce que je puis vous dire, voyez-vous, c’est qu’il n’y a pas de mère qui prenne soin de son marmot comme lui de la jeune fille.
Il couche au pied de son lit, il se lève dix fois dans une nuit pour voir si elle dort.
L’autre jour, elle était plus malade qu’à l’ordinaire, il pleurait que ça nous fendait l’âme.
– Si j’ai jamais un amoureux comme ça, dit Nora, je le ferai empailler de peur qu’on ne me le vole.
– Et comment s’appelle-t-il, cet amoureux chef d’emploi ? demanda le marchand de coco qui avait fréquenté jadis les petits théâtres.
– Oh ! il a un drôle de nom, et je crois bien qu’il a été une jolie pratique dans son temps. Je crois même en avoir entendu parler autrefois par Gustave qui connaissait tout le monde. Il s’appelle Marmouset.
Le four de l’Eldorado n’est pas à plus de vingt pas de l’Auberge des Innocents.
Quand le vent y est, les dormeurs sinistres de ce repaire entendent distinctement toutes les joyeuses folies débitées à l’Eldorado.
À ce nom de Marmouset, un homme se dressa, à l’Auberge des Innocents, et s’approcha de l’Eldorado :
– Faites-moi donc un peu de place, les enfants.
– Tiens ! dit Nora, c’est vous, Pâtissier ?
– Oui, répondit l’ancien chef des ravageurs, et comme on parle de mon enfant chéri, Marmouset, je voudrais avoir de ses nouvelles.
XX
La jeune fille qui répondait au nom de Zélie et qui sans doute voyait pour la première fois ce bandit sinistre qui portait le nom de Pâtissier, éprouva un mouvement de crainte.
Le Pâtissier laissa peser sur elle ce regard qui avait jadis un pouvoir de fascination sur les ravageurs, avant que ceux-ci ne se donnassent à Rocambole.
Zélie se sentit frissonner.
– Voyons, ma petite, dit le Pâtissier, tu connais donc Marmouset ?
– Oui.
– Il y a bien longtemps que je ne l’ai vu, tu devrais bien me donner son adresse.
– Non, répondit Zélie.
– Et pourquoi ça ? fit le Pâtissier d’un ton de menace.
– Parce que vous n’êtes pas franc.
– Hein ?
– Vous n’aimez pas tant ce jeune homme que vous le dites, répondit Zélie.
– Quelle bêtise !
– Vos yeux pleins de haine démentent vos paroles, poursuivit la jeune fille.
Le marchand de coco se pencha à l’oreille de Zélie :
– Tu as tort, ma petite, dit-il tout bas ; il ne faut pas se brouiller avec un homme comme le Pâtissier.
Mais Zélie était courageuse, une fois le premier moment de crainte passé.
– Vous ne le saurez pas, répéta-t-elle.
– Ah ! je ne le saurai pas !
Et le Pâtissier ferma les poings avec colère.
– Battez-moi si vous voulez, reprit Zélie, vous n’en aurez pas l’étrenne ; on m’en a flanqué bien d’autres, mais je ne ferai pas arriver du poivre à un garçon qui est si dévoué que ça à une femme.
Le Pâtissier fit un pas et leva la main pour frapper Zélie.
Le vieux marchand de coco s’interposa :
– Voyons, mes enfants, dit-il, je connais peut-être un moyen de tout arranger. Un homme ne bat pas une femme quand il peut faire autrement.
– Je bats qui je veux, dit le Pâtissier.
Et il fit un pas encore vers Zélie, qui avait mis ses deux poings sur les hanches et l’attendait de pied ferme.
– Mais écoutez donc mon idée, fit le vieillard.
– Eh bien ! dit le Pâtissier s’arrêtant, dégoise-la vite, alors.
– Voici la chose. Zélie ne veut pas parler, reprit le marchand.
– Non, je ne parlerai pas ! dit Zélie.
– Mais elle en a déjà trop dit.
– Comment cela ? demanda le Pâtissier.
– N’a-t-elle pas dit que ce garçon que vous appelez Marmouset demeurait dans la maison d’où on l’a renvoyée, elle, Zélie ?
– Oui.
– Mais personne ne sait où je demeurais, dit Zélie d’un air de triomphe.
– Tu te trompes, répondit une voix de femme. Je te connais, moi.
Et une créature ignoble de laideur, couverte de haillons infects et la tête couronnée de rares cheveux grisonnants, qui jusque là était demeurée couchée sur le four, se dressa sur un coude et ajouta :
– Aussi vrai qu’on m’appelle la Mère au petit bonheur et que je vendais des plaisirs à deux liards dans le faubourg du Temple et le carré Saint-Martin, je te connais. Tu t’appelles Zélie ; Suivez-moi, jeune homme, c’est un nom que les commis du Pauvre Diable t’ont donné.
– Qu’est-ce que ça prouve ? fit Zélie.
– Tu demeurais rue du Vert-Bois, dans la maison d’un marchand de vins, vers le milieu, à gauche. La porte après le bureau de tabac.
– Ce n’est pas vrai, dit Zélie, d’un ton mal assuré.
– Bon ! fit le Pâtissier, je suis fixé maintenant. Petite, tu l’as échappée belle. Bonsoir, la compagnie.
Et le Pâtissier remonta se coucher sur le four de l’Auberge des Innocents.
* *
*
– Qu’est-ce que tu as donc été faire à l’Eldorado ? demanda un homme couché auprès du Pâtissier.
– Prendre l’adresse de Marmouset.
– Qu’est-ce que c’est que ça, Marmouset ?
– Ah ! c’est juste, dit le Pâtissier avec amertume, tu ne me connais que depuis ma débine, toi, et tu ne peux pas savoir ce que c’est que Marmouset.
– Il est vrai, dit l’interlocuteur du Pâtissier, que je ne te connais pas depuis longtemps, mais à la façon dont les camarades te saluent on voit que tu as dû être un crâne.
– Oui, soupira le Pâtissier, mais c’est fini… vingt fois j’ai voulu reconstruire une bande, depuis six mois, pas mèche !
Les uns me disent : « Il n’y a plus rien à faire dans le ravage. »
Les autres haussent les épaules et ajoutent :
« Quelle confiance veux-tu que nous ayons dans un homme qui s’est fait enfoncer par Rocambole ? »
Le nom que venait de prononcer le Pâtissier n’était sans doute pas un mystère pour celui qui lui parlait à voix basse, car il murmura :
– Rocambole en enfoncerait bien d’autres.
– Il m’a tout pris, continua le Pâtissier avec un accent de haine violente, mes hommes, mon industrie, et jusqu’à la Camarde qui était folle de moi, et qui m’a refusé cent sous, il y a huit jours.
Si on ne faisait pas un coup de temps en temps, on mourrait de faim.
– Tu ne m’as toujours pas dit ce que c’est que Marmouset.
– Un garçon que j’avais formé et qui était plein d’intelligence. Rocambole me l’a pris.
– Et tu voudrais le ravoir ?
– Non, mais en retrouvant Marmouset, je retrouverai peut-être Rocambole.
– Est-ce que tu voudrais qu’il te prenne dans sa bande ?
– Lui ! fit le Pâtissier avec un accent de haine sauvage.
– Alors ?…
– Mais je veux le retrouver pour me venger.
– Camarade, dit l’interlocuteur de l’ancien chef de bande, je ne connais pas Rocambole autrement que par ce que j’en ai entendu dire ; mais je vais te donner un bon conseil.
– Parle.
– Ne te frotte pas à lui. Tu seras roulé.
– Moi tout seul, peut-être, dit le Pâtissier, mais j’ai des amis… on verra…
Et il ne voulut pas s’expliquer davantage.
Quelques minutes après, il dormait, ou plutôt il feignait de dormir.
Mais de temps à autre, il ouvrait les yeux et surveillait du regard l’Eldorado.
Le four à plâtre des fantaisistes commençait à se ralentir de sa bruyante gaîté.
On n’entendait plus la voix cassante et dominatrice de Nora Pitanchel. Le marchand de coco s’était endormi, et Zélie ne bougeait pas plus qu’une morte.
Alors le Pâtissier se leva, mit ses nippes au bout d’un bâton, et bien qu’il fût à peine deux heures du matin, il s’apprêta à quitter l’Auberge des Innocents.
– Où vas-tu ? lui demanda celui à qui il avait déjà fait quelques confidences.
– Je vais tâcher de tailler une bonne croupière à ce gueux de Rocambole, répondit le Pâtissier.
– T’as tort, faut pas t’y frotter.
– Qui vivra verra, répondit le Pâtissier.
Et il s’en alla.
XXI
Le Pâtissier descendit dans Paris.
Lorsqu’il fut à l’ancienne barrière de la Villette, au lieu de suivre le faubourg Saint-Martin, il prit la rue Lafayette.
Cette voie nouvelle, une des plus larges de Paris, ne conduisant à aucune halle, est forcément la plus tranquille à deux heures du matin.
Le Pâtissier ne rencontra pas dix passants attardés de l’extrémité nord-est de la rue à la place Saint-Vincent-de-Paul qu’elle traverse.
Cependant un homme assez bien couvert qui rentrait chez lui eut la complaisance de lui tendre son cigare pour allumer sa pipe.
Le Pâtissier, qui était en loques et portait un chapeau sans bords, eut une tentation :
Sauter à la gorge du monsieur et le dévaliser.
Mais il songea à Rocambole, c’est-à-dire à sa vengeance et la tentation s’évanouit.
Arrivé au faubourg Poissonnière, il quitta la rue Lafayette pour prendre la rue Bellefond.
La maison où Antoinette Miller avait été la prisonnière de Timoléon et dans laquelle, sans l’intervention de Vanda, elle eût certainement péri, existait toujours.
En passant rue Lafayette, on pouvait voir encore le pavillon situé à l’extrémité du jardin et qui paraissait suspendu dans les airs.
Le Pâtissier s’arrêta à la porte de la maison, mit deux doigts sur sa bouche et siffla d’une façon particulière.
La porte ne s’ouvrit point, mais un volet de mansarde s’entrebâilla peu après.
Le Pâtissier siffla une seconde fois.
Le volet s’ouvrit tout grand.
Puis une voix dit :
– Je descends.
En effet, quelques minutes plus tard, la porte s’ouvrit et un homme sortit.
Cet homme, qui s’en était revenu rue Bellefond, comme le gibier chassé finit par revenir à son lancer, n’était autre que Timoléon.
Mais Timoléon méconnaissable, courbé, vieilli de vingt années en quelques mois ; Timoléon, l’implacable ennemi de Rocambole et que Rocambole n’aurait peut-être pas reconnu en dépit de son œil de lynx.
Timoléon avait vieilli de trente ans.
Il était revenu à Paris malgré la défense formelle de Rocambole.
Naturellement il était allé demander asile à ces portiers, ses complices d’autrefois, qui faisaient la sourde oreille quand il y avait du bruit dans le pavillon mystérieux.
Timoléon revenait pour se venger.
Cet homme, qui n’avait aimé que sa fille, qui n’avait eu qu’une passion, l’argent, cet homme n’avait plus de fille, cet homme n’avait plus ni argent, ni pain.
Mais il avait au cœur une haine infernale qu’il voulait assouvir à tout prix.
Et l’objet de cette haine c’était Rocambole.
Le jour de son arrivée, comme il se promenait sur un boulevard extérieur, cherchant un marchand de vins chez lequel il pût dîner pour quelques sous, il rencontra le Pâtissier.
Autrefois, on s’en souvient, Timoléon avait servi la police.
Tous les voleurs un peu âgés lui étaient connus.
Il avait employé souvent le Pâtissier.
Celui-ci ne le reconnaissait pas.
– Je suis Timoléon, lui dit-il.
– Pas possible ! s’écria l’ancien chef de bande.
Timoléon eut un sourire triste :
– Je suis un peu dégommé, dit-il ; que veux-tu ? on a des hauts et des bas. Et toi, comment va le ravage ?
– Je suis ruiné, enfoncé, geignit le Pâtissier. J’ai eu des malheurs comme personne. Voulez-vous boire un coup, patron ? Entrons-là, chez le mannezingue, je vous conterai ça.
Timoléon avait suivi le Pâtissier, et le Pâtissier lui avait raconté la désertion complète de la bande, qui s’était rangée sous la bannière de Rocambole.
Quand le Pâtissier eut achevé son récit, Timoléon lui dit :
– Tu hais donc bien Rocambole ?
– Oh ! si je le hais !
– Si jamais je pouvais t’aider à te venger…
– Vous feriez cela, vous !
– Peut-être… Dis-moi où on pourrait te trouver.
– Je couche aux Carrières d’Amérique.
– C’est bien, j’irai t’y voir un jour ou l’autre.
Et ils se quittèrent.
Deux jours après, Timoléon avait retrouvé les traces de Rocambole et il savait qu’il était à Londres.
Timoléon partit pour Londres, le soir même, employant à ce voyage ses dernières ressources.
Huit jours plus tard, il était de retour et se mettait en quête du Pâtissier.
Quand il eut retrouvé celui-ci, il lui dit :
– Veux-tu toujours te venger de Rocambole ?
– Si je le veux !
– Eh bien ! il n’est plus à Londres…
– Ah !
– Il est à Paris.
– Où donc ça ?
– Je ne sais pas, mais il te sera facile de le savoir. Quand tu le sauras, à quelque heure de jour ou de nuit que ce soit, viens me trouver rue Bellefond.
Donc, cette nuit-là, en voyant arriver le Pâtissier, Timoléon éprouva un mouvement de joie sauvage. Si le Pâtissier revenait, c’est qu’il avait trouvé Rocambole.
– Eh bien ! dit-il, où est-il ?
– Lui, je ne sais pas encore, mais je sais où est Marmouset.
Et le Pâtissier rapporta fidèlement, mot pour mot, ce qui s’était passé aux Carrières d’Amérique.
– Ah ! fit Timoléon, il est avec une femme ?
– Oui, une jeune fille.
– Qui est folle ?
– Zélie le disait.
– Et qui ne parle qu’anglais ?
– Ça, dit le Pâtissier, je ne sais pas : je ne crois pas que Zélie en ait parlé.
L’œil de Timoléon brillait d’une joie féroce.
– Pâtissier, mon ami, dit-il en posant la main sur l’épaule du bandit, tu as peut-être fait une belle découverte.
– Vrai ?
– Et il y a à Paris ou à Londres, je ne sais pas au juste, quelqu’un qui remue des billets de mille francs comme nous avons remué des sous, qui nous fera notre fortune en échange de la femme à Marmouset.
Allons-y !
– Où donc ? demanda le Pâtissier.
– Rue du Vert-Bois, pardieu !
Et Timoléon redressa sa taille voûtée et pour un moment les ardeurs de la jeunesse lui revinrent.
Il prit le Pâtissier par le bras et l’entraîna vers le faubourg Poissonnière.
– Mais, dit le Pâtissier, faut se méfier, il est fin comme une fouine, ce petit Marmouset.
– Eh bien ?
– Il me connaît et sait que je n’aime pas son patron.
– Il ne te verra pas : montre-moi seulement la maison, c’est tout ce qu’il me faut.
Et Timoléon murmura :
– Ah ! Rocambole, maintenant que ma pauvre enfant dort sous la terre glacée, je n’ai plus peur de toi, et j’ai fait d’avance à ma vengeance le sacrifice de ma vie !
XXII
Comment et pourquoi Marmouset et Gipsy étaient-ils cachés rue du Vert-Bois ?
C’est ce que nous allons expliquer en peu de mots.
En revenant à Paris, Rocambole avait fait un raisonnement fort simple et d’une rigoureuse logique, en apparence du moins.
– Je ramène, s’était-il dit, deux êtres que je dois cacher à tout prix : sir George Stowe, dont j’aurai besoin pour lutter avec avantage contre sir James Nively et les Étrangleurs ; Gipsy, que je dois soustraire aux poursuites de ce dernier.
S’il est un quartier où jamais on n’ira chercher un Anglais, c’est à coup sûr cette nécropole où tout est vieux, triste et en dehors de tout mouvement, qu’on appelle le faubourg Saint-Germain.
C’est donc là que je cacherai sir George Stowe.
Si Vanda a bien joué son rôle, elle m’a certainement bien posé dans l’esprit de sir James Nively.
Je suis un de ces élégants fripons qui vivent dans les beaux quartiers, fréquentent les clubs, arpentent le boulevard et se logent confortablement dans les quartiers neufs.
Pour sir James Nively, j’ai enlevé Gipsy ; j’ai dû la meubler confortablement et la loger dans un de ces jolis quartiers neufs qui avoisinent les Champs-Élysées ou le boulevard Malesherbes.
Par conséquent, si je veux bien cacher Gipsy, il faut que je la confine dans un quartier populaire, assez obscur pour qu’un homme du monde n’ose s’y risquer, assez honnête pour qu’elle ne coure aucun danger.
Or, en conséquence de ce raisonnement, Rocambole avait envoyé Noël à la découverte.
Noël avait une foule de ramifications dans Paris.
Une ancienne connaissance de maison centrale s’était établi fruitier dans la rue du Vert-Bois.
Devenu honnête, cet homme avait prospéré : son commerce allait bien. Il avait loué toute la maison qu’il habitait et la sous-louait ensuite à différents locataires.
Ce fut chez lui que Noël trouva un petit logis de deux pièces pour Gipsy et Marmouset.
Marmouset avait ordre de ne quitter Gipsy ni jour ni nuit.
En outre, la Mort-des-braves et le Chanoine s’étaient installés en bas, chez le marchand de vin, y passaient la journée à jouer aux cartes et faisaient bonne garde.
Mais point n’était besoin de donner une consigne à Marmouset.
Marmouset aimait Gipsy.
Il aimait la jeune fille avec tout l’entraînement de la jeunesse, avec l’ardent enthousiasme de l’être qui se sent fort et s’éprend de l’être faible qui a besoin de protection.
Gipsy était folle.
Mais cette folie n’inquiétait point Rocambole.
Le mal dont on connaît la cause a toujours un remède.
Or, le mal de Gipsy – sa folie – ne provenait point, comme on pourrait le croire, des terreurs et des angoisses qu’elle avait éprouvées durant cette nuit terrible où, au pouvoir des Étrangleurs, elle avait failli être brûlée vive au pied de la monstrueuse statue de Kâli, la farouche idole indienne.
Gipsy était folle parce qu’elle avait ardemment aimé sir Arthur Newil et que cet amour s’était brusquement brisé dans son cœur, tué par le mépris.
Et Rocambole, ce grand médecin du cœur humain, avait accueilli avec joie cet amour que la folie inspirait à Marmouset, et cette tendresse subite que la jeune fille éprouvait pour lui, – car nul autre ne pouvait l’approcher.
Marmouset seul obtenait d’elle qu’elle prît quelque nourriture, qu’elle se couchât le soir venu, et qu’elle ne sortît point.
Et il obtenait tout cela par le geste et le regard. Il ne savait pas l’anglais, la seule langue que Gipsy parlât.
Et Rocambole se disait :
– Gipsy est devenue folle par amour ; c’est l’amour qui la guérira.
Il y avait huit jours que Marmouset et Gipsy demeuraient rue du Vert-Bois.
La femme du fruitier montait faire leur ménage et préparait leur repas.
Marmouset veillait sur Gipsy comme une mère sur son enfant.
Il ne sortait jamais et il étudiait.
Ce garçon qui savait à peine lire était merveilleusement doué.
Rocambole lui avait donné des livres en lui disant :
– Gipsy ne sera peut-être pas toujours folle : alors, tu ne seras peut-être pas fâché de pouvoir causer avec elle tout à ton aise. Pour cela, il faut apprendre l’anglais. Voilà des livres, étudie…
Et Marmouset étudiait, en se disant :
– Un jour, je pourrai donc lui dire combien je l’aime !
Quelquefois, Milon et Noël montaient dans leur logis et venaient savoir comment allait Gipsy.
La folle souriait à Milon, mais elle regardait à peine Noël.
Milon était le seul être qu’elle connut après Marmouset.
Or, le lendemain du jour où Timoléon avait appris par le Pâtissier que Marmouset habitait avec Gipsy la rue du Vert-Bois, un bonhomme vêtu d’une longue redingote noire usée, les yeux abrités derrière des lunettes bleues et coiffé d’un chapeau gras et hors d’usage, déboucha par la rue Saint-Martin et entra dans cette même rue du Vert-Bois.
Il avait sous le bras gauche une liasse de papiers, et portait de la main droite une petite plaque de tôle peinte en rouge et sur laquelle se détachaient en lettres blanches et noires ces mots :
BUREAU DE PLACEMENT
CÉLÉRITÉ, DISCRÉTION.
Il entra dans les quatre premières maisons où il vit des écriteaux de location à la porte et se fit montrer les appartements vacants.
Pendant trois quarts d’heure, les paisibles habitants de la rue du Vert-Bois virent cet homme, aller de porte en porte d’un air discret.
Le fruitier, principal locataire de la maison où se cachait Marmouset, et qui se trouvait alors au seuil de sa boutique, disait à la marchande de tabac en riant :
– Il paraît que le négociant en domestiques est difficile à loger. Est-ce qu’il lui faut le Palais-Bourbon ?
Le bonhomme passa devant la boutique du fruitier, puis leva la tête et vit un autre écriteau.
Alors, il se risqua dans l’allée humide et noire.
Mais le fruitier l’appela :
– Hé ! monsieur, dit-il, qu’est-ce que vous voulez ?
– Le concierge, répondit le bonhomme, en ôtant son chapeau gras et montrant un crâne pelé.
– Il n’y en a pas. C’est moi qui réponds. Après qui demandez-vous ?
– Je cherche un appartement pas trop haut et pas trop cher pour mon petit commerce, répondit humblement le bonhomme.
– Payez-vous exactement ?
– Le plus que je peux. J’ai une bonne clientèle, du reste. Mais on m’a démoli ; j’habitais rue Greneta, auparavant.
– Eh bien ! entrez, dit le fruitier. Nous verrons à nous arranger.
– Combien l’appartement à louer ?
– Quatre cent cinquante francs.
– Un peu cher, dit le bonhomme en hésitant.
Puis, avec un soupir :
– Enfin… voyons-le…
Et il entra dans la boutique du fruitier.
XXIII
Le bonhomme entra donc chez le fruitier.
Celui-ci ouvrit, dans le fond de sa boutique, une porte qui donnait sur l’allée de la maison et précédant son futur locataire, il gravit l’escalier jusqu’à deuxième étage.
Deux portes ouvraient sur le carré.
L’une était celle de l’appartement à louer.
Tandis que le fruitier se baissait pour mettre la clé dans la serrure, car l’escalier était sombre, le prétendu placeur de domestiques colla rapidement son œil au trou de l’autre serrure et regarda.
Il vit une première pièce dans laquelle un jeune homme était assis devant une table, un livre à la main.
Un peu plus loin se trouvait une femme.
Le bonhomme fut fixé.
Il visita l’appartement que lui montrait le fruitier, le trouva sombre, un peu cher, discuta le prix, insista pour qu’on mit du papier neuf et finit par l’arrêter en donnant cent sous de denier à Dieu.
Un homme si méticuleux et qui marchande si bien est un homme qui paye son terme.
Le fruitier loua.
Le bonhomme annonça qu’il reviendrait le lendemain avec ses meubles et, sur-le-champ, il accrocha son écriteau sous la porte d’entrée.
Puis il s’en alla.
Mais, une heure après il revint.
– Voulez-vous être assez aimable, dit-il au fruitier, pour me donner la clé ? Je voudrais prendre la hauteur des croisées pour les rideaux.
C’était si simple que le fruitier n’hésita pas.
Le bonhomme monta, s’enferma dans l’appartement, puis, après avoir prêté l’oreille, il put se convaincre que le mur qui séparait son appartement de celui dans lequel il avait aperçu un jeune homme et une jeune femme était fort mince.
Le bruit des voix passait au travers.
Le bonhomme enleva délicatement un morceau de papier qui recouvrait ce mur et qui, du reste, tomba en lambeaux, tira de sa poche un vilebrequin de serrurier et se mit à creuser un trou.
Quand il sentit qu’il était tout près de rencontrer le jour de l’autre côté, il s’arrêta.
– En voilà assez pour aujourd’hui, murmura-t-il.
Et il replaça le morceau de papier sur le trou et passa son pied sur le plâtre tombé sur le carreau, de façon à le noircir et à lui donner une apparence de poussière.
Comme il s’en allait après avoir remis la clé au fruitier, une femme entrait dans la rue Vert-Bois.
Coiffée d’un petit bonnet, portant sur une vieille robe de soie un caraco rouge, peignée à la diable, portant des bas crottés et se retroussant plus que de raison, cette femme, qui était jeune et jolie, avait tout d’abord l’apparence d’une de ces beautés qui émaillent le soir le carré Saint-Martin.
Mais le bonhomme ne l’eut pas plus tôt envisagée qu’il tressaillit.
Il avait reconnu Vanda, la compagne de Rocambole.
Que signifiait ce costume ?
Était-ce un déguisement, ou bien Vanda était-elle tombée subitement dans la misère et l’abjection ?
Elle ne fit nulle attention au bonhomme, mais celui-ci la suivit du coin de l’œil.
Vanda entra chez le fruitier.
Des lors, pour lui, la chose était claire.
Vanda était la messagère de Rocambole.
Au lieu de continuer son chemin, le bonhomme revint alors sur ses pas, tira de sa poche une de ces tabatières qu’on appelle des queues de rat, et la posa sur le comptoir du bureau de tabac qui se trouvait à côté de la boutique du fruitier, en disant :
– Deux sous à la fève, s’il vous plaît.
Il y avait au comptoir une vieille femme très bavarde et qui engageait la conversation avec quiconque l’y poussait quelque peu.
Le bonhomme devint loquace.
Il apprit à la marchande de tabac qu’il devenait locataire dans sa maison, qu’il tenait un bureau de placement, que le métier, très bon autrefois, ne valait plus grand’chose ; mais qu’enfin il fallait vivre, et qu’à son industrie de placeur, il joignait celle d’écrivain public.
La marchande de tabac rendit politesse pour politesse. Elle mit le bonhomme au courant de tous les tripotages du voisinage, lui apprit que le fruitier avait été au bagne, mais qu’il était devenu tout à fait brave homme, et qu’on le considérait dans le quartier ; que depuis qu’il servait à boire, le marchand de vins d’à côté perdait de sa clientèle ; que la rue, qui n’était pas très propre, était néanmoins fort bien habitée et qu’on y comptait jusqu’à huit métiers et un employé des contributions.
Ce double bavardage fit passer à la marchande de tabac une heure fort agréable et donna le temps au bonhomme d’observer une foule de choses.
Étant sorti une minute sur le pas de la porte, il avait jeté un coup d’œil rapide dans la boutique du marchand de vins.
Deux hommes, assis dans le fond de la salle, jouaient paisiblement au piquet avec leurs mains graisseuses.
Le bonhomme reconnut ces deux hommes.
L’un était le Chanoine, l’autre la Mort-des-braves.
Tandis qu’ils jouaient, un troisième entra.
Le bonhomme reconnut Milon.
– Bon, pensa-t-il, Marmouset et la jolie Anglaise ont des gardes du corps.
En même temps Vanda sortit.
Alors le bonhomme souhaita le bonjour à la marchande de tabac et se mit à suivre Vanda.
Celle-ci ne se retourna point. Mais quand elle fut au coin de la rue Saint-Martin, elle monta dans un fiacre qui stationnait là comme par hasard.
Le bonhomme passa tout auprès du cocher comme elle disait à ce dernier :
– Rue Saint-Lazare, 28.
Le fiacre partit.
Mais en même temps que lui passait l’omnibus de la place Cadet.
Le bonhomme grimpa sur l’impériale.
Le fiacre de Vanda allait plus vite que l’omnibus.
Pendant quelques minutes le faux placeur put le suivre des yeux.
Mais il le perdit de vue au coin du faubourg Saint-Denis.
Peu lui importait, il gagna la place Cadet et monta dans la correspondance qui longe la rue Lamartine, la rue Saint-Lazare, et va à Chaillot. Arrivé au numéro 28, le bonhomme allait descendre de l’impériale, lorsqu’il vit un petit coupé brun attelé d’un magnifique trotteur qui stationnait à la porte.
En même temps une femme sortit accompagnée par un homme qui ouvrit la portière et dit :
– Tout est bien convenu ainsi ; à ce soir.
Le bonhomme tressaillit.
La femme qui montait dans le coupé n’était autre que Vanda.
Mais Vanda ayant retrouvé sa mise de femme élégante et drapée dans un cachemire long.
Quant à celui qui lui disait « à ce soir, » le bonhomme le reconnut aussi.
C’était le major Avatar qui disait au cocher :
– Aux Champs-Élysées.
Ce qui fit que Timoléon – car on avait déjà deviné que c’était lui qui s’était déguisé en placeur et avait loué l’appartement contigu à celui de Marmouset, rue du Vert-Bois – Timoléon, disons-nous, demeura sur l’impériale de l’omnibus qui, pour se rendre à Chaillot, traverse les Champs-Élysées, et murmura :
– Je sais où trouver Gipsy, je sais où est Rocambole. Quand je saurai où va Vanda, je pourrai aller trouver sir James Nively.
XXIV
Tandis que Timoléon suivait les traces de Vanda, disons ce qui s’était passé la nuit précédente entre elle et Rocambole, lorsqu’après le départ de sir James, elle s’était rendue en toute hâte rue Saint-Lazare.
– Ma chère enfant, disait Rocambole, tu n’as plus besoin de chercher à pénétrer le secret de sir James.
Je sais sur le bout du doigt l’histoire de miss Ellen, c’est-à-dire de milady, et l’heure des investigations a fait place à l’heure d’agir.
La situation est bien simple et peut se résumer ainsi :
Miss Ellen a dépouillé sa sœur et l’enfant de sa sœur.
Il faut rendre à cette dernière, c’est-à-dire à Gipsy, ce que miss Ellen a volé.
Où est cette fortune ?
Ce n’est pas sir James Nively qui nous le dira, c’est milady elle-même.
D’après ce que je vois, cette fortune demeurée intacte apporte chaque année ses immenses revenus dans la maison de banque Davis, laquelle en fait deux parts.
La première est pour milady.
C’est sur cette part de revenu que le fils de milady a vécu.
Que devient l’autre ?
Sans doute elle grossit chaque année ce trésor sur lequel les Indiens comptent pour chasser un jour les Anglais.
Pourquoi Ali-Remjeh a-t-il abandonné milady ?
Pourquoi cette dernière ne voit-elle, n’a-t-elle jamais vu son fils ?
Ceci est encore un mystère pour moi.
Cependant voici ce que j’ai vu.
Et Rocambole après avoir raconté à Vanda la scène des Tuileries, ajouta :
– Milady s’est évanouie en apprenant que son fils était blessé.
Tu penses bien que le coup de théâtre devait avoir un résultat immédiat.
Milady a été reconnue par Marie Berthoud pour la mère de M. Lucien Haas.
Alors elle m’a supplié de lui venir en aide. J’ai couru chercher une voiture. Aidé de deux messieurs qui se trouvaient là, nous y avons transporté milady et nous l’avons conduite rue de la Sourdière.
Pendant le trajet, j’avais rassuré Marie Berthoud de mon mieux sur les conséquences de la blessure de Lucien.
Et Marie avait fini par partager ma conviction.
Lorsqu’après avoir respiré des sels, milady est revenue à elle, elle a manifesté un grand désespoir et versé des torrents de larmes.
Marie Berthoud la rassurait, comme je l’avais rassurée moi-même. Puis elle lui disait :
– Nous allons partir, nous irons nous installer à son chevet et la vue de sa mère hâtera la guérison.
Mais à cette proposition milady a manifesté une grande terreur.
– Non, non, disait-elle, cela est impossible… Cela ne se peut !
Et elle a fait jurer à Marie qu’elle laisserait ignorer à Lucien leur entrevue.
Comme je m’étais donné pour un ami de Lucien et que je lui avais servi de témoin, milady a eu la même confiance en moi et m’a fait prêter le même serment.
– Mais pourquoi ne veut-elle pas voir son fils ? interrompit Vanda.
– Ce n’est pas elle, c’est sans doute Ali-Remjeh qui s’y oppose. Je l’ai deviné à la terreur subite qui s’est emparée d’elle.
– Enfin, dit encore Vanda, te voilà au mieux avec milady ?
– Et avec le major Hoff, son complice. J’ai renouvelé connaissance avec lui en reconduisant milady au Grand-Hôtel.
– Eh bien ! que comptes-tu faire ?
– Milady n’a au cœur qu’une passion vraie ; son amour maternel. C’est là qu’il faut frapper.
– Comment ?
– Suppose que Marie Berthoud disparaisse.
– Bon !
– Que Lucien soit averti que c’est sa mère qui l’a fait enlever.
– Fort bien. Après ?
– On lui dit : Voyez-vous cette femme qui passe ? C’est votre mère. C’est elle seule qui peut vous dire ce qu’est devenue Marie Berthoud.
– Mais milady prouvera à son fils qu’elle est innocente au sujet de Marie.
– Je le sais.
– Eh bien ?
– Alors mon rôle commencera, dit Rocambole.
Puis, après un moment de silence :
– Crois-tu que, lorsque milady verra son fils au désespoir et qu’on viendra lui dire : Que donneriez-vous donc pour lui rendre Marie Berthoud ? elle ne répondra point : « Une fortune entière. »
– Peut-être, dit Vanda.
– Eh bien ! c’est là ce que je veux.
– Mais comment enlever Marie Berthoud ? où la conduire ?
Un sourire vint aux lèvres de Rocambole.
– Ce sont là des jeux d’enfant, dit-il. Je m’en charge. Est-ce que, avec une bande comme la mienne, on ne remue pas Paris tout entier ?
– Maître, dit Vanda, vas-tu me laisser longtemps encore auprès de sir James ?
– Jusqu’à ce que milady et les Étrangleurs aient rendu gorge.
– Cela peut être long.
– Ce sera plus court que tu ne penses.
– Mais d’abord, dit encore Vanda, as-tu songé à une chose ?
– Laquelle ?
– C’est que Lucien et Marie sont deux êtres honnêtes, naïfs, intéressants, et que tu vas les frapper.
Un nuage passa sur le front de Rocambole.
– Je me suis dit tout cela, répondit-il, mais il faut que les millions de la bohémienne soient restitués. Après, Gipsy donnera sans doute de quoi vivre au fils de milady.
– Mais Gipsy est folle !
– Elle guérira, répondit Rocambole avec l’accent d’une émotion profonde.
– Enfin, reprit Vanda, qu’ordonnes-tu, Maître ?
– Rien pour aujourd’hui, mais il faut que je te voie demain.
Vanda s’en était allée.
Mais, le lendemain, dès neuf heures du matin, elle revenait rue Saint-Lazare et disait :
– Alerte ! alerte ! j’ai des nouvelles d’Ali-Remjeh.
– Voyons ? fit Rocambole avec son flegme ordinaire.
Alors Vanda raconta à Rocambole que sir James Nively n’était rentré qu’au petit jour, la nuit précédente, non pas seul, mais en compagnie de deux hommes au teint bistré, aux cheveux noirs et frisés, aux yeux ardents et qui paraissaient être des Indiens.
Ces hommes arrivaient de Londres.
Vanda s’était traînée nu-pieds, retenant son haleine, dans un corridor sur lequel ouvrait la salle où sir James s’était enfermé avec eux.
Comme ils causaient en langue indienne, elle n’avait pu saisir ce qu’ils disaient, mais elle avait entendu prononcer à plusieurs reprises le nom de Gipsy, et elle en avait conclu que ces deux hommes étaient bien certainement sur les traces de la bohémienne.
– S’ils n’y sont pas, je les y mettrai, dit Rocambole.
Vanda le regarda avec étonnement.
– Tu penses bien, reprit le Maître, que je ne vais pas laisser sir James Nively au grand air, maintenant aussi que les principaux Étrangleurs sont arrivés pour lui prêter main-forte.
– Que comptes-tu donc faire ?
Rocambole ouvrit ce même tiroir dans lequel il avait enfermé le curieux mémoire du pauvre Bob ; il y prit un flacon qui renfermait une petite poudre blanchâtre.
– Voici un narcotique, dit-il, que tu feras prendre à sir James ce soir même.
– Après ?
– Quand il dormira, tu placeras une lampe auprès de la fenêtre de sa chambre à coucher, ce sera pour moi un signal.
– Et puis ?
– Et puis, le reste me regarde, mais avant de rentrer avenue de Marignan, tu vas aller rue du Vert-Bois, tu verras Milon, tu sauras si on est venu rôder autour de la maison.
Vanda obéit, après avoir toutefois pris le costume de femme à moitié déguenillée sous lequel Timoléon devait la reconnaître.
Une heure après, elle était de retour.
– Milon et les autres ont fait bonne garde, dit-elle, on n’a rien signalé d’alarmant.
– C’est bien, lui dit Rocambole, tout est convenu ainsi.
C’étaient ces derniers mots qu’avait entendus Timoléon du haut de l’impériale de l’omnibus.
XXV
Le major Hoff, c’est-à-dire Franz, était auprès de milady, au Grand-Hôtel, lorsqu’un commis de la maison Davis-Humphry et Co apporta le billet de sir James Nively.
Milady disait à Franz :
– À la fin je me révolte contre la tyrannie d’Ali-Remjeh. Comment ! j’ai un fils, le sien ; ce fils est malade, ce fils est blessé, en danger de mort peut-être et je ne pourrais aller le voir !
– Milady, répondit Franz, vous savez que votre fortune tout entière est le gage de votre soumission aux volontés d’Ali-Remjeh, prenez garde !
– Eh bien ! dit-elle avec emportement, je serai pauvre, mais je verrai mon fils.
– Mais si vous devenez pauvre, votre fils le sera.
Ces mots calmèrent subitement l’emportement de milady.
– Ô misère, murmura-t-elle ; mais pourquoi cet homme qui m’a abandonnée depuis plus de quinze ans veut-il donc que je ne voie pas mon fils ?
– Je crois le savoir, dit Franz.
– Toi ?
– Oui.
Mais comme le major faisait cette réponse, on apporta le billet.
Franz l’ouvrit.
– Tenez, milady, dit-il.
Et il le mit sous les yeux de la mère de Lucien.
– Qu’est-ce que sir James Nively ? demanda milady avec un certain étonnement.
– C’est l’homme qui a remplacé à Londres sir George Stowe, c’est-à-dire le mandataire d’Ali-Remjeh.
– Et cet homme est à Paris ?
– Apparemment, puisqu’il me demande un rendez-vous.
Et le major Hoff écrivit la lettre que nous avons vu décacheter par Vanda.
– Tu disais donc, reprit milady, que tu savais ?…
– Ah ! madame, dit Franz avec autorité, vous me donnerez bien jusqu’à demain.
– Pourquoi ?
– Pour m’expliquer. Peut-être ma conversation avec sir James Nively rendra-t-elle, du reste, notre explication inutile.
– Que veux-tu dire ?
– Que peut-être j’obtiendrai de lui que vous puissiez voir votre fils.
Milady se résigna ; et le soir, à l’heure indiquée, le major Hoff, couvert de décorations allemandes, se rendit au Club des Asperges .
On s’y entretenait du duel de la veille et de la mort du marquis.
Le major Hoff ne put prêter qu’une oreille distraite et indifférente à la conversation, bien qu’il éprouvât une terrible émotion.
Plusieurs de ces messieurs, les mêmes qui, la veille, étaient demeurés muets, lorsque Lucien cherchait des témoins, s’étaient empressés d’aller le voir.
Tous s’accordaient à reconnaître que la blessure était sans gravité.
En outre, une réaction s’était faite en faveur de Lucien et M. le marquis de Rouquerolles était généralement blâmé.
Le baron de C…, un diplomate allemand, alla même jusqu’à dire :
– Après ça, messieurs, quand Lucien serait – et ceci est possible – le fils de quelque altesse sérénissime ou royale que sa grandeur force à rester dans l’ombre, serait-il moins bon gentilhomme ?
Cette opinion avait rallié tout le monde et on commençait à faire un éloge exagéré de Lucien, lorsqu’un des laquais du club apporta une carte sur un plateau en disant :
– Pour M. le major Hoff.
C’était la carte de sir James Nively.
Franz quitta le fumoir et passa dans un petit salon que d’un commun accord les membres du club avaient converti en parloir et dans lequel on avait coutume d’introduire les étrangers.
Sir James Nively s’y trouvait.
Franz et lui se saluèrent.
Puis ils échangèrent le signe mystérieux de l’affiliation indienne.
Alors sir James dit à Franz :
– Je suis porteur des volontés d’Ali-Remjeh.
– Qu’ordonne le maître ? demanda Franz avec respect.
– Il permet à milady de voir son fils !
Franz eut un mouvement de joie.
Sir James continua :
– Le chef suprême des Étrangleurs est à la veille de résigner ses pouvoirs. Il a vingt-cinq années de dictature et les lois qui nous régissent exigent que chaque quart de siècle voie un nouveau maître.
– Eh bien ? demanda Franz.
– C’est à propos de la fortune de miss Ellen que je vous dis cela.
Franz tressaillit.
– Jusqu’à présent, poursuivit sir James Nively, la moitié des revenus de cette immense fortune a été régulièrement versée par l’intermédiaire d’Ali-Remjeh, dans les caisses du trésor indien. Mais, en quittant le pouvoir, Ali-Remjeh veut liquider.
– Comment l’entendez-vous ? demanda le major Hoff.
– Ce n’est plus les revenus, c’est le capital, dit-il, qu’il veut donner à l’association.
– Miss Ellen fera ce que veut Ali-Remjeh, répondit le major avec soumission.
– Enfin, dit sir James, je suis chargé de transmettre à miss Ellen une autre nouvelle.
– Parlez…
– Le pacte qui lie les fils de l’Inde, les Étrangleurs, comme nous appellent les Européens ignares, veut que le chef suprême demeure célibataire, quand il a le pouvoir en mains.
Franz tressaillit de nouveau.
– Ali-Remjeh n’a cessé d’aimer milady, poursuivit sir James Nively, et il aime le fils qu’il a à peine entrevu vagissant dans son berceau.
– Eh bien ?
– Ali-Remjeh revient en Europe et il compte épouser milady.
– Si milady y consent…
– Ceci est son affaire et non la mienne, dit froidement sir James… Cependant je dois vous dire une chose…
– J’écoute, dit Franz.
– Même après avoir payé cette moitié de fortune aux Étrangleurs, moitié qui était le prix de leur concours et de la mort du commodore Perkins, miss Ellen peut encore avoir besoin d’eux.
– Vous croyez ?
Et Franz eut une légère inflexion d’ironie dans la voix.
– Oui, car la bohémienne est pleine de vie.
– Gipsy ?
– Oui, Gipsy, qui pourrait bien réclamer quelque jour la fortune de sa mère.
– Milord, dit Franz, je ne sais ce que milady voudra faire et ne puis vous répondre à cet égard. Seulement, je vous ferai observer que vous et les vôtres, vous êtes chargés de Gipsy.
– Malheureusement, elle nous échappe.
– Que voulez-vous dire ?
– Elle a quitté l’Angleterre.
– Ah !
– Elle est à Paris…
– Seule ?
– Non, avec un homme qui l’aime et la protège, et qui pourrait bien devenir son vengeur.
Franz eut un éblouissement.
– Il faut la retrouver, dit-il avec vivacité, il faut qu’elle disparaisse à jamais… il faut qu’elle meure !
– C’est pour cela, dit froidement sir James Nively, que je suis venu vous trouver.
XXVI
Sir James Nively avait quitté le major Hoff vers deux heures du matin.
Mais il n’était point rentré chez lui tout d’abord, et le jour naissait, ainsi que devait l’annoncer Vanda à Rocambole, quelques heures plus tard, – lorsqu’il franchit la grille du petit hôtel de l’avenue Marignan, en compagnie de ces deux Indiens, avec lesquels, sans doute, il avait achevé sa nuit.
Sir James, en dépit du sang indien qu’il avait dans les veines, était Anglais par tempérament.
Il avait besoin d’une nourriture substantielle et huit heures de sommeil régulier.
Après le départ des Indiens, il se mit donc au lit et dormit jusqu’à midi, ce qui permit à Vanda de sortir.
Or, comme il s’éveillait, on lui apporta le billet suivant :
« Un homme qui a longtemps vécu à Londres et qui pourrait rendre à sir James les plus grands services désirerait obtenir de lui un moment d’audience. »
Sir James n’eût peut-être pas prêté une grande attention à cette lettre, et peut-être même, en toute autre circonstance, n’y eût-il pas répondu, s’il n’avait eu le matin même une longue conversation avec les deux Indiens entrevus par Vanda.
Ces hommes, qui cependant étaient d’une grande habileté et eussent trouvé à Londres la personne la mieux cachée, perdaient patience à Paris ; et, depuis huit jours qu’ils y étaient, ils n’avaient pas trouvé la moindre trace de Gipsy et de son prétendu ravisseur.
Il jeta le billet au feu et demanda qui l’avait apporté.
– Un homme qui attend dans l’antichambre, lui fut-il répondu.
Sir James quitta son cabinet et passa dans l’antichambre.
Là, il se trouva en présence d’un individu blond, au visage coloré, qui paraissait avoir cinquante ans, et qui portait un habit bleu et une ample cravate blanche dans laquelle son cou disparaissait presque tout entier.
Il s’était donné une tournure si complètement britannique, que sir James ne douta pas un seul instant qu’il n’eût affaire à un bourgeois de Londres ou de Manchester.
Cet homme disait alors à sir James :
– Milord, je puis vous dire où est Gipsy.
Si on eût tiré inopinément un coup de canon aux oreilles de sir James, on ne lui eût pas causé une émotion plus grande.
Quel était cet homme qui prononçait le nom de Gipsy ?
Et comment cet homme savait-il que sir James avait intérêt à retrouver la bohémienne ?
L’inconnu mit un doigt sur ses lèvres.
Puis, se penchant vers sir James :
– Avez-vous dans cette maison une pièce assez reculée pour que nul ne puisse y entendre ce que nous y dirons ?
Sir James répondit :
– Je n’ai ici qu’une personne sachant l’anglais, et je suis sûr d’elle.
Un sourire glissa sur les lèvres de l’inconnu.
– C’est précisément de cette personne-là qu’il faut se défier, dit-il.
Sans le regard d’autorité dont il accompagna ces paroles, cet homme eût peut-être été congédié.
Mais sir James qui se connaissait en hommes, ayant dans sa vie commandé à beaucoup, ne put s’empêcher de tressaillir et dit :
– Veuillez vous expliquer, monsieur.
L’inconnu posa son chapeau sur un meuble et se mit, comme on dit, à son aise.
Puis, regardant sir James avec assurance :
– Milord, lui dit-il, nous ne sommes pas à Londres, ici, et si vous avez des Étrangleurs à votre service, ils ne sont pas dans cette maison. Si vous aviez la fantaisie de me faire violence, nul ne vous viendrait en aide, et je m’en irais librement. Par conséquent, ne vous étonnez point de mes manières et dites-vous bien que, si vous manquiez de patience, vous perdriez la seule occasion peut-être que vous aurez jamais eue de retrouver Gipsy et de sauver sa fortune qu’elle réclamera au premier jour.
Tout cela fut articulé nettement, froidement, presque du bout des dents, et pour la première fois peut-être sir James Nively comprit qu’il n’était pas le seul, dans le monde, à jouer le rôle de dominateur.
– Si je vous dis, continua l’inconnu, que je ne me déciderai à parler que lorsque je serai certain que nul, pas même la personne dont vous croyez être sûr, ne peut nous entendre, c’est que j’ai mes raisons pour cela.
Sir James avait fait une demi-douzaine de haut-le-corps, tandis que cet homme parlait.
Comment cet homme avait-il pu lui parler d’Étrangleurs, prononcer le nom de Gipsy, parler de fortune à réclamer ?
Qui donc l’avait initié à tout cela ?
Mystère !
Sir James finit donc par incliner la tête et répondit :
– Nous sommes ici au premier étage ; la personne dont vous parlez habite le rez-de-chaussée. La maison est neuve ; il n’y a ni trappes, ni oubliettes, ni trous percés dans les murs, et les murs sont épais.
Qui donc pourrait nous entendre ?
– C’est égal, dit l’inconnu, vous permettez, n’est-ce pas ?… afin que nous ne soyons pas dérangés.
Et il alla fermer la porte au verrou.
Sir James, stupéfait, le regardait faire.
L’inconnu se jeta alors sans façon dans un fauteuil et reprit :
– Milord, afin de vous éviter la peine de me l’apprendre, je vais vous dire qui vous êtes.
Vous vous appelez à Londres sir James Nively. D’abord chef occulte de la société indienne, dite des Étrangleurs, vous en êtes devenu le chef apparent, lorsque votre prédécesseur sir George Stowe vous a forcé, par son incapacité, à le déposer.
– Après ? dit froidement sir James.
– Vous êtes venu à Paris un peu pour les intérêts de ceux que vous représentez en Europe, et beaucoup par amour.
Une jeune fille, une bohémienne du nom de Gipsy, qui pourrait être demain une des plus riches héritières de l’Angleterre, a disparu.
Où est-elle allée ?
Une femme s’est chargée de vous l’apprendre.
Cette femme se nomme Vanda.
– Après ? dit encore sir James.
– Gipsy a quitté l’Angleterre avec un homme qu’aimait cette femme, qui répond au nom de Vanda. Certainement, ils sont venus à Paris.
– Je le crois, dit sir James. Eh bien ?
– Pour les retrouver l’un et l’autre, car l’amour de Vanda est à ce prix, n’est-ce pas ?
– Oui, continuez…
– Pour les retrouver, vous avez fait venir de Londres deux hommes qui vous obéissent, deux de ces jongleurs indiens dont l’habileté est proverbiale, dont le flair est égal à celui d’un renard et qui ont répondu du succès.
Ces hommes se trompent et vous vous trompez, sir James Nively.
De même qu’on ne chasse certaines bêtes fauves qu’avec des chiens dressés pour cela, on ne chasse le Parisien qu’avec le Parisien.
Il y a sur le pavé de Paris deux cents voleurs qui déjoueraient en un tour de main toutes vos bandes indiennes, tous vos prestidigitateurs armés de lacets.
Il y a un homme qui ne ferait qu’une bouchée de ces deux cents voleurs et qui a mis souvent sur les dents toute la police de Paris.
– Et… cet homme ? demanda sir James Nively.
– C’est celui que vous cherchez.
L’Anglo-Indien fit un mouvement de surprise.
– Mais quel est donc cet homme ? dit-il.
– Un criminel célèbre, jadis, un homme appelé Rocambole, qui s’est mis en tête de devenir vertueux. Voulez-vous son histoire en deux mots ?
– Parlez !
L’inconnu retraça en dix minutes les principaux épisodes de l’existence si extraordinaire, si agitée de Rocambole. Il décrivit sa miraculeuse évasion du bagne, et sa lutte héroïque avec Morlux, et le sauvetage merveilleux d’Antoinette et de Madeleine.
Sir James l’écoutait avec stupeur.
Quand il eut fini, l’Anglo-Indien lui dit :
– Et c’est là l’homme qui a enlevé Gipsy ?
– Oui.
– Il l’aime donc bien ?
Et sir James se souvint de cet enlèvement grandiose qui avait eu pour théâtre la pagode de Hampstead.
– Non, il ne l’aime pas, dit froidement l’inconnu.
– Qui donc aime-t-il ?
– La femme qui vit sous le toit de cette maison.
– Vanda !
– Oui.
– Mais il l’a abandonnée…
L’inconnu haussa les épaules :
– Aussi vrai, dit-il, que je me nomme Timoléon et que je change de vêtements comme de figure, vous êtes naïf, sir James. Vanda et Rocambole se moquent de vous et n’ont jamais cessé de se voir.
– C’est impossible ?
– Ce matin encore, dit Timoléon avec conviction.
Sir James eut un de ces rires nerveux qui, chez les hommes d’Orient, mettent à nu des dents blanches et pointues comme celles des carnassiers :
– Si cela est ainsi, dit-il, elle mourra.
XXVII
Timoléon, car c’était lui que nous retrouvons ainsi métamorphosé, garda un moment le silence.
Il attendait que la colère de sir James en fût arrivée à ce degré de fureur froide et concentrée que les Russes ont si bien nommée la colère blanche.
Pendant quelques minutes, sir James arpenta la chambre comme une bête féroce prisonnière arpente sa cage. Puis, tout à coup, il vint se rasseoir, calme, effrayant, en face de Timoléon.
– Monsieur, lui dit-il, je ne sais pas qui vous êtes, mais écoutez bien mes paroles : Si ce que vous avez dit est vrai, cette femme mourra… Si vous m’avez menti, je vous tuerai !…
– J’espère me bien porter longtemps, répondit Timoléon avec un sourire.
Puis après avoir regardé sir James fixement :
– Vous pensez bien, monsieur, dit-il, que je ne suis pas venu ici uniquement pour vous prévenir des dangers que vous couriez.
– Eh bien ! que voulez-vous ? demanda sir James.
– Vous proposer une affaire.
– Voyons ?
– Je sais où est Gipsy.
– Vrai ?
– Je puis vous la livrer. Je puis vous donner la preuve que Rocambole et Vanda n’ont pas cessé de s’aimer, de correspondre, de se voir et de vous jouer.
– Et vous venez me vendre vos secrets !
– L’argent n’est rien, la vengeance est tout ! répondit Timoléon.
Et il eut dans les yeux un tel éclair de haine que sir James ne douta plus un seul instant de sa sincérité.
– Vous haïssez donc Rocambole ? demanda sir James.
– Il a tué ma fille, répondit Timoléon.
Et il courba la tête avec un sentiment de douleur si poignant, si immense, que sir James comprit.
– Ainsi, vous voulez vous venger ?
– Milord, reprit Timoléon, je suis pauvre, presque misérable. Eh bien ! je n’aurai recours à votre bourse que pour faire face aux dépenses qu’exigeront les circonstances et la conduite à bien de nos projets.
Le jour où je vous aurai livré Gipsy, le jour où Rocambole montera sur l’échafaud, ce jour-là, j’irai vous tendre la main, et vous laisserez tomber dedans telle aumône ou telle récompense que vous jugerez convenable.
Sir James avait étudié le cœur humain ; il savait que les hommes obéissent encore plus à leurs passions qu’à leurs intérêts et que le désir de se venger est la plus tenace de toutes les passions.
– Je vous crois, dit-il simplement.
Timoléon quitta le fauteuil sur lequel il était assis et reprit son chapeau.
– Milord, lui dit-il, est-ce une affaire convenue, un pacte conclu ? Acceptez-vous mes services ?
– Oui, dit sir James, mais il me faut la preuve de la complicité de Rocambole et de Vanda.
– Je vous l’apporterai.
– Quand ?
– Ce soir.
– À quelle heure ?
– À minuit.
– C’est bien. Vanda mourra.
– Et le plus tôt sera le mieux, dit Timoléon, car c’est un rude auxiliaire de cet adversaire terrible qu’on nomme Rocambole.
Timoléon fit un pas vers la porte.
Mais avant de poser la main sur le bouton de la serrure, il se retourna.
– Encore un mot, milord, dit-il.
– J’écoute.
– Si je n’ai craint au monde qu’un homme, quand j’avais un trésor à perdre, ma fille, un homme qui a triomphé de moi, Rocambole, – aujourd’hui cet homme n’a plus qu’un autre homme à redouter, – c’est moi.
– Eh bien ?
– Si mon nom vous échappait avant que nous nous soyions revus, tout serait perdu !
– Votre nom ? dit sir James, je l’ai déjà oublié.
– J’aime mieux cela, dit Timoléon.
Et il s’en alla.
* *
*
Vanda n’avait vu entrer ni sortir Timoléon.
D’ailleurs, s’il était un homme à qui elle eût pu penser, ce n’était pas à coup sûr sur celui-là.
Sir James Nively, après le départ de cet auxiliaire que lui envoyait le hasard, sonna son valet de chambre et lui dit :
– Prévenez madame que je suis légèrement indisposé, que je ne descendrai pas pour le dîner, mais que je prendrai avec elle une tasse de thé vers neuf heures.
Et sir James, qui se défiait de lui-même, passa la journée dans sa chambre.
Il avait besoin de se calmer pour se retrouver face à face avec elle.
Vanda, de son côté, accueillit sans étonnement les paroles du valet de chambre.
Elle était trop préoccupée des ordres que lui avait donnés Rocambole.
Ce dernier lui avait dit : « Sir James Nively nous gêne. Il faut le supprimer. Quand il aura bu, tu placeras une lampe auprès de la fenêtre, le reste me regarde. »
Vanda, qui ne soupçonnait point que sir James ne fût sur ses gardes, et bien qu’elle eût une confiance aveugle dans les expédients et les ressources de Rocambole, Vanda, disons-nous, ne pouvait s’empêcher de mettre son esprit à la torture.
Comment Rocambole parviendrait-il, en plein quartier des Champs-Élysées, à enlever sir James Nively et qu’en ferait-il ?
Telle était la question qu’elle se posait depuis le matin sans pouvoir la résoudre.
Le soir vint, – elle dîna toute seule.
Puis, vers neuf heures, elle se retira dans sa chambre, fit préparer le thé et attendit la visite de sir James.
Sir James n’avait pas bougé de chez lui.
Un domestique entra et dit à Vanda :
– Monsieur fait demander à madame si elle voit quelque inconvénient à ce que la cuisinière et moi nous sortions ce soir ?
– Aucun, lui répondit Vanda.
Le cocher ne couchait pas à l’hôtel.
Vanda songea à congédier sa femme de chambre ou à lui donner quelque course lointaine.
L’absence complète de domestiques dans l’hôtel allait évidemment servir les plans de Rocambole.
Quelques minutes après, sir James entra.
Le thé était prêt, et Vanda avait jeté dans le fond de la tasse destinée à sir James une pincée de cette poudre blanche que lui avait donnée Rocambole.
Sir James s’était bien fait des serments depuis le matin.
Il s’était juré de tuer Vanda, si elle était coupable et si elle avait allumé dans son cœur cet amour féroce qu’il éprouvait pour elle, dans le but unique de servir Rocambole.
Mais il s’était juré aussi d’être calme et d’attendre la preuve que Timoléon lui avait offerte.
Il baisa donc la main de Vanda comme de coutume et s’assit auprès d’elle.
– Voulez-vous une tasse de thé ? fit-elle.
– Oui, certes.
– Vous êtes souffrant ?
– J’ai un peu de migraine, comme vous dites, vous autres Français.
Et sir James, qui avait des tempêtes dans le cœur, versa dans la tasse que Vanda venait d’emplir la moitié d’un petit flacon de rhum.
En même temps, il la regardait.
Jamais Vanda ne lui avait paru plus belle, jamais elle ne s’était montrée à lui dans une toilette d’intérieur plus provocante.
Sir James oublia ses serments.
Et avant de tremper ses lèvres dans le breuvage préparé, il dit tout à coup :
– Comment va Rocambole ?
Ce fut un coup de théâtre. Vanda, malgré son sang-froid et sa présence d’esprit ordinaires, jeta un cri et se troubla…
Sir James n’avait plus besoin de la preuve offerte par Timoléon.
Il avait lu la culpabilité de Vanda dans son regard effaré.
Et tirant un poignard de son sein, il s’élança vers elle en disant :
– Misérable, tu m’as trahi… et tu vas mourir…
XXVIII
Vanda se vit perdue.
Elle n’avait pas d’arme sous la main et elle avait pour adversaire un de ces hommes aux jarrets d’acier qui bondissent comme des tigres.
Mais la femme qui avait si longtemps vécu de la vie de Rocambole ne perdait jamais complètement la tête.
Un miracle seul pouvait la sauver.
Ce miracle, elle le fit sans l’intervention du ciel.
Déjà sir Nively levait le bras pour frapper, et elle s’était réfugiée à l’autre bout de la chambre ; déjà la lame du poignard étincelait au feu des bougies, lorsque Vanda, par un geste rapide, dégrafa le manteau qui recouvrait son peignoir.
Le manteau tomba.
Le bras levé ne retomba point, la bête fauve ivre de carnage s’arrêta, piquée au cœur par l’aiguillon de l’amour.
Sir James recula d’un pas.
Et en reculant, il embrassa d’un regard cette beauté hardie.
– Oh ! dit-il, en riant d’un rire de tigre, avant que tu ne meures, il faut que ma vengeance soit complète ; il faut… Mais il n’acheva pas !
Vanda respira, elle avait pour dix secondes détourné la foudre.
Et, à son tour, elle bondit à l’autre extrémité de la chambre et dit en ricanant :
– Que m’importe la mort ! que m’importe la honte ! pourvu que mon enfant soit sauvé.
– Ton enfant ! exclama sir James interdit.
– Hé ! oui, mon enfant ! dit-elle.
Puis avec un rire de hyène, belle de désespoir et d’une ironie farouche :
– Croyez-vous pas, dit-elle, que si je n’avais un enfant que Rocambole tient en ses mains, j’aurais obéi à ce forçat ?
En même temps, elle se mit à genoux, joignit les mains, passa du rire aux larmes, de la raillerie à l’accent suppliant de la mère et dit :
– Faites de moi ce que vous voudrez, tuez-moi ensuite, j’ai mérité mon sort, et peu m’importe ; mais sauvez mon enfant, promettez-moi de l’arracher à Rocambole.
Une réaction bizarre s’opérait chez sir James Nively et son bras avait fini par retomber, toujours armé du poignard, le long de son corps.
– Si vous refusez de m’écouter, dit encore Vanda, qui se redressa tout à coup, je vous échapperai par la mort.
En même temps, elle porta rapidement à ses lèvres une bague qu’elle avait au doigt.
Sir James se laissa prendre à ce geste, il crut que le chaton de la bague renfermait quelque poison foudroyant.
Et ce n’était plus seulement la mort de Vanda qu’il voulait.
Et comme il se défiait encore de lui-même, il alla s’asseoir à l’autre extrémité de la chambre, auprès de la table sur laquelle le thé était servi.
– Ah ! reprit-il, tu as un enfant ?
– Oui, dit Vanda.
– Et tu l’aimes ?
– Est-ce qu’une mère aime autre chose que son fils ?
– Et c’est Rocambole qui l’a en son pouvoir ?
– Lui-même.
– Alors, c’était de peur qu’il ne tuât cet enfant ?…
Les instincts brutaux de l’Anglo-Indien grandissaient et se développaient par degrés.
Son œil caressait les splendides épaules de Vanda, ses narines dilatées semblaient s’enivrer des voluptueux effluves qu’épanchait autour d’elle cette fière beauté.
Il y avait en lui, à cette heure, quelque chose de satanique et de fanatique à la fois.
Le satanisme de l’homme qui ne reculera plus devant aucun crime.
Le fanatisme du fakir qui veut caresser son idole avant de la briser.
– Parle, disait-il, parle… mais sois brève… Que veux-tu que je fasse pour ton enfant ?
Vanda sentait bien qu’elle était condamnée ; que cet homme, un moment hésitant, redeviendrait furieux et sauvage tout à l’heure ; que si elle ne gagnait pas du temps, avec l’espoir, hélas ! improbable, que Rocambole surgirait de terre pour venir à son aide, cet homme finirait par la hacher à coups de poignard.
– Oui, reprit-elle, sauvez mon enfant… promettez-moi que vous le ferez…
– Je te le promets, dit sir James. Mais d’abord, où est-il ?
– Rocambole seul le sait.
– Et où est Rocambole ?
– Rue Saint-Lazare, 28.
– Est-ce tout ce que tu as à me demander ?
– Oui, dit-elle, essayant encore de le fasciner de son regard.
Mais sir James n’était plus homme à se laisser attendrir.
– Nous sommes seuls ici, dit-il. J’ai renvoyé tous les domestiques. Il pleut au dehors, l’avenue est déserte. On n’entendra point tes cris. Il faut m’obéir… et mourir !
Et il tenait le poignard dans sa main crispée.
– Laissez-moi faire ma prière, dit-elle encore. Laissez-moi prier Dieu avant de me tuer !
Et de nouveau, elle se mit à genoux.
– Ah ! tu crois au ciel, toi… tu crois à une autre vie ? ricana le misérable.
Et comme s’il eût voulu éteindre les blasphèmes qui brûlaient sa gorge, il s’empara de la tasse de thé qu’il avait devant lui et la vida d’un trait, en répétant :
– Hâte-toi ! hâte-toi !
En même temps il se leva, tenant toujours son poignard, et vint droit à Vanda.
Vanda jeta encore un cri.
Mais ce fut le dernier.
Au paroxysme de sa passion furieuse, sir James Nively jeta son poignard sur la table.
Puis il enleva Vanda de ses bras nerveux :
– Je te hais et je t’aime ! murmura-t-il.
Mais Vanda se débattit violemment et elle parvint à se dégager et à le repousser.
En même temps, elle sauta sur le poignard qu’il avait laissé sur la table et s’en empara.
Mais sir James riait d’un rire féroce.
– Il faut m’obéir, disait-il, il le faut !
Elle s’était acculée dans un angle, le poignard à la main, pelotonnée et prête à bondir.
– Si vous faites un pas, disait-elle, c’est moi qui vous tuerai !
Sir James riait et blasphémait tout à la fois.
– Bah ! disait-il, est-ce qu’un Étrangleur craint le poignard d’une femme ?
Et, se rejetant en arrière, il tira de sa poche le terrible lasso sans lequel jamais ne marche un disciple de la déesse Kâli.
Vanda comprit que sir James allait être une fois encore vainqueur dans cette lutte désespérée qu’elle soutenait contre lui depuis dix minutes.
Que pouvait le poignard contre le terrible lasso ?
La corde de soie tournoyait dans l’air en sifflant.
Et, tout à coup, elle s’abattit sur Vanda.
– Au moins je mourrai sans souillure ! pensa-t-elle, tandis que le lasso s’enroulait comme un reptile autour de son cou.
XXIX
Une minute de plus, et c’en était fait de Vanda.
Mais le lasso, qui déjà la serrait, se distendit comme par enchantement ; la main qui en tenait l’extrémité opposée s’ouvrit et la laissa tomber.
Vanda, qui déjà fermait les yeux et s’apprêtait à mourir en murmurant tout bas le nom de Rocambole, Vanda rouvrit les yeux et regarda.
Elle vit sir James encore debout, mais oscillant déjà comme un chêne déraciné.
Son œil était fixe, sa bouche béante, son front s’était couvert d’une pâleur subite.
Il balbutiait des mots sans suite ; puis ce ne furent plus que des cris étouffés, des sons inarticulés et sauvages.
Et, chancelant de plus en plus, il essaya de se baisser pour ressaisir le lasso.
Mais il tomba lourdement sur le sol.
Le foudroyant narcotique mélangé à la tasse de thé venait de produire son effet.
En tombant, sir James poussa un dernier cri.
Puis, ses yeux se fermèrent.
Pendant un moment encore, son corps s’agita en des convulsions suprêmes. On eût dit la lutte dernière de l’agonie.
Et les convulsions cessèrent à leur tour, comme s’étaient éteints les cris…
Et sir James garda l’immobilité de la mort.
Alors un soupir de soulagement s’échappa de la poitrine de Vanda.
On eût dit qu’on venait de lui ôter un poids écrasant qui l’étouffait.
Pendant quelques minutes, elles fut trop émue, trop bouleversée pour pouvoir faire autre chose que contempler celui qui avait failli la tuer, et qui était réduit à l’impuissance.
Mais enfin le souvenir de Rocambole lui revint, et avec ce souvenir le sentiment du devoir.
Vanda prit la lampe qui se trouvait sur la table, alla vers la croisée qu’elle ouvrit, et la posa sur l’entablement.
Tout aussitôt une ombre s’agita dans le jardin.
Puis auprès de cette ombre une autre.
Et Vanda reconnut Rocambole et Milon.
La chambre de Vanda, nous l’avons dit déjà, était située au rez-de-chaussée.
Rocambole s’arrêta sous la croisée et dit :
– Est-ce fait ?
– Oui, répondit Vanda encore émue.
Rocambole, d’un bond, eut atteint l’entablement de la croisée, et de l’entablement il sauta dans la chambre.
Mais soudain il s’arrêta muet, stupéfait, la sueur au front.
Il venait d’apercevoir au cou de Vanda le terrible lasso des Étrangleurs.
– Ah ! lui dit Vanda, il était temps… J’ai failli mourir…
Et alors elle raconta d’une voix brève, haletante, saccadée, la fureur subite de sir James, ses désirs féroces, sa résolution de la tuer et comment, par un mensonge, par cette supposition d’enfant qu’elle avait accueillie comme une inspiration, elle avait pu gagner du temps…
Comment, maîtresse d’un poignard, elle s’était crue sauvée un moment.
Comment encore elle avait perdu tout espoir et fermé les yeux en sentant le lasso s’abattre sur elle.
– Une minute de plus, dit-elle, et j’étais morte !
– Eh bien ! dit Rocambole frémissant, tu ne le craindras plus désormais.
– Est-ce qu’il est mort ? demanda Vanda.
– Non, mais il est dans la situation où jadis nous avons mis Antoinette pour la faire sortir de Saint-Lazare. En d’autres temps, je l’aurais tué. Mais je me suis juré de ne verser le sang qu’à mon corps défendant.
– Qu’en vas-tu donc faire ?
– Je le tiendrai prisonnier dans la cave de la maison de la rue du Vert-Bois jusqu’à ce que notre but soit atteint, jusqu’à ce que les millions de Gipsy soient retrouvés.
– Et alors ?…
– Alors je l’endormirai de nouveau, nous le placerons dans une caisse, comme un ballot de marchandises et nous le renverrons à Londres où les Étrangleurs sont peut-être encore de mode, car à Paris ils ont fait leur temps.
Milon était demeuré dans le jardin.
Rocambole se pencha à la croisée et lui dit :
– Tu n’entends aucun bruit ?
– Aucun, répondit Milon.
– La maison est déserte, les domestiques sont tous sortis, ajouta Vanda.
– La voiture est de l’autre côté du mur ? demanda encore Rocambole.
– Oui.
– Alors, charge-toi du colis.
Et Rocambole, aidé de Vanda, prit le baronnet sir James Nively aussi inerte qu’un cadavre, et ils l’apportèrent vers la croisée.
Milon s’était établi au pied de la fenêtre, arcbouté comme un hercule forain qui attend la chute d’un fardeau.
Vanda et Rocambole soulevèrent le baronnet, le passèrent en dehors de la croisée et le laissèrent tomber dans les bras de Milon le colosse.
Puis ce dernier chargea le corps sur son épaule et prit la fuite à travers le jardin.
– Adieu, dit Rocambole à Vanda.
– Comment ! fit la jeune femme, tu me laisses ici ?…
– Sans doute, répondit Rocambole qui avait déjà enjambé la croisée pour sauter dans le jardin.
– Mais pourquoi ? demanda Vanda.
– Parce que j’ai besoin de toi ici.
– Ah !
– Je t’ai dit l’histoire de miss Ellen et d’Ali-Remjeh, n’est-ce pas ?
– Sans doute.
– Eh bien ! cet Ali-Remjeh, chef suprême des Étrangleurs, qui depuis vingt ans était retourné aux Indes, s’est repris d’un bel amour pour miss Ellen, c’est-à-dire pour milady.
– Vraiment ?
– Et il veut l’épouser. Mais milady n’en veut pas…
– Pourquoi ?
– Parce que depuis longtemps déjà elle a cédé à l’amour de Franz qui se fait appeler le major Hoff.
– Eh bien ? demanda Vanda.
– Eh bien ! demain milady doit venir ici, croyant rencontrer sir James.
– Ah !
– Elle y viendra pour essayer de faire revenir Ali-Remjeh sur sa fantaisie amoureuse.
– Bon ! je commence à comprendre.
– Il faut que tu sois ici pour la recevoir.
– Et toi, dit Vanda, y seras-tu ?
– Certainement. Avant huit heures du matin. Ainsi, bonne nuit… Tu n’as plus rien à craindre, ni du lasso ni du poignard de sir James Nively.
Rocambole mit un baiser au front de Vanda et sauta dans le jardin.
Celle-ci, appuyée sur la croisée ouverte, le vit s’éloigner et gagner une échelle appliquée contre le mur.
Cette échelle avait déjà servi à Milon qui était de l’autre côté du mur.
Vanda vit Rocambole gravir les échelons, s’établir à califourchon sur le mur, retirer l’échelle ensuite et disparaître.
Alors elle referma la fenêtre et murmura :
– Ah ! je l’ai échappé belle, cette nuit !
– Mais tu ne te sauveras pas ! dit une voix derrière elle.
Et Vanda, les cheveux hérissés, vit deux personnages qui se tenaient immobiles sur le seuil de la porte qui s’était ouverte sans bruit.
L’un était Timoléon.
L’autre Madeleine la Chivotte.
– C’est l’heure de la revanche ! ricana Madeleine, qui se souvenait du coup de pistolet de la rue de Bellefond.
– Voici ta dernière heure ! répéta Timoléon.
Vanda jeta un cri. Mais ce cri, Rocambole ne pouvait l’entendre.
Il était déjà loin.
XXX
Rocambole avait suivi Milon, et Milon, grâce à sa force herculéenne, portait le baronnet sur ses épaules comme il eût fait du plus léger des fardeaux.
Un fiacre attendait de l’autre côté du mur et le cocher de ce fiacre n’était autre que Noël.
Sir James Nively était dans une léthargie si complète qu’un coup de canon ne l’eût pas réveillé.
Le fiacre gagna le Cours-la-Reine et suivit les quais, après avoir traversé la place de la Concorde.
Rocambole était monté à côté de Noël, et Milon se tenait dans l’intérieur de la voiture à côté de sir James qu’il avait étendu tout de son long sur la banquette de devant.
Les quais de Paris, en hiver, sont presque déserts vers dix heures du soir.
Rocambole avait pris ce chemin de préférence aux boulevards qui sont très éclairés, et pour éviter la curiosité d’un agent de police quelconque, qui aurait pu jeter un regard furtif à l’intérieur du fiacre et apercevoir un homme étendu et sans mouvement.
Arrivés à l’Hôtel de Ville, les ravisseurs quittèrent les quais et prirent la rue Saint-Martin.
– Baisse les stores, dit Rocambole à Milon.
Celui-ci obéit, et Noël fouetta les chevaux.
Quelques ouvriers, quelques gamins, voyant un fiacre stores baissés, lâchèrent des lazzis et des plaisanteries de mauvais goût.
Mais le fiacre continua sa route et arriva sans encombre rue du Vert-Bois, à la porte du fruitier, principal locataire de la maison.
La rue du Vert-Bois, le soir, est obscure, à peine sillonnée par quelques rares passants, dont l’attention est ordinairement concentrée par trois ou quatre belles de nuit qui se promènent le long des maisons.
Le fruitier était prévenu sans doute.
Il se hâta d’accourir et ouvrit la portière.
Milon reprit sir James dans ses bras et, d’un bond, franchit le trottoir.
Il était dans la boutique avant que personne eût fait attention à lui.
La boutique était divisée en deux pièces : le comptoir proprement dit, c’est-à-dire l’endroit où l’on vendait des légumes, du laitage et des œufs ; et une petite salle où l’on versait à boire aux consommateurs.
Milon, suivi de Rocambole, entra tout de suite dans cette deuxième pièce.
Le fruitier poussa la porte.
En même temps, sa femme, qui depuis longtemps déjà avait posé les volets à la devanture, se hâta de poser la barre transversale qui servait de fermeture.
C’était dans la buvette, comme on nommait la seconde pièce de la boutique, que se trouvait l’entrée de la cave.
On soulevait une trappe, et un escalier de pierre apparaissait alors aux regards.
Le fruitier s’arma d’une lanterne et prit un trousseau de clés.
Puis, il passa devant et s’engagea dans l’escalier.
Milon, portant le baronnet sur ses épaules, le suivit.
Rocambole fermait la marche.
La cave de la maison était profonde, vaste, et se divisait en plusieurs caveaux.
Au bas de l’escalier commençait un corridor sur lequel s’ouvraient différents petits celliers, jadis destinés aux locataires de la maison et que le fruitier, depuis qu’il était principal locataire, avait gardés pour lui.
Il ouvrit la porte de l’un d’eux et Rocambole et Milon se trouvèrent au seuil d’un caveau assez vaste, au milieu duquel il y avait une large dalle.
– Voilà, dit le fruitier.
En même temps, il posa sa lanterne à terre et alla prendre dans un coin du caveau un pic en fer qui s’y trouvait comme par hasard.
Puis il glissa la pointe du pic entre la dalle et la pierre de taille qui lui servait d’encadrement, exerça une pesée et la dalle se souleva.
Alors Rocambole aperçut un trou béant, assez semblable à l’orifice d’un puits.
Le fruitier lui dit :
– Prenez la lanterne et regardez.
Rocambole se coucha à plat-ventre au bord du trou, laissa pendre son bras armé de la lanterne et sonda du regard la profondeur de ce singulier puisard.
Il vit alors un trou d’une vingtaine de pieds de profondeur, dont les parois étaient en maçonnerie et qui n’aboutissait à aucune ouverture.
Seulement en haut, à une dizaine de pieds du sol, à peu près, on apercevait une petite meurtrière destinée sans doute à laisser pénétrer un peu d’air dans le réduit.
– Ah çà, dit Rocambole étonné, qu’est-ce que cela ?
– La cachette dont j’ai parlé à Noël.
– Oui, mais qui l’a creusée, et à quoi servait-elle ?
– Ma foi, répondit le fruitier, c’est tout une histoire, maître.
Quand j’ai pris la maison à bail, j’ai fait visiter les caves par un architecte, il y avait ici un demi-pied de sable, nous avons déblayé pour trouver le sol et cette dalle que je viens de soulever nous est apparue alors.
Nous l’avons ôtée ; et l’architecte a eu la fantaisie de se faire descendre dans ce trou avec une corde sous les reins.
Lorsqu’il est remonté, il m’a dit :
« Cette cachette a dû être creusée pendant la première révolution et servir de refuge à des prêtres ou des émigrés.
« La preuve en est dans cette meurtrière par laquelle arrive un air humide et froid et qui doit communiquer avec les égouts voisins. »
– Bien, fit Rocambole d’un signe de tête, je comprends.
– C’est là que nous pouvons mettre ce monsieur, poursuivit le fruitier en montrant l’Anglais évanoui que Milon avait posé à terre comme un colis de marchandises.
Si vous voulez vous en débarrasser pour toujours, la chose est facile. Avec un peu de plâtre nous allons boucher la meurtrière et il périra étouffé, faute d’air.
– Non, dit Rocambole, je ne veux pas le tuer.
– Alors nous laisserons la meurtrière ouverte, il aura de l’air. Pour combien de temps est-il endormi ?
– Pour deux jours au moins.
– Faudra-t-il lui donner à manger ?
– Certainement.
– Mais, observa Milon, quand il reviendra à lui, il se mettra à crier.
– C’est probable.
– N’entendra-t-on pas ses cris ?
– J’en réponds, dit le fruitier ; à moins qu’on ne les entende des égouts… ce qui est à peu près impossible, car les égouts de ce quartier sont trop petits pour que les égoutiers s’y promènent de gaîté de cœur.
– Et puis, dit Rocambole, dans deux jours nous pourrons peut-être lui rendre la liberté.
– Ah ! fit Milon, un peu surpris.
– Va chercher une corde, dit Rocambole au fruitier.
– Une corde ?
– Sans doute. Nous n’allons pas jeter cet homme dans le trou. Il pourrait se tuer en tombant, et je ne veux pas de meurtre inutile.
Le fruitier remonta dans sa boutique, et revint peu après avec une corde qu’il lia solidement sous les reins de sir James.
Puis, aidé de Milon, et tandis que Rocambole tenait la lanterne pour les éclairer, il descendit dans le puits le baronnet, toujours aussi inerte que s’il eût été privé de vie.
– Dans deux jours, dit alors Rocambole, nous verrons s’il a de l’appétit.
On replaça la dalle sur le puits.
Ensuite, le fruitier s’arma d’une pelle et recouvrit la dalle d’une couche épaisse de sable.
– À présent, dit encore Rocambole, allons-nous-en !
Et se tournant vers Milon :
– Sir James ne nous gênera plus désormais.
Ils remontèrent dans la boutique.
Le fiacre conduit par Noël attendait toujours à la porte.
– Est-ce que je vous accompagne, maître ? demanda Milon.
– Non, pas maintenant.
– Alors, je vais rester ici ?
– Sans doute. N’as-tu pas une chambre dans la maison ?
– Juste au-dessus de Marmouset.
– Eh bien ! va te coucher et demain, à neuf heures, sois exact au rendez-vous.
– À l’avenue Marignan ?
– Oui.
Rocambole passa par l’allée de la maison, regagna le fiacre et y monta.
– Mène-moi au Grand-Hôtel, dit-il à Noël.
Un quart d’heure après, le fiacre s’arrêtait sur le boulevard des Capucines.
Mais Rocambole, au lieu d’entrer dans l’hôtel, pénétra dans le café.
Un homme et une femme assis à une table prenaient le thé et causaient avec une telle animation que ni l’un ni l’autre ne fit attention à Rocambole.
D’ailleurs Rocambole, qui changeait volontiers de costume et de physionomie, s’était affublé, ce soir-là, d’une perruque blonde et ne ressemblait plus du tout au major Avatar.
Les deux personnages qui prenaient du thé n’étaient autres que milady et le major Hoff, c’est-à-dire Franz, son vieux complice.
XXXI
Rocambole se plaça à une table voisine et demanda en allemand la Gazette de Cologne.
Puis, quand le garçon la lui eut apportée, il s’enveloppa dedans de telle façon qu’il devint pour ainsi dire invisible.
Milady et le major Hoff causaient tout bas.
Mais Rocambole avait l’oreille fine et il ne perdit pas un mot de leur conversation.
Milady disait :
– Comme il est beau, mon fils !
– Ah ! pensa Rocambole, il paraît qu’elle l’a vu.
– Il est beau et distingué, poursuivit milady, et le mélange du sang anglais et du sang indien lui sied à ravir. Il est blanc comme moi, mais il a les yeux ardents et les formes souples et nerveuses de son père.
Le major fit la grimace.
– Oh ! milady, dit-il, ne parlez pas ainsi.
– Pourquoi ?
– Je suis jaloux.
Milady haussa les épaules.
– Ne vous en défendez pas, poursuivit le major Hoff qui eut dans les yeux un éclair de sombre colère, vous l’aimez encore !
– Qui ?
– Ali-Remjeh.
Milady eut alors un éclat de rire si franc, si net, si railleur, que la colère de Franz tomba.
– Oh ! dit-il, c’est que je vous aime, moi, c’est que je suis jaloux.
Milady eut pour lui ce regard de la femme déchue pour son dernier amant.
– Sois tranquille, dit-elle. J’ai aimé Ali-Remjeh, tu le sais, avec frénésie, avec délire, comme la tigresse des jungles de son pays aime le tigre royal. Mais, folle d’amour, la tigresse n’abdique ni sa fierté, ni ses fureurs. Ali-Remjeh m’a abandonnée !
Pendant vingt années, tandis que je me tordais sous le remords, cet homme rentré dans son pays ne s’est souvenu de moi à de longs intervalles que parce que nous avions un fils.
Aujourd’hui que toutes ses ambitions sont satisfaites, que sa vie politique est finie, qu’il est las d’exercer ce pouvoir mystérieux dont il a tant abusé, aujourd’hui que le besoin de vivre en paix, en bon gentleman qui n’a rien à faire, s’est emparé de lui, il s’est dit : « J’ai laissé en Europe une femme et un enfant. C’est une famille. Allons la retrouver. »
– Oui, murmura Franz, il a dû se dire tout cela.
– Il a eu tort, dit froidement milady.
– Ah !
Et Franz regarda la belle Anglaise d’un air timide.
Milady reprit :
– Je te méprise, toi, et quand je fais appel à mes souvenirs de fille de race, je ne puis oublier que tu es un vil laquais.
– Madame…
– Attends donc ! je te méprise, mais le crime a établi entre nous une sorte d’égalité que je subis. Je te méprise et je t’aime…
Franz eut comme un éblouissement.
– Je te méprise et je t’aime, poursuivit milady, parce que tu es entré si complètement dans ma vie que je ne pourrais plus me passer de toi. Et puis, tu m’es dévoué comme le chien l’est à son maître, tu as fini par aimer mon fils. Je suis une parricide, le sang de mon père couvre mes mains, et ces mains tu les dévores de baisers.
– C’est vrai, dit Franz avec enthousiasme.
– Ne sois donc plus jaloux, poursuivit milady, car je n’aime plus Ali-Remjeh.
– Oui, mais peut-être vous aime-t-il encore ?
– Qu’importe !
– Et vous savez bien que si cet homme a mis dans sa tête que vous seriez sa femme…
– Je la serai, n’est-ce pas ?
– Oui.
Milady eut un sourire de démon :
– Écoute-moi bien, mon pauvre Franz, dit-elle.
– Parlez, milady.
– Ali-Remjeh, à cette heure encore, est le chef des Étrangleurs ?
– Sans doute.
– À ce titre, il dispose d’une armée ténébreuse et dominée par le fanatisme qui exécute ses volontés.
– Quelles qu’elles soient, dit Franz avec conviction.
– Mais il veut quitter le pouvoir…
– Il le dit, du moins.
– S’il ne le quitte pas, il restera dans l’Inde et nous n’avons plus rien à craindre.
– C’est juste.
– S’il le quitte, c’est pour venir en Europe, retrouver sa femme et son fils, n’est-ce pas ?
– Oui.
– Alors Ali-Remjeh devient un homme comme tous les hommes, ce me semble.
– Bon !
– Il est riche, il est heureux… il n’est plus à craindre.
– Je ne vous comprends pas, milady.
– Écoute encore. Ali-Remjeh veut m’épouser.
– Vous refusez ?
– Non, j’accepte.
Franz eut un haut-le-corps.
– J’accepte, poursuivit milady. Il reconnaît son fils. Mon fils a un nom ; car, par sa mère qui était Anglaise, Ali-Remjeh appartient à l’aristocratie britannique.
– Eh bien ?
– Eh bien ! le reste te regarde, dit froidement milady. Tu es un homme de ressources et d’esprit, Franz. Ali-Remjeh n’aura plus les Étrangleurs à ses ordres.
– Bon !
– Sa poitrine ne sera plus invulnérable. Si le poignard te répugne…
– Achevez, madame, dit Franz tout frémissant.
– Il y a le poison, acheva milady.
Ces derniers mots furent suivis d’un moment de silence.
À de certaines heures, le silence est un acquiescement.
Rocambole, qui lisait toujours la Gazette de Cologne et ne faisait pas un mouvement, n’avait pas perdu une syllabe de cette étrange conversation.
Franz reprit enfin :
– Alors, que comptez-vous faire, madame ?
– Voir le représentant d’Ali-Remjeh.
– Sir James Nively ?
– Oui.
– Que lui direz-vous ?
– Que je suis prête à recevoir Ali-Remjeh à bras ouverts.
– Ah !
– Mais à une condition.
– Laquelle ?
– C’est que, avant la conclusion du mariage, on m’aura débarrassée à tout jamais de cette petite bohémienne qui peut, un jour ou l’autre, réclamer l’héritage de ma sœur, c’est-à-dire de sa mère.
– Et quand verrez-vous sir James ?
– Demain.
– Vous y conduirai-je ?
– Non, je veux y aller seule.
– C’est bien. À quelle heure ?
– Dès le matin.
Franz s’inclina. Puis, il jeta un regard furtif autour de lui, pensant un peu tard que, peut-être, on avait pu saisir quelques bribes de son entretien avec milady.
Mais il ne vit personne. Les tables étaient désertes tout à l’entour de la sienne, on commençait à baisser la devanture en fer du café, et une heure du matin sonnait.
L’homme à la Gazette de Cologne lui-même, ce Germain blond sur lequel le major Hoff avait une fois levé un regard distrait, avait disparu.
* *
*
Quelques heures après, c’est-à-dire vers huit heures du matin, Rocambole, redevenu le major Avatar, se présentait avenue de Marignan, à la grille de l’hôtel que sir James avait donné à Vanda.
Il sonna.
Un domestique vint lui ouvrir.
– Sir Nively ? demanda Rocambole.
– Son Honneur est absent, répondit le valet de chambre.
– Mais madame y est, reprit Rocambole, qui s’attendait à cette réponse.
– Non, monsieur.
– Comment ! non ?
– Madame est sortie hier soir et n’est pas rentrée.
– À quelle heure donc ?
Le valet était loquace :
– Ma foi ! dit-il, pour dire à monsieur la vérité, ni moi ni les autres personnes de l’hôtel n’en savent rien. On nous avait permis de sortir. Quand nous sommes rentrés, vers trois heures du matin, nous avons trouvé les portes ouvertes et l’hôtel vide.
Monsieur et madame avaient disparu !
– C’est bizarre ! murmura Rocambole qui s’expliquait très bien qu’on n’eût pas trouvé le baronnet, mais qui se demandait vainement ce que pouvait être devenue Vanda.
Et il entra dans l’hôtel, la sueur au front, en proie à un pressentiment funeste…
XXXII
Qu’était devenue Vanda ?
Il nous faut, pour le savoir, nous reporter au moment où la jeune femme, appuyée à la croisée, avait vu disparaître Rocambole par-dessus le mur du jardin.
Alors, elle s’était retournée et s’était trouvée face à face avec Timoléon et Madeleine la Chivotte.
La Chivotte, on s’en souvient, était cette femme perdue, voleuse et dépravée qui, après avoir abreuvé d’outrages, à Saint-Lazare, Antoinette Miller, s’était constituée sa gardienne, dans le pavillon de la rue de Bellefond, où Timoléon l’avait enfermée.
Vanda, on s’en souvient aussi, avait délivré Antoinette au moment où elle allait succomber aux brutalités d’un misérable et périr ensuite sous le sabot de la vindicative Madeleine.
La balle du revolver de Vanda l’avait étendue au milieu d’une mare de sang.
Mais Madeleine la Chivotte n’était point morte, et nous avons vu Rocambole la retrouver dans un garni, en possession d’une petite fille volée.
Comment cette femme, qui s’était amendée en apparence, et qui paraissait convertie au bien par Rocambole, se retrouvait-elle dans le camp de ses ennemis et prête à servir Timoléon ?
C’est là un mystère que nous allons essayer de pénétrer.
Avant son départ pour l’Angleterre, Rocambole avait confié la petite fille aux épaules tatouées, l’enfant de Nadeïa Komistroï, non plus seulement à la Chivotte, mais à la Camarde, la terrible hôtesse du cabaret de l’Arlequin.
Ces deux femmes, la Camarde et la Chivotte, avaient d’abord vécu en assez bonne intelligence ; puis elles avaient eu des querelles et la Camarde, gardant l’enfant, avait chassé Madeleine.
Celle-ci, qui n’était dévouée à Rocambole que par terreur, avait repris alors son indépendance.
Elle s’en était retournée d’abord à Paris, et avait, pendant quelques semaines, fréquenté les cabarets et les garnis où se réunissaient les voleurs.
Puis, la police ayant opéré des razzias, la Chivotte s’était réfugiée aux Carrières d’Amérique.
Là, elle avait retrouvé le Pâtissier.
Le Pâtissier, toujours altéré, toujours ivre de vengeance et ne rêvant qu’une chose, – l’extermination de Rocambole.
Le Pâtissier et la Chivotte se connaissaient de longue main. Le premier s’étonna de retrouver celle-ci, misérable et cherchant, comme disent les voleurs, un coup à faire.
– Tu es donc brouillée avec la Camarde ? lui demanda-t-il d’un air de compassion.
– À mort, répondit la Chivotte.
– Pourquoi ?
– Elle est folle de Rocambole et elle vous en casse la tête du matin au soir.
– Voyez-vous ça ? ricana le Pâtissier.
– Avec ça, reprit la Chivotte, que Rocambole se moque pas mal d’elle.
– Tu crois ?
– Il a une largue qu’il adore.
– Ah ! oui… cette belle blonde… je sais.
– Qui a failli me tuer il y a six mois.
– Encore une histoire que je sais, dit le Pâtissier. Et toi, bonne fille, tu ne lui en veux pas ?
La Chivotte eut un regard et un rire féroces :
– C’est-à-dire, fit-elle, que si je pouvais la manger toute vive…
– Tu le ferais ?
– Un peu, mon neveu.
– Mais, tu ne peux pas… Toi aussi tu as peur de Rocambole…
Et le Pâtissier ricana de plus belle.
– Avec ça que tu n’en as pas peur, toi ? dit la Chivotte d’un ton d’ironie. Il t’a flanqué à la porte de chez la Camarde, et tu t’es en allé sans rien dire.
– Mais c’est parce que j’étais seul !…
– Ah ! tu étais seul… et maintenant…
– Nous sommes deux à le haïr, et si tu voulais, ajouta le Pâtissier, nous serions trois…
La Chivotte secoua la tête :
– Il n’y avait qu’un homme, dit-elle, qui pouvait lutter avec Rocambole.
– Ah !
– Et encore il a été roulé deux fois.
– Comment l’appelles-tu ?
– Timoléon.
– C’est précisément de lui que je voulais te parler.
– Tu le connais ?
– Sans doute, et nous nous sommes associés.
– Pour travailler ?
– Non, pour exterminer Rocambole.
Mais la Chivotte hocha de nouveau la tête d’un air de doute et de découragement :
– Tu te montes peut-être bien le coup ! dit-elle.
– Tu crois ?
– Timoléon a une fille, et c’est par là que Rocambole le tient.
– Tu te trompes, répondit le Pâtissier. La fille de Timoléon est morte, et maintenant il ne craint plus rien et n’a plus qu’une idée, celle de se venger.
Ces mots produisirent une sensation profonde sur la Chivotte :
– Si c’est comme ça, dit-elle, j’en suis !
– Vrai ?
– Oh ! je crois bien, dit-elle ; moi aussi, je veux me venger.
Et le Pâtissier avait embauché la Chivotte, et, le soir même, elle était aux ordres de Timoléon.
Celui-ci s’était introduit dans l’hôtel, après avoir grisé le valet de chambre de sir James Nively, trop tard pour sauver le baronnet, mais assez tôt pour s’emparer de Vanda.
Vanda sentit ses cheveux se hérisser en se trouvant en présence de ses implacables ennemis.
De l’autre côté de la porte, à demi dans l’ombre, par-dessus l’épaule de la Chivotte, apparaissait la tête hideuse et grimaçante du Pâtissier.
– Enfin, dit Timoléon, nous te tenons !
Vanda fit un bond vers la croisée…
Mais elle avait encore au cou le terrible lasso que lui avait lancé sir James Nively, et dont l’extrémité opposée traînait à terre.
Et comme Vanda allait franchir l’entablement et sauter dans le jardin, Timoléon mit le pied sur le bout du lasso.
Vanda fut obligée de s’arrêter, car elle se fût étranglée en essayant de vaincre cette résistance.
En même temps, la Chivotte se jeta sur le poignard que Vanda, tandis qu’elle causait tout à l’heure avec Rocambole, avait replacé sur la table.
Tout cela eut la durée d’un éclair.
Timoléon tira le lasso à lui, Vanda fut obligée de suivre cette pression.
Puis, Timoléon fit un signe, et le Pâtissier ferma la fenêtre et laissa retomber les rideaux ; de façon que s’il se fût trouvé quelqu’un encore dans le jardin, ce quelqu’un n’aurait pas pu voir ce qui se passait à l’intérieur de la chambre de Vanda.
– Cette fois, nous te tenons et nous te tenons bien, dit Timoléon.
Et, d’un vigoureux coup de poignet, et avec une dextérité qui eût fait honneur à un étrangleur de profession, il étendit Vanda sur le parquet.
Vanda jeta un cri étouffé. La corde meurtrissait son cou d’albâtre et l’étranglait.
– Oh ! papa, dit la Chivotte qui avait fermé la porte, vous n’allez pas me voler ma besogne, vous ?
– Hein ! fit Timoléon.
La voleuse s’avança, menaçante :
– Ce n’est pas vous qui l’étranglerez, dit-elle, c’est moi ! Et je n’ai pas besoin de votre corde, mes mains suffisent, ajouta-t-elle avec un accent de haine sauvage.
– Arrière ! dit Timoléon.
– Par exemple ! s’écria la Chivotte, c’est mon ouvrage ça. J’ai eu la balle dans les côtes… c’est moi qui…
– Arrière ! répéta Timoléon avec autorité.
– Cependant, patron, observa le Pâtissier avec déférence, elle a raison, la petite.
– Certainement, elle a raison, dit Timoléon, mais le moment n’est pas venu.
– Qu’est-ce que vous chantez-là, papa ?
– Je dis que le moment n’est pas venu, répéta Timoléon. Quand il sera venu, on te fera signe, petite.
– Comment ! dit le Pâtissier, nous n’allons pas la tuer toute de suite ?
– Non.
– Pourquoi donc ?
– Parce que j’ai mon idée…
Et, avec le ton du commandement, Timoléon ajouta :
– Allons, mes enfants, ficelez-moi proprement mademoiselle et fourrez-lui un mouchoir dans la bouche. Nous avons encore une bonne trotte à faire cette nuit.
* *
*
Un quart d’heure après, garrottée et bâillonnée, Vanda était placée sous la garde de la Chivotte, dans un fiacre qui se mettait en route pour une destination inconnue.
XXXIII
Nous avons dit quelques mots des Carrières d’Amérique et c’est là que nous avons retrouvé le Pâtissier, un des hôtes habituels de l’Auberge des Innocents, le plus redoutable de ces trois asiles où les voleurs se réfugiaient pendant les nuits froides de décembre et de janvier.
Mais, à l’époque où se déroule notre histoire, les Carrières d’Amérique, situées au nord de la Villette, n’étaient déjà plus inviolables et inviolées.
La police y était venue plusieurs fois.
D’abord, elle s’était vue repoussée avec perte.
Puis elle avait été victorieuse.
L’Auberge des Innocents avait été le théâtre de rixes sanglantes entre les voleurs et les sergents de ville ou les agents de la brigade de sûreté.
Cependant, en fin de compte, comme de pareilles campagnes offraient des périls sans nombre, la police ne les renouvelait que rarement et les hôtes mal famés des Carrières d’Amérique y étaient revenus.
Huit nuits sur dix, même, ils voyaient arriver le jour sans avoir été inquiétés.
Les malfaiteurs ont un peu de ce génie d’exploration aventureuse qui caractérise les Anglais.
Chassés peu à peu par les peuples, d’abord asservis, les Anglais découvrent de nouvelles îles, de nouveaux continents et y plantent leurs drapeaux.
Traqués dans un endroit, les voleurs se mettent à la recherche de nouvelles retraites et ils s’y réunissent et y vivent tranquilles longtemps, avant que la police ne parvienne à les dépister de leur nouveau gîte.
Les premières carrières où se réfugièrent les vagabonds, les repris de justice et tous ceux qui avaient de bonnes raisons pour fuir la rue de Jérusalem et ses phalanges, furent celles de Vanves, de Montrouge et d’Issy.
La police les en chassa.
Émigrants nocturnes, ils traversèrent Paris et élirent domicile aux Carrières d’Amérique.
Aujourd’hui, les Carrières d’Amérique sont désertées pour celles de Pantin.
De tous les anciens villages élevés jadis aux portes de la capitale, Pantin est le plus fameux.
À telle enseigne que l’argot lui a fait un emprunt célèbre.
Dans les maisons centrales, dans les bagnes, où l’on parle l’idiome des voleurs, on ne dit jamais Paris, on dit Pantin.
Quand vous avez gravi soit l’interminable rue de Paris-Belleville et dépassé l’église, soit les buttes Chaumont, fameuses par une défense héroïque en 1814, et aujourd’hui converties en jardin populaire, un vallon aride, sans eau, sans verdure, au milieu duquel s’élèvent çà et là de hideuses constructions qui suintent la misère par toutes leurs lézardes, s’allonge sous vos pieds.
À droite, les jolis coteaux de Romainville ; à gauche, dans le lointain, la plaine Saint-Denis que traversent les chemins de fer du Nord et de l’Est.
Au-dessous de vous, cette vallée énorme et désolée qui vous apparaît comme un coin de l’Arabie Pétrée au milieu de l’Arabie Heureuse.
Cela s’est appelé Montfaucon, la voirie, la terre des suppliciés, la patrie des vidangeurs, le cimetière des chevaux morts du farcin ou de la morve.
Cela s’appelle aussi Pantin.
Dans ce vallon, qui paraît avoir été creusé par un torrent et où vous ne trouveriez pas une goutte d’eau, se dressaient jadis les potences du roi, et le vent nocturne y secoua longtemps le squelette d’Enguerrand de Marigny.
C’est là que Charles IX alla contempler les restes de l’amiral de Coligny.
C’est là encore que pendant bien longtemps on laissa pourrir sans sépulture les corps des suppliciés.
Aujourd’hui, ce n’est plus un charnier humain, c’est une voirie.
Quand le soleil darde ses rayons sur cette plaine altérée sans cesse, il miroite sur de larges flaques de sang et sur des ossements blanchis.
Des nuées de rats s’y montrent en plein jour, marchant en colonnes serrées comme ces fourmis monstrueuses du nouveau monde qui ne laissent après elles que la désolation et la mort.
S’il prenait fantaisie un jour à l’édilité de déplacer la voirie, de la transporter du nord au sud, de ce sombre val de Montfaucon aux plaines de Vanves ou de Clamart aux Lilas, Paris serait envahi, prit d’assaut, exterminé.
Pendant des mois, des années peut-être, des milliards de rats traverseraient les rues, les boulevards, inonderaient les maisons, dévorant tout sur leur passage.
Au delà de cette vallée, le petit village de Pantin aligne tristement ses maisons grises, ses jardins sans verdure, et ne paraît pas se douter des horreurs qui l’entourent.
Entre la voirie et Pantin, à la place même peut-être où se dressaient jadis les potences royales, quelques pierres crayeuses s’amoncellent çà et là.
Ce sont les carrières.
Elles ne sont pas toutes neuves, cependant ; il y a même plusieurs siècles qu’on les a partiellement abandonnées.
Les rats en ont pris possession.
Depuis peu, les voleurs ont essayé d’en chasser les rats.
C’était aux Carrières de Pantin que Timoléon, le Pâtissier et la Chivotte conduisaient Vanda prisonnière.
– Là, avait dit Timoléon, nous sommes encore chez nous, et la police ne nous dérangera pas.
Sur les indications du Pâtissier, qui s’était placé à côté du cocher, le fiacre avait traversé les Champs-Élysées, monté la rue Miromesnil, atteint celle du Rocher, et gagné par cette dernière artère l’ancien boulevard extérieur.
Il pleuvait ; la nuit était froide. La population de Montmartre et des Batignolles était rentrée chez elle, ou s’était réunie dans ces nombreux cabarets que l’éloignement du mur d’enceinte n’a fait que multiplier.
Le cocher était ce qu’on appelle un marron. Homme de sac et de corde, il eût transporté, pourvu qu’on le payât bien, un cadavre dans sa voiture, sans témoigner ni étonnement ni curiosité.
Timoléon, qui se connaissait en hommes, l’avait choisi sur sa mine et lui avait dit :
– Il y a vingt francs à gagner. Le reste ne te regarde pas !
– Je suis sourd quand on veut, avait répondu le cocher.
– Il faut être sourd et aveugle, ajouta Timoléon.
Vanda était garrottée solidement ; de plus, elle était bâillonnée.
Néanmoins, Timoléon lui avait effleuré la gorge avec la pointe du stylet de sir James, en lui disant :
– Il n’entre pas dans mes idées de te tuer, du moins pour le moment, mais si tu voulais faire la méchante, j’aurais la douleur d’en venir à cette extrémité.
Vanda était trop l’élève de Rocambole pour ne pas savoir que le sang-froid, la patience et une apparente résignation, sont les seules armes à opposer à une force supérieure.
Elle se tint donc tranquille et ne fit aucune résistance.
Le fiacre suivit les boulevards extérieurs jusqu’à la Villette, et là prit à gauche et se mit à gravir la rue Lafayette prolongée.
Cette rue, qui descend dans Paris en droite ligne, contourne la butte Chaumont et arrive jusqu’à un carrefour de ruelles solitaires et pour la plupart bordées de murailles qui enserrent des jardins.
Le Pâtissier connaissait parfaitement la route à suivre et l’indiquait au fur et à mesure au cocher.
Quand le fiacre fut arrivé au bout de la rue Lafayette, il entra dans une de ces ruelles dont nous venons de parler.
C’était la plus directe de toutes.
Elle partait du sommet de la butte et descendait vers Montfaucon.
Le fiacre la suivit dans toute sa longueur.
– Arrête ici ! dit alors le Pâtissier.
On était dans les champs et le bruit de la grande ville qui se trouvait derrière arrivait aux voyageurs comme un lointain murmure.
Timoléon coupa les cordes qui liaient les jambes de Vanda.
Mais il ne lui détacha point les bras et lui laissa son bâillon.
– Descends, dit-il.
En même temps, la Chivotte la prit par le bras, de peur qu’elle ne cherchât à fuir.
Timoléon donna les vingt francs au cocher en lui disant :
– Tu peux t’en aller.
Puis, s’adressant à ses compagnons :
– En route, maintenant, ajouta-t-il, et toi, ma mignonne, songe à ce que je t’ai dit, je te plante dix pouces d’acier quelque part si tu fais mine de vouloir te sauver.
XXXIV
Nous l’avons dit, la nuit était noire.
Si noire que, si le Pâtissier n’eût pas connu parfaitement le chemin, les ravisseurs se fussent certainement perdus dans les champs.
Le Pâtissier avait pris un étroit sentier qui descendait de la butte dans le vallon.
Ce sentier était boueux, et Vanda, que Timoléon poussait devant lui et que la Chivotte tenait toujours par le bras, glissa plus d’une fois, en marchant derrière le Pâtissier.
Mais la Chivotte la soutint.
Le silence était profond ; on n’entendait au loin que le sifflet des locomotives se dirigeant vers Paris ou s’en éloignant.
– Où peuvent-ils me conduire et où suis-je donc ? se demandait Vanda.
Et ces deux questions étaient insolubles pour elle.
Au bout d’un quart d’heure de marche, le Pâtissier s’arrêta.
– Qu’est-ce qu’il y a ? demanda Timoléon.
– Je pense à une chose, répondit le Pâtissier.
– Quoi donc ?
– Que si nous allons au puits du commissaire, nous y trouverons de la compagnie plus que nous n’en désirerions peut-être.
– Nous n’allons pas au puits du commissaire, répondit Timoléon.
– Ah ! et où allons-nous ?
– À l’hôtel du Dab de la Cigogne.
– Connais pas ! dit le Pâtissier.
– Il y a bien d’autres choses que tu ne connais pas, répondit Timoléon, marche toujours.
Ils arrivèrent dans le vallon.
Alors Timoléon s’arrêta à son tour.
– Est-ce que tu crois avoir découvert les carrières de Pantin ? dit-il au Pâtissier.
– Certainement non.
– Alors, il est tout simple que tu ne les connaisses pas aussi bien que moi.
– Je connais le puits du commissaire.
– Bon ! fit Timoléon avec dédain, c’est là que vont les petits voleurs, les vagabonds, les filles de bas étage.
– Je connais le Grand Tivoli…
– Peuh ! un puisard où la police ne daignerait pas descendre.
– Pourquoi ?
– Parce qu’il ne s’y trouve que des amis dans l’enfance.
Cette expression voulait dire : des malfaiteurs en herbe.
– Et la chapelle de Saint-Crispin, dit le Pâtissier, ainsi nommée parce qu’il y fait si chaud qu’on y est toujours beaucoup de monde, et, par conséquent, à l’étroit.
– Une pétaudière, fit dédaigneusement Timoléon. Et puis, j’aime à être chez moi.
– Bon !
– Et c’est pour cela que nous allons à l’hôtel du Dab.
– On y est donc seul ?
– Parfaitement.
– Les camarades n’y viennent pas ?
– Jamais.
– Pourquoi donc ?
– Mais parce qu’ils ne sauraient pas trouver l’entrée.
– Oh ! oh ! fit le Pâtissier, qui tombait de surprise en surprise.
– Vois-tu, poursuivit Timoléon, ce n’est pas d’hier que je suis dans le métier.
– Je le sais bien.
– J’ai été voleur, j’ai été rousse et quelquefois les deux ensemble.
Comme il pleut, qu’il fait mauvais marcher et qu’un bout de conversation aide à trouver le temps moins long, je te vas raconter comment j’ai découvert l’hôtel du Dab – c’est moi qui lui ai donne ce nom.
Vanda écoutait cet étrange dialogue et se disait :
– Si je parviens à leur échapper, il est probable que Rocambole fera son profit de tout cela.
Timoléon poursuivit :
– Pour lors, j’étais rousse, et on avait confiance en moi à la préfecture.
Un jour le chef de la Sûreté me dit : « on a arrêté un homme violemment soupçonné d’avoir volé cinquante mille francs à un garçon de recettes. Nous avons le voleur, mais nous voudrions avoir les cinquante mille francs. Allez confesser le bonhomme. »
Je me rendis en prison, le voleur ne se fit pas prier :
– Écoutez, me dit-il, si vous voulez faciliter mon évasion, je vous dirai où est le magot et nous partagerons.
J’accepte. Deux jours après, je me rends dans la prison.
Mon homme était dans un cabanon de Mazas.
Je lui donne une lime et une corde.
– Cette nuit, lui dis-je, tu scieras un barreau, tu attacheras cette corde et tu fileras.
Alors il me dit : « J’ai découvert un puisard que personne ne connaît dans les Carrières de Pantin. C’est là qu’est l’argent. »
Et il me donna des indications si précises qu’un enfant en nourrice aurait trouvé son chemin.
– Alors vous trouvâtes le puisard ? dit le Pâtissier.
– Sans doute.
– Et le magot ?
– Naturellement.
– Alors le voleur eut sa part ?
– Non ! dit Timoléon en riant, car il lui arriva un accident.
– Comment ça ?
– La nuit venue il scia son barreau et il attacha sa corde.
– Bon.
– Puis il se laissa couler tout du long.
– Et on l’arrêta ?
– Non, mais la nuit était aussi noire qu’aujourd’hui.
Quand il fut au bout de la corde, il lâcha tout, croyant qu’il était à terre.
– Et alors…
– Alors la corde se trouva trop courte de trente à quarante pieds et il se tua en tombant de cette hauteur dans le chemin de ronde.
– Patron, dit le Pâtissier, avec un accent de naïve admiration, vous êtes un fier homme.
– Combien y a-t-il de temps qu’on fréquente les carrières ? demanda Timoléon qui était peu sensible aux éloges.
– Une couple de mois.
– Eh bien ! j’en suis sûr, personne n’a trouvé l’entrée de mon puisard.
– Où est-il donc ?
– Marche toujours.
Ils cheminèrent environ dix minutes encore, puis tout à coup Timoléon dit :
– Est-ce qu’il n’y a pas un vieux mur couvert de broussailles sur la gauche ?
– Oui, à dix pas…
– C’est là.
Et Timoléon, recommandant à la Chivotte de ne pas lâcher Vanda, se mit à marcher auprès du Pâtissier.
Ils atteignirent ainsi le vieux mur qui était le dernier débris de l’enceinte d’un jardin abandonné.
Au milieu du jardin, il y avait un puits.
Ce puits était probablement sans eau, car on l’avait couvert de vieilles planches et sur ces planches il y avait de la terre et des pierres qui semblaient n’avoir pas été remuées depuis plusieurs années.
– À l’ouvrage ! dit Timoléon, dont les yeux s’étaient faits peu à peu à l’obscurité.
Il se mit à déblayer les planches de leur fardeau de terre et de pierre.
Puis, il les enleva une à une et mit à découvert l’orifice du puits.
– Voyons les chimiques, à présent.
Il tira de sa poche un morceau d’étoupe goudronnée et une boîte d’allumettes-bougies.
Une allumette mit le feu à l’étoupe, et l’étoupe enflammée tomba en tourbillonnant au fond du puits où elle ne s’éteignit point.
Le puits était sans eau.
Il avait à peine sept ou huit pieds de profondeur, et, se suspendant par les mains à la margelle, Timoléon s’y laissa tomber le premier, en disant :
– Veillez bien sur mademoiselle.
– Soyez tranquille, répondit la Chivotte, qui se cramponnait à Vanda.
– Patron, cria le Pâtissier, c’est pire que la chapelle de Saint-Crispin, ça ; nous ne tiendrons jamais quatre là-dedans.
– Imbécile ! répondit Timoléon, tu vas voir que ce n’est que l’antichambre de l’hôtel du Dab.
Nous nous logeons mieux que ça, nous autres.
Et la main de Timoléon se promena sur les parois du puits avec une lenteur mystérieuse.
XXXV
L’étoupe qui brûlait dans le fond du puits était, comme nous l’avons dit, enduite de résine.
C’était une manière de torche qui pouvait durer une heure et plus.
Le Pâtissier et la Chivotte, qui se cramponnaient toujours à Vanda, suivaient avec curiosité les mouvements de Timoléon.
Vanda elle-même, bien qu’elle sentît que quelque chose de terrible se préparait pour elle, n’avait pu s’empêcher de se pencher sur le puits.
La main de Timoléon, après avoir tâtonné un moment, rencontra sans doute ce qu’elle cherchait.
Probablement une fissure dans la maçonnerie du mur.
Car elle disparut tout entière et fut suivie de l’avant-bras.
Puis tout à coup une pierre se détacha et roula dans le fond du puits.
Puis une autre et encore une autre.
Alors Timoléon leva la tête et dit avec un accent joyeux :
– Je savais bien que personne n’avait découvert mon hôtel !
On m’a même laissé mon outillage, et il y a plus de dix ans cependant que je ne suis venu ici.
Alors, tenant l’étoupe enflammée d’une main, il retira de l’autre une bêche, une pince et une pelle en fer.
Ces trois objets lui avaient servi sans doute à rechercher le trésor du voleur – trésor que, on le pense bien, il n’avait jamais songé à restituer.
Les pierres qui venaient de tomber avaient ouvert dans la muraille du puits une brèche assez large pour que le corps d’un homme pût y passer.
– Passez-moi la demoiselle, à présent, dit le bandit en ricanant.
Le Pâtissier prit Vanda à bras le corps et la suspendant ensuite par les cordes qui lui liaient les bras, il la laissa tomber dans le puits.
Vanda tomba sur ses pieds et ne se fit aucun mal.
– À présent, descendez, vous autres, dit Timoléon.
La Chivotte et le Pâtissier se laissèrent couler l’un après l’autre et se trouvèrent alors à l’entrée d’un boyau souterrain à hauteur d’homme, mais très étroit et qui paraissait s’enfoncer peu à peu dans la terre.
– Veillez bien sur mademoiselle, répéta Timoléon.
– Faut-il l’étrangler tout de suite ? demanda la Chivotte.
– Non, pas encore.
Timoléon tira de sa poche un second morceau d’étoupe pour remplacer le premier qui était presque consumé et qu’il éteignit en mettant le pied dessus.
Puis, armé de cette nouvelle torche, il s’engagea dans ce souterrain dont il venait de déblayer l’entrée.
– File donc ! dit la Chivotte en poussant Vanda.
Vanda s’était promis de ne faire aucune résistance.
Elle se mit donc à marcher sur les pas de Timoléon.
La Chivotte venait derrière elle, continuant à l’accabler d’injures.
Le Pâtissier fermait la marche.
Ce boyau souterrain était évidemment l’œuvre des hommes.
C’était un chemin taillé dans la pierre à plâtre qui compose presque tout le gisement des Carrières de Pantin.
Les traces du pic qui avait servi à l’ouvrier étaient très apparentes çà et là.
Mais on n’avait jamais dû se servir de cette ouverture pour extraire de la pierre et il était probable qu’un éboulement s’étant produit dans quelque puisard du voisinage, cette voie étroite n’avait été ouverte que comme moyen de sauvetage.
Timoléon chemina pendant quatre ou cinq minutes, sa torche à la main, tantôt se baissant, tantôt se redressant, suivant que la voûte était plus ou moins haute.
Puis, tout à coup, il s’arrêta et Vanda qui marchait derrière lui le vit en face d’une porte.
Une vraie porte en bois, avec des gonds enfoncés dans le roc, une serrure et un verrou.
La clé était dans la serrure et Timoléon dit encore :
– Ils n’y ont pas touché, personne n’est venu ici depuis moi.
Il tourna la clé, poussa le verrou et la porte s’ouvrit.
Une bouffée d’air nauséabond frappa Vanda au visage. En même temps, elle se trouva au seuil d’une sorte de salle assez spacieuse, de forme ronde et qui était évidemment une carrière à moitié comblée.
En levant la tête, on pouvait voir à une hauteur considérable des planches et des madriers en échafaudage et par dessus lesquels l’éboulement avait dû se produire, il y avait sans doute bien longtemps déjà.
Çà et là, dans les coins, étaient de vieilles futailles, des morceaux de bois, des outils rouillés.
La carrière avait été abandonnée depuis un grand nombre d’années et son entrée primitive, complètement comblée, ne devait plus être connue de personne.
Au moment où Timoléon et ceux qui le suivaient pénétraient dans le puisard, une légion de rats s’enfuit sous leurs pieds et disparut par une demi-douzaine de crevasses.
– Mademoiselle aura de la société, ricana Timoléon.
– Ah ! papa, s’écria la Chivotte, vous êtes un fier homme, tout de même. Je devine à présent. La largue à Rocambole sera grignotée toute vive.
– C’est une idée qui en vaut bien une autre, murmura Timoléon avec un rire cruel.
Vanda ne put s’empêcher de frissonner.
Timoléon avait fait un signe au Pâtissier.
Celui-ci, qui se trouvait derrière Vanda, lui donna un croc-en-jambe.
Vanda tomba.
– Reficelez-moi la petite, ordonna Timoléon, tandis que le Pâtissier et la Chivotte se précipitaient sur elle et l’empêchaient de se redresser.
Ce fut l’affaire d’un tour de main ; les jambes de Vanda furent attachées de nouveau solidement et elle se trouva couchée sur le dos et dans l’impossibilité de se relever.
Mais Timoléon lui ôta son bâillon, disant :
– Il faut qu’elle puisse crier à son aise, cette chère enfant.
Vanda leva sur lui un regard écrasant de mépris :
– Va, dit-elle, je n’ai pas peur.
– Si tu as faim, dit la Chivotte, tu mangeras des rats, en attendant qu’ils te mangent.
– Vous êtes des misérables ! répondit Vanda, mais j’ai foi en Rocambole. Il me cherchera, il finira par me trouver… et malheur à vous !
– En attendant, ma petite, bonsoir !
Et Timoléon entraîna ses deux complices hors du puisard.
Vanda se trouva dans les ténèbres et entendit le verrou et la serrure de la porte grincer.
Puis les pas des trois misérables s’éloigner.
Puis plus rien !
* *
*
– Papa, disait la Chivotte à Timoléon, lorsque, remontés à la surface du premier puits, ils se mirent tous trois à replacer les planches dans le même état, papa, vous avez une crâne idée, mais, c’est égal, j’aurais autant aimé l’étrangler moi-même.
– Pourquoi ?
– C’est plus sûr.
– Mais elle n’aurait pas souffert…
– Oui… mais qui sait ! Rocambole…
Le Pâtissier eut un rire mystérieux.
– Je compte le prendre au piège, dit-il.
– Lui ?
– Et le piège, c’est Vanda.
Et tous trois s’en allèrent sans que le Pâtissier voulût s’expliquer davantage.
XXXVI
Le lendemain matin, c’est-à-dire quelques heures après la séquestration presque simultanée de Vanda et de sir James Nively, l’une tombée au pouvoir de Timoléon, l’autre supprimé par Rocambole, le fruitier de la rue du Vert-Bois venait d’ouvrir sa boutique, lorsque deux commissionnaires passant auprès avec une charrette à bras, vinrent s’arrêter devant la maison.
La charrette à bras était chargée d’un vieux bureau en acajou, d’un lit en fer, d’un matelas, de couvertures et de quelques chaises de paille. En ajoutant à tout cela un casier à cartons verts et un fauteuil à dossier circulaire, on avait tout le mobilier du bonhomme qui avait, l’avant-veille, loué l’appartement du premier pour y tenir un bureau de placement.
Derrière le mobilier cheminait le locataire.
Il avait à la main deux chapeaux non moins gras que celui qu’il portait sur la tête, une paire de vieilles bottes, une lampe à tringle et un mouchoir noué par les quatre coins qui paraissait contenir du linge. Sous les deux bras, des papiers et des portefeuilles, et suspendues à son cou et flottant sur son dos, une demi-douzaine de vestes et de redingotes attachées les unes aux autres par les manches.
Le fruitier se prit à rire en le voyant.
– Vous n’êtes plus un homme, dit-il, vous êtes un magasin.
– On fait ce qu’on peut, répondit le vieillard d’une voix cassée.
Et il demanda la clé du logement, que le fruitier s’empressa de lui donner.
Les commissionnaires détachèrent les meubles et se mirent à les monter un à un, tandis que le prétendu placeur se débarrassait de sa garde-robe improvisée.
Le fruitier lui dit :
– Je vous attendais hier.
– C’est vrai, dit le bonhomme, mais pour déménager, vous savez, il faut payer son terme. On m’a remis à hier soir pour de l’argent qu’on me devait. Quand on est pauvre diable comme moi, on fait ce qu’on peut.
– Vous avez raison, dit le fruitier, que cette humilité et cette franchise séduisirent et qui prit en amitié le vieux bonhomme. Voulez-vous boire une goutte ?
– Volontiers, dit-il.
Il laissa les commissionnaires installer son chétif mobilier, d’après les indications qu’il leur avait données sur la place de chaque meuble, et suivit le fruitier dans cette arrière-boutique que nous connaissons et qu’on appelait la buvette.
Mais tout en trinquant avec lui et en avalant un verre de mêlé, – on nomme ainsi un mélange de cassis et d’eau-de-vie, – il jetait un regard furtif autour de lui par-dessus ses lunettes et se rendait un compte exact de l’état des lieux.
La trappe de la cave ne lui échappa point.
En hiver, dans les cafés, chez les marchands de vin, partout où il entre beaucoup de monde, il est d’usage, par les temps boueux, de jeter un sable jaune qui ressemble par la couleur à de la sciure de bois.
Il y en avait dans la buvette du fruitier, et il était répandu non point du matin, mais de la veille, car la fruitière n’était point levée encore et la boutique n’avait pas été balayée.
Le bonhomme à qui rien n’échappait, remarqua une certaine quantité de traces de pas sur ce sable.
Cela n’avait rien d’extraordinaire, attendu que toute la soirée on entrait dans la buvette et que le quartier est assez populeux pour qu’une boutique bien achalandée ne désemplisse pas.
Mais la nature de ces empreintes méritait d’être étudiée. Il y avait d’abord la trace d’un pied chaussé de lisière.
Ce devait être celui du fruitier qui, dans la maison, quittait toujours ses sabots.
Puis il y avait une large empreinte longue à proportion, marquée de clous.
Le pied qui l’avait frappée devait être celui d’une sorte de colosse ou d’hercule, marchant lourdement et pliant peut-être sous le poids d’un fardeau.
Enfin, au milieu des autres traces, le prétendu placeur remarqua une botte mince, étroite, à talon haut bien certainement ; une botte qui devait chausser un pied élégant et qui, certes, n’appartenait pas aux visiteurs de la rue du Vert-Bois.
Les remarques faites, le bonhomme dit au fruitier :
– C’est à mon tour de régaler, doublons ça.
Et il tira, d’un vieux gilet de tricot à manches, une pièce de quatre sous qu’il posa sur le comptoir.
Puis, quand il eut choqué son second verre avec celui du fruitier, il se dirigea, le tenant à la main, jusque sur le pas de la porte.
Il était à peine sept heures du matin et les balayeurs commençaient leur office aux deux extrémités de la rue, mais n’avaient point encore atteint le milieu, c’est-à-dire le devant de la maison du fruitier.
Ceci était facile à constater par la boue qui couvrait le trottoir et les tas d’ordures qui se trouvaient à la porte.
Sur le trottoir le bonhomme remarqua l’empreinte de la botte aristocratique et celle du grand pied au soulier à clous.
Ces deux empreintes ne suivaient point le trottoir, mais elles le traversaient.
Cependant le bonhomme eut beau les chercher au milieu de la chaussée ; il ne les retrouva point.
En revanche une roue de voiture avait affaissé un tas d’immondices jetés au bord du trottoir et, en y regardant de plus près, on voyait distinctement que le véhicule avait dû séjourner devant la boutique, car les chevaux avaient piétiné à la même place.
Le soulier à clous et la fine botte étaient donc sortis de la voiture.
Le bonhomme faisait toutes ces réflexions regardant devant lui et disant au fruitier :
– Pensez-vous que le quartier soit aussi bon que la rue Greneta ?
– Ma foi ! répondit le fruitier, je ne connais pas assez votre quartier pour vous répondre à coup sûr, cependant, hier j’ai déjà vu deux bonnes du quartier s’arrêter devant votre écriteau.
– Vrai ? fit le bonhomme, qui prit un air joyeux.
Puis il posa son verre sur le comptoir, ajoutant :
– Allons voir à m’installer.
Les deux commissionnaires avaient achevé de monter le chétif mobilier et les loques du vieillard.
Il souhaita le bonjour au fruitier et gagna son nouveau domicile.
L’un des commissionnaires disait à l’autre :
– Tiens ! voilà tes trois francs. Tu peux t’en aller. Je monterai bien le lit tout seul.
Le commissionnaire empocha les trois francs et partit, laissant son compagnon tête à tête avec le prétendu placeur.
Alors ces derniers échangèrent un coup d’œil d’intelligence.
– J’attends vos ordres, patron, dit l’homme à la veste de velours vert, qui n’était autre que le Pâtissier, parfaitement déguisé et méconnaissable.
– Attends un moment, dit Timoléon, il faut voir d’abord si les oiseaux sont toujours en cage.
Et, après avoir fermé la porte, devant laquelle le Pâtissier se plaça, de peur que la fantaisie de regarder par la serrure ne prît à quelque locataire montant ou descendant d’escalier, Timoléon alla soulever le morceau de papier qui recouvrait le trou qu’il avait percé l’avant-veille avec un vilebrequin.
Puis il introduisit son petit doigt dans le trou et appuya.
La mince couche de plâtre qu’il avait laissée se détacha sans bruit et un petit jet de lumière s’échappa du trou, auquel, sur-le-champ, Timoléon colla son œil.
Ce trou était pratiqué juste auprès du lit occupé par Gipsy.
Gipsy dormait encore.
À l’autre bout de la pièce, on apercevait Marmouset, assis devant une table sur laquelle brûlait une chandelle, un livre sous les yeux et sa tête dans ses deux mains.
Il étudiait avec ardeur la langue anglaise, afin de pouvoir bientôt converser avec sa chère Gipsy, et son attention était si bien absorbée qu’il n’avait pas entendu le bruit du plâtre qui tombait derrière le lit.
– Est-ce bien là Marmouset ? demanda Timoléon, qui fit un signe au Pâtissier.
Le Pâtissier s’approcha et regarda à son tour :
– Oui, dit-il, c’est bien lui.
Timoléon tira de sa poche un morceau de pain tout frais, acheté à la livre.
Il prit un peu de mie, en fit une boulette, et, avec cette boulette, il boucha le trou.
– Maintenant, dit-il, que nous avons l’oiseau sous la main, il faut tâcher de retrouver l’acquéreur.
– Qui sait ce que Rocambole en a fait ? murmura le Pâtissier.
– Je crois le savoir, répondit Timoléon.
– Ah !
– Rocambole est venu ici la nuit dernière, avec Milon, et ils sont entrés dans la boutique du fruitier.
– Comment savez-vous cela ? demanda vivement le Pâtissier.
Timoléon se prit à rire :
– Imbécile ! dit-il, on n’a pas été rousse et voleur sans avoir bon nez.
– Plaît-il ?
– Écoute et tu vas voir.
XXXVII
Le faux commissionnaire et le prétendu placeur avaient pris chacun une chaise, s’étaient assis l’un auprès de l’autre et causaient à voix basse.
Timoléon disait :
– Tu te souviens qu’au moment où nous arrivions, hier soir, à l’hôtel de la rue Marignan, un fiacre stationnait auprès du jardin ?
– Oui.
– Ce fiacre était celui de Rocambole, et il a servi à faire le coup et à enlever l’Anglais. Nous n’étions pas de force à nous opposer à l’enlèvement, et nous avons bien fait de nous borner à mettre la main sur la belle Vanda.
– Ah ! par exemple, dit le Pâtissier, je suis un peu de l’avis de la Chivotte, moi.
– Vraiment ? dit Timoléon.
– Il valait bien mieux s’en débarrasser tout de suite.
Timoléon haussa les épaules :
– Je vous ai dit que j’avais mon idée. Par conséquent, laissez-moi tranquille.
Le Pâtissier inclina la tête en signe de soumission.
– Revenons au fiacre, dit Timoléon. C’est dans un fiacre que Rocambole a emmené l’Anglais ?
– Oui.
– Il y a en bas, à la porte, les traces d’un fiacre.
– Bon !
– Et dans la boutique deux empreintes de pas, un pied lourd, écrasé, celui de Milon sans doute, qui portait l’Anglais sur ses épaules ; une botte fine, légère, et qui ne peut qu’appartenir à Rocambole.
– Alors ils sont venus ici ?
– J’en suis sûr.
– Le fruitier serait complice ?
– C’est un cheval de retour.
– Bon ! compris… Mais où ont-ils caché l’Anglais ?
– Je ne sais pas ; mais je le saurai ce soir. Maintenant, écoute bien.
– Voyons ?
– Tu vas rejoindre la Chivotte.
– Elle m’attend au coin du boulevard et de la rue Saint-Martin.
– La demoiselle est trop bien ficelée pour qu’il lui soit possible de bouger, continua Timoléon, faisant allusion à Vanda ; elle aura peut-être bien quelques démêlés avec les rats ; mais c’est au petit bonheur, et on ne peut pas tout prévoir. Seulement, je ne veux pas qu’elle meure de faim. J’ai besoin qu’elle vive, au contraire.
– Mais…
– Pâtissier, dit froidement Timoléon, tu veux te venger de Rocambole, n’est-ce pas ?
– Si je le veux !
– Eh : bien ! fais attention à ceci : Si mes ordres ne sont pas suivis de point en point, je ne réponds de rien. Il y a mieux : je te laisse et je fais la paix avec Rocambole.
Cette menace arracha un frisson au Pâtissier.
– Suffit ! dit-il, parlez…
– Ce soir, à la brune, tu iras avec la Chivotte à l’hôtel du Dab. Vous emporterez un panier de provisions, et vous ne vous en irez pas que la demoiselle n’ait soupé.
– Faudra-t-il lui délier les mains ?
– Sans doute. Mais avant de vous en aller, vous les lui attacherez de nouveau.
– Bon !
– Maintenant, écoute encore. Tu te muniras d’un pistolet.
– Pour quoi faire ?
– Pour casser la tête à la Chivotte, si elle se livre envers cette femme à la moindre violence.
– On vous obéira, patron.
Timoléon parut réfléchir un moment.
– Tu vois qu’il y a ici deux fenêtres, n’est-ce pas ?
– Oui.
– Celle qui est la plus près de la rue Saint-Martin restera fermée toute la soirée. Aux environs de minuit tu passeras dans la rue.
– Et je regarderai la fenêtre ?
– C’est cela. Si tu la vois entre-bâillée, tu t’approcheras de la porte, je l’aurai ouverte. Tu n’auras qu’à la pousser pour entrer. Tu ôteras tes souliers et tu monteras ici sans bruit. Alors nous nous mettrons à la recherche de l’Anglais.
D’ici là, je vais étudier le plan de la maison et les habitudes des locataires.
Le faux commissionnaire s’en alla muni de toutes ces recommandations.
Timoléon acheva de ranger son petit ménage, après avoir remplacé son chapeau par une casquette à double visière en forme d’abat-jour qui achevait de le rendre méconnaissable.
Il passa une partie de la matinée abrité derrière les persiennes de cette fenêtre qu’il avait signalée au Pâtissier, espérant voir soit Rocambole, soit Milon.
Mais ni l’un ni l’autre ne parut.
Trois ou quatre bonnes sans places croyant à un bureau de placement sérieux se présentèrent successivement.
Timoléon les inscrivit gravement et leur dit à toutes :
– Vous reviendrez demain matin.
Vers midi, il descendit chez le fruitier et acheta un morceau de fromage, une demi-chopine et deux ronds de saucisson.
Puis il remonta dans son bureau.
– Voilà un vieux brave homme, dit le fruitier à sa femme, qui ne fait pas grand bruit.
– Pourvu qu’il paye ! dit la femme.
– On verra ça dans trois mois, répondit le fruitier.
Et il ne s’occupa plus de son nouveau locataire.
À la brune, Timoléon sortit de nouveau.
Il trouva le fruitier dans l’allée, et le bas de l’escalier encombré.
Deux garçons marchands de vin de Bercy étaient en train de descendre une futaille dans la cave, non point par cette trappe que Timoléon avait remarquée dans l’arrière-boutique, mais par l’escalier qui était à l’usage de tous les locataires.
La futaille était lourde. À un certain moment, elle entraîna celui des garçons qui se tenait en haut de l’escalier, et le fruitier, posant sa chandelle sur la première marche, dégringola dans la cave en disant :
– Attendez ! je vais vous aider…
– Puis-je vous donner un coup de main ? demanda Timoléon.
– Ce n’est pas de refus. Éclairez-nous.
Timoléon prit la chandelle et descendit :
– Il est plein de complaisance, ce vieux bonhomme, pensa le fruitier.
Timoléon éclairait les garçons et le fruitier avec une patience inépuisable.
La pièce de vin arriva sans encombre au bas de l’escalier et fut poussée dans un caveau que le fruitier ouvrit.
– Bon ! pensa-t-il, je n’aurai pas besoin de passer par la buvette.
Il jeta un coup d’œil à la serrure qui fermait la porte de communication et se dit encore :
– Cela doit s’ouvrir avec une paille.
Enfin, – et il éprouva même une légère émotion, – il remarqua dans le caveau où l’on venait de ranger la futaille, sur le sol humide et boueux une nouvelle empreinte de pas, en tout semblable à celle du matin.
La botte qu’il croyait être celle de Rocambole avait passé par là.
– Venez donc que je vous paye un vermouth ? dit le fruitier qui voulait reconnaître la complaisance de son nouveau locataire.
Timoléon, remonté dans la boutique, trinqua avec les deux garçons du port de Bercy ; puis il annonça qu’il allait dîner dans une gargotte du voisinage.
Et il sortit.
Comme il tournait l’angle de la rue du Vert-Bois, il se trouva face à face avec un homme qui marchait précipitamment et le bouscula même en passant.
– Excusez, le vieux ! dit-il d’une voix émue.
C’était Milon.
Milon n’avait pas reconnu Timoléon.
Mais Timoléon l’avait reconnu.
– Bon ! pensa-t-il, Rocambole et lui sont à la recherche de Vanda, et il vient savoir si on ne l’aurait pas aperçue rue du Vert-Bois.
Et il continua son chemin, riant sous cape, c’est-à-dire sous sa casquette à double visière.
* *
*
Le nouveau locataire du fruitier ne rentra que vers dix heures du soir, et il prit dans la boutique son chandelier de cuivre et sa clé.
Deux hommes faisaient la partie dans la buvette sur un tapis graisseux.
Timoléon, qui connaissait tous les voleurs de Paris, reconnut le Chanoine et la Mort-des-braves.
– Les gardes du corps de monsieur Marmouset, se dit-il.
Et il monta après avoir souhaité le bonsoir à son propriétaire et à son épouse.
Puis, s’abritant derrière les persiennes fermées, il éteignit sa chandelle et murmura :
– Maintenant, attendons que la boutique du fruitier soit fermée.
XXXVIII
Pendant la journée, sans en avoir l’air, Timoléon avait observé une foule de choses, tantôt par la croisée, tantôt par la porte demeurée entr’ouverte.
Il avait vu monter et descendre les locataires, et il était déjà au courant de leurs habitudes.
Il savait qu’à dix heures du soir tous étaient rentrés, à l’exception d’un ouvrier tanneur qui occupait un cabinet au sixième, travaillait durant la nuit et ne reparaissait qu’au point du jour.
La boutique du fruitier était le seul endroit où l’on veillait aussi tard.
Les habitués, les nouveaux surtout, prolongeaient leur partie quelquefois jusqu’à minuit.
Seulement alors, le fruitier fermait sa boutique.
Mais les volets étaient assez disjoints pour laisser passer un filet de clarté, et ce fut les yeux fixés sur cet indice révélateur que Timoléon attendit.
Les locataires rentrèrent un à un.
Timoléon les entendit monter, d’un pas lent ou rapide, l’escalier.
Puis la porte de la boutique qui donnait sur l’allée s’ouvrit à son tour.
Timoléon prêta l’oreille plus attentivement que jamais.
Le fruitier souhaitait le bonsoir au Chanoine et à la Mort-des-braves, qui couchaient dans la maison, à l’étage au-dessus de celui de Marmouset, sans doute pour être prêts à lui venir en aide à la première alerte.
Ils marchèrent quelque temps au-dessus de la tête du faux placeur, qui voyait leur lumière se refléter sur les murs de la maison d’en face.
Enfin, la lumière s’éteignit et les pas ne se firent plus entendre.
La Mort-des-braves et le Chanoine étaient au lit.
Il n’y avait qu’un homme de la bande de Rocambole dont Timoléon n’eût pas de nouvelles.
Mais Milon, sans doute, avait seulement touché barre à la rue du Vert-Bois et s’était empressé de rejoindre son maître.
Le silence le plus complet régnait maintenant dans la maison.
Timoléon ouvrit sans bruit les volets indiqués au Pâtissier, celui-ci ne tarda pas à paraître à l’extrémité de la rue.
Le faux placeur se déchaussa alors et descendit lestement l’escalier.
Il avait remarqué, dans la journée, que la porte de la maison ne s’ouvrait point, comme la plupart des portes de Paris, au moyen d’un cordon tiré par un concierge.
Il se trouvait au dehors une petite plaque du diamètre d’un écu de cent sous.
Avec le doigt, l’initié à ce secret de Polichinelle faisait mouvoir un loquet et la porte s’ouvrait.
Timoléon leva donc simplement le loquet, et le Pâtissier entra.
– Ôte tes souliers, lui dit Timoléon en le prenant par la main, et prends garde de te cogner en montant.
Deux minutes après, le faux placeur et son acolyte étaient enfermés au premier étage et causaient à voix basse.
– Eh bien ! demanda Timoléon, avez-vous vu notre prisonnière ?
– Pardieu !
– Elle n’est pas morte ?
– Non.
– Les rats ne l’ont donc pas mangée ?
– Oh ! dit le Pâtissier, faut que ce soit une crâne femme et qu’elle ait de rudes nerfs. On dirait de l’acier.
– Comment cela ?
– Vous savez que nous l’avions solidement attachée et couchée ensuite sur le dos ?
– Sans doute.
– Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle est parvenue à se dresser sur ses pieds.
– Sans briser les cordes ?
– Non, elle était toujours attachée, mais les rats l’avaient embêtée probablement, et il y en avait même un qui l’avait mordue à la figure.
– Pauvre petite ! ricana Timoléon.
– Elle s’est donc dressée sur ses pieds et elle en a écrasé plusieurs.
– Et ils ne l’ont pas mordue !
– À part ce coup de dent à la figure, elle était saine comme l’œil.
– Avait-elle l’air bien désespéré ?
– Elle était calme comme vous et moi. La Chivotte a voulu l’agonir, mais je m’y suis opposé.
– A-t-elle mangé ?
– De bon appétit. Nous lui avons détaché les bras, et elle n’a pas cherché à nous bousculer.
Quand elle a eu fini de manger, nous l’avons reficelée et elle n’a opposé aucune résistance !
– Fort bien. Mais, dit Timoléon, a-t-elle l’air d’espérer une délivrance ?
– Elle n’a rien dit, elle est calme.
– C’est égal, murmura Timoléon comme se parlant à lui-même, il faudra se hâter.
Maintenant, mon bonhomme, à la besogne !
– Vous savez où est l’Anglais ?
– À peu près.
Timoléon qui jusqu’alors était demeuré dans l’obscurité se procura de la lumière et ouvrit le tiroir de son bureau qu’il avait prudemment fermé à clé.
Ce tiroir était une vraie trousse de serrurier.
Il contenait un trousseau de fausses clés, un monseigneur, des limes, un marteau.
En outre, dans un coin, il y avait un paquet de cordes roulées.
Timoléon s’empara de tout cela et en emplit ses poches.
Puis il souffla la chandelle.
– Bigre ! dit le Pâtissier, vous prenez quelques précautions, papa.
Timoléon se pencha vers lui et approcha ses lèvres de son oreille :
– Écoute bien ce que je vais te dire, fit-il.
– Parlez…
– Nous jouons tout simplement notre vie à l’écarté en ce moment.
– Hein ? fit le Pâtissier.
– Seulement, poursuivit Timoléon, nos adversaires ont trois points et viennent de marquer le roi. Il s’agit de piquer sur quatre.
– Excusez…
– Si tu as peur, va-t’en ! Seulement, nous ne nous vengerons pas de Rocambole. Voilà tout.
– Allons-y ! dit le Pâtissier.
Et il serra dans l’ombre la main de Timoléon en signe de résolution.
Ce dernier ouvrit la porte.
Il l’ouvrit sans bruit, avec des précautions infinies.
Puis éprouvant le besoin de prouver ce qu’il avait avancé, c’est-à-dire de faire comprendre au Pâtissier la gravité des circonstances :
– La maison, dit-il, est pleine de la bande de Rocambole.
– Ah !
– Au-dessus de nous, il y a deux hommes qui, en te reconnaissant, te sauteraient à la gorge et te refroidiraient. Veux-tu savoir leurs noms ?
– Oui.
– Le Chanoine et la Mort-des-braves.
Le Pâtissier les connaissait et il frissonna.
Timoléon poursuivit :
En bas, dort le fruitier ; encore un qui revient de Toulon et un dévoué à Rocambole.
– Ils le sont tous, murmura le Pâtissier avec dépit.
– Au moindre bruit, les uns ou les autres s’éveilleront, envahiront l’escalier et…
– Allons-y ! répéta le Pâtissier, je veux me venger !
Ils descendirent.
À chaque marche, Timoléon s’arrêtait et prêtait l’oreille.
La maison était plongée dans le silence et l’obscurité.
Arrivés au bas de l’escalier, ils s’arrêtèrent de nouveau.
Timoléon promenait ses deux mains sur le mur et cherchait l’entrée des caves.
La porte qui était commune à tous les locataires ne s’ouvrait qu’à l’aide d’un loquet.
Mais Timoléon avait constaté que ce loquet criait, tant il était rouillé.
Aussi prit-il des précautions minutieuses pour le faire mouvoir, appuyant les deux mains dessus.
Derrière lui le Pâtissier retenait son haleine.
Un ronflement sonore qu’ils entendirent leur donna du courage.
C’était le fruitier qui venait de s’endormir et dont le sommeil bruyant retentissait à travers le mur du rez-de-chaussée.
Si le fruitier dormait tout allait bien.
Enfin, la porte de la cave s’ouvrit.
Timoléon, qui connaissait les aîtres, prit le Pâtissier par la main et le poussa dans l’escalier.
– Descends tout droit, lui dit-il.
Puis il referma la porte sur lui, la tirant avec la même lenteur.
Ni la porte, ni le loquet ne firent le moindre bruit.
Alors Timoléon descendit.
– Où es-tu ? fit-il.
– Ici, répondit le Pâtissier.
Le Pâtissier était arrivé au bas de l’escalier et foulait le sol humide et glissant du corridor des caves.
Timoléon étendit la main et le toucha.
– C’est bien, dit-il. Allumons la chimique !
Et il tira de sa poche une allumette qu’il frotta sur son ongle.
L’allumette prit feu et Timoléon l’approcha d’une de ces bougies roulées en corde qu’on appelle rat-de-cave et qui sont à peine de la grosseur du petit doigt.
XXXIX
Tout en allumant son rat-de-cave, Timoléon le tenait devant sa poitrine de façon à en projeter toute la lueur devant lui et à laisser dans l’ombre le bas de l’escalier.
À défaut de sa mémoire, si elle eût eu par hasard un moment d’indécision, les pas des garçons de Bercy et du fruitier, largement imprimés sur le sol du corridor souterrain, l’eussent guidé pour trouver la porte de la cave particulière du fruitier.
Quand il fut devant cette porte, Timoléon tendit son rat-de-cave au Pâtissier :
– Tiens ça, dit-il.
Puis il fouilla dans sa poche, ajoutant :
– Si nous devions filer, après avoir fait le coup, je ferais sauter la serrure ; mais comme nous devons rester dans la maison où j’ai affaire pour deux ou trois jours encore, il s’agit de ne pas nous vendre.
Il prit son trousseau de clefs.
Puis, avec une patience d’ange, et tandis que le Pâtissier tenait son rat-de-cave auprès de la serrure, Timoléon essaya l’une après l’autre ses fausses clés.
Enfin l’une entra et tourna dans la serrure.
Le pêne glissa sans bruit, la porte s’ouvrit.
Timoléon retira la clé du côté extérieur et la passa à l’intérieur.
– On ne prend jamais trop de précautions, dit-il.
Et poussant le Pâtissier dans la cave du fruitier, il referma la porte sur lui.
La cave, comme on a pu le voir quand Rocambole et Milon avaient descendu sir James évanoui, était divisée en plusieurs compartiments et caveaux.
Timoléon n’avait pas de souliers.
Mais il avait mis ses chaussons qui ne devaient laisser qu’une empreinte indécise.
D’ailleurs, les garçons de Bercy avaient piétiné le sol assez pour confondre toutes les traces.
Mais Timoléon avait vu, dans la soirée, l’empreinte de la bottine auprès d’une petite porte qui était celle d’un autre caveau.
C’était là que, selon lui, devait être enfermé l’Anglais.
Il s’arrêta une fois encore et prêta l’oreille.
Comme il était arrivé trop tard, la veille, pour faire avorter l’enlèvement du baronnet, il y avait une chose que Timoléon ne savait pas, – c’est que sir James était sous la puissance d’un narcotique.
Or, il croyait qu’on s’était contenté de le garrotter et de le bâillonner pour l’empêcher de crier.
Mais si serré que soit un bâillon, il laisse cependant passer quelques gémissements étouffés.
C’était pour cela que Timoléon s’arrêtait et prêtait l’oreille.
Timoléon n’entendit rien.
– L’auraient-ils tué ? se dit-il.
Et il sentit quelques gouttes de sueur perler à son front.
Le Pâtissier tenait toujours le rat-de-cave.
Timoléon reprit son trousseau de clés, et comme il avait attaqué la première porte, il attaqua la seconde.
Celle-là encore céda.
Mais, ô surprise !
Timoléon se trouvait au seuil d’un caveau complètement vide.
Où donc était sir James ?
Un moment, croyant s’être trompé, Timoléon songea à revenir sur ses pas.
Mais l’empreinte de la fameuse botte et celle du large pied ferré le frappaient, car elles se continuaient dans ce second caveau.
Timoléon en fit le tour, frappant de son poing fermé sur le mur, avec l’espoir de découvrir quelque cachette, quelque cavité mystérieuse.
Partout le mur rendit un son mat et plein.
Alors Timoléon regarda à ses pieds.
Il lui sembla que le sol qu’il foulait s’affaissait légèrement et n’avait point été tassé aussi durement que celui du caveau précédent.
Quand il se fut baissé et qu’il l’eut labouré avec ses doigts, il s’aperçut que ce sol était friable et qu’il avait été récemment remué.
Alors Timoléon fut fixé.
Il s’accroupit et se faisant une pelle de ses deux mains, il se mit à déblayer le milieu du caveau, au grand étonnement du Pâtissier.
Bientôt les ongles glissèrent sur une surface dure et graveleuse.
Timoléon reconnut une pierre.
En même temps, levant les yeux, il aperçut dans un coin du caveau cette pince dont le fruitier s’était servi la nuit précédente.
Le reste n’était qu’un jeu.
Timoléon mit à découvert la pierre qui recouvrait l’oubliette.
Puis il s’empara du levier et l’introduisit dans la fente.
La pierre se souleva et mit le trou du puits à découvert.
– Ils sont rudement malins ! murmura Timoléon, faisant allusion à Rocambole et à ses complices.
Le Pâtissier s’était agenouillé au bord du trou et plongeait son rat-de-cave à l’intérieur du puits.
Au fond, on apercevait un corps accroupi dans une parfaite immobilité.
– Ils l’ont tué ! murmura le Pâtissier.
Les cheveux de Timoléon se hérissèrent.
Mais il ne perdit pas courage :
– Bah ! qui sait ? dit-il.
Et s’emparant du paquet de cordes qu’il avait apporté, il se mit à l’enrouler autour du corps du Pâtissier.
– Que faites-vous ? dit celui-ci.
– Tu vas voir. Arc-boutes-toi bien sur tes pieds.
En même temps, Timoléon saisit l’autre bout de la corde et se laissa glisser dans le puits.
En touchant le sol, il toucha le corps de sir James.
Le corps ne bougea pas.
Timoléon le toucha. Ce corps était froid.
– Rocambole m’aurait-il donc volé ma vengeance ? se dit-il avec un redoublement d’émotion.
Mais Timoléon ne perdait jamais la tête.
– Voyons ? se dit-il, si Rocambole avait tué sir James, il l’aurait laissé sur place et ne se serait pas donné tant de mal pour l’apporter ici.
En même temps, il leva les yeux.
Il vit à distance égale du fond du puits et de son orifice une espèce de lucarne.
C’était la meurtrière ouverte sur l’égout.
– Bon ! dit-il, s’il y a de l’air c’est pour qu’il vive !
Et soudain un souvenir traversa sa pensée.
Il se rappela comment autrefois, Rocambole avait fait sortir Antoinette de Saint-Lazare, et il songea que sir James avait sans doute, par les soins de Vanda, pris une goutte de ce narcotique si puissant qu’il arrivait à la paralysie complète et à la suspension de tous les organes vitaux.
Dès lors, il ne s’agissait plus pour Timoléon que de s’assurer que sa supposition était fondée.
Il se procura du feu en frottant une autre allumette, puis, la tenant d’une main, il se mit à entr’ouvrir les lèvres de sir James.
Le prétendu mort avait les gencives rouges. C’était bon signe.
– Nous examinerons cela plus en détail, là-haut ! se dit-il.
Il jeta l’allumette. Puis, prenant la corde qui lui avait servi à descendre dans le puits, il la passa sous les aisselles du baronnet et la noua solidement.
Ensuite il dit à mi-voix au Pâtissier penché sur le puits :
– Tiens-toi bien ! je vais remonter !
En même temps, il saisit la corde à un mètre au-dessus du corps de sir James et se hissa hors du puits.
– Il est mort, n’est-ce pas ? dit le Pâtissier.
– Je ne sais pas.
– C’est facile à voir.
– Je ne sais pas, répéta Timoléon.
Puis il prit la corde à deux mains et dit encore :
– Aide-moi, nous allons le remonter.
Un homme inanimé, disent des gens du peuple, est plus lourd qu’un autre.
Cela est-il vrai ? nous n’oserions l’affirmer.
Toujours est-il que le Pâtissier et Timoléon eurent de la peine à retirer sir James hors du puits.
Timoléon le coucha de tout son long dans le caveau.
– Il est mort, répétait le Pâtissier.
Et se penchant sur lui, il posa sa main sur le cœur du baronnet.
Le cœur ne battait pas, la poitrine était aussi froide que le visage.
Timoléon se prit à soulever les quatre membres l’un après l’autre.
Ils pliaient aux jointures et n’avaient point cette rigidité qui s’empare du corps quelques heures après le trépas.
Cependant il y avait vingt-quatre heures que sir James était dans ce cul de basse fosse.
– Non, il n’est pas mort, dit Timoléon.
– Oh ! fit le Pâtissier, il est froid.
– Ça ne fait rien…
– Pourtant…
Timoléon le regarda d’un air de pitié…
– On voit bien, dit-il, que tu ne connais pas Rocambole !
Et le Pâtissier ne put se défendre, à ces mots, d’un léger frisson.
Rocambole jouait donc avec la mort ?
XL
Timoléon s’aperçut de la stupéfaction et même de l’effroi que ses dernières paroles avaient produit sur le Pâtissier.
– Ah ! dit-il, ne crois pas qu’en t’associant avec moi pour exterminer Rocambole, tu t’es embarqué dans une simple partie de bézigue.
– Mais…
– Si tu as peur, il en est temps encore… Va-t-en ! ajouta Timoléon avec calme.
– Jamais ! dit le Pâtissier.
Timoléon s’était agenouillé devant sir James et le considérait attentivement.
– Oui, dit-il enfin, Antoinette Miller était comme ça, quand elle est sortie de Saint-Lazare dans une bière.
– Antoinette ! fit le Pâtissier étonné.
– Oui, c’est une histoire qu’il serait trop long de te raconter. Nous n’avons pas le temps aujourd’hui et il serait dangereux de moisir ici.
– Alors vous croyez qu’il n’est pas mort ?
– Non, dit Timoléon.
– Eh bien ! qu’allons-nous en faire ?
– Voilà ce que je me demande, murmura Timoléon comme se parlant à lui-même.
Mais il eut bientôt pris son parti.
– Je sais bien, dit-il, que le plus sage, en apparence, serait de le prendre sur nos épaules et de le porter hors de cette maison. Mais que dira le cocher de la voiture dans laquelle nous le mettrons ? et ne rencontrerons-nous pas quelque sergent de ville trop curieux…
D’un autre côté nous ne pouvons pas le laisser ici…, et qui sait quand il reviendra à lui ?…
Bah ! quand on ne joue pas le tout pour le tout, on est perdu !…
Et après ces mots qui ne formulaient pas toute sa pensée, Timoléon prit de la même main le pic en fer et le rat-de-cave.
– Tiens-moi bien, dit-il, je retourne faire un tour dans le puits.
Il ne se soutenait à la corde que de sa main droite.
Quand il fut en face de la meurtrière percée dans l’égout, il s’arrêta.
– Voyons, pensa-t-il, quand on joue avec Rocambole, il faut écarter jusqu’à ce qu’on ait tous les atouts.
Il est bien certain qu’on n’aurait pas laissé l’Anglais dans ce puits-là sans prendre de temps en temps de ses nouvelles.
Donc on viendra, si ce n’est aujourd’hui, au moins demain.
Donc, si on vient et qu’on ne le trouve plus, il faut qu’on sache ou que l’on croie savoir où il est passé.
Et avec le pic, il se mit à attaquer à bas bruit une grosse pierre au-dessus de la meurtrière sur laquelle il avait posé son rat-de-cave.
Comme il exerçait des pesées plutôt qu’il ne frappait, l’opération ne faisait pas de bruit.
Au bout de quelques minutes, la pierre oscilla.
Le pic, adroitement glissé entre elle et la pierre, pesa plus fort.
La pierre se détacha et tomba dans l’égout.
Timoléon entendit le clapotement de l’eau qui s’ouvrait et se refermait sur elle.
Désormais la meurtrière était assez grande pour laisser passer le corps d’un homme.
Et Timoléon remonta en se disant :
– Quand Rocambole ou les siens viendront, ils penseront que l’Anglais s’est sauvé par l’égout.
Ce n’était pas le tout d’avoir crocheté les portes, découvert le caveau, mis à nu la pierre de l’oubliette, retiré sir James du puits.
Il fallait encore mettre les choses dans le même état, de façon à ce qu’on ne pût pas supposer que sir James avait été sauvé par une autre issue que par la meurtrière donnant sur l’égout.
Timoléon se mit bravement à l’œuvre.
Il replaça la pierre sur le puits, et le pic dans un coin du caveau.
Puis il repoussa le sable sur la pierre et le piétina en tous sens, ayant bien soin de ne pas effacer deux empreintes de botte qui se trouvaient auprès de la porte.
Quand tout cela fut fait, le Pâtissier et lui prirent sir James, l’un par les pieds, l’autre par les épaules, et ils le transportèrent dans le premier caveau.
Alors, Timoléon referma la porte et retira sa fausse clé de la serrure.
Sir James fut ensuite transporté dans le couloir souterrain, et la deuxième porte fut refermée comme la première.
Le rat-de-cave était près de sa fin.
– Voici le plus dangereux, dit Timoléon.
– Quoi donc ? demanda le Pâtissier.
– Si nous essayons de monter sans lumière, nous allons nous cogner et nous ferons du bruit. On accourra et nous sommes perdus…
D’un autre côté, on peut voir notre lumière.
– Écoutez, dit le Pâtissier, je vais prendre le mort, car il est mort, j’en suis bien sûr, et je le porterai sur mes épaules. Il est lourd, mais ça ne fait rien.
– Soit.
Et Timoléon monta l’escalier de la cave à reculons, tandis que le Pâtissier chargeait sir James sur son dos, comme il eût fait d’un colis.
Timoléon ne poussa la porte de la cave, qui donnait sur l’allée de la maison, qu’au dernier moment.
Puis il abrita le rat-de-cave dans ses mains pour en diminuer la clarté.
On entendait toujours, du reste, les ronflements sonores du fruitier.
Néanmoins, les trois minutes qui s’écoulèrent, tandis qu’il montait à reculons l’escalier, et que le Pâtissier, chargé de sir James, le suivait, parurent trois siècles à Timoléon.
Enfin, il toucha le seuil de son logis, et le Pâtissier put entrer avec son fardeau.
– Jette-le sur mon lit, dit Timoléon.
Le logis du prétendu placeur se composait de trois pièces, une grande qui était la première et dans laquelle il avait établi son bureau, le bureau de placement proprement dit.
Une petite cuisine ; et, au bout de la cuisine, une chambre à coucher qui était plutôt un grand cabinet et dont l’unique fenêtre donnait sur la cour.
C’était là que Timoléon avait dressé son lit.
Ce fut sur ce lit que le Pâtissier déposa sir James.
Timoléon se livra alors à un nouvel examen du corps.
– Non, répéta-t-il avec conviction, il n’est pas mort.
– Alors, dit le Pâtissier, il faut le faire revenir à lui.
– C’est inutile.
– Pourquoi ?
– Parce qu’il reviendra tout seul.
– Quand ?
– Dans vingt-quatre ou trente-six heures, dit Timoléon, qui cherchait à se rappeler combien d’heures avait dormi Antoinette.
– Et d’ici là ?… fit le Pâtissier.
– D’ici là nous avons autre chose à faire.
– Ah !
– Il faut nous occuper de Rocambole.
L’œil du Pâtissier s’éclaira d’une lueur féroce.
Timoléon ouvrit alors l’habit de sir James qui était boutonné, fouilla dans la poche et en retira un petit portefeuille.
Ce portefeuille contenait un millier d’écus en billets de banque.
– Il est juste, dit-il, que l’Anglais paye les frais de la guerre.
En même temps il tendit trois cents francs au Pâtissier en lui disant :
– Tu vas t’en aller comme tu es venu. J’irai fermer la porte quand tu seras parti.
– Bon !
– Demain matin tu iras rue de Bellefond.
– Après ?
– Tu t’adresseras au portier. En te voyant, il saura que tu viens de ma part. Tu lui donneras cet argent et tu lui diras qu’il me faut un baril de poudre.
– Pourquoi faire ?
– Tu le sauras plus tard.
– Est-ce tout ?
– Non, tu iras chez une vieille femme que tu connais ou dois connaître, et qui demeure rue des Filles-Dieu.
– Comment l’appelez-vous ?
– Philippette.
– Je la connais.
– Tu me l’enverras… j’ai besoin d’elle…
– Et quand reviendrai-je ?
– La nuit prochaine, à la même heure.
Et Timoléon jugea inutile de mettre le Pâtissier plus avant dans ses confidences.
Le Pâtissier s’en alla et Timoléon demeura seul auprès de sir James en léthargie.
XLI
Tandis que Timoléon, tout entier à cette vengeance à laquelle désormais il avait consacré sa vie, épaississait les fils de la trame ténébreuse, Vanda était toujours dans cette carrière inexplorée qui se trouvait au milieu de la plaine de Montfaucon.
On sait comme elle y était entrée.
On se souvient que Timoléon l’avait garrottée avant de l’abandonner.
On se rappelle, en outre, qu’il avait donné l’ordre au Pâtissier, le lendemain, de lui porter à manger.
Cet ordre avait paru inexplicable à la Chivotte et au Pâtissier.
À la Chivotte surtout qui disait :
– Puisque nous devons la tuer, pourquoi donc pas tout de suite ? Est-ce que le patron veut attendre que Rocambole la délivre ?
Le Pâtissier n’avait jamais donné une solution à la Chivotte, puisqu’il n’était pas initié aux projets de Timoléon.
Mais il avait observé la consigne que lui avait donné ce dernier, à savoir de protéger Vanda contre toute violence de la Chivotte.
Vanda, ainsi que le Pâtissier l’avait raconté le lendemain soir à Timoléon, était parvenue, en dépit de ses liens, à se tenir debout et à préserver ainsi au moins ses épaules, son cou et son visage de la morsure des rats.
Elle avait passé vingt-quatre heures épouvantables.
Tout autre qu’elle eût succombé ; tout autre eût poussé des cris de désespoir et appelé la mort au fond de ce sépulcre où elle était ensevelie toute vivante.
Vanda ne se désespéra point.
Elle se défendit des rats comme elle put ; puis elle attendit.
Rocambole n’avait-il pas délivré Antoinette ?
N’avait-il pas sauvé Madeleine ?
N’avait-il pas arraché Gipsy au bûcher ?
Vanda se disait :
– Ils ne m’ont pas tuée, ils ne me tueront pas. Sans doute ils veulent me laisser mourir de faim… mais j’endurerai la faim au moins trois ou quatre jours, peut-être plus. Et d’ici là… Ah ! d’ici là, Rocambole peut trouver ma trace, car, à cette heure, il me cherche bien certainement.
Et Vanda calculait, en effet, que Rocambole avait dû aller à l’hôtel Marignan le matin même, et que là, ne la trouvant plus, il aurait deviné tout ou une partie de la vérité.
Avoir seulement un fil conducteur, n’était-ce point assez pour Rocambole ?
Vanda résistait donc à l’horreur des ténèbres qui l’enveloppaient ; elle avait fini par s’habituer au contact de ces êtres immondes et gluants qui passaient sous ses pieds.
Depuis combien d’heures la malheureuse était-elle dans cette situation ?
Il lui eût été impossible de le dire, – lorsque tout à coup, elle entendit du bruit.
Un bruit lointain qui se rapprocha peu à peu et devint plus distinct.
Vanda reconnut des pas et des voix.
Puis un filet de clarté brilla à travers les ais mal joints de la porte de son étrange cachot.
Un moment elle espéra qu’on venait la délivrer.
Un moment elle espéra voir paraître Rocambole.
Hélas ! son illusion fut bientôt détruite.
La porte s’ouvrit, le Pâtissier parut.
Derrière lui marchait la Chivotte.
Cette fois, pensa Vanda, ils viennent me tuer !
Elle avait les pieds et les mains liés, mais Timoléon lui avait ôté son bâillon, elle avait donc l’usage de ses dents et elle songeait à s’en faire une arme terrible et à vendre sa vie le plus chèrement possible, lorsqu’elle entendit le Pâtissier qui disait :
– Nous apportons le souper de madame la duchesse.
En même temps elle vit un panier aux mains de la Chivotte.
– Ah ! canaille, disait celle-ci, il faut que je sois malheureuse pour qu’on me force à t’apporter à manger au lieu de me laisser t’étrangler !
Vanda répondit par un regard de dédain à cette menace.
Le Pâtissier tira un revolver de sa poche et dit à la Chivotte :
– Tu sais l’ordre du patron, si tu manques de respect à madame, je te brûle.
– C’est bon ! on attendra… grommela la Chivotte avec un accent de fureur.
Ceci prouvait une chose à Vanda, c’est que Timoléon n’avait point encore résolu sa mort et qu’elle pouvait manger, sans crainte d’être empoisonnée, ce qu’on lui apportait.
Tandis que le Pâtissier lui déliait les mains, la Chivotte avait ouvert le panier et posé auprès la lanterne dont elle était munie.
La lumière avait mis les rats en fuite.
Faisant appel de nouveau à son énergie et à la force qu’elle possédait sur elle-même, Vanda supporta les injures de la Chivotte, et mangea, tout comme si elle se fût trouvée encore dans le petit hôtel de l’avenue Marignan.
La nourriture qu’on lui avait apportée était cependant des plus frugales.
Elle consistait en deux paquets de couennes de lard, un morceau de fromage, du pain et un demi-litre de vin.
Tandis qu’elle mangeait, le Pâtissier et la Chivotte l’accablaient d’injures.
Elle mangea sans leur répondre ; elle ne daigna pas même les regarder.
Seulement elle trouva le moyen de faire disparaître, tandis qu’elle avait les mains libres, un des paquets de couennes et s’assit dessus.
Son repas terminé, les deux misérables lui lièrent de nouveau les mains et s’en allèrent.
Pour la seconde fois, Vanda se trouva plongée dans les ténèbres, les mains garrottées derrière le dos, les jambes étroitement attachées.
Mais, tout en paraissant manger avec une avidité bestiale et tandis que le Pâtissier et la Chivotte l’insultaient avec trop de passion pour la pouvoir observer, Vanda avait porté autour d’elle un regard investigateur.
Elle avait remarqué plusieurs anfractuosités dans les parois de la carrière.
Elle avait aperçu tout en haut une sorte de trou assez semblable au nid d’un cormoran dans une falaise.
L’espoir d’une évasion lui était venu.
Les deux misérables l’avaient laissée adossée à une des parois de la carrière.
Mais Vanda se coucha d’elle-même.
Elle se coucha sur le dos, de façon à ce que ses mains fussent, quoique liées, en contact avec le sol.
Et, à force de tâtonner, ses mains se trouvèrent à portée du paquet de couennes de lard.
Alors elle se vautra dessus, de façon à enduire de graisse la corde qui lui attachait les poignets.
Puis, avec cette souplesse féline qui lui était particulière, elle se redressa.
La lumière disparue, les rats étaient revenus.
Vanda les sentait grouiller autour d’elle et se disputer les miettes de pain tombées sur le sol.
Bientôt elle sentit que quelques-uns grimpaient après elle.
Mais elle ne fit point comme auparavant, elle ne se secoua point, en criant, de façon à les mettre en fuite.
Les rats grimpèrent, attirés par l’odeur du lard qu’exhalait la corde.
Cette corde serrait les poignets de Vanda, mais lui laissait l’usage de ses doigts.
Elle fut obligée de s’en servir pour étrangler deux rats qui la mordirent.
Mais deux autres s’étaient mis à ronger la corde et Vanda attendait avec anxiété, en supportant ce hideux contact, qu’elle pût profiter de leur œuvre de destruction.
Enfin, elle donna une secousse vigoureuse.
Les rats dégringolèrent.
Mais la corde à demi rongée se rompit.
Les mains de Vanda étaient libres.
Dénouer les cordes qui lui attachaient les jambes fut pour elle l’affaire d’un moment.
Elle avait désormais l’usage de ses membres, elle pouvait se défendre contre les rats et les écraser sous ses pieds. Mais c’était tout…
Vanda n’en était pas moins prisonnière et plongée dans les ténèbres.
Tout à coup, elle entendit des cris aigus.
C’étaient les rats qui s’enfuyaient comme s’ils eussent été surpris par un ennemi inattendu.
En même temps Vanda leva la tête et vit dans un coin de la carrière deux points lumineux comme des charbons.
C’étaient les yeux d’un tigre ou ceux d’un simple chat de gouttière.
Vanda ne le sut pas au juste, tout d’abord.
Mais elle comprit que le ciel lui envoyait peut-être un auxiliaire.
XLII
Les deux points lumineux ne demeurèrent pas longtemps immobiles.
Tout à coup ils s’agitèrent et bondirent.
On eût dit une étoile détachée de son centre de gravité et exécutant une course folle à travers l’espace.
En même temps Vanda entendit un autre cri aigu.
C’était un rat retardataire qui s’était laissé prendre.
En ce moment aussi, Vanda fit un mouvement et ce mouvement fut suivi d’un léger bruit.
Le chat, car c’en était un, prit la fuite.
Vanda le vit bondir, et, suivant la direction de ce regard qui brillait comme une luciole, elle comprit qu’il grimpait le long des parois de la carrière.
À une certaine hauteur, il s’arrêta encore.
Vanda fit un pas en avant.
Il grimpa plus haut.
Elle en fit un autre encore et, tout à coup, les yeux enflammés disparurent.
Vanda avait fini par se familiariser avec ces ténèbres opaques qui l’entouraient.
Bien après que le chat eut disparu, elle croyait voir encore le chemin qu’il avait suivi.
Et, les mains étendues en avant, elle se dirigea vers l’endroit où il avait commencé à grimper.
La paroi de la roche était raboteuse.
À n’en plus douter, c’était l’endroit où, tandis que la lanterne du Pâtissier éclairait la carrière, elle avait remarqué des anfractuosités assez profondes pour qu’on pût y introduire les pieds et les mains.
L’endroit encore où, tout en haut, elle avait remarqué un trou qui pouvait laisser passer un corps humain.
Sans nul doute c’était par là que le chat avait pris la fuite.
Alors commença pour Vanda un singulier travail de patience, – le travail d’un être humain escaladant un rocher au milieu d’une obscurité profonde.
Ses mains rencontrèrent une crevasse et s’y cramponnèrent, tandis que ses pieds en cherchaient une autre. À un mètre du sol à peu près, son pied droit trouva un trou.
Vanda y posa les deux pieds et ses mains cherchèrent une autre anfractuosité.
Peu à peu, avec une patience inouïe, tâtonnant longtemps, risquant à chaque seconde de retomber, Vanda s’éleva à une certaine hauteur.
Le chemin suivi par le chat était toujours présent à son esprit et elle croyait encore voir cette trace lumineuse qu’elle avait suivie des yeux.
À mesure qu’elle montait, les anfractuosités se multipliaient et l’ascension devenait plus facile.
Tout à coup, Vanda sentit un souffle au-dessus de ses cheveux, une haleine chaude et qui paraissait s’échapper d’une poitrine vivante.
Elle leva la tête et revit les deux yeux brillants.
C’était le chat qui s’était familiarisé et était revenu.
– Ah ! te voilà ? dit Vanda.
Sa voix effraya le chat, qui disparut de nouveau.
Vanda comprit qu’elle atteignait ce trou qu’elle avait déjà remarqué.
En effet, ayant gravi à peu près un pied de plus, elle sentit un vent frais lui caresser le visage.
En même temps, elle aperçut les deux yeux à une assez grande distance, dans une direction horizontale.
Et, montant encore, elle se trouva dans une espèce de boyau latéral à la carrière.
Alors elle frappa dans ses mains.
Le chat prit la fuite, et, quand il eut disparu, Vanda vit une clarté pâle à l’extrémité de ce boyau qui lui avait servi de chemin.
D’où provenait cette clarté ?
Vanda eut une espérance. C’était peut-être une issue ignorée de Timoléon.
Peut-être allait-elle recouvrer sa liberté.
Et, se glissant à plat ventre dans le boyau, elle se mit à avancer, les mains toujours étendues en avant, les yeux fixés sur une clarté blafarde qui brillait dans le lointain.
Vanda ne se trompait qu’à moitié.
La lueur blafarde était celle du jour. Seulement, comme le boyau faisait un coude, la lumière le faisait aussi et Vanda n’en voyait que le reflet.
Quand la prisonnière fut parvenue à ce coude, une clarté plus vive frappa son visage.
Elle vit alors assez distinctement, à une dizaine de pas devant elle, un trou par lequel venait cette lumière, et qui avait dû servir d’issue au chat.
En même temps, le boyau s’élargissait peu à peu, et Vanda n’était plus obligée de ramper.
Elle arriva jusqu’à ce trou et reconnut qu’il donnait dans une autre carrière, à ciel ouvert sans doute, car la lumière y tombait verticalement.
Seulement, le trou était trop petit pour qu’un corps humain, si frêle et si mince qu’il fût, pût y passer.
Vanda reconnut avec désespoir qu’il était l’œuvre de la nature et non celle des hommes, et qu’il était pratiqué non point dans cette pierre molle et crayeuse des carrières, mais dans une roche dure.
Or, Vanda n’avait ni outil, ni couteau, ni aucun instrument qui lui permît d’attaquer cette roche avec succès.
Tout ce qu’elle put faire, ce fut de regarder par ce trou dans la carrière dont le sol était presque de niveau avec le trou.
Elle vit alors un amas de cendres, quelques débris de tisons, une cruche cassée, et deux ou trois vieilles planches dans un coin.
C’était une preuve que la carrière avait été habitée quelquefois.
Par qui ?
Sans doute des voleurs ou des vagabonds qui venaient la nuit y chercher un refuge.
Et Vanda se dit :
– D’un moment à l’autre, ils peuvent venir…
Alors, je m’adresserai à eux… Je leur promettrai de l’argent, au besoin…
Et Vanda espéra…
* *
*
Plusieurs heures s’écoulèrent.
Vanda attendait toujours, aspirant avec une âpre volupté cet air plus pur qui lui venait par l’orifice.
D’ailleurs elle était débarrassée des rats et c’était beaucoup.
La lumière s’affaiblissait cependant.
Vanda comprit que le jour tirait sur son déclin.
Puis elle disparut tout à fait. Il était nuit.
Un moment, Vanda pensa à rebrousser chemin et à descendre de nouveau dans la carrière où on l’avait enfermée, de peur que les gens de Timoléon ou Timoléon lui-même, ne revinssent.
Mais soudain elle entendit du bruit de l’autre côté du trou et demeura immobile.
C’était un bruit de pas qu’elle avait perçu.
Bientôt elle vit s’agiter une forme noire et une voix rauque et avinée murmura :
– Pourvu qu’il y ait encore du feu.
Vanda devina que cet hôte inconnu, mais qu’elle attendait avec tant d’impatience, fouillait dans les cendres pour y retrouver un charbon encore allumé.
En effet, peu après, un soupir de soulagement se fit entendre, puis un souffle puissant arracha quelques étincelles à un tison et à la lueur de ces étincelles, Vanda aperçut un visage rouge et hideux.
XLIII
Quel était ce visage rougeaud et d’aspect hideux qui venait d’apparaître à Vanda ?
Avant de le dire, revenons à Timoléon, que nous avons laissé seul en face de sir James Nively, toujours en léthargie.
Timoléon avait donné deux ordres au Pâtissier.
Le premier consistait à découvrir une femme du nom de Philippette, et à la lui envoyer.
Le second, à revenir la nuit suivante, à la même heure.
La deuxième pièce dans laquelle sir James était couché se trouvait assez loin de la porte de l’appartement et, par conséquent, de l’escalier, pour que, si l’Anglais rouvrait ses yeux, Timoléon eût le temps de l’empêcher de manifester trop bruyamment sa surprise, en lui expliquant où il était, avant que personne n’eût rien entendu dans la maison.
Mais cette situation plaçait Timoléon dans l’obligation absolue de ne plus sortir.
Car, en son absence, le baronnet revenant subitement à lui, se trouvant seul, dans un lieu inconnu, n’aurait pas manqué de faire un tapage d’enfer, et tout se serait découvert.
Timoléon, assez vivement préoccupé de cette idée, avait négligé de dire au Pâtissier qu’il fallait, ce soir-là, à la même heure que la veille, porter à manger à Vanda.
Le faux placeur avait bien fermé sa porte au verrou, de peur de surprise, puis il s’était installé non point dans son bureau, mais dans sa chambre, auprès du lit, l’œil fixé sur le baronnet endormi, et il avait attendu Philippette.
Si l’on s’en souvient, Philippette était cette vieille mendiante qui avait, autrefois, servi de commissionnaire à M. de Morlux en se faisant arrêter et portant à Saint-Lazare le poison destiné à Antoinette.
Philippette n’avait pas de domicile ; elle couchait un peu partout, souvent au violon, mais on était sûr de la rencontrer à six heures du matin, en hiver, à quatre heures en été, dans quelqu’un des cabarets qui avoisinent les Halles.
Le Pâtissier savait fort bien cela, et il ne l’avait pas cherchée longtemps.
À dix heures du matin, Philippette arrivait rue du Vert-Bois, avec des renseignements positifs.
Elle savait que Timoléon tenait un bureau de placement.
Elle ne s’amusa point à demander des renseignements en bas et monta tout droit.
Timoléon vint lui ouvrir et s’enferma avec elle.
– Que fais-tu maintenant ? lui dit-il.
– Toujours la même chose, répondit-elle. Mais les temps sont durs. Il pleut des rousses ; on en trouve partout, et à chaque minute on a peur d’être emballé. Il faut avoir bien faim et bien soif pour se risquer à grinchir.
– Où perches-tu, pour le moment ?
– La semaine dernière encore, j’allais coucher au Petit Tivoli, aux Carrières d’Amérique.
– Et… maintenant ?
– Maintenant, depuis qu’on a fait une razzia l’autre semaine, je me méfie et je vais à Pantin.
– Ah ! ah ! fit Timoléon, et dans quelle carrière ?
– Dans une où personne ne va encore. Voici trois nuits que j’y fais du feu et que personne ne me vient tenir compagnie.
– Où est-elle donc, celle-là ?
Comme on le pense bien, Timoléon était revenu dans la première pièce de son logement, pour recevoir Philippette et la vieille femme n’avait point vu sir James Nively.
Timoléon prit un morceau de craie et se mit à tracer sur le carreau une espèce de carte géographique.
C’était le plan du vallon de Montfaucon et de Pantin.
– Tiens, dit-il, regarde bien.
– Allez, dit Philippette, je m’y connais.
Timoléon marqua un point qui, selon lui, devait indiquer la place exacte de l’une des carrières.
– Est-ce là ? dit-il.
– Non.
Il traça un autre point.
– Et là ?
– Non plus. Mais c’est tout à côté.
– Alors, dit Timoléon dont le visage s’épanouit tout à coup, ce doit être là…
Et il fit une nouvelle marque.
– Justement, répondit Philippette.
– Est-ce que tu n’as pas vu un trou dans la roche, tout au fond ?
– Je n’ai pas regardé.
– Mais tu y as couché trois nuits de suite pourtant ?
– Oui.
– Et tu n’as entendu aucun bruit ?
– Aucun.
– C’est drôle, dit Timoléon. J’aurais parié que tu avais entendu des cris de femme appelant au secours.
– D’où venaient ces cris ?
– De dessous terre.
– Je n’ai rien entendu, répéta Philippette. Après ça, la nuit, je suis un peu lasse.
– Et un peu saoûle aussi…
– Je ne dis pas non, patron.
– Ça fait que tu dors bien.
– Comme vous dites.
– Mais, dit Timoléon, si tu veux que nous fassions affaire, il ne faut pas boire.
– De longtemps ?
– Non, de deux jours.
– C’est long, soupira Philippette.
– Mais il y a une dizaine de jaunets au bout.
– C’est bon, on boira de l’eau. Qu’est-ce qu’il faut faire ?
Timoléon tenait toujours son morceau de craie à la main.
– Tiens, dit-il, regarde bien.
– Bon !
– Là, il doit y avoir un mur et un jardin abandonné.
– Oui, c’est, ma foi, vrai…
– Et dans ce jardin un puits couvert de planches.
– Je le vois d’ici.
– Entre ce puits et la carrière où tu as couché, il y a une autre carrière qu’on a comblée par en haut, mais elle est toujours creuse en dessous.
On y arrive par le puits. Seulement, entre le puits et la carrière il y a une porte qui ferme à clé.
Philippette écoutait avec une grande attention ; la promesse des dix jaunets l’avait mise en belle humeur et stimulait sa perspicacité.
– Dans cette carrière il y a une crevasse ; cette crevasse se continue par un boyau souterrain jusqu’à la carrière où tu as couché.
En cherchant bien, tu trouveras un trou large comme la main.
– Bon !
– Ni une femme ni un homme n’y pourraient passer, et le rocher est assez dur pour que deux journées de carrier, avec de bons pics, ne suffisent pas à l’élargir.
Philippette écoutait toujours.
– Dans la carrière qui ferme par une porte j’ai enfermé une femme.
– Ah !
– Cette femme doit crier, certainement, tu l’entendras.
– Et je ne dirai rien ?
– Au contraire, tu quitteras ta carrière, tu t’en iras au puits et tu descendras dedans. La porte est fermée et ce n’est pas toi qui aurais la force de l’enfoncer.
– Alors, à quoi ça sert ce que vous me commandez ? observa judicieusement Philippette.
– Mais tu essayeras de l’ébranler.
– Bon !
– Et la femme enfermée, qui a les bras et les jambes attachées, se réclamera de toi, elle te donnera peut-être une commission… celle d’aller chercher quelqu’un qui s’intéresse à elle et qui demeure rue Saint-Lazare.
– Et j’irai ? dit Philippette.
– Certainement.
– Mais je viendrai vous le dire ?
– Pas ici, mais demain, au coin de la rue, vers sept heures du matin.
– Et puis ?
– Et puis tu iras faire ta commission.
– Voilà tout ?
– Sans doute.
– Pourtant c’est vous qui avez enfermé cette femme ?
– Oui.
– Et vous voulez qu’un autre la délivre ?
– Naturellement.
– C’est drôle fit la vieille bohémienne, je ne comprends pas.
– Tu n’as pas besoin de comprendre, répondit Timoléon.
Et il congédia Philippette.
Puis après le départ de la vieille femme, il murmura :
– Je pourrais bien tenir Rocambole d’ici à trente-six heures.
XLIV
C’était donc, on l’a deviné, le visage de Philippette sur lequel le brasier qu’elle attisait au fond de la carrière, reflétait sa lueur rougeâtre.
Philippette avait tenu parole à Timoléon, elle n’avait bu que de l’eau toute la journée, par conséquent, en se rendant aux Carrières de Pantin, elle était maîtresse de toutes ses facultés.
Philippette avait été une fille de plaisir dans sa jeunesse ; une femme de confiance dans son âge mûr ; elle était voleuse, faute de mieux, sur ses derniers jours.
Au temps où il était une des puissances mystérieuses de Paris, c’est-à-dire à l’époque où employé par la police, il avait la haute main sur les voleurs, Timoléon n’avait jamais eu de serviteur plus dévoué que cette femme.
À la guerre acharnée que la police fait aux voleurs, on pourrait croire qu’elle n’a pas de plus ardents ennemis.
C’est une erreur.
Les voleurs, les impures, tous ces gens sans aveu qui vivent de honte et de brigandage n’ont qu’une ambition : servir tôt ou tard la police.
Il y avait longtemps que Timoléon n’avait employé Philippette.
C’était une raison pour qu’elle le servît avec d’autant plus de dévouement.
Elle ne savait rien de ses malheurs ; elle ignorait que Rocambole l’eût réduit au désespoir et que l’autorité l’eût repoussé.
Avoir trouvé Timoléon dans un logement de la rue du Vert-Bois transformé en bureau de placement, c’était pour elle la preuve qu’il était toujours à la recherche des voleurs qui s’amendaient.
Philippette était saturée de prison ; elle y passait huit mois sur douze, car on ne se donnait plus la peine de la juger, on la condamnait administrativement, ce qui était plus simple, tantôt à deux mois, tantôt à trois mois, quelquefois seulement à quinze jours ou six semaines.
Or, Timoléon avait besoin d’elle et la faisait travailler.
C’était du pain d’abord, et l’implicite assurance qu’elle n’irait pas en prison de longtemps.
Cela ainsi posé, Philippette aurait trahi le diable plutôt que de désobéir à Timoléon.
C’était pour cela qu’elle n’avait pas bu, de façon à être maîtresse de toutes ses facultés.
Cette femme avait été fort intelligente ; elle l’était même encore quand la boisson ne l’abrutissait pas. Aussi elle avait parfaitement compris le plan topographique exécuté sur le carreau avec un morceau de craie par Timoléon.
Elle se rendait un compte exact de la situation du trou percé dans le rocher, du boyau souterrain creusé, entre les deux carrières, soit par la nature, soit par la main des hommes, et de la possibilité, pour elle d’entendre les cris de désespoir de la femme plongée dans ce sépulcre vivant.
En venant prendre possession de cet asile abandonné où, depuis trois jours, elle avait passé la nuit, Philippette avait passé auprès du mur en ruines, du puits couvert de planches, et du jardin abandonné.
En arrivant dans la carrière, elle s’attendait donc à entendre des hurlements et des cris.
Elle n’entendit rien.
D’ailleurs, la nuit était venue, l’obscurité la plus profonde régnait dans la carrière avant qu’elle n’eût songé à déterrer quelques tisons éteints.
Vanda, immobile, de l’autre côté du trou, retenait son haleine, tandis que Philippette attisait le feu.
Cette femme ne lui était pas inconnue.
Où l’avait-elle vue ? voilà ce dont il lui était difficile de se souvenir.
Les haillons qui couvraient Philippette faisaient, du reste, mal à voir.
Après avoir un moment hésité, Vanda résolut de se confier à elle.
Elle se mit d’abord à tousser.
Au bruit, Philippette tressaillit et leva la tête.
– Il y a donc quelqu’un là ? dit-elle avec un étonnement qui n’était pas exempt d’effroi.
– Oui, répondit Vanda, il y a une pauvre femme qui meurt de faim.
Philippette prit un des tisons enflammés pour s’en faire une torche et s’approcha du trou.
La torche improvisée éclaira le visage de Vanda.
– Qui êtes-vous donc ? répéta Philippette.
– Je vous l’ai dit, une femme qui est prisonnière et qui meurt de faim.
En même temps, Vanda regardait Philippette de ce grand air mélancolique et dominateur qui avait, comme celui de Rocambole, une certaine puissance magnétique.
Philippette était de sang-froid.
Dans ces moments-là, elle comprenait vite et bien.
Il y eut une chose qui ne fit pas l’ombre d’un doute pour elle : la femme qu’elle apercevait de l’autre côté de la fissure du roc était celle que Timoléon avait garrottée dans la carrière et qui était parvenue à briser ses liens.
Cela était même d’autant plus admissible que Vanda avait passé la main hors du trou et qu’une marque bleuâtre qui cerclait ses poignets, indiquait la trace des cordes.
Et Philippette prit un air de plus en plus étonné et naïf, et dit à Vanda :
– Mais comment donc êtes-vous là-dedans ? Vous n’avez jamais pu passer par là ?
– Non, dit Vanda. On m’a enfermée dans une autre carrière pleine de rats. Les rats ont rongé les cordes qui m’attachaient et m’ont rendu la liberté de mes mouvements.
Alors, à force de chercher, j’ai trouvé une ouverture qui arrivait jusqu’ici. J’espérais pouvoir sortir. Mais, comme vous le dites, le trou est trop petit.
– Mais qui donc vous a enfermée, ma petite ?
– Des gens qui m’en veulent.
– Mais quel était leur plan ?
– De me laisser mourir de faim.
– Pauvre petite !
Philippette avait une croûte de pain dans sa poche ; elle la prit et la tendit à Vanda.
– Vous ne mourrez toujours pas cette nuit, dit-elle. Mais est-ce qu’il n’y a pas moyen de vous délivrer ?
– Vous êtes vieille, dit Vanda, et vous n’en auriez jamais la force, à vous toute seule, car la carrière où l’on m’a enfermée a une porte massive et garnie d’une grosse serrure. Mais si vous vouliez aller chercher mon homme ?
– Ah ! vous avez un homme ?
– Oui, qui est riche, et qui vous donnera assez d’or pour vous mettre à l’abri du besoin le reste de vos jours.
Philippette tressaillit.
En même temps, un souvenir traversa l’esprit de Vanda.
Elle était encore couverte des vêtements qu’elle avait lorsque Timoléon l’avait enlevée.
On ne l’avait pas fouillée et elle devait avoir dans sa poche un petit portefeuille renfermant quelques pièces d’or.
Philippette murmurait avec un instinct cupide :
– Ah ! on me donnera beaucoup d’or ?
– Oui, répondit Vanda, qui venait de retrouver le portefeuille.
XLV
Philippette ouvrait des yeux avides.
Vanda ouvrit le portefeuille et fit luire tout à coup trois pièces d’or aux regards de la vieille femme.
Philippette étendit vivement la main.
Mais Vanda se rejeta lestement en arrière, hors de toute atteinte, en disant :
– Oh ! tout à l’heure !
Vanda était redevenue Vanda, c’est-à-dire la femme pleine de patience, de sang-froid et de lucidité qui avait coutume de ne rien donner au hasard.
Elle avait lu dans les yeux de Philippette une telle avidité qu’elle comprit qu’il serait dangereux de payer cette femme d’avance.
– Écoutez-moi bien, dit-elle.
– Parlez, dit Philippette qui oubliait, en ce moment, les recommandations de Timoléon.
– Vous voyez que je ne suis pas une mendiante, mais que j’ai de l’or.
– Certainement, dit Philippette.
– Mon homme est riche à millions.
– Vrai de vrai ?
– Il vous donnera cinquante louis, aussitôt qu’il m’aura délivrée.
– Cinquante louis, dit Philippette suffoquée.
– Deux cents même, ajouta Vanda.
Philippette ne songeait plus à Timoléon, un cuistre qui avait promis dix louis.
– Voyons, ma petite, dit-elle, où est votre homme ? Car vous voulez sans doute que j’aille le chercher ?
– Oui.
– Où est-il ?
– Dans Paris, rue Saint-Lazare, n° 52.
– Comment s’appelle-t-il ?
– C’est un Russe, le major Avatar.
– Un drôle de nom ; si j’allais ne pas me le rappeler ?
Vanda arracha un feuillet du carnet et dit à Philippette :
– Reprenez votre tison et éclairez-moi.
Elle traça au crayon le nom d’Avatar et les mots de rue Saint-Lazare, 52, sur la feuille déchirée.
Puis, au-dessous, elle écrivit en russe :
« Suis cette femme. »
– Tenez ! dit-elle à Philippette en lui tendant le morceau de papier, allez vite !
– Mais…, observa Philippette, s’il n’y est pas ?
– Il y aura sans doute un domestique, un grand et gros homme un peu vieux…
– Ah !
– Qui saura où il est et qui vous conduira.
– C’est bon, dit Philippette, j’y vais.
Puis, rejetant le tison et tendant de nouveau la main :
– Vous ne me donnez pas un de ces jaunets-là ?
– Non, dit Vanda.
– Pourquoi ?
– Parce que vous le dépenseriez en route chez tous les marchands de vin et que vous seriez ivre quand vous arriveriez chez mon homme.
– Ça, c’est possible ! dit naïvement Philippette.
– Quand vous reviendrez, répondit Vanda, je vous donnerai tout ce que j’ai sur moi, en dehors de ce que vous donnera mon homme.
– Ça va, dit Philippette qui prit son parti.
Elle avait même, en parlant ainsi, un accent de franchise qui ne laissa pas le moindre doute à Vanda.
Puis elle s’empara du papier et dit encore :
– Je ne fais que les deux chemins.
– Quelle heure est-il, maintenant ? demanda Vanda.
– Approchant onze heures du soir.
Vanda respira.
On ne lui avait pas apporté à manger.
On ne viendrait sans doute pas maintenant.
Car si Timoléon, la Chivotte et le Pâtissier venaient comme la veille, il était présumable que s’apercevant de sa disparition, ils la chercheraient et finiraient par trouver le boyau souterrain dans lequel elle s’était réfugiée.
Et Philippette partie, Vanda se reprit à espérer et elle attendit.
* *
*
Cependant, Philippette était hors de la carrière.
Un moment grisée par la vue des pièces d’or et les mirifiques promesses de Vanda, elle ne se fut pas plutôt exposée au froid humide et vif de la nuit, que le sang-froid lui revint, en même temps que le souvenir de Timoléon.
Qu’allait-elle faire ?
Timoléon lui avait dit :
– Je t’attends demain matin, au point du jour, au coin des rues Saint-Martin et du Vert-Bois et tu auras dix louis.
Vanda, de son côté, venait de lui dire :
– Courez chez mon homme, rue Saint-Lazare, il y a deux cents louis pour vous.
C’était à ne pas hésiter, en présence d’une semblable disproportion.
Cependant, Philippette hésita.
Timoléon représentait toujours à ses yeux la police.
La police toute puissante qui pouvait la renvoyer à Saint-Lazare et même confisquer les deux cents louis avant qu’elle eût le temps de les mettre à l’ombre, comme disent les voleurs.
Et Philippette, au bout d’une centaine de pas, s’arrêta tout net et prit sa tête à deux mains, murmurant :
– C’est joliment embarrassant, tout de même.
Mais, comme elle disait cela à mi-voix, une ombre noire s’agita auprès d’elle.
Philippette fit un pas en arrière.
L’ombre fit un pas en avant.
Puis une voix fit tressaillir la vieille :
– Hé ! Philippette ?
C’était la voix de Timoléon.
L’ombre noire s’approcha, éclairée par un point lumineux.
C’était bien Timoléon, et Timoléon qui fumait.
Philippette eut peur.
– Ah ! dit-elle, vous avez donc craint que je mange le morceau ?
En argot, manger le morceau signifie trahir.
– Non, dit Timoléon, mais il m’est arrivé une chose sur laquelle je ne comptais pas et qui m’a permis de sortir. Alors, je suis venu flâner par ici. Eh bien ! as-tu entendu crier ?
– J’ai entendu mieux que ça.
– Quoi donc ?
– La petite m’a parlé.
– Ah !
– Et je l’ai vue.
– C’est impossible. Tu n’as pas pu passer par le trou.
– Non, mais elle est venue jusqu’au trou.
– Elle !
– Oui, il paraît que les rats ont rongé ses cordes.
– Eh bien ? dit Timoléon qui fronça un moment le sourcil.
– Elle m’a promis beaucoup d’argent si je la délivrais.
– Ah !
– Deux cents louis.
Timoléon changea subitement d’attitude.
– Ça va, dit-il, nous partagerons.
– Plaît-il ? réclama Philippette étonnée.
– Je n’en avais que trente pour la faire enfermer. C’est vingt louis de bénéfice.
Philippette crut comprendre.
– Alors, dit-elle, il faut y aller ?
– Où ça ?
– Prévenir son homme, donc, rue Saint-Lazare, 52. J’ai un billet pour lui.
Et elle montrait le papier sur lequel Vanda avait tracé trois mots au crayon.
– Voyons ça ? dit Timoléon.
Il prit le papier et se fit une lanterne de son cigare qu’il aspira fortement, à un pouce au-dessus, après en avoir secoué la cendre.
XLVI
Comment Timoléon, qui ne devait pas quitter sir James évanoui, se trouvait-il à cette heure auprès des Carrières de Pantin ?
S’était-il défié de Philippette, ou bien un événement inattendu était-il survenu ?
Cette dernière supposition était la plus admissible, car Timoléon ne s’était pas aventuré à se confier à Philippette sans connaître la vieille femme de longue date.
L’événement inattendu, c’était sir James revenant brusquement à la vie et rouvrant les yeux.
Cela s’était passé il y avait environ deux heures.
Pendant toute la journée, Timoléon s’était enfermé rue du Vert-Bois, ouvrant à chaque instant les rideaux du lit pour jeter un regard furtif sur l’Anglais, qui avait toujours l’aspect d’un cadavre.
Cependant, en faisant appel à ses souvenirs, Timoléon se disait qu’Antoinette Miller, laquelle avait certainement été endormie par le même procédé, ne s’était réveillée qu’au bout de trois jours.
Or, en bien calculant, Timoléon ne trouvait encore que trente-six heures.
Mais il pouvait se faire aussi que l’organisation d’un homme étant toujours plus robuste que celle d’une femme, la catalepsie durât moins longtemps chez lui.
Timoléon se disait tout cela, lorsque, tout à coup, il entendit un léger soupir.
La chambre n’était éclairée que faiblement par une chandelle posée sur la table de nuit.
Timoléon tressaillit et se pencha sur sir James.
Les lèvres serrées jusqu’alors de l’Anglais s’étaient brusquement ouvertes.
Il posa la main sur le cœur.
Le cœur commençait à fournir quelques pulsations.
La vie revenait.
Timoléon n’hésita plus.
Il versa quelques gouttes de vinaigre dans la soucoupe d’une tasse, y trempa le coin de son mouchoir et se mit en devoir de frotter les tempes de sir James, et après les tempes, les lèvres, et ensuite les paupières.
En même temps, il se débarrassait en un tour de main de sa perruque blanche, de son crâne ridé et se refaisait la tête qu’il avait l’avant-veille, lorsqu’il s’était présenté à l’hôtel des Champs-Élysées.
Sir James rouvrit les yeux et le regarda.
Timoléon s’attendait à une scène d’étonnement, précédant la scène obligée de reconnaissance.
Il n’en fut rien.
En même temps qu’il ouvrait les yeux, sir James souriait.
– Je sais qui vous êtes, dit-il, je vous ai reconnu à la voix.
Timoléon, stupéfait, fit un pas en arrière.
Sir James poursuivit :
– À partir du moment où je suis tombé en catalepsie, un sens unique m’est resté, l’ouïe.
J’ai tout entendu.
– En vérité ! exclama Timoléon.
– Par conséquent, poursuivit sir James, je sais tout ce qui s’est passé, j’ai entendu causer Vanda et Rocambole.
Puis, j’ai compris que ce dernier m’emportait, et la conversation avec Milon, dans le fiacre, est restée gravée dans ma mémoire.
Je sais encore que la rue où nous sommes est la rue du Vert-Bois ; que dans cette maison se trouvent Gipsy et un jeune homme appelé Marmouset.
Je sais, de plus, qu’on m’avait déposé dans un puits et que c’est vous qui m’en avez tiré.
Tandis que mon corps était complètement privé de sentiment, mon âme vivait et réfléchissait.
L’étonnement de Timoléon allait croissant.
Sir James, encore engourdi, parvint cependant à se mettre sur son séant.
– Maintenant, dit-il, causons, j’ai entendu une conversation avec une femme que vous appelez Philippette, n’est-ce pas ?
– Oui.
– De cette conversation, il résulte pour moi, continua sir James avec un sang-froid imperturbable, que Vanda est en votre pouvoir.
– C’est la vérité, dit Timoléon.
– Que comptez-vous en faire ?
– M’en servir pour attirer Rocambole dans un piège.
– Ah !
– Et, par conséquent, les faire périr tous les deux.
– Quand ?
– J’attendrai que vous soyez revenu à vous pour cela.
– Fort bien, dit sir James avec un calme féroce. Alors, c’est que vous avez besoin de moi.
– Pas précisément.
– Ou bien désirez-vous me faire vos conditions ?
Et sir James eut un sourire.
– Mylord, répondit Timoléon, je vous ai dit, il y a deux jours, que je m’estimerais assez récompensé, le jour où Rocambole serait mort. Cependant, je suis vieux et misérable, et si vous voulez assurer du pain à ma vieillesse…
– Quelle somme voulez-vous ?
– Une centaine de mille francs.
– Vous les aurez, dit sir James. Est-ce tout ?
– Vous donnerez ce que vous voudrez ensuite à ceux qui m’ont servi.
– Ils fixeront eux-mêmes la somme dont ils ont besoin. Est-ce tout ?
– Attendez, dit Timoléon. Puisque vous avez, me paraissant privé de vie, entendu tout ce qui se passait autour de vous, vous devez comprendre que la maison dans laquelle nous sommes est pleine de nos ennemis.
– Oui.
– Aussi est-il nécessaire de nous tenir tranquilles, et de ne pas bouger jusqu’à ce que nous soyons débarrassés de Rocambole.
– Naturellement, dit sir James.
– La crainte que le contraire n’arrivât m’a fait rester auprès de vous. Mais, à présent, il est temps d’agir.
– Je le pense aussi, dit sir James.
Un coup de sifflet se fit entendre de l’autre côté de la rue.
– Ah ! ah ! fit Timoléon, voici le Pâtissier.
– L’homme à qui vous avez donné rendez-vous pour ce soir ?
– Oui.
– Expliquez-moi donc une chose ? demanda sir James.
– Laquelle ?
– Pourquoi lui avez-vous demandé un baril de poudre ?
– Mais, dit froidement Timoléon, pour envoyer Rocambole et Vanda dans les airs.
Et il remit sa perruque blanche et son crâne dénudé, ajoutant :
– Je crois que je ferais tout aussi bien d’aller à la rencontre du Pâtissier.
– Comme il vous plaira, dit sir James. Vous êtes un trop habile homme pour qu’on ne vous laisse pas obéir à vos inspirations.
LES MILLIONS DE LA
BOHÉMIENNE
I
Revenons à Rocambole, qui fut fort surpris, en arrivant à l’hôtel des Champs-Élysées, de n’y plus retrouver Vanda.
Que pouvait-elle être devenue ?
Les domestiques, qu’il interrogea, lui firent tous la même réponse : on leur avait donné congé, ils étaient sortis et à leur retour, ils n’avaient plus trouvé ni leur maître, ni Vanda.
Rocambole leur dit ensuite :
– Je suis l’ami intime de sir James Nively, votre maître, et je suis tout aussi inquiet que vous de sa disparition.
Par conséquent, comme il faut le retrouver, lui et la dame qui se trouvait ici, vous allez m’obéir.
Les domestiques ne virent aucun inconvénient à cela.
Rocambole poursuivit :
– J’ai de graves soupçons, et pour mener à bien le résultat que je me propose, il est de toute utilité que dans le quartier on ne sache rien de ce qui s’est passé ici.
Les domestiques promirent tout ce que demandait Rocambole.
Celui-ci s’installa dans l’hôtel et attendit.
Un quart d’heure après, Milon arriva.
Rocambole avait retrouvé son impassibilité ordinaire et il se borna à dire à Milon :
– Je crois que, au moment où nous nous croyions les plus forts, nous avons été battus.
Milon ouvrit de grands yeux.
– Où est Vanda ? reprit Rocambole.
– Mais… elle doit être ici…
– Non. On ne l’a pas vue depuis cette nuit.
Milon eut un geste d’inquiétude.
– Inutile de te dire, reprit Rocambole, qu’elle a été enlevée.
– Enlevée !
– Oui. Par qui ? C’est ce que nous chercherons tout à l’heure. En attendant, suis-moi.
Et il entraîna Milon dans le boudoir de Vanda, – cette même pièce où sir James était tombé évanoui durant la nuit.
– Regarde, dit Rocambole. Ne vois-tu pas les traces d’une lutte ? Le parquet garde l’empreinte de pieds boueux.
– C’est vrai, dit Milon.
– On a enlevé Vanda, reprit Rocambole, ceci est certain.
À la porte extérieure se trouvent les mêmes empreintes.
Dans la rue, j’ai remarqué le train d’une voiture à quatre roues qui devait être attelée de deux petits chevaux ; j’en conclus que cette voiture était un fiacre.
On a dû garrotter et bâillonner Vanda pour l’emporter.
Le fiacre a ensuite servi à l’enlèvement.
– Ce n’est toujours pas l’Anglais qui a fait le coup ? observa Milon.
– Ça ne peut être lui, dit Rocambole, mais, il a des gens à ses ordres, et ces gens ont peut-être exécuté un plan formé à l’avance.
– Alors, dit Milon, comment se faisait-il que l’Anglais, après avoir donné des ordres, ait voulu ne pas en attendre l’exécution en tuant Vanda ?
Cette observation était d’une logique rigoureuse et frappa Rocambole.
– Cependant, dit-il, les gens qui ont pénétré ici pour s’emparer de Vanda devaient être de connivence avec sir James. Car, sans cela, comment seraient-ils entrés ?
– Mais, répondit Milon, si cela était, maître, il faudrait supposer que c’est sir James qui leur a ouvert.
– Oui.
– Alors pourquoi ne sont-ils pas venus au secours de sir James quand nous l’avons enlevé ?
– C’est juste, murmura Rocambole, qui donc soupçonner alors ?
– Cet Allemand.
– Le major Hoff ?
– Oui.
Rocambole parut réfléchir un moment.
– Si ce que tu dis là est vrai, fit-il, cet homme n’a point agi tout seul.
– C’est probable.
– Il y a une femme dans son jeu, et cette femme, c’est justement milady.
– Naturellement, dit Milon.
– Or, milady va venir ici.
– Naturellement, répéta Milon, puisque sir James lui a donné rendez-vous.
Comme Milon parlait ainsi, la cloche de la grille se fit entendre.
Rocambole s’approcha d’une croisée et aperçut un petit coupé brun qui stationnait devant l’hôtel.
Une femme en descendit et entra dans la cour d’un pas rapide.
Bien qu’elle eût un voile épais sur le visage, Rocambole la reconnut sur-le-champ.
C’était milady.
Et il courut au vestibule et dit au valet de chambre :
– Introduis cette dame au salon et prie-la d’attendre.
Le laquais suivit les instructions à la lettre.
Milady, qui s’attendait à être reçue par sir James Nively, le représentant du terrible Ali-Remjeh, pénétra dans le salon sans défiance.
À peine était-elle assise que Rocambole entra.
Milady étouffa un cri de surprise en le voyant, car elle avait, sur-le-champ, reconnu en lui le personnage qui s’était dit l’ami de Lucien et avait annoncé la veille à Marie Berthoud le duel du jeune homme avec le marquis de Rouquerolles.
– Comment ! dit-elle, vous ici, monsieur ?
– Oui, milady.
– Vous connaissez donc sir James Nively ?
– C’est-à-dire qu’il m’a chargé de vous recevoir.
– Moi ?
Et milady eut comme un geste d’effroi.
Mais elle eut bientôt repris son calme et son impassibilité ordinaires.
– Sans doute, monsieur, dit-elle, sir James, forcé de sortir, vous a chargé de me prier d’attendre ?
– Pas précisément, milady.
Elle prit un air étonné.
– Je ne vous comprends pas, dit-elle.
– Milady, reprit Rocambole en la regardant fixement, sir James Nively n’est plus ici, il a dû partir ce matin pour Londres.
– Alors, dit-elle, je n’ai plus qu’à me retirer.
– Pardon ! fit Rocambole, j’ai les pouvoirs de sir James et qui mieux est, ceux d’Ali-Remjeh.
À ce dernier nom, milady tressaillit et se leva vivement.
– Qu’avez-vous dit ? fit-elle avec une émotion subite.
– J’ai dit que j’avais les pouvoirs d’Ali-Remjeh.
Milady le regardait avec une sorte d’étonnement.
– Cela ne doit pourtant pas vous étonner, reprit Rocambole, que le chef des Étrangleurs de l’Inde ait des représentants partout.
– Comment vous nommez-vous donc ? demanda-t-elle.
– Je suis le major Avatar…
Ce nom résonnait pour la première fois aux oreilles de milady et ne lui apprit rien.
Rocambole poursuivit :
– Milady, je vais en deux mots vous faire comprendre que je suis initié à tous vos secrets.
Elle continuait à le regarder avec inquiétude.
– Ali-Remjeh est le père de votre fils, continua Rocambole.
– Après ? fit-elle.
– Vous avez trempé vos mains dans le sang de votre père.
Elle devint livide.
– Après ? dit-elle encore.
– Maintenant, poursuivit Rocambole, il y a entre Ali-Remjeh et vous une communauté de secrets telle que vous devez lui obéir.
– Qu’ordonne-t-il ? demanda-t-elle avec soumission.
– Je vous le dirai dans trois jours.
– Ah !
– Hier on vous a permis de voir votre fils.
– Oui.
– Et vous l’avez vu ?…
– Si je l’ai vu ! s’écria-t-elle avec un subit enthousiasme.
– Dans trois jours, à pareille heure, vous me trouverez chez lui, et là, vous saurez ce que veut Ali-Remjeh.
En même temps, Rocambole eut un geste qui voulait dire :
– Pour aujourd’hui, notre entrevue est terminée.
Milady se leva et fit un pas de retraite.
II
Le major Avatar reconduisit la mère de Lucien avec les marques du plus profond respect.
Seulement, comme ils traversaient la cour, il lui dit :
– Un mot encore, milady ?
– Je vous écoute, monsieur.
– Pour Paris entier, je ne suis que le major Avatar, et pour votre fils, je suis l’homme qui lui a servi de témoin.
– Eh bien ?
– Si vous ne voulez pas qu’il arrive malheur à votre fils, milady, vous vous tairez sur notre entrevue.
– Oh ! dit milady, la recommandation est inutile. Mon fils ne doit pas savoir…
– Ce n’est pas seulement pour votre fils que je parle, dit Rocambole.
– Pour qui donc encore ?
– Pour Franz.
Ce nom fit monter le rouge au visage de milady.
– Vous savez encore cela ? fit-elle.
– Je sais tout, dit-il avec calme, ainsi prenez garde !
Et il lui offrit la main pour remonter en voiture.
Milady partie, Rocambole rejoignit Milon qu’il avait laissé dans le boudoir de Vanda.
– Eh bien ? fit celui-ci avec anxiété.
– Cette femme croyait trouver ici sir James.
– Bon !
– Et elle ne sait même pas que Vanda existe.
– Alors ce n’est ni elle ni ses complices qui ont fait le coup ?
– J’en suis convaincu.
Et Rocambole, rêveur, prit sa tête à deux mains.
– Maître, dit Milon, Wasilika est morte, sir James est en notre pouvoir… Si quelqu’un a pu enlever Vanda…
– Eh bien ?
– Ce ne peut être que Timoléon.
Ce mot fit tressaillir Rocambole des pieds à la tête.
– Oh ! fit-il, quel nom as-tu donc prononcé là ?
– Lui seul peut vous en vouloir…
– Soit. Mais il n’est pas en France.
– Qui sait ?
– Et alors même qu’il y serait, comment aurait-il pu retrouver la trace de Vanda ?
– Vanda ne vous a-t-elle pas dit, la nuit dernière, que sir James avait voulu la tuer ?
– Sans doute.
– Qui donc aurait pu avertir sir James de la trahison de Vanda dont, ce matin encore, il était éperdûment amoureux ?
Un éclair terrible passa dans les yeux de Rocambole.
– Ah ! dit-il, malheur à lui s’il a osé de nouveau se mêler de mes affaires !
Milon secoua la tête.
– Maître, dit-il, je crois que Timoléon ne vous craint plus.
– Pourquoi ?
– Parce qu’il n’a plus rien à perdre dans la dernière partie qu’il jouera avec vous.
– Que veux-tu dire ?
– Sa fille est morte.
Rocambole fit un pas en arrière.
– Es-tu sûr de cela ? dit-il, et si tu en es sûr comment le sais-tu ?
– Je l’ai appris durant notre séjour à Londres.
Rocambole retomba un moment dans sa rêverie.
Milon l’en arracha par ces mots :
– Si c’est lui, dit-il, nous n’avons pas un moment à perdre.
– Tu crois ?
– Peut-être a-t-il assassiné Vanda.
Quelques gouttes de sueur perlèrent au front de Rocambole.
– Il faut la retrouver… il faut retrouver Timoléon, dit encore Milon.
– Il faut attendre ici d’abord, dit froidement Rocambole.
– Ici !
– Sans doute il avait une clé pour s’introduire dans l’hôtel, et il ignore la disparition de sir James.
– Vous croyez ?
– Alors il reviendra, dans l’espérance de le trouver.
– Vous avez raison, dit Milon, mais si, pendant ce temps…
Et la voix de Milon tremblait.
– Tu vas rester ici, dit Rocambole.
– Et vous, maître ?
– Moi je vais tâcher de retrouver la piste de Vanda.
* *
*
La police, si clairvoyante qu’elle soit, échoue quelquefois dans ses investigations, lorsqu’elle manque de point de départ.
Rocambole était certainement aussi habile que la plus habile police du monde ; et nous l’avons vu à l’œuvre bien souvent.
Mais, cette fois, le point de départ lui manquait.
Milon avait bien parlé de Timoléon, mais ce n’était qu’une prévention et non une certitude.
Évidemment si on avait enlevé Vanda, rien ne prouvait que Timoléon fût l’auteur de cet enlèvement.
Il fallait donc prendre garde de s’égarer dans des investigations aussi longues qu’infructueuses, or, l’unique route à suivre, c’était la recherche de ce fil conducteur qui répondait au nom de Vanda.
Les roues du fiacre avaient tourné sur elles-mêmes devant l’hôtel.
La voiture avait dû regagner le rond-point des Champs-Élysées.
Rocambole s’adressa à un commissionnaire qui stationnait au coin de l’avenue Gabrielle.
Le commissionnaire prétendit que la nuit précédente, en effet, vers minuit et demi, comme il sortait de chez un marchand de vin, il avait vu un fiacre arrêté au milieu de l’avenue Marignan ; que, peu après, ce fiacre avait passé auprès de lui et qu’il avait entendu un homme assis à côté du cocher lui dire :
– Nous allons à Romainville. Tu prendras par les boulevards extérieurs.
Mais le commissionnaire n’avait pas songé à regarder dans l’intérieur du fiacre.
Ce renseignement était trop vague pour que Rocambole pût en tirer parti.
Comme il s’éloignait, le commissionnaire le rappela et lui dit :
– Je crois bien que les lanternes étaient rouges, et que les deux chevaux étaient dépareillés. Il y en avait un noir et un alezan.
Ces deux couleurs sont assez communes parmi les chevaux de fiacre.
Néanmoins Rocambole dit :
– On a dû prendre la voiture à l’une des stations voisines ; cherchons…
Il y a une place de voitures en haut des Champs-Élysées.
Rocambole se dirigea vers ce point.
La voiture qui se trouvait en tête était justement attelée de deux chevaux en tout semblables à ceux que le commissionnaire avait dépeints.
Rocambole remarqua qu’on avait lavé la voiture le matin, mais tellement à la hâte que le dessous de la caisse était encore maculé par places d’une boue jaune et blanche qui n’était pas la boue des rues de Paris.
Cette voiture avait dû faire une excursion nocturne dans les champs et passer, auparavant, dans un de ces ruisseaux où vont se déverser les eaux noirâtres des fabriques dont la Villette, Belleville et Ménilmontant sont couverts.
Rocambole ouvrit la portière et le cocher qui sommeillait sur son siège s’éveilla.
– À l’heure, dit Rocambole.
– Où allons-nous, mon bourgeois ? demanda le cocher d’un air de mauvaise humeur.
Rocambole le regarda sévèrement de cet œil investigateur que possèdent seuls les agents de police.
– Nous allons à la préfecture, répondit-il.
Le cocher fit un mouvement de surprise désagréable.
– Eh bien ! dit Rocambole, est-ce que les chevaux dorment aussi ?
Le cocher prit les rênes et fit claquer son fouet.
Le fiacre partit.
Comme il descendait les Champs-Élysées encore déserts, Rocambole baissa la glace de devant et tira le cocher par le pan de son pardessus.
Celui-ci se retourna :
– Nous allons à la préfecture, dit Rocambole, et la course pourrait bien être plus longue que tu ne penses.
– Pourquoi donc ça ? fit le cocher.
– Tu ferais peut-être mieux de me conduire tout de suite à Romainville.
À ce mot, le cocher ne put pas être maître d’un mouvement de surprise et même d’effroi.
– Bon ! dit Rocambole, je vois que tu m’as compris. Arrête un moment !
Et comme le fiacre s’arrêtait, Rocambole ouvrit la portière, descendit et monta à côté du cocher en lui disant :
– Nous allons causer un brin, mon camarade !
Le cocher était si ému que son attitude embarrassée avait sur-le-champ confirmé tous les soupçons de Rocambole.
Celui-ci ajouta, en tirant un cigare de sa poche :
– J’aime à fumer au grand air, marche !
III
De tous les hommes soumis directement à l’autorité de la préfecture de police, le cocher de fiacre ou de remise est le plus tremblant, peut-être parce qu’il est le plus souvent en défaut.
Les faits-divers des grands journaux rapportent à chaque instant l’histoire d’un honnête cocher qui rapporte trente mille francs trouvés dans sa voiture ; mais ils ne disent pas assez combien ce serviteur du public est grossier à ses heures, insolent, narquois, brutal, quand il se croit assuré de l’impunité.
Le cocher qui renverse un piéton fouette son cheval à tour de bras et se sauve.
Le cocher mécontent d’un mince pourboire épuise le vocabulaire des injures.
Aussi cette gent mal famée a-t-elle grand’peur de la police.
Celui à côté duquel venait de monter Rocambole crut voir en lui un haut représentant de l’autorité.
Aussi ne chercha-t-il point à s’insurger contre la prétention de notre héros de monter à côté de lui.
Rocambole lui dit :
– Tu n’as pas besoin d’aller trop vite. Si je ne te conduis qu’à la préfecture, nous avons le temps.
Dans le cas contraire, nous rattraperons le temps perdu.
Cependant le cocher essaya de payer d’audace.
– Vous êtes un drôle de bourgeois tout de même, dit-il.
– Tu crois ?
– Dame ! Vous ne savez pas bien où vous voulez aller.
– Cela dépend de moi.
– Faut croire, dit encore le cocher, que vous voulez prendre l’air, ce matin, et fumer votre cigare.
– D’abord.
– Et que ça vous est égal, l’endroit où l’on va.
Mais Rocambole arrêta sur lui un regard calme et froid :
– Mon bonhomme, dit-il, ce n’est pas la peine de jouer au fin avec moi et tu perds ton temps. En deux mots, je vais te mettre au courant.
– Voyons ? dit le cocher de fiacre.
– Si je te mène à la préfecture, tu y resteras, jusqu’à ce que ton affaire soit éclaircie.
– Mais, dit le cocher avec un mouvement d’effroi, on n’arrête pas les honnêtes gens.
– Quand ils prouvent qu’ils sont honnêtes, non.
– Ça ne m’est pas difficile.
– C’est ce que nous allons voir, et je vais te prouver que tu pourrais te tromper. Tu as roulé cette nuit, n’est-ce pas ?
– Pardieu ! Faut-il pas que je gagne ma vie ?
– Cela dépend au service de qui !
Et Rocambole, que l’attitude embarrassée du cocher confirmait de plus en plus dans ses soupçons, ajouta :
– Puisque tu ne veux pas me dire ce que tu as fait cette nuit, je te le dirai, moi.
– Ah ! fit le cocher en tressaillant.
– Tu es parti de la rue Marignan…
– C’est mon quartier.
– Et tu es allé à Romainville.
La mine stupéfaite du cocher ne laissa plus un doute à Rocambole.
– Tu avais dans ta voiture, poursuivit Rocambole, une femme qu’on avait attachée et qui avait un bâillon dans la bouche.
Le cocher pâlit.
– Maintenant, continua Rocambole, je vois qu’au lieu de commencer par la préfecture, nous allons faire un tour à Romainville.
– Mais… monsieur…
Rocambole tira sa montre :
– Je n’ai que deux heures à dépenser, dit-il, ainsi ne perdons pas de temps. Allons à Romainville, et prends bien garde de suivre un autre chemin que celui que tu as pris cette nuit.
– Monsieur, dit le cocher, je vois bien que vous êtes un rousse et qu’on ne vous monte pas le coup.
– On essaye, fit Rocambole avec un sourire, mais on ne réussit pas toujours.
– Mais je vous jure que je ne connais pas les deux hommes et la femme qui ont emmené l’autre, dit le cocher.
– Ah ! il y avait deux hommes ?
– Oui.
– Et une femme ?
– Vous le savez aussi bien que moi.
– Peut-être… dit Rocambole, mais je veux voir si tu essayes de m’enfoncer.
Le cocher tremblait et avait de la peine à tenir ses guides.
Rocambole poursuivit :
– Comment étaient les deux hommes ?
– Il y en avait un grand et gros, avec des cheveux presque blancs.
– Qui s’appelait Timoléon, dit Rocambole à tout hasard.
– C’est cela, dit le cocher, l’autre lui a donné ce nom.
– Et l’autre, comment s’appelait-il ?
– Un drôle de nom, et la femme aussi, allez !
L’homme s’appelait le Pâtissier.
Rocambole tressaillit, mais son visage ne laissa rien percer de l’émotion qu’il éprouvait.
– Et la femme ?
– La femme s’appelait la Chivotte, dit le cocher, qui avait bonne mémoire.
Quelques gouttes de sueur perlèrent au front de Rocambole.
Qu’était donc devenue Vanda aux mains de ces trois bandits ?
– Écoute-moi bien, reprit-il, après un silence, et dis-toi que ton sort dépend de ta sincérité : tu peux aller au pré, rien que ça.
Le cocher étouffa un cri d’épouvante.
– Car, poursuivit Rocambole, tu t’es rendu complice cette nuit d’un enlèvement et peut-être d’un assassinat.
– Monsieur, je vous jure… que je croyais… qu’il s’agissait d’une affaire d’amour…
Rocambole regardait le cocher, et la terreur peinte sur le visage de ce dernier lui disait qu’il était sincère.
– Allons à Romainville, dit-il, là… nous verrons…
Les mots d’assassinat et de complicité avaient tellement bouleversé le cocher qu’il n’eût pas même essayé de fuir, s’il en eût eu l’occasion.
Il se mit à suivre exactement le même chemin et contourna les buttes Chaumont, après avoir longé jusque-là l’ancien boulevard extérieur.
Puis il prit le chemin creux qui aboutissait aux champs.
Mais, arrivé au bout, il dit :
– Je me suis arrêté là.
Rocambole descendit ; il put se convaincre de la véracité du cocher.
On voyait distinctement sur la terre fangeuse le train de la voiture qui avait tourné sur elle-même.
Puis quelques empreintes de pas qui descendaient dans le sentier.
Rocambole reconnut le pied mignon et finement chaussé de Vanda.
Il était sur ses traces.
Mais où conduisait ce sentier ?
Rocambole savait heureusement son Paris par cœur : il se dit aussitôt :
– S’ils ne l’ont pas assassinée, ils l’ont séquestrée dans les Carrières de Pantin.
J’arrive trop tard, ou trop tôt.
Trop tôt, si Timoléon a déjà assouvi sur elle la haine qu’il me porte.
Trop tard s’il faut la délivrer.
En effet, ce n’était pas dans le costume qu’il portait que Rocambole pouvait se risquer à pénétrer dans ces nouveaux repaires de vagabonds et de voleurs.
– Il faut attendre à ce soir, dit-il.
Et le cœur plein d’angoisses, mais toujours impassible, il remonta dans le fiacre en disant au cocher :
– Ramène-moi à Paris, là je verrai ce que je dois faire de toi.
IV
Rocambole revint donc à Paris.
– Où faut-il vous conduire ? demanda le cocher tout tremblant.
– À la préfecture, répondit Rocambole.
La terreur du cocher augmentait.
– Mon garçon, lui dit Rocambole, je ne dois pas te cacher que tu as été, sans le vouloir, je veux bien le croire, le complice d’un attentat.
– A-t-on assassiné la personne enlevée ?
– C’est ce que je ne sais pas encore ; et c’est ce que je saurai bientôt.
– Mais, mon bon monsieur, dit le cocher, je vous jure que je suis innocent…
– C’est possible. Mais ton affaire n’est pas bonne. Où demeures-tu ?
– À la Chapelle, rue de la Goutte-d’Or, n° 2.
– Ton nom ?
– Ambroise Giraud.
Rocambole tira son carnet de sa poche et inscrivit ce nom et cette adresse.
Le cocher tremblait de tous ses membres.
– Conduis-moi toujours, dit Rocambole. Nous verrons…
Le cocher gagna la rue Lafayette et la suivit jusqu’au faubourg Saint-Martin ; mais lorsqu’il allait s’engager dans cette nouvelle artère qui, descendant vers les boulevards, était la voie la plus courte pour arriver à la préfecture de police, Rocambole lui dit :
– Ramène-moi donc avenue Marignan.
Le cocher poussa un soupir de soulagement et continua à suivre la rue Lafayette, descendit vers la rue Laffitte, gagna le boulevard des Capucines et, de là, les Champs-Élysées.
Rocambole réfléchissait durant le trajet.
Le cocher vint s’arrêter devant la grille du petit hôtel où il avait stationné déjà pendant la nuit précédente, tandis que Timoléon, la Chivotte et le Pâtissier enlevaient Vanda.
Rocambole lui dit :
– Attends-moi !
Et il s’élança dans l’hôtel.
Milon n’avait pas bougé. Quand Rocambole lui avait donné une consigne, l’honnête colosse n’y eût pas manqué en présence de l’échafaud.
– Eh bien ? fit-il anxieux.
– Je suis sur ses traces, répondit Rocambole.
– Ah !
Et le maître raconta comment son instinct merveilleux lui avait fait retrouver le cocher et comment il était allé jusqu’à l’endroit où Timoléon et ses complices avaient forcé Vanda à descendre de voiture.
– Eh bien ! dit Milon, il faut aller à Pantin.
– Sans doute.
– Et le plus tôt sera le meilleur.
– Non, dit Rocambole. Ou les misérables ont déjà assassiné Vanda, ou ils la gardent prisonnière. Dans ce dernier cas, si nous voulons la délivrer, c’est en allant, la nuit prochaine, nous mêler aux voleurs et aux vagabonds, qui se réfugient dans les carrières.
– Vous avez raison, murmura Milon. Mais que c’est long d’attendre à ce soir ?
– Il le faut.
– Et que ferons-nous d’ici là ?
– Qui sait ? Timoléon viendra peut-être se jeter sur notre passage. Il n’a pas enlevé Vanda d’ici sans avoir quelque projet sur l’hôtel où nous sommes.
– C’est juste, dit Milon.
Rocambole rejoignit le cocher.
– Tu peux t’en aller, lui dit-il. Mais je te conseille de reconduire ta voiture à la compagnie, de dire que tu es malade et de rentrer chez toi.
– Pourquoi donc ? demanda naïvement le cocher.
– Parce que, d’un moment à l’autre, on peut avoir besoin de toi, à titre de témoin, et il faut qu’on t’ait sous la main. Je pourrais te mettre en état d’arrestation, mais tu as l’air d’un honnête homme, plus bête que coupable, et j’ai pitié de toi.
Le cocher crut Rocambole sur parole et se mit à verser des larmes de reconnaissance.
Rocambole ajouta :
– Maintenant un dernier conseil, et je t’engage à en profiter.
– Oh ! monsieur, murmura le pauvre diable, de plus en plus convaincu qu’il avait affaire à un haut agent de police, parlez ! Je ferai tout ce que vous voudrez.
– Le hasard pourrait te remettre en présence de l’un de ces trois bandits.
Le cocher frissonna.
– La police a l’œil sur toi, souviens-t’en. Si tu venais à manger le morceau, tu deviendrais tout à fait complice.
– Ils sont gerbés d’avance, répondit le cocher, s’il n’y a que moi pour les prévenir.
Et il s’en alla, pénétré de reconnaissance.
* *
*
Or, ce que nous venons de raconter se passait précisément le soir de ce jour où Timoléon prenait ses dispositions pour délivrer sir James Nively.
Nous l’avons vu sortir à la nuit, sous prétexte d’aller manger dans une gargote du carré Saint-Martin, et se heurter, à l’angle de la rue de ce nom, avec un homme qui marchait d’un pas rapide.
Cet homme, on s’en souvient encore, qui ne le reconnut pas, et qu’il reconnut, lui, c’était Milon.
– Bon ! s’était dit Timoléon avec un sourire, il va savoir rue du Vert-Bois si on n’a pas des nouvelles de Vanda.
Timoléon se trompait.
Milon allait rue du Vert-Bois, par ordre de Rocambole, savoir si personne n’avait rôdé autour de la maison et si rien de nouveau n’était survenu depuis la nuit précédente.
Comme Timoléon avait merveilleusement joué son rôle de placeur, et que, de plus, il avait agi en grand mystère, le fruitier répondit à Milon que tout était dans l’ordre accoutumé, et Milon s’en alla.
Rocambole lui avait donné rendez-vous à la barrière de Belleville, dans un cabaret situé en face de l’ancienne et fameuse Courtille.
Milon n’était plus vêtu de ce confortable paletot qui lui donnait l’air d’un domestique de confiance.
Il avait revêtu l’uniforme obligé des gens qui vont la nuit chercher un refuge sur les fours à plâtre.
Pantalon sale et frangé, souliers éculés, blouse déchirée recouvrant un lambeau de paletot, linge devenu noir, cravate en corde, chapeau défoncé, rien n’y manquait.
Jamais mendiant doublé de voleur n’avait eu une mise plus réussie.
Rocambole, qu’il eut rejoint en moins de vingt minutes, avait également dépouillé jusqu’à la ressemblance du major Avatar.
Il avait une redingote graisseuse, une casquette de velours posée sur l’oreille, un gilet à carreaux rouges, et il avait mis son pantalon dans de vieilles bottes plusieurs fois remontées.
Une large chaîne en chrysocale, veuve de toute montre, et une pipe en fausse écume complétaient cette tenue qui était celle d’un de ces hommes qu’on voit errer à onze heures du soir chez les marchands de vin, ayant au bras des créatures fardées qui n’ont conservé de la femme que le nom.
On aurait pu, à le voir ainsi, l’appeler le beau Polydore ou le joli Dodolphe.
Le cabaret dans lequel Milon le rejoignit était rempli d’un monde auquel ils semblaient maintenant appartenir.
Il y avait un peu de tout : quelques ouvriers honnêtes, et beaucoup de créatures perdues, de vagabonds, de voleurs à la flan et à la tire.
Tout cela riant, buvant, criant, se disputant et faisant un tapage d’enfer.
– Restons ici un moment, dit Rocambole tout bas après avoir demandé une chopine, nous aurons peut-être des nouvelles de Pantin.
En effet, comme Milon s’asseyait, la porte du cabaret s’ouvrit et une femme entra en disant :
– Merci ! j’en ai assez des carrières ! Tous ces brigands-là n’ont-ils pas manqué m’assommer ?
– Tiens ! dit une des femmes qui buvaient dans le fond de la salle, c’est toi, Nora ?
– Oui, c’est moi.
– Tu as un œil au beurre noir, ma petite.
– C’est les gens de Pantin que me l’ont mis sur le plat répondit-elle.
– Écoutons, dit Rocambole qui se prit à regarder cette fille avec attention.
V
La femme qui venait d’entrer n’était autre que mademoiselle Nora Pitanchel, ex-figurante du théâtre de Montrouge, présentement sans engagement, mais non sans inquiétude, car la police recherchait depuis longtemps cette aimable artiste dramatique pour différents méfaits étrangers à sa profession.
Nous l’avons vue, il y a quelques jours, aux Carrières d’Amérique, sur le four à plâtre nommé pompeusement l’Eldorado, tenir le dé de la conversation, le crachoir, comme on dit dans un certain monde qui n’a rien de commun avec le faubourg Saint-Germain, et énumérer les divers princes russes, moldaves et autrichiens qui s’étaient disputé son cœur.
Mais le temps dont elle parlait était fort loin déjà si on s’en rapportait à son visage couperosé, à ses tempes estampillées par la fatale patte d’oie, et à sa bouche démeublée.
Son costume était aussi ravagé que sa figure.
Nora Pitanchel portait, sur une crinoline effondrée et dont les cerceaux affectaient des formes injurieuses pour la circonférence, une vieille jupe de soie qui n’avait plus de couleur, mais qui pouvait bien avoir été bleue.
Un caraco rouge couvrait mal ses épaules amaigries.
Enfin elle avait enfermé à la diable, dans un filet rouge, graisseux, ses cheveux noirs qui grisonnaient à la naissance du front.
La femme qui l’avait interpellée à son entrée dans le cabaret, n’avait rien exagéré en lui disant qu’elle avait un œil au beurre noir.
En effet, la partie gauche de son visage était comme tuméfiée, et à peine l’œil apparaissait-il au milieu d’un cercle tricolore, rouge, noir et jaune.
– Tu as reçu là un fameux atout ! lui dit encore son interlocutrice.
– C’est cette canaille de Léon, répondit Nora Pitanchel.
– Ton ancien ?
– Justement.
– Vous avez eu des mots ?
– C’est-à-dire qu’il m’a lâchée pour une méchante chipie qu’on appelle Zélie.
– La petite Zélie de la rue du Vert-Bois ?
– Elle-même.
Au mot de rue de Vert-Bois, Milon et Rocambole écoutèrent plus attentivement encore.
– Une jolie connaissance qu’il a faite là, je m’en vante ! dit la femme.
– C’est pourtant aux Carrières d’Amérique que la chose m’est arrivée, dit Nora.
– Comment donc ça ?
– Un soir, il y a huit jours de ça, on jasait à l’Eldorado. Léon n’y était pas. Zélie, que son logeur, le fruitier de la rue du Vert-Bois, avait mise à la porte faute de braise, était venue en garni chez nous.
Personne ne la connaissait, mais à l’Eldorado tout le monde est chez soi.
Voilà que cette petite gale se mit à raconter une histoire et à parler d’un petit garçon qu’on appelle Marmouset.
Milon étouffa un cri… mais Rocambole le masquait et personne ne prit garde à lui.
Nora continua :
– Il y avait là un ami qu’on appelle le Pâtissier.
– Un fameux ! dirent quelques-uns des buveurs.
– Le Pâtissier voulait savoir l’adresse de Marmouset, Zélie ne veut pas la lui donner. Le Pâtissier menace de la battre. Ça fait une bagarre ! Voilà-t-y pas que je me prends d’amitié pour cette petite.
– C’est toujours comme ça que ça commence, dit la femme.
Nora reprit :
– Le lendemain, Léon arrive et nous dit : mes petits agneaux, la rousse va venir ici cette nuit. Que ceux qui ne veulent pas jaser avec les curieux demain matin ramassent leur clique et leur claque et se donnent du vent !
Nous filons, j’emmène Zélie.
Trois jours après, ils étaient ensemble et j’étais laissée comme un vieux bas.
Mais je me suis donné du mal pendant ces trois jours ; j’en ai fait des pas et des marches pour les trouver.
– Et tu les as pincés ?
– Oui, aux Carrières de Pantin, à l’hôtel du Dab.
– Et puis ?
– Et puis, dame ! je n’ai pas été la plus forte ! Léon m’a battue, et tous ces gredins qui étaient là se sont mis contre moi. Ah ! les brigands ! Dire qu’il n’y en a pas eu un seul pour me défendre…
Rocambole, à ces derniers mots, s’approcha.
– Hé ! dit-il, c’est que ce sont tous des feignants et des lâches !
Et il se posa devant Nora Pitanchel, de façon à faire valoir tous les avantages de sa taille et de son costume.
Nora le regarda.
– Tu as l’air d’un bon garçon, toi ? dit-elle.
– Et je suis solide, fit Rocambole.
– Tu me plais, dit encore Nora Pitanchel.
– Toi aussi.
– Veux-tu de mon cœur ?
– Je ne demande pas mieux ; mais il faut que j’extermine Léon auparavant.
Nora fut charmée de l’air belliqueux que prit alors Rocambole.
En même temps, il se fit un cercle autour de lui et il devint le centre de tous les regards.
– D’où donc que tu viens, toi ? demanda un des buveurs.
– J’ai fait le voyage de l’Amérique pour de bon, répondit modestement Rocambole.
Ce qui voulait dire :
« Je reviens de Cayenne. »
– Et vous êtes quitte avec la Cigogne ? fit Nora.
– Pour le moment, mais ça ne durera pas longtemps : pas vrai, camarade ?
Et Rocambole regarda Milon.
Le vieux colosse se leva à son tour et montra complaisamment ses épaules herculéennes.
On battit des mains.
– Monsieur que vous voyez là, dit Rocambole, vous tue un bœuf d’un coup de poing.
– Ça se pourrait bien, murmura-t-on à la ronde.
– Si tu veux venir avec nous, ma mignonne, reprit Rocambole en s’adressant à Nora Pitanchel, on te recevra bien aux Carrières de Pantin.
– Et tu rosseras Léon ?
– Léon et tous ceux qui voudront le défendre.
– Ça me va, dit Nora, tu es mon homme.
– Eh bien ! il faut battre le fer quand il est chaud.
– Tu as raison.
– Allons-y !
Et Rocambole jeta vingt sous sur la table pour payer les deux chopines.
Nora s’était déjà pendue à son bras.
– Bonsoir la compagnie ! dit Milon.
Et tous trois sortirent aux applaudissements de l’assemblée.
Quand ils furent dehors, Rocambole dit à Nora :
– Tu es donc à sec ?
– Oui.
– Tiens ! voilà deux roues de derrière.
– Et il lui mit deux pièces de cent sous dans la main.
Nora lui sauta au cou.
– Écoute, poursuivit Rocambole, j’exterminerai tout pour te faire plaisir, mais il y a encore quelqu’un à qui j’en veux.
– Et qui donc ?
– Le Pâtissier.
– Ah ! fit Nora Pitanchel, je doute que tu le rencontres aux Carrières de Pantin.
– Pourquoi ?
– Il n’y est pas encore venu.
– Qui sait ? fit Rocambole.
Et ils se mirent en route.
Milon se disait :
– Pour que le maître emmène cette créature et se soit fait son chevalier galant, il faut qu’il ait son idée.
VI
Rocambole tressaillit en voyant Nora Pitanchel, après avoir gravi le faubourg de Belleville tourner à gauche dans la rue des Moulins.
La rue des Moulins aboutit à la butte Chaumont, et il y avait gros à parier que Nora allait prendre ce chemin creux, suivi la nuit précédente par la voiture, et au bout duquel Timoléon avait fait mettre pied à terre à Vanda.
Rocambole ne se trompait pas.
Nora lui fit prendre cette route, et tous trois descendirent dans la plaine par ce sentier boueux et glissant dans lequel Vanda avait fait plusieurs faux pas.
La nuit était noire et pluvieuse, le vent violent.
Mais Nora connaissait son vallon de Pantin comme sa poche.
Elle n’hésita pas une seconde en chemin, et conduisit Rocambole et Milon à l’hôtel du Dab.
C’était là que la rixe avait eu lieu, que Nora avait été rossée par Léon ; c’était là qu’elle espérait le retrouver et lui faire faire connaissance avec les poings vigoureux de Rocambole et les épaules herculéennes de Milon.
Mais en entrant dans la carrière, Nora poussa un cri de désappointement.
Léon et Zélie avaient disparu.
Quand les voleurs et les vagabonds couchés sur le four, virent paraître Nora flanquée de ses deux acolytes, ils se mirent à rire.
– Tu as été racoler du monde, lui dirent-ils, mais ça ne te servira pas à grand’chose. Léon est parti.
– Où est-il ? demanda Nora Pitanchel avec colère.
– Cherche-le, mais pas ici, il n’y est pas.
Et l’on se mit à rire de plus belle.
Rocambole se pencha à l’oreille de l’ancienne figurante et lui dit :
– Pour peu que tu y tiennes, mon ami et moi nous allons tremper une soupe à ces messieurs ; mais je crois qu’il vaut mieux commencer par Léon.
– Tu as raison, mon homme, dit Nora. Tous ces gens-là sont des lâches, qui ne valent pas le coup de poing : allons-nous-en !
– Bon voyage ! lui cria-t-on comme elle sortait de la carrière avec ses deux chevaliers.
Ils allèrent ainsi de l’hôtel du Dab à Mexico, et de Mexico à Sébastopol, c’est-à-dire à deux autres carrières qui avaient reçu ces noms pompeux.
Nulle part ils ne rencontrèrent Léon.
Rocambole observait tout, examinait tout, parlait quelquefois du Pâtissier, et comme il s’exprimait dans le plus pur argot des bagnes et des maisons centrales, personne ne doutait qu’il ne fût un ami, c’est-à-dire un voleur.
Aussi ne se cachait-on pas de lui ; et si on ne pouvait lui donner des nouvelles du Pâtissier, c’est que personne n’avait vu ce dernier.
La carrière où Timoléon avait conduit Vanda était inconnue.
Milon et Rocambole passèrent tout près du fameux puits, ne se doutant point que celle qu’ils cherchaient était à quelques centaines de pas sous terre.
La nuit s’écoula en recherches infructueuses.
Nora croyait poursuivre son amant infidèle et sa rivale préférée.
Rocambole, au contraire, ne pensait qu’à Vanda.
Les premières lueurs de l’aube les surprirent dans la plaine de Pantin.
Cependant, cette nuit-là même, la Chivotte et le Pâtissier avaient apporté à manger à Vanda.
Mais la fatalité n’avait pas voulu qu’ils rencontrassent Rocambole.
Ce dernier, voyant le jour, se pencha à l’oreille de Milon et lui dit :
– Il faut pourtant nous débarrasser de cette femme.
– Comment ? demanda Milon.
– Nous allons voir…
Nora était harassée de fatigue.
Rocambole lui dit :
– Puisque Léon n’est pas à Pantin, c’est qu’il est resté dans Paris avec sa largue. Retournons à la barrière.
– Ça va, dit Nora Pitanchel.
– Nous le retrouverons bien sûr dans quelque bouchon de Belleville ou de la Villette.
– Allons, dit Nora qui ne tenait plus sur ses jambes.
On se remit en route et l’on descendit par les Buttes-Chaumont sur l’ancien boulevard extérieur.
– Si nous buvions un coup ? dit Rocambole.
Et il fit entrer Nora et Milon chez un marchand de vin qui venait d’ouvrir sa boutique.
Nora avait soif, elle avait faim.
Rocambole fit apporter du vin et du fromage, dans le cabinet unique de l’établissement.
Nora dévora et but à longs traits.
Après le vin, on passa à l’eau-de-vie.
Nora, au bout d’une heure, avait la tête si lourde qu’elle s’appuya sur la table.
La fatigue acheva l’œuvre. Elle s’endormit.
– Filons ! dit alors Rocambole.
Et tous deux sortirent sur la pointe du pied, laissèrent cent sous au comptoir et dirent qu’ils allaient revenir.
* *
*
Le reste de la journée fut employé par Rocambole et Milon en recherches non moins infructueuses.
Après avoir repris leurs habits ordinaires, ils se rendirent aux Champs-Élysées.
Les domestiques du petit hôtel de l’avenue Marignan étaient dans la consternation.
Ils n’avaient vu revenir ni sir James Nively, ni Vanda.
Milon alla rue du Vert-Bois.
Le fruitier le prit à part et lui dit d’un air mystérieux :
– Il est venu, hier soir, une femme qui s’appelle Zélie.
– Est-ce qu’elle a demandé après moi ?
– Non, dit le fruitier, mais elle voulait voir le petit.
– Qui ça, Marmouset ?
– Oui.
– Eh bien ?
– Je l’ai flanquée à la porte. C’est une de mes anciennes locataires. Je m’en méfie !
Milon rapporta ces paroles à Rocambole qui l’attendait sur le boulevard Saint-Martin.
Rocambole lui dit :
– Tu vas t’installer rue du Vert-Bois. Cette femme reviendra sans doute. Tu lui parleras et si elle a quelque nouvelle du Pâtissier à nous donner, tu me l’amèneras rue Saint-Lazare en lui promettant tout l’argent qu’elle te demandera.
Milon, fidèle à la consigne qu’il avait reçue, s’installa dans l’arrière-boutique du fruitier et attendit Zélie.
Rocambole était retourné rue Saint-Lazare.
Il comptait beaucoup sur l’intelligence et l’audace de Vanda.
Vanda était morte ou prisonnière.
Dans le second cas, si épaisses que fussent les portes de la prison, si bien surveillée qu’elle fût, elle trouverait un moyen de faire parvenir à Rocambole un mot, un billet, un renseignement quelconque.
Rocambole en était si convaincu qu’il s’enferma rue Saint-Lazare et attendit.
La journée s’écoula.
Milon ne revint pas. C’était une preuve que Zélie n’avait pas reparu rue du Vert-Bois.
Puis la nuit vint, et une partie de la soirée s’écoula.
Rocambole commençait à désespérer, lorsqu’il entendit du bruit dans l’antichambre.
Le petit groom, l’ancien serviteur de milady à Rochebrune barrait le passage à une sorte de mendiante avinée qui insistait pour entrer.
Rocambole parut.
Cette mendiante, c’était Philippette.
Elle tenait à la main le papier sur lequel Vanda avait tracé en russe ces quelques mots :
« Prisonnière… au pouvoir de Timoléon… suis la femme qui te porte ce billet… promis deux cents louis. »
– Enfin ! murmura Rocambole, qui ne put contenir plus longtemps cette émotion terrible qui l’étreignait depuis trente-six heures.
Et il s’apprêta à suivre Philippette.
VII
Revenons à Timoléon que nous avons laissé se faisant une lanterne de son cigare pour déchiffrer le billet de Vanda.
Nous l’avons vu aller au-devant du Pâtissier, après avoir recommandé à sir James Nively de ne point bouger et de ne faire aucun bruit.
Le Pâtissier l’attendait au coin de la rue Saint-Martin.
– Eh bien ? est-ce prêt ? demanda Timoléon.
– C’est prêt, fit le Pâtissier.
– Où est le baril ?
– Le baril, la mèche, tout est dans le puits.
Timoléon tira de sa poche une grosse montre d’argent.
– Il n’est que neuf heures, dit-il, nous arriverons avant que Philippette soit partie.
Et ils prirent un fiacre qui les conduisit aux buttes Chaumont.
Des buttes, ils descendirent à pied dans la plaine.
Là, le Pâtissier demeura auprès du puits, tandis que Timoléon s’approchait sans bruit de la carrière où devait se trouver Philippette.
Nous avons vu comment il aborda cette dernière lorsqu’elle sortit.
Philippette ne savait pas plus ce que voulait faire Timoléon qu’elle ne savait ce qu’était le major Avatar.
Timoléon savait quelques mots de russe et il lui fut aisé de traduire le billet de Vanda.
Vanda disait : « Suis la femme qui te porte ce billet… »
– Ça marche comme sur des roulettes, murmura Timoléon en rendant le billet à Philippette.
– Eh bien ? dit celle-ci, que faut-il faire ?
– Pardieu ! Il faut porter le billet à son adresse.
– Et vous croyez que j’aurai les deux cents louis ?
– Certainement, puisqu’il est convenu que nous partagerons.
– Oh ! dit Philippette, si cela arrive et que j’aie ma part, je veux me griser sans désemparer, pendant six mois de suite.
Timoléon se mit à rire.
– Mais pour que tout aille comme tu veux, dit-il, il faut que tu fasses ce que je voudrai.
– Comment donc çà ?
– Que tu écoutes bien mes recommandations.
– Voyons ?
– Tu vas d’abord venir avec moi.
– Où çà ?
– Par ici.
Et Timoléon prit la vieille femme par le bras et l’entraîna vers un petit monticule qui se trouvait à peu près à égale distance du puits et de la carrière à ciel ouvert dans laquelle Philippette avait fait du feu.
Sur ce monticule, il y avait une broussaille et cette broussaille cachait une petite excavation.
– Écoute bien ce que je vais te dire, dit alors Timoléon. La personne que tu vas amener pour délivrer cette dame aura soin de se munir d’une corde et d’un pic.
– Pour quoi faire ?
– Tu vois ce trou ?
– Oui.
– C’était la première entrée de la carrière abandonnée dans laquelle j’ai enfermé la petite dame.
– Bon !
– Avec trois coups de pic, il aura creusé un trou, avec la corde qu’il fixera à une pierre il pourra descendre.
– Et c’est par là qu’il remontera ?
– Naturellement, dit Timoléon, dont Philippette ne vit pas le mauvais sourire. C’est égal, je vais te donner un conseil.
– Lequel ?
– Tu feras bien de te faire payer d’avance.
– Pourquoi ?
– On ne sait pas ce qui peut arriver. Il peut se casser le cou en descendant.
Philippette regarda Timoléon. La nuit n’était pas claire, mais elle vit briller les yeux du misérable d’une joie infernale.
– Ah ! je crois que je comprends, papa, dit-elle.
– À bon entendeur, salut ! dit Timoléon. Seulement, fais bien attention à lui ; c’est que si tu ne joues pas serré, nous sommes flambés et tu n’auras rien.
– C’est pourtant un messière, dit Philippette faisant allusion au major Avatar.
Messière est un mot d’argot qui veut dire bourgeois.
– Oui, mais c’est un malin ; ainsi, prends garde !
– Bon, murmura Philippette, je n’ai pas passé la moitié de ma vie à Saint-Lazare pour être née d’hier… et je ne suis pas saoûle, ce soir… Je l’enfoncerai joliment, le bourgeois.
Et Philippette s’en alla pour remplir son message.
Timoléon redescendit vers le puits.
Le Pâtissier l’avait découvert et il était couché auprès.
– Embarque ! dit Timoléon.
Et il descendit le premier.
Puis, quand le Pâtissier l’eut rejoint, il alluma sa mèche soufrée, disant :
– Vérifions les objets.
– Mais, dit le Pâtissier, vous allez donner l’éveil à la jolie dame.
– Non, dit Timoléon.
– Cependant elle va voir la lumière passer sous la porte.
– Elle n’est plus dans la carrière.
– Hein ?
– Elle est dans le boyau qui conduit à l’autre, mais ce n’est pas par là qu’elle pourra sortir.
En même temps, Timoléon passait l’inspection des objets apportés par le Pâtissier au fond du puits.
Il y avait d’abord une scie à main, semblable à celles dont se servent les menuisiers pour faire un trou rond dans une planche.
– Je ne sais pas trop ce que vous voulez faire de ça, dit le Pâtissier.
– Tu le verras plus tard.
Il y avait ensuite une longue mèche soufrée pareille à celle dont se servait Timoléon, en ce moment, pour y voir clair.
Ensuite une petite futaille qui aurait pu contenir quinze ou vingt litres de vin : c’était de poudre à canon qu’elle était pleine.
– Voilà de quoi faire sauter la moitié de Pantin, dit Timoléon.
– Et c’est pour… Rocambole ?…
– Naturellement.
Les yeux du Pâtissier brillaient d’une joie féroce.
– Maintenant, mon bonhomme, poursuivit Timoléon, nous n’avons plus qu’une chose à faire.
– Laquelle ?
– Nous croiser les bras et attendre.
– Attendre quoi ?
– Que le gibier vienne donner tête baissée dans le panneau que nous lui avons tendu.
– Mais, dit le Pâtissier, je devine bien à peu près ce que vous voulez faire ; seulement…
– Seulement tu ne t’expliques pas les moyens ?
– Non.
– Eh bien ! patience et tu verras qu’à moins d’être le diable ou le bon Dieu, il n’y a pas moyen que l’ami Rocambole en réchappe.
En même temps, Timoléon éteignit la mèche soufrée et tous deux demeurèrent immobiles et silencieux au fond du puits.
VIII
Philippette s’était donc présentée chez le major Avatar, et Rocambole s’était montré dans l’antichambre au moment où le petit groom parlementait avec la vieille femme qui insistait pour entrer.
D’un coup d’œil rapide, Rocambole eut toisé Philippette.
C’était une de ces femmes qui sont descendues au plus bas de l’échelle sociale.
Mais le papier qu’elle apportait était bien de l’écriture de Vanda, et peu importait à Rocambole la messagère qu’elle avait choisie.
D’ailleurs, il y avait une chose qui ne faisait pas doute pour Rocambole.
Vanda était au pouvoir de Timoléon.
Par conséquent, si elle était parvenue à corrompre quelqu’un et à l’intéresser à son sort, ce quelqu’un ne pouvait être qu’une de ces créatures abjectes que Timoléon employait si volontiers.
Ainsi qu’elle l’avait dit à ce dernier, Philippette ne manquait ni d’intelligence ni d’astuce, lorsqu’elle n’était pas prise de boisson.
Si Rocambole avait pu soupçonner un piège, l’attitude que prit tout d’abord Philippette l’eût rassuré.
– Mon bon monsieur, dit-elle, en venant ici je joue gros jeu, parce que les gens qui vous ont pris votre petite dame me tueraient s’ils savaient que je mange le morceau.
Mais votre petite dame m’a dit que vous étiez généreux.
– C’est-à-dire, interrompit Rocambole, qu’elle vous a promis deux cents louis.
– Vous l’avez dit.
– Rassurez-vous, la mère, vous les aurez.
Mais Philippette se rappelait la recommandation de Timoléon.
– J’aimerais autant les avoir tout de suite, dit-elle.
– Pardon, quand nous aurons retrouvé celle que je cherche, dit Rocambole.
Philippette ne bougea pas.
Rocambole comprit qu’elle ne marcherait que si elle voyait l’argent.
– Venez par ici, dit-il.
Et il la fit entrer dans son cabinet et ouvrit un tiroir de son secrétaire.
Dans ce tiroir, il y avait une poignée de billets de banque.
– Connaissez-vous ça ? dit-il en lui en montrant un.
– Pardi ! j’en ai assez remué dans mon jeune temps, quand je roulais voiture, dit Philippette. Ce sont des billets de mille francs.
Rocambole en prit quatre et les mit dans sa poche. Puis il referma le tiroir en disant à Philippette :
– Quand vous m’aurez conduit, vous les aurez.
Il parlait avec un tel accent de franchise et de fermeté à la fois, que la complice de Timoléon comprit qu’il ne la trompait pas et qu’il ne donnerait l’argent qu’après avoir retrouvé Vanda, mais que rien ne le lui ferait lâcher auparavant.
– C’est bien, dit-elle, partons !
– Où allons-nous ? demanda Rocambole.
– À Pantin.
Il tressaillit au souvenir de ses recherches infructueuses.
– Ah ! dit Philippette, ils sont malins, allez !
– Qui donc ?
– Ceux qui ont enfermé la petite dame. Ils l’ont mise dans une carrière qui est bouchée et que personne ne connaît plus.
Ceci confirmait tous les soupçons de Rocambole.
Tandis que Philippette parlait, il avait revêtu rapidement une mauvaise redingote et s’était coiffé d’une casquette, ce qui lui donnait l’air d’un ouvrier.
Puis il avait, sans que Philippette le vît, glissé deux pistolets et un poignard dans ses poches.
– À présent, dit encore Philippette, ce n’est pas tout.
– Que faut-il encore ?
– Vous pensez bien que si j’avais été moins vieille et plus robuste, en place de venir vous chercher, j’aurais délivré la petite dame, mais il y a de l’ouvrage, allez ! il faudrait avoir un bon pic et une longue corde.
– Nous prendrons tout cela en route, dit Rocambole, filons !
Et il la prit par le bras et sortit avec elle, au grand étonnement du petit groom qui ne pouvait comprendre comment un homme de la valeur et de l’éducation du major Avatar pouvait se donner une semblable compagnie.
Dans la rue, Rocambole arrêta un fiacre, y fit monter Philippette et dit au cocher :
– Mène-nous aux buttes Chaumont, mais en passant tu t’arrêteras rue du Vert-Bois, au numéro 19.
Philippette tressaillit.
Comment le major Avatar pouvait-il avoir affaire précisément dans la maison où Timoléon demeurait ?
– Nous allons nous procurer un pic et des cordes, dit Rocambole.
Le fiacre partit.
Un quart d’heure après, il arrivait rue du Vert-Bois.
La rue était déserte, la boutique du fruitier fermée.
Mais un filet de lumière passait sous la porte.
Rocambole frappa.
Ce fut le fruitier qui vint ouvrir.
Il y avait trois personnes dans l’arrière-boutique : Milon, la Mort-des-braves et une femme.
Milon se précipita à la rencontre de Rocambole.
– Eh bien ? dit-il.
La femme se retourna et murmura :
– Le maître !
Rocambole laissa échapper un geste d’étonnement ; il avait reconnu l’ancienne prisonnière de Saint-Lazare, la belle Marton, la femme au chien.
En effet, le chien, ce chien merveilleux d’instinct, qui avait aidé à sauver Mlle Antoinette Miller, était couché sous la table.
Il grogna un moment : mais il finit par reconnaître Rocambole et se mit à le caresser.
– Que fais-tu ici ? demanda Rocambole.
Philippette était restée dans la voiture et ne pouvait entendre ce qui se passait dans la boutique.
– Maître, répondit Marton, je suis venue de la part d’une femme appelée Zélie.
– Bon ! fit Rocambole.
– Prévenir ce jeune homme qui se cache ici que le Pâtissier veut lui jouer un mauvais tour.
– Je le sais, dit froidement Rocambole.
– Zélie est venue déjà, mais le patron l’avait mise à la porte, alors elle m’a envoyée et bien heureux que j’ai trouvé Milon.
– Maître, dit Milon tout bas, avez-vous des nouvelles de Vanda ?
– Oui.
Et Rocambole, qui paraissait fort calme, dit au fruitier :
– Il faut me trouver une de ces longues cordes qui te servent à descendre ton vin dans la cave.
– Bon, dit le fruitier, c’est facile.
– Puis un pic ou une bêche.
– Vous savez que j’ai un pic, je vais le chercher.
– Mais où allez-vous donc, maître ? demanda Milon.
– Délivrer Vanda.
– Alors vous venez me chercher ?
– Non, tu resteras ici.
– Pourquoi ?
– Parce que le Pâtissier et Timoléon rôdent sans doute autour de la maison et qu’il faut veiller sur Gipsy.
Le fruitier revint quelques minutes après.
Il portait le pic et la corde dont il avait fait un écheveau.
– Maître, murmura Milon, n’est-ce point assez de la Mort-des-braves et de notre ami le fruitier pour garder Gipsy ?
– Non.
– Comment, vous allez tout seul ?
– Oui.
– Maître… j’ai peur…
– Imbécile ! dit Rocambole.
Et il lui montra la crosse de ses pistolets, ajoutant tout haut :
– Vous allez tous m’attendre ici.
Et il regagna la voiture dans laquelle se trouvait Philippette.
– Aux buttes Chaumont, maintenant ! dit-il au cocher.
IX
Ainsi que nous l’avons dit déjà, Philippette n’avait pas vu, sans quelque inquiétude, le major Avatar se faire conduire rue du Vert-Bois.
Il est même probable que si elle avait eu les deux cents louis en sa possession, elle aurait pris la fuite tandis que Rocambole entrait dans la boutique du fruitier.
Mais Rocambole ne s’était point dessaisi, et elle resta.
Ensuite une réflexion était venue à son aide, pour calmer son anxiété qui n’était point dépourvue de logique :
– Je ne sais pas pourquoi Timoléon a enfermé cette dame dans les carrières, se dit-elle ; je ne sais pas davantage pourquoi il veut qu’on la délivre ; pourquoi saurais-je les raisons du messière à venir rue du Vert-Bois ? Tout ce que je sais, et ça me suffit, c’est qu’il y a deux cents louis à partager ; et voilà !
Rocambole, qui ne pouvait deviner les réflexions de la vieille fille, se mit alors à l’interroger, tandis que la voiture montait le faubourg Saint-Germain.
Philippette lui raconta fort naïvement que, se trouvant sans asile, elle était allée coucher aux Carrières de Pantin ; mais que là, on l’avait chassée en disant qu’elle était trop vieille ; puis qu’à force de chercher, elle avait trouvé une carrière à ciel ouvert avec un reste de feu, tout au fond, qu’elle y était entrée, et que, tandis qu’elle essayait de ranimer le feu, elle avait entendu Vanda.
Philippette décrivit de son mieux la carrière et l’excavation trop étroite à travers laquelle Vanda avait essayé vainement de passer.
Elle raconta que Vanda lui avait détaillé la place topographique de la carrière dans laquelle on l’avait enfermée.
Rocambole écoutait tous ces détails avec attention.
Philippette lui dit ensuite :
– À la façon dont elle m’a parlé, la petite dame, j’ai bien compris qu’il n’y avait qu’un homme capable de faire tout ça et que cet homme était Timoléon.
– Tu le connais donc ? fit Rocambole.
– J’ai travaillé pour lui dans le temps, mais c’est un pingre. On n’a pas de l’eau à boire, avec lui, et puis je n’aime pas les rousses. Alors, la petite dame m’a dit que vous me donneriez beaucoup d’argent. Dame ! j’ai fait mes conditions, comme vous voyez… avec deux cents louis, j’ai de quoi boire et manger le restant de mes jours.
Rocambole ne répondit pas.
La voiture arriva en haut des buttes Chaumont.
Rocambole donna dix francs au cocher et le renvoya.
Puis il dit à Philippette :
– Viens ! je sais le chemin.
– Encore une drôle de chose ! pensa l’ivrognesse.
Ils descendirent dans la plaine par ce sentier que Rocambole avait déjà suivi une fois.
Puis ils arrivèrent à cette planche jetée comme un pont sur le torrent sans eau.
Bien qu’il ne fît pas clair du tout, la nuit était moins obscure que deux heures auparavant.
Cela tenait sans doute à un vent du Nord qui avait nettoyé le ciel et remis à découvert les étoiles.
Rocambole suivait Philippette qui lui disait :
– Allons vite ! la pauvre petite dame doit se désespérer.
Rocambole, regardant, n’avançait qu’avec précaution, portant autour de lui un regard clair et froid, auquel rien n’échappait.
La plaine était déserte et rien ne bougeait.
Ils passèrent auprès du puits, dans lequel Timoléon et le Pâtissier s’étaient blottis.
Un moment, ce puits fixa l’attention de Rocambole, mais Philippette marchait en avant.
Et puis la nature a refusé à l’homme cette puissance d’odorat qu’elle a accordée aux animaux.
Rocambole passa.
Quelques minutes après, il était dans la carrière à ciel ouvert et Vanda jetait un cri de joie.
Philippette s’accroupit de nouveau sur le foyer pour rallumer quelques tisons, sur lesquels elle jeta une poignée de broussailles sèches.
Bientôt les broussailles flambèrent et projetèrent autour d’elle une certaine clarté.
Il suffit d’un coup d’œil à Rocambole pour se convaincre qu’il lui serait impossible d’élargir ce trou formé dans le rocher, et à travers lequel il apercevait Vanda.
Celle-ci lui dit :
– Ce n’est pas par là que je suis entrée, comme tu le penses bien.
Et elle raconta l’histoire du puits, et décrivit minutieusement ce couloir souterrain que fermait une porte massive et solidement fermée.
– C’est bien, dit Rocambole, j’enfoncerai la porte à coups de pic.
Mais Philippette lui dit :
– Je sais un moyen plus simple de délivrer madame.
– Lequel ?
– Avez-vous vu, reprit la vieille en s’adressant à Vanda, une sorte d’échafaudage au-dessus de la carrière, et qui forme comme un plafond ?
– Oui, répondit Vanda.
– Eh bien ! en deux coups de bêche on aura raison de la première entrée de la caverne, et avec la corde que monsieur a apportée…
– Cette femme a raison, dit Rocambole.
Philippette prit un tison enflammé et dit :
– Venez, je vais vous éclairer.
Rocambole la suivit et, pendant ce temps, Vanda se mit à ramper dans son boyau souterrain, de manière à redescendre dans la carrière.
L’entrée primitive de la carrière était à égale distance, nous l’avons dit, du puits et de l’autre carrière à ciel ouvert, dans laquelle Rocambole avait pénétré tout à l’heure.
Celui-ci se mit à écarter les broussailles et eut bientôt trouvé une excavation de peu de profondeur dans laquelle il descendit.
Puis, ayant frappé du pied, il sentit le sol résonner sous lui, ce qui annonçait une cavité.
Soudain il se servit de son pic et en quelques coups il eut déplacé une grosse pierre, puis une autre et encore une autre.
Alors un trou apparut et les pierres tombèrent avec un bruit lourd.
– Vanda ! cria Rocambole.
Une voix monta des profondeurs ténébreuses de cet abîme :
– Me voilà ! disait-elle.
Rocambole décrocha sa corde et en fixa une extrémité à un bloc de rocher qui se trouvait auprès de l’excavation.
Puis, quand il fut certain qu’elle était solidement attachée, il dit à Philippette :
– Fais le guet, je descends ; la pauvre femme doit être trop exténuée de fatigue et de faim pour avoir la force de monter toute seule.
Philippette eut bien envie, en ce moment, de réclamer son argent.
Mais la crainte que Rocambole ne se défiât du piège qu’on lui avait si habilement tendu jusque-là, l’en empêcha.
Rocambole saisit la corde et descendit avec l’adresse et la légèreté d’un somnambule.
Philippette voyait la corde se tendre sous le poids de son corps.
Tout à coup la broussaille voisine s’agita, un être humain s’avança en rampant jusqu’à Philippette qui recula.
C’était Timoléon.
– Vous ! dit la vieille.
– Moi, tais-toi !
Et Timoléon qui tenait une hache à la main, coupa la corde d’un seul coup.
On entendit en même temps la chute d’un corps, puis un cri de douleur remonta des profondeurs de l’abîme.
* *
*
X
La corde à laquelle il s’était suspendu, se détachant tout à coup, et avant qu’il n’eût touché le sol, Rocambole était tombé d’une hauteur de quinze ou vingt pieds.
Mais le sol de la carrière était humide et offrait une espèce d’élasticité qui amortit sa chute.
Le cri qui lui échappa, et qui monta vibrer aux oreilles de Timoléon, était moins un cri de douleur qu’un cri d’effroi.
Si brave que soit un homme, et en fait de bravoure, Rocambole avait fait ses preuves, il ne se laisse pas choir dans un abîme inconnu et au milieu d’une obscurité profonde sans un premier mouvement d’épouvante.
Au cri qu’il avait poussé, un autre cri avait répondu, celui de Vanda.
Mais Rocambole laissa tout aussitôt échapper un juron formidable et ajouta :
– La vieille sorcière, il faut qu’elle ait détaché la corde.
– Mon Dieu ! dit Vanda, n’es-tu pas blessé, au moins ?
– Je ne crois pas, mais je suis étourdi et moulu.
Et au milieu de ces ténèbres opaques, Rocambole se prit à se tâter et à se palper par tout le corps, puis fit jouer ses membres l’un après l’autre afin de s’assurer qu’il n’avait rien de fracturé.
Il tenait debout sur ses pieds et se mit à faire quelques pas.
Déjà Vanda lui avait jeté ses deux bras autour du cou.
– Enfin ! disait-elle, enfin ! te voilà !…
– Me voilà prisonnier comme toi, dit Rocambole, on m’a tendu un piège et j’y suis tombé comme un niais.
Et, acheva-t-il avec un éclat de rire, il y a des gens qui croient en moi !
Un homme aussi intelligent que Rocambole ne pouvait pas se tromper une minute sur l’accident dont il venait d’être victime.
Cet accident était préparé ; et c’était une trahison.
– Nous avons été roulés, murmura-t-il, maintenant, il faut voir à nous tirer d’affaire.
Et il fouilla dans ses poches et en retira une boîte d’allumettes bougies.
Un danger qu’on peut voir est à moitié conjuré.
Quand l’allumette eut brillé, Rocambole examina à sa lueur le lieu où il était.
Il vit au-dessus de lui, à trente pieds de haut, un trou rond.
C’était le trou qu’il avait fait lui-même, comme s’il eût voulu creuser son tombeau.
La carrière affectait assez correctement la forme d’une cloche et le trou par lequel Rocambole était tombé se trouvait juste au milieu de cette espèce de coupole.
Quant à la corde, elle s’était arrondie à ses pieds.
Remonter vers ce trou était impossible : un chat, mais non un homme, y serait peut-être parvenu.
Les yeux de Rocambole tombèrent sur la porte qui fermait le couloir du puits.
Mais Rocambole, ce jour-là, avait fait toutes les imprudences.
Son pic était demeuré au haut de la crevasse.
Il n’avait d’autre engin pour enfoncer cette porte que deux ou trois pierres qui s’étaient détachées de la voûte qu’il avait effondrée.
Mais il avait sur-le-champ retrouvé son merveilleux sang-froid, et il dit à Vanda :
– Nous sommes ensemble, c’est beaucoup. Sortir d’ici n’est plus rien.
– Ce misérable Timoléon, murmura Vanda, il ne t’a pas attiré ici sans avoir pris toutes ses précautions.
– Je suis armé, répondit Rocambole, nous verrons bien.
Mais, auparavant, ajouta-t-il en laissant échapper l’allumette qui commençait à lui brûler les doigts, auparavant, il faut y voir clair.
Il reprit sa boîte d’allumettes et la donna à Vanda.
– Tu m’éclaireras, dit-il.
Les allumettes qu’on appelle des bougies brûlent environ deux ou trois minutes.
Vanda avait parfaitement compris Rocambole.
Une seconde allumette prit feu, et Rocambole, à sa lueur, étudia de nouveau la configuration de la carrière.
Dès lors, il fut fixé.
Tous ses efforts devaient se concentrer sur la porte.
Il la tâta, comme on dit, en se ruant sur elle et en lui donnant un vigoureux coup d’épaule.
La porte ne bougea pas.
Il recommença et ne parvint qu’à se meurtrir.
Alors, à la clarté d’une troisième allumette, il s’empara de la plus grosse pierre et en fit une sorte de merlin.
Puis il se rua de nouveau sur la porte, espérant toujours l’enfoncer.
Malheureusement c’était une pierre tendre que celle dont il se servait, une pierre à plâtre, comme on dit.
Au lieu d’entamer la porte, elle s’entama elle-même et se fendit en trois morceaux.
Le bloc de roche était devenu poussière, et la porte résistait toujours.
Rocambole prit une seconde pierre qui, bientôt, eut le même sort.
Mais soudain Vanda lui mit la main sur l’épaule :
– Tais-toi, dit-elle.
– Qu’est-ce ? fit Rocambole frémissant.
– N’entends-tu pas ?
– Un bruit… là… derrière…
Et elle laissa tomber l’allumette d’une main, après avoir montré la porte de l’autre.
Le silence et l’obscurité se firent de nouveau dans la carrière.
Rocambole, prêtant l’oreille, entendit, en effet, derrière la porte, un bruit sourd qui allait grandissant.
C’était le bruit d’une scie.
Et il mit la main sur l’un de ses pistolets, disant à Vanda :
– Place-toi derrière moi et ne bougeons pas.
La scie allait son train.
Tout à coup, derrière la porte, une lueur se fit. On avait allumé soit une lampe, soit une torche.
En même temps, la scie à main traversa la porte et se mit à travailler régulièrement, perçant un trou d’une circonférence parfaite.
Rocambole colla ses lèvres à l’oreille de Vanda.
– Qui sait ? dit-il, c’est peut-être Milon qui m’aura suivi malgré ma défense et qui travaille à nous délivrer.
Vanda ne répondit rien.
À mesure que la scie marchait, la lumière qui brillait de l’autre côté de la porte grandissait.
Tout à coup le panneau scié se détacha…
C’est-à-dire qu’il se fit dans la porte une brèche de la largeur d’une assiette, et en même temps, un flot de lumière frappa Rocambole et Vanda au visage.
En même temps aussi, une voix railleuse s’écria :
– Allons, Rocambole, je crois que nous allons faire notre dernière partie, et que tu as perdu d’avance.
Et le trou pratiqué dans la porte encadra une seconde le visage lumineux et grimaçant de Timoléon.
– Pas encore ! répondit Rocambole, qui allongea vivement sa main armée de l’un de ses pistolets, et fit feu !…
XI
La carrière répercuta le coup de pistolet avec un bruit tel que l’on eût dit qu’elle s’écroulait.
En même temps, la tête de Timoléon avait disparu de ce judas que le misérable venait d’improviser.
La détonation roula d’échos en échos pendant dix secondes, puis s’apaisa peu à peu et le silence se fit.
La lumière qui brillait de l’autre côté de la porte s’était éteinte.
Timoléon était-il mort ?
Rocambole l’espéra un moment, toutefois il ne bougea pas.
Mais son espoir fut de courte durée.
Un éclat de rire moqueur retentit de l’autre côté de la porte et exaspéra Rocambole, qui s’arma de son second pistolet.
Timoléon, au moment où Rocambole faisait feu, s’était baissé rapidement et la balle avait passé au-dessus de sa tête.
– Tu tirais mieux que cela autrefois, disait le misérable. La main te tremble, à ta dernière heure, Rocambole !
– Ma dernière heure est loin encore ! répondit Rocambole.
Et il fit feu de nouveau.
Cette fois il entendit un cri de douleur, suivi de ce mot :
– Touché !
Rocambole se rua une fois encore contre la porte, et passant ses mains à travers le judas, il se mit à la secouer avec fureur.
Mais la porte ne bougea pas, elle était d’une solidité à toute épreuve.
– Touché ! touché ! répétait Timoléon, mais je serai vengé ! Rocambole… ta dernière heure est venue.
– Nous serons vengés tous deux ! disait une autre voix derrière Timoléon avec l’accent d’une haine sauvage.
– Pas encore ! répondait Rocambole, secouant toujours la porte sans résultat.
Vanda, immobile derrière lui, ne comprenait pas encore comment Timoléon exécuterait sa vengeance, mais elle prévoyait quelque chose de sinistre et d’épouvantable.
– Rocambole, hurlait Timoléon, tu ne comptais plus sur moi, n’est-ce pas ? tu ne croyais pas que je reviendrais jamais ?… Ah ! ah ! ah ! tu te trompais !
Ma fille est morte ! pouvais-je te craindre, désormais ?
Je t’ai suivi pas à pas, dans l’ombre, t’épiant jour par jour, détruisant patiemment ton œuvre.
Tu t’intéressais à Gipsy, tu voulais te débarrasser de sir James ?
Eh bien ! j’ai délivré sir James et sir James tuera Gipsy.
Je veux que tu saches tout cela, avant de mourir… car tu vas mourir. Ah ! ah ! ah ! tu vas mourir !
Et Timoléon se tordait en blasphémant sur le sol du couloir souterrain : mais à la vigueur de sa voix, on devinait que s’il était grièvement blessé, du moins sa blessure le laisserait vivre quelque temps encore.
Rocambole s’empara de la boîte d’allumettes que tenait Vanda.
Et s’étant procuré de la lumière, il passa son bras en dehors de la porte, de façon à éclairer le couloir.
Alors un spectacle étrange s’offrit à ses yeux.
Le couloir qui avait à peine trois pieds de large renfermait deux hommes et un objet dont Rocambole n’entrevit d’abord la forme qu’imparfaitement, car il était à demi-masqué par les deux hommes.
L’un de ceux-ci cherchait à soulever l’autre.
C’était le Pâtissier.
L’autre, Timoléon, faisait de vains efforts pour se remettre sur ses pieds et retombait sur le sol en poussant des cris de rage.
La balle de Rocambole lui avait fracassé la cuisse.
– Ah ! disait Timoléon, écumant de rage, tu n’en as pas moins perdu la partie, Rocambole !
En même temps, il se traîna pour démasquer l’objet que Rocambole n’avait fait qu’entrevoir.
C’était le baril.
Rocambole, à son tour, poussa un cri de fureur.
Timoléon dit encore, s’adressant cette fois au Pâtissier :
– Mets le feu à la mèche, charge-moi sur tes épaules et allons-nous-en !
Rocambole devina alors ce que contenait le baril.
Le Pâtissier exécuta l’ordre qu’il avait reçu.
Il se procura du feu au moyen d’un briquet et ralluma la mèche soufrée que tout à l’heure Timoléon avait éteinte.
Rocambole, au contraire, avait laissé tomber son allumette, et maintenant si la lumière était dans le couloir souterrain, l’obscurité régnait dans la carrière.
– Dépêchons-nous, ricanait Timoléon, s’adressant au Pâtissier. Dépêchons-nous ! Il ne faut pas faire attendre Rocambole.
Et il grinçait des dents comme un damné que retournerait sur son brasier la fourche de Satan.
Le Pâtissier enleva alors la bonde du baril et introduisit par cette ouverture l’autre extrémité de la mèche.
Cette mèche avait environ cinq pieds de longueur.
Elle pouvait brûler une demi-heure environ.
Puis la mèche ainsi fixée, le Pâtissier en dressa l’autre extrémité contre la paroi du souterrain.
– Maintenant, filons ! dit Timoléon, nous n’avons plus rien à faire ici.
Adieu, Rocambole !
Le Pâtissier reprit Timoléon dans ses bras et le chargea sur son épaule, répétant :
– Bonsoir, Rocambole ! Je te promets que ton protégé Marmouset passera un mauvais quart d’heure.
Rocambole, sinistre et calme, serrait Vanda dans ses bras.
Il vit le groupe s’éloigner, et il ne poussa pas un cri.
La mèche brûlait lentement.
Au bout de quelques secondes, on entendit un nouveau cri de Timoléon, suivi d’un blasphème épouvantable.
Et Rocambole et Vanda écoutèrent.
– Lâche ! lâche ! criait Timoléon qui était arrivé dans le puits.
– Je n’ai pas de corde et je ne peux pas vous monter, répondait le Pâtissier ; ce n’est pas de ma faute si vous êtes trop lourd et si vous avez la cuisse cassée.
– Vas-tu donc me laisser ici ? criait Timoléon.
– Il le faut bien, répondait le Pâtissier dont la voix plus lointaine annonçait à Rocambole qu’il était hors du puits. Il le faut bien, dans un quart d’heure la carrière sautera… bonsoir.
– Lâche ! hurlait Timoléon.
Alors Rocambole, qui collait toujours son visage au trou pratiqué dans la porte, vit reparaître Timoléon qui se traînait sur le sol du couloir comme un reptile.
Il eut un moment d’espoir et crut que l’instinct de sa propre conservation dominerait la haine sauvage qui remplissait le cœur du misérable et qu’il arracherait la mèche du baril.
Mais cet espoir fut de courte durée.
Timoléon se coucha auprès du baril et dit avec un accent de rage suprême :
– Eh bien ! nous mourrons ensemble !
La mèche brûlait toujours et Rocambole, serrant Vanda sur sa poitrine, proféra ces mots :
– Il faut mourir !…
XII
Tandis que la mèche brûlait, tandis que Rocambole, Vanda et Timoléon attendaient le moment fatal où le baril de poudre ferait explosion, d’autres événements se passaient rue du Vert-Bois.
Comme nous l’avons vu, Rocambole n’avait pas voulu emmener Milon, en dépit des sinistres pressentiments de celui-ci.
Milon avait ordre de veiller sur Gipsy et Marmouset.
Et cependant, si jamais Milon avait eu envie de désobéir à Rocambole, c’était assurément ce jour-là.
– Je ne sais pas, murmura-t-il tandis que le fruitier refermait sa boutique, mais j’ai idée qu’il va arriver malheur au maître.
– Oh ! dit la belle Marton, quelle idée !
– Nous avons affaire de nouveau à Timoléon, dit Milon, et j’aimerais mieux tous les Étrangleurs de la terre contre nous.
– Bah ! fit le fruitier, les Étrangleurs ne sont pas dangereux. Du moins celui que nous avons mis dans la cave, là-bas, n’a pas encore donné signe de vie.
Je suis descendu tout à l’heure pour chercher le pic, rien n’a bougé.
– Il dort sans doute encore, fit Milon.
Comme Milon disait cela, on frappa doucement à la porte de communication qui, de l’allée, ouvrait dans la boutique.
C’était, comme on dit, la porte des locataires.
Le fruitier alla ouvrir et fit un geste de surprise en voyant entrer Marmouset.
Marmouset était pieds nus et en chemise.
Sans doute quelque événement inattendu l’avait arraché de son lit.
De plus, il posait mystérieusement un doigt sur ses lèvres.
– Qu’est-ce qu’il y a ? dit le fruitier de plus en plus étonné.
– Il y a, dit Marmouset en entrant, que nous sommes refaits et le maître aussi.
Milon sentit quelques gouttes de sueur perler à ses tempes.
Marmouset reprit :
– C’est dans la cave que vous avez mis l’Anglais ?
– Oui.
– Et vous croyez qu’il y est encore ?
– Dame !
– Eh bien ! il n’y est plus, dit Marmouset.
– Oh ! fit le fruitier, c’est impossible.
– Il s’est échappé…
– Mais par où ?
– Je ne sais pas.
– Échappé ! murmura Milon dont les cheveux blancs se hérissèrent.
– Heureusement, dit Marmouset, que nous allons le reprendre.
– Où est-il donc ?
– Dans la maison.
Marmouset parlait toujours à voix basse.
– Ah ! mais par exemple ! dit-il, faut pas faire du bruit, et il faut ôter vos souliers.
– Pourquoi ? demanda le fruitier.
– Écoutez donc, reprit Marmouset.
Et s’adressant au fruitier :
– Vous avez un nouveau locataire depuis deux jours ?
– Oui.
– Un vieux qui tient un bureau de placement ?
– C’est cela.
– Eh bien ! l’Anglais est chez lui.
Cela paraissait si extraordinaire que le fruitier regarda Marmouset, comme s’il eût douté que l’enfant jouît en ce moment de sa raison.
– Écoutez, vous allez voir, reprit Marmouset.
– Parle.
– Vous savez que Gipsy couche dans la pièce du fond, celle qui n’est séparée que par une cloison de l’appartement du vieux ?
– Oui. Eh bien ?
– J’étais couché depuis une heure et je commençais à m’endormir. Il m’a semblé que Gipsy se plaignait et je suis entré dans sa chambre sur la pointe du pied.
Depuis qu’elle est folle, elle pleure souvent en dormant et elle a des cauchemars.
Je me suis donc approché de son lit ; mais elle dormait et ne rêvait plus.
J’allais me retirer, lorsque tout à coup j’ai vu comme un point lumineux dans le fond de l’alcôve :
C’était un petit trou dans le mur ; un trou rond et percé avec une vrille.
Le lit de Gipsy ne touche pas au mur ; un sentiment de curiosité m’a poussé à entrer dans l’alcôve.
J’ai collé mon œil à ce trou et j’ai regardé, me disant :
– Qu’est-ce que peut bien faire mon voisin, à cette heure ?
Un homme était assis devant une table, de l’autre côté du trou, c’est-à-dire dans l’appartement du vieux.
Cet homme avait le visage tourné de mon côté.
– Eh bien ?
– Ce n’était pas le vieux ; c’est l’Anglais ! Si vous en doutez, venez avec moi.
Milon et le fruitier ôtèrent leurs souliers et tous deux sans lumière, ils se glissèrent dans l’allée de la maison et montèrent l’escalier en retenant leur souffle.
Marmouset, en sortant, avait ouvert la porte sans bruit et l’avait laissée entre-bâillée.
Gipsy dormait toujours.
Marmouset pénétra de nouveau dans l’alcôve et de nouveau colla son œil au trou.
Puis il prit Milon par la main et, l’attirant doucement, il le força à prendre sa place.
Milon regarda à son tour et recula ensuite d’un pas.
– C’est lui ! dit-il.
Marmouset saisit de nouveau le bras de Milon :
– Oui, dit Milon.
Mais comme s’il eût été saisi de vertige, ou du moins comme s’il avait eu peur d’être abusé par ses propres yeux, il se tourna vers le fruitier et le poussa à son tour vers le trou pratiqué dans la cloison.
Le fruitier n’avait vu sir James qu’endormi, et par conséquent, comme mort.
Maintenant sir James avait les yeux ouverts et il était dans l’attitude calme d’un homme qui se croit seul.
Néanmoins le fruitier le reconnut.
– Oui, dit-il, c’est bien lui.
– Que faut-il faire ? demanda Milon.
– C’est bien simple, répondit Marmouset.
– Ah !
– Qu’a voulu le maître en le jetant dans un cul de basse fosse ? le supprimer provisoirement, n’est-ce pas ?
– Oui.
– Eh bien ! dit Marmouset, allons !
Et il se dirigea vers la porte.
– Un moment, dit le fruitier.
– Qu’est-ce qu’il y a ? demanda Milon.
– Je me méfie des Anglais, dit le fruitier. Ils ont toujours des revolvers dans leurs poches.
– C’est bien possible, fit Marmouset.
– Et je vas prendre mon merlin, ajouta le fruitier.
Or, le merlin est une sorte de marteau avec lequel on tue un homme d’un seul coup.
XIII
Tandis que le fruitier descendait chercher son merlin, Milon et Marmouset s’étaient glissés sur le carré et s’étaient placés en sentinelle à la porte du logement de Timoléon, de façon à couper toute retraite à sir James Nively qui pouvait avoir entendu quelque bruit et être pris du désir de fuir.
Le fruitier remonta.
– Un instant, dit Marmouset, si vous m’en croyez, vous me laisserez jaser le premier avec l’Anglais.
– Comme tu voudras, dit Milon.
Marmouset frappa à la porte.
Un bruit de chaise vivement remuée apprit à l’enfant et à ses compagnons que sir James s’était levé brusquement.
Mais on ne répondit pas, et la porte ne s’ouvrit point.
– Voilà un coup d’épaule à donner, souffla Marmouset à l’oreille de Milon.
Le géant ne se le fit pas répéter.
Il s’arc-bouta contre la porte, donna une secousse et la porte s’ouvrit avec fracas.
Sir James jeta un cri de stupeur et peut-être même d’épouvante en voyant ces trois hommes faire irruption dans la chambre.
Il avait reconnu Marmouset et Milon.
Le fruitier, sur un signe de Marmouset, se rua sur sir James, le saisit à la gorge et leva son terrible merlin, disant :
– Si tu pousses un cri, tu es mort !
Sir James était un homme de prodigieux sang-froid, et si désespérée que lui parût la situation, il résolut de lui tenir tête.
Il fit un signe de la main qu’il ne voulait opposer aucune résistance.
– Lâche-le, dit Marmouset, nous allons causer.
Milon, sur un geste de Marmouset, allait fermer la porte, lorsque la belle Marton et son chien entrèrent.
– Je veux en être, moi aussi, dit Marton.
Sir James avait croisé ses bras sur sa poitrine et regardait tous ces gens-là avec calme.
– Que me voulez-vous ? dit-il.
– Ferme la porte, Milon, dit Marmouset.
Puis s’adressant à sir James :
– Milord, dit-il, nous n’avons pas besoin de vous demander votre nom. Vous êtes sir James Nively, le chef des Étrangleurs de Londres, mais nous désirons savoir comment, vous ayant enterré vivant, il y a quarante-huit heures, dans une cave, nous vous retrouvons ici.
– C’est fort simple, répondit sir James, mes amis m’ont délivré.
– Je le pense bien, répliqua Marmouset, seulement ils ont eu tort de vous déposer ici puisque vous voilà retombé en notre pouvoir.
– Aussi, dit froidement l’Anglais, suis-je prêt à céder à la force.
– En vérité !
– Et à retourner dans la cave.
– Oh ! non pas, fit Marmouset.
– Ou à vous suivre où il vous plaira de m’emmener, dit encore sir James.
– Ceci est une erreur, fit Marmouset.
– Je ne comprends pas.
– Un homme qui, comme vous, sort d’une cave, en état de léthargie, est trop difficile à garder. Le maître ne nous a pas donné d’ordres précis vous concernant, puisqu’il ignore encore votre évasion, mais certainement il nous approuvera.
En même temps, Marmouset fit un nouveau signe au fruitier :
– Tu as une bonne poigne, dit-il, passe ton merlin à Milon et étrangle-moi un peu milord.
Sir James pâlit ; mais il ne prononça pas un mot.
Milon s’était emparé du merlin, et le fruitier commençait à serrer la gorge de sir James.
– Un moment, dit Marmouset.
Le fruitier s’arrêta dans sa pression et le merlin prêt à retomber sur la tête de sir James, demeura suspendu.
– Milord, dit Marmouset, si vous voulez gagner une heure ou deux, et attendre, par conséquent, le retour du maître, qui décidera de votre sort, vous ferez bien de nous faire des révélations.
– Hein ? fit sir James toujours calme et qui avait paru attendre la mort avec l’impassibilité des Orientaux.
– Quels sont les amis qui vous ont tiré de la cave ?
– Je ne sais pas.
– Allons donc ! comment êtes-vous ici ?
– Je ne sais pas…
– Prenez garde ! dit Marmouset, nous n’avons pas le temps de flâner.
– Mais enfin, s’écria Milon dont un soupçon traversa l’esprit, si Monsieur est ici, c’est que le locataire de l’appartement l’a bien voulu.
Un sourire passa sur les lèvres de sir James.
– C’est probable, dit-il.
– Comment ! exclama le fruitier, ce vieux ?…
– Ce vieux, dit Milon, est évidemment un complice de l’Anglais, et il nous a tous roulés…
– Alors, dit Marmouset, Monsieur va nous dire son nom.
Sir James haussa les épaules.
– Je l’ignore, dit-il.
– Prenez garde ! répéta Marmouset, si vous vous obstinez je vous fais assommer à coups de marteau.
– Non, dit Milon, le maître ne l’a pas dit.
– Mais, s’écria Marmouset, le maître court peut-être un danger à cette heure.
Sir James ne répondit pas ; mais un éclair de joie sauvage brilla dans ses yeux ; et Marmouset surprit cet éclair.
En même temps, le chien qui, depuis deux minutes furetait dans la chambre, se mit à hurler.
Il avait trouvé sur un fauteuil la vieille houppelande du prétendu placeur et il la mordait avec fureur :
– C’est la pelure d’un ennemi, bien sûr, bien sûr ! dit la belle Marton.
Milon eut de nouveau un éclair d’intelligence.
– Comment est-il ce vieux-là ? demanda-t-il au fruitier.
Le fruitier lui dépeignit de son mieux le bonhomme.
Un nom jaillit des lèvres de Milon :
– Timoléon ! dit-il.
En même temps un mouvement échappa à sir James.
– Nous sommes fixés, murmura Marmouset, qui avait surpris ce mouvement.
Le chien hurlait de plus belle.
– Mes amis, dit Marmouset, je partage l’opinion de Milon. Le maître court un grand danger, et il faut sauver le maître. Le bonhomme qui a loué cette chambre n’est autre que Timoléon. Où est-il ? Il faut que monsieur nous le dise !
Sinon, monsieur va mourir.
Milon avait repris son merlin, et le fruitier, sautant à la gorge de sir James, l’avait terrassé.
– Tuez-moi ! ricana sir James ; mais vous ne saurez rien… et je mourrai vengé !
– Frappe, Milon, frappe ! dit Marmouset.
Mais la belle Marton arrêta le bras de Milon.
– C’est pas la peine, dit-elle ; nous n’avons pas besoin de monsieur pour savoir où est Timoléon.
Le chien, qui entendait retentir ce nom pour la seconde fois, aboyait avec rage.
– Et comment le retrouverons-nous ? demanda Milon ?
– Mon chien est là, dit Marton.
Et s’adressant à l’animal :
– Cherche Timoléon, dit-elle, cherche ! cherche !
Le chien s’était élancé vers la porte.
Marmouset se retourna vers Milon :
– Cette femme a raison, dit-il. Le fruitier et la Mort-des-braves vont garder l’Anglais à vue, jusqu’à ce que nous revenions, toi et moi. Ils feront même bien de le ficeler un peu ; et, ma foi ! s’il fait du tapage…
– Faudra-t-il jouer du merlin ? dit le fruitier.
– Oui.
– Mais nous… fit Milon ?…
– Nous, dit Marmouset, nous allons suivre Marton, c’est-à-dire son chien, et si nous retrouvons Timoléon, il faudra bien qu’il nous dise ce qu’il a fait du maître.
La belle Marton s’était emparée de la houppelande et la faisait sentir au chien qui hurlait toujours avec fureur, ses yeux sanglants tournés vers la porte.
XIV
Marmouset avait reconquis cette autorité dont il jouissait au départ de Londres, de par la volonté de Rocambole.
Milon, le fruitier, la Mort-des-braves et la belle Marton, qui le voyait pour la première fois, s’étaient franchement mis sous ses ordres.
En un tour de main, sir James Nively réduit à l’impuissance fut garrotté et reporté dans la cave ; mais, au lieu de le rejeter dans le puits et de l’y laisser seul, on le coucha sur une planche à bouteilles, et la Mort-des-braves, armé du merlin, demeura auprès de lui.
Quand ce fut fait, Marmouset dit au fruitier.
– Rappelle-toi que tu nous réponds de Gipsy.
– Sois tranquille, dit le fruitier.
– En route ! dit Marmouset qui fit signe à la belle Marton et à Milon.
La belle Marton avait passé, en guise de laisse, un mouchoir au cou de son chien, car l’animal voulait absolument s’élancer dehors et elle avait toutes les peines du monde à le retenir.
– Mais tu vas emporter tes pistolets, j’imagine, dit Milon à Marmouset.
– Ça fait du bruit, répondit le gamin, mais enfin, on ne sait pas…
Et il glissa un revolver dans la poche de son pantalon.
Mais avec le revolver il prit un poignard, ajoutant :
– Voilà qui vaut mieux.
– J’ai envie d’aller changer le mien pour le merlin qu’a la Mort-des-braves, dit Milon.
– Non, c’est inutile, il ne faut pas perdre de temps. Partons…
– Mais où allons-nous ?
– À la recherche de Timoléon, fit Marmouset.
– Ne vaudrait-il pas mieux se mettre à la recherche du maître ? dit Milon.
– Non.
– Pourquoi ?
– De deux choses l’une, dit Marmouset. Ou le maître ne court aucun danger, et il vaut mieux mettre la main sur Timoléon que de le gêner, lui, dans ses plans : – ou le maître est menacé réellement de ce péril que tu redoutes, et alors Timoléon est l’auteur de ce péril.
– C’est juste, fit Milon.
– Par conséquent, en nous emparant de Timoléon nous sauvons Rocambole.
– Tu parles d’or, mon enfant. En route !
La belle Marton était déjà sur le seuil de la porte extérieure de la maison.
– Faut-il lâcher le chien ? demanda-t-elle.
– Sans doute, répondit Marmouset, mais pourrons-nous le suivre ?
– Quand il ira trop vite, je le rappellerai, répondit-elle.
Alors commença au cœur de Paris, une de ces chasses étranges, merveilleuses, qu’on eût dite empruntée à quelque récit de trappeur ou de pionnier du Nouveau-Monde.
On sait comment les gardes-chasse et les piqueurs pratiquent, en forêt, la nuit, cette opération qu’on appelle faire le bois.
Quelquefois le piqueur est seul, quelquefois aussi un valet de chiens l’accompagne.
La nuit est silencieuse, ni lumineuse, ni très obscure ; le vent est tombé. La grande forêt dort avec ses hôtes divers, l’oiseau sur la branche, la tête sous l’aile, le chevreuil dans sa reposée.
À dix pas des deux chasseurs nocturnes, un chien, un limier, marche non moins silencieux, traînant un cordeau dont un des gardes tient l’extrémité.
Le limier quête sagement, s’arrête parfois, étouffe un coup de voix et continue.
S’il s’est arrêté longtemps, s’il a le nez bien collé à l’empreinte découverte, piquet de chevreuil ou piquet de sanglier, les piqueurs s’approchent, rompent une branche d’arbre et marquent la brisée.
Puis le limier continue sa recherche.
La chasse que Milon, Marmouset et la belle Marton venaient d’entreprendre ressemblait à celle-là.
Le caniche marchait en avant, tantôt au pas, le nez à terre, tantôt la tête au vent et au petit galop.
Un coup de voix qui lui échappait de temps à autre apprenait aux trois chasseurs qu’il était toujours sur la voie.
Timoléon s’en était allé à pied jusqu’au boulevard ; mais dans le faubourg Saint-Martin, il avait pris une voiture.
Là il y eut, comme on dit, un défaut.
Le caniche arrivé sur le trottoir de gauche, bondit en avant, s’arrêta, revint en arrière, s’arrêta encore, jappa avec inquiétude.
– Cherche, Phanor ! cherche ! disait la belle Marton.
Et elle faisait sentir au chien la houppelande de Timoléon, dont elle avait fait un paquet.
Il était minuit passé et les passants commençaient à être rares dans le faubourg.
Néanmoins quelques-uns s’attroupèrent et l’un d’eux demanda de quoi il était question.
– Nous faisons la chasse aux rats, répondit Milon.
Les passants continuèrent leur chemin.
Phanor était descendu dans le ruisseau et flairait les pavés comme il avait flairé le trottoir.
Évidemment, c’était là que Timoléon avait cessé de toucher le sol, et par conséquent d’y laisser un fumet identique à celui qui s’exhalait de la houppelande.
Milon et Marmouset le regardaient aller, venir et revenir au même point, avec une inquiétude croissante.
Avaient-ils donc trop présumé de l’intelligence du chien ?
Marton seule ne donnait aucune marque d’anxiété et disait :
– Il a été chien de recors, il finira bien par trouver.
En effet, le caniche fit entendre tout à coup un long aboiement, s’éloigna du trottoir, et se mit à suivre une trace mystérieuse.
Un réverbère projetait sa clarté jusque sur le milieu de la chaussée.
Marmouset suivit le chien et dit tout à coup :
– Bon ! il a compris, et moi aussi.
– Timoléon est monté en voiture. Venez voir…
Et il revint vers cet endroit du trottoir où le chien avait hésité si longtemps, et il montra à Milon les roues imprimées dans le ruisseau, en même temps que les pieds du cheval.
– Eh bien ? fit encore Milon.
– Eh bien ! le chien va suivre la voiture, comme il aurait suivi l’homme.
– Mais c’est impossible !
– Pourquoi ?
– Parce qu’il a passé deux cents voitures peut-être l’une après l’autre, dans la rue.
– Bah ! fit Marmouset, qui paraissait sûr de son fait, un bon chien ne fait jamais change. L’animal chassé peut bien passer au milieu d’un troupeau d’animaux semblables, les chiens ne s’y trompent pas.
En route !
Le chien, par ses allures, semblait donner raison à l’opinion de Marmouset.
Il s’en allait droit son chemin, le nez au vent, la démarche égale, remontant le faubourg Saint-Martin en droite ligne.
– Oui, oui, dit Marton, nous pouvons le suivre ; il est sur les traces de Timoléon.
– Suivons-le donc, s’écria Milon ; car il faut sauver Rocambole !
XV
À mesure qu’on remontait le faubourg Saint-Martin, les passants devenaient plus rares et les boutiques étaient fermées.
Seules, quelques devantures de marchands de vins entr’ouvraient parfois furtivement leurs portes basses et laissaient échapper quelques buveurs attardés.
De temps en temps, Milon secouait la tête en disant :
– Je ne crois pas que ce chien puisse réellement suivre une voiture.
– Oh ! disait la belle Marton avec confiance, il en a fait bien d’autres !
Mais Milon changea tout à coup de langage.
Le chien venait d’arriver à la rue Lafayette, qui coupe le faubourg Saint-Martin tout en haut.
L’animal n’hésita pas.
Au lieu de continuer à suivre le faubourg, il prit la rue Lafayette à droite.
C’était la route des buttes Saint-Chaumont.
Et Milon se souvenait que c’était déjà le chemin que le cocher de fiacre leur avait fait prendre la veille.
Le chien suivit exactement la même route, arriva dans le chemin creux et s’arrêta.
Évidemment, Timoléon avait renvoyé la voiture à cet endroit.
– Cherche ! cherche ! disait Marton.
Et elle lui donna à flairer la hoppelande de Timoléon.
Le chien remit son nez par terre et, tout à coup, poussa un hurlement.
– Marchons ! dit Marmouset.
– Nous sommes déjà venus ici, dit Milon qui se baissa pour examiner le sol.
– Quand ?
– La nuit dernière.
En même temps, Milon frotta une allumette sur son pantalon et s’abaissa vers les empreintes qu’avaient laissées les roues de la voiture.
Mais Marmouset s’écria :
– Ce n’est pas une voiture qui est venue ici, mais deux.
– La nôtre d’hier, dit Milon.
– Non, deux ce soir.
– Eh bien ?
– Celle de Timoléon et celle du maître.
Et Marmouset siffla le chien qui revint sur ses pas, en lui disant :
– Cherche ! cherche !
L’intelligent caniche se mit à flairer l’une des empreintes et ne dit mot ; mais il donna de la voix sur la seconde.
– C’est celle de la voiture de Timoléon, dit Marmouset.
– Bon ! fit Milon qui ne comprenait pas encore.
– Et elle a passé avant l’autre, à preuve que la seconde a tourné dessus et a effacé à demi le train.
– Qu’est-ce que cela prouve ? demanda Milon.
– Cela prouve, répondit Marmouset, de deux choses l’une : ou Rocambole poursuit Timoléon, ou Timoléon a tendu un piège à Rocambole.
De toute façon il faut nous hâter.
Le chien, laissé libre, s’était remis à suivre Timoléon à la piste.
Milon, Marmouset et Marton se remirent en route derrière lui.
Ils se rendirent tous trois dans cette vaste plaine de Pantin que Milon et Rocambole avaient inutilement explorée la veille.
Le caniche filait tout droit.
Quand il eut franchi le torrent desséché en passant sur la planche qui servait de pont, il hésita un moment encore ; puis il prit à travers champs, et se dirigea vers le puits.
– Où diable nous mène-t-il ? dit Marmouset.
Mais le chien tourna sur lui-même, s’éloigna du puits presque aussitôt, monta vers une broussaille qui se trouvait à cent mètres, la fouilla et en sortit un peu indécis encore.
Marmouset avait armé son revolver et Milon saisi son poignard.
Le chien redescendit vers le puits.
Tout à coup, des cris confus arrivèrent aux oreilles de Marmouset.
Ces cris semblaient partir de dessous lui.
– Couchons-nous ! dit Marmouset.
Et tous trois se jetèrent à plat ventre sur le trou.
Le chien s’était rapproché du puits.
Soudain un homme en sortit et se mit à fuir.
Le chien aboya ; mais il ne se lança pas à la poursuite de cet homme.
Tout au contraire, il se précipita de nouveau vers le puits, hurlant de plus belle.
L’homme fuyait.
Mais à cent mètres du puits, Milon se dressa devant lui et le saisit à la gorge.
– Le Pâtissier ! exclama Marmouset, qui reconnut son ancien chef.
– Laissez-moi ! laissez-moi ! dit le Pâtissier, cherchant à se dégager.
Mais le vieux géant l’avait renversé sous lui en disant :
– Si tu ne me dis pas où est Rocambole, tu es mort !
– Rocambole ! hurla le Pâtissier à demi étranglé… Rocambole !… ah ! ah ! ah !
– Parle, ou je te tue ! dit Milon qui lui effleura la gorge avec son poignard.
– Je ne sais pas ! dit le Pâtissier.
– Tu mens !
Le Pâtissier jeta un cri, car la pointe du stylet avait entamé sa gorge.
– Parle ! répéta Milon, où est Rocambole ?
– Perdu, répondit le Pâtissier.
– Perdu !
– Et vous aussi, ricana le misérable, si vous ne me laissez pas fuir… et si vous ne fuyez pas avec moi…
Milon le regarda d’un œil hagard.
– T’expliqueras-tu ? dit-il.
– Dans cinq minutes, la poudre aura pris feu et nous sauterons !
Ces mots produisirent sur Milon une émotion telle qu’il cessa d’appuyer son genou sur la poitrine du Pâtissier.
Celui-ci se releva, voulant se dégager et fuir de nouveau.
Mais la main de fer de Milon l’étreignit.
– Laissez-moi…, ou nous sommes tous perdus ! répétait le Pâtissier, dont les dents claquaient de terreur.
Et comme Milon ne le lâchait pas :
– Rocambole et Timoléon sont dans une carrière, dit-il, là… sous nos pieds… Il y a un baril de poudre, la mèche brûle !…
Tout va sauter !…
Marmouset jeta un cri et s’élança vers le puits dans lequel le chien venait de disparaître.
– Eh bien ! dit Milon ivre de douleur, tu ne verras pas l’explosion !
Et il enfonça jusqu’au manche son poignard dans la poitrine du Pâtissier.
Le Pâtissier tomba en jetant un cri.
Un cri et un ricanement de joie féroce.
Et, se tordant sur la terre humide, il répéta :
– Rocambole va mourir !… je suis vengé !
XVI
Cependant la terrible mèche brûlait toujours.
Timoléon s’était couché à côté du baril et attendait tranquillement la mort.
Rocambole, après s’être épuisé en efforts impuissants pour ébranler et enfoncer la porte, avait senti son âme de bronze se fendre.
Il voulait bien mourir, lui, mais il voulait sauver Vanda.
– Timoléon ? s’écria-t-il.
– Que veux-tu ? demanda le blessé en tournant la tête.
– Tu veux ma mort et je te comprends, et je ne te demande pas grâce pour moi ! dit Rocambole d’une voix suppliante ; mais laisseras-tu mourir une femme ?
Timoléon ne répondit pas.
– Écoute, poursuivit Rocambole, qui suivait d’un œil anxieux les progrès du feu sur la mèche et la voyait se consumer lentement, si tu veux arracher cette mèche, je te jure que je vais m’enfoncer mon poignard dans la gorge jusqu’au manche.
Timoléon se mit à rire.
– Tu as trop de chance, répondit-il, tu te manquerais.
– Tu attendras que j’aie rendu le dernier soupir pour ouvrir la porte, supplia encore Rocambole.
Mais Vanda se jeta à son cou :
– Non, dit-elle, je veux mourir avec toi.
Rocambole poursuivit :
– Que tu me haïsses, moi, je le comprends : mais souilleras-tu tes mains du sang d’une femme ?
– As-tu eu pitié de ma fille, toi ? ricana Timoléon.
Rocambole courba la tête.
La mèche brûlait avec une effrayante rapidité.
Rocambole prit son poignard.
– Je vais me tuer, dit-il. Quand je serai mort, peut-être auras-tu pitié d’elle.
Mais Vanda lui arracha le poignard et le jeta par la lucarne de l’autre côté de la porte, répétant avec enthousiasme :
– Puisque je veux que nous mourrions ensemble !
Rocambole poussa un cri étouffé et Timoléon continua à attendre la mort avec sa froide impassibilité.
Mais soudain Vanda se serra contre Rocambole :
– Entends-tu ? dit-elle, entends-tu ?
– Quoi donc ? dit Rocambole.
Un aboiement avait retenti au-dessus de la tête de Vanda.
C’était le chien de Marton qui venait de fouiller la broussaille qui se trouvait auprès de la crevasse supérieure de la carrière.
– Peut-être vient-on à notre aide, murmura Vanda.
– Qui donc viendrait ? fit Rocambole.
– Je ne sais pas… mais j’espère encore…
Un second aboiement se fit entendre !… mais plus affaibli, plus lointain.
– Fol espoir ! dit Rocambole dont les regards semblaient rivés à la terrible mèche.
Mais soudain une ombre se fit dans le couloir que la mèche éclairait.
Une masse noire tomba comme la foudre et fut d’un bond sur Timoléon.
– Le chien ! le chien ! cria Vanda.
Le chien avait saisi Timoléon à la gorge, et il hurlait de rage.
– Le chien de Marton ! s’écria Vanda, qui le reconnut.
– Il n’éteindra pas la mèche, murmura Rocambole.
Le chien avait enfoncé ses redoutables crocs dans les chairs de Timoléon.
La douleur rendit à cet homme résigné à mourir un peu de l’instinct de la conservation.
Il essaya de se dégager, de lutter, et ses mains crispées rencontrèrent le poignard que Vanda avait jeté à travers la porte pour empêcher Rocambole de se tuer.
Alors commença une lutte étrange et sauvage entre le chien et l’homme.
Timoléon frappait d’une main mal assurée ; le chien exaspéré par la douleur le mordait avec fureur.
L’homme poussait des cris étouffés.
Le chien hurlait.
Rocambole et Vanda assistaient haletants à ce duel bizarre et avaient presque oublié la mèche qui brûlait.
Un moment, pourtant, ils eurent un étrange espoir.
Dans ses bonds convulsifs, le chien avait touché la mèche et avait failli l’entraîner hors du baril.
Mais le Pâtissier l’avait si profondément enfoncée qu’elle résista.
Timoléon ne criait plus, il hurlait, et sa main avait laissé échapper le poignard.
Mais bientôt ses mouvements s’affaiblirent, puis s’éteignirent tout à coup.
Un moment encore son corps convulsé s’agita sous le chien.
Puis il garda l’immobilité de la mort.
L’animal avait triomphé de l’homme.
Le chien de la belle Marton avait étranglé Timoléon.
Et il se coucha, tout sanglant, sur le cadavre de son ennemi.
– Au moins ! murmura Rocambole, nous allons mourir vengés !
* *
*
La mèche n’était plus qu’à deux pouces du baril.
– Plus d’espoir ? murmura Rocambole.
– J’espère encore, moi, répondit Vanda avec une énergie désespérée.
Rocambole s’était mis à genoux et demandait pardon à Dieu de ses crimes.
La mèche avançait avec une rapidité vertigineuse.
– À genoux ! cria Rocambole à Vanda, à genoux ! et prie !
– Oh ! je t’aime… et Dieu te pardonnera ! répondit-elle en l’imitant.
La mèche commençait à lécher les parois inférieures du baril, et, dans une minute, tout serait fini !
Mais alors, une ombre nouvelle tomba comme la foudre des bords du puits dans le souterrain, arriva en bondissant et jeta un cri :
– Sauvés !
C’était Marmouset qui venait d’arracher la mèche, juste au moment où elle allait atteindre la bonde du baril.
Le chien se leva en hurlant, et Rocambole sentit Vanda glisser évanouie dans ses bras.
– Dieu ne veut donc pas que je meure ! murmura Rocambole.
* *
*
XVII
Il y avait deux jours que s’étaient accomplis les derniers événements que nous venons de raconter ; il y en avait quatre que les domestiques du petit hôtel de l’avenue Marignan n’avaient plus entendu parler ni de sir James Nively, ni de la femme qui passait pour être sa femme ou sa fiancée et qu’ils appelaient madame ; ni enfin de ce personnage mystérieux qui, s’étant présenté le lendemain de cette double disparition, avait parlé avec le ton de l’autorité se disant un ami de sir James, et enjoignant à tous la plus profonde discrétion.
Pendant les deux premiers jours, les domestiques s’étaient scrupuleusement conformés à la recommandation de Rocambole.
Le premier surtout, ils avaient été tenus en respect par Milon qui avait passé toute la journée dans l’hôtel.
Si on songe que sir James n’était à Paris que depuis quelques jours, que les gens qu’il avait pris à son service ne le connaissaient pas, que par conséquent ils ne lui étaient nullement attachés, on comprendra leur parfaite indifférence.
Cependant, le troisième jour, comme personne ne revenait, pas même ce personnage dont ils avaient un moment subi la mystérieuse influence, la discorde commença à se mettre parmi eux.
Le cuisinier et la femme de chambre parlèrent d’aller faire une déclaration chez le commissaire de police.
Le cocher, au contraire, rappela les sévères recommandations de Rocambole.
Le valet de chambre dit à son tour :
– Si ce soir il n’y a rien de nouveau, je file, et je me paye moi-même mes gages.
L’hôtel ne renfermait que des meubles.
Si Vanda avait laissé des bijoux et sir James de l’or tout cela était si bien serré, que la femme de chambre qui s’était permis une petite exploration domiciliaire n’avait rien trouvé.
Mais le valet de chambre avait sans doute des renseignements plus sérieux qu’il gardait pour lui-même.
Le quatrième jour parut et on ne vit rien venir.
Le cuisinier reparla d’aller chez le commissaire de police.
– Et pour quoi faire ? demanda le cocher.
– Mais, dame ! fit le cuisinier, pour déclarer que nos maîtres ont disparu.
– Qu’est-ce que ça te fait ?
– Rien, mais on me doit quinze jours de gages, à dix francs par jour. Je veux être payé.
– Paye-toi toi-même, dit la femme de chambre.
– Sur quoi ?
– Fais venir un brocanteur et vends-lui la batterie de cuisine.
– Et puis, un matin, sir James reviendra.
– C’est possible.
– Et il me dénoncera comme voleur.
– Moi, dit la femme de chambre, j’attends huit jours encore. Après, si je n’ai revu personne, je m’arrangerai de la garde-robe de la petite dame.
Le valet de chambre haussa les épaules.
– Vous êtes tous des niais, dit-il.
– Plaît-il, monsieur Antoine ? minauda la camérière.
– Certainement.
– Comment cela, s’il vous plaît ?
– Ne sommes-nous pas bien, ici ?
– Sans doute ; mais nous n’avons pas d’argent.
– Je sais où il y en a.
– Toi ! fit le cocher.
– Sans doute, moi.
– Et tu ne nous l’as pas dit ?
– J’avais songé d’abord à garder tout pour moi. Mais si vous êtes bien gentils, si vous voulez m’écouter, nous partagerons.
– Est-ce que la somme est ronde ?
– Trois rouleaux de mille francs.
– Où sont-ils ? dit la femme de chambre, j’ai fouillé partout et je n’ai rien trouvé.
– Même dans le secrétaire qui est dans la chambre de l’Anglais ?
– La clé est restée après. J’ai fouillé tous les tiroirs : je n’ai rien trouvé.
– Je suis pourtant certain qu’il y a trois mille francs.
– Mais où ?
– Dans un double fond que tu n’as pas vu. Seulement, mes amis, à chacun selon ses œuvres : comme j’ai découvert le magot, je veux la plus grosse part.
– Ça, c’est juste, dit le cuisinier.
– Je garde un rouleau de mille pour moi tout seul.
– Excusez ! dit la camérière.
– C’est un peu cher, observa le cocher.
– Non, si vous réfléchissez que j’aurais pu tout prendre.
– Bien ! fit le cuisinier ; mais quand nous aurons cet argent, que ferons-nous ?
– Nous filerons.
– Et si on nous pince ?
– Il n’y a pas à nous pincer, puisque nos maîtres nous abandonnent, et ne nous donnent pas de leurs nouvelles.
– Mais le vol des trois mille francs ?
– Ce n’est pas un vol.
– Par exemple !
– C’est le prix de nos services ; nous n’avons pas forcé le secrétaire, la clé était dessus.
– Nos services seront bien payés ! ricana le cocher.
– Eh bien ! quand mettons-nous la main sur le magot ?
– Ce soir.
– Mais, dit la femme de chambre, si ce monsieur qui est un ami de l’Anglais allait revenir ?
– Et, ajouta le cuisinier, cet autre grand escogriffe qui a l’air d’un hercule et qui est resté une journée avec nous.
– Eh bien ! ils ne nous trouveront plus, voilà tout.
Le valet de chambre comme on voit avait réponse à tout ; mais un bruit qui se fit à l’extérieur de l’hôtel vint le troubler dans ses calculs et dans sa béatitude anticipée que lui faisait éprouver le rouleau de mille francs.
Une voiture s’était arrêtée devant la grille de l’hôtel.
Non point un fiacre, mais un élégant coupé attelé de deux chevaux bais.
Un cocher poudré était sur le siège ; un grand laquais en bas de soie se prélassait à côté de lui.
Depuis que l’hôtel était veuf de ses maîtres, les domestiques avaient déserté l’office.
Ils passaient leur vie au salon.
La femme de chambre cessa de se regarder complaisamment dans une glace et courut à une des fenêtres qui donnait sur l’avenue.
– Ah ! mon Dieu ! s’écria-t-elle en revenant effarée.
– Quoi donc ?
– C’est Madame.
En effet, les domestiques consternés virent descendre du coupé une femme élégamment vêtue qui posa sa main sur le bouton de la sonnette avec la tranquillité et l’autorité d’une personne qui rentre chez elle.
C’était Vanda.
Les domestiques s’étaient réfugiés, qui à l’office et qui dans l’antichambre.
Ce fut la femme de chambre qui vint ouvrir la grille.
Vanda entra, aussi calme, aussi indifférente que si elle fût sortie le matin et ne demanda même pas s’il était venu quelqu’un en son absence.
XVIII
Que Vanda fût ou non la femme de sir James Nively, pour les domestiques c’était madame.
Aussi, à sa vue, tous les beaux projets de fuite et de vol s’évanouirent et tout rentra dans l’ordre.
Vanda, avant d’entrer, avait renvoyé cette voiture de maître qui l’avait amenée.
Elle alla droit à sa chambre à coucher, et dit à sa femme de chambre :
– Déshabillez-moi.
Une demi-heure après, Vanda en peignoir d’intérieur, dans une chauffeuse, au coin du feu, prenait l’attitude oisive et nonchalante d’une femme qui n’a autre chose à faire qu’à attendre l’homme qu’elle aime.
Les gens de l’office, pendant ce temps, se regardaient d’un air consterné, et le cocher reprochait au valet de chambre de n’avoir pas pris les trois mille francs aussitôt qu’il les avait découverts.
Une heure après l’arrivée de Vanda, un nouveau bruit de voiture se fit entendre à la porte.
C’était le grand coupé de maître à deux chevaux qui revenait.
Cette fois, ce fut un homme qui en descendit.
Les domestiques reconnurent cet homme qui s’était dit l’ami de sir James et les avait si fort dominés de son regard : c’est-à-dire Rocambole.
Le major Avatar était en toilette de ville, et d’une élégance parfaite.
Aussi calme que Vanda, il ne paraissait même pas se souvenir du danger qu’ils avaient couru tous les deux, quarante-huit heures auparavant.
Rocambole entra dans l’hôtel, comme un maître, et, cette fois, il ne demanda pas ce qu’était devenu sir James.
Il se borna à cette question :
– Madame est-elle dans sa chambre ou au salon ?
– Dans sa chambre, répondit la camérière.
Rocambole y alla tout droit, baisa la main de Vanda et s’assit auprès d’elle.
Quelques minutes après, la camérière descendit aux cuisines et dit :
– Est-ce que vous comprenez quelque chose à tout cela, vous autres ?
– Rien du tout, dit-on d’un commun accord.
– Cependant, moi, fit le cocher, j’ai une idée.
– Voyons !
– Madame n’était pas mariée avec sir James.
– Bon ! c’est comme ça.
– Elle l’a flanqué à la porte.
– Bon !
– Et c’est l’autre qui prend sa place.
– C’est mon idée aussi, dit la camérière : tout à l’heure je me suis glissée dans le cabinet de toilette et je me suis mise à écouter ce qu’ils disaient.
– Eh bien ?
– Mais je n’ai pas compris un mot.
– Ils parlaient anglais ?
– Non, allemand ou russe, je ne sais pas trop.
– Ça fait, dit le valet de chambre, que maintenant nous ne sommes plus au service de madame ?
– Non.
– Mais au service de cet autre qui vous brûle les yeux quand il vous regarde ?
– Oui.
– C’est drôle, tout de même.
– Non, dit le cocher, puisque madame est chez elle, à preuve que lorsque nous sommes entrés nous avons eu tous affaire à elle.
– C’est juste. Après tout, pourvu qu’on nous paye.
Le valet de chambre soupira, en parlant ainsi, après les trois rouleaux de mille francs.
* *
*
Or, voici quelle était la conversation de Rocambole et de Vanda qui causaient en langue russe, ce qui n’avait pas permis à la camérière de comprendre ce qu’ils disaient :
– Maître, disait Vanda, il s’est passé tant de choses étranges depuis quatre jours, que je me demande encore si je ne rêve pas.
– Il est certain que nous l’avons échappé belle, dit Rocambole : sans Marmouset, nous étions perdus.
– Enfin, dit Vanda, nous n’avons plus rien à craindre, ni du Pâtissier, ni de Timoléon.
– Timoléon est mort, et le Pâtissier ne vaut guère mieux.
– Je crois qu’il est blessé mortellement, dit Vanda.
– C’est du moins l’avis du médecin de l’hospice dans lequel il a été transporté. Dans tous les cas, s’il survit, il demeurera idiot, et nous n’avons rien à craindre de ses révélations.
Mais, acheva Rocambole, qui ne put réprimer un léger frisson, il était temps que Marmouset arrachât la mèche. Dix secondes et nous étions morts.
– Maître, reprit Vanda, me diras-tu maintenant pourquoi tu as voulu que je revinsse ici ?
– C’est fort simple. Cette maison est à toi. Le contrat de vente n’a-t-il pas été passé en ton nom ?
– C’est juste… mais… sir James ?
– Eh bien ! sir James habitera l’hôtel aussi.
Vanda regarda Rocambole avec étonnement.
– Comment ! dit-elle, est-ce que tu ne vas pas le laisser dans les caves de la rue du Vert-Bois ?
– Non.
– Tu veux donc lui rendre la liberté ?
– Pas davantage.
– Alors, je ne comprends pas.
– C’est fort simple, pourtant : sir James demeurera ici et il sera ton prisonnier.
– Sur parole ? fit Vanda d’un air de doute.
– Non, sous la garde de Milon.
– Mais les domestiques ?…
– Ah ! les domestiques, répondit Rocambole, tu vas les congédier ce soir même en leur donnant un mois de gratification.
– Tous ?
– Sans doute.
– Mais sous quel prétexte ?
– Le prétexte le plus naturel du monde : tu n’aimes plus sir James et tu l’as congédié.
– Bon !
– Tu m’aimes et je prends la place de sir James.
– Alors, je fais maison nette pour t’être agréable ?
– Justement, et nous prenons pour domestiques tous nos gens à nous, Noël, la Mort-des-braves, Milon et le Chanoine.
La belle Marton devient ta femme de chambre ; Gipsy passe pour ta jeune sœur ; Marmouset est mon neveu. La maisonnée est complète, et les Champs-Élysées deviennent notre quartier général.
– Après ? fit Vanda.
– Comment ! après ? mais tu sais bien que notre œuvre n’est point terminée.
– C’est juste.
– Et qu’il nous faut enfin les millions de la bohémienne.
– Oui, mais comment les aurons-nous ?
– Pour le moment, c’est encore mon secret, répondit Rocambole.
XIX
Qu’était devenu sir James Nively ?
Marmouset et Milon, partant sur les pas du chien, à la recherche de Timoléon et par conséquent de Rocambole, l’avaient laissé sous la garde de la Mort-des-braves et du fruitier.
Sir James était un homme de prodigieux sang-froid.
Il eut la sagesse de ne faire aucune résistance, et de se laisser aller avec un flegme tout britannique au courant des événements.
D’ailleurs, il n’avait pas d’armes, et ses deux gardiens étaient de force à l’assommer d’un coup de poing s’il avait essayé de leur échapper.
Il ne chercha point à briser ses liens et demeura couché sur le parquet, avec la résignation d’un fakir indien.
La nuit s’écoula. Personne ne revint.
La Mort-des-braves et le fruitier se regardaient avec inquiétude.
Qu’était devenu le maître ?
Toute la question était là pour eux.
Enfin, vers huit heures du matin, Milon arriva, suivi de Marmouset.
À leurs visages émus mais triomphants, le fruitier et la Mort-des-braves comprirent que Rocambole était sauvé.
Milon voulut parler ; mais il ne le put.
Ce fut Marmouset qui se fit l’historien de cette nuit d’émotions qui avait failli être la dernière nuit de Rocambole.
Sir James ne perdit pas un mot de ce récit.
Timoléon était mort, le fait était certain ; Rocambole était vainqueur, et, par conséquent, lui, sir James, il n’avait plus à compter que sur lui-même pour continuer une lutte désormais inégale.
Mais cet homme était bien trempé ; il ne se décourageait jamais, et il avait une foi aveugle dans l’avenir.
Marmouset dit au fruitier :
– Le maître ne viendra pas, mais j’ai ses instructions.
– Qu’ordonne-t-il ? demanda la Mort-des-braves.
– Vous allez descendre l’Anglais dans la cave.
– Bon !
– Et vous l’y garderez à vue, jusqu’à ce que le maître ait pris un parti le concernant.
Les volontés de Rocambole furent exécutées de point en point.
Sir James, toujours garrotté, fut transporté dans le caveau du fruitier et la Mort-des-braves s’installa auprès de lui.
On lui déliait les mains pour le faire manger ; puis quand il avait pris son repas, on l’attachait de nouveau.
À la fin de la première journée, la Mort-des-braves fut remplacé par le fruitier qui passa la nuit auprès du prisonnier.
Le lendemain matin, la Mort-des-braves reprit sa faction.
Trois jours s’écoulèrent.
Sir James n’était pas plus abattu que le premier jour ; il comptait sur le hasard, en vrai fataliste qu’il était.
Enfin, le soir du troisième jour, au lieu du fruitier, ce fut Milon qui parut.
Le colosse portait sur sa tête une grande caisse carrée qui ressemblait à ces emballages grossiers dans lesquels on enferme des meubles destinés à voyager.
Il posa la caisse à terre et dit à la Mort-des-braves :
– Voici le nouveau domicile de notre prisonnier.
Sir James regarda la caisse avec un étonnement qui tenait de la stupeur.
– Nous allons vous faire voyager, lui dit Milon.
– Où me conduisez-vous ?
– Le maître désire causer avec vous. Or, reprit Milon, vous conduire en fiacre est dangereux ; vous pourriez jeter des cris et attirer l’attention d’un sergent de ville.
Nous allons vous faire passer à l’état de colis.
La caisse était percée sur le côté de trois ou quatre petits trous destinés à donner de l’air à l’intérieur.
Sir James s’était fait le serment de n’opposer aucune résistance.
Il se laissa bâillonner de bonne grâce et placer dans la caisse.
On posa le couvercle dessus.
Ensuite, sir James fut secoué assez violemment et comprit que Milon et la Mort-des-braves emportaient la caisse qui, des profondeurs de la cave, remonta à la surface du sol.
Les bruits extérieurs parvenaient assez facilement aux oreilles de sir James, grâce aux trois trous percés dans la caisse.
Il entendit le fruitier qui disait :
– Vous ne rencontrerez pas grand monde. Il est deux heures du matin et il pleut à verse.
À la porte de la maison était un camion, comme il y en a dans les grandes entreprises de roulage, et sur lequel se trouvaient déjà différentes caisses.
On plaça parmi elles celle qui renfermait sir James et Milon monta à côté du cocher, qui n’était autre que Noël.
– En route ! dit-il alors.
Sir James fut secoué pendant le trajet à perdre la respiration.
Mais il était bâillonné et ne pouvait crier.
Ensuite, Noël faisait claquer son fouet avec un bruit assourdissant, qui eût couvert les plaintes de sir James s’il eût essayé d’en pousser.
Mais sir James était résigné.
Comme le tigre des jungles indiennes fait prisonnier durant son sommeil et qui s’est éveillé dans une cage, il attendait que l’occasion de reprendre sa liberté arrivât.
Le camion roula une heure environ.
Au bout d’une heure, il s’arrêta un moment ; mais, se remettant en route, il réveilla les échos sonores d’une voûte.
Sir James comprit qu’il entrait dans la cour d’une maison et venait de passer sous une porte cochère.
Puis le camion s’arrêta de nouveau.
Alors on reprit la caisse à bras et on la porta dans l’intérieur de la maison.
Enfin sir James entendit une voix qui disait :
– Déclouez la caisse. Il doit étouffer là-dedans.
Le couvercle sauta au troisième coup de marteau.
Sir James, couché sur le dos, ouvrit alors les yeux et vit un plafond doré qu’il reconnut.
C’était le plafond de sa chambre à coucher du petit hôtel de la rue Marignan.
En même temps, Milon le prit à bras-le-corps et le tira de la caisse.
Sir James se trouva alors en présence de Rocambole qui lui dit :
– Je vous demande mille pardons, milord, de la façon excentrique employée pour vous faire voyager.
Et il fit un signe à Milon, qui délia les mains et les jambes du baronnet.
Rocambole tenait à la main le même poignard dont sir James avait essayé de frapper Vanda, cinq jours auparavant.
– Vous le voyez, dit-il, vous êtes revenu chez vous.
Sir James s’inclina silencieusement.
– Et si vous le voulez bien, ajouta Rocambole, nous allons causer. Peut-être finirons-nous par nous entendre.
– Je le souhaite, dit froidement sir James.
Et il attendit.
XX
Sir James et Rocambole avaient échangé entre eux ce regard de deux adversaires qui vont croiser le fer et engager une lutte suprême.
– Milord, dit Rocambole, vous avez dû souffrir beaucoup ces jours-ci et je vous en fais toutes mes excuses, mais les gens que j’ai à mon service sont grossiers et manquent d’éducation.
Ils ne savent pas garrotter un homme sans lui meurtrir les poignets ; ils savent moins encore engager une lutte avec lui et le terrasser sans déchirer ses vêtements.
Sir James écoutait avec un sang-froid tout britannique.
Rocambole poursuivit :
– Comme notre conversation peut être longue et que certainement vous devez avoir faim, permettez-moi de vous faire servir à souper.
Il secoua un gland de sonnette et peu après la porte s’ouvrit.
Milon et Noël reparurent.
Seulement, ils avaient revêtu une belle livrée rouge et or, une vraie livrée de gentleman anglais qui vient en France avec toute sa maison.
Ils roulaient devant eux une table toute servie.
Un pâté du Périgord, une volaille froide, du vieux vin de Médoc, une gerbe de flacons de Mme Amphoux, composaient ce souper improvisé.
– Milord, dit encore Rocambole, vous devez avoir besoin de changer de linge et de vêtements, votre cabinet de toilette est là et on n’a point touché à votre garde-robe, ne vous gênez pas…
En même temps, il s’assit au coin du feu qui pétillait et flambait sous l’influence d’un temps sec et froid.
Sir James remercia d’un geste et accepta avec empressement.
Le cabinet de toilette attenant à la chambre à coucher était une petite pièce carrée prenant jour sur le jardin par une fenêtre.
Il se trouvait un bahut dans lequel sir James se souvenait d’avoir serré, en prenant possession de l’hôtel, une paire de ces jolis revolvers à six coups du colonel Hoff que jamais les arquebusiers français ne parviendront à imiter. Ce souvenir avait traversé l’esprit de sir James avec la rapidité de l’éclair.
Mais son visage ne manifesta aucune émotion et il répondit avec son flegme habituel :
– Je vous remercie mille fois, de votre courtoisie, monsieur, et j’accepte votre offre… car je suis vraiment mal à l’aise dans mes vêtements déchirés et mon linge qui n’a pas été renouvelé depuis plusieurs jours.
– Faites, dit Rocambole d’un signe.
Sir James poussa la porte du cabinet de toilette avec une indifférence parfaite et la referma sur lui avec la même lenteur.
Il avait pris un flambeau sur la cheminée de la chambre et l’avait posé sur la large tablette de marbre qui faisait vis-à-vis au bahut.
Celui qui eût vu sir James en ce moment n’eût pas soupçonné que l’espérance d’une évasion l’envahissait tout entier.
En effet, il revint vers la porte qu’il avait fermée, et tenant d’une main un pot à eau dont il vida bruyamment le contenu dans la cuvette il poussa de l’autre le verrou de sûreté de la porte, qu’il fallait désormais enfoncer pour pénétrer dans le cabinet de toilette.
Cette pièce était dans l’état où sir James l’avait laissée, et rien n’indiquait qu’on y eût pénétré.
Le bahut qui renfermait les revolvers était fermé.
Sir James avait l’habitude d’en mettre la clé sous le socle d’un petit vase de Chine posé sur une étagère.
Il souleva le socle et trouva la clé.
Dès lors il pouvait compter sur ses revolvers.
En outre, la fenêtre dont les rideaux étaient tirés donnait, nous l’avons dit, sur le jardin.
Sir James eut bientôt arrêté son plan d’évasion.
Essayer de passer sur le corps de Rocambole était folie. Il pouvait bien le tuer d’un coup de revolver, mais Milon accourrait, et Noël ensuite ; et bien qu’il eût la vie de douze hommes dans ses mains, une telle mousqueterie ne mettrait-elle pas tout le quartier en émoi ?
L’évasion par la fenêtre était une chose plus simple et ses revolvers ne devaient servir qu’à protéger sa fuite.
Sir James ouvrit donc le bahut, y plongea les mains, et rencontra ses revolvers qui étaient cachés sous une pile de mouchoirs.
Il les mit dans sa poche et courut à la fenêtre.
Mais là, une surprise désagréable l’attendait.
Quand il eut tiré les rideaux, il s’aperçut qu’on avait posé à la fenêtre des volets intérieurs assez semblables à ces rideaux de tôle qui descendent le soir, devant les cafés, à l’aide d’une roue d’engrenage, et qui forment la plus solide et la plus inattaquable des fermetures.
Sir James eût en vain usé ses ongles sur cette surface polie.
Il fallait donc, s’il voulait sortir, sortir par la porte et s’ouvrir un passage les armes à la main.
Sir James n’hésita pas.
Il tira sa toilette, changea de linge et s’habilla avec ce rigorisme qui caractérise les Anglais de haute vie.
Les deux revolvers étaient dans ses poches.
Quand il eut fini, il fit courir le verrou dans sa gâche et ouvrit la porte.
Rocambole, assis au coin du feu, fumait tranquillement une cigarette espagnole, un papelitos, comme on dit.
Milon, une serviette sous le bras, se tenait debout devant la table.
– Tu peux aller te coucher, lui dit Rocambole. Milord et moi nous avons à causer assez longuement.
Milon fit un pas vers la porte.
– Dis à Noël d’en faire autant, ajouta Rocambole.
Sir James tressaillit d’aise.
– À table, milord, dit encore celui que Milon appelait le maître.
– Il paraît, pensa sir James en s’asseyant, que la fenêtre murée n’est pas la seule précaution qu’on ait prise.
Et il faisait cette réflexion en jouant avec un des couteaux de table.
Ils étaient ronds par le bout, à lame d’argent, tout au plus bons à couper de la croûte de pâté, et il ne fallait pas que sir James songeât à s’en servir pour perforer la poitrine de Rocambole.
– Mais, se dit-il encore, il a compté sans mes revolvers.
Et il se plaça vis-à-vis de Rocambole, mettant toute la largeur de la table entre son adversaire et lui.
Puis, avec une urbanité parfaite :
– Je suis maintenant, monsieur, tout disposé à vous entendre.
XXI
Rocambole avait servi à James une tranche de foie gras et il lui versa deux doigts de vin de Porto.
C’est le vin par excellence des Anglais, et c’était acte de courtoisie que d’en avoir fait venir sur la table.
– Pour bien vous faire comprendre ce que je veux, milord, dit-il alors, tandis que le baronnet mangeait avec un certain appétit, vous me permettrez, n’est-ce pas, de résumer un peu la situation ?
– Faites, dit sir James.
– Vous étiez, à Londres, le chef des Étrangleurs…
– Je le suis encore.
– Très certainement, mais ils ne paraissent pas se soucier beaucoup de la disparition de leur chef.
Sir James se mordit les lèvres.
– J’avais arraché Gipsy à sir George Stowe ; vous avez, en vertu de vos pouvoirs, destitué sir George et pris sa place.
– C’est vrai.
– Sir George Stowe a quitté Londres et vous n’en avez rien su, ou plutôt vous avez été moins intelligent que lui, puisque vous avez donné tête baissée dans un piège grossier.
Sir James ne répondit pas.
– Vous avez cru à la haine de Vanda pour moi ; et vous vous êtes follement épris d’elle. Vous l’avez suivie à Paris, et ici commencent vos mésaventures.
– Faites-m’en grâce, dit sèchement le baronnet.
– Pardon, il est absolument nécessaire que je continue pour vous faire comprendre où j’en veux venir. À Paris, le hasard vous donne un auxiliaire, vous savez ce qu’il est devenu. Vous voilà donc seul, comme devant, attendant vos Étrangleurs que ne viennent pas et, par conséquent, courant le risque de demeurer mon prisonnier jusqu’à la fin de vos jours, à moins qu’il ne me prenne fantaisie de vous faire disparaître.
– Après ? fit sir James.
– Maintenant que je vous ai bien démontré votre impuissance…
Sir James ne sourcilla pas.
– Laissez-moi, poursuivit Rocambole vous dicter mes petites conditions. Sir George Stowe était un fanatique qui croyait que l’âme de son père était enfermée dans le corps d’un poisson rouge ; il servait votre prétendue déesse Kâli pour le plaisir de la servir ; vous, au contraire, sir James, vous êtes un esprit fort, un sceptique et les vues politiques dominent en vous l’instinct religieux, vous n’avez pas voulu étrangler et brûler Gipsy la bohémienne parce qu’elle avait manqué à son vœu de chasteté, mais bien parce qu’elle avait droit à une fortune immense.
– Ah ! vous savez cela encore ? fit sir James.
– Cette fortune, volée par miss Ellen et son amant Ali-Remjeh, le chef suprême des thugs de l’Inde, devait être partagée entre eux.
– Continuez, dit sir James impassible.
– J’ai retrouvé miss Ellen, et elle sera en mon pouvoir quand je voudrai.
– Vraiment ?
– Vous souvenez-vous de ce château de Picardie où vous avez passé une nuit avec Vanda ?
– Oui, dit sir James.
– C’était la demeure de miss Ellen. Vanda a couché dans la chambre où revenait le spectre. Le spectre n’était autre que Bob, l’ancien valet de chambre du commodore. Il a cru parler à miss Ellen, et il lui a reproché son crime.
Maintenant, vous comprenez comment l’histoire de miss Ellen et d’Ali-Remjeh nous est devenue familière.
– Mais, où voulez-vous en venir ? demanda sir James, qui leva son œil d’un blanc pâle sur Rocambole.
– À ceci : Je tiens miss Ellen par son fils.
– Ah !
– Miss Ellen rendra tout.
– Vraiment ?
– Et je désire que vous n’y fassiez aucune opposition.
Un sourire effleura les lèvres de sir James.
– J’ai pris Gipsy sous ma protection, ainsi que Nadéïa, la fille du général Komistroï. Je veux faire un pacte avec vous.
– Voyons ?
– Les Étrangleurs renonceront à tous droits sur ces deux femmes.
– Bon !
– En échange, vous serez libre de retourner en Angleterre et je vous jure que je ne me mêlerai plus de vos affaires.
Sir James jouait avec son couteau et traçait sur la nappe des figures bizarres.
– Milord, dit encore Rocambole, je vous demande pardon d’insister, mais je suis pressé.
– Ah !
– J’ai besoin de savoir avant le point du jour votre résolution.
– Vous allez la savoir tout de suite, répondit sir James. Je refuse.
– Vraiment ?
– D’abord parce que je n’ai pas le droit de désobéir à Ali-Remjeh.
– Et puis ?
– Et puis, parce que je compte bien sortir d’ici.
– Dans tous les cas, ricana Rocambole, ce ne sera pas par les fenêtres.
Et il alla soulever les rideaux des croisées et sir James put voir le même système de fermeture que celui qu’il avait remarqué dans le cabinet de toilette.
– C’est fort bien, dit sir James, mais au lieu de m’en aller par la fenêtre, je trouve bien plus simple de prendre la porte.
Et, prompt comme la foudre, il tira les deux revolvers de sa poche.
Rocambole bondit et se trouva devant la porte.
– Place ! cria sir James, place ! ou je fais feu !
– À moi, Milon ! cria Rocambole qui parut visiblement inquiet.
– Il viendra trop tard, dit sir James.
Et il pressa la détente.
L’amorce seule prit feu.
Mais le cylindre tourna et le chien s’abattit de nouveau.
Une nouvelle capsule s’enflamma, mais le coup ne partit point.
Sir James eut un cri de rage, tandis que le cylindre tournait pour la troisième fois.
Alors Rocambole partit d’un grand éclat de rire, et sir James stupéfait laissa retomber son bras armé du revolver.
– Ne vous donnez donc pas une peine inutile, dit Rocambole, vos deux revolvers ne sont qu’amorcés. On a eu soin d’enlever les balles.
En même temps, il répéta :
– Milon ! Milon !
Et Milon entra.
– Je vois, dit Rocambole froidement, qu’il faut se débarrasser de monsieur.
Cette fois, sir James comprit qu’il était perdu !
XXII
Revenons maintenant à ce pâle et beau jeune homme à peine entrevu, qui ne savait rien de son origine mystérieuse, un mois avant les événements que nous venons de raconter et qui s’appelait Lucien de Haas.
Lucien entrait en convalescence.
Son futur beau-père et sa fiancée, cette belle et touchante Marie Berthoud, également à peine entrevue, s’étaient installés à son chevet.
Enfin, un jour, le surlendemain de celui où il avait tué le marquis de Rouquerolles et reçu lui-même un coup d’épée qui avait mis ses jours en danger, une femme s’était présentée chez lui.
C’était milady.
On se rappelle que milady s’était évanouie aux Tuileries, en entendant le major Avatar apprendre à la jeune fille que son fiancé s’était battu le matin.
Cet évanouissement avait trahi la mère.
Dès lors une vive affection avait uni milady à Marie Berthoud.
L’Anglaise, après avoir reçu l’autorisation de sir James, au nom de Ali-Remjeh, de voir son fils, s’était jetée dans les bras de la jeune fille en lui disant :
– Mon fils est trop faible encore pour supporter une pareille reconnaissance. Il faut donc que vous m’emmeniez chez lui comme une parente.
Marie Berthoud avait consenti à cette innocente supercherie.
Mais la voix de la nature est si puissante qu’elle déjoue souvent les combinaisons des hommes.
À peine milady était-elle entrée dans la chambre de Lucien que celui-ci, se dressant sur son lit, s’écria :
– Vous êtes ma mère !
La joie aurait pu tuer Lucien, elle le sauva !
Trois semaines après, Lucien était sur pied, et son mariage était fixé à quinze jours de là.
Mais un nuage obscurcissait le bonheur du jeune homme et quelque peine qu’il prît pour dissimuler la tristesse, elle devenait tous les jours plus apparente.
Lucien était triste, parce qu’il sentait que quelque mystère terrible pesait sur sa naissance et par conséquent sur son nom.
Milady lui avait dit :
– Lucien, je suis votre mère ; mais il m’est impossible de vous dire mon nom et par conséquent celui de votre père.
Lucien avait courbé la tête. Cependant, un jour, il fit cette question :
– Mon père est-il mort ?
– Non, dit milady.
– Il vit ? s’écria-t-il avec un mouvement de joie.
– Oui, répondit milady, mais je crains bien que vous ne le connaissiez jamais.
Lucien avait pâli ; mais ni un murmure, ni une plainte ne lui étaient échappés.
Franz accompagnait souvent milady.
Le passé criminel de ces deux êtres les avait liés l’un à l’autre.
Franz aimait milady avec une fureur jalouse, et milady avait fini par aimer le misérable.
Lucien surprit un jour un regard de Franz qui n’était ni le regard d’un serviteur, ni celui d’un amant.
Quand il fut seul avec sa mère il lui dit :
– Le major Hoff est mon père.
– Vous vous trompez, dit milady.
– Oh !
– Je vous le jure.
Lucien courba la tête ; et à partir de ce jour, il ne questionna plus milady.
Il avait compris que Franz était dans les bonnes grâces de sa mère et n’était point son père.
Sa mélancolie s’en augmenta.
Milady avait des heures de joie et des heures de sombre tristesse.
Quelquefois on devinait qu’elle avait peur d’un avenir peut-être très prochain et qu’elle redoutait quelque événement terrible.
Lucien et Marie Berthoud, qui s’abandonnaient l’un à l’autre avec la candeur et la franchise de deux amis à jamais liés, s’étaient avoué tout cela.
Un jour surtout, milady avait paru plus inquiète et plus sombre que de coutume.
Quand elle s’en alla, elle annonça à son fils que peut-être elle ne pourrait revenir le lendemain.
Le lendemain, en effet, on ne la vit pas.
C’était le jour où sir James lui avait assigné rendez-vous.
On sait qu’à la place de sir James, elle avait trouvé Rocambole, qui lui avait dit :
– Revenez demain matin. Ordre d’Ali-Remjeh.
Persuadée, en effet, que le major Avatar était le plénipotentiaire de son terrible amant, milady s’était représentée le lendemain à l’hôtel de la rue de Marignan.
On lui avait répondu que le major Avatar était sorti.
Elle était revenue le soir.
Ni le major, ni sir James n’avaient reparu.
Dès lors, milady avait attendu qu’on lui assignât un autre rendez-vous.
Mais ni le lendemain, ni les jours suivants, le major Avatar ne lui avait donné signe de vie.
Ce silence, au lieu de la rassurer avait, au contraire, décuplé son inquiétude.
Cependant elle n’osait s’ouvrir à Franz.
Le major Avatar lui avait dit, on s’en souvient :
– Toute confidence au major Hoff faite par vous, pourrait devenir fatale à votre fils.
Elle n’osait pas davantage parler du major Avatar à Lucien.
Et les jours s’écoulaient, et milady devenait plus anxieuse à mesure que la santé de son fils se rétablissait et que le jour du mariage approchait.
Elle redoutait que Ali-Remjeh n’arrivât au dernier moment.
Enfin, un soir, comme le vieux professeur, sa fille et milady étaient réunis dans la chambre de Lucien, on annonça le major Avatar.
Le major entra souriant, tendit la main à Lucien et lui dit :
– Vous ayez dû me croire bien oublieux, mon cher ami. Mais, depuis que je vous ai vu, j’ai fait un voyage à Londres et j’en arrive.
– Vous êtes tout excusé, dit Lucien.
Le major et milady s’étaient salués avec une froide réserve qui ne pouvait laisser supposer à Lucien qu’aucune relation antérieure eût pu exister entre eux.
Rocambole passa deux heures chez Lucien.
Mais avant de se retirer, il trouve l’occasion de se pencher à l’oreille de milady et de lui dire :
– Je vous attends à la porte. Il faut que je vous parle ce soir même.
Milady fit un signe d’obéissance.
Le major Avatar se retira ; et ni Marie Berthoud, ni Lucien ne soupçonnèrent un moment que ce fût pour attendre milady dans la rue.
XXIII
Le front de milady s’était chargé de nuages après le départ du major Avatar.
Cependant elle eut la force de dissimuler son anxiété et de rester jusqu’à onze heures et demie.
C’était l’heure où elle se retirait ordinairement.
– À demain, ma bonne mère, lui dit Lucien.
– À demain, répéta-t-elle d’une voix étouffée.
Elle était assaillie des plus funestes pressentiments.
Quand elle fut hors de la chambre de son fils, elle se retourna, comme si elle en eût franchi le seuil pour la dernière fois ; et ses yeux se mouillèrent de larmes.
Le major Avatar l’attendait, en effet, à la porte de la maison et, quand milady arriva, il avait la main posée sur le bouton de la portière.
Milady monta et Rocambole s’installa auprès d’elle après avoir indiqué au cocher la rue de Marignan.
Milady était si émue que, d’abord, elle ne put prononcer un mot.
Rocambole lui dit :
– Ne croyez point, madame, que j’aie menti tout à l’heure. J’arrive de Londres, en effet.
– Ah ! fit milady.
Mais elle n’osa pas demander si le major avait vu Ali-Remjeh.
La voiture, qui était un carrosse de grande remise, arriva en quelques minutes à la rue de Marignan.
– Madame, dit alors Rocambole, notre entretien sera long peut-être. Renvoyez votre cocher. Je vous reconduirai dans une voiture de place.
Cet homme exerçait sur milady une domination au moins égale à celle qu’elle avait subie autrefois de la part d’Ali-Remjeh.
Elle n’osa résister et donna l’ordre indiqué.
Le petit hôtel était silencieux, et aucune lumière ne brillait aux croisées.
Rocambole entra à l’aide d’un passe-partout, et donnant la main à milady :
– Suivez-moi, dit-il.
Puis il referma la grille sans bruit.
Il ouvrit de même la porte de la maison et introduisit milady dans le vestibule qui était plongé dans l’obscurité.
Mais milady n’avait plus peur des fantômes et elle le suivit bravement.
Au fond du vestibule, Rocambole se procura de la lumière, et faisant passer milady devant lui, il la conduisit au premier étage, dans cette même chambre aux fenêtres condamnées où nous l’avons vu se rendre maître de sir James Nively, en dépit de ses revolvers.
Cette pièce, coquettement meublée, n’avait rien d’effrayant.
Rocambole avait, lui aussi, l’air calme et froidement poli d’un homme qui va traiter une affaire d’intérêt.
L’angoisse de milady se dissipa peu à peu.
Rocambole la fit asseoir dans une bergère et demeura debout devant elle :
– Madame, reprit-il ; j’arrive en effet de Londres.
– L’avez-vous vu ? demanda vivement milady.
– Qui ?
– Lui ?
Et elle souligna ce mot avec une sorte de terreur.
Rocambole ne répondit point directement à cette question :
– Ali-Remjeh, dit-il, sera à Paris avant huit jours.
Milady devint pâle comme une morte.
– Madame, reprit Rocambole, laissez-moi vous dire ce qui se passe à Londres ; c’est le seul moyen de vous apprendre ce que j’attends de vous.
– Parlez, dit la mère de Lucien.
Rocambole reprit :
– Il vient de s’opérer à Londres un changement de ministère.
Le nouveau secrétaire d’État au département de la marine et des colonies, est un homme actif, courageux et résolu. De concert avec le nouveau vice-roi des Indes, également énergique, il a juré de détruire de fond en comble cette vaste et ténébreuse association des Étrangleurs, qui a des ramifications et des adeptes jusqu’au sein de l’aristocratie anglaise.
Milady ne sourcilla pas :
– Ah ! ils ont juré cela ? dit-elle d’un ton railleur.
– Oui, milady. Le lord secrétaire ne se dissimule pourtant pas une chose.
– Laquelle ?
– C’est qu’il sera obligé de traduire devant une haute-cour de justice, en même temps que de vulgaires criminels, des gens qui portent de grands noms et possèdent d’immenses fortunes.
– Après ? dit froidement milady.
– Les secrets de l’association ténébreuse dont Ali-Remjeh est le chef ont été trahis.
– Par qui ?
– Par un homme qui sait l’histoire d’Ali-Remjeh, celle de miss Ellen Perkins…
Milady fit un mouvement de surprise inquiète.
– Il sait, poursuivit Rocambole toujours calme, et comme s’il eût parlé d’un tiers, dans quel but plusieurs jeunes filles de l’aristocratie anglaise ont été marquées mystérieusement sur la poitrine ou sur les épaules de signes non moins mystérieux, et consacrées à la déesse Kâli.
– Vraiment ! dit Milady, cet homme sait tout cela ?
– Oui, et il l’a dit au lord secrétaire ; et le lord secrétaire a promis que justice serait faite.
– C’est difficile dit milady.
– Vous croyez ?
– Sans doute, et cela pour plusieurs raisons.
– Je vous écoute, à mon tour, dit Rocambole.
– D’abord, reprit milady, l’association dont vous parlez est immense.
– Oui, mais elle n’a qu’une tête, Ali-Remjeh.
– Ensuite, Ali-Remjeh n’est pas à Londres.
– Non, mais il doit venir à Paris.
– À Paris, la police anglaise est impuissante.
– Sans doute, mais l’homme dont je vous parle s’est engagé à livrer Ali-Remjeh à l’Angleterre.
– Sans l’autorisation de la France ?
– Sans même que la police française sache qu’Ali-Remjeh est venu à Paris.
– Cet homme a promis plus qu’il ne pourra tenir, dit froidement milady.
– Il s’est engagé, en outre, poursuivit Rocambole, à livrer miss Ellen Perkins.
– Oh ! par exemple !
– Ainsi qu’une pièce importante qui démontrerait qu’elle a assassiné son père, le commodore, de complicité avec Ali-Remjeh et un certain valet allemand du nom de Franz.
– Voilà, par exemple, dit milady, une chose que je le mets au défi de prouver.
– Vous vous trompez, milady.
– Il n’y a pas de preuve !
– Si ! il y en a une.
– Laquelle ?
– Un long mémoire écrit par Bob, votre ancien intendant, et que l’homme dont je parle a en sa possession.
Milady se méprit encore :
– Eh bien ! dit-elle, je suppose que vous avez les pleins pouvoirs d’Ali-Remjeh.
– Pour quoi faire ?
– Mais pour parer le coup qui nous menace.
– Vous vous trompez, milady, car cet homme qui doit livrer Ali-Remjeh, miss Ellen, Franz et les principaux chefs des Étrangleurs…
– Eh bien ?
– Cet homme, c’est moi, dit froidement Rocambole.
Milady jeta un cri, et regarda Rocambole avec un sentiment d’épouvante si grand, qu’on eût dit qu’un abîme s’ouvrait subitement sous ses pas.
XXIV
Milady regardait Rocambole avec une sorte de stupeur.
Cet homme voulait-il l’éprouver, et n’était-il, comme elle l’avait cru d’abord, que l’émissaire de Ali-Remjeh ?
Elle l’espéra, elle le pensa un moment.
Mais Rocambole ne lui laissa pas longtemps cette dernière illusion.
– Madame, dit-il, vous aviez une sœur, miss Anna.
– Ah ! fit milady, vous savez aussi cela ?
– Je sais que vous l’avez fait étrangler.
– Ce n’est pas moi, c’est Ali.
– Ali-Remjeh ou vous, n’est-ce pas la même chose ?
Milady courba la tête et ne répondit pas.
Rocambole reprit :
– Miss Anna a laissé une fille, Gipsy.
– Après ? dit milady d’une voix sifflante.
– C’est à cette fille que revient l’immense fortune volée à sa mère.
Mais milady se redressa, l’œil en feu, terrible, prête à tout :
– Cette fortune est à mon fils ! dit-elle.
Rocambole se mit à rire.
– En êtes-vous bien sûre ? dit-il.
– Elle est à lui, répéta milady avec emportement, car je l’ai achetée au prix d’une vie de crimes et de désespoir.
– Je vous attendais à cet aveu, madame…
Milady regarda son étrange interlocuteur.
– Monsieur, dit-elle froidement, je ne sais pas deviner les énigmes.
– Je vais m’expliquer, continua Rocambole.
– Parlez…
– Votre fils est un galant homme. Il est honnête, il est beau, il est brave… il mérite d’être heureux…
– Ô mon fils ! murmura milady avec un sentiment de tendresse orgueilleuse.
– Par cela même, continua Rocambole, il est incapable de toucher à une fortune souillée.
– Monsieur !
– Si on venait dire à votre fils : la brillante éducation que vous avez reçue, le luxe qui vous entoure, la corbeille de mariage de votre fiancée même, tout cela vous a été donné avec l’argent du crime, que pensez-vous qu’il répondrait ?
Milady poussa un cri sourd, se cacha la tête dans ses mains.
– Madame, poursuivit Rocambole, écoutez-moi sérieusement, car l’heure est solennelle… C’est un marché que je viens vous offrir, et il faudra opter sur l’heure.
De nouveau, elle leva les yeux sur lui et éprouva un sentiment d’angoisse suprême.
– Je sais toute votre histoire et j’ai des preuves de vos crimes. Rien ne me serait plus facile que de vous livrer demain à la justice anglaise. Cependant je ne le veux faire qu’à la dernière extrémité.
Milady retrouva un peu de cette énergie sauvage dont jadis miss Ellen Perkins avait donné tant de preuves.
– En vérité ! dit-elle froidement. Alors pourrai-je savoir qui me vaut cette extrême bienveillance de votre part ?
– Votre fils.
Ce mot frappa juste ; et il ébranla milady qui commençait à se cuirasser contre le danger.
– Je serais sans pitié pour vous, continua Rocambole, si vous n’étiez la mère de Lucien.
– Alors vous ne me livrerez pas ?…
Et elle jeta autour d’elle un regard rapide comme si elle eût songé à prendre la fuite.
Rocambole ne put réprimer un sourire :
– Oh ! rassurez-vous, madame, je n’ai nullement l’intention de vous retenir prisonnière. Seulement, vous auriez tort, peut-être, de sortir d’ici avant que nous nous soyons entendus.
Milady avait reconquis son sang-froid.
– Que voulez-vous donc ? fit-elle.
– Une femme comme vous, madame, douée de cette énergie indomptable, habituée à dominer les situations les plus difficiles, à renverser tous les obstacles, serait capable de tenir tête à des juges, à tout nier, en dépit des preuves les plus accablantes et de se faire l’attitude et le front d’un martyr.
La justice des hommes pourrait vous condamner ; mais votre fils vous absoudrait. C’est là ce que je ne veux pas.
– Continuez, dit milady avec calme.
– Je veux vous donner un juge unique, votre fils.
Milady frissonna :
– Oh ! dit-elle, vous ne ferez pas cela !
– Je le ferai, si vous ne restituez cette fortune volée.
– Dépouiller mon fils !
– Il le faut.
– Jamais ! dit-elle avec force.
– Écoutez-moi avec calme, madame. Votre père, le commodore Perkins, a laissé une fortune immense. Cette fortune destinée à votre sœur, la malheureuse miss Anna, est tout entière en vos mains.
Milady haussa les épaules :
– Ce que vous dites là est possible, dit-elle, mais il est une circonstance que vous ignorez peut-être.
– Voyons ?
– J’ai aliéné cette fortune.
– Je le sais.
– Et je l’ai si bien cachée que ni la justice anglaise ni vous, ni même Ali-Remjeh, qui n’a jamais touché que sa part de revenu, ne saurait la découvrir.
– C’est précisément parce que je sais cela, dit Rocambole, que j’ai songé à employer le moyen unique qui vous puisse forcer à parler.
– Mon fils ! allez-vous dire encore ? fit-elle avec un geste d’impatience.
– Votre fils qui vous méprisera et s’arrachera de vos bras à jamais, quand il saura vos crimes ; votre fils, acheva Rocambole, qui ne voudra peut-être pas survivre à sa honte et cherchera un refuge dans la mort.
Milady jeta un cri.
Mais sa faiblesse et son épouvante n’eurent que la durée d’un éclair.
– Et qui donc vous dit, fit-elle, que mon fils vous croira ?
Un sourire passa sur les lèvres de Rocambole.
– Je m’en charge, dit-il.
Puis, comme milady demeurait impassible.
– Madame, dit-il, la nuit s’avance, et je ne veux pas avoir l’air de vous avoir tendu un piège. Des gens comme nous doivent lutter face à face, corps à corps, et se servir de toutes leurs armes.
– Vous m’avez parlé des vôtres, mais je ne les crains pas, dit milady, vous pouvez tout dire à mon fils, il ne vous croira pas !
– Je vous donne jusqu’à demain, dit Rocambole.
– Et si demain… je refuse ?…
– Demain votre fils vous méprisera, vous maudira…
– Soit : à demain, dit milady.
Et elle se leva.
Rocambole tira le gland d’une sonnette et Milon parut.
– Va chercher une voiture pour milady, dit le Maître.
* *
*
Un quart d’heure après milady s’éloignait, la rage au cœur, mais prête à la lutte et ne voulant point restituer une fortune qu’elle destinait à son fils.
Et quand elle fut partie, Vanda entra dans la chambre où se trouvait Rocambole :
– Maître, dit-elle, je ne comprends pas ce que tu veux faire.
– L’heure de la violence n’est point venue, dit Rocambole.
– Pourquoi ?
– Parce que milady est femme à se laisser traîner à l’échafaud avant de nous dire ce qu’elle a fait des millions de la Bohémienne ; et ce sont les millions qu’il nous faut, acheva froidement Rocambole.
XXV
À peu près à l’heure où Rocambole conduisait milady au petit hôtel de la rue de Marignan, le train express de Bâle arrivait à Paris.
Un homme au teint bronzé, aux cheveux noirs semés ça et là d’un filigrane d’argent, mais aux dents éblouissantes de blancheur, au regard ardent, à la tournure juvénile, descendit d’un coupé en compagnie de deux autres hommes, bronzés comme lui et qui, quoique mis avec une certaine recherche, paraissaient néanmoins n’être que ses domestiques.
Ce personnage, qui venait de Constantinople par la voie de terre et qui, par conséquent, après avoir remonté le Danube jusqu’à Vienne, avait pris les chemins de fer allemands, voyageait avec un passeport turc qui le qualifiait d’effendi, c’est-à-dire de colonel, lui attribuait le nom de Rostuck pacha et disait qu’il était accompagné de deux secrétaires ou officiers d’ordonnance.
L’un de ces derniers, qui remplissait auprès de ce haut personnage les fonctions additionnelles d’interprète, demanda une voiture de place, y fit charger les bagages de son maître et indiqua au cocher, en assez bon français, le Grand-Hôtel comme lieu de destination.
Vingt minutes après, Rostuck pacha arrivait au Grand-Hôtel et demandait un somptueux appartement, toujours par voie d’interprète, car il ne paraissait pas savoir un mot de français.
Tandis qu’on transportait ses bagages, et que ses deux secrétaires faisaient préparer le logis demandé, le Turc, ou plutôt celui qui se donnait comme tel, alluma un cigare et se mit à se promener de long en large sur le boulevard des Capucines.
Comme il était vêtu à l’européenne et avec une distinction parfaite, comme il se dispensait de porter cet odieux bonnet rouge à gland de soie des Turcs vulgaires et l’avait remplacé par un chapeau ordinaire, il n’attira l’attention de personne, en dépit de son visage olivâtre, et les passants déjà rares le prirent pour un honnête voyageur qui jouissait de la tiédeur d’une nuit presque point animée.
Un des secrétaires le rejoignit et vint lui dire que son appartement était prêt.
Rostuck pacha se borna à répondre par un signe qui voulait dire :
– Je prends l’air très volontiers.
Et il continua à se promener de long en large, jetant un regard distrait sur les voitures qui entraient dans la cour de l’hôtel ou en sortaient.
Mais tout à coup il tressaillit, et une sorte de cri guttural lui échappa.
Une voiture venait d’entrer dans la cour.
Dans cette voiture, l’étranger avait aperçu une femme pâle et qui paraissait en proie à une sorte de surexcitation.
– Miss Ellen ! murmura-t-il en anglais.
Puis, au lieu de s’avancer, il s’effaça au contraire dans l’ombre d’une porte cochère et attendit.
Le fiacre s’arrêta devant le péristyle et milady, car c’était elle, descendit.
Un valet de pied s’avança avec un flambeau.
– Le major Hoff est-il rentré ? demanda milady.
– Pas encore, lui fut-il répondu.
* *
*
Milady était si agitée qu’elle ne vit personne autour d’elle, pas même cet étranger aux yeux de feu, qui s’était arrêté sous la porte cochère et qui avait tressailli si violemment en entendant prononcer le nom du major Hoff, que son visage brun était devenu aussi blanc que celui d’un Européen du Nord.
Milady, conduite par le valet, monta chez elle.
En présence de Rocambole elle avait fait bonne contenance.
Mais une fois seule, elle s’était répété les questions que celui-ci lui avait posées, et elle les trouvait insolubles.
Il était évident, en effet, que si son fils savait la vérité, il la renierait pour sa mère.
Peut-être même, – Rocambole le lui avait dit, – se tuerait-il.
Mais rendre cette fortune immense, acquise au prix de tant de crimes et qu’elle avait si bien cachée que nul ne saurait la découvrir, n’était-ce pas, pour elle, un sacrifice au-dessus de ses forces ?
Et puis, comment annoncer à ce fils, qui la connaissait maintenant et à qui elle avait dit « tu seras le plus riche héritier de France ! » : « Tu es ruiné » ?
Elle avait deviné dans le major Avatar un de ces adversaires avec lesquels on ne joue qu’une partie, qu’on perd presque toujours.
Il fallait donc parer au plus vite le coup terrible qui la menaçait, ou bien tout était perdu.
Un seul homme pouvait la servir, et cet homme c’était Franz.
Franz n’était pas rentré encore.
Le prétendu major Hoff passait très souvent une partie de la nuit au Club des Asperges et ne revenait que fort tard.
Milady, bien que depuis longtemps elle fût sa maîtresse, avait su entourer leur liaison de certaines apparences.
Le major avait dans l’hôtel un appartement séparé.
Milady ordonna au domestique qui l’avait accompagnée de ne se coucher que lorsque le major rentrerait et de lui dire qu’elle l’attendait.
Le domestique parti, milady, qui avait la tête en feu, ouvrit la fenêtre et exposa son front brûlant à l’air vif de la nuit.
– Mon fils ! mon fils ! répétait-elle avec une sorte de délire.
Une heure s’écoula.
Milady cherchait un moyen de fuir Rocambole, de lui arracher Lucien, d’échapper à sa poursuite, et ne le trouvait pas.
À la fin un pas d’homme se fit entendre dans le corridor, un peu assourdi par le tapis qui en couvrait le sol.
– Enfin ! murmura milady, voici Franz…
On frappa à la porte.
– Entrez, dit-elle.
Mais soudain milady recula, comme elle avait reculé, naguère, lorsque Rocambole s’était démasqué.
Ce n’était pourtant pas le major Avatar qui entrait.
Ce n’était pas Franz non plus.
C’était le personnage mystérieux arrivé sous le nom de Rostuck pacha et qui s’avança lentement vers milady, les bras croisés et faisant peser sur elle un regard de reproche.
– Me reconnais-tu, miss Ellen ? dit-il.
– Ali-Remjeh ! murmura-t-elle.
Et ses jambes fléchirent, et elle tomba presque sans connaissance, dans un fauteuil qui se trouvait auprès de la cheminée.
– Oui, répondit l’Indien en tirant un poignard, c’est moi qui viens châtier les coupables !
Et il continua à marcher lentement vers elle.
XXVI
Ali-Remjeh, car c’était lui, s’arrêta à deux pas de milady frémissante et qui levait sur lui un regard éperdu.
– Miss Ellen, dit-il, brandissant toujours son poignard, que sont devenus tes serments ? Avec qui as-tu trahi la foi que tu m’avais jurée ?
Elle ne répondit pas.
– Miss Ellen, continua Ali-Remjeh, je sais tout. Un autre possède maintenant votre cœur et vous avez cessé de m’aimer.
– Grâce ! balbutia-t-elle, grâce !
– Non, dit Ali-Remjeh, pas de grâce ! Franz et toi vous êtes condamnés à mourir, mais auparavant je veux savoir où est mon fils.
Et, comme il prononçait ce nom, sa voix irritée devint plus douce et sa fureur se calma comme par enchantement.
Milady le regardait avec épouvante ; et pourtant au travers de cette épouvante on aurait vu poindre une certaine admiration.
Ali-Remjeh était toujours le bel Indien d’autrefois, et le soleil torride, qui avait pesé vingt années sur sa tête, s’était montré impuissant à le vieillir et à creuser son front de rides profondes.
– Mon fils ! où est mon fils ? répéta-t-il.
Et il y avait dans sa voix un certain accent de prière, bien qu’il eût toujours le poignard levé.
Milady entrevit une chance de salut.
– Mon fils, dit-elle, je le vois tous les jours, et il adore sa mère !
Ali-Remjeh jeta son poignard, comme s’il eût craint de ne pouvoir résister à sa soif de vengeance.
Milady se mit à genoux :
– Oui, dit-elle, vous avez raison… je suis coupable… j’ai trahi mes serments… mais ce crime doit-il m’être imputé tout entier ?
Pendant vingt années, Ali, ne m’avez-vous pas délaissée, abandonnée, m’intimant, par la bouche de vos esclaves, les ordres les plus cruels ?
Pendant vingt années ne m’avez-vous pas interdit de voir mon fils ?
– Je ne m’appartenais pas, dit Ali-Remjeh.
– Moi, continua milady, j’étais seule… en proie à mes remords… sans un ami, sans une affection vraie autour de moi… Un homme dont vous aviez fait mon complice, un misérable, si vous le voulez, s’est pris pour moi d’un amour violent et insensé, il m’a poursuivie, il m’a obsédée… il est devenu mon maître en me rappelant sans cesse mon crime…
Et milady se traînait aux genoux de cet homme qui avait repris tout à coup sur elle son empire sauvage et fatal, et que, huit jours auparavant, elle croyait ne plus aimer, au point de redouter son retour.
– Oui, disait-elle en proie à une sorte de délire, je t’ai trahi… je suis infâme !… je mérite la mort… tue-moi !… mais auparavant, laisse-moi revoir notre fils.
Cette corde avait déjà vibré ; milady, en la touchant une dernière fois, apaisa tout à fait Ali-Remjeh.
Il la releva, la regarda longtemps et lui dit enfin :
– Tu es toujours belle !
Milady était sauvée.
– Mais, reprit-il après un silence, je veux tuer cet homme ! je veux le tuer, entends-tu ?
Milady courba la tête.
Elle venait d’abandonner le major Hoff.
Ali-Remjeh continua :
– Je suis libre à présent, j’ai résigné en d’autres mains le pouvoir terrible que j’ai exercé si longtemps et qui m’a tenu vingt années éloigné de l’Europe.
Je ne suis pas Ali-Remjeh, le chef des Étrangleurs ; je suis Rostuck pacha, un homme que le vice-roi des Indes et tout le gouvernement britannique ne sauraient reconnaître. Tu es riche, je le suis aussi… je viens te chercher…
– Mais où veux-tu me conduire ? demanda milady.
– En Amérique. Un navire qui m’appartient nous attend au Havre…
– Et notre fils ?
– Nous l’emmènerons.
– Mais c’est un grand beau jeune homme qui va se marier.
– Nous emmènerons sa fiancée.
Et tandis qu’Ali-Remjeh parlait, milady se souvint…
Elle se rappela le major Avatar, et ses menaces terribles, et les conditions qu’il lui avait faites une heure auparavant.
Se redressant alors et prenant la main de l’Indien, elle lui dit d’une voix brève que l’anxiété rendait sifflante :
– Ali, tu te crois libre ?
– Je le suis.
– Tu te trompes. Dans deux jours peut-être nous serons prisonniers tous deux.
– Prisonniers !
– Oui.
– Et de qui ?
– Du gouvernement britannique. On nous traînera devant une cour de justice, on nous condamnera, toi comme le chef des Étrangleurs, moi comme parricide…
Ali-Remjeh poussa un éclat de rire.
– Bah ! dit-il, tu sais que l’Angleterre a mis ma tête à prix, et ma tête pouvait n’être pas solide sur cette terre anglaise…
– Elle ne l’est pas davantage ici, dit milady.
– J’ai un passeport turc, répondit Ali-Remjeh, et l’extradition ne saurait m’atteindre.
– Tu te trompes…
Et milady qui était encore sous l’impression de terreur que lui avait fait éprouver sa conversation avec le major Avatar, milady raconta à Ali-Remjeh tout ce que cet homme lui avait dit, tout ce qu’elle savait.
L’Étrangleur reparut dans cet homme qui ne voulait plus vivre que pour sa femme et pour son enfant :
– Ah ! dit-il, montrant, en un rire féroce, ses dents éblouissantes, il y a donc un homme qui ose lutter contre moi ?
– Oui.
– Je le briserai.
– Ou il vous brisera, dit milady avec un accent de terreur suprême.
Mais Ali-Remjeh avait retrouvé son sang-froid.
– Et cet homme, dit-il, t’a donné vingt-quatre heures de réflexion ?
– Oui.
– Eh bien ! dans vingt-quatre heures nous serons loin de Paris.
– Mais notre fils ?…
– Nous l’emmènerons avec nous, te dis-je.
Et comme Ali-Remjeh parlait ainsi, des pas se firent entendre dans le corridor et on frappa à la porte.
Milady pâlit et se prit à trembler.
La porte s’ouvrit, le major Hoff entra.
Ali-Remjeh recula d’un pas, et milady épouvantée cacha sa tête dans ses mains.
XXVII
Franz s’arrêta interdit à la vue de Ali-Remjeh.
Lui aussi avait reconnu le terrible Indien.
Celui-ci fit un bond vers la porte et la ferma.
Puis il se plaça devant, de façon à barrer le passage au prétendu major allemand.
Franz jeta un regard sur milady.
Milady baissa les yeux.
Franz comprit que l’étrange pouvoir de fascination exercé jadis sur elle par Ali-Remjeh avait repris tout empire.
– Esclave, dit Ali-Remjeh, tu as osé lever les yeux sur la femme que j’ai aimée, tu vas mourir.
Il ramassa le poignard qu’il avait jeté dans un coin de la chambre, tout à l’heure, attendri qu’il était par les prières de milady.
Mais Franz était un homme hardi et il retrouva toute son audace.
Lui aussi, il était de haute taille ; il avait les épaules larges, le cou musculeux et une force herculéenne.
Et, s’acculant dans un coin de la chambre et tirant un poignard à son tour :
– Ali-Remjeh, dit-il, tu te trompes, je ne suis plus un esclave.
– Ah ! fit Ali-Remjeh avec dédain, qu’es-tu donc ?
– Je suis un homme que milady a élevé jusqu’à elle.
– En vérité ! ricana l’Indien.
– Et que son amour a fait son égal.
L’Indien haussa les épaules ; mais il ne bougea pas.
Et, s’adressant à milady :
– Vous l’entendez, madame ? dit-il.
Milady tremblait et continuait à baisser les yeux.
– Cet homme se vante d’être aimé de vous, miss Ellen ! poursuivit Ali-Remjeh avec un accent de dédaigneuse ironie, dites-lui donc qu’il est un vil esclave, un assassin salarié.
– Milady, disait Franz de son côté, dites donc à Ali-Remjeh que, depuis plus de dix années, mes lèvres se sont unies à vos lèvres, que votre cœur a battu sur mon cœur, que nous avons eu la même vie, partagé les mêmes douleurs et les mêmes joies.
Milady gardait un silence farouche.
Franz brandissait son poignard et, s’exaltant par degrés :
– Oui, dit-il, je le vois, cet homme te fait peur, Ellen. Il t’a menacée, au nom de son pouvoir mystérieux et terrible. Mais je ne le crains pas, moi !
Ali-Remjeh haussait les épaules et regardait Franz avec un dédain suprême.
– Mais dis-lui donc que tu m’aimes ! s’écria Franz avec un accent de haine jalouse, et je vais lui enfoncer mon poignard dans le cœur.
Ces derniers mots rompirent le charme pénible qui semblait peser sur milady et la paralyser.
Elle redressa tout à coup la tête ; son œil étincela, sa lèvre devint hautaine ; la fille des pairs d’Écosse reparut tout entière en elle…
Et, foudroyant le major Hoff d’un regard :
– Esclave, dit-elle, tu mens comme un vil laquais. Je ne t’ai jamais aimé… Je ne t’aime pas ; je te méprise !
Franz jeta un cri.
Un moment il tournoya sur lui-même comme un homme frappé de la foudre.
Puis il jeta un cri sauvage et ses yeux s’injectèrent de sang.
Et tandis qu’Ali-Remjeh, calme et sombre, différant sa vengeance, paraissait jouir de ce triomphe inattendu, le dédain de milady pour Franz, ce dernier ivre de rage s’élança vers elle le poignard levé :
– Tu vas mourir la première ! dit-il.
Mais avant que son bras ne fût retombé, dirigeant l’arme meurtrière vers la poitrine de milady, un bruit se fit dans l’air, pareil au sifflement d’une vipère qui aurait des ailes, et le terrible lasso des Étrangleurs lancé par la main exercée et rapide d’Ali-Remjeh s’abattit autour de son cou, s’y enroula deux fois et le renversa inanimé sur le parquet.
Franz tomba comme une masse, en poussant un cri étouffé, s’agita convulsivement pendant quelques secondes ; puis garda l’immobilité de la mort.
Alors Ali-Remjeh prit dans ses bras milady, folle de terreur, et lui dit :
– Viens ! allons chercher notre fils et fuyons !
* *
*
Cependant l’âme du major Hoff pensait dans son corps immobile.
Était-il mort, vivait-il encore ?
Lui-même n’aurait pu le dire, quoique sa pensée ne fût pas éteinte.
Le lasso avait peut-être amené la mort du corps, mais l’âme qui est immortelle, n’avait point abdiqué sa haine jalouse.
Il se passa alors un phénomène impossible à expliquer, mais qui n’est point sans exemple.
L’âme du major Hoff, comme si elle eût été le jouet d’un rêve, traversa les espaces et suivit pas à pas Ali-Remjeh et milady.
Combien de temps dura ce voyage ?
Mystère !
La nuit s’écoula, le jour vint ; on pénétra dans la chambre abandonnée de milady et on trouva le major Hoff sans connaissance.
Un médecin appelé en toute hâte, déclara qu’il avait cessé de vivre.
Mais un étranger, un Russe, qui se trouvait par hasard dans le Grand-Hôtel où il était venu faire une visite, prévenu, par la rumeur qui se fit, de ce mystérieux événement, entra dans la chambre qui était pleine de monde, s’approcha du prétendu mort et l’examina attentivement.
Puis, se tournant vers le médecin :
– Je crois, docteur, dit-il, que vous vous trompez. Cet homme n’est pas mort.
Le docteur fit la grimace, comme tout médecin consciencieux qui voit son opinion combattue.
– Je vous le répète, dit le Russe, cet homme n’est pas mort.
– Vous êtes donc médecin ? fit dédaigneusement le docteur.
– Je m’appelle le major Avatar, et je suis médecin à l’occasion.
Et Rocambole, car c’était lui, s’installa au chevet du major Hoff en disant :
– Je vais le ressusciter !
XXVIII
Ce soir-là, après le départ de sa mère, Lucien s’était senti plus triste encore que de coutume. Ce mystère qui pesait sur sa naissance, les angoisses inexplicables auxquelles sa mère paraissait souvent en proie, le torturaient.
Un mois auparavant, tout entier à son amour pour Marie Berthoud, Lucien envisageait l’avenir avec joie.
Maintenant qu’il connaissait sa mère, l’avenir l’épouvantait.
Bien longtemps après que la jeune fille et le vieux professeur se furent retirés, Lucien cherchait en vain le sommeil.
Il avait la fièvre comme aux premiers jours de sa blessure, et s’agitait vainement sur son lit.
Deux heures du matin, puis trois heures sonnèrent successivement.
Les noirs pressentiments de Lucien augmentaient. Il lui semblait que quelque chose de terrible allait s’accomplir pour lui.
À de certains moments de la vie, l’esprit semble être doué tout à coup d’une lucidité surnaturelle et, pour ainsi dire, d’une seconde vue.
Et tandis qu’il était en proie aux hallucinations les plus étranges, oubliant presque sa fiancée pour ne plus songer qu’à cette mère si jeune et si belle encore, mais qui semblait porter sur son front le sceau de la fatalité et avait déjà souffert les tortures d’une longue vie tourmentée, un bruit se fit à son oreille.
La nuit, ceux que la fièvre agite ont une finesse d’ouïe qui tient du prodige.
Le bruit qu’avait entendu Lucien était pourtant fort naturel.
C’était celui de la porte cochère de la maison qui s’ouvrait et se refermait.
Cela n’avait donc rien que de naturel, et cependant Lucien sentit battre son cœur avec une précipitation soudaine.
Une voix secrète lui cria :
– C’est pour toi qu’on ouvre cette porte.
Son oreille, obéissant pour ainsi dire à sa pensée, se transporta dans l’escalier.
Un pas léger vint jusqu’à lui.
Le pas d’une femme qui montait l’escalier en toute hâte.
Puis la sonnette de l’appartement tinta, comme agitée par une main fiévreuse.
Lucien bondit hors de son lit.
Depuis qu’il était entré en convalescence, depuis qu’il était devenu inutile de le veiller, Lucien couchait seul dans son appartement, et son valet de chambre avait repris possession de la mansarde qu’il occupait dans le haut de la maison.
Lucien s’enveloppa tout à la hâte dans une robe de chambre, ne prit point la peine d’allumer une bougie et s’élança vers l’antichambre. Il ouvrit la porte, et, en dépit de l’obscurité et bien qu’il ne pût voir son visiteur ou sa visiteuse, il dit :
– Ma mère !
– Oui, c’est moi, mon enfant, répondit la voix émue de milady.
Et elle entra.
Lucien la prit dans ses bras et lui dit :
– Oh ! venez, je vous attendais…
– Tu m’attendais ? fit milady surprise.
– Oui, quand la porte d’en bas s’est ouverte, quelque chose m’a dit : voilà ta mère !
Et il emporta plutôt qu’il n’entraîna milady dans sa chambre.
Un reste de feu brûlait dans la cheminée, projetant une certaine clarté dans la chambre, si bien que Lucien ne songea même pas à allumer un flambeau.
Milady se laissa tomber sur un siège et dit :
– Lucien, mon enfant, je viens te faire mes adieux.
– Ma mère !
– Mes adieux ! répéta-t-elle.
Lucien éperdu s’agenouilla devant elle :
– Mais où allez-vous ma mère ?
– Je pars.
– Oh ! c’est impossible !
– Et nous ne nous reverrons jamais…
Il jeta un cri, lui prit les mains et les étreignit convulsivement dans les siennes.
– Vous voulez donc que je meure ? fit-il.
– Non, je veux que tu sois heureux.
– Heureux ! heureux sans vous ? Ah ! ma mère ! fit-il avec une explosion de douleur.
– Tu seras heureux avec ta jeune femme, poursuivit milady.
– Mère ! mère ! s’écria Lucien hors de lui, tu veux donc me tuer ?
Mais milady dont les reflets rouges du foyer éclairaient le pâle visage, regarda son fils et lui dit d’une voix émue, mais empreinte d’une résolution et d’une sérénité subites :
– Lucien, je suis venue au milieu de la nuit parce que je voulais avoir avec toi un entretien solennel et suprême.
Tu sais que je suis ta mère, mais tu ignores mon nom, et je t’ai dit que tu ne connaîtrais jamais ton père.
Lucien courba la tête et ne répondit pas.
– Lucien, poursuivit milady, à l’heure suprême de la séparation…
– Oh ! ma mère, pourquoi parler ainsi ?
– À cette heure suprême, continua-t-elle, je ne veux pas que mon fils puisse me mépriser.
– Te mépriser !
– Lucien, mon enfant bien-aimé, votre père vit et vous aime…
– Mon père vit, mon père m’aime ! s’écria Lucien avec un accent plein de délire.
– Votre père est à Paris.
Lucien jeta un cri.
– Mais, avant le point du jour, il aura quitté cette grande ville, acheva milady, et vous ne le reverrez jamais.
– Oh ! dit Lucien avec une voix affolée, tout ce que vous dites-là est impossible, ma mère ! Quoi mon père est à Paris… et je ne le verrais pas ?
Milady secoua la tête :
– Je vous le répète, dit-elle, votre père et moi nous aurons quitté Paris avant le point du jour.
– Oh !
Et ne pensez-vous pas qu’il faut un motif bien impérieux pour qu’un père passe à côté de son enfant sans lui ouvrir ses bras, pour qu’une mère se sépare de lui à jamais ?
Et milady fondit en larmes.
– Ma mère ! ma mère ! disait Lucien agenouillé devant elle, ma mère, dites-moi que je fais un rêve horrible !
– Moins horrible que la réalité, dit-elle en essuyant ses larmes.
Et comme il la regardait avec épouvante, elle ajouta :
– Lucien, votre père est condamné à mort !
Lucien se redressa, puis il chancela et faillit tomber à la renverse.
Mais Dieu lui donna sans doute en ce moment une force surhumaine, car il dit avec un accent de volonté et de résolutions subites :
– Ma mère, si épouvantable que puisse être la vérité, je veux la savoir.
– Je parlerai… murmura milady.
XXIX
Milady avait le visage bouleversé et baigné de larmes.
Son fils ne pouvait pas ne point se laisser prendre à cette douleur qui paraissait immense.
– Oui, mon enfant, dit-elle, tu as raison d’exiger la vérité et tu sauras…
En même temps elle essuya ses larmes, parut faire un violent effort sur elle-même et commença ainsi le récit du petit roman qu’elle avait préparé :
– Mon enfant, je suis Anglaise. Ton père est Indien. Par mes aïeux tu descends d’une des plus grandes familles d’Écosse ; par ton père, tu es l’héritier d’un rajah égorgé par les Anglais.
À ces mots, Lucien respira.
– Ah ! dit-il, mon père n’est donc pas un criminel ?
– Ton père est le plus noble des hommes, continua milady. Rebelle à l’Angleterre qui voulait l’asservir, il se battit en désespéré pour défendre le trône de ses ancêtres. À vingt ans, il était général et tenait un moment en échec toute l’armée de la Compagnie des Indes.
Tombé percé de coups sur son dernier champ de bataille, il fut relevé respirant encore ; on lui refusa la mort qu’il demandait à grands cris, et on l’emmena prisonnier à Londres.
Milady s’arrêta un moment et regarda son fils dont le visage s’était, pour ainsi dire, transfiguré.
Lucien se sentait renaître.
– Après, ma mère, après ? fit-il avec une noble impatience.
– C’est à Londres que je l’ai connu, que je l’ai aimé, que j’ai été adorée par lui.
Et la voix de milady redevint émue.
– Mon père, poursuivit-elle, avait longtemps guerroyé dans l’Inde ; il méprisait cette grande race des Indiens et des Maharattes, ou plutôt, il la haïssait.
Il m’eût tuée, s’il avait su que j’avais cédé à l’amour de votre père.
– Je commence à comprendre, murmura Lucien en baissant la tête.
– Non, vous ne me comprenez pas, reprit milady. Un prêtre catholique nous unit secrètement.
Lucien eut une explosion de joie :
– Je ne suis donc pas bâtard ? s’écria-t-il.
– Non, dit milady, mais tu es le fils d’un proscrit. Ton père avait pu s’échapper. Caché à bord d’un navire marchand, il quitta furtivement l’Angleterre, retourna dans l’Inde et, réunissant les débris de ses partisans, il recommença la lutte.
Cette lutte a duré vingt ans.
Pendant vingt ans, tantôt victorieux, tantôt vaincu, tantôt refoulant les Anglais vers le bord de la mer, tantôt obligé de se réfugier dans les montagnes, il a exaspéré la Compagnie des Indes.
– Et il a succombé ? fit tristement Lucien.
– Oui. Il a dû quitter cette terre de l’Inde où il n’avait plus de soldats. Sa tête est mise à prix. L’Angleterre le traque. Partout où elle le trouvera, elle parviendra à s’assurer de sa personne.
– Même en France ?
– À cette heure, dit milady, il y a des gens à Paris qui attendent son arrivée pour s’emparer de lui.
– On sait donc qu’il devait venir ?
– Oui, pour revoir sa femme et pour voir son fils.
– Mais alors… fit Lucien frissonnant de joie, je le verrai !
– Non, car il est obligé de fuir cette nuit même. Au Havre seulement, à bord d’un navire qui le transportera en Amérique, il sera en sûreté.
– Ô mon père !… murmura Lucien.
– C’est pour cela, mon enfant, reprit milady, que je viens te faire mes adieux.
– Ma mère !… vous partez !…
– Je suis mon époux.
Lucien jeta un cri, puis entourant milady de ses deux bras :
– Et si je partais avec vous ?…
– Toi ?
– Oui.
– Pour l’Amérique ?
– Sans doute.
– Mais ta fiancée ?…
– Nous l’emmènerons.
– Consentira-t-elle à nous suivre ?
– Marie fera ce que je voudrai.
Milady secoua la tête :
– Non, dit-elle, c’est impossible !
– Ma mère, répéta Lucien, je vais avec vous.
– Mais songe, mon enfant, qu’il faut que nous ayons quitté Paris avant le jour.
– Qu’importe !
– Comment veux-tu que ta fiancée puisse nous suivre ?… et toi-même, encore souffrant…
Milady s’arrêta brusquement.
Un bruit de voiture s’était fait entendre dans la rue et venait mourir sous les fenêtres de la maison.
– On vient, adieu ! fit milady.
– Qu’est-ce donc, ma mère ? demanda Lucien.
– C’est ton père qui vient me chercher sans doute, répondit-elle.
Et elle s’élança vers une croisée, qu’elle ouvrit.
Lucien demeurait à l’entresol.
La fenêtre que milady venait d’ouvrir donnait juste au-dessus de la porte cochère.
Une voiture, en effet, venait de s’arrêter devant cette porte.
Et, de cette voiture, Lucien, frémissant, vit descendre un homme de haute taille, enveloppé dans un manteau.
– C’est lui, murmura milady.
Et, se penchant, elle prononça quelques mots en langue indienne.
Le cœur de Lucien battait à rompre sa poitrine.
L’homme de haute taille leva la tête et parut lui-même en proie à une vive émotion.
Puis il s’approcha de la porte et sonna.
Alors milady se tourna vers Lucien.
– Tu vas voir ton père, dit-elle.
* *
*
Cinq minutes plus tard, cet homme étrange qu’on appelait Ali-Remjeh serrait dans ses bras Lucien palpitant, et il exerçait sur lui son bizarre pouvoir de fascination.
Lucien voyait, dans le bandit et l’assassin, un héros, un martyr de la liberté.
Sa mère était devenue un ange de résignation et de dévouement.
Le jeune homme enthousiaste s’écria :
– Oh ! je pars avec vous et je vous suivrai jusqu’au bout du monde.
– Toi et ta fiancée, dit milady.
– Elle me suivra.
– Eh bien ! dit-elle encore en redevenant tout à coup effrayée… partons, alors, partons, au plus vite !
Elle songeait au major Avatar qui lui avait accordé un jour de réflexion et qui, dans quelques heures, non seulement s’opposerait à son départ précipité, mais dirait à Lucien :
– Vous vous croyez le fils d’un héros ; vous êtes l’enfant d’une parricide et d’un bandit !
XXX
Revenons maintenant au major Hoff que nous avons laissé sur un lit du Grand Hôtel, privé de tout sentiment, entre un médecin qui prétendait qu’il avait cessé de vivre et le major Avatar qui affirmait le contraire.
Le major Avatar s’étant installé au chevet du major Hoff, demanda qu’on le laissât seul avec lui.
Tout le monde sortit.
Alors Rocambole prit un flacon de sels magiques qu’il avait sur lui et le fit passer sous les narines du major.
Le réactif fut si violent que le prétendu mort fut agité d’une imperceptible convulsion.
Rocambole versa dans le creux de sa main quelques grains de sel et se mit ensuite à les écraser avec le pouce sur le marbre de la cheminée ; puis quand il les eut réduits en poudre, il jeta cette poudre dans un verre, la délaya avec quelques gouttes d’eau et, entr’ouvrant de force la mâchoire serrée de Franz, il versa le tout dans sa bouche.
Ensuite il le prit à bras-le-corps et le souleva à demi pour que cet étrange breuvage pût traverser le gosier et arriver dans l’estomac.
Le major Hoff commença alors à s’agiter sur son lit, par soubresauts imperceptibles d’abord ; puis les soubresauts devinrent plus violents, et plusieurs soupirs s’échappèrent de sa poitrine.
Rocambole alla fermer la porte au verrou.
Cependant le major Hoff ne s’éveilla point et ne rouvrit point les yeux.
Mais les lèvres s’agitèrent et formèrent un son.
Ce son était un nom à peine articulé :
– Milady.
Rocambole se prit à écouter.
Sans doute que l’âme du major Hoff était éveillée tout entière, si la léthargie étreignait encore son corps, et qu’elle jouissait même de cette lucidité étrange qu’on appelle le somnambulisme, car au nom de milady succédèrent d’autres paroles que Rocambole recueillit attentivement.
– Milady, disait le major d’une voix entrecoupée et sans ouvrir les yeux, tu as beau me fuir… je te rejoindrai ! Tu as quitté Paris… je le sais… je le sais… Mais la terre n’est pas si grande qu’on n’en puisse faire le tour.
Rocambole ne s’y trompa point. Franz était en proie à un accès de somnambulisme.
Alors Rocambole se souvint des résultats étonnants obtenus jadis par Baccarat, devenue madame Charmet, sur la petite juive, dont elle avait fait un sujet de lucidité extrême.
Et, prenant l’attitude d’un magnétiseur, il se mit à charger de fluide le front du major endormi.
Franz s’agita sous les effluves mystérieux, comme un cheval rétif cherchant à résister à son cavalier.
Mais le fluide dominateur triompha et le réduisit à l’impuissance.
Rocambole lui posa une main sur le front et lui dit :
– Voyez !
Le magnétisé fit quelques mouvements brusques et désordonnés, comme s’il eût eu de la peine à obéir ; mais il murmura :
– Je les vois !… je les vois tous deux !
– Qui donc ? demanda Rocambole.
– Milady.
– Bon. Et puis ?
– Et Ali-Remjeh.
Rocambole tressaillit. Le magnétisé continua :
– Ils ont quitté Paris.
– Quand ?
– Cette nuit.
– Où vont-ils ?
– Vers la mer.
– Voyez-vous un navire ? demanda Rocambole.
– Oui.
– Comment est-il ?
– C’est un brick.
– Avec des voiles sang de bœuf ?
– Précisément… Ah !… Attendez !
Et le magnétisé sembla faire un effort suprême pour voir à travers les espaces.
– Que voyez-vous encore ? demanda Rocambole.
– Milady à bord du brick.
– Seule ?
– Non, avec Ali-Remjeh… et puis…
– Ah ! quelqu’un est avec eux ?
– Oui… un homme et une femme.
– Les reconnaissez-vous ?
Le magnétisé garda un moment le silence ; puis tout à coup :
– C’est Lucien… et sa fiancée… Je les vois…
– Le navire est-il en mouvement ?
– Non, il est à l’ancre.
– Pourquoi ne part-il pas ?
– Parce que le mauvais temps règne en mer et qu’aucun pilote ne veut sortir de la rade.
– C’est tout ce que je voulais savoir, murmura Rocambole.
Puis il passa de nouveau ses deux mains sur le front du major :
– Éveillez-vous, dit-il.
Et soudain, le magnétisé poussa un nouveau soupir, puis il ouvrit les yeux et promena autour de lui le regard étonné de l’homme qui ne se souvient de rien.
Le major Avatar s’était assis de nouveau.
– Comment ! dit Franz qui le reconnut, c’est vous, major ?
– C’est moi.
– Comment êtes-vous ici, et pourquoi y suis-je moi-même ?
– Mon cher, répondit Rocambole d’un ton dégagé, tâchez de vous souvenir de ce qui s’est passé hier soir, et je compléterai vos souvenirs.
– Oh ! s’écria tout à coup le major Hoff, oui, j’y suis… un homme…
– Un homme vous a passé un lacet au cou et vous a étranglé… soulevez-vous, regardez-vous dans la glace… bon ! voyez-vous cette marque bleuâtre à votre cou ?
– Le misérable, murmura Franz qui pâlit.
– Cet homme, dit froidement Rocambole, c’est Ali-Remjeh, le chef des Étrangleurs, le père de Lucien et par conséquent le premier amant de milady.
Franz se dressa sur son lit tout effaré.
– Comment savez-vous cela ? s’écria-t-il.
– Attendez… Milady et Ali-Remjeh ont quitté Paris.
– Quand donc ? fit Franz rugissant.
Oh ! je les rejoindrai.
– Ce sera facile, puisque je sais où ils sont.
– Vous le savez ?… Mais comment ?
– Vous venez de me le dire dans votre sommeil. Excusez-moi de vous avoir magnétisé.
Et comme le major Hoff regardait Rocambole avec un muet effroi :
– Mon cher, lui dit ce dernier, sans moi, on vous enterrait bel et bien, et un médecin qui sort d’ici avait constaté votre décès.
Franz ne put réprimer un léger frisson.
Rocambole ajouta :
– Je vous ai donc rendu un léger service. Mais ce n’est rien encore et il ne tient qu’à vous de me prendre dans votre jeu contre le ravisseur de votre maîtresse, et votre maîtresse elle-même qui ne vous aime plus. Écoutez-moi…
Et Rocambole, qui s’était levé un moment, reprit place dans le fauteuil, au chevet du major Hoff.
XXXI
Vanda habitait toujours le petit hôtel de la rue de Marignan.
Depuis quinze jours, cette maison d’apparence aristocratique et paisible avait cependant vu bien des événements mystérieux.
Plus d’une fois, la nuit, à l’heure où les Champs-Élysées deviennent déserts, une voiture de place s’était arrêtée devant la grille du petit hôtel.
Tantôt un homme en était descendu.
Tantôt une femme.
Quelquefois l’un et l’autre en même temps.
Pendant le jour, les habitants du quartier apercevaient parfois une jeune femme se promenant dans le jardin.
C’était Vanda.
Souvent aussi, on voyait entrer et sortir un vieux domestique à cheveux blancs et à stature colossale.
C’était Milon.
Mais c’était tout ; et personne ne soupçonnait que le petit hôtel renfermât d’autres hôtes.
Cependant, la Mort-des-Braves, Noël, Marmouset et Gipsy y étaient venus successivement, et n’en avaient plus bougé.
Peut-être même que Milon aurait pu dire que sir James Nively, le chef des Étrangleurs, était enfermé dans les caves et attendait vainement l’heure de sa délivrance.
Cette heure ne sonnait pas.
Enfin, le lendemain soir du jour où le major Avatar avait rendu visite à Lucien, Vanda entendit une clé tourner dans la serrure de la grille.
C’était Rocambole qui revenait.
Rocambole alla droit à la chambre de Vanda et lui dit :
– Je t’apporte mes instructions.
– Comment, maître, dit-elle, tu pars encore ?
– Oui.
– Où vas-tu ?
– Je n’en sais rien.
Elle le regarda avec étonnement.
– Je ne le sais pas aujourd’hui, dit-il, mais je le saurai dans deux jours. Je pars, et j’emmène Milon, la Mort-des-braves et Noël.
– Et moi ?…
– Toi, je te confie la garde de Marmouset et de Gipsy.
Vanda s’inclina en signe d’obéissance.
– Et l’Anglais, que comptes-tu en faire ?
– Je l’emmène avec moi.
Et Rocambole tira à lui un gland de sonnette ; Milon accourut.
– Tu vas te tenir prêt à partir dans une heure, dit-il.
– Avec vous, maître ?
– Oui, fit Rocambole.
Puis s’adressant de nouveau à Vanda :
– Comment va Gipsy ?
– Je crois qu’avant huit jours, elle aura recouvré la raison. Du reste, elle ne peut plus me quitter, depuis qu’elle est ici. Elle passe des heures entières à me tenir les mains et à me regarder.
– Marmouset a-t-il donc perdu de son influence ?
– Oh ! non, on sent qu’elle l’aime !…
– Si Marmouset est aimé de Gipsy, qu’elle revienne à la raison et qu’elle l’épouse, il aura fait un beau rêve, dit Rocambole en souriant.
– Mais nous n’avons toujours pas les millions.
– Je vais les chercher.
Et Rocambole ouvrit son pardessus et tira de sa poche un gros pli cacheté qu’il tendit à Vanda.
– Qu’est-ce que cela ? demanda-t-elle.
– Écoute bien. Si dans huit jours je ne suis pas revenu, tu ouvriras cette lettre.
– Bien.
– Et tu suivras de point en point les instructions qu’elle renferme.
– Je t’obéirai, maître, dit Vanda avec inquiétude. Mais pourquoi ne serais-tu pas ici dans huit jours ?
– Parce que je vais m’embarquer au Havre.
– Pour l’Angleterre.
– Je ne sais pas… Je ne le saurai qu’en montant à bord.
Vanda courba la tête et ne fit plus d’objections.
* *
*
Cependant, sir James Nively, terrassé par Milon, quelques jours auparavant, avait été garrotté et bâillonné, puis enfermé dans la cave de l’hôtel.
Deux fois par jour, on lui apportait à manger ; alors, on lui ôtait son bâillon.
Après avoir passé par toutes les phases de la terreur et du désespoir, sir James avait fini par tomber dans cette prostration résignée qui est commune aux races fatalistes de l’Orient.
Sa captivité durait depuis quinze jours lorsque, un soir, la porte de son cachot s’ouvrit et livra passage à Milon, son geôlier ordinaire.
Mais Milon n’était pas seul.
Un homme l’accompagnait ; et à la vue de cet homme, sir James tressaillit.
Il avait reconnu Franz, c’est-à-dire le major Hoff, le serviteur dévoué de milady.
Franz tira de sa poche une bourse pleine d’or qu’il tendit à Milon.
– Voilà le prix de tes services, dit-il.
Milon prit la bourse avec un tel empressement que sir James le crut réellement acheté par Franz.
Puis il s’en alla laissant ce dernier avec sir James.
Le baronnet regardait le major Hoff avec un étonnement joyeux.
– Vous ici ! fit-il enfin.
– Oui, dit le major Hoff, je viens vous délivrer.
– Me délivrer !
– J’ai corrompu votre gardien et vous allez pouvoir partir d’ici.
– Mais Rocambole ?
– Il est absent.
– Cette maison est pourtant pleine de ses créatures.
– Vous vous trompez. Tout le monde est sorti.
– Ah !
– Milon les a tous éloignés.
En même temps Franz détachait les liens de sir James, ajoutant :
– Nous n’avons pas une minute à perdre.
– Pour sortir d’ici ?
– D’abord, et quitter Paris ensuite. Si vous voulez être libre, il faut me faire un serment.
– Lequel ?
– Celui de m’obéir pendant quarante-huit heures, si étranges que puissent vous paraître mes volontés.
– Je vous obéirai, répondit sir James, qui avait soif de liberté.
– Alors, suivez-moi.
Et Franz entraîna sir James et prit le flambeau que lui avait laissé Milon.
Ils remontèrent dans le vestibule.
L’hôtel était silencieux et paraissait désert.
À la grille, stationnait une voiture.
Franz en ouvrit la portière et dit à sir James :
– Montez !
– Mais, où allons-nous ? demanda le baronnet.
– Au chemin de fer de l’Ouest, prendre le train de minuit qui arrive au Havre à six heures.
– Nous allons au Havre ?
– Nous embarquer pour l’Angleterre.
– Mais, dit sir James avec un éclair de haine dans les yeux, j’aurais pourtant voulu me venger…
– De qui ?
– De Rocambole.
– La vengeance est là-bas, répondit Franz.
Et il remonta dans la voiture, auprès du baronnet.
Ce dernier ne pouvait supposer que le major Hoff avait pour jamais déserté la cause de milady, et il s’abandonnait à lui avec une aveugle confiance.
XXXII
Le port du Havre présente un aspect singulier.
Depuis huit jours, pas un navire n’est sorti du bassin ; aucune voile ne s’est rencontrée en rade.
Il vente tempête en mer, et les pilotes côtiers refusent tout service.
Aussi les cabarets, les auberges, les moindres bouchons regorgent-ils d’une foule de matelots qui n’ont pu prendre la mer.
Les navires dansent dans le bassin et font crier leurs amarres ; souvent même, en dépit de l’abri du port, embarquent-ils à bord des paquets d’eau et des lames énormes, comme s’ils étaient en pleine mer.
Les curieux sont rares sur les quais et la jetée, car le vent qui souffle du large se fait sentir à terre avec une violence énorme.
Pourtant, dans le cabaret de la Fille-Sauvage, sur le port, une trentaine de personnes examinent curieusement à travers les vitres un petit brick aux voiles d’un rouge sombre, à la coque noire, qui se balance sur la lame sans craquement et sans fatigues.
– C’est le brick indien, dit un maître d’équipage qui a pris ses quartiers d’hiver à la Fille-Sauvage et y est écouté comme un oracle par tous les habitués, marins de l’État ou du commerce, baleiniers ou simples caboteurs.
Le père Mahorec est un vieux loup de mer, qui a navigué dans tous les parages, et à qui on n’a rien à apprendre.
– Mes enfants, dit-il, la mer est tellement mauvaise que d’ici à huit jours, on ne pourra mettre à la voile ; et cela paraît joliment contrarier le brick indien.
– Pourquoi donc ça, père Mahorec ? demanda un jeune homme.
– Hé ! le sais-je, blanc-bec ? ou plutôt je m’en doute… mais suffit !… ça ne regarde personne.
– Papa Mahorec, demande un autre matelot, as-tu vu le capitaine du brick ?
– Oui, sur le pont.
– Il ne descend jamais à terre ?
– Jamais.
– Et le second non plus ?
– Si, le second est venu, ce matin encore, à la Fille-Sauvage, chercher des provisions : mais jamais il ne va en ville, c’est ici qu’on lui fait toutes les commissions.
– Sait-on combien d’hommes il y a à bord ?
– Douze matelots, un mousse, un cuisinier, un charpentier et un chirurgien, le second et le capitaine, deux passagers, deux femmes, en tout vingt-deux personnes.
– Hé ! hé ! père Mahorec, dit un homme jeune encore qui est entré tout à l’heure dans le cabaret et s’est fait servir un grog à l’américaine, vous paraissez bien renseigné.
Le maître d’équipage regarde son nouvel interlocuteur, qu’il voit pour la première fois.
Mais ce dernier, avec son chapeau ciré, sa chemise bleue, son teint hâlé et ses grosses boucles d’oreilles qui brillent sous ses cheveux rouges, ne saurait être qu’un marin, et entre marins la confiance est bientôt née.
– Vous me connaissez ? demande Mahorec.
L’inconnu reprend en souriant :
– De Rochefort à Brest et de Lorient à Toulon, qui donc peut se vanter d’avoir navigué s’il n’a rencontré le père Mahorec ?
– Bien parlé, mon garçon, dit le maître d’équipage évidemment flatté du compliment.
Et, prenant sa chope de bière, il va s’asseoir à la table de l’inconnu.
Puis, d’un air confidentiel et baissant la voix :
– Tous ces gens-là, dit-il, sont des brutes qui ne comprennent rien. Aussi ce n’est pas la peine de leur expliquer pourquoi le mauvais temps contrarie le capitaine et l’équipage du brick indien.
– Vous avez peut-être raison, dit l’homme aux boucles d’oreilles.
– Hé ! hé ! continua Mahorec en clignant de l’œil, il y aurait à bord un joli chargement de contrebande à l’adresse de l’Angleterre que ça ne m’étonnerait pas.
– Moi non plus, père Mahorec.
– Il faut vous dire que voilà plus d’un mois que le brick est au Havre.
– Vraiment ?
– C’est le second qui commandait. Il parle anglais comme vous et moi.
L’inconnu sourit.
– C’est un grand diable de mulâtre, très bon enfant. Tous les jours lui et les matelots venaient à terre, et j’ai idée qu’ils faisaient leur chargement à la sourdine. Peut-être même que le gouvernement leur a donné un coup de main en conseillant aux douaniers du port de ne pas y regarder de trop près.
– Vous croyez ?
Le père Mahorec prit un air rusé et continua :
– J’ai toujours idée que nous allons avoir une bonne guerre avec l’Angleterre.
– Alors, à votre idée, ce brick serait un corsaire ?
– Peut-être bien. À preuve que le capitaine que personne ne connaissait et n’avait jamais vu à bord, est arrivé de Paris.
– Quand donc ?
– Il y a trois jours ; et il paraît s’impatienter beaucoup du mauvais état de la mer.
– Alors, personne n’a vu ce capitaine en ville ?
– Non, mais le second m’a dit que c’était un Indien qui en veut à mort aux Anglais et que le gouvernement français protège.
L’homme aux boucles d’oreilles fit encore quelques questions au père Mahorec.
Mais ce fut en pure perte. Le père Mahorec avait, comme on dit, vidé son sac.
Il avait dit tout ce qu’il savait.
D’autres matelots entrèrent dans le cabaret de la Fille-Sauvage et l’homme aux boucles d’oreilles serra la main au père Mahorec sans lui avoir dit son nom.
La journée s’écoula.
Vers le soir, le cabaret se vida.
Les uns s’en allèrent coucher à bord de leurs navires, les autres courir les petites rues tortueuses qui avoisinent le port.
Alors l’homme aux boucles d’oreilles revint et demanda à souper.
La fille du cabaretier lui dit :
– Vous plairait-il de souper en compagnie ?
– Certainement, répondit-il, sans que cette question parût lui causer la moindre surprise.
– Voulez-vous souper avec le second du brick indien ?
– Je ne demande pas mieux. Où est-il ?
– Là-haut. Dans le cabinet.
L’homme aux boucles d’oreilles monta lestement l’escalier tournant qui mettait le cabinet en communication avec le premier étage et pénétra dans une petite salle où, en effet, un homme était déjà à table.
À la vue du nouveau venu, cet homme se leva et salua avec toute la déférence d’un inférieur.
– Eh bien ? dit l’homme aux boucles d’oreilles, en fermant la porte.
– Tout est prêt.
– Nos hommes sont à bord ?
– Oui.
– On ne les a pas reconnus ?
– Aucun. Milady a passé trois fois à côté de Franz, qui fumait sur la dunette, et ne l’a pas même regardé.
– Et Milon ?
– Il s’est fait une tête bronzée admirable et il a teint ses cheveux en noir.
– Tu réponds du reste de l’équipage ?
– Comme de moi-même.
– Noël, dit l’homme aux boucles d’oreilles, tu es un garçon intelligent.
– Maître, répondit le second du brick indien, je n’ai pas passé dix années à Toulon sans devenir un peu marin.
– Partons-nous demain ?
– La mer est bien mauvaise. Mais c’est égal, c’est mon avis !
– Et puis, ça me connaît la tempête, dit l’homme aux boucles d’oreilles, qui n’était autre que Rocambole.
Noël, car c’était lui, le second du brick indien, se prit à sourire et dit :
– Quand on pense que Ali-Remjeh n’attend qu’une chose pour filer.
– Un pilote ?
– Oui.
– Eh bien ! il l’aura demain…
Et Rocambole se mit à table.
XXXIII
Il fait nuit, le vent continue à souffler du large, les navires du bassin s’entrechoquent avec les petites embarcations, et les quais du port sont déserts.
Cependant, à bord du navire qu’on appelle le brick indien, deux hommes causent tout bas, couchés l’un à côté de l’autre, auprès du gouvernail.
Ces deux hommes sont Noël et Milon.
Tous deux pourraient entrer impunément dans la boutique du fruitier, rue du Vert-Bois.
On ne les reconnaîtrait pas.
Milon est devenu un mulâtre de la plus belle venue.
Le teint olivâtre sied à merveille à ses grosses lèvres, à ses cheveux crêpés, à ses larges épaules d’hercule forain.
Noël est devenu un véritable Anglo-Indien, de la race rouge.
Ali-Remjeh s’y était trompé.
Comment tous ces miracles se sont-ils accomplis, comment Noël est-il devenu le second du navire indien ?
C’est ce que Milon lui demande, et ce qu’il est en train de lui expliquer.
– Écoute bien, vieux, dit Noël.
– J’écoute, répond Milon. Le maître et toi, vous êtes partis pour l’Angleterre, voici trois semaines.
– Le surlendemain du jour où le maître l’a échappé belle dans les Carrières de Pantin…
– Et où il a été sauvé par Marmouset ?
– Justement.
– Mais qu’est-il allé faire à Londres ?
– Il est allé voir le lord-chef de l’amirauté, quelque chose comme qui dirait le ministre de la marine.
– Bon ! fit Milon. Eh bien ?
– Alors il a dit au lord : Vous avez offert une prime à celui qui vous livrera Ali-Remjeh, le chef suprême des Étrangleurs de Londres ? – Oui, lui a répondu le lord. – Donnez-la-moi, a dit le maître.
– Mais… fit Milon stupéfait.
– Attends… Le maître a dit encore au lord une foule de choses relatives aux Étrangleurs et il paraît qu’on a eu une grande confiance en lui, puisqu’on lui a donné pleins pouvoirs, qu’on a mis à sa disposition des hommes et de l’argent, et que nous sommes venus tout droit de Brighton ici.
– Tout cela ne me dit pas…
– Mais écoute donc. Jusqu’à présent, tu ne peux pas comprendre… on a donné au maître, pendant qu’il était à Londres, une foule de renseignements. Ainsi, par exemple, qu’un navire sous pavillon anglais, mais avec un équipage indien, viendrait relâcher au Havre, sous le commandement d’un capitaine en second, avec mission de prendre à son bord, à destination de New-York, un capitaine en premier.
– Et ce capitaine, c’est le moricaud qui est arrivé avant-hier matin ? demanda Milon.
– Justement. Seulement, comme tu vois, il a de la compagnie et il voyage en famille.
– Mais, reprit Milon, ça ne me dit pas comment tu as pris la place du second, et nous autres, les gens de Rocambole, celle de l’équipage.
– C’est encore bien simple, dit Noël.
– Comment cela ?
– Tu te souviens de Gurhi ?
– Oui.
– Et de sir George Stowe ?
– Parfaitement.
– Gurhi avait initié le maître à une grande partie des secrets des Étrangleurs.
– Bon !
– Sir George Stowe, avait complété l’œuvre. Or, sir George Stowe dépossédé de son pouvoir à Londres, a juré une haine mortelle à Ali-Remjeh et à sir James Nively.
– Je sais cela.
– Il s’est fait l’esclave de Rocambole et le servira jusqu’à la mort. Or, il faut te dire que sir Georges Stowe, dépouillé par sir James de son autorité est néanmoins demeuré le chef apparent des Étrangleurs de Londres. Il a les signes et les amulettes qui indiquent le commandement.
Quand nous sommes arrivés à Londres, le Maître a envoyé une dépêche à sir George Stowe.
Sir George Stowe est arrivé le soir même.
Alors il s’est rendu à bord du brick indien et s’est fait reconnaître.
Le second l’a reçu avec de grandes marques de respect.
– Ah ! s’interrompît Noël, j’oubliais de te dire une chose.
– Laquelle ?
– C’est que Ali-Remjeh qui a quitté l’Inde depuis plusieurs mois, avait écrit à sir George Stowe pour lui donner des ordres. Sir George Stowe remplacé par sir James, c’est à ce dernier que les ordres arrivés à Londres ont été expédiés.
Or, comme sir James était dans nos mains, c’est par conséquent à Rocambole que les ordres sont parvenus.
– Bon ! fit Milon, je commence à comprendre.
– Sir George Stowe, poursuivit Noël, après avoir causé avec le second, a été convaincu qu’il n’avait jamais vu Ali-Remjeh, et qu’il ne connaissait à Calcutta, d’où venait le navire, que des Étrangleurs subalternes.
Alors il lui a été donné l’ordre de sortir à la nuit tombante, dans la chaloupe du brick, et il a pris le commandement de l’embarcation.
La mer était déjà mauvaise, mais on pouvait encore naviguer.
La chaloupe avait à bord le second et huit hommes d’équipage. Les quatre autres étaient demeurés à bord du brick dans le bassin.
Sir George Stowe étant muni des pleins pouvoirs de Ali-Remjeh le chef suprême, le second n’avait plus qu’à obéir.
La destination était inconnue.
La chaloupe a doublé la pointe de Sainte-Adresse et pris la route de Fécamp.
Le vent fraîchissait, la mer était houleuse, mais la chaloupe avançait toujours. Sur l’ordre de sir George Stowe, le second avait fait mettre la barre au vent et le cap sur un gros brick marchand qui avait cargué toutes ses voiles.
Ce navire qui portait pavillon anglais a mis, en voyant la chaloupe, une embarcation à la mer.
Les chaloupes ont accosté.
Celle du brick était pleine de matelots anglais qui se sont jetés sur les Indiens, les ont garrottés, ainsi que le second et les ont hissés à bord ensuite.
Sir George Stowe est resté dans la chaloupe avec deux matelots du navire anglais, l’un d’eux était la Mort-des-braves, qui est devenu bon rameur, à Toulon, l’autre…
– C’était toi ? fit Milon.
– Justement. Nous sommes rentrés au Havre, tandis que le brick anglais qui avait été envoyé, sur la demande de Rocambole par l’amirauté anglaise, emmenait le second et les huit hommes d’équipage du navire indien.
Au Havre, j’ai recruté mon équipage. Nous sommes rentrés de nuit à bord du brick ; les quatre hommes qui restaient de l’ancien équipage ont été mis aux fers et jetés à fond de cale.
Et voici comment, acheva Noël, Ali-Remjeh, qui croit être chez lui, se trouve chez nous.
– Enfin, quand partons-nous ?
– Demain.
– Et Rocambole vient avec nous ?
– C’est le pilote qui est venu ce matin à bord ?
– Il n’y a que le maître pour se métamorphoser ainsi, murmura Milon. Je ne l’ai pas reconnu.
– Chut ! fit Noël.
Et il poussa du doigt Milon qui tourna la tête.
Une forme noire venait d’apparaître à l’ouverture du grand panneau.
XXXIV
Noël et Milon demeurèrent immobiles.
La nuit était sombre et le vent soufflait avec violence.
La forme noire qui s’était arrêtée à l’orifice du grand panneau fut bientôt rejointe par une autre.
Noël qui avait le regard perçant et avait contracté l’habitude de voir distinctement dans l’obscurité, reconnut Ali-Remjeh dans la première et milady dans la seconde.
Cette dernière prit le bras d’Ali-Remjeh et tous deux se dirigèrent vers l’arrière et s’assirent auprès de la barre.
Ils étaient, en cet endroit, à une assez grande distance de Milon et de Noël pour que ceux-ci, par un temps calme, ne pussent entendre ce qu’ils disaient.
Mais comme le vent soufflait de l’arrière à l’avant du navire, leur conversation arriva par lambeaux à l’oreille des deux faux Indiens qui n’avaient garde de bouger.
Milady disait :
– Tu crois donc, mon bien-aimé, que nous allons pouvoir partir ?
– Oui.
– La mer est cependant bien mauvaise.
– Le pilote qui est monté à bord ce soir prétend qu’on peut sortir du port, franchir la rade et que, une fois au large, nous rencontrerons un temps meilleur.
– Ah ! murmura milady, j’ai hâte de fuir.
– Tu crains donc bien cet homme ?
– Mes cheveux se hérissent, en pensant à lui.
Ali-Remjeh passa un de ses bras autour du cou de milady.
– Chère amie, dit-il, encore quelques heures et tout danger aura disparu. N’avons-nous pas avec nous notre cher fils et sa fiancée !
– Ô les enfants bénis ! murmura milady avec une émotion subite, ils sont prêts à nous suivre au bout du monde !
– Et le pauvre vieillard qui, par amour pour sa fille, s’expatrie à son âge ! fit Ali-Remjeh.
Milady garda un moment le silence.
– Es-tu bien sûr des deux hommes que tu as laissés à Paris ? dit-elle enfin.
– Comme de moi-même.
– Ils pourront, avec nos deux signatures, retirer les sommes énormes déposées dans la maison Davis Humphrey ?
– Sans nul doute.
– Et ils nous les apporteront à New-York.
– Je te le jure, ces hommes sont nos esclaves.
Milady regardait le ciel dans lequel commençaient à courir les premiers rayons de l’aube.
– Dans deux heures, dit Ali-Remjeh, nous aurons quitté le Havre.
– Dans deux heures, pensa milady avec une joie anxieuse, nous n’aurons plus rien à craindre de Rocambole.
Puis, tout haut :
– Ah ! dit-elle, si tu savais ce que j’ai souffert depuis trois jours. Il me semblait que cet homme qui a sauvé Gipsy avait retrouvé nos traces.
Chaque barque se détachant du quai me semblait le porter.
À chaque homme qui paraissait sur le quai, j’étais prête à m’écrier :
– C’est lui !
– Folle, dit l’Indien, as-tu donc perdu à ce point la confiance que tu avais en moi ?
Ne suis-je plus Ali-Remjeh ?
Milady ne répondit pas.
Les pressentiments les plus terribles l’agitaient.
Ali-Remjeh reprit :
– J’ai annoncé à Lucien que le brick lèverait l’ancre au point du jour. Il veut être sur le pont quand nous partirons, pour dire un dernier adieu à la France.
– Eh bien ! dit milady, je vais le rejoindre. J’ai vu de la lumière sous la porte de sa cabine. Certainement il ne dort pas.
Et milady regagna l’escalier du grand panneau.
En effet, Lucien veillait.
Seul, rêveur et mélancolique, le jeune homme à demi-couché dans son cadre, la tête appuyée sur une de ses mains, et le coude replié sur lui-même, il murmurait :
– Singulière destinée que la mienne ! J’ai passé vingt ans à retrouver une famille et le jour où je la retrouve elle est proscrite, et si mon père veut conserver sa tête sur ses épaules, il faut qu’il mette entre l’Europe et lui la largeur de l’Océan ; et si je ne me veux séparer à jamais de lui et de ma mère, il faut que moi aussi je m’expatrie et quitte cette chère terre de France où mon enfance s’est écoulée.
Milady entra.
Lucien lui passa les deux bras autour du cou.
– Eh bien ! ma mère, dit-il, partons-nous ?
– Dans une heure, mon enfant, répondit-elle avec émotion.
– Une heure ! dit Lucien.
Et sa voix s’altéra légèrement.
– Cher enfant, reprit-elle, si tu hésites à faire ce grand voyage, il en est temps encore… Séparons-nous… Retourne à Paris avec ta fiancée…
– Ma mère, dit Lucien avec fermeté, mon devoir est de vous suivre et ce devoir m’est dicté par mon cœur. Marie m’a dit, hier encore, que partout où je serais elle vivra heureuse… Que me faut-il de plus ? J’aime assez Paris pour ne point l’oublier, mais je ne le regretterai pas.
– Qu’il en soit donc ainsi, murmura milady avec une joie qu’elle ne put dissimuler plus longtemps.
En ce moment le brick immobile oscilla légèrement et un certain bruit se fit sur le pont.
Les apprêts de l’appareillage commencent.
– Montons, dit Lucien, je veux voir une dernière fois la terre de France.
* *
*
Une heure après, le jour commençait à poindre, le brick indien se chargeait de toile et hissait ses ancres.
Un homme était monté sur le banc de quart et commandait la manœuvre.
Cet homme, c’était le marin aux boucles d’oreilles qui avait fait connaissance de maître Mahorec, à l’auberge de la Fille-Sauvage.
Il commandait d’une voix pleine et sonore, en anglais, et cette voix arriva jusqu’au quai, qui commençait à se garnir d’un flot de curieux, impatients de voir un navire se risquer à la mer par un temps pareil, car la tempête ne s’était pas apaisée.
Le père Mahorec, le vieux maître d’équipage, était parmi eux, une lunette à la main.
– Ah ! tonnerre ! s’écria-t-il tout à coup, elle est forte, celle-là !
– Quoi donc ?
– C’est mon homme d’hier qui sert de pilote. Il m’a joliment fait poser.
Le brick s’ouvrait un passage à travers les navires, et bientôt il fut hors du bassin.
On le vit entrer dans la rade, prendre le vent et s’élancer vers la haute mer, à demi-couché, sous l’effort du vent, sur la lame couronnée d’écume.
Calme, impassible, dominant la tempête, le pilote commandait : et ce pilote, Noël l’avait dit à Milon, c’était Rocambole.
XXXV
Quand la tempête règne dans la Manche, il n’y a pas de mer plus mauvaise.
Le navire fatigue et n’avance pas, et un pilote côtier seul peut gouverner avec sûreté.
Il y a quinze heures que le brick indien est sorti du bassin du Havre.
Les voiles larguées, couché sur le flanc, il est le jouet des lames énormes.
À chaque instant, il embarque de monstrueux paquets d’eau.
Il a fallu fermer les panneaux et les écoutilles.
De temps en temps, les mâts craquent sous l’effort du vent.
Cependant le pilote n’a point quitté son banc de quart, et sa voix domine toujours l’ouragan.
L’obscurité est opaque, il pleut à torrents.
Milady est dans la cabine de la jeune fille qui doit être bientôt la femme de Lucien.
Marie Berthoud et son père sont en proie aux tortures du mal de mer.
Milady et Lucien leur donnent des soins. – Lucien anxieux, milady toujours agitée des plus noirs pressentiments.
Le navire ne se brisera-t-il pas sur quelque récif à fleur d’eau, et pour sauver cette fortune qu’elle voulait conserver à son fils, n’a-t-elle pas mis en péril la vie de ce même fils ?
Et puis, une vague épouvante qu’elle n’a pas même confiée à Ali-Remjeh s’est emparée d’elle depuis le départ : il lui semble que les Indiens au teint cuivré, qu’Ali-Remjeh croit ses esclaves, ne lui obéiront pas ; elle a cru surprendre entre eux des signes d’intelligence de mauvais augure.
Ce pilote surtout dont la voix domine la tempête lui inspire un superstitieux effroi.
Ali-Remjeh n’a pas quitté le pont ; mais le pilote commande toujours.
Cependant, vers minuit, le chef des Étrangleurs, dominé par une soif ardente, descend dans sa cabine pour y prendre un verre de rhum.
Milady le rejoint.
Elle est pâle, oppressée et, se jetant au cou d’Ali-Remjeh, elle lui dit avec effroi :
– Mon Dieu ! n’allons-nous pas faire naufrage ?
– Non, répond Ali-Remjeh, la mer se calme peu à peu. Dans une heure nous serons hors de tout danger.
Il faut vous coucher, Ellen, il faut prendre un peu de repos. Demain, en vous éveillant, vous verrez le soleil resplendissant sur les vagues apaisées.
Ali-Remjeh a pris la place de milady auprès des deux malades, et milady s’est enfermée à son tour dans la cabine.
Elle s’est mise au lit, elle a essayé de dormir.
Vains efforts ! Ses angoisses augmentent ; elle qui ne craignait rien, redoute à présent le naufrage, et il lui semble que son fils bien-aimé touche à sa dernière heure.
Tout à coup un bruit étrange a frappé ses oreilles.
Un bruit qui n’est ni un craquement de mât ni le choc d’une lame balayant le pont, ni un mugissement du vent, mais les gémissements de voix humaines qui paraissent sortir des entrailles même du navire.
Et milady se relève et appelle Ali-Remjeh.
L’Indien revient dans la cabine ; milady lui montre l’endroit d’où paraissent sortir les voix.
Ali se penche et écoute.
Puis, tout à coup :
– Il y a des hommes enfermés dans la cale, dit-il, des hommes qui sont Indiens, car c’est dans cette langue qu’ils se plaignent, bien qu’il me soit impossible de comprendre ce qu’ils disent, à travers les planches et à cause de l’éloignement.
Ali-Remjeh, en parlant ainsi, s’est élancé hors de la cabine de milady.
Il monte sur le pont.
Là, tout le monde est à son poste ; les douze matelots sont à la manœuvre, le second au gouvernail.
– Qui donc a-t-on enfermé dans la cave ?
Pour la première fois, depuis quatre jours, Ali-Remjeh soupçonne une trahison.
Les hommes qui montaient le brick en arrivant au Havre étaient partis de Calcutta.
Tous appartenaient à cette secte dont il était le chef.
Tous doivent être tatoués sur la poitrine d’un signe mystérieux, et le second aussi bien que les autres.
Noël est à la barre.
Il a su bronzer son visage et se donner l’air d’un Indien.
Mais sa vareuse s’est ouverte sous l’effort du vent et sa chemise flottante laisse en ce moment voir sa poitrine nue qu’éclairent les reflets du fanal de poupe.
Ali-Remjeh s’est approché sans bruit.
Son œil ardent examine Noël.
Celui-ci, tout entier à sa besogne, n’a pas vu l’Indien qui se tient, du reste, à une certaine distance.
Son visage et ses mains sont enduits d’une couleur brune ; mais sa poitrine est demeurée blanche.
Ali-Remjeh tressaille et reconnaît, dans ce prétendu capitaine indien, un homme de race européenne.
– Je suis trahi ! murmure-t-il.
Un moment, il a saisi un revolver et s’apprête à faire feu sur Noël.
Mais Ali-Remjeh est un homme de sang-froid et d’intelligence.
– Comment cet homme a-t-il pris la place du second venu de Calcutta ?
Et, s’il en est ainsi, l’équipage n’est-il pas tout entier à ses ordres ?
Ali-Remjeh remet le revolver dans sa poche et s’éloigne, sans que Noël l’ait aperçu.
Un seul homme a vu Ali-Remjeh et peut-être a deviné ce qui se passait en lui.
C’est le pilote, qui n’a pas bougé de son banc de quart.
L’Indien quitte de nouveau le pont et redescend dans l’intérieur du navire.
Les hommes enfermés dans la cale ne sont-ils pas ceux de l’ancien équipage ?
Quand il les aura délivrés, Ali-Remjeh agira.
Il descend donc dans la cale.
Là, les gémissements et les imprécations sont devenus plus distincts.
Ali-Remjeh se dirige vers la porte du cachot, une lanterne à la main.
Mais la porte est fermée…
Et comme le chef des Étrangleurs cherche autour de lui un levier, un outil quelconque, pour l’enfoncer, un homme se dresse tout à coup devant lui.
Et Ali-Remjeh recule en jetant un cri, comme s’il venait de voir un mort sortir de sa tombe…
XXXVI
L’homme qui venait de se dresser du milieu des barriques et autres objets encombrant la cale et qui se montrait tout à coup à Ali-Remjeh, frappé de stupeur, c’était le major Hoff.
C’est-à-dire Franz, que le terrible lasso de l’Indien avait renversé mort sur le parquet de l’appartement de milady, au Grand-Hôtel.
Avant de devenir chef suprême de la mystérieuse association des Thugs, Ali-Remjeh avait été simple Étrangleur.
Or, jamais il n’avait manqué son coup ; jamais un homme abattu par son lacet de soie ne s’était relevé.
Ensuite, en admettant le contraire, en supposant que Franz ne fût pas mort, comment pouvait-il se trouver sur ce navire ?
Le merveilleux et le surnaturel viennent en aide volontiers aux imaginations colorées de l’Extrême-Orient.
Ali-Remjeh eut un moment d’effroi superstitieux et recula vivement, persuadé qu’il n’avait devant lui que le fantôme de sa victime.
La faculté qu’ont les morts de sortir de leur tombe est au nombre des premières croyances indiennes.
– Arrière ! fantôme ! cria Ali-Remjeh reculant jusqu’à la muraille de la cale.
Ce que voyant, Franz fit un pas vers lui.
Ali-Remjeh avait un revolver dans sa poche, un poignard à sa ceinture.
Mais il était tellement convaincu qu’il n’avait devant lui que l’ombre de Franz, qu’il ne songea point à faire usage de ses armes.
Ce que voyant, Franz fit un bond vers lui, en même temps qu’il fit entendre un coup de sifflet.
Et tandis qu’il prenait l’Indien à la gorge, deux hommes se dressèrent auprès de Franz et lui vinrent en aide.
Ces deux hommes étaient Milon et la Mort-des-Braves. Ce fut si rapide, si instantané, que Ali-Remjeh, revenu de son erreur superstitieuse, n’eut pas le temps de se défendre.
Il fut renversé sur le sol, Milon lui mit un genou sur la poitrine et Franz, lui enlevant son revolver, le braqua sur lui en disant :
– Au moindre cri que tu pousseras, beau ravisseur de femmes, j’ai l’ordre de te tuer.
Franz était le plus fort, au moins pour le moment ; Ali-Remjeh se résigna avec le flegme des gens de sa race.
– Milon, disait Franz, maintenez l’ex-capitaine sous votre genou ; mais ne lui fermez pas la bouche avec vos mains.
Je lui ai défendu de crier ; mais s’il veut causer avec moi et me questionner sur une foule de choses qui peuvent l’intéresser, je n’y vois pas d’inconvénient.
Ali-Remjeh leva sur le major un œil terne et froid.
– Ah ! dit-il, tu n’es donc pas mort ?
– Non, je ne suis pas mort, répondit Franz.
– Et tu reçois des ordres me concernant ?
– Peut-être…
– D’un homme qui commande ici. Mon second ?
– Non, dit Franz en riant, le pilote.
Ali-Remjeh tressaillit.
Et comme les gémissements se faisaient toujours entendre derrière la porte du cachot, malgré lui Ali-Remjeh tourna la tête.
– Ah ! dit Franz, cela t’étonne, n’est-ce pas ?
– Traître, dit Ali-Remjeh, je devine. Toi et les tiens vous vous êtes emparés de mon navire.
– C’est la vérité.
– Et mes compagnons, mes matelots, ceux qui me sont dévoués, sont enfermés là…
– Tu l’as dit.
– Mais l’Indien est patient, poursuivit Ali-Remjeh. Ils finiront par briser cette porte.
– Tu crois ? ricana le major.
– Ils viendront à mon aide, ils me délivreront…
– Et tu nous feras tous pendre aux vergues, dit Franz d’un ton moqueur.
Ali-Remjeh ne répondit pas, mais ses yeux brillèrent d’une flamme sombre.
Franz reprit :
– Malheureusement, le nombre de tes compagnons est moins grand que tu ne supposes. Combien avais-tu de matelots ?
– Douze, dit Ali-Remjeh.
– Il n’en reste plus que quatre.
– Misérables ! hurla Ali-Remjeh, auriez-vous donc jeté les autres à la mer ?
– Non, on les a conduits à bord d’un navire anglais.
L’Indien frissonna.
– Ils sont en Angleterre, à présent, continua Franz, en Angleterre, où nous allons nous-mêmes, et où l’on m’a promis ma grâce en échange de mes révélations.
Un rugissement de fureur s’échappa de la poitrine d’Ali-Remjeh.
– Prends garde, dit Franz, j’ai des ordres.
– Mais comment se nomme donc le misérable à qui tu obéis ? s’écria l’Indien.
– Il te le dira lui-même.
Et, comme Franz disait cela, un nouveau personnage apparut à l’entrée de la cale, et Ali-Remjeh reconnut le pilote.
Celui-ci avait remis le commandement aux mains de Noël.
– Tu veux savoir qui je suis, Ali-Remjeh, dit-il. Je me nomme pour milady le major Avatar, je me nomme pour toi Rocambole.
En même temps, il fit un signe à Milon qui cessa d’appuyer son genou sur la poitrine de l’Indien.
– Relève-toi, Ali-Remjeh, dit-il.
L’Indien n’avait plus son revolver, mais il avait encore son poignard.
Et, le saisissant, il songea un moment à opposer à tous ces hommes une résistance désespérée.
Rocambole haussa les épaules, et lui dit en souriant :
– Prends garde ! tu vas jouer la vie de ton fils.
Et il y avait dans son accent une telle résolution que Ali-Remjeh frissonna, et que le poignard dont il s’était armé échappa à sa main.
– Ali-Remjeh, poursuivit Rocambole, milady et toi, vous avez volé une fortune qui appartient à une femme que je protège.
Ni elle, ni toi ne voulez rendre cette fortune, n’est-ce pas ?
– Jamais, dit l’Indien avec énergie.
– Alors, j’ai dû prendre une résolution qui me mettra en possession d’une somme presque équivalente.
Malgré son effroi et sa fureur, Ali-Remjeh ne put s’empêcher de regarder Rocambole avec curiosité.
– J’ai résolu de gagner la prime de deux cent mille livres sterling offerte par l’amirauté anglaise à celui qui livrera Ali-Remjeh et les siens.
Ali-Remjeh pâlit affreusement.
– Allons ! ordonna Rocambole, qu’on mette cet homme aux fers et qu’il aille rejoindre sir James Nively au cachot.
Et, tandis qu’on exécutait ses ordres, en dépit de la résistance désespérée d’Ali-Remjeh, Rocambole remonta sur le pont.
XXXVII
Ali-Remjeh, en s’élançant d’abord de sa cabine sur le pont, avait laissé milady bouleversée par les gémissements confus qui semblaient partir des entrailles du navire.
Jadis, il y avait vingt ans, l’enthousiaste miss Ellen eût haussé les épaules, si on lui avait dit que quelqu’un pouvait dominer et vaincre celui en qui elle avait une foi ardente, son vaillant Ali-Remjeh.
Maintenant, elle avait perdu la foi.
L’Indien avait vieilli.
Il avait bien conservé son naturel farouche, ses colères tempétueuses ; mais, au travers de tout cela, milady avait surpris mille hésitations.
Et milady avait peur.
Cependant, elle ne quitta point la cabine tout de suite.
Elle attendit même près d’une heure, croyant toujours que Ali-Remjeh allait revenir.
Mais l’Indien ne revenait pas.
Milady se décida à monter sur le pont.
La tempête se calmait peu à peu et, à l’horizon, les nuages tourmentés commençaient à se franger d’une vague clarté.
Le jour n’était pas loin.
L’équipage était toujours à la manœuvre.
Seul, le pilote avait abandonné son banc de quart.
Où était-il ?
Milady le chercha vainement des yeux, comme elle chercha Ali-Remjeh.
Ni l’un ni l’autre n’étaient sur le pont.
Milady pensa que Ali-Remjeh était redescendu dans l’intérieur du navire par un autre panneau ; et elle prit le parti de le rejoindre dans sa cabine à lui.
Sa porte en était entr’ouverte. Un homme s’y trouvait, tournant le dos. Il était assis devant une petite table qui supportait le compas et les autres instruments du capitaine.
Une lampe à abat-jour, placée sur cette table, ne projetait autour d’elle qu’une très faible clarté.
Milady crut que c’était Ali-Remjeh.
Elle entra et ferma la porte.
Alors, l’homme qui paraissait chercher le point et donner la route à suivre, tourna lentement la tête.
Milady recula tout effarée.
Cet homme, c’était le pilote.
Mais le pilote débarrassé de son chapeau ciré, de sa longue chevelure, de la couleur bistrée qui couvrait son visage.
Et, dans le pilote, milady reconnut son terrible adversaire, le major Avatar.
– Je vous attendais, madame, lui dit froidement Rocambole.
Et il lui avança un siège.
– Vous ! vous ! murmurait milady avec une épouvante croissante.
– Madame, dit Rocambole, veuillez vous calmer et reprendre toute votre présence d’esprit, car je vous jure que vous en avez le plus grand besoin.
Et, comme elle continuait à attacher sur lui un œil hagard :
– Milady, poursuivit-il, je vous avais avertie pourtant, à Paris, et vous n’avez tenu aucun compte de mes avertissements.
Ou plutôt, vous avez cru pouvoir m’échapper, vous et votre complice, l’Indien Ali-Remjeh, vous avez quitté précipitamment Paris, en pleine nuit, emmenant votre fils, emmenant sa fiancée et le vieux père de sa fiancée.
Milady courbait la tête sous le regard dominateur de cet homme, mais elle n’avait point pris le siège qu’il lui avait avancé.
– Afin que vous compreniez, madame, la gravité de la situation, reprit Rocambole, laissez-moi vous dire en peu de mots ce qui s’est passé.
Elle le regardait et, comme si elle eût suivi son conseil, elle retrouvait peu à peu son sang-froid.
– Vous êtes ici, continua Rocambole, à bord d’un navire venu tout exprès des Indes, pour prendre Ali-Remjeh et le conduire en Amérique.
Ce navire est entré dans le port du Havre avec un équipage dévoué.
Un homme est venu à bord, vous précédant de vingt-quatre heures ; cet homme, c’était sir George Stowe, hier le fanatique serviteur d’Ali-Remjeh, son ennemi mortel aujourd’hui.
Mais les matelots indiens de qui il s’est fait reconnaître lui ont obéi.
Sur douze hommes d’équipage, huit sont descendus dans la chaloupe, armée par les ordres de sir George Stowe.
La chaloupe est sortie du bassin, elle a pris la mer et abordé un navire anglais qui courait des bordées devant Sainte-Adresse.
Les huit hommes d’équipage, reconnus comme Étrangleurs, sont aujourd’hui aux mains de l’amirauté.
Les quatre autres, ceux qu’on avait laissés à la garde du navire, ont été mis aux fers et jetés à fond de cale.
Ne les entendiez-vous pas crier tout à l’heure durant le gros temps ?
Maintenant, il est inutile de vous apprendre qu’il n’y a ici qu’un capitaine, moi, et un équipage qui m’obéit.
Inutile encore de vous dire que le brick a pris la route d’Angleterre.
– Ah ! fit milady frémissante.
– Et que je vais tenir ma promesse à l’amirauté en lui livrant Ali-Remjeh, le chef des Étrangleurs de l’Inde, sir James Nively, son lieutenant, miss Ellen sa complice dans l’assassinat du commodore Perkins et de miss Anna, sa fille.
Milady était d’une pâleur de statue.
– Oh ! s’écria-t-elle tout à coup, vous vous vantez peut-être, monsieur, et vous ne savez pas quel homme est Ali-Remjeh.
Un sourire glissa sur les lèvres de Rocambole.
– Seul contre vous tous, poursuivit milady s’exaltant par degrés, Ali-Remjeh vous tiendra tête, et je vous défie en son nom.
– Madame, dit Rocambole avec calme, vous vous trompez…
– Moi !
– À cette heure, Ali-Remjeh, mis aux fers, est couché à fond de cale avec ses compagnons.
Milady jeta un grand cri. Puis, tout à coup, regardant fixement Rocambole :
– Oh ! dit-elle, c’est impossible ! Vous mentez !
Rocambole se leva, ouvrit la porte et dit :
– Major, venez donc affirmer à milady que je viens de lui dire la vérité !
Et, à ces mots, un homme entra.
Et Milady, éperdue, essaya de fuir.
Cet homme c’était Franz, qu’elle aussi elle avait cru mort.
XXXVIII
Franz, en entrant, avait refermé la porte derrière lui. Milady, bouleversée, était tombée à genoux.
Cet homme qui savait ses crimes, cet homme qu’elle avait aimé, qu’elle avait trahi, ne venait-il pas pour la tuer.
Elle joignit les mains et balbutia les mots de grâce et de pardon.
Franz se mit à rire.
– Madame, dit-il, je n’ai pas de grâce à vous faire, ni de pardon à vous octroyer. Je ne suis pas le maître ici, et votre sort n’est pas dans mes mains ; vous m’avez abandonné pour Ali-Remjeh, qui n’a pas su vous défendre. Moi, je me suis borné à devenir l’esclave de vos ennemis, et ce qu’ils me commanderont, je le ferai.
Milady, au comble de l’épouvante, regardait tour à tour Rocambole et le major Hoff, semblant se demander ce qu’elle allait devenir entre leurs mains.
Rocambole reprit, après un moment de silence :
– Je vous avais offert le moyen de vous sauver, madame, d’avoir une vie calme et heureuse, – si toutefois vos remords vous le permettaient, – auprès de votre fils et de sa jeune femme, et vous avez été sourde à mes conseils.
Milady retrouva tout à coup sa fougueuse énergie :
– Vous vouliez me faire dépouiller mon fils ! s’écria-t-elle.
– D’une fortune qui ne lui appartient pas, dit froidement Rocambole.
– Jamais ! dit-elle avec force. Nul ne sait où est cette fortune, nul ne le saura…
– Vous vous trompez, milady, dit Franz, car je sais où elle est, moi.
– Vous ! vous ! exclama-t-elle avec une sorte d’épouvante irritée.
– Je n’ai pas vécu vingt années avec vous, répondit le major Hoff, sans avoir pénétré tous vos secrets.
– Et tu sais, misérable !…
– Je sais qu’il suffira de présenter à un magistrat du nom de sir John Mac-Ferson, qui habite Édimbourg, un médaillon que vous avez toujours au cou, pour qu’il remette à celui qui en sera porteur les titres de propriété de cette fortune entièrement monnayée, qui se trouve aux mains de la maison de banque Davis-Humphry et C°.
Milady regardait tour à tour ces deux hommes au pouvoir de qui elle était tout entière.
On eût dit une tigresse prise au piège.
– Mon fils ! murmurait-elle, mon fils !
– Parlez bas, madame, lui dit Rocambole, car votre fils est près d’ici et il pourrait nous entendre, et alors…
– Alors ? fit-elle d’un ton de menace.
– Alors, nous serions bien forcés de lui dire la vérité.
– Il ne vous croirait pas !
– C’est possible, dit Rocambole ; mais, dans huit mois, lorsque vous aurez été jugée par une cour militaire en même temps que vos complices les Étrangleurs, et que vous serez pendue devant la prison de Newgate, il faudra bien que votre fils s’aperçoive qu’on lui avait dit la vérité.
Ces derniers mots terrassèrent milady.
– Oh ! dit-elle, tombant à genoux devant Rocambole, vous êtes sans pitié, monsieur.
– Non, milady, répondit Rocambole d’une voix grave, j’ai une mission à accomplir…
– La mission de dépouiller mon fils, n’est-ce pas ?
– Milady, reprit Rocambole, les instants sont précieux ; dans quelques heures nous serons en vue des côtes d’Angleterre et il sera trop tard. Voulez-vous transiger ?
Elle le regarda avec une sorte de stupeur.
– Qu’entendez-vous par là ? fit-elle.
– Si je me tais, si je vous laisse l’amour et la vénération de votre fils ; si, sur cette fortune immense que je dois vous reprendre, je vous abandonne quelques centaines de mille francs…
– Vous feriez cela ! dit-elle avec égarement.
– C’est un droit que je n’ai pas ; mais j’ai la conviction que ceux à qui je dois rendre le bien détourné de sa source m’approuveront.
– Après ? dit-elle, après ?
– Voici mes conditions, reprit Rocambole. Vous allez me rendre ce médaillon.
– Après ? fit-elle encore.
– Au jour, quand nous serons en vue des côtes, on arrimera la chaloupe. Vous y descendrez, vous, votre fils, sa fiancée, le père de sa fiancée et mon fidèle Milon, qui sera porteur du médaillon.
Milon aura ordre de vous conduire en Angleterre, et de ne pas vous quitter d’un pas, jusqu’à l’heure où vous vous embarquerez de nouveau pour la France, où vous retournerez avec votre fils.
Votre fils qui continuera à aimer et à vénérer sa mère et ne saura jamais rien du passé.
– Mais, s’écria milady encore hésitante, si je vous rends ce médaillon ?…
– Milon s’en servira pour réclamer la fortune de Gipsy la bohémienne ; et sur cette fortune, quand il sera de retour à Paris, il vous abandonnera un million.
Milady courba la tête.
Un moment encore elle lutta, elle résista, elle serra dans sa main crispée le médaillon qu’elle avait au cou.
Mais Rocambole mit fin à ses hésitations par ces mots cruels :
– Vous préférez donc être pendue, et mourir exécrée et maudite par votre fils ?
Elle poussa un dernier cri et arracha de son cou le médaillon qui y était suspendu par un fil de soie.
Puis elle le jeta sur la table en détournant la tête et étouffant un sanglot.
Rocambole prit le médaillon et murmura avec un soupir de soulagement, un mot unique :
– Enfin !
Mais soudain milady semblant sortir de quelque rêve épouvantable, le regarda et lui dit :
– Et Ali-Remjeh ?
– Vous ne le reverrez jamais.
– Jamais ?
– J’ai promis de le livrer.
– À l’Angleterre ?
– Oh ! fit en souriant Rocambole, maintenant que vous êtes devenue raisonnable, milady, ce n’est plus en Angleterre que je le conduirai.
– Où le conduirez-vous donc ? demanda milady anxieuse.
– À Calcutta. Le vice-roi, gouverneur de la compagnie des Indes, sera enchanté de le revoir.
Milady tremblait de tous ses membres.
Rocambole se tourna vers Franz.
– Major, dit-il, nous sommes à deux milles de la côte qui doit être en vue depuis longtemps, si mes instruments ne me trompent.
Montez donc sur le pont et dites à mon second qu’il fasse préparer la chaloupe.
Franz obéit et sortit de la cabine.
– Mais comment, dit encore milady, palpitante sous le regard dominateur de Rocambole, séparerez-vous mon fils de son père ?
Il se prit à sourire et répliqua :
– Vous verrez, tout est prévu…
Milady courba la tête et deux larmes brûlantes jaillirent enfin de ses yeux.
XXXIX
On avait mis la chaloupe à la mer.
Rocambole avait dit vrai. Les côtes anglaises apparaissaient nettement dans la brume transparente du matin, car, la tempête apaisée, le ciel s’était éclairci peu à peu.
Sur l’ordre de Rocambole, on avait transporté dans la chaloupe tout ce qui appartenait à milady et à ses enfants.
Ceux-ci dormaient.
Pour combattre efficacement le mal de mer, le cuisinier lui avait apporté du thé brûlant auquel Rocambole avait fait mêler un narcotique puissant.
La jeune fille, le vieillard, et enfin Lucien, s’étaient successivement endormis.
Maintenant les canons du brick illuminant tous ses sabords à la fois, ne les eussent point réveillés.
Quand tous les préparatifs ordonnés par Rocambole eurent été faits, Milon descendit dans la cabine du capitaine.
– Maître, dit-il, tout est prêt.
– Ah ! fit Rocambole, voici donc l’heure de la séparation.
– Maître, maître, murmura Milon tout ému, cette séparation sera-t-elle donc bien longue ?
– Je ne sais pas, répondit-il.
– Mais nous reverrons-nous, au moins ?
– Je ne sais pas, dit encore Rocambole. Maintenant, écoute bien mes instructions.
– Parlez, maître.
– Voici deux lettres pour Londres, l’une à l’adresse de miss Cécilia, que je remercie de m’avoir prêté son concours contre les Étrangleurs.
– Il est certain, murmura Milon, qu’elle nous a donné un rude coup de main.
– L’autre est pour le célèbre docteur chimiste Kerschoff, un Allemand, établi à Londres.
– Et quand j’aurai porté ces deux lettres ? demanda Milon.
– Tu accompagneras milady au packett, et ne la quitteras, elle et ses enfants, que lorsqu’ils seront embarqués.
– Après ?
– Après, tu iras en Écosse, ainsi qu’il est convenu entre nous, et tu retireras les titres de propriété de cette fortune qui appartient à Gipsy, des mains du docteur Mac-Ferson.
– Et je retournerai en France ?
– Naturellement.
– Mais, dit Milon ému, de quelle utilité sera une pareille fortune à cette pauvre fille qui est folle ?
– D’abord, dit Rocambole, elle guérira.
– Vous croyez, maître ?
– J’en suis sûr. Quand elle sera guérie, elle épousera Marmouset.
– Ah ! fit Milon.
– Et j’ai la conviction, ajouta Rocambole, que Marmouset saura faire un bon usage de cette fortune que lui apportera Gipsy.
– Maître, maître, murmura Milon dont l’émotion grandissait, j’ai d’affreux pressentiments.
– Lesquels, mon bon Milon ?
– Quelque chose me dit que vous quittez l’Europe.
– Oui.
– Pour toujours…
– Non, dit Rocambole. Moi aussi, je suis fataliste et une voix secrète me dit que c’est à Paris que je reviendrai mourir.
Puis le major Avatar rejeta en arrière sa tête intelligente et pâle que son regard dominateur éclairait en ce moment d’un reflet pour ainsi dire prophétique.
– Écoute-moi, Milon, dit-il, écoute-moi, toi l’innocent longtemps jeté au bagne.
– Parlez, maître.
– J’ai été le pire des scélérats. Dieu a permis que je fusse touché par le repentir ; mais il ne m’a accordé cette grâce qu’à la condition que le reste de ma vie serait consacré heure par heure et minute par minute à faire le bien.
Une fois déjà j’ai cru ma mission accomplie et j’ai voulu chercher le repos dans la mort.
La façon miraculeuse dont j’ai été sauvé m’a prouvé que Dieu ne voulait pas que je meure. Cette lutte commencée à Londres, continuée à Paris avec les Étrangleurs, je dois la terminer dans l’Inde.
Milon cacha sa tête dans ses deux mains et quelques larmes coulèrent le long de ses doigts.
– Et vous ne m’emmènerez pas ? dit-il.
– Non, dit Rocambole, il faut que tu restes en Europe pour exécuter mes ordres.
Milon s’inclina en signe d’obéissance.
Rocambole tendit en même temps que les deux lettres, un gros pli cacheté à Milon.
Il avait écrit dessus :
Pour Marmouset.
– C’est bien, dit le vieux colosse.
– Et maintenant, mon vieil ami, acheva Rocambole en lui tendant la main, l’heure est venue de nous dire adieu.
– Au revoir ! voulez-vous dire, maître ? s’écria Milon, qui porta à ses lèvres la main de Rocambole et la couvrit de ses larmes.
– Je l’espère ! dit le maître avec un mélancolique sourire.
* *
*
Quelques minutes après, on avait descendu dans la chaloupe Lucien, Marie Berthoud et son vieux père, tous trois endormis.
Rocambole présidait à l’embarquement.
Il se tourna vers milady.
Milady, appuyée au bastingage, en haut de l’échelle de tribord, promenait autour d’elle le regard hautain d’un lutteur vaincu par la fatalité.
– Madame, lui dit Rocambole, Milon vous remettra un million dans un mois.
Elle s’inclina sans mot dire.
– Madame, ajouta-t-il, remerciez Dieu de vous avoir donné un fils brave, honnête et loyal : son caractère et sa vertu ont plaidé votre cause là-haut.
Dieu ne châtiera pas la mère coupable, parce qu’il ne veut pas briser le cœur du fils.
Milady ne répondit point.
Altière et l’œil sec, elle descendit dans la chaloupe.
Rocambole vit l’embarcation s’éloigner du navire.
Longtemps il la suivit des yeux ; puis, lorsqu’elle ne lui apparut plus que comme un point noir à l’horizon, il se tourna vers Noël et lui dit :
– Route de l’Inde, maintenant !
Et il monta sur son banc de quart, son porte-voix à la main.
XL
Le printemps est venu, les arbres sont en fleurs et les coteaux qui bordent la Seine ont revêtu leur parure de verdure.
Non loin de Sèvres, tout près de Bellevue, au bas Meudon, comme on dit, une villa blanche et coquette se cache à demi dans une touffe de grands marronniers.
Le jardin est ombreux, les oiseaux seuls font tapage dans cette solitude.
Pourtant cette maison n’est point inhabitée.
Sous un berceau de lilas et de chèvrefeuilles, vous pouvez apercevoir une jeune fille assise, les yeux demi-clos, s’abandonnant à une rêverie pleine de douceur.
Cette jeune fille, les habitués de la Taverne du « Roi George » auraient peine à la reconnaître.
C’est Gipsy !
Gipsy la bohémienne, Gipsy la danseuse du Wapping, la mystérieuse maîtresse de sir Arthur Newil, la malheureuse victime des Étrangleurs miraculeusement arrachée au bûcher.
Gipsy folle si longtemps, et qu’on désespérait de rappeler jamais à la raison.
À quelques pas du berceau, assis sur un banc de verdure, deux autres personnes, un homme et une femme, causent à mi-voix.
La femme, on le devine, c’est Vanda, la fidèle gardienne de Gipsy, depuis le départ de Rocambole.
L’homme n’est autre que ce médecin aliéniste allemand à qui Rocambole a écrit et qui s’est décidé à quitter Londres pour venir à Paris soigner la riche héritière.
– Ainsi, docteur, murmure Vanda, vous la croyez guérie ?
– Oh ! bien guérie, madame.
– Et vous pensez qu’on peut sans danger faire revenir le jeune homme qu’elle aime ?
– C’est le seul moyen, selon moi, de dissiper ce brouillard qui obscurcit encore légèrement sa mémoire, car la raison est revenue tout entière.
Vanda se leva, se dirigea vers la maison et appela :
– Milon ? Milon ?
Le colosse accourut.
– Il faut aller chercher Marmouset, lui dit Vanda.
Milon tressaillit.
– Ah ! madame, dit-il, vous ne craignez donc pas que Gipsy ne redevienne folle ?
– Le docteur prétend qu’il n’y a aucun danger.
– Vous vous souvenez pourtant de l’émotion qu’elle a éprouvée, il y a huit jours, quand nous lui avons appris qu’elle était riche à douze millions…
– Eh bien ! dit Vanda, puisque cette émotion ne l’a point tuée, l’autre achèvera de la guérir. Oublies-tu donc qu’elle demande sans cesse son ami ?
– Alors, il faut aller le chercher ?
– Oui.
– C’est bien, dit Milon, dans deux heures, je serai de retour ici avec lui.
Et il traversa le jardin, franchit la grille et gagna à pied la route de Sèvres à Versailles sur laquelle passent de nombreux omnibus de dix minutes en dix minutes.
Une heure après, Milon arrivait à Paris et se rendait au petit hôtel de la rue Marignan.
C’était là que, par ordre du docteur allemand, Vanda avait confiné Marmouset depuis environ trois mois.
Mais Marmouset était bien changé et pas un des bandits qui se réunissaient jadis sous les ordres du Pâtissier, au cabinet de l’Arlequin, tenu par la Camarde, ne l’aurait reconnu.
Le gamin de Paris, le ravageur à la blouse déchirée, aux cheveux en broussaille, à la mine flétrie et souffreteuse à la fois, était devenu un jeune homme de dix-neuf ou vingt ans, mis avec une correcte élégance.
Vanda, à qui Rocambole avait laissé ses instructions, avait voulu que Marmouset mît à profit les loisirs que lui laissait le traitement auquel le docteur allemand avait soumis Gipsy.
Marmouset continuait à s’instruire, il fréquentait le manège et la salle d’armes.
Il avait fait en toutes choses, depuis trois mois, des progrès si rapides qu’il était devenu méconnaissable.
Marmouset, lorsque Milon arriva, descendait de cheval. Il revenait du Bois.
– Eh bien ! comment va-t-elle ? dit-il avec un empressement fiévreux, en voyant entrer Milon.
– Elle est guérie.
– Guérie !
Et Marmouset devint tout pâle d’émotion.
– Et je viens vous chercher, ajouta Milon.
– Je puis donc la voir sans danger ?
– Oui. C’est l’avis du docteur.
Marmouset n’en entendit pas davantage. Il remonta lestement à cheval, oublia Milon et se lança au triple galop dans l’avenue Marignan.
Les Champs-Élysées, le Bois, il traversa tout avec une rapidité vertigineuse ; on le vit passer sur le pont de Saint-Cloud, courbé sur sa selle comme un écuyer maure.
Il traversa le parc, monta la côte de Sèvres au galop, et moins de trois quarts d’heure après avoir quitté l’avenue Marignan, il arrêtait court son cheval à la grille de la villa.
Vanda l’attendait.
Elle le prit par la main et lui dit :
– Venez, mon enfant ; venez vite…
Et elle le conduisit vers le berceau sous lequel Gipsy était assise.
Le docteur se tenait à quelques pas de distance.
En entendant marcher, Gipsy leva la tête.
Elle vit Marmouset, et tout son corps tressaillit.
Puis une vive rougeur couvrit son front ; elle voulut se lever et ne le put, tant son émotion était grande. Mais elle tendit la main à Marmouset et lui dit :
– Viens, mon ami, viens ; je ne suis plus folle, et je me souviens de tout ce qui s’est passé.
Et comme Marmouset, palpitant, s’agenouillait devant elle, Gipsy continua :
– C’est toi qui as sauvé la pauvre bohémienne ; c’est toi qui m’as ramenée en France et qui as veillé sur moi tandis que la folie m’étreignait, comme un frère sur une sœur.
Et elle l’attira vers elle, imprima ses lèvres sur son front et lui dit avec émotion :
– Oh ! je t’aime !…
* *
*
– Madame, disait tout bas le médecin allemand à Vanda, le danger a disparu, mais il peut revenir.
– Que voulez-vous dire, docteur ? fit Vanda avec une inquiétude subite.
– Ces enfants s’aiment…
– Je le sais.
– Il faut qu’ils s’épousent… et le plus tôt sera le mieux.
– Ah ! fit Vanda.
– Quand Gipsy sera mère, ajouta le docteur, elle aura recouvré la raison pour toujours.
Vanda posa un doigt sur ses lèvres :
– Chut ! dit-elle, nous allons hâter les préparatifs, en ce cas.
D’ailleurs, c’est la volonté du maître.
Et Vanda soupira, en songeant à Rocambole, qui, depuis cinq mois, avait quitté Paris et dont elle n’avait plus de nouvelles.
XLI
Plus d’un mois s’est écoulé depuis que Marmouset est revenu à la villa.
Cependant, les deux enfants ne sont point mariés encore.
Le docteur allemand est reparti pour Londres.
Gipsy n’est plus folle, et elle aime Marmouset de toute son âme.
Néanmoins, une tristesse mortelle s’est emparée d’elle.
Pourquoi ?
Gipsy est jeune, elle est belle, elle est fabuleusement riche. Marmouset l’aime et elle l’aime…
Ni Vanda, ni le jeune homme ne comprennent rien à cette mélancolie sombre qui n’abandonne jamais son front.
Plusieurs fois déjà, Vanda a essayé de questionner la jeune fille.
Mais Gipsy s’est contentée de fondre en larmes et elle n’a point livré son secret.
Quand la fidèle compagne de Rocambole parle à Gipsy de sa prochaine union avec Marmouset, Gipsy soupire et ne répond pas.
Cette tristesse a fini par gagner Marmouset, et la tristesse est voisine du désespoir.
Mais, un jour, le jeune homme se frappe le front, comme si un souvenir lointain traversait tout à coup son esprit.
– Oh ! dit-il, je comprends, à présent.
C’est le soir, la nuit est venue. Gipsy est rentrée dans sa villa et l’on voit briller derrière les vitres la veilleuse de sa chambre.
Marmouset et Vanda sont seuls dans le jardin.
– Oui, murmure Marmouset d’une voix timide, je comprends, à présent, je comprends tout.
– Mais quoi ? demande Vanda avec inquiétude.
– Gipsy aime toujours sir Arthur Newil.
– Folie !
– Elle l’aime, vous dis-je.
– On ne saurait aimer ce qu’on méprise, mon enfant.
– Qui sait ?
– Et ne vous a-t-elle pas sauté au cou quand vous êtes revenu ? Ne vous a-t-elle pas dit : je t’aime !
– Elle le croyait.
Vanda, stupéfaite, regarde Marmouset.
L’enfant est affreusement pâle : un tremblement nerveux parcourt tout son corps.
– Oui, répète-t-il, elle le croyait alors. Peut-être m’aime-t-elle comme un frère, mais à coup sûr elle frissonne encore au souvenir des caresses de sir Arthur.
– Ce lâche qui l’abandonnait ?
– Qu’importe ! murmure Marmouset avec un tel accent de conviction, que Vanda se demande s’il n’a pas deviné la vérité.
Et elle voit Marmouset dans un tel état d’exaltation, qu’elle lui dit :
– Mon enfant, mieux vaut encore la certitude que l’incertitude d’un malheur. Partez pour Paris ce soir, et revenez demain. Je vous jure que, d’ici là, Gipsy se sera ouverte à moi tout entière.
Vanda a conservé sur Marmouset un peu de cette autorité qu’exerçait Rocambole.
Marmouset monte à cheval et quitte la villa au galop.
Pendant toute la soirée et une partie de la nuit, il erre comme une âme en peine sur les boulevards, dans les Champs-Élysées, un peu partout, pour tuer le temps. Il a hâte d’être au lendemain.
Marmouset sait bien que Vanda tiendra parole, et que le lendemain elle lui dira la vérité.
* *
*
À peine Marmouset était-il parti que Vanda monta résolument à la chambre de Gipsy.
Elle frappa.
– Entrez ! dit la jeune fille d’une voix émue.
Gipsy n’était point couchée.
Assise devant une table, elle écrivait.
Vanda s’assit auprès d’elle.
– Mon enfant, dit-elle en lui prenant la main, aimez-vous Marmouset ?
– De toute mon âme, répondit Gipsy.
– Comme un frère ou comme un amant ?
Gipsy rougit et cacha sa tête dans ses mains.
– Ah ! fit-elle d’une voix étouffée.
– Vous l’aimez, murmura Vanda, et cependant, à mesure qu’approche l’heure fixée pour votre union, vos joues pâlissent, votre regard s’éteint ; et l’on dirait que c’est à un sacrifice douloureux que vous êtes condamnée.
Gipsy se leva et regarda Vanda.
Elle ne pleurait pas, et sa voix, émue un moment, avait retrouvé toute sa fermeté.
– Madame, dit-elle à Vanda, vous avez eu pour moi la bonté affectueuse d’une mère, et je vous supplie de me témoigner cette bonté quelques heures encore.
– Que voulez-vous dire ?
– Demain, reprit Gipsy, vous reviendrez ici, dans cette chambre, et vous aurez l’explication de ma conduite.
Comme dans ces dernières paroles de la jeune fille il y avait une certaine exaltation, comme une flamme sombre s’était subitement allumée dans son œil, Vanda eut peur.
Elle eut peur que la folie ne revînt, et elle jugea prudent de ne pas insister et de battre en retraite.
– À demain, donc, dit-elle.
Et elle prit Gipsy dans ses bras.
– Adieu, madame, répondit Gipsy avec un élan passionné.
En même temps, Vanda sentit couler une larme brûlante des yeux de la jeune fille sur son cou.
Et elle sortit, persuadée que la folie soutenait une dernière lutte dans ce pauvre cerveau troublé.
Vanda passa une nuit très agitée.
Plusieurs fois, elle se leva sur la pointe du pied et vint coller son oreille à la porte de la chambre de Gipsy.
Mais Gipsy avait fini d’écrire et s’était mise au lit.
Il n’y avait plus de lumière dans la pièce. Le matin arriva, puis le soleil.
Vanda qui remontait à la chambre rencontra Milon.
– Oh ! madame, dit-il, pour sûr, il nous est arrivé un malheur.
Vanda tressaillit.
– J’ai rêvé de ma mère, dit Milon, et quand je rêve de ma mère, c’est signe de mort.
Vanda monta toute tremblante et frappa à la porte. Gipsy ne répondit pas.
Elle frappa une seconde fois, sans plus de succès, et, comme la clé était dans la serrure en dehors, Vanda ouvrit la porte et entra.
Gipsy était couchée toute vêtue sur son lit, les mains croisées sur sa poitrine.
On eût dit qu’elle dormait.
Mais Milon, qui était entré derrière Vanda, s’écria :
– Morte ! morte ! elle est morte !
XLII
Milon ne se trompait pas.
Gipsy était morte.
Vanda lui prit la main.
Cette main était froide.
Mais le visage était si calme, si calme était l’attitude, que la mort avait dû être instantanée.
Auprès du lit était la table sur laquelle la jeune fille avait écrit la veille au soir.
Sur cette table, étaient une lettre à l’adresse de Vanda, une autre à l’adresse de Marmouset.
Auprès d’elle, une bague que Gipsy portait toujours au doigt et qu’elle disait lui venir de ses parents d’adoption, les bohémiens.
Cette bague avait un chaton, et ce chaton était divisé.
Ce fut un trait de lumière pour Vanda.
La bague renfermait quelque poison foudroyant que Gipsy avait avalé.
Milon poussait de grands cris.
Vanda, pâle, muette, frissonnante, prit la lettre qui était à son adresse et l’ouvrit.
Cette lettre était ainsi conçue :
« Pardonnez-moi, madame, de ne pas m’être ouverte à vous. Le courage m’a manqué.
« Je meurs de désespoir et d’amour.
« J’aime avec passion, avec délire, ce jeune homme qu’hier encore vous appeliez mon fiancé.
« Et c’est parce que je l’aime que je ne me sens point le courage de devenir sa femme.
« Gipsy la bohémienne pouvait accepter le premier venu.
« La fille de miss Anna, l’héritière d’un nom appartenant à l’aristocratie anglaise, doit se donner pure à l’homme qui l’épousera.
« En me révélant mon véritable nom, on m’a révélé mon infamie.
« J’ai dansé dans les carrefours, j’ai été la maîtresse de sir Arthur Newil.
« Ce double souvenir m’obsède et m’accable, et pour lui échapper, je me réfugie dans la mort.
« Je laisse toute ma fortune à celui à qui j’ai depuis longtemps donné mon cœur.
« Je compte sur vous, madame, pour adoucir sa douleur, pour calmer son désespoir.
« Il est jeune, son cœur meurtri se cicatrisera.
« Il est riche, il sera aimé.
« C’est le vœu de la pauvre morte, et quelque chose, au seuil de la tombe, me dit que ce vœu se réalisera un jour.
« Adieu ! madame, une fois encore, pardonnez-moi… et priez Dieu qu’il me pardonne…
« GIPSY. »
Cette lettre échappa aux mains de Vanda.
Debout, sans voix, sans haleine, la compagne de Rocambole contemplait cette jeune fille endormie dans la mort, comme un enfant dans son berceau.
– Pauvre enfant ! murmura-t-elle enfin.
– Je savais bien qu’elle n’était pas guérie, moi, s’écria Milon avec une explosion de douleur.
– Peut-être… murmura Vanda.
Et tandis qu’ils étaient là tous deux, en présence de ce cadavre, le galop d’un cheval se fit entendre.
Milon se précipita au dehors.
C’était Marmouset qui revenait.
Et comme Marmouset gravissait l’escalier, il lui barra le passage en lui disant :
– N’entrez pas !
À de certaines heures, l’esprit humain est doué d’une espèce de divination.
Marmouset s’écria :
– Ah ! Gipsy est morte !
Et il poussa Milon, passa outre et entra dans la chambre de Gipsy.
Vanda était agenouillée auprès de la jeune morte.
Marmouset ne versa pas une larme et ne jeta pas un cri.
Il est de ces désespoirs sans limites pour lesquels l’œil n’a pas une larme, la poitrine un gémissement.
Il prit cette lettre qui lui était destinée, et dont Vanda avait respecté le cachet.
Il l’ouvrit et la lut.
Gipsy lui faisait de tendres et déchirants adieux ; Gipsy le suppliait d’accepter ses millions et de faire du bien en son nom ; Gipsy au seuil de l’éternité, lui parlait d’avenir et de bonheur…
Et quand il eut lu cette lettre, Marmouset s’agenouilla lui aussi devant la morte.
Il prit sa main glacée et la porta à ses lèvres.
Puis, se relevant, il sortit de la chambre et alla droit à la sienne.
Dans cette chambre, il y avait une paire de pistolets accrochés au mur.
Marmouset en prit un et appuya froidement le canon sur son front.
Mais comme il pressait la détente, une main nerveuse lui poussa le bras et détourna le canon du pistolet.
Le coup partit, mais la balle, au lieu de briser le front de Marmouset, alla se loger dans le mur.
C’était Vanda, qui avait deviné son sinistre projet et s’était élancée sur lui.
– Laissez-moi mourir ! s’écria Marmouset, qui voulut s’emparer du second pistolet.
Mais Vanda le lui arracha des mains.
– Non, dit-elle, tu ne mourras pas, tu n’as pas le droit de mourir, le Maître ne le veut pas !
À ces mots, le visage empourpré de Marmouset devint d’une pâleur livide.
– Le Maître ! balbutia-il, le Maître !…
– Le Maître a laissé ceci pour toi, répondit Vanda.
En même temps, elle tendit à Marmouset un pli cacheté sur lequel on avait écrit ces lignes :
Cette lettre renferme mes instructions pour Marmouset, pour le cas où je ne serais pas de retour à Paris dans un an.
XLIII
On lit dans le Journal du Havre :
« Le trois-mâts Marthe-et-Marie, capitaine Bondurand, venant de l’île de la Réunion et se rendant au Havre, avec un chargement de denrées coloniales, a recueilli par le travers de l’île de Sainte-Hélène une bouteille cachetée qui contenait les lignes suivantes :
« À bord du brick indien le Sivah, naviguant sous pavillon britannique, capitaine Avatar.
Extrait de mon journal de bord, aujourd’hui 14 juillet 186…, sept heures du soir.
Depuis quarante-huit heures les pompes fonctionnent sans relâche.
Le feu est à bord.
Il s’est déclaré dans la soute aux vivres et couve lentement.
Le temps est calme, la mer ressemble à un lac. En vain toutes nos voiles dehors attendent une brisée folle.
Le vent est mort.
D’après mes calculs, nous sommes à quarante-cinq lieues de toute terre, par le travers du Sénégal.
Depuis hier matin, l’accalmie est complète. Le navire ne marche plus.
Hier, à midi, nous avons eu un moment d’espérance.
Un navire passait au large, mais à une distance telle qu’on ne pouvait apercevoir que ses perroquets.
J’ai fait tirer le canon de détresse.
Un instant, les perroquets ont grandi, le navire a paru se rapprocher.
Puis il a filé sous le vent, et nous ne l’avons pas revu.
Le feu, en dépit des pompes, continue son œuvre de lente destruction.
Dans vingt-quatre heures au plus tard, il aura atteint la sainte-barbe.
Alors nous sauterons, et tout sera fini…
15 juillet, six heures du matin.
Le découragement règne à bord.
Les pompes ne fonctionnent plus. L’équipage, brisé de fatigue, refuse tout travail.
Il attend la mort avec résignation.
Un peu de vent se joue dans nos hautes voiles ; mais il arrive trop tard : le navire ne fait pas deux lieues à l’heure, et nous sommes à quarante lieues de la côte.
Une fumée noire sort de la cale ; le feu est tout près de la soute aux poudres.
D’un moment à l’autre, nous nous attendons à sauter !
Si ces lignes parviennent en Europe, ceux qui les liront sont priés de les publier dans les journaux.
Le nom du capitaine Avatar est peu connu ; mais il éveillera peut-être quelques souvenirs à Paris.
Même jour, midi.
Encore un espoir déçu.
Une voile a été signalée à l’horizon.
Nous avons hissé de nouveau le pavillon de détresse.
La voile vient de disparaître, on ne nous a pas vus.
J’ai fait mettre à la mer notre unique embarcation, le canot.
Nous avons perdu, il y a un mois, notre chaloupe dans un gros temps.
Le canot ne peut contenir que six personnes, et nous sommes dix-neuf à bord.
On a tiré les noms au sort, excepté le mien bien entendu.
Un capitaine doit rester le dernier à son bord.
Les six hommes désignés viennent de descendre dans l’embarcation.
Ils s’éloignent de nous en pleurant.
Arriveront-ils à terre ?
Dieu seul le sait !
Même jour, midi.
Le canot s’est éloigné, nous l’avons suivi longtemps des yeux.
Maintenant on ne le voit plus.
Le charpentier, qui est resté à bord, a voulu descendre une dernière fois dans la cale.
Il est remonté suffoqué.
À son estime le feu ronge les cloisons de la sainte-barbe.
Dans une heure tout sera fini.
Que la volonté de Dieu s’accomplisse !
AVATAR, capitaine,
NOËL, second. »
* *
*
Le Journal du Havre ajoute :
On disait hier, au café de l’Amirauté que le 15 juillet, le brick la Mouette, se trouvant à dix heures du soir, par le travers du Sénégal, a entendu une forte détonation.
Pendant quelques minutes le ciel a paru tout en feu.
Le capitaine de la Mouette dormait.
Mais le second, qui était de quart, en ce moment-là, a pensé que cette détonation pouvait bien être causée par l’explosion d’un navire qui sautait.
Seulement, il lui a été impossible de préciser à quelle distance le sinistre avait dû avoir lieu.
XLIV
Il était deux heures du matin. Il y avait un an, heure pour heure, que M. de Maurevers avait disparu, et l’on parla de lui.
– Messieurs, dit un tout jeune homme, reçu de la veille, au Club des Crevés, car c’était dans le salon de jeu de cet intéressant local de high life que cette conversation s’engageait, je vous demande mille pardon, mais je sais si imparfaitement l’histoire du marquis Gaston de Maurevers, que je serais bien reconnaissant à celui qui voudrait me la raconter.
Le vicomte de Montgeron répondit :
– Je suis ton parrain, Casimir, et à ce titre je te dois des révélations. Sache donc que Gaston de Maurevers était un homme de trente-six ans, beau, élégant, d’éducation accomplie, et riche de cent vingt mille livres de rente.
On ne lui connaissait ni chagrin, ni amour, ni aucun motif raisonnable de quitter la vie.
– Cependant il s’est suicidé ?
– Mais non, voilà ce qu’on ne sait pas. Un soir, il est sorti d’ici, avec Charles Hounot, le fils du banquier.
Ils sont remontés à pied jusqu’à la Madeleine. Le marquis habitait un grand entresol, à l’entrée de la rue de Surène.
Charles l’a mis à sa porte et ils se sont séparés en se disant : « à demain. »
Le concierge de la maison a dit depuis, qu’il avait remis une lettre à Maurevers. Cette lettre était arrivée dans la soirée.
Maurevers l’a lue avec une certaine émotion, à la clarté du bec de gaz qui brûlait sous le vestibule.
Puis au lieu de monter chez lui, il a redemandé le cordon, disant :
– Je ne rentrerai que demain.
Le lendemain et les jours suivants, Maurevers n’a pas reparu. La police s’en est mêlée, les journaux ont transmis au monde entier le signalement du jeune marquis de Maurevers ; peines perdues !
La famille de Maurevers a expédié à ses frais des agents en Angleterre, en Russie, aux États-Unis, partout !
On ne l’a retrouvé ni mort, ni vivant !
– Cependant, dit un des membres du club, tu oublies une chose, Montgeron.
– Laquelle ?
– C’est que la police a retrouvé un cocher de fiacre qui prétend avoir conduit Maurevers cette nuit-là.
– C’est vrai, Maurevers l’a pris derrière la Madeleine, il s’est fait conduire à Auteuil, s’est arrêté une heure environ dans une maison de la Grande-Rue, puis il est remonté en voiture et est revenu place de la Madeleine.
Du moins, c’est ce qu’a dit le cocher. Conduit à Auteuil, il a déclaré ne pas reconnaître la maison devant laquelle il s’était arrêté.
Et il y a de cela un an, mes bons amis, acheva Montgeron, et je crois que nous ne reverrons jamais notre pauvre Maurevers.
– Mais cette lettre, sur la lecture de laquelle il est ressorti ?
– Une lettre ordinaire, venue de Paris : on a retrouvé l’enveloppe dans le vestibule ; écriture de femme, comme il y en a dix mille.
– Maurevers était-il amoureux ?
– Il avait la petite Mélanie du théâtre de X…, qui lui coûtait beaucoup d’argent et lui était parfaitement indifférente, histoire d’avoir une maison montée.
– Et pas d’intrigue dans le monde ?
– C’est ce qu’on ne sait pas.
– Moi, dit un des joueurs, je ne crois pas à un suicide.
– Ni moi, ajouta Montgeron, et si vous voulez savoir toute ma pensée…
– Eh bien ?
– Je crois à un crime, à un enlèvement mystérieux, à un de ces événements enveloppés de ténèbres qui, de dix ans en dix ans, viennent jeter la stupeur dans Paris, dérouter tous les calculs, toutes les conjectures, – énigmes terribles dont le hasard seul révèle le dernier mot aux générations suivantes.
Un jour des ouvriers démolissent une maison, un mur s’écroule, on trouve une cachette ; dans cette cachette un squelette ; et des vieillards de Paris se souviennent alors qu’il y a quarante ou cinquante ans, un certain marquis de Maurevers avait disparu.
– Messieurs, dit un jeune homme qui était entré sur la pointe du pied, tandis que Montgeron parlait, cette histoire est vraiment lugubre. Voici une année que chaque soir nous pleurons Maurevers et nous préparons des cauchemars pour la nuit.
Si nous passions à un sujet plus gai ; si nous parlions des amours de notre ami Marion avec la Belle Jardinière ?
– Ah ! oui, à propos, fit Montgeron, où cela en est-il ?
– Excusez-moi, dit encore le jeune homme présenté de la veille, et à qui M. de Montgeron avait familièrement donné la qualification de filleul et le prénom de Casimir, – excusez-moi, mais je ne suis pas au courant…
– On va t’y mettre, répondit M. de Montgeron. Gustave Marion est un de nos amis de la plus belle eau, un crevé extra, pour tout dire. Il a un commencement d’asthme, toussote gentiment, se casse de temps en temps quelque chose sur la banquette irlandaise des courses de Vincennes ou de la Marche, envoie des bouquets à toutes les grues qui débutent quelque part et n’a pas d’autre profession que d’être aimé, pour lui ou pour son argent, peu lui importe !
– Mais qu’est-ce que la Belle Jardinière ?
– Il nous l’a appris, il y a huit jours ; c’est une femme qui habite Bellevue, où elle est marchande de fleurs et occupe une vingtaine de jardiniers.
Il paraît qu’il faudrait aller à Nice, chez Alphonse Karr, pour trouver des fleurs aussi rares et aussi belles que les siennes.
– Et elle est jolie ?
– Marion prétend que si elle entrait à l’Opéra, un jour de grand spectacle, quand les plus belles femmes de Paris s’y trouvent réunies, leur beauté pâlirait auprès de la sienne.
– Et il est aimé ?
– Oh ! non… pas jusqu’à présent… la Belle Jardinière, toujours vêtue de noir, n’aime personne ; on ne lui connaît ni amant, ni mari. Ses employés lui parlent avec le respect de simples chambellans s’adressant à une reine.
– D’où vient-elle ? quel est son nom ? Mystère !
– Marion a déjà dépensé une vingtaine de mille francs en pure perte, pour obtenir des renseignements que personne n’a pu lui donner.
– Vous êtes en retard de vingt-quatre heures, Montgeron, fit le nouveau venu.
– Comment cela ?
– Marion a des intelligences dans la place.
– Bah !
– Il a corrompu l’unique domestique couchant dans la maison, car chaque soir tous les jardiniers s’en vont.
– Et ce domestique ?…
– Lui a vendu pour quelques centaines de louis une clé du jardin et une autre clé qui ouvre le vestibule.
Le reste sera son affaire ; car le domestique prétend que la Belle Jardinière, qui couche au premier étage dans une chambre aux fenêtres de laquelle on voit briller une lumière toute la nuit, n’a jamais laissé pénétrer personne dans cette chambre.
– Eh bien ! que compte faire Marion ?
– Il nous a retenus quatre, moi, le baron Kopp, Alfred Milleroy, et Charles Hounot.
– Pourquoi faire ?
– Mais dame ! pour l’accompagner cette nuit à Bellevue, faire le guet autour de la maison et assister au besoin à son triomphe.
– Mais, cher ami, dit M. de Montgeron, il y a des commissaires de police partout, même à Bellevue.
– C’est son affaire, non la nôtre. Nous n’entrerons pas, et nous l’attendrons. Si la Belle Jardinière se laisse enlever, tant mieux pour lui, si elle appelle au secours… nous filons.
– Parole d’honneur ! dit Montgeron, j’en serais volontiers.
– Bravo, Montgeron, dit une voix sur le seuil, je vous emmène !
Chacun tourna la tête.
Le crevé extra, comme l’avait appelé M. de Montgeron, Gustave Marion, entrait dans le salon de jeu.
– Ce n’est donc pas une plaisanterie ? demanda le jeune homme appelé Casimir.
– Rien n’est plus sérieux, répondit Marion. Mon break est en bas, sur le boulevard. J’ai cinq places à donner. Qui m’aime me suive !
– Marion, dit M. de Montgeron, en riant, faut-il emporter des armes ?
– Comme vous voudrez. Moi, j’ai un revolver dans ma poche.
– Ce Marion, dit un des membres du club, ne se trouvera un héros de roman accompli que lorsqu’il aura fait connaissance avec la police correctionnelle.
Et les cinq personnes désignées prirent leurs chapeaux et leurs paletots, quittèrent le club et trouvèrent en effet, sur le boulevard, le break de courses de M. Gustave Marion, attelé de deux magnifiques trotteurs irlandais.
– Une heure et demie ! dit Montgeron.
– Dans trente minutes nous serons à Bellevue, dit Gustave Marion, et je veux perdre mon nom si nous ne ramenons pas la Belle Jardinière souper avec nous au Café Anglais !
Sur ces mots il rendit la main à ses deux trotteurs et le break fila rapidement le long des boulevards déserts.
XLV
Gustave Marion avait à côté de lui M. de Montgeron ; les quatre amis étaient dans l’intérieur du break ; un petit groom, juché sur le marche-pied, devait tenir les chevaux.
La nuit était froide et sombre, bien qu’on touchât à la fin de mars.
Il avait plu dans la soirée, le vent roulait de gros nuages, et le décor était parfait pour un enlèvement.
Le break gagna les Champs-Élysées, descendit vers le Bois, arriva au pont de Saint-Cloud, longea le parc, roula bruyamment sur le pavé de Sèvres et atteignit Bellevue.
Gustave Marion s’arrêta, jeta les rênes au groom et mit pied à terre.
– Sommes-nous arrivés ? demanda Montgeron.
– Pas encore. Mais le bruit d’une voiture serait compromettant. Nous allons suivre à pied ce chemin bordé d’une haie ; tenez, d’ici on voit la maison au bas du coteau.
– Je ne vois pas grand’chose, dit Montgeron, la nuit est noire.
– Moi, fit Charles Hounot, j’aperçois très bien un bâtiment carré avec une lumière au milieu, comme un cyclope qui ouvre son œil.
– C’est la maison. Le jardin est à l’entour.
– Et pas de voisinage ?…
– Aucun. La maison la plus rapprochée est à plus de cinq cents mètres.
Les cinq jeunes gens laissèrent le break et les chevaux sur la route, aux mains du groom, et entrèrent résolument dans le chemin creux que bordait une haie vive.
Le sol était boueux, et bien qu’ils marchassent rapidement, nos aventuriers ne faisaient aucun bruit.
Un quart d’heure après, ils étaient sous les murs du jardin.
La maison ressemblait à toutes les villas des environs de Paris.
Rien d’étrange, rien de sinistre ; Montgeron en fut frappé et dit en riant :
– On dirait que tu vas voir ton notaire, mon pauvre Marion ; jusqu’ici, tout cela est fort bourgeois ; il n’y a pas même un chien de garde !
Tout était silence autour de la maison ; cependant, la lumière aperçue au premier étage brûlait toujours.
Gustave Marion tira de sa poche la clé qui lui coûtait si cher et l’introduisit dans la serrure de la grille.
La grille tourna sur ses gonds sans le moindre bruit.
– Jusqu’à présent, murmura Montgeron, resté en dehors avec ses compagnons, rien des Mystères d’Udolphe.
Le joli crevé, qui songeait à enlever une femme, traversa le jardin sur la pointe du pied, tira sa seconde clé et s’en servit avec le même succès.
La porte du vestibule s’ouvrit.
Une allumette-bougie permit à Gustave Marion de s’orienter.
Il trouva un escalier et prit la rampe ; puis il monta, étouffant le bruit de ses pas, sur une bande de tapis qui couvrait le milieu des marches.
Arrivé au premier étage, il fut guidé par un rayon de lumière et éteignit sa bougie.
La lumière partait de l’extrémité d’un corridor au bout duquel se trouvait une porte vitrée.
– Bon ! se dit Marion, c’est la chambre à coucher de la dame.
Et il s’avança avec les mêmes précautions.
Il y avait, en effet, une porte vitrée au bout du corridor et le jeune homme, se dressant sur la pointe du pied, colla son visage à l’un des carreaux.
Mais soudain ses cheveux se hérissèrent, son front s’inonda de sueur, une épouvante indicible le prit à la gorge, et il tomba lourdement en arrière en jetant un cri étouffé.
De l’autre côté de la porte vitrée, Gustave Marion avait aperçu une chambre tendue de noir, comme une chapelle mortuaire.
Sur un lit de parade, un cadavre ; au pied du lit, une femme qui pleurait.
La femme, c’était la Belle Jardinière.
Le cadavre, qu’on aurait pu prendre pour un homme endormi, tant le visage était calme, – Gustave Marion l’avait reconnu sur-le-champ…
C’était celui du marquis Gustave de Maurevers, disparu il y avait un an, et qu’on avait cherché vainement aux quatre coins du monde !
XLVI
Gustave Marion ne s’était pourtant pas évanoui en tombant, mais il avait été frappé d’une sorte de paralysie partielle, à moitié morale, à moitié physique.
L’épouvante l’avait si fort dominé que ses cheveux se hérissaient en même temps que ses jambes refusaient de supporter le poids de son corps.
Peut-être même fût-il demeuré longtemps dans cet état, si la porte vitrée ne se fût ouverte brusquement, livrant passage à cette femme qui, tout à l’heure, pleurait agenouillée au pied du lit mortuaire.
Les larmes ne coulaient plus, ses yeux séchés brillaient d’un éclat orageux ; elle était pâle et ses narines frémissantes attestaient sa colère.
L’épouvante de Marion, dont la paralysie stupéfiante continuait, s’en accrut.
Cette femme qu’il avait si bien reconnue tout à l’heure, ne se ressemblait plus à elle-même.
Ce n’était plus ce visage mélancolique et doux, ce n’étaient plus ces yeux remplis d’une indéfinissable tristesse et tout ce corps élégant et souple qui avait des langueurs voluptueuses.
La Belle Jardinière avait fait place, tout à coup, à une femme au regard ardent et fatal qui saisit brusquement le jeune homme à terre et lui dit d’une voix brève, impérieuse :
– Levez-vous !
Et la paralysie cessa, comme par enchantement ; et, sous le feu de ce regard, Gustave Marion se leva, comme si un courant galvanique eût parcouru tout son corps.
Elle le prit par la main, et le poussa plutôt qu’elle ne l’entraîna, dans cette chambre tendue de noir, sur les murs de laquelle les cierges projetaient une lueur sinistre.
– Puisque vous voulez voir, dit-elle, approchez… approchez donc !
Et son accent avait une ironie sauvage.
M. Gustave Marion, qui était, selon l’expression de M. de Montgeron, un joli crevé, avait cependant fait preuve de sa bravoure.
Il s’était fait administrer, en différentes circonstances, une demi-douzaine de coups d’épée dont il avait fait grand bruit dans le monde.
Mais, avouons-le à sa honte, il était en proie à une terreur sans nom.
Il se tenait debout parce que cette femme le regardait ; mais il n’aurait pas eu la force de rester sur ses jambes si elle eût un moment tourné la tête.
Elle l’avait attiré tout près de ce lit de parade aux quatre coins duquel brûlaient des cierges mortuaires, et elle lui disait :
– Mais regardez donc !
Il obéissait à cette volonté dominatrice sous laquelle il pliait comme un roseau sous l’effort du vent, il regardait avec épouvante ce cadavre qu’il reconnaissait parfaitement.
C’était bien le marquis Gaston de Maurevers.
Il était encore couvert d’un pantalon de velours épinglé, serré au genou, un pantalon de cheval, comme on dit.
Ses pieds étaient chaussés de fines bottes vernies.
Mais l’habit, le gilet, la cravate, avaient disparu.
La chemise était ouverte et laissait voir sa poitrine ensanglantée.
Une blessure triangulaire s’ouvrait béante au-dessous du sein gauche, ses lèvres bordées de quelques gouttes de sang coagulé.
Était-ce un coup de poignard ?
Était-ce un coup d’épée ?
Le marquis était-il mort, tué loyalement en duel ?
Ou bien avait-il succombé sous le fer d’un assassin ?
Gustave Marion, frissonnant, se posait cette question.
Il s’en posait même encore une autre :
Le visage à peine contracté, le sang à peine figé sur les bords de la blessure, la pose même du cadavre, tout semblait annoncer que la mort remontait à quelques heures seulement, une journée au plus.
Or, il y avait déjà un an que Gaston de Maurevers avait disparu.
Pendant un an, toutes les polices du monde s’étaient mises à sa recherche, sa famille consternée avait publié son nom dans tous les journaux.
Et tout cela avait été en pure perte.
Qu’était donc devenu le marquis pendant toute cette année, puisqu’il n’était mort que de la veille ?
Cette question, que l’esprit troublé de Gustave Marion s’adressait, était la complication suprême de cette énigme épouvantable.
Et pendant ce temps, debout, hautaine, l’œil en feu, la lèvre ironique, la Belle Jardinière disait avec un accent sauvage :
– Mais regardez donc, monsieur, regardez donc !
Les dents de M. Gustave Marion s’entrechoquaient de frayeur.
Peut-être même avait-il plus peur encore de cette femme vivante que de cet homme mort.
Tout à coup, elle lui reprit la main.
– Maintenant, dit-elle, écoutez-moi !
Et sa voix avait un sifflement métallique ; et son regard brûlait les yeux du jeune homme.
Il essaya de balbutier quelques mots, mais ses lèvres ne s’entr’ouvrirent point.
La Belle Jardinière continua :
– Depuis un mois, monsieur, vous venez ici chaque jour, sous le prétexte de m’acheter des fleurs. Puis, découragé par ma froideur, vous avez corrompu un de mes domestiques et, grâce à lui, vous avez pu pénétrer jusque dans cette chambre.
Vous aviez cru aller à une aventure d’amour, et vous vous trouvez en face d’un cadavre. Êtes-vous guéri ?
Et il y avait dans sa voix une ironie farouche.
Et comme il ne répondait pas et palpitait sous le regard qui le ravageait par tout le corps, elle poursuivit :
– Si vous voulez vivre vieux, monsieur, vous me ferez un serment.
Il leva sur elle son œil épouvanté, comme s’il eût voulu lui demander la formule de ce serment.
– Vous me jurerez, reprit-elle, la main étendue sur ce cadavre, que jamais vos lèvres n’articuleront un mot de ce que vous avez vu…
Il continuait à trembler ; mais ses lèvres ne s’ouvraient point.
– Mais jurez, monsieur, mais jurez donc ! s’écria-t-elle.
Et la voix était si impérieuse qu’il sembla, en ce moment, à Gustave Marion, que cette femme tenait sa vie dans ses mains et qu’elle n’avait qu’à vouloir pour qu’il devînt un cadavre comme celui qui était devant lui.
– Jurez donc ! répéta-t-elle pour la troisième fois.
Il fit un effort suprême, étendit la main et murmura d’une voix éteinte :
– Je le jure !
Alors, comme dans une féerie de théâtre, les cierges s’éteignirent brusquement et la chambre se trouva plongée dans l’obscurité.
En même temps, la Belle Jardinière lui prit la main et lui dit :
– Venez !
Et il se sentit entraîné par elle hors de la chambre funèbre, à travers le corridor, puis dans l’escalier ; puis, tout à coup, elle le poussa hors du vestibule dont la porte se referma.
Et M. Gustave Marion, à bout de forces, tomba évanoui dans le jardin, au bas des marches du perron.
* *
*
XLVII
Quarante-huit heures après la scène que nous venons de décrire, le Club des Crevés était en émoi de plus belle.
On n’avait vu ni Montgeron, ni Gustave Marion, ni les quatre autres joueurs qui avaient accompagné le hardi ravisseur.
Cependant, on avait passé au club la nuit tout entière, deux fois de suite.
Le tout jeune homme qui avait nom Casimir, et à qui M. de Montgeron servait de tuteur dans le monde viveur, était allé chez lui et ne l’avait pas trouvé.
M. de Montgeron, pas plus que les autres, n’était rentré depuis deux jours.
Les Crevés délibéraient.
– Messieurs, disait l’un d’eux, je vais vous donner mon avis.
– Voyons ?
– Nos aventuriers ont fait buisson creux.
– Comment cela ?
– Je n’ai jamais cru beaucoup à l’audace de Marion et voici, selon moi, ce qui a dû se passer. La Belle Jardinière a un mari…
– Ou un amant.
– Soit ; mari ou amant, il s’est trouvé quelqu’un qui a jeté Marion par la fenêtre.
– C’est bien possible, dit-on à la ronde.
– Un amoureux qu’on jette par la fenêtre ne se tue pas, poursuivit le narrateur ; il y a un Dieu pour les amoureux comme pour les ivrognes ; mais il se contusionne, se poche un œil ou se casse quelque chose.
C’est ce qui a dû arriver à Marion et on l’aura porté dans quelque auberge du voisinage.
– Mais les autres ?…
– Attendez ! Bellevue est un pays de maraîchers, de jardiniers et de blanchisseurs ; braves gens qui ont le Parisien en horreur. On aura maltraité nos amis, et, tout honteux de leur mésaventure, ils n’osent se montrer.
– Tu n’y es pas, mon bon ami, dit une voix sur le seuil de la salle de jeu.
Tout le monde se retourna.
– Montgeron ! s’écria-t-on.
– Messieurs, dit le vicomte, je n’ai absolument rien de cassé, et nos amis non plus. Les gens de Bellevue ne sont pas aussi farouches que vous le pensez.
– Et Marion ?
– Marion est fou.
– Fou d’amour ?
– Non, fou… tout à fait fou…
M. de Montgeron prononça ces mots avec une gravité triste qui eut un effet prodigieux.
– Messieurs, poursuivit-il, vous pouvez vous dispenser de rire, car ce n’est pas une plaisante aventure que je vais vous conter.
Et Montgeron s’assit et s’essuya le front en homme qui a passé par des émotions qui ne sont pas précisément à l’eau de rose.
– Mais enfin, qu’est-il donc arrivé ?
– La Belle Jardinière existe-t-elle, ou bien Marion était-il déjà fou ?
– Je ne sais pas, dit Montgeron, mais voici ce qui s’est passé.
Et le vicomte raconta ce que nous savons déjà, le voyage de Paris à Bellevue, par la route impériale, puis à travers le chemin creux, et la façon toute bourgeoise dont Gustave Marion avait pénétré dans le jardin d’abord et ensuite dans la maison.
– Les yeux fixés sur cette fenêtre où brillait une lumière, nous attendions, dit-il, en fumant, et assis à quelque distance de la grille sur le revers d’un fossé, lorsque, au bout d’une demi-heure, la lumière s’éteignit brusquement.
– Bon ! murmura l’un de nous, il est heureux !
Nous attendîmes une demi-heure encore, puis une heure.
La lumière ne reparaissait pas et nous n’entendions pas le moindre bruit.
– Ma foi ! m’écriai-je, je crois que Marion se moque de nous. Si la dame est si facile, qu’elle ne se défend même pas et ne pousse pas le moindre cri, c’est que Marion est plus heureux qu’il ne le pensait d’abord.
Dès lors, nous pouvons lui souhaiter le bonjour et nous en aller…
Et me levant, je me dirigeai vers la grille demeurée entr’ouverte, bien décidé à sonner à la porte de la maison et à faire savoir à la dame que notre ami était un indiscret.
La nuit était assez claire et comme j’approchais de la maison, par la grande allée sablée du jardin, j’aperçus quelque chose d’immobile qui gisait à terre. Je fis un pas encore et m’arrêtai tout ému.
Ce quelque chose, c’était Marion.
Un moment, je le crus mort, et mon émotion fut si grande que je jetai un cri.
À ce cri nos amis accoururent.
Marion était évanoui.
Son corps ne portait les traces d’aucune blessure, d’aucune contusion.
À quelle cause attribuer son évanouissement ?
Un moment, nous songeâmes à frapper à cette porte close, à l’enfoncer au besoin.
La prudence vint à notre aide fort heureusement.
Avant de songer à venger Marion, il fallait savoir de lui-même ce qui lui était advenu.
D’ailleurs, il était dans son tort, et nous-mêmes, en pénétrant la nuit dans une maison habitée, nous pouvions nous faire une situation dangereuse.
Nous chargeâmes donc Marion sur nos épaules et nous l’emportâmes hors du jardin.
Là, nous essayâmes par tous les moyens possibles de le faire revenir à lui.
Efforts inutiles ; sans les faibles battements de son cœur, on eût juré qu’il était mort.
Nous étions dans un lieu désert ; le jour approchait, et, il pouvait se faire que nous fussions surpris par les jardiniers qui se lèvent de grand matin.
Il nous eût été difficile alors d’expliquer notre présence en cet endroit.
Nous emportâmes Marion jusqu’au break.
Il n’avait pas repris connaissance et de Bellevue à Saint-Cloud il fut aussi immobile qu’un cadavre.
À Saint-Cloud, nous nous arrêtâmes à l’hôtel de la Tête-Noire.
On le déshabilla, on le mit au lit et on envoya chercher un médecin.
Au bout d’une heure de frictions, et après qu’on lui eut ingurgité des cordiaux et fait respirer des sels, Marion ouvrit les yeux.
Mais alors nous fûmes tous saisis d’une véritable épouvante.
Marion avait le regard égaré, il ne nous reconnaissait pas.
Ses dents claquaient de terreur et un délire ardent s’empara de lui.
Ce délire ne l’a pas quitté ; il pleure, il rit tour à tour. Puis, de minute en minute, il s’écrie :
– N’y allez pas ! n’y allez pas !
Hier soir, il a eu une heure de calme ; nous étions tous autour de son lit.
Il nous a reconnus.
Je lui ai pris les mains, j’ai essayé de l’interroger.
– N’y allez pas ! n’y allez pas ! nous a-t-il dit, avec un accent de terreur folle.
– Mais que t’est-il donc arrivé ? lui ai-je dit.
– J’ai juré ! a-t-il répondu.
Et le délire l’a repris.
Le médecin consulté nous a dit qu’il craignait pour sa raison.
– Ah çà ! dit un des crevés, interrompant M. de Montgeron, je suppose que vous êtes allés les uns ou les autres chez le commissaire de police.
– Pour quoi faire ?
– Mais pour lui raconter cette histoire.
Montgeron haussa les épaules.
– Mon ami, dit-il, quand on s’est aventuré dans une expédition comme celle-là, on ne s’en vante pas.
– Cependant… Marion a dû éprouver quelque mystification terrible.
– Je le crois.
– Et il serait convenable de savoir.
– Oh ! dit Montgeron, j’ai mon idée.
– Ah !
– Écoutez, ajouta le vicomte, je suis tellement convaincu que Marion a été la victime d’un guet-apens, que j’ai fait un serment.
– Lequel ?
– Celui de pénétrer dans la maison de la Belle Jardinière de gré ou de force et coûte que coûte.
– Seul ?
– Non, avec l’un de vous, si toutefois quelqu’un de vous veut me suivre.
– Pardieu ! nous irons tous…
– Non, dit M. de Montgeron, un seul.
– Moi ! moi ! dirent tous les crevés.
– Alors, tirez au sort ; je n’en emmène qu’un.
On jeta vingt noms dans un chapeau, et le plus jeune du club, celui qui s’appelait Casimir, y mit la main.
Le premier nom qu’il amena fut le sien.
– Es-tu brave ? dit Montgeron.
– Ah ! fit-il en rougissant.
– Alors, dit froidement M. de Montgeron, en route. Nous partons ce soir.
– À quelle heure ?
– À l’instant même : Ma voiture est en bas.
Et se tournant vers les autres jeunes gens :
– Messieurs, dit-il, j’exige de vous tous un serment.
– Parle, Montgeron.
– C’est que rien de cette ténébreuse affaire ne transpirera au dehors que vous ne m’ayez revu.
Chacun donna sa parole.
– Viens, Casimir, ajouta M. de Montgeron.
Et tous deux quittèrent le club.
À propos de cette édition électronique
Texte libre de droits.
Corrections, édition, conversion informatique et publication par le groupe :
Ebooks libres et gratuits
http://fr.groups.yahoo.com/group/ebooksgratuits
Adresse
du site web du groupe :
http://www.ebooksgratuits.com/
—
Septembre 2011
—
– Élaboration de ce livre électronique :
Les membres de Ebooks libres et gratuits qui ont participé à l’élaboration de ce livre, sont : Christian, Jean-Marc, MarcD, YvetteT, PatriceC, Coolmicro.
– Dispositions :
Les livres que nous mettons à votre disposition, sont des textes libres de droits, que vous pouvez utiliser librement, à une fin non commerciale et non professionnelle. Tout lien vers notre site est bienvenu…
– Qualité :
Les textes sont livrés tels quels sans garantie de leur intégrité parfaite par rapport à l'original. Nous rappelons que c'est un travail d'amateurs non rétribués et que nous essayons de promouvoir la culture littéraire avec de maigres moyens.
Votre aide est la bienvenue !
VOUS POUVEZ NOUS AIDER À FAIRE CONNAÎTRE CES CLASSIQUES LITTÉRAIRES.