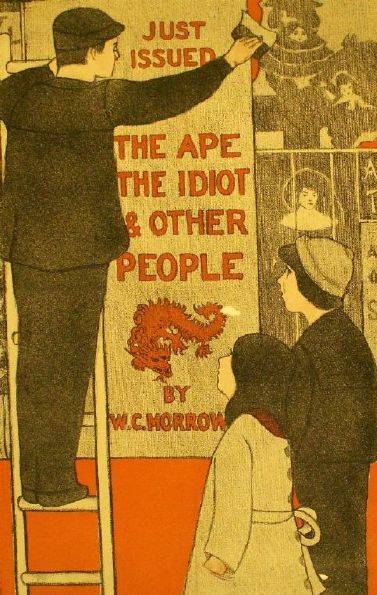
William Chambers Morrow
LE SINGE, L’IDIOT ET AUTRES GENS
1897
Traduit de l’anglais par George Elwall
Éditions de la Revue blanche, 1901
Table des matières
LA RÉSURRECTION DE LA PETITE WANG-TAI
DEVANT UNE BOUTEILLE D’ABSINTHE
UNE HISTOIRE CONTÉE PAR LA MER
À propos de cette édition électronique
NOTE DU TRADUCTEUR
W. C. Morrow est américain. Né à San Francisco peu de temps avant la guerre qui devait mettre aux prises les États du Nord et du Sud, il descend d’une vieille famille française émigrée aux États-Unis lors de la révocation de l’Édit de Nantes. Journaliste, il collabore aux grands journaux de sa ville natale et se repose du dur labeur qu’impose l’article quotidien en écrivant romans et nouvelles. Il a lui-même réuni ces dernières en un volume qui eut en Amérique et en Angleterre un légitime retentissement : c’est ce volume dont nous offrons aujourd’hui la traduction au public.
LA RÉSURRECTION DE LA PETITE WANG-TAI
Une file de voitures foraines, se déroulant sur une route poussiéreuse dans la vallée de Santa Clara, avançait lentement sous la chaleur suffocante d’un soleil de juillet. Des tourbillons de poussière enveloppaient les roulottes bariolées de la ménagerie. On avait fait jouer sur leurs coulisses les volets des cages afin de donner de l’air aux animaux haletants, mais avec l’air entrait la poussière, et la poussière incommodait fort Romulus.
Jamais il n’avait autant aspiré après la liberté. Du plus loin qu’il put se rappeler, il avait été dans une cage comme celle-ci ; il y avait passé son enfance et sa jeunesse. Nulle trace dans sa mémoire d’une époque où il eût été libre. Il n’avait pas le plus léger souvenir d’un temps où il avait pu se balancer dans les branches des forêts équatoriales. La vie n’était pour lui que désolation et désespérance, et le caractère poignant en était encore acerbé par les tourbillons de poussière qui entraient par les grilles de la cage.
Romulus alors chercha un moyen de s’enfuir.
Leste, adroit, l’œil vif, il eut tôt découvert le point faible de sa prison, réussit à le forcer et bondit sur la grand’route, singe libre. Aucun des conducteurs, assoupis et las, n’avait vu sa fuite, mais un juste sentiment de circonspection lui fit quérir l’abri d’un buisson où il se dissimula jusqu’à ce que fût passée la longue procession des roulottes.
Et, maintenant le vaste monde s’ouvrait devant lui.
Sa liberté était immense et douce, mais lui fut, un temps, embarrassante. Un bond tout instinctif pour saisir la barre du trapèze suspendu dans sa cage lui mit seulement les mains en contact avec l’air insaisissable. Il en fut décontenancé et un peu effrayé. Le monde lui paraissait beaucoup plus vaste et plus brillant depuis que les noirs barreaux de sa prison ne striaient plus sa vision. Et puis, à sa stupéfaction, au lieu de la toiture sordide de sa cage, lui apparut l’énorme et imposante étendue du ciel bleu, dont la surprenante profondeur et l’éloignement le terrifièrent.
La course d’un écureuil cherchant son terrier attira bientôt son regard, et il suivit les agissements du petit animal avec curiosité. Puis il courut au terrier et se blessa les pieds sur le chaume acéré. Ceci le rendit plus circonspect. Ne trouvant pas l’écureuil, il regarda autour de lui et aperçut deux hiboux perchés sur un petit tertre, non loin de là. Leur regard solennel fixé sur lui l’emplit d’un effroi mystérieux, mais sa curiosité ne le laissa pas renoncer à les examiner de plus près. Il se glissa prudemment vers eux, puis s’arrêta, s’assit et leur fit des grimaces. Ce ne produisit aucun effet. Il se gratta la tête et réfléchit. Puis il semblant de fondre sur eux : ils prirent leur vol.
Romulus les regarda s’envoler dans un état de stupéfaction profonde, n’ayant encore jamais vu rien voler par les airs. Mais le monde était si vaste et la liberté si illimitée, que sûrement tout être libre devait voler. Romulus alors s’élança dans l’air qu’il battit de ses bras comme il avait vu les hiboux le battre de leurs ailes, et quand il se trouva couché sur le sol, il en éprouva la première et douloureuse déception que devait lui apporter sa liberté.
Son esprit alerte chercha un nouvel aliment.
À quelque distance s’élevait une maison, et devant la porte se tenait un homme. Or, Romulus savait l’homme le plus vil et le plus cruel de toutes les créatures vivantes, le maître sans conscience aucune de l’être faible. Romulus évita la maison et prit à travers champs. Bientôt il rencontrait un objet énorme qui lui en imposa. C’était un chêne, et des oiseaux chantaient dans sa ramure. Mais sa curiosité obstinée mit un frein à sa peur, et en rampant il s’en approcha de plus en plus. L’aspect bienveillant de l’arbre, le charme de son ombre, les fraîches profondeurs de sa frondaison, le doux balancement de ses branches au souffle aimable du vent, – tout l’invitait à s’approcher. C’est ce qu’il fit, jusqu’à ce qu’il eut atteint le vieux tronc noueux, et il s’élança alors dans les branches et se sentit rempli de plaisir. Les petits oiseaux s’étaient envolés. Romulus s’assit sur l’un des rameaux, puis s’y étendit tout de son long et goûta le calme et le bien-être du moment. Mais il était singe, et il lui fallait de l’occupation : il se risqua sur des branches moindres et les secoua à la façon de ses parents avant lui.
Ces joies épuisées, Romulus se laissa tomber à terre, et se remit à explorer le monde. Mais le monde était si vaste que son isolement l’accablait. Soudain il vit un chien et se hâta vers lui. Le chien voyant approcher cet être bizarre, tenta de l’effrayer par ses aboiements, mais Romulus avait déjà vu des animaux comme celui-là, et avait entendu aussi des sons semblables. Il ne pouvait s’en effrayer. Il alla hardiment vers le chien par bonds successifs sur ses quatre pattes. Le chien, terrifié par cette étrange créature, se sauva en hurlant et laissa Romulus avec sa liberté et le monde.
Et voilà Romulus parti à travers champs, d’ici de là traversant une route, et évitant soigneusement les êtres vivants qu’il rencontrait. Bientôt il arrivait devant une haute palissade, fermant un grand enclos, où se dressait une habitation au milieu d’un bouquet d’eucalyptus.
Romulus avait soif et l’eau d’une fontaine dans les arbres le tentait cruellement.
Peut-être eût-il trouvé assez de courage pour s’y aventurer, n’eût-il à ce moment aperçu un être humain, à dix pas de lui, de l’autre côté de la palissade. Romulus se recula avec un cri d’épouvante et puis s’arrêta, se blottissant et, prêt à fuir pour sa vie et sa liberté, il considéra cet ennemi de la création.
Mais le regard qu’il reçut en échange était si doux, et, somme toute, si particulier, si différent de tout ce qu’il avait vu jusque-là, que son instinct de fuite céda devant son désir de se rendre compte.
Romulus ne savait pas que la grande habitation au milieu des eucalyptus était un hospice de jeunes idiots, ni que le garçon à la physionomie étrange, mais bienveillante, était l’un de ses pensionnaires.
Il n’y lisait que bienveillance. Le regard qu’il voyait n’était pas le regard dur et cruel du gardien de la ménagerie, ni le regard vide, frivole, curieux des spectateurs qui encouragent par leur présence et soutiennent de leur obole cette pratique infâme et exclusivement humaine qui consiste à s’emparer d’animaux sauvages pour les garder toute leur vie dans les affres de la captivité. Romulus était si profondément intéressé par ce qu’il voyait qu’il en oubliait ses craintes et, penchant sa tête de côté, fit une grimace baroque. Ses mouvements et son attitude étaient si comiques que Moïse, l’idiot, ricana un sourire que vit Romulus par les fentes de la palissade. Mais ce ricanement ne fut pas la seule manifestation de joie chez Moïse. Un mouvement vermiculaire particulier, commençant aux pieds et se terminant à la tête, fut le précurseur d’un lent et niais accès de gros rire exprimant la joie la plus intense dont il était capable. Moïse n’avait encore jamais vu d’être aussi bizarre que ce petit homme brun, tout velu : il n’avait encore jamais vu un singe, cette banale cause de joie pour les enfants ordinaires.
Moïse avait dix-neuf ans. Bien que sa voix n’eût plus rien de celle de l’enfant, que ses joues fussent couvertes de méchants poils, qu’il fût grand et fort, surtout en bras et en jambes, il était simple et innocent. Ses vêtements étaient bien trop courts pour lui et des cheveux embroussaillés que ne retenait aucune coiffure, lui dominaient la tête.
Et ces deux êtres étranges se considéraient l’un l’autre, retenus par une égale sympathie, une égale curiosité. N’ayant ni l’un ni l’autre le don de la parole, ils ne se pouvaient pas mentir.
Était-ce l’instinct qui avertissait Romulus que parmi tous ces bipèdes diaboliques, il en était un d’esprit assez bon pour l’aimer ? Était-ce aussi par instinct que Romulus, ignorant comme il l’était des façons du monde, découvrit que son propre cerveau était le plus solide et le plus capable des deux ? Et, comprenant la douceur, jusque-là insoupçonnée par lui, de la liberté, lui vint-il à l’idée que ce semblable était prisonnier, comme lui-même l’avait été, et que comme lui il aspirait ardemment à goûter du grand air ? Enfin, si c’était bien ainsi qu’avait raisonné Romulus, était-ce par un sentiment chevaleresque ou par désir d’avoir un compagnon, qu’il fut amené à la délivrance de cet être plus faible encore et plus malheureux que lui ?
Avec circonspection il s’approcha de la palissade, y passa la patte et toucha Moïse. Le gars, ravi, prit la patte du singe dans la sienne, et la meilleure intelligence de régner aussitôt entre eux. À force de taquineries, Romulus invita l’autre à le suivre ; il s’éloignait de quelques pas, puis tournait vers lui ses yeux implorants ; il s’en revenait et à travers la palissade lui prenait la main. Il répéta son manège jusqu’à ce que son intention se fût frayé sa route jusqu’au cerveau de l’idiot.
La palissade était trop haute pour la pouvoir escalader ; mais, maintenant que le désir d’être libre s’était emparé de son être, Moïse eut tôt fait, à grands coups de pieds, de briser quelques planches et il sortit de sa geôle.
Ils étaient maintenant libres tous les deux !
Et les cieux semblaient encore plus loin et l’horizon paraissait plus large. Un fossé se présenta à propos pour leur permettre d’étancher leur soif et dans un verger ils cueillirent quelques abricots bien mûrs ; mais qu’est-ce qui assouvirait la faim d’un singe ou d’un idiot ? Le monde était vaste, et doux, et beau, et un sentiment exquis de liberté sans bornes coulait dans leurs veines surprises comme un vin vieux et généreux. Et tout cela causait à Romulus et au compagnon sous sa garde une joie infinie, comme ils s’en allaient par la plaine.
Pourquoi dire en détail tout ce qu’ils firent par cet après-midi de folie, de caprice et de bonheur, tandis qu’ils allaient en titubant, ivres de liberté ?
En passant quelque part, sans être vus, ils ouvrirent à un serin la porte de sa cage, qu’on avait suspendue à un cerisier non loin de la maison ; ailleurs, ils défirent les courroies qui retenaient un bébé dans sa voiture, et l’auraient pu emporter sans crainte de surprise, mais tout ceci n’a qu’un lointain rapport avec la fin de leurs aventures, marchant à grands pas vers leur terme.
Quand le soleil fut descendu dans la splendeur blonde de l’occident et que le grand dôme argenté de l’observatoire du Mont Hamilton d’argent se fut changé en cuivre, nos deux amis las et affamés de nouveau, arrivèrent en un endroit bizarre et inattendu. Ce fut un grand chêne qui, d’abord, avec son ombre en forme de cône allongé pointant vers l’orient et les fraîches profondeurs de son feuillage, attira leur attention. Autour de l’arbre étaient rangés de petits tertres à la tête desquels se dressait un écriteau dont de plus savants eussent aussitôt saisi la signification. Mais comment un singe ou un idiot eût-il pu soupçonner un affranchissement aussi doux et calme, aussi dénué de toute entrave et de toute réserve que celui de la mort ? Comment auraient-ils su que les gagnants de ce prix inestimable étaient pleurés, mouillés de larmes et placés dans la terre avec toute la majesté, toute la pompe de la douleur ? Ne sachant rien de toutes ces choses, comment pouvaient-ils remarquer que ce cimetière mesquin où ils étaient venus errer, ne ressemblait guère à cet autre, bien en vue, à quelque distance de là, coupé qu’il était d’allées et orné de bouquets d’arbres, de fontaines, de statues, de plantes rares et de somptueux ornements ? – Ah ! mes amis, comment, sans argent, pouvons-nous donner à notre douleur une expression adéquate ? Et la douleur, lorsqu’elle ne peut témoigner de son existence, est bien la plus vaine des satisfactions !
Mais il n’y avait ni pompe ni majesté sous l’ombrage de ce chêne, car la haie défoncée qui dérobait ce lieu à l’influence de la civilisation chrétienne, entourait des tombes renfermant des os qui n’eussent pu reposer à l’aise dans un sol strié par l’ombre d’une croix. Romulus et Moïse ne savaient rien de tout cela ; ils ne connaissaient pas cette loi interdisant toute exhumation avant un espace de deux années ; ils ne savaient rien de ce peuple étrange venu de Chine qui, plein de mépris pour le sol chrétien étranger qu’il foule aux pieds, ensevelit ses morts par soumission à la loi qu’il ne fut pas assez fort pour combattre, et qui, deux ans après, déterre leurs os et les rapatrie, afin de les ensevelir pour l’éternel repos dans un sol créé et fécondé par leur dieu.
Romulus et Moïse pouvaient-ils juger ces peuples ? Ils avaient mieux à faire.
Ils avaient à peine fini d’examiner un étrange four de brique où se brûlait le texte des prières et un petit autel, de brique aussi, tout enduit du suif de cierges consumés, qu’un nuage de poussière longeant la haie défoncée les invitait à plus de circonspection.
Romulus fut le plus prompt à fuir, car une file de voitures foraines laisse aussi une traînée de poussière sur la route, et avec une surprenante agilité il s’élança dans les branches du chêne, suivi par ce lourdaud de Moïse se hissant péniblement à sa suite avec de gros rires à l’éloge de l’agilité supérieure de son compagnon. Ce fit rire encore Moïse de voir le petit homme velu s’étendre sur une branche et dans une sensation de bien-être pousser un soupir de satisfaction. Il manqua choir en voulant imiter le leste Romulus. Mais ils restèrent immobiles et silencieux quand le nuage de poussière se divisant à la barrière, laissa voir pénétrant dans l’enclos une petite procession de voitures et de charrettes.
Une fosse avait été tout nouvellement creusée, et c’est vers celle-ci que se dirigea le convoi – fosse peu profonde, car on ne doit pas s’étendre trop profondément dans le sol chrétien des barbares à face blanche, – mais c’était une fosse si petite ! Romulus lui-même, eût suffi à la combler, et, quant à Moïse, elle n’eut pas été suffisante pour ses grands pieds.
C’est que la petite Wang-Tai était morte, et que dans cette petite fosse devaient reposer pendant vingt-quatre mois ses os fragiles, sous trois pieds de terre chrétienne. L’intérêt tempéra la frayeur que ressentirent Romulus et Moïse, quand la première voiture s’arrêta au bruit d’aigres hautbois, de violons criards, de tam-tam de cuivre et de cymbales discordantes exécutant un chant funèbre pour la petite Wang-Tai, moins pour recommander à la protection divine sa mignonne âme, que pour la protéger contre les tortures des démons.
Puis, au milieu des autres, s’avança une petite femme accablée par la douleur et les larmes, car la petite Wang-Tai avait une mère et toute mère a un cœur de mère. Ce n’était qu’une petite femme jaune de l’Asie, avec une ample et bizarre culotte en guise de jupe, et des sandales qui lui battaient les talons. Ses cheveux noirs non couvert étaient solidement noués et épinglés ; ses yeux étaient noirs de couleur et doux d’expression, et son visage, probablement calme dans le contentement, était mouillé de pleurs et tiré par la souffrance. Et voilà que sur elle, comme un rayonnement du ciel, pesait la plus douce, la plus triste, la plus profonde, la plus tendre de toutes les afflictions humaines – la seule que le temps jamais ne peut guérir.
Et ils ensevelirent la petite Wang-Tai, et Romulus et Moïse voyaient tout cela. Des textes de prières furent brûlés dans le four, des cierges s’allumèrent sur l’autel, et, pour réconforter les anges qui devaient venir emporter la mignonne âme de Wang-Tai dans les hauteurs profondes du ciel bleu, des viandes savoureuses furent disposés sur la tombe.
La fosse comblée, les fossoyeurs serrèrent leurs bêches derrière le four, curieusement épiés par Romulus. La petite femme accablée ramassa toute sa douleur dans son cœur et l’emporta. Un nuage de poussière se leva, grandissant toujours le long de la haie défoncée, pour enfin disparaître dans le lointain. Le dôme du Mont Hamilton s’était changé de cuivre en or ; les gorges empourprées des Monts Santa Cruz se glaçaient sous le flamboiement orange du ciel d’Occident ; sous le grand chêne les grillons faisaient retentir leurs notes joyeuses, et la nuit tomba doucement comme un rêve.
Deux paires d’yeux affamés voyaient les viandes sur la tombe, tandis que quatre narines avides en reniflaient l’arôme. Romulus dégringola et moins habilement voilà Moïse dégringolant à son tour. Ce soir-là, les anges de la petite Wang-Tai remonteraient au ciel sans souper, – et la route est longue de la terre au ciel ! Nos deux vagabonds se jetèrent sur cette proie, se chamaillant et se battant, puis, quand tout fut dévoré, ils se résolurent à de nouvelles entreprises. Romulus alla chercher les bêches et se mit consciencieusement à creuser la tombe de Wang-Tai, et Moïse, riant et croassant, lui prêta main-forte. Comme résultat de leurs efforts, la terre s’amoncela de chaque côté. Trois pieds seulement de terre peu solide recouvraient la petite Wang-Tai !
Une petite femme jaune, gémissant de douleur, s’était toute la nuit tournée et retournée sur la natte dure qui lui servait de couchette et sur son oreiller de bois, plus dur encore. Les sons mêmes qui retentissaient rauques et familiers dès la première heure du matin dans le quartier chinois de San José et lui rappelaient la distante patrie occupant tout ce qui de son cœur n’avait pas été enseveli sous la terre chrétienne, ne pouvaient alléger ce lourd fardeau qui l’accablait. Elle vit le soleil au matin se frayer sa route à travers des flots d’ambre et le dôme argenté du grand observatoire sur le Mont Hamilton se découper d’un noir d’ébène sur la radieuse splendeur de l’orient. Elle entendit le jargon asiatique du revendeur national criant sa marchandise dans les ruelles fétides, et ses larmes vinrent grossir le nombre des perles dont la rosée avait jonché son seuil. Ce n’était qu’une petite femme jaune d’Asie, toute ployée par le chagrin. Et quelle joie pouvait lui apporter l’éclat resplendissant du soleil déversant sur elle sa lumière et conviant tous les gamins et toutes les fillettes du monde à trouver la vie et la santé dans son splendide déploiement ? Elle vit le soleil escalader les cieux dans son impérieuse magnificence, mais des voix chuchotaient à son oreille et tempéraient le rayonnement du jour par les souvenirs du passé.
Auriez-vous pu, le cœur brisé et les yeux voilés de larmes, distinguer avec toute la netteté voulue les personnes composant le cortège bizarre qui, descendant la ruelle, se dirigeait vers sa demeure ? C’étaient des hommes blancs avec trois prisonniers, – trois êtres qui si récemment venaient d’éprouver les douceurs de la liberté pour être de nouveau plongés dans la servitude. Deux d’entre eux avaient été arrachés à la liberté de la vie et l’autre à l’affranchissement de la mort, et on les avait à l’aube trouvés endormis tous les trois près de la fosse ouverte et du cercueil vide de la petite Wang-Tai.
Les malins prétendirent que la petite Wang-Tai, par l’ignorance d’un médecin avait été enterrée vivante, et que Romulus et Moïse, au moyen de leurs tours diaboliques, l’avaient ramenée à la vie après l’avoir arrachée à sa tombe.
Mais qu’importent ces racontars ?
N’est-ce point assez de savoir que les deux brigands furent fouettés et renvoyés à leur esclavage, et que, lorsque la petite femme jaune d’Asie eut serré la mignonne enfant sur sa poitrine, les fenêtres de son âme s’ouvrirent pour recevoir la chaleur que le soleil d’or déversait du ciel ?
DEVANT UNE BOUTEILLE D’ABSINTHE
Arthur Kimberlin, jeune homme d’une surprenante énergie se trouva un soir de pluie sur le pavé de San Francisco, sans la moindre relation dans cette ville et à un moment où son cœur se brisait : la faim le torturait et sa souffrance physique était d’autant plus poignante qu’elle n’avait pu ébranler son cerveau. Il ne lui restait rien ; pas le moindre objet qu’il pût échanger contre un morceau de pain : il avait vendu même la plupart de ses vêtements, ne gardant que ceux que lui commandait la décence. Et maintenant le froid le saisissait, conspirant avec la faim pour achever sa misère.
Né dans une situation aisée, ayant reçu une bonne éducation, il manquait du courage nécessaire et de l’habileté que comporte le vol. Ne lui fût-il pas arrivé une aventure extraordinaire, il se serait dans les vingt-quatre heures noyé dans la baie ou serait mort de pneumonie dans la rue.
Il n’avait rien mangé depuis soixante-dix heures et le désespoir de son cœur avait, concurremment avec le besoin, épuisé ses forces physiques ; maintenant blême et chancelant, il se consolait de son mieux à humer goulûment le fumet des cuisines des restaurants dans Market Street, plus soucieux de ne rien perdre des savoureuses odeurs que d’éviter la pluie.
Ses dents claquaient : il se traînait, trébuchait, haletait, sans force à cette heure pour maudire sa destinée, n’ayant plus qu’un désir… manger ! Raisonner, il ne le pouvait plus ; il ne comprenait pas que dix mille mains se seraient tendues vers lui et de grand cœur lui eussent donné la nourriture dont le besoin le tuait ; il ne pouvait penser qu’à la faim qui le torturait, aux aliments qui lui procureraient chaleur et joie.
Il était arrivé dans Mason Street quand il aperçut à quelque distance, de l’autre côté de la rue, un restaurant : il y alla, traversant la rue en biais. Devant les hautes vitrines il s’arrêta, couvant des yeux les viandes épaisses et bordées de graisse, les larges huîtres posées sur la glace, des tranches de jambon grandes comme son chapeau, des poulets rôtis entiers, rissolés et baignant dans le jus. Il grinça des dents, gémit et s’éloigna en chancelant.
À quelques pas se trouvait un bar, avec une entrée particulière sur la porte de laquelle on lisait « Entrée des Familles ».
Dans l’encoignure de cette porte, d’ailleurs fermée, se tenait un homme. En dépit de son propre supplice, Kimberlin lut sur la physionomie de cet individu un je ne sais quoi qui le fit frémir et le fascina. La nuit était venue, et cet endroit n’était que faiblement éclairé ; mais il était évident que l’inconnu avait une apparence dont il devait lui-même ignorer le caractère particulier. Peut-être fut-ce l’insolite angoisse traduite sur ce visage qui fit appel à la sympathie de Kimberlin.
Le jeune homme s’arrêta hésitant et considéra l’inconnu.
D’abord l’autre ne le vit pas, car il regardait droit devant lui dans la rue avec une fixité singulière et la pâleur de mort de son visage ajoutait à la sinistre immobilité de son regard. Soudain il aperçut Kimberlin.
– Ah ! dit-il lentement et avec une netteté particulière, la pluie, vous aussi, vous a surpris sans pardessus ni parapluie ! Venez sous cette porte… il y a place pour deux.
La voix n’était pas sans bienveillance, bien que d’une inquiétante âpreté. Et puis c’était la première parole que s’entendait adresser le malheureux depuis que la faim s’était emparée de lui, et s’entendre seulement parler, voir aussi qu’on s’inquiétait, si peu que ce fût, de son bien-être, lui donna courage. Il s’abrita sous la porte à côté de l’inconnu, qui aussitôt retomba dans l’immobilité, les yeux fixes perdus dans le vague de la rue.
Mais bientôt l’étranger parut se réveiller.
– Il peut pleuvoir longtemps encore, dit-il. J’ai froid et je vois que vous frissonnez. Entrons boire quelque chose.
Il poussa la porte et Kimberlin le suivit, le cœur réchauffé par l’espoir.
C’était une salle divisée en une série de petits « boxes » ou compartiments qu’une mince cloison séparait les uns des autres ; une porte permettait de s’isoler complètement. Le pâle inconnu le mena dans l’un des deux, mais, avant de s’asseoir, tira de sa poche une liasse de billets de banque.
– Vous êtes le plus jeune, dit-il ; voudriez-vous me faire le plaisir d’aller au bar acheter une bouteille d’absinthe, et de rapporter une carafe et des verres ? Je n’aime pas voir les garçons tourner autour de moi. Voici un billet de vingt dollars.
Kimberlin prit le billet et, sortant dans le corridor, se dirigea vers le bar.
Il tenait l’argent serré dans ses doigts ; il en éprouvait une telle sensation de chaleur et de confortable que dans le bras lui en passait un délicieux frisson. Que de repas copieux et chauds ce billet de banque ne représentait-il pas ? Il le serra plus fort et hésita. Il croyait humer une large grillade, flanquée de gras petits champignons nageant dans le beurre fondu du plat fumant. Il s’arrêta et derrière lui jeta un regard vers la porte du box. Il vit que l’étranger l’avait fermée. Il pouvait revenir sur ses pas, la dépasser, se glisser au-dehors et acheter de quoi manger. Il fit demi-tour, mais le lâche en lui (il est d’autres noms pour cela) fit crouler sa résolution. Il se dirigea droit vers le bar et fit son emplette.
C’était tellement inhabituel que le garçon à qui il s’adressait l’examina attentivement :
– Vous n’allez pas boire tout cela, dites-moi donc ? demanda-t-il.
– Je suis dans un box avec des amis, répliqua Kimberlin, et nous voulons boire tranquillement sans être dérangés. Nous sommes au n° 7.
– Oh ! pardon. Ça va bien, fit le garçon.
Le pas de Kimberlin était bien plus ferme et plus assuré comme il s’en revenait avec la boisson. Il ouvrit la porte du box.
L’étranger s’était assis à la petite table, fixant la cloison en face de lui de ce même regard dont il fixait l’autre côté de la rue tout à l’heure. Il portait un chapeau mou à larges bords, rabattu sur ses yeux. Ce fut lorsque Kimberlin eût posé sur la table la bouteille, la carafe et les verres et eût pris place vis-à-vis de l’inconnu et dans la ligne de son rayon visuel que l’homme pâle le remarqua :
– Ah, vous l’avez apportée ? Que c’est aimable à vous ! Maintenant fermez la porte.
Kimberlin avait glissé la monnaie dans sa poche et se disposait à l’en tirer, quand l’inconnu lui dit :
– Gardez la monnaie. Vous en aurez besoin, car je vais vous la reprendre d’une manière qui vous intéressera. Buvons d’abord, je vous expliquerai ça ensuite.
Le pâle inconnu lentement fit deux absinthes et tous deux burent.
L’ingénu Kimberlin n’avait jamais encore bu d’absinthe ; il trouva ce breuvage âcre et désagréable, mais le liquide ne fut pas plutôt descendu dans son estomac qu’il communiqua à son être entier une douce chaleur.
– Cela nous fera du bien, fit l’inconnu ; tout à l’heure nous en reprendrons. Mais, dites-moi, connaissez-vous le jeu de dés ?
Kimberlin avoua très franchement ne pas le connaître.
– Je le pensais. Eh bien, veuillez donc aller au bar demander un cornet et des dés. Je sonnerai bien, mais je n’aime pas avoir affaire avec les garçons.
Kimberlin revenait bientôt avec le jeu, refermai la porte, et la partie commença.
Ce n’était pas l’antique et simple jeu ; il y avait des complications où le jugement, autant que le hasard, jouait un rôle. Après une partie ou deux sans enjeu, l’étranger dit :
– Maintenant vous m’avez l’air de comprendre. Fort bien… Je vais vous prouver que vous n’y entendez rien. Nous allons jouer un dollar la partie et je vais ainsi vous regagner la monnaie qu’on vous a rendue. Sans quoi ce serait vous voler, et volontiers j’imagine que vous n’avez pas les moyens de les perdre. Ceci n’est point pour vous blesser, mais je parle franc et j’estime plus l’honnêteté que la politesse. Je veux seulement me distraire un peu et je vous crois assez aimable pour pouvoir escompter votre bon vouloir.
– Certainement, répliqua Kimberlin, je serai ravi.
– Parfait, mais buvons encore avant de commencer. Je crois que j’ai plus froid.
Ils burent encore et, cette fois, notre affamé prit le breuvage avec délices ; c’était du moins quelque chose dans l’estomac, et ça le réchauffait et l’enchantait.
L’enjeu était d’un dollar. Kimberlin gagna. Le pâle inconnu eut un sourire lugubre et attaqua une nouvelle partie. Kimberlin gagna encore. L’inconnu alors releva son chapeau et regarda son partenaire de son regard fixe, souriant toujours.
Cette vue en pleine lumière du visage blême de son compagnon épouvanta plus encore Kimberlin. Il avait commencé à retrouver sa pleine possession de lui-même et toute son aisance ; l’étonnement que lui causait le singulier caractère de son aventure avait aussi commencé à se dissiper, et voilà que ce nouvel incident venait de nouveau embrouiller ses idées. Ce qui l’alarmait, c’était l’extraordinaire expression du visage de l’étranger. Jamais il n’avait vu sur un visage humain pareille pâleur de mort. Le visage était plus que pâle : il était blanc. Chez Kimberlin, la faculté d’observation avait été aiguisée par l’absinthe : après avoir à deux ou trois reprises observé que l’inconnu inconsciemment se prenait à caresser de la main une barbe absente, il réfléchit qu’une partie de la blancheur de la figure était due à la récente suppression d’une barbe bien fournie. Outre sa pâleur, la lumière électrique faisait très distinctement ressortir ses traits creusés et très accentués. À l’exception du regard fixe des yeux et, par intervalle, de ce sourire dur qui semblait déplacé sur un tel visage, l’expression était celle d’une statue taillée sans art. Les yeux étaient noirs, mais mornes ; la lèvre inférieure était pourpre ; les mains étaient blanches, fines et maigres, sillonnées de veines sombres.
L’inconnu ramena son chapeau sur ses yeux.
– Vous avez de la chance, dit-il. Si nous buvions encore. Il n’est que l’absinthe pour affiner l’esprit, et je vois que vous et moi, nous allons passer une délicieuse soirée.
Après boire, la partie recommença.
Kimberlin, dès le début, gagna, ne perdant que rarement une partie. Il était maintenant très excité. Ses yeux brillaient. Il avait du rouge aux joues.
L’inconnu ayant perdu la liasse de billets qu’il avait tirée, en prit une autre plus volumineuse et d’un chiffre plus élevé. La liasse valait plusieurs milliers de dollars.
À la droite de Kimberlin étaient ses gains : deux cents dollars environ.
Ils élevèrent l’enjeu et, après avoir bu, se remirent à jouer. La chance alors tourna et l’étranger gagna facilement. Elle revint pourtant à Kimberlin, car il jouait maintenant avec toute la réflexion et toute l’adresse dont il était susceptible. Une fois seulement il se demanda ce qu’il ferait de l’argent s’il se levait de cette table le gagnant, mais un sentiment de délicatesse lui fit décider de le restituer à l’inconnu.
L’absinthe maintenant avait à ce point délié les facultés de Kimberlin que, la satisfaction temporaire donnée à sa faim étant passée, ses souffrances physiques revenaient avec plus de force. Ne pourrait-il pas avec son gain se commander à souper ? Non, c’était là chose impossible et l’étranger ne parlait pas de manger. Kimberlin continua de jouer, tandis que la faim se manifestait par des affres qui le faisaient se tordre et grincer des dents. L’étranger, entièrement absorbé par le jeu, ne s’en apercevait pas. Il semblait embarrassé, déconcerté. Il jouait avec le plus grand soin, étudiant minutieusement chaque coup. Aucun propos ne s’échangeait. Ils ne s’arrêtaient que pour boire, puis le bruit des dés reprenait et l’argent continuait à s’amonceler à la droite de Kimberlin.
La conduite du pâle inconnu devenait étrange. Parfois il tressaillait et tendait l’oreille comme s’il écoutait. Son regard un instant flamboyait, puis redevenait morne.
Plus d’une fois Kimberlin, qui maintenant commençait à prendre son partenaire pour une sorte de monstre, voyait passer sur sa figure une expression hideuse et ses traits, pour un moment, s’immobilisaient en une grimace particulière. Toutefois il était évident qu’il s’affaissait de plus en plus dans un état d’apathique torpeur. Parfois, quand Kimberlin avait eu un coup étonnamment heureux, il levait les yeux vers lui et le considérait quelques instants avec cette fixité qui faisait trembler le jeune homme.
Quand la seconde liasse de billets fut partie, l’inconnu en tira de sa poche une nouvelle, dont la valeur était de beaucoup supérieure à celle des deux autres mises ensemble. L’enjeu fut élevé à mille dollars la partie, et Kimberlin toujours gagnait. Enfin le moment vint où l’étranger se disposa à tenter un effort final. D’une voix un peu pâteuse, mais d’un ton délibéré et tranquille, il dit :
– Vous m’avez gagné soixante-quatorze mille dollars, c’est exactement l’équivalent de ce qui me reste. Voilà plusieurs heures que nous jouons ; je suis fatigué et vous vraisemblablement aussi. Finissons-en. Nous allons en une dernière partie jouer le tout.
Kimberlin, sans hésitation aucune, donna son assentiment.
Les billets formaient sur la table un monceau considérable. Kimberlin jeta les dés : son coup joué, le cornet ne pouvait plus contenir qu’une seule combinaison susceptible d’amener sa défaite et cette combinaison ne se voit qu’une fois sur dix mille. Le cœur de l’affamé battit violemment lorsque l’étranger prit le cornet avec un calme exaspérant. Plusieurs minutes s’écoulèrent avant qu’il abattît. Il amena la combinaison : Kimberlin avait perdu. L’inconnu continua de regarder les dés longtemps, puis lentement se renversa sur sa chaise et, s’installant à l’aise, leva les yeux sur son partenaire et le considéra de ce regard sans vie. Il ne prononça pas une parole ; sur son visage ne se voyait nulle trace d’émotion ou d’intelligence. Il regardait et c’est tout. On ne garde généralement pas les yeux ouverts longtemps sans un clignement des paupières, mais les paupières de l’inconnu ne clignotaient pas. Il restait tellement immobile que Kimberlin se sentit mal à l’aise.
– Je vais partir maintenant, dit-il à son compagnon.
Il disait cela, et il n’avait pas un centime en poche, et il mourait de faim.
L’autre ne répondit rien, et devant la fixité de son regard le jeune homme se recroquevilla sur son siège, terrifié.
À cet instant il se rendit compte que deux hommes causaient à voix basse dans le box voisin et comme, dans le sien régnait un silence de mort, il prêta l’oreille et voici ce qu’il entendit :
– Oui, on l’a vu s’engager dans cette rue, il y a environ trois heures.
– Et il était rasé ?
– Il a dû se raser ; la suppression d’une barbe comme la sienne vous change naturellement son homme complètement.
– Mais ce pouvait ne pas être lui.
– Sans doute ; pourtant, son extrême pâleur a attiré l’attention. Vous n’ignorez pas qu’il a récemment souffert d’une maladie de cœur ; il était sérieusement atteint.
– Oui, mais cela ne lui a rien enlevé de son adresse. C’est le vol le plus audacieux qu’on ait encore jamais commis dans une banque ici. Cent quarante-huit mille dollars… pensez donc ! Depuis quand était-il sorti du bagne ?
– Voilà huit ans. Pendant ce temps-là sa barbe a poussé : il vivait de son adresse aux dés, jouant avec des gaillards qui pensaient bien le pincer s’il tentait de les tricher, mais c’était impossible. Personne n’a jamais pu se vanter de l’avoir gagné. Il n’est évidemment pas ici ; cherchons ailleurs.
Puis les deux hommes trinquèrent et sortirent.
Et nos deux joueurs, le pâle et l’affamé, étaient là assis, se considérant l’un l’autre, avec cent quarante-huit mille dollars s’empilant entre eux. Le gagnant ne faisait pas un mouvement pour empocher la somme ; il ne quittait pas sa place, regardant fixement Kimberlin, nullement troublé par cette conversation dans le box voisin. Son imperturbabilité était stupéfiante, terrifiante son immobilité absolue.
Kimberlin commençait à grelotter la fièvre. Le regard froid et impassible de l’inconnu le glaçait jusqu’à la moelle. Incapable de le supporter plus longtemps, Kimberlin s’écarta et à sa grande surprise, constata que les yeux de son pâle compagnon au lieu de le suivre restaient fixés sur l’endroit qu’il venait de quitter ou plutôt sur la cloison de derrière.
L’épouvante s’emparait maintenant de lui. Il craignait de faire le moindre bruit. Des voix montaient du bar, et l’infortuné s’imaginait entendre des gens chuchotant et marchant sur la pointe du pied dans le corridor.
Il se versa de l’absinthe et, sans quitter un seul instant de l’œil son étrange partenaire, il but inaperçu par lui. Il avait eu, en se versant la liqueur, la main lourde et la boisson produisit sur lui un effet particulier : il sentit son cœur bondir avec une force et une précipitation alarmantes, sa respiration devint difficile. Mais la faim subsistait : la faim, l’absinthe lui donnaient l’impression que les sucs gastriques le détruisaient en digérant son estomac. Il se pencha et parla à voix basse à l’inconnu qui ne fit nulle attention à lui. L’une de ses mains était appuyée sur la table ; sur cette main Kimberlin posa la sienne, qu’il retira aussitôt… cette main était froide comme la pierre.
Il ne fallait pas que l’argent restât là étalé.
Kimberlin en fit plusieurs tas, coulant à chaque instant un regard furtif vers son immobile compagnon, dévoré par une crainte mortelle qu’il ne remuât ! Puis se renversant sur sa chaise, il attendit.
Une invincible fascination le poussa à reprendre son ancienne place de façon à placer son visage en plein dans le rayon visuel de son compagnon, et les voilà de nouveau assis face à face se regardant fixement l’un l’autre.
Kimberlin sentit que sa respiration devenait plus courte et plus faibles les battements de son cœur, mais il s’en trouva mieux, car son anxiété se calma et les affres de la faim diminuaient. Son bien-être physique augmenta ; il bâilla. S’il avait osé, il aurait dormi.
Soudain une vive lueur le frappa et le fit se lever d’un bond. Avait-il reçu un coup à la tête ou avait-il été frappé au cœur ? Non, il était sain et sauf et vivant. Le pâle inconnu était toujours là, ne regardant rien et immobile ; mais Kimberlin n’avait plus peur de lui. Au contraire, une extraordinaire vivacité d’esprit et une surprenante élasticité du corps lui communiquaient je ne sais quelle insouciance et quelle audace. Sa timidité première et ses scrupules se dissipaient ; il se sentait à la hauteur de n’importe quelle aventure. Sans hésiter, il ramassa l’argent et en remplit ses poches.
– Je suis bien bête de mourir de faim, se dit-il, avec tout cet argent à ma portée.
Avec autant de circonspection qu’un voleur, il ouvrit la porte, se glissa dehors, la referma, et la démarche assurée, la tête droite, sortit dans la rue.
À son grand ébahissement, il trouva la ville tout animée comme aux premières heures de la nuit ; le ciel était clair. Évidemment il n’était pas resté dans le box aussi longtemps qu’il l’avait supposé. Il suivait la rue insouciant des périls qui l’entouraient, et riait doucement, mais joyeusement. Ne pouvait-il pas manger maintenant ? Oh ! il le pouvait sûrement ! Comment ? Mais il pouvait acheter une douzaine de restaurants ! Bien plus, il pouvait parcourir la cité en tous sens en quête d’affamés et les nourrir des viandes les plus appétissantes, des rôtis les plus juteux et des huîtres les plus belles.
Il allait d’abord manger, puis il fonderait un établissement où, pour rien, il nourrirait tous les meurt-de-faim.
Oui, il allait d’abord manger et, si bon lui semblait, il mangerait jusqu’à en éclater. Trouverait-il dans un seul établissement de quoi apaiser sa faim ? Vivrait-il assez pour se faire tuer et rôtir un bœuf entier pour son souper ? Outre ce bœuf, il commanderait deux douzaines de poulets rôtis, cinquante douzaines d’huîtres, une douzaine de crabes, dix douzaines d’œufs, douze jambons, huit jeunes cochons, vingt canards sauvages, quinze poissons de quatre espèces différentes, huit salades, quatre douzaines de bouteilles de bordeaux, de bourgogne et de champagne ; il n’oublierait pas la pâtisserie et, pour dessert il ferait apporter, par boisseaux, noix, sucreries et glaces. Il faudrait du temps pour préparer un pareil repas et, s’il pouvait seulement vivre le temps nécessaire à le préparer, cela valait certainement mieux que de gâter son appétit avec une douzaine ou deux de repas ordinaires. Il pensait pouvoir vivre assez de temps, car il se sentait étonnamment fort et dispos. De sa vie il n’avait marché avec autant d’aise ni si allègrement ; ses pieds ne touchaient plus le sol : il courait, il volait.
Cela lui faisait du bien d’infliger à sa faim ce supplice de Tantale, il n’en goûterait que mieux les délices du festin. Comme tous le regarderaient ébahis quand il donnerait ses ordres ! Ce serait comique de les voir hésiter, comique aussi leur stupéfaction quand il jetterait sur la table quelques milliers de dollars, leur disant de se payer et de garder la monnaie ! Vraiment, ça valait la peine d’avoir si faim, car manger lui donnerait alors une indicible joie. Il ne faut pas être pressé de manger quand on a si faim, c’est bestial. De combien de la joie de vivre les riches se privent-ils en mangeant avant que d’avoir faim, avant que d’être restés trois jours et trois nuits sans nourriture ! Et quel courage, quelle preuve d’empire sur soi-même, de se jouer des tortures de la faim quand on a une fortune éblouissante dans sa poche et que toutes les portes des restaurants sont grandes ouvertes !
Mourir de faim quand on n’a pas un sou vaillant, voilà qui est désespérant ! Mais mourir de faim quand l’or fait éclater vos poches, c’est sublime. Certes, le seul vrai paradis est celui où l’affamé se trouve devant un repas succulent qu’il pourrait prendre s’il s’en donnait la peine ; puis, la panse pleine, s’endormir.
Tout en raisonnant ainsi, Kimberlin ne mangeait pas.
Il se sentait grandir démesurément, les gens autour de lui devenaient des nains. Les rues s’élargissaient, les étoiles devenaient autant de soleils et faisaient pâlir les lumières électriques, et les parfums les plus enivrants et la musique la plus suave emplissaient les airs. Criant, riant, chantant, Kimberlin se mêla à un orphéon qui traversait la ville et puis…
Les deux policiers qui avaient filé le fameux voleur de la banque jusqu’au bar dans Mason Street où Kimberlin avait rencontré le pâle inconnu, s’étaient éloignés ; mais, incapables de reprendre la piste, avaient fini par revenir au bar.
Ils trouvèrent la porte du n° 7 fermée.
Après avoir frappé et appelé, ne recevant pas de réponse, ils enfoncèrent la porte du box. Ils y virent deux hommes, l’un d’âge moyen, l’autre très jeune, assis parfaitement immobiles de chaque côté de la table et se regardant l’un l’autre d’une manière étrange. Entre eux, une énorme somme d’argent en petits tas. À côté d’une bouteille d’absinthe, une carafe d’eau, deux verres, un cornet et, devant le plus âgé, les dés encore dans la position qu’ils avaient prise la dernière fois qu’il avait joué.
L’un des policiers braqua son revolver sur le plus âgé et commanda :
– Haut les mains !
Mais le joueur n’y fit point attention.
Les agents échangèrent un regard de surprise.
Ils examinèrent de plus près le visage des deux hommes, et s’aperçurent alors que tous deux étaient morts.
UN STYLET
J’avais en toute hâte envoyé chercher le Dr Rowell, mais il n’était pas encore arrivé et la tension était terrible.
Mon jeune ami gisait sur ce lit d’hôtel et je le croyais mort. Seule, la poignée incrustée de pierreries de la dague se pouvait voir ; la lame était toute dans la poitrine.
– Arrache-le, mon vieux, suppliait le blessé de ses lèvres blêmies et contractées, et sa voix n’était guère moins inquiétante que le regard morne de ses yeux.
– Non, Arnold, lui dis-je, (refus que me dicta l’instinct ou, peut-être, certaines notions élémentaires d’anatomie), et doucement je passai la main sur son front.
– Pourquoi non ? Il me fait mal, murmura-t-il.
C’était pitié de voir ainsi souffrir ce garçon robuste, plein de santé, si hardi et si insouciant.
Le Dr Rowell entra.
C’était un homme aux cheveux grisonnants, de haute taille, l’air grave.
Il s’approcha du lit ; je lui montrai du doigt le manche du poignard que terminait un gros rubis et que des diamants et des émeraudes alternés ornaient d’étranges fioritures.
Le médecin tressaillit. Il tâta le pouls d’Arnold et parut embarrassé.
– Quand cela est-il arrivé ? demanda-t-il.
– Il y a environ vingt minutes, répondis-je.
Le médecin sortit précipitamment, me faisant de la tête signe de le suivre.
– Arrêtez ! dit Arnold.
Nous obéîmes.
– Est-ce de moi que vous voulez parler ?
– Oui, répondit le Dr Rowell avec hésitation.
– Alors parlez en ma présence, poursuivit mon ami. Je n’ai pas peur.
C’était dit de ce ton impérieux qui lui était habituel, et cependant ses souffrances devaient être intolérables.
– Si vous l’exigez…
– Je l’exige !
– Dans ce cas, déclara le médecin, si vous aviez des dispositions à prendre, il vaudrait mieux le faire tout de suite. Je ne puis rien pour vous.
– Combien de temps ai-je à vivre ? demanda Arnold.
Le docteur réfléchit, caressant sa barbe grise.
– Cela dépend, dit-il enfin. Si nous enlevons le poignard, vous vivrez trois minutes ; si nous le laissons en place, vous pouvez vivre une heure ou deux… mais pas davantage.
Arnold ne broncha pas.
– Merci, dit-il, en dépit de la douleur ébauchant un vague sourire. Mon ami, que voici, réglera la question de vos honoraires. J’ai quelques dispositions à prendre. Que le poignard reste.
Il tourna les yeux de mon côté et, me serrant la main, dit affectueusement :
– Et je te remercie bien, mon pauvre vieux, de ne l’avoir pas arraché.
Le médecin, mû par un sentiment de délicatesse, quitta la chambre, disant :
– Veuillez sonner s’il survient un changement ; je reste dans l’hôtel.
Il était parti depuis quelques instants seulement, quand il revint soudain :
– Excusez-moi, dit-il. Il y a dans l’hôtel un jeune chirurgien qu’on dit fort habile. Je ne suis pas chirurgien moi-même, je suis médecin. Le ferai-je mander ?
– Certes, dis-je avec empressement.
Mais Arnold sourit et secoua la tête.
– J’ai grand peur que le temps nous manque, dit-il.
Je refusai de l’écouter et fis mander le chirurgien. J’écrivais sous la dictée d’Arnold, quand les deux hommes entrèrent.
Il y avait chez ce jeune chirurgien un air d’assurance et de résolution qui dès l’abord me frappa. L’apparence, quoique douce, était franche et hardie ; ses mouvements étaient précis et prompts. Ce jeune homme s’était fait remarquer déjà dans de difficiles opérations de laparotomie et il était à cet âge plein de confiance où l’ambition permet de tout tenter. Le nouveau venu se nommait le Dr Raoul Entrefort ; il était créole et avait voyagé et étudié en Europe.
– Parlez franchement, murmura Arnold lorsque le Dr Entrefort eut terminé son examen.
– Qu’en pensez-vous, docteur ? demanda Entrefort à son aîné.
– Je pense, répliqua l’autre, que la lame a pénétré dans l’aorte montante environ deux pouces au-dessus du cœur. Tant qu’elle restera dans la blessure, l’épanchement du sang, bien que certain, sera relativement peu considérable ; mais que la lame fût retirée, le cœur se viderait presque instantanément par la blessure aortique.
Cependant, Entrefort coupait adroitement la chemise et mettait la poitrine à nu. Il examina la poignée de pierreries avec l’intérêt le plus vif.
– Vous vous basez, docteur, dit-il, sur cette supposition que l’arme est un poignard.
– Certainement, répondit le Dr Rowell en souriant, et ce n’est pas autre chose.
– C’est bien un poignard, intervint Arnold d’une voix faible.
– Avez-vous vu la lame ? demanda vivement Entrefort.
– Oui… un instant.
Entrefort lança un regard au Dr Rowell et murmura :
– Alors, ce n’est pas une tentative de suicide.
Le Dr Rowell parut embarrassé et ne répondit pas.
– Je me vois obligé de ne pas partager votre opinion, messieurs, remarqua tranquillement Entrefort. Ce n’est pas un poignard.
Il examina la poignée de très près. Non seulement la lame était complètement cachée aux regards, plongée qu’elle était toute dans le corps d’Arnold, mais encore le coup avait été porté avec tant de violence que la peau était déprimée autour de la garde.
– Le fait que ce ne soit pas un poignard entraîne une curieuse série de d’éventualités et de conjectures imprévues, poursuivit Entrefort avec calme, dont quelques-unes, autant que je puis être renseigné, sont tout à fait nouvelles dans l’histoire de la chirurgie.
Une expression, où se mêlaient manifestement l’ironie et l’intérêt, se jouait sur la physionomie du Dr Rowell.
– Quelle est donc cette arme, docteur ? demanda-t-il.
– Un stylet.
Arnold tressaillit. Le Dr Rowell parut confus.
– Je dois avouer, dit-il, mon ignorance absolue de la différence qui existe entre ces armes de pénétration, kriss, dagues, stylets, poignards ou couteaux catalans.
– À l’exception du stylet, expliqua Entrefort, toutes les armes que vous citez là, sont à un ou deux tranchants et pénètrent en se taillant leur route. Le stylet est rond, n’a généralement qu’un demi-pouce environ, et même moins, de diamètre à la garde et s’effile en une pointe aiguë. Il ne pénètre qu’en refoulant les tissus de tous côtés. Vous saisissez bien l’importance du fait.
Le Dr Rowell hocha la tête en signe d’assentiment.
– Comment savez-vous que c’est un stylet, docteur Entrefort ? demandai-je.
– La taille de ces pierres est l’œuvre de lapidaires italiens, répliqua-t-il, et elles ont été montées à Gênes. Voyez encore la garde : elle est beaucoup plus large et plus courte que celle d’une arme tranchante. Cette arme-ci date de quatre cents ans, et ne serait pas payée trop cher vingt mille florins. Remarquez aussi ces bleus sur la poitrine de votre ami dans le voisinage immédiat de la garde : cela nous indique que les tissus ont été contusionnés par la pression de la « lame », si je puis employer ce mot.
– Que peut me faire tout cela ? demanda le mourant.
– Peut-être beaucoup et peut-être rien. Cela jette une lueur d’espoir sur votre situation désespérée.
Les yeux d’Arnold brillèrent et il retint son souffle. Un frémissement l’agita, que je sentis passer dans sa main qui pressait la mienne. La vie après tout lui était douce, elle était douce à ce garçon hardi et résolu qui venait avec tant de calme de regarder la mort en face.
Le Dr Rowell, sans laisser voir un seul symptôme de jalousie, ne put pourtant dissimuler un regard d’incrédulité.
– Avec votre permission, dit Entrefort, s’adressant à Arnold, je tenterai ce que je puis pour vous sauver.
– Faites, dit le malheureux.
– Mais je vais vous faire souffrir.
– C’est bien.
– Beaucoup peut-être.
– C’est bien.
– Et si je réussis (j’ai une chance sur mille), vous ne serez jamais complètement solide. Un danger terrible vous guettera constamment.
– C’est bien.
Entrefort écrivit un mot qu’en toute hâte il fit porter par un domestique.
– Pour l’instant, reprit-il, toute secousse mettrait votre vie en danger, et cette même cause peut d’ici à quelques minutes ou dans des heures amener la mort. Occupez-vous sans retard des affaires que vous désiriez régler, et le Dr Rowell, ajouta-t-il en se tournant vers ce dernier, va vous ordonner un fortifiant. Je vous parle net, car je vois que vous êtes un homme d’une rare énergie. Ai-je tort ?
– Parlez en toute franchise, dit Arnold.
Le Dr Rowell rédigea une ordonnance. Avec un zèle irréfléchi, j’interrogeai Entrefort :
– N’y a-t-il aucun danger de trismus ?
– Non, répondit-il, la lésion des nerfs périphériques n’est pas suffisante pour entraîner le tétanos traumatique.
Je me tus. On apporta la potion du Dr Rowell et j’en administrai une dose au blessé. Le médecin et le chirurgien se retirèrent alors, tandis qu’Arnold mettait de l’ordre dans ses affaires. Quand ce fut fini, il me demanda :
– Qu’est-ce que ce fou de Français va me faire ?
– Je n’en ai pas la moindre idée ; sois patient.
Au bout d’une heure, ils revenaient accompagnés d’un grand jeune homme qui portait dans un tablier tout un attirail d’instruments et qui, évidemment peu habitué à de pareilles scènes, devint atrocement pâle. Les yeux fixes, la bouche grande ouverte, il battit en retraite vers la porte, balbutiant :
– Je… je ne pourrai jamais.
– Allons donc ! Hippolyte ! Vous n’êtes pas un enfant. Voyons, mon ami, c’est un cas de vie ou de mort.
– Mais… voyez ses yeux ! Il est mourant.
Arnold sourit.
– Je ne suis pas mort, en tout cas ! murmura-t-il.
Le Dr Entrefort fit boire à l’impressionnable jeune homme un verre de cognac et dit :
– Allons, plus d’enfantillage, mon ami… il faut que ça se fasse. Messieurs, permettez-moi de vous présenter M. Hippolyte, l’un des praticiens les plus originaux, les plus ingénieux et les plus adroits du pays.
Hippolyte, étant modeste, s’inclina en rougissant. Afin de dissimuler sa confusion, il déroula son tablier avec un grand cliquetis d’instruments.
– J’ai à prendre quelques dispositions avant que vous commenciez, Hippolyte, et je désire que vous m’observiez pour vous habituer non seulement à la vue du sang, mais aussi, ce qui est plus pénible, à son odeur.
Hippolyte frissonna. Entrefort ouvrit un étui d’instruments de chirurgie.
– Maintenant, docteur, le chloroforme, dit-il en s’adressant au Dr Rowell.
– Je n’en veux pas, interrompit vivement le blessé : je veux me voir mourir.
– Fort bien, dit Entrefort, mais vous n’avez guère d’énergie à perdre. Nous pouvons cependant essayer sans chloroforme. Cela vaudra même mieux. Faites en sorte de rester immobile tandis que je coupe.
– Qu’allez-vous faire ? demanda Arnold.
– Vous sauver la vie, si possible.
– Comment ? Dites-moi tout.
– Faut-il que vous le sachiez ?
– Oui.
– Très bien alors. La pointe du stylet a entièrement traversé l’aorte, grand vaisseau partant du cœur et portant aux artères le sang oxygéné. Si je retirais l’arme, le sang jaillirait par les deux perforations de l’aorte et vous seriez mort en quelques instants. Si l’arme avait été un couteau, les tissus entamés auraient cédé et le sang se serait frayé une route de chaque côté de la lame : d’où, la mort. En l’état actuel, pas une goutte de sang n’a passé de l’aorte dans la cavité thoracique. Tout ce qu’il nous reste à faire, c’est maintenant de permettre au stylet de séjourner définitivement dans l’aorte. Plusieurs difficultés se présentent à la fois, et je ne suis pas étonné du regard de surprise et d’incrédulité du Dr Rowell.
Son confrère sourit et hocha la tête.
– C’est un risque terrible, continua Entrefort, et un cas nouveau en chirurgie ; mais là est notre seul espoir. Le point important c’est que l’arme soit un stylet, arme bête, bien heureusement pour nous à cette heure. Si l’assassin avait eu plus d’expérience, elle eût employé…
À cet emploi du mot « assassin » et du mot « elle », Arnold et moi, nous fîmes un brusque mouvement et je lui criai de s’arrêter.
– Laisse-le poursuivre, dit Arnold qui, par un remarquable effort, s’était calmé.
– Je m’arrête, si le sujet vous est pénible, dit Entrefort.
– Il ne l’est pas, déclara Arnold. D’où vient pourtant que vous pensiez que le coup ait été porté par une femme ?
– D’abord, parce qu’un homme capable d’un meurtre ne se servirait pas d’une arme aussi riche et de pareille valeur ; ensuite, il n’est pas d’homme assez imbécile pour employer un instrument aussi suranné et insuffisant qu’un stylet, quand on peut si aisément se procurer la plus meurtrière et la plus satisfaisante de toutes les armes de pénétration, le couteau catalan. C’était aussi une femme vigoureuse, car il faut une main solide pour plonger un stylet jusqu’à la garde, même en manquant le sternum de l’épaisseur d’un cheveu et en glissant entre les côtes, car ici les muscles sont durs et l’espace intercostal étroit. C’était non seulement une femme vigoureuse, mais encore une femme furieuse.
– Ça suffit, interrompit Arnold.
Il me fit signe de me pencher vers lui.
– Il te faudra surveiller cet homme : il est trop intelligent, il est dangereux.
– Maintenant, reprit Entrefort, je vous dirai donc ce que je veux faire. Il y aura sans nul doute inflammation de l’aorte. Si cette inflammation persistait, elle entraînerait un anévrisme fatal par la rupture des parois aortiques. Mais, avec l’aide de votre jeunesse et de votre santé, nous espérons l’entraver… Il est une seconde difficulté sérieuse : à chaque inhalation, le thorax entier (ou charpente osseuse de la poitrine) se dilate considérablement ; l’aorte, elle, reste stationnaire. Vous comprendrez donc que, l’aorte et la poitrine étant désormais maintenues en relation étroite par le stylet, la poitrine, à chaque inhalation, déplace l’aorte d’un demi-pouce environ. Je suis certain du fait, parce qu’il n’y a aucune indication d’un épanchement de sang artériel dans la cavité thoracique ; en d’autres termes, les lèvres des deux blessures aortiques se sont refermées sur la lame et l’empêchent ainsi d’entrer ou de sortir. C’est une très heureuse circonstance, mais elle sera longtemps une cause de souffrance. Ainsi l’aorte, n’est-ce pas, obligée, par le stylet, de suivre le mouvement respiratoire, fait tour à tour avancer et reculer le cœur chaque fois que vous respirez, mais cet organe, bien qu’indubitablement fort surpris à l’heure présente, s’habituera à cette exigence nouvelle… Ce que je redoute le plus toutefois, c’est, autour de la lame, la formation d’un caillot. Déjà, n’est-ce pas, la présence de la lame dans l’aorte a considérablement diminué la capacité de circulation du sang dans ce conduit : il n’est donc pas besoin d’un bien gros caillot pour obstruer l’aorte, et, si l’aorte s’obstruait, ce serait la mort. Mais le caillot s’il s’en forme un, peut encore être détaché et entraîné, et, dans ce cas, pourrait aller se loger dans quelqu’une des nombreuses ramifications de l’aorte, produisant un résultat plus ou moins sérieux, à la rigueur même fatal. Si, par exemple, il obstruait la carotide droite ou gauche, il s’ensuivrait l’atrophie d’un côté du cerveau et nécessairement la paralysie d’une moitié du corps ; mais il serait encore possible que de l’autre côté du cerveau, une circulation secondaire vînt à s’établir et ramenât un état normal. Or le caillot (qui, en passant d’artères plus grandes dans d’autres plus petites, doit inévitablement en rencontrer une de capacité insuffisante pour le porter et finir par se loger quelque part) peut, ou conséquence ou bien entraîner l’amputation d’un membre, ou se loger si profondément dans le corps qu’il devienne impossible au chirurgien de l’aller chercher. Vous commencez à vous rendre compte de quelques-uns des dangers qui vous menacent.
Arnold sourit faiblement.
– Mais nous ferons de notre mieux pour empêcher la formation d’un caillot, continua Entrefort ; il est des médicaments dont on peut se servir dans ce but.
– Est-il d’autres dangers ?
– Beaucoup d’autres ; je n’ai point parlé de quelques-uns des plus sérieux. L’un d’entre eux serait que les tissus relâchent leur prise sur la lame et la laissent glisser. Le sang jaillirait, entraînant la mort. Actuellement, j’ignore si la lame est maintenue par la pression des tissus ou les qualités d’adhérence du sérum dégagé par la piqûre. Je reste néanmoins convaincu que, dans l’un et l’autre cas, cette pression peut, à un moment donné, cesser, car elle peut subir diverses influences. Chaque fois que le cœur se contracte et refoule le sang dans l’aorte, celle-ci se dilate un peu, pour se contracter à nouveau dès que s’arrête la poussée. Tout exercice inhabituel, toute excitation inaccoutumée précipite les battements du cœur et peut, par une tension, détruire l’adhésion de l’aorte sur l’arme. Une peur, une chute, un bond ou bien un coup sur la poitrine peut faire vibrer le cœur assez pour que l’aorte lâche prise.
Entrefort s’arrêta.
– Est-ce tout ? demanda Arnold.
– Non ; mais n’est-ce pas suffisant ?
– Plus que suffisant, dit Arnold dont les yeux s’éclairèrent soudain d’une lueur dangereuse, et, ce disant, le malheureux saisissait à deux mains le stylet pour l’arracher et mourir. Je n’avais pas eu le temps de mouvoir un muscle que déjà Entrefort, avec une agilité et une rapidité incroyables, s’était élancé et lui maintenait les poignets. Lentement Arnold desserra les doigts.
– Voyons, dit Entrefort doucement, c’était là un manque d’attention qui eût pu rompre l’adhésion ! Il faut être plus circonspect.
Arnold le regarda, et sur son visage passèrent les expressions les plus différentes.
– Docteur Entrefort, fit-il enfin tranquillement, vous êtes le diable en personne.
Entrefort répliqua :
– Vous me faites trop d’honneur.
Puis se penchant vers le blessé, il murmura :
– Si vous recommencez ça, et des yeux il indiquait le manche du stylet, je la fais arrêter pour assassinat.
Arnold tressaillit et suffoqua, et une expression de terreur envahit sa physionomie. Il rejeta ses bras sur l’oreiller au-dessus de sa tête, me serra fortement la main, et, d’un ton ferme, il dit à Entrefort :
– Mettez-vous à l’ouvrage, Monsieur.
– Approchez-vous, dit Entrefort, et suivez-moi bien. Voulez-vous avoir l’obligeance de m’aider, docteur Rowell ?
Ce dernier, étonné, s’était assis silencieux.
Entrefort avait la main vive et sûre, et maniait le couteau avec une merveilleuse dextérité. Il fit d’abord dans la peau quatre incisions à égale distance l’une de l’autre, partant de la garde. Arnold, à la première entaille, retint son souffle et serra les dents, mais il eut vite reconquis son empire sur lui-même. Chaque incision avait environ deux pouces de long. Hippolyte frissonna et détourna la tête. Entrefort, à qui rien n’échappait, s’écria :
– Attention, Hippolyte ! Regardez bien !
Rapidement, la peau fut rabattue à la limite des incisions.
Ce devait être atrocement douloureux. Arnold gémit : ses mains étaient moites et glacées.
Le couteau plongea dans la chair dont la peau avait été relevée, et le sang coula abondamment. Le Dr Rowell maniait l’éponge. Le couteau effilé travaillait avec célérité. La merveilleuse énergie d’Arnold l’abandonnait. L’étreinte de sa main se faisait farouche ; le regard était noyé et la tête s’affaissait.
En un instant la chair avait été coupée jusqu’aux os ; on voyait maintenant mis à jour deux côtes et le sternum. Quelques rapides sections de plus et l’arme était dégagée entre la garde et les côtes.
– À l’œuvre, Hippolyte… faites vite !
De ses longs doigts minces, qui tout d’abord avaient tremblé, le praticien, avec une rare précision, choisit certains instruments, prit rapidement les mesures de l’arme et de l’espace dégagé à l’entour, puis se mit à ajuster les diverses parties d’une bizarre petite mécanique.
Arnold le suivait curieusement des yeux.
– Qu’allez…, commença-t-il à dire.
Il s’arrêta : une pâleur plus grande lui envahit le visage ; ses doigts crispés se détendirent et ses paupières lourdement se fermèrent.
– Le ciel soit loué ! s’écria Entrefort. Le voilà évanoui… il ne pourra plus nous arrêter. Vite, Hippolyte !
Le praticien fixa la petite mécanique à la poignée de l’arme, saisit le stylet de la main gauche et, de la droite, commença une série de mouvements brusques et rapides, d’avant en arrière.
– Pressons, Hippolyte ! insistait Entrefort.
– Le métal est fort dur.
– L’entamez-vous ?
– Le sang m’empêche de voir.
Au bout d’un instant un bruit sec se fit entendre. Hippolyte tressaillit ; il était nerveux. Il enleva la petite mécanique.
– Le métal est très dur, dit-t-il, et casse les scies.
Le temps d’ajuster une nouvelle minuscule scie, et il reprenait son travail. Au bout de quelque temps, il enlevait la poignée du stylet et le posait sur la table. Il l’avait sciée, laissant la lame dans le corps d’Arnold.
– Bien, Hippolyte ! dit Entrefort.
Il ne lui fallut que quelques instants pour dérober aux regards l’acier brillant de la lame en ramenant les lambeaux de peau et en les cousant fortement.
Arnold revint à lui et regarda sa poitrine. Il parut embarrassé.
– Où est l’arme ? demanda-t-il.
– En voici une partie, répliqua Entrefort, prenant la poignée.
– Et la lame…
– Elle fait désormais inéluctablement partie de votre mécanisme intérieur.
Arnold garda le silence.
– J’ai dû la couper, poursuivit Entrefort, non seulement parce que c’eût été un ornement gênant et peu souhaitable, mais encore, parce qu’il m’a paru judicieux de rendre impossible tout effort pour la retirer.
Arnold ne dit rien.
– Voici une ordonnance, dit Entrefort ; vous prendrez le médicament comme il est prescrit, pendant les cinq prochaines années sans y manquer.
– Pourquoi ? Je vois qu’il contient de l’acide chlorhydrique.
– Si c’est nécessaire, je vous l’expliquerai dans cinq ans.
– Si je suis encore de ce monde.
– Si vous êtes encore de ce monde.
Arnold m’attira vers lui et me chuchota à l’oreille :
– Dites-lui de fuir immédiatement. Cet homme serait capable de lui susciter des ennuis.
Je crus reconnaître une figure mince, pâle et vive parmi les passagers que venait de débarquer à San Francisco un vapeur australien.
– Le docteur Entrefort ! m’écriai-je.
Il me regardait curieusement, tout en me serrant la main.
– Ah ! je vous reconnais maintenant, mais vous avez changé. Vous vous souvenez que je fus obligé de partir aussitôt après avoir tenté cette folle opération sur votre ami : j’ai passé ces quatre années aux Indes, en Chine, au Tibet, en Sibérie, dans les mers du Sud et Dieu sait où. N’était-ce pas une tentative absurde et insensée que cette opération ? Cependant c’était la seule chose à tenter. J’ai abandonné toutes ces folies depuis longtemps. Mieux vaut, pour plus d’une raison, les laisser mourir tout de suite. Pauvre garçon ! Il la supporta crânement ! A-t-il beaucoup souffert par la suite ? Combien de temps a-t-il survécu ? Une semaine… un mois peut-être ?
– Il vit toujours.
– Comment ! s’écria Entrefort, abasourdi.
– Il vit vraiment et même se trouve ici, à San Francisco.
– C’est inouï !
– Vous le constaterez vous-même.
– Sans doute, mais parlez-moi de lui dès maintenant, insista le chirurgien, ses yeux ardents éclairés de cette flamme particulière que j’avais remarquée déjà au cours de l’opération. A-t-il régulièrement pris le médicament que je lui avais prescrit ?
– Régulièrement. À vrai dire, il a lamentablement changé depuis l’opération. Ce garçon de vingt-deux ans, véritable risque-tout, qui n’avait pas plus peur d’un danger ou de la mort que d’un méchant rhume, est aujourd’hui un timide et un trembleur ; il a l’air d’un vieillard ; il se dorlote avec un soin jaloux, redoute à tout instant que quelque chose survienne qui détache les parois de l’aorte de la lame du stylet. C’est un hypocondriaque invétéré ; il est maussade, triste, malheureux à l’extrême. Il s’isole, évite toute émotion, tout exercice ; même il ne lit jamais rien d’émouvant. Ce danger permanent a fait de lui une pitoyable épave. Ne peut-on rien pour lui ?
– Peut-être. Mais n’a-t-il consulté aucun médecin ?
– Aucun. Il a toujours peur d’entendre prononcer son arrêt.
– Allons le voir. Ah ! voici ma femme qui vient à ma rencontre. Elle est venue par le paquebot précédent.
Je la reconnus et restai stupéfait.
– C’est une femme charmante, dit Entrefort. Elle vous plaira beaucoup. Je l’ai épousée, il y a trois ans, à Bombay. Elle appartient à une vieille famille italienne et elle a beaucoup voyagé.
Il nous présenta.
À mon inexprimable soulagement, elle ne se rappela ni mon nom ni mes traits. Je dus lui paraître étrange, car il me fut impossible de me montrer tout à fait indifférent.
Nous nous rendîmes chez Arnold. Je n’étais pas, je l’avoue, sans inquiétude. Je la laissai au salon et j’introduisis Entrefort auprès de mon ami. Arnold était trop préoccupé par ses propres inquiétudes pour être très ému par cette rencontre avec Entrefort, qu’il accueillit avec quelque indifférence.
– Mais j’ai entendu une voix de femme, dit-il, elle rappelle…
Il se tut ; mais, avant que j’eusse pu l’en empêcher, il avait gagné le salon.
Là, il se trouva face à face avec la belle aventurière, aujourd’hui femme d’Entrefort, qui, dans un accès de démente colère, l’avait quatre ans auparavant, frappé d’un coup de stylet, parce qu’il refusait de l’épouser.
Ils se reconnurent à l’instant et tous deux pâlirent ; mais elle, d’intelligence plus vive, se remit plus vite et s’avança vers lui, la main tendue, un sourire sur les lèvres. Lui, fit un pas en arrière, le visage blême.
– Oh ! murmura-t-il, l’émotion, la secousse… cela a fait sortir la lame ! le sang coule par l’ouverture… il me brûle… je me meurs !
Il tomba dans mes bras et expira.
L’autopsie révéla ce fait surprenant qu’il n’y avait nulle trace de lame dans le thorax ; la lame avait été graduellement rongée par l’acide chlorhydrique qu’Entrefort lui avait prescrit dans ce but, et les perforations de l’aorte, qui s’étaient graduellement refermées au fur et à mesure qu’était rongée la lame, étaient depuis longtemps cicatrisées. Tous l’organisme vital était parfaitement sain.
Mon pauvre ami autrefois si hardi et si courageux, était tout bêtement mort d’une crainte vaine et enfantine, et cette femme venait inconsciemment de consommer sa vengeance.
LE PRISONNIER
I
Après que les administrateurs de la prison, siégeant en comité à la prison même, eurent entendu et expédié les réclamations et pétitions d’un certain nombre de condamnés, le directeur déclara qu’on avait entendu tous ceux qui en avaient fait la demande. Ici, une expression de gêne et de malaise qui, pendant la séance, avait assombri la physionomie des administrateurs, s’accentua visiblement. Le président, homme nerveux, énergique, brusque, tranchant, jeta un coup d’œil sur un morceau de papier qu’il tenait à la main et dit au directeur :
– Envoyez un gardien chercher le condamné n° 14.208.
Le directeur tressaillit et pâlit légèrement.
Puis, évidemment interloqué, il balbutia :
– Mais il n’a exprimé aucun désir de comparaître devant vous.
– Néanmoins vous l’enverrez chercher tout de suite, répliqua le président.
Le directeur s’inclina d’un air contraint et ordonna à un gardien d’amener le condamné. Puis, se tournant vers le président, il lui dit :
– J’ignore quel est votre dessein en faisant venir cet homme, et je n’ai naturellement pas d’objection à faire ; je désire cependant, avant qu’il soit ici, formuler une déclaration à son endroit.
– Quand nous vous demanderons une déclaration, rétorqua le président d’un ton glacial, vous la ferez.
Le directeur se laissa retomber sur son fauteuil.
C’était un homme de haute taille, aux traits fins, bien élevé et intelligent, à la physionomie bienveillante. Bien qu’il fût, à l’ordinaire, froid, courageux et maître de lui, il était incapable de maîtriser une certaine émotion qui ressemblait fort à la crainte.
Dans la salle pesait un silence lourd que troublait seul le sténographe officiel, taillant ses crayons.
Les rayons du soleil couchant se glissèrent entre le bord du store et le châssis de la fenêtre, et leur mince lame verticale vint éclairer le siège réservé au condamné. Les regards inquiets du directeur tombèrent finalement sur cette lame de lumière et y restèrent fixés.
Sans s’adresser à qui que ce fût personnellement, le président remarqua :
– Il est des manières d’apprendre ce qui se passe dans une prison sans le secours ni du directeur ni des condamnés.
À ce moment le gardien apparut suivi du condamné.
Celui-ci entra : il marchait avec difficulté, d’un pas traînant ; à l’aide d’un bout de corde, il soulevait du plancher le pesant boulet qu’à ses chevilles rivait une chaîne. Il avait environ quarante-cinq ans. Sans aucun doute, l’homme avait été d’une force physique peu commune ; sa peau blême se tendait sur une ossature puissante. Sa pâleur était particulière et hideuse. Elle était causée en partie par la maladie, en partie par quelque chose de pire ; et ce quelque chose expliquait aussi l’amaigrissement de ses muscles et cette faiblesse manifeste.
On n’avait pas eu le temps de le préparer pour cette comparution devant le comité.
En conséquence, ses orteils nus pointaient par ses chaussures trouées ; le costume de prisonnier qui couvrait son grand corps décharné n’était plus qu’un assemblage de loques malpropres ; on avait depuis longtemps oublié de couper, selon la règle, ses cheveux qui se rebellaient sur sa tête, et sa barbe, comme ses cheveux, toute grisonnante, depuis des semaines n’avait point été taillée. Ces particularités et l’expression de sa physionomie lui conféraient un extraordinaire aspect. Il est difficile de donner de cette expression qui n’avait presque rien d’humain, une idée exacte.
À une certaine férocité contenue s’alliait une inflexibilité de volonté qui le couvrait comme d’un masque. Ses yeux étaient affamés et avides ; ils étaient la seule partie de son être qui parût vivre, et, sous la broussaille des sourcils, ils luisaient. Le front était massif, la tête bien proportionnée, la mâchoire carrée et forte ; le nez long et mince témoignait d’une race ayant dû laisser son empreinte en quelque coin du monde à une période quelconque de l’histoire. Il était prématurément vieux, cela se voyait à ses cheveux gris et aux rides singulièrement profondes qui lacéraient son front et se creusaient au coin des yeux et de la bouche.
Après s’être traîné péniblement dans la salle, il regarda autour de lui, l’œil ardent, comme l’ours que la meute a mis à terre. Son regard circula si rapide et si vide d’une figure à l’autre qu’il n’avait encore pu avoir le temps de se former une idée des personnes présentes, quand ses yeux rencontrèrent le visage du directeur. Ses yeux aussitôt flamboyèrent ; il allongea le cou ; ses lèvres s’ouvrirent, bleuirent ; les rides se firent plus profondes autour des yeux et de la bouche, son corps se raidit ; sa respiration s’arrêta. Cette attitude, sinistre d’autant plus qu’il en était inconscient, il la garda jusqu’à ce que le président d’une voix tranchante eût commandé :
– Prenez ce siège.
Le condamné tressaillit comme si on l’eût frappé et regarda le président. Il respira et sa poitrine eut un sifflement rauque. Une expression d’atroce douleur passa sur son visage. Il laissa retomber le boulet qui résonna sur le plancher et ses longs doigts osseux, crispés, étreignirent sur sa poitrine les lambeaux de sa chemise rayée.
Cela ne dura qu’un instant, puis, à bout de forces, il se laissa tomber sur le siège, où il resta assis, conscient, mais veule, désorganisé, indifférent.
Le président se tourna vers le gardien :
– Pourquoi avez-vous enchaîné cet homme, demanda-t-il, alors qu’il se trouve en un tel état de faiblesse et qu’aucun des autres n’est enchaîné ?
– Mais, monsieur, balbutia le gardien, vous connaissez sûrement l’homme ; c’est le plus dangereux et le plus résolu…
– Nous savons tout cela. Enlevez-lui ses fers.
Le gardien obéit.
Le président se tourna vers le condamné et d’une voix bienveillante dit :
– Savez-vous qui nous sommes ?
Il y eut une pause.
Le condamné rassemblait ses esprits et regardait fixement le président.
– Non, répondit-il enfin, d’une voix creuse et rauque.
– Nous sommes les administrateurs des prisons. Nous avons entendu parler de votre cas et désirons que vous nous disiez à ce propos toute la vérité.
L’intelligence du condamné travaillait lentement et quelques instants s’écoulèrent avant qu’il eût compris. Alors, très lentement aussi, il dit :
– Vous voulez, je suppose, que je vous adresse une réclamation.
– Oui, si vous en avez une à faire.
Le condamné rassemblait toute son énergie. Il se redressa et regarda le président avec une fixité singulière, puis fermement et clairement il répondit :
– Je n’ai pas de réclamation à faire.
Les deux hommes, assis l’un en face de l’autre, se considéraient en silence et, lentement, un pont d’humaine sympathie se tendait entre eux.
Le président se leva, fit le tour de la table qui les séparait, s’approcha du condamné et posa une main sur son épaule décharnée, tandis que dans sa voix passait un accent de tendresse que peu de gens y avaient jamais trouvé.
– Je sais, dit-il, que vous êtes patient et ne vous plaignez jamais, sans quoi depuis longtemps déjà nous aurions entendu parler de vous. En vous demandant de faire une réclamation, je vous demande simplement de m’aider à redresser un tort, s’il y a eu tort. Laissez votre propre volonté entièrement de côté, si vous voulez bien. Supposez, à votre gré, que ce n’est ni notre intention ni notre désir de vous apporter un adoucissement ou de rendre plus dure votre situation. Il y a quinze cents êtres humains dans cette prison qui, tous, sont sous le contrôle absolu d’un seul homme. Si l’un d’entre eux subit un tort sérieux, d’autres le peuvent subir également. Je vous demande, au nom de l’humanité simplement, et d’un homme à un autre, de nous mettre en mesure de rendre la justice en cette prison. Si vous avez en vous les instincts de l’homme, vous vous rendrez à ma demande. Parlez donc, comme un homme, et ne craignez rien.
Le condamné fut ému et piqué. Levant avec fermeté les yeux vers le président, il dit fortement :
– Il n’y a rien en ce monde que je craigne.
Puis il baissa la tête, et, la relevant aussitôt, il ajouta :
– Je vais tout vous dire.
Il modifia sa position, et maintenant la lame verticale de soleil passait sur sa figure et sur sa poitrine, de telle sorte qu’il paraissait être coupé en deux. Il semblait se régaler les yeux à ce jeu de lumière. Quelques instants après, parlant avec lenteur et d’une voix étrangement monotone, il conta :
– J’ai été condamné à vingt ans de prison pour avoir tué un homme. Je n’étais pas un criminel ; je l’avais tué sans réfléchir, parce qu’il m’avait volé et m’avait nui. Voici treize ans que je suis ici. Au début, j’eus de la peine, cela m’irritait d’être forçat ; mais je surmontai cela, parce que le directeur me comprit et se montra bon pour moi ; il fit de moi l’un des hommes les meilleurs de la prison. Je ne dis pas ceci pour vous laisser penser que je me plains du directeur actuel, ou qu’il ne m’ait pas bien traité : je sais me conduire avec lui. Je ne fais pas de réclamation. Je ne sollicite la faveur de personne et ne crains la puissance d’aucun.
– C’est très bien. Continuez.
– Quand le directeur eut fait de moi un brave homme, je me mis fidèlement au travail, monsieur ; je faisais tout ce qu’on me disait de faire ; je travaillais volontiers et comme un esclave. Cela me faisait du bien de travailler, et je travaillais dur. Jamais je n’ai manqué à un seul des règlements. Puis fut votée la loi qui dit que des attestations pourront être accordées aux hommes pour leur bonne conduite. J’étais condamné à vingt ans, mais me conduisais si bien que mes attestations augmentaient et, au bout de dix ans, je commençais à escompter ma libération. Je n’avais plus que trois ans à faire, et, monsieur, je travaillais fidèlement pour que ces trois années fussent bonnes. Je savais qu’au moindre manquement aux règlements je perdrais mes attestations, et qu’il me faudrait encore faire près de dix ans. Je savais tout cela, monsieur : je ne l’oubliais jamais. Je voulais être libre de nouveau, me promettant de m’en aller quelque part et de recommencer la lutte, – pour être en ce monde un homme encore une fois.
– Nous savons tout ce que renferme votre dossier à la prison. Continuez.
– Eh bien, cela arriva ainsi. Vous savez qu’on avait entrepris de gros travaux dans les carrières et sur les rampes, et l’on avait besoin des hommes les plus vigoureux de la prison. Il n’y en avait pas beaucoup : il n’y a jamais beaucoup d’hommes vigoureux dans les prisons. Je fus l’un de ceux que l’on mit à ces travaux pénibles et je m’acquittai fidèlement de la tâche. On avait coutume de payer les hommes pour le travail supplémentaire, – on ne les payait pas en argent, mais on leur en donnait la valeur en bougies, en tabac, en vêtements supplémentaires et autres choses du même ordre. J’aimais travailler et j’aimais les travaux supplémentaires, et j’en fis pour les autres. Tous les samedis, les hommes qui avaient fait de ces travaux étaient conduits en rang chez le gardien-chef, qui remettait à chacun de nous ce qui lui revenait. Les noms étaient inscrits sur un registre : à l’appel de son nom, chacun sortait du rang, et le gardien-chef remettait à chacun ce qu’il demandait, qui fût d’accord avec le règlement.
« Un samedi, je m’étais mis en rang avec les autres. Dans les rangs, il y en avait beaucoup devant moi. Mais j’allais oublier de vous dire que quand on avait reçu ce qu’on demandait, on allait se ranger plus loin pour être ramené en cellule. Or, quand vint mon tour, je m’approchai du gardien-chef et lui demandai la valeur de mon dû en tabac. Il me regarda d’un œil perçant et me dit : « Comment êtes-vous revenu là ? » Je lui dis que c’était mon tour et que je venais réclamer mon supplément. Il regarda son registre et me dit : « Vous l’avez eu ; je vous ai donné du tabac. » Et il m’ordonna de rejoindre les rangs de ceux qui étaient déjà payés. Je lui dis que je n’avais point reçu de tabac et n’avais pas encore été appelé. Il me dit : « N’allez pas gâter votre dossier en essayant de voler un peu de tabac. Rompez… » Cela me blessa au vif, monsieur. Je n’avais pas été appelé ; je n’avais pas reçu mon supplément ; et je n’étais pas un voleur, je n’avais jamais volé et nul au monde n’avait le droit de me traiter de voleur. Je lui dis carrément : « Je ne partirai pas avant d’avoir mon dû, et je ne suis pas un voleur, nul ne peut m’appeler ainsi et nul n’a le droit de me voler ce qui m’est dû. » Il pâlit et dit : « Rompez, là. » Je répondis : « Je n’en ferai rien tant qu’on ne m’aura pas donné mon dû. »
« Là-dessus, il leva la main : c’était un signal. Les deux sentinelles postées derrière lui me mirent en joue, et la sentinelle du mur ouest et la sentinelle du mur est, et la sentinelle de la poterne de l’arsenal me mirent en joue. Le gardien-chef se tourna vers un de ses subordonnés et lui ordonna d’avertir le directeur. Le directeur arriva et le chef lui rapporta que j’avais indûment cherché à toucher mon supplément en double et que je m’étais montré insolent et insubordonné en refusant de regagner les rangs. Le directeur me dit : « En voilà assez, rompez. » Je refusai. Je déclarai que je n’avais nullement cherché à toucher quoi que ce fût en double, que je n’avais pas eu mon supplément et que je resterais là jusqu’à la mort plutôt que de me laisser voler. Il demanda au chef s’il n’y avait point erreur ; celui-ci consulta son registre et certifia qu’il n’y avait pas erreur. Il se rappelait, prétendit-il, m’avoir vu prendre mon tabac et gagner les rangs, mais ne m’avait pas vu retourner à mon ancienne place. Le directeur ne demanda pas aux autres s’ils m’avaient vu prendre le tabac et me glisser de nouveau parmi ceux qui attendaient leur tour. Il m’ordonna tout simplement de reprendre mon rang. Je dis que je mourrais plutôt. Je dis que je réclamais mon dû et rien de plus, et lui demandai d’en appeler aux autres. »
« Il répéta : « En voilà assez. » Il fit reconduire les autres en cellule et me laissa campé là. Puis il ordonna à deux gardiens de me reconduire à mon tour. Ils s’approchèrent pour s’emparer de moi et je me débarrassai d’eux comme s’ils eussent été des enfants. D’autres survinrent et l’un m’asséna un coup de bâton sur la tête ; je tombai. Et alors, monsieur – ici, la voix du condamné se changea presque en un murmure – et alors il leur dit de me mener au cachot. »
L’éclat dur, continu qui brillait dans les yeux du condamné s’éteignit ; il baissa la tête et son regard se fixa désespérément sur le plancher.
– Continuez, dit le président.
– Ils me menèrent au cachot, monsieur. Avez-vous jamais vu le cachot ?
– Peut-être ; mais vous pouvez nous en parler.
L’éclat froid et persistant se ralluma dans les yeux du condamné, comme il les reportait sur le président.
– Il y a plusieurs petits réduits dans le cachot. Celui dans lequel ils me placèrent avait environ cinq pieds sur huit. Murailles et plafond étaient de fer, le sol de granit. La seule lumière qui y pénétrât, passait à travers une fente dans la porte. La fente a un pouce de large sur cinq pouces de long. Elle ne donne pas beaucoup de lumière parce que la porte est épaisse. Elle a quatre pouces environ d’épaisseur, et est faite de chêne et de plaques de tôle, rivées. La fente a cette direction-ci – il dessina dans l’air une ligne horizontale, – et elle est à quatre pouces au-dessus de mes yeux quand je me dresse sur la pointe des pieds. Je ne puis voir le mur de l’usine en face à quarante pieds de là à moins de m’accrocher par les doigts à la fente et de me hisser.
Il s’arrêta et regarda ses mains dont l’aspect singulier nous avait tous frappés. Le bout des doigts était extraordinairement épais ; ils étaient curieusement labourés par de larges cicatrices blanches.
– Eh bien, monsieur, il n’y avait rien du tout dans le cachot, mais on me donna une couverture et on me mit à l’eau et au pain sec. C’est tout ce qu’on vous donne au cachot. On vous apporte le pain et l’eau une fois par jour, et cela à la nuit, parce que, en venant dans la journée, on laisserait pénétrer la lumière du jour.
« Le lendemain soir du jour où l’on m’avait enfermé – c’était un dimanche soir, – le directeur accompagna le gardien et me demanda comment j’allais. Je lui dis que j’allais bien. Il me dit : « Voulez-vous vous bien conduire et retourner travailler demain ? » Je répondis : « Non, monsieur, je ne retournerai pas travailler avant d’avoir eu mon dû. » Il haussa les épaules et me dit : « Fort bien ; peut-être changerez-vous d’idée après avoir passé ici la semaine. »
« Ils me tinrent là une semaine.
« Le dimanche soir suivant, le directeur revint et me dit : « Êtes-vous disposé à reprendre le travail demain ? » Et je dis : « Non, je ne retournerai pas à mon travail avant d’avoir eu mon dû. » Il me dit des injures. Je lui dis que c’était le devoir d’un homme d’exiger ses droits et qu’un homme qui se laisserait traiter comme un chien n’était pas un homme.
Le président l’interrompit.
– Ne vous êtes-vous pas dit, demanda-t-il, que ces employés n’avaient pu s’abaisser à vous voler ; que c’était en somme par erreur qu’ils vous retenaient votre tabac et, qu’en tout cas, vous aviez le choix entre deux maux, perdre un paquet de tabac d’une part et sept années de liberté de l’autre ?
– Mais ils m’avaient irrité et blessé, monsieur, en me traitant de voleur, et ils m’avaient jeté au cachot comme une bête… Je défendais mes droits, et mes droits, c’était ma dignité d’homme ; c’est la seule chose qu’un homme puisse emporter intacte au tombeau, qu’il soit prisonnier ou libre, faible ou puissant, riche ou pauvre.
– Eh bien, après votre refus de retourner à votre travail, que fit le Directeur ?
Le condamné, bien qu’une terrible agitation dût bouillonner et faire rage en lui, lentement, délibérément et avec effort se leva. Il plaça son pied droit sur la chaise et posa son coude droit sur son genou. L’index de la main droite, tourné vers le président et qu’il remuait légèrement pour donner plus de force à son récit, troublait seul la rigide immobilité de tout son être.
Sans changement aucun dans le son de sa voix, sans jamais se presser, mais avec la lente et morne monotonie du début, il poursuivit :
– Quand je lui eus déclaré cela, monsieur, il me dit qu’il me mettrait à l’échelle et verrait bien si je ne changerais pas d’idée… Oui, monsieur, il me dit qu’il me mettrait à l’échelle.
Ici, il fit une longue pause.
– À moi, continua-t-il, enfin, à un être humain ayant de la chair sur les os et un cœur d’homme dans le corps. L’autre directeur n’avait pas essayé de briser mon caractère sur l’échelle. Pourtant, il avait réussi à le briser. Il l’avait brisé jusqu’au fond de moi, mais y était arrivé avec une bonne parole, sans le cachot ni l’échelle. Je n’avais pas cru le directeur quand il m’avait dit qu’il me mettrait à l’échelle. Je ne pouvais m’imaginer être vivant et être mis à l’échelle, et je ne pouvais m’imaginer qu’un être humain pût avoir le cœur de m’y mettre. Si je l’avais cru, je l’aurais étranglé sur place et me serais laissé cribler le corps de balles. Non, monsieur, je ne pouvais pas le croire.
« Il me dit de sortir. Je le suivis, escorté par les gardiens. Il me conduisit à l’échelle. Je ne l’avais encore jamais vue. C’était une pesante échelle de bois, accotée à un mur, le pied rivé au sol et le haut à la muraille. Sur le sol, il y avait un fouet.
Ici encore une longue pause.
– Le directeur me dit de mettre bas mes vêtements, et je me déshabillai… Et je ne pouvais toujours pas m’imaginer qu’il me fouetterait. Je pensais qu’il voulait m’épouvanter.
« Il me dit de faire face à l’échelle. J’obéis et élevai les bras à la hauteur des liens. Ils m’attachèrent les bras à l’échelle et serrèrent si fort qu’ils m’enlevèrent du sol. Ils me lièrent ensuite les jambes à l’échelle, et le directeur alors ramassa le fouet. Il me dit : « Je vais vous donner encore une chance : Voulez-vous retourner au travail demain ? » Je dis : « Non, je n’irai pas travailler tant que je n’aurai pas mon dû. – Très bien, dit-il, vous allez avoir votre dû sur l’heure. » Et alors il se recula d’un pas et leva le fouet. Je tournai la tête et le regardai ; je lus dans ses yeux l’intention de frapper… Et quand je vis cela, je sentis que quelque chose en dedans de moi était sur le point d’éclater.
Le condamné s’arrêta à ce moment de son histoire pour rassembler ses forces ; mais il ne changea rien à sa position ; la légère agitation de l’index persista ; les yeux luisaient d’un éclat immobile ; rien n’avait troublé la lenteur monotone du débit.
J’avais été ému par nos plus grands acteurs, lorsqu’ils lâchaient la bride à leur génie en de tragiques situations, mais combien ces spectacles me semblaient pauvres et prétentieux au prix de celui-ci ! Les trémolos de l’orchestre, les lumières, les poses, les masques grimaçants, la respiration convulsive, les cris, les saccades de la démarche, le roulement des yeux, que tout cela était terne, banal et ridicule !
Le crayon du sténographe s’arrêta sur le papier.
– Et alors le fouet me cingla le dos. Ce quelque chose en moi se tordit violemment et, se frayant brusquement passage, se répandit dans tout mon être comme de l’acier en fusion. Et alors je dis au directeur ceci : « Vous m’avez frappé avec le fouet, de sang-froid. Vous m’avez lié, pieds et poings, pour me fouetter comme un chien. Eh bien fouettez tout votre saoul. Vous êtes un lâche. Vous êtes plus abject, plus vil et plus lâche que le plus vil et le plus abject des chiens glapissant au coup de soulier de son maître. Vous êtes né lâche. Les lâches mentent et volent, et vous ne valez pas plus qu’un menteur ou qu’un voleur. Un chien ne vous reconnaîtrait point pour ami. Fouettez-moi fort et longtemps, lâche que vous êtes. Fouettez-moi, dis-je. Sachez combien un lâche se sent meilleur quand il attache un homme et le fouette comme un chien. Fouettez-moi jusqu’à mon dernier souffle ; si vous me laissez vivre, je vous tuerai pour ceci. » Sa figure blêmit. Il me demanda si je pensais ce que je disais. « Oui, certes, devant Dieu, oui. » Alors il empoigna le fouet des deux mains et tapa de toutes ses forces.
– Ceci se passait il y a près de deux ans, rappela le président. Vous ne le tueriez plus maintenant, n’est-ce pas ?
– Si. Je le tuerai, si j’en trouve l’occasion, et je sens en moi que l’occasion se présentera.
– Bien. Continuez.
– Il continua de fouetter. Il me frappa de toutes ses forces, des deux mains. Je pouvais sentir la peau coupée friser sur mon dos et, quand ma tête fut trop lourde pour que je la pusse maintenir droite et que je la laissai tomber, je vis le sang ruisseler sur mes jambes et tomber de mes pieds dans une mare, sur le sol. Et toujours en moi quelque chose luttait et se tordait ; c’était ce quelque chose se tordant en moi qui me faisait mal. Je comptai les coups, et quand j’eus compté vingt-huit, ce tortillement se fit si violent qu’il m’étouffa et m’aveugla… et quand je m’éveillai, je me retrouvai dans le cachot ; le docteur m’avait couvert le dos d’un emplâtre, et, agenouillé près de moi, me tâtait le pouls.
Le prisonnier avait fini. Il jeta autour de lui un regard vague, comme s’il eût voulu s’en aller.
– Et vous êtes toujours resté au cachot depuis ? Depuis ?
– Oui, monsieur, mais cela m’est égal.
– Combien de temps ?
– Vingt-trois mois.
– Au pain sec et à l’eau ?
– Oui, mais c’était tout ce dont j’avais besoin.
– Avez-vous réfléchi que tant que vous garderiez la résolution de tuer le directeur, on pourrait vous garder au cachot ? Vous ne pouvez plus vivre bien longtemps là-dedans, et, si vous mourez là, vous ne trouverez jamais l’occasion que vous voulez. Si vous dites que vous ne tuerez pas le directeur, il pourrait vous remettre en cellule.
– Mais ce serait mentir, monsieur ; j’aurai l’occasion de le tuer, si je retourne en cellule. J’aime mieux mourir au cachot que d’être menteur et sournois. Si vous me renvoyez en cellule, je le tuerai. Mais je le tuerai sans cela. Je le tuerai, monsieur… et il le sait.
Sans dissimulation, mais ouvertement, délibérément et implacablement, dans le corps ruiné de cet homme, si proche que nous l’eussions pu toucher, se dressait le meurtre, – non pas fanfaron, mais inexorable comme la mort.
– Sauf votre état de faiblesse, votre santé est-elle bonne ? demanda le président.
– Oh ! elle est assez bonne, répondit avec lassitude le condamné. Le tortillement revient parfois, mais lorsque je me réveille après cela, ça va bien.
Le médecin de la prison appliqua son oreille à la poitrine du prisonnier, puis, dit quelques mots à l’oreille du président.
– Je le pensais bien, dit celui-ci. Maintenant, conduisez-moi cet homme à l’hôpital. Qu’on le mette dans un lit où le soleil puisse le réconforter et qu’on lui donne une bonne nourriture.
Le condamné, sans prêter attention à tout cela, sortit d’un pas traînant, suivi d’un gardien et du médecin.
II
Le directeur de la prison était assis dans son bureau, seul avec le n° 14.208.
Qu’il eût été enfin amené face à face, et seul, avec l’homme qu’il avait résolu de tuer, cela étonnait le condamné. Il n’était pas enchaîné ; la porte était fermée à clé, et la clé était posée sur la table, entre les deux hommes. Les trois semaines passées à l’hôpital lui avaient été profitables, mais il avait toujours la figure d’une pâleur mortelle.
– L’acte des administrateurs, il y a trois semaines, dit le directeur, a rendu ma démission nécessaire. J’ai attendu la nomination de mon successeur qui a maintenant pris possession de son poste. Je quitte la prison aujourd’hui. Mais, pour l’instant, j’ai quelque chose à vous dire qui vous intéressera. Il y a quelques jours, un condamné qui, son temps fini, avait l’an dernier quitté la prison, ayant lu ce que les journaux ont récemment publié à votre sujet, m’a écrit pour m’avouer que c’était lui qui avait, sous votre numéro, réclamé votre tabac au gardien-chef. Il se nomme Salter et vous ressemble beaucoup. Il avait reçu son compte et, quand il vint réclamer le vôtre, le gardien-chef, le prenant pour vous, le lui donna. Le gardien-chef n’avait pas la moindre intention de vous voler.
Le condamné respira convulsivement et se pencha avidement.
– Jusqu’au reçu de cette lettre, reprit le directeur, je m’étais montré hostile au courant qui s’était établi en faveur de votre grâce ; mais dès que cette lettre m’est parvenue, je l’ai à mon tour sollicitée, cette grâce, et elle vient de vous être accordée. De plus vous avez une grave maladie de cœur. Vous êtes donc maintenant libre.
Le regard du condamné devint fixe et il se redressa sans mot dire. Dans ses yeux passa une expression étrange et ses dents blanches étincelèrent, menaçantes entre ses lèvres écartées. Cependant, une certaine douceur triste tempérait la dureté des traits.
– L’omnibus va partir pour la gare dans quatre heures, continua le directeur. Vous avez proféré certaines menaces contre ma vie…
Le directeur s’arrêta, puis d’une voix que faisait légèrement trembler l’émotion, il poursuivit :
– Je ne laisserai pas vos intentions à ce sujet – car je ne m’en préoccupe nullement – m’empêcher de m’acquitter d’un devoir qui, d’homme à homme, m’est une dette envers vous. Je vous ai traité avec une cruauté dont je comprends maintenant l’énormité. Je croyais avoir raison. Mon erreur fatale a été de ne pas avoir compris votre nature. J’ai, dès le début, mal interprété votre conduite et, ce faisant, j’ai chargé ma conscience d’un poids qui empoisonnera le reste de mes jours. Je ferais tout ce qui est en mon pouvoir, s’il n’était pas trop tard, pour réparer le mal que je vous ai fait. Si, avant de vous mettre au cachot, j’avais pu comprendre le tort et prévoir ses conséquences, j’aurais gaiement donné ma vie plutôt que de lever la main sur vous. Nos deux existences ont été perdues, mais votre souffrance est dans le passé, la mienne est dans le présent, et ne cessera qu’avec ma vie. Car ma vie est une malédiction et je préfère ne pas la conserver.
Sur ces mots, le directeur, très pâle mais l’air décidé, tira d’un tiroir un revolver chargé et le plaça devant le condamné.
– Voilà l’occasion trouvée, dit-il tranquillement ; personne ne peut vous empêcher…
Longuement le condamné respira, puis s’éloigna de l’arme comme d’une vipère.
– Pas encore… pas encore, murmura-t-il, angoissé.
Les deux hommes étaient assis, face à face, sans un mouvement des muscles.
– Avez-vous peur d’agir ? demanda le directeur.
Un éclair rapide passa dans les yeux du condamné.
– Non ! haleta-t-il, vous savez que non. Mais je ne peux pas… pas encore… pas encore.
Le condamné, à qui une effrayante pâleur, des yeux vitreux et des dents étincelantes faisaient comme un masque de mort, se leva en trébuchant.
– Vous y êtes arrivé enfin ! Vous m’avez dompté ! Un mot humain a fait ce que n’avaient pu ni le cachot ni le fouet… Cela me tortille là-dedans maintenant… Je pourrais être pour ce mot humain votre esclave.
Des larmes coulaient de ses yeux.
– Je ne puis me tenir de pleurer. Je ne suis après tout qu’un enfant… et je croyais être un homme.
Il chancela.
Le directeur le saisit dans ses bras et l’assit sur sa chaise. Il prit la main du condamné dans la sienne et sentit une ferme et loyale étreinte. Les yeux du condamné roulaient sans regards. Un spasme douloureux lui fit porter à sa poitrine la main restée libre, ses doigts décharnés, noueux – qu’avait rendus informes leur longue suspension à la fente de la porte du cachot – étreignirent automatiquement sa chemise. Un faible sourire rida son visage pâle, découvrant mieux ses dents étincelantes.
– Ce mot humain, murmura-t-il, si vous l’aviez dit il y a longtemps… si… mais ça va… ça va bien… maintenant. Je retournerai… je retournerai au travail… demain.
La main qui tenait celle du directeur la pressa un peu plus, puis desserra complètement son étreinte. Les doigts crispés sur la chemise glissèrent et la main retomba. La tête, lasse, se renversa et s’appuya au dossier de la chaise ; le sourire se figea sur le visage de marbre, et ce furent les yeux vitreux, les dents étincelantes d’un mort qui restèrent tournés vers le plafond.
LE PERFIDE VELASCO
I
Assise près de sa croisée ouverte, à l’étage supérieur de la ferme, dans le rancho San Gregorio, la señora Violante Ovando de Mc Pherson suivait du regard, avec le plus profond intérêt, un nuage de poussière qui du fond de la vallée s’élevait dans l’air calme de mai ; et très évidemment la couleur de ses joues et l’éclat de ses yeux d’un violet sombre, parlaient un langage de l’amour et du bonheur.
Son mari, avec les vaqueros, regagnait son foyer, revenant de San Francisco où il avait conduit du bétail.
Il était parti depuis un mois ; quelle interminable absence pour une jeune épousée !
Elle avait vu se faner l’or des pavots sauvages ; elle avait suivi le travail des laborieuses ouvrières des ruches entassant leurs réserves de miel cueilli sur les myriades de fleurs qui tapissaient la vallée ; sa monture l’avait menée par les monts Gabilan visiter les milliers de têtes de bétail de son mari. Elle avait scrupuleusement observé ses devoirs de ménagère et avait dirigé Alice, sa chambrière, dans la confection de vêtements pour les prochaines chaleurs. Cependant, occupée comme elle pensait l’être et en dépit de l’importance qu’elle s’imaginait avoir dans l’administration du rancho, le temps lui avait paru se traîner, chargé d’entraves. Mais maintenant voici que s’approchait le nuage de poussière destiné à dissiper son nuage d’isolement, et si jamais cœur de jeune femme battit de plaisir, ce fut le sien.
Bientôt le vigoureux jeune Écossais s’élançait de son cheval, pressait sa femme dans ses bras, lui posait quelques questions rapides sur sa santé, détachait un petit sac en peau de daim du pommeau de sa selle et, disant : « J’ai pensé qu’il vous faudrait quelque argent de poche, Violante », il leva le sac renfermant de l’or, – renfermant cent fois plus d’or que ses goûts simples et les rares occasions ne lui permettraient d’en dépenser. Mais son Robert n’était-il pas le plus généreux des hommes ?
D’autres yeux que les siens l’avaient vu, ceux de Basilio Velasco, l’un des vaqueros, petit homme basané, aux yeux des plus noirs et des plus vifs qui, en ce moment, brillaient précisément d’un étrange éclat.
Quel joli couple que ce jeune mari et cette jeune femme, tandis que, bras dessus bras dessous, ils pénétraient dans la maison, lui si grand, si haut en couleur, si viril, elle si brune, si confiante et délicate ! Les superbes filles de l’Espagne sont nombreuses en Californie, mais Violante était connue pour la plus belle de toutes entre le détroit de Santa Barbara et la baie de Monterey. Le presbytérien écossais, fougueux et obstiné, la douce, patiente et fidèle catholique formaient le plus heureux des couples.
– Eh bien, petite Violante, dit-il, portez le sac à votre chambre, et donnez-nous à dîner ; car avant de reposer, il faut qu’avec mes hommes je parcoure le rancho et m’occupe du bétail ; après quoi vous et moi, nous aurons une bonne et longue causerie.
On eut tôt fait de s’acquitter de l’agréable tâche ; puis Violante vit les hommes, guidés par son mari, s’éloigner au galop.
De sa croisée ouverte elle les suivait des yeux, étonnée de ce sentiment pressant du devoir qui appelait loin d’elle, même pour si peu de temps, ce mari épris, après une aussi longue séparation. Et elle s’était assise, songeant à son grand bonheur de l’avoir encore une fois près d’elle, et aspirant les riches senteurs des grappes de glycines qui alourdissaient les sarments de la vigne grimpante dont la maison était couverte. Cette vieille vigne étalait ses longs bras sur presque tout ce côté de la muraille, se divisant pour encadrer la fenêtre, retombant gracieusement sous l’avant-toit, et abritant la gracieuse señora dans un fouillis de fleurs pourpres. Quel exquis tableau que cette belle jeune femme assise là, vêtue du linon le plus blanc, considérant au loin les collines, dans ce cadre de fleurs splendides ! Derrière elle, de l’autre côté de la chambre, assise, Alice cousait en silence.
Tandis que la señora considérait les collines, elle remarqua les agissements d’un homme à cheval, qui s’approchait de la maison, venant du côté où précisément avaient disparu son mari et les vaqueros. Le fait que cet homme s’approchait en suivant une route anormale, ce que n’eût rendu nécessaire aucune circonstance habituelle, sollicita son attention. Il prenait un tel soin de se dissimuler derrière les arbres qu’elle ne pouvait fixer son identité. Ce lui sembla étrange et mystérieux et quelque chose la poussa à laisser devant la fenêtre retomber la dentelle du rideau, afin de pouvoir ainsi l’épier sans risque d’être vue.
Le cavalier disparut. L’inquiétude de Violante s’en augmenta, mais elle ne dit rien à Alice.
Bientôt elle vit l’homme se diriger vers la maison, à pied, furtivement, se glissant d’un arbre ou d’un bouquet d’arbres à l’autre. Puis, prenant sa course, il arriva tout près et furtivement toujours, sans plus de bruit qu’un chat, il se mit à grimper pour atteindre sa fenêtre, en s’aidant des branches de glycine. Le courage de la señora faiblit et ses joues blêmirent, quand elle vit que l’homme serrait entre ses dents la lame nue d’un poignard.
Elle comprit son but.
Ce qu’il voulait, c’était sa vie et son or ; elle reconnut aussi les yeux brillants du voleur ; c’étaient les yeux de Basilio Velasco.
Après un instant d’épouvante, le vieux sang opiniâtre des Ovandos retrouva toute son alerte activité, et cette douce et gracieuse jeune femme arma son cœur afin de rencontrer la mort sur son propre terrain, acceptant ses conditions, décidée à cette lutte contre elle.
Elle ne poussa point de cri d’alarme ; il n’y avait plus personne dans la maison en dehors d’elle et d’Alice. Céder à la peur, c’était renoncer au seul espoir de salut. Calme à voix basse, elle dit :
– Alice, écoute, mais ne souffle mot.
Le sérieux de ses manières effraya la craintive et timide jeune fille ; mais, en même temps, leur assurance la tranquillisa. Elle laissa son ouvrage et considéra sa maîtresse avec surprise.
– Regarde dans le second tiroir du chiffonnier. Tu y trouveras un pistolet. Apporte-le-moi vite, sans un mot, car il y a un homme qui escalade la fenêtre pour me voler et, si nous poussons un cri ou perdons la tête, nous sommes mortes. Aie confiance en moi, et tout ira bien.
Alice, transie de peur, trouva le pistolet et l’apporta à sa maîtresse.
– Va t’asseoir et reste tranquille, lui dit-elle.
Ainsi fit Alice.
Violante, voyant que le pistolet était chargé, l’arma et regarda par la fenêtre. Basilio grimpait lentement et avec précaution, craignant que le moindre craquement d’une branche ne donnât l’éveil à la señora. Quand il se fut suffisamment approché pour qu’elle pût assurer son coup, Violante brusquement écarta le rideau, se pencha et pointa le canon de son arme à hauteur de la tête de Velasco.
– Que voulez-vous, Basilio ? demanda-t-elle.
En entendant la musique de sa voix, l’Espagnol leva les yeux. La balle de l’arme lui eût-elle à ce moment traversé la cervelle, le choc n’eût point été plus grand que celui qui le secoua tout entier quand il vit le canon noir du pistolet, la petite main blanche, mais ferme, qui le visait à la tête, et le beau visage pâle qui le dominait.
Ayant ainsi le voleur à sa merci, elle dit d’un ton ferme à Alice :
– Alice, il n’y a plus rien à craindre. Cours aussi vite que tu pourras ; à cent mètres de la maison, tu trouveras le cheval de cet homme attaché dans un bouquet d’arbres. Enfourche-le et galope aussi vite que Dieu te le permettra, pour dire à mon mari que je tiens prisonnier un voleur !
La jeune fille, défaillante, sortit de la chambre, trouva le cheval et s’éloigna au galop, laissant les deux ennemis mortels face à face.
Velasco avait entendu tout cela et il percevait le fracas des sabots du cheval gagnant la prairie au-delà des collines de Gabilan. Son imagination hébétée n’eut cependant pas de peine à évoquer le tableau d’un fougueux jeune Écossais survenant précipitamment et, dans sa colère, le tuant sans dire un mot. Il regarda fixement la señora et elle, fixement, le regardait ; et tandis qu’il voyait une étrange pitié et de la tristesse dans son regard, il y lisait aussi une inflexible résolution. Il ne pouvait pas parler ; le couteau entre ses dents lui tenait la langue prisonnière. Si seulement il avait pu intercéder près d’elle et lui mendier sa vie !
– Basilio, dit-elle très calme, voyant qu’il se disposait à lâcher prise d’une main en prenant sur l’autre un point d’appui plus solide, si vous remuez l’une ou l’autre de vos mains, je vous tue. Restez parfaitement immobile. Au moindre mouvement je vous tue. Vous m’avez vue jeter en l’air des pommes et les trouer toutes avec ce pistolet.
Ce n’était pas là une vaine fanfaronnade et Velasco savait que c’était exact.
– Je vous aurais donné de l’argent, Basilio, si vous m’en aviez demandé ; mais venir ainsi avec un couteau ! Vous m’auriez tuée, Basilio, et j’ai toujours été bonne pour vous.
Si seulement il avait pu retirer le poignard de ses dents ! Bien certainement, douce et bonne comme elle l’était, elle lui eût permis de partir en paix s’il avait seulement pu intercéder auprès d’elle ! Mais laisser tomber le poignard, c’eût été se désarmer et il n’était guère disposé à cela. Il y avait bien des plans, bien des projets à former en peu de minutes !
Velasco, le regard toujours rivé sur le canon du pistolet, fit vite une décourageante découverte ; la position dans laquelle il avait été surpris était incommode et peu sûre ; l’inhabituelle tension qu’elle imposait à ses muscles, devenait pénible et fatigante. Changer de position si peu que ce fût, c’était l’inviter à tirer. Comme s’enfuyaient les instants, la tension sur certains ensembles de muscles augmentait la douleur avec une alarmante rapidité et, inconsciemment, il commença à se demander combien il lui restait de temps avant que la souffrance le poussât à une tentative désespérée et à la mort. Tandis qu’il côtoyait ainsi une douloureuse agonie avec, au bout, la fin prochaine de tous les tourments humains, une autre souffrait d’une manière différente, mais presque égale.
La belle señora avait au bout de son pistolet le choix entre deux vies ; mais qu’elle tînt ainsi le sort d’une existence quelconque suffisait à l’étonner, à la tourmenter et à l’angoisser ; qu’elle eût le courage de rester dans une situation aussi extraordinaire la stupéfiait au delà de toute supposition. Or, lorsque quelqu’un réfléchit et se dit qu’il est courageux, son courage est contestable. Et puis, elle était réellement si bonne qu’elle se demandait, au cas où l’assassin ferait un mouvement, si elle exécuterait sa menace. Qu’il l’en crût capable suffisait.
Mais après l’arrivée de son mari, qu’adviendrait-il ?
Avec sa nature fougueuse résisterait-il à la tentation de couper la gorge à cet homme sous ses yeux même ? C’était trop horrible pour y penser. Mais, ciel ! le voleur avait lui-même un poignard ! En appelant ainsi son mari, ne l’invitait-elle pas à engager une lutte mortelle avec un désespéré mieux armé que lui ? Ce lui eût été aisé de mettre Basilio en liberté et de le laisser partir, mais elle savait que son mari le suivrait et le retrouverait. Maintenant qu’elle avait eu le tort de l’appeler, mieux valait garder son prisonnier, qu’elle pût intercéder pour sa vie. Là était son espoir, d’empêcher que l’un ou l’autre de ces deux hommes donnât son sang. Son incertitude, ses indécisions, sa peur de voir se terminer d’une façon terrible un incident qui déjà avait pris une forme tragique, son effroyable responsabilité, la redoutable possibilité d’avoir, pour défendre sa propre existence, à tuer Basilio, ses craintes sur la justesse de son tir et le bon état de son arme, tout cela et d’autres choses encore l’épuisaient, et enfin, elle aussi, elle commença à se demander combien de temps elle supporterait cette tension, et si oui ou non son mari arriverait assez tôt pour la sauver.
Durant ce temps, Velasco, percé jusqu’à la moelle par les souffrances qu’il endurait, sollicité à la fois par le désir de lâcher le poignard, de plaider pour sa vie et par la crainte de se séparer de son arme, était à bout. Toute la supplication dont pouvaient témoigner son visage et ses yeux, parlait éloquemment pour lui, et sa muette prière disait assez son agonie physique. Les muscles de ses bras et de ses jambes se contractaient et frémissaient ; sa respiration pénible sifflait en se brisant sur la lame du poignard. Il était incapable de contrôler plus longtemps les muscles de sa bouche ; le fil aiguisé de son arme se frayait une route dans la chair aux commissures des lèvres, et deux ruisselets de sang dégouttaient le long de son menton et tombaient sur sa poitrine.
Pas un instant il n’avait détourné son regard des yeux de la jeune femme, et ces deux êtres se regardaient l’un l’autre avec un calme et un silence terribles. Le moment décisif allait venir. L’épreuve prolongée ferait inévitablement une victime de l’un ou de l’autre.
La vue de l’agonie de cet homme, le pitoyable spectacle de son regard suppliant, c’était plus que n’en pouvait supporter la chair féminine dont était faite Violante.
La catastrophe arriva.
Basilio le premier fléchit. Volontairement ou non, il lâcha son couteau qui, avec fracas, tomba de branche en branche sur le sol. Aussitôt sa langue, maintenant libre, commençait à déverser tout un torrent de supplications en espagnol avec une éloquence que jamais Violante n’avait vu égaler.
– Ô señora ! dit-il, seul un ange peut faire preuve d’une pitié plus tendre que celle des humains ! Et, aussi vrai que j’espère la clémence de la Sainte-Vierge, il est dans vos traits une douceur et une bonté qui n’appartiennent qu’à un ange de pitié. Ô Mère de Dieu ! tu n’as certainement entraîné ton fils indigne dans cette impasse que pour mettre son âme à l’épreuve et confier son châtiment et sa purification à la plus douce et à la plus noble de tes filles ; car tu as soufflé à son cœur, qui est aussi pur que son visage est beau, de me sauver de la plus horrible des morts. Tu as murmuré à son âme maternelle qu’un de tes fils, si méprisable et indigne fût-il, ne pouvait sans absolution être envoyé devant le tribunal du Très-Saint Christ, ton fils ! Par l’enseignement de l’Église tu as éclairé son âme sur les devoirs d’une chrétienne, car dans sa beauté éclate le divin rayonnement du ciel. Ah, señora ! Voyez-moi solliciter la clémence ! Voyez les angoisses qui m’assaillent, et que mes souffrances m’ouvrent la porte de votre cœur ! Laissez-moi partir en paix, señora, et vous me trouverez votre esclave à chaque heure de la vie, le plus humble et le plus dévoué de vos esclaves, heureux si vous me frappez, me glorifiant de ma servitude, si vous me refusez la nourriture, et louant le Dieu Tout-Puissant, si vous me foulez sous vos pieds. Señora, señora, laissez-moi partir ; le temps presse ; à peine pourrai-je m’échapper, si vous ne me laissez fuir à l’instant. Voudriez-vous voir mon sang rejaillir sur vos mains ? Pourriez-vous après cela affronter la Vierge ? Ô señora, señora…
À elle, la tête lui tournait et tous ses sentiments allaient ballottés sur une mer d’angoisses. Pourtant, elle garda les yeux rivés sur les siens tandis qu’il continuait ses supplications, mais les contours du corps du malheureux étaient maintenant incertains et vacillants, et une inexprimable souffrance engourdissait ses facultés et, toujours vaguement, elle entendait le torrent de ses paroles.
Ce ne fut que lorsque son mari, suivi de deux vaqueros, survint au galop que les deux malheureux placés dans cette tragique situation se rendirent compte de sa venue.
À sa vue, Violante tendit les bras, le pistolet tomba sur le sol et elle-même s’affaissa sur le plancher, tandis que le soleil éclatant se transformait en nuit et que les éblouissantes gloires du jour devenaient néant.
II
Elle ouvrit les yeux.
Elle était étendue sur son lit, son mari, assis près d’elle lui pressant les mains et la regardant anxieusement.
Quelques instants s’écoulèrent avant qu’elle eût rassemblé ses esprits et pu comprendre les affectueuses paroles de son mari, mais en le voyant sain et sauf à ses côtés sa seconde pensée fut pour Velasco.
– Où est Basilio ? demanda-t-elle, se redressant brusquement et regardant craintivement autour d’elle.
– Il est en sécurité, mon aimée. Ne pensez plus à ce Basilio qui voulait faire du mal à ma Violante. Soyez calme, pour l’amour de moi, ma chère femme.
– Oh ! je ne puis, je ne puis ! Parlez-moi de Basilio.
Et à voix basse, d’un ton de frayeur, elle demanda :
– Vous l’avez tué ?
– Non, mon aimée, Basilio est vivant.
Elle laissa retomber sa tête sur l’oreiller.
– Dieu soit loué ! murmura-t-elle.
Brusquement elle se redressa et vivement regarda son mari dans les yeux.
– Vous ne m’avez jamais trompée, dit-elle précipitamment ; mais, Robert, il faut que je sache la vérité. Ne craignez rien, je puis la supporter. Pour l’amour de Dieu, ami, dites-moi la vérité !
Effrayé, il la prit dans ses bras, et dit :
– Soyez calme, ma Violante. Le Tout-Puissant m’en est témoin, Basilio est vivant.
– Vivant ! Vivant ! s’écria-t-elle, qu’entendez-vous par là ? Vous avez une arrière-pensée, ami. Je connais trop votre nature fougueuse… Vous ne pouviez pas lui faire grâce si aisément. Dites-moi toute la vérité, Robert, ou j’en deviendrai folle !
Il y avait dans le ton de sa voix tant d’instance et d’égarement qu’une échappatoire eût été imprudente.
Il le comprit.
– Je vais vous la dire, Violante, je vais vous la dire. Écoutez ; sur mon âme, voici toute la vérité. Quand je vous ai vue lâcher le pistolet et vous affaisser sur le parquet, je sus que vous vous étiez évanouie. J’ordonnai aux vaqueros de s’assurer de l’arme et de garder Basilio. Puis je montai à votre chambre, vous plaçai sur votre lit, défis vos vêtements et m’efforçai de mon mieux de vous faire revenir à vous. Mais vous demeuriez sans connaissance…
– Basilio ! Basilio ! parlez-moi de lui.
– J’allai à la fenêtre et j’envoyai un de mes vaqueros à l’hacienda mander un médecin et je dis à l’autre de conduire ici Basilio, dans cette chambre. Il entra faible et tremblant, car il était tombé de sa branche et dans sa chute s’était étourdi, mais sans se faire grand mal. Il pensait que j’allais le tuer ici même, mais cela je ne le pouvais pas. J’avais peur à cause de vous, Violante. Il était très tranquille et je souffrais…
– Vite, Robert, faites vite !
– Il ne dit rien. Je lui parlai. Il baissa la tête et me demanda de le laisser prier. Je lui dis que je ne le tuerai pas. Sa physionomie aussitôt s’éclaira. Il se jeta à mes pieds, m’étreignit les genoux et baisa mes chaussures, pleurant comme un enfant. C’était à faire pitié, Violante.
– Pauvre Basilio !
– Il me demanda de le punir. Il ouvrit sa chemise et me supplia de le frapper. Je lui dis que je ne le toucherai pas. Il me dit qu’il serait toute sa vie mon esclave et le vôtre, mais il continua de réclamer une expiation physique… Il me fallut le punir. « Fort bien », lui dis-je. Je me tournai vers Nicolas et lui ordonnai d’infliger à Basilio quelque léger châtiment qui pût lui soulager le cœur. Nicolas l’emmena, l’attacha au dos d’un cheval et lâcha la bête dans le corral. Nicolas revint me dire ce qu’il avait fait. Je répondis que c’était parfait et qu’aussitôt que je pourrais vous quitter, j’irais délivrer Basilio. J’ordonnai alors à Nicolas de partir pour la plaine et de ramener Alice, car elle était trop lasse pour revenir avec moi.
– Et Basilio est encore maintenant dans le corral ?
– Oui.
– Comment a-t-il été attaché au cheval ?
– Je ne sais trop, Nicolas ne me l’a pas dit ; mais soyez certaine qu’il est en sûreté.
Elle jeta ses bras au cou de son mari et l’embrassa à plusieurs reprises, disant :
– Mon noble, mon généreux ami ! s’écria-t-elle. Je vous aime encore mille fois plus. Maintenant, Robert, allez tout de suite délivrer Basilio.
– Je ne puis vous quitter, aimée.
– Il le faut, quittez-moi ! Je vais tout à fait bien maintenant. Si vous n’y allez, j’irai.
– Très bien.
Il ne fut pas plus tôt sorti de la chambre qu’elle s’élança de son lit, saisit un canif et sans bruit le suivit ; il ne la soupçonna pas proche derrière lui, tandis qu’il se dirigeait vers le corral.
Arrivée à une courte distance de la maison, son oreille très fine, perçut un bruit particulier qui lui fit froid par tout le corps. C’étaient de faibles cris d’agonie, et ils provenaient d’une direction différente de celle du corral. Étourdiment, et par suite imprudemment, elle courut de leur côté sans appeler son mari et ne tarda pas à être témoin d’un effroyable spectacle.
Mc Pherson poursuivit sa route jusqu’au corral, mais lorsqu’il y arriva, il fut surpris de ne pas trouver Basilio dans l’enclos.
La porte en était fermée ; le cheval auquel on l’avait attaché ne s’était donc pas échappé par là. Regardant autour de lui, il constata parmi les chevaux des signes évidents d’une perturbation, causée sans aucun doute par la vue inhabituelle d’un homme attaché sur le dos de l’un d’entre eux. Le terrain était dans tous les sens battu et foulé par leurs sabots ; une soudaine panique avait jeté le désarroi parmi eux.
La bête à laquelle Nicolas avait attaché Basilio n’était pas là.
Contrarié de la maladresse de Nicolas, Mc Pherson chercha jusqu’à ce qu’il eût trouvé l’endroit de la palissade par où s’était échappé le cheval de Basilio.
Alarmé et désolé à la fois, Mc Pherson franchit la clôture, releva la piste du cheval et la suivit, en courant.
Bientôt il s’apercevait que l’animal, dans sa course folle, s’était frayé un chemin à travers la haie qui fermait le rucher et avait ravagé les vingt ou trente ruches qui s’y trouvaient. Mc Pherson vit alors un spectacle qui un instant l’anéantit tout entier.
La señora, guidée par une intelligence plus prompte que celle de son mari, était allée droit au rucher.
Là, elle vit le cheval, avec Basilio, nu jusqu’à la ceinture, lié sur le dos ; l’animal, fou, se cabrait parmi les ruches, les réduisant en pièces à coups de sabots au fur et à mesure que les cruels insectes le piquaient de leur aiguillon. Basilio était attaché, la face tournée vers le ciel dont le soleil torride lui brûlait les yeux, car Nicolas était dévoué à la señora et avait résolu de rendre le châtiment aussi dur que possible à l’ingrat. Les abeilles s’étaient attachées par centaines au torse sans défense de Basilio, lui infligeant vingt piqûres pour une à la bête, sans qu’il lui fût possible de se protéger. Mille aiguillons déjà lui avaient sur la figure et le corps inoculé leur poison ; ses traits étaient hideusement bouffis et décomposés, les boursouflures de sa poitrine lui avaient fait perdre toute forme humaine.
Sans une minute d’hésitation, la señora s’élança et courut au secours de Basilio, priant Dieu de tout son souffle. Les cris du malheureux étaient indistincts, car ses forces l’avaient presque totalement abandonné, et son incroyable torture lui avait fait perdre toute présence d’esprit. S’approcher de l’animal emballé, au milieu de cet essaim d’abeilles, c’était pour Violante s’offrir à une mort certaine.
Elle s’élança.
Avec toute l’assurance d’une écuyère de profession, elle enroula les doigts d’une main dans les naseaux de la bête affolée, la réduisant immédiatement à la soumission. Puis, sans souci des piqûres que les insectes lui infligeaient à la figure et aux mains, elle coupait les liens de Basilio et saisissait dans ses bras le corps informe qui glissait sur le sol. Alors, le prenant par-dessous les bras, elle le traîna avec une vigueur peu commune hors de l’enclos, loin des meurtriers assauts des abeilles.
Il gémissait ; sa tête roulait d’une épaule à l’autre. Le gonflement des paupières lui bouchait les yeux et il ne pouvait la voir, mais, n’en eût-il pas été ainsi, il ne l’eût pu davantage reconnaître. Elle l’étendit à l’ombre d’un gros chêne et vit, à sa respiration convulsive et courte que c’en serait bientôt fait de lui.
Inconsciente de la présence de son mari qui se tenait maintenant respectueusement, le front découvert, derrière elle, elle leva vers le ciel sa figure frêle et ses beaux yeux, et doucement pria :
– Sainte Mère de Jésus, entends la prière de ta malheureuse fille, et intercède pour cette âme sans absolution.
Elle reporta ses yeux sur Basilio et vit qu’il était mort.
Faible, elle se leva en chancelant, et, apercevant son mari, elle l’appela par son nom, tendit vers lui les mains et tomba sans connaissance dans ses bras vigoureux.
Et c’est ainsi qu’il l’emporta au rancho, lui couvrant le visage de baisers, tandis que des larmes ruisselaient le long de ses joues.
UN SÉPULCRE D’OR
Ce me causa un vif plaisir de recevoir enfin une lettre de mon vieil ami Robert, me suppliant de venir lui rendre visite. Depuis qu’il s’était, à la suite d’un coup de tête, mis en route, il y avait de cela des années, pour la chasse à l’or, je l’avais complètement perdu de vue. Il m’avait, il est vrai, tout d’abord adressé des missives éblouissantes, s’efforçant chaque fois d’infuser dans mon sang l’ardeur et l’impatience qui continuellement faisaient bouillonner le sien, n’oubliant jamais d’y semer quelques sarcasmes voilés sur le genre d’existence plus tranquille et plus paisible qu’il m’avait plu de choisir. Mais depuis longtemps, pris de dégoût peut-être pour mon manque de courage et d’initiative, il avait cessé de m’écrire.
Cette lettre cordiale me causa donc une agréable surprise, car j’avais toujours eu pour lui une réelle affection au collège et jamais un jour ne s’était depuis écoulé sans le rappeler à mon souvenir.
Il lui fallait être bien anxieux de me voir venir le rejoindre, car sa lettre témoignait d’une grande nervosité et d’une sincère émotion. Il me peignait les éblouissantes merveilles du désert, avec toute son ardente habileté d’autrefois et me contait les divertissants tremblements de terre qui donnaient à cette région désolée une saveur particulière. Je me trouvais avoir longtemps désiré visiter ce coin de terre étrange et sauvage, à l’extrémité méridionale de la Californie, et je n’en avais été empêché que par la description des privations que l’on y endurait, et des gens singuliers et peu sociables qu’on s’exposait à y coudoyer. Mais, puisque mon vieil ami Robert s’y trouvait – Robert si raffiné, si instruit, si orgueilleux, si impérieux, si téméraire, – mes désirs se réveillèrent et de suite je lui écrivis pour lui annoncer ma venue.
Je partis.
Par une éblouissante matinée de juillet, je quittai San Diego et me dirigeai vers les Monts Volcan, qui se dressaient à plus de trente lieues au nord-est. Là, sur une hauteur dans une grise bourgade créée pour l’exploitation minière et enchâssée comme une perle dans une forêt d’émeraudes, je fus accueilli par mon excellent ami Robert.
J’étais ravi de le voir, et sa joie évidemment irrésistible en me retrouvant fut infiniment touchante. Il m’embrassait, pleurait, gambadait comme un enfant et m’appelait par un tas de noms ridicules. Soudain il s’arrêta, m’examina de plus près et se mit à laisser voir une surprise mêlée de crainte ; mais pour être plus sûr, il m’entraîna à la buvette du petit hôtel, me plaça sous la lumière d’une lampe, me tourna et me retourna, m’examinant de la tête aux pieds et enfin se reculant et me considérant avec respect et terreur.
– Mais tu es riche !
– Robert ! fis-je, en riant et en manière de protestation.
– Oui, tu es riche ! répéta-t-il, s’exprimant avec un empressement inquiet. Tu as pris le parti le plus sage après tout – tu es resté dans la civilisation et, grâce à ton esprit supérieur, tu t’es engraissé du labeur d’autrui !
Il y avait une certaine amertume dans le ton de sa voix.
– Robert ! fis-je.
– Je n’y trouve rien à redire, mon vieux, expliqua-t-il vivement. Je constate tout simplement un fait évident, car tes mains blanches et douces sont un témoignage que tu n’as rien fait pour ajouter à la richesse de ce monde. Aussi, mon ami, tandis que moi, comme un insensé, je piochais pour un sac d’or au pied de l’arc-en-ciel, souffrant pour ajouter aux moindres raffinements de la vie, menant une existence de proscrit et de vagabond, toi tu léchais la crème de la civilisation et tu te doublais une bonne et épaisse pelisse pour les durs hivers de la vieillesse.
– Robert, en voilà assez ! m’écriai-je, qu’est-ce qui te fait penser que je suis riche ?
– Tes joues rondes, leurs belles couleurs, tes lèvres rouges, ta panse confortable, ta surface dodue, ta voix onctueuse, ton…
– Voyons, Robert ! Es-tu donc si longtemps resté loin des habitudes les plus ordinaires de la vie, que tu ne puisses apprécier les signes extérieurs d’un travail assidu et salubre, d’une bonne alimentation et d’une existence calme et rangée ?
Il releva la tête et fit retentir la pièce d’un rire sonore ; à dire vrai, il me fallut du temps pour convaincre l’obstiné que je n’étais point riche et que j’avais dû peiner pour gagner ma vie. Tout ceci le confondait et il était clair qu’il avait perdu toute notion du monde. Finalement, après avoir longuement réfléchi en silence, il dit non sans quelque embarras.
– Eh bien, si un homme a cette apparence-là et ces mêmes sentiments sans cependant être riche, je me demande si cela vaut la peine pour lui d’avoir de la fortune ; car, ajouta-t-il, me chuchotant à l’oreille pour ne pas être entendu des voisins qui flânaient là, je t’ai fait venir pour t’enrichir.
Je le remerciai en riant et lui serrai la main, en l’assurant que j’en serais ravi au delà de toute mesure. Il me parut à ces mots quelque peu désappointé, mais il en revint à plusieurs reprises à ma mine de prospérité et, finalement, s’écriait avec une brusquerie passionnée :
– Je n’ai pas cet air-là et je n’ai pas non plus ces idées-là. Jamais personne ne me prendrait pour un richard. Je suis un vagabond, mais je serai d’ici un mois aussi riche que Crésus.
– Ou que Midas, dis-je, lui coupant la parole.
Il me décocha un regard acéré.
– Trêve de sermons, fit-il.
Je me mis à rire de si bon cœur, que le rire le gagna à son tour, ce bon rire sonore que, tant de fois dans le passé ce m’avait été une si douce joie d’entendre. Après cela, tout entre nous alla comme sur des roulettes.
Nous nous mettions en route le lendemain matin à la première heure, car il « travaillait », me dit-il, à l’extrême limite du désert de Colorado, à une vingtaine de lieues de là.
Il était, de toute évidence, la proie d’une lourde préoccupation qu’il s’efforçait avec peine de dissimuler, et il avait très certainement en réserve quelque surprise qu’il n’était point encore disposé à me faire connaître. Il m’avait déjà laissé entendre qu’il m’avait fait venir pour m’enrichir, mais à cela je n’avais pas accordé grande attention, ne connaissant que trop les espoirs éblouissants et les visions chimériques qui font sans interruption bouillonner le sang des chasseurs d’or. Certes, il avait parlé en toute sincérité, mais je soupçonnais que l’or restait à trouver. C’est un fait curieux que ce besoin chez un homme qui a mis la main sur une masse d’or, de partager sa bonne fortune avec un ami sans le sou.
Il me causait de tout, hormis de son « travail ». Il s’étendait avec complaisance sur les années heureuses de notre vie de collège, qui ne remontait guère qu’à une dizaine d’années. Il prêtait son oreille avide au récit de mes luttes et de mes petits succès. Bref, n’eût été la lourde préoccupation qui le dominait, et certaines absences par intervalles, il m’apparaissait comme le cher Robert d’autrefois – plein de vie, d’élasticité, spirituel et railleur, mais légèrement détérioré sous certains rapports. Ayant à peine dépassé trente ans, on lui en eût donné plus de quarante. Le visage était marqué de rides profondes, et ses épaules s’étaient voûtées. C’en était fait aussi de ce côté pimpant qui caractérisait autrefois sa mise. Extérieurement, il avait tout l’aspect d’un rude mineur, mais ce me fit du bien de constater qu’il avait conservé son langage châtié.
Descendant la pente orientale de la chaîne boisée des Monts Volcan, nous nous enfonçâmes par une route malaisée et broussailleuse dans l’éclatante vallée de San Felipe, dont l’extrême limite est marquée par des monts rocheux et nus : ce sont comme les sombres gardiens, les tristes avant-courriers du désert plus triste encore qui se déploie à l’infini au delà d’eux.
Nous avions suivi la vallée de San Felipe jusqu’au point où elle débouche sur le vaste désert et nous nous étions engagés sur cet océan rebutant de sables brûlants. Mais, au lieu de nous enfoncer dans ses douloureuses solitudes, nous prîmes au sud, serrant de près la chaîne des monts Cuyamaca. C’est alors que je vis dans toute sa merveilleuse splendeur l’éblouissant éclat du soleil du désert, et me rendis compte de cette qualité de finesse, plus subtile et plus enivrante, de la lumière du désert, de sa force vive et tonique.
– Ah ! s’écria-t-il, comme s’éveillant d’une extase, tu le sens aussi, n’est-ce pas ? Cela prouve, mon vieux, ta belle sensibilité. Vois-tu, cela vaut mieux et c’est plus fort que du vin dans le sang ! Vois comme cela m’emplit de vie ! Et pourtant tu as vu ces quelques brutes que nous avons passées sur la route. Les crois-tu capables de sentir ou de comprendre ce merveilleux stimulant de vie ?
– Mais ils m’ont l’air vieilli et cassé, dis-je, le regardant fixement.
– Parles-tu pour moi ? fit-il, arrêtant sa monture.
– C’est d’eux que je parlais, lui répliquai-je avec calme.
– Ce sont les rides, me dit-il, en guise d’explication. C’est la sécheresse qui en est cause ; on dessèche et on se ratatine dans le désert, mais on ne meurt pas.
Et comme il disait ces mots, une lueur étrange et folle passa dans ses yeux.
Il faisait nuit, une nuit claire et étoilée, quand nous atteignîmes sa « place ».
C’était la plus bizarre construction qu’on pût rêver, aux murs épais, faite de briques d’argile, que seul le soleil avait séchées.
– Nous n’avons besoin de nous abriter que contre le soleil, me dit-il. Ici, il pleut rarement.
Il s’occupa très adroitement de ses travaux domestiques, comprenant les soins à donner à nos chevaux et la préparation du souper. Pendant ce temps, il garda un silence peu habituel chez lui, et je me demandai si le grand esprit muet du désert ne s’était pas irrémédiablement emparé de lui, ou si quelque lourde préoccupation ne l’avait pas soudain envahi.
Le souper achevé, nous sortîmes nous asseoir sous les étoiles. Je remarquai que la hutte était plantée au pied d’un mont étonnamment symétrique d’un contour parabolique, qui découpait hardiment sa masse noire sur le ciel.
Je l’avais déjà remarqué comme nous approchions, mais des tourbillons de sable me l’avaient soudain masqué et mon attention s’était portée ailleurs. Maintenant que le vent était tombé, un calme parfait régnait dans l’air – un calme palpitant pondérable, – et avec lui un ample et inconcevable silence. On n’entendait ni le chant d’un grillon ni le cri d’un oiseau de nuit. Une solitude impénétrable, un incommensurable isolement revêtait ce squelette blanchi du monde, et au plus profond de mon âme je me demandais comment un être humain, élevé comme l’avait été mon vieil et cher ami Robert, pouvait passer plus de quelques journées de curiosité dans cette solitude de mort et de silence. Il semblait que le cœur se devait serrer sous cette pression terrible et implacable du vide, de ce néant énorme et accablant. Du fond du cœur je plaignais ce beau garçon vigoureux qui gaspillait sa vie, quel que fût le trésor que ce désert lui pût livrer.
J’attirai son attention sur la singulière montagne qui se dressait près de nous.
Il fut aussitôt transfiguré.
Il était assis tête nue dans l’air chaud et chargé de forces vivifiantes, et, à la lueur des étoiles, je pouvais voir la tension perpétuelle de son corps encore plus tendu et dans ses yeux cette flamme de folie familière aux chasseurs d’or.
– Elle ! s’écria-t-il, se levant et étendant les bras comme s’il eût voulu étreindre le sombre dôme géant, c’est mon trésor, c’est ma montagne d’or.
Son excitation allait croissante. Brusquement, il se tourna vers moi et avec une impétuosité dont j’avais été témoin déjà, il poursuivit :
– Ma montagne d’or ! Comprends-tu ? Il y en a une moitié pour toi, l’autre pour moi, mais…
Il regarda d’un air soupçonneux à l’entour, comme s’il y avait la moindre possibilité qu’une oreille indiscrète pût surprendre son secret, puis il se rapprocha de moi et ce fut d’une voix contenue qu’il me murmura à l’oreille :
– As-tu remarqué ces pauvres niais qui travaillent aux mines, et que nous avons rencontrés sur notre route en descendant ? Que font-ils, en somme ? Autant de taupes creusant l’ardoise et le schiste, peinant et suant pour sortir de la terre et du roc ourlé de ci de là d’un mince et brillant fil d’or, écrasant et broyant et amalgamant ces masses terrifiantes pour le maigre trésor que la vapeur et le mercure tirent de leurs entrailles récalcitrantes – sottise ! Ici, dans ma montagne splendide – enfermée dans son fourreau de pierre honnête et non plus de roc répugnant – gît une masse d’or vierge solide, attendant le cerveau et les bras qui mettront sa gloire au soleil !
Et alors, avec une éloquence haletante, il se mit à me donner les explications les plus merveilleuses sur les forces mystérieuses et naturelles qui, pendant d’innombrables années avaient emmagasiné cet or au cœur de sa montagne. Puis, s’engageant dans une autre voie, il continua :
– Et les tremblements de terre ! Tu n’en as jamais ressenti. Dans ce nid moelleux et rétréci que tu appelles ville, dans ce San Francisco pusillanime, il y a eu ce que tu as appelé des tremblements de terre, – mesquines secousses de quelques secondes à peine, qui cependant faisaient sortir tout apeurées les femmes mi-vêtues dans les corridors des hôtels.
Il s’arrêta un instant pour rire avec une joie railleuse.
– Et vous appeliez ça des tremblements de terre – de petits ébranlements insuffisants pour disjoindre des briques ! Tu verras ce qu’est un tremblement de terre – là même, où tu es assis. Tu te trouves au sein même de ces forces géantes dont tu ne peux comprendre la splendeur. Et que font-elles ? Elles font de l’or ! de l’or à la tonne, et non par minces filets. Là où est le tremblement de terre, il y a de l’or ; c’est la vibration du puissant métier qui tisse cette glorieuse étoffe. Car sous cette terre vibrante sont les feux éternels qui dégagent la vapeur d’or et la poussent au travers des crevasses des montagnes, où elle se refroidit, se solidifie et se loge. C’est ici – on te le dira – qu’ont lieu les tremblements de terre les plus violents, les plus beaux de l’Amérique du Nord. Il ne se passe guère de jour où tu ne sois ébranlé et projeté dans le désert où tu restes gisant, impuissant et hébété. C’est là un tremblement de terre, et c’est ici que tu apprendras à en comprendre toute la majesté. Regarde les parois de ma hutte – elles sont basses, avec un mètre d’épaisseur et mi-faites de paille pour leur donner plus de légèreté et leur assurer toute l’élasticité voulue. Eh bien, en dépit de la sûreté qu’offrent ses murailles, je considère qu’il est plus sûr encore de dormir au dehors. Ah, c’est là toute la gloire d’un tremblement de terre !
J’avais été submergé par l’éloquence enflammée de mon vieil ami ; j’avais été entraîné par son impétuosité au point de complètement oublier les tremblements de terre avant qu’il en eût lui-même parlé. Et maintenant qu’il se taisait, comme épuisé, je profitai de son silence pour l’interroger et lui demander d’où il tenait que la montagne renfermait une masse d’or et s’il en avait vu des indices.
– Des indices ! s’écria-t-il. Par indices, tu entends ces signes aussi méprisables que futiles, qui guident l’expert et le fait creuser le sol pour trouver de l’or, quand il en a vu à la surface. Des indices, allons donc ! Le Dieu Tout-Puissant a mis sa joie à ne pas borner mes sens à mes seuls yeux !
Ce fut son dernier transport.
De toute évidence il était las et il me faisait bientôt observer que je devais être fatigué et qu’il nous valait mieux dormir maintenant. Il alla prendre deux couchettes et des couvertures dans la hutte et les disposa sur le sable, et nous nous préparâmes à passer là la nuit.
Que tout cela me paraissait extraordinaire et magique, et malsain ! Tout en considérant les étoiles au-dessus de ma tête, et en les regardant clignoter d’un air entendu et bienveillant, les événements de la journée et de la soirée défilèrent devant moi en une fantasmagorie grimaçante et curieuse. Le secret de mon cher Robert était enfin sorti – son pauvre esprit tendu croyait à une masse d’or au cœur de la montagne. Mais pourquoi m’avait-il fait venir ?
De quelle utilité, en effet, lui pouvais-je être ? À quel moyen s’était-il arrêté, si toutefois il en avait un, pour arriver au cœur de la montagne ? Peut-être, après tout, ne m’avait-il mandé que dans l’impossibilité où il se trouvait de supporter plus longtemps cet isolement absolu.
La hutte était toute proche du pied de la montagne, et d’apparence fort ancienne. Quelle avait été sa destination première, je ne le pouvais deviner. Comment Robert l’avait-il découverte, je ne le devinais pas davantage. Tandis qu’étendu, roulé dans ma couverture, je guettais les étoiles au milieu de cette désolation aride qui enveloppait ces lieux comme d’un suaire, je pouvais entendre au pied de la montagne le murmure d’une source. Robert m’en avait déjà parlé, et y avait mystérieusement fait allusion en y associant certaines autres choses. Je savais que l’eau en était brûlante, et qu’il lui fallait y mêler un autre liquide pour la rafraîchir.
Alors, comme je guettais les étoiles et entendais la respiration agitée de Robert qui dormait près de moi, un inexplicable sentiment de danger commença à m’opprimer. Un grondement lointain, rappelant assez l’approche d’un ouragan, troublait graduellement le calme de la nuit. Le murmure de la source changeait de caractère et devenait plus bruyant. Bien que je ne la pus distinguer dans les ténèbres, je me tournai de son côté, car elle n’était pas à plus de quarante mètres. Quelques minutes après, j’étais témoin d’un spectacle curieux. En même temps qu’un léger cahot ébranlait ma couchette, une bouffée de vapeur s’élevait de la source, faisait explosion et montait droit dans l’air, puis tout retomba dans le silence et le calme. Supposant que c’était là quelque phénomène courant, et que la source avait parfois de ces manifestations propres aux geysers, mon malaise n’en fut pas accru.
Bientôt se produisit un nouvel ébranlement, plus fort cette fois, de ma couchette, et en même temps une formidable explosion de la source d’où s’éleva une haute colonne de vapeur, d’eau et de boue, qui rejaillit jusque sur nous.
Robert s’éveilla en sursaut et sauta de sa couchette. Un instant il resta immobile.
Sûrement quelque chose d’extraordinaire avait dû se passer, car habitué comme il l’était aux tremblements de terre de la région, étant donné aussi qu’il n’y avait encore eu que deux légères secousses, il était inadmissible qu’il restât comme pétrifié de terreur, les yeux malgré lui fixés sur la montagne.
Je m’assis sur le bord de ma couchette.
Aussitôt ses yeux se portèrent de mon côté et il se précipita vers moi. M’empoignant par l’épaule, il me dit brusquement, pris d’une exaltation folle :
– Il est enfin venu, l’ami, plus tôt que je ne le pensais. Il y avait eu des signes précurseurs. Béni soit Dieu que tu sois arrivé à temps pour en être témoin, et t’en réjouir avec moi. Mettons-nous hors de danger !
Il me força à me mettre sur mes pieds et m’entraîna dans le désert. Je me défis de son étreinte, lui pris le bras et lui dis avec calme :
– Robert, je suis surpris de ne pas te voir plus maître de toi, de te voir si aisément effrayé.
– Voyons, ne sois pas si enfant ! s’écria-t-il. Ne comprends-tu pas ce qui se passe ? Cette transformation de la source en geyser ne parle-t-elle pas à ton esprit ? Mais, mon ami, nous voici au début de l’une de ces puissantes convulsions qui déchirent le monde. Ce n’est plus un tremblement de terre – c’est un cataclysme. Ne peux-tu évoquer l’image de ces formidables Titans emprisonnés dans leurs donjons souterrains et unissant leurs forces, pour briser la toiture qui les retient et les étouffe ?
– Sois raisonnable, Robert, fis-je, l’interrompant, comme nous nous hâtions de gagner le désert. Dis-moi ce que tu entends par là – une éruption volcanique ?
– Non, non ! un soulèvement, un soulèvement géant, le craquement et la déchirure de grandes montagnes de pierre solide. Et – écoute – ma montagne va se briser et ses réserves éblouissantes d’or vont s’offrir à nos mains.
Ce qu’il eût pu dire encore fut arrêté court par une terrible houle terrestre qui nous jeta à terre comme de simples quilles. Nous voulûmes nous relever, enfonçant nos doigts dans le sable mobile, pour être terrassés une seconde fois, et nous restâmes là étendus et impuissants, tandis que de mystérieuses forces secouaient les profondeurs du sol, que de sourds et rauques grondements faisaient vibrer les airs et que des lames de sable balayaient le désert.
Imitant l’exemple de Robert, je m’étais tourné de façon à faire face à la montagne, et nous gisions là, bercés, le menton dans les mains, entendant le tumulte grandir à tout instant. Les étoiles dansaient éperdument au firmament qui tout scintillant de lumières, se balançait, penchait et frémissait. De la source s’élevaient des rugissements sonores, accompagnés d’explosions de vapeur et de boue brûlante. Un des murs de la hutte s’écroula avec fracas, au milieu d’un nuage de poussière. Les chevaux, attachés au grand air, se cabraient, tombaient, ruaient et hennissaient.
– C’est superbe ! s’écria Robert.
Une série de bruits différents maintenant emplissait l’air. On eût dit des montagnes de pierre broyées en poudre entre les mains de dieux souterrains. À tout instant augmentait cet écrasement assourdissant. Puis vint le couronnement du tout – un fracas formidable, inouï, comme si le monde entier se fendait en deux et…
Je ressentis de violentes douleurs dans la tête ; j’avais le visage couvert de sang coagulé et mêlé de sable ; j’avais du sable plein la bouche et les narines ; à chacun de mes mouvements, je sentais par tout le corps des élancements douloureux. Je me traînai péniblement près de Robert qui gisait immobile. Il était évanoui ; sa respiration était difficile.
Le désert était de nouveau plongé dans un silence effrayant et un calme absolu, car la convulsion était complètement apaisée. Je gagnai en titubant la hutte en ruine, dont pas un pan de mur ne restait debout ; je trouvai un peu d’eau et revins à Robert, dont je me mis à mouiller le visage, les tempes et les poignets.
Bientôt j’eus la joie de le voir ouvrir les yeux, regarder un instant les paisibles étoiles, puis reporter ses regards sur moi.
– Robert, lui dis-je doucement.
Il poussa un soupir, prit sa tête brûlante dans ses mains, avec mon assistance se mit sur son séant et laissa sa tête retomber sur ses genoux. Je lui fis boire quelques gorgées d’eau, et ceci lui fit du bien. Ses yeux retrouvèrent leur ancien éclat, les muscles leur ardente vigueur. S’accrochant à moi, il se mit sur ses jambes et puis lentement, craintivement, tourna les yeux vers la montagne.
Une exaltation folle s’empara de lui : il leva les bras, s’écriant :
– Les Titans nous ont ouvert la porte du trésor, – vois ! la montagne est fendue de son sommet à sa base.
C’était vrai.
Une large crevasse qu’éclairait le scintillement des étoiles allait grandissant de la base au sommet. C’était cette fêlure qui nous avait assourdis et assommés de son fracas.
– L’œuf est brisé, hurla presque Robert ; nous allons maintenant en tirer le jaune superbe.
Les premières lueurs de l’aube naissaient. J’insistai pour déjeuner avant d’entreprendre notre exploration, et ce ne fut point chose aisée que d’y décider mon fou. Les chevaux terrifiés avaient été aussi malmenés que nous-mêmes, mais de l’eau et une bonne provende les remit en état. Dès le lever du soleil, nous nous mettions en route.
Pour la première fois, je voyais nettement l’étrange montagne.
C’était un vaste dôme de roc solide, poli par le sable dont pendant des siècles les vents l’avaient battu. Seuls quelques escarpements susceptibles d’en permettre l’ascension subsistaient en de rares endroits.
Des ruines de la hutte, Robert tira une petite hachette et un carnier de cuir dont il passa la courroie sur son épaule.
– Tu peux m’accompagner et voir l’or si bon te semble, me dit-il, et tu pourrais m’aider. Mais ce serait trop dangereux pour tes jambes et tes pieds inexpérimentés de pénétrer dans la crevasse. C’est moi seul qui m’y risquerai pour l’instant.
Il était maintenant d’un calme merveilleux, d’un calme que je trouvais même de mauvais augure. Il avait trop de sang-froid, me paraissait trop confiant, trop avisé, trop irréfléchi. Un accès momentané le gonfla, lorsqu’il ajouta, en me serrant le bras :
– L’ami, ce ne sont pas des filons de niais que nous allons avoir, ce sont des blocs d’or !
Mais immédiatement il redevint calme – preuve qu’il savait qu’il lui fallait être maître de lui-même.
J’avais des appréhensions.
– Robert, fis-je hésitant, ne vaudrait-il pas mieux attendre quelques jours – ne fût-ce même qu’un jour – et nous assurer que le tremblement de terre est bien fini.
Il me considéra d’un air de tranquille pitié et me répondit :
– Il n’y a pas de tremblement de terre ici.
Et nous voilà partis vers la montagne.
Pour nous y rendre, il fallait passer la source. Elle avait disparu ! En son lieu et place, il n’y avait plus qu’un léger dégagement de vapeur. Robert à cette vue parut un instant décontenancé, mais il ajouta avec un mouvement de tête :
– Bah ! nous avons assez d’eau et le ruisseau de San Felipe n’est, après tout, pas si loin.
Nous voilà gravissant la pente polie, glissante, escarpée. Robert se montra plein de patience devant la lenteur de ma marche, et me tendait la main aux passages difficiles. Il me sembla qu’il nous avait fallu des heures d’un labeur épuisant pour en gagner le sommet.
– La croûte qui recouvre l’or est des plus minces ici, m’expliqua Robert d’une voix tranquille, comme si les moindres secrets de la montagne lui avaient été révélés.
Enfin, nous voici au sommet.
Robert me laissant en arrière, courut au bord de la crevasse et y plongea ses regards ; puis, se couchant à plat ventre, il la scruta si longuement que j’en fus surpris. Bientôt j’étais à son côté et suivis son exemple. Là, à moins de dix mètres de la surface, se voyait une masse jaune et scintillante, d’un poli éclatant qu’expliquait le frottement des parois, et qu’embrasaient les rayons du soleil. Je me gorgeais si goulûment les yeux de ce spectacle que j’en avais oublié Robert. Il éclata brusquement de rire et je tressaillis.
– Robert ! dis-je.
Il tourna vers moi le visage le plus étrange que j’eusse jamais vu éclairer l’âme d’un mortel. Il me paraissait d’un âge invraisemblable. Les yeux étaient profondément enfoncés dans l’orbite et dans leur profondeur brillaient des feux volcaniques ; les joues s’étaient creusées et, à la physionomie tout entière, l’avidité semblait avoir communiqué la dureté et le froid du marbre.
– Enfin ! balbutia-t-il, comme la glace et le feu faisaient tour à tour frémir chacun de ses membres. Enfin !
À cet endroit, la crevasse avait environ trois pieds de large – ouverture suffisante pour l’extraction du métal. Les parois opposées de la muraille rocheuse se hérissaient de nombreuses saillies qui offraient à un homme expérimenté des points d’appui suffisants.
Robert se rassasiait dans la contemplation de son trésor.
– Nous voilà riches, mon vieux, me dit-il, tournant de nouveau vers moi ce visage effrayant, hideux. Riches ! poursuivit-il. Ce n’est pas là le monde d’un miséreux. Comparé à nous, Monte-Cristo n’était qu’un mendiant. Ah, riches !… riches !
Il resta encore quelque temps ainsi, puis, prudemment se laissa glisser par-dessus le bord de l’abîme, reposa adroitement les pieds, et se mit à descendre lentement et posément, jusqu’à ce qu’il eût atteint son trésor. Il passa une main caressante sur sa surface polie, la baisa, il eut voulu pouvoir serrer la montagne dans ses bras ! Puis, hachant, fouillant, creusant avec sa hachette, lentement il poursuivit son travail, extrayant l’or. De gros morceaux irréguliers se détachaient, dont il s’emparait et qu’avec exaltation il me tendait à bout de bras afin que je les pusse voir.
Un étrange malaise s’empara de moi. Un je ne sais quoi se révoltait en moi.
– Robert, lui dis-je, la tête me tourne à toujours plonger dans cette crevasse. Je vais m’éloigner et t’attendre.
– Comme tu voudras, me répondit-il, enfouissant dans sa gibecière de cuir une autre énorme pépite.
Je m’éloignai : à quelque distance je trouvai un endroit qui m’offrait un espace uni où je me pouvais étendre. Je m’étendis. J’étais pris de vertiges et j’étouffais. Je m’efforçai de réagir, mais sans succès. Un mirage éblouissant me peignait maintenant la solitude aride du désert sous des couleurs si vives que je l’acceptais comme une réalité ; il me permettait de voir sans surprise une île magnifique couverte d’une luxuriante végétation, de superbes châteaux, et baignée des flots azurés de la mer, là où jusqu’à l’horizon j’avais vu s’étendre la morne plaine de sable désolée. Un engourdissement accablant, suffoquant, s’empara de moi. D’autres visions m’apparurent. Des dieux se livraient bataille dans le ciel ; je voyais confusément leurs armées en venir aux mains et je croyais percevoir affaibli le bruit des charges. Je crus les voir se rapprocher et le fracas devint plus fort. La terre tremblait sous les pas des bataillons.
Au dessus du tumulte monta un cri terrifiant : on eût dit qu’en lui s’étaient concentrées toutes les agonies des troupes forcenées qui tombaient mourantes dans la bataille. Il était si effroyable, si perçant, qu’il ébranla toutes les fibres de mon être. Je me levai brusquement pour retomber aussitôt.
Un instant, je crus que des vertiges, un éblouissement expliquait cette impuissance, mais en reprenant plus complètement mes sens, je compris qu’un tremblement de terre secouait la montagne.
Tout à cette horrible pensée j’avais oublié le cri qui m’avait tiré de ma torpeur. Je songeai à mon ami. Me traînant sur les genoux et les mains, je gagnai le bord de la crevasse et là le plus effrayant des événements de cet effroyable moment se déroula, tragique sous mes yeux.
Sous ces secousses répétées de la terre, Robert n’arrivait plus à se tenir. Tantôt une saillie se dérobait sous ses pieds, et il se cramponnait alors à la paroi opposée avec les mains. Une fois ou deux, il fit un effort désespéré pour remonter, mais il lui fallait toute sa vigueur et tout son sang-froid pour se maintenir en sûreté à l’endroit où il se trouvait.
Au dessus de lui, le gouffre s’ouvrait béant !
C’était son cri qui m’avait réveillé. Je cherchai à l’encourager, et mes paroles semblèrent doubler ses forces. Il n’était pas bien loin de moi, mais, en dépit de nos mutuels efforts, il nous fut impossible de nous agripper les mains. Alors je me disposai à pénétrer à mon tour dans le gouffre, mais avec un cri d’agonie, il me supplia de n’en rien faire.
Le tremblement de la montagne augmentait d’intensité. Et voilà que le danger se présentait sous une nouvelle et redoutable forme – la largeur de la brèche se modifiait ! Tantôt elle rétrécissait, tantôt elle s’élargissait. Robert leva les yeux vers moi…
Pour la première fois depuis les jours de notre enfance, je retrouvais sur sa physionomie la douce et bonne expression d’autrefois. Son sourire était tranquille. Je me cachai les yeux de mes mains et me reculai. Au même instant, sous une puissante convulsion, la déchirure de la montagne se refermait de la base au sommet, et il n’en restait plus qu’une longue et mince couture.
Mon cher vieil ami était désormais enseveli sous le roc éternel, dans ce sépulcre d’or élevé par notre mère, la Nature, et d’où je m’en revins, piloté par le vaste esprit silencieux du désert, emportant en mon cœur un souvenir que la mort seule lui ravira.
UNE VENGEANCE ORIGINALE
Je reçus un jour une lettre d’un soldat, nommé Gratmar, appartenant à la garnison de San Francisco. Je ne le connaissais que fort peu : notre connaissance était née de l’intérêt qu’il avait pris à certains articles que j’avais publiés et qu’il avait une manière à lui d’appeler « des études psychologiques ». C’était un beau gars, rêveur, romanesque, fier comme un lis, sensible comme un bluet.
Par quel caprice insensé avait-il été poussé à s’engager, je ne l’ai jamais su ; mais ce que je savais en revanche, c’est qu’il n’était pas là à sa place et j’avais prévu que son grossier entourage devait avec le temps, faire de lui un déserteur ou un meurtrier, ou le conduire au suicide.
La lettre tout d’abord paraissait être l’épanchement d’un désespoir farouche, car elle m’informait qu’avant même que je l’eusse reçue, son auteur serait mort de sa propre main. Mais après avoir lu plus loin j’en compris l’esprit ; je me rendis compte du projet froidement conçu qu’elle révélait et du terrible but qu’il se proposait. Le pire du contenu de la missive était l’avis qu’un certain officier (et il donnait son nom) l’avait poussé à cet acte et qu’il se suicidait dans la seule intention d’acquérir par là le moyen de se venger de son ennemi !
J’appris plus tard que l’officier avait reçu une épître semblable.
Le cas était si embarrassant que je m’assis pour réfléchir aux singularités de mon correspondant.
Il m’avait toujours paru un peu déséquilibré, et lui eussé-je montré plus de sympathie, il serait sans aucun doute entré plus avant dans les confidences et m’aurait exposé certains problèmes qu’il prétendait avoir résolus concernant la vie dans l’au-delà.
Une chose qu’il m’avait dite me revint précise à la mémoire : « Si seulement je pouvais surmonter cet amour de la vie, purement grossier et animal, qui nous fait tous éviter la mort, je me tuerai, car je sais combien je pourrais être plus puissant comme esprit que comme homme. »
Son mode de suicide fut saisissant et tel qu’on le pouvait attendre d’un si bizarre caractère.
Évidemment plein de mépris pour la flagornerie des enterrements, il était entré dans une petite casemate située dans un bastion près de la poudrière militaire et avec de la dynamite s’était fait sauter en un million de fragments, si bien qu’on ne trouva plus de son corps que de minuscules parcelles d’os et de chair.
Je tins secrète ma réception de sa lettre, voulant observer l’officier sans qu’il pût soupçonner mes intentions ; ce serait une admirable expérience du pouvoir d’un mort et de son intention réfléchie de hanter un vivant, car c’est ainsi que j’en avais interprété le contenu.
L’officier à punir était un homme d’un certain âge déjà, petit, apoplectique, arrogant et irascible. Il était en quelque sorte assez généralement bienveillant pour les hommes ; mais c’était un esprit grossier et mesquin ; ainsi s’expliquait suffisamment la manière rude dont il avait traité Gratmar qu’il ne pouvait pas comprendre, et ses efforts pour briser le caractère de ce jeune fou.
Peu de temps après ce suicide, mon attentive surveillance se rendit compte de certains changements survenus dans la conduite de l’officier. Sa colère, bien que continuant d’être sporadique, développa une disposition ayant quelques-unes des caractéristiques de la sénilité, et cependant il était encore en pleine maturité et passait pour vigoureux. Célibataire, il avait toujours vécu seul ; bientôt il se mit à éviter la solitude la nuit et à la rechercher le jour. Les officiers, ses camarades, le plaisantèrent ; il riait alors d’une façon un peu niaise et forcée, toute différente de sa manière de rire habituelle, et même, en certaines occasions, rougissait tellement que son visage devenait pourpre. Sa vigilance et sa sévérité militaires se relâchaient parfois étonnamment et à d’autres moments s’exagéraient en une inutile acerbité ; sous ce rapport, sa conduite rappelait assez celle d’un homme ivre qui, se sachant ivre, ferait un effort désespéré pour paraître de sang-froid.
Ces faits, et d’autres encore, indiquant une certaine tension d’esprit, ou quelque terrible appréhension, ou peut-être quelque chose de pire encore, étaient observés en partie par moi et en partie par un officier intelligent dont je m’étais assuré le concours, pour mieux surveiller mon homme.
Pour être plus précis, le malheureux avait été souvent vu tressaillant brusquement ; d’un air alarmé, il regardait vivement autour de lui, puis lançait quelque inintelligible réponse monosyllabique, comme à une imperceptible question que lui aurait posée une personne invisible. Le bruit s’était également répandu qu’il était maintenant la proie de cauchemars, et qu’au milieu de la nuit on pouvait l’entendre hurler de la plus lamentable manière, effrayant prodigieusement ses voisins. Après ces alertes, il se redressait brusquement dans son lit, le visage, ordinairement vermeil, exsangue, les yeux vitreux et brillants, la respiration coupée de soupirs convulsifs et le corps trempé d’une sueur froide.
Dans la garnison, on ne tarda pas à s’apercevoir de ces changements, mais ceux (et en général c’étaient des femmes) qui osaient lui témoigner de la sympathie ou suggérer un tonique, essuyaient de si violentes rebuffades qu’ils bénissaient le ciel d’échapper vivant au torrent de ses reproches et de ses récriminations. Le médecin-major de son bataillon, aux manières très bienveillantes, et le colonel, homme d’allures dignes et sérieuses, ne reçurent en échange de leur sollicitude que peu de remerciements. Bien clairement ce vaillant officier qui s’était battu comme un bouledogue dans deux guerres et avait pris part à cent batailles, souffrait extrêmement d’une inexplicable maladie.
Le nouveau fait extraordinaire qui se produisit fut sa visite un soir (elle ne fut pas suffisamment cachée pour dépister ma vigilance) chez un médium, – extraordinaire, parce que toujours il avait tourné en ridicule les soi-disantes communications avec les esprits.
Je le vis comme il sortait de chez le médium.
Il avait le visage pourpre ; les yeux terrifiés, lui sortaient de la tête ; sa démarche était chancelante. Un agent, témoin de son malaise, s’empressa de lui porter secours, mais l’officier d’une voix rauque demanda :
– Vite, un fiacre.
Il y tomba, plutôt qu’il ne s’assit et se fit reconduire au bastion, où il logeait, en dehors de la ville.
Je gravis rapidement l’escalier du médium. C’était une femme que je trouvai gisant inanimée sur le plancher. Bientôt, grâce à mes soins, elle revenait à elle, mais son état conscient m’effraya presque plus que l’autre. Tout d’abord elle me considéra avec frayeur et s’écria :
– C’est horrible à vous de le poursuivre ainsi !
Je l’assurai que je ne poursuivais qui que ce fût.
– Oh ! je croyais que vous étiez l’esp… je veux dire… je… oh ! il se tenait précisément où vous êtes, s’écria-t-elle.
– Je le crois volontiers, dis-je, mais vous voyez bien que je ne suis pas l’esprit du jeune homme. Toutefois, je suis très au courant de l’affaire, madame, et, si je puis être utile en ces circonstances, je vous serai reconnaissant de m’en informer. Je sais que notre ami est persécuté par un esprit qui le visite fréquemment, et je suis certain que, par votre intermédiaire il lui a fait savoir que la fin était proche et que la mort de notre vieil ami doit revêtir une forme terrible. Est-il quelque chose que je puisse tenter pour empêcher le drame ?
Un silence horrible suivit : elle me regardait fixement.
– Comment savez-vous tout cela ? murmura-t-elle enfin.
– Peu importe. Quand le drame aura-t-il lieu ? Puis-je l’empêcher ?
– Oui, oui, s’écria-t-elle. Il aura lieu cette nuit même ! Mais nul pouvoir terrestre ne le pourra empêcher !
Elle s’approcha de moi et me regarda avec une expression de la plus profonde terreur.
– Dieu tout-puissant ! Que vais-je devenir ? Il doit être assassiné, comprenez-vous – assassiné de sang-froid par un esprit, – et il le sait et moi, je le sais ! S’il en a le temps, il le dira à ses camarades de la garnison et tous croiront que j’y suis pour quelque chose ! Oh ! c’est terrible, terrible ! et pourtant je n’ose dire un mot à l’avance – aucun d’entre eux ne voudrait croire ce que disent les esprits et ils s’imagineront que je suis complice dans le meurtre.
L’angoisse de cette femme faisait peine à voir.
– Soyez certaine qu’il n’en dira rien, lui dis-je ; et si vous retenez votre langue, vous n’aurez rien à craindre du tout.
Je réussis ainsi, en ajoutant en hâte quelques mots de consolation, à la calmer et je m’empressai de partir.
C’est que j’avais en perspective quelque chose d’intéressant : ce n’est pas souvent qu’il est donné d’être témoin d’un meurtre du genre de celui-là ! Je courus chez un loueur, pris un cheval rapide, l’enfourchai et à toute bride me dirigeai du côté du bastion. Le fiacre avait de l’avance sur moi, mais ma monture était bonne et ses flancs se ressentaient de mon impatience. Quelques kilomètres d’une poursuite folle m’amenèrent en vue du fiacre au moment où il traversait un sombre ravin près du fortin. Comme je me rapprochais, il me sembla que le fiacre oscillait et qu’une ombre s’en échappait pour s’enfuir à travers le rideau d’arbres bordant la route, le long du ravin. Je ne me trompais certes pas relativement à l’oscillation, car la secousse avait attiré l’attention stupide du cocher. Je le vis tourner la tête d’un air alarmé et puis tirer brusquement sur ses guides.
Au même instant je le rejoignis et m’arrêtai.
– Est-ce qu’il y a quelque chose ? demandai-je.
– Je ne sais trop, grommela-t-il, descendant de son siège ; j’ai senti la voiture balancer et je vois que la portière est ouverte. Bien possible que le client se soit cru assez dégrisé pour faire le reste à pied sans vouloir me déranger ni moi ni sa bourse.
Durant ce temps, j’avais également mis pied à terre ; je frottai une allumette et à sa lueur nous aperçûmes, par la portière ouverte, le « client » ramassé sur lui-même au fond de la voiture, la tête renversée, et le menton maintenu par la poitrine, adossé qu’il était à l’autre portière, ne formant plus qu’une masse grossière et informe. Nous l’appelâmes ; il ne remua ni ne parla. Nous nous hâtâmes alors de monter dans la voiture et de le placer sur la banquette, mais sa tête roulait de droite et de gauche complètement inerte. Une nouvelle allumette nous fit voir un visage mortellement pâle et des yeux grands ouverts qui regardaient fixement sans rien voir.
– Vous ferez mieux de conduire le corps au quartier général, dis-je au cocher.
Au lieu de le suivre, je regagnai la ville de mon côté, reconduisis ma bête à l’écurie, et tout droit m’allai me mettre au lit. Ceci explique l’information des journaux relative au « mystérieux cavalier » que le magistrat chargé de l’enquête ne put jamais retrouver.
Environ un an après je reçus de Stockholm, Suède, la lettre suivante :
« Cher Monsieur, je lis depuis quelques années vos remarquables études psychologiques avec le plus vif intérêt, et je me permets de proposer un sujet à votre talent. Je viens dans une bibliothèque d’ici de trouver un journal daté d’il y a environ un an, qui rend compte de la mort mystérieuse d’un officier dans un fiacre. »
Puis suivaient les détails, tels que je les ai donnés, et ce même thème de vengeance posthume que j’ai adopté dans l’exposition des faits.
Certaines personnes pourront considérer comme très remarquable la coïncidence entre l’inspiration de mon correspondant et ma propre manière de voir, mais il est vraisemblablement bien d’autres faits merveilleux en ce monde et aucun d’eux ne m’étonne plus. Plus extraordinaire encore me semble son idée que dans l’explosion de dynamite un chien ou un quartier de bœuf pouvait tout aussi bien avoir été mis en pièces qu’un homme projetant de se suicider, que l’homme pouvait en somme ne pas s’être suicidé du tout, mais pouvait avoir joué la comédie du suicide afin de rendre plus efficace une persécution physique que devait terminer un assassinat commis par l’individu vivant, qui aurait lui-même tenu le rôle d’esprit. La lettre suggérait même une entente préalable avec un médium, et je vois là encore une assez bizarre coïncidence.
Le but avoué de cette lettre était de me proposer le sujet d’une autre de mes « études psychologiques » ; mais je trouve que c’est là une question d’un caractère trop sérieux pour la traiter avec la légèreté qui convient à la fiction. Si ces faits et ces coïncidences se trouvent moins embarrassantes pour d’autres que pour moi, ce serait rendre un précieux service à l’humanité que de lui signaler telle solution qu’un esprit plus perspicace que le mien aurait su en dégager.
La seule et la dernière révélation que je sois actuellement susceptible de faire, c’est que mon correspondant avait signé sa lettre « Ramtarg » – nom qui sonne bizarrement, mais qui, pour ce que j’en sais, peut être fort respectable en Suède. Et pourtant il y a dans ce nom quelque chose qui me hante sans cesse, tout comme un de ces rêves étranges que nous savons avoir rêvés et dont il nous est pourtant impossible de nous souvenir.
LE FAISEUR DE MONSTRES
I
Un jeune homme d’apparence élégante, mais sous l’évidente influence de sérieux troubles cérébraux, se présentait un matin à la porte d’un singulier vieillard, connu comme chirurgien d’une remarquable habileté.
La maison était une construction en briques, parfaitement démodée, et d’aspect si bizarre et primitif, que son existence ne s’expliquait que par l’éloignement du quartier où elle était située. Elle était vaste, triste et sombre, avec de longs corridors et de grandes pièces lugubres, bien trop vaste pour le petit ménage – le mari et la femme – qui l’occupait.
Décrire la maison, c’est faire le portrait de son principal locataire. Il savait se montrer aimable au besoin, mais restait néanmoins un mystère vivant.
La femme, elle, chétive, pâle, taciturne, évidemment malheureuse, peut-être témoin de choses répugnantes, exposée aux angoisses et victime de la crainte et de la tyrannie. Mais ce ne sont là, après tout, que des suppositions.
Il pouvait avoir soixante-cinq ans environ, et elle, on lui en eût donné quarante.
Il était maigre, grand et chauve, avait la figure mince et rasée et des yeux très vifs ; il ne sortait jamais et paraissait malpropre. L’homme était fort, la femme faible ; il dominait, elle souffrait.
Bien que chirurgien d’une adresse peu commune, sa clientèle était presque nulle ; il était rare, en effet, de voir ceux qui connaissaient sa grande habileté montrer assez de courage pour se risquer dans la lugubre habitation, et, quand ils s’y décidaient, il leur fallait faire la sourde oreille à toutes les vilaines histoires qui circulaient à son sujet.
Ce n’étaient pour la plupart que des exagérations auxquelles donnaient naissance ses expériences de vivisection : il était fanatique de chirurgie.
Le jeune homme qui se présenta le matin du jour dont nous parlons, était un grand et beau garçon, mais d’un caractère faible évidemment et d’un tempérament maladif, – nature sensitive aussi facilement la proie de l’exaltation que de l’abattement.
Un seul regard suffit à convaincre le chirurgien que son visiteur était atteint de troubles cérébraux sérieux : jamais sur un visage il n’avait vu plus profondément gravé le masque de la mélancolie, fixe et irrémédiable.
Un étranger n’eût pas soupçonné que la maison était habitée. La porte d’entrée, vieille, gauchie et gondolée par le soleil, était fermée à clé, et les minces volets, d’un vert passé, étaient clos.
Le jeune homme frappa à la porte.
Pas de réponse.
Il frappa de nouveau. En vain.
Il consulta un carré de papier, vérifia le numéro de la maison, puis avec l’impatience d’un enfant, lança un furieux coup de pied dans la porte, d’un air qui en laissait prévoir beaucoup d’autres.
La réponse cette fois ne se fit pas attendre : il entendit un pas furtif dans le vestibule ; une clé rouillée grinça dans la serrure et un visage effilé se montra dans l’entrebâillement de la porte.
– Êtes-vous le docteur ? demanda le jeune homme.
– Oui, oui ! entrez, répondit le maître de la maison.
Le jeune homme entra.
Derrière lui le vieux chirurgien referma la porte et, avec soin, tourna la clé.
– Par ici, dit-il, se dirigeant vers un escalier branlant.
Le jeune homme le suivit.
Le chirurgien gravit l’escalier, prit à gauche un étroit corridor où régnait une odeur de moisi, le longea, faisant sonner sous ses pas les lamelles disjointes du parquet et, arrivé au bout, ouvrant à sa droite une porte, il fit signe au visiteur d’entrer.
Le jeune homme se trouva dans une chambre agréable, meublée très simplement, à l’ancienne mode.
– Asseyez-vous, dit le vieillard et il disposa le siège de façon à ce que son visiteur fît face à une fenêtre donnant sur une muraille se dressant à six pieds de la maison. Il ouvrit les volets ; une lumière pâle pénétra dans la pièce. Puis il s’assit près du jeune homme, bien en face, et, d’un œil scrutateur qui avait toute la puissance d’un microscope, il se mit à diagnostiquer son cas.
– Eh bien ? interrogea-t-il enfin.
Le visiteur, gêné, s’agita sur sa chaise.
– Je… je suis venu vous voir, finit-il par balbutier, parce que je suis tourmenté.
– Ah !
– Oui, voyez-vous, j’ai… c’est-à-dire… j’y renonce.
– Ah !
Et il y avait dans cette exclamation un mélange de pitié et de sympathie.
– C’est bien ça. J’y renonce, ajouta le visiteur.
Il tira de sa poche une liasse de billets de banque et, avec le plus grand sang-froid, les compta sur ses genoux.
– Cinq mille dollars, dit-il avec calme. Ils sont pour vous. C’est tout ce que je possède ; mais je présume… j’imagine… non, ce n’est pas le mot juste… je suppose… oui, c’est bien le mot… je suppose que cinq mille dollars… Est-ce bien la somme exacte ? Laissez-moi compter.
De nouveau il compta les billets.
– Ces cinq mille dollars seront des honoraires suffisants pour ce que je désire de vous.
Les lèvres du chirurgien eurent un plissement de pitié, de dédain peut-être aussi.
– Que désirez-vous de moi ? demanda-t-il d’un air indifférent.
Le jeune homme se leva, regarda autour de lui d’un air mystérieux, s’approcha du chirurgien et lui mit la liasse sur les genoux. Puis il se pencha et lui chuchota quelques mots à l’oreille.
Ces mots produisirent sur lui l’effet d’une pile électrique.
Le vieillard sursauta brusquement, puis, se redressant d’une pièce, il empoigna son visiteur avec colère, et lui plongea dans les yeux son regard aussi tranchant qu’un couteau.
Ses yeux flamboyaient, et il ouvrait la bouche pour lancer quelque rude imprécation, quand soudain il se contint.
Toute colère disparut de son visage, qui n’exprima plus que de la pitié. Il relâcha son étreinte, ramassa les billets épars et, les tendant à son visiteur, dit lentement :
– Je n’ai nul besoin de votre argent. Vous êtes tout bêtement absurde. Vous vous croyez dans la peine. Eh bien, vous ne savez pas ce que c’est que la peine. Votre seule peine est de ne pas avoir la moindre virilité. Vous êtes simplement fou… je ne dirai pas pusillanime. Vous devriez vous remettre aux mains des autorités et vous faire envoyer, pour y suivre un traitement, dans quelque hospice d’aliénés.
Le jeune homme sentit vivement l’insulte voulue ; dans ses yeux passa une lueur dangereuse.
– Chien que vous êtes, oser m’insulter ainsi ! cria-t-il. Il vous sied de prendre de grands airs vertueux indigné, vieil assassin que vous êtes ! Vous ne voulez pas de mon argent, hein ! Quand un homme vient à vous de lui-même et vous le demande, vous vous emportez et repoussez son argent ; mais qu’un de ses ennemis vienne et vous paye, vous ne serez que trop bien disposé. Combien de vilenies semblables n’avez-vous pas commises dans votre misérable taudis ? Il est heureux que la police ne l’ait pas envahi et n’ait pas apporté pelle et pioche pour la circonstance. Savez-vous ce qu’on dit de vous ? Croyez-vous donc avoir tenu vos volets assez hermétiquement clos pour qu’aucun son n’ait pu les traverser ? Où cachez-vous vos instruments infernaux ?
Il en était arrivé à un état de violente colère. Sa voix était rauque, forte et rude. Les yeux, injectés de sang, lui sortaient des orbites. Son corps tout entier frémissait et ses doigts se crispaient. Mais il avait devant lui son maître. Les deux yeux adverses se trouaient en lui leur route.
Le résultat ne fut pas long.
– Asseyez-vous, commanda la voix dure du chirurgien.
C’était l’ordre d’un père à son enfant, d’un maître à son esclave. La colère du visiteur tomba, et, faible, vaincu, il s’abattit sur sa chaise.
En même temps, une animation insolite éclaira la physionomie du vieux chirurgien : aube d’une idée étrange ; morne rayon échappé à la fournaise de l’abîme sans fond ; lumière dangereuse, qui illumine la route des enthousiastes. Le vieillard un instant resta plongé dans une rêverie profonde, tandis que des éclairs d’avide intelligence perçaient momentanément le nuage de sombres méditations qui lui couvrait le visage. Puis éclata la large flamme d’une détermination impénétrable. Il y avait en elle quelque chose de sinistre, comme s’il se fût agi du sacrifice d’une chose jusque-là tenue pour sacrée.
Après une lutte, l’intelligence l’emportait sur la conscience.
Prenant une feuille de papier et un crayon, le chirurgien inscrivit soigneusement les réponses aux questions que d’un ton péremptoire il posa à son visiteur, relatives à son nom, son âge, son lieu de résidence, ses occupations, sa famille, etc.
– Quelqu’un sait-il que vous êtes venu frapper à cette porte ? demanda-t-il.
– Non.
– Vous le jurez ?
– Oui.
– Mais votre absence prolongée fera naître des inquiétudes et entraînera des recherches.
– J’ai prévu cela.
– Comment ?
– En jetant, en venant, une lettre à la poste annonçant mon intention de me noyer.
– On draguera la rivière.
– Et après ? demanda le jeune homme, haussant les épaules avec une insouciante indifférence. De rapides courants inférieurs existent, n’est-ce pas ? et on ne retrouve pas tout le monde…
Il y eut une pause.
– Êtes-vous prêt ? demanda finalement le chirurgien.
– Parfaitement.
La réponse était faite d’un ton froid et résolu.
Les manières du chirurgien dénotaient toutefois un trouble réel. La pâleur qui avait envahi son visage au moment où il avait pris une décision, devint intense. Un tremblement nerveux le secouait. Au-dessus brillait toujours la flamme de l’enthousiasme.
– Avez-vous choisi le moyen ? demanda-t-il.
– Oui ; anesthésie absolue.
– Et l’agent ?
– Le plus sûr et le plus rapide.
– Désirez-vous quelque… quelque sensation subséquente ?
– Non ; l’annulation seulement ; simplement m’éteindre, comme une bougie au souffle du vent ; un souffle… puis la nuit, sans trace. Le souci de votre propre sécurité vous suggérera la méthode la meilleure. Je m’en remets à vous.
– Aucun souvenir à vos amis ?
– Aucun.
Il y eut une nouvelle pause.
– M’avez-vous dit que vous étiez prêt ? demanda le chirurgien.
– Tout prêt.
– Et parfaitement consentant.
– Désireux est le mot.
– Alors, attendez un instant.
Sur ces mots, le vieux chirurgien se leva et se détira. Puis, avec la furtive circonspection d’un chat, il ouvrit la porte et jeta un coup d’œil dans le corridor, écoutant attentivement. Aucun bruit. Il referma doucement la porte et en tourna la clé. Puis il tira les volets et les fixa. Cela fait, il ouvrit une porte conduisant dans une pièce contiguë, qui n’avait pas de fenêtre et qu’éclairait seule une petite lucarne.
Le jeune homme le suivait attentivement des yeux.
Un grand soulagement se lisait sur ses traits et avait remplacé l’air d’égarement et de désespérance qu’il avait une demi-heure auparavant. Abattu tout à l’heure, il semblait maintenant dans le ravissement.
Cette porte, en s’ouvrant, laissait voir un spectacle curieux.
Au centre de la pièce, juste au-dessous de la lucarne, était une table d’opération, comme celles dont se servent les professeurs d’anatomie. Une vitrine, contre le mur, renfermait les instruments de chirurgie les plus variés. Dans une autre vitrine étaient suspendus des squelettes de différentes tailles. Sur des rayons étaient rangés des bocaux cachetés, renfermant, conservées dans l’alcool, des monstruosités de toutes sortes. Parmi les objets innombrables épars dans la pièce, se trouvaient encore un écorché, un chat empaillé, un cœur humain desséché, des moulages de différentes parties du corps, des schémas et un grand assortiment de drogues et de produits chimiques. Il y avait aussi un grand sofa pouvant se former un lit.
Le chirurgien l’ouvrit et, tirant de côté la table d’opération, mit le sofa ouvert à sa place.
– Entrez, dit-il à son visiteur.
Le jeune homme obéit sans la moindre hésitation.
– Ôtez votre veste.
Ainsi fut fait.
– Couchez-vous sur ce lit.
Un instant après, le jeune homme était étendu tout de son long, observant le chirurgien. Celui-ci, sans aucun doute, en proie à une très grande excitation, n’hésitait cependant pas. Ses mouvements étaient sûrs et prompts. Choisissant une fiole, il mesura avec soin une certaine quantité du liquide qu’elle renfermait.
Pendant qu’il était ainsi occupé, il demanda :
– N’avez-vous jamais eu de troubles au cœur ?
– Non.
La réponse fut prompte, mais immédiatement suivie d’un regard ironique à l’adresse de l’interlocuteur.
– Je présume, ajouta-t-il, que votre question signifie qu’il pourrait être dangereux de me faire absorber une certaine drogue. Étant données les circonstances cependant, j’avoue ne pas saisir l’à-propos de votre demande.
Cela déconcerta un moment le vieux chirurgien, mais il se hâta d’expliquer qu’il était soucieux de ne pas lui infliger une douleur inutile.
Il posa le verre sur la table, s’approcha de son visiteur et soigneusement lui tâta le pouls.
– C’est merveilleux ! s’écria-t-il.
– Pourquoi ?
– Il est parfaitement normal.
– Parce que je suis complètement résigné. Il y a même longtemps que je n’ai éprouvé pareil bonheur. Il n’est point actif, mais infiniment doux.
– Vous n’avez aucun désir latent de vous dédire ?
– Aucun.
Le chirurgien se dirigea vers la table et revint avec le breuvage.
– Prenez ceci, dit-il avec bonté.
Le jeune homme se souleva et prit le verre. Pas un de ses muscles ne tressaillit. Il but le liquide jusqu’à la dernière goutte, puis rendit le verre avec un sourire.
– Merci, dit-il ; vous êtes l’homme le plus noble de ce monde. Puissiez-vous toujours prospérer et vivre heureux ! Vous êtes mon bienfaiteur, mon libérateur. Soyez béni, béni ! Vous vous êtes baissé vers moi avec les dieux pour m’enlever dans la paix glorieuse et le repos. Je vous aime, je vous aime de tout mon cœur !
Ces mots, dits avec conviction, d’une voix basse et mélodieuse, accompagnés d’un sourire d’une ineffable tendresse, percèrent le cœur du vieillard. Un frémissement réprimé le secoua ; une angoisse intense lui tordit le cœur, la sueur ruissela sur son front. Le jeune homme continuait de lui sourire.
– Ah ! cela me fait du bien ! dit-il.
Le chirurgien s’assit sur le bord du sofa et, prenant le poignet de son visiteur, compta les pulsations.
– Combien de temps cela prendra-t-il ? demanda le jeune homme.
– Dix minutes. Deux se sont écoulées déjà.
Sa voix était rauque.
– Ah ! plus que huit minutes !… Délicieux, délicieux ! je la sens venir… Qu’est-ce que c’était que ça ?… Ah ! je comprends… De la musique… Superbe ! Elle vient, elle vient !… Est-ce là de… l’eau ? Elle coule !… Elle ruisselle ! Docteur !
– Eh bien ?
– Merci… merci… noble cœur… mon sauveur… mon bien… mon bienfaiteur… Elle coule… coule… elle ruisselle… Docteur !
– Eh bien ?
– Docteur !
– Il est maintenant sourd, marmonna le chirurgien.
– Docteur !
– Et aveugle.
Il n’eut pour toute réponse qu’une vigoureuse étreinte de la main.
– Docteur !
– Et froid.
– Docteur !
Le vieillard observait et attendait.
– Elle coule… coule…
La dernière goutte avait coulé. Il y eut un soupir, puis plus rien.
Le chirurgien, qui lui tenait la main, la laissa retomber.
– C’est le premier pas, gémit-il en se levant (Tout son être se dilata.) Le premier pas, – le plus difficile et pourtant le plus simple. La remise providentielle entre mes mains de ce que, depuis quarante ans, j’ai si ardemment désiré. Pas moyen maintenant de reculer ! C’est possible, parce que c’est scientifique ; rationnel, mais dangereux. Si je réussis – si ? Je réussirai. Je veux réussir… Et après la réussite, quoi ? Oui, quoi ? Publier le projet et les résultats. La potence. Tant que lui il existera et que moi j’existerai, la potence. Ceci fait… Mais comment expliquer sa présence ? Ah, voilà qui est embarrassant ! Ayons confiance en l’avenir.
Il tressaillit.
– Je me demande si elle a entendu ou vu quoi que ce soit…
À cette pensée, après un regard jeté sur la forme qui gisait sur la couche, il sortit de la pièce, en ferma la porte à clé, ferma de même la porte de la seconde pièce, suivit deux ou trois corridors, pénétra dans une partie écartée de la maison et frappa à une porte.
Dans l’intervalle, il avait reconquis tout son empire sur lui-même.
– J’avais cru entendre quelqu’un dans la maison tout à l’heure, dit-il, mais je ne trouve personne.
– Je n’ai rien entendu.
Il éprouva un réel soulagement.
– J’ai cependant entendu frapper à la porte il y a moins d’une heure, reprit-elle, et je vous ai, je crois, entendu causer. L’avez-vous fait entrer ?
– Non.
La femme regarda les pieds de son mari et parut embarrassée.
– Je suis presque certaine, dit-elle, d’avoir entendu un bruit de pas dans la maison, et cependant je m’aperçois que vous avez vos pantoufles.
– Oh, j’avais mes souliers tout à l’heure.
– Voilà qui explique tout, dit la femme satisfaite ; ce sont des rats que nous avons entendus.
– Ah ! c’est bien possible, fit le chirurgien.
Il s’en alla.
Il avait refermé la porte. Il la rouvrit pour dire :
– Je voudrais bien ne pas être dérangé aujourd’hui.
Et, tandis qu’il longeait le corridor, il se disait :
– De ce côté tout va bien !
Il regagna la pièce où gisait le visiteur qu’il examina soigneusement.
– Le splendide spécimen ! fit-il à voix basse : tous les organes sont sains, toutes les fonctions parfaites ; le corps est beau ; les muscles sont bien formés, forts et nerveux, susceptibles d’un développement merveilleux, si l’occasion leur en est donnée… Je ne doute pas que ce ne puisse se faire. Déjà j’ai réussi avec un chien, tâche moins difficile que celle-ci, car chez l’homme, le cerveau recouvre le cervelet, ce qui n’est pas le cas chez le chien. Voici qui offre un vaste champ aux expériences, avec une occasion unique dans le cours de toute une vie ! Dans le cerveau, l’intelligence et les affections ; dans le cervelet, les sens et les forces motrices ; dans la moelle allongée, le centre respiratoire. Dans le cervelet et la moelle se trouvent tous les principes essentiels de la simple existence. Le cerveau n’est qu’une parure ; en fait, la raison et les affections servent presque purement d’ornement. Je l’ai prouvé déjà. Mon chien, le cerveau une fois enlevé, était idiot, mais dans une certaine mesure conservait ses sens physiques.
Tout en se parlant ainsi il faisait de diligents préparatifs.
Il éloigna la couchette, replaça sa table d’opération au-dessous de la lucarne, choisit un certain nombre d’instruments, prépara certaines drogues, disposa de l’eau, des serviettes et tous les accessoires d’une longue opération chirurgicale.
Soudain il éclata de rire.
– Pauvre niais ! s’écria-t-il. M’avoir payé cinq mille dollars pour le tuer ! N’avoir pas le courage de souffler lui-même sa bougie ! Singulières, singulières, bizarres, les lubies qu’ont ces fous ! Tu croyais mourir, pauvre idiot ! Permettez-moi, monsieur, de vous informer que vous êtes aussi vivant en ce moment que vous l’étiez tout à l’heure. Mais pour vous ce sera tout comme ; jamais vous ne serez plus conscient que vous ne l’êtes en ce moment ; et pour toute fin pratique, en ce qui vous concerne, vous êtes dorénavant mort, quoique vous deviez vivre. Soit dit en passant, que diriez-vous de perdre la tête ? Ha, ha, ha !… mais c’est une plaisanterie macabre !
Il souleva de la couchette le corps inerte et l’étendit sur la table d’opération.
II
Trois ans après environ, la conversation suivante avait lieu entre le chef de la police et l’un de ses agents :
– Elle pourrait bien être folle, suggérait le chef.
– Je pense qu’elle l’est en effet.
– Et cependant vous ajoutez foi à ses dires !
– Oui.
– Singulier !
– Du tout. J’ai de mon côté appris quelque chose !
– Quoi ?
– Beaucoup dans un sens, peu dans l’autre. Vous savez les bruits bizarres qui circulent sur son mari. Eh bien, ils sont tous absurdes – probablement à une exception près. C’est, à tout prendre, un vieillard inoffensif, mais original. Il a fait de merveilleuses opérations chirurgicales. Les gens de son voisinage sont des ignorants ; ils le craignent et voudraient se débarrasser de lui : de là un tas de racontars qu’ils colportent de tous côtés et auxquels ils finissent par croire eux-mêmes. Le seul fait important que j’aie retenu, c’est qu’il est presque follement enthousiaste des questions de chirurgie, et en particulier de chirurgie expérimentale : or, chez un enthousiaste, il n’y a guère place pour le scrupule. C’est là ce qui me fait croire au dire de cette femme.
– Vous dites qu’elle paraissait terrorisée ?
– Doublement, et parce qu’elle craignait que son mari n’apprît sa trahison et parce qu’aussi la découverte en soi l’avait épouvantée.
– Mais ce qu’elle raconte de cette découverte est bien vague, dit le chef. Il lui cache tout, soigneusement. Elle en est réduite à de simples hypothèses.
– En partie, oui ; en partie, non. Elle a entendu des sons, bien qu’elle n’ait pu les distinguer nettement. L’horreur lui ferma les yeux. Ce qu’elle croit avoir vu est, je l’admets, parfaitement absurde ; mais elle a certainement vu quelque chose de terrifiant. Il y a beaucoup de petits détails intéressants. Il n’a que rarement partagé ses repas pendant ces trois dernières années et presque toujours il emporte ses aliments dans ses pièces réservées. Elle prétend, ou bien qu’il en consomme une énorme quantité, ou bien qu’il les jette, ou bien qu’il nourrit un être quelconque d’un appétit prodigieux. Il lui donne comme explication qu’il garde des animaux pour ses expériences. Or, c’est faux. De plus, il tient toujours la porte de ses chambres soigneusement fermées. Ce n’est pas tout : il a fait faire de doubles portes renforcées et fait poser de solides barreaux à une fenêtre qui cependant ne donne que sur une très haute muraille sans ouverture aucune et qui n’est distante que de quelques pieds.
– Que signifie tout cela ? demanda le chef.
– C’est une vraie prison.
– Pour ses animaux, peut-être.
– Certainement pas.
– Pourquoi ?
– Parce que, en premier lieu, des cages eussent infiniment mieux valu ; en second lieu, les précautions qu’il a prises ne sont nullement en rapport avec celles qu’exigerait la présence de quelques animaux ordinaires.
– Mais tout se peut expliquer aisément ; ne pourrait-il avoir en traitement quelque fou dangereux ?
– J’y avais songé, mais ce n’est pas non plus le cas.
– Comment le savez-vous ?
– En raisonnant ainsi : il a toujours refusé de traiter des cas de folie ; il s’en tient à la chirurgie ; les murs ne sont pas matelassés, car la femme les a entendus résonner sous des coups furieux ; aucune force humaine, pour morbide qu’elle fût, n’expliquerait les précautions prises ; il n’est pas probable qu’il cacherait à sa femme la présence d’un fou confié à ses soins ; il n’est pas de fou susceptible d’absorber tous les aliments qu’il emporte ; une folie furieuse assez violente pour nécessiter toutes ces précautions ne saurait se continuer pendant trois ans ; s’il y avait un fou dans l’affaire, il s’en serait suivi certaines communications avec des gens du dehors, parents de son malade ; il n’y en a pas eu ; la femme a écouté à la serrure et n’a jamais entendu de bruits de voix ; et enfin nous avons la description vague que la femme nous a faite de ce qu’elle a vu.
– Vous avez détruit toutes les suppositions possibles, dit le chef profondément intéressé, mais vous n’avez rien suggéré de nouveau.
– Je ne le puis pas, malheureusement ; la vérité pourrait être simple, après tout. Mais le vieux chirurgien est si original que je m’attends cependant à découvrir quelque chose de surprenant.
– Avez-vous des soupçons ?
– Oui.
– Sur quoi ?
– Un crime. La femme le soupçonne également.
– Et le dénonce ?
– Certainement ; parce qu’il est tellement terrible que son humanité se révolte ; tellement terrible que tout son être lui crie de livrer le criminel à la justice ; tellement épouvantable qu’elle vit dans une mortelle terreur ; tellement effrayant, que son esprit en est ébranlé.
– Que vous proposez-vous de faire ? demanda le chef.
– Trouver une preuve. Je puis avoir besoin de monde.
– Vous aurez tous les agents que vous jugerez nécessaires. Mais soyez circonspect. Vous êtes là sur un terrain dangereux. Vous ne seriez qu’un jouet entre les mains de cet homme.
Deux jours après, l’agent, de nouveau, se présentait devant son chef.
– J’ai un document bizarre, dit-il, tirant de sa poche des fragments de papier couverts d’écriture ; la femme les a volés et me les a apportés. Elle a voulu arracher une poignée de feuillets d’un cahier, mais n’a pu prendre qu’une partie de chacun.
Les deux hommes arrangèrent de leur mieux ces fragments, qui avaient été, expliqua l’agent, arrachés par elle d’un cahier qui formait le premier volume d’une série de manuscrits que son mari avait précisément rédigés sur le sujet même qui causait sa terreur.
– Vers l’époque où, il y a trois ans, il entreprit une certaine expérience, continua l’agent, il enleva tout ce qui se trouvait dans les deux pièces contiguës qui forment son cabinet de travail et son laboratoire. Dans une des bibliothèques qui se trouvèrent ainsi déplacées était un tiroir qu’il tenait fermé, mais qu’il ouvrait de temps à autre. Or, ce qui est assez commun pour ce genre de meubles, la serrure ne vaut pas grand-chose, et la femme, en cherchant bien, hier, a fini par trouver dans son trousseau une clé qui s’y adaptait parfaitement. Elle a ouvert le tiroir, tiré de dessous une pile de cahiers le dernier, afin que le larcin échappât plus facilement à une découverte, et, voyant qu’on y pouvait trouver un indice, en déchira une poignée de feuillets. Elle avait à peine eu le temps de remettre le cahier à sa place, de refermer le tiroir et de disparaître que son mari survenait. Il ne la perd presque jamais de vue quand elle est dans cette partie-là de la maison.
Les fragments rapportés se lisaient comme suit :
« … les nerfs moteurs. J’avais à peine osé prévoir pareil résultat, bien que, par induction, j’eusse conclu à leur possibilité, mon seul doute reposant sur mon manque d’habileté. Leur action n’a été que légèrement altérée et même elle ne l’eût pas été du tout si l’opération avait été faite dès l’enfance, avant que l’intelligence eût cherché et pris sa place comme partie essentielle du tout. Je tiens donc pour prouvé que les cellules des nerfs moteurs ont des forces inhérentes suffisantes au rôle de ces nerfs. Il en est à peine de même pour les nerfs sensitifs. Ces derniers sont, par le fait, un produit des premiers, dérivés d’eux par hétérogénéité naturelle (quoique non essentielle) et, dans une certaine mesure, ils dépendent de l’évolution et de l’expansion d’un résultat parallèle, qui se développe en fonction mentale. Ces deux derniers résultats, ces dérivés, ne sont que des affinages du système moteur et non des entités indépendantes ; c’est-à-dire que ce sont les fleurs d’une plante qui se propage de la racine. Le système moteur est le premier… et je ne suis pas surpris du développement de cette prodigieuse puissance musculaire. Elle promet de surpasser les rêves de force humaine les plus insensés. Je l’explique ainsi : les forces assimilatrices avaient atteint leur complet développement. Elles avaient acquis l’habitude d’une certaine somme de travail. Elles distribuaient leurs produits à toutes les parties du système. Mon opération a eu pour résultat de réduire d’une moitié la consommation de ces produits, c’est-à-dire qu’une moitié environ de la demande a été supprimée. Mais la force de l’habitude nécessitait la distribution de ces produits. Ces produits, c’était la force, la vitalité, l’énergie. Ainsi doublée, cette somme habituelle de force, d’énergie s’est emmagasinée dans le reste… a produit un résultat qui certes m’a stupéfié. La nature, ne subissant plus le tiraillement de ces interventions étrangères et étant en même temps, pour ainsi dire, coupée en deux, dans le cas actuel, ne s’est pas complètement accommodée à sa nouvelle situation, comme le fait un aimant, qui, quand on le brise au point d’équilibre, renaît entièrement dans chacun de ses fragments qu’il investit tous deux de pôles opposés : au contraire, soustraite à des lois qui jusque-là l’avaient dominée, et possédant toujours cette mystérieuse propension à se développer en quelque chose de plus potentiel et de plus complexe, elle a, à l’aveuglette (ayant perdu sa lanterne), augmenté sa demande d’aliments destinés à lui assurer ce développement, et les a tout aussi aveuglément absorbés quand elle les a reçus. De là cette merveilleuse voracité, cette insatiable faim, cette étonnante gloutonnerie ; et de là aussi (puisqu’il n’y a plus rien que la partie physique qui puisse recevoir cet immense approvisionnement d’énergie) cette force qui d’heure en heure devient plus herculéenne, presque chaque jour plus effrayante. Cela devient sérieux… Je l’ai échappé belle aujourd’hui. Je ne sais comment, pendant une de mes absences, il a dévissé le bouchon fermant le tube d’alimentation en argent (que déjà j’ai dénommé « bouche artificielle »), et, au cours d’une de ses curieuses gambades, il a laissé tout le chyle s’échapper de son estomac par le tube. Sa faim est alors devenue intense, – je pourrais dire furieuse. J’ai essayé de le prendre et de le maintenir sur une chaise, mais il m’a saisi, m’a pris par le cou et m’aurait instantanément broyé si je n’avais pu glisser de sa puissante étreinte. Il me faut toujours être sur mes gardes. J’ai pourvu le bouchon à vis d’un ressort à cliquet, et… habituellement docile quand il n’a pas faim ; lent et lourd dans ses mouvements, qui sont, naturellement, tous inconscients ; toute excitation apparente du mouvement est due à des irrégularités locales dans l’approvisionnement de sang du cervelet, que j’exposerais, si je ne l’avais enfermé dans un coffret d’argent que je ne puis plus déplacer, et… »
Le chef regarda l’agent d’un air embarrassé.
– Je n’y comprends rien du tout, dit-il.
– Ni moi, avoua l’agent.
– Qu’avez-vous l’intention de faire ?
– Pénétrer dans l’immeuble.
– Voulez-vous quelqu’un ?
– Il me faut trois hommes. Les trois plus vigoureux.
– Mais le chirurgien est un faible vieillard !
– Soit ; mais il me faut néanmoins trois hommes vigoureux, et même, dans le cas présent, si j’écoutais la voix de la prudence, j’en prendrais vingt.
III
À une heure du matin, le lendemain, on eût pu entendre gratter avec circonspection au plafond du laboratoire du chirurgien. Quelque temps après, la lucarne était soigneusement soulevée et déplacée. Un homme regarda par l’ouverture, mais tout était silencieux.
– Voilà qui est singulier, pensa l’agent.
Il se laissa prudemment glisser au moyen d’une corde jusqu’au sol, et resta là quelques instants, l’oreille tendue, attentif.
Le silence.
Il fit jouer le couvercle d’une lanterne sourde et rapidement balaya la chambre d’un jet de lumière. Elle était vide, à l’exception d’un solide crampon de fer et d’un anneau, vissé dans le plancher au centre de la pièce ; à l’anneau était fixée une lourde chaîne.
L’agent voulut alors examiner la seconde chambre : parfaitement vide aussi.
Très embarrassé, il retourna dans la première, et doucement appela ses hommes, leur disant de descendre.
Pendant ce temps il passait de nouveau dans la pièce contiguë pour examiner la porte. Un seul coup d’œil lui suffit. Un système spécial la maintenait close et une cadole à ressort, qui se pouvait tirer de l’intérieur, la fermait solidement.
– L’oiseau vient de s’envoler, pensa l’agent. Singulier hasard ! Si ma supposition est juste. Oui, seul un hasard pouvait amener la découverte de ce verrou particulier et de son maniement.
Ses hommes l’avaient maintenant rejoint.
Sans bruit il tira le verrou, ouvrit la porte et regarda dans le corridor. Il entendit un bruit particulier. On eût dit qu’un gigantesque homard jouait des pattes et des pinces et s’avançait dans quelque partie éloignée de la vieille maison. Ce bruit était accompagné d’une respiration forte et sifflante, entrecoupée de hoquets convulsifs.
Une autre personne entendit ces bruits : la femme du chirurgien.
Ils se faisaient en effet entendre tout proche de sa chambre, située bien loin de celle de son mari. Son sommeil était léger, torturée qu’elle était par la peur et harassée par d’épouvantables rêves. La conspiration où elle était entrée pour consommer la ruine de son mari, lui était une source d’angoisses. Elle ne vivait plus que dans une atmosphère de terreur. À cette horreur naturelle de la situation s’ajoutaient ces innombrables sources de craintes que se crée et que grossit un esprit ébranlé.
Réveillée en sursaut de son sommeil fiévreux par ce bruit à sa porte, elle sauta de son lit. L’idée de fuir – l’un des instincts les plus puissants – s’empara d’elle, et elle courut à la porte, sa raison ayant perdu tout contrôle. Elle tira son verrou, ouvrit brusquement sa porte et s’enfuit follement par le corridor, tandis qu’à ses oreilles le sifflement effrayant et les hoquets convulsifs résonnaient avec une intensité mille fois plus grande.
Mais le corridor était plongé dans la plus complète obscurité, et elle n’avait pas fait dix pas qu’elle alla buter contre un objet invisible sur le plancher. Elle tomba tout de son long sur une masse large, molle et chaude qui se tordait et se tortillait et d’où s’échappaient les bruits qui l’avaient éveillée.
Se rendant immédiatement compte de sa situation, elle poussa un hurlement d’indicible terreur. Le cri avait à peine éveillé les échos du corridor vide qu’il était aussitôt étouffé : deux bras vigoureux s’étaient refermés sur elle et l’avaient broyée.
Son cri eut pour résultat d’indiquer à l’agent et à ses aides la direction à prendre ; il avait en même temps réveillé le vieux chirurgien, dont la chambre était située entre les agents et le but de leurs recherches. Ce cri d’agonie l’avait transpercé jusqu’à la moelle.
– C’est enfin arrivé ! bégaya-t-il, terrifié, sautant de son lit.
Saisissant sur la table une lampe dont il avait, en se couchant, simplement baissé la mèche, et un long couteau que, depuis trois ans, il gardait toujours à sa portée, il se précipita dans le corridor.
Les quatre agents s’étaient élancés, mais quand ils le virent surgir, ils s’arrêtèrent silencieux.
Il y eut un instant de calme. Le chirurgien fit une pause pour écouter. Il entendit le sifflement et la marche gauche d’une masse vivante dans la direction de la chambre de sa femme. Évidemment cette masse s’avançait vers lui, mais un coude du corridor empêchait qu’il la vît. Il leva sa lampe, qui révéla la mortelle pâleur de son visage.
– Femme ! appela-t-il.
Point de réponse.
Il avança rapidement, suivi des quatre agents. Il tourna l’angle du corridor et courut si rapidement qu’avant d’être aperçu de nouveau par les agents, il avait sur eux une avance de vingt pas. Sans s’arrêter, il dépassa une masse énorme, informe, qui s’avançait en s’agitant, en rampant, en se tortillant, et arriva au cadavre de sa femme.
Il jeta un regard épouvanté sur son visage et s’éloigna en chancelant. Puis une fureur soudaine s’empara de lui. Étreignant solidement son couteau et élevant haut sa lampe, il s’élança vers la masse dégingandée qui oscillait dans le corridor.
C’est alors que les agents, qui s’avançaient avec précaution, virent un peu plus clairement, quoique encore assez indistinctement, l’objet de la colère du chirurgien et la raison de l’inexprimable angoisse peinte sur ses traits. Le hideux spectacle les fit s’arrêter.
Ils virent ce qui apparemment était un homme et cependant n’était évidemment pas un homme ; épais, grossier, difforme ; masse trébuchante, chancelante, grouillante, complètement nue. Ses larges épaules se dressèrent, il n’avait point de tête ; à sa place, une petite boule de métal surmontait le cou massif.
– Démon ! hurla le chirurgien, levant son couteau.
– Arrêtez ! commanda rudement une voix.
Le chirurgien brusquement leva les yeux et vit les quatre agents ; un instant, la peur paralysa son bras.
– La police ! murmura-t-il.
Alors, avec un regard de fureur décuplée, il lança le couteau qui s’enfonça jusqu’à la garde dans la masse grouillante devant lui.
Le monstre blessé se mit sur ses pieds et battit follement l’air de ses bras, tandis que des sons terribles s’échappaient d’un tube d’argent, par lequel il respirait. Le chirurgien chercha à lui porter un second coup, mais n’en eut pas le temps. Sa fureur aveugle lui avait fait perdre toute prudence : il fut saisi par une étreinte de fer.
Dans la lutte, la lampe alla rouler à quelques pas des agents ; en touchant le sol, elle se brisa. Simultanément l’huile prit feu et le corridor s’emplit de flammes.
Les agents ne pouvaient approcher.
Devant eux se dressait un rideau de feu et, derrière, en toute sécurité les deux formes luttaient, étroitement enlacées. Ils entendirent des cris, des hoquets ; ils virent luire la lame d’un couteau.
Le bois de la maison était vieux et sec. Il s’embrasa vite et les flammes se propagèrent avec une invraisemblable rapidité. Les quatre agents battirent en retraite et eurent toutes les peines du monde à s’échapper.
Une heure après, plus rien ne restait de la mystérieuse habitation et de ses locataires, sauf un amas de ruines noircies.
L’HONNEUR POUR ENJEU
I
Quatre de ces cinq hommes assis autour de la table de jeu, dans le carré de la « Jolie sorcière », considéraient le cinquième d’un dur regard d’implacable mépris. L’autre ne put soutenir ce regard terrible. Il baissa la tête et ses yeux se posèrent sur les cartes que ses doigts maniaient machinalement, tandis qu’il attendait, froid et indifférent, que fût prononcée la sentence.
Le plus impérieux des quatre le désigna d’un doigt dédaigneux, puis s’adressa aux autres de la sorte :
– Messieurs, aucun d’entre nous n’a oublié les clauses du traité qui nous lie. Il a été convenu, au début de cette expédition, que seuls des hommes d’une intégrité absolue se verraient autorisés à participer aux dangers prévus et aux récompenses possibles. Pour trouver et entrer en possession du magnifique trésor que nous cherchons avec la pleine certitude de le découvrir, il nous faut courir le risque de rencontres avec les sauvages soldats et marins du Mexique et accepter toutes les autres dangereuses aventures que nous connaissons. Quand j’ai affrété ce navire et pris la direction de cette expédition, j’ai apporté au choix de mes associés le soin le plus minutieux. Nous avons été et nous sommes encore égaux, et le fait d’avoir équipé cette expédition, tout en m’en donnant la direction, ne m’accorde aucun avantage dans le partage du trésor. Comme chef cependant, c’est moi qui commande et j’ai employé, sans que vous le puissiez soupçonner, bien des moyens afin de m’assurer de votre courage à tous. Si je n’avais à l’heure actuelle épuisé toutes les ressources possibles pour atteindre mon but, et si je ne vous avais pas trouvé tous, hormis un seul, dignes d’une absolue confiance, je ne vous révélerais pas aujourd’hui le plan que j’ai suivi.
Les trois autres qui avaient continué de regarder fixement le camarade qui se tenait devant eux la tête basse, reportèrent maintenant leurs regards sur leur chef avec surprise et intérêt.
– L’ultime moyen d’éprouver le caractère de tout individu, poursuivit le chef avec calme, c’est la table de jeu. Tout ce qu’il peut y avoir en lui de faiblesse, que ce soit avarice sordide, lâcheté ou duperie, se révélera là inévitablement. Et fussé-je administrateur de banque, général en chef d’une armée, ou directeur de toute autre grande entreprise, je m’imposerai de mettre à l’épreuve le caractère de mes subordonnés dans une série de parties de cartes, dont les enjeux seraient de préférence de l’argent. C’est la seule épreuve certaine d’un caractère qu’ait été susceptible d’imaginer la sagesse des siècles.
Il se tut, puis tourna dédaigneusement les yeux vers le malheureux, qui maintenant avait retrouvé assez de courage pour relever la tête, et employait ses yeux et ses oreilles à comprendre l’étrange philosophie de son juge. Une expression dont les éléments étaient faits de terreur et de consternation, ravinait curieusement son visage blême, comme s’il s’était trouvé comparaître devant un tribunal d’une impénétrable sagesse et d’une inexorable justice.
Pourtant, dès que son regard rencontra celui de son juge, il baissa les yeux, et sa lèvre inférieure trembla.
– Nous sommes tous tombés d’accord, continua gravement le chef, que quiconque parmi nous serait trouvé coupable d’avoir, si peu que ce fût, trompé ou trahi les autres, aurait à subir le châtiment que nous avons tous prêté le serment d’exiger. L’une des clauses de cet accord, et nous nous le rappelons tous fort bien, veut que le coupable exige lui-même l’exécution de la peine prévue ; ce n’est qu’au cas où il s’y refuserait…, mais je pense qu’il est inutile de mentionner l’alternative.
Il y eut un silence.
Le coupable était assis, immobile, respirant à peine ; une à une ; les cartes lui glissèrent des doigts et tombèrent sur le plancher.
– M. Rossiter, dit le chef s’adressant à l’infortuné d’un ton si dur et si glacial qu’il devait lui congeler la moelle dans les os, avez-vous quelque avis à émettre ?
Il y eut chez le condamné ce pitoyable effort pour redevenir maître de soi que fréquemment révèle l’échafaud. S’il avait eu une lueur momentanée d’espoir due à quelque passagère résolution de plaider sa cause, elle s’éteignit devant les regards durs et implacables qui le considéraient tout autour de la table. Certes, une lutte terrible, révélée par une fugitive rougeur qui empourpra ses traits, avait tordu un instant son âme, mais elle cessa vite, et l’acceptation de son sort se put lire sur son visage.
Il leva alors la tête, et ferme et résolu regarda le chef en face. Sa poitrine en même temps se développait et ses épaules fièrement se redressaient.
– Capitaine, dit-il, et le son de sa voix était clair, quoique je puisse être, je ne suis pas un lâche. J’ai triché. Ce faisant, j’ai trahi votre confiance. J’ai présent à la mémoire toutes les clauses de notre traité. Voulez-vous avoir l’obligeance de mander le maître d’équipage ?
Sans qu’un muscle de son visage tressaillît, le chef se rendit à cette demande.
– M. Rossiter, dit-il au maître d’équipage, a une requête à vous adresser, et, quelle qu’elle soit, je vous autorise à y accéder.
– Je désire, demanda M. Rossiter au maître d’équipage, que vous mettiez une embarcation à la mer et que vous m’y descendiez. L’embarcation ne devra être munie que d’un seul aviron, sans rien de plus.
– Mais, s’écria le maître d’équipage stupéfait, et regardant tour à tour et d’un air consterné chacun des témoins de la scène, cet homme est fou ! Nous sommes à cinq cents milles de toute terre, et sans eau, sans nourriture, un homme ne saurait vivre plus de quatre jours. La mer enfin fourmille de requins. Mais, c’est un suicide !
Le regard du chef se rembrunit, mais avant qu’il pût parler, M. Rossiter très calme avait dit :
– Ça, monsieur, c’est mon affaire ! et sa voix sonna fière.
II
L’homme dans le canot, tête nue et le corps presque nu sous le soleil brûlant, adressait de la sorte quelque objet qu’il voyait proche de lui dans les flots :
– Voyons. Oui, je crois bien que voilà quatre jours environ que nous voyageons de compagnie, mais je n’en suis pas tout à fait sûr. Vois-tu, sans toi, je serais mort d’isolement… Dis-moi, n’as-tu pas faim aussi ? J’avais faim il y a quelques jours, mais maintenant je n’ai plus que soif. Là, tu as l’avantage sur moi, car tu n’as jamais soif. Pour ce qui est d’avoir faim… ah, ah, ah ! Qui entendit jamais parler d’un requin qui ne fût pas affamé ? Oh, je sais fort bien ce que tu penses, mon camarade, mais nous avons le temps encore. Cela me fait peine de troubler nos agréables relations actuelles. C’est-à-dire, – tiens, je vais faire de l’esprit – je préfère nos relations extérieures à une intimité intérieure trop grande. Ah, ah, ah ! Je savais que cela te ferait rire, rusé coquin ! Quel vieux requin sournois et patient tu fais ! Sais-tu bien que si tu n’étais pas flanqué de ces nageoires gauches, que si tu n’avais pas là quelque part sous la partie inférieure du corps cette bouche effroyablement laide et un aussi grotesque écart entre les yeux, et que tu t’en allasses sur terre essayer de rivaliser d’intelligence avec les diverses et amusantes espèces de requins qui y abondent, ta patience à poursuivre un avantage manifeste te ferait millionnaire au bout d’un an ! Pareille idée peut-elle pénétrer ton crâne épais, l’ami ?
» Là, là, là ! Ne te retourne pas comme ça et ne fais pas le nigaud en ouvrant ta jolie bouche et en éblouissant ce soleil de midi de l’éclat de ton ventre blanc. Je ne suis pas encore prêt. Dieu, que j’ai soif ! Dis-moi, as-tu jamais ressenti ça ? As-tu jamais vu d’aveuglantes lueurs te déchirer le cerveau et noircir le soleil ?
» Tu n’as pas encore répondu à ma question. C’est une question hypothétique – hypothétique, oui. C’est bien ce que je voulais dire. Une question hypo – hypothétique. Une question, oui, c’est bien cela.
» Or, suppose que tu aies été un jeune et beau requin à la tête folle, que tu aies rendu ta mère inquiète et malheureuse, que tu te sois adonné au jeu et que tu aies en somme mal tourné. Les requins, ça peut-il mal tourner ? Voilà qui est embarrassant. Oh, quel vieux requin stupidement, subtilement amusant, tu fais ! Tu es terriblement prudent. Ne montre jamais ton jeu, à moins d’être forcé d’abattre. Quel vieux coquin renfrogné tu fais !
» Que tu aies mal tourné, en somme, et que te raidissant tu aies quitté la maison paternelle, résolu à faire de toi un homme. Vois-tu un requin faire de lui un homme ! Et puis – tout doux ! Ne t’anime pas. Je n’ai fait que trébucher sans tomber tout à fait par-dessus le bord. Que mes gesticulations ne t’excitent pas et ferme la bouche, l’ami ! Tu n’es pas joli quand tu souris de la sorte. Je disais donc, oh !…
» Où en étais-je, mon vieux ! C’est heureux pour moi que tu ne saches pas grimper dans un canot, quand un homme est en pareil état. As-tu jamais été en un état pareil, mon camarade ? Tiens, comme ceci : Pouf ! et une grosse flamme rouge dans la tête. Mais, n’importe, après un temps, ça s’éteint et la plus bizarre et la plus biscornue des tarières te perce le crâne, tandis que des millions de têtards de feu partent en l’air dans toutes les directions. Ne sois jamais dans cet état-là, l’ami, si tu peux l’éviter. Mais voilà, jamais tu n’as soif. Voyons. Le soleil était par là, quand la flamme rouge m’a ébloui, et le voici maintenant par ici. C’est un écart d’environ trente degrés. Il y a donc deux heures de cela.
» Nous disions donc que tu avais des amis désireux de te rendre service, voulant te tirer d’affaire et faire de toi un homme. Ils s’étaient assurés de la situation exacte d’un merveilleux trésor enseveli dans une île du Pacifique. Parfait. Ils te savaient doué de quelques-unes des qualités requises pour une expédition de ce genre, – te connaissaient pour un risque-tout, comme n’ayant peur de rien – et autres qualités de même acabit. Tu comprends, l’ami ? Eh bien, les voilà qui tous prêtent des serments longs comme le bras – longs comme ton – oh, bon ! vois-tu un requin avec un bras ! Ah, ah, ah ! longs comme le bras ! Pardonne à ma gaieté, mon vieux, mais j’ai besoin de rire. Ah ! Ah ! Ah !
» Alors, vous jurez tous – toi et les autres requins. Ni mensonge, ni tromperie, ni escroquerie. Le premier requin qui faute doit mander le maître d’équipage et s’en aller à la dérive dans une embarcation, avec un aviron pour tout potage. Et ça, l’ami, après avoir engagé ta parole d’honneur sur la tête de ta mère, sur ton Dieu, sur toi et tes amis, d’être un requin probe et loyal. Ce n’est pas le soleil ardent qui te brûle et te couvre d’ampoules, qui transforme la moelle de tes os en une coulée de métal et ton sang en une lave sifflante, – ce n’est pas le soleil ardent qui fait mal ; ni la faim qui ronge et déchire tes intestins, ni la soif qui change ton gosier en un entonnoir d’acier en fusion, ni les rouges flammes aveuglantes dans la tête, ni de rester couché comme mort seul au fond d’un canot, tandis que le soleil saute de trente degrés dans l’espace, ni le million de têtards embrasés jaillissant dans les airs. Non, tout cela ne fait pas autant de mal que quelque chose d’infiniment plus profond et plus cruel – c’est la parole d’honneur sur la tête de ta mère, sur ton Dieu, sur toi et tes amis, à laquelle tu as manqué. C’est ça qui fait mal, l’ami !
» C’est un peu tard, mon vieux, pour recommencer sa vie, quand on est à l’article de la mort, et pour prendre de bonnes résolutions quand il n’est plus possible d’être mauvais. Mais, c’est notre affaire, la tienne et la mienne. Et à cette heure nous ne discutons pas notre choix de l’utilité de la droiture. Je n’aime pas cette raillerie de tes yeux. Je n’ai qu’un aviron et je te le briserais volontiers sur la tête si tu approchais seulement d’un mètre…
» Ah, tu as cru que j’allais faire la culbute n’est-ce pas ? Vois, j’ai le pied solide quand je veux. Mais je n’aime pas cette raillerie de tes yeux. Tu ne crois pas au repentir des mourants, hein ? Tu n’es qu’un misérable, tu n’es qu’un vil et bas réprouvé. Tu railles les affirmations d’un homme qui peut et veut être honnête enfin et se présenter devant son Créateur en toute humilité, mais cependant en homme. Allons, l’ami, nous allons voir qui de nous deux sera le plus honnête. Joue ton courage contre le mien et risque ta vie en même temps que ton courage. Nous allons voir le plus honnête de nous deux, car je vous le dis, M. le requin, nous allons jouer, et notre enjeu sera notre vie avec notre honneur.
» Approche un peu et surveille la donne. Non ? Tu as peur de l’aviron, lâche sournois ! Tu serais un honorable requin enfin, si cet aviron te fendait le crâne. Tu vois cette carte de visite, rusé coquin ? Regarde-la bien, tandis que je la tiens en l’air. Il y a d’un côté des caractères d’imprimerie ; c’est mon nom, ce sera face et mon côté. Le verso est blanc ; ce sera pile et le tien. Or, je vais jeter cette carte dans les flots. Si elle tombe face, je gagne ; si elle tombe pile, tu gagnes. Si je gagne, je te mange ; si tu gagnes, tu me manges. Est-ce convenu ?
» Écoute encore. Je puis, tu vois, jeter une carte de manière à la faire tomber de tel ou tel côté à mon choix. Ce ne serait pas juste. Car, cette dernière partie de ma vie se doit jouer honnêtement. J’en corne donc un coin de ce côté-ci, et un autre par là. Quand on jette une carte ainsi cornée, il n’est pas de requin au monde, qu’il ait des bras ou des nageoires, qui puisse dire de quel côté elle tombera. C’est donc là un petit jeu des plus honnêtes, mon vieux, et il va résoudre le petit malentendu qui, depuis quatre jours existe entre nous, en supprimant certain écart – un écart de dix ou quinze pieds.
» Tu as bien compris. Si je gagne, tu dois venir le long de l’embarcation et je te tue et je te mange. Cela pourra me soutenir jusqu’à ce qu’on me rencontre. Si tu me gagnes, hop ! je saute et tu me manges. En es-tu ? Eh bien, allons-y, question de vie ou de mort… Ah, tu as gagné ! Et nous avions notre honneur pour enjeu !
III
Un vapeur, crachant des torrents de fumée noire, approchait rapidement du canot en dérive, car la vigie l’avait signalé, et le vapeur se dirigeait vers lui, afin de porter secours.
Le capitaine, debout sur le pont, voyait à l’aide de sa lunette un homme étrange et mi-nu gesticulant de façon extraordinaire, trébuchant et en danger de tomber à tout instant par-dessus bord. Quand le navire se fut suffisamment approché, le capitaine vit l’homme lancer une carte dans les flots, puis se tenir dans une posture rigide et de mauvais augure, sur le sens de laquelle on ne se pouvait méprendre. Il fit retentir la sirène. L’individu en dérive tressaillit violemment et, se détournant, aperçut approchant à toute vapeur, le navire où l’on hâtait la mise à l’eau d’une embarcation.
Le malheureux toujours immobile avait maintenant les yeux rivés sur l’étrange apparition qui lui semblait avoir brusquement surgi de l’océan.
L’embarcation toucha l’eau et avança rapidement.
– Nagez vigoureusement, les gars, car l’homme est fou et se dispose à sauter par-dessus bord. Un énorme requin le guette. Qu’il tombe à l’eau, il est perdu.
Les matelots se courbèrent sur leurs avirons, et poussèrent des appels, afin d’avertir le malheureux de la présence du requin.
– Patientez un instant, lui crièrent-ils, on va vous prendre à bord !
L’intention des matelots parut enfin luire à l’esprit de l’infortuné. Il se raidit tant bien que mal pour prendre une attitude d’un misérable semblant de dignité, et d’une voix rauque répondit :
– Non, j’ai joué ; j’ai perdu. Un honnête homme paie une dette d’honneur.
Et une lueur dans les yeux telle qu’en ont ceux dont la vision a percé le plus prodigieux de tous les mystères, il s’élança dans les flots.
UN IRRÉDUCTIBLE ENNEMI
J’avais été de Calcutta appelé au cœur de l’Inde afin de tenter une difficile opération chirurgicale sur l’une des femmes du sérail d’un rajah. Ce rajah était un homme d’une grande noblesse de caractère, mais possédé, comme je m’en aperçus par la suite, d’un instinct de cruauté purement orientale contrastant avec l’indolence de sa nature. Il fut tellement enchanté de la réussite de ma mission qu’il me pressa vivement de rester son hôte au palais tant que cela me ferait plaisir, et j’acceptai son invitation de grand cœur.
Un de ses serviteurs attira vite mon attention par une faculté de rancune surprenante. Il se nommait Néranya et devait, j’en suis certain, avoir dans les veines une forte proportion de sang malais, car, au contraire des Hindous (dont il ne différait pas moins par le teint), il était excessivement vif, diligent, irritable et susceptible. Son attachement pour son maître rachetait ces défauts. Un jour, emporté par la violence de son caractère, il commit un crime : d’un coup de poignard il tuait un nain.
Il fallait un châtiment.
Le rajah condamna Néranya à avoir le bras droit – le bras criminel – coupé. La sentence fut maladroitement exécutée par une brute armée d’une hache et, comme chirurgien, je fus contraint, pour sauver la vie de Néranya, de faire l’amputation du moignon au ras du corps, sans laisser subsister aucune trace du membre.
Ceci n’eut d’autre résultat que de développer son infernale méchanceté.
Son amour pour le rajah se changea en haine, et dans sa folle colère il dépouilla toute prudence. Un jour exaspéré du mépris que lui témoignait son maître, il s’élança sur le rajah un couteau à la main, mais fut heureusement empoigné et désarmé. À son indicible consternation, le rajah pour cette offense le condamna à subir l’amputation du bras qui lui restait. La sentence fut exécutée de même façon que la première fois. Ceci mit momentanément un frein à l’humeur perverse de Néranya ou, du moins, modifia les manifestations extérieures de son esprit diabolique.
Privé de bras, il se trouva d’abord tout à la merci de ceux qui pourvoyaient à ses besoins, service dont je me promis de surveiller le strict accomplissement, car je n’étais pas sans ressentir quelque intérêt pour ce caractère étrangement dénaturé. Le sentiment de son impuissance, uni à l’atroce projet de vengeance que secrètement il nourrissait, amena Néranya à changer de conduite ; de farouche, furieux et violent qu’il était, il se fit doux, tranquille, insinuant et joua son personnage avec tant d’astuce qu’il parvint à tromper tous ceux avec qui il était en contact, y compris le rajah lui-même.
Néranya, étant excessivement intelligent, vif et adroit, doué aussi d’une indomptable volonté, mit toute son attention à cultiver et à développer la dextérité de ses jambes, de ses pieds et de ses orteils et réussit au point de faire, au bout de peu de temps, accomplir à ses membres inférieurs les tours de force les plus surprenants.
De cette manière sa puissance de méchanceté destructive lui fut dans une grande mesure rendue.
Un matin, le fils unique du rajah, jeune homme fort aimable et de nobles dispositions, fut trouvé mort dans son lit. Le meurtre avait été consommé avec la plus grande cruauté. Le corps était odieusement mutilé ; mais, pour moi, l’enlèvement et la disparition des bras du jeune prince formaient la plus significative des mutilations.
La mort de ce jeune homme mit le rajah à deux doigts de la tombe, et, avant de commencer une enquête approfondie sur ce meurtre, il me fallut attendre que mes soins l’eussent ramené à la santé.
Je ne voulus rien dire de mes découvertes ni de mes déductions avant que le rajah et ses officiers eussent échoué dans les leurs, ni avant d’avoir mené mon travail à bonne fin. Ceci fait, je lui soumis un rapport écrit contenant une analyse attentive de tous les faits et où je concluais en accusant Néranya du crime. Le rajah, convaincu par mes preuves et mes arguments, condamna aussitôt Néranya à la peine de mort. La mort lui devait être donnée lentement, au milieu des plus épouvantables tortures.
La sentence était d’une cruauté si révoltante qu’elle me remplit d’horreur : j’intercédai, demandant que le misérable fût fusillé. Finalement, et par reconnaissance pour moi, le rajah se laissa fléchir.
Quand on l’accusa du crime, Néranya naturellement tenta de nier, mais voyant que le rajah avait sa conviction faite, il renonça bien vite à se défendre et ce fut en dansant, en riant, en hurlant de la plus horrible manière qu’il avoua son crime, s’en glorifiant, et lançant insulte sur insulte au rajah, – et cela tout en sachant fort bien qu’une mort effroyable l’attendait.
Ce même soir, le rajah réfléchit longuement et le lendemain matin m’informait de sa décision. Il laissait à Néranya la vie, mais il aurait les deux jambes brisées à coups de marteau pour être ensuite amputées au ras du tronc ! Comme corollaire de la terrible sentence, il avait décidé que l’infortuné, ainsi mutilé, serait torturé à intervalles réguliers par tels moyens à trouver par la suite.
Le cœur tout angoissé par l’horrible tâche qui m’incombait, je m’acquittai néanmoins avec succès de l’opération. Toutefois j’aime mieux ne pas m’étendre davantage sur cette partie du drame.
Néranya revint de très-loin et fut long à recouvrer son habituelle vitalité.
Pendant les semaines que dura son rétablissement, le rajah jamais ne le vit et jamais ne s’informa de lui, mais lorsque, ainsi que le commandait le devoir, j’eus présenté un rapport officiel déclarant que l’homme avait retrouvé ses forces, les yeux du rajah brillèrent et il sortit avec une implacable activité de l’état de torpeur où il était plongé depuis si longtemps.
Le palais du rajah était un magnifique édifice. Il me suffira ici d’en décrire la salle principale. C’était une salle immense, pavée d’une riche mosaïque que surmontait un plafond en forme de voûte ; la lumière du jour n’y pénétrait que tamisée par les vitraux de la voûte et des hautes fenêtres percées d’un seul côté. Au milieu de la salle, d’une jolie et riche fontaine jaillissait une longue et grêle colonne d’eau, avec d’autres jets retombant en gerbes à l’entour. À l’une des extrémités, à mi-hauteur était une galerie, communiquant avec un des étages supérieurs de cette aile du palais, et à laquelle conduisait un escalier de pierre. Cette salle au temps des grandes chaleurs était délicieusement fraîche ; c’était le séjour favori du rajah et, quand les nuits étaient accablantes, il y faisait dresser sa couche et dormait là.
Cette salle fut choisie comme prison permanente de Néranya.
C’est là qu’il lui faudrait rester tant qu’il vivrait, sans espérance de jamais plus entrevoir le monde extérieur et les splendeurs du ciel.
Pour un être aussi irritable, aussi haineux que lui, pareille réclusion était pire que la mort.
Sur l’ordre du rajah, on lui construisit une petite cage aux barreaux de fer, circulaire, d’un diamètre d’environ quatre pieds que l’on disposa entre la galerie et la fontaine, sur quatre minces piliers à dix pieds du sol.
Telle fut la prison du Néranya.
La cage, haute de quatre pieds environ, était ouverte au sommet afin de faciliter la tâche des domestiques chargés de lui prodiguer à ses besoins.
C’était d’ailleurs à mon instigation que, pour assurer sa réclusion, avaient été prises toutes ces précautions.
Bien qu’il fût maintenant privé des quatre membres, je craignais en effet toujours que cet homme ne trouvât quelque moyen extraordinaire, inouï, de nuire. Aussi avait-on, en outre décidé que les gens chargés de son entretien ne communiqueraient jamais avec sa cage qu’au moyen d’une échelle mobile.
Ces dispositions arrêtées, Néranya avait été placé dans la cage et le rajah se rendit sur la galerie pour le voir.
C’était la première fois depuis la dernière amputation.
Néranya gisait haletant et sans force sur le sol de sa prison, mais son oreille fine n’eut pas plutôt perçu le bruit familier du pas du rajah, qu’il réussit en se tortillant à appuyer le derrière de sa tête contre le grillage et à la dresser au-dessus de sa poitrine, ce qui lui permettait de voir à travers les barreaux. Les deux mortels ennemis se trouvèrent ainsi face à face. Le visage dur du rajah pâlit à la vue de l’être hideux et informe qui frappa ses regards ; mais il se remit vite et ses yeux eurent tôt retrouvé leur dureté cruelle et sinistre. Les cheveux noirs et la barbe de Néranya avaient allongé et ajoutaient à la férocité naturelle de son aspect. Ses yeux en se regardant le rajah étincelèrent d’un éclat terrible ; ses lèvres s’écartèrent et il fit effort pour respirer ; sa figure était blême de rage et de désespoir ; les narines minces et dilatées frissonnèrent.
Le rajah se croisa les bras et du haut de la galerie considéra l’effroyable débris, son œuvre ! Oh ! L’émouvant tableau ! Quel témoignage vivant d’inhumanité ! Quel sombre drame et profondément triste c’était là, et qui pouvait plonger dans le cœur farouche et désespéré du prisonnier et ne pas voir et ne pas comprendre les effrayants sentiments qui l’agitaient, colère houleuse et suffocante, férocité sans frein, mais impuissante, soif forcenée de vengeance plus profonde que l’enfer ?
Néranya le regardait.
Son corps informe haletait, ses yeux lançaient des flammes. Puis d’une voix forte et claire, qui éclata sonore dans cette grande salle, avec une volubilité soudaine il lança au rajah les défis les plus insultants, les malédictions les plus folles. Il maudit les flancs qui l’avaient conçu, les aliments qui le nourrissaient, la fortune qui l’avait porté au pouvoir ; il le maudit au nom de Bouddha et des sages ; le maudit par le soleil, la lune et les étoiles ; par les continents, les montagnes, les océans et les rivières ; par tout ce qui vivait ; maudit sa tête, son cœur, ses entrailles ; le maudit en un ouragan de paroles qu’on ne saurait répéter, entassant d’inimaginables outrages, l’appelant coquin, brute, sot, menteur, infâme et lâche.
Le rajah l’écouta avec calme, sans qu’un seul de ses muscles bougeât, sans la moindre altération du visage, et quand l’infortuné à bout de forces fut retombé épuisé et muet au fond de la cage, le rajah, avec un sourire lugubre et glacial, fit demi-tour et se retira.
Les jours passèrent.
Le rajah, indifférent aux malédictions que souvent lui lançait Néranya, s’attardait même plus volontiers qu’auparavant dans cette salle et y dormait plus fréquemment la nuit. Finalement Néranya, se lassant de le défier et de le maudire, garda un morne silence.
C’était un sujet d’étude pour moi que ce malheureux, et je suivais toutes les changements de son humeur mobile. Généralement, il était plongé dans un état de sombre désespérance, qu’il s’efforçait courageusement de dissimuler. La faveur du suicide même lui était refusée, car, lorsque à force de torsions il arrivait à se dresser, la cage s’élevait encore d’un bon pied au-dessus de sa tête, si bien qu’il ne pouvait se hisser par-dessus pour s’aller briser le crâne sur les dalles. Il avait voulu se laisser mourir de faim, mais on lui fit de vive force descendre les aliments dans le gosier ; il y renonça. Parfois ses yeux étincelaient et sa respiration se faisait saccadée, car des pensées de vengeance le travaillaient ; puis soudain il redevenait plus calme, moins intraitable, se faisait doux même et répondait, quand je lui adressais la parole.
Quelles que fussent les tortures imaginées par le rajah, il n’y avait pas encore eu recours ; et quoique Néranya n’ignorât pas qu’elles fussent à l’état de projet, jamais il n’y faisait allusion ni ne se plaignait de son sort.
La dernière phase de l’émouvante situation arriva un soir.
Aujourd’hui encore, même après ce laps d’années, je ne puis en commencer le récit sans un frémissement.
La nuit était brûlante et le rajah, étendu sur une haute couche placée en dessous du rebord de la galerie dans ce vaste hall, s’était assoupi. Quant à moi, incapable de dormir dans mon appartement, soulevant les lourdes portières qui en masquaient l’entrée à l’extrémité opposée, je m’étais glissé dans cette salle. En entrant, j’entendis, en dépit du discret clapotis de la fontaine un léger bruit particulier. La cage de Néranya m’était en partie cachée par le jet d’eau, mais je soupçonnai aussitôt que ce bruit inaccoutumé provenait de là. Me glissant de côté et me dissimulant parmi les sombres tentures de la muraille, je pus apercevoir cependant Néranya à la faible lueur d’une lampe n’éclairant qu’imparfaitement la salle.
Ma supposition était exacte, Néranya était tranquillement à l’œuvre.
Curieux d’en voir davantage et sachant que seul l’esprit du mal pouvait inspirer ses moindres actes, je m’étendis sur le sol pour mieux le guetter.
À ma grande surprise, Néranya déchirait avec ses dents le sac qui lui servait de vêtement. Il le faisait prudemment, lançant fréquemment un regard furtif du côté du rajah qui, profondément endormi sur son lit de repos, respirait bruyamment. Après avoir avec ses dents déchiré un commencement de bande, Néranya, avec ses dents encore, le noua à l’un des barreaux dont ensuite il s’écarta en se tortillant comme l’eut fait une chenille en marche et réussit ainsi à déchirer une bande de toute la longueur du sac. Avec une patience et une adresse incroyables, il renouvela cette opération jusqu’à ce qu’il eut ainsi déchiré en bandes semblables tout son vêtement. Il en attacha deux ou trois bout à bout avec ses dents, ses lèvres et sa langue, serrant les nœuds en plaçant une extrémité de la bande sous son corps et tirant sur l’autre avec les dents. De cette façon il fit une sorte de cordeau de plusieurs pieds de long dont il fixa solidement un bout à un barreau avec sa bouche.
Les choses commencèrent à m’apparaître sous leur vrai jour.
Il allait risquer une tentative folle – impossible à réaliser sans mains, sans pieds, sans bras ni jambes – pour s’échapper de sa cage !
Dans quel but ?
Le rajah dormait dans la salle… ah ! Le souffle me manqua.
Quelle soif insensée, désespérée de vengeance était donc la sienne pour qu’elle ait pu déranger à ce point son esprit si solide et si net ! Quand bien même il réaliserait cet impossible tour de force et se hisserait par-dessus le grillage de sa prison pour se laisser tomber sur le sol (car comment pourrait-il se laisser glisser le long de cette corde ?), selon toute probabilité il se tuerait ou s’assommerait dans sa chute.
À supposer même qu’il échappât à ces dangers, il ne parviendrait pas à grimper sur le lit sans réveiller le rajah. Enfin, le rajah fût-il mort, il ne pourrait encore y grimper !
Confondu de l’audace de cet homme et certain que sa raison avait fini par sombrer au milieu de ses souffrances et de ses tortures morales, je ne le guettai pas moins avec un intérêt ému.
Avec d’autres bandes, attachées bout à bout, il fabriqua une courte escarpolette en travers d’un des côtés de sa cage. Il saisit dans ses dents le long cordeau à un point assez rapproché du grillage et, se tortillant avec effort, réussit à se placer dans une position verticale. S’accotant alors aux barreaux, il posa son menton sur l’escarpolette et lentement se poussa vers une des extrémités de celle-ci. Du menton il étreignait l’escarpolette et avec une peine inouïe, s’aidant de la partie inférieure de son épine dorsale contre les barreaux, il commençait graduellement à gravir ce côté de sa cage.
L’effort était si considérable qu’il lui fallait parfois s’arrêter ; sa respiration était dure et pénible ; même, lorsqu’il se reposait ainsi, la tension était terrible, et l’escarpolette, conte laquelle il se poussait avec le dos, lui comprimait la gorge et l’étranglait presque.
Après un stupéfiant labeur, il avait réussi à hisser la partie inférieure de son corps sur le sommet de la grille et il se trouvait maintenant faire saillie au dehors, le bas-ventre appuyé sur le cercle horizontal reliant entre eux les barreaux. Graduellement, il se laissa glisser en arrière jusqu’à ce qu’il y eut en dehors de la cage un excédent de poids suffisant et alors, d’un mouvement brusque, il redressa la tête et les épaules et se balança dans une position horizontale au sommet de sa prison. Naturellement il serait tombé sur le sol sans le cordeau qu’il tenait dans les dents. Il avait si exactement calculé la distance ente sa bouche et le point où la corde était nouée au barreau, que le cordeau se tendait pour le retenir au moment précis où il prenait cette position horizontale.
Si quelqu’un m’était venu à l’avance dire que le tour de force que je venais de voir cet homme accomplir, était possible, je l’aurais traité d’imbécile.
Néranya maintenant se balançait sur le ventre en travers de la barre horizontale au sommet de sa cage. Il améliora cette position pénible, en ployant l’épine dorsale pour s’équilibrer dans la mesure du possible. Après avoir pris quelques instants de repos, il se laissa glisser prudemment en arrière, filant lentement le cordeau dans ses dents et se heurtant à une difficulté presque fatale chaque fois que revenait un nœud. Or, il est vraisemblable que le cordeau lui aurait échappé latéralement des dents chaque fois qu’il relâchait sa prise pour le laisser filer, sans un moyen ingénieux auquel il avait eu recours. Avant de s’attaquer à l’escarpolette, il s’était enroulé le cordeau autour du cou, s’assurant ainsi sur cette corde d’un nouveau genre un contrôle triple, l’un avec les dents, un second par le frottement autour du cou, un troisième par l’habileté avec laquelle il l’enserrait entre sa joue et son épaule.
Il était maintenant de toute évidence qu’il avait, avant de se mettre à l’œuvre, minutieusement pesé tous les moindres détails de ce plan compliqué et qu’il avait peut-être fallu des semaines d’étude théorique pour sa préparation mentale. En l’observant, je me rappelais maintenant beaucoup de ses agissements jusqu’ici incompréhensibles pour moi, tels que d’inexplicables mouvements qui sans nul doute n’avaient d’autre but que d’exercer ses muscles au labeur invraisemblablement pénible qu’il accomplissait maintenant.
Il avait déjà mené à bien une prodigieuse partie de sa tâche, en apparence impossible. Pourrait-il descendre sain et sauf ?
Graduellement, il se laissa glisser en arrière par-dessus la cage, en danger permanent de tomber ; mais il n’eut pas un instant d’hésitation et ses yeux brillaient d’un éclat extraordinaire. Une secousse, et son corps tombait tout entier en dehors du grillage auquel il resta pendu par le menton, son cordeau toujours fortement serré dans les dents. Lentement il dégagea le menton et ne se trouva plus retenu que par le cordeau. Par degrés imperceptibles presque, avec une infinie précaution, il descendit le long du cordeau et, finalement, son corps roulait lourdement sur les dalles, sain et sauf !
Quel miracle ce monstre surhumain allait-il maintenant accomplir ?
Agile et vigoureux, je me tenais prêt à empêcher un meurtre, mais je ne voulais pas intervenir avant que le péril fut imminent.
Il me faut avouer la surprise que j’éprouvais en voyant Néranya non pas se diriger tout droit vers le rajah endormi, mais prendre une autre direction. Ce n’était donc, après tout ! que son évasion et nullement la mort du rajah que projetait l’infortuné !
Comment pourrait-il s’échapper ?
La seule manière possible d’arriver au dehors sans grand risque était de gravir l’escalier conduisant à la galerie, de franchir le corridor qui donnait là pour tomber aux mains des soldats Anglais casernés dans les environs. Ceux-ci certainement lui donneraient asile.
Mais sûrement Néranya ne réussirait pas à gravir cette longue suite de marches !
Néanmoins, c’est de ce côté qu’il se dirigeait.
Sa méthode de reptation était la suivante : il s’étendait sur le dos, la partie inférieure du corps tournée vers l’escalier, puis, ployant les reins, il avançait d’autant sa tête et ses épaules ; se raidissant alors, il poussait en avant la partie inférieure de son corps sur une distance égale à celle qu’avait déjà gagnée la tête. Il répéta ce procédé maintes et maintes fois, appuyant sa tête contre le sol pour l’empêcher de glisser, chaque fois qu’il ployait les reins. Sa matche était laborieuse et lente, mais les progrès sensibles, et en fin de compte il atteignait la première marche de l’escalier.
Évidemment son but insensé était de le monter. Son désir de liberté devait être bien fort !
En se tortillant, il se dressa verticalement contre la balustrade, de l’œil mesura la hauteur à gravir et soupira, mais ses yeux ne perdirent rien de leur éclat.
Comment réaliserait-il ce nouveau tour de force ?
Bien qu’audacieuse et périlleuse comme toujours, sa solution du problème était pourtant très simple. Appuyé contre la balustrade, il se laissa tomber diagonalement contre la première marche où il se trouva étendu sur le côté. De nouveau il put reprendre sa position verticale contre la balustrade et, comme précédemment, se laissa tomber, s’abattant sur la deuxième marche. De cette façon, avec une inconcevable endurance, il réussit à gravir l’escalier tout entier.
Comme il m’apparaissait maintenant que le rajah n’était nullement le but des mouvements de Néranya, l’anxiété que d’abord j’avais ressentie à son sujet, s’était entièrement dissipée. Ce qu’il avait accompli déjà dépassait de beaucoup les plus folles conceptions imaginables, et la sympathie que toujours j’avais éprouvée pour le malheureux en était grandie. Pour minces que fussent ses chances de fuite, je n’en espérais pas moins le voir réussir. Toute assistance de ma part restait toutefois hors de question ; mais on ne saurait jamais que j’avais été témoin de son évasion.
Néranya était maintenant sur la galerie et je pouvais confusément le voir ramper vers la porte qui y donnait accès. Finalement il s’arrêta et se redressa contre l’un des balustres assez écartés les uns des autres. Il me tournait le dos, mais lentement il fit demi-tour me faisant face maintenant. À cette distance je ne distinguais plus ses traits ; cependant la lenteur avec laquelle il opérait tout à l’heure encore pendant son ascension de l’escalier, ne prouvait que trop son extrême lassitude. Seule, la résolution du désespoir l’avait jusqu’ici soutenu, mais il avait épuisé ce qui lui restait de forces. Il embrassa la salle d’un long regard, puis reporta ses yeux sur le rajah qui dormait juste au-dessous de lui. Il le considéra longtemps et fixement, s’affaissant de plus en plus contre le balustre. Soudain, à mon inconcevable épouvante, il passa à travers l’écartement des balustres et tomba d’une hauteur de vingt pieds ! Je retins mon souffle, m’attendant à le voir s’écraser sur les dalles mais, au lieu de cela, il tomba droit sur la poitrine du rajah, que le choc précipita sur le sol.
Je m’élançai en appelant au secours et l’instant d’après j’étais sur le lieu même de la catastrophe.
À mon indescriptible horreur, je vis les dents de Néranya enfoncées dans la gorge du rajah ! J’arrachai le misérable, mais le sang jaillissait des artères du rajah que les dents avaient tranchées ; il avait la poitrine défoncée et haletait, mortellement frappé. Des gens accoururent terrifiés.
Je me tournai vers Néranya.
Il gisait sur le dos, le visage hideusement souillé de sang.
C’était ce meurtre, et non son évasion, que depuis le début il avait eu en vue, et il avait eu recours au seul moyen qui devait lui permettre de l’accomplir. Je m’agenouillai à son côté et vis qu’il était lui aussi, mourant. Il s’était dans sa chute brisé la colonne vertébrale. Et comme il allait rendre le dernier soupir, il me sourit doucement et un regard où éclatait le triomphe de sa vengeance satisfaite, éclaira sa physionomie.
UNE FEMME DE MARBRE
Il ne m’arriva qu’une fois dans ma vie de ne pas trouver le Dr Entrefort en pleine possession de ses facultés. La cause première de cet égarement pourrait bien être le sujet d’une fort intéressante histoire, montrant sous un jour singulier l’un des nombreux côtés de cet homme étonnant, mais notre récit n’a d’autre but que de narrer simplement les conséquences de cet état d’esprit.
Son domestique de confiance me vint un soir trouver, tout désolé, et en grand embarras, pour m’avertir que le docteur me priait instamment de me rendre chez lui sans tarder.
Maintes fois déjà il m’avait ainsi fait mander, car le Dr Entrefort et moi, bien que poursuivant dans la vie des routes très différentes, nous nous étions étroitement liés par similitude de caractère et placions l’un dans l’autre une mutuelle confiance. Mais cette fois la manière d’être du domestique m’amena à penser qu’il s’était passé quelque chose d’insolite, et je le pressai de me donner des explications. Le discret serviteur retint sa langue et très sincèrement me dit que, sans aucun doute, le Dr Entrefort me mettrait de suite au courant de la question.
Je trouvai le Dr Entrefort parcourant fiévreusement sa chambre à coucher, dans un état de trouble nerveux complet.
Il avait, par-dessus sa chemise de nuit, passé une robe de chambre et le lit défait disait assez qu’il s’était relevé après s’être couché. Il avait la figure rouge ; ses yeux brillants lui dansaient dans la tête, et l’état d’agitation de son système musculaire témoignait clairement d’un sérieux désordre mental.
Mon arrivée parut vivement le soulager.
– Je croyais que vous ne viendriez pas !
Tels furent les mots dont il me salua à mon entrée, d’un air essoufflé, comme s’il eût parcouru trop vite quelque longue distance. Puis il congédia son domestique pour la nuit, ferma sa porte à clé et se jeta bruyamment sur une chaise longue où il resta quelques minutes haletant, faisant effort pour se maîtriser.
Je fus tellement alarmé de voir cet ami en un pareil état que je lui demandai s’il n’était point malade et s’il ne valait pas mieux, dans ce cas, mander immédiatement un de ses confrères.
– Non, s’écria-t-il, effrayé. Non, pour l’amour de Dieu ! J’ai quelque chose – je ne sais quoi. En d’ordinaires circonstances on serait dans l’impossibilité de me faire peur. Vous m’avez vu dans les situations les plus critiques et jamais, vous le savez, mes nerfs n’ont faibli. Jamais de ma vie, je n’ai éprouvé les terribles et étranges sensations qui semblent maintenant me les tendre tous à les briser. Je suis en ce moment fou – voilà tout. J’ai besoin de votre bonne présence, de votre sympathie, de votre société. J’avais l’esprit suffisamment sain pour vous envoyer chercher à temps. Non, je n’ai nul besoin d’un médecin. Pourquoi en aurais-je besoin ? ajouta-t-il, me lançant un regard méfiant.
Je lui conseillai de se recoucher et de se mettre à l’aise, il refusa avec force. Ses manières étaient si étranges, si tourmentées, que je ne pouvais qu’en attendre les résultats pour déterminer la conduite à suivre.
Entrefort, avec circonspection écouta s’il entendait un bruit dans le corridor, se redressa sur la chaise longue et murmura :
– Il est arrivé un accident terrible. – ma statue est tombée ce soir, tandis que je l’époussetais, et le bras gauche s’est cassé juste au-dessus du coude.
Enfin se soulevait donc un coin du voile cachant ce mystère. Pour la première fois, depuis les longues années de notre intimité, Entrefort semblait sur le point de rompre le silence ! Je retins mon souffle et j’essayai de dissimuler mon impatience.
Que je me rappelai bien ce merveilleux morceau de marbre sculpté !
Déjà, j’avais eu un aperçu de l’histoire de l’étrange et belle créature qu’il représentait ; mais ç’avait été bien vague, quasi insaisissable, et jamais Entrefort n’avait entrepris d’explication. Je savais qu’après que se fut répandu le bruit de sa mort, Entrefort s’était pendant longtemps sévèrement tenu à l’écart de tout, qu’en sortant de cette retraite il avait paru singulièrement vieilli, abattu, cassé, et qu’il n’était que graduellement revenu à sa condition normale d’enthousiasme sans borne et d’indomptable énergie ; et je savais encore qu’il avait chez lui une statue de marbre de la jeune femme, et que c’était une œuvre d’une rare beauté, ainsi que d’une saisissante ressemblance. Je savais qu’il en avait un soin extrême, ne permettant à personne de l’approcher ou de la toucher, que dans ses voyages il l’emmenait invariablement avec lui, veillant sur elle comme si ç’avait été une créature sensible, l’emballant et la déballant avec une incroyable patience et une infaillible adresse, la tenant toujours enfermée sous clé dans un cabinet ou, lorsqu’il le pouvait, dans une chambre particulière. Je n’ignorais pas non plus que, chaque matin il posait sur une table près d’elle un vase de fleurs fraîches, et, que, parfois, il s’enfermait des heures avec elle, pour reparaître en proie à la tristesse la plus profonde.
C’était la statue d’une jeune femme dont les traits dénotaient incontestablement une origine orientale. (Entrefort n’avait-il pas une fois prétendu, que seule une orientale était susceptible de comprendre les qualités les plus subtiles de l’amour de l’homme et que les autres femmes n’en voyaient que l’impétuosité, l’égoïsme, l’avidité virile et impérieuse ?) Elle représentait une femme de taille moyenne, parfaitement modelée et dont les formes étaient ornées de toute la grâce, de toute la délicatesse particulière à ce sexe. L’attitude était le côté le plus frappant de l’œuvre. Dans la pose choisie par l’artiste, le bras droit se levait en un geste de supplication angoissée, que soulignaient admirablement l’expression des yeux grands ouverts, l’écartement des lèvres et le mouvement en avant de la tête. Le bras gauche, qui semblait avoir été arrêté dans un effort pour se lever et se tendre, était le seul point faible de l’œuvre. Ce me paraissait une circonstance curieuse que c’eût été précisément ce bras, le mieux protégé en somme contre un accident de ce genre, qui se fût brisé. Je n’avais pu trouver dans ce morceau la moindre caractéristique du talent de nos meilleurs sculpteurs, permettant d’en désigner sûrement l’auteur : il semblait de beaucoup supérieur à tout ce qu’ils eussent pu produire. Entrefort n’avait jamais rien dit pouvant m’éclairer sur ce point.
– Oui, répéta Entrefort, le bras gauche s’est brisé juste au-dessus du coude. Savez-vous ce que pour moi cela signifie ?
Je fis de la tête un signe de dénégation.
– Cela signifie désespoir, cela signifie…
Il se rejeta sur la chaise longue, se tordant, grinçant des dents.
J’approchai ma chaise, lui pris la main et me mis à lui parler doucement. Puis :
– Je ne vois pas, dis-je alors, ce qu’il y a là-dedans de si grave. Il est d’habiles ouvriers pour raccommoder un marbre brisé.
– Seul Dieu peut réparer cette fracture ! s’écria-t-il avec emportement.
– Entrefort, dis-je, lui parlant pour la première fois avec fermeté et d’un ton de menace ; à moins de faire effort pour vous maîtriser, d’ici une heure vous serez fou.
Ce coup droit le fit tressaillir.
– Ne suis-je pas fou déjà ? demanda-t-il, les yeux dilatés par la terreur. En est-il un d’entre nous qui soit jamais à l’abri de l’affreuse maladie ? Non, je suis sain d’esprit, – seule une innommable terreur m’abat. Laissez-moi vous expliquer, et vous allez comprendre ; car, mon ami, j’ai grand besoin de votre sympathie et des consolations de votre amitié.
» Je l’aimais, vivante, comme un homme de mon tempérament ardent devait aimer la seule femme au monde qui ait été créée pour qu’il l’aimât de toute son âme. Avec votre caractère d’anglo-saxon, placide et accommodant, vous avez pu aimer une femme ou plus ; toutefois vous ne vous êtes jamais trouvé rencontrer la femme que vous deviez aimer de toutes les forces, et de toute la constance de votre âme, – vous n’avez jamais réellement aimé une femme. J’aimais cette femme. Elle était le cœur de mon cœur, l’âme de mon âme. Une grande force enveloppante d’une puissance et d’une douceur infinies nous enserra en un même pli. Il y a, mon ami, entre hommes et femmes des degrés d’affinités. Qu’est-ce que l’affinité ? Une conformité mutuelle, ni plus ni moins. C’est aussi vrai en amour qu’en chimie. Deux molécules avec des éléments totalement différents se combinent pour en former une troisième plus complexe que l’une ou l’autre d’entre elles, mais dont les propriétés et les fonctions n’en sont pas pour cela moins stables. Dorénavant, elles opèrent à tout jamais comme si elles étaient une. Tel est aussi l’amour, l’amour parfait.
» Tel était l’amour qui nous haitliait.
Il était aussi pur et aussi parfait de son côté que du mien. Mais le mien
était-il parfait réellement ? S’il l’était, comment se fait-il que je
l’amenai à cette fin terrible ? Était-il parfait, vraiment et
l’inconcevable mal que je lui causai à elle et à moi, n’était-il qu’une partie
du plan divin ? Qui peut le savoir ? L’amour est la chose la plus lumineuse,
la plus mystérieuse, la plus belle de ce monde, c’est le battement de cœur de
la nature, le souffle de Dieu ! Qui osera mettre en doute sa sainteté,
trouver vulgaires ses manifestations ? La tragédie dans laquelle
s’engloutit mon amour n’était-elle que le plan divin qui en devait assurer
l’immortalité ?
» Écoutez ; elle était si incomparablement belle que je désirai ardemment de toutes les forces de mon être, perpétuer ses charmes célestes. Je savais qu’avec le temps je devais vieillir et mourir, mais je voulais que le monde conservât à tout jamais sa glorieuse beauté. Dieu m’en est témoin, nul mobile égoïste ne me poussait. Jamais, vous le savez, mon ambition insensée n’eut de bornes. Vous m’avez bien compris.
» Je fus franc avec elle, car, sans franchise, il ne peut y avoir d’amour.
» Je lui dis ce que je désirais faire. Je n’oublierai jamais le regard surpris et amusé qui éclaira sa physionomie. Elle me gronda de vouloir poursuivre une chimère, et dit que c’était impossible – impossible, entendez-vous ? – pour moi ! Et elle me dit qu’elle préférerait infiniment mieux vieillir à mes côtés, en même temps que moi, de manière que jamais ne fût troublée l’harmonie entre nous.
» Mais je ne pouvais supporter la pensée qu’elle passerait lentement à la caducité et à la mort, et je lui dis franchement que je poursuivrais mon projet. À cela, souriante, elle me répondit que, si j’y étais résolu, elle se soumettrait.
» Je ne me figurai pas, dans mon exubérante assurance, qu’elle n’ajoutait pas foi à la réalisation de mes plans. Elle se soumit néanmoins gaiement au régime que je lui imposai, – il n’était point pénible, vous m’entendez ; cela m’eût été impossible. Il était assez agréable et elle le subit tout en chantant et sans que rien ne vînt ternir notre bonheur.
» Une fort curieuse caractéristique du régime, c’est que, tandis qu’elle était parfaitement inconsciente de l’effet qu’il produisait sur elle, j’en pouvais clairement suivre les progrès. N’avais-je pas consacré à ce sujet la plus grande partie de ma vie, le meilleur de mes pensées ? N’avais-je pas suffisamment pénétré les mystères de la vie pour connaître comment se peuvent enrayer les ravages des ans ? Ceci, vous le comprendrez, n’est point chose que le monde doive connaître. Les lois de la nature sont d’institution divine ; les mettre de côté, c’est les violer, – et cela c’est un crime. Avec le temps ces secrets s’apprendront, mais l’heure de cette révélation n’a point encore sonné. Pour être permanente et efficace, toute évolution doit être lente.
» Je lui dis en toute sincérité que je pouvais voir les changements s’opérer, mais elle se contentait de rire et m’appelait son cher toqué !
» Enfin parurent certains symptômes qui m’embarrassèrent excessivement, – apparence de marbre que prit la peau, froideur au toucher, très notable augmentation de poids, disparition de l’habituelle élasticité du mouvement, et langueur incompréhensible. Il était certains d’entre eux dont je ne pouvais me rendre compte, mais je revis soigneusement mes recherches, j’analysai ma formule, je fis subir les épreuves les plus complètes aux éléments composant la préparation que je lui administrais. Sa santé et son état d’esprit étaient excellents, mais elle avait une alarmante propension au sommeil. Puis ses muscles durcirent. Au lieu de ceci, je ne devais obtenir que l’embellissement et la fixation de ses charmes. Cependant je ne trouvais rien d’erroné ni dans la théorie ni dans la formule.
» Un jour, après être sorti, je rentrai pour me trouver en face de la plus douloureuse des situations.
» Elle était assise sur une chaise, endormie, et, quand j’entrai, l’apparence cadavérique de son visage m’effraya. Je courus à elle, la saisis par le bras, l’appelai à haute voix et m’efforçai de la mettre debout. Je découvris que son poids était devenu si considérable que cela m’était impossible. Soudain, elle se dressa, les yeux toujours fermés. Elle était blanche, sa peau avait l’éclat du marbre le plus fin et elle était glacée. Je l’appelai de nouveau, je la secouai, je l’embrassai, j’essayai de lui insuffler un peu de l’intense vitalité qui m’emplissait. Elle ouvrit les yeux lentement et regarda fixement, droit devant elle. Mes appels se firent plus pressants, torrent de paroles toutes d’angoisse et d’agonie !
» Elle tremblait, respirait avec peine et elle tourna vers moi ses yeux où peu à peu se mit à monter ce flot d’amour, qui si longtemps les avait emplis. Un vague sourire se joua sur ses lèvres.
» Je reculai d’un pas et, lui tendant les bras, je lui demandai de venir à moi. Elle fit un effort, mais sans succès. Alors une grande et terrible crainte envahit sa physionomie. Ses yeux se dilatèrent ; elle tendit vers moi la tête, ses lèvres s’écartèrent, son bras droit lentement se leva en une attitude de supplication désespérée. Faible, de ses lèvres, s’échappa ce cri : « Sauvez-moi ! » Je la suppliai encore de venir, mais elle demeura immobile. Pris d’un sentiment de terreur indicible, je m’approchai d’elle et la touchai. Elle était parfaitement rigide, – c’était une statue de marbre ! Vous étonnerez-vous que j’aie gardé avec moi cette pierre inanimée et lui aie donné tant de soins ? Ce n’est point son image sculptée, c’est elle-même. Et vous comprendrez ce que signifie pour moi cet accident épouvantable du bras brisé, quand je vous aurai dit que toutes mes espérances, tous mes efforts n’ont d’autre but que de lui rendre la vie !
Entrefort m’avait fait ce récit tout d’un trait, d’une voix passionnée qui très étrangement m’impressionna. En terminant, il fut pris d’un accès d’exaltation nerveuse.
– Je vous ai dit que c’était du marbre ! s’écria-t-il. Vous l’avez cru. Attendez.
Il passa dans la petite pièce où se dressait la statue, prit sur la table le morceau de bras brisé et me l’apporta.
– Voyez cette section, dit-il, me présentant à examiner la surface fracturée.
Ce n’est point sans une vive hésitation que je vais maintenant relater ce que je vis.
Jusqu’ici, en dépit de la passion mise par Entrefort à ce récit, le mystère inconsciemment trouvait chez moi une explication plausible. Mais, maintenant, en examinant la fracture et en voyant ce qu’elle révélait – Après tout, que m’importe ? Personne n’est obligé d’y croire et mieux vaut en somme que nul n’y croie. Comme cependant j’attache plus de prix à ma véracité qu’à ma réputation, je le dirai, et les malins – il n’en manque point de par le monde – croiront ce qu’ils voudront. Au centre était une rondelle de pierre friable de nuance crème, qu’entourait une zone de pierre plus solide, plus grossière et plus blanche, tandis qu’à l’entour une seconde zone plus large, d’une pierre d’un blanc pur et du grain le plus fin et le plus délicat enveloppait la première.
En un mot, je vis la moelle, l’os et la chair d’un bras humain parfaitement pétrifiés.
Avec un regard de triomphe, Entrefort alla dans la chambre replacer le débris de bras sur la table où il l’avait pris et revint à moi.
Stupéfait, je le regardai d’un œil stupide.
Mais la tension nerveuse qui jusque-là l’avait soutenu se relâcha brusquement. Il passa la main sur son front d’un air égaré et chancela. Je le saisis et le couchai sur son lit, où il s’endormit d’un sommeil profond.
Toute la nuit, je veillai à son chevet et jusqu’à une heure avancée de la matinée. Quand il s’éveilla, il parut surpris et enchanté de me voir.
– Quand êtes-vous arrivé ? demanda-t-il faiblement.
– Hier au soir, quand vous m’avez fait demander.
– Demander ? Je ne me le rappelle pas.
– Vous ne vous rappelez pas – tout ce que vous m’avez dit hier de l’histoire de la statue.
On eût dit que je lui avais porté un coup.
– Vous ai-je fait ce conte fantastique, que ç’avait été autrefois une femme et que je l’avais changée en pierre, en m’efforçant de l’affranchir de l’âge et de la mort ?
Je lui répondis d’un signe de tête, surpris du ton de méprisante amertume avec lequel il parlait :
– Naturellement, un homme de votre bon sens, comprendra que ce fut d’un bout à l’autre une fable.
À cela je ne fis pas de réponse.
– Vous ne le croyez pas ? fit-il avec emportement.
Je me contentai de détourner la tête et de regarder dans une autre direction, tandis qu’une douce pression de ma main le calmait et le réduisait au silence.
UNE HISTOIRE CONTÉE PAR LA MER
Une nuit que la tempête était venue du Sud dans le seul but de reprendre les hostilités contre son ancienne ennemie, la Presqu’île de Monterey, je sortis de la vieille ville et, franchissant la langue de terre la reliant au continent, je descendis l’autre versant de Santa Lucia pour assister à la puissante lutte dans la baie de Carmel.
J’allais, cinglé par la pluie qu’apportait le vent qui, soufflant avec rage, s’en prenait noblement à l’Océan et aux cyprès, lançant le premier en une course tumultueuse et faisant gémir les seconds sous ses coups. J’atteignis le haut d’une falaise, au-delà d’une grève encombrée de galets, et, tête nue, le gilet ouvert, je fis face à l’Océan et à l’orage.
La nuit n’était pas froide, bien que ce fût l’hiver ; mais c’était une nuit d’agonies et de luttes ignorées, où une rafale folle fouettait la mer et où la mer affolée assaillait la côte, tandis que la pluie et l’embrun volant de toutes parts assombrissaient encore les grisailles de la scène.
C’était une de ces nuits où la mer en travail parle et livre quelqu’un de ses secrets.
Je quittai la falaise et gagnai, à quelque distance, une petite station de pêche chinoise située sur une plage de sable ; et là, après avoir ôté ma veste et mon gilet, je descendis davantage me mettre en rapport avec ma perfide amie.
L’écume rejaillissait sur moi et les vagues battant lentement en retraite, semblaient m’inviter à me risquer plus avant, ce que je fis, connaissant le terrain, entraîné aussi par l’attrait charmant du danger. Une forte lame m’enleva du sol, mais je déjouai son effort et la poursuivis dans sa fuite ; elle fut suivie d’une autre, celle-là formidablement armée, car se dressant au-dessus de moi, elle s’abattit et me frappa d’un coup de gourdin que je ressentis terrible. Elle avait cette fois le dessus, et dans son reflux m’entraînait. Un aveuglement, une vague sensation d’étouffement, un instinctif effort pour reprendre pied, une poussée nouvelle et enfin une chute sur le sable moelleux – c’est ainsi que je fus sauvé tenant encore à la main l’arme dont ma vieille amie m’avait porté un coup.
C’était une lourde gourde de bois, d’une forme bizarre.
De retour dans ma chambre, à Monterey, je la brisai et y trouvai un document d’un rare intérêt.
Après des semaines d’étude et de déchiffrement – car le temps et une exécution imparfaite en faisaient un travail délicat et rendaient les résultats incertains, – j’en réunis les divers fragments de manière à former un tout ayant une apparence de cohésion.
Je découvris alors que la mer en travail avait révélé l’un de ses plus étranges mystères.
Aucun espoir d’une réponse utile à cette angoissante demande de secours n’exigeait péremptoirement son immédiate publication : je la fais plutôt pour montrer une nouvelle et terrible forme de souffrance humaine, et aussi pour la faire connaître à ceux qui, s’ils sont encore en vie, préfèrent savoir le pire que de continuer à l’ignorer.
Voici les résultats de mon travail :
Je me nomme Amasa D. Keating. Je suis un malheureux, et, en compagnie de beaucoup d’autres, je subis un terrible genre de torture. Le trouble mental, dont je souffre, est si grand que je crains de n’en pouvoir faire un récit intelligible. Je viens d’échapper à un spectacle d’inconcevables terreurs et, bien qu’ayant reçu une certaine éducation, et étant par suite capable de m’exprimer avec clarté, j’endure une si violente crise de perturbation mentale et en même temps suis en un tel état de faiblesse physique, que je redoute pour celui entre les mains de qui tombera ce récit, de réelles difficultés de juste compréhension.
Je supplie néanmoins instamment celui-ci d’en publier en toute hâte le contenu afin que sans délai on puisse envoyer une expédition à notre secours, car, si l’état actuel des choses continuait bien longtemps pour ceux que j’ai laissés derrière moi, j’ai grand peur que toute mesure prise pour leur délivrance ne reste vaine.
Quant à moi et à mon compagnon, nous n’attendons plus guère que la mort.
Je me hâte d’aborder la partie importante de mon récit, me contentant de donner au début les seuls renseignements indispensables pour notre identification.
Le 14 octobre 1852, nous avons quitté Boston sur le brick Hopewell, capitaine Campbell, à destination des îles de l’Océan Pacifique Méridional. Nous emportions une cargaison de marchandises variées dans le but de faire du négoce avec les indigènes, mais nous désirions en même temps trouver une île convenable dont nous pourrions prendre possession au nom des États-Unis et où nous pourrions nous établir définitivement. C’est dans ce but que nous avions formé une société et fait l’acquisition du brick, afin de l’avoir en toute propriété et de le garder comme moyen de communication entre nous et le monde civilisé.
Ces faits et d’autres sont si connus de nos amis à Boston que j’estime parfaitement inutile de les exposer plus en détail. Il n’est pas davantage utile de dresser ici, pour plus ample identification, la liste des noms de tous nos passagers et des hommes de l’équipage : ils sont en effet tout au long sur les registres du port à Boston.
Nous fûmes assez favorisés jusque dans le voisinage des îles Falkland. Mais fait assez inhabituel, nous assura le capitaine Campbell, le cap Horn avait revêtu son plus vilain aspect. En effet le brick était un lent voilier et l’été antarctique était depuis longtemps fini quand nous avons rencontré le mauvais temps. À partir de ce moment-là, nous essuyons une série de tempêtes ; après deux ou trois mois, cela se termine finalement par une terrible rafale, qui non seulement coûte la vie à quelques hommes de l’équipage, mais encore démâte notre navire. La tempête continue et, le brick se trouvant entièrement à la merci du vent et des flots, nous comprenons qu’il doit sombrer. Nous avons alors recours aux embarcations, les chargeant de provisions et de tous les objets nécessaires que nous pouvons emporter. Sans terre aucune en vue, au milieu d’une mer démontée qui, à tout instant, semblait sur le point de nous engloutir, nous nous mettons aux avirons et nous nous dirigeons vers le Nord-Ouest.
Il est à peine utile de dire que nous avions perdu notre route, mais, tant bien que mal, nous pûmes établir que nous nous trouvions à peu près par le 136° 30 de longitude ouest et sur le tropique du Capricorne. Cela nous mettait à environ cent soixante-dix milles d’un certain nombre de petites îles situées à l’est du cent quarantième méridien. La perspective n’était guère encourageante, et, dans les embarcations, tant le mauvais temps nous avait épuisés, il n’y avait presque aucun de nous en état de manier convenablement les avirons. En outre, nous avions perdu nos compas et nos provisions étaient fort endommagées.
Cependant, nous avancions.
Le pauvre brick abandonné, en apparence conscient de notre désertion, se conduisait d’une manière très bizarre. Poussé sans doute par le vent, il semblait faire d’émouvants efforts pour nous rejoindre nous présentant tantôt l’avant, tantôt l’arrière, mais plongeant toujours le nez sous l’eau. Son tangage et ses embardées l’épuisaient ; la cale pleine d’eau ne pouvait plus évidemment résister que quelques minutes. En attendant, ce ne nous était pas une petite affaire que de nous garder à distance, car que nous nous dirigions d’un côté ou de l’autre, il nous suivait et nous courions parfois un réel danger. La fin pourtant arriva ; le brick, maintenant rempli d’eau, s’enlevait majestueusement sur une lame, pour retomber sur le flanc dans l’entre-deux ; il fit un courageux effort pour se redresser, mais aussitôt debout se couchait de nouveau et puis coulait droit comme une masse de plomb.
Sa disparition nous jeta dans la désolation ; car, d’après ce que nous savions et le capitaine Campbell avait déjà navigué dans ces parages, nous n’avions guère d’espoir de gagner la terre vivants.
À notre grande surprise, nous n’avions pas nagé plus de vingt nœuds quand – il était environ minuit, – par notre avant bâbord, c’est-à-dire à l’ouest, nous aperçûmes un feu. Cela nous donna du courage ; de tout cœur nous fîmes force de rames dans sa direction et, vers trois heures du matin, à notre inexprimable joie, nous tirions nos embarcations sur une magnifique plage de sable.
Notre lassitude était telle que, sans perdre de temps, nous nous étendions confortablement dans le sable et bientôt dormions profondément sur la terre ferme.
Le soleil avait, le lendemain, accompli plus de la moitié de sa course avant que l’un de nous s’éveillât.
À part quelques oiseaux au brillant plumage, pas un être vivant n’était en vue, mais nous n’avions pas plutôt commencé à nous mouvoir qu’un certain nombre de beaux hommes, à la peau brune, surgissant de différents côtés, s’approchaient simultanément de nous.
Ils avaient autour du corps une ceinture d’où tombait un court vêtement, formé d’un grossier tissu d’écorce et où s’attachait un pesant sabre de métal.
C’étaient sans aucun doute des sauvages ; mais il y avait dans leurs manières une dignité qui les distinguait tout à fait des habitants connus des îles de la Mer du Sud. Notre capitaine qui comprenait plusieurs des langues et dialectes de ces insulaires, se trouva incapable de toute relation verbale avec ceux-ci, mais nous ne fûmes pas longtemps à les trouver particulièrement aptes à comprendre les signes. Ils nous témoignèrent beaucoup de pitié et, avec de multiples démonstrations d’amitié, ils nous invitèrent à les suivre et à mettre leur hospitalité à l’épreuve.
Nous eûmes tôt fait d’accepter.
L’île, – nous l’apprîmes en route – avait une longueur de dix heures de marche et une largeur de sept : nos yeux nous disaient la merveilleuse fécondité de son sol, car il y avait de grandes plantations de bananiers et d’autres curieuses espèces de plantes. L’étroitesse des routes indiquait l’absence de véhicules et de bêtes de somme, mais il y avait de multiples témoignages d’une civilisation, qui, pour ces régions, paraissait avoir atteint un extraordinaire développement : ainsi, par exemple, les champs étaient merveilleusement cultivés et les maisons construites de pierre, tandis que la culture de beaucoup de fleurs superbes croissant dans l’île, dénotait de la part des habitants, un indiscutable goût artistique.
J’énumère ces divers points en détail afin que l’île puisse être reconnue par les sauveteurs que nous réclamons de tous nos vœux.
La ville, où l’on nous conduisit est un endroit d’une singulière beauté.
Si les rues n’en sont pas disposées avec ordre, – les maisons sont éparses au hasard, – il y a du moins un fort sentiment du bien-être, de l’espace et une belle apparence de propreté. Les constructions sont toutes de pierre brute et ne sont pas divisées en appartements : portes et fenêtres ne sont fermées que par des nattes, témoignant ainsi de l’absence complète de voleurs. Un peu à l’écart, sur une hauteur, se dresse la maison du roi ou chef. Elle ressemble fort aux autres, si ce n’est qu’elle est plus vaste, avec une salle sur le devant, où le roi expédie les affaires de son état.
C’est dans cette salle qu’on nous mena et le roi bientôt fit son entrée.
Il était vêtu avec une profusion plus barbare que ses sujets ; il portait autour du cou et aux oreilles de riches bijoux d’or et d’argent, évidemment sortis des mains d’ouvriers européens, mais portés avec un absolu mépris de leur destination première. De haute taille, vigoureux, bel homme, le roi nous accueillit avec un sourire bienveillant ; si jamais visage humain témoigna de bonté de cœur, c’était le sien.
Il nous fit aussitôt comprendre que nous étions les bienvenus, que dans notre détresse toute sa sympathie nous était acquise et que l’on veillerait à ce que nous ne manquions de rien jusqu’à ce qu’on trouvât un moyen de nous rapatrier ou tout au moins de nous conduire partout où nous pourrions désirer aller.
Il n’était pas du tout probable, dit-il, car il parlait un peu l’allemand, qu’aucun vaisseau venu du dehors visitât l’île qui semblait ignorée des navigateurs et c’était une loi en vigueur dans l’île d’en interdire l’accès aux habitants de toute autre île. À certaines phases de la lune pourtant, il envoyait une embarcation dans une île, à plusieurs lieues de là, échanger les plus rares produits de son peuple contre certaines denrées et, si nous le désirions, l’embarcation pourrait emmener l’un de nous à tour de rôle, et le mettre à même de profiter du passage éventuel d’un navire. Ce ne fut pas sans une nuance d’embarras, qu’il nous informa qu’il était obligé de nous imposer une légère restriction : il se hâtait d’ailleurs d’ajouter qu’elle n’entraverait en rien notre bien-être ni notre plaisir. L’on nous tiendrait, dit-il, à l’écart de son peuple qui était simple et heureux ; il craignait qu’en nous mêlant à ses sujets, nous ne fissions naître en eux des germes de discorde. Ils n’avaient atteint leur condition actuelle que grâce à cette politique d’isolement absolu, pratiquée depuis de fort longues années.
Nous accueillîmes cette détermination avec une joie que nous ne nous donnâmes même pas la peine de dissimuler, et le roi parut touché de nos témoignages de gratitude.
Quelque temps après, nous formions une petite colonie à trois milles environ de la ville ; les indigènes très habilement nous avaient, à l’aide de pieux, de nattes et de chaume, construit un nombre d’habitations suffisant pour notre bien-être et le roi mit à notre disposition une certaine étendue de terre à cultiver si le cœur nous en disait, nous envoyant un de ses sujets les plus intelligents pour nous conseiller.
Nous étions arrivés dans l’île le 10 mai 1853 et le 14 nous étions organisés en colonie.
Je ne puis m’attarder à une description plus étendue de cette île magnifique et du délicieux paysage qui nous environnait ; il me faut en toute hâte en venir au récit des terribles événements qui survinrent.
Nous étions dans l’île depuis un mois, quand le roi qui, à deux reprises, était venu nous rendre visite, envoya un messager nous prévenir qu’une embarcation quitterait le lendemain et que si l’un d’entre nous désirait s’en aller, on l’emmènerait. Le messager nous confia que l’avis du roi était de laisser partir d’abord les maladifs ; mieux valait, dans le cas d’une maladie grave, qu’ils mourussent chez eux.
Nous ne prîmes pas garde à cette manière singulière et un peu barbare de présenter la question, car notre reconnaissance pour le roi était si grande que l’expression de son moindre désir devenait pour nous un ordre. Ce fut donc John Foley, un charpentier, de Boston, que nous choisîmes : les fatigues du voyage avaient développé en lui le germe de la phtisie et de plus il n’avait parmi nous, comme c’était le cas de beaucoup d’autres, ni famille ni parents. Le pauvre garçon était tout confus et reconnaissant, et nous quitta tout heureux.
Je dois ici mentionner un fait singulier qui, lors du départ de Foley, sollicita particulièrement notre attention.
Nous étions dans une vallée spacieuse, presque complètement entourée de rochers perpendiculaires d’une grande hauteur et la mer n’était visible d’aucun point accessible. À plusieurs reprises les plus jeunes et les plus alertes avaient cherché à s’éloigner de la vallée et à gagner le rivage, mais, à chacune de ces tentatives, des indigènes disposés de différents côtés avaient soudain fait leur apparition dans les rares issues que la nature avait creusées dans cette muraille de rocs, et avec douceur, mais fermeté, avaient obligé nos jeunes gens à s’en retourner, disant que le roi désirait nous voir ne pas quitter la vallée.
Les plus âgés parmi nous déconseillaient ces tentatives, les considérant comme des abus de confiance et des infractions aux lois de l’hospitalité, mais la conviction d’être réellement prisonniers nous pesait néanmoins et nous devenait de plus en plus pénible.
Or, lorsqu’on emmena notre compagnon, un mouvement s’organisa parmi les jeunes dans le but d’atteindre un point élevé dominant la mer et d’observer la direction prise par le canot où s’embarquait Foley. Le plan était de se diviser en plusieurs groupes et simultanément de gagner en forces les différentes passes et de maîtriser, sans toutefois avoir recours à une violence dangereuse, les deux ou trois indigènes qui semblaient garder ces points. Quand nos hommes y arrivèrent, ils se trouvèrent en face des quelques indigènes que l’on y voyait habituellement et tentèrent de se frayer une route, mais soudain apparut une troupe nombreuse d’insulaires qui, tirant leurs sabres, prirent une attitude si menaçante que les nôtres sans perdre de temps battirent en retraite. Chacun de nos groupes différents avait fait exactement la même expérience.
Bien qu’il n’y eût pas là de quoi légitimer le sentiment de malaise qui, lorsque ces faits furent connus, se répandit dans la colonie, les plus forts éprouvèrent un certain accablement tandis que les plus faibles s’effrayaient. On tint conseil et l’on résolut de demander au roi une explication.
D’autres faits intéressants avaient d’ailleurs eu lieu : entre autres choses, j’avais subrepticement acquis une connaissance assez étendue de la langue du pays. Je fus donc choisi comme ambassadeur.
Ma mission échoua complètement.
Le roi, très bienveillant, me déclara que ce plan était nécessaire pour assurer l’isolement complet de son peuple et il me chargea de dire aux camarades que tout membre de la colonie rencontré au-delà des limites serait puni de mort. De plus, le roi selon toute apparence froissé que nous ayons pu mettre en doute la droiture de sa conduite, me dit que dorénavant il choisirait lui-même ceux d’entre nous que l’on embarquerait.
J’avais été réellement impressionné par le caractère supérieur de cet homme, et la conviction avec laquelle il nous considérait comme appartenant à une race inférieure à la sienne, à la fois intellectuellement et moralement, m’avait confondu et placé vis-à-vis de lui dans une situation défavorable.
Quand je rapportai ces nouvelles à la colonie, un sentiment limitrophe du désespoir s’empara de chacun. Certains d’un caractère plus violent proposèrent de se révolter et de s’emparer de l’île, mais c’était là une idée tellement insensée qu’on l’abandonna aussitôt.
Quelque temps après le roi envoyait chercher Absalon Maywood, l’un de nos jeunes gens, célibataire, mais qui avait avec lui sa mère.
Maywood, d’abord fort affaibli pendant la traversée par une attaque de scorbut, était tombé la proie de nouveaux maux et se trouvait maintenant malade et très épuisé. Je n’insisterai pas sur l’émouvante séparation de ce fils et de sa vieille mère, ni sur la tristesse qui s’empara de la colonie tout entière.
Que devenaient ces hommes ?
Nul ne pouvait savoir où on les menait, nul ne pouvait deviner leur destinée ! Et derrière nos efforts pour paraître gais et actifs, nous avions le cœur gros et peut-être aussi des pensées et des craintes qui n’osaient se formuler.
Un troisième fut mandé – un malade encore celui-là, – cette fois un fermier souffrant de la poitrine, nommé Jackson ; quelque temps après ce fut le tour d’un quatrième, une femme âgée atteinte d’un cancer ; une Mme Lyons, précédemment modiste dans un quartier de Boston.
La patience et l’espoir qui nous soutenaient encore, tombèrent.
Les plus réfléchis parmi nous se réunirent tranquillement à l’écart pour discuter une ligne de conduite.
Le conseil fut présidé par le capitaine Campbell, homme froid et brave, toujours notre chef, et qui toujours avait plaidé la cause de la patience et de la soumission. Une pensée terrible pesait dans tous les esprits, mais nul n’avait le courage de l’énoncer.
Après un certain nombre de discussions oiseuses, le capitaine prononça l’allocution suivante :
– Mes amis, il est indigne de nous de celer plus longtemps la pensée que nous avons tous et qui, tôt ou tard, se devra formuler. C’est un fait connu que dans la plupart des îles situées en ces parages l’horrible pratique du cannibalisme existe.
Un silence prolongé suivit.
Mais tous nous étions satisfaits que c’eût enfin été dit. Nul n’osait regarder son voisin ou lever les yeux du sol et tous nous avions sur le cœur un pesant fardeau.
– Néanmoins, reprit le capitaine, il est extrêmement difficile de croire que nous sommes menacés d’un pareil malheur, car vous avez pu remarquer que l’on ne prend que les malingres et les malades. Or, bien certainement cela n’indique pas le cannibalisme.
Certains n’avaient pas envisagé ce côté de la question ; ils relevèrent vivement la tête, leurs figures s’éclairèrent.
Le capitaine continua :
– Toutefois vous avez dû observer que malades et malingres nous ont maintenant tous quittés et ceci nous crée une situation différente. J’ai une idée que je vous dirai tout à l’heure, et mon but, en vous réunissant, était d’en rechercher ensemble le bien-fondé ou la fausseté. Mais, pour cela, il faut que l’un de nous, audacieux et agile, expose sa vie.
Presque tous les hommes présents offrirent leurs services.
Le capitaine secoua la tête et d’un signe réclama le silence :
– Il est indispensable, ajouta-t-il, que cet homme comprenne la langue, et je crains qu’il n’y en ait pas un seul parmi vous.
Déconcertés, tous se regardèrent, puis, comme je m’avançais, reportèrent sur ma personne leurs regards.
Le capitaine me considéra d’un air reconnaissant et dit :
– Promettons-nous maintenant de garder la chose secrète entre nous. Il ne faut pas que les autres le sachent encore maintenant, peut-être vaut-il mieux qu’ils ne le sachent jamais. Quand nos craintes se réaliseraient, ce ne serait qu’une raison de plus pour garder notre secret. Est-ce bien compris ? Donc, monsieur Keating, le plan est le suivant : la prochaine fois qu’on prendra l’un de nous, vous devrez, par ruse et non par violence, vous échapper de notre prison, vous assurer de son sort et nous le faire connaître.
Une semaine après, car maintenant cela survenait avec plus de fréquence, Lemuel Arthur, jeune homme de vingt-deux ans, fut emmené vers une heure de l’après-midi.
Mon plan avait été longuement mûri.
Je me vêtis à la manière des insulaires, après m’être bruni la peau à l’ocre, noirci les sourcils et les cheveux avec un mélange de suie et de suif, et réussis à tromper la vigilance des gardes.
Je me trouvai donc libre dans l’île.
Je gagnai un point élevé, mais ne vis nulle trace d’embarcation prête à quitter l’île emportant Arthur. Quand la nuit fut venue, je descendis au village et en suivis les confins, me tenant autant que possible dans l’ombre. Je n’osais adresser la parole à personne, mais je pouvais écouter, et bientôt j’entendis quelque chose qui me glaçait le cœur.
– Il y a si longtemps que nous n’en avions pas eu, disait un indigène à l’autre.
– Oui, et celui-ci sera délicieux. On le dit jeune et gras. C’est que nous n’en avons pas goûté depuis le naufrage qui amenait dans l’île ces quatre hommes et leur femme couverte de bijoux.
– C’est vrai ; mais celui-ci ne suffira pas encore pour tous et il y en aura beaucoup qui s’en passeront.
– Qu’importe ? Ceux qui n’en auront pas cette fois, n’en auront que plus de plaisir quand viendra leur tour. Ceux qui restent maintenant sont tous bons et gras, puisque le roi a pris les chétifs et les malades. Il n’a pas voulu permettre qu’on y touchât en dépit des plus instantes prières. On les a sûrement mis dans le four à chaux.
Je me sentis si malade en entendant cela que je fus sur le point de me trahir, et que je dus certainement perdre une partie de la conversation. Mais bientôt je me rendis compte que rien de ce qui avait été dit ne confirmait absolument l’horrible sort que je redoutais pour nos amis ; mes seules craintes avaient pu suffire à donner cette effrayante signification à leurs propos. Je regardai autour de moi, ils avaient disparu.
Avec précaution je gagnai un autre point du village, toujours dans l’ombre, et en certain endroit j’entendis une autre conversation, la suivante :
– Sait-il ce qu’on veut faire de lui ?
– Non, mais il redoute quelque chose. Il ne comprend pas notre langue. Il a essayé cet après-midi de s’échapper et de gagner la côte où il pensait que l’attendait le canot et s’est emporté quand on a tenté de l’arrêter.
– Et qu’a-t-on fait ?
– On l’a conduit devant le roi qui lui a témoigné tant de bonté que le jeune homme s’est calmé. Notre roi est si doux, ils croient toujours ce qu’il leur dit !
Là-dessus, l’insulaire éclata d’un bon gros rire.
– Et les autres n’ont-ils pas de soupçons ?
– On le craint. Rolulu, le fermier, a déclaré qu’ils paraissaient inquiets et troublés et tenaient des conciliabules secrets.
– Que pensez-vous qu’ils feraient s’ils découvraient la vérité ?
– Ils se révolteraient, je pense, car ils semblent capables de se battre.
– Mais ils n’ont pas d’armes, et nous sommes plus de cent contre un.
– C’est vrai, et de cette manière-là on n’aurait pas de morts à déplorer ni d’un côté ni de l’autre. Après la révolte, on en serait quitte pour les surveiller plus étroitement et tout irait bien, en somme. On continuerait à les prendre un à un, comme on le fait maintenant.
– Ils pourraient refuser de manger suffisamment et se laisser maigrir.
– C’est certainement ce qui arriverait, mais cela ne durerait qu’un temps ; vous avez en effet dû remarquer que les nôtres eux-mêmes, quand ils sont condamnés, perdent d’abord de leur embonpoint, mais invariablement finissent par en prendre leur parti et engraissent plus que jamais.
Les paroles de celui-ci, fonctionnaire du roi, bien évidemment, m’inspirèrent une telle horreur que je ne pus supporter d’en entendre davantage.
Je m’éloignai, me demandant si je retournerais à la colonie rendre compte de ce que j’avais entendu ou si je resterais afin d’assister jusqu’au bout à la terrible tragédie. Comme il n’y avait rien à gagner à un retour immédiat, je me décidai à rester. Dans l’horreur même du spectacle ne pouvais-je pas puiser quelque moyen de délivrance ?
Je compris bientôt, en voyant l’affluence des habitants vers une certaine place, que quelque chose d’une inhabituelle importance se préparait. Du mieux qu’il me fut possible, à l’aide d’un détour, je gagnai le point de convergence, situé dans le voisinage de la maison du roi et là j’assistai à d’extraordinaires préparatifs.
Sur la place brûlait un grand feu de joie ; à l’entour, formant un immense cercle, se tenaient des centaines des étranges demi-sauvages de l’île, qu’une patrouille armée maintenait à une certaine distance. D’un côté, dans un espace vide sur un tertre, se dressait un siège élevé que je supposai réservé au roi.
Manifestement, on se disposait à assister à un spectacle d’importance, ayant probablement un caractère de cérémonie.
Le côté le plus curieux était l’activité déployée par un certain nombre d’ouvriers, occupés à tirer du feu de larges pierres chaudes et à les disposer en forme de remblai oblong. Ce remblai avait ceci de particulier qu’il renfermait un espace libre de six pieds de long sur deux de large et ces hommes ; sur les ordres d’un surveillant, l’élevaient d’une hauteur de deux pieds. Les pierres brûlantes étaient difficiles à manier, même avec l’aide de brancards.
Ils étaient encore au travail, quand la grande excitation contenue qui animait la foule, trouva dans l’arrivée du roi une excuse pour s’exprimer. Le roi, attifé avec un luxe inhabituel, s’avançait solennellement à la tête d’une suite et gagnait son siège élevé. Puis il donna un ordre que vu l’éloignement, je ne pus entendre. Je m’approchai un peu plus grâce à la sécurité que m’offrait la situation, et j’entendis la conversation suivante :
– Pour combien va-t-il y en avoir ?
– Pour une quarantaine, dit-on. Les femmes, vous savez, ne doivent pas en avoir, c’est défendu.
– Oui.
– Ce sont les chefs qui en recevront d’abord. Le prochain sera distribué à soixante hommes de la garde.
– Et le suivant ?
– À la garde encore, jusqu’à ce que tous aient eu leur part, et l’on en distribuera ensuite au peuple par roulement, mais la ration de chacun sera plus petite.
À cet instant une étrange procession sortit de la maison du roi.
En tête marchaient deux prêtres qui récitaient une psalmodie plaintive ; derrière eux s’avançaient quatre hommes, armés d’instruments curieux, – on eût dit des fléaux. Ensuite venaient quatre guerriers et, derrière eux, solidement garrotté et complètement nu, marchait mon jeune ami, Arthur. Six guerriers fermaient la marche.
La peau blanche d’Arthur contrastait avec celle des sauvages qui l’entouraient. Il avait la figure très pâle, et ses yeux, démesurément dilatés se tournaient vivement de tous côtés en quête d’un dernier espoir.
Le groupe fit halte devant le roi ; les insulaires se rangèrent et s’inclinèrent profondément, attendant de nouveaux ordres.
Avant tout ceci, un sauvage devant moi avait dit à un autre : Ces pierres chaudes vont finir par se refroidir.
– Il n’y a pas de danger ; elles conservent très longtemps leur chaleur. Si elles étaient trop chaudes, elles le brûleraient.
– C’est juste.
– Elles sont bien trop chaudes maintenant, mais on ne va pas en avoir besoin tout de suite.
– Vont-ils se servir d’abord du sabre, comme on l’a fait pour ces gens aux bijoux ?
– Non ; la plus grande partie du sang se perdait. Le roi a eu une nouvelle idée. On doit se servir de fléaux qui auront en outre l’avantage de rendre sa chair très tendre. Notre roi est un sage.
Le jeune Arthur maintenant – le roi ayant donné ses ordres – était entouré d’un cercle d’hommes armés, au milieu desquels avaient pris place les quatre insulaires qui portaient les fléaux. On l’avait attaché par les mains à un poteau enfoncé dans le sol. Le roi de la main donna un signal et les quatre hommes frappèrent de leurs fléaux, mais avec une force modérée, le corps nu d’Arthur. Ces instruments étaient lourds et ils prenaient évidemment soin de ne pas lui briser la peau. Sous les coups, le pauvre garçon frémit et son corps se contracta, mais pas un son ne s’échappa de ses lèvres. Les fléaux de nouveau s’abaissèrent.
Et moi, que faisais-je pendant ce temps ? Quelles étaient mes pensées ? Je ne sais, mais quand les seconds coups lui eurent été portés et qu’Arthur eut poussé un cri de d’agonie, je m’élançai à travers le cercle de sauvages, me précipitai au milieu du groupe qui entourait le prisonnier, arrachai à un guerrier son sabre, courus au roi, lui fendis la tête, revins à Arthur, coupai ses liens, le saisis par la main et l’entraînai à toute vitesse dans la nuit.
Jamais surprise ne fut plus complète que celle de ces sauvages voyant un des leurs, à ce qu’ils croyaient, délivrer le prisonnier et massacrer le roi.
Un grand cri retentit bientôt et un certain nombre s’élancèrent sur nos pas. Mais ils avaient le corps du roi et les pierres brûlantes attendaient ! Il n’y avait plus d’autorité ! Ceux qui nous poursuivaient, un à un, s’arrêtèrent et les autres, découragés, renoncèrent à la poursuite. Nous courûmes au rivage ; il y avait un canot, et un instant après nous nous éloignions du rivage.
Nous sommes libres, tous deux ! À quoi cela nous avance-t-il ?
Nous n’avons pas la moindre idée de la direction à suivre ; nous n’avons de nourriture ; nous n’osons rejoindre nos amis, car il n’y a pour nous d’espérance de les délivrer que dans l’improbable espoir d’aborder quelque part. Nous avons fait force de rames toute la nuit ; nous voici maintenant à une heure avancée de l’après-midi ; nous n’avons rien à manger ni à boire ; nous commençons à souffrir, et nous sommes nus tous les deux et le soleil nous dévore.
J’écris ce récit sur des chiffons de papier dont j’avais eu la prudence de me munir en cas de semblable réussite et je vais maintenant le confier à la mer, priant qu’on le découvre avec l’ardeur que seul peut mettre en ses prières le plus malheureux des êtres réduits à toute extrémité.
LE TALISMAN FIDÈLE
C’était un vieux coquin bien bizarre que Rabaya, le Mystique, un de ces types extraordinaires comme on n’en trouve que dans ce singulier coin de San Francisco, connu sous le nom de Faubourg d’Orient.
Son commerce consistait en la vente de philtres et de talismans : sa profession, assez inoffensive, empruntait un cachet impressionnant à sa nationalité hindoue, à son grand âge, à son petit corps ratatiné, à son visage balafré de rides profondes, à son costume oriental, ainsi qu’à l’agencement barbare de son taudis.
Il avait pour client assidu James Freeman, propriétaire et capitaine, moitié pirate, moitié marchand de l’« Ibis Bleu. »
On se souvient encore dans tous les ports situés entre Sikra et Callao de l’étrange petit brigantin, de mince tonnage, mais d’une marche supérieure. Mille histoires baroques circulaient sur ses exploits, mais la plupart étaient colportées par des marins superstitieux et d’imagination vive, de ces gens qui démontrent couramment l’affinité naturelle existant entre le mensonge et l’oisiveté.
On contait non seulement qu’il se livrait à la contrebande, à la piraterie et à la traite qui consiste à enlever des indigènes de certaines îles pour les vendre aux planteurs de l’Amérique Centrale, mais encore qu’il entretenait d’étroites relations avec Satan, grâce au pouvoir mystérieux de certains talismans que son capitaine, supposait-on, se procurait à des sources secrètes et savait employer à l’occasion.
En dehors de l’information que révélaient ses papiers de bord et ses acquits, on ne pouvait rien tirer ni de lui ni de son équipage, concernant ces prétendues opérations ténébreuses. Ses marins comme lui, formaient une troupe étrangement discrète, tous jeunes, vifs, alertes, qui jamais ne buvaient et qui, au port, faisaient bande à part.
C’était un fait très inhabituel et valant d’être noté, qu’il n’y avait jamais de vide à combler dans les rangs de son équipage ; il n’y en eut qu’un qui résulta de la dernière visite que fit Freeman à Rabaya.
Il survint de l’étrange manière suivante.
Freeman, comme la plupart des marins, était superstitieux et attribuait sa chance aux sortilèges qu’en secret il se procurait chez Rabaya. On savait qu’il rendait visite au Mystique, chaque fois qu’il entrait dans le port de San Francisco, et il en est encore aujourd’hui qui sont persuadés que Rabaya était intéressé aux prétendues expéditions flibustières de l’« Ibis Bleu. »
Parmi les plus intelligents et les plus actifs de l’équipage du brigantin était un Malais, que ses camarades avaient surnommé le Diable Volant. Son extraordinaire agilité lui avait valu ce surnom. Un singe n’eût pas été plus actif dans les agrès ; il faisait de la voltige avec une incroyable adresse. Il ne devait pas avoir plus de vingt-cinq ans, mais avait l’apparence recroquevillée d’un vieux. Il avait la peau du visage mate et ridée, les yeux profondément enfoncés et parfaitement noirs et brillants. Sa bouche était ce qu’il avait de plus repoussant. Elle était grande et ses lèvres minces se resserraient sur de grosses dents en saillie qui lui donnaient un air agressif et menaçant. Bien que froid et peu porté à rire, il souriait parfois et l’expression de son visage était alors telle qu’elle donnait à Freeman lui-même l’impression d’un danger imminent.
On ne sut jamais très bien quelle était la réelle destination de l’« Ibis Bleu », la dernière fois que le brigantin quitta San Francisco. Les uns prétendirent que son capitaine projetait de piller de son trésor un navire englouti, d’autres qu’il avait en vue un acte de pure piraterie, ne consistant en rien moins que de saborder un navire après en avoir massacré l’équipage en plein océan ; d’autres enfin, qu’il se proposait de passer en contrebande dans quelque port des îles de la Sonde un chargement considérable d’opium, en faisant la nique aux autorités douanières averties.
Quoi qu’il en fût, l’affaire en devait être une d’importance, car l’on sait maintenant que pour s’assurer du succès, Freeman avait fait chez Rabaya l’acquisition d’un talisman puissant et d’un prix tout à fait inhabituel.
Quand Freeman alla acheter son talisman, il ne s’aperçut pas que le Diable Volant sournoisement s’était attaché à ses pas. Ni le capitaine ni le marchand hindou, d’ailleurs presque aveugle, n’avaient vu le Malais se glisser dans le taudis de Rabaya et assister à leur entretien.
L’intrus dut entendre quelque chose qui remua en lui tous ses instincts mauvais.
Plusieurs années après, Rabaya (que l’on m’eût à peine persuadé de croire même sous la foi de son serment) me conta que le talisman qu’il avait vendu à Freeman en était un d’une extraordinaire vertu. Pendant de nombreuses générations, il avait été possédé par la famille de l’un des plus fiers rajahs de l’Inde, et les armes anglaises avaient échoué dans cette région de l’Inde Orientale tant qu’on n’eut pas réussi à le leur dérober. S’il était entre les mains d’une personne de grand caractère (et tel était Freeman, ainsi qu’il me le fit solennellement savoir), il ne manquait jamais de procurer le plus grand bonheur ; car, bien que le talisman possédât une puissance mauvaise en même temps, une personne digne se devait d’annuler le mal et n’en employer que le bien. Au contraire, ce talisman porté par un être méchant devenait un instrument de mal des plus dangereux.
C’était une petite et très ancienne breloque, faite de cuivre et représentant un serpent grotesquement enroulé autour d’un cœur humain : le cœur était transpercé d’un poignard, et l’un des replis du serpent était disposé en forme d’anneau pour permettre de le suspendre. Ce talisman avait une histoire merveilleuse, mais nous la réserverons pour aujourd’hui ; qu’il suffise de savoir que, étant passé dans bien des mains d’hommes méchants et d’hommes bons, il avait entraîné autant de bienfaits que de calamités.
Il devenait utile et se trouvait en parfaite sécurité, me dit Rabaya, entre les mains d’un homme tel que Freeman.
Or, comme nul ne connaît le fonds et le tréfonds de sa propre méchanceté, le Diable Volant, qui, comme me l’expliqua Rabaya, devait avoir entendu la conversation échangée entre lui et Freeman, à l’occasion de leur transaction, se dit tout simplement que, s’il s’assurait la possession du talisman, sa fortune serait faite : ne pouvant autrement s’en assurer la possession, il le lui fallait voler.
En outre, il devait savoir le prix – cinq mille dollars en or – que Freeman avait payé pour la breloque et cela seul pouvait suffire à émouvoir la cupidité du Malais. L’on dit, en tout cas, qu’il s’arrangea pour voler le talisman et déserter le brigantin.
Depuis cet instant jusqu’à la catastrophe finale, certains de mes renseignements sont plus vagues.
Je ne puis dire, par exemple, comment fut commis le vol, mais il est certain que Freeman ne s’en aperçut que bien plus tard.
Mais ce que Freeman ressentit vivement, ce fut l’absence du Malais au moment où le brigantin levait l’ancre et lançait son amarre au remorqueur qui le devait emmener vers la haute mer. Le Malais était un marin précieux ; le remplacer à sa juste valeur était à ce point impossible que Freeman décida, après de vaines heures de recherches et de retard regrettable, de quitter le port sans lui et sans en embaucher un autre à sa place. Ce fut le cœur gros, mais allégé toutefois par la confiante pensée qu’il avait son talisman en sécurité sur lui, que Freeman descendit le chenal, le cap sur la Porte d’Or.
Durant ce temps, le Diable Volant avait d’étranges aventures.
Sous un déguisement arrangé à la hâte, composé d’un costume de ville pouvant appartenir à un homme de la classe aisée et sous lequel il espérait passer pour un Japonais fortuné, cherchant gauchement à se familiariser avec les coutumes de l’endroit, il surgit d’une misérable taverne des quais et se dirigea d’un pas tranquille jusqu’au sommet de Telegraph Hill de façon à embrasser soigneusement toute la ville du haut de la colline ; il lui était, en effet, urgent de savoir la meilleure route à prendre pour s’échapper.
De cette position élevée, il voyait non seulement une grande partie de la ville, mais aussi la presque totalité de la baie de San Francisco, et la ligne de côte, et les villes et les montagnes se dressant au delà. Son attention fut tout d’abord particulièrement sollicitée par l’« Ibis Bleu », placé précisément en dessous de lui et qu’il voyait se balancer doucement sur ses ancres au bas de Lombard Street. À deux milles à l’ouest, il vit les arbres masquant la caserne et la résidence du général commandant de place sur le haut promontoire de Black Point. Ces arbres lui inspirèrent l’idée d’aller demander abri à leur ombre, jusqu’à ce que la venue de la nuit lui permît de se frayer facilement une route le long de la presqu’île de San Francisco jusqu’aux montagnes bleues de San Mateo qu’il apercevait au loin.
Certain que Freeman le ferait rechercher, mais supposant très justement que ces recherches ne dépasseraient pas les limites des docks, il pensait que ce ne serait point malaisé de s’échapper.
Ayant maintenant ses renseignements, le Malais se disposait à descendre le versant nord de la colline, quand il observa un inconnu appuyé contre le parapet qui couronnait la hauteur. L’homme semblait le guetter. Ne réfléchissant pas que son apparence singulière suffisait à légitimer cet examen, des soupçons lui vinrent ; il redouta, bien qu’à tort, d’avoir été suivi, car l’étranger était venu là quelques instants seulement après lui. Affectant un air d’indifférence, il se dirigea, tout en flânant du côté de l’étranger et, une fois près de lui, avec l’agilité et la férocité d’un tigre, il s’élança et lui plongea la lame d’un couteau dans les côtes.
L’étranger s’affaissa avec un cri sourd, et le Malais s’enfuit.
Par une curieuse coïncidence, l’inconnu était tombé devant un trou que la négligence avait laissé creuser par la pluie sous le parapet. Dans les affres de la mort il se débattit et ses mouvements désordonnés engagèrent le corps dans l’ouverture. Ceci fait, la pente à cet endroit étant particulièrement escarpée, il roula, et la rapidité de la descente s’accroissant à chaque bond. Sur ce versant escarpé sont assez pittoresquement perchées plusieurs villas. Mme Armour, propriétaire de l’une d’entre elles, était assise près d’une fenêtre dans une chambre de derrière, occupée à coudre, quand elle fut stupéfaite de voir un homme voler par sa fenêtre. Il était lancé avec une telle violence qu’il creva la mince cloison qui séparait la chambre d’une pièce contiguë et vint s’affaler masse informe, au pied du mur en face. Mme Armour appela au secours. Il s’ensuivit une grande perturbation, mais on fut quelque temps avant d’établir une relation entre la chute du cadavre et le meurtre commis sur le parapet. La police montra cependant beaucoup d’activité et bientôt une douzaine d’agents s’élançaient sur les larges traces que le meurtrier avait laissées de sa fuite le long de la colline.
Peu de temps après, le Malais se trouvait au milieu des piles de ballots encombrant le quai septentrional. De là, ayant repris haleine, il se dirigea d’un pas tranquille vers l’ouest, passa derrière un chantier et franchit une petite plage de sable, où des mères et des nourrices promenaient des enfants.
Le diabolique esprit du mal qui travaillait le misérable (et que Rabaya ensuite expliqua par sa possession du talisman), rendu encore plus audacieux par l’idée que le charme le protégeait contre tout danger, le poussa à voler un petit réticule placé sur un banc près d’une dame bien mise. Il l’emporta, puis plus loin l’ayant ouvert, fut ravi d’y trouver de l’argent et des bijoux. À ce moment, un des enfants qui avait remarqué le vol du Malais, attira sur lui l’attention de la dame.
Elle s’élança à sa poursuite, poussant des cris qui eurent tôt fait de vider quelques cabarets voisins peu distants, d’une foule de clients qui coururent sur ses pas.
Le Malais bondissait avec une vitesse qui promettait de laisser loin en arrière tous ceux qui le poursuivaient, quand, au moment où il passait devant un grand établissement de bains, un agent ayant tiré sur lui un coup de revolver, la balle le fit tomber sur les genoux.
La foule rapidement l’entoura.
Le criminel réussit à se remettre tant bien que mal sur pied, puis se précipitant férocement sur un individu devant lui, lui plongea son couteau dans le corps, et, reprenant sa course, disparaissait bientôt dans les ruines d’une vieille construction, située au pied d’un cap de sable, sur le bord de l’eau.
On suivit quelque temps sa piste au milieu des ruines, grâce aux gouttes de sang qu’il laissait sur son passage, et puis on le perdit. On supposa qu’il avait gagné un vieux moulin de Black Point.
Comme cela se passe chaque fois qu’une foule poursuit un criminel en fuite, la poursuite était folle et désordonnée, de sorte que, si le Malais avait au delà des ruines laissé quelque trace, elle eût été vite effacée par le piétinement de tant de pieds.
Il n’y avait dans la foule qu’un seul agent de police, mais d’autres mandés par téléphone, accouraient de tous les côtés. Pendant quelque temps des renseignements confus et contradictoires déroutèrent les agents, mais ils formèrent bientôt une longue ligne en demi-cercle, allant de North Beach jusqu’à la nouvelle usine à gaz, bien au delà de Black Point.
C’est à peu près à ce moment-là que le capitaine Freeman leva l’ancre.
Le sommet de Black Point est couronné par de grands eucalyptus que le Diable Volant avait vus du haut de Telegraph Hill. Une haute barrière, qui enclot la maison du général, s’étend tout du long du promontoire jusqu’au bord. Un factionnaire se promenait de long en large devant la porte des jardins, arrêtant tous ceux qui n’étaient point munis d’un laissez-passer. Le factionnaire avait vu la foule et dans le lointain avait remarqué les boutons de métal des agents, luisant sous les rayons du soleil couchant.
Le factionnaire se demanda ce qui se passait.
Tandis qu’il était ainsi occupé, il vit un petit homme, bronzé, maigre, surgir dans la direction du vieux moulin au pied du promontoire.
L’étranger se dirigea droit vers lui.
– On n’entre pas, dit le factionnaire, à moins d’un laissez-passer.
– D’un quoi ? demanda l’étranger.
– D’un laissez-passer, répéta le soldat qui, s’apercevant alors qu’il avait affaire à un étranger connaissant mal la langue, s’efforça de lui donner des explications par signes, gardant toujours son arme sur l’épaule.
L’étranger, dont les yeux brillants causaient une sensation étrange au factionnaire, fit un signe de tête et sourit.
– Oh ! dit-il, j’en ai un !
Il mit la main à sa poche, tout en s’avançant et en lançant à l’entour un regard rapide.
L’instant après, le soldat s’affaissait, la gorge ouverte.
Le Malais se glissa dans les jardins et disparut derrière une charmille.
Ce ne fut guère qu’une heure après, lorsque survinrent la foule et les agents, qu’on découvrit le cadavre du malheureux soldat. On sut alors que l’audacieux criminel n’était pas loin. Le clairon sonna et les soldats s’élancèrent dans la cour de la caserne.
On fouilla tous les coins et recoins.
Il y eut probablement un gros sentiment de soulagement chez plus d’un, quand on annonça que le malfaiteur s’était échappé par eau et que la marée descendante l’entraînerait rapidement dans le chenal vers la haute mer.
On le voyait distinctement dans un petit canot, se dirigeant autant qu’il lui était possible au moyen d’une planche grossière qui lui tenait lieu d’aviron.
Voici comment s’était effectuée sa fuite.
En entrant dans les jardins, il avait en courant suivi la grille orientale, caché par les arbres, jusqu’à une barrière transversale, séparant les jardins des communs. Il avait d’un bond franchi cette barrière et là s’était trouvé en face d’un énorme et formidable dogue.
Il avait tué l’animal et cela de la manière la plus hardie, – en l’étouffant. Il y avait des traces d’une longue et terrible lutte entre l’homme et le dogue. La raison probable pour laquelle l’homme n’avait pas, cette fois eu recours au couteau, se trouvait dans la nécessité où il avait été de réduire la bête au silence et ensuite dans son obligation d’employer les deux mains pour conserver l’avantage.
Après s’être débarrassé du chien, le Diable Volant, quoique blessé, avait accompli un exploit digne de son sobriquet : il avait sauté le dernier mur. Au pied du promontoire, il avait trouvé un canot amarré par une chaîne à un poteau fiché dans le sable. Il n’y avait pas d’autre moyen de détacher l’embarcation que de déterrer le poteau, et c’est ce qu’avait fait le Malais en se servant de ses seules mains ; puis, embarquant chaîne et poteau, il avait fait démarrer le canot, en se servant d’une planche trouvée sur la plage, et s’était laissé emporter par la marée.
Quelques instants après on le découvrait du fort, mais il était si loin et on était si incertain de son identité que les canonniers hésitèrent à tirer sur lui.
Deux faits dramatiques se passèrent alors.
À l’encontre du canot à la dérive marchait un épais banc de brouillard venant de la haute mer. Le meurtrier se dirigeait droit dessus, pagayant vigoureusement avec le jusant. Si le brouillard l’enveloppait, il se perdrait dans le Pacifique ou se briserait presque certainement sur les rochers, et cependant il courait à cette destinée de toutes ses forces. C’est ce qui tout d’abord convainquit les agents à sa poursuite que c’était bien leur homme ; aucun autre ne se serait risqué à suivre une route si dangereuse. En même temps, la lunette d’un soldat de marine, dissipa tous les doutes.
On donna l’ordre de tirer sur lui.
Un canon de six gronda et des éclats du canot volèrent ; mais son possesseur, d’un air de bravade provocante, se dressa dans l’embarcation et agita les bras avec défi. Le canon de six lança alors un obus à répercussion et au moment où le fragile canot entrait dans le brouillard, il fut brisé en mille miettes.
Quelques-uns des curieux jurèrent positivement qu’ils avaient vu le Malais se débattre dans les flots après la destruction du canot, avant qu’il fût enveloppé par le brouillard, mais le fait parut invraisemblable. Quelques instants après la tranquillité était revenue et les agents avaient regagné leurs postes.
Le second fait dramatique doit, dans une grande mesure, rester matière à supposition, mais uniquement à cause de la bizarrerie des témoignages.
Le grand canon d’acier, employé au fort pour annoncer le coucher du soleil, perçait de sa gueule noire le brouillard. L’eût-on, pour tirer, armé d’un boulet ou d’un obus, le projectile eût été labourer le flanc des collines qui se dressaient de l’autre côté du chenal. Mais le canon n’était jamais chargé ainsi : une charge à blanc était suffisante pour lui permettre de remplir sa fonction. Le calibre de la pièce était tel qu’un enfant ou même un homme de petite taille eût pu se glisser dedans, s’il avait osé risquer un jeu aussi dangereux.
Il y a trois faits qui indiquent que le fuyard avait échappé vivant à la destruction de son embarcation et que, grâce au brouillard, il avait pu sain et sauf atterrir sur les rochers perfides au pied du promontoire hérissé de canons.
Le premier est suggéré par le canonnier qui, ce jour-là, fit partir la pièce, deux ou trois heures après que le canot du malfaiteur eut été mis en miettes ; encore ce fait n’eût-il dans d’ordinaires circonstances attiré aucune attention et, en somme, ne s’en vit prêter que longtemps après, quand Rabaya déclara avoir reçu la visite de Freeman, qui lui avait raconté les deux autres bizarres coïncidences.
Le canonnier relata que, ce jour-là, lorsqu’il tira le canon, la pièce eut un recul tout à fait inexplicable, comme si elle avait été chargée d’autre chose que d’une simple cartouche à blanc. Mais il avait lui-même chargé la pièce et était certain de n’avoir rien glissé d’autre dans le canon. À l’époque il se déclarait parfaitement incapable d’expliquer le recul qui s’était produit.
C’est à Rabaya que je dus de connaître le second fait.
Freeman lui conta que dans l’après-midi de ce même jour, comme il se faisait remorquer, il avait rencontré un épais brouillard, au moment où quittant la baie il entrait dans le chenal. Le remorqueur n’avançait que lentement. À l’instant où son brigantin arrivait à la hauteur de Black Point, il entendit gronder le canon annonçant le coucher du soleil et, immédiatement après d’étranges débris s’abattirent sur le bâtiment, placé exactement dans le plan vertical de la portée du canon. Il avait navigué sur bien des mers et vu bien des genres de pluies, mais celle-ci différait de toutes les autres. Des fragments d’une substance collante tombèrent sur le pont et s’accrochèrent aux voiles et aux vergues. On eût dit de la chair coupée en lambeaux menus, mêlée à des parcelles d’os broyés, avec ici et là un bout d’étoffe. Ces fragments qui rappelaient donc les chairs, étaient d’un rouge noirâtre et sentaient la poudre. Cette pluie donna au capitaine et à son équipage la chair de poule et les fit trembler ; l’équipage fut même déprimé, au point que le capitaine Freeman dut avoir recours à une exceptionnelle sévérité pour réprimer une mutinerie, tant les hommes avaient peur de se risquer en mer sous un si terrible présage.
Le troisième fait n’est pas moins singulier.
Tandis que Freeman arpentait le pont et s’efforçait de rassurer son équipage, il heurta du pied un petit objet métallique, tout barbouillé, gisant sur le pont. Il le ramassa et constata qu’il avait aussi une odeur de poudre. L’ayant nettoyé, quelle ne fut pas sa stupéfaction de constater que c’était précisément le talisman que, ce même jour, il avait acheté à Rabaya. Il se refusa à croire que c’était bien le même, tant qu’il n’eut pas cherché l’autre et découvert qu’il lui avait été réellement volé.
Il suffit d’ajouter qu’on ne revit jamais le Diable Volant.
DEUX HOMMES SINGULIERS
Le premier était un vigoureux Italien, au chef toisonné d’une dense broussaille de cheveux noirs rebelles.
Voici quelles circonstances avaient abouti à son engagement dans la troupe du Grand Musée Oriental sous la dénomination du « Merveilleux Sauvage au nez huppé, Hoolagaloo, capturé dans l’île de Milo, mer Égée, après une lutte désespérée » :
Il était bûcheron, doué d’une force prodigieuse et d’un caractère violent. Un jour, dans la montagne, il se prit de querelle avec un camarade et ils en vinrent aux mains. L’Italien dut alors faire près de douze kilomètres à pied pour se rendre chez un chirurgien et lui réclamer des soins dont il avait le plus urgent besoin. Quand il se présenta devant lui, il avait la figure enveloppée de linges trempés de sang.
Il commença par farfouiller dans ses poches et, ne trouvant pas ce qu’il cherchait, sa physionomie trahit l’anxiété la plus vive.
– Qu’y a-t-il ? demanda le chirurgien, et que diable cherchez-vous ?
L’homme se découvrit la bouche et d’une voix qui résonna comme un ophicléide, répondit :
– Mon nez.
– Votre nez !
– Oui. Je croyais l’avoir apporté, mais je ne le trouve plus.
– Votre nez dans votre poche !
– Sais plus… l’aurai perdu. Je me suis battu avec un camarade, il m’a coupé le nez.
Le chirurgien l’assura que le nez coupé n’aurait servi de rien.
– Mais je veux un nez ! glapit l’homme avec désespoir.
Le chirurgien lui affirma qu’il pourrait lui en fabriquer un nouveau et l’homme parut fortement soulagé. Le retrait des linges révéla qu’une partie considérable du nez manquait. Le chirurgien se mit alors à procéder à l’opération familière de la rhinoplastie : cette dernière consiste à faire une incision en forme de V dans la peau du front immédiatement au-dessus du nez, à la détacher et à la ramener, en lui faisant faire un demi-tour de façon à garder l’épidémie en dehors, pour en recouvrir l’appendice nasal. Au cours de cette opération, il fit une intéressante découverte. Les dimensions du nez étaient considérables et le front bas, si bien que, pour assurer au segment une longueur suffisante, il lui fallait empiéter sur le cuir chevelu. À cela point de remède, et ce fut avec quelque appréhension que le chirurgien lui rasa une partie des cheveux et s’acquitta ensuite de sa tâche, qui d’ailleurs réussit admirablement.
Avec le temps, pourtant, les craintes du chirurgien se réalisèrent.
À l’entour du bout du nez pointa une large rangée de cheveux noirs. Lorsque la peau se trouvait dans sa position normale au-dessus du front, les cheveux sur le bord poussaient du haut en bas, mais comme dans sa position nouvelle, la peau avait été renversée, les cheveux, bien entendu, poussèrent de bas en haut, se recourbant légèrement vers les yeux. Ce donnait au bûcheron un aspect grotesque et hideux ; il entra en fureur. Le chirurgien, homme d’esprit prompt et, de plus, soucieux de l’intégrité de son système osseux, le présenta au signor Castellani, directeur du Grand Musée Oriental et ce digne entrepreneur aussitôt l’enrôla dans sa troupe.
C’est ainsi que notre homme était devenu l’une des plus grandes merveilles du monde.
Entre autres camarades dans la troupe, notre homme comptait la Femme Coupée qui, en apparence, n’existait plus que jusqu’à la taille, et la remarquable Femme Tatouée, arrachée aux mains de pirates chinois dans la mer des Célèbes, d’autres encore. Ces camarades connaissaient notre homme au nez huppé sous le nom de Bat, qu’on supposait être un diminutif de Bartolommeo.
Le deuxième homme singulier dont s’occupera notre histoire, était un petit individu de constitution délicate et d’humeur douce qui, n’ayant pas le sou, gagnait sa vie en écrivant dans les journaux. C’était un ami du signor Castellani et cet ami du patron entretenait les meilleures relations avec les « sujets » de ce dernier. Mais comme notre récit a pour but de conter les petits secrets du Musée, il nous faut expliquer que Mlle Zoé, la Femme Coupée que l’affiche annonçait comme le Merveilleux Phénomène Français, était de la part du jeune homme l’objet d’une réelle et très profonde admiration. Dans la vie privée, elle portait le nom de Maggie (à l’origine très vraisemblablement Marguerite) et elle était l’unique fille et l’orgueil de Castellani. Zoé était jolie, avait les joues roses et un petit nez moucheté de taches de rousseur. Notre publiciste sans le sou, s’appelait Sampey.
Or Sampey était, en secret, amoureux de Zoé.
En tant que Femme Coupée, les devoirs professionnels de Mlle Zoé n’allaient pas sans quelque monotonie. Elle avait donc de multiples occasions d’observer et de réfléchir ; elle était de plus jeune et appartenait au sexe féminin ; aussi rêvait-elle !
Ce qu’elle observait le plus, c’étaient les yeux. Ces yeux qui la regardaient, tandis qu’elle se balançait doucement sur son petit plateau devant le public aux heures des représentations. Sa baraque dorée était très achalandée, car elle était jolie et les bonnes âmes plaignaient fort la bonne créature de s’arrêter ainsi à la taille ! Mais loin d’être déprimée par l’apparente absence de cette partie de son corps qu’eût dû dominer sa ceinture d’or à l’étincelante boucle de diamant, elle était enjouée et chantait parfois une courte chanson. La séduction de ses manières, la douceur de sa voix, la rondeur de ses bras et de ses épaules avaient conquis le cœur de Sampey et lui inspiraient un zèle d’autant plus grand à trouver des noms dont Castellani dotait ses « sujets ».
Sa bonne fortune fit tourner la tête à Hoolagaloo. Parce qu’il était monstrueux, il s’imagina être grand. Il devint arrogant et présomptueux. Lui aussi, il aima Zoé.
Ainsi s’établit une rivalité entre Sampey et l’Homme Sauvage de l’île de Milo.
Qu’en pensait Zoé ? Lequel aimait-elle ? – ou même en aimait-elle un ? Observatrice et réfléchie, elle rêvait. Mais comme elle ne voyait que des yeux, c’est seulement d’yeux qu’elle rêvait.
– Ah ! soupirait l’innocente jeune fille, plût au ciel que je puisse trouver dans la réalité les yeux de mes rêves. Dire que sur tant d’yeux qui me fixent dans ma baraque, je n’ai pas encore rencontré les yeux de mes rêves ! Des bleus, des bruns, des noirs, des gris, j’en vois de toutes les nuances et ceux que je désirerais tant voir ne sont pas venus encore ! Ils sont si ordinaires ceux que je vois, si communs ceux qui les possèdent. Je suis certaine que seuls des princes, des chevaliers et des héros peuvent avoir ces yeux qui me sourient dans mon sommeil. Je suis certaine aussi que ces yeux viendront à moi un jour et qu’à ce signe je connaîtrai mon héros, mon maître, mon amour !
Un jour, elle en toucha prudemment un mot à l’Homme Sauvage de Milo, un grossier éclat de rire fut toute la réponse qu’elle en tira, mais il comprit qu’il avait fait une faute et l’embrassa. Il lui mit ainsi dans les yeux, dans ses jolis yeux bleus, les cheveux de son nez huppé, et elle frémit.
Elle s’en ouvrit alors à Sampey qui était réfléchi, prudent et froid. Il écouta, surpris, mais attentif. Quand il eut retrouvé toute sa présence d’esprit, gravement il demanda :
– Maggie, ces yeux que vous voyez dans vos rêves, est-ce leur couleur particulière ou leur expression qui vous attire ?
– Leur couleur, répondit-elle.
– Quelle est-elle ?
– Une douce, pâle et limpide couleur d’ambre.
Et elle dit cela si innocemment, si sérieusement, si doucement aussi, qu’il ne put douter ni de sa sincérité ni de sa raison. Ce lui fut un coup terrible que cet aveu.
Néanmoins, il se mit l’esprit à la torture. Méditant, analysant, fouillant les moindres recoins du magasin de ses ressources mentales, il lutta avec le courage du désespoir. Bientôt une brillante lueur d’intelligence, descendue on ne sait d’où, éclaira sa physionomie inquiète. Cette lueur grandissant peu à peu, augmentant en éclat, illumina bientôt toutes ses facultés et finalement, lui montra la route à suivre pour devenir l’un des deux hommes singuliers de ce récit.
– Je vois, dit-il, essayant de masquer l’air de triomphe de son visage, que vous n’avez pas complètement approfondi le problème des yeux. C’est vrai, seuls les héros ont des yeux couleur d’ambre. Mais ces yeux sont le symbole de l’héroïsme dont les marqua le ciel, et bien qu’un homme puisse ne pas avoir donné des preuves d’héroïsme, dès que l’essence d’un véritable héroïsme est en lui, ses yeux, sans qu’il se rende compte du fait, prennent la nuance ambrée entrevue dans vos rêves. Parfois, dans le développement de cet esprit d’héroïsme, cette couleur n’est encore que transitoire ; mais avec le temps elle doit devenir permanente. Maggie, ces rêves révèlent votre destinée. Vous devez épouser un héros et quand il viendra vous le reconnaîtrez à l’ambre de ses yeux.
En disant ces mots, Sampey poussa un long soupir, car Maggie, attentive, interrogeait ses yeux gris.
Comment ? Dans son aveugle désintéressement se sacrifiait-il donc aux caprices d’une jeune sotte ? Mais alors, que signifiaient la légèreté de sa démarche et la joie de son sourire, dès que celle-ci fut hors de vue ?
Mlle Zoé, la Femme Coupée, certain soir, une semaine ou deux après cet entretien, balançait sa demi-personne et chantait sa petite chanson, tout comme elle chantait et se balançait les soirs précédents. Écarquillés par la surprise, des yeux de toutes sortes la contemplaient, quand soudain son petit cœur fit un bond. Là, devant elle, la considérant avec une tendresse infinie, se trouvait un couple divin d’yeux d’une douce, pâle et limpide couleur d’ambre ! (Une femme dans le public aperçut par hasard, elle aussi, cet extraordinaire spectacle et en fut tellement effrayée qu’elle s’évanouit, croyant avoir vu un cadavre).
Les yeux ambrés aussitôt disparurent, avec leur propriétaire, un certain Sampey. Mais un petit cœur angoissé dans un corps rond et potelé l’avait reconnu, savait que c’était lui, savait par conséquent que son promis était venu et, ce qui était le plus extraordinaire, sous les traits du conseiller littéraire de son père ! Quel choc pourtant, quand, le lendemain, le héros de ses rêves vint à elle avec ses yeux gris pâle de tous les jours, un peu bavochés et tant soit peu humides !
– Sampey ! s’écria-t-elle, consternée, violemment précipitée du ciel.
– Maggie !
– Vos yeux hier soir… Vous étiez alors un héros ; mais aujourd’hui…
– Un héros ! répéta naïvement Sampey.
– Mais oui ! Hier soir, vous aviez des yeux ambrés… de si beaux yeux… les yeux du héros de mes rêves !
– Ma chère enfant, bien certainement vous avez rêvé.
– Oh, que non ! Je les ai vus ! Comme mon cœur a bondi !… Je vous ai reconnu… je vous ai reconnu… et vos yeux étaient couleur d’ambre !
Sampey sourit tristement, non sans quelque complaisance, puis dit avec une grande modestie :
– Je ne puis mettre en doute ce que vous me dites, ma chère enfant, mais, je vous l’assure, j’étais bien inconscient de la couleur ambrée de mes yeux. Je voudrais qu’il me fût permis de vous avouer, combien mon âme a récemment été remuée par d’étranges sollicitations d’héroïsme, mais ce serait me vanter et le véritable héroïsme est modeste toujours. Cependant, je ne dois pas être surpris que vous en ayez découvert la marque réelle avant que j’en aie même soupçonné l’existence. Mais telle est, chère enfant, le signe distinctif d’un vrai héros, il ignore son propre héroïsme.
Il lui prit la main d’un air langoureux et la pressa. Elle rougit et s’enfuit.
Le signor Castellani était riche, mais n’en était pas moins resté homme d’affaires. Sa fille n’épouserait jamais qu’un homme ayant assez d’argent pour garantir son mérite. Avec une perspicacité rare chez un homme, il avait remarqué l’admiration de nos deux hommes singuliers pour sa fille. Or, Bat étant un « sujet » rare, se faisait rapidement un sac, tandis que Sampey n’était qu’un misérable publiciste. Castellani sentit le besoin d’un associé. Pourquoi cet associé ne serait-il pas un gendre ? À ce point de vue, certes, Bat était autrement appréciable que Sampey !
Sampey était un malin et Bat était un niais. D’autre part, Bat était hardi et Sampey était timide. Bat avait le courage de la brute. Sampey savait qu’il était certains moyens d’effrayer des brutes courageuses. Il se prépara à la lutte.
Il se rendit un jour au Musée entre deux représentations et eût vite trouvé l’Homme Sauvage de Milo. Ce dernier ayant des loisirs fumait une cigarette dans un coin tranquille et sa fumée s’enlevait en spirales gracieuses au-dessus de la huppe de son nez. Sampey était plus pâle qu’à l’ordinaire et un brin tant soit peu nerveux, car le but de sa visite n’allait pas sans être hasardeux. Bat, qui se trouvait être de joyeuse humeur, le salua le premier :
– Hé ! appela-t-il.
Sampey se dirigea droit vers lui.
– Vous aimez la baraque, hein, Samp ? Vous venez tous les jours. Bon endroit, hein, Samp ?
– Très bon endroit, Bat, répondit tranquillement Sampey, qui s’efforçait de paraître indifférent tout en fouillant nerveusement dans sa poche.
– Le signor Castellani est un grand homme, un brave homme, un excellent homme. Vous l’aimez ?
– Beaucoup.
Les manières de Sampey étaient bizarres.
Les yeux de Bat brillèrent d’un éclat dangereux.
– Vous aimez la fille aussi, hein, Samp.
– La… oh !… la Femme Tatouée ? Oui, beaucoup certainement.
– Ah, finaud de Samp ! Je parle de la petite demoiselle potelée… de Maggie.
– Oh ! Maggie ? La fille de Castellani ?
– Oui.
– Ma foi, je ne la connais pas autant.
– Vous ne connaissez pas Maggie ?
L’œil de Bat devenait dangereusement farouche. Il quitta son attitude de repos, se raidissant et gonflant ses muscles.
– Vous ne connaissez pas, Maggie ! répéta-t-il, vous croyez donc que je suis si aveugle. Vous aimez Maggie ! Vous voulez l’épouser ! Vous la jugez riche, une proie. Vous n’êtes qu’un misérable sournois !
Et Bat, qui peu à peu s’était échauffé, lança là-dessus un éloquent juron italien.
Pour Sampey, c’était l’instant propice.
Les deux hommes étaient seuls : Bat furieux et mordu par la jalousie, Sampey craintif, mais résolu. La brutalité contre l’intelligence, la force dogue luttant avec une loutre, un coq de combat avec un hibou.
Sampey fit semblant d’avoir par accident laissé tomber quelque objet. Il se baissa pour le ramasser et quelques secondes s’écoulèrent avant qu’il feignit l’avoir retrouvé. Tout en le cherchant, il s’était rapproché de Bat et lorsqu’il se redressa, leurs deux visages se trouvèrent tout près l’un de l’autre. Alors, soudain il leva les yeux et les fixa hardiment sur ceux de l’Homme Sauvage de Milo.
Bat, pendant ce temps, avait continué son injurieuse tirade dans le but très évident de provoquer au combat le paisible publiciste. Mais quand Sampey leva les yeux et l’eut regardé de son regard particulier, Bat un instant le considéra avec une stupéfaction muette, puis, le visage livide, se recula, en poussant une exclamation de terreur :
– Santa Maria !
Une demi-minute il contempla, épouvanté, le spectacle qu’il avait devant lui, la bouche ouverte, les yeux fixes, fasciné, frappé de stupeur, consterné. Sampey, si paisible, Sampey aux yeux de colombe, était transformé. Ce n’étaient plus ses yeux gris habituels, si connus de Bat, ce n’étaient pas les yeux à la douce couleur d’ambre qui avaient fait battre le cœur de la pauvre Zoé, non, Sampey considérait sa victime avec des yeux d’un rouge farouche et révolutionnaire !
Bat, dont l’insolence était maintenant tombée, se sauva. Il raconta son merveilleux récit. Castellani, aux oreilles de qui il était enfin parvenu, fronça le sourcil, pensant que Bat était pris de boisson. La Femme Tatouée éclata de rire. Zoé s’étonna et resta troublée, mais, ce soir-là, devant la rampe de la baraque dorée, vers la fin du spectacle, avant que se fermât le rideau, elle aperçut son héros qui la contemplant tendrement avec des yeux d’une douce, pâle et limpide couleur d’ambre. Après cela, elle s’endormit d’un sommeil calme et profond.
Quand Sampey vint le lendemain rendre sa visite quotidienne au Musée, tous les « sujets » le considérèrent avec une réelle curiosité. Castellani sans ambages lui demanda ce que valaient ces histoires de Bat. Sampey s’attendait à la question et il était prêt à y répondre.
Après avoir fait jurer le secret le plus absolu au forain, il lui confia :
– J’ai fait une grande découverte, dans tous les détails de laquelle il m’est impossible d’entrer. Qu’il me suffise donc pour aujourd’hui de vous dire qu’après des années d’expériences scientifiques, j’ai appris le secret de changer à mon gré la couleur de mes yeux.
Il dit ceci très simplement, comme inconscient qu’il annonçait là l’une des choses les plus extraordinaires auxquelles les siècles eussent donné naissance.
Mais Castellani était à peindre.
Une grande secousse, ressemblant à une attaque d’apoplexie, paraissait avoir ébranlé tout son système. Étant homme d’affaires et particulièrement madré, il retrouva vite tout son sang-froid et du ton le plus indifférent fit remarquer qu’un individu qui pourrait à son gré changer la couleur de ses yeux, devrait vraisemblablement, s’il était convenablement lancé, tirer d’incontestables profits d’un semblable talent, puis il offrit à Sampey quarante dollars par semaine pour figurer parmi ses sujets du Grand Musée Oriental. Sampey savait que le salaire de l’Homme Sauvage de Milo s’élevait à deux cents dollars par semaine (somme qui, bien qu’élevée, était bien gagnée, vu que chacun avait le droit de tirer sur la huppe de son nez pour s’assurer qu’elle n’était pas postiche) ; il demanda du temps pour réfléchir à cette offre splendide qui représentait pour lui une fortune.
Il avait la certitude de perdre Zoé, dès qu’elle apprendrait que ses yeux couleur d’ambre n’étaient point réellement les yeux d’un héros. Il se rendit chez un forain retiré des affaires et lui demanda quel salaire pouvait exiger un homme au nez huppé et un homme qui, à son gré, pouvait changer la couleur de ses yeux.
Le forain répondit :
– J’ai vu l’homme au nez huppé de Castellani. Il gagne chez lui deux cents dollars par semaine. C’est bien payé. Si vous m’amenez un homme, pouvant à son gré changer la couleur de ses yeux, je lui donne mille dollars par semaine et je reprends ma profession.
Sampey ne put de la nuit fermer l’œil.
Pendant ce temps, un changement s’était produit chez Zoé : elle était subitement devenue plus charmante que jamais. Elle avait visiblement grandi en gentillesse et en douceur et se montrait si bonne, si affable pour tous, y compris l’Homme Sauvage de Milo (qu’elle avait jusque-là évité par peur instinctive) que Bat reprit courage et jura de la conquérir, quand il devrait pour y arriver traverser un fleuve fait du sang de Sampey. Or, notez ceci : il ne faut jamais trop faire fonds sur la condescendance qu’une femme vous montre, il se peut que cela provienne de son amour pour un autre.
Zoé était naïve, honnête et confiante. À la naïveté se mesure la force de la foi. C’est son absurdité qui fait le charme de la foi. Zoé croyait en Sampey.
Sampey, soudain devenu étonnamment hardi et plein d’assurance, fit connaître à Castellani ses conditions, partage égal des bénéfices, et Castellani, en dépit de ses jurons, de ses menaces et de ses fanfaronnades, dut les accepter. Du coup, Sampey se trouvait riche. Castellani, de nouveau excessivement gracieux et aimable dès que fut signé le traité, invita Sampey à un dîner intime dans ses appartements privés pour célébrer leur récente association et, quelques instants après, Castellani, Zoé et Sampey se trouvaient réunis autour d’un délicat repas. Zoé était éblouissante de grâce et de beauté, mais entre elle et Sampey se manifestait une certaine gêne. À un moment, elle laissa tomber sa serviette et Sampey la ramassa ; accidentellement sa main frôla l’une des mignonnes pantoufles de Zoé et ce fut pénible de voir le pourpre de ses joues.
Tandis qu’ils étaient ainsi occupés, Bat, sans cérémonie, fit irruption dans la pièce, le visage enflammé, un éclair de triomphe dans les yeux. Il tenait à la main un petit coffret qu’il leur mit grossièrement sous le nez. À cette vue, Sampey pâlit affreusement et se recula, impuissant à se mouvoir ou à parler.
– Je le tiens, le coquin ! cria Bat, menaçant du doigt Sampey tremblant, je l’ai surveillé : je le tiens, le coquin ! Il ne vous a joué que de vilains tours !
L’Homme Sauvage de Milo plaça le coffret sur la table et en souleva le couvercle. À l’intérieur apparut une multitude de menus objets en forme de coupe et en verre blanc opaque, chacun marqué au centre d’un anneau de couleur encerclant un espace de verre transparent ; la variété de la couleur des anneaux était considérable et ces menus objets étaient accouplés par paires suivant leur couleur. Le coffret renfermait encore une fiole avec « cocaïne » sur l’étiquette et un petit pinceau de poils de chameau.
– Vous me regardez, reprit Hoolagaloo très excité. Eh bien, je me changerai la couleur de mes yeux tout comme ce coquin de Samp.
Là-dessus, il trempe le pinceau dans la fiole et s’appliqua de son contenu sur les yeux, puis il prit deux des curieuses petites coupes de verre et se les glissa, l’une après l’autre, par-dessus la prunelle sous la paupière, où elles s’adaptèrent admirablement. C’étaient des yeux artificiels que s’était fait faire Sampey pour se couvrir ses prunelles naturelles selon les circonstances. Bat prit une attitude théâtrale et hurla :
– Diavolo !
Par un étrange hasard il avait pris deux yeux qui n’étaient point appareillés. L’un de ses yeux était d’une douce, pâle et limpide couleur d’ambre, l’autre d’un rouge farouche et révolutionnaire. Ces yeux, joints à son nez huppé et à son attitude tragique, lui donnaient un air si grotesque, si hideux, que Zoé, après s’être brusquement levée et avoir battu l’air de ses bras, tomba évanouie dans les bras de Sampey.
Bat dévorait des yeux son rival ; Castellani était abasourdi. Bientôt avec sa présence d’esprit, Sampey retrouva vite toute son assurance.
– Eh bien, lança-t-il avec mépris, serrant plus étroitement Zoé contre lui et la soutenant avec une tendre sollicitude. Eh bien, et après ?
Son insolence irrita Hoolagaloo.
– Comment, et après ? Santa Maria ! Misérable ! Ah ! Ah ! Elle ne vous épousera plus !
Sampey très délibérément écarta Zoé, de manière à prendre sa montre et, après en avoir un instant, très calme, considéré le cadran, il déclara :
– Voilà juste trente heures que Maggie et moi, nous sommes mariés.
Ce fut un coup d’assommoir pour l’Homme Sauvage.
Castellani, après un rude combat mental, s’était rendu compte de la situation ; alors, avec son égalité d’âme habituelle et son air d’autorité bien connu, il intervint :
– Ah ça, qu’est-ce que tout ce tapage, dites-moi ? Voulez-vous perdre votre situation, maître Bat ? Sachez que mon gendre est aussi mon associé et, rappelez-vous, maître Bat, qu’il commande ici au même titre que moi ?
Ce fut là le coup de grâce pour l’Homme Sauvage de Milo. Il sortit en trébuchant, se rasa le nez, acheta une cognée et s’enfuit dans la montagne couper les arbres, laissant l’Homme Mystérieux aux yeux de spectre devenir le plus heureux des maris et le plus prospère des « sujets » et des forains de ce monde.