
Jules Mary
LA REVANCHE DE ROGER-LA-HONTE
TOME I
Édition J. Rouff 1887 – 1889
Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » – http://www.ebooksgratuits.com/
Table des matières
À propos de cette édition électronique
Premier épisode
CHAPITRE PREMIER
À deux kilomètres et demi de la station de Saint-Rémy, est le village de Chevreuse, qui donne son nom à la vallée.
C’est un village assez irrégulièrement bâti, dont la moitié est éparpillée dans le fond de la vallée, dont une partie s’allonge le long de la rive de l’Yvette, et dont les autres maisons sont accrochées au flanc du coteau que dominent les ruines intéressantes du château de Chevreuse.
Il y a nombre de maisons de campagne autour du village, quelques-unes habitées l’hiver comme l’été – la plupart, l’été seulement.
Une de ces villas, très élégante, flanquée de deux tourelles au toit en éteignoir, et perdue dans un parc de haute futaie de chênes, était à vendre depuis quelque temps quand, tout au début du printemps 1884, dans le mois de mars, le bruit courut à Chevreuse, à Saint-Rémy et dans les environs que le « château » était vendu à un certain William Farney, un Américain très riche.
Les paysans purent voir, pendant tout le mois d’avril, des ouvriers au château, puis, vers la fin du mois, des voitures de déménagement apportant de Paris un luxueux mobilier.
Dans les premiers jours de mai, tout était prêt ; les domestiques étaient installés puis les chevaux et les voitures, un landau, un coupé, un grand break et une petite charrette anglaise pour les déplacements de chasse. On n’attendait plus que le maître de la maison.
Un jour, descendirent à la gare de Saint-Rémy, à deux heures trente, deux personnes, un homme et une jeune fille.
L’homme était de haute taille, d’apparence très vigoureuse et, quoique jeune encore, il avait les cheveux blancs ; sa barbe aussi, qu’il portait tout entière, était blanche ; il eût été difficile du reste, de lui assigner un âge certain sans crainte de se tromper, car, malgré les cheveux blancs, l’allure, la façon de porter la tête, tout indiquait que cet homme n’avait guère plus de quarante-cinq ans. Le front était large, les yeux noirs semblaient doux, mais une terrible blessure donnait je ne sais quelle physionomie étrange et dure au visage : tout un côté de la figure, en effet, avait été brûlé, et, de ce côté, la barbe avait repoussé plus clairsemée.
La jeune fille pouvait avoir une vingtaine d’années. Grande, élégante, svelte, elle était fort jolie, non point de cette beauté ordinaire qui consiste en des traits réguliers. Elle avait mieux que cela : une physionomie d’une distinction rare, des yeux magnifiques, bleus, mais d’un bleu particulier, presque de la couleur de l’ardoise, avec des cils et des sourcils noirs. Elle était blonde, d’un blond chaud, ardent ; sa chevelure gênante tant elle était épaisse et longue, entourait comme d’une auréole d’or, un frais et fin visage, un peu allongé, au nez droit, aux lèvres rouges, aux tempes très aplaties et au menton légèrement accusé – ces deux derniers signes trahissant une grande énergie, une grande force de caractère. Elle était vêtue simplement, – ainsi que l’homme qui l’accompagnait.
Lorsqu’ils descendirent de leur compartiment de première, le chef de gare les salua. Il reconnaissait l’homme pour l’avoir vu à la station plusieurs fois déjà ; c’était William Farney, le nouveau propriétaire du château de Maison-Blanche ; quant à la dame, le chef pensa que c’était sa fille.
Sir William connaissait son chemin, sans aucun doute, car il n’hésita pas devant les sentiers qui se croisaient devant lui.
En sortant de la gare, il laissa Saint-Rémy sur la droite, tourna à gauche, longea le remblai du chemin de fer et gagna une avenue plantée de marronniers superbes et qui conduisait à l’un des nombreux châteaux de la région, – le château de Coubertin. Au bout, commence le mur du parc.
Le père et la fille quittèrent l’avenue pour traverser une prairie et prendre une allée de peupliers. Au bout de cette avenue se voyait Maison-Blanche.
Le père et la fille s’arrêtèrent un moment.
Il y avait un banc de pierre entre deux peupliers, à l’endroit où l’avenue rejoignait la route.
Ils allèrent s’y asseoir.
Puis William Farney adressa, en anglais, la parole à sa fille.
– Seras-tu heureuse ici, ma chère enfant ?
– Je le crois, mon père : le pays est adorable.
– Du reste, Paris est à deux pas et tu penses bien que je ne t’ai pas conduite ici pour t’exiler et t’apprendre la solitude.
– Oh ! mon cher père, partout où vous êtes, l’ennui ne vient jamais. Je me passerais du monde aisément.
– Oui, Suzanne, je le sais, mais tu as besoin de plaisirs et je ferai tout mon possible pour te procurer des distractions.
– Vous êtes bon.
Le soleil éclairait ardemment le château, plus blanc à cette distance parce qu’il ressortait sur le vert sombre de la haute futaie des chênes.
– Oui, mon père, fit la jeune fille en s’appuyant sur le bras de William Farney, je serai heureuse ici, très heureuse.
William regarda sa fille tendrement, et il étouffa un soupir.
CHAPITRE II
Lorsque Roger avait quitté pour la seconde fois la France, emportant le précieux fardeau de Suzanne presque endormie dans ses bras, il n’avait fait qu’un court séjour en Belgique : le temps d’acheter un peu de linge pour sa fille et pour lui.
Après quoi il avait pris passage avec Suzanne à bord d’un paquebot à destination de New York.
Il resta quelques mois seulement dans cette ville ; une occasion s’offrant à lui de diriger une usine importante à Québec, il alla s’installer au Canada.
Il s’était remis au travail avec une sorte d’âpreté, rêvant de reconstituer sa fortune et de revenir en France la consacrer tout entière, s’il le fallait, à la découverte du mystère qui enveloppait le drame de Ville-d’Avray.
Il usait ses forces à des labeurs acharnés, passant ses nuits à des recherches scientifiques, essayant de trouver, le premier, quelques nouvelles formes d’exploitation et qui, remplaçant les procédés vieillis, lui donneraient à bref délai la richesse.
Il avait repris, comme s’il n’avait pas quitté la France, ses travaux d’autrefois, faisant, comme autrefois encore, deux parts de sa vie, l’une à sa fille Suzanne, l’autre à ses travaux de chimie et de mécanique.
Un travail aussi énergique, soutenu par une intelligence très alerte et très développée, devait lui porter bonheur.
Coup sur coup, Roger fit deux ou trois découvertes importantes qui devaient transformer la fabrication de l’acier.
Les Américains sont audacieux et intelligents. Roger trouva auprès d’eux l’appui qu’il lui fallait, et, comme il était lui-même intelligent et audacieux, on ne s’enquit point de son passé ni des raisons qui lui avaient fait quitter la France.
Il revint à New York, où on lui facilita la mise en œuvre de ses procédés de fabrication. Ils réussirent, au-delà même de ses espérances.
Dès lors, ce fut fini.
En quelques années, il eut une des plus importantes aciéries de New York, qui rivalisa avec les plus connues d’Europe puis d’autres maisons s’élevèrent sous sa direction.
Laroque n’eut bientôt plus à s’occuper de l’avenir de sa fille.
Associé toujours, – avec de gros intérêts, – il ne fut jamais en nom. Il se souvenait du passé et ne voulait pas attirer trop près l’attention de l’opinion.
Il craignait, non pour lui, mais pour Suzanne.
Lorsqu’il était au Canada, alors que Suzanne n’avait encore que huit ou neuf ans, il avait pu changer son nom de Roger Laroque contre celui de William Farney.
Il avait trouvé à Québec un employé de l’usine dont il était directeur et dont la douceur, la grande intelligence et la droiture l’avaient tout de suite attiré.
Une amitié avait commencé entre eux, – elle n’était qu’à l’état d’ébauche, – quand un événement dramatique la resserra tout à coup pour la dénouer presque aussitôt.
Un incendie, – un de ces terribles sinistres comme seule l’Amérique nous en montre parfois, – éclata à Québec.
La maison où demeurait Laroque fut une des premières atteintes. Laroque se sauva, mit sa fille en sûreté et courut chez son ami, lequel portait ce nom de William Farney.
La maison de Farney était en flammes. Farney, à une fenêtre, tendait désespérément ses bras, montrant aux spectateurs affolés sa fille, une enfant de dix ans, pour laquelle il implorait la pitié et le courage.
Des flammes les environnaient, les atteignaient, brûlaient leurs cheveux, leurs vêtements. Des poutres se détachaient du plafond, les escaliers étaient crevés, la mort hideuse, épouvantable, approchait pour le père et la fille.
Roger Laroque vit le danger et ne réfléchit pas.
Il fit planter des échelles contre le mur et, les échelles n’arrivant pas jusqu’à la fenêtre, il accrocha une corde d’incendie munie d’un solide crochet, à l’une de ses extrémités, à la fenêtre où se trouvaient le père et la fille.
Il grimpa à cette corde jusqu’en haut :
– Donnez-moi votre fille, William, dit-il.
Le pauvre homme tendit l’enfant évanouie, que Roger retint dans ses bras, en se laissant dégringoler jusqu’à l’échelle.
Puis il descendit. L’enfant était sauvée. Il voulut remonter. Il n’était plus temps.
Voyant sa fille hors de danger et ne craignant rien pour lui-même, William avait profité de la corde pour descendre, mais le mur s’était effondré, la corde s’était détachée et l’homme était tombé en bas, avec des décombres enflammés.
Il avait les deux jambes brisées.
Roger Laroque lui-même avait eu le visage éraflé par une poutrelle qui n’était qu’un brasier rouge ; il était à jamais défiguré. Par bonheur, les yeux avaient été préservés.
Du reste, son héroïque dévouement devait être inutile.
La petite fille avait été si épouvantée par l’horrible danger qu’elle avait couru, qu’elle fut prise, cinq ou six jours après, par une grosse fièvre qui l’emporta.
William Farney adorait sa fille.
Il fut plongé, après cette mort, dans un sombre désespoir.
Quand il guérit, la tristesse demeura, la joie ne revint pas.
L’amitié était devenue plus étroite entre les deux hommes, si étroite même que Roger, un jour, n’hésita pas à lui faire la confidence de ce qu’il était, de ce qu’il avait été, ne lui cachant rien.
William Farney le crut.
Un jour, Farney disparut de l’usine.
Il avait écrit à plusieurs de ses amis que, s’ennuyant depuis la mort de sa fille, il voulait chercher aventure, et, avec les ressources dont il disposait, gagner le nord du Canada pour y faire du trafic.
À Laroque seulement, il avait écrit qu’il était résolu à mourir et qu’il voulait qu’on ignorât son suicide ; non point qu’il eût honte de mourir ainsi et d’en finir avec une vie qui lui était insupportable depuis la mort de sa fille, mais il avait résolu de mourir ignoré et de laisser planer une éternelle incertitude sur sa mort.
Il envoya à Roger tous les papiers pouvant prouver l’identité d’un William Farney et de sa fille, et il achevait la lettre en disant :
« Gardez ces papiers, mon cher ami, je veux qu’ils deviennent les vôtres, afin qu’ils vous donnent la sécurité, si jamais, comme vous en avez le secret espoir, vous retournez en France. Personne ne prouvera que Farney est mort. Substituez-vous à moi, substituez votre fille à ma pauvre enfant. Vous êtes désormais William Farney et non plus Roger Laroque et le hasard devait bien faire les choses puisque nos deux filles s’appelaient Suzanne… Adieu, William, soyez heureux dans votre enfant ! »
À la lettre – lettre étrange – étaient joints, en effet, tous les papiers du mort, tous les papiers de sa fille.
– Eh bien, j’accepte, murmura Roger, cela me servira sans doute.
Et effectivement, lorsque Roger revint à New York, il se fit appeler du nom de son ami.
Il savait l’anglais avant sa condamnation. Il se perfectionna dans cette langue et en vint bientôt à la parler très purement, à l’écrire correctement.
C’est ainsi que s’étaient écoulées les années et Suzanne, au fur et à mesure que l’enfant devenait jeune fille, oubliait qu’elle s’était appelée Laroque, pour ne plus répondre qu’à son nom de Suzanne Farney.
Oubliait-elle vraiment ?
Quand Roger quitta définitivement le Canada, pour s’établir à New York, il mit sa fille dans une excellente pension de cette ville. Elle y resta jusqu’à l’âge de seize ans, y fit de fortes études, et en sortit sachant parfaitement, outre le français qu’elle avait continué de parler, l’anglais et l’italien. Elle était devenue également excellente musicienne et les professeurs de dessin lui avaient prédit de vrais succès si elle voulait travailler sérieusement la peinture.
Quand elle n’eut plus rien à apprendre en pension, elle revint chez son père. Elle était simple de goûts, très modeste, d’un caractère timide, – restée française malgré l’éducation et les mœurs américaines, elle témoigna tout de suite de la plus grande répulsion pour le monde.
Si elle s’était écoutée, elle ne fût jamais sortie de la jolie villa que son père habitait à une demi-heure de New York, tout près des aciéries, et sa santé en eût souffert.
Heureusement, Laroque veillait.
Il lui apprit à monter à cheval, l’accompagnant dans de longues promenades matinales, sous la fraîche et fortifiante brise de mer, l’habituant aux intempéries, au froid, à la pluie, à la chaleur, en l’obligeant à sortir par tous les temps.
Suzanne était donc devenue vigoureuse, sans rien perdre de sa grâce féminine, de sa sveltesse, de sa distinction.
Cette question : « Avait-elle oublié ? » que de fois Roger se l’était faite à lui-même, dans le calme lourd des nuits sans sommeil, quand revenaient à son esprit, trop surexcité de travail, les cauchemars du passé.
Avait-elle oublié ? Il croyait en être sûr… Jamais, depuis dix ans, la moindre allusion, la moindre hésitation, un regard, une phrase inachevée, un geste qui pût lui faire soupçonner une arrière-pensée chez sa fille.
Lorsque, riche désormais, laissant à New York des affaires en pleine prospérité, il songea à revenir en France, il l’avait dit à sa fille en essayant de surprendre chez elle quelque rapide épouvante, suscitée par les souvenirs d’autrefois…
– Mon enfant, nous allons quitter New York pour aller habiter Paris que tu ne connais pas, où je ne t’ai jamais conduite. Cela t’ennuie-t-il et préfères-tu que nous restions où nous sommes ?
– Partout où vous irez, mon père, je vous suivrai.
Elle avait dit cela avec calme, et rien, dans sa physionomie, ne pouvait faire croire à Roger qu’elle avait une arrière-pensée.
Cependant, quand Laroque fut parti, quand il ne fut plus là pour la surveiller, quelque chose changea soudain dans son visage, qui s’assombrit ; elle eut un pli au front ; un souci était né en cette âme ; une tristesse peut-être. Elle s’assit lentement sur une chaise, près d’une fenêtre entrouverte ; elle leva ses beaux yeux limpides vers le ciel où roulaient, dans un bleu intense, quelques nuages blancs que le vent, justement, poussait vers la France, et elle soupira.
CHAPITRE III
Deux mois après, ils étaient à Paris et descendaient à l’hôtel Scribe, au-dessus du Jockey-Club, un hôtel affectionné par les étrangers riches et où Laroque savait trouver des Américains.
Il voulait établir tout de suite quelques relations dont il aurait usé pour éloigner de lui les soupçons si des soupçons avaient pu l’atteindre.
Il redoutait peu de choses, en somme.
Il était connu, par les principales maisons de banque de Paris, comme l’inventeur des procédés nouveaux qui avaient fait la fortune des grandes aciéries de New York.
Bien qu’il ne fût pas en nom, on le savait associé.
C’est donc un terrain solide qu’il sentait sous ses pieds : si Roger Laroque était un forçat, William Farney, en revanche, était un gentleman honoré, bien posé, d’une intelligence supérieure, et, par-dessus tout et ce qui ne gâte rien, extrêmement riche, possesseur d’une fortune dont chacun pouvait connaître la source.
Puis le pauvre homme était sûr de pouvoir passer devant tous ceux qui avaient été mêlés à son affaire autrefois sans qu’ils le reconnussent.
Roger Laroque, possesseur d’une grosse fortune, légitime récompense en somme du travail persévérant, n’était-il pas libre d’en jouir paisiblement ? Mais non ! Comment se prélasser sur un lit de millions quand on porte un nom déshonoré par une erreur de la justice des hommes ?
Grâce à l’or gagné en Amérique, Roger Laroque possédait le levier le plus puissant pour arriver secrètement à la fin d’une enquête qui devait rendre au nom de Roger Laroque toute son honorabilité.
Il lui semblait qu’une volonté supérieure avait présidé à la préparation de sa revanche. Est-ce que l’accident d’où il était sorti défiguré n’était pas une œuvre de la Providence ? Tout ne dépendait plus que de lui maintenant, de son énergie, de son désir de réhabilitation. Il voulait rendre à sa fille le nom de Laroque ; celui de Farney ne pouvait être qu’un subterfuge, bon pour un coupable, inacceptable pour un honnête homme, encore plus pour l’enfant de cet honnête homme.
Ce qui lui coûterait le plus dans ce grand Paris transformé pour lui en désert, ce serait de ne pas revoir Guerrier, le brave garçon qu’il avait tiré de l’ornière, dont il avait fait un homme et qui, seul, alors que tout le monde croyait Roger coupable d’un crime, n’avait jamais douté de son bienfaiteur. Quand on a de grandes choses à faire, on a besoin de s’appuyer sur quelqu’un, de lui confier ses résolutions, de lui demander conseils et encouragements.
Pour retrouver Guerrier, il alla rue Saint-Maur et, au concierge – qu’il ne connaissait pas – le pauvre homme n’hésita pas à poser à tout hasard une question.
– Pardon, dit-il, avec un fort accent anglais, est-ce que monsieur Guerrier est toujours employé ici ?
– Qui ça, Guerrier ? le caissier de Roger-la-Honte ?
– Roger-la… ? demanda l’inconnu, d’une voix indignée.
– Eh oui, Roger Laroque, l’assassin de Larouette.
Laroque, blême de fureur, ne put réprimer un mouvement de brusquerie. Il saisit le bras du bavard et le lui serra avec une telle force qu’il lui coupa net les ailes de son éloquence.
– Aïe ! cria le pauvre diable. Qu’est-ce qui vous prend ? Vous m’avez fait un bleu.
– Voilà pour le soigner, dit Laroque en lui glissant quarante sous dans la main. Je suis étranger et je ne connais rien à vos histoires de brigands. J’ai besoin de voir monsieur Guerrier, qu’on a recommandé à un de mes amis pour une place vacante de caissier. Où demeure-t-il ?
– Rue de Châteaudun, 18. Il est employé à la banque Terrenoire et Compagnie, boulevard Haussmann, une bonne maison. Encore un rude jobard, votre Guerrier ! Il vient parfois ici pour serrer la main à d’anciens camarades et quand on lui parle de son ancien patron, il se fâche si on a l’air de douter de l’innocence de ce scélérat.
Fort heureusement, Roger Laroque n’entendit pas le dernier mot. Il avait déjà sauté dans un fiacre en disant au cocher :
– Rue de Châteaudun, 18.
Donc, Jean Guerrier, n’avait pas plus douté, après qu’avant, de l’honneur de son patron. Donc, Roger pouvait se fier à lui.
Le nom de Terrenoire réveilla en Laroque un souvenir douloureux. Ah ! l’affreuse journée où celle où l’usinier aux abois avait contracté chez ce banquier un emprunt inespéré, sans autre recommandation que l’éloquence persuasive de Jean.
Roger revoyait la physionomie à la fois douce et sombre de M. de Terrenoire, l’air sévère, presque sinistre, de son associé, M. de Mussidan, et il s’étonnait encore de leur facilité à obliger un homme qu’ils ne connaissaient pas.
Le cocher venait d’arrêter Roger rue de Châteaudun.
Le voyageur descendit, paya et s’arrêta sur le pas de la porte.
Voilà maintenant qu’il hésitait à venir troubler la tranquillité de son ancien protégé. Il se faisait scrupule de l’associer à son malheur, de le compromettre peut-être en l’associant à de vaines recherches où, au lieu de trouver l’assassin de Larouette, on risquait de se heurter à la police.
Non, il n’irait pas voir Guerrier. Laroque était bien mort pour le passé.
Il n’y avait plus que William Farney, riche étranger dont les dollars lui permettraient de se créer en France les plus hautes relations, si bon lui semblait.
Et, le cœur tout gonflé par le chagrin de son isolement, Laroque traversa la rue.
En face le 18, se trouve une librairie-papeterie où les journaux illustrés sont accrochés à la devanture, Roger s’arrêta à regarder machinalement les gravures.
De temps à autre, il jetait un coup d’œil furtif sur la porte de la maison de Guerrier. Il aurait tant voulu revoir le jeune homme ; mais à coup sûr, il ne lui parlerait pas.
Soudain, Laroque se sent frapper légèrement à l’épaule. Il se retourne.
C’est Guerrier !
– Tais-toi, enfant. Je suis perdu, puisque tu m’as reconnu.
– Vous, patron ! Est-il possible ! Oh ! c’est bien vous ! Mon Dieu ! que vous êtes changé ! Un accident ? Vous êtes tombé dans le feu, ou bien…
Laroque arrêta un fiacre, y monta et ne se crut en sûreté que lorsqu’il eut baissé les stores. Il était très pâle ; un tremblement convulsif l’agitait.
– C’est curieux, murmura-t-il, je ne croyais pas qu’on pouvait avoir peur quand on n’est pas coupable.
– Peur ! répéta Guerrier. Vous êtes sauvé, puisque j’ai eu le bonheur de vous rencontrer. Personne n’aura jamais l’idée de venir vous chercher chez moi.
– Me cacher ? Jamais ! Je ne suis pas venu en France pour y vivre en malfaiteur impuni. Me voilà riche, très riche, et tout ce que je possède, je le consacrerai à trouver l’assassin de Larouette ! Mais comment m’as-tu reconnu ?
L’ancien caissier de Laroque lui prit les mains et les lui serrant affectueusement :
– Il n’y a rien dans ce fait qui puisse vous inquiéter. Écoutez-moi bien : en toute autre circonstance, jamais je n’aurais retrouvé dans votre visage les traits de mon bienfaiteur. Mais songez que, depuis l’année fatale, je n’ai jamais passé un seul jour sans penser à vous, sans espérer vous revoir. Il me suffisait de fermer les yeux pour vous évoquer, tel que je vous voyais autrefois. Or, tout à l’heure, au moment où j’allais rentrer chez moi, je songeais à vos malheurs et je me disais : « Monsieur Laroque doit être mort, puisqu’il n’a pas trouvé le moyen d’envoyer de ses nouvelles à Jean Guerrier. Il ne souffre plus. » Et cependant, tout en me répétant ces tristes choses, un pressentiment me faisait battre le cœur. L’espoir renaissait en moi, et je m’écriai sans souci des passants qui pourraient me prendre pour un fou : « Il vit, je le reverrai ! » À peine avais-je prononcé ces paroles que mes regards s’arrêtaient sur vous. Je ne vous voyais que de profil et je vous ai reconnu au premier coup. Il y a dans la tournure d’un homme que l’on connaît bien, dont le souvenir remplit votre cœur, un je-ne-sais-quoi auquel on ne se trompe pas. Le corps a sa physionomie comme le visage. Votre façon de pencher la tête, certains gestes qui vous sont familiers vous ont désigné du premier coup à un homme qui, à cet instant même, concentrait toutes ses pensées sur l’absent. Monsieur Laroque, personne autre que moi ne saurait vous reconnaître. Votre visage, qu’un cruel accident…
– Ne dis pas cruel, mais heureux. Sans cet accident, comment pourrais-je espérer affronter Paris sans retomber dans les griffes de mes bourreaux !
– Votre visage, dis-je, est absolument transformé. Vos cheveux blanchis avant l’âge achèvent l’illusion. Votre accent anglais me paraît tout à fait pur. À part quelques rectifications à faire dans votre attitude, je suis convaincu que pas un de nos anciens ouvriers, pas un des magistrats et des juges devant qui vous avez comparu, ne reconnaîtra Roger Laroque dans…
– William Farney. Tel est mon nouveau nom et je ne l’ai emprunté à personne. Ce nom, je le tiens d’un honnête homme qui me l’a légué en retour de mon dévouement pour sa fille que j’ai arrachée aux flammes. Je pouvais accepter ce don suprême, non pour moi, mais pour ma pauvre Suzanne !
– Mademoiselle Suzanne est revenue avec vous ? Elle doit être bien belle.
– Et toujours bonne.
– Est-ce que… ?
Jean s’arrêta sur cette interrogation. Il était très rouge et n’osait préciser sa pensée.
– Parle, mon enfant, dit-il. Ne crains pas de raviver en moi des souffrances auxquelles j’aurais succombé depuis longtemps, n’était l’espoir de la réhabilitation. Tu veux me demander, n’est-il pas vrai, si Suzanne a oublié la terrible scène du procès ? L’a-t-on assez torturée, la pauvre enfant ! Il lui a fallu toute l’énergie qu’elle tient de son père pour ne pas succomber à cette barre où un juge impitoyable n’avait pas craint de l’appeler. Elle en sortit vivante ; mais tu as dû le savoir, une fièvre violente s’empara d’elle. Elle fut de longs jours entre la vie et la mort. Enfin, on la sauva et maintenant elle fait toute ma joie, toute mon espérance. À la suite de cette nouvelle épreuve, conséquence des précédentes, Suzanne perdit la mémoire. Il fallut recommencer son instruction comme si elle n’avait jamais rien su. Tout autre que son père se serait désolé ! Moi je bénissais cette nuit qui avait envahi le cerveau de l’enfant. Je crois que Suzanne a oublié… Quoi qu’il en soit, elle n’a jamais fait la moindre allusion au drame qui a traversé son enfance.
Ils arrivèrent ainsi à l’extrémité des Champs-Élysées. Ils avaient tant de choses à se dire qu’ils ne savaient même pas où ils étaient. Le cocher frappa à la vitre, demandant des ordres.
Laroque se fit conduire au restaurant le plus proche. Ils s’y enfermèrent dans une salle à part, craignant d’être vus ensemble. Précaution utile : que de fois on avait demandé à Guerrier s’il savait ce qu’était devenu le forçat évadé ! Il y avait danger même pour William Farney de se trouver en public auprès de son ancien caissier.
C’est à peine s’ils touchèrent aux plats. Ils avaient hâte de reprendre la conversation interrompue.
– Et toi, mon enfant, demanda Laroque, tu ne me dis pas tout ce que tu as fait depuis notre séparation. Tu n’es pas marié ; sans quoi, je le saurais déjà. Aimes-tu quelqu’un ?
– J’aime quelqu’un, répondit franchement Guerrier, sans remarquer l’expression de désappointement que ces mots amenèrent subitement sur les traits du fugitif.
Roger Laroque avait pensé souvent à Guerrier en voyant Suzanne grandir et devenir chaque jour plus belle. Les pères s’imaginent toujours être assez forts pour préparer la destinée de leurs enfants. Ils comptent sans la fantaisie du hasard qui gouverne les cœurs tout aussi bien que les empires.
Guerrier eut bientôt fait de résumer son histoire. La vente de l’usine l’avait mis d’abord sur le pavé. Il avait fait de vaines démarches pour retrouver une nouvelle situation ; personne ne voulait donner du travail à l’ancien caissier de Roger Laroque. Mais un matin, Jean avait reçu un billet laconique, et il était sorti de chez lui, plein d’espoir. Ce billet disait :
« Monsieur Guerrier,
« Vous êtes prié de vous présenter demain, à onze heures du matin, chez M. de Terrenoire, qui a une communication importante à vous faire. »
Or, Guerrier n’aurait jamais osé s’adresser à l’ancien ami de M. de Vaubernier. Il redoutait des reproches au sujet des 45 000 francs si généreusement prêtés en 1872 et dont la perte devait être sensible au banquier et à son commanditaire.
Était-ce au sujet de cette somme qu’on le mandait ? Qu’y pouvait-il ? Rien.
Ce fut avec les plus vives appréhensions qu’il se rendit à l’invitation.
Contrairement à cette attente, M. de Terrenoire le reçut avec la même bonne grâce que la première fois. Il lui remit sous les yeux la recommandation si pressante de son ancien camarade de collège, feu Vaubernier.
– Je vous avais offert, dit-il au jeune homme, de vous donner la succession de mon caissier dès qu’il prendrait sa retraite. Il part la semaine prochaine chez un de ses enfants qui réside en Bretagne. Il y finira tranquillement ses jours. Voulez-vous sa place, oui ou non ?
Guerrier accepta avec reconnaissance.
Des 45 000 francs, il n’en fut même pas question, encore moins de Roger Laroque. Ces bienfaits ne s’arrêtèrent pas là.
M. de Terrenoire ouvrit à Jean sa maison comme au protégé d’un ami dont on respecte la volonté.
À la fin de l’été, il l’emmenait chasser avec lui dans sa belle propriété de Sologne, à Lamotte-Beuvron. C’est là que, d’année en année, il vit s’épanouir la beauté merveilleuse de Marie-Louise, fille de M. Margival, l’employé principal de la banque de Terrenoire, vieillard que son patron n’aimait pas seulement pour sa probité, son zèle et son intelligence au travail, mais dont il avait fait son ami.
Au château comme à la ville, Marie-Louise était traitée par M. de Terrenoire avec une affection égale à celle qu’il portait à sa fille, Mlle Diane, si belle aussi et si bonne.
Guerrier aimait Marie-Louise, en était aimé, et, comble de bonheur, son amour était encouragé par le père et par l’ami du père.
– Et à quand le mariage ? interrompit Laroque en souriant.
Guerrier ne répondit pas. À la joie succédait une morne tristesse qui se peignait sur sa physionomie.
Roger lui prit les mains.
– Il y a des obstacles ? demanda-t-il ; du côté de la mère ?
– Monsieur Margival est veuf.
– Alors ?
– Alors… Non, je ne puis vous dire… c’est trop affreux.
– Dis-moi tout, au contraire, mon enfant. Les malheurs et l’âge m’ont donné une expérience dont tu pourras profiter. Un conseil de Roger Laroque en vaut un autre. D’où vient l’obstacle ?
– D’une femme.
– Ah ! fit Roger avec étonnement.
– Oh ! vous ne sauriez trouver. Cette femme n’est autre que…
Le nom ne pouvait sortir de la bouche du jeune homme. Roger insista et Jean, faisant effort sur lui-même, lui dit tout bas :
– La comtesse.
– Madame de Terrenoire ? Et pourquoi ?
– Elle m’aime.
– Ah ! Quel âge a-t-elle donc ?
– L’âge où la femme est dans l’éclat d’une beauté qu’elle sait condamnée à disparaître bientôt.
– L’âge terrible. Es-tu certain de n’avoir pas commis auprès de la comtesse une inconséquence qu’elle aura prise pour un témoignage d’amour ? N’as-tu pas éprouvé, ne fût-ce qu’un instant, quelque entraînement vers elle ? Parfois, la chair parle quand le cœur reste muet. Souviens-toi.
– Jamais ! Jamais ! J’avais pour madame de Terrenoire une affection pieuse. N’est-elle pas la femme de mon bienfaiteur ? Je ne lui ai jamais parlé qu’avec respect.
– C’est une femme romanesque, sans doute ? Tu l’aurais vue triste, préoccupée. Tu auras cru bien faire en essayant, par de bonnes paroles, de chasser en elle les idées noires. Il n’en faut pas davantage pour qu’une femme romanesque, se trompant aux apparences, voie s’ébaucher le roman d’amour attendu et dans lequel elle se lancera à corps perdu, sans souci des malheurs qu’elle accumulera sur elle et autour d’elle. Tu ne dis pas non, enfant ; c’est donc que j’ai mis le doigt sur la plaie. Roger Laroque en sait long, vois-tu sur les hommes et sur les femmes aussi. Roger Laroque a vécu, trop longtemps vécu.
– Eh bien, oui, c’est vrai, dit enfin Guerrier, tout cela est de ma faute, et je m’en aperçois seulement aujourd’hui, ou plutôt c’est vous qui m’en faites apercevoir. J’ai commis l’imprudence de dire à la comtesse combien je souffrais de la voir souffrir d’un chagrin mystérieux que rien ne pouvait expliquer. Je me suis plu à lui retracer toutes les raisons qu’elle avait d’être heureuse. Je fis même un jour l’éloge de monsieur de Terrenoire, mais elle me coupa la parole en s’écriant : « Lui ! Vous ne voyez donc pas qu’il n’a d’yeux que pour ces Margival ! Au reste, peu m’importe, si j’ai un désir, c’est qu’il s’occupe plus de la Marie-Louise que de Diane ! Ah ! vous ne le connaissez pas ! » Ces paroles singulières me glacèrent le cœur. La comtesse me parut une énigme indéchiffrable.
– En effet, Dieu te préserve, mon enfant, d’aimer un de ces monstres féminins qui ne recherchent dans l’amour que l’âpre volupté du fruit défendu. Mais arrivons au fait : tu es bien sûr que la comtesse s’est éprise d’une belle passion pour ta personne ?
– Ne plaisantez pas, monsieur Laroque. Voici ce qui s’est passé, il y a trois mois. C’était un dimanche, je m’étais rendu, rue de Chanaleilles, à l’hôtel Terrenoire, dans l’espoir d’y rencontrer Marie-Louise. La comtesse était seule. Diane venait de sortir avec son père et monsieur de Mussidan. La comtesse me reçut dans son boudoir. Jamais je ne l’avais vue aussi abattue, aussi découragée de vivre. J’essayai de la distraire en lui parlant de toutes les banalités du jour. Elle ne m’écoutait pas, et soudain, je la vis pleurer. Alors, je me tus et à mon tour des larmes me vinrent aux yeux. Ce mouvement de sensibilité, comment l’interpréta-t-elle ? Son esprit s’égara. « Soyez franc, s’écria-t-elle en prenant mes mains dans les siennes, est-ce pour cette Margival ou pour moi que vous venez ici ? » Que répondre ? J’allais déclarer que j’aime Marie-Louise, que Marie-Louise est toute ma pensée. Comment dire ces choses à une folle dont la passion éclate dans les yeux et qui croit aux rêves qu’elle s’est forgés. J’allais me dégager lorsque ses lèvres vinrent se coller aux miennes. Ce baiser me brûla comme un fer rouge. « Ne réponds pas, dit-elle, je ne veux pas savoir. Je t’aime, moi, et je t’appartiens. Ne suis-je pas mille fois plus belle que Marie-Louise, une enfant qui commence à peine à bégayer l’amour ? » Alors seulement je la repoussai avec l’indignation que peut éprouver un honnête homme pour une créature aussi perverse, et je m’enfuis comme un fou. Rentré chez moi, je crus avoir rêvé ; mais non ! l’épouvantable réalité se dressait devant moi : j’étais aimé par la femme de mon bienfaiteur. Oh ! ce baiser infâme, il me soulève le cœur de dégoût.
Les deux hommes restèrent longtemps silencieux.
– T’es-tu expliqué enfin avec la comtesse ? demanda Roger.
– Jamais. Je l’évite autant que possible. Mon silence dédaigneux a relevé sa fierté. Mais je sens qu’elle m’aime encore. Lorsque mes regards s’attachent sur ceux de Marie-Louise, la comtesse se trouble, et la jalousie se peint sur sa physionomie. Bientôt cette femme me haïra autant qu’elle m’aura aimé ; mais je crains moins sa haine que son amour.
– Marie-Louise t’aime, dit Laroque. Tu es assuré du consentement de son père, de l’assentiment du comte, pourquoi retarder une solution qui te mettrait à l’abri de la comtesse ?
– J’attends d’un jour à l’autre que Terrenoire m’encourage à parler.
– Pourquoi monsieur de Terrenoire ? C’est à monsieur Margival, au père, qu’il faut t’adresser.
– Non, vous ne savez pas tout : Margival a sacrifié toutes ses ressources pour donner à sa fille une éducation complète. Marie-Louise sera dotée par l’ami de son père. En m’adressant à ce dernier, j’aurais l’air de courir après cette dot. J’attends que mon patron veuille bien me dire : « Faites votre demande. » Je n’attendrai pas longtemps, c’est ma conviction.
Roger réfléchit un instant. Il résumait ses impressions.
– Et monsieur de Mussidan ? dit-il enfin. Est-il pour toi ? Cela importe peu, il est vrai, puisque c’est un étranger dans les deux familles. Néanmoins, son appui ne te serait pas inutile.
– Monsieur de Mussidan ? fit Guerrier. Il ne s’occupe guère de moi. Il n’a d’yeux que pour mademoiselle Diane de Terrenoire.
– Ah ! quel âge a-t-il donc ?
– C’est un de ces hommes bien conservés dont on ne saurait dire d’âge. À coup sûr, il a dépassé la cinquantaine, bien qu’au premier abord il paraisse à peine quarante ans. Correct, froid, un peu compassé, cet homme ne sort de son silence énigmatique que lorsque mademoiselle Diane est devant lui. Oh ! je compte bien peu pour lui. Il n’a ni à approuver ni à désapprouver mon mariage.
Roger Laroque eut un sourire étrange. Il aimait à se rendre compte de tout.
– Si au lieu d’aimer Marie-Louise, tu avais aimé mademoiselle de Terrenoire, aurais-tu pu espérer l’appui de l’ami de son père ?
– Jamais ! Diane est aimée d’un jeune homme, monsieur Robert de Vaunoise, je puis affirmer que ce jeune homme est détesté de monsieur de Mussidan. Mais ce sont là des choses qui ne nous regardent pas. Je n’ai rien à dire contre monsieur de Mussidan. Je le redoute, néanmoins, non pour moi, mais pour le comte. Le rôle que joue cet homme sombre dans la maison de mon bienfaiteur m’a donné souvent à réfléchir. Monsieur de Mussidan me paraît porter le malheur avec lui. Son regard m’effraye. Aime-t-il Diane ? À-t-il le dessein, malgré la disproportion d’âges de la demander en mariage ? Ce serait faire payer bien cher au comte l’appui matériel qu’il lui a prêté dans sa maison de banque ! Quoi qu’il en soit, il ne réussira pas, mademoiselle de Terrenoire aime Robert de Vaunoise, et si ce jeune homme, qu’on dit appartenir à une famille ruinée, osait se déclarer, il aurait le consentement du comte, qui, certes, est un honnête homme et laissera à sa fille le choix d’un parti tout à fait honorable d’ailleurs.
– Concluons, dit Laroque. Ton mariage se fera prochainement, je ne veux pas que tu doives ta fortune au comte. Que te faut-il pour monter une maison de banque ? Quatre ou cinq cent mille francs ? Je les tiens à ta disposition.
Disant cela, Roger souffrait intérieurement. Suzanne eût été si heureuse avec Jean.
– Nous parlerons de cela, s’écria le premier avec des larmes de reconnaissance dans la voix, quand la justice vous aura réhabilité : c’est de vous qu’il faut vous occuper. Tout ce que vous avez de ressources, d’énergie morale, de vouloir, vous avez à le consacrer à la découverte de l’assassin de Larouette. Quant à moi, dès que je pourrai vous être utile dans vos recherches, je serai prêt !
– Je sais où te trouver, dit Laroque. Bientôt, j’aurai besoin de toi. Mon grand chagrin sera de ne pas assister à ton mariage, qui, j’espère, ne tardera pas. Ce mariage accompli, la comtesse oubliera sa folie d’un jour et, s’il reste encore dans son cœur un bon sentiment, elle rougira d’avoir pensé à troubler un bonheur qu’elle aurait dû protéger.
Les deux hommes se séparèrent en se promettant un mutuel appui. Roger était heureux d’avoir pu, depuis tant d’années qu’il se cachait, parler à visage découvert devant un ami fidèle.
CHAPITRE IV
La maison de la rue Saint-Maur avait été vendue par les soins du maître de forges. La situation fut entièrement liquidée, à part la créance Terrenoire.
Quant à la maison de La-Val-Dieu, le vieux Bénardit pensa qu’il ne pouvait mieux faire, quelques années après le départ de Suzanne, que de la vendre, alors qu’elle était en pleine prospérité. Ce qu’il fit.
Les trois ou quatre cent mille francs qu’il en tira, joints à la plus forte partie de ses économies, allèrent grossir le capital de Laroque dans ses entreprises industrielles ; Bénardit et sa femme ne gardèrent qu’une petite rente pour vivre ; ils n’avaient pas de besoins, et, quand ils moururent, – à quelques mois d’intervalle l’un de l’autre, – cette rente passa, de par leur testament, à des parents éloignés.
Lorsque Suzanne eut disparu de La-Val-Dieu, les Bénardit avaient été interrogés souvent sur cette disparition ; ils inventèrent une histoire, et même Mme Bénardit feignit quelques voyages à Paris, où, disait-elle, Suzanne était en pension, et qu’elle prétendait aller voir.
On la crut, la justice ne fut pas avertie, et, grâce aux précautions prises, ils ne furent pas inquiétés.
Tout était donc ainsi réglé pour permettre à Roger de commencer à Paris sa vie nouvelle.
Pourtant, deux ou trois jours après son arrivée, il eut une émotion qui le rendit malade et qui, pendant quelque temps, le replongea, au sujet de sa fille, dans une terrible anxiété, – dans une mortelle angoisse.
Un jour, après déjeuner, il avait dit à Suzanne de ne point s’inquiéter s’il rentrait un peu plus tard que d’habitude. Il avait l’intention, prétendait-il, d’aller visiter, dans les environs de Paris, quelques maisons de campagne que des hommes d’affaires lui avaient proposées.
La vérité, c’est qu’il voulait attendre le soir, presque la nuit, pour faire un pieux pèlerinage.
Il voulait revoir Ville-d’Avray, il voulait revoir la petite maison où il avait été si heureux avec Henriette, il voulait aussi aller au cimetière chercher la tombe de sa femme et prier là…
Il partit vers cinq heures de la gare Saint-Lazare. Il n’alla pas tout de suite au cimetière. Il voulait attendre la nuit…
Il passa les heures, jusqu’au soir, à rôder dans le bois, près des étangs, aux alentours de la villa Montalais…
Il vint s’asseoir sur le banc où il s’était assis douze ans auparavant, en cette fatale nuit où Larouette avait été assassiné et où il n’osait rentrer chez lui, parce que l’idée de la ruine prochaine et du déshonneur imminent le hantait, et qu’il était poursuivi par le cauchemar du suicide.
C’était toujours le même paysage… Rien n’avait changé depuis dix ans.
On apercevait la villa Montalais, à deux pas de la rue, presque en face de la petite maison de Larouette – mais la villa n’était plus la même. Les persiennes closes indiquaient qu’elle n’était pas habitée depuis longtemps, – peut-être depuis le crime, – et le jardin, la pelouse, les charmilles, les allées, rien n’avait été entretenu, tout était dans un inénarrable désordre. Ce désordre, cet abandon, renouvelaient je ne sais quelle souffrance dans le cœur de Roger. Cela lui semblait une profanation qui atteignait le souvenir d’Henriette, de la pauvre morte, et aussi l’innocence de Suzanne qui, fillette, courait là, sous le grand soleil, parmi les fleurs, en chantant. Des larmes lui vinrent aux yeux.
Comme des promeneurs, sur la rive de l’étang, passaient devant lui et, étonnés de son attitude, le regardaient, il se leva. Il rentra dans le bois et n’en sortit plus qu’à la nuit. Alors, il se dirigea lentement, accablé par ses pensées, vers le cimetière. L’obscurité n’était pas très profonde. La lune brillait. Il erra parmi les tombes, se penchant au-dessus pour déchiffrer les inscriptions.
La recherche fut assez longue.
Par les soins de Noirville, sans doute, peut-être par les soins de l’oncle Bénardit, la tombe avait été entourée d’un grillage de fer, et, sur la pierre tumulaire, autour de laquelle bien des herbes avaient poussé, on lisait le nom d’Henriette.
Laroque s’agenouilla, le front contre la grille, et pria longtemps.
Quand il se releva, il jeta un long regard sur cette terre qui lui cachait les restes de celle qui avait été sa femme, qui l’avait aimé, et qui était morte avec l’atroce pensée qu’il était coupable… Puis, chancelant un peu, il regagna la porte du cimetière.
Alors, il eut une vision étrange. Dans la nuit, il vit une ombre errer parmi les croix, parmi les tombes, l’ombre d’une femme qui lui tournait le dos, et qui, ainsi que lui-même avait fait tout à l’heure, semblait chercher quelque inscription sur ces croix, sur ces marbres. Il s’arrêta, frappé d’un grand coup au cœur…
Cette femme, dont la démarche vive trahissait la jeunesse, il ne pouvait distinguer sa taille, à cause d’un grand manteau qui la couvrait des pieds à la tête – il n’aurait même pu voir ses traits, s’il avait été plus près, car ce manteau avait un capuchon et le capuchon était rabattu sur la figure, mais cette démarche, quelques-uns de ces gestes, il lui semblait les reconnaître… Un cri, en la voyant, s’était élevé du fond de son être : « C’est ma fille !… »
Et alors quel tumulte d’effroyables conjectures !… Si c’était elle, si c’était vraiment Suzanne, elle savait donc tout ? Elle n’avait donc rien oublié – car elle ne se fût pas cachée de son père, si elle n’avait pas eu le souvenir du drame d’autrefois ? Alors, depuis douze ans, elle dissimulait donc ? Et elle dissimulait avec tant d’art, avec une si grande possession d’elle-même que, malgré ses efforts pour savoir, son esprit tendu vers ce but, il ne s’était aperçu de rien !
Son émotion fut si forte qu’il eut une défaillance et fut obligé de s’asseoir, un moment, sur une pierre tombale. Son front était mouillé de grosses gouttes de sueur. Il avait beau s’essuyer, la sueur ruisselait sans cesse.
Tout à coup, il pensa : « Si c’est vraiment Suzanne, c’est près de la tombe de sa mère que je la retrouverai… »
Et il allait courir, quand, près de lui, se dressa la même ombre noire, marchant doucement et se dirigeant vers la porte.
Il tendit les mains vers elle, murmurant :
– Madame… Mademoiselle… par pitié… un mot ! ! !
L’ombre entendit, mais cette voix lui fit peur sans doute, car elle se mit à courir et disparut dans la nuit.
Il courut jusqu’au chemin de fer ; ne rencontrant que des hommes sur la route, il ne s’arrêta pas et arriva, épuisé.
À la gare, personne encore. Le train de Paris ne passait qu’un quart d’heure après. Neuf heures venaient de sonner.
Il se promena de long en large devant la station, guettant le moindre bruit de pas, dévisageant les femmes qui s’approchaient de lui, mais ne retrouvant pas cette ombre noire deux fois entrevue.
Le train arriva, partit. Suzanne n’était pas venue.
Le lendemain, quand il la vit, il l’interrogea :
– Je suis rentré tard, hier, tu ne t’es pas ennuyée ?
– Non, père.
– Tu ne t’es pas effrayée non plus ?
– Effrayée ! Pourquoi, père ?
– Dame ! une mauvaise rencontre…
– C’est vrai, j’y ai pensé… Mais je sais que vous êtes brave et fort.
– À quoi as-tu passé ta journée ?
– Je ne suis sortie que très tard.
– À quelle heure ?
– À six heures.
– Pour quoi faire ?
– Nous sommes allés dîner avec les Simpson au Lyon d’Or ; ils voulaient m’emmener au Vaudeville, mais je ne me sentais pas très bien… Moi qui n’ai presque jamais de migraine, j’avais mal à la tête… je me suis excusée… Monsieur Simpson m’a reconduite à l’hôtel Scribe, en quittant le Lyon d’Or, et je me suis couchée, après avoir bu du thé… ce qui m’a fait du bien…
– Tu vas mieux, chère enfant ?
– C’est passé, complètement passé !
– Aujourd’hui, nous ne nous quitterons pas. Nous irons ensemble visiter quelques villas… Celles que j’ai vues hier ne me plaisent pas.
– Alors, je vais m’habiller.
– C’est cela. Nous déjeunerons et nous partirons.
Il la laissa. Suzanne rentra dans sa chambre. Elle resta un moment immobile, rêvant, puis passa la main sur son front.
« Il ne m’a pas reconnue, murmura-t-elle, heureusement !… »
Car Roger ne s’était pas trompé. C’était sa fille qu’il avait vue au cimetière… C’était Suzanne !…
Comment était-elle revenue à Paris ?… Par la voiture de l’hôtel qui l’avait amenée et l’avait reconduite…
Elle n’avait pas pris le chemin de fer…
Roger n’eut aucun doute. Il était heureux… Il avait échappé à un danger… Ce jour-là, il fut d’une joie exubérante…
Suzanne, aussi, riait…
Ils parcoururent la campagne aux environs de Fontainebleau, couchèrent à Barbizon et ne rentrèrent à Paris que deux jours après, sans avoir trouvé rien qui fût à leur goût.
C’est au bout de quinze jours seulement que Laroque découvrit Maison-Blanche et l’acheta.
CHAPITRE V
Les premiers jours après l’arrivée de Laroque à Maison-Blanche furent occupés tout entiers par les soins de l’installation.
Le pays plaisait beaucoup à Suzanne, et elle n’avait guère tardé à s’y créer des habitudes.
Très matineuse le printemps et l’été, son plaisir favori était de vagabonder à cheval au hasard des sentiers, par les prés et les bois.
Un matin du mois de septembre, par un soleil rayonnant, Suzanne fit seller son cheval et sortit, emportant, accrochés à sa selle par une courroie, sa boîte à peinture et son chevalet.
Elle était allée deux ou trois jours auparavant, visiter les ruines de l’abbaye des Vaux de Cernay, et elle voulait en faire une esquisse.
Il était environ sept heures du matin quand elle y arriva. Elle passa la grande grille en fer forgé Louis XV, installée là, sur le mur d’un saut-de-loup, par les soins de la baronne Nathaniel de Rothschild, à laquelle appartient l’abbaye, et gagna la maison du garde, qui se trouvait à droite, à l’intérieur, et tout près.
Il mit le cheval à l’écurie et lui donna du foin et de l’eau.
– Mademoiselle désire-t-elle que je l’accompagne ? fit-il poliment.
Elle refusa. Elle était venue en artiste. Elle aimait mieux vaguer au hasard et s’abandonner à ses impressions, sans être dérangée par les monotones indications d’un guide.
Elle traversa, dans toute sa longueur, le premier parc, celui du prieuré, et pénétra dans le second parc – celui de l’abbaye – en longeant un passage de voitures pratiqué sous la route.
Elle passa sous la voûte de l’une des anciennes portes fortifiées de l’abbaye. Du sommet de l’escalier de cette porte, à travers une fenêtre en ogive, au-dessus des murs à demi écroulés et chancelants, on aperçoit en avant une autre porte fortifiée qui était jadis la première entrée.
De là, on embrasse une vue merveilleuse, les deux parcs, le hameau, la riante campagne au loin, et, tout près, les ruines de l’église entremêlées d’herbes robustes parmi lesquelles, lorsque s’écroule quelque gravier, poussé d’en haut par le pied d’un promeneur, fuient et disparaissent des couleuvres et des lézards verts et gris.
Suzanne redescendit. C’était l’église qu’elle voulait peindre. On voit encore debout le mur de la nef, du côté du nord, le pignon occidental, avec ses roses et ses portes, le collatéral avec ses voûtes, un peu du transept avec les restes des deux chapelles.
Le long des ruines, à l’intérieur comme au-dehors, avaient poussé des arbres, des arbustes, entre les pierres, les lierres et des herbes folles grimpaient le long des vieilles murailles auxquelles, par leur fraîcheur, ils semblaient vouloir infuser une vie nouvelle.
La jeune fille s’installa le plus commodément qu’elle put, s’asseyant sur une pierre d’où sortirent subitement effarouchés de nombreux lézards.
Elle déplia son chevalet, y installa une petite toile et apprêta sa palette.
C’était vraiment un coin délicieux qu’elle avait choisi ; le soleil, en passant par les cimes des bouleaux maigres, poussés là, perdait un peu de sa chaleur.
« Dieu ! qu’on est bien ici ! se dit-elle, à haute voix ; je reviendrai demain et j’y amènerai mon père… »
Et elle se mit au travail.
Les heures s’écoulèrent, sans qu’elle y prît garde, tellement elle avait d’ardeur. Quand elle se leva enfin, un peu fatiguée, un peu courbaturée :
« Mais j’ai faim, dit-elle, j’ai même très faim… Et je n’ai rien à manger… Comment faire ? »
Elle réfléchit un peu, avec une jolie moue soucieuse.
« J’ai même aussi très soif ! dit-elle encore, mais cela, du moins, c’est facile à guérir, et si la soif apaisée pouvait faire passer la faim ?… »
Elle courut à la source de Saint-Thibaut, dégringola jusqu’en bas, s’agenouilla au bord sur les petits cailloux blancs, et, en se penchant sur la fontaine d’une limpidité de cristal, elle prit de l’eau dans le creux de ses deux mains et but, dans le joli vase rose et blanc de ses doigts, plus joli, plus rose et plus blanc que les coquillages les plus frais.
Mais voilà qu’ayant bu, tout à coup, son regard s’arrête effaré sur cette eau limpide, où se reflètent les moindres choses, herbes, plantes, arbustes qui grimpent sur les bords du ravin.
Dans l’eau, elle aperçoit derrière elle un homme qui la regarde, sans bouger, presque caché par une cépée de petits bouleaux.
On ne lui voit que la tête et le cou, qu’il avance avec curiosité, mais précaution, pour ne point troubler la charmante buveuse.
Suzanne pousse un cri effarouché, se relève et se retourne.
Elle se trouve en face d’un grand garçon, qui la regarde en souriant ; il est vêtu d’un costume de toile grise, guêtre jusqu’aux genoux, coiffé d’un chapeau de paille ; un carnier pend à son épaule, et du carnier passe, en haut du filet, la longue queue multicolore d’un coq faisan ; ses deux mains s’appuient sur un fusil double, dont la crosse est dans l’herbe, et un grand chien noir et feu, un chien anglais de la race des Gordon, est couché la tête sur les pattes, la langue pendante.
Le jeune homme parut confus d’être pris en flagrant délit d’indiscrétion.
– Pardon, Mademoiselle, balbutia-t-il, j’ai eu le malheur de vous effrayer… Je vous supplie de m’excuser…
Il avait rougi, Suzanne ne put s’empêcher de sourire.
– Je n’ai rien à vous pardonner, j’ai été surprise, dit-elle, et dans le premier moment !… J’aurais dû penser que l’eau de cette source est rafraîchissante et bonne et qu’elle doit être connue des chasseurs…
Elle remonta, répondant par un léger salut au salut respectueux du jeune homme.
......................
Suzanne s’était remise à peindre.
Une heure s’écoula. De temps en temps, elle entendait un coup de fusil dans les parcs.
Elle se rappela que le matin elle en avait entendu également, mais elle y avait fait à peine attention.
À présent, chaque détonation réveillait en elle le souvenir du jeune chasseur.
C’est vrai, il avait été indiscret ! mais il avait paru si confus et s’était excusé si gentiment !…
Et puis, n’est-ce pas elle, plutôt, qui avait été sotte ? La source n’était-elle pas à tout le monde ?
Au bout d’une heure, elle se leva, jetant son pinceau.
« J’ai trop faim…, se dit-elle, je ne peux plus travailler. »
Alors, laissant là son attirail de peintre, elle revint à la maison du garde.
Celui-ci était absent, mais sa femme était là…
– Est-ce que je vous dérangerais, Madame, fit Suzanne souriante, en vous priant de me donner de quoi manger… peu de chose… une tasse de lait… un œuf à la coque ? Depuis ce matin, je n’ai rien pris…
– Certainement, Madame…
– Mademoiselle Farney…, dit Suzanne, se faisant connaître.
Suzanne lui demanda un peu d’eau, pour se laver les mains.
– À propos, dit la femme du garde – Mme Louis –, vous n’avez pas entendu des coups de fusil, du côté de l’abbaye ?
– Pardon. J’ai même vu un chasseur… un jeune homme…
– C’est cela. Je l’attends pour le faire déjeuner, lui aussi… C’est un gentil garçon, monsieur Pierre de Noirville, auquel on permet, de temps en temps, de tirer quelques faisans dans le parc, il habite avec sa mère non loin d’ici… une ferme, Méridon, comme on l’appelle… Vous la connaissez peut-être, puisque vous habitez le pays ?… Ce n’est pas très loin de Maison-Blanche…
– Non…, fit Suzanne, que ce nom de Noirville avait fait soudain tressaillir…
– Vous ne connaissez point non plus madame de Noirville ?
– Non plus, dit Suzanne, rêveuse.
La paysanne ne demandait pas mieux que de bavarder – elle paraissait avoir la langue bien pendue –, mais Suzanne n’était point curieuse et ne pensait même pas à l’interroger.
Mme Louis avait mis une nappe bien blanche sur une table, et dressé le couvert.
Puis elle servit une omelette fumante.
– Voilà, Mademoiselle, vous pouvez apaiser votre faim.
Suzanne s’assit à la table et déplia sa serviette. Elle semblait distraite maintenant, et resta quelques minutes sans toucher au plat.
– Ça va refroidir, Mademoiselle, dit Mme Louis.
Elle mangea, mais elle n’avait plus d’appétit.
– C’est ce que vous appelez mourir de faim, Mademoiselle ? disait la femme du garde. Est-ce que mon omelette ne vous plaît pas ?
La jeune fille ne répondit rien.
Elle venait d’entendre un bruit de pas devant la porte ouverte. Elle se retourna.
Un jeune homme était là, celui qu’elle avait vu tout à l’heure, et que Mme Louis appelait Pierre de Noirville.
Il parut surpris de la retrouver, la salua, sans mot dire.
– Avez-vous fait bonne chasse, comme d’habitude ? demanda la jeune paysanne.
– Un faisan, dit Pierre, en jetant sur les briques du carrelage un coq magnifique, au collier d’argent éclatant.
– Seulement ? Mais j’en ai entendu tirer…
– Dix autres, c’est vrai !… Du côté de la fontaine de Saint-Thibaut, dans les herbes blanches, mais je les ai manqués.
– Ah ! ah ! vous étiez nerveux ?
– Sans doute. On explique et excuse toujours sa maladresse.
Et, involontairement, le regard du jeune homme alla s’arrêter une seconde – pas même une seconde – sur le joli visage de Suzanne.
Celle-ci avait entendu, mais elle ne leva pas les yeux.
Mme Louis surprit le regard et son œil vif s’emplit de malice.
« Tiens ! se dit-elle ; je sais pourquoi monsieur Pierre a manqué ses faisans. »
Mme Louis servit du jambon et des pommes de terre cuites sous la cendre, avec du beurre bien frais et qui sentait la crème. Suzanne prit un peu de beurre et ce fut tout.
– Vous ne mangez pas plus qu’un chardonneret, Mademoiselle…
– J’ai attendu trop longtemps, dit Suzanne.
La jeune fille se leva pour partir. Elle tira une petite montre de son corsage.
– Dans une heure, je serai de retour, dit-elle. Veuillez dire à votre mari de me seller mon cheval pour quatre heures…
– C’est entendu… Mademoiselle…
Suzanne la remercia et reprit le sentier qui conduisait à la fontaine, à travers les ruines.
– Et vous aussi, monsieur Pierre, vous avez laissé passer l’heure, dit la paysanne. Est-ce que vous mangerez ?
– Oui, ma bonne, et de grand appétit encore, fit-il gaiement.
– À la bonne heure ! Et tâchez de ne pas épargner la miche de pain autant que les faisans du bois.
Pierre n’eut pas l’air d’avoir entendu, car il ne répliqua pas. Il mangeait.
Une demi-heure après, il se leva.
– Je vais faire un dernier tour, dit-il, après quoi je regagnerai la ferme.
Mme Louis le regardait partir.
– C’est toujours gentil, les amoureux ! murmura-t-elle… Et dire que j’ai commencé comme ça avec Petit-Louis !
Il y avait à peine un quart d’heure que Pierre de Noirville l’avait quittée, lorsque Suzanne reparut, rapportant son esquisse, sa boîte à couleurs et son chevalet.
– Je vous les confie, dit-elle, en les remettant à la paysanne… Je reviendrai demain ou après-demain terminer le paysage – si le beau temps continue et si j’ai le même soleil !…
– Eh ! Petit-Louis !… Eh ! Petit-Louis ! viens donc voir…
Le garde entendit et arriva.
C’était un grand gaillard maigre et dégingandé, nerveux, la peau d’un jaune brique, sans barbe.
– Ah ! dit-il, Mademoiselle a fait cela du trou aux lézards… Je le reconnais… C’est le plus joli endroit !… Ah ! que c’est bien ça !
Suzanne coupa court aux admirations naïves de ces braves gens, en demandant son cheval.
Un quart d’heure après, elle mettait un louis dans la main du garde, et lestement sautait en selle.
– Au revoir ! dit-elle.
– Au revoir, Mademoiselle, à bientôt !
– Quelle jolie frimousse, hein, Catherine ? dit le garde.
Suzanne suivait au pas un petit sentier qui longeait les ruines. Le soleil déclinait. Il faisait moins chaud.
Au moment où elle allait quitter le sentier et laisser les ruines derrière elle, pour regagner la route, elle leva les yeux vers ces vieilles murailles effritées et à demi croulantes qu’elle avait peintes tout à l’heure.
Ce fut un geste machinal et sans réflexion.
Mais aussitôt et vivement elle les baissa. Ses joues se colorèrent. Son front se plissa d’une ride de mécontentement et, d’un geste brusque où il y avait un peu de colère, elle cravacha son cheval. Pourquoi ?
C’est qu’elle avait vu, entre deux pans de murs effondrés, Pierre de Noirville, immobile comme une statue, son chien couché près de lui, qui la suivait du regard avec une attention étrange.
Une minute après, elle disparaissait, au loin, dans l’allée d’un bois de chênes où elle était entrée au galop de son cheval.
Aussi longtemps qu’il avait pu la voir, Pierre de Noirville l’avait regardée.
Quand elle ne fut plus visible, il redescendit, traversa les parcs et passa tout pensif devant la maison du garde, sans entendre Mme Louis qui lui criait :
– Toujours aussi maladroit, monsieur Pierre ?
CHAPITRE VI
À peu près situé à égale distance de Chevreuse et de Maison-Blanche, Méridon est une ferme assez importante, traversée par l’Yvette ; les bâtiments sont de construction moderne et n’offrent rien de remarquable, si ce n’est pourtant, au milieu de la vaste cour ménagée au milieu des bâtiments, une sorte de pigeonnier à toit en éteignoir, qui prouve qu’il y avait là, autrefois quelque castel.
Il n’y a point de fermier ; Pierre de Noirville fait lui-même valoir ses terres, avec cinq ou six domestiques et une sorte de chef de culture qui prend pour lui la grosse besogne.
C’est là que, depuis dix ans, habite Julia de Noirville.
Lucien de Noirville, en mourant, n’avait presque rien laissé à sa veuve, qui se trouva, pendant les deux années qui suivirent cette mort, dans une situation très proche de la misère.
Heureusement pour elle, un oncle de l’avocat, qui vint à mourir subitement, laissa aux deux fils de Lucien – Raymond et Pierre – la ferme de Méridon.
Julia était bien changée depuis la condamnation de Laroque, et depuis la triste fin de son mari. Le remords l’avait vieillie vite et, quoique à peine âgée de quarante ans, courbée et cassée, elle avait l’air d’une vieille femme.
Sa vie s’était écoulée dans les larmes, depuis lors.
Elle avait bien pensé à se livrer, à s’accuser, à accuser aussi son complice, pour réhabiliter la mémoire de Laroque mais ce qui l’avait retenue, c’était la pensée de Raymond et de Pierre, au nom desquels elle attacherait le déshonneur d’une infamie !…
Mathias Zuberi avait disparu, elle ne l’avait pas revu depuis la condamnation. Qu’était-il devenu ? Elle ne le savait.
Ce fut bien difficilement qu’elle put faire instruire ses enfants. Si tous les deux avaient voulu suivre une carrière libérale, elle n’aurait pu suffire à leurs dépenses ; Raymond avait fait son droit ; il avait voulu suivre la carrière de son père, du grand talent et de la mort dramatique duquel il avait bien des fois entendu parler.
Quant à Pierre, l’aîné, plus calme, plus robuste aussi, il lui fallait pour vivre le vaste horizon de la campagne qui emplissait d’air ses larges poumons. Il était resté près de sa mère, à Méridon, une fois ses études achevées.
Raymond avait vingt-deux ans ; Pierre vingt-quatre.
Ils ne se ressemblaient pas, et quiconque les eût vus l’un auprès de l’autre, sans les connaître, n’eût pas deviné qu’ils étaient frères.
Raymond était plus petit, plus nerveux ; son visage était plus pâle aussi, et ses yeux en étaient plus noirs.
Pierre était grand et robuste. Son visage très régulier, éclairé par des yeux noirs aussi – les yeux de la mère –, était hâlé par le soleil et le grand air. Il y avait dans sa démarche, dans les moindres de ses mouvements, je ne sais quoi de solide, de mâle et d’assuré.
Bien qu’habitant Paris, Raymond revenait très souvent à Méridon, tous les samedis jusqu’au lundi, d’une façon régulière, et parfois dans la semaine, lorsque ses affaires ne le retenaient pas au Palais. Quant aux vacances, il les passait à Méridon tout entières.
Les deux frères aimaient Julia de tout leur cœur. Ils l’aimaient, non point tant seulement parce qu’elle était leur mère que parce que rarement ils l’avaient vue sourire. Ils devinaient chez elle une tristesse intime plus forte que sa volonté, réagissant sur toutes ses actions, une de ces tristesses, incurables et profondes auxquelles il n’y a point de remèdes, et qui, pour ainsi dire, font corps avec la vie même.
Lorsque Pierre de Noirville, après sa rencontre avec Suzanne, revint dans la soirée à Méridon, il trouva sa mère et son frère qui se promenaient dans la grande allée de châtaigniers, en avant de la ferme, venant à sa rencontre. C’était l’heure où il rentrait de la chasse, d’ordinaire.
Tous les matins, il était debout au soleil levant ; il eût voulu retourner à la fontaine le lendemain, mais le temps avait changé ; il pleuvait ; Pierre fut nerveux ; le soir, Raymond lui dit :
– S’il fait beau demain, je t’accompagnerai à la chasse.
Pierre ne répondit pas. Si Raymond l’avait regardé, il eût observé un léger tressaillement, comme une seconde de gêne.
Le lendemain le soleil brillait ; toute menace de pluie avait disparu.
Ils partirent assez tard, le fusil à l’épaule.
Comme ils n’avaient qu’un chien pour eux deux, en général, ils chassaient l’un à côté de l’autre, ne s’éloignant guère. Ce jour-là, pourtant, Pierre poussa ses pointes, seul, dans la campagne, laissant Black à Raymond, jusqu’à ce qu’il disparût vers les Vaux de Cernay. Raymond ne s’en aperçut pas tout d’abord… Quand il le remarqua :
« Pierre a quelque chose qu’il ne dit pas », pensa-t-il.
Il n’en continua pas moins de chasser jusqu’à ce qu’il arrivât près des ruines. Il entra chez le garde. Mme Petit-Louis était là.
– Ah ! ah ! dit-elle, vous courez l’un après l’autre ?
– Comment cela ?
– Monsieur Pierre est ici depuis une heure ! Vous l’ignoriez ?…
– Absolument… Nous nous sommes perdus…
Mme Petit-Louis baissa la voix :
– M’est avis, voyez-vous, monsieur Raymond, que ce n’est pas le faisan que monsieur Pierre est venu chercher ici aujourd’hui…
– Eh ! qui donc ?
– C’est bien plutôt la… faisane.
Et elle se mit à rire.
– C’est du côté des ruines que je l’ai vu s’en aller tout à l’heure, c’est là que vous le rencontrerez, bien sûr, si vous y tenez.
Raymond avait fort bien compris la plaisanterie de Mme Louis. Il y avait une femme sous roche.
– Parbleu ! murmura-t-il… en voilà le motif !
Et lui aussi s’en alla vers les ruines.
Au moment où il arriva, Black, qui n’avait cessé de chasser tout le temps, tomba en arrêt. Un faisan partit que Raymond abattit d’un coup de fusil.
Fut-ce la vibration soudaine qui ébranla tout à coup les ruines, ou bien celles-ci, minées depuis longtemps par les crevasses où poussaient les ronces et les arbustes, n’attendaient-elles que les dernières pluies pour s’effondrer ?
Toujours est-il que la moitié de la haute muraille s’écroula avec un éclat pareil à celui de la foudre.
Raymond était trop loin pour courir un danger ; mais, de l’autre côté de la muraille, vers la fontaine de Saint-Thibaut, sans doute, il y avait du monde, car, à la détonation, à l’écroulement succédaient coup sur coup deux cris, un cri de femme, aigu… puis un cri d’homme.
Et Raymond, très pâle, s’élançait dans les ruines, en appelant :
– Mon frère, mon frère ! ! !
Il franchit en deux bonds l’écroulement qui venait de se produire.
De l’autre côté, comme lui, un homme accourait ; mais là-bas, dans les herbes blanches, une femme qu’il ne connaissait pas était étendue immobile et semblait morte.
Suzanne était revenue travailler ce jour-là.
Et, depuis deux heures, elle peignait, très attentive, ne voyant rien de ce qui se passait autour d’elle, et ne remarquant pas que, derrière un tas de décombres ensevelis sous les broussailles, Pierre de Noirville la regardait avec une persistance singulière.
Tout à coup, la détonation du fusil de Raymond la fit tressauter.
Puis le mur s’écroule et une pierre qui rebondit sur d’autres pierres la frappe au front et l’étend foudroyée.
Alors devant Suzanne arrivent en même temps les deux frères aussi pâles l’un que l’autre, consternés, emplis d’une inexprimable émotion.
– Morte ! dit Pierre, mon Dieu elle est peut-être morte ! ! !
– Tu la connais ?
– Je l’ai vue avant-hier pour la première fois.
Suzanne était étendue sur le dos, les bras en croix ; le sang coulait de son front le long de sa joue ; sa bouche était entrouverte ; ses yeux fermés ; une de ses mains, dans cette effroyable chute, avait rencontré une touffe d’orties et comme pour se retenir la serrait convulsivement.
Pierre la prit dans ses bras, doucement, avec un infini respect, avec une tendresse de mère et la porta jusqu’à la fontaine.
Là il la déposa et appuya la tête contre un arbre.
Pendant cela, Raymond trempait son mouchoir dans l’eau très fraîche de la fontaine et lui tamponnait le front, lavait la blessure, baignait les yeux, la bouche, les mains.
– Qu’elle est belle ! murmura-t-il en frissonnant.
Pierre disait, étendant les mains :
– Prends bien garde de lui faire mal !…
Mais Suzanne ne revenait pas à elle. Le sang coulait toujours du crâne ouvert, et les cheveux, – les beaux cheveux blonds, – se souillaient.
– Il faut aller chez un médecin, dit Raymond. Elle perd tout son sang, et sa blessure a l’air d’être grave.
– Si elle reprenait connaissance, mon Dieu !
– Cours, dit Raymond, va chercher madame Louis et dis à Petit-Louis d’atteler un cheval à sa carriole. Madame Louis donnera à cette jeune fille des soins que nous ne pouvons lui rendre.
Pierre prit sa course vers la maison du garde.
Il fallait un bon quart d’heure pour y arriver, même en courant.
Raymond, à genoux près de Suzanne, dont l’immobilité l’effrayait, ne cessait d’étancher le sang de la blessure.
Il appuya doucement, chastement, comme il eût fait à sa sœur, la main sur le corsage de la jeune fille, du côté du cœur.
– Il bat, fit-il, on dirait qu’elle se ranime !
Et, penché sur elle, il la contemplait avidement.
Et, il répétait comme une sorte de prière :
– Mon Dieu, qu’elle est belle… et pâle !… Qui donc est-elle ?…
Tout à coup, Suzanne fit un mouvement. Une plainte sortit de ses lèvres, une plainte d’enfant, comme un cri d’oiseau.
– Elle étouffe, dit Raymond… que faire ? La dégrafer ?… le n’oserai jamais…
Il défit les trois ou quatre premiers boutons de l’amazone qui serrait la jeune fille à la gorge, mettant à nu son cou blanc et fin – d’un blanc presque transparent.
Cela lui fit du bien, car elle ouvrit les yeux.
Raymond se recula, craignant de l’effrayer.
Tout d’abord, elle ne le vit pas. Elle sentait sur son front une terrible pesanteur ; elle avait beaucoup de peine à ouvrir les yeux et, même ouverts, elle ne distinguait pas très bien. Elle essaya de se soulever sur les mains, mais elle retomba en laissant échapper une exclamation de souffrance.
Elle resta un moment immobile, puis, de nouveau, elle fit un effort sans plus de résultat.
Raymond s’approcha d’elle. Alors, elle l’aperçut :
– Monsieur, dit-elle, qu’ai-je donc ? Que s’est-il passé ?
– Ne remuez pas, Mademoiselle, ne faites pas un mouvement, vous vous fatigueriez inutilement et cela redoublerait vos souffrances.
Elle porta machinalement les deux mains à sa tempe, où elle venait de sentir, avec l’impression d’une chaleur brûlante, une douleur aiguë.
Elle retira sa main pleine de sang.
– Ah ! je suis blessée !
Ses cheveux s’étaient dénoués. Sur son épaule, le sang avait coulé, tachant son amazone. Elle sentait aussi le sang qui, doucement, coulait dans son cou. Et la fontaine limpide, d’une pureté de cristal, était là, près d’elle. Suzanne tendit la main pour puiser de l’eau.
Sans doute la douleur devint plus vive, car elle pâlit.
Raymond se précipita.
– Mademoiselle, je vous en supplie, ne faites aucune imprudence. J’ai envoyé mon frère chercher la voiture du garde. Dans quelques minutes, il sera ici. Alors nous vous transporterons chez Petit-Louis, où nous vous panserons.
Et, avec une sorte de timidité :
– Tout à l’heure, Mademoiselle, lorsque vous étiez évanouie et que vous ne pouviez ni sentir, ni voir, ni comprendre, j’ai lavé votre front, votre blessure, avec de l’eau fraîche… Voulez-vous me donner votre mouchoir… pour que je vous soulage un peu ?… Le mien, regardez, est rouge de sang…
Elle tira son mouchoir ; il le prit, le trempa dans l’eau. Elle avait appuyé la tête contre l’arbre. Elle ferma les yeux, essayant de sourire pour rassurer le jeune homme, dont elle voyait le trouble.
Lui, doucement, avec des précautions touchantes, refit ce qu’il avait fait tout à l’heure ; il humectait la plaie incessamment.
Entre ses cils, sans qu’il la vît, Suzanne le regardait, point inquiète.
Ce visage délicat et pâle, ces yeux doux, exprimaient si bien la distinction et l’honnêteté, qu’elle était à l’aise auprès de Raymond, comme elle l’eût été auprès de son père.
– Que vous êtes bon, Monsieur ! murmura-t-elle… Vous êtes adroit comme un médecin et vos mains sont douces comme celles d’une femme… Dites-moi votre nom, Monsieur, afin que je le répète à mon père.
– Je m’appelle Raymond de Noirville… N’ayez aucune reconnaissance envers moi, Mademoiselle… ce que je fais n’est-il pas naturel et tout autre ne l’eût-il pas fait à ma place ?…
– C’est étrange, dit-elle d’une voix qui s’affaiblit tout à coup, je ne souffre plus, mais je ne vois presque plus clair.
Sa tête glissa le long du tronc de l’arbre jusque sur l’herbe.
– Mademoiselle…, Mademoiselle…, fit Raymond effrayé. Elle était de nouveau évanouie.
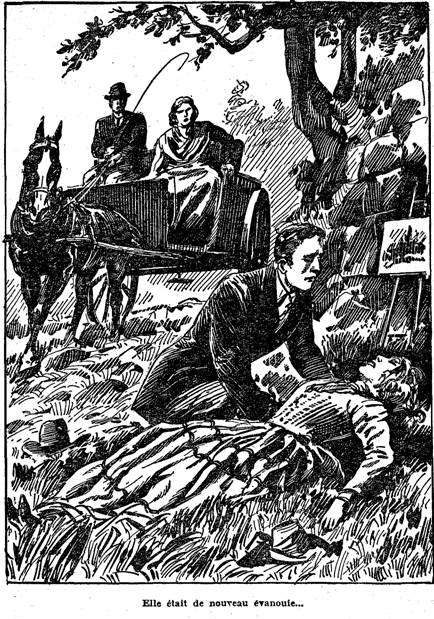
En cet instant, il entendit un bruit de voix et le roulement d’une voiture sur les cailloux.
C’était Pierre qui arrivait avec Mme Louis.
Petit-Louis était allé, sur le cheval de Suzanne, qu’il avait sellé, jusqu’à Chevreuse prévenir le médecin avec mission de le ramener en toute hâte. Pierre avait attelé le cheval du garde à la carriole et était venu aux ruines chercher Suzanne.
– Eh bien ! dit-il à Raymond… Toujours évanouie ?
– Elle est revenue à elle tout à l’heure, m’a remercié, puis elle a perdu connaissance presque aussitôt.
– Pauvre demoiselle ! murmura Catherine. Est-ce que c’est grave ?
– Elle a perdu beaucoup de sang, fit Raymond.
Les deux frères avaient les yeux fixés sur le visage de la jeune fille.
Tout à coup, ils les relevèrent, leurs regards se rencontrèrent et, pendant deux ou trois secondes, fouillèrent jusqu’au plus profond de leur âme.
Puis, ils baissèrent les yeux tous les deux, comme s’ils s’étaient compris.
Ils étaient devenus plus pâles et leurs lèvres tremblaient un peu.
Mme Louis avait arrangé les cheveux de Suzanne et noué des linges autour de sa tête, pour arrêter le sang.
Puis, aidée par les jeunes gens, elle la transporta dans la voiture. Comme il n’y avait que deux places, Catherine monta. Pierre et Raymond marchèrent derrière.
Les cahots firent ouvrir les yeux à Suzanne. Elle souffrait beaucoup. Cependant elle ne se plaignit pas. À la maison, elle voulut descendre sans aide, ce ne fut pas possible… le bras de Pierre la soutint… mais, instinctivement, des yeux, elle cherchait Raymond, resté en arrière, et qui la regardait.
Elle fut étendue sur un lit.
Pierre et Raymond la laissèrent seule avec Catherine.
Du reste, le médecin de Chevreuse arriva presque aussitôt.
Il visita la blessure, la pansa.
– Est-ce grave ?
– Non. Rassurez-vous. Elle est faible parce qu’elle a perdu beaucoup de sang, mais elle est vigoureuse. Dans quinze jours, il n’y paraîtra plus. Seulement, il ne faut pas tarder à la faire reconduire, car la fièvre va la prendre… Il faut des soins…
Le soleil était encore très haut. Il faisait chaud. On installa commodément Suzanne dans la carriole, toujours avec Catherine auprès d’elle. Le cheval de la jeune fille fut reconduit à la main par Petit-Louis. Pierre et Raymond prirent congé de Suzanne, qui leur tendit le bout de ses doigts.
Et l’on partit pour Maison-Blanche.
CHAPITRE VII
À Maison-Blanche, Laroque attendait Suzanne et commençait à s’inquiéter.
Il ne se trouvait pas seul. Un ancien ami était venu voir cet homme qui vivait en proscrit dans son propre pays. On a deviné qui : Jean Guerrier.
L’excellent garçon, étonné de ne pas recevoir de nouvelles de son ancien patron, n’avait pu y tenir. Sans attendre la permission, il accourait à Maison-Blanche. Ses premiers mots furent :
– Y a-t-il du nouveau ?
Laroque répondit par un signe de tête où se voyait la désespérance.
– Avez-vous fait des démarches ? demanda le jeune homme.
– Plus que tu ne saurais croire. Je ne puis malheureusement m’adjoindre encore aucun de ces policiers habiles qui, étant bien payés, savent débrouiller les mystères. J’aurais peur d’être dénoncé et de retomber dans les griffes d’une justice qu’il ne m’est pas permis d’éclairer davantage qu’au premier jour. On ne verrait en moi qu’un forçat évadé, un audacieux faussaire. Sous le masque de William Farney, on se refuserait à voir la victime d’une erreur judiciaire, l’homme qui n’a voulu et atteint la fortune que pour être en mesure de se disculper.
– Pourquoi ne m’employez-vous pas ?
– Cela viendra. Commence d’abord par assurer ton bonheur. Où en es-tu de tes amours ?
– Je touche au port.
– Ah ! tant mieux, mon enfant ! Il n’y a de bonheur réel que dans une union bien consentie de part et d’autre.
Guerrier rougit.
Laroque mit un doigt sur les lèvres, et d’un ton rempli de tendresse inquiète se permit cette question :
– Et la comtesse ?
– La comtesse ?… fit-il ; je n’y pense plus.
– Oui, mais es-tu bien sûr qu’elle ne pense plus à toi ?
– Oh ! cela, je n’en répondrais pas. J’ai surpris dans ses yeux des éclairs…
– Qui annoncent l’orage. Je connais cela, ajouta Laroque, sans songer qu’il trahissait une pensée intime.
Guerrier le remarqua ; mais il avait l’esprit trop préoccupé pour s’arrêter à une impression aussi fugitive.
– Monsieur Laroque, dit Guerrier, apprenez que monsieur Margival, le père de Marie-Louise, ma bien-aimée, vient de m’annoncer que son bienfaiteur, le comte de Terrenoire, aurait à me faire une communication intéressant mon avenir. Cette nouvelle coïncide d’ailleurs avec une autre qu’un heureux hasard a portée à ma connaissance : mademoiselle Diane va enfin épouser monsieur Robert de Vaunoise.
– Ton entrevue avec le comte, quand espères-tu l’avoir ?
– Demain, sans doute. Demain, mardi. Le comte donne, samedi, une grande soirée dans son hôtel de la rue de Chanaleilles, je danserai avec Marie-Louise qui sera ma fiancée. Je verrai bien si madame de Terrenoire, avertie de mon prochain mariage, aura oublié ses menaces.
– Tu verras bien… tu ne verras rien. Est-ce qu’on voit quelque chose quand on aime ? Un seul homme pourrait apprécier sûrement l’état d’esprit de cette folle.
– Qui ?
– Moi.
– Vous ! Vous viendriez à cette soirée ! Si on allait vous reconnaître !
– On ne me reconnaîtra pas. Regarde moi bien : ne suis-je pas méconnaissable ? Tu ne remarques même pas avec quel art je me suis débarrassé des gestes qui m’étaient familiers et qui t’ont fait dire à première vue : « Voici Roger Laroque ! »
Jean dut constater la vérité de cette assertion. Il n’y avait plus rien de Roger Laroque en William Farney.
– Mais comment vous faire assister à cette soirée ? demanda Guerrier avec embarras.
– La belle difficulté ! En m’y faisant inviter. Qui dressera la liste des invitations, qui enverra les lettres ? Toi, sans doute ?
– En effet, j’ai rendez-vous demain matin avec le comte à ce sujet. Nous devrons prendre toutes les mesures.
– Demain, à une heure de l’après-midi, je serai chez toi. Tu me feras voir la liste.
– Pourquoi ?
– J’ai mon idée. Je te la dirai demain. Sur ce, je te remercie d’être venu jusqu’ici, mais je préfère que tu ne t’attardes pas davantage…
– Cependant…
– Oui, je comprends, tu aurais bien voulu revoir Suzanne. Eh bien, je préfère que nous attendions. Qui sait si ta vue ne réveillerait pas en elle les souvenirs endormis ? Soyons prudents, tant que nous serons encore aussi loin du but.
Jean Guerrier poussa un gros soupir, serra avec effusion les mains de son vieil ami et se retira en lui disant :
– À demain.
– À demain, heureux gaillard, répéta Laroque.
CHAPITRE VIII
Trois heures après, à la tombée du jour, Roger, dont le cœur se remplissait d’angoisse, vit arriver de loin le cortège qui ramenait sa fille. Il reconnut le cheval et devina qu’un accident était arrivé à Suzanne.
Il s’élança vers la carriole, comme un fou. Sa fille ! On la rapportait morte, peut-être ! Suzanne, elle-même, l’avait aperçu et de très loin lui tendait les bras.
– Mon enfant ! mon enfant ! Qu’est-il arrivé ?
Et ce fut lui-même qui la descendit et qui l’emporta vers le château.
– Presque rien, dit-elle… Ne vous effrayez pas, mon père… Je peignais les ruines de l’abbaye, vous le savez, quand un pan de mur s’est écroulé et une pierre m’a atteinte, là, dans les cheveux… Ce n’est rien…
Laroque l’avait déposée sur un canapé.
– Quelle peur tu m’as faite ! dit Laroque. Et il essuya son front ruisselant de sueur.
Alors Suzanne lui conta plus longuement ce qui s’était passé, sans omettre les soins empressés dont elle avait été l’objet, aussi bien de la part des deux frères, que de la part de Petit-Louis et de Catherine.
Laroque courut tout de suite remercier le garde et sa femme, qui se mettaient en route pour regagner les Vaux de Cernay.
Puis revenu auprès de sa fille :
– Et ces deux jeunes gens, connais-tu leur nom ?…
– Ils sont frères et habitent, pas très loin d’ici, paraît-il, une ferme qu’on appelle Méridon… L’aîné s’appelle Pierre, l’autre… autant que je me souviens… Raymond, il me semble…
– Mais leur nom de famille ?
– De Noirville…
Roger Laroque fit un brusque mouvement. Il était devenu tout à coup, et par le seul fait d’une émotion subite, presque aussi blanc que sa fille.
– Tu as dit ? demanda-t-il troublé, comme s’il n’avait pas entendu.
Elle répéta le nom.
Laroque tomba dans une profonde rêverie.
« Évidemment, se disait-il, il n’y avait là qu’une rencontre du hasard, les jeunes gens portaient le même nom que Lucien, son ami, voilà tout. Il y a bien des Noirville en France et rien ne prouvait qu’ils appartinssent à la famille de celui qui l’avait jadis défendu ! Pourtant les deux prénoms : Raymond et Pierre ? Lucien de Noirville, il se rappelait, avait deux enfants, deux fils. »
Et il lui semblait se souvenir encore que c’était bien ainsi qu’ils se nommaient : Raymond et Pierre. Si c’étaient eux, pourquoi le hasard les jetait-il ainsi sur sa route ? Dans quel but ?
Et leur mère ?… Et Julia ?… Qu’était-elle devenue ? Autant de ténèbres qu’il se promettait d’éclairer.
Le médecin de Chevreuse, que Roger envoya chercher le soir – car il voulait être complètement rassuré – trouva Suzanne toujours faible, mais ne fit prévoir aucune complication.
Le lendemain, elle eut une forte fièvre qui dura cinq jours ; le huitième jour elle se leva.
Le lendemain de l’accident, vers deux heures de l’après-midi, Catherine Louis avait vu arriver Pierre de Noirville.
– Ma bonne Catherine, avait dit le jeune homme avec embarras, nous avons raconté à notre mère ce qui s’est passé, et de sa part je viens vous prier, si vous avez le temps, d’aller vous informer à Maison-Blanche de la santé de mademoiselle Farney ?…
– J’irai donc, de la part de votre mère…, fit la paysanne avec un sourire.
Pierre partit. Une heure après, ce fut le tour de Raymond. Catherine se préparait justement à atteler le cheval à la carriole.
– Catherine, dit Raymond, voulez-vous me rendre un service ?
– Deux, si vous voulez… monsieur Raymond.
– Vous allez à Chevreuse ?
– Je vais de ce côté-là, oui, monsieur Raymond.
– Vous ne passerez pas loin de Maison-Blanche ?
– Je passerai devant.
– Eh bien, voulez-vous vous y arrêter cinq minutes… le temps de demander comment va mademoiselle Farney ?
– Avec plaisir… Et de la part de qui, monsieur Raymond, voulez-vous que je fasse cette commission-là ?
Le jeune homme rougit, balbutia :
– Mais, Catherine… de la part de ma mère, bien entendu… Et il s’éloigna, sans comprendre pourquoi la paysanne riait.
– Eh ! eh ! elle fait du ravage la demoiselle d’Amérique, fit-elle. Et dire que moi aussi, dans le temps, je n’avais qu’à regarder les jeunes gens pour leur faire tourner la tête… Seulement, les deux frères amoureux, ça ne dit rien de bon… Souvent, ça finit mal, ces histoires-là… Et ce serait dommage, ils sont si gentils !…
Elle grimpa dans la carriole et, un instant après elle disparaissait au tournant de la route.
CHAPITRE IX
Laroque était obligé d’aller à Méridon remercier Pierre et Raymond des soins qu’ils avaient donnés à Suzanne.
Le pauvre homme comprenait cette obligation, et, pourtant, il la reculait autant qu’il pouvait.
Il craignait de voir ses soupçons prendre corps… Il tremblait de retrouver dans les deux jeunes gens les fils de Lucien… Il était épouvanté aussi à la pensée de se retrouver devant leur mère… Non point qu’il craignît d’être reconnu par elle ; non, tel qu’il était, avec les changements survenus dans sa figure, dans toute sa personne, il était sûr de lui.
Mais Julia, c’était le passé qui se dressait devant lui, le passé avec lequel il aurait si bien voulu rompre, avec lequel il croyait si bien en avoir fini !…
Certes, Roger avait expié chèrement cette faute d’un instant… Il l’avait payée de sa fortune, de la mort de sa femme, de sa liberté, de son honneur… et pourtant, malgré cette expiation, Julia, c’était toujours le remords !
Cependant Suzanne était complètement guérie et parlait de reprendre ses promenades à cheval.
Déjà, par quelques discrètes allusions, elle s’était informée si son père avait rendu visite aux Noirville.
Laroque comprit que le moment était venu de s’exécuter.
Il fit atteler. Suzanne l’accompagna.
Les deux frères se trouvaient à la ferme quand la voiture s’y arrêta. On les prévint.
Ils sortirent dans la cour, saluèrent Laroque et sa fille ; celle-ci leur tendit ses mains.
Pierre alla avertir Julia, qui descendit au salon, malgré sa répugnance ; elle connaissait l’aventure, que ses fils lui avaient racontée, et s’attendait à cette visite.
Julia, toute vêtue de noir, le visage maigri, et pourtant sans rides, mais les cheveux aussi blancs que les cheveux de Laroque, Julia était assise dans un grand fauteuil, tout près du foyer.
Quand Suzanne et Laroque entrèrent – Laroque annoncé sous le nom de William Farney par Raymond à sa mère – Julia se leva lentement, avec effort, et salua d’un léger signe de tête.
Ses yeux étrangement noirs d’un noir opaque et sans rayons, se fixèrent un instant sur Laroque, puis se portèrent sur Suzanne.
Elle n’avait pas tressailli à la vue de Roger. Quant à celui-ci, depuis qu’il était entré, il contenait son émotion et son trouble avec beaucoup de peine. Julia était bien changée, malgré cela il l’avait reconnue, tout de suite et sans hésitation.
C’était elle !… Et, vaguement, avec un frisson dans les épaules, il regarda autour de lui, comme s’il avait craint de voir entrer Lucien, le mari !…
– Madame, dit le pauvre homme, vos fils vous ont appris, sans doute, l’accident arrivé à ma fille, et il me tardait de les remercier des soins qu’ils lui ont donnés – et sans lesquels, peut-être, à l’heure qu’il est, Suzanne ne vivrait plus…
Raymond intervint, avec un geste :
– Vous grandissez le service outre mesure, monsieur Farney, dit-il. Ce que nous avons fait est peu de chose et il y a longtemps qu’un sourire de mademoiselle Farney nous a remerciés…
Pierre se taisait. Il dévorait Suzanne des yeux. Quant à celle-ci, elle avait rougi, sans savoir pourquoi, aux paroles de Raymond.
Julia était retombée dans son fauteuil, comme une masse, aux premiers mots prononcés par Laroque… et il y avait, sur son visage, une si visible expression d’épouvante que, si les personnages de cette scène n’avaient pas été tous, eux-mêmes, sous le coup d’une forte émotion – diverse pour chacun d’eux –, ils s’en fussent aperçus certainement.
Pourquoi son regard, ardemment, dévisageait-il Laroque… pendant que son cœur battait à rompre le corsage de sa sévère robe noire…, pendant que ses lèvres s’étaient desséchées tout à coup ?
C’est que si Roger avait vieilli, s’il avait la figure méconnaissable, si la cicatrice laissée par l’incendie de Québec changeait complètement le caractère de sa physionomie, ce qu’il n’avait pu changer, c’était le son de sa voix, c’était aussi le regard profond et doux de ses yeux !… Et Julia venait d’être frappée par le son de cette voix, comme par un écho lointain de son amour et de ses remords… Soit imagination, soit réalité, elle croyait reconnaître dans ce regard la douceur spirituelle des yeux de l’homme qu’elle avait aimé…
De même que, en voyant Julia, le fantôme de Lucien venait d’apparaître à l’esprit de Roger, de même le fantôme de Roger apparut à l’esprit surexcité et malade de Julia.
Il avait fini de parler qu’elle l’écoutait encore et le considérait avec une anxiété indicible…
C’était bien la voix de Roger, mais le doute n’était pas permis, l’homme qu’elle avait en face d’elle n’était pas Roger.
Après quelques mots échangés de part et d’autre, la conversation s’engagea sur des banalités : on parla de l’Amérique et de la France ; puis tous sortirent, comme il faisait très beau, pour visiter les environs de la ferme, dont Pierre voulait faire les honneurs.
Suzanne marchait en avant avec eux, causant avec gaieté, vive, alerte et dans sa gaieté pourtant toujours sérieuse.
Laroque avait en tremblant offert son bras à Mme de Noirville, qui, en tremblant aussi, l’avait accepté.
D’abord, il y eut un silence entre eux, sans que l’un se doutât des préoccupations de l’autre, trop de souvenirs les obsédaient pour qu’ils gardassent l’esprit libre.
– Vous êtes né en Amérique, Monsieur ? dit Julia.
– Oui, Madame, au Canada.
– Vous n’avez pas, ou presque pas, l’accent anglais ?
– Beaucoup de Canadiens sont français – mon père était anglais, mais ma mère était née en France. Je connais les deux langues à fond, les ayant parlées très jeune.
– Vous avez, à ce que je vois, une prédilection pour la France ?…
– C’est vrai, je ne le cache pas…
– Pourquoi ?
– Affaire de tempérament… Et puis, je vous l’ai dit, je suis né au Canada, parmi des Français…
La conversation tomba. Ils avançaient sans rien dire, dans l’avenue des châtaigniers. Toujours, devant eux, était Suzanne avec les deux jeunes gens.
Julia admirait, malgré elle, malgré sa distraction, la taille gracieuse et souple de la jeune fille, sa démarche élégante, et de temps en temps on entendait le timbre cristallin de sa voix ; elle avait conservé un peu la note chantante de sa jolie voix de fillette.
– Vous avez une bien aimable fille, monsieur Farney, dit Julia, et je comprends quelle a dû être votre épouvante lorsqu’on vous l’a ramenée l’autre jour ensanglantée, évanouie.
Ce fut la porte ouverte aux confidences du père et de la mère.
Roger parla de Suzanne, Julia de Pierre et de Raymond.
Bientôt Roger se tut.
Mme de Noirville, seule, parla. Elle ne tarissait pas sur ses fils. Elle les adorait.
C’était, disait-elle, sa seule joie, sa seule consolation depuis la mort de son mari ; le seul bonheur enfin qui la retînt à la vie et l’empêchât de mourir…
Cependant le soleil baissait ; on revint à la ferme.
Quelques minutes après, Suzanne et Laroque prenaient congé et la légère voiture filait comme une flèche dans l’avenue.
Sur le seuil de Méridon, deux regards d’homme la suivirent au loin, jusqu’à ce qu’elle disparût ; deux poitrines d’homme se gonflèrent d’un soupir, quand elle ne fut plus visible, et deux fronts s’abaissèrent lentement vers la terre, comme accablés, tous les deux, par la même pensée.
CHAPITRE X
Le rétablissement de Suzanne fut prompt ; mais la jeune fille conserva sur sa physionomie une teinte de mélancolie qui inspira au père les plus vives appréhensions.
« Elle aime ! se disait-il. Je reconnais bien en elle tous les signes du sentiment nouveau qui agite son âme. Aimerait-elle l’un de ces Noirville ? Oh, l’horrible fatalité, si c’était vrai ! »
Déjà Laroque songeait à quitter Maison-Blanche, à fuir ce voisinage où le passé venait le relancer si cruellement. Il annonça son projet de départ à Suzanne. La pauvre enfant devint toute pâle.
– Sommes-nous donc condamnés, dit-elle, à errer sur cette terre comme les parias dont personne ne veut !
Ce fut au tour de Laroque à pâlir : ce mot « condamnés » venait de lui tenailler le cœur. Suzanne en avait trop dit : il semblait qu’elle faisait allusion à la terrible sentence des juges de Versailles. Mais bien vite l’enfant dissipa les affreux doutes du père. Avec sa câlinerie de fille aimante, elle passa ses mains autour du cou du vieillard, l’embrassa tendrement et lui glissa à l’oreille ces mots qui valaient un ultimatum :
– Je suis si bien ici !
– Eh bien, nous resterons, répondit Roger à la fois rassuré et vaincu.
Ses doutes lui revinrent bientôt et il résolut de hâter ses démarches pour en finir avec une situation qui d’un jour à l’autre pouvait redevenir sans issue.
Le lendemain, à une heure de l’après-midi, il sonnait à la porte de Guerrier, qui l’attendait et ouvrit aussitôt.
– Eh bien ? demanda-t-il. Le comte a parlé ?
– Pas encore ; mais je suis convaincu qu’il parlera samedi soir, au cours de la grande soirée.
– Qui te le fait croire ?
– Après avoir dressé avec lui ce matin la liste des invitations, il m’a dit : « Monsieur Margival vous a annoncé que j’avais une grave communication à vous faire. Veuillez attendre jusqu’à samedi soir ; mais qu’il vous suffise de savoir qu’il s’agit de votre bonheur. » De mon bonheur ! C’est Marie-Louise qui le détient dans ses beaux yeux et qui, j’espère, ne lui donnera pas la liberté de sitôt.
Roger sourit avec bonté.
– Montre-moi, dit-il, la liste de vos invités.
Jean lui tendit un carnet sur lequel près de trois cent cinquante noms étaient inscrits.
L’un de ces noms fit pousser un ah ! au père de Suzanne.
– Le baron de Cé ! s’écria-t-il. Le baron de Cé ! Mais je le connais.
C’est ce baron que j’ai rencontré au cercle dans la nuit qui a précédé le jour fatal. Il s’est assis auprès de moi à la table de jeu, et je vois encore sa longue tête de gentilhomme usé par les veilles et les émotions du tapis vert ! Je tiens à reconstituer la société plus ou moins honorable qui se trouvait présente à ce cercle, durant la nuit où j’ai éprouvé toutes les angoisses de la perte d’un argent sacré et les mauvaises joies de la veine. Les billets de banque tachés d’encre me venaient-ils de cet endroit maudit ou… ?
Roger s’interrompit. Il ne pouvait pas plus confesser à Guerrier qu’à ses juges l’affreux secret des cent mille francs prêtés à une femme et restitués le lendemain du jour où Larouette était tombé sous les coups d’un assassin.
– Peux-tu m’adresser une lettre d’invitation ? dit-il.
– Parfaitement, et je vous présenterai même à monsieur et madame de Terrenoire comme étant un riche Américain dont j’aurai fait la connaissance ces temps derniers et qui se trouvera très honoré d’avoir l’accès d’un salon parisien.
– Très bien. Je verrai ce baron de Cé et j’observerai la comtesse.
– N’allez-vous pas vous compromettre inutilement ?
« Mon avis est que vous feriez mieux d’aller trouver Tristot et Pivolot, ces policiers amateurs, que vous avez eu le malheur de connaître. Ce sont d’honnêtes gens. Ils ne vous trahiront pas. N’ayant point d’avancement à convoiter dans l’administration, travaillant selon leur bon plaisir, en hommes libres, ils verront dans votre démarche toute spontanée la preuve de votre innocence. Vous les verrez se mettre à la besogne sans aucun retard, et si ces deux compères-là ne découvrent rien, il ne vous restera plus qu’à quitter la France et à renoncer à ce travail d’hercule où vous risquez de succomber. Tristot et Pivolot habitent rue de Douai, tout près d’ici.
– J’irai, dit Laroque, mais lorsque ton bonheur sera assuré.
« Quelque chose me dit que la soirée de samedi m’apprendra du nouveau. Il n’y a pas de jour, hélas ! où je ne croie trouver la piste !
CHAPITRE XI
C’était une cohue – mais brillante et parée merveilleusement – qui se pressait, le samedi suivant, dans les salons, le jardin, les serres et sur la terrasse de l’hôtel de M. de Terrenoire, rue de Chanaleilles.
M. de Terrenoire s’était réservé, pour sa femme, sa fille et ses intimes amis, une petite serre en salon, où les fleurs, les larges et robustes feuilles des plantes tropicales, alternant avec des tapisseries orientales, formaient l’effet le plus inattendu et le plus pittoresque et faisaient de cette serre un réduit frais où l’on se reposait de la fatigue de la foule ou de l’étouffante chaleur du bal.
C’était là que venait de temps en temps Mme de Terrenoire, une grande femme mince et élégante, d’une beauté dure et étrange, au visage d’un ton de bistre clair pareil à celui d’une Arabe, aux yeux noirs énormes, sombres et pleins d’éclairs. Elle était âgée de trente-cinq ans.
Là se trouvait également, Diane, sa fille, brune comme elle, mais plus douce, d’allure moins tragique ainsi que le comte de Mussidan, l’associé de Terrenoire, son ami, grand viveur, ne parvenant pas à dépenser les revenus d’une colossale fortune ; d’une distinction rare, mais presque toujours attristé par quelque préoccupation secrète.
Terrenoire venait d’entrer dans la serre, riant, épanoui, heureux du bonheur des autres.
– Ah ! dit-il, apercevant sa femme, Diane et le comte de Mussidan, je suis content de vous trouver. Dans cette foule, ma parole, ce n’est pas chose facile de se rencontrer.
– Tu dois être satisfait, dit Mussidan, on a répondu à ta fête avec empressement !
– Oui, oui et ce qui est mieux, c’est qu’on s’amuse. Mais ce n’est pas pour me reposer que je suis venu, ma foi non. J’ai deux nouvelles à vous apprendre qui vous intéressent.
– Deux nouvelles ?
– Oui. Devinez donc un peu à quoi je m’occupe depuis une heure… je vous le donne en cent mille !…
Diane alla se pendre à son bras, et doucement :
– Mon père, ne nous fais pas languir !
– Eh ! eh ! chère petite impatiente… on dirait que tu n’es pas loin de deviner, toi ? Est-ce que par hasard tu m’aurais vu causer avec Robert de Vaunoise ?…
Diane rougit et détourna les yeux.
– Nous ne devinerons pas, mon ami, fit Mme de Terrenoire… ni monsieur de Mussidan, ni moi. Parle donc !… Deux nouvelles ?… De quoi s’agit-il ?
– De deux mariages ! ! !
– Deux mariages ! fit Mussidan.
– Oui, et à peu près conclus, par moi, ce soir même.
Et Terrenoire ajouta, avec une intonation comique :
– Voilà à quoi je passe mon temps quand je donne une fête japonaise !
Chose bizarre et que le banquier ne remarqua point, ses paroles causèrent plus d’inquiétude que d’étonnement.
Alors que Diane, qui devinait qu’il allait être question d’elle, rougissait de plus en plus – mais ne cherchait pas à dissimuler la joie qui éclatait dans ses yeux – Mme de Terrenoire s’était soudain troublée ; sur son regard sombre les paupières s’étaient abaissées lourdement. Quant à Mussidan, il avait pâli, et un pli profond, creusant son front, avait accentué la tristesse de son visage.
– Deux mariages – reprit Terrenoire – et l’un des deux ne surprendra pas ma femme, car il en a déjà été question entre nous. Je suis presque résolu à donner ma fille – ma petite Diane – à monsieur de Vaunoise.
– Oh ! mon père ! dit la jeune fille, que tu es bon !
– Parce que je fais ce que tu veux, n’est-ce pas ? Ma femme, je le sais, n’a pas d’objections, mais j’étais heureux d’en parler à Mussidan. Eh bien ; qu’en penses-tu cher ami ? Est-ce que cela te contrarie ? Te voilà tout ému ! Tu as ta figure des mauvais jours !
Le banquier se mit à rire. Et il tendit les mains au viveur. Celui-ci répondit froidement à l’étreinte que Terrenoire sollicitait. Sa bouche resta triste et son front ridé.
– Est-ce que ce mariage te déplairait, par hasard ? fit le banquier ; aurais-tu quelque chose à dire contre monsieur de Vaunoise ? Ne te gêne pas. Il n’est pas très riche, je le sais, mais il est d’excellente famille et charmant garçon, enjoué, brave et loyal. Enfin, parle ; je n’en suis pas plus entiché que cela, après tout !… Et si Diane ne l’aimait pas, il n’en serait plus question !…
– Mais je l’aime, mon père, je l’aime.
– Tu vois, Mussidan, je ne le lui ai pas fait dire.
Le comte détournait toujours les yeux.
– Je n’ai pas d’objections, dit-il avec effort. Tu sais que je m’étais habitué à considérer… Diane… ta fille… un peu comme mon enfant !… L’annonce aussi brusque d’un projet qui engage son avenir a bien pu m’étonner… Mais tu as pris tes renseignements, sans doute… et puisque ce jeune homme te convient, puisqu’il a le bonheur d’être aimé de Diane… eh bien, mon ami, ce doit être chose conclue…
– Comme tu me dis cela !
– Veux-tu savoir la vérité vraie ?
– Parbleu ! c’est à celle-là que je tiens…
Mussidan eut un rire nerveux que démentait la pâleur profonde de son visage.
– Je suis jaloux ! dit-il, jaloux de ce titre de père qui te donne le droit de disposer de la vie de Diane en dernier ressort et selon ton bon plaisir !
Mme de Terrenoire avait fait un brusque mouvement. Son brun visage d’Arabe avait pris une couleur terreuse, et elle mâchait à pleines dents une rose qu’elle avait arrachée à son corsage.
Le banquier n’avait sans doute aucune raison de remarquer cette mimique singulière, car il répliqua avec un bon et franc sourire :
– Je sais que tu as beaucoup d’affection pour ma fille. Je ne t’empêche donc pas d’être jaloux de moi.
Il se tourna vers Diane :
– Il y a beaucoup de pauvres petits abandonnés qui n’ont jamais connu ni leur père ni leur mère… Toi, mon enfant, tu ne te plaindras pas du sort, tu as deux pères. Mussidan et moi… Dis-lui que s’il est jaloux de moi, parce que je t’adore, je n’ai, moi, jamais été jaloux de lui parce qu’il t’aime !
Mme de Terrenoire – qui semblait remise de son émotion – s’était penchée vers Mussidan :
– À quoi pensez-vous donc ? dit-elle d’une voix basse, mais brève et impérieuse. Êtes-vous devenu fou ?
Lui ne parut pas entendre et resta songeur.
Tout à coup, le banquier les laissa, et, ouvrant la porte, fit signe à un groupe qui passait, duquel il fut suivi et avec lequel il resta dans la serre.
Il y avait deux hommes et une jeune fille.
Diane vint à celle-ci et lui serra la main.
Elles étaient aussi jolies l’une que l’autre, mais leur genre de beauté formait un frappant contraste.
La nouvelle venue, Marie-Louise Margival, était de taille moyenne, frêle et d’un blond ardent. Ses grands yeux d’un bleu profond semblaient appuyer le regard, et ce regard était d’une douceur infinie.
Elles avaient le même âge : dix-huit ans.
Ainsi, l’une auprès de l’autre, elles offraient un charmant tableau.
Diane, brune comme sa mère, avait une robe japonaise de satin rouge brodé d’or, avec une coiffure pareille à une aigrette de fée, faite de plumes de paon disposées en éventail. Dans les cheveux une masse d’épingles d’or étaient piquées, semblables à des libellules.
Marie-Louise, elle, était en toilette Lamballe de bengaline rose. La redingote était décolletée à la Watteau, ourlée tout autour de guirlandes de roses sans feuilles et ouverte sur une jupe courte de dentelle.
Le premier des deux hommes qui venaient d’entrer avec Terrenoire était Margival, un vieillard à la tête caractéristique, au teint rose, aux yeux bleus.
L’autre, c’était Jean Guerrier.
En entrant, il avait à son bras Marie-Louise, mais il l’avait laissée avec Diane pour aller saluer Mme de Terrenoire.
Il le fit froidement, échangea avec elle quelques paroles de banale politesse et la quitta aussitôt pour revenir à Terrenoire et à Margival, qui causaient.
Mme de Terrenoire se mordit les lèvres. Son visage sembla devenir plus dur, et son regard se fit plus sombre. Elle quitta le divan bas où elle était à demi étendue et rejoignit Diane et Marie-Louise.
Cependant, le banquier, qui s’était interrompu, tout à l’heure, reprenait la conversation où il l’avait laissée.
– J’avais à vous apprendre deux nouvelles – deux mariages –, reprit-il, et justement les intéressés sont ici. Cela tombe bien. Primo, mon ami et mon associé Mussidan et ma femme n’y faisant pas d’objections, une fois, deux fois, c’est entendu, Diane sera fiancée à monsieur de Vaunoise ; secundo, j’espère que le mariage suivra de près celui de mon caissier Jean Guerrier avec la fille de mon vieux Margival.
La pâleur du visage de Mme de Terrenoire venait de s’accentuer tout à coup par la blancheur des lèvres, d’où le sang s’était retiré. Ses yeux flamboyèrent une seconde en se dirigeant sur Guerrier. Et ce fut tout. Le visage reprit son masque de dureté et d’orgueil.
Marie-Louise avait tendu la main à Guerrier, et cette main, le jeune homme l’avait respectueusement et tendrement portée à ses lèvres.
– Monsieur de Terrenoire, dit-il avec simplicité – mais, à sa voix qui tremblait, on devinait son émotion – je vous dois tout – non seulement ce que je suis, mais ce que je vais être, ajouta-t-il en regardant Marie-Louise.
– Brave enfant ! murmura le banquier.
Et son regard, complaisamment, se reposait sur Diane, sur Marie-Louise et sur le caissier.
Et il eût fallu l’observer bien attentivement pour voir avec quelle singulière tendresse ce regard s’arrêtait sur la douce figure de Marie-Louise !
CHAPITRE XII
Terrenoire, Margival et Guerrier s’en étaient allés d’un autre côté et Mme de Terrenoire était restée seule, une minute, avec le comte, dans la serre.
Le comte ne paraissait point s’apercevoir de cette solitude. Il rêvait, les yeux baissés, toujours sombre.
Andréa lui toucha l’épaule du bout du doigt.
Il releva la tête.
– Quelle mouche vous pique, fit-elle avec dureté, de parler comme vous l’avez fait tout à l’heure ?
– J’ai dit ce que je ressentais. Je suis jaloux !
Elle haussa les épaules… Son regard était cruel.
– Vous avez failli me perdre de gaieté de cœur. Je ne vous reconnais plus. Un mot encore, et les soupçons surgissaient à l’esprit de mon mari ! Il apprenait que Diane n’est point sa fille !… Quelle révélation ! J’étais perdue ! Et pourquoi, s’il vous plaît ?
– Vous avez raison. Pardonnez-moi ! Mais est-ce bien ma faute, et ne suis-je pas le seul à plaindre ? Non. Je ne mentais pas en disant que je suis jaloux de Terrenoire, jaloux à en être malade, jaloux à concevoir et à désirer une catastrophe qui me rende mon libre arbitre et la disposition de ma volonté !… et d’avoir au moins le droit d’occuper une petite place dans le cœur de ma fille !…
– Vous souffrez, je le vois, dit Andréa. Vous ne m’aviez jamais ouvert aussi franchement votre âme… Je comprends vos tristesses, mais je ne vous plains pas et faut-il vous rappeler cette histoire d’il y a dix-huit ans ? Auriez-vous la mémoire si courte, Grégoire ? Dix-huit ans, après un tel drame, qu’est-ce donc dans une vie que ce drame a failli briser ?
– Je sais que j’ai été coupable, Andréa.
– Oui, de nous deux, c’est vous qui êtes obligé de rougir devant moi. J’avais seize ans quand je vous connus. Vous étiez séduisant et dangereux. Je ne vis pas le danger et je fus séduite. Quand je m’aperçus que j’étais enceinte, je vous le dis. Le lendemain, lâche, vous aviez quitté la France !… Quand vous revîntes, j’étais mariée à monsieur de Terrenoire – qui avait demandé ma main avant votre départ – et qui ne sut jamais rien de notre secret. Vous êtes devenu son ami et son associé. J’ai souffert votre présence, parce que j’ai eu pitié de votre repentir – et parce que j’ai vu votre cœur se fondre devant la fillette qui vous apparut sur les bras de sa nourrice – et que vous saviez bien être votre fille. Vous l’avez vue grandir, cette enfant, en gentillesse, en esprit, en grâces. Et votre supplice a été de ne pouvoir lui révéler que vous êtes son père ! Je ne vous plains pas, je le répète. C’est le châtiment de votre lâcheté.
– Tout ce que vous dites est vrai…, fit-il d’une voix étouffée ; mais je souffre, je souffre !
Elle le considéra silencieusement, puis, sans ajouter un mot, elle le laissa – brisé et pâle.
CHAPITRE XIII
Jean Guerrier s’inquiétait de ne pas voir arriver William Farney à qui il avait tant de choses heureuses à annoncer. Enfin la voix vibrante du domestique chargé d’annoncer les visiteurs prononça ce nom qu’il lui tardait d’entendre. Il avait hâte de se trouver seul avec cet infortuné pour lui apporter la consolation de son propre bonheur ! Il savait que Laroque n’était pas de ces gens qui confinent l’univers dans leur personnalité et ne trouvent pas le temps de se refaire du bonheur des autres alors qu’ils sont frappés par la fatalité.
– Monsieur William Farney !
Le comte accueillit avec sa cordialité habituelle l’Américain, dont la physionomie ne lui rappela aucun souvenir. La comtesse se montra plus froide. Elle regarda tour à tour les visages de ces deux hommes, et elle parut se demander quel lien mystérieux pouvait les unir dans cette soirée fatale.
Pour détourner tous les soupçons, Guerrier quitta immédiatement son ami, Marie-Louise lui devait encore une valse, et déjà l’orchestre préludait le Beau Danube de Strauss.
William Farney fit le tour des salons, cherchant partout le baron de Cé. Il tenait à bien préciser dans sa mémoire le signalement du gentilhomme afin de le donner à Tristot et Pivolot. Par M. de Cé, les deux limiers arriveraient peut-être à retrouver tous les anciens membres du cercle où Laroque avait joué.
Roger se fatigua en vaines recherches : le baron de Cé n’était pas venu. Ce gentilhomme avait sans doute un meilleur emploi de sa nuit. Il devait achever de se ruiner dans quelque maison de jeu.
CHAPITRE XIV
Guerrier, tout ému d’avoir senti battre sur sa poitrine le cœur de Marie-Louise, cherchait l’isolement pour se remettre. Il venait d’entrer dans un salon où personne ne se trouvait, lorsque, soudain, une main de femme se posa sur son épaule.
C’était la comtesse de Terrenoire.
– Vous êtes heureux, monsieur Guerrier ? dit-elle avec un mauvais sourire. Le bonheur d’aimer et d’être aimé rend égoïste, n’est-ce pas ? Et vous avez besoin de vous retrouver seul pour jouir solitairement de ce bonheur ?
Il balbutia quelques mots, gêné et glacé.
– Accompagnez-moi dans le jardin. On étouffe vraiment dans les salons. Là, nous causerons mieux.
Jean s’inclinait. Mme de Terrenoire prit son bras.
On commençait alors le cotillon, conduit par un garçon nommé Luversan dont personne n’eût pu préciser l’âge et dont les moyens d’existence mystérieux n’empêchaient pas les succès de salon.
Andréa et Jean Guerrier étaient dans le jardin – et échangeaient à voix basse quelques mots rapides.
Tout d’abord, ils avaient gardé le silence, sans doute parce que ni l’un ni l’autre ne voulait entamer une conversation que tous deux redoutaient.
Ce fut Mme de Terrenoire qui s’y décida.
– Mademoiselle Marie-Louise est une personne charmante et bien élevée – dit-elle – elle sera, certes, une femme parfaite. Recevez mes compliments, monsieur Guerrier.
– Je suis, en effet, très heureux, Madame, dit le jeune homme avec franchise, le regard planté droit dans celui de Mme de Terrenoire.
– Je ne sais pas mentir, dit-elle, et je ne mentirai pas plus longtemps. La nouvelle de votre mariage m’a fait un mal affreux. Vous l’avez vu, sans doute, et vous avez deviné pourquoi ?…
« Votre mariage n’aura pas lieu, monsieur Guerrier. Je ne le veux pas. Je n’ai point d’antipathie contre Marie-Louise et je n’en aurai point tant qu’elle ne sera pas votre femme… Jamais je ne vous eusse parlé de la sorte si ce mariage n’avait pas été résolu ! Jamais je ne vous eusse avoué aussi franchement les sentiments que j’éprouve pour vous et que vous avez devinés de longue date, si vous n’aviez pas semblé, par indifférence ou par diplomatie, vous jouer de moi au point d’aimer devant moi !… Ne vous retranchez pas, surtout, derrière je ne sais quelle reconnaissance que vous devez à mon mari… Puisque votre vertu était à l’épreuve et puisque j’étais une tentatrice contre laquelle vous deviez vous défendre, vous n’aviez qu’un parti à prendre : quitter notre maison, vous éloigner… Mais vous vous étiez aperçu que je vous aimais et vous aviez prévu que cet amour, en vous protégeant auprès de M. de Terrenoire, vous rendrait des services et améliorerait votre situation… Vous êtes resté… Je vous aimais toujours… je vous le laissai voir… Alors, comme vous n’aviez plus besoin de moi, vous vous êtes indigné à la pensée que vous tromperiez votre bienfaiteur !… Soit, Monsieur… soyez reconnaissant… à votre manière… mais ne soyez pas étonné si j’en garde quelque rancune !… Ou vous quitterez la maison de mon mari, ou votre mariage n’aura pas lieu !… Je suis prête à haïr comme j’étais prête à aimer… comme j’aimais… Choisissez… et prenez garde !…
Il quitta le bras de la jeune femme brusquement. Un combat visible se livrait en lui. Il fit quelques pas pour s’éloigner, pâle, les dents serrées.
Elle le regardait, l’œil mauvais et plein de menaces.
– Vous fuyez, dit-elle. C’est plus facile que de se défendre.
Ce mot le fit revenir.
– Je ne veux pas me défendre, en effet, dit-il attristé. Cela serait indigne de moi. Et si je m’éloigne, c’est que rien ne m’oblige à entendre plus longtemps vos insinuations, qui sont autant d’insultes.
Elle haussa les épaules avec mépris.
– Osez donc me dire là, bien en face, que je n’ai pas deviné votre jeu et que je me suis trompée ?
Il y eut un moment de silence.
– Je vous le jure, Madame, dit Guerrier d’une voix ferme avec un regard franc, je vous jure par tout ce que j’ai de plus sacré au monde, par cette jeune fille que j’aime et que je vais épouser !… Lorsque je suis entré chez monsieur de Terrenoire, je fus très longtemps, non seulement sans vous connaître, mais sans même vous apercevoir. La banque est boulevard Haussmann, et jamais, que je sache, vous n’y avez mis les pieds. L’intérêt que me portait votre mari me fit monter rapidement en grade. Je fus reçu dans votre maison, et si je m’aperçus, au bout d’un certain temps, qu’il y avait dans votre conduite à mon égard beaucoup de bienveillance, je crus que vous receviez l’influence de l’affection que j’avais eu le bonheur d’inspirer à monsieur de Terrenoire. Telle est la vérité. Bientôt, cependant, à la tendresse de vos regards, à vos allusions, à vos demi-mots, que j’essayais vainement de ne pas comprendre, je devinai que vous éprouviez pour moi un sentiment plus vif que celui d’une simple amitié. Passons sur la scène de vos aveux dont le souvenir me sera toujours pénible. Déjà j’aimais Marie-Louise ; si je ne vous avouai point le mariage projeté, c’est que je connaissais la violence de votre caractère et que je craignais vos entreprises contre ma fiancée, que n’eût pas protégée peut-être l’affection paternelle de monsieur de Terrenoire. Aujourd’hui, je ne crains plus rien, puisque Marie-Louise va être ma femme. Pourquoi n’avez-vous pas ajouté foi à mes paroles, lorsque je vous fis comprendre quel grand crime je commettrais si j’abusais du moment de faiblesse et d’égarement de votre cœur pour tromper l’homme auquel je dois tout ? Vous parlez de calcul, c’est infâme ! Ce serait odieux, mais vous n’y croyez pas… Je me suis éloigné de vous du jour où l’horrible secret tomba de vos lèvres… J’espérais que vous vous repentiriez, que vous oublieriez votre folie. Et c’est vous maintenant qui m’accusez d’une bassesse, quand vous devriez, tout au contraire, reconnaître que j’ai agi en honnête homme. Vous le voyez, Madame, je me défends. Il est possible que vous me haïssiez. Mais la haine n’empêche pas l’estime. Et c’est à votre estime que je tiens !
– Oui, certes, je vous hais ! dit-elle sourdement. Je vous le répète : ou votre mariage n’aura pas lieu, ou bien vous quitterez la maison de mon mari. À quel parti vous arrêtez-vous ?
– Ni à l’un ni à l’autre, Madame.
– Vous me bravez !
– J’aime Marie-Louise, et mon plus ardent désir est de l’épouser. Monsieur de Terrenoire et monsieur Margival sont d’accord pour me l’offrir. Je suis trop heureux. Quant à quitter la banque, je ne le peux… et j’ai pour cela plusieurs raisons… Il faudrait expliquer à mon bienfaiteur les motifs de mon départ. Je n’en trouverais pas. Ensuite, partir serait vous céder, Madame, sur le seul point où, vis-à-vis de moi-même, mon honneur est en jeu… Partir serait reconnaître que vous avez eu raison de m’accuser de froid et vil et infâme calcul lorsque je repoussais votre amour ! Je ne partirai pas !…
– C’est donc la guerre entre nous ?
– Si vous le voulez !
Elle retint un geste de fureur. Son visage était contracté et ses lèvres entrouvertes, serrées, aiguës.
– Peut-être vous repentirez-vous.
– Jamais ! Ce que je fais, c’est mon devoir de le faire. Puis-je regretter un jour d’avoir accompli mon devoir ?
– Peut-être… quand vous verrez autour de vous gémir ceux qui vous sont chers !…
Il tressaillit. Elle avait dit cela avec tant de haine qu’il eut soudain une vague vision d’un avenir cruel – de malheurs prochains.
Ils revenaient maintenant vers les salons. Ils marchaient toujours lentement, comme alourdis par cette scène pénible.
Elle dégagea son bras pour rentrer seule – mais, avant de quitter Jean Guerrier, elle dit :
– J’attendrai, pour vous pardonner, jusqu’à votre mariage. Ce mariage consommé, je ne vous pardonnerai plus.
Jean s’inclina sans parler.
Il avait le cœur serré par un sinistre pressentiment.
Andréa s’était de nouveau mêlée à la foule. La fièvre animait ses joues de lueurs inaccoutumées. Ses yeux avaient l’éclat de deux diamants noirs dans lesquels se joue la lumière. La haine, la passion l’animaient. Elle était plus belle que jamais, plus désirable, plus provocante.
Un homme s’effaça devant elle – la tête baissée – avec un regard qui l’implorait.
Elle s’arrêta, hésita une seconde, puis :
– Monsieur de Luversan, ne vous ai-je pas promis une valse ?
Il balbutia quelques mots. Elle prit son bras, l’entraîna, et à voix basse :
– Monsieur de Luversan, vous m’aimez ?
– Comme un fou ! dit-il en chancelant.
– Et vous seriez capable de tout pour me plaire ?
– De tout…
– Même d’un crime ?
– Même d’un crime !
– Eh bien, espérez !…
Ce dernier mot fut entendu d’un homme qui depuis près d’une demi-heure observait le manège d’Andréa ; cet homme était William Farney.
Quand il sortit de l’hôtel et monta dans sa voiture avec Jean :
– Mon ami, lui dit-il, je sais tout ce que vous allez me raconter : vous êtes, n’est-ce pas, l’homme le plus heureux qui ait jamais foulé du pied la surface du globe. Eh bien, prenez garde que ce bonheur ne soit détruit par une femme…
– La comtesse ?
– Oui, la comtesse… Prenez garde aussi au complice de cette femme.
– Le complice ? Mais qui donc ?
– Ce Luversan, dont j’ai déjà vu quelque part le sinistre visage, ce bellâtre qui m’a tout l’air d’un aventurier. Mais au fait, son nom n’était pas inscrit sur la liste de vos invités.
Jean rassembla ses souvenirs.
– Vous avez raison, dit-il, je n’ai pas envoyé de lettre au nom de Luversan.
– La comtesse aura pris soin de le prévenir elle-même. Allons, voici encore un homme qu’il me faudra signaler à Tristot et Pivolot dès que tu seras l’heureux époux de mademoiselle Margival.
CHAPITRE XV
À Maison-Blanche, Suzanne ne sortait guère pour se promener et faire des courses dans les environs, soit qu’elle fût à pied, à cheval, ou qu’elle eût fait atteler la petite charette qu’elle conduisait elle-même, sans rencontrer Raymond.
On eût dit qu’il y avait entente entre eux, à voir la régularité avec laquelle ils se rencontraient et Raymond rentrait à la ferme avec du bonheur pour toute la journée.
L’amour chez les deux frères, s’était déclaré d’un coup très impérieux, mais ils ne s’étaient jamais fait aucune confidence et, s’ils soupçonnaient leur rivalité, c’était l’instinct seul qui les avait mis sur leurs gardes.
Ils ne sortaient plus ensemble ; ils se fuyaient ; chacun recherchant la solitude, parce qu’il espérait y évoquer plus facilement l’image de la jeune fille ; et chaque fois que leur imagination la faisait ainsi revivre à leur rêve, ils la revoyaient près de la fontaine, étendue dans les grandes herbes blanches, pâle comme une morte, les cheveux dénoués et le sang coulant d’un grand trou dans le crâne.
L’image des deux frères flottait aussi dans les nuits de Suzanne ; ils avaient pris place, malgré elle, en sa vie.
Avant de les connaître, elle ne pensait à rien.
Elle savait bien qu’elle était jolie et capable d’inspirer des passions, mais elle avait fui, avec une sorte de frayeur, toutes les occasions mondaines où elle eût risqué de voir s’ouvrir, auprès d’elle, et s’attacher, du côté gauche à son corsage, la douce fleur d’amour.
Parfois, son père lui avait dit :
– Tu ne songes pas au ménage, ma chérie ?
– Non, père.
– Pourquoi ?… Tu seras bientôt en âge de te marier… Tu es très belle – tu ne serais pas femme si tu ne le savais pas – et, ce qui ne gâte rien, tu seras très riche, car je ne suivrai pas la coutume américaine qui est de ne point doter les filles… Je te doterai… Je te permets donc de songer au mariage…
– Je ne tiens pas à me marier…
– Encore une fois, tu as une raison ?
– Je ne veux pas vous quitter…
– Ma pauvre enfant, ce que tu me dis là me rend bien heureux : mais, va, ne prends pas d’engagement pour l’avenir, car – la vie est ainsi –, du premier amour qui te prendra au cœur, ton père n’y occupera plus qu’une toute petite place, et tu le quitteras, sans remords.
– Alors, mon père, éloignez de moi les occasions.
– Non, c’est la destinée. Et je n’en ai pas le droit. Une créature aussi parfaite que tu l’es est destinée par Dieu à faire le bonheur d’une autre créature, un homme. Je n’ai pas le droit de m’opposer à ce qui sera le bonheur de cet homme. Seulement, je le veux parfait aussi, parce que je te veux heureuse. Et c’est pourquoi ne tremble pas de me prendre pour confident, ma chérie, lorsque tu te sentiras au cœur un trouble, une émotion qui te surprendra et te rendra inquiète. Je suis ton père et ton ami, ne l’oublie pas.
Elle sourit et tendit son front à Laroque.
– Pour le moment, je n’ai rien à vous dire, mon père… et si je dois vous quitter en me mariant, je mourrai vieille fille…
Il ne répondit rien, hocha doucement la tête et la laissa.
Or, elle y pensait depuis quelques jours à cette conversation ; elle y pensait depuis, justement, qu’elle ressentait, en son âme, je ne sais quelle vague inquiétude ; depuis qu’elle rêvait pendant des heures entières à des riens ; depuis qu’elle se sentait triste, parfois, à mourir, quand elle se retrouvait seule après une promenade où elle avait vu Raymond.
Le matin, quand elle sortait, et qu’elle laissait son cheval s’en aller au pas, dans les petits sentiers des bois, dont les branches chargées de la rosée matinale, lui jetaient, en l’effleurant, des frissons dans le cou, elle regardait, aussi loin qu’elle pouvait voir, en se disant :
« Le verrai-je aujourd’hui ? »
Et quand elle l’apercevait tout à coup, arrivant de son côté, le fusil sur l’épaule, rêveur et ne chassant pas, elle arrêtait brusquement son cheval et elle avait envie de s’enfuir.
Et, certes, elle aurait fui, en cravachant sa monture, pour s’éloigner au plus vite, mais – le voyait-elle vraiment ou bien était-ce son cœur qui parlait ? – il lui semblait que le visage de Raymond reflétait une si grande tristesse, un si profond désespoir qu’elle ne s’enfuyait pas.
Et elle en était chaque fois récompensée par l’expression radieuse du visage de Raymond…, par l’expression presque divine de reconnaissance, de dévouement et d’amour qu’elle lisait dans ses yeux.
Alors, ils venaient l’un à l’autre, tous deux tremblants, aussi timides, aussi réservés l’un que l’autre, ils se séparaient presque aussitôt après quelques mots, et c’était du bonheur pour le reste de la journée.
CHAPITRE XVI
Depuis l’accident où elle avait failli trouver la mort, Suzanne n’était pas retournée aux ruines ; c’était de préférence dans la vallée des Vaux-de-Cernay qu’elle allait chercher ses paysages.
Elle aimait le contraste et avait une prédilection pour ce pays sauvage.
Elle s’y trouvait par une radieuse et chaude après-midi des premiers jours d’octobre ; la nature était éclatante de couleur et de lumière ; les feuilles des arbres commençaient à jaunir.
Elle s’était assise à l’ombre, contre un rocher.
Un engourdissement la prit ; elle laissa tomber son pinceau, sa palette ; elle appuya la tête dans un angle de la pierre, et, un sourire sur les lèvres, elle s’endormit.
Raymond savait qu’il la trouverait là, elle le lui avait dit la veille, car déjà, malgré sa prudence, elle ne pouvait plus dissimuler le plaisir qu’elle éprouvait à revoir le jeune homme ; elle se sentait dans les veines comme un sang plus abondant, plus chaud et plus vivace ; elle avait plus de bonheur à vivre et elle s’abandonnait sans y réfléchir encore à cette nouvelle vie, à ce bonheur charmant et nouveau.
Raymond vint et eut de la peine à la trouver.
Quand il comprit qu’elle dormait, il s’approcha doucement. Il était très pâle. Son cœur battait à le faire souffrir.
Quant à Suzanne, elle souriait toujours, rêvant, sans doute.
Il s’arrêta lorsqu’il fut à deux pas d’elle. Et, pendant longtemps, silencieusement, n’osant plus faire un mouvement, il l’admira, puis il alla, très doucement, avec d’infinies précautions, s’accouder à la roche qui servait d’oreiller à la jeune fille. Et là, souriant lui-même, il continua de regarder.
Puis, bientôt, le sourire s’effaça, Raymond se mit à genoux, très près, regardant, admirant.
Mais son pied avait heurté une pierre et fait un léger bruit.
Suzanne avait remué les doigts ; ses paupières, sans s’ouvrir, s’étaient agitées… et ce qu’il ne vit pas, c’est qu’elles s’entrouvraient légèrement, juste de quoi laisser percer le regard, à travers la longueur des cils.
Elle était réveillée et elle voyait Raymond. Et elle éprouvait une douceur infinie à se laisser admirer ainsi… si chaste qu’elle ne pouvait soupçonner le danger… restée enfant dans le fond de son âme.
Elle l’admirait aussi…
Cette figure honnête, loyale, respirait tant d’amour !… Elle devinait dans ces yeux noirs qui l’enveloppaient de leur ardeur, tant de tendresse !… Mais voilà qu’elle ferme les yeux tout à fait pour ne plus voir, pour faire la nuit autour d’elle… ce qu’elle voudrait…
Raymond s’est encore rapproché… Et il s’est penché sur son visage… une seconde, elle a senti sur ses yeux et son front et ses cheveux l’haleine du jeune homme.
Elle a peur… tout son sang reflue vers son cœur… Puis, sans voir, toujours, elle a senti quelque chose de brûlant et de frais qui effleurait les frisures folles de ses blonds cheveux…
N’y tenant plus, Raymond l’avait embrassée furtivement. Et elle avait entendu ces mots, infiniment plus caressants que le baiser.
– Oh ! Suzanne, que je vous aime !…
Puis, comme évanouie, elle était restée sans forces. Et elle n’avait plus rien vu, en rouvrant les yeux…
Raymond s’était enfui, éperdu, la tête en feu…
Cela avait remué son âme.
Elle s’était sentie tout autre… Elle avait vu plus clair en elle-même, et ce baiser la bouleversait.
Elle se leva, agitée par un invincible effroi. Et elle passa lentement, par un geste machinal, la main sur son front, comme si ce simple geste eût pu effacer la trace des lèvres du jeune homme.
« Mon Dieu ! mon Dieu ! » se disait-elle, ayant envie de prier, comme si elle s’était vue à l’approche d’un danger, ayant laissé venir l’amour, parce qu’elle ne se doutait pas de ce que c’était qu’aimer, et épouvantée, maintenant que l’amour était venu.
Toujours sa main essuyait son front, et elle répétait :
– Non, non, je ne veux pas…
Et sans doute quelque vision douloureuse se dressait devant elle, car elle murmurait encore :
– Il m’aime… mais moi, je ne veux pas l’aimer… non, je ne l’aimerai pas, ni lui ni un autre… Cela est impossible… cela ne m’est pas permis… Ni lui ni un autre, jamais !…
Elle se mit à marcher dans les roches, presque courant, essayant de reconquérir son sang-froid et n’y parvenant pas.
Elle voulut se remettre à son tableau, mais, en l’état d’extrême surexcitation nerveuse où elle se trouvait, ce fut en vain…
Alors, elle plia son chevalet et revint au hameau, où, en passant, elle avait laissé son cheval. Un quart d’heure de galop effréné – car voulant s’étourdir, elle aurait voulu ne plus penser – et elle fut à Maison-Blanche.
Son père devina tout de suite que quelque chose s’était passé.
– Qu’as-tu donc, mon enfant ? demanda-t-il.
– Rien, dit-elle d’une voix sourde.
Le lendemain, elle eût bien désiré ne pas sortir encore, mais elle eût inquiété son père qui l’observait. Ils firent ensemble une promenade en voiture.
En rentrant, ils trouvèrent devant la grille la voiture de Méridon. Au château, Mme de Noirville les attendait et venait rendre à Roger sa visite. Raymond et Pierre l’accompagnaient.
Suzanne fut très froide pour Raymond, presque dédaigneuse. Le jeune homme s’en aperçut bien vite et se troubla. Une douleur aiguë se peignit sur son visage. Sa pâleur ordinaire s’était accentuée. Ses yeux, devenus suppliants, interrogeaient Suzanne. Mais celle-ci demeura impénétrable.
Et Raymond se disait :
« Elle s’est réveillée au moment où j’ai effleuré ses cheveux, elle s’est offensée… Elle me méprise… Je suis perdu… »
Profitant d’une seconde où il la voyait seule sur la terrasse, il s’approcha d’elle vivement et, très bas, des larmes dans la voix :
– Mademoiselle Suzanne, je vous demande pardon, dit-il.
Le cœur de la jeune fille s’effondra, pour ainsi dire. Cette voix était si douce !… Un instant, elle eut envie de relever sur lui ses yeux qu’elle tenait baissés et de lui montrer par un sourire de son regard, qu’elle n’était point fâchée !… Mais cela, c’était un aveu d’amour !… Et un secret mystérieux bien puissant, enfoui tout au fond de son cœur, l’empêchait d’aimer, lui défendait l’amour !… Elle dompta son cœur.
– Qu’ai-je donc à vous pardonner ? dit-elle d’un air hautain. Il balbutia, ne sachant plus ce qu’il fallait penser.
– Je croyais, je craignais… j’ai été si hardi… Pardonnez-moi je vous en supplie, je suis si malheureux de m’être attiré votre colère…
– Je ne vous comprends pas ! dit-elle. Et elle passa et alla rejoindre son père, qui descendait au parc avec Julia et Pierre. De loin, se retournant tout à coup, elle aperçut Raymond sur la terrasse, comme cloué à la même place et foudroyé.
Son cœur s’attendrit. Et ses yeux reflétèrent cet attendrissement, mais Raymond était trop loin pour voir… Il resta triste.
– Je l’ai offensée, murmura-t-il… j’ai perdu mon bonheur… et pourtant je l’aime… Oh ! Je l’aime tant !…
Pendant les jours qui suivirent, Suzanne ne sortit qu’à pied et n’alla pas plus loin que l’extrême bordure du parc, du côté de la plaine ; elle savait bien que Raymond, après la scène du château, n’oserait s’aventurer jusque-là.
En effet, Raymond resta invisible.
Il n’était pas loin, cependant, il rôdait aux alentours ; il redoutait et désirait tout ensemble la rencontre de la jeune fille.
Ils restèrent ainsi, dans la même situation, pendant plusieurs jours.
Si Raymond était triste, Suzanne n’était certes pas plus gaie – ou bien, si elle essayait de rire, parfois, pour donner le change à son père et pour éloigner ses soupçons, c’était d’un rire nerveux et forcé qui faisait mal à entendre.
Raymond avait pris possession de son âme.
Elle avait beau vouloir se défendre, il était trop tard.
Laroque remarquait bien sa constante préoccupation et s’en inquiétait. Il crut qu’elle était malade, s’informa tendrement de sa santé, mais elle le détrompa.
Jamais elle ne s’était mieux portée.
– Tu t’ennuies, alors ? fit le père. Je te vois triste.
– Non, je ne m’ennuie pas du tout, croyez-moi.
– Alors, qu’as-tu ? Car tu es toute changée.
– Je n’ai rien, père, je vous assure.
– Veux-tu retourner à Paris ?
Elle tressaillit. Cette idée lui était venue déjà. Retourner à Paris, c’était un moyen presque sûr de ne plus voir Raymond, tant que celui-ci resterait à la campagne ; mais les vacances étaient terminées. Raymond n’allait point tarder, sans doute, à rentrer à Paris… À Paris, Raymond, elle en était sûre, trouverait le moyen de la rencontrer dans le monde – tandis qu’à la campagne elle pouvait le fuir toujours.
Son parti fut bientôt pris. Elle resterait.
– Non, dit-elle, j’aime, vous le savez, la vie très libre que je mène ici. C’est à Paris que je m’ennuierais.
Laroque n’insista pas.
Et la même vie continua.
Deuxième épisode
CHAPITRE XVII
Il y avait déjà longtemps que Suzanne n’avait point vu Raymond, qu’elle ne lui avait point parlé ; depuis le jour où le jeune homme avait voulu obtenir son pardon, sur la terrasse.
Elle avait trouvé ce temps bien long, et souvent, elle s’était surprise à soupirer… et plusieurs fois même, à la dérobée, elle avait essuyé ses larmes, pour ne rien laisser deviner à son père.
Au moins, si elle avait connu quelqu’un qui lui parlât de lui, c’eût été un soulagement à son âme.
Mais qui ? Et comment sans exciter les soupçons ?
Tout à coup, elle pensa à Catherine ; à la femme de Petit-Louis.
– C’est vrai, dit-elle… Catherine le connaît… J’irai…
Et quand elle eut pris cette résolution, elle fut heureuse…
Pourtant, le lendemain, au moment où elle allait partir, sa jolie figure se rembrunit…
« À quoi bon ? se dit-elle… Cela me fera plaisir d’abord. Je souffrirai ensuite… Ne vaut-il pas mieux rester ?… »
Mais elle se répétait tout bas le nom de Raymond, ce nom qui aurait sur son cœur un magique pouvoir, et elle s’amollissait.
* * *
Une demi-heure après, Suzanne était chez Petit-Louis.
Il avait gelé blanc le matin, mais le soleil s’était levé, déchirant un nuage de brumes opaques qui voilaient le ciel ; à midi, il faisait chaud.
Elle avait pris pour prétexte à sa visite l’envie de peindre un des coins du premier parc, du côté de la voûte.
– Ah ! Mademoiselle, qu’il y a beau temps qu’on ne vous a vue ! s’écria Catherine. Est-ce que vous étiez fâchée contre nous à cause de votre accident ?
– Mais non, madame Louis.
– Asseyez-vous donc, Mademoiselle. Voulez-vous prendre quelque chose ?… Une tasse de lait ?
– Merci…
– Petit-Louis me le disait encore ce matin : « Bien sûr, cette demoiselle ne reviendra plus. Son père le lui défendra ! Quel dommage ! Elle était si gentille ! » Il est vrai que, si nous sommes restés sans vous voir, cela ne nous a pas empêchés de parler de vous souvent, tous les jours presque.
Le cœur de la jeune fille battit violemment.
– Avec qui donc, fit-elle… avec Petit-Louis ?
– Oh ! que non… Avec ces messieurs de Noirville… le plus jeune surtout… monsieur Raymond… Si vous saviez comme ils ont été inquiets pendant que vous étiez souffrante ! On aurait dit, vraiment que vous étiez leur parente, presque leur sœur.
Suzanne écoutait, ravie, délicieusement émue.
Catherine vivait seule aux Vaux-de-Cernay et allait rarement au hameau.
Elle n’avait donc pas souvent l’occasion de parler.
Elle ne tarissait pas.
Elle avait trouvé une auditrice bienveillante, et comme sa langue lui démangeait depuis longtemps, ce fut une longue causerie où elle s’épancha – où elle parla de tout – sans s’apercevoir que, chaque fois qu’elle s’égarait sur des riens, Suzanne, habilement, la ramenait par un détour à la seule chose qui avait de l’intérêt pour elle : la vie de Raymond.
Elle eût raconté sur Raymond dix fois la même histoire que Suzanne l’eût écoutée chaque fois avec un même et aussi vif plaisir.
Et pourtant ce que disait la paysanne était bien peu de chose, mais il faut si peu pour intéresser les amants !
– Il était parti depuis quelque temps, disait-elle, mais, avant son départ, il venait tous les jours, sous le premier prétexte et souvent même sans prétexte, simplement pour causer… Ah ! qu’il était doux et aimable… et toujours souriant… pas du tout le caractère de son frère aîné, lequel riait rarement et semblait triste… Mais bons tous les deux, autant l’un que l’autre… Il y avait très longtemps qu’ils habitaient le pays… dix ans au moins… peut-être plus… Et tout le monde les aimait… On les avait connus enfants… Maintenant l’un des deux promettait d’être avocat.
« Les journaux à plusieurs reprises, avaient parlé de lui… comme il paraît que jadis ils parlaient du père… un avocat célèbre, mort en plaidant… dans l’affaire d’un assassin… monsieur Raymond, monsieur Pierre ou madame de Noirville pourront le raconter. Un assassin et un voleur… Je ne sais plus le nom… Mais tout cela, c’est pour dire que monsieur Raymond, sans vous offenser, ne vient peut-être pas ici seulement pour mes beaux yeux. Ah ! je vois cela, moi car, à peine est-il installé, crac, le voilà qui me reparle de votre accident, comme si ce n’était pas de l’histoire ancienne, et comme si vous y pensiez encore, de votre côté… C’est mademoiselle Suzanne Farney par-ci, mademoiselle Suzanne Farney par-là… Allez, vous devez avoir des tintements de cloches dans les oreilles…
Suzanne, en l’écoutant, rougissait et pâlissait tour à tour.
Elle voulait l’interrompre, mais le courage lui manquait et Catherine reprenait, racontait ce qu’elle savait.
Lorsque Suzanne s’en alla peindre, près de la voûte, elle marchait légère comme un oiseau, se répétant :
« Il m’aime ! Il m’aime ! Il ne m’a pas oubliée !… »
Elle fit le lendemain et les autres jours ce que faisait Raymond autrefois, elle revint, elle passa rarement une journée sans venir.
Le tableau du parc, sans doute, était difficile à peindre, et il fallait de nombreuses séances !… Il est vrai que la moitié des séances se passait en conversation avec Catherine, qui s’y prêtait de bonne grâce. Suzanne arrivait chez la paysanne avec d’autant plus de confiance qu’elle savait Raymond à Paris et qu’elle ne craignait point de se rencontrer avec lui.
Cependant, le jeune avocat reparaissait de temps à autre à Méridon, d’autant plus souvent, qu’il était violemment épris.
Un jour – la veille, il avait remarqué de loin Suzanne, qui sortait de chez le garde –, il alla rôder aux alentours des Vaux-de-Cernay. N’apercevant ni Catherine, ni Petit-Louis, et cependant, voyant la porte entrouverte, il entra. Il n’y avait personne. Il s’assit.
Tout à coup, c’est à peine si depuis cinq minutes il était là, ayant levé les yeux, il découvrit Suzanne, sa boîte de peintre et son chevalet à la main, qui suivait l’avenue du parc.
Elle se dirigeait vers la maison.
La première pensée de Raymond fut de s’enfuir… Il était pris d’un tremblement nerveux ; il préférait tout braver, même le ridicule, plutôt que d’affronter le regard méprisant de la jeune fille.
Et cependant, malgré cela, il resta.
Et quand Suzanne ne fut plus qu’à quelques pas, effaré soudain, il se glissa derrière les grands rideaux de serge rouge de l’alcôve, et là, il se tint immobile sans respiration.
Il ne voyait pas la jeune fille, car il n’osait bouger. Elle alla dans un coin déposer son fardeau, puis elle appela :
– Catherine !… Petit-Louis !…
Presque au même instant, Catherine rentrait ; elle venait du jardin, où elle avait ramassé des linges de la lessive, étendus pour sécher au soleil ; elle en avait un ballot énorme qu’elle jeta sur la table.
– Bonjour, Mademoiselle, dit-elle essoufflée – puis regardant de tous les côtés –, tiens, je croyais que monsieur Raymond était là !
La jeune fille fit un brusque mouvement. La paysanne se méprit :
– Oui, dit-elle, du jardin, il m’a semblé le voir entrer. Il sera ressorti sans doute, pendant que j’avais le dos tourné.
Suzanne se rassura. Il n’était pas là. Elle pouvait rester.
– Voyez-vous, Mademoiselle, dit la paysanne tout en pliant son linge, je suis certaine que monsieur de Noirville vous aura découverte, et c’est pour cela qu’il est parti.
– Pourquoi donc ? fit-elle en jouant la surprise. Est-ce que je lui fais peur… et depuis quand ?
– Dame, qui sait ? Il y a peur et peur… Et tenez – autant vous déclarer tout de suite ma façon de penser –, je me suis bien aperçue que monsieur Raymond ne vous regarde pas comme tout le monde – et vous ne seriez point femme si vous ne vous en étiez point aperçue aussi. Il vous – allons, ne vous offensez pas, si je dis le mot –, il vous aime… Eh bien, vous aimant, je comprends qu’il vous fuie.
Suzanne s’était troublée, mais se remettant :
– Ce n’est pas très logique, ce que vous m’expliquez, ma bonne Catherine…
– Peut-être bien… Et, pourtant, réfléchissez !… Vous êtes riche, vous, Mademoiselle. Croyez-vous que les jeunes gens qui vous aimeront et qui seront pauvres ne seront pas gênés de vous ?… Si fait, da !… et malheureusement monsieur Raymond n’a pas la réputation d’être fortuné… Il le deviendra sûrement, mais, en attendant, il n’a que son talent… et sa part de la ferme de Méridon, c’est-à-dire pour ce qui est de la ferme, juste de quoi vivre… et même la ferme ne compte pas, car lui et son frère en abandonnent les revenus à leur mère, qu’ils idolâtrent… Donc, c’est maigre… Dans ces conditions, monsieur Raymond, qui est très fier, souffre évidemment beaucoup de ne pas être votre égal…
Suzanne s’était levée et avait fait quelques pas dans la chambre.
Elle était visiblement en proie à une très vive agitation.
– Voilà, disait la paysanne, sans cesser son travail et suivant du coin de l’œil tous les gestes de la jeune fille, voilà ce que j’ai cru deviner. On n’est pas femme pour rien. Ce n’est pas votre avis ?
Suzanne s’arrêta et, tout à coup, sèchement :
– Est-ce monsieur de Noirville qui vous a priée de me parler de la sorte.
Catherine, consternée, laissa échapper des serviettes qu’elle empilait sur la commode. Elle joignit les mains, silencieusement, très triste… puis :
– Oh ! Mademoiselle !… oh ! Mademoiselle ! fit-elle avec reproche.
Les grands rideaux de serge rouge venaient de s’agiter comme si un violent courant d’air était passé dans l’alcôve. Les deux femmes ne virent rien. Elles n’entendirent pas non plus un soupir entrecoupé qui partait de cette même alcôve.
– Croyez-vous, Mademoiselle, que si monsieur Raymond avait à vous dire certaines choses, il se servirait de moi comme intermédiaire ? Si je vous dis qu’il vous aime, c’est qu’il m’a semblé le deviner… à sa façon de parler de vous, de prononcer votre nom… à mille choses, enfin, qu’on ne peut détailler… et réelles pourtant…
« Mais, après tout, continua Catherine, je ne réponds pas de son amour et il est bien possible que je me trompe… Si cela vous offense, Mademoiselle, n’en parlons plus.
– Ma bonne Catherine, je vous ai fâchée ?
Catherine se mit à rire.
– Un peu, mais c’est fini.
Elles gardèrent le silence, toutes deux gênées quand même. Suzanne avait les yeux baissés. La rusée paysanne la considéra un instant, de haut, et lâcha doucement la tête, avec un demi-sourire.
Et ce geste semblait dire :
– Oh ! malgré vous, je saurai tout ce qui se passe dans ce petit cœur !…
Après un assez long moment, ce fut Suzanne qui reprit, tremblante :
– Alors vous croyez qu’il… m’aime… et qu’il… est malheureux ?…
– Oh ! ce que j’en disais… C’était peut-être aventuré… J’avais remarqué que monsieur Raymond était préoccupé et triste… De là à bâtir une histoire… Tenez, j’aime mieux vous avouer que je me trompais et que je connais le motif de sa préoccupation – laquelle n’est pas tristesse.
– Vous le connaissez ?
– Je m’en doute. Monsieur Raymond est sur le point de se marier…
– Lui ! fit Suzanne en pâlissant.
– Mon Dieu, oui, avec une jeune Parisienne… Il n’y a rien d’étonnant… Et même un beau mariage, à ce qu’il paraît… On en parle dans le pays… Il avait refusé d’abord…
– Ah ! il avait refusé… Et depuis ?…
– Et depuis, il s’est ravisé, il accepte.
– Il accepte… Il accepte ! murmura la jeune fille.
– Qu’avez-vous donc, Mademoiselle, vous voilà toute pâle.
– Pâle ? vous êtes folle !…
Elle se leva, voulut marcher, chancela, et fut obligée de s’asseoir.
La paysanne la regardait, partagée entre la pitié et la curiosité.
– Il fait très chaud, ici, dit Suzanne, vous ne trouvez pas ?
– Mais non, au contraire, le vent est frais… Mon Dieu !…
Suzanne faiblissait, les bras amollis pendant le long de la chaise. Tout à coup de grosses larmes lui vinrent aux yeux.
– Il se marie…, murmura la pauvre enfant, il se marie… Tant mieux… tant mieux, cela vaut mieux…
Les paupières s’étaient fermées, mais entre les cils les larmes filtraient… Et Catherine, agenouillée près d’elle, lui disait :
– Ah ! que vous êtes orgueilleuse… Vous l’aimiez et vous ne vouliez pas vous l’avouer. Et il a fallu un mensonge pour forcer votre aveu… Car j’ai menti… On a bien parlé d’un grand mariage pour monsieur Raymond, mais il a refusé, malgré sa mère, sans donner de motifs… C’est lui qui m’a tout conté… Oui, il a refusé… calmez-vous !…
Elle se calmait, ses larmes s’étaient séchées soudain…
– Vous avez tort, Catherine… grand tort… de vouloir pénétrer ce secret… C’est vrai, j’aime Raymond, mais jurez-moi – sur votre mari – qu’il ne le saura jamais.
Catherine allait répondre… impressionnée par la gravité des paroles de la jeune fille, quand tout à coup elles tressaillirent toutes deux et jetèrent un cri.
Raymond venait d’apparaître – Raymond, pâle comme un mort, et pourtant les yeux humides, avec je ne sais quel rayonnement de bonheur surhumain sur le visage –, Raymond tendait ses mains jointes :
– Oh ! Suzanne… Suzanne ! J’étais là… j’ai tout entendu…
Mais Suzanne, debout, recula jusqu’au seuil… Son visage avait une singulière dureté… son œil brillait sous le sourcil froncé… et les lèvres étaient crispées… Elle avait jeté sa cravache sur la table quand elle était entrée… Elle la reprit, comme pour s’en faire une arme – et d’une voix que la colère entrecoupait :

– C’est un guet-apens… Tout cela était préparé. Cette scène est une comédie. Catherine vous êtes dans votre rôle, car, sans doute, il vous a payée pour cela… Quant à vous, Monsieur, je vous tiens pour un misérable et un lâche !…
Et sa cravache coupa l’air en sifflant entre elle et Raymond.
– Suzanne !… au nom du ciel, Suzanne ! fit Raymond terrifié.
– Mademoiselle… Oh ! Mademoiselle, disait Catherine, je ne savais pas, je vous jure par ce qu’il y a de plus sacré… Je ne le savais pas là…
Mais Suzanne, impérieuse et hautaine :
– Faites seller mon cheval… à l’instant, je vous l’ordonne.
Et reculant, faisant toujours face à Raymond, elle sortit…
Le jeune homme, épouvanté par sa colère, voulait implorer encore :
– Suzanne, dit-il, écoutez-moi !…
Un mot lui cloua brutalement la bouche.
– Vous… je vous méprise. Ah ! je vous méprise bien !…
Raymond tomba, anéanti, et se cacha la tête dans les mains.
Quelques minutes après, la jeune fille s’éloignait au galop.
Cette scène avait à peine duré une minute.
– Ah ! vous m’avez perdu, vous m’avez perdu, Catherine, répétait le malheureux garçon… avec votre curiosité, votre envie de savoir… Est-ce que je vous avais priée de l’interroger, moi ?…
– Et moi, savais-je donc que vous étiez dans l’alcôve ? Est-ce que je pouvais deviner ?… Est-ce ma faute ?…
– C’est fini, maintenant, bien fini.
– Mais il n’est pas possible qu’elle ne vous croie point, qu’elle ne me croie point, aussi, quand nous lui dirons…
– Que lui dirons-nous ?… Tout est contre nous… Elle me méprise… Elle a raison…
– Elle est méfiante comme les filles riches qui s’imaginent qu’on ne veut d’elles que pour leur fortune…
– C’est son droit. Et elle m’aimait ! Et la voilà partie !
– Si elle vous aime, elle reviendra.
– Non, jamais. Je l’ai bien compris à son regard… Oh ! quel mépris ! J’aurais voulu mourir…
– Vous me faites beaucoup de peine, monsieur Raymond… en vous désolant ainsi.
– Et elle m’aimait ! Car je l’ai entendue ! Elle l’a dit…, répétait-il en appuyant les poings sur les yeux.
* * *
Suzanne, en s’en allant, s’écriait :
– Il n’était pas digne de moi, je ne le regretterai pas…
Cela ne l’empêcha pas le lendemain, d’être prise d’une grosse fièvre. Elle souffrit beaucoup, mais n’en dit rien à son père, dans la crainte de l’inquiéter. Un mois se passa, avec une mortelle désillusion.
Les joues de la jeune fille s’étaient un peu défraîchies et un pli amer se voyait presque constamment à chaque coin de ses lèvres.
Laroque avait comme un pressentiment de ce qui se passait dans le cœur de sa fille ; mais qu’y pouvait-il ? Ses préoccupations personnelles l’absorbaient d’ailleurs au point de le rendre égoïste. Dans sa soif de réhabilitation, il passait parfois des journées entières en recherches inutiles concernant toutes les personnes qui avaient pu connaître Larouette.
Quant à Guerrier, qui s’était offert si généreusement à l’aider, il était passé lui-même par de cruelles épreuves. Marie-Louise tomba subitement malade. Une fièvre typhoïde se déclara ; la jeune fille fut plusieurs jours entre la vie et la mort, puis un mieux se produisit et la convalescence commença.
Longue convalescence que le médecin ne trouvait pas encore terminée, malgré les fraîches couleurs revenues sur les joues de Marie-Louise.
Le mariage avait été remis à des temps meilleurs.
Laroque partageait son temps entre sa fille, son enquête et Guerrier.
* * *
Un moment, Laroque s’était cru sur une bonne piste.
Il avait découvert un filleul de Larouette, un filleul pour lequel l’avare avait fait d’incroyables sacrifices d’argent et qui avait néanmoins très mal tourné.
Cet individu, encore jeune, était sous le coup d’une banqueroute frauduleuse ; en outre, son casier judiciaire se trouvait chargé de deux condamnations pour escroqueries.
Au bout d’un mois de pénibles investigations, Laroque dut reconnaître qu’il avait fait fausse route. Le filleul de Larouette n’habitait pas la France au moment de l’assassinat de Ville-d’Avray. Attaché comme voyageur de commerce dans une maison de soieries, il parcourait à cette époque l’Espagne et le Portugal.
Laroque se décida alors à aller trouver Tristot et Pivolot, mais les deux policiers amateurs venaient de partir en Allemagne à la recherche d’un caissier en fuite ; force lui fut donc d’attendre leur retour.
CHAPITRE XVIII
À l’approche du printemps, les bans du mariage de Jean Guerrier avec Marie-Louise Margival furent enfin publiés. Selon la volonté du banquier, cette union se célébra avec toute la discrétion du grand monde. Au lunch qui suivit la cérémonie religieuse, il n’y eut que les parents et les intimes.
Combien Guerrier était désolé de ne pas avoir auprès de lui, ce jour-là, son bienfaiteur ; mais vraiment, il eût été dangereux pour la sécurité du fugitif d’inviter l’étranger William Farney à une solennité toute intime.
Toutefois, Laroque ne put résister au désir d’assister incognito au mariage. Caché dans une voiture qui stationnait presque en face de la Madeleine, il attendit l’arrivée des époux.
Son cœur tressaillit de joie dès qu’il les aperçut : le bonheur, un bonheur sans mélange, se lisait sur les visages des deux jeunes gens.
Laroque n’était pas venu seulement pour eux. Mme de Terrenoire continuait à l’inquiéter. Il voulait savoir si elle avait désarmé.
La femme du banquier était très pâle. Dans ses yeux fixes et durs, Laroque vit bien que la haine n’était pas morte.
Les rares parents et amis qui assistaient au mariage étaient tous entrés dans l’église et Roger s’apprêtait à s’en aller, lorsque soudain il aperçut un individu qui s’avançait lentement vers le portail et regardait de tous les côtés comme s’il cherchait quelqu’un ou comme s’il redoutait d’être observé.
C’était Luversan, cet homme étrange et suspect que William Farney avait vu causer tout bas avec Mme de Terrenoire pendant la soirée japonaise.
Luversan entra enfin dans l’église, mais il n’y resta que quelques instants et Laroque le vit disparaître pour ne plus revenir.
Laroque l’avait bien regardé, cet homme, et comme la première fois, à la soirée japonaise, il lui sembla qu’il l’avait déjà vu, bien antérieurement, dans des circonstances critiques.
Et puis, que lui importait un Luversan ! S’il fallait s’en tenir aux apparences, cet individu avait succédé à Guerrier dans l’esprit capricieux de Mme de Terrenoire.
Laroque se résigna à retourner à Maison-Blanche, où il avait laissé Suzanne dans un état de prostration qui l’inquiétait vivement.
Après son mariage, Jean demanda une quinzaine de jours de congé, pendant lesquels il fit un voyage en Suisse et en Italie.
Après quoi, il reprit ses habitudes.
Dans sa vie calme de travailleur et d’honnête homme, rien d’extraordinaire ne semblait s’être passé. Il n’y avait qu’un heureux de plus.
Il avait loué un coquet appartement rue de Châteaudun, pour être plus près de la banque Terrenoire, située boulevard Haussmann, à deux pas du carrefour Taitbout.
Margival l’y avait suivi, aimant Guerrier presque autant que sa fille, content de les voir à jamais réunis et de ne les point quitter.
Terrenoire avait voulu se mêler de leur installation, et sa générosité avait épargné à Guerrier et à Margival une partie des dépenses nécessitées par ce qu’il appelait plaisamment « cette mise en train d’un jeune ménage ».
Guerrier n’eut qu’un seul secret pour sa femme : le secret de Roger Laroque.
Néanmoins, comme il ne pouvait se faire à l’idée de ne voir son bienfaiteur qu’à la dérobée, il présenta William Farney à Marie-Louise et à son beau-père.
– Monsieur Farney, leur dit-il, dont j’ai fait la connaissance par le plus heureux des hasards chez une tierce personne, me veut beaucoup de bien.
Une sorte d’amitié ne tarda pas à s’établir entre Margival et le riche Américain.
Un soir, Roger Laroque crut s’apercevoir que la physionomie de Jean s’était assombrie. Ce fut à peine si le brave garçon regardait sa femme. Il commit pendant le repas une série de distractions qui décelaient l’agitation de son esprit. Qu’était-il encore arrivé ?
Tout justement, ce soir-là, le visiteur avait fait la gracieuseté aux jeunes époux de leur apporter un coupon de loge pour l’Opéra.
Guerrier remercia, mais déclara qu’il était indisposé et hors d’état de comprendre la musique. Il pria son beau-père de bien vouloir profiter de l’occasion en accompagnant Marie-Louise au théâtre. Marie-Louise adorait la musique et ce fut pourtant avec une moue très accentuée qu’elle consentit à aller à l’Opéra sans son mari.
Dès que Margival fut sorti avec elle, Guerrier s’écria :
– De grands malheurs se préparent ! je crois que monsieur de Terrenoire est ruiné.
Et Jean raconta une scène qui s’était passée dans le cabinet de travail du banquier, en son hôtel de la rue de Chanaleilles. La porte du cabinet était entrouverte ; le jeune caissier entendit le dialogue suivant qui s’était établi entre le banquier et M. Le Charrier, un des hauts employés de la maison.
– J’ai dû vous avertir de mes doutes et de mes incertitudes, disait ce dernier, car il me semblait que vous aviez trop de confiance dans certaines valeurs, qu’un coup de Bourse ferait baisser et dont la baisse serait un désastre pour nous.
– Je suis à l’abri d’un coup de Bourse, monsieur Le Charrier, et Mussidan… dont la fortune est immense, me tirerait de peine au besoin. Je sais que mes dépenses sont très fortes et que ma fortune personnelle n’est pas encore solidement assise, mais j’ai confiance dans l’avenir. De l’audace ! toujours de l’audace !
M. Le Charrier avait répliqué :
– Monsieur Mussidan peut mourir… et si quelque catastrophe arrivait… quel parti prendre ?…
– Censeur incorrigible, oiseau de mauvais augure ! Mussidan est jeune et vigoureux… Il ne mourra pas… Quant à la catastrophe… d’où viendrait-elle ? Nous faisons face aisément à tous nos engagements. Où donc voyez-vous le point noir ?
Guerrier ajouta :
– Monsieur Le Charrier a cru s’être trompé, tant l’assurance du patron et sa confiance en son étoile lui inspirent d’énergie. Je suis convaincu moi, que monsieur de Terrenoire est sur une pente fatale.
Roger Laroque se contenta de sourire. Il n’admettait pas qu’on donnât tant d’importance à des pertes d’argent.
– Et après, dit-il, est-ce que je ne suis pas là ? Monsieur de Terrenoire je ne l’oublierai jamais, m’a tendu la main au moment où je me noyais, au moment où j’imaginais que le plus terrible des malheurs était pour un industriel de ne pas pouvoir faire honneur à ses engagements et de voir son nom, honorable jusque-là, intact, couché sur la liste des faillis. Que j’étais loin de me douter qu’en rentrant chez moi, avec l’argent qui comblait mon déficit, je me trouverais devant la justice qui m’a condamné impitoyablement sans autre preuve que mon silence, ma volonté absolue de ne pas révéler le nom de la personne qui m’avait restitué cent mille francs.
Et le vieillard ajouta avec la joie d’un honnête homme, qui peut enfin reconnaître un service rendu :
– Combien lui faut-il à ton patron ? Cent mille francs, deux cent mille francs ; lui faut-il davantage ?
– Je ne saurais vous le dire, et j’espère n’avoir jamais à vous le dire. Il faut attendre.
– Et c’est ce qui te chagrine à ce point-là ! Il y a autre chose certainement. Dis-moi tout, tu ne dois avoir rien de caché pour ton vieux Roger Laroque.
Jean ne put résister à cet appel de l’amitié. Il fondit en larmes et il conta sa peine tout entière au seul homme à qui il pouvait demander conseil dans un cas aussi difficile.
CHAPITRE XIX
Le mariage de Jean Guerrier n’était pas passé inaperçu dans le cercle des amis de M. de Terrenoire, de Margival et dans les bureaux de la banque. On en parla beaucoup.
Que se passa-t-il pendant les quinze jours où les jeunes mariés furent absents ? Pourquoi Guerrier ne retrouva-t-il plus les mêmes visages à son retour ?
Lorsqu’il reprit possession de la caisse et fit le tour dans les bureaux pour serrer les mains à ceux qu’il croyait ses amis, il trouva partout froide mine.
On lui répondit à peine. Ses effusions n’amenèrent que des paroles glacées, embarrassées.
Guerrier laissa passer quelques jours. Mais il eut beau observer, il n’apprit rien. On se cachait de lui. C’était évident.
Les conversations commencées s’interrompaient soudain à son arrivée dans les bureaux. Il n’y avait plus, tant qu’il était là, que des demi-sourires, des coups d’œil en dessous et des chuchotements.
Ce qui lui fit le plus de peine, ce fut l’éloignement d’un jeune employé nommé Martellier, qu’il aimait beaucoup et avec lequel il était très lié.
Jean le prit à part, un soir, à la sortie des bureaux.
– Veux-tu m’expliquer ce qui s’est passé ici et pourquoi je ne vous ai pas retrouvés, ni toi ni les autres, ainsi que je vous avais connus ?
Martellier parut hésiter.
Puis, tout à coup, sèchement, se débarrassant de l’étreinte de Guerrier :
– Je n’ai rien à te dire, Jean, consulte ton cœur, consulte ta conscience, et tu trouveras là l’explication que tu cherches.
Et il s’éloigna, laissant le pauvre garçon pâle et stupéfait.
Son cœur, sa conscience ? Il avait beau les interroger, ils ne lui reprochaient rien !
Le lendemain dans son courrier, il trouva à son adresse une lettre ainsi conçue :
« Si vous voulez savoir pourquoi l’on vous méprise, interrogez le père de votre femme ! »
Avant de déjeuner, il montra cette lettre à Margival. Le vieux mit ses lunettes, lut attentivement.
– On vous méprise ? Et qui donc ? Et pourquoi ?
– N’est-ce pas vous, d’après cette lettre, qui devez me l’apprendre ?
– Est-ce que je sais ce que cela signifie ? Est-ce qu’il faut s’occuper de ce que contient une lettre anonyme ?
– C’est vrai ! Quelque calomnie, sans doute.
Deux jours après, il recevait une seconde lettre.
Cette fois, elle était signée : « Un ancien ami », mais l’écriture était déguisée.
La lettre portait :
« Si votre beau-père ne vous a rien appris de ce que vous désirez savoir, interrogez votre femme ! »
– Ma femme, murmura-t-il avec angoisse… Et que pourrait-elle me dire ?… Telle je la vois aujourd’hui, telle je l’ai toujours connue…
Il se prit le front dans les mains et perdit son temps à chercher.
Il se heurtait partout à cet inconnu et son angoisse augmentait de ses réflexions mêmes et de sa surexcitation.
C’était le soir, rue de Châteaudun, dans leur logement, où la beauté de Marie-Louise, si joliment encadrée par ce luxe délicat, éclatait comme une fleur superbe, pleine de vie et de parfum…
– À quoi penses-tu ? dit-elle en lui relevant doucement la tête et en l’embrassant sur le front.
Il lui raconta tout et lui tendit la lettre.
Il n’avait aucun soupçon sur elle ; pourtant, il observait son visage, pendant cette lecture.
Elle resta calme et pensive.
– Évidemment, il y a quelque chose, dit-elle, mais je ne sais pas quoi…
Une troisième lettre arriva, la suite et le complément des autres.
« Si votre femme, pas plus que votre beau-père, ne veut vous renseigner – Je dis : ne veut et non point : ne peut – adressez-vous, en désespoir de cause, à M. de Terrenoire. »
Et toujours la même signature mystérieuse.
« Cette fois, l’énigme va s’éclaircir », pensa Guerrier.
Et il alla aussitôt trouver M. de Terrenoire. À lui, ainsi qu’il avait fait à Margival et à Marie-Louise, il raconta cette conspiration du mépris qui se faisait dans les bureaux et jusque dans le monde, autour de sa personne. M. de Terrenoire l’écouta attentivement, lut les trois lettres anonymes, réfléchit.
– Ma foi, mon pauvre garçon, dit-il à la fin, je n’y comprends pas plus que vous. Ce que je peux faire par exemple, c’est prier monsieur Martellier, avec lequel vous étiez, je crois, très lié, de se rendre ici et de lui parler.
Quelques minutes après, l’employé était dans le cabinet du banquier, saluait froidement Jean Guerrier et attendait, debout, qu’on l’interrogeât.
– Monsieur Martellier, dit Terrenoire, vous vous doutez bien un peu du motif pour lequel je vous ai fait venir ?
– Aucunement, Monsieur.
– Ah ! Eh bien, je vais vous le dire. Monsieur Guerrier est très attristé de la froideur que vous lui témoignez et de l’éloignement dans lequel le tiennent, depuis son mariage, tous ses anciens camarades. Monsieur Guerrier n’a rien à se reprocher, et cette froideur et cet éloignement sont d’autant plus pénibles qu’il ne les mérite et ne les comprend pas. Nous avons, lui et moi, compté sur vous pour nous expliquer les raisons d’un pareil revirement.
Martellier garda le silence.
– Répondez, Monsieur ! dit Terrenoire avec fermeté. Vous le devez à votre ami. Au besoin, je vous l’ordonne.
Martellier regardait le banquier avec une fixité singulière – et tournait le dos à Guerrier.
Il semblait vouloir s’obstiner dans son silence.
Alors Jean intervint.
– Mon ami, dit-il, songez que votre refus de me répondre est presque une insulte. Parlez. Je ne sais pas de quoi l’on m’accuse. Donnez-moi donc les moyens de me défendre !
– Je n’ai rien à dire ! murmura Martellier.
– Puisqu’il y a complot, dit Terrenoire impatienté, je renverrai tous les employés de la banque, jusqu’à ce que l’on décide à parler…
– Je partirai, Monsieur, bien que je n’aie que ma place pour vivre, et pour faire vivre ma mère !
– Étrange entêtement ! dit Guerrier
Il n’en put rien tirer. Il fallut le laisser partir.
Deux ou trois jours passèrent encore ainsi.
Après quoi, Jean reçut une quatrième lettre :
« Enfin, si M. de Terrenoire se tait, comme on le croit, l’ancien ami de Guerrier lui apprendra qu’il est bien difficile de conserver son estime à un homme qui pour se pousser et se faire une situation, épouse la maîtresse d’un autre ! »
Jean froissa la lettre avec indignation.
– Infamie ! dit-il. Qui a pu répandre une pareille calomnie sur moi ?… Marie-Louise, la maîtresse d’un autre ? Et de qui ? de monsieur de Terrenoire !…
Il se tordit les mains, pris d’une impuissante rage et cherchant autour de lui quelque chose à briser ou à déchirer.
Il dormit peu.
Peu à peu, l’incertitude, honteusement, pénétrait dans son âme.
Ce n’était pas encore le soupçon.
Il se disait :
– Tous ceux que je connaissais me fuient. Tout le monde ne peut se tromper. Qu’y a-t-il donc de vrai dans cette horrible calomnie ?
Et, l’esprit prévenu, il observa.
Comment était née l’intimité de Terrenoire et de Margival ?
Et une foule de détails lui revenaient maintenant à la mémoire, auxquels jamais il n’avait songé ! Une foule de questions aussi – terribles ! – auxquelles il ne trouvait pas de réponses.
Avant le mariage, le banquier allait tous les jours chez Margival.
Maintenant il trouvait toujours quelque occasion de se rencontrer avec Marie-Louise.
Il envoyait des billets de théâtre, et la première personne qu’on apercevait au théâtre, c’était lui !… Tout lui était prétexte à cadeaux pour Marie-Louise…
Pourquoi tant de choses ?…
La protection du patron s’étendant sur un employé, si intéressant qu’il soit, ne se manifeste pas de cette façon !…
Cela en était venu au point que Terrenoire avait négligé sa femme, tant il se plaisait avec Marie-Louise !… Souvent préoccupé, d’ailleurs, ou ennuyé ou maussade, il n’était gai que chez Margival ; et – voilà que Guerrier, s’en souvenait à présent – si quelque chose retenait, quand Terrenoire était là, Marie-Louise absente, le banquier s’en allait.
Il venait donc pour elle !… c’était évident ! Alors, il l’aimait ! Il l’avait séduite ! Il y avait entre eux des relations d’amant et de maîtresse – à l’insu de Margival – ou même Margival les connaissait, ces relations, et fermait les yeux, parce que cette honte était le prix de l’aisance qu’on lui apportait ?…
– N’ai-je été qu’une dupe imbécile et naïve !… Ah ! si cela est vrai, malheur à eux tous, malheur !…
Ce n’était pas ce que l’on prétendait autour de lui. Une dupe, non. Un complice, oui. Mari complaisant ! Marie-Louise passait pour être la maîtresse de Terrenoire. Et lorsqu’on avait entendu parler du mariage de la jeune fille avec Jean Guerrier quelqu’un résuma comme suit la conversation :
– Le caissier arrive là pour cacher un scandale qui ferait tort à Terrenoire. Si le banquier marie sa maîtresse et si elle y consent, c’est qu’elle est enceinte ! Le pavillon couvrira la marchandise !…
L’avancement rapide de Guerrier, dans les bureaux de la banque s’expliquait ainsi : Terrenoire savait pouvoir compter sur son dévouement honteux. Et le mariage n’empêcherait pas les relations du financier avec la jeune fille !
Il n’y avait pas jusqu’au père Margival qui ne fût complice, lui aussi.
C’était sous ses yeux, avec son consentement, presque son aide, que s’était nouée cette intrigue !… Que de fois n’avait-on pas surpris le banquier sortant, fort tard, de chez Margival !
On avait su, également, par le menu, toutes les dépenses que Terrenoire avait faites.
Il n’apportait pas, n’envoyait pas un cadeau à la jeune fille par un domestique ou un garçon de la banque, sans que le lendemain tous les employés en parlassent et en fissent gorges chaudes.
Quand on apprit que Guerrier allait chez Margival, les plaisanteries redoublèrent. On disait tout haut :
– Tiens ! le caissier qui va souffler la maîtresse du patron ?
Lorsqu’on sut qu’il s’agissait d’un mariage, ce fut un effarement, puis un éclat de rire général.
Ce que faisait Terrenoire et ce que voulait Guerrier, était visible à tout le monde.
Jean Guerrier apprenait cela, jour par jour.
Tantôt, c’était une découverte qu’il faisait de lui-même, et tantôt des lettres anonymes le mettaient au courant. Plus d’une fois, il eut envie de tout dire à Margival, à Marie-Louise, à Terrenoire ; il recula toujours. Cela eût été si abominable d’être sûr qu’il ne s’était pas trompé, qu’il aimait mieux douter encore.
Il pensa un jour, que peut-être la main de Mme de Terrenoire était dans tout cela.
Il chercha à la rencontrer seule, et eut une explication avec elle.
Mais aux premiers mots, il s’aperçut qu’elle ne comprenait pas.
Il ne voulut pas lui donner l’occasion de se réjouir de ses tortures et se retira.
Ce fut le lendemain que Roger Laroque vint les voir. Resté seul après le départ de Marie-Louise et de Margival pour l’Opéra, Guerrier commença par annoncer à Roger la ruine imminente de Terrenoire, puis pressé de questions, il n’hésita pas à lui faire part des affreux soupçons qui l’obsédaient. Laroque l’écouta jusqu’au bout sans manifester d’indignation. Il ne pouvait croire à de telles perfidies.
– Voilà bien l’effet de la calomnie, dit-il. Du reste, il te sera facile de les surveiller. C’est l’affaire de quatre ou cinq jours tout au plus. En attendant, ne laisse rien percer de tes soupçons, que je trouve très peu justifiés. Je n’ai jamais vu de visage plus candide que celui de ta femme ; quant à monsieur de Terrenoire, il n’a rien d’un malhonnête homme dans la physionomie.
« Je ne vois autour de vous qu’une personne dont le silence glacial et l’air sombre me donneraient à penser bien des choses. Je veux parler de monsieur de Mussidan. Pourquoi donc mademoiselle Diane n’est-elle pas encore mariée avec monsieur Robert de Vaunoise ? La faute en est sans doute à ce Mussidan, dont la grande fortune serait le principal appui de son associé si la banque était sur le point de sauter. N’attendrait-il pas la catastrophe pour faire de son mariage avec Diane de Terrenoire la condition du sauvetage de la banque ? D’autant plus que, si je ne me trompe, ce n’est pas la mère de la pauvre enfant qui s’y opposera. Cette femme me paraît chercher les aventures. Elle ne te menace plus, n’est-ce pas ?
– Son attitude à mon égard est devenue tout à fait correcte.
Laroque hasarda une question qu’il n’avait pas encore trouvé l’occasion de poser.
– Quel est ce Luversan qui tourne autour de madame de Terrenoire ?
– Un boursier… une sorte d’intrigant. Je soupçonne cette femme de jouer à la Bourse à l’insu de son mari. Le Luversan doit lui servir d’intermédiaire.
– D’où sort-il ? Qu’a-t-il fait depuis qu’il est au monde ?
– Personne n’en sait rien. Peu nous importe, d’ailleurs ! J’ai bien d’autres soucis en tête.
– Ta Marie-Louise… Elle est innocente, mon expérience, mon instinct me le disent.
– Puissiez-vous ne pas vous tromper ! C’est que, voyez-vous, monsieur Laroque, si je n’aimais pas Marie-Louise autant que le premier jour, si je ne me rattachais pas à l’idée que ma femme est incapable d’une telle dissimulation, je n’hésiterais pas à en finir avec la vie. J’ai peur de moi-même. Ah ! si c’était vrai ; si le père et la fille avaient été d’accord pour me faire l’instrument de leur fortune, je ne répondrais plus de moi-même. Il y a des moments où je vois rouge !
Laroque réussit enfin à calmer son jeune ami, à qui il fit promettre de lui envoyer une dépêche à Maison-Blanche dans trois jours.
Puis ils se séparèrent.
CHAPITRE XX
Suzanne sortait tous les jours de longues heures. Pas une seule fois, Raymond ne se trouva sur son chemin. Elle avait repris toute sa sécurité.
Catherine était venue à la villa deux fois de suite, mais Suzanne ne l’avait pas reçue.
Maintenant, elle dirigeait ses promenades quotidiennes du côté qui l’éloignait le plus des Vaux-de-Cernay, comme si elle avait voulu fuir ces ruines et ces jolis paysages où elle avait commencé à aimer et où elle avait souffert.
Suzanne avait entrepris des études sur les ruines assez importantes et très pittoresques du château de Chevreuse.
Souvent, elle abandonnait son travail et, les yeux perdus sur cet horizon très lointain, s’étageant à perte de vue, elle rêvait.
À quoi ? Qui eût pu le dire ?
Au vide de sa vie, peut-être ?… Ou bien à quelque fatalité attachée à cette vie et qui lui défendait le bonheur ?…
Un jour qu’elle pleurait ainsi sur elle-même, sur sa jeunesse qui se flétrissait dans l’abandon, un jour que, plus triste encore que les autres jours, elle avait appuyé les deux mains sur ses yeux, et silencieusement sanglotait, son gracieux corps secoué de soubresauts nerveux, un peu de bruit lui fit lever le front.
Elle avait cru entendre marcher derrière elle. Elle tressaillit violemment.
– Suzanne, avait-on dit, Suzanne, par pitié !…
Alors elle se leva et regarda, toute blanche, ses larmes séchées.
C’était Raymond… Raymond qui était là et l’implorait.
– Vous ! dit-elle, vous ici !…
– Je vous en prie, Suzanne, écoutez-moi.
– Non.
– Suzanne, je ne suis pas coupable, je n’ai rien à me reprocher… je vous le jure, Suzanne.
– Je ne vous crois pas.
– Suzanne, vous m’aimez et il est impossible que vous me repoussiez ainsi sans m’entendre…
– Allez-vous-en… je le veux…
– Non, cette vie est intolérable… je souffre trop… et c’est injuste… je veux que vous m’entendiez…
– Puisque vous ne voulez pas me céder la place, c’est moi qui partirai.
Elle voulut passer devant lui, fière et méprisante.
Il lui barra le chemin résolument.
– Ah ! Suzanne, Suzanne, vous avez dit que vous m’aimiez… je l’ai entendu… votre cœur doit donc être accessible à la pitié – et même sans amour, vous seriez toujours femme, et regardez-moi, Suzanne, je pleure…
– Que m’importent vos larmes !… Je trouve votre comédie odieuse et ridicule. Finissons-la, si vous m’en croyez…
Et elle voulut passer encore ; lui, toujours résolu :
– Vous ne partirez pas…
Machinalement, elle se recula, presque tout au bord de la muraille. Derrière elle, c’était le vide… c’était l’abîme… elle n’avait plus qu’un pas à faire pour tomber… et s’écraser au bas sur les roches… C’était la mort…
– Si vous faites un pas vers moi, dit-elle, ou si vous dites un mot que je ne puisse entendre, je me jette là…
Il recula, effaré, dans un désordre inexprimable et passa la main sur son front, comme s’il sentait sa raison s’en aller et eût essayé vainement de la retenir.
Il avait le visage défait d’un homme qu’un grand malheur a abattu… les yeux étaient fatigués et rouges…
Les dernières paroles de la jeune fille lui avaient causé une douleur poignante.
– Ah ! vous me croyez, en effet, bien lâche, dit-il très bas, si vous craignez que je ne vous insulte et ne vous violente… Vous avez peur de moi, sans doute, parce que je vous parais très animé… C’est ma vie que je joue en ce moment, et j’ai bien le droit d’être ému…
Ces paroles ne la touchèrent pas.
– Qu’avez-vous à me dire ?… fit-elle en haussant les épaules.
– J’ai à vous parler de mon amour.
– Votre amour n’est qu’une spéculation sur ma fortune.
Il sourit amèrement.
– C’est à mon tour de vous plaindre, Suzanne et je vous plains sincèrement si vous avez de moi cette opinion !…
– Vous me plaignez !…
– Parce que vous devez beaucoup souffrir… de mépriser à ce point un homme que vous aimez…
– Oh ! je ne vous aime plus, le mépris a tué l’amour…
– Alors, pourquoi donc pleuriez-vous ? Car tout à l’heure, je vous ai surprise sanglotant, le visage dans vos mains.
Il l’avait surprise ! Elle eut un geste de colère. Ses lèvres pâlirent. Une lueur mauvaise passa dans ses yeux…
– Ah ! dit-elle, je vous hais, je vous hais bien ! Votre amour m’offense. Je le considère comme une insulte.
Elle regardait avidement cette physionomie bouleversée du jeune homme, ses traits animés et fiévreux, et cherchait à démêler ce qu’il y avait de vrai derrière ses paroles ardentes, ce que pouvait cacher d’amour et d’honneur ce désespoir si noblement exprimé.
Raymond reprit :
– Suzanne, imposez vous-même vos conditions… Si dures qu’elles soient, je les accepte.
Elle garda le silence, cruelle jusqu’au bout.
– Vous ne voulez pas ! dit-il, désolé. Je n’ai plus qu’à me tuer, car je ne peux pas vivre avec la pensée que vous me prenez pour un lâche. Mort, vous me croirez mieux… Et ce sera vite fait, allez !…
Il alla prendre son fusil, resté armé des deux coups.
Il appuya la crosse contre une pierre et mit les canons contre sa poitrine, au milieu.
Alors, se retournant, l’œil ardent, mais extrêmement pâle :
– Suzanne, je vous aime… je vous aurai aimée plus que tout au monde… plus que la vie, plus que mon père et ma mère… Suzanne, je vous aime et je vous pardonne ma mort…
La pointe de son brodequin de chasse alla chercher les gâchettes sous la sous-garde, mais, au moment où, les détentes pressées, les chiens s’abattaient, une main tirait violemment le fusil…
Les deux coups partirent en même temps…
Et aux détonations répondit un cri d’épouvante et d’angoisse poussé par Raymond…
C’était Suzanne qui s’était précipitée sur lui et avait écarté le fusil…
Le coup avait traversé sa robe et la poudre avait mis le feu à l’étoffe.
– Mon Dieu, dit-il, Suzanne, vous êtes blessée…
Elle fit signe que non. Elle n’avait pas la force de parler. Elle chancela. Il la soutint dans ses bras pour l’empêcher de tomber.
Il éteignit le feu de la robe en étreignant celle-ci à pleines poignées.
Il redisait, avec une inquiétude mortelle :
– Vous n’êtes pas blessée, Suzanne ?
– Non…
Tout à coup, ses nerfs se détendirent. Elle éclata en sanglots.
– Suzanne, vous pleurez !… vous avez été effrayée… C’est ma faute… Me pardonnerez-vous cela aussi, Suzanne ?…
Le cœur de la jeune fille éclatait.
– Raymond, dit-elle d’une voix faible comme un soupir, je vous ai méconnu… je vous ai fait une grave offense… Me pardonnerez-vous jamais ?…
– Oui, dit-il, je vous pardonne… sans condition…
– Oui, Raymond, je n’éprouve aucune honte à vous le dire… Je vous aime beaucoup… encore plus peut-être que vous ne m’aimez !…
– Oh ! cela n’est pas possible, Suzanne !

– Je vous aime, Raymond, et j’ai bien souffert… et tout à l’heure, quand vous êtes venu et que vous m’avez surprise, je pleurais, cela est vrai, je pleurais en pensant à vous…
– Toute ma vie vous rendra-t-elle le bonheur que vous me donnez ?
Suzanne secoua la tête avec un geste d’une tristesse navrante. Elle était devenue subitement très grave et se détacha de l’étreinte du jeune homme.
– Raymond, dit-elle, soyez courageux.
– Puisque je suis aimé de vous, comment n’aurais-je pas tous les courages ?
– Hélas, dit-elle.
Et elle fondit en larmes. Il s’effraya. Son cœur se serrait.
– Il ne faut plus nous voir, dit-elle, il ne faut plus que vous pensiez à moi !…
– Pourquoi ?… Quel obstacle nous sépare-t-il donc ?…
– Je ne puis vous le dire !…
– La fortune ?… C’est vrai, je suis pauvre, et l’on dit que vous êtes riche… Mais riche, je le deviendrai certainement, et je vous aime trop pour me sentir humilié d’une disproportion de nos fortunes…
– Ce n’est pas cela.
– Alors, qu’est-ce donc ?
– Ne me le demandez pas, mon ami, je ne vous le dirai jamais.
– Mais cet obstacle, ne peut-on le surmonter ?
– Non ! Et voilà pourquoi notre amour est un malheur… Voilà pourquoi, Raymond, j’ai tout fait pour l’empêcher… Et je ne l’ai pu… Ce n’est pas ma faute… Pardonnez-moi, mon ami…
Raymond avait pris les deux mains de Suzanne dans les siennes ; il les serrait tendrement, et de temps en temps il lui embrassait le bout des doigts, sur les ongles rose et blanc.
– Suzanne, vous me désespérez. Ayez confiance en moi et dites-moi ce qui nous sépare… Peut-être n’y a-t-il là qu’une difficulté créée par votre imagination ? Serait-ce la volonté de votre père ?
Elle secoua la tête.
– Mon père m’aime beaucoup. Et plusieurs fois, il m’a pressée de me marier… Il craint pour moi la solitude et l’ennui…
– Alors, je ne vois que la disproportion de fortune…
– Mon père n’y songerait même pas…
– Monsieur Farney a sans doute choisi, lui-même… un gendre… et vous ne voulez pas désobéir à votre père ?…
– Il ne m’a proposé aucun prétendant.
– Si vous m’aimez vraiment, il ne peut y avoir entre nous d’obstacles que nous ne surmontions quelque jour…
– Renoncez à moi, Raymond, renoncez à toute espérance…
– Mais cela est impossible, vous dis-je… cela est au-dessus de mes forces.
– Mon Dieu, murmura-t-elle, comment le persuader ?
Elle le regarda, les yeux pleins de larmes.
– Raymond, vous ne doutez pas de mon amour ?
– Oh ! Suzanne, que dites-vous là ?
– Mon plus grand bonheur, mon plus grand orgueil serait de porter votre nom… d’être votre femme… et cependant, cela ne sera pas, cela ne sera jamais.
– Serait-ce donc de mon côté, du côté de ma famille, que viendrait l’obstacle ? Que savez-vous ?… Parlez !…
Elle lui mit la main sur les lèvres.
– Taisez-vous, Raymond. Je serais fière d’entrer dans votre famille.
– Alors, je ne comprends plus, fit-il brisé par l’émotion.
– Oui, dit-elle très bas, il aurait mieux valu ne pas nous rencontrer et ne pas nous aimer… Dieu aurait été plus clément en ne le permettant pas, car vous allez souffrir… Quant à moi, je suis habituée à la souffrance… Je ne me souviens pas d’avoir jamais été heureuse… d’un bonheur qu’une arrière-pensée n’empoisonnait pas… Et je vous demande pardon pour tout ce que vous souffrirez à cause de moi, Raymond, car c’est ma faute… vous m’aimez parce que je suis belle, et vous serez malheureux parce que vous m’aimez…
Elle ne retint plus ses larmes.
– Et vous ne me laissez pas même l’espoir qu’un jour, si lointain qu’il soit, vous m’appartiendrez, Suzanne ?
– Pas même l’espoir !
Raymond se laissa tomber sur une pierre, et mit sa tête dans ses mains. Ses doigts voilaient ses yeux. Il resta là, ainsi, longtemps, comme endormi.
Suzanne, debout, le regardait, essuyant ses yeux du coin de son mouchoir, pendant que son cœur était soulevé par des sanglots.
Alors, elle fit ce qu’il avait fait, lui, quand il l’avait surprise dans son sommeil…
Ses lèvres effleurèrent le front du jeune homme.
Et celui-ci entendit une voix – c’était sans doute une voix d’ange, car elle semblait venir du ciel –, qui lui disait :
– Je vous aime, Raymond… Et je ne serai jamais à un autre qu’à vous !…
Et comme il restait immobile, ses larmes redoublant, elle s’éloigna très vite, parce qu’elle se sentait troublée, parce qu’elle se sentait faible devant ce désespoir d’enfant… parce qu’elle sentait qu’elle n’aurait plus de force pour résister…
Elle disparut et Raymond, assis sur la pierre, pleura.
CHAPITRE XXI
Trois jours après avoir fait ses cruelles confidences à Laroque, Jean n’avait pas encore trouvé l’occasion d’obtenir la preuve qu’il cherchait.
« M. Laroque, se dit-il, doit être bien fâché contre moi. Je lui écrirai demain. »
Le soir, après dîner, il retourna à la banque. Un travail supplémentaire devait l’y retenir une partie de la nuit.
Il était dix heures quand il entra dans la maison du boulevard Haussmann, où étaient installés les bureaux de sa caisse.
Il monta droit à son cabinet et s’y enferma. Il y avait, ce soir-là, en caisse, un million deux cent mille francs en valeurs, en billets de banque et en or. Surtout en billets et en rouleaux de cinq cents et de mille francs. Rarement la caisse conservait pareille somme.
Deux gardiens couchaient, quand il le fallait, l’un dans un petit cabinet précédant la pièce où se trouvait la caisse, l’autre près de la caisse : le premier se nommait Béjaud, le second, Brignolet.
C’étaient deux hommes robustes, âgés d’une quarantaine d’années, anciens soldats, point ivrognes, sur la probité desquels on était habitué à compter.
– Brignolet, dit Guerrier, en entrant, comme je vais rester ici toute la nuit, vous coucherez dans le cabinet de votre camarade Béjaud.
– Bien, monsieur Guerrier. Si vous avez besoin de l’un de nous, vous n’aurez qu’à nous appeler, sans vous déranger. Nous avons le sommeil léger.
– J’ai des cigares ?
– La boîte est dans le placard, près de la caisse.
Guerrier n’avait qu’une passion, un défaut : le cigare.
Il s’assit à son bureau, et pendant une heure ou deux travailla sans relâche.
Un grand silence régnait autour de lui. On entendait seulement, derrière la porte, le ronflement égal, régulier, sonore, des deux gardiens, qui dormaient côte à côte.
Un peu fatigué, Jean posa sa plume et se leva.
Il rêva.
« Ma vie à qui m’apprendra la vérité ! », murmura-t-il.
Il secoua la tête, comme pour dissiper ces visions et alluma un cigare.
Il fuma pendant quelques minutes, puis le jeta, l’écrasant d’un coup de pied, en alluma un second, qu’il fuma, puis jeta aussi.
« D’où diable viennent ces cigares ! Ils sont exécrables ! » dit-il.
Il fit encore cinq ou six tentatives en tirant chaque fois quelques bouffées et ne les achevant pas. Alors, il y renonça, se remit au travail, eut besoin d’ouvrir la caisse pour y prendre des papiers, revint à son bureau, et resta là, penché sur ses livres.
Tout à coup, il passa la main sur son front.
« C’est bizarre, comme j’ai la tête lourde, dit-il, mes yeux se ferment malgré moi, et je ne vois plus clair ! »
Il tenta de vaincre cet assoupissement, se leva de nouveau, mais chancela sur ses jambes et retomba dans un fauteuil.
Il conservait cependant toute sa présence d’esprit. Cette torpeur ne gagnait que ses nerfs et non son intelligence.
Il comprit qu’il aurait beau se débattre, qu’il allait dormir. Il eut la vague sensation d’un danger qui le menaçait, aperçut la caisse restée entrouverte, cria :
– Béjaud, Brignolet !
Personne ne répondit. Les gardiens ronflaient.
Et Jean Guerrier ne cria pas une seconde fois. Presque couché dans le fauteuil, les jambes allongées, il s’était endormi…
......................
Depuis des heures, le jeune homme dort, dans la même posture fatigante ; les deux mains pendant inertes, par-dessus les bras du fauteuil, le corps est affaissé comme s’il avait été frappé d’une blessure mortelle.
Cependant, ce sommeil prend fin… Il se lève… Il est debout, marche vers son bureau.
– Dieu que j’ai mal à la tête ! murmure-t-il. Je suis sûr que ce sont ces cigares !…
Il fait, de long en large, quelques pas pour se dégourdir, et tout à coup, dans ses allées et venues, se trouve en face de la caisse… Elle est entrouverte, comme il l’a laissée…
Un geste instinctif, bizarre, irraisonné, lui fait porter la main là et l’ouvrir tout à fait.
Et il pousse un cri terrible, un cri épouvanté… La caisse est vide…
Il croit avoir mal vu, se penche, regarde !… Il ne s’est pas trompé. Elle est vide…
Encore là, dans un coin, quelques paquets de dossiers qui n’ont d’importance que pour M. de Terrenoire et qui n’ont pas attiré l’attention…
Mais les valeurs ont disparu.
Les paquets de billets de banque, les rouleaux de mille et de cinq cents francs, tout a disparu, comme les valeurs !
– Au secours ! Au voleur ! à moi ! crie le malheureux.
Ses cheveux hérissés, les poings en avant… il s’élance vers le cabinet où dorment les gardiens, mais quand il est rentré là, il recule et s’arrête.
Un autre cri sort de sa gorge, étranglée par le saisissement, l’affolement que produit sur lui le spectacle qu’il a devant les yeux.
– À l’assassin ! au secours ! à l’assassin !
Dans ce cabinet, il y a deux lits de sangle, qu’on replie pendant le jour et qu’on range dans un coin.
Sur un de ces lits, un gardien, Béjaud, dort et ronfle, n’entendant même point les cris de Jean Guerrier… il dort les bras sur la couverture, et celle-ci rabaissée machinalement parce que la nuit est chaude, découvre sa chemise de grosse toile, entrouverte sur sa poitrine velue.
L’autre lit est renversé et les draps traînent dans une large mare de sang.
Brignolet, le second gardien, gît là-dessous sans mouvement, la figure grimaçante, les yeux vitreux, la bouche découvrant les dents, un poing crispé autour d’un des montants du lit, et la gorge ouverte par une horrible blessure… Mort !
– À l’assassin ! à l’assassin ! râlait Guerrier.
Et, comme pris de folie, il se jette sur le lit de Béjaud, secoue celui-ci de toutes ses forces, frappant, appelant.
– Malheureux, malheureux, réveille-toi, regarde !
Béjaud s’éveille, à la fin, se frotte les yeux…
Ce qu’il voit, d’abord, c’est le caissier qui le tient par les épaules, qui le tient à la gorge.
Il ne comprend pas et se croit en faute…
– Ah ! pardon, excuse, monsieur Guerrier, vous m’avez appelé… et je ne vous ai pas entendu…, dit-il, embarrassé…
Mais Guerrier s’éloigne, démasque le corps de Brignolet et le lui montre d’un geste.
Et Béjaud croit rêver.
Sa forte figure osseuse, colorée, devient d’un gris sale. Il détourne les yeux.
– Brignolet ! Brignolet !
Il ne sait dire que cela.
Il saute hors du lit, s’habille en toute hâte, prend le cadavre dans ses bras, cherche la place du cœur…
– C’est fini… il est déjà froid !
Tout à coup, il se relève, et, tourné vers Guerrier :
– Et la caisse ?
– On a volé plus d’un million !…
– Malheur ! malheur ! dit l’homme en s’effondrant sur son lit. Et je dormais, moi, je dormais tranquillement… Et pendant ce temps-là…
Une réflexion lui vint, et regardant Guerrier :
– Vous n’étiez pas là ? Vous venez de rentrer ?
– J’étais là. Je ne suis pas sorti. Je me suis endormi dans mon fauteuil. Je n’ai rien entendu, comme vous… Et c’est en me réveillant que j’ai tout découvert.
– Vous dormiez ? Nous étions donc ensorcelés !… Pauvre Brignolet ! Et sa femme ! Son enfant ! Qu’est-ce que tout cela va devenir ?
Cependant, peu à peu, Guerrier reprenait son sang-froid, le premier moment d’épouvante passé.
– Courez prévenir monsieur de Terrenoire, dit-il ; en passant, réveillez le concierge, et envoyez-le au poste de police. À cette heure, il n’y a personne au bureau du commissariat, mais l’officier de paix, s’il est là, ou le chef de poste, connaît l’adresse du commissaire de police et l’enverra chercher. Allez vite ! Gardez le secret et recommandez au concierge de ne rien dire de tout cela. On l’apprendra trop tôt. Allez, Béjaud, prenez une voiture, mon pauvre garçon…
Le gardien sortit, se lamentant toujours.
Jean Guerrier était rentré dans son cabinet. Il essayait de remettre un peu d’ordre dans ses idées, mais il y avait un bourdonnement dans sa tête.
Un quart d’heure, une demi-heure se passa, puis il releva la tête. Il venait, dans le grand silence qui régnait, de percevoir le roulement d’une voiture s’arrêtant devant la banque. La lourde porte s’était ouverte, puis refermée avec un bruit retentissant. Des pas précipités firent résonner l’escalier. Une clé grinça dans la serrure.
On entrait, on traversait le vestibule, la salle d’attente du public. Les portes s’ouvraient et se refermaient avec violence. Ce ne pouvait être que M. de Terrenoire.
Lui seul, avec Guerrier, possédait une clé.
Et c’était lui, en effet.
Il accourait, pâle, bouleversé, la figure décomposée. Quand il vit Guerrier, il se précipita vers lui, en ouvrant les bras, et il eut un cri de tendresse et de douleur à la fois.
– Mon pauvre enfant, dit-il, mon pauvre enfant, on pouvait te tuer, toi aussi !…
Alors, Guerrier, remué jusqu’au fond de l’âme, se rappela sa jalousie, ses atroces pensées.
Et il se disait, pendant que cet homme, oublieux de la catastrophe qui le frappait lui-même, l’étreignait dans ses bras, ne craignant que pour lui :
– Ai-je donc rêvé ?
Le banquier alla vers la caisse, y jeta un coup d’œil.
– Volé, dit-il. Ils ont pris jusqu’au dernier rouleau. Et vous étiez là, Guerrier ?
– Je dormais dans ce fauteuil. J’avais été pris d’un irrésistible besoin de sommeil. Ça a été plus fort que mon énergie, que ma volonté, que mon raisonnement… Je me rappelle que, lorsque je sentis que je m’endormais, j’appelai machinalement Brignolet et Béjaud… M’ont-ils répondu ? Je l’ignore… C’est tout ce dont je me souviens !…
– Si vous vous étiez réveillé, c’en était fait de vous, Jean.
– Qui sait ? J’aurais crié ! Béjaud serait venu.
– Oh ! les assassins n’étaient peut-être pas seuls…
Terrenoire entra dans le cabinet des gardiens et se pencha sur le cadavre de Brignolet.
– Quelle horrible blessure ! murmura-t-il. Il a dû expirer sans pousser un cri…
Ils revinrent à la caisse et se dirigèrent vers les bureaux, car plusieurs personnes arrivaient.
C’étaient deux gardiens de la paix, précédant le commissaire de police du quartier, M. Lacroix, un homme à figure souriante, aux favoris blonds, aux yeux bleus.
M. Lacroix, commissaire de police à Versailles, en 1872, fut appelé le premier à instrumenter contre Roger Laroque, à Ville-d’Avray. Étrange coïncidence, ce magistrat, nommé à Paris depuis deux ans à peine, allait avoir à instrumenter contre l’ancien caissier de Laroque.
Son secrétaire, un grand garçon maigre, au visage froid et intelligent, arriva presque aussitôt, et, presque en même temps que lui, un agent nommé Chambille, expédié par un brigadier de service.
Chambille, sans être ni un Corentin ni un Lecoq, avait une certaine réputation d’habileté – il méritait cette réputation, mais il devait son habileté peut-être à son extérieur.
Nul ne se doutait, en le voyant, qu’on se trouvait en face d’un des inspecteurs de la Sûreté.
Il avait l’air, avec sa force bourgeonnante et enluminée, avec son gros ventre, ses larges épaules et son air paterne, d’un excellent bourgeois.
Quand tout ce monde fut dans le cabinet de Jean Guerrier, M. Lacroix se fit répéter par le jeune homme ce qui s’était passé et comment il avait découvert le vol du million et l’assassinat de Brignolet.
Jean Guerrier raconta ce qu’il savait.
– Avant de commencer mes constatations, dit le commissaire de police, avant même d’examiner le cadavre du gardien assassiné, veuillez, monsieur Guerrier, me permettre quelques questions indispensables pour la clarté de notre enquête.
– Parlez, Monsieur, je suis prêt à vous répondre, dit le jeune homme avec empressement.
– Vous êtes entré dans votre caisse à dix heures ?
– À dix heures, en sortant de chez moi.
– Et à quelle heure vous êtes-vous endormi ?
– Quelques instants après minuit.
– Est-ce que ce sommeil lourd, cet accablement général de toutes vos facultés, vous prend quelquefois ?
– Jamais. J’ai le sommeil très léger. Et je dors très peu. Je suis rarement couché à minuit, et à six heures, été ou hiver, je suis debout.
– Hier, dans le jour, vous êtes-vous senti indisposé ?
– Non. C’est vers minuit seulement, et après avoir fumé, que je me suis alourdi.
– Vous n’avez pas l’habitude de fumer des cigares ?
– Au contraire. Je ne fume même que cela. Je les aime très forts et jamais je n’en ai été incommodé.
– Votre abattement soudain reste donc pour vous une chose incompréhensible ?
– Incompréhensible. C’est le mot…
M. Lacroix réfléchit un instant, puis changeant d’idée :
– Passons dans le cabinet des gardiens, dit-il.
MM. Lacroix et Chambille comprirent, d’un coup d’œil, la scène qui avait précédé l’assassinat.
– Brignolet n’a pas été surpris dans son sommeil, dit l’agent. C’est visible. L’état du lit, les draps déchirés, la chemise de la victime en lambeaux, tout prouve la lutte.
MM. Lacroix et Chambille allaient, venaient, ouvraient, fermaient, pénétraient d’une pièce à l’autre. Chaque fenêtre fut visitée, aussi bien celles du boulevard Haussmann que celles de la cour… Elles étaient intactes et closes.
Ils revinrent au vestibule, examinèrent attentivement les serrures – car il y en avait deux ; une serrure ordinaire et un verrou de sûreté – ce qui nécessitait deux clés, par conséquent.
Elles n’offraient, ni l’une ni l’autre, aucune trace d’effraction.
M. Lacroix interrogea Guerrier :
– Vous étiez-vous enfermé, la nuit, pour travailler ?
– C’est mon habitude.
– Et qui a ouvert cette porte, ce matin ?
– Monsieur de Terrenoire, que j’avais fait prévenir.
Le magistrat se tourna vers le banquier :
– Avez-vous senti quelque résistance en mettant la clé dans la serrure ? La porte était-elle ouverte, ou fermée ?
– Elle était fermée, et je l’ai ouverte sans rien remarquer.
– Personne autre que vous et votre caissier ne possède les clés des bureaux et de la caisse ?
– Personne. Béjaud et Brignolet, qui sont les deux gardiens, couchaient ici, enfermés.
– Le voleur est entre mes mains, dit M. Lacroix. Ce n’est donc pas de lui que nous nous occuperons. Ici, l’affaire me paraît plus mystérieuse – ou, si l’on veut plus simple, ajouta-t-il d’un ton singulier.
Ce mot, Chambille seul l’entendit, et il murmura :
– Tiens, tiens ! monsieur Lacroix me paraît avoir la même idée que moi !…
Le commissaire revint au cabinet de Guerrier et examina la caisse.
– Avouez, Monsieur, ne put s’empêcher de dire M. Lacroix, que s’endormir auprès d’une caisse ouverte, dans laquelle, en plongeant la main, on peut prendre plus d’un million, est d’une imprudence sans égale…
– Je vous ai dit, Monsieur, que je m’étais endormi si brusquement que je n’avais pas eu le temps d’appeler les gardiens…
– C’est bien, c’est bien, dit sèchement M. Lacroix. Mon secrétaire a pris note de vos déclarations. Elles sont écrites. Inutile de les renouveler.
Guerrier se troubla et pâlit. Il chercha des yeux M. de Terrenoire. Celui-ci était pâle également. Alors, le jeune homme s’écria, d’une voix vibrante :
– Quel infâme soupçon avez-vous ? Monsieur de Terrenoire, regardez-les donc ! Ils m’accusent… moi !
Et l’indignation faisait trembler ses lèvres.
Le banquier tressaillit et s’empara vivement de ses mains, qu’il serra longuement dans les siennes.
– Monsieur Lacroix, dit-il, il est impossible que vous ayez eu cette pensée… Ce serait de la folie !… Je me porte garant de sa probité…
Le magistrat eut un geste de surprise – et en même temps, il échangeait un coup d’œil avec Chambille – évidemment, ils continuaient à s’entendre.
– Pardonnez-moi, monsieur de Terrenoire, dit-il froidement, de ne pouvoir répondre aussi formellement que vous m’en priez.
– Votre refus est une insulte, dit Guerrier avec violence, faisant un mouvement en avant.
– Du calme, Monsieur. Je n’ai pas l’intention de vous offenser, et je vous prie de vous reporter à ce que je vous ai dit… Je vous ai accusé d’imprudence d’abord. Où est l’injure et n’avez-vous donc pas été imprudent ? J’ai dit ensuite que mon secrétaire avait pris note de vos déclarations. C’est mon devoir, Monsieur, je ne suis pas ici pour autre chose, et vous ne pouvez vous en formaliser…
Le magistrat avait raison. Guerrier et Terrenoire le comprirent. Ils ne répondirent pas. Lacroix ajouta :
– Vous avez donc tort de vous fâcher. Et vous me permettrez de trouver bien étrange la facilité avec laquelle vous avez pensé que je pouvais vous croire coupable !…
Cela était sans réplique.
Guerrier en fut écrasé. Il ferma les poings avec rage et ses joues s’empourprèrent.
– Du calme, mon enfant, du calme ! fit le banquier.
M. Lacroix fit signe au gardien Béjaud de s’approcher. L’homme obéit, un peu troublé, sans doute encore impressionné par l’horrible mort de son camarade.
– Racontez-nous ce qui s’est passé ! fit le commissaire.
– Et comment diable voulez-vous que je vous le raconte ? fit-il brusquement. Est-ce que j’en sais mot ? C’est monsieur Guerrier qui m’a réveillé – il peut le dire – même que, croyant être en faute, je lui faisais des excuses. Alors, il m’a montré le cadavre de… de ce pauvre Brignolet. Et voilà ! Ah ! coquin de sort, un si brave homme !
– Et il s’est soutenu une lutte mortelle auprès de vous, et l’on a pu assassiner un homme dont le lit était si près du vôtre que vous l’auriez touché en allongeant le bras – et vous n’avez rien entendu ?
– Je le jure !
Le commissaire de police haussa les épaules.
– C’est invraisemblable.
– Alors, Monsieur, répliqua brusquement le gardien, dites tout de suite que c’est moi qui ai égorgé Brignolet. Ça vous épargnera de la besogne.
Le magistrat ne répondit pas à cette boutade et s’entretint quelques instants avec Terrenoire, prit la désignation des valeurs soustraites, les numéros, etc., tout ce qui pourrait mettre sur leurs traces, monta dans le cabinet particulier où Béjaud et Brignolet avaient leurs malles, visita ces malles minutieusement, fit sonner les briques du carrelage, en soulevant même quelques-unes sous lesquelles semblait exister un vide, laissa deux gardiens de la paix dans le bureau de la caisse, et partit en priant M. de Terrenoire et les autres de quitter les lieux.
– La justice est obligée de se substituer à vous, Monsieur, dit-il poliment au banquier. Jusqu’à demain, vos bureaux devront rester fermés.
– Comme il vous plaira, Monsieur, dit le banquier avec accablement. Un jour d’interruption dans mes affaires ne rendra pas pour moi la catastrophe plus grande.
Tous sortirent, excepté les sergents de ville.
Alors, Chambille disait à Béjaud, en lui passant la main sous le bras et en l’entourant de sa ligotte[1], prestement, sans même que l’autre s’en aperçût :
– Eh bien ! vieux, nous allons donc faire route ensemble, comme deux camaros ?
Béjaud fit un brusque soubresaut. Il était blême ; il fut pris soudain d’un tremblement convulsif.
– Mais non, vous vous trompez, je ne vais pas avec vous.
– Tu es sûr ?
– On peut avoir besoin de moi, ici.
Chambille se pencha à son oreille.
– Pour y achever la besogne de cette nuit ?
Le tremblement de Béjaud atteignit ses jambes.
Il flageola et Chambille le retint.
– Quoi ? Que dites-vous ? Est-ce que par hasard, vous allez m’accuser ?… Ah ! mon Dieu !…
– Je ne t’accuse de rien. Seulement, nous avons besoin de toi au Dépôt. Voilà tout.
– En d’autres termes, vous m’arrêtez.
– Oui, provisoirement.
– Vous emmenez cet homme ? demanda Terrenoire.
Il était surpris, et comme mécontent.
M. Lacroix lui parla à voix basse :
– Il me paraît difficile qu’il ne soit pas complice du vol, aussi bien que de l’assassinat. Tout me paraît louche dans sa conduite. Je suis obligé de m’assurer de sa personne. La négligence de certaines précautions a empêché quelquefois nos enquêtes de réussir.
– Je dois vous dire que, depuis qu’il est à la banque, je n’ai qu’à me louer de sa probité et de son attachement.
– D’où sortait-il ?
– Du service militaire.
– Et il était chez vous depuis longtemps ?
– Depuis une quinzaine d’années. C’est un fort brave homme, très doux, ne se grisant jamais. S’il était possible de le laisser en liberté, je crois pouvoir répondre de lui.
Mais Lacroix secoua la tête.
– Nous verrons plus tard. En ce moment, non.
Il salua M. de Terrenoire et s’approchant de Guerrier :
– J’espère, Monsieur, que vous ne m’en voulez pas et que vous ne me tenez pas rancune d’un malentendu ?
– Non, certes ! dit le jeune homme avec élan.
Ils se serrèrent la main.
Chambille les regardait de loin, du coin de l’œil.
– Savez-vous quel est cet homme, que nous venons de laisser libre ? demanda le magistrat au policier.
– C’est le caissier de monsieur de Terrenoire, répondit Chambille.
– C’est aussi l’ancien caissier de Roger Laroque !
Quelques heures ne s’étaient pas passées que tous les amis ou habitués des fêtes de Terrenoire connaissaient la catastrophe.
Terrenoire avait envoyé chez Mussidan, dès la première nouvelle du meurtre et du vol, mais le comte était parti la veille de Paris, pour une de ses terres, en Sologne. Le banquier avait lancé une dépêche aussitôt. Mussidan devait être en route. On l’attendait dans l’après-midi.
De lui dépendaient l’honneur et la vie de Terrenoire.
Le comte était extrêmement riche et dépensait à peine le tiers de ses revenus. Lui seul pouvait sauver le banquier.
Et celui-ci tremblait un peu, bien qu’il fût certain de l’amitié du comte.
Dans le salon de Mme de Terrenoire, la tristesse régnait. On causait à voix basse.
Aux amies qui entraient et venaient lui serrer les mains, elle ne répondait même pas, remuant seulement les lèvres et n’ayant point la force d’articuler des paroles.
À l’autre bout du salon, debout près d’une fenêtre, un homme se tenait qui devait être profondément affecté du malheur qui atteignait cette maison, car il était très pâle et par-dessus les hommes et les femmes qui étaient devant lui, son regard ardent, lumineux, troublant, allait chercher le visage d’Andréa.
L’homme, c’était Luversan.
Mme de Terrenoire ne fuyait pas ce regard, elle le soutenait, au contraire, liée à lui et se sentant comme enlevée et fondue en lui.
Un à un, ceux qui étaient là étaient partis ; elle n’avait retenu personne.
Un homme seul resta ; Luversan, toujours debout, là-bas, dans son immobilité de statue.
Et quand il n’y eut plus qu’eux seuls, ces deux êtres ne cessèrent point de se regarder, plongeant dans l’âme l’un de l’autre.
Tout à coup, Luversan, lestement, s’avança vers elle.
Elle se dressa, comme menacée d’un danger ; sur son visage passa la crispation d’une atroce terreur. Elle étendit les bras.
Luversan prit une de ses mains et la porta à ses lèvres, sans baisser les yeux, la regardant encore, étrangement.
– Je vous aime, dit-il.
Et ce fut le seul mot qu’il prononça.
Il s’éloigna, et Andréa retomba sur le canapé, faisant un geste fou, autour de sa tête, comme pour écarter un horrible cauchemar.
CHAPITRE XXIII[2]
Le jour même, Mussidan arriva.
Terrenoire et lui s’enfermèrent dans un cabinet et restèrent longtemps ensemble.
Le banquier commença par lui faire le récit du drame qui s’était passé boulevard Haussmann.
Après quoi, il aborda la question financière.
Outre le vol de douze cent mille francs, il y avait la débâcle de la Bourse.
À chaque instant, des nouvelles venaient de la Bourse, où l’émotion était indescriptible.
Terrenoire ne cacha rien à Mussidan.
– La situation est désespérée, dit-il, car, outre les pertes énormes que je prévois et qui sont le résultat de la situation de la Bourse, il y a le vol dont je suis victime et le million en caisse était destiné à des remboursements qui devaient se faire aujourd’hui. La faillite pour moi semble inévitable, si tu ne me viens en aide, car, demain, dès que mes bureaux seront rouverts, je m’attends à des retraits de dépôts nombreux, arrivant de tous côtés, auxquels il me sera impossible de faire face, et qui aggraveront encore mes embarras.
Mussidan était assis et l’écoutait distraitement.
Il ne l’avait pas interrompu une seule fois.
Terrenoire, malgré ses efforts pour garder son sang-froid et son calme, était fiévreux et agité.
Il regardait son ami, attendant, de ce qu’il allait dire, un arrêt de vie ou de mort.
– Cela est fort triste et fort inattendu !
– Voilà tout ce que tu trouves pour me plaindre ? fit Terrenoire, surpris. Je sais que peu t’importe la perte que je fais et que cependant tu partages, car tu es riche… mais je n’ai pas la même fortune que toi… c’est moi qui suis frappé, et non toi, car si nous sommes associés de fait, puisque c’est avec tes ressources que j’ai fondé notre banque, je suis seul en nom, et supporterai seul le déshonneur de la faillite…
– Tu étais trop heureux, vois-tu, dit Mussidan d’un air étrange, tu as tenté Dieu… Oui, trop heureux… tu t’es laissé enivrer… Tout te réussissait… La fortune te souriait… Ta femme, belle, fière, triomphante, qui te faisait envier de tous tes amis, a mis la paix dans ton foyer domestique… Ta fille est un ange de grâce et de beauté… Qui ne l’adorerait ? Toi, tu es gai, heureux et bien portant… Tu te laissais vivre… Un seul homme n’est pas capable de supporter tant de bonheur !…
Terrenoire l’écoutait saisi.
Jamais Mussidan ne lui avait parlé de la sorte.
Que se passait-il donc dans cette âme ?
D’où venait cette ironie ?
– Ainsi, tu me refuses ?
– Tous mes capitaux sont engagés, dit le comte – pâle et détournant les yeux – je ne puis disposer, à l’heure présente, que de quelque cent mille francs. Cela ne peut suffire. Je le regrette. Je suis au désespoir. Mais ce coup est si inattendu…
– C’est bien, fit Terrenoire, très bas, c’est bien, Mussidan, tu es libre. Je ne t’en veux pas. Je te remercie de m’avoir parlé comme tu viens de le faire. Adieu. Je vais retrouver ma fille et ma femme. Je leur avais dit que tu ne voudrais pas, sans doute, que la honte entrât dans notre maison, qui est un peu la tienne… Je vais leur apprendre – oh ! sans rancune – que, malgré ton désir, tu ne peux nous sauver.
Mussidan s’était levé brusquement.
Sa fille ! Un instant, la jalousie lui avait tout fait oublier.
Sa fille ! Mais c’était Diane qui serait la première atteinte par ce déshonneur !
Sa fille !… qu’il aimait tant, et qui justement lui inspirait sa jalousie du bonheur de Terrenoire !
Sa fille allait pleurer, et vivre pauvre, dans la gêne, le travail de tous les jours, la misère, pendant que lui, Mussidan, continuerait de traîner sa vie ennuyée à travers ses millions !…
« Malheureux ! se disait-il, à quoi penses-tu ? La honte entrerait par toi dans cette maison et t’en chasserait ! Et jamais plus tu ne pourrais revoir cette enfant que tu adores et qui emplit ta pensée ! »
Terrenoire s’en allait digne et triste.
Mussidan l’arrêta.
– Pardonne-moi, mon ami, dit-il. Depuis quelque temps, je vis un peu comme un fou, ne sachant trop ni ce que je dis, ni ce que je fais.
Et il lui tendit la main.
Terrenoire hésitait.
– Puisque je te demande pardon ? fit Mussidan.
Ce dernier mot vainquit Terrenoire. Toutefois, il lui dit :
– Tu m’avais refusé si durement, mon ami, que s’il ne s’agissait que de moi, et non de ma femme, et de ma fille, je refuserais à mon tour.
Ils s’assirent de nouveau l’un en face de l’autre. Ils causèrent, et leur entretien – longtemps après – finit sur ce mot, dit par le comte :
– Tu peux disposer de ma fortune. Voici mes pleins pouvoirs. Sauve-toi d’abord, sauve ta femme, sauve ta fille. Nous compterons ensuite.
CHAPITRE XXIV
Pendant que le banquier, allégé d’un poids énorme, renaissant à la vie, sortait pour se rendre à la Bourse et faire face à l’orage, Mussidan se faisait annoncer chez Mme de Terrenoire.
Bien que celle-ci fût souffrante, elle le reçut.
Mussidan s’avança vers elle et lui baisa la main.
– Vous semblez tout joyeux, dit-elle, votre visage paraît comme éclairé. Qu’avez-vous ? Vous ne savez donc pas ce qui se passe ?
– Je le sais.
– Et voilà ce qui vous rend gai ?
– Assurément.
– Je ne comprends pas, dit-elle sèchement.
Elle se leva et fit quelques pas pour s’éloigner.
– Vous avez la mémoire courte. Ne vous ai-je pas dit, l’autre soir, tenez, le soir même où vous donniez cette magnifique fête japonaise qui a fait courir tout Paris : « J’en suis presque à souhaiter une catastrophe afin qu’on ait besoin de moi, afin que la vie de Diane, de ma fille, dépende de moi, afin de lui venir en aide à ce point qu’elle soit forcée de m’aimer à égal de Terrenoire ! » Ne vous disais-je pas que j’étais jaloux de l’affection que cette enfant, qui est ma fille, portait à cet homme, qui n’est pas son père…
– Plus bas, malheureux, dit Mme de Terrenoire, effrayée – car Mussidan en ce moment d’exaltation, avait élevé la voix –, on pourrait nous entendre !…
Elle regardait autour d’elle, effarée.
– Aujourd’hui, continuait Mussidan, je suis moins jaloux, parce que je viens d’acquérir un droit à son affection, un droit à sa reconnaissance. Il faut plus de deux millions pour sauver Terrenoire de la honte, du déshonneur, d’une faillite, du suicide. Ces deux millions, je les donne, je les donne à ma fille, je te les donne, Andréa… Je suis heureux aujourd’hui… Ah ! cela me pesait de ne rien faire pour elle, de n’avoir jamais rien fait… J’aurais voulu autre chose qu’un sacrifice d’argent… J’aurais voulu qu’elle eût besoin de ma vie, de mon sang… Qui sait ? Cela viendra peut-être…
Il avait de nouveau élevé la voix, joyeux, délirant, malgré les gestes d’Andréa… mais, tout à coup, il pâlit et Andréa, effarée, demi-morte, tomba sur un fauteuil.
Ils avaient entendu du bruit dans un salon voisin. Assurément, quelqu’un était là, qui avait écouté ce qu’ils disaient !…
Mussidan fit quelques pas dans la direction du salon et allait soulever la portière, quand il recula foudroyé.
Diane écartait cette portière et apparaissait soudain devant lui. D’une pâleur étrange et se soutenant à peine, elle fut obligée de s’arrêter et de s’appuyer. Elle chancelait. Un instant, une seconde – moins peut-être – il y eut entre elle et les deux autres une inexprimable horreur.
Mais elle montra un courage d’homme, cette enfant ; elle eut la sublime énergie d’essayer de sourire à Mussidan et à Mme de Terrenoire, et de paraître gaie, quand elle avait le cœur dévoré de honte, de colère, de dégoût…
Eux baissaient la tête devant la jeune fille, ainsi que des coupables attendant l’arrêt du juge. Ils ne vivaient plus.
– Eh bien ! dit Diane, pourquoi me regardez-vous de la sorte ?… Vous êtes gentils !… Vous voyez que je suis toute défaite et vous ne me demandez même pas quel est le motif de mon émotion…
Mme de Terrenoire respira.
Quant à Mussidan, il se contenta, surpris, d’observer sa fille.
– C’est vrai, dit Andréa, tu es pâle…
– Je me suis trouvée mal dans le salon voisin, cela n’a duré qu’un instant ; j’ai eu un éblouissement et, si je ne m’étais retenue à un fauteuil, je serais tombée… Toutes ces mauvaises nouvelles… arrivant coup sur coup, m’ont troublé un peu la tête… Cela va mieux…
Et elle essayait de nouveau de sourire, mais une étrange fatigue s’était répandue sur ses traits, avec la couleur jaune terreuse des gens malades.
Mme de Terrenoire eut la folle espérance que Diane ne savait rien, n’avait rien entendu.
– Ma pauvre enfant ! dit-elle tout à coup avec élan, n’aie plus de craintes. Ton père est sauvé !… Monsieur de Mussidan, avec une énergie vraiment royale, lui a laissé la libre disposition de sa fortune pour lui permettre de faire face à tous les remboursements… Remercie-le !… C’est à lui que nous devons de garder notre rang dans le monde, notre fortune – et c’est à lui que ton père devra de garder son honneur sauf…
– Vous avez fait cela, monsieur de Mussidan ? dit la jeune fille, dont la voix était profondément altérée.
– Et je suis heureux, dit-il lentement, sans cesser de l’observer, de cette nouvelle occasion qui m’est offerte de vous prouver combien je vous aime, moi qui cependant ne suis rien pour vous, si ce n’est l’ami de votre père.
– L’ami de mon père, oui, fit-elle, et elle répéta plus bas : l’ami de mon père ! C’est pour lui que je vous remercie, Monsieur, et pour ma mère !…
– Et aussi pour vous, n’est-ce pas mon enfant ?
Elle hésita. Elle semblait défaillir encore.
– Oui et aussi pour moi, dit-elle faiblement. Je suis heureuse, très heureuse de ce que vous faites !…
Et, n’y tenant plus, elle éclata en sanglots, s’affaissa sur le parquet avant que Mussidan eût pu la retenir en proie à une violente crise de nerfs, mordant son mouchoir pour étouffer ses cris, se tordant les membres contractés, la gorge étranglée.
Mussidan, égaré, fou, se précipita sur elle, la prit dans ses bras, pendant que Mme de Terrenoire, terrifiée, n’avait même pas la force de bouger. Il répéta : « Elle sait tout. Elle a tout compris ! »
CHAPITRE XXV
Depuis qu’elle avait fait à Raymond l’aveu de son amour, Suzanne était plus calme ; elle se montrait plus enjouée avec son père.
La saison des grands froids approchait. Des pluies torrentielles persistantes, détrempèrent la terre et rendirent impossibles les longues promenades.
Suzanne tuait le temps en jouant du piano et en lisant tous les ouvrages que son père lui apportait de Paris.
– Tu ne t’ennuies pas ici ? lui demanda Laroque un soir qu’il l’avait surprise s’endormant sur sa broderie.
– Mais pas du tout, et j’espère bien que nous y passerons l’hiver.
Laroque répliqua :
– Ce serait un grand plaisir pour moi que de te voir admirée dans une société de gens distingués où ma fortune m’a permis d’être admis dès mon arrivée à Paris.
– Pourquoi voulez-vous qu’on m’admire ? dit la jeune fille avec tristesse. Je me suis toujours sentie mal à l’aise auprès des étrangers, et pour vous dire vrai, je ne retrouverai toute ma gaieté que lorsque nous serons retournés là-bas, en Amérique.
Rien ne pouvait faire plus de plaisir à Roger Laroque que l’idée de quitter la France ; mais il avait encore tant de choses à faire avant de reprendre la mer.
Son enquête personnelle, n’aboutissait à rien. Le moment était venu pour lui de se confier à Tristot et Pivolot.
Un matin qu’il se disposait à prendre le train de Paris pour se rendre chez Guerrier, il croisa Raymond de Noirville.
– Voulez-vous m’accompagner jusqu’à la gare ? demanda-t-il au jeune homme.
– Volontiers, monsieur Farney. Il y a longtemps que je me proposais de venir vous voir. J’ai des renseignements à vous demander.
– Tout à votre disposition. Nous causerons en chemin.
Laroque tenait avant tout à éloigner de sa maison le fils de l’homme qui avait été sa victime. « Ce garçon-là, se disait-il, a tout pour lui ; si Suzanne se prenait à l’aimer ! »
Son instinct de père l’avertissait du danger.
En route, Raymond lui demanda des renseignements sur l’Amérique du Nord. Il ne cachait pas son intention de quitter la France, malgré les succès qu’il avait déjà eus au barreau. Il voulait comparer la législation française avec celle des États-Unis, surtout au point de vue de la procédure. Il était d’avis qu’il y aurait plus de gloire à faire un bon ouvrage, utile à tous, que des plaidoiries passables utiles à quelques-uns.
On sait que Laroque était doué d’une grande pénétration. Sous ces projets de philanthropie prématurée, il devina une grande déception. Raymond de Noirville devait avoir au fond du cœur un profond chagrin : c’était pour s’étourdir et non pas seulement pour travailler, qu’il désirait s’expatrier.
– Vous êtes bien jeune, dit William Farney, pour entreprendre une excursion qui exigerait le sacrifice des plus belles années de votre jeunesse.
– L’étude m’a vieilli, Monsieur, ou plutôt elle m’a donné une expérience rare pour mon âge. La profession d’avocat n’est pas sans déboires. Mon père l’exerçait avec éclat. Qui parle de lui, maintenant ? Qui se souvient d’une seule des causes célèbres auxquelles il a prêté le secours de sa parole chaude et convaincante ? Il n’était pas homme à plaider l’innocence d’un scélérat dont la culpabilité ne faisait aucun doute. Mais, il découvrait des circonstances atténuantes qui, parfois, lui permirent de sauver des têtes condamnées à l’avance. Quand il plaidait l’acquittement, c’est que sa conviction était faite. Il est mort au tribunal même en demandant grâce pour un assassin qui avait été son ami et que des revers de commerce avaient poussé au vol, puis au crime, conséquence du vol. Foudroyé par l’apoplexie, il n’a même pas su que ses dernières paroles avaient encore sauvé une tête…
– Une tête de scélérat, dites-vous ? demanda Roger Laroque, dont le visage s’était couvert d’une pâleur cadavérique.
– Hélas ! oui ! Du moins, je le crois. Du reste, ce malheureux qui s’appelait Roger Laroque et que le peuple a baptisé du nom de Roger-la-Honte, s’est échappé du bagne et, depuis, on n’a jamais plus entendu parler de lui. S’il avait pu prouver son innocence, il n’y aurait certes pas manqué.
Ce que Roger Laroque souffrait en entendant parler de lui par le fils de Lucien de Noirville, nous ne saurions l’exprimer.
Comme il aurait voulu pouvoir s’écrier :
– Ne blasphémez pas, jeune homme. Le prétendu scélérat qui, hélas a hâté la mort de votre père, est innocent. En voici la preuve.
La preuve ! À qui donc pourrait-il la fournir, la preuve ? À Raymond de Noirville, fils de Julia, encore moins qu’à tout autre.
Ah ! l’horrible situation !
Roger donna au jeune homme tous les renseignements dont il avait besoin et lui offrit même de lui prêter le secours de sa bourse, pour son voyage.
Raymond refusa ce concours. Il n’était pas riche, mais son intention était de vivre sans aucun luxe.
– Le travail, ajouta-t-il, est encore ce qu’il y a de moins coûteux au monde.
– Et quand partez-vous ? demanda Farney.
– Le plus tôt possible : le temps de préparer ma mère à cette séparation, d’autant plus cruelle pour elle que mon frère, Pierre, est également décidé à quitter la France. Il a le goût des voyages et nourrit l’ambition de participer à une mission géographique.
CHAPITRE XXVI
Il y avait à peine une heure que MM. Lacroix et Chambille avaient quitté la banque Terrenoire, quand deux hommes se présentèrent à la porte d’entrée des bureaux et frappèrent vigoureusement, pour se faire ouvrir.
L’un des gardiens de la paix se présenta.
– On n’entre pas. Les bureaux sont fermés, dit-il. Que désirez-vous ?
L’un des deux hommes déplia une lettre sans prononcer une parole, et la fit passer sous le nez du sergent de ville, lequel s’inclina, après avoir reconnu le timbre de la préfecture et la signature du chef de la police de sûreté.
Ces deux personnages étaient Tristot et Pivolot. Ils n’étaient point parents, et cependant, par une bizarrerie de la nature, ils se ressemblaient comme s’ils eussent été frères. Grands, maigres, dégingandés, osseux, les jambes démesurées, la figure pointue et sans barbe, les cheveux grisonnants coupés ras, tels ils étaient.
Ils avaient l’air de deux employés jaunis sur les paperasses et ankylosés sur les ronds de cuir. Ils avaient à peu près le même âge, c’est-à-dire une quarantaine d’années environ.
Depuis longtemps la conformité de goûts, d’humeur, les mêmes bizarreries ; peut-être cette ressemblance, cet air de famille, les avaient rapprochés et avaient fait d’eux des amis inséparables.
Rentiers tous les deux, presque riches, indépendants, garçons, sans famille ni liaison, ils vivaient à leur guise, mais la vie leur eût paru sans doute monotone et lourde sans une étrange passion qui leur travaillait l’esprit à tous deux.
Ils avaient voulu faire la police, en amateurs, par goût. Peu à peu, cette idée était entrée profondément dans leur cervelle inactive. Ils désiraient travailler, mais pour eux, en amateurs, tout en essayant d’être utiles.
Les difficultés mêmes qu’ils rencontrèrent au début, chaque fois qu’ils se heurtèrent dans leurs enquêtes, à la police, au lieu de les arrêter, ne firent que les surexciter.
Les agents du quai des Orfèvres ne tardèrent pas à entendre parler d’eux et à les connaître.
Après avoir reçu de fortes admonestations, du chef de la sûreté, Tristot et Pivolot, en plusieurs circonstances, finirent par rendre de si réels services qu’on les écouta.
Ces deux étranges bonshommes étaient doués d’une pénétration singulière, d’un flair étonnant, d’un esprit d’observation très développé.
Par trois fois la police s’était égarée sur des fausses pistes, dans des affaires très graves et qui attiraient l’attention du public, et par trois fois c’étaient Tristot et Pivolot qui l’avaient sauvée d’un humiliant insuccès.
Depuis lors, libres de s’adonner à leur manie, ne craignant plus d’être arrêtés, en pleine enquête, par un ordre péremptoire de la préfecture, Tristot et Pivolot vivaient heureux. Seulement, ils s’étaient fait des jalousies et des inimitiés nombreuses à la préfecture.
Parmi ces jaloux et ces ennemis, le plus ardent, le plus implacable, certes, était le gros Chambille.
Tristot, un jour, l’avait dit à Pivolot :
– Chambille est capable de faire couper le cou à un innocent pour nous donner tort et nous jouer un mauvais tour !
Aussi, chaque fois qu’ils savaient Chambille occupé d’une enquête – et, étant connue son habileté, on ne le chargeait guère que des affaires les plus graves – les deux compères redoublaient de prudence.
C’était entre eux et l’agent, une lutte sourde, où personne ne comptait les coups, à la vérité, mais qui n’en était pas moins redoutable, puisqu’elle se livrait sur un terrain dangereux et qu’elle avait pour enjeu la vie ou la liberté d’un homme, souvent d’un coupable, parfois d’un innocent.
......................
Le gardien de la paix ayant lu la lettre, qui était un laissez-passer de la préfecture, s’effaça.
Tristot et Pivolot entrèrent, clignant les yeux, comme pour concentrer les rayons visuels sur tout ce qui les entourait, et ayant un léger et singulier mouvement de narines, comme s’ils avaient voulu aspirer une odeur de crime.
Les deux sergents de ville laissés auprès du cadavre par M. Lacroix avaient suffisamment vu et entendu, pendant la première enquête, pour mettre les compères au courant. Et, les prenant pour des agents secrets de la préfecture, ils ne refusèrent point de leur donner tous les renseignements possibles.
Tristot et Pivolot surent donc vite les principaux détails – l’attitude singulière de Guerrier – son irritation à certaines allusions du commissaire – l’arrestation de Béjaud et les indices qui avaient amené cette arrestation.
Alors, sans se dire un mot, comme s’ils ne se fussent pas connus, ou plutôt pareils à des visiteurs qui, se rencontrant dans un monument ou dans un musée, entreprennent une promenade chacun de leur côté, Tristot et Pivolot, peu soucieux de la stupéfaction des sergents de ville, se séparèrent, se tournant le dos. Ils allaient à leur guise, ici où là, flairant et furetant suivant leurs inspirations.
Pendant qu’ils étaient là, le médecin commis par le commissaire de police arriva et fit l’examen du cadavre – se réservant de pratiquer plus tard l’autopsie, s’il y avait lieu.
Le médecin constatait la mort, arrivée d’une façon foudroyante, à la suite de la section de la carotide. Il y avait eu une courte lutte ; des ecchymoses se voyaient aux avant-bras de la victime. La mort remontait à deux heures du matin environ.
Il signa, parapha, plia le rapport, demanda d’un ton indifférent si l’on savait qui avait fait le coup et s’en alla sans même attendre la réponse.
Après avoir examiné les serrures, la caisse, les malles de Béjaud et de Brignolet, les papiers, le toit, la situation des bureaux, de la maison, des chambres des domestiques, enfin après avoir tout vu, Tristot et Pivolot, prirent congé des agents, demandèrent au concierge l’adresse de Jean Guerrier, de M. de Terrenoire, de la femme de Brignolet et de celle de Béjaud ainsi que quelques renseignements sur les habitudes de vivre de Béjaud et de Brignolet.
......................
Quand ils s’arrêtèrent au premier étage, occupé par Tristot, d’une maison de la rue de Douai leur appartenant et, quand ils furent installés confortablement devant deux tasses de chocolat qu’on leur servit aussitôt, il parut à certains signes qu’ils allaient enfin se décider à parler.
– Quelle est votre opinion, monsieur Pivolot ?
Ces deux bizarres originaux ne se tutoyaient jamais et ne se parlaient qu’avec la plus extrême politesse, comme s’ils n’avaient pas mis à l’épreuve, de longue date, leur caractère débonnaire, et s’ils avaient craint qu’un froissement quelconque n’altérât leur amitié.
Pivolot mit quelque temps à répondre.
– Mon cher monsieur Tristot, le coup est fait par un bonhomme qui nous donnera du fil à retordre. Et si nous ne le pinçons pas, ça ne sera pas Chambille qui le pincera. Je regrette, monsieur Tristot, de ne pouvoir vous exprimer une autre opinion. Puis-je connaître la vôtre ?
– Exactement pareille, Monsieur. Impossible de me prononcer avant quelques heures ; Chambille a une chance contre nous : l’arrestation de Béjaud…
– Béjaud est-il complice ? Cela n’est pas certain.
– Nous le saurons peut-être avant la fin de la journée.
– Qu’avez-vous observé, boulevard Haussmann ?
– Voici. Je passe sur les détails que vous connaissez qui sautaient à nos yeux et qui ont dû faire la joie de ce pauvre Chambille. Guerrier a prétendu qu’il s’était endormi brusquement, en laissant la caisse ouverte.
« Cela est vrai ! Autrement, en supposant même qu’il fût le voleur, pour écarter les soupçons, il aurait marqué la caisse de traces d’effraction. L’histoire de son sommeil est si invraisemblable, si incroyable qu’elle doit être véridique. Supposons qu’il soit coupable, comme l’en soupçonne monsieur Lacroix, comme beaucoup de choses le font croire. Que devait-il faire ? D’abord, rien ne lui était plus facile que de voler sans assassiner. Puis, le vol commis, la caisse refermée et sillonnée d’éraflures, rien ne lui était plus facile que de partir, comme il l’eût fait s’il ne s’était point endormi. Il est tellement incroyable qu’un assassin attende ainsi la justice, sans avoir une histoire toute prête, que je ne comprends pas monsieur Lacroix de s’être arrêté un instant à croire cette chose possible.
– Et Béjaud ?
– Béjaud, je le réserve. Je verrai plus tard. Que pensez-vous de ce que je viens de vous dire, Monsieur ?
– Sans être aussi affirmatif, je crois, comme vous, Monsieur, que le coup a été fait en dehors… Et cependant rien ne le prouve. Toutefois, quelques indices m’ont frappé, qui me semblent se contredire entre eux. Par exemple, j’ai remarqué que le caissier devait être très agité, car il s’est promené dans son bureau de long en large assez souvent – on voit des traces de pas, qui sont récentes, puisqu’il a plu seulement hier, vers neuf heures du soir et, que Guerrier est venu à la caisse vers dix heures. Pensait-il aux affaires de son patron, à ses affaires particulières ou à autre chose ? Je l’ignore. Mais l’agitation est évidente. Guerrier a voulu fumer. Il a allumé des cigares, il les a laissés s’éteindre, tant sa préoccupation l’obsédait, et les a jetés pour en rallumer d’autres. J’ai ramassé les cigares que monsieur Chambille a oubliés. Les voici.
– J’ai fait la même observation, et j’ai remarqué, comme vous, la contradiction qui existe entre cette fièvre apparente et le calme d’esprit que dénote le fait suivant : monsieur Guerrier était venu à son bureau pour s’occuper, à la veille des versements importants, d’un travail de contrôle et de révision très aride qui nécessitait la concentration de son esprit et une entière liberté de son jugement. J’ai examiné les papiers épars sur son bureau. Ces papiers représentent la besogne accomplie la nuit par le caissier. Tout est en règle.
« Je n’y ai point vu d’erreurs. Il y a là un effort d’intelligence réel. Je ne crois pas un homme capable d’un pareil effort, cinq minutes avant de commettre le crime dont nous parlons. Donc, du côté des cigares, agitation, fièvre ; du côté du travail, des papiers et des chiffres, calme d’esprit, tranquillité, sang-froid. Donc, contradiction.
– Après tout, s’il a allumé tant de cigares, c’est peut-être qu’il les trouvait mauvais !…
Et, cela dit avec philosophie, M. Pivolot choisit dans une boîte un de ces petits havanes délicieux de ceux qu’on nomme : Veni, vidi, vici…
– Allons voir Guerrier, dit-il, nous le jugerons mieux.
Cependant, M. Lacroix avait transmis un rapport détaillé au parquet en même temps qu’il envoyait Béjaud au dépôt.
Puis, sans perdre une minute, il avait essayé de compléter son enquête. Dans la soirée, alors que ses renseignements étaient très complets, il fut appelé au parquet, où il eut une longue conférence avec le juge d’instruction, M. de Lignerolles, commis à cette affaire.
M. de Lignerolles ! Ce magistrat qui avait recommencé, à Versailles, pour Roger Laroque et Suzanne, la torture morale inaugurée par le policier Lacroix.
Toute la nuit qui suivit, deux hommes stationnèrent dans la rue de Châteaudun, devant les fenêtres de l’appartement habité par Jean Guerrier.
De ces deux hommes, l’un était Chambille.
Au matin, Chambille seul entra. L’agent qui l’accompagnait s’en alla au commissariat de police et revint presque aussitôt avec M. Lacroix, qui, sous son paletot, avait passé son écharpe tricolore.
Magistrats et agents montèrent.
CHAPITRE XXVII
Lacroix frappa à la porte du logement. Une bonne vint ouvrir et introduisit les trois hommes.
– Monsieur Jean Guerrier ?
– Que faut-il que j’annonce à Monsieur ?
M. Lacroix déclina ses nom et qualité.
Un instant après, Guerrier arrivait, et, saluant :
– Vous avez besoin de moi, Monsieur, sans doute pour un supplément d’enquête ? Je suis à votre disposition.
– Monsieur, dit le commissaire de police, je me vois dans l’obligation de vous arrêter.
Guerrier devint pâle, mais ne se troubla point.
– M’arrêter ? Moi ? Quelle plaisanterie ?
– Ai-je l’air de plaisanter ? dit froidement Lacroix.
– Songez, Monsieur, que c’est le déshonneur pour moi qu’une arrestation, dût-elle être reconnue injuste. On n’attente pas à la liberté d’un homme sans un motif grave.
– Vos appréciations ne me touchent pas, dit le magistrat, avec un sourire. J’agis contre vous de par l’ordre du parquet. C’est monsieur de Lignerolles qui a signé le mandat d’arrêt.
– Nous ne vivons pas, heureusement, à une époque où il soit défendu de s’élever contre un pareil abus d’autorité. Pour m’arrêter, il faut un motif. Et si je suis le caissier de monsieur de Terrenoire, si l’on a volé un million dans la caisse, ce n’est pas une raison pour me croire coupable.
– Les raisons existent, Monsieur.
– Puis-je les connaître ?
– Certes. Il ne m’appartient pas de vous les apprendre. Du reste, vous comparaîtrez aujourd’hui devant monsieur de Lignerolles, qui vous éclairera.
Guerrier haussa les épaules d’un air impatienté. Il paraissait fort triste et non surpris.
Lacroix le remarqua.
– Je connais trop les hommes pour ne pas être sûr que vous vous attendiez à cette arrestation, dit-il.
– Et vous ne vous trompez pas. Je m’y attendais.
– Vous le voyez bien !
– J’ai été prévenu, il y a deux heures, par deux personnes qui s’occupent de cette affaire que, très probablement, le parquet m’arrêterait.
– Deux hommes ?
– Tristot et Pivolot. Bizarres êtres, mais très intelligents et très fins.
Chambille n’avait pas dissimulé un geste de colère. Sa figure rouge était devenue blanche.
– J’ai entendu parler de ces personnages, fit Lacroix avec dédain. En vous prévenant, ils vous ont tendu un piège grossier, dans lequel vous n’êtes pas tombé… Si vous aviez essayé de fuir, n’était-ce pas vous déclarer coupable ?… Vous n’auriez pas été au chemin de fer que l’on vous eût arrêté… n’est-ce pas Chambille ?
– Assurément, monsieur Lacroix, dit le gros agent, c’est moi qui vous le dis…
– Cependant, on pouvait entrer ici et en sortir sans que vous le remarquassiez, témoin Tristot et Pivolot, que vous semblez connaître et que vous n’avez pas vus.
Chambille se mordit les lèvres.
– Êtes-vous prêt à me suivre ? demanda M. Lacroix.
– Je suis prêt.
– Bien. Avant de partir, cependant, je suis obligé de faire une perquisition dans votre appartement. Veuillez me précéder et me conduire dans toutes les pièces.
– Laissez-moi prévenir ma femme et mon beau-père, qui ne s’attendent pas, eux, à une aussi fâcheuse nouvelle.
Le commissaire de police hésita.
Jean Guerrier le regardait avec un mélancolique sourire, et il dit avec une nuance de dédain :
– Je vois que vos ordres sont très précis et que je passe à vos yeux pour un dangereux malfaiteur, puisque vous tremblez de me laisser seul. Je vous prie donc soit de m’accompagner, soit de me faire suivre par un de vos agents.
Mais, au moment où il allait sortir, suivi de Chambille, Marie-Louise et Margival, prévenus par la bonne de la présence de la police, entrèrent.
Marie-Louise se précipita vers Guerrier, mue par le pressentiment d’un malheur.
– Que se passe-t-il ?… Que te veut-on ?
– Ma chère enfant, dit le jeune homme, je suis forcé de me rendre à l’instant même au parquet, où l’on a besoin de moi… Ne te désole pas, ma chérie, je reviendrai bientôt. Toute cette affaire se présentant comme très mystérieuse, la justice va un peu à tort et à travers, et ne sait trop où donner de la tête.
– Monsieur ! voulut interrompre le commissaire…
– C’est mon opinion, dit froidement Guerrier.
Et, se tournant vers Marie-Louise :
– Le parquet s’imagine que je suis coupable ou complice, et a ordonné mon arrestation.
– On t’arrête ? dit Marie-Louise, en se jetant à son cou, comme pour le défendre.
– C’est une folie ! dit Margival avec violence. Le parquet a perdu la tête.
– Restez calmes, reprit Guerrier, imitez-moi.
« Ma chère enfant, aie l’obligeance d’aller prévenir M. de Terrenoire de ce qui arrive. Monsieur Margival, accompagnez-la, s’il vous plaît.
Ils se préparaient à sortir : Guerrier les retint d’un geste.
– Tout à l’heure, quand la perquisition sera faite.
– Une perquisition ?… Ici ?… chez moi ?…
Et Marie-Louise, anéantie, se laissa tomber sur une chaise… prise de faiblesse.
Margival la soutint dans ses bras, essaya de la réconforter ; mais elle éclata en sanglots.
La perquisition fut à peu près inutile.
Et ils allaient s’en aller, Chambille assez déconfit et mécontent, lorsque M. Lacroix, qui se trouvait alors dans la chambre particulière de Marie-Louise, voulut se faire ouvrir un petit meuble précieux incrusté de laque et d’ivoire, cadeau du banquier, où la jeune femme mettait sa correspondance.
Il y avait deux ou trois tiroirs fermés à clé.
Marie-Louise avait les clés sur elle.
Jean Guerrier fronça le sourcil.
– Monsieur, dit-il, je souffre beaucoup de tout ce que je vois depuis un quart d’heure. Vos recherches restent infructueuses, et ce n’est pas dans ces petits tiroirs que vous trouverez le million que vous cherchez. Tout ce qui est ici appartient à ma femme. Veuillez respecter ces choses comme je les respecte moi-même. C’est souiller certaines intimités que d’y admettre un tiers.
– Je regrette de ne pouvoir vous être agréable.
Et M. Lacroix, s’adressant à Chambille :
– Allez prier madame Guerrier de vous donner les clés de ce petit meuble.
– Monsieur, dit le caissier, très pâle, quand l’agent fut parti, il n’y a là que des lettres…
– Je dois tout voir…
– Des lettres, des souvenirs… toute l’histoire de notre mariage..
– Si je ne trouve que cela, je n’emporterai rien… Mais il pourrait se faire qu’il y eût autre chose !
Chambille revint, apportant les clés.
Il finit, après avoir compulsé des paperasses, par rencontrer une liasse de lettres pliées ensemble par un cordonnet, et, dans le même tiroir, d’autres lettres, plus récentes, de la même écriture.
M. Lacroix courut à la signature tout de suite.
Ces lettres étaient signées : Terrenoire.
Il dénoua le cordon et en lut quelques-unes ; il y avait là une correspondance très intime, échangée entre la jeune femme et le banquier.
La plupart étaient datées d’avant le mariage ; cinq ou six, cependant, portaient une date ultérieure ; mais c’étaient, celles-ci, des billets assez laconiques, annonçant une absence momentanée, s’excusant, ou contenant des invitations.
– C’est très bien ! murmura-t-il, on ne m’a pas trompé, et monsieur de Lignerolles aussi n’avait pas tort.
Il n’avait plus rien à chercher sans doute, car il referma les tiroirs.
Seulement, chose étrange, et qui arracha un geste de surprise à Jean Guerrier, ayant rencontré une liasse de factures acquittées de divers tapissiers, marchands de bibelots, d’objets d’art ou bijoutiers, Lacroix s’en empara.
– Ces factures sont payées, ne put s’empêcher de faire observer Guerrier ; elles portent toutes le timbre de quittance. Je ne vois pas de quel intérêt elles peuvent être pour vous ?
– D’un grand intérêt, Monsieur ; vous devez me comprendre à demi-mot…
– Non, je l’avoue.
– Patience, vous comprendrez. Mais je n’ai plus rien à faire ici. Descendons.
– Je vous suis.
Guerrier attira sa femme dans ses bras, lui mit un baiser sur le front, essayant de paraître gai, bien qu’il fût assailli de tristes pressentiments.
Marie-Louise pleurait.
Un instant, le caissier se rappela ses soupçons, qui l’avaient tant fait souffrir, et, devant ce désespoir profond, il doutait.
– Est-il possible qu’elle dissimule à ce point ? Si elle me trompait, mon arrestation, en lui rendant la liberté, devrait la combler de joie ; aurait-elle la force de la cacher ?
Et, brusquement – comme s’il eût rougi, dans le fond de son cœur, de l’avoir soupçonnée – il l’embrassa derechef, longuement et passionnément.
Il serra la main de Margival et partit.
En bas, Lacroix arrêta un fiacre. Il y prenait place avec Chambille et Guerrier, lorsqu’un homme s’arrêta devant eux.
Cet homme n’était autre que William Farney, qui, inquiet de Guerrier, arrivait de Maison-Blanche.
Du premier coup d’œil, Roger avait reconnu le magistrat bourreau de Suzanne, l’instrument de sa perte. Lacroix, qui, pourtant, observait les allures mystérieuses de l’arrivant, n’avait pas reconnu sa victime.
– Quoi ? Qu’y a-t-il ? demanda Roger à Guerrier, sur un ton qui signifiait : « Toi aussi, te voilà la proie de ce sinistre policier qui m’a fait envoyer au bagne, a causé la mort de ma femme et a failli rendre folle ma Suzanne ! »
– Il y a, s’écria Jean, que je suis accusé d’un assassinat.
Roger faillit tomber à la renverse.
L’idée lui vint un instant de sauter à la gorge de Lacroix. Mais à quoi bon ? Il se fût perdu lui-même sans réussir à sauver Guerrier.
Lacroix dévisageait l’étranger.
– Quel est ce monsieur ? dit-il à l’inculpé.
– Ce monsieur, répondit Jean, est un Américain du nom de William Farney, cinq fois millionnaire. En sa qualité d’étranger, il ne lit jamais nos journaux. Aussi ignore-t-il l’assassinat de ce pauvre Brignolet.
– Où avez-vous connu ce monsieur ? demanda Lacroix.
– J’ai connu ce monsieur chez monsieur de Terrenoire, mon patron. Je vous en prie, monsieur Farney, ne vous attardez pas à gémir sur mon sort. Le juge me relâchera tout à l’heure, ou bien il n’y a plus de justice à Paris.
Guerrier monta dans le fiacre, où il prit place en face de Chambille, à côté de M. Lacroix.
Roger eut assez de force de caractère pour ne pas se trahir. Il salua de la main cet ami que la fatalité faisait tomber comme lui sous les griffes de la justice, et entra dans la maison, où, un instant après, il apprenait, de la bouche de Margival, devant Marie-Louise abîmée dans sa douleur, toute l’horrible vérité.
Quant à Guerrier, en apprenant qu’on le conduisait au dépôt, il ne put s’empêcher de dire :
– J’avais espéré qu’on me ferait comparaître immédiatement devant monsieur de Lignerolles. De cette façon, et sans passer par le dépôt, j’aurais pu être remis en liberté, après les explications que je donnerai ?
M. Lacroix ne répondit pas.
Dans le courant de la journée, deux gardes conduisirent Guerrier au Palais, par d’étroits couloirs.
Il fut introduit dans le cabinet du juge.
CHAPITRE XXVIII
L’hiver passa, Suzanne et Raymond ne se revirent qu’à de rares intervalles. Cependant, ils s’aimaient de plus en plus. L’absence, l’éloignement, loin de diminuer leurs regrets, les augmentaient au contraire.
Et, à chaque rencontre, quand les deux jeunes gens se trouvaient isolés et qu’on ne pouvait les voir, ils se pressaient les mains furtivement et Raymond demandait à voix basse :
– Vous m’aimez ?
– Je vous aime plus que je ne vous ai jamais aimé ! disait Suzanne.
– Et cet obstacle existe-t-il toujours ?
– Toujours.
– Ainsi…
– Je ne puis être votre femme…
Il baissait la tête, désespéré, se torturant l’esprit. Elle le consolait, chaque fois, d’un mot :
– Je ne serai jamais non plus la femme d’un autre…
Cette promesse apaisait sa jalousie, mais ne la consolait pas. Son amour, même, avait fini par s’en irriter. Son imagination travaillait. L’obstination de la jeune fille à ne rien lui expliquer de ce mystère dont elle entourait son refus lui donnait de mauvaises pensées.
Julia était trop perspicace et adorait trop Raymond pour ne pas avoir deviné, de longue date, l’amour des deux jeunes gens. Son regard vigilant avait surpris les demi-mots, les demi-aveux, les serrements de mains à la dérobée.
Elle ne doutait plus.
Ce qui la surprenait et l’attristait, c’était le silence de Raymond à son égard. À plusieurs reprises, elle avait voulu, dans l’intimité, par quelques allusions discrètes et maternelles, toucher à ce culte mystérieux, et elle s’était heurtée contre un entêtement étrange à ne rien dire.
......................
Le printemps était revenu.
Un jour de gai soleil, Julia s’habilla. Elle était toujours vêtue de noir, toujours en deuil. Elle avait fait atteler le cheval à la carriole et elle était sur le point de sortir quand Pierre, son fils aîné, entra.
Il semblait très agité. Son visage était animé, son teint fiévreux.
– Ma mère, dit-il, je voudrais vous parler.
– Quoi donc ? fit-elle. Qu’y a-t-il ? J’allais sortir… Mais…
– Vous alliez sortir ? Je l’ignorais… À votre retour…
– Mais non, tu as l’air trop sérieux, mon enfant… Je veux entendre tout de suite ce que tu as à me confier. Qu’arrive-t-il ?
Tout à coup, il sembla faire un effort sur lui-même, et, d’une voix qu’une violente émotion intérieure rendait tremblante :
– Ma mère, je voudrais me marier…
– Je trouve cela très naturel, mon enfant. Tu es en âge de prendre une femme. Ainsi, tu es amoureux et tu me la cachais ? As-tu bien choisi, au moins ?
– Oh ! ma mère, la plus mignonne et la plus adorable créature qu’on puisse rêver… Jolie au point que cela est presque invraisemblable, bonne, j’en suis sûr, élégante, cela se voit, distinguée et instruite, on n’a qu’à l’écouter pour s’en rendre compte.
– Elle est donc parfaite ? fit Julia en souriant. t
– Elle est parfaite, ma mère, puisque je l’aime.
– C’est vrai. Et je la connais ?
– Oui.
– Tu me fais languir… Parmi les jeunes filles que je connais, celle-là n’aurait-elle pas eu le don de me plaire ?…,
– Au contraire, elle vous plaît…
– Son nom !… Dis vite son nom…
– C’est… c’est mademoiselle Farney, ma mère.
– Suzanne ? Elle ?… Elle ?…
– Je l’aime… je l’aime depuis longtemps… Je l’aime à en devenir fou ! c’est Suzanne, ma mère.
Julia était très pâle.
Et, tout à coup, son visage prit une expression de dureté que son fils ne lui avait jamais vue.
– Eh bien ! mon fils, que veux-tu que je fasse et que je dise ? Cet amour est une folie. Mais tu n’aimes pas sérieusement. Il n’y faut plus penser.
– Hélas ! puis-je commander à mes souvenirs, à mon cœur ?
– Enfin, mon ami, que désires-tu ? Que demandes-tu ?
– Je voudrais que vous alliez trouver monsieur Farney et que vous lui disiez la vérité. Je saurai si mon amour est agréé de Suzanne et si je dois me présenter et faire ma cour.
Mme de Noirville réfléchissait. Une crainte lui venait. Est-ce que, par hasard, ce serait Pierre, et non point Raymond, que Mlle Farney aimerait ?
– Oh ! je veux le savoir ! dit-elle.
Et elle interrogea son fils.
– Que s’est-il passé entre elle et toi ?
– Rien, ma mère.
– Vous vous êtes vus souvent ?
– Non, rarement, au contraire… Je sais si bien que nous sommes séparés par des obstacles presque infranchissables qui viennent de la supériorité de sa fortune, que j’ai fait tout mon possible pour l’éviter, afin de moins souffrir…
– Eh bien ?
– J’ai souffert un peu plus, voilà tout. À présent, je n’y peux tenir. Et voilà pourquoi je suis venu vous trouver.
– C’est un malheur, c’est un grand malheur, murmura Julia en passant la main sur son front.
« Écoute les conseils de ta mère, mon enfant. Ce n’est point une femme comme celle-là qui te conviendrait.
– Pourquoi ? Je vous ai maintes fois entendue vanter ses qualités.
– Certes, elle est bonne et intelligente, mais elle a reçu une éducation très raffinée, elle se trouverait mal dans une ferme… C’est une fille élevée pour le luxe, pour le monde, pour Paris, enfin !
– Mais elle adore la campagne, et va rarement à Paris.
– Une fois mariée, cela changera.
– C’est une conjecture. Vous vous trompez peut-être, ma mère.
Elle dit d’un ton plus sec :
– Il te faut, à toi, une femme qui soit plus terre à terre, qui ait des goûts plus simples – tout en ayant une solide instruction –, il te faut moins d’élégance et plus de sérieux…
– Je crois que vous vous trompez sur son caractère. Elle est sérieuse et non pas frivole. Oh ! ma mère, je vais bien souffrir !…
Il appuya sa tête énergique contre l’épaule de Julia, cherchant une protection auprès du cœur de sa mère qu’il aurait voulu trouver plus chaud, afin de se raviver à ce foyer d’affection.
Mais Julia pensait à Raymond.
On eut besoin de Pierre à la ferme. Il sortit. Quelques instants après, Mme de Noirville montait en voiture et s’éloignait.
Laroque était à Maison-Blanche lorsqu’elle y arriva.
Suzanne se trouvait dans le jardin, travaillant à des fleurs, avec le jardinier. De loin, quand elle aperçut Mme de Noirville, elle accourut pour la saluer.
Julia la regarda avec un fin sourire.
– Votre père est ici, mon enfant ? dit-elle.
– Oui, Madame, et il sera bien heureux de vous voir.
– J’ai à causer très longuement avec lui.
Et après un silence, lui serrant la main avec un geste significatif :
– Il va être question de vous Suzanne !…
– De moi ? dit-elle sans comprendre.
Puis elle crut deviner la pensée de Julia derrière son sourire.
Elle se troubla, et les vives couleurs qui animaient son visage, égayé par le travail et le grand air, disparurent soudain…
– Mon Dieu ! dit-elle, que va-t-il se passer ?
Et elle suivit des yeux, avec une sorte d’épouvante, la mère de Raymond qui entrait au château.
On annonça Mme de Noirville à Roger Laroque.
– Monsieur Farney, dit la veuve, après les compliments d’usage, ma visite d’aujourd’hui n’est pas seulement une visite de voisinage ou de politesse.
Ce préambule fit lever la tête de Roger.
– Elle a un but intéressé, poursuivit Julia. Et je vais droit au but, en vous priant toutefois d’excuser mon trouble et l’agitation où vous me voyez… une agitation qui vous semblera très naturelle quand je vous aurai dit que le bonheur d’un de mes fils dépend de ce que je vais vous demander et de ce que vous allez me répondre.
– Parlez, Madame, dit Farney, légèrement inquiet.
– Mon fils Raymond aime votre fille, Monsieur – j’ai cru remarquer que Suzanne aime mon fils –, je viens vous prier de ne pas vous opposer à leur bonheur et j’ai l’honneur de solliciter pour Raymond la main de mademoiselle Farney…
Aux premiers mots, Laroque s’était dressé brusquement. Cela était si inattendu – il était si loin de se douter – que l’émotion, au premier moment, l’empêcha de parler.
À la fin, il dit, d’une voix rauque, presque méconnaissable :
– Mais c’est impossible !… c’est impossible !…
– Monsieur Farney, dit Julia, mon fils ne m’a pas avoué cet amour, car il se rend compte assurément de la différence de nos fortunes, et il craint sans doute, qu’un soupçon ne vienne effleurer sa délicatesse.
– Alors, comment avez-vous pénétré son secret ?
– Comment, ce serait trop long à vous le dire. Qu’il vous suffise de savoir que je le sais… Et Suzanne l’aime… Je suis certaine qu’ils connaissent leur amour réciproque et qu’ils en souffrent… Voilà pourquoi j’ai pris sur moi de venir vous trouver pour tout vous dire, car de vous seul dépend l’avenir de ces deux pauvres enfants…
– Soit, votre fils l’aime… Cela se peut… Cela devait arriver… J’aurais dû prévoir… J’aurais dû empêcher… Mais ma fille, Suzanne… Si elle l’aimait, elle me l’eût dit… Comment savez-vous… ?
– J’ai surpris bien des étreintes, de leurs mains réunies, j’ai vu bien des soupirs, à demi retenus, et bien des aveux dans des adieux que les lèvres faisaient très froids, mais que les yeux démentaient…
– Et moi, moi, je n’ai rien vu, rien !… Et je doute encore ! ! !
– Interrogez votre fille. Elle ne vous mentira pas.
« Oui, dit-il, se parlant à lui-même, je l’interrogerai plus tard. »
– Nos situations sont loin d’être égales, dit Julia, je ne me fais pas d’illusions à cet égard, et je n’aurais jamais consenti à demander la main de Suzanne pour mon fils Pierre, qui vit près de moi, et n’a point d’ambition. Mais Raymond, tout le monde le dit, sera, est déjà l’un des meilleurs avocats du barreau de Paris. Son père à défaut d’une grande fortune, lui a laissé le don magnifique de la parole, et Raymond surpassera la célébrité de son père… que vous devez connaître de réputation, monsieur Farney ?
– En effet, Madame… sa réputation est venue jusqu’en Amérique… et même on a raconté, sur sa mort, je ne sais quelle poignante histoire…
– Ah ! vous savez cela aussi, dit-elle, d’une voix subitement altérée…
– N’est-il pas mort au milieu d’une admirable plaidoirie en faveur d’un de ses amis accusé de… de vol, je crois, d’assassinat ?…
– Oui… d’un ami et d’un frère d’armes.
– Il le proclamait innocent… paraît-il ?
– Il l’était, Monsieur… il l’était… Lucien l’a dit hautement…
– Cet homme a été condamné, cependant ?
– Ce n’est point la première erreur que la justice ait commise…
– Et qu’est-il devenu ? On ne l’a pas gracié ?
– Il est mort dans une tentative d’évasion.
Elle baissa la tête. Une faiblesse la prenait. Elle chancela sur sa chaise. Il se précipita pour la retenir. Elle fût tombée sans lui.
– Qu’avez-vous, Madame ?
– Rien, un éblouissement, c’est fini. Il est certains souvenirs qu’on n’évoque jamais sans danger…, dit-elle d’un ton étrange.
Ils firent silence. Puis, un peu remise et cherchant le regard de Roger :
– Ainsi, Monsieur, dit-elle… vous voulez le malheur de mon fils, le malheur de votre chère fille !… Vous refusez ?…
Il se promenait de long en large dans le salon. Il ne répondit pas. On eût juré qu’il n’avait pas entendu !…
Non, il ne répondait pas et son esprit était déjà loin.
C’est qu’il venait de revoir tout le passé, avec ses plus dramatiques, comme avec ses plus insignifiants incidents.
Et il se rappelait alors quelques-uns de ses remords d’autrefois, et aussi quelques-uns de ses rêves.
Ne s’était-il pas dit souvent :
« Pour rendre Lucien heureux, pour effacer autant que possible entre nous tout mauvais souvenir, que ne ferais-je !… N’ai-je pas tout tenté ? J’aurais sacrifié ma vie avec joie… J’ai cherché l’occasion de plus d’un dévouement !… Et, au lieu d’un dévouement qui lui eût donné le bonheur ou sauvé la vie, c’est moi qui suis cause de sa mort… C’est en apprenant ma faute et la faute de sa femme qu’il est mort !… Je reste coupable envers sa mémoire ! »
Et Julia, Julia ! – étrange caprice, d’un inexplicable hasard –, venait lui demander aujourd’hui, après tant d’années, la main de Suzanne pour un de ses fils !… De Suzanne, sa fille chérie, sa vie, sa joie, son orgueil !… de Suzanne, que son affection jalouse s’était plu à parer de toutes les qualités, de toutes les vertus !… de Suzanne, ce trésor parfait qui devait rendre heureux, à coup sûr, l’homme qui la posséderait.
N’y avait-il pas dans tout cela une intervention supérieure dont la pensée était évidente et l’illuminait maintenant, pour ainsi dire, de rayons, où il voyait nettement la vérité ?
Puisque Suzanne était parfaite, puisque ce trésor de bonté, de candeur et de grâce, devait faire le bonheur de Raymond, n’était-ce pas une suprême réparation de la faute d’autrefois – une réparation adressée à la mémoire de Lucien ?…
– Oui, dit-il tout haut – et Mme de Noirville qui entendit le regarda sans comprendre –, là est le devoir ! Je n’y faillirai pas !
Et, mentalement, s’apercevant qu’il avait parlé haut :
« Lucien, je t’ai causé jadis la plus atroce douleur qu’il soit possible à un homme de souffrir – je n’ai pu te demander pardon et tu ne m’eusses point pardonné… Aujourd’hui, je vais me séparer de ce que j’ai de plus cher pour le donner à un de tes fils… parce que je suis sûr que Suzanne est la jeune fille que tu aurais rêvée pour tes enfants, – ce n’est ni à Julia, ni à Raymond que je la donne, – c’est à toi, Lucien, mon ami, à toi pour que, là où tu es, tu oublies ! »
Il était redevenu calme. Il s’arrêta de marcher.
Julia devina qu’il avait pris sa résolution. Elle eut peur :
– Je vous en prie, Monsieur, dit-elle encore, avant de refuser, pensez au désespoir de nos enfants… pensez surtout à leur joie si vous acceptiez !
– C’est à cela surtout que j’ai pensé, dit-il…, et j’accepte.
Très émue, ne trouvant point de paroles, la gorge serrée, Julia se leva de son fauteuil et vint à Roger.
– Bien vrai, dit-elle, bien vrai ?… J’ai bien entendu ?… Je ne me suis pas trompée ?…
– Non, vous avez bien entendu…
– Merci, monsieur Farney… Le bonheur et la joie de nos enfants vous remercieront mieux que je ne pourrais le faire !…
Il se dirigea vers une fenêtre et l’entrouvrit.
– Suzanne ! dit-il.
La jeune fille releva la tête. Elle aperçut son père et lui sourit.
– Je travaille, dit-elle…, et je commence même à être très fatiguée…
– Eh bien ! viens te reposer au salon ! nous avons à te parler.
La jeune fille fut reprise par ses terreurs.
Que lui voulait-on ?
Elle passa dans sa chambre, où elle arrangea sa toilette.
Au salon, Mme de Noirville, quand elle entra, vint l’embrasser tendrement. Son père semblait heureux. Elle se rassura.
– Qu’avez-vous donc à me dire de si mystérieux ? dit-elle.
– Ne le devines-tu pas ?
– Comment le devinerais-je ?
Roger Laroque se mit à rire.
– Madame de Noirville m’a demandé tout à l’heure ta main pour son fils Raymond. J’ai répondu que je serais très heureux de la lui accorder, en me réservant toutefois de te demander ton consentement. Ce consentement ne nous avait point paru difficile à obtenir, car il semblait résulter d’observations faites de longue date que tu ne voyais pas Raymond avec indifférence, et même que ta sympathie pour lui était très vive…
– En effet, mon père, j’ai la plus grande amitié pour monsieur Raymond.
– De l’amitié seulement ?
Elle se tut.
– Tu connais maintenant la demande de madame de Noirville. Moi, j’ai répondu favorablement. Mais toi, quelle réponse y fais-tu ?
Elle se taisait toujours, la tête très basse, son cœur était broyé.
– Sache bien que tu es libre, ma chérie, et que je ne veux en aucune manière influencer ta décision… Ta volonté sera la mienne. Il nous a paru que tu aimais Raymond… Nous serions-nous trompés ?
– Je vous ai déjà dit, à plusieurs reprises, mon père, que je ne veux pas me marier…
– Mais c’est de la démence… Jeune, jolie, riche, le bonheur t’attend… auprès d’un mari qui t’adorera…
– Le bonheur, ne l’ai-je pas auprès de vous, mon père ?…
– Mais je ne serai pas toujours près de toi. Je puis mourir. Et tu resterais seule, sans protection, sans amis, sans famille…
– Vous connaissez ma volonté, mon père, je ne me marierai pas.
– Mon enfant bien-aimée, réfléchis… Ton obstination est incompréhensible… Elle me fait tout supposer… N’est-ce pas Raymond que tu aimes ? En aimes-tu un autre ?… Avoue ! Que crains-tu ?… Ne suis-je pas indulgent ?… As-tu laissé en Amérique quelque amour que tu n’as pas osé me confier et auquel tu veux rester fidèle ?…
– Oh ! mon père !…
– Tu me fais tout supposer, te dis-je, même les choses les plus invraisemblables.
– Ne supposez rien, mon père, ne croyez que ce que je vous dis.
– C’est étrange, murmura le pauvre homme.
Mme de Noirville, désespérée, pensait à Raymond.
– C’est ton dernier mot, Suzanne ?
– Oui, mon père. Je suis heureuse telle que je suis…
– Sache que tu me causes beaucoup de peine…
– Oh ! mon père, pardon, dit l’enfant, les larmes aux yeux.
Roger se pencha à l’oreille de Mme de Noirville :
– Il faut que je lui parle, dit-il, laissez-moi seul avec elle.
Mme de Noirville prit congé ; elle embrassa Suzanne, après l’avoir tristement et longuement contemplée.
Le père et la fille restèrent seuls.
Roger avait pris Suzanne par les mains, et, l’entraînant avec lui, était allé s’asseoir dans un fauteuil, l’attirant sur ses genoux sans la lâcher, comme quand elle était petite.
Et il ne lui dit que ce seul mot, qui résumait la scène de tout à l’heure, n’ayant pas besoin d’en rappeler les incidents :
– Pourquoi ?
– Je vous l’ai dit, je ne tiens pas à me marier.
Un soupçon était né dans l’esprit de Laroque – un soupçon qui persistait malgré lui –, qui grandissait malgré lui…
Si sa fille refusait obstinément le mariage, n’était-ce pas parce qu’elle se souvenait… parce qu’elle avait conscience du passé ? parce qu’elle savait que ce nom de Farney n’était pas le sien ? parce qu’elle ne voulait pas rougir du déshonneur de son père ?…
Mais il n’osait remuer ces cendres et l’interroger là-dessus.
– Tu n’as pas d’autres raisons ?
– Quelles autres raisons me supposez-vous ?… Je vous les dirais.
– Je respecte ton secret, quel qu’il soit.
– Je n’en ai pas.
– Oh ! mon enfant, à quoi bon mentir, toi dont les lèvres n’avaient jamais connu le mensonge !
Elle baissa la tête, toute pâle. Roger soupira profondément. « Qui me dira le mystère de ce cœur de fillette ? » pensa-t-il.
Et, après un long silence, gênant pour tous deux :
– Tu ne peux vaincre tes répugnances, alors même que tu vois combien ton mariage me ferait plaisir ? Je crois Raymond digne de toi : je suis sûr qu’il te rendrait heureuse… As-tu de l’aversion contre lui ?… Quelque chose en lui, dans son attitude à ton égard, dans son caractère, t’a-t-il déplu ?
– Loin de là !
– Et si je te disais : « Pour reconnaître la profonde affection que je t’ai toujours montrée – pour me prouver que tu m’aimes –, que tu te souviens des mille soins jaloux dont j’ai entouré ton enfance », si je te disais : « Pour me récompenser de t’avoir tant aimée, et pour que, si je meurs, je puisse mourir avec la certitude de te laisser une famille, marie-toi avec ce jeune homme », – que ferais-tu, Suzanne ?
Elle baissa la tête un peu plus bas et ne sortit pas de son singulier silence.
– Tu n’as rien à me reprocher, n’est-ce pas ?
– Oh ! mon père, fit-elle avec élan, lui entourant le cou de ses bras et cachant sa tête sur l’épaule du pauvre homme.
– Et crois-tu, méchante enfant, que je ne souffre pas, moi, de te voir aussi méfiante ?
– Je vous assure, mon père…
– Ne mens pas, te dis-je… Ne parlons plus de ce mariage, et garde ton secret, puisque tu le veux…
Il avait dit cela brusquement, les sourcils froncés.
Suzanne eut le cœur serré comme par des doigts de fer. Jamais il ne lui avait parlé de la sorte !
La vie continua quelques jours sans incidents nouveaux. Le père et la fille évitaient, lorsqu’ils étaient ensemble, toute allusion à la démarche de Mme de Noirville. Et cependant, comme ils y pensaient tous les deux !
CHAPITRE XXIX
Quand Jean Guerrier lui fut amené, M. de Lignerolles l’examina curieusement, et, le jeune homme l’ayant salué avec politesse, il répondit d’un signe de tête.
Le juge était assis à son bureau.
Jean Guerrier resta debout.
Il pouvait voir, étalés sur le bureau, marqués de coups de crayon rouge et bleu, les papiers trouvés chez lui par Lacroix.
Ces papiers, le juge les étudiait.
Il resta longtemps sans prendre la parole, comme s’il eût cherché par où il commencerait son interrogatoire ; à la fin, il se décida à parler.
– Ainsi, dit-il, vous prétendez n’avoir rien entendu ?
– Absolument rien, je le jure.
– À quoi attribuez-vous donc la lourdeur de votre sommeil ?… Ne craignez pas de tout me dire ; l’accusation qui pèse sur vous est grave et repose sur des preuves morales qui ne sont pas à votre honneur.
Jean Guerrier fit un brusque mouvement.
– Vous pouvez m’accuser, Monsieur, mon honneur n’en restera pas moins sauf. Je n’ai rien à me reprocher, ni une imprudence, ni une négligence, pas même l’ombre d’une mauvaise pensée.
– Je crois cependant que vous aurez beaucoup de peine à répondre à ce que je vais vous demander.
– Je suis impatient de vous satisfaire.
– Eh bien, écoutez. Il résulte de l’enquête rapide à laquelle nous nous sommes livrés depuis hier sur votre compte que vous avez dix mille francs d’appointements, mais que votre train de vie dépasse de beaucoup vos appointements. Vous habitez un appartement luxueux, plein d’objets d’art, de bibelots de prix, votre femme a des diamants, des bijoux d’une grande valeur dont quelques-uns valent assurément la moitié, deux ou trois, même, la totalité de la somme qui vous est fixée pour vos appointements. Pourriez-vous me dire où vous prenez l’argent nécessaire à ces dépenses ?
– Mais, Monsieur, fit Guerrier, un peu interdit, vous vous trompez beaucoup sur la valeur des objets qui sont chez moi. Beaucoup de ces bibelots et de ces œuvres d’art ont été achetés d’occasion. Ce sont des trouvailles qu’on fait à Paris, sinon souvent, au moins quelquefois. Je ne m’y connais pas beaucoup, je l’avoue, et j’aurais pu être trompé. Heureusement, j’étais conseillé par monsieur de Terrenoire. C’est lui qui, en général, m’indiquait ces bonnes fortunes de chercheur. Quant aux bijoux de ma femme, vous n’ignorez pas, sans doute, puisque votre enquête semble si complète, vous n’ignorez pas quel tendre intérêt monsieur de Terrenoire…
Il s’arrêta. Que disait-il ? Ah, ses soupçons ! Ce qu’on lui avait laissé entendre !… Les lettres anonymes !… Tout cela lui revenait à l’esprit…
Et le juge, qui le regardait d’un œil curieux, devait tout savoir comme les autres.
Et voilà pourquoi tout à l’heure, il prétendait que Guerrier ne trouverait rien à répondre.
– Je n’ignore rien, en effet, dit M. de Lignerolles sur un ton singulier, monsieur de Terrenoire avait une affection toute particulière pour votre femme et lui prouvait cette affection par des cadeaux princiers. C’est ainsi que vous avez enrichi votre ménage. C’était une excellente spéculation !
– Monsieur, dit Guerrier, effaré, sentant quelque chose d’énorme s’écrouler sur lui, et s’attendant – d’instinct – à comprendre enfin des faits abominables que tout le monde savait, sans doute, et que lui seul ne connaissait pas.
– Dans la perquisition opérée chez vous ce matin, M. Lacroix a mis la main sur des papiers qui seraient une preuve de plus des relations de monsieur de Terrenoire avec votre femme – s’il y avait encore besoin de preuves et si ces relations n’étaient pas de notoriété publique.
– Taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous ! fit Guerrier d’une voix rauque.
Et de grosses gouttes de sueur lui tombaient du front.
Et c’était comme en un rêve qu’il entendait les paroles du juge.
– Voici, reprit M. de Lignerolles, des passages de certaines de ces lettres. Le plus incrédule, après cette lecture, ne douterait plus :
« Ma chère mignonne, voici huit jours que je ne vous ai vue et ces huit jours m’ont paru longs comme des années. Je me suis habitué à cette vie si douce que je passe entre vous et Margival, à cette nouvelle famille où je retrouve toutes les joies et les tendresses de mon autre famille et, quand un voyage comme celui que je fais me tient absent de Paris, c’est surtout vers vous, Marie-Louise, que se tendent mes bras. J’ai hâte d’entendre votre douce voix et de voir votre joli sourire. »
Dans une autre :
« Vous avez pris possession de mon cœur, ma jolie voleuse. Quelle conquête vous avez faite, et combien peu vous devez en être fière ! »
Dans une autre encore :
« Je voudrais vous voir la plus richement mise et la mieux parée de tout Paris. Vous n’écoutez pas mes conseils et vous avez raison. Je vous aime tant, ma jolie fillette, que si vous n’étiez pas si modeste, si vous attiriez les regards, j’aurais peur qu’on ne vous volât à moi. J’en serai très malheureux. Vous vous êtes rendue nécessaire à ma vie. Je mourrais, bien certainement, si je venais à vous perdre, si vous veniez à m’oublier. »
– Il y a vingt autres lettres de cette nature, reprit le magistrat, écrites sur le même ton. Ces relations d’amour existent entre votre femme et monsieur de Terrenoire depuis deux ans déjà, si l’on en juge par les dates les plus anciennes. Vous viviez dans l’intimité de monsieur de Terrenoire, de monsieur Margival et de sa fille, avant votre mariage. Ces relations vous étaient donc connues.
– Ah ! les misérables ! les misérables ! murmurait Guerrier. Et je ne savais rien !… Je croyais que l’affection de monsieur de Terrenoire pour ma fiancée était chaste et sans aucun autre sentiment que celui de l’amitié ! Je croyais aussi à l’amitié du banquier pour moi ! Je m’étais imaginé que c’était mon travail et mon intelligence et non d’aussi coupables services !… Ah ! comme j’ai été niais et qu’ils ont dû rire de moi !… Misérables ! Misérables !…
Le juge haussa les épaules.
– Prétendriez-vous que c’est aujourd’hui seulement que cette honte vous est révélée ?
– Je vous le jure, Monsieur, fit le pauvre garçon avec véhémence… avant mon mariage, je n’ai rien vu. Depuis, je me suis aperçu que mes amis du bureau me fuyaient. Des lettres anonymes ont fait naître chez moi des soupçons. J’ai observé. Je n’ai rien découvert. Et j’ai cru à des calomnies. J’étais heureux parce que je croyais en l’amitié de monsieur de Terrenoire, en l’amour de Marie-Louise ; j’étais heureux parce que je m’imaginais que mon avancement était la récompense de ma régularité, de mon entente des affaires. J’étais heureux. On m’enviait.
– Vous mentez, Guerrier. Il est impossible que vous souteniez votre ignorance.
– Me croyez-vous capable de pareilles infamies ?
– J’en suis sûr. Votre aveuglement eût été bien étrange, avouez-le. Il ne se passait point de jour, avant votre mariage sans que monsieur de Terrenoire vînt chez Margival. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi votre patron semblait porter tant d’affection à un employé ? L’intimité était grande entre votre fiancée et monsieur de Terrenoire, vous avez dû le remarquer. Monsieur de Terrenoire envoyait souvent des cadeaux à Marie-Louise. Comment ne vous en êtes-vous pas étonné ? Ces cadeaux se renouvelaient sans cesse. Ils étaient très riches. Quelques-uns étaient autant de petites fortunes. Avant votre mariage, encore, il était rare de vous rencontrer, n’importe où, sans que monsieur de Terrenoire fût en tiers. Et, pour ceux qui vous voyaient, aucun doute n’existait sur l’entente de Marie-Louise et du banquier.
– C’est abominable ce que j’entends là ! murmura Guerrier, qui se sentait devenir fou.
Et ses ongles, déchirant sa chair, faisaient saigner son front.
– Et vous n’avez rien vu ? demanda le juge, ironique.
– Rien, Monsieur, je n’ai rien vu… Oh ! je vous en prie, croyez-moi ! C’est horrible, entendez-vous, d’apprendre tout à coup que l’on est couvert d’une pareille honte !… Je vous jure, Monsieur, que si pareille certitude m’avait été donnée, ce matin ou hier, avant mon arrestation, j’aurais tué monsieur de Terrenoire… j’aurais tué ma femme !
Il avait dit cela avec tant d’énergie, et il était si pâle, si défait, son angoisse était si visible que M. de Lignerolles en fut un moment impressionné.
Mais il lui paraissait invraisemblable que Guerrier ignorât ce qui se disait, qu’il chassa cette impression, et observa plus attentivement le jeune homme, persuadé qu’il avait devant lui un habile comédien – un criminel très fort.
Il reprit :
– Pourriez-vous expliquer autrement que je le fais, l’affection étrange de monsieur de Terrenoire, et l’intimité qui régnait entre lui et votre femme ?
– Hélas ! non !…
– À plusieurs reprises, avant votre mariage, et quand votre présence chez Margival, devenant trop fréquente, le gênait, monsieur de Terrenoire, pour profiter des derniers moments de liberté avec sa maîtresse, vous a donné certaines missions qui vous appelaient hors de France. Cela aurait dû si vous aviez été de bonne foi, vous inspirer des soupçons ?
– Je n’y ai vu que mon intérêt et l’envie qu’avait monsieur de Terrenoire de m’initier le plus vite possible aux affaires.
– Eh bien, pendant ces absences, les deux amants, accompagnés du père, sur la complaisance duquel ils savaient pouvoir compter, faisaient des parties de campagne à Meudon, à Chaville, à Saint-Cloud comme des étudiants et des grisettes. Ces parties de campagne étaient suivies de petits dîners fins, après lesquels on rentrait très tard. Ignoriez-vous cela aussi ?
– Non, je le savais, Marie-Louise m’a raconté elle-même ces parties ; je n’y ai vu aucun mal.
– Vous étiez sourd et aveugle. Vous ne voyiez pas non plus monsieur de Terrenoire, redevenu jeune, riant, devant vous, ayant votre fiancée à son bras ; et vous ne les entendiez pas se chuchoter à l’oreille mille phrases mystérieuses ?
– Quel abîme d’infamie ! dit-il.
Et comme s’il avait voulu provoquer une espérance comme si espérer eût été possible encore, il demanda :
– Cependant, si tout cela était faux, si vous vous trompiez, Monsieur, si vous étiez abusé ?
M. de Lignerolles se mit à rire.
– Pour vous parler de la sorte, dit-il, à moins de risquer de vous offenser gravement – et j’en garderais le regret toute ma vie – il me fallait des preuves, je les possède.
– Oh ! Monsieur, ne me les cachez pas, apprenez-moi tout… Je veux savoir ! Je veux savoir !…
– Mon devoir est de vous les faire connaître, car cette histoire intime de votre ménage se rattache au crime dont je m’occupe, et ce n’est pas m’écarter de mon enquête, comme on pourrait le croire au premier abord, que de dévoiler ces honteux calculs…
– Je n’ai à me reprocher ni ce crime ni cette honte.
– Vous n’avez jamais trouvé étonnante cette multiplicité de cadeaux de monsieur de Terrenoire à votre femme ?…
– Je vous ai répondu à ce sujet en vous disant que je croyais de la part de monsieur de Terrenoire, à une sorte d’affection paternelle.
– Vous ne vous êtes jamais demandé non plus comment, avec vos faibles ressources, étaient entrés chez vous, aussitôt votre mariage, des meubles et des tapis précieux qui eussent absorbé plusieurs années de vos appointements, si vous aviez été obligé de les payer…
Le visage de Jean Guerrier manifesta le plus grand étonnement.
– J’ai devant moi les factures de vos fournisseurs. Elles s’élèvent à sept ou huit mille francs, chiffre abordable, ainsi que vous le dites, et qui ne dépasse pas un budget comme le vôtre ; mais deux experts sont allés visiter votre appartement, quelques minutes après votre arrestation – sur la foi de renseignements particuliers qui nous avaient été communiqués –, et leur rapport, très détaillé, constate que vous possédez un mobilier d’une valeur marchande de plus de trente mille francs.
– Trente mille francs !… dit Guerrier, impatienté. Et où diable voulez-vous que je les ai pris ? Vos experts me semblent avoir poussé la plaisanterie un peu loin. J’ai payé mon mobilier comptant – sept ou huit mille francs – mes factures le prouvent.
– Pourquoi mentir, Guerrier ? Ne vous ai-je pas dit que j’avais des preuves de ce que j’avançais ?
– Des preuves ? encore des preuves ? murmura Jean, passant la main sur son front.
Il commençait à ne plus bien comprendre ce qu’on lui voulait.
– J’ai fait venir, et j’ai entendu chacun des tapissiers, des orfèvres, des fournisseurs avec lesquels vous avez eu affaire, soit avant, soit depuis votre mariage. Je leur ai présenté les factures saisies chez vous par monsieur Lacroix et je leur ai fait lire le rapport de mes experts.
– Eh bien ? ils ont ri, parbleu ! Qu’ont-ils répondu ?
– Vous allez le savoir.
M. de Lignerolles appuya sur un timbre.
La porte s’ouvrit et un garde apparut.
– Monsieur Bontemps, monsieur Letelliez et monsieur Cormatin sont toujours là ?
– Ils attendent le bon plaisir de monsieur le juge d’instruction.
– Priez-les d’entrer dans mon cabinet.
Un instant après, les trois hommes apparurent.
M. de Lignerolles leur indiqua des sièges.
Ils s’assirent sans adresser un regard à Guerrier, qu’ils firent semblant de ne pas apercevoir.
– Monsieur Bontemps, dit le juge, vous avez fourni à plusieurs reprises des bijoux à madame Guerrier ?
– En effet, Monsieur, non pas à madame Guerrier directement, mais à monsieur de Terrenoire, qui les lui destinait.
– Ces bijoux étaient faux, n’est-ce pas ? Bontemps fit un soubresaut.
– Monsieur le juge voudrait-il plaisanter ? Il connaît ma maison. Les Bontemps sont orfèvres depuis plus de deux cents ans, de père en fils, et il y a aussi longtemps que les de Lignerolles, de père en fils, se fournissent chez eux. Les bijoux, diamants, colliers, payés par monsieur de Terrenoire et fournis par moi à mademoiselle Margival représentent une valeur de quarante mille francs !
– Vous entendez, monsieur Guerrier ?
Le caissier fermait les yeux et murmurait comme une prière, dans l’effondrement de son âme, de ses croyances, de ses affections, de son bonheur :
– Mon Dieu ! Mon Dieu !
– Le dernier achat de monsieur de Terrenoire, continuait le marchand, a été un collier de perles. J’ignore, par exemple, à qui mon client le destinait.
Ce collier de perles, Jean le connaissait.
Il avait surpris Marie-Louise et Terrenoire les mains entrelacées, au moment où le banquier venait de lui faire ce riche cadeau.
Et il n’avait osé rien dire !
Ah ! s’il avait parlé, à cet instant-là ! quelles catastrophes, il eût évitées !
– Ce collier, reprit le marchand avec indifférence, était d’une valeur de dix mille francs…
– Dix mille francs ! Ah ! niais que je suis ! Est-ce que je savais moi ? J’ai toujours vécu dans le travail et la pauvreté. Est-ce que je connaissais la valeur de ces objets ?… Et comment le connaîtrais-je ?
Personne ne répondit à cette exclamation.
Il baissa la tête.
Hélas ! il comprenait bien qu’il aurait beau se défendre. On ne le croirait pas.
Aussi, c’était sa faute, après tout. Fallait-il être aussi naïf et aussi confiant ?
Le juge compulsait certaines notes.
– Monsieur Jean Guerrier a acheté deux pendules chez monsieur Letelliez. Les factures portent deux cents francs pour la première, trois cents pour la seconde. Les experts ont estimé celle-ci quinze cents francs et l’autre mille francs.
– C’est bien leur prix, en effet ! dit M. Letelliez.
– C’est moi qui les ai achetées et payées, cria Guerrier, d’où vient cette différence d’estimation ?
– De ceci, que monsieur de Terrenoire, par lequel j’avais été prévenu, payait la différence…
Guerrier, blême, râla :
– Vous ne mentez pas ?
– Ai-je intérêt à mentir ? Mes livres feront foi.
M. de Lignerolles, fit un signe à M. Cormatin, le riche tapissier de l’avenue de l’Opéra, et Cormatin, sans autres explications, prit la parole.
– Ce qui arrive pour monsieur Letelliez est arrivé pour moi. Lorsque monsieur Jean Guerrier s’est mis en ménage, il m’a été adressé par mon client, monsieur de Terrenoire, qui m’a prié de lui fournir un mobilier en abaissant les prix, promettant de tenir compte de la différence. Je n’avais pas à me préoccuper des motifs qui faisaient agir mon client. Lorsque monsieur Guerrier se présenta chez moi, je guidai son choix… Pour ne rien cacher, je dois dire à monsieur de Lignerolles que monsieur Guerrier paraissait ne pas se douter le moins du monde de la grande valeur de certains meubles artistiques qui attiraient son regard. Il s’étonnait bien un peu du prix dérisoire que j’en exigeais, mais il paraissait de bonne foi. Les achats qu’il me fit se montèrent, comme vous pouvez vous en assurer, à quatre ou cinq mille francs, je ne me rappelle plus au juste. Il me les paya comptant. Quant à la différence, c’est-à-dire vingt-cinq mille francs environ ce fut monsieur de Terrenoire, selon sa promesse, qui me la remboursa.
Cette déclaration, qui semblait faite avec quelque sympathie, rendit un peu de forces à Guerrier.
Quand Bontemps, Cormatin et Letelliez furent sortis, il y eut une minute de silence entre le juge et le pauvre garçon.
M. de Lignerolles voulait lui laisser le temps de reprendre son sang-froid.
– Remettez-vous, Guerrier, dit-il avec douceur. Calmez votre émotion et songez, avant de répondre, que vous avez un grand intérêt à ne plus me cacher la vérité…
– Mais, Monsieur, je suis sous le coup d’une abominable machination ! Ce que ces hommes viennent de vous dire devant moi, n’est-il pas la preuve que je suis innocent de ce que vous me reprochez ? Si j’avais été le mari complaisant que vous croyez, monsieur de Terrenoire n’eût pas eu le besoin de se cacher de moi. Ces meubles et le reste, il les eût payés seul. Cette comédie était faite pour me tromper… Et si monsieur de Terrenoire cherchait à me tromper en escomptant ma naïveté, c’est donc que j’ignorais qu’il fût l’amant de ma fiancée, c’est donc que je ne suis pas coupable.
Guerrier avait espéré dans cet argument.
Mais son observation ne parut pas frapper le magistrat.
– C’était une comédie concertée entre vous, dit-il. Ne fallait-il pas sauver les apparences ?
Guerrier soupira, hocha tristement la tête.
– Vos antécédents sont déplorables, continua monsieur de Lignerolles. Il n’y a chez vous ni honneur ni dignité. Il n’est donc pas étonnant que vous ayez songé à faire fortune d’un seul coup, en profitant de la somme énorme renfermée dans votre caisse.
– Vous dites que je n’ai ni honnêteté ni fierté, vous me représentez capable de tout. Dès lors, comment expliquez-vous que monsieur de Terrenoire, qui devait bien me connaître, puisqu’il profitait de ma honte et de mon infamie, m’ait confié des fonctions aussi importantes et délicates que celles de caissier de sa banque ?
– Votre raisonnement est logique en apparence. Mais le banquier a convenu lui-même qu’il arrivait rarement que des sommes restassent à la banque. En outre, il y avait là deux gardiens, et il était bien difficile – comme vous l’avez essayé sans doute – de les séduire tous les deux. Enfin, monsieur de Terrenoire, qui s’occupait beaucoup par lui-même de ses affaires, exerçait un contrôle quotidien qui devait vous dérouter.
Le juge s’arrêta, puis, d’un ton incisif :
– Depuis quelque temps, les affaires de monsieur de Terrenoire, étaient en assez mauvais état. Sans avoir subi de grosses pertes, le banquier traversait une période difficile… Ce n’était plus un mystère dans les bureaux qu’un mouvement de Bourse pouvait vous renverser… La situation était donc très tendue… Monsieur Le Charrier, en avait averti monsieur de Terrenoire, mais celui-ci n’avait voulu rien entendre… Et cependant il ne m’est pas prouvé que monsieur de Terrenoire ne prévoyait point la débâcle de la Bourse. Dès lors, pour éviter une partie des responsabilités, monsieur de Terrenoire a pu rêver ce vol dont il se prétend aujourd’hui victime…
– Quoi ! vous pensez…
– Je ne crois rien, pour le moment. J’examine. Voulant enlever le million contenu dans sa caisse, votre complicité était nécessaire à monsieur de Terrenoire et, comme elle lui était acquise, de par les secrets honteux qui vous attachaient l’un à l’autre, rien n’était plus aisé que de perpétrer ce vol. Remarquez que je parle sans données certaines, et que, si votre culpabilité me paraît admise, il n’en est pas encore de même pour monsieur de Terrenoire. La certitude ne tardera pas à venir. Vous seul et le banquier possédiez les clés des bureaux. Or, c’est avec ces clés que les portes ont été ouvertes. Il n’y a nulle part de traces d’effraction. Brignolet et Béjaud se sont réveillés. L’un d’eux, Béjaud, s’est laissé gagner sans doute par des promesses ; l’autre, plus honnête, a menacé de tout dire. Il fallait choisir : ou remettre dans la caisse le million que vous teniez déjà – et le silence de Brignolet n’était acheté qu’à ce prix – ou tuer le gardien pour empêcher ses révélations. Vous l’avez tué… Monsieur de Terrenoire est sorti, emportant cette fortune. Il a une clé de la porte cochère. Il a pu s’enfuir sans éveiller le concierge et mettre en sûreté le million. Quant à vous, il était nécessaire que vous trouviez quelque histoire pour expliquer le vol et l’assassinat. Fuir, c’était vous déclarer coupable. Vous êtes resté, vous et Béjaud, auprès du cadavre de la victime. Vous avez inventé tous les deux ce conte invraisemblable de sommeil, et le matin, à l’heure que vous avez vous-même choisie, vous avez donné l’éveil. Telle nous semble avoir été la combinaison de ce crime. C’est alors que nous pourrons attribuer à chacun sa responsabilité. Mon greffier n’a pas tenu compte de vos dénégations. Je vous ai expliqué la situation telle qu’elle nous apparaît, afin de vous permettre de vous défendre. Contre monsieur de Terrenoire, nous n’avons pas assez de preuves : j’attends.
M. de Lignerolles appuya sur le timbre. Les gardes de Paris qui avaient amené Guerrier reparurent.
Le juge leur fit signe. Ils se placèrent de chaque côté du jeune homme. Et Jean fut réintégré au dépôt.
CHAPITRE XXX
Le lendemain, un étranger, M. William Farney, sujet américain, ne craignait pas de se présenter à M. de Lignerolles, juge d’instruction, pour lui demander l’insigne faveur de voir son ami Jean Guerrier.
Fort heureusement pour le solliciteur que le magistrat avait été averti par M. Lacroix de l’existence d’un riche Américain qui s’intéressait à l’assassin présumé de Brignolet. Sans quoi, il l’eût éconduit, et de la belle façon.
Mais la fortune a tout au moins le droit de discuter même avec un juge d’instruction.
William Farney insista.
– Je suis, dit-il, un des meilleurs amis de la famille Margival. Ma conviction est que Guerrier n’a aucunement trempé dans le crime dont on l’accuse. Je voudrais lui apporter mes consolations et la promesse verbale que je mets toute ma fortune à son service pour sa défense.
Il prononça ses dernières paroles de la voix ferme avec laquelle autrefois il se défendait contre les accusations de ce même de Lignerolles.
Le magistrat le regardait avec la curiosité défiante d’un inquisiteur qui cherche le but véritable d’une démarche imprévue.
Il ne reconnut pas Roger Laroque, sa victime.
– Bien que l’accusé soit au secret, dit-il enfin, il n’y a aucun inconvénient, monsieur Farney, à ce que vous le voyiez pendant quelques minutes, mais en présence de gardiens. Vous n’aurez pas besoin d’aller à Mazas. Nous l’avons conservé au dépôt.
Un instant après, les deux amis se trouvaient en présence à travers le vitrage du parloir. Deux gardiens assistés de deux agents de la sûreté, serraient de près le prisonnier.
Roger faillit se trahir en voyant les ravages que les chagrins avaient creusés sur les traits de Guerrier.
– Comment ! s’écria-t-il, vous en êtes là, au bout de si peu de jours ! Mais vous auriez été condamné à mort que vous n’auriez pas l’air plus défait, plus anéanti.
Jean se redressa sous ces reproches.
– Si vous saviez ! dit-il.
– Je sais que vous êtes accusé d’un crime abominable, d’un assassinat ayant le vol pour mobile, je connais toutes les circonstances de cette affaire, je n’ignore pas que de graves apparences sont contre vous, mais vous ne devez pas faire douter de votre innocence en vous abandonnant au désespoir. Vous n’en avez pas le droit, pour vous-même, pour votre chère femme, Marie-Louise, pour votre excellent beau-père, Margival, pour votre patron et bienfaiteur, monsieur de Terrenoire. Quant à moi, je veux bien ne pas me compter, mais vous savez combien je vous suis attaché et ce que je dois souffrir de vous voir en cet état.
Jean leva les bras comme un homme qui n’espère plus.
Pouvait-il parler devant ses geôliers, pouvait-il étaler sa honte en présence de ces subalternes qui épiaient ses moindres gestes, suivaient ses pensées pour y puiser des renseignements utiles à l’enquête ?
– Monsieur Farney, dit-il, je vous remercie de votre démarche. Vous êtes bon, vous êtes héroïque de ne pas vous séparer d’un malheureux qui aura bientôt contre lui l’opinion presque unanime. Vous ne savez pas tout. Sous peu, mon procès, procès inévitable, vous révélera des choses si abominables que vous vous refuserez à les croire.
Et, sans attendre la réponse, Jean Guerrier reprit le chemin de sa cellule, suivi par les agents, qui redoutaient une tentative de suicide et se tenaient prêts à prévenir les mouvements du malheureux.
Roger se retira, consterné. Que voulait dire Guerrier ? L’infortuné était-il déjà en proie aux hallucinations de la folie ? N’accusait-il pas sa femme, son beau-père et son patron d’avoir causé sa perte !
Roger courut en toute hâte chez Marie-Louise.
Il la trouva seule tout en larmes.
– J’ai vu Jean, lui dit-il.
Elle poussa un cri de joie.
– Il n’est donc plus au secret ? dit-elle. Moi, sa femme, je n’ai pu encore obtenir la permission de le voir, ne fût-ce qu’une minute.
Ce n’était pas là le ton d’une femme qui a causé la perte de son mari.
Roger Laroque ne voulut pas mentir. Il raconta dans ses moindres détails, la scène navrante à laquelle il venait d’assister. Tout en parlant, il regardait attentivement Marie-Louise.
La jeune femme ne se troubla nullement. Il n’y eut pas dans ses yeux la moindre expression qui pût donner à penser à Roger qu’elle comprenait ses paroles accusatrices.
Elle éclata en sanglots, criant :
– S’il m’accuse, c’est que son désespoir a perdu sa raison. Il faut qu’on me rende mon mari. Moi seule suis capable de le guérir.
Margival rentra au même instant. Mis au courant de l’événement de la matinée, il conclut aussi à la folie de Guerrier. Sa sincérité n’était pas plus douteuse que celle de Marie-Louise.
Le père et la fille respiraient l’honnêteté, la probité, l’honneur.
Quant à l’insinuation de Guerrier contre M. de Terrenoire, on convint de ne pas en parler provisoirement au banquier. Il était inutile de lui révéler des paroles que Guerrier regretterait certainement.
Le soir même, le prisonnier recevait de son ancien patron la lettre suivante dont l’écriture allongée en anglaise du plus pur style n’avait aucun rapport avec celle de Roger Laroque :
« Cher Monsieur Guerrier,
« Je n’ai pas hésité à révéler à Marie-Louise et à son père les paroles amères que vous avez prononcées contre ces deux êtres qui vous aiment tant, paroles dont le sens m’échappe absolument.
« Je vous jure que votre femme et votre beau-père n’ont pas compris un mot de ce que vous voulez dire.
« Il y a des expressions, des exclamations qui ne trompent pas. Votre famille est tout à fait en dehors de vos malheurs et le coup qui vous frappe la frappe en même temps.
« Ne vous laissez pas abattre, comptez sur tous les vôtres comme sur moi.
« Votre ami,
« WILLIAM FARNEY. »
CHAPITRE XXXI
Nous avons laissé Mme de Noirville au moment où elle venait d’éprouver, de la part de Suzanne, un refus dont le caractère mystérieux lui donne à réfléchir. Ne pouvant s’expliquer le mobile de la jeune fille, elle se décida à raconter à Raymond sa visite à Maison-Blanche. Tout d’abord, le jeune homme eut envie de reprocher à sa mère cette initiative qu’elle avait prise sans le consulter, mais elle paraissait si triste de son échec, si triste de ne pouvoir annoncer à son fils le bonheur qu’elle avait rêvé pour lui, qu’il n’en fit rien.
Seulement les réponses de Suzanne à Julia et à Laroque ne pouvaient l’étonner, lui à qui la jeune fille les avait déjà faites.
Elles eurent pour résultat de redoubler sa tristesse et de le plonger dans une incertitude cruelle.
Et un jour, en proie au doute, la figure bouleversée, horriblement malheureux, il courut à Maison-Blanche.
Il trouva Suzanne dans la serre voisine du salon.
Elle vint à lui et lui serra les mains en silence. Elle vit tout de suite qu’il s’était passé dans cette âme quelque drame terrible.
– Raymond, dit-elle anxieuse, qu’y a-t-il ? qu’avez-vous ?
– Suzanne… Suzanne… Il m’est venu une atroce pensée… Cet obstacle entre vous et moi, cette raison mystérieuse qui vous éloigne de moi… j’ai pensé… j’ai cherché… Ah ! c’est atroce, je le dis, de douter ainsi… et j’aime mieux la vérité… oui, je l’aime mieux, si épouvantable qu’elle soit…
– Mon Dieu ! que voulez-vous dire ?
– Cette raison… je crains de l’avoir comprise…
– Vous ! dit-elle avec un cri d’effroi !… Vous !…
– Oui, moi… À votre frayeur, je ne doute plus…
– Raymond ! ! !
Et, dans une angoisse affreuse, un indicible désordre, elle lui serrait les mains à les briser, nerveusement…
– Raymond… il faut tout me dire… je veux tout savoir…
– Écoutez, Suzanne… j’ai pensé…
Il s’arrêta.
– Parlez ! dit-elle doucement, bien qu’elle tremblât de peur.
– Je parlerai… je parlerai… Oui, Suzanne, vous refusez de porter mon nom, parce que… vous craignez que je n’apprenne… plus tard… une faute… une liaison du passé… quelque chose que rien n’efface et qui a brisé votre vie… alors que la fleur de votre vie était à peine éclose.
Il se tut, il était tombé à genoux, brisé, anéanti, et il ne voyait plus rien. Il attendait un mot comme son arrêt de mort.
Une longue minute s’écoula.
Suzanne n’avait pas compris, tout de suite, ce qu’il avait dit. Ce ne fut qu’en se répétant à elle-même qu’elle devina. Elle était si loin de cela ! Elle avait cru que Raymond avait surpris le secret du nom de Laroque ! Non, ce n’était pas cela !… Raymond ignorait toujours… Ce qu’il croyait, c’est qu’elle était une fille tombée, coupable, flétrie !…
Un sourire céleste erra sur ses lèvres, sa main, qui tenait son mouchoir, essuya le front de Raymond.
– Oh ! mon ami, mon pauvre ami, que je vous plains !
Elle poussa un soupir, accablée par le découragement.
– Vous aviez le droit de tout croire, fit-elle, mais je ne veux pas que vous doutiez plus longtemps de moi. Vous avez voulu savoir la vérité, je vais tout avouer – après, vous me direz un éternel adieu !…
Alors, il osa lever les yeux : il s’était attendu à une grande colère, à une indignation profonde, et, au lieu de cela, elle venait de lui parler avec une gravité singulière, une tristesse infinie !
– Taisez-vous, Suzanne, pardonnez-moi. Je ne veux plus savoir…
Elle secoua la tête à deux reprises.
– Il est trop tard, dit-elle, une mauvaise pensée vous resterait, le doute est venu et je ne veux pas que vous doutiez. Malgré tout, je vous pardonne de me faire souffrir, mais c’était presque une folie de croire que je pourrais garder toujours vis-à-vis de vous mon secret… le secret de mon père…
– De votre père, Suzanne ?
– C’est de lui qu’il s’agit, non de moi.
Il respira, soudain soulagé. L’homme qui aime – quel que soit son amour, est ainsi fait qu’il croit le mal plus facilement que le bien. Et Raymond, malgré tout, doutait.
À présent, il était un peu rassuré : si navrante que fût l’histoire qu’il allait entendre, il pourrait quand même adorer Suzanne.
– Et d’abord, mon ami, fit-elle à voix basse, promettez-moi le secret sur votre vie, sur votre honneur !…
– Est-il nécessaire de jurer, Suzanne ?
– Non, vous m’aimez, vous vous tairez, je ne crains rien.
– Je vous écoute, dit-il.
Elle ferma les yeux, puis, d’une voix mourante :
– Je ne puis pas être votre femme, Raymond, parce que le nom que je porte n’est pas le mien…, parce que le nom que je porte n’est pas celui de mon père… parce que je suis la fille d’un homme qui se cache dans la crainte de la justice, parce qu’il a commis autrefois un très grand crime, non pas un de ces crimes que la vengeance explique et dont elle peut atténuer l’horreur, mais un de ces crimes odieux, épouvantables, qui déshonorent à jamais une famille, à jamais un nom… Mon père a assassiné pour voler !
Raymond n’eut pas un mot, pas un geste, il avait seulement baissé la tête, de plus en plus, à chaque mot qu’elle avait dit. Du reste, elle gardait toujours les yeux fermés pour ne rien voir…
– Ce crime, vous le connaissez, Raymond, bien que vous fussiez très jeune à l’époque où il a été commis, vous le connaissez, et votre père, qui était l’ami du mien, a défendu mon père… Il en est mort !…
Cette fois, à cette révélation, Raymond s’était levé brusquement et n’avait pu retenir une sourde exclamation.
– Roger Laroque !… L’assassin de Ville-d’Avray…
– Oui.
– Vous êtes la fille de Roger Laroque ?
– Je suis sa fille… Comprenez-vous ?…
– Hélas ! hélas !…
– Mon père, que tout le monde a cru mort dans sa tentative d’évasion pour s’échapper de la Nouvelle-Calédonie – car je sais tout cela, mais lui, il ignore que je sais ! – mon père est condamné aux travaux à perpétuité…
En Amérique, où il s’est réfugié, il a refait rapidement sa fortune… Et il a voulu revenir habiter la France, au risque d’être reconnu, au risque d’être renvoyé au bagne…
– Quel est son but ?
– Il ne peut me le dire, puisqu’il est persuadé que j’ai oublié la triste histoire du crime… alors que, mon Dieu ! fit-elle avec épouvante, alors que je ne passe pas un jour, pas une nuit, sans m’en rappeler les effroyables détails !…
– Ces débats, je les connais, moi aussi, fit Raymond, puisque c’est en pleine cour que mon père est mort. J’ai voulu connaître l’affaire et je l’ai relue bien souvent dans la Gazette des Tribunaux ! Ainsi, Suzanne, c’est vous qu’on a amenée devant le jury, pour vous faire accuser votre père ?… C’est vous, cette enfant qui a fait pleurer tout le monde, qui a excité tant de pitié et d’admiration pour son courage précoce… pour son énergie…
– C’est moi.
– Mais mon père a dit très haut qu’il croyait le vôtre innocent… Et il le croyait ! On ne se trompe pas à de pareilles et aussi chaleureuses paroles !… Monsieur Laroque était l’ami de mon père… Mon père ne pouvait avoir pour ami un voleur et un assassin. Il y a eu dans ce crime je ne sais quel mystère qui n’a jamais été éclairci !…
– Hélas ! mon ami, vous êtes bon de vouloir défendre mon père, mais, pour moi, le mystère n’existe pas… Les juges, autrefois, ont eu raison de vouloir m’interroger… je savais tout !… Ma mère et moi, nous avons assisté au crime !… Mon père est l’assassin !…
– C’est horrible ! murmura Raymond.
Et les deux pauvres enfants restèrent l’un auprès de l’autre, muets, sans pensées, foudroyés par cette révélation dans ce qu’ils avaient de plus noble, de plus cher, de plus sacré : leur amour !…
– À présent, dit-elle, que vous savez tout, que vous ne doutez plus de moi, que vous connaissez le triste secret de ma vie, adieu, mon ami…
– Adieu, non pas, Suzanne, car je vous aime follement…
– À quoi bon m’aimer, Raymond ?
– Puis-je raisonner mon amour ? Je vous aime. Toute ma vie est à vous. Je veux souffrir avec vous, pour vous…
– Oh ! Raymond, vous vous lasserez et vous m’oublierez…
– Le pensez-vous vraiment ?
– Non, dit-elle, et pourtant, je le jure, je préférerais n’être pas aimée de vous… être seule à savoir et à me souvenir…
Et, après un nouveau silence :
– Maintenant, mon ami, laissez-moi… Je suis si troublée par l’aveu que je viens de vous faire, que j’ai besoin d’un peu de solitude pour me remettre… Adieu… adieu… Raymond, partez, et, si vous m’en croyez, ne revenez plus ! Fuyez-moi !…
Mais il eut comme un geste de défi.
– Au revoir, dit-il. Je t’aime… J’aime mieux souffrir !
Elle lui tendit les mains. Mais ce furent leurs bras qui s’enlacèrent. Elle tomba sans force sur la poitrine du jeune homme, la tête renversée sur son épaule, et, pendant une minute, leurs lèvres s’étreignirent en un baiser désespéré, presque douloureux…
......................
La serre communiquait par une porte avec le salon. Après le départ de Raymond, Suzanne se dirigea vers cette porte et l’ouvrit. Ils se dirigèrent vers cette porte. Suzanne l’ouvrit. Et elle poussa un grand cri devant le corps d’un homme qui gisait en travers – le corps de Roger, inanimé, de Roger, qui avait surpris la scène, qui avait tout entendu.
– Mon père ! mon père !
Et elle l’embrassait follement… Et sa main tremblante cherchait la place du cœur… Il battait faiblement… Un instant, elle avait cru qu’il était mort !…
Elle se précipita vers une fenêtre, l’ouvrit pour donner de l’air. Puis elle sonna violemment.
Des domestiques accoururent effarés, transportèrent Laroque toujours évanoui sur une ottomane, et Suzanne se mit à lui prodiguer ses soins !
Elle lui mouilla le front, les paupières, la bouche, le cou, les mains avec un linge trempé dans de l’eau glacée.
Enfin, au bout d’une heure, d’une longue et mortelle heure de désespoir et d’angoisse, il reprit connaissance. Le souvenir lui vint tout de suite de ce qu’il avait entendu. Il poussa un profond soupir et referma les yeux.
Certes, quand tout à l’heure, sachant sa fille dans la serre, il avait voulu entrer ; quand il avait été surpris en entendant la voix de Raymond, qu’il ne savait pas là ; quand, malgré lui, il avait écouté et compris… ; quand il avait senti ses forces s’en aller, le sang se retirer de ses veines, il avait eu un moment de bonheur suprême, inouï…
Il fit un signe aux domestiques, qui se retirèrent.
Quand ils furent seuls, Suzanne murmura :
– Mon père ! mon père ! pardon !…
Il la regarda longuement, sans rien dire. Il était resté étendu sur le canapé ; ses jambes étaient comme brisées. Il avait aussi une très grande lourdeur dans la tête, et une multitude de points multicolores papillotaient devant ses yeux.
Puis, parlant avec lenteur :
– Ainsi, malheureuse enfant, tu n’avais rien oublié ?
Elle cacha son visage sur la poitrine de son père, et ne répondit rien. Les doigts du pauvre homme errèrent dans les cheveux de sa fille. Il la caressait doucement.
– Et moi qui croyais ! Moi qui croyais ! dit-il par deux fois. Ne pleure pas !… Ce n’est pas ta faute… Que veux-tu ? On ne commande pas à ses souvenirs… Mais tu m’as fait de la peine. Une grande peine. Je ne pense pas avoir souffert autant depuis le jour où ta mère et toi vous m’accusiez par votre silence, devant les juges… devant le jury !… Et moi, fou que j’étais, je m’imaginais que ce passé était mort !… Que faire, que dire pour te prouver ?… Car je suis innocent de ce crime !…
Il resta rêveur, puis se relevant un peu, s’appuyant sur une main, et de l’autre écartant la tête de Suzanne.
– Je suis innocent, Suzanne, entends-tu !
– Oh ! mon père, le passé est mort, ne parlons plus de rien !
– Je croyais que tu ne te souvenais pas, et alors je ne voulais pas réveiller toute cette lamentable histoire. Puisque tu te rappelles, puisque rien n’est effacé en toi, je parlerai… je te dirai que je ne suis pas coupable du crime qu’on m’a reproché et pour lequel j’ai subi une condamnation infamante ! Toi, dont la mémoire est si fidèle, ne te souviens-tu pas des dénégations que j’opposais aux preuves relevées contre moi ? J’ai prié, supplié, pleuré qu’on me crût… Je me débattais dans une de ces situations atroces et sans issue où un homme laisse forcément l’honneur. J’avais beau crier mon innocence, personne ne me croyait, pas même toi, ma fille, que j’aimais tant… pas même ta pauvre mère, qui sait la vérité, s’il est vrai que l’âme ne meurt pas.
– Ma mère et moi, nous avons vu !
– Alors, tu me crois vraiment coupable ?… Rien ne plaide pour moi dans ton cœur ? Tu n’as jamais eu rien à me reprocher, jamais, ni avant le crime, ni depuis. Et tu ne t’es jamais dit qu’il était bien étrange qu’un homme, si bon, si attentif, si ouvert, fût devenu brusquement, du jour au lendemain, un misérable, assassin et voleur ?… Mais moi, Suzanne, si j’avais surpris ta mère assassinant et volant, si je l’avais vue, ta mère, avec ces deux yeux qui te regardent, je n’aurais pas cru !… Non, j’aurais dit que c’était un rêve ou de la folie, mais je n’aurais pas cru.
Elle se taisait. Qu’eût-elle dit ? Elle était sûre !…
– Je ne te fais pas de reproches, ma chérie, non, ce serait injuste ! Ce que tu as vu, toute petite, a laissé une trop forte impression sur ton âme pour que tu puisses aisément te mentir à toi-même et dompter les révoltes de ton cœur… Ta jeunesse a été brisée par le spectacle d’un crime et par la honte que ton père a jetée sur ton nom… Oh ! la honte ! la honte ! Cette épithète qu’après ma condamnation certains de mes anciens ouvriers ont accolée à mon nom !… Car, je le sais, quand ils parlent de moi, c’est encore, c’est toujours Roger-la-Honte qu’ils m’appellent !… Les pauvres gens, je leur pardonne ! S’ils savaient tout ce que cette honte imméritée cache de larmes et de courage, ils rougiraient d’eux-mêmes ! La honte !… sur moi ! sur toi !… Être obligé de se cacher… de ramper, pour ainsi dire, dans l’obscurité de la société… de courber la tête… de trembler devant quelque regard curieux… devant quelque parole indiscrète, de se ronger les poings dans l’impuissance !… La honte ! voilà la honte !… Mais, du moins, si je ne puis relever le front devant le monde, je veux ne point rougir devant toi… Je veux te prouver, enfin, que je suis innocent…
Elle fit un geste vague pour l’empêcher de parler.
Mais il continua, avec une véhémence à peine contenue :
– Je suis innocent. Et un seul homme l’avait deviné, Lucien de Noirville… et il en est mort !… Ah ! j’étais vraiment maudit, puisque c’était la deuxième mort à cause de moi !… Écoute, ma fille, ce que je vais te raconter va faire rougir ton front, et diminuera le respect que tu me dois. Ce sera une punition, encore, celle-là – un supplice de plus ajouté à tous les autres supplices –, pourtant, tu sauras tout… Te rappelles-tu tous les incidents de l’affaire ?
– Hélas ! mon père.
– Ce qui m’a fait condamner, surtout, c’est la preuve qu’établissaient contre moi les billets de banque retrouvés dans ma caisse…
– Oui.
– J’ai dit que les cent cinquante mille francs versés par moi la veille et l’avant-veille à Guerrier provenaient pour une part du gain au cercle, la plus grosse part d’un remboursement.
– C’est cela… mais c’est tout ce que vous avez dit.
– Et tu vas voir pourquoi je n’ai pu en révéler davantage… Laroque s’arrêta une seconde à cet endroit de son récit, puis :
– Encore une fois, pardon, dit-il, mais il le faut. J’ai commis une faute dans ma vie, ma chère fille, une faute chèrement expiée. Je l’ai commise en un moment d’égarement, car je n’ai même pas l’amour pour excuse, puisque je n’ai jamais cessé d’aimer ta mère… J’ai été l’amant d’une femme mariée qui s’était prise pour moi d’une passion folle. Cette femme eut besoin d’argent… d’un besoin immédiat… Il s’agissait pour elle de payer des dettes que son mari ne connaissait pas ; ses créanciers la pressaient, et son mari, les ayant déjà remboursés plusieurs fois, avait menacé sa femme d’un scandale, d’une séparation, si elle ne mettait pas un terme à ses dépenses exagérées… Il me fut possible de lui apporter cent mille francs. La guerre vint, puis la paix fut signée. Les affaires se ralentirent. Je dus me résigner à un remboursement important réclamé par ce Larouette. C’était la ruine, et je ne prévoyais pas comment j’allais faire face à mes échéances de fin de mois – c’était la faillite –, lorsqu’un matin je reçus, boulevard Malesherbes, une lettre et un petit paquet cacheté. La lettre était de ma maîtresse – avec laquelle j’avais rompu toute relation depuis la guerre –, elle me savait gêné et me renvoyait les cent mille francs que je ne lui eusse jamais réclamés. Le paquet contenait cent mille francs. Comprends-tu ?… Vois-tu maintenant la situation odieuse, épouvantable et sans issue dont je te parlais ?… L’honneur me défendait de trahir cette femme dont la déposition m’eût sauvé pourtant !… D’un mot, je prouvais mon innocence, en révélant son nom… mais dire ce mot, révéler ce nom, c’était une infamie… Condamné et forçat, mais me sachant même innocent, j’ai gardé ma dignité et le respect de moi-même ; libre à ce prix, je serais déshonoré à mes propres yeux !… Et je n’ai rien dit !…
Suzanne avait écouté ce récit dans une attitude singulière.
Tout d’abord, elle eût mieux aimé ne pas entendre, car elle était si convaincue, si certaine de la culpabilité de son père, qu’elle prévoyait chez lui quelque ruse pour se disculper aux yeux de sa fille…
Aux premiers mots, honteusement, timidement prononcés par Roger, quand elle eut compris le sens de ses restrictions, elle rougit violemment…
Elle rougissait d’entendre… elle rougissait de son père…
Mais elle écoutait, parce que quelque chose d’instinctif lui criait que c’était la vérité !
Son père n’eût point menti et n’eût pas inventé, surtout, cette douloureuse histoire d’adultère.
Car il avait honte, lui aussi, de la raconter. Il rougissait devant sa fille…
Puis, au fur et à mesure qu’il parlait, la honte de la faute commise disparaissait pour la jeune fille…
Elle ne voyait plus qu’une chose, c’est que son père était innocent.
Innocent ! C’était vrai ! Elle croyait, maintenant, elle l’incrédule !…
Elle se laissa glisser aux pieds de Laroque, et, comme les mains du pauvre homme pendaient, inertes, dans l’affaissement de son être, elle les couvrit de baisers passionnés.
– Oh ! mon père ! que de malheurs ! Oh ! mon père chéri !
– Je te pardonne, mon enfant, tu ne pouvais pas savoir !…
– Continuerez-vous de m’aimer, comme par le passé ?
– En doutes-tu, chère et cruelle enfant ?
– Pardon, mon père, pardon !
Soudain, elle se tut. Une pensée luisait dans son esprit.
– Il y a un coupable, dit-elle. Un homme qui vous ressemble… qui a votre taille… qui était vêtu comme vous… celui que j’ai vu, que ma mère a vu comme moi… Quel est-il ?
– C’est là où le mystère commence, ma chérie. Il y a un coupable, comme tu le dis. Qui ? Je l’ignore… Mais patience, il ne se cachera pas toujours si bien que je ne puisse le découvrir… Et c’est là, vois-tu, la vraie raison pour laquelle j’ai quitté l’Amérique, où je vivais en sûreté. Et si j’ai refait ma fortune avec tant d’âpreté à la lutte, aux dépens de ma santé même, c’est bien parce que je voulais me venger et faire réviser mon procès.
Là ne devait pas s’arrêter son récit.
– Puisque tu as tant de mémoire, dit-il à Suzanne, te souviens-tu d’un jeune homme qui te témoignait beaucoup d’amitié quand tu étais petite ?
– Jean Guerrier, votre caissier. Si je m’en souviens ! Il est venu au lit de mort de ma mère. Lui n’a jamais douté de vous ; mais aussi il n’avait pas vu. Que ne suis-je devenue aveugle le jour qui a précédé la nuit fatale !
Roger l’embrassa pour ces bonnes paroles, puis il lui fit part, avec tous les détails, de la terrible accusation qui pesait sur Jean. Apprenant que son père avait eu le courage de demander la permission de voir le prisonnier :
– Qui sait, dit-elle, si on ne vous a pas suivi, si on ne sait pas déjà que William Farney et Roger Laroque sont un seul et même personnage ? Fuyons.
– Fuir ? Jamais ! Tant que Guerrier aura besoin de moi, je resterai. Ne t’afflige pas pour moi, mais pour lui. Du moment que monsieur de Lignerolles ne m’a pas reconnu, personne ne me reconnaîtra à Paris. Demain, je verrai deux hommes sur lesquels je compte pour débrouiller le mystère de l’assassinat Larouette. Ce sont des policiers amateurs qui, à eux deux, en remontreraient à tous les prétendus limiers de la préfecture de police. Il faut qu’en l’espace d’un mois, tout au plus, ils aient trouvé l’assassin de Larouette et l’assassin de Brignolet.
Roger Laroque parlait avec une animation extraordinaire. Ses yeux jetaient des flammes, et le sang, qui lui était monté à la figure, zébrait de rayures écarlates, les cicatrices de ses affreuses brûlures.
Suzanne lui prit la main. Laroque était en proie à une fièvre violente. Il dut se mettre au lit. Durant trois jours, veillé par sa fille, qui ne laissait pénétrer auprès de lui aucun domestique, il délira ; puis, grâce à sa vigueur exceptionnelle, à sa force d’âme, une amélioration rapide se produisit et le malheureux put enfin commencer les démarches sur lesquelles il comptait pour prouver son innocence et celle de Guerrier.
CHAPITRE XXXII
Durant la courte maladie de son père, Suzanne ne revit pas Raymond, qui était à Paris ; mais, le dimanche suivant, le jeune homme revenait à Maison-Blanche. Suzanne ne le savait pas et pourtant elle l’attendait. Plus d’une fois, depuis le matin, son regard avait erré au loin sur la longue route blanche bordée de peupliers, qui filait toute droite vers Chevreuse.
Elle était seule au château. Et elle avait hâte de revoir Raymond, parce qu’elle était bien résolue à tout lui dire…
Elle l’aperçut, marchant très vite.
Elle courut au-devant de lui, son impatience était si grande qu’elle ne pouvait l’attendre. Elle le rejoignit dans le parc.
– Oh ! Raymond, dit-elle, Raymond, que je suis heureuse !…
Et, en effet, son visage était radieux. Ses yeux brillaient, ses joues étaient roses et tout en elle exprimait l’animation et la joie.
Elle était si différente de ce qu’elle était l’autre jour, qu’il crut à un accès de folie et qu’il murmura :
– Suzanne ! Suzanne ! qu’avez-vous ? au nom du ciel !
– Oh ! Raymond, venez vite, je vous dirai tout… Ici, je ne puis parler… Des domestiques, des paysans peuvent passer dans le parc derrière les broussailles et les arbres… Ils nous entendraient… Venez vite, j’ai hâte de vous apprendre… C’est de lui qu’il s’agit… de mon père…
Quand ils furent au château, qu’elle eut fermé les portes, elle lui raconta tout ce que son père lui avait dit. Elle n’omit rien de l’histoire où cette femme inconnue avait joué un rôle néfaste.
Roger Laroque n’avait pas nommé Julia. Raymond ne pouvait se douter qu’il s’agissait de sa mère ! Il avait pour elle le plus profond respect, un respect qu’égalait seule sa tendresse, et un soupçon ne lui pouvait venir. Il lui dit seulement :
– Roger Laroque n’avait-il pas reconnu ma mère ?
– Il a dû la reconnaître, à coup sûr, et je me rappelle maintenant quelques hésitations qui m’avaient frappée au début de nos relations.
– C’est juste. Sa sécurité et le soin de votre bonheur réclamaient les plus grandes précautions.
Raymond devint pensif.
– Ainsi, dit-il, c’est une femme qui a tenu dans ses mains l’honneur, presque la vie de votre père… Et elle n’a rien dit. Qu’est-elle donc, pour avoir tant de lâcheté !
– Songez, Raymond, au déshonneur… pour elle, si elle avait parlé !… Songez qu’elle avait un mari… Songez qu’elle avait peut-être des enfants !…
– Qui est-elle ? Vous a-t-il dit son nom ?
– Oh ! Raymond ! Le pouvait-il sans renier le passé ? lui qui a tout sacrifié à ce secret !… Ce nom, il ne le révélera jamais !
– Laroque est un homme. Mon père avait raison de l’aimer, moi, je ne l’en estime que davantage…
Raymond retomba dans son silence et dans sa rêverie.
– À quoi réfléchissez-vous, mon ami ?
– À une chose bien simple, Suzanne. Puisque votre père est innocent, il y a un coupable… l’homme que vous avez aperçu dans la maison de Larouette… Ce coupable, votre père le cherche, je le chercherai aussi… Je suis avocat… j’ai de nombreux amis au Palais et à la préfecture. Je serai puissamment aidé… Oh ! ne craignez rien, je serai prudent… je penserai à vous… Puis, ce n’est pas tout Suzanne… quelque chose me dit que cette femme, ancienne maîtresse de votre père, a été mêlée de près à cette intrigue… quelque chose me dit qu’elle est complice du crime… Il y a eu là peut-être une vengeance… Cette femme, il faut à tout prix la connaître…
– Raymond, dit-elle, avec une terreur instinctive, épargnez cette femme, si vous la rencontrez sur votre chemin… Songez que si elle est mère… cela serait effroyable… de la livrer ainsi aux juges… de la couvrir de honte, à la face de tous ! Mon père ne voudrait pas, j’en suis sûre !… Épargnez-la !…
– Nous verrons, quand l’heure sera venue. Tout à l’heure, vous m’avez accueilli en me disant que vous étiez heureuse… Eh bien, moi aussi, Suzanne, je suis heureux… car bientôt, je vous le jure, vous serez ma femme !
– Que Dieu vous entende, mon ami !
– Au revoir, Suzanne… Nous ne nous reverrons pas avant des semaines, peut-être, car je ne veux pas revenir sans vous apporter une bonne nouvelle… Ayez confiance… Aimez-moi… Je vous aime… Mon père, qui était l’ami du vôtre, a échoué lorsqu’il a voulu prouver l’innocence de Laroque… mais il est mort… Là où le père n’a pas réussi, le fils réussira peut-être… Lucien de Noirville n’avait que l’amitié… moi, j’ai l’amour… Et je mourrai, s’il le faut, comme est mort mon père !…
Sur ce mot, il partit.
CHAPITRE XXXIII
Les démentis donnés aux bruits de faillite rencontrèrent d’abord des incrédules ; mais il fallut bien que les plus entêtés se rendissent à l’évidence quand on sut que Terrenoire avait payé ses différences dans la journée même de la débâcle et que, le lendemain du jour où la justice avait fermé les bureaux du boulevard Haussmann, tous les dépôts avaient été remboursés.
En un mot, la banque faisait face partout à cette situation et sortait victorieuse d’une crise terrible qui avait un instant menacé de l’engloutir.
M. de Lignerolles apprit l’un des premiers ce revirement, et ce ne fut pas sans une certaine émotion.
Cela n’enlevait rien à la vérité, à toutes les charges relevées contre Jean Guerrier, mais il n’était plus possible de faire peser sur le caissier et sur le banquier un soupçon de complicité.
C’était donc ailleurs qu’il fallait chercher un complice à Guerrier – ou plutôt, pensait M. de Lignerolles, Guerrier a agi seul avec Béjaud pour son propre compte, sans doute à la suite de quelque querelle ignoble où M. de Terrenoire aura repoussé une demande d’argent exorbitante.
Cependant l’enquête devenait, après cette constatation, plus difficile et surtout plus délicate. Béjaud, interrogé à plusieurs reprises, avait fini par dire, en jurant, qu’il ne répondrait plus. Guerrier était si accablé, si malade, qu’il ne se traînait qu’avec peine, tant le coup avait été rude pour lui ; il était vieilli, avait les traits fatigués, les yeux enfoncés et brillants.
Aux questions réitérées du juge, il ne répliquait que par monosyllabes, prononcées sourdement, comme à regret, et qu’on avait peine à entendre.
– Je suis innocent… innocent de tout… Qu’on me mette en présence de ma femme, de monsieur de Terrenoire et de ceux qui m’ont fait du mal… C’est ce que je demande !…
M. de Lignerolles, qui le lui avait promis, était fort embarrassé, à présent, de tenir sa promesse.
Terrenoire étant écarté de l’enquête, le juge n’avait plus de prétexte pour s’occuper de sa conduite privée : les amours du banquier et de Marie-Louise ne le regardaient pas ; ces hontes d’un ménage à trois ne pouvaient l’intéresser que comme observateur et non point comme magistrat.
Comment, dès lors, satisfaire au désir exprimé par Jean Guerrier ?
Heureusement, le hasard le servit.
Guerrier était au dépôt depuis quelques jours quand Marie-Louise et Margival se présentèrent au cabinet du juge d’instruction.
M. de Lignerolles les fit introduire sur-le-champ.
Marie-Louise, pâle, les yeux rouges comme si elle avait passé les nuits à pleurer depuis l’arrestation de son mari, entra, se tenant à peine debout, tant son émotion était grande et tant elle était faible.
Le vieux Margival, aussi triste, mais plus énergique et plus résolu, la suivait.
Ce fut lui qui prit la parole.
– Monsieur, dit-il, nous vous remercions de nous avoir reçus. Dans notre malheur, ce nous est une consolation, et nous n’espérions pas tant, ma fille et moi.
Sa longue figure ridée, encadrée de barbe blanche, son haut front qui se terminait sous une broussaille de cheveux entièrement blancs, donnaient à sa physionomie un cachet d’honnêteté, de naïveté, de franchise, que le juge ne fut point sans remarquer et qui fit impression sur lui.
Il reprit :
– Nous ne savons ce qui se passe, Monsieur ; tout le monde nous délaisse depuis quelque temps, depuis l’arrestation du mari de ma fille… Seul, monsieur de Terrenoire nous a gardé son amitié… Car il ne croit pas plus que nous à la culpabilité de mon gendre. Il cherche partout une preuve de son innocence, il la trouvera, j’en suis certain, et réhabilitera ainsi ce pauvre garçon… Et voilà pourquoi je viens vous trouver, Monsieur, de notre part et de la part de notre ami Terrenoire.
– Pourquoi ?
– J’avais l’intention de vous demander s’il serait possible de remettre Guerrier en liberté…
– Impossible…
– Mais il est innocent, nous vous le jurons. Il faut, pour qu’on le croie coupable, un concours de hasards si extraordinaire que nous en sommes accablés, nous autres, et que nous ne pouvons que nous élever contre de toute notre indignation. Ayez pitié de nous, monsieur de Lignerolles. Voyez en quel état se trouve ma fille, à laquelle on enlève son mari quelque temps après son mariage ; ma fille, malade en ce moment, qui réclame tous nos soins, et qui n’a même pas la force de vous adresser la parole.
En effet, Marie-Louise se contentait de joindre les mains.
Son regard suppliait.
M. de Lignerolles les examinait tous deux d’un œil attentif.
Et sèchement, laissant voir malgré lui, l’antipathie que lui inspirait une pareille fourberie :
– Je voudrais vous être agréable. Je ne le puis.
– Le rendrait-on à la liberté sur caution ?
– Non plus. Mais en tout cas la caution serait trop forte et dépasserait assurément vos ressources.
– Les nôtres, certes, car elles sont minimes, et mon gendre et moi nous n’avions que nos appointements pour vivre. Mais vous savez, sans doute, combien monsieur de Terrenoire s’intéresse à Guerrier, à ma fille et à moi. C’est lui qui a fait le mariage de Marie-Louise…
– Ces détails me sont connus, dit le magistrat d’un ton singulier, et je vous trouve audacieux d’oser faire cette allusion devant moi.
– Cette caution, on peut l’exiger aussi forte qu’on le voudra. Monsieur de Terrenoire, qui semble né pour nous rendre service et nous tirer de peine, se chargera de la payer. J’ai sa promesse ; au besoin, du reste, il viendra vous trouver et renouvellera en personne la prière que je vous fais en ce moment.
– C’est inutile, que monsieur de Terrenoire ne se dérange pas ! dit le juge. Je sais que votre complaisance coupable vous est grandement payée. Je sais qu’un mot de votre fille est tout-puissant auprès de lui.
Marie-Louise s’était levée, dans une agitation extrême, l’œil brillant, les pommettes rouges.
– Monsieur, il m’a semblé voir dans vos paroles une intention qui serait pour mon père et pour moi une insulte mortelle… Je vous ordonne de vous expliquer…
Sa voix tremblait. Ses calmes traits de jolie blonde s’étaient transfigurés. Sa douleur avait fait place à sa colère.
Elle commandait, et comme le juge accueillait avec ironie cette véhémente parole :
– Vous avez compris, dit-elle à son père. Mon mari nous accuse, et la justice ne voit pas que le malheureux est fou. Oui, fou ! s’écria-t-elle, et c’est vous magistrat qui êtes cause de sa folie !
M. de Lignerolles sonna, et au garde qui apparut sur le seuil de la porte, il ordonna d’aller chercher Jean Guerrier et de l’amener dans son cabinet.
Il ne fut pas dit un mot jusqu’au moment où le caissier entra.
Il resta debout devant le bureau du juge.
En le revoyant, Marie-Louise, d’instinct, avait tendu les bras vers lui, mais elle avait été effrayée par cet air d’abattement répandu sur toute la personne de Guerrier.
Un sanglot lui monta aux lèvres et ses larmes jaillirent.
Et Jean Guerrier, qui entendit ce sanglot, tressaillit, se retourna, aperçut sa femme et eut un geste de répulsion.
– Marie-Louise ! dit-il.
Tout à coup, voyant Margival :
– Vous, vous !
Et se précipitant vers eux, l’œil brillant de colère, les poings serrés :
– Vous voilà ! Je vous revois !… Oh ! pour oser se présenter devant moi sans tomber à genoux, il faut que vous n’ayez plus ni honte ni pudeur !…
– Jean !… dit Marie-Louise, effarée… que veux-tu dire ?… De quelle honte parles-tu ?… Pourquoi rougirions-nous de te voir et quels reproches as-tu à nous adresser ?
Le juge souriait en les regardant.
Et il murmurait à part lui :
– Comédie ! Jusqu’où pousseront-ils l’effronterie de se jouer ainsi de moi ?
– Infâmes tous les deux, infâmes ! disait Jean Guerrier. Ah ! ne dissimulez plus je vous en prie… cela est inutile, et j’aime cent fois mieux vous voir tels que vous êtes… Ne dissimulez pas, je ne suis pas votre dupe !… Assez longtemps vous avez abusé de mon honnêteté, de ma naïveté, je devrais dire de ma sottise !… Assez longtemps vous avez fait de moi la risée de tous ceux qui me connaissent, vous avez empoisonné ma vie, vous avez attiré sur moi le mépris universel.
Margival écoutait ces sanglants reproches avec une stupéfaction douloureuse. Il prit Marie-Louise dans ses bras, l’attira contre son cœur comme pour la protéger de son affection paternelle.
Marie-Louise, dont les yeux s’étaient séchés, soudain, murmura :
– L’entendez-vous, mon père ?
– Ma pauvre fille, dit le vieillard, ma pauvre enfant, qu’allons-nous devenir ? N’en doutons plus : Jean est fou !
Il n’avait pas baissé la voix.
Guerrier l’entendit donc. Et il eut un éclat de rire strident.
– Ah ! vous allez me faire passer pour fou, à présent ? Je vous préviens que l’on ne vous croira pas. J’ai toute ma raison. Et c’est avec toute ma raison que je vous juge. Vous êtes deux misérables !
– Jean !… cria Marie-Louise en s’élançant vers lui, ne pouvant plus se contenir. Elle voulait l’enlacer de ses bras.
Il la repoussa brutalement. Il avait le sourcil froncé, l’œil dur et mauvais, et ses lèvres laissaient passer péniblement son haleine oppressée.
Marie-Louise chancela, en reculant sous la poussée.
– Jean, dit Margival, avec une tristesse navrante, s’il est vrai que vous n’êtes point fou, si vous pouvez nous comprendre… ayez pitié de votre femme… Regardez-la, elle est toute faible et toute malade, regardez-la !… Et le médecin que j’ai consulté, s’il nous a rassurés sur son indisposition, nous a cependant conseillé de prendre grand soin d’elle… Regardez-la, Jean, et dites-moi si vous comprenez ?…
– Qu’y a-t-il ?… bégaya Jean, livide…
– Elle vous rendra père, mon ami !…
Guerrier passa la main sur son front…
Ses yeux étaient égarés. Toute sa figure était crispée. On eût dit vraiment à le voir, qu’il était fou !…
– Ah ! dit-il d’une voix basse, mais où l’on sentait l’effort suprême pour rester calme… quelle joyeuse nouvelle vous m’annoncez là !… Que je suis content !… Ma femme enceinte ! Quelle joie dans la maison ! Et que d’honneur pour moi, pensez donc, de donner mon nom, mon pauvre nom modeste, que ne rehaussent ni fortune ni particule, à l’enfant de ma femme et de monsieur de Terrenoire !
– Mon Dieu ! fit Marie-Louise, épouvantée.
– En quel vilain moment vous m’apprenez cette heureuse nouvelle !… Il fallait attendre ma mise en liberté ! Alors, en compagnie de monsieur de Terrenoire, tous les quatre, nous aurions fait la fête… Ma femme porte l’enfant de Terrenoire, quelle aubaine ! Songez donc !… Fort honorée, ma femme, ma foi, et moi aussi, en vérité ! Merci, Marie-Louise, merci, Margival !…
Et il riait et parfois, à travers son rire, ses dents se rencontraient et grinçaient avec une furieuse rage de mordre et de broyer.
Margival était allé à lui et essayait, en employant toutes ses forces, de lui étreindre les bras.
Mais Guerrier se débattait, le repoussait avec dureté.
Alors, le vieillard s’approcha du juge d’instruction, qui était resté calme pendant cette étrange scène.
– Monsieur de Lignerolles, si vous avez quelque pitié pour nous, dites-nous ce qui s’est passé… dites-nous comment est survenue l’effroyable folie de cet homme.
Mais Jean Guerrier intervenait :
– Je ne suis pas fou, monsieur de Lignerolles, ne les croyez pas. Vous le savez, du reste. Ah ! je comprends que leur intérêt, en ce moment, serait de me faire passer pour un insensé…
Margival sentait ses idées s’en aller.
Il ne possédait plus son sang-froid, et, hébété par tout ce qu’il entendait, il essayait de recouvrer sa présence d’esprit.
Ce fut Marie-Louise qui fit acte d’énergie.
– Jean, dit-elle, de grâce, un mot !
– Aurais-tu l’audace de vouloir te défendre ?
– Certes, non, je ne me défendrai pas. Après quelques semaines de mariage, entendre, dans la bouche de son mari, une pareille accusation est assez pénible. Me défendre, ce serait donner prise à cette accusation. Me défendre, Jean, et de quoi, s’il vous plaît ? Ai-je bien compris ? Vous avez sur moi, sur mon honneur, sur mon amour un doute qui me fait injure… Et ce doute répond à l’insulte que me lançait tout à l’heure monsieur de Lignerolles. Non, vous n’êtes point fou, ce que vous avez dit, ce que disait monsieur de Lignerolles est raisonné. Qui vous a inspiré à tous deux pareils soupçons ? Je l’ignore, mais je veux le savoir. Mon Dieu, faut-il que, vous aimant ainsi que je vous aime, je sois obligée de relever cette horrible calomnie, et faut-il que ce soit vous, Jean, toi, pauvre Jean, si calomnié toi-même, qui me renvoies semblable insulte !
– Plût au ciel que ce ne fût qu’une insulte !
– Jean, il est impossible que tu ajoutes foi à ce mensonge. Réfléchis un peu, mon ami. Cela n’a pas le sens commun. Quels sont les semblants de raisons qui ont pu donner naissance à ces bruits ?… Je te le demande, à toi, et je suis sûre que tu ne sais rien… C’est vous, monsieur de Lignerolles, que je devrais interroger, car c’est assurément de vous que partent ces accusations.
Le juge restait silencieux, incrédule à ces manifestations d’angoisse et de désespoir. Alors elle se tourna vers son mari :
– Puisqu’il ne veut rien dire, éclairez-moi, Jean ! Il est horrible pour moi d’avoir à discuter ces choses ; pourtant, puisqu’il le faut, je m’y résigne !
Guerrier, devant cette douleur franchement exprimée, se reprenait à douter et tourna ses regards vers le juge d’instruction.
Celui-ci, froid et sarcastique, écoutait.
– Jean, reprit Marie-Louise, votre accusation repose sur des preuves, sans doute, ou du moins sur des indices qui vous semblent probants, sur des observations que vous avez faites vous-mêmes ou que l’on vous a suggérées. Je suis certaine que l’on vous a trompé, mon pauvre ami, que l’on a abusé de la surexcitation d’esprit ou vous étiez après votre arrestation pour vous raconter je ne sais quelle histoire que je vous prie de me dire. Je suis certaine, aussi, qu’un mot de moi suffira pour vous persuader.
– J’en doute ; mais dans tous les cas, je ne veux rien dire tant que monsieur de Terrenoire ne sera pas ici. C’est en sa présence qu’il faut que cette explication ait lieu. Monsieur de Lignerolles, ne me refusez pas cette grâce ! Ces tristes antécédents que vous croyez avoir relevés contre moi constituent une sorte de preuve morale de culpabilité dans le meurtre de Brignolet et le vol de la caisse. Je reconnais, comme vous, que ces antécédents prouveraient, sinon le crime, du moins que j’étais capable de le concevoir et de le commettre. J’ai donc hâte de vous montrer que je ne suis pas l’homme que vous croyez. Il s’est passé dans mon ménage, avant que je fusse marié, une abominable intrigue. Je n’en suis pas responsable, puisque je l’ai toujours ignorée, voilà ce qu’il faut que vous sachiez, monsieur de Lignerolles. Quand votre conviction sera formée sur ce point, le reste de l’accusation tombera, de lui-même. Veuillez écouter ma prière, Monsieur. C’est peut-être le seul moyen qui soit en mon pouvoir de prouver mon innocence.
– Parlez, Guerrier.
– Ce ne serait pas outrepasser vos droits que d’envoyer prier monsieur de Terrenoire de venir en votre cabinet. Il se peut que vous ayez besoin de renseignements complémentaires ; le prétexte à cette convocation est donc trouvé…
– Soit, demain donc…, fit le juge.
Guerrier eut un geste pour l’arrêter.
– Demain, il sera peut-être trop tard. Monsieur de Terrenoire sera prévenu et aura le temps d’inventer quelque histoire… Monsieur de Lignerolles, je vous en supplie, que ne l’envoyez-vous chercher tout de suite ?…
Marie-Louise s’avança, et avec une grande dignité :
– Je joins mes prières à celles de mon mari, dit-elle, et mon père se joint à moi pour vous supplier, lui aussi. Que monsieur de Terrenoire paraisse et que je sache au moins pourquoi l’on m’accuse.
M. de Lignerolles réfléchit une seconde, griffonna quelques lignes et les tendit à son greffier, après lui avoir parlé à voix basse.
Le greffier sortit aussitôt.
Margival et Marie-Louise rentrèrent dans le couloir qui précède les cabinets des juges d’instruction.
Une heure se passa.
M. de Terrenoire, qu’on n’avait point trouvé chez lui, mais que l’on était allé rejoindre à la Bourse, arriva enfin.
Quand il aperçut Marie-Louise et Margival, il fit un geste d’étonnement et parut inquiet.
– Qu’y a-t-il et que faites-vous là ? Marie-Louise, en le voyant, s’était mise à pleurer.
– Ah ! mon ami, mon bon ami, dit-elle si vous saviez ce dont on nous accuse… ce que prétend Guerrier !…
– Quoi donc ? De quoi peut-on vous accuser ?
Mais ils n’eurent pas le temps d’en dire davantage. On les introduisit chez M. de Lignerolles.
En se trouvant en face de Guerrier, le banquier eut une exclamation joyeuse et s’avança cordialement :
– Bonjour, cher enfant… Patience et ne vous découragez pas… Nous finirons par montrer votre innocence. Et ce sera bientôt, j’en suis certain.
Il restait les mains tendues.
Guerrier s’était reculé et détournait les yeux.
– Qu’avez-vous ? Vous refusez de me serrer la main, à moi qui vous aime tant ?… Vous pouvez prendre cette main, mon ami, car je n’ai pas cru un seul instant que vous pouviez être coupable de ce meurtre et de ce vol…
La porte du cabinet était fermée ; les gardes étaient sortis.
Il n’y avait plus là que M. de Lignerolles, Marie-Louise, le banquier, Margival et Guerrier.
Celui-ci, qui paraissait n’avoir pas saisi un mot de ce que venait de dire M. de Terrenoire, s’avança vers lui tout à coup, pâle, résolu :
– Monsieur, je suis heureux de vous entendre dire que vous êtes convaincu de mon innocence. Votre conviction pèsera d’un grand poids dans l’esprit de monsieur de Lignerolles, je n’en doute pas. Mais il est en votre pouvoir de prouver ma probité en levant les doutes qu’a fait naître l’histoire de votre intimité avec monsieur Margival et sa fille.
– Que voulez-vous dire, mon cher enfant ?…
– Je veux dire, fit Guerrier avec force, que vous avez lâchement abusé de votre situation et de ma dépendance pour vous jouer de ma crédulité et de mon honnêteté…
– Jean ! que signifie…
– Je veux dire que vous étiez l’amant de Marie-Louise avant mon mariage… comme vous êtes demeuré son amant depuis que je suis devenu son mari…
– Moi ! moi ! disait Terrenoire effaré, ne trouvant pas un mot pour se défendre, tant l’émotion l’étranglait.
– Je veux dire que vous étiez son amant, et que pour assurer votre tranquillité, celle de votre maîtresse, pour sauver les apparences, pour éviter un scandale, peut-être pour assurer aussi la paix de votre ménage, vous me l’avez donnée pour femme…
– Malheureux ! criait Margival en se précipitant sur lui, les poings en avant comme pour lui fermer la bouche, oses-tu avancer contre moi pareille calomnie !
– Contre vous, contre Marie-Louise, contre monsieur de Terrenoire, contre vous trois, car vous êtes des misérables… Vous vous entendiez de longue date. Il vous fallait une dupe, une victime. C’est moi que vous avez choisi !…
Terrenoire disait à Marie-Louise :
– Pauvre chère enfant, pauvre douce créature, qu’a-t-on pu lui dire pour qu’il nous croie aussi infâmes !
– Oui, infâmes, répétait Jean Guerrier dans une exaltation si grande qu’elle touchait à la folie… Ah ! ne niez pas, je vous en préviens, ce serait inutile !… Je sais tout !
« Vos relations avec Marie-Louise datent de plusieurs années déjà, et de tous ceux qui vous entourent, moi seul peut-être les ignorais.
Au lieu de se défendre, Terrenoire ne songeait qu’à Marie-Louise.
– Ma pauvre enfant ! disait-il, de quelle odieuse duplicité il vous juge capable !…
– Trêve à vos hypocrisies !… Vous ne connaissiez pas Margival, vous ne connaissiez pas Marie-Louise. Tout à coup, cet homme et cette fille se trouvent sur votre chemin. La fille vous plaît : vous l’aimez. Le père s’en aperçoit et ne vous éloigne pas. Il sait que vous êtes marié, et cependant il ne semble pas redouter cet amour. Il voit sa fortune faite. Vous êtes riche. Il est pauvre. Vous aimez sa fille. Ce n’est plus qu’un marché. Les conditions de ce marché, sans doute, ont été vite débattues. L’horrible chose ! Un père vendant sa fille !
– Qu’est-ce qu’il dit ? faisait Margival, hébété.
Jean Guerrier reprenait, avec une violence croissante :
– Ce marché conclu, il fallait conserver les apparences. Que fîtes-vous ? Vous auriez pu vous débarrasser de Margival en le payant tout de suite, et d’un seul coup. Margival accepta une place dans vos bureaux et sans aucun motif reçut une augmentation rapide. Margival ne pouvait s’étonner d’une pareille protection dont il connaissait le motif. Enfin, lorsqu’on jugea que le scandale allait devenir public – peut-être lorsqu’on s’aperçut – ô honte abominable ! – que Marie-Louise était enceinte, il fallait songer à lui chercher un mari !… Il fallut cacher la faute ! !… Et ce fut sur moi que le choix tomba ! Pourquoi ?… Parce que j’étais jeune, sans défiance, tout à mon travail, sans expérience de la vie. Ah ! les lettres anonymes avaient raison, vous auriez pu, tous les trois, m’expliquer pourquoi l’on me fuyait comme la peste. Je comprends maintenant pourquoi vous paraissiez étonnés, à la lecture de ces lettres, misérables que vous êtes et sot que je suis !
Une accusation de ce genre, arrivant à l’improviste, avait surpris à tel point M. de Terrenoire, l’avait si fort effrayé et bouleversé que, dans les premiers moments, il écoutait sans rien trouver pour sa défense. Une anxiété terrible était peinte sur son visage.
– Mais défendez-vous ! défendez-vous donc ! criait Jean, exaspéré, que la fureur aveuglait.
Et, en effet, cette attitude du banquier était bizarre.
Pourquoi ne lui répondait-il pas ?
Margival intervint, s’efforçant d’être de sang-froid.
– Monsieur de Terrenoire se défendra, dit-il au juge, car il est des infamies contre lesquelles toute une vie de probité proteste : et celle que vous lui attribuez, comme à moi, est du nombre. Mais, puisque vous accusez, il faut que vous prouviez… Nous écoutons…
– Jean ! soupira Marie-Louise, je t’en supplie, reviens à toi, approche-toi de moi… viens mettre tes mains dans les miennes pour que je t’empêche de fuir et regarde-moi de tout près dans les yeux afin d’y lire à ton aise le fond de ma pensée. Viens, Jean, avant de parler… Oh ! nous verrons, ensuite, si tu oses m’accuser toujours !…
– Taisez-vous, dit Jean, et écoutez ! Vous avez payé au père le déshonneur de sa fille, en lui donnant dans votre banque un poste sans importance, dont vous avez plus que triplé les appointements. D’où venait donc cet intérêt manifesté, tout d’un coup, à un homme que vous ne connaissiez pas quelques jours auparavant ?… Répondez !…
Le banquier, de plus en plus pâle, se taisait.
– Ce n’est pas tout !… Margival était inscrit, pour ne pas exciter les soupçons, comme percevant les appointements de son prédécesseur. Je payais le surplus, que monsieur de Terrenoire remboursait à la caisse.
Marie-Louise sanglotait.
Margival vint à Guerrier, troublé, tremblant :
– Cela est vrai, dit-il, mais pourquoi ne pas attribuer à la générosité, au bon cœur de monsieur de Terrenoire ce que tu mets sur le compte d’une ignominie ?…
– Il est possible que, dans les premiers jours, vous ayez agi de bonne foi, mais par la suite ! D’où vient l’intimité entre vous et monsieur de Terrenoire ? D’où vient l’intimité de monsieur de Terrenoire et de votre fille ?… Il néglige son intérieur, il néglige ses amis, le cercle, le monde pour passer les soirées entre vous et Marie-Louise… Et vous estimez que cela est naturel ?… Les cadeaux commencent à affluer ; des bijoux, des bibelots précieux… dont la vente générale constituerait une fortune… Vous ne vous y opposez pas, loin de là !… C’est un prix convenu, sans doute !… Mais alors, vous vous apercevez que j’aime Marie-Louise. Au lieu de me faire congédier par votre fille, vous semblez autoriser mon amour. Votre plan était conçu. Si quelque malheur arrivait, si une grossesse se manifestait, on m’accorderait la main de cette fille. Le mariage se bâclerait en quelques jours, avant que le scandale fût public. Et c’est bien ainsi, en effet, que les choses se sont passées !… Et je me croyais au comble du bonheur quand je roulais dans un abîme de boue !… Allez-vous affirmer encore que vous ignoriez ce qui s’est passé ? que vous n’êtes pour rien, ni vous, ni votre fille, dans ces achats de bijoux que je croyais, que vous me disiez faux, pour la plupart ? dans ces achats de meubles, prétendus d’occasion, dont je ne payais pas le sixième de la valeur, et que monsieur de Terrenoire allait acquitter derrière moi ?… Vous voyez que je n’ignore plus rien ! Il est un peu tard, vraiment, pour être aussi bien renseigné !… Mais je ne trouve pas qu’il soit trop tard pour vous cracher au visage la colère et le dégoût que vous m’inspirez tous les trois !…
Quand il eut ainsi parlé, ce fut un silence. Une épouvante régnait là.
Seul, le juge, appuyé nonchalamment contre le fond de son fauteuil, les yeux demi-clos, gardait sa présence d’esprit, écoutait, regardait, ne perdant ni un mot, ni un geste.
– Monsieur de Terrenoire, dit Margival d’une voix altérée, il y a dans les sanglantes injures de Jean Guerrier quelque chose que je ne comprends pas très bien et sur quoi il est besoin que vous vous expliquiez ! Il y a là un mystère qui va nous paraître très simple, sans doute, après que nous aurons entendu monsieur de Terrenoire. Veuillez me répondre, Monsieur… Vous voyez en quelle angoisse nous sommes.
Le banquier gardait les yeux baissés. Il était si pâle qu’on eût dit qu’il allait s’évanouir. Des frissons le secouaient violemment.
– Que puis-je vous dire ?… Ne voyez-vous pas combien je suis attristé que de pareilles atrocités aient pu trouver créance auprès de Jean Guerrier ?…
Et se tournant vers le caissier :
– Jean, vous que j’aime tant, que je défends depuis qu’on vous accuse !… Moi qui n’ai rien voulu croire de ce qu’on dit contre vous !… Comment avez-vous pu croire ce qu’on vous a dit contre moi !… Jean, que vous me faites de peine !
Mais Guerrier restait sombre. Il n’écoutait que sa jalousie, sa colère, sa rancune !…
Alors, s’adressant à Margival plus particulièrement :
– Interrogez !… Que voulez-vous savoir ?
– N’avez-vous pas entendu ?… Est-il vrai que vous ayez pris avec les fournisseurs de Guerrier les singuliers arrangements dont il parlait ?
– Avec qui donc ? balbutia Terrenoire, comme pour gagner du temps ; et regardant Marie-Louise avec désespoir.
– Je vais préciser, dit Guerrier. Avec monsieur Bontemps, le bijoutier auquel vous avez payé plus de quarante mille francs de bijoux destinés à Marie-Louise… Avec monsieur Letelliez, l’horloger, auquel vous avez payé huit cents et douze cents francs des pendules que j’avais achetées deux et trois cents francs !… Avec monsieur Cormatin, le tapissier, auquel j’achetais, pour quatre à cinq mille francs, des meubles qui en valaient trente mille et dont vous soldiez la facture quelques jours après. Les factures sont là, sur le bureau de monsieur de Lignerolles. Elles ont été saisies chez moi, dans une perquisition. Et des experts ayant indiqué la véritable valeur de ce qui se trouvait à mon domicile – valeur que j’ignorais moi-même dans ma simplicité – les marchands ont été consultés. Ce sont eux qui ont révélé la vérité. Ne niez donc pas !
– Je ne nierai pas ! fit Terrenoire, accablé.
– Ainsi, tout cela est vrai ?
– C’est vrai !
Margival fit un brusque mouvement de stupeur. Quant à Guerrier, il semblait triompher.
– Ah ! vous avouez ! vous avouez enfin ! Achevez donc, puisque vous avez commencé, et faites-nous l’histoire de vos amours… Tenez, je suis tout prêt à en rire, parole d’honneur ! Car j’ai été si bien trompé, que j’aurais, ma foi, mauvaise grâce à me fâcher !… Allons, monsieur de Terrenoire, contez-nous comment vous devîntes l’amant de ma fiancée et comment l’idée vous prit de me choisir pour son mari.
Et il riait d’un rire éclatant où il y avait quelque chose de funèbre.
Terrenoire avait entouré Marie-Louise de ses bras.
– Ne l’accusez pas, dit-il avec égarement, ne l’accusez pas, cette chaste et innocente enfant… En l’accusant, c’est plus qu’un sacrilège que vous commettez !
– De quel droit la défendez-vous ?
– Du droit qu’a tout honnête homme de s’opposer à une injustice.
– Disculpez-vous donc et disculpez-la en même temps.
Marie-Louise se dégagea de l’étreinte du banquier.
– Mon mari a raison, dit-elle. Tout nous accuse. J’ai accepté trop facilement vos cadeaux !… Vous sembliez tant m’aimer et tant aimer mon père… Et ces cadeaux, vous étiez si joyeux de me les offrir !… Mais il y a dans votre conduite un mystère que je vous demande d’éclaircir… comme le demandent mon père et mon mari… Pourquoi cette entente avec le tapissier et les autres ?… Pourquoi avoir trompé mon mari sur le prix de ces meubles, de ces bibelots, de ces œuvres d’art ?… Pourquoi ?…
Terrenoire ne répondit point.
– Vous vous taisez ? Vous ne trouvez pas un mot ?
Guerrier riait toujours.
Marie-Louise, tout près de Terrenoire, le regardait avec horreur.
Quant à Margival, comme si la lumière s’était faite dans son esprit, il s’était approché de Guerrier, et :
– Mon pauvre enfant, murmurait-il, tout ce que tu as dit est peut-être vrai – excepté cependant ma complicité dans cette honte !… J’ai été victime… comme toi… trompé, abusé, dupé, comme toi !… Aie pitié de moi !… Regarde-moi, et vois si je te mens !…
Guerrier détourna les yeux pour ne point voir !…
Cependant, Terrenoire balbutiait :
– Oui, je l’avoue, j’ai fait ce qu’on me reproche. J’ai eu tort. J’aurais dû agir avec franchise. Je n’ai pas osé. J’aime Marie-Louise d’une affection pure où n’entre pas l’amour. J’ai été séduit par les grâces de cette enfant, par le charme qui se dégage de sa personne. Mais m’accuser de l’avoir voulu séduire ! De l’avoir achetée, elle, à son père, comme une vile marchandise !… M’accuser de l’avoir fait servir à mes plaisirs, elle !… C’est horrible, entendez-vous, horrible… Il faut que vous ayez l’âme bien perverse pour imaginer pareille monstruosité !… Qu’y a-t-il d’étonnant à ce qu’on se prenne d’amitié pour une fille comme Marie-Louise ?… Et pouvais-je lui témoigner mon amitié autrement que je l’ai fait ?… Margival était pauvre… il n’eût rien accepté de moi directement. J’ai eu recours à la ruse. Je voulais peu à peu, et sans que personne s’en doutât, constituer une petite fortune à Marie-Louise. Et mon entente avec Bontemps, Cormatin et les autres n’a pas d’autre raison ! J’ai eu tort, je le vois, puisque tous ces actes ont pu donner naissance à ces bruits injurieux… j’ai eu tort…
– Certes, dit Margival, j’étais trahi par vous, qui, sous prétexte de me rendre service, abusiez de ma confiance. J’étais trahi par ma fille… ma fille que j’avais élevée avec tant de soin… et qui est tombée si bas !… Quelle épreuve pour ma vieillesse ! Et combien peu je la méritais !
– Mon père, dit Marie-Louise, je vous en conjure, si vous ne voulez pas me faire mourir de douleur, sous vos yeux, ne me croyez pas coupable !
– Hélas ! murmura Margival, je voudrais bien ne pas croire !… Le puis-je ?…
Marie-Louise voyant qu’elle ne convaincrait pas son père, voyant que Jean Guerrier, blême, l’œil brillant de fièvre l’accusait encore, Marie-Louise, dans un élan de colère et de douleur, se précipita vers M. de Terrenoire :
– Mais parlez, vous, Monsieur, parlez donc ! Puisque c’est vous et moi que l’on accuse… Vous savez mieux que tous, que je suis innocente… Moi, je proclame que vous n’êtes pas coupable, que ma confiance n’a pas diminué… que jamais vous ne m’avez témoigné qu’une affection dont je pouvais être et dont je suis encore fière !… Mais défendez-moi donc !… Vous vous taisez, comme si vous ne trouviez rien… comme si tout cela était vrai !…
Et Terrenoire, la tête basse :
– J’ai dit tout ce que je pouvais… Pourquoi ne pas me croire ?… Je n’ai pas d’autres explications à donner !
Marie-Louise se fit plus pressante ; sa colère augmentait avec ses instances, en même temps que la résistance inattendue de Terrenoire l’effrayait :
– Nous devinons tous, d’instinct, qu’il y a un secret que vous nous cachez – et comment ne le devinerait-on ? Votre trouble, votre pâleur, vous trahissent. C’est ce secret qu’il importe à notre honneur que vous nous fassiez connaître sur-le-champ.
Le banquier, obstinément, balbutiait :
– Il n’y a d’autre secret que celui de ma trop grande affection pour vous.
Marie-Louise se mit à genoux.
– Monsieur de Terrenoire, en vous taisant, vous nous déshonorez. C’est notre malheur que vous consommez ! Qu’avons-nous fait, de quoi sommes-nous coupables, pour que vous laissiez retomber sur nous cette honte ?
Le banquier détourna les yeux. Mais ses lèvres restèrent closes, comme si quelque secret mortel les eût cadenassées.
Margival mêlait ses prières à celles de sa fille. Seul Guerrier, comme le juge, souriait ironiquement ne voulant pas prier. Et le banquier s’entêtait dans son silence.
Margival s’approcha de M. de Lignerolles.
– Monsieur, dit-il, nous vous demandons la permission de nous retirer. Nous n’avons plus rien à faire ici. Demeurer plus longtemps serait nous infliger un supplice inutile.
Le juge d’instruction inclina la tête en signe d’adhésion.
Margival et Marie-Louise partirent.
Terrenoire, abîmé dans ses réflexions, les yeux obstinément fixés à terre, ne s’était même pas aperçu qu’il restait seul avec Guerrier et le juge.
Ce fut celui-ci qui le tira de ce rêve.
– Monsieur de Terrenoire, vous êtes libre ! dit-il.
Le banquier releva les yeux, et soudain, avec chaleur :
– Ah ! Monsieur, je vous jure qu’ils sont innocents et moi aussi des infamies qu’on nous reproche !… Jean, mon fils, croyez-vous vraiment que je suis l’amant de votre femme ? vous que j’aime autant qu’elle ?
Et Guerrier, sombre, haineux :
– Je le crois !
Terrenoire semblait hésiter. On eût dit qu’il allait parler, avouer enfin un secret qu’il cachait, le secret de sa conduite, sans doute… Mais il se tut et, sans saluer, sortit lentement.
Cinq minutes après, deux gardes de Paris emmenaient Jean Guerrier au dépôt.
Et, seul dans son cabinet, le juge d’instruction resta pensif et soucieux. Des réflexions, graves, traversaient son esprit. Et ces réflexions, il les traduisit d’un mot, qu’il laissa échapper tout haut, malgré lui :
– Où est la vérité ?
CHAPITRE XXXIV
Pendant que Roger Laroque essayait de sauver Guerrier et de préparer sa réhabilitation, quelqu’un déployait tout autant d’activité en sa faveur… Raymond de Noirville n’avait plus qu’une pensée : rendre l’honneur au père de celle qu’il aimait.
Ainsi travaillait-il à sa propre félicité.
À Paris, à la préfecture, comme au Palais, on lui fournit tous les renseignements qu’il désirait. L’affaire Laroque était dans toutes les mémoires ; à l’exception de Mme Laroque, morte, de Lucien de Noirville, mort aussi, tous les personnages qui y avaient joué un rôle devaient encore exister.
Et, en effet, il n’eut pas de peine à retrouver leur piste – à l’exception de Victoire, la femme de chambre, laquelle avait, celle-là, complètement disparu.
M. Lacroix, le commissaire de police de Versailles, était, depuis des années, le collègue de M. Liénard aux délégations judiciaires, et on avait mis son nom en avant chaque fois que s’ouvrait la succession du chef de la Sûreté.
Toujours vivants aussi, M. de Ferrand, le magistrat ami de Lucien ; M. de Lignerolles, qui avait instruit l’affaire à Versailles et qui était juge à Paris ; les deux agents Tristot et Pivolot, ces types étranges de policiers amateurs ; le père Ricordot, l’expert que les tribunaux employaient toujours à la vérification de certaines écritures embrouillées.
Raymond, en relisant les procès-verbaux et les dépositions, avait pris tous ces noms, avec des notes en marge de chacun d’eux, afin de se rappeler quelle avait été leur attitude pendant le procès et la somme de renseignements qu’on pouvait leur demander.
Le nom du principal témoin à décharge, « Jean Guerrier », l’intrigua beaucoup. Il n’ignorait pas l’accusation capitale portée par le parquet contre l’ancien caissier de Roger Laroque. Cet accusé était-il l’assassin de Brignolet ? Déjà certains journaux qui cultivent à fond le reportage des faits divers avaient fait remarquer la singulière coïncidence.
« Si cet homme n’est pas remis en liberté, se dit Raymond, j’obtiendrai du parquet de plaider d’office ; s’il refuse mes services, il me suffira de lui rappeler que mon père est mort en défendant son ancien patron, dont il sauva la tête. »
Sa mère l’avait renseigné aussi, maintes fois, sur la manière de travailler de son père.
Il savait que Noirville, quand il se chargeait d’un procès important, préparait sa plaidoirie longuement, à force de notes, en s’entourant de toutes les pièces, de tous les documents possibles. Le dossier de l’affaire Laroque devait être, avec une foule de papiers, jamais classés, dans un grand bahut, à la ferme de Méridon.
Après la mort de l’avocat, et lorsque Mme de Noirville quitta son appartement de la rue de Rome, pour aller habiter Méridon, on avait emporté pêle-mêle ces papiers. Depuis douze ans, personne n’y avait touché !
Raymond se décida à en faire un inventaire complet et jusqu’au soir, il travailla sans rien trouver.
Le lendemain, il recommença, mais sans mieux réussir. Il avait aussi relu la Gazette des Tribunaux et le Droit, où étaient relatés les débats, avec la plaidoirie de son père ; il s’était procuré facilement ces numéros. Une seule chose l’étonnait, à la lecture de cette émouvante affaire. Après avoir nié depuis son arrestation, pourquoi brusquement, à la fin des débats, Roger Laroque avait-il avoué ? Car il avait avoué ! Son aveu était inscrit en toutes lettres dans le compte rendu de la Gazette.
Par deux fois Roger avait dit :
– Je suis coupable. Condamnez-moi !
Et cet aveu, il l’avait laissé échapper après la mort de Lucien, comme si, soudain, après cette mort, un immense découragement lui était venu, comme s’il n’avait plus eu aucun intérêt à paraître innocent, comme si, même, il s’était senti soulagé à paraître coupable et à attirer plus vite le châtiment sur sa tête.
Cette attitude imprévue, Raymond ne se l’expliquait pas. Ce qu’il devinait vaguement, par exemple, et d’instinct, c’est qu’il y avait une corrélation mystérieuse entre cet aveu suprême et la mort de Lucien de Noirville. Laquelle ?… L’apprendrait-il jamais ?
Il reprit son travail avec ardeur ; il avait dépouillé déjà la moitié des pièces renfermées dans le bahut, et il n’avait rien trouvé, quand il tomba enfin sur des notes qui avaient trait à l’assassinat de Larouette.
Avec quelle impatience il les lut !
Peu à peu, il reconstitua le dossier ! Peu à peu, il eut devant les yeux tout le plaidoyer de son père ! Et, à chaque pièce, presque à chaque page, presque sur toutes les marges, il lisait la préoccupation de Lucien traduite par ces mots : « Quel mystère dans la vie de Roger ?… D’où vient le remboursement et pourquoi Roger ne nomme-t-il pas son débiteur ?… Une femme a joué en tout cela un rôle néfaste… Mais pourquoi ?… Et quelle est cette femme ? »
– Mon père ne se trompait pas, murmura Raymond, il y avait une femme… Mais qui ?
Enfin le bahut se vidait. Avec quelques papiers épars sur les rayons, il ne restait plus que des feuilles égarées des dossiers, et dont quelques-unes avaient glissé entre les rayons et le fond de l’armoire. Elles restaient prises là. Comme il voulait tout voir, il les tira avec précaution, dans la crainte d’arracher quelque document précieux. Il amena, parmi eux, une carte-photographie. Que faisait cette photographie dans ce désordre ? Elle avait été perdue, à coup sûr.
Elle était bien jaunie, comme le reste, d’une teinte d’un brun clair et sale. Cela représentait un homme, d’apparence vigoureuse, très brun, à la physionomie énergique et expressive, âgé d’une trentaine d’années. Cet homme, Raymond ne le connaissait pas, ne l’avait jamais vu. Ce n’était pas son père, à coup sûr, dont un portrait, sans compter les photographies de l’album, lui rappelaient chaque jour les traits chéris.
Celui-là était un étranger, sans doute. Qui ? Il retourna la carte, pour voir le nom du photographe. Il y avait quelques lignes manuscrites écrites au dos – d’une écriture fine de femme –, et qui le firent tressaillir violemment, sans savoir pourquoi, car il avait reconnu l’écriture de sa mère. Les lignes manuscrites étaient trois dates.
La première portait :
28 juillet, 11 h. 1/2 du soir.
La seconde :
30 juillet 1872.
La troisième :
14 août 1872.
Qu’est-ce que cela voulait dire ? Et pourquoi ces trois dates derrière le portrait de cet inconnu ? Pourquoi, surtout, ces trois dates écrites de la main de sa mère ? Quelles étaient ces dates ? À quels événements se rapportaient-elles ? Le 28 juillet, 30 juillet, 14 août… Que s’était-il passé ?
Raymond se prit à rêver, essayant de percer ce mystère. Il n’y parvint pas et rejeta la photographie dans le bahut.
Après tout, que lui importait ! Cela ne pouvait-il avoir trait à des choses qu’il ne connaissait pas, et toutes naturelles encore ?
Il ne s’en occupa plus et se mit à classer, dans un même dossier, toutes les pièces du procès Laroque. Mais tout à coup ses yeux rencontrèrent, sur les manchettes de la Gazette des Tribunaux, une date :
14 août 1872.
C’était la troisième de celles inscrites au dos de la photographie : cela devenait singulier… Cette coïncidence le frappait…
Il feuilleta machinalement le journal, par curiosité… d’abord… et sans arrière-pensée… mais tout à coup, dans ses doigts passe un courant de fièvre, un tremblement violent… Il est devenu pâle et, suffocant, il arrache sa cravate et brise le bouton de sa chemise.
C’est qu’il vient de découvrir, ou plutôt de se rappeler, en relisant pour la dixième fois peut-être l’affaire Laroque, que cette première date du 28 juillet est celle du crime de Ville-d’Avray, – l’heure même, onze heures et demie, est celle de l’assassinat de Larouette !… C’est qu’il a découvert aussi que la seconde date du 30 juillet est celle de l’arrestation de Laroque !… C’est qu’il a découvert enfin que la troisième date est celle de la condamnation de Roger aux travaux forcés !… Il a découvert cela, il ne comprend pas, mais il a peur !
Il contrôla dix fois les dates. Il croyait se tromper. Mais non. Et la même et incessante question revenait à son esprit affolé :
– Pourquoi, au dos de ce portrait, la date de ce crime… la date de l’arrestation… la date de la condamnation ?
Il ne trouvait pas. Il se faisait d’épaisses, d’insondables ténèbres dans son cerveau.
Il cacha la photographie dans son portefeuille. Puis, la tête en feu, il sortit et alla se promener à travers champs, espérant que la fatigue aurait raison de sa fièvre. « Qui donc est cet homme ? » se demandait-il à chaque instant.
Et, s’écartant des sentiers, dans l’ombre des bois, il tirait la photographie de son portefeuille et la contemplait avidement. Et, à force de regarder, il en venait à se dire :
– Ce ne peut être que Roger Laroque !
Il essayait bien de fouiller sa mémoire, mais il ne se rappelait rien de précis sur la physionomie de l’ami de son père.
Ses souvenirs étaient donc très vagues, impossible de préciser. Mais comme il avait maintenant l’esprit tendu vers cette idée, il lui semblait retrouver dans la photographie certains traits de la physionomie de Laroque, du Laroque qu’il connaissait.
Certes, le premier, celui du portrait, était plus jeune de douze ou quinze ans. Les cheveux et la barbe étaient noirs. Il y avait là un air de santé, d’énergie, de bonne humeur, que n’avait plus William Farney.
Et pourtant, une chose n’avait pas changé : le regard !… C’étaient bien toujours ces mêmes yeux noirs et profonds, vifs et spirituels tour à tour. Et puis le front aussi était pareil ; le front qu’avait respecté l’incendie de Québec, et qui n’avait pas été atteint par la cicatrice. C’était Laroque, il n’en pouvait douter.
Mais pourquoi ces trois dates ? De la main de son père, il les eût comprises, peut-être, mais de la main de sa mère ? Elle connaissait donc bien Laroque ? Mais alors, comment ne lui en avait-elle jamais parlé ?… Que de mystère !…
Il erra toute la journée dans les bois et rentra le soir à la ferme, sombre et silencieux.
– Qu’as-tu donc, demanda sa mère : serais-tu malade ?
– Un peu de migraine, dit-il pour s’excuser.
Il remonta dans sa chambre aussitôt le dîner, il n’avait pas mangé et il n’avait pas prononcé une parole.
Sa mère le regardait avec une infinie tristesse.
– Vraiment, tu n’as rien ? répéta-t-elle.
– Rien, rassurez-vous !
Dans sa chambre, il se prit à examiner de nouveau la photographie de Laroque. Plus il l’étudiait ainsi, et plus il était sûr de ne pas se tromper. Nul doute n’était plus possible.
Un soupçon lui vint, affreux et mortel. Il savait qu’une femme avait été mêlée mystérieusement au crime de Ville-d’Avray, il recherchait les traces de cette femme, et voilà que le premier indice qu’il découvrait le conduisait droit à sa mère. Cette pensée le tint éveillé toute la nuit. Il entendit sonner toutes les heures à la pendule de sa chambre, et, le matin, le soleil levant le trouva debout.
Il devait être à Paris ce jour-là pour ses affaires.
Avant de partir, il resta seul avec sa mère :
– Tu ne t’es pas ressenti de ton malaise ? dit-elle avec inquiétude.
– Non, dit-il, j’ai bien dormi… je ne me suis pas réveillé.
– Il m’a semblé pourtant que tu t’étais levé de bonne heure.
– Oui, il y a bien longtemps que je voulais mettre en ordre les papiers de mon père… vous savez ? qui se trouvent dans la grande armoire de la chambre proche de la mienne ?… Cette besogne m’a pris toute ma journée d’avant-hier et d’hier…
Et soudain, après un silence embarrassé :
– J’ai trouvé une photographie dans ces paperasses… avec des dates au dos… Il m’a semblé que ces dates étaient de votre écriture… La voici…
Et il tendit le portrait de Roger Laroque.
L’effet fut foudroyant. Pâle comme une morte, Julia eut à peine la force de gagner une chaise. Au premier coup d’œil, elle avait reconnu Roger. Elle tremblait de tous ses membres, et le regard qu’elle arrêta sur son fils n’était plus le regard d’une femme ayant toute sa présence d’esprit, tout son sang-froid, tout son calme : c’était le regard d’une folle !…
C’est en vain qu’elle essayait de se retrouver, de surmonter son horreur, son épouvante, c’était plus fort qu’elle et elle s’abandonnait.
– Ma mère !… ma mère !… dit-il, effrayé de l’effet produit.
Et il se précipita à ses genoux, lui prit les mains, les embrassa.
Elle ne l’entendait pas. De grosses gouttes de sueur lui coulaient du front. Et Raymond était non moins troublé qu’elle. Il lui semblait que tout s’écroulait autour de lui. Il en était à ce point qu’il eût désiré je ne sais quel mensonge ; il avait tant besoin d’être rassuré !
À la fin, elle comprit – peut-être ! – ce qui pouvait se passer dans ce cœur bouleversé. Elle parut se remettre et essaya de sourire.
– Cette chaleur d’orage m’a rendue nerveuse ! murmura-t-elle.
Il alla ouvrir les fenêtres. Une bouffée de l’air matinal entra. Elle respira par deux fois, à pleins poumons.
– À propos, dit-elle, tu me disais tout à l’heure… Que me disais-tu donc ? Tu me parlais d’une photographie ?…
Il la lui tendit à nouveau. Cette fois, elle eut le courage de la regarder sans faiblir.
– Oui, dit-elle, tu as bien fait de me la donner… Comment cette photographie était-elle égarée là ? C’est un jeune homme ami de notre famille… auquel il est arrivé un grand malheur… Tu vois ces trois dates… écrites derrière… la première, du 28 juillet, est celle de son mariage avec une jeune fille qu’il aimait depuis longtemps… le 30, deux jours après son mariage, sa femme mourait… quinze jours après, il était fou… fou de douleur… de désespoir…
– Et aujourd’hui, qu’est devenu ce pauvre garçon ?…
– Aujourd’hui !… il est mort !
Raymond respira, profondément soulagé…
Cette histoire semblait vraie… Et, si elle était vraie, tous ses soupçons tombaient d’eux-mêmes ! Et pourquoi n’eût-ce pas été la vérité ? Cela était possible, en somme.
Il tendit la main pour reprendre la photographie.
– Je la mettrai dans l’album, dit-il.
Elle la lui rendit. La main de la malheureuse femme tremblait.
Il classa devant elle le portrait-carte dans l’album ; avant de fermer celui-ci, il dit en se penchant :
– C’est curieux… on dirait que le carton est percé d’un coup de poignard… là, du côté du cœur ?… Avez-vous remarqué, ma mère ?…
– Il se sera trouvé serré contre un clou, dans le déménagement, dit-elle d’une voix altérée.
Il n’y eut rien de plus entre eux. Quand Raymond eut quitté la ferme pour se rendre au chemin de fer, Julia resta pendant des heures, l’œil fixé sur l’album. Le portrait l’attirait invinciblement. À la fin, elle céda à la tentation. Elle rouvrit l’album et contempla Roger.
Puis, espérant sans doute qu’en anéantissant la photographie elle détruirait le remords, elle effacerait le souvenir, elle alluma une bougie, enflamma la carte et la jeta dans le feu.
Quelques jours après, Raymond était là de nouveau. En arrivant à la ferme, son premier soin avait été de feuilleter l’album. Pourquoi ? Doutait-il encore ? Non, c’était chez lui instinctif.
– Tiens ! dit-il surpris, elle n’est plus là ?
– Quoi donc ? fit la mère.
– La photographie de ce pauvre homme… dont vous m’avez raconté la terrible histoire…
– Ah ! c’est vrai… Elle rappelait un passé trop triste… je l’ai jetée au feu…
Raymond baissa la tête. Ses doutes étaient revenus.
......................
Quelques jours après cette scène, Raymond se rendit à Maison-Blanche. Il s’était dit, pourtant, qu’il n’y reparaîtrait, à cette maison, où il avait laissé la moitié de son cœur, que lorsqu’il aurait quelque bonne nouvelle à y apporter.
Mais le doute affreux le poussait. C’était plus fort que lui. Il voulait savoir.
Suzanne était au château. Il lui demanda un entretien particulier.
Suzanne remarqua l’altération du visage de son ami.
– Qu’avez-vous ? dit-elle. Vous serait-il arrivé malheur ?
Il était bien obligé de dissimuler. Qu’eût-il dit en effet ?
– Non. J’ai besoin d’un renseignement.
– Lequel ? Parlez !
– Il est fort probable qu’il ne vous reste aucune photographie de votre père, il y a douze ou quinze ans ? Obligé de se cacher, de dérober sa figure, ayant changé sa physionomie, monsieur Laroque commettrait la plus grave imprudence s’il laissait chez lui un portrait qui pût rappeler à un ennemi ses traits d’autrefois…
– En effet.
– Il ne vous reste donc rien… absolument rien…
– Si. Écoutez. Mon oncle, lorsqu’il m’eut prise à Ville-d’Avray pour m’emmener dans les Ardennes, choisit, entre autres choses, une photographie de mon père et une de ma mère qui se trouvaient dans l’album ; ces photographies sont restées à La-Val-Dieu, sans doute, et jamais ne m’ont été montrées, car mon oncle et ma tante furent persuadés, comme mon père, que par suite de la maladie qui faillit m’emporter, j’avais perdu la mémoire ; mais ce n’est pas tout. J’avais, moi, un petit médaillon où ma mère avait mis une réduction de la photographie de mon père. Lorsque j’étais toute petite, j’ai réussi constamment à le cacher. Encore maintenant personne ne le découvrirait. Mon père y est très reconnaissable. Voulez-vous que je vous le montre ?
– Si vous avez confiance en moi, Suzanne.
– Oh ! mon ami…
Elle sortit. Quelques minutes après, elle était de retour. Elle ouvrit un petit médaillon d’or et le tendit à Raymond.
Celui-ci n’y jeta qu’un coup d’œil. Cela lui suffit pour reconnaître Roger Laroque – le Roger Laroque dont il avait vu la photographie cinq ou six jours auparavant, car les deux portraits étaient bien ceux du même homme.
Quelle était donc cette histoire racontée par sa mère à ce propos ? Pourquoi ce mensonge ? Pourquoi donc, aussi, avait-elle eu tant de hâte d’anéantir cette photographie – qu’elle croyait sans doute n’exister plus ? Et ces trois dates si fatales à Roger ? Autant de mystères !
Suzanne eut beau se montrer tendre et empressée, elle ne réussit pas à dissiper le nuage qui assombrissait la figure de Raymond. Un profond désespoir s’était emparé du jeune avocat, il sentait tout s’écrouler autour de lui.
En vain, elle voulut l’égayer, le faire sourire. En vain, l’interrogea-t-elle. Il s’excusa et s’enfuit.
Tout en marchant, tout en courant, il répétait :
– Pourquoi ?… pourquoi ?…
Éternelle question… Éternelles ténèbres. Il avait la fièvre.
Rentré à Méridon, vers le soir, il se trouva en face de sa mère. Il y eut un assez long silence. Puis Raymond demanda, dissimulant du mieux qu’il pouvait le tremblement de sa voix :
– Je ne sais pourquoi l’histoire que vous m’avez contée me revient sans cesse à l’esprit.
Elle eut l’air très étonné :
– Quelle histoire ? fit-elle.
– Celle, si lamentable, de ce pauvre garçon dont j’ai retrouvé la photographie dans l’armoire où étaient les dossiers de mon père…
Elle tressaillit et le regarda attentivement.
Mais Raymond avait les yeux baissés.
– Se marier, reprit-il, aimer une jeune fille… s’attendre à la prochaine réalisation de ses rêves… toucher à un de ces rares instants de bonheur presque complet qu’on a dans la vie… et voir comme un fantôme ce bonheur disparaître… voir mourir la femme aimée, la voir mourir dans tout l’éclat de la beauté, dans le plein triomphe de sa jeunesse… C’est horrible et je comprends que cet homme n’ait pas survécu à un aussi grand chagrin… Il est mort… Il a bien fait…
– Comme tu me dis cela… Et pourquoi me le dis-tu ?
– C’est que j’approuve le suicide, dans certains grands, injustes et irréparables malheurs…
– Mon fils !
– Et vous le dirai-je, ma mère ?… J’ai le pressentiment qu’une catastrophe pareille me menace…
– Veux-tu bien ne pas avoir de pareilles idées !
Il resta de nouveau silencieux, puis, ayant l’air de se remettre, et prononçant ces mots avec une feinte indifférence :
– Quel est le nom de cet infortuné ?
Pour la seconde fois, elle tressaillit violemment. Ses yeux noirs, presque toujours éteints, flamboyèrent une seconde, en s’arrêtant sur ceux de Raymond.
Elle hésita un peu, cherchant sans doute ; enfin, ayant trouvé :
– C’était, dit-elle, un de nos parents éloignés, portant le même nom que nous… Jean de Noirville…
– Et la jeune femme ?
– Elle était d’une vieille famille de commerçants très riches… les Lasserre, elle s’appelait Marguerite… Tu as entendu parler des Lasserre… marchands de fourrures ?
– Non.
– Ils n’existent plus, du reste… morts… Marguerite était orpheline… Toute la fortune s’en est allée à des parents plus rapprochés que nous…
Comme il ne répondait pas et semblait profondément absorbé, elle respira… Il la croyait, sans doute, et ne se doutait pas d’un mensonge. Du reste, ce qu’elle avait dit n’était pas inventé… C’était vrai !… L’histoire était arrivée… Elle n’avait fait que la mettre sur le compte de Laroque…
– En mettant de l’ordre dans les papiers, dit-il, j’ai eu entre les mains le dossier de ce mystérieux assassinat de Ville-d’Avray, la dernière plaidoirie de mon père… Et j’essayais, tout en le parcourant, d’évoquer le souvenir de mon enfance… J’avais cru me rappeler la figure de ce Laroque… Vous l’avez connu, ma mère ?
– Oui, dit-elle, presque prise de faiblesse, c’était, tu le sais, un grand ami de Lucien… Ils s’étaient sauvé la vie, l’un à l’autre, pendant la guerre.
– Et, en me rappelant les traits de cet homme, je m’étais imaginé que la photographie était la sienne.
– C’est une erreur, tu le vois.
– En effet, mais j’étais d’autant mieux fondé à le croire, et c’est ce qui fit mon erreur, que les trois dates mentionnées au dos du portrait-carte sont justement les dates de l’assassinat de Ville-d’Avray, de l’arrestation de Roger Laroque, et de sa condamnation aux travaux forcés.
– C’est une coïncidence, et rien de plus.
– Avouez qu’elle est bizarre.
– Bizarre, je le reconnais.
– Et vous êtes bien sûre, ma mère que ce n’était pas le portrait de Laroque ?
– J’aurais donc menti ?… et menti en le sachant ?… Pour quelle raison ? Dans quel but ?… C’est moi qui ai mis les dates… c’est mon écriture. Si elles n’étaient autre chose que les trois époques fatales de la vie de Roger, dans quel intérêt et pour obéir à quelles mystérieuses pensées les eussé-je écrites là ? Réponds à ton tour.
– Ce que je dis n’a pas le sens commun, fit-il, riant faux… Ne voyez dans toutes ces questions que la préoccupation d’un esprit malade, assiégé par les pressentiments dont je vous parlais tout à l’heure…
– Est-ce qu’un homme devrait avoir de ces craintes-là ? Tu me fais beaucoup de peine. Je ne suis pas déjà si bien portante. Tu devrais m’épargner des émotions trop fortes pour moi, mon enfant… Regarde en quel état tu me laisses !
Elle était digne de pitié, en effet, tant ses pauvres membres tremblaient, tant elle paraissait souffrir. Elle avait espéré que Raymond la consolerait d’un mot… Mais les lèvres de Raymond restèrent closes. Son esprit était absent. Il était loin, cherchant la vérité dans l’infini du doute.
– C’est elle, elle m’a menti ! Elle veut me mentir encore ! Pourquoi ? Il faut que je le sache… Je le saurai !
Et Julia, qui comprenait, fermait les yeux, voulant éloigner un fantôme qui, obstinément, se dressait, à cette heure, entre elle et le fils bien-aimé de son cœur.
......................
Accoudé sur la table de travail, Raymond, dans son petit appartement de la rue de Douai, songeait à ces choses ; il avait les yeux fermés, pour mieux concentrer ses idées, et la tête dans les mains.
Il ne s’apercevait pas que la nuit était venue.
Il revivait, à cet instant, douze ans en arrière, et assistait comme un spectateur au théâtre, au spectacle des derniers moments de son père… Il évoquait les derniers moments de cette vie avec une intensité de volonté telle qu’il voyait et entendait vraiment son père à cette heure-là…
Ah ! qu’il eût payé cher celui qui serait venu lui dire :
– La lettre à laquelle vous pensez est là.
Soudain, il se lève, un rayon de lumière a traversé son esprit.
Il se lève et murmure :
– Peut-être ! peut-être !
Que veut-il dire ? À quelle pensée répond-il ?
Il traverse son appartement et entre dans un cabinet noir où se trouvent pendus des vêtements à des portemanteaux. Il décroche une robe d’avocat, sous des vêtements dans un coin. Il la considère un instant, avec crainte, avec de l’attendrissement aussi, car le cœur de son père a battu sous cette robe ; c’est sous cette robe qu’il a cessé de battre. C’est cette robe qu’il portait, quand il défendait Laroque. Raymond l’avait gardée comme une relique.
Il avait voulu être avocat et il s’était dit :
– La première grande cause criminelle qui me sera confiée, je la plaiderai avec cette robe. Cela me portera bonheur.
Il ne l’avait jamais mise.
Pourquoi, ce soir-là, venait-il chercher cette relique ?
Il l’emporta dans son cabinet.
« Mon père avait cette robe quand il est mort. Peut-être la lettre s’y trouve-t-elle. »
Et il allait s’en assurer. Mais il tremblait. Et la main qui fouilla la première poche était agitée de soubresauts, comme si elle commettait une mauvaise action.
Rien… Raymond respira, malgré tout soulagé.
C’est que parfois il est des vérités si atroces et si douloureuses que le doute est préférable.
Il restait une poche. Il y plongea la main et frissonna violemment, comme si sa main avait touché une vipère, ou quelque bête immonde. Un papier froissé était là, ses doigts l’avaient rencontré, le tenaient, et voilà ce qui l’avait fait trembler…
Le papier était jauni, et il avait conservé le froissement de la première main qui l’avait tenu et qui sur lui s’était crispée avec colère et désespoir.

Enfin, il se décida, la sueur au front, à le déplier. Et il lut… Il lut les lignes mortelles qu’il contenait. Il n’était pas signé ; ces lettres ne le sont jamais.
Quand Raymond en eut achevé la lecture, il le laissa tomber de ses mains inertes, et sa tête se baissa, affreusement pâle. Toutes ses illusions s’en allèrent. Tout ce qu’il y avait de bon en lui s’écroulait.
– Ma mère ! ma mère ! murmura-t-il après un long silence.
Il l’aimait tant ! Il l’avait tant aimée ! Et il découvrait qu’elle était criminelle !… qu’elle avait tué son père après l’avoir déshonoré !… Il découvrait qu’au lieu d’amour, c’était de l’horreur qu’il devait avoir pour elle !… Voilà donc pourquoi elle avait déchiré la photographie de Laroque !…
Il ne cherchait pas à deviner si elle avait trempé dans le crime de Larouette… Il n’y pensait même pas !… Tout pour lui se résumait dans la découverte atroce qu’il venait de faire… Ce fut dans le milieu de la nuit, dans la fièvre qui le prit, qu’il y songea.
Si sa mère avait encore aimé Roger au jour de la cour d’assises, elle ne l’eût point laissé condamner ; elle se serait sacrifiée ; donc, leur liaison était finie, et Julia se vengeait ! Et la date de sa vengeance, elle l’avait inscrite au dos de la photographie, comme si elle avait dû l’oublier ! Et ce trou qui perçait le cœur du portrait était un coup de poignard.
Laroque disait vrai… Suzanne n’avait pas menti : son père était innocent. La coupable, c’était Julia…
CHAPITRE XXXV
Si singulière que fût leur façon de travailler, M. Tristot et M. Pivolot ne perdaient pas leur temps. Ils étaient d’abord allés rendre visite à Guerrier le matin du meurtre.
– C’est en le voyant, c’est en causant avec lui, que nous nous formerons une conviction, avait dit l’un d’eux.
Et lorsqu’ils étaient sortis de cet entretien, leur conviction était faite : Guerrier était innocent.
Ils se trouvaient rue de Châteaudun, quand les agents et le commissaire de police emmenèrent le jeune homme et le firent monter dans un fiacre.
Chambille ne les aperçut pas.
– À présent, il faut marcher de l’avant, dit Pivolot. En essayant de prouver l’innocence de Jean Guerrier, nous découvrirons le coupable.
– Dans tous les cas, nous pouvons payer d’audace. Si nous faisons fausse route d’abord, personne n’en souffrira. Nous n’appartenons pas à la préfecture. C’est ce qui a toujours fait notre force !…
Et Tristot ajouta :
– Savez-vous, monsieur Pivolot, que Guerrier est pour nous une vieille connaissance !
– Je le sais, monsieur Tristot.
– Que Guerrier était le caissier de Roger Laroque ?
– Oui, monsieur Tristot.
– Et que…
– Ne concluez pas, monsieur Tristot. Attendons, s’il vous plaît.
Ils combinèrent leur plan.
Béjaud leur paraissait suspect.
Pour eux, Béjaud pouvait bien, s’il n’avait pas commis lui-même le crime, avoir agi de complicité avec le meurtrier.
Tristot prit des renseignements sur Béjaud pendant que Pivolot en prenait sur Brignolet.
Béjaud et Brignolet étaient mariés et pères de famille tous les deux.
Le premier demeurait, ou plutôt – comme il couchait la plupart du temps à la banque du boulevard Haussmann – sa famille demeurait dans un étroit logement composé de deux pièces, une chambre et un cabinet, situé rue Saint-Lazare, dans la partie étroite qui touche à la rue de Maubeuge.
La femme de Béjaud était repasseuse ; tant qu’elle n’avait pas eu d’enfants, elle avait travaillé hors de chez elle ; – maintenant que la famille était venue, d’année en année plus nombreuse, elle s’était vue obligée de rester au logis, pour y soigner et surveiller les marmots.
Tout était réduit au strict nécessaire et à la plus extrême simplicité. Grâce à cette économie, tout était en ordre au logis de Béjaud ; la propreté y régnait ; on devinait là de braves gens vivant de peu et dont l’unique souci était de faire entrer le moins de dépenses mobiles dans le cercle restreint de leur petit budget, afin de mettre bout à bout le 1er janvier et le 31 décembre.
Pas un sou de dettes dans le quartier, chez l’épicier, le boulanger, le charcutier et le boucher.
Béjaud, du reste, prenait ses repas rue Saint-Lazare, lorsqu’il alternait avec Brignolet pour le service de garde.
Il en était de même de Brignolet.
Mais il arrivait aussi que souvent, comme ils cumulaient le service de garçons de bureau avec celui de gardiens, ils ne trouvaient pas le temps de rentrer chez eux, Brignolet, rue de Laval, Béjaud, rue Saint-Lazare.
Alors, ils allaient manger un morceau de pain et du fromage chez un marchand de vin de la rue de La Rochefoucauld.
La vie de Béjaud, c’était la vie de Brignolet.
Cependant, les renseignements sur celui-ci différèrent sur plusieurs points.
Le ménage de Brignolet était aussi bien tenu, aussi propre que celui de Béjaud.
À peine quelques petites dettes, par-ci, par-là, que le gardien finissait toujours par payer.
Même sobriété chez l’un que chez l’autre.
Mais alors que la femme de Béjaud supportait vaillamment la misère – riant et dorant de gaieté la vie de son mari – la femme de Brignolet, une jolie fille rousse avec des yeux noirs, frêle comme une Parisienne, délurée et coquette, souffrait impatiemment la servitude de la pauvreté. Il y avait parfois des scènes dans ce ménage. Les voisins les entendaient.
Mme Brignolet se savait belle – d’une beauté originale et vigoureuse, devant laquelle il était impossible de passer indifférent. On le lui avait dit trop de fois pour qu’elle n’en fût pas orgueilleuse.
Cependant, on ne lui connaissait point d’intrigues ni d’aventures, et, de fait, elle n’avait pas encore d’écarts de conduite à se reprocher.
Mais Brignolet adorait sa femme – laquelle n’avait guère que vingt-deux ans, alors qu’il en comptait quarante. Il l’adorait et il en était jaloux.
Dans les premiers temps de leur mariage, Juliette – c’était le nom de fille de Mme Brignolet – avait vécu modestement des ressources de son travail et du travail de son mari.
Le mariage – et surtout la position de Brignolet, qui restait souvent absent, même les nuits – donna à la jeune femme une indépendance à peu près complète.
Elle n’en jouit pas tout d’abord et se tint tranquille, d’autant plus que quelques semaines après son mariage elle se reconnut enceinte.
Quand elle fut délivrée, quand l’enfant fut sevré, celui-ci fut déjà une compagnie pour sortir.
Tous les après-midi, après avoir fait son ménage à la hâte, elle s’en allait, vaguant au hasard des rues, des squares, des promenades, sous prétexte de faire prendre l’air au petit et de lui faire essayer ses premiers pas.
Cette rousse au teint de lait, aux yeux noirs très doux, fut remarquée par plus d’un passant, suivie plus d’une fois, accostée malgré elle. Elle entendit des paroles flatteuses, des compliments, des promesses… Elle ne s’était peut-être pas doutée, jusqu’alors, qu’elle était jolie… Elle le savait à présent.
Ces adorateurs de grand chemin, à la piste d’une bonne fortune ambulante, qui lui glissaient à l’oreille quelques mots dont elle rougissait de plaisir, n’étaient point tous les premiers venus.
Deux ou trois firent autre chose que promettre, et lui glissèrent des bijoux d’une réelle valeur, en lui disant – c’était toujours à peu près la même phrase :
– Ceci n’est rien. Si vous vouliez m’écouter, et si vouliez me suivre, vous seriez riche et fêtée… Vous auriez les plus jolies toilettes de Paris… Vous seriez heureuse entre toutes…
Ces paroles lui mettaient de l’ivresse au cerveau. Cependant, elle ne succombait pas aux tentations.
Elle hésitait, tantôt se sentant toute faible, tantôt réconfortée par le souvenir de ses années d’enfance et de jeunesse écoulées sans mauvaises pensées.
Mais ces hésitations n’étaient pas sans avoir une influence sur son caractère, et c’était Brignolet, inconscient de ce drame du cœur, qui en recevait le contrecoup. Juliette s’aigrissait.
Sachant qu’un seul mot d’elle pouvait bouleverser de fond en comble son existence ; sachant qu’en cinq minutes, de par sa volonté seule, elle pouvait passer de la misère à l’abondance, du manque absolu de tout au luxe le plus raffiné, sachant cela, mais n’ayant pas encore en elle le triste courage d’une pareille résolution, elle s’en vengeait sur son mari par mille allusions détournées qui d’abord avaient surpris, puis maintenant faisaient pâlir le pauvre homme. Elle devenait mauvaise. Ces allusions avaient toujours le même but, contenaient toujours le même reproche.
– Ainsi, tu ne peux donc pas gagner un peu d’argent ?… Tu ne trouves pas, dans ton esprit, pour vivre, pour m’être agréable, un autre moyen que celui d’être domestique ?…
Il baissait la tête, la plupart du temps, sans répondre.
Un jour, pourtant, il hasarda une observation :
– Autrefois, tu étais contente, tu ne pensais pas à tout cela, tu ne me parlais pas comme tu le fais… Qu’est-ce qui t’a changée. Je ne te reconnais plus.
– Je voudrais être riche !…
Et tout bas elle se disait, mais à elle-même :
– Si je voulais, pourtant !
Cette idée ne l’abandonnait pas, restait en elle constamment, se manifestait dans les détails les plus infimes.
Elle se coiffait, se décoiffait, s’habillait, se déshabillait toute la journée, c’était là son seul plaisir. Et quand, enfin, à force de coquetteries, d’inventions, elle se trouvait convenablement mise, elle sortait.
Brignolet ne croyait pas le mal aussi grand. Il ne s’en aperçut que lorsque des factures impayées arrivèrent de chez l’épicier et les autres. Où était passé l’argent ?
Il y eut des explications entre le gardien et sa femme, et l’amour de Brignolet pour Juliette n’empêcha pas qu’ils n’en vinssent à des violences. Juliette reçut deux soufflets vigoureux dont il lui demanda, du reste, aussitôt pardon.
Elle parut domptée pendant quelques jours, mais elle gardait à présent une rancune au fond du cœur.
Petit à petit, certaine de dominer cet homme par le cœur comme par les sens, glorieuse de son pouvoir sur lui, elle perdait toute prudence, jusqu’à lui confier presque les promesses dont elle continuait d’être l’objet, par les rues parisiennes.
Depuis leur dernière algarade, il laissait passer la tempête, sans faire semblant d’entendre.
Mais ce jour-là, elle alla plus loin, rageuse :
– Tu dors sur tes deux oreilles en te disant que je t’aime, hein ? et que je n’aimerai jamais que toi, comme si tu étais le phénix des hommes ?…
– Juliette !
– Eh ! ne vas-tu pas te scandaliser ? Ma foi, je te conseille d’être fier !… J’en ai refusé et j’en refuse tous les jours, des occasions !… Si je voulais, j’aurais de l’argent… autant que j’en demanderais !…
Le pauvre diable se leva, un flot de sang au visage, et il chancela comme s’il allait être pris d’une attaque d’apoplexie.
Il arracha sa cravate, cassa le bouton de sa chemise, et, se précipitant à la fenêtre qu’il ouvrit, respira à pleins poumons… Puis, revenant à sa femme :
– Juliette, tu ne m’aimes plus ?
Elle lui rit au nez :
– Je veux de l’argent, j’en veux beaucoup, entends-tu ! ou sinon, écoute bien…
– Ou sinon ? demanda-t-il hébété.
– Je te plante là !
– Mais où veux-tu que j’en trouve, de l’argent ?
Et Juliette, avec l’obstination bête et entêtée de certaines femmes :
– Ce n’est pas mon affaire. Cherche !
– Tu ne penses pas à ce que tu dis quand tu me menaces d’en aller voir d’autres qui te promettent monts et merveilles ?
– Ma foi ! Je ne suis pas loin de dire oui !
– Malheureuse !
– Pourquoi te fâcherais-tu ? Est-ce que tu te mets en quatre pour me faire plaisir ? La première chose que je te demande, tu me la refuses !
– Quoi donc ?
– De l’argent !
– Est-ce que j’en ai ? Est-ce que je ne te donne pas ce que je gagne ? Est-ce que je dépense un sou en dehors du ménage ? De l’argent ? C’est facile à demander. Est-ce que j’en fais, moi ? Où veux-tu que je le gagne ? Est-ce que tu veux que j’en vole ?
– Je ne te dis pas d’être voleur… mais je veux de l’argent, là… Tu es un homme, tu dois bien savoir ce que tu as à faire !… Si j’étais homme, j’en gagnerais !
Brignolet, pâle, désespéré, s’arrachait les cheveux. Sa femme demeurait devant lui froide et dédaigneuse, l’œil ironique et méchant.
Brignolet s’en alla, parce qu’il craignait de la tuer, cette créature sans cœur qui prenait plaisir à le torturer… il s’en alla, mais elle ne le laissa point sortir sans lui crier une dernière fois, comme un défi et une dernière menace :
– Tu y penseras !
Et le long des trottoirs, tout en marchant tête basse, il bousculait les passants et ne les voyait pas. Les passants criaient, plaisantaient, le prenaient pour un homme ivre, mais il ne les entendait pas. Dans ses oreilles bourdonnait un mot, un seul mot, celui de sa femme :
– De l’argent !
Et tous les soirs ce fut la même scène, répétée par la jeune femme avec la même obstination, la même sottise, la même cruauté.
Brignolet, jadis très gai, devenait triste et sombre. Quand il rentrait chez lui, c’était avec un serrement de cœur, car chaque fois il se demandait avec angoisse :
– Vais-je retrouver Juliette ? N’est-elle point partie ?
On comprend qu’il fallut plus d’un jour à Tristot et Pivolot pour s’enquérir de tous ces faits.
– Je crois inutile de remarquer, monsieur Tristot, dit un jour Pivolot, que ces détails, qui sont en eux-mêmes fort intéressants, perdent une partie de leur importance du fait qu’ils s’appliquent à Brignolet, c’est-à-dire à la victime. Mme Brignolet est une petite pécore un peu propre à tout faire…
– Quelle a été son attitude depuis la mort de son mari ?
– Bonne, à tout prendre. Elle a pleuré. Elle cherche de l’ouvrage. En attendant qu’elle en trouve, monsieur de Terrenoire lui donne de l’argent qu’elle dépensera bientôt en sottises, je le parierais, car je ne lui laisse pas plus d’un mois pour se consoler de son mari.
– Et après ?
– Après ? eh bien ! elle suivra les instincts mauvais que la bêtise et la coquetterie ont fait naître chez elle. Le premier venu la prendra pour maîtresse et la gardera jusqu’à ce qu’il en ait assez…
– Je ferais volontiers sa connaissance…
– Tiens, tiens !… Auriez-vous, par hasard, l’intention de faire oublier Brignolet ?…
– Non, en tout bien, tout honneur. Mais j’ai comme un pressentiment que cela ne sera pas sans profit pour nous… Elle a été courtisée, cette petite femme.
« Ce que nous ne savons pas, c’est le nom de ses courtisans.
– À quoi bon ?
– Rien n’est inutile dans une enquête.
– En surveillant notre jolie rousse, nous verrons plus clair dans son cœur, et, en filant son amoureux, nous apprendrons comment il se nomme.
– C’est une idée.
La conversation des deux hommes fut interrompue par un coup de sonnette discret.
Avant d’ouvrir, Tristot alla, sur la pointe des pieds, inspecter le visiteur par le judas de la porte d’entrée. Il tira les verrous, et un inconnu, de mise confortable, grand, robuste, aux cheveux blancs, au visage encore jeune, mais ravagé, défiguré par des traces d’horribles brûlures, apparut.
– Messieurs Tristot et Pivolot ? demanda-t-il avec un fort accent yankee.
Tristot continuait son examen, sans laisser paraître le moindre étonnement.
– C’est ici, dit-il. Auquel des deux désirez-vous parler ?
– À tous deux.
– Entrez.
Il le fit passer dans le salon où Pivolot attendait, le visage caché derrière un journal.
Pivolot se leva et indiqua un fauteuil à l’inconnu.
– Messieurs, leur dit l’homme défiguré, je viens pour l’affaire Guerrier. Vous vous en occuperez, n’est-ce pas ?
Quel rapport cet étranger pouvait-il avoir avec l’assassinat de Brignolet ? Tristot et Pivolot, très intrigués, ne purent retenir un mouvement de curiosité.
– Nous nous en occupons, répondirent-ils d’un commun accord et sur le même ton.
– J’ai le plus grand intérêt, reprit le visiteur, à ce que l’assassin soit découvert.
– Découvert ? observa Pivolot. Mais l’assassin est arrêté, ainsi que son complice. Demandez-le à monsieur Lacroix et à monsieur de Lignerolles, ils vous diront tous deux que les coupables ne sont autres que Jean Guerrier et Béjaud, l’ancien collègue de la victime. Vous êtes étranger, Monsieur, peut-être n’avez-vous jamais entendu parler, avant ces derniers temps, de monsieur de Lignerolles et de monsieur Lacroix.
– Pardon, je les connais depuis 1872, et c’est justement parce que je les connais que je suis venu vous trouver.
Pivolot échangea un regard significatif avec Tristot. Évidemment, cet étranger leur apportait du nouveau.
– Je suis riche, Messieurs, très riche, et je viens mettre toute ma fortune à votre disposition pour vous aider dans vos recherches. N’en doutez point, Jean Guerrier n’est pas coupable et cependant, si nous ne trouvons pas la preuve de son innocence, cet homme sera, comme Roger Laroque, victime d’une erreur judiciaire.
– Ah ! dit Pivolot, vous connaissez l’affaire Laroque ?
Roger se leva et se mettant devant la fenêtre, en pleine lumière :
– Voyons, Messieurs, dit-il en dépouillant l’accent yankee auquel les policiers amateurs s’étaient laissé prendre, vous ne vous souvenez donc pas de moi ?
Les deux hommes tressautèrent sur leur fauteuil :
– Roger Laroque ! s’écrièrent-ils à l’unisson.
– Eh oui, Roger Laroque, ou plutôt Roger-la-Honte, comme on dit maintenant, comme on dira jusqu’à la fin des siècles dans les annales des causes célèbres, si vous ne nous rendez l’honneur, Messieurs, à moi et à mon fidèle Jean Guerrier, le seul qui n’ait jamais douté de l’innocence de son ancien patron.
– Le seul ? répliquèrent Tristot et Pivolot en se levant. En êtes-vous bien sûr ?
– Alors, vous aussi, Messieurs, vous avez cru… à mon innocence ?…
Les larmes lui vinrent aux yeux.
– Vous me croyez donc ? répéta-t-il… C’est vrai que vous me croyez ?
– Oui, fit Pivolot, en lui serrant la main ; comment diable ne pas vous croire après ce que vous venez de faire ?… Mais cela ne suffit pas, et, si vous voulez que nous vous tirions d’affaire, il faut tout nous dire… vous entendez… absolument tout…
Sa confession fut pénible : elle ravivait tant de douloureux souvenirs ! Laroque ne cacha rien. Il devait tout dire. Il raconta sa liaison avec Julia et l’amitié qui était née pendant la guerre entre lui et Lucien de Noirville. Voilà pourquoi il avait dû tout cacher aux juges, ne pouvant dévoiler la vérité sans révéler le déshonneur de sa maîtresse.
Pivolot et Tristot écoutèrent, visiblement impressionnés.
Il ne leur vint pas même à l’esprit que Laroque pût mentir. Non, tout ce qu’ils entendaient était vrai !
Quand il eut terminé sa triste histoire, ils lui serrèrent la main de nouveau, en signe d’amitié et de compassion.
Ils s’y connaissaient en courage, et ils avaient même un peu d’admiration pour cet homme, qui avait fait preuve de tant d’énergie…
– Nous écartons tout de suite la culpabilité de Mme de Noirville, fit Tristot, le coup ne vient pas d’elle, bien que nous ayons vu d’étranges choses, à propos de vengeances inspirées par des femmes. Nous l’écartons donc, – en théorie, – s’entend, – car, pour ce qui est de la pratique, c’est autre chose, et il demeure entendu qu’au moindre indice de sa culpabilité nous partons en guerre.
Laroque, persuadé, fit un signe pour indiquer qu’on ne trouverait rien de ce côté-là.
– Reste le cercle, où vous avez joué et gagné. Connaissiez-vous tous les joueurs qui pontaient contre vous ! C’était, je crois, une partie de baccarat ?
– Oui, je connaissais les pontes, au moins de nom.
– Aucun incident ne vous a frappé là plus particulièrement ? Parmi ceux qui jouaient, vous ne connaissiez aucun ennemi ? Il y avait peut-être là quelque amant ancien ou nouveau de madame de Noirville ? Cherchez bien.
– Je ne me connaissais aucun ennemi et personne ne m’avait jamais fait de mal – si ce n’est ce malheureux Larouette, dont la réclamation subite me ruinait et me déshonorait.
– Rappelez bien vos souvenirs.
– Il n’y a rien qui ne soit sérieux dans une affaire aussi malheureuse que la vôtre, monsieur Laroque.
– Voici donc ce que j’ai trouvé, ce dont je me suis souvenu. Alors que je jouais, le baron de Cé est entré dans la salle de jeu, et bien qu’il me connût parfaitement, puisqu’il était alors un de mes amis, il s’est approché d’un des joueurs, par-derrière, en lui touchant familièrement l’épaule et en l’appelant par mon nom.
Le joueur s’étant retourné, le baron reconnut son erreur et lui fit des excuses en lui disant, confus, qu’il l’avait pris pour moi.
– Cet homme vous ressemblait donc ?
– Il le paraît. Le baron de Cé me le dit en me racontant l’aventure. Et cependant, je regardai à peine mon prétendu sosie.
– Et dans ce regard, avez-vous constaté la ressemblance ?
– Oui, et, chose plus curieuse, la vue de cet homme réveilla en moi d’anciens souvenirs que je ne pus préciser. Mais, mon esprit ne s’est pas arrêté plus d’une seconde sur un sujet qui n’avait aucun intérêt pour moi, dans un moment où je luttais contre la faillite.
– Vous exagérez, monsieur Laroque. Vous n’aviez pris dans votre caisse qu’une somme relativement minime et dont la perte n’eût pas entraîné de conséquences fatales pour votre réputation d’honnête homme.
– Ma conscience me condamnait et elle me condamne encore.
– Et le nom de cet homme ?
– On me le dit, mais j’écoutais à peine. Or, le croiriez-vous, Messieurs, ce nom m’est revenu hier en me rappelant deux autres circonstances dont je vous parlerai tout à l’heure. Mon sosie s’appelait Luversan.
– Luversan ? dit Tristot en regardant Pivolot. Nous ne connaissons pas cela… Mais le baron de Cé pourrait sans doute nous fournir des renseignements sur ce personnage.
– Le baron de Cé est mort, répliqua Laroque. J’ai perdu toute une semaine à le rechercher : c’est seulement ce matin que j’ai appris qu’il avait succombé au cercle à une attaque d’apoplexie après y avoir achevé sa ruine dans une seule et même soirée.
Tristot et Pivolot considérèrent Roger avec attention.
– Ma foi, dit le premier, il est possible qu’il y ait eu jadis une certaine ressemblance entre vous et ce Luversan, mais aujourd’hui elle ne doit plus exister.
– J’ai tant souffert, fit Laroque simplement.
– Cet homme n’avait aucune raison de vous détester et de se venger de vous ?
– Aucune que je sache. Je ne me rappelle pas lui avoir jamais adressé la parole.
– C’est un indice assez vague et je doute que cela nous conduise sur une piste, mais enfin c’est un renseignement, et puisque nous acceptons de vous aider, nous ne devons rien négliger. Mais ne disiez-vous pas tout à l’heure que deux autres circonstances vous avaient rappelé le nom de Luversan ?
– Oui. Peu de jours après avoir retrouvé Guerrier, j’eus la curiosité de revoir ce monsieur de Terrenoire qui m’avait rendu service avec tant de générosité et je me fis inviter par Jean à une soirée donnée par ce banquier dans son hôtel de la rue de Chanaleilles. Personne ne m’y reconnut. Or, parmi les valseurs intrépides qu’on remarquait à cette soirée, je surpris l’un d’eux parlant mystérieusement à la maîtresse de la maison, madame de Terrenoire, qui, je le savais, avait conçu pour Jean une passion malheureuse et s’opposait à son mariage avec mademoiselle Margival. Elle l’appela « monsieur de Luversan ». Ni le nom de cet homme, ni son visage ne m’étaient inconnus. Néanmoins, à ce moment, l’incident du cercle ne me revint pas en tête. Je revis une seconde fois ce Luversan, le jour du mariage de Jean. Il rôdait autour de l’église, et, l’examinant sans qu’il pût s’en douter, je me dis encore : « Voilà un homme dont la physionomie m’a impressionné déjà quelque part. » Où ? Quand ? Je ne saurais le dire. Hier seulement, un peu de lumière se fit dans mon esprit et, s’il m’est impossible de préciser à quelle époque et dans quelles circonstances j’ai vu pour la première fois ce personnage, je puis affirmer que Luversan était bien le nom dont on a appelé au cercle l’homme qui me ressemblait.
– De sorte, conclut Pivolot par Tristot, qu’il se pourrait que Luversan en sût long tant sur l’assassinat de Larouette que sur celui de Brignolet.
– Je ne conclus pas. À vous de chercher, Messieurs. En attendant, voici un carnet de chèques de 50 000 francs au nom de William Farney, sur la Société Générale.
Les deux policiers amateurs refusèrent ces subsides.
– Nous vous compterons nos frais, dit Tristot, approuvé par Pivolot, quand nous aurons réussi.
Roger eut un sourire bon enfant.
– Oh ! Messieurs, je ne songe nullement à vous corrompre, croyez-le bien.
Tous trois se prirent à plaisanter sur ce sujet, malgré la gravité de la situation. Puis Laroque remercia de nouveau ses dévoués auxiliaires.
– Vous êtes bons de prendre ainsi une tâche aussi ardue…
– Ce qui est humainement possible sera fait…
– Merci, Messieurs ; je n’aurai pas assez de ma vie tout entière pour vous remercier, vous bénir et vous aimer, car, ce n’est pas pour moi que je cherche la vérité, mais pour ma fille ; si je veux l’honneur, c’est pour que Suzanne ne soit plus contrainte de porter un nom qui n’est pas le sien. Si je veux la révision de mon procès et la réhabilitation, c’est pour qu’elle soit heureuse – car elle aime. Quant à moi, ma vie est finie, et, si j’étais seul, j’accepterais le fait accompli. Quand vous reverrai-je ?
– Nous l’ignorons. Nous nous mettrons en campagne dès aujourd’hui. Si nous avons besoin de vous, un de nous deux ira vous trouver à Maison-Blanche.
– Non, je craindrais d’exciter les soupçons – ou seulement la curiosité de ma fille.
– Alors, un télégramme vous avertira.
– C’est cela, et à toute heure du jour ou de la nuit, je serai à votre disposition.
Les trois hommes se séparèrent après s’être cordialement serré la main.
CHAPITRE XXXVI
Sitôt Laroque parti, les deux policiers amateurs se dirigèrent vers l’établissement du marchand de vin, rue de La Rochefoucauld, où Béjaud et Brignolet prenaient parfois leurs repas.
Ils entrèrent et appelèrent un gros homme à large panse.
– C’est vous qui êtes le patron ?
– C’est moi, Cornélius dit Lupin, pour vous être agréable, si cela se peut.
– Cela se peut, monsieur Lupin. Asseyez-vous auprès de nous, et, si vous désirez prendre avec nous un verre de bière…
– La bière, ça n’est pas mon fort… mais je prendrai un demi-setier, pour profiter de vos bonnes intentions.
Cornélius s’en alla au comptoir, où il se versa un verre plein, qu’il apporta auprès de ceux de Tristot et de Pivolot, et trinquant :
– À la vôtre !
– À la vôtre, monsieur Cornélius.
– Qu’est-ce qu’il y a pour votre service ?
– Avez-vous entendu parler du crime de la banque Terrenoire ?
– Parbleu ! L’affaire a été tout au long racontée dans les journaux. Et puis ça me touche un peu, car Brignolet, qui a été assassiné, – et Béjaud, qui est l’assassin, à ce qu’on dit, – étaient nos clients.
– Ils ne vous doivent rien ?
– Non. Brignolet, de temps en temps, se laissait mettre en retard, mais il finissait toujours par payer.
– À quel moment les avez-vous vus pour la dernière fois ?
– À quel moment ? Ma foi, c’est la veille même du meurtre, au soir, vers sept ou huit heures, que je les ai vus pour la dernière fois.
– Où ?
– Ici où vous êtes, à cette même table.
– Tous les deux ?
– Oui. Ils ne se quittaient presque jamais. C’est une paire d’amis. Ils avaient été soldats ensemble.
– Vous leur avez parlé ?
– Je leur ai dit bonjour en leur donnant une poignée de main, comme je fais à tous mes clients.
– Et vous n’avez rien remarqué d’extraordinaire chez eux, dans leur physionomie, leur allure ?
– Rien du tout.
– Ont-ils bu beaucoup ?
– Un litre à deux. Oh ! ils étaient très sobres. Jamais pour ma part, je ne les ai vus se piquer le nez. C’était leur grosse, très grosse ration, un litre, quand ils mangeaient ensemble.
M. Cornélius, dit Lupin, s’arrêta tout à coup, en se frappant la tête, comme s’il avait eu l’esprit traversé d’une idée lumineuse.
– Qu’est-ce donc ? demanda Pivolot.
– Eh bien, je vous trompe en disant que ce soir-là ils n’ont bu qu’un litre. Ils en ont bu… ou plutôt je leur en ai servi deux.
– Ah ! ah !
– Oui, et voici comment cela s’est fait. En entrant, Béjaud me tape sur le ventre et me dit : « Père Cornélius, un litre, S. V. P. ! » Je sers, et ils trinquent. Béjaud et Brignolet avalent leur verre d’un trait… Et Béjaud jette son verre, en criant qu’on l’a empoisonné. Il était furieux et se démenait comme un possédé…
« – Père Lupin, qu’est-ce que vous avez fichu dans votre vin ? disait-il.
« Et il s’essuyait la bouche, en crachant, en toussant, et en faisant des : Pouah ! et des : Pouah !
« Brignolet regardait Béjaud d’un air étonné :
« – Tiens ! qu’il dit, c’est drôle, je n’ai rien senti…
« – Vrai ? qu’il dit, Béjaud.
« – Ma parole. Je lui ai trouvé le goût de tous les jours.
« Béjaud nous examinait, ne sachant trop s’il fallait rire ou se mettre en colère.
« Il était persuadé que nous lui avions fait une farce, et à la fin il se mit à rire :
« – Je vous revaudrai celle-là…
« Mais Brignolet se fâcha ; il ne voulait pas être accusé.
« – Tu avais pour sûr un crapaud dans le gosier, qu’il dit, et voilà ce que t’auras senti en buvant…
« Il reversa deux verres. Moi-même je goûtai le vin.
« Cette fois Béjaud ne s’aperçut de rien, pas plus que moi, pas plus que Brignolet… Béjaud s’était trompé.
« Le litre était à peu près vide, je l’emportai en déclarant qu’ils ne le payeraient toujours pas, et j’en apportai un autre pour lequel Béjaud ne trouva rien à dire.
« Voilà comme quoi ils ont bu les deux litres, ce soir-là contre leur habitude.
Tristot et Pivolot avaient pris quelques notes.
– Vous êtes de la police ? demanda Cornélius.
– À peu près ! fit Tristot. Et Béjaud et Brignolet sont-ils restés longtemps chez vous ?
– Comme chaque fois, une demi-heure.
– Et c’est tout ce que vous avez remarqué ?
– Tout. Béjaud avait mangé de bon appétit et Brignolet, au contraire, n’avait presque rien pris. Il n’avait fait que boire.
– Ils sont partis ensemble ?
– Ensemble.
– C’est bien, nous vous remercions, monsieur Cornélius.
Les deux amis payèrent leur consommation, glissèrent un fort pourboire dans la main du patron, qui se confondit en remerciements, et s’en allèrent. Pivolot rentra chez lui en se remémorant ce qu’il venait d’entendre et en essayant d’en dégager quelques éclaircissements.
« Il est bien possible, se disait-il, qu’on ait essayé de verser un narcotique dans le vin de Béjaud… »
Et tout en marchant, tout en réfléchissant, Pivolot se grattait vigoureusement l’occiput, comme s’il avait voulu en faire sortir une explication plus sensée.
« Ah ! nom d’un petit bonhomme, se dit-il, cela nous irait comme un gant, cette idée du narcotique… parce qu’elle explique aussi le sommeil étrange de Jean Guerrier. Parbleu ! la voici l’explication : on endort les gardiens ; on endort le caissier ; on entre ; on a des fausses clés ; on vole ; un gardien se réveille ; on l’assassine ; puis on se sauve. Il y a là quelque chose à trouver, je le sens, mais quoi ? »
Il était arrivé chez lui, s’était déshabillé, avait chaussé des pantoufles et passé un veston de chambre.
Toujours plongé dans ses réflexions, il s’assit, ou plutôt se coucha à demi dans un fauteuil large et commode, où il avait l’habitude de faire sa sieste, après déjeuner, et il tira un cigare dont il coupa l’extrémité avec soin.
« Assurément, il y a du narcotique sous jeu, se disait-il ; assurément, Jean Guerrier a dû être envahi par un sommeil contre lequel il lui fut impossible de lutter… Et ce qui le prouve, pardieu ! ce qui le prouve, c’est qu’il a oublié d’éteindre sa lampe… Je me rappelle encore, en entrant, le matin, dans le cabinet près duquel avait été commis le meurtre, je me rappelle cette abominable odeur d’une lampe qui avait filé… Et quelle lampe ?… celle de Guerrier. Si ce garçon avait été coupable, aurait-il eu la présence d’esprit de réfléchir qu’en éteignant la lampe, il se livrait ? Non… Il l’eût éteinte, avant de feindre de s’endormir, naturellement… Tandis que la lampe s’est éteinte d’elle-même, parce que personne n’était là pour la remonter… parce que Guerrier était tombé sans force sous la puissance de ce sommeil maladif… C’est une explication, cela ! »
Il alluma une allumette et, pendant qu’elle commençait à flamber, il jeta un coup d’œil distrait sur un guéridon placé près de son fauteuil, où il avait mis des notes et différents objets relatifs à l’enquête.
Cinq ou six cigares entamés, mais non fumés, étaient sur ce guéridon, épars – les cigares essayés par Jean Guerrier la nuit du meurtre.
Il les regarda machinalement – et son allumette, flambant toujours, lui brûla le bout des doigts – puis tout à coup, poussé par un singulier soupçon, il lança son cigare dans la cheminée, saisit un de ceux de Guerrier et l’alluma.
– La bonne intention excuse la malpropreté, murmura-t-il avec conviction.
Il tira quelques bouffées et toussa.
– Exécrable ! Quel horrible tabac ! Ça ne peut être que des cigares de la Régie !… C’est égal, je veux savoir. J’irai jusqu’au bout.
Et il se remit à fumer consciencieusement.
– Il n’est pas possible que tous ces cigares soient aussi mauvais, murmura-t-il.
Et, imitant Jean Guerrier, il jeta le premier pour en allumer un autre.
Et celui-là, il ne le fumait pas depuis cinq minutes que des symptômes étranges se manifestèrent chez lui tout à coup.
Il fut pris d’un engourdissement général ; des choses de toutes les couleurs dansaient devant ses yeux ; sa tête retomba sur sa poitrine lourdement.
Il se souleva sur ses mains ; ses bras tremblaient ; il essaya de se mettre debout, n’y parvint point et retomba. La terre tournait autour de lui.
Et songeant à Guerrier et à ce que le jeune homme avait dû éprouver en fumant ces mêmes cigares :
– Très bien ! Très bien ! faisait-il.
Il fit encore un effort, pour essayer de se rendre maître de lui, mais il perdit complètement connaissance et s’endormit.
Il y avait déjà fort longtemps qu’il dormait ainsi, quand Tristot frappa à sa porte.
La bonne de Pivolot, une vieille domestique fidèle et dévouée qui le servait depuis vingt ans, alla ouvrir.
– Monsieur Pivolot est chez lui ?
– Il est dans son cabinet, en train de dormir…
– À cette heure ?… Il est neuf heures du soir.
– Voilà ce qui m’inquiète… Monsieur est rentré vers une heure et s’est enfermé… De toute l’après-midi, je ne l’avais pas entendu bouger… Ayant eu besoin de lui parler… car je voulais savoir si Monsieur dînait chez lui, j’entrai… Il dormait encore… et le bruit que je fis ne le réveilla pas… À sept heures, j’entrai de nouveau dans le cabinet, en criant de toutes mes forces : « Monsieur est servi ! » J’entendis un ronflement pour toute réponse.
– Et il dort toujours ?
– Toujours. Entrez, vous le verrez.
Tristot pénétra dans le salon avec une certaine anxiété. Ce sommeil lui semblait extraordinaire.
Il s’approcha de son ami, le contempla attentivement et le secoua vigoureusement.
Puis il cria :
– Hé ! monsieur Pivolot, réveillez-vous ! Quelle idée de dormir ! Est-ce que vous êtes malade ?
Le bonhomme ne fit pas un mouvement.
– Si je ne l’entendais pas respirer, je jurerais qu’il est mort ! murmura Tristot.
Et il recommença à le bousculer et à crier :
– Monsieur Pivolot !… C’est moi, c’est Tristot.
Et comme il ne bougeait pas davantage, Tristot pria la bonne de lui apporter une cuvette d’eau fraîche et un linge.
Il fit mettre le tout près de lui, sur le guéridon, et bassina les tempes, le visage, le cou, les mains, les poignets de Pivolot.
Enfin, il fit tant et si bien que Pivolot ouvrit un œil, puis l’autre, étendit le bras gauche, puis le bras droit, bâilla, se détendit, se souleva, promena des regards effarés autour de lui, reconnut la cuisinière, reconnut Tristot et, ahuri, demanda :
– Qu’est-ce qu’il y a donc, monsieur Tristot, et pourquoi suis-je tout mouillé ?
– Vous dormez depuis six ou sept heures.
– Hein ?
Il passa sa main sur son front.
Il se rappelait :
– Ce sont les cigares ! Sapristi, que j’ai mal à la tête ! Mais je suis bien content !
Tristot le considérait d’un air stupéfait. « Il est fou », pensait-il.
– Oui, je suis rudement content d’avoir si bien dormi. Maintenant, je vois clair dans tout cela. Parbleu ! un enfant comprendrait !… Eh ! c’est très fort !
– Monsieur Pivolot, si vous vouliez m’expliquer ?
Pivolot se hâta de mettre Tristot au courant de ce qu’il avait tenté.
Quand il eut fini :
– Vous voyez, monsieur Tristot, que cette découverte est assez importante. Nous sommes sur une bonne piste.
– Pour cela, il faut que nous voyions Béjaud et Jean Guerrier. Monsieur de Lignerolles ne nous refusera pas, je l’espère, l’autorisation de causer avec eux.
– Surtout, si nous lui faisons part de nos soupçons. Peut-être nous donneront-ils quelques renseignements ; mais auparavant, et afin d’agir avec plus de sécurité, je veux aller trouver notre ami, le docteur Corpitel. Je le prierai d’analyser deux de ces cigares que Guerrier a allumés et dont il a tiré quelques bouffées. Il nous dira ce qu’ils renferment.
Pivolot se mit à table après s’être rafraîchi le front à plusieurs reprises.
Il mangea d’assez bon appétit, pendant qu’auprès de lui, tout en causant de l’affaire qui les préoccupait, Tristot prenait un verre de fin et vieux cognac.
Tristot qui était allé au Palais pendant l’après-midi, avait appris là tous les bruits qui couraient sur Guerrier, sa femme, Margival et Terrenoire.
Il en fit part à Pivolot.
Et, à son grand étonnement, il vit que son compère, tout en écoutant avec attention cette histoire, n’avait pas l’air de s’en soucier.
– Cela ne dérange aucunement mes plans, dit-il. Est-elle vraie, cette histoire ?
– On le dit.
À onze heures, les deux amis se séparaient.
– Je vais dormir sérieusement, cette fois, dit Pivolot.
Et, en effet, il dormit jusqu’au lendemain à huit heures.
Il se leva, s’habilla, avala son chocolat, et sans perdre plus de temps alla sonner chez Corpitel.
Le docteur Corpitel, consulté, décomposa et analysa les cigares, ce qui lui prit la journée et, le soir même, il adressait à Pivolot un assez long rapport où il expliquait le résultat de son analyse. Ce rapport constatait que les cigares qui lui avaient été remis par Pivolot avaient été imprégnés d’une composition obtenue avec du chanvre indien et de l’extrait de daturah.
En lisant le rapport du docteur Corpitel, Pivolot pensait que c’était l’amertume très grande du daturah qui avait dû mettre Béjaud en défiance. Béjaud n’avait bu qu’un verre de vin, auquel était mêlé le narcotique. Jean Guerrier n’avait fait, pour ainsi dire, que toucher du bout des lèvres aux cigares. Enfin, Pivolot, lui-même n’avait pas eu le temps de fumer jusqu’au bout un cigare commencé.
Quand le bonhomme fut bien pénétré des observations scientifiques sur lesquelles le docteur s’était longuement étendu, il alla trouver Tristot, auquel il rendit compte de ce qu’il savait, et tous deux s’empressèrent de courir au parquet, où ils demandèrent à parler à M. de Lignerolles.
Le juge d’instruction pensait à eux depuis quelques jours ; il savait par M. Lacroix, qu’ils s’occupaient de l’affaire, et il commençait à s’étonner de ne les point voir : il les connaissait, en effet, et savait de quelle importance était leur opinion aussi.
« Où est la vérité ? » s’était-il dit.
On comprend avec quel empressement il accueillit Tristot et Pivolot, et avec quelle curiosité il les interrogea.
C’était la première entrevue qu’ils avaient avec le juge pour cette affaire : ils ne lui cachèrent rien de ce qu’ils avaient fait, rien de ce qu’ils pensaient, rien non plus de ce qu’ils avaient découvert.
Ce n’était ni une explication bien précise qu’ils apportaient, ni la preuve indiscutable de l’innocence de Béjaud et de Guerrier, mais c’était du moins une piste qui mènerait au coupable, quel qu’il fût.
M. de Lignerolles le comprit, et n’attendit pas, pour signer aux deux compères une permission de voir Jean Guerrier, qu’ils la lui demandassent.
– Tenez, dit-il, voilà ce que vous désirez, n’est-ce pas ?
– En effet, nous vous remercions, monsieur de Lignerolles.
– C’est bien plutôt moi qui vous dois des remerciements pour le zèle que vous apportez gratuitement aux affaires de la justice.
– Nous trouvons notre récompense en nous-mêmes, Monsieur.
Et Pivolot, se penchant à l’oreille de son camarade, ne manqua pas d’ajouter :
– Et aussi dans la satisfaction d’embêter Chambille.
Ils se rendirent au dépôt, après avoir pris congé du juge, et ils furent introduits sur-le-champ auprès du prisonnier ; le gardien qui les avait amenés se retira après avoir lu le mot de M. de Lignerolles, et ils restèrent seuls avec Jean Guerrier.
Celui-ci, assis sur un escabeau, la tête appuyée contre le mur, dormait à demi, ou plutôt rêvait, ayant les yeux fermés.
Pivolot l’appela doucement.
– Monsieur Jean Guerrier ?
Le jeune homme les regarda tour à tour et ne les reconnut pas.
– Monsieur Guerrier, reprit Pivolot, nous avons déjà eu, mon ami et moi, le plaisir de nous rencontrer avec vous – le matin même de votre arrestation – et vous avez dû voir que nous n’étions ni l’un ni l’autre animés de mauvaises intentions à votre égard… Je vous prie donc de nous considérer bien plus comme des amis que comme des ennemis.
Ce langage surprit Guerrier. Il examina attentivement les deux compères et après un moment d’hésitation, finit par les reconnaître.
– Je vais vous expliquer tout de suite et sans autre préambule, monsieur Guerrier, l’objet de notre visite. Nous croyons, mon ami et moi, que vous êtes innocent.
Le caissier eut un geste attristé.
Pivolot comprit ce que voulait dire ce geste.
– Vous avez tort de vous décourager, Monsieur. À votre place, je me débattrais comme un beau diable, ne fût-ce que dans l’espoir de me venger plus tard de ceux qui m’ont fait de la peine.
Les yeux de Guerrier brillèrent tout à coup.
– Vous avez raison, dit-il, parlez ! Que me voulez-vous ?
– Peu de choses. Nous désirons être renseignés sur un point. Le soir du meurtre, en travaillant aux comptes de votre caisse, vous avez fumé beaucoup ?…
– Oui, beaucoup, comme j’en ai la mauvaise habitude.
– De deux choses l’une : ou vous étiez préoccupé et vous laissiez éteindre vos cigares, que vous jetiez aussitôt pour en allumer d’autres – ou bien vous trouviez vos cigares détestables et en cherchiez un meilleur.
– Votre dernière supposition est exacte. J’allumai quatre ou cinq cigares. Je les trouvai tous infumables.
– Vous n’avez pas remarqué qu’ils vous portaient à la tête ?
– Si. Je me suis endormi presque aussitôt d’un sommeil de plomb, et malgré moi.
– Eh bien ! vous êtes victime d’une intrigue fort habile, les cigares avaient subi une préparation savante dans laquelle entraient, à des doses inégales, le daturah, le chanvre indien et l’opium ordinaire.
– Que dites-vous ?
– La vérité !… Et il est probable – nous l’apprendrons tout à l’heure par Béjaud lui-même – que ce gardien a été endormi de semblable façon… Et il est aussi probable que pareille tentative a été faite sur Brignolet, mais n’aura pas réussi. Ce qui explique que Brignolet se soit réveillé et ait été assassiné !…
Guerrier semblait épouvanté :
– Et vous êtes sûr de ce que vous prétendez ? dit-il.
– Absolument sûr, Monsieur… Nous venons, il n’y a qu’un instant, de déposer entre les mains de monsieur de Lignerolles le rapport du médecin-chimiste qui a analysé les cigares.
Les trois hommes gardèrent le silence.
Guerrier réfléchissait profondément.
– Vous connaissez-vous des ennemis ? demanda Tristot à son tour.
Le premier mot que répondit Jean Guerrier fut :
– Non !
Il se reprit :
– Une femme, pourtant – dit-il – avait juré de tirer de moi une vengeance…
– Une maîtresse abandonnée ?
– Non, une femme dédaignée…
– Oh ! oh ! ceci est grave. Rancune d’amour ! Les femmes dédaignées ne pardonnent pas… Quelle est-elle ?
Guerrier hésita au moment de prononcer le nom d’Andréa… Qu’allait-il faire ?… Ne se trompait-il pas ? Quelles raisons avait-il de croire Andréa si méchante et si perverse ? Un pressentiment seul le poussait. La colère l’emporta sur toute autre considération.
– C’est madame de Terrenoire !
Tristot et Pivolot ne parurent nullement étonnés.
– Nous le savions, dirent-ils simplement.
– Comment ? Par qui ?
– Par l’homme qui vous aime et qui vous estime autant qu’il est possible d’aimer et d’estimer un ami fidèle dans le malheur. Vous comprenez ?
– Oui, fit-il tout bas. Ah ! gardez-lui son secret, Messieurs. Celui-là fut un martyr.
– Il ne sépare pas votre cause de la sienne et n’aura de repos que lorsque tous deux vous serez lavés de la boue sanglante qu’on vous a jetée. Dites-nous bien tout, mon ami. Nous avons besoin d’être guidés par les victimes elles-mêmes dans ce labyrinthe inextricable.
Alors il raconta tout, c’est-à-dire ses relations avec M. de Terrenoire ; il dit comment il remarqua d’abord la bienveillance d’Andréa, puis comment il s’était aperçu, à la fin, que cette bienveillance se changeait en un sentiment plus vif. Il l’avait fuie, alors, pour échapper à la tentation, mais elle l’avait recherché, suivi.
Tristot et Pivolot l’avaient écouté avec la plus profonde attention. Les confidences sincères de Jean Guerrier confirmaient celles de Roger Laroque.
Mme de Terrenoire avait rêvé de se venger du caissier, mais de quelle façon ? Et avait-elle accompli sa vengeance ? C’était un fait intéressant à connaître, que cette inimitié d’une femme.
– Madame de Terrenoire vous hait, c’est visible, dit Pivolot, mais cela ne prouve rien, malheureusement, quant à ce que nous cherchons. La haine de cette femme, le meurtre de Brignolet et le vol de cette caisse n’ont rien de commun. Rappelez-vous bien les moindres incidents de votre vie… Vous ne vous connaissez pas d’autres ennemis ?
– Non.
– Parmi les employés de la banque, vos supérieurs ou vos inférieurs…
– Je n’ai compté parmi eux que des amis jusqu’au jour de mon mariage. Alors, à peine marié, je n’ai plus rencontré chez eux que mépris et éloignement…
– Ah ! je comprends… Ils connaissaient les relations de votre femme et de votre patron.
– Ils les connaissaient, oui.
– Et vous ?
– Pouvez-vous croire que je fusse capable ?…
– Vous ne saviez rien en vous mariant ?
– Je le jure !
– Nous avons besoin de tout savoir. Racontez-nous donc comment vous avez été instruit de ces relations et quelles preuves vous en ont été données.
Guerrier fronça le sourcil. C’était un cruel supplice que de revenir sur une pareille honte.
– À quoi bon ? dit-il, sombre.
– Il le faut ! dit Pivolot. Croyez que si nous insistons, ce n’est ni par curiosité ni par plaisir.
Le caissier rendit compte aux deux agents des scènes qui s’étaient passées devant le juge d’instruction, rapportant fidèlement les moindres paroles de Margival, de Marie-Louise et de Terrenoire.
Tristot et Pivolot ne l’interrompirent point. Ils hochaient la tête, et de temps en temps, se regardaient.
– Tout cela est singulier, murmura Pivolot…
Le récit qu’il venait de faire avait rejeté Guerrier dans une surexcitation nerveuse. Il s’épongeait le front fréquemment, et en même temps il grelottait, secoué de frissons.
Tristot et Pivolot avaient sans doute des pensées graves, car ils gardaient maintenant le silence et ne songeaient plus à interroger.
– Nous avons besoin de réfléchir à tout ce que nous venons d’entendre, monsieur Guerrier, dit Tristot à la fin, c’est pourquoi nous allons vous quitter. En prenant congé de vous, nous n’avons qu’à vous souhaiter un peu de patience, car votre affaire nous passionne mon ami et moi, et nous sommes de fichues bêtes, si nous ne parvenons pas à la débrouiller.
Guerrier haussa les épaules. Cela lui était indifférent, à la vérité.
– Avant de partir, j’ai une question à vous adresser. D’où teniez-vous les cigares que vous avez fumés ?
– D’un garçon de café qui les reçoit directement de La Havane.
– Nous procédons de la même manière, n’est-ce pas, monsieur Tristot ? Mais vous aviez déjà fumé de ces cigares, de la même boîte sans ressentir d’effets soporifiques ?
– Assurément.
– Qu’en concluez-vous ?
– Que, si ce que vous dites est vrai, des cigares empoisonnés ont dû être mélangés aux miens, – placés par-dessus, de façon que je dusse les prendre les premiers.
– Qui s’en occupait d’habitude ?
– Moi-même, quelquefois Brignolet…
– Qui avait apporté ceux-là ?
– Brignolet, justement. Je l’avais envoyé dans l’après-midi renouveler ma provision. Et c’est lui qui, sur mon ordre, plaça la boîte dans le placard.
– Bien. Cette boîte était-elle ouverte ?
– Oui.
– Ah ! ah ! Et Brignolet ne vous donna pas une explication de ce fait ?
– Si. Je crois qu’il me dit que la boîte avait été ouverte par erreur… Peu m’importait, du reste, puisque c’étaient les cigares que je voulais.
– Dans l’après-midi, vous n’avez pas fumé ?
– Jamais je ne fume à mon bureau dans la journée, mais seulement lorsque je suis seul, et obligé de veiller.
– Très bien. Vous aviez confiance en Béjaud et en Brignolet ?
– La plus grande confiance.
– Ni l’un ni l’autre ne vous a jamais donné le moindre sujet de soupçon ?
– Jamais !
– Le soir du meurtre, vous n’avez remarqué rien d’anormal chez eux, sur leur visage, dans leur allure ?
– Brignolet était silencieux et distrait. À plusieurs reprises, je lui adressai la parole et il ne répondit pas. Quant à Béjaud, il s’est couché de bonne heure, disant qu’il avait des coliques violentes et une envie de dormir qui lui coupait bras et jambes… Tous les deux se sont mis à ma disposition, pour le cas où j’aurais besoin de leur service pendant la nuit. Je n’ai pas remarqué autre chose.
– Un dernier mot, dit Pivolot. Madame de Terrenoire ne s’est-elle pas consolée de vos dédains avec un amant ?
– Je l’ignore. Cela me semblerait peu compatible avec ses idées de vengeance.
– Vous raisonnez en honnête homme. Si, comme nous, vous aviez eu souvent l’occasion d’expérimenter la perversité de certaines femmes chez qui la passion parle en souveraine, vous auriez remarqué en elles d’étranges inconséquences, de monstrueuses aberrations. Permettez-moi de vous adresser une question sur laquelle je vous prie de me garder le secret le plus absolu vis-à-vis de monsieur de Lignerolles.
– Parlez.
– Connaissez-vous bien monsieur de Luversan ?
– Ce boursier qui venait de temps à autre à la banque…
– Et aux soirées de la rue de Chanaleilles.
– Oui. Je le connais peu, mais j’avoue qu’il m’est antipathique.
– Ne le soupçonnez-vous pas d’avoir reçu, à un titre quelconque, les confidences de madame de Terrenoire ?
– Je ne puis rien vous dire à cet égard. Je vois bien que l’ami dont vous me parliez tout à l’heure a attiré votre attention sur cet homme qui, comme à moi, lui inspire les plus vives répugnances ; mais je dois vous avouer que je ne saurais vous fournir aucun renseignement utile à son sujet.
Tristot et Pivolot n’avaient pas, provisoirement, d’autres questions à adresser à Jean Guerrier. Ils le quittèrent donc pour se rendre dans la cellule du gardien de caisse Béjaud.
Béjaud avait été interrogé à plusieurs reprises par le juge d’instruction et confronté avec Jean Guerrier. Dans les premiers temps, il avait paru accepter son mauvais sort avec résignation. Il se défendait de son mieux. Mais, quand il vit que toutes ses protestations étaient inutiles, il déclara énergiquement qu’il serait désormais superflu de l’interroger, attendu qu’il ne répondrait pas – quelles que fussent les questions. Et il tint parole, opposant le mutisme le plus absolu à toutes les habiletés de M. de Lignerolles. Il avait commencé par ne point prendre l’accusation au sérieux. Mais, au fur et à mesure des interrogatoires, il avait perdu sa confiance et sa gaieté. C’est alors qu’il déclara qu’il ne répondrait plus. Ce qui lui avait imposé silence, en l’exaspérant, c’était l’impossibilité où il était d’expliquer comment il avait pu dormir si lourdement, qu’on avait assassiné un homme tout près de lui sans qu’il entendît rien.
– Je ne sais pas, moi, avait-il dit, je ne peux pas vous donner de renseignements. J’ai le sommeil léger. Faut croire que, cette nuit-là, je dormais comme une souche. Pauvre Brignolet, va, pauvre Brignolet ! Mais il n’y a pas que moi qui dormais, puisque monsieur Jean Guerrier lui-même… Enfin, il y a de la gabegie là-dessous, c’est sûr, il y en a…
Cependant sa détention lui paraissait longue. Il était au secret, aussi bien que le caissier, et cette solitude était lourde. Dans les premiers jours, il conserva le vague espoir d’être remis en liberté ; mais cet espoir diminua vite pour disparaître tout à fait. Il tomba dans un abattement profond, une prostration absolue, dont les gardiens qui lui apportaient sa nourriture ne purent le tirer. C’était le souvenir de sa femme et de sa famille qui l’obsédait.
– Qu’est-ce que tout ça va devenir, mon pauvre bon Dieu, répétait-il vingt fois de suite, machinalement, qu’est-ce que tout ça va devenir, si je ne suis plus là pour donner la pâtée ?… Ils sont capables de me garder des années sous les verrous… Et pourquoi, mon pauvre bon Dieu, pourquoi ?
Puis il cessa de pleurer et de se plaindre. Mais ses yeux fiévreux indiquaient qu’il était obsédé par une idée fixe.
......................
Pivolot montra au gardien la permission signée par M. de Lignerolles.
Le gardien s’inclina et précéda les deux amis.
Arrivé à la cellule, il tira le verrou, passa la clé dans la serrure et ouvrit la porte.
– Tristot et Pivolot voulurent entrer, mais reculèrent en laissant échapper une exclamation…
– Nom de Dieu !… dit le gardien.
Béjaud s’était pendu.
CHAPITRE XXXVII
La découverte de l’abominable lettre anonyme trouvée dans les vêtements de son père avait porté un coup terrible à Raymond de Noirville. Déduisant les faits avec l’inflexible logique de l’homme habitué à débrouiller les causes les plus obscures, il y voyait clair dans ce passé de honte et de scélératesse. Sa mère qu’il vénérait, dont il admirait encore hier la constance dans le deuil, la résignation, sa mère, qui le choyait, lui, Raymond, jusqu’aux dépens de son frère, avait commencé par tromper le plus noble, le meilleur des époux, et pour se venger de son amant qui, sans doute, la délaissait, avait poussé la haine jusqu’à se rendre complice d’un crime.
Complice ? Avec qui ? Là était le mystère impénétrable, le mur devant lequel se brisait cet ardent désir de réhabilitation dont Roger Laroque était animé. Pourquoi cet assassinat, dont, à coup sûr, le vol n’a pas été le principal mobile ? Pour reprendre les billets de banque versés à Larouette par Roger Laroque et pour les faire rentrer ensuite dans la caisse de ce malheureux. Et qui a tué ? Un scélérat à la solde de cette vengeance implacable.
L’assassin s’est grimé assez habilement pour que des témoins, et quels témoins, la mère et la fille de l’inculpé ! aient pu croire à la culpabilité de celui qu’il s’agissait de perdre.
Quelques lignes d’une écriture masculine ont suffi pour anéantir à la fois et l’éloquence du défenseur et le reste de vie qui avait permis à ce héros mutilé sur le champ de bataille de Sedan de venir in extremis défendre son meilleur ami.
Vingt fois Raymond la relut cette lettre dont chaque mot avait été un coup de poignard pour son père. Si habile qu’eût été ce coup droit frappé en plein cœur de la victime, il avait néanmoins dépassé le but. Ce n’était pas la mort de Noirville que les deux complices souhaitaient, mais bien celle de l’innocent, de Roger Laroque.
La mort de Noirville, en impressionnant douloureusement le jury, sauva la tête de cet innocent, qui, condamné aux travaux forcés à perpétuité, devait revenir plus tard et chercher, avec toutes les ressources de la richesse, le vrai coupable. Voilà ce que les criminels ne pouvaient prévoir.
Raymond s’était juré d’aider Roger dans son œuvre de réhabilitation, et maintenant qu’il tenait la preuve de l’innocence de cet homme, il lui était interdit d’agir. Il fallait qu’il gardât cet horrible secret au plus profond de lui-même, et pourquoi ? Pour sauver sa mère !
Puisque cette lettre ne devait jamais servir à éclairer la justice, Raymond ne la garderait pas. Il livra aux flammes la pièce à conviction et sa conscience ne lui reprocha rien. Un fils ne peut fournir des armes contre sa mère.
Mais le matin, quand Julia, avertie que Raymond, en proie à une fièvre ardente, gardait le lit, vint à son chevet, il ne put, dans son délire, réprimer un mouvement d’horreur.
– Non ! non ! criait-il. Retirez-vous ! Votre baiser me brûle… Je ne veux plus.
Il proféra ainsi des mots sans suite qu’elle écoutait avidement, cherchant à en comprendre le sens caché, prise de peur, tremblant de tous ses membres. Par bonheur, le jeune homme, instinctivement, garda son secret, et la mère se retira à demi rassurée.
Grâce à sa robuste constitution, Raymond en fut quitte pour une courte crise suivie d’un profond anéantissement.
Profitant de l’absence de Laroque, Raymond se rendit à Maison-Blanche. Il trouva Suzanne très animée. Elle connaissait tous les détails de l’enquête concernant Guerrier, et elle ne voyait pas sans frayeur son père se compromettre en démarches qui pouvaient attirer sur lui l’attention de la justice. Elle fit part de ses appréhensions à Raymond.
– Suzanne, dit-il, il n’y a qu’une solution possible à nos misères. Nous sommes tous perdus si nous n’agissons au plus vite.
– Mais que faire ? s’écria-t-elle. Tant que mon père portera ce fardeau de honte et d’infamie qui lui rend la vie intolérable, devons-nous nous occuper de nous-mêmes ? Ne serait-il pas d’un égoïsme odieux de sacrifier l’honneur de mon père à notre amour ? Je vous aime, Raymond, vous m’aimez. N’est-ce pas déjà un bonheur que de pouvoir nous le dire sans contrainte ?
– Sans espoir aussi, Suzanne. Mais laissez-moi vous exposer le plan que j’ai formé. Vous verrez que je ne l’oublie pas, votre père, et que je ne sépare point son bonheur du nôtre.
Il lui prit la main, qu’il couvrit de baisers passionnés, et la gardant serrée dans les siennes, lentement, il lui parla ainsi :
– Suzanne, depuis notre dernière entrevue, il s’est passé des choses terribles dans ma vie, des choses que je vous dirai peut-être plus tard, quand nous serons unis par les liens du mariage. Suzanne, voulez-vous fuir avec moi ?
À cette demande imprévue, elle devint très pâle, et chercha, mais en vain, à dégager sa main.
– Vous vous révoltez à cette idée, Suzanne ? Vous croyez sans doute que je veux vous arracher à votre père. Non, telle n’est pas mon intention. Fuyons, Suzanne. Nous partirons, comme frère et sœur, nous irons loin, bien loin. Croyez-moi, Suzanne, votre père, qui vous aime, qui ne peut vivre sans vous, renoncera à une enquête où il risque à chaque instant de trouver sa perte.
– Quitter mon père ! dit-elle, simplement. Y songez-vous, Raymond ! il en mourrait.
– Ne le croyez pas. Je prendrai soin de l’avertir par une lettre. Il saura que sa fille est sous la sauvegarde d’un cœur loyal, et il attendra impatiemment notre appel. Et dès que nous lui aurons dit d’accourir, il viendra.
Mais Suzanne n’était pas convaincue. Elle aimait encore son père, alors qu’elle le croyait coupable. Maintenant qu’elle était sûre de son innocence, cet amour s’était décuplé par le sentiment de profonde pitié que lui inspiraient les souffrances de ce père vénéré.
Raymond ne se découragea pas. Il plaida la cause de l’amour avec toute l’éloquence d’une conviction sincère.
Et comme elle se laissait aller à dire :
– Calmez-vous, Raymond, je verrai… je réfléchirai.
– Non ! s’écria-t-il, ces décisions-là se prennent tout de suite ou jamais. Je ne m’adresse pas à votre raison, mais à votre cœur. Que dit-il, ce cœur adoré ?
– Il dit qu’il vous aime, mais qu’il chérit un père…
– C’est justement parce que vous le chérissez, votre père, interrompit-il, que vous devez forcer sa résolution. Rester ici, c’est risquer pour lui une nouvelle comparution en cour d’assises, son renvoi au bagne où il finira en martyr.
Raymond avait frappé juste, cette fois.
– Eh bien, oui, s’écria-t-elle, nous partirons…
– Ne dites pas : « Nous partirons », c’est tout de suite qu’il faut partir. Nous serons demain matin au Havre, et dans trois semaines à New York.
Partir ainsi, sans avoir embrassé son père. Elle ne pouvait s’y décider.
– Eh bien, soit, dit-il, ce soir, à onze heures, soyez à votre fenêtre. Je vous attendrai dans une voiture attelée d’un bon cheval qui nous mènera tous deux à Paris, où nous prendrons le premier train du matin pour Le Havre. Vous me promettez ?
Elle hésita encore, et enfin, les yeux pleins de larmes, la poitrine oppressée, elle répondit en détournant les yeux :
– Je vous le promets.
Promesse qui scellait les fiançailles de ces deux êtres dans les yeux desquels rayonnait le pur amour.
– Par prudence, Raymond, dit-elle, retirez-vous. J’attends mon père d’un moment à l’autre, et, s’il survenait, il comprendrait, à notre émotion, qu’il s’est tramé quelque chose contre lui. Pauvre père ! Comme il va souffrir !
À cette pensée, elle eût voulu pouvoir reprendre sa promesse. Raymond la serra contre son cœur, l’embrassa au front et s’enfuit comme un fou.
Quelques instants après, Laroque revenait tout joyeux de Paris. C’est qu’il venait de voir Tristot et Pivolot et que ces deux messieurs lui avaient dit :
– Faites-nous le plaisir, monsieur Laroque, de ne plus bouger de chez vous. C’est jouer avec le feu que de vous montrer au nez et à la barbe des magistrats dont les yeux pourraient se dessiller tout d’un coup.
Et Pivolot, approuvé par Tristot, avait ajouté sur un ton des plus mystérieux :
– Nous tenons une piste. Est-elle bonne ? Est-elle mauvaise ? C’est ce que nous vous dirons bientôt. En attendant, ne nous demandez rien, si vous ne voulez pas nous rendre tout à fait sourds et encore plus muets.
Roger se frottait les mains, embrassait sa fille, et dans sa joie, s’écriait :
– William Farney ressuscitera Roger Laroque.
Et comme Suzanne, toujours attristée, ne se laissait pas aller à cet enthousiasme, il redevint sérieux :
– Je vois, dit-il, que tu doutes du succès. Aussi bien, ne connais-tu pas ces deux prodiges de policiers amateurs en qui j’ai mis tout mon espoir. Quand ces gens-là espèrent, c’est qu’ils sont sûrs de réussir. Je me suis bien gardé d’insister pour connaître leur fameuse piste, mais si mes pressentiments ne me trompent pas, ces gens-là me feront réhabiliter et alors… alors… tu sais ce que je veux dire ?… Tu baisses les yeux… Alors, rien ne t’empêchera plus d’épouser sous ton vrai nom de Suzanne Laroque, le fils de mon meilleur ami, de l’homme qui est mort en me défendant.
Il prononça ces derniers mots avec une certaine hésitation, et un tremblement dans la voix. Le souvenir de Lucien réveillait toujours en lui un cuisant remords. Plus l’homme s’éloigne en vieillissant des grandes fautes de sa jeunesse, plus la conscience, qui n’oublie jamais, elle, parle avec fermeté, plus le remords est cuisant.
Le père et la fille dînèrent silencieusement, Laroque se laissait absorber par les souvenirs du passé ; Suzanne songeait à sa promesse envers Raymond. La pauvre enfant s’était laissé arracher cette promesse dans un moment d’abandon. Elle frémissait à l’idée de tenir parole, d’abandonner son père. Elle n’en aurait jamais la force.
Le soir, Roger la pria de se mettre au piano et de lui jouer les sonates de Mozart qu’il avait entendu si souvent exécuter à Henriette, quand il revenait exténué de l’usine de la rue Saint-Maur.
Plongé dans un fauteuil, les bras croisés, Roger écoutait les suaves mélodies du Raphaël de la musique. Il revoyait Henriette, Henriette heureuse, souriante, ne songeant qu’à plaire à son mari. Que de douces heures il avait passées ainsi auprès d’elle avant cette maudite rencontre de Julia. À onze heures du soir, Suzanne était encore au piano et Roger répétait pour la cinquantième fois :
– Recommence, mignonne. C’est si beau ! Tu joues le Mozart avec le même sentiment que ta pauvre mère. Il me semble l’entendre. Tu me la fais revivre. Va, mignonne.
Et mignonne tournait les pages, et ses doigts agiles couraient sur l’ivoire. Elle avait laissé la fenêtre entrouverte et, tout en jouant, prêtait l’oreille aux bruits du dehors.
Un roulement de voiture se fait entendre. C’est sans doute Raymond.
Suzanne attaque un scherzo avec une maestria surprenante. Les notes crépitent sous ses doigts.
Roger, qui sommeillait, se réveille. Il se lève et va à la fenêtre. La nuit est sombre et il ne saurait voir ce qui se passe sur la route. Son ombre, immensément grande, se projette sur la pelouse du jardin.
Nouveau bruit de voiture. C’est Raymond qui s’éloigne. Il a compris. Elle ne partira pas. Désespéré, il rentre à Méridon. Et demain, entre cette mère qu’il n’aime plus, parce qu’il ne peut plus l’estimer, et cette jeune fille qu’il aime, mais qui ne sera jamais sa femme, à quel projet se résoudra-t-il ?
CHAPITRE XXXVIII
Quelle était l’énigme de la vie de Terrenoire ?
Dans sa jeunesse, alors qu’il avait vingt ans, Terrenoire menait la vie dissipée d’un garçon auquel la mort de son père et de sa mère a tout à coup laissé une fortune indépendante. Il avait le goût du luxe et de la dépense. Maître de ses biens, presque au sortir du collège, il en fut grisé et bientôt il attaqua le capital. Le capital allait bon train et il devenait évident qu’à ce train, il ne résisterait pas à un an ou deux d’attaques pareilles, quand tout à coup Terrenoire, comme par enchantement, disparut.
– Ruiné, fini, plus personne, dit-on. Déjà ?
Et ce fut tout. Quinze jours après il était oublié. Cependant il n’était pas complètement ruiné. S’il avait disparu, ce n’était pas pour faire une fin, c’est qu’il était amoureux.
Cela avait commencé, ainsi que commencent presque toutes les amours, à Paris. Une fillette, un jour, trottinait devant lui. Cette fillette avait une tournure gracieuse, la taille souple, les épaules larges ; ses cheveux, tordus derrière la nuque, se relevaient en masses sous son chapeau de paille orné de fleurs. Elle allait très vite. Terrenoire hâta sa marche et la dépassa. Et en la frôlant, il la regarda. Son air était modeste ; elle avait les yeux baissés ; son visage ovale était d’une exquise distinction, pâle, avec des lèvres rouges et fermes, dessinées d’un coup de pinceau délicat ; avec des yeux bleus, paraissant d’autant plus bleus qu’elle était brune. Ses grands yeux, au regard tout à la fois doux et ferme, s’arrêtèrent une seconde sur Terrenoire. Il n’y eut rien de plus.
Elle passa, gagnant de l’avance, se hâtant, comme si elle avait été en retard. Terrenoire la suivit de loin et la vit entrer dans une maison de la rue Lepic. Il attendit cinq minutes et ne la vit pas ressortir. Il allait entrer, lui aussi, et s’informer auprès du concierge, quand il la vit apparaître à une fenêtre du troisième étage. Elle aussi l’aperçut, car aussitôt la fenêtre se referma. Il attendit encore, mais ce fut vainement. « C’est bon, je reviendrai », se dit-il. Et il revint tous les jours, en effet.
Tous les jours, il suivit la jolie fille, l’accompagnant dans toutes ses courses, d’abord sans qu’elle parût s’en douter ; ensuite, malgré elle ; enfin, peut-être avec son consentement.
Comme il avait fait parler le concierge de la maison de la rue Lepic, il n’avait pas eu de peine à savoir ce qu’était la jeune fille, ce qu’elle faisait, comment elle vivait, à quoi elle passait son temps.
Elle s’appelait Blanche Warner ; elle était la fille unique d’un ancien commandant en retraite. Blanche ne travaillait pas ; elle s’occupait seulement du ménage de son père, qu’elle tenait très gentiment avec le plus d’économies possible.
Il fallait voir le vieux Warner, quand il sortait raide, sa longue taille maigre serrée par sa redingote étroite, sur laquelle il eût été impossible de distinguer un atome de poussière !
Il avait confiance en sa petite Blanche chérie, et il avait raison, car il n’était pas une fille plus honnête et plus chaste. Jusqu’au jour où le hasard – ce dieu qui se plaît à brouiller tant de vies – avait jeté Terrenoire sur son chemin, aucun trouble d’amour n’avait fait rougir son front ; jamais la pensée d’un homme ne l’avait inquiétée et fait tressaillir. Le commandant Warner recevait peu de monde, quelques anciens officiers seulement.
Point de jeunes gens. C’était une règle qu’il s’était imposée. Mais, sans doute, pour confirmer cette règle, il avait souffert une exception en faveur du neveu de son colonel, Margival, un chimiste très distingué et travailleur, lequel consumait sa jeunesse en expériences assez malheureuses, mais fort honorables.
Margival était doux et timide. Blanche avait dix-huit ans ; il en avait plus de trente-cinq ; elle était jolie ; il n’avait jamais songé à aimer ; il se trouva pris un beau jour et laissa là chimie, expériences, travaux et projets pour se mettre à être malheureux tout à son aise, car sa timidité insurmontable l’empêcha longtemps de se déclarer – non seulement à Blanche, ce qui eût été au-dessus de ses forces, mais à Warner lui-même.
Margival était amoureux fou, mais elle ne l’aimait pas. Certes, il ne lui déplaisait pas non plus ; elle était loin d’avoir de l’antipathie ; à force de le voir, même, elle avait conçu une certaine affection de camarade pour ce grand garçon, si occupé de la science, de ses inventions, qu’il en était resté d’une naïveté étonnante pour les choses les plus simples de la vie. Mais de cette camaraderie à l’amour, il y avait loin.
Les jours se passaient ; personne ne parlait de cet amour, et Blanche n’aimait toujours pas Margival. C’est alors qu’elle connut Terrenoire. Comme Terrenoire ne lui manquait pas de respect et lui témoignait au contraire une grande déférence, elle s’enhardit, à la fin, jusqu’à le regarder.
Il lui plut ; il était joli garçon, mis avec élégance, il avait l’air si doux, et fort amoureux, ma foi !
Après s’en être préoccupée, quand elle sortait, Blanche y pensa chez elle. Après y avoir pensé toutes les journées, elle en rêva toutes les nuits. Dès lors, elle était conquise.
Ce n’était plus qu’une question de temps et de prudence pour Terrenoire.
Bientôt ils se donnèrent des rendez-vous. Blanche ne croyait pas mal faire. Quant à Terrenoire, il ressentait un goût très vif pour cette enfant et n’avait d’autre but que d’en faire sa maîtresse, sans aucune préoccupation de l’avenir. Ce fut ce qui arriva. Blanche abusa de la liberté que lui laissait son père, de la confiance qu’il avait en elle.
La faute commise, elle eut le pressentiment de son esclavage, elle se vit à jamais enchaînée à cet homme qu’elle aimait et sans cesse obligée de recourir au mensonge, auprès du commandant Warner, pour cacher sa défaillance, mais l’amour l’emporta sur ses craintes.
Quand Blanche fut à lui, il sentit tout à coup pénétrer dans son âme un sentiment plus doux que le désir de cette belle enfant – un sentiment de pitié pour cette jeunesse qu’il déflorait, de regret aussi. En un mot, il se mit à aimer bel et bien. Lorsqu’il s’en aperçut, deux ou trois mois déjà s’étaient passés.
Un jour qu’il se promenait avec elle – elle s’appuyait, languissante, à son bras, étant malade depuis quelque temps – il rencontra un élégant, nommé du Volterier, avec lequel il avait eu autrefois quelques rapports mondains.
Son mécontentement redoubla quand il vit Volterier s’approcher de lui, le saluer et adresser galamment la parole à Blanche – défaillante.
Ensuite, se tournant vers Terrenoire.
– Voilà donc pourquoi vous avez disparu ?… Mes compliments !… Parole d’honneur, je vous comprends !… J’en aurais fait autant à votre place !…
– Assez ! dit brusquement Terrenoire, dont l’irritation était extrême…
– Hein ! fit le crevé.
– Passez votre chemin et veuillez ne pas vous souvenir que vous m’avez vu, sinon…
– Sinon…, fit Volterier, pâle, se redressant.
– Vous avez deviné.
– À votre aise. Mais je n’ai pas l’habitude d’écouter les menaces. Je trouve très gai ce que j’ai découvert, et rien ne m’empêchera de le raconter.
Blanche, demi-morte de frayeur, avait écouté cette conversation en frémissant. Bien que les deux hommes eussent baissé la voix, elle avait tout entendu.
Ils avaient échangé leur carte, sans plus ajouter un mot. Ils se quittèrent en se saluant froidement.
Terrenoire fut obligé de porter Blanche dans son appartement, tant elle était faible. Là, elle s’évanouit.
Il lui prodigua des soins, la fit revenir à elle. Son premier mot fut pour lui, pour l’empêcher de se battre.
Il essaya de nier encore.
– Jure-moi donc que tu ne te battras pas.
Il se tut.
Quand elle fut plus calme, il la reconduisit jusqu’aux environs de la rue Lepic. Il n’osait jamais s’aventurer dans la rue, dans la crainte de rencontrer Warner ou quelque ami de la famille.
Elle était si étrangement pâle qu’en rentrant son père le remarqua du premier coup d’œil.
– Qu’as-tu donc ? Serais-tu malade ? demanda-t-il.
Elle trouva un prétexte, une raison pour expliquer sa pâleur ; il ne se douta de rien.
Le lendemain, elle alla chez Terrenoire aussitôt qu’elle put sortir. Il n’était pas chez lui ; elle l’attendit.
Il ne tarda pas à rentrer. Il la prit dans ses bras, l’embrassa avec plus de tendresse que jamais ; il paraissait très gai.
– Tu ne te bats pas !
– J’aime mieux ne pas te mentir. Je me bats.
– Quand ?
– Demain matin, vers dix heures.
– Loin d’ici ?…
Il eut une hésitation.
– Non, dit-il, dans le bois de Ville-d’Avray.
– Et rien ne peut empêcher ce duel ?
– Rien, ma chère âme. Ce Volterier, vois-tu, est un de ces plaisantins insolents qu’il faut châtier un jour ou l’autre. Il m’a toujours été profondément antipathique. Je solde une vieille dette.
– Vous vous battez au pistolet ?
– À l’épée.
– Au moins, es-tu fort ?
– De la force de Volterier ; tranquillise-toi…
– Non, je ne suis pas tranquille. Est-ce ma faute ? Me comprendras-tu quand je t’aurai dit que ce serait effroyable… s’il t’arrivait malheur… effroyable, oui, parce que… je vais te confier un secret…
– Un secret ? De toi à moi ?
– Je suis enceinte…
– Dieu !
Et il la prit dans ses bras, l’étreignit contre sa poitrine, la serrant de toutes ses forces.
– Prends garde ! dit-elle, tu me fais mal.
– Chère enfant !
– Comprends-tu, à présent ?
– Sois courageuse, Blanche, et prie pour moi !
– Hélas ! dois-je faire autre chose que prier ?…
– Et si tu veux ne pas m’enlever à moi-même le courage et le sang-froid dont j’ai besoin, sois raisonnable… retourne chez ton père… Laisse-moi !
– Oui, adieu ! dit-elle, cherchant à être calme.
Et ils se quittèrent ainsi, essayant tous les deux de sourire. Ils ne devaient jamais se revoir.
Terrenoire avait menti en disant qu’il se battait à Ville-d’Avray. Rendez-vous avait été pris sur la frontière suisse : il partait le soir même.
Le lendemain dans la matinée, les deux adversaires étaient en présence, l’épée à la main.
Terrenoire s’était-il trompé, en se prétendant de la force de Volterier, ou bien le souvenir de Blanche et de son funèbre pressentiment jeta-t-il quelque trouble en son âme ?… Toujours est-il que les témoins, dès la première passe, s’aperçurent de sa faiblesse ; et il leur fut facile de prévoir un dénouement fatal.
Sur une fausse attaque, Volterier para et riposta avec une telle vigueur que son épée entra profondément dans la poitrine de Terrenoire. Le jeune homme étendit les bras et tomba. Il ne proféra pas une parole : la syncope était complète.
Le médecin ne put se prononcer et ne voulut pas sonder immédiatement la blessure pour se rendre compte de sa gravité. On transporta le blessé en voiture. Et la voiture prit au pas la route de Genève. On n’en était pas loin, heureusement. Terrenoire était toujours évanoui.
La nuit, le médecin put se prononcer.
– S’il en revient, dit-il, ce sera miracle.
Son fâcheux diagnostic ne l’empêcha point de donner à Terrenoire tous les soins que réclamait son état. L’abandonner, autant eût valu l’achever.
Terrenoire resta entre la vie et la mort pendant de longs mois, sans pouvoir recouvrer la parole. Dans les premières semaines, une fièvre ardente le consuma. Le docteur Sernois le disputa pied à pied à la mort, et ce ne fut qu’après trois mois qu’il put se dire à lui-même et dire à Terrenoire :
– Maintenant, je suis sûr de sauver mon malade !
La convalescence fut aussi longue qu’avait été la maladie.
Que devenait Blanche Warner pendant ce temps-là ?
Le jour même du duel, elle vint deux fois chez Terrenoire demander si l’on n’avait rien reçu. Toute la journée, elle attendit vainement. Le lendemain, rien non plus. Donc il était blessé, mort peut-être. Et les jours se passèrent ainsi dans une attente cruelle ; et pendant les nuits elle ne cessait de pleurer silencieusement.
Puis les jours et les semaines s’écoulèrent.
« Il est mort ! » se dit Blanche.
À qui pouvait-elle s’adresser pour le savoir ? Elle ne connaissait pas les amis de son amant, ni les gens qu’il fréquentait. Personne, de ceux-là, ne la connaissait elle-même, leur liaison ayant été mystérieuse. Sans doute, puisqu’il n’avait pas fait écrire, sa mort avait dû être foudroyante. Elle n’en doutait plus !…
Et sa grossesse devenait visible, cela lui était un atroce supplice que de se serrer la ceinture, comme elle le faisait, pour ne point trahir son état. Warner ne voyait rien encore. Mais, d’un jour à l’autre, dans un mois, dans deux mois, il allait tout découvrir, si elle ne trouvait pas moyen de tout cacher. Ah ! si elle avait été seule, elle eût accepté cet enfant qui allait venir, lui apportant le déshonneur, avec une sorte de joie farouche ! Elle eût vécu pour lui, et avec le sourire de Terrenoire elle eût vécu heureuse ! Mais le vieux Warner, le soldat honnête et confiant, qu’allait-il dire ? qu’allait-il faire ?
Ce fut l’amour de Margival qui la sauva.
Voyant que le chimiste ne venait pas à lui, Warner lui parla, le forçant ainsi de s’expliquer. Margival avoua son amour.
– Est-ce que tu crois, dit Warner brusquement, qu’elle t’aurait demandé en mariage ?
– Ainsi, vous pensez qu’elle m’aime ?
– Je n’en sais rien, mais nous allons l’apprendre.
Il alla chercher Blanche, qui était dans sa chambre, et l’amena au salon, où Margival attendait.
– Assieds-toi là, dit-il, et écoute.
Il se moucha et dit :
– Ma petite Blanche, voici, devant toi, un excellent garçon qui t’aime tendrement, et qui, si tu n’y mettais pas d’opposition, ne demanderait qu’à devenir ton mari.
Blanche, très rouge, se taisait.
Warner se moucha derechef.
Quant à Margival, il ne savait trop quelle posture prendre.
– Voyons, sacrebleu, Margival, parle un peu qu’on entende le son de ta voix.
Le jeune homme se leva :
– C’est vrai, Mademoiselle, dit-il, je vous aime, je vous aime profondément, depuis longtemps, et mon plus grand bonheur serait de vous entendre me dire que vous ne ressentez point trop d’éloignement pour moi. Vous voyez en quelle émotion je suis. Votre père a bien fait de tout dire, car jamais je ne m’y serais résolu. J’attends votre réponse, mademoiselle Blanche ; quelle qu’elle soit, je ne vous en aimerai et respecterai pas moins.
Blanche écoutait interdite. Que se passait-il en son âme ? Elle était certaine que Terrenoire était mort. En se mariant avec Margival elle restait quand même, au fond du cœur, fidèle à ses souvenirs ; son apparente trahison était nécessitée par son affection maternelle et par le besoin de donner un nom à cet enfant qui allait naître et était destiné à n’avoir point de père.
– Vous ne répondez pas ? interrogeait Margival.
Blanche se leva. Sa résolution était prise. Elle alla mettre sa main dans celle de Margival. Sa main était glacée mais le jeune homme était si ému qu’il ne s’en aperçut même pas.
– Ainsi, dit-il, tremblant, vous m’aimez un peu ?
– J’ai beaucoup d’affection pour vous, balbutia-t-elle. Ne suis-je pas habituée à vous voir ?… N’êtes-vous pas sans cesse, ici, auprès de mon père, auprès de moi ?… N’ai-je pas pu, chaque jour, apprécier vos qualités ?
– Mademoiselle Blanche je suis bien heureux, bien heureux ! disait Margival.
– Allons, embrassez-vous une bonne fois et ensuite parlons du jour de la noce. Il y a longtemps que je n’ai dansé, moi, mort de Dieu ! Et je tiens, avant de tourner de l’œil, à me dégourdir les jambes !…
Ce ne fut pas la volonté de Blanche qui pouvait entraver le mariage ; elle désirait, au contraire, qu’il fût précipité. Elle sentait sa santé chancelante ; des accidents, qui se renouvelaient fréquemment, rendaient sa grossesse très pénible.
Enfin, elle se maria.
Margival, jusqu’au bout, ne se douta de rien.
Warner, lui aussi, continuait d’être heureux et confiant ; son vœu s’était réalisé ; il avait dansé le jour des noces de sa fille, si bien dansé, tant dansé, qu’il en avait eu, le lendemain, une attaque de goutte, laquelle le retenait au lit, depuis ce temps.
Après quelques semaines, ce ne fut pas sans honte et sans une inexprimable angoisse qu’elle avoua sa grossesse à son mari, et, devant la joie manifestée par Margival, elle éprouva un tel trouble, un tel remords, qu’elle éclata en sanglots, lorsqu’elle rentra chez elle et se trouva seule.
Mais elle était condamnée à la dissimulation jusqu’à la fin – condamnée à boire ce calice d’amertume jusqu’à la dernière goutte de lie.
Afin d’être plus libre et de mieux dissimuler sa grossesse, elle resta chez elle, s’étendit sur une chaise longue, et n’en bougea plus.
– Tu as tort, lui disait son mari, tu devrais marcher.
Mais elle s’obstinait et il ne résistait pas à ses caprices ; ses conseils n’étaient point suivis.
Un jour, comme il lui demandait de ses nouvelles et qu’elle se déclarait souffrante, il eut un mouvement de passion et la prit dans ses bras, la serrant contre sa poitrine.
– Prends garde, dit-elle, tu me fais mal !…
Et tout à coup, se rappelant que jadis, en une pareille occasion, elle avait jeté le même cri devant Terrenoire, elle retomba sur sa chaise, pantelante, effarée, et s’évanouit.
Sept mois après son mariage, elle accoucha.
– Avant terme ! dit le médecin.
De fait, la fille qu’elle mit au monde était si chétive, l’accouchement fut si laborieux que tout faisait croire à un accident de ce genre.
– Vois-tu, disait Margival, si au lieu de rester inactive, tu avais suivi mon conseil !…
– Ne me fais pas de reproches, mon ami, répondit Blanche, je crois que je vais mourir !…
– Mourir ! s’écria-t-il, affolé.
Il prit le médecin à part. Celui-ci n’était pas très rassuré. Il ne voulut pas se prononcer et attendit.
Il n’attendit pas longtemps, la péritonite se déclara le cinquième jour. La maladie fut foudroyante. Blanche fut enlevée en trois jours.
Elle eut le délire quelques heures avant sa mort et prononça quelques paroles que ni son mari, ni Warner – qui s’était fait porter dans sa chambre – ne comprirent.
Elle dit à plusieurs reprises :
– Je le savais bien que ce duel nous serait fatal !…
De quel duel voulait-elle parler ?
Ils l’ignoraient et mirent ces paroles sur le compte de la fièvre.
......................
Cependant Terrenoire, pâle, amaigri, mais sauvé, avait pu quitter Genève et rentrer en France !
Il avait hâte de s’éloigner de cette terre où il avait failli trouver la mort et de revoir Blanche à laquelle il avait écrit – adressant les lettres chez lui, en comptant bien qu’elle viendrait les y prendre – deux ou trois mois auparavant.
Il s’étonnait un peu de n’avoir pas reçu de réponse à ces lettres, et il craignait quelque catastrophe – comme, par exemple, que la faute de Blanche n’eût été découverte par son père.
On devine, dès lors, quelle fut sa surprise, quelle fut son inquiétude, lorsqu’il retrouva chez lui toutes les lettres qu’il avait écrites à l’adresse de la jeune fille.
Il descendit aussitôt interroger le concierge et apprit par lui que Blanche, après être venue assidûment pendant les premiers jours, n’avait pas reparu depuis longtemps.
– Elle m’aura cru mort, la pauvre enfant ! murmura Terrenoire.
Et il tremblait en pensant à cette grossesse qu’elle lui avait avouée la veille même de son duel, lorsqu’elle lui exprimait ses craintes.
– Qu’a-t-elle pu faire ? Qu’est-elle devenue ?
Sachant où demeurait Warner, rien ne lui fut plus facile que de connaître le sort de Blanche…
Morte ! Elle était morte !
Morte mariée… morte en accouchant d’une fille… d’une fille qui était son enfant à lui, il n’en pouvait douter !…
Il était si faible que cette nouvelle le rejeta au lit et l’y retint plus d’un mois encore.
Quand il se releva, il apprit une autre nouvelle qui était, en quelque sorte, le complément de ces drames !…
Warner n’avait pas survécu à Blanche. La mort de sa fille l’avait tué.
Margival restait seul, chargé de l’enfant sur laquelle il avait naturellement reporté tout l’amour qu’il avait toujours pour la mère.
Longtemps Terrenoire resta inconsolable, ne vivant que du souvenir de Blanche et de la fille de Blanche, car la fille de Blanche, la fille de Terrenoire, c’était Marie-Louise.
Terrenoire, pendant les mois qui suivirent, essaya d’oublier en se replongeant plus profondément dans ses dissipations d’autrefois.
Il acheva bientôt de se ruiner. Alors il songea à se marier.
Mussidan avait mis sa fortune à sa disposition pour lancer une banque, laquelle prospéra vite grâce à l’intelligence de Terrenoire.
Quelques affaires bien lancées et heureusement menées lui donnèrent un certain renom d’habileté.
Ce fut alors qu’il épousa Andréa.
Étrange bizarrerie du hasard, il épousait Andréa comme Margival avait épousé Blanche.
La femme de Terrenoire avait été la maîtresse de Mussidan, et lui avait donné une fille.
Ainsi, dans ces deux ménages, dans ces deux familles, le même secret, le même drame douloureux.
Déjà, d’une part Mussidan se trouvait aux prises avec un sentiment contre lequel il s’était vainement débattu : il était jaloux de Terrenoire, et il aimait d’une affection presque maladive, à force d’être intense, Diane, pour laquelle il n’était qu’un étranger !
D’autre part, Terrenoire se voyait soupçonné d’un odieux crime, sans pouvoir se défendre ; on l’accusait d’être l’amant de Marie-Louise. De sa fille !
Emporté par son amour paternel, il avait manqué de prudence peut-être, dans la manifestation de cet amour. Pouvait-il dire qu’il avait suivi, mois par mois, année par année, l’existence de Margival, veillant ainsi de loin sur Marie-Louise, sans qu’on s’en aperçût.
– Est-ce qu’il lui était possible d’expliquer cela ?
Enfin Guerrier, Guerrier surtout – persuadé qu’on s’était joué de son honnêteté et de sa bonne foi – suppliait, menaçait, insultait.
Et Terrenoire ne sait que se taire !… Quel supplice pour cet homme, pour ce père !…
Ainsi sont expliquées les scènes qui se passèrent dans le cabinet de M. de Lignerolles.
Le lendemain du jour où ces scènes s’étaient passées, Margival, qui était venu au bureau, comme d’habitude, attendit que M. de Terrenoire fût à son cabinet et fit dire au banquier qu’il désirait lui parler. On l’introduisit sur-le-champ.
Terrenoire s’avança vers lui avec empressement. Il lui désigna un siège, mais Margival fit un geste pour dire qu’il n’acceptait pas.
– Monsieur de Terrenoire, dit-il, tremblant et d’une voix que l’émotion entrecoupait, je viens vous adresser une dernière, une suprême question.
– Parlez, Margival, je vous écoute – et n’oubliez pas, avant toutes choses, que j’ai toujours été votre ami, que je le suis encore, que je le serai toujours.
– Je voudrais le croire. Oh ! oui, je voudrais, comme par le passé, avoir confiance en vous. Est-ce donc vrai, monsieur de Terrenoire ? Étiez-vous vraiment, êtes-vous l’amant de ma fille ? Personne ici ne nous écoute, personne ici ne sait de quoi nous parlons. Soyez franc !
– Non, je le jure !
– La cause de la justice est sainte et sacrée. Elle doit passer avant toutes les autres. S’il est vrai que vous n’êtes pas l’amant de ma fille, il faut que le juge d’instruction en soit convaincu. Ainsi sera détruite la preuve morale de la culpabilité de Guerrier. Les autres preuves tomberont d’elles-mêmes, au fur et à mesure que l’enquête se complétera.
Terrenoire baissait la tête.
– Il le faut ! insista Margival. Il doit vous être facile de prouver que ces relations dont on vous accuse n’existaient pas – que les apparences seules vous accablent.
– Je ne le pourrais ! dit Terrenoire.
– Vous refusez ? C’est la perte de Jean Guerrier… En refusant, vous consacrez son déshonneur, puisque votre refus passera pour l’acceptation du fait accompli.
Margival eut beau insister. Il n’obtint rien de plus. Il se retira désespéré.
Le lendemain, il envoyait à Terrenoire la lettre suivante :
« Monsieur, je n’ai pas besoin de grandes explications pour vous faire comprendre que je ne puis plus rien avoir de commun avec vous. Je vous donne ma démission et vous prie de ne point vous préoccuper de la façon dont je vivrai. Adieu ! »
– Que va-t-il devenir ? murmura Terrenoire, après avoir pris connaissance de cette lettre.
Dans les premiers jours, il n’en entendit pas parler. Puis il apprit que Margival avait vendu les meubles, les tableaux, les tapis, les bibelots, enfin tout ce qui se trouvait chez lui. La vente s’était faite à l’hôtel Drouot.
Terrenoire en avait été averti par les tapissiers qui le fournissaient habituellement. Les bijoux avaient été vendus – les bijoux achetés par Guerrier, et ceux que Marie-Louise tenait de la générosité de Terrenoire. Rien ne restait dans le petit appartement de la rue de Châteaudun.
Et l’argent produit par cette vente n’entra même pas chez Margival, car Terrenoire apprit par le commissaire priseur qu’ordre avait été donné par le père de Marie-Louise de le verser aux pauvres.
Puis Margival quitta l’appartement pour prendre deux chambres dans la même maison, au sixième étage, sous les toits : une chambre pour lui, une chambre pour sa fille. Et il se mit à la recherche d’un travail quelconque.
Le juge d’instruction était au courant de ce qui se passait ; Tristot et Pivolot n’ignoraient rien, eux non plus, et les agents, troublés par le suicide de Béjaud, et le magistrat surpris par cet acte de probité du vieux Margival, se posaient la question à laquelle une fois déjà le juge n’avait pu répondre :
– Où est la vérité ?
......................
À Méridon, Raymond s’isolait de plus en plus. Ses yeux ne cherchaient plus comme jadis les regards de sa mère. Que savait-il donc ?
Elle voulut se raccrocher à l’affection de son fils Pierre ; mais il était trop tard. Froissé dès l’enfance par la préférence accordée à son frère, habitué à se considérer comme le sacrifié, il se tenait à l’écart. Aux tendresses imprévues de la repentante, il répondit :
– Vous m’avez dit que mademoiselle Farney en aimait un autre, pourriez-vous me nommer cet autre ?
Et comme elle gardait le silence :
– N’espérez pas me faire oublier un amour qui m’avait consolé de toutes les amertumes de ma jeunesse.
Elle se récria, fit semblant de ne pas comprendre.
– Ne me fais pas de reproches, mon Pierre. Je t’aime à l’égal de Raymond et je veux te le prouver à l’avenir.
– Vous n’en aurez plus guère l’occasion, s’écria-t-il. Bientôt, sans doute, mademoiselle Farney sera conduite à l’autel par l’heureux fiancé qu’on lui a choisi et que, paraît-il, elle a accepté. On me conviera à cette fête. Eh bien je n’irai pas, par la raison toute simple que je serai à deux mille lieues d’ici.
– Partir ? toi ! mon Pierre. Toi aussi, tu m’abandonnes ?
– Ma mère, dit-il, je fais des démarches pour participer à une mission scientifique en Océanie. Mon ambition est que ma vie, désormais inutile ici, serve au progrès de la science, au bien de l’humanité.
Elle comprit qu’il ne fallait pas en rechercher davantage pour une première fois. Du reste, on était venu la prévenir qu’un étranger la demandait au salon.
Elle ne recevait personne depuis de longues années. Que lui voulait-on ? Elle descendit.
Un homme à visage sinistre, à l’œil interrogateur, très soigné de sa mise, mais sanglé dans une irréprochable redingote noire, se leva de sa chaise en la voyant entrer et s’inclina cérémonieusement.
– C’est à madame de Noirville que j’ai l’honneur de parler ? dit-il.
– Oui, Monsieur.
Raymond survint à ce moment. Il allait se retirer quand la physionomie bizarre du visiteur l’intrigua. Il s’assit devant le guéridon et se mit à feuilleter un album.
– Je suis, dit l’inconnu, monsieur Pivolot. Peut-être me connaissez-vous, tout au moins de nom ? Les journaux ont bien voulu parler de moi quelquefois.
– Je ne lis jamais les journaux, répliqua-t-elle avec une certaine hauteur. Veuillez me faire connaître le motif de votre visite.
– Il s’agit, Madame, de la mort de monsieur votre mari et des circonstances qui l’ont précédée et suivie.
Raymond ne perdit plus un mot de ce qui allait se dire ; il observait avec attention les expressions de sa mère et celles que M. Pivolot laisserait paraître. Ce nom de Pivolot ne lui était pas inconnu ; mais il ne pouvait préciser ses souvenirs.
Quant à Julia, elle était devenue livide.
– À quel titre, Monsieur, vous présentez-vous chez moi ?
– À titre d’homme libre, mais esclave du devoir qu’il s’est tracé.
– Je ne vous comprends pas.
– Je m’explique. Tristot et moi, Tristot est mon ami, Madame, mon alter ego, comme on dit, un autre moi-même ; Tristot et moi, nous faisons de la police pour notre plaisir, mais de la bonne police, la seule qui mérite cette épithète. Nous cherchons les grands criminels impunis et, quand nous les trouvons, nous ne les arrêtons pas, n’ayant pas mandat à cet effet, mais nous les faisons arrêter. M’avez-vous compris, Madame ? Nous les faisons arrêter.
Raymond se leva. Il était temps qu’il intervînt.
– Ma mère est souffrante, dit-il. Je suis son fils, Raymond de Noirville, avocat, et si je puis vous fournir un renseignement utile, je le ferai volontiers, mais je tiens avant tout à ce que vous me précisiez le but de votre démarche.
Julia aurait voulu sortir ; mais elle se sentait rivée à sa place par une force irrésistible. L’œil finaud de M. Pivolot la fascinait.
– Mon Dieu, dit le policier, c’est bien simple. Je doute cependant que vous puissiez me répondre au lieu et place de madame votre mère. Vous étiez bien jeune à l’époque.
– Votre but, Monsieur, encore une fois, vous dis-je.
– Nous suivons l’affaire Brignolet. Vous connaissez l’affaire Brignolet ?
– Oui, Monsieur ; mais ma mère qui, effectivement, ne lit jamais les journaux ne la connaît pas.
– Madame le regrettera sans doute quand elle saura que le principal inculpé de cet assassinat est un sieur Jean Guerrier, qui fut autrefois le caissier du meilleur ami de votre père, j’ai nommé Roger Laroque… pour le populo, Roger-la-Honte.
– Ah ! fit-elle, très étonnée.
– Cela commence à vous intéresser, Madame. Que diriez-vous si Guerrier n’était autre que l’assassin de Larouette ?
– Je dirais, fit-elle vivement, que vous vous trompez. Ce jeune homme est innocent. N’est-ce donc pas déjà assez d’une victime ?
Elle se trahissait sous l’œil finaud du policier. Raymond vint à son secours.
– Et quels renseignements pourrions-nous vous fournir, monsieur Pivolot ? demanda-t-il.
– Pas vous, Monsieur, mais madame votre mère.
– Je vous écoute, dit-elle en détournant les yeux pour éviter ce regard dont elle se sentait tenaillée jusqu’au fond du cœur.
– Pourriez-vous me dire, Madame, à Tristot et à moi, ce qu’est devenu un certain Luversan qui, à l’époque, fréquentait, je crois, votre maison ?
À cette attaque directe, elle chancela, mais la peur retint sur ses lèvres les paroles imprudentes, et ce fut d’un ton en apparence très calme qu’elle laissa tomber ces mots :
– Ce nom m’est tout à fait inconnu.
M. Pivolot se leva, salua de nouveau humblement, et se retira en s’excusant de la liberté grande qu’il avait prise.
Raymond le reconduisit, mais quand il revint au salon, sa mère n’y était plus. Julia, enfermée dans sa chambre, priait Dieu de la faire mourir, de lui épargner, au moins dans ce monde, un châtiment qui retomberait sur ses enfants.
Quant à Raymond, la visite mystérieuse de ce M. Pivolot l’avait rempli d’épouvante. Il était loin de se douter que M. Pivolot, agissant en « fouinard » à l’insu de Tristot à qui il se garda bien d’en parler, avait fait un pas de clerc. La réponse droite et catégorique de Mme de Noirville l’avait dérouté dans ses inductions.
Les deux policiers amateurs étaient fort perplexes. Ils avaient compté sur l’interrogatoire qu’ils s’étaient proposé de faire subir au gardien Béjaud ; ils s’attendaient à être renseignés par lui sur différents points restés obscurs dans leur esprit ; de plus, ils étaient persuadés de son innocence aussi bien qu’ils étaient convaincus de celle de Guerrier, et voilà que Béjaud se suicidait dans sa cellule !
Cette mort renversait leur plan. Chose plus grave, elle faisait naître le doute chez eux. Béjaud voleur, Béjaud assassin, c’était Guerrier coupable !…
Ils employaient tous les deux le même système de défense ; tous deux, ils prétendaient qu’ils s’étaient endormis, d’une manière bizarre. Tous deux, sans préciser, ils avaient indiqué, dans leurs déclarations qu’ils s’étaient endormis lourdement, sans se réveiller, et qu’ils n’avaient rien entendu de ce qui s’était passé auprès d’eux. C’était pour le moins étrange. Telles étaient les réflexions qu’échangeaient entre eux les deux agents.
Après avoir recueilli le plus de renseignements possibles, Tristot et Pivolot en étaient venus à recouvrer un peu d’espérance.
« Après tout, se disaient-ils, il n’est pas impossible que Béjaud se soit tué par désespoir, et sans être coupable. Il ne serait pas le premier. »
Et ils reprirent de plus belle leur enquête, à laquelle cet incident avait fait subir un moment d’arrêt.
Leur instinct de policier les portait à surveiller la femme de Brignolet, qui avait supporté avec assez de philosophie la mort du gardien.
Cette femme les intéressait. Juliette Brignolet n’avait pas quitté son petit logement de la rue de Laval, depuis la mort de son mari. Elle continuait d’y vivre avec son enfant. Auparavant, elle travaillait un peu ; maintenant, elle ne faisait plus œuvre de ses dix doigts.
M. de Terrenoire, dont le cœur était excellent, et qui aimait beaucoup tous ses employés, petits ou grands, avait envoyé à Juliette une certaine somme pour l’aider à se trouver de l’ouvrage.
Juliette avait profité de cet argent pour se faire confectionner un coquet costume de veuve qui lui seyait à merveille et sous lequel elle était ravissante. De fait, elle était jolie à croquer, avec ses yeux noirs éclairant son teint rendu plus pâle par le deuil, et sa rousse chevelure épaisse qui se tordait sur sa nuque en bandeaux lourds, sous le long voile de veuve.
– Non, Monsieur, elle n’a pas changé son genre de vie ; elle va et vient comme auparavant – avait répondu le concierge à Pivolot qui le questionnait – on ne peut rien dire sur elle ; pour ce qu’elle fait quand elle est hors d’ici, je n’en sais trop rien ; mais pour ce qui est de chez moi, je peux affirmer qu’elle ne découche pas…
Et il ajouta philosophiquement, en prenant une prise :
– Patience, ça viendra !
Tristot et Pivolot ne s’en rapportaient pas souvent aux apparences, de telle sorte que la conduite de Juliette Brignolet pouvant ne rien laisser à désirer quant à l’extérieur, ils ne la surveillaient pas moins pour cela. Ils firent bien.
Quand Juliette sortait, elle s’en allait promener d’abord, soit au square Montholon, soit devant l’église Saint-Laurent, remontant jusqu’au parc Monceau. Mais une fois là, elle prenait l’omnibus, quelquefois même, lorsque les omnibus étaient au complet, ou qu’il pleuvait, ou qu’elle était en retard, sans doute, elle appelait une voiture et allait – toujours dans la même direction.
« Tiens ! tiens ! la petite qui se paye des voitures ! » se dirent les agents. Et ils la filèrent.
Elle se dirigeait vers la rive gauche. Elle passa le Pont-Neuf, et, à peu près devant la statue de Henri IV, tourna à gauche et s’arrêta place Dauphine.
Il y avait encore deux ou trois hôtels garnis où l’on pénétrait par d’étroits couloirs humides et sombres, donnant sur le trottoir par une porte à claire-voie, faisant tinter une sonnette dans la loge du concierge.
La voiture de Juliette Brignolet s’arrêta devant un de ces hôtels, dont le rez-de-chaussée était tenu par un restaurant à bon marché. La jeune femme descendit lestement et s’engouffra dans le couloir.
– C’est un rendez-vous ! dit Tristot.
Les deux amis, en voyant s’arrêter le fiacre qui conduisait Juliette, avaient fait rétrograder leur voiture et étaient venus à pied.
Ils s’attendaient à faire là une longue station. Déjà, ils avaient tiré de l’étui et coupé un cigare, quand tout à coup, à leur grand étonnement, ils virent réapparaître Juliette.
Elle semblait furieuse, sauta d’un bond dans la voiture, et celle-ci avait disparu avant que Tristot et Pivolot fussent revenus de leur étonnement et eussent songé à la suivre.
– Elle n’aura pas trouvé celui qu’elle cherchait.
Nous savons où la retrouver. Ce que je voudrais apprendre, c’est le nom du… Il n’acheva pas.
Comme ils avaient regagné leur voiture, ils aperçurent soudain, à quelques pas, Juliette, – Juliette elle-même, qu’ils croyaient loin. Elle était sur le trottoir et parlait avec animation à un grand et bel homme, encore jeune, bien qu’il eût été difficile de lui assigner un âge exact, d’allure assez distinguée, qui écoutait en manifestant des signes de la plus évidente impatience et semblait chercher autour de lui quelque prétexte pour rompre la conversation.
Tristot et Pivolot s’arrêtèrent sur le quai, et de là suivirent des yeux la scène. Cela dura longtemps.
Ils auraient payé cher pour entendre ce qui se disait, mais, de là où ils étaient, ils se trouvaient réduits à s’en rapporter à la mimique. Heureusement, celle-ci était expressive, chez Juliette surtout, et l’on pouvait mettre les paroles sous les gestes. D’abord, elle parut emportée, menaçante, puis elle se fit suppliante tout à coup, quand elle vit que ses menaces ne réussissaient pas.
Comme cela se passait près du fiacre de Juliette, le cocher entendait, et un large sourire goguenard éclairait sa figure rouge : celui-là, Tristot et Pivolot le comprenaient aussi : ah ! qu’ils auraient voulu être à sa place !
Juliette s’essuya les yeux ; donc, elle pleurait.
Le cocher hocha doucement la tête. Enfin l’homme parut céder aux larmes, Juliette remonta dans la voiture. Elle semblait transfigurée. L’autre prit place à côté d’elle, et le fiacre partit, refaisant le chemin de tout à l’heure et regagnant la place Dauphine.
– Ce n’est pas pour aujourd’hui la brouille ! dit Tristot.
– Tout de même, le monsieur en a assez. Il s’agit à présent de prendre sur lui quelques renseignements. Il a l’air bien cossu, cet amoureux, pour habiter un hôtel de dernière catégorie ?
– Il se cache peut-être ?
– Pourquoi ? Je flaire là-dessous quelque chose, monsieur Pivolot.
– Et moi pareillement, monsieur Tristot. Mais je veux bien me pendre, comme ce pauvre Béjaud si je peux dire ce que je flaire !
Les renseignements recueillis auprès du gérant de l’hôtel garni de la place Dauphine furent assez significatifs. L’homme qui venait d’entrer, en compagnie d’une jolie femme en deuil se nommait Parent. Il habitait là, depuis peu de temps, une quinzaine de jours environ. Du reste, son entrée était consignée, à sa date, sur le livre de police, ainsi que l’exigeait le règlement. À vrai dire, Parent ne venait guère là qu’à certains jours, pendant l’après-midi, et toujours pour y recevoir la jolie veuve avec laquelle il s’était rencontré tout à l’heure et se trouvait en ce moment.
– Depuis combien de temps est-il lié avec cette jeune femme ?
– Depuis qu’il vient ici, je les vois ensemble.
– Connaissez-vous les moyens d’existence de Parent ?
– Ma foi, non. Il a mis sur le registre : « Sans profession ». Je n’ai pas à lui demander autre chose, et il faut que je me contente de ce que l’on m’avoue. Il a accusé, comme dernier domicile, la rue de l’Université. Peut-être trouverez-vous là des renseignements plus intéressants.
Tristot et Pivolot se séparèrent.
Tristot resta en surveillance sur la place Dauphine, afin de filer Parent, lorsqu’il sortirait.
Pivolot courut rue de l’Université. Là, il eut beau consulter le registre de l’hôtel, il ne trouva point de Parent. Il eut beau donner le signalement de l’homme qu’il avait eu le temps de retenir, pendant le court espace de temps qu’il avait vu Parent causant avec Juliette – on ne le connaissait pas. Il revint place Dauphine.
Il était tard ; la nuit était venue. Tristot avait disparu de son poste.
Pivolot parcourut tous les marchands de vin des environs, passa et repassa la Seine, et ne découvrit pas son compagnon.
« Je n’ai qu’à rentrer chez moi, se dit-il. C’est là que Tristot viendra, s’il a quelque communication à me faire. Je l’y attendrai. »
Mais Tristot, toutefois, ne rentra que tard, vers onze heures.
– Voilà, dit-il. La petite veuve est sortie vers six heures. Elle a pris un omnibus qui passait sur le Pont-Neuf. Un quart d’heure après, Parent lui-même sortait. Il a demandé au premier cocher venu s’il était libre. C’est justement le cocher de notre fiacre. Je lui avais fait la leçon. Parent est monté, et le cheval a pris un bon petit trot bien doux qui m’a permis d’attraper moi-même une autre voiture et de suivre facilement.
– Où est-il allé ?
– Chez Lespès, sur le boulevard où il s’est fait coiffer.
– Et de là ?
– Prendre une absinthe à la terrasse de Tortini.
– Puis ?
– Il a dîné au cabaret du Lion d’Or, et comme je mourais de faim, j’ai dîné à la table voisine. Il a mangé copieusement, comme un homme qui a besoin de réparer ses forces – la jolie veuve, sans doute, a des exigences ! Quand il est sorti, je l’ai suivi. Il a fait deux tours de boulevard. Il est entré au cercle de la rue Laffitte, et il est bien probable qu’il y est encore. Qu’allons-nous faire ?
– Le plus simple est de retourner au cercle. Il faut que nous sachions où il demeure.
– J’y retourne.
– Moi, je vous attendrai dans quelque taverne des environs. Vers le milieu de la nuit, je vous rejoindrai.
Ils passèrent la nuit dans la rue Laffitte. Leur homme ne parut point.
– C’est à croire qu’il sera parti pendant que moi-même je suis allé chez monsieur Pivolot.
Entrer au cercle, demander Parent, s’informer s’il se trouvait encore là, c’était bien possible, mais il donnait par là l’éveil. Si Parent était mêlé d’une façon quelconque à l’affaire dont ils s’occupaient, il devait être sur ses gardes.
Mieux valait prendre patience et attendre. La patience était une des qualités de nos deux compères. La nuit s’écoula ; le jour parut ; pas le moindre vestige de Parent.
Ils avaient faim ; ils étaient fatigués et ils allaient quitter leur poste, persuadés qu’attendre plus longtemps était inutile, quand ils virent Parent le visage boursouflé, les yeux rouges, très pâle, les vêtements en désordre, sortir et suivre le trottoir en chancelant.
– Il a passé la nuit au jeu ! dit Tristot. Et il n’a pas gagné, sans cela, il aurait l’air plus joyeux.
Deux jeunes gens étaient sortis derrière Parent, avaient pris le chemin opposé et étaient passés devant les infatigables policiers.
– Quatre-vingt-dix mille francs !… disait l’un ; il n’a pas de quoi payer, c’est connu. Comment diable vas-tu jouer contre ce rastaquouère. ?
– J’entends dire cela depuis longtemps ; cependant, il a perdu plus d’une fois et il a toujours payé.
Le reste de la conversation ne fut pas entendu. Tristot se pencha vers l’oreille de son ami.
– Monsieur Pivolot, j’ai une idée, fit-il rapidement, suivez ces deux joueurs. Sachez leur nom, leur adresse, surtout le nom et l’adresse de celui qui a joué contre Parent. Moi, je file celui-ci. À moins de circonstances imprévues, rendez-vous au Lion d’Or.
À midi, en effet, ils étaient assis dans un coin de la grande salle du cabaret à la mode. Ils se racontaient leurs impressions, leurs observations.
– J’ai suivi les deux joueurs, faisait Pivolot ; ils se sont séparés en arrivant boulevard Haussmann ; l’un est allé vers la Chaussée-d’Antin ; l’autre, celui dont j’avais à m’occuper, sur votre avis, est rentré, quelques minutes après, dans une fort belle maison de la rue de Londres. J’ai réussi à prendre sur lui quelques renseignements dans la matinée. Il se nomme de Luvigny, il est garçon, mène grand train. Cela vous satisfait, monsieur Tristot ?
– C’est plus que je n’en voulais savoir pour le moment.
– Et à quoi serviront ces détails ?
– Ne devinez-vous pas ? Parent doit quatre-vingt-dix mille francs à monsieur de Luvigny. Les dettes de jeu sont des dettes d’honneur et doivent être payées dans les vingt-quatre heures. Parent devra rembourser la somme énorme qu’il a perdue cette nuit.
– Je comprends. Votre idée est excellente ; Parent a tout l’air d’un aventurier. Où trouvera-t-il cet argent ? Payera-t-il ou non ? Tristot hocha la tête.
– Je plaide le pour et le contre, dit Pivolot. Nous allons un peu au hasard depuis hier, et, ma foi, si ce hasard ne nous est pas propice, je crains bien que nous ne fassions fausse route. Que Parent soit aussi riche que Luvigny et nous serons nous, bien avancés ! Avez-vous appris sur lui quelque chose de nouveau ?
– Peu de choses, répondit Tristot. Notre homme, au sortir du cercle, a fumé un cigare sur le boulevard, est entré dans un tripot, d’où il n’est sorti que vers dix heures plus blême encore que le matin. Il est allé prendre une douche au Hammam, est passé comme la veille chez Lespès et il déjeune en ce moment près de nous, ici même.
« Oui. Regardez la table du fond, parallèle à la nôtre au bout de la rangée. N’ayez l’air de rien. L’homme qui déjeune là, seul, c’est Parent.
C’était lui, en effet, fort tranquille, mangeant de bon appétit et n’ayant point la mine d’un homme tracassé par une dette de quatre-vingt-dix mille francs qu’il devait payer dans les vingt-quatre heures.
Cette réflexion les deux amis se la firent à voix basse.
– Il ne faut pas que nous le quittions de toute la journée. Il faut que nous sachions où il trouvera cet argent.
– C’est mon avis.
Ils achevèrent de déjeuner, se réglant sur Parent, afin de n’être ni en avance ni en retard.
Parent ayant allumé un cigare, Tristot et Pivolot, qui, on le sait, étaient toujours fournis, en firent autant.
Leur homme se promena un instant sur le boulevard, flânant, regardant les tableaux au coin de la rue du Helder ; il descendit jusqu’au cercle où il prit une voiture, qui partit au grand trot d’un assez vigoureux cheval.
Tristot et Pivolot avaient prévu le cas et avaient arrêté un fiacre sur le boulevard.
Tristot avait dit deux mots au cocher, et la voiture les suivait pas à pas, de telle sorte qu’au moment où Parent passa dans la sienne, ils ne le perdirent pas de vue.
– Cette fois, dit Tristot, j’espère bien qu’il va rentrer chez lui et que nous allons enfin savoir où il demeure.
Parent se dirigeait vers la rive gauche. La voiture, après avoir suivi un instant les boulevards, prit la rue Montmartre, traversa les Halles, le Pont-Neuf ; mais, au lieu de s’arrêter place Dauphine, comme le croyaient nos deux compères, elle enfila la rue Dauphine, tourna à gauche par la rue de l’Ancienne-Comédie, le carrefour de l’Odéon et s’arrêta rue Monsieur-le-Prince. Parent descendit là et entra dans un hôtel.
Tristot et Pivolot entrèrent dans un café-marchand de vin situé rue Monsieur-le-Prince, et des fenêtres duquel on pouvait aisément surveiller l’escalier et l’hôtel. Ils se firent servir une consommation et attendirent.
Environ trois quarts d’heure après, Parent sortait et remontait dans la voiture du cercle, qui l’avait attendu.
Il s’était habillé, était élégamment mis et avait fait disparaître toute trace des désordres et des fatigues de la nuit.
Sa taille élégante était serrée par une redingote de couleur foncée et il avait un pardessus gris clair.
Pendant que la voiture partait, il arracha le fil qui retenait une paire de gants et les passa.
La porte du petit café étant entrouverte, Tristot et Pivolot purent entendre Parent qui disait au cocher :
– Rue de Chanaleilles !…
Les deux amis se regardèrent.
– Rue de Chanaleilles ? Mais n’est-ce pas là que demeure monsieur Terrenoire, le banquier ?
– C’est là, en effet.
– Je vais le suivre, dit Tristot. Je garde la voiture. Il faut que nous en ayons le cœur net. Vous, monsieur Pivolot, informez-vous auprès du gérant de l’hôtel… et tâchez d’apprendre quelque chose sur Parent.
Le fiacre dans lequel se jeta Tristot ne rejoignit point celui de Parent, mais le cheval ayant marché bon train, il arriva presque aussitôt rue de Chanaleilles.
Les deux amis ne n’étaient pas trompés. La voiture de Parent attendait rue de Chanaleilles. Leur individu était entré depuis un instant.
Lorsqu’il sortit, ce fut pour aller rue de Londres, chez Luvigny, où il ne resta pas longtemps, après quoi, ayant payé la voiture, il la renvoya et descendit à pied jusqu’au cercle où il passa le reste de la soirée.
Parent ne se doutait pas – jusqu’à ce moment – qu’il était filé avec tant d’acharnement et d’adresse, autrement il eût pris, sans aucun doute, ses précautions pour dépister les deux agents.
Tristot, n’ayant plus rien à découvrir pour ce jour-là – car il était plus que probable que Parent allait passer la nuit au cercle – retourna rue de Londres, s’informa auprès du concierge si Luvigny était encore chez lui et sur sa réponse affirmative, monta au premier étage. Un valet de chambre vint ouvrir.
Tristot fit passer sa carte sur laquelle il mit un mot pressant pour le jeune homme.
On l’introduisit quelques instants après.
– Qu’y a-t-il pour votre service, Monsieur ? demanda Luvigny, en lui indiquant un siège, d’un geste indifférent.
– Monsieur, dit Tristot, la démarche que je fais vous surprendra, j’en suis certain, et je suis obligé de vous prier de me promettre de garder le secret le plus profond, jusqu’au jour où vous saurez qu’en la faisant, j’étais conduit par un plus haut intérêt que celui d’une simple et blâmable curiosité…
– Parlez, Monsieur… je suis prêt à satisfaire votre curiosité, si je le peux…
– Vous le pouvez, sans contredit. Voici de quoi il s’agit. Parmi les membres d’un des cercles que vous fréquentez, se trouve un individu avec lequel vous avez joué plusieurs fois déjà, sans doute – et en particulier dans la nuit d’hier… et auquel vous avez gagné une très forte somme…
– Luversan ? dit Luvigny en se levant.
Tristot faillit tomber à la renverse. Parent, c’était Luversan. Ah ! ah ! Cela marchait bien, très bien, et ce pauvre M. Laroque avait eu le nez fin.
– Luversan ? répéta Luvigny. Eh bien ?
Le policier surmonta sa joie.
– Des motifs très graves, que je suis forcé de vous cacher encore, répondit-il, et ce, parce qu’ils ne reposent que sur des observations superficielles qui vous sembleraient à vous, peu probantes, nous ont amenés, un de mes amis et moi, à surveiller cet homme qui nous paraît suspect.
– Vous êtes agent de police ?
– Non point agent de police régulier, comme vous l’entendez probablement…
Luvigny fit un geste de dégoût.
– Un mouchard ! murmura-t-il.
Tristot comprit et sourit.
– Ni l’un ni l’autre, Monsieur, dit-il, et cependant, c’est dans l’intérêt de la justice que je suis ici. Il serait trop long et peu intéressant de vous expliquer notre situation, à mon ami et à moi. Plus tard, s’il y a lieu, nous vous mettrons au courant. Je reviens donc à l’affaire qui m’amène. Je disais que vous aviez gagné à Luversan une somme de quatre-vingt-dix mille francs ?
– C’est vrai.
– Plusieurs de vos amis et entre autres celui avec lequel vous êtes sorti du cercle ce matin, ont exprimé devant vous des doutes au sujet du paiement régulier de cette dette d’honneur ?
– C’est encore vrai, dit Luvigny avec un geste de surprise.
– Et vos amis se trompaient, n’est-ce pas, puisque monsieur Luversan sort de chez vous et vient de vous payer ?
– Comment le savez-vous ?
– Je l’ignore, Monsieur, et c’est ce que je viens vous demander.
– Je n’ai aucune raison pour le cacher.
– Vous êtes payé ?
– Intégralement. Voici, dans ce portefeuille, les quatre-vingt-dix mille francs de monsieur Luversan.
– Voudriez-vous, Monsieur, ne pas vous défaire de cette somme à présent, et la garder par-devers vous jusqu’à ce qu’un mot de moi vous en rende la libre disposition ?
Luvigny hésita un instant. Cependant, il en prit vite son parti. Il alla placer le portefeuille dans un secrétaire.
– Cet argent restera là, dit-il. Cependant, ne me faites pas trop attendre. J’avais grande envie de certains bibelots… et je voulais profiter de cette veine pour me les payer.
– Puis-je compter sur le secret le plus absolu ?
– Vous avez ma parole.
Quel triomphe pour Tristot quand il annonça sa découverte au confrère Pivolot.
– Alors, dit-il en risquant pour la première fois de sa vie un jeu de mots, l’amant de Juliette serait le Parent de Luversan.
– Vous l’avez dit, mon maître.
Mais, le lendemain, ils apprirent avec inquiétude, rue Monsieur-le-Prince, que Parent avait déménagé et n’avait pas laissé sa nouvelle adresse.
Ils coururent place Dauphine.
On ne l’y avait point revu, depuis son dernier rendez-vous avec Juliette Brignolet.
Restait le cercle dont Luversan était un habitué.
Pendant huit jours, tantôt l’un, tantôt l’autre, ils restèrent là en surveillance, mais ne virent pas celui qu’ils attendaient.
Il était évident que Luversan n’y remettrait pas les pieds.
– Il se méfie, dit Tristot, il devient prudent… Donc, il n’a pas la conscience tranquille.
Ils firent une nouvelle démarche place Dauphine.
Le gérant de l’hôtel leur répondit :
– Le soir même du jour où je vous ai vus, j’ai reçu la lettre suivante, que je ne demande pas mieux que de vous communiquer.
Pivolot parcourut la lettre.
Elle ne contenait que quelques lignes assez insignifiantes :
« Monsieur Lurelot – c’était le nom du gérant – obligé de quitter Paris sans retard, pour une affaire urgente qui m’appelle en province, et comptant rester absent plusieurs mois, je vous prie de m’envoyer mes effets dans une malle, à mon nom, en gare à Blois, où je les ferai prendre. Ci-joint un billet de banque pour vous couvrir de vos frais.
« PARENT. »
Il n’y avait rien de plus.
– C’est une ruse. Il n’a pas quitté Paris, dit Tristot.
Et, s’adressant à M. Lurelot :
– Vous avez expédié les bagages ?
– Aussitôt. Je ne pouvais les garder. Mon locataire ne me doit rien.
– Veuillez nous laisser cette lettre.
– Très volontiers.
– S’il vous arrivait quelque nouvelle intéressante, ayez l’obligeance de nous le faire savoir. Voici notre adresse.
– À propos, et sa maîtresse, la jolie veuve rousse ?
– En voilà une qui n’est pas contente. Toutes les après-midi, je la vois arriver. Toujours la même question : « Monsieur Parent ? » à laquelle je suis obligé de faire la même réponse : « Parti ! »
Tristot et Pivolot le laissèrent pour courir à un bureau télégraphique, où ils lancèrent le télégramme suivant, à l’adresse du chef de la gare de Blois :
« Colis, au nom de Parent, à Blois, est-il encore en gare ? Réponse immédiate. »
Une heure après, ils avaient la réponse qu’ils attendaient au bureau :
« Colis n’a pas été réclamé. Est en gare, à la consignation. »
– J’en étais sûr ! dit Pivolot.
Ils se rendirent ensuite rue de Laval où ils grimpèrent au sixième étage et frappèrent à la porte du petit logement habité par Juliette Brignolet.
Elle vint ouvrir et manifesta quelque surprise à la vue des deux hommes.
Ils entrèrent en souriant, et tout de suite Pivolot fit les frais de la conversation.
– Madame, dit-il, je n’ai pas l’honneur d’être de vos amis… et j’en suis heureux pour ma tranquillité – ajouta-t-il galamment – car si j’avais l’occasion de vous rencontrer souvent, je craindrais fort de ne plus guère dormir.
Après quoi, il présenta Tristot et se présenta lui-même.
– Que voulez-vous de moi ? dit Juliette, qui, malgré le calme qu’elle affectait, ne pouvait dissimuler son inquiétude.
– Rien que vous rendre service.
– En quoi pouvez-vous donc m’être utile ?
– En vous renseignant sur l’endroit où se cache un homme qui, nous avons de bonnes raisons pour le croire, ne vous est pas indifférent.
– Je ne comprends pas, dit-elle d’une voix altérée. Veuillez vous expliquer plus clairement.
– C’est de Parent que nous parlons…
Le visage de la jeune femme, de très pâle, devint rouge : ses yeux flamboyèrent… ses narines palpitaient… tout en elle trahissait la colère, la jalousie, la fureur.
– Vous savez où il est ? dit-elle, sourdement.
– Peut-être… Lisez cette lettre !…
Elle arracha des mains de Pivolot le papier qu’il tendait, y jeta un coup d’œil, puis se mit à rire – mais d’un rire brusque, nerveux.
– Cette lettre, je la connais. C’est son hôtelier qui vous l’a remise ; et vous croyez qu’il est à Blois, vous ?
Elle haussa les épaules, et, tout à coup, changeant de ton :
– Cette lettre n’a été pour vous qu’un prétexte pour vous introduire chez moi, me parler, me voir… J’entends que vous me disiez ce que vous me demandez. Quel a été votre but en venant ici ? J’ai le droit de le savoir…
– Là, là ! Vous prenez feu ! Quelle femme vous êtes ! Est-ce notre faute si votre amoureux vous est infidèle !
– Ah ! tenez, dit-elle, qui que vous soyez, vous êtes pour moi les bienvenus, parce que vous pourrez peut-être m’aider à me venger.
– Allons donc ! allons donc, murmura Pivolot, tu y viens, à la fin ! voilà ce que j’attendais !
– Me venger, oui, reprit-elle avec violence. Car je l’aimais, cet homme, autant que je le hais, à présent. Il m’a prise pour dupe… Il s’est joué de moi… Après m’avoir eue comme sa maîtresse pendant quelques jours voilà qu’il me plante là et il croit que cela va se passer de la sorte ? Ah, non ! Ah ! je me vengerai !
– Je trouve, en effet, dit Pivolot, d’un ton paternel, que cet homme a prouvé là beaucoup de légèreté… et si nous pouvons vous aider à en tirer vengeance ?
– Vous êtes de la police ?
– À peu près !
– Eh bien ! informez-vous donc des moyens d’existence de Parent !… Malins, vous serez si vous les découvrez !… Il vivait en garni depuis quelque temps, et de quoi vivait-il ? Je l’ignore. Est-ce que vous le savez, vous ?
– Non, et nous avions compté sur vous.
– Il y a un mois et demi à peu près… peut-être deux mois, que nos relations ont commencé… Ce qu’il m’a promenée d’hôtel en hôtel garni… Il m’a fait faire le tour du quartier Latin…
– Pardon, interrompit Pivolot avec aménité. Vous dites que vos relations avec Parent ont commencé il y a environ deux mois ?…
– Oui.
– Que devenait donc ce pauvre Brignolet pendant ce temps-là ?
Elle tressaillit et se troubla.
– Pourquoi m’adressez-vous cette question ?
– Dame ! c’est tout naturel.
– Est-ce que cela vous regarde ? dit-elle. Je le trompais, mais il n’en a jamais rien su… Et j’en suis contente, aujourd’hui qu’il est mort… C’est un chagrin que je lui aurai épargné, parmi tous ceux qu’il a éprouvés – par ma faute.
Tristot et Pivolot se regardèrent. Évidemment les paroles de Juliette Brignolet les intéressaient.
– Je remarquai, continua Juliette, une chose qui me parut bizarre. Mon mari et Parent avaient lié connaissance.
– Comment avez-vous fait cette remarque ? dit Pivolot.
– Je les ai rencontrés deux fois dans la rue. Ils sortaient d’un café et causaient avec vivacité. Je n’ai pas fait semblant de les voir. Quant à eux, ils ne m’ont pas aperçue, j’en suis sûre.
– Et qu’avez-vous pensé ? fit Tristot, qui redoublait d’attention.
– J’ai pensé que Parent était très prudent et essayait d’entrer dans l’intimité de mon mari pour rendre plus faciles ses relations avec moi.
– Vous n’en avez pas dit mot à Parent ?
– Non – répondit-elle avec un certain embarras – c’eût été entamer avec lui une conversation sur un sujet qui m’eût déplu.
– C’est la vraie raison ?
Elle resta quelques instants sans répondre. Elle regarda tour à tour avec frayeur Tristot et Pivolot, cherchant à deviner au fond de leur âme ce qu’ils pensaient, ce que signifiaient leurs paroles.
Puis, comme poussée par le besoin de faire des demi-confidences, peut-être pour se mettre à l’abri de tout soupçon, elle raconta :
– Un jour, Brignolet me dit : « Tu veux de l’argent ? Tu ne seras tranquille et heureuse que lorsque tu seras riche ? Et tu promets de bien m’aimer quand je t’en apporterai beaucoup, autant que tu en voudras ? Tu ne me tromperas pas ? Tu me resteras fidèle quand les belles toilettes que tu pourras te payer attireront sur toi les yeux de tout le monde ? » Je lui promis tout ce qu’il voulut, mais, inquiète de l’air étrange avec lequel il me racontait tout cela, je voulus m’enquérir du moyen qu’il avait trouvé pour faire fortune, il répondit d’une manière évasive, en me disant qu’il n’était pas assez intelligent pour avoir découvert tout seul ce moyen-là, mais qu’il s’était associé avec un homme dont l’imagination était plus fertile que la sienne, et qui avait promis de le rendre riche. C’est tout ce que j’en pus tirer. J’ajoutai pourtant : « Et ça se fera attendre longtemps, cette fortune ? » Je disais cela en riant, pour le réconforter un brin, parce que je le voyais tout sombre et tout drôle. Il me dit : « Ça commencera peut-être demain ! » Je n’insistai pas, et de toute la soirée nous n’en avons plus parlé…
Elle s’arrêta, en voyant avec quelle ténacité l’examinaient Tristot et Pivolot.
– Comme vous me regardez ! dit-elle.
Pivolot eut un sourire froid.
– Continuez donc, madame Brignolet. Vous êtes vraiment charmante…
– Mais je n’ai plus rien à ajouter…
– Si, une chose… seulement. « Demain, vous avait dit Brignolet, demain, je t’apporterai une fortune. » Et c’est le lendemain, n’est-ce pas, qu’il a été assassiné ?…
– Oui, fit-elle – sans parler – d’un geste de la tête.
Au moment où les deux amis allaient sortir de l’appartement, Tristot, se retournant, demanda tout à coup :
– Et vous n’avez aucun soupçon sur l’assassin de votre mari ?
– Aucun. Si je le connaissais, l’assassin, croyez-vous que j’aurais attendu jusqu’aujourd’hui pour aller faire ma déclaration au commissariat du quartier ?
Elle avait la voix un peu altérée en disant cela.
– Songez, dit Tristot sévèrement, que si vous nous cachiez quelque chose, vous seriez coupable, très coupable, et que vous pourriez même être considérée comme complice du meurtre.
– Moi ?… moi ?… complice du meurtre… de mon mari ?…
– Oui !… réfléchissez-y !
Et sur ce mot, ils partirent, la laissant interdite et pâle.
......................
– Que pensez-vous de tous ces bavardages ? demanda Pivolot.
Tristot mit du temps à répondre, puis, prenant le bras de son ami et lui parlant bas à l’oreille :
– Et vous, monsieur Pivolot ?
– Moi, je suis persuadé que nous n’avons pas perdu notre temps avec ce Luversan…
Tristot eut un sourire approbatif, tira un étui agrémenté de son chiffre en or et offrit un cigare à Pivolot, qui accepta.
Ils étaient d’accord.
CHAPITRE XL[3]
Laroque, énervé par cette enquête interminable, les craintes qui commençaient à l’envahir pour sa sûreté personnelle, se laissait aller à la réaction du découragement.
Suzanne en profita pour essayer de le déterminer à repartir en Amérique.
– Père, lui dit-elle, depuis que je sais dans quel labyrinthe inextricable vous vous êtes engagé, je ne vis plus. La nuit, au moindre bruit, je me réveille en sursaut croyant qu’on vient vous arrêter. Quand vous promettez de revenir à telle heure, et que vous me faites attendre, je songe avec effroi à l’idée que vous êtes retombé dans les griffes de la justice et que je ne vous reverrai plus, comme autrefois que devant ces hommes à robe rouge dont la vue me glaçait d’épouvante, à Versailles. Si cela doit continuer encore plusieurs mois, vous risquerez peut-être de retrouver votre honneur, mais vous perdrez votre fille.
– Chère enfant ! Oui… Tu changes tous les jours… tu t’étioles dans cette solitude… Je devrais partir, retourner là-bas, où je suis honoré, où je serais heureux avec toi… si je pouvais oublier ; mais il y a ici, dans cette France que j’aime tant, où je veux finir mes jours, il y a un homme qui compte pour moi, qui est malheureux, injustement accusé, martyr…
– Jean Guerrier… c’est vrai.
– L’abandonner serait une trahison. Luttons jusqu’au bout, mon enfant. Soyons vaillants. Il n’est pas possible que cet inique jugement de Versailles ne soit pas réformé. Éloigne de toi les folles terreurs. Sois ferme dans ta conviction, dans l’ardent désir de voir ton père réhabilité.
Il achevait ces derniers mots quand la porte s’ouvrit.
Le père Firmin, vieux jardinier du pays, avait passé la journée à Maison-Blanche.
– Que voulez-vous, père Firmin ? demanda-t-elle.
– Pardon, Mademoiselle ; pardon, monsieur Farney. C’est un voisin, un bon voisin, qui demande la permission de visiter votre serre. Je crois bien qu’il voudrait vous demander quelques boutures qu’on aurait bien de la peine à se procurer ailleurs qu’ici.
– Vous n’avez pas besoin de ma permission, père Firmin, dit Laroque. Donnez à ce monsieur tout ce qu’il désire… du moment que c’est un bon voisin.
– Et un voisin rigolo, sauf vot’respect, monsieur Farney, ajouta le père Firmin qui s’arrêtait difficilement de parler quand il avait commencé. Cet homme-là, il en évu de toutes les couleurs. Paraît qu’c’est lui qu’a arrêté Lacenaire, mais vous n’connaissez pas ça, Lacenaire, vous, monsieur Farney. Lacenaire, c’est un assassin qu’en a tué quinze à lui tout seul. Il s’a fait prendre le jour où il a évu un complice.
Laroque écoutait avec intérêt le père Firmin, ce qui ne contribua pas peu à donner au vieux jardinier une impulsion nouvelle d’éloquence.
– J’vas vous dire. C’est un… un bon… un vrai… un roussin, quoi ! Il a été d’la boîte pendant trente-trois ans, sept années de rabiot, sans compter les services militaires. On ne voulait pas lui octroyer sa retraite, mais il l’a prise. C’est Cuvellier qu’y s’nomme : quand on dit « Cuvellier » à la boîte paraît que tout l’monde se découvre. Y en a pas, y en a jamais eu d’pareil, y en aura jamais plus.
Laroque ne put s’empêcher de rire.
Mais, si le vieux de la boîte était réellement aussi malin, peut-être bien qu’on pourrait l’utiliser en faveur de Guerrier.
Laroque invita le père Firmin à le mettre en rapport avec cet homme extraordinaire.
Le vieux jardinier, enchanté du succès de sa harangue, sortit avec son maître et le conduisit à un petit vieillard tout ratatiné et clignotant qui essuyait ses lunettes avec un formidable mouchoir de couleur.
– Vous êtes monsieur Cuvellier ? demanda Laroque au visiteur, en exagérant, par prudence, son accent yankee.
– Oui, Monsieur.
– Et vous désirez visiter notre serre ? Très volontiers, Monsieur. Le père Firmin vous expliquera nos essais d’acclimatation. Si quelques boutures de nos réserves pouvaient vous agréer, ne vous gênez pas. Je me fais un plaisir d’obliger un voisin qui, paraît-il, a rendu de grands services à son pays en le débarrassant de nombreuses bêtes féroces à faces humaines.
– Mon Dieu, oui, Monsieur, de très grands services. Mon pays m’a prouvé sa reconnaissance en m’allouant une petite retraite dont je vis, après avoir élevé cinq enfants qui font leur chemin à Paris. J’aurais peut-être été plus favorisé aux États-Unis, mais je n’aurais pas le plaisir d’être français ; c’est un privilège qui vous console de bien des choses.
William Farney trouva que le petit père Cuvellier ne manquait pas de finesse. Lui aussi aimait la France, sa patrie, et peut-être bientôt la lui faudrait-il quitter pour toujours.
– Quand vous aurez fait votre tournée et vos choix, lui dit-il, vous m’obligerez, monsieur Cuvellier, de m’accorder un moment d’entretien pour une affaire sérieuse où j’aurais besoin de vos lumières.
– Soit, Monsieur ; mais je vous préviens qu’elles sont bien vacillantes, mes lumières. Tant va la mèche au feu qu’elle brûle toute la chandelle. Encore deux ou trois jets de flamme et la farce sera jouée. Chacun son tour.
– Je vous attends au salon.
Le père Cuvellier revint au bout d’un quart d’heure.
– Je suis à vous, dit-il en acceptant avec plaisir le cigare que lui présentait son hôte, de quoi s’agit-il ?
– Il s’agit d’un homme qui veut me faire verser cinq cent mille francs dans sa caisse pour le seconder dans une affaire industrielle.
– Cinq cent mille francs ! répéta l’agent retraité. C’est un joli denier.
– C’est peu pour moi. Néanmoins, je ne tiendrais pas à les perdre.
– Je comprends ça.
– De quels moyens dispose-t-on à Paris pour vérifier l’honorabilité d’un homme ?
– Il y a des agences ; mais quand il s’agit d’une aussi forte somme, il faut se garder des agences. Si vous avez affaire à un coquin, croyez qu’il aura graissé la patte aux gens chargés de vous renseigner. Il peut lui en coûter dix mille francs, mais qu’importe, puisqu’il lui en restera quatre cent quatre-vingt-dix mille.
– Vraiment ! Mais alors, comment faire ?
– Vérifier par soi-même. Ah ! ce n’est pas commode, surtout pour un étranger. Connaissez-vous les habitudes du bonhomme ? C’est un débauché ? Il court les filles ?
– C’est bien pis, m’assure-t-on ; mais je n’ai pu en avoir la preuve. Il serait joueur.
– Joueur ? Et il vous demande cinq cent mille francs ? C’est pour les jouer, Monsieur ! C’est pour avoir la jouissance d’éclabousser de vos billets de banque une galerie émerveillée ! Savez-vous en combien de temps il peut vous les perdre, vos cinq cent mille francs ? En une nuit, en une demi-nuit !
Roger admirait ce petit vieux qui, après quarante années de services militaires et civils, avait encore tant de vigueur dans l’expression de sa pensée.
– Je vois, dit-il, que vous connaissez à fond les joueurs.
– Je vous crois ; j’ai été pendant dix ans brigadier au service des garnis à la préfecture de police, où nous avions entre autres surveillances de nuit, celle des tripots.
– Vraiment ! s’écria Laroque. Alors, vous allez peut-être pouvoir me renseigner.
– J’en doute ; car ce personnel se renouvelle en moyenne tous les cinq ans. Les pigeons disparaissent, se suicident ou vont en prison pour abus de confiance.
Laroque alla droit au but.
– Dans votre collection de voleurs ou de volés n’auriez-vous pas un certain Luversan ?
– Parfaitement, je tiens cet article.
Roger rayonna.
– C’est un homme entre deux âges, beau garçon, brun, l’œil perçant, un accent indéfinissable, un bellâtre, une sorte de rastaquouère, comme on dit de nos jours.
– Parfait, et il ne saurait y avoir deux Luversan de cet accabit.
– C’était de mon temps un boursier, une sorte de banquier marron.
– Ah !
– Il n’a pas toujours fait que de la banque et je l’ai connu dans les bas tripots du Quartier latin. Seulement, il ne s’appelait pas Luversan à l’époque dont je veux parler. Il s’appelait… attendez !… Ah ! diable, c’est qu’il y a bigrement longtemps de cela. Ma foi, je ne m’en souviens plus.
– Je vous en prie, Monsieur, tâchez de vous rappeler ce nom. Faites un effort.
– À quoi bon. Luversan est un coquin à qui je ne prêterais pas quarante sous. Je vous sauve cinq cent mille francs et je ne vous demande pas de remise.
Il se levait pour se retirer quand soudain son visage s’illumina, Cuvellier, triomphalement, s’écria :
– Le nom de votre homme, je le tiens, c’est… c’est Mathias Zo… non ! Zu… Zubé… Mathias Zuberi !
À ce nom de Mathias Zuberi, Roger Laroque avait fait un brusque mouvement. Son cœur avait battu plus vite. Il lui semblait se souvenir, lui, aussi ! Il lui semblait qu’il connaissait ce nom ! Mathias Zuberi avait été mêlé à sa vie.
Le vieux de la boîte s’était remis.
– Un joli coco, dit-il. Je revois son dossier comme si je l’avais là, sous la main. On ne connaît pas sa nationalité, mais on a la conviction qu’il a fait de l’espionnage pendant la guerre de 1870, pour le compte des Allemands. Il est gros joueur et c’est ce qui le perd. Vous êtes renseigné, Monsieur. Encore une fois merci, et bonsoir. Mon petit-fils m’attend.
Il se retira en saluant sans obséquiosité.
Laroque était très agité et très nerveux. C’est que lui aussi se souvenait.
Il se souvenait de ce Mathias Zuberi.
– N’avait-il pas été soldat ? Ne s’était-il pas battu autour d’Orléans ? N’avait-il pas, alors qu’il était sous-officier, surpris ce Mathias Zuberi en flagrant délit d’espionnage et ne l’avait-il pas fait arrêter ?
Mathias Zuberi s’était échappé de sa prison, quelques heures avant d’être conduit devant le peloton d’exécution, et dans la prison, sur les murs, il avait écrit quelques mots à l’adresse de Laroque, par lesquels il le menaçait de sa vengeance…
Tout un monde d’idées et de conjectures se développait devant Laroque. Était-ce donc vrai que ce Mathias Zuberi fût le même que Luversan ? Alors que de choses compliquées se simplifiaient !
Le hasard avait servi le misérable d’une façon bien singulière, mais le hasard est un dieu aveugle qui tend les mains et se laisse prendre par le premier venu.
Zuberi connaissait sa ressemblance avec Laroque, il l’avait augmentée, cette ressemblance, en choisissant des vêtements pareils à ceux que portait le mécanicien, d’une coupe particulière, de la même couleur, sans oublier cette pèlerine – mode assez rare – dont Laroque se couvrait les épaules, car il avait gagné des rhumatismes pendant les terribles froids de la guerre de 1870.
Voilà à quoi il pensait. Mais, tout cela, après tout, n’était que conjectures.
Rien, peut-être, n’était vrai ! Zuberi avait donc calculé qu’il serait vu par la femme et la fille de Laroque ? Impossible. Que des témoins le prendraient pour Roger ? Impossible. Qu’il rencontrerait le mécanicien le lendemain au cercle, perdrait contre lui, et ferait ainsi passer dans sa caisse les billets volés à Larouette, billets accusateurs ? Impossible, encore, toujours !
Toutes ces hésitations, toutes ces incertitudes, Laroque était décidé à ne les confier à personne, pas même à Suzanne.
Le lendemain, il rendait visite au père Cuvellier qu’il trouva en train d’apprendre à lire à un bambin de six ans.
– C’est mon petit-fils, dit le retraité. Il a la tête bien dure, mais il a bon cœur, ce qui fait compensation. La tête s’amollira chez lui et je suis convaincu que le cœur ne s’endurcira pas. Je parie que vous venez pour notre homme ? J’y ai pensé toute la nuit. Si vous voulez savoir ce qu’il vaut, adressez-vous à une sorte de coulissier marron, nommé d’Andrimaud, rue de Rivoli, 104. Il ne vous en dira que du bien, mais l’un vaut l’autre. D’Andrimaud en a eu pour deux ans de Poissy et dernièrement, étant allé à la boîte, j’ai appris que ce coquin recommençait sur une grande échelle. C’est peut-être pour lui que Mathias Zuberi voulait vous faire verser cinq cent mille francs ?
– Non ; mais je vous remercie, Monsieur, de vos bons renseignements. Si votre petit-fils veut venir de temps en temps faire des bouquets chez moi, il sera le bienvenu.
L’enfant sauta de joie, et Cuvellier, reconnaissant, fit à son tour visiter à M. Farney son jardinet et sa basse-cour.
CHAPITRE XLI
Le lendemain matin, Roger Laroque se rendait chez d’Andrimaud.
Cet incorrigible « banquier » tenait au premier étage une agence financière dénommée : Le Sauveteur des Capitalistes.
À la vue d’un gentleman aussi cossu que l’arrivant, d’Andrimaud se leva et, d’un geste noble, lui indiqua un siège.
Laroque n’y alla point par quatre chemins.
– Voulez-vous gagner cinq mille francs à ne rien faire ?
Très étonné, le Sauveteur des capitalistes se demanda s’il n’avait pas devant lui un aliéné ; mais Laroque tira de son portefeuille les cinq billets de mille, ce qui rassura le banquier en lui mettant l’eau à la bouche.
– Que faut-il faire ? demanda-t-il.
– Rien, vous dis-je.
– Je ne comprends pas.
– Connaissez-vous monsieur Luversan ?
– Parbleu !
– Le voyez-vous souvent ?
– Presque tous les jours.
– Pouvez-vous me mettre en rapport avec lui ?
– Pourquoi ?
– Ça, c’est mon secret. Aussi bien ne vous offrirais-je pas cinq mille francs si je n’avais besoin tout au moins de votre discrétion.
– Parlez et je vous réponds que pas un mot de ce que vous m’aurez dit ne sortira de ma bouche.
– Je ne parlerai pas. Je désire seulement que vous me mettiez en rapport avec monsieur Luversan et qu’il ignore ma démarche.
– Quand ?
– Demain.
– Soit ! J’inviterai Luversan à dîner ; je suis garçon. Vous arriverez comme par hasard à six heures et demie, et je vous forcerai à être des nôtres. Cela vous va-t-il ?
– Cela me va. Voici deux mille francs d’arrhes. Vous toucherez les trois autres mille francs fin du mois, à mon domicile.
Roger lui tendit sa carte au nom de William Farney.
– C’est à deux pas de Paris, lui dit-il. La course vaut bien trois mille francs.
Laroque se retira avec la conviction que d’Andrimaud était beaucoup trop fort pour avertir son ancien complice de filouteries. Les heures lui semblèrent interminables jusqu’au lendemain.
Vingt fois il s’était dit :
« Pourvu que Luversan accepte ! Pourvu que je ne reçoive pas de d’Andrimaud une dépêche contremandant ce rendez-vous ! »
Pas de télégramme… Laroque prit le train de Paris.
À six heures, il sonnait au Sauveteur des Capitalistes.
Cinq personnes dînaient ce soir-là avec d’Andrimaud ; tous « banquiers », à l’exception de Laroque. D’Andrimaud fit les présentations d’usage. Il termina par Luversan.
Celui-ci s’était approché de Laroque et le saluait courtoisement. Laroque répondit à son salut avec la même politesse, mais il n’y eut rien de plus entre eux ; pas un mot ne fut échangé.
À table, Laroque l’observa attentivement. Luversan était grand et robuste, large d’épaules, la même taille et la même carrure que Laroque. Mais pendant que celui-ci avait blanchi, Luversan était resté noir.
« Est-ce celui-là l’assassin de Larouette ? » se disait le condamné, en l’examinant à la dérobée.
Après le dîner, ils lièrent conversation.
Laroque s’était donné un air bonhomme admirablement joué, et très bien servi par son horrible accent et le peu de connaissance qu’il semblait avoir des choses parisiennes. Il amena la conversation sur le monde des affaires et de la finance, qu’il disait peu connaître, ayant passé la plus grande et la meilleure partie de sa vie à chercher quelques inventions de mécanique et ne jouissant guère de l’existence que depuis quelques années.
Il ne fit pas un secret de sa fortune. Du reste, d’Andrimaud, en trois ou quatre mots, avait prévenu Luversan que William Farney était l’associé richissime d’une très grosse maison de New York.
Il eut l’air de ne point paraître intéressé aux confidences que lui faisait William Farney. Mais il pensait pourtant, en l’écoutant :
« Cet homme est riche et naïf. Il ne connaît rien de Paris. Comme tous les savants et inventeurs, c’est un grand enfant. Il pourra me rendre service si je me sers habilement de lui. Qui sait ?… C’est peut-être cet imbécile qui m’aidera à rétablir ma fortune !… »
William Farney avait-il lu dans les yeux du misérable ?
Un pâle sourire éclaira un moment son visage et, dans ses yeux éteints, passa comme le rayonnement fugitif d’un éclair. Laroque donna rendez-vous à Luversan dans un café du boulevard des Italiens. Ils se virent tous les jours. Au bout d’une semaine ils étaient intimes.
Ils étaient intimes et si bien entrés dans les habitudes de leur vie, à tous deux, qu’ils n’avaient plus guère de secrets l’un pour l’autre, du moins en apparence, car si Laroque jouait une comédie vis-à-vis de Luversan, celui-ci rendait la pareille et ne lui faisait connaître de ce qui l’intéressait, que juste ce qu’il voulait qu’on sût.
C’est ainsi qu’il se donna comme très riche, alors que Laroque savait très bien à quoi s’en tenir sur ce sujet. Des deux, celui qui gardait sur l’autre une supériorité était donc Roger.
Il arriva ce que Roger avait prévu. Luversan lui offrit de l’associer à différentes affaires qu’il se proposait de lancer et pour lesquelles il lui fallait une mise de fonds considérable.
Roger, pour la forme, hésita quelque temps, se fit donner le plus de renseignements possible, afin d’écarter les soupçons de Luversan, en paraissant s’entourer de toutes les précautions imaginables. Après quoi, il consentit.
Il s’agissait encore d’une vaste agence de vente à tempérament d’obligations.
Ainsi donc, Luversan avait l’aplomb de parler philanthropie, lui ! voleur, espion, escroc, assassin !
Et Laroque ne sourcilla pas.
– Quelle somme vous faudrait-il ?
– Un million est nécessaire, dit-il.
– C’est beaucoup, fit le faux Américain avec le plus grand flegme, mais enfin je m’attendais à quelque chose de plus excessif. Je vais réfléchir… Dans combien de jours vous faudrait-il cet argent ?
– Quatre jours au plus tard.
– Dans quatre jours, vous aurez ma réponse… Un million, vous pensez bien, ne se réunit pas en quelques heures…
Il se tut un instant, puis, soudain, comme ayant une autre idée :
– Mieux que cela, dit-il, je puis être en mesure de vous rendre réponse dans deux jours, et de vous fournir l’argent, si je m’y décide…
– Oh ! vous vous déciderez… il ne peut en être autrement…
– Je ne dis ni oui ni non… Dans deux jours donc… c’est-à-dire samedi, venez me trouver chez moi…
– À Paris, rue d’Amsterdam ?
– Non.
Le boursier ne connaissait que l’appartement de la rue d’Amsterdam où il était allé la veille. Laroque avait loué en outre à Ville-d’Avray la maison où s’était commis le meurtre de Larouette, et qui, en raison de ce meurtre même, n’avait pas été habitée depuis lors.
Luversan demanda :
– Où donc vous verrai-je ?
– À la campagne…, fit William Farney.
Et il n’osait achever… dans une agitation visible qu’il aurait voulu surmonter en vain… Et l’œil toujours fixé sur Luversan :
– Je vis très simplement, vous le savez, mon cher monsieur. Comme je vis seul, sans famille, sans besoins, sans rien, je me contente de peu. Eh bien, j’ai trouvé à louer à Ville-d’Avray une gentille maisonnette où je vais aller m’installer pendant l’été. Ville-d’Avray me plaît. Il y a de l’eau, il y a des arbres… Et la maison est isolée…
Malgré sa puissance sur lui-même, dans le premier moment de surprise, Luversan s’était troublé. Il dit, péniblement, d’une voix altérée :
– Votre adresse exacte ? Ville-d’Avray est grand !
– C’est juste. La maison ne porte pas de numéro, mais elle est bien facile à trouver. Connaissez-vous le village ?
– Non, dit-il, cherchant à reprendre son sang-froid, je n’y suis jamais passé qu’en voiture… il y a très longtemps…
– Le premier venu vous renseignera. Vous demanderez la rue de Paris. Quand vous arriverez tout au bout, près du bois, la dernière maison, à droite, c’est la mienne…
Luversan était horriblement pâle. Les yeux étaient agrandis par une épouvante atroce. Laroque le regardait.
– Du reste, fit le faux Américain, la maison est connue… Il paraît qu’il y a dix ou quinze ans, ou vingt ans, même, je ne sais plus, un crime a été commis là… on a assassiné un vieux bonhomme… et le nom de la victime est resté à l’habitation qu’on n’appelle que la Maison Larouette. Tout le monde vous la montrera…
Les jambes de Luversan chancelaient. Il s’assit lourdement. Pour la seconde fois, son front était mouillé d’une grosse sueur. Et il l’essuyait machinalement du plat de la main.
– Qu’avez-vous ? fit Roger qui l’observait.
– Rien, dit-il. Je suis un peu énervé par tout ce qui arrive… Je ne me suis, je l’avoue, jamais trouvé dans une situation aussi critique, et cela m’émeut profondément… Pardonnez-moi si je vous fais répéter… Ainsi, vous dites, n’est-ce pas : Ville-d’Avray, rue de Paris… la dernière à droite, près du bois… la maison… la maison Larouette…
– C’est cela. Avec ces indications, vous ne vous tromperez pas.
– Donc, à samedi ?…
– À samedi.
– Et j’aurai une réponse certaine ?
– Je serai en mesure de vous la donner.
– Favorable ?
– Cela, c’est moins sûr. Je réfléchirai… Je verrai…
– Monsieur Farney, croyez que l’affaire est superbe !…
– Un million, c’est beaucoup…
– Si peu pour vous !… Je me charge de doubler le capital en moins de dix ans. Je vous enverrai demain un mémoire détaillé.
– Bien !… je verrai, vous dis-je…
Et, sur ce mot, il quitta le misérable.
Celui-ci le reconduisit, puis, se retrouvant seul, resta debout un instant, sombre, les yeux baissés.
– Ville-d’Avray, murmura-t-il… La rue de Paris ! La maison Larouette !… Qu’est-ce donc que cette fatalité qui m’y ramène, après douze ans !…
Roger Laroque ne retourna pas ce soir-là à Maison-Blanche ; sur-le-champ, il partit pour Ville-d’Avray. Cette maison qu’il avait louée, il ne l’avait pas habitée encore et il voulait s’y trouver au moins deux jours avant le moment où Luversan y viendrait.
Les héritiers de Larouette avaient fait enlever les meubles, mais l’ameublement de la chambre où avait eu lieu le crime, et où Laroque avait été confronté avec le cadavre était resté dans sa mémoire comme un souvenir impérissable, comme si vraiment la scène s’était passée la veille.
Il lui avait été bien facile de reconstituer le mobilier, au moins de cette chambre, car il n’avait vu que celle-là. Et il y avait fait porter, depuis qu’il était entré en relations avec Luversan, suivant en cela, pas à pas, le plan mystérieux qu’il s’était tracé, un bureau secrétaire d’acajou, une table ronde, quelques chaises recouvertes en velours d’Utrech (pareilles à celles de Larouette) et des chandeliers de cuivre.
Il donna à la chambre une apparence de vie, un air habité, en jetant, par-ci par-là, des journaux, en laissant traîner sur la cheminée des cigares, des allumettes. Sur la cheminée, la pendule marchait. Aux fenêtres, des rideaux blancs et des doubles rideaux d’Utrech. Dans le bureau d’acajou, du papier, des plumes, de l’encre, des lettres, des enveloppes, des pains à cacheter, des épingles, de la cire à cacheter, un cachet.
La mère Dondaine, qui faisait toujours des ménages à Ville-d’Avray, celle-là même qui avait trouvé un matin, douze ans auparavant, le cadavre de Larouette, avait ciré et épousseté partout. Elle ne s’était pas fait faute, la bonne femme, de raconter à Laroque l’histoire de Larouette, et si Laroque en avait oublié les détails, elle se serait chargée de les lui rappeler…
CHAPITRE XLII
Terrenoire, après quelque temps de mariage, s’était aperçu que sa femme ne l’aimait pas.
Il s’en était vite consolé, du reste, car son cœur était encore plein du souvenir de Blanche Warner.
Il ne demanda point à sa femme un amour qu’il n’éprouvait pas lui-même ; pourvu qu’elle gardât intact son honneur et le fît respecter, il n’en désirait pas plus.
Mais il eût été implacable s’il avait découvert une faute, et Andréa, qui avait eu tout le temps de connaître et de redouter cette inflexible nature, tremblait, souvent, au fond du cœur, qu’une imprudence de Mussidan – dont la jalousie était surexcitée – ne fît tout apprendre à Terrenoire…
Cette épouvante – où elle vivait – était un attrait de plus qui l’entraînait vers le mal. C’est pourquoi elle avait songé, d’abord à Jean Guerrier ; elle avait vu là une liaison plus criminelle qu’une autre, puisque Guerrier était presque un enfant d’adoption de son mari, qu’il était aimé de lui comme son fils, entouré de faveurs, choyé.
Lorsque Mme de Terrenoire s’était aperçue de la violente et réelle passion qu’elle avait inspirée à Luversan, bien qu’il fût très beau et très séduisant – tout occupée qu’elle était, à ce moment, par son amour pour Guerrier – elle ne voulut pas y répondre. Elle ne se sentait pas, alors, de goût pour lui – et ce qu’elle éprouva seulement, ce fut la satisfaction intime de toute femme qui se voit distinguée par un homme dont la séduction est dangereuse et dont les bonnes fortunes sont connues.
Sous la violente colère que lui inspira le mépris de Jean Guerrier, l’idée lui vint tout à coup de donner quelque espoir à Luversan.
– Êtes-vous capable de tout, même d’un crime, si je vous aime ? lui avait-elle demandé, le soir de la fête japonaise.
Quelle était son intention ? Quel projet sinistre avait-elle donc ? Avait-elle vraiment résolu de se venger de Jean Guerrier par un crime ? Et de Marie-Louise, par quelque terrible intrigue où viendrait sombrer son honneur ?
Après cette déclaration d’Andréa à Luversan, pendant la fête japonaise, quelques jours s’étaient passés sans que ni l’un ni l’autre n’y fissent allusion.
Andréa attendait, espérant jusqu’à la fin que Jean Guerrier n’oserait pas braver sa fureur, reculerait devant son mariage avec Marie-Louise, ou quitterait la banque du boulevard Haussmann.
Rien de tout cela n’arriva. Un soir que Luversan et Andréa se trouvaient seuls – c’était le lendemain du mariage du caissier – le jeune homme s’approcha de Mme de Terrenoire et, sans la quitter de son regard fixe et troublant :
– Je vous ai dit que je vous aimais… Vous souvenez-vous de votre promesse ?
– Je m’en souviens.
– Vous m’avez dit que vous m’aimeriez… peut-être…
– Je l’ai dit !…
– Seulement, il m’a semblé qu’à votre amour vous mettiez une inexorable et terrible condition…
– J’ai parlé d’un crime…
Elle avait dit cela très bas – si bas qu’à peine il l’entendit – et cependant, le son de sa voix leur fit peur à tous deux.
– Je suis prêt, dit-il, mais avant de vous dévoiler, avant de vous confier à moi, songez que nous devenons complices ; songez, je vous le dis, parce que je vous aime plus que moi, plus que ma vie, songez à quelle intimité terrible cela vous condamne… Ce n’est pas un amour commun que le mien, puisque je vous aimerai jusqu’au crime…
Il s’était approché d’elle, et elle se sentait attirée vers lui, machinalement, par une étrange fascination.
– Mais je vous promets, Madame, de vous aimer avec fureur, avec délire, avec folie, car je suis vraiment fou quand je suis près de vous. L’amour d’un criminel – et je le serai devenu pour vous – ne peut être un amour ordinaire… N’avez-vous point peur ? Est-ce bien ainsi que vous désirez que l’on vous aime ?
Elle passa sur son front sa main toute moite de sueur. On eût dit qu’en un éclair, elle avait entrevu l’avenir.
– Non, je n’ai pas peur, dit-elle. Je me venge !… Et puis, l’amour que vous m’offrez, c’est bien cet amour-là que je demande, que je veux. Il y a là quelque chose de terrible et de mortel qui m’attire… Oui, c’est bien cela que je veux…
Il la prit dans ses bras et leurs lèvres se réunirent, brutalement. C’était une morsure, plutôt qu’un baiser.
Et quand ils se séparèrent, Luversan, alla s’assurer que personne ne les épiait :
– Maintenant, dit-il parlez ! Qu’exigez-vous de moi ?
Ce qu’elle lui dit, on le devine : elle lui raconta comment elle avait aimé Guerrier, comment elle avait été repoussée ; elle lui confia ses menaces, sa vengeance.
Elle acheva ainsi :
– C est lui que je veux punir, mais je veux que ma vengeance soit si terrible qu’elle rejaillisse sur sa vie tout entière. Je n’ai pas d’autre projet. C’est à vous que je livre le soin de châtier cet homme. Vous avez en partie deviné mon âme… Je m’étais promise à vous en récompense de ce que vous ferez… mais, en me donnant, je pouvais réserver le cœur… Allez, ayez confiance… vous ne me faites point peur… Je n’ai plus que la haine pour Guerrier… et je tiendrai mieux que ma promesse…
Il l’étreignit dans ses bras une seconde fois.
Huit jours se passèrent encore.
Jean Guerrier avait repris son train de vie ordinaire : Luversan n’avait pas paru devant Mme de Terrenoire.
Que prépare-t-il ? se demandait celle-ci, avec une angoisse qui lui faisait passer des frissons dans le dos.
Un matin, en se réveillant, elle apprit le vol du million à la banque du boulevard Haussmann et le meurtre de Brignolet. Elle en fut terrifiée, car, sans rien soupçonner, prise d’une superstition subite, elle vit là comme une punition qui la frappait, elle-même, pour avoir rêvé contre Jean Guerrier une vengeance injuste.
Ce coup l’atteignait d’autant plus rudement qu’elle se crut ruinée. Elle dépensait beaucoup d’argent, sans compter – elle en dépensait même plus que Terrenoire ne lui en donnait, à des fantaisies coûteuses. Elle était criblée de dettes. Deux fois déjà son mari les avait payées, en lui faisant de douces remontrances. La troisième fois, elle n’avait pas osé les avouer.
Et elle vivait, depuis longtemps, dans des angoisses, recevant en cachette les réclamations des créanciers, leur faisant prendre patience, essayant de les convaincre et de les amener à entendre raison, jusqu’au jour où quelque occasion s’offrirait pour elle de les payer.
Cette occasion, en général, c’était un gain de Terrenoire à la Bourse, ou bien une rentrée sur laquelle on ne comptait plus. Et voilà qu’au lieu d’un succès financier à la Bourse, au lieu d’une rentrée, la Banque Terrenoire, à la suite de ce vol et d’affaires assez mal engagées, était menacée d’une formidable débâcle !
Le soir, comme elle recevait quelques amies qui, à la nouvelle de la catastrophe, étaient venues la consoler, Luversan entra.
Il était étrangement pâle.
Il s’avança lentement vers Mme de Terrenoire qui, tout de suite, à sa vue, comme frappée d’un coup de foudre, était restée épouvantée…
Il s’inclina, correctement, prononça quelques paroles à voix basse, qu’on n’entendit pas, mais qui furent prises pour des compliments de circonstance et se retira auprès de la fenêtre, d’où il ne perdit plus de vue Mme de Terrenoire.
Nous avons raconté quelle fut la scène.
Andréa, subitement, avait compris…
– Le meurtre ! le vol ! c’est lui qui les a commis !
Telle avait été sa première réflexion. Tout le lui criait, à elle, bien haut, dans l’attitude de Luversan : son air étrange, la pâleur de son visage, la ténacité de son regard fiévreux, je ne sais quoi de résolu et de fatal, tout à la fois, dans sa physionomie.
Quand il partit, sans autre explication, elle ne doutait plus. C’était lui ! ! !…
Le lendemain, eut lieu entre Mussidan et Terrenoire la scène qui eut pour résultat le sauvetage de la banque.
Et ce fut ce jour-là, aussi, que Luversan, se trouvant seul avec Mme de Terrenoire, lui tendit silencieusement un portefeuille gonflé de billets de banque et de titres.
– Ceci vous appartient, dit-il, je vous le restitue, car cela est à votre mari.
– Malheureux, qu’avez-vous fait ?
– J’ai tué, j’ai volé, n’était-ce pas convenu ? Ne l’aviez-vous pas ordonné ? Prenez ce portefeuille et cachez-le ; quelqu’un peut entrer et nous surprendre…
– Jamais ! vous me faites horreur !…
– Je m’y attendais, dit-il froidement – ayant toujours le million du meurtre dans sa main tendue – je m’y attendais et c’est parce que je crains vos remords que je veux que vous possédiez ce portefeuille.
Elle saisissait le portefeuille, rentrait dans sa chambre, le cachait et tombait demi-morte devant le petit secrétaire où elle venait d’enfouir cette fortune. Luversan l’attendit au salon.
Quand elle rentra, ayant recouvré un peu de force, elle lui dit :
– Allez ! ne reparaissez plus devant moi !… Laissez-moi toute ma vie pleurer l’abominable crime que vous avez commis.
Il haussa les épaules.
– Trop tard, dit-il, sombre. Trop tard !
– Je vous avais dit : Vengez-moi de Guerrier ! Vous avais-je conseillé de voler… d’assassiner ?
– Vous aviez dit : Êtes-vous capable d’un crime ?
Après un silence, il reprit :
– En volant, j’ai été amené à tuer… Ce n’est pas ma faute… c’est la fatalité qui l’a voulu… Le meurtre, du reste, vous vengera mieux que le vol… Guerrier est accusé de l’un et de l’autre… Il ne pourra se disculper… C’est pour lui l’échafaud – ou, sinon l’échafaud, le bagne !… Votre vengeance ne sera-t-elle pas complète ?… C’était auparavant qu’il fallait avoir peur… À présent, je le répète, il est trop tard.
Puis, après un silence, il dit, plus doucement :
– Qu’avez-vous à redouter, après tout ?… N’avez-vous pas confiance en moi ? Ne vous suis-je pas dévoué jusqu’à la mort ?…
– Allez, murmura-t-elle d’une voix étouffée, maintenant je ne peux rien dire… Je vois partout du sang ! Revenez plus tard, quand je serai calme…
– Et vous me retirez tout espoir ?
– Non. Puisque c’est moi qui ai commandé le crime, eh bien ! je le payerai.
Elle le paya, en effet.
Une sorte de folie des sens l’avait atteinte et elle se jeta dans les bras de Luversan, ne vivant que par lui.
Cet homme la possédait bien tout entière jusqu’à la moindre de ses pensées ; c’était ce qu’il avait rêvé. Ce crime, commis en commun, les enchaînait éternellement.
Peu à peu, Mme de Terrenoire en oubliait l’horreur – ou bien, si quelques remords traversaient encore la perversité de son esprit, elle les étouffait sous les transports d’amour dont l’accablait Luversan, dans les scènes de passion exaltée, affolée, maladive, auxquelles ils se livraient.
– Dis-moi tout, faisait-elle à Luversan. Si nous sommes découverts, je veux tout savoir, afin de tout avouer, avec toi…
Et lui, tranquille, comme s’il se fût agi d’une simple aventure et non d’une tragédie sanglante, raconta l’histoire du vol et de l’assassinat, disant de quels moyens il s’était servi pour accomplir son œuvre terrible.
– Vous vouliez vous venger de Guerrier… Comment faire ? Je pensai, d’abord à séduire sa femme ; mais je réfléchis qu’une jeune mariée, pendant la période de la lune de miel, est une place imprenable. J’appris, à peu près en même temps, que sa femme ne l’aimait pas, que ce mariage n’avait été qu’un mariage d’affaires et que Marie-Louise, depuis un an ou deux passait pour être la maîtresse de monsieur de Terrenoire. On expliquait de la sorte l’avancement rapide qu’avaient obtenu Jean Guerrier et Margival dans les bureaux de la banque.
– C’est une calomnie, dit Andréa. Si Marie-Louise a un amant, ce n’est pas monsieur de Terrenoire.
– En êtes-vous sûre ?
– Oui.
– Quelle preuve en avez-vous ?
– Mon mari m’a épousée sans amour. Aujourd’hui il m’aime !
Et comme Luversan faisait un geste de colère :
– Que vous importe ? Doutez-vous de moi ?
Il se radoucit et reprenant son récit :
– Quoi qu’il en soit, je l’ai cru, comme tout le monde, et c’est moi qui ai averti Guerrier, par des lettres anonymes, des bruits scandaleux que l’on colportait autour de lui…
– Quel était votre but ?
– Ne comprenez-vous pas ? Détruire son bonheur, d’abord ; ensuite m’attaquer à son honneur. Et comment pouvais-je mieux le perdre, cet homme dont vous vouliez vous venger, et que je haïssais, moi, parce qu’un jour vous l’aviez aimé, comment pouvais-je mieux vous venger, enfin, qu’en volant sa caisse et le laissant accuser de ce vol !
« J’appris vite quelles étaient les habitudes de la banque et je sus que lorsque la caisse renfermait une somme considérable, deux gardiens, Béjaud et Brignolet, couchaient auprès, soit dans un cabinet particulier, soit dans la pièce même où se trouve la caisse.
« Il me fallait faire la connaissance de l’un de ces gardiens. Ce fut Brignolet que je choisis ; pourquoi ? parce qu’il avait une femme fort jolie et fort coquette avec laquelle je ne tardai pas à me mettre en relations, et par laquelle je connus vite les secrets de ce ménage. Je pris le faux nom de Parent.
« Bientôt, la vie de Brignolet devint un enfer ; sans cesse sa femme lui réclamait de l’argent, lui faisait honte de la position servile qu’il occupait et dont il ne pouvait sortir.
« Juliette – c’est le nom de sa femme – me tenait au courant, sans qu’elle se doutât de l’immense intérêt que j’apportais à ses paroles.
« Il était aux abois et cherchait des expédients. Le pauvre diable aimait passionnément sa femme.
« Quand je devinai que Brignolet était prêt à m’écouter, je ménageai certaines occasions d’entrer en relations avec lui et je fis sa connaissance. Je ne tardai pas à entrer dans sa confiance. Et un jour où je le vis plus triste et plus sombre que jamais, je m’ouvris à lui… J’étais sûr de mon homme ; je n’avais plus d’hésitation à avoir. J’étais sûr qu’il allait m’écouter, et qu’il ne s’effaroucherait pas aux premiers mots… Il m’écouta, en effet, froidement.
– Que lui disiez-vous ? fit Andréa, haletante.
– Oh ! deux mots sans grands détails : « Il y aurait un moyen d’être riche, Brignolet, très riche, si vous vouliez… mais pour cela, il faut que vous vouliez, et cette fortune dépend de vous seul !… »
« – Comment ? répliqua-t-il…
« – Il y aura, dans trois jours, plus d’un million en or et en billets dans la caisse de monsieur de Terrenoire… Ce million, s’il était à vous, vous ferait heureux jusqu’à la fin de votre vie…
« Il avait une grosse sueur au front, et il s’épongea à plusieurs reprises avec son mouchoir. Il était devenu si pâle, ses yeux étaient si troublés, que je crus qu’il allait se trouver mal. En même temps, il me regardait, avec épouvante.
« Je le laissai revenir à lui, sans le presser, patientant.
« – Vous voulez vous moquer de moi, dit-il en riant faux… Pour qui me prenez-vous donc ? Cessez cette plaisanterie…
« – Ce n’est pas une plaisanterie, Brignolet. Demain, je serai ici, à ce café, et vous me direz ce que vous pensez.
« Je partis, voulant le laisser à ses réflexions, à ses tentations. Il rentrait chez lui, et il allait trouver Juliette revêche, avec sa demande incessante : « De l’argent ! »
« Le lendemain, je trouvai Brignolet qui m’attendait. Il m’avait précédé au rendez-vous que je lui avais donné. Et avant même que je lui eusse dit un mot :
« – J’accepte, fit-il… Je veux en finir !… Quelle sera ma part ?
« – La moitié.
« – C’est convenu. Comment nous y prendrons-nous ?
« Je lui expliquai ma pensée. Je lui demandai quelle était la disposition intérieure de la banque. Cette disposition, je la connaissais déjà, mais je désirais être sûrement renseigné. Quand il eut fini de parler, mon plan était conçu.
« – Béjaud sera-t-il des nôtres ?
« – Jamais ! Au moindre soupçon, soyez sûr qu’il avertirait monsieur de Terrenoire ou monsieur Jean Guerrier.
« – Très bien ! Nous nous arrangerons pour que ce soupçon ne lui vienne pas. Depuis combien de temps avez-vous repris votre service de nuit à la caisse ?
« – Depuis deux jours.
« – À quand le versement des douze cent mille francs ?
« – Demain.
« – De telle sorte que nous n’avons plus que cette nuit pour agir.
« C’est grave. Pouvez-vous me cacher dans la maison de la banque, boulevard Haussmann ?
« – Ce n’est pas impossible, dit-il. Nous avons en commun, Béjaud et moi, un petit cabinet noir, sous les toits, où nous mettons quelques effets.
« – Et si Béjaud vient pendant que je serai là ?…
« – Ma malle est très grande… et contiendrait facilement un homme… Vous vous y cacherez…
« – Tout est pour le mieux. Je me tiens coi jusqu’au milieu de la nuit. Je me lève, je descends doucement jusqu’à la porte de la banque, au premier étage. Vous m’attendez derrière cette porte et vous m’aidez à faire sauter la serrure. J’entre, et nous allons droit à la caisse.
« Brignolet hocha la tête.
« – Je vois à tout cela bien des inconvénients, dit-il.
« – Je prévois vos objections. Il s’agit de Béjaud, n’est-ce pas, qui peut se réveiller et entendre ?…
« – D’abord…
« – Eh bien ! il dormira, je vous en réponds, quand vous aurez réussi, en buvant avec lui, à lui jeter dans son verre le contenu de la petite fiole que voici !…
« Et je lui donnai un narcotique puissant.
« – Réussirez-vous à le lui faire prendre ? Tout est là.
« – Je le pense. Mais une fois dans le bureau, tout n’est pas fini. Vous n’avez pas le mot de la caisse…
« – Je vois avec plaisir, monsieur Brignolet, que vous êtes un homme de précaution. En effet, je n’ai pas le mot de la caisse, et je ne l’aurai pas, car il est probable que monsieur de Terrenoire ne vous le confiera, ni à vous, ni à moi. Mais le coffre doit être construit comme tous les autres. Il est scellé au mur et inattaquable par-devant…
« – Je le crois.
« – Eh bien, nous défoncerons la muraille et nous l’attaquerons par-derrière… De ce côté-là, avec d’excellents outils, nous rencontrerons moins de résistance.
« – Et Béjaud ne se réveillera pas ? Ce n’est pas du poison, au moins ?
« – Tranquillisez-vous, Béjaud ne sera même pas malade.
« – Je dois vous faire part d’un détail qui a son importance.
« – Ne me cachez rien. Un rien qu’on oublie peut nous faire échouer au dernier moment.
« – Il arrive parfois que monsieur Guerrier, à la veille des grands versements, conserve de la besogne pour le soir et passe à travailler une partie de la nuit. En ce cas, que ferions-nous ?
« J’avoue que ce détail, que j’ignorais, et que pourtant j’aurais dû prévoir, m’embarrassa sur le moment. Cela était de nature à faire échouer mon projet. Je dus le modifier.
« Et d’abord, je priai Brignolet de mettre en ma possession, ne fût-ce que pendant un quart d’heure, la clé de l’entrée, qui restait sur la porte tant qu’il y avait du monde dans les bureaux. Ce qu’il fit. C’était une clé ordinaire, et je n’eus pas de peine à trouver sa pareille chez un serrurier.
« De ce côté-là, j’étais tranquille, et, si Guerrier était dans son cabinet, il n’entendrait pas ouvrir ; n’ayant plus besoin de faire sauter la serrure, je ne ferais aucun bruit.
« En m’enquérant des habitudes du caissier, j’appris qu’il fumait beaucoup. Cela me suggéra l’idée de me servir de certains cigares qu’un de mes amis m’avait rapportés de l’Amérique du Sud et qui avaient subi une préparation opiacée. Je remis ces cigares à Brignolet avec ordre de les mélanger à ceux de Guerrier.
« J’étais sûr que, s’il les fumait, il s’endormirait. Et, le caissier endormi, le vol de la caisse devenait une œuvre d’enfant.
Luversan s’arrêta un moment.
Il eut un sourire et reprit :
– J’arrive à la nuit où je vous vengeai…, dit-il, où, par amour pour vous, je devins un meurtrier, un voleur.
« J’étais monté le soir dans la maison. Brignolet m’avait remis la clé du cabinet noir. Je m’y cachai. Je n’eus pas besoin de me jeter dans la malle, car Béjaud ne vint pas. La nuit s’écoula lentement. Dans la soirée, Brignolet, qui conservait plus de sang-froid que je n’aurais osé l’espérer, monta m’avertir que monsieur Guerrier prenait ses dispositions pour passer une partie de la nuit dans les bureaux.
« – À-t-il fumé ? demandai-je.
« – Pas encore.
« Je désespérais de réussir. Tout dépendait de Guerrier. Minuit sonna.
Quelques instants après, on frappait doucement à la porte du cabinet noir et je reconnus la voix de Brignolet qui me disait d’ouvrir.
« – Messieurs Guerrier et Béjaud sont endormis, dit-il, et sa voix tremblait, cette fois – les portes sont ouvertes.
« Je descendis. Pour sortir, Brignolet s’était servi de la clé de Jean Guerrier. La mienne ne devait plus nous être utile que pour refermer les portes afin que le vol devînt inexplicable.
« Guerrier dormait !… Je pus m’approcher de lui ; il ne se réveilla pas ; il ne fit pas un mouvement. Cinq ou six bouts de cigares, jetés autour de lui, me prouvaient que mon ami ne m’avait pas trompé sur leur efficacité.
« La caisse était ouverte ! En une seconde, j’eus fait un paquet de tout ce qu’elle contenait. Ce n’est pas très lourd, un million.
« J’avais conseillé à Brignolet de se recoucher auprès de Béjaud et d’attendre patiemment le petit jour. Brignolet s’assit sur son lit. Il paraissait en proie à l’émotion la plus violente.
« J’essayai de le rassurer en lui montrant comme nous avions facilement réussi et je froissais sous ses yeux les papiers satinés de la Banque de France.
« – Demain, lui dis-je, vous viendrez chez moi et nous partagerons cette fortune.
« L’émotion de Brignolet redoubla. Il était pris de frissons si violents que ses dents claquaient.
« – Non, non, dit-il, on verra tout de suite que je suis coupable. Je n’aurai jamais la force de nier, d’inventer et de soutenir des histoires…
« En vain, je voulus lui prouver qu’il n’aurait rien à inventer, rien à soutenir ; que ses réponses aux demandes qu’on lui ferait seraient bien simples et qu’il n’aurait qu’à dire :
« – Je ne sais rien. Je dormais. Je n’ai rien entendu.
« Mais il répétait obstinément :
« – Non, non, je ne veux pas… j’ai peur de la police… Remettez cet argent dans la caisse…
« – Vous êtes fou ?… Jamais !…
« Et je voulus partir.
À cet instant de son récit, Luversan s’essuya le front.
Ce qu’il dit ensuite, ce fut d’une voix rauque :
« Il était bien décidé à rentrer en possession de cet argent, car il se jeta devant la porte pour m’empêcher de m’enfuir.
« – Vous ne vous en irez pas, disait-il en regardant d’un air effaré Béjaud qui dormait, vous ne vous en irez pas ou vous me passerez sur le corps… Heureusement, il n’est pas trop tard… vous êtes là… Allons, hâtez-vous ! décidez-vous ! Monsieur Jean Guerrier peut se réveiller… Nous serions pincés, et ce n’est pas ce que vous cherchez, n’est-ce pas ?
« La colère me montait au cerveau. Je voyais rouge. Cependant, j’eus encore assez d’énergie pour essayer de le convaincre sans me fâcher.
« – Non, non, non, tu ne passeras pas ! dit-il, élevant la voix au fur et à mesure que moi, au contraire je baissais la mienne. Rends-moi cet argent et disparais, et que je ne te revoie jamais plus, car je ne sais ce que je ferais…
« – Réfléchissez, Brignolet, à ce que vous perdez. Acceptez-vous ? Oui… Rangez-vous donc, et ne me défendez plus cette porte…
« – Je refuse. Tu ne partiras pas !…
« – Place ! une dernière fois, je te l’ordonne !
« – L’argent ! je veux cet argent !
« J’avais, sans qu’il le vît, tiré de ma poche un poignard que j’y avais mis, à tout hasard, pour me défendre…
« Je me précipitai sur lui et le saisis à la gorge. Il se défendit ; il était robuste, mais l’épouvante lui enlevait la moitié de sa force ; quant à moi, la hâte d’en finir doublait ma vigueur… Je fus bientôt maître de lui…
« – Choisis, lui dis-je à voix basse, ou tu resteras mon complice ou tu vas mourir…
« Il essaya sans me répondre, de se débarrasser de moi. Alors le poignard que j’avais levé s’abattit. Il s’écroula, sans un cri, en poussant seulement un profond soupir, essaya de se relever, machinalement, en tendant les bras en avant et resta immobile. Il était mort. Je l’avais tué raide.
« J’eus un moment de frayeur… Dans la courte lutte que j’avais eu à soutenir, j’avais repoussé Brignolet sur son lit… C’était là, sur ce lit, qu’il était tombé… Je le tirai fortement par les bras pour le placer de son long sous les draps et les couvertures, afin de faire croire qu’il avait été frappé là, pendant son sommeil. Je regardais Béjaud…
« Il continuait de dormir… Je sortis et passai dans le cabinet de Jean Guerrier. Le caissier, lui aussi, dormait. Je pouvais être tranquille. Toutes mes précautions étaient prises, et rien ne viendrait me trahir.
« Je n’ai plus rien à vous dire, Andréa. Maintenant, vous savez tout !… Vous pouvez me livrer !… Je vous appartiens comme vous m’appartenez !… Je suis un meurtrier et un voleur !… Mais c’est par amour pour vous que j’ai volé et que j’ai tué…
Et après un silence :
– M’aimez-vous ?
– Je vous aime ! dit-elle avec une violence farouche.
......................
Luversan occupait jadis un assez joli petit appartement, de ceux qu’on appelle garçonnières – rue Royale.
Ce fut là, dans les premiers jours, qu’il reçut Mme de Terrenoire ; mais, au fur et à mesure que l’enquête de la police agrandissait son investigation, Luversan comprenait qu’il ne serait en sécurité qu’autant qu’on ne le trouverait plus à son domicile.
Il partit de la rue Royale, un soir, en disant qu’il se rendait à Blois, où il passerait sans doute quelque temps.
Puis il courut les garnis ; tantôt descendant dans les meilleurs hôtels de Paris, tantôt retournant à son ancienne vie de bohème et dégringolant jusqu’aux garnis borgnes du Quartier latin.
Il ne se départit plus de cette bizarre conduite qui lui donnait, à ce qu’il croyait, la sécurité, surtout quand il remarqua qu’il était suivi depuis quelques jours par deux singuliers personnages dont les allures lui paraissaient suspectes.
Pourquoi le filait-on ? qu’avait-on pu découvrir ?
Il n’avait commis aucune imprudence pouvant laisser prise aux soupçons. Il avait eu Juliette Brignolet quelques jours pour sa maîtresse – caprice peu fait pour le distraire de sa passion pour Mme de Terrenoire.
Il avait fini par s’en débarrasser…
Mais ne craignait rien de Juliette…
Il n’avait eu garde de lui confier ses projets sur la caisse de M. de Terrenoire, elle ne pouvait donc le livrer.
Dans ses fuites d’hôtel en hôtel, Mme de Terrenoire le suivait ; cette vie de terreurs continuelles, de continuelles angoisses, en l’énervant, doublait pour ainsi dire les voluptés criminelles qu’elle éprouvait à se retrouver auprès de Luversan.
Habituée à tous les raffinements que donne la richesse, elle ressentait une curiosité malsaine à passer quelques heures de sa vie – heures remplies d’amour et de baisers – dans ces maisons garnies où s’abritaient, en tout temps, les amours banales des étudiants et des grisettes.
Après avoir quitté le garni de la place Dauphine, après être resté quelques jours dans un hôtel de la rue de l’Odéon et quelques autres dans la maison de la rue Monsieur-le-Prince, Luversan était allé, pour éviter la curiosité gênante de Tristot et Pivolot, se réfugier rue Saint-Jacques, dans une maison meublée d’assez triste apparence.
C’était là qu’il avait donné rendez-vous à Mme de Terrenoire.
Depuis qu’elle était sa maîtresse, il n’avait eu, en somme, que d’assez rares moments à passer avec elle ; Andréa était obligée pour ne pas être soupçonnée, à d’incessantes précautions et jamais elle n’avait accordé à Luversan, qui la réclamait avec les instances de la passion partagée, une nuit tout entière. Une nuit d’amour, pendant laquelle il aurait été tout à Andréa, jusqu’au lendemain – pendant laquelle elle aurait été tout à lui !
Elle le lui avait promis, à la première occasion. Cette occasion se présenta plus tôt qu’elle ne pensait.
M. de Terrenoire fut obligé de s’absenter pendant plusieurs jours pour un court voyage en Allemagne.
C’était l’été ; Mme de Terrenoire témoigna le désir d’aller passer ces quelques jours à la campagne, dans une maison que son mari venait de faire construire et meubler aux environs de Vernon.
Elle y envoya donc son domestique, afin de partir seule avec sa fille. De telle sorte qu’elle se trouva libre, sinon pour une nuit entière, au moins pour une partie.
Elle était sortie vers neuf heures sous prétexte d’une soirée chez une amie. Et elle était allée droit rue Saint-Jacques.
Luversan l’y attendait, dans la rue même. Ils montèrent aussitôt, sans prononcer une parole, s’enfermèrent, à double tour et tombèrent dans les bras l’un de l’autre.
......................
Il était minuit ; peu à peu les locataires, filles et garçons, étaient rentrés à l’hôtel ; coup sur coup, la porte du corridor s’était ouverte, puis fermée avec un bruit retentissant après des coups de sonnette à réveiller un mort.
Depuis quelques minutes, l’hôtel était devenu plus tranquille.
Comme il faisait très chaud, Luversan et Andréa avaient laissé entrouverte la fenêtre de la chambre, sur la rue.
À voix basse, les deux amants causaient. Ils osaient faire des projets d’avenir.
– Nous courons trop de dangers, disait Luversan, à rester à Paris. La terre ne nous appartient-elle pas ? N’y pouvons-nous trouver, à deux mille lieues d’ici, s’il le faut, un asile où il nous sera permis de nous aimer sans redouter les comptes à rendre à la justice.
– Partir ? Partir avec toi !
– Que veux-tu dire ?
Elle ne s’expliqua point. Elle n’osait pas dire à cet assassin qui la subjuguait : « Partir avec toi, c’est me livrer pieds et poings liés à tes fantaisies sanglantes. Quand tu auras assez de moi, je sais trop bien ce dont tu serais capable pour que mon horrible secret ne sorte jamais de ma bouche. »
Lui ne comprenait pas.
– Est-ce pour ta fille que tu ne voudrais pas me suivre ?
Sa fille ! Qu’il y avait longtemps qu’elle ne l’embrassait plus comme autrefois ! Devant cette candide enfant, elle rougissait de honte d’être tombée au dernier échelon du vice et de l’infamie.
– Eh bien oui, dit-elle, je voudrais assurer le bonheur de Diane. Son mariage est retardé par…
Elle ne savait comment dire.
– Par notre crime, n’hésita pas Luversan.
Elle trembla : ainsi donc, elle était la complice de cet homme. N’avait-elle pas provoqué le meurtre pour assouvir une basse vengeance ?
– Son père s’en chargera.
– Ma fuite rendrait ce mariage impossible.
– Et cependant, il faut fuir, et à tout prix, déclara Luversan. Divers indices m’ont révélé que j’étais surveillé. Je puis être arrêté d’un moment à l’autre. Je réponds de moi ; mais je ne réponds pas de vous. Les femmes sont sujettes aux remords. Quand la peur de l’Éternité les assaille, elles parlent… elles disent tout.
Elle se révolta à cette idée.
– Alors, ce n’est donc point par amour que tu veux m’enlever, mais par peur ? Je te croyais moins pusillanime.
Luversan se redressa.
– Écoute, Andréa, dit-il, et ne m’insulte pas.
Sa voix était vibrante. Il ne songeait même plus qu’il pouvait se trahir si, par hasard, quelqu’un écoutait dans la chambre voisine séparée de la leur par une mince cloison.
– Rester à Paris, continua-t-il, c’est notre perte à tous deux. Et puis, à la forte somme que je t’ai confiée en dépôt viendra s’adjoindre un million tout rond qui m’est promis à bref délai.
– Par qui ?
– Peu t’importe, pourvu qu’il vienne.
– Sera-ce à un nouveau forfait que tu devras cette fortune ?
Il hésita à répondre, mais songeant qu’il n’avait aucun intérêt à révéler ses sinistres projets sur William Farney :
– Non, répondit-il.
– Un vol, peut-être ?
– Oui.
Elle détourna la tête. Ne savait-elle donc pas que l’homme, une fois lancé sur la pente du crime, doit rouler jusqu’au fond du gouffre, qu’il n’y a plus pour lui de repos jusqu’à ce qu’il soit perdu tout à fait !
Soudain, ils entendirent le bruit que fait, sur le trottoir, la marche d’une petite troupe de cinq ou six personnes arrivant ensemble. Cette petite troupe parut s’arrêter devant l’hôtel. Personne ne parlait.
Quelqu’un sonna vigoureusement, le concierge étant endormi, on sonna derechef et l’on secoua la porte. On entendit le bruit du cordon et du ressort qui s’ouvrait.
Luversan, pris d’un pressentiment bizarre, s’était précipité vers une fenêtre et penché sur la rue. Il ne vit que des hommes, qui s’engouffraient dans le couloir. Il fronça le sourcil… Il devinait un danger et tout de suite il en avertit Mme de Terrenoire…
Celle-ci était couchée, dans le lit, déshabillée. Elle se mit à rire.
– Tu as peur ? dit-elle.
– Je te prie de croire que c’est pour toi que je crains, non pour moi.
On montait l’escalier, lentement. La chambre où ils étaient se trouvait au troisième étage.
Les hommes s’arrêtèrent au premier et heurtèrent une porte. Une voix vigoureuse cria, sur un ton insolent :
– Allons, ouvrez, et plus vite que ça, s’il vous plaît !
– Ce n’est pas à moi qu’on en veut, murmura Luversan, rassuré.
Et il écouta toujours, tout en s’habillant et en conseillant à Mme de Terrenoire de s’habiller aussi pour être prêts à tout événement.
– Bast ! fit-elle, j’ai encore une heure devant moi avant de rentrer rue de Chanaleilles. Inutile de me presser.
Et elle resta au lit.
Il y avait comme des cris, des pleurs, des larmes, des bousculades au premier étage.
– Qu’est-ce que cela signifie ? murmurait Luversan.
C’étaient des cris de femmes surtout que l’on percevait, des plaintes, des reproches, des protestations. Puis, des courses précipitées dans l’escalier jusqu’au fond du corridor qui restait fermé et où tout cela semblait se masser et attendre.
Cela dura une demi-heure. Puis les hommes montèrent au deuxième étage. Et les mêmes scènes recommencèrent. Cette fois, les pleurs et les cris paraissaient plus distincts. Et Luversan, comprenant, devint très pâle et ne put retenir une exclamation de terreur.
– Qu’avez-vous donc ? demanda Mme de Terrenoire, qui ne put s’empêcher, devant ce qu’elle prenait pour de la pusillanimité, d’avoir un geste d’impatience.
– Ce que j’ai ? Prêtez l’oreille ! Vous n’entendez pas ? Vous ne devinez pas ce qui se passe là, auprès de nous ?
– Non, je ne sais… Une querelle d’amoureux ?… Eh bien ! n’y sommes-nous pas un peu habitués, et pareilles scènes ne se renouvellent-elles pas toutes les nuits ?
– Il s’agit bien de cela !
Et il paraissait en proie à la plus grande agitation.
– Enfin, parlez ! ! !
Il dit, avec effort :
– La police fait dans l’hôtel une descente de garni !…
Mme de Terrenoire eut l’air surpris.
Évidemment, l’expression dont venait de se servir Luversan ne signifiait rien pour elle.
Il fallut qu’il la lui expliquât.
Mme de Terrenoire avait perdu son air de fanfaronnade et ne songeait plus à rire. Toute pâle, à genoux sur le lit, elle écoutait, à son tour, les bruits d’en bas, retenant sa respiration, et entendant le battement sourd et précipité de son cœur.
– Est-ce qu’ils viendront ? interrogea-t-elle, haletante.
– Peut-être.
– Et s’ils viennent, que faire ?
– S’ils viennent, nous sommes perdus.
– Mais peuvent-ils donc me prendre pour une fille ?
– Est-ce qu’ils savent ?
– Je me défendrai… je leur parlerai…
– Rien ne fera. Ils n’écoutent pas les protestations. Chacune de celles qu’ils enlèvent pleure et éclate en reproches, en récriminations, inutile ! C’est au dépôt que l’on donne des explications, quand ce n’est pas à Saint-Lazare…
– Le dépôt ! Saint-Lazare ! ! ! dit-elle, frémissante.
La situation lui apparaissait maintenant dans toute son horreur !…
– Ah ! non, non, cela ne peut pas être ! dit-elle… Ils verront bien qu’ils se trompent !…
– Ils ne verront rien !… Toutes prétendent que l’on se trompe, et qu’elles sont honnêtes et vivent de leur travail… Ils ne les croient jamais !…
– C’est horrible !… Je ne puis pas, cependant, leur dire qui je suis !
– Ce serait le seul moyen.
– Mais c’est le déshonneur !…
– C’est vrai… Tout plutôt que d’en arriver à pareille extrémité… Habillez-vous vite, Andréa ! Je les entends au second étage… Dans un instant, ils seront ici… Il ne faut point qu’on nous y trouve…
– Qu’allons-nous tenter ?
– Nous allons essayer de nous sauver, de nous cacher… Vous êtes prête… suivez-moi… Donnez-moi votre main, afin de ne pas trébucher, car l’escalier est noir… le corridor n’est pas éclairé. Montons à l’étage supérieur…
Ils se hâtaient, cherchant à mettre le plus d’espace possible entre eux et la police.
Au quatrième, blottis l’un contre l’autre dans un coin obscur, ils écoutaient.
Les agents des mœurs en avaient fini maintenant avec le deuxième étage et s’en venaient au troisième et arrivaient devant la porte de la chambre que venaient de quitter Mme de Terrenoire et Luversan et que celui-ci avait laissée ouverte, dans la précipitation qu’il avait mis à s’enfuir.
Ils avaient poussé la porte et étaient entrés dans la chambre où tout, depuis le lit défait jusqu’à des vêtements traînant sur des meubles, attestait la présence des amants.
– Hé ! hé ! dit l’un en riant, le nid est vide ; les oiseaux sont envolés…
– Oh ! fit un autre, nous les retrouverons… Ils ne peuvent être loin… ils ont dû grimper au quatrième…
Mme de Terrenoire s’affaissa dans les bras de Luversan ; ses dents claquaient.
Luversan, le front mouillé de sueur, crispait les poings. Et, dans ses yeux, passaient de sanglantes lueurs, comme à cette minute maudite où il avait assassiné Brignolet.
La maison n’avait bien que quatre étages, mais un petit escalier conduisait, au bout du corridor pavé de briques, à un grenier où le gérant de l’hôtel mettait des malles. C’était la dernière ressource des deux amants.
Quand ils devinèrent que la visite du troisième étage était terminée, ils grimpèrent au grenier. Luversan souleva quelques malles, en fit une pile dans un coin, et derrière ce rempart improvisé attira sa maîtresse. C’était leur dernière ressource.
Mme de Terrenoire était demi-morte de frayeur.
Machinalement, Luversan avait tiré de sa poche un couteau-poignard et l’avait ouvert, prêt à tout.
Et Andréa, épouvantée, le suppliait :
– Je t’en prie, disait-elle, tu vas nous perdre… Jette cette arme… S’il y a, comme tu le crois, un commissaire de police avec les agents des mœurs, peut-être entendra-t-il raison.
Il ferma son couteau, mais sa respiration oppressée disait son émotion et sa colère.
La visite du quatrième étage était faite. On entendit la voix de l’agent qui avait parlé le premier : « Et nos tourtereaux ? »
Deux ou trois agents répondirent par un éclat de rire.
– Est-ce qu’ils seraient au grenier ?
– Cependant, s’ils se cachent, c’est qu’ils pourraient bien avoir quelque peccadille sur la conscience…
– Au fait ! cela ne nous coûte pas de grimper là-haut…
Et ils montèrent. Cinq minutes leur suffirent pour trouver Mme de Terrenoire et Luversan. Celui-ci s’était jeté devant sa maîtresse, en voyant les agents.
– Que voulez-vous ? dit-il. Que demandez-vous ?…
Les agents se mirent à rire. Pourtant, ce fut avec une certaine politesse qu’ils répondirent :
– Ce n’est pas vous que nous cherchons, Monsieur, mais la personne qui vous accompagne, que nous apercevons derrière vous, et qui serait bien aimable si elle consentait à nous suivre sans résistance, afin de nous empêcher d’employer la force.
– Madame n’est pas ce que vous croyez…
– Parbleu ! Est-ce que nous ne le savons pas… Voilà la dixième fois, depuis une demi-heure, que nous entendons cette phrase.
Les agents riaient de nouveau. Un homme âgé s’avança.
Il portait une ceinture tricolore sous sa redingote. C’était le commissaire du quartier.
Il dit, impatienté :
– Finissons-en ; nous n’avons pas le temps de passer la nuit en conversations…
Deux agents écartèrent Luversan avec violence.
Et comme un de ceux qui étaient là tenait une bougie allumée au-dessus de sa tête, la lumière éclaira Mme de Terrenoire, bouleversée par la terreur. La malheureuse était affaissée, sans force, presque sans connaissance. Elle cachait, d’un geste machinal, son visage dans ses mains.
– Allons ! pas de comédie, s’il vous plaît ! fit un agent.
Elle regarda Luversan, désespérée… mais ne put faire un mouvement… Elle eut un sanglot nerveux, une sorte de cri de colère et de terreur… Luversan sentait que toute prudence allait lui échapper… Il avait pris un des policiers par les bras et d’un vigoureux effort l’avait jeté contre des malles. Il était tombé en jurant.
– Eh bien ce ne sera pas la fille seulement qu’on emmènera, dit le commissaire, vous ligoterez l’homme aussi. Ça lui apprendra à se mêler de ce qui ne le regarde pas.
– Ne me touchez pas, râla Luversan.
Il allait se servir de son poignard… oubliant toute prudence… quand, soudain, Mme de Terrenoire se précipita devant lui, échevelée, blême :
– C’est vous qui êtes le commissaire de police ? dit-elle, en s’adressant au vieillard.
– C’est moi !
– Ordonnez à ces hommes de ne pas me toucher… Je vais vous dire mon nom…
– Que m’importe votre nom… Demain, on vous interrogera…
– Il importe. Vous vous méprenez sur mon compte… Regardez-moi donc de plus près ! Est-ce que j’ai l’air d’une de ces filles que vous cherchez ?…
Le commissaire de police eut un sourire sceptique.
Il y eut, dans l’attitude de Mme de Terrenoire, un désespoir si profond, si près de la folie que le commissaire en fut frappé.
– Monsieur, dit-elle, veuillez m’écouter, je vous en supplie… et avoir pitié de moi… J’ai assez honte de me trouver ici, en pareille situation, sans que vous rendiez mon déshonneur public…
Le magistrat fit un signe à ses agents. Ils s’éloignèrent à contrecœur.
– Parlez, Madame, disait le commissaire.
– Je voudrais bien ne pas vous dire mon nom, murmura la malheureuse affolée. Est-ce possible ?… Vous devez voir, à la façon dont je vous parle, que je ne suis pas une femme pareille à celles que vous êtes venu chercher ?… Cela ne vous suffit-il point ?
Certes, cela pouvait suffire, en effet. Le commissaire de police pouvait passer outre, ne plus s’occuper d’elle et partir ? Cependant, il insista.
– Nous sommes seuls, dit-il ; votre amant et moi, nous pouvons seuls vous entendre… Quel est votre nom ? Qui peut vous réclamer, qui peut répondre de vous ?
Son nom ! Elle allait livrer son nom à cette ignominie ! Il le fallait !… Ou une honte plus grande encore, le dépôt !… Saint-Lazare ! l’attendait. D’une voix étranglée, elle murmura :
– Je suis madame de Terrenoire…
Le commissaire de police fit un geste de surprise.
– Madame de Terrenoire !… dit-il, la femme du banquier du boulevard Haussmann ?
– Oui.
Et Luversan la reçut dans ses bras, à demi morte. Le commissaire de police la regardait, en réfléchissant.
Le crime du boulevard Haussmann avait fait trop de bruit pour qu’il n’en connût pas les détails ; le mystère dont ce crime était entouré, malgré l’arrestation de Jean Guerrier, était trop impénétrable pour n’avoir point excité sa curiosité.
La présence de Mme de Terrenoire dans cet hôtel, avec un amant, lui parut bizarre, inexplicable.
« Cette femme ne ment point, se disait-il, j’en suis sûr. Du reste, je peux également m’en assurer… »
Et, se tournant vers Luversan :
– Monsieur, j’ai également besoin de savoir votre nom…
– Mais, Monsieur, pourquoi, s’il vous plaît, et de quel droit ?
– Je ne veux pas vous donner d’explications… Si vous refusez, j’envoie Madame au dépôt…
Luversan fit un pas vers le commissaire, comme s’il eût voulu l’étrangler… Un regard de sa maîtresse le contint.
– Je porterai plainte contre vous, Monsieur, dit-il, je vous en préviens… Et je saurai si vos fonctions vous permettent…
– À votre aise. Répondez-moi, je vous prie. Votre nom ?
Luversan hésita. Donnerait-il son vrai nom ? Mais il s’était inscrit, sur le registre de l’hôtel, sous celui de Pierre Laugevin, professeur : c’était ce nom qu’il fallait donner… Ce fut celui que le commissaire inscrivit sur son carnet, à côté de celui de Mme de Terrenoire…
Et, en regard du nom de Pierre Laugevin, le magistrat inscrivit, en quelques coups de crayon, le signalement de Luversan.
– Vous demeurez ici ? Vous êtes professeur ?
– Oui, répondit Luversan aux deux questions.
Le commissaire n’avait pas besoin provisoirement d’en apprendre davantage. Il remit son carnet dans sa poche.
– Vous êtes libre, dit-il à Mme de Terrenoire. Vous pourrez partir quand vous voudrez.
Elle respira, puis, sans dire un mot, elle regagna sa chambre, suivie par Luversan.
Le magistrat fit signe à un agent d’approcher :
– Cette femme va regagner son domicile, vous la filerez et vous vous assurerez de son identité… Elle prétend se nommer madame de Terrenoire et être la femme du banquier du boulevard Haussmann… Allez, je vous attendrai à neuf heures, à mon bureau.
À neuf heures du matin, l’agent était au commissariat de police.
– Cette femme ne vous a pas trompé, dit-il.
Sur-le-champ, le commissaire fit un rapport qu’il adressa à la préfecture – à tout hasard – pour informer ses chefs de cette aventure.