
Pierre Maël
LE FORBAN NOIR
(1907)
Illustrations d’après H. Vogel.
Table des matières
À propos de cette édition électronique
I[1]
Sauvetage.
« Alain ! Alain ! Lân ! Lân ! »
Ainsi criaient des voix d’hommes et de femmes à la porte d’une humble maison du bourg de Louannec, à l’angle des routes de Tréguier et de Lannion.
Il était cinq heures du matin, d’un matin de mars lugubre. Le jour, à peine commençant, éclairait un paysage désolé. Une tempête du nord-est ravageait la côte depuis la veille. Le sémaphore de Ploumanac’h l’avait annoncée, et les barques des pêcheurs de mulets et de congres n’étaient pas sorties du port.
Aux appels venus du dehors, une étroite fenêtre s’ouvrit au rez-de-chaussée de la maison. Une rafale faillit rejeter le volet sur le visage d’homme qui s’encadrait dans la baie. Mais celui-ci repoussa le battant de bois et, se penchant sur le rebord de la croisée, demanda :
« Qu’est-ce qu’il y a ? »
Un vieux, la tête encapuchonnée, répondit pour tous :
« Lân, c’est le syndic qui m’envoie. Le Guern, de Saint-Quay, est malade. Il manque un homme à l’équipe, et, comme ça, c’est ton tour de suppléant.
– C’est bien. On y va. »
L’instant d’après, Alain Plonévez, l’interpellé, était sur la route, au milieu du groupe, et gagnait Perros-Guirec, où il allait tenir sa place à bord du canot de sauvetage.
C’était un grand et beau garçon de vingt-cinq ans, ancien Terreneuvat et marin de l’État, qu’un répit entre deux engagements avait ramené chez sa vieille mère, la veuve Anna Plonévez, à Louannec.
« Tout de même, disait-il en riant, ce n’est pas drôle, pour la première nuit que je passe chez la bonne femme, d’être réveillé avant l’heure. Je dormais si bien.
– Que veux-tu, mon gars ? répliquait le matelot d’âge. Nous sommes là pour notre service, pas vrai ? Et on ne peut laisser des chrétiens se noyer, faute d’un homme pour souquer sur l’aviron.
– Et, au moins, sait-on qui c’est que nous allons tirer de l’eau ?
– Dame non, on ne sait pas. Tu penses bien qu’avec cette brume, on ne voit pas loin. Le sémaphore a signalé, il y a une heure, un grand navire en perdition du côté de l’île aux Moines. C’est tout. Mais de la pointe de Trestrignel on distingue ses mâts et sa coque. Il a dû donner sur les récifs en avant de Ploumanac’h.
– Bon ! On verra bien tout à l’heure. »
Ils avaient atteint Perros. Toute la population était en éveil, et, à mesure que la lumière grandissait dans le ciel fuligineux, les gens se pressaient au dehors, courant, les uns vers les promontoires, les autres au Linken, pour assister au départ du canot.
Le moment était mauvais. Il s’en fallait d’une bonne heure que le flot fût au plein. Le port de Perros assèche presque entièrement aux matines, et l’on était précisément au 19 mars, jour de la grande marée d’équinoxe cette année-là. Le jusant n’avait pas laissé deux pieds d’eau dans le chenal du port. Aussi le patron du canot jurait et sacrait-il comme une demi-douzaine de païens, en dépit des adjurations amicales du recteur, accouru pour soutenir de ses paroles les généreux efforts de ces simples héroïques.
Cependant le canot était hors de son abri. Le chariot attelé faisait grincer ses roues sur le sable, sous le piétinement des chevaux.
En un clin d’œil, l’équipe fut armée, les avirons bordés, la barre aux mains du patron.
Le chariot s’ébranla, descendit sur le rivage, vira pour permettre le lancement. On fit culer les bêtes récalcitrantes jusqu’à ce qu’elles eussent de l’eau au niveau du poitrail. Alors les crics jouèrent, les câbles se déroulèrent en sifflant, et le « life-boat », le « bateau de vie », comme le nomment poétiquement les Anglais, glissa et entra, telle une flèche, dans le clapotis du chenal.
D’un seul fouet, les douze avirons tendus horizontalement s’abaissèrent, frappant l’eau de leurs palettes rythmées. Et le canot bondit dans le chemin liquide élargi, portant vers les vagues énormes et les hurlements féroces de la tempête déchaînée au delà du cap rugueux de Trestrignel.
Superbes en leur force stoïque, le torse alternativement droit et penché, selon que les rames se levaient ou se plongeaient, la jambe gauche fixée au banc par la courroie, les treize sauveteurs, muets, impassibles, entrèrent dans la chaudière en ébullition.
Rude combat, terrible lutte, qui ne permet aucune défaillance au courage ni à la clairvoyance. Car, ce matin-là, on avait tout contre soi : le froid de cette matinée d’hiver finissant, la rage du vent de nord-est descendu sur la Manche et poussant les flots de la mer montante à la côte. Et il ne fallait rien moins que le bras herculéen et l’imperturbable sang-froid du patron Guénic pour empêcher la violence du flux de jeter sur les roches basses cette carène insubmersible, à ventre enflé d’air, à quille de fonte, à profil massif et lourd.
Quand la pointe de Trestrignel eut été dépassée, le canot se vit aux prises avec la plus grande furie de la mer. Alors, aussi, il découvrit le navire au secours duquel il se portait.
C’était un trois-mâts de moyennes dimensions, fin voilier taillé pour les longs cours transatlantiques. À sa corne battait le pavillon de son origine, les trois bandes bleu et blanc de la République Argentine.
Depuis qu’il avait été signalé par le sémaphore, il avait gagné quelque avance et se trouvait présentement à un mille environ de la passe qui s’ouvre entre Trestrignel et l’île Tomé.
On le voyait monter et descendre sur les lames, se débattant en une cruelle agonie, essayant de s’arracher aux étreintes de l’Océan, secoué, tordu, ballotté dans tous les sens, pareil à quelque bête blessée à mort. De ses trois mâts, un seul restait entier, le misaine. L’artimon avait été brisé au ras du pont et à moitié balayé. Retenu par les agrès et les haubans, le grand mât pendait en trois morceaux que les coups de mer et les rafales agitaient comme des fétus ou laissaient retomber, à l’instar de marteaux destructeurs, sur le bordé qu’ils écrasaient et défonçaient sous chaque choc. Le bout-dehors de beaupré traînait à l’avant avec des lambeaux de focs, qui donnaient à ce lamentable débris l’aspect d’un bandage de charpie arraché à quelque plaie mal pansée.
Telle quelle, l’épave s’avançait par soubresauts effrayants. Tout à l’heure, quand elle serait tombée dans le lit du courant de la passe, elle serait roulée jusqu’au bord, éventrée, déchiquetée, éparpillée par les féroces morsures des écueils à l’affût sous l’eau glauque.
Cependant le canot de sauvetage se rapprochait. Comment aborderait-il le navire : par la hanche ou la joue, par tribord ou bâbord ? Problème délicat, et que, seuls, des marins pouvaient résoudre. Car il ne fallait pas s’exposer à recevoir la masse flottante dans sa chute, et, à voir les oscillations qui la jetaient tantôt à droite, tantôt à gauche, on ne pouvait deviner sur lequel de ses flancs elle se coucherait pour sombrer.
Le patron Guénic mesura du regard la distance qui le séparait de l’épave et, par une manœuvre habile, vira dans le vent même du trois-mâts, de façon à se maintenir en ligne perpendiculaire à la coque. Les avirons se mirent à refouler en sens inverse, et la forte voix du pilote interpella l’équipage du bateau en perdition.
Aucune voix ne répondit à son appel, aucune forme humaine ne se dessina dans les ruines de la mâture écroulée, dans l’échevellement des vergues et des cordages.
« Malloz ! gronda le vieux brave. Nous arrivons trop tard. Il n’y a plus personne de vivant là-dessus. »
La manœuvre qu’il venait d’exécuter à tribord, il la renouvela à bâbord. Le canot tourna le trois-mâts par l’arrière et vint se placer, toujours perpendiculaire, entre le large et la carène.
Derechef, Guénic interpella l’équipage absent.
Cette fois, un cri aigu répondit.
« Santa Madre de Dios ! » clama une voix déchirante, une voix d’enfant au timbre clair.
Et du canot on put apercevoir deux créatures accrochées aux porte-manteaux d’une baleinière disparue : un homme et un petit garçon.
Le navire donnait furieusement de la bande.
À chaque retraite des lames, il se penchait plus bas, sur le flanc, et les deux malheureux, suspendus à leur dernier refuge, étaient immergés jusqu’aux aisselles. La mort jouait avec eux comme le chat avec la souris.
« Nous ne pouvons pourtant pas les laisser là sans secours ! » s’exclama Alain Plonévez.
Entre deux rugissements de la rafale, on entendit une sorte d’imprécation jaillir de la gorge du patron, en même temps qu’un ordre. Le canot vira une fois de plus et vint se ranger au flanc du navire. Trois des hommes se dressèrent et, armés de gaffes, évitèrent le choc. Quatre autres attendirent la poussée de la vague, et, debout, cueillirent les naufragés sur leur effrayants perchoirs.
Tout aussitôt, on les coucha entre les bancs, où ils s’affalèrent inertes, les yeux fixes, les dents crochetées.
« Faudrait voir sur le pont s’il y a encore de la marchandise ! commanda la voix de Guénic.

– On y va », répondit encore Alain.
Et, comme le canot remontait à la lame, le robuste gars se cramponna à une drisse pendante et se hissa par-dessus les bastingages.
Il n’eut pas loin à courir pour se rendre compte de l’état du trois-mâts.
Le pont était vide, vide de vivants, du moins. À dix pas de lui, sous les ruines du gaillard d’arrière, deux cadavres gisaient, broyés par la chute du grand mât. Un troisième, la tête en bas, le crâne emporté, se balançait dans un réseau de câbles traînants. Un peu plus loin, une autre victime, passager ou matelot, râlait dans un éboulis de vergues et de haubans.
Celui-ci respirait encore. Lân le souleva, le chargea sur son épaule de titan, le remit aux bras de deux camarades. Puis, se laissant tomber, il regagna sa place et ressaisit l’aviron.
Le canot n’avait plus rien à faire. Le navire n’était plus qu’un cercueil mouvant. Le patron poussa un soupir et, renversant la barre, s’éloigna de l’épave par un véritable bond de vingt brasses.
Il n’était que temps.
Comme si la mer n’eût attendu que la fin de cet héroïque sauvetage, elle se ramassa sur elle-même, s’enfla en une vague monstrueuse, dont la volute démesurée vint se crever à la pomme du misaine encore debout, et s’écrouler sur le pont du trois-mâts.
Il y eut un gémissement sourd de toute la membrure, suivi d’un cliquetis de choses rompues et fracassées. Par les sabords, par les écoutilles l’eau entra dans les flancs du grand bateau, l’emplissant, le surchargeant sans résistance. Et l’arrière s’enfonça, tandis qu’avec un bruit de souffle épuisé, un fouettement de l’air, toute l’étrave se levait hors de l’eau, à la façon d’un cheval qui se cabre. Puis, la masse entière écrasée disparut sous les cataractes des lames, avec de suprêmes convulsions, des révoltes contre la mort, des insurrections des mâts, semblables aux derniers mouvements d’une main de noyé s’accrochant au vide avant de couler.
Pendant que s’achevaient ces convulsions du navire, le canot de sauvetage regagnait le port.
Toute une heure s’était écoulée. Maintenant la mer était pleine et les rameurs n’avaient plus à lutter contre le courant. Le retour fut rapide. Aux acclamations de la foule, entassée sur le môle et sur l’épi, le life-boat doubla derechef la pointe de Trestrignel, vola sur les lames moins hautes, sortit de l’enfer liquide et gagna son point d’atterrissage sur l’étroite presqu’île du Linken.
Les premiers qui débarquèrent, ou plutôt qu’on débarqua, ce furent les naufragés. Le blessé fut emporté d’urgence et déposé sous l’abri du canot. Le recteur n’eut que le temps de prononcer les paroles de l’absolution in articulo mortis. Au moment où la suprême formule de pardon tomba des lèvres du prêtre, le mourant rendit l’âme.
Les deux autres semblaient ne point valoir beaucoup plus.
On les tira du milieu des bancs, évanouis, les prunelles vitreuses, le souffle court et haletant. On transporta l’homme jusqu’à un hôtel du voisinage. Les femmes de pêcheurs s’empressèrent, avec des exclamations, autour de l’enfant dont elles admirèrent la beauté frêle et délicate, rendue plus impressionnante par la pâleur du charmant visage.
C’était un garçonnet de dix à onze ans, aux traits purs, à la peau mate et blanche, ainsi qu’on la rencontre habituellement dans le type espagnol. Et, comme une certaine confusion régnait dans ce multiple désir de charité, contrarié par le dénuement presque absolu de ces populations pauvres, comme toutes ces mères de familles nombreuses ne pouvaient s’offrir pour bien longtemps à héberger la petite victime, ce fut encore le bon Alain qui trancha le débat.
« Pour lors, madame Hélic, dit-il à la propre femme du syndic, voulez-vous prendre ce petiot chez vous jusqu’à ce que ma vieille vienne vous le chercher ? C’est moi qui l’ai pêché là-bas ; j’entends le garder, et je suis bien sûr que la maman m’en voudrait de ne pas lui donner ce fieu à nourrir. »
La vieille femme interpellée répondit :
« C’est bien parlé, Lân Plonévez. Et moi aussi je le garderais bien ce joli-là, au moins pour un temps. Mais si la bonne femme Plonévez le réclame, faudra bien que je lui cède. C’est son droit et le tien, mon gars. »
L’accord ainsi fait, on ne s’occupa plus qu’à donner des soins aux survivants de la catastrophe.
Le jeune médecin du bourg les avait soigneusement auscultés et palpés. Rien de cassé dans les os, rien de lésé gravement dans les organes ; seulement, chez l’enfant, les râles crépitants, dénonciateurs d’une forte bronchite.
En conséquence, il ordonna qu’on les couchât dans des lits bien chauds, qu’on les tînt provisoirement à la diète. En même temps, il prescrivit, pour l’enfant, une potion et des boissons stimulatrices. Quant à l’homme, robuste gaillard, dont la face glabre et dure ne parlait guère en sa faveur, le praticien déclara, en riant, qu’il serait sur pied au bout de vingt-quatre heures.
Toutes les sympathies purent donc confluer sur le petit garçon, et ce fut à qui épierait son retour à la connaissance, pour lui offrir les pauvres gâteries dont on disposait sous ces toits que la fortune n’a jamais visités.
L’évanouissement dura un peu plus d’une heure. Puis l’enfant ouvrit les yeux, et ce fut un spectacle touchant que celui des pleurs de commisération dont fut accueilli ce premier regard vague et plein d’hébétude, au fond duquel la pensée ne luisait qu’à l’état de flamme vacillante.
Le petit garçon parla, mais nul ne comprit ses paroles. La langue dont il se servait n’était certes pas celle des braves gens assemblés autour de sa couche. Aucune de ces femmes, baragouinant le dialecte du Trécorois, n’avait le moindre soupçon du langage des hidalgos et des conquistadores. À peine leur arrivait-il d’échanger entre elles une centaine de mots français plus ou moins estropiés.
L’une d’elles, toutefois, ayant proféré une exclamation française, les yeux du garçonnet s’illuminèrent. Un sourire glissa sur ses lèvres, en même temps qu’une phrase en jaillissait, d’une accentuation caractéristique :
« Francès ? Yo aussi parler francès. »
Alors Mme Hélic, la femme de l’équoreur, s’approcha du lit et, tant bien que mal, se mit en devoir d’interroger le petit malade. En ce jargon où se mêlaient trois idiomes, la vérité se fit jour. Les renseignements abondèrent, l’enfant ne demandant qu’à bavarder.
On apprit, de la sorte, que le navire perdu se nommait la Coronacion et venait du petit port de Sant Antonio, dans la baie de San Matias, sur la côte Argentine, au-dessous de Buenos-Ayres ; qu’il avait déchargé un fret considérable de cuirs en Angleterre et comptait prendre livraison de produits hollandais à Amsterdam ; que le capitaine était mort subitement deux heures après avoir quitté la Grande-Bretagne ; que le second du bord, qui faisait ce voyage pour la première fois, avait littéralement perdu la tête et s’était laissé entraîner dans les parages des Sept Îles, où la tempête avait surpris le navire.
On sut, en outre, que le petit Pablo, c’était son nom, âgé d’un peu plus de onze ans, était mousse à bord de la Coronacion ; qu’il ne se connaissait ni père, ni mère, mais se dénommait lui-même « le fils de la mer », hijo del mar ; que le matelot sauvé avec lui s’appelait Ricardo.
Ce long babillage avait fatigué l’enfant. La survenance, fort opportune, du docteur Bénédict y mit un terme. Celui-ci gourmanda les commères trop curieuses qui avaient fait jaser le petit malade, sans souci de la bronchite qui avait gagné les capillarités du poumon et pouvait dégénérer en fluxion de poitrine. Et, comme sa visite coïncidait avec le retour d’Alain Plonévez amenant sa mère, femme de cinquante-huit ans, fort ingambe, il recommanda que l’on transportât Pablo sans plus tarder dans la maison de la veuve, où il serait à l’abri des importunes sympathies de l’entourage.
Alain avait déjà retenu une voiture fermée. On y coucha l’enfant, enveloppé de couvertures, sur une banquette, et l’attelage prit au grand trot le chemin de Louannec, où, une demi-heure plus tard, Pablo fut définitivement couché dans un lit de bois blanc, en une chambre claire et aérée.
En l’y installant, la maman Plonévez ne put se dispenser de lui parler affectueusement :
« Voyez-vous, mon mignon, c’est ici la chambre et le lit d’un autre fils, un frère de Lân, que j’ai perdu, il y a longtemps. Ce serait un homme aujourd’hui. En souvenir de lui, et pour la paix de son âme, je vous soignerai comme si le bon Dieu m’avait donné un autre fils. »
Elle parlait bien, la vieille Bretonne, en mère pieuse, avec cette grave mansuétude d’accent qui dénote les nobles résignations et la tranquillité des belles âmes.
L’enfant l’écouta avec une déférence empreinte de quelque surprise. On eût dit qu’il n’avait jamais entendu pareil langage, ou, plutôt, que, tout au fond de sa mémoire, s’agitait quelque obscure réminiscence de paroles semblables prononcées par une autre bouche de femme, de sa propre mère peut-être.
La demeure n’était pas luxueuse, il s’en fallait. Le plafond bas, les murs blanchis à la chaux, le plancher mal raboté eussent offusqué tout autre qu’un modeste habitant de ce pittoresque coin de terre. Mais tout cela était si propre, si bien tenu, les rideaux de cretonne qui pendaient au-dessus du lit, les draps de fil et la taie d’oreiller exhalaient une si bonne odeur de linge fraîchement repassé, que le petit garçon en eut le cœur réjoui. Aussi bien le « fils de la mer » ne devait-il pas être gâté par l’habitude d’un confortable excessif.
Il fit bien voir sa satisfaction lorsque, pour la troisième fois, le docteur Bénédict le visita, le lendemain matin. Pablo avait passé une bonne nuit ; il n’avait point de fièvre, ou si peu, et l’appétit aiguisé par les secousses physiques et morales autant que par un jeûne de quarante-huit heures, s’était converti en une fringale indomptable.
Le praticien estima que la maladie n’était point assez grave pour interdire toute alimentation. Après avoir posé des ventouses sur le thorax, il permit que l’on donnât au malade un fort bon potage de légumes, que celui-ci absorba avec une allégresse démonstrative.
« Parbleu ! mon gars, s’exclama en riant M. Bénédict, c’est une bonne disposition pour guérir vite que de garder son estomac en verve. Allons ! Ce n’est pas encore pour toi que la mère Plonévez se ruinera en médicaments. »
Et il s’en alla en se frottant les mains.
Ce même jour, le grand Alain, simple lui-même comme un enfant, vint s’installer quelques heures au chevet du mousse espagnol et s’entretenir avec lui. Nouvelle joie pour le garçonnet, à qui le temps ne parut pas long, et qui accabla de questions affectueuses le jeune marin, son sauveteur. Lân y répondit avec toute la complaisance désirable. Il se fit connaître à l’enfant, tout en l’interrogeant lui-même sur ses propres origines, sur le mystère de son passé, car tous, dans l’entourage du petit malade, ne pouvaient se défendre d’un profond étonnement à voir cet enfant, si délicat, si distingué de visage et de manières, mêlé à un équipage de matelots du commerce recrutés dans tous les milieux et appartenant aux nationalités les plus diverses. Et plusieurs hochaient la tête, disant avec un scepticisme de facile explication :
« Pour sûr, ça doit être quelque petit trouvé, qu’on aura pris par pitié ou embarqué de force. »
Le quatrième jour après le naufrage, alors que toute crainte de pneumonie était écartée, le docteur Bénédict permit d’alimenter le malade « à sa faim », et, certes, celui-ci se montra d’un appétit vorace, faisant honneur au menu très rudimentaire de la mamm Plonévez.
Or, ce même jour, un homme vint frapper à la porte de la veuve et demanda à parler à l’enfant. La vieille femme l’introduisit sur-le-champ.
Le visiteur n’était autre que le second des naufragés, le matelot Ricardo. Comme le petit Pablo, il comprenait le français et se débrouillait, au hasard des termes employés, dans un dialogue d’une syntaxe et d’une prononciation ultra-fantaisistes.
Alain Plonévez était à la maison pour le déjeuner. Il assista donc à l’entrevue des deux survivants de la Coronacion.
Elle ne fut pas « chaude », cette entrevue, bien au contraire. Il parut même, aux yeux attentifs du jeune Breton, que Pablo accueillait son « camarade » avec une sorte d’effroi, que justifiaient, d’ailleurs, la face bestiale, l’œil torve et le mauvais rictus toujours grimaçant sur la bouche épaisse de l’Argentin.
Celui-ci se retira, après une demi-heure de conversation, jetant à l’enfant quelques paroles gutturales accompagnées d’un regard en dessous à Lân, dont la grande taille et les proportions athlétiques semblaient l’impressionner grandement.
Quand il eut quitté la demeure, le fils de la veuve Plonévez demanda, en riant, à son hôte :
« Parbleu, petit, tu n’as pas l’air de l’aimer beaucoup, ton pays ?
– Oh ! non, Io ne l’amo pas, répondit l’enfant, avec un froncement expressif des sourcils.
– Ah ! ah ! Le fait est qu’il n’a pas l’air très aimable, le particulier. Je ne suis pas méchant, mais je crois que j’aurais du plaisir à cogner sur ce mufle-là, bien que j’aie contribué à le tirer du mauvais pas.
– Il est très méchant, confirma Pablo. À bord, il me battait toujours, et, bien sûr, il m’aurait jeté à la mer, si…
– Si ? interrogea Alain.
– Si mon ami Ervan ne l’en avait empêché. Celui-là est bon, et fort. Il vous ressemble.
– Comment dis-tu qu’il s’appelle, celui-là ?
– Ervan. Il parle bien français, il n’est pas Espagnol. Mais, voilà. Il n’est pas venu, cette fois, il est resté en Angleterre. C’est extraordinaire comme vous lui ressemblez ! On dirait que c’est votre frère. »
La mère Plonévez entrait, apportant le déjeuner du malade. Alain en profita pour interrompre là le dialogue. Ce mot « frère », prononcé par l’enfant, avait, sans doute, réveillé en lui quelque pénible souvenir, car son front s’était plissé d’une ride.
Quand la veuve fut ressortie de la chambre pour aller surveiller sa cuisine, le jeune Breton se hâta de dire à Pablo :
« Écoute, petit. Ne parle jamais de personne qui pourrait me ressembler devant ma mamm, parce que, vois-tu, ça lui ferait beaucoup de peine. J’ai eu, en effet, un frère, qui est mort, et qu’elle pleure et pour qui elle prie tous les jours.
– C’est bien, señor Alain, répondit l’enfant, devenu grave. Je n’en parlerai jamais. »
Le marin sortit, le front toujours soucieux, et se dirigea vers Perros, où il avait du nouveau à apprendre.
En effet, il s’y était passé ceci que, le matin même, on avait vu arriver une baleinière des Ponts et Chaussées, détachée d’un vapeur faisant l’inspection des côtes. Celui-ci venait de Paimpol afin d’opérer des sondages dans le dessein de renflouer, s’il était possible, ou, du moins, de détruire à la dynamite l’épave du navire perdu, qui pouvait obstruer la passe entre Trestrignel et l’île Tomé.
Or, l’ingénieur et ses aides n’avaient pas eu à se donner beaucoup de mal. La mer avait travaillé pour eux, sans eux.
La carcasse désemparée, poussée par le flot, avait été roulée et, finalement, abandonnée par les vagues, sur les hauts-fonds qui bordent la plage de Trestraou, en deçà des roches granitiques qui supportent le phare de Ploumanac’h.
Et, maintenant, les employés de l’État fouillaient le ventre du trois-mâts d’où ils retiraient méthodiquement tout ce qui pouvait servir à établir l’identité du navire et de son équipage, tant des vivants que des morts : livre de bord, connaissements, chartes-parties, toutes pièces établissant que le navire Coronacion, venant du port de Sant Antonio, dans la République Argentine, après avoir déchargé sa cargaison de cuirs dans le havre de Dunby, au voisinage de Falmouth, avait repris sa route vers Amsterdam.
Tout ceci confirmait les déclarations du petit Pablo et du matelot Ricardo Lopez, qui attendait, à Perros, l’ordre de l’administration maritime pour se faire rapatrier ou, tout au moins, ramener en ce port de Dunby, dernier relâche de la Coronacion.
Mais, en dépit de ces assertions écrites, un doute planait encore. Au cours de leurs recherches, les divers fonctionnaires de la marine n’avaient découvert aucun document établissant la propriété du navire. Ils en conclurent que, sans doute, ce titre de propriété s’était perdu pendant le naufrage, ou bien qu’il n’était point d’usage, à Sant Antonio, de faire figurer un tel document au nombre des pièces indispensables à la franchise des bateaux de commerce.
Ils interrogèrent Ricardo Lopez, mais n’en purent tirer aucun renseignement utile. L’Espagnol parut ne rien comprendre aux questions qu’on lui posait à ce sujet. Il se borna à déclarer qu’il avait été enrôlé lui-même à Buenos-Ayres par le second Rodriguez, ce blessé vainement arraché à l’épave par la courageuse intervention d’Alain Plonévez, et qui était venu expirer dans le hangar-abri du canot de sauvetage. Comme, depuis huit jours, cette pauvre dépouille reposait en une fosse du cimetière de Perros-Guirec, on ne crut pas devoir l’exhumer pour en constater l’identité. Mais le registre des décès porta la mention du nom du capitaine Rodriguez-Wickham, décédé et inhumé sur le territoire de la commune.
On n’attacha pas plus d’importance à la réclamation de Ricardo, demandant que le mousse Pablo fût rapatrié avec lui. L’enfant, à la première offre qui lui en fut faite, la repoussa avec une énergie farouche et manifesta une sorte de terreur à la pensée de retourner avec le matelot, son compagnon. Et, comme celui-ci ne pouvait justifier d’aucun titre à l’exercice d’un droit quelconque sur l’enfant, comme, d’autre part, la veuve Plonévez et son fils se déclaraient tout disposés à adopter le petit abandonné, force fut à Ricardo de quitter la France en y laissant Pablo.

II
Le fils de la mer
En apprenant que Ricardo Lopez avait quitté le pays et qu’il n’aurait point à le suivre, Pablo manifesta une joie si vive qu’elle sembla tenir du délire.
Cette explosion d’allégresse commença par faire beaucoup rire Alain Plonévez. Puis elle le fit réfléchir et, pendant quelques jours, le jeune matelot parut un peu préoccupé. Il ne lui semblait pas normal que le petit Argentin exprimât tant de bonheur à se séparer d’un homme dont il avait partagé la vie et les dangers, et qui, deux semaines plus tôt, n’avait dû, comme lui-même, d’ailleurs, son salut qu’au secours providentiel apporté par le canot de sauvetage.
Mais Lân se souvint fort opportunément des confidences à lui faites par le mousse. Celui-ci ne lui avait point dissimulé son aversion invincible à l’encontre de Ricardo. Et Alain se disait qu’un ressentiment aussi violent s’expliquait, le plus simplement du monde, par le vindicatif souvenir que l’enfant avait gardé des mauvais traitements infligés à sa frêle jeunesse.
Alain se promit donc d’interroger Pablo plus à loisir et d’en tirer quelques éclaircissements, tant sur son propre passé que sur celui de cet Espagnol, que lui-même, Lân, haïssait d’instinct.
L’occasion lui en fut offerte quelques jours plus tard, lorsque avril, en gonflant les bourgeons, et en verdissant les premières pousses des arbres, eut suffisamment attiédi l’atmosphère pour permettre au garçonnet, définitivement rétabli, de faire, avec son grand ami, quelques courses dans la campagne et sur la côte.
Aussi bien le congé d’Alain touchait à sa fin. Il ne lui restait plus qu’une dizaine de jours avant qu’il se rendît à Paimpol, où il allait s’embarquer pour un voyage dans les régions des Antilles.
Et il expliquait à l’enfant que, ce voyage, il allait le faire avec le grade de second à bord du vapeur le Kerret-Barbe-Noire, afin de s’y instruire, pendant six ou huit mois, à la pratique de la machinerie.
Au retour, c’est-à-dire en décembre, au plus tard, il se rendrait à Nantes pour y suivre l’enseignement spécial qui forme les capitaines au long cours. Comme il avait été second maître sur le Formidable et qu’il possédait les qualités physiques et la connaissance des manœuvres, en outre du stage exigé pour le service à la mer, il estimait qu’il pourrait conquérir le diplôme de long courrier en un délai maximum de dix-huit mois.
« Alors, dans deux ans, vous commanderez un bateau, tout seul ? Vous serez capitaine ?
– Oui, mon petit ; du moins je l’espère.
– Oh ! alors, vous me prendrez avec vous, dites ? »
Et les yeux de Pablo étincelaient, une flamme colorait la mate blancheur de son visage. Il se pendait à l’épaule herculéenne de son sauveteur, et celui-ci lisait, en ces prunelles limpides, la sincère affection qu’il avait su inspirer à cet enfant étranger.
« Sais-tu, disait gaiement Alain, que tu commences à parler joliment le français, mieux que la mamm, mieux surtout que la mammagoz, chez qui je t’ai mené il y a deux jours, à Trébeurden.
– C’est que, le français, Lân, je l’ai parlé autrefois, il y a bien longtemps, quand j’étais tout petit.
– Par exemple ! Et où donc parlais-tu le français, toi, espèce de petit Gaucho ? »
Les sourcils de l’enfant se froncèrent, en même temps que ses poings se serraient.
« Ne m’appelez pas comme ça, Lân. Autrement, je ne vous aimerais plus. Ricardo est un Gaucho, pas moi.
– Ça va bien : Je ne le dirai plus. Je ne savais pas que ce mot fût une injure à ton oreille. Mais revenons à ce que tu me racontais. Tu as parlé français autrefois ?
– Oui, répliqua Pablo, j’en suis sûr.
– Tu en es sûr ? Mais, en ce cas, tu dois te rappeler en quel pays tu as vécu, quel est le lieu de ton origine ? »
Le matelot vit de nouveau les sourcils du mousse se rapprocher, non plus sous l’action de la colère, cette fois, mais sous celle d’une contention ardue, d’un violent effort de la mémoire pour relier entre elles de lointaines réminiscences.
« Je ne sais pas, répondit-il enfin, je ne peux pas me rappeler. C’est bien loin. Il me semble que c’était dans un pays comme celui-ci, au bord de la mer. Il y avait une belle dame qui m’aimait bien, que j’aimais bien, que j’appelais mama, comme vous appelez votre mère. »
Et les paupières du mousse se gonflaient de larmes. Il était visible qu’une fugitive et chère image se laissait voir dans cette nuit du passé, mais qu’il ne parvenait pas à en fixer exactement les traits.
Alain vint à son aide, essaya de suppléer au défaut de précision, de combler les lacunes de cette évocation incomplète.
« Voyons, petit Pablo, tâche de réunir tes idées. Il est probable que, comme tu le dis, cette belle dame était ta mère. Si tu la revoyais, la reconnaîtrais-tu ?
– Oh ! oui », s’écria impétueusement l’enfant.
Mais, tout aussitôt, son regard s’attrista. Le même doute cruel y fit remonter les larmes.
« Je crois que oui, bégaya-t-il ; je ne suis pas sûr ; je ne sais pas, non, je ne sais pas.
– Et, reprit le matelot, elle n’était pas seule, cette dame ; elle ne pouvait pas être seule. Il y avait un homme avec elle ; il y avait ton père !
– Mon père ? C’est vrai. Il y avait mon père. Mais je ne me rappelle pas, pas du tout. Est-ce que vous avez un père, vous, Alain ?
– Je ne l’ai plus, petit Pablo, mais j’en ai eu un, que j’aimais bien. C’était un rude marin, qui avait beaucoup navigué, il est revenu ici, à Louannec ; il était malade ; il a traîné quelque temps, puis il est mort, et nous l’avons couché dans sa tombe, sous une pierre, derrière l’église neuve, là-haut. »

Il désignait, par delà un rideau de pins, le clocher carré se détachant sur le ciel bleu.
Les larmes pendaient encore aux cils de Pablo, mais ses pupilles étincelaient. Il demanda naïvement.
« Alors, tous les hommes ont un père et une mère ?
– Cette question ! fit Lân, en éclatant de rire. Ah ! çà, d’où sors-tu, petiot ? D’où crois-tu donc que tu viens ?
– Je viens de la mer, riposta l’enfant, non sans une certaine fierté. Je me souviens qu’un jour, j’ai demandé la même chose à Ervan, mon ami Ervan. Il a ri comme vous, Alain. Puis, il n’a plus ri. Il m’a regardé sérieusement, gravement, comme s’il allait me dire quelque chose. Mais, après ça, il m’a embrassé, et il m’a raconté une drôle d’histoire.
– Quelle histoire, pour voir ?
– Voilà ce qu’il m’a dit : « Petit Pablo, un matin, comme nous passions la Ligne, nous avons vu sur la mer un berceau qui flottait. Nous l’avons tiré à bord. Dans le berceau, il y avait un enfant : c’était toi. »
– Mais, s’exclama derechef Alain, c’est l’histoire du petit Moïse qu’il t’a contée là, ton ami Ervan ! Il s’est moqué de toi.
– Ce n’est pas bien ce que vous dites là, Ervan ne s’est pas moqué de moi, Ervan ne se moque de personne. Il vous ressemble, il est bon. S’il m’a raconté cette histoire, c’est qu’elle est vraie, et c’est pour ça qu’on m’a appelé le « fils de la mer ».
– Allons, petit, je ne veux pas te faire de la peine. Mais si tu as lu quelquefois des livres, si l’on t’a appris ta religion, tu dois bien savoir que ce conte que t’a fait ton ami Ervan est le récit d’un livre que les chrétiens respectent et qui se nomme la Bible. »
Pablo baissa tristement les yeux.
« Je n’ai jamais ouvert un livre, Lân, sinon pour regarder les images. Je ne connais pas celui dont vous me parlez. Je ne sais pas lire. »
Il était tout honteux de son aveu.
Le marin le réconforta et lui fit entendre de bonnes et simples paroles qui émurent le mousse.
« Je veux apprendre à lire, Alain. Je pense que je pourrai apprendre, en m’appliquant de tout mon cœur. »
Et il fit comme il le disait. Elle fut féconde, cette conversation entre le jeune homme et l’enfant. En rentrant au logis, Alain prit sa mère à part et lui conseilla de mettre le petit garçon à l’école.
La chose était d’autant plus facile que la maison était toute proche de l’école primaire. La vieille femme alla, dès le lendemain, rendre visite à l’instituteur. Il fut décidé que Pablo entrerait le jour suivant.
Tout de suite, il eut un surnom : « l’Espagnol ». Et il ne fut plus connu que sous ce vocable.
Les premiers temps, il éprouva bien quelque humiliation à se voir assimilé aux commençants, aux tout petits qui épelaient leurs lettres. Mais l’émulation aidant, Pablo justifia promptement le renom de vive intelligence des enfants de sa race. Le mois n’était pas achevé qu’il savait lire et traçait déjà quelques mots. L’instituteur était ravi d’avoir fait une telle recrue. À la rentrée de Pâques, Pablo, sautant toute une classe, se trouvait dans les rangs des écoliers de dix à onze ans.
Cependant Alain était parti, et la veuve Plonévez avait reçu de lui une première missive, datée des Canaries. Le jeune homme s’y montrait gai et satisfait des conditions du voyage.
C’était un garçon sérieux et studieux, un bon fils que soutenaient l’espoir de consoler sa mère et l’ambition de conquérir ce brevet de capitaine au long cours, qui le rendrait maître de ses propres destinées. Sa lettre se ressentait de ce double désir.
Elle se terminait par un affectueux souvenir.
« Embrasse Pablo pour moi, dis-lui que je pense beaucoup à lui. Puisque Dieu t’a donné un nouveau fils, qu’il apprenne à t’aimer comme je t’aime. Qu’il travaille de tout son zèle pour acquérir le plus de savoir qu’il pourra. Il m’a demandé de le prendre avec moi lorsque je serai capitaine. Je le lui ai promis, mais c’est à lui de comprendre que je n’entends pas le considérer comme un simple matelot. »
Il va sans dire que la mamm Plonévez ne pouvait lire couramment les épîtres de son fils aîné, bien que l’écriture en fût large, régulière et bien modelée. Autrefois, elle se rendait chez l’instituteur ou le recteur pour qu’ils lui en fissent la lecture. Maintenant, elle n’avait plus à recourir à leurs bons offices. C’était Pablo qui lui rendait ce service, et il put s’en acquitter sans trop de peine à la réception de ce premier courrier.
Et, de la même façon, ce fut lui qui tint la plume pour la réponse. Il servit de secrétaire à la bonne femme et emplit, tant bien que mal, les quatre pages de ce papier quadrillé sur lesquelles il transcrivit les témoignages un peu incohérents de tendresse maternelle prodigués par la veuve au cher voyageur. Lui-même y ajouta, pour son propre compte, quelques compliments d’amour fraternel :
« Vous voyé, mon chair Alin, que je fet du progré depui que vous ète parti. M. l’Ainstitutor é contan de moi. Il di que dans un an je sorai ossi bien que ceu de la grande classe. Et come je seré heureu de vous montré mé page quand vous reviendré. Je ne dis plus « Io » come je disait otrefoi. Mais, par egzample, cé l’ortografe qui e bien dificil. En espagnol, je croi, lé mot secrive comme il se prononce. Pourcoi ce né pas la meme chose en francès. »
Il était évident que, sous ce rapport, Pablo avait encore beaucoup de « progrès » à faire, quoi que lui dît l’instituteur, pour l’encourager, et il exprimait sa bonne volonté, aussi bien que son ignorance, en une forme qui ne laissait aucun doute sur l’une ni sur l’autre.
Au cours de cette besogne épistolière, car la mère Plonévez, plus prolixe que son « gars », multipliait les manifestations de sa sollicitude, Pablo entra plus avant dans la confiance de la vieille femme et parvint à posséder la plus grande part du secret qui arrachait toujours des larmes à ses pauvres paupières.
Il était cruel, ce secret, de ceux qui font saigner à perpétuité les cœurs des mères pieuses.
Anna Plonévez était restée veuve à trente-cinq ans, avec deux fils qu’elle chérissait d’une égale tendresse. Le peu de bien qu’elle avait, elle l’avait consacré à leur éducation.
En ce temps-là, outre la petite maison de Louannec, qui lui venait de son mari, elle possédait à Trégastel une autre demeure entourée d’un jardin. L’idée lui était venue de l’embellir et de la meubler pour la louer aux baigneurs, encore rares, qui venaient, tous les ans, passer les mois de juillet et d’août en ce coin merveilleusement pittoresque du pays de Trécor.
Heureuse inspiration.
La maisonnette était si propre, si bien tenue, les lits si soigneusement nettoyés et désinfectés après chaque séjour, que Mme Plonévez trouvait acquéreur tout de suite, et cela lui assurait six cents francs en supplément de sa pauvre petite rente d’autant.
En outre, très vaillante, très entendue au ménage, elle se louait elle-même comme cuisinière aux gens de médiocre fortune qui, cela va sans dire, n’amenaient point avec eux leur personnel de domestiques parisiens.
Et cela lui apportait encore une centaine de francs.
Elle avait pu, de la sorte, élever ses deux fils.
L’aîné, Ervoan, avait manifesté le désir d’entrer dans l’enseignement, ou bien encore de s’attacher à l’administration comme employé de la douane, de l’enregistrement, des contributions directes, voire, s’il en trouvait l’occasion, de devenir maître clerc en quelque bonne étude du voisinage.
Alain, le cadet, avait suivi la tradition paternelle. L’irrésistible appel de la mer s’était fait entendre, et il avait écouté la vocation.
À quinze ans, après d’assez médiocres études à l’école de Louannec, il s’était fait embaucher à Paimpol sur des bateaux d’Islande ou de Terre-Neuve, et avait « bourlingué » jusqu’au moment où la conscription l’avait pris en sa qualité d’inscrit maritime. Et il était devenu ainsi marin de l’État.
Mais, entre temps, un événement grave s’était produit qui avait, pour toujours, enveloppé de deuil le front d’Anna Plonévez, que les voiles du veuvage mêmes n’avaient pu dépouiller de sa forte jeunesse.
Ervoan avait brusquement dévié de la bonne voie.
Entré comme troisième clerc chez un notaire de Saint-Brieuc, il avait fait la connaissance de quelques mauvais drôles et, en une heure d’égarement, s’était approprié une somme de deux cents francs prise à la caisse du « patron ».
Ce larcin ne lui avait point profité. Pour chaque centaine de francs il avait obtenu un mois de prison, et, comme la loi Bérenger n’était point encore promulguée, il avait dû purger sa peine.
Pendant ce temps, la malheureuse mère était accourue, portant la somme volée par son fils. Elle avait indemnisé le notaire, sans que cette compensation atténuât la sévérité de la sentence.
Au sortir de la maison centrale, Yves avait déclaré à sa mère qu’il voulait se réhabiliter. Mais, pour ce faire, il lui fallait quitter le pays.
Anna Plonévez avait pris encore cinq cents francs sur son livret de Caisse d’Épargne pour les donner à l’enfant prodigue. Du coup ses économies avaient été épuisées.
Yves était parti, ainsi qu’il l’avait annoncé.
Ces choses s’étaient passées quelque dix ans plus tôt, et l’on n’avait plus eu de nouvelles du fugitif. Après avoir espéré longtemps son retour, la veuve avait fini par considérer son fils aîné comme mort, et n’avait plus voulu quitter le deuil de cette mort.
Tel était le secret que l’intelligence très éveillée de Pablo parvint à pénétrer. Il comprit alors pourquoi son ami Lân lui avait recommandé de ne jamais parler, devant la vieille femme, du matelot Ervan, qui lui ressemblait tant, attendu que ce nom d’Ervan sonnait comme celui d’Ervoan, diminutif familier du vocable Yves.
Il garda donc pour lui tout ce qu’il avait appris ou deviné et, en cœur généreux, plein de délicatesse, se promit d’apporter tous ses soins à panser et adoucir, autant qu’il serait en son pouvoir, la plaie depuis si longtemps ouverte dans l’âme de cette mère douloureuse, devenue la sienne par l’adoption.
Celle-ci, de son côté, s’attachait chaque jour davantage au petit garçon. Elle sentait en lui une noblesse de caractère et de pensée bien supérieure à celle du commun des enfants, et aussi des hommes.
Il lui arrivait de dire au recteur ou à l’instituteur, chaque fois qu’elle trouvait une occasion de leur parler du petit abandonné :
« Bien sûr qu’il n’est pas comme les autres. Ce n’est pas un fils de paysans de par ici. Quand il est propre et bien habillé, il a l’air d’un petit monsieur de la ville. »
Et c’était vrai. L’« Espagnol » était un grand seigneur au milieu de ses jeunes camarades d’école. Ayant beaucoup voyagé, dès sa plus tendre enfance, il s’était étrangement développé. Sa force et sa souplesse le distinguaient, même au centre de ce noyau de garçonnets robustes de la côte, parmi ces rejetons précoces d’une race que le vent salin fortifie et adapte, depuis des siècles, aux périlleuses exigences des industries de la mer dont ils vivent. En sorte que, peu à peu, dans tout le pays, de Trélévern à Trégastel, tous les garnements de son âge en étaient venus à le considérer comme leur chef, presque leur roi.
Pablo n’abusait point de cette royauté, bien au contraire. Il justifiait sa prééminence, non seulement par la vigueur de ses muscles, mais, plus encore, par la supériorité de son intelligence. Et ce qui achevait de lui attacher tous ces jeunes cœurs frustes, c’était sa bonté native, pleine d’attentions et de scrupules. Pas un de ces trois ou quatre cents éphèbes, avec qui il lui arrivait d’échanger des mots de joie ou d’amicales bourrades, n’eût voulu lui faire la moindre peine, lui susciter le plus petit ennui.
La renommée de l’« Espagnol » grandissait donc dans le petit monde de la jeunesse aux alentours des bourgs de Louannec et de Perros-Guirec, et, vraiment, à le voir ainsi chéri et fêté de tous, la veuve Plonévez se sentait envahie d’un légitime orgueil.
N’était-ce pas elle, en effet, qui, dès le premier moment, avait accueilli, sans hésiter, cet orphelin ? N’était-ce pas son vaillant Alain qui lui avait donné ce fils adoptif, après l’avoir arraché au naufrage ?
Aussi, dans sa naïve fierté, n’éprouvait-elle pas de plus grande joie que de se montrer au bras de l’enfant dans ses promenades du dimanche, à la sortie de la grand’messe ou des vêpres. Car, bien que l’existence de Pablo eût été fort troublée et que son passé fût obscur au point qu’il n’aurait su dire lui-même exactement son âge, une chose restait certaine en ces ténèbres, la religion de son origine que pratiquaient, oh ! bien singulièrement, ses pires compagnons de courses et d’aventures.
Sur ce point, le seul qui offrît quelque précision, l’enfant avait parfois des révoltes et ses yeux brillaient d’un éclair, quand un de ses petits camarades lui demandait, sans y mettre plus de malice :
« Alors, tout de même, Pablo, tu as été baptisé ? »
À quoi Pablo répondait, avec une fougue bien digne d’un hidalgo du temps de la conquête de Grenade :
« Crois-tu donc que les hommes de mon pays sont des chiens ? »
À le juger sur ses dispositions d’intelligence et d’énergie, l’instituteur de Louannec, une main posée sur cette chevelure brune et bouclée, ne pouvait s’empêcher de dire à la veuve, en riant :
« Çà, madame Plonévez, il faudra, décidément, faire quelque chose de ce gamin. Quand Alain sera de retour, on verra à causer de cela. Le petit est assez jeune pour qu’on puisse le préparer au Borda. Il faudrait l’envoyer à l’École Saint-Charles, à Saint-Brieuc. »
Et, comme ces paroles n’étaient pas claires pour Pablo, il fallut que le magister lui expliquât que le Borda était le vaisseau-école des futurs officiers de marine, qui en sortent avec le titre d’« aspirant ».
De ce jour, l’esprit de l’ex-mousse de la Coronacion s’ouvrit aux plus généreuses espérances, aux plus vastes ambitions. Il n’hésita pas à en faire part à la veuve :
« Oh ! mamm Plonévez ! Quelle joie si je devenais officier ! Comme vous seriez fière, n’est-ce pas ? Vous auriez vos deux fils capitaines. Et je pense qu’alors vous ne pleureriez plus, que vous oublieriez l’autre, qui vous a fait tant souffrir ? »
L’enfant n’avait pas été, cette fois, le maître de son premier mouvement. Sa parole avait dépassé sa pensée. Il s’aperçut de la faute qu’il venait de commettre en voyant de grosses larmes perler aux cils de Mme Plonévez.
« Oh ! petit, soupira celle-ci, que dis-tu là ? Crois-tu donc qu’une mère puisse oublier son fils ? »
Mais Pablo se jeta à son cou.
« Il faut me pardonner, mamm Plonévez. Je voulais dire seulement que, si je devenais officier, je vous rendrais si heureuse que, peut-être, vous auriez moins de chagrin d’avoir perdu votre autre fils. »
La veuve lui rendit sa caresse et murmura :
« Ne t’excuse pas. Je sais que tu as bon cœur, petit Pablo, que tu aimes ta vieille mamm presque autant qu’elle t’aime. Retiens seulement ceci : autant que dure la vie d’une mère, elle garde le souvenir des enfants qu’elle a perdus. Il n’y a que le bon Dieu qui puisse la consoler, vois-tu ! »
Et hochant la tête, elle ajouta :
« Il n’en manque pas, de mères qui pleurent, en notre pays, Pablo, de mères comme moi, et les riches ne sont pas plus exempts que les pauvres de ces douleurs-là. Et, tiens, il y a, pas bien loin d’ici, entre Trélévern et Treztel, une jeune dame plus malheureuse encore que moi. Elle est venue, je crois, des Amériques, comme toi, mon petiot. On ne sait pas bien au juste ce qui lui est arrivé, mais on dit qu’elle a été un temps folle de chagrin, parce qu’elle a vu mourir, à la fois, son mari et un petit garçon qu’elle avait. »
Pablo la considéra, ému de compassion :
« Pauvre dame ! C’est vrai, tout de même, mamm Plonévez, qu’il y a des gens qui sont bien malheureux ! »
Et l’esprit mobile du garçonnet aborda un autre sujet :
« Vous dites qu’elle vient aussi de l’Amérique, cette dame ? De quelle Amérique, du Nord ou du Sud ? »
Ça, c’était trop demander à la veuve Plonévez, dont les connaissances en géographie étaient plus rudimentaires encore qu’en orthographe.
« Dame ! petiot, répliqua-t-elle, tu es trop savant pour moi. Si Lân était ici, il pourrait te dire la chose. Encore faudrait-il qu’il connût la dame, qu’il l’eût vue, pour le moins.
– Je crois que je l’ai vue, moi, reprit Pablo avec véhémence. C’est une jolie dame, tout en noir, qui ressemble à la Sainte Vierge du grand vitrail qui est derrière le maître-autel ? Et elle se promène avec une petite fille qui a des cheveux qu’on dirait en or ?
– Peut-être bien ! concéda la veuve en souriant. Je ne suis pas aussi avancée que toi ; je ne l’ai jamais vue. Tout ce que je t’en dis, c’est ce qu’on m’a raconté. Mais, toi-même, où l’as-tu rencontrée ? »
Alors Pablo expliqua qu’une semaine auparavant, il était sorti du port de Perros sur la chaloupe des Douanes et était descendu avec deux douaniers sur la plage de Treztel, après le village du Trévou, au voisinage du Bois-Riou. C’était là qu’il avait rencontré la dame en noir, donnant la main à la fillette blonde.
Les douaniers avaient respectueusement salué la dame, qui leur avait répondu par une inclinaison de tête et un aimable sourire.
Et, maintenant, Pablo osait se souvenir d’une particularité qui l’avait un peu troublé sur le moment. La promeneuse, en passant près de lui, s’était arrêtée brusquement et l’avait dévisagé avec une singulière insistance. Il avait même semblé au petit garçon que ses yeux, qu’il avait jugés les plus beaux qu’il eût jamais vus, s’étaient obscurcis en le considérant, comme si une buée de pleurs s’y était épanchée.
« Peut-être que ma vue lui a rappelé son petit garçon, n’est-ce pas, mamm Plonévez ? Pauvre dame ! Elle a l’air bien triste, je vous assure. »
Cette réflexion compatissante lui inspira un retour sur lui-même. Il soupira :
« Et, moi aussi, j’ai eu une mère, que je n’ai pas connue, et, peut-être, me croit-elle mort et me pleure-t-elle, comme la dame noire pleure son fils et vous le vôtre, mamm Plonévez ! »
À son tour, il eut des larmes sous les paupières et se détourna pour les cacher.
« Tu vois, prononça la veuve, que le bon Dieu fait bien tout ce qu’il fait, puisqu’il t’a donné à moi, qui regrette un fils, et qu’il m’a accordé de devenir un peu ta mère, mon petiot.
– C’est vrai, mamma, répliqua Pablo, en se rejetant dans les bras de la vieille femme, qu’il étreignit chaleureusement. Mais, tout de même, vous étiez moins à plaindre que la pauvre dame, puisque le bon Dieu vous avait laissé un fils, grand et bon, et qu’elle n’a plus son petit garçon, qui était peut-être son seul enfant. »
Il se reprit tout aussitôt pour ajouter :
« Mais non. Je me trompe, puisqu’elle a une petite fille. »
Cette rencontre et cet entretien laissèrent une trace profonde dans l’esprit du jeune « Espagnol ». Un étrange désir lui vint de revoir la dame en noir, la pauvre affligée aux beaux yeux, qui l’avaient si tendrement considéré. Et voilà qu’un sentiment insoupçonné prit naissance dans l’âme de Pablo.
Insouciant et joyeux jusqu’alors, il devint mélancolique et rêveur. Cette pensée qu’il avait exprimée à la bonne Anna Plonévez hanta ses méditations solitaires. Il se prit à aimer cette créature absente et lointaine qui avait été sa mère inconnue, et, à force d’y porter son imagination, il en arriva à lui prêter les traits, le port, l’attitude de la dame en noir aperçue à Treztel.
En même temps, il se souvint de la jolie petite fille aux cheveux d’or, et il songea que, en ce pays d’Amérique, d’où, comme lui, la dame était originaire, il avait peut-être une sœur aussi jolie, aussi blonde que celle-là. Ce fut une sorte d’éveil de sa conscience, une entrée en un monde nouveau de sentiments.
Le coin de terre bretonne où l’avait conduit la destinée capricieuse est, entre tous, propice à la poésie mystique du cœur. Là règne une végétation abondante que n’effarouche point le vent du large et qui fait onduler les cimes vertes jusqu’au bord des flots tantôt alanguis, tantôt tumultueux de l’Océan. Car la Manche prend fin, à proprement parler, plus haut, dans les parages de Saint-Malo et de la Rance. Ici, c’est bien l’Armor des légendes et des traditions que, par malheur, dégradent et dénaturent progressivement les passages, chaque jour plus nombreux, de touristes venus de l’est, pour la plupart sans traditions et sans goût.
Les derniers costumes disparaissent. Seules, les coiffes de batiste ou de dentelle résistent encore. Mais le sol se défend mieux. La voix de la mer « qui parle beaucoup » continue à se faire entendre aux fils de la côte, à imposer silence aux sottises et aux propos profanateurs. Les landes et les bois, le vaste horizon, les étangs réflecteurs du ciel mélancolique, les croix des chemins, les pierres des nécropoles solitaires gardent les âmes du tumulte envahisseur des villes ensorcelées. On peut encore rêver, aimer, pleurer et prier en Bretagne, et le Trécor lui-même, plus entamé par l’influence étrangère que le Léon et la Cornouaille, n’en conserve pas moins sa grandeur farouche et sublime.
Or, le petit mousse orphelin, jeté par la tempête sur ce rivage à la fois grandiose et tendre, sur cette terre peuplée de souvenirs mystiques et héroïques, les aimait d’un attachement profond. Il sentait sourdre en lui il ne savait quel atavisme dormant dans les ténèbres de ses origines, comme si une partie de son sang lui venait d’une des sources fraîches qui murmurent sous les ombrages de ce beau pays.
Alors, poussé par une force irrésistible, il mettait à profit ses heures libres et solitaires pour courir vers les bords fascinateurs, vers les silencieuses profondeurs du Bois-Riou, les eaux alanguies des étangs ou le fracas grondant des lames sur les écueils du rivage.
Partout, il retrouvait, dans la paix de ses contemplations, les chers fantômes évoqués par son imagination en travail ; partout il demandait à la nature pleine de mystères la réponse aux questions que posait son esprit inquiet.
Cela dura autant que la belle saison, cela se prolongea même après les derniers crépuscules de septembre. Vinrent les brumes d’automne, et elles ne firent point oublier à Pablo le chemin des solitudes attristées.

III
Suaire blanc.
Les brouillards d’automne sont soudains et épais sur toute la côte septentrionale de la Bretagne. Ils montent brusquement de la mer et, en moins d’une demi-heure, d’un quart d’heure même quelquefois, submergent les rives et s’étendent assez avant dans les terres.
Malheur alors aux errants des plages qui découvrent à grande distance. Si la brume coïncide avec le flot, il y a danger de mort pour les infortunés perdus dans l’immensité de la grève, et qui ne retrouvent plus leur route au travers de cette humidité opaque dont s’ouate l’atmosphère.
Sinistre, insidieux, le flot rampe autour d’eux, sous leurs pas, emplit les déclivités du sol, les dépressions du sable, les enserre entre les bras de multiples chenaux, les sépare de la terre ferme. Nul signal que la voix ne peut guider au sein de ces ténèbres blanches ; nul feu, si intense qu’on l’allume, ne perce ce rideau de vapeurs que la mort tisse, comme un linceul, sous les yeux, ou, plutôt, sur les yeux du condamné. Et, dans la solitude glaciale, quelle oreille attentive se trouverait là, juste à point, pour percevoir l’appel de détresse, quelle énergie dévouée pourrait se porter à temps au secours de l’abandonné ? Comme dans l’atroce enlisement des sables du Mont-Saint-Michel, c’est ici la mort pleine d’affres prolongées, bue littéralement goutte à goutte, et que le misérable voit monter, trame liquide, de la plante de ses pieds jusqu’à sa hanche, criant en vain les clameurs de son désespoir.
La plage de Treztel, où s’érigent quelques villas, habitées en été par leurs propriétaires, presque tous citoyens de Guingamp, est absolument déserte dès que les soirs abrégés d’octobre et les frissons des premières brumes ont dispersé les dernières villégiatures.
Il ne reste plus alors sur le rivage que des maisons définitivement closes pour huit mois de l’année. De temps à autre des pêcheurs y débarquent pour y rapiécer d’occasion leurs filets ; des paysans y viennent ramasser le goémon, qu’ils chargent et emportent sur leurs charrettes, les uns jusqu’au village du Trévou, distant de plus d’un kilomètre, les autres jusqu’aux chaumières disséminées dans l’étroite vallée qui met la mer en communication avec les étangs du Bois-Riou.
Parfois aussi l’écho y vibre sous l’ébranlement d’un coup de fusil, attestant le passage d’un chasseur en quête de canards sauvages et qui pour ne point revenir bredouille, décharge son arme, inutilement meurtrière, sur un goéland ou une alouette de mer.
Cet après-midi-là, après une journée radieuse, le soleil se couchait en une gloire rouge, empourprant et dorant les pointes basses de Ploumanac’h, entourant d’un cadre incandescent les profils de Tomé et des Sept Îles, la silhouette élégante et fière du phare des Triagoz.
Une femme et une petite fille suivaient lentement le sentier de douaniers qui borde la côte, en surplombant les roches basses.
La femme, grande, mince de taille, moulée en sa sévère robe noire, la tête coiffée d’une simple toque de velours sous laquelle se gonflaient les épaisses torsades de sa chevelure sombre, avait les traits purs, les yeux profonds, le teint mat des races blanches du Midi. Tout, dans sa personne d’une distinction souveraine, décelait une sorte de lassitude, et dans ses prunelles indifférentes se laissait lire une douleur incurable, intermittemment éclairée d’une flamme imprévue.

La fillette, qui pouvait avoir dix ou onze ans, était aussi blonde que sa compagne était brune. Celle-là appartenait, sans doute possible, aux familles du Septentrion, dont elle avait le teint éclatant et frais, les yeux bleus et les lèvres roses, pleins d’espoir et de sourires.
« Maman, demanda gaiement la petite fille, voulez-vous que nous descendions sur la plage ? La mer est tout à fait basse et le sable sec. Nous ne courrons pas le risque de mouiller nos bottines. »
La jeune femme hocha la tête et répondit :
« Peut-être est-il un peu tard, Irène. Tu peux voir que le soleil est tout à fait au bord de l’horizon. Il ne faut pas nous laisser surprendre par le serein, et nous avons une bonne demi-heure de marche pour regagner notre Ker Gwevroc’h.
– Oh ! c’est plus qu’il ne faut, maman. Vous savez que je suis bonne marcheuse, et le docteur vous a ordonné de longues promenades quotidiennes. Un peu plus tôt, un peu plus tard. Je suis sûre qu’il n’est pas plus de cinq heures. »
La mère tira de sa ceinture un bijou orné de diamants, une de ces montres grosses comme des œufs de pigeon, merveilles dont les horlogers comtois se sont fait une spécialité.
« Tu ne pouvais dire plus juste, reconnut-elle en souriant. Il est, en effet, cinq heures précises, si, toutefois, je suis d’accord avec le cadran de Trélévern. »
En ce moment, porté par le vent d’ouest, une claire sonnerie, venue du clocher de Perros-Guirec, traversa la rade alanguie et tinta cinq fois distinctement aux oreilles des promeneuses.
« Allons, acquiesça la dame en noir, nous pouvons aller jusqu’au bout de la grève. »
Et, précédée d’Irène, alerte comme un cabri, elle sauta légèrement d’une roche assez élevée sur le sable, suivant d’une allure tranquille l’enfant qui bondissait impétueusement de cailloux en cailloux, de flaque en flaque, sur la plage déserte.
Ces courses sur la côte étaient manifestement toute la joie de la fillette, vigoureuse et débordante de santé. Elle respirait l’air bienfaisant qui, du large, fouettait et rosissait son charmant visage. Sa jeune poitrine se dilatait à chaque inspiration des effluves salins ; une force splendide semblait y pénétrer, et la cornée humide de ses grands yeux en paraissait plus limpide et plus brillante.
Rêveuse, celle qu’elle nommait « maman » l’accompagnait d’un regard mélancolique, à peine distrait un instant par le spectacle de ces ébats en un lieu où nul danger n’était à craindre.
Peut-être n’était-elle pas fâchée de voir ainsi courir et gambader l’enfant assez loin pour qu’elle pût s’absorber elle-même en sa méditation douloureuse !
Car elle marchait d’un pas lent et onduleux, n’attachant aucun intérêt au tableau de ce couchant féerique, dominée par la vision de quelque scène pénible, dont la présence inévitable retenait le regard de son âme.
Pourtant, un moment, elle s’alarma.
Irène avait couru sans arrêt jusqu’à l’extrémité de la lisière sablonneuse, là où clapotaient les flots clairs, roulant des paillettes de rayons. Elles étaient si jolies, ces lames, à peine frangées d’une ligne de diamants ; elles avaient une si douce mine qu’elles faisaient songer involontairement aux yeux caressants de tout petits chats se roulant les uns sur les autres, se mordillant la queue, se ramassant en pelotes soyeuses.
Sans doute, telle fut l’image que leur vue suscita aux prunelles charmées de la fillette, car, éclaboussée tout à coup par l’une des volutes liquides, à laquelle elle n’avait pas pris garde, elle éclata d’un rire sonore et, tout aussitôt, se mit à réciter à pleine voix, dans le susurrement du flot, les premiers vers d’un morceau enfantin bien connu :
Venez ici, minet ; il faut que je vous gronde.
Et, modifiant la poésie au besoin des circonstances, elle en tira cette variante :
On dit que sans pitié vous mouillez tout le monde.
C’est bien joli, ma foi !
« À qui parles-tu donc ainsi ? questionna la jeune femme, attirée par ce rire et ces éclats de voix.
– Je parle à l’eau, maman, à la méchante eau, qui vient de mouiller mes bottines. »
Et la mère de sourire, en répliquant doucement :
« Ce n’est pas l’eau qui est méchante, c’est Irène qui est une petite sotte de ne l’avoir pas vue venir. »
Le ciel était d’une incomparable douceur. À mesure que l’astre s’immergeait, les rouges vifs de l’horizon se dégradaient en rose tendre, en violet clair, en mauve, en gris perle qu’ourlaient des fils d’un or fluide. Des cirrus en écharpe au zénith empruntaient de fugitives pudeurs aux caresses du grand œil de flamme disparu.
« Voyons, ordonna affectueusement la dame en deuil, allons nous asseoir sur cette roche et regardons finir le jour. »
Irène la suivit docilement jusqu’à un large bloc de granit, surgi comme une chaise naturelle du milieu des sables environnants.
« Maman, interrogea la fillette, peut-être allons-nous voir ce « rayon vert » dont parle Jules Verne dans le livre que vous m’avez donné ?
– Je ne le pense pas, ma chérie. Il paraît que ce rayon n’est visible que si nulle terre n’interrompt la ligne de l’horizon. Or, ce n’est pas ici le cas.
– Quel dommage ! » soupira Irène.
Elle fixa de tous ses yeux le fond du ciel à l’Occident, comme pour contraindre le mystérieux phénomène à s’accomplir, sur son ordre, en dépit de toutes les lois de l’optique.
Mais l’astre descendait plus bas, et ses feux en éventail abandonnaient la voûte pour ne plus colorer que les nuées les plus proches de la courbe.
Irène releva la tête et, se penchant sur l’épaule de la jeune femme, reprit, changeant de sujet :
« C’est tout de même drôle que la terre tourne sans qu’on la voie tourner. Mlle Dougal me répète toujours cela et je n’arrive pas à m’y faire. Je comprends très bien que l’on ait cru, autrefois, que le soleil tournait autour de la terre. C’est bien plus naturel, et, puis, ça se voit. »
Après une nouvelle pause, elle poursuivit :
« Et le voilà parti pour sa grande tournée, de l’autre côté du monde. Dire que toute cette eau finit si loin ? Au bout, maman, c’est une autre terre, n’est-ce pas ? C’est l’Amérique ? »
Ce nom fit tressaillir la femme en deuil. Ainsi qu’un morne écho, elle répéta :
« L’Amérique ! »
Et, ses yeux, jusque-là noyés dans la contemplation de l’infini, s’emplirent de larmes.
« Oh ! maman ! s’exclama la fillette, en se jetant à son cou, voilà que je viens encore de vous faire pleurer. »
La mère affligée l’entoura de son étreinte, et la pressa affectueusement sur sa poitrine.
« Non, ma chérie, ce n’est pas toi qui me fais pleurer. Vois-tu, mes souvenirs sont trop cruels.
– Oh ! oui, je sais, murmura la gentille créature, je sais que ce n’est pas la même chose. Je vous appelle maman, mais je ne suis que votre nièce. Je ne peux pas vous remplacer le petit garçon que vous avez perdu. Vous êtes madame Isabelle Hénault et moi je suis Irène Corbon. Je vous aime pourtant comme si vous étiez ma mère, puisque je n’en ai plus. »
Soudain, un cri lui échappa, arraché par une impression de froid gagnant ses pieds.
« Voyez donc, voyez donc, maman : la mer monte ! On dirait qu’elle sort du sable sous nos semelles. »
En effet, le phénomène habituel d’infiltration, qui précède le flot et suit le jusant, s’accomplissait autour des deux femmes. Partout où se posaient leurs bottines une tache humide les dessinait sur le sol, comme si toute la plage, subitement imprégnée, se fût transformée en une immense éponge.
Mais un autre détail, fort imprévu, celui-là, venait s’ajouter à cette constatation d’habitude.
En même temps que l’eau se transsudait de la grève, au large, sur la mer, des vapeurs moutonnaient, tantôt fragmentaires, en taches circulaires, tantôt haillonnées en écharpes traînantes, dont la transparence de gaze se tissait plus épaisse à vue d’œil. Et ces lambeaux de brume s’attiraient, confluaient, se soudaient naturellement. En quelques secondes, elles s’étendirent en nappe sur l’eau bleue et la couvrirent entièrement. On ne vit plus qu’une plaine sans bornes, toute blanche, ondulant en fumée basse du rivage de Treztel à celui de Perros-Guirec. Les îles en furent, l’une après l’autre, estompées d’abord, puis définitivement effacées.
« Allons-nous-en ! dit vivement Mme Hénault, en entraînant Irène. Ce brouillard doit être très malsain à respirer. »
À son tour, elle ne put retenir un cri d’effroi.
Elle s’était retournée vers la terre, et voilà qu’elle y retrouvait la brume, venue des profondeurs de la vallée.
Toute la grève fumait, à droite, à gauche, devant, derrière. Les deux femmes en étaient entourées ; elles ne voyaient plus le sol sous leurs pieds.
« Courons, courons, fit la tante d’Irène, en entraînant vers la partie haute de la plage la fillette amusée par ces préludes du météore.
Elles coururent, pas assez vite pourtant pour devancer la rapide expansion des vapeurs. Elles n’avaient pas fait deux cents pas que la brume leur venait à la taille.
Et, grâce à la réfraction, l’horizon de la terre leur parut reculer et fuir dans un lointain énorme.
Au-dessus du mouvant nuage, les rochers et les cassures du rivage s’érigeaient ainsi que des caps. Plus haut frémissaient les cimes jaunies des arbres du Bois-Riou, s’échevelaient, sur les crêtes, les branches épineuses des ajoncs.
Mme Hénault et sa nièce pressèrent leur course.
Brusquement, une risée de brise courut sur cette ouate impalpable, la fit houler et diffluer dans tous les sens. La voix, toujours rieuse, d’Irène, dit :
« Oh ! maman, je ne vous vois plus. Je suis dans la fumée. »
Elle avait disparu sous le linceul de brume, que Mme Hénault dominait de la tête seulement.
À son tour, la jeune femme ne vit plus rien. Le brouillard l’ensevelissait. Elle marchait au hasard, serrant nerveusement la petite main qu’elle tenait dans la sienne.
« Tiens ! prononça Irène, qui ne s’effrayait point encore, on dirait qu’ici aussi il y a de l’eau. »
Mme Hénault frissonna.
Elle venait de se rappeler que la plage était sillonnée d’innombrables dépressions, de rigoles formant canaux, que la mer montante emplissait les premières.
Est-ce que la marée allait, en débordant de ces canaux, leur couper la retraite, leur fermer la fuite en avant ?
Elle eut envie de crier, d’appeler au secours.
Mais elle se dit qu’en agissant ainsi, elle effraierait la petite fille prématurément et courrait le risque de l’affoler, ce qui constituerait un péril nouveau.
Elle se tut donc et continua d’avancer.
Une sensation glacée l’arrêta court. En même temps, un cri jaillissait de la poitrine d’Irène :
« Mais c’est l’eau, maman ! C’est l’eau ! »
Oui, c’était l’eau, l’eau perfide, insidieuse, qui, en s’insinuant dans les chenaux, les avait tournées et enveloppées, qui leur barrait la route.
Mme Hénault eut une terreur paralysante.
« Avançons encore », dit-elle d’une voix étouffée.
Avancer ? Comment ?
Au premier pas qu’elles firent, elles sentirent le froid leur gagner les chevilles. Retroussant leurs jupes, elles s’acharnèrent. Le bain glacé leur mouilla les genoux. Trois pas de plus, et elles comprirent qu’elles étaient en face d’une de ces excavations que les pêcheurs nomment des « trous ».
Déjà trempées, frissonnantes, elles durent rétrograder. La barrière liquide était peut-être très large, très profonde. Mme Hénault se prit à trembler.
Dilemme atroce. Qu’allait-elle faire ? Où chercher sa route dans cette obscurité imprécise ? Se jeter à droite ou à gauche ? La rigole devait se continuer jusqu’à la mer, et la mer était derrière elle, sournoise, implacable, les emprisonnant en ce filet de brume. Elle la sentait venir, bien plus, elle entendait son bruissement doux et sinistre, à moins de cent pas en arrière.
Misère ! Étaient-elles donc abandonnées de Dieu, condamnées à mourir là, dans cette longue agonie du brouillard et du froid ?
Mourir ! cette femme avait tant souffert que la mort ne l’effrayait pas. Mais il y avait l’enfant, il y avait cette petite Irène, si douce, si affectueuse, si jolie ! Et voilà qu’elle ne riait plus, Irène ; elle avait conscience du péril, elle avait peur. Sa voix craintive, presque basse, venait de murmurer, en grelottant :
« Oh ! maman, elle est bien froide, cette eau ! On ne voit plus rien. Est-ce que nous allons rester dans ce brouillard ? On dit qu’il y a des gens qui sont noyés par la mer montante. La mer monte, maman. »
Ces mots galvanisèrent la pauvre femme. Elle secoua la torpeur morbide qui l’envahissait et, sans se séparer de l’enfant, essaya de chercher sa voie d’un autre côté.
Elle alla sur sa droite. Mais là encore elle fut arrêtée par l’eau et dut reculer.
Elle se rejeta à gauche. Un passage s’offrit. Elle traversa un filet moins profond et recommença à courir devant elle. Le voile de brume s’épaississait. En portant la main à sa chevelure, elle la sentit gemmée de gouttelettes. La sensation glaciale la pénétra davantage.
Tout à coup une roche se rencontra sous leurs pieds. Irène buta et fit un faux pas.
Elles se trouvaient sur un plateau granitique. Des poussées de pierres crevant le sable s’étendaient là, tapissées de goémon. Elles glissaient sur l’herbe gluante, chancelaient. Une fois de plus la fillette perdit pied. Elle tomba. Mme Hénault la retint à temps. Il y avait là un trou sinistre, dont on ne pouvait deviner la profondeur.
Mais le plus terrible en cette angoisse, c’était l’incertitude. Dans leurs tentatives successives pour fuir, elles s’étaient désorientées. Où étaient-elles, à cette heure ? Peut-être étaient-elles revenues vers la mer ? Peut-être tournaient-elles le dos à la côte ?
Le sol s’élevait insensiblement sous leurs pas. L’espoir rentra en elles. Elles devaient toucher à la rive, puisque la montée s’accentuait. Encore quelques efforts, et elles seraient à l’abri ; elles émergeraient des plis du linceul des vapeurs ; elles reverraient le ciel.
Une roche nouvelle les fit trébucher. Elles l’escaladèrent. Ce ne fut que pour en heurter une autre au-dessus.
À tâtons, de leurs pieds hésitants, de leurs doigts crispés, sans souci de leurs vêtements salis et mouillés, elles s’y juchèrent, croyant gravir la falaise du salut.
Mais après ces premiers échelons, d’autres surgirent, et il fallut recommencer l’escalade. Elles montèrent, montèrent encore, haletantes, éperdues, stimulées par le bruissement du flot qui, maintenant, au-dessous d’elles, les enveloppait de son susurrement et emplissait, de tous côtés, la solitude de la grève.
Elle fut ardue, cette ascension. Leurs ongles se retournaient, leurs paumes saignaient aux arêtes coupantes du granit. Mais, à mesure qu’elles s’élevaient d’un degré, le tissu brumeux se faisait moins dense ; une lumière plus vive y filtrait, preuve qu’elles atteignaient les couches supérieures du brouillard, qu’elles allaient revoir le ciel.
Elles le revirent, en effet.
Hélas ! Cette vue ne leur apporta que le désespoir, la certitude de la condamnation.
Lorsque, trouant de la tête l’opaque moutonnement des vapeurs qui déferlaient au-dessous d’elles, elles contemplèrent le paysage environnant, elles se rendirent compte de leur détresse.
Dans leur fuite, elles avaient perdu le sens de la direction ; elles étaient revenues vers l’écueil en forme de chaise sur lequel, moins d’une demi-heure plus tôt, elles s’étaient installées pour contempler la féerie du couchant.
« Il faut appeler, maman, murmura Irène, il faut crier. On nous entendra peut-être ; on viendra.
– Oui, appuya la jeune femme. Que le bon Dieu nous protège, ma chérie ! Prions-le et appelons-le autant que les hommes, à notre secours. »
Unissant leurs voix, elles élevèrent leur appel alternativement vers la pitié du Ciel, vers l’intervention des créatures.
Et ceux qui, ce soir-là, passèrent sur les sentiers de la grève et les chemins de douaniers, parmi les genêts et les landiers épineux, frémirent d’entendre ces cris d’épouvante venus du large, à travers les premières ombres du crépuscule, pour implorer la pitié des rares errants du rivage.
« Le brouillard diminue, maman » risqua timidement Irène, d’un organe que le froid enrouait.
Elle disait vrai. La couche des vapeurs s’abaissait, ou, plus exactement, se fondait par la base sous l’haleine plus chaude de la mer.
Dans la pénombre, encore assez limpide, les deux femmes virent émerger du nuage leur piédestal de granit. La fumée humide descendit plus bas, découvrit les gradins inférieurs du récif, battit les assises en se haillonnant, et, tout à coup, sous la poussière d’argent de la lune, la plaine liquide étincela, nappe transparente étendue des bornes de l’Océan au seuil de la vallée de Treztel.
Il n’y avait plus de brume, mais ce qu’il y avait était pire. La mer remplaçait partout le brouillard.
Elle enveloppait l’écueil, l’étreignait, et, d’une lente ascension, le gravissait, à la poursuite des fugitives.
Jusqu’où monterait-elle ? Atteindrait-elle à leur niveau, recouvrirait-elle ce socle, leur suprême refuge ? Elles ne le savaient point ; elles ne se souvenaient pas d’avoir naguère remarqué cette roche au-dessus de l’eau pendant les pleines mers.
Et, calme, plus effrayante en sa placidité qu’en ses colères d’ouragan, la marée s’élevait, ligne par ligne, pouce à pouce, avec des gaîtés féroces dans ses rides poudrées de diamants par la lune.
Les condamnées s’agenouillèrent, se serrant l’une contre l’autre, et prièrent en se recueillant.
Puis, redressées, debout, elles clamèrent un dernier appel au rivage, sans espoir, d’ailleurs.
Un même frisson les fit tressaillir soudain.
À leur cri, un autre cri venait de répondre.
Elles se turent, n’osant parler, tant cette voix lointaine les subjuguait, prenant presque des apparences miraculeuses.
Elles ne voulaient point croire encore. Ce n’était là, peut-être, qu’un écho de la falaise, si ce n’était pas une illusion.
D’interminables secondes s’écoulèrent. Dans l’ombre accrue, elles ne virent que la tache mouvante de la lune se rapprocher d’elles, clapotant et gazouillant sur les surfaces polies des blocs arrondis par les baisers séculaires des flots.
Mais, derechef, un cri traversa l’espace, une voix bien nette, bien distincte, cette fois. Ce n’était pas un écho ; c’était un organe masculin et jeune. Il disait :
« Tiens bon ! On y va ! »
« Tiens bon ! » l’interpellation habituelle des pêcheurs et des matelots. Une joie délirante entra dans les deux âmes en dérive. Dieu les prenait en pitié. Le salut venait vers elles.
Oui, à moins que ce ne fût une horrible et suprême ironie ! « Tiens bon ! » Et comment « tenir » sur ce morceau de roche, large de six pieds, long de huit, qui ne dominait que de quelques centimètres la nappe ambiante ? Avant que le secours arrivât, l’eau n’aurait-elle pas happé sa proie, nivelé ce refuge provisoire ?
Il y eut là un moment d’affreuse torture morale.
La nuit était complète. Les étoiles scintillaient dans l’immensité de bleu sombre. À l’ouest, on n’apercevait plus qu’un liséré livide derrière les noirceurs informes des îles et des promontoires. Presque au zénith, la lune se laissait tomber en quartiers de métal lumineux, qui palpitaient dans la molle ondulation de l’eau.
Celle-ci murmurait à moins d’une coudée du sommet. Elle n’avait pas l’air méchant ; elle ne se pressait pas à faire le jeu de la mort ; elle laissait au secours le temps de venir.
« Écoutez, maman, prononça Irène à voix basse ; on vient. »
Sur la nappe, à une distance imprécise, un bruit cadencé se faisait entendre : le rythme de deux avirons frappant régulièrement la surface miroitante.
« Ici ! À nous ! » cria désespérément Mme Hénault.
Le jeune cri de tout à l’heure résonna de nouveau :
« Tiens bon ! On y va ! »
Dans la large tache d’argent une tache noire s’accusa.
Les prunelles dilatées des deux femmes virent une étrave lourde se profiler, une palette de rame sortir de la nuit éparpillant des étincelles de lumière blanche.
Le bateau était là, l’arche de la délivrance.
Mais, en même temps, une sensation glacée baigna leurs pieds déjà mouillés. Une première lame escaladait la plateforme rocheuse. La mer, qui leur faisait grâce, leur donnait son baiser d’adieu.
L’embarcation glissa et vint ranger le bloc. Un seul homme s’y tenait, un homme tout petit, qui leur parut grand comme le ciel. Il rejeta l’aviron sur le tolet, enleva d’un effort la petite Irène. Puis, poussant l’enfant sur l’autre bord, il sauta lui-même sur la roche, afin d’y tirer le bateau et d’aider Mme Hénault à y monter.
L’instant d’après, les deux femmes agenouillées remerciaient Dieu avant de remercier leur sauveteur. Penché à l’arrière, celui-ci godillait vigoureusement et virait pour regagner la côte.

IV
Mère douloureuse.
Mme Hénault s’était relevée. Assise sur l’un des bancs, elle tenait Irène dans ses bras, étroitement serrée sur sa poitrine, s’efforçant de la réchauffer, car les jupes et les chaussures, trempées d’eau de mer, communiquaient à leurs membres une sensation prolongée de froid.
Alors seulement elle remarqua que le batelier, dont la prompte survenance les avait arrachées à la mort, n’était au plus qu’un adolescent, autant, du moins, qu’elle en pouvait juger à l’apparence.
« Merci, pour ce que vous venez de faire, dit-elle d’un accent qui parut céleste aux oreilles du jeune sauveteur. Vous avez droit à toute ma reconnaissance. Comment pourrai-je m’en acquitter ? »
Pablo, car c’était lui, ne trouva rien à répondre.
Un saisissement le tenait, paralysant ses cordes vocales. Cette femme qui lui parlait, c’était la même qu’il avait rencontrée, sur cette grève, à mer basse, quelques semaines plus tôt, celle dont mamm Plonévez lui avait parlé avec compassion, la dame en noir dont il rêvait en ses courses solitaires. La petite fille qu’elle tenait enlacée était aussi la compagne de la dame, vue en leur première rencontre. Bien que la clarté lunaire ne lui permît pas de distinguer leurs traits, il reconnaissait leurs silhouettes. Ce ne pouvait être qu’elles. Il n’y avait pas dans le pays une autre femme et une autre fillette aussi semblables à l’image qu’avait retenue son cerveau.
Ce soir-là, il était sorti de l’école, en demi-congé de la journée, à trois heures. Il avait profité de cette liberté pour se donner à ses chères rêveries. Il avait franchi presque en courant les deux lieues qui séparent Louannec du Trévou. Une sorte de pressentiment le hantait, avivant son désir de retrouver cette mère qui avait perdu son fils, et lui, l’orphelin qui n’avait plus de mère, se disait que la similitude de leurs malheurs créait un occulte lien entre cette femme et lui. Il demandait à Dieu de la revoir, et l’intensité de sa prière lui mettait des larmes dans les yeux.
Après avoir dépassé Trélévern, tout de suite il avait pris le chemin de la grève. Il y était descendu joyeusement. Et là, dans la féerie du couchant, il avait aperçu, au fond, se détachant sur l’horizon incandescent, les deux formes auxquelles son imagination prêtait toutes les grâces qui peuvent charmer le cœur et l’esprit d’un enfant.
Ah ! s’il avait, lui, Pablo, une mère et une sœur, sans doute ressembleraient-elles à cette femme et à cette fillette, sans doute les chérirait-il comme il aimait, d’instinct, sans réflexion, spontanément, ces deux inconnues ?
Et, tandis qu’il les contemplait à distance, voici que la brume, exhalée de la mer et du sol, avait estompé tout le paysage du large. Il l’avait vue monter, s’épaissir, onduler comme les flots eux-mêmes, envelopper et effacer les figures à peine aperçues des promeneuses.
Avant elles, et pour elles seulement, il avait eu peur. Mieux qu’elles il connaissait ces brouillards inattendus et les périls affreux dont ils sont tissés. Et, pour leur porter secours, s’il était nécessaire, il s’était élancé de leur côté, vers une barque que les risées du flot commençaient à balancer sur son grappin. Il ne les voyait plus ; elles avaient disparu sous la brume.
Pablo n’avait point hésité. Depuis dix ans qu’il menait la vie de marin, les choses de la mer lui étaient familières.
D’un bond, il avait sauté dans l’embarcation, qui, par bonheur, s’était trouvée assez légère pour se laisser manœuvrer par de jeunes bras. Il n’avait point hissé les voiles, ne comptant que sur sa vigueur pour diriger l’esquif sur cette nappe unie comme un miroir.
Un instant, lui aussi s’était immergé dans l’humide réseau de vapeurs. Mais, sur l’eau, elles étaient moins denses et moins hautes que sur la grève encore sèche. En se dressant sur les bancs, le gars les dépassait de la tête et pouvait mesurer l’horizon.
Le temps s’usa dans cette attente. Son œil se fixait obstinément sur le point où il avait vu les deux ombres disparaître ; il fouillait du regard l’obscurité croissante.
Et, tout à coup, il perçut un premier cri, puis un second, il amena le grappin et saisit les rames.
De nombreux appels le guidèrent. Ses prunelles, habituées aux ténèbres, distinguèrent deux points sombres au-dessus d’une masse noire de rochers. Il crut voir ces points remuer. Alors à son tour, il jeta sa voix dans le silence. Par deux fois il cria :
« Tiens bon ! On y va. »
*
Et, maintenant qu’il les avait recueillies, maintenant qu’il les ramenait saines et sauves au rivage, Pablo ne pouvait plus rien dire aux deux inconnues. Son cœur battait à lui crever la poitrine. L’anhélation de son souffle lui ôtait toute faculté d’articuler une syllabe.
Mme Hénault ne lui adressait plus la parole. Elle se disait que ce petit gars Breton ne devait comprendre, sans doute, que sa langue maternelle. Or, elle-même ignorait le dialecte trécorois, et Irène ne le bredouillait pas beaucoup mieux, bien qu’elle eût quelques occasions de s’y essayer en causant avec des gens du pays.
« Tout à l’heure, pensait la jeune femme, je remercierai mieux les parents de ce garçon, car il va, je présume, me conduire vers eux. Il me paraît étonnamment jeune et ne peut être que le fils de quelque pêcheur de la côte. »
Le bateau marchait assez vite, car Pablo souquait dur sur l’aviron. Mais il se fatiguait visiblement. L’effort était presque excessif pour un enfant de son âge.
À la fin la quille racla le sable dans un demi-pied d’eau. Le gars sauta par-dessus bord et, poussant l’embarcation par l’arrière, mit l’avant au sec.
Alors, empressé et frémissant, il vint vers les deux voyageuses déjà prêtes à débarquer et, très poliment :
« Donnez-moi la main, madame, dit-il, vous descendrez mieux. »
Mme Hénault s’émerveilla. Il parlait bien le français, ce garçonnet de la côte. Elle accepta l’aide de ce petit bras si vaillant et sauta à terre. Après quoi, ce fut le tour d’Irène, qui n’eut pas besoin de ce secours.
« Vous êtes un brave enfant, prononça doucement la jeune femme. Je tiens à vous exprimer ma reconnaissance devant vos parents. Voulez-vous nous conduire ? »
Il les précéda et se mit à marcher devant elles gravissant le revers de la côte rocheuse. Au sommet, il se trouva entouré de gens accourus des chaumières les plus proches.
Ils avaient entendu les cris et, indécis, ne savaient de quel côté diriger leurs recherches. Porteurs de lanternes, armés de gaffes et de cordes, ils venaient, un peu tard, au sauvetage, désormais accompli.
En reconnaissant Mme Hénault et sa nièce, tout ce monde poussa des exclamations de surprise et de joie.
Transies de froid, les deux femmes acceptèrent l’hospitalité d’une brave fermière installée dans un ancien manoir très déchu. Un grand feu de sarments leur permit de sécher provisoirement leurs jupes, trempées d’eau de mer, avant de reprendre le chemin de leur propriété, le Ker Gwevroc’h, située à un kilomètre plus haut.
Mais, alors, Mme Hénault s’enquit des parents de son jeune sauveteur. On le chercha lui-même parmi les assistants. On ne le trouva point. Cette brusque disparition de l’enfant chagrina Mme Hénault et Irène.
« J’aurais tant voulu le voir, le remercier, témoigner ma reconnaissance aux siens, dit-elle. Mais je m’en acquitterai dès demain. Quel est son nom ? »
Elle adressait ces questions à son entourage.
On ne put lui répondre tout de suite, soit qu’on ne comprit qu’imparfaitement sa question, soit que Pablo fût inconnu lui-même. À la campagne, huit kilomètres constituent une véritable distance entre les villages, et il y en avait plus de huit entre le bourg de Trélévern et celui de Louannec.
À la fin, un gamin d’une dizaine d’années parlant mieux le français que tous ses compatriotes, hommes et femmes, se glissa entre les commères babillardes et donna la réponse, par à peu près, aux interrogations d’Irène et de sa tante :
« Il n’est pas d’ici. C’est Pol, l’Espagnol comme on l’appelle, le fils à Mme Plonévez, de Louannec. »

Mme Hénault attira celui qui venait de parler plus près d’elle. En souriant, elle lui mit dans la main une pièce de deux francs, disant affectueusement :
« Voilà pour toi. Tu seras bien gentil de t’informer mieux demain et de venir me porter tes renseignements à Ker Gwevroc’h. Je tiens à aller remercier cette Mme Plonévez. »
Et le garnement, tout joyeux de l’aubaine, les yeux brillants, promit que, le lendemain, sans faute, « la dame » saurait exactement tout ce qu’il aurait su lui-même sur le compte de Pol Plonévez ».
Pendant ce temps, celui qui faisait l’objet de cet entretien dévalait au pas gymnastique la descente du Trévou, remontait la côte de Trélévern et parcourait, à la même allure, les huit kilomètres qui le ramenaient à Louannec.
Il était plus de sept heures quand il entra, rouge et essoufflé, dans la maisonnette de la veuve. Il y trouva mamm Plonévez, agitée, inquiète, se demandant ce que « le petiot » était devenu, ce qui causait cet énorme, cet invraisemblable retard.
Autour d’elle, jacassant à qui mieux mieux, des voisines s’efforçaient de calmer son impatience, de dissiper ses alarmes, bien qu’elles les partageassent un peu.
Pablo, en effet, était le modèle des garnements du village, depuis six mois que la tempête avait fait de lui le fils d’adoption de la veuve. On le savait doux, sage, ponctuel, n’ayant jamais causé un souci à la vieille femme.
Il fit donc irruption au milieu des potins et des hypothèses et, tout de suite, alla se jeter au cou de la mamm, qui n’eut pas le courage d’opposer des reproches aux bons baisers qu’il lui prodiguait.
À peine parvint-elle à lui dire :
« D’où que tu viens ? »
Lui, la face animée, hilare, débordant du rayonnement de sa petite âme en joie, n’hésita pas à tout raconter : sa fugue sur Trestel, sa rencontre avec la « dame en noir et sa petite fille », le brouillard, le péril couru par les deux femmes, le sauvetage accompli.
« Et, comme ça, s’écria la vieille femme émerveillée, c’est toi qui les as tirées de l’eau ?
– C’est moi, mamm Plonévez, répliqua Pablo.
– Tout seul ?
– Mais oui, tout seul. Ça n’était pas bien difficile. »
Il disait cela simplement, sans ostentation, laissant lire dans ses yeux l’étonnement qu’on admirât son action comme une prouesse.
Puis, les détails fournis sur le sauvetage, des compliments distribués, au lieu de blâmes, au vaillant garçonnet, on épuisa le sujet en parlant de la « dame en noir » et de « sa fille ».
Mme Plonévez et ses voisines racontèrent ce qu’elles en avaient appris par à peu près, c’est-à-dire la substance de l’événement qui avait privé, du même coup, la veuve de son mari et de son fils.
Mais, comme l’heure du souper était plus que dépassée, on borna là l’entretien, et les commères regagnèrent leurs pénates, laissant mamm Plonévez et son « fieu » manger leur soupe quotidienne.
On se couche de bonne heure dans les pauvres familles de Bretagne, sauf aux jours d’hiver où l’on vieille en commun à la faveur des « fileries ».
Neuf heures sonnant, Pablo et sa mamm étaient couchés sous les rideaux de cretonne des lits clos.
Mais pour le petit garçon le sommeil fut long à venir.
Le souvenir de sa belle action le hantait, et il s’y mêlait un grain d’orgueil, maintenant qu’il en avait entendu faire l’éloge, à l’égal d’un glorieux exploit, par quatre bouches laudatives. Jusqu’alors, il n’y avait pas attaché d’autre importance, ayant fait cela avec toute la spontanéité de sa nature généreuse.
Cette mesquine vanité ne pouvait prévaloir dans une âme aussi droite que celle du petit « Espagnol ». Tout de suite elle céda la place à une autre forme de satisfaction, plus noble parce qu’elle procédait du témoignage de sa propre conscience. Et à cette satisfaction une immense joie s’ajoutait, une joie d’une espèce particulière, celle qu’il ressentait à la pensée d’avoir rendu service aux deux chères créatures vers lesquelles, depuis plusieurs semaines, l’emportait l’élan irréfléchi de son cœur naïf et bon.
Oui, c’était à la dame en noir et à la petite fille, qu’il aimait comme il eût aimé sa mère et sa sœur, c’était à ces deux êtres dont il était ignoré la veille, qu’il venait de payer, sous sa forme la plus émouvante, le tribut de la tendresse qu’il leur avait vouée.
Cette pensée lui était très douce. Il lui plaisait infiniment d’avoir acquis des droits à la reconnaissance de cette femme et de cette enfant. En même temps, il s’émouvait au récit très incomplet qu’il venait d’entendre, pour la seconde fois, des malheurs survenus à la jeune femme, dont le nom même lui était encore inconnu. Sans doute, il la reverrait, car elle voudrait le revoir, lui donner une nouvelle assurance de sa sympathie.
Bercé par cette espérance, Pablo passa insensiblement de la veille au sommeil, et ce sommeil fut peuplé de rêves charmants et terribles à la fois, au cours desquels il se vit derechef sur la barque, mais aux prises avec une furieuse tempête, arrachant les chères victimes à une affreuse mort, puis recevant d’elles de tels témoignages d’affection qu’il acquérait le droit de dire à l’une « ma sœur », à l’autre « ma mère ».
Certes la sensibilité du garçonnet était en éveil par la divination vague du mystère de la vie de cette femme, analogue à celui de sa propre vie. Combien plus ne se fût-elle pas émue s’il eût connu dans sa réalité le drame affreux de cette existence foudroyée !
Cela s’était passé dix ans plus tôt.
À cette époque, celle que l’on nommait aujourd’hui Mme Hénault était l’heureuse mère d’un bel enfant de deux ans, l’heureuse épouse d’un Français, qui, après avoir acquis une fortune considérable par l’élevage en de vastes estancias de la République Argentine, avait cédé à la tentation d’exploiter une mine d’or récemment découverte en Guyane, au voisinage de Paramaribo.
Bien qu’il fût déjà riche d’une quinzaine de millions, M. Pierre Hénault, fils d’armateurs bretons de Saint-Brieuc, mari de la charmante Isabelle Corsol, fille elle-même d’un père espagnol et d’une mère française, bien qu’il adorât l’enfant né de leur mutuel amour et se disposât à rentrer en France pour y jouir de tout son bonheur, M. Pierre Hénault estima qu’il devait, une dernière fois, tenter la chance en faisant œuvre d’intelligence et d’énergie.
Hélas ! « Il ne faut qu’un coup pour tuer un loup », dit le proverbe. La destinée a d’étranges caprices. Toutes les prospérités antérieures de cet homme courageux et bon, la félicité qui habitait sous son toit, la tendresse de sa jeune femme et de son enfant, furent brisés d’un seul choc. La foudre s’abattit sur ce bonheur aventuré.
Il y avait deux mois à peine que le jeune ménage venait de s’installer dans la colonie hollandaise, au voisinage des placers acquis par M. Hénault, qu’une épidémie de fièvre jaune éclata dans la cité la plus voisine. Un médecin européen, venu pour étudier le fléau au péril de sa vie, conseilla à son compatriote de fuir au plus tôt cette terre malsaine, s’il voulait préserver du contage les êtres qui lui étaient chers.
Isabelle Corsol était orpheline et ne comptait que des parents éloignés en Amérique. Pour assister sa jeune femme, un peu languissante, dans les soins qu’elle donnait à son fils, Pierre Hénault avait prié sa propre mère, vaillante et robuste Bretonne du pays de Trécor, de venir passer quelque temps auprès de lui. Et la belle-mère était accourue ; elle avait entouré sa bru et son petit-fils de soins et de précautions.
À peine, sur l’avis du médecin, M. Hénault eut-il pris la décision de partir sans retard, que la courageuse femme ordonna les préparatifs et vaqua aux soins nécessaires à la bonne disposition de cet exode.
Deux journées de marche séparaient du port le plus proche la petite ville de Taman où séjournait la famille. Mme Hénault mère pourvut à tout. Elle loua les voitures indispensables, retint les attelages de mules, empaqueta les objets précieux et les vivres du parcours, régla l’ordre et la marche de la caravane.
Celle-ci se divisa en deux troupes : la première conduite par M. Hénault en personne, qu’escortait un domestique argentin en qui le maître avait mis toute sa confiance, et à qui obéissait le reste du convoi ; la seconde dirigée par sa mère veillant sur la jeune femme qu’une fièvre récente avait couchée sur son lit et qui allait voyager étendue sur les banquettes d’une sorte de palanquin.
On avait franchi la moitié du parcours et M. Hénault, précédant les femmes d’une étape seulement, les tenait au courant des incidents du trajet par l’intermédiaire de courriers indiens qui se relayaient d’heure en heure. Il était convenu que le repos de la nuit, entre les deux journées, serait pris en commun en une hacienda de la route, dont les chambres avaient été retenues d’avance, quand, soudain, les dames Hénault virent venir à elles un des courriers, les traits décomposés, couvert de sang, blessé sur plusieurs parties du corps. Cet homme tomba expirant aux pieds des mules qui portaient la chaise d’Isabelle. Avant de mourir, toutefois, il eut la force de raconter que la tête du convoi avait été surprise par une bande de regatoes, associations de bandits de toute race et de toute origine qui pillent et mettent à feu et à sang les régions équatoriales de l’Amérique, des bords de l’Orénoque à ceux de l’Amazone. M. Hénault était tombé sous leurs coups, ainsi que la majeure partie de son escorte, et le petit Paul, son fils, confié aux soins du fidèle domestique Ricardo, avait sans doute subi le même sort.
Horrible nouvelle, confirmée par la découverte de plusieurs cadavres, au nombre desquels l’un des premiers retrouvés fut celui du Français. On chercha vainement les restes de l’enfant. Ceux du serviteur furent à peu près reconnus, grâce aux vêtements qu’il portait, car le corps sanglant n’avait plus de visage ; les assassins l’avaient réduit en une abominable bouillie de chairs et d’os.
C’en était trop pour la jeune femme déjà malade. On dut la coucher dans un lit à l’hacienda, d’où, après une maladie d’un mois, elle sortit privée de raison.
L’héroïque Mme Hénault fut à la hauteur de son terrible devoir. Surmontant sa propre douleur, elle veilla sur sa bru avec un incomparable dévouement. Et, lorsqu’elle jugea la pauvre démente assez forte pour poursuivre sa route, elle reprit ce chemin du désespoir jusqu’à la côte, où elle s’embarqua avec la malheureuse femme pour la conduire en France, afin d’y vivre associées désormais dans la désolation et le deuil.
La mort de M. Hénault avait mis aux mains de ses meurtriers une somme qu’on pouvait évaluer à un million en espèces, lingots, banknotes, toutes valeurs qui ne pouvaient dénoncer leurs ravisseurs. Les recherches des diverses polices, tant dans les Guyanes qu’au Brésil n’aboutirent à aucune découverte. Force fut de renoncer à leur poursuite. Par les soins de Mme Hénault, une partie importante de la fortune fut réalisée, mais l’impossibilité d’établir le décès du petit garçon laissa subsister les titres de propriété que l’enfant censé disparu pourrait revendiquer ultérieurement. Un délai légal de vingt années était requis pour le retour de cette même propriété à la mère, seule héritière de son fils.
Mais qu’était-ce que cette perte d’argent en regard de l’effroyable catastrophe qui venait de bouleverser tout un foyer ? Pendant six années, Mme Isabelle Hénault demeura privée de raison. Puis, lentement, progressivement, la flamme de l’intelligence se ralluma en ce cerveau obscurci, et la cruauté du souvenir remplaça le bienfait de l’oubli.
Elle reprit possession d’elle-même. Hélas ! Les années écoulées dans la nuit de la pensée n’avaient point affaibli la mémoire, et l’événement sinistre se représenta à ses yeux avec toute la vivacité des premières impressions, comme si le drame s’était accompli la veille. Et les larmes de la mère infortunée brûlèrent ces yeux que l’amnésie bienfaisante avait rendus secs pendant six ans.
Alors, pour distraire cet esprit trop captivé par le chagrin, Mme Hénault mère donna à sa bru une enfant d’adoption, la fille d’une nièce, la petite Irène Corbon, orpheline elle-même de père et de mère, qui devint sa compagne de prédilection.
*
« Eh bien ! maman, c’est aujourd’hui que nous allons à Louannec pour remercier le petit Breton ?
– Oui, ma chérie, répondit Mme Hénault en souriant. Je n’aurais garde de l’oublier. Notre dette envers lui est assez grande pour que nous l’acquittions au plus tôt. Et grand’mère a tenu à nous accompagner, ajouta-t-elle en montrant sa belle-mère déjà habillée pour cette cérémonieuse visite.
– Certainement que j’y tiens, s’écria impétueusement la vieille dame. On n’a pas tous les jours l’occasion d’admirer un héros et de récompenser une belle action. »
Aussitôt après le repas, un grand break vint se ranger au pied du perron, et les trois femmes y prirent place. Vingt minutes plus tard, elles arrivaient à Louannec.
Ce fut une stupeur dans le village de voir s’arrêter la voiture devant l’humble maisonnette et descendre les deux dames chez la vieille Anna.
Cependant, depuis le matin, grâce aux voisines pressées de la raconter, l’histoire du haut fait de Pablo s’était répandue dans le bourg. Elle avait fait traînée de poudre et précédé la venue du garçonnet à l’école, où ses jeunes camarades lui firent une ovation, tandis que l’instituteur, justement fier de son élève, lui donnait l’accolade et lui décernait publiquement les plus brillants éloges.
C’était une première récompense, qu’allait rendre plus flatteuse encore l’intervention des dames Hénault.
À leur vue, l’excellente mamm Plonévez s’était un peu troublée. Elle avait fait asseoir ses visiteuses dans la grande salle à manger claire et luisante de son rez-de-chaussée et, les laissant seules une minute, avait prié sa plus proche voisine de courir jusqu’à l’école, afin de demander au maître qu’il laissât Pablo revenir à la maison.
Puis la bonne femme était retournée auprès de ses visiteuses et, pour leur souhaiter mieux la bienvenue, avait débouché deux bouteilles de vieux cidre mousseux. Les dames y avaient à peine mouillé leurs lèvres, mais Irène, que l’aventure de la veille avait quelque peu surexcitée, sans lui laisser d’autre mal, faisait honneur au pétillant breuvage, dont elle raffolait, d’ailleurs.
Ce ne fut point la commère, ce fut toute l’école, maître et adjoint en tête, qui ramena triomphalement Pablo vers la demeure de mamm Plonévez.
Et le petit mousse de la Coronacion, qui, vingt-quatre heures plus tôt, affrontait sans frémir sur un bateau d’emprunt la mer et les perfidies du brouillard, faiblit tout à coup devant cette manifestation de la sympathie universelle.
Il pâlit et chancela, lorsque Mme Hénault, se penchant vers lui, dit de sa voix, aussi douce que celle des cloches de Louannec et de Perros-Guirec dans les angélus du matin et du soir :
« Voulez-vous me permettre de vous embrasser, mon enfant ? »
S’il le permettait ? Il n’eût pas même osé espérer une telle récompense. Il lui sembla que les lèvres de la dame, en se posant sur son front, avaient la fraîcheur des pétales des roses qui, du printemps à l’automne, s’épanouissaient dans le petit jardin de la veuve.
Après la mère, ce fut l’aïeule qui l’embrassa. Et voici qu’au milieu du silence, l’accent très pur d’Irène prononça :
« Est-ce que je peux aussi l’embrasser, maman ? »
La permission fut gaiement accordée. Au milieu des sourires de l’assistance, Pablo s’avança, gauche et timide, vers cette belle petite fille vêtue de velours et de soie et, n’osant prendre la permission pour lui, tendit ses joues à cette bouche en fleur, plus fraîche encore que celle de sa mère.
Mais la fillette avait murmuré un mot dont la suavité avait porté au paroxysme le trouble du pauvre Pablo, ce mot « maman » qui prenait en cette intonation un charme plus grand encore.
Cette fois l’émotion fut trop forte. Il n’y put résister. Elle déborda en larmes que l’enfant s’en alla cacher dans les bras de mamm Plonévez, laquelle, voyant pleurer son fils adoptif, se transforma, à son tour, en fontaine de joie.
L’instituteur, de sa bonne voix de fête, mit un terme à ces effusions trop mouillées. Il plaisanta amicalement le petit « brave » sur sa faiblesse, et ramena le rire sur toutes les faces. Et l’allégresse fut à son comble lorsque Mme Hénault mère annonça que, le dimanche suivant, dans six jours, elle donnerait à Ker Gwevroc’h, en l’honneur de Pablo et de Mme Plonévez, une grande fête à laquelle elle conviait tous les villages d’alentour, et, en premier lieu, M. le recteur, M. l’instituteur et Mme l’institutrice, et les bonnes sœurs de Louannec. Il y aurait des réjouissances publiques, table ouverte, gâteaux et cidre, et champagne, et, le soir, à neuf heures, un feu d’artifice importé tout exprès de Paris.

V
Joies d’enfants.
L’hiver se montra très clément, et quand le retour du printemps gonfla derechef les bourgeons, l’année fut révolue depuis le terrible matin où le mousse Pablo avait été arraché à la mort, par Alain Plonévez, sur le bordé de la Coronacion agonisante.
Alain n’était pas revenu à Louannec depuis le mois d’avril, époque de son départ de Paimpol. Il avait écrit fréquemment à sa mère, et, en dernier lieu, de Nantes, où il s’était fixé pour préparer, sans interruption, ses examens pour le brevet de capitaine au long cours.
Les épreuves n’auraient pas lieu avant le mois de juin, et le courageux garçon ne voulait pas perdre une seconde de son temps. Il comptait bien prendre sa revanche de cette absence de dix-huit mois, lorsqu’il viendrait se reposer sous le toit de la vieille mère, pour quelques semaines, avant de chercher un commandement de navire, voilier ou à vapeur, car il tenait à satisfaire à l’une ou l’autre exigence.
Mais, s’il n’était pas revenu, Alain n’en était pas moins tenu au courant des événements accomplis dans le pays de Tréguier par de longues et pittoresques missives de Pablo, son frère d’adoption.
Car, à cette heure, Pablo avait justifié toutes les espérances de ses maîtres et faisait le plus grand honneur à l’école de Louannec. Il mettait l’orthographe sans accroc, possédait à fond sa grammaire, battait les premiers de la classe, en un mot était mûr pour entrer à l’École Saint-Charles, de Saint-Brieuc, préparatoire au Borda.
On lui donnait approximativement treize ans. Le maire avait fait appeler Mme Plonévez et l’avait interrogée. L’enfant, sur le compte de qui les consuls français d’Amérique n’avaient pu fournir aucun renseignement utile, avait été inscrit à l’état civil sous le nom de Paul Plonévez, et, à partir de ce moment, couraient les délais légaux qui permettraient plus tard à la veuve de lui donner son nom avec le consentement de l’intéressé lui-même, si celui-ci n’avait pas retrouvé auparavant sa famille légitime.
Toutes ces choses, Pablo les avait racontées à Alain.
Le jour anniversaire de son sauvetage, il écrivit à son « grand frère » une longue lettre qui dut intéresser vivement le laborieux matelot :
« Mon cher Alain,
« Il y a juste un an, aujourd’hui, que vous m’avez sauvé en me décrochant du portemanteau de la Coronacion. Vous le rappelez-vous ? C’était terrible ; rien qu’au souvenir, je frissonne encore et je remercie le bon Dieu de la grâce qu’il m’a faite et du bonheur qu’il m’a accordé.
« Car je suis très heureux, mon cher Alain. Notre mamm Plonévez me gâte, M. le recteur et M. l’instituteur sont contents de moi. Je suis le premier à l’école et au catéchisme ; les camarades ne m’en veulent pas pour ça ; ils disent, au contraire, que c’est juste. Moi, je vous le répète pour que vous sachiez bien ce que fait votre petit frère Pablo, vous qui êtes occupé par des études bien plus sérieuses.

« Il y a une autre raison à mon bonheur. Tous les jeudis et les dimanches de quinzaine, je vais passer la demi-journée dans la belle maison de Ker Gwevroc’h, vous savez, celle de la dame que j’ai pu tirer du brouillard de la grève.
« Oh ! oui, elle est belle, cette maison. C’est vieux, mais la mère de Mme Hénault, qui s’appelle aussi Mme Hénault, l’a fait réparer, et c’est bien ce qu’il y a de plus magnifique dans le pays, avec le château du Bois-Riou et le manoir du Trévou, qui aurait bien besoin, par exemple, qu’on le réparât de la même façon.
« On m’y reçoit comme si j’étais de la famille ; on m’y donne beaucoup de bonnes choses à manger, parce qu’il y a un chef cuisinier très habile, qui sait faire un tas de gâteaux et de friandises. Le soir, quand je m’en retourne, on me fait un paquet de ces choses, qu’on me met dans une espèce de sac que Mlle Irène a cousu exprès pour moi, afin que je régale la mamm. Et il y en a toujours pour les voisines et pour mes camarades, à preuve que, l’autre jour, Yves Le Troadec, qui est gourmand comme deux douzaines de chats, m’a dit dans le creux de l’oreille :
« – Dis donc, l’Espagnol, est-ce que tu ne pourrais pas y aller tous les jours, chez les belles dames du Trévou ? »
« Je lui ai donné un coup de poing et il s’est ensauvé en riant comme un fou de sa bonne farce.
« Pour en revenir à la belle maison, mon cher Alain, je vous dirai qu’elle est très grande et bâtie, d’après ce que m’a appris M. l’adjoint, à l’italienne. Elle est carrée avec douze fenêtres sur chaque face, six au rez-de-chaussée, six au premier étage. On y entre par quatre grands perrons avec escaliers de huit marches. En dessous sont les cuisines, l’office et les caves. Il y a une très grande terrasse sur le toit, qui est plat et garni d’une balustrade.
« Bref, comme vous voyez, c’est un véritable château.
« À l’intérieur, il y a d’immenses pièces : deux salons, une salle à manger, une salle de billard, une bibliothèque avec des livres superbes, que je voudrais bien regarder. S’il pleut, nous allons jouer, Mlle Irène et moi, avec d’autres enfants, dans une salle qu’on appelle le vestibule des pauvres, parce qu’il paraît qu’il y a cent ans, c’était là que la dame du château, une comtesse, distribuait des secours aux pauvres gens des environs, tous les dimanches après les vêpres. Maintenant, Mme Hénault, la vieille, fait la même chose, mais c’est le vendredi seulement, avant midi.
« Il y a toutes sortes de jouets dans ce château, mon cher Alain, mais ce sont, en général, des jouets de filles, et Mlle Irène, qui a onze ans passés, est presque trop grande pour s’y amuser.
« Elle aime bien mieux courir et sauter dans le parc, et j’avoue que je préfère aussi cela.
« On lui a installé, sous un hangar, un petit gymnase, et c’est très drôle de la voir, habillée en garçon, faire des cabrioles au trapèze et à la barre fixe, ou grimper à la corde lisse. Moi, je n’ai pas eu de peine à l’imiter, vu que je sais tout ça par cœur, puisque j’ai été mousse.
« Il y a un mois, Mme Hénault, la jeune, lui a fait cadeau d’une bicyclette. Alors, vous comprenez bien, Alain, que, tantôt elle, tantôt moi, nous sommes toujours à cheval sur cette bicyclette, et nous roulons dans toutes les allées du parc, qui est aussi grand que celui du Bois-Riou.
« À propos, il faut que je vous confie une chose.
« Mlle Irène n’est pas la fille de Mme Hénault, la jeune. Elle n’est que sa nièce, la fille d’une autre nièce de Mme Hénault, la vieille. Elle l’appelle « maman », parce qu’elle n’a plus de parents et que Mme Hénault, la jeune, l’a adoptée pour se consoler de la perte de son petit garçon.
« Et, tout de même, elle ne se console pas, la pauvre dame, et ça fait de la peine de la voir toujours si triste. Elle passe quasiment son temps à pleurer.
« Moi, ça me retourne de la voir ainsi, et, si j’osais, j’essaierais de lui dire quelque chose. Mais… quoi ? Je l’aime tant, cette dame, plus que je ne le comprends, et je ne sais pas pourquoi.
« Quand je joue avec Mlle Irène, au plus fort de nos courses dans le parc, je m’arrête net dès que Mme Hénault se montre dans une allée. Ça me gâte tout mon plaisir, et j’ai bien envie de pleurer aussi.
« Et puis elle a une façon si drôle de me regarder ! Ses beaux yeux, qui sont comme du velours noir, se posent sur moi avec une telle affection que je suis prêt à me jeter à son cou et à lui dire « maman » comme Mlle Irène. Mais je n’ose pas, je n’en ai pas le droit. Pourtant, il me semble que ma mère, à moi, devait ressembler à cette pauvre dame, si jolie et si triste.
« L’autre jour, il n’y a pas une semaine, elle est venue tout d’un coup près de moi, sans que je l’eusse entendue venir. Elle m’a posé sa main sur la tête, en souriant et m’a dit :
« Ainsi, petit Pol, il paraît que votre vrai nom, c’est Pablo, et que, dans le pays, on vous appelle « l’Espagnol » ? Est-ce vrai ?
« – Oui, madame », ai-je répondu.
« Alors, elle s’est penchée, elle m’a mis un baiser sur le front et j’ai senti tomber une larme. Puis elle s’en est allée, la poitrine courbée, en sanglotant.
« Et, moi, je suis resté là immobile, sans un mot, très bête. Et, quand Irène est revenue de sa course à bicyclette, elle m’a retrouvé à la même place, et je n’ai plus eu le cœur à jouer. »
Là se bornait la missive du petit garçon à son « grand frère ». Le bon Alain dut la relire à plusieurs reprises, car elle avait fait naître de singulières hypothèses en son esprit.
À la fin de juin, une nouvelle épître vint donner une vraisemblance plus grande à ces hypothèses.
Pablo commençait par narrer au marin les événements de Louannec et d’ailleurs, c’est-à-dire les faits accomplis dans un rayon de deux ou trois lieues.
D’abord, il lui racontait les impressions de sa première communion, qu’il venait de faire à l’occasion de la Saint-Jean. Et rien n’était plus touchant que les élans de foi et de piété de cette jeune âme en éveil.
Puis, sans transition, avec une soudaineté d’accent qui trahissait celle de l’émotion subie, il se mettait à lui parler des choses qui mettaient en rumeur le pays, de Port-Blanc à Trébeurden.
« Figurez-vous, Alain, qu’il nous est venu, ces jours-ci, un magnifique yacht à vapeur. Il est demeuré vingt-quatre heures à Perros, après quoi, il est reparti pour le Légué. Mais il doit revenir, dit-on, et vraiment, j’en serai ravi, parce que c’est le plus joli navire que j’aie jamais vu.
« Le plus singulier, c’est qu’il appartient au même propriétaire que la Coronacion, le trois-mâts sur lequel vous m’avez recueilli. Ce monsieur est un Américain très riche, qui se nomme Gonzalo Wickham.
« Il venait, paraît-il, pour interroger le maire de Perros et les douaniers sur la perte de son bateau, il y a un an, et s’enquérir de ce qu’on avait pu retirer du bord. On lui a répondu que, s’il avait des réclamations à formuler, il venait trop tard, que l’épave avait été vendue par lots de bois et de fer, après les délais fixés par la loi.
« Il n’a pas insisté sur ce sujet et s’est contenté de se promener dans le pays, qui a dû beaucoup lui plaire, car on dit qu’il a loué la plus belle villa de Trestraou pour la saison. Comme je revenais de l’école, avec les camarades, il y a trois jours, je l’ai rencontré. Il était en voiture découverte, avec un autre homme. Il n’a pas fait attention à nous, mais j’ai pu bien le voir.
« C’est un assez grand monsieur, assez gros, avec des favoris noirs. Il a l’air d’être fort méchant et très riche, vu qu’il a des bagues, avec d’énormes pierres, à tous les doigts, et une immense chaîne d’or, avec des breloques, à son gilet.
« Mais, ce qui m’a le plus frappé, c’est que l’homme qui l’accompagnait ressemblait beaucoup, oh ! mais, beaucoup, à Ricardo, vous savez, l’autre, le méchant matelot que vous avez sauvé avec moi. Seulement comme celui-ci a de la barbe et que Ricardo était toujours rasé, je n’oserais pas affirmer que c’est lui.
« S’ils reviennent ici, je vous l’écrirai. »
Ils revinrent et Pablo écrivit.
Alain apprit de la sorte assez de détails pour que ses suppositions antérieures prissent corps.
Ce « monsieur Gonzalo Wickham », le propriétaire du beau yacht qui avait émerveillé Pablo, était un homme d’une quarantaine d’années, réalisant en sa hideuse perfection le type du parvenu sans vergogne que les Américains du Sud désignent par le mot rastracuero, dont nous avons fait « rastaquouère ».
Il devait être puissamment riche, si l’on jugeait sur l’apparence. Gras et bedonnant, basané, rutilant d’or et de pierreries, il avait l’air de suffisance classique que l’on prête à ses pareils et, au premier abord, aurait pu passer pour un « brave homme », insignifiant et vaniteux, n’eût été l’expression basse et servile de ses yeux noirs où brillait, à certaines occasions, l’éclair d’une cupidité féroce.
Quelle était l’origine de ce personnage dont le nom de famille saxon s’alliait à un prénom latin ? Un observateur expert en l’art de discerner les caractères ethniques n’eût pas hésité. Il eût reconnu, dans ce produit du croisement de plusieurs sangs, un métis d’Indien garani, tupayan ou roucouyenne, d’Espagnol descendu des conquistadores, et d’Anglais venu du Royaume-Uni avec les compagnons de Penn, non sans quelque soupçon de parenté cafre.
Cette constatation n’eût pas suffi. Il eût fallu préciser encore le berceau du señor, ou senhor, Gonzalo Wickham. Était-il Brésilien, Argentin, Colombien, Péruvien, Chilien ? Lui seul aurait pu fournir le renseignement cherché.
Il y avait dans sa démarche quelque chose de l’allure et de la figure du tigre, mais d’un tigre alourdi, qui aurait pris du ventre.
Même face arrondie par le haut, accusée en son maxillaire inférieur, même bajoues, mêmes dents blanches aux canines aiguës, mêmes mains molles susceptibles de se rétracter en griffes. Et l’œil aussi participait de cette débonnaireté sommeillante que l’on trouve chez les félins, et sous laquelle on voit luire la sanguinaire cruauté de la prunelle mobile.
Cet homme riche avait loué, sur la plage de Testraou, l’une des plus belles villas récemment construites, appelée Ar rock, « le Rocher », parce que de sa terrasse, surplombant la plage, on descendait jusqu’à un bloc granitique émergeant du milieu du sable.
En cette villa du Rocher, le propriétaire du yacht s’était installé, en compagnie de Mme Wickham, son épouse, personne non moins sang-mêlé, non moins fastueuse que son mari, mais infiniment moins laide, quoique beaucoup plus voisine de l’obésité.
Autour du couple se mouvait un assez hétéroclite assemblage de domestiques de toutes les couleurs : deux nègres, un Chinois, un Indien du plus pur aspect caraïbe ; plus, des blancs si cuivrés qu’on les eût pris pour des noirs déteints, au nombre de trois.
Ces gens de maison n’étaient que l’équipage du yacht Mapana, étrange vocable d’un navire de plaisance, rappelant le serpent le plus venimeux du Nouveau Monde, après son congénère le crotale.
Il est vrai que, quinze jours après son arrivée à Perros-Guirec, le señor Gonzalo, sans en avoir informé le bureau maritime, faisait ajouter, au-dessus de ce nom de Mapana, cet autre nom, en magnifiques lettres d’or gothiques : Cacique, de façon que la première désignation s’effaçât, en quelque, sorte, à l’ombre de la seconde.
Malgré leur faste, le métis, sa compagne et ses matelots-domestiques ne parvinrent pas à se concilier les sympathies des habitants du bourg. On leur trouvait une odeur exotique déplaisante. Ces gens en pain d’épice, en dépit de leurs breloques et de leurs bijoux, n’inspiraient pas la confiance. Pêcheurs et paysans hochaient la tête ; quelques-uns même disaient, d’un ton profondément sceptique :
« Après ça, c’est peut-être bien faux, toute cette quincaillerie qu’ils étalent ? »
Mais, dans les villes d’eaux, petites ou grandes, on a trop naturellement une tendance à marquer d’un sourire la méfiance conçue. Tant que les « baigneurs » paient en bonne monnaie sonnante et trébuchante, on leur fait crédit, ce qui, somme toute, est rationnel.
Gonzalo Wickham et sa suite payèrent fort bien leurs fournisseurs tout le temps qu’ils demeurèrent à Perros-Guirec. En conséquence, ils furent, ainsi que le veut l’adage, « considérés ».
Il advint que, vers le milieu d’août, un nouveau compagnon vint s’adjoindre aux précédents.
Celui-ci était un grand et solide garçon d’une trentaine d’années, à l’épaisse barbe noire. Il n’avait pas l’air à son aise et se montrait peu dans le bourg. On l’avait rencontré pourtant dans la campagne, sur les roches qui s’élèvent entre Trestrignel et Trestraou, à l’opposite de la Pointe du Château. On eût juré qu’il ne voulait pas se laisser voir, et un pêcheur roscovite, venu pour vendre du poisson dans les hôtels, avait été apostrophé, dans le propre dialecte léonais, par ce promeneur farouche, qui parlait couramment le breton. Comme ses pareils il couchait, un jour sur deux, à la villa Ar Rock, l’autre sur le yacht.
Cependant, le seigneur Wickham parcourait la région en touriste. Il avait, tout d’abord, visité les curiosités les plus proches, le chaos granitique de Ploumanac’h et de Trégastel, les trois vallées des Troïerou, les ruines du château de Barac’h.
Puis, il avait étendu le cercle de ses excursions, poussé jusqu’aux ruines bien autrement belles de Tonquédec, dans la vallée du Léguer, jusqu’aux grèves solitaires de Saint-Michel et de Plestin.
Enfin, il s’était rendu à Paimpol, à Tréguier, et, en revenant d’une de ces courses en voiture, avait paru émerveillé des sites du Bois-Riou et de Ker Gwevroc’h, où la verdure s’allie aux paysages de mer.

Il avait donc arrêté son landau de louage, et, avec un sans-gêne qu’excusait seule sa qualité d’étranger, peu au courant de la politesse française, il avait demandé à saluer les dames Hénault.
La belle-mère d’Isabelle Corsol avait seule reçu le rastaquouère et son épouse. La vieille dame professait une aversion invincible à l’encontre de ces « espèces » et la manifestait sans réserve.
Le double échantillon qui s’offrit à elle sous les traits du señor et de la señora Wickham ne l’amena point à modifier ses sentiments.
Elle accueillit ces étranges visiteurs avec un dédain qui eût mis en fuite de tout autres gens. Et son attitude se fit plus méprisante encore lorsque le sang-mêlé demanda à parcourir le beau domaine, qu’il se déclara prêt à payer la somme d’un million.
« Ker Gwevroc’h n’est pas à vendre », se contenta de trancher sèchement Mme Hénault.
Force fut au couple indiscret de reprendre le chemin de Trestraou, où, le même soir, le propriétaire du Cacique tint conseil avec deux de ses subordonnés, les plus importants, sans doute, les mieux investis de sa confiance.
De ces deux hommes, l’un était le matelot farouche qui s’était trahi en parlant la langue de ses compatriotes, l’autre, ce Ricardo Lopez que Pablo avait si bien cru reconnaître sous sa barbe à tous crins.
Le dialogue qui s’engagea entre ces trois hommes eût été singulièrement instructif pour un policier international qui aurait pu l’écouter en cachette.
Gonzalo Wickham s’était assis en un vaste rocking chair, une de ces balancines dont l’usage est surtout utile pendant les longues traversées de mer. Il fumait un volumineux cigare, tandis que le Breton bourrait sa pipe et que l’Argentin roulait des cigarettes de tabac havanais.
« Tu sais, commença le métis, s’adressant à l’Argentin en sa langue, que je suis entré aujourd’hui même chez la vieille dame Hénault. Elle a toujours bon pied bon œil, et même un œil terrible. Je te recommande, mon vieux Ricardo, de ne point l’approcher de trop près, car il ne lui faudrait pas longtemps pour te reconnaître.
– Elle me croit mort, répliqua l’Argentin. Songez donc qu’il y a douze ans écoulés.
– N’importe ! Et, si elle te reconnaissait, elle ne manquerait pas de te poser des questions gênantes. Il vaut donc mieux qu’elle ne te voie pas avant notre tentative. »
Il fit une pause, et reprit, en français :
« Maintenant, écoute ce que j’ai résolu. Tends tes oreilles, Ervoan, car je t’ai assigné un rôle dans l’aventure. »
Le Breton secoua la tête et répondit :
« Avant toute chose, patron, rappelons nos vieilles conventions. Tout ce que vous voudrez, n’est-ce pas, en dehors du sang à verser, du sang français surtout, et particulièrement en ce pays qui est le mien. Rien que d’y être revenu, d’en avoir respiré l’air, de me retrouver si près de ma pauvre vieille mamm, je me sens tout chaviré et, bien sûr, je flancherais.
– Hé ! qui parle de sang, tête dure ? Pas plus que toi je ne le désire. Ça fait des taches et ça laisse des traces. Encore si tu savais jouer du machete ou de la navaja comme Ricardo ! Mais non. Ce que j’attends de toi est bien plus facile, et même ta vieille femme de mère y trouvera son profit, car je te donnerai, tout exprès pour elle, cinq beaux billets de mille francs de votre Banque de France, que tu lui feras accepter comme le fruit de tes économies. »
Et, après ce préambule, le señor Gonzalo s’expliqua en toute précision.
Ce qu’il voulait, c’était qu’on lui ramenât, vivant et bien portant, ce petit Pablo qui avait échappé au naufrage de la Coronacion. Cet enfant, il ne le disait pas, lui était indispensable pour l’accomplissement de ses projets, lesquels étaient d’une malhonnêteté si simple qu’elle frisait la naïveté et décelait une candeur toute américaine dans l’âme de ce chef de bandits, car le señor Gonzalo prétendait se servir de l’enfant à trois fins également criminelles.
D’abord comme otage en prévision des découvertes fâcheuses que pouvaient encore faire les membres survivants de sa famille, ledit Pablo étant, ni plus, ni moins, un enfant volé à ladite famille, à la suite d’un attentat.
Ensuite, comme héritier et représentant de son père dont les grands biens étaient encore sous séquestre, en partie, et seraient remis à l’enfant sur présentation des pièces d’identité que détenait le seigneur Wickham.
Enfin, à titre de moyen de chantage à l’encontre de cette même famille, qui pleurait sa perte, et n’hésiterait pas à le racheter au prix des plus grands sacrifices.
Tout ceci, le métis le tut à ses complices, se bornant à leur donner des ordres précis. Quand il eut fini de parler, Ricardo Lopez hocha la tête en signe de doute :
« Señor, dit-il, l’affaire me semble aventureuse. Outre que nous ne savons pas ce que fera le garçon, lorsqu’il aura atteint sa majorité, je ne vois pas très bien comment nous pourrions l’empêcher de rejoindre sa famille, ou empêcher sa famille de le retrouver. Vous connaissez mon opinion sur les demi-mesures : « Il n’y a que les morts qui ne parlent pas ». Vous avez commis une première faute en laissant vivre cet enfant ; n’allez pas en commettre une seconde en vous faisant connaître à lui comme son ravisseur. Et, si vous consentiez à suivre un instant mes avis, j’aurais bientôt fait de réduire pour toujours au silence une bouche qui peut nous faire pendre, guillotiner, garroter ou électrocuter, selon le mode désagréable d’exécution en usage chez le peuple qui nous donnera la chasse. »
En entendant ces mots, Ervoan se leva, serrant les poings.
« Si ce malheur t’arrivait, Lopez d’enfer, gronda-t-il, je te jure, sur la tête de ma mère, que ton compte ne serait pas long à régler. C’est moi qui ai tiré l’enfant de tes griffes, lorsque ton machete menaçait sa poitrine, et ta voix a gardé l’enrouement que lui donna la pression de mes doigts sur ton gosier. Ne t’avise pas de recommencer, car, cette fois, je serrerais plus fort. »
L’Argentin s’était levé aussi, avec un ricanement qui donnait à sa face bestiale l’aspect d’un mufle de jaguar dont les babines retroussées laissent luire les dents. Sa paume caressait le manche d’un de ces longs couteaux à gaine de cuir que les gauchos et les rastreadores portent dans leurs ceintures lâches.
Mais le « patron » intervint avec autorité :
« Paix, brutes maudites ! Pensez-vous que je vais vous laisser longtemps échanger de pareilles tendresses ? Quand vous aurez rempli mes ordres, vous serez libres de vous étrangler, de vous éventrer en toute liberté. Mais, jusque-là, je vous ferai bien voir que je suis le maître. »
Les deux ennemis se turent, et Wickham acheva d’exposer son plan.
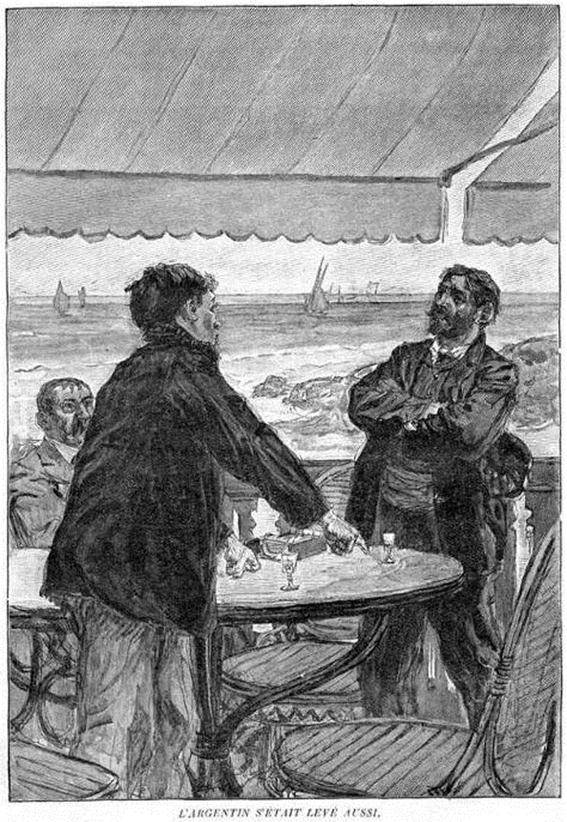
Son séjour à Perros n’avait eu d’autre fin que d’assurer le rapt de l’enfant. Depuis plus d’un mois, Gonzalo rassemblait les renseignements indispensables. Il savait que le petit Pablo vivait sous le toit de la bonne Anna Plonévez et qu’il se rendait fréquemment chez les dames de Ker Gwevroc’h. Une impérieuse nécessité exigeait qu’il disparût du pays.
Le métis n’avait pas voulu charger Lopez de l’enlèvement. Il se méfiait de la promptitude de celui-ci à jouer du couteau et savait que plusieurs raisons l’eussent porté à se défaire du petit garçon.
En conséquence, il avait pris ses dispositions pour que celui-ci fût attiré sans violence jusqu’à une grève où lui, Gonzalo, aidé de quelques hommes sûrs, l’emporterait, bâillonné et ligotté, sur le yacht, qui cinglerait aussitôt vers des cieux plus propices aux pirateries.
« C’est pourquoi j’ai compté sur toi, Ervoan, conclut Wickham. Tu te rendras chez ta mère, tu y verras l’enfant. Je sais qu’il avait pour toi une vive affection. Il ne concevra aucune méfiance à ton endroit, et tu n’auras qu’à l’amener au lieu que je t’aurai désigné. Le reste me regarde. Acceptes-tu ? »
Ce disant, il étalait sur une table les cinq billets bleus, prix de l’affreux marché à conclure.
Le Breton hésita quelques secondes. Puis, saisissant les banknotes d’un geste brusque, il dit, d’une voix rauque :
« J’accepte. »

VI
Tête-à-tête.
C’était le soir, un beau soir d’été, tout doré par les reflets du couchant. Un rayon, décoché par le soleil comme une flèche, vêtait de lumière la maisonnette de la veuve Plonévez, et les pierres en paraissaient tressaillir de joie.
La rue était déserte, la maison le paraissait aussi. Dans ce pays où tout le monde se connaît, la méfiance n’a pas beaucoup de précautions. L’huis entrebâillé touchait à peine le chambranle du bout de son pêne rouillé. Il suffisait d’une poussée de l’épaule pour l’écarter entièrement.
Un homme s’avançait sur le chemin, l’œil fixé sur cette porte entr’ouverte. Il marchait d’un pas hésitant, la tête penchée et sournoise, l’allure cauteleuse, à la façon de quelqu’un qui médite un mauvais coup.
Elle l’attirait, cette maison ; elle le fascinait. Du bord opposé de la route, il la couvait des yeux. Son regard inquiet la sondait, en interrogeait les abords, cherchait un motif de se décider à en franchir le seuil.
Brusquement, il s’y résolut. En trois pas, il enjamba la chaussée ; il poussa le battant et entra.
Pas un bruit à l’intérieur. Dans l’étroit corridor carrelé, le mystérieux visiteur s’arrêta court, pris d’un tremblement incoercible, et porta les deux mains à sa poitrine, comme pour en comprimer les battements. On eût dit qu’il allait défaillir.
Pourtant, il était grand et fort. Son visage hâlé disait la plénitude de la santé dans un organisme robuste. D’où pouvait venir une telle faiblesse à cet hercule ?
Il la domina néanmoins, et aspira longuement, évitant qu’on pût ouïr son souffle.
Puis, s’appuyant à la cloison de briques, il pénétra plus avant. Sa main palpa un loquet de cuivre et y demeura immobile pendant quelques secondes.
Nul bruit de l’intérieur ne vint le détourner. Avec d’infinies précautions, il tourna la poignée de laiton et se risqua à pousser cette deuxième porte.
C’était celle de la salle à manger, une pièce à plafond bas, éclairée de deux petites fenêtres, prenant jour, l’une sur la rue, l’autre sur l’étroit jardin, à solives saillantes, à cheminée de bois, du reste carrelée comme le couloir, et blanchie à la chaux.
Sur la cheminée, une pendule muette et sans mouvement sous un globe de verre, entre deux vases de porcelaine abrités de même façon et garnis de fleurs de papier ; au-dessus un mauvais tableau, peint par quelque naïf artiste du pays et représentant la Stella maris, le brick de feu le « capitaine » Plonévez ; au mur, accrochés en ordre, des portraits photographiques défraîchis : trois hommes, une femme : le père, la mère et les deux fils.
Au centre de la pièce une table de bois blanc, ronde, couverte d’un tapis de toile cirée, était entourée de six chaises paillées en bois de cerisier poussé au rouge clair.
Contre le mur du fond, un buffet vitré mettait en montre l’humble vaisselle de faïence ou de métal blanc, les verres et les boîtes enfermant les six couverts de ruolz réservés pour les grandes occasions.
Tel était le mobilier de cette salle à manger rustique. Mais, en en franchissant le seuil, on avait tout de suite l’odorat charmé par le parfum qui emplissait la pièce.
Il s’exhalait, ce parfum, de deux gros bouquets de fleurs, installés en des pichets de grès sur un second buffet, très bas, formant console.
Ces fleurs venaient de l’enclos. Tous les deux jours, Anna Plonévez les renouvelait avec soin, les cueillant elle-même aux magnifiques rosiers de son jardin, aux tonnelles de jasmin ou de chèvrefeuille, dans les plates-bandes ornées de pois de senteur, de verveines, de balisiers et de glaïeuls.
L’homme s’arrêta derechef ; derechef il parut en proie à la défaillance déjà éprouvée.
Et, tout d’un coup, n’y tenant plus, il traversa violemment la salle, alla droit à la cheminée et… décrocha le portrait de femme qui pendait à la gauche de la pendule. D’un geste passionné, il le porta à ses lèvres et se mit à le couvrir de baisers.
Soudain, un pas retentit derrière lui, dans le corridor, un pas élastique et léger, le pas d’un enfant.
À ce moment même, l’homme venait de tirer de sa poche une enveloppe gonflée de papiers.
Au bruit venu du corridor, il glissa l’enveloppe sous la pendule de la cheminée, et, d’un geste non moins vif raccrocha le portrait à son clou.
Celui qui entrait n’était autre que Pablo.
À la vue d’un étranger dans la maison, il s’arrêta, interdit, sur le pas de la porte.
L’homme se retourna. Un cri d’allégresse jaillit des lèvres de l’enfant.
« Ervan ! Ervan ! C’est toi ? »
Les bras ouverts et tendus, il courut vers le singulier malfaiteur.
Il faut croire que la sympathie était ancienne et profonde entre les deux personnages, car l’homme enlaça l’enfant d’une chaude étreinte et l’embrassa à deux reprises.
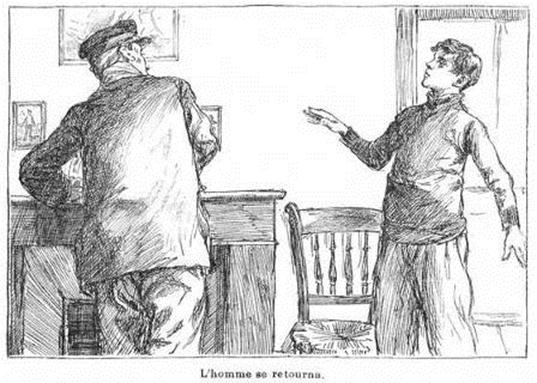
« Ah ! petit Pablo, petit Pablo ! Je te revois donc ! Il y avait dix-huit mois que je te croyais noyé. »
Certes, il mentait en parlant de la sorte, mais, tout de même, sa joie était sincère. Il était visible que ce rude matelot adorait le petit garçon.
On ne s’embrassait plus, mais les mains retenaient les mains. L’homme riait et pleurait à la fois ; le gamin le considérait avec des yeux émerveillés.
« Tu me croyais noyé, Ervan ? C’est vrai que j’en ai été bien près. Tu ne sais pas ? C’est le fils de la maison, le fils de mamm Plonévez, mon ami Alain, qui m’a sauvé, qui m’a ramené ici.
– Ah ! proféra l’autre, dont la voix s’étrangla.
– Oui, poursuivit l’enfant. C’est Alain. Il te ressemble. On dirait que c’est ton frère. »
Les lèvres de l’homme s’agitèrent à plusieurs reprises, sans qu’aucun son en sortît ; sa poitrine se soulevait tumultueusement. Il lâcha l’une des mains de Pablo pour écraser à moitié, sous ses paupières, des larmes qui, malgré tout, coulèrent sur ses joues bronzées et allèrent se perdre dans son épaisse barbe noire.
« Tu pleures ? questionna le petit, interdit par ce spectacle inattendu. Tu pleures parce que j’ai dit qu’Alain te ressemble ! Mais c’est que c’est vrai, tu sais ? »
Et, plus bas, timidement il ajouta :
« Il avait un frère, Alain, un frère dont on ne parle jamais devant mamm Plonévez, parce qu’il est mort. »
Ervan tremblait comme une feuille. Il tenait les yeux baissés, n’osant regarder son interlocuteur.
À la fin, d’un organe rauque, saccadé, il demanda :
« Alors, il y a dix-huit mois que tu es ici, dans cette maison, chez… »
Il ne put prononcer le nom. Un spasme le suffoqua.
« Oui, il y a dix-huit mois. Quand Alain m’a retiré de l’eau, on m’a porté ici. Mamm Plonévez m’a pris, m’a soigné, m’a gardé. Elle m’aime bien, et moi aussi, tu sais. Elle est si bonne, si pieuse. Et puis elle a eu tant de chagrin. Elle pleure tant, quand elle pense à… celui qui est mort ! C’est pour ça qu’Alain lui a dit, quand j’ai été couché là-haut : « Mamm, nous allons le garder, pas vrai, ce moussaillon ? Ça ne te consolera pas tout à fait, mais ça te fera un fils de plus pour remplacer mon frère Ervoan. » Car, tu ne sais pas ça, il s’appelait Ervoan, le frère d’Alain, un nom qui est presque la même chose que le tien. Ervoan, – Ervan. Il n’y a pas de différence. »
Il disait tout cela ingénument, sans remarquer le trouble croissant de celui à qui il parlait. Il poursuivait :
« En sorte que mamm Plonévez m’a donné la chambre de son fils aîné, son propre lit. Quel dommage qu’il soit mort ! »
Et, brusquement, changeant de sujet, exprimant une surprise qu’il n’avait pas eue au premier moment, l’enfant se prit à interroger :
« Mais toi, Ervan, comment se fait-il que tu sois ici ? Tu la connais donc, toi aussi, la chère mamm Plonévez ? »
D’un accent qui grondait comme un feulement étouffé, le matelot du Cacique répondit, au hasard :
« Oui, un peu ; je connais surtout Lân.
– Lân ? Tu dis Lân, comme les gens d’ici ? Tu parles breton peut-être ? Tu es du pays ? »
Mais déjà l’autre s’était ressaisi.
Le dialogue devenait dangereux ; il ne fallait pas s’y attarder. Au surplus n’avait-il pas une besogne à faire ?
Dominant donc son trouble, maîtrisant les hoquets de sa gorge, celui que Pablo appelait Ervan s’expliqua :
« Écoute, petit : ce n’est pas tout ça. La vérité, c’est que je suis venu pour toi, pour te voir.
– Pour moi ? prononça l’enfant, les yeux grands ouverts.
– Oui, pour toi. J’avais appris ta présence dans le pays. On m’avait indiqué cette maison. Alors, tu comprends, je voulais t’embrasser. Je suis venu.
– Mais, tu m’as dit, tout à l’heure, que tu me croyais mort. »
Ervan s’aperçut de sa maladresse. Il était trop tard pour chercher à la réparer. Bredouillant, mal à l’aise, désireux de couper court aux questions embarrassantes, il prit la tangente et répliqua :
« Écoute, Pablo ! Veux-tu faire une chose, venir avec moi, un tour seulement, sur la grève ? Nous causerons bien plus à notre aise. »
Il insista, afin de mieux séduire l’enfant :
« Tu as été mousse, tu aimes les beaux bateaux. Il y en a un très beau dans la rade.
– Oh ! oui, je sais, ce yacht, qui s’appelait le Mapana, et qui s’appelle à présent le Cacique ?
– Tout juste. C’est sur lui que je suis embarqué. Je puis te le faire visiter en détail. Tu seras content de ta visite. »
Il avait repris la main du garçonnet ; il l’entraînait vers la porte. Il avait hâte de sortir de cette maison, car, maintenant, il étouffait sous ce toit.
Trop de souvenirs l’assaillaient. Le passé l’enveloppait, l’entourait d’une chaîne. Il avait l’horreur de lui-même, de sa vie perdue, de son abjection présente.
« Je veux bien », avait consenti Pablo.
Mais, tout à coup, il se dégagea d’une brusque secousse, et, riant, les yeux pleins de malicieuse gaîté, il s’écria :
« Seulement, tu comprends bien que tu ne peux pas t’en aller comme ça, sans avoir bu une bolée de cidre ? Mamma Plonévez ne me le pardonnerait pas. »
D’un bond, il sortit de la salle, ouvrit une porte du corridor donnant sur le jardin, et le matelot put l’entendre, appelant à plein gosier :
« Mamma Plonévez ? Mamma Plonévez ? où êtes-vous ? Venez vite ! »
Le forban s’affola. Tout, tout plutôt que cette rencontre, trop chère et trop redoutable ! Misère ! Il ne fallait pas que cela fût. Il était « mort », Pablo venait de le lui dire. Il devait rester « mort ».
Profitant de l’absence momentanée du mousse, sans réfléchir aux conséquences de cette fuite, aux commentaires qu’elle provoquerait, aux périlleuses recherches auxquelles elle donnerait lieu, il s’élança, tête baissée, vers la porte.
Et voilà que cette porte fut poussée. Une voix qu’il connaissait bien, qui fit tressaillir ses entrailles, répondait aux appels de Pablo :
« Me voilà, petit, me voilà. Je suis ici. Qu’est-ce qu’il y a ? »
Mamm Plonévez entrait, effarée, dans la salle à manger. Le matelot avait reculé, courbant le front, honteux, essayant de se voiler la face.
Mais qui peut tromper l’œil d’une mère ?
À peine ceux d’Anna Plonévez eurent-ils dévisagé l’intrus, qui pénétrait ainsi sous son toit, qu’une exclamation sourde jaillit de sa poitrine, tandis que, vacillante, elle s’accrochait à une chaise.
« Jésus ! Maria ! Mon fils ! mon fils Ervoan ! »
Elle avait failli tomber. Elle se redressa, aussi blanche que le lin de sa coiffe. Elle vit le malheureux agenouillé devant elle, baisant le carreau qu’il mouillait de ses pleurs, enfin débordés, et sanglotant :
« Mamma, mamma, pardonnez-moi. »
Alors la mère se pencha. Elle tendit ses vieilles mains à l’enfant prodigue ; elle le releva, disant :
« Embrasse-moi, mon petit, mon pauvre petit. »
Et lui, le pirate, l’homme déchu, osa la regarder.
Il aperçut ses bras ouverts, l’adorable sourire maternel épanoui sur les rides de l’âge, sur les sillons de la douleur. Il put se croire pardonné, réhabilité. D’un seul élan, il fut sur pieds. Son étreinte se referma sur la mamm qui avait pu le croire mort, mort du moins à la vraie vie de l’honneur et du devoir. Et, pendant quelques secondes, leurs larmes se mêlèrent avec leurs baisers.
Cependant Pablo, après avoir fait le tour du jardin, revenait à la maison, appelant encore.
« Chut ! dit-elle. Le petit a su par nous que tu étais mort. Il faut qu’il te croie ressuscité. »
Comme tout à l’heure, le mousse s’était arrêté sur le seuil. Mais sa stupeur était plus grande encore de voir mamm Plonévez dans les bras de son ami Ervan. Son intelligence, après avoir frôlé un instant la vérité, avait vu la lueur s’éteindre. Maintenant, il ne comprenait plus.
Une question de naïve candeur lui vint à la bouche.
« Alors, mamma, c’est donc que vous le connaissez bien, vous aussi, mon ami Ervan ? »
Elle rit, d’un rire nerveux, et répliqua :
« Si je le connais, Pablo ? Mais c’est mon fils, mon fils Ervoan, que je croyais mort ! »
Il y a, dans toute existence humaine, de ces heures uniques, prodigieuses, pendant lesquelles l’homme, s’il pouvait s’analyser, se rendrait compte que le libre arbitre, la raison, tous les attributs dont se flatte son orgueil, n’existent plus, en quelque sorte, des heures où il devient, à son insu, le jouet d’une force incommensurable, un fétu, mais un fétu conscient, emporté dans l’immense tourbillonnement des causes pivotant autour de la Cause première.
Pendant quelques minutes, les trois acteurs de ce drame intime, – est-ce « acteurs » qu’il faut écrire ? – se sentirent enlevés en un irrésistible courant d’émotions imprévues, suaves et douces, annihilant leurs vouloirs, les fondant en une commune joie dont le principe résidait en leur commune affection.
La première, la vieille mère recouvra sa présence d’esprit. Elle dit posément :
« Puisque te voilà revenu, mon fils Yves, tu vas faire ce qui s’est toujours fait en Bretagne : tu vas boire le cidre de ta mère et, tout à l’heure, en dînant, tu rompras le pain avec nous. »
Ervoan était pris, il ne pouvait plus s’échapper. Il n’y songeait pas même. Un peu fataliste, il se disait que ce qui était arrivé devait arriver. Et puis, quoi ? Dans cette atmosphère de tendresse et de vertu, il se sentait soudainement transformé. L’homme de péché qui, en lui, s’était greffé sur le Breton naïf et croyant de l’origine, se flétrissait brusquement. Il recouvrait sa grandeur primitive. Le baiser de sa mère lui avait éclairci le front, dissipé les ténèbres de son âme. Il n’était plus le pirate Ervan ; il redevenait Ervoan Plonévez, le fils d’une sainte et d’un brave, le frère d’un vaillant garçon, plein de courage et d’honneur.
Maintenant, il avait pris les mains de sa mère, il les baisait passionnément. Ses prunelles inlassées se fixaient sur la belle vieille figure encadrée de mèches blanches, aussi blanches que les ailes de la coiffe de batiste. Et avec un rire de petit enfant, il répétait, à l’instar d’un refrain :
« Oh ! que vous êtes jolie mamma ! Vous n’avez pas changé, pas changé du tout. Vous restez la même. Oh ! que vous êtes jolie ! »
Mais elle de répondre, en secouant la tête :
« Pas changée ? En douze ans ? Parce que voilà douze ans de ça, sais-tu ? Pauvre petit ! Tu ne m’as pas bien regardée. Mes pauvres yeux sont brûlés, mon fils. Pourtant, jusqu’à l’année dernière, je pouvais coudre encore avec mes yeux. Depuis, le docteur Bénédict m’a ordonné de prendre des lunettes. Il a bien fallu. Tu vois que j’ai changé tout de même. »
Et elle riait en répondant ainsi, et lui, prévenu, la regardait mieux. Il voyait bien qu’elle ne mentait pas. Au tour des yeux, restés purs, d’une douceur angélique, les paupières s’étaient recroquevillées, plissées de mille rides ; un cerne bleuâtre les entourait par-dessus et par-dessous. Le nez, très fin, paraissait un peu pincé, la bouche s’infléchissait aux commissures, retombait, ainsi qu’il arrive sur les figures qui ont appris à mépriser le rire, qui ont subi la lassitude et les désenchantements de la vie.
Tout à coup, comme elle détournait la tête, sa vue s’arrêta sur la cheminée, sollicitée par une tache blanche sous le socle en bois de la pendule.
Elle quitta Ervoan et courut à la cheminée, où elle prit l’enveloppe qu’y avait glissée le matelot.
Elle l’ouvrit. Ses paupières s’écarquillèrent à la vue des billets de banque. Un peu troublée, elle murmura :
« Qu’est-ce que c’est que ça ? »
Le marin avait rougi et pâli tour à tour. Par bonheur pour lui, il tournait le dos à la fenêtre de la rue, qui ne donnait plus que le jour douteux du crépuscule finissant. Son émotion ne fut pas remarquée.
Recouvrant son sang-froid, il courut vers la bonne femme et, du ton le plus gai qu’il put affecter :
« Ça, mamm, c’est une surprise que j’ai voulu te faire.
– Une surprise ? »
Elle avait tiré ses besicles de sa poche. Elle les assujettit sur son nez et examina mieux le contenu de l’enveloppe.
« Jésus ! s’exclama-t-elle. Des billets de mille francs ? Il y en a cinq. Cinq mille francs ! »
Elle ajouta, la voix changée :
« Cinq mille ! C’est une fortune ! »
Brusquement, elle releva les lunettes sur son front.
Un pli barrait ce front. La voix, tout à l’heure si douce, si maternelle, se fit presque dure :
« Et c’est à toi, tout ça, bien à toi ? »
La mémoire lui était revenue, soudaine, implacable. Elle se rappelait l’odieux passé, le malheur qui lui avait tiré plus de larmes que la pensée même de la mort de son fils. Elle avait revécu les heures atroces de Saint-Brieuc, pendant lesquelles elle avait supplié le tabellion au cœur de métal, puis celles où elle avait entendu, effondrée sur un banc des pas perdus du Tribunal correctionnel, l’écho de la sentence qui condamnait Ervoan à deux mois de prison ; puis, enfin, les moments cruels où, accompagnant le malheureux libéré jusqu’au bateau qui allait l’emporter au loin, elle lui avait mis aux mains les derniers cinq cents francs retirés de la Caisse d’Épargne.
Et c’était depuis ce jour, néfaste entre tous les jours, qu’elle n’avait pas revu son fils, qu’elle l’avait cru mort ; et voici qu’il reparaissait, qu’il « ressuscitait », selon l’expression dont elle-même s’était servie.
Toute à sa joie du revoir, elle avait oublié l’adieu. Douze années s’étaient écoulées. En douze ans, un homme qui est mal parti dans la vie peut y rentrer le plus honnêtement du monde. Pourquoi fallait-il que cet horrible doute vînt assombrir sa pensée, gâter son bonheur ?
Mais Ervoan avait jeté un cri sincère.
« Oh ! mamma, mamma, pouvez-vous croire ? »
Et il avait reculé, avec des larmes plein les yeux.
Il n’en fallait pas plus à la mère. Cette simple parole la convainquait mieux qu’un long plaidoyer.
Elle revint vers lui, noua ses bras aux épaules herculéennes d’Ervoan et dit, très bas :
« Pardonne-moi, petit, pardonne-moi ! »
Afin de rompre tout à fait la gêne, elle poursuivit :
« C’est à toi ? tu as gagné tout ça ? Mais alors, tu as joliment travaillé mon gars ?
– Ah ! oui, je vous le garantis, proféra-t-il. Parce qu’on a fauté une fois, on n’est pas un coquin pour le restant de ses jours. Cet argent-là est bien à moi la mamm. Vous pouvez le garder sans crainte, vu que c’est le fruit de mes économies, un peu dans tous les métiers. Dame ! On prend ce qu’on trouve, on fait ce qu’on peut ; on n’a pas toujours le choix. »
Dans ces derniers mots s’enveloppait une tristesse. Il était manifeste que, si cet argent avait été honnêtement gagné, peut-être le matelot en avait-il d’autre par devers lui dont l’origine était moins pure.
Présentement, il n’était question que de celui-ci. Gravement, la mère Plonévez avait posé sa main sur la tête de son fils. Elle lui dit :
« C’est bien, Ervoan. Je vais porter cet argent-là chez M. Dugué. Il le placera à ton nom, et tu le retrouveras, avec les intérêts, quand tu reviendras au pays. Le bon Dieu fasse que ce soit avant longtemps !
– Mamma, demanda-t-il humblement, s’exprimant en langue bretonne, croyez-vous vraiment que je pourrai… un jour… revenir à Louannec, qu’on aura… oublié ?
– Tout s’oublie, mon gars, surtout quand tout est réparé. Ta place t’attend à la maison.
– Et… ce petit-là ? questionna le marin qui, d’un clin d’yeux, désigna Pablo.
– Ce petit-là, soupira la veuve, voilà dix-huit mois qu’il est ici. Il est devenu aussi mon fils et je l’aime, Ervoan, et il me le rend, car c’est un ange du bon Dieu. Mais je ne crois pas que nous le garderons toujours, car vois-tu ce n’est pas un gars de chez nous. C’est un enfant d’Espagne qu’Alain a ramassé sur un bateau perdu entre Tomé et l’île aux Moines. Bien sûr qu’il doit avoir une famille quelque part. Un jour peut-être, il la retrouvera. »
Le forban garda le silence et demeura le front penché. Ceci, il ne le savait que trop, par les demi-confidences du « patron » Gonzalo Wickham. L’enfant, il le connaissait bien pour avoir, pendant des années, navigué avec lui sur les divers navires du señor armateur ; il l’aimait de tout son cœur ; il avait prouvé cette affection en l’arrachant, à plusieurs reprises, aux intentions homicides de Ricardo. Une justice secrète, dont il entendait, avec effroi, la voix au fond de sa conscience, lui reprochait d’avoir accepté du pirate l’abominable mission de lui ramener cet enfant volé, que Dieu avait confié aux soins de sa propre mère. Et il se disait déjà que cette action-là serait plus infâme que toutes celles qu’il avait pu commettre jusqu’alors.
Non, il ne la commettrait pas ; il ne ferait pas cela.
Cependant Pablo se mêlait à la conversation.
« Il est trop tard pour visiter le bateau, Ervan. Il va faire nuit. Voudras-tu demain ?
– Oui, c’est ça, demain », répondit l’autre, évasivement.
L’angélus sonnait au clocher de Louannec. L’air était saturé de cette clarté pâle qui suit la disparition de l’astre sous l’horizon. Dans la maisonnette, l’ombre envahissait les angles.
« Allons ! fit gaiement la veuve ; il est temps de dîner. »
Et, comme elle faisait chaque jour, elle enleva le tapis de linoléum, installa une nappe blanche, mais toute neuve ce soir-là, en l’honneur de son fils, et mit le couvert, aidée du petit garçon.
« Et moi, mamma, réclama Ervoan, je veux faire aussi quelque chose.
– Alors, va chercher le cidre et le vin.
– Où sont-ils ?
– Tu connais la maison. Il n’y a rien de changé. Descends à la cave. La clef est accrochée à la cheminée de la cuisine. En bas, tu prendras trois bouteilles de cidre et une du vin de ton père. Il a plus de vingt-cinq ans. Mais c’est vrai qu’il te faut de la lumière. »
Ce disant, elle précéda son fils à la cuisine, où elle alluma une lampe en cuivre, qu’elle tendit au matelot.
Un quart d’heure plus tard, la mère et ses deux « fils » s’asseyaient à la table ronde qu’éclairait la suspension assez rustique tournoyant au bout de sa chaîne d’acier.
Un potage aux choux fumait, appétissant, que tous les trois mangèrent d’excellent appétit. Puis ce fut le tour d’une belle dorade toute fraîche. Après quoi, il y eut un plat de pommes de terre préparées au lard.
Ervoan n’avait jamais fait pareil repas. Il se régalait. Sur sa face broussailleuse, une félicité s’épandait et rayonnait. L’enfant prodigue retrouvait sans doute la paix du cœur, qu’il avait perdu.
Il causait allègrement avec sa mère, avec Pablo. Sa langue, naguère paralysée, se déliait. Il s’enquérait de la santé de son frère Alain, de ses projets d’avenir. Il ne put réprimer un soupir.
« Je serais parti quand il reviendra.
– Si tu passes par Nantes, tu pourras l’embrasser.
– C’est juste ; je n’y pensais pas », fit-il, déplaçant la conversation, car le sujet devenait épineux.
Comment dire à sa mère, en effet, qu’insoumis et réfractaire, il ne pouvait séjourner en France sans avoir satisfait à la loi sur le recrutement ?
L’entretien se prolongea bien au delà de l’heure habituelle du repos. L’horloge de Louannec avait tinté dix fois lorsque le marin, comprenant qu’il retardait le sommeil de sa mère, se leva pour prendre congé.
« Allons, mamma, il faut que je vous laisse dormir, pas vrai ? » dit-il en souriant.
Anna Plonévez n’avait pas pensé à cela. Elle s’écria :
« Tu veux t’en aller ? Pourquoi ne restes-tu pas ? il y a de quoi te coucher tout de même. Le petit aura un matelas sur le plancher. »
Et Pablo, se pendant à son bras, insista :
« Oui, oui, Ervan ; reste. Tu reprendras ton lit. Ce sera bien plus gentil. On causera jusqu’à ce que les yeux se ferment. Oh ! oui, va ! Reste. »
Mais cette prière bouleversa le déchu.
Rester, là, sous ce toit, lui, le condamné, le déserteur, lui, l’impur et le misérable.
« C’est mon tour de veille sur le Cacique », haleta-t-il d’une voix à peine distincte.
Et il s’en alla dans le noir de la belle nuit étoilée, semant, sous les ténèbres, de lourdes larmes qui, en tombant, mettaient des tâches rondes sur la poussière du chemin.
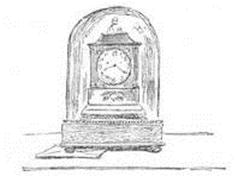
VII
Les deux frères.
Le lendemain, Mme Plonévez attendit vainement son fils. Ervoan ne reparut pas, selon qu’il l’avait promis. Et la veuve s’essuya les yeux, se demandant si le démon avait ressaisi cette âme qui paraissait lui échapper. Les cœurs de mères ont été faits pour saigner.
Elle recommanda à Pablo de ne point parler de la visite de la veille. L’enfant ne s’en étonna point. Son esprit très ouvert avait compris qu’un mystère douloureux se cachait dans la vie de son étrange ami. N’était-il pas surprenant déjà que celui-ci n’eût point tenu sa promesse de venir le chercher pour lui faire visiter le yacht ?
Ainsi qu’elle l’avait annoncé la veille, Anna Plonévez s’en alla, vers les dix heures du matin, chez le notaire Duguer, dont l’étude était située en arrière du bourg, sur la route du Port-Blanc.
Les notaires sont un peu comme les prêtres et les avocats ; ils sont tenus au secret professionnel. On peut donc leur confier bien des choses secrètes.
Ainsi jugeait la veuve, et elle avait raison, au moins dans son cas. Me Duguer, en effet, était un vieillard de soixante-dix ans, vénéré de tout le pays, d’une droiture et d’une intégrité à toute épreuve. Il avait reçu bien des confidences pénibles, il connaissait des « histoires » bien lamentables. Toutes étaient ensevelies en son loyal oubli comme au fond d’une tombe.
Il reçut donc la veuve avec sa cordialité joviale, qualifiant la brave femme de « ma cadette », vu les quinze ans qui séparaient leurs âges. Après quoi, il l’écouta d’une oreille attentive, prit en dépôt les cinq mille francs qu’elle lui apportait et déclara qu’il allait les convertir en titres de rentes trois pour cent, dont le revenu se capitaliserait à raison de cent cinquante francs par an.

Comme elle regagnait sa demeure, Mme Plonévez rencontra Fantik Le Goff qui vint droit à elle.
« Je retourne de chez vous, mamm Plonévez, dit la petite employée du télégraphe. Je vous apportais une dépêche de Nantes, de votre fils Alain. »
Et elle lui tendait le papier bleu sur lequel la receveuse de Perros-Guirec avait transcrit le télégramme.
Anna n’avait point ses « yeux » sur elle, car elle n’avait pas jugé utile de se munir de besicles pour se rendre chez le tabellion.
Elle prit donc la dépêche, assez contrariée de ne pouvoir la lire séance tenante. Mais, se ravisant, elle demanda à la jeune fille :
« Sais-tu que tu serais bien gentille, Fant, de me dire ce qu’il y a dessus ? »
La petite candidate aux emplois du Ministère des Postes rompit le pointillé du télégramme et s’empressa d’en donner lecture à la veuve.
Voici ce qu’annonçait Alain à sa mère :
« Reçu. T’embrasse et Pablo. Arriverai ce soir. »
– Ah ! mon Dieu ! s’exclama Anna.
– Il faut vous réjouir, mamm Plonévez, appuya Fantik Le Goff. Votre fils est reçu. Il est capitaine. Vous allez le revoir et l’embrasser. Vous pouvez vous vanter d’être la mère d’un brave garçon. Ils ne sont pas tous comme votre Alain, les gars, savez-vous. »
Et elle s’en alla, la petite Françoise, fraîche comme un bouton de rose, gaie comme un pinson, pendant que la vieille femme, se détournant vers l’église, gravissait les dix marches du cimetière pour remercier le bon Dieu de la faveur accordée à son fils cadet.
L’aîné, où était-il à cette heure ? Pourquoi n’était-il pas revenu, ainsi qu’il l’avait promis ?
Hélas ! l’explication en était bien simple, trop simple.
En parcourant la petite lieue qui séparait la maisonnette de Louannec de la belle villa Ar Rock, de Trestraou, Ervoan avait eu tout le temps de méditer sur la situation. Et, comme le craignait mamm Plonévez, le mauvais esprit avait repris son empire sur cette âme que le bon ange venait de lui arracher un instant.
Ce n’était pas que le pauvre garçon eût conçu quelque nouveau dessein coupable. Non ; le mal procède rarement par à-coups, par décisions violentes. Il s’insinue lentement, il organise des travaux d’approche, il mine la volonté, il sème la lâcheté dans le cœur.
À mesure qu’il regagnait le bourg de Perros, Ervoan sentait s’affaiblir ses bonnes résolutions. Il ne souscrivait pas encore au crime ; il composait avec sa conscience.
Le problème qui l’angoissait était précis.
Qu’allait-il répondre aux questions du señor Gonzalo, aux ricanements de Ricardo Lopez ?
Oh ! s’il n’y avait eu que celui-là !… Et les robustes poings d’Yves Plonévez se serraient. Comme il eût tôt fait de lui rompre les os, en dépit de son machete, dont il avait si souvent raillé la pointe acérée !
Mais, voilà. Ce gredin était le confident de choix, ou, pour dire plus exactement, l’âme damnée de Gonzalo Wickham. Ces deux hommes se valaient. Ils avaient des crimes communs sur la conscience, des « cadavres » entre eux, au sens propre et au sens figuré du mot.
Ceci, Ervoan ne le savait pas de science certaine, mais il en avait la certitude morale irréfutable. Et, comme Ricardo tenait Gonzalo, ce dernier tenait le Breton par des complicités périlleuses. Dans le passé du malheureux garçon dévoyé, il y avait des pages sinistres sur lesquelles son nom était inscrit, bien que son consentement n’y eût jamais été requis. Il avait été, sans le vouloir, sinon à son insu, mêlé à d’abominables drames, et cet odieux passé avait déjà dix ans de date. On n’efface pas dix ans de mauvaise vie. Peut-on même les réparer ?
Ah ! la loi devrait toujours être miséricordieuse ; elle devrait laisser grande ouverte la porte au repentir. C’est le désespoir du relèvement qui fait les récidives, qui sacre l’affreux orgueil de la damnation.
Et voilà que le démon soufflait ce désespoir dans l’âme d’Ervoan. Un moment réconforté par la douce chaleur du foyer maternel, il retombait aux pires découragements.
Sous cette nuit tiède et embaumée, il marchait plus ténébreux encore. La mer, pleine et étale, battait de petites tapes caressantes les murs et les digues du vieux port, roulant dans ses lames amicales des paillettes de rayons. Lui, le malheureux, ne percevait pas ce langage de la nature vivifiante et consolatrice. Il allait, sombre, farouche. Il tenait ses yeux abaissés sur la terre poudreuse où traînait son pas alourdi ; il ne les relevait pas vers le ciel ; il n’en voyait pas les étoiles.
Oui, qu’allait-il répondre au métis insolent ? Celui-ci avait le droit de lui reprocher sa couardise, sinon son parjure, car il n’avait pas rempli les conditions du marché accepté. Et l’abominable Ricardo joindrait son affreux rire aux invectives de l’autre rastaquouère, et, lui, Ervoan, ne pourrait rien répondre, car il ne pourrait pas écraser ces deux hommes à la fois.
Si, pourtant, il pourrait répondre quelque chose. Et le bon ange l’assistait une dernière fois. Il n’aurait qu’à tirer de sa poche l’autre enveloppe, pas celle qu’il avait laissée à sa mère, et qui ne contenait que de l’argent honnêtement gagné, mais celle dans laquelle Gonzalo avait placé une somme égale, le prix du contrat proposé, et accepté, hélas !
Cette seconde enveloppe, le Breton la tira effectivement de sa vareuse ; il la palpa de ses doigts rugueux, il en fit sortir, l’un après l’autre, les cinq billets bleus et violets, qu’il considéra à la clarté blanche de la lune. Dans un mouvement de rage, il eut envie de les jeter à la mer.
Mais la réflexion vint, luisante, acérée, comme le poignard de la nécessité.
En donnant à sa mère les autres cinq mille francs, son argent à lui, son bon argent, loyalement gagné, il s’était dépouillé de tout ; il n’avait rien gardé pour lui. Comment vivrait-il, surtout ici, en Bretagne, en France, où il n’était qu’un paria ? Car il ne pouvait s’imposer au logis déjà si pauvre de sa mère. D’ailleurs, ce n’était pas une solution. La gendarmerie aurait tôt fait de remettre la main sur le réfractaire, et ce serait alors une honte nouvelle pour ce cher vieux front ridé, une nouvelle douleur pour ces chers yeux, déjà corrodés par les larmes.
La mer clapotait encore à ses pieds. Il était dans Perros, à l’extrémité du port. Cette eau claire et souriante l’attirait. Il n’avait qu’à s’y laisser tomber, et ce serait fini.
Non ; ce ne serait pas fini. Ce ne serait qu’une lâcheté inutile. Quand, demain, on le tirerait de là, ramassé dans la vase, déjà rongé par les crabes qui y pullulent, quand on le porterait à la gendarmerie, bleui, gonflé, les yeux vides, les lèvres mangées par les crustacés hideux, le tambour de ville battrait ; il appellerait la population à reconnaître ce mort. Et la veuve Plonévez viendrait, sans doute, avec les autres femmes et les autres hommes ; elle verrait ce corps mutilé ; elle ne pourrait pas se taire, et ce serait encore, pour elle, le chagrin et l’humiliation.
Ervoan triompha de la tentation. Il continua sa route vers Trestraou. Comme il passait devant l’église, il vit la lune blanchir les pierres et les croix du cimetière, et il pensa à son père, le vieux brave, qui dormait son dernier sommeil dans la nécropole de Louannec, au pied du clocher tout neuf.
Quand il franchit la grille de la villa, il n’avait aucune résolution prise.
Gonzalo Wickham l’attendait dans le jardin, auprès de l’inévitable Ricardo. Tout l’après-midi, il était resté en permanence, ayant donné l’ordre à l’Argentin de rôder aux alentours de la grève de Louannec. Celui-ci était revenu, disant qu’il avait vu Ervoan entrer chez la veuve Plonévez, mais ne l’en avait pas vu sortir.
Le métis accueillit donc le Breton avec sa brutalité ordinaire, et demanda :
« Il paraît que tu as remis l’affaire à plus tard ? »
Et lui confus, de répondre en hésitant :
« Ce n’était pas possible ce soir. La bonne femme est venue.
– Il fallait l’assommer, la bonne femme, la jeter dans un coin. »
Ervoan répondit, avec effort, ces simples mots :
« C’est ma mère ! »
Mais l’accent dont il avait prononcé ces mots avait fait réfléchir le bandit. L’organe du matelot ressemblait au grondement d’un lion, et sa stature de colosse se découpait, formidable, dans la grande clarté blanche dont la lune baignait le jardin.
Gonzalo baissa donc le ton et se contenta de demander :
« Recommenceras-tu demain ?
– Peut-être ? » fit simplement le breton.
Et, comme on ne le retenait pas, il s’en alla, un peu au hasard, se demandant où il passerait la nuit. Il remonta vers la Clarté, afin de chercher asile dans un petit hôtel où il savait trouver un gîte.
Il ne put donc entendre Ricardo, disant au métis :
« Si vous m’en croyez, vous tiendrez le Mapana sous pression. On ne sait pas ce qui peut arriver. Cet Ervoan ne me paraît pas sûr et nous devons être prêts à disparaître au premier indice de menace.
– Que crains-tu donc ?
– Tout. Cet homme est visiblement sous une influence qui peut nous devenir funeste. Les souvenirs de son passé, le désir de se réhabiliter, le remords suffiraient à en faire notre ennemi, le pousser à parler, et alors…
– Oui, prononça Gonzalo Wickham, il vaut mieux qu’il ne parle pas. »
Ce fut sur ces paroles que se séparèrent les deux complices. La nuit allait « porter conseil » à leurs initiatives.
Le jour venu, Ervoan, qui avait mal dormi, redescendit à la villa du rocher. Il la trouva vide d’habitants. La concierge, représentant le propriétaire et aussi les locataires, en cette circonstance, lui apprit que M. et Mme Wickham étaient retournés de bon matin au yacht, afin de faire une rapide excursion du côté de Lézardrieux, d’où ils reviendraient le lendemain, peut-être le même soir.
La nouvelle déconcerta le matelot, au point de lui enlever l’envie de retourner chez sa mère.
Quel projet menaçant couvrait cette fugue inattendue ?
Le proverbe dit : « Comme on connaît ses saints, on les honore. » Or, Ervoan connaissait trop bien Gonzalo et Lopez, qui n’étaient pas des saints, pour les honorer d’une bien grande confiance.
Il traîna donc sur les chemins, indécis, sollicité, tantôt par le désir de revenir vers la petite maison de Louannec, tantôt par une impulsion plus forte que sa volonté, qui l’engageait à fuir des lieux où il croyait sentir la présence d’un danger. Mais, lorsque vint le soir, le premier sentiment l’emporta. Un peu plus tôt que la veille, c’est-à-dire vers sept heures, il gagna Louannec et, sans hésiter, cette fois, franchit le seuil de la maisonnette.
Des voix animées et joyeuses y devisaient. Il recula et voulut battre en retraite. Pablo, qui l’avait entendu, accourut, la face radieuse, et, le saisissant par la main, l’attira dans la salle à manger, avec une exclamation : « Le voilà, Alain, le voilà ! je ne m’étais pas trompé. »
*
C’était Lân, en effet, qui était dans la pièce, conversant en tête-à-tête avec sa mère et le petit garçon.
Il était arrivé de Lannion, une heure plus tôt, venant de Nantes, Rennes et Saint-Brieuc.
Il avait embrassé avec effusion sa mère et le petit Pablo, leur confirmant la nouvelle de son succès. Le diplôme, en effet, avait couronné ses études. Celui qui avait durement parcouru les premières étapes de la vie de matelot était désormais le maître de sa destinée. Il était capitaine au long cours ; il pourrait exercer le commandement, diriger seul un grand navire à vapeur ou à voiles. Il ne lui restait plus qu’à trouver un embarquement.
Après les détails sur sa propre existence, sur les dix-huit mois employés au labeur acharné, il s’enquit de l’existence des siens. Tout de suite, Anna Plonévez le mit au courant des événements accomplis la veille, trop récents pour qu’elle ou Pablo eussent eu le temps de lui écrire à ce sujet.
En l’écoutant, Alain paraissait préoccupé. Ses sourcils s’étaient rapprochés. Une pensée attristée creusait sa ride au milieu de son front.
« En sorte que, demanda-t-il, Ervoan est encore ici ? »
La vieille femme hésita avant de répondre :
« Je le suppose. Cependant il nous avait promis, hier, de revenir aujourd’hui, et il n’est pas venu.
– Et, cet argent qu’il vous a donné, qu’en avez-vous fait, s’il vous plaît ? »
Un nuage passa sur la figure de la mère.
« Je l’ai remis à Me Duguer, le notaire. Je me suis dit que ton pauvre frère pourrait en avoir besoin plus que moi, car dans la vie qu’il mène… »
Elle n’acheva pas.
Alain lui avait pris la main, qu’il baisa avec le plus profond respect, en disant :
« Vous avez bien fait, mamma. Je crois, comme vous, qu’il en aura plus grand besoin que vous. »
La conversation en était là, au moment même où résonna, clair et joyeux, le cri de Pablo annonçant la venue d’Ervoan.
L’instant d’après, les deux frères étaient dans les bras l’un de l’autre et s’embrassaient, les larmes aux yeux. Quand ils eurent échangé les premiers compliments, les multiples questions qu’ils étaient fondés à s’adresser, brusquement le matelot du Cacique dit à Alain :
« Lân, te plaît-il de faire un tour avec moi, dans les champs, avant de revenir dîner.
– Oui », répondit le cadet, que, depuis le récit de sa mère, obsédait le souci de connaître le passé de son misérable aîné.
« Mamma, dit-il à la veuve, nous sortons un moment, Yves et moi. Nous rentrerons pour le dîner. »
Ils s’en allèrent sur la route déserte, et se jetèrent, à travers champs, dans les sentiers ombreux qui rayonnent autour des bois de Barac’h.
Chacun d’eux attendait les confidences et les questions de l’autre. Douze ans d’absence les avaient séparés. Ils se retrouvaient hommes faits, l’aîné âgé de trente-deux ans, le cadet de vingt-sept. Et, si leur tendresse de frères avait survécu à l’épreuve de cette séparation, elle n’en avait pas moins subi l’ordinaire dépression que laisse le doute, surtout à la suite de pénibles souvenirs.
Tout de suite le dialogue devint grave.
Yves avait trop cruellement souffert, au cours de ses incertitudes et de ses angoisses de la nuit précédente, pour ne point désirer épancher le trop-plein de son cœur ulcéré. Ce qu’il n’eût osé avouer à sa mère, il le confessa à Alain avec une sincérité d’accent auquel celui-ci ne pouvait se méprendre.
« Mon pauvre frère ! mon pauvre Ervoan ! » soupira-t-il en serrant la main du matelot.
Et brusquement, en homme énergique qu’il était, il domina son émotion et conclut :
« Mais, ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Il faut une conclusion à ta confidence ; il faut que tu t’arraches à l’horrible milieu dans lequel tu as vécu jusqu’à présent, que tu répares ton passé, que tu redeviennes un honnête homme, un bon Français.
– Et ma condamnation, Lân, ma condamnation d’autrefois, de Saint-Brieuc, l’as-tu oubliée ? »
Alain eut une rapide hésitation. Puis :
« Non, je ne l’ai pas oubliée. Eh bien ! Quoi ? Ta condamnation ? Sans doute, il vaudrait mieux qu’elle n’existât pas. Mais pour celle-là tu n’as plus de comptes à rendre à personne. Tu as payé ta dette ; la mamm a remboursé le notaire. Tu es donc quitte envers les hommes. Non ; celle-là ne m’inquiète pas. Mais c’est le reste, c’est cette bande où tu t’es laissé embaucher, car je sens que tu ne m’as pas tout dit, que là gît le plus cruel de ton secret, que se tisse le plus noir de ton passé. Il faut que tu sortes de là, par tous les moyens.
– Je ne peux pas, pourtant, être un traître ! bégaya le malheureux, en se tordant les mains.
– Un traître, envers des bandits ? Tout de même, je comprends tes scrupules. Mais ce que tu ne peux faire toi-même, un autre peut l’accomplir à ta place.
– Quel autre, Lân.
– Moi, par exemple, moi, ton frère. »
Les yeux d’Yves laissèrent voir une réelle terreur.
« Toi ? Mais tu ne les connais pas, tandis qu’eux, ils auront vite fait de te connaître. Ils te tueront. »
Les yeux du jeune capitaine étincelèrent :
« Alors, raison de plus pour que j’engage la lutte. »
Ervoan se trahit. Il laissa échapper son secret.
« Quelle lutte, mon pauvre Lân ? On ne lutte pas contre des adversaires invisibles, qui sont, à la fois, partout et nulle part, qui ont pour refuge l’univers entier.
– Que dis-tu là ? s’exclama Alain.
– La vérité, mon frère, rien que la vérité. Si tu veux me comprendre, rends-toi compte de mes paroles. Je ne suis qu’un simple matelot, embauché, il y a huit ans, parmi ces équipages de bandits. Oh ! rassure-toi. Je n’ai jamais ni tué, ni même… volé, depuis ma première faute. L’argent que j’ai donné à la mamm était à moi, bien à moi, bien gagné, avant que je devinsse leur complice. Car je suis leur complice, Lân, par cela seul que sachant leurs mauvaises actions, j’y suis resté associé, par nécessité. J’aurais dû me séparer d’eux, les dénoncer. Aujourd’hui, il est trop tard pour le faire, et, outre que je suis trop compromis, je serais un traître en les livrant. »
Alain l’interrompit avec véhémence.
« Oui, fit-il, je comprends que tu ne veuilles pas être mouchard. Mais ne peux-tu rompre avec eux, en leur déclarant loyalement la guerre ? Ne peux-tu m’aider à leur faire cette guerre, qui serait ta réhabilitation ? »
Le matelot réfléchit quelques secondes, puis :
« Sans doute cela serait possible, et cela, je le ferais volontiers, car il ne me déplairait pas de les combattre à visage découvert. Mais, encore une fois, comment engager cette lutte avec des adversaires insaisissables ? »
Alors, aux oreilles stupéfaites de son frère, Ervoan raconta la plus étonnante histoire que le plus fantaisiste des cerveaux imaginatifs eût pu échafauder en roman.
Boileau a dit, en son Art poétique :
Le vrai peut quelquefois n’être pas vraisemblable.
C’était le cas de la prodigieuse révélation que l’aîné des Plonévez faisait à son cadet.
Ce yacht, appelé tantôt Cacique et tantôt Mapana, était le bateau de plaisance d’un chef de pirates redoutable qui, depuis dix ans, mettait sur les dents toutes les polices de l’univers.
Gonzalo Wickham possédait une véritable flotte, des équipages merveilleusement entraînés, qu’il payait grassement, des armées de brigands qu’il entretenait dans les cinq parties du monde. Il avait des ports d’attache, des refuges toujours ouverts, des affiliés et des complices jusque dans les rangs des marines régulières de certains peuples trop aisément admis à la qualité de puissances.
Ceci, toutes les nations le savaient. Mais jamais on n’avait pu prendre en défaut l’astucieux forban. Ses navires voyageaient sous des pavillons connus, arrivaient avec des connaissements réguliers, des rôles d’équipages parfaitement authentiques. Les grandes maisons de commerce dont ils se réclamaient étaient connues pour leur droiture et leur loyauté, et celles auxquelles ils livraient leurs marchandises étaient bien et dûment informées de leurs arrivées comme de leurs itinéraires.
Une seule chose avait fait ouvrir l’œil aux puissances : la fréquence de certains sinistres en mer. Il était arrivé, en plusieurs occurrences, que tel bateau, après remise de sa cargaison au lieu voulu et arrimage d’un fret de retour, s’était perdu corps et biens en d’obscures circonstances. Les Compagnies d’assurances avaient dû payer d’importantes sommes, et l’impossibilité de trouver soit un survivant, soit un témoin de la catastrophe, leur avait donné l’éveil. Elles s’étaient entendues pour exercer une occulte surveillance, qui, malheureusement, jusqu’à ce jour, n’avait donné aucun résultat concluant.
Tout au plus, de quelques vagues racontars avait-on pu induire quelques soupçons, dénués eux-mêmes de vraisemblance. On avait parlé d’attaques à main armée sur tous les océans, de bateaux de commerce pris d’abordage par des navires de grande course, d’équipages égorgés jusqu’au dernier homme, de chargements pillés, et, pour finir, du sabordage de ces mêmes bâtiments en des parages où leur perte pouvait paraître due à une cause accidentelle vulgaire.
Il était advenu que certains cadavres s’étaient échoués sur des plages civilisées et qu’après examen des pauvres corps, leurs blessures avaient paru suspectes. Ou bien encore, quelques épaves, poussées par le flot, renflouées après de longs efforts, avaient décelé la trace de mains criminelles dans les déchirures du bordé ou les éventrements de la flottaison.
Tout cela avait fourni des indices moraux nombreux, mais n’avait permis que des hypothèses.
Ervoan révélait ces choses à Lân, qui n’en croyait pas ses oreilles.
« Écoute, frère, dit celui-ci avec gravité, tout ce que tu viens de m’apprendre doit être examiné à loisir. Je veux te sauver et, avec l’aide de Dieu, je te sauverai. Toutefois, il faut nous entendre et agir avec la plus extrême prudence. Il convient que rien dans ta conduite, ni dans ton attitude n’éveille les méfiances de ces gredins, car ils pourraient se défaire de toi et disparaître, sans nous laisser même le moyen de te venger. »
Et, posant sa main nerveuse sur celle de son frère, il ajouta :
« Voyons ! À l’appui de tes dires, peux-tu me citer un fait, un seul, qui nous serve de fanal pour nous éclairer ? Connais-tu quelque événement pouvant guider nos recherches sur la piste de ces bandits ? »
Le matelot eut une dernière hésitation.
« Eh bien ! oui, murmura-t-il enfin, et à toi, je peux bien le confier, surtout, après tout ce que je t’ai déjà livré. La preuve de leurs méfaits, elle n’est pas loin d’ici ; elle est sous le toit de notre mère.
– Tu dis… ?
– Je dis que… l’enfant que tu as sauvé de la tempête, que la mamm a recueilli, ce joli petit Pablo que j’aime tant, est un enfant volé, dont ces coquins ont tué le père et qu’ils voudraient bien reprendre, afin de s’assurer par lui, quand il sera majeur, ce qu’ils n’ont encore pu s’approprier de l’énorme fortune de son père. »
Alain frémit d’indignation et de terreur.
Alors, ne se contenant plus, ne gardant aucune réserve, Yves raconta tout ce qu’il avait appris ou deviné lui-même du passé du petit garçon, dont, malheureusement, il ignorait le véritable nom. Il dit à son frère de quelle abominable mission l’avait chargé Gonzalo Wickham, comment, séduit par la perspective de donner à la vieille mamma le fruit de ses économies, sans se réduire lui-même à la misère, et aussi pour empêcher que l’affreux Ricardo le remplaçât en cette besogne, il avait accepté le rôle que lui avait distribué le métis.
Lân demeura un instant sans parole. L’amour fraternel luttait douloureusement en lui contre l’horreur que lui inspirait la conduite criminelle du misérable Ervoan.
Pourtant la compassion prit le dessus.
Il serra à les broyer les mains de son frère, et, d’une voix où se brisait un sanglot, il dit :
« Oui, oui, il faut que tu sortes au plus tôt de cette association infâme, il faut que tu répares ton passé. Vois-tu, si notre mère se doutait seulement de l’horrible vérité, elle tomberait morte sur le coup. »
Ils ne s’adressèrent plus que de rares paroles et regagnèrent le logis où ils s’assirent, assez tristement, à la table de famille.
Comme la veille, Ervoan attendit que la nuit fût faite pour sortir. Sa résolution était bien prise. Loyalement il allait retourner à la villa Ar Rock, jeter à la face de Gonzalo les billets, prix de la félonie, et l’avertir qu’il eût à mettre l’Océan entre lui et la justice française, car il n’entendait plus être le complice de ses forfaits.
Ce soir-là, la lune était voilée. De gros nimbus noirs venaient du sud-ouest, porteurs de la pluie pour le lendemain. À peine le matelot, absorbé dans ses sombres réflexions, voyait-il le chemin devant ses pas.
Brusquement, comme il doublait l’amorce de la route de Perros, une silhouette sortit de l’ombre derrière lui. Une lueur blême déchira les ténèbres, la lueur d’une lame d’acier, et, frappé entre les deux épaules, Ervoan s’écroula dans le fossé, tandis qu’un ricanement sifflait ces mots haineux :
« Cette fois, mon machete n’a pas manqué son but. »

VIII
Confession publique.
Le deuil, profond, inattendu, régnait dans la petite maison de Louannec, la douleur sans cris, sans gestes, sans mise en scène extérieure, de celles dont l’adage dit si justement qu’elles sont « muettes ».
Dans la petite chambre du premier étage qu’occupait depuis dix-huit mois Pablo, l’enfant adopté, la veuve Anna Plonévez avait couché son fils aîné. Et, maintenant, Ervoan gisait dans son propre lit, celui où il avait dormi jadis, au temps heureux où la mère, quoique vêtue de noir, s’enorgueillissait de la beauté et de la force des deux soutiens que la Providence avait laissés à sa détresse.
À cette heure, il n’y avait plus de place pour l’orgueil dans l’âme d’Anna Plonévez. Mais sa tendresse farouche avait encore une fierté, celle de sauvegarder le renom de ce fils qu’un arrêt occulte du destin ramenait au toit familial pour y mourir. Elle avait voulu le dérober aux visites importunes, aux commentaires désobligeants ; elle gardait jalousement l’entrée de cette chambre presque mortuaire, confirmée, d’ailleurs, en sa résolution par les prescriptions sévères du docteur Bénédict.
Pourtant, ni les prescriptions du médecin, ni les pudeurs maternelles, si légitimes qu’elles fussent, n’avaient pu mettre obstacle aux instructions juridiques, aux formalités légales.
Depuis deux jours que le crime avait été commis, force avait été à la veuve d’ouvrir sa porte aux autorités : maire, juge de paix, brigadier de gendarmerie, bientôt suivis du commissaire de police et du substitut de Lannion.
Tous ces fonctionnaires, à des titres divers, avaient franchi le seuil de l’humble maison et approché le lit du blessé. Un interrogatoire décousu, entre deux délires, sous la menace d’une syncope mortelle, n’avait donné naissance qu’à un procès-verbal informe. Les magistrats devaient attendre que le malheureux, sorti de son coma intermittent, eût recouvré assez de forces pour comprendre les questions posées et y répondre lucidement.
Quarante-huit heures ! il y avait quarante-huit heures que le matelot du Cacique était étendu là, sans mouvement, entre la vie et la mort.
On l’avait ramassé sur la route, où il s’était traîné quelques pas après avoir reçu le coup fatal. Un fermier qui revenait de Tréguier à Perros, avait aperçu ce corps en travers du chemin. Le cheval s’était arrêté spontanément. L’homme avait interpellé celui qu’il prenait pour un ivrogne « soûl perdu ». Et, comme l’ivrogne ne bougeait pas, le fermier était descendu de la voiture, s’était approché du corps, l’avait retourné, découvrant une flaque rouge, qu’il avait prise, d’abord, pour un produit de déjections. Mais son erreur n’avait pas été de longue durée.
Alors il avait crié. Les volets s’étaient ouverts, puis des portes ; des gens étaient accourus. Un hasard avait amené l’appariteur du bourg, vieux soldat amputé.
Celui-ci avait reconnu Ervoan et jeté une sourde exclamation :
« Malloz ! Je le remets, pour sûr. C’est le fils aîné à mamm Plonévez. »

Quelqu’un s’était détaché. On avait trouvé la famille en partie couchée. Alain fumait une dernière pipe ; la veuve achevait de mettre en ordre sa vaisselle.
Le messager avait été maladroit ; il avait parlé à haute voix. Anna était accourue.
Sans prendre le temps de s’informer davantage, elle s’était élancée dans la rue. À trois cents pas de sa maison, elle avait rencontré le lugubre cortège qui se disposait à transporter Ervoan à la mairie, faute de meilleur asile.
Mais la mère n’y avait pas consenti.
Vaillante, malgré le tremblement nerveux qui la secouait, malgré la pâleur de sa face, elle avait exigé qu’on ramenât son fils chez elle. Alain, qui l’avait suivie le plus promptement qu’il avait pu, confirma sa volonté. On porta donc le blessé chez la veuve.
Il fallut arracher Pablo au sommeil. Le désespoir de l’enfant fut affreux à la vue de son ami « Ervan » si semblable à un mort. Et, tout de suite, un cri lui échappa :
« C’est Ricardo, c’est Ricardo qui l’a tué. »
Ce que fut cette nuit dans la demeure affligée, l’enfant devait se le rappeler toute sa vie. Il voulait prêter son concours aux femmes venues en aide à Anna. Il se laissa pourtant docilement emmener, lorsqu’on lui eut fait comprendre que sa présence gênerait les soins à donner.
Alain le conduisit dans la seconde chambre, la sienne, et le fit coucher, en dépit de ses dénégations et de ses pleurs.
« Pauvre Lân, gémissait le petit garçon, ce n’est pas une belle fête qui célèbre ton retour et ton diplôme ! »
Lân ne répondit pas. Il se contentait de sa propre tristesse. Le lendemain, la nouvelle avait couru tout le pays.
On se répétait les propos du petit « Espagnol », l’accusation spontanément portée contre le brigand de la villa Ar’ Rock. Elle ne tarda pas à se confirmer, cette accusation.
Non seulement les propriétaires du yacht Cacique ne rentrèrent point en leur logis de villégiature, mais le yacht lui-même ne reparut pas à Perros.
Aux dépêches lancées immédiatement dans tous les ports de France et de l’étranger, il ne fut répondu qu’au bout de trois jours. Le bateau de plaisance avait relâché à Brest, où, interrogé séance tenante, M. Gonzalo Wickham avait insolemment manifesté sa surprise de se voir l’objet d’un soupçon. Citoyen de la République de Vénézuela, il l’avait pris de haut avec les autorités françaises. Quant au matelot Lopez qu’on lui réclamait, il n’était point à son bord, ayant déserté le yacht quatre jours plus tôt, en compagnie d’un autre, appelé Ervan, en rade de Perros-Guirec. D’ailleurs en quoi, lui, Wickham, était-il responsable des méfaits de ses matelots, mercenaires dont le passé ne lui était pas connu ? Il était probable que Lopez et Ervan avaient dû se prendre de querelle et que le meurtre de l’un d’eux était le résultat de ce conflit.
L’explication était plausible. Le citoyen du Vénézuela s’offrit, d’ailleurs, à laisser visiter le navire, de la soute à la pomme des mâts. Et, comme les délais de sa croisière sur les côtes de France rendaient invraisemblable l’hypothèse d’une fuite de l’assassin sur une autre terre, en Angleterre par exemple, on n’inquiéta pas autrement le señor Gonzalo.
Cependant le bruit de l’affreux événement avait ému les environs. Le matin du troisième jour, le landeau des dames Hénault s’arrêta devant la maison des Plonévez. Les deux femmes et la fillette en descendirent, qui, après avoir offert, de leur mieux, leurs consolations à la malheureuse Anna, lui proposèrent d’emmener Pablo à Ker Gwevroc’h où il recevrait l’hospitalité tout le temps qu’exigerait le séjour du blessé sous le toit maternel.
La veuve accepta. Elle avait l’âme trop douloureuse pour n’être point sensible à toute intervention du dehors lui apportant une aide ou un soulagement à sa détresse présente. Alain joignit ses remerciements à ceux de sa mère. Partagée entre ses multiples affections, Pablo pleura et se défendit, mais finit par se laisser convaincre. Il fut ramené dans le landau jusqu’au vieux manoir dont il avait fait naguère à Lân une si enthousiaste description.
Ni les deux dames, ni Irène Corbon ne troublèrent son chagrin du premier moment. On le laissa pleurer tout à son aise. Le soir venu, on le fit même dîner à part, afin qu’il pût se coucher de bonne heure dans la jolie chambre qu’on avait aménagée pour lui, au premier étage, à côté de celle d’Irène.
Ce changement en son existence produisit une heureuse diversion dans le cours des pensées du garçonnet. Lorsqu’une bonne nuit de repos lui eut rendu la fraîcheur de son teint et le calme de son regard, on prit d’autres moyens pour le distraire.
Mais si les deux femmes, avec une touchante sollicitude, s’attachaient à détourner l’esprit du jeune garçon des réflexions cruelles, la fillette, moins attentive, ne put se retenir de l’interroger sur le drame de Louannec.
Pablo n’en savait que ce qu’il avait entendu raconter autour de lui. Une fois la question posée, il répondit copieusement à Irène, devenue rouge et embarrassée sous les regards de blâme que lui adressaient ses deux tantes.
Celles-ci connurent ainsi les détails de l’événement sur lequel elles étaient encore fort mal renseignées.
Pablo, eu effet, n’avait aucune raison de les taire.
Il expliqua comment, l’avant-veille du jour où le crime avait été commis, son ami Ervan était venu à la maison de la veuve, la vive joie que lui, Pablo, en avait ressentie, surtout en apprenant que ce même Ervan n’était autre qu’Yves, ou Ervoan, le fils aîné de mamm Plonévez, la rencontre des deux frères, leur conversation sérieuse, puis le départ du matelot.
Et, brusquement, ainsi qu’il avait fait devant le pauvre corps inerte dans le lit que lui-même venait de quitter, il laissa jaillir cette exclamation accusatrice, qui avait inutilement guidé la justice française sur la piste du yacht.
« Je suis sûr que c’est Ricardo qui l’a frappé ; je suis sûr… »
Il fut interrompu par un double cri des deux femmes, et Mme Hénault la mère lui demanda, d’une voix frémissante :
« Ricardo ? De qui parlez-vous, mon enfant ? Qui est ce Ricardo ? »
Ses yeux brillaient d’une flamme étrange, qui intimida d’autant plus le petit garçon que, sur les traits de l’autre dame il vit s’étendre une ombre de terreur et de désolation. Il répondit donc en balbutiant :
« Je parle, madame, de ce méchant homme qui était matelot avec moi, et qui a été sauvé en même temps que moi, par le canot de Perros-Guirec.
– Et vous dites, reprit Mme Hénault, que ce méchant homme s’appelait Ricardo ? Ricardo quoi ? N’avait-il pas un autre nom ?
– Je n’en suis pas bien sûr, mais je crois qu’il s’appelle aussi Lopez.
– Lopez ! s’exclamèrent les deux femmes, en joignant les mains. Ricardo Lopez ! Le sang-mêlé, l’Indien… Le domestique, l’assassin de mon mari et de mon fils. »
Isabelle se laissa tomber, la tête dans ses mains, sur le bord de la table et sanglota éperdument.
Mme Hénault, la mère, s’était levée, car cette scène se passait au repas du soir, qui venait de prendre fin.
Le trouble insolite des femmes avait profondément remué les deux enfants. À voir pleurer celle qu’elle nommait « maman », Irène s’était mise à pleurer, elle aussi. Quant à Pablo, bouleversé, il vint s’agenouiller près de la jeune femme et, tel qu’un coupable, mais qui ignorerait la nature de sa faute, il implorait son pardon :
« Oh ! madame, madame ! Je vous jure que je ne voulais pas vous faire de la peine… Je ne savais pas. »
Mme Isabelle releva le front et laissa voir son beau visage inondé de larmes, au travers desquelles ses grands yeux considéraient l’enfant avec une expression presque effrayante, tout le désespoir s’y exaltait par l’amour.
Et, soudain, étendant les bras, elle saisit Pablo d’un geste passionné, l’attira sur sa poitrine, le couvrit de baisers, murmurant entre les spasmes du sanglot :
« Te pardonner, moi, te pardonner, pauvre petit ! Et pourquoi ? Parce que tu as fait revivre en moi un cher et affreux souvenir ? Mais je t’aime, mon petit Pablo ; mais ta seule présence, ta seule vue, avive ce souvenir. Je me dis que, moi aussi, j’avais un fils, qu’il se nommait comme toi, Pablo, qu’il aurait ton âge ; je me dis qu’il te ressemblerait, qu’il serait bon, brave, doux comme toi, s’il vivait. »
Elle s’interrompit, étreignant l’enfant plus étroitement :
« S’il vivait ! répéta-t-elle, avec un accent déchirant. Et tiens, ce que tu viens de nous apprendre m’a jeté dans l’esprit une pensée… Ah ! mon petit, mon petit ! Si mon Pablo, à moi, n’était pas mort, si tu… »
Mais Mme Hénault mère intervint. Elle se pencha sur sa belle-fille et, avec une douce autorité, murmura :
« Isabelle, Isabelle, mon enfant. »
La jeune femme détacha ses bras du cou de Pablo et, se levant, tomba dans ceux de la vieille dame, en gémissant :
« C’est vrai, ma mère, c’est vrai ! J’ai tort. Je le sais. Voilà que je redeviens folle ! »
Le petit garçon restait immobile, devenu soudain très pâle. Ses yeux ne pouvaient se détacher de la figure éplorée d’Isabelle. À son tour, il éprouvait une véritable commotion. Oh ! ce cri qu’elle avait jeté, cette parole qu’elle avait laissé échapper !
Une lumière en était jaillie, qui l’éblouissait, qui l’aveuglait, pour mieux dire. Il n’était plus le maître de sa pensée. Tout son cerveau était en ébullition. Le sang y confluait du cœur par bouffées, par poussées violentes qui lui donnaient le vertige. Des suppositions s’y pressaient plus extravagantes les unes que les autres.
Mais l’imagination de l’enfant n’eut pas le loisir de s’élancer plus avant dans les champs illimités du rêve charmant et cruel. Il venait d’entendre Mme Hénault la mère dire à sa belle-fille :
« Non, ma chérie, ne vous engagez pas sur cette voie aussi douloureuse que décevante. Vous le savez comme moi : qu’y a-t-il de plus répandu, de plus commun, parmi les Espagnols ou leurs congénères américains, que ces noms de Lopez et de Ricardo ? On ne peut asseoir aucune présomption sur d’aussi frêles concordances. »
Et, s’apercevant que le petit garçon, très ému, les écoutait et les contemplait de ses pupilles dilatées, elle entraîna doucement la pauvre affligée hors de la salle à manger.
La semaine s’acheva de la sorte, dans une silencieuse incertitude à laquelle s’ajoutait l’angoisse du dénouement fatal à craindre dans la situation du malheureux Ervoan.
Presque tous les jours, l’une des voitures du manoir portait à Louannec Pablo, tantôt seul, tantôt accompagné des dames ou d’Irène, qu’escortait une domestique. Ils allaient prendre des nouvelles du blessé, consoler la pauvre mamm, apporter quelque objet utile au soulagement du marin.
Il advint que, le dimanche, à l’issue de la grand’messe à Trélévern, au moment où les dames Hénault remontaient dans leur break, elles virent s’avancer Lân Plonévez qui, le chapeau à la main, après un salut respectueux, leur dit :
« Mesdames, mon frère a recouvré ses esprits et quelques forces. Il désirerait que vous lui fissiez l’honneur de le visiter, seules, – et d’un clignement d’yeux, il désignait les enfants, – car il voudrait vous faire entendre, devant M. le recteur et M. le notaire, des paroles qui vous intéresseraient.
– Ah ! proféra Isabelle Corsol, devenue aussi blanche que sa collerette de dentelle.
– C’est bien, monsieur Plonévez, se hâta de déclarer Mme Hénault mère. Nous vous remercions de l’avis. Aussitôt après le déjeuner, nous nous rendrons chez vous. À tout à l’heure. »
Elle serra la main du jeune capitaine, qu’embrassa Pablo, avant de remonter en voiture, et l’équipage regagna Ker Gwevroc’h d’un trot rapide.
On prit le repas de midi avec quelque hâte. Les deux dames venaient de sentir passer en elles simultanément le frisson prémonitoire des grandes crises de l’existence.
À deux heures sonnantes, elles reprenaient le chemin de Louannec.
Quand elles arrivèrent chez la veuve Plonévez, celle-ci les reçut avec cette déférence fière qui est la distinction des gens dont le cœur est plus haut que leur condition. Son visage, la veille encore ravagé par le souci, avait recouvré une sérénité qui n’était qu’un reflet du calme de sa belle âme. Aux questions que lui adressa Mme Hénault mère, elle répondit avec une noble simplicité :
« Madame, vous me voyez contente parce que le bon Dieu a visité mon fils et lui a inspiré de faire une bonne action. À présent, s’il vit, je serai plus heureuse, s’il meurt, je serai plus tranquille. »
Ayant ainsi parlé, elle les introduisit dans la chambre du premier étage, où reposait le blessé.
Celui-ci avait été examiné et ausculté, le matin même, par le docteur Bénédict. Le médecin avait constaté avec satisfaction que le poumon gauche, seul lésé par le couteau de l’assassin, n’était que perforé, et que la cicatrisation en était commencée. En conséquence, il avait signé un rapport au Parquet de Lannion, déclarant qu’Ervoan Plonévez pouvait subir un premier interrogatoire, à la condition que cet interrogatoire ne durât pas plus de quelques minutes.
Mais, en apprenant cette décision du praticien, le blessé avait demandé qu’il lui fût permis de faire, devant quelques personnes, une confession d’un haut intérêt.
Il y paraissait tenir essentiellement. Le docteur hésitait à autoriser ce qu’il tenait pour une imprudence.
La veuve intervint alors et appuya le désir de son fils, attestant qu’elle préférait le voir mourir, la conscience libérée du péché, que vivre avec la charge de son iniquité.
En conséquence M. Bénédict, respectueux de ces généreux scrupules, accorda son consentement. Tout aussitôt Lân alla chercher le recteur, qui convoqua à son tour le maire et le notaire Duguer. Puis le jeune homme prit sa course vers Trélévern, où il rencontra les dames Hénault, particulièrement visées par la confidence annoncée.
Donc, lorsqu’elles entrèrent dans la chambre, oppressées par une émotion facile à comprendre, elles saluèrent le prêtre, le magistrat municipal et le tabellion, qui se levèrent à leur vue.
Puis elles s’approchèrent du malade et lui adressèrent quelques paroles de réconfort.
Ervoan était presque assis dans son lit, adossé à une pile d’oreillers et de traversins qui le soutenaient en cette posture. Sa face exsangue, car la plaie avait provoqué une abondante hémorragie, gardait, même dans l’humilité du repentir, son caractère de générosité native. On devinait en cet homme un faible beaucoup plus qu’un coupable, presque une victime de ces fatalités organiques que les philosophes et les moralistes invoquent parfois à titre, sinon d’excuses, tout au moins de circonstances atténuantes. Il avait suffi d’une première faute pour dévoyer cette nature de sa voie, la pousser, par la désespérance, sur une pente fatale. Et peut-être fallait-il ne voir en ce coup de couteau meurtrier qu’un bienfait de l’immanente justice.
Quand tous les spectateurs de cette scène, qui s’annonçait émouvante, furent assis, le blessé, d’un organe caverneux, commença sa confession.
Il dit comment, après avoir fui son pays à la suite de la peine subie, il avait cherché à gagner sa vie à l’étranger : comment, pendant quatre ans, il avait fait un peu tous les métiers et, tout en vivant, mis de côté la somme qu’il avait pu offrir à sa mère.
Puis il expliqua qu’au bout de ces quatre ans, il s’était laissé embaucher comme matelot à bord de divers bateaux de nationalités différentes, mais qui, tous, relevaient d’une puissante maison d’armements ayant des sièges un peu partout et dont, longtemps, il avait ignoré le nom ou plutôt les noms.
Pourtant, un jour, il avait fini par s’apercevoir que la Ligue des Armateurs, la Free Sea Society, la Libera Unione, et d’autres associations ejusdem farinæ, n’étaient que les prête-noms et les masques d’une gigantesque entreprise de piraterie, d’un trust d’écumeurs de mer, dont le chef, apparent ou réel, était un métis, Brésilien, Argentin ou Cubain, dénommé Gonzalo Wickham.
Mais ces détails n’étaient que l’introduction ou la préface de la confession véritable.
Un peu fatigué par ce discours préliminaire, le blessé était retombé sur ses oreillers, et la syncope paraissait imminente. Alain et sa mère accoururent et rafraîchirent les tempes du pauvre garçon défaillant. Il se redressa avec une nouvelle énergie et poursuivit :
« Mais ce n’est pas pour vous dire cela que j’ai prié les deux dames de venir. Il y a trois jours, en causant avec mon cher petit Pablo, j’ai appris de lui qu’il y avait dans le pays des dames appelées Hénault, qui pleuraient la mort d’un enfant assassiné douze ans plus tôt. Alors la mémoire m’est revenue. Je me suis rappelé que j’avais souvent entendu le patron Gonzalo Wickham parler de grosses sommes qu’il toucherait un jour et qui dépendaient d’une succession Hénault. En même temps je me souvins de propos tenus devant moi par un mauvais drôle du nom de Ricardo Lopez, lui aussi un métis de blancs, d’indiens et de nègres. Ce Ricardo haïssait mortellement un enfant qu’on gardait à bord, dont on voulait faire, et dont on fit, par la suite, un mousse. Il le maltraitait souvent. Je m’étais attaché à cet enfant. Il m’arriva de le défendre contre Ricardo et même d’étrangler à moitié celui-ci, un jour qu’il courait, le couteau ouvert, sur le mousse.
» Le misérable se tira de mes mains, tout bleui et grinçant des dents. Il me jeta ces mots à la face :
» – Ce n’est pas toi, demonio, qui m’empêcherait de rendre aux poissons ce hijo del mar, si je ne craignais d’encourir la colère du patron.
» – Et moi, lui répondis-je, il n’y a pas de patron au monde qui puisse m’empêcher de te rompre les os, si tu t’avises de recommencer ce geste contre mon petit ami Pablo.
» Car l’enfant ainsi menacé, le petit mousse, n’était autre que celui dont m’a mère a accepté la garde, que mon frère Lân a tiré du naufrage sur le trois-mâts la Coronacion. »
Derechef les forces manquèrent au narrateur. Il s’affaissa, à moitié évanoui sur les coussins.
Mais il en avait assez dit pour que la vérité se fît jour. Les deux dames s’étaient jetées dans les bras l’une de l’autre et pleuraient, avec des lueurs de folle joie au travers de leurs larmes.
« Vous voyez bien, vous voyez bien, ma mère ? bégayait Isabelle en étreignant sa compagne. Mon cœur ne me trompait pas, Pablo est bien mon fils. »
Mais l’aïeule, plus prudente, se montrait lente à croire.
Tout ce bonheur inattendu, survenant après douze années de deuil, après d’infructueuses recherches conduites par toutes les polices du monde, lui inspirait une bien naturelle méfiance, une bien excusable appréhension.
Qui pouvait dire jusqu’où allait la véracité de ce blessé ? Qui pouvait assurer qu’il ne mentait pas lui-même, ou, peut-être, qu’il n’était pas le complice d’une odieuse machination, ou encore, qu’ayant surpris les projets de ses complices, il ne cherchait pas à en tirer parti pour lui-même, en substituant un enfant étranger à celui que pleuraient sa mère et son aïeule ?
Tout cela était possible, et, sans doute, le même soupçon avait effleuré l’esprit des trois hommes présents à l’entretien, car ils gardaient un silence plein d’incertitude.
On en était à ce point d’angoisse affreuse, lorsque Ervoan, revenant au sentiment, fit signe qu’il voulait achever sa confession. Le calme se rétablit, les oreilles se firent plus attentives que jamais.
« Monsieur le recteur, dit le blessé en étendant la main avec solennité, vous m’avez donné l’absolution. Je ne sais pas si je vais vivre ou mourir, mais je jure que j’ai dit la vérité. Pas toute la vérité, bien sûr, car je ne puis affirmer que Pablo est vraiment le fils de M. Hénault assassiné par ces bandits. Cependant, je crois en avoir mieux qu’une présomption, presque une preuve.
– Une preuve ? s’écrièrent les deux femmes.
– Voici ce que j’ai à vous dire, reprit Ervoan. L’enfant que je connais porte à la plante du pied, près du talon, une cicatrice profonde. La chair a été fort entamée, on dirait même brûlée, et, ce qui est le plus étrange, c’est que la trace de cette brûlure a laissé un double bourrelet, comme si l’on y avait posé un instrument à deux pointes. »
Un cri simultané interrompit le narrateur.
« Plus de doutes ! s’exclama la jeune femme. Ce ne peut être que mon fils. Rappelez-vous, ma mère. Pablo avait quinze mois. Sa nourrice l’avait posé sur la pelouse du jardin. Un serpent, qui rampait dans l’herbe, le mordit au pied gauche. Nous accourûmes aux cris de l’enfant et de la nourrice. Je suçai la plaie et vous voulûtes la cautériser sur l’heure.
– C’est vrai, reconnut la vieille dame, et, comme je n’avais sous la main aucun instrument qui pût me servir à cette fin, je m’emparai d’un fer à tuyauter qui rougissait sur un petit fourneau à repasser. Et je me rappelle que je tins le fer trop longtemps sur la blessure, que le pauvre petit pleura beaucoup et fut malade pendant trois jours. »
Ervoan était retombé, épuisé. Il murmura :
« Voilà ce que j’avais à vous dire, mesdames. Je ne sais rien de plus. À vous de vous assurer que Pablo porte bien la cicatrice que je vous indique. Pour moi, j’ai fait mon devoir. Je le ferai plus encore, si Dieu me laisse vivre. Je me mettrai à la disposition de la police, parce que je connais plusieurs des endroits où les bateaux maudits relâchent, où ils ont des correspondants attitrés. Mais, d’abord, j’ai tenu à faire ces déclarations, et je désire qu’on les écrive. Je suis tout prêt à les signer. »
Le maire, le curé, le notaire, très émus maintenant, donnèrent au blessé la certitude que, le lendemain, ils témoigneraient devant le substitut de Lannion. Frémissantes d’impatience, les dames Hénault remercièrent Ervoan et les siens avec effusion et s’empressèrent de gagner leur voiture.

IX
Enfant retrouvé.
Ce fut de leur trot le plus rapide que les chevaux de Ker Gwevroc’h ramenèrent les dames Hénault au manoir.
Pablo et Irène étaient descendus dans le parc. Ils s’y entretenaient des incidents du déjeuner.
Maintenant qu’ils connaissaient leur commune pensée, ils n’avaient plus de motifs de s’en taire l’un en face de l’autre.
Aussi devisaient-ils gravement, avec une précocité de jugement bien supérieure à celle des enfants de leur âge.
Car ils ne pensaient pas à jouer, ce jour-là.
Ils s’étaient dirigés vers un kiosque rustique situé au milieu d’une pelouse, sur un monticule assez élevé, d’où l’œil pouvait embrasser un merveilleux panorama de mer.
Pablo, anxieux, interrogeait sa jeune compagne, lui demandant de nouveaux éclaircissements sur les paroles qu’elle avait prononcées naguère.
« C’est drôle, répondait Irène, il y a déjà longtemps que j’ai cette idée-là dans la tête. Elle m’est venue, tout d’un coup, je ne sais comment, ni pourquoi, le jour où vous nous avez dit votre nom pour la première fois. Mme Plonévez venait de raconter à ma tante comment son fils Alain vous avait sauvé du naufrage sur le pont de ce bateau qui s’est perdu. Elle avait ajouté que vous-même ne saviez ni votre âge, ni votre nom. Et, alors, vous êtes intervenu, disant :
» – Mon nom, mamm Plonévez ? Oh ! si je le sais bien. Je m’appelle Pablo.
» Je vois encore la figure de ma tante se troubler en vous entendant parler ainsi. Et c’est alors que, sans rime ni raison, l’idée m’est venue que vous étiez peut-être son fils Pablo. »
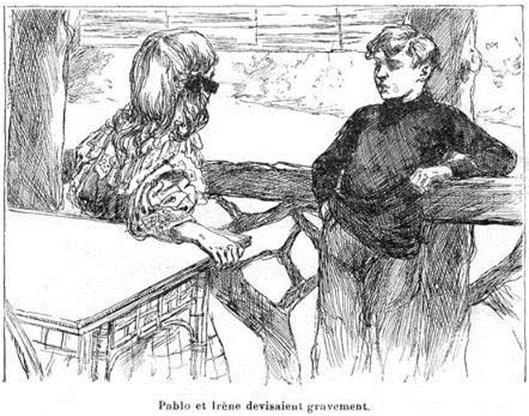
Le jeune garçon était en proie à une agitation croissante.
« Oh ! mon Dieu ! fit-il en joignant les mains ; si vous aviez raison ! Si cela pouvait être vrai !
– Vous en seriez donc bien heureux, Pablo ?
– Si j’en serais heureux ? Ah ! mademoiselle Irène, il me semble que j’en deviendrais fou de joie. Retrouver ma mère ! Songez donc que je ne l’ai jamais connue ?
– Moi non plus, Pablo, murmura la petite fille, en essuyant les larmes pendues à ses paupières.
– Oh ! oui, je le sais. Quel malheur de n’avoir plus de mère !
– Un immense malheur, Pablo. Et le mien est plus grand que le vôtre, puisqu’il vous reste encore un espoir de retrouver la vôtre, tandis que, je suis trop sûre de ne jamais revoir la mienne, puisqu’elle est morte. »
Et elle se mit à pleurer, sans que Pablo parvînt à imaginer des mots pour consoler ce chagrin trop justifié.
Pourtant, après quelques instants de silence, Irène reprit :
« Mais, si vous la retrouviez, Pablo, il vous faudrait vous séparer de votre mamm Plonévez. Dites ? Est-ce que ça ne vous causerait pas de douleur ? Car vous l’aimez bien, n’est-ce pas ?
– Certes, oui, je l’aime, s’exclama le gars avec chaleur. Je suis sûr que je pleurerais. Mais, que voulez-vous, Irène ? je serais tout de même bien heureux d’aller vers l’autre, vers ma vraie mère. Croyez-vous que ce serait mal ? »
La pensée mobile de la fillette passa brusquement à d’autres considérations.
« Savez-vous ce que je juge plus extraordinaire encore ?
– Quoi donc ? Qu’y a-t-il de plus extraordinaire ?
– C’est que, depuis six mois que nous nous connaissons, que vous venez ici, que nous jouons ensemble, que vous déjeunez et dînez avec mes tantes, pas une seule fois il ne vous est arrivé de prononcer le nom de ce méchant homme que vous accusez d’avoir frappé votre ami Ervan, de ce Ricardo.
– C’est vrai, reconnut Pablo ébahi. C’est vrai, je n’avais jamais parlé de tout cela.
– Et c’est pourtant d’entendre ce nom de Ricardo que maman Isabelle, d’abord, maman Hénault ensuite, se sont si fort émues. Qu’est-ce donc que ce Ricardo ? »
Le jeune garçon raconta alors à son interlocutrice tout ce qu’il savait du sinistre personnage.
Ce « tout » n’était pas grand’chose.
L’ancien mousse n’avait gardé de l’ex-matelot de la Coronacion qu’un souvenir d’exécration. Il narra à la petite fille toutes les misères que lui avait fait endurer le mulâtre féroce, les injures prodiguées, les coups reçus, jusqu’à la menace de faire inopinément connaissance avec la navaja de l’Argentin.
« Alors, reprit la petite fille, vous ne savez pas autre chose de cet homme ? Je comprends que mes tantes se soient émues, car le domestique qu’elles avaient en Amérique, et qu’elles croyaient mort en même temps que mon oncle et le petit garçon, s’appelait précisément Ricardo Lopez. »
Le temps s’était écoulé rapidement, au cours de cet entretien, sans qu’ils s’en aperçussent. Il y avait plus de trois heures que les dames Hénault avaient quitté Ker Gwevroc’h.
En ce moment, un roulement de voiture venu de la route attira l’attention des enfants. Ils portèrent leurs regards dans la direction du bruit et, à travers le rideau d’arbres, purent reconnaître le véhicule courant sur la chaussée, avant de tourner à l’avenue du manoir.
« Les voilà qui reviennent, s’écria Irène. On dirait que les chevaux vont plus vite qu’à l’ordinaire, que Pierre les presse davantage. »
Pierre, c’était le cocher du manoir, un vieil homme lent et flegmatique à son habitude et qui, pour rien au monde, n’eût dérogé à cette habitude. Pour qu’il mît une telle hâte à l’allure de ses bêtes, il fallait qu’on le stimulât.
Pablo et Irène s’élancèrent dans l’avenue, au-devant de la voiture. En les apercevant à distance, Mme Hénault la mère donna l’ordre au cocher d’arrêter. Mais, en même temps, elle dit à sa belle-fille :
« Ma chère Isabelle, je vous en prie, pas de fausse joie, pas d’exaltation. La déception serait trop cruelle.
– N’avez-vous pas entendu cet homme, ma mère.
– Sans doute, et c’est parce que je m’en souviens que je veux, tout d’abord, vérifier l’exactitude de ses dires. Si ce petit garçon porte vraiment à l’endroit indiqué la cicatrice probante, je ne contesterai plus le témoignage de cet Ervoan qui, je l’avoue, n’a pu inventer un semblable détail, connu de nous seules, puisque la nourrice de Pablo mourut un mois après l’accident et que Ricardo n’entra à notre service qu’une année après.
– Je ne dirai rien, ma mère, je vous le promets. »
Isabelle mit pied à terre, mais, en dépit de sa promesse, elle eut toutes les peines du monde à réprimer les élans de son cœur.
Elle se contenta, néanmoins, de prendre les mains d’Irène, tandis que sa belle-mère s’emparait de celles de Pablo et l’entraînait vers la maison.
La vieille dame, malgré son empire sur elle-même, n’en paraissait pas moins très émue.
En ramenant le petit garçon, elle s’oubliait à le tutoyer, entremêlant le tu au vous.
« Écoutez, mon cher Pablo. Tu vas me faire un plaisir. Tu vas monter dans la salle de bains. Tu t’y déchausseras et tu ne remettras pas tes chaussures avant que je ne sois allé vous voir. »
Tout à fait surpris par cette invitation et plus encore par ce langage décousu, l’enfant y obtempéra néanmoins sans réserve. Chose qui lui parut plus étrange encore, ce fut Mme Hénault elle-même qui voulut lui porter l’eau chaude nécessaire au bain de pieds qu’on lui imposait, sans qu’il sût pour quel motif.
Jamais sa propre attention ne s’était portée sur la cicatrice qu’il gardait au métatarse. Il ne la remarqua qu’en cette circonstance à la faveur de la recommandation faite par la vieille dame.
Quand il eut terminé le bain imposé, il appela. Mme Hénault n’était pas loin. Elle attendait à la porte même de la salle de bains. À l’appel de Pablo elle entra brusquement, et le petit garçon remarqua qu’en outre de ses lunettes de presbyte relevées sur son front, la « bonne maman » d’Irène s’était munie d’une loupe à main. Elle tenait également un instrument qui parut bizarre à l’enfant, en cette circonstance, à savoir un fer à tuyauter dont l’une des branches s’emboîtait dans la cannelure de l’autre.
Elle entra, souriante, mais il était visible que son émotion de naguère n’avait fait que croître. Elle tremblait lorsque, ajustant ses lunettes, elle fit signe à l’enfant de s’asseoir et de lui tendre ses pieds.
Armée de la loupe, elle examina avec soin.
Le pied droit n’offrait rien d’anormal, mais le gauche répondait au signalement fourni par Ervoan.
Sur la peau très blanche, un double bourrelet rose se montrait, accusant une cautérisation profonde opérée par un instrument à deux branches. Entre les lèvres de ces bourrelets, un sillon se creusait qui, bien que comblé par la chair, était encore assez récent pour permettre l’application du fer à tuyauter.
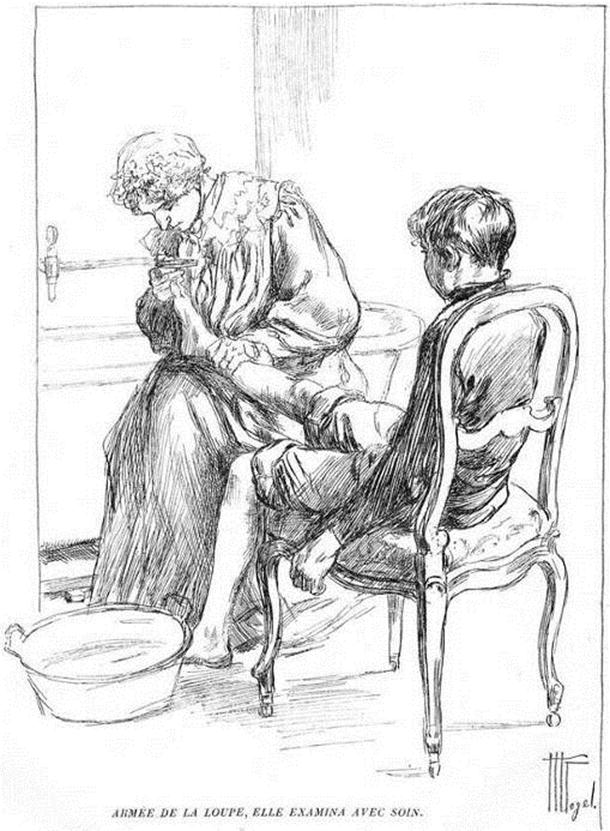
La main de Mme Hénault tremblait en posant l’objet sur la plante du pied ; des pleurs brouillaient ses yeux. Pourtant Pablo l’entendit murmurer :
« C’est cela, c’est bien cela. Le doute n’est plus possible. »
Et, se relevant, la vieille dame revint vers la porte et, du seuil, appela dans le corridor :
« Isabelle, ma fille, venez. »
La jeune femme n’était pas éloignée non plus. Comme l’autre, elle avait attendu, le cœur sursautant d’angoisse.
Elle accourut, palpitante, suivie d’Irène qui s’avançait timidement et qui demanda :
« Et… moi, bonne maman, est-ce que… ?
– Viens aussi, ma chérie », autorisa l’aïeule.
Irène entra, hésitante. Elle vit Pablo, les pieds nus sur le tapis, troublé, attachant sur les deux femmes des yeux où se lisait une émotion égale à la leur.
« Isabelle, prononça gravement Mme Hénault la mère, je n’ai pas voulu que mes baisers précédassent les vôtres. Embrassez votre fils et remercions Dieu de nous l’avoir rendu. »
La jeune femme chancela en ouvrant les bras à l’enfant retrouvé. Un double cri s’échangea dans le frisson des larmes d’immense joie :
« Pablo ! mon Pablo ! mon fils !
– Maman ! »
Pendant quelques minutes, il n’y eut pas d’autre parole. La mère et l’enfant s’étreignaient follement, comme s’ils eussent voulu compenser par d’innombrables caresses les douze années de deuil et de séparation.
À la fin, les mots revinrent sur les lèvres du jeune garçon et se mirent à en jaillir simples, naïfs, abondants, variant les expressions de tendresse, exprimant toutes les nuances du sentiment sacré que, depuis des mois, Pablo s’efforçait de contenir en son cœur plein à éclater.
« Maman, maman, comme je vais t’aimer, comme je vais rattraper le temps perdu ! Oh ! tu ne sauras jamais, tu ne peux pas savoir combien je t’aime, combien je t’aimais déjà depuis longtemps, depuis le premier jour où je t’ai rencontrée sur la plage de Treztel. »
Et elle, entre deux baisers, en riant, de répondre :
« Oui, sur cette plage de Treztel où tu nous as sauvées, Irène et moi. Tu vois, mon cher petit, Dieu est bon. C’est ta mère qu’il t’a permis de sauver ! »
La première joie n’était pas épuisée. Pourtant les témoins du drame en demandaient aussi leur part.
« Et moi, petit Pablo, questionna Mme Hénault, est-ce que tu ne m’embrasseras pas aussi ? Je suis ta grand’mère.
– Ma « bonne-maman », comme celle d’Irène ! » s’écria-t-il en passant impétueusement, des bras de sa mère à ceux de son aïeule.
Une voix apitoyée, presque dolente, murmura :
« Est-ce que je ne pourrais plus, maintenant, dire « maman » et « bonne-maman », comme auparavant ?
– Oh ! chère petite ! proféra Isabelle en enlaçant la fillette. Peux-tu demander cela ? Pablo serait trop triste si je n’étais plus aussi ta mère.
– Comme tu parles bien maman ! s’exclama le jeune garçon. Tu as le cœur bien assez grand pour aimer deux enfants à la fois ! »
C’était le mot très simple et très noble qui résumait les sentiments divers éclos dans tous ces cœurs généreux où le bonheur tombait en semence d’autant plus féconde, qu’ils avaient été plus cruellement labourés par la douleur.
Et, cependant, la générosité naturelle de Pablo trouva encore à se manifester.
Lorsque, plus calme, Isabelle passant des larmes au rire, eut voulu examiner à son tour la bienheureuse cicatrice qui avait, en quelque sorte, marqué son fils pour le « revoir » inespéré, lorsqu’elle eut raconté à celui-ci stupéfait et à Irène curieuse l’événement lointain qui avait occasionné cette brûlure providentielle, lorsque Pablo, rechaussé et bondissant, fut descendu avec ses trois compagnes dans le parc, il se pencha, un peu mélancolique, sur l’épaule de sa mère, qui ne le quittait plus, et murmura à son oreille :
« Maman, il faudra bien que j’aille embrasser mamma Plonévez qui m’a soigné comme son fils, Lân et Ervan qui m’ont aimé comme si j’étais leur frère !
– Certes ! répliqua l’heureuse femme. C’est moi-même qui t’y conduirai. Crois-tu donc, mon cher petit, que j’aie moins de reconnaissance que toi envers cette autre mère qui m’a conservé mon enfant, qui l’a gardé, soigné, nourri lorsqu’il n’avait aucun espoir à lui offrir, aucune récompense à lui donner ? Sois assuré que, désormais, Mme Plonévez est de notre famille. Ce n’est pas moi qui serai jalouse de t’entendre l’appeler du même nom que moi.
– Oh ! fit le garçonnet en étreignant sa vraie mère d’un geste ardent, ce ne sera pas tout à fait la même chose. »
Avec un fin sourire, Irène souligna le propos.
« Non, ce ne sera pas la même chose. Tu l’appelleras mamma en breton, et ici tu prononceras maman en français. »
Il était trop tard pour que, ce même jour, on pût mettre le projet à exécution. On se borna donc à se réjouir en famille, sans en excepter les serviteurs qui, le soir venu, furent tous assemblés au salon par Mme Hénault la mère.
En termes émus, la vieille dame leur présenta Pablo et le fit unanimement reconnaître pour son petit-fils.
Après quoi, l’on passa dans la salle à manger où Irène plaça des coupes pour les domestiques présents, tandis que Pablo les emplissait lui-même, en faisant sauter joyeusement les bouchons du champagne.
Puis il fit le tour de l’assistance et donna l’accolade aux douze membres du personnel, depuis le vieux cocher Pierre jusqu’au petit groom Erwin, qui avait le même âge que lui, à savoir quatorze ans.
On trinqua, on porta des toasts marqués au coin de la plus fruste sincérité. La femme de chambre Annaïk, qui ne parlait guère que le breton, ne fut pas la moins éloquente.
Le lendemain, la voiture fut attelée de bonne heure. Les dames Hénault, Irène et Pablo partirent simultanément pour Louannec.
On allait porter la bonne nouvelle à mamm Plonévez et à ses fils, confirmer les déclarations d’Ervoan par la reconnaissance officielle de l’enfant retrouvé.
Quand on arriva à la maisonnette, le substitut de Lannion achevait d’interroger le matelot.
Il fut satisfait d’apprendre la venue des habitants de Ker Gwevroc’h. En sa présence le blessé renouvela ses déclarations, auxquelles Isabelle Hénault et sa belle-mère joignirent la preuve de leurs propres constatations.
Le magistrat conseilla aux deux dames d’introduire tout de suite une instance en rectification d’état civil. Il s’agissait, en effet, d’établir au plus tôt l’identité de l’enfant. On verrait quelle suite il conviendrait de donner, plus tard, aux renseignements fournis par Yves Plonévez au sujet de l’association de malfaiteurs qu’il venait de dénoncer aux autorités françaises.
Mme Hénault la mère se conforma donc à ce sage avis.
Dès le lendemain, accompagnée de sa belle-fille et des deux enfants, elle se transporta à Lannion, où elle remplit toutes les formalités judiciaires requises par la loi.
Mais là ne devait pas se borner son action.
C’était une maîtresse femme que cette Mme Hénault. Elle l’avait bien montré en de plus graves circonstances. Elle allait en fournir de nouvelles preuves.
Huit jours n’étaient pas écoulés que, franchissant, seule cette fois, les huit kilomètres qui séparent le Trévou de Louannec, elle se présenta inopinément chez la veuve Plonévez et, sans précautions oratoires fit à Alain des ouvertures catégoriques.
Ses propositions étaient aussi nettes qu’ingénieuses.
« Monsieur Plonévez, dit-elle, je viens vous demander votre concours pour une œuvre de préservation sociale.
– Que dois-je entendre par là, madame ? interrogea le jeune homme, un peu surpris par cet exorde ex abrupto.
– Je vais m’expliquer, reprit la vieille dame. Les magistrats de Lannion m’ont fait savoir que notre démarche pour rétablir l’état civil de notre petit Pablo serait grandement facilitée par la production de quelques pièces authentiques établissant sa filiation légitime, et que la preuve serait absolue si la pièce en question pouvait surtout être prise des mains des scélérats dénoncés par votre malheureux frère. Commencez-vous à me comprendre ?
– J’essaie, madame, répondit dubitativement Alain.
– Bien. Je continue donc. Selon le témoignage de votre frère, ces misérables ont trouvé, jusqu’ici, le moyen de se dérober à toutes les poursuites des polices internationales, soit qu’ils jouissent de privilèges inconnus, soit qu’ils fomentent des complicités au sein de ces polices mêmes. Et c’est bien là ce que laissaient entendre les déclarations de M. Ervoan Plonévez.
– En effet, madame. Mon frère ne l’a pas seulement donné à entendre, il l’a formellement précisé.
– Eh bien monsieur Alain, vous allez connaître toute ma pensée, et vous y répondrez selon la franchise de votre caractère, avec toute la liberté de votre jugement.
« Voici ce que je veux faire.
» Puisque ces coquins sont assez bien organisés pour déjouer toutes les surveillances et acheter, au besoin, les complaisances de polices vénales, il faut leur opposer des adversaires qui ne soient pas à vendre et qui, en les poursuivant, obéissent à un désir personnel de justice, de vengeance même, si vous préférez.
– Ah ! s’exclama Alain, dont les yeux étincelèrent, si je saisis bien votre pensée, vous voudriez organiser une expédition contre ces bandits ?
– Une expédition serait trop dire. Des gens qui disposent d’une véritable flotte et d’équipages nombreux ne sauraient être réduits que par une force égale à la leur en nombre d’hommes et de bâtiments. Il n’y a guère que les puissances des deux continents qui disposent d’un pareil chiffre de vaisseaux et de marins. C’est donc affaire à elles d’engager la lutte contre cette association de forbans.
» Mais, en dehors de l’action des puissances, pour servir et faciliter cette action, il suffirait de grouper un certain nombre de volontés énergiques et d’expériences confirmées, résolues à donner la chasse à ces pirates internationaux, à suivre leur piste sur toutes les mers, à la signaler aux vaisseaux de guerre chargés d’en faire justice. Il suffirait d’un navire de rapides allures, monté par un équipage d’élite, commandé par un homme de tête qui aurait à cœur de délivrer le monde de ce fléau, tout en assurant sa propre gloire ou, tout au moins, la réhabilitation d’un être qui lui serait cher. J’ai pensé à vous pour cela, monsieur Alain. Vous cherchez un commandement ; je vous offre celui du navire que je vais armer et équiper pour accomplir cette grande besogne de salubrité.
– Et, s’écria Lân, enthousiasmé, quel est ce navire ?
– Ah ! Voilà où, précisément, votre secours va surtout m’être indispensable. Ce navire, je ne le possède pas encore, je ne sais s’il existe, ni combien de temps il faudrait pour le construire. Mais ce que je sais fort bien et que je n’hésite pas à vous dire, c’est que j’aurai un tel navire. Ma fortune et celle de ma belle-fille, surtout lorsque nous aurons établi l’identité de mon petit-fils, peuvent être appelées considérables, sans aucune forfanterie, ni vanité. Je puis donc affecter un ou plusieurs millions à l’achat ou à la construction de ce bateau, pourvu que cette construction soit rapide, car c’est en ce moment qu’il faut nous lancer à la poursuite de ces bandits, si nous ne voulons pas leur laisser le temps de pénétrer nos desseins.
» Pouvez-vous et voulez-vous coopérer à mon dessein ? »
Ce disant, Mme Hénault tendait la main au jeune homme.
Celui-ci la porta à ses lèvres.
« Madame, dit-il, j’accepte d’autant plus votre offre que, selon vos propres paroles, j’entends poursuivre « la réhabilitation d’un être qui m’est cher » entre tous, mon frère Ervoan, plus malheureux que coupable. Il peut nous être un guide sûr. Le médecin répond de sa vie et assure qu’il sera sur pied d’ici deux mois. C’est le temps qu’il nous faut pour préparer l’expédition projetée, si, du moins, nous avons pu, d’ici-là, trouver le navire que vous cherchez.
– Il faut le trouver, monsieur Alain.
– Je le veux bien, madame. Mais laissez-moi vous dire que nous ne le trouverons certainement pas en France. Il nous faudra le découvrir en Hollande, ou en Angleterre, peut-être même aux États-Unis.
– Qu’importe ! Vous le découvrirez. Je vais déposer dans une grande banque parisienne, au Crédit Lyonnais par exemple, une somme de deux millions avec ouverture de compte à votre nom. Demain, je signerai avec vous, chez Me Duguer, un contrat en bonne et due forme. Le tout devra rester secret entre nous, car nos ennemis éventuels doivent être aux aguets ; ils doivent être informés que le poignard de Ricardo Lopez, tout en blessant gravement votre frère, n’a pas supprimé son témoignage.
– Je suis entièrement de votre avis, madame. Jusqu’au jour où nous prendrons la mer, il faut agir avec la plus extrême circonspection. Un secret rigoureux doit envelopper nos projets et nos actes. Rien n’en doit transpirer au dehors.
– C’est bien ainsi que j’envisage la chose, monsieur, confirma la vieille dame. À partir d’aujourd’hui, tout demeure entre vous et moi. Moi seule recevrai vos avis et vos communications. Allez donc, monsieur, et agissez à votre guise. Je m’en remets entièrement à vos soins. »
Le lendemain de ce jour, le contrat était signé entre les deux parties, dans le cabinet même de Me Duguer. Rien, dans sa teneur, n’en précisait la cause ni la fin. Tout se bornait à cette vague indication que Mme veuve Hénault, désignée avec ses noms et prénoms de femme et de jeune fille, mettait à la disposition de M. Alain Plonévez, capitaine au long cours, une somme provisoire de cinq cent mille francs à un million pour achat d’un yacht de plaisance, au compte de ladite dame Hénault, yacht dont ledit Alain Plonévez serait le capitaine.
En même temps, Mme Hénault adressait au notaire parisien détenteur des titres de sa fortune la demande de faire ouvrir au Crédit Lyonnais un compte courant au nom de M. Alain Plonévez.
Trois jours encore s’écoulèrent, qui ajoutèrent à la lente amélioration de l’état d’Ervoan. Le blessé, très affaibli par la perte de son sang, put s’alimenter et recouvrer des forces.
Au bout de ce temps, voyant son frère en voie de guérison, Alain annonça son départ pour le surlendemain, puis se rendit à Ker Gwevroc’h, afin de prendre congé des dames du manoir.
Il y trouva la joie encore exultante. Il embrassa tendrement Pablo, qui ne cessa de le nommer son frère.
Le jeune capitaine quitta Louannec le soir de ce jour et gagna Paris, d’où il passa en Belgique.
Ce fut d’Anvers qu’il adressa à Mme Hénault une dépêche sommaire, ainsi conçue :
« Trouvé l’objet rêvé. Rentre en France pour conférer avec vous. Serai Paris demain soir, six heures. »
« J’y serai aussi », décida la vieille dame.
Tout aussitôt, à la grande surprise de son entourage, elle prépara une valise, fit atteler et, sans fournir la moindre explication, se fit porter à Lannion, où elle prit le train de huit heures, correspondant à Plouaret avec l’express de Brest.
Le lendemain, elle était à Paris et se rendait, dans la soirée, à la gare du Nord pour y attendre l’arrivée d’Alain par le rapide de Bruxelles.
« Mon cher monsieur Plonévez, lui dit-elle gaiement, j’ai voulu vous économiser du temps et un chemin inutile. Nous allons nous reposer ce soir à l’hôtel et nous repartirons demain pour Anvers.
– À la bonne heure ! s’exclama le jeune Breton. Voilà comment je comprends que l’on mène les affaires. Je ne suis que capitaine, madame. Vous êtes mon amiral. »
La vaillante femme ne put s’empêcher de rire.
« Hé ! hé ! fit-elle, que diriez-vous si l’amiral voulait s’embarquer sur le vaisseau de son capitaine ? »
Alain partagea son hilarité.
« Je n’aurais rien à dire, puisqu’il userait de son droit. N’est-ce pas, d’ailleurs, sous votre pavillon que nous allons naviguer ? Il est donc tout à fait juste que vous connaissiez le navire qui doit vous porter. Je crois que vous ne serez pas mécontente de mon choix. »
Il expliqua allégrement qu’il considérait sa trouvaille comme une prédestination du sort. Comment, en effet, désigner d’un autre nom les circonstances qui l’avaient conduit à Anvers où il allait découvrir un superbe bateau, récemment construit pour un milliardaire américain, tenant à la fois du yacht et du destroyer, ayant fourni aux essais une vitesse de trente nœuds et pouvant se maintenir huit heures à celle de vingt-cinq nœuds ? Comment surtout expliquer que ce navire, dont le propriétaire était mort subitement et dont ses héritiers se défaisaient au prix de quinze cent mille francs, eût reçu le nom symbolique de Némésis, c’est-à-dire de la déesse des justes vengeances ? Car n’était-ce pas à une œuvre de juste vengeance, contre des écumeurs mis au ban de l’univers, qu’allait s’employer cette providentielle Némésis ?
La journée s’acheva en conversations et en courses à travers Paris, et, le lendemain, ainsi qu’il avait été convenu, la vieille dame et Alain prirent le train pour la Belgique.
Six heures plus tard, ils mettaient pied à terre dans la belle cité de l’Escaut et, le déjeuner pris aussi promptement que possible, se dirigeaient vers les admirables bassins du port.
Là se balançait sur ses ancres le beau navire dont Alain Plonévez avait entretenu Mme Hénault.
Celle-ci voulut le visiter sur-le-champ. Le yacht était entièrement neuf. Il n’y avait pas un mois qu’on en avait achevé le boisage intérieur, aussi luxueux que pouvait le désirer un amateur qui y consacrait le double de la somme que demandaient les héritiers pour s’en défaire.
En revenant au quai, Mme Hénault manifesta son émerveillement à Alain. Modeste autant qu’avisé, le jeune capitaine se félicita néanmoins d’avoir eu la main si heureuse.
« Il nous faut, maintenant, conclut-il, achever l’aménagement et l’approvisionnement pour une longue croisière, et, ce qui sera plus difficile, recruter un équipage d’élite. C’est à cela que je vais pourvoir au plus tôt.

X
La Némésis.
Le 1er novembre, le port de commerce de Brest reçut un bateau de plaisance qui fut, tout aussitôt, l’objet d’une vive curiosité de la part des habitants et de la population maritime de la ville.
Ce navire, qui battait pavillon belge et appartenait, disait-on, à un sénateur anversois, mesurait quatre-vingts mètres de longueur, de la guibre au couronnement de l’arrière, et sept mètres de largeur sur le pont. Élégant et gracile, gréé en brick, avec misaine et grand mât, sans artimon, il avait une hauteur de deux mètres seulement à l’arrière, tandis qu’à l’avant le taille-mer s’élevait du double au-dessus de l’eau. Son tirant d’eau était d’un mètre à l’avant, de quatre à l’arrière.
Il apparaissait donc tout de suite comme un véritable coursier de l’océan, spécialement construit pour les vitesses supérieures à la norme habituelle.
Sur le pont, indépendamment de ses deux cheminées, le navire montrait deux superstructures rectangulaires, les spardecks de l’avant et de l’arrière. Ses mâts, peu élevés, appartenaient au type du gréement aurique, c’est-à-dire en goélette. Ils ne figuraient là qu’à titre d’ornements, peut-être aussi pour permettre le repos de la chauffe, en cas d’interruption forcée.
Le dessin du bateau en faisait un yacht de plaisance. On le reconnaissait d’ailleurs à la richesse de son bordé, au luxe de ses bois et de ses cuivres. L’acajou y avait été prodigué en revêtements intérieurs. Partout ailleurs, au poli de la carène, on devinait l’emploi du teck, aussi bien dans l’armature des couples que dans la doublure du vaigrage.
Mais, sous d’autres aspects, il eût pu se présenter comme vaisseau de guerre, tant l’étroitesse de ses flancs lui donnait l’apparence d’un de ces lévriers sloughis dont la maigreur est caractéristique de leur rapidité. Il portait, en outre, une artillerie légère, de douze pièces, que l’on voyait distribuées à la fois sur les spardecks, à l’avant et à l’arrière, et sur les coursives de tribord et bâbord. De fortes gaines de cuir les dissimulaient entièrement aux regards, tout en accusant leurs inquiétantes silhouettes.
Ce fut précisément cette figure sournoise qui excita au plus haut point la curiosité des Brestois, plus particulièrement des officiers de marine, dont beaucoup demandèrent à visiter le mystérieux navire. Et l’on ne fut pas peu surpris d’apprendre que ce yacht belge était commandé par un jeune capitaine français, et, qui plus était, par un enfant du pays, un breton des Côtes-du-Nord, nommé Alain Plonévez.
L’équipage lui-même, composé de trente officiers et matelots, ne comptait que deux Belges, les chauffeurs.
Cependant le yacht Némésis, tel était son nom, n’était venu à Brest que pour faire le plein dans sa soute à charbon et dans les flancs de la chaufferie. Du moins tel fut le prétexte qu’il invoqua. On remarqua pourtant que le capitaine avait été reçu à deux reprises par le préfet maritime, avec qui il avait eu d’assez longues conférences.
Le quatrième jour après son arrivée, plus exactement le 5 novembre au matin, il quitta le port et après quelques évolutions dans la rade, évolutions au cours desquelles l’amiral et une partie de son état-major embarqués en curieux, purent constater que le yacht pouvait donner la prodigieuse vitesse de trente-deux nœuds, qui est celle des contre-torpilleurs aux essais, la Némésis prit définitivement congé de la ville de Brest et disparut en quelques minutes sur l’horizon du Goulet.
Depuis six semaines de graves décisions avaient été prises à Ker Gwevroc’h.
Mme Hénault, à son retour d’Anvers, s’était arrêtée à Paris et avait obtenu une audience du ministre de la Marine.
Avec une logique et une clarté souveraines, elle lui avait exposé les récents événements accomplis à Louannec, et qui, par une chance inattendue, avaient mis entre ses mains le secret des pirates internationaux dont la police du monde entier cherchait vainement la trace depuis nombre d’années.
Elle avait, en outre, notifié au ministre sa volonté de poursuivre, à son compte et par son initiative privée, l’œuvre de justice que réclamaient les forfaits, impunis jusqu’alors, dont toutes les chancelleries s’étaient émues.
La surprise avait été grande au Ministère. Il n’avait fallu rien moins que les preuves fournies par l’énergique femme pour convaincre le ministre.
Mais alors, plein d’admiration, celui-ci avait donné toute son approbation et promis tout son appui à Mme Hénault.
Le premier effet de ce concours officiel avait été que le ministre avait obtenu de son collègue de la Justice la suspension de toutes recherches judiciaires au sujet d’Yves Plonévez, ce dernier devenant l’auxiliaire de Mme Hénault et étant appelé à lui rendre de signalés services. Il avait exigé, toutefois, que le commandement du yacht, affecté à la besogne de recherches, serait remis à un officier de marine, le choix du titulaire étant laissé, d’ailleurs, à Alain Plonévez, qui figurerait à titre de second ; que l’équipage fût composé d’hommes choisis et éprouvés.
La vieille dame n’était que trop bien disposée à tenir compte de ces avis. Elle en fit part à Lân, qui y souscrivit avec d’autant plus d’empressement que cette décision ministérielle mettait à couvert sa responsabilité de capitaine débutant en une carrière difficile.
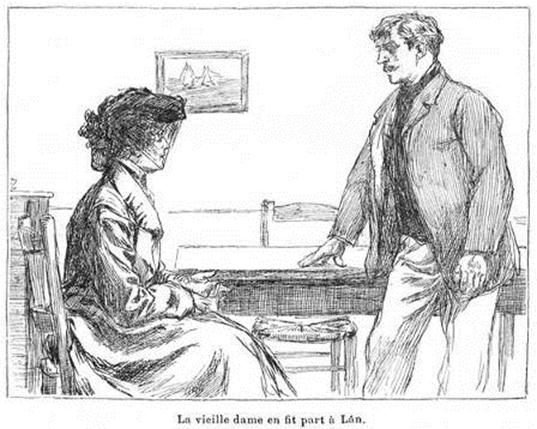
Il résulta de l’accord des parties que ce dernier se rendrait à Brest où, parmi plusieurs officiers sous les ordres desquels il avait servi, il demanderait l’acquiescement de celui à qui la mission lui paraîtrait le mieux dévolue.
Telle fut la raison qui amena le yacht Némésis à Brest d’où il repartit, emmenant à son bord, avec le consentement de l’amiral et sur l’offre d’Alain, l’enseigne de vaisseau Eugène Le Gouvel, désormais capitaine en titre, dont Lân Plonévez devenait le second.
À Saint-Servan, où il devait relâcher, il prendrait en outre deux seconds maîtres mécaniciens, placés sous les ordres du mécanicien Grandy, et un médecin, le docteur Perrot, un ami de la famille Hénault.
À partir de ce moment le personnel du bateau pouvait être considéré comme entièrement complété. Il comprenait, outre le capitaine, son second, les trois mécaniciens et le médecin, un maître d’équipage, un armurier, cinq gabiers, deux timoniers, deux mousses, ensemble dix matelots de pont, plus trois graisseurs et six chauffeurs pour la machine, un cuisinier, un maître coq et un infirmier.
Tout ce monde occupait, les officiers et le médecin, le gaillard d’arrière, l’équipage, un carré situé à l’avant, précédant le gaillard opposé. Au-dessous de celui-ci, divisé en salle à manger et salon, étaient disposées quatre cabines dont les occupants n’étaient pas encore connus.
On ne devait prendre ceux-ci à bord que vers le 12 novembre en pleine mer.
Car il s’agissait de donner le change aux espions et agents secrets de la piraterie internationale dont les yeux devaient être ouverts un peu partout et particulièrement fixés sur les alentours de Louannec, où le crime de Lopez n’avait pu passer inaperçu.
Ces mesures de précaution avaient été conseillées par le ministre lui-même, lequel, en même temps qu’il avisait toutes les chancelleries des puissances, en recevait des communications précises.
Mme Hénault avait fait savoir de son côté qu’elle entendait prendre sa part de l’expédition. Seule, en effet, elle pouvait fournir des indications exactes sur l’identité de ce Ricardo Lopez, qui paraissait être l’âme damnée du chef des pirates. Elle possédait, en outre, des documents établissant la concordance de certains pillages organisés, tant en Amérique qu’en d’autres parties du monde, et qui prouvaient le concert d’une bande fort bien disciplinée. De ce nombre était le massacre du personnel noir d’une factorerie fondée jadis par M. Hénault sur le Rio Nuñez, au nord de la station sénégalienne de Conakry. La vieille dame, confirmée en ceci par les dires d’Yves Plonévez, avait quelques raisons de soupçonner la présence d’une embuscade ou d’un point de relâche des brigands aux environs de ce cours d’eau africain.
Alain et le commandant Le Gouvel n’avaient pu s’opposer au désir de l’énergique sexagénaire. Ils avaient, par contre, fait de respectueuses objections à l’intention manifestée par elle d’emmener également sa belle-fille, les deux enfants, Pablo et Irène, et une jeune servante bretonne très dévouée à ses maîtres.
Mais la volonté de Mme Hénault était aussi ferme que ces desseins étaient clairvoyants. N’était-elle pas d’ailleurs la propriétaire du yacht ?
Force fut donc aux officiers de s’incliner devant cette volonté inébranlable.
La résolution avait été prise un soir, à l’issue du dîner, entre la belle-mère et sa bru, en présence des deux enfants.
La vieille dame, jusqu’à ce moment, n’avait point ouvert la bouche sur ces projets, ni fourni aucune explication relative à ses récentes absences de Ker Gwevroc’h. Et comme, malgré son inaltérable bonté, on la savait d’un caractère autoritaire, nul n’avait osé l’interroger sur ces fugues devenues fréquentes depuis deux mois.
Ce jour là, donc, après une visite à la mamm Plonévez, qu’on avait trouvée toute réjouie d’avoir guidé les premiers pas de son fils convalescent, on était revenu au Trévou, sous un ciel d’octobre, maussade et ouaté de brume.
Les esprits étaient un peu soucieux. On avait remarqué le mutisme croissant de l’aïeule et, depuis le déjeuner surtout, celle-ci avait gardé un silence presque absolu, méditant, sans nul doute, quelque grave communication.
Les prévisions s’étaient justifiées, l’attente n’avait pas été trompée. Au dessert, Mme Hénault avait parlé.
« Mes enfants, avait-elle dit, s’efforçant de comprimer son émotion, je vais vous quitter pour quelque temps.
– Nous quitter ? » s’écria douloureusement Isabelle.
Et les voix, non moins anxieuses des enfants, répétèrent :
« Nous quitter ?
– Oui, reprit la vieille dame, je vais vous quitter, pas pour bien longtemps, j’espère, mais mon absence pourrait durer plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois. »
Les paupières s’écarquillèrent, exprimant l’effarement de l’auditoire.
« Où donc allez-vous aller, bonne-maman ? interrogea naïvement Irène.
– C’est ce que j’allais vous apprendre, petite », répondit l’aïeule, dont le visage, jusque-là grave, et même un peu triste, s’éclaira d’un pâle sourire.
Alors, lentement, sans surcharger son récit de détails inutiles, elle fit connaître à Isabelle et aux enfants le résultat de ses démarches à la suite de la résolution qu’elle avait prise.
Quand elle eut tout dit, exposant son plan et son projet, elle considéra les physionomies de ses auditeurs.
Isabelle, attristée, avait baissé le front, muette et retenant ses larmes. Irène, les prunelles brillantes, avait laissé s’exhaler un soupir, en murmurant :
« Vous allez faire un beau voyage, bonne-maman ? »
Mais Pablo, se levant, fit entendre un autre langage.
« Grand’mère, dit-il, – et sa voix tremblait un peu, – je vais vous adresser une prière. Je demande à partir aussi.
– Partir ! » s’exclama la mère, alarmée, en entourant brusquement de ses bras le cou de son fils.
La vieille dame, elle, n’avait pas prononcé une parole. Il était à croire qu’elle avait prévu cette requête.
Pablo reprit :
« Oui, partir, maman. N’est-ce pas pour moi, pour me rendre mon identité, n’est-ce pas pour venger la mort de mon père que cette campagne est entreprise ? Et j’y demeurerais étranger, alors que bonne-maman, à son âge, va y prendre part ? Et je resterais à terre, comme un poltron, comme un propre à rien, alors que, depuis huit ans, j’ai navigué, j’ai été mousse, j’ai grimpé aux vergues, j’ai couru le pont de tous les bateaux, les hunes de tous les mâts, j’ai grimpé à tous les haubans ? Et j’aurais l’affront de demeurer inutile au moment même où mes quatorze ans peuvent rendre les plus signalés services ? »
Ses yeux étincelaient. Il paraissait grandi, devenu un homme. Sa taille souple et robuste se dressait comme un jeune chêne dont la croissance fera un arbre magnifique.
Mme Hénault, la mère, le considérait avec une émotion où la fierté se manifestait de voir un pareil rejeton s’épanouir sur le vieux tronc de la famille malouine, car les Hénault étaient originaires de ce nid de corsaires glorieux. Et Isabelle, elle-même, bien que des pleurs tremblassent au bout de ses cils, n’osait laisser sa tendresse prendre le pas sur son admiration.
Une discussion s’engagea au cours de laquelle les résistances de la pauvre mère fléchissaient progressivement devant la réclamation de l’enfant.
À la fin, elle risqua, d’un organe hésitant :
« Il y aurait un moyen de tout concilier.
– Un moyen, Isabelle, dites-vous ? questionna la vieille dame.
– Oui. Ce serait que nous partissions tous avec vous. »
Elle avait prononcé ces mots avec l’exquise douceur qu’elle mettait en toutes ses intonations. Et à entendre cette femme un peu craintive, pleine de morbidesse, parler avec cette tranquillité, l’aïeule avait ressenti une stupeur.
Quoi ! était-ce bien Isabelle qui faisait une telle proposition ?
Elle garda le silence, et les enfants se turent également sous l’empire d’une surprise analogue.
Mais la jeune femme reprenait, très résolument :
« Vous paraissez étonnée, ma mère ? Qu’y a-t-il d’extraordinaire dans ma déclaration ? J’admire l’énergie dont vous avez fait preuve en toute cette affaire ; je ne puis me défendre d’un sentiment d’orgueil en écoutant les paroles de mon petit Pablo. Et parce que la pensée d’une séparation, si brève que je l’envisage, m’est insupportable, je l’écarte par la seule solution que comporte le problème : partir tous ensemble. »
Le doute n’était plus permis. Tout ce que venait de faire entendre Mme Isabelle Hénault n’était pas dit à la légère. C’était l’expression d’un sentiment réfléchi.
« Ma fille, répondit l’aïeule, vous fournissez en effet une solution au problème qui nous occupe. Encore faut-il que je m’assure de ce que cette solution a de réalisable. Je vais y méditer jusqu’à demain. Puis nous aviserons en commun aux moyens de la réaliser. »
On n’aborda plus le sujet de la soirée, et l’on se retira de fort bonne heure, chacun ayant l’esprit préoccupé.
Le lendemain, Mme Hénault la mère assembla toute la famille et fit connaître sa propre décision.
Si le yacht était assez bien aménagé pour permettre l’installation à son bord de trois femmes et de deux enfants, il n’y avait plus d’hésitation.
En conséquence elle allait écrire à Alain Plonévez pour lui soumettre le désir commun. Selon l’avis qu’il exprimerait, l’idée d’Isabelle serait rejetée ou mise à exécution.
Très tranquillement, mais très fermement, la mère de Pablo signifia son ultimatum.
« On ne peut refuser à mon fils la faveur qu’il sollicite. C’est un peu son droit qu’il réclame. Mais, s’il part, je le suivrai. »
Il n’y avait pas à s’opposer à une volonté manifestée avec une aussi douce ténacité. Au surplus, on n’eut pas à la discuter longuement.
La réponse d’Alain Plonévez fut aussi favorable qu’on la pouvait souhaiter. Elle indiquait que le logement réservé aux propriétaires du yacht, sur l’avant du bateau, était suffisant pour permettre l’installation des cinq personnes désignées. Elle soulevait néanmoins quelques objections sur l’inconvénient qu’il pouvait y avoir à mêler des femmes et des enfants, exception faite en faveur de Pablo, à une aventure où il y aurait certainement des fatigues à endurer, peut-être même des dangers à courir.
Après un dernier débat avec sa belle-fille, Mme Hénault, voyant sa résolution inébranlable décida qu’il sera donné suite à son projet.
On activa donc les préparatifs du départ, et, le 10 novembre, le landau de Ker Gwevroc’h emporta les voyageurs et leurs bagages jusqu’à la gare de Lannion, d’où ils prirent le train à destination de Saint-Malo.
L’embarquement à bord de la Némésis s’effectua le lendemain, 11, à quelque distance du port.
Ce fut un départ joyeux pour les enfants, Irène s’exaltant à la pensée d’une longue promenade en mer, Pablo ravi de se retrouver sur le mobile élément qui, pendant tant d’années, avait bercé son enfance. Au contraire, l’adieu à la terre fut, pour les deux femmes, empreint d’une grave mélancolie. Après douze ans d’un séjour sur la terre ferme, séjour attristé par la longue nuit où avait dormi l’intelligence d’Isabelle, voici que le retour du bonheur et de la lumière était lui-même subordonné aux aléas d’un déplacement imprévu.
Toute la paix de Ker Gwevroc’h, la miraculeuse félicité octroyée par la destinée, qui venait de rendre à la mère désolée l’enfant qu’elle croyait à jamais disparu, étaient troublées par cette nouvelle obligation d’assurer l’avenir de Pablo et son identité officielle.
« Allons, dit Mme Hénault, en mettant un baiser sur le front de sa belle-fille, soyons reconnaissantes à la Providence de tout ce qu’elle a déjà fait pour nous, et ne lui reprochons pas ce léger surcroît de peine par lequel elle nous fait acheter notre allégresse à venir. Qu’est-ce, d’ailleurs, que cette absence momentanée loin de notre foyer ? Bien des gens nous porteraient envie estimant que nous allons faire un merveilleux voyage d’agrément.
– Vous avez raison, ma mère, reconnut Isabelle, en s’efforçant de sourire. J’aurais tort de me plaindre, puisque le sort, tout en m’éloignant de notre cher Ker Gwevroc’h, ne me sépare ni de mon fils, ni de vous. »
Au reste, les premières heures de l’installation apportèrent d’assez nombreuses distractions pour que les esprits se détournassent des réflexions moroses.
Outre qu’il fallut procéder à l’aménagement des cabines, à la réglementation minutieuse de l’emploi des heures à bord, on eut encore l’attrait de la nouveauté pour égayer les débuts de la croisière.
Et cette nouveauté, ce fut, tout d’abord, la prise de possession du domicile flottant, la présentation du nouveau commandant, l’enseigne Le Gouvel, du chef mécanicien Grandy, et de tout l’équipage, la visite détaillée du yacht, objet de la curiosité admirative des voyageuses et de l’enthousiasme des enfants.
Initié à toutes les particularités de la vie de matelot, Pablo n’eut à s’instruire que sur le chapitre des moyens mécaniques mis en œuvre dans la construction et la propulsion de ce vaisseau modèle, le type le plus récent et le plus beau des unités similaires de la navigation de l’avenir.
Il en acquit rapidement la connaissance, grâce aux complaisantes indications que lui fournit son ami Alain, lui-même enseigné plus complètement par le chef mécanicien Grandy.
La Némésis avait été exécutée sur les plans d’un ingénieur français, amendés et complétés par le richissime étranger qui leur avait donné la réalisation.
La conception créatrice avait assuré au yacht une singularité mixte, entre le destroyer, arme de guerre, et le bateau de plaisance destiné à servir les caprices d’une humeur changeante, éprise de mouvement et de vitesse. Sa propulsion était réglée par des machines d’une puissance maxima de 6 800 chevaux, à turbines, actionnant cinq hélices, dont une seule centrale dans le prolongement de l’étambot, pouvant, d’ailleurs, s’engrener pour la marche arrière, les quatre autres étant montées deux par deux sur les arbres de tribord et bâbord. La marche en avant exigeait le jeu de quatre turbines ; une seule suffisait à actionner l’hélice centrale pour la marche arrière.
Ces turbines elles-mêmes procédaient d’une ingénieuse combinaison entre le système Astor et le système Laval, permettant une surélévation de vitesse, qui pouvait atteindre trente-deux nœuds, où une réduction à douze nœuds pour le déplacement normal.
En prenant possession du commandement, l’enseigne Le Gouvel n’avait pu s’empêcher d’exprimer à Alain Plonévez sa satisfaction d’avoir à manier une nef atteignant un tel degré de perfection.
« En vérité, lui avait-il dit, je crois que nous possédons le plus rapide coursier de la mer qui se puisse concevoir.
– Sans doute, avait répliqué Lân, mais ce coursier demande à être suralimenté. Il est terriblement vorace. Savez-vous qu’une course fournie avec le maximum de vitesse nous laisserait en panne au bout de trente heures ?
– Oui, reconnut l’enseigne en hochant la tête, et c’est là le grand obstacle que la vitesse trouvera toujours devant elle. Comment jalonner une route de mer, y installer des postes de relâche assez nombreux pour que les navires y trouvent leur combustible préparé d’avance toutes les vingt-quatre heures ? Si parfaits que soient les engins de propulsion, leur voracité croîtra en raison directe de la vitesse dépensée, et il ne sera jamais possible à un navire d’emporter en ses flancs le charbon nécessaire à cette prodigieuse consommation.
– N’aurons-nous pas les briquettes de pétrole ? »
L’officier fit un geste évasif, qui exprimait une réelle désillusion.
« Les briquettes de pétrole ? Oui, sans doute, je sais. On en a fait l’expérience. Mais ne tenez-vous aucun compte de l’usure et de l’encrassement ? L’impossibilité de recourir à ce combustible est déjà si bien envisagée que d’audacieux inventeurs prétendent y substituer l’alcool. Ah ! il n’y aura lieu de se féliciter que le jour où l’électricité aura victorieusement chassé tous ces moyens encore trop primitifs. »
Ce dialogue avait pour auditeur Pablo, toujours avide de s’instruire et qui, lorsqu’il avait bien retenu un enseignement, s’efforçait de l’inculquer à sa petite compagne.
D’autres fois, aux applaudissements de l’équipage, au grand effroi d’Irène et des dames Hénault, le garnement se donnait le plaisir de grimper aux haubans, d’escalader les mâts jusqu’aux pommes de perroquets et de cacatois.
Cependant, quand il s’aperçut que ces spectacles blêmissaient le front de sa mère au point de faire redouter un évanouissement, il modéra son ardeur et promit de ne plus renouveler ses prouesses vertigineuses. Il fit toutefois une réserve :
« Le jour où nous aurons pris cette canaille de Ricardo ou son patron, le señor Gonzalo Wickham, c’est moi qui irai allumer une fusée à la pomme du grand mât. »
On s’en tint à cette promesse, et, pendant les jours qui suivirent, Pablo se montra tout à fait « sage ».
Pendant ce temps, la Némésis, ménageant ses provisions, s’en allait à l’allure de douze nœuds, tirant des bords successifs de la côte bretonne à la côte anglaise. Se tenant en rapports constants avec la terre, elle attendait qu’une dépêche vraiment significative lui révélât une piste sérieuse, car, depuis trois mois que le Cacique avait été vu à Brest, on n’en avait plus de nouvelles. Nouveau Protée, le yacht avait dû changer de figure au besoin des circonstances et des rencontres périlleuses.
Le 20 novembre, au moment où la Némésis, après avoir couru aux alentours de la côte d’Arvor jusqu’à Lorient venait de jeter l’ancre dans la baie de Douarnenez, le canot détaché aux renseignements ramena le commandant Le Gouvel et le second Plonévez porteurs d’une dépêche du ministère de la Marine.
Cette dépêche leur signalait qu’un navire suspect avait été frappé d’embargo dans le port de la Canée et son équipage emprisonné sous l’inculpation de trafic de contrebande de guerre en même temps que de piraterie. Avis était donc donné au yacht de se transporter le plus rapidement possible en Crète.
Cette fois, on était en présence d’une piste sérieuse. Quel était le navire ainsi arrêté ? Dépendait-il de l’association internationale des malfaiteurs ? On devait le supposer, car s’il se fut agi du Cacique alias Mapana les renseignements fournis au ministère auraient précisé les caractères du bateau et de son personnel.
Il fallait donc s’assurer de cette première indication qui permettrait, sans doute, de donner une base précise aux recherches ultérieures.
Le yacht s’éloigna donc définitivement des rivages de France. Il porta son allure à dix-huit nœuds et, le 25 du mois, après avoir franchi, sans arrêt, le détroit de Gibraltar, se trouva à la hauteur des Baléares. Le 27, il doublait la côte de Candie et entrait dans le joli port de l’ancienne Cydonia.
Il y arrivait trop tard. La justice de Sa Hautesse le Sultan avait été expéditive. Sur les douze hommes qui composaient l’équipage du Tiger, c’était le nom du brick-goélette dont les flancs contenaient les munitions de guerre destinées aux insurgées de l’Ida, trois, parmi lesquels le capitaine, venaient d’être empalés, quatre avaient reçu une telle bastonnade qu’ils agonisaient à l’hôpital international, et les cinq autres attendaient qu’on les dirigeât sur les mines du Caucase, à moins que leurs gouvernements ne les réclamassent pour leurs propres bagnes.
Les uns et les autres étaient de nationalité colombienne.

XI
En chasse.
Les dames Hénault ne passèrent à la Canée que vingt-quatre heures. Le commandant Le Gouvel, en effet, venait d’y trouver, avec de nouveaux avis du Ministère, des documents pris sur le bateau contrebandier, établissant, sans doute possible, la complicité de ses gens dans l’association cosmopolite qui mettait le monde en coupe réglée. Et l’une des pièces ainsi interceptées dénonçait le passage du Cacique à Constantinople, à Athènes, à Brindisi, à Malte. Le yacht de Gonzalo Wickham avait donc repris sa course vers l’ouest et le peu qu’on savait de lui permettait de supposer que sa vitesse égalait celle de la Némésis.
Le Gouvel et Plonévez discutèrent donc sérieusement le plan qu’ils devaient adopter.
Manifestement, il était inutile de visiter les ports de Tunisie et d’Algérie, où la police prévenue était aux aguets. Tout au plus pouvait-on soupçonner un contact des audacieux bandits avec les côtes de Sicile ou d’Espagne.
Cependant, au passage du yacht à la hauteur de Minorque, un steamer charbonnier, venu à sa rencontre pour le transbordement du combustible, fournit quelques indications utiles.
On apprit, de la sorte, que, huit jours plus tôt, quelques paysans du Mahon avaient dénoncé aux autorités la présence, dans une crique du rivage, d’un bateau fort élégant, dont celui qui paraissait en être le capitaine était descendu à terre et s’était promené plus d’une heure aux environs. Le signalement du personnage répondait à celui de Gonzalo Wickham. Les gendarmes mis en mouvement étaient arrivés juste à point pour voir le forban disparaître à l’horizon. On se rapprochait donc des pirates, puisqu’une semaine plus tôt, ils étaient encore dans les eaux des Baléares.
Le Gouvel et Alain décidèrent sur-le-champ de marcher à la vitesse de vingt nœuds pour rattraper le temps perdu, et de ne loucher qu’à Tanger, les ports espagnols devant être étroitement surveillés par les agents internationaux.
« Il faut bien, pourtant, disait le commandant, qu’ils fassent du charbon quelque part ? »
À quoi Lân répondit, en hochant la tête :
« À moins qu’ils ne soient approvisionnés en cours de route par des charbonniers amis, comme nous venons de l’être nous-mêmes. »
Et, devant le regard stupéfait de son chef, il ne put se défendre de sourire, ajoutant :
« Je ne sais pourquoi, mais je suis hanté de l’idée que ce même charbonnier est un complice des bandits, qu’il a pris prétexte de notre propre fourniture pour se dérober aux investigations de police et munir notre adversaire aussi bien que nous. »
Plus gravement, il insista :
« Mes soupçons peuvent n’avoir rien de fondé, mais vous connaissez le proverbe : « Deux sûretés valent mieux qu’une », je vous proposerais…
– Que supposez-vous donc », interrompit Le Gouvel, qu’une appréhension soudaine venait de mordre au cœur.
Alain s’expliqua. Le combustible acheté au bateau mahonais ne représentait guère qu’une vingtaine de tonnes, le surplus devant être pris à Tanger ou dans un port de la côte portugaise. Avec de pareils ennemis, tout était à redouter et à prévoir. Ne pouvaient-ils avoir mêlé au charbon quelque matière de mauvaise qualité, susceptible d’encrasser ou d’obstruer la chauffe ?
« Parbleu ! vous avez raison, mon cher, s’exclama l’enseigne. Il nous faut vérifier sur l’heure le chargement. »
Bien leur en prit. Par bonheur, la soute était distribuée de telle sorte, pour le contrôle de la dépense et la facilité du service, que les compartiments ne s’emplissaient qu’au fur et à mesure des besoins de la marche.
Il fut aisé de vérifier le charbon pris à Minorque. On le trouva de qualité très inférieure, mélangé de beaucoup de pierres. Il en fallut donc faire un tri minutieux, au terme duquel on constata que la déperdition était d’un quart au moins du combustible acheté.
Mais ce qui provoqua chez les officiers et parmi les chauffeurs une légitime colère, consécutive à un premier mouvement d’effroi, ce fut la découverte parmi les agglomérés misérables, de deux bombes de dynamite, dont la forme imitait à s’y méprendre des briquettes.
Le yacht l’avait échappé belle. Ce n’était pas seulement un arrêt fatal dans la marche du navire qui venait d’être ainsi providentiellement prévenu ; c’était la destruction même de la Némésis, sans possibilité de secours, qu’un événement accidentel conjurait. Mais un ardent désir de vengeance grandit dans les âmes de ces hommes si lâchement menacés et stimula leur énergie.
Le yacht atteignit Tanger le surlendemain. Là encore on recueillit quelques indications et l’on dénonça la tentative dirigée contre la Némésis. Mais déjà les difficultés se multipliaient. Ce n’était plus la Méditerranée, c’était l’Océan qui s’ouvrait devant les investigations du yacht. Sur cette nappe immense, quelle chance pouvait-on avoir de surprendre des pirates qui, depuis plus de dix ans, se faisaient un jeu de dépister toutes les poursuites comme toutes les surveillances ?
Parmi les hommes qui composaient l’équipage figurait Yves Plonévez. Il avait supplié son frère de le prendre à son bord, convaincu que, malgré l’état précaire de sa santé, il pourrait rendre d’utiles services. Pablo et les dames Hénault avaient appuyé cette demande. Qui pouvait mieux que l’ex-matelot du Cacique découvrir et signaler la présence d’un navire suspect ?
Lân avait donc consenti à engager le blessé. Mais sa faiblesse encore excessive ne permettait pas qu’on exigeât de lui un labeur considérable. On se borna à lui assigner un rôle de vigie, que son excellente vue, aidé d’une puissante lorgnette, lui permit de tenir à la satisfaction générale.
La vie à bord du yacht n’allait pas sans une certaine monotonie, et il était à craindre que les femmes – Mme Isabelle du moins – s’énervassent en ce déplacement invariable qui, sans leur accorder le répit d’une descente à terre, n’offrait à leurs yeux fatigués, que le spectacle continu du ciel et de l’eau.
Là n’était pas le seul inconvénient. L’objet qu’on s’était proposé était tout le contraire d’un voyage d’agrément. Après les ravissements des premiers jours étaient venus la lassitude très naturelle, presque le dégoût de cette existence qui, sans manquer de perspectives, n’y rencontrait aucune variété reposante.
En outre, les divers états du ciel et de la mer, tantôt calmes, tantôt agités, ébranlaient la solidité des résistances. Quel que fût le luxe de l’aménagement intérieur, il ne pouvait remédier aux brusques secousses des lames, à la trépidation ininterrompue du navire, aux nauséabonds balancements du tangage. Et le terrible « mal de mer », dont les plus éprouvés marins ne peuvent s’affranchir entièrement, commençait à exercer ses ravages dans les cabines du gaillard d’avant. Déjà Mme Hénault, la mère, envisageait avec inquiétude et dépit, l’éventualité d’un débarquement, peu rassurant pour sa belle-fille, en quelque ville d’Afrique au climat insalubre. Elle n’avait encore fait part de ses alarmes à qui que ce fût, mais, à voir la mère de Pablo, pâle, anémiée, se traîner péniblement de son cadre au rocking chair qu’on installait pour elle sur le spardeck, elle ne pouvait s’empêcher de laisser lire le souci sur son front plissé de rides.

À plusieurs reprises, elle avait pu voir les yeux d’Alain se fixer sur elle et lui traduire les appréhensions personnelles du jeune capitaine au long cours.
Or, on était en décembre, mois où la tempête se déchaîne âprement sur les côtes marocaines. Qu’allait-il advenir des voyageurs au milieu des fureurs de l’Océan ? Déjà la servante Anne-Marie semblait atteinte des prodromes d’une égale langueur.
Mme Hénault voyait donc approcher l’heure, où, à son grand regret, elle serait contrainte de demander aux officiers du yacht une relâche à Saint-Louis ou Dakar, à moins que l’on ne préférât le séjour paradisiaque des Canaries.
On en était à ce point d’incertitude angoissante, lorsque, le 15 décembre, du haut de la hune de misaine, Ervoan laissa tomber ce cri significatif :
« Voile, – à tribord, – trois milles, – sous le vent. »
« Une voile », cela voulait dire un navire suspect.
Ceci, il était inutile que la vigie le précisât. Tout le monde avait compris la désignation.
En un clin d’œil les dispositions furent prises à bord du yacht, le branle-bas de combat ordonné au sifflet. Par mesure de précaution, le commandant Le Gouvel pria les dames de se laisser enfermer dans leur cabine. Quant à Pablo, il fut impossible de l’assujettir à la même règle. Il venait, comme un écureuil, de grimper jusqu’auprès d’Ervoan et, lui empruntant ses jumelles, il avait fouillé attentivement l’horizon de la mer.
L’instant d’après, il était redescendu sur le pont et confirmait l’annonce du frère d’Alain.
Ce n’était pas une « voile », mais deux que la vigie avait découvertes. Des deux bateaux signalés, l’un était, à n’en pouvoir douter, le Cacique. L’œil clairvoyant d’Yves ne s’était pas laissé tromper. Il avait reconnu le long bateau dépassant par ses extrémités un second navire gros et court qui le masquait. Et ce second navire ne pouvait être qu’un de ses complices, venu le ravitailler en pleine mer.
« À la bonne heure ! s’exclama Le Gouvel. Nous allons pouvoir, cette fois, nous renseigner utilement. Il nous suffit de mettre la main sur ce pourvoyeur. Nous y trouverons, à coup sûr, des indications précises.
– Hum ! prononça Alain. Je ne suis pas si sûr que cela du résultat. Croyez-vous que d’aussi audacieux brigands laissent des traces de leur passage, des jalons de leur route ?
– Que voulez-vous dire ? interrogea l’enseigne, hésitant.
– Je veux dire, expliqua Lân, que ce bateau secondaire peut fort bien n’être qu’un trompe-l’œil, destiné à nous donner le change. Il est possible, il est même probable, qu’après l’avoir vidé de sa cargaison, ceux que nous poursuivons l’abandonnent à la dérive. En ce cas, nous aurions perdu notre temps. »
Le capitaine Le Gouvel fut frappé de la justesse de l’observation. Il hésita sur le parti à prendre.
On fit le point. On se trouvait exactement par 16 degrés de longitude occidentale, sous le trentième parallèle nord, à cinquante-cinq milles environ de l’île de Fuerteventura, qui dépend de l’archipel des Canaries. Il était certain que les deux bateaux pirates avaient pris contact avec quelque port de cette côte hospitalière.
« Nous n’avons pas le choix, conclut l’enseigne. Donnons la chasse aux véritables bandits ! »
La Némésis se ramassa sur elle-même comme un félin qui va bondir. En un clin d’œil, les chaufferies furent chargées. Le chef mécanicien et ses aides prirent place à leurs machines respectives, dont les chambres furent instantanément closes, et le premier commandement qui tomba dans le porte-voix fut celui-ci :
« Soixante-dix tours. »
La seconde d’après, la voix du capitaine jetait successivement les chiffres de vitesse croissante :
« Quatre-vingts, cent, cent vingt-cinq, cent soixante, deux cents. »
Le yacht, tel un cheval de course progressivement entraîné, allongeait son élan, pressait sa marche. On n’en était encore qu’à vingt-deux nœuds. La marge était large, la propulsion, sur une nef aussi perfectionnée que la Némésis, pouvait atteindre quatre cents tours à la minute.
La mer était calme, ce qui permettait de n’utiliser que l’hélice centrale et les deux hélices les plus extérieures de tribord et bâbord.
Mais les deux officiers étaient ménagers de leurs provisions. On n’était plus dans la Méditerranée, où les ports sont assez nombreux pour assurer un prompt ravitaillement en combustible. En outre, ces instruments d’action sont d’une merveilleuse délicatesse. L’usure en est rapide et la fatigue dangereuse. Il faut également tenir compte de la presque impossibilité pour des chauffeurs européens de soutenir longtemps des températures variant entre quarante et quarante-huit degrés.
Brusquement, en levant les yeux, Alain put voir le groupe des bateaux suspects dédoublé, comme se dédoublent certaines étoiles sous l’œil du télescope.
« Malloz ! grommela-t-il en langue bretonne. Le failli chien nous échappe. Il doit être aussi bien machiné que nous. Voyez ! il a déjà gagné d’un mille sur l’autre bateau. Il faudrait donner notre maximum. »
Le Gouvel serra les poings.
« Notre maximum ? Je voudrais bien. Mais il ne nous reste pas plus de quatre-vingts tonnes dans la soute, quatre-vingt-dix avec les réserves des machines. À peine pourrions-nous fournir dix ou douze heures de chasse. Et, d’ailleurs… »
Il s’interrompit. Alain acheva sa pensée.
« Oui, et vous redoutez ceci ? »
Il avait posé son doigt sur le baromètre qui, depuis le matin, accusait une dépression uniformément décroissante. Il accusait présentement 746 degrés, mais il était manifeste qu’il tomberait au niveau de « tempête ».
Or, au point où l’on se trouvait, c’est-à-dire à trente degrés de la ligne équinoxiale, dans la saison et la région des perturbations soudaines, il fallait prévoir quelque formidable météore de la nature des cyclones et des typhons.
« Ah ! prononça le jeune enseigne, c’est une vraie calamité que nous ayons des femmes à bord. »
Alain ne répondit rien. Mais il partageait le sentiment de son chef.
Brusquement la voix d’Ervoan tomba de misaine.
« Bâbord, dans le vent, croiseur anglais.
– Signalez », dit Le Gouvel à son second.
Le moment d’après, au-dessous du pavillon triangulaire, à bandes transversales rouge et blanc, s’alignaient, sur les drisses, les flammes multicolores qui expriment l’abécédaire du Code maritime international.
Le croiseur anglais y répondait, tout en pressant son allure. C’était un de ces vaisseaux de guerre à marche rapide qui peuvent atteindre une vitesse de vingt-cinq nœuds. Il venait, superbe, fendant l’eau de son étrave droite, courant droit au pirate dénoncé.
L’accord était fait d’avance. Les deux navires, malgré leur différence, poursuivaient la même fin. Le croiseur King Edward signala que, depuis trois jours, il était avisé de la présence du « Forban Noir » (c’était le nom dont se servaient les veilleurs espagnols) dans ces parages de difficile surveillance. Il fut immédiatement convenu que le yacht et son puissant compagnon de route fonceraient sur le bateau suspect, que l’on voyait décroître rapidement à l’horizon. Mais il était encore à portée de canon.
L’anglais l’avertit d’un coup de semonce, qui ne servit qu’à accélérer la fuite du pirate. Alors le commandant du King Edward invita la Némésis à s’emparer du vapeur laissé en arrière et à l’amariner, pendant que lui-même, chassant à vue, s’efforcerait de couper aux forbans la route du sud-ouest, afin de les rejeter sur la côte d’Afrique, où ils rencontreraient sans doute les stationnaires français, anglais ou allemands.
« Le plan est bon, reconnut Alain. L’English va faire le plus ennuyeux de la besogne. Il est vrai que, s’il prend ces coquins, il s’en donnera les gants à la face du monde entier. Mais en la circonstance nous n’avons pas mieux à faire.
– Oui, appuya Le Gouvel, le docteur vient de me prévenir que la jeune Mme Hénault est fort souffrante et qu’il y a urgence à la déposer à terre. Nous sommes assez proches de la Puenta de Cabras pour permettre à la malade de s’y reposer dès ce soir.
– Sans doute, mais il faut nous hâter, car, outre qu’il fera nuit dans trois heures, l’ouragan commence à monter du sud-est. C’est le mauvais vent du Sahara. Nous ferons sagement de nous mettre à l’abri. »
Il n’était pas nécessaire de maintenir l’allure de vingt-deux nœuds.
Le yacht reprit donc sa marche normale, laissant porter vers le bateau-leurre abandonné par les pirates, afin de le prendre à la remorque jusqu’à la côte de l’archipel des Canaries. Quand on fut dans les eaux du petit steamer, la baleinière de la Némésis se détacha pour aller à la visite. Lân Plonévez et six hommes de pont la montaient.
Ils abordèrent le navire par la hanche de tribord et constatèrent sans surprise qu’il n’y avait personne à bord.
La chose avait été prévue par le second.
En revanche, le bateau, un vrai sabot, à carcasse vermoulue, contenait encore un tiers de son chargement en charbon.
L’un des matelots fit cette réflexion :
« Faut croire qu’ils n’ont pas eu le temps de tout transborder. Nous les avons surpris au milieu de la besogne.
– Bah ! fit un autre, c’est de bonne prise. Il y a bien là une vingtaine de tonneaux. Ça fera notre affaire. »
Sur l’ordre d’Alain, l’épave fut immédiatement amarinée, et la remorque portée au yacht qui prit alors directement sa course vers l’île Fuerteventura, afin d’atteindre avant la nuit, s’il était possible, le petit port de la Pointe de Cabras.
Un débat s’engagea sur l’heure entre les deux officiers. Cette capture réjouissait l’enseigne Le Gouvel, homme jovial et d’humeur accommodante. Ces vingt tonnes de combustible, qui ne coûtaient que la peine de les prendre, lui mettaient le cœur en joie à l’égal d’un butin de guerre considérable. Plonévez s’empressa de le rappeler à la prudence.
« Hé ! hé ! il faut y regarder à deux fois. Souvenez-vous de notre aventure de Mahon. Qui nous assure que ce ponton n’est pas un brûlot destiné à nous faire sauter ?
– En ce cas, répondit le Gouvel, nous ferons bien d’opérer le transbordement tout de suite.
– Je veux bien, à la condition que le cyclone nous en laisse le temps. »
Et, il montra du droit l’horizon du sud-ouest soudainement assombri, comme si une fumée opaque se fût élevée au-dessus de l’Océan jusqu’aux cieux.
« Bonne chance à l’engliche ! plaisanta l’enseigne. Je ne crois pas que ce qui se prépare lui facilite la besogne. En tout cas, ce qui est bien certain, c’est qu’il va danser une belle gigue autrement qu’à la mode de son pays.
– Nous aussi, commandant, si nous ne nous pressons pas », appuya Alain, le front barré d’une ride.
Comme pour souligner ces paroles, la mer se gonfla rapidement et une lame, de six à huit mètres de hauteur, vint battre le yacht par le travers, déferlant sur le pont, inondant le rouf. La Némésis donna violemment de la bande à tribord.
En un clin d’œil, on eut rabattu les capots, fermé les écoutilles et le navire s’apprêta à reprendre ses allures de grande vitesse.
Mais si l’entêtement est la caractéristique du Breton, l’enseigne Le Gouvel, Finistérien, originaire de Châteaulin, était encore plus Breton qu’Alain Plonévez.
Il tenait à son idée, qui était de faire passer à son bord le charbon trouvé dans la cale du mauvais steamer pris en remorque. Il donna donc l’ordre qu’on amenât celui-ci bord à bord avec le yacht, afin de procéder au plus vite à la besogne du transbordement.
Cela n’allait pas « tout seul », selon l’expression commune. La mer, en effet, se faisait de plus en plus grosse. Afin d’éviter des chocs préjudiciables au yacht, on dut fixer le bateau charbonnier à bâbord, à la façon d’un balancier de pros malais ou néo-hébridais. Cela fait, il fallut rouvrir les puits de soute et établir un pont volant entre les deux carènes, toutes choses de pénible aménagement et qui ralentissaient la marche du yacht.
Cependant la besogne s’accomplissait tant mal que bien, et cinq tonnes de charbon étaient déjà passées des flancs de l’épave dans ceux de la Némésis, quand la survenance d’une nouvelle lame, celle-là suivie de plusieurs autres, avertit le capitaine qu’il y avait désormais péril à rester attaché à ce cadavre.
En même temps, l’obscurcissement du ciel hâtait la nuit toute proche et de furieuses rafales enveloppaient de leur fouet les deux navires liés.
Le Gouvel donna donc l’ordre de larguer les amarres, se contentant de laisser la remorque au bateau capturé. Car, selon le Code international, bien que la prise fût légitime, les officiers du yacht en devaient justifier auprès des autorités compétentes, justification qui ne pouvait se faire que dans un port des Canaries.
Brusquement, un événement se produisit qui simplifia le problème, tout en mettant en péril l’existence même de la Némésis.
Au milieu des violentes secousses du langage, tandis que les hommes affectés au transbordement se hâtaient de dégager le yacht et de filer la remorque de l’épave, on vit un matelot surgir sur le pont de celle-ci et tendre des bras désespérés à ses compagnons, avec des appels de détresse.
Dans la précipitation de la manœuvre, on l’avait oublié. Il accourait, affolé, réclamant le secours immédiat, et sa physionomie exprimait une telle épouvante que le commandant donna l’ordre de stopper, afin de ramener le charbonnier à portée de la Némésis. L’homme bondit frénétiquement par-dessus les bastingages et vint tomber si malheureusement sur le pont du yacht que sa tête porta avec violence contre une chaîne d’arrimage. Il s’évanouit, le crâne ouvert, ne proférant que ce mot sinistre :
« Le feu ! »
Ce cri jeta l’épouvante dans l’équipage et, pendant quelques secondes, glaça les énergies.
Le feu ! Où était le feu ? Le matelot blessé n’avait pas eu le temps de préciser sa parole d’alarme. Le fléau s’était-il manifesté dans la coque du charbonnier, ou bien l’homme, du pont de l’épave, l’avait-il vu éclater dans les flancs mêmes du yacht ?
On n’eut pas le loisir de préciser la question affolante. L’événement donnait lui-même la réponse.

En effet, à travers les ténèbres accrues du météore destructeur, on vit, tout à coup, la carène du steamer remorqué s’entourer d’une lueur bleuâtre, presque surnaturelle, reflet extérieur de la combustion du charbon qu’il contenait. Et, simultanément, malgré les rugissements de la tourmente, on perçut des craquements significatifs.
C’était bien l’épave qui brûlait, accrochée à la hanche de tribord de la Némésis. Chaque paquet de mer qui la soulevait la jetait plus lourdement sur le bordé du yacht. Il n’était que temps de rompre les amarres et d’abandonner à l’abîme cette proie qu’on avait voulu lui arracher.
Tous les hommes s’étaient élancés vers les câbles et les grappins. Les haches eurent tôt fait de trancher les premiers, mais la besogne n’alla pas de même quand il s’agit de détacher les chaînes. L’état de la mer était devenu tel que les lames balayaient le pont de bout en bout. Force fut de lier les hommes à l’aide d’aussières pour les empêcher d’être enlevés.
Le spectacle était effrayant.
Après avoir couvé des heures à fond de cale, intentionnellement allumé par les forbans, l’incendie, gagnant de proche, avait transformé la soute du charbonnier en un brasier tel que la coque ne pouvait résister à cette incandescence.
On entendait distinctement crépiter, se tordre et jaillir les lames du bordé extérieur en même temps que celle du vaigrage et les parties boisées des baux et des couples.
« Il est doublé en cuivre, fit remarquer Grandy. Sans cela, il n’aurait pu résister aussi longtemps.
– Oui, opina Alain, et je suis convaincu qu’il va finir en fusée. Il doit cacher de la dynamite. Ah ! les gredins ! Ils avaient bien préparé leur coup ! »
En ce moment le tableau atteignait le paroxysme de l’horreur. La carcasse entière du steamer flambait ; l’épave semblait flotter dans les vapeurs bleues d’un punch. On n’avait pu détacher la dernière chaîne. Ce cadavre en feu suivait le yacht dans sa fuite, fixé à lui par une amarre de moins de vingt brasses, dégageant un rayonnement de chaleur qui écaillait ses revêtements de teck et d’acajou, qui faisait surgir à la surface de ses vernis et de ses peintures, ces pustules huileuses qui précèdent la combustion.
Sur l’ordre du commandant, dix hommes, armés de pompes, arrosaient copieusement le pont et les superstructures du navire. L’angoisse croissait dans les poitrines, et sur le seuil des logis de l’avant, les dames Hénault, Irène et Anne-Marie se tenaient muettes, blêmes d’épouvante.
« Si cette satanée carcasse brûle encore un quart d’heure, prononça Lân à l’oreille de Le Gouvel, le yacht flambera comme une allumette. »
L’enseigne avait le front plissé. Il se reprochait amèrement son imprudence. Hélas ! il n’était plus temps d’y remédier. On ne pouvait attendre d’autre secours que du ciel.
La Némésis accélérait sa course. Au milieu de ces retards mortels la nuit était venue. L’Océan déchaînait toute sa furie, prêt à dévorer le bateau du châtiment en même temps que le brûlot enchaîné à sa fuite et dont la lueur d’outre-tombe éclairait, comme une torche funèbre, cette scène infernale.
Tout à coup, un seul cri jaillit de toutes les poitrines :
« La remorque est rompue ! »
Ou venait d’entendre un bruit de ferraille. Détachée du plat bord incandescent, la dernière chaîne venait de tomber à la mer.
La Némésis bondit, comme un cheval échappé, par-dessus les crêtes mugissantes, à travers les écumes furieuses.
C’était le salut aux portes de la mort. Trente secondes n’étaient pas écoulées que l’épave, s’ouvrant comme un cratère, projetait dans les airs, et jusque sur le pont du yacht, ses entrailles embrasées.

XII
Exploits de bandits.
La Némésis, après avoir réclamé un pilote, venait de mouiller en une anse profonde de la pointe de Cabras. Il était temps. L’ouragan faisait rage au large. C’était miracle qu’on eût pu échapper ainsi au double enfer de l’eau et du feu.
Un proverbe anglais dit : « Il importe peu qu’on fuie le danger de la largeur d’un mille ou de l’épaisseur d’un cheveu. »
Les officiers, l’équipage et les passagers du yacht venaient de contrôler par eux-mêmes la profonde exactitude de cet adage. Aussi n’eurent-ils pas un instant la pensée de se plaindre du lamentable refuge qui leur était ouvert.
La crique, merveilleusement abritée, gardait ses eaux calmes et comme endormies, au pied d’une montagne où quelques misérables demeures de pêcheurs s’alignaient à la façon des oiseaux de ces mêmes îles, qui, exilés sous les cieux glacés d’Europe, cherchent à se réchauffer en se pressant les uns contre les autres. Une auberge, plus misérable encore, s’y décorait du nom pompeux d’hôtel.
Ce fut pourtant en cet inconfortable asile que descendirent les dames Hénault et leur servante. On n’avait pas le choix. L’heure pressait et l’état de Mme Isabelle, qui avait eu deux syncopes au cours de l’effrayante traversée, exigeait des soins immédiats.
On avait dû la descendre, chaudement enveloppée, dans la baleinière de la Némésis, puis la transporter sur une civière jusqu’à l’Osteria Reale.
Là, le docteur Perrot s’était appliqué à rendre à la jeune femme quelques forces. Il était urgent, en effet, de secouer au plus vite la torpeur physique et morale qui l’engourdissait, afin d’empêcher le retour offensif des troubles cérébraux qui avaient obscurci son esprit pendant de si longues et si cruelles années.
On lui dressa donc un lit de sangles dans la chambre la plus propre de cette rudimentaire hôtellerie. Le linge fut apporté du yacht, et, en même temps que le médecin, Mme Hénault s’installa au chevet de la malade.
Aidée d’Anne-Marie, elle lui prodigua les soins les plus constants, en conformité avec les prescriptions sagaces du jeune médecin. Irène, que le voyage n’avait pas trop éprouvée, devint, elle aussi, une gardienne experte, une infirmière pleine d’habileté.
« Je ne suis bonne à rien, n’est-ce pas ? disait-elle à Pablo. Mais je veux, au moins, faire preuve de bonne volonté et m’instruire.
– Comment ? Tu n’es bonne à rien ? se récriait le gars, car maintenant, les deux enfants se tutoyaient fraternellement. Est-ce que je ne t’ai pas vue doser les potions de maman, faire des compresses et de la charpie pour ce pauvre Van Dysten, qui a été si gravement blessé sur le pont, au moment de l’incendie ? »
Il ajouta, avec des larmes dans les yeux :
« À propos, tu ne sais peut-être pas qu’il est perdu, le malheureux ? Le docteur l’a déclaré hier à Lân, devant moi. Il a une inflammation du cerveau, que le docteur appelle une méningite diffuse. Le crâne a été fracturé à la base, paraît-il, au moment où il est tombé sur la chaîne. »
Le pronostic du médecin, ainsi que le rapportait Pablo, n’était que trop fondé. L’infortuné Hollandais mourut le troisième jour après le débarquement, et fut inhumé pieusement dans le cimetière du village.

Par bonheur, l’influence du séjour à terre eut promptement dissipé les graves inquiétudes qu’avait fait naître la santé d’Isabelle Hénault. L’admirable climat de ce paradis de l’Atlantique, en cette saison où l’hiver du Septentrion se transforme en un printemps chargé d’effluves régénérateurs, ranima la malade. Dès le cinquième jour, elle était sur pied, se déclarant rétablie et prête à reprendre la course sur l’Océan, si malencontreusement interrompue.
Mais, cette fois, Mme Hénault la mère agit de pleine autorité. Elle fit comprendre à sa belle-fille que ce serait folie de s’exposer aussitôt aux hasards d’une traversée. Tout au plus agréait-elle que la jeune femme se rembarquât le temps nécessaire au yacht pour se rendre de l’île Fuerteventura à Las Palmas, où la malade trouverait un hôtel convenable et pourrait attendre le retour, probablement très prochain, de la Némésis, après terminaison d’une croisière accidentellement troublée.
Isabelle se laissa doucement convaincre. Il y eut bien quelques larmes versées, lorsque, trois jours plus tard, dans la capitale de la Grande Canarie, les passagers se séparèrent, laissant Isabelle, Irène et la servante Anne-Marie dans un hôtel de Las Palmas, tandis que Mme Hénault et Pablo reprenaient leur place à bord de la Némésis.
De graves nouvelles, en effet, étaient parvenues par le télégraphe, en réponse aux communications du yacht.
Voici ce que le commandant Le Gouvel venait d’apprendre par une dépêche adressée de Dakar, sur avis des autorités françaises de Konakry.
La poursuite du croiseur anglais King Edward n’avait donné aucun résultat. À la hauteur du quatorzième parallèle, le vaisseau de guerre avait totalement perdu de vue le navire suspect.
Aux prises lui-même avec le cyclone du sud, qui avait failli engloutir la Némésis, il avait dû fuir devant la tempête et s’était trouvé très gravement endommagé par un accident de machine. Il avait donc rallié les côtes de Guinée et rejoint les stationnaires de Free Town, quatre jours après sa rencontre avec le yacht français.
Dans l’intervalle, un événement sinistre s’était produit qui avait paru, aux yeux des Administrateurs européens de la Côte de Guinée, se relier par d’assez concluantes apparences aux agissements ordinaires des bandits.
Trois jours plus tôt, en effet, les autorités de Konakry avaient câblé au gouvernement du Sénégal que deux importantes factoreries allemandes et une maison française du Rio Nuñez, entre Boké et l’intérieur, avaient été assaillies par une bande armée conduite par un chef que les nègres dénommaient le Forban Noir.
En vain les stationnaires français avaient-ils établi le blocus de la côte, en vain une colonne volante de matelots et de laptots s’était-elle enfoncée dans l’intérieur, on n’avait recueilli aucun renseignement utile.
En prenant connaissance de ces nouvelles, Mme Hénault avait éprouvé un véritable désespoir.
Outre que la factorerie ruinée dépendait d’un établissement dans lequel elle avait engagé des sommes importantes, un des colons blessés, Jacques Rivard, était son propre neveu, garçon plein d’avenir, seule consolation d’une mère veuve restée sans ressources.
La légitime aversion qu’elle ressentait à l’encontre des pirates s’accrut de toute l’intensité de ce nouveau chagrin, et la vaillante femme, réunissant autour d’elle les officiers et l’équipage de la Némésis, leur fit entendre une énergique déclaration :
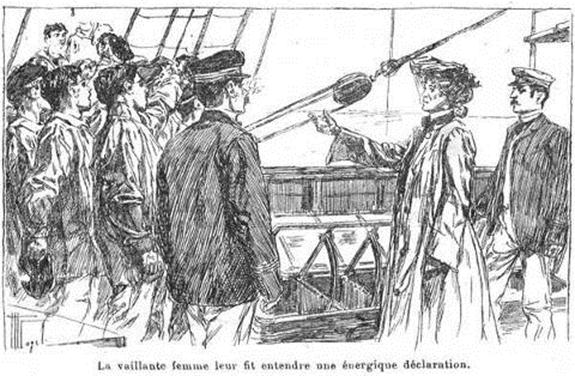
« Messieurs, leur dit-elle, les faits tout récents que vous venez de porter à ma connaissance sont un stimulant de plus pour ma volonté. Ils me créent une obligation de poursuivre et de mener à bien l’entreprise à laquelle j’ai voué mes efforts. J’ai déjà écrit à mon notaire d’assurer une pension de six cents francs aux enfants du pauvre garçon, mort si douloureusement à Cabras. Je vous prie d’accepter de moi, au terme de notre campagne, en outre de la haute paie qui vous est servie, une prime individuelle de deux mille francs pour chacun de vous. Et j’ajoute qu’en agissant ainsi, je n’entends pas épuiser ma reconnaissance envers vos généreux services. En route donc pour Konakry et, s’il plaît à Dieu, ce que n’ont pu faire les agents de la force publique, nous le ferons, nous, officiers et marins du yacht Némésis, du vaisseau qui porte en ses flancs la légitime vengeance. »
Une émotion profonde, qui se traduisit par un triple hourra, salua ces héroïques paroles.
Le même soir, après avoir pris congé de la jeune Mme Hénault et de la charmante petite Irène, le commandant Le Gouvel reprenait sa place au banc de quart et la Némésis s’élançait sur la nappe apaisée du détroit de Palmas, vers les rivages de l’Afrique équatoriale. Pendant ce temps, quels événements dramatiques s’accomplissaient dans les eaux de la Guinée et du Rio Nuñez ?
*
* *
C’était vraiment un beau bateau que ce Cacique, naguère Mapana, du nom du reptile effrayant qui, dans tout le sud du Nouveau Continent, est l’égal redouté du terrible serpent à sonnettes.
Il pouvait soutenir la comparaison avec la Némésis dont il ne différait guère que par ses formes extérieures.
Au lieu du taille-mer incurvé dont l’élégance courbe s’échancrait en arche au-dessous du beaupré, le Cacique avait l’étrave droite et tranchante, analogue à celle des vaisseaux de guerre et de grande navigation. Il y gagnait de loger en ses joues des magasins plus vastes que ceux de son prestigieux rival. Mais, par un maquillage habile, il dissimulait cette rigidité de la guibre et allongeait son avant d’un museau effilé qui donnait le change aux regards les plus expérimentés.
Pour masquer ainsi sa proue, le forban n’avait qu’à appliquer un faux bordé, tout en projetant le beaupré au dehors. Par le même procédé, il donnait à son arrière les lourdes allures d’un bateau de commerce, en gonflant ses hanches.
Enfin, une charnière à coulisse permettait l’arasement des cheminées, lesquelles, aux deux tiers aspirées dans la chaufferie, renversaient leurs pavillons en sens inverse sur la toiture du rouf.
En un clin d’œil, l’élégant coursier de la mer devenait un massif trois-mâts qui paraissait ramper sur l’eau.
C’était à l’aide de ces déguisements et de ces ruses que Gonzalo Wickham avait pu déjouer la surveillance des stationnaires européens.
Comment avait-il su la poursuite dont il était l’objet ? L’organisation de cette bande occulte était si bien ourdie que les pirates avaient une contre-police à l’affût de toutes les occasions, en garde contre toutes les surprises et les trahisons possibles.
Lorsque, cédant à l’entraînement de sa haine, Ricardo Lopez avait poignardé Ervoan Plonévez à la sortie de Louannec, la colère de Wickham avait été formidable. Peu s’en était fallu qu’il n’envoyât l’Argentin rejoindre en enfer celui qu’il croyait avoir réduit à l’éternel silence. Mais il avait songé que la mort de Ricardo le priverait d’un de ses plus fidèles acolytes et qu’en outre elle pourrait indisposer l’équipage. Il avait donc refréné son ressentiment, et après de véhéments reproches, avait fini par dire à l’assassin :
« Au moins, es-tu bien sûr qu’il ne parlera pas ?
– Mon machete n’a jamais laissé a un homme plus d’un quart d’heure de vie », avait répliqué l’Argentin avec une forfanterie digne de sa prouesse.
Mais cette fanfaronnade n’avait pas convaincu Gonzalo.
« Écoute, avait-il dit, il faut tout prévoir. Nous ne pouvons rentrer à Perros. Nous allons donc filer à grande vitesse. En vue de la côte anglaise, tu t’embarqueras seul dans le grand canot. J’aurai déjà télégraphié aux nôtres de venir à ta rencontre. »
Quinze jours plus tard, Ricardo était en Hollande, où il s’engageait, sous un faux nom, sur un brick portugais rentrant à Lisbonne, et, dans cette dernière ville, retrouvait sa place dans l’équipage du Cacique.
Mais, à ce moment, Ervoan avait parlé, la Justice française s’était émue. Et, comme le silence n’était pas de rigueur, les révélations du blessé s’étaient divulguées.
Hardi jusqu’à la témérité, le Forban était revenu vers le nord, averti par ses agents secrets. Si étroitement que fussent surveillés les ports de mer, Gonzalo n’en avait pas moins mis pied à terre dans un fiord de la côte norvégienne, d’où il était passé en Hollande.
Rasé, pourvu d’un déguisement qui le rendait méconnaissable, il était venu jusqu’à Anvers, avait remarqué le yacht mis en vente, l’avait même visité en qualité d’acheteur éventuel. Puis lorsque la vente s’était consommée au nom de Mme Hénault, il avait poussé l’effronterie jusqu’à venir offrir lui-même à Alain de racheter le yacht pour le prix de deux millions.
Le nom de Mme Hénault, la grande ressemblance du cadet des Plonévez avec son frère aîné, il n’avait pas fallu davantage à Gonzalo Wickham pour deviner que ce bateau aux vitesses prodigieuses était destiné à lui donner la chasse. Et, alors, il avait formé le projet de s’en défaire par tous les moyens.
Peut-être eût-il mis ce projet à exécution dans le bassin même où se balançait la Némésis, si le retard imprévu d’un de ses propres navires, sur la venue duquel il comptait pour s’enfuir, ne l’eût contraint d’ajourner cette mesure de violence qui l’eût tout de suite signalé à l’attention de la police belge.
Or, dans l’intervalle, le yacht avec son équipage provisoire avait quitté le grand port de l’Escaut, se dirigeant vers Brest, où il allait prendre son commandement définitif, en la personne de l’enseigne Le Gouvel.
Le steamer qu’attendait Wickham n’arriva que quarante-huit heures après ce départ. Encore apportait-il de si fâcheuses nouvelles que le forban n’eut pas le loisir de donner suite à ses néfastes intentions.
Il venait d’apprendre, en effet, qu’un de ses plus vieux complices, un négociant en merrains et bois du Nord, avait été arrêté à Riga, et que l’un des deux bateaux qu’il affrétait était frappé d’embargo. L’autre, celui-là même qui servait présentement de messager, avait dû son retard à l’obligation de fuir les côtes où il était signalé. Par une chance inexplicable, il avait pu tromper les autorités du port d’Anvers au moyen d’un faux connaissement.
Il était donc urgent d’échapper au plus tôt aux soupçons possibles. Le steamer leva l’ancre dès l’aube, et, comme la chance protectrice durait toujours pour les bandits, il put atteindre sans encombre une des criques familières de l’Écosse où Gonzalo comptait des fidèles parmi les contrebandiers.
Mais, déjà, l’étoile du Forban entrait dans le cône d’ombre des éclipses fatales. Les contrebandiers, ses amis, l’avertirent que la côte était surveillée par deux destroyers et qu’il ferait prudemment d’abandonner le steamer compromis.
En conséquence, l’équipage débarqua et déchargea le bateau de sa cargaison, que la population complice s’empressa de cacher en ses caves. Après quoi, à la faveur de la nuit, le navire fut sabordé et envoyé par le fond en une profondeur de deux cents yards.
Une station de chemin de fer était proche. Gonzalo et ses gens s’y rendirent par petits groupes et prirent des trains différents pour s’éparpiller dans toutes les directions. Les uns allèrent se perdre dans la fourmilière de Londres ; les autres gagnèrent Édimbourg, Glascow ou Liverpool. Le chef lui-même ne trouva rien de mieux que de repasser en France où, par les trains rapides, il traversa les Alpes et alla rejoindre le Cacique qui l’attendait en une anse isolée de l’Adriatique, au sud de Trieste.
Hélas ! Là encore de funèbres nouvelles lui furent données.
À cette heure, le mystère qui, jusqu’alors, avait voilé l’infernale Société était, désormais, percé à jour. À Smyrne, à La Canée, on avait mis la main sur plusieurs comparses. Soumis à la bastonnade, ils n’avaient pu résister à la torture et leurs aveux avaient livré le secret de l’occulte organisation.
Il fallait sauver, s’il en était encore temps, ce qui pouvait être sauvé. Gonzalo n’hésita pas. Il courut au plus pressé, réconforta le courage des siens, se dissimula assez habilement pour être instruit des mesures prescrites par les chancelleries et de l’impitoyable chasse qu’allait lui donner la Némésis.
À quelque distance de Port-Mahon, l’association avait un membre zélé qui lui fournissait son charbon. Le hasard avait voulu que ce même fournisseur eût reçu la commande anticipée du commandant Le Gouvel. L’occasion s’offrait donc, unique, au forban d’accomplir le projet funeste qui lui était venu à l’esprit, lors de son séjour à Anvers.
Ce fut ainsi que le charbonnier, qui avait approvisionné le Cacique en pleine mer, vint également porter le combustible à la Némésis. N’eût été la méfiance spontanée d’Alain Plonévez, le yacht aurait borné là sa carrière maritime, et le Canal des Baléares eût enseveli sous sa nappe bleue les cadavres du navire et de son équipage.
Mais la tentative échoua. Les bombes de dynamite furent découvertes avant qu’elles eussent fait sauter le yacht, et ce fut celui-ci qui, prévenu par les agissements de l’ennemi, commença contre lui une guerre sans trêve ni merci.
Lorsque, à la hauteur de Fuerteventura, le Cacique fut rejoint par le bateau de charbon, dont il allait faire un brûlot, le plan de Gonzalo Wickham était dressé.
Il allait, une fois de plus, attirer la Némésis sur ses traces, lui laisserait, en cadeau d’adieux, le vieux steamer destiné à l’incendier, puis, par un détour rapide, se porterait sur la côte africaine où il frapperait un coup terrible en détruisant les factoreries blanches du Rio Nuñez.
La survenance du croiseur King Edward avait quelque peu dérangé ce plan, mais le forban avait trouvé une complice dans la tempête.
Après six heures d’une course haletante, l’Anglais avait dû céder à la furie des flots. On ne triomphe du cyclone que par la fuite. Le croiseur avait fui vers l’est, en trouant l’opaque météore, non sans avaries graves qui allaient l’immobiliser tout un mois.
Pendant ce temps, le Cacique, jouant son va-tout, décrivait une vaste gyre dans le sud, puis, revenant sur ses pas, traversait, telle une flèche, la zone de surveillance des croiseurs français, retenus à Dakar et à Konakry par la tourmente, et s’engageait dans le lit du fleuve de Guinée, qu’il remontait, en eau profonde, jusqu’à soixante kilomètres de son embouchure.
Là s’arrêtait momentanément sa course.
Le Rio Nuñez, en effet, qui serait presque un grand fleuve d’Europe, a toutes les faiblesses des cours d’eau équatoriaux : lit peu profond, quoique large, baisse des eaux intermittente, crues soudaines qui déplacent ses chenaux en moins de vingt-quatre heures.
Né sur les pentes du Fouta-Djalon, le Tiguilinta, qui doit son nom de Rio Nuñez au Portugais Nuño Tristan, par qui il fut découvert en l’an 1445, descend au sud-ouest et vient se jeter dans la mer de Guinée, après un cours très fantasque de cent quatre-vingts kilomètres.
Il remonte, d’abord, vers le nord-est, enserre d’une boucle arrondie une région désertique d’une incomparable richesse en faune et en flore, y répand la fécondité par des débordements redoutables, et vient sinuer, en six ou sept branches, à travers la brousse méridionale, pour se fondre en une seule masse aqueuse, que l’île de Sable coupe en deux branches, entre les pointes Dampierre, au sud, et Kembuto, au nord.
Sa navigation est donc extrêmement difficile, car tantôt il offre des fonds suffisants pour les plus grands tirants d’eau, tantôt il se coupe de barres multiples qui surgissent, ainsi que les obstacles successifs, devant la marche des navires.
Un voilier doit donc tenir compte de ces difficultés d’une navigation dont aucun sondage précis n’a encore repéré les niveaux et rester aux aguets pour la soudaine irruption des crues assurant sa libération à la suite d’un échouement malencontreux. Un vapeur, bien que mieux pourvu en moteurs, doit également faire état de ces niveaux variables de l’étiage, et prendre garde à ne point se laisser abandonner par le fleuve en un terrain d’où la plus prochaine crue pourrait ne le tirer qu’au bout de six mois ou un an.
Gonzalo Wickham avait à son bord des marins nègres qui, à huit ou dix reprises, avaient exploré le cours du fleuve capricieux. En outre, ces bandits perfectionnés entretenaient, dans le pays même, des intelligences avec des noirs et des mulâtres évadés de pénitenciers divers et organisés en petites compagnies qui pouvaient, à l’occasion, fournir l’effectif d’une compagnie beaucoup plus forte.
Afin de les mieux discipliner, le « Forban noir » avait mis à contribution le goût du pillage de ces volontaires en d’autres expéditions sous tous les cieux de l’univers. Il les avait ainsi répartis pour un temps dans ses bandes de « regatoes » sur les bords de l’Amazone, de « dacoïts » en Birmanie ou dans l’Inde, de « coupeurs de têtes » à Bornéo, aux Moluques, en Papouasie.
C’était donc une véritable « élite » de gredins cosmopolites que commandait le métis sud-américain.
Il y avait là des forçats et des convicts blancs, des demi-blancs, ou alf-cast indous, malais, nègres, des Dayaks, des Maoris, des Yolofs. Et lorsque Gonzalo convoquait par ban et arrière-ban, trois cents hommes pouvaient se grouper presque instantanément autour de lui.
En cette occurrence, il ne mobilisa que la moitié de ce chiffre, le renforçant des vingt-cinq pirates de choix qui formaient l’équipage du Cacique.
L’expédition fut rapide et terrifiante.
Laissant le yacht sous le commandement d’un second et de quatre hommes experts, avec l’ordre de se tenir prêts à se porter en avant, au delà de Boké, dès les premiers indices de la crue prochaine ; il s’élança tant par voie de pirogues qu’à travers la brousse vers le haut du fleuve, où s’étend la région forestière de Guémé.
Il fallait, en effet, frapper les postes les plus éloignés, afin d’éviter qu’un échappé du massacre pût prévenir les stations plus voisines de la côte. Depuis quelques mois, Boké était pourvu d’un fil télégraphique le mettant en communication avec Konakry. Il suffisait d’un signal avertisseur pour couper la retraite aux pirates et les rejeter dans l’intérieur.
L’infâme besogne fut promptement exécutée.
Une première station, de nationalité allemande, fut prise et pillée. Ni blancs, – ils étaient quatre, dont une femme et un enfant, – ni noirs, au nombre de seize, ne trouvèrent grâce devant la férocité des bandits. Et, après l’égorgement, l’incendie effaça toute trace du crime. Sur la cendre, la végétation équatoriale allait pousser ses germes vivaces.
Puis ce fut le tour d’une deuxième factorerie allemande. Elle comprenait six hommes, Hanovriens et Hambourgeois, chasseurs de fauves et négociants de caoutchouc. Ceux-ci se défendirent, tuèrent quatre de leurs adversaires et ne succombèrent qu’après en avoir mis dix autres hors de combat.
Gonzalo eût été sage de ne pas pousser plus loin le pillage en cette occasion. Il ramenait douze pirogues chargées de résines et de gommes diverses, de tissus européens emmagasinés pour la vente aux indigènes, d’ivoire d’éléphant ou d’hippopotame, et même de fort belles peaux de panthères. Ceci constituait un butin évaluable à une centaine de mille francs au plus bas mot, qui fut, tout de suite, arrimé dans la cale ou le faux pont du Cacique, à qui la crue avait permis de remonter une cinquantaine de kilomètres plus haut.

Mais la cupidité est un vice analogue à la gourmandise. Elle incite le voleur à toujours prendre davantage.
Comme il redescendait le fleuve, Gonzalo rencontra sur son passage, à dix lieues au nord de Boké, le poste français de Grand Cône, occupé par douze blancs et soixante nègres. Il était aventureux de risquer l’attaque, les Français comptant dans leur nombre trois anciens sous-officiers et dix-huit ex-tirailleurs sénégalais.
Gonzalo ne tint pas compte des conseils de prudence donnés par Ricardo Lopez en personne. Il résolut l’attaque.
Cette fois, ce fut une véritable bataille.
Les pirates furent chaudement reçus.
Trois assauts furent repoussés et les assaillants laissèrent vingt des leurs sur le terrain.
Alors, le Cacique débarqua deux mitrailleuses Maxim et deux Hotchkiss, avec lesquels il ouvrit le feu. Les Français luttèrent jusqu’au dernier homme et à la dernière cartouche. Quand les forbans s’emparèrent de la factorerie, qu’ils incendièrent, ils durent marcher sur les cadavres de cinquante de leurs compagnons.
Le yacht songea au retour. Mais comme il approchait de Boké, quelques éclaireurs de la brousse vinrent en hâte le prévenir. L’estuaire du fleuve était bloqué, et deux navires en remontaient le cours. Le Cacique rétrograda.

XIII
La Grâce de Dieu.
La Némésis n’avait fait que toucher à Dakar, le temps d’y embarquer un supplément de charbon indispensable. De là, munie de nouveaux renseignements, elle était descendue à Konakry et avait pris les dispositions pour remonter le Rio Nuñez.
Mais il avait fallu tout de suite renoncer à ce projet.
Les eaux étaient basses. À peine permettraient-elles au yacht de s’élever jusqu’à une soixantaine de kilomètres dans l’intérieur. Et comme nul, parmi le personnel de la Némésis n’était au courant du phénomène variable des crues, comme nul ne pouvait suppléer à l’absence d’un pilote, force fut à Le Gouvel d’arrêter sa course à Konakry, en attendant que l’opiniâtre Mme Hénault eût trouvé quelque autre moyen de pénétrer dans le fleuve.
Ce moyen s’offrit assez fortuitement à la vieille dame.
Il y avait, en ce moment même, dans le port, un brick-goélette de Nantes qui, après avoir déchargé dans les docks sa cargaison de conserves alimentaires, avait dû être délaissé par son équipage, pour cause d’avaries graves.

C’était un assez vieux bateau, dénommé la Grâce de Dieu, dont la moitié de l’équipage s’était rembarquée sur un steamer allemand. L’autre, c’est-à-dire quatre hommes, fort marris de se trouver ainsi retenus sur un rivage malsain, demandait, à cor et à cris, au moins une occasion d’utiliser le temps d’inaction forcée. Sur la prière de Mme Hénault, le commandant Le Gouvel et Alain Plonévez visitèrent le brick et le reconnurent encore assez solide pour fournir une course fluviale, la résolution de la vieille dame étant inébranlable, d’aller chercher elle-même son neveu blessé à Boké, où il était soigné provisoirement, en attendant soit une issue fatale, soit le moyen de le ramener en France. Et comme les quatre hommes de son ancien équipage ne demandaient qu’à s’embaucher, les deux officiers les retinrent à leur service.
Mme Hénault affirma son désir de partir au plus tôt pour l’intérieur. On décida donc que le départ aurait lieu le surlendemain, la distance de Konakry au Rio Nuñez exigeant deux jours de mer par voilier, sans parler des lenteurs de la navigation sur le fleuve lui-même. Il fallait ce délai de deux jours pour aménager, dans les flancs du vieux bateau, un logement supportable pour la voyageuse et les dix hommes qui allaient le monter.
Alain en prenait le commandement, emmenant avec lui son frère Ervoan, le petit Pablo et trois des gabiers de la Némésis. Il était convenu que celle-ci remonterait elle-même le Rio dès que l’élévation des eaux le permettrait. On avait désinfecté aussi énergiquement que possible la coque du brick et, vu la température pluvieuse, un maître calfat nègre, sous la direction du docteur Perrot et du mécanicien Grandy, avait construit à l’arrière une façon de dunette dans laquelle la vieille dame serait plus confortablement installée que dans l’entrepont.
Au dernier moment, le docteur s’offrit spontanément à faire partie du voyage. Sa présence pouvait, en effet, être fort utile à la voyageuse, sans préjudice des soins plus éclairés qu’il apporterait au jeune blessé de Boké.
On était à la veille de Noël. Mme Hénault voulut qu’avant de se séparer provisoirement de son vaillant entourage, celui-ci célébrât la grande fête qui, dans tous les pays chrétiens, met en joie les plus riches comme les plus humbles foyers.
Il y eut donc à bord de la Némésis, une réjouissance à laquelle furent conviés tous les blancs de Konakry, les officiers de l’équipage du stationnaire français, et jusqu’aux noirs attachés aux services publics.
Le 25 décembre, au matin, la Grâce de Dieu hissa ses voiles pour utiliser le vent favorable qui soufflait du sud-est.
Elle franchit en trente-six heures la distance, doubla le cap Kembuto et s’engagea résolument dans la branche méridionale du fleuve. Deux jours après, elle mouillait au pied du môle rudimentaire du port de Boké.
Mme Hénault courut tout de suite au hangar misérable qui tenait lieu d’hôpital, accompagné de Pablo, d’Alain et du docteur Perrot.
Elle trouva le blessé très affaibli. En reconnaissant sa tante, dont rien ne pouvait lui faire prévoir l’arrivée invraisemblable, Jacques Rivard laissa éclater une joie enfantine. Le diagnostic du docteur fut assez favorable pour lui permettre de donner de sérieuses espérances à la vieille dame.
Malheureusement l’état d’anémie du jeune homme lui causa de réelles inquiétudes, et il crut devoir différer de quelques jours son transfert sur la Grâce de Dieu.
Cette décision créait des loisirs forcés à Mme Hénault et à son entourage. Sur la demande même du blessé, Alain décida de remonter le fleuve jusqu’à l’emplacement de la station pillée. Jacques Rivard, en effet, désignait une dépendance de la factorerie, où, dans le creux d’une citerne, le chef du poste avait enfoui la caisse et les papiers les plus précieux de la maison de commerce.
Ce fut l’annonce du départ de la Grâce de Dieu pour le haut fleuve, annonce apportée par des noirs affiliés à ses bandes, qui détermina Gonzalo à reculer lui-même jusqu’au delà de Guémé Sansan et à utiliser les eaux profondes.
Le dilemme, en effet, se présentait sous sa forme la plus simple :
Ou le brick ainsi aventuré n’était que l’avant-garde d’une flottille militaire, et, en ce cas, il fallait accumuler les obstacles devant cette flottille ; ou il était seul et s’engageait à ses risques et périls, ce qui en faisait une proie nouvelle pour le Cacique.
De façon ou d’autre, ce dernier était contraint de différer sa sortie. Mais Gonzalo, devenu soucieux, ne se dissimulait plus la faute qu’il avait commise en s’attardant dans ces régions fermées. Chaque heure qui s’écoulait diminuait ses chances d’évasion. Il ne pouvait douter, en effet, que ses ennemis eussent mis à profit le temps écoulé pour fortifier les postes du fleuve inférieur, et tendre un filet de surveillance à l’embouchure du Rio.
Heureusement pour lui, il se trouvait dans la boucle boisée du Tiguilinta. Ici ce n’était plus la brousse, avec sa végétation ingrate, mais la haute futaie épaisse et drue, aux arbres énormes, aux embûches végétales et animales. Ici, sur les versants montueux de la Nigritie commençante, croissaient le baobab, le dragonnier, l’arbre de fer, les palmiers de multiples essences, où s’accroche l’impénétrable rideau des lianes, sous lequel errent, en liberté, l’éléphant d’Afrique en famille, le rhinocéros, les variétés de buffles et de cerfs, la panthère, cette sœur féroce et tachetée du lion, le chimpanzé, docile compagnon de l’homme, en qui le nègre voit un humain condamné par Dieu, sous lequel rampent les crocodiles, les lézards et les batraciens géants, et les serpents innombrables, depuis le boa qui écrase jusqu’au céraste, à la vipère cornue, au corail, dont les crochets venimeux distillent la mort foudroyante. Ici, enfin, les insectes insupportables, papillons diurnes ou nocturnes, mouches multicolores, lucioles de feu, moustiques vampires, scorpions, mygales et scolopendres, sillonnaient l’air de leur vol affolant ou transformaient en pièges les moindres creux des troncs, les moindres cornets de feuilles.
La retraite était donc sûre, mais pouvait se changer en prison, si les eaux, par une défection subite, venaient à baisser, ne laissant plus assez de profondeur sous la quille du Cacique, et le réduisaient à l’état de ponton.
Et cette perspective angoissante commençait à assombrir les regards du Forban Noir. Il y avait des heures où l’audacieux bandit, toujours secondé par la chance, doutait de son étoile. On n’abuse pas impunément des faveurs du sort.
Les pirogues qu’il lança sur le fleuve, pour épier le mouvement de ses ennemis possibles, lui rapportèrent des nouvelles rassurantes. La Grâce de Dieu remontait seule vers Guémé. Le second navire signalé n’avait pas dépassé Boké.
Alors le pirate tint un conseil de guerre.
Les avis furent partagés.
Quelques-uns jugèrent que le plus sage était de profiter de la crue pour descendre rapidement le Rio et s’échapper à la faveur d’une nuit obscure, en prenant pour voie la branche septentrionale du fleuve, qui serait la moins surveillée par les navires de guerre.
Le passage dangereux d’ailleurs n’existait qu’au voisinage de Boké.
Arrivé à ce niveau, le Cacique donnerait sa vitesse maxima, dût-il la soutenir sept ou huit heures de suite, en consommant toute sa provision de briquettes de pétrole. Il irait se réfugier en une crique du Gabon, à l’entrée de l’Ogôoué, dût-il piller quelque poste de charbon destiné au ravitaillement des stationnaires.
Les autres, les plus nombreux, tout en se ralliant à ce plan, estimèrent que l’on pourrait, sans inconvénient, mettre à mal l’imprudent voilier qui venait se jeter spontanément dans le piège. Outre que cette capture achèverait dignement la campagne, elle offrirait cette sécurité de ne point laisser d’ennemis derrière le yacht.
Gonzalo hésitait entre les deux partis à prendre.
Un renseignement du dernier moment le décida à s’arrêter au second plan.
Un des piroguiers, en son sabir cosmopolite, venait de lui apprendre qu’à bord de la Grâce de Dieu se trouvait une vieille femme blanche, du nom de Hénault. Ce nom arracha un cri de triomphe au bandit.
« Hénault ? s’exclama-t-il, en secouant Lopez par les épaules. Hénault ! As-tu entendu, Ricardo ? C’est le diable qui nous les livre ! Bien sûr cette vieille folle n’est pas seule ; l’enfant doit être avec elle, et ils ont dû amener une bonne partie de l’équipage de leur yacht maudit. Je te dis que c’est le diable, notre patron, qui les inspire. Jamais nous n’aurons accompli plus belle campagne. Après ça, nous rentrerons en paix dans notre Amazone et nous pourrons y vivre de nos rentes, en attendant que le petit drôle ait atteint sa majorité. Car, de deux choses l’une : ou sa famille nous le rachètera un bon prix, ou ton machete lui fera signer la cession en notre faveur des biens qui lui doivent revenir de son père. »
Et, sur l’heure, il donna l’ordre de soulager le yacht pour courir à la rencontre du bateau signalé.

Cependant la Grâce de Dieu avait atteint le poste détruit au voisinage de Guémé. Ce jour-là était le premier janvier.
Une année venait de finir, une année nouvelle se levait sur le monde. Et ce fut un sentiment d’une intense poésie qui rapprocha les uns des autres, dans l’échange des souhaits d’avenir, tous ces Français se félicitant sous un ciel lointain, mais se sachant encore en France sur ce territoire colonial, abrités par les plis du drapeau, cet emblème sacré de la patrie absente.
Lorsque, à la suite d’Alain Plonévez et du docteur Perrot, les hommes de l’équipage vinrent, à tour de rôle, offrir leurs vœux à Mme Hénault, une scène touchante se produisit.

Yves Plonévez, que sa blessure avait laissé très affaibli et qu’un séjour dans les régions tropicales ne contribuait guère à rétablir, s’avança, un peu chancelant, et tendit à la vieille dame un bouquet de fleurs sauvages que, le matin même, il avait cueilli en un fourré du rivage, à la faveur d’un arrêt du bateau.
« Ça ne vaut pas une fleur de France, madame, dit-il d’une voix atténuée par la faiblesse, mais, en France, en cette saison, vous n’en trouveriez guère. Au moins celles-ci sont-elles pour vous seule et la main qui vous les offre les a choisies dans cette unique intention, là où il a plu au ciel de les épanouir. »
Les yeux de Mme Hénault se mouillèrent de larmes.
« Monsieur Ervoan, répondit-elle en prenant le bouquet, vous n’aviez pas besoin de m’attester ainsi vos sentiments. Je les connais de longue date. N’est-ce pas vous qui êtes notre créancier, qui avez acquis tous les droits à notre reconnaissance en restituant à ma fille et à moi le cher enfant dont nous pleurions la perte ? C’est à mon tour à rendre le même bienfait à l’excellente mère qui vous attend à Louannec et de lui ramener son fils heureux et à jamais… guéri. »
Ervoan hocha tristement la tête.
« Je ne voudrais pas affliger votre cœur, madame, ni assombrir ce premier jour de l’année. Mais laissez-moi vous dire que je ne crois pas à mon retour en France. Quelque chose m’avertit que je ne reverrai plus notre Bretagne. Avant de partir, nous sommes allés, la mamm et moi, à l’église de Louannec et sur la tombe de mon père. Et nous nous sommes dit adieu, parce que la mamm a reçu le même avertissement que moi. L’Ankou ne m’a laissé que le temps de me repentir. »
Pablo, sanglotant, se jeta avec impétuosité dans les bras de son grand ami.
« Tais-toi, Ervan, tais-toi. Il ne faut pas dire de pareilles choses. À quoi nous servirait-il d’être venus jusqu’ici, si nous devions en rapporter un pareil chagrin ? »
Il pleurait et étreignait le pauvre homme débile, sur les traits duquel la pâleur des anémies équatoriales ne confirmait que trop cruellement les tristes présages qu’il venait d’énoncer.
Pour mettre fin à cette scène pénible, Lân se hâta de régler le plan de la journée.
Le poste ruiné naguère était situé à quelque trois kilomètres de l’endroit où la Grâce de Dieu venait de jeter l’ancre, sur un petit bras du fleuve que, présentement, le bateau ne pouvait atteindre.
Il était desservi par une route encore en bon état, et le trajet ne demandait pas plus d’une demi-heure de marche. On offrit à Mme Hénault d’improviser pour elle une façon de chaise que deux hommes, en se relayant, porterait à tour de rôle.
La vieille dame se refusa à infliger une telle peine à ses compagnons. Elle était valide et bien portante. Ses soixante ans n’avaient jamais eu plus d’énergie.
On débarqua donc, en ne laissant à bord que deux hommes pris dans l’ancien équipage du bateau nantais. Le reste de la petite troupe s’enfonça résolument sous le couvert de la futaie, guidée par Ervoan et l’un des matelots, qui se souvenaient fort bien d’être venus jadis en ces régions.
La petite colonne ne mit pas plus que le temps prévu pour atteindre la station détruite.
Là un lamentable spectacle les attendait, qui alluma dans leurs cœurs une légitime indignation, mêlée à la douleur du souvenir évoqué.
La ruine et la désolation régnaient partout. Des édifices construits en briques, quelques pans de murs subsistaient avec leurs charpentes et leurs armatures de fer tordues. Tout ce qui avait été boiseries gisait sur le sol, en un tas de cendres et de gravats informes. Au milieu de ces débris carbonisés, des cadavres apparaissaient, réduits à l’état de squelettes pour la plupart, déchiquetés par les bêtes et les oiseaux de proie.
On voulut écarter Mme Hénault de cet affreux tableau. Une fois de plus, la vaillante femme manifesta sa volonté d’assister à tous les détails du drame. Sous ses yeux, les ruines furent déblayées, les dépouilles humaines reçurent la sépulture en une large fosse creusée au pied d’un énorme baobab.
Vinrent les approches du crépuscule, ou plutôt ce moment ultime qui précède la chute du jour, car il n’y a pas, comme en Europe, de lentes transitions entre la lumière et les ténèbres.
On avait fouillé la citerne désignée par Jacques Rivard, le neveu de Mme Hénault. Conformément à ses indications, on y avait retrouvé les papiers et ce qui restait de la caisse de la factorerie.
Il ne restait plus qu’à regagner la Grâce de Dieu et à redescendre le fleuve jusqu’à Boké.
On mit les montres et les chronomètres d’accord. Comme ils marquaient cinq heures, la petite troupe s’ébranla pour regagner le bateau.
On marcha sans hâte, la chaleur étant encore très forte. Ne savait-on pas, d’ailleurs, que le brick attendait le retour de ses passagers et leur offrirait un lieu de repos plus confortable que le couvert des bois ?
On suivit la même route que le matin. Pas plus qu’au départ, Mme Hénault n’accepta l’offre des robustes épaules prêtes à la transporter. Elle fit à pied le chemin déjà parcouru.
Une immense déception, bientôt convertie en une affreuse angoisse, attendait la petite troupe à son arrivée au bord du fleuve.
Lorsque, à travers l’échancrure du rideau d’arbres précédant le lit du Rio, les regards embrassèrent la large nappe jaunâtre, où se jouaient, çà et là, les familles d’hippopotames, une stupeur paralysa les arrivants.
La Grâce de Dieu n’était plus là. Elle avait disparu, non seulement du rivage, mais de l’horizon même.
Un instant, la surprise seule se manifesta, puis le doute et les soupçons lui succédèrent.
On voulut s’expliquer cette absence. La première version qui s’offrit à l’esprit fut que, séduits par la tentation de s’approprier le brick et son contenu, les deux hommes laissés à sa garde avaient levé l’ancre et s’étaient enfuis vers le sud, sur le navire devenu leur butin.
Mais cette opinion fut promptement abandonnée.
Outre que la manœuvre du brick, en une navigation aussi tortueuse, exigeait l’union d’un plus grand nombre de concours, les deux matelots nantais ne pouvaient nourrir l’espoir de passer inaperçus, soit devant le poste de Boké, soit à leur sortie des bouches du Tiguilinta.
Ils ne pouvaient ignorer les rigueurs du Code maritime en temps de guerre. Or, depuis le pillage des factoreries, le territoire de Rio Nuñez était placé sous le régime de la loi martiale. Pris, les deux délinquants eussent été exécutés sans jugement.
On abandonna donc a priori cette hypothèse. On n’eut, d’ailleurs, que trop tôt, l’explication de la disparition du navire et des deux hommes.
À moins d’un mille du lieu où avait mouillé la Grâce de Dieu, la petite troupe abandonnée, en descendant la rive, eut l’horrible solution de ses incertitudes.
Lié à un arbre du rivage, un cadavre leur barrait le chemin. C’était celui de l’un des deux matelots nantais. Il était presque méconnaissable, tant l’aveugle rage de ses meurtriers s’était acharnée sur lui. En outre des blessures mortelles, par lesquelles s’étaient vidées les artères en une flaque rouge, sur le sol, la face du malheureux était tailladée de plus de vingt coups de couteau. Les yeux arrachés, les oreilles coupées gisaient aux pieds de la lamentable dépouille.
L’infortuné était-il tombé sous les coups de son compagnon, dont on ne retrouvait les traces nulle part, ou avait-il succombé sous l’attaque de toute une bande survenant à l’improviste ?
Alain et le docteur Perrot étaient partagés d’avis. Ils furent promptement mis d’accord par la concise sentence d’Ervoan, mis à son tour en présence du cadavre.
« Ricardo Lopez, prononça gravement le Breton. Le Cacique est dans la rivière. Nous sommes aux mains de nos ennemis.
– Que Dieu nous sauve ! » conclut religieusement Mme Hénault.
Yves Plonévez avait raison. Ricardo Lopez et le Cacique étaient passés par là, accomplissant leur hideuse besogne.
Le yacht maudit avait mis à profit les fonds subsistants de la crue pour se porter, à toute vitesse, à la rencontre de la Grâce de Dieu.
Gonzalo Wickham ne se dissimulait point que la prise du brick ne serait pas facile. Bien qu’il ignorât le chiffre de son équipage, il ne pouvait douter que celui-ci fût composé d’hommes robustes et courageux, prêts à lui vendre chèrement leurs vies.
Mais jamais occasion meilleure ne s’était offerte à lui de mettre la main, d’un seul coup, sur d’aussi précieux otages. Mme Hénault morte ou prisonnière, Pablo reconquis pour être, ultérieurement, revendu ou dépossédé, une telle proie valait bien qu’on risquât quelques mauvais coups pour s’en rendre maîtres.
Et, quant à ce qu’il adviendrait par la suite, le brigand n’y voulait pas songer encore. Ou plutôt, il se disait qu’un bateau de la vitesse du Cacique pourrait toujours déjouer les poursuites de ses ennemis et franchir, de nuit, la zone dangereuse entre Boké et la mer.
Au delà, c’était l’espace, c’était la liberté.
Il vint donc droit à la crique où s’abritait le brick.
Il s’était attendu à la résistance. Grande fut sa joie en se trouvant en présence d’un navire vide, n’ayant que deux hommes pour le défendre.
Et, pourtant, même dans ces conditions, exceptionnellement favorables, la capture n’alla pas sans dommage pour l’assaillant.
En effet, les deux hommes restés à bord de la Grâce de Dieu s’apprêtèrent à une furieuse défense.
Mais le nombre était trop considérable. Vingt-cinq pirates montèrent à l’abordage du brick. Surpris et tournés, les matelots eurent à peine le temps de décharger une ou deux fois leurs revolvers. L’un d’eux fut abattu d’un coup de poignard qui lui ouvrit le bras. L’autre, un hercule, se défendit, un quart d’heure, une hache au poing, et atteint de dix blessures, fut traîné à terre où, après l’avoir lié à un tronc d’arbre de la rive, les bandits l’égorgèrent avec un raffinement infernal de cruauté.
Ce fut ce cadavre que retrouvèrent Mme Hénault et ses compagnons.
La première victime ne fut point immolée.
Ricardo Lopez avait donné un conseil de prudence à son chef.

« Emmenons le brick : laissons croire à ceux qui sont descendus à terre que le second matelot a tué son camarade et s’est enfui lui-même avec le bateau.
– Bah ! fit Gonzalo, ils pourront le croire aussi bien si nous donnons cet imbécile aux poissons du fleuve. Ne pourrions-nous les attendre et les cerner ?
– À quoi bon ? Si nous attendons leur retour, il nous faudra livrer une nouvelle bataille. Or, nous venons de perdre trois hommes. Ils sont huit ou dix chez nos adversaires, et tous gens résolus. Ils peuvent nous tuer la moitié de notre effectif. Et, alors, que nous restera-t-il pour nous en aller d’ici, surtout si notre mécanicien et nos chauffeurs sont parmi les morts ?
– Tu as raison, reconnut le métis. Emmenons le brick. En les laissant ici, nous les abandonnons à la faim, à la soif, à la chaleur, à toutes les misères du désert. Dans trois jours, ils seront à notre merci, et nous les prendrons au filet. Donc, commençons par leur ôter tout moyen de regagner la côte. Il y a soixante-dix milles d’ici à Boké. »
Le plan était d’une infernale sagesse. Il fut exécuté.
On jeta le prisonnier blessé à fond de cale, et le yacht, donnant la remorque au brick, traîna la Grâce de Dieu jusqu’à une trentaine de milles plus bas.
Là, le Rio Nuñez formait une nouvelle boucle, absolument dissimulée dans la verdure et semée d’îlots de sable. Le Cacique y mouilla pour la nuit.
On était bien approvisionné de vivres sur le yacht, mieux encore de boissons fortes. L’aguardiente, le pulché, le whisky, les rhums de toutes provenances étaient mis à la discrétion des pirates sous les noms divers auxquels les reconnaissaient ce résidu de pillards et d’écumeurs, rassemblés des quatre vents du ciel.
On fit donc ample bombance pour n’en pas perdre l’habitude.
Le lendemain, les moins ivres se levèrent, sous la conduite de Lopez, et s’en allèrent pagayer sur le fleuve, le long de la rive, afin de se renseigner sur le sort des Européens dont ils avaient volé le navire.
Nulle part ils n’en relevèrent les traces.
Le jour suivant, ils ne furent pas plus heureux en leurs recherches et un doute commença à hanter leurs esprits. Qu’étaient devenus les abandonnés ?
S’étaient-ils jetés dans la brousse pour entreprendre, à marches forcées, le retour sur Boké ? L’hypothèse n’était point invraisemblable ; bien que la survenance des pluies et le dégagement des miasmes délétères rendît un tel exode affreusement pénible et permît de croire que sa perspective avait fait reculer la poignée de malheureux laissés sans ressources. N’auraient-ils pas, au contraire, rétrogradé jusqu’à l’ancien poste de Guerm pour s’y fortifier et y attendre l’arrivée, concertée d’avance, d’une canonnière ou d’un torpilleur ?
Ici la supposition apparaissait beaucoup plus plausible.
Et, comme rien dans les alentours ne décelait un indice quelconque, comme les noirs, devenus brusquement circonspects, ne fournissaient que des renseignements évasifs, quand ils ne fuyaient pas à l’approche des bandits, ces derniers ne purent se défendre d’une inquiétude justifiée.
Allaient-ils donc se laisser prendre au piège par une embarcation de guerre française ou allemande, alors que le chemin de la fuite leur restait encore ouvert ?
Gonzalo Wickham eut recours à l’astuce et résolut d’élucider le problème en employant la ruse. Il appela Lopez.
« Ricardo, ordonna-t-il, tu vas mettre ce brick en état. Tu prendras six hommes avec toi, et tu le reconduiras jusqu’à une dizaine de milles en amont. Là tu mouilleras et vous reviendrez tous en pirogue. Si nos gens escomptent la venue d’un aviso ou d’une canonnière, ils ne s’expliqueront pas le retour de leur bateau, mais ne perdront pas cette occasion de se porter au-devant de leurs libérateurs. Et, comme, pour s’y porter, ils devront passer par ici, ils nous trouveront à point nommé pour leur épargner le reste du chemin. »
Ricardo battit des mains à l’audition de ce plan.
Certes la ruse était grossière, mais n’est-ce pas souvent ces moyens grossiers qui donnent les meilleurs résultats ?
Et, en cette circonstance, le stratagème devait réussir d’autant mieux qu’à l’heure où le préparaient les pirates, leurs victimes, épuisées par la fatigue, la faim, la soif et les angoisses de trois journées d’incertitude, demandaient au Ciel une planche de salut pour regagner la station du bas fleuve.

XIV
Dans la brousse.
Ce fut un cruel moment que celui où, en découvrant le cadavre du pauvre matelot nantais, en s’apercevant du rapt de la Grâce de Dieu, Mme Hénault et les vaillants hommes qui l’entouraient se demandèrent à quel parti ils allaient se résoudre.
La première impression fut celle d’une profonde stupeur bientôt suivie d’un sentiment d’humiliation.
Avaient-ils bien pu se laisser jouer de la sorte, attirer dans une embuscade et surprendre comme des enfants étourdis !
Et, maintenant, ils étaient en face du plus redoutable des inconnus, entourés sans nul doute, épiés, surveillés par des ennemis invisibles. D’un instant à l’autre, ceux-ci pouvaient surgir du milieu des bois, se jeter sur eux en une seule masse et les égorger jusqu’au dernier.
De chaque buisson, de chaque tronc d’arbre, une balle pouvait siffler, les frappant à coup sûr, lâchement, alors qu’eux-mêmes ignoreraient à quelle sorte d’adversaires ils avaient affaire. Quelles précautions prendre, où chercher un refuge, demander une protection ?
Là n’était pas l’unique souci. En quittant le brick, pour quelques heures seulement, ils n’avaient emporté avec eux que le strict nécessaire, en fait de vêtements et de provisions, pour la subsistance d’un repas et d’une demi-journée. Ils n’avaient pas entièrement consommé leurs aliments. Il leur en restait encore assez pour le repas du soir. Mais… après ?
On pouvait, à la rigueur, rationner les appétits et durer ainsi jusqu’au surlendemain. Hélas ! Sans parler de la privation d’une nourriture parcimonieuse, privation qui pouvait entraîner un affaiblissement corporel désastreux, quel avantage offrirait un tel rationnement ?
On se trouvait à une distance de quarante lieues de Boké, en une région d’une effrayante sauvagerie. Les cases des nègres étaient dispersées sur d’immenses espaces ; on en ignorait l’emplacement, on ignorait jusqu’au caractère, jusqu’à la langue de ces races si voisines de l’animalité bestiale. Savait-on seulement si, en cherchant aide et secours, on n’allait point attirer sur l’infortunée caravane le regard fourbe et intéressé de quelque chef de tribu Yolaf ou Mandingue ?
Un assez long temps, l’indécision régna.
Allait-on marcher en avant ?
Hélas ! Cette solution était interdite, au moins pour ce jour-là. Le soleil touchait au terme de sa course. Une demi-heure encore, et il ferait nuit.
Cette nuit serait de douze heures. L’équateur ignore l’inégalité des solstices. Il n’y a pour lui qu’un perpétuel équinoxe. Douze heures en cette obscurité du désert, avec tous ses pièges, toutes ses embûches !
Alain, le front sombre, s’approcha de Mme Hénault.
« La plus vulgaire prudence, madame, nous oblige à camper ici », parvint-il à articuler.
La vieille dame releva fièrement le front.
« Nous camperons donc, monsieur, à la belle étoile. L’étoile, c’est un des yeux du ciel. »
Lân assembla ses hommes. Deux d’entre eux furent placés en faction, après qu’on eut rétrogradé d’un demi-kilomètre, afin d’éviter les agressions à l’improviste du côté du fleuve. Puis, le siège du campement choisi, on s’occupa de le fortifier et de le munir.
Des branchages et des pousses de jeunes arbres tombèrent sous les lames d’acier. Par hasard, Ervoan avait emporté du brick une hache. Elle fit le meilleur de la besogne. Si bien que, lorsque les ténèbres tapissèrent le paysage, la petite troupe avait eu déjà le temps de se retrancher derrière une enceinte assez épaisse, en une façon de kraal. Pour n’y laisser subsister aucun ennemi intérieur, serpent, scorpion, mygale ou scolopendre, on purgea la place par le feu. Un lit épais de cendre forma une couche sous les tentes.
On était huit pour veiller, neuf si l’on comptait Pablo. Mme Hénault, indomptable, réclama sa dixième part dans la garde nocturne. Et l’on se disposa à user les longues heures de ténèbres.
Par bonheur, la lune brillait au ciel. Elle s’y maintint presque toute la nuit, malgré le passage de nuées sombres. Ces premières pluies n’étaient pas encore le diluvium tropical.
Mais combien elle fut âpre, cette veillée !
Qui n’a pas posé le pied sur ces terres à peine déflorées par le contact de l’Europe profanatrice ne peut savoir ce que sont les farouches concerts de la jungle.
À peine l’ombre eut-elle couvert de son manteau piqueté de diamants la face du continent noir que des voix innombrables s’élevèrent au milieu du silence.
Elles avaient, ces voix, tous les accents, toutes les intonations. Elles venaient des profondeurs denses de la futaie, des espaces immenses de la brousse. Elles étaient faites de glapissements prolongés, de feulements rauques, de grincements de dents, de battements d’ailes obscures, du grondement sourd et lointain, pareil au tonnerre, du « sultan à la grosse tête », du barrissement d’éléphants sauvages, du cliquetis des cornes de rhinocéros écaillant les troncs d’arbres, du bourdonnement continu d’insectes ailés traversant l’air et interrompant les fragiles sommeils.
Pourtant, tout s’use, même le mal. Elle prit fin, cette nuit insupportable, et le jour vint mettre quelque baume au cœur des voyageurs abandonnés.
On tint conseil. À l’unanimité, on décida la marche en avant. Péril pour péril, souffrance pour souffrance, mieux valait affronter l’un et l’autre, en se portant à la rencontre de la délivrance éventuelle, en tendant la main aux libérateurs, peut-être plus proches qu’on ne le supposait.
Il fallait régler l’ordre de la marche. La présence d’une femme dans la caravane, surtout d’une femme âgée, compliquait singulièrement la difficulté. En outre, on ne disposait guère que de trois heures dans la matinée, de deux vers le soir, et il fallait prévoir les intempéries d’un ciel menaçant.
La situation était aussi précaire que possible. Les vivres allaient manquer, les munitions étaient courtes. Chaque coup de fusil devait être bien placé et assurer un gibier comestible, si l’on voulait fournir de sérieuses étapes.
Ce fut encore Mme Hénault qui fit preuve du plus viril courage en donnant l’ordre du départ.
À dix heures du matin, le soleil, par bonheur voilé, étant déjà très haut, on avait parcouru sept milles environ.
Mais la marche s’annonçait déjà comme devant être très pénible, la forêt s’éclaircissant graduellement et faisant place aux embûches de la brousse.
On eut pourtant la chance d’apercevoir une agglomération de huttes. Quelques enfants noirs détalèrent à l’approche de la petite colonne qui, cent pas plus loin, fut accueillie par les cris et les supplications de femmes terrorisées. Celles-ci, en effet, avaient eu à souffrir, peu de jours auparavant, des déprédations et des brutalités des pirates conduits par Gonzalo Lopez. Il fallut un assez long palabre pour les convaincre que les nouveaux venus n’avaient rien de commun avec les premiers bandits.
Lorsque, à l’aide d’une mimique expressive, confirmant un jargon bizarre entrecoupé de mots français, l’un des anciens matelots de la Grâce de Dieu fut parvenu à convaincre son noir auditoire, le village cessa de trembler, les portes du tata s’ouvrirent, et ce fut à qui apporterait aux voyageurs des œufs, du lait de chèvre et des graines de maïs. On fit donc halte dans l’hospitalière bourgade et l’on put s’y restaurer tant bien que mal.
Mais, d’un entretien avec les indigènes naquit, pour les malheureux fugitifs, une source de craintes bien autrement graves.
La région qu’ils traversaient, ils l’apprirent alors, était particulièrement dangereuse. Les grands fauves la parcouraient en tous sens, et un séjour nocturne y courait le risque d’être troublé par quelque agression presque certaine.
La caravane eut l’occasion d’en faire l’expérience le même jour. Peu s’en fallut qu’elle n’y laissât la vie de plusieurs de ses membres.
À quatre heures de l’après-midi, l’astre déclinant vers l’ouest, la colonne reprit sa marche vers le sud, prenant soin de maintenir sa route à égale distance entre les bords du fleuve et les profondeurs de la brousse.
Elle venait de franchir trois milles environs, guidée et escortée par une vingtaine de guerriers du village où elle avait reçu l’hospitalité, quand, tout à coup, elle vit ses éclaireurs noirs se rabattre précipitamment sur le gros de la troupe, en donnant tous les signes d’une violente terreur.
On fit halte instantanément et l’on se mit sur la défensive en prévision d’une attaque des pirates.
Mais le péril, s’il n’était pas moindre, était d’une tout autre nature.
Le sol résonnait d’un piétinement sourd, comme au passage d’une troupe à la démarche pesante. En même temps des cris rauques, caractéristiques du barrissement, jaillissaient de l’épaisseur des fourrés, se rapprochant de seconde en seconde.
C’était, en effet, une bande entière des farouches pachydermes qui s’avançait en sens opposé de la marche de la colonne, et c’était de cette rencontre, dangereuse entre toutes, que les nègres s’étaient épouvantés.
L’éléphant d’Afrique diffère entièrement de son congénère asiatique. Il n’en a ni la prodigieuse intelligence, ni la débonnaireté classique qui rend ce dernier susceptible de domestication.
Ceux qui accouraient en ce moment, en une famille composée d’un grand mâle aux formidables défenses, de deux adultes à peine moins redoutablement armés, de quatre femelles et de cinq petits, appartenaient à la plus sauvage espèce.
Les noirs racontaient sur les terribles animaux les plus effrayantes histoires. Ils les dépeignaient comme incapables de discernement, fonçant sur tout ce qui leur pouvait sembler hostile, pareils, en cela, aux rhinocéros et aux gorilles qui, eux aussi, attaquent l’homme à l’improviste, par un instinct irraisonné de crainte et de conservation.
Le troupeau s’avançait donc en ligne droite. Il était impossible de l’éviter, car non seulement les pesantes bêtes sont douées d’une puissance de vision incroyable, mais leur odorat est d’une délicatesse comparable à celle des chiens de chasse les mieux doués sous ce rapport.
Et, par malchance, ce jour-là, le vent, soufflant d’amont, portait droit aux éléphants les émanations humaines.
Ils accouraient à ce trot continu qui fait d’eux, malgré leur masse, des bêtes d’une agilité susceptible de faire concurrence à celle des dromadaires et des chevaux.
Ils n’étaient plus qu’à la distance d’un quart de mille au moment où les éclaireurs les avaient aperçus. Il ne fallait pas songer à la retraite jusqu’à l’orée de la haute futaie. Outre que le temps eût fait défaut, on ne pouvait songer à hisser Mme Hénault au sommet d’un arbre. Ici, pas un seul abri ne se laissait voir, à l’exception de quelques cônes de termitières géantes. Alentour, la végétation basse, qui pouvait, à la rigueur, dissimuler la troupe aux regards d’assaillants humains, n’offrait aucune cachette que ne pénétrât point l’œil aigu des terribles animaux. On devait donc livrer bataille, une bataille sans merci et de laquelle on ne pouvait sortir victorieux qu’en achetant le succès au prix de pertes douloureuses.
Alain Plonévez prit donc le soin d’organiser la défense.
S’emparant de Mme Hénault, il l’entraîna vers les termitières et la fit entrer dans l’interstice de deux cônes. On coupa la brousse dont on couvrit entièrement la vieille dame, afin qu’elle échappât à l’œil des pachydermes, pendant que le reste de la troupe combattrait à découvert.
« Lân, cria vivement Pablo, je vais rester ici près de ma grand’mère. C’est ma première bataille. Je veux voir l’ennemi en face. »
Et, sans attendre l’approbation verbale de son ami, l’ex-mousse de la Coronacion escalada la plus haute des fourmilières, après avoir garni le magasin de son fusil de balles à pointes d’acier.
Cependant les pachydermes, sûrs maintenant de la présence de leurs adversaires, accouraient au trot de charge, emplissant l’air de leur infernal barrissement. Ils n’étaient plus qu’à trois cents mètres de distance.
Juché sur le cône artificiel, Pablo dominait la plaine. Il pouvait voir les énormes bêtes fendre la brousse comme le soc d’une étrave sillonne la surface des eaux. Il voyait onduler les croupes puissantes, se lever et s’abaisser les trompes à la façon de serpents au-dessus des herbes et des arbustes environnants.
Tout à coup, l’un des trois mâles le découvrit sur son perchoir, et, avec une atroce fanfare de guerre, s’élança vers l’adversaire isolé.
Si impressionnant que fût le spectacle, Pablo n’en perdit pas son sang-froid. L’arme qu’il possédait, quoique moins lourde que celles de ses compagnons, n’en était pas moins d’une précision mortelle.

Pablo, le cœur battant, le souffle court, s’agenouilla comme il put sur l’espèce de colonne qui lui servait d’observatoire. Il épaula et visa posément.
L’éléphant arrivait, broyant les herbes, renversant tout sur son passage.
Une détonation éclata, dont le retentissement formidable éveilla les échos de l’immense plaine et eut pour premier effet de rompre la ligne d’attaque des assaillants.
Atteint au sommet du crâne par la balle de Pablo, l’éléphant parut avoir donné de la tête contre un mur et vacilla sur ses jambes. Mais le projectile avait porté trop haut ; la blessure n’était que superficielle. La bête se remit d’aplomb et poursuivit sa course.
Pablo n’eut pas le temps de puiser en sa cartouchière. Il arma le winchester a l’aide du magasin et, visant plus bas, cette fois, fit feu à cent cinquante pas. La balle atteignit l’animal entre les yeux, à la naissance de la trompe. Il n’y eut pas d’effet immédiat.
L’éléphant fournit toute sa course, en proférant des cris sourds de plus en plus étouffés. Et, brusquement, parvenu au pied de la termitière, il leva sa trompe pour saisir l’intrépide enfant qui, d’un bond, s’élança en arrière.
De l’autre côté du cône, il vit l’énorme bête, prise d’un frisson subit, trembler de tous ses membres puis s’abattre sur le flanc, tout d’une pièce.
Le projectile avait fait son œuvre, perforant l’encéphale et broyant la boîte crânienne. Mais l’hémorragie cérébrale avait dû être lente, par voie d’infiltration ; la mort avait été longue à venir.
Pendant ce temps, sur le reste de la ligne, le combat était engagé avec une égale intensité.
Au bruit des premiers coups de feu, les éléphants avaient pris peur et reculé de quelques centaines de mètres. Moins bien placés pour diriger leur feu, Alain, le docteur Perrot et leurs hommes avaient perdu leurs balles en tirant au jugé. Ils en ignoraient l’effet. Ils n’en surent l’efficacité qu’en entendant la charge de l’ennemi résonner brusquement sur leur droite. L’agresseur les avait tournés. Les lourdes brutes mettaient en leur attaque autant d’intelligence que les manœuvriers d’une armée civilisée.
Ceci obligeait les défenseurs à changer de front. En un clin d’œil, Lân jeta l’ordre de ralliement.
« À la termitière ! commanda-t-il.
– Attends ! » répondit Ervoan.
Il avait tiré de sa poche une boîte d’allumettes. Il en enflamma toute une poignée et la jeta devant lui, dans la brousse.
Malgré l’humidité du sol et de l’atmosphère, l’herbe prit feu. Un clair rideau de flamme se leva sur la plaine brasillante. Activée par le vent, cette flamme gagna en étendue, et ce fut un mur de feu qui marcha à la rencontre des assaillants.
Le moyen était bon. Les bêtes géantes reculèrent devant le rouge élément et se mirent à fuir vers le sud, poursuivies par les langues dévoratrices sinuant à travers la fruste végétation.
Mais l’arme était à double tranchant. Elle se retournait contre ceux qui s’en étaient servis.
Voici qu’en effet, sous l’action de l’incendie une chaleur intense se dégageait, ajoutant à celle qui tombait du ciel brumeux. Une cendre incandescente s’éparpillait dans l’air, rendant l’atmosphère irrespirable. D’innombrables flammèches voltigeaient, communiquant le fléau autour de la poignée des blancs. Et, tout d’un coup, le feu, perfide et sournois, gagna le pied même de la fourmilière.
On vit fumer et crépiter l’amoncellement de branches sous lequel on avait caché Mme Hénault.
Il fallut renverser l’abri, disperser les brindilles embrasées, afin de délivrer au plus tôt la veille dame, à moitié suffoquée par l’ardeur du sol et l’épaisse fumée des arbustes verts.
L’effort uni d’Alain et d’Ervoan la hissèrent au sommet de l’un des cônes, où tous les hommes se guindèrent à leur tour, pour éviter d’être grillés comme des rôtis ou enfumés comme des jambons d’Outre-Rhin.
Et, pendant une demi-heure, force leur fut de demeurer immobiles en cet îlot d’un océan de feu.
À leurs pieds gisait l’éléphant mort. La flamme avait roussi l’énorme cadavre. Au loin, sur l’horizon enfumé, le fléau achevait la déroute du reste de la bande que l’on pouvait voir fuir désespérément vers le sud.
Mais cette victoire extrême coûtait des pertes à la troupe, sinon dans ses propres rangs, du moins en ceux de ses alliés.
Des cris de désespoir, des plaintes d’agonie jaillissaient de la jungle. Bientôt la caravane vit accourir à elle les noirs qui, tout à l’heure, l’avaient si lâchement abandonnée au moment de l’agression des éléphants. Ils venaient, nus, bondissant au milieu des cendres crépitantes, plusieurs grièvement brûlés, d’autres plus légèrement. Quelques-uns ne revinrent pas. Surpris par l’incendie, ils avaient été asphyxiés, puis carbonisés au milieu des hautes herbes.
Pauvres peuplades à qui les bienfaits de la civilisation, sous les traits des amis comme des ennemis, n’apportaient, hélas ! que la désolation et la mort !

L’incident causait un nouveau retard. On ne pouvait songer à reprendre la marche sur ce sol ardent. On était contraint d’attendre qu’il se fût refroidi.
Le refroidissement s’opéra beaucoup plus tôt qu’on ne l’eût espéré, mais dans quelles conditions !
Les lourdes nuées qui, depuis le matin, voilaient le firmament, crevèrent, et une averse diluvienne inonda le sol. Il fallut dresser des tentes au milieu d’une boue noire et liquide, pour laisser passer cette chute du ciel. Elle dura tout le jour et une partie de la nuit.
Vers deux heures du matin, le lever de la lune précéda celui du soleil. Et, dans la grande clarté blanche, les objets apparurent avec un fantastique relief. Personne n’avait fermé l’œil. Les entrailles criaient famine, et l’on n’avait plus que quelques biscuits à se partager. Les grandes tortures du désert commençaient. La faim et la soif s’alliaient pour épuiser les infortunés voyageurs. Trouverait-on quelque gibier sur un territoire que l’incendie venait de dépeupler à dix lieues à la ronde ? Et l’eau potable apparaîtrait-elle sur ce sol noirci par une fange immonde où les débris organiques se mêlaient à tous les putrides ferments dissous par la délétère influence d’un climat meurtrier ?
Mme Hénault s’adressa à Alain à part.
« Monsieur Plonévez, lui dit-elle, voici notre troisième matin qui se lève. Je me rends compte que notre situation est extrêmement précaire, que nous n’avons à attendre de secours que de Dieu. »
Le jeune homme s’inclina, plein d’admiration, devant cette femme si haute en son indomptable fermeté.
« Vous avez raison, madame, répondit-il. Je n’attendais que votre consentement pour donner l’ordre du départ. À dire le vrai, je redoutais pour vous les fatigues et les souffrances qui vont nous assaillir.
– Soyez sans inquiétude à mon sujet. Je me sens encore très forte. Je ne sais quel sera notre lendemain, mais j’ai une foi invincible en la Providence. S’il m’arrivait de défaillir en chemin, votre devoir serait de m’abandonner dans la première hutte de sauvages que nous rencontrerions, et de poursuivre votre route avec mon petit-fils. C’est de lui seul que vous devez vous occuper. »
Et, abordant directement le problème, elle demanda :
« Quel doit être, selon vous, l’ordre et le plan de notre itinéraire ? »
Alain hésita quelques instants avant de répondre, puis :
« Madame, dit-il, je crois que nous avons commis une faute en redescendant le Rio Nuñez. Nous aurions dû, au contraire, le remonter jusqu’à sa source, d’où nous eussions pris la route ordinaire des caravanes commerciales.
« Quelle route, monsieur Plonévez ? » interrogea-t-elle, surprise.
Alain tira d’une poche de sa vareuse une carte de la Guinée et, l’étalant comme il put, sur ses genoux, il montra à la vieille dame, à la clarté d’une lanterne, l’habituel tracé des parcours géographiques.
Ces parcours sont ceux des explorateurs. Laissant, en effet, aux navires marchands le long trajet du fleuve, utile au transport des marchandises, les voyageurs remontent plus aisément le Konkouré, de Dubréka à Bramaya, ou le Pongo, à partir de Boffa, pour atteindre, par la voie de terre, les sources du Rio Nuñez, ces sources voisinant, au pied du Fouta D’jallon, avec celles des deux autres cours d’eau.
Le jeune capitaine au long cours expliqua alors à Mme Hénault qu’en adoptant cette voie, on eût, sans doute, renoncé à rejoindre la Némésis à Boké, et qu’on eût été contraint d’abandonner la Grâce de Dieu. Mais on y aurait trouvé l’avantage de passer, sans fatigues excessives, du cercle de Boké à celui de Boffa, d’abord, et ensuite, directement dans celui de Konakry, où l’on aurait trouvé des noirs mieux disposés à servir les intérêts d’un peuple dont ils sentent la surveillance plus immédiate.
« Bien ! fit la vieille dame, ce plan est-il désormais impraticable ?
– Non, madame, si nous trouvons des pirogues au bord du fleuve qu’il nous suffira de traverser. Mais, dans ce dernier cas, il nous faut perdre l’espoir de rallier la Némésis. »
Mme Hénault soupira et conclut :
« Faites pour le mieux, monsieur, et que Dieu nous guide. Vous êtes le capitaine. À vous de décider. »
Alain prit donc ses dispositions pour le départ. L’examen du ciel lui permit de s’orienter. La nécessité, plus encore que la prudence, commandait de regagner le fleuve au plus tôt. De ce côté, en effet, on devait retrouver quelque végétation et l’occasion d’abattre le gibier nécessaire à l’alimentation. En outre, ce n’était point en cette direction, d’où soufflait le vent, que l’incendie avait exercé ses ravages. On marcha donc vers le sud-est, dans l’abominable fange de ce sol détrempé par la pluie. Au deuxième mille, on retrouva la brousse avec ses multiples obstacles, mais aussi les occurrences d’heureuse chasse.
Par malheur, oiseaux et fauves, épouvantés par le fléau récent, semblaient avoir déserté la région.
Lorsque, à la clarté lunaire, succéda le grand jour, les voyageurs, médiocrement sustentés par quelques morceaux de biscuit, étaient déjà très las. Ils n’avaient pas franchi plus d’une lieue et demie en trois heures.
Il fallut faire halte pour permettre aux meilleurs fusils de la troupe d’aller à la découverte du gibier.
Pablo, qui marchait à côté de sa tante, la carabine passée sous le bras droit, vit tout à coup l’un des hommes de l’escorte chanceler. C’était un des gabiers de la Némésis, un breton de l’île de Groix, homme d’une vigueur prodigieuse, mais qui, pour cette raison même, avait besoin d’une plus grande somme de nourriture. Or, depuis trois jours d’accablants efforts, le malheureux colosse jeûnait.
Pablo courut à lui spontanément et, le voyant tituber comme un homme ivre, la face pâle et décomposée, lui demanda sans préambule :
« Est-ce que tu es malade, Joël Le Corre ?
– Dame ! mon petit monsieur, répliqua le pauvre garçon en s’efforçant de sourire, je ne sais pas trop ce que j’ai, mais je crois bien que j’ai faim. »
L’enfant tira de sa poche le quartier de biscuit qu’il tenait en réserve pour son propre dénuement et le tendit vaillamment à son compagnon.

« Ben ! Et vous ? Comment que vous ferez ? questionna le Grésillon, baissant les yeux, honteux d’y laisser lire la convoitise qu’y allumait l’inanition.
– Moi ? répliqua Pablo, avec un rire d’insouciance. D’abord, je suis le contraire de toi, je n’ai pas faim.
– Vous êtes bien heureux ! s’exclama l’autre, avec une sincérité d’accent qui ne laissait aucun doute sur la lamentable détresse de son estomac.
– Et puis, reprit le gars, continuant à rire, je gage qu’avant une heure, nous aurons plus de gibier de poil ou de plume que nous n’en voudrons. »
Et il alla rejoindre Mme Hénault, ravi d’avoir pu, à son propre détriment, faire cette aumône à son camarade d’infortune.
Hélas ! Il s’en fallait que ses prévisions optimistes se justifiassent. En fait de gibier, on ne vit passer, dans un souple et élégant éclair, que la robe ocellée d’une jeune panthère, fuyant à l’approche de la caravane, avant même qu’on eût le temps de la mettre en joue.
Quand les éclaireurs rallièrent le gros de la troupe, l’étrangeté de leur butin provoqua quelques rires, malgré la gravité d’une situation pleine d’angoisses.
Le docteur Perrot, l’un deux, avait tué un boa énorme qui lui barrait la route. Ervoan plus heureux, rapportait trois perroquets surpris dans les branches d’un dragonnier. Enfin, le mécanicien traînait une bête étrange, un chlamydosaure, sorte de lézard géant, qui doit son nom à la large collerette d’écailles qui se hérisse autour de sa tête, quand l’animal est en colère.
Sauf en ce qui concernait les oiseaux, la vue de ce gibier hétéroclite, après le premier rire et la première curiosité, ne souleva que des « pouah » de dégoût. Cependant Joël Le Corre, dont le biscuit de Pablo n’avait fait qu’exciter l’appétit, fit cette réflexion mélancolique :
« Dommage qu’on n’ait pas une marmite. On aurait cuit une soupe à la tortue. »
Le régal fut donc piteux. Les trois perroquets, plumés et rôtis en plein vent, sur un feu de branches et d’herbes, donnèrent à chaque convive la valeur d’une aile de pigeon. On tira du chlamysodaure les pattes qui fournirent aux amateurs un supplément de nourriture. Le python même fut mis à contribution par les Nantais, et le docteur Perrot y goûta.
Le fleuve se laissait deviner à la végétation plus dense de ses bords. On se résolut à l’atteindre sans nouvel arrêt. À la chute du jour, on découvrit la nappe limoneuse, semée d’îles.
Et, soudain, un grand cri jaillit, unanime, de toutes les poitrines.
« La Grâce de Dieu ! »
Immobile dans les eaux du Rio, le brick venait d’apparaître, intact, se balançant mollement sous le clapotis du flot, à moins de dix mètres de la rive.

XV
Pris au piège.
Il y eut, parmi les fugitifs, un instant de folle joie.
La Grâce de Dieu, là, sur le fleuve, alors que tout espoir de la retrouver était abandonné, alors que le massacre des matelots laissés à son bord n’indiquait que trop douloureusement le passage des bandits. Dieu avait donc eu pitié des délaissés, qu’il leur restituait ce moyen de salut ?
Mais, presque aussitôt, à ce sentiment d’allégresse succéda une légitime méfiance.
« Hum ! prononça Ervoan. Ceci ne me dit rien qui vaille. Si, comme je continue à le croire, c’est Ricardo, avec sa bande, qui a pris le brick à l’abordage, comment se fait-il qu’après l’avoir emmené, ils l’aient laissé ici en panne ?
– Bah ! répondit le docteur. Peut-être ont-ils eu peur de notre retour et se sont-ils enfuis sans nous attendre ? »
À cela, Ervoan donna une judicieuse réplique :
« En ce cas, monsieur le docteur, puisqu’ils étaient déjà partis, ils n’avaient qu’à continuer leur route. C’est sur les bicyclettes volées que se sauvent leurs voleurs.
– Vous avez raison, reconnut le médecin.
– Il y a place pour d’autres hypothèses, fit remarquer Mme Hénault, dont les prunelles brillaient d’espoir ; par exemple que les bandits aient été prévenus de l’approche de quelque vaisseau de guerre remontant le fleuve ?
– Oui, confirma Alain. Cette supposition est plausible. Mais, je ne m’explique pas, alors, comment les pirates se sont enfuis.
– En pirogues sans doute, reprit Ervoan, et, dans ce cas, ils doivent se cacher sur l’autre rive. »
Le docteur tenait ses yeux fixés sur le bateau.
« Heu ! fit-il, que diriez-vous si ces gredins-là se tenaient tapis dans l’entrepont et n’attendaient que notre retour pour nous massacrer en bloc ? »
Pablo jeta impétueusement son avis :
« Il est bien facile de nous en assurer. Nous n’avons qu’à prendre d’assaut le brick, ainsi qu’ils ont dû faire eux-mêmes. Nous saurons bien ce qu’il cache dans ses flancs. »
Tous les hommes regardèrent l’enfant avec admiration.
« Voilà bien parlé, petit ! » s’exclama le Grésillon Joël, en soulevant Pablo au bout de ses bras herculéens.
Et les autres d’acclamer leur camarade.
Alain étendit la main et réclama le silence.
« J’approuve autant que vous le conseil de M. Hénault, et il prononça ces mots avec une déférence qui émut l’aïeule et le petit-fils. Mais avant de nous y conformer, il faut nous en assurer les moyens. »
Ces simples paroles calmèrent l’effervescence.
« Pour monter à l’abordage, il nous faut passer cette eau. Certes la distance est insignifiante et nous pourrions la franchir à la nage. Mais ce qui nous est permis ne l’est pas à madame (il désignait Mme Hénault). Or, nous ne pouvons nous éloigner d’elle tous à la fois et la laisser seule ici.
– C’est juste, reconnut Le Corre. Alors, quoi faire ?
– Je vais te le dire, bon Breiz, dit gaiement le capitaine. Il y a ici quelques arbres. Trois de nous vont y monter, armés de leurs carabines. De là-haut, ils surplomberont le pont du bateau, prêts à faire feu sur toute créature qui s’y montrerait hostile. Les autres vont nager jusqu’au brick, avec fusils et munitions au-dessus de la tête. Trois grimperont par les barbes de beaupré, deux par l’étambot. Et, si la bataille s’engage, dame, on se battra en conscience.
– Bravo ! fit Ervoan. Mon frère est un vrai capitaine.
– En ce cas, capitaine, réclama Pablo, je demande à être de la bordée qui nage.
– Je t’y autorise, mon enfant, prononça Mme Hénault, qui bénit son petit-fils d’un baiser sur le front.
– Alors, branle-bas de combat », ordonna Lân Plonévez.
En un clin d’œil, sur sa désignation, lui, le docteur et Ervoan escaladèrent les troncs de trois arbres à pin. Derrière le plus gros des troncs, on abrita Mme Hénault.
Pendant ce temps, Pablo et ses quatre camarades se dépouillaient de leurs vêtements, fixaient au-dessus de leurs têtes les carabines et les cartouchières, et, le revolver ou le poignard aux dents, se jetaient à l’eau. Du haut de leurs miradors feuillus, les trois tireurs, l’arme à l’épaule, le doigt sur la gâchette, se tenaient prêts à fusiller quiconque se montrerait inopinément sur le pont de la Grâce de Dieu.
Mais aucune face humaine, blanche ou noire, ne se démasqua. En moins de trois minutes, les assaillants avaient exécuté l’ordre du capitaine. Ils avaient escaladé l’arrière et l’avant du bateau et, présentement, se rencontraient au milieu du gaillard d’arrière, surveillant l’écoutille grande ouverte et interpellant d’invisibles ennemis dans les flancs mêmes du bateau. Brusquement, Joël Le Corre sauta dans l’intérieur de l’entrepont, criant à ses camarades :
« Quelqu’un appelle au fond. Je vais voir. »
Pablo et un autre le suivirent, attirés par des gémissements et des supplications.
À fond de cale, ils découvrirent le malheureux Nantais qu’avait épargné Gonzalo. Ils le soulevèrent et l’emportèrent, mourant, sur le pont, où ils le déposèrent sur un lit de voiles pliées.
Le pauvre garçon agonisait. Pourtant, il eut la force de remercier ses tardifs libérateurs et de leur faire un bref récit de l’agression dont il avait été victime. Après quoi, il s’assoupit en un pesant coma.
À terre, les trois guetteurs étaient redescendus de leurs arbres.
Les cinq hommes de la Grâce de Dieu s’occupaient à présent de lever l’ancre et de diriger le brick plus près de la rive, afin de permettre l’embarquement de leurs compagnons.
Bientôt, le navire démarré glissa dans le courant et vint raser la berge, en eau profonde. Il s’agissait de faire monter Mme Hénault à bord.
On y parvint en installant une sorte de va-et-vient à l’aide d’aussières tendues entre les arbres du rivage et les galhaubans. On fit asseoir la vieille dame sur un siège de cordes, que Joël Le Corre hala du pied de l’artimon.
Alain, le docteur et Ervoan n’eurent besoin que des câbles pendants pour se hisser à leur tour.
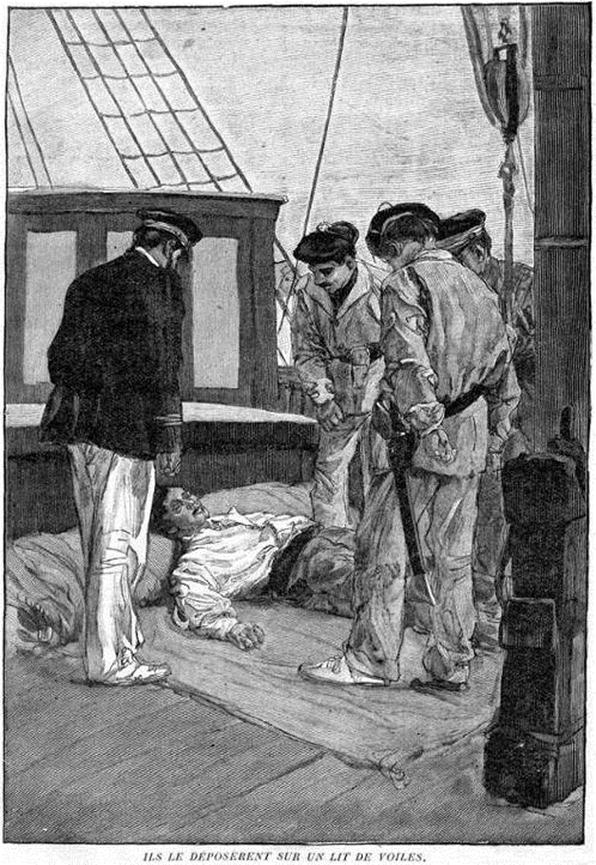
L’un des anciens matelots du brick, celui qui faisait fonctions de calfat, avait soigneusement inspecté les flancs du navire. Il n’y trouva point d’avaries, ce qui confirma les fugitifs dans l’opinion que les bandits avaient dû s’enfuir en toute hâte pour ne point se laisser surprendre par quelque vaisseau de guerre venu de la côte, torpilleur ou canonnière.
On inspecta ce qui restait du gréement. La mâture était en bon état, comme aussi les voiles survivantes du pillage. Il y en avait assez pour garnir les basses vergues et le beaupré : deux focs, quatre ou cinq voiles carrées, une brigantine susceptible de se fixer à l’artimon avec un gui quelque peu égratigné. On vérifia les haubans, les palans, les poulies, les drisses. Tout pouvait rendre d’utiles services.
Décidément les pirates avaient pris peur et déguerpi en débandade. La chose paraissait indéniable.
Alors, Lân fit opérer des sondages. On avait assez d’eau sous la quille pour naviguer, à la condition qu’on n’allât point se jeter sur quelque sable mouvant. On constata, toutefois, par un examen attentif de la berge, que le niveau des eaux avait sensiblement baissé depuis la veille, peut-être même depuis le matin de ce jour. Il fallait donc se hâter, si l’on ne voulait pas s’exposer à l’échouage imprévu.
Le vent, quoique très affaibli, était assez constant pour qu’on ne différât point le départ.
En conséquence, Alain Plonévez arbora toute sa toile disponible et, profitant des dernières heures du jour, dirigea la Grâce de Dieu dans le lit du courant, vers la descente du fleuve.
Il fallut y mettre beaucoup de circonspection, car on n’avait aucune carte du pays. Mais, comme, à la chute du jour, la brise avait fraîchi et se maintenait, on put utiliser toute la voilure et gagner une quinzaine de milles pendant la nuit.
Le brick était sorti du dédale d’îlots qui encombraient le fleuve à sa boucle. Maintenant le Rio Nuñez s’étendait en une large nappe d’or terni sur une largeur de cinq ou six cents mètres. Les horizons du sud semblaient plus clairs, alors que, vers le nord, la région qu’on venait de quitter s’effaçait en un moutonnement confus de verdures. L’espoir entra définitivement dans les cœurs.
Puisque la Grâce de Dieu, la bien nommée, avait tenu bon jusque-là, il n’y avait pas de raisons pour qu’elle n’achevât pas aussi heureusement sa course.
Une seule chose tenait en éveil l’esprit soucieux d’Alain.
Si, comme on l’avait présumé au départ, comme semblaient le confirmer les événements, les bandits avaient fui pour éluder la poursuite d’un vaisseau de guerre, comment se faisait-il qu’on n’eût pas encore rencontré ce vaisseau ?
Cette inquiétude ne tenaillait pas le seul esprit d’Alain. Il pouvait lire la même préoccupation sur les traits de son frère, qui avait pris la barre.
Yves Plonévez ne s’en cacha point.
« Vois-tu, frère, dit-il à Lân, j’ai du noir dans les idées. C’est peut-être pour ça que je me méfie. Mais je me suis dit que ça allait trop bien, et que ce n’est pas naturel. Nous sommes tombés dans un piège.
– Explique-toi ! interrogea Lân, un peu nerveux.
– Voilà, continua Ervoan. Je crois que les faillis chiens nous ont laissé le brick pour nous attirer. Eux-mêmes ont dû se cacher quelque part, sur la côte, et ils vont nous tomber dessus d’un moment à l’autre. Et, tiens, justement, regarde, en avant de nous, à bâbord. On dirait la fumée d’une cheminée. »
Sa main tendue désignait au capitaine un petit nuage gris blanc qui venait de monter soudain de la rive, du milieu d’un fouillis vert d’arbres.
Ils n’étaient pas les seuls à l’avoir aperçu.
De l’avant, des cris s’élevaient, Pablo accourait en bondissant :
« Capitaine, capitaine, voyez donc. Un torpilleur ! »
D’autres voix se joignaient à la sienne. Les avis étaient partagés, les conjectures indécises.
« Ce n’est pas un torpilleur, c’est une canonnière garde-côtes. On voit ses deux cheminées. »
Cependant, la Grâce de Dieu, en plein courant, vent arrière, filait à la vitesse de neuf à dix nœuds, ce qui était une belle allure pour un voilier.
Elle arrivait maintenant au niveau du navire signalé. Elle l’avait à un quart de mille environ à bâbord. On commençait à en deviner la figure.
C’était un bateau allongé, un steamer à l’étrave droite, taillé pour la course et qui ne prenait pas la peine de masquer ses lignes. On entendait le grondement de sa machine dans ses flancs, et les volutes de fumée empanachaient d’un plumet plus sombre ses cheminées grises. Le vapeur était sous pression, prêt à bondir sur l’eau limoneuse du fleuve.
« Le Cacique, proféra Ervoan, les poings crispés.
– Le Cacique ? questionna Lân, à voix basse. Ici, dans le Rio Nuñez, à moins de trente milles de Boké ? Ce serait une pure folie de sa part !
– Folie ou non, c’est bien le Cacique », répéta le marin.
Il n’avait pas achevé sa phrase que le forban lui-même la soulignait à sa manière. Un sifflement caractéristique venait de se faire entendre. Un projectile, dont il était impossible de contrôler les dimensions et la nature, venait de passer à travers les haubans, écornant la hune de misaine.
Déjà Alain avait bondi vers Mme Hénault assise à l’entrée du rouf et, l’entraînant vivement, lui faisait dégringoler l’escalier de l’entrepont, avec une rudesse dont il s’excusa sommairement :
« Madame, pardonnez-moi. Il le faut. Nous sommes attaqués. Les pirates. »

Et, avant qu’elle pût l’interroger, il était remonté sur le pont, où il commandait le branle-bas.
Les hommes s’assemblèrent autour de l’artimon. Il leur donna ses instructions précises : ne point s’émouvoir de ce qui pourrait survenir, s’abriter derrière les bastingages, à bâbord, prêts à accueillir l’ennemi par une fusillade nourrie, viser comme au tir, afin d’utiliser les munitions, réduites à moins de vingt cartouches par homme, ne prêter aucune attention aux dégâts de la mâture, mais seulement aux avaries de la coque, l’artillerie de l’ennemi ne pouvant être très redoutable.
La brise soufflait toujours et l’allure du brick se maintenait. Et, cependant, la Grâce de Dieu filait allégrement. La distance croissait entre elle et le Cacique, dont on voyait maintenant le profil décroître par le travers de la hanche de bâbord.
« Gurun ! fit Joël, est-ce que cet enfant du diable serait cloué sur un banc ? Aurait-il une patte cassée ? »
Lân fit mesurer le sondage. Sa figure s’éclaira.
« Je vais vous dire, mes gars. Il y a que le tirant d’eau, suffisant pour nous, ne l’est pas pour ce maudit. Ça nous donne une petite avance. Mais gare dessous, si la pluie d’hier et d’avant-hier ramène la crue. »
L’explication était juste. Dans sa hâte à saisir sa proie, Gonzalo Wickham s’était démasqué trop tôt. Il n’avait pas pris garde à la baisse des eaux. Au premier tour d’hélice, le Cacique avait donné violemment de l’éperon dans un banc de sable. Et, maintenant, avec trois mètres de quille emportée sur l’avant, il s’efforçait de culer pour retomber dans un chenal propice à une plus sage évolution.
La manœuvre n’était pas facile, et, pendant ce temps, la Grâce de Dieu dépassait son adversaire. Elle avait vent arrière et prenait chasse devant lui.
Ce fut alors que le Forban noir, exaspéré, fit tirer sur le brick. Mal pointée, la pièce n’atteignit que la mâture ; le projectile, un boulet conique, passa, inutile, à travers les cordages de la Grâce de Dieu.
Celle-ci utilisait le vent par tous les moyens.
On avait fait voile de tout le linge qu’on avait pu trouver : les draps du lit de Mme Hénault avaient fourni le perroquet de misaine ; avec cinq ou six hamacs rapidement cousus bout à bout, on établit à l’avant de vagues maraboutins.
Si misérables que fussent ces ressources, elles n’ajoutèrent pas moins à la vitesse du bateau et lui firent gagner quelques milles de plus. La Grâce de Dieu vit s’écarter les rives basses du fleuve et s’estomper derrière elle les massifs forestiers du haut fleuve.
On reprit courage, et Alain Plonévez tint un conseil de guerre. On ouvrit l’avis d’accoster sur la berge à droite, afin d’y déposer Mme Hénault sous la garde de quelques hommes résolus, pendant que le reste de l’équipage continuerait la route jusqu’à la rencontre des navires de Boké, en entraînant les forbans à sa suite.
Mais Mme Hénault repoussa d’emblée ce plan.
« Ou nous échapperons, ou nous mourrons tous ensemble ! » s’écria-t-elle avec une généreuse énergie.
Alain fit remarquer, toutefois, qu’il y avait urgence à se rapprocher de la côte, pour y courir la chance d’abattre quelque gibier. Il ne restait plus rien à manger à bord, et, si l’on échappait aux écumeurs, on ne pouvait se dérober à la faim dont les affres commençaient à se faire cruellement sentir.
Vers la fin du jour, on découvrit quelques pirogues. Les noirs qui les montaient se laissèrent approcher. On parlementa assez heureusement pour obtenir d’eux la promesse d’aller chercher au plus prochain village du maïs, quelques poulets et des fruits. Cette convention obligea le brick à ralentir son allure, en se rapprochant de la terre.
Les nègres mirent quatre longues heures à leur commission et il fallut, tout ce temps, imposer silence aux entrailles affamées. Mais lorsque, la nuit venue, les voyageurs se réunirent dans l’entrepont pour manger le maïs sommairement grillé et les bananes qui leur tenaient lieu de dessert, la joie de ce repas frugal leur fit oublier les appréhensions du jour et les menaces du lendemain.
Devait-on reprendre la route sur-le-champ, afin de profiter des ténèbres, ou passer la nuit en cette station imprévue ? L’absence d’instruments de calculs – les pirates ayant volé montres et sextants – ne permit pas de faire le point. On supputa, au jugé, que l’on devait se trouver encore à trente ou trente-cinq milles de Boké.
La discussion fut assez longue. Elle se termina par la décision de séjourner au point où l’on se trouvait, les noirs ayant promis de revenir à l’aube porteurs de quelques sacs de farine, de volailles et d’un quartier de porc.
On avait la terre pour refuge au cas où l’on serait contraint de battre en retraite en abandonnant le brick. On avait enfin la perspective d’un repos momentané, indispensable après les surmenantes fatigues des jours précédents.
Lân enjoignit donc de couvrir les feux. On se borna à l’emploi d’une lanterne dans l’entrepont, où Mme Hénault se reposa comme elle put entre deux toiles de tentes, tellement accablée de lassitude qu’elle ne prêta pas d’attention au râle du pauvre Nantais agonisant. Ce râle, d’ailleurs, s’éteignit aux approches du jour. La mort avait délivré le blessé de sa torture.
On distribua les quarts de deux heures en deux heures, ce qui ramena pour Alain lui-même la veillée au commencement et à la fin de la nuit. Les vigies s’installèrent dans la hune de misaine et sur le pic d’artimon, l’arme au poing, prêtes à faire feu sur toute embarcation suspecte.
La lune, plus brillante encore que la veille, inonda la nappe de sa grande clarté blanche, dénonçant aux regards les mouvements de la berge aussi bien que ceux de l’eau.
Vers trois heures du matin, un bruit insolite troubla le solennel silence du désert, empli jusqu’alors des rumeurs innombrables de la jungle.
Les nègres à demi sauvages de la région pouvaient s’y tromper peut-être ; l’oreille d’un marin ne conservait aucun doute sur sa nature et son origine.
C’était l’anhélation rythmique qui s’exhale des flancs d’une machine à vapeur, accompagnée du grondement sourd des chaudières. En même temps, un sifflement léger, le bruissement de l’eau qui se fend sous l’étrave et bouillonne sous les coups de queue de l’hélice, décelait l’approche d’un steamer.
En ce moment, Ervoan et Pablo étaient de quart.
Ils descendirent vivement sur le pont, mus de la même inquiétude.
« As-tu entendu, petit ? questionna Yves Plonévez.
– J’ai entendu, répliqua l’enfant, mais je ne sais d’où ça vient, d’aval ou d’amont.
– Ça vient du haut de la rivière, mon gars. Il n’y a pas à s’y tromper. Ce sont les bandits qui nous cherchent.
– En ce cas, il faut éveiller le capitaine.

– Ce n’est pas nécessaire, prononça l’organe grave d’Alain émergeant de l’écoutille. Moi aussi j’ai entendu. Je ne dormais pas.
Un par un, afin de ne pas troubler le repos de Mme Hénault, on alla secouer les autres membres de l’équipage.
On se distribua les postes de combat, tout en déplorant qu’il ne fît pas encore jour. On avait deux heures de nuit pour le moins à subir. Et, par malheur, la lune s’abaissait rapidement sur l’horizon.
Le tic tac des pistons se rapprochait. Brusquement, dans un grand rais d’argent, une silhouette longue à museau de tanche se profila.
« Tiens ! murmura Joël Le Corre, ce n’est plus le même bateau.
– C’est le même, Joël, mon gars, rectifia Ervoan, avec un geste de colère. Seulement, il a masqué son groin. »
Et, en effet, le Cacique s’avança, maquillé, déformé à souhait à l’instar d’un comique grimé. Mais la sveltesse de sa carène se laissait deviner sous le mensonge de son déguisement d’emprunt.
Il venait, très lent, inspectant les deux rives du fleuve. Celle où la Grâce de Dieu était ancrée avait des arbres se baignant dans l’eau. Les mâts du brick se mêlaient aux branches des grands troncs. On pouvait ne point découvrir sa présence.
Aussi le yacht ne le découvrit-il pas de prime abord. Il le dépassa de plusieurs longueurs et, sans doute, l’eût-il laissé en arrière, si tout d’un coup, il ne se fût avisé de recourir aux projecteurs.
Un grand rayon blanc fusa, qui courut sur les deux rives, avant de venir éclabousser de sa poussière lumineuse la berge où la Grâce de Dieu se tenait tapie.
Ce fut un éblouissement. L’aveuglante clarté fouilla le rivage à la droite et à la gauche du brick, puis se fixa sur lui, immobile.
Tout espoir était perdu d’échapper aux investigations des forbans. Il fallait se résoudre à la lutte sans merci.
« Ils nous ont vus », prononça Ervoan à voix basse.
L’organe du capitaine Alain s’éleva, clair et vibrant.
« Camarades, disait-il, nous n’avons plus de secours à attendre que du ciel et de nous-mêmes. Allons-nous recevoir leur choc ici-même, sans bouger, ou préférez-vous que nous courions droit aux bandits pour les aborder.
– À l’abordage ! » approuva Joël avec véhémence.
Mais le docteur intervint.
« Capitaine, oubliez-vous que nous avons une femme à notre bord ? Qu’allons-nous faire de Mme Hénault ?
– J’y ai songé, répondit Lân. Il y a une pirogue laissée par les noirs à tribord. Nous allons déposer Mme Hénault à terre, avec vous, docteur, le petit Pablo et mon frère Ervoan. Nous resterons cinq ici. C’est bien assez pour amuser ces coquins tout le temps qu’il vous faudra pour gagner les cases les plus voisines.
Une autre voix donna la réplique à Alain.
« Je pense, capitaine Plonévez, dit Mme Hénault, inopinément apparue sur le pont, que vous n’avez pas parlé sérieusement ? Pour me débarquer, il vous faut mon consentement ; or, ce consentement, je le refuse. J’entends demeurer avec vous et prendre ma part de la lutte. Après tout, ce ne sera pas la première fois que je me serai vue face à face avec des bandits. Je vous prouverai tout à l’heure, s’il le faut, que ma main ne tremble pas plus que mon cœur. »
Ces paroles furent prononcées avec un accent qui électrisa le vaillant entourage. Avant tout autre, Pablo donna à la vieille dame le témoignage de son enthousiasme.
« Bravo, bonne maman ! s’écria-t-il en se jetant dans ses bras. Au moins, si nous devons mourir, ne serons-nous pas séparés. Et, tu peux m’en croire, je serai digne de toi.
– Cher petit, murmura la vaillante femme, en essuyant furtivement une larme, Dieu m’est témoin que j’aimerais mieux te savoir auprès de ta pauvre mère. Mais tu es, comme moi, d’un sang qui ne saurait mentir. »
En ce moment, le rayon qui venait du Cacique se détourna, et les défenseurs du brick purent voir le yacht maudit mouillé à trois encablures de la côte. Il avait déjà mis ses embarcations à la mer, et l’on distinguait deux taches noires s’avançant vers la Grâce de Dieu.
Le plan de l’ennemi se dessinait. Il lançait contre la poignée d’hommes prêts à se défendre jusqu’à la mort ses compagnies de débarquement prélevées sur son équipage de forbans résolus à tout.
Combien étaient-ils ? C’est ce que nul ne pouvait savoir à bord de la Grâce de Dieu.
Mais déjà le faisceau aveuglant était revenu se fixer sur le brick. Il était impossible de tirer sur les canots autrement qu’au jugé.
« Attends, capitaine, dit Ervoan à son frère. Il me vient une idée. »
Et, rampant à travers la largeur du pont, il gagna la hanche de tribord, se glissa dans l’ombre du rouf et, à l’aide d’une aussière, se laissa tomber dans la pirogue attenante aux flancs de la Grâce de Dieu.
Cela s’était si brusquement fait qu’Alain Plonévez n’avait pas même eu le temps d’ouvrir la bouche pour s’enquérir des intentions de son frère.
Il n’eut pas davantage le loisir de s’en préoccuper.
Un triple éclair brilla sur le pont du Cacique ; une grêle de plomb vint s’abattre sur le brick, fauchant des haubans, pénétrant dans la joue de bâbord.
Le yacht venait de faire feu à l’aide de trois mitrailleuses, afin de couvrir l’abordage de ses hommes. Un choc presque imperceptible à la coque révéla que l’une des embarcations abordait le brick par sa hanche de bâbord.
Alain s’était redressé pour courir à l’arrière.
Il n’eut que le temps de se laisser tomber sur les genoux et les mains. Derechef les canons du yacht avaient vomi la mort et le pont du navire crépitait sous les projectiles, tandis que l’air s’emplissait du fracas de la détonation.
Tout à coup, à l’avant du brick, une furieuse clameur monta, faite de cris de rage et de plaintes d’agonie.
Le rayon du projecteur s’abaissa. Pablo, le docteur, Joël, levés au-dessus des bastingages, virent l’effrayante scène.
Ervoan avait poussé la pirogue le long des flancs du navire jusque sous les barbes du beaupré. Au moment où la seconde chaloupe des pirates avait abordé la joue du brick, le Breton s’était dressé, déchargeant dans le tas les six coups de son revolver. Puis, épique, formidable de résolution désespérée, il avait bondi dans le canot, broyant des crânes, défonçant des poitrines.
Du pont de la Grâce de Dieu, les témoins de cette scène n’osaient tirer sur la bande de peur de frapper leur héroïque ami.
Ils n’eurent pas, d’ailleurs, le loisir de contempler longtemps le spectacle.
D’une voix tonnante, Alain les appelait à l’arrière. Là, en effet, était le péril. Dix hommes hurlant, s’excitant les uns les autres, dix démons échappés de l’enfer, venaient d’escalader le bordé et accouraient, ivres de sang et de pillage.

XVI
La vengeance.
Alain s’était élancé à la rencontre des assaillants. Sa carabine avait fait feu une première fois, jetant un homme à terre. Derrière lui, ses compagnons arrivaient. Ils saluèrent d’une salve les agresseurs. Trois de ceux-ci roulèrent sur le pont.
« Hardi ! cria le capitaine. Jetons-les à la mer. »
Les bandits avaient reculé. Ils n’étaient plus en force. Ils rétrogradèrent jusqu’au bordé.
Mais, alors, des clameurs s’élevèrent sur l’avant. Quatre nouveaux ennemis escaladaient la guibre.
Le docteur fit volte-face et, accompagné du mécanicien, se jeta sur les arrivants. Deux d’entre eux s’abattirent. Les survivants firent face à leur tour.
Le mécanicien chancela. Il avait la cuisse gauche traversée par une balle. L’un des pirates qui venaient de tomber, blessé comme lui, rampa, le couteau aux dents, vers les deux défenseurs de l’avant. Il saisit les jambes du docteur.
Mais le canon d’un revolver s’appuya à son oreille et lui fit sauter la cervelle.
C’était Pablo qui venait d’accomplir cette prouesse.
Brusquement le rayon du projecteur s’éteignit. Le Cacique craignait sans doute d’éclairer trop vivement les siens, et d’en faire des cibles pour le feu des défenseurs du brick.
Pendant quelques secondes, les yeux, passant de la clarté trop vive aux ténèbres ambiantes, demeurèrent aveugles de part et d’autre. Alain en profita pour rassembler ses compagnons en faisceau et les abriter sous le rouf où l’on fit entrer Mme Hénault.
Mais les prunelles s’étaient promptement faites à l’obscurité. On s’aperçut que le jour était beaucoup plus proche qu’on ne l’avait cru. Bien qu’en ces régions, voisines de l’équateur, on ne connaisse ni l’aube ni le crépuscule, le lever du soleil n’en est pas moins précédé d’une clarté diffuse qui, en blanchissant le ciel, revêt la terre d’une lueur spectrale. On put voir assez clair pour continuer la bataille.
Tout à coup, de l’avant, un homme s’avança, titubant, dont la voix mourante cria aux défenseurs du brick :
« Ne tirez pas ! C’est moi, Ervoan. »
Et on le vit venir, le simple héros, tel un fantôme, s’accrochant, de ses mains défaillantes, aux cordages, n’ayant plus rien d’humain, rouge de la tête aux pieds, perdant son sang par vingt blessures.
Il vint jusqu’à la poignée des défenseurs. Un rire atroce écarta ses lèvres. Il dit, hoquetant :
« J’en ai tué… six… Je suis… content… Ai-je racheté ?… Adieu, petit Pablo ! Frère… tu… diras… à la mamm… »
Il ne put proférer une syllabe de plus, et s’écroula, les dents crochetées, avec un flot de sang débordant des commissures. Ses yeux chavirèrent tandis qu’il esquissait un geste religieux. Il était mort.
« Nous n’avons pas le temps de le pleurer, cria Lân, farouche. Vengeons-le.
– C’est ça ! Vengeons-le ! » gronda Joël.
Et, jetant son fusil, le colosse brandit une barre d’anspect.
Les pirates étaient maintenant au nombre de vingt.
Tous ensemble se ruèrent sur la poignée des défenseurs.
L’énorme massue tournoya aux mains du géant. Des têtes fracassées laissèrent jaillir leurs cervelles, des nuques rompues pendirent sur des épaules effondrées. Cinq cadavres s’ajoutèrent aux premiers.
Mais les quinze survivants parvinrent jusqu’au groupe.
Les revolvers partirent, grossissant le sanglant monceau.
Hélas ! la résistance était à bout. Quatre bandits s’étaient pendus, tels des bouledogues, aux membres du titan Joël. Alain venait de recevoir sa troisième blessure, le docteur Perrot avait laissé tomber son bras droit, cassé par une balle, le mécanicien se défendait assis, une balafre rayait le jeune front de Pablo, à la racine de ses cheveux noirs. Deux des gabiers gisaient, râlant, dans une mare de pourpre.
Soudain, du yacht un appel strident résonna. C’était un ordre de retraite.
Les pirates tressaillirent et s’arrêtèrent. Quelques-uns, escaladant les bastingages, se laissèrent couler dans les embarcations. Les autres, hésitants, reçurent le dernier feu de Lân et de ses compagnons encore debout. Joël en écrasa deux d’un moulinet, sur le bois du bordé. Un seul ne se résigna pas à fuir.
Avec un feulement de tigre, il fonça sur la ligne des défenseurs, renversa le docteur et, bondissant sur Pablo surpris, le jeta à terre, lui posant le genou sur la poitrine.
Le machete de Ricardo Lopez se leva sur l’enfant terrassé.
Mais, alors, une main plus prompte, une main de femme, saisit le métis à la nuque et attira sa tête en arrière. Les yeux du misérable virent étinceler, plus terribles, ceux de Mme Hénault, en même temps que son oreille entendait cette suprême malédiction terrestre.
« Ricardo Lopez, je venge mon fils. »
Et, par la bouche entr’ouverte de l’assassin, pénétra la balle du châtiment. Le revolver à poignée d’ivoire argenté avait fait son œuvre justicière.
Il n’y avait plus un seul forban sur le pont de la Grâce de Dieu. Les survivants, huit ou dix à peine, s’éloignaient, à force de rames, du brick pour rallier le yacht, lui-même grondant et se balançant sur l’eau comme un coursier de race qui s’apprête à fournir une course désespérée.
Une stupeur hébétée paralysait les assistants de cette scène, la dernière, semblait-il, du sinistre drame. Cette retraite imprévue, ce salut inespéré qui leur venait au moment même où toute chance semblait perdue, ils ne pouvaient se l’expliquer.
Et, tout à coup, une détonation éclata au large, devant eux, dans le lit du Rio Nuñez.
Le soleil venait, d’un bond, de prendre possession du ciel. Pablo, dont le front saignait, leva les deux bras à la fois, tandis que de sa poitrine convulsive s’exhalait un grand cri :
« La Némésis. »
Les délivrés se tournèrent, tous à la fois, vers le point de l’horizon du sud que désignaient les regards de l’enfant.
Un chapelet de taches blanches y déroulait, sur le firmament très bleu, les flocons d’une fumée. Cette fumée se détachait, en panache intermittent des cheminées d’un navire qu’on voyait grossir à vue d’œil.
Et tel était l’intérêt de ce spectacle pour les malheureux voyageurs qu’ils en oubliaient de suivre les mouvements du Cacique, qui déjà s’éloignait de la rive, qu’ils en oubliaient jusqu’au soin, jusqu’à la douleur de leurs blessures.
Pourtant celles-ci ne tardèrent point à se rappeler à eux. À mesure que tombait la surexcitation de la lutte, la souffrance la remplaçait et prenait le dessus.
Ils étaient tous atteints, plus ou moins grièvement. En outre d’Ervoan, déjà froid, un autre matelot était mort, un troisième, les yeux vitreux, exhalait ses derniers soupirs au pied de l’artimon. Alain avait reçu un coup de poignard sous les côtes ; une balle lui avait emporté un morceau de l’oreille droite, une autre lui avait labouré l’épaule gauche. Le docteur Perrot avait un bras cassé, une joue tailladée ; le chef mécanicien, couché sur la hanche, ne pouvait plus remuer sa jambe, traversée de part en part, Joël ne comptait pas moins de six entailles, du sommet du crâne au-dessous du genou ; Pablo avait le front ouvert.
Le pont de la Grâce de Dieu n’était qu’une mare de sang.
En proie à un tremblement nerveux, Mme Hénault fixait des yeux dilatés par l’horreur sur le cadavre hideux de Ricardo étendu à ses pieds, mort de sa main.
Huit autres corps, tordus par les spasmes de l’agonie, gisaient, çà et là, à l’avant comme à l’arrière.
À la fin le sentiment revint à la vaillante femme. Avisant un seau de toile goudronnée accroché à l’un des portemanteaux, elle le laissa glisser jusqu’au fleuve et le ramena plein d’eau. Alors, faisant toile de tout ce qui lui tombait sous la main, déchirant son mouchoir, ses jupons, elle se prodigua pour laver les plaies et étancher le sang qui coulait des blessures. Le docteur, dont le bras droit pendait inerte, la guidait de ses conseils, et Pablo l’aidait à faire les premiers pansements pour arrêter les hémorragies.
Les noirs, ainsi qu’ils l’avaient promis, accouraient de la rive. On voyait leurs pirogues bondir sur la nappe dorée. Ils venaient avec des clameurs gutturales.
Mais, plus prompte qu’eux, la Némésis dévorait l’espace. Tel qu’un lévrier qui rase le sol, le yacht se dessinait fluet et mince. Il paraissait glisser sur l’eau, tant son allure était rapide, et, dans la pure clarté du matin, on l’eût dit soutenu par une coulée d’or en fusion. Il venait implacable, prêt à fondre sur la nef des pirates.
Encore quelques minutes, et il serait sur lui.
Mais il avait aperçu le brick en détresse. Sans se préoccuper de l’ennemi, il stoppa, et la baleinière se détacha de son flanc pour accoster la Grâce de Dieu.
Ce fut avec une joie mêlée de larmes que se réunirent les survivants du brick et leurs vengeurs.
Par l’ordre du commandant Le Gouvel, cinq hommes de l’équipage du yacht prirent possession du navire nantais, tandis que les blessés étaient transportés sur la Némésis. L’enseigne de vaisseau avait lui-même complété son équipage à Boké par l’adjonction d’une dizaine de laptots et de deux chauffeurs noirs. Il avait, en outre, amené avec lui un jeune médecin de marine de passage à la station. L’aide-major ne demandait pas mieux que d’accompagner les vaillants volontaires courant sus au forban. Il trouva ample besogne parmi les blessés de la Grâce de Dieu, à commencer par son collègue le docteur Perrot dont il dut extraire la balle, demeurée dans les chairs du biceps droit. On n’avait que trop de pertes à déplorer. Le jeune praticien fut tout heureux de déclarer à son entourage qu’il répondait de toutes les guérisons.
On établit donc les valétudinaires dans les chambres du gaillard d’avant, jadis occupées par Mme Hénault et sa famille, n’en réservant qu’une pour la vieille dame. Pablo partagea la sienne avec Alain et le docteur.
Quant aux morts, on les laissa sur la Grâce de Dieu ; on devait les déposer à Boké où ils recevraient une sépulture honorable. Le cadavre de Ricardo fut conservé pour la confrontation avec ses complices. Quant aux huit autres, comme ils encombraient le pont, le commandant Le Gouvel les fit, sans façons, jeter au fleuve.
Ils ne méritaient pas de plus dignes cercueils que les ventres des requins, leurs émules, qui, à ce voisinage de l’Océan, remontaient encore assez haut dans les eaux du Rio Nuñez.
Tout cela n’avait pas été sans retarder les opérations d’une bonne heure, ce qui avait accordé au Cacique un utile répit et lui avait permis de prendre chasse devant la Némésis avec une forte avance.
Il avait même disparu derrière un angle du fleuve, lorsque Le Gouvel, qui venait de causer un instant avec Alain, resté debout malgré ses blessures, jeta cette exclamation de colère :
« Ah ! non, par exemple ! Je n’entends pas laisser à d’autres le soin de capturer ces brigands-là ! »
Et, reprenant son poste de commandement, il donna l’ordre aux mécaniciens de porter la vitesse à trois cents tours.
Alors commença le plus beau raid maritime dont les annales de la navigation aient jamais fourni l’exemple.
Si la Némésis pouvait prétendre à tenir la première place à la tête des coursiers de la mer, elle trouvait dans le Cacique, ex-Manapa, un rival digne d’elle.
Le yacht forban, lui aussi, était, depuis longtemps, préparé et entraîné aux folles vitesses.
Quand il sentit son ennemi sur ses traces, il accéléra son allure. De vingt nœuds qu’il donnait au début, il passa, d’un bond, à vingt-cinq, puis à vingt-huit.
À ce train, il devait atteindre Boké en deux heures.
Qu’allait-il y trouver ? Il l’ignorait. Mais Gonzalo Wickham était beau joueur. Ce n’était plus pour la victoire, mais pour la vie même, qu’il luttait à cette heure.
« Coûte que coûte, il faut que je passe ! » s’était dit le bandit.
Cela ne pouvait avoir qu’une signification.
Torpilleur ou canonnière, quelque vaisseau qui se jetât en travers de sa fuite, il devrait le combattre et l’écarter par la force, le couler avec ses canons ou l’éventrer de son éperon.
Et, maintenant, sans plus se soucier du mensonge des apparences, il avait démasqué sa figure, jeté à l’eau le faux nez de son museau, les renflements de ses hanches, il allait droit devant lui, sinistre, effrayant, laissant luire, comme une lame de couperet, l’acier de son étrave droite, véritable tranchant assez puissant pour couper en deux le navire de moyennes dimensions qui aurait l’imprudence de se présenter à lui par le travers.
À proprement parler, ce n’était pas les chiens de garde massifs venus à sa rencontre qu’il redoutait le plus, mais bien le terrible limier dont il entendait le souffle haletant sur ses traces, dont il croyait entendre déjà siffler les projectiles au travers de sa superstructure.
Car la Némésis, démentant l’aphorisme qui fait la Justice boiteuse et lente à se mouvoir, ne ménageait plus ses provisions ni sa machine. L’enseigne Le Gouvel venait de jeter au porte-voix ces mots :
« Quatre cent vingt tours. »
Quatre cent vingt tours ! C’était le maximum, la limite qu’on ne pouvait plus dépasser, à laquelle on ne pouvait même se maintenir plus de six heures, à peine de provoquer une explosion mortelle. Ces quatre cent vingt tours, donnés par les cinq hélices, portaient l’allure à l’incroyable vitesse de trente nœuds, même de trente-deux dans le courant.
Et, déjà, malgré le refoulement d’air dans la machinerie, les deux chauffeurs blancs avaient dû être retirés de l’étuve, à moitié asphyxiés. Les nègres seuls, bien qu’épuisés, ruisselants de sueur, tenaient encore bon. Par un acte d’héroïsme surhumain, le chef-mécanicien Grandy venait de descendre, tout habillé, dans la fournaise.
Sur la rive du fleuve, toute la population, blanche ou de couleur, de Boké, était accourue, palpitante d’émotion, pour contempler le terrible et émouvant tableau. Elle vit passer, comme deux bolides, les deux yachts à un quart d’heure de distance l’un de l’autre. Mais, aux mouvements convulsifs du premier, au long frémissement continu du second, les spectateurs du drame comprirent qu’il touchait au dénouement, que le dernier acte allait se jouer à quelques milles plus bas, hors de portée de leurs regards enfiévrés.
Les navires sous pression dans le port n’avaient pas osé se jeter à la traverse du Cacique. Surpris par son arrivée en foudre, ils s’étaient empressés de lui livrer passage.
À présent, ils s’emplissaient de curieux, réclamant à grands cris qu’on les menât au large, à la suite des deux adversaires, afin qu’ils pussent assister aux dernières péripéties de la lutte, s’emplir les yeux des suprêmes passes de ce duel à mort. Duel à mort, en effet, et qui fut vaillamment combattu.
Le Cacique voyait déjà s’élargir l’estuaire du fleuve et s’ouvrir les horizons sans bornes de la mer. L’île de sable coupait en deux l’embouchure, laissant un double chenal d’eau profonde. Mais, déjà, la Némésis embouquait la passe du nord, prête à se retourner pour venir dans le flanc de l’ennemi.
Le Cacique se jeta dans la passe du sud.
Il n’y fit pas plus d’un quart de mille.
À la bouche méridionale se dressait, superbe, évoluant à petite vitesse, un croiseur anglais, ce même King Edward qui lui avait donné la chasse quelques jours plus tôt.
C’était le passage barré, la retraite coupée.
Gonzalo sentit le désespoir entrer en lui.
Qu’allait-il faire ? Courir droit au colosse de fer, essuyer son feu et gagner, à la même allure, la haute mer ?
Mais un seul obus du croiseur suffirait à couler le Cacique. Et il ne fallait pas espérer que l’on pourrait passer indemne.
Mieux valait livrer bataille à la Némésis.
Là, du moins, – le forban le croyait, – les chances pourraient s’égaliser, la victoire balancerait.
Il avait compté sans les pièces de 47 millimètres de son adversaire, dont deux étaient disposées en chasse et en retraite et deux à bâbord et tribord, soutenant les huit pièces de 37 millimètres, distribuées, quatre par quatre, sur les spardecks.
Pour y répondre, le Cacique n’avait que deux hotchkiss et quatre maxim.
Le yacht évolua donc sur le bras méridional du fleuve et, par un crochet soudain, revint sur la nappe principale, où il fonça, par l’avant, sur son ennemi.
La Némésis avait prévu l’attaque. Elle vira sur place et, défilant sous le feu inutile du pirate, lui envoya sa première volée de chasse. Puis, le croisant, bâbord à tribord, elle lui lâcha toute la bordée de ses six pièces de flanc.
L’effet fut terrible. Des vingt-deux hommes qui formaient l’équipage du Cacique, dix s’abattirent morts ou blessés sur le pont.
Il ne fallait plus songer à la résistance. Gonzalo riposta, tant bien que mal, tuant deux gabiers à son adversaire. Mais c’était là une prouesse inutile. Le bandit ne songeait qu’à fuir, en se jetant à la côte.
Il fournit donc sa dernière course vers la rive orientale du Rio, résolu à s’y échouer pour se jeter ensuite dans la brousse.
Il n’en eut pas le loisir.
La Némésis accourait et, tout en virant sous le vent, le balayait, pour la troisième fois, avec sa pièce de retraite. Trois bandits tombèrent encore.
Il restait neuf hommes valides sur le yacht. Ils se ruèrent vers leur chef et, dans le paroxysme du désespoir, le sommèrent de se rendre. Il résista, en abattit un d’un coup de pistolet ; mais, accablé par le nombre, fut terrassé, ligotté, tandis que les vaincus amenaient leur pavillon noir et arboraient le signal parlementaire.
Le Gouvel leur intima l’ordre de jeter leurs armes, de descendre la baleinière et de venir se remettre à sa discrétion. Ils obéirent.
C’était fini. Lorsque les habitants de Boké, arrivés trop tard sur le théâtre de la lutte, voulurent régaler leurs yeux, ils ne virent que la Némésis gagnant la haute mer, en donnant la remorque au Cacique, en attendant qu’elle pût fournir au yacht capturé l’équipage indispensable pour le conduire jusqu’à Konakry, d’où les criminels seraient dirigés sur Saint-Louis pour y subir le châtiment de leurs forfaits.

ÉPILOGUE
Le mois de février venait de finir. Mars, aux giboulées fantasques, se levait au septentrion. Par un de ces caprices dont il est coutumier, son premier soleil brillait radieux ce jour-là.
Toute la population de Perros-Guirec se pressait sur le port. On était venu en foule de Lannion, de Guingamp, de Saint-Brieuc, de Morlaix.
À l’entrée du port, des tribunes étaient dressées pour les autorités, avec des mâts et des banderoles multicolores. Quatre compagnies de fusiliers-marins, venus de Brest, un bataillon d’infanterie, huit brigades de gendarmes, ajoutaient à la magnificence de la fête.
Au premier rang des tribunes s’asseyaient le recteur de Louannec, le maire, le notaire Duguer, l’instituteur et le docteur Bénédict. Ils avaient bien mérité cet honneur.
Une seule personne manquait à la fête, une pauvre mère en larmes qui, à la même heure, priait auprès d’un grand cercueil de bois de fer, doublé de plomb, déposé, entre des cierges, dans la nef de l’église neuve de Louannec, en attendant le service solennel qu’on y célébrerait le lendemain. Car, depuis la veille, la baleinière de la Némésis avait apporté sur la rive du bourg la dépouille mortelle d’Yves Plonévez, tombé dans l’apothéose d’une réhabilitation, et cette dépouille allait dormir son éternel sommeil dans la terre sacrée de la patrie, près des os des obscurs héros qui l’y avaient précédée.
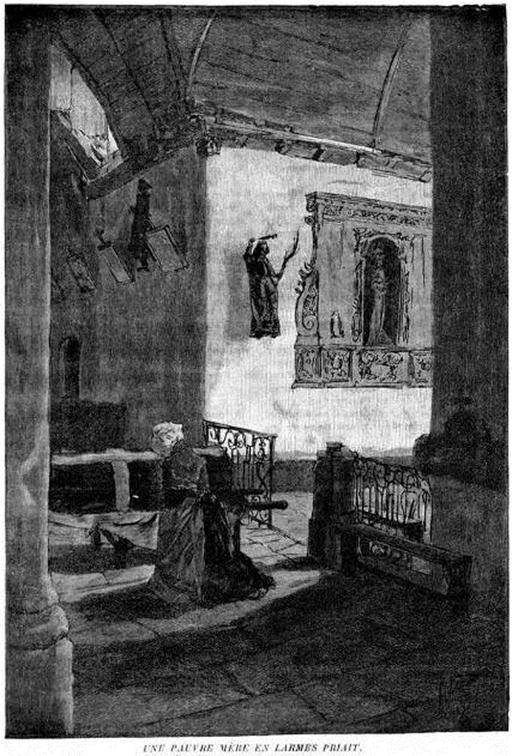
Or, ce qu’attendait le ministre, ce qu’attendaient les autorités du pays, les amis de la première heure, la noble et élégante assistance, ce qu’attendait la population tout entière, c’était la rentrée triomphale de la Némésis qui venait d’accomplir en trois mois une si féconde croisière et de délivrer les nations civilisées d’un long cauchemar de quinze ans.
On la vit, gracieuse et légère, doubler le môle au bruit des acclamations, faire vibrer d’une dernière salve l’écho des collines environnantes, puis, après avoir mouillé au centre du bassin, accueillir à la coupée les embarcations dépêchées pour recevoir les passagers, les officiers et les marins.
Le commandant Le Gouvel descendit le premier, donnant la main à Mme Hénault, la mère ; puis ce fut Alain Plonévez conduisant Mme Isabelle, puis Pablo et sa cousine Irène, puis le docteur Perrot, le chef mécanicien Grandy, les matelots, gabiers, chauffeurs. Dans leur nombre on admira la superbe carrure du titan Joël Le Corre. Le Grésillon donnait le bras à la gentille Anne-Marie, à qui il s’était fiancé au cours de la traversée du retour.
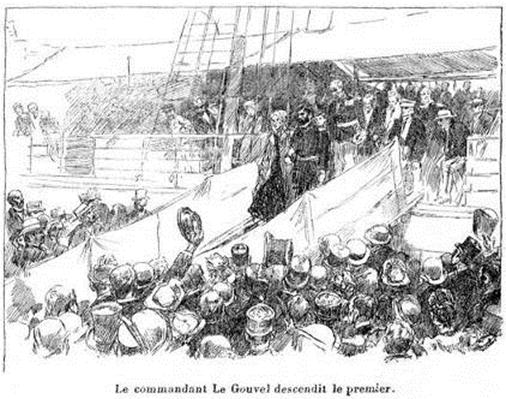
Le ministre et son état-major vinrent recevoir les voyageuses. En un discours plein de chaleur, le représentant du gouvernement rappela les origines de l’expédition, en narra les dramatiques incidents et, finalement, lut la liste des récompenses décernées. Il y en avait pour tous. Cinq croix de la Légion d’honneur étaient octroyées, à Mme Hénault d’abord, à l’enseigne Le Gouvel, promu lieutenant de vaisseau, au capitaine Alain Plonévez, au docteur Perrot, au mécanicien Grandy. La médaille militaire allait orner la poitrine de Joël Le Corre et d’un des aides-mécaniciens ; des médailles spéciales étaient accordées au reste de l’équipage. Enfin, par une mention particulière, Paul Hénault, solennellement réintégré en son état civil, recevait une médaille d’or unique, prémice des récompenses futures que décernerait la France au vaillant enfant, lorsqu’il serait sorti du Borda avec les aiguillettes d’aspirant.
Alors se produisit un incident qui porta au comble l’émotion de l’assistance.
Mme Hénault s’était levée et, s’adressant au ministre, lui faisait entendre, d’une voix vibrante, le langage d’une admirable Française.
« En me décernant une récompense que je n’ai ni sollicitée, ni même souhaitée, dit-elle, le gouvernement m’accorde un honneur au-dessus de mes faibles mérites. Fille et descendante de marins, sortie d’une race glorieuse sur mer entre toutes, puisque ma famille est Malouine, je n’ai fait que ce que toute Bretonne de cœur eût fait à ma place. Je n’accepte donc pas cette croix qui sera mieux placée sur une poitrine virile. Mais afin qu’aucun doute ne plane sur la nature du sentiment qui m’inspire, je tiens à le faire connaître sans ambages.
« Il me serait trop cruel d’obtenir le signe de l’honneur au prix du deuil qui afflige une héroïque femme de cette terre. Car, sachez-le, monsieur le ministre, je pleure à la pensée de cette autre mère, dont l’absence attriste cette fête, et qui prie en ce moment sur le cercueil de l’un de ses fils, du pauvre homme, tombé en héros, dont le dévouement a rendu mon petit-fils Paul à sa mère et à moi-même, son aïeule. Je demande qu’une mention spéciale soit faite de cette Bretonne plus grande que les meilleures d’entre nous, d’Anna Plonévez, la mère de notre vaillant capitaine Alain, de notre cher Ervoan, mort en enfant glorieux de la Bretagne et de la France. »
À l’audition de ces nobles paroles, un long frémissement courut d’un bout à l’autre de l’auditoire. On vit le ministre se lever et, tenant à la main le joyau symbolique, il le suspendit un instant sur la poitrine de Mme Hénault. Puis, pliant le genou, il lui baisa respectueusement la main.
Toute une grande heure dura le défilé des hauts personnages, des amis, des admirateurs. Les deux dames, Pablo et Irène, durent entendre bien des compliments, serrer bien des mains de gens qui leur étaient totalement inconnus. Ce sont là les exigences de la gloire.
Après quoi, les voitures de Ker Gwevroc’h, suivies d’une dizaine d’autres véhicules, emportèrent les voyageuses et leurs invités jusqu’au manoir du Trévou, où un grand banquet leur était préparé.
Elle prit fin, cette journée mémorable. Elle eut un lendemain tendu de noir, mais mieux encore consacré par le souvenir à la glorification des morts.
Car un service de première classe, une messe de Requiem fut chantée ce jour-là pour le repos de l’âme d’Yves Plonévez, et aussi des vaillants marins de la Némésis tombés sur la terre africaine et inhumés, loin du sol de la France, mais sous les plis du drapeau français. L’église de Louannec fut trop petite pour l’innombrable assistance qui se pressa autour de la fosse où l’on descendit les restes du malheureux Ervoan.
Et, au retour de la cérémonie, les rangs s’ouvrirent respectueusement devant la mère inconsolée, mais réconfortée en sa douleur par ce témoignage d’universelle sympathie.
Comme elle s’avançait au bras d’Alain, dont la boutonnière brillait de la récompense décernée la veille, on vit le petit « Espagnol » venir à elle, et doucement, de sa voix tendre des anciens jours, lui murmurer à l’oreille :
« Mamma Plonévez, est-ce que je ne suis plus aussi votre fils ? »
Alors, chancelante, les yeux pleins de pleurs, la mère du vaillant mort et du glorieux vivant, se tourna vers Mme Hénault et Isabelle, et, d’un accent intraduisible, leur dit :
« Le bon Dieu m’en a pris un ; il vous en a rendu un. Voulez-vous tout de même, que celui-là soit aussi à moi jusqu’à l’heure où je m’en irai rejoindre l’autre ? »
Les deux mères heureuses se jetèrent en sanglotant au cou de la mère éplorée, et la mamm Plonévez, en tête du cortège, regagna son humble demeure, un bras sous le bras d’Alain, l’autre sous celui de Pablo. Il lui restait encore deux fils, et le hijo del mar avait encore deux mères.

À propos de cette édition électronique
Texte libre de droits.
Corrections, édition, conversion informatique et publication par le groupe :
Ebooks libres et gratuits
http://fr.groups.yahoo.com/group/ebooksgratuits
Adresse
du site web du groupe :
http://www.ebooksgratuits.com/
—
Février 2011
—
– Élaboration de ce livre électronique : Les membres de Ebooks libres et gratuits qui ont participé à l’élaboration de ce livre, sont : PatriceC, Jean-Marc, Coolmicro et Fred.
– Dispositions : Les livres que nous mettons à votre disposition, sont des textes libres de droits, que vous pouvez utiliser librement, à une fin non commerciale et non professionnelle. Tout lien vers notre site est bienvenu…
– Qualité : Les textes sont livrés tels quels sans garantie de leur intégrité parfaite par rapport à l'original. Nous rappelons que c'est un travail d'amateurs non rétribués et que nous essayons de promouvoir la culture littéraire avec de maigres moyens.
Votre aide est la bienvenue !
VOUS POUVEZ NOUS AIDER À FAIRE CONNAÎTRE CES CLASSIQUES LITTÉRAIRES.